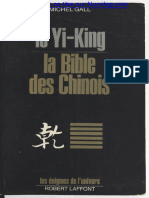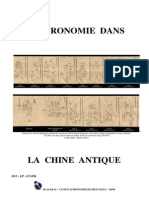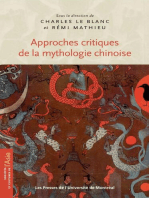Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Pensée Chinoise
La Pensée Chinoise
Transféré par
Youlian TroyanovTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Pensée Chinoise
La Pensée Chinoise
Transféré par
Youlian TroyanovDroits d'auteur :
Formats disponibles
@
LA PENSE
CHINOISE
par
Marcel GRANET (1884-1940)
1934
Un document produit en version numrique par Pierre Palpant, bnvole,
Courriel : pierre.palpant@laposte.net
Dans le cadre de la collection : Les classiques des sciences sociales
fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web : http ://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul -mile Boulet de lUniversit du Qubec Chicoutimi
Site web : http ://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Marcel GRANET La pense chinoise 2
Cette dition lectronique a t ralise par Pierre Palpant, collaborateur bnvole.
Courriel : pierre.palpant@laposte.net
partir de :
La pense chinoise,
par Marcel GRANET (1884-1940)
Paris : Editions Albin Michel, 1968, 568 pages.
Tome XXV bis de la Bibliothque de Synthse historique
Lvolution de lHumanit , fonde par Henri BERR.
Polices de caractres utilise : Times, 10 et 12 points.
Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11
dition complte le 30 novembre 2004 Chicoutimi, Qubec.
Marcel GRANET La pense chinoise 3
T A B L E D E S M A T I R E S
Notes Bibliographie Index
Introduction
Livre premier : Lexpression de la pense
Chapitre I.- La langue et lcriture : I. Les emblmes vocaux II. Les
emblmes graphiques
Chapitre II.- Le style : I. Les sentences II. Les rythmes
Livre deuxime : Les ides directrices
Chapitre I.- Le temps et lespace
Chapitre II.- Le Yin et le Yang
Chapitre III.- Les nombres : I. Nombres, Signes cycliques, lments II.
Nombres, Sites, Emblmes divinatoires III. Nombres et
rapports musicaux IV. Nombres et proportions architecturales
V. Fonctions classificatoire et protocolaire des Nombres
Chapitre IV.- Le Tao
Livre troisime : Le systme du monde
Chapitre I.- Le macrocosme
Chapitre II.- Le microcosme
Chapitre III.- Ltiquette
Livre quatrime : Sectes et coles
Chapitre I.- Les recettes du gouvernement : I. Lart de russir II. Lart de
convaincre III. Lart de qualifier IV. Lart de
lgifrer
Chapitre II.- Les recettes du bien public : I. Confucius et lesprit humaniste
II. M tseu et le devoir social
Marcel GRANET La pense chinoise 4
Chapitre III.- Les recettes de saintet : I. Lart de la lon gue vie II. La
mystique de lautonomie
Chapitre IV.- Lorthodoxie confucenne : I. Mencius : le gouvernement par la
bienfaisance II. Siun tseu : le gouvernement par les rites
III. Tong tchong-chou : le gouvernement par lhistoire
Conclusion
Marcel GRANET La pense chinoise 5
I N T R O D U C T I O N
9
Jai dj, en analysant le systme dattitudes et de conduites qui commande
la vie publique et prive des Chinois, essay de donner une ide de leur
civilisation. Je vais tenter, pour prciser lesquisse, de dcrire le systme de
partis pris, de conceptions, de symboles, qui rgit en Chine la vie de lesprit.
Je ne prtends offrir au lecteur de ce livre quun complment de La
Civilisation chinoise (
1
).
Quand jai prsent celle -ci, jai indiqu que je ne voyais (pour le
moment) aucun moyen dcrire un Manuel dAnti quits chinoises. Cette
opinion a dict le plan de mon premier volume. Un sentiment analogue inspire
le second : je naurais pas accept la tche de rdiger un Manuel de Littrature
ou de Philosophie de la Chine.
Beaucoup douvrages ont t publis qui peuvent prten dre un pareil
titre. Je renvoie tout de suite ces livres excellents (
2
) ceux qui dsirent tre
renseigns tout prix sur le classement des uvres ou la filiation des
Doctrines. Mme si linventaire des documents ne mavait point montr que
vouloir restituer dans le dtail lhistoire des thories philosophiques tait
une entreprise pour le moins prmature, je me serais encore propos de faire
entrevoir les rgles essentielles auxquelles, dans son ensemble, obit la pense
chinoise. l nest pas inutile de le signaler : pour dcouvrir ce qui constitue, si
je puis dire, le fond
10
institutionnel de la pense chinoise, on dispose de
renseignements assez bons, mais ils ne pourraient gure autoriser composer
une Histoire de la Philosophie comparable celles quil a t possible dcrire
pour dautres pays que la Chine.
*
* *
La Chine ancienne, plutt quune Philosophie, a possd une Sagesse.
Celle-ci sest exprime dans des uvres de caractres trs divers. Elle sest
trs rarement traduite sous la forme dexposs dogmatiques.
Il ne nous est parvenu quun petit nombre douvrages attribus
lAntiquit. Leur histoire est obscure, leur texte incertain, leur langue mal
connue et leur interprtation commande par des gloses tardives,
tendancieuses, scolastiques.
Nous ne savons dailleurs peu prs rien de positif sur lhistoire ancienne
de la Chine.
Quil sagisse de Confucius, de M tseu, de Tchouang tseu,... la
personnalit des penseurs les plus illustres se laisse peine entrevoir. Nous
navons, le plus souvent, sur leur vie, aucun renseignement, ou presque, qui
Marcel GRANET La pense chinoise 6
soit utile ou concret. En gnral, nous ne connaissons que des dates, parfois
contestes : au reste, elles se rapportent des temps pour lesquels lhistoire est
particulirement vide de faits. Certains auteurs , Tchouang tseu, par
exemple, ou Lie tseu, nont pas mme une lgende.
Sur les enseignements, nous ne possdons que rarement des tmoignages
directs. La tradition orthodoxe attribue Confucius la rdaction dun grand
nombre duvres : presque tous les classiques. Ds quils chappent des
proccupations apologtiques ou scolaires, les critiques avouent quil reste
tout au plus du Matre un Recueil dEn tretiens (le Louen yu). On nest pas sr
que ce recueil, dans sa forme originale, ait t luvre des premiers disciples ;
en tout cas, nous ne possdons pas cette compilation, sans doute tardive ; il ne
nous est parvenu quune dition rema nie, postrieure denviron cinq cents
ans la mort du Sage (
3
).
11
Tous les interprtes saccordent reconnatre des sages ou des
chapitres interpols dans les uvres les plus authentiques et le mieux dites.
Laccord cesse ds quil sagit de faire le tri. Tchouang tseu (
4
) est un
vigoureux penseur et le plus original des crivains chinois : tel critique
reconnatra la manire et le style de Tchouang tseu dans le chapitre sur les
spadassins, mais non dans le chapitre sur le brigand Che, cependant quun
autre rudit liminera les Spadassins pour conserver le Brigand (
5
). Le Han
Fei tseu est louvrage dun des auteurs dont la vie est la mieux connue ; il fut
crit peu de temps avant la formation de lEmpire, et sa transmission premire
sest opre sans grands -coups. Cependant lun des meilleurs critiques
contemporains, sur les 55 sections de louvrage, nen veut conserver que 7.
Ceci, du reste, ne lempche pas, quand il analyse la doctrine, de se rfrer
aux sections condamnes (
6
) .
Aprs stre donn beaucoup de peine pour attribuer une date aux uvres
et pour fixer leur aspect original, on aboutit dordinaire des conclusions
aussi vagues et dcevantes que celles-ci : Dans lensemble, louvrage parat
dater de la seconde moiti du IIIe sicle (av. J.-C.) mais il nest pas
entirement de la main de Han Fei ; comme pour Tchouang tseu, M tseu et la
plupart des philosophes de cette poque, une partie importante est due aux
disciples du Matre... Il nest que rarement possible de distinguer entre les
parties qui peuvent remonter au Matre et celles qui doivent tre attribues
son cole (
7
).
Depuis le IVe sicle, tout au moins, considrable a t le rle jou par des
coles (Kia) ou plutt limportance acc orde aux polmiques entre coles.
Les plus pres de ces polmiques sont celles quentretenaient les disciples
dun mme patron : tel fut le cas, au dire du Tchouang tseu (
8
), pour les
disciples de M tseu ; tel aussi parat avoir t le cas pour les disciples de
Confucius (
9
). Mais (cest un fait significatif) jusqu lpoque des Han, on
confond toujours, lorsquon pense aux doctrines, lensemble des tenants de
M tseu (m) et lensemble des tenants d e Confucius () sous une dsignation
Marcel GRANET La pense chinoise 7
commune (jou-m) : cette expression se trouve trs rarement ddouble. Les
polmiques entre coles
12
traduisent des conflits de prestige. Elles
nentranent pas la preuve dune opposition proprement doctrinale.
Au reste, si lusage veut quon traduise le mot Kia par cole, il importe
davertir que les Chinois lui donnent une acceptation trs large. Ils lemploient
propos des diffrents Arts [les corps de recettes que dtiennent par exemple
les matres en mathmatiques, astronomie, divination, mdecine...] (
10
) , tout
aussi bien qu propos des diverses Mtho des de conduite [les recettes de vie
patronnes par tel ou tel matre de Sagesse]. Ces mthodes, qui ont pour objet
de rgler les conduites, senseignent laide dattitudes. Cha cune suppose,
assurment, une certaine conception de la vie et du monde, mais aucune ne
vise dabord se traduire en un systme dogmatique.
Lide dopposer des coles, comme si celles -ci avaient eu pour premier
objet de donner un enseignement thorique, est une ide relativement tardive.
Elle est ne de proccupations pratiques, si mme elle nest pas dinspiration
mnmotechnique. La rpartition des uvres et des Auteurs entre les coles,
qui est lorigine de tous les classements proposs, est emprunte au Trait
sur la Littrature quon trouve insr dans l Histoire des Premiers Han. Or,
ce trait est une uvre de bibliothcaire, et le classement quil a russi
imposer nest quun classement de catalogue . Aprs avoir rang par catgories
les uvres que lon conservait, on a admis que chaque lot correspondait
lenseignement dune cole ou dcoles apparentes dont on a alors song
dfinir loriginalit dogmatique.
Mme si nous pouvions supposer que les coles ou les Auteurs dont nous
avons nous occuper sont surtout intressants par leurs conceptions
thoriques, le projet dexposer le dtail et les rapports des thories devrait tre
considr comme extraordinairement aventureux, car ltude du vocabulaire
philosophique prsente, en Chine, des difficults singulires.
Je montrerai plus loin que la langue chinoise ne parat point organise
pour exprimer des concepts. Aux signes abstraits qui peuvent aider spcifier
les ides, elle prfre des symboles riches de suggestions pratiques ; au lieu
13
dune acception dfinie, ils possdent une efficacit indter mine : celle-ci
tend procurer, non pas, succdant une analyse, un acquiescement de
simples jugements qui visent permettre des identifications prcises, mais,
accompagnant une adhsion densemble de la pense, une sorte de conversion
totale de la conduite. Il convient donc de rompre avec la tendance, qui prvaut
encore, de rendre ces emblmes, lourds de jugements de valeur o sexprime
une civilisation originale, par des termes emprunts (aprs une assimilation
rapide et qui ne tient point compte de la divergence des mentalits) au
vocabulaire conventionnel lui aussi mais visant expressment une
prcision impersonnelle et objective des philosophes dOccident. Sinon on
sexposerait aux pires anachronismes, comme cest le cas, par exemple, quand
on traduit par altruisme (
11
) le terme jen (caractristique de la position
Marcel GRANET La pense chinoise 8
confucenne, ou par amour universel , lexpression kien ngai (
12
)
(significative de lattitude de M tseu). On sexposerait encore
consquence autrement grave trahir, si je puis dire, dans son esprit mme
(cest le cas, par exemple, quand on prte a ux Chinois une distinction entre
substances et forces ), une mentalit philosophique qui se dtourne des
conceptions dfinies, car elle est commande par un idal defficacit.
Dautre part, mme si nous pouvions supposer que les Sages chinois ont
constitu un vocabulaire destin permettre lexpression conceptuelle de
thories , tout essai pour restituer une histoire des Doctrines se heurterait
(pour linstant) une autre difficult. Nous dpendons, pour la lecture des
textes anciens, des commentaires dont toutes les uvres ont t dotes. Les
plus anciens de ces commentaires datent des environs de lre chrtienne. Ils
ne sont pas antrieurs au mouvement de pense qui, au temps des Han, orienta
dfinitivement la Chine vers les voies de lort hodoxie. Ils donnent
linterprtation correcte , cest --dire linter prtation exige des candidats
dans les examens qui ouvraient accs aux honneurs et aux carrires officielles.
Aucun lecteur (un Chinois moins que tout autre) ne lit un texte librement. Il
est sollicit par les gloses, mme sil les sait inspires par un systme
dinterprtation quimprgnent des proccu pations scolaires, morales,
politiques. Nul, en effet, naccde
14
au texte, crit dans une langue
archaque, que par la glose. Le travail qui consiste dpasser le commentaire
doit tre accompli sans que (pour le moment) on puisse saider dun manuel,
de stylistique ou mme de philologie chinois. Ce travail, dailleurs, est domin
par lincertitude la plus grave : lesprit orthodoxe, qui inspire tout le dtail des
gloses, oscille entre deux passions : une passion de polmique qui incline
prter une valeur irrductible aux interprtations opposes, une passion de
conciliation qui empche toujours de dfinir rigoureusement. Il nest gure
facile, dans le dtail des cas, de distinguer dans les formules orthodoxes
laspect original des ides. Il faudrait un bonheur constant de divination pour
restituer dans leur puret les thories et se mettre ainsi en mesure de
dfinir idologiquement leurs relations. Quelle chance y a-t-il de reconstituer,
par surcrot, lhistoire de leurs rapports rels ?
Aucun accord nexiste pour le moment entre spcialistes sur les grandes
lignes de lhistoire ancienne de la Chine.
Tant quon navait pas pris conscience du caractre dogmatique des
traditions chinoises, et, tout particulirement, des traditions relatives
lhistoire littraire, on pouvait se ris quer conter lhistoire des Doctrines .
On admettait, en effet, que les uvres conserves, si e lles se trouvaient peu
nombreuses, taient cependant les plus importantes ; on ne savisait pas de
penser quelles taient devenues classiques parce quelles taient les seules
conserves. Comme la tradition les chelonnait sur quelques bons sicles (de
Yu le Grand Confucius en passant par le duc de Tcheou), on ne voyait
aucune difficult retracer lvolution des concep tions chinoises, ou plutt
Marcel GRANET La pense chinoise 9
parler de la grandeur et de la dcadence des Doctrines, tout en se
persuadant quon faisait ainsi uv re historique.
Peut-on conserver la mme illusion aujourdhui o les cri tiques attribuent
une brve priode (Ve-IIIe sicles) la quasi-totalit des uvres quils
considrent encore comme anciennes ? Pour justifier une rponse ngative, il
devrait suffire de remarquer que, de toutes les poques de lhistoire de Chine
(si mal connue dans son ensemble), celle-ci est lune des plus mal connues.
Cest celle sur laquelle nous
15
possdons le moins de renseignements
proprement historiques. Tous, dailleurs, so nt suspects, et lensemble des faits
se rduit une chronologie abstraite, dailleurs souvent incer taine.
Nanmoins, ceux-l mmes qui voient dans les Ve-IIIe sicles lpoque
des romans historiques et des supercheries littraires continuent
dimagi ner que le premier travail, ou le seul positif, consiste tablir un
classement chronologique des Thories . Ils le tirent du classement quils
admettent pour les uvres. Ils ne rsistent pas la tentation de dterminer la
date o apparut telle conception ; ils ne consentent pas ignorer ceux qui lont
invente . Ils savent, par exemple, que linvention de la thorie philo-
sophique du Yin et du Yang (labore, disent-ils, au cours du Ve sicle et
gnralement adopte par tous les philosophes ds la fin de ce sicle) est
due une cole de Mtaphysiciens , dont luvre tient tout entire dans
un opuscule (intitul le Hi tseu) (
13
). Tout ce quils devraient dire est que le
Hi tseu est le fragment philosophique quils estiment le plus ancien parmi
ceux qui nomment le Yin et le Yang. Sans doute la philosophie est-elle
expose confondre lhistoire des faits et celle des documents, mais un
historien, qui se propose de dater autre chose que des rfrences, ne devrait-il
pas se rappeler sans cesse que la preuve par labsence lui est interdite ? Il ne
peut constater que des absences de tmoignages. Sil sagissait dcrire
lhistoire philosophique dune priode connue par des tmoignages sincres et
contrlables, et si, dailleurs, ces documents formaient un ensemble qui
paratrait intact, nul ne croirait que la revue suppose complte des seuls faits
enregistrs lautoriserait attribuer une sorte de commence ment absolu telle
ou telle conception. Doit-on profiter de la mdiocrit proclame des
tmoignages pour parler din vention et dorigine premire, ds quon pense
avoir dat lattestation qui, dans un vide quasi total dattestations, parat la
plus ancienne ?
Si, en lespce, la critique littraire a tan t de prsomption, cest quelle
part de postulats quelle oublie de rendre expli cites. On admet tout uniment
quune conception (disons, par exemple, celle du Yin et du Yang) commune
(ainsi quon
16
lavoue) tous les penseurs de la fin du Ve sicle (nou s nen
connaissons gure de plus anciens) sest labore dans le cours du Ve sicle
parce quon postule quavant Confucius et le dbut du Ve sicle la philosophie
chinoise ntait pas sortie de lenfance (
14
). Ce jugement sur les faits nest
rien dautre encore que la transposition dune opinion sur les documents : on
ne pense possder aucune uvre mtaphysique crite avant le temps de
Marcel GRANET La pense chinoise 10
Confucius. Accordons, si on lexige, que jamais, avant cette date, nul, en effet,
nen crivit... Ira-t-on jusqu affirmer quauparavant il ny eut aussi aucun
enseignement oral ? Les uvres prtes aux Ve -IIIe sicles ont t (personne
ne le nie pour la plupart dentre elles) transmises dabord par voie orale.
Avant que ne ft produit le petit nombre dcrits qui nont pas t perdus,
lenseignement oral na -t-il rien invent en fait dides ou de thories ?
Si lon crit une histoire o lon sapplique attribuer lauteur de tel
document conserv linvention de telle Doctrine, c est que lon donne
(implicitement) une rponse ngative cette question et, si on rpond
ngativement, cest quon obit, avec une apparence de libert critique, une
conception orthodoxe de lhis toire de Chine. On suppose (avec les
traditionalistes) que les Ve-IIIe sicles furent une poque danarchie ; on
postule ensuite (en vertu dune ide toute faite) que cette anarchie favorisa
lclosion de la rflexion philosophique ; on induit enfin quavant la priode
trouble des Royaumes Combattants les Chinois navaient point
philosoph , car ils possdaient un rgime politique stable et vivaient en
obissant passivement un parfait conformisme. Ceci revient simplement
admettre que les traditions de lhistoire officielle sont justes et que la Chi ne a
form anciennement un tat homogne dot dune civilisation fermement
assise.
Je nadmets pas, pour ma part, cette vue thorique sur lhistoire chinoise.
Je ne lui opposerai cependant aucune autre conception. Il me suffira pour
linstant de noter que, mme dbarrasse de toute hypothse sur leurs origines,
lanalyse des opinions formules par les penseurs que quelque crit permet de
connatre risque dtre singulirement imprcise et surtout mal oriente, si on
ne la complte point par lin ventaire des ides qui relvent dune tradition
anonyme.
17
Les remarques qui prcdent indiquent les raisons qui mont interdit
de donner un essai sur la pense chinoise la forme dune histoire suivie des
doctrines. Jai rejet rsolu ment toute ordonnance chronologique et nai
aucunement cherch renseigner sur tout cest --dire sur tout un dtail de
discussions traditionnelles. Je ne vois, par exemple, aucun moyen de
dterminer si Confucius estimait bonne ou mauvaise la nature de
lhomme, et je ne trouverais, entrer dans le dbat, aucun des avantages que
pensent en retirer tels ou tels patrons de sagesse, missionnaires imports en
Chine ou politiciens indignes : jouer, dans une mle dopinions
aventures, le rle darbitre, on ne gagne tout au plus quun renom de finesse
ou mme drudition. Je me proposerai simplement danalyser, en my
prenant de la manire qui aura le plus de chance dtre objective, un certain
nombre de conceptions et dattitudes chinoises. Je nai considr, pour
avoir le temps de les examiner avec attention, que les plus significatives
dentre elles.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 11
Mon Livre IV a pour titre Sectes et coles. Les trois premiers Livres
visent faire connatre les conceptions chinoises quil ny avait ni possibilit
ni, du reste, avantage envisager autrement que comme des notions
communes : elles signalent certaines habitudes mentales auxquelles les
Chinois semblent attribuer une puissance imprative. Jai rejet dans le
dernier Livre les conceptions quil me paraissait possible je ne dis pas de
rattacher un Auteur ou une cole mais dtudier commodment par
rapport des uvres attestant certaines directions de la pense chinoise ; ces
conceptions signalent des tendances moins constantes ou moins profondes et
sont remarquables, prcisment, par leurs fortunes diverses : leur principal
intrt est quelles peuvent contribuer faire entrevoir lorientation que la
pense chinoise a acquise dans son ensemble.
Sous le titre Sectes et coles, je donnerai, sur les Hommes et les uvres,
les quelques renseignements qui ne me paraissent pas trop incertains. Je ne
tirerai, en revanche, des ouvrages, pour les prter aux auteurs, aucune sorte
dexpos dogmatique.
18
Tous les matres de lancienne Chine ajoutaient des connaissances
vastes la science de quelque spcialit (
15
). Tous taient capables de
parler de tout, trs rares ceux qui se proccupaient de donner un tour
systmatique lensemble de leur enseignement. Chacun sattachait mettre
en valeur lefficace de la recette de sagesse qui constituait le secret de son
cole .
Je nessaierai pas de dfinir les enseignements en num rant les ides
accueillies par chacune des coles. De pareils inventaires ne permettraient
mme pas de rien conclure sur les connexions des diverses doctrines .
Toutes les uvres abondent en dveloppements purement parasites : lcrivain
a trouv profitable de faire parade de son information ou expdient
dargumenter ad hominem. Nul ne se complat autant quun Chinois
juxtaposer les thmes emprunts (sans conviction) aux conceptions les plus
divergentes, ou employer (par astuce pure) les raisonnements qui donnent
prise sur autrui sans quo n en accepte soi-mme la lgitimit. Je me garderai,
en consquence, daffirmer, par exemple, que tel crivain de lcole des Lois
qui il arrive dargumen ter en taoste est, en quelque manire, un adepte
du Taosme. Lemploi ornemental ou dialectiqu e dides emprun tes un
enseignement concurrent constitue, en soi, un fait significatif : il mrite dtre
not, non parce quil peut tre pris immdiatement pour lindice dune
connexion doctrinale, mais parce quil rvle un trait de lesprit chinois . Il
tmoigne tout ensemble de la force de lesprit sectaire et de lattrait du
syncrtisme. Cette indication de porte gnrale doit tre retenue une fois pour
toutes. En revanche, si lon veut atteindre lessence dune doctrine
chinoise, on se montrerait malavis en portant son attention sur les ides que
Marcel GRANET La pense chinoise 12
ses adeptes semblent avoir accueillies et que, pourtant, ils nont aucunement
tent dajuster leurs conceptions.
Pour ne point trop risquer de trahir les faits, il convient de ne jamais
oublier quune doctrine chinoise doit tre dfinie, non en tentant de
dterminer les articulations dun systme dogmatique, mais en essayant de
dgager une sorte de formule matresse ou de recette centrale. Vous pensez
sans doute a dit, parat-il, Confucius que je suis un homme qui a appris
beaucoup de choses et qui sen souvient ?
19
Non pas : un unique
(principe me suffit) pour (tout) embrasser (
16
). Cette parole peut faire sentir
lintrt dun nouveau trait de lesprit chino is : aucune recette ne vaut, si elle
ne parat pas possder tout ensemble une essence singulire et une vertu de
panace. Il faut quelle se prsente comme spcifique tout en se proclamant
omnivalente. Tout Matre de Sagesse prtend donc dispenser un Savoir dune
qualit toute particulire (cest le Savoir de tel Sage) et dune effi cacit
indfinie (il implique toute une entente de la vie). Faire connatre les
conceptions ou, plutt, les attitudes propres une cole ou, plutt, une
Secte, revient tenter de dcouvrir le secret ou le matre-mot jadis rvl aux
adeptes laide des procds qui conviennent aux enseignements sotriques.
Ces secrets, bien entendu, ou ces matres-mots, les disciples les
acquraient, non de faon discursive, mais par voie dinitiation, la suite dun
long entranement. Aussi ne peut-on se flatter datteindre lessence dun
enseignement tant quon ne connat point le systme de pratiques qui (bien
plus quun corps de doctrine) permettait cette essence dtre apprhende
ou, pour mieux dire, ralise. Certains ouvrages clbres, le Tao t king, le Yi
king, sont faits dune suite dadages ; Pris dans leur sens littral, ils paraissent
vides, extravagants ou plats : cest un fait, cependant, que, pendant de longs
sicles et de nos jours encore, ces livres ont inspir des exercices de
mditation ou mme une discipline de la vie. Ils peuvent, non sans raison,
paratre hermtiques. Dautres ouvrages ne le paraissent point. Du seul fait
quils semblent se prter une analyse d iscursive des ides, nous avons
tendance admettre que nous les comprenons. La doctrine quils peuvent
prconiser nen demeure pas moins impntrable tant quon narrive pas
dterminer les attitudes quelle commande et qui lexpriment rel lement.
Pour restituer le sens des diffrents corps de pratiques et pour deviner
notre tour la formule matresse des doctrines , il convient dabord de
chercher reconnatre le genre defficacit que lensemble des matres anciens
attribuaient leurs recettes. On a remarqu depuis longtemps que toute la
Sagesse chinoise a des fins politiques. Prcisons en
20
disant que les Sectes
ou coles se sont toutes propos de raliser un amnagement de la vie et des
activits humaines prises dans leur totalit entendez : dans la totalit de
leurs prolongements, non seulement sociaux, mais cosmiques. Chaque Matre
professe une Sagesse qui dpasse lordre moral et mme lordre politique :
elle correspond une certaine attitude vis--vis de la civilisation ou, si lon
veut, une certaine recette daction civilisatrice. Do il suit quil nest pas
Marcel GRANET La pense chinoise 13
impossible de retrouver la signification prcise dune attitude dtermine ou
dune recette spcifique, si lon sefforce dabord de prciser la position que
les diffrents groupements sectaires occupent dans lhistoire de la socit
chinoise, dans le dveloppement de la civilisation chinoise.
Une premire consquence est que le travail critique doit tre domin non
par des recherches de philologie ou mme dhistoire pure (ce q ui, vu ltat des
documents et des tudes, est, aprs tout, fort heureux), mais par ltude des
faits sociaux. Nul ne sait mieux que moi combien sont neuves les recherches
sur la socit chinoise et rares les rsultats quon peut considrer comme
acquis. On en peut tirer cependant une indication assez sre pour servit de fil
conducteur : lpoque o ont paru les Sectes dont nous pouvons essayer de
connatre la doctrine est celle o lordre fodal seffon drait et o se
prparait lunit impriale. Cet te simple constatation, on le verra plus loin,
fournit un point de dpart do lon peut sacheminer, par exemple, vers une
interprtation prcise de lattitude de M tseu ou de celle des Matres taostes.
Une seconde consquence est que nous aurons fixer la position de divers
groupements sectaires dans le monde fodal finissant, plutt qu dterminer
(suppos que ce soit possible) lordre chronologique des doctrines . Je
dcrirai donc les plus significatives des attitudes qui sexpriment dans les
conceptions propres aux coles chinoises, sans jamais songer les
prsenter dans un ordre historique. Je les grouperai de faon faire ressortir
que ces attitudes correspondent un certain nombre de proccupations
techniques. Elles trahissent diverses espces de mentalits corporatives. Elles
renseignent sur limportance des impulsions que la
21
pense chinoise est
susceptible de recevoir lorsque la socit se prpare un nouveau
conformisme : ces circonstances favorables font alors accueillir li nfluence de
spcialistes dont lesprit de corps se trouve momentanment anim dun
surcrot de conscience ou dimagination cratrice.
Deux doctrines , en raison de leur fortune, mritent une attention
particulire : celle quon qualifie de taoste, cell e qui se rclame du patronage
de Confucius. Jtudierai plus longuement que toute autre l cole taoste
et jac corderai tout un chapitre lorthodoxie confucenne.
Lune et lautre sont remarquables par la puissance de lesprit sectaire et,
en mme temps, par la force de leurs apptits syncrtistes. Toutes deux, en
effet, ont lambition de constituer une orthodoxie. Dans un cas comme dans
lautre, cette orthodoxie se signale par une prtention de Sagesse la fois
universelle et exclusive, sans que cependant soit profess un dogme ou que
les articles de lenseigne ment soient le moins du monde arrangs en systme :
ils forment une sorte de confdration envahissante dont la masse est sans
cesse grossie grce un parti pris dannexion ou de concili ation. A ces sortes
de rassemblements dides, il manque (comme lEmpire chinois) dtre
organiss et articuls, mais (de mme que lEmpire a pour fondement une
unit de civilisation), le Taosme et lOrthodoxie tirent leur puissance dune
Marcel GRANET La pense chinoise 14
force particulire danimation. Si leur opposition parat tre celle de deux
partis pris (lun en faveur dune sorte de naturisme fond magico-mystique,
lautre en faveur dune espce de sociocentrisme dintentions posi tives), le
Taosme et lOrthodoxie confucenne s inspirent tous deux (de faon
ingalement apparente mais galement profonde) dune double tendance,
universiste (17) et humaniste la fois. Cest cette tendance, double et
commune, qui explique leurs fortunes jumelles et leur opposition dans
lhisto ire comme leur conciliation dans les esprits.
*
* *
Les opinions professes dans ces diverses Sectes ou coles signalent
certaines orientations secondaires de la pense chinoise. Pour entrevoir,
autrement que par contraste, son
22
orientation profonde, il convient de
considrer les donnes fournies par les mythes et le folklore avec autant
dattention que les tmoignages emprunts aux uvres philosophiques .
Mes trois premiers Livres traitent de notions communes quil ny ava it point
avantage envisager dabord sous laspect quont pu leur donner tel travail de
rflexion technique ou telle mentalit corporative. Si jai commenc par elles,
cest quil mest apparu quelles permettaient dat teindre une sorte de fond
institutionnel trs rsistant de la mentalit chinoise.
Cette rsistance invite, certes, prsumer que ce fond est trs ancien. Je
nentends pas, cependant, par la place que je leur attribue, donner croire que
ces notions communes reprsentent une espce de Sagesse prexistant
lactivit de toute cole ou de toute Secte. Si lactivit des Sectes et des
coles nest un peu connue qu partir dune poque relativement tardive (Ve
sicle av. J.-C.), les documents qui renseignent sur le fond institutionnel de la
pense sont, de leur ct et par nature, intemporels. Je ne veux point, par cette
qualification, suggrer ni, bien entendu, que ce fond est demeur invariable, ni
que rien de son volution ne peut tre connu : je dirai tout lheure par quelle
mthode jai cru pouvoir donner une ide du progrs des ides chinoises Pour
linstant, je tiens marquer que ce nest point une vue sur lhistoire, mais des
raisons de commodit et, du reste, ltat et la nature des documents, qui mont
conduit ne point commencer par parler des coles et des Sectes. Je crois que
lon comprendrait difficilement les attitudes propres aux diverses coles si
lon ntait point dabord renseign sur un ensemble dattitudes mentales qui,
plus directement et mieux que les conceptions des coles, clairent les rgles
fondamentales de pense adoptes par les Chinois. Mais le lecteur est averti :
je ne lui prsente pas les conceptions dont je moccupe en premier lieu comme
un systme de notions qui seraient, toutes et sous tous leurs aspects,
antrieures au travail thorique des premires coles connues.
Jai donn tout dabord quelques renseignements sur la langue et le style.
Il ntait pas inutile, pour dbuter, dinsis ter sur les caractres que prsente en
Marcel GRANET La pense chinoise 15
Chine lexpression
23
(orale ou crite) de la pense (Livre I). Tout essai de
critique ou dinterprtative des uvres et des ides doit en tenir compte. En
particulier, tout ce quon entend conter sur les diffrences qui sparent la
langue parle et la langue crite invite supposer que la langue littraire
correspond, ds lantiquit, une sorte de langue morte ou savante. Or le
chinois, tel quil scrit, recherche avant tout les effets daction qui semblent
rservs la parole vivante. Ce fait permet dapprcier limpo rtance
longtemps conserve par lenseignement oral. Il semble mme indiquer qu
lpoque o ont t conues les uvres dans lesquelles de nombreuses
gnrations ont cherch des modles de style, lcriture ntait gure utilise
en dehors des actes officiels. Sous prtexte que linvention de lcriture
remonte pour le moins au deuxime millnaire avant Jsus-Christ, on est tent
de prter dantiques origines la littrature chinoise, cependant quen
raison de la date relativement basse quon attri bue aux rdactions conserves,
on est souvent conduit dclarer tardif lveil de la pense philosophique ou
savante. De cet ensemble de postulats contradictoires procdent des tentatives
anarchiques de datation de thories qui dtournent dune histoire positive
des ides. On renoncera ces postulats et ces errements en faveur dune
recherche mieux oriente, ds que lon aura constat que le langage des
philosophes chinois, loin dtre de formation livresque, procde dune
tradition denseignement oral et pragmatique.
Les remarques que je prsente sur la langue et le style nont pas t
inspires par les proccupations propres au critique littraire ou au linguiste
pur, ni par lintention de donner, titre de prliminaires, une description
dtaille de 1a langue ou une esquisse de lhistoire des styles. Si jai group
ces chapitres de dbut sous la rubrique : lexpression de la pense, cest que
jai considr le langage comme celle des symboliques dont il tait le plus
commode de partir pour signaler certaines dispositions de lesprit chinois.
Lexamen en effet, des lments du langage et du style conduit deux
observations essentielles. Les Chinois, dune part, semblent viter tous les
artifices qui tendent utiliser lexpression verbale des ide s de manire
conomiser les oprations mentales ; ils ddaignent les formes analytiques ; ils
24
nemploient aucun signe auquel ils ne prtent que la simple valeur dun
signe ; ils dsirent que, dans tous les lments du langage : vocables et
graphies, rythmes et sentences, clate lefficience propre aux emblmes. Ils
veulent qucrite ou parle lexpression figure la pense et que cette figuration
concrte impose le sentiment quexprimer ou plutt figurer ce nest point
simplement voquer, mais susciter, mais raliser. Si les Chinois, dautre
part, rclament pour le langage une efficience aussi parfaite, cest quils ne le
sparent point dun vaste systme dattitudes destines permettre aux
hommes de figurer dans ses divers aspects laction civili satrice quils
entendent exercer sur toutes les appartenances humaines, y compris lUnivers.
Une mme ide de lUnivers se retrouve dans lensemble des auteurs
chinois. Des surcharges scolastiques peuvent lalourdir plus ou moins, mais
Marcel GRANET La pense chinoise 16
elle procde directement de conceptions mythiques. Emprunter au savant
nest pas le fait du sage : voil sans doute la raison pour laquelle nous ne
savons peu prs rien du dveloppement de la pense scientifique en Chine.
En partant de cette absence de renseignements, on a pu soutenir lhypothse
que cest seulement aprs les conqutes de Darius, ou mme celles
dAlexandre, que des trangers auraient rvl aux Chinois les propri-
ts du cercle et du carr (
18
) : ce seraient aussi des trangers qui leur
auraient tardivement fait connatre le compas, lquerre et le gnomon (
19
) ... Je
croirai difficilement, pour ma part, que le progrs des techniques indignes
(rappelons ici ladmiration de Biot pour les chars et les arcs chinois) ne sest
point accompagn, dans certains milieux, dun effort de rflexion proprement
scientifique (
20
). Mais le fait est quil nen reste aucune trace certaine. Et cest
un fait aussi que, lorsquils argumen tent et quel que soit le sujet, les penseurs
chinois ne songent accrditer leurs opinions qu laide dhistoriettes
vnrables, de lgendes et de thmes mythiques. Lhistoire de la pense est
remarquable en Chine par lind pendance que le savoir philosophique entend
conserver lgard de ce que nous appelons la science. Enregistrer cette
donne a, pour notre sujet, plus dimportance que de dresser un inventaire des
connaissances o lon essaierait (sans grand
25
espoir darriver quelque
prcision) de marquer les progrs de lesprit scientifique : quoi quil en soit de
ces progrs, ils nont exerc anciennement sur la pense chinoise aucune
influence qui soit sensible.
Aussi ne me suis-je pas occup du Systme du Monde (Livre III) conu par
les Chinois pour faire connatre les rsultats quils avaient obtenus dans
diverses sciences et pour dire quelle classification des sciences ces rsultats
les avaient conduits. Jai cherch simplement dcouvrir quel esprit animait
certaines techniques quon ne c ultivait ni en vue de la connaissance pure, ni
mme pour acqurir des connaissances ; jai mis en vidence le systme de
fins toutes pratiques que ces arts tendaient raliser, et jai essay de
dterminer les principes de ce systme. Comme il ne sagissa it pas de
dnombrer des connaissances positives dont lordre dacquisition aurait t
important fixer et que javais uniquement donner des exemples en prenant
soin (dans la mesure du possible) de distinguer entre les formules mythiques
ou scolastiques dun savoir de fonds homogne, jai, pour aller plus fond
(quand je le pouvais), emprunt de prfrence mes exemples la pense
mythique, mais je nai nullement nglig les formulations pdantes ou
relativement tardives qui proclament lautorit durable de ce vieux savoir.Il
inspire entirement la Scolastique laquelle a fini par aboutir leffort de
pense des Sectes et des coles (Livre IV). Jai donc rserv pour le Livre III
lexa men du Systme du Monde imagin par les Chinois. Au reste, lide
matresse du systme ne pouvait tre dgage commodment que lorsque
lanalyse des Ides directrices de la pense chinoise (Livre II) en aurait fait
apercevoir le fondement. La reprsentation que les Chinois se font de
lUnivers repose sur une thorie du mic rocosme. Celle-ci se rattache aux
premiers essais de classifications de la pense chinoise. Elle drive dune
Marcel GRANET La pense chinoise 17
croyance extrmement tenace : lHomme et la Nature ne forment pas deux
rgnes spars, mais une socit unique. Tel est le principe des diverses
techniques qui rglementent les attitudes humaines. Cest grce une parti -
cipation active des humains et par leffet dune sorte de discipline civilisatrice
que se ralise lOrdre universel. A la place dune Science ayant pour objet la
connaissance du
26
Monde, les Chinois ont conu une tiquette de la vie
quils supposent efficace pour instaurer un Ordre total.
La catgorie dOrdre ou de Totalit est la catgorie suprme de la pense
chinoise : elle a pour symbole le Tao, emblme essentiellement concret. Jai
abord ltude des catgories concrtes de lesprit sitt aprs avoir montr, par
lexamen des lments du langage, que les Chinois prtaient leurs emblmes
un pouvoir de figuration quils ne distin guaient pas dune efficience
ralisatrice. Quelques emblmes, remarquables parce quils sont les plus
synthtiques de tous apparaissent dous dune puissance danimation et
dorga nisation quon ne peut caractriser quen la qualifiant de totale. La
fonction souveraine quils se voient attribuer rend ma nifeste le fait que la
pense chinoise sest refuse dis tinguer le logique et le rel. Elle a ddaign
les ressources de clart quapportent lesprit une logique de lextension et
une physique de la quantit. Elle na point voulu consid rer titre
dabstractions les Nombres, lEspace, le Temps. Aussi na -t-elle point estim
utile de constituer des catgories abstraites telles que nos catgories de Genre,
de Substance et de Force. La notion de Tao dpasse les notions de force et de
substance, et le Yin et le Yang, qui valent indistinctement comme forces,
substances et genres, sont encore autre chose, puisque ces emblmes ont pour
fonction de classer et danimer tout ensemble les aspects antithtiques de
lOrdre universel : le Tao, le Yin et le Yang voquent synthtiquement,
suscitent globalement lordonnance rythmique qui prside la vie du monde
et lactivit de lesprit. le pense chinoise semble entirement commande
par les ides jointes dordre, de total et de rythme.
Lintime liaison de ces n otions et, plus encore, lefficience souveraine
quon leur prte suffiraient rvler lorigine sociale des catgories chinoises.
Cette origine se trouve confirme ds quon analyse le contenu des ides
directrices. Quil sagisse de la notion chinoise d Espace ou de celles de
Temps, de Nombre, dlments, de Tao, de Yin et de Yang, ce contenu ne
peut sexpliquer uniquement par les conceptions propres aux penseurs ou aux
techniciens qui les
27
utilisrent. Il nest certes pas inutile pour les
interprter de considrer lemploi quelles ont reu dans telle ou telle
spcialit du savoir qui apprend amnager les occasions et les sites : art
gographique ou calendrique, musique ou architecture, art des devins,
technique des mutations... Mais on ne touche au fond et linterprtation na
quelque chance dtre correcte et complte que lorsquon envisage les notions
directrices en cherchant dterminer leurs rapports avec la structure de la
socit chinoise. Par suite, si je me suis refus dater ces ides par la date
Marcel GRANET La pense chinoise 18
(suppose) du fragment philosophique o lon voit mentionns pour la
premire fois les termes qui les notent, jai essay de fixer le temps et lordre
de leur formation en mettant profit le fait que celle-ci est lie des
circonstances sociales. Les notions auxquelles les Chinois attribuent une
fonction de catgories dpendent, pour lessentiel, des principes sur lesquels
repose lorganisation de la socit : elles reprsentent une espce de fond
institutionnel de la pense chinoise, et leur analyse se confond (comme on le
verra par exemple pour les ides de Temps, dEspace et mme de Nombre)
avec une tude de morphologie sociale. Mais ces ides matresses ne sont pas
toutes devenues explicites au mme moment de lhistoire : aussi se
signalent-elles par quelques traits qui les situent ou les datent. Si le Yin et le
Yang forment un couple et paraissent prsider conjointement au rythme qui
fonde lOrdre universel, cest que leur conception relve dun ge de lhistoire
o un principe de roulement suffisait rgler lactivit sociale rpartie entre
deux groupements complmentaires. La conception du Tao remonte une
poque moins archaque ; elle na pu devenir explicite qu un moment o la
structure de la socit tait plus complique et dans des milieux o lon
rvrait lautorit de Chefs justifis se prsenter comme les seuls auteurs de
lordre dans le monde : alors et l seulement, put tre imagine lide dun
pouvoir danimation unique et central.
Classer les notions en les rapportant des milieux dont on connat la place
et le rle dans lhistoire de la socit chinoise, cest esquisser lhistoire des
ides, et cest mme indiquer des dates. Si ces dates ne peuvent sexprimer au
28
moyen de chiffres, elles nont pas, sans doute, un moindre caractre de
prcision concrte. Pourtant, je le sais bien, certains liront avec dplaisir des
dissertations o, faute de dates abstraites et de noms propres, les ides
sembleront sortir directement de la foule. Quy puis -je ? Je me suis interdit
demployer mme les dsignations (videmment commodes mais dune
prcision toute fictive) telles que lcole des Devins . Je les ai vites par
pure prudence et non pas, on peut le croire, par oubli du fait que, pour pro-
duire des ides, il faut des individus. Jai pu montrer que le contenu des ides
directrices sexplique par la structure de la socit chinoise et que lvolution
de ces ides dpend trs strictement de lvolution sociale. Il est videmment
regrettable quon nait pas le moyen de ci ter les noms et de donner les dates
des personnages qui furent les tmoins actifs de ces volutions parallles.
Lessentiel cependant est quon en peut marquer le paralllisme. Quel quait
t le gnie des sages qui prirent conscience des principes directeurs de la
pense et de lorganisation chinoises, lexplication de ces principes se trouve
bien moins dans ce gnie que dans lhistoire du systme social.
Cette histoire est remarquable, en Chine, par une continuit dont on ne
trouve nulle part lquivale nt. Les philosophes chinois de toute cole nont
jamais cess de penser que le systme national de symboles, fruit dune
longue tradition de sagesse, ne pouvait pas, dans son ensemble, ne pas tre
Marcel GRANET La pense chinoise 19
la fois adquat et efficace : autant dire quils pro fessent pour lui la confiance
quen Occident nous inspire la Raison.
Celle-ci nous parat correspondre un corps de notions directrices dont les
notions chinoises semblent diffrer profondment. Comme on le verra, ces
dernires se rattachent un systme de classification quil est trs lgitime de
rapprocher des classifications primitives . Il serait assez facile dattribuer
aux Chinois une mentalit mystique ou prlogique si lon interprtait
la lettre les symboles quils rvrent.
Mais, en considrant comme des invitations tranges et singulires ces
produits de la pense humaine, jaurais cru manquer lesprit de lhumanisme
comme au principe de
29
toute recherche positive. Dailleurs, linjustice
quimplique rait un prjug dfavorable se trouve dmontre par lana lyse des
ides directrices ; ces cadres permanents de la pense sont calqus sur les
cadres dune organisation sociale dont la dure suffit prouver la valeur : il
faut donc que ces rgles daction et de pense rpondent en qu elque manire
la nature des choses (21). La Sagesse chinoise na sans doute pas su se
dfendre de dvier vers une pure scolastique ; partir de la fondation de
lEmpire, lOrthodoxie a impos son rgne, et le principal souci de la pense
savante a t le classement mnmotechnique dun vieux savoir : ds lors, le
sens exprimental a fait dfaut. Mais ce savoir scolastique stait constitu
partir dexpriences dont est sortie, avec la notion mme de classement, lide
que toute organisation tire sa valeur dune efficience constate. Arbitraires
assurment en quelque mesure comme toutes les crations humaines, les
amnagements sociaux qui ont servi de modles lamnagement de lesprit
reposent nanmoins sur un effort persvrant dadaptation exprime ntale.
Cest une tentative longtemps poursuivie d organisation de lexprience qui
est lorigine des catgories chinoises : il y aurait imprudence prjuger
quelles sont, en tout point, mal fondes. Elles paraissent sopposer nos
propres ides directrices et peuvent nous surprendre par un parti pris hostile
lgard de toute abstraction. Mais les Chinois ont su dgager une logique de la
hirarchie ou de lefficacit qui sajuste par faitement leur got pour les
symboles concrets. Et si, en se refusant prter un aspect dentits abstraites
au Temps, lEspace et aux Nombres, ils se sont dtourns dune phy sique
quantitative et se sont cantonns (non sans rsultats profitables) dans la
poursuite du furtif ou du singulier, rien ne les a empchs, aucun prjug
thologique ne les poussant imaginer que lHomme formait lui seul dans la
nature un rgne mystrieux, ddifier toute leur sagesse sur une
psychologie desprit positif. Peut-tre est-on conduit une apprciation
plus quitable de la pense chinoise quand on sest aperu que le crdit des
notions qui lui servent de principes directeurs tient non pas la vogue de tel
ou tel enseignement, mais lefficience longuement prou ve dun systme
de discipline sociale (
22
) .
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 20
30
Javais faire connatre le systme de pense qui, joint leur systme
social, dfinit la civilisation des Chinois. Jai d, car je ne disposais que de
renseignements incomplets et frustes, procder par de lentes analyses quil
ma fallu pr senter sous la forme de dissertations spares. Jai cherch les
grouper de faon indiquer la structure et le mouvement qui caractrisent le
corps de doctrines ou de rgles daction que javais interprter. Lide
qui semble lanimer est que la pense hu maine a pour fonction non la
connaissance pure, mais une action civilisatrice : son rle est de scrter un
ordre agissant et total. Il ny a point, par suite, de notion qui ne se confonde
avec une attitude, ni de doctrine qui ne sidentifie avec une recet te de vie.
Dfinir, pour lessentiel, le systme de pense des Chinois revient
caractriser lensemble des attitudes chinoises. Aussi la conclusion que jai
donne ce volume vaut-elle pour le volume prcdent. Si ce titre ne
supposait pas une ambition dplace, je pourrais dire quelle a pour objet de
faire entrevoir lesprit des murs chinoises . Je me suis propos dy
signaler les plus remarquables des partis pris do la civilisation de la Chine
tire son originalit. Ce rsum, bien entendu, nes t que le rsum de mon
exprience. On le reconnatra sans doute : si un esprit systmatique apparat
dans ces conclusions provisoires, cest que javais dfinir lesprit dun
systme (
23
) .
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 21
L I V R E P R E M I E R
LE X P R E S S I O N
D E L A P E N S E
31
Ces premiers chapitres ont pour objet de renseigner sur la langue,
lcriture, la stylistique, la rythmique chinoises. Nous sommes habitus
considrer le langage comme une symbolique spcialement organise pour
communiquer des ides. Les Chinois ne mettent pas lart du langage part des
autres procds de signalisation et daction. Il leur parat solidaire de tout un
corps de techniques servant situer les individus dans le systme de
civilisation que forment la Socit et lUnivers. Ces diverses te chniques de
lattitude visent dabord laction. Quand ils parlent et quand ils crivent, les
Chinois, au moyen de gestes styliss (vocaux ou autres), cherchent figurer et
suggrer des conduites. Leurs penseurs nont pas des prtentions diffrentes.
Ils se contentent parfaitement dun systme traditionnel de symboles plus
puissants pour orienter laction quaptes for muler des concepts, des thories
ou des dogmes.
Marcel GRANET La pense chinoise 22
CHAPITRE Premier
La langue et lcriture
33
Le chinois est une grande langue de civilisation qui a russi devenir
et rester linstrument de culture de tout lExtrme -Orient. Elle a, de plus,
servi dorgane lune des littratures les plus varies et les plus riches. La
langue chinoise appartient au type monosyllabique. Lcritur e est figurative.
I. Les emblmes vocaux
Dans ltat actuel de nos connaissances, cest seulement pendant la
priode comprise entre le VIe sicle de notre re et les temps modernes quon
peut suivre lvolution phon tique et morphologique du chinois (24). Pour les
temps plus anciens qui nous intressent ici, les documents ne renseignent que
dune manire insuffisante sur la prononciation et la langue parle.
Les spcialistes admettent que le chinois est une langue du groupe dit
sino-tibtain. Tous les parlers de ce groupe sont caractriss par une tendance
au monosyllabisme. Le sino-tibtain commun tait-il une langue
monosyllabique ? Certains pensent qu il serait inexact de le dfinir ainsi
si lon entend par l un idiome dont tous les mots lorigine nauraient eu
quune syllabe (25). Il ne parat point possible, pour le moment, disoler les
racines primitives. On considre cependant comme probable qu date
ancienne de nombreux mots taient plus longs quils ne le sont aujourdhui
34
et comprenaient, outre la racine, un ou plusieurs affixes et peut-tre mme
une dsinence. Au cours des sicles, cet agrgats se sont rduits
graduellement (26). M. Karlgren a mme essay de dmontrer que les
Chinois employaient jadis des pronoms personnels diffrents au cas-sujet et au
cas-rgime (
27
). Les documents quil a tudis ne sont certainement pas
antrieurs aux VIIIe-Ve sicles avant notre re. Les Chinois de lpoque
fodale auraient donc parl une langue o existaient des traces de flexion
(dclinaison sinon conjugaison).
Il parat, dautre part, que le chinois archaque tait pho ntiquement moins
pauvre que le chinois moderne. Les consonnes, initiales ou finales, taient
plus nombreuses. La srie des vocales comprenait un assez grand nombre de
diphtongues et de triphtongues. Chaque mot portait un ton dont la hauteur
variait selon que linitiale tait sourde o sonore, tandis que linflexion
dpendait, semble-t-il, de la finale. Ces tons taient au nombre de huit : quatre
Marcel GRANET La pense chinoise 23
dans la srie basse, quatre dans la srie haute. Ils pouvaient aider
diffrencier les homophones (
28
). Si, en prononant un mot, on faisait passer le
ton de la srie basse la srie haute ou inversement, la valeur de ce mot se
trouvait modifie. l encore, il y a (peut-tre) trace dun procd ancien de
drivation.
Il est impossible de dire si les diffrents procds de drivation quon
pense avoir restitus et dont il ny a gure moyen de dterminer limportance
tmoignent dun tat archaque du chinois ou sil faut y voir lamorce dun
dveloppement de la langue dailleurs rapidement arrt.
Quoi quil en soit, la langue parle aux temps les plus anciens de lhistoire
chinoise (
29
) apparat dj comme une langue dun phontisme trs pauvre et
dont la morphologie est extrmement rduite.
Mme si lon postule que, dans lidiome chinois, les mots ntaient point
primitivement monosyllabiques, on doit reconnatre que nulle part la tendance
au monosyllabisme na t plus forte. Sil est vrai que les Chinois aient
employ des affixes, le rle de ceux-ci tait, en tout cas, si restreint que le
sujet parlant navait gure le moyen de prendre conscience daucune
drivation. Il avait utiliser des mots qui,
35
rduits ltat de monosyllabes,
dpourvus de toute souplesse, de toute fluidit, se prsentaient lui,
pratiquement, comme autant de racines indpendantes.
Nous ne connaissons pas limportance des varits dialec tales qui
pouvaient distinguer les parlers des diffrents pays de la Chine ancienne.
Le fait quune mme langue se retrouve dans lensemble des chansons
locales (Kouo fong : Chansons de pays) qui forment la premire partie du Che
king prouve peu de chose. Il nest pas impossible que ces chansons aient t
remanies au moment o on en fit une anthologie. On peut cependant
supposer que tous les sujets de la vieille Confdration chinoise avaient
conscience quils parlaient un mme idiome.
Il y a des chances que lhabitude des runions interfodales ait favoris le
dveloppement dun parler commun aux nobles des diffrentes seigneuries.
Ceux-ci considraient cette langue commune comme la seule qui ft digne
deux. Un prince de Wei (seigneurie du Ho -nan), revenu dans son pays aprs
un temps de captivit, se plaisait imiter la faon de parler de ses vainqueurs,
les gens de Wou (Ngan-houei). On scria aussitt : Le prince de Wei
nvitera pas le Sort ! Ne sera-ce point de mourir chez les Barbares ? Il fut
leur prisonnier. Il se plat parler leur langue ! Le voil dcidment li
eux (
30
) !
On doit admettre que, ds lpoque fodale, le chinois est une langue de
civilisation (
31
).
Il mrite de ltre parce quil est lorgane d une culture originale et parce
quil prsente certaines qualits. Ces qua lits, vrai dire, sont trs diffrentes
Marcel GRANET La pense chinoise 24
de celles que nous serions tents de demander une langue choisie pour
assurer une bonne transmission de la pense.
Les mots, brefs lex cs et que la pauvret du phontisme rendait souvent
difficiles distinguer, pouvaient, pour la plupart, tre employs
indiffremment comme noms, verbes, adjectifs, sans que leur forme ft
change sensiblement (
32
). Quelques particules, qui, du reste, servaient
chacune plusieurs fins et valaient surtout comme ponctuations orales,
aidaient faire entendre le sens de la phrase.
36
Mais seule une construction
rigide pouvait apporter quelque clart lexpression des ides. Or, quand on
crivait, ctait bien lordinaire, un emploi strict de la rgle de position qui
fixait le rle syntactique de chaque mot. Mais, quand on parlait, lordre des
mots tait dtermin par la succession des motions. Cet ordre ne faisait que
mettre en valeur le degr dimportance affective et pratique attribu aux
diffrents lments dun ensemble motionnel.
La langue offrait peu de commodits pour lexpression abstraite des ides.
Sa fortune comme langue de civilisation a cependant t prodigieuse.
Le chinois, il est vrai, possde une force admirable pour communiquer un
choc sentimental, pour inviter prendre parti. Langage rude et fin la fois,
tout concret et puissant daction, on sent quil sest form dans des palabres
o, saffrontaient des volonts ruses.
Peu importait dexprimer clairement des ides. On dsi rait, avant tout,
arriver (discrtement tout ensemble et imprativement) faire entendre son
vouloir. Un guerrier, avant que le combat ne sengage, sadresse un ami
quil a dans lautre camp. Il veut lui donner de prudents conseils, lengager
fuir travers les boues de la plaine inonde, lui faire entrevoir quen ce cas il
pourrait lui porter secours... Cependant il se borne lui dire : Avez-vous du
levain de bl ? Non , rpond lautre [qui, peut -tre, ne comprend pas].
Avez-vous du levain (de plantes) de montagne ? Non , rpond de
nouveau lautre. [Malgr linsistance sur le mot levain (le levain passait pour
tre un excellent prventif contre linfluence pernicieuse de l humidit), il ne
comprend point encore ou feint de ne pas comprendre : sans doute
dsire-t-il recevoir, avec un conseil plus explicite, lengagement quon lui
viendra en aide.] Lami reprend alors [vitant encore le mot essentiel, mais le
suggrant avec force] : Le poisson du Fleuve aura mal au ventre. Quel
remde lui donnerez-vous ? Et lautre [qui se dcide enfin] : Regardez les
puits sans eau. Vous len retirerez. Il va donc, su gros du combat, se cacher
dans une fondrire boueuse et, le danger pass, son ami ly retrouve. Le don -
neur de conseil a concentr lattention sur un mot quil sest
37
bien gard de
prononcer tout en sachant lui donner une pleine valeur dimpratif
complexe. ( Songez leau ! Mfiez-vous de leau ! Servez-vous de leau
1 = Sauvez-vous, en utilisant, avec prudence, linondation ! )
Le langage vise, avant tout, agir. Il prtend moins informer clairement
qu diriger la conduite. Lart de sexprimer ( wen) rend la parole
Marcel GRANET La pense chinoise 25
puissante (
33
). Cet art, tel quil apparat dans les rcits anciens de
transactions ou de palabres, ne se soucie aucunement de notions explicites ou
de raisonnements en forme. Pour prendre barre sur un adversaire, pour peser
sur la conduite de lami ou du client, il suffit quaccumulant les formules on
impose la pense un mot, un verbe, qui la possdera entirement.
Le mot, en chinois, est bien autre chose quun signe ser vant noter un
concept. Il ne correspond pas une notion dont on tient fixer, de faon aussi
dfinie que possible, le degr dabstraction et de gnralit. Il voque, en
faisant dabord app aratre la plus active dentre elles, un complexe indfini
dimages particulires.
Il nexiste point de mot qui signifie simplement vieillard . Il y a, en
revanche, un grand nombre de termes qui peignent diffrents aspects de la
vieillesse : laspect d e ceux qui, dj, ont besoin dune alimentation plus riche
(ki ), laspect de ceux dont la respiration est suffocante ( kao), etc. Ces
vocations concrtes entranent une foule dautres visions qui sont, toutes,
aussi concrtes : tout le dtail, par exemple, du mode de vie propre ceux
dont la dcrpitude requiert une nourriture carne, ils sont ceux quon doit
exempter du service militaire, ceux quon ne peut plus obliger aller
lcole (sorte de prytane), ceux pour qui, en prvision de leur mort, on
doit tenir prt tout le matriel funraire dont la prparation exige un an de
travail, ceux qui ont le droit de porter un bton en pleine ville, du moins
quand celle-ci nest pas une capitale, etc. Telles sont les images, veilles,
entre autres, par le mot ki , lequel, au total, correspond une notion quasi
singulire, celle de vieillard de soixante soixante-dix ans. A soixante-dix
ans, on devient spcifiquement vieux. On mrite alors dtre appel : lao. Ce
mot voque un moment caractristique de la
38
vie qui est larrive la
vieillesse. Il nquivaut pas au concept : vieux. Il entrane lapparition dune
suite dimages qui ne se fondent point en une ide abstraite. Si ce flot
dvocations nest point arrt, la reprsentation embrassera le nsemble des
aspects qui singularisent les diffrentes catgories de gens pour lesquels a pris
fin la priode active de la vie. Quand elle aura atteint son maximum
dampleur, cette reprsentation restera encore domine par une vision carac -
tristique, celle de lentre dans la retraite, ou, plus exacte ment, celle du geste
rituel par lequel on prend cong de son chef. Aussi le mot lao, comme la.
plupart des mots chinois, garde-t-il, mme quand on lemploie de faon
nominale, une sorte de valeur vivante. Il ne cesse pas dvo quer une action et
demeure foncirement verbe (se dclarer vieux ; tre dclar vieux ; prendre
sa retraite).
Le mot, de mme quil ne correspond pas un concept, nest pas non plus
un simple signe. Ce nest pas un signe abstrait auquel on ne donne vie qu
laide dartifices gram maticaux ou syntactiques. Dans sa forme immuable de
monosyllabe, dans son aspect neutre, il retient toute lnergie imprative de
lacte dont il est le correspondant vocal, dont il est lemblme.
Marcel GRANET La pense chinoise 26
Cette puissance des mots et ce caractre quils possdent dtre considrs,
non pas comme de simples signes, mais comme des emblmes vocaux,
clatent dans certains termes, qui dordinaire semploient redoubls et forment
des auxiliaires descriptifs.
Limportance de ce s auxiliaires descriptifs est un des traits de la posie
ancienne. Mais ils jouent un rle considrable dans la posie chinoise de tous
les temps, et la prose elle-mme ne les ignore pas (
34
). Quand un pote peint
les jeux de deux sortes de sauterelles laide des auxiliaires yao yao et ti -ti ,
il nentend point (ses interprtes nous laffirment) se borner dcrire avec
expression. Il veut conseiller il prtend ordonner ses auditeurs dobir
un ensemble de rgles dont les gestes des sauterelles sont lemblme naturel,
dont les auxiliaires qui les peignent sont lemblme vocal. Ces rgles sont trs
particulires et cependant orientent largement la conduite. On ne conoit pas
(il ne se peut pas) que, par une sorte def fet direct, les emblmes
39
vocaux
yao-yao et ti -ti nimposent point, par leur force seule, le respect
dobligations (mariage hors de la famille et de la rsidence, entre en mnage
aprs la saison des travaux agricoles, etc.) impliquant toute une discipline de
vie (sparation des sexes, rites de la vie de mnage, etc. ) (
35
). Lauxiliaire siu
peint le bruit particulier que font avec leurs ailes les couples doies sauvages ;
lauxiliaire yong rend le cri de ces mmes oies, quand, lappel du mle, la
femelle rpond. De nos jours encore, il suffit dvoquer ces pein tures vocales
(on peut pour cela se borner inscrire sur une pancarte les caractres
correspondants, lemblme scriptural tenant la place de lemblme vocal, qui
est lui-mme lqui valent de lemblme naturel), pour tre assur (du moins si
lon porte cette pancarte, la place convenable, en tte dun cortge nuptial)
que lpouse simprgnera tout aussitt de la vertu dune oie femelle : elle
suivra, sans le dpasser jamais, le chef du mnage, et, dsormais soumise
tous ses ordres, elle lui rpondra sur le ton dun unisson harmonieux (
36
).
Utiliss par la plus savante des rhtoriques, les concepts abstraits de pudeur,
de soumission, de modestie auraient-ils des effets plus puissants ?
Certains auxiliaires descriptifs ressemblent des onomatopes. La plupart
dentre eux sont des peintures vocales, mais non dans le sens raliste du mot.
Ki -ki , qui peint le chant du coq tout comme celui du loriot, voque encore
les bourrasques du vent du nord (
37
). Les monosyllabes homophones abondent
dans le chinois, trs pauvre en sons, trs riche en mots : deux homophones,
chacun avec la mme force de suggestion, la fois singulire et indfinie,
peuvent veiller les sries dimages les plus dissemblables. Rien, dans leur
vocabulaire ou leur grammaire, ne laisse entrevoir que les Chinois aient
prouv le besoin de donner aux mots, avec un aspect nettement individualis,
le moyen de signaler clairement leur sens ou leur fonction. On peut parfois
songer retrouver dans certains mots une sorte de musique imitative. Ce nest
point delle quils tirent une puissance voca trice telle que les prononcer cest
contraindre. Si en chacun deux demeure, avec une sorte defficace, une
valeur latente dimpratif, cela tient une attitude densemble lgard de la
Marcel GRANET La pense chinoise 27
parole. Les Chinois ne semblent pas stre soucis de
40
constituer un
matriel dexpressions claires qui vaudraient uni quement en tant que signes,
mais qui, en elles-mmes, seraient indiffrentes. Ils paraissent tenir ce que
chacun des mots de leur langue les invitent sentir que la parole est acte.
Le terme chinois qui signifie : vie et destine (ming), ne se distingue gure
de celui (ming) qui sert dsigner les symboles vocaux (ou graphiques). Peu
importe que les noms de deux tres se ressemblent au point quil y ait chance
de les confondre : chacun de ces noms exprime intgralement une essence
individuelle. Cest p eu de dire quil lexprime : il lappelle, il lamne la
ralit. Savoir le nom, dire le mot, cest possder ltre ou crer la chose.
Toute bte est dompte par qui sait la nommer. Je sais dire le nom de ce
couple de jeunes gens :ils revtent aussitt, faisan et faisane, la forme qui
convient leur essence et qui me donne prise sur eux. Jai pour soldat des
tigres si je les appelle : tigres ! . Je ne veux point devenir impie, jarrte
donc ma voiture et je fais demi-tour, car je viens dapprendre que le nom de la
bourgade prochaine est : la mre opprime . Quand je sacrifie, jemploie le
terme convenable, et les dieux aussitt agrent mon offrande : elle est parfaite.
Je connais la formule juste pour demander une fiance : la fille est moi. La
maldiction que jexhale est une force concrte : elle assaille mon adversaire,
il en subit les effets, il en reconnat la ralit. Je sors dun sang princier, je
deviendrai pourtant garon dcurie, car on ma appel palefrenier . Je me
nomme Yu, jai d roit au fief de Yu, la volont du suzerain ne peut me
lenlever je ne puis tre dpossd de la chose, puisque jen dtiens
lemblme. Jai tu un seigneur :aucun crime na t commis si nul na os
dire cest un assassinat !Pour que ma seigneurie prisse, il suffit que,
violant les rgles protocolaires du langage, je me sois dsign par une
expression qui ne convenait point :elle disqualifie, avec moi, mon pays (
38
).
Cest dans lart de la parole que sexaltent et culminent la magie des
souffles et la vertu de ltiquette. Affecter un vocable. cest attribuer un rang,
un sort un emblme. Quand on parle, nomme, dsigne, on ne se borne pas
dcrire ou
41
classer idalement. Le vocable qualifie et contamine, il pro-
voque le destin, il suscite le rel. Ralit emblmatique, la parole commande
aux phnomnes.
Le vocabulaire ancien comprend un certain nombre de ces vocables uss
que les grammairiens modernes qualifient de mots vides ou de mots
morts . Les autres, les mots vivants , sont infiniment plus nombreux : ce
sont ceux en qui rside une force capable de rsister lusure. Quils
expriment une action, un tat (nimporte quelle espce dap parence
phnomnale), tous ces mots suscitent, si je puis dire, une essence
individuelle. Tous participent de la nature des noms propres. Ils valent en tant
quappellations, en tant quappellations singulires. Do ce pullulement des
mots qui fait un si trange contraste avec la pauvret du phontisme. Il y a de
nombreux termes, de sens trs divers, qui se prononcent peng, hong, sseu,
tsou ; en revanche, il ny a aucune expression qui, phontiquement bien
Marcel GRANET La pense chinoise 28
individualise et claire pour loreille, exprime lide gnrale, abstraite et
neutre de mourir . On ne peut exprimer lide mourir , sans qualifier et
juger le dfunt, sans voquer (au moyen dun seul monosyllabe) tout un
ensemble de pratiques rituelles, tout un ordre de la socit. Selon que vous
aurez dit peng, hong, sseu ou tsou, le dfunt sera mort (cest --dire quil aura
t convenable, pour ce qui est du deuil, de le traiter) en Fils du Ciel, en
seigneur fieff, en grand-officier, ou en homme du peuple. Par leffet dun seul
mot, vous aurez dispos du sort du dfunt, fix sa destine dans lautre vie,
class sa famille, moins que, incapable de porter un jugement valable, vous
ne vous soyez disqualifi vous-mme car la force dun emblme se
retrouve contre qui sait mal lattribuer. La vie chinoise est domine par
ltiquette. Le vocabulaire sest accru, dmesu rment, de faon permettre
qu chaque situation correspondt un terme protocolairement juste et, partant,
dou defficace. Cet immense vocabulaire ne corres pond point un inventaire
o lon viserait la clart : il forme un rpertoire de jugements de valeur,
jugements singuliers et pourvus defficience. Il constitue un systme de
symboles dont lemploi, titre demblmes agissants, doit permettre de
raliser un ordre rgl par ltiquette.
42
Le chinois ancien, avec son abondant vocabulaire, dispose non pas
dun grand nombre de signes faciles reconnatre et notant des notions
distinctes, mais dun riche rpertoire demblmes vocaux. A ceux -ci, il
importe peu de donner une individualit sensible, un extrieur concret, une
allure qui apparente ou qui distingue. Chacun, selon les circonstances et la
mimique qui orienteront en un sens dtermin les proccupations des
interlocuteurs, peut retrouver, dans sa force entire, une puissance particulire
de suggestion. La langue chinoise ne sest pas plus soucie de conserver ou
daccrotre sa richesse phontique que de dvelopper sa mor phologie. Elle na
pas cherch se perfectionner dans le sens de la clart. Elle ne sest point
modele de faon paratre faite pour exprimer des ides. Elle a tenu rester
riche de valeurs concrtes et surtout ne pas laisser amoindrir la puissance,
affective et pratique, qui, en tant quil est senti comme un emblme, appartient
chaque mot.
II. Les emblmes graphiques
Le Chinois, quand il sexprime, parat proccup deffi cacit, plus quil ne
semble obir des besoins dordre stric tement intellectuel.
Cette orientation de lesprit explique sans doute le fait que lcriture na
jamais, en Chine, cess dtre une criture emblmatique.
Cette criture est souvent qualifie didographique [
38p
], parce quun
caractre spcial est affect chaque mot. Les caractres sont plus ou moins
compliqus. Ils se rsolvent en un certain nombre dlments graphiques,
Marcel GRANET La pense chinoise 29
dpourvus de signification et qui correspondent simplement un certain mou-
vement de loutil employ par lcrivain. Ces traits, groups en plus ou moins
grand nombre, forment de petites figures. Les figures que lon arrive
simplement dcomposer en traits lmentaires sont qualifies de symboles
ou dimages. On retrouve chez les unes la reprsentation dune chose ( arbre) ;
les autres paraissent voquer une ide (sortir). Ces caractres que lon nomme
simples, sont relativement peu nombreux. Les caractres dits complexes sont
en bien plus grand nombre. Quand on considre quun caractre
44
complexe
est uniquement form de composants (images ou symboles) concourant tous
indiquer le sens (habit + couteau = commencement), on admet quon est
encore en prsence dun idogramme (
39
). Le plus souvent on aboutit, par
lana lyse graphique, isoler deux parties. Lune (simple) est alors qualifie de
radical ; elle est cense donner une indication sur le sens. La seconde
(considre comme plus ou moins complexe), qualifie de phontique, est
cense donner une indication sur la prononciation. Les caractres de ce type,
dits complexes phoniques, ne sont pas prsents comme des idogrammes. Ils
voquent un mot en faisant dabord songer (par leur radical) une catgorie
dobjets, puis en spcifiant (grce la phontique) cet objet : il est, dans la
catgorie indique, celui (ou lun de ceux) qui correspond ( peu prs) telle
prononciation [doublure (li) = vtement (radical) + li (phontique ; le signe
qui appelle cette prononciation signifie village)].
Leibniz a crit (40) : Sil y avait (dans lcriture chinoise)... un certain
nombre de caractres fondamentaux dont les autres ne fussent que les
combinaisons , cette criture aurait quelque analogie avec lanalyse des
penses . Il suffit de savoir que la plupart des caractres sont considrs
comme des complexes phoniques, pour sentir combien est fausse lide que les
Chinois auraient procd linvention de leur criture comme celle dune
algbre en combinant des signes choisis pour reprsenter les notions
essentielles.
Les mrites de lcriture chinoise sont dun ordre tout autre : pratique et
non pas intellectuel. Cette criture peut tre utilise par des populations
parlant des dialectes ou mme des idiomes diffrents, le lecteur lisant
sa manire ce que lc rivain a crit en pensant des mots de mme sens, mais
quil pouvait prononcer de faon toute diffrente. Ind pendante des
changements de la prononciation au cours des temps, cette criture est un
admirable organe de culture traditionnelle. Indpendante des prononciations
locales quelle tolre, elle a pour principal avantage dtre ce quon pour rait
appeler une criture de civilisation.
Elle a servi puissamment la diffusion de la civilisation chinoise. Cest en
partie cette raison quelle a d de n e point se voir encore remplace par une
criture phontique.
45
Dautre part, elle a pu tre conserve parce que la
tendance de la langue au monosyllabisme ne sattnuant point sensi blement, il
ntait besoin, pour lcrire, que de figurer des racines. On na vait aucunement
noter des flexions. On peut, du reste, penser que lhabitude de lcriture
Marcel GRANET La pense chinoise 30
figurative a t un obstacle pour tout dveloppement de la langue qui aurait
amen utiliser les divers procds possibles de drivation.
Dans les idiomes qui admettent ces procds, la conscience des drivations
peut prdisposer et aider lanalyse des ides. Contrairement ce que Leibniz
imaginait, lcriture chinoise nest point faite pour rendre un service analogue.
Les combinaisons de traits que lon nomme proprement des radicaux ne sont
nullement des caractres symbolisant des notions fondamentales. Il suffira
dindiquer quun de ces soi -disant radicaux prtend reprsenter les dents
canines et un autre les incisives, mais quil ny en a aucun rpondant l ide
gnrale de dents. A vrai dire, ces radicaux correspondent des rubriques
destines faciliter non pas un classement prtention dobjectivit, mais une
recherche pratique dans les lexiques et, sans doute, un apprentissage plus ais
de lcrit ure.
Tsin Che Houang-ti (
41
) , afin dimposer lEmpire entier lcriture
officielle en usage dans le pays de Tsin, fit publier par son ministre Li Sseu
un recueil contenant, dit-on, trois mille caractres dont lemploi devint
obligatoire pour tous les scribes. La proscription des manuscrits des Cent
coles fut, peut-tre, entre autres raisons, dicte pour empcher la
conservation des modes dcriture propres aux Six Royaumes dtruits par
Tsin. Dautre part, le dveloppem ent de la bureaucratie impriale mit en
faveur lemploi dune cursive (on la dnomme : criture des tribunaux) que les
savants affectrent de considrer comme une criture moderne, issue, par
simple dformation, de lcriture correcte, seule en usage, affi rmait-on, dans
lantiquit (
42
). Favoriss par le besoin dinterprter en caractres modernes
les manuscrits quen vue de reconstituer les uvres classiques (
43
) les savants
des Han surent retrouver ou restituer en criture archaque ou archasante, les
travaux lexicographiques se poursuivirent et aboutirent (vers 100 ap. J.-C.)
la composition dun grand recueil
46
connu sous le nom de Chouo wen. Son
auteur seffora disoler dans chaque caractre des lments composants quil
prsenta comme tant employs en vue dindiquer soit le sens, soit la
prononciation. Il dtermina, parmi les lments significatifs, 540 signes
graphiques qui lui servirent de rubriques pour classer lensemble des
caractres tudis, au nombre de 10 000 environ. De ces rubriques, rduites en
nombre, furent tirs les radicaux qui, dans les dictionnaires modernes,
permettent de chercher un mot, la manire des initiales dans nos
dictionnaires phontiques. Il conviendrait de les qualifier de cls, et il ne
faudrait aucunement les prendre pour des racines graphiques. Cependant
lide que le dvelop pement de lcriture avait t unilinaire et que lanalyse
du Chouo wen valait pour les diffrents types de symbolisation graphique, a
confr cette analyse le crdit dune explica tion tymologique. On sest
efforc ds lors dexpliquer les caractres partir dun lot de formes
primitives dont ils seraient issus par voie de combinaison. Et lon a admis,
sans discussion, que les primitives tant, lorigine, des dessins ralistes, les
caractres complexes doivent se comprendre la manire de rbus.
Marcel GRANET La pense chinoise 31
Lide que les caractres ont valeur de rbus parat ancienne. Un chef
vainqueur (596) press dlever un monument triomphal rpond que son
premier devoir est de remettre les armes aux fourreaux, car le caractre wou
(guerrier) est form des lments : arrter (image dun pied) les lances (image
dune lance) (
44
) . Cette anecdote laisse entrevoir la valeur pratique de
lexplication par rbus. On se sert, pour justifier la conduite ou les jugements
motivant la conduite, dune sorte d exprience consigne dans lcriture.
Cette exprience est considre comme parfaitement adquate la ralit
des choses. Il faut entendre par l quelle est pleine defficace, ou, si lon
prfre, pleine dune sagesse divine. La tradition veut que lcriture ait t
invente par un ministre de Houang-ti, le premier des Souverains, aprs un
examen des traces laisses sur le sol par les oiseaux. On explique de mme,
partir de lauguration, lorigine des figures proprement divinatoires. On
explique encore ces dernires partir de lusage des cordes noues et,
47
prcisment, le plus ancien systme dcriture (on lui attribut la valeur dun
systme de gouvernement) consistait se servir de nuds ou de tailles ( fou).
Les tailles valaient comme talismans (leur nom sert toujours dsigner ces
derniers). Les signes graphiques (ces traditions le prouvent) se distinguent mal
des symboles vertus magiques. Au reste, leur utilisation par tes hommes en
dmontra la parfaite efficacit. Ds que les emblmes graphiques furent
invents, les dmons senfuirent en gmissant (
45
) : les humains avaient prise
sur eux.
Le premier devoir du Chef est de fournir aux hommes les emblmes qui
permettent de domestiquer la Nature, parce quils signalent, pour chacun des
tres, sa personnalit, ainsi que sa place et son rang dans le Monde. Aux
premiers jours de la civilisation chinoise, Houang-ti acquit la gloire dun hros
fondateur, car il prit soin de donner toutes choses une dsignation (ming)
correcte (tcheng), ceci afin dclairer le peuple sur les re ssources
utilisables . Rendre les dsignations correctes (tcheng ming) est, en effet,
la premire des obligations gouvernementales. Le Prince a pour mission de
mettre de lordre tout ensemble dans les choses et les actions : il ajuste les
actions aux choses. Il y parvient demble en fixant les dnominations ( ming :
la prononciation des mots) et les signes dcriture ( ming : les caractres) (
46
) .
Houang-ti, le premier Souverain, commena par fonder lordre social ; il
affecta aux diffrentes familles un nom destin singulariser leur Vertu. Il y
russit, dit-on, en jouant de la flte. On sait que la vertu spcifique dune race
seigneuriale sexprimait par une danse chante ( motif animal ou vgtal).
Sans doute convient-il de reconnatre aux anciens noms de famille la valeur
dune sorte de devise musicale, laquelle, graphiquement, se traduit par une
espce de blason, lentire efficace de la danse et des chants demeurant
aussi bien dans lemblme graphique que dans l emblme vocal. Mais les
hommes ne forment point dans la nature un rgne spar, et les rgles qui
simposent qui veut dfinir les familles humaines simposent aussi quand il
sagit dadapter un signe chaque chose. Le devoir essentiel de tout gouver -
Marcel GRANET La pense chinoise 32
nement est dobtenir une rpartition harmonieuse de len semble des tres. Il y
parvient en rpartissant les emblmes,
48
devises orales et graphiques. Il a
pour principale charge de surveiller le systme des dsignations. Toute
appellation vicieuse dans la langue comme dans lcriture rvlerait une
insuffisance de la Vertu souveraine. Aussi le suzerain doit-il, tous les neuf
ans (
47
) , runir une commission charge de vrifier si les emblmes visuels ou
auditifs ne cessent point de constituer une symbolique conforme au gnie de la
dynastie. Cette commission soccupe la fois des vocables et des caractres :
elle est donc compose de scribes et de musiciens aveugles (
48
) .
Symboles galement puissants, les signes dcriture et les signes vocaux,
quun mme terme ( ming) sert nommer, sont considrs comme tant
strictement solidaires. Cette conception permet de comprendre pourquoi les
signes o lon reconnat des complexes phoniques ne sont pas moins
reprsentatifs de la ralit que les caractres, dits idographiques, o lon
veut uniquement voir des dessins. Fait remarquable : la partie dite phontique
de ces complexes en est le plus souvent llment stable. Le radical, au
contraire, est instable et souvent, se trouve supprim. Il est llment le moins
significatif. Il joue, tout au plus, le rle dun spcifi cateur. Normalement, il
na gure que lutilit, toute pra tique, de faciliter un classement (technique)
des signes (et non pas une classification des notions). Ces prtendus radicaux
apparaissent comme des lments superftatoires. En revanche, chacun des
groupements de traits, quon traite souvent de phontique , forme un
symbole en soi complet et correspond dordinaire, beaucoup mieux qu e le
radical, ce que nous pourrions tre tents dappeler une racine. Solidaire
dun signe vocal dans lequel on tient voir une valeur demblme, le signe
graphique est lui-mme considr comme une figuration adquate, ou plutt,
si je puis dire, comme une appellation efficace.
Lcriture, tant donnes ces dispositions desprit, na point besoin dtre
idographique au sens strict du mot. En revanche, elle ne saurait se dispenser
dtre figurative. Par contrecoup, la parole se trouve lie, pour une mme
destine, lcriture. Do limportance de cette dernire dans le
dveloppement de la langue chinoise et le fait que (tel un charme que double
un talisman) la vertu des vocables est
49
comme sustente par la vertu des
graphies. Le mot prononc et le signe crit sont, joints ou spars, mais
tendant toujours se prter appui, des correspondants emblmatiques que
lon estime exactement adquats aux ralits quils notent ou suscitent ; en
eux et en elles rside la mme efficacit, tant du moins que reste valable un
certain ordre de civilisation.
Cet ordre ne diffre pas du systme gnral de symbolisation. Il y a, par
suite, identit complte (ou, plutt, on tient penser quil y a rellement
identit) entre le sens de la correction du langage (crit ou parl), le sentiment
de la civilisation et la conscience de la valeur tymologique des signes.
Marcel GRANET La pense chinoise 33
Ces conceptions et ces doctrines, qui font entrevoir latti tude chinoise
lgard des procds dexpression, nimpli quent nullement que la
symbolisation vocale ait relev dun art raliste du chant et la symbolisation
graphique dun art raliste du dessin.
Confucius a, parat-il, dclar que le signe figurant le chien en tait le
parfait dessin (49). Il est clair, considrer ce signe, que, pour le Sage, une
reprsentation peut tre adquate sans chercher reproduire lensemble des
caractres propres lobjet. Elle lest lorsque, de faon stylise, elle fait
apparatre une attitude estime caractristique ou juge significative dun
certain type daction ou de rapports. Il en est de mme pour les ides figures.
Lide dami ou d amiti est suggre par la reprsentation schmatique de
deux mains unies (caractre dit simple). Les diffrents contrats (contrats de
fianailles, de compagnonnage militaire, daffiliation) crateurs de liens
extra-familiaux se liaient par la paume. Le signe dcriture met sur la voie
dune sorte d ide valeur gnrale en voquant dab ord un geste consacr
riche de consquences diverses. Aussi suggestif est le caractre (dit complexe)
qui dclenche la srie de reprsentations conduisant lide de froid. On y
retrouve divers signes lmentaires qui font penser lhomme, la paille, la
maison. Lensemble fait surgir lvocation du geste initial de lhiver nage. Les
paysans chinois, lors de leur rentre au village (dlaiss pendant la saison des
travaux de plein champ et des
50
grandes pluies), commenaient par
reboucher avec de la paille les murs de pis et les toits de chaume de leurs
masures.
Lemblme graphique enregistre (ou prtend enregistrer) un geste stylis.
Il possde un pouvoir dvocation correcte, car le geste quil figure (ou
prtend figurer) est un geste valeur rituelle (ou, du moins, senti comme tel).
Il provoque lapparition dun flux dimages qui permet une sorte de
reconstruction tymologique des notions.
Cette reconstruction do les notions, comme les signes, tirent u ne espce
dautorit, na rien de commun (est -il superflu de le dire ?) avec ce quun
savant appellerait une recherche tymologique. La diversit des opinions
formules par les palographes en fait foi. Chacun, ou plutt chaque cole,
isole, dfinit et regroupe sa manire les lments dont la combinaison a,
prtend-on, form le caractre ; chacun, daprs lorientation de sa pense ou
daprs les besoins du moment, trouve le sens du rbus. Dans le caractre que
lont prononce tchang (crotre, grandir) ou tchang (long, chef), les uns voient
des cheveux assez longs pour quil faille les retenir par une broche ; dans le
mme caractre, dautres distin guent sans effort un homme tte de
cheval (50). En fait, ces deux explications tymologiques se relient aisment
et de faon suggestive. Le double sens et la double tymologie sexpliquent
par la parent de deux danses anciennes. Lune est la danse du chef (et de ses
femmes), qui se fait en tournoyant et cheveux pars. Lautre est une danse
Marcel GRANET La pense chinoise 34
cheval : les cavaliers tournent en rond, cheveux et crinires sployant. Un
rcit significatif montre quon pensait semparer dun gnie de la vgtation
en le faisant entourer par des cavaliers aux cheveux pars et, aussi (car
lemblme graphique na pas moins de puissance que la danse rituelle), quon
pouvait rduire ce gnie merci par la seule reprsentation dune tte la
chevelure ploye (
51
). Lorsquil doit, en dansant, faire clater son pou voir sur
la nature et que, se mettant en pleine action, il laisse une force divine chapper
des longs cheveux quil fait alors sployer, le chef se qualifie comme tel, et,
du mme coup, il fait grandir et crotre la vgtation et les troupeaux.
Lcriture figurative tend retenir quelque chose de la valeur tymologique.
Mais peu importe quen fait elle retienne ou non le sens premier ; peu importe
que la
51
reconstruction tymologique soit imaginaire ou exacte lessentiel
est que les graphies procurent le sentiment que les notions demeurent
attaches de vritables emblmes.
Le mrite premier de lcriture figurative est dans le fait quelle permet
aux signes graphiques et, par leur intermdiaire, aux mots, de donner
limpression quils valent en tant que forces agissantes, en tant que forces
relles.
La langue chinoise se souciant aussi peu de la richesse phontique que des
enrichissements procurs par lusage des drivations, lcriture a servi
accrotre le vocabulaire. Ds quon eut admis lide que les signes avaient t
forms par voie de combinaison, ds quon eut appris les dcomposer en
lments pourvus dune signification, les ressources pour crer des caractres
devinrent illimites. Pour obtenir un terme nouveau, de prononciation dfinie,
il suffisait de combiner avec un radical choisi lun des anciens ensembles gra -
phiques pourvu de cette prononciation ou dune prononcia tion voisine. Ds
lors linvention graphique a pu fonctionner la manire dun procd de
drivation, mais en multipliant les homophones et en aboutissant souvent
masquer la parent relle des notions. Chaque caractre nouveau (tout aussi
bien que nimporte quel complexe phonique) pouvait figurer concrtement une
ralit. Le got du concret, joint la passion de ltiquette, entrana une
prolifration extraordinaire des signes graphiques.
En 485 aprs Jsus-Christ, les lexiques saugmentrent par dcret imprial
dun millier de termes nouveaux (
52
). On voit que demeurait intacte la
conception faisant du chef de ltat le matre du systme national de
symboles. En mme temps quelle, sans doute, restait valable lide que les
signes graphiques, dans leur ensemble, sont solidaires dun certain ordre de
civilisation et que chacun dentre eux possde la puissance de ralisatio n
caractristique des emblmes.
On na point mention, pour lantiquit, denrichissements aussi massifs.
Mais la prolifration des caractres est assurment un fait ancien. De trs
bonne heure, lart des crivains et surtout celui des potes a paru tenir
labondance des signes graphiques utiliss dans leur manuscrit. Ce fait signale
Marcel GRANET La pense chinoise 35
lac tion dominante que le systme dcriture a exerc sur le
52
dveloppement de la langue. Il faut supposer que les pomes, au cours de leur
rcitation, parlaient aux yeux, si je puis dire, grce la mise en branle dune
mmoire graphique doublant la mmoire verbale. Il nous est difficile de nous
reprsenter le procd, mais il est clair quil a eu un effet dcisif : les mots ne
devinrent jamais de simples signes.
Lcritu re figurative a aid la plupart des mots garder, avec une sorte de
fracheur et le caractre de mots vivants, un entier pouvoir dexpression
concrte. Conserve, sinon choisie, en vertu dune disposition de lesprit
chinois qui semble profonde, elle a empch le vocabulaire de former un
matriel abstrait. Elle parat convenir une pense qui ne se propose point
dconomiser les oprations mentales.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 36
CHAPITRE II
Le style
53
Nous sommes peu renseigns sur la stylistique chinoise, moins bien
encore que sur la langue. Lart dcrire na gure t, en Chine, lobjet
d tudes prcises. Quand il arrive aux sinologues dOccident de soccuper
de questions de style, sils ne se bornent point formuler des apprciations, ils
visent presque uniquement dater ou localiser les uvres (53). Ils
prtendent, au reste, y arriver par les voies ordinaires de la simple philologie
et ne poussent gure jusquaux recherches de stylistique. Dailleurs lhistoire
littraire de la Chine est entirement refaire : elle reste domine, mme chez
nous, par les postulats de lorthodoxie indigne. Par exemple, on exprime
assez souvent lide que la prose chinoise drive, dune part, de lart des
scribes, de lautre de lart des devins (
54
) ; les premiers auraient fix les
principes du style historique ou documentaire, les autres cr le style
philosophique ou scientifique. On se borne caractriser ces deux styles en
affirmant que celui-ci est concis jusqu lobscurit, celui -l simple, aride,
prcis, sec. Ces gnralits dispensent dapporter la preuve que scribes et
devins formaient des coles distinctes, des corporations opposes. Les faits
semblent imposer lopinion contraire, mais peu importe si lon entend
continuer croire que la pense de Confucius, grand patron de lcole
historique, na subi que de trs loin linfluence des techniciens de la magie et
de la divination : devant un dogme, quimportent les faits ? Si, dcid partir
de ceux-ci, on se librait des prjugs dogmatiques qui
54
commandent
encore le classement des uvres et des personnages, une constatation pourrait
orienter de faon positive une recherche sur la stylistique chinoise. Les uvres
anciennes (quelle que soit lcole laquelle on dcide de les rattacher ) (
55
)
renferment de nombreux passages en vers, si peu distincts du contexte que
la critique, souvent, na discern que fort tard leur caractre potique. Il y a
donc quelques raisons de supposer que les faons de dire de la prose littraire
chinoise ne se diffrencient gure de celles quutilisait lancienne posie. En
suggrant que la prose archaque (modle de la prose savante dont le prestige
tient lemploi dune langue crite distincte de la langue vulgaire au point de
paratre quasi sacre ou de passer pour une langue morte) nest point une
cration due entirement des lettrs ou des sages, on risque certes
davancer une opinion qui sera reue comme hrtique (
56
) ; on aggravera
lattentat s i lon ajoute que la posie dont la prose archaque ou archasante
tire ses procds, apparat, non pas comme une posie savante, mais
simplement comme une posie dordre religieux. Ces hypo thses, pourtant,
rendent compte, on va le voir, des caractres les plus remarquables du style
chinois.
Marcel GRANET La pense chinoise 37
Les Chinois, quand ils parlent et quand ils crivent, sexpriment
uniformment en employant des formules consacres. Ils composent leur
discours laide de sentences quils enchanent rythmiquement. Rythmes et
sentences concourent pourvoir dautorit les dveloppements et les phrases.
Ceux-ci (de mme que les mots valent pour leur force agissante) visent surtout
un effet daction.
I. Les sentences
La littrature chinoise est une littrature de centons. Quand ils veulent
prouver ou expliquer, quand ils songent raconter ou dcrire, les auteurs les
plus originaux se servent dhistoriettes strotypes et dexpressions
convenues, puises un fonds commun. Ce fonds nest pas trs abondant et,
dailleurs, on ne cherche gure le renouveler. Une bonne partie des thmes
qui ont joui dune faveur permanente se retrouvent dans les productions les
plus anciennes et les plus spontanes de la posie chinoise.
55
Un lot important de pomes anciens a t conserv dans le Che king
(57). Nous ne possdons aucune uvre chinoise authentique qui soit
sensiblement plus ancienne. Ce classique ne contient sans doute que des
pices antrieures au Ve sicle avant Jsus-Christ. Le choix des posies, si
lon veut croire la tradition, est d Confucius. Le Matre naurait admis dans
son anthologie que des pomes inspirs par la plus pure sagesse. Ils se
prsentent dans son recueil groups en quatre sections. Tous appartiennent au
genre de la posie dite rgulire (che) ; les vers, qui le plus souvent sont de
quatre caractres (quatre syllabes), se rpartissent en couplets offrant des
combinaisons de rimes assez peu varies. Les trois dernires sections
renferment des pices parfois fort courtes, mais parfois assez longues ; celles
de la premire partie (Kouo fong) nont pour la plupart que trois couplets (en
gnral douze vers en tout). Dans lensemble, ni la composition ni les pro -
cds rythmiques ne diffrent grandement dune section lautre. La tradition
orthodoxe affirme, dautre part, lunit de linspiration. Tous les pomes du
Kouo fong auraient t composs et chants loccasion de circonstances
historiques dfinies et du reste bien connues. Tous possderaient la fois un
intrt politique et une valeur rituelle, car ils auraient eu pour objet de dicter
aux princes leur conduite et de la rendre conforme aux bonnes murs (
58
).
Cette doctrine traditionnelle a le mrite de mettre en vidence le caractre reli-
gieux commun toutes ces posies. Ce caractre est essentiel : il explique seul
la conservation de ces pomes et lutilisation qui en a t faite au cours de
lhistoire chinoise, car le Che king est le classique qui inspire le plus de
respect ; on y trouve, mieux que dans les rituels eux-mmes, des principes de
conduite. Les opinions courantes, aujourdhui encore, dans la critique
occidentale sont beaucoup plus simplistes. Les Occidentaux ne reconnaissent
dordinaire un sens reli gieux qu certaines odes des derrires sections ; ils
Marcel GRANET La pense chinoise 38
affirment aussitt que, banales lextrme, leur valeur potique nest pas
trs haute (
59
), Ils accordent plus dintrt aux pomes, quils traitent
volontiers d lgies ou de satires , car ils y sentent une inspiration
toute profane. Quant aux pomes du Kouo fong, ils voient en eux, comme les
Chinois, des uvres de circonstance, mais ne comprennent point
56
quelles
aient pu, tout de mme, prsenter un intrt rituel. Ils les qualifient donc de
lieder ou de pomes dimitation populaire et pensent ainsi se librer
heureusement de la tradition indigne (
60
). A moins que cette dernire
ninspire une foi av eugle, on doit renoncer la prtention de dterminer, une
par une, le sens de posies pour la plupart remanies bien que faites
dlments anciens. En revanche, si lon porte son attention sur ces lments
et si on envisage ces thmes dans leur ensemble (
61
) quelques faits importants
se dgagent nettement, et dabord celui -ci : lancienne posie chi noise
appartient au type gnomique. Elle aime se parer de toute la sagesse et de tout
le prestige des proverbes.
Elle se soucie mdiocrement des nouveauts dexpressions, des
combinaisons indites, des mtaphores originales. Les mmes images
reviennent sans cesse. Elles sont toutes dins pirations trs voisines et,
dailleurs, tires sur un trs petit nombre de modles. Voici que tombent les
prunes ! Voici que chante le loriot ! A lunisson, crient les
mouettes ! Se rpondant, brament les cerfs ! Ces images ne furent
point inventes par got de lexpression neuve, destines se faner avec le
temps : ce sont des dictons de calendrier. On en retrouve une bonne partie
dans les calendriers rustiques que les Chinois ont conservs (
62
). Or, elles se
rapportent surtout aux priodes du printemps et de lau tomne. Nous savons
qualors se tenai ent de grandes ftes dont la tradition sest maintenue dans
certains coins de lAsie. Ces ftes ont pour objet de renouveler entre les
hommes et la nature un bon accord dont parat dpendre le sort de tous les
tres. Tous les tres, de mme, concourent la fte. Celle-ci se passe en
chants et en danses. Tandis que sur les fleurs brille la rose printanire ou que
sur la terre givre tombent au vent dautomne les fruits mrs et les feuilles
fltries, mlant leurs voix et leurs gestes aux appels que, mles et femelles, les
sauterelles, les cerfs, les mouettes, se lancent en se poursuivant, les gars et les
filles des champs forment des churs de danse qui se rpondent par vers
alterns. Hommes et choses, plantes et btes confondent leurs activits comme
sils conspiraient au mme but. Ils semblent, unis par le dsir dobir de
concert un ordre valable pour tous, sen voyer des signaux ou rpondre des
commandements (
63
).
57
Ce sont ces signaux et ces commandements qui,
enregistrs dans les vers, valent tout ensemble comme thmes potiques et
comme dictons de calendrier. A chaque fte, ainsi que lont fait les deux, tous
les acteurs sefforcent de collaborer avec la Nat ure. A tous et depuis toujours,
le mme paysage rituel propose imprieusement les mmes images. Chacun
les rinvente et croit improviser. Tous pensent apporter une collaboration
efficace luvre commune, ds quils ont retrouv, par un libre effort, les
Marcel GRANET La pense chinoise 39
formules dont les anctres vrifirent le pouvoir. Fraches trouvailles autant
que centons restitus, les thmes que peuvent inspirer les jeux de cette
improvisation traditionnelle (
64
) durent, sous forme de proverbes, mais,
librement recrs, sont choisis pour leur convenance parfaite. Ils valent, titre
de signaux adquats, parce quils correspondent exactement aux signaux que
rpte et quinvente la nature en fte, cependant que, dans leurs joutes
chantes, les hommes rivalisent de savoir traditionnel et desprit inventif.
Retenant en eux tout le gnie crateur quil a fallu, au cours des temps,
dpenser pour les parfaire, riches defficience, ils valent en tant quemblmes
(
65
).
Faites de dictons de calendrier, les posies du Kouo fong ont pu conserver,
en mme temps que la puissance gnomique affirme par la tradition chinoise,
un air de fracheur et de grce libre qui peut inviter les traiter de lieder .
Dans ces dictons demeure, avec une essence de ncessit qui est la vertu
premire de tout rite, lune de spontanit qui est le moteur de tous les jeux.
Ils possdent lentire efficacit et la jeunesse sans cesse renaissante des jeux
et des rites. Ils ne prendront jamais laspect de mtaphores usages qui peu-
vent recevoir une signification dfinie et abstraite. Ce sont des emblmes
vivaces, dbordants daffinits, clatants de puissance vocatrice, et, si je puis
dire, domnivalence symbolique. Ils ne peuvent cesser de dicter aux hommes,
avec tel geste initial, toute la conduite qui simpose quand on veut aider la
nature et, la nature elle-mme, ils savent toujours, dun seul signe, rappeler
lensemble de ses devoirs tradition nels. Aux ftes du printemps, les jeunes
gens qui passent la rivire, dansant et jupes trousses, chantent ces vers :
Cest la crue au gu o leau monte !
Cest lappel des perdrix criant (66) !
Au thme de la crue printanire, le thme de
58
la qute amoureuse rpond,
comme un cho, dans leur chanson. Mais, dans la ralit de la fte, ces
signaux solidaires se suscitent effectivement lun lautre, et lun et lautre sont
suscits ds que la danse et le chant des jeunes couples ralisent
emblmatiquement lun ou lautre : cest cette dans e et cest ce chant qui,
faisant tout ensemble saccoupler les perdrix et grossir, autant quil convient,
la crue saisonnire, russiront faire apparatre tous les signes du printemps.
La biche quon tue pour offrir sa peau en cadeau de noces, la blanche litire de
chiendent sur laquelle on devra prsenter ce don lorsque viendra avec
lautomne le temps dentrer en mnage, les sollicitations des garons mus,
lapproche de lhiver, par linfluence du Yin (principe fminin) et, chez les
filles, le souvenir des jours printaniers o elles durent obir lappel du Yang
(principe mle), tous ces thmes qui sappellent, mais qui voquent aussi une
foule de thmes correspondants, peuvent, en un couplet, suggrer toutes les
motions et inviter tous les actes que les rites et les jeux des ftes saison-
nires prsentent comme un ensemble li. Mais, au lieu de chanter :
Dans la plaine est la biche morte !
Marcel GRANET La pense chinoise 40
dherbe blanche, enveloppez-la !
Une fille songe au printemps !
Bon jeune homme, demandez-la (
67
)
il suffira, en deux mots, de rappeler le thme songer au printemps , pour
que jeux et rites, gestes humains et correspondances naturelles apparaissent
dans leur liaison ncessaire et voulue. Et si mme un pote emploie, en bonne
place, le seul mot printemps , non seulement il suggrera, avec leur
cortge rituel dimages, toutes les alternatives de langoisse amoureuse, mais
il pensera encore obliger lauditeur ressentir, en plein accord avec les
volonts de la nature et les coutumes des cieux, un sentiment si actif quil faut
lui attribuer la valeur dun vu et dun ordre. On voit pourquoi le mot, comme
1a formule elle-mme, nest pas, en chinois, un simple signe, mais un
emblme, pourquoi le mot juste nest pas un terme acc eption claire et
distincte, mais une expression o clate la. force de solliciter et de
contraindre. Le mot, quand on lisole, continue apparatre comme le verbe le
plus actif dune sentence quil voque dans sa toute -puissance de signal et
demblme. Il retient, condenses en lui, toutes les vertus (lnergie
ralisatrice de limpratif, la pit ingnieuse
59
de loptatif, le charme
inspir du jeu, la puissance adquate du rite) que possde dabord, rite, prire,
ordre, jeu, le thme potique.
Quelques posies du Kouo fong demeurent, dans la forme o on nous les a
transmises, assez proches des chants improviss dans les vieilles ftes
rustiques. Mais, chansons populaires remanies ou compositions nourries
demprunts, le plus grand nombre se prsentent comme des uvres plus ou
moins savantes. Il ny a aucune raison de rejeter la tradition qui les donne
pour des posies de cour. Rien mme nest plus instructif que lexplication
dtaille qui se fonde sur cette tradition. Les Chinois admettent comme allant
de soi que les thmes potiques, les dictons de calendrier, mis en couplets par
de sages potes ou des vassaux fidles (cest tout un), ont eu la force
dinstruire et de corriger (
68
). Sentence allgorique, toute comparaison
consacre rvle lordre de la nature et, par suite, dvoile et provoque le
Destin. La perdrix qui chante appelant le mle au temps des crues printanires
peut sans quil soit besoin de la nommer, et cepen dant en lui donnant un
conseil, en lui lanant une invective voquer la princesse Yi Kiang. Cette
dame, qui pousa le duc Siuan de Wei (718-699) aprs avoir t la femme de
son pre, tait destine mal finir. Elle se suicida, en effet, ds que le duc
leut remplace dans sa faveur par lpouse pr tendue de son propre fils. Le
thme de la qute amoureuse est solidaire de tout un ensemble dusages
naturels et dobser vances humaines. En lespce (et par leffet dune intention
qui na pas mme besoin de sexprimer), les perdrix qui chantent signifient
Yi Kiang quelle aura payer par le sort malheureux d qui contrevient
lordre des choses son union irrgulire avec le duc Siuan (
69
). Une mtaphore
consacre donne au pote la force de maudire avec prcision et de lier son
Marcel GRANET La pense chinoise 41
destin tel coupable dtermin. Lutilisation occasionnelle dun thme potique
ne lui enlve rien, on le voit, de sa puissance de sollicitation. Ceci reste vrai
mme dans le cas o le thme se trouve entirement dtourn de son sens
premier. La princesse Siuan Kiang, dabord destine au fils an du duc Siuan
de Wei, pousa le duc lui-mme et fit alors, en vraie martre, tuer son premier
fianc. Elle devait, sunissant, sur le tard, avec un frre cadet de son
malheureux
60
prtendu, rgulariser enfin sa situation. Pour linviter
sapparier convenablement, un pote, affirme -t-on, lui chanta :
Les cailles vont par couples
et les pies vont par paires !
Or, les mmes vers furent utiliss (en 545) dans un tournoi de chansons donn
loccasion dun banquet diplomatique. Les diplomates, dans ces rencontres,
ninventent rien, ni couplets ni thmes. Ils se contentent de donner, par un
sous-entendu que les circonstances clairent, un sens dtourn des
vers-proverbes. Ils pensent ainsi sduire les volonts et contraindre les
dcisions. Lorsque, lintention dun ministre tranger, un ambitieux chanta :
Les cailles vont par couples
et les pies vont par paires !
le thme de la qute amoureuse servit, en vertu dune transposition latente,
pousser un homme dtat, non pas se marier, mais se lier secrtement avec
un conspirateur (70). Par le seul fait quil parle avec autorit, le thme
potique peut tout dire. Si les auteurs sappliquent parler par proverbes, ce
nest point quils pensent de faon commune, cest que la bonne faon, et la
plus fine, de faire valoir leur pense, est de la glisser dans une formule
prouve dont elle empruntera le crdit. Les centons possdent une sorte de
force, neutre et concrte, qui peut, de faon latente, se particulariser lin fini,
tout en conservant dans les applications les plus singulires, un rel pouvoir
dinviter agir.
Les expressions convenues, puissantes pour suggrer des actions, peuvent
encore servir dcrire et mme avec une vigueur singulire. Il y a dans le Che
king un passage narratif o le got europen a pu dcouvrir un petit
tableau assez vivant . Cest, nous dit -on, une scne de beuverie o lon voit
les courtisans ivres se querellant (
71
). En fait, il sagit de vassaux qui se
saoulent par devoir au cours dun festin offert aux Anctres ; ce ne sont pas
ces derniers qui doivent le moins boire, eux, ou, du moins, les figurants dont
leurs mes viennent prendre possession. Tous sagitent, ins pirs par une
frnsie traditionnellement rgle, renversant les vases, les pots , [il faut
bien, aprs sen tre servi dans une orgie sanctifiante, casser la vaisselle
sacre] (
72
), dansant sans trve en titubant [ainsi doivent chanceler ceux
qui travaillent entrer en transes et prtendent porter le poids dun esprit
saint] (
73
), se levant et se relayant [la danse de relais
61
simpose dans les
crmonies o lon cherche faire circuler les mes] (74), bonnets penchs
Marcel GRANET La pense chinoise 42
prts tomber [on peut, certes, trouver lexpression pittoresque ; elle a, en
ralit, une valeur rituelle : un rite essentiel des ftes orgiaques obligeait les
acteurs sarracher les uns aux autres leurs coiffures, car les chevelures
libres devaient sployer tels de roides drapeaux dans le tournoiement
qui prcdait la prostration finale], dansant sans trve en tourbillon [cette
danse tournoyante qui devait sexcuter le corps ploy, la tte renverse, le
danseur paraissant senlever comme aspir au souffle du vent, est dpeinte ici
au moyen dun auxiliaire descriptif qui forme un thme repris, en prose et en
vers, ds quon veut voquer la danse extatique]. Si un critique occidental peut
opposer cette description pittoresque aux passages des odes strictement
religieuses quil juge dune banalit extrme , cest quil oublie que rien,
sinon la danse, na plus d e valeur rituelle que livresse, quaucun acte ne
comporte autant de pit que la danse en tat divresse, et, enfin, que les
ballets qui prparent lextase sont de tous le plus minu tieusement rgls.
Aussi, pour dcrire une danse orgiaque, lauteur ne sest pas plus livr la
fantaisie que sil avait entrepris dvoquer un crmonial dapparence plus
compasse. Dans les rceptions solennelles, un matre des crmonies
surveille tout le dtail des saluts, tandis quafin den avertir lhistoire un
annaliste se hte de consigner les moindres fautes de tenue. Mais aux
beuveries sacres assistent aussi, obligatoirement, un annaliste et un
crmoniaire chargs de rappeler lordre et de noter dinfamie ceux qui, se
saoulant mal ou titubant sans perfection, se drobent aux plus menus devoirs
de livresse extatique (
75
). Tandis que les acteurs par une gesticulation
correcte, parfont la crmonie, le pote qui voque la scne, non pour en faire
un tableau , mais pour en donner le modle, sapplique, sil est sincre (sil
met tout son cur obir aux usages), employer les formules traditionnelles
qui, seules, sont adquates. On peut trouver que sa description est pittoresque :
elle se propose uniquement dtre efficien te.
Lefficacit des formules est aussi le but premier des po sies chantes au
cours des crmonies sacres. Dclarer banales les odes du Che king (dont
les thmes ont t repris
62
indfiniment par la posie religieuse), cest ne pas
les comprendre : elles ne sont pas moins riches que toute autre pice en
vigueur descriptive et en nuances de sentiments. Pour confrer la majorit,
utilisant la puissance de ralisation que possdent les formules convenues, on
souhaite au jeune noble (on le rend capable) darriver au grand ge o les
sourcils sallongent , o les cheveux jaunissent (
76
). Ce sont l des vux
tout concrets, dont les retentissements sont infinis. Chaque fois quon les
formule, ils veillent une motion singulire. Un pote, qui, par exemple, veut
porter bonheur au prince de Song (
77
) utilisera les mmes centons. En sus de
la puissance bnficiente quil conserve entire et dun air de grandeur
impersonnelle dont le pome tire son envol lyrique, le thme des cheveux
jaunissants et des longs sourcils peut servir parfaitement (les gloses
laffirment) expri mer un vu empreint dune effusion tout intime et particu -
laris par lintention la plus dtermine. Il ne convient pas que la prire, le
Marcel GRANET La pense chinoise 43
vu, le commandement aient lair de trop se particulariser. Ils perdraient en
efficace ce quils semble raient gagner en prcision. Au contraire, les formules
strotypes dont le pouvoir de suggestion concrte est indfini, ont la force
de signaler, par quelque prolongement secret, les nuances les plus fines du
dsir : celles-l mmes qui, en termes analytiques, seraient inexprimables. Les
pomes du Che king qui sont crits dans la langue la plus proverbiale sont
assurment ceux (lopinion publ ique en fait foi) o se sont signifies les
penses les plus subtiles. La mme rgle vaut pour les uvres de tous les
temps, de tous les genres. Les posies les plus riches en expressions
consacres sont les plus admires. Dans aucune, les formules convenues ne se
pressent autant que dans ces sortes de mditations mystiques (
78
) o le lyrisme
chinois donne sa note la plus haute. La densit en centons ne mesure pas
seulement le savoir traditionnel du pote : la densit la plus forte est la marque
de la pense la plus profonde.
Les formes anciennes de limprovisation lyrique font comprendre la valeur
demblmes que possdent les dictons potiques, leur puissance de
suggestion, leur vigueur descriptive. Le fait essentiel noter est que le rle
des centons nest pas moins grand dans la prose que dans la posie, dans
63
le
style savant que dans la langue vulgaire. Lhistorien parat avoir pour tche de
noter des faits singuliers. Il est vrai quau moyen de noms et de dates il situe
les vnements. Mais il y a, pour localiser, dater, nommer, des formes
convenues ; elles seules, elles impliquent une sorte de sentence : lhisto rien a
dj port un jugement quand il semble commencer un rcit. Ce rcit, du reste,
ne sera quune suite d e jugements, rendus au moyen de formules consacres
et, par suite, dcisifs. Confucius fut un matre dans le savant emploi de ces
formules ; aussi russit-il montrer ce que sont les rites et lquit : tel est
lidal de lhistorien, au dire de Sseu -ma Tsien, qui sy connaissait (
79
).
Cependant le mme Sseu-ma Tsien a compos des narrations qui donnent aux
Occidentaux limpression dune photographie merveilleusement nette , tel
par exemple le passage des Mmoires historiques o il fait voir comment
limpratrice Lu se vengea dune rivale (
80
). Il serait ais de montrer que, faite
dlments folkloriques, cette narration est entirement crite laide
dexpressions strotypes. Le cas est si peu exceptionnel quun lecteur
attentif des Annales chinoises hsite constamment : veut-on lui prsenter des
faits particuliers, singulariss, ou lui apprendre ce quil convient de faire ou de
ne pas faire ? La rdaction en termes rituels sexplique -t-elle simplement par
un parti pris de stylistes ou bien lhistoire na -t-elle conter quune succession
dincidents rituels ? Il ny a pas dcider : en fait, le got des formules toutes
faites nest que lun des aspects dune adhsion gnrale une mora le
conformiste. Des expressions proverbiales peuvent servir tracer le portrait
physique et moral de personnages dont lidal constant fut de marquer leur
ressemblance avec tel ou tel hros typique. Elles peuvent encore servir
relater les vnements de faon adquate si les actions des hommes cherchent
toujours se couler dans les formes du crmonial. Les biographies passent
juste titre pour tre les parties les plus vivantes et les plus instructives des
Marcel GRANET La pense chinoise 44
Annales chinoises. Il y a de grandes chances que, pour la plupart, elles
drivent dloges funbres (
81
). Il est certain, en tout cas, quelles parais sent
dautant mieux russies quelles sont plus riches en centons. Lun des
morceaux dhistoire les plus vants, la bio graphie de Kouan tseu par Sseu-ma
Tsien, nest quun
64
discours chinois , une mosaque de proverbes. On y
trouve, de faon clatante, le mrite premier des rcits historiques : elle
enseigne des attitudes. On devine dj, je suppose, que, de tous les auteurs,
ceux qui devront au plus haut degr possder le gnie du proverbe, ce sont les
philosophes. Mais (et cest l un fait remarquable), le gnie du proverbe est
indispensable, non pas aux seuls tenants de la tradition orthodoxe : il lest
aussi, il lest surtout aux matres de la pense mystique, c eux dont lobjet est
dexprimer lindicible. Cest laide de dictons quils notent les sentiments les
plus fugaces dune exprience extatique quils prsentent cependant comme
tant dordre strictement individuel. Chez Lao tseu ou Tchouang tseu,
leffus ion mystique se traduit au moyen de locutions traditionnelles, tout
fait analogues aux auxiliaires descriptifs dont jai marqu plus haut le
caractre proverbial tout en signalant leur pouvoir indfini de suggestion.
Comme les annalistes, les philosophes chinois sont des conteurs
dhistoriettes. Dans les ouvrages de tous genres, on trouve, utilises satit,
les mmes anecdotes, si bien quun lecteur occidental lisant pour la
premire fois une uvre chinoise prouve presque immanquablement une
impression de dj lu. Les anecdotes diffrent parfois par quelques dtails
darrangement ou de style ; parfois les thmes subsistent seuls, le paysage,
temps et lieu, et les personnages variant ; le plus souvent, elles sont reprises
textuellement, et leur forme parat strotype. Les critiques en ce cas parlent
volontiers demprunt. Ils affirment, par exemple, quun certain lot danecdotes
commun au Tchouang tseu et au Lie tseu provient dune contamination des
deux ouvrages (
82
). En ralit, il nest mme pas sr que lemploi dun mme
matriel dexpressions prouve une communaut de doctrine ou de pense. Une
mme anecdote, conte dans les mmes termes, peut servir dfendre des
opinions trs diverses. Quand il parle de ces singes qui, condamns par un
leveur appauvri un rgime moins abondant, refusrent, indigns, un dner
fait de quatre taros et un djeuner rduit trois, puis mangrent avec
satisfaction quatre taros le matin et trois le soir, Lie tseu se propose de
rabaisser lorgueil humain et de mettre en vidence les analogies profondes
qui existent
65
entre lhomme et lanimal. La mme fable, sans le moindre
changement, dfend, dans Tchouang tseu, la thse que tout jugement est
subjectif ; cest l un fait heureux : si lon sait mettre profit la variabilit des
jugements, qui peut, par bonheur, aller jusqu labsurde, on tient le moyen de
dresser les singes et de gouverner les hommes (
83
). Chaque auteur, pour
affabuler sa pense, emprunte la tradition, mais il suffit que diffre lesprit
des dveloppements o elle est insre pour que lhistoriette traditionnelle
semploie pro voquer les mouvements de pense les plus divers. Les anec-
dotes strotypes forment un fonds o puisent les auteurs les plus originaux.
Marcel GRANET La pense chinoise 45
Le succs de ces fables tient la puissance neutre qui se dgage delles : elle
est, comme dans le cas des simples formules et aussi des mots, dautant plus
active que, par leur dehors, ces fables sont dapparence plus commune. Il
sagit moins, en effet, de leur faire exprimer des ides, une par une, que
dutiliser leur prestige afin de pourvoir dauto rit le dveloppement tout
entier. Elles ont pour vertu non de dfinir, dans ses lments, la pense, mais
de laccrditer dans son ensemble. Elles disposent lesprit accepter une
suggestion. Elles ne font pas pntrer en lui, dans un ordre logique, des ides
dtermines ds labord. Elles mettent en branle limagination et la rendent
docile, tandis que le mouvement gnral du dveloppement linvite
sacheminer dans une direction dfinie. La pense se propage (plutt quelle
ne se transmet) de lauteur au lecteur (disons plutt du matre au disciple ;
disons mieux : du chef au fidle) sans quon mnage ce dernier la moindre
conomie defforts, sans que, dautre part, on lui laisse la moindre facilit
dva sion. Il nest pas appel accepter les ides, dans leur dtail et leur
systme, aprs avoir t admis les contrler analytiquement. Domin par une
suggestion globale, il se trouve apprhend dun seul coup par un systme
entier de notions.
Le lot danecdotes donnant autorit aux ides, loin daller se diversifiant, a
tendu se rduire, cependant que chaque historiette plaisait davantage
exprime en termes immuables. On comprend fort bien que le parti pris
dveiller la pense et non de linformer prsentait de grands avantages tant
dans la vie de Cour que dans lenseignement des sectes. Dans ces milieux,
lessentiel est de sentendre mots couverts,
66
daccrotre lesprit de finesse,
de dvelopper lintuition. Au reste, dans les rapports entre personnes, grce
la mimique qui accompagne les formules et lart quon peut mettre dta -
cher les mots, les suggestions les plus prcises peuvent sinsi nuer dans la plus
neutre des formules. Mais le fait significatif est que la littrature crite sest
accommode dun fonds res treint dhistoriettes schmatises, quelle a tendu
les rduire en nombre et rduire chacune delles un simple dicton de forme
invariable (
84
). Au lieu de raconter, avec tout un dtail anecdotique que,
danseur un pied (yi tsiu) Kouei suffisait lui seul (yi tsiu) animer dun
mouvement irrsistible les sauteries sacres de la Cour royale, on a prfr,
dans tel on tel dveloppement, se borner crire Kouei yi tsiu ou mme
voquer le nom de Kouei. On signalait ainsi soit quil suffit dun ministre
bien choisi pour conduire efficacement les affaires de ltat, soit quun
unipde nest point surpass dans lart de se m ouvoir par les tres sans pattes
ou les millepieds. Et lun ou lautre sens simposait selon que le dvelop -
pement densemble visait veiller lide, tantt quen vertu de lquivalence
des divers tats de nature lefficace rsulte de la simple conserva tion des
caractres naturels, tantt et loppos quune stricte convenance la fonction
est le vrai principe de lefficace (
85
). Lide, dans les deux cas, tire sa force
dun mme thme mystique li une pratique rituelle. La danse sur un pied
est lun des grands devoirs du chef ; charg de fconder la nature, il provoque
en dansant la monte de la sve (
86
). On le voit, lautorit dun complexe
Marcel GRANET La pense chinoise 46
mythique li un systme de pratiques rituelles demeure, intacte et multiple,
dans le centon o ce complexe tend se cristalliser.
Ainsi le schme mythique, le thme littraire, le mot lui mme ont pu
conserver, dans sa fracheur, la plasticit omnivalente des emblmes, mme
quand, sans le secours direct de la mimique, ils sont employs par la littrature
crite. Varie, puissante, raffine, cette littrature se soucie peu des formes
discursives. La prose la plus savante conserve le mme idal que la posie la
plus archaque. Elle prfre les symboles qui parlent avec le plus dautorit.
Peu importe sils ne peuvent gure voquer des concepts clairs et distincts ;
lessentiel, cest quils suggrent avec force et entranent
67
ladhsion. La
parole crite (aide par lcriture emblma tique) veut dabord retenir la pleine
efficacit de la parole vivante ; elle sapplique conserver le pouvoir des
chants quune mimique rituelle accompagne.
Marcel GRANET La pense chinoise 47
II. Les rythmes
La mimique et le rythme sont, avec lemploi des auxiliaires descriptifs, les
grands moyens daction dont dispose un orateur chinois. Mme dans la prose
crite, le rythme nest pas moins essentiel quen posie. Cest le rythme qui lie
le discours et permet de comprendre.
De mme que les mots, vocables ayant une apparence de racines, figurant
dans les locutions, simplement juxtaposs, sans quaucun deux soit
sensiblement modifi dans sa forme par lemploi qui en est fait ou par son
contact avec les mots voisins, de mme les historiettes, auxquelles on
conserve volontiers leur rdaction traditionnelle, se succdent dans un ouvrage
sans quon prouve le besoin de marquer leurs con nexions ; de mme encore
les formules strotypes quon aligne en vue de former une phrase se su ivent
sans sinfluen cer lune lautre et comme disposes sur le mme plan. Tous les
lments du discours semblent, intangibles dans leur forme et isols dans la
composition, conserver une sorte dindpendance jalouse. Les formules,
lments de la phrase, ne comprennent quun petit nombre de mots. Rien,
sinon leur position, ne dtermine le rle et les rapports de ces derniers ; encore
la rgle de position nest -elle point valable en tous les cas ; la valeur
syntactique des mots nest alors aper ue que lorsquon a dabord saisi le sens
global de la formule : ce sens sapprhende dun coup, mais condition que la
formule soit brve. Ces brves sentences, au contraire, se trouvent runies
parfois en assez grand nombre dans une seule phrase. Elles sont simplement
places bout bout spares, en certains cas, par des termes qui mritent le
nom de ponctuations orales. Ils notent diffrents types dar rt de la pense
plus quils ne signalent des modes divers de liaisons et de rapports. Isoles par
eux, plutt que raccordes, les formules forme fixe se succdent,
ressemblant beaucoup moins des propositions qu des locutions
adverbiales.
68
Dans le chinois crit (si on le lisait simplement des yeux) rien
le plus souvent ne ferait distinguer, titre de dominante, une locution parmi
les autres ; on napercevrait pas non plus, de faon claire, les subordinations
diverses de ces dernires. Il faut, pour comprendre, que la voix ponctue et
trouve le mouvement de la phrase.
L est la raison pour laquelle, ds lantiquit, lenseigne ment a consist
dans une rcitation scande faite par le matre, reprise par les lves. Ceux-ci
taient entrans couper les phrases des auteurs daprs le sens (
87
). Cet
apprentissage se renouvelait pour chaque auteur, ou presque, et toujours par
lunique procd de la rcitation scande, sans aucun exercice comparable
lanalyse grammaticale ou logique (
88
). Pour trouver le sens, lessentiel est
donc de connatre la ponctuation. Il semble (on limaginerait volontiers) que,
pour faciliter la lecture, les Chinois auraient d, de trs bonne heure, songer
diter des livres ponctus. En fait, il leur a fallu plus de temps pour sy
Marcel GRANET La pense chinoise 48
rsoudre que nen ont mis, pour sen aviser, les peuples crivant une langue
o il ny a gure de difficults discerner la fin des phrases. Et mme, il y a
peu dannes, ils r servaient encore leur gnie typographique linvention de
signes (parfois multicolores, dans les ditions de luxe) servant pointer, dans
des textes sans ponctuation, les passages importants et les mots remarquables.
Ces pratiques sont significatives. Elles montrent que, dans cet exercice de
lesprit quest la lecture, ce qui importe cest de ne point mnager les efforts
du lecteur, et, peut-tre encore, dobtenir que, nayant point conomis sa
peine, il accorde avec plus dabandon, son admiration ou son assentiment.
Dans les confrences sotriques ou mme dans les simples palabres, lobjet
premier de lorateur est de glisser dans un amas de formules riches de
sollicitations neutres et pressantes une locution ou un verbe agissant, dont le
vulgaire ne mrite point de deviner la force prcise et les dessous, mais quon
voudra bien, peut-tre, signaler aux esprits veills par tel geste ou tel dbit
convenus. De mme, lcri vain, ses exgtes et ses diteurs, sils peuvent
consentir marquer les mots actifs et les locutions dominantes, sinter diront
dindiquer les mouvements de dtail et les articulations
69
secrtes de la
pense. Celle-ci, dans sa pleine richesse, sera communique au seul lecteur
qui, si son esprit sveille au signal puissant et fu rtif quune formule ou un
verbe lui auront fait entendre, pourra, par un effort comparable celui dun
adepte cherchant linitiation, pntrer lessence rythmique de la phrase.
Pour composer en chinois, il ny a pas (puisque cette lan gue sest refuse
demander tout appui une syntaxe varie et prcise) dautre moyen que de
recourir la magie des rythmes. On ne peut arriver sexprimer quaprs un
apprentissage o lon sest entran employer, dans leur pleine efficacit,
non seulement des formules proverbiales, mais encore des rythmes consacrs.
Les uvres chinoises se rpartissent en genres, que la critique indigne
considre comme nettement tranchs. Ce qui dtermine le classement, cest le
type de linspiration (qui parat solidaire dune attitu de morale dfinie) et, en
mme temps, le systme rythmique : ce dernier parat simposer la manire
dune attitude densemble et correspondre une certaine faon denvisager le
monde et la vie. Par exemple, tous les fou anciens qui sont prsents comme
des mditations lgiaques tmoignent dune propension une certaine qualit
deffusion mystique ; ce type dinspiration se traduit rythmiquement par une
espce de soupir obligatoirement plac en csure dans chaque verset. Le
rythme particulier aux fou pourrait, assurment, tre caractris par bien
dautres rgles. Nul na jamais prouv le besoin de les dfinir : on apprend
composer un fou, non pas en se faisant enseigner le dtail des rgles, mais en
sentranant saisir lessence rythmique du genr e. Cette essence est tenue
pour significative dun mode particulier dactivit spirituelle. Elle nest pas
susceptible de se transmettre par voie dialectique. Ni lentente dune certaine
langue, ni le sens de la langue, ni lentente de certains rythmes, n i le sens du
rythme ne sauraient senseigner par chapitres au moyen dun cours de
rhtorique. Le gnie des sentences et le gnie des rythmes nont point pour
Marcel GRANET La pense chinoise 49
objet dorner et de diversifier le dis cours. Tous deux se confondent toujours
avec une puissance dinspiration elle -mme indistincte dun savoir
traditionnel.
70
Ces caractres de lapprentissage littraire se comprennent, ainsi que
limportance du rythme et le succs de certains rythmes, ds quon connat les
conditions anciennes de linvention lyri que. Sur ces conditions, certaines
chansons du Kouo fong, malgr les remaniements, renseignent assez bien.
Linvention des sentences potiques dont elles sont formes est due une
improvisation traditionnelle ; celle-ci correspond une vritable preuve de
savoir quon impose aux jeunes gens, au moment de leur initiation.
Linitiation se fait au cours de ftes saisonnires. Formant des churs qui
rivalisent en chantant, les garons et les filles se font vis--vis et se rpondent
tour tour. Chacune des rpliques changes forme un vers ou plutt un
distique ; un couplet est fait ds que deux distiques ont t changs. Les cou-
plets suivants ne comportent gure que des variantes des deux thmes qui
sopposent dans le premier couplet (
89
). Dordinaire, lun de ces thmes
enregistre un signal donn par la nature, lautre donne la formule des gestes
par lesquels les humains rpondent ce signal. Cet change de rpliques rend
manifeste la solidarit tablie par la fte entre tous les acteurs quy dlguent
la socit et la nature. Mis en correspondance par leur symtrie, les thmes
(thme humain, thme naturel) acquirent une valeur demblmes : ils
sappellent, ils se suscitent, ils se provoquent lun et lautre. Inhrent aux
sentences, le rythme est un des lments de leur efficace, car lquivalence
emblmatique des ralit voques par les distiques jumeaux est rendue
sensible par leur analogie rythmique.
Mais lanalogie rythmique a encore pour effet daccrotre la puissance des
emblmes : elle multiplie leurs affinits et leur pouvoir dvocation. Quand
arrive le terme des assembles quinoxiales, et que le Yang et le Yin, ces
principes, mle et femelle, de lalternance des saisons, sopposent et
sappellent pour jouter face fa ce, les signes mouvants qui prludent leurs
noces se multiplient dans le Monde. Ces signaux multiples sont repris en des
vers qui alternent par des churs opposs. Ils leur servent composer des
litanies jumelles, incantations accouples qui enchanent les volonts et font
concorder les dsirs (
90
). Les forces antithtiques dont lunion fait vivre
lunivers clbreront avec discipline leurs
71
noces quinoxiales, aussitt
quau son des tambourins dar gile les churs de danse , voquant le roulement
du Tonnerre et le grondement des Eaux, auront, dans une procession qui
pitine, lentement parcouru le paysage rituel, ou bondi, sans se lasser, sur le
tertre sacr. Tantt, dans les chansons, les thmes senchanent dans une
progression pitinante, et tantt, comme un refrain qui rebondit, un mme
thme est repris sans trve, peine nuanc par quelques variations. Que les
sentences se rptent ou saccumulent, un mme effet de martlement sajoute
pour discipliner les churs leur efficace premire (91).
Marcel GRANET La pense chinoise 50
Dans tous les genres, mme en prose, o, visant la noblesse et la force,
ils veulent agir en communiquant dabord le sentiment dun quilibre ordonn
et puissant (telles sont les caractristiques du style kou-wen, idal de la prose
savante), les auteurs chinois composent en employant de brves sentences
strictement balances et lies entre elles par lanalogie rythmique. Ils les
accumulent sans crainte de redondance, rptant parfois, comme un refrain,
une formule dominante qui prend la valeur dun motif central (et que nous
traduirions sous la forme dune proposition principale) ; ou bien encore, grce
de subtils procds de paralllisme, ils substituent un thme majeur des
formules apparentes : lide saccrot alors en force, sustente plutt que
diversifie par le dveloppement de ces variations thmatiques.
Le rythme, dans la prose chinoise, a les mmes fonctions que remplit
ailleurs la syntaxe. Les rythmes favoris de cette prose drivent de la posie
chorale. Cependant, elle utilise parfois des rythmes plus heurts, sinon plus
libres, qui, eux aussi, furent crs pour la posie. Les versets saccads, les
stances essouffles des fou sopposent aux vers ( che) et aux couplets rguliers
du Che king. Tandis que lon retrouve en ces derniers la majest lente des
danses densemble et la symtrie tranquille des chants choraux, les autres
portent la marque dune danse et dune musique toutes diffrentes.
Quelques-uns des fou les plus anciens accompagnaient des crmonies
desprit magique plutt que religieux (
92
). On sy proposait dvoquer les
mes (tchao houen), non pas comme
72
dans les crmonies rgulires du
culte ancestral, pour quelles vinssent prendre, ainsi quil se doit, possession
de leurs descendants, mais pour arriver, par leur intermdiaire, entrer en
contact avec un monde dnergie spirituelle : il sagissait dacqurir ainsi un
surcrot de vie, de puissance personnelle, de prestige magique, Le rite
essentiel de ces crmonies tait une danse des femmes, pouses du chef ou
sorcires. Nues et parfumes, elles attiraient et captaient les mes sduites, se
relayant pour tournoyer une fleur la main et se passant lme et la fleur au
moment o, les yeux pms, lasses de porter le dieu, lpuisement les jetait
terre. Cependant, tasss dans une salle close o ronflaient les tambours lgers
accompagns de cithares et de fltes aigus, les assistants, sentant souffler sur
eux le vent qui terrifie , entendaient slever des voix surnaturelles. Ces
gracieux sabbats ne sont pas des ballets moins bien rgls que les autres, mais
lvocation des esprits, haletante, ponctue de soupirs mourants, dappels
frntiques, forme un chant tumultueux o les formules consacres se heurtent
sur le rythme saccad propre aux jaculations mystiques.
Ce rythme est rest particulier au fou. On peut cependant penser que, bien
connu des crivains de lcole mystique, il na pas t sans influence sur leur
prose, plus varie, plus nerveuse. Dans cette prose, abondent, en effet, les
nuances rythmiques qui remplacent en chinois ce quon appelle les nuances de
la syntaxe. Elles servent organiser le discours. Elles servent encore
communiquer aux sentences une vibration particulire ; celle-ci, en les situant
Marcel GRANET La pense chinoise 51
dans un certain monde de lactivit mentale, qualifie leur inspiration et leur
confre une efficacit spcifique.
On ne comprend gure un auteur chinois tant quon na pas pntr les
secrets rythmiques au moyen desquels il signale et livre le fin mot de sa
pense. Aucun auteur, dautre part, narriverait se faire entendre sil ne
savait point utiliser la vertu des rythmes. Sur ce point, nul na jamais possd
la matrise de Tchouang tseu. Or, Tchouang tseu nous apparat comme le
moins impermable des penseurs chinois. Il donne, en mme temps et bon
droit encore, limpression quil est aussi le plus profond et le plus fin. Sa
puissance et
73
son aisance rythmiques semblent correspondre au libre jeu
dune intelligence toute concrte . Ne faut-il pas induire que, dans son
expression, la pense chinoise, ds quelle slve un peu haut, est de nature
strictement potique et musicale ? Elle ne cherche point pour se transmettre
sappuyer sur un matriel de signes clairs et distincts. El le se communique,
plastiquement et pour ainsi dire en dessous, non point de faon discursive,
dtail aprs dtail, par le truchement darti fices du langage, . mais en bloc et
comme en appariant des mouvements, induits, desprit esprit, par la magie
des rythmes et des symboles. Aussi, dans les coles o a fleuri la pense la
plus profonde, a-t-on pu se proposer comme idal denseignement vritable et
concret un enseignement sans paroles (
93
).
*
* *
Le chinois a pu devenir une puissante langue de civilisation et une grande
langue littraire sans se soucier plus de richesse phontique que de commodit
graphique, sans davantage chercher crer un matriel abstrait dexpression
ou se munir dun outillage syntactique. Il a r ussi conserver aux mots et
aux sentences une valeur emblmatique entirement concrte. Il a su rserver
au rythme seul le soin dorganiser lexpression de la pense. Comme sil
prtendait, avant tout, soustraire lesprit la crainte que les ides ne
devinssent striles si elles sexprimaient mcaniquement et de faon
conomique, il sest refus leur offrir ces instru ments commodes de
spcification et de coordination apparentes que sont les signes abstraits et les
artifices grammaticaux. Il est demeur rebelle, obstinment, aux prcisions
formelles, par got de lexpression adquate, concrte, syn thtique. La
puissance imprieuse du verbe entendu comme un geste complet, ordre, vu,
prire et rite, voil ce que ce langage a fait effort pour retenir, dlaissant sans
peine tout le reste. La langue chinoise napparat point organise pour noter
des concepts, analyser des ides, exposer discursivement des doctrines. Elle
est tout entire faonne pour communiquer des attitudes sentimentales, pour
suggrer des conduites, pour convaincre, pour convertir.
Marcel GRANET La pense chinoise 52
74
Ces traits ne paratront pas sans intrt, si lon noublie point que le
chinois est la langue de civilisation ou, si lon veut, linstrument de culture qui
a support le plus aisment la plus longue mise lpreuve.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 53
L I V R E D E U X I M E
L E S I D E S D I R E C T R I C E S
75
Un Chinois, surtout sil est philosophe et prtend ensei gner, na jamais
recours pour traduire le dtail de ses opinions quaux seules formules dont un
lointain pass garantit lefficace. Quant aux notions qui semblent destines
ordonner la pense, elles sont signales chez tous les auteurs par des symboles
qui, plus que tous les autres, paraissent dous dune efficace indtermine.
Rebelles par cela mme toute abstraction, ces symboles notent des ides
directrices dont le mrite principal tient leur caractre de notions synth-
tiques. Elles jouent le rle de catgories, mais ce sont des catgories
concrtes.
Rien, chez aucun Sage de lAncie nne Chine, ne laisse entrevoir quil ait
jamais prouv le besoin de faire appel des notions comparables nos ides
abstraites de nombre, de temps, despace, de cause... Cest, en revanche,
laide dun couple de symboles concrets (le Yin et le Yang) q ue les Sages de
toutes les coles cherchent traduire un sentiment du Rythme qui leur
permet de concevoir les rapports des Temps, des Espaces et des Nombres en
les envisageant comme un ensemble de jeux concerts. Le Tao est lemblme
dune notion plu s synthtique encore, entirement diffrente de notre ide de
cause et bien plus large : par elle, je ne puis dire : est voqu le Principe
unique dun ordre universel ; je dois dire : par elle, est voqu, dans sa
totalit et son unit, un Ordre la fois idal et agissant. Le Tao, catgorie
suprme, le Yin et le Yang, catgories secondes, sont des
76
Emblmes
actifs. Ils commandent tout ensemble lordon nance du Monde et celle de
lEsprit. Nul ne songe les dfi nir. Tous leur prtent, en revanche, une qualit
defficace, qui ne semble pas se distinguer dune valeur rationnelle.
Ces notions cardinales inspirent aux Chinois une confiance unanime. La
plupart des interprtes dOccident voient cependant en elles les produits de
telle ou telle pense doctrinale. Ils les traitent comme des conceptions
savantes, susceptibles, par suite, dtre dfinies ou qualifies abstrai tement. Ils
Marcel GRANET La pense chinoise 54
commencent, en gnral, par leur chercher des quivalents dans la langue
conceptuelle de nos philosophes. Ils aboutissent dordinaire, ds quils les ont
prsents comme des entits scolastiques, des dclarer tout ensemble
curieuses et sans valeur. Elles leur paraissent tmoigner du fait que la pense
chinoise ressortit une mentalit quon .peut (pour se servir dexpressio ns
toutes faites et qui soient la mode) qualifier de prlogique ou de
mythique (94).
Pour analyser ces notions, jai d me servir de thmes mythiques ou
rituels : cest que jai voulu mappliquer respecter ce qui fait leur originalit,
cest --dire, tout justement, leur qualit de notions synthtiques et efficaces.
Sans tenter de les dfinir ou de les qualifier, jai essay de recon natre leur
contenu et de faire apparatre leurs utilisations multiples. Lanalyse demandait
quelque minutie. Tant pis si elle peut paratre lente... Tant pis si elle exige
quelques dtours... Il ntait gure possible dindiquer le rle des notions de
Yin et de Yang sans dire dabord comment taient imagins le Temps et
lEspace. Il convenait aussi de rensei gner sur la conception que les Chinois se
font des Nombres auxquels ils attribuent surtout des fonctions classificatoires
et protocolaires, avant daborder avec la notion de Tao, catgorie suprme de
la pense, lanalyse des attitudes pro pres aux Chinois en matire de physique
et de logique. Le sujet imposait ce procd par approches successives. Cest le
seul qui permettait de faire sentir que les ides directrices de la pense
chinoise ont, bien que concrtes, valeur de catgories : leur qualit de notions
concrtes ne les empche nullement dintroduire dans la vie de lesprit, ou dy
signaler, un principe dorganisation et dintelligibilit.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 55
CHAPITRE Premier
Le temps et lespace
77
La pense, savante ou vulgaire, obit en Chine une reprsentation de
lEspace et du Temps qui nest point pure ment empirique. Elle se distingue
des impressions de dure et dtendue qui composent lexprience
individuelle. Elle est impersonnelle. Elle simpose avec lautorit dune cat -
gorie. Mais ce ne sont pas comme des lieux neutres que le Temps et lEspace
apparaissent aux Chinois : ils nont point y loger des concepts abstraits.
Aucun philosophe na song concevoir le Temps sous laspect dune
dure monotone constitue par la succession, selon un mouvement uniforme,
de moments qualitativement semblables. Aucun na trouv intrt considrer
lEspace comme une tendue simple rsultant de la juxtaposition dlments
homognes, comme une tendue dont toutes les parties seraient superposables.
Tous prfrent voir dans le Temps un ensemble dres, de saisons et
dpoques, dans lEspace un complexe de domaines, de climats et dorients.
Dans chaque orient, ltendue se singularise et prend les attributs particuliers
un climat ou un domaine. Paralllement, la dure se diversifie en priodes de
natures diverses, chacune revtue des caractres propres une saison ou une
re. Mais, tandis que deux parties de lEspace peuvent dif frer radicalement
lune de lautre et, de mme, deux por tions du Temps, chaque priode est
solidaire dun climat, chaque orient li une saison. A toute partie
individualise de la dure correspond une portion singulire de ltendue.
78
Une mme nature leur appartient en commun, signale, pour toutes deux, par
un lot indivis dattribut s.
Une re, un monde, nouveaux tous deux, se trouvrent constitus, sitt
que, manifestant la vertu des Tcheou, apparut un corbeau rouge. Le rouge
(parmi dautres emblmes) caractrise lpoque des Tcheou, lEmpire des
Tcheou, et il caractrise encore lt comme le Sud (
95
). La vertu de
sociabilit (jen) est un attribut lEst. Un ethnographe qui entreprend de
dcrire les murs des contres orientales, constate, pour commencer, quil y
rgne une exemplaire bont. Aussitt, il conte la fin du plus fameux hros de
ces rgions. Ctait un tre sans rigidit aucune, dpourvu dos, tout en
muscle, et il prit pour la raison justement quil tait trop bon. Les muscles
ressortissent lEst, comme le foie et la couleur verte, qui est la couleur du
printemps ; cest la saison o la nature manifeste sa bont, vertu de
lOrient (96). Les bossus, ainsi que les montagnes, abondent lOuest quils
qualifient, de mme que la hotte des rcoltes voque lAutomne. Une bosse
est une excroissance de peau ; la peau dpend du poumon, le poumon de
lautomne et de mme la couleur blanche. Mais qui dit peau, dit cuir, et
Marcel GRANET La pense chinoise 56
cuirasse, cest --dire guerre et punition. Aussi les barbares dOccident sont -ils
taxs dhumeur bataill euse, cependant que les excutions, pnales ou
militaires, sont rserves lAutomne et que, remarquable par ses poils
blancs, le gnie des chtiments rside lOuest. Les poils tiennent de la peau
et le blanc est lemblme significatif de lOuest et de lAutomne, comme il
lest de lpoque des Yin. Celle -ci fut inaugure, caractrise par le rgne de
Tang le Victorieux, hros clbre par les chtiments quil infligea et par la
faon quil avait de marcher le corps tout courb (
97
).
Ces exemples suffiront montrer quayant localiser dans le Temps et
lEspace, non pas des concepts dfinis et dis tincts, mais des emblmes riches
daffinits, les Chinois navaient aucune disposition concevoir, comme deux
milieux indpendants et neutres, un Temps abstrait, un Espace abstrait. Pour
abriter leurs jeux de symboles, ils avaient tout au contraire avantage
conserver aux reprsentations lies dEspace et de Temps, avec un maximum
dattributs con crets, une solidarit favorable lin teraction des emblmes.
79
Tant quon ne voit pas, dans lEspace et le Temps, deux concepts
indpendants ou deux entits autonomes, ils peuvent constituer un milieu
daction qui est aussi un milieu rceptif. Discontinus et solidaires, ils affectent
conjointement des qualits, tout en recevant ensemble des dterminations.
Toute localisation, spatiale ou temporelle, suffit ds lors particulariser, et de
mme il est possible dimposer au Temps comme lEspace tels ou tels
caractres concrets. On peut agir sur lEspace laide demblmes temporels ;
sur le Temps, laide demblmes spatiaux ; sur tous deux la fois, au moyen
des symboles multiples et lis qui signalent les aspects particuliers de
lUnivers. Un guitariste veut -il, en plein hiver, faire revenir lt ? Il lui suffit,
sil connat bien son art, de faire rsonner celle des notes de la gamme qui est
lemblme de lt, du Rouge, du Midi (
98
). Pour capter dans sa force
lnergie mle du Yang, on doit faire face au Midi ; un sage gnral (peu
importe la route quil donne suivre son arme) sait toujours recueillir cette
nergie : il na besoin pour cela que de faire dployer lavant -garde la
bannire de lOiseau Rouge (
99
).
Le Temps et lEspace ne sont jamais conus indpendamment des actions
concrtes quils exercent en tant que complexes demblmes solidaires,
indpendamment des actions quon peut exercer sur eux au moyen
demblmes appels les singulariser. Les mots che et fang sapp liquent, le
premier toutes les portions de la dure, le second toutes parties de
ltendue, mais envisages, chaque fois, les unes comme les autres, sous un
aspect singulier. Ces termes nvo quent ni lEspace en soi, ni le Temps en soi.
Che appelle lide de circonstance, lide doccasion (propice ou non pour une
certaine action) ; fang, lide dorientation, de site (favo rable ou non pour tel
cas particulier). Formant un complexe de conditions emblmatiques la fois
dterminantes et dtermines, le Temps et lEspace sont toujours imagins
comme un ensemble de groupements, concrets et divers, de rites et
doccasions.
Marcel GRANET La pense chinoise 57
Ces groupements sont lobjet dun savoir qui, par la ma tire sur laquelle il
sexerce, tout comme par ses fins prati ques, se distingue des sciences de
ltendue et de celles de la dure. On a longtemps admir les anciens Chinois
pour leur
80
chronologie astronomique. On a aujourdhui tendance affirmer
quils reurent tardivement de ltranger leurs pre mires notions gomtriques
et tout ce quil y a de prcis dans leur astronomie (
100
). Il ny a pas lieu ici
dentrer dans un dbat ou le manque dinformations se fait sentir cruelle ment.
Il suffira de noter, dune part : que les techniques chinoises auraient
difficilement atteint la perfection quon y constate, si elles ne staient pas
appuyes sur des connaissances gomtriques lmentaires ; dautre part, que
la spculation philosophique sest toujours complu, sinon borne, partir dun
savoir dont lobjet est de classer, en vue de laction et en raison de leurs
efficacits particulires, les sites et les occasions. Cest en ratiocinant sur ce
savoir que les Sages ont espr dcouvrir les principes dun art suprme.
Lobjet de cet art, qui tient lieu d e physique comme de morale, est damnager
lUnivers en mme temps que la Socit. Ces proccupations dernires des
philosophes permettent dentrevoir le caractre fondamental des ides
chinoises relatives lEspace et au Temps. Les reprsentations collec tives
dont elles drivent ne sont que la traduction des principes qui prsidaient la
rpartition des groupements humains : ltude de ces reprsentations se
confond avec une tude de morphologie sociale.
*
* *
La vertu propre du Temps est de procder par rvolution. Cette nature
cyclique lapparente au rond et loppose lEspace, dont le premier caractre
est dtre carr. Telles sont, si je puis dire, les formes pures de la dure et de
ltendue. Les formes intermdiaires, combinaisons du rond et du carr, tel
par exemple, loblong (101), ne sont, chacune, que le symbole dune
interaction particulire de lEspace et du Temps. On a vu que la convexit des
montagnes et des dos arqus est lemblme dune tendue de caractre
automnal : tout Espace est inform en raison de sa liaison avec une espce de
Temps. Mais lEspace, en principe, est carr : toute surface, donc, est, en soi,
carre (si bien que pour donner la dimension de la zone claire par la lumire
que produit, par exemple, un grand flambeau, il
81
suffira dindiquer la
dimension dun de ses quatre cts) (
102
). La Terre, qui est carre, se divise en
carrs. Les murs extrieurs des principauts doivent former un carr et de
mme les murailles des villes quils e nglobent, les champs et les camps
tant carrs eux aussi (
103
). Chaque ct de la Terre correspond un orient.
Camps, btisses et villes, de mme, doivent tre orients. La dtermination
des orients comme celle des sites [le mot fang (
104
), orient, site, a encore le
sens de carr et dquerre] appartient au Chef en tant quil prside les
assembles religieuses (
105
). Les techniques de la division et de
lamnagement de lEsp ace (arpentage, urbanisme, architecture, gographie
Marcel GRANET La pense chinoise 58
politique) et les spculations gomtriques quelles supposent (
106
) se
rattachent apparemment aux pratiques du culte public.
Les fidles, en effet, se formaient en carr. LAutel du Sol, autour
duquel se faisaient dordinaire les grands ras semblements, tait un tertre
carr ; son sommet tait recouvert de terre jaune (couleur du Centre) ; ses
cts (tourns vers les quatre orients), revtus de terres verte, rouge, blanche
ou noire. Ce carr sacr reprsente la totalit de lEmpire. On est pourvu
dun domaine ds quon sest vu attribuer une motte de terre, emprunte
lAutel du Sol. Cette motte sera blanche et prise lOuest si le fief octroy
appartient lOccident, verte sil est dans lEst (
107
). Mais que survienne, par
exemple, une clipse, et que les hommes sen inquitent comme dune menace
de destruction ! Les vassaux accourent au centre de la patrie : pour la sauver,
pour reconstituer, dans son intgrit, lEspace dtraqu (et le Temps comme
lui), ils se groupent et forment le carr. Ils russissent carter le danger si
chacun deux se pr sente avec les insignes qui expriment, si je puis dire, sa
nature spatiale et celle de son fief. Ce sera, pour ceux de lOrient, qui
salignent lEst, une arbalte, des vtements et un fanion verts (
108
).
LEspace se trouve restaur dans tou tes ses dimensions (et jusque dans le
domaine des Astres), par la seule force des emblmes correctement disposs
dans le lieu-saint des runions fdrales.
On voit que lide dune Terre carre, dun Espace carr apparat lie un
ensemble de rgles sociales. Lune delles, lordonnance des assembles, a d
jouer un rle dcisif pour
82
rendre sensible et imposer tous tout le dtail
des symboles qui constituent la reprsentation de lEspace. Elle explique la
forme carre, significative de ltendue. Elle explique encore le caractre
dhtrognit dont cette dernire est dote : les symboles des diffrentes
sortes dtendue se confondent avec les emblmes agissants des divers
groupes sociaux qui adhrent ces espaces. Mais ceux-ci ne se distinguent pas
uniquement par des particularits correspondant aux attributs des groupements
humains qui se partagent le monde. A ces diffrences spcifiques sajoute une
diffrence de valeur.
Ltendue ne reste point indfiniment elle -mme. Par-del les quatre cts
de lEspace, se trouvent, formant une sorte de frange, qu atre vagues rgions
quon nomme les Quatre Mers. Dans ces Mers diverses, habitent quatre
espces de Barbares. Ceux-ci, apparents diffrents animaux, participent
tous de la nature des Btes. Les Chinois les humains ne peuvent rsider
dans les Marches du Monde sans perdre tout aussitt leur statut dhommes.
Les bannis, quon veut disqualifier, revtent, ds quon les y expulse,
lapparence demi animale qui signale les tres de ces confins dserts (
109
).
LEspace inculte ne supporte que des tres imparfaits. Il nest quun espace
dilu, une tendue qui svanouit.
LEspace plein nexiste que l o ltendue est socialise. Lorsquun Chef
qui se charge damnager le monde pro mulgue ses ordonnances, par-del le
Marcel GRANET La pense chinoise 59
carr que, se pressant autour de lui, forment les fidles ; un carr plus vaste est
dessin par les chefs sauvages appels la crmonie pour y figurer la
Barbarie et les lointains vagues o lUnivers sestompe. Mais les Barbares des
Quatre Mers doivent saligner en de hors de lenceinte rituelle que les fidles
garnissent eux seuls, car, seuls, ils font partie dune socit constitue (
110
).
Ainsi se manifeste, ainsi stablit la hirarchie des tendues. Ltendue
nest entirement elle -mme, elle ne possde, si je puis dire, sa densit
intgrale que dans lenceinte o tous ses attributs se fdrent. Lemplacement
sacr des runions fdrales est un monde clos qui quivaut lEspace total et
lEspace entier. Il est le lieu o, regroupant l es
83
emblmes de ses
diffrentes fractions, le groupe social connat sa diversit, sa hirarchie, son
ordre et o il prend conscience de sa force une et complexe.
Cest l seulement o le groupe fdr prouve son union, que ltendue,
compacte et pleine, concentre, cohrente, peut paratre une. La Capitale, o
lon sassemble, doit tre choisie (aprs une inspection de ltendue) dans un
site qui satteste voisin de la rsidence cleste , dans un site qui, par la
convergence des rivires et la confluence des climats, savre comme le centre
du monde (
111
). Cest uniquement son voisinage que les mesures de distance
restent constantes l, pour apporter le tribut des quatre cts du monde, les li
de la route sont uniformes (
112
). Le Chef vit en un milieu dEspace pur o
ltendue est, en un sens, homogne, mais non parce quelle est vide
dattributs ; en ce point de convergence et dunion, lEspace se constitue dans
son intgralit, car il y reoit lensemble de ses attributions .
LEspace est tantt imagin comme compos de secteurs, espaces
singulariss correspondant chacun une saison, qui, se touchant par les
pointes, sunissent au centre dun carr ; tantt comme form de carrs
embots espaces hirarchiss que distingue, si lon peut dire, une
diffrente de tension plutt que de teneur (
113
). Ces carrs sont au nombre de
cinq ; au centre est le domaine royal ; aux confins, les marches barbares. Dans
les trois carrs mdians habitent les vassaux, appels la cour plus ou moins
frquemment en raison de la distance de leur domaine. Leur dignit, comme
celle de lespace o ils commandent, est exprime par la frquence de leurs
communions avec le Chef ; ils se rendent tous les mois, toutes les saisons ou
tous les ans, dans ce centre intact de lEspace quest la capitale ; l, le suzerain
leur dlgue un certain pouvoir danimation dont procde la qualit de
cohsion particulire leur domaine (
114
). Ce pouvoir danimation spatiale,
sil est appel sexercer dans une portion plus centrale et plus noble de
ltendue, doit aller se restaurer plus frquemment la source de toute
coexistence. La dignit des espaces rsulte dune sorte de cration rythme,
laptitude faire coexister qui sous -tend, pour ainsi parler, toute tendue, tant
fonction dune aptitude faire durer : lEspace ne se conoit pas
indpendamment du Temps.
Marcel GRANET La pense chinoise 60
84
La ncessit dune rfection priodique de lEspace nest pas moins
ncessaire quand il sagit dimprimer un caractre singulier ses diffrentes
portions. Le Roi passe quatre annes recevoir les visites des vassaux ; aprs
quoi, il rend les visites et parcourt les fiefs. Il ne peut manquer de faire un tour
dEmpire tous les cinq ans. Il rgle sa marche de faon se trouver dans lEst
lquinoxe de Printemps, au Sud au solstice dt, en plein Ouest au cur de
lAu tomne, au Nord plein au plein de lHiver. A chacune de ces stations
cardinales, le suzerain donne audience aux feudataires de lun des quatre
Orients. Assemblant autour de lui un quadrant de lEmpire, il tient dabord
une cour toute verte, puis une toute rouge, puis une blanche, puis une noire,
car il doit, en des temps et des lieux cohrents, vrifier les insignes qui
proclament et instaurent la nature propre chacun des quartiers de
lUnivers (
115
).
Le Chef sapplique amnager lEspace en adaptant les tendues aux
dures, mais la raison de sa circulation souveraine se trouve dabord dans la
ncessit dune reconstitution rythme de ltendue. La reconstitution
quinquennale ravive la cohsion quil a inaugure en prenant le pouvoir. A
chaque avnement, les cinq carrs embots qui constituent lEmpire refluent
la Capitale, o doit se recrer, pour un temps, lEspace entier. Le Roi uvre
alors les portes de sa ville carre et, expulsant les mchants aux quatre
frontires du monde, il reoit les htes des quatre Orients. Jusque dans les
lointains de lUnivers, il qualif ie les diffrents espaces. De mme quil les
singularise en distribuant des emblmes conformes aux sites diffrents, il les
hirarchise en confrant les insignes qui rvlent les dignits ingales (
116
).
Cest en classant et en r partissant temps rgls les groupes qui
composent la socit humaine que le Chef parvient instituer et faire durer
un certain ordre de lEs pace. Cet ordre peut tre qualifi de fodal ; il fut, en
effet, conu par une socit fodale, et cest, san s doute, parce que, dans son
fond, cette socit est demeure fodale que lEs pace na point cess dtre
imagin comme une fdration hirarchise dtendues htrognes.
Caractris par une sorte de diversit cohrente, il nest point partout le
mme. Il nest pas non plus toujours le mme. Il ny a quun Espace
85
vide
l o ltendue nest pas socialise, et la cohsion de ltendue va
diminuant (
117
) mesure que se dilue le souvenir des assembles fdrales o,
dans une enceinte sacre qui les runit temps rythms, les hommes arrivent
prter au monde une espce dunit, car cest alors que se reforge en eux
lorgueil dappartenir une socit qui forme un tout et semble une. Aussi, la
reprsentation dun Espace complexe, clos et instable, saccomp agne-t-elle
dune reprsentation du Temps qui fait de la dure un ensemble de retours,
une succession dres closes, cycliques, discontinues, compltes en soi,
centres, chacune, comme lest lEspace, autour dune espce de point
temporaire dmanation.
*
Marcel GRANET La pense chinoise 61
* *
Aucun philosophe chinois na voulu voir dans le Temps un paramtre. A
tous, ltendue apparat tantt dilue, tantt concentre. La dure nest pas non
plus imagine comme toujours gale elle-mme. La discontinuit quon lui
prte nest nullement l effet du cours variable de lactivit de les prit chez les
individus. Elle nest ni anarchique ni totale. Les Chinois dcomposent le
Temps en priodes comme ils dcomposent lEspace en rgions, mais ils
dfinissent chacune des parties composantes par un lot dattributs (
118
). Cette
dfinition est accepte par tous les esprits : chaque espce de Temps
correspond une notion impersonnelle, bien que concrte. Ce caractre concret
clate dans le fait que chaque priode est marque par les attributs propres
une saison de lanne, une heure du jour. Il ne faudrait point en conclure tout
de suite que les Chinois ont difi leur conception de la dure en se bornant
ne point distinguer le Temps (tout court) du temps quil fait ou du temps astro-
nomique. Les saisons nont fourni que des emblmes la conception chinoise
du Temps. Si elles ont t appeles les fournir, cest pour la raison que
(lEspace tant figur comme clos) le Temps paraissait avoir une nature
cyclique et que lanne, avec ses saisons, offrait l(image dun cycle ainsi que
des symboles propres caractriser des cycles divers.
La reprsentation chinoise du Temps se confond avec celle
86
dun ordre
liturgique. Le cycle annuel des saisons nen est pas le prototype. Cet ordre
embrasse un moment de lHis toire (dynastie, rgne, portion de rgne) que
distingue un ensemble de rgles ou, si lon veut, une formule de vie singu -
larisant cette poque de la civilisation. Dans ce corps de conventions figurent
dabord les dcrets dont procde, avec un amnagement particulier de
lEspace, un amnage ment particulier du Temps. La promulgation dun
Calendrier, dcret inaugural dun rgne, est lacte dcisif dune crmonie
davnement. Mais, avant que puisse sinstaller un ordre neuf du Temps, il
faut que lordre ancien soit dabord aboli. Toute tape de la dure suppose une
viction lie une cration. Il en est ainsi pour les diffrentes tapes de la vie
humaine (
119
). Une femme ne passe de ltat de fille ltat dpouse, un
homme ne sort de la vie pour entrer dans la mort, un nouveau-n nabandonne
le monde des anctres pour pntrer dans la portion vivante de la famille que
si des gestes de cong ont prcd les ftes dail. Initial en apparence, le rite
inaugural de la naissance, du mariage, de la mort, a la valeur dun rite central.
La puissance quil dgage e ntrane comme la propagation dune onde. En
avant comme en arrire et marquant, pour ainsi dire, les sommets dune srie
dondulations concentriques, des crmonies, que sparent des temps de stage,
concourent au mme rsultat que le rite central. Cette sorte de propagation
rythmique, qui commande lorganisation dun ensemble litur gique, est
signale par lemploi de certains nombres. Pour marquer la valeur entire de
toute liturgie, cest de lunit que lon part, car elle est lemblme du total ;
mais, comme il faut pouvoir la dcomposer, on lenvisage sous laspect de la
dizaine ou de la centaine. 10 peut se dcomposer en 3 + (2 + 2) + 3, 100 en
Marcel GRANET La pense chinoise 62
30 + (20 + 20) + 30. Aux deux bouts de la srie, 3 ou 30 indiquent la longueur
des priodes qui bordent immdiatement soit lentre, soit la sortie ;
7 [ = 3 + (2 + 2) ou (2 + 2) + 3], ou 70, celle des priodes liminaires ou
terminales (dont 50 ou 5 marquent parfois un moment important). Aussi les
termes des crmonies rparties autour dun geste central sont -ils le plus
souvent signals par les nombres 3 (=30), [5 (=50)] et 7 (=70), qui servent
rythmer le Temps (
120
). Les dures
87
proprement liturgiques ne sont point
les seules qui soient senties comme rythmes et comme totales. Le temps his-
torique ne parat pas constitu autrement. Les rudits, quand ils reconstruisent
le pass, ont la conviction datteindre la vrit chronologique ds quils
parviennent situer les faits dans les cadres rythmiques dune liturgie.
Chouen, sitt quil eut vcu trente ans, devint le ministre de Yao. A
cinquante ans, il exera le pouvoir quaprs une nouvelle crmonie son
matre lui cda. Il devait, aprs tre mont sur le trne, cder lui-mme la
direction de lEmpire un ministre -successeur. La rgle (conserve dans les
usages domestiques) est quun chef abandonne le pouvoir soixante -dix ans.
Pour que lhistoire part en tous points correcte, on aurait d nous dire que
Chouen, abandonnant le gouvernement soixante-dix ans, comme le fit Yao,
sut se rserver une retraite dont la dure fut de trente annes (comme avait
dur trente ans le temps pass, au dbut de la vie, hors de toute fonction), car
(souverain parfait et dont la vertu devait profiter cent gnrations de descen-
dants), Chouen vcut exactement cent ans. Lessentiel a t dit cependant,
puisque, sil nest pas indiqu pour Chouen dont la carrire, pour tout le reste,
est si rgulire, lge vridique de la retraite a du moins t donn pour
Yao (
121
). Portion de la dure en soi complte, un rgne, telle est du moins la
conviction des historiens, doit se prsenter avec une organisation rythme
identique celle dun ensemble liturgique.
Le rgne de Chouen mritait quon lui prtt la rgularit dune liturgi e
parfaite. Ce souverain est connu pour un exploit qui lui permit de renouveler
la dure. Il inaugura les temps nouveaux en procdant, pour commencer, une
crmonie dexpulsion. Il bannit, les relguant en marge du monde, des tres
quinfestait une vertu nocive : ctaient les rejetons dgnrs, les restes
malficients de dynasties dont le temps tait fini. Tout ordre prim de la
dure doit achever de svanouir dans les lointains vagues o ltendue se
dilue et se termine (
122
). Deux domaines ne peuvent rester contigus,
simplement spars par une frontire idale : il faut quun foss les isole.
Deux res ne peuvent se succder
88
sans quon ne marque une rupture de
continuit : ce sont deux cycles auxquels il est interdit de se compntrer. Un
cycle, cependant, quand il se trouve achev, nest point vou une destruction
dfinitive : il suffit quun ordre prim du temps soit mis hors dtat de
contaminer lordre rgnant.
Au moment mme o une dynastie chinoise proclamait son avnement en
promulguant le calendrier destin particulariser sa priode de domination,
elle prenait soin de distraire de lEmpire des fiefs destins aux rejetons des
Marcel GRANET La pense chinoise 63
dynasties dchues. Ces derniers taient chargs de conserver dans ces
domaines clos les rglements significatifs dun cycle rvolu de lhistoire (
123
).
De mme, on ne dtruisait pas les Autels du Sol des dynasties tombes : on se
contentait de les emmurer (
124
). Si la conservation de ces tmoins tait
juge ncessaire, cest que lon prvoyait un retour de fortune pour lordre de
civilisation dont ils conservaient le souvenir et, si je puis dire, la semence.
Des conceptions analogues se retrouvent dans les rgles du culte
ancestral (
125
). Seuls, les aeux appartenant aux quatre gnrations
immdiatement antrieures celle du chef du culte ont droit une place
rserve dans le temple domestique. Ils y sont reprsents par des tablettes
que lon conserve dans des chapelles orientes et disposes en carr. Sur ces
tablettes, qui conservent leur mmoire, leur nom personnel doit tre inscrit.
Aucun des noms des membres disparus de la famille ne peut tre repris dans la
parent tant que les tablettes qui les portent demeurent dans lune de ces cha -
pelles. Mais quand meurt le chef de culte et quil faut donner une place la
tablette de ce nouvel anctre, on doit liminer la tablette sur laquelle est inscrit
le nom de son trisaeul. Tout aussitt ce nom peut tre redonn un enfant de
la famille. Avec celui-ci reparat lune des vertus qui prsident lordre
domestique : cette vertu sest conserve dans la retraite du temple ancestral,
o elle effectuait une sorte de stage la prparant une renaissance, cependant
que quatre gnrations de chefs de famille se succdaient dans lexer cice de
lautorit.
De mme, quand ils font de lhistoire et mettent de lordre dans le pass,
les Chinois admettent que les dynasties se relaient au pouvoirs animes de
vertus diffrentes et se
89
succdant de faon cyclique. Tant que rgne lune
des cinq vertus qui peuvent caractriser une re, les quatre autres, destines
reparatre, se conservent par leffet dune sorte de quaran taine restauratrice.
Lide du retour cyclique des Cinq Ver tus souveraines nest, titre de thorie,
atteste qu partir des IVe -IIIe sicles av. J.-C. : elle inspirait ds ce temps
une entire confiance, car cest alors quelle servit de cadre aux rudits
empresss de reconstituer les antiquits nationales (
126
). Quant aux sentiments
dont cette ide procde, ils se retrouvent au cur danciennes donnes
mythiques. Lorsque Chouen expulsa les vertus primes, il les expdia dans
les marges de lUnivers, non pour les faire prir, nous dit-on, mais pour leur
permettre de se rnover. Tandis que lui-mme, vertu neuve et prte dominer,
prenait, au centre de lEspace humanis, possession dune capitale carre,
cest aux quatre frontires de ltendue quil logea, pour une longue
pnitence, des vertus provisoirement puises, lesquelles, tout justement, se
trouvaient tre au nombre de quatre (
127
).
La conception dun Temps qui se dcompose en res, compltes en
elles-mmes, tout autant que finies et en nombre fini, saccorde avec une
conception de lEspace qui dcompose un monde clos en une confdration de
secteurs. Toutes deux ont pour fondement une ordonnance fdrale de la
socit. Un suzerain, dont lautorit repose sur u n pouvoir de dlgation,
Marcel GRANET La pense chinoise 64
napparat point revtu dune Majest qui lui confre des pouvoirs indfinis. Il
a des pairs, et ceux-ci escomptent quils auront leur tour de domination. Le
pouvoir danimer le Temps et lEspace nest confr que pour une re dont le
terme viendra et dont le retour doit tre prvu, car le prestige dune dynastie
ou dun chef est soumis aux jeux rgls de la fortune fodale.
Les res dynastiques sont signales par les mmes lots demblmes que les
saisons et les orients. Le rythme saisonnier a-t-il inspir directement lide de
leur succession cyclique ? On ladmettra difficilement si lon songe lim -
portance de lide de Centre : elle joue un rle gal dans les reprsentations de
Temps et dans celles dEspace. Envisa ge du point de vue de ltendue, elle
correspond lide
90
de fdration. Elle parat lie, dautre part, une
conception liturgique de la dure : lordre liturgique qui caractrise une re et
a sa source dans un pouvoir rgulateur dessence finie parat maner dune
sorte de centre dmission que dterminent simultanment la proclamation
dun calendrier et linauguration dune capitale fdrale. Lide que toute
dure ne se conoit point sans un centre nest pas passe sans artifice des
units de temps de nature proprement sociale (comme le sont les res)
lanne, unit de dure conventionnelle, mais lie des donnes dexprience.
Il na t possible de lappliquer une dure dfinie par le cours des astres
quen vertu dune liaison prtablie des reprsenta tions de Temps et dEspace.
Une ancienne tradition (
128
) veut, on la vu, que les souve rains de jadis
aient fait priodiquement un tour dEmpire, commenant par le Levant et
suivant la marche du Soleil, de manire adapter exactement les Temps aux
Espaces. Ces souverains ntaient obligs dimiter le soleil que tous les cinq
ans. Une fois faite cette commmoration quinquennale de la promulgation du
calendrier, ils pouvaient, pendant quatre annes entires, demeurer dans leur
capitale. Ils indiquaient alors le centre de lEspace aprs en avoir trac les
pourtours. Ils avaient aussi dfini le cycle des saisons, tout en commmorant
la fondation dune re. Mais, au cours de leur circumambulation, ils navaient
pas pu fixer de centre lanne.
Daprs une autre tradition (
129
), une capitale ne mrite ce nom que si
elle possde un Ming tang. Le Ming tang constitue une prrogative
proprement royale et la marque dun pouvoir solidement tabli. Cest une
Maison du Calendrier, o lon voit comme une concentration de lUnivers.
difie sur une base carre, car la Terre est carre, cette maison doit tre
recouverte dun toit de chaume, rond la faon du Ciel. Chaque anne et
durant toute lanne, le souverain circule sou s ce toit. En se plaant lorient
convenable, il inaugure successivement les saisons et les mois. La station quil
fait, au deuxime mois de printemps, revtu de vert et plac au plein Est,
quivaut, puisquil ne se trompe ni sur le site ni sur lemblme , une visite
quinoxiale du Levant. Mais le chef ne peut poursuivre indfiniment sa
circulation
91
priphrique sous peine de ne jamais porter les insignes qui
correspondent au Centre et sont lapanage du suzerain. Aussi, qu and est fini le
troisime mois de lt, interrompt -il le travail qui lui permet de singulariser
Marcel GRANET La pense chinoise 65
les diverses dures. Il se vt alors de jaune, et, cessant dimiter la marche du
soleil, va se poster au centre du Ming tang. Sil veut animer lEs pace, il faut
bien quil occupe cette place royale et, ds quil sy arrte, cest delle quil
semble animer le Temps : il a donn un centre lanne. Pour permettre au
souverain dexercer son action centrale, il a fallu, entre le sixime mois qui
marque la fin de lt et le septime qui est le premier de lAutomne, instituer
une sorte de temps de repos que lon compte pour un mois, bien quon ne lui
attribue aucune dure dfinie (
130
). Il na quune dure de raison ; celle-ci
senlve rien ni aux douze mois ni aux saisons, et cependant elle est loin
dtre nulle : elle quivaut lanne entire, car cest en elle que parat rsider
le moteur de lanne.
Le Temps est constitu par la succession cyclique dres qui, toutes,
dynasties, rgnes, priodes quinquennales, annes elles-mmes, doivent tre
assimiles une liturgie et qui, toutes, mme lanne, ont un centre. On ne
reoit point dordre, en effet, liturgique ou gographique, temporel ou spatial,
sans supposer quil a, si je puis dire, pour garant, un pouvoir minent dont la
place, vue dans lEspace, parat centrale. Cette conception traduit un progrs
de lorganisa tion sociale dsormais oriente vers un idal de hirarchie et de
stabilit relative. La notion de centre dont limpo rtance accuse ce progrs est
loin dtre primitive : elle sest substi tue la notion daxe. Le rle jou par
cette dernire demeure sensible dans les calendriers de lge fodal o lon
voit que les jours environnant les deux solstices mritent un respect
particulier (
131
). Ce rle est plus sensible encore dans divers mythes desprit
archaque. En eux sest conserv le souvenir dune poque o la conception
dune ordonnance hirarchique de lEspace et du Temps tendait remplac er
une reprsentation de lUnivers et de la socit simplement fonde sur les
ides dopposition et dalternance.
Yao, sans songer visiter lEmpire ou circuler dans un Ming tang, mit
de lordre dans le monde en se bornant
92
envoyer aux quatre ples quatre
dlgus lastronomie ; Chouen russit, son tour, instaurer un ordre neuf
en se contentant dexpdier quatre bannis sur quatre monts polaires. Les
dlgus de Yao (
132
) taient les deux frres Hi et les deux frres Ho. Hi-ho est
le Soleil,. ou, plutt, la Mre des Soleils qui sont dix (un pour chacun des
jours du cycle dnaire). Hi-ho est un, comme il est dix, mais il est dabord un
couple, car la Mre des Soleils est marie. Aussi Hi et Ho sont-ils un couple
das tronomes. Couple complexe vrai dire : il y a 3 Hi et 3 Ho. Ils forment
cependant un total, non pas de 6, mais de 4, ds quon leur a distribu les
saisons et les orients. Cest que Yao, enlevant leurs chefs ces churs
opposs, a pris soin de conserver la Capitale proches manations de son
pouvoir rgulateur lan des 3 Hi et lan des 3 Ho. Il forme avec ces
ans une triade, auguste et centrale. Si on veut la compter pour 1, un centre se
trouve constitu au milieu du carr. Tel un Soleil, central et fixe, lautorit
minente du Chef y clate demeure, tandis quelle se manifeste, cartele
aux quatre orients, sous laspect particulier qui convient chacun des qua -
Marcel GRANET La pense chinoise 66
drants du monde. Lanne se distribue ds lors en secteurs auxquels on peut
prter des emblmes emprunts aux saisons. Ces secteurs rayonnants semblent
maner dun Soleil -matre condamn scarteler, parce quil doit rgenter les
diffrents espaces. Cest cependant 6 et non pas 4 (ou 5) qui est le nombre
vritable dune famille so laire, de mme que cest le simple affrontement par
bandes et non la rpartition en carr qui indique la division premire de
lEspace.
Nous connaissons dautres fils du Soleil que les Hi et les Ho : non
seulement ils taient six comme ces derniers, mais nous savons, en outre,
quils sortirent du ventre de leur mre 3 par la gauche (= Est) et 3 par la
droite (= Ouest) (
133
). De mme encore que les Hi et les Ho, les bannis de
Chouen (
134
), qui rnovent leurs vertus aux quatre orients, semblent dabord
compter pour quatre, et, cependant, ils forment, eux encore, une double bande
de trois. Lun deux se nomme Trois -Miao. Les autres composent un trio o
deux comparses encadrent un puissant personnage. Ce dernier, nomm Kouen,
devait, transform en tortue trois pattes, aller rgner lExtrme -Orient (=
gauche), sur un Mont des
93
Oiseaux. Face lui, et eux aussi sur un Mont des
Oiseaux, mais lExtrme -Occident (= droite), se dressaient les Trois-Miao,
Hibou triple corps. Coupables davoir dtra qu le Temps, les Trois-Miao
furent, au cours dune fte danse, dompts par un Hros qui cet exploit,
il dansait lui-mme revtu de plumes, gagna le trne (
135
). Quant Kouen,
qui ne sut danser quune danse impuissante, il fut sacrifi par Chouen, qui il
avait disput lEmpire (
136
). Or, dans les ballets des vieux ges, les danseurs,
nous dit-on, se groupaient par trois (
137
). Nous savons mme, par un exemple
significatif, que les ftes dinauguration dune re nouvelle consistaient en un
combat rituel opposant deux chefs encadrs chacun par deux seconds (
138
). Ils
reprsentaient deux groupes complmentaires, deux moitis de la socit qui,
par roulement, se partageaient lautorit (
139
).
Ce principe dalternance simple explique lopposition face face des
acteurs. Au lieu de former le carr, ils se disposaient, sur laire rituelle, de part
et dautre dune ligne axiale sparant les deux camps. La reprsentation du
Temps et de lEspace, qui les suppose dcomposs en secteurs se rattachant
un centre dont procde leur pouvoir de durer et de coexister, a permis
demprunter aux saisons et aux orients les emblmes destins particulariser
les dures comme les tendues. Cette conception procde dune reprsentation
plus ancienne. Les lments de cette dernire drivent entirement, non pas de
simples sensations individuelles ou de lobservation de la nature, mais
dusages purement sociaux. Ils sont emprunts limage quoffraient, en des
circonstances particulirement mouvantes, deux bandes saffron tant en une
joute rituelle. Avant que les jeux de la politique fodale naient fait alterner
la place souveraine les reprsentants des diverses vertus qui exprimaient les
aspects particuliers de la dure et de ltendue, ctait un combat rituel qui
amenait tour tour au pouvoir les reprsentants de deux groupes
complmentaires. Un rythme deux temps, fond sur la simple opposition et
Marcel GRANET La pense chinoise 67
lalternance simple, commandait alors lorganisation socia le. Il commanda
aussi les reprsentations jumelles de Temps et dEspace.
94
Ce rythme simple est celui quimpose la vie de socit un besoin
priodique de rfection. Lespace est fait dtendues tantt pleines et tantt
dilues ; il se vide et sextnue l o toute vie sociale parat manquer ; il
semble rsider entirement dans lenceinte sacre des runions fdrales. La
dure est faite de temps faibles et de temps forts : elle parat se rfugier tout
entire dans les priodes de ftes et dassembles plnires. Les mots houei et
ki signifient tous deux : temps, mais au sens doccurrence ; hi voque surtout
lide de ren dez-vous ou de terme ; houei, celles de runion (march, foire,
fte), de congrgation, de socit. La dure nest vraiment elle -mme, intacte
et dense, que dans les occasions enrichies par la vie en commun qui font date
et semblent fonder le Temps.
La station que les rituels savants imposent une fois par an au Souverain
dress au centre du Ming tang, comme sil tait le pivot de lann e, semble
correspondre une priode de retraite pendant laquelle les chefs anciens
devaient se confiner au plus profond de leur demeure (
140
). Sur la dure de
cette retraite, les diverses donnes mythiques ne sont pas daccord : elle se
continuait pendant douze jours, dit-on, ou bien tait termine le septime jour.
Il y a des raisons de penser que les six ou douze jours de retraite taient consa-
crs soit aux six animaux domestiques, soit aux douze animaux qui sont les
emblmes des douze mois (
141
). Ces jours taient employs des rites et des
observations (
142
) qui permettaient de pronostiquer (ou, pour mieux dire, de
dterminer laide de prsages), la prosprit des le vages et le succs des
rcoltes. Dans les douze jours, par exemple, on voyait une prfiguration des
douze mois de lanne. On considrait cette priode privilgie comme une
sorte de temps concentr, quivalant la dure entire de lanne. La
longueur variable quon lui attribue sexplique par la concurrence de deux
dfinitions savantes de lanne et lexis tence dun calendrier luni -solaire.
Lanne solaire tait estime 366 jours ; lanne religieuse nen comptait que
360. Les 12 mois lunaires se virent dabord attribuer 29 jours (le quinzime
jour a toujours t considr comme tant celui de la pleine lune et le centre
du mois), puis on porta 30 jours la dure de 6 dentre eux. La dure totale
des
95
12 lunaisons [(348 ou) 354 jours] se trouvait infrieure de 6 (ou de 12)
jours celle de lanne religieuse, de 12 (ou de 18) jours celle de lanne
solaire. Ceci, dans la pratique, conduisit adopter le systme des cycles
quinquennaux et des mois intercalaires : on attribua 354 jours et 12 mois aux
1
e
, 2
e
et 4
e
annes de chaque cycle, 13 mois et 384 jours aux 3
e
et 5
e
annes (
143
). Cependant la pense religieuse ne cessa point daccorder une
sorte dexistence spare aux 12 premiers jours de lanne (
144
).
A ces jours de nature particulire semble stre attache une fte dont le
nom peut sentendre avec le sens de : fte de la (plus) longue nuit. Ce sens
simposa ds quon eut lide de faire passer par les solstices laxe de lanne
et quon vi t dans le solstice dhiver un point initial. Mais le dbut de lanne
Marcel GRANET La pense chinoise 68
chinoise est, par principe, variable : cest en fixant les heures, jours et mois
initiaux que les diffrentes dynasties dterminaient leurs insignes et leur
calendrier de faon singulariser le temps de leur domination. Fait
remarquable : le dbut de lanne na jamais oscill quentre les divers mois
de la saison froide. La fte hivernale na pas t, ds lorigine, une fte
solsticielle : son nom peut vouloir dire : fte de lallongement des nuits, et
il est certain quelle prsente tous les carac tres dune fte des rcoltes. Sa
dure, dabord fort longue, tait en fait dtermine par des termes rels, ceux
du gel et du dgel (
145
). Elle stendait, avec ses crmonies initiales et
terminales, sur toute la priode de lhivernage, si bien que de nombreux
pisodes rituels ont pu sen dtacher : attribus aux huitime et deuxime
mois (
146
), ils ont marqu les deux bouts dun axe q uinoxial de lanne. Les
crmonies de la liturgie annuelle eurent alors tendance se rpartir en consi-
dration la fois de cet axe quinoxial et de laxe solsticiel : cest ainsi que, se
conformant une division de lEspace par quadrants, un ordre liturgique,
fond sur la division de lanne en quatre saisons, servit rythmer le Temps.
Mais on doit noter quune des extrmits de la croise est reste peu prs
vide de valeur religieuse : elle correspond simplement aux vacances dt,
simple temps de repos et dabsten tion. Les vacances dhiver ont une autre
importance. Mme rduites une priode de six ou de douze jours, elles
semblent valoir autant que lanne entire.
96
Elles doivent cette valeur au fait quelles ont fini par rsor ber en elles
toute la puissance dgage par les ftes de la morte-saison (
147
). Celle-ci, qui
sintercale entre deux annes relles, entre deux campagnes agricole s, enferme
en elle le seul Temps qui compte et qui date. Cest la priode o les hommes
que la vie des champs ne disperse plus se rassemblent dans les hameaux et les
bourgades. A une dure profane, goste, monotone et vide dmotions,
succde alors une dure quemplissent les espoirs religieux et lactivit
cratrice propres aux exercices accomplis en commun. Un rythme simple
oppose comme un temps faible un temps fort la priode de vie
dissmine o ne subsiste quune activit sociale latente, la priode de
congrgation consacre tout entire la rfection des liens sociaux. Ce rythme
nest pas calqu directement sur le rythme saisonnier. Sil parat dpendre de
lensemble des conditions naturelles qui commandent lexistence dune
socit vivant surtout dagricul ture, cest que la saison pendant laquelle la
Terre naccepte plus le travail humain soffre comme le temps o les hommes
peuvent le plus commodment soccuper dintrts qui ne sont pas profanes.
La Nature offre le signal et procure lo ccasion. Mais le besoin qui pousse
saisir loccasion et perce voir le signal a sa source dans la vie sociale
elle-mme. Une socit ne peut durer sans se recrer. Les Chinois furent
conduits penser que la dure ne saurait subsister sans rfections priodiques,
parce queux -mmes se sentaient obligs se runir priodiquement en
assembles. Comme les ftes o le groupe humain reprenait vie se clbraient
chaque morte-saison, ils imaginrent que le renouvellement du Temps devait
se faire chaque anne. De l procde, avec lide mme dun cycle annuel et le
Marcel GRANET La pense chinoise 69
souci den retrouver lquivalent dans la Nature, le dsir dattacher dsormais
chacune des manifestations de la vie sociale un signal extrieur fourni par
les manifestations naturelles. Mais les vieilles ftes de la morte-saison
nexprimaient, en principe, que des besoins dordre humain, des besoins
proprement sociaux (
148
). La preuve sen trouve dans le fait que leur objet
premier et principal fut non pas de mriter dheureuses saisons ou une bonne
anne, mais dobtenir la perptuation du groupement social.
97
Celui-ci, pour y arriver, mettait en action toutes les forces dont il
pouvait disposer. Il dpensait tout et il se dpensait tout entier : vivants et
morts, tres et choses, biens et produits de toute sorte, les humains comme les
dieux, les femmes avec les hommes, les jeunes en face des vieux, tout se
mlait alors en une orgie pre et vivifiante. Les joutes qui prparaient cette
communion totale cherchaient surtout mettre aux prises, de toutes les faons
possibles, les dfunts et les vivants, les vieux et les jeunes, tout le pass et tout
lavenir. Ainsi stablissait entre les gnrations une conti nuit dont profitait
le Temps lui-mme, si bien que sa rfection parut ressembler un
rajeunissement. On put ds lors imaginer que lon clbrait la fte avec
lintention dinau gurer lanne nouvelle et de prparer le succs de la
prochaine campagne agricole. Les rjouissances se terminaient cependant par
un vivat, indfiniment rpt de proche en proche : Dix mille annes ! Dix
mille annes (
149
) ! Quand la fte fut clbre au profit de chefs investis du
pouvoir de faire durer et coexister, ce vivat parut correspondre une
acclamation davnement, un souhait dynastique, linau guration dune re.
Il servait aussi, employ pour dsigner le chef, concentrer dans sa personne
une puissance de vie impliquant des espoirs illimits de perptuation (
150
). Au
temps o la fte de la longue nuit se confondait encore avec lassemble
hivernale dune communaut paysanne, dans ce cri de Dis mille annes !
se signifiait avant tout la confiance dune race dans le succs de ses labeurs,
succs sans cesse renouvel et qui garantissait au groupe humain une porte de
prennit. Vide et comme sans force dans le courant des jours, la dure, su
cours des assembles de la morte-saison, semplissait tout coup de ralit
vivante. Riche despoirs et de souvenirs confondu s, elle simprgnait de ce
pouvoir de ralisation qui signale les dsirs exalts par laction en commun.
Tout le pass, tout lavenir, le Temps entier (avec lEspace entier) semblaient
se condenser dans les occasions saintes (attaches des sites sacrs) o un
groupe humain arrivait se concevoir comme une unit permanente et totale.
*
* *
98
Dans les civilisations o lactivit sociale ne cesse gure dtre
intense, la continuit parat tre un caractre essentiel de la dure. Porte un
maximum din tensit pendant la retraite hivernale, la vie sociale des anciens
Chinois, ds que la reprise des travaux profanes obligeait les hommes la
Marcel GRANET La pense chinoise 70
dispersion, se trouvait brusquement rduite peu de chose. Aussi le Temps (et
lEspace) paraissaient -ils prsenter une densit entire dans les seuls moments
(et lieux) rservs aux assembles et aux ftes. Lis des espaces pleins, des
temps forts alternaient avec des temps faibles lis des espaces vides. La
ncessit dune rfection rythme du sentiment social en trana lide que
lEspace et le Temps possdaient en commun une constitution rythmique.
Cette constitution rythmique, dont le principe se trouve dans lantithse des
priodes de dispersion et de concentration, sexprima dabord par les ides
jointes dopp osition et dalternance simples, et la reprsentation de lEspace et
du Temps impliqua ds lorigine le sentiment dune diffrence de valeur entre
deux qualits dtendue et de dure.
Dautre part, la dure et ltendue ne paraissaient exister pleinement q ue l
ou elles taient socialises : soumises la ncessit dune cration priodique,
elles semblrent maner dune sorte de centre. Ceci permit aux reprsentations
spatiales de ragir sur la reprsentation du Temps qui, dabord les avait
informes. A lide que les tendues comme les dures taient de valeur
ingale, sajouta lide que les dures comme les tendues taient de nature
varie. Ce progrs saccomplit ds que la reprsentation de lEspace fut
commande, non plus par le spectacle de deux camps garnis par des bandes
saffrontant face face, mais par celui dune formation en carr, la ligne
axiale sparant les partis stant rsorbe en un centre occup par un Chef.
Cette dernire disposition a pour principe un accroissement de complication
de la structure sociale. Celle-ci ne repose plus sur une division en deux
groupes complmentaires qui dominent tour de rle. Elle a pour fondement
une organisation fdrale. Plac en un point de convergence, le suzerain dont
la vertu rgente la confdration semble occup unifier du divers. Au cours
des ftes fdrales, cette diversit apparat rpartie en quatre quadrants : aussi
emprunte-t-elle
99
ses emblmes aux quatre orients. LEspace se trouve ainsi
diversifi en tendues orientes : le Temps aussitt parat se dcomposer en
dures pourvues dattributs saisonniers. Si les groupes dune confdration
nalternent plus au pouvoir selon le rythme simple qui convient deux
groupes complmentaires, un principe de roulement continue de rgenter
lorganis ation fodale. Cest pourquoi le temps parat form dres qui, se
succdant de faon cyclique, sont elles-mmes imagines sous laspect de
cycles. Ainsi sexplique la thorie des Cinq Vertus souveraines, tantt places
en un poste central de commandement, tantt relgues en quarantaine aux
quatre bords de lEmpire. Mais lEspace, aprs avoir, du fait de sa division en
quadrants, impos au Temps un rythme quinaire, doit lui-mme lui emprunter
ce rythme. Ainsi sexplique la division de ltendue en cinq car rs embots,
espaces hirarchiss que distingue leur degr de cohsion : celui-ci est signal,
pour chacun deux, par la priodicit caractristique du rythme de rfection
qui leur est propre.
Les Chinois ne se sont point soucis de concevoir le Temps et lEspace
comme deux milieux homognes, aptes loger des concepts abstraits. Ils les
Marcel GRANET La pense chinoise 71
ont dcomposs conjointement en cinq grandes rubriques, dont ils se servent
pour rpartir les emblmes signalant la diversit des occasions et des sites.
Cette conception leur a fourni les cadres dune sorte dart total : appuy sur un
savoir qui nous semble tout scolastique, cet art tend raliser, par le simple
emploi demblmes efficaces, un amnagement du monde qui sinspire de
lamnagement de la socit. Dautre part , les Chinois ont vit de voir dans
lEspace et le Temps deux concepts indpendants ou deux entits autonomes.
Ils aperoivent en eux un complexe de rubriques identifies des ensembles
agissants, des groupements concrets. Loin de leur paratre incohrents, les
jeux de ces rubriques leur semblent commands par un principe dordre : ce
principe se confond avec le sentiment de lefficacit du rythme. Manifeste
dans le domaine de lorganisation sociale, cette efficacit ne parat pas avoir
une moindre valeur quand il sagit dorganiser la pense. On va voir que ce
mme sentiment de lefficience universelle du rythme se trouve au fond de la
conception du Yin et du Yang.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 72
CHAPITRE II
Le Yin et le Yang
101
La philosophie chinoise (du moins dans toute la partie connue de son
histoire (
151
) est domine par les notions de Yin et de Yang. Tous les
interprtes le reconnaissent. Tous aussi considrent ces emblmes avec la
nuance de respect qui sattache aux termes philosophique s et qui impose de
voir en eux lexpression dune pense savante. Enclins inter prter le Yin et
le Yang en leur prtant la valeur stricte qui semble convenir aux crations
doctrinales, ils sempressent de qualifier ces symboles chinois en empruntant
des termes au langage dfini des philosophes dOccident. Aussi dcla rent-ils
tout uniment tantt que le Yin et le Yang sont des forces, tantt que ce sont
des substances. Ceux qui les traitent de forces telle est, en gnral,
lopinion des critiques chi nois contemporains y trouvent lavantage de
rapprocher ces antiques emblmes des symboles dont use la physique
moderne (
152
). Les autres ce sont des Occidentaux entendent ragir
contre cette interprtation anachronique (
153
). Ils affirment donc (tout
loppos) que le Yin et le Yang sont des substances, sans songer se
demander si, dans la philosophie de la Chine ancienne, soffre la moindre
apparence dune distinction entre substances et forces. Tirant argument de
leur dfinition, ils prtent la pense chinoise une tendance vers un dualisme
substantialiste et se prparent dcouvrir dans le Tao la conception dune
ralit suprme analogue un principe divin (
154
).
Pour chapper tout parti pris, il convient de passer en
102
revue les
emplois anciens des termes yin et yang, ceci en vitant tout pdantisme
chronologique et en songeant aux dangers de la preuve par labsence.
Cest aux premiers astronomes que la tradition chinoise fait remon ter la
conception du Yin et du Yang (
l55
) de fait, on trouve mention de ces symboles
dans un calendrier dont lhistoire peut tre suivie partir du IIIe sicle avant
notre re (
156
). Il est la mode, de nos jours, dattribuer aux thoriciens de la
divination la premire ide dune conception mtaphysique du Yin et du
Yang : ces termes apparaissent en effet assez frquemment dans un opuscule
se rapportant lart divinatoire. Ce trait a longtemps pa ss pour tre luvre
de Confucius (dbut du Ve sicle). On prfre aujourdhui le dater des IVe
IIIe sicles (
157
). Les thoriciens de la musique nont jamais cess de fonder
leurs spculations sur le thme dune action concertan te (tiao) prte au Yin
et au Yang. Ce thme est lun de ceux quaime tout particulirement
voquer Tchouang tseu, auteur du IVe sicle, dont la pense se rattache au
courant taoste (
158
). Une allusion, courte et prcise, cette action
concertante, se retrouve dans un passage de M tseu (
l59
) : comme la doctrine
Marcel GRANET La pense chinoise 73
de Confucius, celle de M tseu se rattache une tradition de pense
humaniste. Son uvre date de la fin du Ve sicle av. J. -C. Ajoutons que les
termes yin et yang figurent dans la nomenclature gographique : celle-ci, au
moins pour ce qui est des lieux saints et des capitales, sinspirait certainement
de principes religieux. Ds la priode qui stend du Ve au IIIe sicle, les
symboles Yin et Yang se trouvent employs par des thoriciens dorientations
trs diverses. Cet emploi trs large donne limpression que ces deux symboles
signalent des notions inspirant un vaste ensemble de techniques et de
doctrines.
Cette impression se trouve confirme ds que lon songe vrifier dans le
Che king lusage des mots yin et yang. On nglige dordinaire den tenir
compte. On suppose quil ne peut sagir que demplois vulgaires auxquels on
dnie tout intrt philosophique. Le Che king, cependant, quand il sagit
dune tude de termes et de notions, fournit le fond le plus solide : ce recueil
potique, dont la compilation ne peut tre postrieure au dbut du Ve sicle,
est, de tous les documents anciens, celui qui a le mieux rsist aux
interpolations.
103
Dans la langue du Che king, le mot yin voque lide de
temps froid et couvert (
160
), de ciel pluvieux (
l61
) ; il sapplique ce qui est
intrieur (nei) (
162
) et, par exemple, qualifie la retraite sombre et froide o,
pendant lt, on conserve la glace (
163
). Le mot yang veille lide
densoleillement (
164
) et de chaleur (
165
) ; il peut encore servir peindre le
mle aspect dun danseur en pleine action (
166
) ; il sa pplique aux jours
printaniers o la chaleur solaire commence faire sentir sa force (
167
) et aussi
au dixime mois de lanne o dbute la retraite hivernale (
168
). Les mots yin
et yang signalent des aspects antithtiques et concrets du Temps. Ils signalent,
de mme, des aspects antithtiques et concrets de lEspace. Yin se dit des
versants ombreux, de lubac (nord de la montagne, sud de la rivire) ; yang,
des versants ensoleills (nord de la rivire, sud de la montagne), de
ladret (
169
), bonne exposition pour une capitale (
170
). Or, quand il sagissait
de dterminer lemplacement de la ville, le Fondateur, revtant ses ornements
sacrs, commenait par procder une inspection des sites laquelle
succdaient des oprations divinatoires : cette inspection est qualifie
dexamen du Yin et du Yang (ou, si lon veut traduire, dexamen des versants
sombres ou ensoleills) (
171
). Il est sans doute utile de rappeler ici que le
dixime mois de lanne, qualifi de mois yang par le Che king, est celui o
les rites ordonnaient de commencer les constructions : on doit penser quon
en choisissait alors le site. Les premiers jours de printemps sont ceux o les
constructions doivent tre termines et, sans doute, inaugures (
172
) ; ces
jours convient aussi lpithte yang. Ces tmoignages, les plus anciens et les
plus certains de tous ceux quon possde, ne peuvent tre ngligs. Ils
signalent la richesse concrte des termes yin et yang. Ces symboles paraissent
avoir t utiliss par des techniques varies : mais ce sont toutes des
techniques rituelles et elles se rattachent un savoir total. Ce savoir est celui
dont lanalyse des reprsentations de Temps et dEspace a pu faire pressentir
limportance et lantiquit. Il a pour objet lutilisation religieuse des sites et
Marcel GRANET La pense chinoise 74
des occasions. Il commande la liturgie et le crmonial : lart topographique
comme lart chronologique.
*
* *
104
De ce savoir dpend lensemble des techniques dites divi natoires.
Rien dtonnant, par suite, sil se trouve (tenons ici compte des hasards qui
ont prsid la conservation des documents) que les plus anciens
dveloppements connus sur le Yin et le Yang. sont contenus dans le Hi tseu,
petit trait annex au Yi king (le seul manuel de divination qui ne soit pas
perdu). Rien dtonnant, non plus, si lauteur de Hi tseu parle du Yin et du
Yang sans songer en donner une dfinition (
173
). Il suffit, vrai dire, de le
lire sans prjug pour sentir quil procde par allusion des notions connues.
On va mme voir que le seul aphorisme contenant les mots yin et yang o
nous puissions deviner lide quil se faisait de ces sym boles apparat comme
une formule toute faite, comme un vritable centon : cest mme en ce fait
que rside la seule chance qui nous soit donne darriver interprter cet
aphorisme.
Une (fois) Yin, une (fois) Yang (yi Yin yi Yang), cest l le Tao (
174
) !
crit le Hi tseu. Tout dans cet adage est deviner. La traduction la plus
littrale risque den fausser le sens. Celle que je viens de donner est dj
tendancieuse : elle suggre linterprtation : un temps de Yin, un temps de
Yang... . Il y a, sans doute, des chances quun auteur proc cup de
divination envisage les choses du point de vue du Temps ; cependant, prise en
elle-mme, la formule pourrait tout aussi bien se lire : un (ct) Yin, un
(ct) Yang... . Ce quon a appris sur la liaison des reprsentations dEspace
et de Temps permet dj de rejeter comme partielles lune et lautre de ces
interprtations. Il y a lieu de prsumer que les ides dalternance et
dopposition sont suggres, toutes (lei) deux ensemble, par le
rapprochement des emblmes Yin, Yang et Tao. Mais ce nest point tout : la
seule transcription est dj interprtative, car elle comporte lemploi de
majuscules ou de minuscules. Faut-il crire :
Dabord le Yin, puis le Yang,
cest l le Tao !
Ici le Yin, l le Yang,
ou bien :
Un temps Yin, un temps Yang,
cest l le Tao !
Un ct Yin, un ct Yang,
Marcel GRANET La pense chinoise 75
Sagit -il de Substances ou de Forces (disons, pour plus de prudence, de
Principes) qui alternent ou qui sopposent ? Ou
105
bien, sagit -il daspects
opposs et alternants ? Il est imposable de rien dcider en essayant de fixer
tout de suite le sens du mot tao : tout ce que le Hi tseu pourrait nous
apprendre, cest que ce mot signale une notion apparente aux ides de yi
(mutation), de pien (changement cyclique), de tong (interpntration
mutuelle). Une seule voie nous est ouverte. Laphorisme du Hi tseu est
remarquable par sa forme : on peut esprer en claircir le sens si on le
rapproche de formules prsentant une constitution analogue.
Le Hi tseu fournit deux de ces formules. Au dbut du trait, figure un
passage destin rendre sensible lexacte correspondance qui existe entre les
manipulations divinatoires et les oprations de la Nature. Laphorisme une
(fois) froid, une (fois) chaud ou un (temps de) froid, un (temps de)
chaleur suit immdiatement une formule voquant les rvolutions du Soleil
et de la Lune. Il prcde lindication que le Tao, sous laspect de Kien (Kien
tao), constitue le mle et que, sous laspect de Kouen (Kouen tao), il
constitue la femelle (
175
). Toute la tradition reconnat dans Kien et dans
Kouen [qui sont, lignes indivises ou lignes discontinues, les symboles
primordiaux de la divination] la reprsentation graphique du Yang et du Yin.
Le Hi tseu, dans un autre endroit, assimile Koue n, symbole fminin, la
porte quand elle est ferme [la femelle se tient cache et forme intrieurement
(nei) cachette lembryon] et Kien, symbole mle, la porte qui souvre [le
mle se rpand et se produit ; il produit, pousse et crot (cheng) ; il
sextriorise ( wai) (
176
)]. Aprs quoi, lauteur ajoute une (fois) ferme, une
(fois) ouverte, cest l le cycle dvolution ( pien) ! un va-et-vient (wang lai)
sans terme, cest l linterpntration mutuelle ( tong) (
177
) ! Le
rapprochement de ces formules suggre limpression que les notions de Yin
et de Yang sinsrent dans un ensemble de reprsentations que domine lide
de rythme. On croit mme entrevoir que cette ide peut avoir pour symbole
toute image enregistrant deus aspects antithtiques.
Une formule voisine nous est fournie par le Kouei tsang. Tel est le nom
dun manuel de divination perdu depuis longtemps (
178
). Il y a des chances
que le Kouei tsang se soit rattach aux anciennes traditions religieuses dune
manire
106
bien plus troite que le Yi king. A en juger daprs les fragments
qui nous restent, il abondait en thmes mythologiques (
l79
). Nous avons
conserv deux passages o il est question de Hi-ho. Cest aux astronomes Hi
et Ho que la tradition, au temps des Han (180), attribuait la conception du Yin
et du Yang. Mais nous savons que Hi-ho est la mre des Soleils ou le
Soleil lui-mme. Le Kouei tsang, qui nous en parle en vers, le connat comme
tel. Il dcrit son ascension au long du Mrier creux, demeure solaire et royale,
qui se dresse dans la valle du Levant (yang) (
181
). Cest l, dit -il, que Hi-ho
(en) entrant, (en) sortant (fait l) obscurit (ou la lumire (houei ming) .
Le Kouei tsang crit ailleurs : Regardez-le monter au ciel un (temps de)
lumire, un (temps d) obscurit (yi ming yi houei) cest le fils de Hi-ho
Marcel GRANET La pense chinoise 76
sort du Val du Levant ! Ces deux fragments sont dignes dattention. Ils font
apparatre le fond mythique et ltroite correspondance des thmes du
va-et-vient (porte ouverte et ferme, entre et sortie) et de lopposition de
lombre et de lumire. Ils montrent aussi que nous avons affaire des
formules strotypes, des dictons riches de posie.
Jai montr plus haut que ces centons sont remarquables par une sorte
dquivalence symbolique qui leur permet de se susciter les uns les autres. Le
dicton :
yi ming yi houei dabord la lumire, puis lobscurit !
ici la lumire, l lobscurit !
si voisin par la forme et le sens (du moins si lon noublie pas les
significations premires des termes yin et yang) de laphorisme du Hi tseu :
yi yin yi yang dabord lombre, puis lensoleillement
ici lombreux, l lensoleill !
se retrouve, tel quel, dans un passage de Tchouang tseu.
Il y est plac [comme dans le Hi tseu laphorisme un (temps de) froid,
un (temps de) chaud ] ct dune formule voquant les rvolutions du
Soleil et de la Lune. Tchouang tseu, dans ce dveloppement qui na rien de
proprement taoste, vise, de faon explicite, dcrire les jeux du Yin et du
Yang (
182
). Il les dcrit plus longuement dans un autre passage (
183
), o se
pressent les dictons de mme forme : un (temps de) plnitude, un (temps
de) dcrpitude... un (temps d) affinement, un (temps d) paississement... un
(temps de)
107
vie, un (temps de) mort... un (temps d)affaissement ; un
(temps de) surrection ... Tchouang tseu multiplie ces dictons dans une page
trs potique o il essaie de donner une transposition littraire dune antique
symphonie (il se pourrait bien quil en ait utilis le livret) ; cette symphonie
prcisment se rattachait au mythe de Hi-ho : elle clbrait ltang sacr, o,
chaque matin, la Mre des Soleils lave le Soleil Levant (
184
).
Un des dictons qui figurent dans cette sorte de pome mrite une
attention particulire. Cest le dicton : yi tsing yi tchouo . Je lai rendu par
la formule : un temps daffine ment, un temps dpaississement . Tsing
donne lide du pur, du tnu ; tchouo, lide du mlang, du lourd. Ces termes
opposs font apparatre limage de la lie qui se dpose au -dessous de la partie
clarifie dune boisson fermente. Ils peuvent servir voquer les deux
aspects antithtiques de ce que nous appellerions matire ou substance. Mais
tchouo qualifie aussi les sons troubles et sourds, les notes basses et graves ;
tsing, les sons clairs et purs, les notes aigus et hautes (
185
). Aussi le dicton
doit-il se lire comme sil signi fiait
Ici du tnu, l du lourd
indistinctement :
dabord de laigu, puis du grave
Marcel GRANET La pense chinoise 77
Et, en effet, quand Tchouang tseu, avec le dsir de rvler la constitution
de toutes choses, crit, grand renfort de centons, une manire de symphonie
cosmique, il ne parat pas quil ait la moindre ide dune distinction entre la
matire et le rythme (
186
). Il ne pense point opposer, comme des entits
indpendantes, des forces ou des substances ; il ne suppose de ralit
transcendante aucun principe ; il se borne voquer un choix dimages
contrastantes. Or, le centon yi tsing yi tchouo est suivi par une formule
(elle parat, elle aussi, impliquer une mtaphore musicale) qui a surtout la
valeur dun rsum : Le Yin et le Yang concertent (tiao) et sharmonisent
(ho) (
187
) , telle est cette formule que Tchouang tseu nonce aprs avoir
numr quelques uns des contrastes significatifs rvlant la constitution
rythmique de lUnivers. Lantithse du Yin et du Yang peut, semble -t-il (sans
doute parce quelle est particulirement
108
mouvante) (
188
), servir
voquer tous les contrastes possibles : do une tendance retrouver en
chacun de ceux-ci lantithse du Yin et du Yang, qui parat les rsumer tous.
Cette antithse nest en rien celle de deux Substances, de deux Forces, de
deux Principes. Cest tout simplement celle de deux Emblmes, plus riches
que tous les autres en puissance suggestive. A eux deux, ils savent voquer,
groups par couples, tous les autres emblmes. Ils les voquent avec tant de
force quils ont lair de les susciter, eux et leur accouplement. Aussi
prte-t-on au Yin et au Yang la dignit, lautorit dun couple de
Rubriques-matresses. Cest en raison de cette autorit que le couple
Yin-Yang se voit attribuer cette union harmonique, cette action concertante
(tiao ho) que lon imagine saisir au fond de toute antithse et qui parat
prsider la totalit des contrastes qui constituent lUnivers (
189
).
Par une concidence significative (elle prouve le crdit des centons et que
les philosophes sinspirent de la sagesse commune), M tseu voque, lui
aussi, cette action concertante (tiao) dans lunique passage o il nomme le
Yin et le Yang. Ce morceau (sil nest pas interpol) est le plus ancien frag -
ment philosophique qui mentionne ces symboles (190). Il est intressant
dautres gards. M tseu parle du Yin et du Yang (aprs avoir, lui aussi,
indiqu lantithse du chaud et du froid) dans un dveloppement qui porte sur
le Ciel et le cours du temps et qui, dautre part, est remarquable par lemploi
de mtaphores empruntes la musique. Laction concertante du Yin et du
Yang (fait non moins remarquable) nest point donne comme ayant son
principe dans le Yin et le Yang eux-mmes. Sa source est dordre s ocial. Le
rythme a, non pas un auteur, mais une sorte de rgent responsable lequel
appartient au monde humain. La qualit de rgulateur du rythme universel
est une prrogative princire, car cest au Chef que la. socit dlgu e une
responsabilit, une autorit plnires. Un Roi-Saint fait surgir en temps
convenable (tsie) (
191
) les quatre saisons ; il fait concerter (tiao) le Yin et le
Yang, la pluie et la rose. On voit que les deux grands symboles se trouvent
ici placs sur le mme rang que la pluie et la rose (
192
). Cest l, sans doute,
Marcel GRANET La pense chinoise 78
le trait le plus intressant de ce passage. Il permet de confirmer ce que
109
suggraient les analyses prcdentes : le Yin et le Yang valent en tant
quemblmes, et ils expriment des aspects concrets. Ce que M tseu dsire
voquer, en lespce, cest prcis ment limage que, pris dans leur
signification initiale, ces deux emblmes voquent, en effet : quand elle est
mentionne ct de lopposition de la rose et de la pluie, lopposi tion du
Yang et du Yin signale certainement lantithse des aspects ombreux et
ensoleills. Nous aurons expliquer pourquoi cette antithse, parmi tant
dautres, a fourni les emblmes appels jouer le rle de
Rubriques-matresses. Nous devrons alors nous rappeler que le contraste du
Yin et du Yang compose une sorte de spectacle quun ordre musi cal semble
rgler. Lessentiel, pour linstant, est de noter que rien ninvite voir, dans le
Yin et le Yang, des Substances, des Forces, des Principes : ce ne sont que des
Emblmes pourvus dune puissance dvocation vraiment indfinie et, pour
bien dire, totale.
La thorie du Yin et du Yang doit, sans doute, beaucoup aux
musiciens, plus, peut-tre, encore quaux astro nomes et aux devins. Mais,
assurment, devins, astronomes, musiciens sont partis dune reprsentation
qui, traduite en mythes (
193
), relevait de la pense commune. Cette pense
parat domine par lide que le contraste de deux aspects concrets caractrise
lUnivers ainsi que chacune de ses appa rences. Quand (en raison de telle ou
telle proccupation dordre technique) on envisage le contraste du point d e
vue de la dure (cest le cas des sciences strictement divinatoires en tant
quelles se distinguent de la science des sites et se soucient surtout de la
connaissance des occasions), loppo sition des aspects entrane lide de leur
alternance. Aussi conoit-on que le monde ne prsente aucune apparence qui
ne corresponde une totalit dordre cyclique (tao, pien, tong) constitue
par la conjugaison de deux manifestations alternantes et complmentaires.
Mais cette conjugaison ne sopre pas moins dans le domaine de lEspace que
dans celui du Temps. Lide dalternance peut tre suggre par une dis -
position spatiale comme par une disposition temporelle. La juxtaposition de
secteurs rayonnants lvoque tout aussi bien quune succession en forme de
cycle. Cest mme, nous
110
lavons vu, en vertu de sa liaison lEspace et
non pas par une extension abusive des caractres du temps concret que le
Temps se dcompose en ensembles cycliques dont certains (le rgne ou lre)
se distinguent nettement de lanne. Cette remarque conduit prsumer que
le Yin et le Yang ont pu, en tant quemblmes utiliss par les astronomes, tre
pris pour des entits cosmogoniques, mais quils ne corres pondaient point,
dans le principe, des reprsentations simplement temporelles. La pense
chinoise, commune ou mme technique, ne spare jamais la considration des
temps de celle des tendues. Le fait que les termes adopts pour exprimer
lopposition cyclique des aspects constitutifs de toute ralit impliquent des
images spatiales, en donne une preuve nouvelle. Laphorisme du Hi tseu :
yi yin yi yang (194) peut se rendre sans dommage par la formule un
Marcel GRANET La pense chinoise 79
(temps) yin, un (temps) yang , quand on linterprte du point de vue des
devins. Mais elle implique aussi lide : un (ct) yin, un (ct) yang (
195
) .
Le seul moyen de ne point linter prter de faon trop partielle est donc de
lire : un (aspect) yin, un (aspect) yang , de ne point oublier que cette
opposition veille une image concrte et complexe, celle dun aspect dombre
conjugu un aspect de lumire, et de sous-entendre, enfin, que ces
aspects antithtiques sont toujours sentis comme alternants : ils paraissent
alterner non seulement quand on envisage la succession des priodes dobscu -
rit (nuit, hiver) et des priodes lumineuses (jour, t), mais encore quand on
voque simultanment le spectacle double dun paysage o lon pourrait
passer dun versant ombreux ( yin : ubac) un versant ensoleill (yang :
adret).
*
* *
Il est difficile, on le voit, de considrer les termes yin et yang comme des
vocables affects arbitrairement par des astronomes ou des devins des
entits inventes par eux. Ces mots voquent dabord une image, et celle -ci
est remarquable en ceci quelle implique une reprsentation lie des Espaces
et des Temps. Lide dalternance, cependant, semble lavoir emport (si peu
que ce soit) sur lide dopposition. Ce fait ne doit pas tre nglig. Il signale
lun des services quont
111
rendus les symboles Yin et Yang. Ils ont t
utiliss comme principes directeurs par les sages qui ont organis le Calen-
drier. Les Chinois voient dans le Calendrier une loi suprme (
196
) Cette loi
leur parat rgir les pratiques de la Nature parce quelle est la rgle qui
domine lensemble des habitudes humaines. Dans lemploi quen font les
calendriers, le Yin et le Yang apparaissent comme les principes du rythme
des saisons. Si les savants ont pu leur confier ce rle, cest que ces
emblmes avaient le pouvoir dvoquer la formule rythmique du rgime de
vie anciennement adopt par les Chinois.
Sitt aprs avoir parl de laction concertante du Yin et du Yang,
Tchouang tseu cite le dicton : Les animaux hibernants commencent
bouger. Toujours li (comme il lest dans ce passage du Tchouang tseu)
lide dun rveil prin tanier de lactivit du Tonnerre, ce thme est rpt par
tous les calendriers, savants ou non. Daprs le Yue ling, le Tonnerre
commence se faire entendre, et les animaux hibernants sortent de leurs
cachettes, ils sy enferment et le Tonnerre cesse de se manifester, deux
moments prcis de lanne solaire : ce sont deux quinoxes, instants dra-
matiques o, dit-on, les nergies du Yin et celles du Yang se balancent
exactement, sapprtant, les unes ou les autres, triompher ou dcliner.
Dans le Yue ling, en effet, calendrier savant base astronomique, le Yin et le
Yang figurent sous laspect de deux entits antagonistes : lune correspond
len semble des nergies destructrices (Hiver), lautre len semble des
nergies vivifiantes (t) (
l97
). Le Yin et le Yang ne sont pas mentionns dans
Marcel GRANET La pense chinoise 80
les calendriers plus anciens o rien, non plus, nindique le besoin de diviser l e
Temps au moyen de repres fournis par la marche du soleil. Les moments de
lanne que les Chinois trouvrent dabord dignes dintrt sont uniquement
ceux que des centons suffisaient signaler. Ces remarques paysannes sur les
habitudes de la Nature peuvent, sans le secours daucune prci sion dordre
astronomique, indiquer parfaitement aux hommes la succession des besognes
utiles. Elles rendent sensibles, dautre part, les principales rgles qui prsident
lactivit sociale. Cest ainsi, par exemple, que la disparition et la rap-
parition des hibernants marquent respectivement le dbut
112
et la fin de la
morte-saison. Les hommes passent cette priode dramatique en demeurant,
eux aussi, cachs dans leurs retraites dhiver. En fait, le temps de rclu sion
na jamais dur de lquinoxe dautomne lquinoxe de printemps. Aussi
bien, loin de songer rapporter la sortie des hibernants un terme de lanne
solaire, un calendrier ancien fait-il, tout au contraire, commencer lanne
linstant fix par ce signal naturel (198). Il voit en lui le point initial dun
cycle liturgique dont tous les temps sont dtermins concrtement par les
signaux (gestes des animaux, habitudes de la vgtation) que les centons
rustiques savent enregistrer. Si les calendriers anciens valaient comme des
lois, cest quils taient faits de proverbes. Ils ne sencombrrent que
tardivement de notations astronomiques. Lart savant du Calen drier eut alors
distribuer, par rapport des repres clestes, les remarques paysannes
juges suffisantes jadis pour organiser lactivit sociale (
199
). Cest alors aussi
que cet art fit explicitement appel aux symboles Yin et Yang. Simples
concepts, produits artificiels dune conception doctrinale, ces notions
na uraient pas eu la vertu dtablir une corres pondance entre les remarques
proverbiales et les repres astronomiques. En dpit de la foi nouvelle que
lastronomie leur inspirait, les techniciens du calendrier nont point song se
dbarrasser dune notatio n rustique du temps faite de signaux vnrables.
Cest apparemment dans le mme patri moine de symboles quils ont trouv,
quitte les transformer peu peu en principes scolastiques, les notions
qui, dabord toutes concrtes, pouvaient efficacement servir de principes de
classement.
Le Yin et le Yang ont t appels organiser la matire du calendrier,
parce que ces Emblmes voquaient avec une puissance particulire la
conjugaison rythmique de deux aspects concrets antithtiques. En effet, le
trait le plus remarquable du lot de thmes utiliss par les calendriers est quils
se conjuguent par deux, saccouplant de la mme manire que le Yin et le
Yang. Les hibernants gagnent ou quittent leurs retraites ; les oies sauvages
volent vers le Nord ou vers le Midi. Daprs la thorie que soutiennent les
glossateurs, les mouvements de va-et-vient, dentre et de sortie (200),
quexpriment ces dictons opposs, sont
113
commands par le rythme de
lactivit solaire : ils mritent ce titre de signaler les jeux et les triomphes
alterns du Yin et du Yang. Tout autre tait le point de vue de la pense
mythique. Il nous en reste de bons tmoignages. Rglant leur vie sur la
Marcel GRANET La pense chinoise 81
marche du soleil, les hirondelles, au dire des savants, marquent exactement,
avec leurs arrives et leurs dparts, les deux termes quinoxiaux. Mais les
calendriers rustiques nous apprennent que les hirondelles ne font pas que se
dplacer. A lautomne , elles se retirent dans des cachettes marines,
cependant que les hibernants ( savoir les rongeurs, les ours et, aussi, les
lopards) rintgrent des cachettes souterraines (201). Les informations des
mythes taient plus prcises encore et plus concrtes. Les hirondelles cessent
dtre hirondelles, quand il sagit de passer lhiver : en pntrant dans leurs
retraites aquatiques, elles deviennent coquillages. Les calendriers les plus
savants nont pas oubli quune formule de vie analogue simposait aux
moineaux comme aux cailles. A la fin des beaux jours, les moineaux plongent
dans la mer ou la rivire Houai : durant la froide saison, o ils se cachent, ils
ne sont plus que des hutres. De mme, la caille est un mulot que le printemps
transforme. Quand elle a chant tout lt, elle se terre et reste mulot jusqu
la saison nouvelle (202). Tout changement dhabitat est li, comme on voit,
ladoption dun nouveau rgime dexistence, lequel comporte un
changement substantiel daspect ; je ne dis pas un changement de substance,
car il ne sagit, au vrai, que dune mutation. Cette mutation est tout fait
analogue celles dont soccupe lart divinatoire quand il considre les
alternances obtenues en substituant lun lautre tels symboles graphiques
reprsentatifs du Yin ou du Yang. Cest prcisment parce quils enregistrent
de semblables mutations que les centons de calendrier valent titre de
signaux. La chasse et la pche sont interdites tant que la loutre et lpervier
nont pas inau gur par un sacrifice la saison o ils tuent oiseaux ou poissons.
Au moment mme o lpervier sacrifie, il subit une muta tion : depuis la
fermeture de la chasse, il vivait avec les murs et laspect dun ramier. Les
hommes, de leur ct, ne redeviennent des chasseurs qu linstant o par
leffet dun sacrifice oprant une mutation demblmes, le signal
114
de
lpervier se substitue dans les cieux au signal du ramier. Inversement, pour
que les femmes soccupent des vers soie, il faut que, sur les mriers, se
fasse entendre, non plus le cri de lpervier poursuivant sa proie, mais le
chant du ramier (
203
). Les mutations animales sont les signaux et les
emblmes des transformations de lactivit sociale. Ces dernires, comme les
mutations elles-mmes, saccompagnent de changements dhabitat, de
variations morphologiques. On sait limportance qua conserve, mme dans
le Hi tseu, le thme du va-et-vient li aux ides dentre et de sortie. On sait
encore que la retraite et la vie cache ont le Yin pour emblme, tandis que le
Yang symbolise toutes les manifestations actives. La tradition philosophique
na jamais cess de voir dans lun le symbole des activits qui stalent, dans
lautre lemblme des nergies replies et latentes. Ne semble -t-il pas que
(bien avant lpoque o la rflexion savante sest efforce de leur prter la
valeur dentits cosmogoniques), les notions de Yin et de Yang taient
incluses dans les dictons antithtiques qui donnaient la formule de vie des
animaux, servaient de signaux lacti vit des hommes, marquaient les temps
Marcel GRANET La pense chinoise 82
du rythme universel, et mritaient enfin de fournir les symboles choisis
pour prsider lorganisation du Calendrier ?
Les techniciens du Calendrier ont rparti les signaux rustiques tout au
long de lanne. Ils les ont, avec plus ou moins dadresse, accols un par un
toute la suite des termes de lanne solaire. Une semblable rpartition ne se
retrouve pas dans les calendriers les plus vieux (204). Tout au contraire, les
signaux abondent et se pressent dans les priodes o les hommes changeaient
la fois de genre de vie et dhabitat. Au reste, ces calendriers anciens ne se
distinguent gure de chants desprance ou dactions de grces, enchanant,
en de vritables litanies, une foule de thmes rustiques. Nous avons conserv
un de ces cantiques et nous savons quon le chantait dans les assembles
paysannes de la morte-saison. Tous les signaux que la Nature, dans les annes
passes, leur avait gnreusement prodigus, les hommes les rptaient leur
tour avec lespoir dobliger, par lefficace de leur chant, la Nature les
rpter nouveau au cours des annes venir (
205
). Ces litanies de proverbes
115
devaient un surcrot defficience la disposition des chan teurs et
larrangement de la fte. Ceux -ci ne nous sont connus, vrai dire, que par des
rituels savants. On y affirme que les participants devaient se former en
groupes orients. Les chefs de chur reprsentaient les aspects alternants et
opposs qui constituent lEspace et le Temps ; ils figuraient le Ciel et la
Terre, le Soleil et la Lune, le Sud et lt, lHiver et le Nord, le Printemps et
lEst, lOuest et lAutomne. Tous les acteurs, la joute termine, commu -
niaient, en mangeant la viande dun chien : on lavait fait bouillir lEst
(puisque lEst, cest le Printemps), point de dpart, nous dit -on, de lactivit
du Yang (
206
). Nombre de raffinements thoriques se sont sans doute glisss
dans ces descriptions ou ces interprtations tardives. A coup sr, ce nest
point une conception labore du Yin et du Yang qui a dabord command
lordonnance de la fte. Tout au contraire, ce qui a permis dlaborer cette
conception, cest le travail de rflexion dont cet arrangement a fou rni la
matire. Les assembles de la morte-saison o les hommes rappelaient en
vers et mimaient sans doute avec leurs gestes les habitudes des animaux (
207
)
se tenaient dans un abri souterrain, sorte de maison commune dont les
traditions relatives au Ming tang et des mythes tels que celui de Hi-ho et du
Mrier creux ont conserv le souvenir. Les hibernants et les oiseaux
migrateurs menaient, dans une cachette approprie leur aspect hivernal, une
vie ralentie et recluse. Les hommes, de leur ct, en attendant que la venue du
printemps leur permt de casser la glace qui emprisonnait les eaux et la terre
et de lenfermer son tour dans une cachette pleine dombre (
208
) se
soumettaient, dans lombre, un e retraite : ils prparaient, pour les jours du
renouveau, le rveil de leurs nergies. Ces pratiques et les sentiments qui les
accompagnaient expliquent lune des ides qui dominent la conception
savante du Yin et du Yang. Les philosophes admettent que, pendant tout
lhiver, le Yang, circonvenu par le Yin, subit, au fond des Sources sou -
terraines (
209
), au-dessous de la terre glace, une sorte dpreuve annuelle
dont il sort vivifi. Il svade de sa prison au dbut du printemps en frappant
Marcel GRANET La pense chinoise 83
le sol du talon : cest alors que la glace se fend delle -mme et que les sources
116
se rveillent (
210
) Sans la moindre mtaphysique, les anciens Chinois
savaient entendre ce signal de dlivrance. Ils navaient qu couter la danse
pitinante des faisans. Les hommes avaient de bonnes raisons pour ne point
ignorer les murs et les gestes de ces oiseaux. Ils avaient appris danser
eux-mmes, en se revtant de leurs plumes, la danse des faisans. Ils savaient
donc que ceux-ci staient prpars donner le branle au renouveau, faire
monter la sve, librer les eaux, dlivrer le Tonnerre, en passant la morte-
saison confins en des retraites souterraines ou aquatiques, ici sous
lapparence dhutres, l, sous forme de serpents (
211
) Un (aspect de)
dragon, un (aspect de) serpent ! scrie Tchouang tseu (
212
) quand il veut
donner la formule dune vie bien rgle ; nul ne peut se soustraire la loi
universelle du rythme : le Sage sait se plier un rgime altern fait dactivit
libre et de retraite restauratrice. Ce rgime est celui que suivaient les
anciens Chinois, leur vie sociale tant commande par un besoin priodique
de rfection. Les mythes imposaient le mme rgime aux dragons ainsi
quaux faisans : aussi le faisan pouvait-il fournir aux hommes des signaux
daction et le dragon des conseils de sagesse. Mais nest -il pas
remarquable que le prcepte par lequel Tchouang tseu rsume toute
lexprience de sa nation soit emprunt au thme des mutations rythmiques et
quil revte exactement la fo rme de laphorisme du Hi tseu : Un (aspect),
yin, un (aspect) yang ?
Les notions de Yin et de Yang ont pu servir organiser le Calendrier,
parce que, comme les dictons dont est fait celui-ci, ces notions ont pour
fondement une ordonnance rythmique de la vie sociale qui est la contrepartie
dune double morphologie. Cette double morphologie sest traduite, dans le
domaine des mythes, par le thme des alternances de forme. Le besoin de
signaux naturels conduisait prter aux choses une formule de vie o pouvait
se retrouver le rythme qui animait la socit. Par une voie parallle, on a
dtermin cette formule de vie en attribuant aux ralits choisies pour fournir
des signaux des formes alternantes destines servir tour tour demblmes
aux aspects contrastants que, dans les occupations comme dans lhabitat,
prend successivement la vie sociale. LUnivers, tel que le
117
faisait
apparatre cet ensemble de notations mythiques, semblait constitu par une
collection de formes antithtiques alternant de faon cyclique. Ds lors,
lordre du monde a paru rsulter de l interaction de deux lots daspects
complmentaires. Il a suffi que le Yin et le Yang fussent considrs comme
les Emblmes-matres de ces deux groupements opposs pour que les savants
aient t conduits leur prter la valeur de deux entits antagonistes. Les
devins ont vu en eux les principes de toute mutation. Les astronomes, aussi
facilement, en ont fait deux principes cosmogoniques tenus pour responsables
de lordre des saisons et du rythme de lactivit solaire. Mme dans ces
emplois techniques, lorigine sociale et la valeur concrte de ces deux
Emblmes demeurent sensibles. Lopposition classique du Yin et du Yang
Marcel GRANET La pense chinoise 84
pris pour symboles des nergies latentes ou agissantes, caches ou manifestes,
rappelle exactement la vieille formule de la vie sociale, qui tantt se dpensait
dans les champs ensoleills et tantt se restaurait dans lobscurit des retraites
hivernales.
*
* *
Un lot de dictons signalant des aspects alternants a t choisi pour donner
la formule et pour marquer les temps du rythme qui commande lactivit des
hommes et semble prsider la vie de lUnivers. Ces dictons ont lapparence
de formules potiques. Pourquoi les a-t-on emprunts la posie et pourquoi
aussi se plat-on dordinaire exprimer lide du rythme des saisons laide
de mtaphores musicales ? Pour quelles raisons, enfin, le Yin et le Yang
ont-ils mrit dtre traits comme les Emblmes -matres de cette collection
de symboles antithtiques ?
Les termes yin et yang, mme quand cest une pense savante et
technique qui les emploie, ne servent pas simplement dsigner des entits
antagonistes. Ils servent aussi de rubriques deux classes opposes de
symboles. Si lon tend les considrer comme des princip es efficients, on
tend aussi, simultanment et dans la mme mesure, voir en eux des
rubriques efficaces. Ils forment la fois un couple dactivits alternantes et
un groupement biparti de formes
118
alternes. Ils prsident au classement
de toutes choses. Les Chinois, en effet, ont russi organiser leur pense sans
songer vraiment constituer des espces et des genres. Ils se contentent de
diverses rpartitions base numrique et dotent, si je puis dire, la simple
bipartition dune sorte de puissance souveraine en matire de classification.
Dans leur langue, cependant (et le contraste mrite dtre soulign), lide de
genre (au sens grammatical du mot) ne parat jouer aucun rle. Le chinois
ignore la catgorie grammaticale de genre, tandis que la pense chinoise est
entirement domine par la catgorie de sexe. Aucun mot ne peut tre qualifi
de masculin ou de fminin. En revanche, toutes les choses, toutes les notions
sont rparties entre le Yin et le Yang.
La tradition philosophique saccorde reconnatre une nature fminine
tout ce qui est yin, une nature masculine tout ce qui est yang. Cest ainsi,
par exemple, quon oppose comme le mle au femelle les symboles
divinatoires Kien et Kouen, lesquels passent, le premier, pour figurer le
Yang et, le second, pour figurer le Yin. Cette reprsentation sexuelle du Yin
et du Yang nest point particulire aux thoriciens de la divination. Le Hi
tseu, en vue dinterprter un passage du Yi king relatif au mariage humain, a
recours au dicton le mle et le femelle mlent leurs essences (tsing =
liqueurs sexuelles) et les dix mille tres se produisent (
213
). La crudit de
lexpression est significative. Il ne faut p as oublier cependant que les
expressions dix mille tres , mle et femelle se rapportent uniquement,
Marcel GRANET La pense chinoise 85
en lespce, des symboles divinatoires. En fait, un des principaux efforts de
la tradition orthodoxe a consist enlever tout sens raliste lo pposition
sexuelle du Yin et du Yang. Elle y a russi tel point quon a longtemps
flicit les Chinois pour navoir jamais ni dans leurs concep tions ni dans leurs
pratiques religieuses accord la moindre place la sensualit (
214
). Aussi
se trouve-t-il, mme aujourdhui, des exgtes qui discourent sur le Yin et le
Yang sans signaler que la fortune de ces symboles est due limportance de
la catgorie de sexe (
215
).
Celle-ci, malgr les apparences imposes par un souci croissant de
prudhomie, na pas cess de rgir la pense
119
philosophique. Elle doit cet
empire au fait quelle a dabord rgi la pense mythique : le thme de
lhirogamie domine toute la mythologie chinoise. Les ritualistes, dautre
part, ont toujours soutenu que lharmonie ( ho) de toutes les choses yin et yang
(le Soleil et la Lune, le Ciel et la Terre, le Feu et lEau) dpendait de la vie
sexuelle des souverains et dune rglementation des murs excluant les excs
de dbauche et, plus encore, de chastet. La multiplication des espces
animales et vgtales est due, comme la sant du Monde, la pratique
dhirogamies rgulires (
216
). Les Chefs, qui portrent dabord le titre de
Grands Entremetteurs, avaient pour premire fonction de prsider des ftes
sexuelles. Ces ftes revenaient, temps rgls, tablir le bon accord de deux
groupements antagonistes. Lun reprsentait la socit des hommes, lautre
celle des femmes, car lopposition des sexes tait la rgle cardinale de lorga -
nisation chinoise (
217
). Elle na jamais cess de ltre. Jamais non plus la
catgorie de sexe na perdu son prestige.
Cest uniquement en considrant les formes anciennes de lopposition des
sexes quon peut arriver comprendre les notions de Yin et de Yang, leur
contenu, leur rle, leur fortune et leurs noms eux-mmes. Dans la vieille
Chine, les hommes et les femmes sopposaient la manire de deus
corporations concurrentes. Une barrire din terdits sexuels et techniques les
sparait. Laboureurs et tisserandes formaient des groupements que la
diffrence des genres de vie, des intrts, des richesses, des attraits, rendait
rivaux mais aussi solidaires. Ces groupes complmentaires se divisaient le
travail, rpartissant entre eux les diverses besognes ainsi que les temps et les
lieux o celles-ci devaient se faire. Chacun avait une formule de vie, et la vie
sociale rsultait de linteraction de ces deux formules.
Les tisserandes, qui nabandonnai ent jamais leur village, employaient
lhiver prparer pour la saison nouvelle les toffes de chanvre. Lhiver tait
pour les hommes une morte-saison. Ils prenaient du repos avant daller
travailler dans les champs. Le Yin et le Yang se relayent louvr age de la
mme manire : ils manifestent leur activit le premier en hiver, le second
dans la saison chaude. Les hommes et les femmes, que leur industrie
enrichissait tour tour, se
120
rencontraient au dbut et la fin de
lhivernage. Ces rencontres taient loccasion de foires ( houei) et de
rendez-vous (ki) o chaque corporation, les tisserandes au printemps, les
Marcel GRANET La pense chinoise 86
laboureurs lautomne, passait tour de rle au premier plan. Le Yin et le
Yang se donnent eux aussi des rendez-vous (ki) et se runissent (houei),
disent les savants, aux termes quinoxiaux, avant que lun ou lautre ne cesse
ou ne commence son rgne. On sait que le Yin et le Yang ont pour
emblme la porte : la porte est aussi lemblme des ftes sexuelles (
218
). On
ouvrait, au printemps, les portes des hameaux, et les laboureurs partaient pour
passer lt besogner dans les champs : le Yang voque limage dune porte
qui souvre, entranant lide de gnration, de production, de force qui se
manifeste. En hiver, les portes des villages taient tenues fermes : lhiver est
la saison du Yin, dont le symbole est une porte close. Les savants
affirment que, pendant la saison glaciale, le Yang est condamn vivre dans
une retraite souterraine, circonvenu de tous cts par le Yin. Il y a des raisons
de croire que la maison commune o les hommes se runissaient pendant la
morte-saison tait une sorte de cave situe au centre du hameau et environne
par toutes les demeures particulires : celles-ci, aux origines de la vie
villageoise, appartenaient aux femmes. Redevenus des laboureurs, les
hommes, une fois restaures leurs nergies, allaient sactiver au soleil dans la
pleine campagne. Les tisserandes, au contraire, ne travaillaient que dans des
lieux obscurs : ds quelles se mettaient tisser les vte ments de ftes, elles
devaient fuir le soleil (
219
). Les deux sexes taient soumis une discipline
antithtique. Leurs domaines respectifs taient lintri eur (nei) et lextrieur
(wai) : ce sont aussi les domaines respectifs du Yin et du Yang, de lombre et
de la lumire. Aussi lopposition des sexes sest -elle traduite mythiquement
par lopposition du Yin et du Yang.
Ces oppositions symtriques se manifestaient conjointement dans le
spectacle quoffraient au printemps et lautomne les assembles des ftes
sexuelles. Ces ftes avaient lieu dans des vallons o la rivire marquait une
sorte de frontire sacre. Cest en la franchissant que les reprsentants des
deux corporations rivales commenaient
121
se mler et prludaient
lhirogamie collective qui ter minait les rjouissances. Mais ils
commenaient par former des churs antagonistes. De part et dautre dun
axe rituel, ils se provoquaient en vers, aligns face face. Si, dans le camp
fminin, on smouvait alors en reconnaissant au camp adverse un aspect
vraiment mle (yang-yang) (
220
), cest apparemment que le Yang (versant
ensoleill) tait rserv au groupe vou aux labeurs de plein soleil. Aux
hommes ladret ( yang) appartenait, et aux femmes lubac ( yin). Le champ de
fte prsentait en spectacle, versant dombre touchant au versant de lumire,
groupements sexuels saffrontant pour sunir, le Yin et le Yang tout
entiers (
221
).
Le Yang appelle, le Yin rpond ; les garons appellent, les filles
rpondent (
222
). Ces formules jumelles signalent la discipline antithtique
qui commande les rapports des deux symboles antagonistes, comme elle rgle
la concurrence des deux corporations rivales. Les termes quon emploie sont
significatifs : ils ne sexpliquent qu titre dallusions aux rites et aux jeux des
Marcel GRANET La pense chinoise 87
ftes sexuelles. On dit du Yang quil appelle et commence le chant (tchang) :
cest ce que font en ralit les garons au cours de la fte chante. On dit du
Yin quil rpond en donnant une rplique harmonieuse ( ho) : tel tait
effectivement le rle des filles. Filles et garons prludaient leur union (ho)
par une joute (king) : le Yin et le Yang joutent (king) eux aussi avant de
sunir ( ho), et ils le font, comme les dlgus des deux corporations rivales,
chaque printemps et chaque automne. Le mot (ho), qui dsigne ces unions
symtriques, sapplique encore aux r pliques chantes qui marquent laccord
parfait des jouteurs ; il sert de mme exprimer lharmonie ( ho) qui rsulte
de laction concertante ( tiao ou tiao ho) du Yin et du Yang. On comprend
maintenant pourquoi cest au moyen de mtaphores musicales quon se plat
voquer la concurrence rythmique des symboles Yin et Yang : la conception
comme le nom de ces emblmes procdent du spectacle des assembles o,
aligns face lombre ou face au soleil, deux churs chantants se donnaient
la rplique. Ils rivalisaient en talent inventif et en savoir proverbial, se livrant
une improvisation traditionnelle. Ainsi furent invents la plupart des
centons potiques qui formrent la matire du calendrier ;
122
ces centons
voquent les images quoffrait, aux changements de saison, le paysage rituel
des ftes : do leur valeur demblmes et de signaux. Leur origine explique
encore la liaison qui, ds le principe, les unit aux symboles Yin et Yang.
Cest en vertu de cette liaison premire que ce couple de symboles a p u
prsider lorganisation savante du calendrier. Une thorie du Temps sest
trouve constitue ds que lon eut distribu dans les saisons classes sous
lune ou lautre de ces Rubriques -matresses, la masse des centons potiques
qui sopposaient par deu x comme autant de couples antithtiques. Dans cet
ensemble demblmes contrastants fournis tour tour par le paysage des
assembles dautomne et de printemps. lopposition essentielle, la plus
visible, la plus mouvante, la seule qui voqut instantanment le drame tout
entier, ctait lopposition des churs antagonistes saffrontant comme
lombre et la lumire. Aussi le Yin et le Yang ont -ils mrit dtre considrs
comme des emblmes qui rsumaient, voquaient, suscitaient tous les autres.
Ils ont donc constitu un Couple de Rubriques efficaces rpondant du
classement de tous les aspects alternants et tout aussi bien un Couple de
Symboles efficients responsables de luniverselle alternance.
La conception du Yin et du Yang sest bauche locca sion de
spectacles dramatiques o joutaient et communiaient deux corporations
solidaires et rivales, deux groupements complmentaires. Lassistance
paraissait comprendre la totalit du groupe humain, et la totalit des choses de
la nature, prsentes ou voques, figurait la fte. Le champ o ces
conventions sassemblaient reprsentait lespace entier, la dure entire tenait
dans la joute o les centons potiques rappelaient les signaux successifs de
lUnivers : Ce spectacle total tait un spectacle anim. Tant que durait le
combat de danse et de posie, les deux partis rivaux devaient faire alterner
leurs chants (
223
). Tandis que, garni par les churs antagonistes, le champ du
duel paraissait compos dtendues affrontes et de genre contraire, le temps
Marcel GRANET La pense chinoise 88
de la joute, occup par une alternance de chants et de danses antithtiques,
semblait constitu par linteraction de deux groupements concurrents et de
sexe oppos. Ainsi sexplique, avec la diversit des tendues et celle des
dures,
123
la liaison rythmique des Espaces et des Temps sous la domi-
nation des catgories Yin et Yang. Se distribuant chacun en dures ou en
tendues qui sopposent et alternent, ni lEspace ni le Temps ne sont un, pas
plus quils ne peuvent se concevoir s parment mais ils forment eux
deux un ensemble indissoluble (
224
). Ce mme ensemble embrasse et le
monde naturel et le monde humain : il est, pour parler plus exactement,
identique la socit totale qui groupe, en deux camps opposs, toutes les
ralits concevables. Lopposition des sexes apparaissait comme le
fondement de lordre social et servait de principe une rpartition sai sonnire
des activits humaines. De mme, lopposition du Yin et du Yang apparut
comme le fondement de lordre universel : on vit en elle le principe dune
distribution rythmique des uvres naturelles. Jamais lunit de lUnivers ne
pouvait tre sentie plus parfaitement, ni mieux sentie comme entire, que
dans les instants sacrs o, tout en procdant une distribution cohrente des
sites, des occasions, des activits, des emplois, des emblmes, on restaurait un
ordre total en pensant clbrer des noces collectives, cependant que le Yin
et le Yang sunissaient eux aussi et commu niaient sexuellement. Si donc le
Temps, lEspace, la Socit, lUnivers doivent une ordonnance bipartite la
catgorie de sexe, ce nest nullement par leffet dune tendance mta physique
un dualisme substantialiste (
225
). A lide de couple demeure associe lide
de communion, et la notion de totalit commande la rgle de bipartition.
Lopposition du Yin et du Yang nest pas conue en principe (et na jamais
t conue) comme une opposition absolue comparable celles de ltre et
du Non-tre, du Bien et du Mal (
226
). Cest une opposition relative et de
nature rythmique, entre deux groupements rivaux et solidaires,
complmentaires au mme titre que deux corporations sexuelles, alternant
comme elles la besogne et passant tour tour au premier plan. Le
fondement de cette alternance se trouve dans le fait que, au temps o se
forma la conception du Yin et du Yang (et cest l une preuve dcisive de
lantiquit de cette conception lordre social reposait, non sur un idal
dautorit, mais sur un principe de roulement (
227
). Aussi le Yin et le Yang ne
sont-ils imagins ni comme des
124
Principes ni comme des Substances. Si
lon conte quafin de restaurer lordre universel ils doivent clbrer leurs -
noces chaque quinoxe, ce nest point en sous -entendant quun Principe
mle sunit alors un Principe femelle. Il sagit bien de noc es relles, mais
leur ralit est dordre emblmatique. Elles correspondent, dans le monde
naturel, aux ftes qui, chaque printemps et chaque automne, ravivent, dans les
groupes humains, le sentiment dune unit communielle. Les noces du Yin et
du Yang, comme celles des paysans, sont des noces collectives. Elles sont
visibles dans larc -en-ciel. Larc -en-ciel nest lui -mme rien dautre quun
emblme ou un signal. La fte se rverbre en lui. Aussi est-il fait de
laccolement de bandes de cou leurs opposes, sombres et claires (
228
). Ces
Marcel GRANET La pense chinoise 89
couleurs antithtiques ne signalent point deux Substances diffrentes : ce sont
de simples appartenances des groupements fminin et masculin, car le
sombre appartient aux femmes et la clart aux hommes. Mme quand ils
joutent ensemble et quils saccolent pour sunir, il ne faut voir dans le Yin et
le Yang que les Rubriques-matresses de deux lots demblmes. Ce ne sont
point deux Ralits antagonistes, mais deux groupements rivaux. Bien plus
que des groupements de ralits ou de forces, ce sont des groupements
daspects et demplois : ce sont, au juste, deux classes dattributs ou
dattribution partages entre les deux moitis du corps social.
*
* *
Le Yin et le Yang ne peuvent tre dfinis ni comme de pures entits
logiques, ni comme de simples principes cosmogoniques. Ce ne sont ni des
substances, ni des forces, ni des genres. Ils sont tout cela indistinctement pour
la pense commune, et aucun technicien ne les envisage jamais sous lun de
ces aspects lexclusion des autres. On ne les ralise pas plus quon ne les
transcende ou quon ne cherche en faire des abstractions. Domine tout
entire par lide defficacit, la pense chinoise se meut dans un monde de
symboles fait de correspondances et doppositions quil suffit, quand on veut
agir ou comprendre, de faire jouer. On sait et on peut ds quon possde la
double liste
125
des emblmes qui sattirent ou se contrarient. La catgorie
de sexe fait apparatre son efficace dans lagencement des groupements
humains. Elle simpose donc comme principe dune classification
densemble. Ds lors, la totalit des aspects contrastan ts qui constituent la
socit forme par les hommes et les choses, sarrange en deux bandes
affrontes dappartenances masculines ou fminines. Symboles des
oppositions et des communions sexuelles, le Yin et le Yang semblent
conduire la joute concertante o ces aspects sappellent et se rpondent
comme autant demblmes et de signaux. Ils les suscitent par paires et
forment eux-mmes un Couple de Rubriques.
Les Chinois nont aucun got pour classer par genres et par espces. Ils
vitent de penser laide de concepts qui, logs dans un Temps et un Espace
abstraits, dfinissent lide sans voquer le rel. Aux concepts dfinis, ils
prfrent les symboles riches daffinits ; au lieu de distinguer dans le Temps
et lEspace deux entits indpendantes, ils loge nt les jeux de leurs emblmes
dans un milieu concret constitu par leur interaction : ils ne dtachent pas le
Yin et le Yang des ralits sociales dont ces symboles voquent lordre
rythmique. Lempire quils accordent la catgorie de sexe implique le
ddain de la catgorie de genre (
229
). Lune permet un classement neutre des
notions qui les distrait de la dure et de ltendue. Lautre conduit des
classifications demblmes que domine la vision de leurs rapports concrets,
cest --dire de leurs positions respectives dans ce milieu actif que forment
lEspace et le Temps. On les voit dabord qui sopposent en saffrontant, rgis
Marcel GRANET La pense chinoise 90
par une loi dalternance simple, et on les groupe par paires : cest qualors la
catgorie de sexe rgne seule la manire dune catgorie de couple. Elle
constitue, sous cet aspect, la premire des catgories numriques. Elle permet
en effet de noter la disposition la plus simple que prend, dans lEspace et le
Temps, une totalit quon ne peut concev oir comme indivisible, car ce qui a
permis de limaginer, cest le spectacle des assembles plnires dun
groupement humain : si ce groupement tait entirement homogne, il
naurait aucun besoin de refaire son unit.
Le sentiment de lordre harmonieux q ue les joutes
126
procuraient
lensemble des tres a confr la classification bipartite un tel prestige
religieux que nulle autre na pu la surpasser en autorit. Les Chinois ne se
sont point condamns ne trouver de lordre que l o rgnait la bip artition ;
mais le principe de leurs divers classements na pas vari. Tous impliquent
lanalyse dun total senti comme plus ou moins complexe et, toujours, cette
analyse procde dune image : celle-ci, tout ensemble rythmique et
gomtrique, fait apparatre la rpartition, dans lEspace et le Temps, des
lments entre lesquels le total se trouve dcompos, si bien quun emblme
numrique suit signaler le mode de groupement de ces lments et, par
suite, dceler la nature intime du total. Do limport ance des notions lies
de Nombre et dlment.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 91
CHAPITRE III
Les nombres
127
Lide de quantit ne joue autant dire aucun rle dans les
spculations philosophiques des Chinois. Les Nombres, cependant,
intressent passionnment les Sages de lancienne Chine (
230
). Mais,
quelles quaient pu tre les connais sances arithmtiques ou gomtriques (
231
)
de certaines corporations (arpenteurs, charpentiers, architectes, charrons,
musiciens...), nul Sage na accept de les utiliser, si ce nest dans la
mesure o, sans jamais contraindre des oprations dont le rsultat ne se pt
commander, ce savoir facilitait des jeux numriques. Chacun entendait
manipuler les Nombres comme il maniait les Emblmes : et, pour les Chinois,
en effet, les Nombres sont remarquables, la faon des Emblmes, par une
polyvalence propice aux manipulations efficientes.
Sachant, par exemple (et dsirant, dabord, justifier cet te connaissance en
la rattachant un savoir densemble), que, pour lespce humaine, la vie
embryonnaire dure 10 mois (232), un philosophe (233) raisonnait ainsi :
(Le) Ciel (vaut) 1 ; (la) Terre (vaut) 2 ; lHomme (vaut) 3 ; 3 (fois) 3 (font)
9 ; 9 (fois) 9 (font) 81 [= (octante et) 1] ; 1 rgit le Soleil ; le nombre du Soleil
est [1 (dizaine) =] 10 ; le Soleil rgit lHomme ; cest pourquoi (tout) homme
nat au 10e mois (de la gestation) (
234
). Et le sage poursuivait, nous
apprenant [car 9 x 8 font (septante et) 2] que le cheval, rgi par la Lune qui
vaut 2, a besoin il y a [2 (+ une dizaine) =] 12 lunaisons (
235
) de 12
mois de gestation.
128
Puis (et simplement en continuant de multiplier 9 par
7, 6, 5, etc.) (
236
), il trouvait encore enseigner que les chiennes portent [9 x 7
= (soixante et) 3] 3 mois ; les truies [9 x 6 = (cinquante et) 4] 4 mois ; les
guenons [9 x 5 = (quarante et) 5] 5 mois ; les biches [9 x 4 = (trente et) 6] 6
mois ; las tigresses [9 x 3 = (vingt et) 7] 7 mois..., do lon peut voir : dune
part, quune quivalence symbolique rapprocha 81 de 10, mais aussi 72 de 12,
tandis que 63 ou 54 signifient 3 ou 4 ; et, dautre part, que 2 (interchangeable
avec 12 ou 72) rgit la Lune et (vaut) la Terre, cependant que 10
(interchangeable avec 1 et 81, qui lui-mme quivaut 9 et 3) rgit le Soleil
tout en (valant) le Ciel (
237
).
Un symbole numrique commande tout un lot de ralits et
demblmes ; mais, ce mme mot, peuvent tre attachs divers nombres,
que lon considre, en lespce, comme quivalents. A ct dune valeur
quantitative qui les distingue, mais quon tend ngliger, les Nombres
possdent une valeur symbolique beaucoup plus intressante, car, noffrant
aucune rsistance au gnie opratoire, elle les laisse se prter une sorte
dalchimie. Les Nombres sont suscep tibles de mutations. Ils le sont en raison
Marcel GRANET La pense chinoise 92
de lefficience mul tiple dont ils paraissent dots et qui drive de leur fonction
principale ; ils servent et valent en tant que Rubriques emblmatiques.
Les Nombres permettent de classer les choses, mais non pas la manire
de simples numros dordre, pas plus, du reste, quen dfinissant
quantitativement des collections. Les Chinois ne se proccupent pas tantt
dattribuer un rang qui ne soit quun rang, tantt dtablir un dcompte du
seul point de vue de la quantit. Ils se servent des Nombres pour exprimer les
qualits de certains groupements ou pour indiquer une ordonnance
hirarchique. En plus de leur fonction classificatoire et lie elle, les
Nombres ont une fonction protocolaire.
I. Nombres, signes cycliques, lments
La distinction dun emploi cardinal, ordinal ou distributif des Nombres ne
prsente pas pour les Chinois un intrt essentiel. On se sert des Nombres
pour classer parce quils
129
peuvent servir situer et figurer concrtement.
Ce sont des emblmes. On leur attribue tout dabord un vritable pouvoir
descriptif.
* * *
Pour dcrire numriquement, les Chinois disposent de trois sries de
signes : lune dnaire, lautre duodn aire (
238
), la troisime dcimale. On
qualifie, en effet, de Nombres (chou), les signes de ces trois sries,
indistinctement.
Les nombres des sries dnaire et duodnaire sont figurs par des
symboles quon envisage rarement sans leur prter une valeur dimages.
Jen (lun des termes de la srie de dix) suggre Sseu -ma Tsien lide
dun fardeau ( jen) (
239
) ; ce signe fait voir les dix mille espces dtres au
moment o ils sont ports et nourris dans les bas-fonds du Monde. Le Chouo
wen, de son ct, reconnat dans jen la figuration dune femme grosse ( jen),
qui porte son fardeau, qui nourrit un embryon. Pareillement, selon le Chouo
wen, tchen (de la srie de douze) note lbranlement ( tchen) que produit le
Tonnerre ; il montre, dit Sseu-ma Tsien, (les femelles) des dix mille espces
qui viennent de concevoir (tchen) (
240
). Ce sont l des images
complmentaires, car un autre signe (prononc tchen lui aussi) voque
indiffremment la femme que la fcondation meut ou la Terre qubranle le
Tonnerre (
241
).
Les valeurs attribues ces images sont remarquables : entre les gestes de
la Nature et les comportements humains, elles font apparatre une intime
concordance. On peut deviner qu ce titre elles peuvent tre utilises comme
Marcel GRANET La pense chinoise 93
signaux de calendrier. Ceux-ci, comme de juste, comportent une indication
topographique.
Tchen, en effet, est lemblme de lE -S-E ainsi que du troisime mois de
printemps ; cest seulement une fois lquinoxe pass que les premiers
grondements du Tonnerre doivent se faire entendre. Le Tonnerre, alors,
ouvrant et branlant le sol, svade de la retraite souterraine o lhiver la
confin : les hommes, dsormais, pourront ouvrir la terre et lmouvoir par de
fructueux labours ; mais, si elle ne veut pas qu peine fconde, son fruit lui
chappe et ne
130
mrisse point, toute femme devra vivre dans la retraite
sitt entendu le signal du Tonnerre ou lordre que rpte un battant de bois
branlant une cloche (
242
). De mme, emblme du plein Nord et du solstice
dhiver, jen prside la naissance du Yang indique dans le cycle
duodnaire par le signe tseu (dont le sens est enfant ) quencadrent jen et
kouei du cycle dnaire. Tandis que jen signifie gestation kouei figure les
Eaux qui, des quatre Orients, pntrent dans le sein de la Terre. Celle-ci
souvre elles vers le ple Nord ; aussi kouei, tout en marquant leurs sites,
dsigne-t-il les humeurs fcondes qui permettent aux femmes de concevoir et
de nourrir leur faix : les temps propices la conception sont la mi-hiver ainsi
que la mi-nuit, et le plein nord est lorient favorable (
243
).
Les signes des sries dnaire et duodnaire suscitent des groupements
dimages (qui nont rien darbitraire, car dans leur assemblage sexprime le
lien de fait unissant son cadre naturel telle ou telle catgorie dusages). Ces
symboles, que lon considre comme des nombres, servent donc de
rubriques des ensembles concrets quils paraissent spcifier par le seul fait
quils les situent dans le Temps et lEspace.
Le Monde est un univers clos ; comme lui, lEspace et le Temps sont
finis. Aussi les signes numriques affects comme tiquettes aux secteurs de
lEspace -Temps sont-ils en nombre fini. Ils correspondent chacun un site du
Temps aussi bien qu u ne occurrence spatiale et sordonnent, orients, en
forme de cycle.
Tandis que les nombres du cycle duodnaire sont disposs un par un, sur
le pourtour dun cercle, les nombres du dnaire sont groups en cinq
binmes, quatre couples quant les pointes dune croise et le cinquime le
centre. Comme cet arrangement lindique, la conception dun cycle de dix
tiquettes numriques est lie un systme de classification par 5 : on connat
limportance de ce systme qui complte, en sopposant lui, un systme d e
classification par 6 (
244
). Or, la disposition en croise suppose une
reprsentation de lquerre et du carr (
245
). querre et carr tenus pour
significatifs de lEspace et de lordre terrestre. Dau tre part, 2 (pair) est,
comme on le verra bientt,
131
lemblme de la Terre et du carr (du moins
quand on envisage le primtre sans penser au centre) ; 3 (impair) est, en
revanche, le symbole du Ciel et du rond (ou, plutt, de la demi-circonfrence
qui, inscrite dans un carr de ct 2, a 2 pour diamtre). De fait, le Ciel (mle,
Marcel GRANET La pense chinoise 94
yang, 3, impair) a pour Nombre 6 [= 3 x 2], cependant que la Terre (femelle,
yin, 2, pair) a pour nombre 5 [= (2 + 2) + 1], car, si lon pense a une croise,
on ne peut ngliger le centre : ainsi, ds quon leur a affect un symbole
numrique, la Terre et le Ciel (femelle et mle) se trouvent avoir chang
leurs attributs (pair et impair). Fait symtrique, les signes dnaires (kan),
disposs en croise, sont, cependant, qualifis de clestes (tien kan : troncs
clestes), tandis quon qualifie de terrestres (ti tche : branches terrestres) les
signes duodnaires (tche), arrangs en cercle. Cette inversion significative
atteste linterdpendance des deux cycles. Il y a lieu de su pposer que, lie la
classification par 6, la conception dun cycle duodnaire se rfre aux
reprsentations de Ciel et de Temps, de la mme manire que, solidaire de la
classification par 5, la conception dun cycle dnaire drive des
reprsentations de Terre et dEspace. Mais, entre lEspace et le Temps, le
Ciel et la Terre, nulle indpendance nest concevable, et la liaison des deux
cycles na pas moins dimportance que leur opposition. Lun et lautre
figurent lensemble des sites et des occasions que chacun deux permet de
disposer dans un ordre tel quil convienne la Terre et simpose au Ciel ou
que, significatif du Ciel, il rgisse la Terre (
246
).
Cependant que les signes dnaires ou duodnaires prsident, titre de
rubriques, diffrents lots de ralits que leurs situations dans lEspace et le
Temps suffisent identifier, les cycles constitus par ces signes voquent
deux modes complmentaires de rpartition gomtrique. Ceux-ci
correspondent deux analyses numriques destines solidairement rvler
la composition du total ordonn que forme lUnivers.
Cest en vertu de leur pouvoir descriptif (et parce que, en suggrant des
compositions et des dispositions, ils peuvent indiquer des rpartitions et des
situations) que les diffrents cycliques possdent lefficacit caractristique
des
132
Nombres, en mritent le nom et, par suite, sapparentent aux
symboles de la srie dcimale.
Pour que lUnivers se prsente comme un ensemble ordonn, il faut et
suffit quun Calend rier promulgu rgente, dans un Monde rnov, une re
nouvelle. Le Monde est recr neuf sitt quun Chef digne dexercer une
mission civilisatrice a mrit de se voir confier les Nombres du Calendrier
du Ciel (Tien tche li chou) (
247
) . Inversement, lUnivers se dtraque
lorsquune Vertu dcadente fait perdre leur ordre aux Nombres du Calendrier
(li chou) (
248
). Les Nombres (chou) auxquels font allusion ces formules
consacres sont des symboles qui passent pour signaler des situations
(tseu) (
249
) rparties dans le Temps (ainsi que dans lEspace) : ils ne diffrent
pas, au moins quant leur objet, des signes des cycles dnaire et duodnaire.
Prcisment les seconds de ces signes ont t affects la notation des heures
et les premiers la dsignation des jours (
250
). Mais ils semploient aussi en
combinaison. On dispose parfois les signes des deux sries de manire leur
faire former une rose de 24 vents correspondant 24 demi-mois de quinze
jours (
251
). On les a surtout utiliss en les combinant par deux de manire
Marcel GRANET La pense chinoise 95
constituer un cycle de 60 binmes, les caractres de la srie dnaire (premiers
termes de chaque binme) tant employs 6 fois et 5 fois ceux de la srie
duodnaire (deuximes termes) (
252
). Ces couples numriques ont, trs
anciennement, servi identifier les jours, puis, plus rcemment, les annes,
les mois et les heures. Il a t, ds lors, possible, au moyen de quatre binmes
du cycle sexagnaire, de caractriser avec une extrme prcision les situations
temporelles (et spatiales). On sait que les huit caractres [Pa tseu (les quatre
binmes cycliques)] qui situent la naissance des individus doivent de nos
jours, tre examins avant tout mariage, on sait aussi que le principe de
toutes les rgles de choix, en matire matrimoniale, est lexogamie de
nom (
253
). Lusage des Pa tseu (remarquable par sa persistance) ne remonte
pas plus haute antiquit (
254
), mais il rappelle deux usages qui comptent
parmi le plus anciennement attests. Dune part le Yi li ordonne au fianc de
demander le nom personnel (ming) de la future, afin, dit-on, de pouvoir
consulter le sort et de ne point risquer de contrevenir la rgle
133
dexogamie (
255
). Dautre part, sous la dynastie des Yin (
256
), le nom
personnel tait choisi parmi les signes de la srie dnaire : lemblme du jour
de naissance servait demblme individuel. Du seul fait quils situent les tres
(wou), les signes cycliques les identifient : tout comme le font les noms, ils
dfinissent les individualits, les essences (wou).
Supposez quune apparition divine se produise et quon ait (ainsi que dans
le cas dune na issance) dterminer, de faon pouvoir la propitier sans
erreur sacrilge, la personnalit qui vient de se rvler ; le problme paratra
susceptible de deux solutions, dans le fond indistinctes : dcouvrir le nom du
gnie qui sest manifest ou fixer le site de la manifestation. Nous possdons,
pour un cas de ce genre, un double rcit (
257
). On nous dit, dune part, que
lAnnaliste charg de lidentification reconnut quil sagissait de Tan -tchou :
tel tait le nom du fils de Yao le Souverain, anctre de la famille Li. Ctait
donc la famille Li quil incombait de fournir le sacrifiant [et les offrandes :
ces dernires ne sont agrables que si, en raison du domaine et de la cuisine
dont elles proviennent, elles ressortissent une espce symbolique (lei)
laquelle leur destinataire appartient aussi] (
258
). Dans lautre rcit o lon a
jug inutile de donner le nom du gnie apparu, lAnnaliste, aprs avoir
nonc le principe : Il faut (lui) faire offrande en employant son essence
(wou) , prcise en ajoutant : Le jour de son apparition, voil, en vrit, son
essence ! Une fois dtermin le signe cyclique qui situe la manifestation
propitier, la nature des offrandes qui devaient appartenir au mme secteur du
monde, se trouvait fixe [et du mme coup, apparemment, celle du sacrifiant,
car lune et lautre ressortissent une mme espce ( lei)].
Il y a, on le voit, quivalence entre une espce (lei) ou une essence (faou),
cest --dire un nom (ming), et un site ou un secteur de lEspace -Temps. Mais
il se trouve de plus que les signes cycliques qui voquent les espces et les
secteurs, les sites et les essences, et qui ont la valeur dun nom, dune
appellation, suggrent du mme coup des reprsentations directement
Marcel GRANET La pense chinoise 96
numriques. Il suffit quon puisse dire dune apparition quelle se rfre un
site kia yi
134
(premier binme dnaire) pour quil soit aussitt connu que les
crmonies devront tre faites (ceci va dterminer le choix des victimes, des
couleurs, etc.) sous le signe de lEst -Printemps, secteur auquel ce binme sert
dtiquette (
259
). Mais on sait encore que toute lordonnance de la liturgie
(dimensions protocolaires, dures, quantits...) devra tre commande par le
nombre 8 (
260
). Autrement dit, des situations caractrises par ltiquette kia
yi correspondent obligatoirement des arrangements rgis par le classificateur
8 ; 8 et kia yi tant conjointement envisags sous laspect de rubriques
numriques. Tout en indiquant [rvlatrice dune essence dtermine] une
localisation spcifique qui se rfre un dispositif densemble impliquant une
composition dfinie, lti quette numrique (prise aux sries cycliques)
voque un lot demblmes que caractrise, dautre part, un mode dfini de
composition : celui-ci est signal par un nombre-matre (emprunt la srie
dcimale). Ce nombre-matre a le rle dun classificateur et sait imposer des
prsentations (gomtriques ou rythmiques) significatives de telle situation et
de telle essence emblmatiques.
Cest ainsi, Sseu -ma Tsien nous lapprend, qu un site S -S-E, marqu
par le signe duodnaire sseu (lequel exprime la perfection du Yang)
correspond le nombre 7 (car, dit lhis torien, les nombres yang atteignent leur
perfection 7) aussi la constellation caractristique de ce site se prsente-t-
elle forme de 7 (tsi ) astres et se nomme-t-elle Tsi sing : les
Sept-toiles (
261
). Pareillement, si le dveloppement masculin est rythm par
le nombre 8, le dveloppement fminin par le nombre 7, cest que, nous
affirme-t-on, les SITES des naissances masculines ou fminines sont res-
pectivement les NOMBRES (du cycle duodnaire) yin (E.-N.-E. = 8) et
chen (S.-S.-W. = 7) (
262
).
Les signes duodnaires et dnaires ne servent pas tablir des dcomptes
et on ne les emploie pas non plus pour indiquer, titre de numros dordre,
un rang abstrait : ils mritent le nom de nombres (de mme que les signes de
la srie dcimale) parce quils servent demblmes des situations
spcifiques quils figurent concrtement. Chacun deux peut voquer, sa
place dans une organisation
135
densemble (que caractrise un certain mode
de division en secteurs singulariss), un groupement local dont les sence
(wou) se traduit par une organisation (de nature rythmique ou gomtrique)
spcifie, elle aussi, par un diviseur caractristique.
*
* *
Les Chinois ont donn le nom de Nombres des signes cycliques conus
pour dsigner non pas des rangs mais des sites et capables dvoquer des
arrangements plutt que des totaux. Pour compter et numroter, ils disposent
dun autre systme de symboles qui constituent une srie dcimale dispose
Marcel GRANET La pense chinoise 97
linairement (1, 2, 3... 11, 12... 101...). Les nombres de cette troisime srie
sont nanmoins considrs comme des emblmes, remarquables, tout autant
que les autres, par leur pouvoir descriptif. Eux aussi font image, et, dans les
reprsentations quils suggrent, les ides daddition et dunit ont bien
moins dimportance quune sorte dana lyse concrte visant spcifier le type
de division ou dorgani sation qui parat convenir tel ou tel groupement.
Alors mme quils semblent servir numroter et comp ter, les nombres
de la srie dcimale sont employs figurer les modalits concrtes
darrangement. Un passage du Tso tchouan (
263
) peut le faire sentir :
lindiffrence distinguer une fonction cardinale et une fonction ordinale des
nombres apparat clairement.
Ce passage, singulirement instructif, tend, par la simple numration
dune suite de types de classement, suggrer le sentiment dune progression
rythmique. Il est insr dans un dveloppement sur lharmonie ( ho), o lon
veut rendre sensibles les correspondances intimes qui unissent les saveurs et
les sons, la nourriture et la musique : bref, ce que nous appellerions la
substance et le rythme (
264
). Tout est harmonie, cest --dire dosage, et les
diffrents dosages ne sont quune mme harmonie dont les modalits, par
ordre de complication croissante, sont exprimes au moyen dune suite de
symboles numriques. Ces emblmes rgentent un classement par catgories,
tout en figurant la disposition interne
136
qui convient chacune des
ralisations (totales chaque fois et chaque fois spcifiques) de lharmonie
universelle.
Ceci sexprime laide de neuf mots prcds, chacun, de lun des neuf
premiers nombres. On ne peut traduire ni par : 1 le souffle... 9 les chants
ni par 1 (est) le souffle... 9 (sont) les chants . Il faut entendre : 1 (=
Unique et en premier lieu est le) Souffle (ki ). 2 (= Deux et en second lieu
sont les) Ensembles [(ti) que forment, en saffrontant comme le Yang et le
Yin (couple antithtique), les danses civiles et militaires ; ces danses
conviennent soit lt (Sud), soit lHiver (Nord) (opposition simple)]. 3 (=
Trois et en troisime lieu sont les) Modes [potiques (lei) qui, rpartis entre
les seigneurs, le roi-suzerain et les dieux, sordonnent hirarchiquement (sur
une ligne centre) ; plac entre les dieux et les feudataires, le suzerain occupe
une situation intermdiaire et minente la fois : centrale]. 4 (= Quatre et en
quatrime lieu sont les) Emblmes [de danse (wou), car les quatre Orients
(disposition en carr, significative de la forme propre lEspace et la Terre)
fournissent, avec les danseurs et leurs insignes, les quatre types de danses]. 5
(= Cinq et en cinquime lieu sont les) Sons [primordiaux (cheng) : essence de
la musique, les sons appellent le classificateur 5 (emblme du Centre) et
mritent doccuper dans la progression (entre 1 et 9) la place centrale ;
affects aux quatre saisons-orients et au Centre, ils permettent de classer
lensemble des choses de la musique dans lEspace -Temps (disposition en
croise)]. 6 (= Six et en sixime lieu sont les) Tubes [musicaux (liu) ou,
plutt, les six couples de tubes musicaux (6 tubes yin doublant les 6 tubes
Marcel GRANET La pense chinoise 98
yang) : eux douze, ils rappellent les douze mois et ralisent la distribution
de lharmonie dans le Temps (symtriquement aux quatre Emblmes qui 1a
ralisent dans lEspace) (arrangement en hexagone ou dodcagone
voquant le Temps, le Ciel, le rond)]. 7 (= Sept et en septime lieu, sont les)
Notes [de la gamme (yin) figurant soit le total des Influences exerces par les
Sept Recteurs astronomiques, soit une semaine de sept jours. Sept (comme
cinq) donne lide dun total centr, savoir : soit (6 + 1) un hexagone (=
cercle) envisag avec son centre soit (4 + 3) un carr (4) dispos autour dun
axe perpendiculaire (3) marquant le Haut (Znith), le Bas (Nadir) et le Centre
137
du monde]. 8 (= Huit et en huitime lieu sont les) Vents ((fong), qui
correspondent, ainsi qu huit instruments de matire diffrente (les timbres
entrent en considration aprs les intervalles), aux huit rgions concrtes de
lEspace, savoir les huit carrs extrieurs de ltendue (carre et sub divise en
neuf carrs)]. 9 (= Neuf et en neuvime lieu sont les) Chants [(ko),
cest --dire la musique et la danse dans leurs manifestations les plus
sensibles ; danseurs et musiciens en plein travail voquent les neuf activits
(toutes les activits relles) ; lensemble des ralisations ( kong) rendues
possibles par une activit ordonne, entirement hirarchise, occupe tout
lespace concret (8) plus son centre idal (1) ; cet ensemble est figur par
trois lignes qui, centres et hirarchises, valent chacune trois et composent
ensemble la figure dun carr subdivis en neuf et prsid, si je puis dire,
son centre, par un carr-matre (domaine du Chef)].
Le Souffle est plac au dbut de la progression, parce quon voit en lui
llment unique et premier, simple et total, du rythme, et les Neuf Chants la
terminent, car ils marquent la ralisation panouie et suprme, dernire et
complte, de tout ce que le rythme contient en soi. Veut-on montrer comment
se constituent les ralits (de tous ordres) et comment elles se groupent ?
Veut-on, pour signaler concrtement leur rang, leur essence, rvler la
manire typique dont elles sont constitues ? Il suffit dindiquer que les
choses de la musique sordonnent en catgories sous des emblmes
emprunts la srie des Nombres. Ces tiquettes numriques non seulement
marquent les places dans la progression, mais encore dterminent la
composition et la figure qui distinguent chaque catgorie : ce qui, par
exemple, se produit et se range en quatrime lieu, se dispose en carr et se
prsente par 4, constituant un groupement de ralits dont lessence est dtre
quatrime et quadruple la fois.
Lordre ontologique et lordre logique se traduisent ensemble en images
rythmiques et gomtriques. Ils se confondent si bien quil parat possible de
classifier et de caractriser au moyen dexpressio ns numriques. En raison de
leur pouvoir descriptif, les Nombres, indices dune ana lyse concrte, sont,
titre de classificateurs, appels identifier des groupements rels. Ils peuvent
servir de rubriques,
138
car ils sont significatifs des divers types
dorganisation qui simposent aux choses quand elles se ralisent leur rang
dans lUnivers.
Marcel GRANET La pense chinoise 99
Le monde est un univers clos. Affects la dsignation des sites, les
signes cycliques voquent des arrangements. Symtriquement, les nombres de
la srie dcimale paraissent destins spcifier les dispositions, mais on leur
accorde aussi le pouvoir de figurer des sites.
Pratiquement indfinie, la srie dcimale semble se disposer linairement.
De fait, lorsquon veut communiquer le sentiment dune progressi on, on
utilise apparemment les nombres dans leur suite linaire. Mais, on vient de le
voir, entre le principe et la fin de la progression, il nest pas imagin dautre
distance que celle qui spare un total, envisag dabord uniquement dans son
unit, dun ensemble susceptible danalyse, mais toujours considr comme
complet. Pour donner lide dune semblable progression, foncire ment
statique, si je puis dire, et imagine en vue de rpartir entre des catgories
hirarchises les aspects significatifs dun univers fini, il ny a aucune raison
de faire appel aux nombres en laissant apparatre quils peuvent former une
suite illimite : on prfrera se les figurer comme composant un ensemble de
sries finies que lune delles, celle des units simples, p eut entirement
reprsenter.
Image de la progression des nombres, la premire dizaine se voit ds lors
attribuer le caractre dun cycle : do la possibilit dapparenter ses
symboles aux symboles cycliques, ceux surtout du cycle dnaire. Les
simples signes cycliques, cependant, sont les emblmes de groupements dont
ils fixent les sites sans chercher (en principe) indiquer leur hirarchie. Par le
fait quils notent une progression, les pre miers nombres, au contraire, quand
ils servent de rubriques des catgories, permettent dimaginer un ordre
hirarchique. Or, lide de hirarchie se traduit dans la pense des Chinois par
la reprsentation raliste dun centre. Plac au milieu des neuf premiers
nombres, 5 simpose comme le symbole du centre.
Ds que 5 sest vu attribuer le Centre, les signes voisins, chappant leur
formation linaire, se rpartissent dans
139
lEspace et revtent leur tour
des attributions spatiales. Par suite, sils paraissent dabord aptes
caractriser des sites la manire des emblmes cycliques, les symboles de la
srie dcimale peuvent encore, comme on le verra bientt tre appels
figurer, par rapport un ensemble centr, lajustement des diffrents
secteurs : ils composent alors une sorte dimage o lordonnance du
monde se trouve reprsente numriquement.
Le passage du Tso tchouan quon vient danalyser a montr que les 5 sons
primordiaux, essence du rythme, ont droit une place centrale qui leur
confre ou que leur confre le classificateur 5. Le mme thme se retrouve,
illustr de faon plus significative encore, dans un document vnrable.
Le Hong fan (
265
), petit trait qui passe communment pour le plus ancien
essai de la philosophie chinoise, a pour sujet lensemble des recette s quun
Souverain digne de ce nom doit connatre. Cette somme de sagesse est
Marcel GRANET La pense chinoise 100
expose en 9 points chaque action tant numrote ou, plutt caractrise
par un nombre.
On a crit (
266
) quil nexistait aucun rapport entre les nom bres affects
aux sections du Hong fan et les ides quon y voit exprimes. Si ce rapport
chappe, en effet, dans la plupart des cas, il est manifeste pour la septime
rubrique. Elle est consacre aux choses de la divination. 7 doit les classifier,
car 7 les rgit : les devins, pour pratiquer leur art, manipulent 49 (= 7 x 7)
baguettes magiques et considrent (dit le Hong fan lui-mme [css09]) 7
catgories dindices. Mais la cinquime section est plus intressante
encore. Il y est parl de la plus haute perfection du Souverain (Houang
ti) (
267
). Le Souverain, on le sait, est la Fortune du pays. Aussi nous est-il dit
quil doit, dans sa Capitale, travailler recueillir puis rpandre sur
lensemble des fidles la totalit du Bonheur. Il a donc droit, lui et sa
perfection , la rubrique centrale. Cest celle que rgit le classificateur 5, et,
en effet, la flicit totale que le chef dispense et possde se rpartit en 5
Bonheurs.
Ltiquette numrique, dans ce cas encore, est tout autre chose quun
simple numro, mais, de plus, il apparat que
140
la conception dun ordre
exprim par des classificateurs numriques entrane la reprsentation dun
dispositif spatial.
Telle tait bien, au reste, lide qui inspirait les interprtes anciens quand
ils expliquaient le Hong fan dans son ensemble et aussi quand ils en
expliquaient la premire section, celle o sont numrs les 5 lments.
Ils voyaient dans le Hong fan une sorte de mditation sur la structure de
lUnivers, do un Sage pouvait tirer les principes qui commandent toute
Politique. Par suite dun prjug troitement rationaliste, les modernes se
refusent ne point confondre la science des Anciens Sages avec le simple
bon sens. Ils ne veulent dcouvrir dans le Hong fan quune suite, plus ou
moins bien ordonne, de conseils profitables, de renseignements utiles.
Comment admettraient-ils que lauteur du trait, coordonnant de vieux
systmes de classification, ait pu avoir lide de rendre manifeste lorga -
nisation de lUnivers au moyen de Nombres et de dispositions de
Nombres (
268
) ? Ils rejettent donc les traditions et, pour commencer, ou bien
ils naccordent quun faible intrt la mention des 5 lments place en tte
du Hong fan, ou bien mme ils svertuent la prtendre interpole (269).
Mais, dune part, la place est significative, et lon na, dautre part, aucun
droit ngliger les indications fournies par le dialogue qui sert dexorde a u
trait (
270
) : Ah ! cest de faon mystrieuse que le Ciel fixe aux hommes
dici -bas les domaines o les uns et les autres vivront en harmonie ! Et moi, je
ne sais rien de lordre qui rgit les rapports rguliers (des tres) ! Jadis
Kouen fit obstacle aux Grandes Eaux et jeta le trouble dans les 5 lments ;
le Souverain, frmissant de colre, ne lui ayant pas dlivr les 9 Sections du
Hong fan, les rapports rguliers (des tres) se pervertirent. Mais Kouen prit
Marcel GRANET La pense chinoise 101
excut dans les Marches du Monde et Yu accda au pouvoir. Le Ciel, alors,
dlivra Yu les 9 sections du Hong fan et les rapports rguliers des tres
retrouvrent leur ordre. Ne faut-il point rapprocher ce passage des vieilles
formules indiquant que les Hros civilisateurs se voient confier les Nombres
du Calendrier du Ciel auxquels une Vertu dcadente peut faire perdre leur
ordre ? On a vu que les Nombres du Calendrier ne paraissent gure
diffrer des signes cycliques : comme ces derniers, ils figurent des sites.
141
Le dialogue qui ouvre le Hong fan [css01] exprime assurment lide
que lamnagement de lUnivers implique une rpartition des choses et des
hommes, laquelle peut se traduire tout aussi bien par un arrangement en 9
Rubriques que par une distribution en 5 lments.
Aux 5 lments est affecte la Rubrique 1 [css02]. Noublions pas que (1)
lunit simple ne diffre point de (10) la dizaine, unit pleine. Les 5 lments
constituent un total. A chacun deux doit donc (
27l
) correspondre une valeur
numrique. Cest prcisment ce que dit la section I du Hong fan.
Chavannes traduit ainsi : (I) Des cinq lments, le premier est
appel (
272
) leau ; le second, le feu ; le troisime, le bois ; le quatrime, le
mtal ; le cinquime, la terre. (La nature de) leau est (
273
) dhumecter et de
descendre ; celle du feu, de flamber et de monter ; celle du bois, dtre sus -
ceptible dtre courb et redress ; celle du mtal, dtre obissant et de
changer de forme ; celle de la terre, dtre seme et moissonne.
Chavannes rend, dans le premier membre de phrase, par est appel , le
caractre yue quil traduit dans le second membre par est . Yue peut, en
effet, signifier est , mais, quand il figure dans une numration (tel est le
cas ici et tout au long du Hong fan), yue nest rien de plus quune simple
particule. Lui attribuer pleinement une valeur de copule conduit dj fausser
le sens. Le texte ne dit pas : (La nature de) leau est dhumecter et de des -
cendre... ; il dit : (l) Eau : (elle) humecte (et) tend vers le Bas ; (le) Feu :
(il) flambe (et) tend vers le Haut... Mais le sens est fauss bien plus
lourdement quand on prte yue dans la premire phrase sans pouvoir la
lui conserver dans la seconde la signification de est appel . On ne peut
tre conduit cette faute que par une ide prconue et si lon prsuppose
que, dans le Hong fan, les nombres ne sont employs qu titre de numros
dordre. Mais, dans le Hong fan mme et, du reste, ailleurs, nous avons trouv
des preuves garantissant que les Chinois naiment pas distinguer dans les
Nombres une fonction cardinale et une fonction ordinale.
Nous traduirons par un mot mot strict : I : 5 lments. 1 : Eau ; 2 :
Feu ; 3 : Bois ; 4 : Mtal ; 5 : Terre , en
142
entendant que lEau vient la
premire et le Feu le second parce que 1 et 2 expriment emblmatiquement
lessence et le rang qui sont les leurs. 1, 2, 3, 4 et 5 doivent tre regards
comme des indices spcifiant la valeur des diffrents lments.
Et, en effet, sil arrive aux Chinois, sous lempire de diff rentes
proccupations doctrinales, de faire varier la squence des lments, ils ne
Marcel GRANET La pense chinoise 102
leur attribuent jamais des valeurs numriques quon puisse considrer comme
diffrentes de celles que le Hong fan leur assigne.
Servant dindices aux places qui les situent dans un dispo sitif densemble,
ces valeurs, mme quand varie la squence adopte pour lnumration,
tmoignent seules de lordre vritable et premier des lments (
274
). Ceux-ci,
dans le Yue ling par exemple, se prsentent selon la squence : Bois, Feu,
Terre, Mtal, Eau (
275
). Et cependant, le Yue ling les assimile respectivement
aux nombres 8, 7, 5, 9, 6. Or, 1 et 6 (= 1 + 5) que le Hong fan, dune part, et
le Yue ling, dautre part, affectent lEau sont estims quivalents pour leur
valeur symbolique, car tous deux sont congruents 5. Il en est de mme de 2
et de 7 (= 2 + 5), de 3 et de 8 (= 3 + 5), de 4 et de 9 (= 4 + 5). Dailleurs, si le
Yue ling suppose une quivalence emblmatique entre lEau, par
exemple, et, dans la srie dcimale, le seul nombre 6 (nombre fort du couple
congruent 1-6), il affirme aussi que, dans la srie dnaire, cest un couple de
lments Eau Feu Bois Mtal Terre
Hong fan 1 2 3 4 5
Yue ling 6 7 8 9 5
nombres cycliques que lEau correspond. Notons ici que, lorsquil analyse les
couples cycliques de la srie dnaire, le Chouo wen prsente le premier des
deux signes comme lemblme dun Orient et le second comme le symbole de
la Saison correspondante (
276
). Le Hong fan et le Yue ling, qui affectent aux
lments, lun le premier des nombres dun couple congruent et lautre le
second de ces nombres (le nombre fort), envisagent apparemment les
correspondances numriques de points de vue diffrents, mais qui se
compltent : tous deux sinspirent
143
dun systme gnral de classification
dont de nombreux mythes attestent lantiquit et le prestige.
Ce systme consiste en une combinaison dquivalences tablies entre les
Saisons, les Orients, ... les Couleurs, les Saveurs, ... et les lments ainsi que
les Nombres. Le Yue ling rapporte le nombre 6 et la saveur sale (hien)
lHiver [= Nord], quil place sous linfluence ( t = vertu) de lEau ; le
nombre 7 et la saveur amre (kou) lt [= Sud] quil place sous linfluence
du Feu ; le nombre 8 et la saveur acide (siuan) au Printemps [= Est] quil
place sous linfluence du Bois ; le nombre 9 et la saveur cre (sin)
lAutomne [= Ouest] quil place sous linfluence du Mtal ; le nombre 5 et la
saveur douce (kan) au Centre quil identifie la Terr e cependant que
(dsignant les saveurs cardinales par les mmes mots que le Yue ling) le Hong
fan crit : (Ce qui) humecte (et) tend vers le Bas [Eau : 1], produit le sal ;
(ce qui) flambe (et) tend vers le Haut [Feu : 2] produit lamer ; (ce qui) se
courbe (et) se redresse [Bois : 3] produit lacide ; (ce qui) est ductile (et)
multiforme [Mtal : 4] produit lcre ; (ce qui) est ensemenc (et) moissonn
[Terre : 5] produit le doux. Le Yue ling et le Hong fan se rfrent, on nen
peut douter, un mme systme de classification. Mais, trait sur le
Marcel GRANET La pense chinoise 103
Calendrier, le Yue ling semploie montrer loffice des Nombres dans
lamnagement de lanne. Il ne considre que les nombres forts [ seconds
nombres] des couples 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, car leur total (6 + 7 + 8 + 9) fait 30.
30 (lun des principaux diviseurs de 360) peut, par lui -mme, voquer le
pourtour de lanne ; 6, 7, 8, 9 (en montrant comment se dcompose le total
30) mritent donc de servir de classificateurs aux quatre saisons qui compo-
sent lanne (
277
) [et que symbolisent les seconds nombres des couples
cycliques]. Le Hong fan, au contraire, se propose, en voquant une
progression de catgories, de rvler la constitution de lUnivers. Lorsque,
pour commencer (section 1), il indique une rpartition en lments, cest un
dispositif spatial quil entreprend de dcrire, et il le dcrit en marquant, si je
puis dire, les tapes de sa construction. Il nutilise que les nombres faibles des
couples congruents [ils en forment les premiers termes : ce sont les premiers
termes des couples cycliques qui sont affects aux diffrents
144
sites de
lEspace]. Ces nombres peuvent dautant mieux servir de rubriques aux sites
du dispositif que, placs au dbut de la srie numrique (1, 2, 3, 4), ils se
trouvent particulirement aptes signaler lordre des affectations qui
identifient tel site telle rubrique.
En effet, lnumration qui dtermine la fois le domaine et la valeur
numrique des diffrents lments reproduit le trac dun templum et
marque les temps de lopration. LEau [= Nord = 1 (= 1 + 5 = 6)] et le Feu
[ = Sud = 2 (= 2 + 5 = 7)] sopposent aux deux extrmits de la bran che quon
dessine la premire et quon trace verticalement en la commenant par le Bas
[= Nord] [o tend lEau (comme le dit expressment le Hong fan)] pour aller
vers le Haut [= Sud] [o tend le Feu (ainsi que le Hong fan laffirme)] ; le
Bois [Est = 3 (= 3 + 5 = 8)] et le Mtal [= Ouest = 4 (= 4 + 5 = 9)] se font
face aux deux pointes de la deuxime branche qui coupe perpendiculairement
la premire et doit se tracer horizontalement en allant de la Gauche
[= Est = Bois] la Droite [= Ouest = Mtal (
278
) ; la Terre [= Centre = 5 (qui
quivaut 10 = 5 + 5)] occupe le point central que la croise sert dterminer
et qui dfinit la place du Chef (
279
) [279p].
LEau est premire nomme parce quelle a pour domaine spatial le site
[Nord] qui est le premier constitu car la rubrique 1 le rgit cependant
que le classificateur 6 commande son domaine temporel [Hiver]. Le Feu, de
mme, se nomme le deuxime parce quil doit prendre place en deuxime lieu
dans le dispositif o il doit occuper lorient, [Sud ] dont la rubrique est 2, 7
appartenant comme classificateur la saison [t] correspondante.
Lis aux lments, les Emblmes numriques ne peuvent simaginer sans
quon ne les relie encore des Espaces et des Temps concrets. Ces liaisons,
et la liaison mme des Temps et des Espaces, ont pour premier effet de rendre
sans objet la distinction de lordinal, du cardinal et mme du distributif : ces
fonctions, dans les Nombres, demeurent indiffrencies tant, en eux,
lemporte la fonction classifi catoire. Mais, de plus, limpossibilit de les
concevoir en dehors de lEspace -Temps concret qui forme la chane et
145
la
Marcel GRANET La pense chinoise 104
trame dun Univers fini, a pour consquence darracher les emblmes
numriques la disposition linaire abstraite que semble exiger le caractre
illimit de leur suite. Ils sont forcs de sarranger en forme de cycle : riches
de reprsentations gomtriques et rythmiques, ils peuvent, bien mieux que
de simples symboles cycliques, servir de rubriques des groupements de
ralits quils iden tifient en signalant leur situation et leur ordre, leur forme et
leur composition.
II. Nombres, sites, emblmes divinatoires
Cest au moyen de nombres quil convient de figurer les secteurs
logiques, les catgories concrtes qui composent lUnivers. Et s i lon prtend
les figurer conformment leur essence et cet ordre constitutionnel que le
Hong fan appelle les rapports rguliers des tres , cest laide de
dispositions de nombres quon pensera y parvenir. En choi sissant pour
ceux-ci telle ou telle disposition qui permette de se reprsenter leurs jeux, on
croira avoir russi rendre lUnivers la fois intelligible et amnageable.
Toutes les vertus qui permettent un Hros damnager le Monde, Yu le
Grand les possdait. Il fonda donc la dynastie des Hia, et cest lui,
raconte-t-on, que le Ciel confia les 9 sections du Hong fan [css03].
Ceci ne signifie pas que le Ciel offrit Yu une dissertation en neuf points.
Dans la composition littraire quapr s la fin des Yin un prince de la maison
dchue rcita au fondateur des Tcheou, sexprimait, nul sen doute, le savoir
suprme reclus dans le Hong fan de Yu. Mais les mditations quavait pu
inspirer ce document cleste en diffraient de la mme manire,
apparemment, que diffrent du vritable texte du Yi king les gloses littraires
qui semblent composer ce livre sacr des devins. Soixante-quatre dessins, les
Hexagramme, composent eux seuls le texte vritable du Yi king : tout le
reste nest que commentai re, amplification, lgende pour aider au
dchiffrement des emblmes divinatoires. Cest dans ces 64 symboles
graphiques quest contenu un savoir, un pouvoir total. De mme, sans doute,
avant quelle ne ft mise au clair dans les neuf points de la dissertat ion rcite
146
au roi Wou, une pareille Somme de sagesse se trouvait dj dans les 9
Rubriques du Hong fan tel que Yu le possda. Hong fan veut dire grand
modle ou plan suprme . Que pouvaient figurer les Rubriques du Grand
Plan, sinon un groupement de symboles capables de susciter dans le rel
comme dimposer lesprit les arrangements de cat gories qui voquent
lordre universel ? Disposes autour du nombre 5 (emblme du poste
souverain et centre de lEspace) que pouvaient bien tre ces 9 Ru briques
numrotes, sinon, tout simplement, les 9 premiers symboles numriques ?
Marcel GRANET La pense chinoise 105
Assurment, ce que le Ciel donna Yu, ce ne fut pas la glose du texte,
mais sa lettre mme, ou plutt son chiffre : ce fut, modle dchiffrer, image
faite de nombres, le Monde lui-mme.
Aussi longtemps que les savants ne se sont point mls de critiquer les
traditions dans lintention de donner lhis toire ancienne un tour raisonnable
et correct, les Chinois ont identifi le Hong fan octroy Yu par le Ciel un
diagramme mythique, dnomm le Lo chou, o ils se sont appliqus voir un
arrangement de nombres.
Les traditions relatives Yu et au Hong fan se rfrent un ensemble de
mythes trop cohrents pour quon ait le droit de les ngliger. On sait que Yu
le Grand, comme il convenait un Fondateur ou un Dmiurge, fut la fois
un matre de forges et un matre arpenteur (
280
). Il parcourut et mesura les 9
Montagnes, les 9 Fleuves, les 9 Marais, amnageant le sol quon put enfin
mettre en culture, cest --dire quon partagea en champs, lesquels taient
carrs et diviss en 9 carrs : bref, nous dit-on, Yu divisa le Monde en 9
Rgions.
Aussi possda-t-il 9 Trpieds. Les 9 Pasteurs offrirent le mtal en tribut
et, sur ses chaudires, Yu put dessiner les emblmes des tres de tous les
pays, car ces emblmes lui furent remis titre dhommage par les 9
Rgions. La puissance incorpore en eux par ces symboles tait telle que les 9
Chaudrons valaient le Monde ; grce eux, dans tout lUniver s, rgnrent
lordre et la paix : les divers tres se tinrent cois dans leurs domaines, si bien
quil fut possible de parcourir sans danger les 9 Marais, les 9 Fleuves, les 9
Montagnes... Ainsi fut assure lunion du Haut et du Bas et
147
reue la
faveur du Ciel (
281
). A Yu donc, qui possdait avec ses 9 Trpieds une
image du Monde et la puissance sur le Monde, le Ciel transmit les 9
Rubriques.
Ce fut une tortue qui les lui apporta. Toutes-puissantes dans le Monde, les
tortues sont une image de lUnivers. Si les devins peuvent connatre par elles
les indices efficients qui conseillent les actes efficaces, cest quelles
participent de la longvit de lUnivers et si lUnivers leur fait part de la
longue vie, cest quelles prennent intimement part 1a vie universelle,
vivant troitement enveloppes dans un habitat amnag sur le modle du
macrocosme : leurs carapaces, en effet, carres par le bas, sont rondes par le
haut. Les tortues reprsentent si bien le Monde quelles figurent
ncessairement dans les mythes o lon voit un Hros tra vailler consolider
lordre universel. Si quelque Gnie mau vais, cassant une des colonnes du
Monde, et ne lui en laissant que trois, fait basculer le Ciel et la Terre et livre
lUnivers au Dluge, un Gnie bienfaisant peut rtablir la stabilit en
redonnant au Monde quatre colonnes faites avec les pattes coupes dune
tortue (
282
), car il ne faudrait point laisser les tortues se dplacer et nager
librement, ou bien les Terres partiraient la drive et les Eaux les englou-
tiraient (
283
). Aprs que Kouen, monstre nfaste et tortue trois pattes, eut
Marcel GRANET La pense chinoise 106
dchan les Grandes Eaux qui menacrent denglo utir Ciel et Terre (
284
), Yu,
qui tait son fils, mais un Hros parfait par la vertu comme par le corps,
rtablit le bon ordre. Il sut trouver la gloire dans des travaux mythiques qui se
rattachent au thme du Monde sauv des Eaux : une tortue devait donc figurer
dans son histoire. Yu le Grand, en effet, rduisit les Eaux au devoir et
disciplina les Fleuves. Or donc, un cheval-dragon ou le Fleuve lui-mme,
dieu au corps de poisson ou de tortue (
285
), dut sortir du Fleuve jaune et lui
remettre le Tableau du Fleuve (Ho tou) ; une tortue dut sortir de la rivire Lo
pour lui prsenter le Lo chou (crit de la rivire Lo) qui est dit la tradition
le Hong fan.
Image du Monde, une tortue apporta Yu cette image Yu qui,
lui-mme, par sa voix, sa taille, son pas, pouvait servir dtalon toutes les
mesures : tout ce que les nombres sont destins voquer. Comme les 9
Trpieds
148
de Yu, les images sorties des Eaux furent conserves, dit
lhistoire, da ns le trsor des Rois, Fils du Ciel ; ils figuraient parmi les gages
et les principes de leur puissance ; quand prit la Royaut, les Trpieds
svanouirent dans les Eaux et nul ne sait ce quil advint alors du Ho tou et
du Lo chou... Le Lo chou et le Ho tou ne reparurent que sous les Song, au
XIIe sicle de notre re. Ce fut sous le rgne dun Empereur qui favorisa la
gomancie et collectionna les grimoires taostes ; il fit aussi fondre 9
Trpieds (
286
)...
Les savants nont qu e mpris pour le Lo chou et le Ho tou des Song. Ces
uvres ne manquent pas pourtant dintrt ; ce sont tout simplement des
arrangements de nombres : aprs de longs sicles de civilisation brillante, les
savants chinois ne cessaient pas de prter aux emblmes numriques la
fonction de figurer lUnivers. Lessentiel, pour nous, est de constater ce parti
pris. Sa persistance invite le considrer comme une attitude fondamentale
de lesprit chinois. Mais, par ailleurs, pourquoi accabler les faussaires ?
Ils nont rien invent, ce ne sont que des rudits : ils se sont borns traduire
graphiquement des ides quil ne sagit pas, pour nous, de faire remonter
Yu, Hros mythique, mais qui nen sont pas moins suffisamment anciennes
pour mriter notre intrt. cf. figure 01
Le Ho tou des Song figure [au moyen des ronds blancs (yang) ou noirs
(yin) selon quils sont impairs ou pairs] les dix premiers nombres disposs en
croise avec, au centre, 5 et 10 : cest, on la vu, la disposition que, pour les
emblmes numriques des lments, Orients et Saisons, supposent le Yue
ling et la premire section du Hong fan. Quant au Lo chou, le diagramme qui
prtend le restituer sinspire de donnes formellement attestes ds l poque
des Han (
287
). Ce diagramme, sil nest pas moins intressant que lautre,
149
nest pas fait pour surprendre beaucoup plus. Les 9 pre miers nombres y sont
disposs en carr magique (autour de 5) ainsi quon pouvait le prvoir
pour un tableau du Monde offert (par lintermdiaire dune tortue) un Hros
qui divisa 1a Terre (carre) en 9 Rgions (carres). cf. figure 02
Marcel GRANET La pense chinoise 107
Yu, pour organiser le Monde, larpenta. Il le parcourut effectivement. Les
souverains qui ne sont pas des Fondateurs se contentent, comme on sait, de
circuler dans la Maison du Calendrier. Leur circumambulation sur
lemplacement sacr du Ming tang suffit ordonner lEspace et le Temps et
maintenir une exacte liaison des Saisons et des Orients.
Rond par son toit de chaume et carr par sa base, le Ming tang est une
image du Monde aussi parfaite que peut ltre une tortue.
Les devins (288) peuvent faire surgir dune carapace de tortue un cycle
complet de signes : 360 types de fissures les renseignent sur lensemble des
circonstances de temps et de lieu. Il les font apparatre [en se servant du Feu
(= Haut = Ciel)] sur la partie basse [et carre (= Terre)] de la carapace. Ce
sont les divisions de cette partie infrieure de lcaille qui permettent de
caractriser les fissures cf. figure 03 : une ligne axiale allant de lArrire
lAvant [lArrire vaut le Bas (= Nord) et (Avant vaut le Haut (= Sud)]
partage lcaille en deux moitis qui sont la Gauche (= Est) et la Droite (=
Ouest) ; cet axe est coup par 5 raies qui figurent les 5 lments ; elles dter-
minent [6 Gauche et 6 Droite] 12 sites [qui sont les sites des 12 mois],
mais elles nenserrent que 8 domaines, lesquels (coupls par deux) se
disposent en formant 4 secteurs autour du Centre marqu par la croise de
laxe mdian et de la raie centrale (
289
). Ainsi [aprs avoir
150
(en
considrant 1 axe et 5 voies transversales) dessin une croise de faon
voquer une rpartition par 5], on arrive [bien que lon op re, dit-on, en
distinguant 6 catgories (ou plutt, trois couples de catgories, savoir : le
Haut et le Bas, la Gauche et la Droite, et aussi le Yang et le Yin)] ne
distribuer lEspace o les 360 signes pourront apparatre et se spcifier
quen tre 4 domaines (doubles) qui, seuls, mritent de porter un nom.
De mme, dans le Ming tang (290) lEspace, o la circulation royale
doit susciter lapparition du cycle complet de jours qui compose une anne,
ne se divise quen 5 domaines dnomms (et consacrs aux 5 lments)
dont lun ne correspond quau Centre et au pivot du Temps, tandis que les 4
autres figurent les Orients et les Saisons relles. Et cependant, dans le Ming
tang, aussi, se trouvent mnags, de faon correspondre 12 stations
royales propices la promulgation des ordonnances (yue ling) qui
conviennent aux 12 mois, 8 emplacements, dont 4 occupent des positions
angulaires et les 4 autres (seuls dnomms) des positions cardinales. Cet
amnagement de lEspace sacr peut sexprimer par deux dispositions
architecturales ; elles furent prconises, lune et lautre, lpoque des Han,
par les savants qui prtendaient fournir aux Empereurs les plans vritables
dun Ming tang. Selon les uns, la Maison du Calendrier devait se diviser en 9
salles ; elle ne comprenait, selon les autres, que 5 btiments ou 5 pices.
Fait de pices contigus ou de btiments indpendants, le Ming tang 5
salles dessine une croix simple inscrite dans un carr (ou un rectangle) ; le
Ming tang 9 salles occupe entirement ce carr ; mais, tous deux
comprenant une salle place au centre et, si je puis dire, sans vue, tous deux
Marcel GRANET La pense chinoise 108
possdent galement 12 regards sur lextrieur cf. figure 13 : en effet,
chacune des salles cardinales du Ming tang en forme de croix a trois faades
externes [4 x 3 = 12], cependant que,
151
dans le Ming tang carr, ces
mmes salles nont quune faade, les 4 salles dangles, ayant, en revanche,
faade double [(4 x 1) + (4 x 2) = 12]. Les deux dispositions architecturales
conviennent aussi bien lune que lautre sil sagit de disposer autour dun
centre 12 vues ou 12 stations cycliques.
En fait, les deux systmes de construction ne sopposent que parce quils
ont pour objet de traduire deux dispositions diffrentes des nombres.
Lune de ces dispositions est implique par le Yue ling. Ce trait sur le
calendrier indique les positions que le Fils du Ciel doit occuper sur
lemplacement du Ming tang quand il dicte les ordonnances mensuelles
(yue ling). Pour les mois initiaux ou terminaux des diverses saisons, il suffit
que le souverain se porte gauche ou droite de lune des 4 salles cardinales.
Cest, en revanche, dans ces salles mmes quil doit prendre place aux mois
(solsticiels ou quinoxiaux) qui forment le centre des 4 saisons. On sait que le
Yue ling affecte aux trois mois de chaque saison un seul et mme nombre [6
pour lHiver (Nord), 8 pour le Printemps (Est), 7 pour lt (Sud), 9 pour
lAutomne (Ouest) et 5 pour le Centre)] : cf. figure 04. Le Ming tang 5
salles est conu, on le voit, pour voquer la disposition des nombres en croix
simple que le Ho tou des Song devait illustrer, et que le Hong fan impliquait
dj.
Larrangement en carr a, de mme, une base numrique. La tradition du
Ming tang 9 salles se trouve dfendue par le Ta Tai Li ki (291). Cet
ouvrage, prcisment, affecte chacune des 9 salles (comme le Hong fan
chacune des 9 Rubriques) lun des 9 premiers nombres, et, ces nombres, il les
nonce dans un ordre (2,9,4 ; 7,5,3 ; 6,1,8) qui suppose
152
un arrangement
en carr magique : cf. figure 07
Cette disposition (qui est celle du Lo chou des Song) possdait donc, pour
Marcel GRANET La pense chinoise 109
4 9 2
3 5 7
8 1 6
le moins ds le temps des Han, une valeur rituelle : ds cette poque, elle
paraissait constituer une image du Monde quil importait de retrouver dans le
plan du Ming tang, tout un ensemble de traditions invitant, dautre part,
penser quun Hros avait pu la dchiffrer sur une car apace de tortue.
Les traditions relatives au Ming tang le prouvent nouveau : les
Nombres ont pour principal office de caractriser des sites et dexprimer
lorganisation de lEspace -Temps.
La disposition en carr magique dont le prestige sest impos aux
techniciens du Ming tang ne jouissait pas dune faveur moindre auprs des
thoriciens de la divination. Nous allons constater cette vogue et pourrons, du
mme coup, en comprendre la raison. Tout aussi bien quen divi sant en
secteurs lcaille divinat oire, on peut, en disposant les nombres en carr,
arriver voquer le Total (360) des circonstances de temps et de lieu qui
conditionnent les travaux des devins ainsi, du reste, que luvre des Fils
du Ciel dans la Maison du Calendrier.
*
* *
Le point de dpart de la vogue des carrs magiques se trouve dans un
ancien systme de spculations qui portent sur les Emblmes divinatoires et
aussi sur les Nombres.
Lessentiel de ce systme a t consign, plusieurs sicles avant les Han,
dans le Hi tseu. Nulle uvre, si ce nest le Hong fan, nest plus proche des
dbuts de la tradition crite.
Le Hi tseu fait partie du cycle du Yi king. Les matres du Yi king
opraient sur des signes fournis par lachille. La divination par lachille, au
tmoignage des savants qui la pratiquaient, ne reposait pas sur un autre savoir
que la divination par la tortue. Ces deux mthodes dinvestigation pa -
raissaient solidaires et destines se complter : le Hi tseu lui-mme
laffirme et aussi le Hong fan, comme, par ailleurs,
153
le Tcheou li (
292
). Les
mythes relatifs la tortue donnent penser que lart de prparer lcaille en la
divisant en domaines se rattache aux techniques utilises, pour la division des
terres, par les arpenteurs gomtres. Le savoir, en revanche, qui permet
didentifier les circonstances de temps (et de lieu) laide de btonnets
dachille, parat li une technique du calcul. Mais les anciens Chinois
Marcel GRANET La pense chinoise 110
vitaient de distinguer larithmtique et la gomtrie. Nombres et f igures
fournissaient aux sages des symboles, pratiquement interchangeables et
galement puissants, qui rendaient faciles lidentifi cation et la manipulation
des ralits de toute espce.
Le mot qui dsigne les fiches divinatoires dsigne aussi les fiches
calcul. Lorsquils tiraient les sorts et faisaient leurs supputations, les devins
devaient conserver, entre le quatrime et le cinquime doigt de la main
gauche, une de ces baguettes qui figurait alors lHomme plac entre le Yin et
le Yang (
293
). Quand on hsitait sur la voie suivre, on devait de mme tenir
en main une de ces fiches : elle servait alors de bton-pilote (
294
). Le caractre
qui reprsente ces btonnets scrit en ajoutant la cl du bambou un
ensemble graphique figurant, dit-on, les traces quune charrue imprime sur le
sol. Si lon ajoute ce groupe de traits la cl qui reprsente les champs
cultivs en carr, on obtient un caractre de prononciation identique
(tcheou). Il signifie cultiver la terre, limites des terres, domaines
hrditaires . Ce signe semploie pour dsigner les savants (astronomes,
astrologues, matres du calendrier) vous hrditairement lart du calcul...
Gnie des nombres, gnie des figures, gnie gouvernemental, gnie
divinatoire se confondent... Cest tout justement le mot tcheou qui sert
dnommer les 9 Sections du Hong fan, les 9 Rubriques ou les 9 Domaines du
Grand Plan que la tradition identifie au Lo chou apport Yu, larpenteur,
par la tortue.
Mais ce nest pas sous le patronage de Yu que le Hi tseu se trouve plac :
cest sous celui de Fou -hi. Fou-hi a pour attribut lquerre et sa femme le
compas. On les reprsente toujours se tenant enlacs, car leurs corps se
terminent par un nud de serpents (
295
). Prn par les tenants du Yi king,
Fou-hi a t pouss au premier rang des auteurs de la civilisation ; il inventa
le systme des cordes noues ainsi que la
154
divination par les baguettes
dachille qui furent les premiers moyens de gouvernement. Il eut une
naissance miraculeuse : certains racontent que sa mre le conut par leffet
dun bton flottant ; dautres (cest la version courante) quil fut mis au
monde dans un marais clbre par les Dragons qui le hantaient. Il avait
laspect dun Dragon... (
296
). Cest donc lui que, selon la tradition la plus
suivie, un Dragon apporta le Ho tou, lui et non pas Yu, le fondeur de
Trpieds... Mais Dragons et Trpieds se distinguent mal. Pour peu quils
soient prcieux, on retrouve sur les Trpieds les reflets changeants des
Dragons (
297
). Et, quand un Saint mrite dattirer les Dragons, il commence
par entrer en possession dun Tr pied. Ce dernier, au reste, ne lui promet
larrive du Dragon que si des btons dachille laccompagnent... LHistoire
ne dit pas que Fou-hi ait trouv ou fondu 1 ou 9 Trpieds. Elle sait seulement
que cet inventeur des Trigrammes partagea, bien avant Yu, le Monde en 9
Rgions.
Cest mme loccasion de cet exploit que les annotateurs des Annales
sur bambou savisent de rapporter une glose de Tcheng Hiuan o ce l ettr
Marcel GRANET La pense chinoise 111
clbre de lpoque des Han indique lordre de cration des Trigrammes
divinatoires.
Les spcialistes de lachille opraient en manipulant un jeu de baguettes
de faon obtenir un rsultat pair ou impair. Ils traduisaient graphiquement
ce rsultat en traant une ligne continue (impaire, yang, mle) ou brise
(pai re, yin, femelle). Ils arrtaient leurs oprations quand ils avaient
dessin une figure forme de 6 lignes superposes. En superposant 6 lignes
brises ou continues, on peut composer 64 Hexagrammes diffrents. Avec 3
lignes, on ne peut composer que 8 Trigrammes. Il est ais de constater que
chacun des (8 =) 64 Hexagrammes est fait de deux Trigrammes
superposs (
298
) : les 8 Trigrammes rsument donc les 64 Hexagrammes.
Ceux-ci passent pour reprsenter lensemble des r alits ; ceux-l fournissent,
si je puis dire, une reprsentation concentre de lUnivers.
Pour que cette image du Monde soit estime parfaite, il convient quelle
comporte une orientation des Trigrammes.
Assimils mythiquement aux 8 Vents, les 8 Trigrammes servent, en effet,
disposs en octogone, former une rose des
155
vents huit directions. Le
Lo chou soppose au Ho tou, et lon connat, pour le Ming tang comme pour
les Nombres, deux dispositions concurrentes : il existe de mme deux
arrangements des Trigrammes. Tous deux taient clbres ds lantiquit.
Loin de paratre sexclure, ils semblaient rendre des services
complmentaires. Le Chouo koua (qui est lun des principaux traits du cycle
du Yi king), se rfre, selon loccasion, tantt lun et tantt lautre de ces
arrangements. Lun deux est remarquable par une recherche de symtrie
graphique : cest celui que la tradition rapproche du Ho tou et attribue
Fou-hi, inventeur des Trigrammes :
DISPOSITION DITE DE FOU-HI : cf. figure 05
Figures et noms des Trigrammes dans la disposition dite de Fou-hi. La ligne spare les Trigrammes
mles (M) [ceux dont la ligne infrieure (tourne vers le centre) est continue (yang)] des Trigrammes
femelles (F) [dont la ligne de base est brise (yin)].
Lautre serait d au roi Wen, Fondateur des Tcheou. Le roi Wen inventa,
dit-on, les Hexagrammes, Il sest aussi rendu clbre par la construction dun
Ming tang. La disposition dite du roi Wen est dordinaire mise en rapport
avec le Lo chou. Fait curieux : bien que la glose de Tcheng Hiuan soit utilise
propos de la division du Monde en 9 Rgions qui fut luvre de Fou -hi (le
matre du Ho tou), cest la dispo sition du roi Wen (le constructeur du Ming
tang) que cette glose se rfre.
Marcel GRANET La pense chinoise 112
DISPOSITION DITE DE WEN : cf. figure 06
Figures et noms des Trigrammes dans la disposition dite du roi Wen. La ligne spare les Trigrammes
(M) mles [celui qui est fait de 3 lignes continues et les trois qui contiennent une seule ligne continue]
des Trigrammes (F) femelles [ceux qui ont un nombre impair (3 ou 1) de lignes brises].
Selon les traditions recueillies sous les Han par Tcheng Hiuan, cest
lUnit suprme ( Tai Yi ) qui dispose lempla cement qui convient (kong =
palais, chambre) chacun des 8 Trigrammes ; chaque fois quelle en a plac
quatre, lUnit suprme revient se reposer au Centre. Voici donc le chemin
[hing : cest le mot que, dans lexpression wou hing (le 5 hing), on rend par :
lment] quelle pa rcourt. Partant (1) de Kan (N), elle passe (2) par Kouen
(SW), puis (3) par Tchen (E), puis (4) par Siuan (SE) et de l, aprs avoir
touch au Centre [5] (qui est sa propre demeure), elle arrive (6) Kien
(NW) do en passant (7) par Touei (W), pu is (8) par Ken (NE), elle gagne
(9) Li (S), do elle reviendra au Centre [10 = 5]. cf. figure 07
Lordre suivi est celui qui permet de disposer les nombres dun carr
magique (
299
) en partant du plus petit pour finir par le plus grand : et, en effet,
si lon remplace les Trigrammes par le classificateur numrique (
300
) qui
correspond leur rang de production, on obtient un carr magique
157
centre 5 : les nombres y reoivent une orientation identique celle quon leur
attribue quand ils servent qualifier les 9 divisions du Ming tang.
*
* *
Comme les lments (quand on les dispose en croise), les Trigrammes,
ds quon les oriente, se voient affecter un e valeur numrique : eux aussi ont
pour emblmes les nombres qui servent dindices leur localisation dans
lEspace -Temps, et cest par ces nombres que se rvle leur ordre
constitutionnel. Un mme systme de postulats se trouve donc la base des
deux arrangements (carr ou croise numriques) qui fournissaient aux
anciens Chinois des images du Monde juges complmentaires plutt
quopposes. Ds lpoque du Hong fan, lordre constitutionnel des lments
se traduisait en dessinant une croise numrique ; le carr magique qui rend
manifeste lordre constitutionnel des Trigrammes ne doit pas jouir dun
prestige moins ancien.
Ce prestige clate dans les traditions recueillies sous les Han (301)par le
Ta Tai Li ki et par Tcheng Hiuan, mais cest le Hi tseu qui permet den
comprendre les raisons.
Appels par leur mtier manipuler des fiches divinatoires, qui sont aussi
des fiches calcul, les Matres du Hi tseu avaient labor une thorie de la
divination qui sap puyait sur une science des Nombres. Lart de disposer et
Marcel GRANET La pense chinoise 113
de combiner des emblmes divinatoires se confondait pour eux avec lart des
combinaisons numriques.
Dans un passage qui se rapporte la disposition octogonale des
Trigrammes, et o ces derniers sont expressment assimils des Nombres,
le Hi tseu les prsente comme groups de manire sopposer
diamtralement, ces oppositions tant toutes, semble-t-on dire, commandes
par la formule 3 x 5. Les commentateurs orthodoxes ne donnent de ce passage
quune glose vi de de toute apparence de sens (
302
). En revanche, certains
interprtes indignes ont voulu y voir une allusion au carr magique centre
5, o les couples de nombres extrieurs qui sopposent diamtralement
forment toujours un total de 10, si bien que le total des 3 nombres
158
[centre
(5) compris] disposs sur une mme ligne est ncessairement gal 15.
Le passage est trop obscur pour quon puisse faire tat de cette
interprtation sduisante, mais il convient de retenir limp ortance attribue au
nombre 15. Celle-ci se trouve affirme par des faits qui sinsrent dans une
tradition immmoriale.
Les devins qui se servaient du Yi king pour dchiffrer les symboles
divinatoires dnommaient laide du nombre 9 les lignes yang des diverses
figures et par le nombre 6 les lignes yin. Ces appellations sexpliquent par le
fait que le rapport du Yin au Yang reprsente le rapport de la Terre au Ciel et,
partant, du Carr au Rond. Ce rapport, qui est de 2 3, peut sexprimer par
les nombres 6 et 9. Mais dautres devins, ceux du pays de Song, se servaient
pour leurs dchiffrements non du Yi king, mais du Kouei tsang, manuel qui
passait pour plus ancien, car on voyait en lui le livre de divination en usage
sous la dynastie Yin. Pour ces devins, les lignes paires (yin) valaient 8, et les
lignes impaires (yang) 7. En fait, il semble qu lpoque Tchouen tsieou on
utilisait concurremment les deux systmes de symboles numriques. Comme
le montre un passage du Tso tchouan (
303
) opter pour lun ou lautre de ces
systmes permettait un oprateur astucieux de rendre des oracles plus
convenables.
Une double remarque simpose : lopposition du Yin et du Yang est
essentiellement celle du Pair (8 ou 6) et de lImpair (7 ou 9), et, dautre part,
8 + 7, comme 9 + 6, galent 15.
Notons ici qu lorigine des figures divinatoires le Hi tseu place, aprs
les deux symboles lmentaires (quon dit constitus par une ligne brise ou
continue), quatre symboles secondaires, auxquels toute la tradition attribue
les dsignations de Grand Yang (ou Vieux Yang), Petit Yin (ou jeune Yin),
Petit (ou jeune) Yang, Grand (ou Vieux) Yin (
304
). A chacun de ces symboles
correspond un emblme numrique : le Vieux Yang et le jeune Yang
(impairs) valent respectivement 9 et 7, le Grand Yin et le Petit Yin (pairs) 6 et
8.
Marcel GRANET La pense chinoise 114
Or, si le Grand Yin (6) correspond au Nord-Hiver, dont llment
emblmatique est lEau (6), et si le jeune Yin (8) est (ordinairement) assimil
lEst-Printemps dont
159
llment est le Bois (8), le Jeune Yang (7)
correspond lOuest -Automne, bien que le Mtal, emblme de ce quartier de
lunivers vaille 9, tandis que 9 est le nombre du Vieux Yang, lequel
commande au Sud-t, secteur dont llment (Feu) vaut pourtant 7.
Les valeurs numriques attribues aux 4 emblmes secondaires du Hi
tseu impliquent une orientation des nombres diffrente de celle quils
reoivent lorsque, connotant des lments, ils sont disposs en croise, ainsi
que le suppose le Hong fan et que la reprsent le Ho tou. Lorientation
quimposent aux nombres du Grand Yang et du Petit Yang (ainsi qu ceux
du Grand et du Petit Yin) les affectations spatiales de ces emblmes est, au
contraire, celle du carr magique, o 9 ainsi que 4 (nombres congruents) sont
disposs sur la face Sud et 7 ainsi que 2 (nombres congruents) sur la face
Ouest, 6 (et 1) comme 8 (et 3) tant respectivement placs sur les faces Nord
et Est.
Dans les figurations, dailleurs tardives, quon en a donn, l es quatre
symboles secondaires sont reprsents comme forms de deux lignes (
305
).
Grand Yang
9
Petit Yin
8
Petit Yang
7
Grand Yin
6
Il y a de grandes chances que cette reprsentation soit due un travail
dabstraction dri vant dun classement des Trigrammes sur lequel le Chouo
koua insiste longuement et dont le Hi tseu proclame le principe (
306
). Ce
principe devait avoir une extrme importance pour des gens qui, par mtier,
jouaient constamment sur le pair et limpair.
Il se fonde sur la remarque que le pair sobtient en unis sant des paires
dimpairs (comme aussi en sajoutant lui -mme), tandis que limpair se cre
grce une addition ou plutt une synthse (exactement parlant : une
hirogamie) du pair et de limpair. Aussi considrait -on comme yin (pair) les
Trigrammes faits de deux lignes yang (paire dimpairs = pair) et dune ligne
yin [paire (dimpairs) + Pair = Pair) ], et comme yang les Trigrammes faits de
160
deux lignes yin (paire de pairs = pair) auxquelles sajou tait une ligne
yang [paire (de pairs) + impair = impair]. Les quatre Trigrammes pairs
comprenaient un Trigramme (fait de trois lignes brises) o lon voyait
lemblme de la mre et auquel sop posaient trois Trigrammes, appels les
trois filles, tous forms de deux lignes mles et dune ligne femelle. Si lon
suppose (comme cela semble indiqu) que toute ligne femelle, paire, vaut 2,
et que toute ligne mle, impaire, vaut 3, les trois derniers Trigrammes
pouvaient tre exprims par la valeur 8 [= (3 + 3) + 2] et le premier par la
Marcel GRANET La pense chinoise 115
valeur 6 (= 2 + 2 + 2). De mme, aux trois Trigrammes yang, dnomms les
trois fils (faits dune ligne yang et de deux lignes yin), convenait la valeur 7
[= (2 + 2) + 3] et la valeur 9 [= 3 + 3 + 3] au dernier Trigramme
entirement fait de yang, et qualifi de pre.
On voit que les nombres exprims graphiquement par les emblmes du
pre et de la mre sont respectivement ceux du Vieux Yang et du Vieux Yin,
et lon peut induire que les emblmes numriques attribus au Jeune Yang et
au jeune Yin dpendent de la figuration des Trigrammes qualifis de fils et de
filles.
Le classement des Trigrammes qui parat correspondre ces quivalences
numriques est celui quutilise l arrangement invent, dit-on, par le roi Wen
clbre par son Ming tang : or, lordonnance du Ming tang passe pour
tre inspire par le carr magique, tandis que larrangement du roi Wen est
mis en rapport avec le Lo chou, quon figure laide de ce c arr.
Dans cet arrangement (
307
), les quatre Trigrammes mles stendent du
Nord-Ouest lEst et les quatre femelles du Sud -Est lOuest, spars par un
axe E.-S.-E. W.-N.-W. Si lon oriente conformment leurs quivalences
traditionnelles les symboles numriques du jeune et du Vieux Yang, du Vieux
et du jeune Yin, cest un axe de direction analogue qui sparera le groupe
impair (S.-W.) du groupe pair (N.-E.). Au contraire dans larrangement dit de
Fou-hi (
308
), les Trigrammes yang [dfinis, cette fois, comme tels par le sexe
(mle) de leur ligne infrieure (ligne intrieure dans lar rangement en
octogone)] stendent du Sud au Nord -Est, et les Trigrammes yin
[caractriss par leur ligne infrieure
161
brise] du Nord au Sud-Ouest.
Laxe qui les spare suit en ce cas la direction S. -S.-W. N.-N.-E.
Marcel GRANET La pense chinoise 116
S 9 (VIEUX YANG)
E 8 (JEUNE YIN) 7 W (JEUNE YANG)
6 N (VIEUX YIN)
Cette dernire rpartition saccorde peut-tre avec la disposition des
nombres quand ils figurent les lments et forment une croise, car, dans ce
cas, le couple 7-8 (S.- E.) est spar du couple 9-6 (W.- N.) par un axe dont la
direction est analogue celle de la ligne de sparation des deux groupes de
Trigrammes dans larrangement attribu Fou-hi. Ce schma veut sans doute
faire apparatre lquilibre du Yin et du Yang reprsents par des couples
numriques de valeur quivalente (9 + 6 = 8 + 7 = 15). Sans doute aussi la
mme ide est-elle illustre par le dispositif du roi Wen.
S 7 (FEU)
E 8 (BOIS) 5 9 W (METAL)
(TERRE)
6 N (EAU)
En effet, si lon remplace les trigrammes ( mre et filles ; pre et fils) par leurs
quivalents numriques, on aperoit que les groupes yang et yin se font
encore quilibre [(8 x 3) + 6 = (7 x 3) + 9 = 30]. Mais, dans le dispositif o
figurent seuls, placs aux points cardinaux, les nombres significatifs des 4
emblmes secondaires du Hi tseu, cest laxe E. -S.-E.W.-N.-W. qui spare
les nombres impairs (9-7) des nombres pairs (6-8). Les deux couples qui
trouvent ainsi distingus ont, cette fois une valeur ingale : lun vaut 16 et
lautre 14, soit 8 x 2 et 7 x 2, ce qui, peut -tre, justifie lattribution des valeurs
8 et 7 aux emblmes lmentaires du Yin et du Yang. Mais, de mme que le
rapport 8/7, le rapport 9/6 est voqu par cet arrangement.
Marcel GRANET La pense chinoise 117
S
8
8 6
Yin
E 7 8 W
Yan
g
7 9
7
N
En effet, une tradition incorpore au Po hou tong permet destimer quon
doit rattacher au groupe impair 9-7 le nombre central 5 (= Terre). Le Po hou
tong (309)affirme quil y a 2 ( pair) lments yang (impair), savoir lEau et
le Bois dont les valeurs (6 et 8) sont (pourtant) paires, et 3 (impair) lments
yin (pair), savoir les 3 lments (de valeur impaire cependant) 5, 7, 9 : Terre,
Mtal, Feu (1). Cette thorie, en apparence paradoxale, comporte une
nouvelle illustration du n thme que jai dj signal : les jeux du Yin et du
Yang (femelle et mle) ont pour principe une inversion dattributs (pair et
impair) qui rsulte dun change hirogamique. La classification du Po hou
tong suppose vraisemblablement lintention de mett re en vidence la valeur
globale des deux groupes ingaux (3 face 2) dlments. Ceux que lon
considre comme yin (tout en leur donnant des symboles impairs et en les
groupant par 3) valent 21 (= 3 x 7), tandis que valent 14 (= 2 x 7) les
lments qualifis de yang (quon groupe par 2 et qui ont reu des symboles
pairs) : on fait ainsi apparatre que le rapport (invers) du Yang (3) au Yin (2)
est 14/21, soit 2/3. Il y a de grand chances que la classification des
Trigrammes du roi Wen soit une illustration du mme thme, puisque
lorientation des Emblmes secondaires dont elle parat solidaire oppose aussi
6 et 8 (total : 14 = 2 x 7) 9 et 7, auxquels il faut, sans doute, ajouter 5
(emblme du centre) total : 21 = 3 x 7.
163
Fait remarquable, le rapport (invers) du Yin et du Yang se trouve
voqu de manire analogue dans le carr magique qui, si lon en croit
Tcheng Hiuan, tmoigne de lordre consti tutionnel des Trigrammes. On a vu
que cet ordre apparat prcisment dans larrangement qui est attribu au roi
Wen. cf. figure 08
Aux Trigrammes yang (N.-E.) correspondent les couples congruents 3-8
et 1-6, dont le total vaut 18 (= 2 x 9) ; aux Trigrammes yin (S.-W.), les
couples 4-9 et 2-7, lesquels, si on leur ajoute le 5 central, valent 27 (= 3 x 9) :
ce qui fixe encore 2/3 le rapport (invers) du Yang et du Yin reprsents par
les deux familles de Trigrammes.
Marcel GRANET La pense chinoise 118
Or, si le carr magique peut voquer ce rapport, nous allons voir que cest
prcisment sous les aspects o il intresse particulirement le Hi tseu (
310
).
*
* *
Le Hi tseu contient un important dveloppement sur les nombres. Ce
dveloppement vise montrer que les emblmes divinatoires sont capables
dvoquer la totalit des choses ce que les Chinois appellent les Dix mille
tres ou Essences (wan mou).
Les devins pouvaient en prciser le nombre, qui tait, selon eux, 11 520.
En effet, les 64 hexagrammes comportent 384 lignes (= 6 x 64), soit 192
lignes paires et 192 lignes impaires. Le pair valant les 2/3 de limpair, on
admettait que 192 lignes paires reprsentaient 4 608 (= 192 x 24) Essences
fminines, les 192 lignes impaires 6 912 (= 192 x 36) Essences masculines, si
bien que le total des choses yang et yin tait de 11 520 (= 4 608 + 6 912).
10 000 est un Grand Total populaire. 11 520 est le nombre le plus
164
proche
de 10 000 qui soit un multiple la fois de 360 [nombre thorique des jours de
lanne] et de 384, [qui reprsente la fois le total des lignes emblmatiques
et le total des jours dune anne embolismique (
311
) : 11 520 = 384 x 30 et
360 x 32 ou encore (216 + 144) x 32].
A une division du total des choses en 5 parties qui permet de les opposer
selon le rapport 3/2 (= 6 912 / 4 608 = 192 x 36 / 192 x 24), daprs la
remarque 60 = 5 x 12 (= 36 + 24), correspond une division de ce total quest
lanne en 5 parties, valant chacune 72 (= 6 x 12) : on arrive ainsi
dcomposer 360 selon le rapport 3/2, en opposant 216 (= 3 x 72), emblme
du Yang (impair), 144 (= 2 x 72), emblme du Yin (pair).
Aux passages o ils expriment le rapport 3/2 en des termes qui leur
paraissent significatifs, les auteurs du Hi tseu juxtaposent des remarques sur
les dix premiers nombres quinspire lintention dopposer le pair et limpair.
Aprs avoir dclar que les 5 premiers nombres impairs sont produits par
le Ciel et les 5 premiers nombres pairs par la Terre, ils indiquent que ces dix
nombres se disposent dans lEspace de faon former des couples
pair-impair. Ces 5 couples peuvent tre, et telle est lopinion des
glossateurs, les couples constitus par 2 nombres congruents 5 (1-6, 2-7,
3-8, 4-9, 5-10) : on sait que ces couples se retrouvent, orients, tout aussi bien
dans le Ho tou que dans le carr magique (Lo chou). Ils sont, dans le Ho
tou, disposs au
165
centre et sur les branches dune croise. Il suffit de
rabattre angle droit les quatre extrmits de la croise pour obtenir la
disposition en carr magique, si lon a soin de consacrer les positions
cardinales aux nombres impairs, et dintervertir les couples 7-2 et 9-4.
Marcel GRANET La pense chinoise 119
S S
7
|
2 4 --
-
9 2
| |
E 8 --
-
3 5.10 4 --
-
9 W E 3 --
-
5 --
-
7 W
| |
1 8 1 --
-
6
|
6
N N
Exprime par des auteurs que proccupent visiblement les divisions en 5
parties, lide de disposer dans les sec teurs de lEspace 5 couples de nombres
congruents peut passer pour une allusion la disposition en croise o sont
figurs avec leur orientation les emblmes des 5 lments. Mais, sans se
refuser admettre cette thse, on ne doit pas oublier que linterprtation
traditionnelle du Hi tseu attribue au Vieux Yang, symbole du Sud,
lemblme 9, et au jeune Yang, symbole de lOuest, lemblme 7. Ce nest
que dans le carr magique que 7-2 est lOuest et 9 -4 au Sud.
Or, le Hi tseu, sil insiste sur la possibilit de former 3 couples
pair-impair avec les 10 premiers nombres, insiste, dautre part, sur la valeur
totale de ces dix nombres qui est 55. 55 vaut 5 fois 11, et lon peut former 5
couples pair-impair (1-10, 2-9, 3-8, 4-7 et 5-6) ayant chacun 11 pour somme.
Le Hi tseu ne manque pas de signaler que les 5 premiers nombres pairs
valent 30 (= 5 fois 6) et les 5 premiers nombres impairs 25 (= 5 fois 5).
Lopposition du pair et de limpair, telle quelle se manifeste dans les 10
premiers nombres considrs comme reprsentatifs de la srie numrique tout
entire, a donc pour symbole le rapport 6/5, ce qui doit prter au nombre 11
[= 5 + 6] un prestige gal celui du nombre 5 [= 3 (Ciel, rond) + 2 (= Terre,
carr)]. Limportance attribue 11 ne peut gure surprendre quand en
connat le rle de classificateur privilgi qui appartient 5, emblme de la
Terre (carre), comme 6, emblme du Ciel (rond).
Au reste, cette valeur de 11 est affirme par un adage remarquable cit par
le Tsien Han chou.
Lauteur de lHistoire des Premiers Han (312), aprs avoir appel
lopinion traditionnelle qui fait de 6 le Nombre du Ciel (et de ses Agents) et
de 5 le Nombre de la Terre (comme celui des lments), rappelle le
dicton : Or, 5 et 6, cest lUnion cent rale (ou, aussi bien, lUnion en leur
Marcel GRANET La pense chinoise 120
Centre (tchong ho) du Ciel et de la Terre. Les glossateurs se
166
contentent
de dire que 5 est au Centre de la srie impaire (1, 3, 5, 7, 9) cre par le Ciel,
6 au Centre de la srie paire (2, 4, 6, g, 10) cre par la Terre. Cette note,
qui nous ramne de la faon la plus prcise aux spculations numriques du
Hi tseu pourrait surprendre, puisquil sagit dexpliquer que 5 ( impair)
appartient la Terre (yin), tandis que 6 (pair) appartient au Ciel (yang). Elle
nest explicative qu condition de sous -entendre que la Terre et le Ciel,
quand ils sunissent, changent leurs attributs, et lun des intrts des textes
rapprochs par le Tsien Han chou est daffirmer explicitement que cet
change rsulte dune hirogamie. Mais lauteur continue en affirmant que
11 [rsultat de lunion ( ho) des nombres centraux (tchong)] est le nombre par
lequel se constitue dans sa perfection (tcheng) la Voie (Tao) du Ciel et de la
Terre.
Cette Voie qui, qualifie emblmatiquement par 11, va de 5, plac au
milieu, cest --dire la croise des nombres impairs, 6, plac de mme la
croise des nombres pairs, runit manifestement par leur centre [et tout fait
la manire dun gnomon dress, comme un arbre, au milieu de lUnivers ]
deux carrs magiques superposs (
313
).
9 2
3 5 7 8 6 4
1 10
Dans le carr magique centre 5, tandis que les nombres pairs, placs aux
angles, marquent lextrmit des branches en querre de la croix gamme, les
nombres impairs occupe les positions cardinales, et 5 est au centre de 1, 3, 7,
9. Mais, si lon remplace chacun des nombres de ce carr par le nombre qui,
ajout lui, donne 11, on obtient un nouveau carr magique (centre 6 ; valeur
totale, dans tous les sens, des nombres placs sur une mme ligne : 18). Les
nombres impairs y occupent les quatre bouts de la croix gamme, et, rpartis
aux positions cardinales, les nombres pairs encadrent 6.
On commencera par remarquer que, 6 (reprsentant du
167
couple 6-1)
passant au Centre, celui-ci change ses attributs (5-10) avec le Nord, et que,
de mme, lOuest et le Sud changent leurs symboles numriques (2 -7 et
4-9). On notera surtout qu part le passage cit du Tsien Han chou, la
littrature chinoise ne semble contenir aucune allusion au carr magique
centre 6. Ceci doit conduire penser, mon pas que ce carr ne jouissait
daucun prestige, mais, tout au contraire, quune bonne partie de lantique
Marcel GRANET La pense chinoise 121
science des nombres tait chose mystrieuse : de ce savoir sotrique peuvent
seules tmoigner des allusions furtives.
La figure forme par la superposition des carrs centre 5 et 6 est
remarquable parce quelle est constitue par 9 couples pairs -impairs qui
valent chacun 11 et qui valent 99 au total.
S S
4 9 2 7 2 9
E 3 5 7 W E 8 6 4 W
8 1 6 3 1
0
5
N N
Elle convenait admirablement pour fournir une reprsentation totale de
lUnivers, en mme temps quune justifi cation numrique une thorie
essentielle, celle de laction rciproque et imbrique des Agents et Domaines
clestes (les 6 Tsong) et des Agents et Domaines terrestres (les 5 Hing) dans
les 9 Provinces de la Terre et du Ciel.
Nous savons, au reste, que les devins utilisaient un instrument dont la
disposition rappelle cette figure. Il en est question dans le Tcheou li (314), et
les fouilles japonaises de Lo lang (
315
) ont permis den dcouvrir un
exemplaire fabriqu antrieurement lre chrtienne. Cet instrument se
compose de deux planchettes, lune de bois dur ( yang), lautre de boi s tendre
(yin), lune ronde (Ciel), lautre carre (Terre) ; elles sont faites pour tre
superposes et pour pivoter indpendamment lune de lautre, car elles sont
perces au centre dun petit trou destin vraisemblablement servir
dencoche une tige perpendiculaire formant pivot. Sur lune et lautre
168
sont inscrits diffrents emblmes classificatoires : symboles des mois, signes
cycliques, constellations et trigrammes, ces derniers tant placs, dans la
disposition du roi Wen, sur la tablette carre (Terre). Sil y a lieu, comme je
le crois, dta blir un rapprochement entre cet ustensile divinatoire et le double
carr magique, on devra conclure que celui-ci, tout en voquant lide dangle
droit et dquerre, devait suggrer lide dun mouvement circulaire.
On a dj vu que les carrs magiques, ds quon prend soin de runir
entre eux les couples congruents, reproduisent une disposition en svastika :
par elle-mme, celle-ci suggre lide dun mouvement giratoire. Le Hi
tseu, prcisment, invite penser quil convient de lire les deux signes
Marcel GRANET La pense chinoise 122
inscrits sur chaque branche de la croix gamme, non comme un couple de
signes numriques, mais comme un nombre.
Le Hi tseu (
316
), en effet, en mme temps quil insiste sur le no mbre 55,
attribue un rle privilgi 50 (emblme de la Grande Expansion). On peut,
partir de cette donne, deviner limportance que, pour une pense proccupe
de 5 et de 6, et aussi bien de 50 et de 55 (5 fois 11) pouvait prsenter une
srie numrique forme de nombres diffrant entre eux par laddition non de
1 unit, mais de 11 units et qui, partant de 6 [sans aller jusqu 105
39 94
28 83
[50(105)]
17 72
6 61
39
61
28
72
[50]
17
83
6
94
(= 55 + 50 ; mais 105 qui comprend 1 et 5 peut sassimiler 6, point de
dpart de la srie)] comprenait, outre 50, centre de la srie, 8 nombres
quon pouvait opposer 2 par 2, de manire que leur diffrence ft toujours 55.
Cette srie [6, 17, 28, 39, (50), 61, 72, 83, 94 (105)] mritait dautant plus
lattention quon pouvait encore former avec eux 4 couples de nombres
169
de faon que le total de chacun deux ft 100, les chiffres figurant dans la
colonne des units se succdant dans lordre occup par eux dans la srie
numrique. Les 4 plus forts de ces nombres sont encore remarquables parce
que chacun deux scrit laide du n couple de nombres congruents [61, 72,
83, 94 (et, de mme, 105)]. Or, ce sont l les nombres que lon peut lire
sur les diverses branches des croix gammes numriques inscrites dans les
carrs magiques.
Le Hi tseu invite, par lui-mme, cette lecture. Certains dtails
mythiques viennent, de faon inespre, mais non point surprenante,
tmoigner de sa lgitimit.
Les souverains qui fondrent les dynasties successives, selon que la Vertu
du Ciel ou celle de la Terre les animait, furent alternativement longs ou brefs,
car le Ciel stend en hauteur, et la Terre en largeur (317). Les Chinois ont
pieusement gard la mmoire de ce thme essentiel. Ils ont mme conserv
un souvenir prcis de la taille des Hros quils vnraient le plus (
318
).
Chouen, qui possdait la Vertu de la Terre, tait trapu et navait que 6 pieds 1
pouce (61 pouces), tandis que Yao, son prdcesseur, avait un corps (ou
peut-tre une chevelure) qui mesurait 7 pieds 2 pouces (72 pouces). On peut
Marcel GRANET La pense chinoise 123
penser, car le corps dun Fondateur sert dtalon une dynastie, que ces
nombres commandrent le systme des poids et mesures que ces souverains
tablirent, cependant que, donnant un calendrier nouveau une re nouvelle,
ils rorganisaient les dimensions du Temps. Ces mmes nombres, fait
curieux, sinon inattendu, commandrent en tout cas les divisions de leur
temps de rgne ou dexistence. Ce temps, quand il sagit dun Sou verain
parfait, est de 100 annes. Il suffira donc de se reporter au tableau prcdent
pour savoir que Chouen, qui vcut 100 ans, eut 39 ans de rgne : ce Hros de
6 pieds 1 pouce prit le pouvoir 61 ans. Quant Yao (72 pouces), qui rgna
100 ans, il ne conserva lautorit effective que durant 72 ans : il vcut
pendant 28 annes comme un souverain retrait. Nous navons pas de
renseignements prcis sur la taille des Fondateurs des trois Dynasties royales.
Sur le roi Wen, fondateur des Tcheou, peu de dtails mythiques ont t
conservs. Nous savons, cependant, quil cda son fils
170
une partie des
100 annes qui formaient son lot de vie. Le roi Wen tait gros et court :
peut-tre 50 convenait-il mieux que 100 pour mesurer sa taille. Pour Yu le
Grand, fondateur des Hia (dont la haute stature est reste clbre bien quon
lui attribue la Vertu de la Terre), il vcut 100 ans, rgna 17 ans et, puisquil
monta sur le trne 83 ans, il y a toute apparence quil mesurt 8 pieds 3
pouces. Pntr par linfluence du Ciel, le fondateur des Yin, Tang le
Victorieux, avait plus de raisons encore dtr e trs grand. LHistoire na pas
oubli sa taille. Celle-ci, ce qui nest pas le cas pour Chouen et pour Yao,
sexprime par un nombre entier de pieds : Tang, nous dit -on, avait 9 pieds de
haut, cest --dire 90 pouces ; il semble donc lui manquer 4 pouces, car
Chouen et Yu en comptaient 61 et 72, et, puisque les nombres 83 et 50 (ou
100) semblent jouer un rle dans la vie de Yu et du roi Wen, le seul des 5
nombres inscrits sur la croix gamme qui reste disponible est 94. Mais, par
une remarquable rencontre, si lon ne donne Tang que 90 pouces, on lui
attribue soit des bras longs, longs de 4 coudes, soit des bras orns de 4
coudes. Or, le mot dont liconographie mythique, le comprenant par
coude ou par coude , sest empare pour peindre, avec plus dclat, la
puissance de Tang, ne diffre pas sensiblement du mot qui signifie
pouce ... Il y a de grandes chances que, pour prter au Hros des bras 4
coudes ou de 4 coudes, on ait retir 4 pouces sa taille.
Ce groupe de faits mythiques a trop de cohrence pour quon ne conclue
pas que les couples de nombres congruents inscrits sur les carrs magiques se
lisaient comme les nombres 94, 83, 72, 61, 50 (ou 105 : 5-10 ou 10-5). Sur les
deux carrs, les branches opposes de la croix gamme forment deux couples,
lun Sud -Nord, lautre Est -Ouest, parfaitement quilibrs puisque leurs poids
numriques, si je puis dire, sont quivalents, ainsi quil convient dans des
figures faites pour suggrer lide de giration. Il apparat, du reste, que le
mouvement de giration quon veut reprsenter est celui de lanne. Les deux
figures, en effet, voquent numriquement 360.
Marcel GRANET La pense chinoise 124
Le carr centre 5 a un mrite particulier : il voque ce
171
nombre en
mettant en valeur lopposition (3/2) chre aux auteurs du Hi tseu, de 216 et
de 144. En effet, 83 + 61 sopposent 72 + 94, auxquels il convient dajouter
50 figur par le 5, substitut du couple congruent 5-10 (
319
) plac au centre de
la croix.
Le carr centre 6 nest pas moins riche de puissance figurative. La
somme des nombres inscrits sur son pourtour, qui est gale 354 (= 2 x 177),
exprime le nombre des jours de lanne luni -solaire, cependant que 6, plac
au centre, permet de rappeler le total 360 (= 354 + 6) et, sans doute aussi (car
Marcel GRANET La pense chinoise 125
4 9 2
3 5 7
8 1 6
94+61 = 72+83 = 155
S N W E
(2*155) + 50 = 360
7 2
9
8 6
4
3 10
5
72+105 = 94+83 = 177
S N W E
(2*177) + 6 = 360
6 est le substitut du couple congruent 6-1 et 61 x 6 = 366), le total des jours
de lanne solaire (366) ce qui suggre lide des intercalation s ncessaires
et peut en indiquer le rythme, 6 faisant songer aux 60 (= 12 x 5) jours qui,
dans une priode de 5 ans, doivent tre rpartis entre les deux mois
supplmentaires.
Ces remarques imposent lide que ce carr (aussi bien que le carr
centre 5) tait connu des Matres du Hi tseu, a que ces deux dispositions (du
reste solidaires) des premiers nombres taient considres par eux comme des
traductions numriques de larrangement octogonal des symboles
divinatoires. Le Hi tseu, en effet, propos de ces symboles et de la
manipulation des fiches qui servaient les construire et aussi calculer, fait
expressment allusion la pratique de la double intercalation
quinquennale (
320
).
172
Le Rvrend Legge refusait avec indignation toute apparence de bon
sens ce passage de trait. On ne voit pas, dit-il, comment en formant des
groupements pairs et impairs de btonnets on pourrait dterminer le nombre
des jours intercalaires et le rythme des intercalations. Il est vrai... Ce nest ni
au moyen de coupes pratiques dans un jeu de btonnets, ni par la
construction de carrs magiques que lon a tabli les lois du calendrier. Mais
il nappartenait pas aux devins dinstituer ces lois. Il suffisait quils rendissent
clatante lefficacit dune institution qui commandait leur mtier.
Ils avaient tenir compte des reprsentations sociales relatives au Temps
et lEspace et de systmes imbriqus de classifications. Ils avaient aussi
doter toutes ces conventions dun prestige qui sduisit la pense et justifit
laction. Ils se servirent cette fin de symboles gomtriques et arith -
Marcel GRANET La pense chinoise 126
mtiques. Ceux-ci, comme tous les emblmes, jouissaient du pouvoir de
susciter en figurant. Mais, plus abstraits, en un sens, que les autres, ces
symboles devaient inspirer une sorte particulire de confiance : sils se
prtent une multitude de jeux utiles pour raccorder les unes aux autres les
classifications les plus diverses, mme au moment o on en joue
arbitrairement, ils ont lair de command er le jeu. Quand on les utilisait pour
figurer lordonnance prte lUnivers, lImage du Monde quils
permettaient de construire tirait de ces emblmes un air de ncessit. Elle
semblait garantir lefficience des manipulations que, cependant, elle rendai t
aises.
En faisant apparatre que les symboles divinatoires quils avaient manier
se rfraient des dispositifs o les Nombres paraient du prestige qui leur est
propre les divisions conventionnelles de lEspace et les lois traditionnelles du
Calendrier, les devins mettaient en valeur leur art. Celui-ci paraissait domin
par lambition de rendre le Monde la fois intelligible et amnageable.
Lorsquils assimilaient au carr magique la rose octogonale de leurs
Trigrammes et rendaient ainsi manifestes les interactions du Ciel et de la
Terre, du Yang et du Yin, du Rond et du Carr, de lImpair et du Pair, les
Matres de la divination pouvaient se vanter de cooprer lOrdre universel
de la mme faon
173
que les Chefs, quand, en circulant dans leur Ming
tang carr, ils sefforaient de mettre en branle la croix gamme constitue
par les symboles numriques des Orients et des Saisons.
*
* *
Les remarques qui prcdent montrent la valeur des traditions recueillies
(ou restitues) par les rudits du temps des Han ou mme du temps des Song.
Les diagrammes du Lo chou et du Ho tou sont, sans doute, des
reconstitutions, mais dues des interprtes bien informs ou qui raisonnrent
correctement. Un dispositif numrique se trouve assurment la base de la
thorie des Cinq lments, quexpose le Hong fan, et les Neuf Sections du
Hong fan drivent, elles aussi, dun dispositif numrique. Les arrangements
des nombres en croix simple ou en croix gamme servaient tous deux,
comme le Yue ling le fait voir et comme on doit le supposer ds quon
interprte le Hi tseu, fournir une Image de lUnivers et de ses
diffrentes divisions en Secteurs. Les mythes relatifs lamnagement du
Monde saccordent avec les traditions de lart divinatoire : les divisions de
lcaille de tortue, le groupement orient des Trigrammes, le plan du Ming
tang ne se comprennent qu condition de les rapprocher de la thorie des
Neuf Provinces ou de la division des champs en neuf carrs et de
reconnatre aux Nombres, comme leur attribut essentiel, une fonction
classificatoire.
Marcel GRANET La pense chinoise 127
Celle-ci ne leur a point t dvolue tardivement, pour de simples raisons
de commodit mnmotechnique, et la suite du dveloppement de lesprit
scolastique. Elle les caractrise, ds leurs premiers emplois mythiques et na
pas cess de les caractriser. Les premires spculations sur les nombres sont
domines par le fait quon voit en eux des rubriques emblmatiques
commandant les systmes traditionnels de classifications. Cette attitude
lgard des Nombres, qui apparat dans le Hong fan comme dans le Hi tseu,
est atteste ds les premiers dbuts de la littrature savante.
Les utilisations quont pu faire des Nombres les diffrentes techniques,
loin de modifier cette attitude fondamentale,
174
lont plutt renforce.
Assimils des sites, et toujours considrs en rapport avec des Temps et des
Espaces concrets, les Nombres ont pour rle essentiel non pas de permettre
des additions, mais de reprsenter et de lier entre eux divers modes de
divisions, valables pour tels ou tels groupements. Plutt qu supputer des
quantits diffrentes on les emploie noter les organisations variables quon
peut attribuer tels ou tels ensembles. Les diffrences qualitatives de ces
groupements et leur valeur de Total absolu intressent beaucoup plus que leur
valeur arithmtique, telle que nous lentendons. On se plat diviser en
secteurs plutt quon ne songe faire des sommes dunits.
Do limportance : dune part, des nombres, tels 5 ou 6, quon affe cte au
Centre et qui, considrs comme des expressions privilgies du Total,
servent surtout, employs comme diviseurs, symboliser des modes de
rpartition ; dautre part de grands nombres, tels 360, faciles diviser, qui
apparaissent comme des expressions priphriques du Total. Sans doute,
ces dispositions de lesprit chinois ont -elles gagn en force par suite de
lusage que les techniciens du Calen drier et de la Musique ont fait des
Nombres. Comme ils les ont employs pour exprimer je ne dis pas pour
mesurer des rapports, des secteurs ou des angles, larithm tique,
demeurant au service dune gomtrie adapte un Espace -Temps conu
comme un milieu concret, ne sest point transforme en science de la
quantit.
III. Nombres et rapports musicaux
Les Neuf Sections du Hong fan furent confies par le Ciel Yu, dont le
corps mritait dtre pris pour talon de toutes les mesures, tandis que sa voix
pouvait servir de diapason... On ne sparait jamais le tube qui donnait la note
initiale de lus tensile divinatoire (
321
) form par deux planchettes, images du
Ciel et de la Terre, superposes comme deux carrs magiques...
Il serait difficile de montrer que la thorie chinoise des tubes musicaux
se raccorde directement aux spculations sur les carrs magiques. Pourtant,
certains rapprochements sont significatifs. Afin dillustrer leur thorie
Marcel GRANET La pense chinoise 128
musicale,
175
les Chinois avaient imagin pour leurs tubes un arrangement
prestigieux, car il mettait en valeur les relations du pair et de limpair (2/3 ou
4/3) en voquant la grande unit 360 (= 216 + 144). Le prestige de
larrangement des nombres en carr tenait un fait analogue. Cest en
raison de ce prestige que lon se plaisait mett re en relation avec un carr
magique le Ming tang, tout comme la rose octogonale des Trigrammes : les
rglements propres chacun des 12 mois de lanne taient proclams dans le
Ming tang, et cest les 12 mois que figuraient les 12 tubes, lesquels,
comme les mois (et en raison de la remarque : 12 x 2 = 24 = 8 x 3), taient
aussi mis en rapport avec les Huit Vents dont les Huit Trigrammes sont les
emblmes. Lanne (360) se divise en 12 mois (et aussi en 24 demi -mois
de 15 jours) groups en 4 saisons autour dun centre ou dun pivot ; les 8
Trigrammes passent pour driver des 4 Emblmes secondaires assimils aux
4 Saisons-Orients ; dans le Ming tang, mme quand on lui attribue 9 salles, 4
salles cardinales ont, en sus de la salle centrale, une importance particulire,
car elles sont consacres aux mois des quinoxes et des solstices, si bien que,
la disposition en croix simple se retrouvant dans la disposition en croix
gamme, larrangement en carr magique permet dvoquer la classification
en 5 lments. La thorie musicale juxtapose, tout pareillement, une
classification en Douze Tubes dont on se sert pour construire une rose
Douze Vents et une classification en Cinq Notes, dont on fait, formant une
croise, les symboles du Centre et des Quatre Saisons-Orients.
Ce sont des jeux numriques (et graphiques) qui permettent de rapprocher
ces classifications et de passer de lune lautre : il suffit quils autorisent ces
rapprochements et ces passages pour quen se livrant ces jeux on ait
limpres sion quon parvient rvler lOrdre du Monde et y colla borer.
Depuis que, grce au Pre Amiot (
322
), on connat, en Occident, la thorie
chinoise des Douze Tubes et des Cinq Notes, on la rapproche des thories
musicales des Grecs, et on a insist sur son caractre scientifique.
Mais Chavannes a not que les thoriciens chinois ne
176
staient point
attachs avec un plein respect lexactitude des rapports numriques. Cette
remarque la conduit conclure que, le caract re scientifique de la thorie
ayant vite laiss les Chinois indiffrents, ils navaient point invent celle -ci,
mais en avaient reu le principe des Grecs (
323
). Chavannes a dfendu cette
hypothse, contraire lopi nion de la plupart des autres savants sur
lorigine de la musi que chinoise, au moyen de raisonnements
philologiques qui ne paraissent point irrprochables et qui ont un grand
dfaut : ils laissent de ct toutes les donnes mythiques du problme et ne
font appel quaux documents dont on espre tirer des faits historiques, car on
peut les dater.
Si lon sen tient ces documents, il semble que les instru ments auxquels
les Chinois ont appliqu la thorie taient des cloches sonores ; avec ces
instruments, les mesures sont infiniment dlicates, et presque impossibles, par
Marcel GRANET La pense chinoise 129
suite, les remarques sur les rapports numriques (
324
) : la thorie applique
tait donc une thorie toute faite... Il est clair que les Chinois lavaient reue
des Grecs. En fait, les traditions chinoises mettent lorigine des inventions
instrumentales celle des instruments cordes ou vent. Dans le mythe qui
explique la division essentielle des Douze Tubes en 6 Tubes mles et 6 Tubes
femelles, se trouve employe, il est vrai, une expression gographique o
Chavannes a voulu voir le souvenir dune influence de pays atteints par la
civilisation grecque (
325
). Mais la division en tubes yin et yang, surtout
lorsquelle se fonde (comme cest le cas, on va le voir) sur le rapport (3/2 ou
) du Ciel et de la Terre, se raccorde avec les conceptions, mythiques ou
savantes, de lUnivers, qui sont propres aux Chinois, dune manire trop
parfaite pour que lide demprunt puisse simposer. Dautre par t, le mythe
relatif aux Douze Tubes fait expressment allusion des danses sexuelles et
dune faon signi ficative : ds que furent coups et assembls les douze tubes
de bambou, ils servirent faire danser un couple de phnix (qui est sans doute
la transposition mythique dun couple de faisans). Or, Dans tout
lExtrme -Orient, est rpandu un instrument, le cheng (
326
), dont les Chinois
attribuent linvention Niu -koua (sur ou femme de Fou-hi), qui inventa
aussi le mariage. Le cheng, qui sert de nos jours
177
encore accompagner
des danses sexuelles, existe sous deux formes : il y a un cheng mle et un
cheng femelle ; dans tous les cas, la disposition des tuyaux est faite, nous
dit-on, pour reprsenter les deux ailes dun oiseau (phnix ou faisan). Lorsque
lon danse au son du cheng, cest vraiment le couple de phnix ou de faisans
qui danse : cest (car les excutants dansent tout en jouant du cheng) le cheng
qui danse et qui est dans (
327
). Ce trait accuse trop darchasme et le prestige
du cheng est trop grand en Extrme-Orient, pour quil semble lgitime de
considrer le rcit mythique de linvention des 12 tuyaux mles ou femelles
comme une fable entirement imagine par des rudits pour justifier un
emprunt.
En mme temps (quelle que soit limportance des instru ments
percussion dans la musique chinoise), la remarque de Chavannes sur la
difficult quauraient eue les Chinois constater des rapports numriques
tombe entirement.
Tout au contraire, les instruments faits en bambou invitaient ces
constatations. Rappelons ici que le mot chinois (tsie), qui sert
mtaphoriquement exprimer lide de me sure (
328
), a pour sens concret
articulation, nud de bambou . Ce nest as surment pas en procdant des
mensurations dlicates sur des cloches de bronze que les Chinois ont pu
inventer la thorie sur laquelle ils ont fait reposer leur technique musicale. Ils
ont fort bien pu, en revanche, fonder lart de la Musique sur lart des
Nombres en savi sant dexprimer la longueur de leurs diverses fltes de
bambou par le Nombre des articulations ; ils ont pu encore y arriver en
valuant numriquement des cordes (jentends les cordes relles de vritables
arcs) : on ne pensera pas que les deux mthodes sexcluent si lon songe
Marcel GRANET La pense chinoise 130
quau dire des Chinois leur premier et plus vnrable systme de symbol -
isation tait constitu par des cordes noues (
329
).
Au reste, jespre le montrer tout lheure, les nombres qu i servirent
dabord exprimer la longueur des tubes sono res furent des nombres entiers
et de petits nombres. La srie quils formaient fut remplace, par la suite, par
diverses sries concurrentes faites de nombres plus grands, mais toujours
entiers, ces substitutions ayant pour principe certains changements du
systme de comput. Diffrents nombres, utiliss (successivement ou
concurremment) pour
178
dterminer les divisions des units de mesure,
servirent aussi multiplier les premiers emblmes numriques des tubes
musicaux. Il semble que ce soit en comparant et, du reste, en faisant
sinterpntrer les sries obtenues au moyen de ces multiplications que
lon arriva dgager le principe arithmtique de la gamme. Mais, si lon y
arriva, ce fut la suite de jeux numriques commands par lautorit du total
360 et par le prestige de lopposition de 216 et de 144.
Laissant de ct tout dbat dorigine (sans intrt pour notre sujet), nous
nous refuserons suivre Chavannes. Nous ne dirons pas : les Chinois nont
pas dcouvert par leurs propres moyens le principe arithmtique de leur
thorie musicale, car ils nen ont compris ni la rigueur, ni la perfec tion. Nous
dirons : si les Chinois sont arrivs fonder leur technique musicale sur un
principe arithmtique que, du reste, ils nont pas trouv ncessaire
dappliquer la rigueur, cest que la raison de leur dcouverte fut un jeu
ralis au moyen de symboles numriques (considrs non comme des signes
abstraits, mais comme des emblmes efficients) et que 1a fin de ce jeu tait
non pas de formuler une thorie exacte qui justifit rigoureusement une
technique, mais dillustrer cette technique en la liant une Image prestigieuse
du Monde.
*
* *
La thorie des 12 tuyaux sonores parat, en Chine, aussi ancienne que la
littrature savante. Sseu-ma Tsien (
330
) lui a consacr un important chapitre
o sont indiques les imbrications de la classification par 12 [12 Tubes et 12
Mois] et de la classification par 8 [8 Vents et 8 Trigrammes]. Bien des annes
auparavant, Lu Pou-wei (
331
) avait donn, en termes brefs et dailleurs trs
clairs, la formule arithmtique qui fonde cette thorie. Au reste, lautorit de
cette formule tait reconnue quand fut compos le Yue ling.
Ce trait sur le Calendrier met dj les tubes en rapport avec les mois,
relation qui implique pour chacun deux (par lintermdiaire du cycle
duodnaire) une orientation dfinie. On trouve dans la littrature ancienne de
nombreuses allusions aux tuyaux sonores ; certains attestent quon les ima -
gine orients :les orientations sont celles du Yue ling.
Marcel GRANET La pense chinoise 131
179
Parmi ces allusions littraires, lune est significative. Elle apparie aux
Sources Jaunes le tube initial dnomm houang tchong, la cloche jaune. Le
mythe archaque des Sources Jaunes, Pays des Morts, que lon enterrait au
Nord des villes, la tte tourne vers le Nord, place ces Sources au fond du
Septentrion. Celui-ci est signal dans le cycle duodnaire par le caractre
tseu, qui signifie enfant : en mme temps que le plein Nord, ce signe
cyclique marque le solstice dhiver et la mi -nuit, temps propices pour les
conceptions. Un ensemble important de thmes, mythiques ou rituels, prouve
que les Sources Jaunes, Pays des Morts, constituaient un rservoir de vie (
332
).
Les Chinois admettaient donc que, rfugis aux Sources Jaunes, dans les
bas-fonds (le Bas est
180
yin) du Septentrion (yin), le Yang passait lhiver
(yin) emprisonn et envelopp par le Yin (Eau). Il y rcuprait sa pleine
puissance, sapprtant en surgir, en frappant le sol du talon : on
prtendait (
333
) retrouver cette image dans lexpression houang tchong qui
dsigne le tube initial. Le houang tchong mritait bien affect au onzime
mois (mois du solstice dhiver) de figurer le Yang au plus bas de sa
puissance : le tube initial qui est le plus long de tous, rend la note la moins
aigu ; or, le Yang est aigu (clair), tandis que le Yin est grave (obscur).
Lattribution des tubes aux dif frents mois illustre la croissance continue du
Yang partir du solstice dhiver. Sur la rose 12 vents, o est marque
lorientation des mois et des tubes, les tubes se succdent donc partir du
plein Nord par ordre de grandeur dcroissante.
Pour obtenir cette disposition, implique par le Yue ling comme par des
mythes anciens, il faut construire une toile 12 pointes. Or, cette
construction suppose la connaissance de la rgle arithmtique dont Lu
Pou-wei a donn la formule et qui a permis de rapprocher la thorie chinoise
de la thorie grecque (
334
).
TOILE A 12 POINTES : cf. figure 09
Les nombres en chiffres romains dsignent les mois.
Les nombres en chiffres arabes indiquent la longueur des tubes sonores.
Les signes 1, 2, indiquent le rang des tubes dans lordre de leur cration.
On a figur dans un rond le nombre indiquant les dimensions que devraient
avoir les 2, 4 et 6 tubes si la note mise par eux ntait pas abaiss e dune
octave.
Lu Pou-wei et tous les auteurs chinois noncent cette rgle en disant que
les tubes sengendrent ( cheng) les uns les autres, mais ils distinguent ce quils
Marcel GRANET La pense chinoise 132
appellent la gnration suprieure (chang cheng) et la gnration infrieure
(hia cheng), cest --dire celle o le tube produit est plus long (chang :
suprieur) que son producteur, et celle o, il est moins long (hia : infrieur).
Il y a gnration infrieure lorsquon diminue la longueur en enlevant un tiers
celle que mesure le tube prcdent : tel est le cas, par exemple, quand on
passe du tube initial qui vaut 81 (= 3 x 27) au deuxime tube qui vaut 54
(= 2 x 27). Il y a gnration suprieure lorsquon augmente la longueur en
ajoutant un tiers celle du tube prcdent : tel est le cas quand on passe du
deuxime tube qui vaut 54 (= 3 x 18) au troisime qui vaut 72 (= 4 x 18). Le
troisime tube (72) cre par gnration infrieure le quatrime (48), celui-ci,
par gnration suprieure, le cinquime (64) et ainsi de suite jusquau
septime tube. Celui-ci, bien quil soit
181
lui-mme cr par gnration
suprieure, cre, encore par gnration suprieure, le huitime tube : partir
de ce dernier ce sont donc les tubes de rang pair (et non plus ceux de rang
impair) qui produisent par gnration infrieure.
Ceci nempche pas de considrer tous les tubes de rang impair comme
des tubes mles [= Yang = Impair = Ciel = Rond = 3 (valeur de la
circonfrence inscrite dans un carr de ct 1)] et tous les tubes de rang pair
comme des tubes femelles [= Yin = Pair = Terre = Carr = 2 (valeur du
demi-primtre du carr circonscrivant la circonfrence de valeur 3)] (
335
).
Pour en dcider ainsi, les Chinois avaient de bonnes raisons. Si les trois
premiers tubes impairs valent les 3/2 des trois premiers tubes pairs, les trois
derniers tubes impairs valent respectivement les des trois derniers tubes
pairs ; 3/2 exprime le rapport de la circonfrence (= Ciel) au demi-primtre
du carr (= Terre) qui la circonscrit ; exprime le rapport de la circonfrence
au primtre : aussi bien que 3/2, et mme mieux, peut donc exprimer la
relation du Yang au Yin.
Il se pourrait que les Chinois aient dabord attribu leurs tubes des
emblmes numriques qui illustraient le seul rapport : il est dit, en effet,
dans un passage du Kouan tseu (
336
), que les cinq premiers tubes valaient
respectivement 81, 108 (= 54 x 2), 72, 96 (= 48 x 2), 64, do lon peut
conclure, semble-t-il, que le sixime valait 84 (= 42 x 2). Les Chinois
semblent avoir divis par 2 les dimensions des trois premiers tubes de la srie
paire, tout en vitant de modifier les dimensions des trois derniers tubes de
cette srie.
Cette rforme enregistre, peut-tre, un progrs de la technique
musicale (
337
) ; mais ce quil importe pour nous de souligner, cest que, si lon
navait pas rendu, en les dimi nuant de moiti, les trois premiers tubes yin
infrieurs en longueur aux trois derniers, il naurait pas t possible dassi -
gner aux tubes, en construisant une toile 12 pointes, lorientation que le
Yue ling leur attribue.
Quon se reporte au tableau figure 10
Marcel GRANET La pense chinoise 133
[Les nombres donnent les dimensions aux tubes par
Houai-nan tseu.
On a rajout 6o au dbut de 1a srie et 81 la fin, car, en
raison de leur disposition cyclique, le 12
e
tube, 60,
produit le premier, 81.]
et la figure figure 09
Reprsents par les nombres entiers qui indiquent leurs dimensions
traditionnelles, les 12 tubes occupent dans
182
la figure les orientations
assignes aux signes cycliques et aux mois qui leur correspondent. Ils sont
rangs sur le pourtour dun cercle partir du Nord (XIe mois ; solstice
dhiver ; tube initial) en ordre de grandeur dcroissante : leurs emblmes
numriques prsentent limage de la croissance continue du Yang (aigu). On
voit aussi quils occupent les 12 pointes dune toile. Cette dernire se trouve
dessine ds que lon a runi par une droite les emblmes des tubes (yang ou
yin, yin ou yang, crateurs ou produits) qui, dans lordre de pro duction, se
trouvent contigus.
Cette construction graphique met en vidence : dune part, lordre de
production des tubes et, par suite, la formule qui commande leurs rapports
numriques ; dautre part, la disposition cyclique des tubes ainsi que les
orientations do rsulte leur correspondance aux divers mois. Mais, si la
figure symtrique que forme ltoile 12 pointes peut tre obtenue, cest que
deux droites traces conscutivement (et qui, par suite, doivent unir les
emblmes des trois tubes suivant dans lordre de production) dcoupent
toujours un arc de 60 ; et cest aussi parce quon a commenc par unir deux
points distants sur la circonfrence de 210 dun ct
183
[ gauche, en
lespce, parce que, dans la disposition adopte par les Chinois, les signes
cycliques se suivent dans lordre de la succession des temps en allant vers la
gauche], et de 150 de lautre. Le tube initial (81, srie yang) tant affect au
XIe mois (mois impair), le 2
e
tube (54, srie yin) doit ltre au VIe mois (mois
pair), le 3
e
(72, srie yang) au Ier mois (mois impairs, le 4
e
(48, srie yin) au
VIIIe mois (mois pair), le 5
e
(64, srie yang) au IIIe mois (mois impair), le 6
e
(42, srie yin) au Xe mois (mois pair), le 7
e
(57, srie yang) au Ve mois (mois
impair), [cest --dire : plac 180 du tube initial (81)]..., etc. Mais,
puisquon avait dcid de laisser gauche de la premire ligne trace la
section la plus grande du cercle, les emblmes numriques des 4
e
et 6
e
tubes
devaient, comme celui du 2
e
(ce sont les trois premiers tubes de la srie yin),
se trouver dans la partie droite du cercle est y rencontrer les emblmes des 9
e
et 11
e
tubes qui sont eux-mmes droite du 7
e
plac 180 du tube initial. Or
ces trois tubes sont les derniers et les plus petits de la srie yang. Les
emblmes numriques des Douze Tubes ne se seraient point succd par
ordre de grandeur dcroissante si lon avait attribu aux trois premiers tubes
de la srie paire des dimensions (108, 96, 84) fondes sur le rapport 4/3 entre
tubes yin et yang. Pour obtenir ce rsultat, il fallait les diminuer de moiti,
abaissant dune octave la note quils rendaient, tout en conservant
Marcel GRANET La pense chinoise 134
cependant des dimensions conformes au rapport 4/3 aux trois derniers tubes
pairs : les emblmes de ceux-ci devaient, en effet, se placer dans la moiti
gauche du cercle, intercals entre les emblmes des trois premiers, plus
grands, tubes yang.
La figure gomtrique qui, afin dillustrer la croissance continue du Yang
partir du solstice dhiver, justifie le systme de correspondances tablies
entre les mois et les tubes, ne peut tre construite, on le voit, qu condition
de donner aux tubes des dimensions telles que les six premiers illustrent le
rapport 3/2 (= 81/54 = 72/48 = 63/42) (
338
) et les six derniers le rapport
(= 57/76 = 51/68 = 45/60). Toute allusion une quivalence entre tubes et
mois conforme au systme du Yue ling suppose cette construction et, par
consquent,
184
implique la dcouverte pralable de la rgle arithmtique
sur laquelle repose la thorie musicale des Chinois.
Cette constatation a, peut-tre, une porte historique, mais son intrt
vritable est de montrer que les Chinois ne se trompent point quand ils
affirment que leurs anciens Sages considraient comme des questions lies les
problmes relatifs la thorie musicale et lamnagement du Calendrier. Ne
se sent-on pas invit induire que la dcouverte de la formule arithmtique de
la gamme drive des spculations numriques des techniciens et cet art
suprme qui visait amnager lEspace et le Temps et dont le problme
essentiel tait de rvler les relations du Pair et de lImpair ?
La construction de la rose 12 pointes navai t pas le seul avantage de faire
apparatre la croissance continue du Yang au sortir des Sources jaunes. Elle
avait, de plus, le mrite de justifier, par lalternance des tubes yin et yang,
lalter nance des mois de rang pair et impair auxquels lanne luni -solaire de
354 jours faisait attribuer tantt 30 jours et tantt 29. La division des tubes en
deux groupes gaux de genres diffrents, en mme temps quelle autorisait des
rapprochements nouveaux de classifications, servait dune autre faon encore
illustrer les lois du Calendrier. La porte mythique de cette division apparat
dans diverses appellations symboliques employes propos des tubes. On les
traite de pres et de fils, parce quon considre quils sengendrent ( cheng) les
uns les autres : lopposition des gnrations alternant au pouvoir (
339
) peut
traduire lopposition rythmique du Yin et du Yang. Dautre part les emblmes
des tubes yin et yang alternent sur le pourtour du dodcagone, ce qui permet
de les grouper par couples : on disait de deux emblmes voisins quils taient
femme et mari . De semblables reprsentations mtaphoriques permettaient
de rapprocher les 6 tubes mles et les 6 tubes femelles des 12 lignes, mles ou
femelles, qui composent le premier couple dHexagrammes. Ainsi sexplique
une autre manire de dnommer les tubes sonores ; elle consiste les
identifier aux lignes pleines ou brises des Hexagrammes, en voquant
nouveau les rapports du Pair et de lImpair. On dsignait par Six les tubes yin
et par Neuf les tubes yang. Pour mieux faire songer aux
185
Hexagrammes
(quon analysait en numrotant les lignes de bas en haut), on appelait le
premier tube yang et le premier tube yin (comme la premire ligne mle ou la
Marcel GRANET La pense chinoise 135
premire ligne femelle dun Hexagramme) : Neuf de base et Six de base ; les
tubes intermdiaires : (2
e
ou 3
e
...) Neuf ou Six et les deux derniers tubes : Neuf
suprieur et Six suprieur.
Un passage de Sseu-ma Tsien, dont nous aurons bientt signaler
limportance, garantit lancie nnet de ces dsignations (
340
). Elles sont
solidaires dun dveloppement de la technique musicale quil faut donc, lui
aussi, considrer comme ancien. Chacun des tubes pouvant tre pris tour
tour pour tube initial et donner la premire note de la gamme, il tait possible
de constituer 12 gammes (
341
). Ces gammes, formes chacune de 5 notes,
taient caractrises par les emblmes numriques des tubes qui les
mettaient ; mais quand on avait en parler, il suffisait de donner la dsigna-
tion symbolique (Six de base... 3
e
Neuf... Neuf Suprieur...) du tube pris, en ce
cas, pour tube initial. Avec ces 12 gammes ainsi constitues, on disposait, au
total, de 60 notes quon mettait en relation avec les 60 b inmes cycliques
forms par la combinaison des 12 (= 6 x 2) signes duodnaires (lesquels
comme les 12 tubes voquent une disposition en rond) et des 10 (= 5 x 2)
signes dnaires (lesquels appellent comme les notes de la gamme une
disposition en croise).
Ce nouveau systme de correspondances conduit encore, en combinant les
emblmes (5 et 6) de la Terre et du Ciel, au grand Total 360 (= 12 x 5 x 6).
Napparat -il pas, une fois de plus, que la thorie musicale doit son dveloppe-
ment aux spculations numriques des Matres de cet art suprme, le
Calendrier ?
*
* *
Les auteurs de la thorie, en tout cas, taient des gens peu soucieux, dans le
dtail, de lexactitude des rapports numriques et qui se proposaient, avant
tout, de mettre en vidence un rapport densemble obtenu au moyen de totaux
significatifs.
Sseu-ma Tsien, il est vrai, a pris soin dexprimer les
186
longueurs des
tubes en se servant de nombres fractionnels peu prs conformes la
thorie (
342
). Ce souci dexactitude a permis Chavannes de supposer que les
Chinois avaient, au dbut, appliqu sans ngligence le principe de la construc-
tion de la gamme grecque. On remarquera : 1 quavant de les consigner dans
son Histoire, Sseu-ma Tsien, comme membre de la Commission du Calen-
drier, et loccasion dune importante rforme de celui -ci, avait d refaire
avec soin tous les calculs ; 2 que, vers les mmes temps, Houai-nan tseu (
343
)
indiquait les dimensions des tuyaux en ne se servant que de nombres entiers.
Ce sont ces nombres, toujours reproduits, qui intressaient vritablement les
Chinois ; pour comprendre la pense de ces derniers, cest de ces nombres
quil faut partir.
Marcel GRANET La pense chinoise 136
Comme il est ais de le voir, cf. figure 14, avec les 12 nombres (81, 54, 72,
48, 64, 42, 57, 76, 51, 68, 45, 60) de la liste transmise par Houai-nan tseu, il
nest possible dtablir de rapports conformes la rgle quen admettant pour
ces nombres le jeu dune unit, sauf dans trois cas (
344
), pour 54 qui vaut les
2/3 de 81 et les de 72, pour 72 qui vaut les 4/3 de 54 et les 3/2 de 48, pour
48 qui vaut les 2/3 de 72 et les de 64. Il faut admettre que le 5
e
tube vaut 64,
puisquil est les 4/3 de 48, et quil vaut aussi 63, puisquil doit tre les 3/2 de
42. De mme, le 7
e
tube vaut la fois 56 et 57, le 8 76 et 75, le 9
e
50 et 51, le
10
e
68 et 69, le 11
e
46 et 45. Mais les
187
12 tubes forment un cycle. Le 12
e
doit, en consquence, tre les du premier (si celui-ci est produit par
gnration suprieure) (
345
). 60, multiple de 3, peut facilement tre augment
de 1/3. Pour que la rgle soit respecte, il faut donc que le 1
er
tube vaille 80(=
60 x 4/3), en mme temps que 81(=54 x 3/2) : ici encore, le jeu dune unit
est ncessaire.
Dans le dtail, les dimensions attribues aux tubes sont, on le voit,
inexactes.
Il est remarquable que, pour les dimensions des derniers tubes, on ait choisi
57, 76, 51, 68, 45, 60. Si lon avait pris pour les tubes yin les dimensions 75,
69, 60, le total des trois nombres (204) naurait pas t modifi. Mais si, pour
les tubes yang, au lieu de 57, 51, 45, on avait pris 56, 50, 46, le total des 3
nombres aurait t 152 au lieu de 153. Les nombres choisis expriment
inexactement le rapport 3/2, qui devrait exister entre le 8
e
tube (75) et le 9
e
(51), entre le 10e tube (69) et le 11
e
(45), mais ils expriment, en revanche,
exactement tous les rapports gaux (= 57/76=51/68=45/60) ; et est
aussi le rapport de la valeur totale des trois tubes yang (153) aux trois tubes
yin (204) [153/204=(3x51)/(4x51)]. La somme des 6 derniers tubes est 357 ;
synthse du Yin (4) et du Yang (3) [dont la deuxime moiti de la srie des
tubes doit indiquer les relations sous la forme , puisque le premier (57) de
ses six tubes vaut les du deuxime (76)], 357 est un multiple de 7 : cest,
parmi les multiples de 7, celui qui se rapproche le plus du grand Total 360 et
de 354, total des jours de lanne luni -solaire (
346
).
La srie des 6 premiers tubes commence, au contraire, par un tube qui vaut
les 3/2 du suivant ; il conviendrait que la somme de ces 6 emblmes
numriques soit un multiple de 5, synthse du Yang (3) et du Yin (2) ; on
attendrait que ce multiple de 5 ft 360 et le rapport 3/2 crit globalement sous
la forme 216/144. Si le total des premiers tubes yin est bien
188
144(= 54 + 48 + 42), celui des tubes yang (81 + 72 + 64) est 217, si bien que
la somme totale nest pas 360, mais 361. Il ny avait pourtant aucune difficult
obtenir le nombre 216 ; pour les 1
er
et 3
e
tubes yang, on avait le choix entre
80 et 81, 64 et 63 ; ajouts 72 (2
e
tube yang), 80 + 64 (= 144) comme
81 + 63 (= 144) donnent 216. Mais on a pris 81 et 64. A 80(= 60 x 4/3), qui
et rendu sensible le caractre cyclique de la srie des tubes, on a prfr 81.
Aussi, le premier rapport (81/54) est-il rigoureusement gal 3/2. Ladoption
de 63 semblait ds lors simposer pour le 5
e
tube, puisque 63 vaut exactement
Marcel GRANET La pense chinoise 137
les 3/2 de lemblme numrique du 6
e
(42). On sest condamn, cependant,
rendre moins apparent le grand Total 360 et le rapport typique 216/144,
puisque, aprs avoir attribu 81 au 1
er
tube, on a attribu 64 au 5
e
. De mme
que 81 vaut exactement les 3/2 de 54, 64 vaut exactement les 4/3 de 48 (4
e
tube). Si lon a adopt 81 et 64, cest que, grce cette adoption, les 5
emblmes numriques affects aux premiers tubes (81, 54, 72, 48, 64) taient,
condition de les considrer isolment et de ne penser leurs rapports ni
avec le 6
e
, ni avec le 12
e
, absolument conformes au principe de la thorie.
Lexamen des emblmes numriques que les Chinois, grce au jeu quasi
constant dune unit, ont jug suffisants pour exprimer le principe de leur
thorie musicale conduit une triple remarque :
1 Lexactitude, dans le dtail, des rapports arithm tiques importe peu ;
presque tous les emblmes numriques correspond une double valeur dont
lune figure seule sur la liste, lautre restant implique ; de mme que 81 et 63
peuvent tre lus comme signifiant encore 80 et 64, 361 semble bien tre senti
comme signifiant 360. Tout ceci suggre lide que [grce dimplicites
mutations dautres emblmes, et, par exemple, par suite dune quivalence
latente entre 60 et 63], 357 pourrait bien, lui aussi, signifier 360. Il apparat
surtout que la srie des 12 nombres na pas t tablie au moyen de vritables
oprations arithmtiques, mais laide de manipulations demblmes
quinspirait une ambition dfinie.
189
2 Les totaux 357 et 361 qui rsultent des additions des 6 premiers ou
des 6 derniers nombres sont, de toute faon, trop voisins de 360 pour quils
aient t obtenus par hasard. La juxtaposition de deux sries demblmes qui
suggrent, toutes deux, le grand Total, en voquant une division en 5 sections
(rapport 3/2) et une division en 7 sections (rapport ), semble driver de
proccupations analogues celles dont est sortie lide de juxt aposer un carr
centre 5 et un carr centre 6, rappelant deux divisions de 360, lune en 5
sections de 72, lautre en 6 sections de 60 ; de pareilles proccupations
attestent que la thorie des 12 Tubes est due aux Matres du Calendrier.
3 Cette thorie apparat comme une construction artificieusement
superpose une construction pralable qui doit tre celle de la gamme 5
notes. Quel que ft leur dsir de mettre en valeur 360, les Matres du
Calendrier ont prfr conserver aux 5 premiers tubes, cest eux que
dordi naire on fait correspondre les 5 notes, des emblmes numriques
impliquant des rapports exacts. Quand ils ont labor la thorie des 12 Tubes
en songeant faire de ces derniers les emblmes des 12 mois, il sagissait
pour eux de complter une thorie de la gamme. Les 5 notes de celle-ci
figuraient les 4 Saisons et le Centre de lanne et se disposaient en croise. En
adaptant limage de la croise qui faisait songer au carr limage dun
dodcagone sur le pourtour duquel les emblmes des tubes et des mois se
disposaient en cercle dans un ordre rgulier, les Matres du Calendrier
Marcel GRANET La pense chinoise 138
sefforaient de donner une reprsentation plus dtaille et plus cohrente de
lUnivers.
*
* *
La gamme chinoise comprend 5 notes, nommes kong, tche, chang, yu et
kio.
La tradition veut que le roi Wen, fondateur des Tcheou, ait invent deux
notes nouvelles. Seules, les 5 premires notes sont considres comme pures
et possdent un nom. Les dsignations des 6
e
et 7
e
notes, pien kong et pien
tche, montrent quon ne sentait pas une grande diffrence entre elles et les 1
e
et 2
e
notes. Au reste, dans la pratique, seules
190
comptent vraiment les 5
notes pures. Pour les dfinir, on se bornait dire quelles correspondaient aux
sons mis par les 3 premiers tubes. Ctait aussi en donnant les dimensions
des 6
e
et 7
e
tubes quon dfinissait les 6
e
et 7
e
notes. La thorie musicale des
Chinois a son point de dpart dans la construction des 5 premiers tubes.
Quand on a indiqu les dimensions de ces tubes et signal, par l mme,
les rapports des notes entre elles, il ny a, techniquement parlant, plus rien
dire de la gamme. Mais, si lon veut comprendre les ides des Chinois et ne
point parler trop vite dun emprunt aux Grecs, il convient de tenir compte de
deux faits :
Orients
Centre Sud Ouest Nord Est
Saisons
Centre Et Automne Hiver Printemps
Notes
Kong Tche Chang Yu Kio
Emblmes des Tubes et des Notes
81 54 72 48 64
Emblmes des Saisons-Orients et
des Notes
5 7 9 6 8
Numros dordre des lments
5 2 4 1 3
Couples de nombres congruents
5 - 10 2 - 7 4 - 9 1 - 6 3 - 8
lments
Terre Feu Mtal Eau Bois
1 en mme temps quils attri buent chacune des 5 notes un emblme
numrique montrant quelle est mise par lun des 5 premiers tubes, les
Chinois lui affectent un autre emblme, qui est aussi un nombre, et un
nombre entier : hong a pour petit et pour grand emblmes 5 et 81 (dimension
du 1
er
tube) ; tche, 7 et 54 (dimension du 2
e
tube) ; chang, 9 et 72 (dimension
du 3
e
tube) ; yu, 6 et 48 ; kio, 8 et 64 ;
Marcel GRANET La pense chinoise 139
2 5, 7, 9, 6 et 8 sont les emblmes du Centre et des 4 Saisons-Orients
(ainsi que des 5 lments) : les 5 notes, de mme que les Saisons
auxquelles ces symboles numriques les apparentent, forment
apparemment un cycle, la faon des 12 Tubes quon apparente aux 12 Mois.
On nglige ces donnes,
191
dordinaire, sous prtexte que les
correspondances chinoises (surtout quand y figurent des nombres) sont des
jeux tardifs et arbitraires, et parce quon ne remarque aucun rapport entre les
dimensions des Tubes et les nombres servant communment dembl mes aux
Notes, aux. Saisons et aux lments.
Peut-tre une observation moins paresseuse ferait-elle apparatre un
rapport entre le grand et le petit emblme (exprims tous deux par des
nombres entiers), qui, pour les Chinois, dfinissent une note. Rangeons-les,
quivalences conserves, en disposant par ordre de grandeur les grands
emblmes. A part 5 (mais 5 ne peut-il reprsenter 10, second membre du
mme couple congruent ?), les petits emblmes se trouvent, eux aussi, rangs
dans le mme ordre.
Marcel GRANET La pense chinoise 140
81 72 64 54 48
5 9 8 7 6
Mais par lattribution dun petit emblme aux diffrentes notes na -t-on
voulu que signaler lordre de grandeur des tubes qui leur correspondent ?
Disposons les deux sries demblmes en tenant compte de lordre de
production des Tubes ;
81 54 72 48 64
5 7 9 6 8
une remarque simpose : les 3 derniers petits emblmes sont 9, 6, 8. Ces
nombres, dans lor dre o ils se succdent, suffisent exprimer la rgle
arithmtique qui commande la construction de la gamme, comme celle des 12
Tubes (diminution de 1/3 suivie dune augmentation de 1/3). cf. figure 15
9, 6, 8, multiplis par 9 donnent les dimensions des 1
er
, 2
e
et 3
e
tubes ;
multiplis par 8, celles des 3
e
, 4
e
et 5
e
tubes ; multiplis par 7, celles des 5
e
, 6
e
et 7
e
tubes. 72 (3
e
tube), tant un multiple de 9 et de 8, assure une jonction
parfaite, et les 5 premiers tubes paraissent correspondre des dimensions
rigoureusement exactes : il y a 5 notes pures. 64, multiple de 8, nest pas
un multiple de 9. Il faut lassimiler
192
63 (produit de 9 par 7) pour passer
la srie des multiples de 7. Cest ainsi q uon peut, aux cinq notes pures,
ajouter les deux notes supplmentaires. A partir de 56-57, les nombres
sont obtenus en multipliant 9, 6, 8, non pas, comme au dbut, par les nombres
entiers 9, 8, 7, mais par les mmes nombres augments de 0,5 (9,5, 8,5, 7,5).
Le 7
e
tube, produit par gnration suprieure (56), produit lui-mme
(57 = 6 x 9,5) par gnration suprieure le 8
e
tube (76 = 8 x 9,5). Tout se
passe comme si on avait juxtapos 2 gammes de 5 notes (81, 54, 72, 48, 64, et
76, 51, 68, 45, 60) : la jonction de la 2
e
gamme la 1
e
, rsultant de lassimi -
lation 81 (1
er
tube) de 80 [que peut, condition quil y ait nouveau
gnration suprieure, produire 60 (12
e
tube issu lui-mme de 45 par
gnration suprieure], la transition
193
de la 1
e
gamme la 2
e
sest trouve
assure par ladjonction du 6
e
et 7
e
tubes lesquels correspondent aux 2
notes supplmentaires.
Ces observations font apparatre le rle des nombres 9, 6, 8, emblmes,
comme on a vu, des 3
e
, 4
e
et 5
e
notes. Elles montrent, dune part , que la
thorie des 12 Tubes se relie linvention, attribue au roi Wen des Tcheou,
des 2 rotes supplmentaires dont lune (6
e
tube) a pour emblme 42 et,
dautre part, quon ne pouvait imaginer une juxtaposition des 2 gammes que
si le 1
er
tube pouvait tre reprsent par 80 aussi bien que par 81.
Marcel GRANET La pense chinoise 141
Cest ici le moment dutiliser la remarque que, assimiles aux Saisons, les
5 Notes de la gamme forment un cycle.
Comme pour les 12 Tubes, une figure peut reprsenter ce cycle, tout en
mettant en vidence lord re de production des notes. Disposons leurs
emblmes (81, 72, 64, 54, 48) intervalles gaux sur le pourtour dun cercle,
partir de 81 (vers la gauche), en suivant lordre de grandeur. Si,
maintenant, pour figurer lordre de production, nous relions par des droites
81 54, 54 72, 72 48 et 48 64, nous formerons une toile 5 branches,
cf. mg_pc_figures : 16a , mais le dessin ne sera parfait que si nous runissons
64 81 : cest --dire si, du 5
e
tube, nous revenons au 1
er
. Diminu de 1/3, 64,
ds quon lassimile 63, produit 42. Si 42 tait la moiti de 81, les notes
mises par les deux Tubes, tant la diffrence dune octave,
pourraient tre assimiles, ce qui donnerait le droit de fermer la figure.
Puisque les 5 notes forment un cycle et que la figure doit tre ferme, il faut
admettre [soit que, double de
194
42, lemblme numrique du 1
er
tube tait
senti comme ayant pour valeur 84 (
347
), soit] que, 80 reprsentant ce 1
er
tube,
on estimait que de 64-63 on passait, par gnration infrieure, une valeur
dont 40 pouvait tre lemblme (
348
).
Difficile imaginer avec les emblmes numriques, 81, 72, 64, 54, 48
(choisis pour illustrer la rgle que la squence 9, 6, 8 peut rsumer), la
construction de ltoile 5 branches, ncessaire la figuration dun cycle,
devient toute simple si les nombres disposer sur le pourtour du cercle sont
ceux-l mmes qui servent demblmes aux notes cf. mg_pc_figures : 16b
la seule condition de supposer que 5 reprsente le couple congruent 10-5.
Nous voici conduits formuler une hypothse : les emblmes numriques
des notes, loin dtre arbitraires, ont commenc par signifier des dimensions
relles. La remarque quentre 10 et 5, moiti de 10, il y a 5 intervalles,
explique la constitution dune gamme 5 notes, les rapports des notes
tant symboliss par les nombres 7, 9, 6, 8 et le couple 10-5 qui donnait lide
de loctave.
Pour les Chinois, plus attentifs on la vu lexactitude des rapports
densemble qu celle des rapports de dtail, la srie 10, 9, 8, 7, 6, 5 avait un
grand mrite.
Elle permettait dtablir, car 10 + 9 + 8 = 9 x 3 et 7 + 6 + 5 = 9 x 2
entre lensemble des notes yang [10 (1
re
note), 9 (3
e
note), 8 (5
e
note)] et
lensemble des notes yin [7 (2
e
note), 6 (4
e
note), 5 (1
re
note loctave)] un
rapport gal 3/2 (qui est le rapport du Ciel et de Terre), et ce rapport se
retrouvait, exprim de faon typique dans le rapport (9/6) de la 2
e
note yang
la 2
e
note yin.
195
A la srie 10, 9, 8, 7, 6, 5 appartient encore un autre mrite, plus
grand, peut-tre, aux yeux des Chinois.
Marcel GRANET La pense chinoise 142
Elle vaut, au total, 45, qui, ds quon le multiplie par 8 , permet dobtenir
360. Puisque 5 est la moiti de 10, on pouvait, certes, prsenter limage dun
cycle en disposant sur le pourtour dun pentagone les nombres 9, 8, 7, 6, et 10
voquant 10-5. On le pouvait mieux encore en remplaant ces nombres par 72
(= 9 x 8), 64 (= 8 x 8), 56 (= 7 x 8 , 11 (= 6 x 8) et 80 (= 10 x 8) mentalement
associ 40 (= 5 x 8) qui en est la moiti : on voquait ainsi le grand
emblme du cycle, 360, et, laide de 5 nombres, qui en supposaient un 6
e
, la
division caractristique de 360 en 5 parties ainsi que le rapport prestigieux de
216 (= 80 + 72 + 64 : emblmes des 3 tubes yang) 144 [= 56 + 48 + 40,
emblmes des 2 tubes yin et du tube (40 = 80/2 ) qui, la diffrence dune
octave, permet de revenir la 1
e
note yang]
La srie 80, 56, 72, 48, 64 ne diffre que par ses mrites symboliques de
la srie 10, 7, 9, 8, 6 (et 5). Elle ne diffre vraiment de la srie classique 81,
54, 72, 48, 64 que par le nombre 56. Elle est le prototype de cette dernire,
mais drive elle-mme de la formule 10, 7, 9, 8, 6, (5), dont les emblmes
numriques des notes ont conserv le souvenir.
Si nous postulons que les nombres de la srie 10, 7, 9, 6, 8 (dont la srie
80, 56, 72, 48, 64 nest quune autre expression) se prtaient servir
demblmes a ux dimensions relles des tubes, notre hypothse nimplique
nullement qu cette traduction numrique, qui parat incorrecte, ait
correspondu une pratique galement incorrecte.
Admettons, conformment aux traditions chinoises, que les premiers
tubes sonores taient des tuyaux de bambou. Leurs dimensions pouvaient tre
figures au moyen dun petit nombre entier obtenu en comptant les
articulations (= tsie, qui signifie aussi : mesure) de chacun des 5 bambous
donnant les 5 notes de la gamme primitive. Il est ais de voir que, pour
obtenir des intervalles justes, tout en attribuant aux tubes des dimensions
impliquant des rapports inexacts, il suffisait que lartisan choist pour les 1
er
et
196
2
e
tuyaux, des bambous dont les nuds taient, pour le 1
er
, un peu plus
distants, et un peu moins distants pour le 2
e
(
349
).
Une pratique juste sest donc trouve lgitime, au dbut, par une thorie
inexacte, mais qui avait, au moins, un mrite : elle traduisait le sentiment de
loctave.
Les dfauts de la thorie taient sans consquences et pouvaient ne pas
apparatre tant que, comptant par articulations, on laissait aux artisans un
certain jeu pour lvaluation des dimensions relles. Mais, pour donner un
surplus de perfection symbolique la thorie, et dans lintention de combiner
lide doctave avec lide de cycle en voquant 360 (
350
), les Chinois ont t
conduits remplacer la srie 10, 7, 9, 6, 8, (5) par la srie 80, 56, 72, 48, 64,
(40). Ceci revenait prter 8 divisions (
351
) tous les intervalles
(pratiquement ingaux) compris entre deux nuds.
Marcel GRANET La pense chinoise 143
En comptant par sous-divisions, au lieu de compter par articulations, les
Chinois sexposaient substituer des units concrtes un systme dunits
abstraites.
Ds quils mesurrent leurs tubes au moyen dun systme de
sous-divisions gales entre elles, linexactitude de la thorie dut apparatre
dans la pratique. Tel est, sans doute le principe du perfectionnement qui
conduisit adopter pour emblmes numriques des premiers tubes les
nombres 81 et 54 au lieu de 80 et 56, 72, 48 et 64 (nombres conformes la
squence 9, 6, 8) restant inchangs.
Reste fixer la date de ce perfectionnement, ce qui, du reste, va donner
loccasion de vrifier lhypothse.
Cette hypothse rend compte de lensemble des donnes mais, postulant
que la srie 81, 54, 72, 48, 64 est postrieure aux deux sries (quivalentes)
10, 7, 9, 6, 8 et 80, 56, 72, 48, 64, elle suppose entre les faits un ordre
historique.
Toute hypothse de ce type peut facilement tre retourne. La ntre ne
sort point des faits ; elle entrane la conclusion, assez satisfaisante en
elle-mme, que la thorie des tubes et de la gamme expose par les Chinois
est solidaire de leur pratique musicale et se relie strictement au systme de
notions qui exprime leurs vues sur lUnivers. Mais ne
197
pourrait-on dire :
les Chinois ont dabord connu, par emprunt formule en termes
abstraits ou traduite (cest possible) par la squence 9, 6, 8, la rgle
arithmtique de la gamme invente par les Grecs ;ils lont exprime par
la squence 81, 54, 72, 48, 64, qui avait (cela est juste) le mrite, grand pour
eux, dvoquer peu prs 360 et le rapport 216/144 ; ils ont alors remarqu la
proximit de cette squence et de la srie 80, 56, 72, 48, 64, entirement
forme de multiples de 8 ; indiffrents la rigueur des faits mathmatiques,
ils ont tir de cette dernire la formule 10, 7, 9, 6, 8, et ceci leur a permis
dattribuer aux notes des emblmes numriques, qui (on le reconnat) ne sont
point entirement arbitraires ?
Si lon interprtait ains i les faits, lordre quon fixerait leur histoire ne
serait point draisonnable. Il est vrai. Et il est vrai aussi que, ce faisant, on
se rserverait lavantage de postuler une origine par voie demprunt ; cest l
le type de faits historiques quun bo n philologue se plat tablir : en
dcidant quil y a emprunt, on passe dautres spcialistes le souci de trouver
lexplication relle des faits. Les questions dorigine nous intressent ici
fort peu. Il nous suffirait parfaitement quon accorde que la thorie de la
gamme sest dveloppe en Chine sous linfluence dune reprsentation du
monde, si une importante question de fait ntait en jeu. Admettre lordre
historique que suppose lhypothse ici dfendue permet de comprendre dans
son fond mme lattitude des Chinois lgard des Nombres. Il sagit de
constater la difficult que les Chinois ont eue concevoir sous son aspect
arithmtique lide d unit et den indiquer les raisons.
Marcel GRANET La pense chinoise 144
Nous avons donc tablir la primaut de la srie 10, 7, 9, 6, 8, et nous
ltablirons prcisment en montrant que le dveloppement de la thorie
musicale est d la concurrence de plusieurs systmes de comput qui
imposaient lunit des divisions variables et qui, en retardant les progrs de
la notion abstraite dun it, se sont opposs une conception quantitative des
nombres.
A ce propos, nous devons dabord montrer que notre opinion sur le
passage de la srie 10, 7, 9, 6, 8 la srie
198
80, 56, 72, 48, 64 nest point
une simple vue thorique : Or, cest un fait, la relation existant entre les
emblmes communs aux Notes, aux Saisons, aux lments, et les dimensions
des 5 Tubes tait encore sentie au temps de Sseu-ma Tsien.
La preuve en est dans une phrase insre par lhistorien dans la
conclusion de son chapitre sur les Tubes sonores. Cette phrase se compose
des caractres dsignant les 5 Notes, associs chacun un nombre ; les
nombres sont ceux que le Yue ling donne comme emblmes aux Notes, mais
les quivalences du Yue ling ne sont point respectes (
352
). Aussi les
commentateurs, sans se rsoudre corriger un texte vnrable, dclarent-ils
ces nombres inexplicables. Cette dclaration a suffi pour dcider Chavannes
ne point chercher de sens la phrase de son auteur. Il est vrai quil navait pas
compris les deux mots par lesquels elle souvre. Il les a traduits
(littralement) par neuvaine suprieure , ce qui ne prsente aucun sens
intelligible. Ces deux mots Neuf Suprieur dsignent, nous lavons vu,
une gamme : cest celle dont la note initiale est produite par le dernier
(Suprieur) Tube yang (Neuf ).
Les dimensions des tubes correspondant cette gamme sont 45 (11
e
tube),
60 (12
e
tube), 81( 1
er
tube), 54 (2
e
tube), 72 (3
e
tube). Tous [sauf 60, mais 60,
valeur du dernier tube, doit tre senti comme quivalant 63, si lon veut que
le total des six derniers emblmes numriques de la srie des tubes gale 360]
sont des multiples de 9. En les divisant par 9, on obtiendrait : pour 72 (3
e
tube), 8 (5
e
note) ; pour 54 (2
e
tube), 6 (4
e
note) ; pour 81 (1
er
tube), 9 (3
e
note) ; pour 63 (remplaant 60, 12
e
tube), 7 (2
e
note) ; et pour 45 (11
e
tube), 5
(1
e
note), cest --dire tout justement les valeurs emblmatiques attribues aux
notes par le Yue ling.
Sseu-ma Tsien a crit cette phrase aprs avoir collabor une rforme du
Calendrier. Cette rforme entrana lattribution de nouveaux emblmes
numriques aux 12 Tubes. Elle eut pour principe ladoption dun gnomon de
9 pouces li une division du pouce en 9 sections, do rsultait pour le
premier tube sonore, gal en longueur au gnomon, une longueur mesure par
81 divisions de pouce. Il nest pas douteux, vu ce fait, quon ait le droit de
rtablir lord re des
199
correspondances qua drang une faute inexplicable
due un copiste. On na aucune chance de mal lire la phrase de Sseu -ma
Tsien en la traduisant ainsi : [cest dans la gamme qui commence] avec le
(11
e
tube, 45) Neuf Suprieur [que la note initiale] kong [prend la valeur] 5
Marcel GRANET La pense chinoise 145
(qui est son emblme car 45/9=5) ; [que la 2
e
note] tche [vaut] 7 (car 60/9, ou
plutt 63/9 = 7) ; [que la 3
e
note] chang [vaut] 9 ( car 81/9=9) ; [que la 4
e
note] yu[vaut] 6 (car 54/9=6 ; [que la 5
e
note] kio [vaut] 8 (car 72/9=8).
Limportance de ce passage de Sseu -ma Tsien, dont on peut restituer
avec certitude le sens original, est trs grande. Il prouve, dabord, comme
nous lavons suppos, que les emblmes numriques affects aux notes
ntaient point sentis c omme arbitraires : on songeait les mettre en relation
avec les nombres fixant la longueur des tubes correspondant une certaine
gamme. Il conduit de plus une observation essentielle : si la relation existant
entre les emblmes des notes et les dimensions des tubes tait sentie au temps
des Han, leur historien na pu la signaler quen se reportant, non pas la
premire gamme, mais la onzime. Ceci dmontre lanciennet de la thorie
des 12 gammes et permet de confirmer un fait. Ds quon se rfre la
onzime gamme, il nest plus possible dobtenir 10 pour emblme de la
premire note ; on obtient 5, or, le Yue ling attribue, lui aussi, la premire
note lemblme 5. Il faut donc supposer que, ds lpoque (au plus bas IIIe
sicle av. J.-C.) o le Yue ling a t rdig, la thorie des 12 gammes tait
constitue. Mais le fait a des consquences plus importantes.
Le remplacement de 10 par 5 en tte de la srie des 5 emblmes
nentranait pas 1a mconnaissance de leur signifi cation. Elle cachait
cependant le principal mrite de cette squence qui est de donner le sentiment
de loctave. Pour quoi, malgr ses avantages, avait-on dlaiss la formule :
10, 7, 9, 6, 8, (5) ? Cest apparemment quil ntait possible
200
de la
rapprocher telle quelle dau cune gamme tandis que (grce
lidentification de 60 et de 63), la onzime gamme fournissait un expdient
pour faire ressortir la signification des emblmes des notes au moyen dune
formule commenant non plus par 10, mais par 5. On doit conclure que, ds
le moment o 5 est prsent comme lemblme de la note initiale, la srie
forme par les emblmes numriques des dimensions attribues aux 5
premiers tubes (Ire gamme) ne pouvait plus tre rapproche de la squence
traditionnelle indiquant la valeur des notes.
Cest prcisment ce qui doit arriver ds que les dimen sions des tubes
sont exprimes en obissant une dcision fixant obligatoirement 9 les
sections de lunit.
Sseu-ma Tsien [pas plus, sans doute, que ne lavaient t ; avant lui, les
thoriciens dont sest inspir le Yue ling] na pas t gn par la difficult
dobtenir 7 en divisant 60 par 9. Il aurait fort bien pu, partir de la formule
classique (81, 54, 72, 48, 64) des tubes correspondant la premire gamme,
tirer, sans plus de gne, 7 de 54, sil avait divis ce nombre par 8, et il aurait,
sans plus dinexactitude, obtenu, avec le mme diviseur, et toujours partir de
la formule classique, la srie 10 (=81/8), 7 (=54/8), 9 (=72/8), 6 (=48/8),
8(=64/8). Cest bien l ce qui aurait d se passer si, comme on pourrait
nous lobjecter, je lai dit, ctait de la formule arithmtique (primitive)
Marcel GRANET La pense chinoise 146
donnant les dimensions (relles) des tubes (81, 54, 72, 48, 64) quon avait
(par jeu et en servant dun diviseur quil et t possible de choisir
arbitrairement) tir la formule (uniquement emblmatique et non primitive)
de la gamme. Mais, comme on voit, Sseu-ma Tsi na pas procd ainsi. Cest
donc que le diviseur 9 lui tait impos.
Nous pouvons donc conclure que la formule des notes na pas t tire,
par jeu et au moyen dune division, de la forme des tubes. Tout au contraire,
ce sont les diffrentes formules relatives aux longueurs des tubes qui ont t
tires, au moyen dune multiplication (et dabord sans aucun jeu), de la forme
des notes, le multiplicateur ayant t impos par un systme de
conventions, et 8 tant le premier multiplicateur impos.
Lartifice qui a consist, pour retrouver la formule
201
emblmatique des
notes, se reporter la onzime gamme, laquelle na quun intrt
thorique, mais peu de valeur dans la pratique, a t rendu ncessaire par
ladoption ( pralable cet artifice) de lindice 9. La srie classique (81, 54,
72, 48, 64) nest point primitive. Lordre des faits suppos par notre
hypothse se trouve confirm.
Reprenons donc cette hypothse. A partir de la rgie primitive exprime
par la squence 10, 7, 9, 6, 8, (5), a t construite la formule 80, 56, 72, 48,
64, prfre en raison de ses vertus symboliques et imagine en des temps ou
dans des milieux qui avaient adopt lindice 8 pour la division de lunit.
En dautres temps ou en dautres milieux, cet indice a t remplac par
lindice 9 , que les Han remirent en honneur (
353
).
En attribuant 9 sections chacun des intervalles compris entre deux
nuds de bambou, il est toujours possible de figurer loctave, mais les
dimensions des tubes ont alors pour symboles les nombres 90, 63, 81, 54, 72,
(45), dont la valeur totale est suprieure 360. Pour voquer, comme il
convient, 360, il faut liminer 45, moiti de 90. Dans la liste ainsi rduite
figurent 81, 72, 63, dont la valeur totale est 216 qui est aussi le total de
80+72+64 ;comme 80, 72 et 64 dont ils diffrent peu, 81, 72 et 63 mritent
donc de fournir les dimensions des 3 tubes yang (1
er
, 3
e
et 5
e
tubes). Restent,
pour les tubes yin, 90 et 54, dont le total est 144. Mais 90 est trop fort pour un
tube yin (qui doit tre les 2/3 dun tube yang), puisque le plus fort de ces
derniers est 81 ; 54, en revanche (il vaut les 2/3 de 81), peut mesurer le pre-
mier tube yin. Dautre part, pour figurer loctave, il faut pouvoir indiquer 6
longueurs de tubes. Reste donc diviser 90 en deux parts ingales. Dans la
formule construire, 72 est prdispos servir demblme au 2
e
tube yang,
puisquil a dj ce rle dans la formule prcdente o le 2
e
tube yin (48) vaut
tout justement les 2/3 de 72. On prendra donc 48 pour emblme du 2
e
tube yin
dans la formule quon construit, et il restera lemblme 42 (= 90-48) pour le
3
e
tube yin lequel devrait rendre, lintervalle dune octave, la note kong
mise par le 1
er
tube (81).
Marcel GRANET La pense chinoise 147
202
Or, 42, dune part, diffre trop sensiblement de 81/2 pour quun tube
de cette dimension ne part point donner une note nouvelle (la sixime) et,
dautr e part, 42 vaut les 2/3 de 63, comme 54 les 2/3 de 81 et 48 les 2/3 de 72.
Do lide de faire de lui lemblme dun tube indpendant, le sixime.
En mme temps, 81, 54 et 72 tant considrs comme les emblmes des
1
er
, 2
e
et 3
e
tubes, et 72, 48, 63 comme ceux des 3
e
, 4
e
et 5
e
tubes, il tait ais
de remarquer que la squence 9, 6, 8 se retrouvait dans les deux sries
condition dcrire 64 comme lpoque o lindice 8 tait obligatoire.
Cependant, condition dcrire 63, comme limposait maintenant l indice 9,
lemblme numrique du 5
e
tube apparaissait comme un multiple de 7, ainsi
que 42, dont il valait les 9/6. Il suffisait donc de multiplier 7 par 8 pour
obtenir un nombre (56) qui deviendrait lemblme dun septime tube.
Le remplacement de lindic e 8 par lindice 9 a conduit :
1 A remarquer la squence 9, 6, 8. Cette remarque a rendu possible la
formule de la rgle arithmtique qui fonde la gamme chinoise sur une
progression par quintes et, par suite, elle a permis de constituer la thorie des
12 Tubes.
2 A inventer, le sixime tube ne rendant plus une note qui ft loctave
de la note initiale, deux notes nouvelles mises par des tuyaux de dimensions
telles que ft assure la jonction entre les 5 tubes primordiaux et 5 autres
tubes (75, 51, 68, 45, 60) fournissant une autre gamme de 5 notes raccorde
directement la premire puisque le 12
e
tube (60) vaut ( peu prs) les 2/3 du
1
er
(81). A la premire des deux notes inventes, on donna le nom de pien
kong, qui tmoigne encore du sentiment de loctave, et le nom de pien tche
la deuxime, mise par un tube dont lemblme numrique tait 56, ancien
emblme du (2
e
) tube, mettant la note tche, au temps o les emblmes
numriques des tubes primordiaux taient fournis par la formule (80, 56...)
constitue au moyen de multiples de 8.
Nous pouvons maintenant rsumer lhypothse. La formule 10, 7, 9, 6, 8,
(5), constitue la premire expression
203
numrique de la gamme chinoise.
Cette formule, dont les termes, arithmtiquement inexacts, ne gnaient pas la
pratique, est lorigine dune thorie correcte.
La thorie est devenue correcte la suite dun progrs accompli en deux
tapes. Les longueurs des tubes, quon estimait de faon concrte en
comptant des nuds, furent dtermines par des symboles numriques
drivant de la premire formule. Ces symboles ont vari comme le systme
conventionnel de divisions adopt pour lunit.
Distingus des emblmes affects aux notes, les emblmes numriques
attribus aux tubes commencrent cependant par tre de simples produits des
premiers. Lindice 8 leur servant de multiplicateur, les Chinois prtrent aux
tubes des longueurs indiques par les nombres 80, 56, 72, 48, 64, (40). Ces
nombres avaient le mrite de rappeler, avec le total 360, limage dun cycle
Marcel GRANET La pense chinoise 148
en la liant au principe de loctave. Les divisions des tubes se trouvrent ds
lors fixes non plus par un certain nombre indiquant des divisions concrtes,
telles que ltaient les articulations de bambou, mais par un certain compte de
sous-divisions abstraites. Ceci devait avoir une double consquence :
technique et pratique. Dans la fabrication des instruments, il tait
pratiquement difficile de ne pas considrer comme gales entre elles les
sous-divisions dont le compte indiquait la longueur des tuyaux sonores : ds
lors, comme des instruments fabriqus en tenant compte des nombres choisis
pour chaque tube ne pouvaient plus donner des notes justes, la pratique
musicale put rendre les Chinois sensibles linexactitude de la formule
originelle. Ils furent amens la corriger avec bonheur quand ils adoptrent
pour lunit une division non plus en 8, mais en 9 sec tions. La correction
obtenue, ils purent amorcer un perfectionnement de la pratique en inventant
deux notes nouvelles ; et songrent surtout dvelopper la thorie en
construisant une srie de 12 Tubes qui leur permt, une fois de plus, de figurer
concrtement leur conception de lUnivers.
Cette hypothse rend compte de lensemble des faits et parat conforme
leur ordre historique.
Elle saccorde aussi avec les traditions chinoises. Sous la dynastie des
Yin, disent celles-ci, on divisait les units en 8 sections. Les Tcheou
adoptrent la division par 9 (
354
). On
204
dit encore ; rencontre remarquable,
que linvention des deux notes supplmentaires est due au roi Wen, fondateur
des Tcheou.
*
* *
Les traditions chinoises sont prcieuses : elles signalent des connexions
de faits qui, le plus souvent, ne sont pas arbitraires. Toutes les donnes, en
lespce, invitent penser que linvention des deux notes supplmentaires
rsulte du remplacement de lindice 8 par lindice 9. Connatre lordre
historique des faits nautorise point rapporter ces faits des dates prcises.
Les traditions chinoises enregistrent fidlement des connexions, mais elles les
transmettent transposes en mythes ou en lgendes historises. Ce nest
pas pour attribuer au roi Wen (ou ses contemporains) un rle dans le
dveloppement de la thorie musicale que nous rappellerons une autre
tradition : les Chinois affirment, on la vu, quun descendant des derniers Yin
rcita au fils du fondateur des Tcheou le texte vritable du Hong fan. Si nous
mentionnons ce dtail, cest quil faut bien en reve nir au Hong fan et sa
premire Section. Nous ne pouvons pas ngliger une donne importante : les
5 Notes de la gamme sont mises en rapport avec les 5 lments.
La premire section du Hong fan, je dois le rappeler, numre les
lments dans un certain ordre. Elle affecte chacun deux un nombre qui
nest pas, je lai montr, un simple numro dordre. Les nombres indiqus par
Marcel GRANET La pense chinoise 149
le Hong fan signalent lordre des affectations qui permettent didentif ier, en
traant un templum, chaque lment un site de lEs pace-Temps. Ces
nombres sont les premiers termes dun couple congruent dont le deuxime
terme sert, dans le Yue ling, demblme aux Saisons -Orients. Premire
nomme, dans le Hong fan, et affecte par lui au Bas, qui vaut le Nord (site 1),
lEau (lment 1) correspond, comme en tmoigne toute la mythologie
chinoise, au Nord (Bas) et lHiver auxquels le Yue ling attribue, comme
classificateur, le nombre 6 (= 1 + 5) ; il en est de mme pour le Feu (lment
2, site du Sud-t, classificateur 7 (= 2 + 5)] pour le Bois [lment 3, site
Est-Printemps classificateur
205
8 (= 3 + 5)], pour le Mtal (lment 4, site
Ouest-Automne, classificateur 9 (= 4 + 5)) et pour la Terre [lment S, site
Centre, classificateur 5] car, pour le Centre [Terre] le Yue ling indique
pour classificateur 5, et non pas 10, de mme que, pour la premire note, il
indique la valeur 5 et non pas la valeur 10. cf. mg_pc_figures : 17 Il affecte,
en revanche, la note yu (6) au Nord-Hiver [6, Eau, lment 1] ; la note tche
(7) au Sud-t [7, Feu, lment 2] ; la note kio (8) lEst -Printemps [8, Bois,
lment 3] ; la note chang (9) lOuest -Automne [9, Mtal, lment, 4]. Tant
pis pour les rudits frus de ce quils appellent les mthodes philologiques
au point de voir en elles linstrument privilgi des recherches archologiques,
206
et qui veulent, avec leur seul secours, dcouvrir (en datant des textes) non
seulement lordre des faits, mais encore la date des faits, tant pis pour eux
si [aprs avoir soutenu que les Chinois ont reu des Grecs leur gamme sous sa
forme parfaite et mathmatique (
355
), ou que toute interprtation du Hong
fan qui insiste sur limportance des nombres dans les formes premires de la
thorie des lments est anachronique (
356
), ou encore que les lments
furent dabord conus comme triomphant les uns des autres et non pas comme
se produisant les uns les autres (
357
)], ils se voient proposer le problme
suivant :
tant donn que :
a. Lo rdre des lments, quand ils se succdent les uns aux autres, nest
point absolument arbitraire [ il y a quelque cohrence dans les mtaphores
des Chinois qui disent : lEau produit le Bois (en lui donnant sa sve) ; le
Bois produit le Feu (quil alimente ) ; le Feu produit le Mtal (quil dgage du
minerai) ; le Mtal produit lEau (puisquil peut se liqufier)] ;
b. Lordre des lments nest aucunement arbitraire une fois quon les a
assimils aux saisons [ celles-ci se succdent dans un ordre fixe] ;
c. Lordre des Notes est entirement command [ il lest par la
longueur des tubes qui mettent ces notes. Si lon admet que ces tubes ont
pour emblmes numriques 10, 7, 9, 6, 8, (5), il sensuit imprativement que
la note tche, mise par le 2
e
tube, doit tre classe la 2
e
, aprs la note kong,
mise par le 1
er
tube, puisque (pour parler comme les Chinois) le 2
e
tube est
produit par le 1
er
, et quon pourrait tout aussi bien dire, tant quil ny a
point de diffrence entre les emblmes numriques des tubes et des notes,
que la 1
e
note produit la deuxime ; on peut en dire autant pour les 3
e
, 4
e
et 5
e
Marcel GRANET La pense chinoise 150
notes, et il faut rappeler quaprs la 5
e
on revient la 1
e
note (10), qui est
aussi la sixime (5)].
Comment expliquer lassimilation entre eux des lmen ts, des Notes, des
Saisons, et leur assimilation commune aux emblmes numriques indiqus
par les couples congruents 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10 ?
Comment lexpliquer si lon a postul par avance : que la numrotation
des lments dans le Hong fan est sans intrt ?
207
que les quivalences
chinoises sont de simples jeux arbitraires ? et que les emblmes
numriques des notes sont galement arbitraires ? (Cette dernire supposition
est exige par lhypothse que les Chinois ont dabord reu leur gamme sou s
la forme arithmtiquement parfaite qui est celle de la gamme grecque.)
Une des 5 notes (si on veut les orienter) devant aller au Centre puisquil y
a 5 lments et 5 Sites de lEspace -Temps, la premire note, 10 (5), pouvait y
tre place sans difficult, et il est clair que lon pouvait choisir pour la
deuxime une place arbitraire sur la croise. Mais cette 2
e
note une fois
affecte au Sud et lt, qui produit lAutomne, la 3
e
note, mise par un
tube considr comme produit par le 2
e
tube, ne pouvait plus tre attribue
qu lAutomne et lOuest. Pour les mmes raisons, les 4
e
et 5
e
notes ne
pouvaient manquer dtre affectes, dans lordre, lune au Nord -Hiver, lautre
lEst -Printemps.
Lassimilation des Notes, des Saisons -Orients et des lments ne peut
sexpliquer quen admettant la primaut de la squence des notes 10, 7, 9, 6,
8, (5). Cest partir de cette formule que les Saisons ont reu les emblmes
numriques destins servir de classificateurs aux sites de lEspace -Temps,
et cest encor e de cette formule que drive, avec la thorie de la
production des lments les uns par les autres, lordre des lments qui
commande le trac du templum, leur disposition sur la croise et la
numrotation que le Hong fan leur attribue (
358
).
Si lon ne trouve pas au problme pos une autre rponse qui soit
satisfaisante, il faudra nous accorder que la squence 10 7, 9, 6, 8, (5), qui
est lorigine de la thorie musicale du Chinois, est aussi lorigine de
leur thorie des lments, telle que le Hong fan la suppose, et, par suite,
quelle antrieure au Hong fan. Il restera toujours, il est vrai, la libert de
supposer que le Hong fan est une uvre de basse poque ou que le texte de sa
premire Section est interpol ou truqu.
Mais que fera-t-on du Yue ling, riche de tant de donnes archaques
parfaitement cohrentes ? Dailleurs, peu importe. Nous ne nous soucions pas
de dater du roi Wen,
208
inventeur des deux notes supplmentaires, ou du roi
Wou, son fils, auditeur du Hong fan, un progrs quelconque de la thorie
musicale. Nous ne tenons mme pas prtendre que la squence 10, 7, 9, 6,
8, (5) faisait autorit avant les Ve-IVe sicles, poque assigne avec
vraisemblance la rdaction du Hong fan. Des dates reportes une
Marcel GRANET La pense chinoise 151
chronologie vide de faits concrets ne nous intressent aucunement. Que la
formule 81, 54, 72, 48, 64, ne soit point primitive, mais drive de la squence
10, 7, 9, 6, 8, (5), dont lautorit se trouve atteste par un passage du Hong
fan, ce fait rend peut-tre difficile lhypothse que les Chinois ont reu par un
effet indirect des expditions dAlexandre, la thorie grecque de la gamme
toute parfaite. Mais rien nexcl ut la possibilit de rapports plus anciens entre
la Chine et des pays dOcci dent o lon spculait aussi sur les Nombres et les
lments. Ce dbat importe peu. Ce qui importe dabord lhis toire des
ides, cest lordre historique des faits, ainsi que les connexions qui, seules,
peuvent aider les comprendre.
Le rapprochement tabli entre lordre des lments et la squence des
Notes qui se ramnent tous deux la mme formule numrique a pour nous
un premier intrt. Il apporte un surcrot de probabilit notre hypothse.
Puisque les emblmes numriques des lments tmoignent de lordre dans
lequel ceux-ci se produisent (cheng) les uns les autres, nous avons une raison
nouvelle de penser que les nombres conservs comme emblmes aux notes,
indiqurent dabord les dimensions des tubes dans lordre o ceux -ci se
produisaient (cheng). Ces nombres devinrent les emblmes des notes seules
la suite dun dveloppement de la thorie et de la technique musicales que
lhypothse suffit expliquer.
Voici, cependant, lintrt principal du rapprochement. Il montre que la
thorie des lments, ou, tout au moins, lexpression numrique quelle a
reue, a t commande par la thorie premire de la gamme. Cette
remarque peut tre prcieuse. La thorie des lments, par suite de
lassimilation de ceux -ci aux Saisons-Orients, faisait corps avec le Savoir
suprme qui consiste amnager les Temps et les Espaces. Il devait en tre
de mme de la thorie de la gamme et, sur ce point, lvocation du Hong
fan est, en elle-mme, pleine de significations. La premire Section
209
de ce
trait, o il est question des lments, se rapporte certainement une division
du Monde en 4 Secteurs [carr de ct 2, subdivis en 4 carrs] obtenus par le
trac dune croise, cependant que les 9 Sections du Hong fan (le grand
Plan) sont mises par la tradition en rapport avec une division du Monde en 9
Provinces [carr de ct 3, subdivis en 9 carrs] et avec un arrangement des
Nombres en carr magique ; cette division et cet arrangement commandaient,
nous dit-on, le plan du Ming tang, Maison du Calendrier, o le Chef assurait
une juste rpartition des sites de lEspace -Temps et distribuait, temps
rgls, entre ses fidles, les domaines de tous les quartiers de lEmpire.
Peut-tre trouverons-nous de nouvelles connexions qui permettraient de
mieux comprendre lattitude des Chinois lgard des Nombres, si nous
songeons confronter leurs ides sur les rapports musicaux et les proportions
architecturales.
Marcel GRANET La pense chinoise 152
IV. Nombres et proportions architecturales
Le rapport du 1
er
au 5
e
tube, dans la formule (80, 56, 72, 48, 64)
compose de multiples de 8, est gal 10/8. Il devient gal 9/7 dans la
formule (81, 54, 72, 48, 63), qui rsulte de ladoption de lindice 9 comme
multiplicateur. Tout aussi bien que les rgles musicales, les canons
architecturaux sont domins par lopposition ou lquivalence des rapports
9/7(=81/63) et 10/8(=80/64), et cest la gomtrie des constructeurs qui rvle
les vertus que les Chinois ont prtes aux couples corrlatifs 80-64 et 81-63.
*
* *
Deux lments, dans les constructions chinoises, sont fondamentaux.
Ldifice, en lui -mme, importe moins que 1a terrasse qui le supporte et que
la toiture qui le couvre. Le Ciel couvre et le toit reprsente le Ciel ; la
Terre, qui supporte , est figure par la terrasse. Un difice apparat comme
une image de lUnivers, ds que les proportions donnes au profil du toit et
au plan de la terrasse voquent, les premires le rond (impair, 3, yang), les
autres le carr
210
(fang, le rectangulaire, pair, 2, yin). Ces principes
commandent, en particulier, la construction du Ming tang. La tradition veut
que la Maison du Calendrier ait anciennement consist en une aire carre
(rectangulaire) que recouvrait (li elle par quelques colonnes) un toit de
chaume circulaire (
359
).
Sur le profil de la toiture, nous navons que des renseigne ments tardifs. La
base du toit du Ming tang devait tre mesure par le nombre 144, et son
contour par le nombre 216, la hauteur tant figure par 81. Telles quon les
indique, ces dimensions supposent que le profil du toit de chaume est un
triangle isocle dont la base (2 x 72) figure la Terre (144) et les deux autres
cts [2 x 108 = 216] la courbure du Ciel (3 x 72) cf. mg_pc_figures : 18.
Cette construction a pour principe une querre dont le grand ct vaudrait
9 x 9, le petit 8 x 9 et lhypotnuse 12 x 9. Cette querre (8, 9, 12) est estime
juste, grce au jeu dune unit, en vertu de la formule 9 + 8 = 12 (+ 1) ou
81 + 64 = 144 (+ 1).
On remarquera que :
1 Le renseignement (360) date de la dynastie des Souei (589-618),
cest --dire dune poque o les connaissances mathmatiques (indignes ou
importes) avaient atteint en Chine un niveau lev. [Mais le jeu dune unit
ntait point fait pour gner les charpentiers dans lassemblage des chevrons,
poutres et colonnes et pas davantage ntaient gns les charrons par
Marcel GRANET La pense chinoise 153
lobligation de donner l a val eur 3. Lessentiel tait dutiliser des
Nombres qui pussent voquer le rapport (3/2 ou 9/6) du Ciel et de la Terre] ;
2 Lobtention des Nombres, terrestre et cleste,
144 [= (8 x 2) 9] et 216 [= (12 x 2) 9]
partir de lquerre 8, 9, 12, suppose lemploi, comme multiplicateur, de
lindice 9. [De lemploi de cet indice rsulte,
211
pour la gamme, la fixation
9/7 du rapport entre les 1
er
et 5
e
tubes] ;
3 Lquerre 8, 9, 12, fournit la squence (9, 6, 8) qui rgit la construction
des 12 tubes sonores (
361
). [Le 2
e
tube (6 x 9) vaut la moiti de lhypotnuse
(12 x 9) : on sait que Kouan tseu, qui ne le rduisait pas de moiti, lui
attribuait la valeur 108] (
362
).
4 La hauteur (81) a la dimension quon donne au gnomon, quand
lindice adopt pour le sectionnement de lunit est 9.
Le Ta Tai Li ki (363) fournit sur le plan du Ming tang une indication qui
se raccorde fort bien ces renseignements tardifs sur le profil du toit. Laire
rituelle devait comprendre de lEst lOuest 9 (longueurs de) nattes et 7
(longueurs de) nattes du Sud au Nord. 9 (le multiplicateur conventionnel)
mesure la longueur des nattes. Laire (carre, fang) du Ming tang forme donc
un rectangle (fang) de cts 81 et 63. Le demi-primtre vaut 144,
dimension convenable puisque 216 mesure la circonfrence et le pourtour du
toit. Il sagit du Ming tang des Tcheou ; le multiplicateur adopt est 9, et
le rapport de la largeur (E.-W.) la profondeur (S : N.) de laire est 9/7
(exprim sous la forme 81/63).
Les dires du Ta Tai Li ki sont confirms par un passage du Kao kong Ki,
prcieux recueil de renseignements techniques qui forme aujourdhui le
sixime Livre du Tcheou li (364). On y donne, mesures en nattes de 9 pieds
(de long), les dimensions du Ming tang qui sont bien, en largeur, 9 x 9 et, en
profondeur, 9 x 7. Le passage est surtout intressant parce quil prtend
encore renseigner sur la Maison du Calendrier au temps des Hia et des Yin.
La proportion, dans les deux cas, nest plus 9/7 mais 5/4 (= 10/8).
Pour les Hia, premire dynastie royale, le Kao kong ki indique
expressment que la proportion est 5/4. Laire rituelle mesurait en profondeur
2 x 7 (pou) et en longueur un quart en plus ; le multiplicateur (qui est
sous-entendu) est le pou ou pas de 6 pieds : laire tait donc profonde de 7
doubles pas de 6 pieds, soit 7 x 12 ou 84 pieds (= 4 x 21) et large de
(5 x 21 =) 105 pieds. Pour les Yin, deuxime dynastie, seule est donne la
profondeur, qui est de 7 sin, ce qui, le
212
sin ayant 8 pieds, fournit le
nombre 56. 56 mesure la profondeur dune sorte de vestibule accol par les
Hia leur aire rituelle ; les dimensions de ce vestibule sont les 2/3 des
dimensions de laire, soit 56 en profondeur et 70 en lar geur. On admet (
365
)
donc que laire des Yin mesurait 70 x 56 (soit 5 x 4). Tcheng Hiuan,
cependant, le plus illustre des interprtes, pour la raison que les Yin sont
Marcel GRANET La pense chinoise 154
intermdiaires entre les Hia et les Tcheou, affirme que la largeur tait de 9
sin, soit 72 pieds : ce qui implique la proportion 9/7 et non 5/4 et donne au
demi primtre
(72 + 56 et non 70 + 56)
une valeur gale deux fois 64 et non pas deux fois 63. Cette hsitation
entre 70 et 72 constitue un renseignement prcieux : elle montre que le
sentiment dune opposition ou dune quivalence entre les rapports 5/4 (ou
10/8) et 9/7 saccompagnait dun sentiment analogue lgard des nombres
63, 64.
Lopinion de Tcheng Hiuan sur la largeur de laire des Yin part du dsir
de trouver une sorte de lien ou de mesure commune entre les aires rituelles de
trois dynasties. Si lon suit Tcheng Hiuan, il apparat que le rectangle sacr
des Yin (8 x 7 sur 8 x 9) comprenait 8 x 8 petits rectangles de 9 pieds sur 7,
tandis que le Ming tang des Tcheou (9 x 7 sur 9 x 9) contenait 9 x 9 nattes de
9 pieds sur 7. Les superficies des deux aires peuvent donc tre indiques par
les carrs 64 et 81. Pour leur comparer laire sacre des Hia, il faut pouvoir la
mesurer laide de nattes ; cest dailleur s en nattes, le Kao kong ki
laffirme, que devaient tre mesu res des superficies de ce genre (366). Pour
que la chose soit possible, il suffit de modifier lgrement, de mme quon
la fait dans le cas des Yin, la dimension de la largeur de laire et de
lestimer non pas 105, mais 108. Ds lors le rectangle (12 x 7 sur 12 x 9)
pourra contenir 12 x 12, soit 144 nattes, de 9 pieds sur 7. Notons le
procd de mesure : il revient, si je puis dire, traiter comme des carrs des
rectangles dont les deux cts paraissent recevoir le mme emblme
numrique (12, 9 ou 8) (
367
). Tandis que lunit de superficie (9 x 7) est un
rectangle qui vaut (63), une unit prs, un carr (64), les trois aires
213
rectangulaires se trouvent mesures par des carrs (12, 9, 8). Ces
carrs sont tout particulirement remarquables par le fait que le rapport
quils signalent entre les trois aires rituelles drive de la formule de lquerre
(considre comme valable pour les charpentes) 8, 9, 12. Mais, sil semble
avoir tenu le retrouver dans les superficies, Tcheng Hiuan aurait pu mettre
en valeur le mme rapport, et cela sans modifier la largeur de laire des Yin.
Il suffisait de considrer les profondeurs qui sont gales 12 x 7 pour les Hia,
8 x 7 pour les Yin, 9 x 7 pour les Tcheou. Elles font voir, elles seules, que
12 (ou 6), 8 et 9 valent comme les emblmes des trois dynasties royales.
Leurs relations sont celles de trois tubes musicaux conscutifs,
conformment la formule 9, 6, 8, laquelle conduit, comme on sait, fixer
9/7 le rapport des 1
er
et 2
e
tubes, cependant que 9 x 7 donne la mesure de
lunit des superficies rituelles.
*
* *
Si lunit de superficie valait (non pas 9 x 7) mais (5 x 4 ou) 10 x 8 (10/8
est le rapport originel du 1
er
au 2
e
tube), il faudrait, pour comparer les trois
Marcel GRANET La pense chinoise 155
aires rituelles, modifier trs lgrement les dimensions de laire des Tcheou.
On le ferait avec moins de dommages que dans le cas de laire des Yin ; on y
russirait en effet sans modifier la valeur du demi-primtre, particulirement
sacre en lespce : 80/64=5/4 ou 10/8 et 80 + 64, comme 81 + 63 font 144.
Ainsi modifie, laire des Tcheou (8 x 8 sur 8 x 10) contient 8 x 8 units de
superficie (8 x 10), et celle des Yin (7 x 8 sur 7 x 10) en contient 7 x 7
lunit de superficie (8 x 10) tant indique par un nombre (80) gal, une
unit prs, un carr (9) et les superficies des deux aires (64 et 49) tant
encore ramenes des carrs (8 et 7). On aperoit que, pour les Chinois,
limportance des couples 81 -63 et 80-64 tient au fait que, 81 tant le carr de
9 et 64 le carr de 8, 63 est un multiple de 9, tandis que 80 est un multiple de
8.
On connat le prestige de la division du carr en 9 carrs : telles taient les
divisions que les arpenteurs donnaient au
214
plus petit domaine, le tsing ;
mais ils groupaient les tsing par 4, 16, 64... pour former les divisions
administratives (
368
). 9 et 8 ou 4 valaient comme nombres privilgis dans la
technique de larpentage. Si, dune part, le plan des aires rituelles nest pas
sans rapport avec cette technique, dautre part, les nombres qui mesurent ces
aires laissent voir les liens qui existaient entre lart des architectes et lart des
devins. Les quadrilatres de ct 8, avec leurs 64 divisions, rappellent les 8
Trigrammes, ou les 8 Vents, et les 64 Hexagrammes. Et nous allons voir
bientt que le quadrilatre de ct 7, avec ses 49 divisions, tout en rappelant
les 50-1 baguettes que manipulaient les devins, a pour premier mrite
dvoquer lunique btonnet que ceux -ci conservaient en main, bois
dress qui, tel un gnomon, signalait les mutations du Yin et du Yang .
Mais il nous faut dabord noter que, si le rapport du demi primtre des aires
Hia (105 + 84) et Yin (70 + 56) est gal (189/126 =) 3/2 ou 9/6, le rapport
des demi primtres des aires Yin (126) et Tcheou (144) est gal 8/7 [tandis
que, tout au contraire, le rapport de leurs superficies, quand on les mesure
avec une unit gale 10 x 8, cest --dire voquant le rapport 5/4
devient sensiblement gal (64/49) 9/7 (=63/49). Nous connaissons le
prestige du rapport 9/6 dans la musique, la divination, la cosmographie. Nous
savons aussi que le rapport 8/7 (rapport du Petit Yin au Petit Yang) avait,
(sous les Yin et) dans le pays de Song, un prestige quivalent : au lieu de
nommer Neuf et Six les lignes yang et yin des Emblmes divinatoires (
369
), on
les appelait Sept et Huit. Le rapport 8/7, qui a fourni une de ses expressions
aux relations du Pair et de lImpair, a -t-il, comme le rapport 9/6, un
fondement musical ou cosmologique ?
Le rapport du demi-primtre de laire des Hia (189) au demi -primtre
de leur vestibule ou de laire des Yin (126) est gal 3/2 ou 9/6. Rencontre
curieuse, la gamme (dite Neuf Suprieur) qui a permis Sseu-ma Tsien de
justifier les emblmes numriques des notes, est mise par cinq tubes
215
dont les trois premiers [45, 63 (= 60), 81] ont une valeur totale gale 189 et
les deux premiers (54, 72) une valeur totale gale 126. Il est possible que,
Marcel GRANET La pense chinoise 156
pour faire apparatre une relation entre les aires Yin et Hia (dont les
proportions sont rgles par le rapport 10/8), on ait song choisir des
dimensions empruntes aux tubes dune certaine gamme. Il se pourrait
encore quon ait procd de mme pour faire apparatre les rapports des aires
Yin et Tcheou (en leur supposant les mmes proportions).
Les 6 premiers tubes sonores valent 360 ; 360 = 24 x 15 ; 15 est gal 8
+ 7 comme 9 + 6 ; 24 vaut 9 + 8 +7, et il vaut aussi 10 + 8 + 6. En
multipliant 15, cest --dire, 9 et 6 par 9, 8 et 7, on obtient les longueurs des
six premiers tubes [81 (=9x9), 72 (=9x8), 63 (=9x7) ; 54 (=6x9), 48 (=6x8),
42 (=6x7)] que lon peut ranger en deux groupes yang ( 9) et yin (6), les
rapports de deux nombres conscutifs tant gaux (81/54 = 72/48 = 63/42=)
9/6 ( = 81/63) du 5
e
. Mais en multipliant 15, cest --dire 8 et 7 par 10, 8 et
6, on obtient 6 dimensions [80 (= 8x10), 64 (=8x8), 48 (=8x6) ; 70 (=7x10),
56 (=7x8), 42 (=7x6)] telles que, en rangeant les nombres en deux groupes, le
rapport densemble soit gal 8/7 (= 192/168) comme le sont, dans le dtail,
les rapports des nombres pris deux deux.
Parmi les nombres ainsi obtenus, figurent 70 et 56, dimensions de laire
des Yin, 80 et 64 dimensions de laire des Tcheou [ramene la proportion
10 x 8 sans quil y ait changement de la valeur du demi -primtre (144)], et
dautre fart ces 6 nombres [80, 56, 70, 48, 64, (42)] diffrent fort peu de ceux
quindique la formule premire de la gamme [80, 56, 72, 48, 64, (40)] : seuls
diffrent 70 et 40, mais 42 ne devrait pas tre estim trs diffrent de 40,
puisqui l est devenu lemblme du 6
e
tube, lequel devait rendre, la
diffrence dune octave, la note mise par le 1
er
tube (81 ou 80), et, par
ailleurs, nous venons de voir que Tcheng Hiuan na pas
216
hsit assimiler
72 70, afin dtablir une relation ent re les aires Yin et Tcheou. Or, avec la
formule 80, 56, 70, 48, 64, (42), non seulement le premier nombre (80) vaut
les 5/4 du cinquime (64), mais il vaut encore les 5/3 du quatrime (48) et, de
mme, le troisime (70) vaut les 5/4 du deuxime (56) et les 5/3 du sixime
(42).
Il se pourrait bien quavant de tirer dune fausse querre (8, 9, 12) la
squence (9, 6, 8) qui a servi (en illustrant le rapport 9/6 et la proportion 9x7)
parfaire leur thorie musicale, les Chinois aient pens justifier
(approximativement) la longueur de leurs tubes en les rapportant une autre
querre qui permettait dillustrer le rapport 8/7 et la proportion 10 x 8 : cette
querre (3, 4, 5 ou 6, 8, 10) est une querre juste, et cest celle qui donne la
rgle du gnomon.
Le prestige de 9/6 et de 8/7 comme formules des relations du Pair et de
lImpair est, peut -tre, li au fait que 9 et 6, 8 et 7 permettent de sectionner le
grand Total 360 en 6 nombres estims capables dexprimer des proportions
musicales Les sries numriques obtenues par ce sectionnement sont presque
pareilles et, cependant, elles se rattachent deux querres diffrentes, dont
Marcel GRANET La pense chinoise 157
lune (8, 9, 12) entrane ladoption de 9 x 7 comme unit de superficie, tandis
quavec lautre (3, 4, 5) cette unit vaut 10 x 8.
Le Kao Kong hi affirme quon mesure au moyen de nattes (9 x 7) la
superficie des aires rituelles, mais ceci ne lempche pas dindiquer en sin,
ou en pou les dimensions des aires Yin et Hia. Bien plus, le Kao Kong hi et
le Tcheou li lui-mme indiquent, dautre part, que ltalon des dimen sions
architecturales (tou) est le pi sien (
370
).
Or, le pi sien est une tablette de jade de forme ovale dont le diamtre
moyen vaut 9. Elle doit sinscrire dans un rec tangle long de 10 et large de 8.
Le primtre du rectangle vaut donc 36, et le contour de lovale 27. Ces
nombres sont significatifs : ils montrent que ltalon de jade et, sa suite,
tous les quadrilatres de proportion 10 x 8 ou 5 x 4 avaient le mrite de
rappeler les rapports du carr et du rond (36/27 = (4x9)/(3x9) = 4/3). Les
surfaces 9x7 mesures en nattes ont un demi-primtre gal 144 (= 81 + 63
= 2 x 72 =16 x 9),
217
condition que le multiplicateur conventionnel soit 9.
Inversement les surfaces 10 x 8, drives du pi sien, ont un demi-primtre
gal 144 (= 80 + 64 = 18 x 8), condition que le multiplicateur soit 8 et,
dans ce cas, lovale inscrit vaut (27 x 8 =) 216. La proportion 10 x 8 et
lquerre 3, 4, 5 sont lies lemploi de lindice 8, de mme que sont lies
lemploi de lindice 9 la proportion 9 x 7 et lquerre, 8, 9, 12. Et le pi
sien, cependant, permet lvocation du rapport prestigieux 216/144.
Le rapport 216/144 est voqu, comme on sait, par la disposition en carr
magique des 9 premiers nombres. Ceux-ci, qui valent 45, multiple de 5,
peuvent tre groups de manire obtenir le rapport 3/2 sous la forme 27/18
qui indique le rapport de lovale du pi sien au demi-primtre du rectangle
ex-inscrit. 45, dautre part, tant un multiple de 9, les neuf premiers
nombres peuvent tre groups de manire obtenir le rapport 5/4 ou 25/20 :
25 est la somme des cinq premiers nombres impairs, 20 celle des quatre
premiers nombres pairs. Le fait, cependant, que le rectangle dans lequel
sinscrit le pi sien vaille 36 [= (2x10) + (2x8)] soit 20 + 16 entrane la
conclusion que cette figure illustre un autre groupement de nombres. 16 est la
somme des quatre premiers nombres impairs [(1 + 7) + (3 + 5)] et 20 celle
des quatre premiers nombres pairs [(2 + 8) + (4 + 6)]. Ltalon de jade
ralisait une synthse parfaite du Pair et de lImpair : synthse hirogamique
avec change dattributs (
371
) puisque, dans la proportion 5 x 4, lImpair, 5,
voque la somme (20) des nombres pairs, et le Pair, 4, la somme (16) des
nombres impairs.
Cette synthse parfaite se manifestait dune autre manire encore. 27
(contour de lovale) plus 36 (primtre du rectangle) font 63.
Multiple de 9 et de 7, 63 est une synthse de 5 et de 4, comme de 4 et de
3. Il peut dabord voquer par lui -mme, le rapport (3/4 = 27/36) du contour
cleste et du contour
218
terrestre, et il lvoque mieux encore (27x8)/(36 x
8)=216/(2x144), quand on adopte le multiplicateur 8. Il peut surtout, par
Marcel GRANET La pense chinoise 158
lvocation du rapport 5/4 (=35/28), rappeler la proportion 5x4 (et lquerre
3,4,5) Une vertu inverse appartient 64 : ce multiple de 8 contient 4 fois
16 et 16 = 9 + 7. 64 peut donc rappeler la proportion 9 x 7 (lie au multiplica-
teur 9 et lquerre 8, 9, 12). Il la rappelle sous une forme remarquable, car
64 = 36 + 28. 36 (comme 360) est lemblme de la totalit dun contour (
372
).
28 est le nombre des mansions lunaires. Or, le dais circulaire qui recouvre le
char du Chef et figure le Ciel mesure 36 par son contour et 28 arcs le
rattachent la colonne centrale, qui le relie la caisse carre du char
(Terre) (373).
*
* *
Les vertus et les jeux des multiplicateurs 8 et 9 peuvent ds maintenant se
deviner. Mais, si les 28 mansions lunaires indiquent lintrt du nombre 7,
il reste comprendre la signification de ce nombre et limportance attribue
au rapport 8/7, il reste surtout expliquer la liaison de ce rapport avec
lquerre 3, 4, 5, cest --dire avec le gnomon, auquel vient tout justement
nous faire songer la colonne centrale du char.
Les mrites de lquerre 3, 4, 5, sont vants dans un opuscule clbre dont
le titre : Tcheou pei (
374
) signifie : gnomon. Le Tcheou pei (o lon retrouve
la comparaison du Ciel et du dais du char) rsume les enseignements
mathmatiques dune cole de cosmographes dnomm e lcole du Dais
cleste (
375
). Il a pour thme lide que les dimensions clestes peuvent tre
connues grce au gnomon et lquerre 3, 4, 5. Le gnomon y est dcrit
comme un signal de bambou qui, perc, au 8
e
pied, dun tr ou de 1/10 de pied,
est long de 8 pieds ou de (80+1)/10 de pied. Lauteur, cependant, commence
par rattacher lquerre 3, 4, 5 la formule considre comme la premire
des rgles : 9 x 9 = 81.
219
Le Tcheou pei, pour instruire lquerre 3, 4, 5, commence par
construire un rectangle de cts 3 et 4, puis il en trace la diagonale. Le texte
ne contient rien de plus ; on ny trouve, a remarqu Biot, aucun essai de
dmonstration du thorme du carr de lhypotnuse. Dans les ditions du
Tcheou pei qui ont t conserves, la rgle de lquerre, ou plutt de la
diagonale, est illustre au moyen de trois figures. Ce sont trois carrs de ct
7 diviss en 49 petits carrs et renfermant, lun, un carr de ct 5 contenant
25 petits carrs, lautre, un carr d e ct 4 (16 petits carrs) et le dernier un
carr de ct 3 (9 petits carrs). Nul ne peut affirmer que ces figures
existaient, ainsi faites, dans les ditions originales. Telles quelles sont
parfois dessines, elles semblent navoir pas dautre obj et que dillustrer pour
les yeux la formule 3 + 4 = 5.
Elles sont cependant destines, bien quon lait contest (
376
), faire
songer une dmonstration gomtrique de cette formule. cf.
mg_pc_figures : 19a Linsertion dun carr (de ct 5) valant 25 lintrieur
Marcel GRANET La pense chinoise 159
dun carr (de ct 7) valant 49 se relie directement une donne fourme par
le texte du Tcheou pei : celui-ci considre lhypotnuse 5 comme la diagonale
dun rectangle 3 x 4. Dans un carr de ct 7, on peut loger quatre de ces
rectangles, et leurs quatre diagonales forment un carr inscrit qui a pour
surface la moiti des quatre rectangles [savoir : 4(3*4)/2, soit 24] plus 1 petit
carr laiss au centre par le trac des quatre rectangles. Telle est la
vrification gomtrique de la formule : 3 + 4 = 5.
Voici maintenant la preuve de lantiquit de cette
220
dmonstration
que les figures des ditions actuelles laissent entrevoir, mme quand elles
lentourent de que lque mystre. Inscrire les trois carrs 9, 16, 25 dans un
carr de ct 7, cest suggrer lquivalence de 45 et de (9 + 16) + 25, ou,
autrement dit, lquivalence de 25 + 25 et de 49 : ceci revient affirmer que
le triangle rectangle isocle de ct 5 a une hypotnuse (
377
) qui vaut peu
prs 7. Or, tout autant, sinon davantage, que lquerre juste 3, 4, 5, cette
querre approximative 5, 5, 7 intressait les Chinois.
Elle les intressait ds une haute antiquit. Jai dj dit que le devin ou le
chef et lon verra que le Chef, lHomme Unique, est identique au gnomon
prlevait, sur le lot des cinquante baguettes divinatoires, une baguette quil
conservait la main pendant quil oprait. Ce prlvement permet tait de
diviser le lot (49) en deux parties qui taient ncessairement, lune paire,
lautre impaire. La baguette quil tenait en main prsidait avec lui la
divination : ce bton de commandement reprsentait le carr central, le
Centre, lUnit lUnit qui ne compte pas, mais qui vaut et fait lensemble,
le rpartiteur, le pivot du Yin et du Yang (
378
).
Lide que ce que nous appelons lunit ne sajoute pas, mais simplement
opre une mutation du Yin au Yang ou du Yang au Yin et, par suite, se
confond avec lEntier ou le Total dans lequel le Yin et le Yang oprent leurs
mutations, se rattache aux thories politiques des Chinois sur la puissance
universelle, mais uniquement ordonnatrice de lHomme Unique lequel, du
Centre du Monde, commande toutes choses sans interfrer en aucune chose,
sans rien ajouter de priv au Total quil fait tre tel qu Il est. Cette ide se
relie encore la tendance que nous avons si souvent constate dajuster les
ensembles et de dterminer les proportions en rservant toujours le jeu dune
unit. Elle explique le got marqu des Chinois pour les querres
mathmatiquement imparfaites, mais plus efficientes pour eux que les autres,
prcisment parce quelles rservent un jeu dans lassemblage, et la part, si
je puis dire, du tour opratoire, uvre royale.
Nous connaissons dj le prestige de lquerre 8, 9, 12. Nous pouvons
hardiment supposer que, comme les querres, juste ou approximative, 3, 4, 5
et 5, 5, 7, on lillustrait en
221
traduisant gomtriquement la formule (a +
b) = 4 ab +(a - b) = 2 ab + [2 ab + (a - b)] Dans un carr de ct 17 (= 9 +
8), ou peut inscrire 4 rectangles 8 x 9, dont les diagonales vaudront peu prs
12, puisquelles enferment quatre demi -rectangles de valeur 72, cest --dire
Marcel GRANET La pense chinoise 160
144, plus 1 carr central (1 tant le carr de 9 - 8) (17 = 289 = 144 + (144 +
1)].
Une construction analogue cf. mg_pc_figures : 19b et, dailleurs, calque
sur une figure essentielle de la gomtrie ou de larpentage chinois, devait
aussi servir montrer les vertus de 12. La Chine, la Terre des Hommes,
a 12 ou 9 Provinces ; 12 valant 3 x 4, il est possible de construire un carr de
ct 12 quon divisera, tout aussi bien, en 9 carrs ou en 12 rectangles.
Partons de la division en 9 carrs, qui est celle du Ming tang, du Carr
magique, etc. Tout autour du carr central et figurant parfaitement le svastika,
se trouvent dessins quatre rectangles remarquables par ce fait que leur
hauteur est double de leur base. Ils valent 4 x 8 cest --dire 2 x 16. En traant
les diagonales, on les divise en triangles, de valeur 16, comme le carr
central [(8 - 4)]. Cette construction fait apparatre la rgle de la surface du
triangle (base x hauteur)/2 laide dun exemp le conforme au got chinois,
puisque la surface de ces triangles se trouve exprime par un carr (16). Elle
conduit, de plus, tracer [puisque les quatre diagonales enserrent quatre
triangles valant 16 et un carr qui, lui aussi, vaut 16 (soit 16 x 5 = 80)] un
carr inscrit qui approche du plus parfait des carrs (9), car il vaut 80.
222
Do la formule 8 + 4 = ( une unit prs) 9, formule prcieuse, puisquelle
donne une valeur approche de lhypo tnuse dun triangle dont la base est la
moiti de la hauteur (querre approximative 4, 8, 9).
Mais voici une autre querre approximative, cf. mg_pc_figures : 19c tout
aussi utile tablir, puisque elle peut aider au calcul des lments de
lhexagone et que, se ra pprochant de lquerre 4, 8, 9, elle va permettre une
application de cette dernire lhexagone. Si 81 ( - 1) = 64 + 16, 64 (+ 1) = 49
+ 16. Un carr de ct (7 + 4 =) 11, divis en 4 rectangles (4 x 7) entourant un
carr de valeur 9 [= (7-4)] permet de vrifier ( une unit prs) cette nouvelle
querre extrmement prcieuse, puisque lhypotnuse y vaut le double de
la base, ce qui est le cas pour les triangles forms par le ct dun hexagone
(hypotnuse) le demi-ct de lhexagone (base), et la hauteu r du trapze
form par le demi-hexagone.
Nous voici arrivs aux raisons du prestige du rapport 8/7 et bien prs de
comprendre la liaison tablie entre ce rapport et lquerre 3, 4, 5, cest --dire
la proportion 8 x 10 et le gnomon.
*
* *
Le rond provient du carr, comme le prtend le Tcheou pei, mais par
lintermdiaire de lhexagone.
Si la circonfrence est estime valoir les du carr dans lequel elle
sinscrit, cest que le ct de ce carr vaut deux cts de lhexagone inscrit
dans la circonfrence. Quand le primtre du carr est 8 et son ct 2,
lhexagone et la circonfrence (comme lui) vaudront 6, le rayon et le ct de
Marcel GRANET La pense chinoise 161
223
lhexagone valant 1, le diamtre (2 cts de lhexagone) valant 2, et ,
par suite, tant estim gal 3.
De lquivalence tablie entre la circonfrence et lhexa gone inscrit, il
reste, comme premier tmoignage, le fait quon donne la roue 30 (= 6 x 5)
rayons. Ceci, dit-on, parce que la roue doit rappeler le mois, cest --dire la
lune. Mais lemblme de la lune, cest, bien plus que la roue, le couteau, qui
est courbe : le couteau courbe, cest la lune qui sbrche, et ce qui brche la
lune, ce st le couteau (
379
). Pour vrifier si la courbure des couteaux tait
conforme aux bonnes rgles, on les assemblait par 6 et lon examinait sils
formaient un cercle parfait. Or, les couteaux devaient tre longs de 1
pied (
380
). On voit que lhexagone vaut le cercle et que tous deux valent 6
cf. mg_pc_figures : 19d.
Laformul e = 3 est unedonne essentielle de la mathmatique et de la
cosmographie chinoises. Elle a servi et sert encore de rgie aux charrons.
Ceux-ci, jadis, fabriquaient non seulement les roues, mais les dais du char.
Lcole du Dais cleste admet, dune part, que le Ciel est un dais et,
dautre part, quon peut mesurer le Ciel au moyen de lquerre 3, 4, 5 ; elle
admet encore que la formule 9 x 9=81 constitue la premire des rgles et que,
cependant, le gnomon vaut 80. Avec lquerre 3, 4, 5, o 5 est lhypotnuse,
on peut donner au gnomon, selon que lon prend 3 ou 4 pour hauteur, la vale ur
81 (= 3 x 27) ou 80 (= 4 x 20). Lhypotnuse vaudra alors, selon le cas : 135
(= 5 x 27) ou 100 (= 5 x 20) et la base : 108 (= 4 x 27) ou 60 (= 3 x 20). Les
nombres 108 et 135, 60 et 100, qui sont dans le rapport 4/5 et 3/5, sont
inutilisables pour qui se propose de faire sortir le rond du carr, cest --dire
dillustrer les rapports
224
ou 3/2. Ce nest donc pas la construction dun
triangle rectangle de cts 3, 4, 5 ou dun triangle isocle de cts 5 et de
hauteur 3 ou 4, la base tant 8 ou 6, que se rattache le prestige du gnomon et la
prtention de tirer le rond du carr.
On peut, au contraire, tirer le rond du carr (
381
) et justifier, par surcrot, la
hauteur du gnomon, en construisant un trapze form par un demi-hexagone
et une base valant deux cts de lhexagone. On y arrivera (grce au jeu dune
unit et lutilisation concurrente des multiplicateurs 9 et 8) si lon fixe 8/7
ou 9/8 le rapport du ct de lhexagone la hauteur du trapze. Nous allons
le montrer et nous russirons ainsi expliquer la vogue ancienne de 8/7,
comme expression (aussi valable que 9/6) des rapports du Pair et de lImpair.
Nous justifierons par l mme notre hypothse sur lobtention des querres,
justes ou approximatives, partir de linsertion dans un carr de quatre
rectangles englobant un carr central, ce qui reviendra prouver lanti quit
de la dmonstration du thorme de lhypotnuse.
Partons de la donne essentielle : pour lcole du Tcheou pei ou de
lquerre 3, 4 , 5, le Ciel est identique au dais du char. Le dais des chars se
dcompose en trois parties : la partie centrale, qui vaut 2 + 2, est plane et
supporte en son milieu par une colonne ; les deux bords, qui sont courbes,
Marcel GRANET La pense chinoise 162
mesurent, chacun, 4. Puisque le dais figure le Ciel, son contour, analogue au
Contour cleste, doit valoir 36 et le diamtre (bien que les bords du dais soient
courbes) tre estim gal 12 [= (4 + 2) + (2 + 4)]. Le contour du dais est
donc form par trois lignes considres comme gales entre elles (4 + 4 + 4),
ainsi que le sont les trois cts dun demi -hexagone, mais langle que forment
les bords avec la partie plane nest pas gal 60 ; il est beaucoup plus
ouvert : la hauteur du trapze que forme, avec sa base, le contour du dais, est,
en effet, fixe 2. Cest l une donne essen tielle (382), sur laquelle nous
reviendrons.
Mais commenons par construire un trapze cf. mg_pc_figures : 21a dont
trois cts forment un demi-hexagone, la base valant deux cts. Donnons
chaque ct la valeur 1, puisque les 6 couteaux qui forment un cercle parfait
mesurent chacun 1 pied. Le primtre de notre trapze se dcompose en 5
parts gales et
225
quil suffira pour que ce primtre figure un contour total
(360) destimer gales 72. Ds lors, la base aura les dimensions
significatives de la Terre et du Yin (144), et le contour du demi-hexagone
quivaudra un contour semi-circulaire, car il aura les dimensions du Yang et
du Ciel (216).
72 vaut 9 x 8. Pour porter 72 la valeur 1 de chacun des 5 cts
dhexagone qui forment notre primtre, nous pourrons procder par deux
mthodes, mais toujours en deux temps : multiplier, dabord, par 8 puis par 9
ou multiplier par 9 et ensuite par 8.
Commenons en multipliant par 8 : le ct de lhexagone vaut 8, le
demi-ct 4. Si nous connaissons la construction dont il a t parl plus haut
(quatre rectangles 7 x 4 disposs dois un carr de ct 11), nous pourrons
estimer 7 la hauteur du trapze (
383
). Multiplions maintenant par 9 : le ct
vaudra 72, le demi-ct 36, la hauteur 63, et nous aurons form sur le ct de
notre trapze une querre 36, 63, 72 cf. mg_pc_figures : 20c
Passons lautre mthode et multiplions, pour commencer, par 9. Le ct
de lhexagone vaut 9 et le demi-ct 4,5. Si nous connaissons la construction
dont il a t parl plus haut (quatre rectangles 8 x 4 disposs dans un carr de
ct 12), il sera trs tentant dutiliser lquerre (approximative) 4, 8, 9, car, si
nous multiplions maintenant par 8 le ct 9, nous obtiendrons, comme tout
lheure, 72 et nous obtiendrons aussi 36 (= 4,5 x 8) pour le demi-ct [dont
nous noublie rons pas (bien que nous nous servions dune querre 4, 8, 9)
226
quil vaut, en lespce, la moiti de 9, soit 4,5]. La hauteur, dabord exprime
par 8, conformment lquerre utilise, se trouvera dfinie aprs la seconde
multiplication par 64, et nous aurons construit sur le ct de notre trapze une
querre 36, 64, 72, cf. mg_pc_figures : 20f qui ne diffrera de lquerre
forme par les oprations prcdentes que par le remplacement de 63 par 64.
63 vaut 9 x 7 et 64 vaut 8 x 8. Ces hauteurs conviennent parfaitement,
puisquil sagit de loger, entre la caisse et le dais du char, un homme, et que la
taille de lhomme (jen), symbolise par le caractre jeu, est estime
Marcel GRANET La pense chinoise 163
hsitation prcieuse gale 7 pieds ou 8 pieds, cest --dire, dans un cas,
63, si le pied a 9 divisions, et, dans lautre, 64 , si le pied a 8 divisions.
Mais, depuis que, grce Tchong-li, ancien Hros solaire devenu le patron
des astronomes, les communications entre la Terre et le Ciel ont t
coupes (
384
), la tte des hommes pas mme celle du Chef ( moins quil ne
grimpe au mt de cocagne) ne touche plus le Ciel. Dailleurs, il faut quun
guerrier puisse y voir quand il est enclos entre la caisse et le dais courbe de
son char. Aussi ce dais est-il surlev. Quand la taille de lhomme est estime
8 pieds, la colonne centrale du char compte deux pieds en sus (385).
Admettons quelle a de mme deux pieds de plus quand lhomme (sans que sa
taille ait chang, sans doute, mais quand la mesure de sa taille a chang,
dfinie par 63 divisions de pied au lieu de 64) nest plus haut que de 7 pieds.
La hauteur du trapze (dans la premire mthode et 8 tant le premier
multiplicateur) est 7 (rai de la roue cosmique cest --dire 63, puisque, pour
que le contour du trapze
227
vaille 360, il faut que le deuxime
multiplicateur conventionnel soit 9. Comme il faut carter le Ciel de la Terre
afin de rompre les communications, le dais sera support par une colonne qui
vaudra (7 + 2) x 9, soit 9 x 9 ou 81, et tel est, en effet, le Nombre du Tcheou
pei (gnomon). Mais, si la taille de lhomme ou le rayon rel de la roue
cosmique est 8, il faudra (9 tant le premier multiplicateur) que le deuxime
multiplicateur conventionnel soit 8 pour que le contour du trapze gale
toujours 360. Ds lors 8 x 8, soit 64, donne la taille de lhomme et [(8 + 2) x 8
=] 80 la hauteur de la colonne centrale : telle est, en effet, la dimension du
gnomon (Tcheou pei).
81 provient de 63, comme 80 provient de 64. Lorsquon la divise en 7 on 8
pieds, en 63 ou en 64 parties, on ne fait pas varier, sacs doute, la taille-talon
de lhomme. Quand on fixe 81 la hauteur du gnomon ou quand on la fixe
80, la hauteur relle (distance au sol du trou perc au sommet de la perche)
change-t-elle vraiment ? 81 ne diffrerait-il de 80 que par une unit qui ne
compte pas ? Les Chinois ont constamment choisi un multiple de 8 pour
indiquer la hauteur du gnomon... Quand les ouvriers des chars construisaient
la colonne et le chapiteau o ils attachaient le dais, ils prenaient soin de laisser
passer au-dessus du dais une toute petite partie du chapiteau (1/100 de pied)...
Le nombre 81 a de bien grands mrites, surtout quand il mesure une hauteur
ou un signal dress sur une base valant 2 x 72 : ne connat-on pas une querre
(9, 8, 12) qui pour une hauteur de 81 et une base de 72 (= 12 ) a une
hypotnuse valant 108, cest --dire la moiti de 216, Contour cleste, que
peuvent reprsenter, dautre part, trois cts dhexagone ?
La hauteur ou le gnomon 81 fournit le moyen de
228
passer, pour
un dais ou un toit, dun profil trapzodal un profil triangulaire. [Le profil
triangulaire convient parfaitement un toit de chaume circulaire, tel que,
dit-on, le Ming tang en avait un. Mais les toitures en tuiles, dont le Kao kong
ki (386) affirme quelles taient moins pentes que les toits de chaume,
Marcel GRANET La pense chinoise 164
ressemblaient (du moins au temps des Han) (
387
) un demi-hexagone ou un
dais de char]. De profil triangulaire ou trapzodal, les toitures qui valent
216 doivent tre agences sur des rectangles, dont il convient (par suite), que
le demi-primtre vaille 144.
Quand le gnomon vaut 81, cest lui qui donne la largeur, tandis que 63,
hauteur du trapze, donne la profondeur. On a vu que, dans ce cas, lunit de
superficie (la natte) vaut 9 x 7, le multiplicateur conventionnel tant 9.
Lunit est le pi sien (10 x 8) et le multiplicateur 8 quand le gnomon, et par
suite la largeur, valent 80, la profondeur des difices et la hauteur du trapze
valant 64. Dans tous les cas, on arrive faire sortir le rond (216 = 108 x 2 ou
72 x 3) du carr [72 x 2, base du trapze, demi-primtre du carr.] Et quand
le gnomon vaut 80, [ou mme 81 (80 + une unit qui ne compte pas],
lquerre 3, 4, 5 se retrouve d ans la proportion 10 x 8, [quon arrive
elle-mme retrouver dans les surfaces de proportion 9 x 7, puisque
81 + 63 font 144 tout aussi bien que 80 + 64].
Par lintermdiaire de la proportion 8 x 10 et du pi sis, on peut do nc
rappeler lquerre parfaite, 3, 4, 5, tout 4 fixant 80 ou 80 (+ 1) la hauteur
du gnomon. Mais, pour y arriver et pour illustrer lide que le rond sort du
carr en passant par lhexagone, cest --dire pour voquer sous la forme
216/144 le rapport 3/2 ou 9/6 du rond et du carr, on a d [ce qui, dailleurs, a
permis dopposer et dassimiler les proportions 9 x 7 et 10 x 8, par suite, de
rappeler lquerre 3, 4, 5] partir du rapport 8/7 (ou 9/8) du rayon de la
circonfrence (ct de lhexagone) au rayon rel de la roue (hauteur du tra-
pze dessin par le demi-hexagone). Pour obtenir ce rsultat le
Constructeur, tout comme le Musicien quand il a perfectionn la formule
de la gamme, a d employer concurremment les multiplicateurs
conventionnels 8 et 9. Cest ce quimplique notre dmonstration. Cest ce
quaffirme la
229
tradition. Les Tcheou se servaient, pour mesurer, de
nattes de 9 pieds de long, mais ils divisaient le pied en 8 pouces. Les Yin
mesuraient avec des sin de 8 pieds, mais ils divisaient le pied en 9
pouces (
388
). Dailleurs, quand le gno mon valait 80, on pouvait encore
estimer quil ntait pas suprieur de 2/8 la taille de lhomme ; pour
lestimer gal ltalon -homme (8), il suffisait (80 = 10 x 8) de diviser le pied
en 10 pouces : tel tait, dit-on (
389
), le systme des Hia (
390
).
*
* *
Que lHomme (le jen) mesure 7 pieds (querre 4, 7, 8) ou quil mesure 8
pieds (querre 4, 8, 9), sa taille ne varie pas plus que ne varie la hauteur du
gnomon quand il vaut 81 ou 80, cest --dire quand on lui attribue 9 fois 9
divisions, ou 10 fois 8 divisions, ou 8 fois 10 divisions.
Les Nombres nont pas pour fonction dexprimer des grandeurs : ils
servent ajuster les dimensions concrtes aux proportions de lUnivers.
Marcel GRANET La pense chinoise 165
Pour quil remplisse parfaitement sa mission, un Emblme numrique doit,
si je puis dire, exprimer, ou, plutt, contenir deux coordonnes : lune voque
la structure permanente du Monde, lautre un tat dfini de lOrdre ou de la
Civilisation. Les Emblmes les plus riches : 3 et 2, 3 et 4, 5 et 4, 10 et 8, 9 et
6, 8 et 7, 64 et 80, 63 et 81, 144 et 216, 108 et 72... sont ceux qui rendent
manifeste la morphologie et la physiologie de lUnivers ; leurs jeux sont
commands par le grand Total 360 (= 5 x 72 = 6 x 60).
La structure de lUnivers ou sa morphologie se rsume dans la double
expression que prennent les rapports du Yang et du Yin, de lImpair et du
Pair : 9/6 et 7/8. On a vu que (et cest passer par lintermdiaire de
lhexagone du carr au rond) on arrive du rapport [7/8 (ou 8/9)] du rayon
rel de la roue cosmique (ltalon -homme, 7 ou 8, le jen : hauteur du trapze)
au rayon de la circonfrence (ct de lhexagone), passer au rapport (9/6) du
Contour cleste (demi-primtre de lhexagone) sa Base terrestre (base du
trapze). Cest par ce passage que sexprime la physiologie de LUnivers :
lalternance rythmique du droit et du courbe, du Yin et du
230
Yang. Ce qui
rend le passage possible, cest lemploi conjugu de multiplicateurs qui,
considrs comme des classificateurs de lEspace -Temps, valent comme des
Emblmes dynastiques. Ces Emblmes permettent de reprsenter en termes
diffrents et pourtant assimilables [proportions 8 x 10 ou 9 x 7,
demi-primtres 81 + 63 ou 80 + 64 (tous deux gaux 144)] la structure de
lUnivers en caractrisant une re de la civilisation. La succession des
diffrents ordres dynastiques de la Civilisation [cette succession est rgle par
un rythme musical, cest --dire par la squence, 9, 6, 8 : (6 tant lemblme
numrique des Hia, 8 celui des Yin, 9 celui des Tcheou)] naltre pas la
structure du Monde. On rend manifeste la permanence de cette structure en
ayant soin de choisir, pour indices des divisions des diverses units de mesure,
des nombres qui puissent se combiner de faon que seul tant chang
lordre des manipulations, le rsultat, une unit prs, ne soit pas modifi.
Au lieu de servir mesurer, les nombres servent opposer et assimiler.
On les emploie intgrer les choses dans le systme que forme lUnivers. Les
choses, en effet, ne se mesurent pas. Elles ont leurs propres mesures. Elles
sont leurs mesures. Elles sont telles que lout il ou lartisan les fait tre. Leur
mesure est celte de louvrier, comme la mesure du Monde est celle du Chef,
Homme-talon. La construction des chars est le plus noble des arts (391), car
le char, caisse et dais, cest la Terre et le Ciel. La structure du char (dais et
colonne) illustre les rapports 9/6 et 8/7 et ce qui commande le dtail des
proportions (longueur des armes, hauteur du dais), cest la taille du
guerrier (
392
) ; mais, de mme que les dimensions relles des ouvrages de
poterie dpendent des dimensions relles du tour quutilise le potier (
393
),
lartiste qui construit les chars dtermine toutes les mesures en se servant
uniquement du manche de sa cogne (394). Le plus beau triomphe du
fondateur de lunit impriale (Che Houang-ti sen vante dans ses inscriptions
et, peut-tre, se vante-t-il) (
395
) a t dobtenir que les moyeux des chars de
Marcel GRANET La pense chinoise 166
tout lEmpire, tous les chars, ds avant lui, taient construits en utilisant
les mmes nombres proportionnels, aient effectivement le mme
cartement.
Il y a, dans la conception chinoise des Nombres, une
231
admirable
conciliation du conformisme le plus strict, ou du sentiment du style, et de la
fantaisie, ou de lindividualisme le plus jaloux. Cette conception permet (en
dehors de leurs emplois pratiques) dutiliser les Nombres la seule fin de
rendre manifestes la structure du Monde et les ordres successifs de
civilisation par lesquels sexprime le rythme de la vie universelle. Pour qui
multiplie les classifications numriques, vite dadopter, pour lensemble des
units de mesure, un systme unique de division, caractrise chaque unit par
un mode de division spcial et prend soin de conjuguer des modes de division
complmentaires, les Nombres servent signaler des rapports et des
proportions sans plus interdire la manipulation des rapports quun certain jeu
dans les proportions.
Les Nombres ne sont que des Emblmes : les Chinois se gardent de voir
en eux les signes abstraits et contraignants de la quantit.
V. Fonctions classificatoire et protocolaire des nombres
Lorsque les interprtes chinois veulent justifier les dimensions (10 x 8) du
pi sien, ils notent que les anciennes units de mesure drivent toutes du corps
humain, puis ils ajoutent : la main, mesure partir du pouls, vaut 10
(pouces) chez 1homme et 8 chez la femme. Aussi le Pair (8 ou 4) prside -t-il
aux dimensions des toffes (que les femmes fabriquent), [et mme (en
principe) celles des objets fabriqus (qui sont yin)]. Il prside aussi la
division des surfaces et surtout celle des volumes (
396
) : le Yin est creux.
Quant aux longueurs quon rapporte la taille -talon, au gnomon, au Chef,
elles mritent dtre e xprimes par un nombre yang (Impair).
Les nombres, pairs et impairs, ont pour premier emploi de distribuer
lensemble des choses dans les catgories Yin et Yang. A cette fonction
classificatoire se rattache immdiatement une fonction protocolaire. Le
Yang lemporte sur le Yin : lImpair est une synthse de lImpair et du Pair.
On peut rsumer la conception chinoise des Nombres en rappelant une
formule des tymologistes indignes. Pour
232
expliquer quun sorcier puisse
tre dsign par lemblme graphique ( wou) qui signifie sorcire , mais
quil mrite, dautre part, de possder une dsignation ( hi) qui lui soit propre,
ils disent : la sorcire est yin, le sorcier est yin-yang. Lexpression yin-yang
na jamais cess de dsigner le sorcier, et le sorcier na pas cess, non plus,
privilge quil tient de la pratique de lhirogamie, dtre homme et
Marcel GRANET La pense chinoise 167
femme la fois, et femme volont. LImpair contient le Pair et il peut le
produire. En lui et par lui se mutent le Pair et lImpair.
Les vertus du pi sien, fait de 10 (main de lhomme) et de 8 (main de la
femme), tiennent ce que son diamtre moyen est fait de 5 et de 4, dont la
synthse est 9. 11 [synthse de 5 et de 6 (et aussi de chacun des 5 couples que
forment les 10 premiers nombres)], 7 [synthse de 3 et de 4 (circonfrence
inscrite et demi-primtre du carr ex-inscrit)], 5 [synthse de 3 et de 2
(demi-circonfrence et ct du carr) peuvent servir demblmes aux choses
yang, qui sont aussi yin-yang. Aucun de ces nombres ne le peut aussi bien que
9. Si 9 vaut 5 + 4, il vaut aussi 3, et 3, qui est la premire synthse du Yang
et du Yin, est aussi le premier nombre (
397
)
Un nest jamais que lEntier (
398
), et Deux nest, au fond, que le Couple.
Deux, cest le Couple caractris par l alternance (et la communion, mais non
la somme) du Yin et Yang. Et Un, lEntier, cest le pivot, qui nest ni yin, ni
yang mais par qui se trouve ordonne lalternance du Yin et Yang ; cest le
carr central qui ne compte pas, mais qui (comme le moyeu dont les auteurs
taostes disent que, grce son vide, il peut faire tourner la roue) (
399
)
commande la giration de la croix gamme dessine par les quatre rectangles
entre lesquels se partage le grand carr, Espace entier ; cest lIndivisible qui
ne peut sajouter, car il nest point une synthse de pair et dimpair ; cest
lUnit qui ne peut valoir 1 parce quelle est Tout et que, dailleurs, elle ne
peut se distinguer de Deux, car cest en elle que se rsorbent tous les aspects
contrastants et que sopposent, mais aussi sunissent, la Gauche et la Droite,
le Haut et le Bas, lAvant e t lArrire, le Rond et le Carr, lensemble du
Yang, lensemble du Yin. Tout ensemble Unit et Couple, lEntier, si on veut
lui donner une expression numrique, se retrouve dans tous les
233
Impairs
et, dabord, dans 3 ( : Un plus Deux). 3, nous le verrons, vaut comme une
expression peine affaiblie de lunanimit.
La srie des nombres commence donc 3 (
400
). Ce nest pas une srie
continue, car les nombres se groupent immdiatement en deux bandes
opposes. Une srie continue ne pourrait servir qu compter. Ce nest pas
dhier que, dans la pratique, les Chinois comptent juste. Mais ce que leurs
sages demandent aux Nombres, cest que les sries yin et yang leur
fournissent des classificateurs pour grouper hirarchiquement les tres en
catgories antithtiques. Ils dsirent, avant tout, distinguer par des emblmes
convenables les groupements pairs et impairs, et signaler, tout dabord, les
plus parfaits de ces groupements. Do limportance, atteste par ses
emplois rituels, de la double progression 3, 9, 27, 81, et 8, 16, 32, 64. Le
premier mrite de cette double srie est vident (
401
) : elle oppose, deux
reprises, deux carrs dont la somme voque un autre carr [9 + 16 = 5 et 81 +
64 = 12 (+ 1)] et invite construire deux querres (toutes deux essentielles,
bien que lune soit approximative). Autre raison de prestige : 3 + 9 + 27 + 81,
comme 8 + 16 + 32 + 64 = 120 et font ensemble les 2/3 de 360. Quand on
affronte ces deux sries, faites des impairs les plus parfaits et de pairs
Marcel GRANET La pense chinoise 168
parfaitement pairs, les 120 qui manquent pour parfaire 360 ne manquent
quen apparence. 120 pouses et 120 ministres doivent figurer aux ct s du
Roi. LHomme Unique (dont la robe brode de 12 insignes et qui suspend
son bonnet de crmonie 12 pendeloques de jade) vaut lui seul le groupe
entier de ses vassaux et le groupe entier de ses vassales ; il vaut ces deux
groupes qui ne sont que sa Gauche et sa Droite et, matre des 12 Provinces, il
vaut encore le grand Total 360, dans lequel il ne compte pas pour 1, pas plus
que ne compte pour 1, dans le groupe des 120 pouses, la Reine. En raison
des hirogamies qui la rsorbent dans le Matre, elle ne se distingue pas de
lHomme Unique, Sorcier suprme : Couple Yin-Yang.
LImpair contient et produit le Pair, qui nest jamais quune projection
double (droite et gauche, yin et yang) de lImpair. Ni lImpair, ni lUnit ne
sajoutent au Pair. Ils centrent le Symtrique et le transforment en Impair. Ni
lImpair, lUnit ne sajoutent lImpair : ils transforment une disposition
centre en un arrangement symtrique. Ces mutations ne sont que des
changements daspects, des changements de formes, de vrai es
mtamorphoses : elles ne paraissent pas impliquer un changement quantitatif.
Au reste, tous les Pairs valent galement comme expression dune disposition
symtrique, et tous les Impairs comme expression dun arrangement
hirarchis. Aussi les Impairs valent-ils encore comme des expressions du
Total, cest --dire de lUnit envisage sous un aspect plus ou moins
complexe. Un cest le Total et tout Impair, qui est une espce de Total, est
Un.
Sans quil y ait lieu de penser une addition, mais plutt en voquant une
rpartition diffrente de lensemble, un changement interne dorganisation,
lImpair opre le passage du Pair lImpair ou de lImpair au Pair. Le
passage du Pair lImpair nest pas celui de lIllimit au Limit ou de
lIndtermin au Dtermin, cest le passage du Symtrique au Centr, du
Non-Hirarchis au Hirarchis. Ce passage se fait sans suggrer de
reprsentation proprement quantitative. Le Double (Yin) et lIndivis (Yang),
le Carr (Symtrique) et le Rond (Centr) se produisent lun lautre ( cheng
cheng) (
402
), ou plutt alternant rythmiquement. Lidal gomtrique (
403
)
serait une assimilation (succdant une opposition) du Droit et du Courbe, du
Diamtre et du Demi Cercle, de 2 et de 3, cest --dire linterdiction de prter
une valeur 1.
*
* *
Lassimilation et lopposition du Pair et de lImpair, du Symtrique et du
Centr, montre suffisamment que la science des Nombres ne se distingue pas
dun savoir gomtrique. Ce savoi r a sa source et ses applications dans la
morphologie sociale.
Marcel GRANET La pense chinoise 169
Les Chinois voient dans les Nombres deux lots dEmblmes aptes
caractriser (en les hirarchisant) les diverses modalits de groupement qui
ressortissent aux catgories Yin et Yang. Leurs Sages, cartant une
conception
235
arithmtique de lunit, vitent de ranger les Nombres dans
une srie continue forme par additions successives de 1. Ils nprouvent pas
le besoin de considrer comme illimite la srie numrique ; ils prfrent
limaginer comme un ensemble de sries finies capables (la premire dizaine
en particulier) de figurer des cycles. Les emblmes numriques leur
paraissent destins voquer le dispositif dun ensemble fini, cest --dire
voquer le contour de cet ensemble en nonant les divisions de ce contour.
Lart des Nombres est la spcialit des Matres du Calendrier, chargs de
dcouvrir dans le Ciel des repres et de diviser le contour cleste en secteurs.
Il leur importe peu de le diviser en secteurs gaux ; tout au contraire, une
conception arithmtique de lunit les gnerait. Leur premier devoir est de
concilier des classifications et de les imbriquer de faon tirer de ces
imbrications des possibilits de jeu.
Le Ciel, en sus de son Fate (cest le Palais Central, le Palais de lUnit
suprme. Tai yi : compte-t-il pour 1 ? ne compte-t-il pas ?), comprend 4
Quartiers, mais qui ne correspondent point, chacun, 90. Le Palais de lEst
vaut 70 50 et celui de lOuest 75 40 ; le Palais du Nord 101 10 et celui
du Sud 112 20 (
404
). Chaque quartier se divise en 7 secteurs et lquateur
entier se trouve divis en 28 mansions, qui diffrent fortement dtendue et
dont deux [Fa, aujourdhui Chen, lpe dOrion) et Chen (lpe dOrion,
aujourdhui Tsouei)] occupent la mme rgion du Ciel. Si lon compte 7
mansions par quartier, cest sans doute parce que lastrisme du Palais
Central (la Grande Ourse), rsidence de lUnit Suprme, a 7 toiles (
405
).
Nest -il pas dit, dans un passage du Chou king (que Sseu-ma Tsien a pris
soin de conserver) : Les Sept Recteurs et les Vingt-huit Mansions, les Tubes
(=la Musique) et le Calendrier, le Ciel sen sert pour mettre en
communication (tong) les influences (ki ) des Cinq lments et des Huit
Directions (les Huit Vents) (
406
) ? Aussi, tout un chapitre des Mmoires
historiques a-t-il t consacr par lauteur (expert en matire de Calendrier)
montrer comment, se raccordant ensemble, la classification par 8 (Vents) et la
classification par 28 (Mansions) se relient aussi la classification par 12
(Tubes et Mois) (
407
). Sseu-ma sien ajoute, sur le pourtour du Ciel, les 8 vents
aux
236
28 mansions, puis il divise len semble en 4 quadrants. 28 + 8 font
36, soit 4 fois 9 : Sseu-ma Tsien accorde donc chacun des quadrants 7
mansions plus 2 vents, sans se sentir gn par le fait que les 7 mansions dun
secteur ngalent en aucun cas 90. Do, dans le dtail des quivale nces
tablies entre les Mois, les signes cycliques, les Vents et les Tubes, de
nombreuses singularits. La plus curieuse est que le Ve mois, qui est le mois
du solstice dt, est mis en rapport avec trois mansions qui dpendent du
Vent du Sud-Est, cependant que le Vent du plein Sud (et les deux mansions
rattaches lui) ne correspondent qu un simple site et que le VIe mois,
Marcel GRANET La pense chinoise 170
dernier mois de lt, est rattach au Vent du Sud -Ouest avec lequel
commencent lAutomne et le secteur occidental (
408
). Rien de tout cela
ninquite Sseu -ma Tsien, lun des Matres de la connaissance des Temps. [Il
tient en revanche signaler quune des mansions du Sud se nomme et)
compte 7 toiles : elle en compte 7, dit-il, parce que 7 est le Nombre du Yang
(et du Sud = Feu) (
409
)].
Concilier des classifications htrognes et les imbriquer avec lespoir
que leurs chevauchements faciliteront les manipulations demblmes et, par
suite, la manipulation du rel, tel est le mtier, tel est lidal de
lastronome. Les Nombres ont, pour lui, une premire vertu : ils savent
figurer les combinaisons diverses quon peut, si on le dcompose, attribuer
aux lments dun ensemble, et ils permettent, en outre, de combiner entre
elles ces combinaisons. Aussi, aprs avoir confi aux Nombres la mission de
qualifier des compositions, nhsite -t-on pas leur demander, les traitant
comme des signes cycliques, de caractriser des positions. Ce nest point l
une fonction trs diffrente de celles quils remplissent en tant que symboles
des diverses dispositions cycliques auxquelles selon loccurrence, il convient
de se rfrer : quand un nombre figure un site, cest titre de symbole du
dispositif quimposent, en lespce, tels ou tels caract res circonstanciels de
lEspace -Temps (
410
). Mis au service dune cosmographie et dune gomtrie
dont la donne premire est que le Temps et lEspace forment ensemble un
milieu concret, les Nombres servent avant tout figurer les formes
circonstancielles de lUnit ou, plutt, du Total.
237
Cest 3, Premier Nombre, Nombre parfait ( tcheng), que se
rattachent tous les grands systmes de classification : classifications par 5,
ainsi que par 6, 4 et 7 ; classifications par 8, ainsi que par 9, 10 et 12 (et par
24, 36, 60, 72, etc.).
Fait remarquable, ce sont des mythes relatifs aux Patrons de lAstronomie
et de lArt du Calendrier qui peuvent faire apparatre une donne instructive :
la gomtrie des savants chargs damnager le Temps et lEspace est (de
mme que lensemble du systme des classifications numriques) calque sur
la morphologie, sur lamnagement de la socit chinoise quand celle -ci
commence tre commande par un principe de hirarchie. Toutes les
classifications chinoises se rattachent une formation en carr qui est une
formation militaire et au dessin, voquant lide de rond et de giration,
dune croix simple ou dune croix gamme.
Jai dj, propos de la disposition centre attribue au Temps et
lEspace (
411
), montr comment le dispositif en croise [qui permet de rpartir
lUnivers en 4 secteurs et de placer, comme principe de toute hirarchie, au
Centre, et en lui donnant lemblme 5, lUnit, Total et pivot du Total] drive
dun affrontement en bataille, 3 face 3, [o se retrouve avec limage dun
axe, le souvenir des joutes et de lantique organisation dualiste dont est sortie
la conception dune cat gorie de Couple, premier modle des classifications
Marcel GRANET La pense chinoise 171
numriques]. Je lai montr en utilisant le mythe de Hi -ho (
412
) , qui est le
Soleil, la Mre des Soleils, le Couple solaire, mais qui est aussi les 3 Hi et les
3 Ho. Yao le Souverain (qui avait lui-mme lapparence dun Soleil) se servit
de cette double trinit de faon dessiner une grande croise : envoyant en
mission aux quatre Ples les cadets des Hi et des Ho, il retint prs de lui,
encadrant le Centre la faon dune Gauche et dune Droite, lan des Hi et
lan des Ho, chargs de diriger le Soleil et la Lune, le Yang et le Yin, car les
Hi et les Ho, tous les 6, sont des astronomes en mme temps que des devins.
LUnit, une et double, gauche, centre et droite, avant, centre et arrire, se
projette, comme on voit, ainsi quune double trinit, cartele sur une croix,
mais de faon fixer au Monde un Centre soit en opposant (lensemble
valant 5) 1, le Centre, la croise qui spare 4 secteurs, soit
238
en opposant
(lensemble valant 7) 4 (le pourtour, cest --dire le Carr) 3 (le pivot,
cest --dire le Cercle) : 4, 5 et 7 (ds que lUnit se dcompose en 6) peuvent
exprimer la forme et lorganisation de lUnivers. Un thme analogue se
retrouve dans le mythe de Tchong-li. Tchong et Li sont, eux aussi, des
astronomes, et Tchong-li (
413
) est encore le Soleil. Comme Hi-ho, Tchong-li
est un, mais il est aussi la moiti dun Couple, sa moiti droite puisque
Wou-houei, frre de Tchong-li (et grand-pre de 6 petits-fils qui sortirent du
corps maternel 3 par la gauche, 3 par la droite), ne possdait, affirme-t-on,
que la moiti gauche du corps (
414
). A lui seul, cependant, Tchong-li est un
couple fraternel : Tchong et Li. Lun de ces frres gouverna le Ciel et lautre
la Terre, cest mme de ces prudents astronomes que date la sparation de la
Terre et du Ciel, du Bas et du Haut. Mais on dit parfois que Tchong et Li ne
sont pas frres. Tchong, en cas, fait partie dun groupe de 4 frres, lesquels
ne comptent que pour 3 ; deux dentre eux, vous au Nord (Yin), ne sont
quun couple ; les deux autres, gnies de lEst et lOuest, encadrent cette
unit double : ce trio soppose le seul Li, lequel, ne se projetant pas
triplement ne commande qu un quart dhorizon, un seul secteur du
Monde, celui du Sud, il est vrai, du Feu et du Yang. Voici donc marques les
pointes de la croise et 4 Hros prposs aux 4 Orients : au centre, ct du
Souverain qui doit possder la Vertu du Ciel, viendra se placer un cinquime
hros, prpos la Terre (Heou-tou). La Vertu de la Terre appartient en
propre au Ministre qui est le second du Souverain et qui, un et triple, est
appel Trois-Ducs , de mme quon appelle Trois-Vieillards les
doyens et chefs de bourgades. Rien ne peut, mieux que ces appellations,
montrer les vertus qui autorisent 3, lImpair, tre lemblme -matre de tout
dispositif exprimant une organisation hirarchise (
415
). On aperoit,
dailleurs, que, dans la classification par 5, mme quand elle tend se
dtacher de la classification par 6, quelque chose demeure du dualisme
ancien : lunit centrale conserve une valeur de couple.
Des traces de dualisme se montrent encore lorsque les progrs de lImpair
et du principe hirarchique entranent le
239
rgne des classifications par 9 et
10. Si dans le Ciel, Hi-ho, Mre des Soleils, a 10 fils, sur Terre, un Souverain
Marcel GRANET La pense chinoise 172
tel que Yao (qui a lapparence du Soleil) a lui -mme 9 ou 10 fils (416). Yao
fit tuer par son vassal (ou son double), le Grand Archer, 9 Soleils, qui,
empchant son accession au pouvoir, prtendaient usurper, dans le Ciel, la
place du seul Soleil alors qualifi pour rpartir lombre et la lumire. Il fit
aussi tuer (ou du moins bannir) par Chouen, son ministre et son double, lan
de ses fils, dont (8 ou) 9 seulement taient dociles. Lopposition 1 face 9
nest quun autre aspect de loppo sition 1 face 3 ou 3 face 3. Quand
lEmpire et le Monde sont dtraqus, on peut voir se combattre 1 et 9 Soleils ;
dordinaire la bataille se livre entre le Soleil montant qui va rgner au Ciel et
le Soleil tombant qui tarde regagner, sur Terre, le Couchant (
417
) : quon
compte les joueurs pour 2 ou quon les compte pour 10 (1 face 9), la joute
marque une opposition du Haut et du Bas. Mais si, au moins dans lun des
camps, les joueurs sont 9, cest que 9 marque, en plan, les divisions de
lEspace. La classification par 10 (= 9 +1) sort de la classification par 9,
dont drive aussi la classification par (9-1 =) 8. Quand un Souverain ne
dlgue pas aux Ples 4 astronomes, il y bannit (
418
) un carr de Gnies
malfaisants (lesquels, dailleurs, quivalent, eux aussi, un double trio) ; en
ce cas, contrepartie ncessaire (
418b
), lHomme unique sentoure d une double
bande de Gnies bienfaisants ; il charge les Huit minents de prsider aux
choses de la Terre (Heou-tou : tel est le titre du Gnie du Centre et de la
Terre dont lemblme est 5), et il confie aux Huit Excellents le soin de
rpandre les 5 Enseignements dans les 4 directions. Tous, sur deux plans
diffrents : besognes matrielles ou morales, terrestres ou clestes,
accomplissent leur tche par dlgation de lautorit centrale (5 = Centre). Le
seul fait, cependant, que, dans chaque groupe, ils soient 8, montre assez que
leur activit est priphrique. Ils la dploient non seulement dans les 4
Directions cardinales, mais encore dans les 4 Directions angulaires, cest --
dire dans le domaine des 8 Vents et des 8 Trigrammes : dans les 8 carrs qui,
accols deux par deux, forment les 4 rectangles dessinant autour dun carr
central, moyeu du Monde, une croix gamme. Lorsque lUnit Suprme
dispose la
240
rose octogonale des Trigrammes et les 8 emblmes num-
riques du pourtour du carr magique, elle se repose, nous dit-on, deux fois au
centre (5 et 10) (
419
). Cest dire (nouvelle trace du dualisme primitif) que le
Centre et lUnit elle-mme sont doubles, quun plan cleste se superpose au
plan terrestre, un Haut un Bas, et quenfin le Centre, tant pivot, unit le Ciel
et la Terre. Aussi le Souverain a-t-il besoin, pour propager sa double vertu
centrale, dune double bande d e 8 auxiliaires. La classification par 8 (ou 2 x
8) se rattache, ainsi que la classification par 10, la division du carr en 9
carrs. Et il en est de mme (comme je lai montr propos du Ming
tang, de ses 8 salles extrieures et de ses 12 regards sur lhorizon) de la
classification par 12 Lopposition de la Terre et du Ciel rappelle le
dualisme premier, mais toutes ces classifications font apparatre les progrs
de lide de hirarchie. Ces progrs sont lis au succs de lImpair. Au lieu de
ne se projeter triplement que 2 fois, de faon naboutir dabord qu
affronter un couple dunits triples, lUnit centrale se projette 3 fois
Marcel GRANET La pense chinoise 173
triplement, en avant, au centre, en arrire (
420
) ; le carr nest plus simplement
bauch, par le trac dune croix simple ; il est entirement limit par les
branches de la croix gamme ; lUnivers na plus 4 Secteurs et 1 Centre
(classification par 5 lments) : il a 9 Provinces, 1 Centre et 8 Directions,
Vents ou Trigrammes (classification par 8).
Hi-ho, patron des devins, matre du Yin et du Yang, commande aux 8
Vents et aux 8 Trigrammes, de mme que, Soleil et patron des astronomes, il
commande aux jeux de lombre et de la lumire. Il y a un couple Hi -ho,
comme il y a, parmi les Trigrammes, un couple Kien -Kouen, pre et mre
des 3 Trigrammes femelles, qui sont surs, et 3 Trigrammes mles, qui sont
frres, et il y a de mme 3 frres Hi et 3 frres Ho. Les Hi et les Ho sont
encore considrs comme les Matres du Soleil et de la Lune (
421
). La Mre
des Soleils (qui sont 10) ne se distingue gure, mythiquement, de la Mre des
Lunes (qui sont 12). Toutes deux ont le mme mari. Ce Souverain, qui fut le
pre de Trois-Corps, engendra aussi Huit Hros qui inventrent la Danse et la
Musique (422). Corbeau ou Livre, le Soleil et la Lune ont tous les deux 3
pattes. Le Soleil dans sa journe doit
241
parcourir 16 stations ; pour prsider
la Nuit, il y a, comme pour aider un Souverain, une double bande de 8
Gnies (
423
). Les danses anciennes opposaient les danseurs 3 face 3 ; plus
tard, dans les churs de danses, les danseurs saffrontrent 8 face 8 (424).
Nous savons mme quil exis ta jadis une confrrie de danseurs o, dit-on,
lon dansait par 2 et par 3, cest --dire, sans doute, par 8 et par 9. La confrrie
comptait, en effet, 81 ou 72 membres qui figuraient soit (9 x 9) les 9
Provinces du Monde, soit [ou bien (9 x 8) ces 9 Provinces encore, ou bien] (8
x 9) les 8 Vents et les 8 Trigrammes, rappelant, dans un cas, lUnit
centrale et le Nombre du gnomon (81-80) et dans lautre la division du Total
(360) en 5 parties.
Lorigine des grandes classifications se retrouve dans des myth es qui sont
souvent relatifs au Soleil et aux familles de Soleils, car les classifications
numriques intressaient surtout les astronomes et, par ailleurs, le Soleil est
lemblme du Chef. Ces mythes ne sont que laffabulation de joutes et de
drames rituels. Dans la gomtrie de ces ballets, se traduisaient la structure et
lamnagement de la socit ancienne. Les classifications essentielles [par 6
et 5 (thorie des lments), par 8 et 9 (Vents et Provinces)] signalent, succ-
dant au rgne de la bipartition (Yin et Yang : catgorie de Couple),
lavnement du privilge masculin et du privilge de lImpair. La formation
en carr et la formation par 3 caractrisent lorganisation urbaine et militaire.
On montait 3 dans les chars ; les archers, pour concourir, saffrontaient par
groupes de 3 ; la ville et le camp avaient, encadrant la rsidence du chef, un
district de gauche et un district de droite, dont les chefs commandaient aux
lgions de gauche et de droite ; les armes opposaient 3 lgions 3 lgions,
lar me royale ayant seule 6 lgions. Les villes et les camps comptent 9 ou 12
quartiers (
425
). Le Monde a 9 ou 12 Provinces ; le Ming tang [quil ait 5
Salles (croix simple) ou 9 Salles (croix gamme)] contient 9 sites sacrs et
Marcel GRANET La pense chinoise 174
jette sur lhorizon 12 regards ; mais le carr 3 x 4 ne peut-il tre divis en 9
carrs dont 8 sont en bordure ? et, divis en 16, na -t-il pas, sur ses 4 faces, 4
carrs, de telle sorte quil per met de jeter sur lhorizon 2 x 8 regards (426) ?
La ville, le
242
camp, la bataille, les joutes de confrries illustraient gom-
triquement les vertus des nombres 8 et 9, 5 et 6, 10 et 12 destins servir de
multiplicateurs et de classificateurs privilgis, puisque les astronomes
pouvaient les employer (et les combiner) de manire diviser 360 en (5, 6, 8,
9, 10, 12 ou 30, 36, 40, 45, 60, 72...) secteurs (
427
).
A part la catgorie de Couple (lie lide daffrontement et dalternance
simples ainsi qu limage dun axe linaire), toute s les classifications
numriques drivent 6 [croix simple, (6 ou) 5 domaines, 4 secteurs] et 9
[croix gamme, (10 ou) 9 domaines, 8 secteurs] servant dintermdiaires
de 3, lImpair, crateur du Carr et demblme du Courbe, synthse du
Double et de lIndivis, Nombre yin-yang, Nombre mle, principe de
hirarchie, symbole du Total nombr, premier Nombre.
*
* *
Les classifications numriques commandent en Chine tout le dtail de la
pense et de la vie. En les combinant et en les imbriquant, on est arriv
difier un vaste systme de correspondances. La rpartition des choses entre
les divers lments et les divers Trigrammes tient dans ce systme la
premire place, mais dautres classifications, galement base numrique,
viennent sy enchevtrer, c ompliquant (ou mme inversant) les
correspondances et les antagonismes. Par suite de ces enchevtrements et de
lemploi linfini des classificateurs numriques, ceux -ci finissent par ne plus
avoir quune espce de valeur mnmotechnique : ils naident que dune faon
tout extrieure et purement scolastique raccorder au systme du Monde le
dtail des ralits. Tel est le cas, par exemple, lorsque le Hong fan (428)
rpartit en 8 sections lactivit gouvernementale [ css04] (alimentation,
marchandises, sacrifices, travaux publics, instruction, justice, hospitalit,
arme) ou lorsque le Tcheou li (429) classe en catgories numriques les
attributions du Ministre du Ciel (6 ministres, 8 rglements, 8 statuts, 8
principes dmulation, 8 principes de morale, 9 classes de travailleurs, 9
revenus, 9 dpenses, 9 tributs, 9 principes dautorit...). Il ny a pas lieu
dinsister
243
sur la vogue persistante des classifications numriques ; mais
le prestige quelles continuent dexercer montre que, si les Chinois classent
laide dindices numriques, cest quils estiment ces indices capables de les
renseigner en quelque manire sur la nature des choses (
430
). Les Nombres ont
commenc par avoir un rle logique plus effectif. On les employait ajuster
aux proportions cosmiques les choses et les mesures propres chaque chose,
de faon montrer que toutes sintgrent dans lUnivers. LUnivers est une
hirarchie de ralits. A la fonction classificatoire des Nombres sajoute
Marcel GRANET La pense chinoise 175
immdiatement une fonction protocolaire. Les Nombres permettent de classer
hirarchiquement lensemble des groupements rels.
Une rgle domine lemploi protocolaire des Nombres. Cette rgle peut
aider comprendre la conception que les Chinois se font de lunit et de la
srie numrique. Les techniques rituelles mettent au premier rang tantt les
petits et tantt les grands nombres. Tandis que les divinits secondaires, qui
sont nombreuses, ont droit, chacune, une multiplicit de victimes, le Ciel ne
se voit sacrifier quun seul taureau : le Ciel est un et seul lui sacrifie, Homme
Unique, le Suzerain. La quantit, du reste, importe peu pour le Ciel et les
autres divinits qui se contentent de la Vertu (t) des victimes. Mais la
foule des gens du commun mange autant quelle peut (elle ne mange, il est
vrai, que les portions qui ne sont point nobles). Les nobles eux-mmes ne
sont pas rassasis avant le troisime plat. Un seigneur lest ds le deuxime et
le roi sitt quil a got du premier. Cepen dant, on dispose devant le suzerain
vingt-six vases de bois garnis de victuailles, seize seulement la table dun
duc, douze celle dun seigneur fieff, huit ou six pour un grand officier de
premier ou de second rang... Je pourrais multiplier les exemples. Il suffira
dindiquer que le principe de ces rgles numriques a t clairement dfini
par les Chinois. Tantt le grand nombre (ou la grande dimension) est une
marque de noblesse : cest que le cur se tourne vers lext rieur... (tantt) le
petit nombre (ou la petite dimension) est une marque de noblesse : cest que
le cur se tourne vers lintrieur (
431
) . Ceci revient dire que la hirarchie
244
sexprime laide de nombres choisis en parcourant la srie numrique
dans un sens ou dans lautre, la pense tant alternativement domine par le
sentiment dune expansion ou dune concentration, par li de du complet, qui
est nombreux, ou du total, qui est un.
Le mme principe se retrouve dans lemploi constant des multiples que
font les techniques rituelles. La srie impaire : 3, 9, 27, 81, qui semble se
rattacher naturellement lunit, est, pour cet te raison, presque toujours
prfre la srie paire : (4), 8, 16, 32, 64. On lutilise, le plus souvent, de
faon rendre sensible un va-et-vient rythmique entre le simple et le
complexe, tout en conjuguant des reprsentations spatiales et des
reprsentations temporelles. On sait quun roi a 120 femmes, non comprise sa
reine, qui ne fait quun avec lui. Cet entourage fminin se dcompose en
quatre groupes, en cinq, si lon veut compter la reine. Ces groupes, ingaux
en grandeur, le sont aussi en valeur, mais en sens inverse. Les femmes
royales ont dautant moins de noblesse quelles appartiennent un groupe
plus vaste et, par suite, plus distant du Matre. Il y a donc 81 femmes de 5
e
rang, 27 de 4
e
rang, 9 de 3
e
rang, 3 de second rang, la reine partageant seule la
noblesse du roi. Vus dans lespace, ces groupes, si je puis dire, sembotent
les uns dans les autres. Une sorte de rythme concentrique (
432
) rgle leur vie
dans le Temps. Rparties par 9 en 9 sections, les moins nobles des femmes
royales approchent du Matre au dbut et la fin des lunaisons, lune des neuf
premires, et lune des neuf dernires nuits du mois. Les femmes de
quatrime et troisime rangs sont de mme convoques auprs du roi par
Marcel GRANET La pense chinoise 176
sections de neuf et deux fois par mois, mais pour des nuits plus centrales. Au
groupe des trois femmes de second rang, que le Seigneur admet aussi deux
fois auprs de lui, appartiennent la 14
e
et la 16
e
nuit qui, toutes deux,
avoisinent la nuit sainte o la lune, toute ronde, fait face au soleil. Cest
pendant cette nuit unique, mais cest pendant cette nuit tout entire, que la
reine demeure, seule, en prsence de lHomme unique. On retrouve un emploi
comparable des nombres dans la crmonie fameuse du labourage printa-
nier (
433
). Le Suzerain laboure le premier, mais il ne trace que trois sillons.
Les trois ducs du palais labourent aprs
245
lui, chacun deux traant cinq
sillons. A leur suite viennent les neuf ministres ; ils doivent, chacun en traant
neuf, ouvrir 81 sillons. Plus nombreux louvrage, ils ont aussi une tche
plus longue. Cest que leur besogne est dordre secondaire ; ils ne font que
rpter, prolonger, clbrer la seule uvre efficace, luvre Royale : la Terre
est fconde sitt quen elle lHomme unique a enfonc son soc. Et, de
mme, que comptent les 120 pouses et leurs unions multiplies ? Il convient,
certes, que, dilue, la fcondit royale, se rpande rythmiquement, atteignant
enfin, avec les 81 femmes de dernier rang, les parcelles les plus infimes de
lUnivers ; mais lUnivers entier est fcond, mais un rythme unique est
donn la vie universelle, ds quinvitant la Lune et le Soleil se faire face
temps rgls, le Couple royal sest uni. Si le protocole se plat utiliser les
sries de multiples, cest que ceux -ci, tout en signalant un certain rythme,
voquent une nature ou une disposition du Total, lequel demeure identique,
mme quand on lenvisage sous laspect du Complet et dans tout le dtail de
sa composition. Tous les multiples, au fond, squivalent ou, du moins, leur
grandeur importe peu et pourtant les nombres servent estimer ; mais
ce nest point la quantit qui compte dans ce quils estiment, cest la valeur,
cosmique et sociale la fois, des groupements quils tiquettent : cest la
dignit ou le lot de puissance des catgories quils permettent de hirarchiser.
Peu importe donc, dans les nombres, la grandeur. Pour hirarchiser, pour
signaler, si je puis dire, un rythme hirarchique, peu importe quon parcoure
dans un sens ou dans lautre la srie numrique ou une srie de multiples.
Faire partie dun lot de 81 femmes, cest tre aussi distant que possible du
matre et nen recevoir que des faveurs dilues ; mais possder 81 femmes
quivaut rgenter les 9 Provinces et concentrer en soi une autorit totale.
Un simple noble peut nourrir 9, 18 (= 2 x 9) ou 36 (= 4 x 9) personnes sil est
de 1
er
, de 2
e
ou de 3
e
rang ; un grand prfet peut en nourrir 72 (= 9 x 8), un
ministre 288 (= 9 x 32), un prince 2 880 (= 9 x 320) (
434
). Les nombres
savent exprimer la dignit, parce quils signalent limportance du groupe
infod. Ils savent lexprimer aussi en signalant un
246
coefficient de
puissance ou un lot de prestige, cest --dire une valeur sociale.
Telle est, par exemple, la fonction des quatre nombres impairs 3, 5, 7, 9.
La salle o le Chef reoit et mange forme une estrade surleve de 3 pieds,
sil est un simple officier ; de 5 pieds sil est grand officier, de 7 sil est
seigneur, de 9 sil est le roi (
435
). Quand le roi meurt, on doit, pour lui fermer
Marcel GRANET La pense chinoise 177
la bouche, se servir de 9 cauris ; on le pleure sans arrt 9 jours ; on continue
pleurer pendant 9 mois, on trpigne par sries de 9 bonds ; il faut, enfin, aprs
lenterrement dfinitif, rpter 9 fois les offrandes (
436
). Les seigneurs, les
grands officiers, les officiers nont droit qu 7, 5 ou 3 offran des, cauris,
bonds, mois ou jours de pleurs. Leur corps est plus vite prt pour
lenterrement dfinitif : il se dissout aprs moins deffort. Il faut moins de
temps et de gestes rituels pour les aider passer de la vie la mort : la vitalit
est dautant mo ins puissante que la dignit est moins haute. La socit
fodale est une socit militaire ; prestige, rang, dignit sy gagnent dans des
concours et des preuves. Les preuves les plus importantes sont celles du tir
larc : nappelle -t-on pas les feudataires : les archers ? Aux joutes du tir
larc on peut dmontrer son adresse ou sa loyaut (cest tout un) et la qualit
de son vouloir en dcochant ses flches bien en mesure (car le concours se
fait en musique) et droit dans le but. Quand on les dcoche avec force, on
prouve sa vitalit, sa valeur : la puissance de son gnie. Aussi construit-on les
arcs en tenant compte du vouloir (tche liu) et de la vitalit (hiue ki ) (437) de
leur destinataire. Pour apprcier la dignit que celui-ci mrite, il sufft, au
concours, destimer la force de son arc. Les arcs les plus forts ont
linflexion la plus faible. Il faut donc, pour former un cercle parfait, en
prendre 9, sil sagit darcs dont un roi, seul, pourra se servir ; mais on parfera
la circonfrence avec 7 arcs de seigneurs, 5 arcs de grand officier, 3 arcs
dofficier (438).
Loin de chercher faire des Nombres les signes abstraits de la quantit,
les Chinois les emploient figurer la forme ou estimer la valeur de tels ou
tels groupements qui peuvent tre prsents comme des groupements de
choses, mais quon tend toujours confondre avec des groupements humains.
Les Nombres disent la forme ou la valeur des
247
choses, parce quils
signalent la composition et la puissance du groupe humain auquel ces choses
adhrent. Ils expriment dabord le lot de puissance qui appartient au Chef
responsable dun groupement humain et naturel.
Les Sages peuvent donc reprsenter laide de Nombres lordre
protocolaire qui rgit la vie universelle. Ce sont des rgles sociales qui leur
permettent de concevoir cet ordre. Lordre de la socit est fodal. Une
logique de la hirarchie inspirera donc tout le systme des classifications
numriques et lide mme quon se fait des Nombres.
*
* *
Les Nombres ont une fonction logique : classificatoire et protocolaire tout
ensemble. Ils tiquettent des groupements hirarchiss. Les tiquettes
numriques servent qualifier la valeur que possde, en tant que total, chaque
groupement : elles permettent destimer la teneur et l a tension du groupe, sa
cohsion, sa concentration, cest --dire la puissance dani mation qui signale
Marcel GRANET La pense chinoise 178
son Chef. Ce sont des scnarios de ballets ou de joutes danses qui
clairent le rle gomtrique ou cosmologique des Nombres ; ce sont les
rgles de construction des arcs servant lpreuve des Chefs qui expliquent la
fonction des nombres lorsquon les emploie estimer, non pas, certes, ces
grandeurs, mais des valeurs. On peut voir, dans les deux cas, quune mme
ide domine les conceptions chinoises : la notion dunit arithmtique ou
daddition demeurant au second plan, les Nombres apparaissent comme des
Emblmes figurant les aspects plus ou moins nobles de la totalit, de
lefficace, de la puissance. Ces emblmes, plu tt quils ne diffrent
quantitativement les uns des autres, sopposent, se correspondent, svoquent
ou se suscitent. Tous les pairs sont le Pair, tous les impairs lImpair et, grce
lImpair, sont possibles les mutations du Pair et de lImpair. Les Nombres
peuvent se substituer les uns aux autres et, diffrents de grandeurs,
squivaloir (
439
) ; tous les jeux sont possibles, puisquon peut faire varier le
systme de division des units. Mais les mutations, les substitutions, les
quivalences sont commandes par une ide fondamentale. A partir
248
de 3,
premier Nombre, tous les symboles numriques sont les tiquettes du
Nombreux, cest --dire des approximations du Complet (tsin). 3 nest quune
synthse. Seul, Un, qui contient Deux, le Couple, Unit communielle,
exprime parfaitement le Total, qui est lEntier. Le Total, Yi, lEntier, cest le
pouvoir universel danimation qui appartient au Chef, Homme Unique. Toute
la conception chinoise des Nombres (comme, on la vu, la conception du Yin
et du Yang, et comme, on va le voir, la conception de Tao) sort de repr-
sentations sociales, dont elle na aucunement cherch sabstraire. Aussi
pourrons-nous, pour conclure, finir sur une anecdote.
Le Tso tchouan raconte les dbats dun Conseil de guerre (
440
) : doit-on
attaquer lennemi ? Le Chef est sduit par lide de combattre, mais il faut
quil engage la responsabilit de ses subordonns et prenne dabord leurs
avis. Douze gnraux, lui compris, assistent au Conseil. Les avis sont
partags. Trois chefs refusent dengager le combat ; huit veulent aller la
bataille. Ces derniers sont la majorit et ils le proclament. Lavis qui runit 8
voix ne lemporte point cependant sur lavis qui en runit 3 : 3, cest presque
lunanimit, qui est bien autre chose que la majorit. Le gnral en chef ne
combattra point. Il change dopinion. Lavis auquel il se rallie en lui donnant
son unique voix simpose ds lors comme une opinion unanime (
441
).
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 179
CHAPITRE IV
Le Tao
249
Comme la classification bipartite par le Yin et le Yang, les
classifications numriques tirent leur valeur dun senti ment de lunit
communielle, ou, si lon veut, du Total. Ce sentiment est celui quprouve un
groupement humain lorsquil sapparat lui-mme comme une force intacte
et complte ; il surgit et sexalte dans les ftes et les assembles : un haut
dsir de cohsion lemporte alors sur les oppositions, les isolements, les
concurrences de la vie journalire et profane. Les plus simples et les plus
permanents de ces antagonismes et de ces solidarits se sont traduits dans la
conception qui fait du Yin et du Yang un couple antithtique et cependant uni
par la plus parfaite des communions. Les classifications par 6 et 5, 8 et 9,
correspondent un progrs du besoin de cohsion. Elles semblent se rattacher
une organisation plus complexe de la socit et lide dune union
fdrale. Quelles suggrent limage dun rassemble ment militaire en carr,
ou dune disposition en bataille, ou enc ore celle des divisions du camp, de la
ville ou de la maison des assembles masculines, cest une organisation
fodale quelles font songer. Comme les groupes fodaux, les groupements
orients de ralits agissantes, dont les Cinq lments et les Huit Vents sont
les emblmes, ne se bornent pas saffronter et communier : ces secteurs du
Monde sont disposs autour dun Centre dont ils semblent, de tout temps,
dpendre. Cest que les hommes voient dans leur Chef lauteur dune
distribution harmonieuse de lensemble
250
des activits, humaines ou
naturelles. Le Suzerain amnage le Monde et il lanime : du seul fait quil
tient sa cour au centre de la confdration, tout, dans lUnivers, coexiste et
dure. Lattribution dune autorit totale un personnage, quon se plat
nommer lHomme Unique, saccompagne de la conception dune puissance
rgulatrice. Cette puissance, on limagine, de faon plus ou moins raliste,
sous laspect dun principe dordre suprmement efficace : le Tao.
*
* *
De toutes les notions chinoises, lide de Tao est, non certes la plus
obscure, mais celle dont lhistoire est la plus difficile tablir, tant est grande
lincertitude o lon demeure sur la chronologie et la valeur des documents.
Lusage dappeler Taostes ou sectateurs du Tao les tenants dune doctrine
considre comme trs dfinie expose faire croire que la notion de Tao
appartient une cole dtermine. Je crois devoir la rattacher au domaine
de la pense commune.
Marcel GRANET La pense chinoise 180
Tous les auteurs, les Taostes comme les autres, emploient le terme tao
pour noter un complexe dides qui restent trs voisines, mme dans des
systmes dont lorientation est assez diffrente. Au fond de toutes les
conceptions du Tao se retrouvent les notions dOrdre, de Totalit, de
Responsabilit, dEfficace (
442
)crivains dits taostes se signalent par le dsir
denlever ces notions tout ce quelles peuvent contenir de reprsentations
sociales. Loin dattribuer la conception premire du Tao aux auteurs quon
qualifie parfois de Pres du Taosme , jestime que cest chez eux quelle
se prsente sous laspect le plus distant de sa valeur premire. Ces penseurs se
servent du mot tao pour exprimer lOrdre efficace qui domine puissance
indfinie lensemble des ralits apparente s, tout en restant, quant lui,
rebelle toute ralisation dtermine. Quand ils en viennent, cependant,
illustrer cette ide, ils se contentent, bien souvent, dvoquer lart total qui
permet un Chef, il sagit, dordinaire, de Houang -ti (
443
) qui est leur
patron, mais qui est aussi le
251
premier Souverain de lHistoire chinoise,
de rgenter le Monde et lEmpire. Principe unique de toutes les russites, le
Tao se confond pour eux avec lart de gouverner.
Cet art, pour les auteurs de lcole dite confucenne, est aussi un art
souverain et qui embrasse tout le savoir. Ils voient dans le Tao la Vertu propre
lhonnte homme ( kiun tseu) : celui-ci, limage du Prince ( kiun), se pique
de ne possder aucun talent particulier (
444
).
Les Taostes, de leur ct, opposent le mot tao diffrents termes (chou,
fa) qui signifient recettes, mthodes, rgles et font songer aux procds de
techniciens spcialiss (
445
). Ceci nempche point qu laide du Savoir total
quimplique le Tao on ne puisse, leur avis, possder le Gnie qui fait russir
dans lastronomie ou la physique, qui permet dtre un Immortel ou de
commander telle province de la nature (
446
). Tchouang tseu, en donnant de
pareils exemples, veut rendre sensibles les possibilits indfinies que confre
le Tao. Il est remarquable quil les emprunte la mythologie courante.
Dans un hymne ancien en lhonneur de Heou -tsi, le Prince des Moissons, le
pote proclame que ce Hros possdait la Vertu (tao) daider (la
Nature) (
447
) : il russissait faire pousser tout ce quil plantait. Il y a les
plus grandes chances que le mot tao, dans la langue mythique et religieuse, ait
exprim lide dune efficace indtermine en e lle-mme, mais qui tait le
principe de toute efficience.
Les Pres du Taosme nont gure employ le mot tao sans le
rapprocher du mot t. Ce terme dsigne, chez eux, lEfficace quand elle a
tendance se particulariser. Lexpres sion double tao-t na jamais cess, dans
le langage commun, de rendre lide de Vertu, mais non pas dans lacception
purement morale de ce mot. Tao-t signifie prestige , ascendant
princier , autorit efficace (
448
). T, dans la langue des mythes, est la
qualit des gnies les plus complets, les plus royaux (
449
). Cest sans doute le
dsir danalyser, en les opposant, deux notions peu distinctes dans le principe
qui a conduit donner t la valeur de vertu spcifique et noter par ce
Marcel GRANET La pense chinoise 181
terme, dans le langage philosophique, lide dune Efficace qui se singularise
en se ralisant. Tandis que t veille surtout le sentiment des russites
particulires, tao
252
exprime lOrdre total que traduit lensemble des r alisa-
tions.
Le Tao (ou le Tao-t), cest lEfficace, mais caractrise par son action
rgulatrice et en tant quelle se confond avec un principe souverain
dorganisation et de classement.
*
* *
Le premier sens du mot tao est chemin ; cest aussi le sens du mot
hing, que lon a pris lhabitude de traduire par lment .
Comme pour les notions de Yin et de Yang, les rudits qui se sont
employs interprter hing et tao en termes europens, se divisent en deux
groupes : les uns nhsitent pas reco nnatre dans le Tao et les lments un
principe agissant et des forces naturelles (
450
) ; les autres, sans plus hsiter,
voient dans les lments des substances et dans le Tao une substance aussi,
car ils en font la somme du Yin et du Yang qui seraient galement des
substances (
451
).
Ces affirmations divergentes se rattachent, le plus souvent, des opinions
sur la chronologie des documents.
Pour plusieurs rudits, la thorie des Cinq lments est dinvention
rcente (IIIe-IIe sicles av. J.-C.). Sil y est fait allusion dans le Hong fan,
cest que ce document est lui -mme rcent ou quil a t interpol (
452
). La
vogue de la thorie, selon Chavannes, ne remonterait qu Tseou Yen
(IVe-IIIe sicles av. J.-C.). On peut prter Tseou Yen bien du gnie et toutes
sortes dinventions ; on ne le connat que par quelques lignes, soudes par
Sseu-ma Tsien la biogra phie de Mencius (
453
). Il en rsulte que Tseou Yen
avait fond Tsi une cole trs florissante (
454
). Il patronna, dit-on, lide que
les lments se succdent en se dtruisant les uns les autres. Si ctait bien l
la thorie premire, on pourrait conclure, comme a fait Chavannes, que les
lments sont de grandes forces naturelles qui se succdent en se
dtruisant (
455
).
Une remarque de Chavannes a plus de porte que cette hypothse. Il a
suppos que la thorie des Cinq lments (wou hing) expose par Tseou
Yen saccordait avec la thorie des Cinq Vertus ( wou t : cinq efficiences),
qui fleurit vers
253
la mme poque (
456
). Cette dernire a servi de cadre aux
politiciens qui ont utilis les traditions mythiques ou folkloriques pour
reconstituer lhistoire ancienne de la Chine. Ils dsiraient montrer que les
vnements, dans lordre historique comme dans lordre naturel, sont
commands par une succession de type cyclique : toute Vertu (t) puise doit
tre remplace par une autre Vertu dont cest le temps de rgner. Lide, sans
Marcel GRANET La pense chinoise 182
doute, ntait point nouvelle, la notion de Tao (ou de Tao-t), nous le
verrons, au moins ds quelle est utilise par les thoriciens de la d ivination,
implique le concept de succession cyclique, mais seulement la faon de la
prsenter. En insistant sur les ides de destruction et de triomphe, on tendait
justifier lesprit de conqute devenu trs puissant pendant la priode qui pr -
cda la fondation de lunit impriale (
457
).
On a peut-tre le droit de dclarer rcente la thorie des Cinq lments
quand on la relie la thorie, ainsi comprise, des Cinq Vertus (
458
). Mais il
faudrait ajouter (tel est lintrt du rapprochement) que les lments,
lorsquils caractrisent une Vertu dynastique, apparaissent comme des
Emblmes. Dire quils se succdent par voie de triomphe revient dire que,
pour dfinir sa Vertu emblmatique, une Dynastie doit choisir llment qui
soppose, sur la rose quadrangulaire, llment adopt par la Dynastie
vaincue. On devrait conclure, non que les lments sont des forces naturelles
mais quils valent en tant que Rubriques emblma tiques (
459
).
Est-ce bien avec lide dune succession assure par triomphe qua dbut
la thorie des Cinq lments ?
Les interprtes indignes saccordent admettre que lordre du
triomphe des lments drive de leur ordre de production. Ce dernier se
retrouve dans la disposition oriente attribue aux lments par le Hong fan.
Le trac du templum conduit placer lEau (1) au Nord, le Feu (2) au Sud, le
Bois (3) lEst, le Mtal (4) lOuest et la Terre (5) au Centre. Nous
avons vu que cet ordre rsulte de la formule de la gamme (10, 7, 9, 6, 8, (5)).
Pour tablir une quivalence entre les emblmes numriques des tubes qui se
produisent les uns les autres et les saisons qui se succdent,
254
elles aussi,
dans un ordre fixe et dont on peut dire quelles se produisent lune lautre, il
tait ncessaire dattribuer aux diffrents sites, partir dun point dtermin
de lhori zon (le Sud, par exemple), et dans lordre, les emblmes 7, 9, 6, 8.
Cet ordre impos rendait facile le rapprochement des Notes et des
Saisons-Orients, dune part, avec les l ments, dautre part cf.
mg_pc_figures : 22. Ces derniers, en effet, se distribuent en deux couples
(Eau-Feu, Bois-Mtal) forms chacun de termes antithtiques, et lattribution
dun site aux deux termes de lun de ces couples tait, par avance, indiqu. Le
Feu tend vers le Haut et le Haut vaut le Sud, cependant que le Feu peut
fort bien caractriser lt, saison chaude. LEau tend vers le Bas , et le
Bas est le Nord, cependant que lEau peut fort bien caractriser lHiver, qui
est une saison sans eau, parce que les Eaux disparaissent alors de la Terre
et se rejoignent dans les Bas-fonds septentrionaux
255
du Monde. Le Centre
convenait parfaitement la note initiale mise par ce tube-talon et, par suite,
cette mme note abaisse dune octave : on plaa donc au centre de la
croise le couple congruent 10-5. Si lon affectait au Sud 1a 2
e
note et le
couple congruent 7-2, lordre des Saisons et celui des Notes exigeait
laffectation au Nord du couple 6 -1. Si donc, on commenait par attribuer
llment Eau au Bas et au Nord -Hiver, lordre impos permettait daffecter
Marcel GRANET La pense chinoise 183
au Sud et au Haut llment antithtique Feu, prdispos tre assimil
lt. La 3
e
note, 9, et le couple 9-4 devaient ncessairement aller lOuest, et
lEst, la 5
e
note, 8, et le couple 8-3 : on devait, en consquence, rpartir entre
ces deux sites opposs la paire antithtique dlments forme par le Mtal et
le Bois. Le Bois pouvait, avec avantage, tre plac lEst et li au Printemps,
tandis quil tait facile dimaginer des raisons pour justifier la liaison
lAutomne et lOuest de llment Mtal (
460
)emblmes des Notes (7, 9, 6,
8) devenant respectivement les emblmes du Feu et du Sud-t, du Mtal et
de lOuest -Automne, de lEau et du Nord -Hiver, du Bois et de lEst -Printemps
et 10, [avec le nombre congruent 5] allant au Centre, 5 et les quatre petits
nombres des couples congruents (2, 4, 1, 3) pouvaient lgitimement indiquer
lordre des affectations symbolis par le trac du templum. La solidarit
nest pas douteuse des deux ordres dnumrations des lments : celui
quindique le Hong fan et qui obit au trac du templum, celui que suppose le
Yue ling, et qui est lordre dit de la succession des lments par
production .
Nous pourrions tirer parti du fait pour revendiquer une certaine antiquit
en faveur de la thorie de la succession des lments par production, et
ceci non pas parce que lordre dnumration suivi par le Hong fan (dont il est
toujours possible dabaisser la date) parat saccorder avec cette thorie. Cest,
tout au contraire, une anomalie quon peut retrouver dans cette dernire qui
suppose lantiquit de lordre suivi par le Hong fan. Bien quil soit facile de
dire que le Feu (t) produit le Mtal (Automne) quil liqufie, les Chinois
disent que le Feu produit la Terre et la Terre le Mtal. Ces mtaphores ne sont
pas entirement absurdes [les minerais se trouvent dans la Terre, et cette
dernire se
256
cultive aprs quon a mis le feu aux broussailles et rduit le
Bois en cendres : on peut dire ( la rigueur) que le Feu la produit]. Mais elles
supposent que lordre de succession des lments nest plus senti comme
strictement quivalent lordre de production des notes. Au lieu dtre place,
comme ce dernier ordre limposerait, entre le Bois (Printemps) et le Feu (t),
la Terre (Centre) est place entre le Feu et le Mtal. Cet ordre (Bois, Feu,
Terre, Mtal, Eau) sexplique par une rgle du Calendrier. Cest entre lt et
lAutomne que sinsre le mois idal (
461
) dont la dure de convention
correspond la station faite par le chef (pivot du Temps) au centre de la
Maison du Calendrier. Ce mois sans dure est une invention qui nest sans
doute pas trs rcente : elle implique une division de lanne groupant
ensemble lAutomne et lHiver, le Printemps et lt, comme si lanne tait
traverse par un axe N : E. - S : W. analogue laxe qui spare les trigrammes
mles et femelles dans la disposition de Fou-hi (
462
). Lusage, cependant,
correspond une innovation : la fin de lt et le dbut de lAutomne sont,
comme ce mois sans dure, vides de toute espce de ftes religieuses. Au
contraire, une station au centre (= Terre) de la Maison du Calendrier parat
beaucoup plus indique pour le Chef la fin du Printemps (= Bois). Cest
alors le moment dune srie de ftes, les plus importa ntes peut-tre de lanne,
et ces ftes impliquent une sorte de retraite, puisquon leur a conserv le nom
Marcel GRANET La pense chinoise 184
de ftes du manger froid (
463
). Elles comprenaient la crmonie du
transport des foyers en plein air : le feu, en hiver, avait t conserv
lintrieur de btisses en pis ou de demeures souter raines, et lon pouvait
bien dire, en inaugurant la Saison chaude : la Terre produit le Feu. Cest,
dailleurs, au moment o la sve monte et nourrit les plantes que le Chef,
comme on verra, doit rester immobile au Centre de lEspace, debout entre
Terre et Ciel. Si grande que puisse tre lantiquit de lordre de production
des lments qui se trouve la fois conforme lordre des Saisons et aux
rgles de la morphologie saisonnire des Chinois, nous ne rclamerons pour
lui, cependant, aucune primaut. Lordre du triomphe en est strictement
solidaire. Il rsulte de lopposition cardinale des lments Feu -Eau et
Bois-Mtal, opposition illustre et
257
respecte par la disposition en croise
qui rend manifeste, dautre part, lordre de production.
Certains Occidentaux admettent, la suite des interprtes chinois, que
lide de production et lide dopposition ou de triomphe sont galement
anciennes. Dautre part, ils accordent au Hong fan une certaine
antiquit (464). Mais, au lieu de conclure, comme le texte et la disposition du
Hong fan semblent y inviter, que les Cinq lments sont les Rubriques qui
prsident un certain systme de classification, ils professent qu il devait
ds lors y avoir plusieurs thories leur sujet. Ils prennent donc parti contre
lide de Chavannes et refusant de voir dans les lments des forces
naturelles, ils en font cinq substances relles (
465
). Linterprte qui emploie
cette expression reconnat cependant lauthenticit de deux passages
importants du Hong fan. Dans lun, chaque lment est dfini par une certaine
saveur [css05] ; on veut faire de cette saveur la proprit physique de la
substance relle quest llment correspo ndant ; le Feu, par exemple,
produit lamer . Lautre passage (
466
) est consacr aux Cinq Activits
(wou che) , qui produisent cinq sortes de Vertus. On estime que les
activits correspondent aux lments. Dira-t-on que ces Cinq Activits, le
Geste, la Parole, la Vue, lOue, la Volont, sont des substances (relles) ? et,
dans ce quelles produisent, verra -t-on leurs proprits morales ? Les
Cinq Saveurs figurent dans le systme de correspondances qua conserv le
Yue ling, et les Cinq Activits du Hong fan sont le premier tmoignage
dun grand systme de correspondances tablies entre le macrocosme et le
microcosme, dont nous aurons parler plus loin. Ne voit-on pas que les Cinq
lments sont les grandes Rubriques dun systme de correspondances, quil
ny a lieu de les traiter ni de substances, ni de forces, que ce sont, dabord, les
symboles des Cinq groupements de ralits emblmatiques rparties dans les
Cinq Secteurs de lUnivers ?
Dans lexpression wou king, le mot cinq (wou) a peut-tre plus de
signification que le mot hing traduit par lments .
Marcel GRANET La pense chinoise 185
Les wou hing sont toujours associs aux wou fang et
258
aux wou wei.
Les wou wei, ce sont les cinq positions cardinales et, dans le langage du Hi
tseu, les cinq positions marques chacune par un couple de nombres
congruents (
467
) Les wou fang, ce sont les cinq directions, ou plutt les cinq
secteurs forms par le Centre et les quatre Orients, quand on les envisage
disposs en querre, car fang signifie querre . Le Hong fan lui-mme
voque, quand il numre les lments, limage dune croise. Il faut donc
voir dans les Cinq lments les emblmes dune rpartition gnrale des
choses dans un Espace-Temps o le trac du templum dlimite quatre aires et
marque un centre.
On sait limportance de la classification par 5 et quelle est solidaire de la
classification par 6. Le Hong fan oppose aux Cinq Bonheurs les Six
Calamits [css07], et les Cinq lments eux-mmes sont parfois compts Six.
Il est question deux dans un chapitre du Chou king dont il ny a lieu
suspecter ni lauthenticit ni lanciennet. Ce chapitre contient le texte dune
harangue qui aurait t prononce avant une bataille par le fils de Yu le
Grand (
468
). Lennemi y est accus davoir mpris les Cinq lments ainsi
que les Trois Rgulateurs (
469
). Les glossateurs ne sont point dac cord quand il
sagit de dire ce qutaient les Trois Rgulateurs ; il semble bien que
lexpression appartient lart du Calendrier et quelle doit tre rapproche de
lexpression wou ki : celle-ci, dans le Hong fan (470), dsigne les Rgulateurs
de lanne. Il se pourrait que les Trois Rgulateurs se rapportent une
classification par 6, relie la classification par 5. Le principal intrt de la
harangue o il question des Cinq lments est dans le fait quelle fut rcite
dans un camp, et quelle sadressait aux Six Chefs et aux Six Lgions de
larme royale : cest en traant un templum que lon construit les camps ainsi
que les villes. Quand on dnombre les lments en les comptant Six, on
peut ddoubler llment Terre en lui substituant la Nourriture et la Boisson,
soit, tout simplement, laccoupler aux Crales (
471
) ; il y a, du reste, 5 ou 6
Crales, comme il y a 5 ou 6 Animaux domestiques ou encore 6 Animaux
domestiques et 5 Animaux sauvages. Fait significatif : tout au moins quand on
les compte Six, les lments sont assimils aux 6 Fou. Fou signifie
magasin .
259
On ne saurait mieux veiller lide de rpartition, de classi fication
concrtes.
Cest aussi lide dune rpartition et dune classification concrtes
quvoquent les notions de Yin et de Yang. Le Yin et le Yang sont les
emblmes de deux groupements opposs et alternants que caractrise leur
localisation dans lEspace -Temps. Une organisation de la socit fonde par
une double morphologie et le principe du roulement sest exprime dans cette
conception. Le Yin et le Yang peuvent tout aussi bien apparatre comme un
couple de forces alternantes que comme un groupe biparti de ralits
antagonistes : on ne peut les qualifier uniquement de forces ou de substances.
Il doit en tre de mme des lments. Utiliss comme des sous-rubriques
Marcel GRANET La pense chinoise 186
places sous la domination du Yin et du Yang, couple de
rubriques-matresses, ils peuvent ressembler tantt, sinon des forces, du
moins des principes actifs, et tantt, sinon des substances, du moins des
groupements de ralits agissantes. Lis aux Saisons, comme aux Orients, ils
alternent ou sopposent, se combat tent ou se succdent paisiblement. Les
thoriciens, cependant, qui ont spcul sur eux, les ont surtout envisags
comme des emblmes dynastiques ou des rubriques capables de spcifier un
certain ordre de lEspace -Temps. Que les lments soient le Bois, le Mtal, le
Feu, lEau et la Terre, ce st l, somme toute, fait secondaire et question de
nomenclature ou de mtaphores : lide -matresse de la conception (je
mabstiens de dire : thorie) est celle dun groupement en secteurs, non pas
simplement affronts, mais rattachs un centre. Les lments sont-ils des
forces ou sont-ils des substances ? Il ny a aucun intrt prendre parti dans
ce dbat scolastique. Lessentiel est de constater la disposition en croise des
lments.
Ce dispositif est fondamental, comme est fondamentale, dans la
conception du Yin et du Yang, limage de deux camps disposs de part et
dautre dune sorte daxe sacr.
A quoi se rattache le trac du templum ? Telle est la premire question.
Pourquoi les Chinois ont-ils qualifi de hing les emblmes des diffrents
Secteurs du Monde ? Tel est le deuxime point du problme. Il faut dcider si
lon a raison de traduire hing chemin par lment . On pourrait,
260
sans mconnatre la valeur du mot, car hing exprime les ides de se conduire
et dagir, wou hing par Cinq Agents . Cest cette traduction que lon
pense quand on traite les lments de forces naturelles. Quand on les traite de
substances, et quon se laisse dominer par le fait que la dnomi nation donne
chacun des lments parat voquer un aspect de la matire (eau, bois...), on
peut, plus valablement, conserver la traduction lments ; il conviendrait,
en ce cas, dexpliquer la fortune dun mot choisi pour expri mer une notion si
distante, premire vue, de son sens premier. Pour nous, qui relions la notion
dlments lide de cardo, si nous justifions notre interprtation, nous
aurons justifi, du mme coup, la traduction du mot hing par le terme qui a
dj servi rendre .
Tao signifie : Voie . Cest un mme groupe de faits qui va faire
apparatre les images dont les Chinois sont partis pour dsigner par deux mots
qui veillent lide de chemin les cinq rubriques cardinales et le grand
principe dordre et de classement.
*
* *
Les mots hing et tao appellent limage dune voi e suivre, dune direction
donner la conduite. Tao, en particulier, fait penser la conduite la plus
rgulire et la meilleure, celle du Sage ou du Souverain. Ces sens drivs ont
Marcel GRANET La pense chinoise 187
permis aux commentateurs de donner une interprtation purement morale
des fragments littraires imprgns de pense mythique. Certains de ces
fragments, o lon retrouve des formes potiques, demeurent trs instructifs.
Ils nous est parvenu quelques dbris dune geste versifie dont le hros est
Yu le Grand. Lun deux peu t aider comprendre les rapports des mots hing
et tao et les premire valeurs mtaphoriques de ces termes.
Il est question des travaux de Yu. A tout fondateur de Dynastie
incombe une uvre de dmiurge. Nul cependant ne fut jamais aussi qualifi
que Yu pour amnager le Monde. On sait que son pas tait ltalon des
261
mesures de longueur et quune tortue lui apporta, Image du Monde, les Neuf
Tcheou du Hong fan. Rappelons que tcheou suggre limage de sillons
tracs, quil signifie domaine et limites de terres et quenfin le mme vocable
peut dsigner les fiches divinatoires. La tortue ne sortit pas seule des Eaux
pour favoriser Yu le Grand. Si le Hros parvint vaincre le Dluge, ce fut
grce un Dragon qui sut ouvrir une voie aux Eaux en traant des dessins sur
le sol. Le mot tao, chemin , ne se distingue gure dun mot de
prononciation analogue qui signifie lui seul ouvrir la voie, mettre en
communication . Quand un Chef est, comme Yu, qualifi pour rgner, on dit
que le Ciel lui ouvre la Voie (kai Tao). On entend par l que le Ciel
lautorise restaurer les bons usages, et un Prince ou un Sage sastreint, en
effet, le plus souvent en voyageant, difier le Monde par sa Vertu. Mais, aux
temps mythiques, lorsque le Ciel lui ouvrait la Voie (Tao), un Hros devait,
dans un sens plus raliste du mot, difier lUnivers tout entier. Voici donc
comment Yu, en arpentant la Terre des Hommes, parvint lajuster sa vraie
mesure.
Tenant compte, nous dit-on, des saisons, il ouvrit (kai ) les 9 Provinces
(du Monde), fit communiquer les 9 Chemins (tao) endigua les 9 Marais, nivela
les 9 Montagnes (
472
) . Lorsquon dcrit le dtail de ces travaux, on se sert du
mot tao pour exprimer lide que Yu sut tracer leur chemin aux fleuves (
473
).
Le mme mot se retrouve au dbut dune des cription dtaille des Fleuves et
des Monts, veillant tout ensemble les ides de parcourir et de mettre en
ordre : Yu tao (parcourut et mit en ordre) les 9 Montagnes..., tao (parcourut et
mit en ordre) les 9 Cours deau (
474
). Quand le Hros eut fini damnager les
9 Provinces de faon que le Monde, dans les 4 directions, pt tre habit et
cultiv, il se trouva quil avait aussi mis dans un ordre parfait les Six Fou. On
sait que les Six Fou sont les Six Magasins [savoir : les Cinq lments (hing),
plus les Crales]. Yu, tout aussitt, distribua les terres (domaines) et les
noms de familles, puis il scria : Quon prenne pour guide (ma) Vertu (t) !
Quon ne scarte pas de mes Chemins (hing) ! (
475
).
On doit voir dans la formule employe par Yu une dclaration
davnement. Elle couronne le labeur mythique o la Vertu (t) du Hros sest
dpense tracer des Voies (tao). Sans doute le rapprochement quon y trouve
entre le
262
mot hing (si on ne suit pas la glose qui, comme de juste, lui prte
Marcel GRANET La pense chinoise 188
le sens moral de conduite ) et t (si on ne lui donne pas le sens moral de
Vertu et si on se rappelle quil est un quiva lent de tao) est-il significatif.
Peut-tre justifie-t-il lhypothse que le mot tao a commenc par voquer
limage dune circulation royale ayant pour fin de dlimiter, par un trac de
chemins (hing, tao), les lots de ralits (hritages, noms, emblmes, insignes)
qui devaient tre rpartis entre les fidles des Quatre Orients et auxquels les
Cinq lments furent prposs comme rubriques.
Cette hypothse permet de rattacher au sens premier du mot tao sa
signification de pouvoir rgulateur et dordre effic ace. Elle donne aussi le
moyen de comprendre la valeur des expressions Wang Tao et Tien Tao :
lOrdre (le Tao) Royal ou Cleste.
Cest en circulant sur Terre que le Souverain, imitant la marche du Soleil,
arrive se voir considr par le Ciel comme un Fils (
476
).
Telle est la tradition rituelle atteste par un pome ancien qui veut
expliquer le titre de Fils du Ciel et le principe du Pouvoir royal (
477
). Quand ils
veulent, leur tour, dfinir le Pouvoir royal, les Matres du Calendrier
dclarent que le Chef a pour rle dinstituer les Cinq lments et les Cinq
(catgories d) Officiers, de faon affecter aux hommes et aux divinits
(chen) des tches bien distinctes (
478
). En rpartissant les fonctions, en
classant les choses et les tres, le roi empche un mlange des activits
vulgaires et divines, un contact dsordonn du Ciel et de la Terre (
479
)
.
Le
contact entre la Terre et le Ciel ne peut sta blir de manire utile et faste que
par lintermdiaire du seul Souverain, matre unique du culte public. Celui -ci
fait le tour de lEmpire dans le sens du Soleil ( Tien tao), de manire ajuster,
comme les Orients aux Saisons, les Insignes des fidles aux Vertus
emblmatiques des quatre quartiers du Monde ; il prouve ainsi quil est
capable de faire rgner sur la Terre des Hommes (Tien hia) un Ordre
cleste (Tien Tao) : il mrite dtre appel Fils du Ciel ( Tien tseu), car il a
fait voir quil poss de la Voie cleste (Tien Tao). Il mrite dtre appel Roi -
suzerain (Wang) quand il a fait voir quil possde la Voie
263
royale (Wang
Tao) : pour cela, il doit prouver quil est lHomme Unique et la seule Voie par
laquelle le Ciel, les Hommes et la Terre peuvent communiquer.
Entre les deux thmes du Tien Tao et du Wang Tao, il ny a quune
diffrence daspect. Tous deux se rattachent la mme conception rituelle. Le
dveloppement de la posie pique et de la littrature politique en a fait sortir
lid e de Tien Tao, tandis que lide de Wang Tao demeurait plus proche de
lexpression lyrique quavaient dabord reue les faits rituels. En obligeant le
suzerain aller vrifier les insignes des feudataires aux quatre bouts de
lEmpire, de manire marque r les extrmits dune croise gigantesque, la
posie pique trouvait la matire dun rcit hroque o de nombreux mythes,
et, en particulier, celui du Monde sauv des Eaux, pouvaient tre incorpors.
Aux rcits de ces labeurs piques se sont souds, comme de juste, des
descriptions de gographie administrative : telle est lorigine de lune des
Marcel GRANET La pense chinoise 189
uvres les plus anciennes de la littrature savante, le fameux Tribut de Yu, o
des thmes administratifs senchevtrent des passages potiques (
480
).
Magnifi par la posie, le thme des randonnes impriales a conserv,
pendant des sicles, un entier prestige. Le fondateur de lEmpire chinois, Che
Houang-ti, et le grand souverain des Han, lEmpereur Wou, nont pas manqu
dentreprendr e de grands voyages ; tous deux ont voulu mettre de lordre dans
lEmpire, en construisant du Nord au Sud et de lEst dOuest une immense
croise de chemins (
481
). Le thme lyrique de la Voie royale a lui-mme
longtemps persist ; mais, dguis sous des formules mystiques, il se traduit
par lambition quont prouve de nombreux potentats de slever jusquaux
Cieux. Il est cependant possible de reconstituer les faits rituels que ce thme a
dabord traduits.
A la lgende pique des randonnes royales correspond une autre lgende,
plus proche de la vrit rituelle. Les Souverains expdient des dlgus aux
Quatre Ples ou bien, thme plus dramatique et pourtant plus rel, ils
expulsent Quatre Gnies malfaisants sur Quatre Montagnes cardinales, cepen-
dant quils reoivent comme des Htes les vassaux des Quatre Orients
conduits par leurs Chefs nomms : Quatre montagnes. Ils ouvrent, pour cela,
les quatre portes de leur
264
ville ou de leur camp. Ainsi se trouvent
inaugurs un rgne ou des Temps nouveaux (
482
). A cette lgende se relient les
traditions qui se rapportent au Ming tang. Le Ming tang nest pas seulement
la Maison du Calendrier o doivent sinaugurer toutes les priodes du Temps ;
il est aussi le lieu o les vassaux se forment en carr, tout comme ils le font
chaque rassemblement militaire, autour du tertre carr du Sol, chacun
portant les Insignes qui conviennent son Orient (483). Quon lui suppose
cinq salles ou quon lui en suppose neuf, le plan du Ming tang reproduit celui
des camps et des villes, et, par l mme, le plan du Monde et de ses Neuf
Provinces ; peu importe que ce plan donne lide dune croix simple ou dune
croix gamme : il suffit que le Suzerain circule dans la Maison du Calendrier
pour que cette croix soit mise en branle et qu sa suite le Soleil et les Saisons
suivent lOrdre ou la Voie clestes ( Tien Tao On a vu quil fut un temps
o les Chinois dessinrent, laide de nombres, la cr oix, simple ou gamme,
et qu la croise des nombres impairs se superposait la croise de nombres
pairs comme se superposaient, dans un instrument propre aux devins, une
planchette carre (Terre) et une planchette ronde (Ciel) que reliait un pivot.
Or, pour qualifier 11, synthse hirogamique des nombres centraux 5 et 6,
qui figurent la Terre et le Ciel, on disait que par ce nombre se constituait dans
sa perfection (tcheng) la Voie (Tao) du ciel et de la Terre (
484
).
La Voie Royale (Wang Tao) ne serait-elle pas laxe qui part du Centre du
Ming tang, le pivot autour duquel, gamme ou simple, tourne la croix lorsque
le roi, imitant le Soleil dans sa course, fait le tour de la Maison du Calendrier ?
on plutt, nest -ce pas lHo mme Unique, matre du Tao cleste et royal, qui
est cet axe et ce pivot ?
Marcel GRANET La pense chinoise 190
Le mot roi (wang) scrit avec un signe compos de trois traits
horizontaux figurant, disent les tymologistes, le Ciel, lHomme et la Terre,
quunit, en leur milieu, un trait ve rtical, car le rle du roi est dunir. Les
traditions conserves propos des symboles graphiques ne sont pas, en ce cas,
moins instructives que les traditions conserves propos des symboles
numriques. Pour clore lhiver, les
265
anciens Chinois clbraient une fte
qui servait soit rnover la Vertu du Chef, soit instaurer un Roi de
lAnne (
485
). Elle comprenait de nombreux jeux et de multiples preuves, car
un Chef doit prouver sa Vertu en triomphant dans les jeux publics. Il y avait
une preuve de beuverie : il fallait, aprs stre empli de boisson, savoir
encore se tenir droit. Il y avait des preuves sexuelles : les premiers Chefs, qui
semblent avoir port le titre de Grand Entremetteur , taient responsables
de la fcondit universelle, et, de tout temps, les Chinois ont pens que le
Soleil perd sa route (Tien tao) si le Roi ne couche pas, au bon moment, avec
la Reine. Il y avait sans doute une autre preuve de rsistance : le Chef,
patinant cloche-pied ou immobile comme une souche, attendait et
provoquait la monte de la sve (
486
). Il y avait, surtout, une preuve du mt de
cocagne. Ce mt tait dress au centre de cette Maison des Hommes qui fut le
prototype du Ming tang et qui tait une maison souterraine, car, parvenu au
fate du mt, on pouvait tter le Ciel, cest ainsi quon devient Fils du Ciel,
ou plutt la Cloche cleste, mais les ttons de la Cloche cleste (ce sont
les stalactites) sont suspendus aux plafonds des grottes. Cest en gagnant
lpreuve de lascension que le nouveau Fils du Ciel mritait, devenu le trait
dunion du Ciel et de la Terre, dimposer sa taille au gnomon, sa mesure au
tube-talon : il stait identifi la Voie Royale.
Les Chinois ont conserv quelque souvenir de cette ascension triomphale :
de tout temps, chez eux, les prtendants se sont appliqus rver quils
montaient au Ciel, ou mme quils le ttaient, et, du reste, accder au trne,
se dit monter au Fate (teng ki).
Or, la 5
e
Rubrique du Hong fan, cest la Rubrique cen trale [css08], et
lon sait que le Hong fan, quand la tortue lapporta Yu, tait un carr
magique centre 5, a pour emblme le Houang Ki ou le Wang Ki le
Fate Auguste ou Royal (
487
).
On traduit, dordinaire, ces termes par la plus haute [ki] (Perfection) du
Souverain [Wang ou Houang] . Pourtant une glose vnrable, que les
Chinois attribuent Kong Ngan -kouo, interprte cette expression par les
mots la grande Voie (Tao) Centrale . Toute glose, je le sais, est
266
suspecte, mme attribue Kong Ngan-kouo. Mais, par une heureuse chance,
un pome, apparemment ancien, a t incorpor au texte, tout justement, de la
5
e
Section du Hong fan ; ce pome fait songer la remarquable dclaration de
Yu, cite plus haut : Quon ne scarte pas de mes Chemins (hing) ! et il
est impossible de ne pas le comprendre comme une dclaration davnement.
Je le traduis mot mot :
Marcel GRANET La pense chinoise 191
Rien qui penche ! Rien qui oblique !
Suivez lquit ( Yi) Royale !
Nulle affection particulire !
Suivez le Tao Royal !
Nulle haine particulire !
Suivez le Chemin (lou) Royal !
Rien qui penche ! Rien de factieux !
Le Tao Royal, quil est large !
Rien de factieux ! Rien qui penche !
Le Tao Royal, quil est uni !
Rien qui se tourne vers larrire ! Rien qui sincline de ct !
Le Tao Royal est tout droit !
Unissez-vous celui qui possde le Ki !
Accourez prs de qui possde le Ki (488) !
Je ne garantis pas que ce soit l le texte de la proclamation lance aux
fidles, du fate du mt de cocagne, par lheureux gagnant de lpreuve royale.
Mais ce st un fait que celui qui possde le Tao Royal est aussi celui qui
possde le Ki et que Ki signifie fate et mme poutre fatire. Cest un fait
encore que le pote ne voit aucune diffrence ni entre le Ki et le Tao, ni entre
les ides de Tao, de Lou et de Yi. Comme tao et hing (lment), lou signifie
chemin , mais uniquement au sens matriel du mot ; le tao royal , quon
qualifie de large ou d uni , nvoque -t-il pas, lui aussi, une image
matrielle ? Quant Yi, lquit, cest une vertu, mais quon peut bien
rapprocher de tous ces termes concrets ; cest la vertu qui inspire le respect du
tien et du mien et qui doit prsider la distribution des sorts, noms ou rangs
(ming) et hritage (fen) (
489
). Or, quest -ce que le Houang ki, emblme de la 5
e
Section, centre du Hong fan ? cest par lui que se recueillent et se
distribuent les 5 Bonheurs ; si fou (distribuer du Bonheur) veut dire
distribuer des fiefs (
490
) ; dans les assembles fodales, le suzerain
recueille puis redistribue les 5 Insignes : le Wang ki ou le Tao Royal nest -il
pas
267
le principe quitable, quand on le prend au sens moral de la
rpartition des fiefs et des 5 Insignes entre les vassaux accourus des Quatre
Orients au Centre de la confdration ? Remarquons ici que les Pres du
Taosme imaginent le Tao sous laspect dune sorte de rpartiteur
responsable (cest par lui quun tre est on ne dit pas : dieu, table ou
cuvette, mais pe de prix ou pe vulgaire) (
491
) et que Tchouang tseu voit
dans le Tao le Ki de toutes choses : Tao, wou tche Ki (
492
) : le
rapprochement des deux termes est dautant plus remarquable quil termine un
passage o le Tao est considr tout ensemble comme le milieu et comme le
centre des quivalences et des contrastes, des attractions, des rpulsions, des
hirogamies alternantes qui constituent lvolution giratoire de lUnivers. Je
ne songe pas le nier : pour les interprtes (ou les auteurs) du Hong fan qui
ont song citer ce vieux pome, lide quil sagissait dexprimer tait bien
Marcel GRANET La pense chinoise 192
celle dune perfection toute morale, faite dimpar tialit, dlvation, de
rectitude : bref, de la perfection quimplique la positi on centrale dun Chef
plac au-dessus de toutes les factions, de tous les groupements particuliers.
Mais il reste expliquer tout ce lot de mtaphores et dire pourquoi les mots
choisis pour dsigner une Perfection centrale et complte sont tantt ki, poutre
fatire (
493
), tantt lou, chemin, ou bien tao, quon peut qualifier de large
et d uni . Pourquoi surtout toutes ces images qui semblent voquer le
spectacle dune station droite, celle que, pour lpreuve de beuv erie, on
imposait aux buveurs, ou la vision dun poteau dress ?
Quand les Chefs fondaient une Capitale et dterminaient la croise des
chemins par o leur viendraient les tributs des Quatre Orients, ils devaient
observer le jeu des ombres et des lumires (le Yin et le Yang) et planter un
gnomon (
494
). La mystique politique des Chinois a toujours maintenu le
principe que dans la Capitale dun souverain parfait, au midi de la mi -t, le
gnomon ne doit point donner dombre (
495
), Les mythes sont plus instructifs
encore. Au centre mme de lUnivers l o devrait tre la Capitale
parfaite, slve un Arbre merveilleux : il runit les Neuvimes Sources
aux Neuvimes Cieux, les Bas-Fonds du Monde son Fate. On lappelle le
Bois Dress (Kien-mou), et lon dit
268
qu midi rien de ce qui, auprs de
lui, se tient parfaitement droit, ne peut donner dombre. Rien non plus ny
donne dcho (
496
). Grce une synthse (qui est parfaite, car elle rsulte
dune hirogamie), tous les contrastes et toutes les alternances, tous les
attributs, tous les insignes se trouvent rsorbs dans lUnit centrale.
Les expressions Houang (ou Wang) Ki et Wang Tao ont pris ensemble une
valeur morale, et Tao, comme Ki, est entr dans la langue des Sages. Tous ces
termes voquent les ides de Perfection et de Vertu Royales ; mais Tao nest
devenu le symbole de lOrdre efficace quaprs avoir signal un complexe
dimages et de sentiments tout concrets. Si Tao (chemin) a pu prendre le sens
dEfficace, de Vertu, dAuto rit, tout en suggrant lide dun Ordre total
entirement conforme lordre cleste, cest que linauguration dun pou voir
princier saccompagnait dune rparti tion des choses de ce monde entre les
groupements assujettis un Chef nouveau qui partageait entre eux les
Secteurs de lUnivers. Afin de pouvoir procder cette rpartition, le Chef
devait se soumettre une preuve inaugurale. Avant daller distribuer les
Insignes en circulant sur terre la manire dun Soleil ( Tien Tao), il devait,
pour mriter le titre de Fils du Ciel et dHomme Unique, slever, tout droit et
confondu avec laxe du Monde, sur la Voie ( Wang Tao) par laquelle, des
instants sacrs, le Ciel et la Terre entrent en communion (
497
). Le Tao est
devenu lemblme dun Ordre souve rain aprs avoir, dabord, figur le pivot
mt ou gnomonautour duquel lombre tourne ainsi que la lumire.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 193
Si jai raison e t si tao (chemin, voie centrale, (gnomon)) et hing [chemin,
lment, ( )] sexpl i quent conj oi ntement partir de limage dun
pivot et dune circulation, on comprendra aisment la plus ancienne des
dfinitions savantes du Tao. Cest celle que donn e le Hi tseu et que nous
avons dj rencontre (
498
) : yi yin yi yang tche wei Tao : un (aspect) yin, un
(aspect) yang, cest l le Tao .
Nous savons maintenant quil faut entendre : tout yin,
269
tout yang,
cest l le Tao . Le Tao est un Total constitu par deux aspects qui sont, eux
aussi, totaux, car ils se substituent entirement (yi) lun lautre. Le Tao nest
point leur somme, mais le rgulateur (je ne dis pas : la loi) de leur alternance.
La dfinition du Hi tseu invite voir dans le Tao une Totalit, si je puis
dire, alternante et cyclique. La mme Totalit se retrouve dans chacune des
apparences, et tous les contrastes sont imagins sur le modle de lopposition
alternante de la lumire et de lombre. Au -dessus des catgories Yin et Yang,
le Tao joue le rle dune catgorie suprme qui est, tout ensemble, la catgorie
de Puissance, de Total et dOrdre. Comme le Yin et le Yang, le Tao est une
catgorie concrte ; il nest pas un Principe premier. Il prside rellement aux
jeux de tous les groupements de ralits agissantes, mais sans quon le
considre ni comme une substance, ni comme une force. Il joue le rle dun
Pouvoir rgulateur. Il ne cre point les tres : il les fait tre comme ils sont. Il
rgle le rythme des choses. Toute ralit est dfinie par sa position dans le
Temps et lEspace ; dans toute ralit est le Tao ; et le Tao est le rythme de
lEspace -Temps.
Dans les conceptions enregistres par le Hi tseu, la connaissance du Tao
se confond avec la science des occasions et des sites dont lart divinatoire
donne la cl. En apprenant discerner les situations propices dans chaque cas
particulier, cet art dveloppe le sens de lorganisation du Monde : il en fait
connatre les dtails et lensemble. Aussi est-il lapanage du Roi, du Prince
(Heou), de lHomme grand ( Ta jen), du gentilhomme (kiun tseu) (
499
). Rois,
Princes, Hommes grands, gentilshommes commandent aux gens de peu (siao
jen), aux petites gens, car la science divinatoire leur fait acqurir une Sagesse
indistincte de la Saintet : ce Savoir agissant, cest le Tao.
On possde le Tao, on peut ordonner le Temps et lEs pace, on sait, on
gouverne ds quon est initi au jeu des Emblmes divinatoires. Ces
emblmes, on la vu, puisent le rel. Lordre du Monde embrasse 11520
situations spcifiques dsignes par le mot wou, lequel sapplique tout la
fois aux choses et leurs emblmes (
500
). Les 384 lignes des Hexagrammes
voquent concrtement ou plutt
270
suscitent lensemble des ralits
apparentes dont elles sont la ralisation emblmatique. Chaque ligne connote,
elle seule, un lot de ces ralits : 24 ou 36, selon quelle est faible ou forte,
yin ou yang. Chaque ligne a donc la valeur dune rubrique emblmatique. En
elle-mme, cependant, elle nest, brise ou continue, que le symbole le plus
simple du Yin ou du Yang, du Pair ou de lImpair. Mais elle se trouve dfi nie
Marcel GRANET La pense chinoise 194
et singularise par la place quelle occupe dans un hexa gramme dtermin.
Cest donc leur seule situation dans len semble des emblmes qui spcifie les
attributs de chacune de ces catgories concrtes que sont les 192 lignes yang,
les 192 lignes yin. Ces attributs se rvlent lorsquon exa mine la place que la
ligne occupe dans lun des 64 hexagrammes. On procde cet examen soit en
considrant successivement les lignes voisines dun mme hexagramme, soit
en comparant deux lignes homologues de deux hexagrammes. On voit alors
un emblme se substituer un autre emblme, chose quon exprime en
disant : quand deux lignes, lune faible, lautre forte, changent leurs places, il
se produit (cheng) une substitution (pien houa) (
501
).
Ce passage dun symbole un autre, que lon considre comme une
substitution, est lindice, ou, plus exactement, est le signe actif, le signal,
dune mutation (yi) qui seffectue dans le cours rel des choses. a Des
productions alternantes (cheng cheng), voil ce que sont les mutations (
502
).
Cette formule vise faire entendre que chacune des apparences quon veut
voir se raliser est le produit (cheng) de lappa rence quelle doit elle -mme
produire (cheng). Lide savante de mutation repose sur des reprsentations
analogues celles que nous avons analyses propos de lalternance des
formes (animales) sous laction alterne des catgories Yin et Yang (
503
). Ce
ne sont point les choses qui changent : cest lEspace -Temps, et il leur
imprime son rythme. Le mot houa qui sert noter les alternances de formes
[et qui dsigne aussi les mutations relles opres par les mages (houa jen)]
figure dans lexpression pien houa qui sert exprimer la substitution dun
symbole divinatoire un autre symbole divinatoire. Le terme pien donne lui
seul lide dune transformation cyclique. Le Hi tseu lemploie pour expri mer
lalternance daspects dont une porte, faite pour
271
souvrir et se fermer,
peut veiller lide (
504
). Cest cette alter nance qui, pour les devins, constitue
le Tao.
Ainsi, dans la langue technique de la divination, le mot tao exprime la
rgle essentielle qui se retrouve au fond de toute mutation, mutation relle
comme mutation de symboles, car elle prside globalement lens emble
des mutations. Le Tao apparat, ds lors, comme le Principe dOrdre qui
prside la fois la production par voie dalternance des apparences
sensibles et la manipulation par voie de substitution des rubriques
emblmatiques qui signalent et suscitent les ralits. Il est tout ensemble (car
entre lordre technique, lordre rel, lordre logique, il ny a pas lieu de
distinguer) le Pouvoir de rgulation, quon obtient en mani pulant des
emblmes, le Savoir efficace qui prside aux substitutions de symboles,
lOrdre actif qui se ralise, par de perptuelles mutations, dans la totalit de
lUnivers. Ces mutations se font toujours, relles ou symboliques, sans
changement rel, sans mouvement, sans dpense. Les auteurs chinois insistent
sur le sens du mot yi (mutation), qui voque lide de facilit et exclut
celle de travail. Les ralits, les emblmes se mutent, et on les mute sans que
Marcel GRANET La pense chinoise 195
pour cela on ne dpense, et sans que pour cela il ne se dpense aucune espce
dnergie.
*
* *
La pense mythique, et, avec elle, les diffrentes techniques qui
semploient amnager le Monde, est pntre de la croyance que les
ralits sont suscites par les emblmes. Le travail de rflexion fourni par les
thoriciens de lart divinatoire a abouti, en lui donnant un tour systmatique,
renforcer cette disposition de lesprit chinois. Concevant le Tao comme un
principe dOrdre qui rgit indistinctement lactivit mentale et la vie du
Monde, on admet uniformment que les changements quon peut constater
dans le cours des choses sont identiques aux substitutions de symboles qui se
produisent dans le cours de la pense.
Cet axiome une fois admis, ni le principe de causalit, ni le principe de
contradiction ne pouvaient tre appels prendre le rle de principes
directeurs, ceci non point
272
parce que la pense chinoise se plat dans la
confusion, mais, tout au contraire, parce que lide dOrdre, lide dun Ordre
efficace et total, la domine, rsorbant en elle la notion de causalit et la notion
de genre. Quand on part des ides de mutation et de Vertu efficace, il ny a
aucune raison de concevoir une logique de lextension, ou une physique exp -
rimentale, et lon conserve lavantage de ne point sobliger, en imaginant des
paramtres, enlever au Temps et lEs pace leur caractre concret.
Lide de mutation te tout intrt philosophique un inventaire de la
nature o lon se proposerait de constituer des sries de faits en distinguant
des antcdents et des consquents.
Au lieu de constater des successions de phnomnes, les Chinois
enregistrent des alternances daspects. Si deux as pects leur apparaissent lis,
ce nest pas la faon dune cause et dun effet : ils leur semblent apparis
comme le sont lendroit et lenvers, ou, pour utiliser une m taphore consacre
ds le temps du Hi tseu, comme lcho et le son, ou, encore, lombre et la
lumire (
505
).
La conviction que le Tout et chacune des totalits qui le composent ont
une nature cyclique et se rsolvent en alternances, domine si bien la pense
que lide de succession est toujours prime par celle d interdpendance. On
ne verra donc aucun inconvnient aux explications rtrogrades. Tel seigneur
na pu, de son vivant, obtenir lhgmonie, car nous dit -on, aprs sa mort, on
lui a sacrifi des victimes humaines (
506
). Linsuccs politique et les
funrailles nfastes sont des aspects solidaires dune mme ralit qui est le
manque de Vertu du prince, ou plutt, ils en sont des signes quivalents.
Ce quon se plat enregistrer, ce ne sont pas des causes et des effets,
mais, lordre dapparition important peu, des mani festations conues comme
Marcel GRANET La pense chinoise 196
singulires, bien que greffes sur une mme racine. galement expressives,
elles paraissent substituables. Une rivire qui tarit, un mont qui scroule un
homme qui se change en femme,... annoncent la fin prochaine dune
dynastie (
507
). Ce sont l quatre aspects dun mme vnement : un ordre
prim disparat, faisant place un ordre nouveau. Tout mrite dtre not,
titre de signe
273
prcurseur ou comme confirmation dun signe (ou dune
srie de signes), mais rien ninvite rechercher une cause efficiente.
Quand on tablit un rapport, on ne pense jamais mesurer les termes mis
en relation. Ce ne sont pas des phnomnes que lon considre, et il ny a pas
considrer leur ordre de grandeur. Il ne sagit que de signaux pour lesquels
les valuations quantitatives de dimension ou de frquence importent peu. Les
plus utiles des signes prcurseurs, ce sont les plus singuliers, les plus tnus, les
plus rares, les plus furtifs. Un oiseau qui dtruit son nid (508) fournit lindice
(physique et moral) dun dtraquement de lEmpire dont la gravit est
extrme, puisque le sentiment de pit domestique fait dfaut, mme chez les
btes les plus humbles. Les moindres apparences mritent donc dtre
catalogues, et les plus tranges ont plus de prix que les plus normales. Le
catalogue na pas pour objet de faire dcouvrir des squences ; on le dresse
dans lintention de faire apparatre des solidarits. Au lieu de considrer le
cours des choses comme une suite de phnomnes susceptibles dtre
mesurs, puis mis en rapport, les Chinois ne voient dans les ralits sensibles
quune masse de si gnaux concrets. La charge de les rpertorier incombe, non
pas des physiciens, mais des annalistes : lHistoire tient lieu de
Physique-comme elle tient lieu de Morale (
509
).
Loin, donc, de chercher isoler les faits des conditions de temps et
despace, les Chinois ne les envisagent que comme des signes rvlant les
qualits propres tel Temps et tel Espace. Ils ne songent pas les enregistrer
en les rapportant un systme uniforme et immuable de repres. Ils cherchent
ne rien oublier de ce qui peut rvler leur valeur locale. Ils emploient pour
les noter des indications de temps, des pace, de mesure, qui conviennent une
re dfinie du monde, un secteur ou une rubrique dtermins (
510
). Ils
multiplient les systmes de classifications, puis ils multiplient les imbrications
de ces systmes. Ils vitent tout ce qui rendrait comparable et ne sattachent
qu ce qui parat substituable. Ils fuient ce qui, dans les indications de
mesure, conduirait mesurer par units abstraites. Les nombres leur servent
moins additionner des units gales entre elles qu figurer
274
concrtement, dcrire et situer, pour aboutir enfin suggrer la possibilit
de mutations que justifient lidentit ou lquivalence des emblmes
numriques. Le principe est didentifier en rapportant des rubriques, sans
abstraire ni gnraliser et plutt en singularisant, tout en rservant cependant,
grce aux polyvalences emblmatiques, de larges possibilits de substitutions.
Les solidarits concrtes importent infiniment plus que les rapports abstraits
de cause effet.
Marcel GRANET La pense chinoise 197
Le savoir consiste constituer des collections de singularits vocatrices.
Le jardin du Roi ou son parc de chasse doivent contenir toutes les curiosits
animales et vgtales de lunivers. Celles que nul prospecteur na su trouver y
figurent, tout de mme, rellement : sculptes ou dessines. Les collections
visent tre compltes, surtout en monstruosits, parce quon rassemble
moins pour connatre que pour pouvoir, et les collections les plus efficaces ne
sont pas faites de ralits, mais demblmes. Qui possde lemblme agit sur
la ralit. Le symbole tient lieu du rel. On se proccupe donc des ralits et
des faits, non pour remarquer des squences et des variations quantitatives,
mais pour possder et tenir disposition des rubriques emblmatiques et des
tables de rcurrences constitues en songeant uniquement aux
interdpendances de symboles.
Quand une apparence concrte parat appeler une autre apparence, les
Chinois pensent tre en prsence de deux signes cohrents qui svoquent par
un simple effet de rsonance (
511
) : ils tmoignent tous deux dun mme tat,
ou plutt dun mme aspect de lUnivers. Quand une apparence se mue en une
autre apparence, cette mutation vaut comme un signal auquel dautres signaux
doivent rpondre lunis son. Elle indique lavnement dune nouvelle
situation concrte, laquelle comporte un ensemble indfini de manifestations
cohrentes. Quant la manire dont sopre cette substitution, qui nest pas un
changement, on sait que toute mutation porte sur le Total et est, en soi, totale.
Il ny a aucune mesure commune chercher entre deux emblmes qui
tmoignent tous deux de deux aspects concrets de len semble du Monde. La
considration des causes secondes ne prsente pas dintrt : elle na pas
dapplications. Ce
275
qui rend compte de tout le dtail des apparences, ce
nest point un dtail de causes, cest le Tao.
Le Tao nest pa s lui-mme une cause premire. Il nest quun Total
efficace, un centre de responsabilit, ou, encore, un milieu responsable. Il
nest point crateur. Rien ne se cre dans le Monde, et le Monde na pas t
cr. Les hros qui ressemblent le plus des dmiurges se bornent amnager
lUnivers (
512
). Les souverains sont responsables de lOrdre du Monde, mais
ils nen sont point les auteurs. Quand ils ont de lEfficace, ils parviennent, sur
une aire et pendant une re dtermines dtermines en fonction de leur
Autorit, maintenir un Ordre de civilisation dont lOrdre des choses est
solidaire. Le Tao nest que la subli mation de cette Efficace et de cet Ordre.
Pour donner une rgle laction et pour rendre le monde intelligib le, point
nest besoin de distinguer des forces, des substances, des causes et de
sembarrasser des problmes quentranent les ides de matire, de
mouvement, de travail. Le sentiment de linterdpendance des ralits
emblmatiques et de leurs ralisations apparentes est suffisant en soi. Il invite
reconnatre des solidarits et des responsabilits. Il dispense de concevoir
une Cause, mais aussi de rechercher des causes.
Ces dispositions de leur pense nont pas empch les anciens Chinois de
faire preuve de grandes aptitudes mcaniques : la perfection de leurs arcs et de
Marcel GRANET La pense chinoise 198
leurs chars en tmoigne. Mais voici comme ils imaginent la marche dune
invention. Quand un de leurs philosophes veut expliquer linvention de la
roue, il affirme que lide en a t f ournie par les graines volantes qui
tourbillonnent dans les airs (
513
). Rebelle aux explications mcaniques, la
pense chinoise ne cherche pas sexercer dans un domaine qui serait celui du
mouvement et de la quantit. Elle se cantonne obstinment dans un monde
demblmes quelle ne veut pas distinguer de lUni vers rel.
Pour se renseigner sur lUnivers, il suffit de rpertorier des signaux. Mais,
si une ralit singulire correspond chaque emblme, chaque emblme
possde une puissance dvocation qui est indfinie. Il suscite, par une sorte
deffet direct, une foule de ralits et de symboles substituables.
276
Cette
vertu contagieuse des emblmes diffre radicalement dune participation des
ides. On nimagine point de limit es la convenance des divers symboles. On
ne voit, par suite, aucun avantage classer les ides ou les choses par genres
et par espces. Ne pouvant, ds lors, recevoir un sens relatif, le principe de
contradiction se trouve sans emploi. Au lieu de classer des concepts, on
sefforce dordonner les ralits, ou plutt les emblmes, qui paraissent plus
rels puisquon les estime plus efficaces, et lon sefforce de les ordonner,
en tenant compte de leur efficacit, dans un ordre hirarchique.
La distinction du Mme et de lAutre est prime par lanti thse de
lquivalent et de lOppos. Les ralits et les emblmes se suscitent par
simple rsonance quand ils sont quivalents ; ils se produisent rythmiquement
quand ils sont opposs. Le monde et lesprit ob issent simultanment une
rgle unique, qui parat, dabord, tenir en deux formules. Ce sont (non pas : le
semblable produit le semblable et le contraire sort du contraire, mais :)
lquivalent se range avec lquivalent et loppos rpond loppos. Ce s
deux formules, qui nimpliquent pas plus lide de genre que lide de cause,
expriment toutes deux un mme sentiment : chacune des apparences de
lUnivers ou des dmarches de la pense rsulte, comme lUnivers lui -mme,
de linter dpendance de deux aspects complmentaires.
Le Yin et le Yang ne sopposent pas la manire de ltre et du Non -tre,
ni mme la manire de deux Genres. Loin de concevoir une contradiction
entre deux aspects yin et yang, on admet quils se compltent et se parfont
(tcheng) lun lautre dans la ralit comme dans la pense. Dans la
multiplicit des apparences, les unes (celles qui peuvent se manifester
simultanment), lies par une solidarit simple et distante, sont quivalentes
(tong) et se contagionnent sans se confondre, les autres (celles qui contrastent
ensemble) sopposent, mais sont unies par une interdpendance communielle
que rend manifeste leur succession cyclique (cheng cheng). Les Chinois
peuvent viter de confier au principe de contradiction loffice dordon ner
lactivit mentale. Ils attribuent cette fonction au principe de lharmonie (ho :
union harmonique) des contrastes. LOrdre efficace qui rgit
277
la pense et
laction est fait de contrastes, mais exclut la possibilit de contraires tant au
sens absolu quau sens relatif. Il ny a pas lieu de constituer des genres et des
Marcel GRANET La pense chinoise 199
espces. LOrdre se ralise en constituant des groupements dem blmes ayant
valeur de rubriques actives. Toutes ces rubriques se relaient louvrage (les
divers lments faisant alterner leur rgne, aussi bien que le Yin et le Yang) :
les classifications les plus dtailles ne servent qu traduire un senti ment plus
complexe de lOrdre et une analyse (plus pousse sans devenir jamais
abstraite) des ralisations rythmiques de cet Ordre dans un Espace et un
Temps entirement composs de parties concrtes.
La reprsentation que les Chinois se font de lUnivers nest ni moniste, ni
dualiste, ni mme pluraliste. Elle sinspire de lide que le Tout se distribue en
groupements hirarchiss o il se retrouve entirement. Ces groupements ne
se distinguent que par la puissance de lEfficace qui leur est propre. Lis des
Espaces-Temps hirarchiss tout autant que singulariss, ils diffrent, si je
puis dire, par leur teneur, et plus encore, par leur tension : on voit en eux des
ralisations plus ou moins complexes, plus ou moins dilues, plus ou moins
concentres de lEfficace. Le Savoir a pour objet, premier et dernier, un plan
damnagement de lUnivers qui parat devoir se raliser gr ce une
distribution hirarchique de rubriques concrtes. De mme quils
sabstiennent de percer conceptuellement par genres et par espces, les
Chinois nont aucun got pour le syllogisme. Que vaudrait du reste, la
dduction syllogistique pour une pense qui se refuse priver lEspace et le
Temps de leur caractre concret ? Comment affirmer que Socrate, tant
homme, est mortel ? Dans les temps qui viendront et sur dautres espaces,
est-il sr que les hommes meurent ? On peut dire, en revanche : Confucius est
mort, donc je mourrai : il y a peu despoir que personne mrite un lot de vie
plus grand que le plus grand des Sages. La logique chinoise est une logique de
lordre ou, si lon veut, une logique de lEfficacit, une logique de la
Hirarchie. Le raisonnement prfr des Chinois a t compar au sorite (
514
),
mais, sauf chez quelques dialecticiens (
515
), et chez les premiers Taostes qui
cherchaient tirer de lide ancienne de Total la notion dIn fini
278
ou, tout
au moins, dIndfini (
5l6
), ce raisonnement ne se rsout pas en une chane de
conditions ; il tend rendre manifeste la circulation dun principe dOrdre
travers les ralisations diverses, plus ou moins parfaites, et, par suite,
hirarchisables, de cette Totalit qui doit se retrouver dans chacune de ses
manifestations (
517
). Se passant de raisonnements inductifs ou dductifs, les
Chinois sefforcent de mettre de lordre dans la pe nse de la mme manire
quils en introduisent dans le Monde, cest --dire dans la Socit. Ils donnent
leurs emblmes et leurs rubriques une disposition hirarchique par laquelle
sexprime lAutorit propre chacun deux.
Le principe de contradiction et le principe de causalit ne possdent ni lun
ni lautre lempire attribu aux rgles direc trices. La pense chinoise ne leur
dsobit pas systmatiquement ; elle nprouve pas non plus le besoin de leur
prter une dignit philosophique. Les Chinois sappliquent dis tinguer
comme ils sappliquent coordonner. Mais, plutt que disoler par abstraction
des genres et des causes, ils cherchent tablir une hirarchie des Efficacits
Marcel GRANET La pense chinoise 200
ou des Responsabilits. Les techniques du raisonnement et de
lexpr imentation ne leur semblent pas mriter autant de crdit que lart
denregistrer concrtement des signes et de rpertorier leurs rsonances. Ils ne
cherchent pas se reprsenter le rel en concevant des rapports et en analysant
des mcanismes. Ils partent de reprsentations complexes et conservent une
valeur concrte tous leurs emblmes, mme aux rubriques cardinales. Ces
emblmes et ces rubriques leur servent stimuler la mditation et veiller le
sens des responsabilits et des solidarits. En fin de compte, ils conoivent le
Monde comme sil tait rgl par un protocole et ils prtendent lamnager
la manire dun crmonial. Leur morale, leur physique, leur logique ne sont
que des aspects dun Savoir agissant qui est ltiquette.
Quand ils mditent sur le cours des choses, ils ne cherchent ni
dterminer le gnral, ni calculer le probable : ils sacharnent reprer le
furtif et le singulier. Mais, ce faisant, ils visent saisir les indices des
mutations qui affectent le total des apparences, car ils ne sattachent au dtail
279
que pour se pntrer du sentiment de lOrdre. Du fait quelle se meut
dans un monde demblmes et quelle attribue une pleine ralit aux symboles
et aux hirarchies de symboles, la pense chinoise se trouve oriente vers une
sorte de rationalisme conventionnel ou de scolastique. Mais, dautre part, elle
est anime dune passion dempirisme qui la prdispose une observation
minutieuse du concret et qui la sans doute conduite de fructueuses
remarques (518). Son plus grand mrite est de navoir jamais spar lhumain
du naturel et davoir toujours conu lhumain en pensant au social. Si lide de
Loi ne sest point dveloppe, et si, par suite, lobservation de la nature a t
abandonne lempirisme et lorganisation de la socit au rgime des
compromis, lide de Rgle, ou plutt la notion de Modles, en permettant aux
Chinois de conserver une conception souple et plastique de lOrdre, ne les a
point exposs imaginer au-dessus du monde humain un monde de ralits
transcendantes. Toute pntre dun sentiment concret de la nature, leur
Sagesse est rsolument humaniste.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 201
L I V R E T R O I S I M E
L E S Y S T M E
D U M O N D E
281
Les ides jointes dOrdre, de Total, dEfficace dominent la pense des
Chinois. Ils ne se sont pas soucis de distinguer des rgnes dans la Nature.
Toute ralit est en soi totale. Tout dans lUnivers est comme lUnivers. La
matire et lesprit nappa raissent point comme deux mondes qui sop posent.
On ne donne pas lHomme une place part en lui attribuant une me qui
serait dune autre essence que le corps. Les hommes ne lemportent en
noblesse sur les autres tres que dans la mesure o, possdant un rang dans la
socit, ils sont dignes de collaborer au maintien de lordre social, fondement
et modle de lordre universel. Seuls se distinguent de la foule des tres le
Chef, le Sage, lHonnte homme. Ces ides saccordent avec une
reprsentation du Monde, caractrise non par lanthropocentrisme, mais par
la prdominance de la notion dautorit sociale. Lamna gement de lUnivers
est leffet dune Vertu princire que les arts et les sciences doivent semployer
quiper. Une ordonnance protocolaire vaut pour la pense comme pour la
vie ; le rgne de ltiquette est universel. Tout lui est soumis dans lordre
physique et dans lordre moral, quon se refuse de distinguer en les opposant
comme un ordre dtermin et un ordre de libert. Les Chinois ne conoivent
pas lide de Loi. Aux choses comme aux hommes, ils ne proposent que des
Modles.
Marcel GRANET La pense chinoise 202
CHAPITRE Premier
Le macrocosme
283
Un fait signale la place privilgie que les Chinois donnent la
Politique. Pour eux, lhistoire du Monde ne commence pas avan t celle de la
Civilisation. Elle ne dbute pas par le rcit dune cration ou par des
spculations cosmologiques. Elle se confond, ds lorigine, avec la biographie
des Souverains. Les biographies des Hros antiques de la Chine contiennent
dassez nombreu x lments mythiques. Mais nul thme cosmogonique na pu
entrer dans la littrature sans avoir subi une transposition. Toutes les lgendes
prtendent rapporter des faits de lhistoire humaine. Une mme philo sophie
politique les inspire. Les tres et les choses existent et durent en raison de
lharmonie ( ho) institue par les saints auteurs de la civilisation nationale.
Cest leur Sagesse qui permet aux hommes et aux tres de se conformer leur
essence (wou) et de raliser pleinement leur destin (ming). Lharmonie
sociale, qui est due lascendant des Sages, entrane, avec la Grande Paix
(Tai ping ),un parfait quilibre du macrocosme, et cet quilibre se reflte
dans lorganisation de tous les microscosmes. La prdominance accorde aux
proccupations politiques (
519
) saccompagne, chez les Chinois, dune
rpulsion foncire pour toute thorie crationniste.
*
* *
Seules quelques mtaphores, jointes des dbris de lgendes, renseignent
sur lide que les anciens Chinois se fais aient de
284
lUnivers. Il y a peu de
chances que ces donnes folkloriques se rattachent un systme unique et
dfini de pense. Elles peuvent cependant faire entrevoir un fait essentiel : la
conception du monde physique est entirement commande par des
reprsentations sociales.
LUnivers, cest le char ou la maison du Chef.
On compare souvent le Monde un char ridelles recouvert par un dais.
Le dais est circulaire et figure le Ciel ; la Terre est reprsente par la caisse
carre qui supporte loccu pant du char. Mais il ne sagit pas dun char
quelconque. Quand on dit la Terre... cest le grand fond de char , on pense
la voiture de crmonie (
520
) o prend place lHomme Unique et, sans doute,
imagine-t-on le Fils du Ciel au moment o, pour remplir le premier devoir de
sa charge, il fait le tour de la Terre des hommes en suivant la route du Soleil.
Au Ciel, le Soleil parcourt sa carrire mont, lui aussi, sur un char.
Marcel GRANET La pense chinoise 203
Le Chef de char se tient, tout lavant de la voitur e, sous la bordure du
dais. Le mot (hien) qui dsigne cette place sert aussi nommer lendroit de la
salle de rception o, quand il tient sa cour, doit se placer le Matre. Quand on
dit : la Terre porte et le Ciel couvre (
521
), on nvoque pas moins la maison
que le char. Ldifice o le suzerain reoit les feudataires, carr la base,
doit tre recouvert par un toit circulaire. Cest sous le pourtour de ce toit que
le Fils du Ciel se poste quand il promulgue les ordonnances mensuelles qui
ajustent les temps aux espaces.
Le toit du Ming tang et le dais du char sont relis par des colonnes leur
support carr. Des colonnes, quon nomme les piliers du Ciel, sont bien
connues des gographes qui en savent le nombre et lemplacement. Elles sont
en rapport avec les Huit Directions, les Huit Montagnes et les Huit Portes qui
livrent passage aux Nues pluvieuses et aux Huit Vents (522). Relis par
lintermdiaire des Huit Vents aux Huit Trigrammes que lo n dispose en
octogone, les Huit Piliers rattachent le primtre de la terre au pourtour cir-
culaire du Ciel.
Larchitecture du Monde fut dabord imagine plus simplement. On ne
comptait que quatre colonnes, et lon ne connaissait que quatre Montagnes
cardinales. Quatre
285
Montagnes est le nom des chefs que le Suzerain
chargeait dassurer la paix dans les Quatre Directions et quil recevait en
ouvrant les Quatre Portes de sa rsidence (
523
), Les Montagnes ont dans la
nature un rle analogue celui des Chefs dans la socit. Elles assurent la
stabilit de lUnivers. Mythiquement, il ny a point de diffrence entre la lutte
engage par un usurpateur contre le souverain lgitime et lattaque mene
contre une montagne par un gnie mauvais quon se reprsente sous laspect
dun Vent soufflant en tempte et faisant choir le toit des maisons (
524
).
Le seul pilier du monde qui soit clbre est un mont, le Pou-tcheou, au
nord-ouest du Monde ; l se trouve la Porte qui conduit la Rsidence
Sombre ; par elle souffle un vent quon nomme aussi Pou -tcheou (525). Au
cours de la bataille quil engagea contre le Souverain Tchouan -hiu,
Kong-kong, gnie du Vent, qui la Rsidence Sombre sert de retraite, russit
branler le Pou-tcheou. Un dluge suivit. Le monde nest en ordre que
lorsquil est clos la manire dune demeure (
526
).
Jadis, lorsque Niu-koua entreprit damnager lUnivers, les Quatre
Ples taient renverss, les Neuf Provinces fissures, le Ciel ne couvrait point
partout, la Terre ne supportait pas tout le pourtour (pou-tcheou), le Feu
incendiait sans steindre jamais, les Eaux inondaient sans jamais sapaiser,
les Btes froces dvoraient les hommes valides, les Oiseaux de proie
enlevaient les dbiles. Niu-koua, alors, fondit les pierres de cinq couleurs pour
rparer le Ciel azur ; elle coupa les pieds de la Tortue pour dresser les Quatre
Ples ; elle tua le Dragon noir pour mettre en ordre le pays de Ki ; elle entassa
de la cendre de roseau pour arrter les Eaux licencieuses. Le Ciel fut rpar,
les Quatre Ples se dressrent, les Eaux licencieuses furent assches, le pays
Marcel GRANET La pense chinoise 204
de Ki fut mis en quilibre (ping), les btes froces prirent, les hommes
valides subsistrent, la Terre carre porta sur son dos, le Ciel rond tint
embrass , et lUnion (ho) se fit entre le Yin et le Yang (
527
).
Jadis aussi, montant et descendant, les Iles des Bienheureux flottaient au
gr des mares ; on ne pouvait sy tenir immobile. Elles ne devinrent stables
que le jour o, sur lordre dun gnie de la mer, des tortues gantes les
286
prirent sur leur dos (
528
). Les Chinois ont longtemps pens quils pouvaient
procurer au sol la stabilit en sculptant des tortues de pierre et en leur faisant
supporter une lourde stle. Montagnes ou piliers, les colonnes qui relient la
Terre et le Ciel donnent la solidit cette architecture quest lUnivers.
Cependant, depuis la rvolte de Kong-kong, lquilibre nen est plus
parfait. Ce monstre cornu, se lanant sur le mont Pou-tcheou, lbrcha dun
coup de corne ; il brisa le pilier du Ciel et rompit lamarre ( wei ; les Huit
Amarres pa wei, correspondent au pa ki, aux Huit Ples, aux Huit Directions)
de la Terre . Aussi le Ciel bascula-t-il, sincli nant vers le Nord-Ouest, si bien
que le Soleil, la Lune et les Constellations durent sacheminer vers le
Couchant, tandis que, sur la Terre, qui, basculant en sens inverse, cessa dtre
comble vers le Sud-Est, tous les cours deaux prirent la direction de ce coin
bant de lespace.
On raconte dune autre manire les mfaits de Kong-kong : cest lui,
dit-on, ou bien Tche -yeou, autre gnie du Vent, autre Monstre cornu, qui
dchana le dbordement des Eaux, en attaquant Kong-sang (
529
). Ces mythes
se rapportent une reprsentation lgrement diffrente de lUnivers.
Kong-sang, le Mrier creux, qui soppose Kong -tong, le Paulownia creux,
est, comme ce dernier, la fois un arbre creux et une montagne : tous deux
servent dabri aux Soleils et de demeure aux Souverains (
530
). Dautres arbres
encore se dressaient comme des piliers clestes : au Levant, le Pan -mou, un
immense pcher situ prs de la Porte des Gnies (
531
) ; au Couchant,
larbre Jo, sur lequel, comme sur le Mrier creux, mais l e soir, les Dix Soleils
viennent se percher (
532
); au centre, le Kien-mou (le Bois dress), par lequel
les Souverains (on ne dit pas, en ce cas, les Soleils) montent et
descendent (
533
).
Les Chinois racontaient volontiers que leurs anctres avaient commenc
par nicher sur des arbres ou par gter dans des cavernes. La plupart des
lgendes voquent lide dune construction colonnes, mais quelques traits
mythiques montrent que le Ciel est conu comme la vote dune grotte.
Dans leurs rves dapothose, les Souverains, quand ils slvent jusquaux
Cieux, sen viennent lcher les ttons de la
287
Cloche cleste, cest --dire les
stalactites qui pendent du toit des cavernes (
534
).
Humble tout dab ord comme la demeure des premiers chefs, le Monde a
grandi, linverse de ce pays des Gants qui diminua dtendue lorsque la
taille de ses habitants fut devenue plus petite (
535
). On le croyait encore au
temps des Han : comme tous les corps que le souffle (ki ) emplit, la Terre et le
Marcel GRANET La pense chinoise 205
Ciel ont progressivement augment de volume. La distance entre eux sest
accrue (
536
). Ils se tenaient jadis, quand les Esprits et les Hommes vivaient en
promiscuit, si troitement rapprochs (la Terre offrant au Ciel son dos et le
Ciel la tenant embrasse) quon pouvait montant et descendant passer
chaque instant de lune lautre. Tchong -li, coupant la
communication (
537
), mit fin ces commencements scandaleux de lUnivers.
*
* *
Tchong-li est un hros solaire, promu, par la grce de lHistoire, au rang
dastronome. Les Chinois ne semblent pas stre jamais soucis de tirer de
leurs mythes une cosmogonie systmatique. Leurs astronomes, en revanche,
ont emprunt aux lgendes anciennes lessentiel de leurs thories.
Tout au moins, ds le IVe sicle avant notre re, il y a eu en Chine de
nombreux savants que lastrologie passionnait : ils sappliqurent dresser
des catalogues de constellations et noter les mouvements des astres. Ils
furent amens, au moins, semble-t-il, ds le IIIe sicle avant Jsus-Christ,
prsenter diverses descriptions du Monde. Leurs spculations ne nous sont
connues que par de brves allusions littraires ou par des rsums assez
rcents (
538
). Elles se rattachent de trs prs aux traditions mythiques.
Au temps des seconds Han (539), on attribuait ces spculations trois
coles distinctes. Lune delles, la plus sotrique peut -tre, tait dlaisse
sinon oublie : ses partisans admettaient, dit-on, que le Soleil, la Lune et tous
les astres flottaient librement dans lEspace, le Ciel ntant pas un corps
solide (
540
).Daprs les deux autres systmes, les astres adh rent au Ciel ; cest
sur sa surface rsistante quils ont leurs
288
routes : ils se dplacent tout en
tant emports par le Ciel dans son mouvement circulaire.
La Terre et le Ciel sont spars par de vastes tendues. Les savants avaient
calcul, laide, disaient -ils, du gnomon, les dimensions du monde. 357 000
li, telle est, selon les uns, la mesure du diamtre de lorbite solaire, et selon les
autres celle du diamtre de la sphre cleste, la distance entre deux points
opposs du pourtour de la Terre tant de 36 000 li (
541
). 357 et 360 sont, on la
vu propos des tubes musicaux, des nombres prestigieux ; multiples de 7 ou
de 5, ils peuvent voquer le rapport 3/2 ou du rond et du carr. Les di-
mensions indiques par les savants nont pas dautre intrt que leur grandeur.
LUnivers, dont ils veulent faire sentir limmensit, continue de ressembler
au monde cr par limagination mythique.
Les partisans de lcole du houen tien prtent au Ciel la forme dune
sphre ou plutt celle dun uf (
542
). Cette conception se rattache au thme
mythique dont la lgende de Pan-kou est sortie ainsi que divers rcits de
naissances miraculeuses (
543
). Plusieurs hros fondateurs sont ns dun uf
parfois couv dans une tour qui a neuf tages et qui figure le Ciel. Au reste,
Marcel GRANET La pense chinoise 206
pour dire le Ciel couvre , on emploie toujours un mot dont le sens exact est
couver . Entirement enveloppe par la Coque cleste, la Terre, tel un
jaune duf, repose sur une masse liquide. Elle flotte, monte, descend,
sap proche ou sloigne successivement du znith et des quatre points
cardinaux, cependant que le Ciel, tournant sur lui-mme la faon dune roue,
entrane chaque soir le Soleil au-dessous de lhorizon terrestre. Lalternance
du jour et de la nuit sexpliqu e par ce mouvement du Ciel ; les mouvements de
balancement de la Terre rendent compte de lal ternance et de la varit des
saisons. De plus, puisque le Ciel est ovode et que le Soleil ne le quitte point
dans sa marche, il est clair que cet astre se trouve plus prs de la Terre le
matin comme le soir et plus loin delle au moment o il arrive au plus haut de
sa course : aussi est-ce au plein midi quil parat tre plus petit, ses dimensions
apparentes (mais non pas son clat) diminuant avec lloignement (
544
).
Lautre systme, sans doute plus ancien, compare le Ciel un dais ( tien
kai) mobile qui recouvre la Terre. Celle-ci se
289
tient au-dessous, sans
bouger, dans la position dun bol renvers (
545
). La surface terrestre ne forme
point un dme parallle la cloche cleste qui le recouvre. La Terre a la forme
dun chiquier, cest --dire dune pyramide qua drangulaire tronque (
546
). Le
sommet (la Terre habite) est plat et se trouve juste au-dessous du fate du
dais, l o demeurent la Grande Ourse et les constellations du Palais central
du Ciel. Les Eaux glissent sur les quatre faces de la pyramide ; elles vont
former tout autour de la Terre habite les Quatre Mers : dans ce systme,
comme dans lautre, leau emplit les bas -fonds du monde. Laspect prt la
Terre par lcole du dais cleste ne diffre pas de limage quoffrait le tertre
carr et entour deau sur lequel on sacri fiait au sol : lorsque les sacrifices
taient russis, des vapeurs venaient former un dais au-dessus de
lautel (
547
).La varit des saisons sexplique, dans le systme du tien kai, par
le fait que le Soleil chemine sur le couvercle cleste en empruntant des routes
diffrentes qui lloignent ou le rapprochent (du centre) de la Terre (
548
). Si la
nuit succde au jour, cest que, emport par le dais dans sa rotation, le Soleil
scarte successivement des quatre cts de la Terre, y devenant tout tour
invisible par suite de son loignement (
549
).
Certains imaginaient que le dais cleste sinclinait vers le Nord, si bien
que le Soleil vers le soir passait au-dessous de lhorizon (
550
). Cette
explication se rattache la lgende de Kong-kong : le Ciel sest inclin vers le
Nord-Ouest depuis que ce monstre a bris le mont Pou-tcheou. Wang Tchong
a conserv une variante significative de la thorie. Le Ciel vers le Nord plonge
dans la Terre, si bien que le Soleil, dans toute la partie septentrionale de sa
route, doit cheminer souterrainement (
551
). Cette opinion fait penser la Porte
qui souvrait aux abords du mont Pou -tcheou et qui conduisait la Rsidence
Sombre.
Lide que le Soleil cesse dclairer quand il pntre dans le domaine de
lombre se retrouve dans la thorie des clipses. Celles -ci (qui peuvent
commencer par le centre de lastre tout aussi bien que par ses bords) ne
Marcel GRANET La pense chinoise 207
diffrent pas en nature de certains voilements (po) que lon peut constater
nimporte quel moment du mois. Les clipses proprement
290
dites se
produisent soit le premier, soit le dernier jour de la lunaison : lObscurit
(houei) lemporte alors, si bien que la Lune perd son clat pendant cette
priode. Le Soleil, qui sunit (kiao) alors elle, subit lui-mme linfluence du
principe sombre (Yin) : il peut en ce cas s clipser (
552
). La Lune, qui, par
essence, dpend du principe Yin, est sujette des clipses plus frquentes : on
peut en observer aux diffrents moments de la lunaison. Lieou Hiang (
553
)
crivait cependant (au 1
er
sicle avant J : C.) que le Soleil sclipsait lorsque la
Lune venait le cacher, et Wang Tchong (554), qui nignorait pas cette
opinion, affirmait quil sagissait l dun phnomne rgulier. Ces thses nont
pas empch de conserver, titre de dogme, lide ancienne que les clipses
sont provoques par la conduite drgle des souverains et de leurs
femmes (
555
).
Les cosmographes chinois ont mis profit les progrs faits par
lastronomie lpoque des Royaumes Combat tants (
556
). Ces progrs sont
dus aux astrologues qui piaient, pour le compte de princes ambitieux, les
vnements clestes. La liaison de ces vnements et des faits de lhistoire
humaine tait le principe de toute observation. Si les savants ont t conduits
prter lUn ivers de vastes proportions, ils nont pas cess de concevoir le
Monde daprs le modle cr par limagination mythique. Leurs
connaissances saccroissent dans le dtail sans que la tentation leur vienne de
rechercher des explications dordre proprement p hysique. Ceux qui refusent
dadmettre que, vers le Nord, la Terre et le Dais cleste se compntrent, ne
font valoir aucune considration tire des ides de mouvement de rsistance,
dimpntrabi lit... Ils ne voient aucune difficult accepter (bien mieux, ils
utilisent dans la discussion) le mythe de lunion du Ciel et de la Terre (
557
).
Les savants nont gure modifi la reprsentation que les Chinois se faisaient
de lUnivers. Les architectes et les potes lont enrichie bien plus queux.
*
* *
A lpoque des Royaumes combattants (Ve -IIIe sicles av. J.-C.), les
potentats fodaux jouaient qui possderait les demeures les plus vastes, les
donjons les plus levs,
291
les caves les plus profondes. Leur cour tait
remplie non seulement dastrologue s, mais de mages et de potes, ding -
nieurs et de baladins (
558
), de pourvoyeurs de lgendes et de pourvoyeurs de
curiosits. Grce tous ces concours, la vision du Monde sest largie,
lUnivers sest peupl, cepen dant que les palais sexhaussaient et
slargissaient et que la cour, les parcs, les viviers, les jardins se garnissaient
de merveilles. Tandis que les Neuf Plaines du Ciel (kieou ye) correspondaient
aux Neuf Provinces de la Chine, la Terre et le Ciel, saccroissant en
profondeur, stageaient sur Neuf Gradins (
559
). Tout en bas taient les
Marcel GRANET La pense chinoise 208
Neuvimes Sources, tout en haut les Neuvimes Cieux. Et, en effet, tageant
jusqu neuf leurs caves et leurs terrasses, les Tyrans prten daient atteindre les
Sources souterraines tout aussi bien que les Hautes rgions o dans les nues
se cache le Feu cleste. Du fin fond du monde jusqu son fate suprme
(Houang ki), le palais semblait se confondre avec laxe de 1Univers.
Mme quand il a pris des formes magnifiques, on retrouve dans lUnivers
la trace de ses humbles commencements. Au centre des plus pauvres maisons
devait souvrir un pui sard plac sous une ouverture laisse au sommet du
toit (
560
). Les eaux entraient en terre par ce puisard et, par le trou du toit, la
fume du foyer rejoignait au ciel les nuages porteurs de feu. De mme, dans
les bas-fonds du Monde se creuse un vaste cloaque, tandis quau plus haut des
cieux souvre la fente dont les clairs schappent (
561
). Le cloaque est gard
par un monstre anthropophage, le Ya-yu : Yi lArcher tira sur lui des flches
meurtrires, mritant ainsi de devenir le gnie du centre de la maison et le
Matre du destin (Sseu-ming) (
562
). Le Monde souterrain des Eaux est en effet
le Pays des morts. Les libations y arrivent quand on les verse sur le sol en
terre battue des maisons. Les Sources jaunes furent dabord imagines
toutes proches des rsidences humaines. Ds quon creusait un peu la terre et
quon dcou vrait leau, l e monde des morts sentrouvrait (
563
). Les esprits sen
chappaient aussitt que, surtout en hiver, le sol dessch se fendillait :
revenus sur terre, on les entendait gmir.
Les Sources jaunes, dans le Monde agrandi, se sont trouves relgues tout
au fond du Septentrion : on avait cess
292
denterrer les morts dans les
maisons, et cest au nord des villes qutaient placs les cimetires. Cest un
peu louest du plein Nord ( lorient qui correspond au dbut de la sai son
dhiver) que se creuse (on situe parfois au Nord -Ouest limpluv ium des
maisons) (
564
) labme par o les Eaux venues des Quatre Orients disparaissent
lintrieur de la Terre (
565
). Un monstre quon appelle parfois le Seigneur de
la Terre (Tou-po) habite ces rgions, o il garde une Porte en senroulant neuf
fois sur lui-mme (
566
). On voit souvent en lui un vassal de Kong-kong ; cest
un serpent neuf ttes : les neuf ttes dvorent les Neuf Montagnes et le
monstre rpand linfection en vomissant des marcages (
567
). Au-dessus de
labme qui be, stagent les Neuf Portes des Cieux gardes par des loups et
par un tre neuf ttes capable darracher les arbres par neuf mille. Ceux qui
veulent passer ces portes, saisis et suspendus la tte en bas, sont prcipits
dans le gouffre (
568
). Rares sont les Hros qui peuvent en imposer au Portier
du Souverain cleste. Mais les Saints, dment entrans aux pratiques
mystiques, entrent tout droit dans le Monde dEn -haut. Ils y pntrent par la
fente ouverte au plus haut des cieux sans que les clairs qui en jaillirent les
fassent retomber (
569
).
Plus frquemment visit, lintrieur du Ciel est un peu mieux connu que
celui de la Terre. Le Souverain dEn -haut (Chang-ti) y tient sa cour (
570
). Il y
possde des palais, des arsenaux, des harems. Leurs noms se retrouvent sur
terre : ce sont ceux que les chefs donnent aux difices de leur capitale (
571
). A
Marcel GRANET La pense chinoise 209
ceux quil admet auprs de lui, le Souverain dEn -haut fait entendre
dad mirable musique (
572
). On change des cadeaux avec lui. Quand on lui
offre un lot de belles femmes, il remercie en confrant la proprit dun
hymne divin (
573
). On peut tre convi par lui une chasse aux ours (
574
), car il
possde des parcs tout comme des viviers, et lon peut tirer larc dans le Ciel
comme en ce bas monde. Ny voit -on pas Hi-ho, la Mre des Soleils, qui,
monte sur son char, poursuit coups de flcher le Chien cleste (Tien -
lang) (
575
) ? Les joutes des habitants du Ciel (ils ont conserv leurs blasons
bien mieux que les humains) apparaissent comme des combats danimaux.
Corbeaux trois pattes, les Soleils sclipsent quand il y a une joute de Ki -lin
(licornes) ou que le
293
Ki-lin veut les dvorer (
576
). De mme Tchang-ngo, la
Lune, est un crapaud quun crapaud dvore et fait clipser, tandis que la mort
du King-yu (la Baleine ?) fait apparatre les Comtes et que les hurlements du
Tigre dchanent le Vent printanier (
577
).
Ce nest pas pourtant dans le Ci el, cest dans les rgions recules de
lEspace que les divinits ont leur repaires et prennent, dordinaire, part des
joutes. Les dieux y subissent lattaque des hros qui ont pour mission de les
rduire au devoir. Le Seigneur des Vents (Fong-po) demeure ligot sur le
Tertre Vert, tandis que le Seigneur du Fleuve (Ho-po) se cache dans le gouffre
de Yang-yu (
578
), Blesss, lun lil gauche et lautre au genou, ils furent
compts par lArcher qui tua le Ya -yu dans son cloaque et massacra, sur les
branches de leur Mrier, neuf Soleils indisciplins (
579
). Cest ainsi
quobissant un sage Souverain il vacua hors du monde habit tout ce qui
pouvait porter tort aux hommes. Dans un monde bien amnag, seuls les coins
perdus que le dais du Ciel ne recouvre pas (
580
) sont les endroits o on laisse
subsister vaguement les tres qui ont une nature monstrueuse ou divine.
Dans langle nord -est du monde, au pays de Fou-lao, vit misrablement, se
nourrissant de crudits, fruits et racines, un peuple de brutes qui ignore le
sommeil : il sagite inlassa blement sur un sol brl quclairent sans trve le
Soleil et la Lune(
581
). Jadis, dans ces parages, flottait sur la mer une sorte de
buf, corps vert et patte unique. On le nommait Kouei. Quand il entrait
dans leau et quil en sortait, pro duisant le vent et la pluie, il faisait entendre le
bruit du Tonnerre. Houang-ti vint prendre sa peau et eut lide de la battre
avec un os enlev la Bte du Tonnerre. Grce ce tambour, il inspira
lEmpire entier une crainte respec tueuse (
582
). Plus sage encore que Houang-ti
et dployant le gnie civilisateur qui signale les vrais Souverains, Yao
emmena Kouei sa cour pour en faire un matre de danse : il conduisit, en
frappant sur des pierres sonores, les ballets que dansaient les Cent Animaux,
enfin domestiqus (
583
).
Au sud-est stale le Ta -ho, labme, immense et sans fond, o se dverse,
avec tous les fleuves terrestres, la Voie lacte, Rivire du Ciel (
584
). La Mre
des Soleils et la Mre des
294
Lunes trouvent dans ces rgions leau qui,
chaque jour, sert laver leurs enfants, tels des nouveau-ns, avant quils ne se
montrent dans le Ciel (
585
).
Marcel GRANET La pense chinoise 210
Dans langle sud -ouest est le pays de Kou-mang, o le Yin et le Yang
nunissent point leur souffle et o nalternent pas la chaleur et le froid, la nuit
et le jour. Le Soleil et la Lune ny rpandent point leur clat. Les pauvres
hres qui y vivent, sans manger ni se vtir, dans une somnolence continuelle,
sveille nt peine une fois tous les cinquante jours(
586
).
Pire encore est le coin nord-ouest. Cest la contre des Neuf Obscurits
quillumine le Dragon -Flambeau. Grand de mille li, il se dresse tout rouge et
les yeux fixes. Sil ouvre les yeux, cest le jour. Sil les ferme, cest la nuit.
Sil souffle, cest lhiver ; sil aspire, cest lt. Il ne boit, ne mange ni ne
respire : vent et pluie alors sarrtent sa gorge. Il respire : cest le Vent (
587
).
Le Dragon-Flambeau slve dan s la nuit sur les bords de la Rivire Rouge o
vit aussi Niu-pa, la Scheresse, fille de Houang-ti, quelle aida vaincre
Tche -yeou, le grand rebelle, aprs quoi elle fut bannie dans lhorri ble pays
des Sables mouvants (
588
). Tout auprs se trouve le gouffre o le Tonnerre
sengloutit en tourbillonnant (
589
). Cest la rgion sinistre de la soif, que
hantent des fourmis rouges gigantesques et des gupes, plus grosses que des
calebasses, dont la piqre dessche aussitt toutes choses (
590
).
Mais le nord-ouest est aussi le pays mystrieux o slve le
Kouen -louen, rplique superbe des Cieux et des palais princiers (
591
), Le
Kouen -louen est une montagne en mme temps quune btisse neuf tages.
On peut y voir des jardins suspendus dont les arbres portent des perles ou
produisent du jade, neuf puits do jaillit un lixir et dinnombrables portes.
Le vent Pou-tcheou pntre par lune delles, mais une autre ne se distingue
pas, au moins par le nom, de la principale porte des palais des Cieux. Et, en
effet, ceux qui russissent gravir les paliers successifs du Kouen -louen
slvent limmortalit : on nous dit quils montent au Ciel (
592
). On affirme
que le Souverain suprme rside dans le Kouen -louen. Pourtant la seule
divinit qui y reoive des visites est la Mre-reine dOccident, la
Si-wang-mou. Cest une sorte dogresse queue de lopard, qui a la
295
mchoire des tigres et se plat comme eux hurler. Elle rpand au loin la
peste. chevele comme une sorcire, elle vit au fond dune caverne (
593
).
Cest de cette desse de la Mort quon peut obtenir lherbe de longue vie (
594
),
et il lui arrive doffrir des festins tout en haut dune tour de jade (
595
).
Des lgendes analogues et aussi disparates ont servi illustrer un autre
thme cosmologique : on a log en bordure du carr terrestre tous les peuples
tranges. Quand Sseu-ma Tsien combine les 8 Vents et les 28 Mansions, il ne
se proccupe pas des dimensions des fuseaux, mais chacun des 4 cts de
lhorizon il fait correspondre 9 sites. Houai -nan tseu imagine de rpartir les
peuples tranges sur le pourtour carr de la Terre ; il en loge 6 lEst et 10
lOuest, 13 au Sud et 7 au Nord : tous les besoins logiques du philosophe sont
satisfaits ds quil a obtenu, lui aussi, le total 36 (
596
).
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 211
Ce sont les philosophes, autant que les potes, qui nous ont transmis ces
lgendes : ils les utilisaient dans leurs argumentations bien plus que les
thories des savants. Les potes qui chantent les randonnes piques des Sages
ou les bats mystiques des Hros en savent long sur lAu -del, et, de mme
queux, les jongleurs ou les chamanes qui sen vien nent de loin la cour des
tyrans. Cependant, les renseignements des baladins et les dcouvertes des
potes nont gure fait quajouter du pittoresque aux reprsentations chinoises
du monde que les savants, avec leurs grands nombres, aidaient pourvoir de
majest. Toujours conue limage dune demeure princire, humble donjon
ou palais gigantesque, larchitecture de lUnivers reste commande par les
vieilles rgles des systmes indignes de classification. Seul, le parc de chasse
sest enrichi tout en slargissant. Cest un fait remarquable : si les Chinois ont
bien voulu accueillir, comme des curiosits profitables, des lgendes ou des
techniques, des jongleries ou des ides entaches dexotisme ou de nou veaut,
ils ne les ont point admises dans leur maison. Il est plus remarquable encore
quils naient point log hor s de lHistoire, dans le temps vague et lointain qui
parat convenir aux mythes, les lgendes, nouvelles ou anciennes, o figurent
296
les dieux avec les monstres. Le Temps tout entier appartient aux hommes
et lHistoire. LUnivers nexiste rellement q ue depuis le moment o les
Sages ont institu la Civilisation nationale. Cette civilisation rgne sur
lensemble des Neuf Provinces. Circonscrivant lEspace amnag par les
Saints, stendent les Quatre Mers de Barbares, espace inorganique, Au -del
de lEspace, auquel tout lgitimement sadapte un Au -del du Temps. Ces
franges vagues du monde rel conviennent aux Monstres et aux Dieux tout
aussi bien quaux Barbares. La Terre des Hommes appartient aux Chinois,
leurs Anctres, leurs Chefs. Ceux-ci ont divis les champs en carrs et
construit le templum, qui donne une juste orientation aux Neuf Quartiers de
leur ville, de leur camp, de laire rituelle o ils devaient officier. De ces
usages saints drivent les classifications qui permettent damnager lU nivers
rel et den construire la reprsentation vritable. Les champs quon labourait,
le camp o lon se rfugiait, la maison sacre o demeurait le Chef, sil
fournirent limage des Neuf Provinces du Monde, furent dabord, tout exigus,
enserrs par les Marches o vaguaient les Btes divines et les Barbares, gibier
du Chef (
597
). Tel est le terrain o les guerriers ont men leurs conqutes, les
gographes ou les potes leurs explorations. LUnivers agrandi a conserv
larchitect ure, fruste ou splendide, de la grotte, de la hutte, du donjon,
quhabitrent les Fondateurs de lancienne Chine. Et leurs descendants
nacceptrent daccueillir que dans le parc rserv leurs chasses, leurs ftes,
leurs jeux, tout ce que leur apportrent, ides ou dieux exotiques ou nouveaux,
les astrologues, les potes, les baladins.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 212
CHAPITRE II
Le microcosme
297
Les Sages de la Chine ont toujours poursuivi de leur haine les
baladins. Ceux-ci, quand ils font larbre droit, risquent de boulev erser le
Monde. Les hommes ont des pieds carrs et qui doivent reposer sur la terre. Ils
sont coupables sils posent de tendre la tte vers le haut : la tte est ronde
limage du ciel (
598
). La conformation des tres humains reproduit
larchitecture du monde, et avec toutes deux saccorde la structure sociale. La
socit, lhomme, le monde sont lobjet dun savoir global. Valable pour le
macrocosme et pour tous les microcosmes qui sembotent en lui, ce savoir se
constitue par le seul usage de lanalogie.
*
* *
Rien nillustre mieux la conception chinoise du micro cosme que les ides,
les usages, les mythes relatifs la Gauche et la Droite.
En Chine, lantithse de la Droite et de la Gauche na rien dune
opposition absolue (
599
), Le yin et le Yang eux-mmes ne sopposent pas,
comme le Non-tre et ltre ou le Pur et lImpur. Les Chinois nont pas la
fougue religieuse qui condamne rpartir les choses entre le Mal et le Bien.
Nous honorons la Droite, dtestons la Gauche, qualifions de sinistre tout ce
qui appartient au Mal : nous blmons les gauchers et nous sommes droitiers.
Les Chinois sont droitiers comme nous ; pourtant ils honorent la Gauche, et
leurs plus grands
298
hros, Yu le Grand, Tang le Victorieux, sont les uns
gauchers, les autres droitiers. Ce sont mme, pourrait-on dire, des Gnies de la
Droite ou des Gnies de la Gauche : Matres de la Pluie ou de la Scheresse,
vous entirement au Yin ou au Yang, on les dclare volontiers atteints
dhmiplgie, si mme on ne les rduit pas la moiti droite ou la moiti
gauche du corps (
600
). Un gnie terrestre ou un gnie cleste doivent animer
les fondateurs de deux dynasties successives. Mais le hros, pas plus que la
dynastie quil fonde, ne vaut mieux ou pis, selon que, gaucher ou droitier, il
est possd par la Vertu du Ciel ou par la Vertu de la Terre. Ces vertus sont
complmentaires. Elles doivent se relayer louvrage. Bien plus, elles
imprgnent successivement les Sages les plus parfaits. Ceux-ci, dabord
ministres, exercent des fonctions actives. Ils dploient leurs talents dans le
dtail des choses de la Terre. Devenus souverains, seul le souci du Ciel les
occupe : ils ne vivent que pour concentrer en eux lEfficace ( tao) suprieure
toute efficience de dtail (t) (
601
). La Gauche et le Ciel lemportent en
Marcel GRANET La pense chinoise 213
quelque manire sur la Droite et la Terre, comme le Yang lemporte sur le
Yin, le Tao sur le T, luvre Royale sur les bes ognes ministrielles.
Lopposition se rduit cependant une diffrence de grade ou une
distinction demploi.
Dans le signe qui figure la Droite (main + bouche), les tymologistes
savent lire un prcepte : la main droite sert manger (
602
). La Droite convient
donc aux choses de la Terre. Llment main se retrouve dans le signe
adopt pour la Gauche, joint, cette fois, un autre lment graphique qui
figure lquerre. Lquerre est le symbole de tous les arts, et surtout des arts
religieux et magiques. Cest linsigne de Fou -hi, premier souverain, premier
devin. Fou-hi est le mari ou le frre de Niu-koua, dont le compas est linsigne.
Ce couple primordial a invent le mariage ; aussi pour dire bonnes murs ,
dit-on compas et querre (
603
). Les graveurs (
604
) reprsentent Fou-hi et
Niu-koua se tenant enlacs par le bas du corps. A Niu-koua, qui occupe la
droite, ils font tenir le compas de la main droite (
605
). Fou-hi, gauche, tient,
de la main gauche, lquerre. L querre, qui produit le Carr, emblme de la
Terre, ne peut tre linsigne du Mle quaprs un change
299
hirogamique
dattributs ; mais, le Carr (comme lenseigne le Tcheou pei) produisant le
Rond (quil contient) (
606
), l querre mrite tout de suite dtre lemblme du
sorcier qui est yin-yang (
607
), et surtout de Fou-hi, savant dans les choses du
Ciel comme dans celles de la Terre (
608
). Fou-hi peut donc porter lquerr e de
la main gauche, et la main gauche (avec lquerre) voquer luvre Royale,
lhiroga mie premire, lactivit magico -religieuse. Les Chinois nopposent
pas fortement la religion la magie, pas plus que le pur limpur. Le sacr et
le profane ne forment pas eux-mmes deux genres tranchs. La Droite peut
tre consacre aux uvres profanes et aux activits terrestres sans devenir
lantagoniste de la Gauche. La pense chinoise sintresse non aux contraires,
mais aux contrastes, aux alternances, aux corrlatifs, aux changes
hirogamiques dattributs.
Linfinie varit des Temps et des Espaces multiplie ces changes, ces
contrastes, ainsi que les conditions concrtes des corrlations et des
alternances. Ltiquette doit tenir compte de toutes ces complic ations ; aussi
met-elle lhon neur tantt la Gauche et tantt la Droite. Les Chinois sont
droitiers, obligatoirement, car, ds leur enfance, on leur enseigne se servir de
la droite, du moins pour manger (
609
). Mais tous les garons on enseigne
aussi quil convient de saluer en cachant la Main droite sous la main gauche ;
les filles doivent au contraire placer la gauche sous la droite. Telle est la rgle
qui, en temps normal, sert distinguer les sexes : la Droite est yin, la Gauche
est yang. En temps de deuil, le Yin et la Droite lemportent : les hommes
eux-mmes saluent alors en cachant la gauche et en prsentant la Main
droite (
610
). Une deuxime prescription montre que la Gauche, car elle est
yang, saccorde avec lheureux ou le faste : se dcouvrir lpaule droite, cest
se dclarer vaincu et sappr ter au chtiment ; on dcouvre au contraire
lpaule gauche quand on assiste une crmonie joyeuse (
611
). Et pourtant le
Marcel GRANET La pense chinoise 214
mot gauche sert qualifier les voies dfendues et semble, en ce cas,
quivaloir sinistre . Si faste que la gauche puisse tre par ailleurs, cest
toujours en serrant la droite quon jure par la paume et quon fait amiti (
612
).
Le serment par la paume peut tre complt par un change du sang tir du
bras et apparemment du bras droit (
613
).
300
En revanche, quand on donne
force au serment en flairant le sang dune victime, le sang est pris prs de
loreille (pour le prendre, il faut avoir lpaule gauche dcouverte), et on doit
le tirer de loreille gauche, car cest loreille gauche quavan t de les sacrifier
on coupe aux prisonniers de guerre tenus en laisse de la main gauche (
614
).
Ainsi, tandis que la main droite lemporte sur la main gauche, loreille
gauche vaut mieux que loreille droite.
Le choix entre la Droite et la Gauche, mme quand il semble justifi par
des raisons pratiques, est inspir par des principes thoriques de classement.
On offre avec la corde qui les attache, les chevaux ou les moutons, les chiens
ou les prisonniers de guerre. Pour les premiers, qui, dit-on, sont inoffensifs, la
corde est tenue de la Main droite (
615
). Plus dangereux quun cheval, le chien
peut mordre ; on tient sa laisse avec la gauche ; la Main droite, reste libre,
pourra matriser lanimal (
616
). Mais est-ce bien parce quil demeure
dangereux quon tient aussi avec la gauche la laisse dun prisonnier dont on
coupe loreille gauche (
617
) ? On tient de mme avec la gauche larc quon
offre un archer dont la place sur le char est gauche (
618
). En gnral, on
donne gauche et on prend droite (
619
). Les prsents doivent tre dposs
la gauche du prince, o un officier en prend livraison. Cet intermdiaire se
place la droite de son seigneur quand celui-ci donne des ordres et quil faut
les transmettre (
620
). Cette rgle (considre comme trs importante parce
quelle se relie la distinction des historiens de droite chargs de noter les
faits et des historiens de gauche chargs denregistrer les paroles) (
621
) est
formule ct dun principe plus pittoresque, mais non moins impratif, sur
la manire de servir le poisson frais (
622
). Si vous donnez manger du poisson,
tournez la queue vers linvit ; en hiver, mettez le ventre droite ; mettez-le
gauche en t. Lt, la Gauche et lAvant (cest --dire le ct de la poitrine)
sont yang ; le poisson, tel quon le sert en t, parat correctement dispos
dans lespace ; tout ce qui est yang concide : lavant, la gauche, lt. Il ne
semble pas en tre de mme en hiver : lArrire et le Dos sont yin et le dos se
trouve alors gauche (yang). Cest quon mange avec la Main droit e, quon
entame les victuailles par la
301
droite et quil est poli de faire commencer
par les bons morceaux. Si lavant, bien quil soit yang, est tourn vers la droite
(yin), cest que le ventre est yin : il fait partie de lavant mais il en est le bas.
Or, lHiver vaut le Nord et le Nord, lui aussi, est le Bas. Quand rgne lhiver,
cest le Bas et le Yin qui dominent ; cest le ventre qui dans le poisson, sera la
partie la plus grasse et la plus succulente. Le ventre, donc, en hiver, mrite
doccuper la droite puisquelle est, pour la nourriture, la place de choix.
Bien entendu, si lon donne manger du poisson sch, tout change : il
convient pour commencer de le prsenter la tte tourne vers linvit...
Marcel GRANET La pense chinoise 215
Service de table, rituel du don ou du serment, crmonies tristes ou gaies,
ltiquette commande tout cela, cherchant choisir pour le mieux, dans le
dtail des cas, entre la Droite ou la Gauche. Mais cest dans la politique quil
faut chercher lorigine des principes de ltiquette et des attribut ions premires
de la Gauche et de la Droite. La politique (et la logique avec elle) est domine
par une conception fodale de la subordination. Tout vassal est chez lui un
seigneur, et, pourtant, il est toujours un vassal. Dans chaque domaine, tout se
date daprs les annes de rgne du seigneur local ; on suit, cependant, pour
les divisions de lanne, les pres criptions du calendrier royal. De mme, pour
choisir entre la Droite et la Gauche, on tient compte des circonstances locales,
mais on prtend toujours se rfrer au plan dorgani sation de lUnivers. Le
plan quon retrouve dans le macro cosme et les microcosmes, cosmographie,
lgislation, physiologie, a son principe dans lordonnance des assembles
fodales, pompes civiles ou militaires. Tous les conflits de la Gauche et de la
Droite, tout le protocole des prsances se rattachent la distinction fodale
du suprieur et de linfrieur. Seulement cette distinction doit (car la cat gorie
de sexe domine lorganisation sociale) se combiner avec la dis tinction du mle
et du femelle, du Yang et du Yin. Le Chef reoit debout, dress sur son
estrade, face au sud, les vassaux qui, tourns vers le Nord, sinclinent au pied
de lestrade, jusqu terre. Le Chef, qui occupe le Haut, se place de manire
recevoir en pleine face linfluence ( ki ) du Ciel, du Yang et du Sud. Le Sud est
donc le Haut, comme lest le Ciel, et le Nord est le Bas, comme lest la
Terre (
623
).
302
Le Haut, je veux dire le Chef, tend sa poitrine au Sud et au
Yang : lAvant, comme le Sud , est Yang. Il tourne le dos au Yin et au Nord
qui sont lArrire, en mme temps quils sont le Bas et la Terre. Aussi la Terre
et le Yin portent-ils sur leur dos, tandis que le Yang et le Ciel serrent sur leur
poitrine (
624
). Le Chef, puisquil se tourne vers le Sud, confond sa gauche
avec lEst, sa droite avec lEst ; lOuest est donc la Droite, lEst est donc la
Gauche. Le Chef est un Soleil levant et victorieux. Il est aussi un Archer. Tout
char est occup par un trio de guerriers ; la place du conducteur est au centre,
celle du lancier est droite ; comment tenir convenablement les rnes sinon
du milieu du char ? comment ( moins dtre gaucher) manier utilement la
lance si lon sest pas post droite ? Larcher est donc gauche. La Gauche
est la place du Chef. La Gauche est le cot honorable, et lEst lest avec elle.
La Gauche, lEst, le Levant sont yang comme le Chef, le Sud et le Ciel ; la
Droite, lOuest, le Couchant sont yin comme la Terre et le Nord, comme
lpouse du chef, reine ou douairire. Le palais du prince hritier est lEst
(Printemps) et gauche, la rsidence de la douairire est lOuest (Automne)
et droite. La Droite est yin et appartient aux femmes, et la droite
appartiennent lautomne, les rcoltes, la nourriture. La Gauche est yang, elle
appartient aux hommes, et la Gauche appartiennent lactivit virile et
lactivit religieuse, les formes suprieures daction. Tel le Yang, la main
gauche se place en haut, et sa paume recouvre le dos de la main infrieure et
qui est yin, la droite, qui manie la lance et qui tue, qui est la main du soldat et
non la main du Chef : car, sil faut que le soldat donne la mort et chtie ( yin),
Marcel GRANET La pense chinoise 216
le Chef, dit Tcheng Hiuan (
625
), ne cherche, avec la victoire, qu conserver la
vie et rcompenser le mrite (yang). Tenant son arc, le bras gauchi
dcouvert, de la main gauche, lArcher, o quil aille, se tient main gauche :
du ct du Soleil levant et victorieux (
626
). Larme transporte avec elle le
drapeau du seigneur ; elle est toujours, quelle que soit sa route, oriente,
comme le seigneur, face au Sud : le fanion rouge du Sud la prcde (
627
). Le
Yang et lEst sont sans cesse sa gauche ; lArme nest que le camp ou la
ville qui se dplace, sans perdre jamais son orientation. La lgion de gauche,
commande par le
303
chef du district de gauche de la ville, est toujours
gauche et toujours lEst, puisqu e le district de lEst est, pour le Matre,
gauche (
628
). Les armes ont trois lgions ; le Suzerain a trois premiers
ministres que lon nomme les Trois Ducs . Ils se tiennent devant lui face au
Nord, mais on voit en eux une triple manation de sa Vertu. Comme sils
taient, la manire de lHomme Unique, tourns vers le Sud, la gauche, pour
eux, est lEst. Le duc de gauche commande donc lEst de lEmpire (
629
).
Cest au Chef quon rapporte les divisions du Monde. LEst est partout
la gauche, puisque lEst est sa gauche. Mais le Chef, le suprieur ( changh) est
celui qui se tient en haut. Cest pour le Haut seulement, pour le Ciel et son
manation, le Chef, pour le Chef et ses manations, les Trois Ducs, que la
gauche est le ct honorable. Pour les infrieurs, pour le Bas, pour 1a Terre, le
ct honorable, cest toujours lEst, ce nest plus la gauche. Au pied de
lestrade du Chef, les vassaux se tournent v ers le Nord et salignent de lEst
lOuest : le plus noble se place main droite. Les vassaux, cependant, sont,
chez eux, des Chefs. Dans leur propre demeure, ils se tiennent en haut et face
au Sud. Le matre de maison a sa place au-dessus des degrs de lEst de la
salle de rception, sur la gauche ; droite et au-dessus des degrs de lOuest,
est la place de la matresse de maison : la Gauche est toujours yang, la Droite
est toujours yin (
630
). Hommes et femmes, cependant, sortent de chez eux. Sur
les voies publiques, le milieu de la chausse appartient aux chars. Les hommes
doivent cheminer sur la droite, cest --dire lOuest, laissant, par pudeur, les
femmes marcher seules sur le trottoir de gauche et de lEst (
631
). Telle est la
rgle, et Tcheng Hiuan affirme que les hommes occupent, avec la droite, le
ct le plus honorable ; ils sont, en effet, des vassaux : les vassaux, o quils
aillent, demeurent, par essence, tourns vers le Nord. Tout change sils
regagnent leur maison et tout change encore quand ils se couchent. Quand on
se couche, cest lorientation propre au Bas et la Terre qui simpose.
Lpouse tend sa natte dans le coin o lon conserve les graines quon rcolte
lautomne et q uon engrange lOuest : elle leur emprunte leur fcondit et
leur donne la sienne. La natte de la femme est tout contre le mur du
304
Couchant. Le mari abandonne, pour la nuit, le ct du Levant ; sa natte,
cependant, est place lest de celle de lp ouse. Quand ils stendent pour
dormir, le mari et la femme ne peuvent point placer leur tte dans la direction
du Sud, car cest ainsi, dans le Monde du Bas, que se disposent les morts :
seuls, les dfunts ne craignent pas de tourner les pieds vers le septentrion o
Marcel GRANET La pense chinoise 217
sont leurs demeures. La femme, donc, reste lOuest, mais, pendant la nuit,
elle occupe la gauche et lhomme la droite. Toutes ces inversions sont
commandes par la structure fodale de la socit, par la subordination de la
femme lhomme, par la subordination du vassal au seigneur. Elles
nempchent pas que la Gauche ne soit foncirement yang, la Droite
foncirement yin. Un mdecin ne peut se tromper sil veut connatre, avant la
naissance, le sexe dun enfant. Ce sera un garon si lembry on est plac
gauche, une fille sil se tient droite (
632
)
La distinction du Haut et du Bas, qui a dabord une valeur politique,
conduit accorder, selon loccasion, la prmi nence la Gauche ou la
Droite. La cosmographie, la physiologie, lhistoir e dmontrent la justesse du
principe qui dtermine leurs attributions. Le premier devoir du Chef est de
circuler dans le Ming tang ou dans lEmpire en imi tant la marche du Soleil.
Parti du plein Nord, il doit se diriger vers lEst afin que le Printemps succde
lHiver. Il le fait, plac quil est tout dabord face au Sud ( et au Centre) en se
dplaant face au Centre, cest --dire la Gauche en avant. La marche vers la
Gauche conforme (chouen) lordre des caractres cycliques, est la marche
royale, celle du Soleil et du Yang. Cest le sens convenable pour les choses
den Haut. La cosmographie chinoise admet que le Ciel est sinis trogyre, la
Terre dextrogyre (
633
). La marche vers la Droite, le sens contraire (yi),
simpose pour les crmonies funbres q ui se rapportent au monde den
Bas (
634
). Cette marche o clate la prminence de la Droite simpose au Yin
comme elle simpose la Terre. La physiologie le prouve. Lun des grands
principes de cette science est que les nombres 7 ou 8 commandent la vie
fminine ou la vie masculine (
635
) ; les hommes terminent leur vie sexuelle
64 ans, les femmes 49 ans ; les garons ont des dents 8 mois ; ils en
changent
305
8 ans, ils deviennent pubres 16 ans ; les filles, pubres 14
ans, font ou perdent leurs premires dents 7 mois et 7 ans ; 7, emblme du
Jeune Yang, prside au dveloppement des femmes qui sont yin ; 8, emblme
du jeune Yin, au dveloppement des hommes, qui sont yang : do leur vient
cette vertu ? 8 correspond au Printemps (yang, gauche) et au signe yin de la
srie duodnaire ; 7 lautomne (yin, droite) et au signe chen ; le signe sseu
marque le site de la conception ; la grossesse dure 10 mois. Or, on parcourt 10
stations cycliques (
636
) en allant de sseu yin, si la marche se fait vers la
gauche, dans le sens du Soleil et du Yang (mle). On compte aussi 10 stations,
mais condition de suivre le sens inverse, pour aller de sseu chen ; le
mouvement est dextrogyre. Cest celui q ui convient un embryon fminin ;
port droite, cet embryon opre sa giration en avanant vers la droite. De
mme, en partant du plein Nord, pour se rencontrer sseu, site de la
conception, le mle et le femelle (les hommes se marient 30 ans, les femmes
20 ans) doivent parcourir, le premier 30 stations, lautre 20 sta tions, sils
avancent, le premier vers la gauche, le second vers la droite. La marche vers la
gauche, qui convient aux choses du Haut et du Yang, caractrise aussi les
hros quanime l e gnie du Ciel. Ceux quanime le gnie de la Terre et du Yin
sont vous la marche vers la droite. LHistoire en contient des preuves
Marcel GRANET La pense chinoise 218
convaincantes. Marcher vers la gauche, cest marcher la gauche en avant , sans
que
306
jamais le pied droit dpasse le pied gauche (
637
). Cest ainsi que
marchait Tang le Victorieux, lequel ne touchait la Terre que par des pieds
minuscules, tant la Vertu du Ciel le possdait. Aussi tait-il sorti par la
poitrine (yang) du corps maternel. Yu le Grand, sorti par le dos (yin),
possdait, avec de trs grands pieds, la Vertu de la Terre. Aussi marchait-il
dans le sens qui convient au Yin, la droite en avant, le pied gauche ne
dpassant jamais le pied droit (
638
).
La poitrine et lAvant, lEst et la Gauche, appartiennent au Yang, au Mle,
au Haut et au Ciel ; le dos et lArrire, lOuest et la Droite appartiennent au
Yin, au Femelle, au Bas, la Terre. La distinction du Haut et du Bas,
mtaphore politique fondamentale, introduit dans la socit, mais aussi dans le
macrocosme et dans les microcosmes, une double dissymtrie. La Gauche
lemporte en Haut, la Droite en Bas. Un mythe explique cette antithse. Les
mdecins qui le rapportent y voient le premier principe de leur art (
639
).
Depuis que les mfaits de Kong-kong et la rupture, au Nord-Ouest du Monde,
du mont Pou-tcheou ont fait basculer en sens inverse le Ciel et la Terre, le
Ciel, affaiss vers le Couchant, nest entirement plein qu gauche (Est), l
o, prcisment, la. Terre effondre laisse un grand vide. Tout lEst est
domin par linfluence du Ciel et du Yang. LOuest, au contraire, est domin
par le Yin, car la Terre y subsiste seule, tandis que le Ciel fait dfaut. Cette
disposition architecturale se retrouve dans le microcosme. Pour le corps
humain, lOuest (je veux dire droite), le Ciel (je veux dire le Yang)
manque, la Terre (je veux dire le Yin) abonde. Le Yin, dans la partie
infrieure du corps, qui est prs de 1a Terre, rgne en matre ; aussi les
Chinois sont-ils et doivent-ils tre droitiers pour ce qui est des mains et surtout
des pieds. En revanche, pour ce qui est des yeux et des oreilles (placs au haut
du corps), ils sont et doivent tre gauchers : lEst (je veux dire gauche) le
Yin est dficient comme la Terre, mais le Yang abonde, comme le Ciel. Voil
pourquoi il convient de couper loreille gauche des ennemis ou de leur crever
lil gauche (
640
). Voil pourquoi, pour manger les choses de la Terre, on se
sert obligatoirement de la main droite. cest la main qui agit, mais qui tue et
quon cache (
641
) tandis que la Gauche est le ct honorable par lequel tout
307
homme (en temps normal) doit avancer et se prsenter, la main gauche
tant celle quil prsente quand il salue (
642
).
*
* *
Le Ciel accomplit son mouvement circulaire en 4 saisons. Nous avons
donc 4 membres forms, chacun, de 3 parties : 3 mois font une saison. 12
mois font lanne, soit 360 (jours) : tel est le nombre des articulations de notre
corps. Nous possdons, haut placs, des yeux et des oreilles : le Ciel na -t-il
pas le Soleil et la Lune ? Le Vent et la Pluie sba ttent dans lunivers : en nous
Marcel GRANET La pense chinoise 219
sbattent le Souffle ( ki ) et le Sang. Cest un philosophe qui enseigne tout
cela, lun des mieux informs : Houai-nan tseu (
643
). Il sait bien des choses
encore et, par exemple, que le Ciel, ayant 9 tages, est perc de 9 portes. A
notre corps sont aussi perces 9 ouvertures, car nous sommes mieux pourvus
que les oiseaux, lesquels, naissant dun uf, ont une ouverture en moins ;
mais leurs 8 orifices correspondent aux 8 espces dinstru ments de musique :
cest grce au phn ix que la musique fut invente. Et Houai-nan tseu (644)
sait encore que nous possdons 5 Viscres, car il y a 5 lments. Dix mois de
gestation sont ncessaires pour former le corps avec les 5 Viscres et les
Ouvertures quils rgissent : les poumons et les (2) yeux, les reins et les (2)
narines, le foie et les (2) oreilles, le fiel et la bouche... ce qui fait, si nous
comptons, 7 Ouvertures et 4 Viscres seulement. Lart de concilier les
classifications est difficile, mais le profit est grand quand on arrive les
imbriquer : lordre commun au macrocosme et au micro cosme apparat.
La thorie des 5 Viscres et celle des 9 (ou 7) Orifices permettent de
montrer que la conformation de lHomme est modele sur celle de lUnivers.
Ces thories ont mme servi, quand on a identifi les 5 lments et les 5
Plantes, imaginer une doctrine (comparable la mlothsie), dont certaines
parties peuvent tre anciennes, car, de tout temps, les 7 Ouvertures semblent
mises en rapport avec les 7 Recteurs clestes ou les 7 toiles de la Grande
Ourse. Ces deux thories, en tout cas, se rattachent dantiques classifications
mythologiques. On ne cesse point de se rfrer ces dernires
308
quand on
veut prsenter un tableau cohrent du rel. La pense, savante ou technique,
loin de chercher saffranchir de la mythologie, lui emprunte son matriel
demblmes et sa mthode. Le rle du savant est de tirer des mythes une
scolastique. La somme du savoir se constitue en accroissant, grce
lanalogie, le rpertoire des cor rlations. Comme au temps o furent invents
les couplets du Che king, le grand principe des correspondances et des
interactions (tong) est la solidarit qui unit le naturel lhumain, le physique
au moral.
Le Hong fan suppose ce principe. Il lillustre en tablissant grce
lordre suivi pour lnumration la correspondance des Cinq lments et
de leurs produits, des Cinq Activits humaines (che) et de leurs rsultats, des
Cinq Signes clestes (tcheng)
Marcel GRANET La pense chinoise 220
Numros dordre 1 2 3 4 5
lments
Eau
Sal
Feu
Amer
Bois
Acide
Mtal
Acre
Terre
Doux
Activit humaines Geste
Gravit
Parole
Bon ordre
Vue
Sapience
Oue
Bonne
entente
Volont
Saintet
Signes clestes Gravit
Pluie
Bon ordre
Yang
Sapience
Chaud
Bonne
entente
Froid
Saintet
Vent
et des indications quils fournissent en marquant le retentissement quont dans
le Ciel la tenue, bonne ou mauvaise, des hommes et les murs que le gouver -
nement fait fleurir parmi eux. Ces signes (comme le montre le tableau
ci-dessus) traduisent en symboles matriels les vertus rsultant des
Activits symtriques. Il y a, comme on voit, correspondance stricte entre les
Signes clestes et les Activits humaines qui occupent le mme rang dans
lnu mration. La correspondance ne peut pas tre moins stricte entre ces
Activits ou ces Signes et les lments symtriques. Sur ce point, dailleurs,
les paralllismes de dtail sont instructifs, puisque le Yang est rapproch du
Feu (= Sud-t) et lEau (= Nord -Hiver) de la Pluie qui parat bien ici voquer
le Yin (= Obscurit, temps couvert) (
645
). Bien que, par la suite, la
nomenclature ait chang et quil y ait, da ns le dtail, des divergences assez
nombreuses, le systme du
309
Hong fan na pas cess dinspirer les tableaux
de correspondances auxquels se rfrent les ritualistes comme les
philosophes. La liste des quivalences nest jamais donne compltement, c ar
les points de vue diffrent et, par exemple, le tableau (ci-dessous) quon peut
tirer du Yue ling nembrasse gure que le domaine des choses et des actes
rituels.
Marcel GRANET La pense chinoise 221
- lments
- Orients
- Couleurs
- Saveurs
- Odeurs
- Aliments
vgtaux
-Animaux
domestiques
- Lares ou
parties de la
maison
- Gnies des
Orients
- Souverains
- Notes
- Nombres
- Binmes de
signes
cycliques
dnaires
- Classes
danimaux
- Viscres
Bois
Est
Vert
Acide
Rance
Bl
Mouton
Porte
intrieur
e
Keou-
Mang
Tai -hao
(Fou-hi)
Kio
8
kia-yi
cailles
Rate
Feu
Sud
Rouge
Amer
Brl
Haricot
Poulet
Foyer
Tchou-
jong
Yen-ti
(Chen-
nong)
Tche
7
ping-
ting
plumes
Poumon
s
Terre
Centre
Jaune
Doux
Parfum
Millet
blanc
Buf
Impluvium
Heou-tou
Houang-ti
Kong
5
meou-ki
peau nue
Cur
Mtal
Ouest
Blanc
Acre
Odeur de
Viande crue
Graines
Olagineuse
s
Chien
Grande Porte
Jou-Cheou
Chao-hao
Chang
9
keng-sin
poils
Foie
Eau
Nord
Nir
Sal
Odeur de
Pourri
Millet
jaune
Porc
Alle
[ou puits]
Hiuan-
ming
Tchouan-
hiu
Yu
6
jen-kouei
enveloppe
dure
Reins
Mais Houai-nan tseu (
646
) enseigne : dune part quon assimilait le Vent, la
Pluie, le Froid et le Chaud avec laction de prendre celle de donner, la joie et
la colre ; et dautre part, que le Tonnerre correspondait la Rate et les Reins
la Pluie. Les gestes et les motions taient donc raccords par
Marcel GRANET La pense chinoise 222
lintermdiaire des lments et des Viscres aux phnomnes cosmiques ou
plutt aux Signes clestes .
Est
Bois
Vent
Foie
Sud
Feu
Souffle
(ki)
Poumons
Centre
Terre
Cur
Ouest
Mtal
Nues
Fiel
Nord
Eau
Pluie
Reins
Eau
Tonnerre
Rate
Par ailleurs, Sseu-ma Tsien nous apprend que, par
310
lintermdiaire
des Cinq Notes, on raccordait aux Cinq Viscres les Cinq Vertus
fondamentales (
647
). De mme que le Hong fan, Sseu-ma Tsien affecte la
Saintet au Centre. Or lordre des lments que suit le Hong fan drive,
comme on a vu, de lordre de production des Notes. On peut donc considrer
comme ancienne la liaison des Notes, des lments et des Vertus. Leur liaison
commune aux Viscres ne doit pas tre moins ancienne : la technique rituelle,
comme le Yue ling en fait foi, exigeait qu chaque saison, dont lemblme
tait une certaine note, on donnt, dans les sacrifices, la prminence un
certain viscre (
648
). La note kio (= Est-Printemps = Bois) meut le foie et
met lhomme en harmonie avec la Bont parfaite. Rien ne peut aussi bien
que cette phrase de Sseu-ma Tsien signaler linteraction emblmatique et la
solidarit profonde qui unit le physique et le moral sous la domination du
rythme cosmique.
Orients
Nombres
Notes
Viscres
Vertus
Est
8
Kio
Foie
Bont
Sud
7
Tche
Cur
Esprit
rituel
Centre
5
Kong
Rate
Saintet
Ouest
9
Yu
Poumons
Equit
Nord
6
Chang
Reins
Sapience
Pan Kou, dans son Po hou tong (
649
), dveloppe des ides analogues. Une
distinction vient les compliquer : cest celle du Haut et du Bas, du Ciel et de la
Terre. Elle nest pas absente du Hong fan, o les Cinq Signes clestes
sopposent aux Cinq lments.
Orients
Emblmes
Saisons
Ki
Est
Etoiles
Printemps
Vent
Sud
Soleil
Et
Yang
Centre
Terre
Ouest
Mansions
Automne
Yin
Nord
Lune
Hiver
Froid
Marcel GRANET La pense chinoise 223
lments
lments
corporels
Passions (t)
Bois
Os
Joie
Feu
Souffle
Plaisir
Terre
Muscles
Mtal
Ongles
Peine
Eau
Sang
Colre
Un excellent mdecin fit, pour consoler un moribond, un beau discours,
que rapporte le Tso tchouan (
650
), o il opposait aux Cinq Saveurs, Couleurs et
Notes, les Six Influences (ki ) : Yin, Yang, Vent, Pluie, Obscurit, Lumire.
Cette liste diffre peu de la liste des Cinq Signes : Yang, Vent, Pluie, Froid,
Chaud. Un passage du Kouan tseu (
651
) rapproche les Passions des Influences
en donnant les correspondances avec les Saisons-Orients, les lments, mais
sans sexpliquer sur les Influences ( ki ) du Centre.
311
Dans tous ces cas, on
oppose des choses clestes des choses terrestres. Cette opposition se
retrouve dans le Li yun (
652
) (o il est question des Six ou des Sept Passions
opposes aux Six ou aux Cinq Devoirs) signale par les nombres 5 et 6, qui
sont ceux du Ciel et de la Terre. Il en est de mme dans le Po hou tong, o
Pan Kou ( loppos de Houa i-nan tseu) compte 5 (et non pas 6) Viscres,
mais les oppose aux 6 Magasins [Fou : les 6 Fou, on la vu, sont les 5
lments plus les Grains (qui doublent llment Terre)]. Les 6 Magasins du
corps [petites et grosses entrailles, estomac, intestins, vessie et fiel (quon
distingue du foie, seul considr (ici) comme un viscre)] sont relis aux 6
Ho, cest --dire aux 6 Directions quand on les numre en ddoublant le
Centre en un Haut et en un Bas. Cest ainsi que Pan Kou arrive opposer,
comme les Magasins aux Viscres, les 6 Passions (Colre et Joie, Peine et
Plaisir, Amour et Haine) aux 5 Vertus cardinales. Une distinction analogue
joue un grand rle dans le Houang-ti nei king, brviaire de lancienne
mdecine chinoise. On y disserte abondamment, comme dans le Po hou
tong (
653
), sur les correspondances du microcosme et du macrocosme. Le
tableau quon peut extraire du chapitre deuxime est, dans le dtail, souvent
contredit par dautres passages du trait : ce nest pas desserv ir lart mdical
que daccrotre, au prix de quelques contradictions, les paral llismes
symboliques dont on tire les principes du traitement et les lments du
diagnostic. Ce tableau ne diffre gure de celui quon peut tirer du huitime
chapitre de Pan Kou. Tous deux distinguent les Vertus et les Passions. Tous
les deux montrent limportance quon attribuait aux orifices du corps humain.
De mme que la thorie des Cinq Vertus
312
se rattache celle des Cinq
Viscres, la thorie des Ouvertures se relie la thorie des Passions. Tels sont
les fondements de la connaissance du Microcosme.
Marcel GRANET La pense chinoise 224
Est-
Printemps
Sud-
t
Centre Ouest-
Automne
Nord-
Hiver
Foie
Bont
Cur
Esprit rituel
Rate
Bonne foi
Poumons
Equit
Reins
Sapience
I Yeux Oreilles Bouche Nez
II Yeux Langue Oreilles
II
I
Yeux Langue Bouche Nez Oreilles
A
Colre
Est
Haine
Sud
(Haut)
Plaisir
(Bas) Peine
Centre
Joie
Ouest
Amour
Nord
B
Fiel
Foie
Petites
entrailles
Cur
Estomac
Rate
Grosses
entrailles
Poumons
Vessie
Reins
Pour inventorier lHomme, au physique comme au moral, il a fallu
dpenser beaucoup dingniosit : on avait concilier des classifications ou
plutt montrer que, dans le monde humain comme dans le monde naturel,
lordre et la vie rs ultent de limbri cation des classifications numriques qui
conviennent soit la Terre, soit au Ciel.
Est-Printemps Sud-t Centre Ouest-
Automne
Nord-Hiver
Bois
Acide
Foie
Muscles
Yeux
Appeler
Serrer
Colre
Bont
Feu
Amer
Cur
Sang
Langue
Rire
Sagiter
Joie
Esprit rituel
Terre
Doux
Rate
Chair
Bouche
Chanter
ructer
Volont
Bonne foi
Mtal
Acre
Poumons
Poils
Nez
Se lamenter
Tousser
Tristesse
Equit
Eau
Sal
Reins
Os
Oreilles
Gmir
Trembler
Crainte
Sapience
La thorie des Ouvertures ne parat pas moins ancienne que celle des
Viscres. Elle inspire, elle aussi, diverses pratiques rituelles. La mythologie en
Marcel GRANET La pense chinoise 225
tient compte. On peut croire que les auteurs du Hong fang en ont fait cas.
Les
313
Activits humaines que ces savants numrent sont ( part la
Volont ou la Pense, qui convient une place centrale) : la Vue et lOue, le
Geste et la Parole. Un dsir de symtrie apparat dans cette conception. Il
apparat aussi dans la rpartition du corps humain en huit parties (assimiles
aux Huit Trigrammes) qui tait professe par les matres de la divination : les
Yeux taient affects au plein Est, les Oreilles devaient aller lOuest (
653b
).
Le Hong fang situe de mme lOue au Couchant et la Vue lOrie nt. Quant
on rpartit les orifices, on attribue au Nord et lEau les Reins, et, leur suite,
les Oreilles. Les Yeux sont toujours lEst, et la Langue au Sud. La Vue et la
Parole occupent de mme lEst et le Sud dans le Hong fang, lequel affecte au
Nord le Geste. Le Nord est lorient des Reins : ceux-ci comme on verra,
prsident la danse et la gesticulation.
Si la thorie des orifices est ancienne, les divergences, dans lapplication,
simposaient ds lorigine, car, ds lorigine on avait concili er des
classifications divergentes. Le Po hou tong en fournit un remarquable
exemple.
Est Sud Centre Ouest Nord
Colre
Haine
Haut Bas
Plaisir Peine
Joie
Amour
Pluie Yin Lumire
Obscurit
Vent Yang
Il appuie son systme de rpartition sur lautorit dun adage emprunt au
Li yun : Les Six Passions sont ce par quoi se ralisent les Cinq Qualits
naturelles (wou sing) (654). Or cet adage ne se retrouve plus dans le Li yun
tel quil est dit depuis quon la incorpor au Li ki (
655
), On y rencontre, en
revanche, lindication quil y a Dix Devoirs et Sept Passions, savoir : la joie,
la colre, la peine, la crainte, lamour, la haine, le dsir. Les glossateurs ne
signalent pas le texte diffrent conserv par Pan Kou, mais lun dentre eux
rappelle le passage du Tso tchouan sur les Six Influences (ki ) clestes, puis
ajoute que, sur Terre, elles correspondent aux Six Passions : la joie, la colre,
la peine, le plaisir, lamour et la haine. Ce sont l les Six Passions du Po hou
tong, quon ne cite
314
point, prfrant indiquer lquivalence avec les Six
Ki . Et lon conclut : Le dsir, cest le plaisir... la crainte fait la septime
passion (
656
).
Il y a 6 Influences clestes. Il y a 6 ou 7 Passions. Il y a 7 ou 9
Ouvertures. Et, sil y a 6 Magasins, il ny a que 5 Viscres. On ne
nomme gure les Ouvertures sans dire : les 7 Ouvertures. Ce sont les 7
orifices de la face : les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines, la
bouche. On parle plus rarement des deux ouvertures basses qui sont yin. Si on
Marcel GRANET La pense chinoise 226
les considre toutes les 9, il parat ais, en principe, de les distribuer entre les
5 Viscres. Les yeux, les oreilles, les narines, les orifices yin, qui vont par
paires, comptent pour quatre et la bouche fait 5. On adjugera sans difficult
les ouvertures basses aux Reins, viscre double, et, de mme, les Narines aux
Poumons. Les Yeux, sans trop de peine encore, iront avec le Foie, qui le Fiel
peut servir de viscre annexe. Restent la Rate et le Cur, les Oreilles et la
Bouche. Confrer la Bouche la Rate, viscre unique et central, convient fort
bien : la Bonne foi suivra la Bouche au Centre. Le Crus aura donc pour lot les
Oreilles (
657
) Mais est-il convenable de le lotir ainsi ? Le Cur est un
viscre yang, un viscre simple. Il a droit tre log en Avant (yang), dans la
Poitrine (yang), tout en Haut (yang) du corps, tel un Prince(yang) (
658
) Nest -il
pas, comme les Hros du Yang et de la Gauche qui vont seffilant prs de
Terre, large vers le Haut (yang), mince en Bas (yin) (
659
) ? Les Oreilles,
(remplaant la ouvertures basses), iront bien (on les coupe aux prisonnier de
guerre dont on veut affaiblir la force virile) aux Reins logs dans le Ventre
(yin), en Bas (yin), (comme des sujets qui sont les pieds et les mains du
seigneur et bien placs pour animer les pieds la danse (
660
). Les ouvertures
basses nentrant plus en compte (
661
), il ne reste, en sus de la Bouche, que trois
paires douverture et il y a pourvoir 5 Viscres. Mais na -t-on pas lhabitude
de ddoubler ce qui est central et la Bouche ne contient-elle pas la Langue ?
Les Yeux restant au Foie, les Narines aux Poumons, la Bouche la Rate, on
affectera au Cur la Langue, orifice de la salivation (
662
). Pour continuer
compter 7 Ouvertures, les yeux, les narines ou les oreilles comptant toujours
respectivement deux, il suffira de compter pour un la bouche et la langue.
315
Les classifications par 9, 8, 7, 6, 5, une fois concilies et imbriques,
il ne reste qu justifier les quivalences. Ce sest, pour le savant, quun jeu
dont le gurisseur saura profiter. Le Cur est rouge : cest la couleur du
Feu ; cest celle d e la joie ; le Tonnerre est le bruit du feu et il est le rire du
Ciel (
663
) : le Cur prside au Rire, lAgitation, la Joie. Les
Lamentations et la Tristesse dpendent, comme la Toux, des Poumons.
Ceux-ci sont blancs, couleur de lAutomne, de lOuest , du Tigre, du
Couchant, de la Grande Blanche (Vnus) et du deuil. LOuest est la rgion des
Montagnes et des Gorges o sengouffre le Vent et do vient la Pluie. Le
Nez, orifice des Poumons, slve haut sur le visage ; des cavits profondes le
percent ; cest par lui que sort la morve ; cest grce lui quon respire (
664
).
On pleure et lon est clairvoyant grce aux Yeux : ce sont les orifices du
Foie qui est vert et correspond au Printemps, au Bois et au Vent. Le Vent
balaye les nues obscures, il rend lumineuses les gouttes de pluie (
665
). Ce sont
l paroles de potes. Quant aux physiologistes, ils expliquent que le Bois,
lorsquil en sort du Feu, projette de la lumire et quil fait, chaque
printemps, poindre les bourgeons et perler la sve (
666
). La lumire ne sort-elle
pas de lOrient ? LEst, comme le Printemps, na -t-il pas une influence
bienfaisante ? Les Poumons sont le viscre de la Bont...
Marcel GRANET La pense chinoise 227
La physiologie et la psychologie sont acheves ds quon a combin la
thorie des Ouvertures et celle des Viscres. Mais elles ne servent pas
connatre le seul Microcosme ; elles conduisent une connaissance totale du
Ciel et de la Terre : Viscres, Vertus, lments, Ouvertures, Passions, Influx
clestes se correspondent. Qui connat lHomme connat l e Monde et la
structure de lUnivers comme son histoire. Nul besoin de constituer,
grand-peine, des sciences spciales : le Savoir est un. Le gographe nignore
rien des montagnes ds quil a reconnu en elles les os de la terre : elles
donnent au monde, comme le squelette au corps, la solidit, la stabilit (
667
).
Le physiologue sait tout de suite que le sang circule ; il connat exactement le
rle des vaisseaux o passent les humeurs corporelles ; il lui suffit davoir fait
une remarque : lunivers est s illonn de fleuves qui
316
charrient les
eaux (
668
). Les cheveux et les arbres, la vgtation et le duvet sont choses du
mme ordre ; les politiciens le savent fort bien et tous les faiseurs de beau
temps ; ils peuvent cumuler les moyens daction : lorsquon rase la vgtation
dune montagne ou quun chef fait le sacrifice de ses poils, les pluies, ces
humeurs fcondes, sarrtent de couler (
669
).
Heureux les historiens et les psychologues ! Ont-ils faire le portrait de
Kao-yao, donner sa gnalogie ou bien celle de Confucius et caractriser
lesprit du Matre ? Leur recherche aboutit bientt. Kao-yao fut ministre de la
justice et charg par Chouen de faire les enqutes criminelles ; le viscre de la
bonne foi est la rate ; la bouche dpend de la rate ; Kao-yao avait la bouche
fort grande, et il louvrait largement... comme font les chevaux ou les
oiseaux : Kao-yao nest autre que Ta -y, fils de Niu-sieou, qui conut en
avalant un uf et dont les descendants (qui ressemblent des oiseaux) savent
lever les chevaux (
670
). Confucius descendait des Yin qui rgnrent en
vertu de lEau ; il avait au fate du crne (son nom de famille signifie
creux , son nom personnel tertre creux ) une dpression semblable
celle des collines qui retiennent leur sommet un amas deau ; leau
correspond aux reins et la couleur noire ; le teint de Confucius tait fort noir
(signe de profondeur) et son esprit caractris par la sapience, car la sapience
dpend des reins (
671
).
Plus heureux encore les philosophes et les mdecins ! A eux appartient le
domaine merveilleux des classifications mythologiques : quel admirable
matriel pour des gens dont cest le mtier dargumenter ! Il fournit linfini
les thmes du diagnostic ou du jugement, les secrets de la thrapeutique ou de
la direction morale. On y peut trouver, avec la facult de ratiociner sur le
macrocosme et le microcosme, toutes les recettes pour bien vivre ou pour
vivre bien et, pour le moins, le moyen dobliger convenir que, telle tant la
suite des choses, tout va pour le mieux. Un prince de Tsin est malade ; on
appelle auprs de lui un sage et un mdecin ; tous deux concluent quil ny a
rien faire, et lon rpond : Cela est bien vrai , car les deux experts ont
dissert savamment. Le sage, grands renforts de renseignements historiques
ou astronomiques, sest expliqu sur
317
laction des Esprits et le mdecin,
Marcel GRANET La pense chinoise 228
enchanant les apophtegmes, a discouru sur le malfice : Les 6 influences
(ki ) du Ciel deviennent en Bas (sur Terre) les 5 Saveurs, se manifestent dans
les 5 Couleurs, ont pour indices les 5 Notes. Lexcs engendre les 6 Maladies.
Les 6 Influences (ki ) sont le Yin et le Yang, le Vent et la Pluie, lObscurit et
la Lumire. (Bien) rparties, elles forment les 4 Saisons ; (mises) en ordre,
elles forment les 5 divisions [de 72 jours chacune] de lanne. Ds quelles
sont excessives, il y a calamit. Lexcs de Yin cause les refroidissements ;
lexcs de Yang, les fivres ; lexcs de Ve nt, les maladies des membres ;
lexcs de Pluie, celles du ventre ; lexcs dObs curit, les troubles mentaux ;
lexcs de Lumire, les malaises du cur. La femme est la chose du Yang et
des moments dobscurit [la compagne de nuit]. Si on en use avec exc s, il y a
fivre interne et troubles mentaux malficients (kou)... Le kou (malfice) est
li lexcs et aux trou bles mentaux. On crit ce mot avec les signes vase
et vermine ; l(tre) ail qui sort du grain ( kou) [plac dans un vase] est le
kou (malfice) (
672
). Le Yi (king) des Tcheou dit : La fille trouble lesprit du
garon ; le vent renverse la colline , cest (lhexagramme) Kou (
673
). Toutes
ces choses se correspondent (tong) ! Quel excellent mdecin !
sexclame -t-on sitt ce discours fini, et lon a plaisir payer richement la
consultation (
674
).
*
* *
Rien de plus raisonnable, pour un malade, que dappeler en consultation
un mdecin disert et un sage fort en histoire. La physiologie et lhygine ou la
morale se confondent avec la physique, ou plutt avec lHistoire,
cest --dire avec lart du Calendrier ; lanatomie et la psychologie ou la
logique se confondent avec la cosmographie, la gographie ou la politique : et
lessentiel de la politique, cest cet art, dnomm par la suite Gomancie ( fong
chouei), grce auquel les Chinois entendaient amnager le monde en lui
appliquant leur systme de classifications, cest --dire les rgles de leur
morphologie sociale. Gomancie et calendrier, morphologie et physiologie
communes au macrocosme et
318
aux microcosmes, voil le savoir total et
lunique rgle. Ce savoir et cette rgle dictent et enseignent tous les compor -
tements des hommes et des choses. Tout tre serait rebelle et fauteur de
dsordre sil contrevenait aux moindres prescriptions de ltiquette.
Ltiquette est la seule loi. Cest grce elle que se ralise lordre de
lUnivers. Elle doit commander chaque geste, chaque attitude des tres, petits
et grands.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 229
CHAPITRE III
Ltiquette
319
Au lieu de sappliquer mesurer des effets et des causes, les Chinois
singnient rpertorier des correspondances. Lordre de lUnivers nest point
distingu de lordre de la civilisation. Comment songerait -on constater des
squences ncessaires, immodifiables ? Inventorier des convenances
traditionnelles exige un art plus subtil et dun tout autre intrt. Savoir, alors,
cest pouvoir. Les souverains, quand ils sont des sages, scrtent la
civilisation. Ils la maintiennent, ils propagent en tendant toute la hirarchie
des tres un systme cohrent dattitudes. Ils ne songent pas la contrainte des
lois, puisque le prestige des rgles traditionnelles suffit. Les hommes nont
besoin que de modles et les choses sont comme eux. On ne savise pas de
voir dans le monde physique le rgne de la ncessit, pas plus quon ne
revendique pour le domaine moral la libert. Le macrocosme et les
microcosmes se complaisent galement conserver des habitudes vnrables.
LUnivers nest quun systme de compor tements, et les comportements de
lesprit ne se distinguent pas de ceux de la matire. On ne fait point la
distinction de la matire et de lesprit. La notion dme, lide dune essence
entirement spirituelle et qui sopposerait au corps comme lensemb le des
corps matriels est tout fait trangre la pense chinoise.
*
* *
320
Lie tseu dveloppe longuement la thse que les actions les plus
relles sont des actions sans contact et sans dperdition dnergie (
675
). Agir,
cest influencer. Lide quon agit par simple influencement nest pas
spcifiquement taoste. Une anecdote du Tso tchouan (
676
) le prouve. Un bon
cocher arrive conduire un char plein chargement avec des traits prts se
rompre. Changez le cocher et ne chargez le char que dun peu de bois ; les
traits cassent immdiatement ; ils nont plus de cohsion : ils ne sont plus
influencs par lascendant dun conducteur matre en son art. La matire et
lesprit (ou plutt ce que nous appelons ainsi) ne forment pas des rgnes
spars. Telle est en Chine lide commune ; cest, pour Lie tseu (
677
), une des
ides matresses de son systme. Aussi, avec tout le srieux quun philoso phe
peut conserver quand il argumente, raconte-t-il complaisamment une scne de
comdie qui fut, au temps du roi Mou des Tcheou, joue par des marionnettes.
Le baladin qui les montrait les avait faites de cuir et de bois peints et vernis.
Ces figurines faisaient des courbettes tout aussi bien que les hommes et,
Marcel GRANET La pense chinoise 230
mme, elles chantaient juste et dansaient joliment. Cest quelles taient,
lintrieur, garnies de viscres de bois et quaucune ouverture ne leur
manquait. Leur enlevait-on les reins ? elles ne savaient plus danser. Leur
tait-on le foie ? elles ny voyaient plus. Munies de leurs Cinq Viscres et de
toutes leurs Ouvertures, elles prouvaient toutes les Passions. Le roi Mou dut
se mettre en colre : les marionnettes lanaient impudemment des clins dyeux
ses favorites. Ces appareils de dmonstration magico-philosophique valaient
ce que valent les hommes : ils en avaient la face. Quand le Chaos, ayant fait
preuve de civilit, mrita dtre reu parmi les hommes, deux amis (ctaient
les gnies de lEclair) employrent toute une semaine, lui perant chaque jour
une ouverture, lui donner la face humaine quil mritait (
678
). Au septime
jour de lopration, le Chaos mourut, dit Tchouang tseu . Cest dire que toute
initiation ou toute naissance ressemble une mort. La mort vritable
saccompagne au contraire de lobturation de tous les orifices du corps. On
clt les yeux des dfunts. On leur ferme la bouche. Ds lantiquit, sans doute,
on scellait avec du jade toutes les ouvertures :
321
cet usage sapparente la
coutume qui impose de dessiner sur les cercueils les Sept toiles de la Grande
Ourse (
679
). Il convient denfermer dans le cadavre linfection funraire et le
principe mme de la mort. Il faut aussi enclore dans le criminel le principe de
son crime et de sa malficience : cest donc par prcaution, plus que par
cruaut, quon obture les orifices de son corps (
680
). Chez les sages et les purs,
toutes les ouvertures souvren t et fonctionnent librement, les 7 ouvertures de
la face et les 7 ouvertures du cur qui leur correspondent. La qualit de vivant
ne sobtient et ne se conserve que si les premires sont bien ouvertes ; la
saintet est obtenue ds que les autres sont dbouches ou prs de ltre (
681
).
La puissance de vie atteint son maximum quand rien nentrave lendosmose
du Microcosme et du Macrocosme. Do limportance des Ouvertures.
Cette importance, reconnue par toute la tradition, sexpli que par le prestige
dont a joui de tout temps, en Chine, la magie des scrtions, des excrtions et
des souffles. Les prcautions quexige ltiquette et qui paraissent relever des
soins de propret sont imposes par le souci de ne pas laisser un suprieur
ptir ou un ennemi profiter des exhalaisons, pertes ou dgradations de ce qui
constitue la puissance de vie. Cest aux proches, cest aux fils (
682
) quil
appartient de recueillir et de cacher soigneusement les crachats et la morve des
parents ; cest e ux quil incombe de recueillir le dernier souffle, de clore les
yeux, la bouche, damonceler sur tous les orifices un amas de vtements, de ne
rien laisser perdre de la substance paternelle, denfouir dans le sol de la
maison les ongles, les cheveux du dfunt, leau qui a servi laver le
cadavre (
683
). On peut agir sur autrui (et sur tous les siens) ds quon possde
une part ou un rsidu de sa substance. En lui en drobant quelque portion
choisie, on peut aussi sannexer ce qui l dtient de vie, la puissance de sa vue
ou de son oue si lon sempare dyeux ou doreilles, la vie sa source mme
si lon drobe le premier sang des vierges ou lembryon peine form. Ces
pratiques, encore punies par les codes des dynasties les plus rcentes, ne sont
point nouvelles. Ce ntait point par cruaut ou dilettantisme de tyran que
Marcel GRANET La pense chinoise 231
Cheou-sin, le dernier des Yin, ventrait les femmes enceintes et mangeait la
chair de ses ennemis (
684
).
322
Tout chef, tout magicien a besoin de rcuprer
de la puissance, de la substance, de la vie, car il doit dpenser, au profit de
tous, son entire vitalit. Le magicien use la sienne quand il anime les
marionnettes ou fait se combattre des pices sur lchiquier (
685
) ; le cocher
suse aussi quand il donne de la cohsion aux rnes. Mais combien plus le
Chef ! Il obtient, par un effet direct dinfluencement (ce serait parler notre
langue que de dire par un effet desprit esprit), que les chevaux de son ch ar
marchent droit ds quil pense droit, que les flches de ses sujets touchent
juste ds quil pense juste. Il suffit que le magicien atteigne son ennemi avec
sa salive ou quil souffle sur son ombre, pour que, rong dulcres, le
malheureux prisse (
686
) : dans sa salive ou dans son souffle, le magicien a
concentr lessence de ses vertus magiques. Mais luvre royale exige la
concentration dune puissance danimation vraiment totale. Dans tous les
guerriers passe le seul souffle du Chef : celui-ci, en battant le tambour,
communique la bataille entire le rythme de sa propre ardeur (
687
) Un dcret
a force dexcution ds que le prince a dit oui ; il est efficace, en
lui-mme, tout aussitt, et peu importe que dans la pratique on lexcute : en
ce oui sest condense toute la vertu danimation que la pratique de
ltiquette maintient intacte dans le prince. Sil y a une tiquette du costume,
de la coiffure, du rire, des lamentations, du cot, sil faut que linfrieur, par
respect. tantt se vte et tantt se dvte, que la femme demeure toujours
habille et que la sorcire opre toute nue, quon rase les criminels, que les
cheveux des femmes soient sans cesse cachs, tandis que la magicienne danse
chevele, si le Chef tantt rase ses poils pour les offrir aux dieux, tantt
shabille hermtiquement comme une femme et tantt danse les cheveux pars
comme une sorcire, si lon doit viter de biller, dternuer, de cracher, de se
moucher, de tousser, de roter, sil ne faut ni rire ni pleurer inconsidrment,
mais sil faut en temps de deuil se lamenter pleine voix, si lon fait amiti
par le rire ou le sourire, si le pre doit rire quand il donne droit la vie au petit
enfant, si lenfant doit ri re ds quil reoit un nom de son pre et pleurer pour
mriter ce nom, sil est dangereux pour une femme quon lui arrache un rire
ou quelle ne sen laisse point arracher,
323
si elle doit cacher son sourire en
voilant sa bouche de ses manches et si elle ne doit jamais drober lhomme
un soupir, sil faut tantt se livrer, tantt se conserver, si le Chef, qui devra
parfois se dpenser entirement, prend plus de prcautions que tout autre pour
demeurer hermtique et muet, cest que le corps, par tous ses orifices, laisse
pntrer et laisse chapper, sait retenir, projeter et mme capter, substance qui
vaut puissance, puissance qui vaut substance, ce qui fait ltre et ce q ui fait
tre.
Tous les auteurs, et non pas les seuls taostes, saccordent sur le principe
que les activits, les passions, les sensations usent ltre et diminuent en lui
substance et puissance. Tous admettent aussi que les orifices du corps sont les
organes des sens, que les Passions et les Activits (ou les Vertus) dpendent
Marcel GRANET La pense chinoise 232
des Magasins (fou) ou des Viscres auxquels on donne le nom de Greniers
(tsang), et que Viscres, Magasins, Ouvertures se correspondent. Tandis que
les Chinois confondent les ides de substance et de puissance dans lide
dtre, ils accordent, comme on voit, la nourriture une extrme importance.
La valeur dun individu se voit au nombre des vassaux quil peut nourrir (
688
),
et ce qui constitue son autorit, cest la faon dont il se nourrit lui -mme :
cest le lot de nourriture qui lui est attribu. La res pectabilit, la richesse de la
table, labondance de vie, la qualit de lefficace, sont choses lies,
indistinctes. Seuls, pourrait-on dire (pour parler notre langage), les nobles ont
une me : ils ont seuls des anctres qui mritent dtre nourris. Les nobles, les
chefs, les dieux sont riches en substance et puissance : ce sont des
pourvoyeurs de nourriture. Ce quils possdent en abondance, ils affe ctent de
le donner et den faire fi pour eux -mmes. Toute la nourriture est eux : ils
nen prennent que lessence ( tsing) ou la vertu (t) (
689
). Ils se contentent de
humer ou de goter. La vie en eux se fortifie en mme temps quelle se
spiritualise. Le dosage protocolaire de la nourriture saccompagne, en effet,
dune tiquette de la table (
690
). Qui mange selon ltiquette, affine et accrot,
toffe et anoblit, rconforte, complte et condense en lui une vitalit dessence
plus subtile et de teneur plus riche. Seul le Roi a la nourriture prcieuse ,
dit le Hong fan : il est le centre, le pivot du Monde (
691
).
324
Les mdecins
combinent pour lui les saveurs (
692
) et son premier ministre, le meilleur
ministre est celui qui se connat en cuisine (
693
), alimente, en la personne
du Souverain, la Vertu Royale (Wang Tao) (
694
) : il organise le tribut de faon
que rien ne manque pour composer lme du matre, je veux dire : pour
sustenter une Autorit qui, digne de lUnivers, soit la plus entire possible et
la plus une, la moins matrielle et la moins prissable : telle, enfin, quon
puisse voir en elle le foyer dun rayonnement sans dper dition. Pour conserver
intact ce principe dinfluencement, il suffit de recueillir, dans les temps et les
lieux convenables, lessence de tout ce qui est vie dans lUnivers. Le premier
ministre fait venir, pour son Matre, le cresson du Marais de Yun-mong, les
fves yun du Mont Yang-houa, et, du fond du Kouen -louen, la marsilea
quatre feuilles (
695
). Il apprend aux mdecins comment doivent se combiner
et sunir ( tiao ho) (
696
) les saveurs. Les sauces, selon les saisons seront
base de vinaigre, de vin, de gingembre ou de sel, mais toujours lies avec du
miel, car le doux correspond la Terre, qui est au Centre (
697
). Le bl sera
mang au printemps avec du mouton et une sauce au vinaigre, car le mouton a
une odeur rance, et lacide, qui va avec le rance, co nvient au Printemps, qui
desserre et pendant lequel il faut rassembler (
698
). Au reste, lEst est le
site des Muscles qui dpendent du Foie que lAcide, produit par le Bois,
produit son tour (ainsi le dcrte le brviaire de la mdecine) (
699
). En
combinant les viandes des 5 (ou des 6) Animaux domestiques, les 5 (ou les 6)
Aliments vgtaux, les 5 Odeurs et les 5 Saveurs, on rparera, selon un rythme
conforme lOrdre du Monde, les 5 Viscres (
700
) dont les experts pourront
vrifier le bon tat en inspectant les 9 Ouvertures et en examinant, laide des
5 Sons et des 5 Couleurs, les 5 Exhalaisons (ki ) (
701
). Ce serait un indice
Marcel GRANET La pense chinoise 233
nfaste et o lon verrait la preuve dun dtraquement du Microcosme et du
Macrocosme, si, en Hiver o le Fils du Ciel doit revtir des ornements noirs, il
navait pas le teint noir, je veux dire couleur des Reins, car lInfluence ( ki )
des Reins (puisque le sel assaisonne la nourriture hivernale, millet et viande
de porc) doit prdominer. Pour les mmes raisons, il faut encore, en hiver, que
la voix rende la note yu.
325
Lhomme est le cur du Ciel et de la Terre, la
rgle des 5 lments : quand, nourri par les 5 Saveurs, il distingue les 5 Notes
et revt les 5 Couleurs, alors il a de la vie (
702
) ! Les nobles mangent leur
fief (
703
) : lHomme Unique, saison par saison, mange lUnivers. Il
emmagasine, en temps utile, dans les 5 Greniers de son corps, lessence de ce
que la vie universelle produit de plus exquis. Il cueille dans les 5
Saisons-Orients la vie dans sa fracheur premire. Il nourrit son tre de
primeurs. Les grains en eux ont de la vie , dit le Che king (
704
). La vie
sextrait, plus puissante, des aliments frais -vivants (
705
), quand on ly p uise
dans sa nouveaut et si pure quelle est alors, pour limpur, un poison mortel.
Les entrailles dun prince mauvais, ds quil mange du bl nouveau, se
tournent en pourriture et en fumier (
706
) ; celles du sage demeurent nettes et la
puret saccrot en lui avec la vie quand il se sacralise en gotant, aprs les
dieux, la vertu (t) des offrandes saisonnires. Si la vie est dans la
nourriture, dans la nourriture est aussi un principe de mort et de corruption.
Tout repas est une ordalie, et, plus encore, toute beuverie, car la boisson est un
extrait, extrait de vie ou extrait de mort, qui excute les coupables et
rconforte les bons (
707
). Aussi est-ce au moment du renouveau que ltiquette
impose au Chef lpreuve dcisive de la boisson. Il faut quil se montre
capable dassurer la pren nit des rcoltes, la perptuit de la vie. Il mritera
de rester le Chef, on lacclamera en criant Dix mille annes ! (
708
), si le
succs de lpreuve montre que, pour lui, la vie nest point poison. Sil boit
autant quil convient et reste droit (
709
), cest quil est pur et que, par le
renouveau de sa vitalit, il sapparie au Macrocosme.
Les Chefs seuls paraissent avoir de lme . Ce sont les ribotes et les
ripailles sacres qui entretiennent leur puissance, rajeunissent leur substance,
accordent leur vie au rythme de lUnivers. Les Chinois ne croient point que
lme donne la vie au corps ; ils croient plutt, pourrait-on dire, que lme
napparat quaprs un enrichissement de la vie corporelle. Mais il vaut mieux
viter le mot me auquel rien, en chinois, ne correspond si on veut lui
donner la signification dessence uniquement spirituelle. Les mot s kouei et
chen quon traduit par dmons ou revenants et par
326
esprits ou
dieux se rapportent des manifestations tangibles. Pierres qui parlent,
sangliers qui tuent, dragons qui se combattent (
710
), les kouei ou les chen
apparaissent toujours sous une forme matrielle. Les Anctres eux-mmes ne
boivent et ne mangent que parce que les crmonies du culte leur permettent
de se rincarner dans le corps dun de leurs descendants. Pour mriter le nom
de chen, il faut avoir une place reconnue dans la hirarchie fodale ; il faut
tre honor dun titre nobiliaire comme le sont le duc du Tonnerre et le comte
Marcel GRANET La pense chinoise 234
du Vent. Inversement, un seigneur peut, puisquil est chef de culte, tre
qualifi de chen (
711
). Le mot convient pour tout tre investi dune autorit
religieuse. On parle de kouei quand il se produit une manifestation inattendue,
inquitante, illicite. Les sages ne croient pas que les pierres parlent, que les
dragons joutent et se combattent, que les morts reviennent tuer leurs
ennemis (
712
). Ce dernier cas est celui qui semble le plus frquemment se
produire ; les sages calment lmotion du public en autori sant un sacrifice :
tout tre qui mange est apais. Rgulirement appoints, les chen reoivent
chacun un lot protocolaire de nourriture et de vie ; tels les nobles qui mangent
sur lestrade du Chef, ils vivent la cour du Souverain dEn -haut, do ils
peuvent humer la fume des sacrifices. Tout ce qui ne peroit pas un tribut
saisonnier doffrandes, esprits irrgulier s qui ne figurent pas sur les listes du
protocole, aeux bout de carrire dont le nom (ming) a t repris par les
vivants, morts vulgaires qui nont jamais mrit davoir un nom (ming), tout
cela (que le mot kouei peut dsigner) nest nourri que par occa sion. Il sagit
dtres dont la place est dans le monde dEn -bas et qui ne devraient plus sortir
des Sources jaunes. Ils sen chappent cependant si, par malheur, le sol vient
se fendiller (
713
). Pour les faire rentrer sous terre, pacifis, il suffira
dhumecter le sol en y faisant pntrer la libation ; celle-ci, comme dans les
sacrifices la Terre, sera faite du sang qui coule des viandes crues. Seuls les
chen ont droit aux exhalaisons (ki ) qui schappent des viandes cuisin es.
Diffremment et ingalement nourris, ni les chen ni les kouei nont la pleine
(cheng) vitalit qui caractrise les hommes, largement pourvus de Sang (hiue)
et de Souffle (ki ). Les matres de la divination admettent que la
327
fin et le
commencement, la mort et la vie dpendent des jeux du Yin et du Yang, des
combinaisons du Sombre (yeou) et du Lumineux (ming), des joutes et des
unions du Ciel et de la Terre. Cest le Tsing (lEssence) et le Ki (le Souffle)
qui constituent les tres (wou = les 10 000 tres : lHomme na point une
place part) ; ce sont les voyages du Houen qui sont (le principe) des
alternances (dtat des tres), et cest ainsi quon peut distinguer les aspects
essentiels de (ce qui est) kouei ou chen (714). Questionn au sujet des kouei
et des chen, Confucius, du moins on laffirme, rpondit : Le Souffle (Ki ) est
la pleine perfection (cheng) de (ce qui est) chen ; le Po est la pleine perfection
de (ce qui est) kouei. (
715
). Les Chinois, en effet, opposent le Sang et le
Souffle, le Houen et le Po. La formule prte Confucius montre que le
Houen ne se distingue pas du Souffle. Le Po ne se distingue pas du Sang. Une
dfinition clbre [on lattribue Tseu -tchan de Tcheng (534 av. J. -C.), et
elle exprime sans doute des conceptions trs anciennes], faisait du Po le
principe de la vie embryonnaire, le Houen napparaissant quaprs la
naissance (
716
), cest --dire, les rites le montrent, quand le pre, riant et
faisant rire lenfant, lui a communiqu son souffle en lui donnant un nom
(ming). La mort a lieu quand le Houen part en voyage et, ds quon constate
que le Souffle est parti, on rappelle (en criant le ming) le Houen, quon essaie
de rattraper au sommet du toit, avant quil ne sen aille en Haut rejoindre le
Ciel lumineux. Quant au Po (le nouveau-n prend vie mme la terre), il
Marcel GRANET La pense chinoise 235
retourne (kouei) la terre et devient alors kouei. Le corps doit pourrir et se
dsagrger en Bas, dans lObscurit (Yin), et toutes le s odeurs sont des
manations (tsing : les tsing sont les Essences que le Hi tseu oppose au ki,
aux Souffles) qui proviennent des corps enfouis : ainsi sexprimait, dit -on,
Confucius, et il ajoutait que le Ki slance vers le Haut pour y briller. Si lon
nous impose de traduire les mots houen et po, nous devons dire que le Houen
est lme -souffle et le Po lme( -du-)sang ; mais sans compter limproprit
du mot me , lemploi du singulier fait certainement contresens. Le Houen,
cest le Ki (cest le Souffle), et cest les Ki , les Influences, les Exhalaisons,
et le Po, cest le Sang, mais cest le Tsing, lEssence, et les Tsing, les
manations. En effet, dans le ki et le tsing, qui
328
constituent les tres (les
tres de toutes sortes), comme dans le Sang et le Souffle qui constituent les
vivants, il faut voir des couples complexes. Ce sont des couples parce que
lanti thse du Yin et du Yang domine la pense ; ce sont des couples
complexes, parce quau -dessous de la catgorie de Couple rgnent dautres
catgories numriques, classifications par 5 et 6, par 7, par 8 et 9... La thorie
dite des mes viscrales (717) nest point atteste avant lre chrtienne,
mais la liaison des Passions nommes tsing de mme que les
manations (
718
) avec les Viscres est une donne ancienne comme la
correspondance tablie entre les Passions et manations et les Ki , Influences
ou Exhalaisons du Ciel, Exhalaisons des viscres et des orifices du corps. Les
kouei et les chen ne sont pas des mes dsincarnes. Le Houen et le Po ne sont
pas deux mes, lune matrielle, lautre spirituelle : il faut voir en eux les
rubriques de deux lots de principes de vie qui ressortissent les uns au Sang et
toutes les humeurs du corps, les autres au Souffle et toutes les exhalaisons
de lorganisme. Les unes sont yang, car le pre fournit le souffle et le nom, les
autres yin, car la mre fournit le sang et la nourriture. Celles-ci tiennent de la
Terre qui porte et nourrit ; celles-l du Ciel qui embrasse, rchauffe (719) et
vers qui sexhale la fume chaude des offrandes, tandis que le sol,
quhumectent les libations, sengraisse des produits de la dcompo sition des
corps. La Terre les rendra sous forme de nourriture, car la vie alterne avec la
mort, et tout retourne la vie comme tout retourne (kouei) la mort, un ordre
cyclique et un rythme quinaire prsidant aux rincarnations comme au retour
des saisons.
*
* *
Rebelle tout postulat spiritualiste, la psychologie chinoise est une
psychologie du comportement qui sadapte une morale de lattitude.
Les missionnaires reconnaissent aujourdhui volontiers quon ne peut
relever en Chine aucun vestige de lide de chute ou de faute originelle (
720
).
Mais leurs prdcesseurs taient ce point proccups de dcider si, dans la
conception chinoise, la nature humaine tait foncirement bonne ou
329
Marcel GRANET La pense chinoise 236
mauvaise, quils ont impos aux sinologues la traduction par le mot nature
du terme sing . Sing scrit avec la cl du cur (ce qui incite lui prter
une acception purement morale) ajoute au signe qui veut dire vie . Cest
ce dernier symbole graphique qui donne la prononciation de lensemble. Il en
est llment significatif. Sing se dit du lot de vie qui caractrise un individu.
On lemploie aussi quand on veut parler de personnalit ou, plutt, de
lensemble des dons qui constituent , tant au physique quau moral,
domaines indistincts, lindividualit et la valeur dun tre. Aussi est -il
souvent difficile de conserver pour sing la traduction nature ou mme
caractre (au sens moral du mot). La difficult devient apparente quand on
doit traduire une phrase visant non pas dfinir, les Chinois ne dfinissent
jamais. mais faire entendre ce quest le sing. Lhomme est compos
dlments matriels et dune me intelligente , crit le P. Couvreur (
721
) ;
Chavannes (
722
) crit : Lhomme a, de naissance, le sang et la respiration, un
cur et une intel ligence. Ces deux traducteurs prtendent rendre la mme
phrase, dont voici le sens : Lhomme a un s ing [une individualit, un
ensemble de dons vitaux (principalement) faits] de sang, de souffle, de
volont (cur), de sapience Lemploi du mot cur qui dsigne (le
sige de) la volont (tche) parce quil est le nom du viscre central et du
mot ki symbole du Souffle, mais aussi de lardeur, du temprament, de
lnergie montre suffisamment quon na point lide dopposer les facults
de lesprit aux princi pes de la vie corporelle. Cur et sapience se rapportent,
plutt qu la vie spirituelle, aux foncti ons de dpense plus ou moins
distingues des fonctions de rcupration : la volont et la sapience emploient
et usent la puissance vitale, que nourrissent (entre autres lments) le sang et
le souffle. Cette phrase tire du Yo ki mrite dtre confront e avec
laphorisme, cit plus haut, du Hi tseu : Les tres (wou) sont faits de tsing
(et de) ki , cest --dire dExhalai sons et dmanations provenant du Ciel o
rgne le Souffle (ki ) et de la Terre qui produit les Essences (tsing) nourri-
cires. Les mdecins voient dans le tsing (et le) ki ce quon inhale ou exhale :
ils appellent tsing-ki les liqueurs fcondes du corps humain (
723
) Quant au
mot wou (tre, emblme),
330
il se rapporte tous les tres que nous
qualifions danims et dinanims, car tout ce qui est symbolis est. Ds quil
y a emblme , il y a tre . On admet de mme que tout, et par exemple,
la Terre comme le Ciel, a un sing (
724
), cest --dire de ltre et une manire
dtre. Toute individualit est un complexe et correspond une certaine
combinaison dlments. Les composants ( tche) ne sont jamais conus ni
comme uniquement spirituels, ni comme uniquement corporels. On dit mei
tche pour parler des bonnes qualits, tche ki pour dsigner lhumeur ou le
caractre, tsai tche pour exprimer les talents naturels ; on appelle tsai li la
force qui permet de se tenir droit et de procrer et Tien tche les facults
procratrices ou, tout aussi bien, une nature cleste, tche (lments)
pouvant dailleurs signifier nature ou aspect quand il sagit dun
morceau de pierre ou de mtal. Toute nature (sing) est donc le produit
dun certain dosage et dune combinaison ( ho) plus ou moins harmonieuse
Marcel GRANET La pense chinoise 237
(ho), ainsi sont faits les bouillons dont on nourrit les Chefs (
725
),
dlments qui ressortissent de lEau, du Feu, du Bois, du Mtal, de la Terre et
qui appartiennent au Yin ou au Yang. Ce sont les proportions du dosage qui
caractrisent la nature intime (tchong, intrieur, quivaut sin, cur) dun
tre ; cette nature est le rsultat dune imbrication ( kiao) des Exhalaisons
(ki ) du Yin ou du Yang quon qualifie de faibles ou de fortes ( la manire
des lignes des Hexagrammes) (
726
), ou encore de tsing et de tchouo ( la
manire des sons) : tchouo voque le lourd, lpais, le mlang, lobscur, le
grave ; tsing (= tsing, essences, manations), le tnu, le clair, le limpide,
laigu, le lger (
727
). Cest donc une opposition du subtil et du grossier et non
une opposition de lesprit et de la matire que se ramnent les distinctions
quon tablit, je ne dis pas entre les substances, mais entre les tats ou, plutt,
les aspects rythmiques pris par les lments dont la combinaison produit ltre
et la personnalit. Aussi le sing, la manire dtre, correspond -il une certaine
aptitude tre, un lot de vie affrent un temprament dtermin. Tel qui,
dans son enfance, tta goulment et prit, vu le ki (Souffle) dont il se trouvait
pourvu, trop de lait, ne pourra jamais disposer dune complexion ( sing)
solidement quilibre : il vivra en malade et mourra bientt (
728
). Tel
331
autre qui se porte mal parce que sa volont (tche) lui impose des dpenses trop
fortes, tant donn son ki (sa capacit de rcuprer du Souffle), pourra
gurir : il gurira sil trouve un mdecin pour laider troquer son cur ( sin :
cur , et volont : tche, ne se distinguent pas) avec le cur dun autre malade
dont le ki par rapport au tche sera surabondant mais, sitt lopration
russie, lun et lautre, ayant chang de sentiments ( sin = cur), devront aussi
changer de femmes, denfants, de ma ison, de situation sociale (
729
). Il y a,
comme on voit, des natures bonnes, dautres qui sont mauvaises et
dautres quon peut amliorer...
La vitalit, les complexions, les sorts diffrent parmi les hommes.
Lhomme (comme l es autres tres) est fait du sing du Ciel et de la Terre ; il
tient de la Terre son sang, ses humeurs fcondes et nourricires, telles les
sves ; il tient du Ciel son souffle chaud et subtil ; il tient de tous deux le
rythme battement du pouls et respiration qui entretient ou plutt
constitue en lui la vie. Mais cest le Ciel (honor comme un pre, pourvu
dautorit, lou pour sa permanence et son unit) qui distribue les sorts, les
rangs, les lots de vie, les destins : le mot ming ( ming signifie ordonner et
se confond souvent avec un autre ming qui signifie donner un nom )
veut dire tout cela. Le souffle, qui vient du Ciel, varie surtout par la
puissance ; le sang, que nourrit la Terre, varie surtout par sa composition. Au
Ciel se rattache la personnalit, la Terre lindividualit qui dpend de
linfini varit des Espaces. Lunit du Ciel cependant est toute relative ; il se
diversifie selon les saisons ; le Temps na de continuit que dans les instants
sacrs o il sinaugure ; des moments riches en dure sopposent des
priodes o la dure sextnue. Quand rgne un ordre neuf et durable de la
civilisation, le souverain peut distribuer durablement des fiefs et le Ciel
rpartir des lots de longvit : les hommes vivent vieux et, daille urs, tout dure
Marcel GRANET La pense chinoise 238
lorsquun sage souverain tablit dans le monde un ordre qui mrite dtre
permanent. La valeur de la personnalit dcrot quand lEmpire et le Ciel
perdent leur unit ; par temps de dcadence, la varit des Espaces contamine
le Temps ; les lots de vie se raccourcissent ; les monstres apparaissent ;
lindividualit se dveloppe abusi vement et fait tort la personnalit : plus
exactement, les
332
tempraments se singularisent et la puissance vitale
diminue aussitt. Cela ne veut pas dire que les Chinois dtestent les monstres
ou mprisent entirement les spcialistes. Il y a, comme on a vu, des occasions
et des sites o le Chef lui-mme se doit de ntre que droitier ou gaucher. Le
sage utilise tous les climats. Il sait se servir de la fougue des mridionaux,
chez lesquels le ki lemporte au point quils peuvent se nourrir uniquement de
crudits (
730
). Il sait employer les bossus (nombreux en Occident) dont le dos
ressemble une hotte [car lautomne (= Ouest) e st le temps des rcoltes] : ils
porteront, penchs en avant, les pierres sonores, tandis que, ploys en arrire,
des tres dos concave frapperont les cloches de bronze (
731
). Au reste, la
plupart des Hros, tels des arcs bands ou dbands, se courbent en avant ou
en arrire (
732
). Lidal cependant, est que le Chef soit droit comme un gno -
mon. Le sage utilise tous les ges. Il sait employer comme sorcires, pour
commander le temps, les vieilles femmes qui leurs rgles ont fait perdre une
bonne part de leur sang : presque rduites au souffle, ployes en arrire, elles
tendent vers le Ciel leurs narines si bien que, craignant dengorger avec de
leau un orifice fait pour aspirer le Souffle, le Ciel sin terdit de faire tomber la
pluie (
733
). Le sage sait aussi employer les phtisiques que leurs crachats
appauvrissent en sang, et il admet que les sorciers (et mme les chefs)
sentranent pour obtenir, avec lmaciation, une surabondance de ki . Il
tolre, mais il surveille, car elles reclent un danger tout en se montrant,
loccasion, utilisables, les individualits excessives que signalent quelque
insuffisance ou quelque hypertrophie. Il envoie des experts la recherche des
manations qui peuvent trahir la puissance naissante dun gnie rival (
734
). Il
entretient des historiens pour cataloguer les dformations physiques dans
lesquelles lart des physiogno mistes sait voir des signes de fortune ou des
preuves de talents (
735
). Il possde encore des ethnographes, des gographes
pour le renseigner sur les complexions qui dpendent de la structure du sol ou
des genres de vie. Les complexions (tsai ) varient selon le Ciel et la Terre, le
Froid et le Chaud, lHumide et le Sec. Dans les plaines larges et les longues
valles, la corpulence diffre (
736
). Les murs dif frent aussi. Les tribus des
quatre orients de lEmpire ont
333
des sing, des manires dtre, qui
varient , car les 5 Saveurs sy combinent diversement et la diversit de
nourriture fait que les hommes y sont faibles ou forts (comme les lignes des
Hexagrammes), lourds ou lgers (comme les sons et les parties dun
breuvage), lents ou vifs : les uns sont carnivores, les autres frugivores et, si
ces derniers sont lestes et stupides, les autres sont braves et audacieux... Le
sage laisse subsister dans les franges du Monde les manires de vivre et dtre
qui ne sont point conformes ltiquette. Il ne ddaigne pas les individus
pourvus dun gnie excentrique, sil peut les tenir au loin ou les domestiquer.
Marcel GRANET La pense chinoise 239
Pour lui et les siens, il recherche la complexion quilibre qui accompagne un
riche Destin. Quand il attend un fils, il impose sa femme une retraite stricte
et une surveillance constante : cela sappelle duquer lembryon (
737
). Si
cest un fils de roi qui va na tre, on suit les usages placs sous linvocation de
Tai Sseu, lir rprochable pouse du roi Wen. [Tai Sseu, pendant sa
grossesse, ne se permit jamais, mme dans le priv, aucun laisser-aller ; elle
ne se tint jamais, debout, sur une seule jambe, assise, de travers sur sa natte ;
elle vita tout rire bruyant et, mme en colre, sabstint de jurer.] Trois mois
avant laccouchement, le matre de musique vient, muni dun diapason,
prendre la garde la gauche de la porte ; le grand intendant (premier ministre
et chef de cuisine) se poste droite, la louche en main. Quand la reine
demande un peu de musique, si ce nest point un air convenable, le matre de
musique brouille les cordes de sa guitare et fait lignorant ; quand elle rclame
manger, le grand intendant incline sa louche en disant, si ce nest pas un
mets correct, quil nose point le servir au prince hritier. Aussi, quand
celui-ci nat et quavant de lui donner le nom ( ming) qui dfinira sa destine,
on commence par dterminer laide du diapason celle des 5 Notes sur
laquelle il vagit et (par un procd que nous ignorons) celle des 5 Saveurs qui
lui conviendra, on peut tre certain que souffles et sucs nourriciers, puissance
et substance, lot de vie et complexion, tout en lui sera de la qualit la
meilleure (
738
).
Nous verrons, en parlant, propos des Taostes, des pratiques de la longue
vie, que la Saintet sacquiert en soumet tant une gymnastique et un
entranement rythms ce
334
que nous appelons les fonctions nutritives,
sexuelles, respiratoires... Cette rythmique batifiante est parfois utilise par les
adeptes htrodoxes du Tao pour obtenir, avec des dons magiques, tels talents
spciaux. Les sages vritables admettent tous, sans distinction dcole, que le
premier devoir de tout tre est de rechercher un dveloppement complet de
son gnie. Quelques mystiques prtendent saffranchir des limites que les
traditions imposent aux destines humaines. Pour tous les autres, ce sont les
rgles traditionnelles de lart de vivre qui permettent chacun de tirer le
meilleur parti possible de son lot de vie et de sa complexion. Prendre soin de
son ming et de son sing, cest protger tout ensemble sa personnalit et son
individualit ou, plutt, cest dfendre, dans les limites permises par le
protocole et lorganisation hirarchique de la socit, un lot de puissance
dment dose et qualifie. Dans la mesure o il y a une psychologie et une
mtaphysique chinoises, elles ont pour fonction de glorifier ltiquette.
*
* *
Le matre de musique a droit la gauche, place dhonneur, et le chef de
cuisine lui fait face droite (
739
). Les Chinois ne distinguent gure la
substance de la puissance ; toutes leurs notions sont domines par les ides de
Marcel GRANET La pense chinoise 240
rythme et dautorit sociale. Do limportance quils accordent aux Rites et
la Musique : ils les opposent comme les deux aspects complmentaires de
ltiquette. Les Rites tablissent parmi les hommes et tout ce qui dpend
deux les distinctions ncessaires. La Musique oblige tous les tres vivre en
bonne harmonie.
Les Rites disait (parat-il) Tseu-tchan (
740
), ce sont les
dlimitations (propres) au Ciel, les rpartitions quitables (yi)
(propres) la Terre, la conduite qui convient aux hommes. Le Ciel
et la Terre ont des dlimitations (qui leur sont propres) et les
Hommes les prennent pour modles (ts) ; ils se modlent sur les
clarts (les astres) du Ciel ; ils se fondent sur la complexion (sing)
de la Terre. Quand sont produits les 6 ki (Influences, Exhalaisons)
et mis en activit
335
les 5 lments, les Exhalaisons forment les 5
Saveurs, se manifestent par les 5 Couleurs, se symbolisent au
moyen des 5 Notes. Sil y a excs (dans leur emploi), confusion et
troubles en rsultent. Les hommes perdent alors la complexion
propre chacun deux ( sing). Les Rites servent la leur conserver.
Il y a 6 Animaux domestiques, 5 Animaux sauvages, 3 Animaux de
sacrifice qui servent la prsentation des 5 Saveurs ; on fait 9
Emblmes, 6 Ornements, 5 Dessins pour prsenter les 5 Couleurs ;
il y a 9 Chants, 8 (Instruments de musique correspondant aux 8)
Vents, 7 Sons, 6 Tubes yang (et 6 Tubes yin) afin de prsenter les 5
Notes ; il y a (les rapports de) seigneur () vassal, (de) suprieur ()
infrieur, par lesquels on prend modle sur les rpartitions
quitables (yi) (propres ) la Terre ; il y a (les rapports de) mari ()
femme, (de l) extrieur (et de l) intrieur qui servent
dlimiter (741) les deux (sortes d) tres ( wou : essences, ralits
emblmatiques) ; il y a (les rapports de) pre () fils, (de) frre an
() frre cadet, (de) tante () cadette, (de) gendre () beau-pre, (d)
allis par mariage, (de) beaux-frres, qui servent symboliser les
clarts du Ciel (les rapports des astres) ; il y a les actes de
gouvernement, les travaux du peuple, qui servent obir aux 4
Saisons ; il y a les chtiments, les pnalits, qui inspirent aux
peuples le respect des interdictions et qui correspondent (lei) aux
destructions du Tonnerre et des clairs ; il y a la douceur,
laffection, la bienfaisance, la concorde, qui servent imiter la
force productrice du Ciel et son action nourricire (
742
). Les
hommes ont (les 6 Passions, savoir :) lAmour, la Haine, la Joie, la
Colre, la Peine, le Plaisir qui naissent des 6 ki (Influences,
Exhalaisons clestes). Aussi (les Sages) ont-ils, aprs tude, pris
pour rgler les convenances et les correspondances afin de
rglementer les 6 Tche (Volonts, Impulsions). La Peine fait gmir
et se lamenter ; le Plaisir, chanter et danser ; la Joie produit la
bienfaisance ; la Colre, les combats et les rixes. Le Plaisir nat de
lAmour ; la Colre de la Haine. Aussi (les Sages) ont-ils, aprs
Marcel GRANET La pense chinoise 241
tude, mis en usage et, de bonne foi, ordonn, les Rcompenses et
les Chtiments [mot mot : (les distributions de) Bonheur (et de)
Malheur], les Largesses et les Punitions. La vie est chose aime ; la
mort, chose hae ; une chose aime fait plaisir ; une
336
chose hae
fait peine. Quand la Peine et le Plaisir sont bien utiliss, il peut y
avoir harmonie [entre (la complexion de) lhomme] et la
complexion du Ciel et de la Terre ; et cest l ce qui fait durer
longuement (la vie).
Les Rites sont le fondement de lOrdre (social et cosmique) : cest grce eux
que se ralise une rpartition quitable (yi) des portions (fen) dautorit
sociale.
Le Ciel et la Terre sont les principes de la vie... Ce qui distingue
(les tres), cest que ceux qui sont nobles servent noblement
(tandis) que les vilains servent dans les besognes viles : il convient
que les grands soient grands, et vils les vilains (
743
).
La Musique est ce qui rapproche (tong) ; les Rites, ce qui
diffrencie (yi). De lunion rsulte laffection mutuelle ; des
diffrences le respect mutuel... Permettre aux Passions (tsing) de
saccorder, donner aux manires de belles appa rences, tels sont les
rles de la Musique et des Rites (
744
).
Ds quon met en action la Musique,
les (5) rapports sociaux sont bien observs ; les yeux et les
oreilles voient et entendent bien ; entre le sang et le souffle
stablit un quilibre harmonieux ; les murs se civilisent ; la
Terre des Hommes est paisible (
745
).
De la Musique rsulte lunion harmonieuse du Ciel et de la
Terre, et des Rites la bonne ordonnance du Ciel et de la Terre ;
quand il y a union et harmonie, tous les tres (wou) obissent
laction civilisatrice (du Fils du Ciel) ; quand il y a bonne
ordonnance, tous les tres conservent la place distincte (qui leur est
assigne). La Musique tire du Ciel son rendement (civilisateur) ;
les Rites empruntent la Terre leur (capacit de) rglementation.
(Si lon poussait ) trop de rglementation, lesprit danarchie se
dvelopperait ; (si lon exigeait) trop de rendement , lesprit de
domination se dvelopperait... Obtenir que les rapports (entre les
tres) ne crent point de dsordre, voil lessence ( tsing) de la
Musique, qui, par la satisfaction et la joie, le contentement et
lamour, invite agir. Conserver sans dvia tion un quilibre juste
et correct (
746
), voil la complexion (tche : lments constituants)
des Rites qui, par la gravit et le respect de soi, par le respect
dautrui et la docilit, aident la rglementation (
747
).
Marcel GRANET La pense chinoise 242
Quand la Musique est parfaite, il ny a plus de rbellion ; quand
les Rites sont parfaits, il ny a plus de querelles (
748
).
La
337
guitare a 81 pouces de long ; la corde la plus longue rend
la note kong (81) ; elle est place au Centre : elle est le Prince. (La
corde de la note) chang (72) stend droite ; les autres se placent,
les unes par rapport aux autres, daprs lordre de leurs
dimensions, sans aucune erreur : ds lors, vassaux et prince sont
leur place (
749
).
Kong (81, Centre) est le Prince ; chang (72, Ouest, droite), les
vassaux ; kio (64, Est), le peuple ; tche (54, Sud), les affaires
dtat ; yu (48, Nord), les ressources (du peuple, dsignes ici par
le mot wou : les dix mille tres) (
750
). Quand, dans les 5 Notes, il
ny a aucun trouble, tout est harmonieusement modul. Si (cest de
la note) kong (que vient le) trouble, (les modulations sont) rudes :
(cest que) le prince est arrogant. Si (cest de la note) chang (que
vient le) trouble, (les modulations donnent limage du) pench :
(cest que) les offices sont mal remplis. Si (cest de la note) kio
(que vient le) trouble, (les modulations sont) chagrines : (cest que)
le peuple devient rebelle. Si (cest de la note) tche (que vient le)
trouble, (les modulations sont) plaintives : (cest que) les affaires
dtat sont accablantes. Si (cest de la note) yu (que vient le)
trouble, (les modulations donnent limage dun) prcipice : (cest
que) les ressources manquent au peuple. Si le trouble vient de
lensemble des notes empitant les unes sur les autres, (cest que)
ltat va prir incessamment !
Les notes et la musique branlent le sang et ses conduits, mettent
en circulation les esprits vitaux (tsing chen : cette expression peut
signifier : humeurs fcondes) et donnent harmonie et rectitude au
cur (
751
).
Si lon scarte un i nstant des Rites, il ny a plus, au dehors, que
cruaut et arrogance ; si lon scarte un instant de la Musique, il
ny a plus, au dedans, que licence et perversion. La Musique
permet au sage (kiun tseu) de faire grandir (parmi les hommes le
sentiment des) rpartitions quitables (yi) (
752
).
Ces citations peuvent se passer de commentaires. Le respect des
distinctions protocolaires et de lharmonie traditionnelle qui rsulte dune
distribution hirarchique des sorts, voil ce que les Rites et la Musique sont
chargs dinculquer aux Chinois. Rites et Musique, par surcrot, leur
communiquent, rconfort suprme, le sentiment quobir ltiquette permet
aux individus dintgrer
338
rythmiquement chacun de leurs gestes dans le
grand systme rythmique de comportements qui constitue lUni vers. Ainsi
devient impossible lendosmose des microcosmes et du macrocosme : de cette
endosmose proviennent, avec la vie, lindividualit et la personnalit.
Marcel GRANET La pense chinoise 243
Ltiquette se voit donc attribuer la va leur combine dune hygine et dune
morale : le moral nest distingu ni du physiologique ni du physique.
Lexpression protocolaire des sentiments, prcisment parce quelle se fait
laide de symboles convenus et de gestes obligatoires, a la vertu de
discipliner les passions. Les rites chinois de la douleur le montrent
clairement (
753
). La peine, dans le deuil par exemple (
754
), doit sexprimer
temps rgls, selon un rythme que le protocole dfinit en tenant compte de la
valeur sociale du dfunt. Elle se traduit par des gestes, une tenue, un genre de
vie, un type de quarantaine minutieusement rglements. La faon mme de
pleurer en vagissant sans cesse, ou sans arrter la voix mais en se
lamentant, ou encore, en laissant tomber la voix aprs une triple modulation,
ou, enfin, en prenant simplement un ton plaintif, tait chose impose,
contrle. Rien ntait laiss linspiration du moment : toute impulsion
personnelle, toute fantaisie taient blmes svrement et disqualifiaient son
auteur, quil ft trop peu ou quil ft trop. Un homme qui avait perdu sa mre
pleurait comme un enfant :
Il a un deuil (ngai), quil ait donc de la peine ( ngai) ! dit
Confucius. Mais il serait difficile imiter, et le principe des Rites
est quon doit leur obir : il est donc ncessaire quil soit possible
de sy conformer. Pour les lamentations et les bonds, il faut quil y
ait une mesure (
755
) !
Tous les gestes du deuil ont pour fin dvacuer limpuret contagieuse de la
mort ; tous les gestes de la douleur tendent vacuer une impression dhorreur
ou de crainte : tous visent rendre inoffensive la douleur. Deux disciples de
Confucius virent un jour un afflig qui bondissait comme un enfant regrettant
un objet perdu. Lun deux dclara que lusage des bonds ne lui plaisait gure.
Il prfrait les douleurs moins exubrantes. Lautre lui dit :
Il y a des rites pour modrer les passions ; il y en a aussi pour les
exciter du dehors. Donner libre cours ses passions, cest imiter la
conduite (tao) des
339
Barbares. La conduite que prescrivent les
Rites en diffre. Quand un homme a de la joie, son apparence est
gaie ; il est gai et il chantonne ; il chantonne et il se dandine ; il se
dandine et il danse. Il danse et une peine lui arrive. En prise la
peine, il soupire ; il soupire et il se frappe la poitrine ; il se frappe
la poitrine et il bondit. Fixer une mesure et des rgles, tel est lobjet
des Rites. Un mort nous inspire de lhorreur (mot mot : de la
haine). Il est incapable en tout : nous nous cartons de lui. Les
Rites prescrivent de lenvelop per dun linceul, de vtements... afin
que nous cessions davoir de lhorreur... (
756
).
Quand un fils est en deuil et quil bondit et met en mouvement
ses membres, il apaise son cur et fait tomber son souffle
(ki ) (
757
):
Marcel GRANET La pense chinoise 244
les bondissements protocolaires lui permettent de redonner sa respiration et
aux battements de son cur une certaine rgularit rythmique.
La grande vertu des Rites (et de la Musique) tient au rythme rgulier quils
imposent la gesticulation et aux fonctions vitales. Quand les manires dtre
sont gouvernes par ltiquette, ltre sanoblit et mrite de durer. Sil fait
sienne cette symbolique, lindividu incorpore en lui la civilisation nationale. Il
peut alors tre reu parmi les hommes. Il a acquis une personnalit.
*
* *
Lhomme doit tout la civilisation : il lui doit lquilibre, la sant, la
qualit de son tre. Jamais les Chinois ne considrent lhomme en lisolan t de
la socit ; jamais ils nisolent la socit de la Nature. Ils ne songent pas
placer au-dessus des ralits vulgaires un monde dessences purement spiri -
tuelles ; ils ne songent pas non plus, pour magnifier la dignit humaine,
attribuer lhomme une me distincte de son corps. La nature ne forme quun
seul rgne. Un ordre unique prside la vie universelle : cest lordre que lui
imprime la civilisation.
Cet ordre sort de la coutume. Dans la socit que forment en commun les
hommes et les choses, tout se distribue en catgories hirarchises. Chacune
delles a son statut. Le rgime nest nulle part celui de la ncessit physique,
nulle
340
part celui de lobligation morale. Lordre que les hommes acceptent
de rvrer nest point celui de la loi ; ils ne pensent pas non plus que des lois
puissent simposer aux choses : ils nadmettent que des rgles ou plutt des
modles. La connaissance de ces rgles et de ces modles forme le savoir et
donne le pouvoir. Dterminer des apparentements et des hirarchies, fixer, par
catgories, en tenant compte des occasions et des grades, des modles de
conduite et des systmes de convenances, voil le Savoir. Pouvoir, cest
distribuer rangs, places, qualifications ; cest doter lensemble des tres de
leur manire dtre et de leur aptitude tre. Principe de la puissance
rgulatrice qui appartient au Chef, des talents ordonnateurs que dtient le
savant, de lautorit exemplaire que possde le sage, ltiquette inspire
lensemble des disci plines de vie ou des savoirs agissants qui constituent
lOrdre universel.
Que reste-t-il pour occuper lactivit des fondateurs de Sectes ou
dcoles ?
Pour ce qui est des ides, chez tous lemportera une passion dorthodoxie.
Les ides ne servent qu justifier les pratiques en les rattachant au systme
des notions communes. Nul sage ne savisera de contester le caractre concret
de lEspace et du Temps ou de voir dan s les Nombres les symboles de la
quantit. Les jeux des nombres, limbrication des classifications numriques,
les joutes du Yin et du Yang fourniront tous des symboles suffisants pour
Marcel GRANET La pense chinoise 245
faire apparatre dans les comportements de la Nature et des hommes un
rythme rgulier et un ordre intelligible. Cela suffit une mtaphysique qui
sinterdit de distinguer la matire et lesprit, qui prfre lide de modle
lide de loi, que seules intressent les hirarchies, les convenances, les
manires dtre. Aucu n progrs de ce que nous appelons les connaissances ne
saurait lmouvoir ou lenrichir.
Seuls, quelques grands esprits, dans le camp des Taostes, songeront
(mettant profit les trouvailles des explorateurs et des astronomes, mais
utilisant le lgendaire ou le thorique aussi volontiers que le confirm) se
servir de lide que le monde est immense pour illustrer le thme de la
puissance indfinie que confre la Saintet. Mme alors,
341
lide ne sert
qu justifier, pour les besoins de la polmique, un systme de pratiques, une
attitude corporative. Les enseignements rivaux ne cherchent pas dabord se
signaler par une doctrine originale : il leur suffit dachalander une recette. Ds
quil sagit, non plus dides, mais de pratiques, la passion du singulier
lemporte et, avec elle, lesprit de secte. Toute corporation prsente son savoir
comme une sorte de secret opratoire. Mais chaque discipline prtend aussi
quelle est seule en mesure dquiper lUnivers et ceux qui le rgentent, la
Civilisation et ceux qui la scrtent. Les spcialistes proposent un certain
savoir-faire qui correspond au meilleur savoir-tre, une faon de se gouverner
qui constitue lunique faon de gouverner : les secrets les plus spcifiques sont
toujours donns comme des panaces. Aussi les enseignements sectaires
finissent-ils par prendre une porte doctrinale. Ils en viennent prconiser, en
mme temps quun lot de recettes, un systme dattitudes qui sembl e procder
dune conception plus ou moins dfinie. On commence, dans le camp taoste,
par achalander des recettes de longue vie ; on arrive prsenter une concep-
tion en partie neuve et, sur certains points, trs hardie, de la Saintet et de
lEfficace. On commence, dans la corporation des lgistes, par prconiser des
recettes de rglementation ; on aboutit une ide rvolutionnaire et qui aurait
pu tre fconde, de la Loi et du Pouvoir princier. Cest ainsi que de diverses
proccupations corporatives et techniques est sorti un lot de problmes
philosophiques sur lesquels, pendant un certain temps, la pense chinoise
sest exerce.
Le nombre de ces problmes est demeur restreint. Lintrt quils ont
suscit na pas dur. Ils ne touchent gure qu la morale, ou, plutt, la
politique. Ils reviennent toujours poser, en termes plus ou moins neufs et
pour des fins toujours pratiques, la grande question des rapports du
Microcosme et du Macrocosme, de lIndividu et de la Civilisation. Comme les
solutions proposes lattestent, toute lactivit de pense que ces problmes
ont provoque a t dtermine par une crise sociale o le systme fodal et la
conception traditionnelle de ltiquette auraient pu sombrer. Lordre fodal,
cependant, est, pour le fond, demeur vivace. Lagitation philosophique qui
donne tant
342
dintrt la priode des Royaumes combattants a abouti au
triomphe de la scolastique. Un conformisme archasant a renforc le prestige
Marcel GRANET La pense chinoise 246
de ltiquette et de tout le vieux systme de classifica tions, de
comportements, de convenances.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 247
L I V R E Q U A T R I M E
S E C T E S E T C O L E S
343
Cest pendant la priode la plus mal connue de lhistoire de Chine que
la pense philosophique a rencontr ses plus vifs succs. Ces sicles (Ve-IIIe),
dcris par les historiens indignes qui les donnent pour un temps
danarchie (
758
), doivent tre considrs comme lun des plus grands mo ments
de lhistoire chinoise (
759
). La Chine tentait de se dlivrer du rgime fodal ;
sous ce rgime, la civilisation chinoise stait forme et largement tendue : il
restait faire de la Chine une Nation et y crer un tat. Prparant lEmpire,
de vastes royaumes, au cours des Ve, IVe et IIIe sicles, se sont crs et
heurts. Le pays a t amnag ; il sest peupl ; il a connu de grandes
guerres ; il sy est fait un grand brassement de populations et de classes ; il sy
est lev des oppositions violentes entre nobles et parvenus, riches et pauvres ;
tout a t remis en question : les sorts, les rangs, les hritages, les traditions,
les coutumes, on nhsitait pas emprunter, mme aux Barbares, des
techniques, des ides, des symboles, des faons dtre (
760
) ; tout changeait et
tous innovaient. Les despotes taient lafft de tous les savoir -faire. Ils
accueillaient, do quils vinssent, les prneurs de techniques, les inventeurs
de stratagmes, les donneurs de conseils, les dtenteurs de recettes. Les
corporations, les sectes, les coles ont pullul.
Les unes taient accueillies, subventionnes, patronnes par des princes ;
les autres taient libres, tantt fixes, tantt errantes ; certaines avaient une
vaste clientle ; dautres
344
taient rduites un matre entour de quelques
apprentis ; lenseignement, parfois, tait exclusivement technique ; parfois les
arts libraux dominaient ; parfois le matre enseignait des spcialits qui
peuvent sembler assez diverses : telles la rhtorique, la balistique, la
bienfaisance (
761
). Ce qui constituait lunit du groupement, quil ressemblt
davantage une secte ou davantage une corporation, ctait un genre
particulier de vie et surtout de tenue. On faisait partie de lcole de Tseou, on
se rclamait du patronage de Confucius ds quon portait un bonnet rond et
Marcel GRANET La pense chinoise 248
des souliers carrs : ctait safficher expert aux choses du Ciel (rond) comme
celles de la Terre (carre) expert capable de mettre de lharmonie tant
dans le Macrocosme que dans le Microcosme puisquon prenait encore soin
de garnir sa ceinture de breloques donnant toutes les notes de la gamme (
762
).
Si lon sattachait M tseu, il fallait au contraire, du moins le Tchouang tseu
laffirme, se contenter de sabots et de toiles grossires (
763
). Un disciple
jouait-il son tour au matre ? Il adoptait aussitt un signe de ralliement. Yin
Wen tseu sectateur de M tseu, puis chef dcole , choisit pour coiffure le
bonnet du mont Houa (
764
). Adhrait-on lune des sectes qui
prconisaient le retour la nature ? On se rduisait ne manger que glands et
chtaignes ; luni forme tait alors une dpouille de bte, ce qui, du reste,
nempchait pas de pratiquer les arts, puisque tel sage se plaisait, vtu de peau
de cerf, jouer du luth (
765
).
Lincorporation une secte ou une cole ne parat pas avoir diffr de
lentre dans une c lientle. Le patron quon se choisissait ne communiquait
point ses recettes si lon ne venait pas, avec tous les siens, se placer sous sa
recommandation. Aprs sept jours de jene purificatoire, le rcipiendaire tait
invit la table du Matre : telle est du moins la procdure dcrite dans un
passage du Lie tseu (
766
). Lapprenti venait habiter prs du patron. Il prenait le
titre de men jen qui dsigne les clients, ceux qui se runissent prs du portail
(men) du Matre pour sy voir distribuer lenseignement quotidien. Le lien de
vassalit ainsi cr se traduisait par lobligation de porter le deuil : ce devoir
tait impos au Matre comme lapprenti (
767
). Celui-ci nentrait pas tout de
suite dans la familiarit du Matre. Lie tseu resta
345
longtemps sans obtenir
du sien un seul regard. Au bout de cinq ans, il eut un sourire et droit une
natte au bout de sept ans (
768
). Lapprentissage fini, le disciple recevait son
cong accompagn dune collation. Il arriva it que le patron profitt de
loccasion pour essayer de retenir son client en lui don nant entendre quil ne
lui avait point rvl le dernier mot de son talent (
769
). Bien entendu,
lenseignement tait payant (limportance des rtributions scolaires variant
suivant les cas). Il ne semble pas quil tait distribu tous avec la mme
libralit. Confucius, par exemple, la leon de chant, ne faisait rpter que si
ctait bien , mais, alors, il prenait la peine d accompagner
lui-mme (
770
). Devant celui qui ne manifestait pas un vif dsir
dapprendre, il ne sexpli quait pas ; quand il avait montr un coin dune
question, si on ne rpondait pas (en tmoignant quon avait vu) les trois autres
coins, il ne recommenait pas sa leon (
771
). Il donnait croire (du moins on
laffirme) que derrire ses ensei gnements de dtail il y avait un principe de
sagesse suffisant pour tout pntrer (
772
). Ses disciples le croyaient : Les
enseignements du Matre sur les Arts libraux, on peut les apprendre ! mais
les paroles du Matre sur la Voie cleste (Tien tao) ainsi que sur les
complexions (sing) et les sorts (ming), on ne peut les apprendre (
773
) !
Pourtant, sur 3 000 apprentis, il y en eut 72 (72 exactement : cest le nombre
caractristique des confrries) qui comprirent entirement les leons de
Confucius. Encore lun deux se plaisait -il dire : Quand javais pui s
Marcel GRANET La pense chinoise 249
toutes mes capacits, il restait encore quelque chose qui se dressait trs haut
et, quand je voulais y atteindre, je nen trouvais pas le moyen (
774
). Ce
propos est dautant plus significatif quil fut tenu par un adepte de lcole qui
passe pour avoir donn lenseignement le plus positif et le plus terre terre. A
des apprentis excits par lespoir de se voir un jour rvler le principe
unique qui fait tout comprendre (
775
), le savoir tait dispens avec la manire
un peu chiche et lallure avantageuse qui carac trisent les enseignements
sotriques.
Il serait tout fait vain dessayer de tracer dans le dtail lhistoire des
ides dans cette priode fconde, mais qui est peu prs inconnue. Quand Che
Houang-ti a fond lunit impriale, il a voulu dtruire le souvenir des ges
346
fodaux. Il a fait brler les Discours des Cent coles (
776
). De la.
plupart des matres clbres rien ne subsiste que le nom ou des ouvrages
apocryphes. Les rares uvres, authentiques en partie seulement, qui ont
t conserves ne comportent presque jamais un expos dogmatique, jamais
un expos historique, jamais un essai dhistoire des coles et surtout des
ides. De nombreux penseurs sont connus uniquement par les dires de leurs
adversaires. Ceux-ci les ont-ils cits exactement ? interprts de bonne foi ?
Les polmiques sont inspires par des soucis de prestige ; le sentiment de la
valeur propre aux ides apparat peu : les matres cherchent moins faire
preuve doriginalit doctrinale qu faire briller lefficacit de la panace
quils prco nisent. Confucius sexprimait demi -mots et Tchouang tseu par
allgories (
777
). Ils enseignaient une Sagesse plutt quune Doctrine ; ils se
rclamaient de patrons vnrs ; ils leur prtaient une sagesse entire, un
savoir total. Ds ses premiers dbuts, toute cole doit prtendre ne rien
ignorer. Les matres voyagent et se rencontrent pour rivaliser de talent ; les
disciples passent dune cole une autre, collectionnant tous les
savoir-faire (
778
). Lesprit dappropriation sectaire a dj fait son uvre quand
les enseignements paraissent se prsenter dans leur puret premire. Les
uvres authen tiques que nous possdons datent des derniers temps dune
priode abondante en polmiques ; sil y eut des doctrines originales, nous ne
les saisissons quune fois contamines : laveu en a t fait (
779
). Pour
prtendre reconstituer lhis toire des Doctrines , il faudrait avoir, en soi et
dans les documents, une trange confiance. Il y a dj bien de lambi tion
vouloir distinguer les courants principaux de la pense chinoise pendant la
priode des Royaumes combattants. Sans mcarter sensiblement des
classifications proposes en Chine, mais en commenant par considrer les
recettes prconises plutt que les thories dfendues, je distinguerai trois
courants. Jessaierai de dire ce quont apport de neuf, dabord
techniquement, puis sous un aspect thorique, les penseurs qui prconisrent
les vritables recettes du gouvernement, du bien public, de la saintet,
lordre suivi tant dtermin par un fait historique difficile contester : ce
sont les efforts tents par les gouvernements de potentats
347
(dont certains
jouaient les despotes clairs) pour difier ltat sur un ordre social rnov qui
Marcel GRANET La pense chinoise 250
sont lorigine des con currences corporatives et des polmiques sectaires par
lesquelles se signalent les Ve, IVe et IIIe sicles. Beaucoup dides f condes
furent alors brillamment dfendues. Aucune na russi modifier
profondment la mentalit des Chinois.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 251
CHAPITRE Premier
Les recettes de gouvernement
349
Tant que les coutumes fodales rgnent sans conteste, cest
ltiquette qui confr e au Oui princier son efficace et la vertu de rendre
unanimes les dcisions prises, aprs avis et rprimandes, dans la cour des
vassaux. Matres, non dun troit domaine hrditaire, mais de vastes
territoires conquis sur la Nature ou les Barbares, les potentats cessent de
traiter les affaires en convoquant les vassaux au conseil. Ils sappuient sur un
conseil secret. Ils y appellent qui bon leur semble. Alors commence la ruine
du rgime fodal. Les statuts coutumiers et ltiquette traditionnelle perde nt
leur prestige. Les princes exercent leur autorit de faon nouvelle. Il faut
trouver de nouveaux fondements lautorit du Prince.
Fait remarquable, les coles de Sagesse qui se rclament des traditions se
sont dveloppes dans des bourgades relevant de seigneuries restes petites et
faibles, tel ltat de Lou ; cest au contraire la capitale de grands tats, tels
que Tsi, que vivent ou viennent faire leur apprentissage les partisans dun
ordre nouveau. Lcole de Confucius (ou de Tseou, bourgade de Lou) se
plaait sous le patronage du fondateur de la maison seigneuriale de Lou,
Tcheou-kong, frre du roi Wen. Tcheou-kong, dans son fief, stait appli qu
faire rgner ltiquette (
780
). Lu Chang, fondateur de la maison de Tsi, laissa,
dit-on, les habitants de son domaine agir selon leurs murs (
781
). Lu Chang
avait t le conseiller du roi Wen : cest avec lui que ce fondateur de dynastie
fit
350
secrtement des projets sur les moyens de pratiquer la Vertu en
renversant le gouvernement des Yin. Cette entreprise demandait une grande
puissance militaire ainsi que des plans trs habiles. Cest pourquoi ceux qui,
dans les gnrations suivantes, ont parl de la guerre et de la puissance secrte
des Tcheou ont tous vnr Lu Chang comme linstigateur des projets (
782
) .
Cest Tsi que vcurent Kouan Tchong, patron des conomistes et des
lgistes (
783
) ; Yen tseu, lennemi de Confucius, politique raliste, fertile en
stratagmes (
784
) ; Tseou Yen, linventeur ( ce quon dit) de la thorie de la
succession par violence et triomphe des lments et des Dynasties, thorie
que, du reste, on fait remonter Lu Chang (
785
). A Tsi vcurent aussi,
sjournrent ou passrent Yin Wen tseu, le Matre de lcole des Noms ; Chen
Tao, le juriste ; Tien Pien la bouche divine ; Song Kien, de lcole de
M tseu ; Chouen-yu Ko uen le bouffon ; Mencius, qui prtendait continuer
Confucius ; peut-tre aussi Tchouang tseu, le grand taoste (
786
) ; et Siun tseu,
lui-mme, de qui se rclame lortho doxie. Si lcole de la Porte Tsi Lin -tso,
capitale de Tsi, dont le roi Siuan (342 -322) fut le grand mcne, a accueilli
des savants par centaines , de leur ct, les princes de Tsin, de Tchou, de
Marcel GRANET La pense chinoise 252
Wei russirent attirer leur cour un grand nombre de ces colporteurs de
sagesse.
A patronner des Sages de toute espce, on recueille toujours quelque
prestige ; les despotes, cependant, qui travaillaient supplanter les derniers
rois Tcheou (
787
), essayaient surtout dattirer auprs deux les Politiciens,
habiles dresser des plans et les faire russir.
I. Lart de russir
Les Politiciens sont, lpoque des Royaumes combattants, les grands
hros de lHistoire. Pour des temps plus anciens, le Tso tchouan, le Kouo yu,
le Chou king mettent assez souvent en scne des conseillers privs. Mais les
faits et gestes de ces derniers remplissent presque eux seuls les Discours des
Royaumes Combattants (
788
). Ces personnages, qui offrent volontiers leurs
services tous les tats, viennent de tous les milieux. Parmi eux, il y a des
bouffons (
789
) et des
351
musiciens de profession, tel le Matre Kouang,
puissant auprs du duc Ping (557 -532) de Tsin (
790
). Il y a aussi des historio-
graphes et des astrologues comme Mo de Tsai consult par Tchao Kien -tseu
(512) (
791
), et Po, qui (en 773) renseigna le premier prince de Tcheng sur lart
de choisir un territoire o sa maison pt prosprer (
792
). Il y a mme des
commerants, comme Fan Li, qui fut ministre de Keou-tsien, roi de Yue
(496-465) ; Sseu-ma Tsien a consacr cet aventurier une biographie
romance (
793
). Dailleurs, presque tous ces personnages, surtout les
diplomates et les militaires, ont t les hros de quelque Geste, tels Wou Ki,
gnral de Wei (
794
) ou Sou Tsin, le transfuge, qu i passa de Tsin
Tchao (
795
). A nombre dentre eux sont attribues des uvres, comme cet
opuscule o Li Kouei (ou Li Ko on ne sait sil sagit dun ou de deux
personnages) enseignait un prince de Wei (424-385) les moyens de
russir (
796
). Le plus intressant de ces faux est le Kouan tseu, quon attribua
Kouan Tchong, sage semi-lgendaire du VIIe sicle, et qui fut peut-tre rdig
vers les IV-IIIe sicles (
797
). En fait, de tous les hros, rels ou imaginaires, de
ces temps obscurs, il ne nous reste que des traits folkloriques. Han Fei tseu a
cependant conserv quelques aphorismes attribus lun des matres de la
Politique, Chen Pou-hai, qui fut ministre dun prince de Han (358-353) (
798
).
Ils sont trs prcieux pour aider comprendre les ides, en parties neuves,
dues aux Politiciens. Deux mots les rsument peu prs intraduisibles :
chou, recettes, mthodes, artifices, et che, conditions, situations,
circonstances, forces, influences (
799
).
Notre mot chance est, peut-tre, celui qui rend le moins mal le mot
che . Les situations et conditions diverses de temps et de lieu reclent des
occasions dont il faut se mettre en tat de capter linfluence et la force pour
risquer le sort avec le maximum de chances. Limportance de cette ide
Marcel GRANET La pense chinoise 253
sexplique par le caractre concret universellement attribu lEspace et au
Temps et par la nature du problme politique qui se posait alors. Les despotes
vivaient dans un tat dexpectative rvolutionnaire. Ils se prparaient tous
usurper le rang de Fils du Ciel, cest --dire imposer un ordre neuf la
civilisation. Or, changer la moindre chose, cest tout changer ; et capter le
moindre signe de
352
changement, cest saisir loccasion dun changement
total. Aprs avoir pris (car il risque son trne) des mnagements infinis pour
faire accepter sa dcision par ses proches, un roi de Tchao qui veut adopter le
costume des Huns conclut en disant : il faut partout rechercher lavantage ;
le mrite quon a se conformer aux coutumes ne suffit pas lever un
homme au-dessus du sicle (
800
). Les potentats entretenaient titre de
conseillers politiques des spcialistes de toutes sortes ; ils les employaient tous
guetter le signe favorable. Cet t une faute impardonnable de faire erreur
sur loccasion, un crime de la manquer, un crime de ne pas la solliciter
(kieou) juste point (
801
). Reprocher aux Politiciens leur fatalisme, comme
Han Fei tseu la fait et comme on la rpt aprs lui, cest leur faire une
critique purement spcieuse (
802
). Ils nont nullement lide que gouverner
cest se laisser aller au cours des choses. Leur art, tout au contraire, consis te
utiliser le Destin en le tentant. Ils suivaient sur ce point lopinion commune.
Les Chinois admettaient, par exemple, quun songe est une force relle. Il
doit, par suite, susciter du rel ; il ninterfre, cependant, dans le cours des
choses qu p artir du moment o on le traite comme une ralit : jusque-l son
efficience demeure nulle : tel dont le rve est un prsage de mort et qui,
dabord prudent, nen tient point compte, continue, pendant trois ans, vivre,
mais il meurt le jour mme o, croyant avoir lass le temps, il fait interprter
son songe et le rend enfin rel (
803
). De mme que modifier des symboles,
cest se montrer rvolu tionnaire, capter des signes, cest interfrer. Les princes
qui emploient des Politiciens pour se faire signaler les occasions de chances,
ds quils sollicitent la chance, risquent daccro tre et risquent aussi
damoindrir leur Destin. Toute utilisa tion des circonstances implique un pari
sur la destine o le joueur est aussi lenjeu. Lide ntait point neuve, mais
les Politiciens, en cultivant le dsir de tenter constamment le sort, ont affaibli
le prestige dont jouissaient les rgles coutumires et lide de statut. Sans
quils aient eu la moin dre notion du dterminisme, et simplement parce quils
diminuaient lemprise de la coutume, ils ont, pour un temps, rendu lesprit
chinois moins rebelle lide de lois (valables dans telles ou telles conditions
dtermines).
353
Les lments circonstanciels du succs varient lextrme. Si
diverses que soient les prescriptions de ltiquette, elles ne visent jamais qu
conserver le statu quo. Un prince, avide daccroissement, a besoin de disposer
de moyens sans cesse renouvels de russite. Les Politiciens professionnels
ont pour fonction de lui apporter, pour chaque occasion de chance (che), une
recette approprie de succs (chou). Le grand Patron des Politiciens est Wang
Hiu, le Matre du Val des Dmons , personnage sans doute lgendaire : on
Marcel GRANET La pense chinoise 254
ne sait rien sur lui sinon quil fut consid r comme linventeur du systme des
alliances et des ligues de barrage par lequel on explique (apparemment aprs
coup) la diplomatie des Royaumes combattants (
804
). Lunique principe des
Politiciens parat tre lintrt du mome nt joint au mpris des traditions et de
la foi jure : le pass ne lie point puisque les circonstances changent tout. Tout
ce que peut nous apprendre le folklore politique, cest que les Chinois taient
passs matres dans lart daffaiblir un rival en lui cdant loccasion
inopportune de faon faire natre pour soi loccurrence favorable (
805
).
Peut-tre cet art a-t-il t mis en formules. Keou-tsien, roi de Yue, aprs stre
servi du politicien Wen Tchong, lautorisa se sui cider ; il lui fit prsent
dune pe et lui dit : Vous mavez, pour combattre Wou, enseign les Sept
Recettes (chou) ; trois mont suffi pour triompher de Wou ; il reste en votre
possession quatre Recettes : allez les essayer, je vous prie, auprs du roi, mon
prdcesseur (
806
) [
806c
]. Les glossateurs numrent ces Sept (ou Neuf)
Recettes ; ce ne sont (en apparence) que roueries vulgaires (on pousse, par
exemple, le rival saffaiblir par des dpenses d e luxe ou par le got des
femmes), mais tout est dans lart, entirement personnel, qui les met en
uvre : la prcaution prise par Keou-tsien le montre fort bien. Les recettes
politiques ne diffrent pas de lensemble des autres recettes, tours de main qui
ne senseignent point, pur savoir opratoire. Un incantateur fait apprendre par
son fils ses formules ; celui-ci sait les rciter trs exactement : elles ne
produisent aucun effet (
807
). Un charron, soixante-dix ans, continue de
fabriquer seul ses roues : il na pu trans mettre son art ses enfants (
808
). De
mme lart de faire rus sir les plans politiques correspond une vocation :
toute
354
recette est, par essence, secrte (yin) et prive (sseu) Sur ce point
encore, il ny a rien doriginal dans les principes de lart politique ; pourtant
ils ont aussi conduit une conception neuve : savoir la distinction de la
coutume (ou de la Loi) et de lart gouvernemental. Au Prince seul en fait
au Conseil priv doit tre rserve la connaissance des che et des chou, des
situations dont peut natre la puissance, du savoir-faire qui fait sortir la
puissance des situations. Sans doute Han Fei tseu reprochera-t-il Chen
Pou-hai de ngliger la Loi et la rglementation pour ne tenir compte que des
Recettes, mais il reconnatra que, si des Lois publies et permanentes
sont ncessaires la bonne administration, lautorit princire et leffi cace
gouvernementale ont leur principe dans la puissance que les Recettes,
conserves secrtes, tirent des conditions circonstancielles (
809
).
II. Lart de convaincre
A limpulsion novatrice donne aux ides chinoises par l es Politiciens sest
ajoute, aux IVe et IIIe sicles, limpulsion quessayrent de lui donner les
Dialecticiens et les Logiciens. M. Forke a attir lattention sur des crivains
quil a qua lifis de sophistes, suggrant un rapprochement trs lgitime avec
Marcel GRANET La pense chinoise 255
la Grce (
810
). Les Chinois tendent confondre dans une seule cole, quils
appellent lcole des Noms ( ming kia), des logiciens dont les proccupations
paraissent avoir t trs diverses. Les uns ont t amens la Logique par la
Rhtorique ou lristique ; les autres y ont t conduits par des soucis dordre
politique et moral, sinon juridique. Ceux-ci sont les reprsentants dune vieille
logique indigne. Il ny a aucun moyen den apporter la preuve, mais je
croirais volontiers que les premiers reprsentent une tradition dorigine
trangre et qui, du reste, na point russi sacclimater en Chine.
La plus sectaire et la plus combative des coles anciennes est celle de M
tseu. On la compare un ordre de chevalerie qu i se serait donn la mission
de secourir les opprims ; on pourrait mieux encore la comparer une
congrgation de frres prcheurs. Ses membres se proposaient de faire
355
revenir la sagesse les princes que lambition en dtournait. Ils choisissaient
pour adversaires les conseillers pernicieux habiles capter les adhsions.
Do limportance attribue lenseignement de la rhtorique : tous les
membres de lcole co nservaient des modles dhomlies dont la rdaction
tait attribue au Matre. Au moins ds le milieu du IVe sicle, certains
dentre eux formrent des congr gations spares [les Pie-m : (disciples)
spars de M (tseu)] qui sadonnrent lristique. Il y a peu de chance
quils aient invent la chose et mrit les premiers le nom de Disputeurs
(Pien-tch). Le folklore historique nous fait voir, bien avant le IVe sicle, les
disputeurs prorant dans les conseils privs.
Rduire ladversaire quia par une bouffonnerie est lun des thmes
significatifs de la littrature (
811
) de ces sicles de dispute, et plus significatif
encore est lemploi des apologues et des allgories saugrenues (
812
). Tout cela
semble sortir dune sagesse colporte dont linspiration internatio nale
demeure sensible. Les sophistes chinois ne possdaient quun petit nombre de
paradoxes. Nous en avons des listes, et cest peu prs tout ce qui nous reste
deux. Pour ce qui est de leurs adversaires, il na gure t conserv quune
liste dexercices dcole destins prparer les disciples ne pas rester cois
en face dun disputeur de profession. Celui -ci se sert des paradoxes dont il a le
secret pour forcer lattention, rduire a u silence, glisser finalement un avis. Le
roi Kang de Song a dfendu quon discourt jamais devant lui, sauf sur la
bravoure et les coups de force : Jai du savoir (tao) sur ces sujets , lui dit un
sophiste. Il propose, et le roi accepte, de parler sur les coups de force qui
tantt russissent et tantt non. Il entrane ainsi le roi consentir quon lui
parle de ce qui peut faire russir. Ce qui peut faire russir, reprend bien vite le
sophiste, cest lti quette et lamour de la paix. Le voil arriv prorer sur
des thmes dfendus... : il se retire triomphalement sans attendre que le roi ait
trouv rpliquer (
813
). La guerre ou la paix lemportera -t-elle dans les
conseils de Wei ? Un sophiste est introduit : Savez-vous ce quest une
limace ? Oui, dit le roi. Sur la corne gauche de la limace est le royaume
des Trublions ; sur la corne droite, celui des Brutes.
356
Sans arrt, ils se
querellent propos de leurs territoires et se battent. Les cadavres gisent par
Marcel GRANET La pense chinoise 256
milliers. Quinze jours aprs une dfaite, on retourne au combat. Inepties !
dit le roi. Que Votre Altesse veuille bien leur trouver quelque fondement.
Ne pense-t-elle pas que des quatre cts, et en Haut comme en Bas, il ny a
pas de limites (
814
) ? Il ny en a pas. Ne savez-vous pas vous battre en
intention (yeou sin) dans ce qui na point de limites ? Ne vous parat-il point
alors sans intrt que des royaumes qui se bornent les uns les autres existent
ou non ? Assurment. Parmi ces royaumes borns est (votre tat de)
Wei. Dans Wei est Leang (votre capitale). Votre Altesse est dans Leang. En
quoi diffre-t-elle du roi des Brutes ? Pas de diffrence , dit le roi. Et le
sophiste se retire triomphalement, laissant le prince hbt et comme
perdu (
815
).
Les sophistes que ces histoires mettent en scne de manire avantageuse
font partie, semble-t-il, de lentourage de Houei tseu (ou Houei Che),
personnage originaire de Wei, o il vcut et servit (dit-on) comme ministre le
roi Houei (370-319). Houei tseu, le plus clbre des dialecticiens chinois,
tait-il, comme les sophistes de son entourage, un ami de la paix ? Linduction
est vraisemblable. Doit-elle conduire rattacher Houei tseu lc ole de M
tseu ? Peut-on aller plus loin et prtendre encore que toute la dialectique de
Houei tseu tendait donner un fondement mtaphysique la doctrine de
lamour universel quon prte M tseu ? Le fond de cette mtaphysique
serait, parat-il, la thorie, dorigine taoste, de lidentit essentielle des
choses et des tres (
816
). En fait, Houei tseu nest connu que par les brocarts
dont les taostes lont accabl (
817
). Ils laccusaient de ne possder quun faux
savoir (tao) et de discourir sans souci du rel. Il y a quelque excs raconter
que Houei tseu avait tudi fond la science de son temps, astronomie,
astrologie, science du Yin et du Yang, des Nombres, etc. (
818
), sous le seul
prtexte que Tchouang tseu se moque de lui parce que sans hsiter ni rflchir,
il parla sur toutes choses, indfiniment, un jour o quelquun samusa lui
demander pourquoi le ciel ne tombait pas, pourquoi il y avait du vent, de la
pluie, du tonnerre... Quel que soit le dsir quon puisse avoir de renseigner les
lecteurs,
357
il convient dabord de leur dire quil ne nous reste sur Houei
tseu quun petit nombre danecdotes ironiques et la liste de ses principaux
thmes de paradoxes.
Lun deux (V) a donn bien du mal aux traducteurs (
819
) La distinction
(yi) entre ce qui se rapproche (tong) le plus (ta) et ce qui se rapproche (tong)
le moins (siao) est le minimum (siao) de rapprochement (tong) et de distinc-
tion (yi) ; (ce qui) dans tous les tres est entirement rapproch (tong) et
entirement distinct (yi) (correspond) au maximum (ta) de rapprochement
(tong) et de distinction (yi). Cet aphorisme entortill nest quune manire
piquante de formuler la distinction (les glossateurs ny voient pas autre chose)
des aspects corrlatifs et des aspects indpendants. Les aspects corrlatifs (vie
et mort, bonheur et malheur, chaud et froid, jour et nuit, repos et
mouvement...) sont lis et complmentaires (minimum de distinction), mais
perus successivement (minimum de rapprochement). Les aspects
Marcel GRANET La pense chinoise 257
indpendants (tels le blanc et le solide) se trouvent runis ensemble (par
exemple dans une pierre) dans un mme objet (maximum de rapprochement),
bien quentirement sparables (maximum de distinction).
Unir (ho : runir la faon de deux moitis, en fait insparables) ce qui
se rapproche et se distingue (tong yi : les aspects complmentaires), sparer
(li : diviser comme des parts adhrentes mais distinguables) le blanc et le
solide (les aspects indpendants) , tel est le mtier du sophiste (
820
).
Les dialecticiens disputent sur le pair et limpair, sur ce qui se rapproche et
ce qui se distingue (tong yi ), sur le blanc et le solide (
821
), mais ce dont ils se
font gloire cest de faire apparatre clairement, telle une maison sur un fond
de ciel, la sparation (li) du solide et du blanc (
822
). LEmpire des catgories
Yin et Yang, joint au prestige rituel dun systme indfini de correspondances,
tend empcher les Chinois de ne point tout ramener des contrastes. Sparer
le Blanc du Mtal ou le Noir de lEau aboutit ruiner ltiquette, dlivrer
delle la pense, permettre les reclassements de choses que doit entraner
une refonte de lordre social. Do le succ s des sophistes la cour des
despotes clairs. Quils aient fait eux -mmes la trouvaille ou quils aient eu
le mrite de comprendre la valeur dides
358
importes, les dialecticiens
savaient donner leurs discours un attrait neuf. Ils apprenaient abstraire et
jouer avec des notions abstraites.
Ragissant lextrme contre la tendance chinoise ne pas svader du
concret et raisonner sans opposer des contradictoires, ils ont ralis des
abstractions et utilis le principe de contradiction en lui prtant une valeur
absolue. Ce ralisme abstrait les a conduits imaginer un lot de paradoxes
impliquant une analyse strictement formelle des ides de grandeur, de
quantit, de temps, despace, de mouvement, de continuit, dunit, de
multiplicit... Mais, tandis que le Ve paradoxe de Houei tseu indique le
principe de tous les paradoxes inspirs par une notion abstraite de la qualit,
les paradoxes qui visent extnuer les ralits physiques sont exprims sans
aucun essai de systmatisation.
(I) La grandeur extrme (et telle quelle ne laisse) rien en dehors (delle)
cest le tout ( yi : unit, total) le plus grand ; la petitesse extrme (et telle
quelle ne conserve) rien en dedans (delle -mme), cest le tout ( yi) le plus
petit. (II) (Ce qui) na pa s dpaisseur et ne (peut) sajouter ( tsi :
saccumuler) a mille stades de haut. (III) Le Ciel nest pas plus haut que la
Terre ; une montagne est aussi plate quun marais. (IV) Le Soleil, quand il
atteint son midi, atteint son couchant et quand un tre parvient la naissance,
il parvient la mort... (VI) Le Sud stend sans limite et pourtant a des
limites. (VII) Aujourdhui je vais Yue et pourtant jy suis arriv hier.
(VIII) Les anneaux enchans peuvent tre spars. (IX) Je connais le
centre du Monde : il est au nord de Yen (extrme-nord) et au sud de Yue
(extrme-sud). (X) Si laffection stend au dtail des tres, lUnivers (mot
mot : le Ciel et la Terre) nest (plus) quun seul corps (
823
).
Marcel GRANET La pense chinoise 258
Houei tseu crivit de quoi charger cinq charrettes, mais son savoir tait
spcieux et ses paroles sans porte. Tel est le jugement de Tchouang tseu
qui vit fort bien le principe commun tous ces paradoxes, savoir lapplication
tout le concret dune division e xtnuante. Il sest amus montrer Houei
tseu, labstracteur, contraint apporter, en termes concrets, laveu de
linefficacit de son principe : Le roi de Wei, dit Houei tseu qui vient de
lui-mme conter sa
359
msaventure Tchouang tseu, mavait do nn des
graines dune grosse courge. Je les ai semes et elles ont pouss donnant des
fruits si gros quils pouvaient contenir cinquante boisseaux. Jen ai fait (en les
coupant par le milieu) des bassines pour ma toilette. Elles taient si lourdes
que je ntais point capable de les soulever. Je les ai divises ( nouveau) pour
en faire des vases boire. Les (morceaux d) corce sche taient encore trop
grands et, de plus, instables, ne conservaient pas le liquide : ce ntait que des
objets inutiles et gros. Comme ils ne me servaient rien, je les ai coups en
morceaux (
824
) !
Les Chinois nont pas accord grande faveur au ralisme abstrait de Houei
tseu et de ses continuateurs ou de ses rivaux. Le mieux connu de ceux-ci est
Kong-souen Long qui vcut aussi Wei vers la fin du IVe sicle. Il y eut, pour
principal disciple, si lon en croit le Lie tseu, le prince Meou de
Tchong-chan (
825
). Kong-souen Long excellait : farder les dsirs humains
et transformer les intentions. Il tait capable de toujours triompher dans la
discussion, mais sans arriver convaincre profondment (
826
), Il semble
quil ait abus de la distinction des aspects indpendants, en lemployant d es
dmonstrations par labsurde loccasion de thmes paradoxaux : un chien
blanc est noir , un cheval blanc nest pas un cheval , car un chien noir et
un chien blanc tant tous deux des chiens, un chien blanc quivaut un chien
noir et, sil est blanc, un cheval ne pourra tre considr comme un cheval
que si on consent le confondre avec cheval noir ou un cheval bai, si bien
quaucun cheval blanc, noir ou bai, nest un cheval. Ces jeux dialectiques
visaient interdire toute qualification en quivalant toutes les qualifications,
et, aprs lavoir utilis trop rigoureusement, nier le principe de contradiction
au profit dun relativisme absolu. Ils ont tonn, mais lass, les
contemporains. Seuls, quelques initis, comme le prince de Tchong-chan,
voulaient leur reconnatre un sens profond. Un cheval blanc nest pas un
cheval (indique) la distinction (li) de lobjet (ou plutt de lemblme dun
objet : hing) et de la qualification ; Qui a (des) dsirs na point (un) cur
(sige du dsir), signifie : (seule) labsence de dsirs permet lunification du
cur (
827
) ; Qui a (des)
360
doigts narrive pas ( toucher), veut dire : il ne
faudrait pas avoir du tout de doigts pour arriver ( toucher) entirement ;
(Le thme :) un cheveu soutient trente mille livres (sert illustrer lide de)
che (force, influence conditions) (
828
) et (le thme :) une ombre ne peut se
mouvoir (ou lombre dun oiseau qui vole ne peut bouger ), (lide de)
changement (kai : changement et non mouvement) (
829
).
Marcel GRANET La pense chinoise 259
Le prince de Tchong-chan admirait aussi le paradoxe de la flche, mais il
ne la pas comment. Cest cependant ( divers points de vue) le paradoxe le
plus intressant de Kong-souen Long, et celui dont linterprtation est la
moins incertaine. On en possde deux variantes pittoresques. Le thme de la
flche suit le thme de lombre immobile et snonce ainsi : Quelle que soit
la vitesse de la pointe de flche et de la flche (tsou che) (
830
), il y a temps
(pour elles) de ne point se dplacer et de ne point rester en place (
831
). Voici
comment Kong-souen Long illustrait cette nigme. Il dit un jour Kong
Tchouan : Un matre archer a le pouvoir de faire toucher par la pointe dune
seconde flche la queue de la flche tire prcdemment ; dcoches la file
et se rejoignant lune lautre, toutes ses flches se font suite, pointes et queues
se touchant sans interruption, si bien que, de la premire la dernire, elles
joignent continment le but la corde de larc et paraissen t ne faire quun.
Kong Tchouan demeurait tout bahi... Il ny a pas de quoi stonner, reprit
Kong-souen Long. Un apprenti de Peng-mong (patron des Archers), qui se
nommait Hong-tchao, se fche un jour contre sa femme et veut leffrayer ; il
saisit lArc Cri -de-Corbeau, la Flche Hi-wei, et vise aux yeux : la flche rase
les pupilles sans que les yeux clignent et choit terre sans soulever de
poussire(
832
). Lance avec puissance et matrise, la flche, vitesse pure, se
meut, et sarrte, vitesse abolie, sans jamais produire aucun effet. Entre
labsolu de vitesse et le nant de vitesse qui se succdent, la diffrence est
totale, mais elle est nulle, car lorsquelle termine sa course sans mme
tomber, bouger, ni faire bouger, la flche est encore en vol, et elle est
immobile quand elle passe si vite que, tout comme si elle ne passait ni ne
bougeait, elle ne fait aussi rien bouger. Dailleurs limmobilit parfaite et
lextrme mobilit se
361
confondent absolument : la chane de flches qui va
de larc au but est la fois mobile et immobile, immobile puisque, tout se
dplaant encore, rien na boug, la queue restant sur la corde alors que la
pointe arrive au but, mobile puisque tout se dplace, rien ne bougeant, la
pointe tant bout de course alors que la queue reoit de la corde sa vitesse
entire.
Lintrt de ce thme paradoxal tient ce quil porte non pas seulement
sur la divisibilit indfinie du temps et de lespace, mais, tout ensemble, sur la
notion de force efficace (che) et de changement (kai). Il doit, ce titre, tre
rapproch de certains thmes chers aux Taostes. Lpe la plus puissante,
celle qui pourfend tout sans que le sang jamais ne la tache, permet
dentailler, sans le moindre effort, trois reprises, et du cou jusqu la
ceinture, un ennemi, mais le passage de lpe na rien spar ; le corps
pourfendu reste intact (
833
). Le paradoxe de la flche sappa rente aussi un
important thme mythique : la chane de flches du matre archer est
lquivalent de la flche royale qui tablit le contact entre le Roi et le Ciel
contact continu, comme celui de la corde et du but, mais non sens unique : la
flche partie du tireur lui revient et il y a circuit et immobilit (de mme quil
y a communion mais non contact) (
834
). Au fond des paradoxes inspirs par
lide que tout est changement, mais que le changement (comme, par suite, le
Marcel GRANET La pense chinoise 260
mouvement) est impossible, apparat un ralisme magique auquel se rattache
directement le ralisme abstrait des dialecticiens.
Seuls, les Taostes semblent avoir tir quelque fruit des analyses que leur
verve dialectique inspira aux sophistes. Ils utilisrent, de mille faons, la
formule : Une rgle dun pied de long quon diminue de moiti chaque jour,
(mme) au bout de dix mille gnrations, ne sera point extnue (
835
). Sans
doute est-ce des dialecticiens que provient le got de nombre dcrivains
chinois, en particulier de Wang Tchong, pour le sorite. Cependant les
Taostes eux-mmes nont que mpris pour les sophistes. Ils leur reprochent
leur morgue, les taxent de jalousie, les accusent davoir vcu sans amis,
lcart de toute cole, satisfaits ds quils trouvaient loccasion de prorer, ne
songeant, sans sintresser aux
362
ides ou aux choses, qu avoir le dernier
mot, heureux si leurs interlocuteurs demeuraient bouche bante, la langue
colle au palais (
836
). Tout au plus, accordent-ils Houei tseu un talent de
musicien et le charme de lloquence (
837
). Peut-tre est-il vrai que les
sophistes songeaient surtout blouir et surprendre laquiescement. Cest
au contraire un art de la persuasion que semblent avoir voulu crer et mettre
en formules les derniers disciples de M tseu (
838
).
Il est bien difficile de dire si, comme on la soutenu, ces rhtoriciens ont
conu clairement le principe de causalit et le principe de contradiction ; les
aphorismes o lon veut retrouver ces principes paraissent, lus dans le texte
chinois, dune extr me imprcision (
839
). Sil fallait admettre quils ont t
conus et formuls avec quelque rigueur, comment arriver expliquer le fait
quils aient pu passer inaperus et naient pas eu la moindre fortune ? De
mme, sil tait vrai que les logiciens aient dj eu lide dopposer la
dduction (hiao) et linduction ( touei ), il serait bien curieux quils se soient
eux-mmes borns argumenter laide dexemples, dvelopper grand
renfort danalogies. Il tait dj beau de s aviser que des rgles pratiques
taient ncessaires pour apprendre non pas procder par raisonnements
formels, mais argumenter de bonne foi quand on illustre laide
dexemples (hiao) et quon amplifie en utilisant lanalogie (touei ) : tel est,
sans doute, le sens des termes techniques qui ont fait penser linduction et
la dduction (840). M. Forke ne parat pas stre tromp en affirmant que les
disciples de M tseu ont voulu faire uvre pratique.
Il ne faut pas voir en eux des thoriciens du raisonnement : seul les
intresse lart de conduire victorieusement une discussion (
841
). Ils ne se sont
proccups que de recettes oratoires. Pourtant il ne serait point quitable de ne
pas insister sur la difficult de leurs efforts et de ne pas en signaler la porte
thorique. Le chinois ne marque ni le temps, ni le nombre, ni le genre ; ceci
permettait de formuler plaisamment certains paradoxes, mais rendait difficile
toute analyse des notions. Le chinois ne distingue pas le verbe, le nom,
ladject if, ladverbe... : dans ces conditions, il est merveilleux quon ait eu
lide danalyser les rapports des
363
termes rapprochs par le discours et peu
tonnant quon nait pas pouss bien loin lanalyse (
842
). Les discussions sur le
Marcel GRANET La pense chinoise 261
blanc et le solide, le cheval et le blanc, la qualification (ming) et lobjet ( che)
ou son symbole (hing), surprennent par leur caractre inattendu et leur mrite
rvolutionnaire. Elles tendaient ruiner un systme vnrable de classifi-
cations et de correspondances. Les dialecticiens minaient ltiquette sa base.
Aussi ont-ils fait scandale et mdiocrement russi. Ils ne lont point emport
sur les partisans de la vieille logique indigne.
III. Lart de qualifier
Les Chinois aiment argumenter et sy montrent habiles ; pourtant ils ne se
soucient gure de mettre en forme des raisonnements. Ils attachent, en
revanche, une extrme importance lart de qualifier ( ming). Aussi
groupent-ils, dans ce quils appellent lcole des Noms ( ming kia), tous ceux
quils considrent, non comme de simples disputeurs ( pien-tch) mais comme
des logiciens. Lobjet de la logique, ce sont les dsignations ou les
qualifications correctes.
La tradition voit dans Confucius linventeur de la logique traditionnelle.
Elle se fonde sur un passage du Louen yu : Tseu-leu dit ( Confucius) : Le
seigneur de Wei se propose de vous confier le gouvernement. Que
considrez-vous comme la premire chose faire ? Les sentiel est de
rendre correctes les dsignations (tcheng ming) , rpondit le Matre, et i1
ajouta : Si les dsignations ne sont pas correctes, les paroles ne peuvent tre
conformes ; si les paroles ne sont point conformes, les affaires (dtat) nont
aucun succs ; si ces affaires nont aucun succs, ni les rites ni la musique ne
fleurissent ; si les rites et la musique ne fleurissent point, les punitions et les
chtiments ne peuvent toucher juste ; sils ne touchent pas juste, le peuple ne
sait comment agir. Aussi le Sage (kiun tseu), quand il attribue des
dsignations, fait-il toujours en sorte que les paroles puissent sy conformer,
et, quand il les emploie en parlant, fait-il aussi en sorte quelles se ralisent en
action. Que le Sage, dans ses paroles, ne commette aucune lgret ! cela
suffit (
843
) ! Cette anecdote prtend renseigner sur les
364
relations de
Confucius et de la maison de Wei. Prise comme telle, elle ne vaut ni plus ni
moins que tous les renseignements donns par le Louen yu sur le Matre. Rien
nauto rise dire que Confucius a ou na point connu et profess la thorie des
dsignations correctes. Mais Confucius importe peu ici. Ce qui importe, cest
de constater que la thorie se prsente dabord sous laspect dune doctrine
morale et politique. Le bon ordre dpend entirement de la correction du
langage. Invente ou non, lan ecdote a le mrite dillustrer ce principe. Elle a
encore celui den faire appa ratre le fondement.
Ce nest pas sans raison, en effet, que lanecdote met en cause le prince de
Wei. Le duc Ling (534-493), avec qui Confucius fut en rapports, fut un mari
complaisant et un pre dnatur. Sa femme, la princesse Nan-tseu, tait
Marcel GRANET La pense chinoise 262
incestueuse. Son fils an fut un rebelle : il senfuit de Wei aprs avoir
complot de tuer Nan-tseu (
844
). Aussi voit-on dans les paroles de Confucius
une allusion ces dsordres. Nan-tseu ayant pris en haine le fils hritier, le
fils et le pre changrent (yi) leurs dnominations (ming) (
845
). Ainsi
sexprime Sseu -ma Tsien, qui dit ailleurs : Confucius a dit : Lessentiel
est de rendre les dsignations correctes. A Wei les places (kiu) ntaient
point en accord (avec les dsignations) (
846
). La doctrine confucenne
affirme quil ny a dordre dans ltat que si tout, dans la famille princire, est
conforme lordre. A Wei, Nan -tseu, lpouse, ne se conduisait pas en
pouse, ni le mari en mari, ni le pre en pre, ni le fils en fils. Cela sexprime
en disant soit que personne ntait sa place ( kiu), soit que pre et fils avaient
troqu leurs dsignations (yi ming) : les rapports de situation se trouvant
inverss, ctait comme si les dsi gnations avaient, elles-mmes, t
inverses.
Un passage du Yi king illustre des ides analogues. Le trente-septime
hexagramme comprend, en haut, le trigramme qui est lemblme de la fille
ane ; en bas, celui qui symbolise la fille cadette. Les deux filles , comme
on voit, occupent des places en rapport avec leurs rangs. Aussi cet
hexagramme, qui porte le nom de kia jen (la famille), voque-t-il une famille
o rgne lordre. La premire glose y dcouvre cet enseignement : le prince
tend sa bonne
365
influence tous les siens et se montre svre pour
empcher que ses femmes et enfants ne se conduisent mal (
847
). La deuxime
glose (
848
) ajoute : La femme occupe correctement (tcheng) sa place (wei :
son rang) dans le gynce et, de mme, le mari correctement sa place hors du
gynce. Quand le mari et la femme se tiennent correctement ( leurs places
respectives), il y a une rpartition entirement quitable (yi) (de toutes les
choses) du Ciel et de la Terre... (Quun) pre (mrite le nom de) pre ! un fils
(le nom de) fils : un frre an (le nom de) frre an ! un cadet (le nom de)
cadet ! un mari (le nom de) mari ! une pouse (le nom d) pouse ! Lordre
(tao) de la famille sera correct (tcheng). (Rendez) correcte (tcheng) la famille
et la Terre des hommes (jouira dun ordre) stable ! De ce passage ressort
lquivalence des expressions : tcheng wei (places, positions correctes) et
tcheng ming (dsignations, appellations correctes).
Deux adages du droit coutumier font comprendre la porte de cette
quivalence, Les appellations (ming) sont le grand principe dordre des
relations humaines. Quand (dans la famille) les appellations (ming) sont
manifestes, les rgles de la sparation des sexes sont respectes (
849
). Ces
adages sont employs justifier une rgle de la morale sexuelle dont
limportance est extrme dans lorganisation de la famille : beaux-frres et
belles-surs ne peuvent porter le deuil les uns pour les autres, et il ne peut y
avoir entre eux aucune conversation : ils ne pourraient, puisquils
appartiennent une mme gnration, et que la belle-sur ane, par exemple,
ne pourrait tre qualifie de mre , sappeler autrement quavec les mots
femme et mari , ce qui ne serait pas moins grave que dtablir entre eux
Marcel GRANET La pense chinoise 263
des rapports maritaux. Les dsignations commandent les murs parce que les
appellations suscitent le rel : il est donc ncessaire quelles correspondent
exactement aux distinctions de sexe et de gnrations, dattributions et de
rangs, qui fondent lordre domestique. Il y aurait promiscuit si lo n appelait
une belle-sur femme . Il y a inceste si pre et fils changent leurs
dsignations . Quand un pre drobait au fils sa fiance, il cessait dtre un
pre et descendait au rang de ses propres enfants. Linverse se pro duisait
lorsquun fil s pousait sa martre (
850
). Les
366
ethnographes chinois
marquent violemment leur mpris pour les barbares du Nord ou du Sud chez
qui pres et fils (tseu : fils ou filles) cohabitent ou vont ensemble au bain. Les
moralistes fulminent contre les danses quils appellent modernes, o se mlent
non seulement hommes et femmes, mais mme pres et fils (ou filles),
cest --dire des sexes diffrents et des gnrations opposes qui perdent ainsi
le statut qui leur est propre. Ces sentiments sont violents parce quils sont
relativement neufs. Ils datent dune trans formation de lorganisation
domestique et du remplacement de la promiscuit caractristique de la grande
famille par la discipline propre la famille patriarcale (
851
). On voit
quhistorique ou non, la necdote o lon nous montre Confucius exprimant la
rgle des dsignations correctes loccasion des dsordres domestiques de la
maison princire de Wei, a le mrite dexprimer fort exactement la valeur
originelle de cette rgle (
852
). Tout autant quune rgle de pense, cest une
rgle daction.
Elle a toujours gard le caractre impratif dun pr cepte moral. On la
formule, dordinaire ( peu prs comme dans le Yi king), la faon dun bref
commandement, en rptant deux fois, pour lui donner sa force pleine, un mot
qui vaut dj par sa puissance propre. Quand on scrie : Prince, (sois)
prince ! vassal, (sois) vassal ! pre, (sois) pre ! fils, (sois) fils !... , il est clair
quon se sert des mots pour animer les ralits. Nous avons vu, propos du
langage, que dsigner (ming) les choses, cest leur donner lindivi dualit
(ming) qui les fait tre. Nous avons vu, aussi, que la civilisation a t cre
lorsque les premiers Sages ont confr tous les tres des dsignations
correctes (
853
). A lorigine de la thorie des dnominations, comme
lorigine des paradoxes dialectiques, se trouve une sorte de ralisme
magique.
Tandis que les dialecticiens se plaisaient abstraire et bouleverser les
ides reues, les logiciens sefforaient de conserver aux emblmes leur
valeur concrte et traditionnelle. Au moins ses dbuts, la thorie des
dnominations correctes est bien loin de ntre quune simple thorie de
correct prdication , comme laf firment les critiques chinois (lorsquils
sexpriment en anglais). Sil ne stait
367
dabord agi que dviter les
confusions verbales et les qualifications incorrectes, on ne voit pas comment,
rien quen distribuant des noms, on aurait pu esprer intro duire de lordre
parmi les hommes et, par surcrot, dans la Nature.
La doctrine des dnominations correctes est une doctrine de lordre.
Marcel GRANET La pense chinoise 264
Son succs sexplique par le prestige dont a joui lti quette. Les traditions
chinoises ne faussent certainement pas les faits quand elles rattachent cette
doctrine aux techniques du Crmonial : ceci conduit, assez lgitimement
dailleurs, admettre quelle a t professe par Confucius. Jadis les noms
(ming) et les rangs (wei) taient divers ; aussi les rites (li, les honneurs rituels)
taient-ils calculs (chou) (
854
) de faon diffrente (selon les rangs et les
noms). Confucius a dit : Lessentiel est de rendre les noms corrects... (
855
).
Tant que rgnent lor dre fodal et ltiquette, le parler correct et, sa
suite, la correction logique sont solidaires de la tenue correcte et, par
consquent, de la correction morale. On ne discute pas alors laxiome que les
comportements de lUnivers dpendent de la condui te princire. Il ny a
dordre, dans les choses et dans les penses, que si le Chef pour qui, plus que
pour tout autre, la parole est acte, ne qualifie (ming) rien la lgre et
ninvestit ( ming) personne sans se conformer au protocole. Tout gentilhomme
(kiun tseu) ou tout sage (kiun tseu) doit, tel un prince (kiun), faire effort pour
conformer sa tenue son statut, cest --dire au rang (wei) et au nom (ming)
dont il est investi (ming). Ming (nom personnel) sert dsigner lindividu et la
part dhonneur qui lui revient, son lot de vie (ming) et son hritage (fen),
lensemble de ses appartenances, la totalit de ses attributions. Cest un
principe rituel que nul ne doit sortir de ses attributions (cheou fen). Quand
ltiquette stend tout, les attrib utions (fen) (de tous les tres) demeurent
fixes (ting) (
856
).
Lordre fodal a un second principe. Princes et vassaux vivent sous le
contrle de lhistoire (
857
). Ce sont les annalistes officiels qui, usant de rgles
traditionnelles, dnomment et qualifient leurs actions. Ils les honorent et les
destituent par la seule vertu des termes quils emploient pour
368
les dsigner
et les juger, eux et leurs actes (
858
). La rdaction historique vaut comme
jugement : elle confirme ou modifie, pour lternit, les statuts.
Un passage remarquable du Tchouang tseu (
859
) rattache la notion de
Tao-t (Efficace premire) celles de jen et de yi (
860
), qui commandent la
conduite du gentilhomme (kiun tseu). Delles drivent le respect des
attributions (fen cheou), (laccord des) ralits et (des) noms ( hing ming), la
(bonne) rpartition des charges, l(exacte) discrimination des homme s et de
leurs uvres, la (juste) distribution des approbations et dsapprobations (che
fei : mot mot : oui et non), des rcompenses et des chtiments. Quand est
clair (le principe) des rcompenses et des chtiments, les plus stupides savent
ce quon at tend deux, les nobles et les vilains gardent leurs rangs ( wei), les
bons et les mauvais font pour le mieux, car on na pas manqu de fen (rpartir)
les talents en tenant compte des ming (noms, dignits), si bien que les
suprieurs sont servis, les infrieurs nourris, (lensemble) des tres gouvern
et (chaque) personnalit cultive (sieou chen)... et cest l ce quon appelle la
Grande Paix, la perfection du gouvernement (
861
). Tchouang tseu (avant de
passer leur critique) nonce ici les ides qui rapprochent lcole des Noms
Marcel GRANET La pense chinoise 265
de lcole des Lois en les rattachant aux thories attribues Confucius sur
lefficace du jen et du yi.
Un autre passage du Tchouang tseu (
862
) insiste, de manire significative,
sur ce dernier point. Il y est question de lenseignement livresque en honneur
dans lcole confu cenne et affirm que le Tchouen tsieou servait
expliquer les ming et les fen, cest --dire apprendre qualifier et rpartir,
distribuer et juger. Telle est bien lide que les Chinois se sont faite et quils
ont garde du Tchouen tsieou (
863
) ; ils ne voient point en cet ouvrage une
simple chronique du pays de Lou ; ils admettent que Confucius a repris la
rdaction des annalistes officiels. Le Matre prit soin, pesant ses termes plus
soigneusement encore que lorsquil jugeait des procs, de rabaisser ce qui
devait tre abaiss . Il obtint, parat-il, lapprobation de Tseu -hia, juge
difficile. Pourtant, il dclara que, sil devait, dans les t emps futurs, tre lou
ou blm, ce serait cause du Tchouen tsieou (
864
).
369
Interprtes en
tenant compte de ce que rapporte le Tchouang tseu, ces traditions sont
instructives. Ce nest pas sans raison que Confucius a t appel un roi sans
royaume : il stait arrog le droit de distribuer les honneurs et les qualits
(ming). Ds quil y a eu en Chine, non plus seu lement des vassaux parlant
pour leurs seigneurs, mais des sages ou des crivains jugeant pour leur
compte, le thme de la correction du langage a pris un sens nouveau. Ctait
un axiome, ltiquette rgnant, que, d istribus par la grce du Prince, les lots
dhonneurs et dappartenances assigns, avec un nom, aux individus taient
assigns correctement. Un problme va se poser. De quel droit un simple
individu peut-il porter un jugement sur un autre individu ? Quelles sont les
recettes qui permettent au commun des hommes de qualifier correctement ?
Le problme des jugements individuels et des rapports du Moi (wo) et du
Toi (tseu), combins avec ceux du Ceci (tseu) et du Cela (pei) a proccup
les Dialecticiens. Tchouang tseu, regardant des poissons sbattre, scria :
Voil le plaisir des poissons ! Vous ntes pas un poisson, dit Houei
tseu ; comment connaissez-vous ce qui fait le plaisir dun poisson ? Vous
ntes pas moi, rpliqua Tchouang tseu ; comment savez-vous que je ne sais
pas ce qui fait le plaisir dun poisson ? Je ne suis pas vous et assurment je
ne (puis) vous connatre, mais assurment aussi vous ntes pas un poisson, et
tout cela concorde prouver que vous ne pouvez connatre ce qui fait le plaisir
dun poisson (
865
). Les sophistes professaient un subjectivisme total : ils
sappli quaient ruiner les ides reues. Les partisans de M tseu avaient un
idal duniformit et de paix sociale. Ce quest un tre, ce quon en connat,
ce quon en fait connatre, peuvent diffrer (
866
), concdaient-ils, mais ils
posaient en principe que les dnominations (ming) doivent tre soustraites aux
discussions (pien). Ds quil ny a point de confusion dans leurs applications,
cest --dire tant que le langage nest point dlibrment incorrect, les
qualifications (ming) correspondent lobjet ( che). Sil ny a point de con -
fusions dont le Moi ou le Ceci seraient responsables, les qualifications
appartiennent rellement au Cela (
867
).
Marcel GRANET La pense chinoise 266
Telle, du moins, parat avoir t lopinion de Yin Wen
370
tseu. Ce Sage
aboutissait fonder la valeur des jugements sur lopinion, dont les dcisions
sont valables ds que la socit est assez stable pour quil soi t possible
dutiliser correctement le langage (
868
). Yin Wen tseu semble avoir t
considr comme un sectateur de M tseu. Les Taostes, cependant, parlaient
de lui avec quelque indulgence : Se librer des coutumes, mpriser les
ornements, ne pas tre inattentif aux individus, ne point sopinitrer contre la
foule, dsirer la tranquillit de lEmpire afin que les hommes puis sent vivre
jusquau bout leur lot de vie ( ming), se tenir pour satisfait ds que les autres et
soi-mme ont de quoi subsister... telle fut la rgle suivie par... Yin Wen tseu...
Dans ses rapports avec autrui, quels que fussent les diffrends, il faisait preuve
damnit ; il endurait les injures sans se sentir outrag ; il cherchait, au plein
des rixes, porter secours, prvenir les agressions, empcher les batailles.
Il fit le tour de lEmpire, reprenant les grands, endoctrinant les petits ;
personne au monde ne voulut laccueillir : il ne se rebuta jamais et
persvra (
869
). Yin Wen tseu fut-il, comme M tseu, un prcheur de paix ?
Fut-il un clectique, influenc par le Taosme comme par les Lgistes ? Il est
bien difficile de le dire. Nous ne savons rien de lui sinon quil vcut sans
doute la fin du IVe sicle et (peut-tre) sjourna Tsi au te mps du roi Siuan
(343-324). Son uvre, perdue plusieurs reprises et reconstitue laide de
citations (en particulier vers le XIe sicle de notre re), nous est parvenue sous
la forme dun opuscule incohrent. Il est loin dtre sr que tous les lment s
en soient authentiques ; on y relve des contradictions graves ; le style ne
prsente aucune unit et il ny aucun moyen de dterminer, pour les termes les
plus importants, sils sont toujours employs avec la mme valeur technique.
On court, en particulier, le risque de trahir lau teur si, le prenant pour un pur
logicien, on traduit par spcificit ou spcificit des noms les
expressions fen et ming fen (
870
). De lensemble du texte, pris tel quil nous est
arriv, il semble rsulter que le sentiment dominant du rdacteur est lhorreur
de la confusion et de lindistinction, car ce sont des sources de dispute.
Un premier remde la confusion est dordre logique ou plutt
linguistique : les acceptions doivent tre dfinies et
371
le Ceci distingu du
Cela (
871
). Mais il y a lieu, par ailleurs, de distinguer entre les jugements
attribuant aux objets des proprits (fen) dune application indfinie et qui
doivent avoir un fondement dans le Cela, et les jugements, dpendant
entirement du Moi, qui impliquent des prfrences et des aversions (
872
).
Pour obtenir la paix sociale, il faut qu une discipline du langage qui permet
des dnominations (ming) correctes et assure lobjectivit des prdications,
sajoute une discipline des murs garantissant, avec des estimations justes,
une distribution des honneurs (ming) et des sorts (fen) qui ait la vertu
dempcher tout empitement (
873
).
Il faut que les qualifications (ming) honorables et pjoratives soient
distribues efficacement entre les bons et les mauvais, les jugements
dapprciations constituant un art dont lobjet est prcisment dviter
Marcel GRANET La pense chinoise 267
discussions et disputes (
874
). Il y a donc une politique des noms (ming) qui les
utilise titre de rcompenses ou de chtiments dans le but de fixer les
conditions (fen), afin que le marchand, lartisan, le laboureur, le noble ne
puissent abandonner leur tat, leur nom les limitant , et que les infrieurs
ne puissent exercer leur ambition , chacun se contentant de sa place, bonne
ou mauvaise (
875
). Yin Wen tseu demande quon condamne la mort les
sophistes que leur savoir nempche pas dtre vils (car lloquence sert
corrompre, flatter et tromper), et tous ceux qui parmi les hommes vils sont
des hros capables (en raison de leurs talents personnels et de leurs
connaissances dangereuses ), dembellir linjustice et de troubler la
multitude (
876
). En effet, les noms (qui) versent (attribuer) correctement
les rangs peuvent servir (incorrectement utiliss) favoriser lambition et
lusurpa tion : le pouvoir de qualifier et dhonorer laide de noms doit donc
rester une prrogative princire (
877
), mais sous deux rserves. Le Prince
est tenu tre bienfaisant et, sil doit en conservant de la fixit ( ting) aux
conditions (fen), empcher que ceux qui sont intelligents et forts ne se
montrent arrogants, il doit aussi viter de ne point utiliser correctement les
talents qui sont le lot (fen) des individus (
878
). Le Prince, dautre part, bien
quil doive sattacher demeu rer la source unique des libralits, na point le
droit davoir des favoris et dagir daprs son propre cur (
879
). Il faut
372
donc quil vite de gouverner en se servant des hommes. Il convient quil ne
gouverne quau moyen des noms (cest --dire en rpartissant impartialement
les rangs, les honneurs, les attributions) et des lois (cest --dire en soumettant
les tres de toutes conditions des dcisions uniformes ) (
880
) .
Loriginalit de Yin Wen tseu semble se rsumer dans leffort quil tenta
pour distinguer les estimations des simples qualifications. Cependant, mme
pour lui, dfinir ou qualifier, estimer ou hirarchiser sont des arts solidaires.
Leur pratique nest possible que si la socit est assez stable pour que les
opinions soient uniformes. Aussi lidal du logicien est -il la stabilit sociale et
la conciliation des conflits sous la domination de la loi. Ce nest plus
ltiquette qui donne autorit au jugement ; ce ne peut tre lindividu ; ce doit
tre laccord des individus : celui-ci dpend de limpar tialit du Prince.
Lautorit logique appartient au Prince en tant quil est la source de toute
paix et de toute stabilit. Lart de qualifier se confond avec lart de lgifrer.
Cest bon droit, sans doute, que Yin Wen tseu a t, en tant que logicien,
class parmi les tenants de lcole des Lois. Pour ces derniers, comme pour
lui, les dsignations (ming), comme les attributions, les rangs et les hritages,
ne dpendent pas des statuts coutumiers ; ceux-ci ne peuvent les doter ni de
stabilit ni duniversalit, ni mme de souplesse et deffica cit : mais tout cela
peut leur venir de lautorit du Prin ce, auteur de la loi et apprciateur
souverain des donnes circonstancielles (che).
Telle est la doctrine qui faillit triompher avec Che Houang-ti. Le grand
Empereur uniformisa lcriture, dicta un dictionnaire officiel et crivit sur ses
Marcel GRANET La pense chinoise 268
stles : Jai apport lordre la foule des tres et soumis lpreuve les actes
et les ralits : chaque chose a le nom qui lui convient (
881
).
IV. Lart de lgifrer
On groupe sous la rubrique : cole des lois (fa kia) des crivains qui se
sont surtout occups dadministration et qui eurent comme idal dtre les
hommes du Prince (
882
). Ils
373
se distinguent des Politiciens. Ceux-ci se
proccupaient surtout de faire russir les combinaisons diplomatiques. Les
Lgistes sintressaient au contraire aux recettes dont les tats peuvent tirer
leur force intrieure. Organisation du territoire et de larme, conomie et
finances, prosprit et discipline sociales, tels sont leurs thmes favoris.
Tandis que les Sophistes, ennemis de tout le systme des traditions, paraissent
avoir t les meilleurs auxiliaires des Politiciens ou des Diplomates, les
Administrateurs ou les Lgistes se sont appuys sur les Logiciens (ming kia),
que dominait lide dun ordre stable. Les premiers songeaient profiter des
bouleversements du monde fodal pour pousser leurs matres lHgmonie ;
les seconds, dans le dsir de justifier des pratiques administratives toutes
nouvelles, furent conduits imaginer une ide neuve : celle de la souverainet
du Prince et de la Loi. Ils avaient administrer des territoires tantt conquis,
par diplomatie et guerre, et parfois arrachs aux Barbares, tantt rcuprs,
grce aux initiatives princires, sur la nature elle-mme. Ils ntaient point, en
ce cas, lis par les traditions, arrts par les statuts coutumiers. Les ordres du
conqurant faisaient la loi. Les administrateurs voulurent que ces ordres
fissent aussi la loi dans le vieux domaine de leur matre et que toute coutume
ou tout statut ft sans valeur devant la volont du Prince (
883
). Il est possible
que leurs ides aient pris un tour plus thorique aprs avoir servi de thmes
aux dbats acadmiques de la porte Tsi Lin-ts. Ce nest point dans
loisivet de ces palabres quelles se formrent (
884
), mais, directement, dans
la besogne administrative. Elles ont pour lien organique un sentiment qui
proclame leur origine et leur valeur techniques. Ce qui justifiait lempire de
ltiquette, cest l Efficace quon lui prtait. Ce qui autorise dclarer la loi
souveraine, cest le rendement effectif (kong yong) de la pratique
administrative quand elle sappuie sur des lois.
Il ny a aucun moyen dindiquer le progrs historique des ides dans le
camp des Lgistes. Nous connaissons assez bien la vie du dernier dentre eux,
Fei de Han, appel Han tseu ou Han Fei tseu. Il appartenait, dit-on, la
maison princire de Han et fut, peut-tre, llve de Siun tseu. Il servit les
princes de Han, puis ceux de Tsin. Le futur Che
374
Houang-ti eut de
ladmiration pour lui, puis le mit en prison avec permission de se suicider, le
ministre Li Sseu, qui avait t son condisciple, layant, dit -on, calomni par
jalousie (
885
) Han Fei tseu mourut vers 233, laissant une uvre en 53
chapitres. Le Han Fei tseu a toujours 53 chapitres, mais plusieurs, aprs avoir
Marcel GRANET La pense chinoise 269
t perdus, ont t reconstitus ; la critique na point encore russi sparer
les parties fausses des autres ; dans le texte mal tabli, parfois
incomprhensible, les interpolations fourmillent (
886
). Un autre ouvrage, le
Chang tseu, ou Chang kiun chou (Livre du Seigneur de Chang) est un
assemblage, fait date inconnue (peut-tre entre les IIIe et VIe sicles de
notre re), de morceaux dont certains remontent, peut-tre, au IIIe sicle avant
Jsus-Christ (
887
). Cest luvre suppo se de Wei-yang (ou de Yang de Wei),
ministre du duc Hiao (361-336) de Tsin. On lui fait honneur des dcrets
rvolutionnaires (359) qui abrogrent Tsin le rgime fodal ; nomm
seigneur de Chang (340) aprs un succs militaire, il fut cartel la mort de
son matre : il avait eu le tort dobliger le prince hritier respecter les
lois (
888
). Le plus ancien patron des Lgistes, Kouan tseu, nest connu que par
des lgendes (
889
). Rien dauthentique ne subsiste de plusieurs ou vrages,
rdigs sans doute, comme le Kouan tseu, vers le IIIe sicle, et placs, eux
aussi, sous le nom de hros anciens du Droit, comme Teng Si, ministre de
Tcheng, qui fut (disent les uns) mis mort (501) par son rival Tseu-tchan,
autre Lgiste, que le Tso tchouan met frquemment en scne (
890
).
Tseu-tchan, de qui la mort, parat -il, fit pleurer les gens de Tcheng et
Confucius lui-mme et que lhistoire vante pour son amour du prochain et sa
bienfaisance, avait dabord t honni parce quil essaya de lutter contre les
associations prives (
891
). Au crime dessayer daccrotre la force de ltat, les
Lgistes ajoutaient une autre sclratesse. Ces serviteurs indiscrets du Prince
exigeaient que lon travaillt et que les greniers fussent pleins, de faon
parer aux besoins des armes et aux temps de famine. Sans doute exigrent-ils
beaucoup des paysans. Cependant, quand leurs compatriotes nous assurent
que le peuple (min) les dtestait, il faut songer que ce mot (min) signifie
les grandes familles et dsigne, non la plbe (chou jen), mais ceux qui se
considraient comme les pairs du seigneur.
375
Au temps des Royaumes
Combattants, certains pays chinois ont connu un rgime analogue au rgime
des Tyrannies. Le Prince combat la noblesse et la routine fodales. Il essaie
daugmenter les revenus et la puissance militaire de ltat en donnant la terre
aux paysans. A ces deux principes de lad ministration tyrannique se rattachent
la thorie du rendement et la pratique de la publication des lois. Celle-ci a
servi de point de dpart aux rflexions des Administrateurs et celle-l de
fondement la doctrine des Lgistes sur la souverainet du Prince et de la Loi.
A dfaut de faits historiques qui puissent renseigner sur lvolution des
ides dont le Han Fei tseu marque le terme, le Tso tchouan rapporte deux
anecdotes que leur symtrie rend dignes dintrt. Aprs avoir ( ? 542)
distribu des terres diffrents nobles pour se concilier un parti parmi eux,
Tseu tchan, ministre de Tcheng, instaure une hirarchie nouvelle, chaque
rang tant distingu par le vtement ; puis il procde une rpartition des
terres et tablit entre les voisins un lien de compagnonnage militaire (wou).
Quelques grands laident ; les autres sont terrasss . Aprs quelques
meutes et mme quelques chansons satiriques, tout sapaise. Cinq ans plus
tard Tseu-tchan fixe les contributions foncires ; on le traite de scorpion : il
Marcel GRANET La pense chinoise 270
exigeait trop pour ltat. Deux ans aprs ( ? 535), il fait fondre des chaudires
pour y inscrire des lois pnales (hing pi) ; un sage le menace tout aussitt des
feux clestes et, en effet, un incendie clate Tcheng. Le sage rappelait que
les souverains anciens se contentaient dinstituer des peines ( hing) et des
chtiments, de faon frapper de terreur les mchants ; ils ndictaient pas de
lois pnales (hing pi) par crainte de dvelopper lesprit processif ( tcheng sin).
Quand les gens savent quil y a une loi ( pi) (pnale), les grands ne sont plus
pour eux sacro-saints (ki). Lesprit processif sveille, et lon fait appel au
texte crit (chou) avec lespoir que les arguments pourront russir... A quoi
pourront servir vos lois (pi) ? Une fois que les gens connaissent sur quoi
fonder leur esprit processif, ils font fi des Rites. Ils sappuieront sur vos textes
crits : propos de pointes daiguille, ils dveloppent jusquau bout leur esprit
processif. Troubles et procs iront se multipliant et croissant ! Les prsents
pour gagner les juges auront largement
376
cours (
892
) ! En 512 ( ?),
Tsin, aprs un succs militaire, des lois pnales (hing) furent graves sur des
chaudires de fer. Ces chaudires devaient tre considres comme une
proprit commune tous, car chacun avait t tenu dap porter sa quote-part
de fer. Un sage manifesta sa dsapprobation. Ce fut, dit-on, Confucius
lui-mme : Les gens vont sattacher ces chaudires ! Est-ce quils
continueront dhonorer les nobles ? Confucius, renseignement prcieux,
aurait ajout que le peuple continuerait de respecter les nobles si lon
conservait Tsin les rgles protocolaires (tou) et les modles de conduite (fa)
prescrits par les anciens princes, mais non pas si lon mettait en vigueur des
lois pnales promulgues jadis ( ? 620) au cours dune parade militaire o
rang et offices avaient t rviss (
893
).
Ces anecdotes, quelle que soit leur valeur historique, font apparatre deux
faits importants. 1 En Chine (comme dans dautres pays, ve rs la mme
poque et pour des raisons analogues), laristocratie se scinda en deux parts :
certains nobles sattachrent sauver les privilges fodaux, dautres favo -
risrent lavnement des Tyrannies. 2 Lun des fondements du prestige des
chefs fodaux et des nobles rsidait dans leur autorit discrtionnaire, en
matire de diffrends surgis chez leurs vassaux. Leur gloire consistait, non pas
tant juger daprs les coutumes rituelles dont ils connaissaient seuls les
secrets, qu faire en sorte quau cun diffrend ne ft jamais voqu en justice.
Les chtiments (hing) taient institus non pour tre appliqus, mais pour faire
peur ; les modles de conduite (fa) taient proposs litre difiant, mais non
impratif. Les prescriptions (hing ou fa) ntai ent estimes que pour leur
efficacit symbolique (siang) ; les moralistes disaient (et disent encore) (
894
)
quelles avaient la vertu de prvenir en amendant les mauvais penchants. Il
faut entendre par l que tout diffrend se rglait par une procdure de
conciliation. Le Chef conciliait et rconciliait ou, mieux encore, la crainte du
Chef (sans compter le prix de la procdure de paix ralise laide de prsents
rituels, li) invitait les plaignants rgler entre eux leurs querelles (
895
). Les
dispositions pnales navaient point tre appliques ; aucun crime ne
devenant manifeste, il ny avait pas de cri mes. Et tout ceci faisait clater la
Marcel GRANET La pense chinoise 271
Vertu ordonnatrice du
377
Chef (
896
). Dans un cas seulement, lesprit de
discipline et de commandement lemportait : ctait lorsque se runis saient les
milices fodales. A loccasion des guerres et des triomphes, les chefs se
dbarrassaient des indociles (
897
). Cest un fait significatif que toutes les
admonestations o lon voit des codes anciens soient dites lances au cours de
parades militaires (
898
).
Quand le rgime des Tyrannies se constitue, les potentats mprisent et
craignent la milice fodale, dangereuse pour eux, sans force contre lennemi.
Ils inventent le systme de la nation arme et toujours sous les armes. Sils
donnent aux paysans la terre, cest en vertu du principe : qui a la terre doit le
service. Aussi les distributions de terres saccompa gnent-elles de
ltablissement dun rgime de compagnon nage militaire (wou) entre les
paysans. La discipline des camps doit alors simposer dans tout le cours de la
vie sociale. Les avertissements promulgus loccasion des parades militaires
fournissent, comme le Tso tchouan laf firme pour Tsin, le fond des lois
nouvelles, conues, ds lors, non plus comme des exhortations, mais comme
des prescriptions destines tre effectives. Inscrire une loi sur une chaudire
cest avertir le coupable quil sera bouilli (
899
) ; cest dire que la loi sera
applique. Cest aussi publier la loi, limiter par l le pouvoir discrtionnaire
du Chef et avouer, par surcrot, que la Vertu du Chef ne suffit pas empcher
le crime. Cest donc renoncer fonder lautorit sur l e prestige que nourrit
ltiquette. Cest la fonder sur le pouvoir que confre le commandement
militaire. Lorsque Wei-yang fit adopter par Tsin le principe de la publicit
des lois, il attendit pour dicter son code davoir remport par les armes, un
succs dcisif. Il btit alors les piliers Ki. Ce fut sur ces monuments
triomphaux quon afficha les lois nouvelles (
900
).
Jusquau moment o les Lgistes, crant une justice dtat, enlevrent aux
nobles non seulement leurs privilges, mais le prestige que leur donnait leur
rle darbitres, les mots hing (lois pnales) et fa (loi) ont eu la signification de
modles , ou de moules , de recettes opratoires ou, si lon veut, de
prceptes mi-moraux, mi-techniques. Ni lide do bligation, ni lide de
contrainte ntaient impliques par ces termes (
901
).
378
Les lgistes ont cherch introduire dans lide de fa (loi) la notion
de force imprative. Pour eux le magistrat nest point un conciliateur que,
seule, la paix proccupe. Il doit appliquer la loi ses administrs ; il doit la
publier ; il est tenu de dire le Droit. Cest la publication de la loi qui lui
confre son caractre obligatoire. Les premiers codes, gravs sur des
chaudires, gardent encore quelque chose des palladia dynastiques. Tout
change quand les lois sont graves sur fiches, innovation attribue Teng Si
de Tcheng (en 500 ?) (
902
). Han Fei tseu crit : Les lois doivent tre runies
et affiches sous forme de tableaux ; les fiches doivent tre exposes en bon
ordre dans (tous) les offices administratifs ; elles doivent tre rendues
publiques dans lensemble du peuple. Il y a loi lorsque les dcrets et
ordonnances ont t affichs dans (tous) les offices administratifs et que les
Marcel GRANET La pense chinoise 272
chtiments et les peines paraissent invitables tous les esprits. Les
rcompenses sont attaches lobservation respectueuse des lois et les peines
leur violation (
903
).
La porte de ces deux dfinitions est dautant plus grande quelles sont
donnes dans des passages o lauteur oppose fa et chou, deux termes qui ont
dab ord signifi indistinctement recettes, manires de faire . Fa prend un
sens impratif et signifie loi ds quon lapplique aux rglements rendus
publics, tandis que chou garde sa valeur de recette parce que (chou ou)
recettes doivent demeurer secrtes. Han Fei tseu considre que les lois (fa)
doivent rgler inexorablement la pratique administrative. Les besognes
ministrielles se rsument dans lapplication stricte des dispositions lgales.
Les administrateurs ne sont que les instruments de la loi : ils ne peuvent
lamender. Les admi nistrs ne sont que les sujets de la loi : ils sont tenus une
discipline sans dfaillance. La loi publie rgne par le concours obligatoire de
tous. Toute infraction doit tre dnonce, toute action conforme signale. Nul
ne peut receler ni lacte juste ni lacte fautif. Nul ne peut se soustraire ou
soustraire autrui la punition ou la rcompense. Lini tiative et
linterprtation ne peuvent tre tolres. Il eut tort, ce ministre de Tchou qui
condamna comme mauvais fils un homme qui avait dnonc le vol dun
mouton commis par
379
son pre. Et plus coupable encore fut Confucius
louant un rcidiviste de la dsertion, sous prtexte quil avait un vieux pre
soigner (
904
). Il ny a pas de conflits de devoirs : puisque la loi est publique,
tous sont tenus de la faire rgner, sous peine de ruiner le principe de lordre.
Dangereux seraient les administrateurs ou les sujets trop instruits et disposs
discuter en dehors de la loi crite. Dans le pays dun Prince sage, il n y a pas
de livres : la Loi seule est enseigne ; il ny a pas de sentences des anciens
rois : seuls les fonctionnaires (qui disent le Droit) font autorit (
905
). Aucune
discussion nest possible puisque les dispositions lgales ( ming) dfinissent
lacce ption des mots (ming : vocables ou graphies). Lordre rgne.
Cest un ordre correct, car il est entirement anonyme et impartial :
Quand les suprieurs et les infrieurs ninter frent point, les noms sont
corrects , disait Yin Wen tseu (
906
), et, dans les rangs, il ny a aucune
confusion. Le Prince, comme le Chef fodal, mais par de tout autres voies,
est un crateur de hirarchie. Seulement, cest une hirarchie militaire qui
nat de son pouvoir de commandement. Elle rsulte des sanctions entirement
automatiques. Le gouvernement a deux poignes , le Hing et le T, le
pouvoir dappliquer les sanctions ngatives ( hing) et positives (t) De cet
imperium double aspect, le Prince ne dlgue rien. Ce ne sont point les
administrateurs qui, deux -mmes, ni le seigneur qui, privment, promeuvent
ou dgradent, cest la Loi. Le Prince ne saurait intervenir dans les affaires
administratives o rgne, seule, la loi publie. Inversement aucun sujet, aucun
ministre ne saurait intervenir dans les affaires du Prince (
907
). La haute direc-
tion de ltat ne relve que de lui. De lui seul dpend la Politique ; lui seul
appartiennent privment les Recettes (chou) qui, grce aux kiuan
Marcel GRANET La pense chinoise 273
[combinaisons diplomatiques tirant de chaque occasion le poids (kiuan) qui
fait pencher vers soi le destin] permettent de raliser les che (conditions
circonstancielles du succs). Les lois (fa) sont la rgle des administrateurs.
Les recettes (chou) sont les rnes que tient le Matre (
908
). Les Lgistes
distinguent fortement de la Loi lArt gouvernemental (
909
). Les recettes
intransmissibles par dfinition composent la puissance personnelle du Prince ;
380
elles constituent son efficace intime, sa valeur propre grande si le
prince est un Saint.
Ces t dans leur conception de lArt gouvernemental que se rvle
linfluence profonde que, par lintermdiaire des Politiciens, les Taostes ont
exerce sur les Lgistes (
910
). Cette influence est plus extrieure, sinon
uniquement formelle, en ce qui concerne leur conception de la Loi. Pour les
Ritualistes, le pouvoir princier, fond sur la coutume, rsulte dun Prestige
non point priv mais patrimonial. Toute autorit, pour les Taostes, est
constitue par la puissance, strictement personnelle, que procure la Saintet.
Une part de lautorit princire drive des talents personnels, concdent les
Lgistes, mais ils se htent de cantonner rigoureusement lemploi de ces
vertus. En fait, ils exigent du Prince, non des talents, mais de limpartialit.
Certes Han Fei tseu compare cette impartialit celle du Tao et il semble alors
argumenter en Taoste. Pourtant il y a un abme entre limpartialit subjective
et secrte du Saint et limpartialit quon exige du Prince : toute objective et
fonde sur une ide militaire de la discipline, elle se confond avec
linexorabilit de la loi publie.
Les Lgistes sont arrivs dgager les ides de Prince et de Loi
souveraine parce quils cherchaient dfinir une discipline qui convnt de
grands tats. En mme temps qu celle des hommes, ils avaient songer
ladministration des choses. Ce sont des faits conomiques et lobservation de
ces faits qui commandent leur conception. Le peuplement trop rapide de la
Chine posait, ds leur temps, un problme qui na pas cess de demeurer
tragique : celui des subsistances. Au temps jadis (
911
), les hommes ne
faisaient point de culture ; les fruits des arbres suffisaient la nourriture. Les
femmes ne tissaient pas : les peaux des animaux suffisaient aux vtements.
Sans quil ft besoin de travailler, il y avait de quoi subsister. Les hommes
taient peu nombreux et les ressources surabondaient : le peuple navait pas
desprit processif. Nul besoin de rcompenses renforces, de punitions
redoubles : le peuple, de lui-mme, se gouvernait. De nos jours, cinq fils sont
peu pour un homme, un grand-pre de son vivant peut compter vingt-cinq
petits-fils. Les hommes sont nombreux et les
381
ressources rares : il faut
travailler force pour subsister pauvrement. Le peuple a donc lesprit
processif. Mme en multipliant les rcompenses et en accroissant les
chtiments, on ne peut chapper au dsordre. Sil y a du dsordre dans
ltat, il y a famine, et la population se disperse, man quant de ressources... Il y
a des ressources suffisantes, et la population demeure en place, quand on met
les lois en pratique (
912
).
Marcel GRANET La pense chinoise 274
Pour les Lgistes, la loi consiste en une distribution impartiale des peines
et des rcompenses qui permet daccrotre la production et, par suite , rend
moins redoutable la rpartition, non pas des richesses, mais des biens les plus
ncessaires. Il sagit dviter que les paysans ne vendent leurs filles et qu
bout de ressources, ils ne se mettent vagabonder : ltat touche alors sa
perte, menac par les associations prives qui peuvent faire la fortune de
quelque aventurier. Or, en matire conomique, deux faits sont patents : on ne
peut ni compter sur les chances exceptionnelles (et attendre, abandonnant son
araire, quun livre vienne se pr endre dans des branchages o, une fois, un
livre sest pris) (
913
), ni ne point tenir compte des conditions changeantes (et
se servir, par exemple, pour arroser son champ, dune cruche, aprs que la
bascule puiser a t invente) (
914
). Le rendement (kong yong) (
915
) est le
premier fait considrer dans ladministration des choses. On doit aussi
prendre le rendement pour base quand on soccupe de ladministration des
hommes.
Do plusieurs consquenc es. Il est absurde dimiter les anciens.
Lantiquit dun procd parle contre lui : temps diffrents, lois diffrentes.
Il est absurde de compter sur la Vertu des Sages. Il y a peu de sages, et lon a
besoin de solutions quotidiennes. Pour sauver un homme qui se noie au centre
de la Chine, on nenvoie pas chercher le meilleur des nageurs de Yue
(extrme-sud). Au lieu dattendre batement la chance ou le sauveur, il faut
soccu per des conditions prsentes et normales, calculer le probable et
prvoir le possible. Si vous voulez aller loin et arriver vite, nattendez pas
quil vous arrive un cocher tel que Wang Leang, capable de faire parcourir en
un jour mille stades ses chevaux. Calculez vos tapes en tenant compte de
382
lhabilet moyenne des cochers , de la qualit moyenne des chars, et faites
disposer des relais en consquence. Un administrateur ne sintresse pas
lexceptionnel et se fie non la fortune, mais aux calculs ( chou : nombres).
Aussi ne perd-il point son temps chercher des gens de talent pour laider : il
lui suffit dappliquer les lois conues pour la moyenne des cas (
916
). Dans les
actes et les paroles, on prend pour rgle le rendement (tchong yong). Si, aprs
avoir aiguis une flche, vous la lancez au hasard, il se peut que sa pointe
touche le plus fin des duvets ; nul ne dira que vous tes un matre archer : ce
(coup) nest point (leffet) dune rgle constante. Sur une cible de cinq
pouces, faites tirer dix pas un matre archer ; il nest pas sr quil atteigne le
but : cest l une rgle constante (
917
). Aussi dans la pratique, se sert-on
dinstruments tels que la rgle et le compas, le poids et la balance. Les
commerants psent avec des balances et estiment en pouces ; ils ne sen
remettent pas lapprciation personnell e. De mme, si lon veut obtenir un
rendement sr, il faut se servir des lois (
918
), et non pas des hommes.
La Grande Paix... est due non au gouvernement du Saint, mais celui
des lois saintes (
919
). Les Lgistes opposaient avec force le Prince au Sage et
la Loi (fa) aux Rites (li) ; ils essayaient de faire prvaloir une conception toute
Marcel GRANET La pense chinoise 275
objective du licite. Est licite ce qui contribue effectivement la paix sociale en
assurant un bon rendement moyen lactivit productrice des hommes.
*
* *
Che Houang-ti, quand il fonda lEmpire, pensa tablir le rgne de la Loi.
Le rgime na pas dur. Les Chinois lont honni, reprochant aux Lgistes leur
duret, leur cruaut. Les Lgistes taient coupables, en effet, davoir cru
lunique vertu de la discipline. Ils partaient dune psycho logie un peu courte et
desprit militaire. Les hommes aiment la vie et dtestent la mort, disait
Tseu-tchan (
920
). Tel est le principe du systme des sanctions automatiques et
de la hirarchie militarise qui sert embrigader la population tout
entire (
921
). Cette conception est fruste et
383
rigide, mais il y avait pour le
moins du courage vouloir lappliquer dans un pays dont les grandes plaies
sont le brigandage, le respect accord tout chef de bande, lattrait quexerce
le vagabondage, le rendement mdiocre du travail (
922
). Les Lgistes
engagrent la lutte la fois contre lesprit dimprovisation et lesprit de
routine. Ils ont voulu ruiner lide du Sage, dont la vertu peut tout et quon
prend pour un sauveur ds quil se prsente modestement comme le disciple
des Anciens. Ils ont voulu limiter larbitraire gouvernemental. Ils ont
condamn lincohrence lgis lative (
923
) et prconis les codifications. Ils ont
dfendu le principe que les lois nont de rendement qu deux conditions : si
le Prince fait en sorte que son intrt concide avec lensemble des intrts
particuliers (
924
), et si, condamnant le rgime du bon plaisir, il prend soin
daccorder la rglementation aux circonstances concrtes. Ils ont joint un
idal de discipline le sentiment de lvo lution des murs et des conditions
sociales. Ils ont eu le got des jugements impartiaux, des valuations
objectives, des arguments concrets. Ces esprits positifs et dj pris de rigueur
scientifique nont obtenu quun succs fugitif. Les Sophistes nont pas
russi faire accepter par les Chinois lide quil existt des termes
contradictoires. De mme, les Lgistes nont pas russi ac crditer la notion
de rgle constante et la conception de la Loi souveraine.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 276
CHAPITRE II
Les recettes du bien public
385
Les Politiciens et les Lgistes sont ou bien des aventuriers
prestigieux, ou bien, comme Wei-yang et Han Fei tseu, des fils de grande
famille : plutt que des chefs dcoles, ce sont des patrons dont le nom ajoute
lautorit dune doctrine. Ni Confucius ni M tseu nont jou un rle
politique. Ils appartenaient cette partie de la noblesse que le rgime des
Tyrannies condamnait la ruine. Le conseil des fidles seffaait devant le
conseil secret. Ce ntait pas aux membres de la noblesse locale quallaient les
faveurs des potentats. Dsuvrs, appauvris, carts de la cour, les petits
nobles, bien souvent, servent comme domestiques, intendants ou cuyers, et
composent la clientle dun noble plus puissant. Parfois ils vivent pniblement
sur leurs terres, et quelques-uns sont des sages cachs . Parfois ils forment
lun dentre eux, qui a acquis quelque renom, une clientle dapprentis qui
poussent le Matre vers la gloire et esprent partager sa fortune sil russit
inspirer confiance quelque Prince : tel tait sans doute lespoir des disciples
de Confucius. Mais, parfois aussi, cette clientle ressemble davantage une
confrrie : tel fut le cas pour les tenants de M tseu. Aux yeux de leurs fidles,
M tseu et Confucius apparaissaient comme des princes sans domaines, des
chefs sans vassaux (
925
). La qualification de Roi sans royaume sera
officiellement attribue Confucius quand, avec les Han, lorthodoxie
confucenne aura triomph. M tseu, ds lors, sera considr comme un
hrtique : sa secte, cependant,
386
fut dabord la plus active et la plus
brillante. Recrutes dans les mmes milieux, les deux coles avaient des
tendances voisines. Tandis que les grands et leurs favoris taient lafft des
recettes qui pouvaient accrotre la puissance de ltat et le rendement de
ladministration, les sectateurs de M tseu et de Confucius ne se
proccupaient que du Bien public. Dans ce milieu de nobles malchanceux, un
tour desprit conservateur dforma assez vite les doctrines. Ceci ne prouve
nullement que les Matres aient, eux-mmes, manqu de gnie et de hardiesse.
Confucius et M tseu apparaissent comme des novateurs trahis par leurs
fidles. M tseu essaya de crer une doctrine du devoir social en dnonant les
mfaits de lesprit de clientle. Confucius eut, se mble-t-il, lide plus hardie
encore de faire reposer toute la discipline des murs sur un sentiment affin
de lhumanisme.
Marcel GRANET La pense chinoise 277
I. Confucius et lesprit humaniste
On a souvent compar Confucius Socrate. Sa gloire, moins immdiate,
na pas t moins durable. Son prestige, auprs de ses disciples, fut aussi
grand. Mais sil y a, peut -tre, quelque analogie dans lesprit des
enseignements donns par ces deux sages, pour ce qui est de leur rendement
aucune comparaison nest possible. Les Chinois ont reconnu dans Confucius
un Matre pour dix mille gnrations , seulement aprs en avoir fait le
patron dune morale conformiste. Ils voient en lui lexemplaire le plus parfait
de la sagesse nationale : nul ne lui prte le mrite dune pense originale. Il
ne demeure sur Confucius aucun tmoignage fidle. Ce nest pas une raison
suffisante pour accorder lorthodoxie que le Matre ne fut que le plus grand
des lettrs orthodoxes. Mais cest une tentative bien c hanceuse que dessayer
de dire ce quil fut.
Nous ne savons rien de certain sur la vie de Confucius, sinon quil
enseigna au dbut du Ve sicle dans une bourgade du Chan-Long, peut-tre
dans la capitale de ltat de Lou. Il fut enterr un peu au nord de ce tte ville, et
cest autour de sa spulture que se forma le village (Kong li) (
926
), o furent
387
conserves ses reliques : son bonnet, sa guitare, son char... L
demeurrent groups les plus fidles de ses disciples. La tradition le fait natre
en 551, mourir en 479 ; ces dates ne saccordent pas trs bien avec celles que
lon assigne ses descendants, son petit -fils Tseu-sseu, en particulier ; il ny
a aucune raison de modifier les unes plutt que les autres ; toutes participent
de lincertitude de la chrono logie chinoise pour cette priode ancienne.
Confucius (
927
) appartenait la famille Kong ; tablie Lou depuis trois
gnrations, elle tait originaire de Song, apparente la famille princire de
ce pays, et se rattachait par elle aux rois de la dynastie Yin ; il ny a aucune
raison de considrer cette gnalogie comme purement fictive ; elle est
confirme par plusieurs passages du Tso tchouan, mais aucune gnalogie,
surtout pour cette priode trouble, ne peut inspirer une grande confiance (
928
).
Confucius naquit, dit-on, Tseou, bourgade du pays de Lou, dont son pre
tait gouverneur ; il fut orphelin trs jeune, vcut dans la pauvret, exera
quelques bas emplois, parut la cour, dut voyager et revint finir ses jours dans
son pays entour de nombreux disciples ; il ny a aucune raison pour rejeter en
gros ces donnes biographiques, mais aucune raison aussi pour les accepter
dans le dtail. Le Tchouen tsieo u, chronique de ltat de Lou, ne mentionne
nulle part Confucius, ce qui ne prouve pas que Confucius nait jamais eu de
fonctions officielles. Les aventures prtes au Matre, bien que les
contradictions, les doublets, les impossibilits y fourmillent, no nt, en
elles-mmes, rien dinvraisemblable. On prtend que Confucius enseigna les
arts libraux et quil professa la sagesse en sappuyant sur divers ouvrages qui
(plus ou moins remanis par la suite) sont devenus les Classiques chinois : le
Che king (Livre des Vers), le Chou king (Livre de lHistoire), le Yi king (Livre
de la Divination), les Rituels (dont sortirent le Yi li et le Li ki), le Tchouen
Marcel GRANET La pense chinoise 278
tsieou (Chronique de Lou, que le Matre aurait lui-mme remanie), un
ouvrage sur la musique (aujourdh ui perdu). Il parat certain que, dans
lenseignement donn par les disciples, le commentaire de ces uvres tint de
bonne heure une large place (
929
), combin avec des exercices pratiques de
bonne tenue rituelle : rien ne permet daffirmer
388
ni que lenseignement du
Matre fut aussi livresque, ni quil le fut beaucoup moins. On ne croit plus
aujourdhui que Confucius ait rdig aucune uvre. Rien ne prouve cependant
que la tradition se trompe en supposant quil introduisit dans le Tchouen
tsieou, par de lgers remaniements de style, un certain nombre de jugements
sur les uvres et les personnes (
930
) : sil fit des remaniements, leur
importance et leur sens thorique sont impossibles dterminer.
Collectionns seulement vers la fin du Ve sicle, les aphorismes de Confucius
forment le Louen yu. Cet ouvrage fut perdu, puis reconstitu sous les Han, un
demi-millnaire aprs la mort du Sage. Il y a des raisons pour nen point
suspecter la valeur (
931
). Pourtant, il convient de noter que les propos du
Matre sont donns ds lorigine avec une interprtation implicite ; celle-ci se
trouve suggre par lindication des circonstances qui motivrent ces ensei -
gnements ; le Louen yu repose donc sur une trame biographique (
932
) : or, il
na pas t rdig avant que les pol miques entre hagiographes naient
obscurci les souvenirs laisss par Confucius. Dautres traditions, incorpores
dans divers chapitres du Li ki, laissent mieux entrevoir les polmiques dont
elles procdent. Elles ne sont ni moins instructives, ni plus sres. Laspect
discontinu que prsente la collection daphorismes formant le Louen yu a
impos lide que la pense de Confucius ne fut aucun degr systmatique.
Aussi fait-on honneur, non pas lui, mais Tseu-sseu, son petit-fils, des
thories exprimes dans le Tchong yong et le Tai hio, deux brefs traits
figurant aujourdhui dans le Li ki. En fait, il ny a aucun moyen de dis tinguer
lenseignement personnel de Confucius de celui des premires gnrations de
disciples.
Ds que Confucius a t considr comme le patron de lorthodoxie ( jou
kiao), lHistoire sest applique le dpein dre comme le plus orthodoxe des
lettrs (jou). La biographie qucrivit Sseu -ma Tsien (
933
) se ressent de ce
parti pris : le souci deffacer les couleurs vives imposes par lhagio graphie
est peine attnu par le dsir, assez naturel chez un historien, de paratre
largement inform. Mais, si elle tait moins anachronique, limage quon se
faisait du Sage vers les Ve et IVe sicles ntait gure moins conventionnelle.
389
Confucius na eu une histoire quaprs avoir mrit de laisser une
lgende. Une fois avou quon ne sai t rien de la vie du Matre, on pourrait,
certes, en faisant un choix des traits hagiographiques les plus exquis, satisfaire
la pit de ceux qui demandent voir, ft-ce en un portrait acadmique,
revivre les mes les plus hautes du pass. On voudra bien mexcuser si je ne
parle point des paysages du Chan-tong, du temprament mystique de ses
habitants (
934
), des histoires qui couraient parmi eux sur le duc de Tcheou,
lequel revenait visiter en rve Confucius (
935
), ou sur Yi Yin, dont lme
Marcel GRANET La pense chinoise 279
hantait encore les abords du Tai chan, et si je nvoque pas non plus cette
Montagne sainte dont le Matre put admirer, tout enfant, les lignes svres, les
sombres escarpements, les cdres toujours verts et dont le souvenir lemplit
ses derniers moments : il eut alors, pensant son uvre inache ve, un instant
dangoisse et il scria : Voici que le Tai chan scroule... que la matresse
poutre se gte... et le sage sen va comme une fleur fane (
936
). Il suffira de
signaler que Confucius possda les vertus classiques des saints de sa
gnration. Il tait trs grand, peine un peu moins que Yu le Grand (
937
). Il
tait trs fort : il pouvait lui seul soulever la barre verrouillant une porte de
ville (
938
). Il avait les sens les plus aiguiss et pouvait sen servir sans la
moindre fatigue : du haut dune montagne, il distinguait plusieurs lieues de
distance des objets que le meilleur des disciples arrivait vaguement voir,
mais avec tant defforts que ses cheveux en blanchissaient dun coup. Une
extrme puissance physique accompagne, chez le Saint, une sorte
domniscience (
939
). Confucius savait, au premier coup dil, rpertorier des
objets prhistoriques, identifier des ossements gigantesques, dire le nom
vritable des btes les plus mystrieuses et des plus bizarres concrtions (
940
).
Aussi tous linterrogeaient. Mais il n e rpondait point en disant : Je sais ; il
disait : On ma appris que... Aprs que le roi Wen eut disparu, sa
perfection ne fut-elle point place en cet homme-ci ? disait-il
ingnument (
941
), car il pensait avoir reu du Ciel, avec une mission remplir,
tous les dons ncessaires pour la mener bien.
Aussi inspirait-il une confiance absolue ses fidles. Lun deux, dans un
moment de danger, passa pour mort ; il dit,
390
quand il reparut : O matre,
tant que vous vivrez comment pourrai-je mourir ? (
942
) La puissante
esprance de quelque chose de grand et qui ne pouvait tarder inspirait tous
une foi qui tantt sexaltait, mais tantt t ombait jusquau reniement : Nous
ne sommes ni des rhinocros ni des tigres pour nous tenir dans ces rgions
dsertes , dit le Sage une fois que sa troupe tait en danger et quil sentait
lirritation dans tous les curs. Ma sagesse serait-elle en dfaut ? Nous
ne sommes point assez sages ! rpondit un disciple, et un autre : Votre
sagesse est trop haute ! Mais Confucius : Un bon laboureur peut semer ; il
nest pas sr quil puisse rcolter... Votre sagesse, Matre, est trs haute,
dit son tour le disciple prfr. Aussi personne ne ladmet. Cependant,
Matre, ne vous relchez pas... Si nous ne pratiquions pas la sagesse, la honte
serait pour nous ; si nous la ralisons pleinement et que nul ne nous emploie,
la honte est pour les seigneurs. O fils de la famille Yen, rpondit Confucius
avec un sourire, si vous aviez beaucoup de richesses, je serais votre
intendant (
943
). Cest ainsi que le Matre soutenait les courages. Il savait
mme supporter le blme quand sa conduite scandalisait les siens. Il eut une
fois lide dentrer au service dun brigand qui promettait de russir, et il fit sa
cour une princesse qui vivait mal ; Tseu-lou, le plus entier de ses lves, se
fcha : Celui qui mappelle auprs de lui , comment le ferait-il sans
raison ? dit tranquillement le Matre, ou bien : Si jai mal fait, cest le Ciel
qui my a contraint ! Cest le Ciel qui my a contraint ! (
944
). Parmi ces gens
Marcel GRANET La pense chinoise 280
inquiets, orgueilleux de leur indpendance, mais avides de servir, lune des
grandes querelles tait de savoir lequel vaut mieux : se retirer du monde en
affectant une indiffrence lourde de reproches, crier son dgot et lancer
linvective, servir et supporter compro missions et outrages en se gardant pur.
Confucius ne condamnait ni la morgue asctique, ni lhumilit stocienne, ni
mme le prophtisme criard. Je diffre de tous ces gens, disait-il ; rien ne me
convient et tout me convient (
945
). Il avait la foi ingnue qui ne refuse
aucune chance et que les difficults exaltent : Nous ne pouvons vivre avec
les btes ni faire delles notre compagnie. Si nous nacceptons pas de vivre
parmi les hommes, avec qui ferons-nous compagnie ?
391
Certes, si lEmpire
tait bien ordonn, y aurait-il pour moi besoin de le changer (
946
) ? Si un
seigneur memployait, en un an jaurais fait quelque chose ; je russirais en
trois ans... Supposez quil y ait un roi (digne du nom de roi) : il ne faudrait
quune gnration pour que sinstaure le jen [cest --dire : un ordre digne des
hommes] (
947
).
Les anecdotes du Louen yu font assez bien comprendre lesprit et la vie de
lcole. Elles imposent le sentiment que le Ma tre avait, dans les vertus
humaines, une foi qui le mettait au-dessus de ses disciples. Certaines de ces
historiettes semblent indiquer les raisons de son ascendant ; peut-tre
rvlent-elles quelque chose de sa personnalit : ce ne sont pas, comme on
peut penser, celles que lorthodoxie prfre. Le Sage avait des mouvements de
sensibilit que les siens jugeaient contraires au protocole. Une douleur vraie
lui arrachait plus de larmes quil net fallu (
948
). Il ne se considrait pas
comme li par les formes rituelles. Tenir un serment extorqu par violence
tait, pour ses contemporains, un moyen daccrotre leur renom : pour lui, un
serment extorqu ne devait point tre tenu (
949
). Il nhsitait pas p rtendre
quaux purs tout est pur : Ne dit-on pas : Ce qui est dur peut tre frott
sans quon luse ? Ne dit-on pas : Ce qui est blanc, mis dans la teinture, ne
devient pas noir ? Suis-je une calebasse qui doit rester pendue sans quon la
mange (
950
) ?
La doctrine du Matre parat avoir t une doctrine dac tion. Il enseignait
une morale agissante, et la lettre des principes lintressait moins que laction
morale quil entendait exercer. Cest en tant que directeur de conscience quil
semble avoir mrit son prestige. Il nhsitait pas, selon les hommes et les
circonstances, donner des instructions que lon trouvait contradictoires. Il
imposait aux uns de songer tout dabord mettre les prceptes en action, mais
Tseu-lou, le hardi, il conseillait de ne rien faire sans consulter pre et frre
an. Les tranards, je les pousse ; les fougueux, je les retiens (
951
). Il ne
parlait point pour formuler des prceptes inconditionns, sex posant ainsi se
voir refuser le mrite dune doctrine ferme. Il prfrait tirer de chaque
occasion la leon dont tel de ses fidles pourrait profiter :
392
Voici un
homme avec qui tu peux parler ; tu ne lui parles pas : tu perds un homme.
Voil un homme avec qui tu ne dois pas parler ; tu lui parles : tu perds une
parole. Sage est celui qui ne perd ni un homme ni une parole (
952
). Mais pour
Marcel GRANET La pense chinoise 281
lui le vritable enseignement ntait point celui qui se transmet avec des mots.
Je prfre ne pas parler, disait-il. Si vous ne nous parlez pas, dit
Tseu-kong, nous, vos disciples, quaurons -nous enseigner ? Le Ciel
parle-t-il donc ? Les quatre saisons suivent leur cours, tous les tres reoivent
la vie, et pourtant le Ciel parle-t-il (
953
) ?
Linfluence du sage, comme celle du Ciel, est silencieuse, profonde,
vivifiante. Comme les comportements des tres soumis laction rgulatrice
du Ciel, les comportements des hommes subissent lascendant de lordre qui
sexprime dans la conduite du sage. On nous a donc conserv de nombreux
traits qui font clater le contrle rigoureux que Confucius exerait sur ses
moindres gestes et son constant souci de tenir compte des situations et des
circonstances (
954
). Il avait une faon raffine et personnelle de pratiquer
ltiquette (
955
). Cest une certaine finesse lgante des manires et de la
tenue quil reconnaissait lhomme polic ( wen : civilis). Il soutenait que,
pour mriter ce titre, il fallait tre actif, soucieux dapprendre, jamais honteux
de sinformer (mme) auprs dun infrieur (
956
). Si jai (seulement) deux
hommes avec moi, je suis sr davoir un Matre (
957
) , disait-il, car son grand
souci tait de marquer que la vie en commun (et mieux encore, sans doute, la
vie dans une cole) est, avec le contrle quelle entrane des moindres dtails
de la conduite, le principe de perfectionnement qui fait dun individu humain
un homme accompli (tchen jen).
Aimer une vertu, quelle quelle soit, sans aimer sins truire , naboutit
qu grossir un d faut (
958
). Les hommes diffrent moins par leurs
complexions naturelles (sing) que par la culture (si) quils se donnent. Seuls
ne changent point les sages de premier ordre et les pires idiots (
959
).
Lorsquon a lu une affirmation aussi nette et quand, dailleurs, tout le Louen
yu fait apparatre lmulation qui rgnait dans lcole et la passion avec
laquelle le Matre lexcitait, on a quelque peine comprendre quil se soit
trouv des interprtes pour
393
dire de Confucius : La pense du
perfectionnement individuel ne lui vient mme pas (
960
). Toute la pense du
Sage, et en particulier sa politique, se rsument dans lassimila tion quil
tablit entre le Matre et le Prince. Celui-ci mrite le nom de Prince (kiun) et
celui-l lappellation de kiun tseu, sils possdent, lun et lautre, le Tao ou le
T (ou le Tao-t) cest --dire lefficace qui permet de promouvoir ceux qui
(dj) sont bons et dinstruire ceux qui nont pas (encore) de talent, de faon
que tous soient excits leffort (kiuan) (
961
).
Cette obligation leffort et le devoir dy exciter se rappor tent surtout la
vie morale. Lessentiel pour un gouverne ment est dobtenir q ue rgnent la
confiance, la bonne entente, la probit (sin). Labondance de ressources et la
force militaire ne viennent quau second plan (
962
). Comme le Prince, les
gentilshommes dignes de ce nom (kiun tseu) ne sintres sent point aux
bnfices matriels ; ils ne cherchent point lavantage (li) (
963
). Ce mot a un
sens trs large. Confucius ne condamne pas seulement la poursuite de
lintrt, mais tout esprit de comptition vulgaire ( ko). Lhonnte h omme ne
Marcel GRANET La pense chinoise 282
cherche qu se surpasser ( ko) lui-mme (
964
), Le noble (che : le lettr)
tend sa volont vers le Tao et ne doit point avoir honte dtre mal vtu ou mal
nourri. Le gentilhomme (kiun tseu, ou lhomme de bien, chan jen) ne
pense quau T ; les gens de peu (siao jen) ne pensent quaux biens (mot
mot : la terre) (
965
). A-t-on appris le matin ce quest le Tao et meurt-on le
soir ? cest parfait ! En cette fire maxime, se rsume une morale de leffort,
desprit aristocra tique dont loriginalit est marque par la nuance nouvelle
donne aux mots tao et t.
Le Tao-t, lEfficace princire, nest plus conu par Confucius comme une
sorte de qualit proprement patrimoniale. Sans doute conserve-t-il lide que
cette efficace nat teint sa plnitude que chez le Chef. Celui-ci peut seul se
dgager entirement de toute vile proccupation. Sans doute aussi Confucius
est-il convaincu que seul un gentilhomme peut prtendre au Tao et au T, car
la vie quil mne le dtache de la terre , cest --dire des besognes et des
soucis vulgaires : il peut se policer par la pratique de ltiquette (
966
). Il reste
cependant que lacquisition du Tao et du T est affaire deffort personnel. Elle
demande une application
394
constante, un acharnement de tous les instants.
Il ny faut point drober mme le temps dun repas (
967
). Tout au plus, peut-on
esprer lobtenir comme le couronnement dune vie tout entire tendue vers
cette fin idale. Si lon vous inter roge sur moi, disait Confucius, que ne
rpondez-vous : Cest un homme qui son constant effort fait oublier le
manger et qui y trouve une joie qui lui fait oublier ses peines : il ne saperoit
pas que la vieillesse arrive (
968
) ? Pourtant il ne se flattait pas davoir atteint
la saintet (cheng) et mrit le nom de jen : De moi, lon peut dire
seulement que jai persvr sans lassitude et que jai enseign autrui sans me
dcourager (
969
). Cet effort incessant vaut comme une prire. Quand le
Matre fut prs de mourir, les disciples voulurent offrir des sacrifices : Il y a
longtemps que ma prire est faite , dit Confucius (
970
).
Dans la pense confucenne, le Tao-t tend se confondre avec un idal
de perfection obtenu par la pratique de vertus purement humaines : ce sont le
jen et le yi, vertus qui ne peuvent se cultiver quau contact des autres hommes
et dans une socit police.
Le rapport tabli par Confucius entre le jen, le yi et le Tao-t a t
soulign trs objectivement par le taoste Tchouang tseu (
971
). Sur ce point, du
reste, le Louen yu contient les indications les plus nettes : Le T nest point
pour qui vit seul : il faut avoir des voisins (
972
). Rien nest plus impor tant
que le choix des amis et lentretien des relations dami ti (yeou) (973). Il faut
viter lexcs de familiarit, les frotte ments trop vifs, les conseils indiscrets.
Surtout il ne faut se lier quavec des gens capables de cultiver en commun le
jen et le Yi. Toutes les fautes des hommes proviennent du groupement (tang)
dont ils font partie. Point de progrs hors du contrle dun groupe damis,
mais quon prenne garde lesprit partisan ( tang) !
Marcel GRANET La pense chinoise 283
Seul le gentilhomme a des lumires sur lquit ( yi) ; les gens de peu
nen ont que sur lavantage ( li) (
974
). Cultiver le Yi, cest tcher dacqurir
une notion entirement quitable du toi et du moi et non pas seulement du tien
et du mien. Il ne sagit pas uniquement de ne point faire de torts matriels et
de ne considrer que les droits, les statuts, les biens : tout
395
cela est dj le
devoir des simples vilains. Pour les honntes gens, il sagit encore de
sastreindre ne jamais porter sur autrui que des jugements quitables,
impartiaux, rversibles (chou). De cette rversibilit (chou), le Louen yu a
donn, par trois fois, une belle dfinition : Ce que vous ne dsirez pas
(quon vou s fasse), ne le faites pas autrui (
975
). Ce haut sentiment de la
rciprocit, fait de scrupules lgard du toi comme du moi, a un double
aspect : le respect dautrui ( king), le respect de soi-mme (kong) (
976
). Du
souci constant des rciprocits quitables et du sens de la respectabilit
quaffine la pratique lgante de ltiquette ( 1i), nat, quand il sy ajoute
encore des dispositions indulgentes et affectueuses, la vertu suprme, le jen,
cest --dire, un sentiment actif de la dignit humaine (
977
).
Perptuellement interrog sur le jen, Confucius en a donn les dfinitions
les plus diverses. Dfinitions toujours concrtes ou plutt pratiques et
inspires par le dsir de tenir compte, dans la direction morale, des
dispositions propres chaque disciple. Si pourtant ces dfinitions sont
diverses, cest quil sagissait dune vertu complte en soi et quaucun terme
ne pouvait puiser, sinon le mot mme qui la dsignait. Sans cette vertu,
dernire et totale, et quon acquiert en vivant dans une socit damis
soigneusement tris, nul ne sait ni aimer, ni har, ni pratiquer la loyaut, ni se
dlivrer de lapprhension de la mort ou de toute anxit, ni se faire respecter,
aimer et obir, ni se montrer endurant, ferme, simple et modeste, ni viter la
violence, ni se vaincre soi-mme, ni possder lloquence vritable ou la
vritable bravoure (
978
). Les premires conditions du jen, il est possible de les
indiquer : ce sont le respect de soi, la magnanimit, la bonne foi, la diligence,
la bienfaisance. Mais Confucius prfrait avouer quil ne pouvait exprimer ce
quest au fond le jen (
979
). Il dit cependant un jour que lhonnte homme doit
aimer autrui et que si le sage (tche) connat (tche) les hommes, qui possde le
jen ou, plutt, qui est jen doit aimer les hommes (jen) (
980
).
Le P. Wieger a affirm que Confucius exigeait, quoi ?... la charit, le
dvouement ?... oh ! pas du tout. Il exigeait la neutralit de lesprit et la
froideur du cur (
981
). Aussi
396
aprs stre cri : Ne traduisez pas jen
par charit ! , a-t-il propos le mot altruisme. Cest faire dune pierre deux
coups, et peu importe un anachronisme ; mais on est surpris que, sans
avoir, pour commettre le pch danachronisme, les m mes excuses que le P.
Wieger (sil en a), dautres interprtes (
982
) aient pu se laisser sduire par une
traduction qui nglige toutes les dfinitions du Louen yu et dissimule deux
caractristiques essentielles du jen : le respect dautrui, le respect de soi. La
conception confucenne du jen ou de lhomme accompli, et qui mrite seul le
nom dhomme, sinspire dun sentiment de lhuma nisme qui peut dplaire,
Marcel GRANET La pense chinoise 284
mais quon na point le droit de celer. Tout le Louen yu, (comme du reste le
Tchong yong et le Tai hio), le montre, lide matresse de Confucius et de ses
premiers disciples (de Confucius ? ou de ses premiers disciples ? je ne puis en
dcider) fut de rejeter toute spculation sur lUnivers et de faire de lhomme
lobjet propre du savoir. Pour eux, le principe de ce savoir, seul intressant et
seul efficace, tait la vie en socit, le travail de connaissance, de contrle, de
perfectionnement poursuivi en commun, la culture humaniste, grce laquelle
lhomme se constitue en dignit.
Se cultiver (sieou ki ou sieou chen) nest point considr comme un simple
devoir de morale personnelle. Cest grce la vie de socit que se constitue
la dignit humaine ; cest la socit qui bnficie de la culture atteinte par les
sages : Lhonnte homme ( kiun tseu), dit Confucius, cultive sa personne et
(par suite) sait respecter (autrui) ! Est-ce tout ? demanda Tseu-lou. Il
cultive sa personne et (par suite) il donne aux autres la tranquillit ! Est-ce
tout ? Il cultive sa personne et donne la tranquillit au peuple
entier (
983
) ! Sans avoir intervenir (wou wei), gouverner lEmpire, cest
ce que fit Chouen et comment ? Il avait le respect de lui-mme (kong ki) ; il se
tourna face au Sud : ce fut assez (
984
).
Le Tai hio (
985
) ne fait quamplifier ce thme. Les anciens (Rois) qui
dsiraient faire resplendir le T (lEfficace) dans lEmpire, commenaient par
bien gouverner leur domaine ; dsirant bien gouverner leur domaine, ils
397
commenaient par mettre de lordre dans leur famille ; dsirant mettre de
lordre dans leur famille, ils commenaient par se cultiv er eux-mmes ;
dsirant se cultiver eux-mmes, ils commenaient par rendre conforme aux
rgles (tcheng) leur vouloir (leur cur) ; dsirant rendre leur vouloir conforme
la rgle, ils commenaient par rendre sincres (tcheng) leurs sentiments ;
dsirant rendre sincres leurs sentiments, ils commenaient par pousser au
plus haut degr leur sagesse (tche). Pousser sa sagesse au plus haut degr,
cest scruter les tres. Quand ils avaient scrut les tres, leur sagesse tait
pousse au plus haut degr ; quand leur sagesse tait pousse au plus haut
degr, leurs sentiments taient sincres ; quand leurs sentiments taient
sincres, leur vouloir tait conforme aux rgles ; quand leur vouloir tait
conforme aux rgles, eux-mmes taient cultivs ; quand eux-mmes taient
cultivs, leur famille tait en ordre ; quand leur famille tait en ordre, leur
domaine tait bien gouvern ; quand leur domaine tait bien gouvern,
lEmpire jouissait de la Grande Paix. Depuis le Fils du Ciel jusquaux gens
du peuple, tout le monde doit avoir pour principe : cultiver sa personne (sieou
chen). Ce raisonnement, bien quon lait compar au sorite, ne repose point
sur un enchanement de conditions : il cherche rendre sensible lunit dun
principe dordre (le Tao-t), unissant, la manire dun courant rversible,
des groupements hirarchiss, mais troitement solidaires qui vont de
lIndividu lUnivers (
986
).
Marcel GRANET La pense chinoise 285
De mme, lauteur du Tchong yong (
987
), qui semble donner une mme
valeur aux expressions sieou chen (
988
) (cultiver sa personne) et sieou Tao
(cultiver, pratiquer le Tao) (
989
), crit : Le sage (kiun tseu) ne peut pas ne
point se cultiver (sieou chen) ; ds quil pense se cultiver, il ne peut pas ne
point servir ses proches ; ds quil pense servir ses proches, il ne peut pas ne
point connatre les hommes ; ds quil pense connatre les hommes, il ne
peut pas ne point connatre le Ciel (
990
). Connatre les hommes et se cultiver,
cest se connatre soi -mme, mais non par simple introspection ni en vue de la
simple connaissance. Ce que le sage, en vue de rgenter les conduites, se
propose de connatre, ce sont les comportements des individus quil
398
sabstient de considrer comme des ralits autonomes. Lindividu nest
jamais dtach abstraitement des groupes hirarchiss parmi lesquels sa vie se
passe et o il acquiert, avec une personnalit, tout ce qui constitue la dignit
dhomme. Ce nest point une science abstraite de lhomme que Confucius et
ses fidles ont tent de fonder : cest un art de la vie qui embrasse
psychologie, morale et politique. Cet art nat de lexprience, des observa tions
que suggre qui sait rflchir la vie de relation et auxquelles sajoute le
savoir lgu par les anciens.
A cet art ou ce savoir convient le nom dhumanisme. Il sinspire dun
esprit positif. Il ne tient compte que de donnes observables, vcues,
concrtes. Confucius disait : Scruter le mystre, oprer des merveilles,
passer la postrit comme un homme recettes (chou), cest ce que je ne
veux pas (
991
). Il se refusait discourir sur les Esprits : Tu ne sais rien de
la vie, que (peux-tu) savoir de la mort (
992
) ? Il ne parlait que rarement de
lAvantage, de la Destine, du jen (
993
) et seulement propos de cas
particuliers : Il sabstenait de parler des choses merveilleuses, des tours de
force, des troubles, des choses sacres (
994
) , non par agnosticisme ou mme
par prudence rituelle : seuls lintressaient le quotidien, le prochain, le positif.
Peut-tre voulait-il dtacher ses compatriotes du vieux savoir classificatoire,
o politique et physique samal gamaient obscurment. Il esprait, sans doute,
les dtourner des spculations scolastiques ou mystiques. Seul, semble-t-il, lui
paraissait bienfaisant et valable un art de la vie jaillissant des contacts
amicaux entre hommes polics. Il identifiait culture humaine et bien public.
II. M Tseu et le devoir social
Nous ne savons rien de la vie de M Ti (ou M tseu). Il naquit dans le
pays de Lou (ou de Song), fit, peut-tre, un voyage Tchou, se fixa, sans
doute, Lou et mourut au dbut du IVe sicle. Comme Confucius, M tseu
tait un noble sans fortune. Il fonda une cole prospre : elle eut aux IVe et
IIIe sicles bien plus dclat que lcole confu cenne. Nulle cole ne
ressemble plus une secte. Elle se
399
divisa, vers la fin du IVe sicle, en
plusieurs chapelles qui conservrent une certaine unit. Cette unit fut dabord
Marcel GRANET La pense chinoise 286
plus stricte : la secte tait soumise lautorit dun Grand -Matre (Kiu-tseu),
considr comme un saint (
995
). On ne sait pas quelle autorit disciplinaire ou
doctrinale pouvait lui tre attribue, mais il parat bien que la secte avait une
organisation et reconnaissait une hirarchie. Jusquau moment o une chapel le
spare (Pie-m) sadonna surtout la logique (
996
), rpter les discours du
Matre fut le principal devoir des fidles. Ceux-ci apparaissent, tels quon
nous les dcrit, comme des frres prcheurs allant partout porter la bonne
parole. Ils cherchaient faire impression en affectant, dans leur tenue, un
extrme dnuement. Le patron quils avaient adopt ntait point un hros du
crmonial, comme le duc de Tcheou, inspirateur de Confucius. Ctait Yu le
Grand qui parcourut lEmpire entier pour amnager fleuves et
montagnes (
997
), portant lui-mme des sacs, maniant lui-mme la bche,
susant, pour le bien commun, au point de navoir plus un poil au mollet, sen
remettant, pour se laver, au vent et, pour se peigner, la pluie. Qui ne faisait
point vu de vivre la manire ( tao) de Yu ntait point admis dans la
secte (
998
). Il fallait surtout tre mme de prcher. Aussi la rhtorique
tait-elle enseigne aux adeptes. Ils recevaient des modles de sermons que,
dit-on, le Matre avait rdigs. Exordes, divisions, dfinitions, rfutations,
conclusions, rptitions, mouvements oratoires, rien ny manquait, pas mme
un titre mouvant : De la frugalit , Contre la violence , La volont du
Ciel , Contre les spectacles , Contre les esprits forts , Contre les
lettrs... Ces sermons nous sont parvenus, pour la plupart, sous trois
rdactions sensiblement diffrentes (
999
). Les diffrences datent-elles du
moment o on les mit sous forme crite (
1000
) ? Sont-elles dues une
mauvaise transmission ? Il est difficile den dcider (
1001
), Peu importe, au
reste. Chez M tseu et ses disciples, le fonds doctrinal, assez mince, a moins
dintrt que la foi sectaire quon y sent.
Sur lesprit de la secte, le Tchouang tseu nous a conserv un jugement qui
saccorde fort bien avec celui quon peut tirer des documents conservs.
Sopposer au got du
400
luxe, viter la dilapidation, ne point chercher la
splendeur dans les nombres et mesures protocolaires, se soumettre des rgles
strictes, se prparer aux difficults de la vie, tels furent les principes... de M
tseu... Il crivit Contre les spectacles ... Sur la frugalit . (Selon lui) les
vivants ne devaient point chanter, ni les morts tre lobjet dun deuil. (Il
conseilla) dtendre ( tous) une affection ( fan ngai) impartiale, de
(considrer) impartialement les bnfices (de toutes sortes) (kien li) et de
sopposer aux querelles ( fei teou). Il condamnait la colre. Il aimait ltude,
mais ne voulait point de distinctions pour les savants... (
1002
). Comme le
Tchouang tseu le constate, ce fanatisme triste et cet idal de macration (tseu
hou) avaient peu de chances de russir en Chine. La secte connut, cependant,
pendant prs de deux sicles, un succs que peut seule expliquer la crise que
traversait alors la civilisation chinoise (
1003
). La vogue de M tseu fut
phmre ; la secte dut disparatre quand Che Houang-ti fonda lEmpire. A
loppos du Confucisme, elle ne refleurit point sous les Han. Longtemps
considr comme un ennemi de la culture, partisan dun utilitarisme mdiocre,
Marcel GRANET La pense chinoise 287
M tseu est, depuis peu, revenu la mode. Les uns se plaisent voir en lui un
prcurseur du socialisme et les autres une belle me qui crut en Dieu (
1004
)...
M tseu est un conservateur pessimiste. Il est ais de dfinir son attitude,
difficile de dgager ses ides. Ce prdicateur tenait convaincre, bien plus
qu prouver ; sa faon dargumenter a quelque chose de dmagogique : la
mme vulgarit se retrouvait-elle dans sa pense ? Quand il dclame au profit
du bien public, il ne fait jamais appel qu des sentiments intresss :
rduisait-il tout lintrt ? Confucius (ou ses disciples) concevait la vie
comme un effort perptuel de culture, que lamiti et une franche politesse
rendaient possible, qui se poursuivait dans li ntimit, qui valait comme une
prire, mais une prire dsintresse. M tseu semble admettre, sans
restriction aucune, le principe dautorit ; ce sont les chefs et les dieux tablis
qui dterminent le licite et lillicite et, comme ils dtiennent les san ctions, il
ny a, si lon ne veut point sexposer tre chti, qu se soumettre leur
volont.
401
Le point essentiel de la doctrine est une vue sur lorigine du
gouvernement. Elle est remarquable par la primaut quon accorde non pas au
caractre social (jen) des hommes, mais leur sentiment strictement
individuel du tien et du mien (yi). Les hommes nont pu sortir de lanarchie
(louan) quen acceptant de sen remettre pour toutes choses aux dcisions
dun chef : Il ny avait au dbut ni gouverneme nt, ni pnalits. Chaque
homme avait une ide diffrente du tien et du mien (yi) ; un homme en avait
une ; deux hommes en avaient deux ; dix hommes, dix ; autant dhommes,
autant dopinions ( yi) diffrentes. Chacun nacceptant que son ide du tien et
du mien et refusant dadmettre celle quen avait autrui, (il ny avait entre les
hommes que) des rapports dhostilit ( fei : de ngation) rciproque. Dans les
familles, rgnaient entre pres et fils, ans et cadets, la haine, la discorde, la
division, la dsunion : (les parents) taient incapables de vivre ensemble en
bonne harmonie. Dans lEmpire, tous les hommes se dtestaient comme leau
et le feu, (se hassaient) comme du poison. Ce qui leur restait dnergie, ils
taient incapables de lemployer sentr aider. Ils vivaient dans lanarchie,
tout comme les btes. Puis ils comprirent que lanarchie provenait de
labsence de chefs. Ils choisirent le plus sage pour le constituer Fils du Ciel.
Le Fils du Ciel craignant de ne pas avoir, lui seul, assez dnergie choisit les
plus sages pour en faire ses Ministres... Les Ministres craignant de navoir pas
assez dnergie, lEmpire fut divis en seigneuries, et les plus sages furent
choisis pour en tre les chefs... (Et ainsi de suite jusquaux chefs de
village) (
1005
).
Depuis ce contrat initial, il ny a plus qu se soumettre passivement
lopinion des chefs. Si lon ignore si (une chose) est licite ou non, on doit
sadresser au chef ; si le chef dit oui, tous disent oui ; sil dit non, tous disent
non... Le chef du village est le meilleur (jen) du village... Le chef du district
est capable dunifier toutes les ides (des gens) du district sur le tien et le
mien... Il est le meilleur du district... Le Fils du Ciel est capable dunifier dans
Marcel GRANET La pense chinoise 288
tout lEmpire lid e du tien et du mien... Quand le Fils du Ciel dit oui, tous
disent oui ; quand il dit non, tous disent non (
1006
). La pense de M tseu est
bien autrement brutale que celle
402
des Lgistes. Lidal duniformit
(tong) quil professe nadmet aucune at tnuation. Il y a anarchie si
luniformit nest point totale et constante. Il suffit aux Lgistes que le Prince
dicte la loi. Pour M tseu, il doit dicter lopinion. Tel est le sens quil donne
au mot yi, tandis que le mot jen dsigne le meilleur, le saint, cest --dire le
Chef (
1007
).
Cette admiration sectaire du despotisme se raccorde une conception
religieuse o certains discernent une haute pit. M tseu invective les esprits
forts, quil appelle des fatalistes. Ils sapen t la morale traditionnelle : pit
filiale, amour fraternel, loyalisme, pudicit. Ils ruinent la bonne opinion (yi),
lautorit des rois saints ( cheng), des sages, des meilleurs (jen), en soutenant
que le bonheur et le malheur sont affaire de chance (
1008
). Bonheur et malheur
sont, en ralit, les rcompenses et les chtiments que dcerne le Ciel. Il ny a
pas dans le sermonnaire de M tseu de passages plus brillants que ceux o il
dplore le dclin de la foi ancestrale. Si la criminalit augmente, cest quon
ne croit plus [comme au temps jadis o il y avait des rois saints et (o)
lEmpire navait point perdu la bonne opinion ( yi) ] linter vention des
esprits (kouei chen) qui viennent rcompenser les sages et punir les
mauvais (
1009
). Nombreux furent, Tsi, ceux qui virent lauteur dun faux
serment encorn par le blier qui devait tre sacrifi ; quand le roi Siuan fut
abattu coups de flches par le spectre de sa victime, nombreux furent les
tmoins ; et, du reste, comment douter de ces miracles ? ils furent consigns
dans les Annales officielles (
1010
)... Mais cest surtout le Souverain dEn -haut,
cest surtout le Ciel quil faut craindre. La crainte des parents, des voisins, des
chefs, qui lon peut chapper, nest quune barrire mdiocre contre
lanarchie. On nchappe pas aux Esprits et moins encore au Ciel. Il nest
point de forts, gorges ou retraites qui permettent de fuir son courroux, car sa
lumire voit tout (
1011
).
Le Ciel soccupe plus spcialement d e rcompenser et de punir les Fils du
Ciel. M tseu, pour refrner les tendances criminelles du peuple, fait surtout
appel aux croyances populaires sur le pouvoir vengeur des Esprits ; pour
refrner les vices des Tyrans, il voque, la suite des potes de la cour royale,
lide du Ciel justicier, du Souverain dEn -haut,
403
patron dynastique. Aussi
parle-t-il de la Volont du Ciel (Tien tche) avec les mmes termes, peu prs,
quil emploie pour exiger une entire soumission aux dcisions du souve rain :
La Volont du Ciel est pour moi comme lquerre et le compas pour le
charron ou le charpentier. Si elle dit : cela est juste, ce lest ; si elle dit : ce
nest pas juste, ce ne lest pas (
1012
).
Confucius concevait lenseignement moral comme une exci tation amicale
et nuance la rflexion personnelle. M tseu enseigne la soumission la
Volont Cleste et se sert, pour endoctriner, dune sorte de catchisme :
Comment savons-nous que le Ciel aime tous les hommes ? Parce quil les
Marcel GRANET La pense chinoise 289
claire tous uniformment. Comment savons-nous quil les claire tous
uniformment ? Parce quil les a tous uniformment (pour fidles).
Comment savons-nous quil les a tous uniformment (pour fidles) ? Parce
que tous uniformment le nourrissent. Comment savons-nous que tous
uniformment le nourrissent ? Parmi tous les mangeurs de riz, il ny en a
point qui nlvent bufs, moutons, chiens et porcs, qui ne prparent du riz et
du vin de riz pour en faire offrande au Souverain dEn -haut et aux
Esprits (
1013
). Il est difficile de dcider si, la conception utilitaire de la
religion qui stale dans ses sermons M tseu joignait les sentiments de pit
quil est la mode de lui attribuer. Il y a loin, en tout cas, entre cette pit et le
positivisme confucen qui interdit toute prire intresse.
Voir en M tseu un successeur de Confucius, lui prter une pense plus
profonde que celle de son devancier et dfinir son originalit par une
moindre dvotion aux anciens (
1014
), cest, je crois, apprcier sa
doctrine non sans parti pris et dune faon superficielle. Certes, M tseu
fait un grand emploi des termes jen et yi ; il utilise leur prestige, mais il leur
donne une valeur toute diffrente de celle que Confucius leur assignait. Pour
ce dernier, le bien public a pour fondement leffort personnel de culture qui
fait de lindividu un homme accompli ds quil acquiert un senti ment nuanc
du toi et du moi. Pour M tseu, la distinction du toi et du moi est le principe
de toutes les plaies sociales.
404
Ce nest point lindividu qui le proccupe,
mais le bien public, quil ne distingue pas des bo nnes murs du temps
jadis. Il se fait, de lordre fodal, une ide tout utopique : il na connu que le
rgime des Tyrannies dont Confucius vit seulement les premiers dbuts.
Tandis que les Lgistes vont tenter dopposer au bon plaisir du despote
lintrt de ltat et la loi souveraine, M tseu exige une entire soumission
aux autorits tablies, car il ne peut y avoir de bonnes murs si le pouvoir de
coercition du Chef se trouve limit. Mais le Chef lui-mme doit obir aux
murs, et cest le rle des sages de le lui rappeler. Do la ncessit de la
prdication et son objet : raliser le bien public en obtenant des Princes, quon
menace du courroux divin, quils sattachent aux bon nes murs et les
imposent leurs sujets.
Ici intervient ce quon se plat d ordinaire appeler la doctrine de lamour
universel. On la prsente comme une pure doctrine morale. Pourtant ce qui la
domine, cest uniquement lide de lordre social, ou plus exactement
lhorreur de la misre. Lexpression kien ngai (quon tra duit par amour
universel ) soppose lexpression pie ngai qui dsigne laffection partiale,
celle qui se limite lentourage immdiat : kien ngai, cest laffection
impartiale que ne fausse point lesprit de clientle, que lesprit de clan ne
transforme point en gosme ou plutt en une passion haineuse de rivalit.
Fait caractristique (et dj fort bien signal par le Tchouang tseu) (
1015
), M
tseu unit toujours le kien ngai au kien li, le pie ngai au tseu li. Tseu li, cest la
volont de rserver, pour soi ou les siens, tous les profits ; kien li, cest, au
contraire, ne point se montrer partial dans lattribution des avantages et des
Marcel GRANET La pense chinoise 290
biens de ce monde. M tseu professe que tous et chacun ptissent ds
quil y a esprit de luc re (tseu li) et esprit de clan (pie ngai).
Lintrt bien compris se confond avec lintrt public pour conseiller une
distribution des bnfices et des affections qui ne soit point inspire par des
sentiments troits, mais par le sens de limpartialit ( kien li, kien ngai). Qui
aime (ngai) autrui sera aim son tour ; qui fait profiter autrui profitera son
tour. Un prince qui ne sait chrir (ngai) que son domaine, et na aucune
affection pour les domaines dautrui, rien ne lempche demployer tou te la
puissance de
405
son domaine pour attaquer les domaines dautrui. Un chef
de famille qui ne sait chrir que lui-mme... rien ne lempche... de semparer
(de ce qui est ) dautres , do les usurpations, les brigandages, les vols.
Mais si tous les hommes avaient entre eux une affection mutuelle, les forts
ne feraient plus leur proie des faibles, ceux qui sont en nombre ne violen-
teraient pas ceux qui sont moins nombreux, les riches ne brimeraient point les
pauvres, les habiles ne duperaient pas les simples... (
1016
). Limpartialit
dans laffection ne fait point tort aux affections personnelles ; tout au
contraire, elle leur ajoute une sorte de garantie. Un prince, un pre qui ne
chrissent que leur propre domaine, leur propre famille, pourquoi ne
saimeraient -ils pas eux-mmes uniquement ? Mais un fils, sil chrit son
pre, ne doit-il pas dsirer lui assurer le bnfice de laffection et de
limpartialit dautrui ?
M tseu donne pour fondement lordre social non pas le sentiment affin
de la rciprocit (chou) que Confucius fait natre des contacts amicaux entre
hommes polics, mais le vieux devoir, fodal et paysan, de lentraide. Sur ce
point encore, cest la sagesse enregistre dans les pomes du Che king quil
se rfre : Si tu me donnais une pche, je te revaudrais une prune ! Tout
mot entrane une rplique, tout bienfait appelle un paiement (
1017
) ! Aussi
admet-il que rien nest plus facile pratiquer que cette entraide, du moins si,
comme au temps jadis, les chefs donnent le bon exemple. Pour que lesprit
dentraide et dentente impartiale produise son plein effet, il faut quil rgne
universellement, simpo sant tous, et dabord aux chefs eux -mmes.
A tous, et dabord aux grands, simpose donc un double devoir : le travail
et lconomie. La pense de M tseu, comme celle des Lgistes, est domine
par la crainte de voir les homme manquer de ressources ; seulement, au lieu de
pousser la production en vue daccrotre la force de ltat, il condamne la
thsaurisation, et plus encore le luxe, le dveloppement de la fiscalit,
laccroissement de la puissance militaire. Il dit avec force que la guerre nest
quun brigan dage sans profit rel. Elle empche les deux belligrants de
produire des biens utiles ; elle ruine le vainqueur lui-mme ; enrler des
soldats, cest laisser les champs sans travailleurs,
406
les filles sans maris ; et
pourtant, pour se perptuer, la socit a besoin de vivres et denfants. Le fisc,
en drobant au peuple mme le ncessaire, ruine le got du travail. Du reste,
le luxe que les impts permettent dentretenir dans les cours des tyrans est non
seulement dpense improductive, mais encouragement loisivet. Une
Marcel GRANET La pense chinoise 291
temprance laborieuse doit tre la rgle commune. Il est mal de dilapider ; un
vtement est assez bon sil protge le corps ; cest un pch dy ajouter des
broderies. Tous les travaux des artisans doivent tre rglements en vue de
lutile, contrls afin dviter toute perte de temps. Il est mal de chmer ; les
dpenses somptuaires du deuil doivent tre interdites comme les deuils trop
longs ; trois mois suffisent pour le deuil : pourquoi dfendre aux veuves de se
remarier avant trois ans ? Il est mal de se rcrer : les rites et les ftes, les
jeux, les spectacles ne servent qu diminuer les surplus ncessaires la
pratique de len traide. Chaque homme doit employer toutes ses forces en
songeant au profit commun. Il doit dabord chercher se suffire. Sil lui
reste des forces, il doit les employer soulager autrui. Sil lui demeure
quelque surplus, il doit en faire part autrui (
1018
).
Fruste dans lexpression et ne semblant, le plus souvent, faire appel qu
lintrt, la prdication de M tseu a une saveur plus pre et plus puissante
quune simple doctrine de lamour du prochain. Les malheurs du temps, le
spectacle de la misre matrielle ont conduit ce conservateur tirer de la
vieille ide de lentraide deux ides neuves, rvolutionnaires, et dont
linsuccs proclame la hardiesse, sinon le mrite. Possd par le sentiment du
bien public, il sest attaqu la fois lesprit danarchie et lesprit de clan. Il
a compromis lide de devoir social qui inspire sa morale en la liant une
utopie conservatrice et lapologie de la macration, du travail sans
dlassement, de la discipline la plus frugale. Ses compatriotes lui ont reproch
son manque dhumanit, le peu de cas quil fait des sentiments individuels les
plus profonds, le mpris quil semble professer pour lidal confucen de vie
police et de culture personnelle. Certains ont fort bien compris que la
prdication de M tseu tendait instituer un Despotisme appuy sur une
organisation sectaire (
1019
). Ils se sont en gnral contents de le blmer
407
pour avoir subordonn les devoirs de famille au devoir social. Tous ont senti,
mais aucun na dit expressment, que la doctrine de M tseu avait chou non
pas seulement parce quelle heurtait un idal dindividualisme, mais surtout
parce quelle dnonait lesprit de clan et voyait en lui un principe danarchie.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 292
CHAPITRE III
Les recettes de saintet
409
Un adversaire insidieux demanda un jour M tseu pourquoi il se
mettait en peine de courir aprs les hommes : Une jolie fille demeure la
maison et se garde bien de sortir : les hommes lenvi la recherchent.
Va-t-elle se produire nous ? Nul ne lui prte attention. Nous vivions,
rpondit M tseu, dans un sicle corrompu. Pour rechercher les jolies filles, il
y a foule. Une jolie fille na pas besoin de sortir de chez elle pour quon la
recherche. Pour rechercher les gens de bien, il ny a pas presse. Si lon ne
violentait pas les gens pour les endoctriner, nul ne vous prterait
attention (
1020
). Au proslytisme et la faconde rhtoricienne de M tseu
soppose la vie efface et secrte des sages du Taosme. Sans souci, ils vivent
dans les solitudes, ou bien, au milieu des hommes, se rfugient dans lextase.
Ils ne sinquitent pas de recruter des adeptes. Sils font des conversions, cest
par leffet dun enseignement silencieux. Ils recherchent la saintet avec tant
de dsintressement quils nont lide ni den faire bnficier autrui, ni den
profiter eux-mmes daucune manire (
1021
). Ce sont des asctes, mais qui
dtestent les macrations. Ce sont des croyants, mais peu leur importent dieux,
dogmes, morales, opinions. Ce sont des mystiques, mais jamais prires ou
effusions ne furent plus froides et plus impersonnelles que les leurs. Ce sont,
du moins ils nen doutent pas, les seuls vritables amis de lhomme, mais ils
se moquent des bonnes uvres. Ils con naissent, disent-ils, la vraie manire de
mener le peuple ;
410
cependant, ils profrent leurs plus durs sarcasmes sils
entendent parler de devoir social. Ils ont fourni la Chine des chefs de secte
redoutables, des politiciens pleins dentre gent, ses dialecticiens les plus
subtils, les plus profonds de ses philosophes, son meilleur crivain. Pourtant,
ils nes timent que la modestie, labstention, leffacement. Nul nest saint,
insinuent-ils, sil laisse une trace (
1022
).
Nous ne savons rien sur lhistoire ancienne du Taosme, rien s ur la vie des
principaux crivains taostes, trs peu de choses sur lhistoire des ouvrages
quon leur attribue.
Les seules uvres anciennes qui demeurent sont le Lie tseu, le Tchouang
tseu et le Lao tseu ou Tao t king (Livre du Tao-t). Ce dernier tait jadis
donn tantt comme luvre de Houang -ti (le premier des cinq Souverains
mythiques), tantt comme celle de Lao Tan (ou Lao tseu). Ctait un livre
clbre et frquemment cit ds la fin du IVe sicle. Il est possible quil ait
subi des remaniements (les citations anciennes ne concordent pas toujours
exactement avec le texte actuel), mais peu probable quil ait t fabriqu par
un faussaire du IIe sicle. Cette opinion, soutenue par H. Giles, na, en sa
Marcel GRANET La pense chinoise 293
faveur, quun fait : le livre ne prsente aucune suite et peu dunit. Pour des
raisons purement mystiques, on la divis tantt en 81, tantt en 72 chapitres.
En fait, on ny peut marquer que des divisions de versets ; il est constitu par
une succession dapophtegmes mls des passages versifis, sans doute
runis ( peu prs dans leur ordre actuel) depuis le dbut du IVe ou la fin du
Ve sicle. Il faut avouer que ce livre, traduit et retraduit, est proprement
intraduisible (
1023
). Les brves sentences qui le composent taient
apparemment destines servir de thmes de mditation. Il serait vain de
chercher leur prter un unique sens, ou mme un sens un peu dfini. Ces
formules valaient par les suggestions multiples quon y pouvait trouver. Elles
avaient une ou plusieurs significations sotriques indiscernables
aujourdhui : les gloses qui prtendent les expliquer sont franchement
mdiocres et tout extrieures.
Le Lao tseu apparat comme une sorte de brviaire destin des initis. Le
Lie tseu et le Tchouang tseu, moins
411
hermtiques, sont des uvres de
tendance polmique ; tous deux sont surtout composs dhistoriettes
symboliques, dapo logues, de discussions (
1024
).
Le Tchouang tseu, cependant, est luvre dun crivain trs personnel . Il
se peut que cet ouvrage ait t grossi de quelques passages et mme de
chapitres, dus des disciples imprgns de la pense du Matre et exercs
imiter son style. Il comprenait, sous les Han, 52 chapitres ; il en comprend
aujourdhui 33. On ne sa urait dire si 19 chapitres ont t perdus ou si les
divisions de louvrage ont t modi fies. Compos vers la fin du IVe sicle,
peut-tre accru dans le dtail et sans doute augment de ses derniers chapitres
(en particulier du dernier), au cours du IIIe sicle, le Tchouang tseu est, dans
son ensemble, un document sr et din terprtation relativement facile.
Tchouang tseu, cependant, avait trop de gnie pour quon puisse considrer
son uvre comme un expos neutre des doctrines courantes.
Il nest pas s r que le Lie tseu puisse aider ne point confondre le
Taosme avec la pense de Tchouang tseu. Le Lie tseu est une compilation
faite, peut-tre, limitation du Tchouang tseu. Est-ce par des adeptes se
rattachant la mme chapelle ? par les disciples dun enseignement rival ? Je
ne crois pas quon puisse en dcider. Cette uvre sans unit a pu, si mme
elle na pas t entirement recompose, se grossir dinterpolations jusquaux
environs de lre chr tienne. Le Lie tseu comprenait, sous les Han, huit
sections, comme aujourdhui. Lune des sections actuelles (la sep time,
entirement consacre Yang tseu) (
1025
) fait connatre les thories dun
penseur trs indpendant. Louvrage abonde en historiettes prcieuses par les
indications quelles donnent sur les ides et les pratiques en faveur dans les
milieux taostes. Malheureusement, il est impossible de fixer lpoque sur
laquelle elles renseignent : IIIe, IIe sicles, dbut des Han...
Lie tseu est le hros de quelques anecdotes du Tchouang tseu. Est-ce un
matre lgendaire, un personnage rel ? Rien ne permet de rpondre cette
Marcel GRANET La pense chinoise 294
question. Exista-t-il un personnage nomm Lao Tan ? Une anecdote hagiogra-
phique, clbre ds le temps de Tchouang tseu, voulait que Lao tseu ait reu la
visite de Confucius, son cadet, quil
412
aurait morign (
1026
). Aprs avoir
t archiviste la cour des Tcheou, Lao Tan ou Lao tseu se serait retir dans
le Sud du Chan-tong. On racontait encore quil aurait quitt la Chin e pour un
voyage mystrieux en Occident (
1027
). Ce serait cette occasion quil aurait
rencontr Kouan Yin tseu, autre matre clbre, dont rien nest demeur (
1028
).
Nombreux sont les matres ou les patrons du Taosme ancien que nomment le
Tchouang tseu ou le Lie tseu : pour aucun, il ny a moyen de savoir sil fut
autre chose quun nom. Seul Tchouang tseu (
1029
) apparat comme un
personnage rel : on ne sait cependant rien de sa vie, sauf son nom (Tchouang
Tcheou) et que, peut-tre, il naquit et vcut Wei, vers la fin du IVe sicle. Il
nest pas impossible quil ait fait un voyage Tchou et un autre Tsi, o il
aurait connu les matres de lAcadmie de Lin -ts. En tout cas, il tait
admirablement inform de toutes les ides en vogue. Peu de Chinois eurent
autant de curiosit et douverture desprit. Nul ne fut plus libre et plus objectif
dans ses jugements. En ceci, au moins, il fut un parfait Taoste : de sa vie,
nulle trace ne demeure, sinon un livre tincelant de gnie et de fantaisie.
Tchouang tseu vcut dans le Nord de la Chine et, de mme (sil exista),
Lao Tan. Lhypothse simpliste et toute gratuite qui oppose le Taosme au
Confucisme comme deux philosophies, nes la premire dans le Sud de la
Chine et la seconde dans le Nord, ne mrite pas quon perde le moindre temps
la discuter. On a longtemps soutenu lhypo thse que le Taosme, avant de
devenir un mlange de superstitions grossires , avait commenc par tre
une pure doctrine , ( celle de Tchouang tseu et de Lao tseu ), une
philosophie dune rare lvation (
1030
). Or, les No-taostes
emploient pour dsigner leurs pratiques superstitieuses des expressions qui
se retrouvent dans les uvres du Taosme ancien . Faut-il, pour sauver
lhypo thse, considrer que ces expressions, simples mtaphores lorigine,
furent, plus tard, prises au sens propre (
1031
) ? Ou bien convient-il
dabandonner lide quentre ce quon appelle le No-taosme et ce que lon
considre comme un systme doctrinal invent par les Pres du Taosme
ancien il ny a point labme qui spare la superstition de la
413
philosophie ? Entre ces partis pris opposs, on doit choisir. On reconnat
volontiers que la pense des premiers auteurs taostes ne peut sexpliquer sans
tenir compte de la pratique de lextase (
1032
), courante dans les milieux o ils
vivaient. Cest admettr e implicitement que le Taosme a pour point de dpart,
non la pure spculation, mais des usages religieux (
1033
). Il serait curieux que
lextase ait t, comme on semble le penser, la seule pratique qui ait marqu la
doctrine. Ne voudrait-on prter qu elle seule, avec une valeur reli gieuse
minente, une dignit philosophique que risquerait de dconsidrer tout
rapprochement avec des pratiques tenues pour moins pures ou moins
lgantes ? Lextase que dcrivent les premiers pens eurs taostes quand ils
parlent de leurs bats mystiques, ne diffre nullement des transes et des
Marcel GRANET La pense chinoise 295
randonnes magiques grce auxquelles les sorciers chinois, hritiers dun
antique chamanisme, accroissaient leur saintet, augmentaient leur puissance
de vie, affinaient leur substance. Telles taient aussi les fins vises par tout un
ensemble de pratiques dnommes les pratiques de la longue vie. Lextase
nest que lune dentre elles. Si on la dtache de lensemble, croit -on quon en
fera mieux voir la porte relle ? et quon en dcouvrira lintrt prcis, si lon
se borne rapprocher la mystique chinoise des mystiques chrtienne ou
musulmane ? Tous les Pres du Taosme font de nombreuses allusions
lart de la longue vie. On peut voir, lire Siun tse u (
1034
), par exemple, quils
ntaient point les seuls en reconnatre la valeur. Il sagit dune discipline
quon pourrait qualifier de nationale. En honneur de nos jours encore, mme
chez les plus humbles, elle se rattache au plus vieux pass religieux de la
Chine. Les rites de la longue vie se relient aux ftes de la longue nuit (
1035
). Il
ne peut tre question de les envisager ici dans leur dtail. Ce qui importe, cest
dindiquer leur esprit. Ils constituent une ascse tend ue vers un idal de vie
naturelle, libre, pleine, joyeuse.
Lattachement des Taostes cette discipline explique leur opposition
Confucius, leur mpris pour M tseu, leur succs plus vif auprs des humbles
et des grands quauprs de la classe moyenne de s serviteurs du bien public. A
lloge, mme modr, de la contrainte rituelle, lapologie brutale
414
de la
macration, toute morale de ltiquette, de lhonneur, du sacrifice ou du
devoir social, les Taostes ont rpondu par un plaidoyer mystique en faveur de
la libert pure, qui, pour eux, se confond avec la pleine puissance et la
Saintet.
I. Lart de la longue vie
La Saintet, pour les No-taostes, cest essentiellement lart de ne point
mourir. Ds les environs de lre chr tienne, on imaginait quune parfaite
russite en cet art tait sanctionne par une apothose vritable. On racontait
que le prince de Houai-nan avait pu monter au Ciel suivi de toute sa
maisonne et mme de sa basse-cour (
1036
) (car la saintet nest point rserve
aux hommes). Lempereur Wou (140 -87) et volontiers abandonn tous les
siens et lEmpire mme, si un Dragon lavait bien voulu ravir et mener aux
cieux comme le fut Houang-ti suprme patron du Taosme (
1037
). Lempereur
Wou chercha entrer en communication avec les gnies ; il envoya vers le
Kouen -louen et sur la Mer orientale des missions charges de dcouvrir le
chemin du Paradis. De mme avait fait Che Houang-ti, qui, ds la fin du
IIIe sicle, accepta de vivre, cach de tous, au fond de son palais, afin dattirer
lui les gnies et de trouver la drogue qui empche de mourir. Il dsirait
durer autant que le Ciel et la Terre , entrer dans leau sans se mouiller et
dans le feu sans se brler (
1038
) Les mythes relatifs lherbe de vie
paraissent fort anciens (
1039
), tout comme les rcits sur les Iles ou les
Marcel GRANET La pense chinoise 296
Montagnes des Bienheureux. Les Pres du Taosme connaissaient de
nombreux paradis, et ils professaient, eux aussi, que ni leau ni le feu, ni les
btes mchantes, ne peuvent rien contre les Saints.
Tchouang tseu considre comme des esprits borns ceux qui traitent de
fables de pareilles croyances et se refusent croire, par exemple, aux
merveilles des les Kou-che. L vivent des gnies (chen jen) dont la chair et
la peau sont fraches et blanches comme glace et neige. Ils ont llgance
exquise des vierges. Ils sabstiennent de manger des crales. Ils aspirent le
vent et boivent la rose. Ils se font porter par lair et les nues, traner par des
dragons volants. Ils
415
sbattent hors des Quatre Mers (par-del lEspace).
Leur puissance (chen) sest concrte (ying : la manire de leau quand elle
forme des glaons), si bien quils peuvent prser ver les tres des pestilences et
donner des moissons et des annes prospres... Rien ne peut rien (contre le
Saint) ! Un dluge slevant jusquaux cieux narriverait pas le noyer ni le
brler, une scheresse qui liqufierait mtaux et pierres, grillerait plaines et
montagnes (
1040
) ! LHomme suprme ( tche jen) a une telle puissance
(chen) quon ne peut lui donner chaud en mettant le feu une immense
brousse, ni lui donner froid en faisant geler les plus grands fleuves ; les plus
violents coups de tonnerre ruineront les montagnes, les ouragans dchaneront
les mers sans pouvoir ltonner mais lui, qui se fait porter par lair et les
nues, et qui prend pour coursiers le Soleil et la Lune, sbat par-del lEspace
(hors des Quatre Mers) ! Et la mort et la vie ne changent rien pour lui ! Et que
lui importe ce qui peut nuire ou tre utile (
1041
) ! Je sais, dit Lao tseu, que
celui qui est expert prendre soin de sa vie (che cheng), ne rencontrera dans
ses voyages ni rhinocros, ni tigres et, dans les combats, naura point
dtourner de lui les armes. Un rhinocros ne trouverait en lui nul endroit pour
enfoncer sa corne ! ni un tigre o planter ses griffes ! ni une arme o faire
pntrer son tranchant ! Et pourquoi donc ? Il ny a point en lui de place pour
la mort (
1042
) !
Puissance pure, puissance libre, un Saint nest que Vie. Il est de la vie qui
sbat, de la puissance qui joue. Commen ons, cependant, par noter quil
possde les pouvoirs magiques que, plus tard, les Empereurs cherchrent
obtenir, et quau temps jadis devaient obligatoirement acqurir chefs et
chamanes.
Subir lexposition dans la brousse, ne point se laisser mouvoir p ar la
foudre et louragan, sortir vainqueur de diverses preuves de leau et du feu,
ce sont l des prouesses qui furent exiges des premiers magiciens comme on
exigeait deux, en les prenant pour chefs, quils fussent capables de chasser les
pestilences et de faire crotre les rcoltes (
1043
). Lapothose qui couronne ces
labeurs nest elle -mme quune prouesse suprme. Bien avant lpoque o les
Empereurs rvrent dachever au ciel leur carrire, leurs humbles
416
devanciers se soumettaient annuellement lpreuve de lascen sion et
connaissaient lart de slever dans les cieux (
1044
). Tchouang tseu ninvente
aucune mtaphore, il voque de vieilles croyances lorsquil raconte que,
Marcel GRANET La pense chinoise 297
fatigus du monde , aprs mille ans de vie , les hommes suprmes
(tche jen) slvent au rang de gnies ( sien) et, monts sur un nuage blanc,
parviennent au sjour du Souverain dEn -haut (
1045
). Le roi Mou, comme
dautres hros anciens (
1046
), fut ravi aux cieux. Un rcit du Lie tseu montre
quil dut cette faveur au pouvoir dun magicien ( houa jen) qui lemporta,
cramponn sa manche, sbattre ( yeou) avec lui, lentranant dabord
jusquau Palais des Mages ( houa jen). Puis il le conduisit la ville de
Puret , o, dans un paysage de paradis ors, argents, perles, jades le
Souverain (dEn -haut) offre des spectacles de feries. Enfin, par-del le Soleil
et la Lune, il le fit pntrer dans un monde de pur blouissement (
1047
)
Ces longues randonnes (yuan yeou), ces bats spirituels (chen
yeou) taient la spcialit des sorcires et des sorciers que potentats, puis
empereurs, entretenaient leur cour (
1048
). Des potes officiels chantaient
leurs exploits dans un langage qui ne diffre gure de celui des philosophes
taostes (
1049
). Che Houang-ti et lempereur Wou aim rent se faire dsigner
par des termes (tchen, ta jen), impliquant quils po ssdaient lascendant d
la pratique des arts magiques et la frquentation des gnies (
1050
). Les
penseurs taostes revendiquent, pour eux ou leurs matres, des privilges et des
titres analogues, quils partagent avec les ha bitants de ces paradis o lon
naccde que par des courses ou des randonnes de lesprit ( chen hing, chen
yeou) (
1051
). Ta jen (Hommes grands), Tche jen (Hommes suprmes), Tchen
jen (Hommes vritables), Cheng jen (Hommes saints), Chen jen
(Hommes-gnies)..., tels sont ces titres. Ils font songer des emplois ou des
grades dans un collge de chamanes. Certains matres sont qualifis de T jen
(Hommes du T), cependant que le Tao est appel Matre (Che) ou Matre
cleste (Tien che) et que le disciple salue du nom de Tien (Ciel) le Matre
qui lui confre une initiation (
1052
). Les thories mystiques des Pres du
Taosme se sont labores dans un milieu o (valant comme des
417
preuves
dinitiation des degrs divers de Saintet) des joutes de passes magiques
mettaient aux prises sorciers, devins, thaumaturges : tous les matres des arts
sotriques (
1053
).
De tous ces arts secrets, le Taosme na jamais cess dtre linspirateur ou
le refuge, car tous (y compris lalchimie) (
1054
), ont pour premier objet
daccrotre la puissance de vie qui donne lAutorit et constitue la Saintet.
Ces arts, en raison mme de leur objet, forment un tout. Il ny en a aucun
quon ne sache utiliser en vue de la longue vie . Aux pratiques, cependant,
qui visent essentiellement donner, avec un surplus de puissance vitale,
lascendant qui confre lautorit (ce sont celles qui expliquen t les succs
aristocratiques du Taosme) sopposent, dune certaine ma nire, les pratiques
qui visent dabord obtenir quil ny ait dans le Saint aucune place pour la
mort : ce sont elles qui ont assur la fortune du Taosme parmi les humbles,
et, de fait, elles sinspirent moins dune ascse vises aristocratiques que
dune entente paysanne de lart de vivre.
Marcel GRANET La pense chinoise 298
Elles constituent une sorte dhygine sanctifiante, connue, anciennement,
sous le nom de yang cheng, lart de nourrir (ou daccrotre) la vie. De cet art
se rclament diverses techniques (alimentaires, sexuelles, respiratoires,
gymniques). Objet dun enseignement plus ou moins sotrique, ces
disciplines ont pu se grossir, au cours des sicles, de recettes plus ou moins
raffines et plus ou moins secrtes, mais on aurait grand tort de les considrer
comme des disciplines rcentes ou uniquement formes de pratiques
superstitieuses . Les matres du Taosme apprciaient leur valeur, et il ny en
a gure qui ne se puissent rattacher des rites ou des mythes anciens. Je dois
me borner indiquer ici (il serait trop long et hors de mon sujet dapporter une
dmonstration) quun grand principe domine ces tech niques diverses. Pour
accrotre ou seulement conserver sa vitalit, tout tre doit adopter un rgime
conforme au rythme de la vie universelle.
Toutes ces techniques procdent, en effet, dune systma tisation des rgles
saisonnires de la vie rustique dont la
418
grande loi tait de faire alterner les
dbauches dactivit joyeuse et les temps de starvation, de restriction, de
contrainte. De l provient en particulier lide que le jene vaut uni quement
titre de prparation la frairie. Les privations, loin dtre inspires par le dsir
de macrer le corps, tendent uniquement le purger de tout ce qui peut tre
poison, malfice, germe de mort. Il sagit non de se mortifier, mais de se
vivifier : non de smacier, mais de sentraner et dacqu rir (si je puis dire)
une forme athltique. Lide de jeu domine toute cette ascse, dont lidal est
le libre essor et les tats illimits de lge dor ou de lenfance (
1055
).
Pour conserver sa vitalit (wei cheng), dit Lao tseu (
1056
), il faut
ressembler au nouveau-n : ses os sont tendres, ses muscles sont
souples, et cependant il serre avec force ! Il ne sait rien encore
de lunion sexuelle, et cependant sa verge se redresse (
1057
) !
Tout au long du jour il crie, et cependant son gosier ne
senroue pas !.. Tout au long du jour il regarde, et cependant ses
yeux ne clignent pas !
Lenfant nest que vie :
Nulle bte venin ne le pique ! Nul animal froce ne le saisit !
Nul oiseau rapace ne lenlve !
galement soumis (car la naissance est une initiation et linitiation une
naissance) lpreuve de lexposition en pleine brousse, le hros et le
nouveau-n sont invulnrables au mme titre. La vie se constitue ou se rnove
grce un contact troit avec la Nature.
Dans les paradis, les gnies vivent mls aux btes (
1058
). Les Saints (
loppos des sages confucens qui nacceptent pas dtre rduits la socit
des rhinocros et des tigres) recherchent et savent obtenir la familiarit des
animaux (
1059
). Ils professent que tous les tres qui ont sang et souffle ne sau-
raient beaucoup diffrer par les sentiments et lintelligence (
1060
). Loin de
Marcel GRANET La pense chinoise 299
penser humaniser les btes et moins encore les domestiquer, ils se font
enseigner par elles lart dviter les effets nocifs de la domestication
quimpose la vie en socit. Les animaux domestiques meurent
prmaturment (
1061
). De mme les hommes, qui les conventions sociales
interdisent dobir spontanment au rythme de la vie universelle. Ces
conventions imposent une activit continue, intresse, extnuante. Lexemple
des animaux hibernants montre quil faut, au contra ire, faire alterner les
priodes de vie ralentie
419
et de libres bats. Le Saint ne se soumet la
retraite et au jene quafin de parvenir, grce lextase, svader pour de
longues randonnes . Des jeux vivifiants, quenseigne la Nature, prparent
cette libration. On sentrane la vie paradi siaque en imitant les bats des
animaux. Pour se sanctifier, il faut dabord sabtir entendez : apprendre
des enfants, des btes, des plantes, lart simple et joyeux de ne vivre quen vue
de la vie.
Cest en dansant que les sorciers entrent en transe e t se font saisir par
lextase. Les Saints qui ont pntr les plus hauts secrets et mritent de se voir
dcerner le titre de Ciel ne cessent pas, mme pour enseigner, de
sautiller la manire des moineaux, tout en se tapant sur les fesses (
1062
).
Pour nourrir sa vie et obtenir le Tao , la faon de Peng-tsou, qui russit
durer plus de sept cents ans, il faut se livrer des exercices dassouplissement
(tao yin) ou, mieux encore, danser et sbattre la manire d es animaux (
1063
).
Tchouang tseu et Houai-nan tseu mentionnent quelques-uns des thmes de
cette ascse naturiste. Il est recommand dimiter la danse des oiseaux quand
ils tirent leurs ailes, ou des ours quand ils se dandinent en tendant le cou vers
le Ciel. Cest laide de cette gymnastique que les oiseaux sexercent voler,
que les ours deviennent de parfaits grimpeurs. Il y a aussi beaucoup
apprendre des hiboux et des tigres, habiles ployer leur cou pour regarder en
arrire, et des singes qui savent se suspendre la tte en bas (
1064
)... Le premier
bnfice de ces jeux est quils procurent la lgret indispensable qui veut
pratiquer la lvitation extatique.
Ils servent encore affiner la substance (lien tsing). Ils constituent, en
effet, une discipline de la respiration. Ils permettent de ventiler le corps
entier, extrmits comprises. Si le souffle (ki ), dit Tchouang tseu, saccumule
dans le cur, la maladie sensuit, ou la perte de mmoire, sil reste dans le bas
du corps, ou la colre, sil demeure dans les parties hautes. Qui veut viter
passions et vertiges doit apprendre respirer non par le gosier seul, mais avec
tout le corps partir des talons (
1065
). Seule cette respiration, profonde et
silencieuse, affine et enrichit la substance. Cest, au reste, la respiration qui
simpose, tant pendant lhibernation que
420
pendant lextase (
1066
). En
respirant le cou cass ou tendu, on arrive, si je puis dire, laminer le Souffle
et quintessencier sa puissance vivifiante. Le but suprme est dtablir une
sorte de circulation intrieure des principes vitaux telle que lindividu puisse
demeurer parfaitement tanche et subir sans dommage lpreuve de
limmersi on. On devient impermable, autonome, invulnrable ds quon
Marcel GRANET La pense chinoise 300
possde lart de se nourrir et de respirer, en circuit ferm, la manire dun
embryon (
1067
).
Le nouveau-n doit cet art, quil na point encore oubli, non seulem ent
le secret de pouvoir vagir sans se lasser ni se fatiguer, mais encore la
souplesse de ses os et de ses muscles. On a vu que Lao tseu considrait
comme parfaite la puissance virile du petit enfant, qui ne subit aucune
dperdition dnergie vitale (
1068
). A ce thme se raccorde toute une ascse
sexuelle, qui, ds avant les Han, avait suscit de nombreuses publications
places sous le patronage de diffrents hros taostes (
1069
). On y enseignait
diverses mthodes, toutes destines accrotre la longvit et fondes, non sur
un idal de chastet, mais sur un idal de puissance. Au reste, le folklore nous
renseigne sur une sorte dpreuve sexuelle impose au Saint. Entour de
nombreuses vierges ou se couchant sur lune delles, il ne devait point
changer de couleur .
Tant pour raffiner le souffle vital que pour raffiner lner gie virile, il faut
dabord respecter, aussi bien que le font les animaux, aussi bien que le font
les plantes dont la sve ne circule qu la belle saison, le rythme qui rgit la
vie de lUnivers et fait alterner et parfaire lun par lautre le Yin et le Yang.
Cest le matin seulement que la gymnastique respiratoire est profitable. Les
exercices dassouplissement nont dheu reux effets quau printemps. Les
jeunes pousses, alors, sont encore toute souplesse. Le printemps est la saison
des danses rustiques qui suscitent la monte de la sve et aident au
renouveau : on y mime les souples inflexions des tiges naissantes sous le
souffle fcond du Ciel. De pareilles danses et des bats gymniques peuvent
seuls conserver la souplesse premire. Quand celle-ci disparat, la mort triom-
phe chez les humains qui sankylosent , comme chez les plantes qui se
lignifient. Ce qui est dur et rsistant suse et
421
prit. Seul demeure
invulnrable et vivant ce qui sait ployer (
1070
).
Des ides analogues inspirent une dittique qui ne prescrit ni le jene
constant, ni mme la sobrit. Elle dfend de se nourrir de crales, la faon
du vulgaire (
1071
), mais invite dguster le suc des choses. Elle conseille de
boire la rose fconde. Elle ninterdit nullement les boissons al coolises. Elle
les considre comme des extraits de vie. Pas plus quun nouveau -n, un adulte
ne se blessera en tombant (mme du haut dun char et mme sur sol dur) si la
chute a lieu quand il est ivre : cest que, grce livresse, sa puis sance de vie
(chen) est intacte (tsiuan) (
1072
). Liv resse fait approcher de la saintet, car,
comme la danse, elle prpare lextase.
Seule lextase peut conserver parfaitement intacte la puissance de vie
(chen tsiuan). La saintet, cest --dire la pleine vie, est atteinte ds que,
rfugi dans le Ciel (tsang yu Tien ), on russit se maintenir dans un tat
divresse extatique ou, plutt, dapothose permanente (
1073
). Arriv ntre
plus quune puissance pure, impondrable, i nvulnrable, entirement
autonome, le Saint va jouant en toute libert, travers les lments, dont
Marcel GRANET La pense chinoise 301
aucun ne le peut heurter. Il traverse impunment les corps solides. Toute
matire est pour lui poreuse. Le vide quil a cr en lui, grce lextase,
stend en sa faveur lUnivers entier (
1074
).
Les Matres mystiques affirment que cet tat de grce magique est ltat
de nature, celui du veau qui vient de natre. Les plus belles prouesses sont
le fait des tres demeurs les plus simples (
1075
). Il apparat pourtant, lire Lie
tseu ou Tchouang tseu, que cette simplicit parfaite est le fruit dun
entranement systmatique. Pour devenir un matre dans lart de la lvitation
ou dans lart de lextase, une longue pratique est ncessaire, ainsi que des
initiations successives. Lie tseu (qui prit soin de se confier aux meilleurs
matres) narriva jamais se maintenir en tat de transe plus de quinze jours
de rang. Il lui fallut cependant neuf ans dappre ntissage pour obtenir la recette
(chou) qui permet de chevaucher le vent . Quand il eut reconquis la
simplicit premire,
son cur (sa volont) se cristallisa ( ying), tandis que son
422
corps se dissolvait et que ses os et sa chair se liqufiaient. Il ne
sentit plus que son corps sappuyait ni que ses pieds reposaient sur
quelque chose. Il sen allait, au gr du vent, lest, louest,
comme une feuille ou un ftu dessch, sans pouvoir se rendre
compte si ctait le vent qui len tranait ou lui-mme qui tranait le
vent (
1076
).
Lexpression ftu dessch, javelle vide , quon emploie propos des
randonnes ariennes, mrite dtr e retenue, car, pour dpeindre le saint en
extase, on ne manque jamais de dire que son cur est comme de la cendre
teinte et son corps tel du bois mort (
1077
). Quest donc devenue la jeune
souplesse que visent conserver les pratiques de la longue vie ? Le bois mort
voque la rigidit cataleptique. Tout ce qui, dans lindividu, est principe de
mort, a t, si je puis dire, vacu dans lenveloppe corporelle ( hing), qui est
devenue semblable un cadavre, cependant que la souplesse, intacte, sest,
avec toute la vie, concrte dans ce que la langue mystique appelle le double
(ngeou : la moiti, le compagnon) et le langage commun lme -souffle
(houen) (
1078
) Ltre nest plus alors quun souffle qui se mle au souffle
vivifiant de lUnivers et, libre, se joue dans le vent.
Aussi lascte sanctifi peut -il, sans craindre aucun obstacle, sans
quaucun heurt ne le vienne blesser, sans que rien ne le fatigue ou ne luse,
sbattre ( yeou), chevauchant la lumire, dans limmensit du vide : le Souffle
de lUnivers est la fois vide et lumire, chaleur et vie (
1079
). A ces ides se
rattache une mtaphore populaire que les mystiques reprennent quand ils
affirment que la mort ne peut rien sur eux.
On disait jadis que le Souverain (dEn -haut) suspend (le fagot)
puis le dfait... Le fagot brle, la flamme se transmet... (
1080
).
Marcel GRANET La pense chinoise 302
principe de la souplesse et de la chaleur vitales, le Souffle, que lextase ser t
tout ensemble affiner et concentrer, puis librer, svade de ce qui nest
plus que mort et cendre teinte , pour rejoindre la vie et la lumire pures.
Ainsi sextriorise et se spare du prissable ce que nous ne pouvons
appeler lme (
1081
), car ce nest pas une entit spirituelle : ce nest chaleur,
fluidit, vacuit lumineuse que le principe universel, subtil et concret, de la
vie. Commence par de libres bats et des jeux vivifiants, grce
423
auxquels
ltre saffine en se pliant au rythme de lUnivers, lascse de la longue vie
sachve par une illumination dont le Saint retire, avec tous les dons du Mage,
une puissance de vie illimite.
II. La mystique de lautonomie
A tout un dtail de recettes de vie ou de saintet, enseignes sans doute
par des matres concurrents, et trs diverses bien que relevant dune mme
inspiration, sest superpo se ce quon appelle la doctrine de lcole du
Tao . Cette expression, consacre par lusage, nest pas heureus e. Lide de
Tao nest point particulire aux matres du Taosme, et ceux -ci, plutt quils
nont profess une doctrine, se sont borns prconiser une Sagesse. Cette
sagesse est de tendance mystique, ce qui nimplique pas quelle soit favo -
rable le moins du monde au personnalisme et au spiritualisme. On la trahirait
plus encore que tous les autres enseignements en faveur dans la Chine
ancienne, si, pour lex poser, on se laissait entraner employer le mot
Dieu ou le mot Ame . Le Taosme de Lao tseu et de Tchouang tseu
est une sorte de quitisme naturaliste.
Vomis ton intelligence (
1082
), telle est, en principe, lunique rgle de la
Sagesse. Tout dogme est nocif. Il ny a point de bonnes uvres. Seuls sont
efficaces le silence et la quitude (tsing).
Approche ! je vais te dire ce quest le Tao suprme ( tche Tao) ! Retraite,
retraite, obscurit, obscurit : voil lapoge du Tao suprme ! Crpuscule,
crpuscule, silence, silence : ne regarde rien, nentends rien ! Retiens
embrasse ta puissance vitale (pao chen), demeure dans la quitude : ton corps
(ne perdra pas) sa correction (native) ! Conserve la quitude (tsing), conserve
ton essence (tsing) : tu jouiras de la longue vie ! Que tes yeux naient rien
voir ! tes oreilles rien entendre ! ton cur rien savoir ! Ta puissance vitale
conservera ton corps, ton corps jouira de la longue vie ! Veille sur ton
intrieur, ferme-toi lextrieur : savoir beaucoup de choses est
nuisible... (
1083
).
Le quitisme des sages taostes se rattache expressment,
424
comme on
voit, au vieil idal de la longue vie. Ces sages, cependant, paraissent avoir t,
de mme que Confucius, mais dans un autre milieu, des rformateurs.
Marcel GRANET La pense chinoise 303
Eux aussi ont voulu fonder la sagesse sur la connaissance de lhomme. Mais
Confucius semble stre propos de librer la psychologie dun antique savoir
magico-religieux, tout en exaltant la vertu ducative de ltiquette. Les
Pres du Taosme , au contraire, se soucient de distinguer la connaissance
psychologique de la science des comportements rgis par les conventions
sociales, bien plus quils ne se proccupent de la dtacher des spculations sur
lUnivers. Ils affectent de voir dans la socit ( actuelle) non pas le milieu
naturel de la vie humaine, mais un systme fallacieux de contraintes. Ce ne
sont point la frquentation des Anciens, la conversation des honntes gens, le
contrle mutuel, ce ne sont pas lamiti ni lobservation qui peuvent
renseigner sur la nature humaine. La mditation solitaire est lunique voie du
savoir et du pouvoir (tao) :
Connatre autrui nest que science ; se connatre soi-mme, cest
comprendre (
1084
).
La civilisation dgrade la nature : tout est conventionnel dans ce que
lobservation peut atteindre. La dialectique na quun intrt ngatif : elle
dmontre larbitraire de tout savoir qui nest point d la seule mditation.
Cette dernire suffit au Saint. Par-del lartificiel, elle lui fait apprhender
dun seul coup le rel et la vie. Il na qu se replier sur lui -mme : oubliant
dans limmobilit ( tsouo wang) tout ce qui nest que savoir conventionnel, il
purifie son cur ( sin tchai) de tous les faux dsirs et de toutes les tentations
qua invents la socit. Il restitue ainsi en lui la simplicit (pouo) parfaite,
qui est ltat natif de tout tre et de lUnivers entier. Pour retrouver en soi
lhomme naturel et la Nature, il ny a qu redevenir soi -mme et
conserver en paix lessence de vie qui est propre son soi (ngan
ki sing).
Ne passe point ta porte, tu connatras lempire entier. Ne regarde
pas par la fentre : le Tao cleste tapparatra (
1085
).
La mditation na pas pour fin la seule connaissance. Elle pur ifie et elle
sauve. Mais le salut nest quun retour la nature, et ce nest pas de ce que
nous appelons la matire que lapprenti -saint cherche se librer. Seul le
sicle (che), et non pas le monde, mrite le nom de bourbier. Ce qui est
425
impur et germe de mort, cest lartificiel, cest lacquis : tout ce par quoi la
civilisation a dform et fauss la nature. Toute invention, tout
perfectionnement prtendu ne vaut pas mieux quune excroissance gnante.
Cest bien plutt une tumeur nocive (
1086
). Il ne faut pas violenter la nature et
surtout sous prtexte de la rectifier. Ce qui est courbe doit rester courbe. Ne
prtendez pas raccourcir les pattes de la grue, allonger celles du canard ! Pour
peu quelle ft artificielle, to ute technique de la longue vie serait pernicieuse,
et condamnable tout parti pris damlioration sil sinspirait de prjugs
moraux. Le pis serait de vouloir lier ensemble par le jen et le yi, par ces liens,
ces rseaux, ces colles, ces vernis factices que sont les rites, les lois,
ltiquette, des tres qui ne peuvent subsister qu condition de rester
Marcel GRANET La pense chinoise 304
eux-mmes. On perd sa nature (sing) si lon sattache aux coutumes ; on
dtruit son soi si lon sattache aux autres tres (
1087
). Le soi (tseu) ne
doit pas se laisser contaminer par l autrui (pei) . Il convient, au contraire,
de se rfugier dans le t (lessence spcifique) qui vous est propre ( tsang yu
ki t) (
1088
) , car cest l se rfugier dans le Cleste (tsang yu Tien) ,
cest --dire dans la Nature.
Lopposition du Tien et du jen (qui est non pas lhumain, mais le social,
le civilis) est le centre de la doctrine de Lao tseu et de Tchouang tseu. Elle
diffre entirement dune opposition entre le divin et lhumain (
1089
). La
mditation, ni mme lextase, ne visent pas donner accs une sagesse
transcendante. Elles rvlent lhomme ce quil est, ce quil peut demeurer, si
la civilisation (jen) noblitre pas en lui le tao, le t, le Tien, cest --dire son
essence propre (sing), pure de toute contamination. Aussi lHomme vritable
(Tchen jen) est-il celui qui, fuyant ses semblables, na pas de semblable :
Celui qui ne sassemble pas avec les autres hommes (ki jen) sgale au
Ciel. On peut encore dire de lui quil sbat dans le vrai , que la porte
du Ciel souvre pour lui , qu il est un Fils du Ciel , qu il sgale au
Souverain (dEn -haut) (
1090
). Ce sont l des formules mythiques, qui ne
doivent point garer : la mditation taoste ne recherche aucun rconfort dans
lau -del. Elle est strictement solitaire. Son idal est lautonomie. Il ny a que
le mchant qui soit seul, diraient volontiers les tenants de Confucius (
1091
).
Leurs
425
adversaires font dune autonomie absolue la condition du salut et
de la vie mme. Cest pour soi seul, cest par soi seul que doit vivre le Saint.
La salut, la saintet sont acquis ds que, libr de toute compromission
avec lautrui, le soi ( tseu) nest plus que vie et spontanit pure ( tseu jan).
Rduit lui-mme, lindividu sgale lUnivers, car la spontanit dont il
fait dsormais son unique loi est la loi unique du Tien ou du Tao. Qui sait
demeurer autonome possde le Tien tao, la Voie, la Vertu cleste.
Cest en effet le tseu jan, la spontanit, ou plutt, cest un pouvoir total
de ralisation spontane qui est la caractristique du Ciel comme du Tao.
Tien (le Cleste, qui sop pose jen, la Civilisation) voque une ide que le
mot nature peut rendre et, dans la mesure o il parat juste de traduire
par nature, cest encore ce terme qui expri mera le mieux la notion
taoste de Tao (
1092
).
Partant de lide courante que Tao note le pouvoir uni versel de ralisation
dont la puissance rgulatrice du Chef est, dans lordre humain, la plus haute
expression, les Matres taostes ont prt cette notion une valeur plus intel-
lectuelle, sinon plus abstraite. Dans la notion de Tao se rsumait le sentiment,
religieux la fois et familier, de la sympathie troite et de lentire solidarit
qui unit la nature et les hommes. Pour les coles proccupes daction
politique ou morale, lordre naturel, conu sur le modle de lordre social,
parat maner du chef, gardien responsable des statuts et des coutumes. Mais
la pense des Matres taostes subit moins directement linfluence de la
Marcel GRANET La pense chinoise 305
politique que celle des arts magiques. Plus puissante encore chez eux que chez
tous les autres sages de la Chine, lide que lhomme ne forme pas un rgne
dans la nature saccompagne dun sentiment trs vif de lunit du Monde. Les
devins caractrisaient len semble des mutations (yi), relles ou symboliques,
en les qualifiant da ises (yi) : elles se produisent, affirmaient-ils, sans quil y
ait dpense dnergie. Les magiciens prsen taient les tours de force les plus
miraculeux comme les effets directs dun gnie opratoire inpuisable. Cest
de ces conceptions, combines avec la croyance (mi-populaire,
427
mi-savante) que le Ciel, invariable, impartial, demeure sans cesse lui-mme,
tout en rgissant les quatre saisons, que drive la thse essentielle du
Taosme : le Tao (comme le Ciel, cest --dire la Nature) est imagin comme le
principe immanent de luniverselle spontanit.
Aussi se signale-t-il dabord par une sorte dindiffrence et
dindiffrenciation totales. Il est vide (hiu) , vide de prformations comme
de prjugs ; il ne fait obstacle aucune libre initiative : lui, qui est
lInd nommable (le Total incapable de retenir aucune spcification), nulle
individuation ne vient se heurter. Le Tao (le Ciel, la Nature) nest pas liant,
mais dtach, mais impartial ; il anime le jeu et se tient hors du jeu. Sa rgle
unique est le wou wei, la non-intervention. On pense, certes, quil agit ou
plutt quil est actif, mais en ce sens qu il rayonne inlassablement une sorte
de vacuit continue. Principe global de toute coexistence, il forme un milieu
neutre, propice, par l mme, au flux et au reflux indfinis des interactions
spontanes.
Certains Taostes (comme il apparat lire le Lie tseu) ne distinguent
gure le milieu interactif que constitue le Tao du monde des actions
proprement magiques. Quand ils insistent sur la continuit (kiun) de lUnivers
et quils lop posent la simple contigut (
1093
), ils songent surtout ( ce que
nous appellerions les actions desprit esprit) aux passes magiques, aux tours
opratoires, aux jeux des illusionnistes. Cest grce au continu cosmique, cest
grce au Tao, en fait, cest grce leur propre efficace ( tao), que tel
pcheur (dont la ligne est faite dun seul filament de soie) retire dun profond
abme dnormes poissons et que tel joueur de guitare (rien quen pinant
lune de ses cordes) obtient, sil lui pla t, que les moissons mrissent ds les
premiers jours du printemps ou, en plein t, que la neige tombe et que glent
les fleuves. De semblables pouvoirs sont acquis, dit expressment le Lie tseu,
qui sait les secrets des jongleries illusionnistes (houan), qui connat la
science des transformations (tsao houa) (
1094
).
On affecte souvent de ne voir dans le Lie tseu quune uvre du Taosme
dj dcadent, mais cest un fait que les actions sans contact ni dpense de
travail sont lun des thmes favoris de Tchouang tseu. Ce dernier mme, fait
plus
428
remarquable encore, emploie les mots tsao houa pour qualifier le
Tao. Certains interprtes nhsitent point, en ce cas, tra duire tsao houa par le
Crateur et, prcisment, locc asion dun passage o Tchouang tseu montre
le Tao oprant la mutation dun bras gauche en coq et dun bras droit en arba -
Marcel GRANET La pense chinoise 306
lte (
1095
). Rien nest plus tranger aux penseurs taostes que la tendance
crationniste ou personnaliste. Ils ne sparent point les ides de spontanit
(tseu jan) et de non-intervention (wou wei), dimpersonnalit et dautonomie.
Tout justement parce quils ne voient dans le Tao que le principe immanent et
neutre de toute ralisation spontane, ils ont tendu, Tchouang tseu surtout,
faire de lui le principe du dveloppement naturel des choses et, par suite, de
leur vritable explication.
On a caractris leur effort en disant quils ont voulu se librer des
conceptions animistes qui, de leur temps, dominaient lesprit chinois (
1096
). Il
serait plus exact de ne point parler danimisme, mais de magie. En
intellectualisant, si je puis dire, lide du Tao et en insistant sur les notions
dimpersonnalit et dimpartialit, les Matres taostes ont essay dinterprter
comme un principe dexplication ration nelle ce qui navait t conu jusqu
eux que comme le principe concret et total de lOrdre ou le milieu efficient
des actions magiques. Cependant, ils nont point song lier l ide du
dveloppement naturel des choses une technique de lexprimentation. Si
puissante quait t linspiration naturiste qui les animait, ils restaient, tout
autant que leurs adversaires, sous lempire de proccupations humanistes. Ils
ne songeaient prconiser quune certaine entente de la vie. Lide quils se
font du Tao ou de la nature des choses sexpli que par leur got pour la
mditation [quils combinaient (Tchouang tseu tout au moins) avec un vif
penchant pour la dialectique] au moins autant que par leur savoir en matire
de magie ou de physique.
La notion de continuit est lie, dans le Lie tseu, la thse que lEspace et
le Temps ne sont point limits (
1097
). Quand il veut faire entrevoir ce que peut
tre le Tao, Tchouang tseu insiste, lui aussi, sur cette thse. Il lillustre
abondamment au moyen, dune part, dallgories ou danecdotes
429
mythiques, et, dautre part, dune argumentation nourrie de thmes emprunts
aux sophistes (
1098
). Comme ces derniers, Tchouang tseu professe un
relativisme rigoureux, mais quil dtache de tout ralisme abstrait.
Pour lui, le monde se rsout en un flux dapparences concrtes,
occasionnelles, singulires, entre lesquelles il ny a point de mesures
communes, sinon extrieures, humaines, artificielles. Toutes les sensations ont
autant, ou aussi peu, de ralit les unes que les autres. Tout jugement nest
quun jugement de valeur, une estimation toujours arbitraire. Je suis, dans
mon rve, un papillon ; je me rveille et je suis Tchouang tseu. Qui suis-je ?
Tchouang tseu rvant quil est un papillon ! Un papillon qui imagine tre
Tchouang tseu (
1099
) ? Ces deux apprciations successives tmoignent dune
transformation (wou houa) dont on ne peut dire si elle est relle ou imaginaire.
De mme, il nest point possible dtablir de distinction assure non seulement
entre des termes voisins, mais encore entre le Ceci et le Cela, lexis tence et la
non-existence, la vie et la mort, le beau et le laid, lutile et le nuisible, le
bien-tre et le mal tre. Ce ne sont point l, en fait, des termes rellement
contraires, ce ne sont que des apprciations contrastantes entirement
Marcel GRANET La pense chinoise 307
subjectives, simplement momentanes. Se coucher dans la boue nest malsain
que pour tel individu et tel moment (
1100
). Lhumidit, la chaleur nexistent
que pour qui a chaud ou se sent mouill et au seul instant o il le sent. Le
Tout et tout tre sont en perptuel changement. Me voici autre que moi-mme
quand je crois tre le moi de tantt.
La vie de lhomme entre Ciel et Terre, cest comme un cheval
blanc sautant un foss et soudain disparu (
1101
).
Natre ou mourir, voil, certes, un changement (kai) total, instantan ; il ne
diffre point des changements du tout au tout dont, chaque instant, la vie est
faite. Lindividu, tout autant que le monde, est multiple, pas plus que
lindividu, le monde ne demeure identique (
1102
) ; et, pourtant, lUnivers est un
et, de mme, chacun des tres. Les changements du tout au tout ne sont que
des mutations.
Il ny a donc point derreurs, ni mme de possibilits derreurs. Aussi
tous les paradoxes des Sophistes peuvent-ils tre tenus pour vrais. Le Moi et
lAutrui, le Ceci et le
430
Cela ntant que des situations diffrentes, il est
lgitime de dire quun centenaire nest pas vieux, ni un mort -n jeune, quun
poil vaut une montagne, et quentre tel ciron et lUni vers aucune diffrence
nexiste, ni en noblesse, ni en puis sance, ni pour lge, ni pour la
grandeur (
1103
). Il ny a, en revanche, que des vrits occasionnelles,
impermanentes, multiples, singulires, concrtes, ou ce qui revient au
mme il ny a quune vrit, abstraite, totale, indfinie, qui est le Tao : le
milieu indiffrent et neutre, impassible, indtermin, suprmement
autonome de lensemble des vrits transitoires, des apparences
contrastantes, des mutations spontanes.
La dialectique mise en honneur par les Sophistes permet Tchouang tseu
de prsenter le Tao comme le milieu o sopre la synthse de tous les
antagonismes. Lorsque, cessant de rester confin entre les Six Ples de
lUnivers et de sy laisser blouir par les jeux de la lumire et de lombre, on
se dcide monter dans le char du Soleil (
1104
), on jouit, de cet observatoire
neutre et souverain, dun point de vue qui nest ni celui du Ceci, ni celui du
Cela, mais celui o le Cela et le Ceci ne peuvent qutre unis. Cest le point de
vue du Centre de lanneau, o se manifeste la vanit des oppositions (en
apparence) diamtrales. Pour qui se place au centre de lanneau, il ny a rien
qui ne trouve sapparier (t ki ngeou) , tous les contrastes se rsorbant dans
lOrdre total qui les rgit, car cest l le pivot du Tao (
1105
),
Envisags partir du principe indiffrent de toutes les ralisations
autonomes, et non plus avec les prfrences passionnes du petit face au grand
ou du grand face au petit, le minuscule et le majuscule se confondent, car ils
sont immenses pareillement. Est suprmement tnu (selon le dire des
dialecticiens) ce qui na aucune apparence sensible ( wou hing) ; suprmement
grand, ce qui ne peut tre circonscrit. A cet aphorisme qui voque des
sensations, des oprations concrtes, mais sinspire dun ralisme abstrait,
Marcel GRANET La pense chinoise 308
Tchouang tseu substitue une formule par laquelle saffirme sa thse que seules
comptent les oprations de lesprit, et quil ny a ni petit, ni grand, mais
seulement de limmense. Il caractrise donc ce qui na aucune apparence
sensible par limpos sibilit de le diviser par le calcul ; ce qui ne peut tre
431
circonscrit, par limpossibilit de le supputer numriquement (
1106
). Le
relativisme de Tchouang tseu est dinspiration idaliste.
Cest avec lui quapparat, dans la philosophie chinoise, destine, du reste,
une fortune mdiocre, lide dinfini. Linfiniment grand, linf iniment petit,
ce nest pas ce qui, matriellement, se trouverait inscable, ou ce que, techni -
quement, on ne pourrait circonscrire : cest ce qui, encore et toujours, demeure
imaginer ds que lesprit a commenc dimaginer. A moins quon ne soit
une grenouille confine dans un puisard, un champignon n pour un seul
matin, comment ne pas sentir que lEspace et le Temps (et, avec eux, tout tre
ou toute situation dans lEspace -Temps) sont illimits ? Si grandes que
puissent tre dpeintes une tendue ou une dure, toujours apparatra une
insuffisance de grandeur, une fois quon se sera avis de songer un
au-del (
1107
). Pensez, par exemple, au Peng, cet oiseau immense, qui na
besoin que de six mois de vol pour senle ver dans les airs une hauteur de
quatre-vingt-dix mille stades : o pourrait-il (o pourriez-vous) arrter son
essor ? Cette allgorie ou de semblables thmes mythiques suffisent pour
imposer lide dinfini (
1108
). Cest, en effet, u n besoin de lesprit quelle
correspond. Et ce besoin, la notion de Tao le satisfait.
Entirement indtermin, et absolument autonome, le Tao se retrouve en
toutes choses. Toutes choses comportent de la spontanit, de
lindtermination, et ces possibilits indfinies de mutations qui appartiennent
tout tre, car chaque emblme les recle.
O est le Tao ? Il ny a rien o il ne soit ! Prcisez par un
exemple, cela vaudra mieux. Il est dans cette fourmi !
Pourriez-vous donner un exemple plus humble ? Il est dans
cette herbe ! Plus bas encore ? Il est dans ce tesson !
Est-ce l le plus bas ? Il est dans cet excrment !
Mais il ne sert rien dinterroger sur le Tao la manire des
experts (
1109
), dans les marchs, estiment un cochon en enfonant le pied, tant
quils peu vent, dans la graisse. Ne demandez pas dexemples, il ny a rien
o le Tao ne soit. Le Tao mrite dtre appel le Suprme ,
lUniversel , le Total , cest --dire lEntier -Unique (Yi) (
1110
),
Immanent en toutes choses (il ne faut
432
pas dire : animes ou inanimes,
mais : les plus vulgaires comme les plus nobles) (
1111
), il y signale un principe
dind termination dont procde, pour chacune delles, avec une absolue
singularit, une entire indpendance. Ce ne serait pas assez de dire que
chaque tre, comme toute pense, est tout ensemble libre, fugace, illimit, ou
quil participe dun infini de puissance et de libert ; cet infini, il ny a rien
Marcel GRANET La pense chinoise 309
qui ne sgale et , pour valoir le Tout, il suffit chaque tre dtre et de
devenir : il suffit dtre soi -mme, avec tous ses possibles.
Cet infini immanent, la dialectique ou limagination mythique font voir
quil est un besoin de la pense. Lextase, qui en procur e, dans sa pure
splendeur, le sentiment, prouve quil est lunique ralit, la ralit totale.
O mon Matre ! mon Matre ! Tu donnes toutes choses et
ninterviens pas par quit ( yi) ! Tu fais largesse aux gnrations
de tous les temps et nintervie ns pas par amiti (jen) ! Tu es plus
ancien que les plus vieux ges et nes pas vieux ! Tu couvres et
supportes (tels le) Ciel et (la) Terre ! Tu cisles et sculptes toutes
les apparences et nes pas un artisan ! Cest en toi que je mbats
(yeou) [ou bien (cest une autre clausule) : cest toi quon nomme :
Joie cleste !],
telle est loraison ( strotype) par laquelle sachve lextase taoste (
1112
). On
arrive cette extase la suite dun entranement qui purge ltre de to utes les
contradictions artificielles, surimposes sa nature par le contact dautrui et
les conventions sociales. On conserve, dans le plus grand ge, la fracheur
dun enfanon, lorsquon rejette hors de soi dabord le monde des
hommes , puis toute ralit (extrieure), et, enfin, lide mme
d existence . On obtient alors, dans une lumire diffuse (
1113
) qui est celle
de laube (tchao tche) , la vision dune indpendance solitaire , si bien
que, pass et prsent sanantissant on entre dans ce qui nest ni le vivre
ni le mourir (
1114
). Cest ainsi que,
laissant tomber corps et membres, bannissant audition et vision,
se sparant de toute apparence corporelle et liminant toute
science, on sunit ce qui pntre partout (ta tong) (
1115
) et donne
sa continuit lUnivers ( Tien kiun) (
1116
).
Grce la purification du cur et au vide (hiu) , on adhre au Tao
(tao tsi) (
1117
).
433
Aprs avoir embrass lUnit ( pao yi) et puisque les dix mille
tres ne sont quun (
1118
) et quil a su, lui -mme, conserver en lui
lunit (
1119
), le Saint, nayant plus ni quant soi, ni activit prive, ni nom
propre (wou ming) (
1120
) se fond, indtermin et libre, dans le principe,
indnommable (wou ming) et total, qui, ntant que laxe, le fate ( ki), le
pivot, le centre vide du moyeu (
1121
) na ni activit ni existence propres,
mais en dehors de qui il ny a point de ralit, de libert, de vrit, car il est
lIntacte Efficace dont procde, avec tous les arts, lensemble des efficiences,
lUnique Savoir qui, telle une lumire diffuse (on la nomme la Lumire cleste
cest --dire naturelle Tien kouang) (
1122
), rumine tout, uniformment,
donnant chaque chose son apparence vritable (
1123
).
Loriginalit des Matre s taostes ou, tout au moins, de Tchouang tseu,
tient au fait quils ont su justifier une technique de la Saintet, domine par un
Marcel GRANET La pense chinoise 310
idal dautonomie, en la combinant avec une thorie de la connaissance (
1124
)
fort bien ajuste aux postulats de leur quitisme naturaliste.
Dans cette thorie, la part de la tendance mystique nest pas plus grande
que celle de la tendance intellectualiste. Envisag comme le principe
immanent et neutre de tous les libres dveloppements, le Tao (mme si, dans
lexaltation de la vision extatique, on le qualifie de mystrieux et dinef fable)
est, avant tout, conu comme un principe dexpli cation rationnelle. Et
dailleurs, son indtermination et son impartialit (qui se traduisent par la
froideur impersonnelle des effusions et oraisons mystiques, toujours de forme
strotype) excluent toute tendance au personnalisme, cependant que toute
tendance au spiritualisme se trouve exclue par lide de la continuit de
lUnivers.
Le Tao, dont on peut dire quil est la fois Nature et Raison (ou, si lon
veut, et ), est un pri nci peduni versel l ei ntel l i gi bi l i t. La formule
vomis ton intelligence nexprime pas le mpris de lactivit de lesprit,
mais, simplement, le ddain de la science discursive, des jeux de la
dialectique, de toute espce de ralisme abstrait.
434
Les Matres taostes ne font aucune difficult pour utiliser (ni
dailleurs, semble -t-il, aucun effort pour perfectionner) le systme de
classifications dont leurs contemporains se servent pour ordonner la pense.
Ils admettent que le vulgaire est domin par 6 Apptits (ceux des honneurs et
des richesses, des distinctions et du prestige, de la renomme et de la Fortune),
6 Entraves (celles quimposent le maintien et le comportement , la sensualit et
le raisonnement, le temprament et la rflexion), 6 (Sentiments qui font)
obstacle au T (haine et dsir, joie et colre, peine et plaisir), 6 (Attitudes qui
font) obstacle au Tao (celles qui consistent viter ou aller au-devant,
prendre ou donner, acqurir des connaissances ou exercer des talents) : il
faut rprimer ces 24 dispositions pour obtenir la rectitude et la quitude,
lillumination et la vacuit (
1125
). Il faut encore, sous peine de perdre
lessence qui vous est propre ( sing), viter les 5 perversions (
1126
) qui
rsultent dun usage civilis des sens : peinture, musique, parfums, cuisine,
prdilections du cur corrompent la vue, loue, lodorat, le got, le
jugement (
1127
). En lui-mme, dj, lusage naturel des sens peut tre perni -
cieux, si lon ne sapplique dfendre, contre la multiplicit des apparences,
la simplicit originelle (pouo) de ltre. La vision, laudition, lod orat, le
got, la connaissance ne mritent dtre qualifis de tche (qui pntre tout, qui
stend tout) que si aucun objet particulier ne les arrte.
Pour que la perception soit pure, il faut que, diffuse, elle se rapporte au
total et non au dtail des choses. Il faut encore que, globale, elle soit fournie,
non par lun des sens, mais par ltre entier. Il faut quelle rsulte dune union
(ho) de ce qui, dans lindividu comme dans lUnivers, constitue la puissance
de vie [le ki (souffle) (
1128
)]. Le vritable sage entend avec ses yeux et voit
avec ses oreilles . Ce nest pas quil ait, dj, trouv le secret de laudition
Marcel GRANET La pense chinoise 311
paracoustique ou de la vision paroptique. Il admet volontiers quil nest point
possible dintervertir les fonctions des divers organes. Il sait seulement unir
son corps son cur, son cur son ki (souffle), son ki son chen
(puissance vitale) et le tout au wou (cest --dire non pas au nant , mais au
Total indtermin...) Si donc
il se produit un son, soit au loin, par-del les Huit Marches de
lUnivers, soit tout prs, entre
435
cils et sourcils, il ne peut pas ne
pas en tre inform sans que, pourtant, il sache si cest par ses
oreilles ou par ses quatre membres que sest faite la perception ou
si cest par son cur, son ventre, ses cinq viscres quil est
inform : il le st, voil tout (
1129
).
Seule parat valable la perception, spontane et globale, qui rsulte dune libre
fusion communielle. Le sage sabstient de se servir de ses yeux pour voir, de
ses oreilles pour entendre ; il se refuse faire un usage distinct de ses sens de
peur de voir sengorger les orifices qui en sont les organes ; il nutilise ses
yeux que de la manire dont il utilise ses oreilles et emploie son nez comme il
emploierait sa bouche : cest ainsi seulement que la communication entre
lextrieur et lintrieur stablit innocemment (
1130
).
Toute sensation partielle est puisante et corruptrice. A heurter la
multiplicit des choses une part, puis une autre part de son tre, lindiv idu
sextnuerait. Un Saint, dont le premier devoir est de prendre soin de sa
vitalit, craint ces heurts, surtout quand, en bon Taoste, il est pntr de lide
que, l o la multiplicit apparat, il ny a point de terme prvoir. Il se garde
de vouloir connatre par le dtail :
Vivre a des bornes et il ny a point de bornes au connatre ! Cest
un pril pour ce qui est limit de poursuivre ce qui ne lest pas
(
1131
) !
Nul, dans lancienne Chine, nignore que toute image r sulte dun contact,
ce choc pouvant se produire dans ltat de veille comme dans le rve (
1132
). Le
Saint ne se permet pas de rver ou de penser, pas plus que de fatiguer ses
muscles (
1133
), car il redoute lusure et, plus encore, la contagion. Ds quil y
a, non pas union roborifiante avec le Total indtermin, mais rapprochement
indu de lAutrui et du Moi, il y a choc, cest --dire usure, et contact nuisible,
ou, plutt, souillure.
Pour empcher ces contacts malficients et les empitements doublement
sacrilges qui blessent lautonomie de lAutrui comme celle du Moi (
1134
), les
Matres taostes devraient, semble-t-il, se bornant lunion extatique avec le
Tao, professer le plus rigoureux des subjectivismes mystiques. Ils chappent
ce subjectivisme grce leur thse sur la continuit de lUnivers. Cette thse
leur permet aussi de se dbarrasser du ralisme abstrait des dialecticiens.
Marcel GRANET La pense chinoise 312
436
Au sophiste Houei tseu, qui flnait en sa compagnie sur la passerelle
dun ruisseau et qui lui reprochait davoir, ntant pas un poisson, prtendu
reconnatre ce qutait le plaisir des poissons, Tchouang tseu rpondit :
Vous mavez demand : Comment savez-vous ce quest le
plaisir des poissons ? Puisque vous mavez pos cette question,
cest que, dabord, vous saviez que je le savais. Et moi, je le sais
parce que je suis sur la passerelle du ruisseau (
1135
).
La possibilit de communications entre le Moi et lAutrui est un fait. Si,
mme pour lui, ce ntait pas un fait constant, le dialecticien se montrerait
absurde, puisque et prcisment propos de ce fait il questionne autrui.
Mais si le fait qui autorise la dialectique tout en faisant apparatre
linefficacit du raisonnement dans labstrait o elle se cantonne est
constant, cest la preuve quentre toutes les portions de lUnivers existe une
continuit concrte.
Pour les Matres taostes, en effet, la communication dindi vidu humain
individu humain nest possible que parce quest dabord possible la
communication entre individuations de toutes sortes. Tout parti pris
spiritualiste tant exclu, il ne sagit point de communications dme me,
ni, non plus, dune transmission dides assure par une symbolique
artificielle, tel le langage humain. Si le Moi peut connatre lAutrui, cest en
raison de lUnit du monde. Cest grce la continuit naturelle (Tien
kiun) que le vrai (jan) et le faux (pou jan) se distinguent deux -mmes
(tseu) , se manifestent spontanment (tseu jan) (
1136
).
Lunit du monde tait clatante, et toute facile la con naissance des choses
aux temps o la civilisation navait point perverti les hommes en les
dformant et en les isolant.
Ils vivaient jadis fraternellement avec les animaux et ne faisaient
quune famille avec les dix mille tres.
On ne se proccupait point alors de science du dtail , mais tous les tres
sentendaient et se comprenaient, car les pies elles-mmes laissaient
regarder dans leurs nids (
1137
). Les sages disaient donc que, pour ce qui est
de lentendement, il y avait, entre tout ce qui vit, bien peu de diffrence. Aussi
communiquaient-ils librement avec les quadrupdes, les oiseaux, les
insectes, les gnies, les dmons de toutes sortes. Et, en effet, les
comportements humains ne sopposaient pas
437
encore ceux des autres
tres (
1138
). Mais, aujourdhui, la plupart des hommes demeurent enserrs et
parqus par les barrires artificielles, les distinctions arbitraires quimposent la
culture et lti quette. Ils ont perdu leur simplicit native. Ils ne peuvent donc
plus comprendre ce qui seul peut tre compris : les comportements naturels
(sing) des tres.
Seuls quelques barbares entendent encore le langage des animaux, et
quelques leveurs leur nature : eux-mmes ont conserv une nature simple.
Marcel GRANET La pense chinoise 313
Cest eux quil convient de demander le secret dune connaissance vraie :
Gardant toujours la mme humeur , ils ne cessent point dtre naturels, si
bien quauprs deux les tigres se croient au milieu des monts et des forts ,
en pleine nature. Une sympathie impartiale et libre (
1139
) unit en pareil cas le
Moi et lAutrui. Cette vritable entente est le principe dune connaissance
vraie. A celui qui les aime et, par amiti pure, les vient saluer tous les matins,
les mouettes se livrent familirement. Entre elles et leur ami, le jeu est
dsintress, et, par suite, la communication intime. Mais si, un jour, lhomme
vient les voir avec le dsir de semparer delles, les mouettes peroivent cette
intention secrte et fuient aussitt (
1140
). Nul narrive comprendre, sil ne
respecte, conservant lui-mme sa propre nature, la libre nature dautrui.
La connaissance rsulte dun accord spontan de deux auto nomies, de
deux indiffrences bienveillantes. Aussi leau est -elle le symbole de la
sagesse : elle offre limage de la quitude, du bon accueil et du
dsintressement. Indiffrente, souple, ne susant point , ne cherchant ni
agir, ni connatre, leau na point de revendications ; elle accepte toutes
les formes, toutes les places ; elle va vers le bas que tous mprisent ; elle
est le grand confluent de toutes choses (
1141
), ce qui ne lempche point,
toute impuret ne faisant que la traverser (car au pur tout est pur), de soffrir
comme une masse limpide ; elle se trouble seulement quand elle est agite,
mais ses agitations ne durent pas, car elles ne viennent point delle.
Delle -mme, leau est inerte, accueil lante et paisible. Les choses lui confient
donc librement leur vritable image.
Personne ne va se mirer dans leau courante. Seul ce qui est fixe
peut fixer ce quil y a de fixe (
1142
),
Quand leau est tranquille, sa clart (ming ; ming signifie
comprendre)
438
illumine mme les poils de la barbe et des
sourcils. Elle possde un si parfait quilibre (ping : la paix) quon
a tir delle la rgle du niveau. Quand leau demeure quite (tsing),
elle claire (ming : comprendre, illuminer) toutes choses (
1143
).
LHomme suprme utilise son cur comme un miroir. Il ne
sempare et ne va au -devant de rien. Il rpond tout et ne retient
rien. Il peut vaincre toute chose sans en blesser aucune , car sil
est le rceptacle de tout ce que la Nature (Tien) lui donne, il ne
sen considre pas comme le possesseur (
1144
).
A celui qui demeure en lui-mme sans sy cantonner, disait Kouan Yin
tseu, les choses se manifestent delles -mmes et telles quelles sont, car ses
comportements sont ceux de leau, sa quitude celle du miroir, sa rponse
celle de lcho (
1145
).
La quitude seule procure une connaissance vraie de la nature. Toujours
dsintress, le Saint, sans faire effort, ni rien gter en lui et hors de lui,
reflte, immuable et pur, car ce ne sont point des empreintes qui pntrent et
Marcel GRANET La pense chinoise 314
persistent, les images indfiniment mobiles qui constituent lUnivers. Il
connat dans son intgrit la nature entire. Il la connat sans soccuper du
dtail, mais concrtement. Il a des perceptions justes, mais qui ne valent que
sur linstant. Toute abs traction, toute gnralisation, et mme tout
raisonnement par analogie ( plus forte raison induction ou dduction) lui sont
interdits. Toute science est impossible et surtout lhis toire : rien ne peut
demeurer de ce qui a t, si ce nest une empreinte. Une empreinte est chose
morte et ne signifie rien (
1146
). Seul le reflet fugace est une image exacte,
complte, innocente. Il ny a point de connaissance vraie hors de lInstant et
du Total.
Il ny a de mme quune Efficace totale et des Recettes singulires.
Toute prtendue technique ne saurait tre que trompeuse et novice (
1147
).
Toute recette est intransmissible (
1148
), toute connaissance incommunicable,
du moins dialectiquement. Cest grce la quitude que lon peroit les
comportements naturels. Ce ne sont aussi que des comportements quon peut
enseigner, et on ny ar rive que par la seule attitude efficace : celle de la
concentration dsintresse et paisible.
Un bon patron ne soccupe pas dexpliquer les dtails du
439
mtier. Il se
conduit en sorte que le principe de toute efficace apparaisse au disciple. Celui
qui sait faire ne sait ni pourquoi ni comment il fait ; il sait seulement quil
russit et que lon russit toujours quand, de tout son tre, on ne songe qu
russir. Pour abattre des cigales en plein vol, il suffit de ne plus voir, dans
lUnivers entier, que la cigale vise : on ne peut la manquer, ft-on malingre,
bossu, tortu (
1149
). Voudriez-vous tre un matre archer ? Ne vous souciez
daucune rgle technique. Passez deux ans couch sous le mtier tisser de
votre femme, et forcez-vous, quand la navette les frlera, ne pas cligner les
yeux. Puis, pendant trois annes, occupez-vous uniquement faire grimper sur
un fil de soie un pou que vous contemplerez, face la lumire. Quand le pou
vous apparatra plus grand quune roue, quand, plus grand quune montagne,
il vous cachera le soleil, quand vous verrez son cur, alors prenez un arc et
tirez hardiment : vous toucherez le pou juste au cur, sans mme effleurer le
fil de soie (
1150
). Le bon forgeron forge sans y penser ni se fatiguer ; le bon
boucher dcoupe sans y penser ni mme user son couteau : lun et lautre
dcoupe ou forge spontanment (
1151
).
Enseigner sans nulle parole, tre utile sans aucune intervention,
peu de gens y arrivent , et, pourtant, la suprme parole est de ne
rien dire ( autrui), lacte suprme de ne point intervenir (wou
wei) (
1152
).
Ne parlez pas ! Exprimez-vous sans parler ! Tel a parl toute sa
vie qui na rie n dit. Tel, de toute sa vie na point parl, qui nest
jamais rest sans rien dire (
1153
).
Celui qui parle ne sait pas , celui qui sait ne parle pas (
1154
).
Marcel GRANET La pense chinoise 315
La Sagesse, la Puissance ne peuvent se communiquer que par
lenseignement muet, qui, seul, respecte la nature des choses et lautonomie
des tres.
Le Saint ne sait et ne vit que pour lui, mais il enseigne tout et il sanctifie
tout. Il enseigne et sanctifie par un effet direct de son efficace. Entirement
introverti, il sabstient de toutes paroles ou actions particulires. Il nintervient
en rien (wou wei) (
1155
), Il se borne, tel le Tao, rayonner une vacuit propice
au dveloppement spontan de tous les tres.
Cette vacuit batifiante est, si je puis dire, latmosphre du
440
Paradis.
Ce sont des mythes sur lge dor ou les Terres des Bienheureux, qui servent
illustrer la morale et la politique taostes. Il est, vers le Nord-Ouest, un trs
lointain pays o
nexiste nul chef : (tout sy fait ) spontanment et voil tout ! On
ny connat ni lamour de la vie, ni la haine de la mort : aussi ny
a-t-il point de morts prmatures ! On ny connat ni laffection
pour soi, ni lloignement pour autrui : aussi ny a -t-il ni amour, ni
haine !... Ni nuages ni brouillard ny arrtent la vue ; ni tonnerre ni
clairs ny troublent loue ; ni le beau ni le laid ny corrompent les
curs ; ni monts ni valles ny gnent les pas... (
1156
).
Au temps jadis,
quand les hommes se comportaient naturellement ..., et quil ny
avait ni route, ni bacs... chacun restait chez soi sans savoir ce quil
y faisait ou se promenait sans savoir o il allait. Lon bfrait et lon
sesclaffait ! On se tapait sur le ventre et sbau dissait ! Et ctaient
l les seuls talents (
1157
) !
Les hommes pouvaient, en cet ge heureux, demeurer dans ltat
dinnocence. Ils vivaient, en effet, sans prendre contact avec le voisin, sans se
forger des dsirs artificiels. Ils restaient autonomes.
Satisfaits de leurs manires, paisibles dans leurs demeures ..., ils
mouraient de vieillesse sans tre entrs en relation mme avec
ceux dont ils entendaient le chien aboyer et le coq chanter (
1158
).
Quelques habitants de lEx trme-Sud conservent encore cet esprit
dindpendance et de simplicit.
Innocents et frustes, ils rduisent au minimum lgosme et le
dsir. Ils donnent, mais ne sollicitent rien en retour (pao) (
1159
).
Tels sont les principes de la vraie morale :
Soyez simples, soyez naturels ! Rduisez au minimum gosme
et dsirs !
ordonne Lao tseu et il ajoute :
Marcel GRANET La pense chinoise 316
Le sage conserve le gage du contrat, mais jamais ne rclame son
d (
1160
).
Sont pernicieuses et dgradantes toute socit, toute morale fondes sur le
respect dune hirarchie autoritaire, sur lexcution force des contrats, sur la
contrainte.
Autonomie sans nulle restriction, bonne entente toute spontane, voil, en
politique, le seul principe, lunique rgle en morale. Rites et rcompenses, lois
et chtiments, et (pis encore) service social et dvotion au bien public, ces
thses abominables de M tseu, des Lgistes, des disciples de Confucius,
morales du sacrifice, de la discipline, de lhonneur, voil do proviennent les
pires dsastres et lanarchie (
1161
).
441
Bties pour exploiter quelque passion,
ces fausses morales dchanent toutes les passions. Elles font rgner le got de
lintrigue, lesprit processif, la rage de dominer. Qui sing nie, pour en
profiter, susciter des dsirs artificiels et, pourtant, se propose de refrner les
dsirs, doit manquer son but. Pour avoir de bons soldats, vous glorifiez le
mpris de la mort ? Vous ferez-vous obir de vos hommes en menaant de les
chtier par la mort ? Vous crerez des brigands que vous neffraierez poin t. Ce
sont les lois qui font les criminels, les rglements qui provoquent lanarchie.
Qui suit la nature veut rester libre et, pour le demeurer, vite tout dsir. Cest
ainsi quon demeure innocent et inoffensif... Mais il ne peut y avoir que
misre, crime, dsordre, ds quon commence, en dformant la nature
humaine, opprimer lindividu (
1162
).
Loin, cependant, de professer un individualisme absolu, les matres
taostes rpudient les thories de Yang tseu : Tchouang tseu, qui attaque
frquemment Yang tseu, lui reproche (tout autant qu M tseu) dtre un de
ces ennemis de la nature qui encageraient volontiers lhomme comme un
ramier (
1163
).
Si ces attaques sont violentes, cest que lindividualisme d e Yang tseu na
point de contrepartie et que, de plus, il se rattache (tout comme le sectarisme
de M tseu) une tendance pessimiste. Yang tseu (
1164
) mprise la vie que les
Taostes sanctifient.
Cent ans de vie est un maximum ! On en passe la moiti, enfant,
tre port dans les bras et, vieillard, radoter. Lautre moiti se
partage entre le sommeil et ltat de veille, ce dernier occup,
pour la moiti encore, par la maladie, la douleur, le chagrin, les
peines, les disparitions, les pertes, les craintes, les inquitudes.
Dans les quelque dix ans qui peuvent rester, il ny a pas peut -tre
un instant qui nait son souci (
1165
) !
Cent ans de vie, cest bien trop supporter ! Pire serait la peine
prise pour faire durer la vie (
1166
) !
Yang tseu condamne les pratiques de la longue vie (kieou cheng), chres
aux Taostes. Cest sans nergie quil blme le suicide. On peut aller, dit -il,
Marcel GRANET La pense chinoise 317
jusquau bout de lexistence, qu and on se persuade que la fin en est
proche (
1167
).
Cette lassitude, qui exclut mme le dsespoir, soppose
442
nettement
lataraxie taoste. Elle part du sentiment que lhomme nest rien et ne peut
rien, que rien ne fait rien rien, quun isolement absolu est le lot de tous les
tres. Tout bonheur est vain, toute gloire vaine, toute sanction indiffrente.
Lou ou honni, chacun finit par la putrfaction, insensible la gloire ou au
blme (
1168
). Est-il plus pnible de passer la vie en prison, mains et pieds
garrotts, ou, pour viter les chtiments, de se priver soi-mme de tout (
1169
) ?
Nul ne peut faire mieux quobir sans joie ses instincts et aux
circonstances... Le berger ne saurait prtendre quil conduit le troupeau ; les
btes vont o bon leur semble et le ptre les suit. Le plus grand sage
narriverait pas imposer son vouloir un seul mouton (
1170
).
Il ny a pas de conducteurs dhom mes. Il ny a ni morale valable, ni
politique efficace. Ceux qui se prsentent comme des hros et prtendent se
sacrifier utilement au profit du bien public sont des imposteurs. Un des grands
thmes de la secte de M tseu tait la belle histoire de Yu le Grand, usant, au
profit de lEmpire, tout le poil de ses jambes, tous les ongles de ses
mains (
1171
). Quelquun de lcole demanda donc Yang tseu sil donnerait
un poil de son corps pour secourir le Monde. Il nobtint que cette rponse :
Le Monde, assurment, ce nest pas avec un poil quon peut le
secourir !
Mais, insista lautre, suppos quil puisse tre ainsi secouru, le
feriez-vous ?
Yang tseu ddaigna de rpondre (
1172
).
Il mrita ainsi dt re cit (tout au long de la littrature chinoise) comme le
type de lgoste. En fait, individualiste intransigeant, il stait simplement
refus avouer que, mme dans le domaine des actions magiques (ou des
mythes politiques), aucun tre pt rien faire qui ft efficient sur dautres tres.
Les Matres taostes chappent lindividualisme intgral de Yang tseu,
mais non pas seulement, comme pour le subjectivisme, en raison de leur thse
sur lunit de lUnivers. Ils ne sont aucunement pessimistes. Sils se dfendent
de tout orgueil humain, ils ont un vif sentiment de lgale dignit de toutes
choses. Toutes, obscurment, et le Saint, dans une illumination glorieuse,
participent de lefficace indfinie du Tao. Cest ici le moment de rappeler tout
ce que la
443
conception de Tao doit la notion defficience magique, de
redire que le Saint est lhritier des chamanes, de rpter, enfin, que toute
autorit sociale paraissait dpendre de la possession de pouvoirs
magico-religieux. Ni lide duvres p ies ni lide du Bien public ne
jouent le moindre rle dans la politique taoste. Tchouang tseu se gausse de
lentraide telle que M tseu la conoit. Elle aboutit faire dire, quand on tue
des brigands, quon ne tue point des hommes (
1173
). Pareils sophismes ne
Marcel GRANET La pense chinoise 318
servent qu justifier un despotisme cruel. Et, dailleurs, on ne fait son salut
quindividuellement. Admirez -vous les poissons qui, lorsque la scheresse
vide les ruisseaux, pensent se sauver en sentassant dans des trou s ? Au lieu
de se coller troitement pour se maintenir humides , ne feraient-ils pas mieux
de gagner, un par un, les eaux profondes ?... Le bel expdient que de se
baver les uns sur les autres (
1174
) ! Et certes, il nest pas plus sage de confier
son sort un prince qui croit gouverner en se proccupant des rites, des
prcdents, en demandant des conseils : tout cela a autant deffet quune
mante qui prtend arrter un char (
1175
). Aucun expdient politique nest
valable, mais il y a une Politique et il ny en a quune. Seul peut sauver les
tres celui qui fait son propre salut. Rien quen se sauvant lui -mme, il sauve
le Monde.
Parvenu se placer au centre de lanneau , il laisse saccomplir toutes
choses (
1176
), Il se voue luvre suprme qui est de sabstenir de toute
intervention (wou wei) :
Son savoir stend au monde entier sans quil pense rien par lui -
mme : son talent stend sans limite lIntrie ur des Mers sans
quil fasse rien par lui -mme (
1177
).
Il nourrit lEmpire. Il na point de dsir et lEmpire a de quoi se
suffire. Il ninter vient en rien, et les dix mille tres se transforment
spontanment. Il a la quitude dune eau sans fond et les Cent
Familles demeurent en paix (
1178
).
Identique la Saintet, lEfficace est exactement le con traire de lutilit
profane.
Seuls les arbres improductifs et dont le tronc se creuse, pargns par les
charpentiers qui nen pourraient rien tirer, grandissent, prosprent, deviennent
vnrables et finissent par se voir promus dieux du sol. Ils nont rien fait pour
obtenir cet honneur, et ils nen ont cure. Ce nest point leur saintet
444
officielle qui les protge. Leur longvit (leur saintet relle), ils la doivent
uniquement leur parfaite inutilit. Aussi inutiles, au sens profane, doivent se
montrer les hommes quon peut qualifier de gnies (chen jen) (
1179
). Un
sage, mme sil fuit au dsert, sy voit rejoint par des apprentis. Un ha meau se
forme vite autour de lui et lui doit sa prosprit. Voil donc que les villageois
veulent faire de lui leur dieu du sol. Les disciples se rjouissent. Le sage se
dsole... Il nignore pas quon na daction vritable que si lon na point de
succs (
1180
).
Pour pouvoir comme pour savoir, il faut tre entour dindiffrence et
sabsorber dans lindiffrence (
1181
). Ler mite, dgrad au rang de ministre,
peut, certes, se rfugier dans lextase. Pourtant, en laissant deviner sa
puissance, il a trahi la saintet (
1182
). Il et mieux fait de se suicider (
1183
). Une
indpendance absolue, une autonomie sans dfaillance sont les conditions de
Marcel GRANET La pense chinoise 319
lEfficace (
1184
). Pour tre vritablement utile au monde, il importe de
loublier et de ne songer qu subsister paisiblement.
Jadis Houang-ti dsira obtenir
la recette qui permet de matriser lessence du Monde de faon
seconder la bonne venue des moissons et nourrir le peuple, et de
se faire obir du Yin et du Yang de faon rconforter les
vivants... Si vous gouverniez ainsi le monde (lui dit un sage
vritable) les nues, avant mme de sassembler, tomberaient en
pluie ! Les plantes perdraient leurs feuilles avant quelles ne
jaunissent ! Et la lumire du Soleil et de la Lune aurait tt fait de
steindre.
Aprs tre demeur trois mois dans la retraite, Houang-ti se borna
questionner sur lart de
se rgler soi-mme afin de durer et de subsister.
Voil, lui dit alors son matre, la vraie question (
1185
) !
Lautonomie, la vie cache, la non -intervention sont les principes de
lEfficace, de la Majest, de lAutocratie.
Identifi au Tao par la pratique de la mditation solitaire, le Saint possde
la science des transformations (tsao houa) ; il pourrait faire tonner en plein
hiver, produire de la glace en t , mais il ne daigne utiliser son
pouvoir (
1186
). Mage dsintress, il laisse le Monde aller son train. Il lui
permet de subsister en demeurant lui-mme imperturbable. Il ne veut ni luser,
ni suser. Il se borne, pour le profit de
445
toutes choses, mais sans charit ni
orgueil, concentrer en lui-mme une intacte Majest. Cette Majest
souveraine ne se dpense au profit de rien, prcisment parce quelle est
indispensable lexistence de toutes choses. Elle ne dis tingue pas dun
Pouvoir pur, ni dune Connaissance intgrale (yi tche) (
1187
). Matre de
lUnivers, mais condamn rester matre de lui -mme, le Saint pourrait
choisir le jour de son apothose : il ny aurait alors point dhomme qui ne le
voudrait suivre ! Mais comment consentirait-il loccuper des tres (
1188
) ?
Le Saint, autocrate inconnu, fait son uvre sans que nul ne s en
aperoive, et cette uvre saccomplit sans quelle intresse en rien celui dont
elle mane. Sa Saintet lui suffit lui-mme et se suffit en soi. Il est, et
chaque chose conserve son essence propre. Il dure et la Nature subsiste.
Lidal politique des Matres taostes parat avoir t un rgime de
minuscules communauts paysannes. Dans une bourgade isole, un saint
(vnr comme un dieu du sol) peut, de la faon la plus modeste, exercer ses
pouvoirs indfinis. Tchouang tseu dclare que tout va bien dans lEmpire
lorsquon laisse libre cours aux traditions locales quil nomme les maximes
villageoises (
1189
). Cependant, en professant que le Saint sgale lUnivers,
que toute efficace est totale en soi et que le principe de la Saintet ou de
Marcel GRANET La pense chinoise 320
lEffi cace se trouve dans une autonomie absolue, les Taostes ont prpar la
thse autocratique dont sest rclam le fondateur de lEmpire chinois
Avide de frquenter les gnies, mais invisible ses sujets, Che Houang-ti
prtendait animer lEmpire par sa seule Majest (
1190
). Ceci ne lemp chait ni
dordonner, ni de svir : les Lgistes avaient su mettre profit lide de
non-intervention (wou wei) pour donner un fondement thorique la
conception de la loi, impartiale et souveraine (
1191
). Les Taostes dtestent
les chtiments, la contrainte, toute rglementation. Tout au plus accordent-ils
une valeur ces rgles souples et sorties naturellement de la pratique que
notent les maximes villageoises (
1192
). Et cependant, Tchouang tseu lui-
mme, cet ennemi dcid de toute intervention, se complat imaginer
quelques mesures un peu brutales. Il conseille
446
gentiment dobturer les
oreilles des musiciens, de crever les yeux des peintres, de briser les doigts des
artisans et, surtout, de verrouiller la bouche de tous les doctrinaires, ses
ennemis (
1193
). Supprimer tous les fauteurs dartifices, ce nest point, son
sens, intervenir. Si les saints du Taosme avaient consenti exercer leur
efficace pour restituer lge dor, le retour la nature se serait peut -tre fait
avec quelque rudesse...
Dissimuls sous llgance philosophique des Matres les plus anciens, le
plus ancien Taosme recouvre une mentalit religieuse, un esprit sectaire.
Tmoin ladage invoqu par Tchouang tseu : Supprimez les sages !
Expulsez les savants ! Et lEmpire sera bien rgl (
1194
). A la vrit, comme
dau tres doctrines mystiques, et dautant plus quil dfinit la Saintet par
lAutonomie, le Taosme, plus encore peut-tre quil na favoris
lautocratie, a encourag les mouve ments sectaires. Les matres anciens ne
montraient aucun respect pour les pouvoirs tablis. Ctait pour eux un
axiome quun prince ne se distingue pas dun brigand (
1195
). Et ctait aussi,
consquence directe de leur mysticisme, une vrit fondamentale que tout
individu, mme non noble, mme difforme, mme mutil aprs condamnation,
est aussitt quil a communi avec le Tao un Fils du Ciel (
1196
). Ce
principe pos, il tait tout aussi difficile au Taosme de fournir le credo dune
glise organise que dinspirer, sans retouches, une doctr ine constitutionnelle.
Hostile toute autorit constitue, le Taosme a inspir de nombreux mou-
vements sectaires sans que jamais une religion organise en soit sortie. Au
reste, la sagesse taoste est un quitisme, mais un quitisme naturaliste. Un
esprit trop exclusivement humaniste la dominait pour quelle ait pu
dvelopper le got dune science de la nature. En revanche et malgr le mpris
affect des matres anciens pour tout ce qui nest que technique , elle tait
destine entretenir et accrotre le prestige de tous les savoirs inspirs par la
magie.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 321
La vogue du Taosme ainsi que sa valeur comme source dinspiration
artistique (
1197
) sont attestes ds la fin du
447
IVe sicle avant J.-C. par les
posies attribues Kiu -yuan. Le Yuan yeou (la randonne lointaine) est le
rcit dbats extatiques accomplis sous la conduite dun Gnie et dun
Homme vritable qui mnent le pote jusqu la Ville de puret . Il y
est parl du Tao en des termes qui se retrouvent dans la Lao tseu et le
Tchouang tseu. Kiu -yuan, pote de cour, servit de modle, sous les Han,
Sseu-ma Siang-jou, autre pote de cour (
1198
), Celui-ci se plut aussi chanter
des randonnes extatiques. Il est clair que, dans lentourage des potentats, une
posie dinspiration taoste semployait magnifier des crmonies o lon
sefforait, ouvrant toute grande pour le Matre la Porte du Ciel , dexalter
sa Majest par une sorte dapothose mi -potique, mi-magique.
Le Houai-nan tseu tmoigne mieux encore des succs du Taosme dans les
milieux aristocratiques. Rien, dans cet ouvrage composite, ne donne penser
que, depuis Tchouang tseu, la mtaphysique taoste stait enrichie ou
renouvele. Le Houai-nan tseu (
1199
) est une sorte dencyclopdie o une part
fort large est faite aux savoirs les plus divers. Il fait voir que le Taosme,
remarquable ds le principe par son indiffrence tout dogme et sa facilit
prendre de toutes mains, soriente dcidment vers le syncrtisme, qui signale,
du moins en Chine, toutes les orthodoxies.
Cette propension lorthodoxie et au syncrtisme sexplique peut -tre par
un recrutement plus large des adeptes. Il semble que le Taosme ait bnfici,
plus encore que lcole de Confucius, de la ruine de lcole de M tseu
(accomplie ds la fondation de lEmpire). Telle est, appa remment, la raison du
renforcement de lesprit sectaire qui aboutit aux renouveaux taostes des
environs de lre chrtienne. Si mal quon connaisse ces renouveaux, il y
clate une religiosit, voire mme une tendance asctique qui contraste avec
lesprit du Taoste ancien.
Dans ce dernier, cependant, le dsir de propagande ne manquait pas au
point quon ne puisse trouver, chez Tchouan g tseu lui-mme, des concessions
surprenantes au traditionalisme religieux dont M tseu se rclamait. Tel, par
exemple, ce passage : Celui qui fait le mal la lumire du jour, les hommes
trouvent loccasion de le punir ! Celui qui fait le mal dans les tnbres, les
esprits trouvent loccasion
448
de le punir ! (Que toute action) soit connue des
hommes ou connue des esprits, voil qui doit inspirer la conduite, mme
quand on est seul (
1200
) !
On croirait entendre M tseu. Si cest Tchouang tseu qui parle ainsi, cest
quil ne ddaigne pas de ramener au Taosme tous ceux que la religiosit de
son adversaire pouvait attirer. Il apparat, en tout cas, que la croyance aux
rtributions ntait point entirement trangre la viei lle sagesse taoste. Elle
ne sest pas introduite dans le Taosme sous la seule influence du
Bouddhisme. Le Bouddhisme chinois doit au Taosme plus dides quil ne lui
en a apportes (
1201
), mais, ds le moment o le Bouddhisme sest introduit en
Marcel GRANET La pense chinoise 322
Chine, la tendance syncrtiste tait, dans le Taosme, suffisamment puissante
pour lui permettre de sinfoder nombre dides demi nouvelles pour lui.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 323
CHAPITRE IV
Lorthodoxie confucenne
449
Les attaques de ses adversaires le prouvent : sinon de son vivant, du
moins ds la fin du Ve sicle, le nom de Confucius tait clbre dans toute la
Confdration chinoise. La tradition veut que le Matre ait eu de nombreux
disciples. Soixante-douze, dit-on, avaient parfaitement compris les
enseignements du Sage. Sans doute firent-ils beaucoup pour propager la gloire
de leur patron. Il est moins sr quils aient t fidles lesprit de sa sagesse.
Quelques-uns des disciples de Confucius entrrent au service de princes
qui rgnaient dans la Chine du Nord-Est, principalement Lou, Tsi et
Wei. Leur carrire, mal connue, ne semble pas avoir t trs brillante. Ils
firent peut-tre figure de conseillers dtat, et il se peut quils aient eu des
disciples. Cest cependant dans un hameau form autour du tombeau du
Matre que se perptua la tradition confucenne. A la fin du Ve sicle, ceux
qui se rclamaient de Confucius apparaissent groups dans diverses coles se
rclamant du patronage de Tseu-kong, Tseu-yeou, Tseu-hia, Tseng tseu et
Tseu-sseu.
Ce dernier tait un descendant du Sage. On lui attribue la rdaction du
Tchouang yong et du Tai hio, et lon considre gnralement quune influence
taoste est sensible dans ces deux uvres. Cest faire remonter assez haut le
prestige des doctrines philosophiques attribues Lao tseu. Cest aussi
admettre quune tendance syncrtiste rgna dans lcole confucenne peu
prs ds sa fondation.
450
On admet encore que les premires gnrations de disciples, et
peut-tre Confucius lui-mme la fin de sa vie, sintressrent au Yi
king (
1202
). Dans lensemble des traits qui composent aujourdhui cet
ouvrage, on ne retrouve gure, en effet, que des proccupations morales et
politiques : celles-l mmes qui prdominrent dans le groupe confucen. Le
fait que, dans ce groupe, on se soit intress la divination et complu
commenter des signes ou des tmoignages naturels prouve suffisamment que,
loin de saccentuer, la tendance humaniste, caractristique de la rforme
confucenne, saffaiblissait.
Dautre part, la passion denseigner en commentant signale le
flchissement du got pour les formes pragmatiques denseigne ment
auxquelles Confucius dut apparemment son prestige. Le Matre avait essay
de faire reconnatre la valeur dune psychologie positive en habituant ses
disciples rflchir en commun propos dincidents journaliers. Ses
Marcel GRANET La pense chinoise 324
successeurs enseignrent en commentant les vers du Che king aussi bien que
les formules du Tchouen tsieou, les aphorismes chers aux devins tout comme
les adages des matres de crmonies. Ds la fin du Ve sicle, on pouvait les
accuser de ne sattacher qu un savoir livresque et de naccorder de valeur
quaux semblants rituels (
1203
).
En mme temps que sattnuait linspiration humaniste, saccroissait
lattachement un dcorum archasant. Plutt qu observer les
comportements de lhomme en cherchant af finer le sens de la dignit
humaine, les hritiers infidles du Matre semployrent subordonner
lensemble du savoir ltude des traditions rituelles. Ils semblent, dail leurs,
avoir russi dgager une notion destine un grand avenir : cest cell e de
sincrit (tscheng). Lhonnte homme doit en tout obir aux rites avec
scrupule et minutie. Il mrite quon le dise sincre si, chaque instant, pour
ses moindres gestes comme pour ses plus importantes actions, il puise son
cur (
1204
) dans laccomplissement des pres criptions rituelles.
Une morale de lintention vient ainsi sous -tendre le conformisme. Dans la
terminologie taoste, le terme cur voque la vie antrieure. Son emploi
par les ritualistes qui
451
se rclamaient du patronage de Confucius indique
un progrs important de la tendance syncrtiste qui favorisa la victoire de
lorthodoxie confucenne. Cest par sa thorie de lintention anoblissante
(leang sin) (
1205
) que Mencius procura un nouvel lan lcole confucenne.
I. Mencius : le gouvernement par la bienfaisance
Mencius (Meng tseu, fin du IVe sicle) (
1206
) parat avoir t le premier
crivain de talent qui ait expressment considr la doctrine de Confucius
comme la doctrine orthodoxe.
Il tait n, comme Confucius, dans la seigneurie de Lou (ou aux environs).
Il descendait, semble-t-il, de la famille princire de Lou. Orphelin sans
fortune, il fut lev par sa mre, femme prudente qui lon fait gloire du soin
quelle prit pour soustraire son fils aux mauvaises influences. Il frquenta
peut-tre lcole de Tseu-sseu, puis essaya de recruter quelques disciples.
Vers la quarantaine, il alla Tsi. Il compta quelque temps parmi les
acadmiciens que protgeait le roi Siuan (342-324). Il ny connut point un
succs assez grand pour y demeurer et partit rechercher la faveur de divers
potentats, les princes de Song, de Teng et de Wei. Il revint enfin Tsi, o le
roi Min lemploya peut -tre comme conseiller. Disgraci, il retourna dans son
pays natal. Il y demeura jusqu sa mort, entour de quel ques disciples, dont
un seul, Yo-tcheng Ko, eut quelque renomme.
Mencius lui-mme ne semble pas avoir joui dun grand crdit auprs de
ses contemporains. La gloire ne lui vint pas avant le moment o la dynastie
des Han sappliqua justifier les institutions impr iales en favorisant
Marcel GRANET La pense chinoise 325
lorthodoxie. Cest alors que la thorie du gouvernement par la bienfaisance
esquisse par Mencius fut reconnue comme le fondement de la politique
officielle.
Luvre de Mencius, assez brve, parat avoir t transmise sans grand
dommage. Elle est dune lecture facile. Brillant crivain, Mencius est plutt
un polmiste quun penseur. Il se plat se mettre en scne, discutant avec de
grands personnages (
1207
). Il se prsente comme un homme qui se serait
452
donn la tche de publier les principes de Confucius afin dempcher que les
paroles de Yang tseu et de M tseu (ne) remplissent le Monde (1208). Il
dfendait la sagesse confucenne en la dfinissant comme une sagesse de
juste milieu, galement distante de deux utopies pernicieuses. Mencius est un
politicien, et il argumente en rhteur : les adversaires quil attaque de front ne
sont point ceux quil dsire surtout atteindre. Ses vritables adversaires, ce
sont les Lgistes. Au gouvernement par les Lois, il oppose le gouvernement
par les Sages.
Les adeptes du Tao et, mme, les sectateurs de M tseu ne pouvaient avoir
de sympathie pour une doctrine niant la valeur de la sagesse. Mencius
sadresse eux pour les r allier. Il ne sen prend qu ce quil peut y avoir
dextrme dans leurs propres tendances. Il essaie de les dtourner en les
dgotant soit de lindividualisme pur (quil leur prsente, chez Yang tseu,
comme un gosme grossier), soit du fanatisme et du ne dvotion sectaire au
Bien public (en accusant M tseu de nier la valeur des sentiments
domestiques). Il crit donc (se souciant fort peu dtre juste) :
Yang tseu part du (chacun) pour soi. Sarracher un seul poil
lavan tage de lEmpire, il ne la urait pas fait. M tseu, (cest)
laffection qui ne distingue pas : se faire broyer (du) cou (au) talon
lavantage de lEmpire, il laurait fait.
Ceux qui quittent M tseu vont Yang tseu, ceux qui quittent
Yang tseu M tseu. Il faudra bien quils viennent aux Lettrs
(jou : les tenants de Confucius) (
1209
) ! Il ny aura qu les
accueillir. Ceux qui discutent avec les disciples de Yang et de M
sont comme ceux qui, pourchassant un cochon quand celui-ci est
dj dans l table, continuent lappeler et le poursuivre (
1210
).
Mencius, au lieu danalyser criti quement les thories, prfre en appeler
au sentiment. Il fait honte un disciple de M tseu de lavarice quil y a
enterrer chichement ses parents : nest -ce point par eux que laffection
commence ? Voil lhomme tout aussitt ramen aux bonnes ides (
1211
).
Afin de rallier ses adversaires, Mencius leur emprunte largement. Son
orthodoxie est base de syncrtisme.
Les Lgistes nattendent rien de la bonne volont des hommes et tout de la
seule contrainte. Mencius
453
contre-attaque en empruntant aux
Taostes (
1212
) leur optimisme. Il affirme que lHomme grand (le ta jen) est
Marcel GRANET La pense chinoise 326
celui qui na point perdu son cur de nouveau -n (
1213
). Seulement, quand il
parle ainsi, il ne songe point la simplicit native que toute civilisation
dforme (
1214
). Il veut dire : seul lHomme grand (c est --dire celui qui ne
travaille pas avec ses muscles, mais avec son cur : celui qui vit
noblement) (
1215
), peut, loppos des petites gens (siao jen), car il
chappe toute activit intresse, dvelopper librement des sentiments
naturels de bienveillance et de compassion. La morale de Mencius est une
morale (aristocratique) du cur.
Il nest personne qui, sans mme penser la rcompense ou lloge, ne
voudrait sauver un enfant tomb dans un puits (
1216
). Tous les hommes ont
un cur compatissant . Tel est le principe du jen (de lamiti entre
humains), tandis que le principe de lquit ( yi), du sens rituel (li), du
discernement (tche) se trouve dans la sensibilit du cur la hont e, la
modestie, lacquiescement ou la contradic tion (
1217
). Ces principes,
communs tous les humains et qui permettent de dire que lessence de
lhomme est bonne ( chan) (
1218
), ne se dveloppent de faon noble et insigne
(leang), constituant alors les quatre qualits fondamentales, que si on les
cultive. A ltat fruste, ils ne permettent mme pas de servir les parents .
Nourris, et mus en jen, en yi, en li et en tche, ils permettent de prserver de
tout mal le monde entier (
1219
).
Les hommes, selon quils nourrissent en eux ce qui est grand et noble ou
petit et vil, sont des Hommes grands ou de petites gens (
1220
). Cest seulement
chez les Hommes grands que les qualits deviennent excellentes (leang).
Lexcellence du cur dpend de lducation et celle -ci du statut de vie. Dans
les annes heureuses, les gens du peuple sont honntes pour la plupart ; la
plupart deviennent violents dans les annes mauvaises. Ce nest pas que le
Ciel leur ait dparti une toffe diffrente, mais (dans le second cas) les
conditions de vie ont suffi dgrader le cur (
1221
). Certes, daucun cur
humain ne sont absentes les dispositions amicales et quitables (le jen et le yi).
Pour que les hommes perdent lexcellence du cur, il faut quils soient
comme
454
les arbres sous la hache. Mais encore est-il ncessaire, pour que
les arbres croissent, que, jour aprs nuit et nuit aprs jour, pluie et rose les
humectent. Sans nourriture convenable, il nest rien qui grandisse (
1222
).
Lexcellence du cur (le leang sin) nest point inne, au sens exact du mot.
Elle rsulte de la culture dun germe de bont, telle une semence dorge qui
profite dun bon sol, dune anne heureuse (
1223
) Lhonnte homme, le kiun
tseu, lhomme cultiv, peut seul mener la noble vie qui fait fleurir une noble
nature. Tous ses actes sont inspirs par lintention danoblir son cur (
1224
).
Mencius ne se borne point aiguiller vers un idal de culture humaniste la
tendance un optimiste naturaliste si profonde chez ses compatriotes (
1225
).
Aprs avoir tir les Taostes vers Confucius, il travaille encore entraner
auprs du Sage les disciples de M tseu.
Marcel GRANET La pense chinoise 327
Ces derniers attribuaient une grande importance aux conditions matrielles
de la vie : cest par l quils se rappro chaient dangereusement des pires
ennemis des Lettrs, les Lgistes. Comme les Lgistes, et cest l, dans
lcole confucenne, sa principale originalit, Mencius sint resse
lconomie. Seulement, il sy intresse avec des proc cupations morales, tout
comme M tseu, et, tout comme M tseu, afin de dfendre une utopie
conservatrice. Il conseillait aux Princes de restaurer le systme tsing (
1226
), de
supprimer la proprit individuelle et limpt, de partager priodiquement les
terres et de ne rclamer que des corves ou une dme, de supprimer les
douanes, et dimposer, non des taxes sur les marchandises, mais une simple
patente sur les talages des marchs (
1227
).
Mencius tait hostile au rgime des Tyrannies et toutes les innovations
qui servaient aux Lgistes introduire en Chine lide de Loi et lide dtat.
Il ne concevait point dautre gouvernement que celui o le conseiller est, non
pas un technicien, mais un homme cultiv.
Seul, lHomme grand peut redresser ce qui est mal dans le cur du
Prince (
1228
). Aussi, avant toutes mesures conomiques, Mencius rclame-t-il
du souverain qu il honore les sages et emploie les habiles (
1229
)
cest --dire les lettrs quinspire lenseignement confucen sur le jen et le yi.
Et, de mme, quand il prconise le systme de la tenure commune
455
et du
travail collectif sur le champ rserv au Prince, il ajoute tout aussitt que le
premier devoir du seigneur est lentre tien des coles. Les coles ont pour
unique tche de faire comprendre les (cinq types de) relations entre hommes
(celles de seigneur vassal, de pre fils, dan cadet, de mari femme,
dami compagnon). Cet enseignement doit suffire faire rgner dans le
petit peuple laffection mutuelle (
1230
) et affermir le pays . Il tend
refrner lesprit de vagab ondage propre aux petites gens, toujours prts
senrler dans les sectes ou les associations de bri gandage. Cest l le pire
dsastre, celui quon doit craindre dans les annes mauvaises o les gens (en
dpit de leur bonne nature) deviennent violents . Telle est la faon de se
conduire (tao) des gens du peuple. Quand ils ont des moyens dexistence
assurs, ils ont le cur assur. Mais sans moyens assurs dexistence, point de
curs assurs. Quand les curs cessent dtre assurs, il ny a point de
divagations et de licences o le peuple ne se laisse aller. Il sengage dans le
crime. Mais si, alors, on poursuit et punit, cest prendre le peuple au
filet (
1231
).
Voil lhumeur punisseuse des Lgistes proprement criti que. Et voici
affirms les bienfaits de lenseignement confu cen : Navoir pas de moyens
dexistence assurs, et garder un cur assur, cest ce dont seuls sont capables
les nobles (che, quivalent de jou, lettrs) (
1232
). Le prince, bien conseill,
qui pratique le jen et ne laisse point ses lgistes prendre le peuple au filet, doit
procurer ce dernier la subsistance et linstruction. Le principe du
gouvernement doit tre la bienfaisance, son objet lanoblissement du cur des
Marcel GRANET La pense chinoise 328
petites gens, cependant que la culture morale a pour fonction daffer mir en
chaque homme lintention de sanoblir.
Tel est le biais par lequel, tout en essayant de dtourner ses contemporains
de la dmagogie sectaire de M tseu et de ruiner linfluence des techniciens
du gouvernement par les lois, Mencius sefforce de pousser les despotes
clairs (ming kiun, ming tchou) (
1233
) patronner les enseignements
orthodoxes.
Les ides de Mencius ont moins doriginalit que dastuce. Peut-tre est-ce
pour cela et pour leur manque de prcision
456
(propice aux commentaires)
quelles ont obtenu la clbrit. A vrai dire, ce qui a fait la gloire de Mencius,
ce ne sont pas ses thses rhtoriciennes, mais son attitude.
Il a t le premier champion de lorthodoxie. Il a t aussi le premier
polmiste qui ait su prsenter sous des couleurs dmocratiques une morale
desprit aristocratique, le pre mier aussi qui ait su se servir de la sophistique
pour clore la bouche aux tyrans en faisant sonner haut de vieux prin-
cipes (
1234
). Il a proclam que ceux qui travaillent avec leur esprit (sin, cur)
doivent tre entretenus par ceux qui travaillent avec leurs muscles et quils
doivent les gouverner (
1235
). Il a t le premier des lettrs. Et il en a fix le
type.
Toujours prt faire de courageuses rprimandes, mais ne sollicitant
jamais un entretien, ne faisant jamais le premier pas et exigeant toujours dtre
invit dans les formes, acceptant volontiers une charge, mais refusant les
simples cadeaux, fier, dsintress, soucieux dhonneur et dind pendance, le
lettr doit, par toute son attitude, inspirer tous le sentiment que nul, ft-il
prince, nest suprieur au Sage.
II. Siun Tseu : le gouvernement par les rites
Siun tseu nest pas, comme Mencius, ce quon appelle un brillant crivain.
Cest en revanche un penseur original et profond. Il a subi, lui aussi, des
influences diverses. Il na pas cherch les concilier astucieusement. Il a s u
en tirer un systme parfaitement cohrent. Il a dfendu, il a consolid dans le
Confucisme le sens du social et lesprit positif.
Siun Kouang (ou Siun tseu, parfois appel Siun -king : Siun le ministre,
parce quil reut la cour de Tsi un titre honor ifique) descendait dune
puissante famille apparente aux seigneurs de Tsin. Sa vie est mal connue. Si
lon savi sait dutiliser les donnes historiques contenues dans la courte
biographie que Sseu-ma Tsien lui consacre (
1236
), on se trouverait amen lui
attribuer prs de cent cinquante ans dexistence. Il semble quil soit mort, trs
g, vers 328-325. N dans le pays de Tchao, il visita la plupart des grandes
cours, celles de Tsi, de Tsin et de Tchou . Vers
457
la fin de sa vie, il tait
Marcel GRANET La pense chinoise 329
la tte dune cole florissante, soccu pant principalement denseigner la
technique rituelle. Les ditions actuelles de son uvre contiennent 32
sections, dont 27 seulement (certains disent 4) seraient authentiques (
1237
). De
trs nombreux dveloppements nont quun intrt technique et certains
sentent lamplification scolaire. Mais Siun tseu a su condenser en quelques
passages vigoureux et brefs lessentiel de ses thses (
1238
).
Loriginalit de Siun tseu consiste dans leffort trs rfl chi, trs probe, qui
la conduit constituer une morale du perfectionnement ; cette morale desprit
positif et de tendance librale est entirement commande par un rationalisme
humaniste.
Siun tseu doit beaucoup aux Lgistes et aux Taostes, dont il a voulu
dpasser lempirisme autoritaire et lesthtisme mystique. Il doit plus encore
aux traditions de sagesse de sa nation. Le got profond pour la mesure, la
rgle, lintel ligibilit qui anime tous ses compatriotes lui a donn llan. Il est,
cependant, le premier avoir mis au centre de lintrt philosophique la
Raison (Li). Il voit tout ensemble dans la Raison un produit de lactivit
sociale des hommes, car lesprit co nfucen linspire plus encore que
lesprit des Lgis tes et un principe dobjectivit, car il utilise les thses
de Tchouang tseu, mais sans accepter de reconnatre dans le Li ce germe
duniverselle indtermination qui, pour les Taostes, constitue le ssence du
Tao.
Comme les Taostes et les Lgistes, Siun tseu part de lopposition du naturel
et du social. Il ne fait, au rebours de Mencius, aucune concession au Taosme
sur le point fondamental : il se refuse identifier bont et nature. Il sy refuse
non point par pessimisme, mais, tout au contraire, parce quil se fait une trs
haute ide de la civilisation, une trs haute ide du rang que la socit a
permis lhomme dattein dre dans la nature.
Les lments (lEau et le Feu) ont le ki (souffle) sans avoir la Vie ; les
vgtaux ont la Vie sans avoir la Connaissance (tche) ; les animaux ont la
Connaissance, mais non (le sens de) lquit ( yi) ; les hommes ont le Souffle,
la Vie, la
458
Connaissance et, de plus, lquit (le sentiment du tien et du
mien). Aussi sont-ils ce quil y a de plus noble dans le monde. La force des
hommes ngale pas celle des buffles, ni leur vitesse celle des chevaux :
buffles et chevaux sont cependant leur service. Pourquoi ? Cest que les
hommes savent former une socit (neng kiun) et que les autres btes ne le
savent pas. Et pourquoi les hommes savent-ils former un socit ? Cest quils
savent procder des rpartitions (neng fen). Mais ces rpartitions (fen),
comment peuvent-elles se faire ? Grce lquit ! Quand lquit prside
aux rpartitions, il y a bon accord. Du bon accord procde lunit et de lunit
labondance de force. Cette abondance de force donne la puissance et celle -ci
permet (aux hommes) de matriser (toutes) choses. Ils ont donc des demeures
o ils habitent ; obissant lordre des saisons, ils gouvernent les dix mille
tres et font impartialement du bien (kien li) (
1239
) au monde entier. Tout cela,
Marcel GRANET La pense chinoise 330
ils lobtiennent grce lquit des rpar titions (fen yi). Les hommes ne
peuvent vivre sans former de socit. Mais, sils se formaient en socit, sans
procder des rpartitions, il y aurait dispute, anarchie, sparation et par
suite faiblesse. Or, rduits cette faiblesse, les hommes ne matriseraient point
les choses (
1240
).
Cest donc la socit qui est le principe de lminente dignit des hommes,
la condition de toute vie sociale tant (non pas tout fait la division du
travail), mais le partage des attributions (fen), cest --dire des rangs en mme
temps que des emplois, des biens en mme temps que des dignits. Cette
condition premire de la vie sociale dtermine lobjet de la socit qui nest
point, comme des Lgistes le donneraient croire, la simple matrise sur les
choses ou la puissance des groupements humains. Cet objet, cest la consti -
tution dune activit proprement morale. Pour quil y ait socit, et non pas
rassemblement anarchique, il faut que les hommes acquirent la sagesse qui
fait accepter la distinction du tien et du mien. Il faut quils pratiquent le Yi
(lquit). Ils ne le feraient point, livrs leur seule nature. Ils sy rsol vent
sous lempire de ce corps de conventions que sont les Rites ( Li).
La puissance des socits et la valeur morale des tres humains ont un
fondement commun non point naturel,
459
mais ajout la nature : la
civilisation, invention des Sages, invention humaine, sortie des ncessits de
la vie sociale. Ce nest pas dans la nature quest l e bien ; cest la socit qui le
produit.
Tel est le sens de la clbre thse de Siun tseu : La nature humaine est
mauvaise ; ce quelle a de bon est artificiel ( wei). Il faut entendre, non que
cette nature est mauvaise foncirement, mais que le bien y est un apport, un
perfectionnement (
1241
).
Le mal dont parle Siun tseu nest pas un vice mtaphysique, ou le contraire
dun Bien hypostasi. Ce nest que lgosme, la tendance ne point cder,
lapptit qui veut accaparer, le dsir qui dresse le moi c ontre lautrui et tourne
en violence ds que sa satisfaction lui est soustraite (
1242
). Ce nest pas non
plus un mal matriel. La socit ne le supprimerait point si elle se proposait
simplement de matriser les choses afin daugmenter les possibilits de
satisfaction. Cest un vice psychologique dont la civilisation tire, par artifice,
un certain mieux, car elle apprend non pas supprimer (Siun tseu nest pas,
comme M tseu ou Lao tseu, un sectaire triste ou un mystique) mais
discipliner et duquer les apptits. Loin dtre un ennemi des arts, Siun tseu
croit donc leur vertu. Fidle la tradition confucenne, il voit dans la
musique et dans la danse mieux que de simples divertissements. Il y voit une
sorte dentranement la bonne entente. Dan ses et chants ( condition de ne
point tre nervants et dissolus, comme les airs du pays de Tcheng)
entretiennent la concorde humaine (
1243
). Les ftes, ds quelles sont
ritualises, assagissent lapptit des liesses, la passio n du jeu (
1244
). Mais, pour
les apptits les plus brutaux, il faut une discipline constante. Lart suprme qui
Marcel GRANET La pense chinoise 331
y pourvoit, cest ltiquette. Les rites ( li) peuvent seuls faire natre et
prosprer lesprit dquit ( yi). Cest par le bien faire que se cre le bien tre.
Tous les hommes prouvent des dsirs et tous prouvent les mmes dsirs :
manger, se rchauffer, se reposer. Tous les hommes sont, par essence (sing),
pareils : voici le mal (
1245
).
Les rites, voil lartifice do procde le bien. Les rites, en
460
effet,
permettent de faire accepter aux hommes une rpartition conventionnelle des
emplois et des ressources.
Cette rpartition, qui spcialise les apptits et qui les dose, a un premier
mrite : sans elle, il ny aurait aucun moyen de satisfai re les besoins. Quelle
est lorigine des rites ? Les hommes naissent avec des dsirs. Ces dsirs, ils ne
peuvent les raliser, et il ne se peut pas quils ne cherchent point ( le faire).
Sils le cherchent sans quil y ait des rgles et des mesures dans les
rpartitions et les partages, il ne se peut pas quil ny ait point de disputes. Des
disputes sortent lanar chie, de lanarchie lpuisement (des biens). Les
Anciens Rois dtestaient lanarchie. Ils institurent donc les Rites et lquit
(li yi), afin de procder des rpartitions (fen), de faon satisfaire les dsirs
des hommes et donner ( chacun) ce quil recherchait. Ils firent en sorte que
les dsirs ne fussent point limits par les choses, ni les choses puises par les
dsirs, mais quil y et (au contraire), des deux parts, un dveloppement
symtrique (
1246
).
Ce passage, que suit lnonc de diverses rgles protocolaires,
prsente un double intrt. Il montre que, pour Siun tseu, la rpartition
dactivits qui fonde lordre social consiste moins distribuer le travail qu
distribuer emplois et honneurs. Joint la spcification des dsirs, le dosage
protocolaire des apptits, en premier lieu, soppose lpui sement des choses
par les hommes et, en second lieu, contribue, dabor d en singularisant, puis en
hirarchisant les individus, un dveloppement des personnalits qui fait
enfin surgir le sentiment de la dignit humaine.
Dautre part (cest l son intrt principal), ce passage fait apparatre la
vertu premire dune rpartition des emplois. Sil sort delle un bien faire qui
provoque un mieux tre, le principe du progrs tient au caractre absolument
conventionnel de la rpartition. Dune masse dhommes galement mdiocres,
en eux-mmes, en raison de la vulgarit de leurs apptits identiques dans le
principe, la socit fait sortir, par dcret, une hirarchie de personnalits
anoblies, en proportions ingales, par lemploi dont elles se trouvent investies.
Ce sont donc de simples conventions sociales qui, elles seules, crent du
mieux dans lhomme, ce mieux se ralisant, en chacun deux, du seul fait que
les rites lobligent
461
bien faire, cest --dire conformer sa conduite son
emploi et au rang, la dignit que cet emploi confre.
Siun tseu a donc prouv sa thse. Le bien qui est dans lhomme nappartient
pas sa nature : il nappartient pas lessence commune tous les humains
Marcel GRANET La pense chinoise 332
(sing). Le bien sort dun perfectionnement impos par la socit, seule
capable de tirer de lhomme brut des individualits morales.
Siun tseu croit la perfectibilit de lindividu, de mme quil croit aux
progrs matriels que la vie sociale permet de raliser. Seuls, cependant,
comptent vritablement pour lui le perfectionnement moral et lentranement
individuel au bien agir et au bien penser. Mais tout individu ne peut
sentraner au bien quen se pntrant de li et de yi : en apprenant respecter
la hirarchie des fortunes, des dignits, des talents. Le principe du
gouvernement se confond avec le principe de lducation : on gouverne
laide des rites, car cest laide des rites quon duque. Chaque homme
samliore par le seul fait quil connat les bienfaits de la rpartition
conventionnelle tous impose par la socit. Il convient pour cela quil se
soumette aux rgles protocolaires dcoulant de cette convention
fondamentale. La culture individuelle a donc pour condition lacceptation
dun conformisme moral et dun conformisme social.
Aussi Siun tseu est-il accus bien souvent davoir intro duit dans la tradition
confucenne un esprit conservateur auquel, grce la thorie du jen,
Confucius chappait (
1247
). Pour le Matre, la dignit dhomme sacquiert
grce la rflexion morale librement pratique dans un groupe damis. Siun
tseu parat se faire une conception moins librale de la culture. Mencius
nomme quatre vertus essentielles : le jen, le yi, le li et le tche (
1248
). Siun tseu,
omettant (en apparence) le jen et le tche, les dispositions amicales et le
discernement moral, ne conserve que le yi et le li. Mais le li-yi dont il fait le
principe de tout bien, le conoit-il, la manire de Mencius, comme un
principe interne ? On lui reproche den parler sur le ton dont les Lgistes,
empresss nutiliser que des rgles objectives (fa : loi) parlent de lquerre
ou du compas (
1249
). Siun tseu crit, en effet : Il faut prendre pour rgle ce
que nul ne peut fausser (
1250
). Et il adopte pour les
462
Rites la dfinition
que les Lgistes donnent des Lois. Cest dans le cordeau quest la perfection
du droit... dans lquerre ou le compas quest la perfection du carr et du rond.
Cest dans les Rites quest la perfection de la conduite humaine (
1251
). Siun
tseu croit la ncessit de rgles objectives.
Il ne fait pas cependant sortir le bien de la simple coercition. Il na
nullement du bien moral ou mme du bien social une conception strictement
autoritaire, rigide et mcanique. Une pice de bois qui est courbe doit tre
assouplie et redresse pour devenir droite ; de mme la nature humaine qui
nest point bonne doit subir laction des Matres et des Rgles ou des
Modles (fa) (
1252
). Le moyen le plus expdient pour se cultiver est
dentrer en relation amicale avec un Matre. Se plier aux rites vient
ensuite (
1253
). Le Matre joue le rle de lartiste ; les Rites, celui de lquerre
ou du cordeau. Mais do viennent les Rites ? Siun tseu oublie rarement de
rappeler (
1254
) que ce sont les Anciens Rois ou les Sages qui, procdant la
rpartition conventionnelle des emplois, ont institu le li yi. Les rgles
ncessaires lducation morale (comme au gouvernement) sont objectives
Marcel GRANET La pense chinoise 333
sans tre extrieures lhumanit. Elles sont imprieuses, mais nexercent
point une action coercitive ou mcanique. La civilisation, qui conditionne les
perfectionnements individuels, repose sur un effort de perfectionnement
collectif matriel et moral. Cest elle qui, en fournissant des rgles
objectives (le li-yi), prside, par lintermdiaire du Matre, au progrs du bien
dans chaque homme et, par suite, la formation dans tout individu du
discernement moral et de la Raison (li).
Le vrai na pas une autre origine que le bien. Il chappe au vulgaire, aux
petites gens (siao jen), car ce quils coutent par loreille leur sort par la
bouche . Seul le Saint possde le calme intrieur qui permet de fixer dans
le cur, de rpan dre dans les quatre membres (dassimiler ltre
entier) (
1255
) les enseignements qui feront de lui un matre et un modle.
Le seul enseignement qui soit essentiel est celui de la bonne tenue (
1256
). En
effet, celui-l (seul) qui demeure dans la limite des rites est capable de bien
penser et de rflchir . Et, inversement, celui-l seul qui est capable de
rflexion et de fermet... est un Saint (
1257
) Autrement dit : seule la
463
perfection morale conduit la connaissance vraie (
1258
). La perfection morale
est un fruit de la civilisation ; de mme, connatre serait impossible des
hommes qui seraient demeurs frustes et simples. Si les hommes peuvent
atteindre le rel, ces t quils ont t civiliss par les Anciens Rois, par les
Sages (
1259
). Ceux-ci ont attribu chaque ralit (che) une dsignation
(ming) : cette dsignation est correcte (tcheng), car, par le seul fait quelle
rsulte dune rpartition, communment respect, des diffrents noms aux
diffrents tres, elle empche, dans la pratique sociale, toute erreur, cest --
-dire toute discussion (
1260
).
Siun tseu, quand il reprend la vieille doctrine des dsignations correctes,
prend soin dliminer tout ce quelle pouvait contenir de ralisme magique. Ce
qui constitue la proprit des noms, ce nest point une efficace qui leur per -
mettrait dappeler et de susciter le rel. Ils ne servent qu dsigner, mais ils
dsignent utilement. Lattribution des noms rsulte dune convention toute
arbitraire, laquelle, prcisment parce quelle est une convention sociale, sim -
pose tous et permet de sentendre.
Les noms ont tout justement les mmes mrites que les rites. Ils constituent
une symbolique qui vaut, pour les individus, comme une rgle. Rgle
objective, mais non pas extrieure. Les hommes raisonnent juste (de mme
quils agissent bien), ils apprennent bien penser (de mme quils appren nent
bien faire), ils progressent hors de la stupidit (de mme quils progressent
hors de luniformit, cest --dire du mal) en se conformant la symbolique
conventionnelle que forment les signes verbaux et les gestes rituels.
Rites et langage servent dabord, pratiqus correctemen t, supprimer les
discussions et les dsordres, les disputes et lanarchie. Pratiqus avec finesse
(et sous la direction dun Matre dont lenseignement pntre dans les quatre
membres , au plus profond de ltre), ils introduisent dans lesprit le cal me
Marcel GRANET La pense chinoise 334
quils font, dautre part, rgner dans la socit. De ce calme rsulte la
connaissance vraie : il est le signe que lesprit est entirement ouvert la
Raison.
Pour dfinir ce calme intrieur, Siun tseu se sert de mtaphores
taostes (
1261
), Il compare le cur humain un
464
bassin deau. Quand rien
ne lagite, la vase trouble demeure au fond. La surface, claire et brillante
(tsing ming) fait apparatre le moindre cil de qui sy mire (
1262
). Une clart
et une puret parfaites sont ncessaires au cur pour obtenir une
reprsentation entirement correcte des ralits. Tout ceci peut sexprimer en
disant que le cur doit, pour li miner lerreur, se maintenir vide, unifi, en
tat de quitude . Les remarques auxquelles succdent ces mtaphores prou-
vent que Siun tseu (avec une orientation tout autre et plus dcidment encore
que Tchouang tseu, dont les analyses lont sans doute aid) est un pur
intellectuel.
Ce quil entend signaler par le vide du cur, ce nest point le vide extatique,
mais un tat dimpartialit. Lerreur pro vient des jugements incomplets (
1263
)
que porte lesprit ( sin : cur) quand une passion lobnubile et lobstrue
entirement. Tel est le principe des critiques que Siun tseu adresse aux
doctrines de ses adversaires par exemple lorsquil reproche M tseu,
Houei tseu et Tchouang tseu, obnubils par la considration soit de lutile,
soit de lexprim, soit du naturel, davoir oub li la culture ou les ralits, ou la
civilisation. Siun tseu se refuse, en effet, distinguer les ides des sentiments
et le bien du vrai. Le jugement doit porter sur lobjet tout entier. Il na de
valeur que sil rsulte dun effort de synthse de lesp rit. Contrairement aux
Matres taostes, Siun tseu ne demande pas lesprit de refl ter passivement le
flux des apparences mouvantes. Ce quil appelle connatre est tout autre chose
que la simple perception de linstantan. Quand il parle de l unification du
cur, il songe une opration synthtique qui vient terminer une revue,
conduite, pour ntre point incomplte et partiale, avec lattention la plus
minutieuse. Le bourdonnement dune mouche peut, dit -il, troubler le
jugement. Lactivit de lesprit, telle quil la conoit, ne ressemble en rien
une mditation vagabonde ou un envol extatique. Elle doit consister en une
mditation rflchie, tenace, srieuse. Son objet est de dsobstruer lesprit
en rduisant lordre les passions partiales qui ferment la porte au Juge
suprme (Ta Li) .
Cest ainsi que Siun tseu appelle la Raison. Lexpression est significative.
Le mot Li, employ bien avant Siun tseu, pour
465
dsigner tout principe
dordre, soppose au mot tao (
1264
). Tao voque lide du Pouvoir souverain,
Li celle de ladminis tration de la justice, en mme temps que celle du
travail bien fini et fait en tenant compte de lajustement des parties au tout.
Siun tseu se refuse confondre la vrit avec une intuition instantane et toute
personnelle. Il croit quil y a des rgles pour juger, et que le maniement de ces
rgles sacquiert par lducation. Lindividu les possde aprs stre entran
faire un emploi correct, puis distingu, de la symbolique (rites et langage)
Marcel GRANET La pense chinoise 335
conventionnelle qui a apport de lordre dans la pense comme dans les
murs.
Lenseignement des rites, cependant, forme la partie essentielle du dressage
qui conduit les individus concevoir le bien et pratiquer le vrai.
La Raison (Li : Siun tseu crit avec respect : Ta Li), le Juge suprme,
permet au Sage, quand il se lincorpore, de connatre le Monde et de le
gouverner. Celui qui parvient lui ouvrir et lui faire possder
entirement son esprit, y fait entrer une clart, une puret parfaites . Des
dix mille tres, il ny en a aucun qui ne lui apparaisse et dont il ne puisse
estimer, sans se tromper, le rang (
1265
). Assis dans sa maison, le Monde lui
apparat (
1266
), et tandis quil demeure dans le prsent, il peut estimer le pass
le plus lointain. Il pntre les dix mille tres et connat leur essence. Il
examine lordre et le dsordre et comprend leur principe. Il dessine la trame et
la chane de lUnivers et distribue aux dix mille tres leurs fonctions. Telle
est la puissance de lHomme grand quanime la Raison.
Le vrai et le bien rgnent dans le monde si le Sage le gouverne,
cest --dire si le monde est rgi par les rites, par le li-yi o sexpriment,
ensemble, la Civilisation et la Raison.
III. Tong Tchong-Chou : le gouvernement par lhistoire
Linfluence de Siun tseu a t considrable. Elle a donn un renouveau de
vigueur ltude des rites. Cette vogue explique peut -tre le fait que (malgr
le ddain dont les
466
premiers Han firent preuve, pendant prs dun
demi-sicle, lgard de ltiquette) la littrature rituelle qui fleurit au IIIe
sicle avant J.-C. ait laiss dabondants souvenirs. La vogue une fois
retrouve, il fut ais de recueillir les lments dont sont forms deux des
classiques, le Yi li et le Li hi (
1267
). La lecture et le commentaire de ces Rituels
devinrent la base de lenseignement destin former des honntes gens et des
fonctionnaires. Bien plus, on shabitua ds lors lire lhistoire en se
proccupant dabord dexaminer les gestes des personnages anciens pour
dcider sils taient ou ntaient pas conformes ltiquette.
Cette collusion de larchologie et du ritualisme n tait aucunement
conforme aux ides de Siun tseu. Esprit positif et critique, traditionaliste
assurment mais non pas ractionnaire, Siun tseu, en bon intellectuel, se
mfiait des gots archasants et mme de lhistoire. Il sopposait Mencius,
pour qui le gouvernement du Sage devait ressembler celui de Yao et de
Chouen. Que peut-on bien connatre, disait Siun tseu, de ces antiques
hros (1268) ? Mais, une fois consolids au pouvoir, les Han cherchrent
justifier, par des prcdents, les institutions de ladministration impriale. On
se souvint que Confucius avait rdig le Tchouen tsieou, pesant chacun de
ses termes de faon quil contnt un juge ment, cest --dire un enseignement
Marcel GRANET La pense chinoise 336
rituel. Deux coles de commentateurs de cette vieille chronique, lcole de
Kong-yang et celle de Kou-leang, suscitrent une vive admiration. Les
querelles de leurs partisans prirent parfois lallure de joutes en Conseil
dtat (
1269
).
Alors parut la thorie du gouvernement par lhistoire, qui d evait donner une
orientation nouvelle la doctrine orthodoxe. De cette thorie, Tong
Tchong-chou fut lun des grands patrons.
467
Tong Tchong-chou (
1270
) est un rudit qui pensa russir dans
ladministration. Il nexera que d es charges secondaires et termina ses jours,
dans la retraite, en crivant. Il nous reste de lui trois importants discours et un
recueil dessais (quon croit authentiques pour la majeure partie) (
1271
) ; mais
le principal de son uvre consistait en comme ntaires destins illustrer lune
des interprtations du Tchouen tsieou, celle de Kong-yang.
Tong Tchong-chou, plutt quun penseur, est un person nage reprsentatif. Il
tait hostile aux Lgistes et partisan du gouvernement par la bienfaisance. Il
admettait que la nature humaine a besoin dtre perfectionne, que la musique
peut y aider, et les rites plus encore, et que, par suite, le premier devoir du
gouvernement est dinstruire le peuple. Ce devoir est dautant plus urgent que
les temps sont plus troubls. Il faut alors, pour refrner les tendances
populaires aux querelles et aux dsordres, restaurer les bonnes murs.
On peut y arriver en propageant la doctrine de Confucius et en rpandant les
six arts, cest --dire (1272) les enseignements des six livres canoniques : [Che
king (livre de la posie) ; Chou king (livre de lhistoire) ; Li king (livre des
rites : le Yi li ?), Yo king (livre de la musique, aujourdhui perdu) ; Yi king
(livre des mutations) et Tchouen tsieou (les annales)]. Mais il faut en outre
exterminer les doctrines htrodoxes et instituer un corps dinterprtes
officiels des classiques (
1273
),
Tong Tchong-chou, comme on voit, est rsolument orthodoxe. Il demandait
(et son conseil fut suivi par les Han) que, chargs denseigner par lexemple
les bonnes ides et la bonne conduite, les fonctionnaires fussent choisis parmi
les lettrs. Il exigeait deux un noble dsintressement. Les fonctionnaires ne
doivent ni rechercher la fortune ni, surtout thsauriser ; ils doivent, non pas
conserver leurs biens dans des coffres, comme font les petites gens , mais
faire circuler les richesses. Tel tait, aux temps fodaux, le devoir des nobles.
Les obligations des gens en place sont autres que celles des gens du commun,
disait Tong Tchong-chou. Il mrite dtre rang dans le groupe dhommes qui,
sous les Han, travaillrent crer une sorte de classe officielle vivant de la
propagation dune doctrine orthodoxe. Ni Confucius, sans doute, ni Siun tseu
nauraient voulu con fondre la sagesse avec un enseignement livresque et une
morale de caste.
Siun tseu et Confucius taient des moralistes desprit positif et de tendance
strictement humaniste. Tong Tchong-chou reprsente une tendance
Marcel GRANET La pense chinoise 337
politicienne. Aussi cet rudit sest -il surtout employ construire une
mythique qui facilitt la besogne gouvernementale et, plus encore le rgne,
dans ladministration, de la caste orthodoxe.
468
Le point de dpart de cette mythique est la vieille ide, sur laquelle
Mencius insista, que le Prince exerce son pouvoir sous le contrle du Ciel et
du peuple. Cette formule senten dait jadis avec le sens que linitiative
politique est limite par un ensemble de rgles traditionnelles pourvues dune
espce de prestige religieux. Mais, dune part, l es Lgistes ont fait voir que le
maintien des statuts coutumiers enlve lactivit sociale le rendement
effectif dont a besoin un grand tat et, dautre part, dans un grand tat, la voix
du peuple, qui est celle du Ciel, arrive malaisment au Prince. Les tenants de
lorthodoxie se rsignent, sans doute (il le faut bien) laisser ltat lgifrer
pour parer ses besoins nouveaux. Ils rclament, en revanche, pour les
fonctionnaires, qui doivent tre des lettrs : noblesse nouvelle dpositaire
des vieilles traditions, le privilge de contrler la pratique gouvernementale
en faisant entendre au Prince la voix de lancienne sagesse.
Dans ce cas encore, une pratique corporative se trouve lorigine dune
thorie. La pratique, cest le vieil usage de la r primande, devoir sacr du
vassal (
1274
). Le gouvernement par lhistoire, telle fut la thorie, laquelle visait
faire accorder aux lettrs au vaste savoir un pouvoir minent : le
privilge dune sorte de censure.
Cest en s e servant des prcdents, cest --dire grce une interprtation
des faits de lhistoire, quon justifiera, mais aussi quon pourra condamner les
dcisions du Prince et de ses conseillers. Ceux-ci et leurs dcrets se trouveront
jugs par le Ciel et le peuple, ds quun savant, ayant pro duit un fait
historique, laura interprt en montrant quel fut, jadis, dans une situation
dclare analogue telle situation actuelle, le jugement du peuple et du Ciel.
Cette thorie a eu une consquence grave. Elle a empch, en Chine tout
progrs de lesprit historique. Elle a conduit concevoir lhistoire comme un
amnagement du pass estim efficace pour lorganisation du prsent.
Les parties les plus curieuses de luvre de Tong Tchong -chou sont celles
o il nonce le principe qu chaque change ment de dynastie correspond un
reclassement des dynasties anciennes (
1275
). A ce principe se rattachent la
doctrine des Trois Rgnes et celle des Quatre Modalits. Les Quatre
469
Modalits correspondent quatre types dins titutions qui doivent se succder
comme se succdent les Saisons. De mme au Rgne Noir succde le Rgne
Blanc ; puis vient le Rgne Rouge ; aprs quoi reparat le Rgne Noir, chacun
entranant une formule particulire de civilisation. Toute cette scolastique de
lhistoire permet de reconstruire le pass avec une tonnante prcision. Tong
Tchong-chou nhsite point, en vertu dune sorte de dterminisme rebours,
prsenter comme le portrait vridique dun per sonnage rel le signalement
caractristique que, selon le Rgne ou la Modalit auquel on le fait ressortir,
un Fondateur de dynastie se voit imposer par la thorie (
1276
),
Marcel GRANET La pense chinoise 338
Cette construction fabuleuse, qui na pas d gaspiller ni gter faiblement
le folklore historique, se rattache, par lintermdiaire dune glose, un fait
insignifiant : un personnage secondaire du Tchouen tsieou tant dsign par
un certain titre, on voit dans ce titre (quon suppose donn avec intention) une
indication sur les principes de ltiquet te qui convenait rellement lpoque
Tchouen tsieou, ce qui permet de restituer dans sa correction vritable toute
lhis toire de la Chine antique, en justifiant, bnfice essentiel, telle rgle quon
voudrait bien voir applique dans le prsent (
1277
). On a dailleurs, en
dfinissant chaque Rgne ou chaque Modalit, trac le plan de gouvernement
qui simpose tel ou tel moment de lhistoire.
La thorie du gouvernement par lhistoire se rsume dans lide que
lhistoire et l e gouvernement dpendent de lart du Calendrier.
Cest grce cette ide que lorthodoxie sest enrichie dun lot de doctrines
et de techniques trs prospres non sans quun coup funeste ne ft port
lhumanisme de Confucius ou de Siun tseu.
Siun tseu mprisait la divination comme lhistoire. Il rpudiait les
spculations sur le pass, les dieux, le destin, linconnaissable. Il condamnait
la recherche des signes. Quant Confucius, il stait, dit -on, toujours abstenu
de parler des tres surnaturels et des prodiges. Mais cest le mtier des
Annalistes denregistrer les prodiges et les signes : le Tchouen tsieou
(rdig, disait-on, par Confucius)
470
en mentionne maintes reprises. Ayant
fait cette constatation, lcole de Kong-yang, Tong Tchong-chou en tte,
affirme que lhistoire permet de connatre les rgles de conduite du Ciel.
Lhistoire (celle des Annalistes) a pour premier mrite de rvler les
connexions des faits humains et des signes, clestes ou autres (clipses,
tremblements de terre, inondations, pidmies, famines, monstruosits de
toutes sortes...). Tong Tchong-chou, dit la chronique, pendant quil remplissait
les fonctions de grand conseiller dans la principaut de Kiang-tou, soccupa
expliquer, en se fondant sur le Tchouen tsieou, les dsastres, les prodiges,
laction du Yin et du Yang (1278). Ceci lui donna, parat-il, loccasion de
critiquer les actes du gouvernement imprial, et daccomplir ainsi noblement
son mtier de lettr (en substituant, en vertu de son rudition, sa voix celle
du peuple ou du Ciel). A offrir ainsi ses conseils, il russit sur linstant assez
mal, mais obtint une grande gloire. A la fin du sicle dernier (en 1893), un
rformateur chinois admirait en Tong Tchong-chou le plus grand des disciples
de Confucius. Sa doctrine lui paraissait capable de conduire la Chine sur le
chemin du progrs (
1279
).
Il est certain que Tong Tchong-chou contribua puissamment au succs de
lorthodoxie. Il lui rallia les adeptes des coles du Yin et du Yang, des Cinq
lments : tous les techniciens qui spculaient sur la Nature. Ces savants
jetaient dans le cadre du vieux systme de classifications tout le folklore, et ils
en faisaient sortir une scolastique. Cest cette scolastique, peine libre
Marcel GRANET La pense chinoise 339
de la magie, quinfidle la pense humaniste et positive de Confucius
lorthodoxie sallia.
*
* *
La solidit de lalliance saffirme au temps des seconds Han, avec des
uvres telles que le Po hou tong, rdig par Pan Kou (
1280
). Luvre de
Wang Tchong (le Louen heng), qui date sensiblement de la mme poque,
permet, dautre part, de constater les effets de lenseignement officiel (
1281
).
Wang Tchong naquit pauvre, le demeura, eut une carrire
471
trs mdiocre,
chappa lasservissement des honneurs, crivit librement. Toujours
caustique, parfois violent, il se plut passer en revue toutes les ides de son
sicle. Cest un esprit fort. Il ne cr oit ni aux dieux, ni aux esprits, ni aux
monstres, ni aux miracles. Les hros confucens ne lui en imposent gure, et
moins encore les saints taostes. Il na aucun respect pour lhistoire. Il ne
craint point de parler de lgendes truques, de textes falsifis. Il se mfie des
livres. Et pourtant tout son scepticisme a quelque chose de livresque. Lui qui
semble possder les plus jolies qualits de fantaisie et dentrain, il na gure
que des saillies de pdant. Il commente aigrement, mais ne fait que
commenter... Il ne sort point des textes et des scolies... Il use sa fantaisie
gloser sur des gloses...
Les commentateurs abondent en Chine partir du moment o lEmpire est
fond et o lOrthodoxie commence son rgne. Mais il faut attendre de longs
sicles avant quappa raisse nouveau un penseur original. Le Bouddhisme
ne sest acclimat en Chine quen devenant chinois : ce quil y a produit de
plus puissant, la doctrine mystique de la secte tchan, est une faon de
Taosme quune symbolique trangre d guise peine. Le Manichisme a,
peut-tre, exerc une influence plus active, si cest de lui que procde la
tendance dualiste, toute neuve en Chine, du rationalisme de Tchiu Hi. Cest
Tchou Hi (1130-1200), en effet, et lpoque des Song quil faut ar river pour
voir prosprer nouveau lactivit philosophique. Ce regain parat tirer sa
sve dun vieux fond : la philosophie des Song se rattache, sans doute avec
plus de fidlit quon ne lenseigne dordinaire, aux premires spculations
de la pense chinoise. Cette pense sefforce de nos jours de se renou veler.
Le contact de lOccident a donn llan. Cependant, lorsquil sagit
dacclimater chez eux des notions vraiment neuves, puisquelles sortent dun
mouvement scientifique tout nouveau en Occident mme, cest encore en
commentant ingnieusement les uvres de leurs vieux sages que les Chinois
les plus modernistes pensent y russir (
1282
).
On aurait tort de stonner de cette fidlit aux Anciens et des sommeils
apparents de la pense philosophique. La mditation est, pour les Chinois, un
jeu dont le thme
472
importe peu, mais cest le jeu le plus srieux du monde.
Leur pense joue, lance sur un thme de mditation, au moment o ils
Marcel GRANET La pense chinoise 340
peuvent paratre ntre occups qu gloser. Les ada ges du Yi king qui,
traduits, semblent dsesprment plats et vulgaires, nont jamais cess de
fournir, tels pour certains Occidentaux, les versets bibliques, un
stimulant pour la pense la plus probe et la plus libre. En Chine, en effet, la
pense nest point tendue vers la connaissance, mais vers la culture. On y
admet que tout ce qui est matire tude aide dvelopper la personnalit.
Cette amlioration de tout ltre par ltude, conue comme un jeu de tout
ltre, procure un sentiment, qui se suffit en soi, de libert et daccroissement.
Les anciens sages lont senti vivement et fort bien exprim. Aussi leurs
uvres ont -elles pu, pendant de longs sicles, suffire leurs compatriotes.
Constater le triomphe de lorthodoxie et un long arrt de la production
philosophique, ce nest point constater un endormissement de la pense.
Ddaignant toute science discursive et proccups uniquement de culture, les
Chinois purent se borner mditer ds que leurs Sages leur eurent appris
sentir que la pense est une source de libration.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 341
C O N C L U S I O N
473
Des thmes favorables une libre mditation, voil ce que les Chinois
demandent leurs Sages, et non pas des ides des dogmes, encore moins.
Peu importe sils cl assent parmi les Taostes ou les Confucens le Matre qui
veille en eux le jeu de lintelligence ; peu importe si les pratiques qui
prparent la libration de lesprit visent faire surgir limpression dune
autonomie inconditionne ou crer le sentiment de la dignit souveraine de
lhomme. Ni lobjet vritable de lentranement, ni mme lesprit des
mthodes ne diffrent. Il sagit toujours dun dressage de ltre entier. Quil
tende constituer en saintet ou en sagesse, quil se fasse au moyen de j eux
sanctifiants ou de rites anoblissants, ce dressage sinspire toujours dun dsir
de libration, et toujours il saccomplit dans un esprit de libert. Dans le
Taosme et le Confucisme, mme dgnrs en orthodoxies, mme quand des
intrts de secte ou de caste semblent pousser au rigorisme doctrinal, lesprit
de conciliation ne cesse point de dominer, et lclectisme demeure la rgle.
Lidal, dans les deux camps, est une sagesse complte. Si celle quon
propose ressemble davantage, chez les Confucens, une sagesse stocienne
(mais peu prs dmunie de religiosit) ou, davantage, chez les Taostes,
une sagesse picurienne (mais faiblement proccupe de science), lidal
commun est une entire connaissance ou plutt une matrise de soi.
Cette matrise de soi et la connaissance quelle apporte et de soi et du monde
(car lUnivers est un),
474
sobtient grce une libration des apptits et des
dsirs. Un sentiment exalt de puissance en rsulte. Ds quils se sentent les
matres deux -mmes, le sage confucen et le saint taoste pensent avoir
acquis, stendant tout lUnivers, une mat rise qui se suffit en soi. Elle a son
principe dans la pratique de rites quon accomplit de tout son cur ou de jeux
auxquels, de tout son tre, on se donne. Quon emprunte les modles rituels
la socit, ou, la nature, les thmes des jeux, cest l ch ose accessoire, et
cest chose accessoire que dinsister, quand on polmique, sur lexcellence du
conventionnel ou du naturel. Dans lentranement qui puri fie ou anoblit, ce qui
importe, cest un effort, intime et total pour chapper la servitude des
apptits. Quon les consi dre comme artificiels ou comme naturels, quon
pense revenir la nature ou slever au -dessus delle, quon la sanctifie ou
quon glorifie la civilisation, quon se rclame du naturisme taoste ou de
lhumanisme confucen, seul co mpte un effort libre vers la puissance pure.
Cest dun jeu profondment srieux, cest dun jeu pur, quon attend, conf -
rant saintet ou sagesse, une libration souveraine. Elle ne saurait rsulter
dune contrainte extrieure, mme simple ment dogmatique.
Les Chinois ont conquis leurs murs, leurs arts, leur criture, leur
Sagesse, lExtrme -Orient tout entier. Dans tout lExtrme -Orient, de nos
Marcel GRANET La pense chinoise 342
jours encore, aucun peuple, quil paraisse dchu ou quil senorgueillisse
dune puissance neuve, nose rait renier la civilisation chinoise. Celle-ci, quel
que soit lclat que la science exprimentale ait pu pr ter lOccident,
maintient son prestige : il demeure intact, bien que la Chine ait perdu la
supriorit que, jusqu la Renaissance, sur bien des points, en matire
technique, elle possdait sur les pays dEurope. Si grande quait pu tre,
jadis, en matire technique, la supriorit de la Chine sur tout
lExtrme -Orient, ce nest ni cette supriorit, ni mme la puissance de la
Chine impriale qui expliquent le prestige chinois. Ce prestige durable a
dautres fonde ments. Ce que les Extrme-Orientaux tiennent conserver aprs
lavoir emprunt la civilisation chinoise, cest une certaine entente de la
vie : cest une Sagesse. Lautorit morale de la Chine commence stablir
au moment o,
475
unifie sous forme dEmpire, elle est capable de faire
rgner au loin son influence. Cest ce mme moment que les Chinois
semblent se dcider adopter, comme rgle des murs, un conformisme
archasant et que (la production philosophique sarrtant ds que se trouvent
constitues deux orthodoxies complmentaires) ils semblent de mme se
rsoudre se confier uniquement la sagesse des Aeux. La civilisation
chinoise parat alors arrive la maturit. Quand on sest essay dcrire
le systme de conduites, de conceptions, de symboles qui semble dfinir cette
civilisation, peut-tre, linstant o on la montre prte dominer pendant de
longs sicles sur une immense masse dhommes, est -on tenu de dire en quoi se
rsume lautorit morale qui lui a t reconnue. On ne le fera point sans avoir
marqu combien il est prsomptueux de tenter de dfinir lesprit des murs
chinoises. La rgle imposant de faire passer lhistoire des ralits avant
lhistoire des ides et celle-ci avant lhis toire de la littrature, est plus
imprieuse dans le cas chinois que dans tout autre. Or, pour peu quon aborde
les choses de Chine avec quelque esprit raliste et un peu dimagina tion
critique, on doit reconnatre que tout ce que la Chine parat dcide laisser
voir delle nest que littrature... Sans doute, pour la nation comme pour
lindividu, lortho doxie sert-elle, ainsi que le conformisme, abriter une vie
profonde... Tout ce qui constitue le fond vivant de la civilisation chinoise,
la vie technique, le folklore, demeure dissimul sous un revtement
damplifications litt raires... Ceux que peuvent rebuter ces commentaires flat-
teurs danciens commentaires avantageux se livreraient assurment une
plaisanterie malveillante sils se laissaient aller comparer ces gloses desprit
officiel aux rclames qui ne dissimulent rien, sauf les secrets de fabrication...
Toute civilisation a besoin dune certaine inconscience et droit une sorte de
pudeur... Mais le fait est que rien ne permet, sinon par effraction, de pntrer
la vie relle de la Chine... Pour lindiscret, les chances de bon accueil sont
nulles, et rares (malheur plus grand) les occasions de tomber juste et de voir
clair. Sil faut donc, pour conclure , essayer dindiquer les traits les plus
remarquables de la civilisation chinoise, la formule la moins imprudente sera
celle qui
476
prsentera un aspect ngatif. En raison mme de cet aspect, celle
que je vais proposer, moins pour dfinir que pour situer la plus massive et la
Marcel GRANET La pense chinoise 343
plus durable des civilisations connues, aura peut-tre, du moins pour des
Occidentaux, quelque intrt. Insistant sur le fait que les Chinois ne subissent
volontiers aucune contrainte, mme simplement dogmatique, je me bornerai
caractriser lesprit des murs chinoises par la for mule : ni Dieu, ni Loi.
On a souvent dit que les Chinois navaient point de religion et parfois
enseign que leur mythologie tait autant dire inexistante. La vrit est quen
Chine la religion nest, pas p lus que le droit, une fonction diffrencie de
lactivit sociale. Quand on traite de la civilisation chinoise sans vouloir jeter
les faits dans des cadres qui, pour telle autre civilisation, peuvent paratre
valables, on ne doit point rserver la religion un chapitre. Le sentiment du
sacr joue, dans la vie chinoise, un grand rle, mais les objets de la vnration
ne sont point (au sens strict) des dieux. Cration savante de la mythologie
politique, le Souverain dEn -haut na quune existence littraire. Ce patron
dynastique, chant par les potes de la cour royale, na jamais d jouir dun
grand crdit auprs des petites gens , ainsi que semble le prouver lchec
de la propagande thocratique de M tseu. Confucens ou Taostes ne lui
accordent aucune considration. Pour eux, les seuls tres sacrs, ce sont les
saints ou les Sages. Ctaient, pour le peuple, les Magiciens, les Inventeurs,
les Chefs. La mythologie chinoise est une mythologie hroque. Si les
historiens ont pu, sans grande peine prsenter comme de simples grands
hommes les hros des vieilles lgendes, cest que ceux -ci navaient jamais
possd la majest qui isole les dieux. Lhistoire de ce matre dcole, bien
achaland, dont des campagnards voulurent faire leur dieu du sol, est
significative : on ne conoit pas de dieux qui soient trangers aux hommes,
qui aient une autre essence que la leur. LUnivers est un. Les Chinois nont
aucune tendance au spiritualisme. A peine trouve-t-on la trace, dans les
croyances populaires, dun animisme inconsistant. On croit aux revenants, aux
esprits des morts, aux dmons vengeurs, toute espce de lutins : ils peuvent,
de certains instants, inspirer la terreur, mais quelques exorcismes en
dbarrassent, et,
477
aussitt, ils ne fournissent plus que le sujet de bonnes
histoires. Lincrdulit, chez tous les sages, est totale, bien plus souriante
quagressive. La bonhomie des anecdotes quils racontent fait voir quelles
sortent dun fond paysan (
1283
). La pense nest point occupe par les dieux :
la clientle de chacun deux est restreinte, son existence est locale, momen -
tane passe la fte, pass le dieu. Il nexiste aucun clerg organis (
1284
) ;
les dieux nont point dappui : ils nont aucune transcendance. Trop engags
dans le concret, trop singuliers, ils manquent aussi de personnalit. Et chez
aucun sage, en effet, aucune tendance au personnalisme ne se remarque, pas
plus quau spiritualisme. Ce quil peut rester de ralisme magique dans la
pense savante se tourne facilement en agnosticisme ou en positivisme.
Quand, ft-ce dabord pour viter de les susciter, on sapplique ne parler ni
des miracles ni des tres extraordinaires, lide mme quil sen puisse
produire est tt chasse de lesprit. Les Chinois adoptent lgard du sacr
(sils ne sappliquent pas lliminer de leur pense) une attitude de
familiarit tranquille. Do le sentiment de son immanence, sentiment
Marcel GRANET La pense chinoise 344
profond, mais furtif, mais impermanent. Cette immanence occasionnelle du
sacr favorise, certes, un certain mysticisme, de mme quelle rend aise
une certaine utilisation artistique (ou politique) du folklore superstitieux.
Confucius reoit, de temps autre, la visite dun gnie familier, les Taostes
pntrent, par instants, dans lintimit du Tao ; mais le Tao nest point conu
comme une ralit transcendante, mais le gnie familier de Confucius nest
quun personnage historique : il reprsente une tradition impersonnelle de
Sagesse, tandis que le Tao nest qu e le principe impersonnel de toute saintet.
Les Confucens ne permettent jamais de rien glisser dindividuel dans une
formule de prire ; les Taostes en extase ne font que rpter une oraison
strotype. Sauf M tseu (sil faut admettre que ce prdicat eur croyait sa
rhtorique), il nest point, dans lantiquit, de sage Chi nois qui ait
vritablement song fonder, sur des sanctions divines, la rgle des murs.
Bannies dans un espace et un temps sans ralit, loignes des hommes sans
pour cela se trouver grandies, neutralises par le culte sans quil y ait un
clerg qui travaille les magnifier, les divinits, toujours
478
occasionnelles,
tantt trop familires et inactuelles le plus souvent, ne fournissent point
une reprsentation assez mouvante du sacr pour quon soit tent den faire
le principe de la morale ou de la sagesse. La sagesse chinoise est une sagesse
indpendante et tout humaine. Elle ne doit rien lide de Dieu.
Les Chinois nont aucun got pour les symboles abstraits. Ils ne voient dans
le Temps et lEspace quun ensemble doccasions et de sites. Ce sont des
interdpendances, des solidarits qui constituent lordre de lUnivers. On ne
pense pas que lhomme puisse former un rgne dans la Nature ou que lesprit
se distingue de la matire. Nul noppose lhumain et le naturel, ni surtout ne
songe les opposer, comme le libre au dtermin. Quand les Taostes
prconisent le retour la nature, ils attaquent la civilisation comme contraire
la fois lordre humain vritable et la socit bienheureuse que ne
dformaient point encore de faux prjugs : leur individualisme nest point tel
quils oppose nt radicalement le naturel au social. Quand les Confucens
vantent les bienfaits des contacts amicaux ou de la division des fonctions, le
sentiment quils ont de lamlioration que procure la vie de socit ne les
conduit pas non plus opposer radicalement le social au naturel. Entre lidal
taoste de saintet et lidal confucen danoblissement, la diffrence est sans
porte, je lai dit. Cest celle qui spare le jeu du rite, et ni dun ct, ni de
lautre, on ne consentirait nier la parent des jeu x et des rites, car on entend
prter aux jeux lefficace des rites, et lon ne songe point enlever aux rites
leur valeur de jeux : les rites demandent de la sincrit, les jeux exigent des
rgles, ou, tout au moins, des modles. Les Taostes insistent sur la valeur de
lautonomie, les Confucens sur la valeur de la hirarchie ; mais lidal
Age dor, Rgne de la sagesse quils entendent raliser est toujours un idal
de bonne entente : bonne entente entre les hommes, bonne entente avec la
nature. Cette entente des choses et des hommes est un souple rgime
dinterdpendances ou de solidarits qui jamais ne saurait reposer sur des
prescriptions inconditionnelles : sur des Lois. Le prestige du concret, le
Marcel GRANET La pense chinoise 345
sentiment de loccasionnel sont trop puissants, l ordre humain et lordre
naturel paraissent trop troitement
479
solidaires pour que le principe de tout
ordre puisse tre lou dun caractre dobligation ou de ncessit. Ni dans la
nature, ni dans la pense, on ne dcouvre de vritables contraires, mais
uniquement des oppositions daspects qui procdent de simples diffrences de
situations. Aussi lascse naturiste des Taostes ne comporte -t-elle ni contre--
indications ni indications formelles ; aussi ltiquette confu cenne ne
comporte-t-elle ni prescriptions impratives ni tabous stricts. Puisque tout
dpend de congruences, tout est affaire de convenances. La loi, labstrait,
linconditionnel sont exclus lUnivers est un tant de la socit que de la
nature. De l la haine tenace quont excite les Lgistes et aussi les
Dialecticiens. De l le mpris de tout ce qui suppose luniformit, de tout ce
qui permettrait, induction, dduction, une forme quelconque de raisonnement
ou de calcul contraignants, de tout ce qui tendrait introduire dans le
gouvernement de la pense, des choses, des hommes, rien de mcanique ou de
quantitatif. On tient conserver toutes les notions, mme celle de Nombre,
mme celle de Destin, quelque chose de concret et dindtermin qui rserve
une possibilit de jeu. Dans lide de rgle, on ne veut gure voir que lide de
modle. La notion chinoise de lOrdre exclut, sous tous ses aspects, lide de
Loi.
On se plat parler de linstinct grgaire des Chinois, et lon aime aussi leur
prter un temprament anarchique. En fait, leur esprit dassociation et leur
individualisme sont des qualits campagnardes. Lide quils ont de lordre
drive dun sentiment, sain et rustique, de la bonne entente. Lchec des
Lgistes, les succs conjugus des Taostes et des Confucens le prouvent : ce
sentiment, que blessent les intrusions administratives, les contraintes
galitaires, les codifications ou rglementations abstraites (
1285
), repose
(pour des parts, variables, sans doute, selon les individus, mais, en gros,
sensiblement gales) sur une sorte de passion dauto nomie, et sur un besoin,
non moins vif, de compagnonnage et damiti. tat, Dogmes et Lois ne
peuvent rien en faveur de lOrdre. LOrdre est conu sous laspect dune Paix
que les formes abstraites de lobissance ne sauraient tablir, ni imposer les
formes abstraites du raisonnement. Pour faire rogner en tout lieu cette paix, ce
qui est ncessaire, cest un
480
got de la conciliation qui demande un sens
aigu des convenances actuelles, des solidarits spontanes, des libres hi-
rarchies. La logique chinoise nest point une logique rigide de la
subordination, mais une souple logique de la hirarchie : on a tenu conserver
lide dOrdre tout ce quavaient de concret les images et les mo tions dont
elle est sortie. Quon lui donne pour symbole le Tao et quon voie dans le Tao
le principe de toute autonomie et de toute harmonie, quon lui donne pour
symbole le Li et quon voie dans le Li le principe de toute hirarchie ou
rpartition quitables, lide dOrdre retient en elle, trs ram, certes, et
pourtant tout proche encore de son fond rustique, le sentiment que
comprendre et sentendre, cest raliser la paix en soi et autour de soi. Toute la
Marcel GRANET La pense chinoise 346
Sagesse chinoise sort de ce sentiment. Peu importe la nuance plus ou moins
mystique ou positive, plus ou moins naturiste ou humaniste de leur
inspiration : dans toutes les coles se retrouve, exprime par des symboles
qui demeurent concrets et nen conservent que plus defficience, lide qu e
le principe dune bonne entente universelle se confond avec le principe dune
universelle intelligibilit. Tout savoir, tout pouvoir procde du Li ou du Tao.
Tout Chef doit tre un saint ou un Sage. Toute Autorit repose sur la Raison.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 347
N O T E S
1 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200
Les renvois des sections du texte sont faits laide des mentions : voir plus haut, plus
loin, ...
Les renvois aux ouvrages chinois sont faits laide dune rf rence donnant le titre usuel
de louvrage, suivi de lindication du chapitre.
Les renvois aux Mmoires historiques de Sseu-ma Tsien sont faits laide de
labrvation SMT, suivie, pour les parties non traduites, de lindica tion du chapitre et, pour les
parties traduites, de lindication du tome et de la page dans la traduction Chavannes .
Les renvois aux traductions des classiques de Legge ou de Couvreur sont indiqus par le
nom usuel du classique, suivi des lettres L ou C :
L = James Legge, The Chinese Classics, Londres, 1867-76.
C = Le Pre S. Couvreur, s. j. : Cheu king, Ho-kien-fou, 1896 ; Li ki, Ho-kien-fou, 1899 ;
(Confucius), Les Quatre livres, Ho-kien-fou, 1895 ; (Id.), Chou king, 1897.
Notes 1 99 :
(1) Le second volume, comme le premier, nembrasse que la priode ancienne qui se conclut
avec la dynastie des Han. Le rgne de lorthodoxie et de la scolastique commence avec
lEmpire : les principaux traits de la mentalit chinoise sont ds lors fixs. Je conserverai pour
ce second volume la bibliographie du premier. Quelques ouvrages, rcents ou spciaux, y ont
t ajouts.
(2) Giles, History of chinese literature ; Grube, Geschichte der chinesischen Literatur ;
Mayers, Chinese readers manual ; (Leang Ki -tchao) Liang Chi -chao, History of Chinese
political thought, trad. par L. T. Chen ; Le P. Wieger, Histoire des croyances religieuses et
des opinions philosophiques en Chine, depuis lorigine jusqu nos jours ; Tucci, Storia della
filosofia cinese antica ; Forke, Geschichte der alten chinesischen Philosophie ; Suzuki, A
brief history of early chinese philosophy ; Hackmann, Chinesische Philosophie ; Hu Shih, The
development of logical method in ancient China ; Maspero, La Chine antique (Livre V, pp.
543-621).
(3) Sseu-ma Tsien , Mmoires historiques (SMT), V,
441 sqq
.
(4) Pour simplifier, jcris (par exemple) Tchouang tseu quand je parle de lauteur (rel ou
suppos) de louvrage que je dsigne, par raison de commodit, en crivant : le Tchouang
tseu.
(5) Maspero, op. cit., fin de la note 777.
(6) Ibid., note 907.
(7) Ibid., cest moi qui souligne.
(8) P. Wieger, Les Pres du systme taoste, p.
501
.
(9) Li ki, C., I,
133,
153,
164,
175 ,
212,
216.
Marcel GRANET La pense chinoise 348
(10) Le schma suivant servira illustrer ce fait : je lemprunte (en le simplifiant lgrement)
lun des essais les plus ingnieux (Hsu Ti -shan, n de dc. 1927, p. 259, du Yenching
Journal, en chinois) que lon ait faits rcemment en Chine pour montrer les rapports des
coles ou des doctrines (philosophiques ou techniques). Lauteur dsire surtout montrer les
origines de la doctrine taoste : il ne cherche pas tre complet et nglige, par exemple,
lcole des Lois et lcole des Dnominations.
cole des sorciers cole des Annalistes
cole du Yi king
cole des Nombres
Arts Doctrines Doctrine Doctrine cole
cole
Magiques Divinatoires des Astronomes du tao t de M tseu de
Confucius
Mdecine Hygine cole du cole du
Sexuelle Calendrier Yin Yang
Doctrine dimmortalit
Doctrine des
Cinq lments
Doctrine taoste
(11) Le P. Wieger, Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques en
Chine, depuis lorigine jusqu nos jours, pp.
133,134
et, sa suite, Maspero, La Chine
antique, 464.
(12) Maspero op. cit., 473.
(13) Ibid., 480.
(14) Ibid., 468.
(15) SMT, V,
414
.
(16) Louen yu, L., 159, [CSS Louen yu] (Legge traduit : I seek a unity all-pervading).
SMT, V,
367
. (Chavannes traduit : je nai que le seul principe qui fait tout comprendre). Les
caractres employs suggrent lide que Confucius ( ?) a voulu exprimer sa pense par une
mtaphore : une seule (barre ou cordelette) suffit enfiler ( runir, lier, soutenir tout un
ensemble dobjets).
(17) de Groot, Universismus.
(18) Maspero op. cit., 620.
(19) Ibid., 616-620.
Marcel GRANET La pense chinoise 349
(20) On peut, sur ce point, se reporter aux remarques dA. Rey, La Science orientale, pp.
351,352. Mais je dois dire que, pour ce qui est des possibilits de connatre les ides
scientifiques des anciens Chinois, je nai point loptimisme de Rey.
(21) Cf. Durkheim, Les formes lmentaires de la vie religieuse, p. 633 sqq.
(22) Il se peut (ce ne serait pas chose nouvelle) que, de diffrents cts, et, jimagine, titre
de compliment, ces pages ne me fassent dire que jai voulu clairer les faits chinois au moyen
de thories sociologiques ou (tout aussi bien) que jai tent dillus trer la thorie
sociologique laide de f aits chinois. Faut-il dclarer que je ne sais rien de ce quon appelle
la thorie ou les thories sociologiques ? Depuis quil y a des sociologues, leur pre mier objet,
quand ils travaillent, nest -il pas de dcouvrir des faits ? Peut-tre en ai-je signal quelques--
uns qui navaient pas attir lat tention. Le principe de leur dcouverte se trouve dans le
mmoire sur les classifications primitives quont publi Durkheim et Mauss ; jai plaisir
le dire et peut-tre nest -il pas sans intrt dajouter : bien que peu de spcialistes les aient
cites (voir cependant Forke, Lun-Heng, Selected Essays of the philosopher Wang Chung,
(MSOS, 1911) t. II, p. 442), les quelques pages de ce mmoire qui ont trait la Chine
devraient marquer une date dans lhistoire des tudes sinologiques.Jajouterai encore que, si
jai conduit lanalyse des catgo ries chinoises avec lunique proc cupation de tirer des seuls
faits chinois une interprtation correcte, la meilleure raison que jai de croire cette analyse
exacte est quelle met en vidence la prmi nence de la catgorie de totalit sur laquelle, aprs
une vaste enqute, Durkheim (Formes lmentaires, p. 630), avait insist fortement.
(23) Les rfrences se rapportent (autant que possible) des traductions ou publications en
langues occidentales : elles permettront de retrouver le contexte. Jai dit, dans la plupart
des cas, proposer une traduction nouvelle.
(24) Przyluski, Le sino-tibtain (in Langues du monde), 1924, p. 374 ; Karlgren, tudes sur la
phonologie chinoise, et ID, Sound and symbol in China ; Maspero, Le dialecte de Tchang-
ngan sous les Tang, BEFEO, 1920.
(25) Przyluski, op. cit., 363.
(26) Ibid., 362.
(27) Karlgren, Le protochinois, langue flexionnelle, JA, 1920. La dmonstration de Karlgren
souffre dun classification contes table des textes anciens. En revanche, les analogies que lon
peut relever en birman paraissent postuler en faveur de la thorie quil avance.
(28) Maspero, La Chine antique, 18-19.
(29) VIIIe au Ve sicles av. J.-C.
(30) Tso tchouan, C., III,
682.
Le mme sort nfaste est prdit (Ibid., II, 565) un prince qui
sest fait construire une maison darchitecture trangre. (Comp. Civ. Chin., 270). On dfinit
sa personnalit, on fixe son destin par le parler que lon adopte, lar chitecture (les rites, la
musique, les danses, etc.) que lon prfre. Le langage et tous les autres sys tmes de symboles
ont une mme vertu : ils sont significatifs dun certain ordre de civilisation.
(31) Les succs postrieurs du chinois comme langue de civilisation tiennent pour beaucoup
sa transcription figurative, unifie et fixe. A lpoque fodale, il ne peut tre question de
considrer lcriture chinoise comme tant dj abs olument uniformise. Cest en tant que
langue parle que le chinois a t dabord une langue de civilisation.
(32) On a vu que le ton peut varier.
(33) Tso tchouan, C., II,
437-439
.
Marcel GRANET La pense chinoise 350
(34) Granet, Quelques particularits de la langue et de la pense chinoises (Revue
philosophique, 1920), 114 sqq. ; Id., Ftes et chansons anciennes de la Chine,
93
sqq. Un
lexique ancien, le Kouang ya, consacre un chapitre entier aux auxiliaires descriptifs.
(35) Granet, Ftes et chansons...,
117
sqq.
(36) Id., Quelques particularits de la langue..., 118.
(37) Ibid., 119 ; Id., Ftes et chansons...,
41
, et Che king, C.,
189
.
(38) Voir Civ. Chin :
276-277,
287,
322,
376
(39) Lun des composants est alors qualifi, lui tout seul, de radical.
(40) Leibniz, d. Dutens, V, 488.
(41) Civ. Chin.
119
,
120
.
(42) Mestre, Quelques rsultats dune comparaison entre les caractres chinois modernes et
les siao-tchouan ; Laloy, La musique chinoise ; Grube, Die Religion der alten Chinesen ;
Karlgren, Sound and symbol in China ; Karlgren, Philology and ancient China.
(43) Civ. Chin.
61-63.
(44) Tso tchouan, C., III,
635
. Cest ce texte que lon fait dor dinaire remonter lusage de la
divination laide des caractres. Il fournit un premier indice de la parent des emblmes
graphiques et des figures proprement divinatoires.
(45) Lu che tchouen tsieou , 17, 2. Chouo wen, prf. Les nud s et les entailles servent
capter les ralits : de mme les signes vocaux ou figurs.
(46) Li ki, C., II,
269
.
On tudiera plus loin les aspects proprement philosophiques de la doctrine des dsignations
correctes. Disons par avance que, pour les tenants de cette doctrine, nommer, cest classer et
cest juger : cest pour voir dune cer taine vertu, bnficiente ou malficiente.
(47) Cest aussi tous les neuf ans que devait, dit -on, se faire la rpartition des charges (et, sans
doute, des terres). On affirme, dautre part, que les fonctionnaires taient examins tous les
neuf ans.
(48) Tcheou li, Biot, Le Tcheou li ou les Rites des Tcheou, II, 120. On sait (Civ. Chin.)
qu la naissance le nom personnel est cho isi aprs que la qualit de la voix du nouveau-n a
t dtermine, laide dun tube de bronze par un musicien : on reconnat parfois en elle
celle dun animal dont lenfant possde la nature.
(49) Le P. Wieger, Caractres (Rudiments, V,12), 364.
(50) Ibid, 322 ; Mestre, op. cit., 8.
(51) Granet, Danses et lgendes...,
364-365
.
(52) SMT, V,
380
.
(53) Tel est le premier objet de la tentative, au reste neuve et intressante, de Karlgren, On the
authenticity and nature of the Tso chuan.
(54) Par exemple La Chine antique, de Maspero, 432 sqq.
(55) Il y a des passages en vers dans le Chou king comme dans le Yi king (considrs lun
comme luvre des scribes, lautre comme luvre des devins), dans le Lao tseu comme dans
le Tso tchouan ou les Mmoires historiques.
Marcel GRANET La pense chinoise 351
(56) Les critiques chinois modernes qui, par sentiment dmocratique, prconisent lemploi de
la langue parle (pai houa) cherchent accrditer leurs opinions en montrant limportance de
cette langue dans la littrature ancienne.
(57) Granet, Ftes et chansons anciennes de la Chine, Introd.
(58) Ibid, 18 sqq.,
78 sqq .
(59) Maspero, La Chine antique, 429.
(60) Grube Geschichte der chinesischen Literatur, 46 ; Maspero, op. cit., 430.
(61) Granet op.cit.,
27 sqq
., 31.
(62) Ibid.,
53
sqq
.
(63) Civ. Chin.
187
.
(64) On peut, de nos jours encore, observer ce mlange dinspi ration traditionnelle et
dinvention libre. En fvrier 1922, au cours dune fte annamite au Tonkin. les protagonistes
chantrent des couplets emprunts au Che king puis improvisrent en chants alterns.
(65) Voir (Civ. Chin.,
191
,
204
,
212
) des exemples de danses emblmatiques motifs
animaux. Les danses emblmes floraux no nt pas d tre moins importantes. Une des danses
le mieux conserves dans la tradition des cours reproduit les mouvements des fleurs et des
branchages. Houai-nan tseu (ch. XIX) dit dune danseuse :
Son corps, cest un iris dautomne aux souffles du ven t.
(66) Granet, Ftes et ch.,
102
.
(67) Ibid.,
123
. [ LXIV ]
(68) Ibid.,
78 sqq.
;
140 sqq.
;
235 sqq [cf. n. 91]
.
(69) Ibid., 101 sqq. [ L, vers 5 sqq] ; Civ. Chin.
(70) Granet, Ftes et chansons anciennes de la Chine, p.
36
[VII] ; Civ. Chin.
(71) Maspero, La Chine antique, p. 430 [57-58].
(72) Sur la destruction des instruments rituels, cf. Li ki, C., II, p.
218
.
(73) de Groot a donn une excellente description des mouvements caractristiques des por-
teurs dEsprits ( Ftes dmouy, p. 289).
(74) Tchou tseu, 2 (Li houen).
(75) Che king, L., p. 395 et notes de la p. 399. [Couvreur, p.
298
].
(76) Yi li, Steele, I Li, or the Book of Etiquette and Ceremonial, t. II, pp. 14 et 15. Le
traducteur a laiss perdre tout le concret de ces expressions.
(77) Che king, C.,
461
.
(78) Elles appartiennent au genre dnomm fou, dont il sera parl plus loin.
(79) SMT, Introd., p.
LIX
. Le livre de Confucius (le Tchouen tsieou ) est dit tre le code du
vrai souverain.
(80) SMT, Ibid., p.
CLXIV
, et t. II, p. 410 ; Civ. Chin.
(81) Sur ces derniers, voir Civ. Chin.
Marcel GRANET La pense chinoise 352
(82) Maspero, op. cit., pp. 489 et 491.
(83) Le P. Wieger, Les Pres du systme taoste, pp.
103
et
219.
(84) Les sculpteurs et dessinateurs chinois (eux aussi se proposent denseigner) nont pas,
plus que les potes et les philosophes, besoin dun grand nombre de motifs. Ceux dont ils
usent peuvent frquemment avoir pour lgende une anecdote strotype, une concrtion de
thme mythique. (Cf. Granet, Danses et lgendes..., p.
598
; Id., Ftes et chansons an-
ciennes..., note 2 de la p.
236
, et Civ. Chin.).
(85) Granet, Danses et lgendes..., pp.
505
et
509
.
(86) La tradition des rois cloche-pied sest conserve au Siam et au Cambodge jusquau XIXe
sicle. Aprs avoir trac un sillon (dsacralisation du sol par le chef au dbut dune campagne
agricole), ils devaient aller sap puyer contre un arbre et se tenir debout sur un seul pied (le
pied droit plac sur le genou gauche). (Cf. LECLRE, Le Cambodge, p. 297). Voir plus bas.
(87) Li ki, C., II,
30
et
34
.
(88) On verra plus loin (p.
362
) que lcole de M tseu, qui a donn un enseignement de la
logique, est une secte de prdicateurs. Peut-tre y enseigna-t-on la rhtorique. Cest l un fait
exceptionnel dans lhistoire de lenseignement en Chine.
(89) Granet, Ftes et chansons..., p.
224
sqq
.
(90) Nous possdons une complainte de ce type ; la tradition lui attribue la valeur dune
incantation procdurire. On se combattait en justice en enchanant rythmiquement des
proverbes. Granet, op. cit., pp.
261
sqq
.
(91) Ibid.,
235,
266
,
267.
(92) Les pices les plus caractristiques sont (dans le Tchou tseu) le Yuan yeou et le Tchao
houen.
(93) Sur la doctrine de lensei gnement muet, voir plus loin p.
391
et
439.
Notons ici le
lien de cette doctrine et de la pratique de la confirmation du converti par le sourire. Cest aus si
par le sourire quun pre reconnat un enfant comme sien, ceci au moment mme o il lui
donne un nom, cest --dire une personnalit et une me. On aperoit le rapport des techniques
et des doctrines de lexpression avec la magie des souffles. Les mots, les formules, les
rythmes sont la fois des symboles et des choses.
(94) Hackmann, Chinesische Philosophie, p. 35.
(95) Civ. Chin.
222
.
(96) Heou Han chou, 115 ; Houai-nan tseu, 4.
(97) Houai-nan tseu, 4 ; Song chou, 27 ; Kouo yu, 8 ; Granet, Danses et lgendes..., p.
258
.
(98) Lie tseu, Le P. Wieger, Les Pres du systme taoste, p.
141
.
(99) Civ. Chin.
292
.
Marcel GRANET La pense chinoise 353
Notes 100 199 :
(100) Consulter ce sujet Biot, Astronomie chinoise ; DOldenberg, Nakshatra und Sieou ;
De Saussure, Les Origines de lastronomie chinoise ; Maspero, La Chine antique, pp. 607
sqq ; Rey, La Science orientale, pp. 333 sqq.
(101) Tchouen tsieou fan lou, 7.
(102) Chan hai king, 12 ; Granet, Danses et lgendes..., note 1357.
(103) Civ. Chin.
272
.
(104) Ce mot entre dans lexpression fang che = magicien, sorcier. Cf. pp 298, 299.
(105) Civ. Chin.
265
.
(106) Voir plus loin, p.
210 sqq
.
(107) Chavannes, Le Tai chan, pp.
451 sqq
.
(l08) Granet, La religion des Chinois[css], p. 55 ; ID., Danses et lgendes... p.
233
.
(109) Granet, Danses et lgendes...,
245 sqq
;
257 sqq.
(110) Id., Ibid.,
249 ;
Id., La religion des Chinois, 52 ; Li ki, C., I, p.
726
.
(111) SMT, I, pp.
242, 243
; Tcheou li, Biot, Le Tcheou li, ou les Rites des Tcheou, I, p. 201
et notes.
(112) SMT, I, p.
247
; Civ. Chin.
281
.
(113) Granet, Danses et lgendes..., pp.
231 sqq
.
(114) Kouo yu, 1. SMT, I,
251 sqq.
; ?746 sqq ; Tcheou li, Biot, op. cit., p. 167 et p. 276.
(115) SMT, I, p.
62
.
(116) SMT, I, pp.
79
,
62
; Granet, Danses et lgendes .... pp.
249 sqq
.
(117) A une dynastie dcadente correspond un espace dtraqu.
(118) Civ. Chin :
27, 28, 48 , 49.
(119) Sur lemploi liturgique du temps, Voir Granet, Le dpt de lenfant sur le sol (Rev.
arch.,1922), pp. 34 46.
(120) Id., Ibid., p. 35.
(121) Id., Danses et lgendes..., pp.
286 sqq
(122) Id., Ibid., pp.
238 sqq.
Les marges de lUnivers forment une sorte despace inactuel qui
correspond aux temps mythologiques ; ce monde non humanis est en dehors du temps
historique.
(123) Civ. Chin.
(124) Chavannes, Le Tai chan, p.
462
.
(125) Civ. Chin. ; Granet, Danses et lgendes..., pp.
21
sqq
.
(126) SMT, Introd.,
CXLIII sqq
; Civ. chin. Voir plus loin.
Marcel GRANET La pense chinoise 354
(127) Granet, Danses, p.
241
.
(128) SMT, I, pp.
58 sqq
.
(129) Granet, op. cit., pp.
116 sqq
; Civ. Chin.
(130) Yue ling, Li ki, C., p.
371
.
(131) Id., Ibid., pp.
303
et
402.
(132) Granet, Danses, pp.
252 sqq
.
.
(133) Ibid., p.
254
.
(134) Ibid., pp.
241 sqq
. ; pp.
250 sqq
. ; pp.
257 sqq
.
(135) Ibid., pp.
243
,
244
,
248
.
(136) Ibid., pp.
245
,
248
,
268
.
(137) Ibid., p.
270
.
(138) Ibid., p.
271
; Civ. Chin.,
221
.
(139) Civ. Chin.,
231 sqq
.
(140) Civ. Chin.,
223 sqq
.
(141) Granet, Danses et lgendes..., pp.
305 sqq
.
(142) SMT, III, p.
400
.
(143) SMT, I, p. 49 ; Yi king, L., pp. 365 et 368.
[ 5 x 366= (384 x 2) + (354 x 3) = 768 + 1062 = 1830 ].
(144) Et peut-tre (aussi) aux 6 journes environnant chacun des deux solstices. SMT, III, 320
sqq. ; Yue ling, 5
e
et 11
e
mois.
(145) Granet, Danses et lgendes..., pp.
330 sqq
. ; pp.
470
,
476
.
(146) Ou aux neuvime et troisime mois.
(147) Granet, op. cit., pp.
327 sqq
. Civ. Chin .
(148) Id. Ftes et chansons anciennes de la Chine, pp.
178
sqq
.
(149) Id. La religion des Chinois[css] ; Civ. Chin.
(150) Civ. Chin. :
45
,
228
. Dix mille annes est un quivalent de Fils du Ciel . Ces
deux expressions dsignent le souverain.
(151) Rappelons quil ne nous est parvenu aucun fragment (o se retrouve une proccupation
philosophique) qui puisse tre estim sensiblement antrieur au Ve sicle.
(152) Hu Shih. The development of logical method in ancient China, et ( sa suite) Tucci,
Storia della filosofia cinese antica, p. 15, et Suzuki, A brief history of early chinese
philosophy, p. 15.
(153) Maspero, La Chine antique pp. 482-483. Des ides assez diffrentes et qui semblent
sinspirer dune autre interprt ation sont exprimes aux pages 273 et suiv. du mme ouvrage.
Marcel GRANET La pense chinoise 355
Comp. Wieger, Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques en Chine,
depuis lorigine jusqu nos jours, p. 127.
(154) Maspero, op. cit., p. 483, note 1, et pp. 499 sqq.
(155) Tsien Han chou, 30, p. 15 b.
(156) Ce trait, le Yue ling (Cf. Li ki, C., I, pp. 330 sqq. ), nous est parvenu dans trois
ditions conserves par le Lu che tchouen tsieou , Houai-nan tseu, et le Li ki.
(157) Ce trait, le Hi tseu, est un appendice du manuel divinatoire nomm Yi king (Cf. Yi
king, L., 348 sqq). Comp. les Prolgomnes de Legge (Ibid., pp. 26 sqq. ; pp. 36 sqq.), et
Maspero, op. cit., p.
480
.
(158) SMT, III, pp.
301 sqq
. et le P. Wieger, Les Pres du systme taoste, p.
321
.
(159) M tseu, 7. Cf. Forke : Mo Ti, des Socialethikers und seiner Schiller philosophische
Werke, p. 324. Maspero professe que les auteurs du Hi tseu sont les inventeurs de la thorie
du Yin et du Yang ; aussi admet-il (le Hi tseu tant jug postrieur luvre de M tseu) que
ce passage est interpol, tout en reconnaissant quil fait partie dun chapitre de cette uvre
estim authentique.
(160) Che king, C., p.
35
.
(161) Ibid., pp.
39
,
159
,
254
.
(162) Ibid., p.
144
.
(165) Ibid., p.
165
.
(164) Ibid., p.
197
.
(165) Ibid., p.
161
.
(166) Ibid., p.
78
.
(167) Che king, C., p.
161
.
(168) Ibid., pp.
185
,
190
; Civ. Chin.,
171
,
189
.
(169) Che king, C., pp.
23
,
104
,
143
,
202
,
324
; Granet, Ftes et chansons, p.
246,
n.1.
(170) Ibid., pp.
349
,
463
.
(171) Ibid., p.
362.
Civ. Chin. Noter que le passage du Che king o il est question de cette
inspection tablit lantiquit des pratiques dont est sorti le fameux art chinois de la gomancie.
La gomancie (fong chouei) a pour objet de dterminer la valeur des sites en considrant les
eaux courantes (chouei) et les courants ariens (fong) ; ceux-ci sont toujours mis en rapport
avec les montagnes : on aperoit facilement lintrt que pouvaient avoir des termes comme
yin et yang, dont le sens premier parat tre ubac et adret. Noter encore que linspection des
ombres et de la lumire est exprime dans ce passage par le mot king. Ce mme mot signifie
gnomon et sappa rente par la graphie, comme par la prononciation, au mot king : capitale.
(172) Civ. Chin.,
265
.
(173) Maspero, La Chine antique, p.
482
. Ce fait dconcertant pour eux aurait d tre
signal par les interprtes qui attribuent lauteur du Hi tseu linvention dun syst me
mtaphysique dont les notions de Yin et de Yang formeraient le centre. Ces interprtes, en
revanche, nhsitent pas supposer que ces termes sont le sujet de deux phrases o lauteur du
Marcel GRANET La pense chinoise 356
Hi tseu ne les mentionne pas. Maspero a pris soin, en traduisant ces deux phrases, de mettre
entre parenthses les mots yin et yang, que le texte chinois ne contient pas, mais quil nhsite
pas, sur la foi des glossateurs, restituer.
(174) Yi king, L. 355.
(175) Ibid., p. 349.
(176) Telle est 1interprtation traditionnelle recueillie par les gloses. Noter le caractre
sexuel de ces reprsentations. Nous aurons revenir sur ce point.
(177) Yi king, L., p. 372.
(178) Le Kouei tsang, daprs la tradition, tait le livre divina toire des Yin (conserv par les
princes de Song, leurs descendants) ; le Yi king, le livre des Tcheou, successeurs des Yin.
(179) Le Yi king est peu prs vide de thmes mythiques : do sa faveur dans lcole de
moralistes qui se rclame de Confucius, et, par suite, sa conservation.
(180) Tsien Han chou, 30, p. 15b.
(181) Granet, Danses et lgendes..., p.
253
. On pourrait traduire : la valle du Yang.
(182) Tchouang tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
383
.
(183) Ibid.,
321
.
(184) Granet, op. cit., p.
435
.
(185) Noter que, tout comme la substance (= nourriture), le rythme est voqu laide dune
image fournie par la boisson. Voir plus loin, p.
330
et p.
332
.
(186) Non seulement les ides de rythme et de substance sont confondues, mais encore
loppo sition entre les termes antithtiques quon imagine tout la fois dans le Temps et dans
lEspace, impliquent lide dune juxta position comme celle dune alter nance. Jai dj
indiqu lapparentement des ides de pien (volution cyclique) et de tong (interpntration).
(187) Ho et tiao voquent lide dune harmonie la fois musicale et substantielle
(alimentaire) dont limage est le bouillon. Cf. Civ. chin.
(188) Cest l le point expli quer. Je lessaierai, voir plus loin.
(189) Noter que lexpression ho tiao (mmes mots inverss) signifie : Harmoniser et mettre
daccord (les saveurs primordiales qui composent la nourriture). Le rythme et la substance
sont 1objet dune intuition globale, indistincte.
(190) M tseu, 7.
(191) Le mot tsie signifie articulation, jointure , et voque limage dun nud de bambou.
I1 dsigne linstrument dont on se sert pour battre la mesure (Le Roi fait concerter le Yin et le
Yang en battant la mesure aux quatre saisons) et les divisions du temps qui servent rythmer
le cours des saisons. Il est aussi lemblme de la loyaut et de la chastet, et, pour dire bref, de
la mesure. Les divers aspects concrets de la notion de mesure semblent tous impliquer une
image musicale qui parat lie la reprsentation dun instrument (de bambou) mesur par le
nombre de ses articulations.
(192) La pluie et la rose fournissent des thmes potiques qui servent demblmes certains
termes de lanne. La pluie et la rose sopposent. Lide de pluie est lie des
reprsentations de nature fminine (yin) ; la rose veille lide de la bienfaisance princire
(mle, yang). On remarquera que le Yang soppose la Pluie dans la liste des Cinq signes
fournie par le Hong Fan (SMT, IV, p. 228) ce qui dailleurs montre : 1 que (la thorie
Marcel GRANET La pense chinoise 357
du Yin et du Yang est connue des rdacteurs du Hong Fan ; 2 que, pour eux, (le Yin et) le
Yang sont des catgories concrtes. Cf. infra, pp. 257, 308 sqq.
(193) Le plus intressant est celui de Hi-ho. La tradition veut que lan des Hi et lan des
Ho, astronomes en chef qui doublent le souverain, aient t prposs, lun au Yin, et lautre au
Yang. SMT, pp. 43 et 44, et note 1 ; Granet, Danses et lgendes..., p.
253.
(194) Je transcris sans mettre de majuscules : il ne sagit pas de lopposition de deux
principes, mais du contraste de deux aspects.
(195) Une des traditions relatives aux symboles quemploient les techniques divinatoires
(symboles que le Yi king reprsente graphiquement au moyen de lignes pleines et continues
ou creuses en leur milieu) veut que les devins se soient servis de fiches dont une face tait
garde intacte et sans doute bombe (yang = mle = saillant) et dont lautre tait creuse (yin
= femelle = creux). La meilleure traduction de la formule du Hi tseu en termes
divinatoires serait donc : une (fois la face) yin, une (fois la face) yang .
(196) Civ. chin.
(197) Li ki, C., I, pp.
345,
348,
377,
382.
(198) Petit Calendrier des Hia, Ta Tai Li ki, 47.
(199) Granet, Ftes et Chansons anciennes de la Chine, pp.
53
sqq
.
Marcel GRANET La pense chinoise 358
Notes 200 299 :
(200) Cf. plus haut, p.
105
.
(201) Ta Tai Li ki, 47.
(202) Yue ling et Calendrier des Hia
(203) Id., Ibid. ; cf. Wang tche, Li ki, C., I, p.
283
,
332
,
340
,
389
.
(204) Granet, op. cit., p. 54.
(205) Che king, C., p.
160
; Granet, op. cit., p.
56 ;
Civ. Chin.
(206) Granet, Ftes et Chansons, p.
184
; Li ki, C., pp.
652 sqq
. Le chien est un animal
yang.
(207) Granet, op. cit., p.
181
; Id., Danses et lgendes..., pp.
305 sqq
.
(208) Civ. Chin.,
189 sqq
,
281
.
(209) Ce sont les demeures des morts (cf. Granet, La vie et la mort, croyances et doctrines de
lantiquit chinoise, pp. 15 sqq). La morte-saison est la saison des morts (cf. Granet, Danses
et lgendes..., pp.
321 sqq
.). Les philosophes font de cette saison yin la saison de la mort, et
du Yin le symbole des nergies destructrices.
(210) Granet, La vie et la mort..., pp. 15 sqq. ; SMT, III,
305
.
(211) Id., Danses et lgendes, pp.
570 sqq
; Calendrier des Hia, 10
e
mois.
(212) Tchouang tseu, Le P. Wieger, Les Pres du systme taoste, p.
369.
Ce prcepte est
glos par la formule : Un (temps) dlva tion, un (temps) dabaissement. Tchouang tseu
dit peu aprs Une (fois en) haut, une (fois en) bas.
(213) Yi king, L. p. 393. Lexpression dix mille tres (plus exactement : les dix mille la
totalit des ralits emblmatiques) dsigne les 11 520 ralits Yin ou Yang figures par
les 64 hexagrammes divinatoires.
(214) Voir sur ce point les affirmations catgoriques de de Groot (Ftes dEmouy, p. 745 de la
traduction franaise). Une mode plus rcente consiste retrouver partout, et mme dans les
caractres dcriture, des reprsenta tions phalliques (p. ex. Karlgren, Some fecundity symbole
in ancient China, dans Bulletin of the Museum of Far Eastern antiquities , n 2,
Stockholm, 1930). Les thmes sexuels abondent dans la littrature chinoise. I1 ny a, en
revanche, aucune raison de croire que les Chinois aient jamais song diviniser le sexe. En
tout cas, ils se sont abstenus dopposer le Yin et le Yang en les ralisant lun comme un
principe fminin, lautre comme un principe mle.
(215) Maspero, La Chine antique, pp. 480 sqq. ; pp. 270 sqq.
(216) Granet, Ftes et chansons anciennes, p.
79
; Civ. Chin.,
196
,
209 sqq
.
(217) Civ. Chin.
(218) Kouan tseu, 3 ; Granet, Ftes et chansons anciennes..., p.
132
.
(219) Civ. Chin.
(220) Che king, C., p.
78
.
(221) Granet, Ftes et chansons anciennes..., pp.
244 sqq
.
Marcel GRANET La pense chinoise 359
(222) Id. Ibid., p
43
. Les deux formules sont interchangeables : toutes deux servent signaler
le rythme universel aussi bien que le rythme social. Linitiative attri bue au Yang comme aux
garons est lindice de la primaut que la doption dune organisation agnatique a fait attribuer
aux mles. On notera quanciennement lini tiative dans le mariage appartint aux filles : la
formule classique de laction alterne du Yin et du Yang voque en premier lieu l aspect
yin .
(223) Id., Ibid., pp
92
,
146 sqq
. ; pp.
261 sqq
. ; Civ. Chin.
(224) Granet, Ftes et chansons anciennes, pp.
244
sqq.
(225) Voir en sens contraire Maspero, La Chine antique, p.
482
.
(226) Leur conception est domine par lide de roulement : le pre est yang ; mais le fils, yin
vis--vis de son pre, est yang vis--vis de ses propres fils. Le Ministre est yin, et devient
yang quand il succde et prend le titre de souverain. Si lon dit que le Yin est un principe
de mort et de chtiment (hing), le Yang un principe de bienfaisance (t), cest que lun
exprime la vertu du Chef, lautre celle du Ministre. Ministre et chef forment un couple. Cf.
Granet, Danses et lgendes de la Chine ancienne, pp. 117-421.
(227) Civ. Chin.,
183
,
231 sqq
(228) Granet, Ftes et chansons anciennes de la Chine, p.
272
sqq
.
(229) Au sens logique du mot.
(230) Selon Chavannes, Une philosophie des Nombres a, comme la doctrine pythagori-
cienne, brill en Chine dun vif clat . Il est assurment plus facile de prsumer lclat de
cette philosophie que den dter miner linfluence et den saisir les principes. Les
observations que je me suis appliqu recueillir depuis bon nombre dannes me permettent
tout au plus de prsenter quelques remarques sur latti tude des Chinois lgard des Nombres.
Je ny mlerai aucune hypothse ou recherche dori gine, question prmature sans
mme indiquer aucun rapprochement, je me tiendrai aux ides chinoises. Jai tch
dinterprter celles -ci en traitant divers sujets (questions des sites, des lments, des
emblmes divinatoires, des tubes musicaux...) choisis en raison de limportance que les Chi -
nois leur attribuent et quils ont, en effet. Javais dcouvrir les faits et lordre historique des
faits, et javais, de plus, montrer comment on peut les dcouvrir. Javais encore les
interprter dans notre langue qui se prte mal exprimer les conceptions chinoises. Je nai pas
mexcuser de la minutie des analyses et de la longueur dun chapitre o je devais expliquer
un des traits fondamentaux de la pense chinoise, savoir : un extrme respect pour les
symboles numriques qui se combine avec une indiffrence extrme pour toute conception
quantitative.
(231) Se reporter sur ce point la discussion institue par A. Rey pp. 389 sqq. de la Science
orientale.
(232) Les Chinois comptent termes compris.
(233) Houai-nan tseu, 4. Cf. Ta Tai Li ki, 81.
(234) Les joues se comptent laide dun cycle dnaire. Mythi quement il y a 10 Soleils.
(235) Aussi y a-t-il 12 Lunes.
(236) On voit que les Nombres servent conduire une certaine forme dinduction.
(237) Lquivalence : 1 (yi) et Ciel (Tien), est si parfaite quon crit : Tien yi, sans copule.
Aussi dois-je crire (vaut) entre parenthses.
(238) Les signes du cycle dnaire sappellent les dix tiges ( kan) ; ceux du cycle duodnaire,
les douze branches (tche). Bien quon oppose kan tche comme le tronc aux branches, tche,
Marcel GRANET La pense chinoise 360
tout comme kan, dsigne une perche plante verticalement. Kan ou tche, branches ou tiges,
servent situer, marquer des positions (les gomtres se servent des signes dnaires pour
marquer les angles de leurs figures), mais tiges et branches servent aussi comparer des
grandeurs : tche (branche) signifie : mesurer, compter, nombre, quantit, et lexpression jo
kan (Jo = tel, kan = tige) veut dire tel nombre, tant ou tant.
(239) SMT, III, p.
305
. Chavannes a traduit tort ce jen par bont.
(240) SMT, III, p.
308
.
(241) Toutes ces images se rattachent une reprsentation de la Terre-mre.
(242) Li ki, C., I, p.
342
Le Yue ling fixe au troisime jour aprs lquinoxe les premiers
grondements du tonnerre et la proclamation par le hraut muni de la clochette battant de
bois des interdits imposs aux femmes. Je dois insister sur la valeur rituelle des images que les
signes cycliques voquent au dire des interprtes chinois : trop de sinologues nont voulu voir
dans ces interprtations que des jeux de mots pdants. Cf. SMT, III, note 25.141, et notes des
pages suivantes.
(243) Granet, La vie et la mort..., pp. 12 sqq.
(244) Voir pp.
91
,
237
,
258
.
(245) Voir plus loin, p.
264
.
(246) Sur la signification de ces inversions avec changes dattri buts et sur leur rapport avec
le thme de lhirogamie, voir plus loin, pp.
166
et
231
.
(247) SMT, III, p.
325
.
(248) SMT, III, p.
326
.
(249) Tseu signifie : ordre, srie, place, station. Les interprtes reconnaissent dans les
Nombres du Calendrier les emblmes de sites ou de positions astronomiques (ou solaires).
(250) Je nai pas (question pr mature) traiter ici de la question dorigine (trangre ou chi -
noise) du systme des douze heures doubles (conues comme encadrant, chacune, lune des
pointes dune rose douze directions). La mythologie chinoise admet lexis tence relle de 12
Lunes et de 10 Soleils.
(251) Pour obtenir 24 sites avec 10 + 12 signes cycliques, on commence par ajouter 4 termes
(affects aux 4 directions dangle), puis lon emploie les 12 signes duodnaires et seulement 8
signes dnaires, les 2 signes dnaires restants formant un binme toujours rserv au centre.
Cf. Houai-nan tseu, 2 et Granet, op. cit., p. 13, n.2. Noter qu la division en 24 orients
correspond une division administrative en 24 services (rpartis entre 4 directions) confis
des chefs dsigns par des noms doiseaux (ces oiseaux, certains du moins, figurent dans les
signaux calendriques). Le chef de ces services (phnix) prside au calendrier. Cf. Tso
tchouan, C., t. III, pp
276
et
277
, et Granet, Danses et lgendes..., p. 236, n. 1. Remarquer
que les 24 mois de 15 jours se subdivisent chacun en 3 priodes de 5 jours : aux 72 priodes
de 5 jours qui composent lanne (360 = 72 x 5) sont affects 72 dictons de calendrier,
rubriques concrtes (cf. Granet, Ftes et chansons anciennes, p.
54
), il existe une autre
rpartition des jours de lanne en 30 (= 5 x 6) priodes de 12 jours (cf. Granet , op. cit., pp. 54
et 132, Kouan tseu, 14 ; Granet, Danses et lgendes..., p. 270, n. 1, et note 902). Dans ces
divers arrangements se rvla la solidarit des classifications par 5 et par 6.
(252) Noter cette action imbrique de 5, multiplicateur de 12 (=6x2) et de 6, multiplicateur de
10 (=5x2).
Marcel GRANET La pense chinoise 361
(253) Jointe lexogamie terri toriale, mais on sait (cf. Civ. Chin.,
178,
204,
et Granet,
Danses et lgendes..., fin de la note 341) quil devait exister use consonance entre le domaine,
lhabitat, le site et le nom.
(254) On sest servi des Pa tseu ds lpoque des Tang, sinon ds le temps des Han. En tout
cas, le Tcheou li (Biot, Le Tcheou li, ou les Rites des Tcheou, t. II, p. 307) montre
quanciennement on tenait compte, dans les appariages, de lanne, du mois, du jour de nais -
sance et du nom personnel.
(255) Granet, Danses et lgendes..., p.
159
. Cet usage suppose que le nom personnel (dont on
sinforme, car il est secret) soutient avec le nom de famille (connu) un rapport ana logue
celui qui existe entre une essence (wou) et une espce (lei). Les noms de famille rvlent une
vertu (t) spcifique (lei), susceptible de quatre particularisations qui (en raison des ides
relatives la rincarnation) semblent avoir correspondu un lot de quatre noms (ming)
distinguant quatre gnrations successives. (Cf. plus haut, p.
88 ;
Granet, op. cit., pp.
368
sqq). Le nom personnel (ming) situe (dans telle famille) la gnration : il exprime une sorte de
rang.
(256) Cf. SMT, I, pp.
169
,
175
,
176
. Larchologie parat avoir confirm la tradition.
(257) Cf. Granet, op. cit., p
158
. Les deux rcits proviennent duvres de date, dinspiration
et de style analogues.
(258) Ibid., p.
157 sqq
. Le principe rituel est que les Esprits ne mangent rien, sinon ce qui (en
raison de la nature de loffrant et de celle de loffran de) est de leur espce (lei).
(259) Ibid. p.
158
.
(260) Cf. Tchouen tsieou fan tou, chap. 13. Tout, dans un sacrifice fait au printemps (Est), se
dispose par 8 (par 7 lt , par 9 lautomne, etc.), et si lon veut alors, par exemple, faire
pleuvoir, il faudra faire danser 8 danseurs, offrir 8 poissons, construire un tertre de 8 pieds de
ct, fabriquer 8 dragons : 1 grand (de 8 pieds de long) + 7 petits (de 8/2 pieds de long), etc.
(261) SMT, III, pp.
308-309
.
(262) Granet, La vie et la mort... pp. 1 sqq. Sept, qui quivaut chen (S-S-W) dans cet
exemple, quivaut, dans lexemple qui pr cde, sseu (S-S-E). Attachs un mme lot
demblmes, des nombres diffrents (72, 12, 2. Cf. p.
127
), peuvent tre considrs comme
quivalents ; de mme, un nombre peut, attach deux lots diffrents, changer de valeur
emblmatique : ceci nest quune simple consquence de la concurrence des systmes divers
de classification.
(263) Tso tchouan, C., III, p.
327.
Extrait dun discours prt Yen tseu, contemporain de
Confucius.
(264) Cf. plus haut, p.
107.
Comp. Yo ki, dans Li ki, C., II, p.
83
. Ces correspondances sont
tablies sous lempire des divers systmes de classification, en parti culier du systme de
classification par 5.
(265) SMT, IV pp. 219 sqq. Le Hong fan, insr titre de chapitre dans le Chou king, a t
aussi incorpor par Sseu-ma Tsien son uvre. La tradition y verrait volontiers un ouvrage
du troisime ou deuxime millnaire av. J.-C. Les critiques modernes lattribuent les uns au
VIIIe, les autres au IIIe sicle av. J.-C. La rdaction du Hong fan ne parat gure pouvoir tre
place plus bas que les VIe, Ve sicles av. J.-C. Elle me semble dater des premiers dbuts de
la littrature crite.
(266) Le P. Wieger, Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques en
Chine, ... p.
57
.
Marcel GRANET La pense chinoise 362
(267) SMT, V, p, 221. Je conserve provisoirement la traduction donne par Chavannes. Se
reporter p.
266 et suiv.
(268) SMT, IV, p. 219, note 5. Cf. Maspero, La Chine antique, 440, note 4.
(269) NAITO On the compilation of the Shoo king et HONDA, On the date of compilation of
the Yi king.
(270) Dialogue entre le fondateur de la dynastie Tcheou et le frre du tyran Cheou-sin, dont la
vertu dcadente provoqua la ruine de la dynastie Yin :palabre correspondant linauguration
dun monde nouveau aprs trans mission dune famille une autre des principes ou des
palladia du pouvoir.
(271) Les 5 lments, comme on va voir, valent respectivement 1, 2, 3, 4, 5, cest --dire pour
leur ensemble (5, emblmes du centre, ne devant pas, comme on verra, tre compt)
1+2+3+4, soit au total prcisment 10 (qui quivaut 1).
(272) Cest moi qui souligne.
(273) Idem.
(274) Chavannes (SMT, IV, p. 219, note 5) dclare singulier lordre suivi par le Hong fan. Il
nhsite donc pas proposer de corriger le texte. Cest quil a commenc par admettre que
les plus anciennes numrations (quil rapporte au IIIe sicle) suivaient un ordre diffrent
(Introduction p.
CXLIII
), lordre dit du triomphe. Comme il attribue au Hong fan une date
antrieure au IIIe sicle, il lui faut donc trouver dans lnumration du Hong fan (la plus
ancienne en fait) une erreur quil corrigera de faon la rendre semblable aux numrations
dabord affirmes plus anciennes. Les successeurs de Chavannes abandonnent sa correction
juge inacceptable, parce quun autre texte confirme la rdaction de ce passage du Hong fan.
Mais ils sabstiennent de rechercher le sens que peut prsenter lordre indiqu en affirmant
tout simplement que les interprtations numriques quon en peut donner sont anachr oniques.
Se reporter pages 204 et 254.
(275) Cette squence correspond ce quon appelle lordre de production des lments. (Voir
pp 255 sqq ).
(276) Sauf pour le couple meou ki (centre), dont les deux signes sont dits tous deux tre les
emblmes du Palais central . Noter que le Yue ling dfinit la Terre par le centre et lui
donne, comme le Hong fan, 5 (et non pas 10) pour emblme.
(277) 5, conserv comme emblme du Centre par le Yue ling, se trouve rserv aux jours (non
dnombrs, mais peut-tre au nombre de 6 et non de 5 car lanne solaire a 366 jours)
qui marquent le pivot de lanne. Cf. p 95.
(278) Les quivalences. Bas : Nord : Eau Haut : Sud : Feu Gauche : Est : Bois
Droite : Ouest : Mtal, sont des donnes essentielles du systme chinois de classifications et
de correspondances. Les formules du Hong fan : LEau humecte et tend vers le Bas ; Le Feu
flambe et tend vers le Haut prouvent nettement :
1 que le Hong fan se rfre ce systme explicitement ;
2 que lnumration des lments implique un dispositif spatial
3 et enfin (puisque les lments sont caractriss par des emblmes numriques) que la
science des nombres nest point dtache dun savoir gomtrique.
(279) Houang ki : 5. Les deux termes du couple dnaire qui correspondent au Centre servent
indistinctement demblmes au Palais Central.
(280) Granet, Danses et lgendes de la Chine ancienne, pp.
482 sqq
.
(281) Ibid., p.
489
.
(282) Voir plus bas.
Marcel GRANET La pense chinoise 363
(283) Lie tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste, p.
131
.
(284) Granet, Danses et lgendes..., pp.
568
,
244.
(285) Ibid., notes 1284 et 1285.
(286) Cest lempereur Houei -tsong des Song (1101-1125).
(287) On verra plus loin quelles semblent remonter pour le moins au Hi tseu, uvre peine
moins ancienne que le Hong-fan.
(288) Tcheou li, Biot, op. cit., II. pp. 75, 70.
(289) Laxe mdian s appelle le chemin (lou ou tao) des 1 000 stades (li).
(290) Granet, op. cit., notes des pages 116-119.
(291) Ta Tai Li ki, 66.
(292) Tcheou li, Biot, op. cit., t. II, p. 70 ; SMT ; IV, pp. 226-227 ; Yi king, L., 369 note et p.
371.
(293) Yi king, L., 365.
(294) Tsien Han chou, 98, p. 7 b.
(295) SMT, I, pp.
3-7
.
(296) SMT, I, pp. 3-7.
(297) SMT, III, p.
484.
(298) Je ne soutiens pas que les trigrammes ont t dessins avant les hexagrammes. Cest l
un point impossible dcider. Mais je ne crois pas quon ait pu, les 82 hexagrammes une fois
forms, ne pas voir quils se ramenaient 8 trigrammes. Maspero croit lantriorit des
hexagrammes. Il justifie cette hypothse (contraire aux traditions chinoises) laide de
raisonnements que je ne parviens pas comprendre et dont le point de dpart est une lourde
erreur dobservation [ n. css : cf. aaa]. Maspero affirme que, sauf le premier couple
dhexagrammes, tous les autres couples sont forms par retournement, le deuxime
hexagramme de chaque couple tant le premier retourn. Mais les couples 27-28, 29-30,
61-62, ne risquent gure dtre forms par retournement. Ils sont forms dhexagrammes
parfaitement symtriques qui, si on les retourne, se reproduisent eux-mmes. Au reste, il serait
facile, mais un peu long et hors de notre sujet, de prouver que lordre suivi par le Yi king
implique lide que les hexagrammes sont faits de deux trigrammes super poss.
(299) Ceci ne vaut pas pour les carrs magiques du type ci-dessous (dont je nai dailleurs
trouv aucune trace dans la littrature chinoise ancienne).
Marcel GRANET La pense chinoise 364
Notes 300 399 :
(300) Lide que les Tr igrammes sont, en mme temps, des Orients et des Nombres nest pas
un jeu drudit : elle inspire de nos jours encore une mthode dinvesti gation rpandue dans
tout lExtrme-Orient, et par exemple chez les Man du Tonkin (cf. BEFEO, VII, 109 ; lauteur
de lobserva tion nen a pas vu tout lintrt parce quil a cru quil sagissait de la disposition
de Fou-hi).
Comment dterminer, par exemple, la partie de la maison o une femme enceinte doit
sinterdire de planter des clous, sous peine de clouer son fr uit ? On commence par diviser la
maison en neuf emplacements dsigns par le caractre centre et les noms des huits
Trigrammes (orients daprs la disposition du roi Wen). On crit ensuite sur sa main ces huit
noms et le mot centre : ce dernier se place sur la deuxime phalange du mdius ; de chaque
ct (dune part, sur le deuxime mtacarpien et les trois phalanges de lindex ; dautre part,
sur les trois phalanges de lannulaire et le quatrime mtacarpien) sont inscrits les noms des
huit Trigrammes (qui se trouvent ainsi placs dans lordre que leur affecte la numrotation de
Tcheng Hiuan). En suivant cet ordre (sens des flches), on compte, partir dun point
dtermin par le fait que lanne de la conception est yin ou yang (cest --dire quelle occupe
une place paire ou impaire dans le cycle sexagsimal), autant de stations que contient
dunits le numro du mois o sest faite la conception : le Trigramme sur lequel on sarrte
rvle lorienta tion interdite. Soit un enfant conu au sixime mois de la premire (impair)
anne du cycle : on part du centre (impair : 5) et, comme la sixime station dans lordre des
flches (et de la progression des nombres), on arrive Kan () Tri gramme du Nord, on sait
que la partie nord de la maison doit tre taboue. On notera que les nombres qui, dans les
deux colonnes, se font face, font un total de 10 (5 tant au centre) : cette disposition en double
colonne a la mme valeur que la disposition en carr magique, sauf que, par elle-mme, elle
nindique aucune orientation.
(301) La fin des premiers Han et le dbut des Han postrieurs forment une poque (environs
de lre chrtienne) o, pour des raisons politiques (comme par exemple sous les Song),
abondrent les ouvrages sur le Yi king et les diagrammes magiques. Ces ouvrages (qualifis de
wei) constituent une tradition que les rudits, indignes ou autres, estiment impure : il serait
peu critique de les suivre et de dater des Han tout ce qui nest pas attest avant les Han. Au
reste le Ta Tai Li ki appartient la tradition orthodoxe, et puisque Tcheng Hiuan corrobore
son tmoignage, il y a prsomption en faveur de la thse que le prestige du carr magique est
antrieur aux Han.
(302) Yi king, L., 369.
(303) Tso tchouan, C., II,
236
.
(304) Yi king, L., 375.
(305) Ibid., pp. 58, 423.
(306) Ibid., pp. 388, 422.
(307) Voir figure 06 : disposition dite du roi Wen.
(308) Voir figure 05 : disposition dite de Fou-hi.
(309) Po hou tong, 4. Les lments sont alors numrs dans lordre, Mtal, Bois, Eau, Feu
(Terre), ordre qui drive des quivalences tablies par le Chouo koua (Yi king, L., pp.
430-432) les Trigrammes tant numrs dans un ordre qui suppose la disposition de
Fou-hi entre Kien et le Mtal ; Siuan et le Bois, Kan et lEau, Li et le Feu (ce qui suppose
que Kien et le Siuan sopposent ainsi que Kan et Li : or ceci nest vrai que dans la
disposition du roi Wen : preuve que les deux dispositions simpliquent lune lautre, loin
dtre considres comme contradictoires).
Marcel GRANET La pense chinoise 365
(310) Yi king, L., 365.
(311) Le plus petit multiple commun de 360 et 384 est 11520/2. Lanne luni -solaire (6 mois
de 29 et 6 mois de 30 jours) tant de 354 jours, et les Chinois estimant 366 jours lanne
solaire (diffrence 12 jours), on intercalait, tous les cinq ans (12 x 5 = 60), 2 mois de 30 jours
(30 x 2 = 60) ; la 3
e
et la 5
e
anne dun cycle cinq ans comptaient donc (354 + 30 =) 384 jours.
Noter limportance du cycle de 5 ans, celle de lintercalation de 60 jours et le fait que le
rapport du nombre des annes normales et des annes embolismiques est de 3 2.
(312) Tsien Han chou, 21a, p. 9a.
(313) Je dis carr, mais le Ciel est rond, et il y a lieu de supposer que la distance cleste des
nombres doit, en quelque manire, voquer le cercle. Larrangement en octogone propre aux
trigrammes a sans doute le mrite dimpliquer une participation du cercle et du carr. (Cf.
infra, p. 266-268).
(314) Tcheou li, Biot, op. cit., t. II, p. 108.
(315) Yoshito Harada, Lo Lang p. 39 du rsum en anglais ; p. 61, du texte japonais, figure 27
et planche CXII. Le fait que les planchettes pivotantes sont lune en bois dur, lautre en bois
tendre, impose lide que linstrument imite un ancien ustensile faire du feu. Cette remarque
nest peut -tre pas sans porte, car diffrentes traditions littraires ou rituelles conservent le
souvenir dun instrument servant obtenir le feu par friction grce un mouve ment rotatoire.
Cet instrument tait peut-tre encore utilis en certains cas lpoque fodale Je dois ici
me borner signaler (rservant pour un autre ouvrage ltude dtaille) lexistence de tout un
lot de donnes mythiques attestant la liaison du thme du feu et des thmes de la giration, de
la roue et du pivot joints aux thmes de la balanoire, du mt de cocagne, du gnomon. On
trouvera (p. 264) lindication du rapport de certains de ces thmes avec la notion de Tao et
avec les pratiques hirogamiques. Jajouterai simplement que linvention de la dispositi on des
trigrammes dite du roi Wen (en rapport, comme je viens de le montrer, avec le carr magique,
cest --dire avec un arrangement de nombres voquant la svastika), est rattache par la
tradition une preuve subie par lapprenti -chef. Cette preuve subie au cours des ftes de la
longue nuit aboutit au renouveau de lanne et des vertus royales, et les ftes sachvent
quand on rallume les flambeaux. Or le thme des flambeaux rallums parat li tout un
ensemble de pratiques et de mtaphores en rapport avec lide de hiroga mie.
(316)Yi king, L., 365.
(317) Tchouen tsieou fan lou , 7.
(318) Renseignements tirs du Tchou chou ki nien et du chapitre 27 du Song chou.
(319) 5 (x) et 10 (+) scri vaient anciennement laide dune croix.
(320) Yi king, Ibid., p. 365 et note p. 368. Legge crit : But how could such a process be of
any value to determine the days necessary to be intercaled in any particular year ?
(321) Tous deux taient emports la guerre sur le mme char : Tcheou li, Biot, op. cit., t. II,
p. 108.
(322) Tome VI des Mmoires concernant lhistoire... des Chi nois.
(323) App. 2 du tome III de SMT, pp.
630-645
.
(324) SMT, III, p.
640
.
(325) SMT, III, p.
643
.
(326) Lu che tchouen tsieou, 5. Le cheng est une espce dorgue bouche. Les cheng,
dit-on, avaient anciennement (19 ou) 13 tuyaux. Les cheng de 13 tuyaux sont faits de 6 tubes,
Marcel GRANET La pense chinoise 366
placs droite dun tuyau central, et de 6, placs ga uche, disposs de manire imiter les
deux ailes dun oiseau.
(327) Granet, Danses et lgendes..., p.
577
.
(328) Voir plus haut.
(329) SMT, I, p. 6. Jai dj signal limportance des nuds, dans la thorie de la
divination dont jai montr, par ailleurs, les rapports avec les spculations sur les nombres.
(330) SMT, III, pp.
293 sqq
.
(331) Lu che tchouen tsieou, 5 (IIIe sicle avant J.-C.).
(332) Granet, Coutumes matrimoniales de La Chine antique (Toung pao, 1912).
(333) SMT, III, p.
304
.
(334) SMT, III, p.
631
. Le systme des 12 tuyaux correspond une progression de 12
quintes justes ramenes dans lintervalle dune seule octave et touchant ai nsi successivement
les 12 demi-tons dune gamme chromatique non tempre .
(335) SMT, III, p.
632
et p.
637
. Lu Pou-wei compte 7 tubes produits par gnration
suprieure contre 5 produits par gnration infrieure : il les dnombre par ordre de grandeur
et ne fait figurer parmi les derniers que le 2
e
tube et ceux dont la longueur est infrieure.
(336) Kouan tseu, 58.
(337) Invention des 6
e
et 7
e
notes avec deux rductions successives loctave. On
remarquera combien la srie : 108, 96, 84, 72, 64 est proche de la srie 105, 94, 83, 72, 61,
(50) [Intervalle : 11] inscrite sur le pourtour des carrs magiques. Le nombre qui, dans cette
dernire srie, vient aprs 50 est 39. Or (39+81) / 2 = 40 et le Lu che tchouen tsieou, dans le
passage o il raconte linvention des douze tubes, indique que le tube initial (considr
comme central) vaut 39. Les glossateurs, embarrasss, remarquent que 39 doit sexpliquer
par une imbrication (kiao) avec 81 : cest --dire, je suppose, par le fait que 81 + 39 rduit de
moiti fait 40 (13
e
tube, tube central donnant, la diffrence dune octave, la mme note que
le 1
er
tube. Cf. p. 194 et note 345.
(338) Lexactitude de ce dernier rapport disparat ds quon donne au 5
e
tube la valeur 64
(=48x(4/3)). Voir plus loin p.
187 -188
.
(339) Voir plus bas, p.
123
.
(340) SMT, III, p.
316
.
(341) Li ki, C., I, p.
519
5 notes, 6 tubes mles, 12 tuyaux qui donnent successivement la
note initiale (kong) .
(342) SMT, III, p.
314
(343) Houai-nan tseu, 3. Houai-nan tseu, comme Lu Pou-wei, indique que les 6
e
et 7
e
tubes
sont produits par gnration suprieure ; il donne cependant la rpartition par mois impliquant
que le 6
e
est un tube femelle.
(344) On pourrait, la rigueur, dire 4 cas, puisque 42 vaut les 2/3 de 63 et les de 56. Mais
42, tir de 63 et non de 64, se ressent de son origine inexacte.
(345) Chavannes (SMT, III, n. a32.106) suppose lexistence dun 13
e
tuyau dont la longueur
tait exactement la moiti du premier . Si lon suppose que le premier rend la note fa, le dou-
zime donne le la dise, le treizime le mi dise que les Chinois, selon Chavannes,
quivalaient au fa.
Marcel GRANET La pense chinoise 367
(346) 357 figure (comme on verra p. 288) parmi les dimensions caractristiques de lUnivers,
que les Chinois disaient avoir obtenues laide du gnomon. Il y figure ct de 360.
(347) Notons que, dans le systme des 12 tubes, le 1
er
devrait tre voqu par 84 si lemblme
du dernier tait senti comme quivalant 63 afin de parfaire 360 le total (357) des valeurs
numriques attribues aux 6 derniers tubes.
(348) Chavannes, pour expliquer la thorie des 12 tubes, en suppose un treizime qui serait
exactement la moiti du premier (SMT, III, p. ?463).
(349) Ou encore quil choist des bambous de sections lgre ment diffrentes.
(350) On considre 5 tubes et on donne des noms 5 notes, mais loctave (en lespce) em -
brasse 6 notes : merveilleuse combinaison de 5 (Terre, carr) et de 6 (Ciel, rond).
(351) Cest ce que semble dire Houai-nan tseu (chap. 3) : Les notes sengendrent les unes
les autres laide de 8 : aussi lhomme est-il haut de 8 pieds. (Voir plus loin p.
226
).
(352) SMT, III, p.
316
. La neuvaine suprieure est ceci : chang, 8 ; yu, 7 ; kio, 6 ; kong,
5 ; tche, 9 . Il faut, on va le voir, corriger ainsi : kong, 5 ; tche, 7 ; chang, 9 ; yu, 6 ; kio,
8.
(353) Jcris en dautres temps ou en dautres milieux parce quen fait, ainsi quon va le
voir, les diviseras 9 et 8 ont t utiliss concurremment, mais pour des units diffrentes.
(354) Mais il ny a aucune conclusion historique tirer de cette donne. Les Yin mesuraient
en sin de 8 pieds, mais divisaient le pied en 9 pouces, tandis que les Tcheou, sils mesuraient
en nattes de 9 pieds de long, divisaient le pied en 8 pouces. Les indices numriques adopts
par les dynasties servent sectionner des units de mesure qui ne sont point les mmes, de
faon que les nombres puissent diffrer sans que, pour cela, les grandeurs diffrent. (Voir plus
loin )
(355) SMT, III , p.
644
.
(356) Maspero, La Chine antique, p. 440, note 2. Maspero crit : Pour lexplication par la
correspondance avec les points cardinaux, cf. Granet, Religion des Chinois, mais lintro -
duction dans la discussion des passages numriques du Hi tseu me parat un anachronisme.
Je nai ni institu de discussion (dans ce passage de la Religion des Chinois), ni utilis
cette occasion les donnes du Hi tseu. Il ny en a, en lespce, aucun besoin.
(357) SMT, Introduction, p.
CXCI sqq
.
(358) Cf. infra,.
(359) Voir plus haut et plus loin.
(360) Ta Tai Li ki, 66, gloses (HTKKSP, 828, p. 11a et HTKK, 705, p. 9b) ; Wou li tong
kao, XXVI, pp. 20 sqq.
(361) Voir plus haut, p.
191
.
(362) Voir plus haut, p.
181
.
(363) Ta Tai Li ki, 66.
(364) Tcheou li, Biot, op. cit., t. II, pp. 556-561.
(365) Ibid., t. II, p. 560, note 1. Biot crit ingnument : sa longueur tant de 7 sin, sa largeur
avait environ le quart en sus, ce qui fait 9 sin (plus exactement la longueur tait de 56 pieds, la
largeur de 70 pieds) .
(366) Ibid., t. II, p. 561.
Marcel GRANET La pense chinoise 368
(367) Cet emblme est, en les pce, lemblme ou le classifica teur dynastique.
(368) Tcheou li, Biot. op. cit., t. I, p. 227. Signalons ici quune tradition veut que le tsing
(carr de 9 champs) ait mesur sous les Yin ou dans le pays de Song 630 arpents (meou) (Cf.
Maspero, La Chine antique, p 110).
(369) Et les tubes musicaux yang ou yin. (Voir plus haut, p.
185
).
(370) Tcheou li, Biot, op. cit., t. I, p 490 ; t. II, p 524.
(371) Voir plus haut, p.
166
et plus loin, p.
231
.
(372) Contour terrestre (carr de ct 9), contour cleste (circonfrence de diamtre 12 ou
hexagone de ct 6), ou mme contour terrestre et cleste trapze form dun demi -hexagone
de ct 72 (ou 3 x 72, soit 216) et dune base de valeur 144 (=2 x 72).
(373) Tcheou li, Biot op. cit., t. II, p. 477.
(374) Sur la date du Tcheou pei, voir p. 508, note 538. La traduction du Tcheou pei, parue
dans le Journal asiatique en 1841, est due Ed. Biot, dont le pre, lastronome J. -B. Biot,
a ajout un commentaire clbre la traduction. Le scnario du Tcheou pei ressemble celui
du Houang-ti nei king et celui du Hong fan. Il met en scne le frre du roi Wen, fondateur
des Tcheou, qui interroge un savant sur les origines de la science des nombres et des mesures
des dimensions clestes. Lopus cule abonde en formules techniques trs obscures qui
alternent avec des formules desprit sot rique ; ces dernires reviennent toutes affirmer que
le Ciel est le cercle, la Terre le carr, et que le Cercle provient du Carr.
(375) Voir p. 288.
(376) A. Rey (La science orientale, p. 394) sest inspir de la description donne par Biot des
figures du Tcheou pei pour contester une interprtation suggre par Zeuthen et reprise par
Milhaud. En fait ces figures, telles quelles sont dessines dans les meilleures ditions du
Tcheou pei (celles, par exemple, du Sseu pou tsong kan), justifient la suggestion de Zeuthen.
(377) Il ne faudrait pas dire que les Chinois attribuent lhypotnuse du triangle rectangle
isocle de cts 5 et 5 la valeur 7. La figure 19A montre que la diagonale ne se confond pas
avec le ct du carr.
On sait que Fou-hi est le patron des devins qui utilisent 49 baguettes. Lemblme de Fou-hi
(cf. Civilisation chin., pp. 19-21, ) est une querre branches gales, semble-t-il. Je croirais
volontiers que cest l lquerre 5, 5, 7 (ou 10, 10, 14). Le Tcheou pei professe que le rond
sort du carr. Or le diamtre des roues (Tcheou li, Biot, op. cit., t. I, p. 471) est 7, et 14 ou
7 x 2 mesure le diamtre de la roue cosmique dont lHomme, qui a pour taille 7, est le
rayon.
(378) Le P. Gaubil avait dj remarqu que la formule 3+4+5=(3 + 4) +1 est implique par
les rgles de la pratique divinatoire nonce par le Hi tseu (Lettres difiantes, t. IX, p. 435).
Les deux carrs magiques ( centre 5 et 6) superposs comprennent au total 18 nombres.
Ils tournent autour dun pivot (11) qui vaut peut -tre comme un 19
e
nombre ; or, 19 = (4 x
90) + 1 = 360 (+ 1, carr central).
(379) Sur le thme du couteau et de la lune brche, voir Granet, Danses et lgendes..., p.
535, et sa note 2 ; p. 533, note 1 ; pp. 533 et 534.
(380) Tcheou li, Biot, op. cit., t. II, p. 492. Daprs les commentaires, il sagirait de couteaux
crire. Le couteau, arme courbe, et qui pourtant se porte droite, bien que la droite soit yin et
que le rond soit yang, est essentiellement une arme yin, car il est lemblme de la Lune, tandis
que lpe (droite) est lemblme du Soleil. (Cf. Granet, op. cit., p. 498, note 2, in fine.)
Marcel GRANET La pense chinoise 369
(381) Le compas, emblme fminin, insigne de Niu-koua, sur de Fou -hi (premier magicien
et porteur de lquerre voir plus haut, plus bas) est fait (cf. Civ. Chin) de deux droites ou
tringles qui se coupent, formant une croise (croix simple).
(382) Tcheou li, Biot, op. cit., t. II, p 476.
(383) Ce que nous appelons ici la hauteur correspond au rayon rel dune roue vide lint -
rieur en forme dhexagone. Le rapport 7/8 est celui de la dimension dun rai la dimension du
rayon de la circonfrence forme, extrieurement, par la jante.
(384) Voir plus loin, p.
287
.
(385) Tcheou li, Biot, op. cit., t. II, p. 476.
(386) Id., Ibid., t. II, p. 571.
(387) Comme le montre une terre cuite reprsentant une maison conserve au Muse
Cernuschi, reproduite dans Goldschmidt, Lart chinois, p. 71.
(388) Cf. le Tou touan de Tsai Yong, dans Han Wei tsong chou.
(389) Ibid.
(390) On a prtendu, sous les Souci, que le Ming tang des Tcheou tait carr : on le mesurait,
disait-on, du Nord au Sud avec 7 longueurs de nattes, soit 7 x 9 = 63 et de lEst lOuest avec
9 largeurs de nattes, soit 9 x 7 = 63.
(391) Tcheou li, Biot, op. cit., t. II, p. 462.
(392) Ibid, t. II, p. 463. Si la taille de lhomme est 8 pieds, llvation de la caisse au -dessus
du soi est 4 ; la hauteur du dais (2 x 4) + 2 ; le bton darrt (quon pourra incliner sur les
parois de la caisse, ayant 6,6, de faon dpasser de), 4 ; le bton de combat : 8 x 3, etc.
(393) Ibid., t. II, p. 539. Noter la remarque des interprtes : La roue du potier peut dtermi-
ner la forme carre comme la forme ronde des objets.
(394) Ibid., t. II, pp. 574 sqq.
(395) Civ chin.
119
.
(396) Tcheou li, Biot. op. cit., t. II, p. 504. Ltalon de capacit est une sorte de cloche de
bronze (qui doit rendre le mme son que le houang tchong, tube initial), carre 1 intrieur
(yin), ronde lextrieur ( yang). Lintrieur me sure 1 pied carr et contient un fou, soit 64
cheng. Le dessous de la cloche, qui est creux, contient un teou (4 cheng) et les oreilles de la
cloche mesurent le cheng. Quatre teou font un kiu (16 cheng) ; quatre kiu (64 cheng) font un
fou.
(397) Le Chouo wen dfinit 3 comme la voie (tao) du Ciel et de la Terre. 3 est une synthse
comparable 11 (Voir p. 166).
(398) Yi (Un) donne lide de lindivis plus que de lunit. Em ploy adverbialement, yi
signifie 3 entirement, du tout au tout.
(399) Lao tseu, Le P. Wieger, Les Pres du systme taoste, p.
27
.
Marcel GRANET La pense chinoise 370
Notes 400 499 :
(400) Sur 3, voir Granet, La Polygynie sororale et le Sororat dans la Chine fodale, p. 27 et
Id., Danses et lgendes... (Index).
(401) Au tube initial (qui, comme le gnomon, vaut 81) soppose lta lon de capacit (qui vaut,
on la vu, 64).
(402) Voir p.
270
.
(403) Le diagramme clbre du Tai ki (le Fate suprme : sur le mot ki, fate, voir plus loin, p.
266
) est une illustration de cet idal. La figure prtend montrer lunion du Yin et du Yang,
au moment o ils produisent les 10 000 tres. Le Yin (sombre) et le Yang (clair) sont enclos
dans un cercle dont chacun occupe la moiti. La ligne qui les spare et qui serpente autour
dun diamtre est faite de 2 demi -circonfrences ayant, chacune, un diamtre gal la moiti
du diamtre du grand cercle. Cette ligne vaut donc la demi-circonfrence. Le contour du Yin,
comme celui du Yang, est gal au contour qui les enferme tous les deux. Si lon rempla ait
la ligne de sparation par une ligne faite de 4 demi-circonfrences de diamtre deux fois plus
petit, elle continuerait valoir la demi-circonfrence ; il en serait toujours de mme si lon
poursuivait lopration, et la ligne sinueuse tendrait se confondre avec le diamtre : 3 se
confondrait avec 2.
Le Tai ki est mentionn par le Hi tseu (o il parat en rapport avec la disposition
octogonale des trigrammes) dans le paragraphe o sont nomms le Lo chou et le Ho tou (Yi
king, L., p. 373) ; il y a des chances que, ds le temps du Hi tseu, le Tai ki ait t imagin
comme la forme indtermine (je ne puis dire la limite) vers laquelle tendent la ligne forte
(impair, 3 demi-circonfrence, 3 cts dhexagone), cest --dire le Yang, et la ligne faible
(pair, 2, diamtre, 2 cts dhexagone) cest --dire le Yin. Un thme graphique analogue
celui du Tai ki se retrouve dans liconographie ancienne : cest le motif du dragon enlaant la
colonne (sur le thme de lascension et ses rapports avec lide de ki (fate) et de tao ; voir pp.
263 sqq.
Le diagramme du Tai ki napparat, comme les diagrammes du Lo chou et du Ho tou que
sous les Song. Seules, des trouvailles archologiques pourront dire sil est plus ancien. En tout
cas, les lments de cette construction graphique existaient ds lAntiquit.
Les joyaux de jade, que les Japonais appellent magatama (lun de ces joyaux est, avec le
Miroir et lpe, lun des trois palladia de la famille impriale) ont une forme qui ne parat
pas diffrente du demi-Tai ki (partie Yang ou partie Yin). On vient de retrouver, dans le Sud
de la Core, des magatama ornant les colliers dun homme et dune femme. La littrature
chinoise ancienne ne parle pas de ces jades en forme de crochet, mais elle qualifie le croissant
lunaire de lune en forme de crochet . La lune est associe au jade. Le diagramme du Tai ki
tait considr sous les Song comme un emblme des phases de la lune.
(404) L. De Saussure, Les origines de lastronomie chinoise, p. 100. Une figure (p. 101) mon-
tre lingalit des 24 mansions. La moyenne des palais quinoxiaux et solsticiels est : 7315
et 10650, soit peu prs 73 et 107 (i bid). La proportion est peu prs 108/72 ou 9/6.
Lhiver, du solstice la fte du manger froid, durait (compris les 3 jours de cette fte) 108
jours.
Kouan tseu (chap. 3), partant dune division de lanne en 30 priodes de 12 jours (15 pour
lt et le printemps, 15 pour lhiver et lautomne) attribue 96 jours au print emps et
lautomne, et 84 jours seulement lt et lhiver : en ce cas les secteurs quinoxiaux sont
plus grands que les secteurs solsticiels. Remarquer que Kouan tseu oppose le printemps
lt et lautomne lhiver selon le rapport 8/7.
(405) SMT, III, p.
311
.
Marcel GRANET La pense chinoise 371
(406) SMT, III, p.
301
. Les interprtes affirment que les Sept Recteurs sont le Soleil, la Lune
et les Plantes ; mais propos dun autre passage du Chou king, o il est question des Sept
Recteurs, il apparat que cette expression, au moins pour Sseu-ma Tsien, dsi gnait la Grande
Ourse. (Cf. SMT ; I, p. 58 et la note 2). Tong, mettre en communication, voque lide de
circuit ; ki , (influence), souffle, lid e de rythme. La phrase du Chou king veut sans doute
veiller le sentiment dun double rythme circulaire terrestre (lments et Vents) et cleste
(Mansions et Recteurs). Noter cette mention ancienne des 5 lments et leur rapprochement
avec les 8 Vents.
(407) SMT, III, pp.
293 sqq
.
(408) SMT, III, pp.
308
,
309
et tableau de la page
302
. Le fait que le vent du plein Sud ne
correspond aucun des 12 mois doit-il tre mis en rapport avec lexis tence thorique dun 13
e
mois ? Ce 13
e
mois est affect une priode postrieure au 7
e
mois, fin de lt. La division
de 360 par 28 donne peu prs 13 (364 = 28 x 13).
(409) SMT, III, p.
308
.
(410) Voir plus haut, p.
134
.
(411) Voir p.
90
.
(412) Granet, Danses et lgendes...,pp.
252 sqq
.
.
(413) Granet, op. cit., pp.
254 sqq
.
.
(414) Ibid., p. note 599.
(415) Civ. chin.
221 sqq
.
(416) Granet, Danses et lgendes., pp.
253
, note 570, note 975, note 583. Les 19 Soleils sont
affects chacun des 10 jours du cycle dnaire.
(417) Ibid., pp.
377
et
399
.
(418) Ibid., pp.
238
,
277
.
(418b) Ibid, pp.
238
,
257
. SMT, I, p.
77
. Tso tchouan, C., I. pp.
553
et
554
.
(419) Voir plus haut, p.
155
.
(420) Cette projection triple se rptant sur deux plans, aux 9 Provinces de la Terre
correspondent les 9 Rgions du Ciel.
(421) Granet, op. cit., note 595.
(422) Ibid., p.
264
.
De mme, le souverain Tchouan-hiu (Ibid., p. 243, note 4) eut 3 fils,
disent les uns, 8 fils, disent les autres. Il eut aussi 1 fils qui tait une tortue 3 pattes. Ce
dernier trait se rapproche la fois du thme de la danse par 3 (sur 1 pied) et du thme des
chaudrons 3 pieds. Le hibou corps triple (Ibid., 523) [qui soppose la tortue 3 pattes
(Ibid., 248)] est le double et 1 antithse du corbeau 3 pattes (thmes du Soleil et
lAmi -Soleil, Ibid., 527 sqq.).
(423) Granet, Danses et lgendes,
264
.
.
(424) Civ. Chin.
300
.
(425) Danses et lgendes,
616 sqq
, note 1667 ; Civ. Chin. p.
229
.
Marcel GRANET La pense chinoise 372
(426) Voir figure 19b de la p.
221
.
(427) Je croirais volontiers que Biot ne sest pas tromp en affir mant que les mansions ont t
dabord 24 et non 28 [les 24 fuseaux primitifs tant lis la division horaire du jour et les 4
fuseaux supplmentaires (8
e
, 14
e
, 21
e
, 28
e
) tant lis lanne tro pique]. Sur ce point voir A.
Rey, La Science orientale, p. 377 sqq. La question, controverse, nentre pas dans le sujet de
cet ouvrage. Je me bornerai remarquer que le classificateur 7 [(li lide daxe, de taille
humaine (voir p. 225) et de dimension du rai de la roue cosmique (voir p. 226)] est employ
surtout mesurer le temps rituel en raison de la formule 10 = (3 + 4) + 3 = 3 + (4 + 3) (voir p.
86).
7 nest pas un diviseur de 360. Quand on compte 28 mansions, on doit les combiner, ds quil
sagit de diviser en secteurs le contour du Ciel, avec les 8 Vents (Voir p. 235) car 28 -i- 8 =
36.
(428) SMT, IV, 219 .
(429) Tcheou li, Biot, Le Tcheou li, ou les Rites des Tcheou, t. I, 43 sqq.
(430) Voir p.
307
p.
318
le rle des indices numriques dans la thorie du microcosme.
(431) Li ki, C., I,
550
.
(432) Cf Granet, La polygynie sororale..., 37 sqq. Cf. supra p. 83.
(433) Li ki, C., II,
335
.
(434) Ibid., I.,
326
.
(435) Ibid., I,
547
.
(436) Ibid. II,
184 ;
II,
548
; II,
141 ;
II,
543
. Les officiers et les grands officiers sont
enterrs au 3
e
mois ; leur temple ancestral comprend 3 chapelles (ils ont 3 anctres qui ils
rendent un culte personnel). Les seigneurs ont 5 chapelles dans leur temple ; on les enterre au
5
e
mois ; le roi a 7 chapelles, on lenterre au 7
e
mois. Les pleurs continuent deux mois aprs
lenterrement dfinitif ( partir du rang de grand officier) : do les nombres, 3, 5, 7, 9.
(437) Tcheou li, Biot, op. cit., II, 596.
(438) Ibid., II, 596.
(439) Voir p.
127
.
(440) Tso tchouan, C., II,
59
.
(441) Sur la ncessit de lunani mit dans les Conseils, voir Civ. Chin. p.
326 sqq
.
(442) Jai rapproch, en 1913, la notion de tao de la notion de mana (in Coutumes
matrimoniales de La Chine antique). Toutes mes lectures, depuis lors, mont confirm dans
lide que ce rappro chement tait juste. De mme que la conception de mana demeure latente
dans les socits les plus archaques et ne commence tre exprime que dans des
civilisations plus volues, lide de tao, latente en Chine ds le temps o furent conus les
Marcel GRANET La pense chinoise 373
Emblmes Yin et Yang, ne sest dgage quau moment o les Chinois adoptrent une
organisation hirarchise : elle en porte la marque.
(443) Voir, par exemple, Tchouang tseu, Le P. Wieger, Les Pres du systme taoste,
287
,
ibid.
417
.
(444) Cest le thme principal du Tchong yong (Li ki, C., II,
427 sqq.
; Civ. Chin.).
(445) Tchouang tseu, chap. Tien hia, Wieger, op. cit.,
499 sqq.
(446) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
255
, et Houai-nan tseu, II ; Granet, Danses et
lgendes..., note 1428.
(447) Che king, C.,
351
; Granet, Le dpt de lenfant sur le sol, 31.
(448) Civ. Chin.
278
; Granet, Ftes et chansons anciennes
79
,
197
.
(449) Civ. Chin. :
21
,
25
.
(450) SMT, Introduction, p.
CXLIV
.
(451) Maspero, La Chine antique,
483,
440.
(452) Ibid., note 684.
(453) SMT, chap. LXXXIV. [cf. note 450].
(454) SMT, Introduction, p.
CXLIV
.
(455) SMT, Introduction., 1. c.
(456) SMT, Introduction, note 230.
(457) Civ. Chin.,
42 sqq
. Sur lhistoire traditionnelle et ses cadres, voir Ibid..
(458) Voir plus haut, le rapprochement tabli entre la thorie des 5 Vertus, les rgles du culte
ancestral et les divisions du groupe familial.
(459) Les Tsin, qui sattribu rent lEmblme de lEau, mirent en honneur le Noir, la Svrit,
etc., et adoptrent, pour la division de lunit, lindice ou le clas sificateur 6 : 6 pieds firent un
pas, les attelages eurent 6 chevaux. Cf. Civ. Chin.).
(460) Si la disposition en croise (Ho tou) des nombres, des notes, des Saisons-Orients et des
lments, mrite de passer pour une image du monde, cest quelle fait clater la cohrence de
divers systmes de classification. Cette image parat efficace, car elle fait voir que lordre de
production des emblmes musicaux reproduit lordre naturel des saisons et tient compte dune
opposition des 1ments qui parat, elle aussi, naturelle. Ce sont les nombres qui rendent la
cohrence manifeste do leur prestige et celui des classifications numriques.
(461) Voir plus haut, p.
91
.
(462) Voir plus haut, p.
155
.
(463) Le carme chinois commence au 3
e
jour du 3
e
mois (dernier mois du printemps),
105 jours, dit-on, aprs le solstice dhiver. ( On a vu que 105 caractrise le Nord, dans le carr
magique centre 6). Aux bombances de la morte-saison, saison des morts qui se termine
lorsque les vivants renvoient dans leurs demeures souterraines les mes des dfunts et
sapprtent reprendre les travaux de la vie profane, succde une priode de starvation quasi
volontaire : cest le moment choisi pour les divers jeux (balanoire, mt de cocagne) destins
assurer le succs des cultures.
Marcel GRANET La pense chinoise 374
(464) Maspero, p.
440
.
(465) Ibid., p.
440
. Maspero crit : (Les lments) sont tout simplement les cinq
substances relles qui portent ces noms (Eau, Feu, Bois, Mtal, Terre), et ils en ont les
proprits physiques . Je ne suis pas sr de comprendre Maspero et le sens quil donne
lexpression substance relle quand, par exemple, il lapplique au Feu.
(466) Cest la section II du Hong fan [css06] : elle suit immdiatement la section consacre
aux Cinq lments. (Cf. infra
308,
313 )
.
(467) Voir plus haut, p.
164
.
(468) SMT, I,
164
.
(469) On a vu que 3 dnombre la moiti du total 6.
(470) SMT, IV, 221.
(471) Tso tchouan, C., III,
380
, et Ibid, I,
468
. Les six magasins sont mentionns ct des
9 chants : ces derniers sont en rapport avec les 5 notes et, par suite, avec les 5 lments. Je
pourrais multiplier les exemples sur la solidarit des classifications par 5 et 6 (Voir Granet,
Danses et lgendes..., Index aux mots Cinq et Six). Je signalerai pourtant un passage du
Chouen tien (SMT, I,
59-61
) ; aucun texte nest plus vnrable. Il y est question dun sacrifice
aux Six Tsong (considrs dordinaire comme les Six Domaines ou Agents clestes, les
lments) et, immdiatement aprs, dune distribution des Cinq Insignes (aux Cinq
Catgories dofficiers).
(472) SMT, I,
101
.
(473) SMT, I,
127
.
(474) SMT, I, n. 02.219, et
140
.
(475) SMT, I,
146
.
(476) On qualifie de Voie (Tao) Cleste le chemin circulaire du Soleil.
(477) Che king, C.,
424
.
(478) SMT, III,
323
. Je traduis, ici, par dieux le mot chen, qui dsigne toutes les
puissances sacres, les Chefs, comme les Divinits auxquelles, seuls, ils pouvaient rendre un
culte.
(479) SMT, III,
325
. Ce thme se rattache la fois aux mythes de la sparation du Ciel et de
la Terre et la distinction des rites religieux (publics et dintrt public) et des rites magiques
(privs et fins prives).
(480) SMT, I,
103 sqq
.
(481) Civ. Chin.
119,
140.
(482) Granet, Danses et lgendes..., pp.
238 sqq
.
(483)
Voir plus haut, p.
81
.
(484) Voir plus haut, p.
166
.
(485) Jindique ici brivement des faits sur lesquels je me rserve de revenir dans un autre
ouvrage. Voir Civ. Chin,
223 sqq
.
Marcel GRANET La pense chinoise 375
(486) Lexpression jen tao (mot mot : la voie de lhomme) dsi gne lacte viril. Le Tao nest
pas, proprement parler, une puissance cratrice, mais il est lembl me du rythme de la vie
universelle.
(487) Dans le signe houang figure le signe wang (image du trait dunion). Les termes houang
et wang, quon peut tous deux traduire par auguste , appartiennent la nomenclature poli-
tique (lhistoire de Chine connat les Trois Augustes et les Trois (Dynasties) Ro yales. Voir
Civ. Chin.) et la nomenclature religieuse : les parents sont qualifis dAugustes, houang ou
wang, lorsque, aprs leur mort, ils sont monts la Cour du Souverain cleste.
(488) SMT, IV, 222.
(489) Voir plus loin, p.
371
.
(490) Civ. Chin.,
335
; Granet, Danses et lgendes..., note 180.
(491) Tchouan tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
257
. Noter lide de hirarchie.
(492) Ibid.,
439
. Au fond de cette conception se retrouvent les thmes du potlatch et de
lunion communielle.
(493) Sans quil paraisse avoir pens quune semblable traduc tion devrait tre justifie, le P.
Wieger (Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques..., p.
61
) a
interprt lexpression : houang ki par pivot :
Le roi, dit-il dans son interprtation du Hong fan, est le pivot autour duquel
tout tourne sur la terre, comme au Ciel tout gravite autour du ple, sige du
Souverain dEn-haut.
Ces expressions montrent que le P. Wieger a appuy son interprtation sur des ides courantes
au temps des Han. Le procd peut paratre abusif, mais, sil a pu conduire une
interprtation juste, cest que les ides en usage sous les Han, telles que Sseu-ma Tsien, pa r
exemple, les exprime, drivaient directement de conceptions anciennes. Sseu-ma Tsien crit
(SMT, III, 342) : le Boisseau [(La Grande Ourse) dont les 7 toiles correspondent aux 7 Rec-
teurs (voir pp.
235
,
242
,
321
)]
est le char du Souverain ; il se meut au Centre ; il gouverne les 4 Orients ; il
spare le Yin et le Yang ; il dtermine les 4 Saisons ; il quilibre les 5 lments ;
il fait voluer les divisions du Temps et les degrs (du Ciel et de lEspace) ; il
fixe les divers comptes
Sseu-ma Tsien ( Ibid., 339) dclare ailleurs que Tai yi (lUnit suprme, voir pp.155 et 156)
rside dans ltoile polaire qui se nomme Tien ki : le Fate du Ciel.
(494) Civ. Chin,
265
.
(495) Civ. Chin.
229
.
(496) Granet, Danses et lgendes..., note 767. Le thme de larbre solaire ou de larbre creux
est toujours en rapport avec lide dune demeure royale. L o le Roi rside pousse larbre
de Vie.
(497) Le Tao, cest 11, lunit totale qui rsorbe en elle le Pair et lImpair, le Ciel et la Terre,
5 et 6.
(498) Et explique partir dun thme mythique o il est question de Kong -sang, le Mrier
creux, Arbre solaire et royal, Arbre de Vie.
(499) Lexpression Ta jen appartient la langue mystique et dsigne le Hros qui connat les
secrets de la puissance personnelle (Cf. Civ. Chin,
421
). Lexpression kiun tseu appartient
Marcel GRANET La pense chinoise 376
la langue rituelle. Elle a servi successivement dsigner le gentilhomme, puis lhonnte
homme (cf : Civ. Chin,
263
), qui doivent la science des rites leur autorit. Toutes ces
expressions sont employes les unes pour les autres, indiffremment, par les traits qui
forment le Yi king. La distinction entre le courant mystique et le courant orthodoxe est loin
dtre ralis aux IVe -IIIe sicles avant Jsus-Christ.
Marcel GRANET La pense chinoise 377
Notes 500 599 :
(500) Voir plus haut,
163
,
164
.
(501) Yi king, L., 350.
(502) Ibid, 356. Legge traduit : Production and reproduction is what is called (the process
of) change . Le sens littral de lexpres sion cheng cheng est : (le) produit produisant (
son tour son producteur) .
(503) Voir plus haut.
(504) Voir plus haut.
(505) Yi king, L., p. 369.
(506) SMT ; II, 42 ; Granet, Danses et lgendes...,
105.
(507) Civ. Chin.,
29 et 30
.
(508) Tsien Han chou, 27 b, p. 4b sqq.
(509) Le chapitre cit dans la note prcdente contient une foute dindices du genre de celui
qui est rapport plus haut. La plupart des Histoires dynastiques renferment de semblables
chapitres, extrmement longs et o lon pr tend fournir la cl de nombreux et importants faits
historiques.
(510) Voir plus haut p.
78
, plus haut p.
228
,. A chaque re dynastique convient un systme
de mesures (Civ. Chin.,
27, 29, 31 , 49
) et de dnominations.
(511) Tchouang tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
419
.
(512) Civ. Chin
20, 22,27.
(513) Houai-nan tseu, 17. Dans lhistoire des sciences occidentales, ce qui a le plus intress
les Chinois, ce nest pas, peut -tre, la pomme de Newton, cest lanec dote des deux chattires
que fit percer le physicien. Lide que le plus petit des deux mritait davoir un trou pour lui,
et qui ft plus petit, a sduit les Chinois, sans doute parce quelle est plaisante. Il nest pas
dit quelle ne leur paraisse pas profonde. Les anciennes maisons souvraient par une porte
faite la taille du Chef de famille ; malheur au pre dont le fils, n dans les jours les plus
longs de lanne, ntait point tout de suite mis mort ! Ce fils grandissait abusivement et, ds
que sa taille dpassait louverture de la porte, tuait son pre (Granet, Danses et lgendes...,
532) .
(514) Masson-Oursel, Etudes de logique compare ; Id., La dmonstration confucenne et
Granet, Quelques particularits de la langue et de la pense chinoises.
(515) Voir plus bas, p.
362
.
(516) Voir plus bas, p.
430
.
(517) On trouvera plus loin un bel exemple de ce type de raisonnement employ par les
premiers Confucens pour montrer que la connaissance de soi conduit la connaissance de
lUnivers.
(518) Si nous tions mieux renseigns sur la pharmacope et la chimie des Chinois, et surtout
sur leurs inventions en matire dagri culture et dlevage, cration et utilisation despces
vgtales et animales, il nous apparatrait, sans doute, que lempirisme des Chinois et les
vertus pdagogiques de lide de mutation ne sont pas sans valeur. On sest beaucoup trop
moqu de ce lettr chinois qui, en plein XIXe sicle, et, il est vrai, par gloriole nationaliste, a
Marcel GRANET La pense chinoise 378
prtendu que des dcouvertes comparables celles des sciences occidentales taient
contenues en germe dans le Yi king. Ceci ne veut point dire que lon doive croire
aveuglment les affirmations de lettrs contemporains quand ils affirment que leurs anctres
avaient pressenti des merveilles telles que les thories actuelles sur la courbure de lespace ou
llec tricit.
(519) Civ. Chin, p.
19
.
.
(520) Tcheou li, Biot, Le Tcheou li ou Les Rites des Tcheou, 488 ; Yi king, L., 430.
(521) Li ki, C., II,
475
.
(522) Houai-nan tseu, 3.
(523) SMT, I,
79
; Granet, Danses et lgendes..., p.
249
.
.
(524) Granet, op. cit.,
484
,
485
,
379
,
437
.
(525) Houai-nan tseu, 3.
(526) Lie tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
131
; Houai-nan tseu, 3, 1 et 6 ; SMT,
I, p. 11.
(527) Houai-nan tseu, 6. A rapprocher de la formule clbre de Lao tseu (Wieger, op. cit.,
46
), souvent mal traduite, qui voque la production de toutes choses par effet de
lhirogamie du Yin et du Yang : Les 10 000 tres sont ports sur le dos du Yin et tenus
embrasss par le Yang. (Cf. Houai-nan tseu, 7.)
(528) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
133
.
(529) Granet, op. cit.
435
. Ce mythe sert expliquer le dsaxement du monde : la Polaire ne
se trouve pas au Znith de la capitale des hommes.
(530) Granet, op. cit.
436
.
(531) Ibid., note 740.
(532) Houai-nan tseu, 4 ; Granet, op. cit., 305 ;
Maspero, Les lgendes mythologiques dans le Chou king,
20
.
(533) Granet, op. cit., 379.
(534) Tchou chou ki nien, 5 ; Heou Han chou, 10 ; Song chou, 27, p. 3 . Sur le thme de
lArbre de Vie, voir plus haut.
(535) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
133
.
(536) Louen heng, Forke, Lun-Heng. Selected Essays of the philosopher Wang Chung, I, 252.
(537) SMT, III,
324
; Chou king, L., 593.
(538) Le trait le plus ancien qui nous reste est le Tcheou pei. (Cf. Biot, Traduction et examen
dun ouvrage chinois intitul Tcheou pei, JA, 1841), qui date tout au plus des premiers Han,
mais a peut-tre t remani sous les Tang. Le 11
e
chapitre (Tien wen) de lHistoire des Tsin
renferme de nombreuses citations dauteurs appartenant lpoque des Han. Maspero
(Lastronomie chinoise avant les Han, TP, 1929, pp. 267 sqq.) admet avec raison, mon sens,
que les thories cosmographiques remontent aux IVe-IIIe sicles avant notre re. (Cf. de
Saussure, Les origines de lastronomie chinoise et Forke, Die Gedankenwelt des chinesischen
Kulturkreises.) Deux chapitres du Louen heng de Wang Tchong (Forke, Lun-Heng. Selected
Marcel GRANET La pense chinoise 379
Essays of the philosopher Wang Chung, 250 sqq. ; 258 sqq.) peuvent donner une ide des
controverses soutenues au temps des seconds Han sur la structure du Monde.
(539) Tsin chou, II ; TP, 1929, p. 334.
(540) TP, 1929, p. 340. Abandonne pendant un temps, cette thorie (dite siuan ye) fut
reconstitue au IIe sicle av. J.-C., daprs la tradition orale, dit -on (TP, 1929, p. 340). On
peut en retrouver la trace dans un passage du Lie tseu (Wieger, op. cit.,
79
), o li de que ni
le Ciel ni les Astres ne sont des corps solides est utilise pour rassurer un homme tourment
par la crainte que le Ciel ne scroult ( peng : terme employ pour la chute dune montagne et
la mort dun souverain) et que la terre ne seffondrt.
(541) TP, 1929, pp 347 et 350.
(542) Tsin chou, II ; TP, 1929, p. 355.
(543) Civ., chin., aaa, bbb ; Granet, Danses et lgendes...,
449
. Lu chetchouen tsieou, 6 ,
8. La lgende de Pan-kou est plus ancienne en Chine quon ne la jadis soutenu. Le monde est
le corps de Pan-kou.
(544) Louen heng, Forke, op. cit., I, 253 ; Lie tseu,Wieger, op. cit.,
139
.
(545) Yin chou, II ; Louen heng, Forke, op. cit., I, 260.
(546) Sin chou, II ; TP, 1929, p. 338. Maspero dcrit tort la Terre comme un dme. La
comparaison avec le bol renvers ne fait quindiquer lide de convexit. Cest la
comparaison avec lchiquier qui donne la forme.
(547) Civ. Chin.,
412
; SMT, III,
483.
(548) Louen heng, Forke, op. cit., I, 259 ; TP, 1929, p. 340.
(549) Louen heng, Forke, op. cit., I, 362.
(550) Ibid, I, 360.
(551) Ibid, I, 361.
(552) TP, 1929, p. 292. Louen heng, Forke, op. sit., I, 269-270. LObscurit ( houei) est lqui -
valent du Yin (sombre). Voir plus haut.
(553) TP, 1929, pp. 291 et 293.
(554) Louen heng, Forke, op. cit., I, 271.
(555) Che king, C.,
235
sqq., et les notes o Couvreur rapporte les opinions de Tchou Hi.
(556) Sur ces progrs : TP, 1929, p. 267 sqq.
(557) Lo uen heng, Forke, op. cit., I, 261.
(558) Le rle des baladins, danseurs, musiciens, illusionnistes, montreurs de curiosits, ne
saurait tre surestim ; ils ont transport une masse de lgendes, darts et de connaissances :
beaucoup de lgendes chinoises, rapportes, par exemple, par le Chan hai king, prsentent des
traits qui rvlent des origines trangres, parfois trs lointaines et, peut-tre aussi, trs
anciennes.
(559) Tchou tseu, Tien wen.
(560) Li ki, C., I,
372
; Granet, Danses et lgendes..., note 753 ; Tchouang tseu, Wieger, op.
cit.,
363
. Li ki, C., II,
478
.
(561) Granet, op. cit.,
545
.
Marcel GRANET La pense chinoise 380
(562) Ibid., p.
379
.
(563) Id., La vie et la mort..., 17.
(564) Li ki, C.,
478
.
(565) Granet, La vie et la mort..., 13.
(566) Tchou tseu, Tchao houen.
(567) Granet, Danses et lgendes...,
486
.
(568) Tchou tseu, Tchao houen.
(569) Tchou tseu, Yuan yeou.
(570) SMT, III,
339 sqq
.
(571) Civ. Chin. 51.
(572) SMT, V, 26.
(573) Granet, Danses et lgendes...,
582
.
(574) SMT, V, 27.
(575) Tchou tseu, Tong kiun.
(576) Houai-nan tseu, 3.
(577) Ibid.,
(578) Granet, op. cit., p.
379
.
(579) Granet, Danses et lgendes,
512
,
469
.
(580) Ta Tai Li ki, 5.
(581) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
111
.
(582) Granet, op. cit.,
509
.
(583) Lu che tchouen tsieou, 5, 5 ; Granet, op. cit., 507 sqq.
(584) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
131
et Tchouang tseu, Ibid, p.
303
.
(585) Granet, op. cit.,
437
; Chan hai king, 15.
(586) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
111
.
(587) Chan hai king, 8 et 17 ; Houai-nan tseu, et Granet, op. cit., 523.
(588) Chan hai king, 17 ; Granet, op. cit., p.
315 sqq
.
(589) Tchou tseu, Tchao houen.
(590) Chan hai king, 2 ; Granet, op. cit., p.
386 sqq
.
; Tchou tseu, Tchao houen.
(591) Houai-nan tseu, 4.
(592) Ibid.
(593) Chan hai king, 2 et 16.
(594) Houai-nan tseu, 6 ; Granet, op. cit.,
376
.
Marcel GRANET La pense chinoise 381
(595) Mou Tten tseu tchouan, 3.
(596) Houai-nan tseu, 4.
(597) Civ. Chin,
246 sqq
.
(598) Tsin chou, 23, in Houai-nan tseu, 7. Un chef qui possde plus particulirement la Vertu
de la Terre a des pieds particulirement carrs (fang) : entendez par l que ces pieds forment
une querre (fang) parfaite (Tchouen tsieou fan lou, 7 ; Civ. Chin.).
(599) R. Hertz, dans son brillant article sur La prminence de la main droite, sest born
indiquer la difficult que prsente pour ce problme le cas chinois.
Marcel GRANET La pense chinoise 382
Notes 600 699 :
(600) Granet, op. cit.,
455
,
467
,
551
; plus haut p. 251 ; Tchouen tsieou fan lou, 7.
(601) Civ. Chin.,
232
.
(602) Lindex est le doigt du manger (et non du montrer , montrer est dangereux,
interdit).
(603) Granet, Danses,
498
.
(604) Civ. Chin,
19-21
.
(605) Le compas trace les ronds ; llment graphique, dont on dit quil figure la bouche dans
le signe de la Droite, tait (dans lcriture archaque) un rond.
(606) Cercle inscrit, voir plus haut, pp
81
,
105
et
222sqq
.
(607) Voir plus haut, p.
232
.
(608) Yi king, L., 382.
(609) Li ki C., I,
673
. Ds quun enfant devenait capable de prendre lui -mme sa nourriture,
on lui enseignait se servir de la main droite.
(610) Li ki, C.,
143
,
675
; II,
150
; Yi li, C.,
75
.
(611) Li ki, C., I,
153
,
160
,
246
; Granet, Danses
99
,
135
.
(612) Civ. Chin,
353
; Tso tchouan, C., III,
319
.
(613) Civ. Chin.
318
; Houai nan tseu, 11 ; Lie tseu, Wieger, p.
147
.
(614) Granet, op. cit.,
138
,
167
.
(615) Li ki, C., I,
44
.
(616) Ibid, C., I,
44
; II,
17
.
(617) Ibid., C., II,
17
.
(618) Ibid., C., II,
18
.
(619) Yi li, C.,
67
.
(620) Li ki, C., II,
17
.
(621) Granet, op. cit., 70, note 2 ; Li ki, C., I,
678
.
(622) Li ki, C., II,
21
.
(623) Do la disposition des diagrammes chinois o le Sud est toujours en haut.
(624) Voir plus haut. Le Ciel est une poitrine. Aussi a-t-il des mamelles (Voir plus haut 265 et
plus haut 286). La Terre est un dos ; aussi quand on sacrifie la Terre, choisit-on une colline
en forme de croupion (Civ. Chin., p. 412).
(625) Li ki, C., II,
19
.
Marcel GRANET La pense chinoise 383
(626) Yi li, C.,
123,
125,
144.
Aux joutes du tir larc, les archers vaincus doivent tenir
leurs arcs dbands et couvrir leur paule gauche.
(627) Civ. Chin. ; Li ki, C., I, 55 .
(628) Civ. Chin.
(629) Granet, Danses, note 1089 ; Li ki, C., I,
89
. Cf. Tso tchouan, C., III,
598
.
(630) En temps de deuil tout change : le chef de deuil est lOuest ; les femmes se placent
lEst ( Yi li, C.,
498
).
(631) Li ki, C.,I,
319
; Houai-nan tseu, 11. Les voitures dun convoi funbre occupent aussi
sur la route la gauche et lEst ( Yi li, C.,
513
).
(632) Heou Han chou, 121b, p. 4 .
(633) Louen heng, Forke, Lun-Heng..., t. I, 265. Tchouen tsieou fan lou, 12.
(634) Li ki, C., I,
146
.
(635) Granet, La vie et la mort..., 3.
(636) Les Chinois comptent terme compris.
(637) Quand on marche vers la gauche, et quon a monter un escalier, on part du pied
gauche, le pied droit rejoint le gauche sur la premire marche, et lon repart du pied gauche :
cest ce que d oit faire un hte. Le matre de maison part, au contraire, du pied droit, bien quil
ait monter les degrs de lEst, cest --dire les degrs de gauche. Il faut bien, quand il
introduit son hte, quil parcoure lEst de la cour en marchant vers la droite. Cest quand il
reconduit le visiteur que tous deux peuvent employer, lEst et lOuest, la marche vers la
gauche ou vers la droite, qui convient ces sites de lespace ( Li ki, C., I, 19).
(638) Tchouen tsieou fan lou, 7 ; Granet, Danses,
549
. Le pas de Yu, demeur clbre, a t
de tout temps nolis par les sorciers pour leurs exploits magiques : le sens inverse (yi)
convient la magie. Dans le chapitre 8 du Po hou tong apparat nettement la liaison de la
marche, la gauche ou la droite en avant, que dtermine un gnie cleste ou terrestre, et du
principe que le Ciel est sinistrogyre, la Terre dextrogyre.
(639) Houang nei king, p. 2.
(640) Granet, op. cit.,
378
,
137 sqq
.
(641) Lao tseu, Wieger, Les pres du systme taoste,
39
et
40
.
(642) Les vassaux, pour qui la droite est le ct honorable, sont considrs comme les pieds
et les mains du Prince.
(643) Houai-nan tseu, 7.
(644) Ibid, 3.
(645) Je ne comprends pas pourquoi Maspero, La Chine antique, (p. 442) a, comme le P.
Wieger (Histoire des croyances...,) (p.
62
), nglig de signaler limportance des Cinq Signes
clestes. Ne pas la marquer aboutit ne pas voir ce quest le Hong fan : un tableau rapide du
systme des classifications chinoises. Pourquoi, dautre part (est -ce cause de la traduction
donne par Chavannes qui a rendu yang par soleil clairant ), dissimuler la mention
(significative par lopposition avec la Pluie) qui est faite ici du Yang ?
(646) Houai-nan tseu, 7. Noter que lon compte ici 6 viscres.
(647) SMT, III,
290
.
Marcel GRANET La pense chinoise 384
(648) La liaison des vertus cardinales aux saisons-orients est, du reste, implique par divers
mythes : la Bont (jen), par exemple, est la vertu caractristique des Orientaux.
(649) Po hou tong,
8.
(650) Tso tchouan C., III,
30-39
, [cf. note 674].
(651) Kouan tseu, 14. Les correspondances tablies par Kouan tseu diffrent de celles du Po
hou tong et du Houang-ti nei king. On notera lopposition du Soue (ki), rapproch du Feu, et
du Sang, rapproch de lEau, et le fait que les passions sont qualifies de t, mot dont le sens
(vertu) rappelle celui dinfluence ( ki ).
(652) Li ki, C., I,
516
,
519 sqq
.
Peut-tre doit-on considrer les 6 Ki (Influences) comme les pro duits des 6 Tsong, des 6
Domaines clestes que le Chou king (SMT, I,
59-61
) met en rapport avec les 5 Insignes. Il y a
dsaccord sur la liste des 6 Tsong, mais on fait toujours figurer parmi eux la Pluie et le Vent
ou les Eaux et la Scheresse.
Un passage du Tsi fa (Li ki, C., II,
259
) semble autoriser rapprocher le sacrifice fait aux 6
Tsong des sacrifices faits : 1 aux Quatre Saisons ; 2 la Chaleur et au Froid ; 3 au Soleil et
la Lune (Yang et Yin) ; 4 aux toiles et la Pluie (le Comte du Vent et le Matre de la
Pluie rsident dans deux toiles)...
1. Or, le texte du Hong fan sur les 5 Signes clestes renferme une double difficult :
contrairement ce qui est fait pour la plupart des autres rubriques les Signes ne sont
pas nombrs ; pourtant la seconde partie du texte considre 5 Signes et commence
par le mot cinq ;
2. la premire partie du texte contient 6 fois le mot yue (Voir plus haut), ce qui semble
indiquer une liste 6 numros ; le sixime yue prcde le mot che, o Chavannes a
vu un dmonstratif et quil a li la phrase suivante. Mais ce mot signifie saison ,
et lon voit que le Tsi fa indique un sacrifice aux Saisons, la plupart des interprtes
admettant, par ailleurs, que les Saisons figurent parmi les 6 Tsong. Il semble dont
que les diteurs du Hong fan ont hsit entre 5 et 6.
(653) Je simplifie les tableaux tirs de Pan Kou et du Houang-ti nei king en supprimant les
odeurs, couleurs, etc. (conformes aux quivalences du Yue ling). Pan Kou donne pour les
ouvertures trois rpartitions diffrentes (I, II, III), que jisole. Jisole aussi (A, B) les
correspondances des Passions et des Orients, des Passions et des Magasins que Pan Kou
donne part.
(653b) Yi king, L, 429 ; Granet, Danses et lgendes..., [note 1187]. La rpartition se fait
daprs lorientation dite de Wen Wang
(654) Po hou tong, 8.
(655) Li ki, C., II,
516
. Les Dix Devoirs sont :
laffection frater nelle et lamour filial,
la bont du frre an et la soumission du cadet,
la justice du mari et lobis sance de la femme,
la bienfaisance des ans et la docilit des plus jeunes,
la bont du prince et la fidlit du vassal.
Ces 10 Devoirs se rapportent 5 relations.
(656) Glose de Kong Ying-ta des Tang. Les quivalences avec les Orients indiques dans le
tableau sont celles de Pan Koa
(657) Voir tableau tir du Po hou tong, I. Cur et Prince appar tiennent la Gauche.
Marcel GRANET La pense chinoise 385
(658) Po hou tong, 8. Le Houang-ti nei king veut que le dos soit yang. (Le Yin et le Yang,
quand ils sunissent, ne sont pas rduits la seule position que prennent le Ciel et la Terre.) Il
loge donc (chap. I) le cur dans le dos.
(659) Po hou tong, 8, et plus haut, p. 306.
(660) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
145
.
(661) Voir tableau tir du Po hou tong (III), et tableau tir du Houang-ti nei king.
(662) Po hou tong, 8 ; Houang-ti nei king, 2 et 14 ; une troisime solution [tableau tir du Po
hou tong (11) ] sera de donner les Oreilles la Rate.
(663) Houang-ti nei king, 2 et 8 ; Po hou tong, 8 ; Chen yi king, I.
(664) Po hou tong, 8.
(665) Tchou tseu, 9.
(666) Po hou tong, 8.
(667) Louen heng, Forke, Lun Heng..., 1.
(668) Ibid., II, 250.
(669) Granet, Danses et lgendes...,
285
,
484
.
(670) Ibid.
373
,
374
. Po hou tong, 7 et 8.
(671) Granet, op. cit.,
432 sqq
. ; Po hou tong, 7 ; Louen heng, Forke, op. cit., I, 304.
(672) Ce procd pour nourrir le malfice est encore employ dans le Sud de la Chine, au
moins chez les Barbares. Grain et malfice se lisent : kou.
(673) Hexagramme 18 (Yi king, L., 95) form du trigramme Ken (Montagne) superpos au tri-
gramme Siuan (Vent). Cf. Ibid., p. 290.
(674) Tso tchouan, C., III,
30
39
. (Cf. Ibid., 380.)
(675) Lie tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
139 -
150
.
(676) Tso tchouan, C., III,
611
.
(677) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
145
. Le baladin mis en scne a t rencontr par le roi Mou
prs du Kouen-louen, cest --dire en Asie centrale ou dans la rgion (frange de la
civilisation) qui est le domaine des dieux et des mages. Le baladin est expert dans lart des
mutations (homo) : cest un houa-jen (le signe houa scrit avec limage dun homme debout
et celle dun homme culbut).
(678) Granet, op. cit., 544 ; Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
269
.
(679) Civ. Chin.,
303,
360.
La Grande Ourse est lemblme du cur qui a 7 ouvertures, lui
aussi : Po hou tong, 8 ; Houang-ti nei king, 14.
(680) SMT, II, 410 ; Civ. Chin, 55.
(681) SMT, I,
206
; Lie tseu, Wieger op. cit.,
119
, op. cit.,
123
; Civ. Chin.
(682) Li ki, C., I,
622 sqq
.
(683) Yi li, C.,
450
; Granet, Danses et lgendes..., note 345 ; Civ. Chin.,
360
.
Marcel GRANET La pense chinoise 386
(684) de GROOT, The religious system of China, IV, 398. Ta Tsing lu li, 36. On mange
surtout le foie, sige du courage (le foie commande les muscles, les yeux, la colre). On
dshonore lennemi si lon refuse de manger son foie : cest le tr aiter de lche.
(685) SMT, III,
479.
(686) Granet, op. cit., [note 760].
(687) Civ. Chin., p.
301
.
(688) Voir plus haut, p.
245
.
(689) Granet, op. cit., note 52 ; 88, note 2.
(690) Civ. Chin.
283,
330,
334.
(691) SMT, IV, 225 ; [css : voir Hong Fan]
(692) Tcheou li, Biot, op. cit., I, 94.
(693) Granet, op. cit.,
419
,
420
.
(694) Ibid.,
41
.
(695) Lu che tchouen tsieou, 14, 2.
(696) Houai-nan tseu, 20.
(697) Tcheou li, Biot, op. cit., I, 94, et note de la p. 96.
(698) Ibid., I, 94. Se reporter aux tableaux.
(699) Houang-ti nei king, 2.
Marcel GRANET La pense chinoise 387
Notes 700 799 :
(700) Yue ling et Tcheou li, Biot, op. cit., I, 93.
(701) Tcheou li, Biot, op. cit., I, 96.
(702) Li ki, I,
520
.
(703) Granet, op. cit., note 180.
(704) Che king, C.,
441
.
(705) Cheng , vivant , se dit des aliments frais.
(706) Tso tchouan, C., II,
85
.
(707) Nul poison ne doit avoir prise sur le pur. Do lide que le contenant peut neutraliser
leffet du contenu. Cette ide parat tre lorigine des premiers essais de lalchimie chinoise
(SMT, III,
465
) qui sest tout dabord pro pos de fabriquer une vaisselle de longue vie, le
rcipient dtruisant la nocivit du contenu.
(708) Anne signifie rcoltes .
(709) Voir plus haut.
(710) Tso tchouan, C., III,
153
; I,
143
,
533
; Granet, Danses...
558
.
(711) Granet, op. cit.,
344
.
(712) Tso tchouan, C., II,
153
,
302
,
141
.
(713) Ceci se produit : pendant lhiver, saison yin, saison des morts ; en temps de scheresse ;
quand une dynastie finissante dtraque lordre du monde : on entend alors gmir les kouei (les
sages disent : le peuple).
(714) Yi li (Hi tseu), L., 353-354.
(715) Li ki (Tsi yi), C., II,
289
.
(716) Tso tchouan, C., III,
142
.
(717) de GROOT, The religious system of China, t. II, 46, 47.
(718) Entre ces deux mots tsing (passions ou manations, essences) et tsing (partie clarifie
dun liquide), il ny a quune diffrence superficielle de graphie.
(719) Li ki, C., II,
84
. Le Ciel est compar au Pre. Il couvre la Terre et couvre tous
les tres.
(720) P. L. Wieger, Histoire des croyances..., 714.
(721) Li ki, C., II,
71
.
(722) SMT, III,
261
.
(723) Houang-ti nei king, 1 ; Granet, Ftes et chansons..., 7 sqq.
(724) Li ki, C., II,
52
. Tso tchouan, C., III,
380
.
(725) Civ. Chin..
(726) Li ki, C., II,
73
.
Marcel GRANET La pense chinoise 388
(727) Voir plus haut. 107. Lopposition du tchouo et du tsing (lie et liquide clarifi) amne
(par une image emprunte la fabrication des boissons) lantithse du Bas et du Haut (lourd
et lger), du Yin et du Yang (obscur et clair).
(728) Lie tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
147
.
(729) Ibid.,
141
. Le mdecin nopre quaprs avoir anesthsi les deux patients en les
endormant, pour trois jours, laide dun vin ml du poison.
(730) Li ki, C., I,
295
.
(731) Kouo yu, 10.
(732) Louen heng, Forke, op. cit., 1, 304.
(733) Granet, Danses et lgendes...,
315
; Houang ti nei king, 1.
(734) SMT, III,
331
; Civ. Chin., p.
54
.
(735) Louen heng, Forke, op. cit., I, 304 sqq.
(736) Li ki, C., I,
295
.
(737) Ibid., I,
295
,
296
; Ta tai Li ki 80.
(738) Sin chou, 10 ; Ta tai Li ki, 48.
(739) La droite est la main du manger, voir plus haut.
(740) Tso tchouan, C., III,
379
. Sur Tseu-tchan, voir plus bas.
(741) On emploie ici le mme mot (dlimiter) que plus haut, propos du Ciel. Les deux tres
(les deux rubriques emblmatiques) sont le Yin et le Yang, la femelle et le mle.
(742) Cette action nourricire est-elle celle du Ciel ou celle de la Terre ?
(743) Ta Tai Li ki, 42.
(744) Li ki, C., II,
55
; SMT, III,
245
.
(745) Li ki, C., II,
78
.
(746) Mot mot : Centre, Droit, pas de dviation. Se reporter p.
267
.
(747) Li ki, C., II,
60
; SMT, III,
249
.
(748) Li ki, C., II,
57
.
(749) SMT, III,
291
. On remarquera que la droite (Ouest) est la place assigne aux vassaux.
Chang doit donc tre affect lOuest (droite).
(750) Li ki, C., II,
48
. Si lon rap proche ces donnes de celles que fournit le texte prcdent
emprunt Sseu-ma Tsien, on voit que la corde centrale quivaut au tube initial (81) ; les
autres quivalent donc pour la longueur aux 4 tubes suivants. Chang (72) est droite,
cest --dire lOuest ; il suit que kio (64) est gauche, cest --dire lEst. Tout ceci est
conforme aux indications du Yue ling et au rituel de la gauche et de la droite (Voir plus haut).
(751) SMT, III,
290
.
(752) Granet, Le langage de la douleur daprs le rituel funraire de la Chine classique.
(753) SMT, III,
291
.
Marcel GRANET La pense chinoise 389
(754) Peine et deuil se disent avec le mme mot.
(755) Li ki, C., I,
161
.
(756) Ibid., C., I,
217
.
(757) Ibid., C., II,
553
.
(758) Civ. Chin., p.
42
(759) Civ. Chin. :
90 sqq,
101 sqq.
(760)
Civ. Chin.
104,
310.
(761) Enseignes, dit-on, par M tseu.
(762) Tchouang tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
383
.
(763) Ibid.,
501
.
(764) Ibid.,
503
. Le mont Houa est une montagne sainte, riche en ermites.
(765) Ibid.,
373
; Lie tseu, Ibid.,
75
.
(766) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
149
.
(767) Li ki, C., I, 146.
(768) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
85
.
(769) Ibid.,
143
.
(770) Louen yu, L. 69. [CSS Louen yu]
(771) SMT, V,
405
.
(772) SMT, V,
407
.
(773) SMT, V,
412
,
(774) SMT, V,
413
.
(775) SMT, V,
367
.
(776) Civ. Chin.,
50
.
(777) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
449
.
(778) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
95
.
(779) (Leang Ki -tchao) Liang Chi -Chao, History of Chinese political thought, 37. Aussi
Leang Ki -tchao ne cher che-t-il dfinir les doctrines des principales coles quen les tu-
diant sous leur aspect dernier tout juste avant la fondation de lEmpire.
(780) Granet, Danses et lgendes...,
407
.
(781) SMT, IV, 40.
(782) SMT, IV, 36.
(783) Civ. Chin,
103
.
Marcel GRANET La pense chinoise 390
(784) Civ. Chin,
324
.
(785) Voir plus haut p.
252
; SMT, IV, 37 (glose).
(786) SMT, V, 258-260.
(787) SMT, II, 171.
(788) SMT, V, 1, 3.
(789) Tso tchouan, III,
755
; SMT, chap. 126.
(790) SMT, III,
289
.
(791) SMT, IV, 125 ; Tso tchouan, C., III,
452
.
(792) SMT, IV, 450 ; Kouo yu, 16.
(793) SMT, IV, 439.
(794) SMT, V, 148 et chap. 63
(795) Escarra et Germain, tudes asiatiques (publies loccasion du XXVe anniversaire de
lcole franaise dExtrme -Orient, 1925) II, 141 sqq.
(796) Wieger, Histoire des croyances...,
236
; Maspero, La Chine antique, 520.
(797) Pelliot, Meou tseu, ou les Doutes levs, 585. Luvre que nous possdons, peut -tre
remanie sous les Han, demeure riche en donnes archaques.
(798) Louvrage quon lui attri buait est perdu depuis le temps des Han, Maspero, La Chine
antique, 521.
(799) Duyvendack, The book of Lord Shang, 96 sqq. Leang Ki -tchao a insist avec raison
sur limportance des ides notes par ces deux termes que son tr aducteur (ce dernier, plutt
quune traduction, a donn un rsum interprtatif) a cru pouvoir rendra en anglais par les
mots : Favouritism et Despotism . (Cf. Leang Ki -tchao, History of Chinese political
Thought, 116 et Escarra et Germain, La conception de la loi et les thories des lgistes la
veille des Tsin, 28 sqq.) Il y a certainement abus parler, comme Leang Ki -tchao la fait,
dune cole des chou et dune cole des che , surtout quand on veut conclure que chou
et chi notent des ides absolument opposes et cependant professes par les mmes hommes
(Escarra et Germain, op. cit., 32).
Marcel GRANET La pense chinoise 391
Notes 800 899 :
(800) SMT, V, 84.
(801) Granet, Danses et lgendes..., notes des pp.
85
,
85
,
88
,
91
.
(802) Escarra et Germain, op. cit., 34.
(803) Tso tchouan, C., II,
158
.
(804) Wieger, Histoire des croyances...,
236
; Civ. Chin.
(805) Civ. Chin,
38
,
39
; Granet, op. cit., note 178.
(806) SMT , IV, 432.
(807) Lie tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
197
. Ces formules incantatoires sont
dsignes par le mot Nombres et qualifies de chou (Recettes).
(808) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
317
. La bouche ne peut dire (en quoi lart consiste).
Il y a un Nombre ! Cest --dire une formule opratoire qui ne sappro prie que par intuition
et grce une vocation pralable. Noter que lide de Nombre voque non le dtermin ou le
mcanique, mais lArt, mais lEfficace.
(809) Han Fei tseu, 43 et 40 ; Escarra et Germain, op. cit., 28 et 30.
(810) Forke, The Chinese Sophists, JRAS, tudes asiatiques, 1 sqq. Ltude des Sophistes a
t brillamment reprise en Chine par Hou Shih, The development of logical method in ancient
China, 111 sqq. Voir encore Suzuki, A brief history of early chinese philosophy, 57 sqq., et
TP, 1927, 1 sqq.
(811) Par exemple dans un livre comme le Yen tseu tchouen tsieou, ouvrage crit vers les
IVe-IIIe sicles et attribu Yen tseu (fin du VIe, dbut du Ve sicle), dont la tradition fait un
nain et le conseiller dun prince de Tsi, amateur de nain s et de bouffons (Maspero, La Chine
antique, note 980 ; Granet, Danses et lgendes..., 171 sqq ).
(812) Soit (SMT, IV, 387) une tentative diplomatique avant la bataille ; ils sagi t de persuader
au gnral ennemi de ne point combattre, de ne rien faire de trop. Lenvoy raconte un
apologue. Plusieurs domestiques nont pour eux tous quune coupe de vin ; au lieu de la
partager, ils la jouent : la boira le premier qui aura dessin un serpent. Le plus rapide prend la
coupe, mais fait le fanfaron : Jai encore le temps dajouter des pieds. On lui reprend la
coupe : Un serpent na pas de pieds ; maintenant que vous lui avez fait des pieds, ce nest
plus un serpent. Comparer les paradoxes (qui semblent impliquer une distinction de
lessence et de laccident) chers aux disciples de M tseu tels que : Un char est en bois ;
monter sur un char nest pas monter sur du bois , ou Un coq de combat nest pas un coq ,
ou encore : Tuer un brigand nest pas tuer un homme. Ce dernier thme a t utilis par
Mencius (L 231) pour viter une rponse directe et dangereuse dans un de ses exercices de
rhtorique la cour du roi Siuan de Tsi.
(813) Lie tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
103
.
(814) Lespace est un et indi visible comme lest le corps de la limace.
(815) Tchouang tseu, L., H, 118 ; Wieger, op. cit.,
p.
433
. Comparer lanecdote suivante
emprunte SMT, V, 155. Le prince hritier de Wei va combattre. Un homme demande tre
reu par lui. Il possde, dit-il, une recette qui, dans cent combats, donne cent fois la victoire.
Introduit, il sexprime peu prs ainsi (je rsume) : Si vous tes vainqueur et annexez un
territoire, vous ne serez jamais que le roi de Wei ; si vous tes battu, vous perdrez Wei ;
Marcel GRANET La pense chinoise 392
telle est ma recette pour remporter cent victoires dans cent combats . Autrement dit, il est
inutile de combattre pour agrandir un territoire. Dans ce paradoxe qui conserve, ici, sa forme
populaire, on pourrait, comme dans les autres, trouver une thorie sur le caractre indfini
propre lespace.
(816) Maspero, La Chine antique, 532.
(817) Ce qui reste de Houei tseu est contenu dans le chapitre 33 du Tchouang tseu (L., II,
229-232), quoi sajoutent quelques anec dotes (Wieger, op. cit., 215, 221, 249, 347, 349,
351, 419, 431, 445, 451 et 507-509).
(818) Maspero, La Chine antique, 531.
(819) Legge (Tchouang tseu, II, 229) traduit : (When it is said that) things greatly alike are
different from things a little alike, this is what is called making little of agreements and diffe-
rences ; (When it is said that) all things are entirely different, this is what is called making
much of agreements and differences. Wieger, op. cit., 507 : La diffrence entre une grande
et une petite ressemblance, cest la petite ressemblance -diffrence ; quand les tres sont
entirement ressemblants et diffrents, cest la grande ressembla nce-diffrence. Maspero,
(op. cit., 533) : (Dire que) ce qui a beaucoup de points didentit est diffrent de ce qui a peu
de points didentit, cest ce quon appelle la Petite Identit et Dissimilarit ; (dire que) toutes
les choses sont entirement identiques (les unes aux autres) et entirement diffrentes (les
unes des autres), cest ce quon appelle la Grande Identit et Dissimila rit. Maspero ajoute :
Dans ces conditions, toute distinction tait illusoire, et ainsi se trouvait fond le principe de
M tseu de lamour universel sans distinc tion : Aimez toutes choses galement, le monde
est un. La phrase mise entre guillemets est la traduction du 10e paradoxe de Houei tseu, que
je comprends ainsi : Si laffection stend au dtail des tres, lUnivers (m. m. : le Ciel et
la Terre) nest (plus) quun seul corps.
(820) Tchouang tseu, L., I, 387
(821) Ibid., II, 220.
(822) Ibid., I, 317. Le mot li a le sens de sparer, distinguer, couper ; il se dit, dans la langue
du Yi king, des choses qui sont adhrentes ; il indique les sparations opres sur ce qui se
trouve runi par association (ping). Je ne mexplique pas qu on ait pu le traduire par faire la
synthse de.. (Maspero, op. cit., 536) et crire (T. P. 1927, 63) : Cette opration (de
lesprit) est, pour employer lexpression kantienne qui traduit exactement le mot li, une
synthse.
(823) Tchouang tseu, L., II, 229. Tchouang tseu discute le principe de tous ces paradoxes. Cf.
Ibid., I, 181 sqq, 187 sqq.
(824) Tchouang tseu, L., I, 172.
(825) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
127
. Tchouang tseu (Ibid.,
419
) en fait un rival de M tseu,
de Yang tseu, des tenants de Confucius et de Houei tseu lui-mme. Il compare ces cinq
enseignements aux cinq notes dun luth dsac cord. Dans le chapitre 33 du Tchouang tseu, il
est dit que Kong-souen Long et dautres sophistes ne firent que surenchrir sur les paradoxes
de Houei tseu, seul grand inventeur. Je ne vois aucun fondement lopinion (Maspero, La
Chine antique, 535) que Kong-souen Long ait t linventeur du thme de : la divisibilit
indfinie , lequel est essentiel chez Houei tseu. Kong-souen Long, quon a tent didentifier
Tseu-che, disciple de Confucius, et qui fut, peut-tre, un sophiste voyageur, est connu par un
petit opuscule qui nous est parvenu en assez mauvais tat. Il a t, en partie, traduit (Tucci,
Storia della filosofia cinese antica, p. 44 sqq.) ; linterprtation qui en a t donne dans
lHistoire des croyances religieuses .... du P. Wieger (
218 sqq
) est dune prcision toute
fallacieuse.
(826) Tchouang tseu, L., II, 231. [css Wieger, Tchouang tseu,
509
]
Marcel GRANET La pense chinoise 393
(827) Ce thme est plus prs du taosme que de la doctrine de M tseu.
(828) Autre thme desprit taoste : influencement sans contact. (Cf. plus haut/a, plus haut/b)
(829) Lie tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
128
.
(830) On pourrait traduire flche pointe (mais non pointe de flche) : ce nest sans doute
pas sans raison que la formule commence par cette expression invitant distinguer la tte et le
corps de la flche, distinction importante pour lexpli cation par la chane de flchs.
(Comparer la chane dannea ux qui peut, elle, tre divise.)
(831) Ce paradoxe a t traduit et glos sans quon tint compte des illustrations concrtes qui
viennent de Kong-souen Long lui-mme.
Legge traduit (Tchouang tseu, L., 230) : Swift as the arrow head is, then is a time
when it is neither flying, nor at rest.
Wieger, (op. cit.,) une flche qui touche la cible navance p lus et nest pas
arrte .
Maspero (qui reproche Hou Che davoir rendu le paradoxe inintelligible en
comprenant : la flche a des moments la fois de mouvement et de repos traduit
lui-mme le mouvement rapide dune flche est (la succession des) moments o
elle nest ni arrte ni en mouvement. (La Chine antique, 537.) Je ne suis arriv ni
comprendre le sens de la discussion institue dans la note 2 de cette page, ni
savoir sur quelles donnes chinoises on peut sappuyer pour interprter le paradoxe
en crivant
en mouvement : si on prend comme une unit lespace que la flche par court
de larc au but ; arrte si on prend pour unit lespace occup par la flche et
quon considre non lensemble du trajet mais sparment chacune de ces
units .
(832) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
127
.
(833) Ibid.,
149
.
(834) Sur ce thme, voir, provisoirement, Civ. Chin.
(835) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
509
.
(836) Ibid.,
347
; Lie tseu, Ibid.,
127
.
(837) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
221
.
(838) On a conserv la trace de leurs efforts, grce aux sections 40-45 du M tseu, traduites
par Forke (Mo Ti, des Socialethikers und seiner Schler philosophische Werke) ; le texte est
en si mauvais tat quil est presque impossible den rien tirer de prcis. Plusieurs auteurs
chinois contemporains, MM. Tchang Ping-lin, Hou Che, et Leang Ki -tchao se sont efforcs
den extraire les lments dune logique formelle. Leurs recherches, trs mritoires, ont
peut-tre t vicies par une trop bonne frquentation de Stuart Mill : cest ce que leur a
reproch Maspero (Notes sur la logique de M tseu et de son cole, T. P. 1927, p. 10). En fait,
dinnombrables difficults se prsentent ds quon essaie de prciser la va leur des termes
employs dans une acception technique par les auteurs de ces traits.
(839) Maspero, La Chine antique, 540.
(840) T. P., 1927, pp. 11, 26, 32.
(841) Forke, Mo Ti..., 85.
Marcel GRANET La pense chinoise 394
(842) Cf. plus haut,
272
et
277
, et Granet, Quelques particularits de la langue et de la
pense chinoises, 124. Sur lemploi des analogies vraies et fausses dans les discussions non
savantes, voir Granet, Ftes et chansons..., 64. Noter encore la parent des paradoxes tels que
un veau orphelin na jamais eu de mre (quand il avait sa mre, il ntait pas un veau
orphelin) qui ressemblent des plaisanteries paysannes et des pures plaisanteries telles que
celle de lhomme dans le puits [Granet, Danses et lgendes..., note 1387 : un homme qui
voulait creuser un puits trouva un artisan capable, creusa son puits et dit : Jai creus un
puits ! Javais trouv un homme ! On comprit (lantriorit ntant pas exp rime) : Jai
creus un puits ! J(y) ai trouv un homme ! ].
(843) Louen yu, L., 127 , [CSS Louen yu] ; SMT, V,
378
.
(844) Civ. Chin.,
399
; Tso tchouan, C., III,
586
; SMT, IV, 205. Nan-tseu couchait avec
son propre frre.
(845) SMT ; chap. CXXX et SMT, V,
379
.
(846) SMT, III,
208
.
(847) Yi king, L., 136. Une chanson du Che king (Granet, Ftes et chansons..., 10, vers 12 et
sa note) est interprte comme une illustration du thme : une bonne pouse sait mettre un
ordre convenable dans la famille (kia jen).
(848) Yi king, L., 242. Premier appendice du Yi king.
(849) Li ki, C.,
780
et Yi li, Steele, I Li, or the Book of Etiquette and Ceremonial, II, 29.
(850) Civ. Chin.,
368
,
369
.
(851) Civ. Chin,
443
.
(852) Une autre anecdote (Louen yu, L., 120 , [CSS Louen yu] ; SMT, V,
305
) fait prononcer
par Confucius dans des circonstances analogues la formule prince, prince ! vassal, vassal !
qui illustre la doctrine des dsignations correctes.
(853) Li ki, C., II,
269
. Supra, p.
47
.
(854) Voir pp.
242 sqq
.
(855) Tsien Han chou, 30, p. 15. Noter le rapprochement de ming et de wei, dj suggr par
le premier appendice du Yi king. Le Han chou classe, dans lcole des Noms, Yin Wen tseu
ct de Houei tseu et de Kong-souen Long.
(856) Li ki, C., I,
515
.
(857) Civ. Chin,
288
.
(858) Granet, Danses et lgendes..., p .
64
.
(859) Tchouang tseu, L., 336-337.
(860) Sur ces termes, voir pp.
394-395.
(861) Ce passage doit tre rapproch, mme dans la forme, dun passage fameux du Tai hio.
Tchouang tseu continue en critiquant la doctrine des dnominations (quil unit celle des
punitions et rcompenses de lcole des Lois) : il naccorde aux noms et aux lois quune
efficacit de dtail, une efficacit simplement technique. Parler des ralits et des noms, des
punitions et des chtiments, cest montrer quon connat les instruments du gou vernement et
non le principe (tao) du gouvernement... cest ntre quun dialecticien.
Marcel GRANET La pense chinoise 395
(862) Tchouang tseu, L., II, 216 [Wieger Tch33].
(863) Woo Kang, Les trois thories politiques du Tchouen tsieou, 1, 77 sqq.
(864) SMT, V,
422
.
(865) Tchouang tseu, L., I, 392 [Wieger Tch17G].
(866) M tseu, 41.
(867) Masson-Oursel et KIA KIEN-TCHOU, Yin Wen-tseu, 570. Il est curieux de constater
que le M tseu (41) emploie lexpression : dnomination correcte propos de la distinction du
Ceci et du Cela.
(868) Ibid., 585.
(869) Tchouang tseu, L., II, 221.
(870) Masson-Oursel (op. cit.,) a donn de cet opuscule une traduction trs attentive, mais o
ne sont point suffisamment distingus les divers emplois techniques des mots.
(871) Masson-Oursel, op. cit., 570.
(872) Ibid., 570-571.
(873) Ibid., 577.
(874) Ibid., 570.
(875) Ibid., 572, 576, 579.
(876) Ibid., 574, 590, 588, 589.
(877) Ibid., 585, 586.
(878) Ibid., 597, 577, 576.
(879) Ibid., 595.
(880) Ibid., 586, 587.
(881) SMT, II, 188. On a contenu que lexpression tcheng ming (rendre les dsignations
correctes) a dabord signifi : corriger les caractres dcriture ( SMT, V, note 439). Lcriture
nest devenue uniforme quavec Che Houang -ti, et cest lpoque des Royaumes
Combattants que sest sans doute forme la dont est sorti l echi noi s. L expl i cation de
tcheng ming par corriger les caractres dcriture est certainement une explication trouve
aprs coup. Lemploi correct des dsignations vocales ou graphiques na point vis dabord
obtenir la diffusion universelle dun systme de symbolisme. Il ne sagissait que demprunter
ltiquette, avant de lemprunter la loi, lautorit qui habilite porter un jugement. Lordre
impos la foule des tres est un ordre administratif.
(882) Le Tsien Han chou (30, p. 15a) rattache lcole des Lois aux Administ rateurs (li
kouan) et les Doctrines des Politiciens (30, p. 16b) aux Diplomates.
(883) Civ. Chin,
424
,
104
.
(884) Voir en sens inverse la Chine antique, de Maspero,
516
, et (moins catgorique) The
book of Lord Shang, de Duyvendack, 72.
(885) SMT, chap. 63.
(886) Une partie de louvrage a t traduite en russe par Ivanov en 1912 (Public. de la Facult
des Langues Orientales de lAcadmie de Saint -Ptersbourg).
Marcel GRANET La pense chinoise 396
(887) Le Livre du Seigneur de Chang a t traduit intgralement, avec beaucoup de soin, par
Duyvendack (op. cit.,), qui sest efforc (p . 141 sqq.) de distinguer stylistiquement les
morceaux dges divers.
(888) Civ. Chin.
43
,
222
; SMT, II, 62 sqq. Le Duyvendack contient la traduction de la bio-
graphie de Wei-yang crite par Sseu-ma Tsien, p. 8 sqq.
(889) Granet, Danses et lgendes..., (index).
(890) Voir plus haut, p.
334
, et Civ. Chin.. Sur le sort funeste des Lgistes au temps de
lEmpe reur Wou des Han, voir Ibid.
(891) Civ. Chin.
43
. Lhistoire na jamais pardonn ce crime aux Lgistes, pas plus quelle
na cess de honnir les attaques de M tseu contre lesprit de clientle.
(892) Tso tchouan, C., II,
549
,
660
( il faut dabord contenter les grands ),
661-662
; Ibid,
II,
87-88
,
116 sqq
(893) Ibid., C., III, 456 ; Ibid, I,
385
et
469
.
(894) Escarra et Germain, La conception de la loi..., 10 sqq.
(895) Granet, op. cit.,
394
.
(896) Le principe na pas chang quand les dynasties impriales ont promulgu des codes ; on
a continu dadmettre que le meil leur magistrat tait celui devant qui le moins daffaires
taient voques.
(897) Civ. Chin.
309
.
(898) Ibid., 247 ; Escarra et Germain, op. cit., 6 sqq. En vertu dun prjug aristocratique,
Leang Ki -Tchao ne distingue pas entre la plbe et les Barbares, seuls sujets, daprs lui, aux
chtiments. Ceux-ci, en ralit, sont rservs aux vassaux indociles.
(899) La mort dans la chaudire est le chtiment caractristique des ministres de la guerre
(Civ. Chin.
303
). Ce fut, sous les empereurs, le chtiment de tous les mauvais administrateurs
(Ibid., 135.) Che Houang-ti se vante dy avoir plong tous les fodaux rebelles ( SMT, II, 198).
Marcel GRANET La pense chinoise 397
Notes 900 999 :
(900) SMT, II, 65. Ldification de ces piliers concide avec le dplacement de la capitale
(inauguration dune re nouvelle) et une refonte de tout le systme administratif.
(901) Voir, dans Escarra et Germain, op. cit., (prface, VIII et IX), un remarquable exemple
donn par M. Padoux du fait que, de nos jours encore, la loi a lautorit dun conseil et non
point force souveraine.
(902) Tso tchouan, C. III,
550
.
(903) Han Fei tseu, 38 et 43.
(904) Ibid., 49.
(905) Ibid., 49.
(906) Masson-Oursel et KIA KIEN-TCHOU, op cit., 580.
(907) Ibid., 580.
(908) Han Fei tseu, 44.
(909) Ibid., 43. Chen Pou-hai parle des recettes (chou) ; mais Wei-yang fait des lois (fa)
cf. Masson-Oursel et KIA KIEN-TCHOU, op. cit., 569. Les recettes, cest ce dont le Prince
use dans le priv : les infrieurs ne doivent pas en tre informs.
(910) Voir p.
353
.
(911) Han Fei tseu, 49.
(912) Yin Wen tseu, Masson-Oursel et KIA KIEN-TCHOU, op. cit., 31.
(913) Han Fei tseu, 49.
(914) Je choisis cet exemple parce que Tchouang tseu la uti lis pour condamner les recettes
perfectionnes (Wieger, Les Pres du systme taoste,
301
). Cest l un point essentiel o
Lgistes et Taostes sopposent.
(915) Cest, mon sens, une erreur grave de traduire cette expression par Efficace . (Voir
en sens contraire Maspero, La Chine antique,
527
). Il sagit deffi cience constate positive.
(916) Han Fei tseu, 40.
(917) Ibid., 41.
(918) Ibid., 27.
(919) Yin Wen tseu, Masson-Oursel et Kia Kien-Tchou, op. cit., 592.
(920) Voir pp.
335, 336
.
(921) Civ. Chin,
116
.
(922) Wei-yang imagina, dit-on, un systme des permis de circulation pour enrayer le
vagabondage.
(923) Han Fei tseu, 49.
(924) Yin Wen tseu, Masson-Oursel et Kia Kien-Tchou, op. cit., 593.
(925) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
103
.
(926) Le hameau de Confucius . SMT, V,
436 sqq
.,
435
.
Marcel GRANET La pense chinoise 398
(927) Latinisation de Kong fou-tseu (fou-tseu, matre, est une appellation honorifique).
(928) Granet, Danses et lgendes...,
431 sqq
. Cf. Ibid.,
556
.
(929) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
499
.
(930) Woo Kang, Les trois thories politiques du Tchouen tsieou, 173 sqq.
(931) SMT, V,
442
.
(932) Voir, pour une opinion contraire, Maspero, La Chine antique, 456, note et 461 note.
Voir supra p.
363 sqq.
(933) SMT, V,
281 sqq
. Sseu-ma Tsien, fait significatif, a class la biographie de Confucius
parmi les monographies des Maisons seigneuriales.
(934) Les mouvements sectaires ont toujours t frquents au Chan-tong.
(935) Louen yu, Legge, 60. [CSS Louen yu] . Combien, hlas ! je dchois ! Voil longtemps
hlas ! que ne mest plus apparu en rve le duc de Tcheou !
(936) Sur Yi Yin et Confucius, voir Granet, Danses et lgendes...,
431 sqq
. SMT, V,
424
.
(937) SMT, V,
338
,
298
. Yen tseu son ennemi, est un nabot. (Cf. note 812.)
(938) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
189
.
(939) SMT, V,
341
,
312
,
310
.
(940) Granet, op. cit.,
552
.
(941) SMT, V,
333
.
(942) SMT, V,
332
.
(943) SMT, V,
367
.
(944) SMT, V,
317
et
324
.
(945) Louen yu, L., 200. [CSS Louen yu]
(946) Ibid., L., 198. [CSS Louen yu]
(947) Ibid., 131, [CSS Louen yu] ; 131, [CSS Louen yu] .
(948) Ibid., 104 , [CSS Louen yu] ; et Li ki, C., I,
141-142
.
(949) SMT, V,
345
.
(950) Louen yu, L., 185, [CSS Louen yu] .
(951) Ibid., 108, [CSS Louen yu] .
(952) Ibid., 161, [CSS Louen yu] .
(953) Ibid., 190, [CSS Louen yu]
(954) Louen yu (tout le chap. X), L., 91 sqq. [CSS Louen yu]
(955) Granet, Le langage de la douleur, 115.
(956) Louen yu, L., 42, [CSS Louen yu] .
(957) Ibid., 66, [CSS Louen yu] .
Marcel GRANET La pense chinoise 399
(958) Ibid., 186, [CSS Louen yu] .
(959) Ibid., 182, [CSS Louen yu] .
(960) Maspero, La Chine antique,
462
. Maspero ajouta p.
464
: Ltude nest pas tout, il
faut savoir simposer un perfectionnement moral et, trois pages plus loin p.
467
: Le
perfectionnement de chaque individu ny (dans le systme de Confucius ) apparat
quacces soirement , et enfin, p.
479
, Confucius a cherch la fondement de la morale, hors
de la conscience, dans les Rites, et celui des relations sociales, au contraire, lintrieur de la
conscience, dans lAltruisme . Jai bien peur de navoir pas compris ces formules ni ce que
veut dire Maspero quand il dit que lindividu, en tant que tel, reste compltement tranger
ses recherches (aux recherches de Confucius). Je souponne, cependant, que Maspero
emploie lexpression individu en tant que tel pour dsigner, par opposition au Prince, les
simples particuliers. (Cf. p. 379.)
(961) Louen yu, L., 16, [CSS Louen yu]. Lexpres sion kiun tseu dsigne le noble qui a une me
princire (kiun), le gentilhomme qui est honnte homme.
(962) Ibid, 118, [CSS Louen yu] .
(963) Ibid, 33, [CSS Louen yu] .
(964) Ibid., 114, [CSS Louen yu] .
(965) Ibid., 33, [CSS Louen yu] .
(966) Un disciple encourageait un seigneur faire prsent Confucius dun vaste domaine :
Il nen tirera aucun avantage personnel , ce quil recherche, cest le Tao propre au kiun
tseu . (SMT, V,
387
.)
(967) Louen yu, L., 30, [CSS Louen yu] .
(968) Ibid., 65, [CSS Louen yu] .
(969) Ibid., 70, [CSS Louen yu] .
(970) Ibidem, [CSS Louen yu] .
(971) Voir le passage cit, p.
368
.
(972) Louen yu, L., 36, [CSS Louen yu] .
(973) Ibid., 126, 26, 31, 134, 164. Le mot rang sapplique aux coles et aux sectes.
(974) Ibid., 34 [CSS Louen yu] , et 144.
(975) Ibid., 164, [CSS Louen yu] ; 41, [CSS Louen yu] ; 115.
(976) Ibid., 42, [CSS Louen yu] .
(977) Ibid., 135.
(978) Ibid., 30 ; 43, [CSS Louen yu] ; 114, 115, 116 ; 126, [CSS Louen yu] ; 138, [CSS Louen
yu] ; 140.
(979) Ibid., 184, [CSS Louen yu] ; 39.
(980) Ibid., 183, [CSS Louen yu] ; (Cet amour dautrui est le ffet que produit sur le
gentilhomme ltude du Tao), p.124 . Le mot jen, qui se prononce comme le mot signifiant
homme, scrit avec le signe homme plus le signe deux.
(981) Wieger, Les Pres du systme taoste, 133. Ce nest pas moi qui souligne. Le P. Wieger
crit, p. 135 (aprs avoir rserv le mot charit) ce jugement sur les disciples de Confucius :
Marcel GRANET La pense chinoise 400
Aimer accaparer les esprits, voil leur amour des hommes. Cette formule sinspire dun
esprit de dnigrement qui est, pour le moins, imprudent.
(982) Maspero, La Chine antique, p.
464
.
(983) Louen yu, L., 156, [CSS Louen yu] ;
(984) Ibid., 159, [CSS Louen yu] ; Lexpression wou wei est gnralement donne comme
spcifiquement taoste.
(985) Ce trait (Li ki, C., II,
614 sqq
.) attribu tantt Tseu sseu, petit-fils du Matre, tantt
Tseng tseu (lun des disciples), se compose dun texte trs bref et de longs commentaires.
(986) Voir Granet, Le langage de la douleur, 178 sqq
(987) Trait attribu Tseu-sseu (Li ki, C., II,
427 sqq
.).
(988) Li ki, C., II
427
.
(989) Ibidem.
(990) Ibid, II,
450
. Cf. p.
452
. Quand on sait comment se cultiver soi-mme (sieou chen),
on sait comment gouverner les hommes ; Quand on sait comment gouverner les hommes, on
sait comment gouverner lEmpire ou un tat Le Tao nest pas loin de lhomme (p. 436).
On se cultive soi-mme laide du Tao ; on cultive le Tao (sieou Tao) laide du jen :
quest -ce que le jen ? cest lhomme ( jen) (p. 449). Cest avec lhomme quon rgle
lhomme. (p. 436).
(991) Li ki, C., II,
434
.
(992) Louen yu, L., 104, [CSS Louen yu].
(993) Ibid., 80, [CSS Louen yu].
(994) Ibid., 65, [CSS Louen yu].
(995) Tchouang tseu, L., II, 221.
(996) Voir p.
361
et Tchouang tseu, L., II, 220.
(997) La tradition veut que M tseu ait t un habile technicien (Cf. Lie tseu, Wieger, Les
Pres du systme taoste,
145
et
189
). Les dernires sections du M tseu (52-71) se
rapportent lart des siges et la balistique.
(998) Tchouang tseu, L., II, 220.
(999) Ce sont ces onze sermons (livres 2 9 des ditions actuelles) qui forment la partie la
plus ancienne du M tseu. Le livre entier a t traduit par Forke (M Ti, des Socialethikers
und seiner Schler philosophische Werke). De nombreux passages, trs abms, sont
incomprhensibles. Une tude des sources du M tseu reste faire.
Marcel GRANET La pense chinoise 401
Notes 1000 1099 :
(1000) Forke, op. cit., 22.
(1001) Ceux qui admettent lhomognit de style du M tseu ne ladmettent quavec des
restrictions embarrasses (Maspero, La Chine antique, 472, note).
(1002) Tchouang tseu, L., 219.
(1003) Tchouang tseu (Wieger, Les Pres du systme taoste,
491
) nous parle dune famille
qui se divise entre sectateurs de M tseu et de Confucius. Un autre passage (Ibid.,
473
)
montre le prestige gal des deux sages.
(1004) Wieger, Histoire des croyances religieuses...,
209
. Ce fut, dit le P. Wieger :
le seul crivain chinois dont on puisse penser quil crt e n Dieu, le seul aptre
de la charit et chevalier du droit que la Chine ait produit. Il prcha, en des
pages magnifiques, la ncessit du retour la foi des anciens
Dans ce dithyrambe imprudent, il y a, pour le moins, quelque lgret.
(1005) M tseu, 11.
(1006) Ibid., 11.
(1007) Lidal de la secte, cest la thocratie : le grand matre qui tait considr comme un
saint tait dsign par son prdcesseur (Liang Chi-Chao, History of political thought, 110).
(1008) Ou plutt dutilisation des chances, voir pp
351 sqq
.
(1009) M tseu, 29.
(1010) Ibid., 31.
(1011) Ibid., 26.
(1012) Ibid., 26.
(1013) Ibid., 26.
(1014) Pelliot, Meou tseu ou les Doutes levs, 479.
(1015) Voir la citation de la p. 400. Liang Chi-Chao (op. cit., 98 sqq). a fort justement insist
sur ce fait.
(1016) M tseu, 14 et 15.
(1017) Ibid., 1 ; Che king, C.,
381
.
(1018) M tseu, 11.
(1019) Liang Chi-Chao, Op. cit., 110.
(1020) M tseu, 48.
(1021) Tchouang tseu, Wieger, Les Pres du systme taoste,
423
.
(1022) Lao tseu, Wieger, Op. cit.,
37
, et Tchouang tseu, ibid.,
233
,
ibid.,
487
.
(1023) Une de ces traductions, celle de Stanislas Julien, (1842) mrite dtre signale ; parfai-
tement consciencieuse, elle ne trahit pas le texte, mais elle ne permet pas, non plus, de le
comprendre.
(1024) Tchouang tseu, L., II, 227, [Wieger, p.
505
]
Marcel GRANET La pense chinoise 402
(1025) Voir p.
441
.
(1026) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
313
.
(1027) Lie Tseu, Wieger, op. cit.,
107
.
(1028) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
357
.
(1029) SMT, chap. 63. Legge (Texts of Taoism) a donn une traduction consciencieuse, mais
extrieure et formelle, du Tchouang tseu (et du Lao tseu [ou Lao tseu]). Le P. Wieger a publi
une sorte de paraphrase du Lao tseu, du Lie tseu et du Tchouang tseu peu fidle dans le dtail,
elle donne une ide assez vivante, mais tendancieuse, de ces uvres.
(1030) SMT, Introd., p. XVIII.
(1031) Wieger, op. cit., note 105, note 118.
(1032) Maspero, La Chine antique, 493.
(1033) Granet, La religion des Chinois ; Remarques sur le Taosme ancien, As. maj., 1925, p.
146 sqq. Je rserve pour un autre ouvrage lexamen dtaill des usages, religieux et
esthtiques, dont est sortie la mystique taoste ; je ne puis, dans les pages qui suivent,
quindiquer une partie des conclusions o cet examen ma conduit.
(1034) Siun tseu, section 2.
(1035) Sur ces ftes, voir, provisoirement, Civ. Chin.,
223 sqq .
(1036) Louen heng, Forke, Lun-Heng..., I, 335. Lieou Ngan (Houai-nan wang), prince de la
famille impriale, fut contraint se suicider en 122.
(1037) Civ. Chin. :
57,
419 sqq.
(1038) Civ. Chin. :
51,
418.
(1039) Granet, Danses et lgendes...,
314
,
344
,
376
.
(1040) Tchouang tseu, L., I, 171, [Wieger, p.
211
]. Comp. Lie tseu, Wieger, op. cit.,
83.
(1041) Tchouang tseu, L., I, 192, [Wieger, p.
223
].
(1042) Lao tseu, L., 93, [Wieger, p.
48
].
(1043) Granet, op. cit.,
280 sqq
,
199 sqq
.,
466 sqq
.
(1044) Voir plus haut p.
265
.
(1045) Tchouang tseu, L., I, 314, [Wieger, p.
297
].
(1046) Granet, op. cit.,
562
.
(1047) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
107
.
(1048) Civ. Chin.
422
.
(1049) Supra, p.
64
et
72
et Infra, p.
446
.
(1050) Civ. Chin.
418
,
420
.
(1051) Ni gorges ni montagnes narrtent leurs pas : cest une course de lesprit ; ni
chars ni bateaux ny pourraient mener, ce sont des bats spirituels Lie tseu, Wieger, op. cit.,
82).
Marcel GRANET La pense chinoise 403
(1052) Tchouang tseu, L., I.,168, 324, 332, 299, 303
;
II, 97.
[Wieger, pp.
211,
303,
309,
287,
291,
417].
(1053) Une anecdote commune au Tchouang tseu, (L., I, 262 sqq., [Wieger, p.
265
) et au
Lie tseu (Wieger, op. cit.,
95
) peut donner une ide de ces joutes : le vaincu perd prestige et
disciples, de mme que le chef vaincu dans les joutes chamanistiques perd ses droits la
chefferie (Granet, op. cit., 282 : lutte entre Chouen et son frre).
(1054) Voir plus haut p.
325
.
(1055) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
137
.
(1056) Lao tseu, L., 99 [Wieger, Lao55]. Comp. Tchouang tseu, L, II, 80.
(1057) Le texte prsente ici deux leons : je suis celle que Legge avait adopte.
(1058) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
101
; Tchouang tseu, ibid.,
275
.
(1059) Voir p.
390
et Lie tseu (Ibid. 93).
(1060) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
101
.
(1061) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
273
.
(1062) Tchouang tseu, L, I, 300 sqq. [Wieger, Tch11D].
(1063) Ibid., I, 245 [Wieger, Tch6E] ; I, 265 [Wieger, Tch7E].
(1064) Houai-nan tseu, 7 ; SMT, chap. 105.
(1065) Tchouang tseu, L. II, 19, [Wieger, Tch19G] ; et I, 238 [Wieger, Tch6B].
(1066) Ibid., I, 176. [Wieger, Tch2A].
(1067) Lexpression respirer la manire dun embryon ne sembla pas apparatre avant
les Han, mais le Lao tseu (L., 53, ; 95 [Wieger, Lao52] ; 100 [Wieger, Lao56] ) contient des
allusions trs prcises cette pratique.
(1068) Lao tseu, L., 53.
(1069) Tsien Han chou, 30, p. 338b ; Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
360
et
357.
(1070) Lao tseu, L., 118, [Wieger, Lao76] ; L., 120 [Wieger, Lao78].
(1071) Tchouang tseu, L., II, 171.
(1072) Ibid., II, 14 ; Lie tseu, Wieger, op. cit.,
87
.
(1073) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
251
[Tch6A],
259
[Tch6G],
289
,
265
[Tch7D],
325
[Tch14E].
(1074) Ibid., 357 [Tch19B].
(1075) Ibid., 391 ; Lie tseu, Ibid.,
85
,
89
.
(1076) Tchouang tseu, Wieger, op. cit., 211 [Tch1C] ; Lie tseu, Ibid., 85 [Lie2C],.
(1077) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
393
, 380 ?.
(1078) Ibid,
159
,
215
. Le nouveau-n, comme le saint en extase, a un corps et un cur
comparables du bois mort et de la cendre teinte : cest pour cela quil est toute souplesse
(Ibid.
407
).
Marcel GRANET La pense chinoise 404
(1079) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
259
,
305
,
325
,
331
,
287
,
289
,
223
.
(1080) Tchouang tseu, L., 201, 202 [Wieger, p.
229
].
(1081) Maspero (La Chine antique,
494
), na pas craint de traduire p ar me le mot ki
(souffle).
(1082) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
289
.
(1083) Ibid.,
287
.
(1084) Lao tseu, L., 75 [Wieger Lao33].
(1085) Ibid., L., 89 [Wieger Lao47].
(1086) Tchouang tseu, chap. VIII, chap. IX.
(1087) Tchouang tseu, L., I, 373. [Wieger, p.
335
]
(1088) Ibid., I, 274 [Wieger Tch8D].
(1089) Voir, en sens inverse, Maspero La Chine antique,
495
.
(1090) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
325,
261,
233,
333
, et L., 367, note 2.
(1091) Cf. p.
394
.
(1092) Legge, Texts of Taoism, Introd., 12 sqq.
(1093) Le P. Wieger (op. cit.,
139
) a le premier propos la traduction de kiun par continuit
[il dit parfois : continu mystique (Ibid.,
142
)], mais sans signaler le caractre magique de
cette notion.
(1094) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
109
.
(1095) Maspero, La Chine antique,
502
.
(1096) Cest la thse soutenue par Hou Che, dans un opuscule intitul Houai-non wang chou
(Changha, 1931).
(1097) Lie tseu, chap. V.
(1098) Tchouang tseu, chap. I, chap. II, chap. XVII.
(1099) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
227
. Comp. Ibid.
225
.
Marcel GRANET La pense chinoise 405
Notes 1100 1199 :
(1100) Tchouang tseu, Legge, I, 191, [Wieger, Tch2F].
(1101) Ibid., II, 65, [Wieger,
395
].
(1102) Ibid., I, 277 ; Lie tseu, Wieger, op. cit.,
79
.
(1103) Tchouang tseu, L., I, 182.
(1104) Ibid., II, 96.
(1105) Ibid., I, 183 (Comp. p.
321
lanalyse de lide de Houang ti).
(1106) Ibid., I, 378.
(1107) Ibid., I, 164 sqq. et 374 sqq.
(1108) Ibid., II, 164.
(1109) Cest --dire des Sophistes quand ils argumentent en voquant une suite progressive de
divisions relles.
(1110) Tchouang tseu, L., II, 166.
(1111) Les Taostes ne refusent point dadmettre une certaine hirarchie.
(1112) Tchouang tseu, L., I, 256. Comparer Ibid., 352
(1113) Le mot tche signifie pntrant et qui se rpand partout uniformment .
(1114) Tchouang tseu, L, I, 245. Comp. Ibid., II, 145, et Lie tseu, Wieger, op. cit.,
121
.
(1115) Tchouang tseu, L., I, 257.
(1116) Ibid., II, 83.
(1117) Ibid., I, 209 [cf. note 1090].
(1118) Ibid., I, 224 [Wieger,
243
].
(1119) Ibid., I, 229 (Wieger,
289
).
(1120) Ibid., I, 169 (Wieger,
211
).
(1121) Ibid., L., II, 129 sqq. ; Lao tseu, L., I, 54.
(1122) Tchouang tseu, L., II, 83.
(1123) Ibid., I, 243 et 311.
(1124) Cest l, sans doute, ce qua voulu exprimer Hou Che (The development of logical
method in ancient China, 142 sqq.) quand il a prsent Tchouang tseu comme un thoricien
de la logique thse repousse dun mot comme pa radoxale par Maspero (La Chine antique,
492, note), qui accorde peu doriginalit aux matres taostes pour ce qui est de leurs
thories doctrinales et voit, dans la pratique de la vie mystique, leur grande dcouverte
(Maspero, Le saint et la vie mystique chez Lao-tseu et Tchouang tseu, 7 et 9).
(1125) Tchouang tseu, L., II, 87, 89. [Wieger, Tch23F]
(1126) Les 5 perversions proviennent des 5 Couleurs (qui troublent les deux yeux), des 5
Notes (qui troublent les deux oreilles), des 5 Odeurs (qui troublent les deux narines), des 5
Saveurs (qui troublent la bouche) au total sept orifices et quatre sens et des prfrences
et dgots qui troublent le cur (lequel a, lui aussi, sept orifices).
Marcel GRANET La pense chinoise 406
(1127) Tchouang tseu, L., I, 328. Comp. Ibid., 268, et Lao tseu, L., 55.
(1128) Ibid., II, 139.
(1129) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
117 - 119
.
(1130) Ibid., 121.
(1131) Tchouang tseu, L., I, 198 ; Lao tseu, L., 90.
(1132) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
109
.
(1133) Tchouang tseu, L., I, 366.
(1134) Ibid., I, 274.
(1135) Ibid, I, 392. Voir plus haut, p.
369
.
(1136) Ibid, II, 143 (Wieger,
449
).
(1137) Ibid., II, 278 ?.
(1138) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
101
, ibid.,
91
.
(1139) Ibidem.
(1140) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
93
.
(1141) Lao tseu, Legge 54, 104. 120 (Wieger
24,
ibid.,
61
,
53
).
(1142) Tchouang tseu, Legge, I, 225 (Wieger
243
).
(1143) Ibid., I, 330 (Wieger
309
).
(1144) Ibid., I, 266 (Wieger
267
).
(1145) Ibid., II, 226 et Lie tseu, Wieger, op. cit.,
129
.
(1146) Ibid., I, 361 (Wieger
329
). Les livres sont les dtritus des anciens (Ibid., I, 344,
[Wieger
317
).
(1147) Ibid., Wieger, op. cit., 273, 279, 301 [Tch12K].
(1148) Ibid.,
317
.
(1149) Ibid.,
359
.[css : et Lie tseu, Wieger, op.cit.,
93
]
(1150) Lie tseu, Wieger, op.cit.
145
.
(1151) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
399
;
229
.
(1152) Lao tseu, L., 87, [Wieger, Lao43] ; Lie tseu, Wieger, op. cit.,
187
.
(1153) Tchouang tseu, L., II, 143.
(1154) Lao tseu, L., 100, [Wieger, Lao56].
(1155) Ibid., 90, [Wieger, Lao48].
(1156) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
82
.
(1157) Tchouang tseu, L., I, 278-280. Ce tableau, qui veut glorifier les joies simples des ges
sans rites ni contrainte, a servi faire accuser les Taostes de partager avec les autres sages
Marcel GRANET La pense chinoise 407
chinois un mpris cynique du peuple (Maspero, La Chine antique, 557). Lao tseu (Legge,
p. 49) conseille, il est vrai, demplir le ventre et daffaiblir le vouloir, mais il le conseille
tous et dit le saint semploie en faveur de son ventre (quil peut satisfaire) et non de ses
yeux (qui sont insatiables) (Legge, 55).
(1158) Tchouang tseu, L., I, 288. (Comp. Lao tseu, L., 122.)
(1159) Ibid., II, 30.
(1160) Lao tseu, L., 52 [Wieger, Lao07] et 121 [Wieger, Lao79].
(1161) Tchouang tseu, chap. X, chap. XI.
(1162) Ibid., chap XV, chap. XXIX, et Wieger, op. cit.,
405
; Lao tseu, L., 117.
(1163) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
307
. Yang tseu est encore nomm cit de M tseu,
pp.
269
et
279
.
(1164) On ne sait rien sur Yang tseu, sinon quil vcut avant Tchouang tseu et Mencius, qui le
combattent. Rien nest rest de son uvre, sil a crit. Un lot danecdotes o Yang tseu est en
scne forment le chapitre VII du Lie tseu actuel. Ce sont suppositions gratuites que prtendre
soit que cet opuscule contient une analyse faite par Lie tseu des thories de Yang tseu (LIANG
CHI-CHAO, History of Chinese political Thought, 87), soit quil est un fragment des
uvres de Yang tseu (Maspero, La Chine antique, 509).
(1165) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
165
.
(1166) Ibid.,
173
.
(1167) Ibid.,
(1168) Ibid.,
165
.
(1169) Ibid., et
175
et
177
.
(1170) Ibid.,
177
.
(1171) Voir, p.
398
. On sait que Yu, pour rduire les eaux dbordes, se dvoua au Fleuve
Jaune. Le dvouement sopre en jetant au dieu ongles et cheveux (qui donne la partie donne
le tout). (Granet, Danses et lgendes...,
467
.
(1172) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
173
.
(1173) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
327
.
(1174) Ibid.,
253
et
327.
(1175) Ibid.,
301
.
(1176) Tchouang tseu, Legge, II, 117, [Wieger, Tch25C] Comparer plus haut, p.
432
.
(1177) Ibid., I, 324. [Wieger, Tch12L]
(1178) Ibid., I, 308. [Wieger, Tch12B]
(1179) Ibid., I, 217 220. [Wieger, Tch4D]
(1180) Ibid., II, 74 sqq. [Wieger, Tch23A]
(1181) Tchouang tseu, Wieger, op. cit.,
425
.
(1182) Ibid.,
423
. Comp. Lie tseu, Wieger, op. cit.,
97,
125.
Marcel GRANET La pense chinoise 408
(1183) Ibid.,
463
.
(1184) Tchouang tseu, chap. XXVIII.
(1185) Tchouang tseu, L., I, 297 sqq. [Wieger, Tch11C]
(1186) Lie tseu, Wieger, op. cit.,
109
(1187) Tchouang tseu, L., I, 226. [Wieger, Tch5D]
(1188) Ibid.
(1189) Tchouang tseu, L., II, 126 sqq. [Wieger, Tch25J]
(1190) Civ. Chin..
(1191) Voir p.
380
.
(1192) Lopposition de Tchouang tseu et de Siun tseu (infra, p.
462
) est uniquement
formelle.
(1193) Tchouang tseu, L., I, 286, 287. [Wieger, p.
279
]
(1194) Ibid., I, 207.
(1195) Tchouang tseu, chap. X.
(1196) Tchouang tseu, L., II, 82. [Wieger, Tch23D]
(1197) Linfluence ancienne du Taosme sur les arts plastiques parat certaine dans la
mesure o lon peut juger sur documents. Ceux-ci sont rares et, pour la plupart, difficiles
localiser historiquement, si bien que larch ologie chinoise (qui cesse peine dtre purement
livresque) dpend encore (et le dommage est plus grand en ce cas que pour toute autre
discipline) de la littrature, ou, plutt, de lamplification littraire.
(1198) Civ. Chin.
(1199) On dsigne ainsi un recueil dopuscules publi sous le patronage de Lieou Ngan,
prince de la famille des Han, qui fut roi de Houai-nan de 164 123. Il fit figure de mcne et
de bibliophile. Il passe pour avoir, sinon rdig nouveau, du moins marqu de son style les
traits assez varis, mais o se sent toujours une inspiration taoste, qui forment le Houai-nan
tseu.
Marcel GRANET La pense chinoise 409
Notes 1200 1285 :
(1200) Tchouang tseu, L., II, 83.
(1201) Les dettes du Bouddhisme chinois au Taosme sont bien indiques par Pelliot (Meou
tseu ou les Doutes levs). Comp. Hackmann, Chinesische Philosophie, 229.
(1202) SMT, V,
400
.
(1203) SMT, V,
307
,
438
.
(1204) Li ki, C., II,
319
,
320
.
(1205) Mencius, L., 283, 284, [Couvreur, p.
577
]. De lexpression leang sin se rapprochent
les expressions leang neng et leang tche : le talent et le savoir nobles.
(1206) Legge (t. II des Chinese Classics) a donn une bonne traduction des uvres de
Mencius [note css : on a retenu pour sa clart le site nothingistic.org ; sacred-texts.com
prsente aussi la traduction Legge. Mais : il ny a sur aucun des deux sites la numrotation
de page du livre de Legge utilise par M. Granet ; il ny a sur aucune rfrence de M. Granet
la numrotation des chapitres des deux sites ... Les liens sur le site nothingistic ci-dessous
conduisent prs de la rfrence Granet ; il faut ensuite aller au indiqu par css entre
crochets pour atteindre son but. ] Sseu-ma Tsien a consacr Mencius une courte notice bio -
graphique (chap. LXXIV). La tradition fait vivre Mencius de 372 288 : dates contestes et
impossibles prciser.
(1207) Par exemple le roi Houei de Wei (mort vers 323), et le prince hritier de Teng.
(1208) Mencius, L., 158 [ 9], [Couvreur, p.
321
].
(1209) Mencius, L., 340 [ 1], [Couvreur, p.
321
].
(1210) Ibid., 367 [ 2], [Couvreur, p.
321
].
(1211) Ibid., 135 [ 1], [Couvreur, p.
432
].
(1212) Fait remarquable : Mencius vite de combattre et mme de nommer les Taostes quil
ne pouvait manquer de connatre ; il se peut mme quil ait rencontr Tchouang tseu Tsi.
(1213) Mencius, L., 198, [Couvreur, p.
490
].
(1214) Voir, pour une interprtation contraire Pelliot, Meou tseu ou les Doutes levs, 561.
(1215) Mencius, L., 125 [ 6], [Couvreur, p.
373
].
(1216) Ibid., 78 [ 3], [Couvreur, p.
375
]. De mme Mencius admet Ibid., [ 1], [Couvreur,
p.
477
] que (malgr le tabou qui les spare) un beau-frre peut tendre la main sa belle-sur,
si elle est sur le point de se noyer. Lintention, le cur , lemportent sur les formes rituelles.
(1217) Ibid., 79 [ 4-7], [Couvreur, p.
376
]. Ces principes sont aussi essentiels aux hommes
que leurs quatre membres.
(1218) Ibid., 110 sqq, [Couvreur, p.
406
].
(1219) Ibid., 80 [ 7], [Couvreur, p.
376
].
(1220) Ibid., 292, 293 [ 2], [Couvreur, p.
576
].
(1221) Ibid., 280 [ 1], [Couvreur, p.
565
].
Marcel GRANET La pense chinoise 410
(1222) Ibid., 283-284 [ 3], [Couvreur, p.
568
].
(1223) Ibid., 280 [ 2], [Couvreur, p.
566
].
(1224) Mon interprtation se rapproche de celle donne par Liang Chi-Chao, (History of
political thought, 54) et soppose la thse (Maspero , La Chine antique, 552) prtendant que
Mencius, comme les Taostes ( ?) admet le caractre dualiste de lesprit humain . Mencius
se borne opposer la culture noble et la grossiret plbienne.
(1225) Linspiration taoste est rendue manifeste par la formule Lhomme, par essence, tend
vers le bon, comme leau va vers le bas. Legge, p. 271.
(1226) Civ. Chin..
(1227) Mencius, L., 75-76 [ 1 sqq], [Couvreur, p.
373
].
(1228) Mencius, L., 186, [Couvreur, p.
481
]. Ainsi conseill le prince pratique le jen et il
ny a personne qui ne pratique le jen. Il pratique le yi et il ny a personne qui ne pratique le yi.
Le prince est correct et tout est correct. Ds que (le conseiller) a rendu le prince correct, le
pays est affermi.
(1229) Mencius, L., 75 [ 1], [Couvreur, p.
373
].
(1230) Mencius, L., 118 [ 6-10], [Couvreur, p.
415
].
(1231) Mencius, L., 115 [ 3], [Couvreur, p.
412
] . Voir (Civ. Chin.) la faon dont les
Lgistes de lempereur Wou se servirent des lois pour prendre le peuple au filet et
lasservir.
(1232) Mencius, L., 23 [ 20], [Couvreur, p.
321
]
(1233) Mencius, qui vita de parler des Lgistes, leur emprunte cette dsignation significative
du chef (L., 23 [ 21-22] [Couvreur, p.
322
] ) : Un prince clair fixe des moyens dexis -
tence son peuple de manire que chacun ait de quoi subsister et faire subsister parents,
femmes et enfants... sinon comment demander au peuple quil cultive les rites et lquit,
li-yi ?
(1234) Mencius, L., 231[ 6] [Couvreur, p.
519
]. Cf. Ibid., 359. Un prince ne peut
transmettre son pouvoir : il prsente un successeur au Ciel, puis au peuple ; le Ciel puis le
peuple acceptent. Le peuple est ce quil y a de plus noble, puis viennent les autels du sol et
des moissons ; et, en dernier lieu, le prince.
(1235) Mencius L., 125 [ 6] [Couvreur, p.
422
] cite cet adage au cours dun tournoi oratoire
contre Hiu-hing, un conomiste physiocrate.
(1236) SMT, chap. LXXIV.
(1237) Maspero. La Chine antique, 565, note. (Cf. Bubs, The works of Hsntze).
(1238) Deux sections, certainement authentiques, ont t traduites, la 22
e
(sur les dsignations
correctes) en franais, par Duyvendack (TP, 1924), la 23
e
(sur le naturel mauvais de
lhomme), en anglais, p ar Legge, dans les Prolgomnes de sa traduction de Mencius. Sur la
doctrine de Siun tseu, ) Duyvendack a publi (tudes de philosophie chinoise (Revue philoso-
phique, 1930) une excellente analyse.
(1239) Comparer cette thse celle de M tseu, supra, p. 404.
(1240) Siun tseu, section 9 ; Liang Chi-Chao, History of Chinese political Thought, 63.
(1241) Siun tseu, section 23 (Legge, Chinese Classics, II, 82 des Prolgomnes).
Marcel GRANET La pense chinoise 411
(1242) Ibidem.
(1243) Il nest pas impossible que Siun tseu, sans le dire trop expressment, ait attribu aux
ftes danses et chantes une sorte de valeur cathartique. Il ne croyait pas la ralit du
Souverain dEn-haut, ni celle des dieux, ou mme des esprits, mais il approuvait les
crmonies faites en leur honneur, sacrifices au Ciel, sacrifices au Sol : ces crmonies, par le
seul fait quelles sont rgles, servent purger le cur des hommes des craintes ou des
esprances qui peuvent le troubler.
(1244) Siun tseu, chap. 14.
(1245) Section 4, Liang Chi-Chao, op. cit., 64.
(1246) Section 19. Cf. SMT, II, 212.
(1247) Liang Chi-Chao, Op. cit., 66 sqq.
(1248) Supra, p. 453.
(1249) Liang Chi-Chao, Op. cit., 70. Siun tseu fut lami de Li Sseu, qui devait devenir le
principal conseiller de Che Houang-ti, et il passe pour avoir t le matre de Han Fei tseu.
Rien dans son uvre ne donne penser quil ait song accrotre la puissance de ltat, ou
quil ft partisan de la mani re autoritaire des lgistes.
(1250) Section 23.
(1251) Section 21. SMT, III,
227
.
(1252) Section 23.
(1253) Section 1. Comparer section 23 : La nature humaine tant mauvaise a besoin de
matres et de modles.
(1254) Supra, p. 460.
(1255) Section 1.
(1256) Siun tseu, personnellement, enseignait les rites et marquait quelque mpris pour
lensei gnement de la posie (Che king) et surtout pour celui de lhistoire.
(1257) Section 19.
(1258) Duyvendack, tudes de philosophie chinoise, 387.
(1259) Lopposition avec les Taostes est absolue.
(1260) Section 22. TP, 1924, p. 234 sqq.
(1261) Ceci a conduit Maspero attribuer Siun tseu un mysticisme qui jure avec lensemble
de sa doctrine, si cohrente (cf. Duyvendack, op. cit., 385 sqq.) ; Maspero confond leffort
synthtique de lesprit et ltat de transe o lesprit est transport hors de lui -mme (in La
Chine antique, 572). Aucune expression, ni dans Siun tseu (ni du reste dans Tchouang tseu,
plus intellectuel que mystique), ne justifie cette glose.
(1262) Section 21 (do sont aussi tires toutes les citations qui suivent).
(1263) Siun tseu insiste sur les illusions des sens dues aux passions : On prend un roc pour
un tigre prt bondir si, la nuit, on se laisse dominer par la crainte.
(1264) Siun tseu (mme section) emploie frquemment le mot Tao dans le sens de raison
humaine. Le Tao, cest la faon dont lhonnte homme agit. Le Tao est raison pratique ; le
Li, raison pure et pratique la fois.
(1265) Comme de juste, la logique du Siun tseu est une logique de la hirarchie.
Marcel GRANET La pense chinoise 412
(1266) Comparer, p. 425, la formule de Lao tseu. Siun tseu, qui se rclame expressment de
Confucius et de lorthodoxie, travaille au syncrtisme.
(1267) Le Yi li est un manuel pour matres de crmonies, le Li ki un recueil composite o les
questions rituelles tiennent la plus grande place.
(1268) Section 5.
(1269) SMT, Introd., p.
CLI
.
(1270) [portrait] Il naquit vers 175 et mourut vers 105 avant J.-C. Nomm lettr au vaste
savoir sous le rgne de lempereur King (156-141), il exera, sous lempereur Wou, des
fonctions en province ; il dut dmissionner parce que, en dissertant sur les prodiges, il se livra,
dirent ses ennemis, des critiques contre le gouvernement des Han. Il composa, pour rpon-
dre un questionnaire de lempe reur Wou, trois discours clbres (Tsien Han chou, ch. 56).
Ses uvres, faites darticles divers, composent aujourdhui le Tchouen tsieou fan lou. Cf.
Franke, Das Confuzianische Dogma und die chinesische Staatreligion, Woo Kang, Les trois
thories politiques du Tchouen tsieou et Hackmann, Chinesische Philosophie, 205 sqq.
(1271) Woo Kang, op. cit., 51.
(1272) Ibid., 73.
(1273) Lempereur Wou cra, en 136, la charge de lettrs au vaste savoir des Cinq Livres
canoniques . En 124, on adjoignit ce Collge de lettrs cinquante disciples destins
devenir de hauts fonctionnaires.
(1274) Civ. Chin. :
326 sqq,
425 sqq
.
(1275) Tchouen tsieou fan lou, 7 ; Woo Kang, op. cit., 111 sqq.
(1276) Supra, p. 169.
(1277) La glose qui sert de point de dpart (Kong-yang tchouan, 11
e
anne du duc Houan)
indique que confondre les trois titres de comte, vicomte, baron dans une seule classe, cest
adopter le principe cleste du gouvernement, car le ciel a trois luminaires et lon rduit alors
trois les classes de la noblesse. Si on en comptait cinq (cinq lments), cest quon tirerait de
la terre le principe du gouvernement.
(1278) SMT, chap. CXXI, et Tsien Han chou, 27a, p. 5. sqq.
(1279) Il sagit du rformateur Kang Yeou -wei (1858-1927), qui fut le matre de Leang
Ki -tchao (cf. Woo Kang, Les trois thories politiques du Tchouen, 164).
(1280) Dans le Po hou tong sont consigns les travaux dune commission impriale.
Linfluence de Tong Tchong-chou y est manifeste.
(1281) Sur Wang Tchong (n en 27 ap. J. -C., mort vers 100), on peut consulter ltude que
Forke a mise en tte de sa traduction du Louen heng (Selected Essays of the philosopher
Wang Chung). Peuttre Forke montre-t-il une excessive bienveillance quand il compare
Wang Tchong Lucien et Voltaire.
(1282) Telle est linspiration qui anime luvre de Hu Shih (Cf. The development of logical
method in ancient China) et aussi, mais dune faon moins expresse, celle de Liang Chi -Chao
(Cf. History of Chinese political Thought).
(1283) Voir, par exemple, dans Siun tseu (section 21), lhistoire du nigaud qui, se promenant
sous la lune, prit peur de son ombre et, regardant en haut pour ne plus la voir, aperut ses
propres cheveux, quil prit alors pour un esprit gant : Il senfuit, arriva chez lui hors
dhaleine et mourut, le pauvre homme ! Ou encore (mme section) propos des gens qui
font cuire un cochon et battent le tambour pour exorciser la maladie : Voil un tambour us
et un cochon perdu, mais de gurison, point !
Marcel GRANET La pense chinoise 413
(1284) Voir, en sens contraire, Schindler, Das Priestertum im alten China et, sa suite,
Maspero, La Chine antique, 187 sqq.
(1285) En matire de mesures, comme en matire de monnaie.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 414
BIBLIOGRAPHIE
table
La liste des travaux donne ci-dessous ne lest pas titre de bibliogra phie
critique ; on y a mentionn des articles jugs importants ct douvrages
tendus moins utiles consulter.
PRIODIQUES
As. Maj. : Asia Major
BEFEO : Bulletin de lcole franaise dExtrme -Orient.
ChR : China Review
JA : Journal Asiatique
JPOS : Journal of the Peking Oriental Society
JRAS : Journal of the Royal Asiatic Society
MAO : Mmoires concernant lAsie orientale
MSOS : Mitteilungen des Seminars fr orientalische Sprachen
NChR : New China Review
OZ : Ostaslatische Zeitschrift
OS : Ostasiatische Studien
Sh : Shinagaku
TP : Toung pao
VS : Varits sinologiques
OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
ANDERSSON (J. G.), An early Chinese culture, Pkin, 1923.
- Preliminary report on archaeological research in Kansu, Pkin, 1925.
ARDENNE DE TIZAC (H. D), Lart chinois classique, Paris, 1926.
ARNE, Painted stone age pottery fiom the Province of Honan, China, Pkin,
1925.
ASHTON (L.), An introduction to the study of Chinese sculpture, Londres,
1924.
AUROUSSEAU (L.), La premire conqute chinoise des pays annamites,
BEFEO, 1923.
Biot (E.), Le Tcheou li ou les Rites des Tcheou, Paris, 1851.
- Recherches sur les moeurs des anciens Chinois daprs le Che king (JA,
1843)
BLACK, The human skeleton remains from Sha kuo tun, Pkin, 1925. - A
note on physical characters of the prehistoricKansu race, Pkin, 1925.
Marcel GRANET La pense chinoise 415
BRSCHAN (E.), Chinesische Architektur, Berlin, 1926.
BRETSCHNEIDER, Botanicon Sinicum (J. of the China Branch of the
R..A.S., XXV).
BUSHELL (S. W.), Chinese Art, Londres, 1914.
CHALFANT, Early chinese writing, Chicago, 1906.
Chavannes (Ed.), Les mmoires historiques de Se-ma Tsien, 5 v., Paris,
1895-1905.
- La sculpture sur pierre au temps des deux dynasties Han, Paris, 1893.
- Le Tai chan, Paris, 1910.
- Mission archologique dans la Chine septentrionale, Paris, 1913.
- Le jet des Dragons (MAO, III), Paris, 1919.
- Confucius (Revue de Paris, 1903).
- La divination par lcaille de tortue dans la haute antiquit chinoise daprs
un livre de M. Lo Tchen-yu (JA, 1911).
- Trois gnraux chinois de la dynastie Han (TP, 1906).
- Les documents chinois dcouverts par Aurel Stein dans les sables du
Turkestan, Oxford, 1913.
- De lexpression des vux dans l art populaire chinois, Paris, 1922.
CONRADY, China, Berlin, 1902.
CORDIER (H.), Histoire gnrale de la Chine et de ses relations avec les
pays trangers, Paris, 1920.
DEMIVILLE (P.), C. R. TCHANG HONG-TCHAO, Che ya, Lapidarium
sinicum (BEFEO, 1924).
- La mthode darchitecture de LI MING-TCHONG des Song (BEFEO,
1925).
- HOU-CHE, Tchang che tsi (BEFEO, 1924).
DUBS (H. H.), The works of Hsntze, Londres, 1927.
Duyvendack (J. I. L.), The book of Lord Shang, Londres, 1928.
- tudes de philosophie chinoise (Rev. philos., 1930).
DVORAK (R.), Chinas Religionen, Munster, 1903.
EDKINS, The evolution of chinese language (JPOS, 1887).
ERKES, Das Weltbild des Huai-nan-tze (OZ, 1917).
- Das lteste Dokument z. chines. u. Kunstgeschichte : Tien-wen ; die
Himmelsfragen des Kh Yuan, Leipzig, 1928.
Escarra et Germain, La conception de la loi et les thories des lgistes la
veille des Tsin, Pkin, 1925.
tudes asiatiques, publies loccasion du XXV anniversaire de lcole
franaise dExtrme -Orient, Paris, 1925.
Marcel GRANET La pense chinoise 416
Forke (A.), Lun-Heng. Sdected Essays of the philosopher Wang Chung
(MSOS, 1911).
- Mo Ti, des Socialethikers und seiner Schler philosophische Werke (MSOS,
1923).
- The world conception of the Chinese, Londres, 1925.
- Yang Chu, the Epicurian in his relation to Lieh-tse the Pantheist(JPOS, III).
- Geschlchte der altern chinesischen Philosophie, Hambourg, 1927.
- Der Ursprung der Chinesen.
FRANKE (A.), Das Confuzianische Dogma und die chinesische Staats
religion, 1920.
FUIITA, The River Huang in the Reign of Yu (Sh.,1921).
GABELENTZ (von der), Beitrage z. chines. Grammatik (Abhandl. d. Sachsi-
schen Gesells. f. Wissens. 1888).
- Confucius und seine Lehre, Leipzig, 1888.
GIESLER, La tablette Tsong du Tcheou li (Rev. Arch.,1915).
Giles (H. A.), History of chinese literature, Londres, 1901.
Giles, Chuang Tsu, mystic moralist and social reformer, Londres, 1889.
- Lao Tzu and the Tao t king (Adversaria sinica, IIl).
- The remains of Lao Tzu (ChR, 1886-1889).
- Religion of ancient China, Londres, 1905.
- Confucianism and its rivals, Londres, 1915.
Granet (M.), Ftes et chansons anciennes de la Chine, Paris, 1919.
- La Polygynie sororale et le Sororat dans la Chine fodale, Paris, 1920.
- La religion des Chinois, Paris, 1922.
- Danses et lgendes de la Chine ancienne, Paris, 1926.
- Coutumes matrimoniales de la Chine antique (TP, 1912).
- Quelques Particularits de l alangue et de la pense chinoises (Rev.philos.,
1920).
- La vie et la mort, croyances et doctrines de lantiquit chinoise (Ann. de
lc. des Hautes tudes, 1920).
- Le dpt de lenfant sur le sol (Rev. arch., 1922).
- Le langage de la douleur daprs le rituel funraire de la Chine classique
(Rev. de Psychologie, 1922).
GROUSSET (R.), Histoire de lAsie, Paris, 1922.
GROTT (J.-J.-M. DE), The religions system of China, Leyde, 1892-1921.
- The religion of the Chinese, New York, 1910.
- Universismus, Berlin, 1918.
- Sectarianism and religious persecution in China,Amsterdam, 1903.
- Chinesische Urkundenz. Gesch. Asiens, 1921.
Grube, Geschichte der chinesischen Literatur, Leipzig, 1902.
- Die Religion der alten Chinesen, Tbingen, 1908.
Marcel GRANET La pense chinoise 417
- Religion und Cultus der Chinesen, Leipzig, 1908.
Hackmann (H.), Chinesische philosophie, Munich, 1927.
HALOUN (G.), Contribution to the history of the clan settement in ancient
China (As. Maj., 1924).
- Seit wann kannten die Chinesen die Tocharer (As. Maj., 1926).
HAUER, Die chinesische Dichtung, Berlin, 1909.
HAVRET et CHAMBEAU, Notes concernant la chronologie chinoise (VS,
1920).
HIRTH, The ancient history of China to the end of the Chou Dynasty, New
York, 1909.
- Chinese metallic mirrors, New York, 1906.
HONDA, On the date of compiltion of the Yi king (Sh., 1921).
HOPKINS, Chinese writings in the Chou Dynasty on the light of recent
discoveries (JRAS, 1911).
- Metamorphic stylisation and the sabotage of signification, a study in ancient
and modern chinese writing (JRAS, 1925).
Hu Shih, The development of logical method in ancient China, Changha,
1922.
IMBAULT-HUART, La lgende des premiers papes taostes (JA, 1884).
Karlgren (B.), tudes sur la phonologie chinoise, Leyde et Stockholm, 1913.
- Sound and symbol in China, Londres, 1923.
- Analytic Dictionary, Paris, 1923.
- On the authenticity and nature of the Tso chuan, Gteborg, 1926.
- Philology and ancient China, Oslo, 1926.
- Le protochinois, langue flexionnelle (JA, 1920).
Laloy (L.), La musique chinoise, Paris.
LAUFER (B.), Jade, a study in chinese archaeology and religion, Chicago,
1912.
- Chinese Pottery of the Han Dynasty, Leyde, 1909.
- Ethnographische Sagen der Chinesen (in Festschrif. f. Kuhn).
(LEANG KI -TCHAO), LIANG CHI -CHAO, History of Chinese political
thought (tr. by L. T. Chen), Londres, 1930.
MAILLA (le P. DE), Histoire gnrale de la Chine, traduite du Tong-kien
kang-mou, Paris, 1777-1789.
MARTIN, Diplomacy in ancient China (JPOS, 1889).
Maspero (H.), La Chine antique, Paris, 1927.
- Les origines de la civilisation chinoise (Ann. de gographie, 1926).
- Les lgendes mythologiques dans le Chou king (JA, 1924).
Marcel GRANET La pense chinoise 418
- Notes sur la logique de M tseu (TP, 1927).
- Le mot ming (JA, 1927).
- Le saint et la vie mystique chez Lao-tseu et Tchouang-tseu (Bull. de lAssoc.
fran. des amis de lOrient, 1922).
- Le songe et lambassade de lempereur Ming (BEFEO, 1910).
Masson-Oursel (P.), La philosophie compare Paris, 1923.
- tudes de logique compare (Rev. philos., 1917).
- La dmonstration confucenne (Rev. dhist. des relig., 1916).
Masson-Oursel et KIA KIEN-TCHOU, Yin Wen-tseu (TP, 1914).
Mayers, Chinese readers manual. Mmoires concernant les Chinois, par les
missionnaires de Pkin, Paris, 1776-1814.
Mestre (L..), Quelques rsultats dune comparaison entre les caractres
chinois modernes et les siao-ichouan, Paris, 1925.
NAITO, On the compilation of the Shoo king (Sh., 1923).
PARKER, Kwan-tze (NChR, 1921).
- Hwai-n an-tze (NChR, 1919).
Pelliot (P.), Le Chou king en caractres anciens et le Chang chou che wen
(MAO), Paris, 1919.
- Jades archaques de la collection C. T. Loo. Paris, 1921.
- Notes sur les anciens itinraires chinois dans lOrient romain (JA,1921).
- Meou tseu ou les Doutes levs (TP, 1918-19).
PLATH, Fremde barbarische Stmme in alten China, Munich, 1874.
Przyluski, Le sino-tibtain (in Langues du monde, Paris, 1924).
RICHTHOFEN, China, Berlin, 1877-1912.
ROSTHORN, Geschichte China, Stuttgart, 1923.
SAUSSURE (L. DE), Les Origines de lastronomie chinoise, Paris, 1930.
SCHINDLER (B.), On the travel, wayside, and wing offerings in ancient
China (As. Maj., I).
- The developrnent of Chinese conception of Supreme Beings (As. Maj.,
1923).
- Das Priestertum im alten China, Leipzig, 1919.
SCHMITT (E.), Die Grundlagen der chinesischen Che, 1927.
Steele (J.), I Li, or the Book of Etiquette and Ceremonial, Londres, 1917.
Suzuki, A brief history of early chinese philosophy, Londres, 1914.
TCHANG FOND, Recherches sur les os du Ho-nan et quelques caractres de
lcriture ancienne, Paris, 1925.
TCHANG (le P. M. ), Synchronismes chinois (VS, 1905).
Marcel GRANET La pense chinoise 419
TERRIEN DE LACOUPERIE, Western Origin of chinese civilization,
Londres, 1894. - Languages of China before the Chinese, Londres, 1887.
TSCHEPPE (le P.), Histoire du royaume de Wou (VS, 1896).
- Histoire du royaume de Tchou (VS, 1903).
- Histoire du royaume de Tsin (VS, 1909).
- Histoire du royaume de Tsin (VS, 1910).
- Histoire des trois royaumes de Han, Wei et Tchao (VS, 1910).
Tucci (G.), Storia della filosofi cinese antica, Bologne, 1922.
UMEHARA, Deux grandes dcouvertes archologiques en Core (Rev. des
Arts asiatiques, 1926).
VISSER (M. W. DE), The Dragon, in China and Japan, Amsterdam, 1913.
VORETZCH (E : A.), Altchinesische Bronzen, Berlin, 1924.
WALEY (A.), The Temple and others Poems, Londres, 1923.
WEDEMAYER, Schaupltze and Vorgnge der alten chinesischen Ges-
chichte (As. Maj., Prel. V).
WERNER (E. T. C.), Myths and legends of China, Londres, 1924.
Wieger (le P. L.), Histoire des croyances religieuses et des opinions
philosophiques en Chine, depuis lorigine jusqu nos jours, Hien-hien, 1917.
- Les Pres du systme taoste, Hien-hien, 1913.
- La Chine travers les ges, Hien-hien, 1920.
- Textes historiques, Ho-kien-fou, 1902.
- Caractres (Rudiments, V, 12), Ho-kien-fou, 1903.
WILHELM (R.), Dchuang dsi, das wahre Buch vom sdlischen Bltenland,
Ina, 1920.
- Lia dsi, das wahre Buch vmt quellenden Urgrurnd, Ina, 1921.
- Lu Puch-wei, Frhling und Herbst, Ina, 1927.
Woo Kang, Les trois thories politiques du Tchouen tsieou, Paris, 1932.
WYLIE, Notes on Chinese literature, Changha, 1902.
YUAN (Chaucer), La philosophie politique de Mencius, Paris, 1927.
ZACH (E. VON), Lexicographische Beitrge, Pkin, 1902.
ZOTTOLI (le P.), Cursus litteraturae sinicae, Changha, 1879-1882.
Marcel GRANET La pense chinoise 420
I N D E X
Les nombres renvoient aux pages de ldition dorigine : il faut donc lire par
ex. p.
152
et non p. 152 de Word ou autre.
A
Achille, 152 et s.
Administrateurs, 372-383.
Agriculture, 380, 454.
Alchimie, 325.
ALEXANDRE, 24, 208.
Alternance, 91 et s., 109 et s., 267 et s., 428 et s.
Ame, 319, 325-328.
Ames viscrales, 328.
AMIOT (Le P.), 175.
Analogie rythmique, 70.
Anatomie, 306 et s.
Annamites, 57 et note n 64.
Anne, 85 et s., 94 et s., 143, 167 et s., 174 et s., 235, 236, 242, 265, 316.
Antithtiques (aspects), 102-126, 428 et s.
Apothose, 414, 416 et s., 421.
Arbre de vie, 166, 267, 268, 286. Arc, 24, 246, 300, 302 et s., 332.
Arc en ciel, 124.
Architecture, architectes, 27, 81, 127, 150, 209-231, et note n 30.
Arithmtique, 127-248,
Arpentage, arpenteur 81, 127, 146 et s., 153 et s.
Arrire, voir Avant.
Ascension, 265 et s.
Astrologie, astrologues, 153, 287, 296.
Astronomie, 12, 79-80, 102, 106, 109, 110, 112, 197, 234 et s., 237 et s.
Auguration, 46.
Autel du Sol, 81 et s., 88, 264, 289, 443, 444.
Autocratie, 444 et s.
Autonomie, 420, 423-446, 478.
Auxiliaires descriptifs, 38 et s.
Avant, 149, 300 et s.
Axe, 92 et s., 121, 136, 149, 237, 242, 264.
B
Baladins, 291, 295, 296, 297, 320.
Marcel GRANET La pense chinoise 421
Bas, 137, 143, 144, 146, 149, 204, 238 et s., 254, 301 et s., 311, 313, 327.
Binmes cycliques, 132 et s., 134.
Biographies, 63, 350, 388.
Biot (E.), notes n 365, 374, 538.
Biot (J.-B.), notes n 100, 374, 427.
Bipartition, 117 et s., 249 et s.
Birman, 34 et note n 27.
Blason, 47.
Boisson, 107 et s., 265, 267, 325, 421.
Bouddhisme, 448, 471.
C
Calendrier, 27, 86 et s., 102, 111, 117, 140, 141, 174 et s., 186 et s., 235-239,
262 et s., 317 et s.
Calendrier lunisolaire, 94.
Cambodge, 66, note n 86.
Camps, 85 et s., 241, 296.
Capitale, 83 et s.. 92 et s., 102, 139, 267 et s., 377 et s.
Cardo, 260.
Carr, 24, 80-85, 130, 136, 137, 157, 165 et s., 181-209, 263 et s., 286, 294,
297, 298, 344.
Carrs magiques, 149-175, 256.
Catgories, 26 et s., 75-279.
Causalit, 271 et s.
Centons de Calendrier, 110 et s., 121 et s., 132.
Centre, 89-91, 136-145, 249-268.
Chamanes, 295, 413-417.
Chan hai king, note n 558.
Chan jen (homme de bien), 393.
Chan-long, 389, 412, et note n 934.
Chang kiun chou, voir Chang tseu.
CHANG TI, voir Souverain dEn -haut.
Chang tseu, 374.
Changement, 360-362, 429 et s.
Chants, 67, 136-137.
Chants alterns, 56 et s., 69 et s., 121 et s.
Chaos, 320.
Char, 24, 218-231, 241, 284, 300 et s., 320.
Charpentiers, 127, 210 et s.
Charrons, 127, 210 et s., 223 et s.
Chavannes (E.), 141, 175, 176, 178, 186, 198, 252, 257 et notes 16, 230, 239,
274, 345, 348, 645, 652.
Che (activits humaines), 308.
Che (conditions, circonstances, chances), 351-354, 360, 361.
Marcel GRANET La pense chinoise 422
Che (matre), 417.
Che (noble, lettr), 392, 455.
Che (objet, ralit), 363-372, 461.
Che (occasions, circonstances), 79 et s.
Che (sicle), 424.
Che (vers rguliers), 55 et s., 71.
Che cheng (soin de la vie), 415.
CHE HOUANG-TI, 45, 230, 263, 345, 372-374, 382, 400, 414, 445 ; notes n
899 et 1249.
Che king, 35, 55-62, 102, 103, 308, 325, 387, 405, 450, 467 ; notes n 847 et
1256.
Chen (puissance, sacr, divinit, chef), 262, 326-328, 402, 414, 415, 421, 423.
Chen jen (gnies), 414, 416, 444.
Chen hing (randonnes spirituelles), 416.
CHEN POU-HAI, 351, note n 909.
CHEN TAO, 350.
Chen yeou (bats spirituels), 416.
Cheng (orgue bouche), 176 et s.
Cheng (saintet), 394, 402.
Cheng (vivre, vitalit), 415.
Cheng jen (hommes saints), 416.
CHEOU-SIN (roi), 140, 321 et note n 270.
Chimie, 278.
Chou (nombres), 132, 354, 382 et s.
Chou (recettes), 251, 351-354, 378 et s., 398, 495.
Chou (rversibilit, rciprocit), 395, 405.
Chou jen, 374.
Chou king, 235, 258, 350, 387, 467 et notes non 55 et 406.
CHOUEN (souverain), 87, 89, 92, 169, 466 et note n 1053.
CHOUEN-YU KOUEN, 350.
Chouo koua, 155, 159.
Chouo wen, 45, 46, 129, 142 et s.
Chronologie, 79 et s.
Ciel, 127, 130 et s., 136, 147-150, 157 et s., 169 et s., 181-208, 209-231, 234
et s., 284-296, 297 et s., 310 et s., 329-331, 344, 432, 468.
Cinq, 136, 138 et s., 149 et s., 229 et s., 232 et s., 237 et s.
Cinq (classification par), 83 et s., 130 et s., 136 et s., 175 et s., 237 et s., 253 et
s.,
Cinq Activits, 308 et s.
Cinq Bonheurs, 139, 258, 266.
Cinq Devoirs, 311 et s.
Cinq lments, 26, 126, 128-145, 161 et s., 176 et s., 191 et s., 204-209, 235,
248-260, 261 et s., 307 et s., 312, 350 et s., 470 et notes n 10 et 471.
Cinq Insignes, 266, 267, 310 et note n 471.
Cinq Notes, 136, 175-209, 310, 317, 336, 337 et note n 1126.
Marcel GRANET La pense chinoise 423
Cinq Qualits naturelles, 313.
Cinq Signes, note n 192.
Cinq Signes clestes, 308 et s. ; note n 652.
Cinq Vertus, 88 et s., 252 et s. 310.
Circonfrence, 130, 181-234.
Circumambulation, 84 et s., 90 et s., 263,
Classificateurs numriques 134-174, 204 et s., 241 et s., 253 et note n 459.
Classifications, 78 et s., 323 et s.
Classifications numriques, 118 et s., 125, 127-248, 253 et s., 307, 335, 433.
Classiques, 10, 387, 467.
Cls, 42 et s., 51 et s.,
Cloche cleste, 265, 286, 287, 288, 289.
Commentaires, 13, 145, 450, 466 et s., 471.
Communion, 123 et s., 232 et s., 266, 361.
Compas, 24, 153, 224, 298, 382, 403, 461.
Complet, 137, 138, 244, 247, 248.
Complexes phoniques, 42 et s., 48, 51.
Comportements, 337 et s., 436 et s.
Comput (systmes de), 177 et s., 197 et s., 224 et s., 228 et s.
Confucisme, 473 et 9.
Confucius, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 53, 63, 102, 277, 316, 327, 338,
344, 345, 346, 349, 350, 363-368, 374, 379, 385, 387, 398-400, 403, 412, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 461, 466, 467, 469, et notes n 179, 263, 825,
1266.
Continuit, 427, 428, 429, 432 et s.
Contradiction (principe de), 271, 272, 276 et s., 299, 358 et s., 383, 429 et s.
Contrastants (aspects), 107 et s., 116 et s., 276 et s., 429 et s.
Cordes noues, voir Nuds.
Core, note n 403.
Corporations, 340 et s., 344 et s.
Corporations sexuelles, 119 et s.
Corrlations, corrlatifs, 299 et s., 307 et s., 357 et s.
Correspondances (systmes de), 124 et s., 142 et s., 300 et s.
Cosmographie, 288 et s., 304-306,
Cosmologie, 283-298.
Couple (catgorie de), 27, 92 et s., 238 et s., 249, 258 et s.
Couvreur (Le P.), note n 555.
Croise (disposition en), 131 et s., 136, 144, 165, 224, 254, 264.
Croix gamme, 164 et s., 175, 232, 237 et s., 264.
Croix simple, 151 et s., 175, 224, 237 et s., 264.
Cycle dnaire, 128-135, 167.
Cycle duodnaire, 129-135, 167.
Cycle liturgique, 86 et s.
Cycle quinaire, 91 et s., note n 311.
Cycle sexagnaire, 132 et s.
Marcel GRANET La pense chinoise 424
Cyclique (disposition), 85 et s., 129 et s., 138 et s., 151 et s., 156 et s., 181 et
s., 194-204, 205 et s., 238 et s., 254, 255, 268.
D
Dais cleste (cole du), 218 et s., 289 et s.
Danse, 50 et s., 57 et s., 66 et s., 93 et s., 134, 136, 137, 176, 177, 240 et s.,
419 et notes n 30, 558.
DARIUS, 24.
Dmons, voir Esprits.
Dnominations (cole des), voir Ming kia.
Dsacralisation, 66, 244.
Destin, 35, 40 et s., 132, 133, 283, 328, 330, 331, 345 et s., 352 et s., 479.
Deuil, 303, 338 et s.
Deux, 131, 136, 157 et s., 180 et s., 222 et s., 232 et s.
Devins (cole des), 12, 28, 53.
Devises, 47.
Dextrogyre, 304, et s.
Diagonale, 219 et s.
Dialectes, 35.
Dialectique, dialecticiens, 278, 354-372, 430,471.
Dieu, 476 et s.
Diplomates, diplomatie, 351 et s., 372.
Discours des Royaumes Combattants, 350.
Divination, 12, 27, 46 et s., 54, 102, 109, 110, 117, 139, 145174, 177, 179,
220, 269 et s., 450,469 et note n 377.
Divisibilit, 357 et s.
Dix, 127-135.
Dix Devoirs, 313.
Dix mille tres, 118, 327 et notes n 403, 527.
Dodcagone, 136, 181 et s.
Douze, 127-135, 240 et s.
Douze (classification par),149 et s., 175 et s., 240 et s.
Dragon, 116, 154, 261, note n 403.
Dragon-flambeau, 294.
Droite, 92 et s.,149, 237 et s., 297307, 314, 337.
Durkheim (E.), p. 29 et notes n 21 et 22.
DUYVENDAK (J. J. L.), notes n 887, 1238.
Marcel GRANET La pense chinoise 425
E
Eaux, 130, 140, 147, 148, 261, 263, 285, 286, 288, 289, 291 et s.
Eclipses, 290.
coles, 11 et s., 17 et s., 45, 340, 341, 343 et s.
conomie, conomistes, 380 et s., 393, 404 et s., 445 et s., 454 et s., 456.
criture, 22 et s., 31, 42-52, 118, 372.
dification (thorie de l), 376 et s.
ducation, 392 et s., 453, 461 et s., 467 et s.
Efficacit, 13, 18, 19, 29, 249, 279, 353 et s., 373, 433-446.
lments, voir Cinq lments.
Emblmes divinatoires, 105, 110, 127, 145-174, 276 et s.
Emblmes sexuels, 105, 109, 118, 223, 224, 231, 232, 234, 235. 298.
Embolismique (anne), 95, 164 et note n 311.
Embryologie, 304 et s., 333.
Enseignement, 68, 344 et s., 387 et s., 450, 455 et a, 462.
Enseignement muet, 73, 438 et s.
Enseignement oral, 22 et s.
Entraide, 405 et s.
preuves, 265 et s., 325, 417 et s.
Equerre, 24, 130 et s., 153, 210, 229, 298, 382, 402, 462.
Equinoxes, 111, 235.
Eristique, 354-363.
Espace, 26 et s., 75, 76, 77-100, 122 et s., 130 et s., 136, 237, 239, 260 et s.,
273 et s., 296, 340, 357 et s., 431, 478 et s.
Esprits, 47, 133, 398, 402, 459, 476.
talon, 102, 169 et a, 196-234.
tiquette, 24, 25 et s., 40 et s., 281-348, 349, 357 et s., 363, 367 et s., 373-383,
437, 459 et s.
tymologie, 46, 49 et s.
Excrtions, 321 et s.
Extase, 413, 432 et s.
F
Fa (recettes, lois, modles), Z51, 376-383, 461, 462.
Fa kia (cole des Lois), 372-383.
Faite, 265-268.
FAN LI, 351.
Fan ngai (affection impartiale), 400.
Fang (site, orientation, querre), 79 et s., 209 et s., 258, 297.
Fang che (magicien), 81.
Fatalisme, 352 et s., 402.
Fdration, 83 et s., 249 et a, 267.
Fen (lot, proprit rpartition), 267, 367-372, 458.
Marcel GRANET La pense chinoise 426
Ftes, 56 et s., 94 et s., 120, 256, 265 et s., 459.
Feu (fabrication du), 167.
Feu cleste, 291 et s.
Fiches calcul, 153 et s.
Fiches divinatoires, 110, 153 et s., 220 et s.
Fils du Ciel, 41, 262, 265 et s., 425, 446.
Fong chouei (gomancie), 317 et note n 171.
FONG-PO (Seigneur des Vents), 293.
Forces, 13, 26 et s., 101 et a, 253 et s.
Forke (A.), 354 et notes n 538, 838, 999, 1281.
Formules, 40 et o., 57 et s., 67.
Fou (genre potique), 62, 69, 71 et a et note n 78.
Fou (six) Six magasins, 258, 311.
Fou (taille, talisman), 47.
Fou HI (Souverain), 153, 155, 160, 176, 256, 298, et notes n 300, 309, 377,
381.
Fou-lao, 293.
Fou-tseu (matre), 387 et note n 927.
G
Gamme, 136, 174-216.
GAUBIL (I,e P.), note ne 378.
Gauche, voir Droite.
Genre, 26 et s., 118 et s., 276 et s.
Gographie, 27, 81, 102, 284, 315.
Gomancie, 103, 317.
Gomtrie, 80, 81, 127, 131, 134, 153 et s., 209-231.
Giles (H.), 410.
Gnomon, 24, 103, 166 et s., 198, 211, 220-231, 232 et s., 265, 268, 288, 332.
GOLDSCHMIDT (D.), note n 387.
GROOT (J. J. M. de), notes n 73, 214.
H
HAN (dynastie), 11,12,13, 45,106, 148, 152, 157, 165, 228, 263, 267, 351,
374, 385, 388, 400, 411, 447, 451, 465, et a, et notes n 1, 254, 538.
Han (seigneurie), 351, 373.
HAN -FEI Tssu, 11, 351, 352, 374, 383, 385 et note n 1250.
HARADA (Yoshito), note n 315.
Haut, 136, 137, 143, 144, 146, 149, 204, 238 et s., 254, 301 et a, 310 et s.,
314. 327.
HEOU-TOU, 238, 239.
HEOU Tsi, 251.
HERTZ (R.) note n 599.
Marcel GRANET La pense chinoise 427
Heures, 132.
Hexagone, 136, 222 et a
Hexagrammes divinatoires, 118, 145, 213 et s., 269 et s., 317.
Hi-Ho, 92, 106, 107, 115, 237 et s., 240, 292.
Hi tseu, 15, 104, 105, 106, 118, 152-172, 258, 268 et s., 329 et notes n 157,
159, 355, 378, 403.
HIA (dynastie royale), 145, 211, 214, 229.
HIAO (duc de Tsin), 374.
Hiao (exemplification), 362.
Hibernants (animaux), 111 et s.
Hirarchie, 29, 82 et s., 91 et s. 128, 136, 234, 237-248, 249 et s. : 276 et s.,
301 et s., 371 et s., 432, 440, 460 et s., 478 et note n 491.
Hirogamie, 118 et s., 131, 159 et s., 166 et s., 217, 231, 264 et s., 285, 287,
298, 314 et note n 527.
Hing (chtiments, lois pnales), 124, 375, 383.
Hing (chemin, lment), 156, 252, 263.
Hing (symbole, ralit symbolique, corps), 363, 422, 430.
Hing pi (lois pnales), 375-382.
Histoire, historiens, 62 et s., 316 et s., 368, 438, 465 et a
Hiu (vide), 427, 432.
HIU-HING, note n 1235.
Hiue (sang), 326 et s.
Hiue ki (sang et souffle : vitalit), 246.
Ho (harmonie, union), 107 et s., 121,135,166, 276, 283, 330, 434.
Ho-nan, 35.
HO-PO (Seigneur du Fleuve), 293.
Ho tiao (dosage, harmonie), 108 et s.
Ho tou, 148-174 et notes n 403, 460.
Homme grand, 269, 416, 452, 465.
Hong fan, 139-173, 204-209, 242, 252-261, 308-312, 323 et note n 192.
HOU CHE (ou HOU SHIH), notes n 810, 831, 838, 1096, 1124, 1282.
Houa (mont), 344.
Houa (substitution, transformation), 270 et s., note n 677.
Houa fen (magiciens), 320, 416.
HOUAI-NAN TSEU, 309, 311, 447 et notes n 343, 351, 594, 596, 643, 644.
HOUAI-NAN WANG, 414. Voir aussi Houai-nan tseu.
Houan (jonglerie, illusionnisme), 427.
Houang ki, 139, 266-268, 291, 430 et note n 279.
Houang tchong (tube initial), 180 et s., et note n 396.
HOUANG-TI, 46, 250, 293 et s., 444.
Houang-ti nei king, 311 et notes n 374, 651, 658.
Houa (prince de Wei), 356, 451.
Houei (temps, runion, foire, socit), 94, 119 et s.
HOUEI CHE, voir Houei tseu.
HOUEI TSEU, 356-363, 436, 464 et note n 855.
Marcel GRANET La pense chinoise 428
HOUEI TSONG (empereur), 148 et note n 286.
Houen (me, souffle), 326 et s., 422.
Houen tien (cole du), 288.
Hsu Ti-shan, note n 10,
Huit, 134, 137, 104-231, 239 et s.
Huit (classification par), 134, 137, 154 et s., 175 et s., 239 et s., 284,
Huit (symbole des lignes yin), 158, 214.
Huit Vents, 137, 175 et s., 214, 235 et s., 249, 284, 295.
Huns, 352.
Hygine sexuelle, 12, 417 et s.
Hypotnuse, 209-229,
I
Identification, 132 et s., 274 et s.
Illusionnistes, 291, 427.
Image du monde, 140-174, 178, 260 et s.
Impair, 131-249, 269, 270.
Impluvium, 292.
Improvisation traditionnelle, 57 et s., 69, 121.
Inauguration, 86 et s., 103, 260 et s.
Incantations, 70, 353.
Indices naturels, 139, 273 et s., 468 et s.
Individualit. 132 et s., 329 et s.
Infini, 251, 340, 430 et s.
IVANOV, note n 886.
Ivresse, 421.
J
Japon, note n 403.
Jen (amiti), 13, 394-398, 401 et s., 425, 453 et s., 461 et note n 648.
Jen (humain, civilis), 425 et s.
Jen (taille, talon), 226 et s.
Jeu, 57 et s., 418 et s., 437, 473, 478, 479.
Jo (Arbre), 286.
Jou (lettrs), 11, 388, 452, 455.
Jou-m, 11.
JULIEN (Stanislas), n 1023.
K
Kai (changements), 360, 361, 429.
Kan (tige, signe cyclique), 131 et note n 238.
Marcel GRANET La pense chinoise 429
KANG, 355.
KANG YOU-WEI, note n 1279.
KAO-YAO, 316.
Kao kong ki, 211, 216, 228.
Karlgren (B.), 34 et notes n 53, 214.
KEOU-TSIEN, 351, 353.
Ki (fate), 235, 266 et s., 433 et note n 403.
Ki (sacro-saint), 375.
Ki (terme, rendez-vous), 94, 120.
Ki-lin, 293 et s.
Ki (souffle, influence), 136, 287, 307, 310, 313, 317, 324, 326, 327, 329, 330,
331, 339, 419, 434, 457 ; note n 406.
Kia (secte, cole), 11 et s.
Kiang-tou, 470.
Kiao (union, imbrication), 290, 330.
Kien (emblme divinatoire mle), 105, 118, 240.
Kien li (dsintressement), 400, 404 et s., 458.
Kien mou, 268, 287.
Kien ngai, 13, 404 et s.
Kieou cheng (faire durer la vie), 441.
Kieou ye (neuf plaines), 291.
King (capitale), note n 171.
KING (empereur), note n 1270.
King (gnomon), note n 171.
King (joute), 121.
King (respect dautrui), 395.
Kiu (place, rang), 364 et s.
Kiu-tseu (Grand Matre), 399 et note n 1007.
KIU-YUAN, 446 et s.
Kiuan (poids), 379 et s.
Kiun (continuit), 427.
Kiun (prince), 251.
Kiun tseu (genthilhomme, honnte homme), 251, 269, 337, 363, 367, 368,
393, 454.
Kong (respect de soi-mme), 395, 396.
KONG (nom de famille de Confucius), 387.
KONG-KONG, 285, 286, 289, 292.
KONG-SOUEN LONG, 359-362 ; note n 855.
KONG-YANG, 466, 467, 470.
Kong yong (rendement), 373-382.
KONG FOU-TSEU, 387. Voir Confucius.
Kong li, 386.
KONG NGAN-KOUO, 266.
KONG SANG, voir Mrier creux.
KONG TONG (arbre), 286.
Marcel GRANET La pense chinoise 430
KONG YING-TA, note n 656.
Kou (malfices), 317.
Kou-che (Iles), 414.
KOU-LEANG, 466.
Kou-mang, 294.
Kou-wen (style), 71.
KOUAN TCHONG, voir KOUAN TSEU.
KOUAN TSEU, 63 et s., 181, 211, 310, 351, 374 ; note n 404.
KOUAN YIN TSEU, 412, 438.
KOUANG, 351 et s.
Kouei (esprits), 325-328, 402.
KOUEI, 66, 293.
Kouei tsang, 105, 106.
KOUEN, 92, 140.
Kouen (emblme divinatoire femelle), 105, 118, 240.
Kouen louen, 294, 324. 414 et s. ; note n 677.
Kouo yu, note n 792.
L
Langue chinoise, 12, 13, 22 et s., 31-42.
Langue parle, 33 et s., 35, 54.
LAO TAN, 411. Voir Lao-tseu.
LAO TSEU, 410-448, 449, 459 ; notes n 55, 527, 1266.
Leang, 356.
Leang che (savoir noble), note n 1205.
LEANG KI -TCHAO, notes n 799, 838, 898, 1015, 1278, 1282.
Leang neng (talent noble), note n" 1205.
Leang sin (cur noble, intentions anoblissantes), 451, 454 et s., note n 1205.
LECLERE (A.), note n 86.
Legge (Le Rvrend), 172, 357 ; notes n 16, 157, 502, 819, 831, 1029, 1057,
1092, 1206, 1238.
Lei (espce), notes n 255, 258.
Leibniz (G.), 46 et note n 40.
Lexiques, 38.
Li (avantage, fortune), 393 et s.
Li (dissocier, sparer), 357.
Li (raison), 457, 462, 464 et s. 479.
Li (rites, honneurs, cadeaux rituels, 367, 376, 383, 453, 459 et s.
Li chou (nombres du calendrier), 132.
Li ki, 313, 387, 388, 466.
Li king, 467.
LI KO, 351.
LI KOUEI, 351.
LI SSEU, 45, 374 et note n 1249.
Marcel GRANET La pense chinoise 431
Li yun, 311, 313.
LIE TSEU, 10, 64, 320, 344, 410, 448.
Lien tsing (affiner la substance), 419.
LIEOU HIANG, 290.
LIEOU NGAN, note n 1036. Voir HOUAI-NAN TSEU.
Lin-ts, 350, 373, 412.
LING (duc de Wei), 364.
Lo chou, 148-174 et note n 403.
LO LANG, 167.
Logique, 68, 243, 275 et s., 317, 354-372, 399, 433, 479 et note n 1124.
Logos, 433.
Lois, 279, 281, 340, 341, 372-383, 404, 440 et s., 452, 454, 461 et s., 476,
479.
Lois crites, 375-383.
Lois (cole des), 12, 18, 368, 369, 372-383, 440, 445, 452, 454, et s., 457,
479.
Longue nuit, 95, 413 et note n 315.
Longue vie, 295, 325, 333, 413, 422, 423, 425.
Lou (seigneurie), 349, 350, 387, 399, 449, 451.
Louen yu, 10, 363, 364, 388-398.
LU (impratrice), 63.
LU CHANG, 349 et s.
LU CHE TCHOUEN TSIEOU, voir LU POU -WEI.
Lunaison, 94 et s., 128, 244.
Lune, 105, 128, 132, 223, 237 et s., 244 et s., 286 et s. et notes n 403, 406.
LU POU-WEI, 178, 180 et note n 343,
M
Magatama, n 403.
Magie, 12, 40. 71 et s., 299, 306, 334, 413-422, 424, 426 et s. ; notes n 55,
479.
Maison du Calendrier, voir Ming tang.
Majest, 444 et s.
Malfices, 317.
Man (barbares), note n 300.
Manichisme, 471.
Mansions lunaires, 218, 235 et s., 242,295.
Maspero (H.), notes n 24, 100, 159, 173, 298, 356, 465, 538, 546, 645, 819,
831, 838, 960, 1124, 1261,
Masson-Oursel (P.), note n 870.
Mt de cocagne, 226, 265-269 ; notes n 315, 463.
Mathmatiques, 12, 127 et s.
Mauss, note n 22.
Mdecine, 12, 310 et s., 329.
Marcel GRANET La pense chinoise 432
Mditation, 424 et s., 471 et s.
Mlothsie, 307.
Mmoires historiques, voir Sseu-ma Tsien.
Men jen (client, lve), 344.
MENCIUS, 252, 350, 355, 451456, 457, 461, 466, 468 et notes n 1164, 1238.
MENG TSEU, voir MENCIUS.
Meou (arpent), note n 368.
MEOU (prince de Tchong-chan), 359.
Mesures (systme de), 169 et s., 273 et s., 479.
Mtamorphoses, 133 et s.
MILHAUD (G.), note n 377.
MILL (Stuart), note n 838.
Min (peuple, grande famille), 374.
MIN (roi de Tsi), 451.
Ming (destin), 40 et s., 134, 283, 331 et s., 345, 367. Voir Destin.
Ming (nom, dnomination), 40 et s., 47, 266, 326, 327, 331, 363-372, 433, 463
et note n 255.
Ming kia (cole des Noms), 350, 354 et s., 363-372, 373 et note n 10.
Ming tang, 90-92, 94 et s., 115, 149-152, 175 et s., 210-229, 240 et s., 256,
263 et s., 284.
Mo (de Tsai), 351.
MO TI, voir M TSEU.
M TSEU, 10, 11, 13, 20, 102, 108, 109, 344, 350, 354, 355, 356, 362, 370,
385, 398-408, 409, 413, 440, 441, 442, 447, 448, 452, 454, 455, 459, 464,
476, 477 et notes n 88, 825, 827, 891, 1239.
Modles, 279, 281, 340 et s., 461 et s., 478.
Mois, 94 et s., 179 et 9.
Mois intercalaires, 95, 171 et s. ; note n 311.
Monnaie, 479 et note n 1285.
Monosyllabisme, 33 et s.
Morphologie sociale, 27, 234248, 249, 259.
Morphologiques (variations), 114 et s.
Mou (roi), 320.
Mouvement, 290, 360 et s.
Multiplicit, 358 et s.
Mrier creux, 106 115, 286, 293 et note n 498.
Musique, musiciens, 27, 108 et s., 127, 135, 137, 174-216, 240 et s., 333,
334-339, 350, 362 et notes n 30, 48, 187, 558.
Mutations, 27, 114, 270 et s., 320, 426 et s., 429, 431.
N
NAN-TSEU (princesse de Wei), 364.
Natte (unit de superficie), 212 et s.
Nei (intrieur), 103, 105, 120.
Marcel GRANET La pense chinoise 433
Ne-Taosme, 412-414.
Neuf, 137, 140 et s., 199-232, 246.
Neuf (classification par), 239 et s.
Neuf (symbole des lignes et tubes yang), 158 et s., 184 et s., 198 et s., 214.
Neuvimes Cieux, 267, 291.
Neuvimes Sources, 267, 291.
NEWTON (I.), note n 513.
Ngai (deuil, peine), 338.
NGAN-HOUEI, 35.
Ngeou (double, apparier), 422, 430.
NIU-KOUA, 176, 285, 298 ; note n 381.
NIU-PA (scheresse), 294.
NIU-SIEOU, 316.
Nuds, 47, 177 et s., 195 -201 note n 191.
Nom (personnel), 40 et s.. 47 et s., 88, 132, 266 et note n 93.
Nombres, 12, 26 et s., 75, 127, 248, 340, 356 ; note n 807.
Nourriture, 37, 107 et s., 235, 243, 298 et s., 323-328, 333 et s., 421 ; note n
187.
Numration dcimale, 128 et s.
O
Occasion, 27, 103, 109, 352.
Octave, 193-203 ; notes n 334 et 337.
uf, 288.
OLDENBERG (d), note n 100.
Onze, 164-169, 264, 325 ; notes n 337 et 497.
Onze mille cinq cent vingt, 118, 163,269.
Oppositions diamtrales, 157, 430.
Oraison extatique, 432 et s.
Orgue bouche, 176 et s.
Orthodoxie, 13, 14, 21, 29, 269, 388, 447, 449 et 9, et note n 1.
Ouvertures, 307-323 ; note n 1126.
Ovale, 217 et s.
P
Pa ki (huit directions), 286.
Pa tseu (huit caractres), 132.
Pa wei (huit amarres), 286.
PADOUX, note n 901.
PAN-KOU, 310, 313, 470 ; note n 543.
PAN-MOU (Arbre), 287.
Pair, voir Impair.
Palladia, 378 et note n 270.
Marcel GRANET La pense chinoise 434
Paradis, 415 et s., 439 et 9.
Paradoxes, 355 et s., 429 et s.
Pelliot (P.), note n 1201.
Peng, 431.
PENG-TSOU, 419.
Primtre, 181-313.
Personnalit, 47, 329-340, 424 et s., 429 ; note n 93.
Pharmacope, note n 518.
Phontique, 34 et s.
Phusis, 426, 433.
Physiologie, 306 et s.
Physique, 272 et s.,
, 210, 223 et s.
Pi (lois pnales), 375 et s.
Pi sien (talon de dimension), 216-232.
Pie-m (disciples spars de M tseu), 355, 399.
Pie ngai (affection partiale), 404 et 8.
Pien (changement cyclique), 105, 270 ; note n 186.
Pien-tch, voir Eristique, 822.
PING (Duc de Tsin), 350, 351.
Ping (niveau, quilibre, paix), 285,437.
Pivot, 150, 167, 220, 232, 264, 323, 430.
Plan (Grand), 146, 209
Po, 351.
Po (me-sang), 327.
Po (voilement du soleil), 289.
Po hou tong, 162, 310, 311, 314, 470 ; note n 638.
Posie, 54 et s., 136, 263, 291-296.
Politiciens, 349-354, 380 ; note n 882.
Potlatch, note n 492.
Pou (unit de longueur), 211 et s.
Pou- tcheou (mont), 285, 286, 289, 294.
Pouo (simplicit native), 424 et s., 434.
Prince (ide de), 371 et s., 373, 384.
Prose, 54 et s.
Protocole, protocolaire, 40 et s., 128, 134, 243-248, 281, 337 et s., 367, 390 et
s., 460 et s.
Proverbes, 56 et s.
Psychologie, 310, 315 et s., 397, 434 et s.
Publication des lois, 375-383.
Q
Qualifications, 40, 359 et s., 363. 372.
Quantit, 26 et s., 127-248, 273 et s., 358 et s., 479.
Marcel GRANET La pense chinoise 435
Quatre, 92 et s., 136 et s., 149 et s., 158 et s., 183 et s., 235 et s., 237.
Quitisme, 423.
R
Radical, voir Cl.
Rangs, 39, 47, 132, 266, 364 et s., 459.
Recettes, 11, 12, 17 et s., 340, 351-354, 378 et s., 398, 438.
Rgles, 278, 339 et s., 382 et s., 462 et s., 478.
Religion, 476 et s.
Rendement (thorie du), 373-383.
Rsidence sombre, 285, 289.
Responsabilit, 190, 275.
Rve, 352, 435, 436.
Rey (A.), notes n 20, 100, 231, 377, 427.
Rhtorique, 344, 354, 362 et s. ; note n 88.
Rites, 34, 57 et s., 334-339, 382, 456-465, 473, 478.
Rond, 80, 136, 158, 165 et s., 181-209, 285, 297, 299, 344.
Rose, 108, 414, 421.
Roue, 169, 226 et s., 232, 275, 288 ; note n 383.
Roulement (principe de), 27, 93 et s., 123, 124, 259.
Rythme, 26 et s., 75, 105-126, 134, 135, 137, 235, 271 et s., 330, 336 et s.,
340, 417.
Rythme saisonnier, 85, 89 et s.
Rythmique, 31, 68-73.
S
Saintet, 389, 399, 409 et s.
Salut, 426 et s., 443.
Sang, 307, 310, 321, 326, 327, 332, 336, 418. - Voir Hiue.
SAUSSURE (de), note n 100.
Scolastique, 9, 25, 29, 112, 279, 342, 470.
Scrtions, 321 et s.
Sectes, voir coles.
Secteurs, 81 et s., 92 et s., 133 et s., 235 et s.
Sentences, 54 et s., 71 et s.
Sept, 134, 136, 139, 208-229.
Sept (symbole des lignes yang), 158, 214 et s.
Sept orifices, voir Ouvertures.
Sept passions, 313.
Sept Recteurs, 136, 235, 267, 307.
Srie numrique, 135-145.
Serment, 299, 300, 390.
Sve, 66, 256, 265, 420 et s.
Marcel GRANET La pense chinoise 436
Sexe (catgorie de), 117-126, 301 et s.
Si (culture), 392 et s.
SI-WANG-MOU (mre-reine dOcci dent), 294, 295.
Siam, note n 86.
Siang (symbole, efficacit symbolique), 376.
Sieou chen (se cultiver soi-mme), 396 et s.
Sieou ki (se cultiver soi-mme), 396 et s.
Sieou tao (cultiver le Tao), 397.
Signaux, signes, 57 et s., 112 et s., 121 et s., 273 et s. 450, 470.
Signes, voir Cinq Signes.
Sin (cur), 331, 463.
Sin (probit), 393.
Sin (unit de longueur), 211 et s.
Sin tchai (purification du coeur), 424.
Sing (complexion, temprament, essence), 329-335, 345, 392, 425 et s., 434,
437, 461.
Sinistrogyre, voir Dextrogyre.
Sino-tibtain, 33.
Sites, 27, 103, 104, 110, 127, 128-136, 144-152, 204 et s.
SIUAN (roi de Tsi), 350, 355, 370, 451.
Siuan ye (cole du), note n 540.
SIUAN-KING, 456. Voir Siuan tseu.
SIUAN KOUANG, 456. Voir Siun tseu.
SIUAN TSEU, 350, 373, 413, 456, 465, 466, 467, 469 et notes n 1192 et
1283.
Six (classification par), 92, 93, 136, 175 et s., 237 et s., 258 et s.
Six (symbole des lignes et tubes yin), 158 et s., 184 et s., 198 et s., 214, 215.
Six calamits, 258.
Six Ho (directions), 311.
Six influences clestes, 313, 317, 335.
Six passions, 311 et s., 313, 335.
SOCRATE, 277, 386.
Soleil, 92 et s., 105, 106, 128, 132, 237 et s., 262-268, 286.
Solstices, 95, 235.
SONG (dynastie impriale), 148, notes n 301, 403.
SONG (seigneurie), 62, 105, 355, 398, 451 ; note n 368.
SON KIEN, 350.
Sophistes, 354-363, 381, 429, 431.
Sorciers, sorcires, 12, 71, 72, 231, 299, 306.
Sorite, 278, 361,
Sort, voir Destin.
SOU TSIN, 351.
SOUEI (dynastie), 210 ; note n 390.
Souffle, 40, 73, 136, 137, 235, 287, 307, 310, 321, 326, 327, 329, 332, 336,
338, 418 et s., 422.
Marcel GRANET La pense chinoise 437
Sources jaunes, 115, 179, 184, 291, 292.
Souverain dEn -haut, 292 et s., 326, 403, 416, 422, 425, 459, 476.
Souverainet (ide de), 373-383.
Spontanit, 426 et s.
Sseu (priv), 353, 354.
SSEU-MA SIANG-JOU, 447.
Sseu-ma Tsien, 63, 64, 129, 134, 178, 185, 186, 198, 200, 214, 235, 236, 295,
310, 337, 351, 364, 388, 456 ; notes n 55, 265, 493, 888, 1206.
SSEU-MING (matre des destins), 291.
Statut, 365, 373-383.
Stoichelon, 260, 268.
Stylistique, 13,22,31,52-68.
Subsistances (problme des), 381 et s., 406 et s., 453 et s.
Substance, 13, 26 et s., 101 et s., 107 et s., 135, 323-329.
Substitution, 270 et s.
Svastika, 167, 221 et note n 315.
Symbolique. 24, 28 et s., 31-73, 463 et s.
Syncrtisme. 18, 21, 447, 448, 450 et s., 465.
Syntaxe, 35 et s., 67 et s., 362.
T
Ta fen, voir Homme grand.
TA-HO (grand abme), 293.
Ta Tai li ki, 157, 211 et s., et note n 301.
Ta-ye, 316.
Tablettes des anctres, 88.
TAI HIO, 388, 396, 449.
TAI CHAN, 389.
Tai ki (Fate suprme), 235 et note n 403.
Tai ping (grande paix), 283.
TAI SSEU, 333.
Tai Yi (unit s uprme), 155, 235, 267.
Talisman, 47.
TAN-TCHOU, 133.
Tang (parti, esprit partisan), 394.
TANG (dynastie), 33 et notes n 254 et 538.
TANG LE VICTORIEUX, 78, 170 et s., 297 et s., 306.
Tao, 26, 27, 75, 76, 101, 150, 166, 249-279, 298, 333, 334, 338, 380, 393 et s.,
452, 479 et notes n 403, 861 et 1264.
Tao t, 249-279, 368 et s., 393 et note n 10.
TAO TO KING, voir LAO TSEU.
Tao yin (exercices dassouplis sement) 419.
Marcel GRANET La pense chinoise 438
Taosme, taostes, 18, 20, 21, 22, 102, 148, 250, 266, 277, 320, 340, 350, 361,
370, 380 et s., 409-448, 449, 450, 452, 453, 463 et s., 471, 473 et s. Notes n
10, 828, 1224.
TCHANG-NGO (Mre des Lunes), 293.
TCHANG PING-LIN, note n 838.
TCHANG-NGAN, note n 24.
TCHAO (seigneurie), 351, 456.
TCHAO KIEN-TSEU, 351.
Tche (branche, signe cyclique), 131 et s., note n 238.
Tche (lment, composant), 330.
Tche (savoir, sagesse, sapience), 395, 397, 453, 457, 461.
Tche (volont), 330 et s.
Tche jen (homme suprme), 416.
Tche liu (vouloir), 246.
Tche Tao (Tao suprme), 423.
TCHE-YEOU, 286, 294.
Tchen jen (homme vritable), 416, 425.
Tcheng (correct, rendre correct), 47, 397, 463.
TCHENG (seigneurie), 327, 351, 374, 375, 378, 459.
Tcheng (signes clestes), 308.
Tchong (sincrit), 39, 450.
TCHENG HIUAN, 154, 155, 157, 163, 212, 213, 215, 216, 303 et note n
301.
Tcheng ming (dsignations correctes), 47 et s., 363-372, 463.
Tcheng sin (esprit processif), 37.5 et s.
Tcheng jen (homme accompli), 392 et s.
TCHEOU (duc de), 14, 349, 389.
TCHEOU (dynastie royale), 78, 105, 145, 156, 189, 193, 203, 204, 211-215,
229 et s., 317, 412 et notes n 270, 374.
Tcheou (domaine, section), 153. 261.
Tcheou (fiches divinatoires), 153 et s.
TCHEOU KONG, voir Duc Tcheou.
Tcheou li, 211, 216, 242 et notes n 254 et 314.
TCHEOU PEI 218, 219, 222, 299 et note n 538.
Techniques, techniciens, 251, 343, 399, 417, 438 et s. Note n 10.
TCHONG -LI, 226, 238, 287.
TCHONG YONG, 388, 396, 398, 449 et note n 444.
TCHOU (seigneurie), 350, 378, 399, 412, 457.
TCHOU HI, 471 et note n 555.
TCHOUAN-HIU, 285 et note n 422.
TCHOUANG TCHEOU, 412. Voir TCHOUANG TSEU.
TCHOUANG TSEU, 10, 11, 64, 65, 72, 102, 106, 107, 111, 116, 320, 344,
346, 350, 356, 358, 368, 399, 400, 410-448, 457, 464 et notes n 443, 491,
492, 824, 914, 1212, 1262.
Tchouen tsieou , 368, 387, 450, 466 et s., 469, 470.
Marcel GRANET La pense chinoise 439
Tchouo (mlang, lourd, grave), 107, 330.
Temple ancestral, 88, 246.
Templum, 144 et s., 204-207, 253 et s., 296.
Temps, 26 et s., 75 et s., 77-100, 122 et s., 130 et s., 136, 149 et s., 236 et s.,
260, 273, et s., 295, 296, 340, 358 et s., 431, 478.
TENG (seigneurie), 451.
TENG SI, 374, 378.
Terrasse, 209-229.
Terre, 81 et s., 127, 131 et s., 136, 147-150, 158, 165 et s., 170 et s., 181-209,
210-232, 284-296, 297 et s., 310 et s., 329-332, 344, 432.
Terre-mre, 129.
Thocratie, 402, 476 et note n 1007.
Ti tche (branche terrestre), 131.
Tiao (action concertante), 102, 107, 108, 121.
Tiao ho (action concertante), 108 et s., 121, 324.
Tien (Ciel, Nature), 416, 425.
Tien che (Matre cleste), 416.
Tien kai (cole du), voir Dais cleste.
Tien kan (tronc cleste), 131,
Tien ki (Faite du Ciel), note n 493.
Tien kiun (continuit naturelle), 432, 436.
Tien-Lang (le chien cleste), 292
TIEN PIEN, 350.
Tien Tao, 262-269, 345.
Tien tche (facult procratrice), 330.
Tien fiche (volont cleste), 402, 403.
T (bienfaisance), 379 et note n 226.
T (vertu), 243, 251-279, 298, 325, 393 et s.
T jen (homme du Tti), 416.
Toiture, 209, 230.
Ton, 34, 35.
Tong (analogue, rapproch, correspondance, uniformit), 317, 336, 357 et s.,
402.
Tong (interpntration mutuelle, interaction), 105, 308 et notes n 186, 406.
TONG TCHONG-CHOU, 465-470.
Tonkin, notes n 65, 300.
Tortue, 92, 93, 147 et s., 149, 261, 285.
Totalit, total, 26, 75, 85 et s., 97, 131-248, 431, 432.
Tou (rgles protocolaires) 376.
TOU-PO (seigneur de la Terre), 292.
Touei (analogie), 362.
Trpieds, 146, 154.
Trigrammes, 154-174, 175 et s., 214, 240, 256, 313 et note n 403.
Trois, 131, 136 et s., 237 et s.
Trois (classification par), 92 et s., 237 et s.
Marcel GRANET La pense chinoise 440
TROIS MIAO, 93.
Tsai (complexion), 330, 332
TS AI (seigneurie), 351.
Tsao houa (transformation), 427, 428.
TSENG TSEU, 449 et note n 985.
Tseou, 344, 349, 387.
TSEOU YEN, 252, 350.
Tseu (situation, station), 132.
TSEU-CHE, note n, 825.
TSEU-HIA, 368, 449.
Tseu jan (spontanit), 426 et s., 436.
TSEU-KONG, 392, 449.
Tseu kou (macration), 400.
Tseu li (sentiments intresss), 404.
TSEU-LOU, 363, 390.
TSEU-SSEU, 387, 449, 451 et note n 985.
TSEU-TCHAN, 327, 334, 374, 375, 382.
TSEU-YEOU, 449.
Tsi (Porte), 350, 373.
TSI, (seigneurie), 252, 349, 35 0, 370, 412, 449, 451, 452, 456 et note n 811.
Tsie (articulations, mesure), 108, 177, 195 et note n 191.
Tsin (complet), 247, 248.
TSIN (dynastie impriale), 287.
TSIN (seigneurie), 316, 350, 351, 376, 377, 456.
TSIN (dynastie impriale), 45 et note n 459.
TsIN(seigneurie), 350, 351, 373, 377, 456.
TSIN CHE HOUANG-TI voir CHE HOUANG-TI.
Tsing (division agraire), 213, 214, 454.
Tsing (passions), 336.
Tsing (essence, manation, liqueurs fcondes), 118, 323, 327 et s., 329, 330,
423.
Tsing (quitude), 423.
Tsing chen (esprits, vitaux, humeurs fcondes), 337.
Tsing-ki (liqueurs sexuelles), 329.
Tsing (pur, tnu, clair, aigu), 107, 108, 330.
Tso tchouan, 135, 139, 248, 310, 320, 350, 374, 377 et note n 55.
Tsong (Six), (les Six domaines clestes), 67, et notes n 471, 652.
Tubes musicaux, 174-217, 235, 236.
Tyrannies, 290, 295, 374-383, 404, 454, 456.
U
Unanimit, 233-248.
Unit (arithmtique), 186-248.
Units de longueur, 211-232.
Marcel GRANET La pense chinoise 441
Units de superficie, 211-232.
Units de volume, 231.
Unit suprme, 155, 156, 235, 267.
Unit, unique, 27, 220 et s., 358 et s.
Urbanisme, 81.
Vide, 232, 422, 427, 432.
Vingt quatre (classification par), 132.
V
Viscres, 307-323.
Voie lacte, 293.
W
Wai (extrieur), 105, 120.
Wan wou (dix mille essences), 163.
Wang (roi-suzerain), 262-268.
WANG HIU, 353.
Wang ki, voir Houang ki,
Wang Tao, 261-268, 324.
WANG TCHONG, 289, 290, 361, 470 et note n 538.
Wei (artificiel), 459.
Wei (littrature extra-canonique), note n 301.
Wei (place, rang), 365.
WEI (seigneurie), 35, 59, 350, 351, 355, 358, 359, 363, 364, 366, 412, 449,
451.
Wei cheng (conserver sa vitalit), 418.
WEI-YEANG, 374, 377, 385 et notes n 888, 922.
Wen (civilisation, art de sexpri mer), 37, 392.
WEN (roi), 155, 160, 161, 170 et s., 189, 193, 204, 207, 333, 349, 389 et notes
n^ 300, 309, 374.
WEN TCHONG, 353.
Wieger (Le P.), 486 et notes n 493, 645, 819, 831, 981,1004, 1029, 1093.
Wou (compagnonnage militaire), 375.
WOU (Empereur), 263, 414 et notes n 890, 1231, 1270.
Wou (essence, emblme), 133, 269 et s., 283, 327, 329 et s.
WOU (roi), 145, 146, 208.
WOU (seigneurie), 35, 353.
Wou che (Cinq activits), 257.
Wou fang (Cinq directions), 258.
Wou hing (Cinq lments), 156, 252-269.
Wou houa (transformations), 429 et s.
WOU-HOUEI, 238.
Wou ki (Cinq rgulateurs), 258.
Marcel GRANET La pense chinoise 442
WOU KI, 351.
Wou sing (Cinq qualits naturelles), 313.
Wou t (Cinq vertus), 252
Wou wei (Cinq positions cardinales), 258.
Wou wei (non intervention), 396, 427, 428, 429, 443.
Y
YA-YU, 291, 293.
Yang, 15, 26 et s., 58, 70, 75-79, 100-126, 134, 136, 153, 158, 174, 176-209,
214 et s., 223, 249 et s., 268-270, 285, 294, 297-306, 310, 314, 317, 327, 330,
340, 356, 420, 470 et note n 645.
YANG (de Wei), voir Weryang.
Yang cheng (nourrir la vie), 417.
YANG TSEU, 411, 441, 442, 451 et note ne 825.
YAO (souverain), 87, 91, 133, 169, 239, 293, 466.
YEN (seigneurie), 358.
YEN TSEU, 350 et notes n 263, 811.
Yeou (amiti), 394.
Yeou (bats, sbattre), 416.
YI lArcher, 291, 293.
Yi (diffrent, distinct), 357.
Yi (quit, rparations quitables), 266, 337, 394, 401, 425, 432, 453.
Yi (mutation, ais), 105, 270, 426.
Yi (unit, un, entirement), 248, 431 et note n 237.
Yi king, 19, 145, 152, 366, 387, 450, 467, 472 et notes n 10, 55, 157, 174,
175, 179, 213, 403, 499, 501, 502, 673, 847.
Yi li, 133, 387, 466, 467 et note n 1267.
YI YIN, 389.
Yin, voir Yang.
YIN (dynastie royale), 78, 105, 133, 140, 145, 203 et s., 212, 213, 214, 215,
216, 228, 316, 321, 350, 387.
Yin (secret), 353.
YIN WEN-TSEU, 344, 350, 369-372, 379 et note n 855.
Yin Yang (cole du), note n 10.
Yo ki, 329.
Yo king, 467.
YO-TCHENG Ko, 451.
YU LE GRAND, 14, 140, 145-149, 153, 258, 260, 297 et s., 306, 389, 399,
442 et note n 1171.
Yuan yeou (longues randonnes), 416, 447 et s.
YUE (seigneurie), 351, 353, 358, 381.
Yue ling, 142, 178, 200, 204, 207, 255, 309 et notes n 156, 750.
Z
Marcel GRANET La pense chinoise 443
ZEUTHEN, note n 377.
*
* *
Marcel GRANET La pense chinoise 444
La Pense chinoise : Introduction Livre 1 - I.- Langue et Ecriture : Emblmes vocaux - Emblmes
graphiques II.- Style : Sentences - Rythmes Livre 2 - I.- Temps et espace II.- Yin et Yang III.- Nombres et :
Elments - Emblmes - Rapports musicaux - Proportions - Fonctions IV.- Tao Livre 3 - I.- Macrocosme II.-
Microcosme III.- Etiquette Livre 4 - I.- Recettes du gouvernement : lart de : Russir - Convaincre - Qualifier -
Lgifrer II.- Recettes du bien public : Confucius - M tseu III.- Recettes de saintet : Longue vie - Mystique de
lautonomie IV.Orthodoxie confucenne : Mencius - Siun tseu -Tong tchong-chou Conclusion
Notes : 1 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 Index Cartes/G table
Nom du document : la_pensee_chinoise.doc
Dossier : C:\CSS\Envoi021204\granet_marcel
Modle : C:\WINDOWS\Application
Data\Microsoft\Modles\Normal.dot
Titre : La pense chinoise
Sujet : srie Chine
Auteur : Marcel Granet
Mots cls : Chine antique, Chine classique, ethnologie de la Chine,
mythologie chinoise, mythes chinois, civilisation chinoise, religion
chinoise, ancient China, sinologie, sociologie de la Chine, histoire de la
Chine, Hia, Chang, Tcheou, Zhou, Xia Shang, lou, Kia-ko
Commentaires :
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sc
iences_sociales/index.html
Date de cration : 01/12/04 14:51
N de rvision : 3
Dernier enregistr. le : 01/12/04 22:12
Dernier enregistrement par : Pierre Palpant
Temps total d' dition: 3 Minutes
Dernire impression sur : 05/12/04 12:30
Tel qu' la dernire impression
Nombre de pages : 444
Nombre de mots : 193 546 (approx.)
Nombre de caractres : 1 103 217 (approx.)
Vous aimerez peut-être aussi
- La Chine Ancienne (Jacques GERNET) (10e Éd., 2005) +Document130 pagesLa Chine Ancienne (Jacques GERNET) (10e Éd., 2005) +Mohamed75019100% (1)
- Léon VANDERMEERSCH - Nature Et Culture, Une Vision Chinoise: Le Ciel Et L'homme Ne Font Qu'unDocument9 pagesLéon VANDERMEERSCH - Nature Et Culture, Une Vision Chinoise: Le Ciel Et L'homme Ne Font Qu'unFondation Singer-PolignacPas encore d'évaluation
- Création Du Taoïsme ModerneDocument7 pagesCréation Du Taoïsme ModerneTrismegistePas encore d'évaluation
- BashoDocument16 pagesBashoVirgile110Pas encore d'évaluation
- Isabelle Robinet Histoire Du TaoïsmeDocument252 pagesIsabelle Robinet Histoire Du TaoïsmeDarko DraškovićPas encore d'évaluation
- Ebook PDF Taoisme Le Lao Tseu Tao Te King Le Livre de La Voie Et de La Vertu Leon Wieger Laozi Da de JingDocument119 pagesEbook PDF Taoisme Le Lao Tseu Tao Te King Le Livre de La Voie Et de La Vertu Leon Wieger Laozi Da de JingPatouche Matthys100% (2)
- Zenker PhilosophieDocument204 pagesZenker PhilosophieRăzvanMitu100% (1)
- Maspero TaoismeDocument286 pagesMaspero TaoismeVincent Feutry100% (1)
- Les Pères TaoistesDocument393 pagesLes Pères TaoistesVCOLONGUE100% (1)
- La Pensee ChinoiseDocument445 pagesLa Pensee Chinoiseyields100% (1)
- Les Pères Du Système TaoisteDocument420 pagesLes Pères Du Système TaoisteMadiamika100% (1)
- Anne Cheng - Histoire de La Pensée Chinoise-Le Seuil (2015)Document884 pagesAnne Cheng - Histoire de La Pensée Chinoise-Le Seuil (2015)AlainPas encore d'évaluation
- Notes Sur La Trad. de L'avatamsaka - 01Document28 pagesNotes Sur La Trad. de L'avatamsaka - 01Patrick CarréPas encore d'évaluation
- Les 3 Piliers Du ZenDocument303 pagesLes 3 Piliers Du ZenBenjamin SantamariaPas encore d'évaluation
- TAO TÖ KING LE LIVRE DE LA VOIE ET DE LA VERTU... Par J. J.-L. DUYVENDAKDocument135 pagesTAO TÖ KING LE LIVRE DE LA VOIE ET DE LA VERTU... Par J. J.-L. DUYVENDAKspiritualbeingPas encore d'évaluation
- Mensuel Jean Pelissier 37Document16 pagesMensuel Jean Pelissier 37emilie leclercPas encore d'évaluation
- 108ouvrages PDFDocument8 pages108ouvrages PDFSung RemiPas encore d'évaluation
- (JACQUES MAY) ARYADEVA ET CANDRAKIRTI SUR LA PERMANENCE ( (I) - 1980 (II) - 1981 A. (III) - 1981 B. (IV) - 1982 (V) - 1984) (Chapitre IX)Document132 pages(JACQUES MAY) ARYADEVA ET CANDRAKIRTI SUR LA PERMANENCE ( (I) - 1980 (II) - 1981 A. (III) - 1981 B. (IV) - 1982 (V) - 1984) (Chapitre IX)MYSTICPas encore d'évaluation
- De Groot - Les Fetes - Étude Concernant La Religion Populaire Des Chinois.Document558 pagesDe Groot - Les Fetes - Étude Concernant La Religion Populaire Des Chinois.varnamala100% (2)
- PSYCHANALYSE ET TAOISME... Par Genveviève GANCETDocument97 pagesPSYCHANALYSE ET TAOISME... Par Genveviève GANCETspiritualbeing100% (1)
- Histoire de Théodoric Le Grand Roi D It PDFDocument543 pagesHistoire de Théodoric Le Grand Roi D It PDFMarina SanduPas encore d'évaluation
- Poesie Hinoise BilleterDocument44 pagesPoesie Hinoise BilleterAnonymous FUolFTPas encore d'évaluation
- Pěng Qì Guàn Dĭng FăDocument19 pagesPěng Qì Guàn Dĭng FăMaurizio BadanaiPas encore d'évaluation
- La Notion de ShenDocument27 pagesLa Notion de ShenarbedPas encore d'évaluation
- La Patte de L'oursDocument39 pagesLa Patte de L'oursLigia UrcanPas encore d'évaluation
- Mensuel Jean Pelissier 31Document16 pagesMensuel Jean Pelissier 31emilie leclercPas encore d'évaluation
- Despeux, Catherine - Le Corps, Champ Spatio-Temporel, Souche D'identitéDocument35 pagesDespeux, Catherine - Le Corps, Champ Spatio-Temporel, Souche D'identitéAnonymous 8VbEv5tA3100% (1)
- Carnets (L. Lévy-Bruhl) PDFDocument152 pagesCarnets (L. Lévy-Bruhl) PDFEduardo Soares NunesPas encore d'évaluation
- Maspero Henry - Le TAOÏSME Et Les Religions Chinoises (1950)Document284 pagesMaspero Henry - Le TAOÏSME Et Les Religions Chinoises (1950)MonkScribd100% (3)
- Les Vers Dorés de Pythagore (... ) bpt6k649986 PDFDocument415 pagesLes Vers Dorés de Pythagore (... ) bpt6k649986 PDFyvan wandjiPas encore d'évaluation
- Bible Des ChinoisDocument36 pagesBible Des Chinoisnanayannick6416Pas encore d'évaluation
- Vandermeersch Léon - Origine Et Évolution de L'achilléomancie ChinoiseDocument16 pagesVandermeersch Léon - Origine Et Évolution de L'achilléomancie ChinoiseAlmuric59Pas encore d'évaluation
- Prasannapada MadhyamakavrttiDocument275 pagesPrasannapada Madhyamakavrttiooker777100% (1)
- These - Esploration de La Pensée de F.jullien PDFDocument395 pagesThese - Esploration de La Pensée de F.jullien PDFJean PeuplusPas encore d'évaluation
- Prasannapada MadhyamakavrttiDocument275 pagesPrasannapada Madhyamakavrttiooker777100% (1)
- Zhineng Qi GongDocument7 pagesZhineng Qi GongMaurizio BadanaiPas encore d'évaluation
- Un Équilibre Entre Le Yin Et Le YangDocument10 pagesUn Équilibre Entre Le Yin Et Le YangAtianaxPas encore d'évaluation
- Abrégé de L'histoire de La Médecine Chinoise - MéridiensDocument9 pagesAbrégé de L'histoire de La Médecine Chinoise - MéridiensKim Huy NguyenPas encore d'évaluation
- Philosophie, Poésie Et Musique Chez PléthonDocument19 pagesPhilosophie, Poésie Et Musique Chez PléthonbrysonruPas encore d'évaluation
- Astronomie ChinoiseDocument32 pagesAstronomie ChinoiseC2D100% (1)
- Petite Histoire de La Medecine ChinoiseDocument8 pagesPetite Histoire de La Medecine ChinoiseIzo JEANNE-DIT-FOUQUEPas encore d'évaluation
- Le Soutra de La Terre Pure D' Amitabha - Version CourteDocument13 pagesLe Soutra de La Terre Pure D' Amitabha - Version CourtehomePas encore d'évaluation
- Catherine Despeux - Le Corps, Champs Spatio-Temporel, Souche D'identité (Article - Hom - 0439-4216 - 1996 - Num - 36 - 137 - 370037Document35 pagesCatherine Despeux - Le Corps, Champs Spatio-Temporel, Souche D'identité (Article - Hom - 0439-4216 - 1996 - Num - 36 - 137 - 370037MonkScribdPas encore d'évaluation
- Lin TsiDocument3 pagesLin TsiJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Nishida Kitaronotes Et GlossaireDocument55 pagesNishida Kitaronotes Et GlossaireTRIBYPas encore d'évaluation
- (Ebook FR) Religion - Taoisme Et Sciences Chinoises PDFDocument8 pages(Ebook FR) Religion - Taoisme Et Sciences Chinoises PDFEddy Manijean100% (1)
- Wuji QigongDocument6 pagesWuji QigongAlain CobtiPas encore d'évaluation
- Taijiquan Chen 18mouvementsDocument7 pagesTaijiquan Chen 18mouvementsLista LuisPas encore d'évaluation
- Sagese ChinoiseDocument29 pagesSagese ChinoiseKrystyan KellerPas encore d'évaluation
- Lexique PhiloDocument698 pagesLexique PhiloJulien LaizéPas encore d'évaluation
- Robinet, Isabelle - Le Rôle Et Le Sens Des Nombres Dans La Cosmologie Et L'alchimie TaoïstesDocument29 pagesRobinet, Isabelle - Le Rôle Et Le Sens Des Nombres Dans La Cosmologie Et L'alchimie TaoïsteshighrangePas encore d'évaluation
- Bibliographie Medecine ChinoiseDocument3 pagesBibliographie Medecine ChinoiseSylvieMartinPas encore d'évaluation
- Cursus Qi Gong - 2783Document2 pagesCursus Qi Gong - 2783bourgPas encore d'évaluation
- Arts de l’Inde: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandArts de l’Inde: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Pensee Chinoise Confucius A Mao PDFDocument294 pagesPensee Chinoise Confucius A Mao PDFDAVID MESIASPas encore d'évaluation
- Zenker PhilosophieDocument693 pagesZenker Philosophietoopee1100% (2)
- Gilson - Le ThomismeDocument248 pagesGilson - Le ThomismeLucas Esandi100% (1)
- Approches critiques de la mythologie chinoiseD'EverandApproches critiques de la mythologie chinoisePas encore d'évaluation