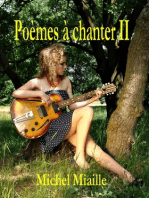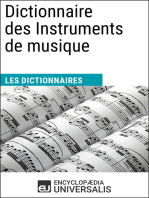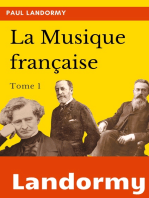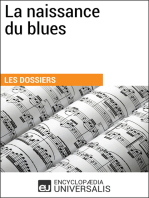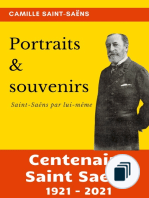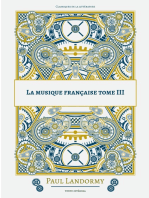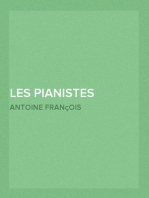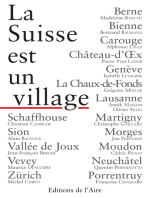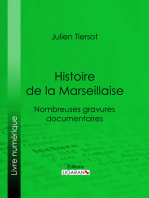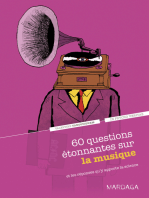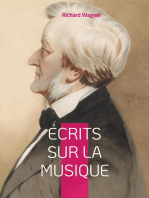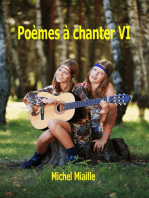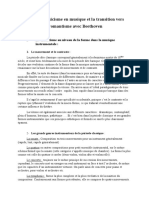Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dictionnaire de Musique Théorique Et Historique - Escudier, Léon, D. 1881
Transféré par
Ahmed BerrouhoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dictionnaire de Musique Théorique Et Historique - Escudier, Léon, D. 1881
Transféré par
Ahmed BerrouhoDroits d'auteur :
Formats disponibles
O M U N D O
|
DO L I V R O
11 -L. da Trindade- 13
Telef. 36 99 51
Lisboa
,K 'G/An \J
mm
a y
m/Ss # *s
X
^^^kr^^^^^^^^M %
#1111
y*
^owfwOTlaS
i\>^5
-
wms f^'%
^s
^2*J &KM
oMichd'cmoeb 9jamki
DICTIONNAIRE
DE
MUSIQUE
Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto
http://www.archive.org/details/dictionnairedemuOOescu
DICTIONNAIRE
DE MUSIQUE
THORIQUE ET HISTORIQUE
PAR
LON ET MARIE ESCUDIER
AVEC UNE PRFACE
DE M. F. 1IALVY
CINQUIME DITION-
REVUE, CORRIGE, CONSIDRABLEMENT AUGMENTE.
E. DENTU
diteur.
Palais-Royal, 1* et lO.
PARIS
LON ESCUDIER
diteur.
91, rue l'holscul.
1872
Tous droits rservs.
INTRODUCTION.
&y !Li7
Chaque jour le got de la musique se rpand et se
popularise; cet art est devenu une des plus vives jouis-
sances des nations civilises
;
dans les deux mondes, toutes
les classes de la socit subissent son influence. Chez di-
vers peuples, la musique fait dj partie intgrante de
l'ducation publique; et, le jour arrivera bientt peut
tre, o, plus puissante que la diplomatie, elle trouvera
le secret de les concilier, de les unir.
Aussi, depuis plusieurs annes surtout, cet art a t
l'objet des travaux et des recherches de beaucoup d'cri-
vains, et a fait clore un assez grand nombre de traits
spciaux, de recueils biographiques, d'histoires gnrales
et particulires. Mais ce qui manquait encore, croyons-
nous, c'tait un dictionnaire de musique bien conu, bien
excut, prcis et pourtant complet
;
en un mot, une en-
cyclopdie musicale qui rsumt toutes les connaissances
acquises, tous les faits importants, et qui fut au niveau
des progrs de l'poque.
Cependant des hommes d'un grand mrite se sont oc-
cups successivement de travaux de ce genre, et, bien
qu'ils ne soient pas arrivs des rsultais tout fait sa-
tisfaisants, leurs tentatives ne mritent pas moins d"tre
signales avec loges. Le Flamand Jean Tinctor a publi
le premier dictionnaire de musique qui ait vu le jour
depuis l'invention de l'imprimerie. Cet ouvrage, qui pa-
rut en 1470, l'poque de la renaissance des lettres, sous
le titre Terminorum mueic
definitorium, a joui pen-
dant longtemps d'une grande estime dans le monde
musical
;
mais il est aujourd'hui sans valeur, sans int-
rt. Ainsi que son titre l'indique, c'est tout simplement
une srie de dfinitions : on
y
chercherait vainement
une critique leve, des dtails intressants, des faits
2
INTRODUCTION.
historiques de quelque importance : au reste, il n'en
pouvait tre autrement l'poque o Tinctor crivait
;
les
communications intellectuelles entre les divers peuples
taient encore trop rares pour qu'il pt runir tous les
lments ncessaires la construction d"un vaste monu-
ment.
Dans le sicle dernier, un de nos crivains les plus c-
lbres, Jean-Jacques Rousseau, a interrompu ses m-
ditations sociales et ses tudes littraires pour nous
donner un dictionnaire de musique : mais cet excursion
dans le domaine de l'esthtique musicale n'a pas t
heureuse; son uvre fourmille de fautes et d'erreurs
;
et ceci n'est pas seulement notre opinion personnelle,
c'est aussi celle des critiques les plus clairs et des juges
les plus comptents.
D'autres productions du mme genre ont t publies
depuis avec plus de succs
;
quelques-unes mme, et
leur tte il faut placer le Dictionnaire de musique par
Castil-Blaze, sont dues des esprits minents : mais on
ne saurait nier que nos connaissances musicales ont sin-
gulirement progress depuis leur apparition
;
aussi sont-
elles devenues incompltes, surtout sous le rapport
historique.
L'ouvrage qui laisse peut-tre le moins dsirer est le
Dictionnaire de Lichtenthal. Aid des travaux les plus
rcents de l'Italie et de l'Allemagne, des ouvrages des
Kock, des Marpurg, des Forkel, des Martini, le docteur
Lichtenthal a donn la meilleur encyclopdie musicale
qui ait encore paru. Riche de documents prcieux, vi-
vifi par des recherches immenses, son livre offre la
fois un vif intrt aux artistes et aux amateurs
;
cepen-
dant, il faut le dire, le Dictionnaire de Lichtenthal pr-
sente de notables imperfections : son style laisse parfois
dsirer sous le rapport de l'lgance; les diverses par-
ties de son ouvrage manquent de proportion, et par une
contradiction trange, on
y
voit traits avec beaucoup
d'tendue des sujets d'un intrt mdiocre, tandis que
des matires plus importantes
y
sont peine effleures;
enfin, l'auteur a nglig une foule de documents, de d-
INTRODUCTION. o
couvertes modernes, dont l'exhibition aurait donn plus
de prix son travail. Il
y
a donc prendre et laisser
dans le Dictionnaire de Liclitenthal : c'est un excellent
guide que l'on peut suivre souvent; mais la condition
de modifier ce qui est diffus, et de dvelopper ce qui est
incomplet.
Aprs avoir fait la critique des productions de nos
devanciers, nous allons dire en peu de mots comment
nous avons entendu notre publication.
Les articles purement didactiques sont traits d'une
manire claire, succincte et concise. On conoit, en effet,
que dans les limites o nous avons d nous renfermer,
nous n'ayons pu donner, sur chaque matire, un trait
ex professo. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce dic-
tionnaire n'est pas fait uniquement pour les artistes, pour
les vritables connaisseurs
;
mais qu'il est aussi destin
aux gens du monde : en un mot, nous avons voulu le
rendre accessible toutes les intelligences
;
pour atteindre
ce but, nous avons d nous borner des notions lmen-
taires. Ceux des lecteurs qui voudraient approfondir les
sujets que nous n'avons fait qu'esquisser ici pourront re-
courir aux ouvrages spciaux.
Quant aux articles historiques, nous nous sommes
livrs de longues et nombreuses recherches pour don-
ner tout l'intrt possible cette partie de notre travail,
et la mettre en harmonie avec les dcouvertes de ce
sicle.
Ainsi on
y
trouvera la dsignation de tous les instru-
ments, tant anciens que modernes, avec le nom de leur
inventeur, la date de leur construction, toutes les fois
que ces dates ont t conserves.
On
y
rencontrera galement le nom des anciens lu-
thiers, l'cole d'o ils sortent, le lieu de leur naissance,
et l'indication du pays et de l'poque o ils travaillaient.
Les savants ouvrages que possdent l'Italie et l'Alle-
magne nous ont t d'une grande utilit sous ce double
rapport; mais ces productions trangres ne sont pas les
seules que nous ayons consultes avec fruit : les crits
si solides et si ingnieux de M. Gastil-Blaze, et notam-
4 INTRODUCTION.
ment son Histoire de l'Opra; YHistoire de la musique
en Italie, par le comte OrlofF; les Esquisses sur la mu-
sique, par Laborde
;
le Dictionnaire des musiciens, par
Choron et Fayolle.
Lus travaux rudits de M. Ftis, Biographie des mu-
siciens et Histoire de la musique; V Organographie, de
M. le marquis de Pontcoulant; les ouvrages didactiques
ou historiques de M. Berton, Baillot, Clment, Berlioz,
Halvy, Gewaert, Gustave Chouquet : tous ces crits, et
bien d'autres encore, nous ont fourni de prcieux mat-
riaux.
Nous avons aussi compuls avec soin les journaux
spciaux de musique, qui se publient en France, en
Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Les
livres de voyages les plus rcents ont t galement, de
notre part, l'objet d'un srieux examen pour tout ce qui
se rattache notre spcialit.
Escudier frres.
PRFACE.
Un Dictionnaire de musique se compose d'lments
divers, chaque poque, chaque transformation de l'art
ayant ncessairement laiss dans la nomenclature des
traces profondes des ides qui servaient de base aux
thories, des principes qui en dcoulaient, des formes
qu'adoptaient le gnie ou le caprice des compositeurs,
des instruments qui taient leurs interprtes.
On trouve, ds l'abord, dans l'histoire de la musique,
en cartant les temps bibliques et les monuments des
anciennes civilisations orientales qui ne nous ont laiss
que des documents en petit nombre, obscurs et incer-
tains, on trouve les trois grandes divisions qui partagent
aussi l'histoire de tous nos arts, de presque toutes nos
connaissances : l'antiquit, le moyen-ge, les temps
modernes
;
et chacune de ces poques apporte son
contingent au dictionnaire.
Les Grecs se sont beaucoup occups de musique.
Tout le monde sait, et il est presque superflu de le
rpter, que la musique faisait partie de l'ducation
des jeunes citoyens. Tout le monde sait quelle place
occupaient les chants, les churs, la lyre ou la cythare,
la flte, dans les temples, dans les ftes, au thtre,
II
PRFACE.
dans les festins, les concours publics, dans ces jeux si
fameux qui passionnaient la Grce entire. On connat
aussi le respect qu'ils conservaient pour leurs vieilles
coutumes musicales. Pendant longtemps, les Grecs
ont veill sur le maintien des anciennes lois de la
musique, avec cette ardeur qu'apportent au maintien
de Yhabeas corpus, les membres d'un parlement anglais.
La moindre tentative de changement tait svrement
rprime. Terpandre, un peu l'troit sur sa lyre
quatre cordes, se prsente aux jeux pythiques, une
lyre nouvelle la main, riche d'une corde de plus !
A l'aspect de cette corde, les partis s'agitent
;
mais
les conservateurs l'emportent
;
Terpandre est con-
damn l'amende, et sa lyre, honteusement chasse,
subit l'opprobre d'une exposition permanente, comme
pour avertir et prserver les tmraires qui seraient
tents de le suivre dans cette voie subversive de l'ordre
public. Que les murs sont changes ! et combien nos
clbres facteurs de piano, aujourd'hui honorablement
et lgitimement rcompenss, doivent rendre de grces
au Ciel de n'avoir pas vcu dans ces temps antiques !
Entrans par leur gnie, quelle concurrence ils eussent
faite Terpandre, et quelles amendes ils auraient
payes !
Cependant, malgr cette grande part faite la
musique dans la vie publique comme dans la vie prive
des Grecs, malgr cette grande consommation de
churs de toutes sortes, d'odes, de chansons; il ne
nous est rien parvenu de leurs compositions. Tout a
pri. Trois fragments seulement de musique note sont
arrivs jusqu' nous. Cette pnurie, cette absence
presque totale de documents nots, s'explique d'ailleurs
par leur musique mme, fonde sur un systme qui
PREFACE.
111
n'admettait pas l'harmonie, qui la repoussait en
quelque sorte. Us ne pouvaient, par consquent, avoir
ce que nous nommons des partitions, assemblage qui
devient tous les jours plus volumineux, des parties
diffrentes qui, dans notre musique moderne, forment
l'ensemble d'une composition. Ils n'avaient pas, d'ail-
leurs, proprement parler, de musique note spar-
ment, et ne connaissaient pas ce que nous appelons
parties d'orchestre ou de churs
;
les signes qui leur
servaient crire la musique, tous tirs de l'alphabet,
taient tracs au-dessus du texte, dans le manuscrit
mme qui contenait la posie ;
les mlodies s'appre-
naient par cur avec les paroles. Peut-tre le coryphe,
le batteur de mesure avait-il seul, sous les yeux, le
texte ainsi accompagn des signes ncessaires pour la
direction de l'ouvrage qu'on excutait ou qu'on repr-
sentait. Il n'existait donc vraisemblablement, et si je
ne me trompe, que peu de musique crite. Beaucoup
de chants, d'ailleurs, taient traditionnels, c'taient des
nomes consacrs pour les diverses solennits, et que
chacun savait et chantait de mmoire, comme aujour-
d'hui encore dans les glises, dans les temples rfor-
ms, dans les temples isralites, l'assistance chante
certains versets, certains plains-chants, certaines mlo-
dies consacres, pendant le service religieux. Il est
jamais regrettable, pour les potes comme pour les
musiciens, que quelques-uns, qu'un seul du moins des
ouvrages des grands tragiques grecs, n'ait pu venir
jusqu' nous, avec son cortge de signes musicaux,
pour nous apprendre comment Eschyle, comment
.
Sophocle faisaient rciter leurs vers, faisaient chanter
leurs churs. Quelle tude curieuse ! Que d'nigmes
deviner ! Peut-on conserver encore l'espoir que
IV
PRFACE.
quelques
manuscrits ainsi annots, aient, jusqu' ce
jour, chapp aux recherches des savants ? Qui sait
si les couvents du mont thos n'en reclent pas
quelques-uns ? Qui sait si la fameuse bibliothque
d'Alexandrie n'tait pas dpositaire de tant de
mlopes jamais perdues ? Le farouche Omar n'avait
aucune raison d'pargner ces chants qui n'taient pas
dans le Coran. Que de regrets il a prpars aux savants,
aux Acadmies, aux Conservatoires du monde entier !
Mais ne nous attendrissons pas outre mesure sur cette
perte douteuse, et ne versons pas trop de larmes sur ce
dsastre imaginaire.
Si notre civilisation devait prir un jour dans un
naufrage gnral, il se passerait peut-tre quelque
chose d'analogue, mais seulement pour tout ce qui est
romance, chanson ou morceau dtach de peu d'ten-
due. Quoique nous soyons incomparablement plus
riches que les Grecs en musique crite (nous pouvons
mme nous dire d'une richesse incommensurable), et
que nous puissions laisser nos successeurs cent mille
fois plus de romances que les Grecs ne nous ont laiss
de statues, il est probable que tous les morceaux dta-
chs priraient : on en a la preuve par la rapidit avec
laquelle disparaissent les romances qui ont seulement
quelques annes de date. Mais les partitions, les parti-
tions modernes
surtout, chapperaient peut-tre la
destruction par leur solidit
;
et leur volume respectable
les empchant
d'tre aussi facilement disperses par la
tempte, elles
resteraient comme des monuments d'un
art perdu, comme
des pyramides charges d'hirogly-
phes et attendant un
nouveau Champollion.
Mais si nous sommes ainsi dshrits des uvres des
musiciens de l'antiquit,
la thorie a t moins avare,
PREFACE. V
parce que beaucoup des principes qui chez eux consti-
tuaient l'art ont t recueillis dans des livres. Les
Grecs nous ont donc lgu, et certes ce n'est pas une
compensation qui puisse satisfaire l'artiste oul'rudit,
presque tous les mots qui entraient dans l'expos de
leur systme musical. Ils fournissent ainsi au vocabu-
laire un assez grand nombre de mots, lesquels, en
gnral, trouvent parfaitement leur place dans ce que
nous savons de leur thories. Beaucoup de ces mots
figurent encore aujourd'hui dans la langue usuelle des
musiciens de tous les pays, comme diapason, coryphe,
mlodie, harmonie, quoique ce dernier mot chez les
anciens ft loin de signifier ce qu'il signifie pour nous.
On puise donc dans l'antiquit une partie notable des
mots qui entrent dans le dictionnaire.
Avec le paganisme et la civilisation des anciens,
s'teignit et mourut aussi la musique des Grecs. Les
Romains qui avaient pris chez leurs devanciers les arts
tout faits, et qui n'avaient eu que la peine de les trans-
porter chez eux, n'ont laiss la musique rien qui leur
appartienne en propre.
Pour la musique, le moyen-ge commence vers la
fin du sixime sicle avec le pape Grgoire le Grand.
Deux cents ans avant lui, l'vque de Milan, saint
mbroise, avait dj tent de fonder sur les ruines de
la musique des Grecs la musique que rclamaient les
temples chrtiens
;
mais Grgoire le Grand jeta les
bases d'une thorie, et, ce qui importe surtout pour
l'histoire des dictionnaires, il donna des noms aux
modes grecs qu'il reconstituait sous une forme nouvelle
pour le service de la liturgie
;
ces noms se sont main-
tenus jusqu' nos jours, ce sont encore ceux que
VI
PRFACE.
portent
aujourd'hui les tons de Fglise. Cette priode
ne se termine qu' la fin du seizime sicle, embrassant
ainsi dans son cours l'espace de dix sicles complets,
depuis Grgoire qui monta sur le trne papal en 590,
jusqu'en 1595, poque de la mort de l'homme en qui
se
rsument et semblent se personnifier les travaux,
la patience, les recherches des matres qui avaient tra-
vers cette longue tape, et qui avaient creus leur
sillon plus ou moins profond, plus ou moins fertile.
On comprend que nous voulons parler de Palestrina,
homme d'un gnie simple et modeste, humble chape-
lain du Vatican, et qui certes ne savait pas, en crivant
les messes et les motets que lui commandaient ses fonc-
tions, qu'il scellait de sa main obscure le couronnement
d'un difice dont un pape illustre avait pos la premire
pierre, sans qu'il ait t donn non plus probablement
celui-ci de prvoir combien de matriaux, combien de
sicles seraient ncessaires l'achvement du monu-
ment qu'il commenait. Ces ttracordes que Grgoire
empruntait aux paens, pour en former ses gammes
chrtiennes, ces modes nouveaux auxquels il donnait
des noms antiques, tout pleins des souvenirs de la
Grce, et qui, sans cesser d'tre phrygiens, doriens, ou
lydiens, formaient les chants qui remplissaient l'enceinte
des basiliques, allaient devenir pendant mille ans le
point de dpart de travaux immenses, auxquels con-
courraient les musiciens de toute l'Europe, pour que
les derniers dbris de cette musique grecque, o
l'harmonie ne pouvait se faire jour, pussent enfin natre
et se dvelopper dsormais toutes les richesses de
l'harmonie, de cet art inconnu aux anciens, de faire
entendre la fois plusieurs voix excutant des chants
diifrents, et se combinant sans se confondre.
PRFACE.
VII
De mme que, clans les coles, l'lve s'exerce d'abord
composer sur des chants qu'il reoit de son matre, et
que pour cette raison on nommechants donns, de mme,
il semble que les plains-chants grgoriens aient servi
de chants donns aux compositeurs de ces temps. C'est
sur ces plains-chants grgoriens qu'ils faisaient leur
ducation, en mme temps que celle de la gnration
qui devait leur succder, jusqu' ce qu'ils aient enfin
dgag l'harmonie, art grave et pur, brillant d'un clat
doux et qui n'a rien de mondain
;
c'est ainsi que du
minerai rempli d'impurets sort le mtal sans taches
qui doit parer l'autel. Mais il fallut mille ans cette
pnible et glorieuse transformation.
Pendant que la musique religieuse s'tait ainsi for-
me, pendant que les accords, ns de cet art nouveau,
s'panouissaient l'ombre du sanctuaire, la musique
profane ne perdait pas son temps, les trouvres allaient
leur chemin, et composaient leurs gaies chansons
;
tendres, amoureux, moqueurs, nafs, et toujours bien
venus dans les nobles manoirs comme dans les chau-
mires, ils se souciaient fort peu des rgles inventes
par les clercs, et marchaient joyeusement, au grand
mpris des canons et des fugues. Ils avaient bien raison.
Ils tenaient la musique en quilibre. La musique est
comme la justice. Elle a deux plateaux. Les matres de
la gaie science faisaient contrepoids aux matres de la
science srieuse, et tout le monde chantait. La musique
facile et lgre forait la main aux chapelains et entrait
dans l'glise, bras dessus bras dessous avec le contre-
point qui la couvrait et la dguisait sans la masquer.
L'homme pieux gmissait de ces scandaleuses alliances,
l'homme de got se bouchait quelquefois les oreilles,
le docte coutait le contrepoint et s'y dlectait sa
VIII
PRFACE.
faon, tandis que le bourgeois, le paysan, et le seigneur
aussi, tout ce qui est peuple en musique, coutaient
avec recueillement la chanson mondaine et quelquefois
grivoise, et n'entendaient qu'elle. Car remarquez que,
pour beaucoup de gens, il n'y a pas deux musiques
;
ces gens-l ne distinguent point en musique sacre,
en musique profane.
Il n
J
y
a pour eux qu
J
une musique, celle qu'ils savent,
c'est--dire celle qu'ils ont entendue autour d'un ber-
ceau, l'cole, la danse, dans le village, dans la
plaine, sur la montagne
;
elle leur est bonne partout, et
se trouve sacre ou profane suivant l'occasion et le
besoin. On sait bien d'ailleurs que le peuple se plait
volontiers au gros vin du cabaret.
Il faut rentrer dans les bornes que nous nous
sommes prescrites, et que nous n'avons dj que trop
franchies. Loin de nous la pense de tracer ici une
esquisse, mme lgre, de l'histoire de la musique.
Htons-nous donc de dire que cette priode, qui com-
mence la rforme des chants de l'glise par le pape
Grgoire le Grand, rforme laquelle il a laiss son
nom, et qui se rsume dans le beau style qui a conserv
aussi le nom de Palestrina, priode complte, dont on
embrasse d'un coup-d'il la porte, et bien encadre
entre ces deux noms qui en marquent le dbut
et la fin,
apporte au dictionnaire tout le vocabulaire des
anciennes
notations,
de l'ancienne solmisation, du
plain-chant,
de l'harmonie, de la composition plu-
sieurs parties,
des artifices de tout genre qu'elle
comporte, et des rgles auxquelles elle a donn lieu.
Peut-tre, si Grgoire, au lieu de rattacher la musique
religieuse
au systme des Grecs et laiss plus de
PRFACE.
IX
libert cet instinct mlodique que les peuples ont
toujours conserv des degrs diffrents, les tudes
des matres et des chercheurs eussent-elles pris une
autre direction. Certes, il avait raison de mettre, ds
e dbut, une barrire entre la musique consacre au
service de Dieu, et la musique qui sert aux usages
habituels de la vie
;
mais tout en traant et en mainte-
nant d'une main forte et svre cette limite dsirable,
et en
y
installant, pour ainsi dire, une forte garde, il
et moins enchan l'inspiration, s'il n'avait cru devoir
lier aussi troitement la musique renaissante au
cadavre de la musique antique. Peut-tre la musique
purement expressive serait-elle ne plus tt, si les
hommes minents qui ont illustr et dirig la marche
de la musique pendant ces dix sicles, avaient t, au
dpart, plus matres de choisir leur chemin, et avaient
pu s'orienter leur gr. Qui sait si cette marche n'et
t plus libre et plus hardie ? Josquin des Prs, tant
d'autres, et Palestrina, obissant leur voix intrieure,
guids par ce gnie qui les clairait, mais chargs de
moins d'entraves, et prouvant moins de rsistance,
n'auraient-ils pas port plus haut leur essor, et, dans
ce vol plus rapide et plus lev, n'auraient-ils pas vu
l'horizon s'agrandir autour d'eux ? Devanant et rappro-
chant l'avenir, ils auraient jet une lumire plus vive
sur la route que suivaient leurs contemporains, et sur
les sentiers battus par les musiciens vulgaires. Car il
ne suffit pas que le peuple chante, il faut que des
hommes habiles et dous de Dieu se mettent la tte
de l'art et lui impriment une direction vigoureuse pour
qu'il s'cartent temps des ornires banales o le chant
populaire s'embourbe volontiers. Sans quoi la musique
reste en l'tat o nous la voyons encore aujourd'hui
X
PRFACE.
dans certains pays, loigns des grands centres de
civilisation ;
elle
y
demeure stationnaire. Renferme
dans un cercle troit qu'elle ne peut plus franchir,
confondue avec les vieux usages et les vieilles tradi-
tions, elle n'est plus elle-mme qu'une de ces vieilles
coutumes de la contre transmises de pre en fils, et
mrite peine dporter le nom d'art, quel que puisse
tre d'ailleurs le charme de certaines mlodies, pleines
de coloris, qui souvent refltent avec une grce
inexprimable les lieux, les murs du pays qui les a
vues natre, mais qui ne changent jamais, et vieil-
lissent, sans mourir, dans une originalit strile et
improductive. C'est une question qu'on ne peut
rsoudre aujourd'hui que par des hypothses, dont il
vaux mieux au reste ne pas chercher la solution, et
que je n'ai aborde que comme malgr moi et en
hsitant, que de savoir si Grgoire le Grand, en indi-
quant d'une manire aussi absolue le chemin que
devaient suivre les musiciens, n'a pas, et pour un long
espace cle temps, dtourn l'art de sa vritable route.
Au reste, il faut reconnatre que les travaux de ces
musiciens taient conformes l'esprit gnral du
temps.
Ds que Palestrina et ses contemporains eurent
atteint le but o tendaient les travaux qui avaient
rempli ces dix sicles
couls, tout semble rajeunir
autour de la musique. Elle sort de l'glise, et quittant
peu peu ses vtements
modestes, elle prend le got
des ornements et des riches
atours. Un instinct secret
venait de rvler aux jeunes
musiciens de ce temps, que
la science religieuse
avait
dit son dernier mot, qu'il n'y
avait rien
ajourner au style pur, modr, contenu
qu'on admirait dans la chapelle
Sixtine. Pour bien
PREFACE.
XI
marquer que tout tait puis de ce ct-l, ils lvent
une barrire que le temps n'a pas dplace, qu'il affer-
mit au contraire chaque jour davantage, et pleins d'un
zle ardent, ils s'engagent sans hsiter dans une voie
nouvelle. Ils ferment derrire eux les portes du sanc-
tuaire, et s' lanant dans le monde avec la musique qui
dsormais leur appartient, ils lui demandent des chants
pour toutes les passions humaines.
C'est alors que commencrent les premiers essais de
la musique unie au drame dans une treinte intime,
lui consacrant toutes ses forces, l'animant de sa cha-
leur, lui apportant une expression plus profonde, une
accentuation plus persuasive
;
mais il faut remarquer
que ce furent encore les souvenirs de la Grce qui
inspirrent ces tudes nouvelles, comme si tout ce qui
tenait la musique dt nous venir de l'antiquit.
L'avenir interrogea encore une fois le pass, et toutes
les esprances se tournrent vers ces monuments, vers
ces statues que la Grce avait lgus l'Italie, modles
imprissables, que les architectes et les sculpteurs, plus
heureux que les musiciens, s'empressaient d'tudier
dans leur ensemble comme dans leurs dtails
;
on et
dit qu'un voile venait de tomber, et avait dcouvert
toutes les richesses qui jusque-l n'avaient frapp que
d-es yeux sans regards. Un jeune gnie, le gnie de la
Renaissance, clairant de son flambeau ces merveilles
de l'art, et d'un souffle puissant dissipant tant de tn-
bres, rendait tout leur clat ces beauts caches sous
la poussire des sicles. Alors aussi put jaillir libre-
ment l'tincelle que de froides tudes avaient glace
dans les curs, et la flamme put s'allumer dans les
esprits que Dieu avait choisis.
C'est la tragdie d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide,
XII
PRFACE.
qui
passionnait les novateurs, hommes jeunes, lettrs,
lgants dans leur amour de l'antiquit, dont ils
voquaient ainsi tous les arts oublis. De mme que des
ttracordes et des modes des Grecs tait ne la mu-
sique
chrtienne, de la mlope, du chur antique,
devait natre la tragdie lyrique moderne. Rome, la
mtropole des papes, avait t le berceau de la pre-
mire transformation. Des patriciens de Florence
furent, dix sicles plus tard, les ouvriers de la seconde,
si diffrente de la premire dans sa tendance, dans ses
effets, dans sa posie. C'est Florence, en effet, que
brilla d'abord le signal de cette renaissance, laquelle
s'attachait aussi un nom dj illustre, et qui devait
bientt briller d'un clat plus vif encore : Vincenzo
Galilei, pre de Galileo-Galilei, tait un des chefs de
cette cole nouvelle.
A compter de ces premiers essais, qui eurent lieu
vers le milieu du seizime sicle, commena la marche
incessante de Part musical vers l'expression drama-
tique. Cette troisime poque, lie nos jours par une
chane de travaux non interrompus, apporte donc au
Dictionnaire tous les mots qui composent le vocabulaire
de la musique destine au thtre, lequel comprend
principalement : le rcitatif; les coupes diffrentes des
morceaux qui se sont successivement accrus dans leurs
proportions diverses, depuis l'air voix seule, jus-
qu'aux compositions les plus riches et les plus compli-
ques, jusqu'aux
finales,
merveilleux assemblage des
personnages du drame et du chur, tous anims de
passions diverses
;
les mesures nouvelles
;
les mouve-
ments, qui indiquent l'allure de la mesure; les nuances,
qui ajoutent l'expression; l'instrumentation, qui
tendait toujours son domaine, et s'introduisait peu
PRFACE.
XIII
peu jusque clans la musique d'glise; et enfin la mu-
sique purement instrumentale, ne tout entire dater
de ce temps, depuis les courtes ritournelles des premiers
essais d'opra, jusqu' la symphonie, dernire cration
des temps modernes.
Il faut parler maintenant des mots qui n'appar-
tiennent aucune des trois grandes divisions que l'on
vient de tracer, ou plutt qui se tracent d'elles-mmes,
pour ainsi dire, dans l'histoire de la langue du mu-
sicien.
On sait peu de chose de la musique des Hbreux, et
cependant la musique remplissait une place importante
dans leurs crmonies religieuses. Elle tait une des
magnificences du temple de Salomon, o un chur
nombreux de lvites, accompagn de harpes, chantait
les louanges du Seigneur. Ce n'est pas ici le lieu de
traiter cette matire, ni de parler des chants employs
aujourd'hui dans les temples des Isralites, o toutes
les prires se font encore en musique, de la rcitation
qui leur est particulire, de leurs accents vocaux.
Disons seulement que les mots que l'on trouve dans les
livres saints sont pour la plupart des noms d'instru-
ments de musique, sur la signification desquels on n'est
pas toujours d'accord.
11 faut mentionner aussi les mots qui appartiennent
diverses civilisations plus ou moins effaces, et qui
servent dsigner diffrentes mlodies qui ont conserv
la fois, et leur individualit et leur nom primitif;
comme les airs venus des pays du Nord, de l'Irlande,
de l'Ecosse, de l'ancienne Angleterre, de l'Allemagne,
de la Hongrie, de certaines parties de l'Italie, de l'Es-
pagne, de la France
;
comme les chants ns dans les
Xl\
PRFACE.
montagnes, qui ont un parfum plein d'une pre suavit
et qui leur est particulier. Ces airs sont tantt des airs
de danse, tantt des chants consacrs certaines cr-
monies, certains usages du pays
;
d'autres sont des
chants patriotiques, devenus comme des symboles
vivaces d'une nationalit teinte ou florissante encore
;
ou bien ce sont des chants inspirs par l'amour, ce mo-
bile ternel des inspirations des potes et des musiciens.
Ce sont l ces mlodies traditionnelles dont nous avons
parl, fleurs sauvages de la musique, que l'art n'a pas
fcondes, mais que les compositeurs les plus renomms
ne ddaignent pas de ramasser lorsqu'il les rencontrent
sur leur chemin.
Quant aux diffrentes musiques qui ont aujourd'hui
le privilge de charmer les peuples de l'Orient, Turcs,
Maures, Arabes, Indous, Chinois, elles apportent aussi
leur tribut au Dictionnaire. Il se compose de mots
peut-tre clairs pour les musiciens de ces contres,
mais que pour la plupart nous ne comprenons pas plus
que nous ne comprenons leur musique elle-mme,
musique dont nous avons eu quelques chantillons
apports en Europe par des artistes de toutes couleurs,
lesquels, la vrit, n'taient probablement ni les
Paganini,ni les Rossini, ni les Mozart de leur pays.
Ces mots s'appliquent des modes que nous connais-
sons peu, des instruments d'une forme, toute primi-
tive, et d'une sonorit tantt douteuse et tantt trop
bruyante. Le gong ou tamtam, les cymbales, le triangle,
les grelots, les sonnettes, les clochettes, le pavillon
chinois, la grosse caisse, les timbales, les tambours
sont les seuls emprunts que nous ayons faits aux
orchestres de l'Orient, et combien de fois, et avec
quelle amertume, n'a-t-on pas reproch ces emprunts
prface;
xv
aux compositeurs de nos jours ! ils n'ont cependant fait
que cder au dsir bien lgitime d'augmenter les jouis-
sances d'un public trop ingrat, et ce n'est pas leur faute
si dans ces bazars si renomms, ils n'ont pas trouv un
bagage moins retentissant. On prend ce qu'on peut; le
musicien a l'esprit envahisseur :
Il a du chamelier emport les sonnettes
Plutt que de sortir du bazar les mains nettes.
Ces musiques, au reste, sont destines disparatre
devant l'art europen, dj entr sur leur territoire,
en alli ou en conqurant, soit la tte des rgiments,
soit avec ces thtres que de hardis navigateurs ne
craignent pas de transporter travers l'Ocan, et
qu'il lvent comme des temples nomades, au mi-
lieu de ces peuples qu'il faut convertir ta la vraie
musique.
Le premier Dictionnaire de musique qui ait paru en
France, est d un prtre, Sbastien de Brossard,
grand chapelain et matre de musique de la cathdrale
de Meaux. Ce sont les titres qu'il prend au bas de la
ddicace de la premire dition qui a paru Paris, en
1703, et cette ddicace est adresse l'vque de
Meaux, Bossuet. Bossuet, alors
g de soixante-
quinze ans, un an seulement avant sa mort, ne ddaigna
pas d'accepter l'hommage du principal matre de mu-
sique du diocse qu'il gouvernait depuis vingt-deux
ans. Cette sainte ardeur, u lui dit Brossard dans son
ptre ddicatoire, qui vous anime remplir, dans
toute leur tendue, les devoirs sacrs de l'piscopat,
n'clate pas seulement dans les fonctions les plus
XVI
PRFACE.
a minentes; elles se plat encore descendre aux
a emplois les plus simples, et ne trouve rien que de
Grand et d'Auguste dans les moindres parties du
culte de Dieu. La musique est une de ces parties, on
n'en peut disconvenir. Ses premiers sons ont
t
consacrez chanter les louanges du Seigneur
;
et si
la corruption des hommes a entrepris de la dtourner
de sa source, pour l'appliquer des objets profanes,
elle n'en est ny moins pure, ny moins difiante, pour
les curs que l'Esprit saint a prservez de la conta-
gion.
Le Dictionnaire de Brossard est le premier qui ait
paru en langage moderne. 11 est vrai, dit M. Ftis,
a que ds le quinzime sicle, Tinctor avait compos
un recueil de dfinitions des termes de musique en
usage de son temps
;
il est vrai encore que le bohme
Janowka avait publi Prague un lexique de musique
en latin, deux ans avant que Brossard donnt son
dictionnaire : mais
leDefinitoriumde Tinctor, manus-
crit indit, tait d'une excessive raret, et n'tait pas
plus parvenu jusqu' Brossard que le lexique de
Janowka, ainsi qu'on peut le voir dans le catalogue
des livres qu'il avait lus. Car Brossard a joint son
Dictionnaire, un catalogue dplus de
neuf cents auteurs
qui ont crit sur la musique, en toutes sortes de temps, de
pays et de langues.
Brossard n'avait pas pens d'abord faire un Dic-
tionnaire. 11 avait compos et publi plusieurs livres
de motets
;
dans ces compositions, toutes les indications
de mouvements et de nuances taient en italien, comme
on fait encore aujourd'hui. Car si le franais est la
langue cosmopolite, la langue de la conversation, l'ita-
lien, langue des musiciens, en vertu d'une convention
PRFACE.
XVII
excellente, a fourni une espce de seconde notation,
l'aide de laquelle tous les pianistes, tous les violonistes,
tous les instrumentistes, tousles compositeurs,
rpandus
sur la surface du globe, se comprennent et chappent
aux embarras d'une seconde tour de Babel. Un musi-
cien allemand, ou slave, ou anglais, ou caffre, ou hot-
tentot, n'est pas tenu de savoir ce que signifient les mots
franais; lentement, gaiement, vite; un Franais
n'est
pas tenu de comprendre ces mmes mots dans les lan-
gues qu'il ne sait pas, mais tous les musiciens de tous
les pays doivent entendre, et entendent les mots
adagio,
allgro, et presto, et crescendo et
smorzando, et tant
d'autres qui ont cess d'tre italiens pour devenir tech-
niques, et ont sacrifi leur nationalit
pour se faire na-
turaliser musiciens. Beaucoup d'artistes n'en savent
pas
plus long, et se contentent de ce lger bagage
; mais cet
accord tacite, ce trait d'alliance pass entre toutes les
nations, et sanctionn par un long et constant usage,
n'en est pas moins un vritable hommage rendu la
terre natale des arts.
Toutes les indications ncessaires taient donc en
italien dans les motets de Brossard, qui, lui, savait
parfaitement l'italien. Mais le prudent abb, se dfiant
de l'intelligence ou de l'rudition de ses lecteurs et de
ses chanteurs, prit la prcaution de faire prcder ses
motets a un vocabulaire expliquant en franais le sens
de tous les mots italiens ncessaires la bonne excution
de la musique, comme il le dit lui-mme en justifiant
timidement son innovation un peu injurieuse pour les
musiciens de son temps. Son essai russit, et c'est ce
petit catalogue qu'il complta depuis, et qu'il publia s-
parment sous le titre de Dictionnaire de musique, con-
tenant une explication des termes grecs, latins et franais
XVIII
PRFACE.
les plus usitez dans la musique.
Certaines parties de ce
travail sont excellentes et peuvent tre encore consultes
avec fruit, surtout pour ce qui touche le systme grec,
c'est--dire l'ensemble des modes et des ttracordes de
diffrents genres, et les anciennes notations, que Bros-
sard connaissait bien. Ses dfinitions sont en gnral
concises et parfaitement claires, et il
y
a dans tout son
livre un caractre de simplicit et de bonne foi qui s-
duit. Il ne se compromet pas, ne s'aventure pas, et,
lorsqu'il doute, il s'abstient, principalement quand il
s'agit de noms propres, et lorsqu'il faudrait prendre un
parti propos de certaines inventions attribues quel-
quefois plusieurs musiciens diffrents. Ainsi, aprs
avoir parl du ttracorde ou systme de Mercure,
auquel on en attribue communment l'invention vers
l'an du monde 2000, et de Pythagore, qui, selon la
plus commune opinion, avait tabli des rgles pour
trouver les proportions des sons, il ajoute : Mais
comme on vit que ces huit sons ne suffisaient pas, di-
vers particuliers ajoutrent peu peu d'autres chordes,
etc. C'est un moyen naf de se tirer d'embarras et
d'viter les discussions.
Ce n'tait pas tout que d'avoir expliqu, traduit,
comment tous les mots italiens employs en musique.
L'abb Brossard n'tait pas satisfait, il voulut encore
qu'on stles lire harmonieusement, qu'on les pronont
clans toute leur puret, en vritable Toscan, en acad-
micien de la Crusca
;
il aurait volontiers lait couler
l'Arno dans la Seine. Il mit donc la suite de son Dic-
tionnaire un Trait de la manire de bien prononcer les
mots italiens. Quelques-unes des explications de l'abb
semblent empruntes M. Jourdain. Ainsi il dit que la
lette A doit se prononcer la bouche bien ouverte
,
les
PRFACE. XIX
lvres bien spares, et, surtout, les dents bien desserres,
c'est--dire. qu'il faut que la mchoire d'en bas soit
tellement baisse ou spare de celle d'en haut, que
du moins la langue puisse passer librement entre les
dents. Je dis du moins, car si on peut la sparer da-
vantage, ce ne sera que tant mieux, a L'ouvrage est
termin par la liste des neuf cents auteurs dont nous
avons parl, aprs quoi l'auteur, par une prire tou-
chante, adjure les dtenteurs de livres ou de manuscrits
qu'il ne connatrait pas, et avec les prcautions et les
instructions les plus minutieuses, de les lui vendre,
ou de les lui trocquer, ou de les lui prter sous pro-
messes et telles assurances qu'on souhaitera. *
Le dictionnaire de J.-J. Rousseau ne vint que cin-
quante-cinq ans plus tard. La premire dition parut
en 1758; c'tait en grande partie le travail qu'il avait
fait pour l'Encyclopdie, qu'il avait revu et qu'il aurait
voulu refondre en entier. Dans la prface de la seconde
dition, date de Motiers-Travers, le 20 dcembre 1764
(il
y
aura bientt un sicle, et la musique a bien chang
depuis ce temps), il fait bon march de son uvre, et
regrette de ne pas avoir eu le loisir d'en faire un ouvrage
trait avec plus de soin. 11 avertit ceux qui ne veulent
souffrir que des livres bien faits de ne pas entreprendre
la lecture de celui-l. 11 pense cependant que ceux que
le mal ne dtourne pas du bien,
y
trouveront peut-tre
assez de bons articles pour tolrer les mauvais, et dans
les mauvais mmes, assez d'observations neuves et vraies
pour valoir la peine d'tre tries et choisies parmi le
reste.
*
Les musiciens lisent peu, dit-il, et cependant,
je connais peu d'arts o la lecture et la rflexion soient
plus ncessaires. Les meilleurs livres, dit-il plus
loin,
sont ceux que le vulgaire dcrie, et dont les gens
4..
XX PRFACE.
talent profitent sans en parler. Il faut tout pardon-
ner un homme tel que Rousseau, ses omissions, ses
erreurs, ses obscurits, tout jusqu' son ddain, on peut
dire sa haine pour Rameau et ses ouvrages
;
il faut avoir
son livre, le lire, non le consulter.
Il
y
a eu deux Dictionnaires publis en France depuis
celui de Rousseau. Le Dictionnaire de musique moderne,
de M. Castil-Blaze, qui a eu deux ditions, dont la der-
nire a t publie en 1825, et celui du docteur Lich-
tenthal, traduit en 1839, de l'italien, par M. Dominique
Mondo. A cette liste, il faut ajouter celui de MM. Escu-
dier, qui ont voulu faire un manuel commode, utile
tous, o l'artiste puisse se renseigner, et l'amateur
s'clairer et trouver l'explication des mots qu'emploie
aujourd'hui si frquemment la critique musicale.
En rsum, les mots qui entrent dans un Diction-
naire de musique, ont donc pour origines diverses, et
en suivant l'ordre des temps, la Bible et l'ancien Orient,
l'antiquit
paenne, le moyen-ge, la renaissance, les
temps modernes.
S'il tait possible de ranger ces mots par ordre chro-
nologique et de les classer par poque, au lieu de suivre
l'ordre
alphabtique
que commande d'une manire
absolue l'usage
auquel un Dictionnaire est destin, on
aurait pour ainsi dire, sous les yeux une image des rvo-
lutions que la musique a subies. De mme que l'il du
gologue
interroge la terre, et suit le travail des sicles
dans le dpt des terrains de formations diverses, de
mme,
l'artiste, au pote, au philosophe qui vou-
drait
connatre
l'tat de l'art dans chacune de ses pha-
ses, ces mots ainsi
disposs par couches successives,
tmoins
parlants
de l'histoire de la musique aux diff-
PRFACE. XXI
rents ges, montreraient chaque poque clans son
ensemble, et diraient combien la musique, mesure
qu'elle s'loignait de son origine, prenait de force et de
consistance. Mesurant d'un regard la richesse de ces
dbris prcieux, traversant parla pense les poques
dont ils sont souvent les seuls vestiges, fouillant dans le
sein de ce sol toujours fertile, et comparant entre elles
les productions varies qu'il n'a cess de fournir, l'ob-
servateur aurait d'abord percer les tnbres qui enve-
loppent les premiers ges, puis remontant par degrs
au jour qui nous claire, il rencontrerait la fin le ter-
rain sur lequel nous marchons aujourd'hui
;
terrain
paissant et fcond, riche de ce qu'il a donn comme de
ce qu'il promet encore, sur lequel reposent les thories
modernes, et que couvrent tant de beaux monuments
levs par nos matres et par le gnie de nos contempo-
rains. Si quelques-uns de ces monuments chancellent
dj, d'autres sont fermes encore, et seront justement
admirs, jusqu'au jour o succombant eux-mmes sous
le poids du temps, et couchs dans la poussire, ils con-
fondront leur souvenir avec le souvenir effac des races
teintes et des difices crouls
;
ils cderont alors leur
place aux travaux d'une cole dont l'avenir seul a le se-
cret, travaux qui deviendront leur tour le symbole
d'une halte de plus dans le chemin que l'humanit ne
cesse de parcourir
;
transformation nouvelle, ajoute
tant d'autres, de cet art toujours le mme et pourtant
toujours jeune, renaissant de lui-mme Tintant qu'il
vieillit, qui descend jusqu'au peuple en restant un mys-
tre, semblable ces fleuves bienfaisants qui coulent
pleins bords, et dont on ignore les sources caches, de
cet art qui veille au fond de l'me la prire pour la
porter au ciel, et qui est pour ceux qui le cultivent, un
XXII PRFACE.
bonheur dplus clans les jours heureux, une consolation
suprme dans la douleur.
F. HALVY.
FLN DE LA PREFACE.
DICTIONNAIRE
DE MUSIQUE.
A. Cette lettre dsigne dans la musique moderne, et
notamment dans la musique allemande, le sixime degr
del gamme diatonique et naturelle, ou la dixime corde
de la gamme diatonico-chromatique, appele dans l'an-
cien solfge a la mi r, a mi la, ou la.
Dans la mu-
sique allemande, A majuscule dsigne le la de la pre-
mire octave, a minuscule indique celui de la seconde
octave, a marqu avec un petit trait horizontal, celui de
la troisime octave, et a avec deux petits traits horizon-
taux, celui de la quatrime octave.
A majuscule crit
sur une partition, indique l'alto.
Dans l'ancienne
gamme franaise, qui commence par
f,
la lettre A tait
nomme mi, quinte de la, quand on chantait au naturel,
et la, quinte de r, quand on solfiait par bmols. A n'-
tait dans cette gamme que tantt mi et tantt la; c'est
pourquoi on l'appelait A mi la. Par la mme raison, les
mmes dnominations s'appliquaient toutes les lettres
reprsentant les notes de la gamme, et l'on disait : B la
si, G sol ut, D la r, E si mi, fi ut
fa,
G r sol.
Ces
dnominations ont t rformes depuis que l'invention
du si a mis un terme aux difficults dont tait hriss
l'ancien solfge. On dit maintenant : une symphonie en
do, une sonate en sol, etc.
;
et mme, pour faire connatre
les tons dans lesquels doivent jouer diffrents instru-
ments vent, plusieurs musiciens se servent de simples
lettres, comme cors en A, clarinettes en B, trompettes
en G.
La lettre A indique galement la premire note
du ttracorde hyperbolien rpondant la sixime corde
1...
2
ABY
de la gamme de la.
Plac en tte d'un morceau,
A marque la partie de la haute-contre, alto.
Dans les
antlphonaires, A dsigne les endroits o il faut lever la
voix.
Abat-voix. Espce de construction tablie au-dessus
de la scne pour rejeter la voix et les sons des instru-
ments vers les auditeurs.
a
,
b
,
c
,
musical. Petite mthode de solmisation ou
solfge lmentaire l'usage des enfants, comprenant
un abrg des principes et une srie d'exercices vocaux
prparatoires.
Abrg. Terme de facture d'orgue
;
c'est un mcanisme
qui, par l'assemblage des rouleaux, transporte aux sou-
papes des sommiers respectifs le mouvement des tou-
ches du clavier.
Abrge pneumatique. Systme de mcanisme d'orgue
imagin en
1850,
par Moitessier, de Montpellier.
Abrviation. Nous avons en musique un grand nom-
bre d'abrviations. On les figure avec des barres places
au-dessous d'une ronde, la queue d'une blanche ou
d'une noire, ou seules chaque temps, ou au milieu de
la mesure. Dans le premier cas, la barre signie que la
note ronde, blanche ou noire, doit tre divise en autant
de croches que sa valeur en contient, et en doubles et
triples croches, si la barre est double ou triple. La barre
seule, aprs un groupe de notes, signifie que l'on doit
rpter ce mme groupe autant de fois qu'il
y
a de barres.
L'abrviation diminue le travail du copiste. Place
avec intelligence dans les parties spares et les parti-
tions, elle fait connatre d'avance que le trait redire est
exactement le mme que celui que l'on vient d'excuter,
et qu'il ne faut, par consquent, pas changer d'intonation
ni dposition.
Abub. Instrument de musique en forme de flte en
usage dans le temple de Salomon; le sanctuaire de ce
saint lieu possdait un abub mince, uni. fait de roseau et
garni d'or.
Abyssinie (musique de Y). L'antiquit de cette partie
de l'Afrique gale presque celle de l'Egypte. Bruce, qui
avait entendu deux tilles de cette nation*chanter alterna-
tivement des strophes, en se rpondant l'une l'autre
d'une manire trs-mlodieuse, s'attendait trouver la
musique porte un haut point de perfection dans ce
royaume; mais il ne tarda point reconnatre son erreur.
AGA 3
Les Abyssins ont six instruments de musique
;
le
sistre, la lyre, le tambourin, qu'ils assurent avoir reu
de l'Egypte ou de l'Ethiopie, la flte, les timbales et la
trompette qui furent apports chez eux de la Palestine,
par Menelek, fils de la reine de Saba. La flte, le tam-
bourin, les timbales et la trompette servent la guerre
;
le sistre est consacr au service religieux, et la lyre est
rserve pour les ftes et les rjouissances. La flte des
Abyssins se joue comme notre clarinette.
L trompette est faite d'un morceau de roseau de
cinq pieds de long, avec une ouverture large d'environ
trois centimtres
;
ce long bton se trouve fix le cou
d'une courge, qui a prcisment la forme du pavillon de
notre trompette; cette partie est orne de petites co-
quilles blanches
,
et la totalit de l'instrument est rev-
tue de parchemin
;
cette trompette ne donne qu'une seule
note, mi, dont le son est rauque et trs-fort.
La lyre des Abyssins a cinq
,
six , et quelquefois sept
cordes. La guitare se trouve aussi dans les mains des
Mahomtants de l'Abyssinie, mais elle leur a t ap-
porte de l'Arabie.
Il est regretter que le voyageur Bruce ne nous ait
point initi aux lments et aux effets de la musique des
Abyssins. La description de leurs instruments nous
donne penser qu'elle tait un peu barbare
,
du moins
dans les temps reculs.
Acadmie. Nom gnrique donn chacune des cinq
classes de YInstitut de France. L'Acadmie des Beaux-
Arts comprend la peinture, la sculpture, l'architecture,
la gravure et la musique. Cette dernire
y
est repr-
sente par six membres, choisis parmi les plus clbres
compositeurs franais . L'Acadmie des Beaux-Arts est
charge de prparer et de juger les concours annuels
pour les grands prix de Rome, de faire des rapports sur
les ouvrages prsents son examen
,
et de rechercher
avec soin tout ce qui peut contribuer au progrs de l'art
en France. (Voyez Institut.)
Acadmie de Musique, maintenant Acadmie natio-
nale. L'origine de cette institution musicale remonte
au pote Ba'f, contemporain de Ronsard et de Malherbe,
qui tablit dans sa maison, rue des Fosss-Saint-Victor,
de concert avec son associ Thibaut de Gourville, une
acadmie de musique autorise par Charles IX, en 157 J.
On
y
excutait des ballets et des mascarades. Depuis la
4
ACA
mort de Baf, cette institution tomba dans une complte
dcadence. En
1645, le cardinal Mazarin ayant fait venir
des acteurs italiens, les tablit dans la rue du Petit-Bour-
bon, prs de la partie du Louvre o fut depuis btie la co-
lonnade. Ils yjourent et chantrent une pastorale en 5
actes, Achille Scyros
,
de Jules Strozzi. Cet opra, le
premier qui ait t donn en France , fut suivi en 1647
,
d'un second, Orpho et Eurydice. Andromde , tragdie
machines du grand Corneille, joue en 1650
,
tait un
vritable mlodrame
,
puisque la musique n'y tait
qu'accessoire. Les ballets que Benserade commena
faire reprsenter en 1651 , au nombre de vingt et un
,
et
dans lesquels Louis XIV et sa cour ne ddaignrent pas
de danser, n'taient que des intermdes adapts d'au-
tres pices. 11 est certain que l'abb Perrin
,
de Lyon
,
doit tre regard comme le crateur de notre Acadmie
nationale de musique. Il donna l'opra une forme plus
rgulire, et en fournit le premier modle. Conjointe-
ment avec le musicien Cambert, il fit jouer, pour essai
,
en
1659, une pastorale dont ou ignore le titre. Le succs
qu'elle obtint engagea les auteurs en composer deux
autres, dont la mort du cardinal Mazarin interrompit
les rptitions. Dans ce mme temps, un marquis de
Sourdiac
,
opulent amateur, perfectionnait les machines
propres l'opra, et faisait jouer dans son chteau la
Toison d'Or, de Corneille. Associs avec lui , Perrin et
Cambert obtinrent par lettres-patentes, en 1659
,
le pri-
vilge pour douze ans d'une Acadmie de musique o
Ton chanterait au publie des pices de thtre. Elle fut
tablie dans la rue Gungaud. On
y
joua Pomone
,
en
1671, et les Peines et les Plaisirs de VAynour, en 1672.
Mais la discorde ayant dsuni les associs, Lulli, plus
habile qu'eux, les supplanta.
Surintendant de la mu-
sique du roi, Lulli obtint facilement de nouvelles lettres
patentes qui lui concdrent le privilge retir Perrin.
Associ avec Vigaroni, machiniste du roi, il disposa une
salle de jeu de paume
,
rue de Vaugirard
,
prs du Lu-
xembourg, et
y
ft reprsenter les Ftes de VAmour et
de Bacchus
,
dont les paroles taient de Quinault. Aprs
la mort de Molire, en j 673,
son thtre, fond au
Palais-Royal par le cardinal de Richelieu
,
fut donn
Lulli,
qui
y
poursuivit sa carrire avec
autant de gloire
que de bonheur
,
et la termina
,
en 1686
,
par Armide
,
qui fut regard comme le meilleur de ses opras.
Une
AGA 5
innovation importante eut lieu sous l'administration de
Lulli. Des danseuses parurent sur le thtre. Les rles
de femmes, dans le ballet , taient remplis auparavant
par des hommes travestis.
C'est dans
la
salle du
Palais- Royal que
,
durant prs d'un sicle,
ont t don-
nes toutes les tragdies lyriques, tous les ballets hro-
ques de Quinault,Campistron,Fontenelle, Lamotte,Fuse-
lier
,
Gahuzac, mis en musique par Lulli
, Destouches
,
Campra, Labarre, Rameau, Mondonville.L chantrent
pendant quarante ans Chass, Jlyotte,
et diverses
reprises la clbre Lemaure. L dansrent Marcelle
,
qui voifait tant de choses dans un menuet , la Gamargo
et la Salle , immortalises par Voltaire. L enfin dbuta
le grand Vestris
,
le dieu de la danse.
C'est l aussi que
la rvolution musicale fut commence par des chanteurs
italiens venus en 1752 , et par le Devin du village de
Jean-Jacques Rousseau. Un incendie ayant consum
cette salle, le 6 avril
1763, l'Opra fut transport l'anne
suivante aux Tuileries. Il retourna au Palais-Royal dans
une salle qui ouvrit en 1770, et qui fut encore dtruite
par le feu en 1781.
Cette priode est remarquable
sous plusieurs rapports. Les ballets acquirent, sous No-
verre, plus de mouvement , de grce , d'expression et de
naturel. L'arrive Paris de Gluck, de Piccinni et d'une
troupe de bouffes italiens acheva la rforme musicale.
Gluck ne se borna pas enrichir notre scne lyrique
d'une foule de chefs-d'uvre , Iphignie en Tauride
,
Orphe, Alceste
;
il donna l'orchestre plus de vigueur
,
d'nergie et de prcision
;
il apprit aux acteurs chanter
en mesure, dclamer le rcitatif d'une manire moins
tranante et plus anime. Piccinni fit entendre la plus
touchante et la plus suave mlodie dans Atys
,
Roland
,
Didon.
Les Bouffes, dont les reprsentations alter-
naient trois fois la semaine avec celles de l'Opra fran-
ais, firent goter aux dilettanti parisiens les chefs-
d'uvre des Sarti, des Anfossi, des Paisiello. Les Ra-
mistes
,
ou partisans de Rameau
,
qui avaient triomph
des Lullistes, furent vaincus leur tour, et le dernier
coup fut port la vieille et lamentable musique fran-
aise. Mais en mme temps se formrent les factions
non moins opinitres et irascibles des Gluekistes et des
Piccinnistes.
Heureux temps o des lgions d'amateurs et d'en-
thousiastes prenaient l'Opra pour un champ de bataille,
6
ACA
et s'y dfiant courageusement,
attaquaient un duo, sa-
paient les fondements d'un choeur, renversaient l'difice
du finale le plus formidable ! L'histoire nous a transmis
les noms de ces braves, qui tour tour imptueux ou
calmes
,
lanaient une grle de traits hardis ou rece-
vaient avec un flegme stoque le feu roulant des quoli-
bets et des calembours. On raconte ce sujet une anec-
dote assez piquante. M
lle
Levasseur
,
jouant le rle
d'Alceste, chantait le bel air qui finit par ce vers :
Il me dchire et m'arrache le cur.
Un piccinniste s'cria : Ah ! mademoiselle, vous
m'arrachez les oreilles.
Quelle fortune, si c'est pour
vous en donner d'autres ! rpliqua son voisin.
A l'poque dont nous parlons, on applaudissait des
chnntcurs et des cantatrices d'un trs-grand-mrite,
Sophie Arnoult, Rosalie, Levasseur, Larivire, Legros.
C'est encore pendant cette priode que l'Acadmie royale
de musique qui, ds son origine, avait langui sous le
despotisme des gentilshommes de la Chambre, passa
momentanment sous la direction de la ville de Paris,
qui en confia la gestion, de 1778 1780, aux soins
clairs et actifs de Viseney de Volgay. Le thtre de la
Porte-Saint-Martin ayant t bti en moins d'un an, on
en fit l'ouverture par une reprsentation gratis, afin
d'essayer sur le peuple si les gens comme il faut pou-
vaient
y
assister sans danger. Cette poque est une des
plus brillantes qu'offrent les annales de l'Acadmie
royale de musique. On
y
rforma les costumes ridicules
des acteurs ; on
y
entendit la Caravane et Panurge, de
Grtry; Renaud, Dard.aaus, dipe Colone, de Sac-
chini
;
les Danades et Tarare, de Salieri; les Noces de
Figaro, de Mozart. Ces remarquables compositions,
soutenues par les meilleurs ouvrages du dernier rper-
toire et par les charmants ballets de Garde], Tlmaque,
Psych, Paris, ont form pendant trente ans un fonds
aussi agrable et varie pour le public, que peu dispen-
dieux pour l'administration.
On applaudissait alors comme acteurs et comme chan-
teurs Laine, Lays, Chardini, Rousseau, Chron et sa
femme, la clbre madame de Saint-Hubert, made-
moiselle Maillard, qui la remplaa, sans la faire oublier;
dans la danse, Vestris et Didelot, Laborie, Milon, mes-
ACA
7
dames Guimard, Rose Chavigny,
Saulnier.
L'orchestre
offrait aussi des artistes du premier mrite.
En
1790,
l'administration retourna sous la direction de la
muni-
cipalit de Paris; et en 1793 les acteurs s'en chargrent
comme socitaires. Depuis la rvolution,
l'Acadmie
royale de musique avait successivement pris le nom
d'Opra National et de Thtre de la Rpublique et des
Arts. On
y
sacrifia au got du temps; mais du moins
les ouvrages de circonstance qu'on
y
reprsenta ne
manquaient pas d'une certaine dignit, et quelques
beauts dans la musique
y
rachetaient les dfauts
et
l'absurdit des paroles.
En
1795, le
gouvernement
acheta, sans le payer, le Thtre National,
qu'on avait
permis la Montansier, deux ans auparavant, de btir
en lace de la Bibliothque de la rue Richelieu
;
et
malgr le danger d'un tel voisinage pour cet immense
et prcieux dpt littraire, la ci-devant
Acadmie
royale de musique fut tablie dans la nouvelle salle. On
remit alors ce spectacle en direction. Deux hommes de
lettres, Lachabaussire et Parny, l'ancien acteur Caillot,
et un quatrime personnage, formant le comit d'admi-
nistration, s'acquittrent assez, mal de leurs fonctions.
Une seconde administration n'ayant pas mieux russi,
Devismes fut nomm en 1799. Mais on lui donna pour
collgue un ex-lgislateur avec lequel il ne put s'en-
tendre, et lui cda la place en 1800.
L'poque
du
Consulat et de l'Empire ne fut pas trs-fconde en
ouvrages saillants. Les seuls qui obtinrent un succs
soutenu sont les suivants : Anacron chez Polycrate, de
Grtry
;
la Cration du monde, de Haydn
;
les Mystres
d'Isis, de Mozart; Ossian oues Bardes, de Lesweur; la
Vestale et Fernand Coriez, de Spontini
;
la Jrusalem
dlivre, de Persuis. Les recrues en talents furent peu
nombreuses aussi pendant cette longue priode; elles se
bornrent, pour le chant, Nourrit pre, Drivis,
Lavigne, mademoiselle Armand et madame Branchu
;
et pour la danse, Ferdinand, Albert, Montjoie, mes-
dames Fanny Bios et Gosselin.
Redevenu Acadmie
royale de musique en 1814, l'Opra, avec la Restau-
ration, retomba sous l'influence de la Maison du roi et
de l'intendant des Menus-Plaisirs. Les mutations dans
l'administration
y
devinrent frquentes et onreuses.
Aprs avoir t tenu tour tour par Persuis, Yiotti,
M. Habeneck et M. Duplantis, le sceptre de l'Acadmie
8
ACA
royale de
musique tomba entre les mains d'un noble
vicomte,
qui, avec d'excellentes intentions, se donna
nanmoins des ridicules en s'occupant de rglements de
morale pour les coulisses.
Nomm directeur de
l'Opra en 1827, M. Lubbert, ancien lve de M. Fetis,
homme d'esprit et passionn pour les arts, immola
grands frais l'Ecole franaise l'Ecole italienne. Le
thtre devint le patrimoine du gnie ultramontain.
L'immortel Rossini,
y
fit jouer Mose, le Sige de
Corinthe, le Comte Ory, Guillaume Tell. A peine la
Muette de Portici, d'Auber, put-elle
y
trouver place.
Indpendamment de ces ouvrages, plusieurs ballets,
Mars et Vnus, de Blache
;
le Page inconstant, de Dau-
berval
;
la
Somnambule, la Belle au Bois dormant,
auraient suffi pour donner de l'clat l'administration
de M. Lubbert.
Sous la restauration, la direction de
l'Opra fit de nombreuses et importantes acquisitions
;
pour le chant, Adolphe Nourrit, bien suprieur son
pre, Dabadie, Dupont, mesdames Ginti Damoreau,
Grassari, Javareck; et pour la danse, l'arien Paul,
Perrot, mesdames Monfessu, Marie Taglioni.
Depuis
J830, le sceptre de l'Acadmie royale de musique passa
tour tour- entre les mains de M. Vron, de M. Du-
ponchel, de M. Monnais, de M. Lon Pillet, et plus
tard, de MM. Duponchel et Nestor Roqueplan associs.
Enfin, M. Duponchel, resta unique directeur jusqu'au
mois de septembre 1853, poque laquelle il s'adjoignit
comme associ M. Aigoin. Puis reparut, M. Nestor
Roqueplan auquel succda M. Alphonse Royer
;
et ce
dernier cda sa place M. Emile Perrin qui conserva
avec clat la direction de l'Opra jusqu'en 1871. Pen-
dant les tristes jours de la Commune M. Eugne Gar-
nier fut implant l'opra, et enfin aprs la dfaite des
communeux, la direction de notre premire scne
lyrique fut confie M. Halanzier. Cette priode a t
signale par des ouvrages importants, tels que Robert le
Diable, les Huguenots, le Prophte, VAfricaine, de
Moyerbeer
;
la Juive, la Peine de Chypre, Charles VI,
d'Halvy; la Favorite, de Donizetti, Jrusalem, les
Vpres Siciliennes, le Trouvre, Don Carlos, de Verdi
;
Herculanum, de P. David, Faust, de Gounod
;
Hamlet,
d'Amb. Thomas
;
et quelques jolis ballets, la Sylphide, le
Diable Boiteux, Giselle, la Jolie fille de Gand, la Pri,
le Violon du Diable, la Vivandire, Jovita, le Diable
ACA
9
Quatre, laMaschera, la Source, Coppelia, etc. Les princi-
paux artistes qui ont cr des rles importants dans ces di-
vers ouvrages, sont pour le chant : Mesdanips Falcon, Do-
rus-Gras, Nau, Stoltz, Alboni, Tedesco, Bosio, Pauline
Viardot-Garcia, Gueymard-Lauters, Sasse, Cruvelli, Nil-
sson ; Messieu rs Nourrit, Levasseur, Alizard, Duprez, La-
font. Alexis Dupont, Morelli, Gueymard, Roger, Derivis,
Depassio, Belval,Obin, Barroilhet,Faure. Pour la danse :
Mesdames Taglioni, Fanny et Thrse Essler, Carlotta
Grisi, Cerrito, Fitz-James/Boschetti, Dumilatre, Plun-
kett, Priola, Guy-Stephan, Zina Mrante, Rosati, Fonta,
Ferraris, Emma Livry, Granzow, Murawieff, Bozzacchi
;
Messieurs Perrot, Petit-Pas, Saint-Lon, Mazillier.
Acadmies de musique. On donne ce nom plusieurs
sortes d'institutions relatives la musique. Appartien-
nent aux plus remarquables acadmies musicales :
La Socit philharmonique
de Vrone, qui florissait
dj dans le seizime sicle;
L'Acadmie philharmonique de Rome
;
L'Acadmie philharmonique de Bologne, fonde en
1066
;
Le Conservatoire royal et l'Acadmie royale de mu-
sique de Paris
;
L'ancienne Socit de musique, fonde Londres en
1710;
L'Acadmie impriale de Saint-Ptersbourg;
L'Acadmie royale de Stockholm
;
L'Acadmie de chant, fonde Berlin en 1789
;
La Socit philharmonique
de l'empire d'Autriche,
fonde Vienne en 1812.
Acadmicien philharmonique.
Titre que portent les
membres des Socits philharmoniques
de Bologne et
de Vrone.
A capella
de chapelle. Ce terme, en usage dans
la musique d'glise, signifie que les instruments mar-
chent l'unisson ou l'octave avec les parties chantantes,
comme dans la fugue. Ce qu'on appelle tempo a capella
est indiqu par un 2 ou par un C barr. (Voy. Temps.)
On dit aussi stile a capella (style de chapelfe), et l'on
entend par l un style grave, pos, sans instruments,
et qui autrefois tait souvent appuy et form sur le
plain-chant. (Voy. Alla Palestrina.)
A capricio. signifie la volont
de l'excutant. (Voy.
d libitum.)
10
AGG
Acclrer. Presser le mouvement, ce qui arrive dans
les morceaux passionns et pleins de vigueur.
Accent. Appliqu la dclamation, et spcialement
au chant et la musique, ce mot exprime les diverses
modifications qu'prouve le son de voix sous l'impres-
sion d'un sentiment, d'une passion quelconque.
Voici les nuances le plus en usage de Vaccent mu-
sical :
Piano-pianissimo
(ppp),
le plus faiblement possible;
Pianissimo
(pp),
trs-faiblement
;
Piano
(p),
faiblement
;
Mezzo piano (mp), faiblement, d'une manire mod-
re;
Poco forte (poco f), un peu fort;
Mezzo forte (mf), modrment fort;
Forte (f), fort
;
Fortissimo (ff), trs-fort
;
Forte fortissimo (fff), le plus fort possible : on dit
aussi Tutta
forza.
"Voici les termes qu'on emploie pour indiquer la mo-
dification successive des nuances :
Crescendo cres. ou cr
,
en augmentant de force
par degr
;
Rinforzando rinf. ou rfz ,
en renfonant;
Decrescendo.... dcres...... avec une force dcrois-
sante
;
Diminuendo dimin, ou dim
,
en diminuant;
Calando.... cal
,
en dcroissant
;
Mancando mancand
,
en s'teignant.
Morendo mor
, en mourant
;
Perdendosi perdend
,
en laissant mourir le
son.
On emploie encore les mots :
Vibrato, qui signifie qu'il faut faire vibrer le son
;
Sforzando, qui signifie qu'il faut tout d'un coup don-
ner plus de force
;
Legato, qui signifie qu'il faut lier et couler
les notes
;
Et staccato, qu'il faut les dtacher.
On emploie d'autres mots encore pour indiquer toutes
les nuances de l'accent
;
ils sont moins importants
;
on
les trouvera leur place.
L'art d'accentuer convenablement constitue en grande
partie le talent du comdien, du chanteur; c'est par le
juste caractre de l'accent que se manifestent l'intelli-
ACG
11
gence et la sensibilit.
Il faut viter de trop multiplier
les accents. A force de prodiguer les effets, on finirait
par les teindre, de mme qu'on blouit les yeux en pro-
diguant les lumires.
Accents d'glise. On appelait ainsi ces formules mlo-
dieuses que dans l'ancienne glise on devait savoir par
cur, selon la ponctuation, l'poque o l'on chantait
les leons vangliques ou pistolaires
;
ces formules
taient au nombre de sept :
1
Yaccent immuable,
quand
la dernire syllabe d'un mot n'tait ni leve ni abaisse;
2
Yaccent moyen, quand on chantait la dernire syllabe
d'une tierce plus bas
;
3
Yaccent grave, en la chantant
d'une quarte plus grave
;
4
Yaccent aigu,
lorsqu'on
chantait quelques syllabes avant la dernire, d'une tierce
plus grave, et la dernire sur l'intonation
prcdente;
5
Yaccent modr, chantant quelques syllabes avant la
dernire, d'une seconde plus aigu, et la dernire sur l'in-
tonation prcdente
;
6
8
Yaccent
interrogatif, lorsqu'on
chantait la dernire syllabe d'une interrogation d'une
seconde plus aigu
;
7
Yaccent
final,
quand les dernires
syllabes descendaient par degrs vers la quarte sur
laquelle devait tomber la syllabe finale.
Accentuer. Exprimer dans
l'excution, avec exacti-
tude, les accents musicaux conformes aux indications du
compositeur, l'accent des mots et au bon got; mar-
quer exactement les accents musicaux, les
forte et les
riano.
Accessoires. Dans les uvres de l'art et spcialement
dans les compositions musicales, on appelle parties acces-
soires celles qui, sans tre insparables du sujet trait
par l'artiste, servent le relever, h le mettre dans tout
son jour,
y
rattacher certaines ides secondaires rela-
tives ce sujet, en gnrale l'embellir et le dvelopper
davantage. L'accessoire doit d'ailleurs tre li au sujet
principal de manire en paratre presque insparable.
(Voir composition.)
Au thtre on nomme acces-
soires certains objets portatifs qui peuvent tre nces-
saire la reprsentation, comme les meubles, les cor-
beilles, etc.
Ce mot dsigne galement les petits rles
d'une pice, indpendants du sujet. On dit d'un acteur, il
joue les accessoires.
En lutherie on nomme accessoires
d'un violon, la barre, Ycime et le chevalet.
Acciacatura. Terme italien de musique, signifiant
une espce d'agrment d'excution, sur laquelle cepen-
12
ACC
dant ou n'est pas
gnralement d'accord. Selon les uns,
elle consiste frapper
rapidement et d'une manire suc-
cessive
toutes les notes d'un accord, pour leur donner une
plus
grande rsonnance; elle se marque en crivant en
petites
notes et dans leur ordre successif toutes les notes
de
l'accord, et ensuite l'accord
lui-mme, ou en faisant
prcder l'accord par une espce de zig-zag perpendicu-
laire.
Selon d'autres, elle consiste frapper dans un ac-
cord une ou plusieurs notes qui ne lui appartiennent pas
;
elle se marque par une petite ligne transversale, traver-
sant l'accord, l o la note trangre l'accord doit tre
frappe.
Selon d'autres, enfin, c'est une appogiature,
mais que l'on frappe presque simultanment avec la note
principale. Pour exprimer cette nuance, quelques com-
positeurs
coupent la petite note par un trait.
Accident. En musique les accidents sont des signes,
appels dises, bmols, bcarres, doubles dizes, doubles
bmols, qui viennent altrer accidentellement les sons
naturels de la gamme, pendant la dure de la mesure o
ils sont placs.
Accidentel.
Dises ou bmols accidentels, lignes acci-
dentelles ou
supplmentaires, c'est--dire celles qu'on
ajoute en dessus ou en dessous de la porte, lorsque
l'tendue des voix ou des instruments l'exige.
Accidentia notarum.
Expression employe dans la
musique ancienne pour indiquer qu'on devait rendre
d'une moindre valeur une note place entre deux notes
d'une plus grande valeur, quivalente la note prc-
dente ou la suivante; ou qu'une note d'une plus grande
valeur devait perdre la troisime partie de cette mme
valeur. Ce moyen n'a t
pratiqu que dans les temps
pairs.
Acclamateur. Celui qui applaudit, qui concourt aux
acclamations.
Acclamations. A Rome les acclamations taient fort
usites au thtre, et particulirement dans les repr-
sentations lyriques. Ce ne furent d'abord que des cris et
des
applaudissements confus
;
mais ds le rgne d'Au-
guste on en tit un concert tudi : un musicien don-
nait le ton, et le peuple, formant deux churs, rptait
alternativement la formule d'acclamations. Le der-
nier acteur qui occupait la scne donnait le signa] des
acclamations par ces mots : <c Vadete et applaudite.
Lorsque Nron jouait de la lyre sur le thtre, Snque
AGG i3
et Burrhus taient alors les coryphes ou premiers accla-
raateurs ;
de jeunes chevaliers se plaaient en diffrents
endroits du thtre pour rpter les acclamations, et des
soldats, gags cet effet, se mlaient parmi le peuple afin
que le prince entendit un concert unanime d'applaudis-
sements. Ces acclamations chantes ou plutt accentues,
durrent jusqu'au rgne de Thodoric. Chez les H-
breux le ffosanna, chez les Grecs l'a-poT) tj/t), chez les
Modernes le Vivat et les Hourra, sont des termes d'ac-
clamation.
Accolade. Nom du signe ou du trait de plume qui
unit deux ou plusieurs portes.
Accompagnateur. Celui qui aide
,
soutient et re-
lve l'aide de la voix ou de l'instrument la partie prin-
cipale d'un morceau de musique excut soit par la voix
soit par un instrument.
Accompagnement. On entend par ce mot tantt l'aide
ou le soutien harmonique d'un chant ou d'une voix prin-
cipale, au moyen d'un ou plusieurs instruments, tantt
la science des accords applique l'excution de la basse
continue et des partitions. Le mot accompagnement, pris
dans ce dernier sens, signifie peu prs la mme chose
qu'harmonie. Ainsi, apprendre l'accompagnement qui-
vaut ces mots : apprendre l'harmonie.
Le chant, plac en premire ligne dans une composi-
tion, reoit diverses parties qui le suivent, le soutien-
nent, lui donnent plus d'expression et de vigueur, et font
clater simultanment l'harmonie dont la phrase princi-
pale a dtermin l'ordre et le dessin. L'union de ces par-
ties diversement arranges s'appelle accompagnement.
Avant qu'on et pris l'habitude d'arranger les parti-
tions d'orchestre pour le piano, l'accompagnement sur la
partition mme tait assez en usage. Le pianiste devait
dchiffrer et analyser premire vue une partition d'o-
pra, de symphonie, etc., malgr le grand nombre des
portes et la diffrence des clefs; choisir avec tact, dans
toute la partition, les traits mlodiques et les combinai-
sons harmoniques qui rendaient le mieux la pense du
compositeur, et improviser un rsum complet de tout
cela qui ft excutable sur le piano. Cette espce d'ac-
compagnement tait fort difficile
,
exigeait une trs-
grande habitude et demandait une connaissance parfaite
de la musique.
Aujourd'hui presque toutes les partitions remarqua-
14 ACG
bls d'opras ou de symphonies sont arranges pour le
piano par les pianistes, et ne sont pas d'une excution
plus difficile que celle de toute autre musique de piano.
L'accompagnement tant toujours subordonn au
chant, quelques personnes l'ont considr comme un ac-
cessoire de peu d'importance, et l'ont compar mal
propos au cadre d'un tableau, au pidestal d'une statue.
Cette comparaison, bien qu'elle ait une apparence de
justesse, ne mrite mme pas d'tre combattue.
Les instruments vent, qui sont d'un si grand secours
l'accompagnement, furent pendant longtemps ngligs.
On trouve bien quelques soli de ces instruments dans
les anciennes partitions; mais l'art de grouper dans les
masses harmoniques les fltes, les bassons, les cors, les
hautbois, tait autrefois inconnu. Gluck fut le premier
qui ft entendre des accompagnements pompeux et dra-
matiques; ceux de Piccinni et de Sacchini sont d'une
grande puret
;
mais Mozart est celui qui a port l'art
magique de l'orchestre son plus haut degr. Depuis
cette poque , les beaux modles se sont multiplis.
Les grands matres unissent aujourd'hui, par un heu-
reux accord, les grces de la mlodie la richesse de
l'harmonie et des accompagnements.
Il
y
a mille manires de conduire un accompagne-
ment, mais il n'existe aucune rgle prcise qui dtermine
le dessin, le mouvement
et le rhythme de cette impor-
tante partie des compositions musicales. Le sens des pa-
roles, les situations dramatiques, la disposition de la scne
et le got sont les seuls guides du compositeur, et les bel-
les partitions des grands matres sont ses modles. La pa-
lette prsente toutes les couleurs au peintre; l'orchestre
offre tous les sons au compositeur: il s'agit de choisir. De
mme que le premier, en formant ses teintes, nglige ou
rejette prsent la nuance qu'il emploiera dans une au-
tre occasion et pour un autre effet
;
ainsi le compositeur,
suivant le caractre de la scne qu'il doit traiter, emploie
les instruments cordes ou les instruments vent, les
notes appuyes ou les notes tenues, l'unisson ou des
groupes
d'accords.
Nous ne saurions trop insister sur l'accompagnement
de la partition. 11 faut d'abord remarquer que son ex-
cution demande, outre une tude pralable des accords,
une prompte lecture de toutes les clefs, l'habitude de
passer
chaque instant, non seulement des sons graves
ACC 15
aux sons aigus, mais encore d'un ton dans un autre, une
main accooutume aux difficults, et une parfaite con-
naissance des effets qui rsultent de l'orchestre.
L'accompagnement d'un instrument par un autre ins-
trument, comme, par exemple, le piano par le violon, la
flte, etc., demande de la part de l'accompagnateur une
lecture exacte de la musique, une oreille trs-dlicate
pour l'intonation, et un grand soin de s'abstenir de tout
ce qui pourrait nuire la partie principale, comme les
ornements inutiles; au contraire, si l'accompagnateur
s'aperoit que la partie principale s'carte un peu de l'in-
tonation ou del mesure, il doit aussitt la ramener dans
le vritable sentiment du temps, en pressant ou ralentis-
sant le mouvement, afin de rtablir l'quilibre dans l'en-
semble. Dans les moments o la partie principale se re-
pose, il est permis l'accompagnateur de faire briller
son instrument par tous les moyens que lui suggre le
bon got.
L'origine de l'accompagnement ne remonte qu'au
commencement du xvn* sicle. On en attribue l'invention
Louis Viadama nLodi en 1580. Depuis lors, le sys-
tme des accompagnements s'est successivement dve-
lopp, sous le nom de basse continue.
On nomme accompagnement plaqu celui qui se rduit
en une suite d'accords harmoniques; il fut longtemps
usit en France.
Uaccompagnement
figur
h. la fois harmonique et m-
lodique est en grande vogue en Italie et en Allemagne.
h''accompagnement traduit est le plus complet des ac-
compagnements mais aussi le plus difficile, c'est l'accom-
pagnement de la partition en usage partout.
On nomme accompagnement de quatuor celui qui est
excut par les instruments cordes et archets : violon,
alto, violoncelle et contrebasse.
\* accompagnement d'harmonie n'est compos que des
instruments vent.
Et Yaccompagnement grand orchestre se dit de celui
auquel concourent tous les instruments de l'orchestre.
Accord. On appelle accord l'union simultane de plu-
sieurs sons produisante l'oreille un effet agrable.
La classification des accords employs dans l'harmonie
a subi des variations infinies depuis Rameau jusqu' nos
jours. Nous les ferons connatre en parlant des thories
harmoniques.
16 ACG
En ralit, il n'y a que deux accords : l'accord parfait
sur la tonique, et l'accord de dominante.
L'accord parfait sur la ionique est compos de la toni-
que, de sa tierce majeure ou mineure, de sa quinte, et, si
l'on veut, de son octave
;
par exemple, ut, mi, sol, ut,
dans le ton d'ut majeur, et ut, mi bmol, sol, ut, dans le
ton d'ut mineur.
L'accord de dominante est le mme dans les deux mo-
des. Il est compos de la dominante, de sa tierce, de sa
quinte, de sa septime, et si l'on veut de son octave
;
par
exemple, sol, si, r,
fa,
sol, dans le ton d'ut.
L'harmonie entire, dans un ton donn, se rduit
l'emploi successif de ces deux accords. (Voyez le mot
Harmonie.)
On peut employer les accords dans leur tat naturel
et tels que nous venons de les crire; on peut aussi
double?* ou retrancher quelques-unes de leurs notes, et
les disposer de plusieurs manires. On peut les modifier
par le renversement, les altrations, le retard, Vantici-
pation, la substitution, les appogiatures, les notes de
passage, les pdales et les progressions. (Voyez ces mots.
Voyez aussi Rsolution des accords et Marche des
parties harmoniques.)
L'tude des accords et des lois qui les rgissent cons-
titue 1
!
harmonie thorique', leur emploi, leur enchane-
ment plus ou moins heureux dans une pice de musi-
que, constitue Yharmonie pratique. (Voyez le mot
Harmonie et tous les mots Accords.)
Accords consonnants. Les accords consonnants sont
ceux qui ne se composent que des intervalles agrables
appels consonnances, et qui peuvent toujours tre
attaqus sans prparation. (Voyez Intervalle, Con-
sonnances, Prparation.)
Accords drivs. Accords tirs des fondamentaux et
dans lesquels on ne dispose pas les sons dans l'ordre le
plus direct.
Accords dissonants. Les accords dissonants sont ceux
qui procurent l'oreille une sensation mois satisfaisante
que les accords consonnants, qui se composent de dis-
sonances (voyez ce mot), et qui, le plus souvent, ne peu-
vent s'attaquer sans prparation.
Accords fondamentaux. Les accords fondamentaux
sont ceux dans lesquels on dispose les sons dans l'ordre
le plus simple, c'est--dire la tierce l'un de l'autre.
ACC
A 7
(Voyez Tierce.) Il n'y en a que deux dans un ton donn :
Vaccord parfait sur la tonique et Vaccord de dominante.
Accord parfait. Il est compos de la tonique, de la
tierce majeure ou mineure et de sa quinte. C'est le plus
doux l'oreille, et le seul qui donne le sentiment d'une
conclusion harmonique.
Accord de dominante. Il est compos de la domi-
nante, de sa tierce, de sa quinte et de sa septime. L'a
dissonance et les attractions multiplies qu'il renferme
lui donnent l'expression du mouvement. (Voyez le mot
Harmonie.)
Accorder les instruments. C'est tendre ou lcher
les cordes, allonger ou racourcir les tuyaux de l'orgue,
de la flte, du cor, tendre ou lcher les peaux des timba-
les
;
en un mot, c'est augmenter ou diminuer la tension
des corps sonores, jusqu' ce que toutes les parties de
l'instrument soient au ton qu'elles doivent avoir.
Le parfait accord de tous les instruments est une des
principales qualits pour une bonne excution d'ensem-
ble. C'est pourquoi l'on a l'habitude, quelque temps
avant de commencer jouer, non-seulement d'accorder
les instruments cordes d'aprs le diapason, mais encore
d'essayer tous les instruments vent, pour voir s'ils
sont d'accord entre eux. Au thtre, ces prparatifs
doivent se faire avant de descendre l'orchestre.
Accords (Positions des). (Voyez le mot Positions.)
Accords (Enchanement des). L'harmonie entire se
rduit l'emploi alternatif de deux accords. (Voyez le mot
Harmonie). Il faut donc apprendre lesenchaner l'un
l'autre avec rgularit.
En gnral, l'accord parfait et l'accord de dominante
se succdent avec rgularit, lorsqu'ils le font d'une ma-
nire simple, naturelle, sans contorsion et, pour ainsi
dire, de plain pied.
L'accord de dominante doit toujours tre suivi de l'ac-
cord parfait du ton dans lequel on est. Cette rgle ne
souffre qu'une exception dont nous parlerons dans l'ar-
ticle spcial du changement de ton. (Voyez Modula-
tion.)
Lorsqu'on passe de l'accord de dominante l'accord
parfait, la sensible doit monter la tonique, et le qua-
trime degr descendre sur le troisime. Ce sont prci-
sment les tendances de la sensible vers la tonique, et du
quatrime degr vers le troisime, qui caractrisent l'ac-
18
ACC
cord de dominante, en font un accord de mouvement, et
le rendant propre effectuer le mouvement au passage
d'un ton un autre ton. Ce n'est que dans les parties inter-
mdiaires, et en secret pour ainsi dire, qu'il est permis
de les ngliger. Encore les bons auteurs ont-ils vit cette
licence.
.
Les autres notes de l'accord de dominante peuvent
marcher au gr du compositeur. Le deuxime degr
monte ou descend de manire complter l'accord par-
fait autant qu'il est possible. La basse monte ou descend
presque toujours sur la tonique, moins que Ton n'aime
mieux un accord renvers.
Dans les mlodies et dans les parties harmoniques
chantantes, il n'est pas ncessaire que le quatrime de-
gr descende immdiatement sur le troisime, ni que la
sensible monte immdiatement la tonique : il suffit que
cela ait enfin lieu. Souvent mme on vite cette termi-
naison, en offrant l'oreille une autre tendance qui fait
oublier la premire. Ainsi, par exemple, la tendance de
la sensible vers la tonique peut faire oublier celle du
quatrime degr vers le troisime, et rciproquement.
Quelquefois aussi on les nglige tout fait. Le got et
l'tude des matres enseigneront bien vite le reste.
Lorsque l'accord de dominante est trop loign de sa
forme naturelle par la substitution, le retard, les altra-
tions, ou quelque autre modification en usage, on le ra-
mne ordinairement cette forme naturelle ou quel-
qu'un de ses renversements, avant de le terminer. On
peut, son gr, l'y ramener immdiatement, ou se ser-
vir un instant de l'accord parfait, si on trouve cette voie
plus simple et plus facile.
L'accord parfait et l'accord de dominante peuvent se
prolonger aussi longtemps qu'on le dsire, avant de les
faire succder l'un l'autre.
Accordeurs. On nomme accordeurs d'orgue ou de
piano ceux qui vont dans les glises ou dans les maisons
accorder ces instruments. Quand les accordeurs raccom-
modent aussi ces instruments, ils prennent le nom de
facteurs. (Voyez Facteurs.)
On nomme galement accordeur, un petit instru-
ment compos de douze diapasons en acier disposs sur
une planchette sonore et donnant avec justesse les douze
demi-tons de la gamme par temprament gal.
Accordon. L'accordon est un instrument anche
,
AGC 19
renferm dans une petite caisse qui se dilate et se res-
serre volont, et produit ainsi les tons au moyen du
mcanisme d'un doigt touches. Son tendue est dia-
toniquement du sol , clef de violon
,
au-dessous des li-
gnes, au do, mme clef, au-dessus de la porte
,
except
le la, au-dessous et le si au-dessus des lignes de la mme
clef du violon. Il
y
a cependant des accordons qui peu-
vent donner dans cette tendue les tons dises et bmo-
liss.
On peut s'en servir pour jouer de petits airs
simples, et mme pour donner quelques accords.
Cet instrument fut invent en Allemagne en 1832 par
un aubergiste des environs de Vienne
,
qui, le premier,
imagina un harmonica de bouche , compos de petites
lames de mtal perpendiculaires , au moyen desquelles
on obtenait quelques accords en soufflant et en aspirant;
plus tard, on renferma ces lames ou anches libres dans
une petite caisse. On
y
adapta une soufflerie pour agiter
les lames et un clavier pour laisser l'air s'introduire sous
telle ou telle lame, et donner la note voulue.
Les pre-
miers accordons taient privs de demi -tons. Ce fut
Reisner, de Breslau, que cet instrument dut ce perfec-
tionnement.
Accordon a piston ou systme de registre permet-
tant de faire parler une ou plusieurs notes volont,
l'aide de la mme touche.
Accordon-Piano
,
construit en 1852,
par Boulon,
Paris. Cet instrument offrait la runion de l'accordon
et du piano.
Accordo, lyre barberienne. C'tait une espce de
basse italienne
,
quinze cordes
,
qui servait ancienne-
ment pour jouer la basse de l'harmonie.
Accordoir
,
outil de facteur servant accorder les
pianos.
Accords. (Modification des). L'harmonie est la fois
une science et un langage. Comme science, elle doit for-
mer un corps de doctrine, un ensemble, un tout : elle
fait par la tonalit, son principe unique et gnrateur.
Comme langage, elle doit tre varie, afin d'exprimer les
sentiments varis du compositeur : elle l'est par les mo-
difications qu'on peut faire subir aux accords, par le
changement de ton.
Ainsi l'harmonie est la fois une et varie : elle est
une par son essence et varie par ses formes.
Les modifications
harmoniques sont nombreuses
;
les
20
ACO
voici : changement de mode, doublement des notes, re-
tranchement de quelques noies, disposition varie des
notes,
renversement, notes de passages et appogiatures,
substitution,
altrations diverses, prolongation et retard,
pdale,
progression ou marche de basse. Nous parlerons
enfin de la modulation. (Voyez Harmonie et chacun de
ces mots.)
Les
modifications harmoniques ne changent absolu-
ment rien la nature de l'accord parfait et de l'accord
de dominante
;
mais elles en changent la physionomie et
l'expression.
Accouplement. Se dit de la runion de plusieurs jeux
de l'orgue, runis aux pressions d'un mme clavier.
Acetabulum. Instrument ancien appel en italien
crepitacolo . Les acetabulums taient des instruments
de bronze ou d'argent qui faisaient un grand bruit, et
on les frappait comme les sistres.
Achens. Les Achens chantaient en l'honneur d'A-
pollon des hymnes et des pomes dont plusieurs portaient
le nom de pean, pour obtenir la laveur de cette divinit.
A
chula, a fofa. Danses portugaises qui ressemblent
au fandango. A dfaut de castagnettes, on bat la mesure
avec les doigts.
A cinq parties. Se dit d'un morceau cinq voix ou
cinq instruments, qui, par d'heureuses combinaisons de
chants et d'accords, concourent former un ensemble
harmonieux. S'il n'y a qu'une seule voix chaque par-
tie, c'est un quintette (voyez ce mot); s'il
y
a plusieurs
voix chaque partie, c'est un chur (voyez ce mot).
Acoumtre, instrument servant mesurer l'tendue
des sons de l'oue chez l'homme.
Acoustique. Tel est le nom que l'on donne la science
des sons
,
l'tude de leurs mesures
,
des moyens de les
produire.
La vue et le toucher permettent de constater que le
son qui frappe l'oreille a pour cause le mouvement vi-
bratoire d'un corps solide, liquide ou gazeux. Le son pour
tre peru, a besoin d'un intermdiaire, ainsi dans le vide
le son n'arrive pas notre oreille
;
l'air sert le plus gn-
ralement de vhicule au son pour sa transmission. Cette
transmission n'est pas instantane, et on s'aperoit faci-
lement de ce fait en remarquant la distance qui existe,
quand on tire le canon, entre l'explosion lumineuse et la
perception du son. Des expriences ont fait reconnatre
ACO 21
que le son parcourt 333 mtres par seconde
,
la tem-
prature de 0 , et pour une temprature plus leve
,
l'lasticit de l'air tant augmente, la vitesse de son
augmente galement : ainsi on a reconnu qu' une tem-
prature de 6, la vitesse de son tait de 337 mtres par
seconde
,
et il est peu prs prouv que les sons se pro-
pagent galement vite, quels que soient leur intensit,
leur diapason et leur timbre. L'harmonie d'un concert
n'est pas trouble quelque distance qu'on se place pour
l'entendre
;
l'intensit gnrale seule diminue par l'loi-
gnement, mais la mesure et la simultanit des sons
diffrents qui concourent former les accords restent
inaltres.
L'air n'est pas le seul vhicule du son. Colardon et
Sttirm ont dtermin la vitesse du son dans l'eau calme
,
par une srie d'expriences faites sur le lac de Genve
,
et la vitesse de la propagation du son tait de
1
,435 mtres
par seconde.
La mesure des sons et les moyens de les produire ont
donn naissance un art, celui de la construction des
instruments et des appareils musicaux
(
Voir Facture
instrumentale).
Le mouvement des vibrations qu'prouve un corps se
propage dans l'air par une transmission de proche en
proche
,
que l'on peut comparer aux ondes successives
auxquelles donnent naissance un caillou jet dans une
pice d'eau tranquille.
Lorsqu'une lame
,
tenue fixement par une de ses ex-
trmits, est mise en mouvement son extrmit libre,
elle comprime les molcules de l'air qu'elle rencontre,
exerce une certaine pression qui va croissant avec la
vitesse de la lame; puis, dcroissant, et enfin devenant
nulle quand celle-ci rentre en repos. Un effet inverse
se produit par le mouvement d'avant en arrire de la
lame.
On appelle onde sonore l'ensemble des couches d'air
diverses pressions croissantes et dcroissantes pour une
vibration. Par suite de la grande lasticit des gaz
,
ces
couches d'air communiquent leur vitesse aux couches
suivantes, puis rentrent en repos. Les molcules d'air ne
parcourent donc que des distances peu tendues
,
tandis
que le son se propage comme les ondes liquides la sur-
face de l'eau
.
De la vitesse des vibrations, ou du nombre de ces vi-
22 AGO
brations, dans un temps donn, dpend le plus ou moins
de hauteur du son
,
qui sera d'autant plus lev que les
vibrations seront plus rapides, et d'autant plus bas que
ces vibrations seront plus lentes. Mais notre oreille n'est
pas susceptible de percevoir le son tous les degrs
;
il
y
a des limites cette perception. En gnral , les sons
cessent d'tre perceptibles quand le nombre des vibra-
tions dpasse environ 10,000
vibrations par seconde
,
ou
reste infrieur 30. Pour valuer ces vibrations
,
beau-
coup trop rapides pour tre comptes directement , on a
imagin divers instruments. (Voir Sirne), qui indiquent
d'une manire assez prcise le nombre de vibrationsdans
un temps donn.
Il existe un phnomne d'acoustique que l'valuation
numrique des vibrations a servi expliquer : c'est celui
des battements. Quand deux instruments de mme na-
ture, ou deux cordes, ou deux tuyaux rendent des sons
prolongs, on entend en sus une sorte de roulement dont
les battements lmentaires sont d'autant plus rappro-
chs que l'intervalle des deux sons est plus grand. Quand
les deux instruments, les deux cordes ou les deux tuyaux
sont l'unisson, tout battement cesse. Quand, au con-
traire, les sons sont trs-distants l'un de l'autre
,
le rou-
lement peut devenir assez prcipit pour engendrer un
troisime son. Ce phnomne est d la concidence des
vibrations de deux corps sonores
,
qui se reproduit p-
riodiquement et dtermine, chaque fois, un renforcement
dans le son.
Le son se produit de diffrentes manires : les frotte-
ments et les chocs excitent une quantit de sons en
dterminant dans les molcules des corps des agitations
et des mouvements plus ou moins rguliers.
Nous ne nous occuperons dans cet ouvrage, consacr
spcialement la musique, que des circonstances dans
lesquelles peuvent prendre naissance les sons musicaux.
Les moyens de production du son dans les instruments de
musique sont de trois sortes.
1
Les cordes sonores
(voir ces mots)
;
les expriences ont tabli que les
nombres de vibrations des cordes sont proportionnes
aux racines carres des poids qui les tendent, mais ils
sont en raison inverse des longueurs des cordes, de leur
paisseur et des racines carres de leurs densits;
2
La vibration des tiges. Quand une tige ou une lame
est pince par une de ses extrmits dans un tau, si on
AGT 23
fait un effort pour la courber et qu'on l'abandonne
elle-mme, on la voit, comme une corde pince, dcrire
des oscillations dont le nombre est li la longueur de
la partie vibrante d'une manire assez simple. Ce nombre
est en raison inverse de la racine carre de la longueur,
compte partir de l'extrmit libre jusqu'au point ou
la tige s'engage entre les dents de l'tau
;
3
Vibration
de l'air dans les tuyaux. L'air dans bien des cas, est lui-
mme le corps dont les vibrations excitent le son. On en
voit de nombreux exemples dans les instruments vent,
qui, en gnral, isolent une colonne d'air, dont les di-
mensions influent sur la hauteur du son. Le procd usit
pour mettre cette colonne d'air en vibration, varie
d'un instrument l'autre, mais toujours on peut le con-
sidrer comme fond sur remploi de Vanche (voir ce
mot) ou du bec de flte.
Le son prouve quelquefois certains obstacles sa
propagation, et alors il se rflchit. Les conditions de ce
mouvement rtrograde sans diffrer sensiblement de
celles qui dterminent la propagation directe, donnent
naissance ces phnomnes qui ont reu le nom d'cho.
(voir son
.)
Acoucryptophone. Instrument sans corde et sans
clavier, imagin en Angleterre, en
1822,
par Wheatstone,
ayant la forme d'une lyre antique suspendue au plafond
par un cordon de soie, il n'tait pourvu d'aucune corde,
mais pour le faire vibrer, on appliquait une clef une
petite ouverture pratique dans le corps de l'instrument
comme on monte le ressort d'une montre. Aussitt l'har-
monie se faisait entendre, et semblait provenir de la lyre.
Peu peu les sons semblaient s'unir ceux d'un piano
de forme conique, ainsi qu' ceux d'un tympanon placs
dans l'appartement.
Acresciuto (augment). Quelques auteurs, dans les
intervalles augments de demi-tons, adoptent ce terme,
qui est oppos diminu, au lieu d'employer les mots
excdant, altr, superflu. Ils repoussent sur tout les deux
dernires expressions comme des mots d'une significa-
tion quivoque.
Acte. En musique et en posie ce mot signifie une
division du drame, qui sert reposer l'attention du
spectateur.
L'intervalle entre deux actes s'appelle
entr'acte. (Voyez le mot Opra.).
Acte de cadence. Nom de la cadence qui consiste
24 AGT
en un mouvement dans une des parties et sur tout dans
la basse, qui force toutes les autres parties de concourir
former une cadence ou l'viter.
Acteur. C'est le nom gnral donn par le public aux
personnes qui paraissent sur le thtre, depuis les pre-
miers sujets de la tragdie, de la danse et du chant,
jusqu'aux plus modestes comparses. Chez les nations
grecques, doues d'une intelligence vive et d'une exquise
sensibilit, la profession d'acteur, exerce par des ci-
toyens clans les runions solennelles et aux ftes olym-
piques, dut ncessairement tre honorable et honore.
11 n'en fut pas de mme chez les Romains, peuple
de murs nergiques, mais grossires, plus fait pour la
guerre que pour les jeux de l'esprit. L, les premiers
acteurs, sortis de la classe des esclaves, ou tout au moius
des affranchis, ou venus des provinces conquises, se
trouvrent en concurrence avec les gladiateurs et des
entrepreneurs de combats d'animaux. L'infriorit de
position de ceux qui exercrent, les premiers, la profes-
sion d'artiste dramatique, et notamment celle de chan-
teur, influa puissamment sur le degr d'estime que le
snat crut devoir accorder h leurs successeurs. Tacite
nous apprend que, d'aprs des ordonnances spciales,
un snateur ne pouvait les visiter chez eux, ni un che-
valier romain les accompagner dans la rue. 11 fallut les
rclamations d'un tribun du peuple et le bon sens de
Tibre pour maintenir une ordonnance d'Auguste, qui
les proclamait exempts du fouet, et empcher le snat
de livrer leurs paules l'arbitraire d'un prteur. Un
des reproches que les historiens ont faits a Nron, c'est
d'avoir chant sur le thtre. Cependant les acteurs
n'taient pas tous mpriss des Romains
;
la jeunesse
romaine elle-mme imita, dans les ftes solennelles, et
surtout dans celle des moissons, les acteurs toscans qui,
les premiers, avaient import Rome les jeuxscniques
de l'trurie.
Plus tard, ce qu'il parat, ce fut encore la jeunesse
romaine qui joua les compositions dramatiques appeles
satires. Le savant Alexandre Adam ne laisse aucun
doute cet gard, dans les Antiquits romaines.
Les potes dramatiques taient presque tous acteurs
dans leurs ouvrages, comme Molire dans les siens;
c'tait l'usage alors. Or, parmi les Nvius, les Ennius,
les Plaute, les Ccilius, les Trence, les Afranius, les
AGT
25
Pacuvius, les Accius et les autres potes dramatiques
romains, il
y
eut des hommes trs-honorables et trs-
recherchs.
Lorsque le jeu dramatique devint un art, la jeunesse
romaine abandonna la reprsentation des pices rgu-
lires aux acteurs de profession, mais elle joua les com-
positions bouffonnes, ou farces entremles de beaucoup
de facties, par lesquelles on terminait ordinairement le
spectacle, et que l'on nommait Exodies ou pices atel-
lanes.
Les acteurs de ces farces conservaient tous leurs droits
de citoyens et pouvaient servir dans les armes.
Le grand Gicron tait l'admirateur et l'ami du cl-
bre tragdien Esope et du clbre comdien Roscius.
Celui-ci tait aussi l'ami de Pison et de Sylla : c'est pour
lui que Gicron fit son beau discours Pro Roscio.
Les mimes Labrius et Publius Syrus taient fort re-
nomms Rome, sous Jules Csar. Auguste causait
avec Pylade, et Bathylle tait le favori de Mcnes.
En France, placs entre la noblesse, qui les nourris-
sait sur le pied de domesticit, et la bourgeoisie qui, ne
les rencontrant dans aucune ville en corporation de
quelque importance, oublia de les admettre cette con-
fraternit d'estime que les arts et mtiers s'accordaient
mutuellement, la condition des artistes dramatiques de-
vint fort prcaire. Elle fut empire encore par les ana-
thmes que les ecclsiastiques franais fui minrent contre
elle. Il le faut avouer, cependant, ils en avaient le droit.
Le gouvernement civil peut refuser son concours, ses
honneurs, ses rcompenses, ses croix, ses pensions
ceux qui ne les ont point mrits : de mme, le gouver-
nement ecclsiastique peut refuser ses sacrements, ses
prires, ce qu'il appelle ses grces et ses honneurs spiri-
tuels quiconque ne lui en parat pas digne. Il a pu abu-
ser de son droit; mais enfin c'tait son droit.
Au reste, les anathmes dont nous parlons, n'ont
exist qu'en France et seulement dans quelques diocses,
et cela, grce aux Jansnistes. Partout ailleurs, en Es-
pagne et en Italie, il n'existe rien de
semblable; et mme,
lorsque les pices de thtre ne sont pas immorales, il est
parfaitement loisible aux ecclsiastiques d'assister leur
reprsentation.
Le diocse de Paris se montra svre entre
tous,
l'gard des thtres et des acteurs : on sait ce qui fut
26 AGU
fait Molire. Cela n'empcha pas la cour et la ville de
les frquenter et mme de les honorer. Molire tait reu
la cour puritaine et dmesurment aristocratique de
Louis XIV. Le comdien Baron forma la dclamation
dramatique une ou deux altesses royales de la famille
de Louis XV. Au reste, Louis XIV et sa famille toute
entire, la Pompadour, Marie-Antoinette, les ducs de
Provence et d'Artois se firent acteurs.
Aujourd'hui qu'on exerce l'art thrtral sans en tre
moins garde national, lecteur, jur etligible, la femme
du monde reoit dans son salon le comdien, le chanteur
ou
la cantatrice clbres. Le bourgeois ne refuse pas
un artiste dramatique sa table et mme sa fille, s'il gagne
de bons appointements et mne une vie range, et le pro-
ltaire professe presque du respect pour tout acteur.
Action. Expression des mouvements de l'me par les
mouvements et l'attitude du corps. On se sert particu-
lirement de ce terme pour la pantomime et l'art du
chanteur et du comdien.
Le pantomime ne parle
qu'aux yeux, tandis que le comdien
y
joint la dclama-
tion ou le chant. L'action du chanteur dtermine par la
musique, diffre de l'action du comdien qui dclame.
L'action embrasse
1
le maintien, la pose du corps, en
un mot, l'attitude;
2
les mouvements des diffrentes
parties du corps, telles que la tte, les mains, les pieds.
Les plus expressives de ces parties sont les yeux et les
muscles du visage, les mains et les doigts. Les mouve-
ments des pieds sont du domaine de la danse.
Acuit. C'est cette modification du son qui fait qu'on
le considre comme aigu ou lev par rapport d'autres
sons qu'on appelle graves ou bas. L'acuit du son d-
pend du nombre de vibrations que le corps sonore
excute dans un temps donn
;
plus ce nombre est grand,
plus le son est aigu ou lev.
On a cru longtemps qu'il
y
avait une limite au-del
de laquelle les sons taient trop graves ou trop aigus
pour tre entendus. On avait fix la limite de ces derniers
12,000 ou 15,000 oscillations par seconde. M. Savart
prouv que l'affaiblissement des sons extrmes tait la
principale cause, sinon la cause unique, qui avait emp-
ch de percevoir les sons placs en dehors de ces limites,
et qu'en augmentant leur intensit on percevait trs-
bien les sons aigus correspondants 48,000 oscillations
ou 24,0OC vibrations par seconde.
ADE
27
Acuto-aigu. Qualit du son qui rsulte des vibrations
rapides de l'air. (Voyez son.)
Acut^c-claves, Acut.e-voces. Expressions qui indi-
quent l'tendue des sons, du la, cinquime ligne de la
basse, au sol, deuxime ligne du violon.
Adagio, (posment). L'adagio est un mouvement un
peu moins lent que le larghetto. (Voyez le mot mouve-
ment.)
Le mot adagio se prend quelquefois substantivement
et s'applique par mataphore aux morceaux de musique
dont il dtermine le mouvement; ainsi l'on dira : un
adagio de Boccherini, Baillot excutait trs-bien l'a-
dagio, etc. C'est Corelli, clbre violoncelliste italien
du xvn
e
sicle, que l'art musical doit la cration de l'a
dagio.
Le mot adagio se prend quelquefois substantivement
et s'applique alors certains morceaux de musique;
ainsi on dit : Yadagio de Tartini, Yandante de San Mar-
tino et Yallegro de Locale! li.
L'excution de Yadagio exige la plus scrupuleuse
observation des signes et des accents musicaux et re-
pousse les ornements qui dnaturent la mlodie et d-
truisent l'ide du compositeur.
Adagio assai. C'est un mouvement plus lent que
l'adagio.
Additato. Terme italien qui correspond au mot fran-
ais doigt. Un morceau de musique est bien doigt,
quand le compositeur, en crivant, a facilit la position
des doigts sur l'instrument qui doit servir son excu-
tion.
Addition des rapports, des intervalles. Calcul qui est
souvent ncessaire dans le canon (voyez ce mot), pour
apprendre trouver le rapport qui est gal au produit
de l'addition des rapports.
Additional keys. Terme anglais qui se trouve quel-
quefois dans les sonates et concertos de piano gravs en
Angleterre, et qui signifie touches ajoutes, c'est--dire
les touches qui succdent l'aigu, la cinquime octave
du clavier.
A deux. On dit : une sonate deux pianos, deux
violoncelles, etc.
Cette expression signifie souvent
qu'on marche l'unisson comme dans les parties de
basson
;
quelquefois mme on rencontre ce terme dans
un chur ou ripine : c'est quand le compositeur
y
en-
28 MOL
Iremle de petits duos, en les marquant avec les mots
deux., indiquant par l que ces passages doivent tre
chants deux voix seules.
Adiaphonon. Instrument anches libres, construit
en 1819, Vienne, parSchuster, horloger Vienne.
Ad libitum
(
volont). Cette expression est ordinai-
rement employe dans les parties et dans les passages
oii le mouvement de la mesure est interrompu par un
point d'orgue. Alors le compositeur laisse l'excutant
la libert de lier la note du point d'orgue la note qui
la suit avec des broderies ou des modulations vo-
lont.
Adonidion. Espce de pome chant en l'honneur
d'Adonis.
Adonion. Chant excut par les Spartiates au mo-
ment d'attaquer l'ennemi. On avait l'habiiude d'ac-
compagner ce chant par des fltes appeles tibia ambvr-
latori.
A dorio ad phrygium. Proverbe ancien driv des
modes dorien et phrygien, qui signifiait sauter, dans
le discours, d'un objet un autre, sans aucune tran-
sition.
Adrianali (adriniens). Jeux fonds par l'empereur
Adrien.
Adufe. Espce de tambour de basque dont on se sert
en Espagne.
Aegual. Ce terme dsigne un registre d'orgues huit
pieds.
jEoline. Instrument anches libres et soufflet,
construit en 1816 par Schlembach, facteur Ohr-
douff.
.
iEoLiNE. Instrument invent et amlior dans ces
dernires annes par Eschembach, Bavarois, mais dont
on n'a pas encore une description bien exacte. Le son de
cet instrument est produit par l'air, qui agit sur des
baguettes en acier de diffrentes grandeurs.
Dans
quelques glises de l'Allemagne on s'en sert pour accom-
pagner le chant, et il a t introduit avec succs dans les
orgues en forme de registre.
jEolodicon. Instrument construit par Voit de
Schwemlurt, dans le mme systme que l'aeoline avec
cette diffrence que la soufflerie tait vent contenu.
iEoLO-MELODiKON. Instrument anches libres, invent
en 1818, Varsovie, par Bruner.
AFP
29
iEoLO-PENTALON. Instrument construit en
4824, par
Dagosi, de Varsovie, qui tenait du physharmonica et du
piano.
jEolos-clavier. Instrument invent par Schortmann
de Buttelstardt en 1820, dont Je son tait produit par
un courant d'air agissant sur des languettes de mtal.
^Erephone. Espce de physharmonica
imagine par
Dietz, en 4828, ayant une table d'harmonie
vote dans
laquelle il plaait les lames vibrantes.
jEroctavicorde. Instrument que l'on ft entendre
Paris en 1778,
dont les cordes de mtal rsonnaient par
le moyen d'un courant ou filets d'air auxquels on don-
nait une vive impulsion au moyen du soufflet.
Affections. La musique vit surtout d'affections et
de sentiments. Le compositeur a principalement pour
mission de traduire, en notes tour tour vives,
joyeuses, passionnes, plaintives et mlancoliques, les
affections diverses qui agitent le cur humain.
Bien
qu'il n'ait pas la prcision du langage
ordinaire, le lan-
gage musical offre pourtant des ressources infinies.
Ecoutez une des belles compositions de Gluck, de
Weber, de Rossini, quelle varit
d'impressions fait
natre en vous l'oeuvre de ces grands artistes ! Avec quel
art merveilleux ils savent exprimer tous les sentiments,
l'amour, la haine, l'ironie, la colre.
La vive expres-
sion des affections de l'me est le plus beau privilge
du gnie musical
;
elle est la source des grands succs
dramatiques. On ne saurait donc trop recommander aux
compositeurs l'tude de la nature et du cur humain.
La science du contrepoint a son utilit sans doute, mais
elle ne saurait produire que des rsultats
mdiocres sans
la connaissance des affections et des sentiments.
Affetto ou Affettuoso. Ce mot est le signe d'une
expression douce et tendre; il indique un mouvement
moins lent que l'adagio et plus pos que l'andante.
Ainsi que la plupart des mots usits dans la musique, ce
mot est tir de l'italien, et se prend aussi substantive-
ment.
Affinit des tons. C'est le rapport le plus rapproch
qu'a tel ou tel ton avec un ton principal, la quinte par
exemple, aura un rapport plus rapproch avec le ton
principal que la quarte; car la quinte se trouve avec le
ton principal dans le rapport de 2
3,
et la quarte dans
celui de 3 4.
30
AGR
Agada.
Instrument h vent des Egyptiens et des
Abyssins,
qui a la forme d'une flte, et dont on joue
avec
une anche semblable celle de la clarinette.
Agali keman. Instrument archet des Turcs, qui a
une espce de jambe, et dont on joue comme de notre
violoncelle.
Agilit des voix. Excution rapide de toute m-
lodie par le moyen des paroles ou de la simple vocalisa-
tion.
Agitato. Ce mot, crit au commencement d'un mor-
ceau de musique, indique un caractre d'expression qui
rend le sentiment vague du trouble et de l'agitation.
Gomme l'agitation ne saurait exister sans la vitesse, le
mot allegro le prcde ordinairement. S'il
y
a seulement
agitato, on sous-entend allegro. La symphonie en sol
mineur de Mozart, le duo de violon en
fa
mineur de
Viotti,
renferment chacun un bel agitato.
Agnus dei. On appelle ainsi une prire de la liturgie
catholique romaine qui commence par ces mots, et que
l'on chante ordinairement avant la communion. Suivant
une bulle du pape Sergius I
er
,
de 688, elle doit terminer
la messe.
Agoge. Mot grec qui indiquait chez les anciens la
forme mlodieuse dans la marche successive des sons,
soit en montant, soit en descendant.
Agoge rhythmique. Cette expression, chez les an-
ciens Grecs, avait la mme signification que notre mot
mesure.
Agons musicaux. Luttes musicales, bu concours
entre plusieurs instrumentistes ou chanteurs, pour un
prix propos, ainsi que cela se pratiquait dans les an-
ciens jeux des Grecs, et se pratique encore aujourd'hui
pour avoir une place vacante dans une chapelle ou dans
un orchestre.
Agrable. Un morceau de musique d'un caractre
agrable, est celui qui a un mouvement moderato : sa
mlodie marche par gradation, vite les sauts, n'admet
ni de nombreuses dissonances, ni de modulations
loignes.
Agrments. Les agrments sont des sons ou des
groupes de sons ajouts par l'excutant ceux qui sont
nots pour amener les intonations, lier les sons en rem-
plissant les intervalles qui les sparent et donner
ainsi
plus de varit, d'effet et d'expression aux compositions.
ALB 31
Les principaux agrments sont : le port de voix, la rou-
lade, ]e trille, le groupe, la mise des voix, l'appogiature,
le mordant
;
ils sont employs de la mme manire par
les chanteurs et les instrumentistes. Les clavecinistes
du sicle dernier employaient aussi des agrments qui
s'appelaient pinc, tremblement, arpgement, etc.
Aigre. Signifie rude, raboteux en parlant de la mau-
vaise qualit des sons, soit de la voix, soit des instru-
ments.
Aigu. Oppos au grave, mais il faut toujours une
comparaison entre ces deux tons pour donner une ide
juste du grave et de Yaigu, car un son grave par rap-
port l'aigu peut devenir lui-mme l'aigu par rapport
un son plus grave. Enfin, pour donner une dfinition
juste, il faut dire que dans deux sons composs, plus
les vibrations du corps sonore sont frquentes, plus le
son est aigu.
Air. Cette dnomination se donne en musique un
morceau dont le sens peut tre compris tant excut
par une seule voix ou un seul instrument, et lorsque ce
morceau a toute l'tendue dsirable pour constituer,
d'aprs les rgles de l'art, une pice de musique bien
complte.
Un bon air, pour mriter cette qualifica-
tion, doit tre un petit pome musical, et on en compte
un trs-petit nombre. Il doit avoir son exposition, son
nud et son dnouement, et surtout cette unit si pr-
cieuse dans les beaux-arts, lorsque l'on veut plaire ou
charmer.
Voyez les mots Ariette, Rondeau, Bar-
carolle, Nocturne, Romance, Vaudeville, pour
connatre leurs liens de parent avec l'air dont ils sont
issus, et savoir quel degr de filiation les placent leurs
titres.
Albani, Paul et Mathieu, luthiers de Palerme, imita-
teurs d'Amati qui vcurent en 1633 et en 1650.
Albani, (Mathieu), luthier, n Bolzano en 1621,
porta son industrie dans le Tyrol en 1660. Il tait de
l'cole de Stainer. Il travailla jusqu'en 1672.
Albani, (Mathieu), fils du prcdent, travailla long-
temps Crmone
;
c'est un des bons imitateurs d'Amati.
On a des instruments de ce luthier qui portent la date de
1708 et 1709.
Alboguet. Instrument de cuivre, compos de deux
parties qu'on frappe l'une sur l'autre la manire des
cymbales.
32 ALL
Aliquotes. En musique Ton entend par parties
aliquotes les sons secondaires qu'un corps sonore mis
en vibration fait entendre en mme temps que le son
principal. Quand on frappe ou pince un corps sonore,
si Ton
y
prte attention, on entend vibrer plusieurs
sons : mais celui qui frappe le plus l'oreille aprs le son
principal, c'est le douzime, et ensuite le dix-septime.
Ces deux sons rapprochs de la tonique, ou son prin-
cipal, donnent la quinte ou la tierce : en rsum, on
appelle parties aliquotes les sons concomitants qu'une
corde fait entendre simultanment avec le son prin-
cipal.
Alla, brve, Alla capella. Indication d'une mesure
quatre temps, que l'on ne bat que par deux, cause
de sa vitesse. Les notes se frappent galement en ma-
tire de
chant d'glise. Dans les compositions musicales
cette
manire de mesure s'annonce par un G barr.
Quoiqu'elle se trouve dans la musique profane, on ne
s'en sert gure que dans la musique d'glise, di capella,
d'o vient l'indication alla capella.
Alla palestrina. C'est ainsi qu'on nomme quelque-
fois le contrepoint fugu, parce que le fameux Palestrina
l'a port h son plus haut degr de perfection. Ce contre-
point consiste prendre un sujet, un trait de plain-chant,
tir de la pice de plain-chant que portent les paroles, et
le dvelopper en manire de fugue.
Alla zoppa
(
la boiteuse), c'est une suite de figures
dans lesquelles, entre deux notes d'une gale valeur, se
trouve
une note de la valeur des deux autres runies.
Allegretto. Diminutif d'allegro, indique un mou-
vement gracieux et lger, qui tient le milieu entre X! al-
legro, et
Vandantino.
Allegro. Quoique ce mot signifie gai, il ne faut pas
croire que le mouvement qu'il indique ne soit propre
qu' des sujets joyeux. C'est son degr de vitesse qu'il
faut considrer, puisque ce mouvement s'applique par-
fois des morceaux qui respirent l'emportement et le
dsespoir.
Uallegro est le mouvement le plus vif aprs le presto;
mais il reoit tant de modifications selon la mesure et
les passions des divers morceaux de musique
,
et mme
selon la nature des compositions, que l'on pourrait par-
courir les deux tiers du mtronome sans sortir du do-
maine de Vallegro.
ALL 33
Le mot allegro
,
crit en tte d'un concerto
,
d'un air
de bravoure, d'une polonaise, marque un mouvement
modr. Le mme mot commande une grande vitesse
,
s'il s'agit d'un menuet de symphonie
,
ou d'une ouver-
ture d'opra.
Allegro. Se dit de l'air mme dont le mouvement est
vif et anim.
Allluia. Mot hbreu qui signifie louez le Seigneur^
Saint Jrme est le premier qui ait introduit le mot
allluia dans le service de l'Eglise. Pendant longtemps,
on ne l'employait qu'une seule fois l'anne dans l'Eglise
latine
,
savoir le jour de Pques. Mais il tait plus
en usage dans l'Eglise grecque , o on le chantait dans
la pompe funbre des saints. Cette coutume s'est con-
serve dans cette Eglise, o l'on chante mme Yallluia
pendant le carme. Saint Grgoire le Grand ordonna
qu'on le chanterait aussi toute l'anne dans l'Eglise la-
tine
;
ce qui donna lieu quelques personnes de lui re-
procher une prdilection marque pour le rite des Grecs.
Dans 11 suite, l'Eglise romaine supprima le chant all-
luia dans l'office de la messe des morts
,
aussi bien que
depuis la Septuagsime, jusqu'au graduel del messe
du samedi saint , et elle
y
substitua ces paroles : Laus
tibi, Domine, rex tern glori , comme on le pratique
encore aujourd'hui. Haendel a compose sur ce thme un
morceau de musique devenu clbre.
Allemagne. A l'poque de la renaissance des lettres
et des arts, tandis qu'en Italie la musique prenait un
brillant essor, elle restait peu prs stationnaire dans
les autres contres de l'Europe.
L'Espagne, toute
proccupe de ses gigantesques projets d'ambition et de
sa conqute du Nouveau-Monde
,
n'attachait qu'une
faible importance la culture des arts.
Les Pays-Bas,
o Jean Tinctor avait port les premiers lments de
l'harmonie
,
n'avaient encore produit aucun homme de
gnie qui st dvelopper et faire clore ces germes pr-
cieux.
L'Angleterre , uniquement absorbe par une
pense fixe, incessante, le dsir d'entendre et de consoli-
der sa puissance industrielle et maritime, ddaignait le
culte de l'art musical.
La France n'avait encore que
des essais informes, des uvres sans porte, et l'Alle-
magne ne possdait que les chants populaires de ses
minnesingers, dont le plus souvent l'harmonie tait d-
fectueuse et les paroles totalement dnues d'euphonie.
2..
34 ALL
Mais la fin du dix-septime sicle, l'Allemagne su-
bit tout coup une brillante mtamorphose. Le gnie de
la Germanie, qui s'tait longtemps consum en bauches
grossires, entre dans une voie de rgnration et verse
sur l'Europe des flots de posie. On voit cette poque
se produire dans le domaine de l'art musical des chefs-
d'uvres et des grands matres, qui rivalisrent avec les
plus clbres artistes de l'Italie, tout en conservant un
caractre individuel, et en imprimant leurs composi-
tions ce cachet de grandeur, qu'lvation, de mlancolie, de
rverie mystique, qui fait le charme de la posie al-
lemande.
Charles-Henri Graun est, dans l'ordre chronologique,
un des premiers matres qui aient illustr l'cole alle-
mande. Graun a galement brill comme chanteur et
comme compositeur. Lorsque Frdric II monta sur le
trne il le nomma son matre de chapelle. Ce prince,
excellent virtuose sur la flte, se connaissait en musi-
ciens. Le talent principal de Graun, comme chanteur,
tait \adagio et il faisait ce qu'on appelle les traits avec
autant de facilit que de got. Gomme compositeur, la
pure et belle expression de ses ouvrages, le charme del
mlodie et son harmonie savante l'ont justement plac
au rang des classiques. Des cantates, des motets o res-
pire un profond sentiment religieux, des compositions
dramatiques pleine de chaleur et de verve, des composi-
tions plus lgres o son talent a dploy beaucoup de
grce et de souplesse, tels sont les titres de Charles
Graun aux suffrages du monde musical. A ct du com-
positeur dont nous venons de parler, Philippe-Emma-
nuel Bach figure avec clat dans les fastes de l'harmonie
allemande. Sbastien Bach eut son pre pour matre et
ses frres pour rivaux. Il naquit Weimar en 4714,
acheva ses tudes Leipsick, fonda Francfort sur l'O-
der une acadmie dont, jeune encore, il eut la direction,
et plus tard fut nomm musicien de la chambre la cour
de Berlin, o il accompagna dans un solo de flte le
grand Frdric son avnement au trne. Une grande
richesse d'rudition, une tonnante profondeur et une
piquante originalit d'aperus, telles sont les principales
qualiis des ouvrages didactiques de Bach. Par la luci-
dit de l'exposition, par l'excellence de la mthode, son
Essai sur le clavecin rivalise avec les crits thoriques
les plus remarquables et les plus complets que possde
ALL 35
l'Allemagne musicale. Ses compositions dramatiques et
religieuses portent toutes le cachet d'une individualit
puissante, et plus d'un artiste a puis dans l'tude de ses
ouvrages de srieuses et fcondes inspirations. Un nom
qui brille d'un, vif clat dans les fastes de l'art germani-
que, c'est celui de Haydn, surnomm le cygne de l'Alle-
magne. A dix ans, Haydn s'essayait dj avec succs
dans la composition de morceaux seize parties. A
quinze ans, il fit son premier quatuor, qui, malgr les
clameurs de l'envie, obtint un grand et lgitime succs.
A dix-huit, il composa pour un chanoine de Cadix son
clbre oratorio des Sept paroles de Jsus-Christ
,
des-
tin tre excut dans la cathdrale de cette ville pen-
dant la semaine sainte. Plus tard, l'illustre matre se re-
tira dans une petite maison d'un des faubourgs de
Vienne. C'est l qu'il composa les oratorios de la Cration
et des Saisons. Ces uvres si puisantes, si grandioses,
d'une conception si belle, d'un style si lev, sont la pro-
duction d'un ge avanc, et cependant on trouve dans
toutes les parties de ces vastes compositions tant de sve,
tant de verdeur d'imagination, qu'on les croirait closes
dans toute la vigueur de la jeunesse.
Tout prs de
Haydn vient se placer naturellement le profond et bril-
lant Mozart. Wolfgang Mozart, n Saltzbourg, en
1756, n'avait que trois ans, lorsque, coutant son pre
qui donnait des leons de clavecin sa sur, il manifesta
ds cet ge de merveilleuses dispositions pourla musique.
A quatre ans, il jouait des menuets
;
cinq, il composait
de petits morceaux de musique, que son pre crivait. A
la fin de sa septime anne, il vint Paris o il composa
et publia ses deux premires uvres. En Angleterre, o
il passa bientt aprs, il joua la premire vue, avec
toute la justesse et la prcision dsirables, les morceaux
les plus difficiles de Bach et Haendel. Il composa
cette poque six sonates qu'il fit graver Londres.
Aprs cette excursion dans la capitale de l'empire bri-
tannique, il vint se rchauffer ou soleil de l'Italie. A Flo-
rence, Rome, il excita le plus vif enthousiasme. A
Milan, il composa l'Opra de Mithridate, qui eut vingt
reprsentations de suite. Trois ans aprs, celui de Lucio
Sylla en eut vingt-trois
;
et successivement l'Europe vit
paraitre cette srie de crations magnifiques du mu-
sicien le plus tonnant peut-tre qu'ait produit l'Alle-
magne.
36 ALL
A ces grands compositeurs, ajoutons Reynard Keyser,
surnomm le pre de la mlodie allemande
;
Amde
Naumann, qui, d'une obscure cole de village, s'lan-
ant dans une sphre clatante, enrichit successivement
l'Italie, le Danemarck, la Sude, de belles productions
dramatiques et religieuses; Joachim Quantz, qui fut
la fois un compositeur distingu et un admirable violo-
niste; Frdric Haendel, dont le gnie profond et vigou-
reux a exerc sur l'Europe entire une magique influence
et commenc l'importante rvolution que devait plus
tard achever le puissant Gluck. A vingt ans, Haendel
donna Hambourg son premier opra allemand, inti-
tul Almira. Bientt il vint en Italie, et fit jouer Flo-
rence son premier opra italien, intitul Rodrigo. A Ve-
nise il fit reprsenter celui d'Agripine
;
Rome,
il triomfo del Tempo, et Naples, Alcide e Galatea.
Plus tard il passa en Angleterre, o l'appelait galement
la gloire et la fortune. L'opra de Rincddo, qui fut son
dbut sur la scne britannique, devint la pice favorite
des Anglais et jeta les bases de la collossale rputation
qu'il acquit chez cette nation opulente. Il se fixa ds ce
moment en Angleterre. Non content de l'inhumer dans
la spulture de leurs rois, les Anglais lui ont vot une
fte funbre qui se clbre tous les ans l'poque de sa
mort.
La rvolution musicale commence par Haen-
del fut acheve par Gluck, Christophe Gluck naquit dans
le Haut-Palatinat, en 1714. C'est Prague qu'il puisa
les premires notions de l'art musical, et s'y fit d'abord
remarquer comme excellent violoniste. L'Italie jouit de
ses premiers travaux. C'est l qu'il apprit la composition
et qu'il ft jouer son premier opra. A Venise il donna
celui deJDemetrius, qu'accueillirent de chaudes sympa-
thies. Il passa ensuite en Angleterre, et fit reprsenter
sur la scne britannique la Chute des Gants
t
sujet
grandiose et digne d'un gnie aussi lev. A partir de
cette poque, il se fit un systme o tout est li, com-
bin, senti. Sur cette forte base, il se mit construire,
pierre pierre, son grand et majestueux difice drama-
tique. Fort de ces nouveaux principes, il dbuta au th-
tre de Vienne par les opras d'Hlne et Paris, d'Al-
ceste et d'Orphe. A Paris, le succs d'Iphignie en Au-
lide mit le sceau sa rputation.
Nous complterons cette brillante galerie de l'cole
musicale allemande par les noms de Weber, ce grand
ALP 37
musicien, ce grand pote, qui a dploy dans son
Freischutz tant d'originalit, tant d'inspiration
;
de Bee-
thowen, dont l'imagination active et fconde produisit
en peu d'annes une foule de chefs-d'uvre, et notam-
ment Fidelio, le Christ au jardin des Oliviers, ses
concertos de violon, ses trios, ses quatuors, son grand
septuor et surtout ses symphonies; de Schubert, de
Mcyerbeer,deLachner, de Mendelssohn, de Spohr, quia
fait'Jessonda, Faust; de Schneider, l'auteur du Dluge
;
de Schumann
;
de Richard Wagner, l'auteur du Tann-
hauser, etc.
En Allemagne, l'excution vocale est loin d'tre arri-
ve d'aussi beaux rsulats que la composition. Comme
l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal, elle a t long-
temps sous ce rapport tributaire de l'Italie. Cependant
depuis quelques annes, un grand mouvement artiste
s'est opr en Allemagne et s'est manifest par la cration
de nombreuses et remarquables socits chorales. On dis-
tingue entre toutes, celles de Cologne et de Mayence.
Un des titres les plus clatants de l'cole allemande
l'estime du monde musical, c'est la supriorit de ses
instrumentistes. L'esthtique et la littrature musicales
constituent aussi un des plus riches trsors de l'cole
allemande. La Bohme, la Saxe, l'Autriche possdent
une foule d'tablissements, d'coles lmentaires dans
les villes et jusque dans les campagnes. Quant aux trai-
ts, aux ouvrages didactiques, les uvres de Fuchs, de
Mathisson, de Marpurg et de Kock, pleines de penses
neuves et profondes, d'aperus intressants, galent et
surpassent mmes les productions des crivains didacti-
ques les plus distingus de la France et de l'Italie.
Allemande. Danse originaire de l'Allemagne. Cette
figure chorgraphique
,
compose de passes tout fait
pittoresques, et dans laquelle un cavalier semble coque-
ter entre deux dames, s'excute sur un air trs-gai dont
la mesure se bat deux temps. On l'a danse autrefois en
France. Elle est maintenant exile de nos salons.
Alphabet musical. L'alphabet musical n'est compos
que de sept mots. Les voici : A, la, r, mi (la), B, mi
(si), C, sol,
fa,
ut (do). D, la, sol (r), E, la, mi (mi),
F, la, ut
(fa),
G, sol, r, ut (sol). Ces termes servent
dsigner les diffrents sons de la musique, qui, dans
l'ordre naturel, ne sont qu'au nombre de sept, ainsi que
les degrs contenus dans l'octave.
2...
38
ALT
Dans l'article solmisation, nous ferons connatre l'ori-
gine de cet alphabet et ses diffrentes compositions.
Aujourd'hui on a abandonn ces anciennes dnomina-
tions, et le solfge moderne a adopt les syllables ut, r,
mi,
fa,
sol, la, si.
Altration. En musique lmentaire, ce mot dsigne
le changement que l'on fait subir aux notes naturelles
ou diatoniques par le moyen de certains signes nomms
dises, bernois ou bcarres.
Le dise lve d'un demi-ton la note devant laquelle
il est plac, le bmol l'abaisse d'un demi-ton, et le b-
carre la remet dans son tat naturel, en dtruisant l'effet
du dise ou du bmol.
Le demi-ton d'lvation que le dise produit et le
demi-ton
d'abaissement produit par le bmol ne conci-
dent pas tout fait au mme point. Ainsi ut dise et r
bmol ne donnent pas tout fait le mme son
;
ut dise
est un peu plus lev que r bmol, et rciproquement
r bmol est un peu plus bas que ut dise
;
de sorte
qu'en montant d'ut r, on a ut, r bmol, ut dise,
r. C'est pour cela que ut dise tend monter vers r,
et r bmol, au contraire, descendre vers ut.
En pratique, r bmol et ut dise sont considrs
comme donnant le mme son. Dans les instruments
sons fixes, comme le piano, l'orgue, etc., on lve un peu
le bmol et on abaisse un peu le dise pour les faire
concider parfaitement au mme point. C'est ce qu'on
appelle temprament. (Voyez ce mot).
Altration.
Dans la science harmonique, on ap-
pelle accord altr celui dont une ou plusieurs notes sont
accompagnes d'un signe altrateur qui les lve ou les
abaisse d'un demi-ton, sans que cet accord perde pour
cela son individualit. Ainsi, l'accord de dominante sol,
si, r bmol,
fa,
ou sol, si, r dise,
fa
au lieu de sol, si,
r,
fa,
est un accord altr.
Outre la multiciplit d'accents expressifs que les alt-
rations introduisent clans l'harmonie, elles mettent en
rapport, les uns avec les autres, les tons les plus divers,
et procurent le moyen d'oprer les modulations les plus
inattendues. Ainsi, par exemple, le r bmol ou le r
dise de l'accord altr cit plus haut ne change rien la
nature de cet accord, il
y
introduit cependant l'attrac-
tion puissante de r bmol vers ut ou de r dise vers
mi. Or, cette attraction puissante donne la facult de
ALT
39
moduler dans plusieurs tons fort diffrents et fort loi-
gns d'ut naturel. Nous en parlerons en dtail l'article
Modulation. (Voyez aussi le mot Prolongation des
notes altres,)
Alto. Voix de femme au-dessous du soprano et au-
dessus du contre-alto. (Voyez l'article Voix.)
Alto ou alto-viola. On appelle ainsi un instrument
quatre cordes, connu sous le nom de violle, d'une
dimension un peu plus grande que celle du violon, et
qui tient, dans un orchestre, le milieu entre cet instru-
ment et le violoncelle ou la basse. Comme le violon, il
est compos de deux tables colles sur des clisses qui
forment le tour de l'instrument, et d'un manche dont le
sommier est travers par des chevilles qui servent
tendre les cordes retenues l'autre bout par une seconde
pice de bois noirci que l'on appelle la queue. Le manche
est galement couvert par une seconde pice de bois dur
et noirci qu'on nomme la touche, et sur laquelle posent
les cordes lgrement inclines par le chevalet plac
entre lui et la queue.
L'alto n'a que quatre cordes
comme le violon, et se joue de mme, avec un archet qui
lui fait rendre un son plus grave, mais doux et mlanco-
lique.
L'alto nous vient des Italiens, qui excellaient
dans la fabrication de cet instrument. Le nom du cl-
bre Amati donne, de nos jours, un prix trs-lev ses
productions, devenues trs-rares.
Le timbre de Yalto
possde des qualits expressives si saillantes, que dans
les occasions o les anciens compositeurs l'ont mis en
vidence, il n'a jamais manqu de rpondre leur attente.
On sait l'impression profonde qu'il produit toujours dans
ce morceau d'Iphgnie en Tauride, o Oreste. accabl
de fatigue, haletant, respirant peine, s'assoupit en
rptant : Le calme rentre dans mon cur /pendant que
l'orchestre, sourdement agit, fait entendre des sanglots,
des plaintes convulsives, domins incessamment par
l'affreux et obstin grondement des altos.
Quelquefois on donne aux altos la partie grave de
l'harmonie. Gluck l'a fait pour rendre plus terrible l'atta-
que des basses, au forte, et Sacchini, dans l'air
d'OEdipe : Votre cour devient mon asile, pour donner
l'instrumentation une fracheur et un calme dlicieux.
Autrefois, on appelait alto-basso, un instrument de
percussion cordes que le musicien frappait avec un
petit bton, tandis que de l'autre il jouait sur la flte un
40 AME
air qui s'unissait aux sons de l'alto-basso accord l'oc-
tave, la quinte ou la quarte. De nos jours, il n'est
plus d'usage parmi les musiciens, qui en conservent
peine le souvenir.
Amateur. On nomme ainsi celui qui, sans tre musi-
cien de profession, fait sa partie dans un concert pour
son plaisir et par amour pour la musique.
On appelle
encore amateurs ceux qui, sans savoir la musique, ou
du moins sans l'exercer s'y connaissent et frquentent
les concerts et les thtres lyriques.
Ce mot est tra-
duit de l'italien dilettante. (Voyez Mlomanie.)
Amati. Famille d'illustres luthiers de Crmone com-
pose d'Amati (Andr) qui travailla de 1560 1600,
d'Amati (Jrme) et Amati (Antoine) ses fils de 1596
1620 et d'Amati (Nicolas) fils de Jrme de 1662 1692.
Ambrotsien. (chant et rit). Lorsque saint Ambroise
monta sur le sige piscopal de Milan, en
374, il
y
avait
incontestablement dans cette Eglise un ordre provenant
d'un de ses prdcesseurs pour clbrer les saints mys-
tres. Mais les crmonies en taient simples, sans fixit,
conformes, en un mot, l'tat d'humilit des chrtiens,
et l'esprit qui les animait. Quelques-unes des parties
del liturgie n'taient peut-tre pas encore crites, et
certainement elles n'taient pas toutes recueillies. Saint
Ambroise leur donna la forme et la splendeur qui leur
convenaient. Il organisa la liturgie dans le diocse de
Milan, et en fit un tout complet. Il composa des messes
pour chaque circonstance, un grand nombre de prlaces
o l'on voit en peu de mots les sujets des mystres et les
actions des saints, beaucoup d'hymnes et d'autres prires.
Quant la psalmodie, il est constant qu'il tablit, en
386,
le chant alternatif des psaumes l'imitation des
Eglises orientales, et que, de Milan, il passa dans tout
l'Occident, dont quelques contres le possdaient encore
dans le xn
e
sicle, comme saint Ambroise l'avait not.
C'est ce saint prlat qui nous apprend lui-mme cette
institution dans sa lettre sa sur Marceline.
Ame. Petit cylindre de bois qu'on place debout entre
la table et le fond d'un instrument cordes pour main-
tenir toujours les parties dans le mme degr d'lvdtion
et communiquer leurs vibrations. La manire dont est
plac le cylindre contribue beaucoup la beaut des sons
de l'instrument.
Amen. Ce terme hbraque, qui signifie ainsi soit-il,
ANC 41
a t adopt par les chrtiens dans plusieurs crmonies
religieuses. Quand le prtre a termin une prire, le
peuple, en signe d'approbation, rpond Amen. Ce mot
est employ aussi pour dsigner le dernier verset de
plusieurs textes ecclsiastiques, tels que les psaumes, les
hymnKS, les motets, qui se terminent par le mot amen.
A-mi-la. Mot que l'on employait autrefois pour dsi-
gner le ton de la.
Amoroso, (tendrement). Ce mot indique l'expression
tendre et touchante d'un morceau de musique. Il accom-
pagne souvent les mots andante et andantino,
et
demande une excution semblable celle de Yaffettuoso,
Amphigordum. Nom donn la lyre barbarina cons-
truite en 1673 par Donis, praticien Florentin, elle avait
la forme d'une basse de violon, mais avec douze ou
quinze cordes.
Anabasis. Ce terme indiquait chez les anciens Grecs
une mlodie ascendante.
Anacamptos. Expression grecque qui signifiait le
contraire de la prcdente, c'est--dire une progression
de l'aigu ou grave.
Anacata. Sorte de tambour en usage dans la cavalerie
orientale.
Anche. Deuxlanguettesde roseau fort minces dans leur
extrmit, places horizontalement l'une sur l'autre et
assujetties sur un petit tuyau de mtal, forment l'anche
du hautbois. Celles du cor anglais et du basson, faites de
la mme manire, ont des proportions plus grandes.
L'anche de la clarinette n'a qu'une seule languette de
roseau, qui produit les vibrations en frmissant contre
le bec de cet instrument o elle est fixe.
Anche libre. Est une languette fixe par une de ses
extrmits au devant d'une ouverture pratique dans une
paroi solide. Cette languette est construite de manire
se cambrer dans l'tat de repos et dgager l'ouverture.
Mais si on tablit d'une manire quelconque un courant
d'air qui tend s'chapper par l'ouverture, dans le sens
ncessaire la vibration, on voit la languette ou anche
entrane s'appliquer d'abord sur la paroi et suspendre
momentanment l'coulement, puis son lasticit la
ramne sa position premire, aprs quoi elle est de
nouveau entrane et ainsi de suite, tant que l'air fait
effort pour s'couler par l'ouverture, dans beaucoup
d'instruments vent le son se produit par l'intervention
42 ANC
d'une anche : la clarinette, le hautbois, certains orgues.
Le cor de chasse et la flte semblent dpourvus d'anches,
mais les lvres en tiennent lieu. La voix humaine elle
mme se produit dans le larynx par Je passage plus ou
moins rapide de l'air expir entre les replis nombreux
appels cordes vocales qui jouent peu prs le rle
d'anche.
Angher. Garnir un instrument de son anche, ancher
un basson, ancher un jeu d'orgue.
Anches (jeu d'). Registre d'orgue compos d'une srie
de tuyaux anches et donnant un son clatant et incisif.
Anches libres. Lames mtalliques fixes sur autant
d'ouvertures perces sur une plaque et qui vibrent ais-
ment par le moyen de la soufflerie, seulement aujour-
d'hui on se sert, pour attaquer la lame, de la percussion,
et la vibration est contenue par la soufflerie.
Anciens. (Musique des). Lorsque les savants moder-
nes lisent dans les ouvrages de l'antiquit les loges
pompeux qu'on
y
fait de la musique, et les merveilles
qu'on lui attribue, ils ne peuvent les concevoir; et
comme ils ne voient rien dans l'tude et dans la prati-
que d'un art assez fri\ole qui justifie ces loges ou qui
confirme ces miracles, ils traitent les auteurs de vision-
naires et les accusent d'impostures, sans rflchir que
ces crivains qu'ils osent ainsi calomnier sont les hommes
les plus judicieux, les plus sages, les plus instruits et
les plus vertueux de leur sicle. Les musiciens eux-
mmes, fort embarrasss d'expliquer au moyen del mu-
sique moderne les effets surprenants attribus l'an-
cienne, prennent le parti de rejeter ces effets tantt sur
la nouveaut de l'art, tantt sur le pouvoir de la posie
qui
y
tait unie, tantt sur la prtendue grossiret des
peuples. Burette, le moins excusable de tous, puisque
ses connaissances devaient le rendre plus juste, prtend
que les merveilles qu'on raconte de la musique des
anciens ne prouvent en aucune manire sa supriorit
sur la ntre, et qu'Orphe, Demodocus, Terpandre,
n'opraient rien de plus que ne pussent oprer les plus
mauvais rcleurs de village, s'ils trouvaient de sembla-
bles auditeurs. Cet crivain, qui croit pouvoir assimiler
ainsi les peuples de l'antiquit aux hordes sauvages de
l'Amrique, oublie sans cloute que ces peuples taient,
de tous ceux qui ont paru sur la terre, les plus sensibles
aux beauts des arts; il ne pense pas que c'est peu de
ANC
43
temps aprs l'apparition d'Orphe que viennent
Hsiode
et Homre, les plus savants des potes. Lycurgue
et
Zaleucus, les plus rigides des lgislateurs. 11 ne veut pas
voir que Tyrthe et Terpandre taient presque contem-
parains de Sapho et d'Esope, de Solon et de Pindare.
Nous ne savons pas comment il aurait arrang des
choses aussi contradictoires s'il avait voulu
y
rflchir
un moment, ni de quelle manire il nous aurait prouv
que ceux qui avaient des posies comme celles d'Homre
et de Sapho, des lois comme celles de Lycurgue et de
Solon, des statues comme celles de Phidias, se seraient
extasis en coutant l'harmonie d'un de nos mntriers
;
car nous, dont la musique est si parfaite son avis, qui
possdons des opras si magnifiques, nous sommes
encore bien loin d'avoir rien de comparable YIliade et
. Y Odyssei
rien qui approche de l'Apollon du Belvdre
et de Vnus pudique, quoique nos potes et nos statuai-
res copient et recopient sans cesse ces admirables mo-
dles. Il fallait que le brillant auteur d'Anacharsis et
sur les yeux un bandeau bien pais, pour avoir adopt
sans examen l'opinion de Burette
;
il semble qu'il aurait
d lui prfrer celle de Platon, celle d'Aristote, celle
de Plutarque.
Ces opinions valaient pourtant la peine d'tre discu-
tes. L'historien Polybe, dont on connat l'exatitude,
raconte que de tous les peuples d'Arcadie, les Cynthes
taient les plus froces, et il attribue hardiment leur
frocit l'loignement qu'ils avaient pour l'art musical.
Il s'lve avec force contre un certain Ephore qui avait
os dire que la musique ne s'tait introduite parmi les
hommes que pour les sduire et les garer par une sorte
d'enchantement, et lui oppose l'exemple des autres Ar-
cadiens qui, ayant reu de leur lgislateur des rgle-
ments propres leur inspirer le got de la musique,
s'taient distingus par leurs murs douces et leur res-
pect pour la Divinit. Il fait le tableau le plus flatteur
des ftes o la jeunesse arcadienne s'accoutumait, ds
l'enfance, chanter des hymnes religieux en l'honneur
des dieux et des hros du pays.
Ainsi, Polybe attachait la musique le pouvoir d'a-
doucir les murs. Longtemps auparavant, Platon avait
reconnu dans cet art une influence irrsistible sur la
forme du gouvernement; il n'avait pas craint de dire
qu'on ne pouvait faire aucun changement dans la musi-
44 ANC
que sans en effectuer un correspondant dans ia consti-
tution de l'Etat. Cette ide, suivant ce philosophe, ap-
partenait Damon
,
qui avait donn des leons d'harmonie
Socrate. Mais aprs l'avoir reue de Socrate, il l'avait
fort dveloppe par ses tudes et ses mditations. Jamais
il ne perd dans ses ouvrages l'occasion de parler de la
musique et de dmontrer ses effets : il assure ds Je
commencement de son livre des Lois, que dans la musi-
que sont renfermes toutes les parties de l'ducation.
L'homme de bien, avait-il dit ailleurs, est le seul excel-
lent musicien, parce qu'il rend une harmonie parfaite,
non pas avec sa lyre ou tout autre instrument, mais avec
le total de sa vie. Ce philosophe se garde bien, comme
le vulgaire commenait le faire de son temps, de placer
la perfection de la musique dans la facult qu'elle a d'af-
fecter agrablement l'oreille. Il assure, au contraire, que
rien n'est plus loign de la droite raison et de la vrit.
La beaut de la musique consiste, selon lui, dans la
beaut de la vertu qu'elle inspire; il pense qu'on peut
connatre les inclinations des hommes par l'espce de
musique qu'ils aiment ou qu'ils louent, et veut qu'on
forme de bonne heure leur got sur cette science en la
faisant rentrer dans l'ducation des jeunes gens, d'aprs
un systme fixe et bien arrt.
Le systme musical que Platon avait en vue dans ce
passage tait originaire d'Egypte. Port d'abord en Grce
par Orphe, quant la partie potique, il fut ensuite d-
velopp par Pythagore, qui en expliqua la partie tho-
rique assez exactement, cachant seulement le principe
fondamental de la science, dont il rserve la connaissance
aux seuls initis, ainsi qu'il en avait pris l'engagement
dans les sanctuaires; car les prtres gyptiens ne com-
muniquaient les principes des sciences, en gnrai, qu'a-
prs les plus terribles preuves, et les serments les
plus solennels de les taire ou de ne les livrer qu' des
hommes dignes de les possder. Voil la cause de ce long
silence que Pythagore exigeait de ses disciples, et l'ori-
gine de ces voiles mystrieux dont il les obligeait 5 son
tour de couvrir ses enseignements.
Le systme musical que nous possdons aujourd'hui
nous tant venu des anciens, est, quant son principe
constitutif, le mme que le leur; il n'a vari que dans les
formes potiques. C'est ce mme systme que Time de
Locres regardait comme institu par les dieux pour le
AND 45
perfectionnement de l'me, et dans lequel il voyait celte
musique cleste qui, dirige par la philosophie^ peut fa-
cilement forcer la partie sensible de l'me d'obir l'in-
tellectuelle, adoucir sa partie irascible, et les empcher
de se mouvoir contre la raison, ou de rester oisives quand -
la raison les appelle.
*
%
*
Les potes anciens avaient trac des modles de m-
lodie et d'harmonie, et les avaient fait graver sur des ta-
bles exposes aux yeux du peuple dans les temples : il
n'tait permis personne de rien changer ces modles;
en sorte que les mmes lois rglent tout ce qui concerne
la musique, la peinture et la sculpture. On voyait des
ouvrages de ces deux derniers arts qui dataient de mille
ans, on entendait des chants qui remontaient la mme
poque.
L'antiquit de ce systme musical en laisse infrer
l'universalit; aussi le trouve-t-on, avec des modifica-
tions diverses, dans tous les lieux de la terre qu'ont ha-
bits les anciens.
Nous nous sommes borns, clans cet article, des ides
gnrales sur la musique des anciens; nous dveloppe-
rons ce sujet d'une manire plus tendue aux articles
Egypte, Grce, Rome, etc.
Andamento. Ce mot italien dsigne, relativemnt la
composition de la fugue, une priode, une composition,
une espce de sujet un peu long, qui parcourt toutes les
phases du ton,
y
mle parfois d'autres sujets, et contient
deux ou plusieurs membres.
L'expression andamento se prend aussi pour mou-
vement, et l'on dit un andamento, juste, vif, rapide
;
quelquefois pour caractre, en disant : Cette composition
a une marche andamento (rgulire et calme).
Andante. Plac en tte d'une uvre musicale, ce mot
andante commanderait l'excution la grce, le laisser-
aller (andare), si la conduite d'un orchestre et le gnie
d'une uvre pouvaient dpendre d'un mot, d'un titre.
Ici, comme dans tous les cas d'indications italiennes, il
faut bien se rappeler que le sens des mots subit la loi des
temps, des lieux et des murs.
Axdantino, diminutif d'andante, imprime la mesure
une certaine rgularit qui tient de la raideur plutt que
de la gravit. On aurait tort toutefois de prendre cette
dfinition la lettre, car andantino se trouve dans les
mmes opras en tte de vingt morceaux d'un genre tout
46
ANG
diffrent. C'est du reste le destin de toutes les indica-
tions
italiennes. L'andantino doit tre excut de la
mme
manire que Tandante, mais avec un mouvement
un peu plus vif.
^
M
Anmocorde. Instrument clavier construit Paris
'&i
en 1784,
par un nomm Schnell. Les cordes taient mises
en vibration par un courant d'air.
Anglica-vox. Voix anglique. Registres d'orgues
forme cylindrique et anches.
Anglique. Instrument ancien de la famille des luths,
invent dans le xvn
e
sicle par Rotz, facteur d'orgues
Mulhouse.
Angleterre. Dans le moyen-ge, la musique eut en
Angleterre la mme existence qu'en France et en Italie;
elle fut divise en musique religieuse et en musique s-
culire. La premire tait consacre au plain-chant ou
canto ferma; la seconde, aux ftes de la ville et de la
cour. Ds le rgne de Henri VIII, les mntriers et les
troubadours, ces rustiques Orphes des temps barbares,
disparurent; et ce prince offrit aux Anglais le mme
phnomne qui avait frapp les Romains sous l'empire
de Nron, le spectacle d'un tyran sanguinaire aimant et
cultivant lui-mme la musique, celui de tous les arts le
mieux fait pour adoucir le cur humain.
Dans ce temps, Londres comptait un grand nombre
d'amateurs, et le got de l'art musical tait tellement
rpandu, que son enseignement faisait dj partie int-
grante de l'ducation des personnes nes dans l'opu-
lence. Ce got gnral tendit son influence sur le rgne
suivant, et l'on vit la reine Elisabeth protger la musique
et la cultiver elle-mme, comme l'avait cultive son pre.
Le pote Shakespeare connaissait cet art ravissant et lui
adressa d'clatants hommages dans plusieurs de ses
drames. Ce furent les premier vers que les Anglais en-
tendirent chanter sur leurs thtres, et l'on peut dire que
de l date l'origine de leur opra.
Parmi les meilleurs compositeurs de ce temps pour la
musique d'glise et la musique sculire, citons d'abord
Thomas Tallis. Tallis fut le plus grand musicien, dit
Burney dans son Histoire de la Musique, non-seulement
de l'Angleterre, mais de l'Europe, pendant le seizime
sicle. Ses compositions portent l'empreinte de la plus
riche et de la plus pure harmonie. Guillaume Bird et
Thomas Morley furent les dignes disciples de Tallis.
ANC 47
Morley tait attach la chapelle de la reine Elisabeth.
Excellent thoricien dans l'art musical, il fat aussi un
praticien trs-habile. Les ouvrages de ce compositeur
sont des chansons, des madrigaux et des cantates.
En Angleterre, la musique vocale sculire fut inf-
rieure celle de l'glise, particulirement sous le rgne
d'Elisabeth. Les chants trois et six voix, composs
par Witame, sont, les uns trop longs, les autres trop
courts. Quant au dessin musical et la forme, tous por-
tent l'empreinte encore rude des temps o ils ont t
composs. Les paroles de ceux de ces chants faits avant
l'apparition de Bird sont extrmement barbares. Ce-
pendant les frquents voyages que les Anglais opulents
commencrent faire ds cette poque en Italie, leur fi-
rent apprcier la douceur et le charme de sa musique.
Des madrigaux italiens furent adapts des vers an-
glais. Palestrina, Luca Marenzio et d'autres composi-
teurs italiens furent les Orphes de l'Angleterre.
Les premiers madrigaux anglais furent ceux de John
Wilbie, qu'on chantait solennellement chaque anne
dans les collges.
Bientt parurent les madrigaux
trois, quatre, cinq et six voix, dont Thomas Wilkes fit
les accompagnements et Shakespeare les paroles. Ces
compositions sont places avec raison parmi les meilleurs
ouvrages du temps.
Nos lecteurs verront avec plaisir sans doute que,
parmi les compositeurs anglais de cette poque, figure
aussi le pre de Milton. Divers historiens ont parl avec
de grands loges de son talent musical. Il fit dit-on, jus-
qu'aux carillons qu'on sonne dans les campagnes, en An-
gleterre, et les chants que murmurent les nourrices en
berant leurs enfants. Il composa In nomine Patris sur
quarante tons.
Les airs ou ariettes que Frabosca composa dans le
mme temps portent tous l'empreinte profonde de la
mlodie italienne. Ils firent faire celle de l'Angleterre
des pas aussi grands que rapides.
En mme temps, la musique d'glise, les madrigaux
et les chants appels en parties se perfectionnrent. Le
got, le rhythme, la grce et l'accent brillrent galement
dans ces divers genres de compositions, qui n'taient
point infrieures celles du continent.
Sous le rgne de Charles I
er
,
la musique continuant
ses progrs, Thomas Tomkins, lve de Bird, composa
48
ANG
un nombre considrable d'ouvrages d'glise justement
admirs. Ehvay Bevia, lve de Tallis, dploya un tel
talent dans les siens, que, perdus en partie depuis, ils
ont laiss de justes regrets aux amis de l'harmonie.
Mais le plus grand des matres de ce temps fut
Edwar Gibbons. La mlodie de ce profond compositeur
est pleine d'expression et de douceur; son harmonie est
claire, facile et pure. 11 composa, comme les Tallis et les
Bird, ses matres, alla pallestrina. Ses airs sont majes-
tueux et solennels, ses fugues sont riches.
C'est galement sous le rgne de Jacques I
er
que fut
joue la premire comdie crite en anglais, o l'on in-
troduisit de la musique pendant les entr'actes.
La tragi-comdie intitule Cambyse, o il
y
eut un
banquet sur le thtre, pendant lequel une musique ins-
trumentale se fit entendre, et les masques, dont l'usage
se rpandit la cour comme la ville, furent des amu-
sements qui devaient amener ncessairement l'invention
de l'opra.
Sous le rgne de Charles I
er
,
la musique dut suivre le
sort de l'Etat lui-mme; elle marcha rapidement vers sa
dcadence. L'anarchie ne conserve et ne respecte rien.
La destruction est son gnie.
La restauration anglaise, consomme par le retour de
Charles II, en ramenant la paix et les plaisirs dans Lon-
dres,
y
ramena aussi la musique. Smith et Harris,
grands compositeurs et grands organistes, vinrent, l'un
d'Allemagne, l'autre de France, pour ranimer l'harmo-
nie expirante. L'entre de Charles II et son couronnement
donnrent la musique, interprte de l'allgresse publi-
que, l'occasion de signaler ses progrs. Mais, soit que
Tmigration et influ sur elle, soit que l'interrgne lui
et port des coups mortels, elle parut cette poque plus
franaise qu'anglaise. Blow, compositeur, dont plusieurs
ouvrages sont admirables, se signala pendant ce rgne;
Michel Wise, Thomas Tudway, suivirent ses traces.
Mais tous furent effacs par Henri Purcell. Son gnie
embrassa tous les genres de composition. Profond et
souvent sublime dans la musique d'glise, il fut agra-
ble et plein d'expression dans la musique sculire.
Le premier il reconnut le charme et la puissance de la
voix, et en respecta les accords. Grce lui, la musique
dramatique, jusqu'alors informe, subit de notables per-
fectionnements. Il surpassa tellement ses devanciers
ANG 49
dans la musique de chambre, que la plupart de leurs
compositions tombrent dans l'oubli partir de l'poque
o les siennes parurent. Gomme musique instrumentale,
les airs qu'il a mis des odes, des ballets, des ma-
drigaux, sont des morceaux ravissants.
Sous le rgne de Jacques II, et gnralement pendant
une moiti du dix-septime sicle, la musique anglaise
fut atteinte d'un principe de dcadence, comme elle l'a-
vait t pendant l'interrgne et le protectorat. Jacques II
s'occupa exclusivement d'abstractions et de controverses
religieuses, sans encourager les arts et les sciences. Ce-
pendant, vers la fin de ce sicle, les progrs de la mu-
sique instrumentale furent sensibles, surtout dans le
violon, et Nicolas Mathes et Lestronge n'ont t sur-
passs dans ce temps que par le tendre et mlodieux
instrument de Corel] i.
Aprs la mort de Purceil, Clarke, Holder, Crigglon,
Tucker, Boyce et plusieurs autres brillrent encore dans
le musique d'glise. Mais aucun ne donna mieux que lui
de l'expression, du charme, de l'harmonie la langue
anglaise. 11 sut la rendre musicale malgr sa rudesse, et
euphonique malgr son anliphonie naturelle.
\JOratorio, cette sorte de composition mixte, moiti
religieuse et moiti dramatique, conduisit l'invention
et l'usage du drame lyrique en Angleterre, Comme
nous l'avons dj dit, ce furent plusieurs pices de
Shakespeare, dans lesquelles on introduisit del musique,
qui formant dj une espce d'opra, prludrent la
dcouverte de ce genre de spectacle, si naturel l'Italie.
EtLulli, du sein de la France o il dirigeait le thtre
lyrique de cette nation, voyait, ses ouvrages influer puis-
samment sur l'art dramatique dans la Grande-Bretagne.
Les Anglais, mettant l'amour-propre national de ct,
sentirent que la musique italienne tait prfrable la
leur. Ds ce moment, les premiers compositeurs et les
chanteurs les plus habiles de l'Italie s'empressrent de
descendre dans cette le, et ce futelle qui, devanant plu-
sieurs autres nations dans l'adoption du grand opra, eut
de bonne heure un tel spectacle. Le premier qui fut
donn sur le thtre de Londres avait pour titre :
Arsino, reine de Chypre. Il fut reprsent sous le
rgne de Marie, et un anglais, Thomas Clayton, en fit
la musique. Mais il n'avait que la manire italienne;
tandis que l'opra intitul Pyrrhus et Dmtrius, dont le
50
ANT
clbre Alexandre Scarlati fit la musique, et Adrien
Morselli les paroles, fut jou moiti en italien, moiti en
Anglais.
En 1710, l'opra cVAlmade fut excut en
entier par des chanteuses et des chanteurs italiens.
Bientt parut Haendel, suivi de l'lite des artistes
ultramontains, et l'opra srieux italien ne fut pas
moins nationalis en Angleterre que l'opra comique.
Aujourd'hui, la musique italienne et franaise a
acquis dfinitivement droit de cit au del de la Manche.
L'Angleterre possde peu de compositeurs indignes.
En revanche, elle possde une foule d'coles et d'institu-
tions musicales, appropries au got et l'intelligence
des diverses classes de la socit. Londres fourmille
d'tablissements spcialement consacrs la propagation
des chefs-d'uvre de la musique ancienne et moderne.
De nombreux amateurs se forment dans leur sein
;
et,
grce cette diffusion de connaissances, l'Angleterre
comptera peut-tre son tour quelques talents originaux.
Anthologium. Nom d'un livre o se trouvent recueillis
les oifices sacrs.
Anthropophages (Musique des). Un voyageur qui a
parcouru, il
y
a quelques annes, les les de Sainte-
Christine, raconte les faits suivant : Bien que le chant
de ces sauvages ne soit autre chose qu'une espce de
murmure, l'observateur clair distingue facilement dans
leurs chansons le mode mineur, commun tous les
peuples sauvages, et mme aux nations les moins civi-
lises de l'Europe. Il est trs-singulier de voir que ces
anthropophages, qui ne doivent pas avoir l'oreille fort
dlicate, aiment beaucoup la tierce mineure marque
dans leurs chansons par cette ligne \.
Le narrateur termine son rcit de la manire suivante :
11
y
a dans l'expression des chants de ces sauvages
quelque chose d'effravant qui vous pousse tellement au
dsespoir, qu'il vous semble entendre le chant funbre
de votre convoi. J'ai pass dans cettre angoisse une nuit
entire que les habitants de Sainte-Christine ont bien
voulu employer en mon honneur, afin que j'eusse une
ide de ce que je viens de vous communiquer.
Anticipation. L'anticipation est la contre-partie du
retard. Il n'y a retard dans quelques parties que parce
que les autres anticipent, (Voyez le mot Retard.)
Antienne. Chant d'glise, que dans l'origine on chan-
tait deux churs qui se rpondaient alternativement
;
APL
51
on comprenait sous ce titre les hymnes et les psaumes
que l'on chantait dans l'glise deux churs. Aujour-
d'hui, la signification de ce terme est restreinte certains
passages courts tirs de l'Ecriture, qui conviennent au
mystre, la vie ou la dignit du saint dont on clbre
la fte, et qui, soit dans le chant, soit dans la rcitation
de l'office, prcdent ou suivent les psaumes et les can-
tiques.
Anti-musical. Contraire la musique.
Antiphonairh ou Antiphonier.
Livre o les
antiennes et autres parties de l'office divin, surtout
Vintrot, le graduel, le trait, Vcdleluia,
Yoffertoire et la
communion, sont nots sur une porte de quatre lignes
et avec les caractres propres au plain-chant.
Antiphonx. Appareil inaugur en 1846 par Debain
qui consiste en une srie de leviers en acier, poss
horizontalement bascule dans une bote ayant une lon-
gueur moins tendue que celle d'un clavier d'orgue. Cette
bote contient des pelotes correspondant chacun des
leviers et reposant par l'autre extrmit sur les touches.
Une srie de planchettes, notes musicalement avec des
pointes de fer se place sur la bote et se trouve entrane
par la pression d'un rouleau. Les pointes rencontrant les
leviers en acier les forcent d'appuyer sur les pelotes et
ceux-ci sur les touches.
Antistrophe. On nommait ainsi, chez les Grecs, la
seconde stance d'un chant lyrique semblable en tout la
premire, la seule diffrence venait de ce que celle-ci se
chantait en tournant droite autour de l'autel et celle-l
en tournant gauche.
Antithse. Opposition qui arrive souvent en musique
comme un passage cantabile avec un accompagnement
bruyant, etc.
Antkemps. Nom anglais d'un morceau de musique
d'glise, compos trs-souvent sur des sentences tires
del Bible.
Aoud ou oude instrument arabe c'est un luth quatre
cordes
;
les Arabes attribuent chacune de ces quatre
cordes un effet particulier, on croit que c'est Aoud que
notre luth fait remonter son origine.
Aplomb. On dit qu'un danseur a un bel aplomb quand,
aprs avoir fait un saut, il descend directement. Ce
terme mtaphorique passa de la danse a la musique, o
52 APO
il indique la prcision dans la mesure, soit pour Ja voix,
soit pour les instruments.
Apobaterton. Nom grec d'une chanson de cong.
A poco a poco (Peu peu).
Cet adverbe se trouve
ordinairement joint aux mots crescendo et decrescendo,
et il indique qu'on doit successivement renforcer ou
diminuer la mlodie.
Apodipna. Expression grecque qui signifie chants qu'on
excute aprs souper.
Apollo-lyra. Instrument en bois et vent imagin
en 1832 par Schmids. Cet instrument imitait les sons de
cor et de la clarinette. Son tendue tait de quatre
octaves.
Apollon. Dieu des arts, des lettres et de la mdecine,
le plus beau, le plus aimable des dieux. Onle peint sou-
vent sur le Parnasse, aux milieu de neuf Muses, avec sa
lyre en main et une couronne de laurier sur la tte.
Malgr ses qualits remarquables, Apollon eut des
rivaux. Pan, qui se croyait un admirablejoueurde flte,
le dfia
;
mais Imole, roi de Lydie, choisi pour juge,
dclara Apollon vainqueur. Midas, roi de Phrygie, tmoin
de ce combat musical, rcusa le jugement d'Imole, et
Apollon, pour laisser un monument de la stupidit de
Midas, lui fit venir des oreilles d'ne. La dfaite de Pan
ne dcouragea pas Marsyas, habile joueur de flte,
qui osa provoquer Apollon. Les Muses taient ses juges
;
elles dcidrent en faveur du dieu. Le vaincu fut corch
pour sa punition, et perdit la vie.
Apollon. C'est le nom d'un instrument en guise de
luth vingt cordes, invent Paris, en
1678,
par un
artiste nomm Promt.
Apollonicon. Instrument construit en 1833 par High
ou Robson, de Londres; il avait cinq claviers et marchait
si on le dsirait l'aide d'un cylindre, il avait quel-
que rapport avec l'orchestrion de Maelzel.
Apollonion. Instrumenta touches, invent parjean
Voiler, de Darmstadt, la fin du sicle dernier, et qui
n'est autre chose qu'un piano deux claviers avec un jeu
de tuyau bouche de huit, quatre et deux pieds, et avec
automate de la grandeur d'un enfant de huit ans, qui
joue diffrents concertos de flte.
Aposiopesis. Dans la musique grecque ancienne, ce
mot signifie pause gnrale.
Apotome. Terme grec qui signifie la division intgrale
APP 53
du ton entier, ou le demi-ton majeur dans le rapport de
2048/2187.
Appel. C'est le nom de certains airs.de chasse que l'on
sonne sur la trompe pour appeler les chasseurs ou les
chiens.
On se sert aussi de ce terme pour dsigner
dans la symphonie et la musique dramatique un trait de
cors qui offre quelque ressemblance avec les appels de
chasse.
Appel. (Harmonie) de l'ordre des appels naissent,
selon Diderot, la diversit des mesures, la place et la
dure des sons appels. Les appels ont diffrentes ner-
gies
;
ce sont eux qui dterminent et la chane des sons
naturels et le choix des basses.
Les appels s'ordon-
nent dans la phrase harmonique selon leur nergie.
Appogiature. Terme de musique emprunt h la
langue italienne [appogiatura)
;
signifie un agrment qui
se fait dans le chant, en appuyant la voix sur lanotequi
prcde en dessus de l'harmonie. C'est ce qu'ancien-
nement on appelait petites notes, notes perles, j)orts de
voix, avec cette diffrence cependant que ces derniers se
faisaient presque toujours en dessous.
C'est aussi un terme de la science harmonique. On
trouve souvent, dans un morceau d'harmonie, des notes
plus ou moins nombreuses qui n'appartiennent point
l'harmonie. Celles de ces notes qui se trouvent aux temps
forts de la mesure ou aux parties fortes des temps, sont
nomms appogiatures.
Les appogiatures sont d'un frquent usage, et leur
emploi est laiss entirement la volont du compositeur.
Cependant comme elles produisent toujours une assez
forte dissonnance, elles demandent de la discrtion et du
got.
Apprciable. Les sons apprciables sont ceux dont
on peut trouver ou sentir l'unisson et calculer les inter-
valles. On compte huit octaves et demi, depuis le tuyau
de trente-deux pieds du grand orgue jusqu'au sonleplus
aigu du mme instrument, apprciables notre oreille.
Il
y
a aussi un degr, de force au del duquel Je son ne
peut plus s'apprcier. On ne saurait apprcier le son
d'une grosse cloche dans le clocher mme. Il faut en
diminuer la force en s'loignant pour le distinguer. De
mme, les sons d'une voix qui crie cessent d'tre appr-
ciables. C'est pourquoi ceux qui chantent fort sont sujets
chanter faux.
54 ARA
Arabebbah. C'est un instrument dont on se sert sur
les cles de la Barbarie, et qui consiste dans une vessie
domine par une corde.
Arabo-pebsane (musique). Les anciens Perses
n'aimaient pas la musique
;
ils la considraient comme
un art dangereux. Ce n'est que dans quelques rares
occasions qu'ils chantaient des hymnes solennels dans les
temples de leurs dieux et dans les palais des rois.
L'aurore de la civilisation, ayant pour cortge les arts,
passa de]a Mdie en Perse. Les Persans n'taient encore
que de grossiers pasteurs qui habitaient des montagnes
inaccessibles, lorsque dj la Mdie tait occupe par un
peuple civilis, qui connaissait tous les arts qu'inventa le
luxe. Les Mdes furent subjugus par les Persans
;
mais
ilscommuniqurentlanation victorieuse leurs arts, leurs
lois, leurs murs et leur langage. Les Persans apprirent
donc de leurs matres en civilisation, la musique et les
autres arts analogues. Les plaisirs de la table s'accrurent
du charme de la musique. Les monarques eux-mmes
voulurent prendre part ces jouissances et toutes celles
qui pouvaient animer les festins, la danse particuli-
rement.
Dans la priode dont nous parlons, on trouve dj
des intermdes, des fantaisies et des prludes qui parta-
geaient avec le chant l'attention des auditeurs. Les Perses
possdaient dj beaucoup d'instruments de diffrents
genres.
L'introduction de la musique des Grecs en Perse sous
Alexandre et ses successeurs aurait pu exercer une salu-
taire influence, si on et cherch en appliquer les rgles
aux chants nationaux. Au lieu de cela, les Persans, gars
dans les disputes d'cole des harmonistes grecs, prf-
raient l'tude de l'acoustique aux charmes de la modula-
tion, et traitaient la musique, comme une science
spculative.
On ne sait pas d'une manire certaine si
le systme musical des Indiens tait cette poque connu
des Persans, ou s'il ne le fut que plus fard. On peut
conjecturer cependant, d'aprs les recherches historiques
faites rcemment par la Socit littraire de Calcutta,
qu'il existait bien anciennement des relations entre les
deux peuples.
One nouvelle poque pour la musique commena en
Perse avec les Arabes. Lorsque le calife Omar dtruisit
ce royaume et planta sur ses ruines la bannire del'isla-
ARA
55
misme, la lutte fut terrible. Les premires
annes qui
suivirent cette rvolution furent pleines de
meurtres et
de dsolation, mais la Perse
y
gagna sous
quelques rap-
ports. Le peuple vainqueur tait dou d'une
organisa-
tion plus dlicate. Ce mlange d'esprits
diffrents pro-
duisit un effet salutaire aux deux nations.
La langue
arabe, en s'unissant la langue persane, la rendit plus
douce et plus sonore. La musique et la posie des Persans
devinrent les filles chries de celles des Arabes.
Ds les temps les plus reculs, la musique et la posie
taient fort estimes chez les Arabes, bien que leurs mo-
dulations et leurs instruments de musique fussent extr-
mement simples. Dans le principe, leur musique et leur
chant n'taient pas autre chose que les cris avec lesquels
ils excitaient leurs chameaux, et l'art de leurs
chanteurs,
qu'ils appelaient hadis, c'est--dire
piqueurs,
consistait
en accents sauvages qui pouvaient servir
exprimer les
passions brutales de ces conducteurs de troupeaux.
A l'apparition de Mahomet, les murs des
Bdouins
s'adoucirent, et, lorsqu'ils furent devenus les heureux
possesseurs des trsors de la Grce et de la Perse, ils con-
urent du got pour les plaisirs de la vie. Comme on l'a
dit plus haut, ils reurent leur service des musiciens
grecs et persans qui les initirent aux secrets du plus
beau des arts. Bientt on vit briller les Arabes dans l'art
du chant, qui atteignit peu peu le degr de
perfection
dont leur systme tait susceptible. Sous les Abbassidcs,
Bagdad tait cette poque le centre de la bonne mu-
sique.
Le kalife Haroun-al-Raschid, qui rgna de 786 809,
tait grand amateur de musique
;
il avait pour ami et
confident un clbre joueur de flte nomm Ishac. Les
airs composs par Abou-Giafar, de la race des Abbas-
sides, font encore les dlices des Arabes, et l'on attribue
des effets merveilleux la musique du kalife Abou-Na-
sar-Mahomet-al-Farabi, qui tait appel Y Orphe avala.
Voici en abrg les lments du systme
musical
arabe :
La musique est divise en deux parties : le telif
(composition), ou la musique considre relativement
la mlodie; elYikda, (cadence), qui est la terminaison
mesure d'un chant, et qui regarde seulement la
musique
instrumentale.
Les modes principaux sont :
1
le rast: ou mode droit;
3.
oG
ARC
2
Yirack ou mode des Chaldens
;
o le zirafkend, et
4
e
Yisfelian, ou mode de la capitale de la Perse. Chacun
de ces modes a une proprit diffrente. Ainsi, par
exemple, Yirak agite l'me, le zirafkend fait natre l'a-
mour, etc. Les drivs de ces modes, appels
furo (ra-
meaux), sont au nombre de huit. Leurs noms sont
presque tous emprunts quelque ville, quelque prince,
ou quelque grand homme. Aprs les huit modes nom-
ms furo)
viennent les six modes appels evazat, ou
composs et drivs
;
puis sept autres modes nomms
bohar (mer), qui sont autant de phrases musicales com-
menant chacune par un des sept intervalles qui forment
la gamme arabe.
Malgr l'origine persane de leur musique, les Arabes
employaient quelquefois, pour indiquer les intervalles,
les lettres de leur alphabet au lieu des noms de nombre
persans. Les lettres dont ils se servaient sont : alif,
be,
gim, dal, he, waio, zain, qui correspondent nos notes :
la,
si, do, r, mi,
fa,
sol.
Les Arabes appellent la musique science des cordes,
parce qu'ils placent dans un cercle le carr de leurs
modes. Cette mthode convient trs-bien une musique
aussi simple et aussi limite que celle de ces peuples.
Les Arabes et les Orientaux, ne passent jamais d'un
iniervalle un autre, soit en montant, soit en descen-
dant, sans parcourir et (aire sentir tous les intervalles
intermdiaires. Cette manire de faire glisser la voix,
qui nous semble insupportable, constitue, suivant eux,
l'agrment de la musique. Les Arabes ne connaissent
pas l'harmonie, et, dans leurs concerts, toutes les par-
ties chantent l'unisson ou l'octave.
Le nombre de leurs instruments est considrable
;
voici les plus connus :
Le Rcbab, le Tambour, le
Duf,
le Fang, le Kanoon,
le Mai, YAoud. (Voir ces mots.)
Le prince de la Moskowa nous donna, il
y
a quelques
annes, un spcimen de la musique arabe h notre po-
que : c'est presque la mlodie caractristique de nos
montagnes; mais on voit que l'Europe a pass parla.
Le type de leur musique ancienne s'est considrable-
ment altr.
Araiine, sorte de trompettes en usage dans le moyen-
ge.
Aucata, Coup d'archet. Le coup d'archet est sans
ARC 57
contredit la qualit la
plus importante pour celui qui
joue d'un instrument archet. La manire de tenir et
de gouverner l'archet appartient l'cole de l'art. Qu'il
suffise ici de faire observer qu'en gnral on divise le
coup d'archet :
1
en staccato (dtach articul), quand
on emploie une petite partie de l'archet pour piquer
plusieurs notes du mme coup d'archet et avec un cer-
tain degr de rapidit;
2
en tirato (dtach) quand on
conduit l'archet tout entier ou sa plus grande partie sur
les cordes;
3
en legato (li), quand on prend quatre,
huit, seize notes diffrentes, et plus encore d'un seul
coup d'archet.
Chacune de ces trois espces, qui peut
avoir lieu tant en poussant qu'en tirant, est soumise
aussi diffrentes modifications qu'on doit appliquer
selon le mouvement et le caractre de la composition
musicale.
Archet. L'archet se compose d'une baguette de bois
dur et d'un faisceau de crins de cheval assujettis ses
deux bouts et tendus au moyen d'une vis de rappel. C'est
en frottant l'archet sur les cordes qu'on obtient un fr-
missement qui agite l'air et le fait vibrer clans la table
d'harmonie des violons, des violes et des basses. Pour
donner plus de force l'action de l'archet sur les cordes,
on enduit l'archet de colophane.
C'est Tartini qui a appris aux violonistes se servir
de l'archet et leur en a rvl la magie. C'est de la ma-
nire de le tenir et de le gouverner que dpendent la
la force, la douceur, l'intensit des sons.
Archeggiare (manier l'archet). Se servir de l'archet
sur les instruments cordes.
Archicembalo. Ce clavecin, qui avait des cordes et
des touches particulires pour les sons enharmoniques,
fut
invent en 1557,
par Nicolas Vicentino, de Vicence.
Archichantre. Dignit ecclsiastique, directeur des
chantres.
Archiluth. tait une varit de l'instrument, nomm
Thorbe dont la caisse tait un peu plus allonge et un
peu moins arrondie.
Archimime. Chef des acteurs qui jouaient la panto-
mime Rome.
Archiparapkoniste. C'est le nom que l'on donnait
anciennement l'archichantre qui devait chanter l'intro-
duction de la messe et prsenter l'eau au prtre.
Archives musicales. Lieu o l'on garde toute espce
58 ARI
de compositions musicales ncessaires au service des
chapelles, des acadmies, des cours, des thtres, des
maisons particulires.
Les archives musicales de la
chapelle pontificale dans le palais Quirinal sont les plus
riches et les plus importantes de l'Europe : on
y
compte
350,400 volumes, qui contiennent les compositions mu-
sicales des coles romaine, vnitienne et napolitaine, et
300 volumes renfermant un choix prcieux de documents
de littrature musicale.
Archi-viole. Ancien instrument de musique com'pos
d'une espce de clavecin auquel tait adapt le mcanisme
d'une viole, et qu'on faisait marcher l'aide d'une ma-
nivelle.
Archi-viole de Lyre. Instrument cordes dont on se
servit longtemps en Italie, et qui avait de la similitude
avec la lyre et la guitare. Il avait un manche trs-large,
sur lequel on montait douze seize cordes.
Ar-Dito. Ce mot crit en tte d'un morceau de musi-
que demande que l'on fasse ressortir avec clat les prin-
cipales notes de la mlodie, et que l'on mette une cer-
taine nergie dans l'excution des accents grammaticaux
et oratoires.
Ariette. Diminutif d'air, driv, selon Saumaise, du
latin ra. On appelle ariette un chant form d'une suite
de phrases mlodiques, rhythmes et coupes par des
repos qu'on nomme cadences, Ce chant est ordinaire-
ment fait pour tre excut par un instrument
quelcon-
que, ou adapt certaines posies faites pour tre chan-
tes.
Chaque sorte d'ariette porte un nom particulier,
selon le caractre qui lui est propre. Autrefois le nombre
en tait considrable
;
ainsi, l'on avait les villanelles, les
ariettes de bravoure, les bourres, les gigues, les cavati-
nes, les barcarolles, les gavottes, les passe-pieds, les
musettes.
De toutes ces ariettes peu sont encore en
usage aujourd'hui, et l'exception de Yair dclam, du
grand air, de la cavatine, du rondeau, de
\kbarcarolle,
de la romance, et de quelques autres, les compositeurs
modernes ne s'assujettissent plus gure telle ou telle
forme pour le caractre et la coupe de l^urs airs.
L'ariette est, en gnral, un petit air dtache, lger et
gracieux, qui tient le milieu entre la romance et la
chanson. Les ariettes taient fort en usage vers le mi-
lieu et la fin du dix-huitime sicle
;
elles sont mainte-
nant presque entirement passes de mode.
On appc-
ARP
59
lait autrefois ariette de bravoure, ce que nous dsignons
aujourd'hui sous le nom tVair roulades. Les ariettes
composes avant le quinzime sicle portaient presque
toutes le nom de chanson.
Arigot. petite flte ou octavin, fort en usage dans
l'ancienne arme suisse. Il tait perc de quatre trous en
dessus et de deux en dessous.
Arioso. Ce mot italien, plac la tte d'un morceau
de musique, inclique une manire de chant expressive et
soutenue.
Aristoxniens. Disciple d'Aristoxne, matre de mu-
sique grec, et inventeur d'un systme oppos celui de
Pythagore, puisqu'il se basait sur le jugement de l'o-
reille, tandis que ce dernier tait appuy sur le
calcul.
Armarius. Archichantre dans les couvents, et mme
le gardien des livres d'glise.
Armature. Runion des signes qui se trouvent la
clef d'un morceau de musique.
Armer la clef. C'est mettre auprs d'elle les acci-
dents convenables au ton daus lequel on veut crire la
musique.
Arpaneta. Espce de petite harpe triangulaire qui
tait compose d'un fond plein, d'une caisse sonore per-
ce d'ouies et monte avec des cordes de mtal.
Arpge. De l'italien arpegio et arpa, harpe.
Ma-
nire dfaire entendre successivement tous les sons qui
entrent dans la composition d'un accord, au lieu de les
frapper simultanment. Le piano et la harpo ne pouvant
rendre que des sons qui ne durent pas, on est quelque-
fois oblig, pour soutenir l'harmonie, de frapper plu-
sieurs fois et l'une aprs l'autre les touches ou les cordes
de ces instruments. Ce qu'on fait par ncessit, on le l'ait
aussi par got
;
11
y
a des instruments qui ne peuvent
faire entendre que deux sons la fois, comme le violon,
le violoncelle et la viole, et d'autres qui n'en peuvent
rendre qu'un seul, comme tous les instruments vent.
Si donc, l'on veut faire entendre sur ces instruments une
harmonie pleine, on est oblig de jouer alternativement
sur chacune des notes qui composent les accords dont on
fait usage. C'est ce qu'on appelle arpger ou faire des ar-
pges.
Les arpges se font plus souvent sur le violon,
le violoncelle, le piano et la harpe, en allant du grave
l'aigu, et revenant sur les mmes notes de l'aigu au
eo ARR
grave.
Les arpges ne peuvent tre excuts avec la
mme facilit par les instruments vent que par les ins-
truments archet. Aussi ne leur en fait-on faire que
trs-rarement et avec cls modifications qui les simpli-
fient. La flte et la clarinette sont presque les seuls
instruments vent qui puissent arpger convenable-
ment.
Arpone. Cet instrument, invent par Michel Barbici,
de Palerroe, ressemble un piano vertical, mont de
cordes de boyau qu'on fait raisonner en les pinant avec
les doigts. Les sons qu'on en obtient sont doux et flat-
teurs, surtout dans l'adagio.
Arranger. C'est mettre la porte d'un ou de plu-
sieurs instruments ce qui a t compos pour un ou plu-
sieurs instruments d'une nature diffrente. Il signifie
encore resserrer le dessin harmonique dans ses formes
et ses moyens, pour que les excutants puissent rendre
en sextuor, en quatuor, ou simplement sur le piano, la
harpe et mme la guitare, une symphonie ou un accom-
pagnement destin pour le grand orchestre.
L'arrangement peut avoir son utilit
; mais, en gnral
et au point de vue de l'art, il est presque toujours une
insigne trahison l'gard du compositeur. Comment
pourra-t-on conserver sa pense ? Les lments sonores
qu'il avait choisis, leur disposition, leur combinaison,
leur opposition ou leur harmonie, leur ensemble, en un
mot, tait prcisment, ses yeux, le moyen ncessaire
et choisi entre mille d'exprimer sa pense : si tout cela
disparat, que devient-elle? Et si la pense disparat,
qu'a-t-on conserv de l'auteur primitif?
Beaucoup de virtuoses, dit un critiqueclbre, grands
et petits, chanteurs ou instrumentistes, ont l'insupporta-
ble tendance mettre toujours en premire ligne ce
qu'ils croient l'intrt de leur personnalit, ils tiennent
peu compte du respect inaltrable que tout excutant
doit h tout compositeur, et de l'engagement tacite, mais
rel, que le premier prend envers l'auditeur, de lui
transmettre intacte la pense du second, soit qu'il honore
un auteur mdiocre en lui servant d'interprte, soit qu'il
ait l'honneur de rendre la pense d'un homme de gnie.
Et, dans l'un et l'autre cas, l'excutant qui se permet'
ainsi, obissant son caprice du moment, d'aller ren-
contre des intentions du compositeur, devrait bien pen-
ser que l'auteur de l'uvre telle quelle qu'il excute, a
ART
61
probablement mis cent fois plus d'attention . dterminer
la place et la dure de certains effets, indiquer tel ou
tel mouvement, dessiner, comme il l'a fait, sa mlodie
et son rhythme, choisir ses accords et ses instruments,
qu'il n'en met lui, l'excutant, faire le contraire. On ne
saurait trop se rcrier, en toute occasion, contre cette
insense prrogative qui s'arrogent trop souvent les ar-
rangeurs, les instrumentistes, les chanteurs et les chefs
d'orchestre.
Arsis. Enlevant, ou la partie non-accentue de la me-
sure.
Per arsin signifie spcialement un chant ou
contre-point dans lequel les notes descendent de l'aigu
au grave.
Art. Ensemble et disposition des moyens et des prin-
cipes pratiques par lesquels l'homme fait un ouvrage,
excute un objet, exprime ses sentiments, sa pense par
voie d'imitation ou de sympathie.
Les arts mcaniques ou mtiers demandent de prf-
rence des forces physiques, les arts libraux exigent
particulirement des forces intellectuelles.
Autrefois les Grecs placrent au rang des arts libraux-
la posie, la musique, le dessin, la gomtrie, la philoso-
phie; et comme la nation grecque tait divise en deux
classes d'hommes, en hommes libres et en esclaves, il
n'tait permis qu'au Grec libre d'apprendre et d'exercer
les arts libraux.
Les termes arts et sciences ne sont pas du tout syno-
nymes. L'art est la runion des prceptes dont la con-
naissance est ncessaire ou simplement utile pour faire
une chose, Ainsi, par exemple, on dit : l'art djouer du
violon, de chanter. L'art n'a pas de rapport ncesaire
avec l'explication rationnelle ou scientifique des choses
dont il s'occupe. La science, au contraire, est prcis-
ment la connaissance raisonne, philosophique ou scien-
tifique, des choses dont l'art s'occupe et des prceptes
qu'il donne.
Toutefois ces deux mots sont employs souvent l'un
pour l'autre, ainsi qu'on le verra h l'article artiste.
Art de l'archet. Maniement de l'archet, dans lequel
on doit considrer :
1
la fore
;
2
le prolongement du
son
;
3
la juste mesure
;
4
le jeu
;
5
la reprise.
On peut compter cinq diffrentes manires de jeu
d'archet : le dtach {sciolto), le li {legato) le port (por-
tato), le piqu [picfiettatto)
,
le mixte (misto). Dans le d-
62 ASO
tach, on fait la premire note en tirant et la seconde en
poussant. Ce jeu, on peut l'appeler maniement de l'archet
droit et rgulier
;
mais si l'on dtache la premire note
en poussant et la seconde en tirant, alors on l'appelle
contre-archet.
Fiorello, Kreutzer, Rode, Baillot, Paganini, ont
crit des ouvrages sur l'art de Varchet.
Articulation. L'articulation est aujourd'hui compte
pour peu de chose chez la plupart des musiciens. Il ne
suffit pas de prononcer correctement, c'est--dire de
donner aux lettres et aux syllabes les sons qu'elle doivent
avoir dans l'idiome dont on se sert, il faut, de plus, faire
entendre ce qu'on prononce d'une manire nette et dis-
tincte, de telle sorte qu'il soit impossible de perdre une
syllabe des paroles ou une note de la musique. Il faut, en
somme, bien articuler. Bien articuler, c'est faire ressor-
tir les diverses syllabes d'un mot en attaquant les
voyelles qui forment ce mot, au moyen des consonnes
qui entrent dans sa composition.
Articuler. Ce mot dsigne en musique une manire
d'excuter nette et distincte qui ne laisse pas perdre une
syllabe des paroles ni une note de la musique.
Artiste. Le musicien artiste qui s'tudie perfec-
tionner son art, doit le rendre non-seulement l'objet
d'une pratique mcanique, mais encore l'objet de la
rflexion et d'une tude scientifique. Les anciens artistes
en musique taient aussi potes, philosophes et orateurs
du premier ordre. Boce n'appelle pas artiste celui qui
pratique seulement la musique avec le servile secours
des doigts et de la voix, mais celui qui possde la
science du raisonnement et de la mditation. On ne sau-
rait douter aussi que pour s'lever aux grandes expres-
sions de la musique dramatique il ne faille avoir fait une
tude particulire des passions humaines et du langage
de la nature.
Ascarum. Nom d'un instrument appartenant aux
peuples de la Libye. Il tait muni de petits canons de
plumes qui, pendant qu'on tournait l'instrument, pro-
duisaient des sons.
Ascendere (monter). C'est faire succder les sons de
bas en haut, c'est--dire du grave l'aigu.
Asor. Instrument de musique des anciens Hbreux
;
il avait la forme d'un carr oblong, et il tait mont de
dix cordes que l'on faisait rsonner avec une plume.
ASS 63
Asosta. Espce de trompette des anciens Hbreux.
Aspiration, Aspirer. Dans le langage ordinaire
YAspiration indique l'action par laquelle l'homme et les
animaux forcent l'air s'introduire dans leurs poumons
pour l'en chasser ensuite, ce qui constitue la respiration
dans le langue musicale, dfaut du chanteur qui consiste
mettre un h devant les voyelles, et quelquefois mme
devant les consonnes. Ce mot se prend aussi dans un
bon sens : c'est lorsque le chanteur emploie une espce
de soupir peine marqu pour orner son chant avec
l'aspiration
;
ou lorsqu'un chanteur, par ce moyen et
sans qu'on s'en aperoive, sait prendre la respiration, et
peut ensuite prolonger insensiblement, au grand plaisir
et au grand tonnement de l'auditeur, la tenue et la pro-
gression de la voix,
Assalone. Gaspard luthier romain est le premier qui
introduisit dans sa patrie les principes de l'cole de
Crmone.
Assaluzzo (Gappa). Luthier Crmone, lve de
Nicolas Amati travaillait en 1640.
Assyriens. Musique des Assyriens, des Babyloniens,
des Modes, des Perses, etc.,
Nous n'avons point de documents assez prcis pour
parler en dtail et avec connaissance de cause de la
musique de chacun de ces peuples en particulier. Ce qui
nous intresse avant tout, c'est de savoir qu'ils l'ont
aime et pratique.
Il n'est pas tonnant, dit Rollin, que, dans un pays
comme l'Asie, livr au plaisir, aux dlices et' la bonne
chre, la musique, qui en faisait le principal assaisonne-
ment,
y
ait t en honneur et cultive avec un grand
soin. Le seul nom des principaux modes de l'ancienne
musique, et que la moderne a conserv, le Dorien, le
Phrygien, le Lydien, l'Ionien, l'Eolien, marque quel a
t le lieu de sa naissance ou du moins celui o elle
s'est accrue et perfectionne.
L'criture Sainte nous apprend que, du temps de
Laban, la musique et les instruments taient fort en
usage dans le pays qu'il habitait, c'est--dire dans la
Msopotamie, puisque entre autres reproches qu'il fait
Jacob, son gendre, il se plaint que par sa fuite prci-
pite il ne lui ait pas laiss l'occasion de le reconduire,
lui et sa famille, avec des chants de joie, au bruit des
tambours et au son des harpes.
64 AUG
Dans le butin que Cyrus fit mettre part pour
Gyaxare, son oncle, il est fait mention de deux musi-
ciennes trs-habiles qui accompagnaient une dame de
Suseet qu'on avait fait prisonnires avec elle...
11 est remarquer que, dans les livres de plain-chant
moderne, et la fin des brviaires, on a rapport aux
diffrents modes prcipits les diffrents tons qui sont
en usage dans les chants de l'Eglise. Le 1
er
et le
2
ton
appartiennent au mode dorien, le 3
e
et le 4
e
au mode
phrygien
;
les autres aux modes lydien et mixolydien.
Astabolo. Instrument de musique des Maures, qui
ressemble au tambour.
Athena. Espce de flte des anciens Grecs. On croit
que Nicophle a t le premier . s'en servir dans les
hymnes Minerve. Il
y
avait aussi une espce de trom-
pette appele athena.
A trois, quatre, cinq parties. Composition musi-
cale dans laquelle trois, quatre, cinq voix sont unies
harmoniquement, de manire ce que chacune d'elles
excute une mlodie diffrente de l'autre.
Atropus. Ancien instrument dont parlent les histo-
riens mais dont la forme est reste inconnue.
Attabale. Instrument de musique mauresque sem-
blable aux tymballes de la cavalerie.
Attaga. Ce mot, quand il prcde un morceau de
musique, signifie que ce morceau suit immdiatement
le prcdent sans aucun repos.
Attaquer. C'est l'action du chanteur ou de l'instru-
mentiste qui commence un morceau de musique, ou le
continue aprs un silence. On prend aussi ce mot dans
le sens d'entonner, mettre la voix, et pour indiquer
l'entre immdiate d'une partie quelconque dans l'excu-
tion d'un morceau de musique vocale ou instrumentale.
On attaque le son avec grce, force, nettet.
Aubade. Musique qu'on excute l'aube du jour sous
les fentres de quelqu'un.
Ce genre de musique tait connu des Grecs et se nom-
mait vo;j.o opOpioc. On lit dans un commentateur rudit :
Quicl sit nonus in musice notissimum est vo-xoc Sppto erat
canticum quod sub delictdum pro foribus accinebatur.
Hodie apucl nos dicitur : Aubade quod sub album, id
est auroram, id soleat.
Augment. L'intervalle naturel qui spare deux notes
tant altr par un dise ou un bmol, on dit qu'il est
AUT 65
augment quand le signe qui Faltre augmente cet
intervalle naturel.
Les harmonistes franais du iS
ms
sicle appelaient
superflus les intervalles augments. Cette expression
n'est pas rationnelle : il n'y a rien de superflu dans les
lments constitutifs d'un art.
Aulemata. Sonate de flte et de fifre.
Aulte. Joueur de flte.
Aultique. Art de jouer de la flte.
Auletride. Nom que les Grecs donnent des femmes
qui formaient avec les joueurs de cithares et les dan-
seuses une classe de courtisanes qui amusaient les
convives pendant les repas, ou assistaient aux ftes et
aux crmonies.
Aulos, mot grec, qui se rend ordinairement par
flte.
Aura (guimbarde.) Nom particulier de l'instrument
appel en italien spassa pensieri.
Dans les dernires annes qui viennent de s'couler,
on a perfectionn cet instrument, en runissant six, dix
guimbardes en une seule, et plus encore. La Gazette
musicale de Leipsick de l'anne 1816 contient, dans son
numro 30,
une description dtaille de la guimbarde,
avec plusieurs morceaux de musique que l'on peut
excuter sur cet instrument.
L'Aura de ScheiUer en 1824taitune runion de vingt
deux guimbardes rgulirement accordes runies sur
deux barres d'acier dont un mcanisme fort simple
facilitait l'usage.
Auteurs dramatiques. Dans le sicle de Louis XIV
et mme dans le dernier sicle, les ouvrages drama-
tiques taient d'un faible rapport. Corneille mourut
pauvre. Racine, quoique historiographe et pensionn,
n'avait que de l'aisance. Nous n'avons vu nulle part que
Molire ait achet des terres, et si Regnard en eut une,
ce fut comme trsorier de France, et non comme pote
dramatique.
Les auteurs de ballets, delibretti ou de
pomes lyriques ne furent pas plus heureux. Quinault et
Benserade, ces habiles collaborateurs de Lulli, n'amas-
srent point de rentes avec leurs ouvrages, et vcurent
des faveurs de la cour.
L'auteur de Figaro, homme d'esprit et de talent, qui
savait compter aussi bien qu'crire, mrita la reconnais-
sance de ses confrres en rclamant et obtenant pour
tous des rtributions qui rendirent leurs travaux plus
GG
AUT
fructueux. Ainsi le produit trs-considrable alors, del
location des loges Tanne, fut ajout la recette jour-
nalire sur laquelle se prlevaient leurs droits. On raya
aussi du rglement de l'Opra et de la Comdie-Fran-
aise l'article abusif par lequel une grande pice deve-
nait la proprit du thtre, partir du jour o elle
n'avait pas produit une somme dtermine. Un grand
abus existait encore. Les thtres de piovince pouvaient
s'emparer de tous les ouvrages reprsents Paris, sans
rien payer aux auteurs et aux compositeurs. La rvolu-
tion de 89 dtruisit cet abus. Ce fut encore Beaumar-
chais qui, second par Mercier et plusieurs gens de
lettres, obtint de l'Assemble constituante la libert des
thtres et l'obligation pour tous, sans exception, de
traiter de gr gr avec les auteurs, avant de pouvoir
reprsenter leurs ouvrages. Ces amliorations ont t
compltes depuis que les auteurs et compositeurs dra-
matiques, sentant aussi la ncessit d'avoir leur assem-
ble reprsentative, ont form une commission charge,
entre autres attributions, de dfendre et de protger
leurs intrts.
Authentique (mode.) Mode ou ton dont la dominante
est la quinte de la finale. On regarde aussi comme
authentique) tous les tons, pourvu que la modulation
soit rgulre, parce qu'on ne reconnat jamaispouriinale
que la note qui a pour dominante la quinte l'aigu ou
la quarte au grave. L'glise possde encore aujourd'hui
quatre tons authentiques.
Le mot authentique ren-*
ferme ici le sens d'approuver, parce que ce furent les
quatre tons admis et choisis par Saint-Ambroise.
Automates musiciens. On a avanc ce sujet un
grand nombre de faits plus ou moins fabuleux, plus ou
moins invraisemb^bles, qu'il serait trop long de repro-
duire ici
;
en 1738 Yaucanson fit une figure de cinq
pieds qui excutait sur la flte douze airs diffrents.
Le plus clbre des automates musiciens est celui
que l'abb Mical construisit vers la fin du sicle dernier.
11 fit un groupe de figures qui jouaient de diffrents
instruments et formaient un concert. En 1780 et 1783
il prsenta l'Acadmie des sciences deux ttes humaines
qui avaient, dit-on, la facult d'articuler des sons. Sui-
vant Vicq d'Azyr, qui lit un rapport sur ces machines,
Mical avait atteint en partie le but qu'il s'tait propos.
Mais il avouait que les sons rendus par ces ttes
BAC 07
n'taient que des imitations
trs-imparfaites de la voix
humaine.
Voici le mcanisme de ces automates : les
ttes posaient sur des botes dans l'intrieur desquelles
on avait dispos des glottes artificielles qui rendaient
des sons plus ou moins graves. On faisait parler ces
glottes au moyen d'un clavier. Le joueur de flte et le
joueur de tambourin de Vaucauson sont beaucoup plus
clbres et beaucoup plus parfaits. Les Autrichiens nous
les ont vols en 1815.
B
R reprsente la septime note de la gamme que nous
appelons si. Cette lettre place la tte d'une partie,
marquait, dans la musique ancienne, la basse chantante,
pour la distinguer de la basse continue marque par BC.
B ou COL B crit sur une partition, la partie de
l'alto, signifie que cette partie doit marcher l'unisson
avec la basse. Parfois aussi on crit cette lettre sur la
partie du violoncelle, ce qui est ordinairement indiqu
par la clef de basse.
B indique aussi le signe acci-
dentel qui abaisse le son naturel d'un demi-ton.
Dans
le xi
e
sicle le B correspondait la septime note de la
gamme diatonique de si. Dans la gamme des anglais, le B
correspond au r des franais.
Baazs. Guitare h quatre cordes en usage chez quel-
ques nations de l'Amrique.
B cancellatum. N'est autre chose que le dise ordi-
naire.
Babylonien. Nom d'un des modes arabes, exprimant
la joie, qu'on ajoutait au mode guerrier, lorsque le vain-
queur revenait du combat port en triomphe. (Voyez le
mot Assyriens.)
Bacchanales. Ftes des anciens Grecs et Romains
clbres en l'honneur de Bacchus, et accompagnes de
musique. On donnait aussi ce nom certaines composi-
08
BAL
tions vocales, ordinairement sans instruments, crites
sur des posies burlesques et populaires, qui ressem-
blaient aux chants du carnaval, jadis en usage Flo-
rence, surtout au temps des Mdicis.
On nomme aussi
Bacchanale une certaine danse bruyante et tumultueuse
introduite dans un ballet.
Bacchia. Danse la manire des ours, en usage
parmi les Kamtschadales, qui, en murmurant une m-
lodie mesure
2[4,
et d'un mouvement vif, poussent
par intervalles de forts gmissements et marquent les
temps de la mesure en frappant avec force la terre de
leurs pieds.
Bacciocolo. Instrument dont on se sert dans quel-
ques parties de la Toscane. Il consiste en un vase qui a
la forme d'une cuelle. On le tient de la main gauche,
et de la main droite on le frappe avec un pilon de la lon-
gueur de quatre pouces environ, et assez semblable
ceux qu'on emploie pour les mortiers en bronze. Les
sons qu'on tire de cet instrument ne sont pas harmo-
nieux, mais ils plaisent aux paysans.
Bachique, Se dit des airs et des chansons boire.
Badiani, (Javetta), luthier, lve de Stradivarius
Brescia, en 1580.
Baglatea. Instrument de musique des arabes consis-
tant en trois cordes tendues sur une planchette et mises
en vibration avec une plume.
Baguette. Se dit des deux morceaux de bois qui ser-
vent battre le tambour.
Bal. Assemble de personnes qui se sont runies
pour danser aux sons des instruments.
Baladin. Nom donn anciennement aux danseurs de
thtres, et rserv aujourd'hui pour dsigner les dan-
seurs grotesques, farceurs ou saltimbanques.
Baladoire. Danse que l'on excutait jadis avec des
gestes lascifs et des postures quivoques, le 1
er
janvier et
le 1
er
mai. Elle fut abolie par diverses ordonnances des
rois et plusieurs bulles papales.
Balafo. Espce d'pinette en usage parmi les ngres
de la Cte-d'Or.
Garni de calebasses et ayant de la
similitude avec nos anciens claquebois.
Balaleiga. Guitare trois cordes en usage chez les
Russes.
Balance pneumatique. Instrument l'aide duquel
BAL
69
on mesure le degr de force et de compression de Pair
dans les orgues.
Balbatrie. (Claude), clbre organiste du xvm
e
sicle,
son jeu attirait tant de monde pour l'entendre, que
l'archevque de Paris fut oblig de lui dfendre de jouer
les jours de grandes ftes.
Balestieri, (Thomas), luthier, lve de Stradivarius,
travailla Mantoue de 1720 1750.
Ballade. Chanson ou espce d'ode plusieurs cou-
plets ou strophes, que l'on chante ordinairement, mais
qui sert aussi quelquefois d'air de danse, comme les
vaudevilles. Il
y
a des ballades trs-anciennes, qui sont
fameuses et mritent de l'tre par leur simplicit, la
navet et le pittoresque des penses. Telle est la ballade
des deux enfants dans les bois.
On sait quel succs a
obtenu en Allemagne, la ravissante ballade Lonore,
par Burger.
Ballet. On entend gnralement par ballet un spec-
tacle compos de pantomime et de danses excutes
par plusieurs personnages et accompagnes par la mu-
sique.
La musique des ballets doit tre fortement rhythme
et s'identifier en quelque sorte avec le caractre des
danses, la physionomie des personnages qui sont sur la
scne et les diverses situations du drame.
Les ballets sont rgls par les danseurs qui portent le
nom de chorgraphes. Un des meilleurs ouvrages con-
sulter est celui de M. Saint-Lon, intitul : la Stno-
chorgraphie, dans lequel on trouve d'excellentes bio-
graphies des plus clbres matres de ballets, anciens et
modernes.
La danse est un des premiers besoins, des premires
expriences, des premires joies de l'homme
;
quelque-
fois aussi les temps antiques la jetaient comme une
guirlande funbre autour des tombeaux. La danse est la
vritable forme potique des premiers ges. David, dont
la loi est place comme une borne lumineuse entre l'O-
rient primordial et l'Occident moderne, rendait grce au
Seigneur par le geste et par la voix : il dansait devant
l'arche, et chantait ses psaumes dans le temple.
Le ballet qui est un drame dans, un dialogue de
gestes, fut pratiqu par les Egyptiens dans leurs cr-
monies sacres. Il tait compos alors sur des dessins
hiroglyphiques. Il exprimait la doctrine sacerdotale
3..
70 BAL
et le mouvement des astres. La thocratie
gyptienne
enseignait l'astronomie ses fidles, en leur
apprenant
danser.
Les Grecs dansaient beaucoup. Socrate, dj vieux,
termina son cours d'tudes en prenant des leons d'As-
pasie, danseuse trs-renomme.
On dansait dans l'aropage, et les membres de cette
docte assemble s'avanaient en cadence pour venir d-
poser leur boule ou leur coquille dans l'urne.
Pylade et Bathyle, fameux pantomimes, se parta-
grent les faveurs du public de Rome sous le rgne
d'Auguste. Le premier inventa le ballet noble, tendre
et pathtique. Les compositions de Bathyle taient vives,
lgres et pleines de gaiet. Runis d'abord, ils construi-
sirent un thtre leurs frais, et reprsentrent en-
semble des tragdies et des comdies, sans autre secours
que ceux de la pantomime, de la danse et de la sym-
phonie. Cette heureuse association de deux talents, la
fois si divers et si originaux, fut pour le public romain
une source de vives jouissances. Pylade et Bathyle joui-
rent pendant quelque temps en commun de leur fortune
et de leur clbrit. La jalousie altra leur amiti et
rompit leur union
;
ils se sparrent.
Les divisions des Pyladiens et des Bathyliens ensan-
glantrent souvent la scne. A la fin du spectacle, ces
acteurs, enorgueillis ou bien irrits de la diversit de
leur succs, se battaient, s'gorgeaient derrire le
thtre.
Tibre chassa de Rome les pantomimes
;
Caligula,
Nron les rappelrent et rtablirent les spectacles
publics.
Les pantomimes employaient quelquefois des moyens
violents pour reprsenter, au naturel, la mort l'assassinat,
ou le supplice d'un personnage. Un criminel, la figure
couverte du masque de l'acteur qu'il remplaait au
dnoment, tait rellement empoisonn, tortur, poi-
gnard, livr aux flammes, etc..
Les historiens de la musique sautent pieds joints
plusieurs sicles, et d'une seule enjambe passent du
rgne de Constantin celui des Mdicis. L'art drama-
tique s'tait perdu
;
la pantomime et l ballet thtral
taient dchus de leurs prestiges, au milieu des tnbres
dont le moyen-ge avait envelopp l'Europe. Le premier
ballet rgulier et somptueux qui fut excut lors de la
BAL 71
renaissance des lettres, n'eut d'autre objet que d'offrir
une socit d'illustres amateurs de quoi satisfaire l'apptit
de leurs estomacs. Toutes les notabilits de la fable et de
l'histoire furent voques pour servir un repas splendide.
Bergonzo di Botta, de Tortone, dont les annales de la
gastronomie et de la danse ont conserv le nom, signala
doublement son got dans la fte par lui donne en 1489
h Galas, duc de Milan, qui venait d'pouser Isabelle
d'Aragon.
Les grands ballets parurent bientt aprs.
On les rserva d'abord pour clbrer, dans les cours, les
mariages des rois, la naissance des princes, et tous les
vnements heureux qui intressaient les nations. Ils
formrent seuls un spectacle d'une dpense vraiment
royale.
Les ballets potiques, tels que la Nuit, les Saisons, les
Ages; les ballets allgoriques et moraux, tels que les
Plaisirs troubls, la Curiosit, leur succdrent. La
division de toutes ces compositions chorgraphiques
taient en cinq actes; chacun prsentait trois, six, neuf
et mme douze entres.
Catherine de Mdicis introduisit les ballets potiques
la cour de France. Baltasarini apporta le premier une
certaine rgularit dans ce genre de spectacle. Ce fut
lui qui, en 1581, composa le fameux Ballet comique del
reine, pour les noces du duc de Joyeuse. Ce ballet n'tait
qu'un intermde destin l'embellissement de ces ftes
nuptiales.
La danse tait un des amusements favoris d'Henri IV.
Sully, le grave Sully, prparait les ftes, faisait cons-
truire les sades, tait l'ordonnateur suprme des ballets.
Il
y
figurait comme danseur, en excutant les pas que
la sur du roi lui montrait. Plus de quatre-vingts grands
ballets contriburent aux divertissements de la cour
d'Henri IV, sans compter des bals magnifiques et une
infinit de mascarades singulires.
Au commencement du dix-septime sicle, les ballets
devinrent un travestissement agrable des passions
et des secrets de la cour. Benserade mettait dans les
siens, qui jouissaient d'une vogue immense, des rondeaux
o se peignaient adroitement les dames et les seigneurs
qui les chantaient.
Quinault accomplit une rvolution dans le ballet. Dj
Pierre
Corneille avait crit des pices comme Andromde,
o la danse et le chant sont subordonns au rcit drama-
72
BAN
tique. C'est un retour vers les traditions
grecques et
romaines,
entirement conforme au mouvement des arts
cette
poque. Quinault fit ses opras o la danse n'est
qu'un
divertissement accessoire; il escamota le ballet au
profit du chant. Du reste, Quinault n'tait proccup que
d'une
certaine manie du merveilleux, du besoin de ferie
et de
grandeur. Il tait en cela l'cho des dsirs souve-
rains de Louis XIV.
L'art s'tiola dans l'atmosphre du dix-huitime sicle,
et le mauvais got qui rgnait alors exera sa funeste
influence sur les ballets.
Noverre parut : il retrouva
l'art de la pantomime, et donna les premiers modles du
ballet d'action, tel que nous le possdons. Le 13 juin
1763,
on reprsenta Ismne et Ismnias, dans lequel
plusieurs scne de Mde et Jason, ballet-pantomime,
sont intercales. On ne gota les uvres de Noverre que
quand il vint en France pour
y
faire excuter ses
ouvrages.
La famille Vestris, originaire de Florence, a rgn plus
d'un sicle sur notre empire dansant. Gatan Vestris
parut en 1748 l'Opra, qu'il n'a quitt qu'en 1800. Il
avait quatre frres qui suivirent la mme carrire. Son
fils Auguste, virtuose de grand talent, se fit admirer dans
la pantomime et l'excution des pas.
Le ballet rsista l'action destructive du torrent rvo-
lutionnaire. On dansait encore au milieu des sanglantes
orgies de 93. Les danseurs de l'Opra figurrent la fte
que
Robespierre ddia l'Etre-Suprme ;
et plusieurs
pices
rvolutionnaires, telles que l'offrande la libert,
ballet, la Rimion du 10 aot, opra en cinq actes,
furent reprsentes du temps de la rpublique.
La restauration vit s'accomplir une importante rvo-
lution dans le ballet.
-
Mademoiselle Taglioni dbuta
l'Opra, le 23 juillet 18:27, dans le Sicilien, avec un
succs prodigieux. Sa gice nave, ses poses dcentes et
voluptueuses, sa lgret extrme, la nouveaut de sa
danse, dont les effets paraissaient plutt appartenir aux
inspirations de la nature qu'aux combinaisons de l'art,
excitrent une admiration
gnrale. Elles furent le signal
du progrs qui s'est accompli.
Bamboula. Espce de flte faite d'une tige de bambou
en usage chez les ngres pour accompagner une certaine
danse qui, par la suite a pris le nom de l'instrument.
Bande. (Compagnie). Ce moi signifie un corps de
BAR 73
musiciens jouant de toutes sortes d'instruments vent
et de percussion. En Italie, on donne habituellement le
nom de banda quelques instruments de percussion,
comme les cymbales, les pavillons chinois, le triangle,
qui, runis dans les orchestres des grands thtres ser-
vent renforcer au besoin les forte dans les diffrents
morceaux de l'opra et du ballet.
Le mot Bande s'applique principalement aux musi-
ques militaires, composes d'instruments vent
;
ainsi
Ton dit : la bande de tel rgiment. La musique militaire
de la cavalerie nese compose que d'instruments de cuivre.
On nommait la grande Bande les vingt-quatre violons
attachs la musique de la chambre sous Louis XIV et
son successeur.
Bandore. Espce de mandoline en usage chez les
peuples du Nord c'est le mme instrument que les Espa-
gnols nommaient Bandola.
Banque. Vieux mot franais qui signifie thtre, il est
aujourd'hui pris en mauvaise part.
Banza. Sorte de guitare en usage parmi les ngres de
la cte d'Afrique.
Bancloche. Nom que l'on donnait la cloche du bef-
froi ou la cloche d'appel.
Barbiton. C'est le nom d'un instrument cordes des
anciens Grces, dont on ne sait pas prciser positivement
l'espce. Les uns attribuent l'invention de cet instrument
Alce, les autres Anacron.
Barcarolle. Sorte de chanson en langue vnitienne,
que chantent les gondoliers Venise. Quoique les airs
de barcarolles soient faits pour le peuple, et souvent
composs par les gondoliers eux-mmes, ils ont tant de
mlodie et un accent si agrable, qu'il
y
a peu de musi-
ciens dans toute l'italie qni ne se piquent d'en savoir et
d'en chanter. L'entre facile qu'ont les gondoliers
tous les thtres, les met mme de se former sans frais
l'oreille et le got; de sorte qu'ils composent et chantent
leurs airs en amateurs qui, sans ignorer la finesse de la
musique, ne veulent point altrer le genre simple et na-
turel de leurs barcarolles. Les paroles de ces chansons
sont communment sans prtention, sans apprts, comme
les conversations de ceux qui les chantent. Mais ceux
qui les peintures fidles des murs du peuple peuvent
plaire, et qui aiment d'ailleurs le dialecte vnitien, se
3...
74 BAR
passionnent facilement pour ces chants, sduits qu'ils
sont par la beaut des airs.
La barcarolle est presque toujours crite en
6[8 quel-
ques t'ois cependant, mais trs-rarement en
2[4. Le mou-
vement est modr et onduleux.
N'oublions pas de remarquer, la gloire du Tasse,
que la plupart des gondoliers savent par cur une grande
partie de son pome de la Jrusalem dlivre, et qu'ils
passent les nuits d't sur leurs barques le chanter
alternativement d'une gondole l'autre.
Les chansons des gondoliers vnitiens ont tant d'agr-
ment, que les compositeurs ont imagin d'en placer dans
leurs opras, en leur donnant cependant un cadre plus
tendu. A Venise, jeune Fillette, de [Michel-Ange) Blon-
dinette, joliette (d'Aline,) sont des barcarolles
;
celle du
Roi Thodore, plusieurs voix, est d'un effet charmant.
Bardes. Hommes trs-respects chez les Germains,
les Gaulois, les Anglais et les Irlandais. Ils taient la fois
potes, musiciens et guerriers. Fingal et son fils Ossian
sont regards comme les plus fameux; ils vivaient
vers 260. Fergus, barde contemporain de Fingal et
d'Ossian, fut aussi grand pote qu'eux. C'est surtout
dans les combats que son gnie brillait de tout son clat,
et qu'il exerait son empire. A la bataille de Fiatri, Os-
sian ayant engag un combat singulier, commenait
plier, Fergus l'aperut, et des hauteurs o il tait plac,
il lui adressa des chants qu'Ossian entendit, et qui lui
rendirent le courage et la victoire.
Bardit. On appelait ainsi le chant guerrier des an-
ciens Germains.
Baripyeni. On appelait ainsi dans la musique an-
cienne, cinq des huit sons, ou cordes stables du dia-
gramme ou systme musical des anciens.
Baroque. Une musique baroque est celle dont l'har-
monie est confuse, charge de modulations et de disso-
nances, le chant dur et peu naturel, l'intonation difficile,
et le mouvement contraint.
Ce terme vient du mot
grec baros, chose dsagrable.
Baroxiton. Instrument vent, sorte de contrebasse
d'harmonie construite en 1853 par Cerveny's.
Barres. Traits tirs perpendiculairement la fin de
chaque mesure pour les sparer; il n'y a pas encore deux
sicles que l'usage des barres a t introduit dans la
musique.
BAS 73
Baryton. C'est la
seconde espce de voix d'homme
en comptant du grave l'aigu. Par got ou par ncessit,
les Franais ont toujours prfra la voix de baryton
celle de basse.
Cette voix tient le milieu entre la
voix de basse, qui est la plus grave, et le tnor, qui lui
succde immdiatement, l'aigu.
On l'appelle aussi troisime tnor ou basse-taille.
(Voy. l'article Voix.)
Baryton. Cet instrument cordes et archet tait
une espce de viole monte sur le manche de sept cordes
de boyau, et sous le manche se trouvaient tendues plu-
sieurs cordes de mtal, ordinairement au nombre de
seize, que l'on touchait vide avec le pouce de la main
gauche, tandis que les autres doigts se posaient sur
les cordes en boyaux que l'archet taisait raisonner.
En 1855, on prsenta un autre genre de baryton, c'tait
un gros violon, ou une petite viole, s'accordant l'oc-
tave infrieure du violon, et se jouant comme Valto.
Bas. Signifie en musique un son grave cppos haut
ou aigu.
Bas -dessus. Se dit dans la subdivision des dessus, de
celui des trois qui est le plus bas. (Voy. l'article Voix.)
Base. C'est la mme chose que tonique, son fonda-
mental.
Bassanelli. Instrument de la famille des hautbois et
imagin par Giov. Bassano, compositeur vnitien du
xvn
e
sicle.
Basse. Celle des quatre parties de la musique qui est
au-dessous des autres, la plus basse de toutes, d'o lui
vient le nom de basse.
La basse est la plus importante des parties. C'est sur
elle que s'tablit le corps de l'harmonie.
Il
y
a plusieurs sortes de basses.
La basse fonda-
mentale est celle qui n'est forme que de sons fondamen-
taux de l'harmonie, de sorte qu'au-dessous de chaque
accord elle fait entendre le vrai son fondamental, qui est
le plus grave, l'accord est divis par tierces.
Basse
continue, ainsi appele parce qu'elle dure pendant toute
la pice.
Basse contrainte, dont le sujet ou le chant,
born un petit nombre de mesures, recommence sans
cesse, tandis que les parties suprieures poursuivent
leur chant et leur harmonie en les variant.
Basse (voix de). C'est la voix d'homme la plus basse.
Son diapason commence au second
fa
grave du piano, et
76 BAS
s'lve jusqu'au r hors des lignes. Cette voix n'a qu'un
seul registre, celui de poitrine. C'est en lisant les parti-
tions allemandes et italiennes qu'on pourra se faire une
ide des effets ravissants qu'obtient un compositeur de
mrite en employant avec art cette voix de basse, la plus
riche de toutes.
Basse, instrument. (Voy. Violoncelle.)
Basse chantante. Espce de voix qui chante la partie
de la basse.
Basse-contre. Sorte de voix qui a le mme timbre
que la basse-taille, seulement elle a moins d'tendue
l'aigu et plus au grave.
Basse-cor. Espce de Serpent imagin en 1806 par
Frichot.
Basse de Flandre. Sorte de trompette marine
compose d'un simple bton sur lequel on tendait une
ou deux cordes. Sous ces cordes on plaait une vessie de
cochon pour faire le bourdon.
Basse de viole a clavier. Invente et construite par
Risch, du grand duch de Weimar, en 4710. Cet instru-
ment tait mont de cordes de boyau mises en vibra-
tion par de petites roues enduites de colophane qu'une
roue plus grande place sous la caisse mettait en mouve-
ment.
Basse de violon. Instrument qui servait ancienne-
ment accompagner les voix et qui se nommait aussi
viole d'paule parce qu'on la suspendait l'paule droite
l'aide d'un large ruban.
Basse d'harmonie. Nom donn l'Opkiclde, (Voir
ce mot).
Basse-figure. Est celle qui se place sous une note
longue comme la ronde, par exemple, divise les temps
de la mesure en plaant sous chacun d'eux une des notes
formant l'accord plaqu de la mlodie qu'elle acccom-
pagne.
Basse-horn. Construit en 1820 par Stratwolf, de
Gottingue, espce de trompette chromatique ayant trois
trous pour les doigts et neuf clefs.
Basse (Marche de). (Voy. le mot Progression.)
Basse-orgue. Etait un instrument du mme genre
construit en 1813 par Sautermeister, dont l'tendue tait
de trois octaves pleines et quelques notes.
Basse-Taille. Voix d'homme qui est immdiatement
au-dessus de la basse. On l'appelle aussi baryton et quel-
BAS
77
que fois troisime tnor. Voix de Tnor s'appelait jadis
Taille en France. (Voy. l'article Voix.)
Bien des persondes confondent la basse-taille avec la
basse. Cette erreur vient en gnral de ce que les rles
crits pour ces deux sortes de voix sont chants en
France par les mmes acteurs. Gomme nous avons
trs-peu de rles de basse dans nos opras, les chanteurs
dont les moyens seraient disposs parla nature et l'art
remplir convenablement cette partie, sont forcs d'a-
voir recours ceux crits pour des voix plus aigus, et
forcent leur organe pour atteindre aux tons levs de ]a
basse-taille. Ils ne donnent par consquent que le rebut
de leur voix, et ngligent sa quinte grave, dont on aurait
pu tirer un grand parti.
Basse-tuba. C'est une espce de bombardon perfec-
tionn par M. Wibrecht, chef des musiques militaires
du roi de Prusse. Son tendue est de quatre octaves,
depuis le la, deux octaves au-dessous des lignes, clef de
fa,
jusqu'au la du tnor, une octave au-dessus des lignes
de la mme clef.
Basson. Instrument de musique vent et anche,
invent par Afranio, chanoine, de Pavie, en 1539, et per-
fectionn en
1578,
parSigismondScheltzer. Il tient, dans
la famille du haut-bois, le mme rang que le violoncelle
dans celle du violon. Le diapason du basson est de
trois octaves partir du premier si B grave du piano.
Il commence par consquent un ton plus bas que celui
du violoncelle.
Le basson joue dans tous les tons; ses
tons favoris sont : ut,
fa,
si B, mi B, et leurs relatifs
mineurs.
Le caractre du basson est en gnral tendre et mlan-
colique
;
cependant ses accents, pleins de vigueur et de
sentiment, servent parfois exprimer Jes grandes pas-
sions dans Vagitato, invitent au recueillement, et inspi-
rent une douce pit quand ils accompagnent des chants
religieux. Si le basson ne peut tre trs-brillant, il s'unit
du moins parfaitement aux instrnments qui ont cette
qualit; et lorsque les violons suspendent leur discours
pour laisser le champ libre aux fltes, aux clarinettes,
aux cors, c'est lui qui sert de base leur harmonie cla-
tante.
Le basson fit sa premire entre dans l'orchestre, en
iGoO, dans la pastorale intitule Pomone, musique de
Canbert, il n'avait alors que trois clefs.
78 BAT
Les notes hautes du basson ont quelque chose de
pnible et de souffrant dont on peut tirer d'excellents
effets. Tels sont les soupirs tranges et touffs qu'on
entend dans la symphonie en ut mineur de Beethoven,
la fin du decrescendo. Les sons du mdium ont quelque
chose de flasque; c'est l que M.Meyerbeer a trouv la
sonorit froide, dcolore, cadavreuse dont il avait
besoin dans la scne de la Rsurrection des Nones.
Les traits rapides en notes lies peuvent tre employs
avec succs dans les tons favoris de l'instrument.
M. Meyerbeer en a obtenu d'excellents effets dans la
scne des Baigneuses, au deuxime acte des Huguenots,
dans l'accompagnement du chur : Jeunes beauts, sous
ce feuillage, etc.
Il existe un nouveau basson invent par Ad. Sax en
1849,
entirement construit en cuivre. Les trous aboucher
par l'extrmit des doigts
y
sont supprims et se bou-
chent au moyen de clefs.
Basson a fuse. Espce de basson invent vers l'an
1680 par Deaner, de Leipsig. Le tube fait neuf tours.
Basson (jeu de basson). Est un jeu d'anches qui, dans
l'orgue, complte le jeu du hautbois et lui sert de basse.
Le jeu de basson a une tendue de deux octaves.
Basson-quinte.
C'est un diminutif du prcdent,
qui possde la mme tendue, s'crit galement sur
deux clefs, la clef de
fa
et la quatrime clefd'wtf mais
dont le diapason est plus lev d'une quinte.
Le basson-quinte s'crit une quinte au-dessous des
sons rels qu'on veut obtenir : ainsi on crit en sol pour
jouer en r, etc.
Le cor anglais remplace avantageusement le basson-
quinte pour les deux octaves suprieures de ce dernier.
Cependant le timbre du basson quinte a plus de force,
et, runi aux bassons ordinaires, il serait d'un excellent
effet dans la musique militaire dont il adoucirait l'cla-
tante et quelque peu pre sonorit.
Basson Russe. Imagin par Rigibo en
1780,
pour am-
liorer le serpent, transport ensuite en Russie, d'o il
nous est revenu comme nouveaut, environ trente ans
aprs.
Bataille. On donne ce nom une sorte de composi-
tion musicale dans laquelle on cherche imiter avec les
sons les bruits de la guerre et les divers rsultats d'une
bataille.
BAY T9
Batiphone. Espce de clarinette basse, construite en
Allemagne.
Bton. Sorte de barre qui traverse perpendiculaire-
ment une ou plusieurs lignes de la porte, et qui, selon
le nombre des lignes qu'elle embrasse, exprime une plus
grande ou moindre quantit de mesures qu'il faut passer
en silence.
Les btons ne sont plus en usage, et l'on
marque le nombre des pauses avec des chiffres placs
au-dessus de la porte.
Bton de mesure. C'est un bton fort court, ou
mme un rouleau de papier, dont les chefs d'orchestres
se servent pour marquer la mesure.
Battement. Espce de mordante, ou selon quelques-
uns, de trille, qui, au lieu de commencer par une note
plus leve, commence par la note plus basse "que la note
principale.
Batteur de mesure. Le batteur de mesure tait ap-
pel chez les anciens Grecs coryphe, parce qu'il tait
plac au milieu de l'orchestre dans une situation leve,
pour tre plus facilement vu et entendu de tout l'orches-
tre. Les Romains les appelaient pedarii. Pour rendre la
percussion rhythmique plus clatante, ils garnissaient
leurs pieds de certaines chaussures ou sandales de fer.
Quelques nations ont des manires particulires pour
battre la mesure. Les Chinois se servent de tambours
;
les Hongrois, dans leurs danses nationales, marquent la
mesure en dansant, avec les perons de leurs bottes,
qu'ils frappent l'un contre l'autre
;
les Portugais, dans
leurs danses, la battent en faisant claquer leurs doigts,
t)es Espagnols avec les castagnettes.
I Battochio. C'est le nom d'un instrument auxiliaire
qui donne l'intonation plusieurs autres instruments.
Battre la mesure. C*est en marquer les temps par
des mouvements de la main ou du pied qui en rglent la
dure, et par lesquels toutes les mesures semblables
sont rendues parfaitement gales, en valeur chroni-
que, dans l'excution.
Bayadre.
Ce mot vient du portugais hailodera,
femme qui danse, danseuse. Les Bayadres forment dans
l'Inde une partie du personnel attach aux pagodes, o
l'on",
entretient une troupe de huit, de douze et mme
seize femmes.
Chaque jour, matin et soir, elles dansent
dans le temple et chantent des pices devers libres, dont
le sujet est tir de la mythologie indienne
;
elles reeoi-
80
BC
vent pour ces fonctions des apointements fixes prlevs
sur le trsor de la pagode.
Les bayadres paraissent dans toutes les solennits
publiques, et accompagnent les personnes qui rendent
des visites d'apparat. Un les appelle aussi aux ftes de
famille, et dans ces occasions elles excutent des danses
plus ou moins libres, selon le got des spectateurs.
L'orchestre qui accompagne la danse des bayadres est
ordinairement fort simple, et se compose de tala, esp-
ces de petits cylindres qui rendent un son argentin trs-
aigu, et d'un dolh, petit tambour dont la caisse est de
terre cuite, et que l'on frappe des deux cts. Cette mu-
sique, et peut-tre aussi les applaudissements qu'on leur
prodigue, animent tellement les bayadres, que l'on
fait venir quelquefois successivement dans une mme
nuit jusqu' quatre et cinq bandes de ces danseuses, qui
se retirent puises de fatigue.
Les indiens ne regardent pas le mtier des bayadres
comme infamant, et mme dans les castes les plus leves
il se trouve des parents qui font vu, s'ils ont une fille,
de la consacrer de cette manire la divinit pour la-
quelle ils ont le plus de respect. Les petites filles desti-
nes au mtier de bayadre apprennent de trs-bonne
heure lire, chanter et danser, et on ne leur laisse
ignorer aucun des arts, aucune des manuvres qui peu-
vent les rendre par la suite plus sduisantes et plus dan-
gereuses.
Bec. Partie de la clarinette que l'on place dans la
bouche lorsqu'on veut jouer de cet instrument.
Bcarre. Ce mot signifie b carr, et se compose
peu prs de deux 7 placs, l'un dans la position naturelle
et l'autre dans une position inverse.
L'un des trois signes accidentels qui se pla-
cent, soit la clef d'un morceau de musique, soit dans
le courant d'une section de phrase musicale. Le bcarre
dtruit l'effet du bmol et du dise. Le bcarre n'a de
valeur que pendant toute la dure de la mesure dans
laquelle il est employ.
Ce serait commettre uu non-
sens musical que de poser des bcarres la clef de dbut
d'un morceau de musique, puisque le ton d'ut naturel
comporte implicitement autant de bcarres que ce mme
ton a de notes pour former sa gamme. Mais 11 arrive
souvent que pour passer d'un ton mineur son majeur
synonyme, on arme la clef d'autant de bcarres qu'il
y
BM 81
est ncessaire d'avoir de notes remises naturelles ou dans
l'tat de gamme normale.
Autrefois que la figure de dise (voyez ce mot) tait
inconnue, on remplaait ce signe par celui du bcarre,
l'antipode du bmol (voyez ce mot), on l'appelait aussi
quelquefois b dure Le bcarre participe du dise et du
bmol tout la fois
;
du dize, lorsqu'on le place
devant une note bmoHse, et du bmol, lorsqu'on le
place devant une note dise.
Bedon de Biscaye. C'est une espce de petit tambour
de basque, dont le cercle est garnie de castagnettes. En
le faisant rsonner avec les doigts, les castagnettes frap-
pent les unes contre les autres.
Beffroi ou tamtam. Instrument de percussion en
usage chez les Orientaux, et admis dans notre musique
militaire et nos orchestres. C'est dans sa forme une es-
pce de tambour de basque, tout entier d'un mtal com-
pos, qui a une vibration extraordinaire quand on le
frappe avec un marteau.
Le beffroi s'emploie avec succs dans les marches lu-
gubres et funbres, dans les churs qui expriment des
passions violentes et dont l'effet doit tre terrible, tel
que celui qui termine le deuxime acte de la Vestale.
Beffroi. Tour d'o l'on fait le guet et o il
y
a une
cloche pour sonner le tocsin d'alarme. On donne aussi
ce nom la cloche mme qui est dans la tour.
On connat l'expression terrible, sinistre, effrayante
du tocsin dans les jours de troubles politiques.
Le tocsin produit des effets qui ont peu de rapports
avec la musique : cependant on l'emploie quelquefois
dans la musique dramatique. Nous en parlerons l'ar-
ticle CLOCHE.
Belloneon. Cet instrument construit Dresde en
1804,
par Kaufmann, tait un physarmonica qui excu-
tait des fanfares et imitait seul le son de vingt trom-
pettes avec tambours et timballes.
Bmol. Nom du second signe altraiif qui, avec le
dise et le bcarre, se place devant une note pour abais-
ser, hausser ou remettre naturelle l'intonation. Le b-
mol, qui se figure par un B, tait, dans le systme an-
cien deGuido d'Arezzo, le contraire du B dur, ou bcarre
des modernes, parce que ce signe n'tait employ, cette
poque recule, que pour attnuer l'effet assez dissonant
produit par la succession des sons naturels
fa,
sol, la,
4
82
BER
si de la gamme ascendante. On crivait donc cette gamme
en bmolisant ou adoucissant la note si (septime degr de
la gamme moderne).
Depuis que la dcouverte de la dissonance harmonique
a t faite par Monteverde, au commencement du dix-
septime sicle, le bmol ne figure plus qu'accidentelle-
ment dans la gamme naturelle d'ut majeur. Mais alors
ce n'est plus pour adoucir l'avant dernier son de l'-
chelle, mais bien pour dterminer une modulation rela-
tive dans le ton majeur du quatrime degr, ou dans
celui du relatif mineur de ce mme ton.
Lorsque la modulation l'exige on emploie un signe
appel double bmol (BB). Il possde, devant une note
naturelle, la double facult du bmol simple, c'est--dire
que si ce dernier baisse la note d'un demi-ton mineur le
double bmol la baisse de deux demi-tons. Lorsque la
note est dj simplement bmolise, le double bmol ne
la baisse que d'un seul demi-ton mineur. Enfin, les b-
mols poss la clef d'un morceau conservent pendant
toute sa dure leur qualit diminutive des sons naturels;
tandis que, poss seulement devant une note, et par ac-
cident, ils n'ont de valeur que pendant toute la dure de
la mesure dans laquelle ils sont employs.
Les tons bmoliss ont une sonorit bien moins bril-
lante, surtout dans les instruments archet, que les tons
naturels et diss. Aussi les compositeurs les emploient-
ils de prfrence dans certains morceaux d'une expression
calme et religieuse. Cependant la musique militaire, si
clatante et d'un effet souvent, lectrique, s'crit presque
toujours et brille davantage dans les tons bmoliss.
Bmoliser. Placer des bmols la clef pour changer
l'ordre et la place des demi-tons, ou marquer une note
d'un bmol accidentel.
Bente (Matheo), luthier, lve de Stradivarius, tra-
vaillait Brcscia en i580.
Berceuse. Nom donn un genre de chanson faite
pour endormir les enfants.
Bergamasque. C'tait une espce de danse et air de
danse en usage dans le sicle dernier. On trouve des ber-^
gamasques dans plusieurs recueils de sonates pour violon
et pour luth.
Bergonzi (Franois), luthier de Crmone, imitateur
de Stradivarius, travaillait en 1G87 et 1720.
Bergonzi (Charles), frre du prcdent, fut un des
BIS
83
meilleurs lves de Stradivarius. Ses violons ont un-
m-
rite incontestable, il florissait de 1724 1750.
B fa. C'est le nom que l'on donnait la quarte natu-
relle de
fa,
appele aujourd'hui si bmol.
Bibliographie musicale. Livre qui contient dans un
ordre systmatique, chronologique, et de la manire la
plus
parfaite, la description complte de tous les titres
originaux des uvres musicales, thoriques et pratiques,
historiques et philosophiques
,
imprimes ou manus-
crites, de tous les temps, de toutes les nations, avec les
noms de l'auteur et de l'diteur; plus le format du livre,
le nombre des volumes et des ditions.
Bibliothque musicale. Collection ou recueil d'u-
vres musicales.
Les plus fameuses bibliothques de
musique sont : celle de la cour de Vienne, que l'on croit
la plus considrable de toutes celles qui existent en
Europe, attendu qu'elle a t forme par une srie d'em-
pereurs qui taient tous des musiciens distingus : celle
de Munich, en Bavire; celle du Conservatoire de Paris;
celle du Lyce musical de Bologne, forme par les
recherches de l'infatigable Martini, celle de Saint-Marc,
Venise, et celle du Conservatoire de Naples, qui ren-
ferme un grand nombre de partitions manuscrites de
l'cole napolitaine.
Bicordatura. Nom de la double gamme sur les
instruments archet.
Bignou. Instrument fort en usage dans les campagnes
de la Bretagne; c'est une espce de cornemuse. Ce nom
est d'origine celtique et drive de Bigna (le renfler
beaucoup.)
Binaire. Qui est compos de deux units. On donne
le nom de binaire la mesure a deux temps, attendu
qu'elle se partage en deux temps gaux. Elle est oppose
la triple, ou mesure ternaire.
Biographie musicale. Livre qui contient des rensei-
gnements sur la vie, les uvres et les crits des auteurs,
compositeurs de musique, chanteurs, instrumentistes,
amateurs clbres, fabricants d'instruments, diteurs de
musique de toutes les nations. Le travail le plus com-
plet que nous possdions en ce genre, est celui qu'a
publi M. Ftis, sous ce titre : Biographie gnrale des
Musiciens.
Bis. Mot latin qui signifie deux fois, et dont on se
sert en musique, soit pour faire recommencer un air
84
BOH
quand il est fini, en disant bish. celui qui l'a chant, soit
pour marquer dans une mme pice de musique, qu'un
mme trait de chant doit tre excut deux fois de
suite.
Bischero. (cheville). Dans les instruments cordes,
on appelle chevilles les petites pices de 1er ou de bois
sur lesquelles on roule les cordes, et qui servent
ainsi leur donner plus ou moins de tension pour les
accorder.
Biscome. Mot italien qui signifie double-croche.
Bissex. Espce de guitare monte de douze cordes,
invente en
1770,
par un chanteur parisien, nomm
Van-Hecke. L'tendue de cet instrument tait de trois
octaves et demie.
Blanche. C'est le nom d'une note qui vaut deux
noires, ou la moiti d'une ronde. Autrefois on l'appelait
minime.
B mi. C'est le nom que l'on donnait la septime ma-
jeure de do, aujourd'hui appele si.
Bocal. Petit hmisphre concave de mtal, d'ivoire
ou de bois dur, perc par le milieu, et qui forme l'extr-
mit infrieure du cor, du trombone, du serpent, etc., etc.
Bohme (Notice historique sur la musique en). La
Bohme a produit un nombre prodigieux de composi-
teurs et d'excutants d'un grand mrite.
Ds les
xv
e
et xvi
e
sicles on vit se former dans la majeure
partie des villes de la Bohme plusieurs congrgations,
dont le noble but tait d'augmenter la splendeur du
culte divin au moyen du chant. Rodolphe II, dont le
rgne fut la plus brillante poque pour la littrature et
les arts en Bohme, monta ses frais une magnifique
chapelle compose d'artistes italiens et bohmiens. Mais
l'poque qu'on peut appeler juste titre le plus beau
temps de la musique en Bohme, commence l'expulsion
des protestants, sous Ferdinand II et Ferdinand III.
Dans chaque couvent, dans chaque paroisse, il existait
des possessions dont le produit tait affect l'entretien de
la musique du chur. Dans les collges et les sminaires,
la musique formait la partie principale des plaisirs et
des rcrations.
Les moyens d'apprendre cet art ne
manquaient dans aucune partie de la Bohme. Il
y
avait
jusque dans le plus petit bourg un matre d'cole charg
d'apprendre la musique.
Il ne faut donc pas s'tonner
si la Bohme compte parmi ses enfants, Gossmann,
BOU 85
Gluck, les deux Benda, Stamitz, Weber, et si l'un des
plus beaux Conservatoires de l'Europe se trouve
Prague, en Bohme.
Boiteux. Se disait anciennement d'un contre-point
charg de syncopes, de contre-temps sur lesquels la voix
semblait sautiller.
Bolro. Sorte d'air de chant et de danse en usage en
Espagne. Le bolro est presque toujours accompagn par
une guitare, par des castagnettes, ou par un violon.
Le bolro est souvent crit en mode mineur et dans la
mesure trois temps.
Bombarde. C'est, dans l'orgue, un registre de tuyaux
anche, ouvert de seize et mme de trente-deux pieds,
imit d'aprs l'instrument dont ils est question dans
l'article suivant.
Bombarde. Instrument a vent en bois dont on taisait
un grand usage dans les sicles passs. Cet instrument
tait de l'espce du hautbois, avait six trous pour les
doigts, diffrentes clefs, et se jouait avec une anche.
Bombardon. C'est un instrument grave, sans clefs,
et trois cylindres, dont le ton diffre un peu de celui
de rophiclide. Son tendue va du
fa,
une octave au-
dessous de la ligne clef de
fa,
jusqu'au r au-dessus des
lignes.
Cet instrument, dont le son est trs-fort, ne peut ex-
cuter que les successions d'un mouvement modr. Il
produit un bon effet dans les grands orchestres o. les
instruments vents dominent.
Bombix. Nom grec de l'ancien chalumeau.
Bombo. Anciennement on appelait ainsi la rptition
d'une note sur le mme degr.
Bomby kas. Nom grec des clefs des instruments
vent.
Bouche. On donne ce nom l'ouverture horizontale
pratique au bas d'un tuyau d'orgue pour laisser
chapper l'air qu'il contient.
Bouffon, opra bouffe. C'est le titre que l'on donne
un certain genre de drame lyrique en opposition avec
le genre srieux. Cette dnomination est particulirement
en usage en Italie, ou affecte aux ouvrages italiens. En
Italie, chaque ville, pour ainsi dire, a son bouffon
par-
ticulier, national, parlant exclusivement le dialecte po-
pulaire. Milan a son Jirolama
;
Venise a le Pantalon, le
Scaramouche, le Brighella; Florence a la Fiorentino
;
86 BRA
Rome a la Bergama$que
z
YJSminente, bouffon femelle;
Naples en a deux, l'un pour l'opra, le Lazzaroni,
l'autre pour la comdie et le mlodrame, Pulchinella,
Les comdiens chantants ne sont fixs en aucun lieu en
Italie ;
les engagements ne se font que pour une saison,
et rarement on voit les mmes chanteurs une anne en-
tire dans la mme ville.
Les drames franais, dans le genre bouffe, s'appellent
plus ordinairement opras-comiques. (Voyez Thtre
Italien et Opra-Comique.)
Boulina-ha-ha. Chant des matelots franais pendant
qu'ils hlaient sur les quatre principales boulines (cordes
servant h la manuvre des voiles,) ce chant est aujour-
d'hui remplac par les coups de sifflet.
Bouquin. Sorte de corne recourbe, servant de trompe
d'appel.
Bourdon. C'est le nom par lequel on dsigne ordinai-
rement les tuyaux ou cordes d'instruments qui donnent
toujours le mme son dans le grave, comme dans les
musettes, les vielles.
Bourdon est galement le nom
de certaines grandes cloches.
Bourre. Sorte d'air h deux temps, propre une
danse qui est en usage en Auvergne.
Boutade. Nom ancien d'un petit ballet impromptu.
Brabanonne. Nom d'une chanson patriotique Belge
dont la musique fut compose en 1830 par Compenhout.
Brailler. Excder en chantant le volume de la
voix.
Branle. Sorte de danse fort gaie, qui se danse en
rond, sur un air court et en rondeau, c'est--dire avec
un mme refrain la fin de chaque couplet.
Bravo. Exclamation que nous avons emprunte aux
Italiens, et qui nous sert aujourd'hui, comme eux,
exprimer l'admiration due un artiste qui excelle dans
son art.
Les Italiens ont l'habitude, flatteuse pour le compo-
siteur, de crier au thtre, pendant un morceau de mu-
sique o l'orchestre domine : Brava la viola! bravo il
fagoito ! Si c'est un chant mlodieux et pathtique qui
les flatte, ils ont aussi la coutume de crier tour tour :
Bravo, Sacchini ! bravo, Cimarosaf bravo, Rossini !
bravo, Ricci ! bravo, Donizetti ! bravo, Verdi !
Bravoure. (Air de). Air dans lequel se trouvent plu-
sieurs passages d'une certaine tendue, que la voix ex-
BUC
87
cutc avec tout le brio, toute la dsinvolture imaginables,
et destine ordinairement faire briller l'habilet du
chanteur.
Bravoure. On dit air de bravoure, genre de bra-
voure, qui est oppos au genre simple et cantabile.
Brve. Ce mot signifiait autrefois une figure de note
qui avait la valeur de deux rondes.
Aujourd'hui on
appelle brves les notes dont la valeur est moindre que
les prcdentes, et spcialement celles qui suivent imm-
diatement les notes pointes : ainsi, une noire prend le
nom de brve, lorsqu'elle est aprs une blanche pointe,
la croche aprs une-noire pointe.
Brillant. Ce mot indique une modification de carac-
tre. -On dit : musique brillante
;
excution brillante.
Brioso (vif). Ce mot joint h. Vallgro le rend plus vif,
plus rsolu et plus brillant.
Brochette. Echelle comparative, ou gamme d'un ca-
rillon.
Broderie se dit en musique de plusieurs notes que le
musicien ajoute sa partie dans l'excution, pour varier
un chant souvent rpt, pour orner des passages trop
simples, et. pour faire briller la lgret de son gosier ou
de ses doigts. Rien ne montre mieux le bon ou le mau-
vais got d'un musicien, que le choix ou l'usage qu'il fait
de ces ornements.
Bruit, C'est en gnral toute motion de l'air qui se
rend sensible l'organe auditif. Mais en musique, le
mot bruit est oppos au mot son, et s'entend de toute
sensation de l'oue qui n'est pas sonore et apprciable.
On donne par mpris le nom de bruit une musique
tourdissante et confuse, o l'on entend plus de fracas
que d'harmonie. Ce n'est que du bruit
;
cet opra
fait
beaucoup de bruit et peu
d'effet.
buccin. Espce de trombone que l'on a adopt pour la
musique militaire. Il ne diffre du trombone ordinaire
que par son pavillon taill en gueule de serpent. Le son
du buccin est plus sourd, plus sec, que celui du trom-
bone.
Buccine. Se disait autrefois pour la trompette.
Bche. Espce d'instrument de musique qui consiste
dans une caisse longue et assez semblable une bche
;
il est compos de trois ou quatre cordes de laiton que
88
G
l'on fait rsonner fort, soit avec un bton soit avec le
pouce.
Budani
(Juvietta). Clbre luthier qui exerait son art
Brescia, en 1580.
Buffet. Se dit de toute la menuiserie ou se trouvent
renferms les jeux d'un orgue.
Buffo. Chanteur qui joue un rle plaisant dans l'o-
pra comique. On le divise, en Italie, en.
buffo
primo
(premier), buffo
secondo e terzo (second el troisime),
buffo
nobile (noble), cli mezza carattere (mixte), cari-
cato (exagr),
buffo
cantante e comco (chantant, co-
mique.
Bugle. Espce de trompette dont le tube est perc de
diffrents trous et arm de clefs. Il futimaginpar Wei-
dinger.
Bulaffo. Instrument de musique en usage sur les c-
tes de Guine. C'est la runion de plusieurs tuyaux de
bois attachs les uns aux autres avec des bandes de cuir.
Les ngres frappent ces tuyaux avec de petites ba-
guettes.
Buonacordo. C'tait un clavecin dans lequel l'espace
des octaves pouvait s'adapter aux petits doigts des en-
fants.
Burletta, Burlette. Nom que l'on donne un
petit opra comique, une petite farce en musique.
Busca tibia. Instrument vent de l'antiquit la plus
recule, qui avait la forme de notre cornet et qui tait
fait d'ossements d'animaux.
Busseto (Giov. Mar.) luthier de Brescia qui avait
adopt les formes de Gaspard di Salo. Il exerait de 1550
1580.
C
C. Cette lettre sert marquer la mesure quatre
temps. Elle devient le signe de celle deux temps, si or.
la traverse d'une ligne perpendiculaire. C'est ce qu'on
appelle C barr.
CAD
89
Lorsqu' la clef d'un cancn ferme' deux parties, on
trouve un G simple et un G barr l'un sur l'autre, c'est
une marque qu'une des parties excute le chant tel qu'il
est not, et que l'autre donne toutes les notes, pauses,
silences, le double de leur valeur. Lapartie dont la marque
est en haut commence la premire.
Le G plac hors des lignes, signifie canto; s'il est plac
hors des lignes et accompagn d'un B, il signifie
Col basso.
G sol ut, ou simplement C, caractre ou terme de mu-
sique qui indique la premire note de la gamme, que
nous appelons ut.
G sol faut. On appelait ainsi dans l'ancien solfge le
do, clef du violon au-dessous des lignes, attendu qu'on
y
chantait tantt la syllabe sol, tantt la syllabe
fa,
tantt la syllabe ut.
G tait anciennement le signe de la prolation mineure
imparfaite.
G travers d'une barre inclique la mesure deux
temps.
G sur les lignes de la porte marque la mesure quatre
temps.
G indique la clef de
fa.
Gabalette. Pense lgre et mlodieuse, ou cantilne
pleine d'une simplicit qui flatte, dont le rhythme bien
marqu se grave facilement dans l'me de l'auditeur, et
qui a tant de naturel, qu' peine entendue, elle est rp-
te par ceux qui savent la musique et par ceux mme qui
la sentent sans la savoir.
Cachet. Manire de faire, caractre particulier qui
distingue les ouvrages d'un compositeur.
Gachoucha. Nom d'une danse espagnole excute par
un homme et une femme sur un air vif et passionn.
Cacophonie. Union discordante de plusieurs sons mal
choisis ou mal accords. Ce mot vient du grec cacos mau-
vais, etphone, son.
Cadence. La cadence est la terminaison d'une phrase
musicale sur un repos.
On peut briser, suspendre t>u dtourner cette termi-
naison; de l, plusieurs sortes de cadences :
La ca-
dence parfaite, la cadence la dominante ou demi ca-
dence, la cadence imparfaite, la cadence rompue, la
cadence vite et la cadence plagale.
90 CAL
La cadence est parfaite, quand, l'accord de domi-
nante succde l'accord parfait sans renversement.
La cadence la dominante ou demi-cadence est un re-
pos momentan sur l'accord de dominante.
La cadence imparfaite ou suspendue est la rsolution
de l'accord de dominante sur l'accord parfait renvers.
Comme celui-ci n'exprime qu'un repos imparfait, la ca-
dence est nomme imparfaite.
Quelquefois on retarde la ralisation de la cadence par-
faite en reproduisant plusieurs fois la cadence la do-
minante ou la cadence imparfaite.
ta cadence est rompue lorsqu'on rsout l'accord de
dominante, non point dans raccord parfait naturel ou
renvers du ton dans lequel on est, mais en prenant l'ac-
cord parfait du ton relatif. Cet artifice harmonique est
trs-frquemment employ.
La cadence est vite quand, au lieu de la rsoudre,
on passe dans un autre ton.
Nous parlerons ailleurs de la cadence yiagale. (Voyez
ce dernier mot.)
Cadence. C'est le battement du gosier qui se fait quel-
quefois sur ta pnultime note d'une phrase musicale. Le
mot de cadence, pris dans ce sens, n'est plus en usage
parmi les musiciens
;
on l'a remplac par celui de trille.
(Voyez ce mot.)
Cadence (la) est une qualit de la bonne musique,
qui donne
ceux qui l'excutent ou qui l'coutent
un sentiment vif de la mesure, en sorte qu'ils l'a mar-
quent et la sentent tomber propos, sans qu'ils
y
pen-
sent et comme par instinct : cette qualit est surtout re-
quise dans les airs de danse.
Cadence
signifie encore la conformit des pas du dan-
seuravecla
mesure marque par l'instrument.
Cadence.
Une musique bien cadence est celle ou la
mesure est sensible, ou le rhythme et l'harmonie concou-
rent le plus parfaitement qu'il est possible faire sentir
le mouvement.
Caesta.
Luthier dont les violons ont une certaine r-
putation
,
natif de Crmone, imitateur du Stradivarius,
travaillait en 1677.
Caisse (Grosse). (Voyez le mot Tambour.)
Calachon.
Petit instrument qui avait la forme d'un
luth
long manche avec une touche et deux cordes, et
CAN 91
que l'on faisait vibrer avec les doigts ou un petit morceau
de bois.
Calamel. Nom donn par les anciens crivains au
chalumeau. (Voir ce mot).
Calare. Baisser, par opposition ascendere.
Galathisme. Danse anciennement en usage chez les
Grecs lors des ftes annuelles en l'honneur deCrs.
Calcul, On se sert de ce mot pour dsigner la partie
purement scientifique de l'art musical, ou pour indiquer
un genre de musique qui manque de chaleur et d'inven-
tion, et dans laquelle on sent trop le mcanisme de
l'art.
Calibre. Plaque triangulaire servant au facteur d'or-
gues pour former les bouches des tuyaux d'orgues.
Calichon. Ancien instrumente la forme d'un luth,
mont de cinq cordes accordes au sol de la basse, qua-
trime espace do au-dessous des lignes en clef de violon,
et
fa,
la, r, mme clef, premier et second espace et
quatrime ligne.
Calinda. Danse des ngres croles en Amrique,
qu'ils excutent rangs sur deux lignes en face les uns
des autres, avanant et rcculanten cadence et faisant des
contorsions et des gestes lascifs.
Callinique. Chanson de danse des anciens Grecs,
excute en l'honneur d'Eercule.
Camillus de Camille. Luthier, n Mentana, imita-
teur de Stradivarius. On a des violons qui portent ce
nom, dats de 1713.
Campagne.
Un des noms de la flte de Pan.
Canaris. Ancienne espce degigue, en mesure 6[!6.
et excute avec un peu plus de mouvement.
Cancan. Danse indcente interdite par la police.
Campana. Grande cloche qui tait suivantStrabon, plus
volumineuse que celle qui servait ordinairement donner
des signaux.
Canarder. C'est, en jouant du hautbois, tirer un son
nasillard et rauque, approchant du cri du canard
;
ce
qui arrive aux commenants, et surtout dans le bas,
pour ne pas serrer assez l'anche avec les lvres.
Canevas.
C'cstainsi qu'on appelait les paroles ajustes
par le musicien aux notes d'un air parodier. Ces paro-
les, insignifiantes, servaient de guide au pote en lui
marquant le mtre et la coupe des vers, et Tordre sui-
vre pour les rimes.
4.
92
GAN
Canna D'organo, Tuyaux d'orgue. Tubes ou ca-
naux de bois, d'tain, ou d'un mlange mtallique ap-
pel toff, de forme carre, cylindrique ou conique,
dans lesquels ont fait entrer le vent qui produit le son
de l'orgue.
Canna, Roseau. Plante qui crot dans les pays chauds
et les contres mridionales de l'Europe.*Les paysans se
servent encore de ces tiges creuses pour faire des flageo-
lets, des fifres, etc.
Canon. Ancienne rgle ou mthode de dterminer les
intervalles des sons.
Canon. C'est une sorte de fugue qu'on appelle perp-
tuelle, parce que les parties, partant l'une aprs l'autre,
rptent sans cesse le mme chant. Il
y
a plusieurs es-
pces de canons; pour les connatre toutes, il faut avoir
gard :
4
Au nombre des parties : le canon peut tre deux,
trois, quatre parties, ou davantage
;
2
Au nombre des solutions : il
y
a des canons
qui n'admettent qu'une solution, il
y
en a qui en admet-
tent un plus grand nombre
;
3
Au nombre des voix principales : un canon d'une
seule voix principale s'appelle canon simple
;
un canon
compos de plusieurs voix principales s'appelle canon
double, triple, etc., selon le nombre de ses voix.
4
Aux intervalles par lesquels se faitla reprise; il
y
a
des canons l'unisson, la seconde suprieure ou inf-
rieure, la tierce suprieure ou infrieure et de mme
la quarte, la quinte la sixte
;
5
A la dure de l'imitation : tout canon se compose
de faon, ou que la voix suivante rpte le chant de la
premire en entier, et que pendant que l'une des parties
finit, l'autre puisse recommencer le chant de nouveau
;
ou il ne se compose pas de cette faon, la voix suivante
ne rptant le chant de la prcdente que jusqu' une
certaine distance marque, et la pice Unissant par l.
Un canun de la premire espce se nomme canon perp-
tuel ou oblig; le second s'appelle canon libre. Quand
le canon perptuel est compos de telle sorte qu' chaque
reprise on change de ton, et qu'il faut faire par cons-
quent le tour des douze modes, on l'appelle canon circu-
laire.
6
A la figure des notes : quand l'imitation des parties
se fait par augmentation ou par diminution: il en r-
CAN 93
suite un canon par augmentation ou diminution; et cette
augmentation ou diminution peut tre double, triple, et
davantage
;
7
Au mouvement : il
y
a des canons par mouvement
contraire, par mouvement rtrograde, et par mouvement
rtrograde et contraire;
8
A la qualit des parties : on fait des canons sur un
canto fertno, on en fait d'autres avec des parties acces-
soires la tierce, ou avec une partie qui sert d'accompa-
gnement.
9
Aux temps de la mesure : on fait des canons con-
tre-temps, dans la classe desquels on peut aussi ranger
ceux par imitation interrompue
;
10"
A la manire d'crire le canon : on les crit de
deux manires :
1
l'on ne met par crit que la voix prin-
cipale du canon, pour en faire deviner les antres au lec-
teur, ce qui s'appelle canon ferm
;
2
on
y
joint toutes
les voix conscutives la voix principale en les mettant
en partition, ce qui s'appelle canon ouvert.
Canon. Espce de monocorde servant anciennement
de diapason, pour l'enseignement de la musique vocale
dans les coles.
Canon (demi). Sorte de petite flte en usage en 1349.
Gantabile. Adjectif italien qui signifie chantable,
chantant, ce qui est fait pour tre chant, c'est--dire le
morceau o l'on doit runir tous les moyens, tous les
pouvoirs, tous les ornements du chant.
Un morceau de musique teJ que le cantabile est le
plus difficile qu'on puisse excuter : aussi il n'appartient
qu'aux grands talents de le bien chanter, car il exige les
quali's de la voix les plus parfaites, et l'emploi le plus
svre de la mthode de chant. Les qualits requises
pour bien chanter le cantabile sont : 1
e
de possder par-
faitement l'art de filer les sons
;
2
d'excuter les phrases
de chant, les agrments et les traits, avec expression
;
3
enfin, de mettre beaucoup de moelleux et d'onction
dans le port de la voix.
Le cantabile est au chanteur ce que Yadagio est l'ins-
trumentiste.
Cantate. Sorte de petit pome lyrique qui se chante
avec des accompagnements, et qui, bien que fait pour les
salons, doit recevoir, du musicien, la chaleur de la musi-
que imitative et thtrale.
Les airs, les scnes, les churs d'opras que l'on ex-
94
CAP
cute dans les concerts et les runions musicales, ont fait
perdre l'usage de la cantate. On en compose cependant
encore de temps en temps ponr certaines ftes solen-
nelles.
Gantatile. Petite cantate fort courte.
Cantatrice. On dsigne ainsi les femmes qui aprs
avoir reu de la nature un organe sonore, ont su le rendre
propre au chant, en se livrant de bonne heure et avec as-
siduit Ftude de la musique et la pratique des exer-
cices de la bonne cole de chant. (Voyez les articles
Opra, Acadmie de musique.)
Cantilena. Nom que les italiens donnaient autrefois
la musique mondaine pour la distinguer de la musique
sacre, que l'on appelait motets.
Cantique. Hymne que l'on chante en l'honneur del
Divinit. Les premiers et les plus anciens cantiques fu-
rent composs l'occasion de quelque vnement mmo-
rable, et doivent tre compts parmi les plus anciens
monuments historiques. Ces cantiques taient chants
par des churs en musique, et souvent accompagns de
danses, comme nous le voyons dansl'Ecriture, la pice la
plus importante qu'elle nous oifre en ce genre est le can-
tique des cantiques, ouvrage attribu Salomon.
Dans un sens plus moderne et plus en usage, on ap-
pelle cantique un hymne en langue vulgaire, dans lequel
on clbre Dieu, les anges, les saints ou quelque vrit
de la religion, et compos expressment pour l'dification
des fidles.
Il doit tre religieux, puisqu'il doit exprimer des ides
religieuses; noble, puisque toutes les ides religieuses
.le sont; vari comme elles, et toujours simple, parce
qu'il doit tre autant que possible accessible la multi-
tude.
Cantomane. Celui ou celle qui a la manie de chan-
ter.
Cappa (Geofred), luthier de Crmone, lve d'Amati,
naquit en 1590, il quitta son pays en 1010 et fut fondera
Sahi7zio une cole clbre de lutherie.
Gaxtoria (tribune). Espce de galerie stable, ou
momentanment leve dans les glises pour les artistes
qui excutent la musique vocale ou instrumentale.
Caprice. Sorte de pice de musique, libre, fantasque ou
bizarre, dans laquelle l'auteur, sans s'assujtir aucun
sujet, donne carrire son gnie, et se livre tout le
CAR
95
feu de la composition. Les caprices de Locatelli ont joui
d'une grande clbrit.
Caractre. Pour qu'une musique ait du caractre,
il ne suffit pas qu'elle exprime les paroles auxquelles elle
est applique, ni mme la situation dramatique, car une
symphonie excute dans un concert et dnue de paroles,
peut aussi avoir cette qualit
;
il faut que cette expres-
sion ait quelque chose de particulier qui saisisse l'oreille
et l'me de l'auditeur. Le caractre est donc une certaine
originalit qui se sent tout de suite, qui distingue'un
morceau de la foule, qui l'lve au-dessus de beaucoup
d'autres, peut-tre mieux faits, plus remplis de mrite,
mais auxquels manque cette originalit qui sauve les
uvres d'art de l'oubli.
Caractres. Indpendamment des qualits qui appar-
tiennent au style considr comme art d'crire, il en est
d'autres qui, tenant de plus prs l'expression, donnent
la composition une teinte gnrale et servent encore
dterminer les styles
;
c'est ce qu'on nomme caractres.
De ces caractres les uns sont gnraux, tant relatifs
i nos affections;
2
au degr dans lequel nous les
ressentons
;
3
au ton sur lequel nous les exprimons. Le
premier donne le caractre gai ou triste
;
le second la vi-
vacit ou la douceur
;
le troisime la sublimit ou la sim-
plicit. Chacun de ces trois tats a un caractre moyen :
en les combinant, on aura un grand nombre de caract-
res mixtes, dont voici les principaux
;
1
Le caractre ou style tragique, qui runit la tristesse
la force et la sublimit
;
2
le bouffon, qui joint la
gaiet la vivacit
;
3
enfin le demi -caractre', qui ru-
nit les situations moyennes.
Les autres caractres sont particuliers
;
ils se rappor-
tent diverses circonstances, telles que les habitudes
d'un peuple ou d'une classe d'hommes
;
ainsi on a le
style religieux, le style militaire, le style pastoral.
Caractres de musique. Ce sont les divers signes
qu'on emploie pour reprsenter tous les sons de la mlo-
die et toutes les valeurs des temps et de la mesure, en
sorte qu' l'aide de ces caractres on peut lire et excuter
la musique exactement comme elle a t compose : cette
manire d'crire s'appelle noter. (Voyez Notes).
Carillon. Les grands carillons ne peuvent tre
placs
que dans les clochers. Presqne toutes les glises de Hol-
lande en ont
;
ceux d'Amsterdam sont les plus fameux.
96 CAS
L'glise paroissiale de Berlin en possde aussi un, et ce-
lui de la Samaritaine, Paris, tait mis enjeu par des
cylindres qui marchaient au moyen de roues hydrau-
liques.
Carillon. Runion de cloches accordes de manire
former une
chelle chromatique.
Le premier
carillon fut excut Alost, en Flandre,
en 1487.
Carnes. Nom de certaines ftes des Spartiates, qui
duraient neuf jours, pendant lesquels a\aient lieu des
concours publics de musique.
Carnix. C'est le nom d'une trompette en usage chez les
anciens Grecs
;
elle avait un son aigu et trs doux.
Carta di musica, Papier rgl. On appelle ainsi le
papier prpar avec les portes toutes traces pour
y
no-
ter la musique.
Cartello (Thtres di). On dsigne ainsi en Italie les
thtres de premier ordre, tel que la Scala de Milan,
San Carlo de Naples, la Pergola de Florence, la Fnice
de Venise, Regio de Turin, Apollo de Rome, Carlo Al-
berto de, Gnes, etc
,
etc. Il
y
a aussi dans de trs-petites
ville, l'occasion des foires, des saisons de thtres di
cartello. La saison di Fiera de Bergame, est une des
plus renommes. Les artistes di cartello sont, en
gnral, les plus clbres, et par consquent les mieux
pays.
Gartilles. Grandes feuilles de peau ou de toile, prpa-
res et vernies, sur lesquelles on marque des portes
pour pouvoir
y
noter tout ce qu'on veut en composant,
et l'effacer ensuite avec une ponge.
Casino. Mot italien. Se dit d'un lieu o l'on se rassem-
ble pour se livrer au plaisir de la musique, de la danse
et du jeu.
Cassi-flute. Instrument du genre de l'orgue, in-
vent Paris en 1857 par Cassi-Mloni.
Castagnettes. Instrument de percussion compos de
deux petites pices de bois concaves faites en forme de
noix. On fait rsonner ces concavits en les appliquant
l'une contre l'autre. On tient une castagnette en deux
pices de chaque main, en passant les doigts dans les
cordons qui les runissent. Cet instrument est fort en
usage chez les Espagnols, qui s'en servent pour mar-
quer la mesure en dansant le fandango, le bolerola segui-
dilla.
GAT
97
Gastorium melos. Certain air guerrier qui faisait al-
lusion aux exploits de Castor et Pollux et qui imitait leurs
batailles.
Castrat. Chanteur de soprano ou de contralto qu'on a
priv ds son enfance des organes de la gnration pour
lui conserver unp voie aigu, comme celle d'un enfant.
Les voix de castrats, dans la musique sacre, produi-
saient un effet si merveilleux, qu'on ne tarda pas les
employer dans les thtres lyriques. Peu peu le nombre
des castrats devint trs considrable, et les plus clbres
d'entre eux firent d'immenses fortunes. Cet exemple
poussa h la spculation, et il se trouva des parents dna-
turs qui cherchrent s'enrichir parce moyen odieux.
Aujourd'hui cet usage barbare a compltement dis-
paru.
Les castrats les plus clbres des temps passs sont
Parinelli, lve de Porpora, au dix-huitime sicle, le
plus admirable chanteur qu'on ait jamais entendu :
Bernacchi, qui s'est fait la mme poque, une grande
rputation comme chanteur et comme professeur
;
Pasi,
Minelli, Conti, surnomm Giziello, du nom de son ma-
tre Gizzy
;
Paul Nicollini et une foule d'autres. Napolon
possdait sa cour le fameux sopranisteCrescentini, une
des dernires et des plus brillantes toiles de cette
pliade -de grands chanteurs.
Catabasis. Ce mot, chez les anciens Grecs, signifiait
une progression de son descendante.
Catakoreusis. Cinquime et dernire partie du nome
pythien excut par les concurrents dans les jeux
py-
thiques.
Catachrse. Les musiciens pythagoriens expliquaient,
au moyen de la catachrse, une suite de sixtes entre trois
parties, c'est--dire d'accords de sixtes.
Catacoustique. Science des chos ou sons rflchis,
d'o dpend celle des salles de spectacle.
Cataphonique. Science des sons rflchis, qu'on ap-
pelle aussi catacoustique.
Gataplon. Nom d'une certaine danse pyrrhique des
Grecs.
Catch. Nom anglais d'une certaine espce de petits
canons ou fugues, que l'on chante dans les socits,
comme simple divertissement.
Catena, Barre. Petite lame de bois que l'on colle au
93 CHA
dedans des instruments archet dans la longueur de la
table d'harmonie.
Cavarre il suono, Tirer du son. Manire de faire
sortir le son de quelque instrument : de l les diffrentes
qualits ou modifications du son. On dit : tirer des so?is
doux et pres.
Cavatine. Sorte d'air, pour l'ordinaire assez court,
qui n'a ni repriseni seconde partie, et qui se trouve sou-
vent dans des rcitatifs obligs. Ce changement subit
du rcitatif au chant mesur, et le retour inattendu du
chant mesur au rcitatif, produisent un effet admirable
dans les grandes expressions.
Ccile (Ste.) Romaine qui souffrit le martyre en Si-
cile, sous l'empereur Marc Aurle. Les musiciens l'ont
prise pour patronne parce que en chantant les louanges
de Dieu elle s'accompagnait souvent avec un instru-
ment.
Cleste (musique). Se dit de certains registres d'or-
gue qui produisent des sons doux et voils.
On dit
galementjeux clestes
,
pdales clestes.
Clestino. Sorte de clavecin archet invent en Alle-
magne par le mcanicien Walker, en 178-1.
Cembalo. (Voyez Clavecin).
Centre Phonique. On nomme ainsi le lieu o se tient
celui qui parle dans un cho et centre phonocamptique
l'endroit qui renvoie le son.
Centon, en italien centone. On appelle ainsi un orato-
rio, un opra compos d'airs de plusieurs matres. On
lui donne aussi le nom de pastieco, pastiche, composi-
tion dans laquelle il entre des morceaux de divers au-
teurs. Ce mot drive du grec centon, habit de plusieurs
morceaux.
On nomme galement Centon des fragments de traits
recueillis et arrangs pour la mlodie qu'on a en vue.
Cerataule. Musicien qui sonnait une espce de
trompe faite avec une corne d'animal.
Cerceau. Sorte d'instrument de musique en bronze
dont les Grecs et les Romains taisaient usage dans leurs
jeux, en l'agitant en Tair et en le frappant avec une ba-
guette de fer.
Cervelas. Diminutif de basson. Son nom indique la
forme de cet instrument qui n'avait ordinairement que
cinq pouces de long.
Chacone. Air de danse trs-tendu, qui servait de fi-
CHA 99
nale un ballet ou un opra. La chacone n'est plus en
usage sur aucun thtre. Elle s'crivait deux ou trois
temps et quelquefois quatre.
Chahut. Nom d'une danse indcente usite dans cer-
tains bals publics.
Chalumeau. Instrument vent fort ancien, et le pre-
mier, peut-tre qui ait t invent. Cet instrument pas-
toral n'tait dans l'origine qu'un roseau perc de plu-
sieurs trous. Le chalumeau moderne tait une espce de
petit hautbois, que Ton a abandonn cause de la mau-
vaise qualit de ses sons. L'embouchure se composait
d'un morceau de roseau taill d'une seule pice ou divis
en deux parties ou languettes trs-minces et trs-rappro<-
ches. Le tube infrieur ^'largissait en forme de pavil-
lon.
Changuion. Instrument anches libres, sorte de
phylharmonica invent Paris en -1846.
Chanson (la). L'homme mu d'un sentiment gai,
tendre, ardent ou belliqueux qui prolonge ses accents,
les module et varie les tons de sa voix en mlant des
paroles cette expression naturelle, fait une chanson. Le
guerrier scalde, qui s'criait sur le champ de bataille:
corbeaux, voici votre pture
;
nos ennemis sont morts,
remerciez-moi
;
venez, voici votre pture, et qui ac-
compagnait ces mots d'inflexions diverses, faisait une
chanson militaire.
Cette origineest commune toutes les espces de chan-
sons. Les rgles sont nes ensuite du nombre mme des
exemples, et ont t soumises cette manire d'exprimer
son motion par une alliance intime du chant et du lan-
gage.
Nous ne nous arrtons pas, ainsi que l'a fait Rousseau,
sur l'origine plus ou moins ancienne de ce petit pome,
et nous avons de bonnes raisons pour nous en tenir
l'opinion d'Aristote, qui prtend que les lois elles-mmes
taient des chansons. Chez les Grecs, les unes et les au-
tres empruntaient le secours de la mlodie.
La chanson, parmi nous, est un petit pome marqu
d'unrhythme populaire et facile
;
passant de bouche en
bouche, et rapide comme la renomme, il devient l'ex-
pression de tout un peuple, qui rpte ses refrains
joyeux ou passionns. Comme la chanson se prte
tous les sentiments, elle emprunte aussi tous les tons;
iOO CHA
gaie, tendre, satirique, philosophique, jamais fe n'eut
dans ses mains un prisme plus variable : la seule teinte
qu'elle rejette est celle du pdantisme.
Si nous cherchons tablir une espce d'ordre dans
un sujet qui en comporte si pen, nous trouvons d'abord
la chanson religieuse, la chanson politique et patriotique,
la chanson guerrire, la chanson philosophique, la chan-
son satirique ou vaudeville, dans laquelle les Franais
ont surtout excell
;
la chanson grivoise, qui est l'abus
et l'excs de ce dernier genre; enfin la chanson burles-
que, ou parodie, qui tient de la chanson grivoise et de
la chanson satirique. Au reste, il est inutile de dire que
tous ces genres rentrent souvent l'un dans l'autre, et
qu'il est par consquent impossible d'en dterminer
exactement les limites.
De la chanson religieuse. De tout temps l'exaltation
religieuse a produit des chants, et les hymnes se sont
levs vers le ciel avec la fume des anciens sacrifices.
Sans parler des hymnes d'Orphe, des pans ou canti-
ques sacrs des Grecs, deceux des adorateurs du soleil,
dont on retrouve quelques vestiges dans les fragments
du Zendavesta, sans nous occuper de ces chants hbra-
ques connus sous le nom de psaumes, passons cet usage
populaire des chants inspirs par la religion chr-
tienne.
Ces chansons, appeles cantiques ou nols, sont cu-
rieuses comme monuments de l'esprit humain. La plus
connue, comme la plus burlesque de nos chansons reli-
gieuses, est celle que le peuple adressait l'ne, qee l'on
ftait jadis comme l'animal choisi par Dieu mme pour
porter son fils h Jrusalem.
Plus tard , lamalignit satirique s'emparant du rhy thme
des anciens cantiques, transforma en pi grammes licen-
cieuses les navets des vieux nos.
La chanson politique onpatriotique. L'antiquit nous
a laiss quelque chefs-d'uvre dans ce genre. Le plus
clbre, c'est le chant d'Harmonius et Aristogiton
;
Mon pe est entoure de myrte
;
elle me rappelle le
souvenir de nos frres qui ont rtabli l'galit des lois.
Harmodius et Aristogiton frapprent d'un glaive orn
de ces feuilles verdoyantes le tyran qui opprimait la R-
publique. Mon pe, sois entoure de myrte; je te con-
sacre leur mmoire.
Ombres saintes, vous n'avez pas cess de vivre invi-
CHA 101
sibles
;
vous prsidez encore nos destines. Vous tes
au milieu de nous, et vous souriez vos amis, alors
qu'en votre honneur ils couronnent leur coupe et leur
glaive de myrte vert.
a Mon pe, sois entoure de myrte,, et rappelle-moi
sans cesse le souvenir des deux frres immortels qui,
dans Athnes, ont rtabli l'galit des lois.
Cette sensibilit vive, qui faisait dire Duclos que les
Franais taient. les enfants de l'Europe, s'est de tout
temps exhale en chansons. On chantait quand les An-
glais dmembraient le royaume
;
on chantait pendant la
guerre civile des Armagnacs; on chantait pendant la Li-
gue, pendant la Fronde, sous la Rgence, et c'est au bruit
des chansons de Rivarol et de Ghampcenetz que la mo-
narchie s'est croule la fin du dix-huitime sicle.
Cette rvolution de
89,
qu'avait prdite en chansons le
chevalier Delisle, en 1784, embrasa tous les curs de
l'amour de la libert, et des chants vraiment nationaux la
clbrrent : mais bientt la plus belle des passions
s'exalta jusqu' la frnsie, et les fureurs populaires
dshonorrent une cause si belle : des refrains de sau-
vages poussrent au pillage et au meurtre une population
en dlire.
La Rpublique prit au milieu de ses triomphes et de
ses succs. L'ascendant d'un seul homme remplaa l'-
nergie de la nation, et la servitude glorieuse qu'il im-
posa au peuple franais fit succder des chants de vic-
toire aux hymnes de la libert.
La muse patriotique se rveille au bruit de la chute du
conqurant. Un pote, dou de la grce et de la finesse
d'Horace, d'un esprit la fois philosophique et satirique,
d'une me vive et tendre, d'un caractre qui sympathi-
sait avec toutes les gloires de la patrie, Branger, la lyre
en main, s'assied sur le tombeau des braves. Par un ta-
lent qu"il a seul possd, il a su rassembler, dans des
pomes lyriques de la plus petite proportion, la grce
antique et la saillie moderne, la pense philosophique et
le trait de l'pigramme, la gaiet le plus vive et la sensi-
bilit la plus profonde; en un mot tout ce que l'art a de
plus raffin et la nature de plus aimable.
Chanson guerrire. Il
y
a, dit Montaigne, une har-
monie courageuse qui chauffe en mme temps le cur
et les oreilles. Les chansons militaires ont partout
anim
les hommes au combat, et les vers de Tyrte,
i02
GHA
rpts par les Athniens au son des lyres, ne contri-
burent pas moins la bataille de Marathon, que la
valeur et les talents de Miltiade.
Au moyen ge, quelques trouvres, et notamment le
clbre Bertrand de Born, qui florissait au xn sicle,
nous ont laiss des chants guerriers pleins d'entrane-
ment et d'enthousiasme. Tout le monde sait l'influence
lectrique qu'exera sous la Rpublique l'hymne mar-
seillais. A ces accents belliqueux des millions de com-
battants jaillirent tout coup sur le sol franais, et leurs
phalanges victorieuses repoussrent l'Europe coalise
contre nous.
Chanson philosophique. Quelques-unes des plus belles
odes d'Horace ne sont videmment que des chansons, et
bien avant lui, les Grecs qui mlaient tout des ides de
libert et de philosophie, animaient leurs repas par des
chansons de ce genre. Athne en rapporte plusieurs.
Aristote, aprs la mort de son ami Hermias, a compos
sur ce sujet la plus belle chanson philosophique qui nous
soit parvenue. Cette espce de chanson a d prendre
parmi nous une teinte moins svre; elle se confond le
plus souvent avec le genre erotique. Panard, Branger,
Pierre Dupont et Nadaud offrent de beaux modles de la
chanson philosophique.
Chanson satirique ou vaudeville. De tout temps, les
potes franais ont excell dans ce genre minemment
national. Sous le rapport de l'tendue, le vaudeville est
le pome pique du genre : comme il ne prescrit point
de marche rgulire, et qu'il va lanant au hasard l'pi-
gramme et la saillie, il ne s'arrte que lorsque l'auteur
a puis sa verve satirique.
Panard est le roi de l'ancien vaudeville; il
y
atteint
parfois la navet de La Fontaine et la gaiet de
Piron. Aucun chansonnier avant lui n'avait su rendre
la morale plus gaiement populaire. Coll, Jean Monet,
Pavart, Dsaugiers, ont laiss quelques vaudevilles qui
mritent de trouver place dans les recueils, mais qui ne
leur assignent dans ce genre qu'un rang trs-infrieur
Panard et plusieurs de nos contemporains, notamment
Scribe, Thaulon, Bavard, Duvert, Mlesville.
Chanson bachique. Les premires chansons de table
furent rptes en choeur, et l'on avait soin de n'y intro-
duire que les louanges des dieux. Mais la chanson de
table quitta bientt ce ton svre
;
on clbra le pouvoir
CHA 403
du vin et de l'amour. Chacun des chanteurs prit pour
sceptre une branche de myrte qu'il passait son voisin,
aprs avoir achev sa chanson et vid son verre. Quand
le voisin ne savait pas chanter, il se contentait de garder
la branche entre ses mains, tandis qu'un autre chantait
pour lui. De l cette expression populaire : Chanter au
myrte.
Anacron n'a gure fait que des chansons de table.
La meilleure est celle o il fonda sur la certitude de la
mort la ncessit de boire. Il
y
a de la grce et de l'a-
bandon dans les raisonnements qu'il oppose la Parque
fatale. Tous les chansonniers, depuis, ont adopt sa
logique.
Les chansons bachiques d'Horace ont plus de charme,
plus de philosophie. Les guirlandes enlaces par une
jeune esclave, le doux murmure des baisers timides, le
Falerne ptillant dans l'amphore, la brivet de nos
jours, la folie de l'ambition qui tourmente une vie si
courte et la ncessit d'en jouir, la combinaison de ces
ides riantes et mlancoliques, animent les chansons
d'Horace. C'est de lui que Montaigne a dit : il berce la
sagesse sur le giron de la volupt.
Nos chansons de table ont t longtemps des orgies
grossires ; celles de Matre-Adam ne manquaient pas
de verve. Chaulieu et Lafare donnrent ce genre de
chanson une forme de bonne compagnie. Les faridon-
daincs, les tourlouribo, rgnrent jusqu'au sicle de
Louis XV. Dufrny, Panard et Coll peuvent tre
regards comme les restaurateurs de la chanson ba-
chique, o ils ont t surpasss de nos jours par Dsau-
giers et Branger.
Chanson erotique. Dans l'ordre naturel, cette espce
de chanson doit avoir prcd toutes les autres. Quoi
qu'en disent Hobbes et Machiavel, les hommes ont fait
l'amour avant de faire la guerre. Bornons-nous rap-
peler ici que plusieurs odes de Catulle et d'Horace sont
les premiers modles de la chanson erotique, et qu'elles
seraient encore sans rivales, si de nos jours Branger en
France, et Thomas Moore en Angleterre, n'eussent
port ce genre au plus haut degr de perfection. Quel-
ques chansons erotiques de Boufflers, de Sgur, de
Parny et de Longchamps, peuvent tre mises au nombre
des chefs-d'uvre du genre erotique.
Chansonnette. C'est ainsi qu'on appelle aujourd'hui
104 CHA
une petite posie lvrique qui n'a rien de recherch ni
dans le sujet, ni dans l'excution.
Chant. Sorte de modification de la voix humaine, par
laquelle on forme des sons varis et apprciables; obser-
vons que pour donner cette dfinition toute l'univer-
salit qu'elle peut avoir, il ne faut pas seulement en-
tendre par sons apprciables ceux qu'on peut dsigner
par les notes de notre musique et rendre par les touches
de notre clavier, mais tous ceux dont on peut trouver ou
sentir l'unisson, et calculer les intervalles, de quelque
manire que ce soit.
Chant, appliqu, plus particulirement notre mu-
sique, en est la partie mlodieuse, celle qui rsulte de la
dure et de la succession des sons, celle d'o, dpend en
grande partie l'expression, et laquelle tout le reste est
subordonn. Les chants agrables frappent d'abord, ils
se gravent facilement dans la mmoire; mais ils sont
souvent recueil des compositeurs, parce qu'il ne faut que
du savoir pour entasser des accords, et qu'il faut du
talent pour imaginer des chants gracieux; inventer des
chants nouveaux appartient l'homme de gnie, trouver
de beaux chants appartient l'homme de got.
Dans le sens le plus resserr, chant se dit seulement
de la musique vocale, et dans celle qui est mle de
symphonie on appelle parties de chant celles qui sont
excutes parles voix.
Chant (fart du) a pour objet l'excution de la mu-
sique vocale.
La voix, dans son principe absolu, doit tre consi-
dre comme un moyen naturel d'exprimer nos senti-
ments. Applique au chant, c'est une force expansive,
qui nous porte produire au dehors nos sensations
agrables ou dsagrables, surtout quand nous sommes
sous l'influence d'une motion puissante. Il semble que
la nature ait tabli entre le coeur et l'me une liaison
merveilleuse, tant l'effet d'un air a sur nous de sponta-
nit. Aussi peut-on dire que la source du chant est en
nous, et que la voix nous a t donne pour nous lever
par des accents harmonieux une nature suprieure.
(Voyez l'arficle-Voix.)
Chant alternatif. Manire de chanter les psaumes
dans les premiers temps de l'Eglise, et qui est employe
encore aujourd'hui.
Chant du carnaval. Chansons de carnaval qu'on
CHA
d05
excutait dans les anciennes mascarades de Florence. Il
existe encore de ces chansons trois voix composes par
Henri Tsaak.
Chant du cygne. Le cygne ne chante pas; mais on
croyait autrefois qu'il exhalait un chant suave, lorsqu'il
tait sur le point de mourir. C'est par suite de cette tra-
dition qu'on a appel Chant du cygne le dernier ouvrage
d'un artiste ou d'un compositeur, lorsque cet ouvrage est
vraiment digne de son gnie. Ainsi le Requiem de
Mozart a t pour lui le chant du cygne.
Chant du ligo. Chant populaire dans les environs de
Riga en Russie, excut dans la campagne par un
chur de jeunes filles et de garons, pendant le sols-
tice d't.
Chant dur. Nom ancien d'une mlodie qui modulait
clans l'exacorde du sol.
Chant ecclsiastique. Comme nous l'avons dj dit,
les vritables fondateurs de la musique d'glise furent
saint Ambroise et saint Grgoire. Dans le sicle qui
suivit le rgne de ce dernier pontife, le pape Vitellien
introduisit dans l'Eglise romaine le chant qu'on appelle
consonnance ou plusieurs voix. Il voulut que l'orgue,
alors peine connu en Italie, accompagnt, les chan-
teurs.
Tout attestait, malgr la prsence des barbares, que
l'art musical, et spcialement le chant d'glise, luttait
avec avantage contre le gnie de la destruction. L'cole
fonde Rome par saint Grgoire tait dans l'tat le
plus florissant, et le chant, ouvrage de ce pontife et la
gloire de son rgne, fut adopt par toutes les glises qui
suivaient le rite latin.
En 754, Charlemagne demanda au Pape Etienne des
chanteurs tirs de cette cole pour enseigner la musique
ecclsiastique dans toute la France. Plus tard, il pria le
pape Adrien de lui envoyer les deux plus clbres artistes
que possdait Rome, Benoit et Thodore, dont l'un fut
destin pour la ville de Metz, et l'autre pour la ville de
Soissons, chargs tous deux d'y fonder des coles de
musique.
Dj saint Grgoire avait envoy saint Augustin en
Angleterre et saint Boniface en Allemagne. Plus tard, le
pape Agathon l'avait imit
;
mais leurs efforts, sans tre
infructueux, n'eurent point le succs de ceux d'Adrien,
dont les envoys propagrent rapidement les principes
OG CIIA
de la musique d'glise dans toutes les parties de la
France.
Au ix
e
sicle, les signes tracs au-dessus des lettres
employes dans la musique crite, furent invents pour
indiquer la manire de porter la voix dans le chant. Ces
signes prirent le nom de neumes, et firent l'aire un pas
immense l'art.
Dans le sicle suivant, de nombreuses tentatives furent
faites pour hter le progrs du chant ecclsiastique et de
la musique religieuse. La ville de Milan voit Rmi,
abb profondment vers dans cet art, et jouissant d'une
grande faveur auprs de l'empereur Othon II, ne se
servir de son crdit auprs de ce prince que pour r-
pandre le chant ecclsiastique et le faire fleurir; saint
Robert, vque de Chartres, s'efforce d'apporter des
perfectionnements h la manire de chanter en France.
Dunstan, voque de Cantorbry, introduit en Angle-
terre la mthode de chant plusieurs voix, invente par
le pape Vitellien. Thodulphe, voque d'Orlans, fut,
sous Louis le Dbonnaire, condamn une prison per-
ptuelle; il
y
composa le cantique Gloria, laus et honor
tibi, Christe Redemptor, et le chanta le dimanche des
Rameaux au moment o le prince passait processionnel-
lement. Le chant inattendu d'une belle voix, une m-
lodie pure et simple, et surtout les saintes paroles du
cantique murent le cur du monarque. Il pardonna
Thodulphe : ses fers furent briss.
Malgr les tentatives que nous venons de mentionner,
le chant ecclsiastique avait encore toutes les imperfec-
tions de l'enfance. Il tait aride, monotone, et dnu ga-
lement d'harmonie et de mlodie. Le besoin de rgles
plus sres, plus positives, se faisait partoutsentir.il
tait ncessaire qu'un esprit suprieur vint imprimer
la musique religieuse une impulsion fconde. Guido
d'Arezzo parut.
Quand nous traiterons l'article Histoire de la Musique,
nous donnerons une analyse dtaille du systme de
Guido. Bornons-nous dire ici qu'il introduisit d'im-
portantes modifications dans le chant d'glise. Quelques
crivains font mme ce moine laborieux et clbre
l'honneur de l'invention du contre-point ou de l'art de
composer plusieurs voix.
Aprs Guido parurent plusieurs musiciens qui con-
coururent aussi hter les progrs du chant ecclsiasti-
CHA
i07
que. Un des plus clbres fut Franco, qui appartenait
l'ordre de Saint-Benoit.
Malgr ces heureuses tentatives, on voit la musique
religieuse perdre de nouveau sa noble simplicit au
douzime sicle. Le mauvais got l'envahit alors de toutes
parts, et la puret du chant grgorien fut altr par des
cantilnes chantes en langue barbare. L'harmonie fut
pendant plus d'un sicle encore faible et languissante.
Mais, au treizime sicle, une foule d'crivains et d'au-
teurs didactiques lui impriment une vive impulsion.
Walter Bington crit, en Angleterre, l'ouvrage de Specu-
ltione music, renfermant un commentaire de la doc-
trine de Franco, et Marchetti, de Padoue, son Lucidrim
de Arte musicali, qu'il ddia au roi de Naples, Robert,
de la maison d'Anjou. Enfin Jean de Mris parat, et
grce ses dcouvertes ingnieuses, l'harmonie fait un
pas immense.
Mais de tous les musiciens qui parurent cette poque,
Jean Tinctor est sans contredit celui qui, par ses ouvra-
ges didactiques, exera sur les progrs de l'art l'influence
la plus fconde.
Vers la fin du douzime sicle, pendant le treizime et
une partie du quatorzime, on imagina d'accoupler le
chant ecclsiastique avec des mlodies de chansons pro-
fanes ou mme obcnes. Dans les compositions de cette
poque, la voix qui avait le chant principal, s'appelait
tnor ou teneur] lorsqu'elle tait accompagne d'une
seule voix, celle-ci s'appelait discant; lorsqu'elle l'tait
de deux voix, la voix suprieure s'appelait triplum, la
voix intermdiaire motectus, et la voix intrieure conser-
vait le nom et la fonction de tnor. Or, qu'arriva-t-il?
sur un texte sacr qui rappelait la mort du Sauveur, on
mettait pour accompagnement Liesse prendrai] sur un
autre texte, on mettait en Espoir d'amour merci.
Je
m'tais mis en voie.
Baise-moi, ma mie.
Las, bel
amy, tu m'as toute arrose, et autres choses dvotieuses
semblables. Jean XXII, le concile de Trente et l'exemple
des grands matres de l'cole romaine firent cesser enln
cette bizarre et stupide monstruosit.
Le seizime sicle se lve, et une re nouvelle s'ouvre
pour les beaux-arts. Au milieu de ce merveilleux pa-
nouissement de facults potiques, la musique religieuse
devait ncessairement subir une heureuse mtamor-
phose et il tait naturel de penser qu'il s'lverait un
108
CHA
homme de gnie pour complter l'uvre de ses devan-
ciers. C'est Palestrina qu'appartint cette glorieuse
mission.
La mlodie, le style de Palestrina sont aussi parfaits
que ses ouvrages sont nombreux, et de ses travaux
immenses a jaili une multitude de chefs-d'uvre; on
doit le considrer comme le crateur de la musique
d'glise moderne perfectionne. Ses productions sont des
monuments de science dposs dans les principales cha-
pelles de l'Europe.
Grand harmoniste et mlodiste la
ibis, il ouvrit l'art une route nouvelle, et aprs plus
de deux sicles, ses
compositions sont encore entendues
dans toutes les glises de la pninsule italienne avec le
mme enthousiasme que lorsqu'elles parurent.
Chant gal. Qui ne roule que sur deux tons et qui ne
forme ainsi qu'un seul intervalle.
Chant en contre-point. Cette expression signifiait
anciennement un chant avec imitation.
Chant figur. C'est celui o l'on fait usage de notes
d'une valeur mixte, par opposition nu plain-chantqui est
compos de notes principales et uniformes.
Chant grgorien. C'est Saint-Grgoire, qui parut
dans le sixime sicle, qu'il appartenait vritablement
d'tre le rformateur de la musique d'glise. La premire
opration de ce saint, appel aux honneurs de la tiare,
fut de rduire sept les quinze lettres du systme qu'a-
vait rajeuni Boce, pour indiquer les diverses modula-
tions de la musique. Jl corrigea ensuite les chants
d'glise, en rejeta plusieurs, et en substitua de nouveaux.
Il fonda h Rome deux collges ou coles de chant, et
leur affecta les revenus ncessaires pour que la musique
fut enseigne des enfants. C'est de cette poque que
date la fondation de la chapelle appele depuis pontifi-
cale, et le nom devenu classique de Matre de chapelle,
qui est donn celui qui en dirige la musique. Ds ce
moment aussi le chant d'glise prit le nom du pape qui
venait de le rgnrer, et se nomma grgorien. Il se
transmit de pontife en pontife et d'glise en glise, et
prit spcialement le nom de
plaid-chant
,
pour le distin-
guer du chant figur.
Chant instrumental. On nomme ainsi en musique
les parties de chant confies aux instruments, pour laisser
reposer le chanteur, remplir les intervalles destines
au jeu de la scne, ou varier le discours par des solos
CHA 409
contrastes. Le chant vocal, (voir ce mot), exprime. les
passions, le chant instrumental est rserv l'action.
Chant militaire russe. (Voyez Russie.)
Chant sur le livre. Plain-chant ou contre-point
quatre parties, que les musiciens composent et chantent
impromptu sur une seule, savoir, le livre de chur qui
est au lutrin ; en sorte qu'except la partie note, qu'on
met ordinairement au tnor, les musiciens affects au
trois autres parties n'ont que celle-l pour guide, et com-
posent chacun la leur en chantant.
Chantant. Epilhte que l'on donnn certaines uvres
de musique, dans lesquelles l'auteur s'est attach princi-
palement aux effets de la mlodie. On dira cet air est
chantant, cette sonate, ce quatuor sont chantants.
Chanter. C'est, dans l'acception la plus gnrale,
former, avec la voix, des sons variset apprciables (voyez
Chant)
;
mais c'est plus communment faire diverses
inflexions de voix sonores, agrables l'oreille, par des
intervalles admis dans la musique et dans les rgles de la
composition.
On chante plus ou moins agrablement, selon qu'on a
la voix plus ou moins agrable et sonore, l'oreille plus
ou moins juste, l'organe plus ou moins flexible, le got
plus ou moins form, et plus ou moins de pratique dans
l'art du chant.
Tous les hommes chantent bien ou mal, et il n'y en a
point qui, en donnant une suite d'inflexions diffrentes
de la voix, ne chantent, parce que, quelque mauvais que
soit l'organe, l'action qui en rsulte alors est toujours un
chant.
On chante sans articuler des mots, sans dessein form,
sans ide fixe, dans une distraction, pour dissiper l'ennui,
pour adoucir les fatigues. C'est, de toutes les actions de
l'homme, celle qui lui est la plus familire, et laquelle
une volont dtermine a le moins de part.
Chanterelle La corde la plus aigu du violon et
d'autres instruments. Cumme dans les instruments
cordes on est dans l'usage de placer les motifs du chant
dans les hautes rgions de leur diapason et que, pour cette
raison, les solos de violon et de violoncelle s'excutaient
anciennement en grande partie sur la corde aigu, on lui
donne le nom de chanterelle, corde destine au chant.
Chanteur. Celui qui excute des compositions musi-
cales au moyen de la voix. Il
y
a des chanteurs de so-
4...
110
CHA
prano, de mezzo soprano, d'alto, de contralto, de haute
contre, de tnor, de baryton et de basse. (Voyez l'article
Voix.)
Chanteurs erotiques. (Voyez Minnesinger.)
Chanteurs provenaux. (Voyez Troubadours.)
Chanteuse. Ce mot est le fminin de chanteur, sui-
vant l'Acadmie
;
il devrait par consquent avoir la
mme signification, Le vocabulaire musical la lui refuse.
La musicienne
ambulante, qui mle sa voix au bruit
discordant de l'orgue de Barbarie, est une chanteuse.
Celle qui parvient fixer dans sa tte les airs de Grtry
et de Dalayrac, h force de les entendre racler sur un
aigre violon, est encore une chanteuse. Mais nous appe-
lons cantatrices les personnes qui unissent une belle
voix la doctrine musicale et une connaissance parfaite de
l'art du chant.
Chantre. Ecclsiastique ou sculier appoint dans
les chapitres pour chanter le plain-chantaux offices reli-
gieux.
Chapeau chinois. Instrument en usage encore il
y
a
peu d'annes dans les musiques mililaires. Il consistait
en un disque ou chapeau de cuivre garni de clochettes et
fix au bout d'un manche qui servait l'agiter en me-
sure.
Chapeau. Trait demi-circulaire dont on couvre deux
ou plusieurs notes pour indiquer que le son doit tre li.
Chapelle. On entend par chapelle le lieu dans une
glise o l'on excute la musique, ainsi que le corps
mme des musiciens qui excutent cette musique, et par
extension tous les musiciens qui sont gags par un sou-
verain, quand mme il n'excutent jamais de musique
dans les glises.
Franois 1
er
fut le premier qui tablit en France un
corps de musique en dehors du service divin. Il divisa sa
chapelle en deux parties dont l'une fut appele chapelle
de musique, compose de chanteurs et d'instrumentistes;
l'autre nomme chapelle de plain-chant, comprenant les
chantres et les ecclsiastiques destins chanter les offices.
Dans certains cas ces deux corps taient runis et pre-
naient alors le nom de la grande chapelle.
Quelques chapelles sont composes seulement de chan-
teurs et d'un ou de plusieurs organistes, comme celle de
la cathdrale da Milan. D'autres sont formes par un
ensemble complet de chanteurs et
d'instrumentistes.
Chapelle (Matre de). Celui qui est charg de diri-
ger le chant dans une glise et de former les enfants de
churs. Ce terme signifie galement, en Italie, un matre
de musique.
Chapelle pontificale. Dans le sens musical, cette
expressisn indique, Rome, les chapelains chanteurs,
les . chanteurs apostoliques, les chanteurs pontificaux,
La fondation de la Chapelle pontificale remonte au rgne
de saint Grgoire le Grand.
Charge. Air militaire des trompettes, des fifres et des
tambours, qu'on excute quand l'armeest prte charger
l'ennemi. On dit sonner la charge pour les trom-
pettes, battre la charge pour les tambours. Le mouve-
ment de la charge est deux temps, trs-vile. Les tam-
bours en marquent le rhythme, en frappant sur chaque
temps, et en roulant ensuite pendant quelques mesures.
Charg. Se dit d'une production d'art clans laquelle
on prodigue plus de moyens d'expression ou plus de
beauts accessoires qu'il n'en faut.
Charivari. Bruit tumultueux, musique bruyante, dis-
cordante, dans laquelle on ne fait entendre nulle mlodie.
Chasse. On donne ce nom certains airs, certaines
fanfares de cors ou d'autres instruments, dont la mesure,
le rhtyhme, le mouvement, rappellent les airs que ces
mmes cors donnent la chasse.
On appelle aussi chasse une symphonie, une ouverture
dont les divers motifs sont des airs de chasse, et dont
les effets tendent imiter l'action d'une chasse : telle est
l'ouverture du Jeune Henri. On donne aussi le caractre
et le mouvement d'une chasse un chur, un air. Les
opras de Didon, des Bardes, l'oratorio des Saisons en
fournissent la preuve. Le Freyschulz de Weber est
rempli de chasses admirables.
Le chur des gardes-
chasse dans le Songe d'une Nuit d'Jbt, d'Ambroise
Thomas, est encore un modle de ce genre de musique.
Chaudron. Calotte de cuivre sur la qtielle se trouve
tendue la peau des tymbales.
Chef d'attaque. Musicien charg de conduire tous
les chanteurs qui, dans un chur, disent la mme partie.
Chef de musique. Se dit de celui qui se trouve la
tte d'un corps de musique militaire.
Cheng. Instrument vent en usage chez les chinois
qui a fourni le premier emploi connu de l'anche libre.
Chevalet. Pice de bois pos d'aplomb sur la table
112 CHI
des instruments, pour en soutenir les cordes et leur
donner plus de son en les tenant releves en l'air.
Chevalet. (Prs du). Ce mot plac sous un trait de
violon ou d'un autre instrument archet, signifie qu'il
faut excuter le trait en attaquant les cordes prs du
chevalet, ce qui donne un son grle et un peu rauque.
(Voyez Ponticelle.)
Cheville. Dans les instruments cordes on appelle
chevilles les petites pices de 1er ou de bois sur lesquelles
on roule des cordes, et qui servent ainsi leur donner
plus ou moins de tension pour les accorder.
Chevrettes. Nom donn anciennement une espce
de cornemuse, dont le son tait aigre.
Chevroter. C'est battre d'une manire ingale les
deux notes d'un trille, ou mme n'en battre rapidement
qu'une seule, ce qui imite peu prs le blement des
chvres.
Chga. Espce de danse de ngres ayant beaucoup
d'analogie avec le fandango des espagnols.
Ghiffonie. Ainsi se nommait une espce de lyre an-
cienne qui n'tait en usage que chez les mendiants.
Chiffres. Caractres qu'on place au-dessous des notes
de la basse pour indiquer les accords qu'elles doivent
porter. Quoique parmi ces caractres, il
y
en ait plusieurs
qui ne sont pas des chiffres, on leur a gnralement
donn ce nom, parce que c'est l'espce de signes qui s'y
prsente le plus frquemment.
Le chiffre qui indique chaque accord est ordinaire-
ment celui de l'accord. Ainsi l'accord de seconde se
chiffre
2,
celui de septime
7,
celui de sixte
6,
etc. C'est
Ludovico Viadana, qui, le premier, a reprsent les
accords par des chiffres. Cet auteur vivait dans le
xvi
e
sicle.
Les chiffres ont t employs par le P. Souhaity et
J.-J. Rousseau pour dsigner les notes de la gamme.
Ce moyen a t repris par Gallin, et puis ensuite par
MM. Paris et Chev. (Voir notation.)
Chinois (systme musical des). Les historiens de la
Chine conviennent unanimement que le principe fonda-
mental sur lequel s'est lev leur empire a t celui de
la musique.
Pankou, l'un des plus clbres d'entre eux,
dclare formellement que la doctrine des Kings, livre
sacr de la nation, repose toute entire sur cette science,
et est reprseLte dans ces livres comme l'expression et
GHI 113
l'image de l'union de la terre avec le ciel. Ceux que les
Chinois regardent comme les auteurs de leur systme
musical, sont Ling-Lun-Kouei et Pin-Mou-Kia. L'po-
que o parut Ling-Lunne saurait tre exactement fixe.
Le Yo Ring, celui des livres sacrs qui contenait les lois
sur la musique, ne nous est point parvenu; on croit que
tous les exemplaires furent livres aux flammes. Les
fragffleatSj qui s'taient conservs dans la mmoire, fu-
rent soigneusement recueillis, et plusieurs savants mi-
rent leur gloire les rtablir, et firent de grands efforts
pour faire refleurir l'ancienne musique; mais les trou-
bles et les guerres qui survinrent ne leur permirent pas
d'achever leur ouvrage, et jetrent tout dans un nouveau
dsordre : ce ne fut que trs-longtemps aprs qu'un
prince nomm Tsa, enthousiasm pour l'art musical,
entreprit de lui rendre son lustre antique. Il s'entoura,
pour arriver ce but, de tout ce qu'il
y
avait parmi les
Chinois, d'hommes savants dans la musique thorique
et pratique, et fouilla dans tous les monuments natio-
naux dont son rang lui facilitait l'accs. Le rsultat de
son travail fut un systme musical complet, considr
comme sacr ds l'antiquit la plus recule.
Le principe appel koung c'est--dire foyer lumineux,
centre o tout aboutit et d'o tout mane, rpond au son
que nous appelons
fa.
C'est du koung fondamental ou du
principe
fa
que tout reoit chez les Chinois, tant dans le
moral que dans le physique, son nombre, sa mesure et
son poids. C'est cet unique principe que tout se rap-
porte, et c'est en tudiant ce principe qu'on peut apprcier
jusqu' la position exacte que ces peuples donnaient
leurs chants sur le diapason musical. Ce n'est pas moins
merveilleux peut-tre et ce qui rsulte pourtant d'une
telle institution, c'est que, grce ce mme principe
fa,
reconnu comme sacr, et dont la forme est invariable-
ment fixe, le peuple a eu les mmes poids, les mmes
mesures, et a fait usage des mmes intonations dans les
mmes traits de chant.
Maintenant que nous connaissons le principe sur le-
quel est fond le systme musical de Ling-Lun chez les
Chinois, et la manire dont ils l'tablissent, voyons sous
quels rapports cet homme clbre en concevait les dve-
loppements, et comment il en faisait dcouler les sons
diatoniques et chromatiques qu'il mettait dans son sys-
tme.
114 CHI
Ling-Lun ayant pris la corde fondamentale
fa
comme
le son gnrateur de tous les autres sons et l'ayant fait
vivement retentir, soit sur la pierre sonore du yuking,
soit sur le bronze harmonieux du lienchtoung, il saisit
dans le retentissement de ces corps plusieurs sons ana-
logues au son gnrateur, parmi lesquels il reconnut
que l'octave ou la musique l'aigu de ce mme son, et
sa double quinte ou sa douzime, taient Tes premiers et
les plus permanents;,en sorte qu'il fut conduit penser
que le dveloppement des corps sonores, en gnral, avait
lieu par une marche combine qui lui faisait suivre la
fois une progression double et triple, double comme de
1 fi 2 ou de 4 8 pour produire son octave, et triple
comme de \ 3 et de 4 \2 pour produire son dou-
zime. Cette marche combine, qui renfermait les facul-
ts opposes du pair et de l'impair, lui convint d'autant
plus qu'elle dispensait d'admettre un nouveau principe,
et lui permettait en apparence de tout faire dcouler de
l'unit. Nous disons en apparence, car en supposant
possible cette marche htrogne et simultane de 1 2
et de 1
3,
le systme o elle rgnera l'exclusion de
celle de 3 -4 manquera toujours de chromatique des-
cendant et d'enharmonique. Rameau, qui plus de huit
mille ans aprs Ling-Lun a voulu en faire la base de son
systme musical, en partant de la mme exprience, a t
forc d'avoir recours un fade temprament qui mutile
tous les sons, et qui, vingt ibis propos en Chine, a vingt-
fois t rejet; car les savants de la nation, quoique p-
ntrs depuis longtemps du vide de leur systme, ont
mieux aim le conserver pur, quoique incomplet, que de
le gter dans une de ses parties pour suppler celle qui
lui manque.
A l'poque o Ling-Lun posait son principe unique,
pouss par l'esprit de schisme qui dominait sur lui. il
ne pouvait pas trouver une thorie meilleure, et il faut
convenir que, malgr ses dfauts, elle prsente encore de
grandes beauts, et surtout annonce une grande perspi-
cacit d'esprit dans son auteur.
Un des crivains dont les ouvrages peuvent donner les
meilleures indications sur la musique des Chinois, est le
pre Amyot.
Chiuogymnaste, ou Gymnase des doigts, l'usage des
pianistes, invent par M. Casimir Martin, en 18i0. Le
chirogymnaste est un assemblage de neuf appareils
CHOE
115
gymnasliques destins donner de l'extension la
main et aux doigts, augmenter et galiser leur force,
et
rendre le quatrime et le cinquime
indpendants
de tous les autres.
Ghitarome. Nom que l'on donnait
quelquefois au
thorbc.
Choeur. C'est en musique, un morceau d'harmonie
complte quatre, huit, douze parties vocales ou plus,
chant la Ibis par toutes les voix, et ordinairement ac-
compagn par tout l'orchestre.
Leschursde l'Opra se rangeaient autrefois sur deux
files, et, formant un double espalier le long des coulis-
ses, sans jamais prendre part aux jeux de la scne, ils se
bornaient crier tue-tte : Jurons, clbrons, chantons,
dtruisons, combattons^ de Rameau et de ses mules.
Puisque l'Opra, jouissait du beau privilge de faire
parler la multitude, il ne devait pas la tenir dans un re-
pos d'autant plus ridicule, que les personnages ne ces-
saient de dire : Courons aux armes,
branlons la terre,
rien rigale ma fureur, etc., ce qui suppose l'agitation
et le mouvement.
Le gnie de Gluck, portant une salutaire rforme dans
notre systme musical, vint animer cette troupe immo-
bile, et la fit participer l'action scnique.
Les churs sont de diverses natures, selon le style
auquel ils appartiennent, c'est--dire le style svre, le
style libre ou le style mixte, et leurs subdivisions.
Outre
cela, ils sont divers nombres de parties : il
y
a des
churs l'unisson, deux, trois, quatre, cinq, et
un plus grand nombre de parties, forms des diffrents
mlanges de voix.
Les combinaisons de voix pour les churs sont trs-
varies : elles dpendent entirement du caprice et du
bon got. Haydn, Mozart et d'autres grands matres
ont presque toujours crit les churs pour soprano,
alto, tnor et basse.
Cette combinaison est bonne; cependant elle est su-
jette un inconvnient qui n'est point sans gravit. La
partie d'alto ou de contralto ne ressort pas assez, sur-
tout dans les churs voix nombreuses, et la plupart
des effets qui lui sont confis sont anantis
Les churs de femmes sont d'un effet ravissant dans
les morceaux religieux et tendres.
Quelquefois on donne une partie de tnor pour basse
116 CHO
aux voix fminines : Weber l'a fait avec succs pour ses
churs d'esprits, dans Oberon. Cette combinaison de
voix produit un effet doux et calme.
Les churs d'hommes, au contraire, produisent les
plus nergiques efets. Dans son terrible chur des
Scythes, au premier acte d'Iphignie en Tauride, Gluck
fait frissonner de terreur par le subit unisson des t-
nors et des basses, sur les mots : les dieux nous amnent
des victimes.
On donne aussi le nom de chur la runion des mu-
siciens qui doivent chanter les churs. Chur signifie
encore la partie de l'glise on l'on chante l'office divin,
et qui est spare de celle qu'on appelle la nef.
Choeur rel. C'est le nom que l'on donne un
chur o l'union harmonique des quatre voix humaines
est telle, que chacune d'elles a une mlodie qui lui est
propre et qui est diffrente des autres.
Choral. En latin, cantus choralis, a choro; en ita-
lien, canto fermo; en espagnol, canto llano, signifie
chant ecclsiastique, ou cette espce de mlodie dont on
fait usage dans les crmonies du culte divin. Cette m-
lodie, d'un mouvement lent, est entirement compose
de notes d'une gale valeur sans aucun agrment.
On trouve chez les Hbreux des traces de chants sa-
crs populaires qui, sans doute, n'taient que de sim-
ples mlodies. La raison d'ailleurs en est naturelle : en
effet, si ces chants, ds leur origine, avaient t sur-
chargs d'ornements artificiels, ils n'auraient pas pu tre
excuts par un peuple nombreux, dont la plus grande
partie, sans doute, ignorait tout lment de musique.
Sous le rgne de David et de Salomon, les chants sa-
crs prirent une forme plus parfaite, et leur usage se
conserva jusqu' la captivit de Babyone. Enos passe
chez les Hbreux pour tre l'inventeur du chant,
parce qu'il chanta le premier les louanges du Seigneur.
(Gense, c.
4.)
Les anciens Grecs aimaient dans les hymnes que le
peuple chantait dans les temples , la mlodie la plus
simple.
Les premiers chrtiens chantrent aussi des psaumes
et des hymnes dans leurs crmonies religieuses. Au qua-
trime sicle de l're chrtienne, saint Ambroise, arche-
vque de Milan, donnaauplain-chant sa forme primitive,
en se servant de quelques anciennes mlodies grecques.
GflO M7
Boce fut
le premier en France qui, au commence-
ment du cinquime sicle, transfra la musique des
Grecs, et surtout leur plain-chant en Italie. Plus tard,
saint Grgoire-le-Grand
,
non-seulement introduisit le
plain-chant dans l'glise occidentale, mais il mit en or-
dre lui-mme le recueil des antiennes, des hymnes et
des psaumes; plaa certains caractres de musique sur
les paroles, forma une cole de plain-chant dont il a t
le premier matre, et contribua puissamment de tous ses
moyens son perfectionnement. C'est en l'honneur de
saint Grgoire que le plain-chant s'appelle encore Gr-
gorien.
Luther fit beaucoup aussi, pour le plan-chant,
l'occasion de la rforme dans l'glise. Les choraux de
Luther sont justement clbres.
Le mot choral peut s'appliquer aussi aux churs
;
ainsi on dit une socit chorale.
Dans un sens plus restreint, ce mot dsigne le chur
d'une chapelle, form de la masse des chantres qui sont
au chur de l'glise. On dsigne aussi par l le faux-
bourdon. (Voyez Faux-Bourdon.)
Ghorge. Nom que l'on donnait chez les Grecs aux
directeurs de leurs thtres.
Chorgraphie. Art d'crire la danse l'aide de
certains signes. Tornot Arbeau, chanoine de Langres est
le premier qui ait crit sur la chorgraphie; Hairer pu-
blia un systme de cet art et de nos jours Saint- Lon a
publi un ouvrage spcial sur la chorgraphie.
Choriste. Homme ou femme qui ne chante que dans
les churs.
Chorodie. Se disait de tout chant excut en chur.
Chorus. Faire chorus, c'est rpter en chur Tunis-
son ce qui vient d'tre chant une seule voix.
Chorus. Instrument form d'une peau et de deux
tuyaux dont l'un tait l'embouchure et l'autre le pavil-
lon; c'tait comme on voit une espce de cornemuse.
Chromatique. Genre de musique qui procde par
plusieurs demi-tons conscutifs. Ce mot vient du grec
chroma, qui signifie couleur, soit parce que les Grecs
marquaient ce genre par des caractres rouges ou diver-
sement colors, soit, disent quelques auteurs, parce que
le genre chromatique est moyen entre les deux autres,
comme la couleur est moyenne entre le blanc et le noir.
On appelle une basse chromatique, une gamme chro-
5
418
GLA
matique, une marche d'harmonie qui procde par demi-
tons dans le grave, une gamine qui s'lve ou descend par
demi-tons.
Chrome. Ce mot vient du grec chroma, et signifie
couleur. En italien, une croche se nomme croma, parce
qu'on la figure avec une blanche colore.
Chrononome.
Appareil servant lire la musique,
imagin en 1842 par Le Bihan.
Chula. (A). Danse portugaise qui ressemble au fan-
dango. A dfaut de castagnettes on bat la mesure avec
les doigts.
Chut. Terme dont on se sert pour imposer silence.
Chute. Se fait lors qu'en descendant par intervalle de
tierce, on touche en passant du second coup d'archet la
note dont la situation est entre les deux qui font la tierce,
la chute peut se faire galement sur des notes du mme
degr.
Chuter. Mot nouveau qui exprime qu'une pice ou
un artiste n'ont pas russi.
Cimbalo. Ancien instrument h cordes, appel aussi
prote invent, en
1650,
par un Florentin nomm
Franois Nigelli.
Circolo-Mezzo. Agrment de chant qui se rapproche
du
grapello.
Cistre. Instrument ancien qui tenait du luth et de la
gui tare, il avait un corps sonore plat, de forme ovale, sans
courbure du luth, les cordes taient en mtal.
Cithare. Ancien instrument de musique dans lequel
les
antiquaires prtendent retrouver la chelys invent
par Mercure. C'tait une espce de guitare de forme
ovale,
diminuant vers la partie o tait fix le manche
qui tait droit et surmont d'un chevillier recourb au
dedans et lgrement inclin de ct.
Citharde. Joueur de cithare qui se servait de cet
instrument pour accompagner sa voix.
Citole. Nom donn jadis h une espce d'instrument
corde.
Clair accord. Instrument vent et lames vibrantes,
construit par Gavioli en 1855.
Clairon. C'est le mme instrument que la trompette.
Dans le style potique, on appelle clairon tout instru-
ment embouchure propre h exciter l'ardeur belliqueuse
des soldats. (Voyez Trompette.)
Il est principalement employ dans la musique mili-
GLA
119
taire; les exercices se font gnralement aux appels du
clairon.
Clairon mtallique. Cet instrument imagin en 1817
par Aste, dit Hallary, tait une espce de clarinette en
cuivre, en tout point semblable aux clarinettes en bois.
Claque. Nom collectif indiquant une troupe ou
runion d'applaudisseurs salaris pour applaudir, quand
mme, les auteurs et les acteurs.
Claquebois. Instrument de percussion et touches,
compos de dix-sept btons qui vont diminuant de lon-
gueur et qui ont chacun un degr diatonique; on les fait
rsonner en frappant avec des baguettes.
Claquette. Instrument servant imiter le claquement
du fouet de poste.
Clarinette. Instrument de musique vent, bec et
anche. La clarinette a t invente Nuremberg, il
y
a environ cent ans : c'est de tous les instruments vent
celui dont l'invention est la plus rcente
; aussi sa struc-
ture n'a-t-elle pas atteint toute la perfection que l'on
remarque dans la flte, le hautbois et le basson. Mais
quoique cet instrument prsente des dfauts assez graves,
les matres habiles ont toujours su les corriger, et les
Lefvre, les Gambaro, les Dacosta, les Klos, les Caval-
lini, ont runi la puret du son une excution aussi
rapide que brillante.
La clarinette est le fondement des orchestres mili-
taires; elle
y
tient le mme rang que le violon dans la
symphonie ou dans la musique dramatique. Plusieurs
clarinettes en ut jouent le chant, tandis qu'un nombre
gal forme le second dessus, et qu'une clarinette en
fa
porte l'octave de la mlodie ou excute des passages en
volubilits.
La clarinette a quatre registre : le grave, le chalumeau
,
le mdium et l'aigu. Les sons graves ont surtout dans
les tenues, un accent menaant dont Webera fait le plus
heureux usage
;
les sons du mdium sont empreints de
fiert et de tendresse. C'est la voix noble et potique d'un
hroque amour. Si les masses d'instruments de cuivre,
dit un clbre critique, rveillent dans les grandes sym-
phonies militaires, l'ide d'une troupe guerrire cou-
vertes d'armures tincelantes,* marchant la gloire ou
la mort, les nombreux unissons de clarinettes semblent
reprsenter les femmes aimes, les amantes l'ilfer,
la passion profonde,
que le bruit des armes exalte, qui
120
CL\
chantent en combattant, qui couronnent les vainqueurs
ou meurent avec les vaincus. Ce beau soprano instru-
mental si retentissant, si riche d'accents pntrants quand
on l'emploie par masses, gagne, dans le solo, en dlica-
tesse, en nuances fugitives, en affectuosits mystrieuses,
ce qu'il perd en force et en puissants clats.
Weber a parfaitement saisi ces nuances et en a fait
une application admirable dans le solo de clarinette qui
se trouve au milieu de l'ouverture du Frysahutz. Cette
voix rveuse et pure de la clarinette, planant sur un
trmolo d'instruments cordes, peint avec une vrit
sublime, l'amante du chasseur, qui, isole au fond des
bois solitaires, les mains et les yeux vers le ciel, mle sa
voix suppliante au bruit de la nature tourmente par
l'orage.
Clarinette-Alto. C'est une clarinette en
fa
bas ou
en mi bmol bas, qui est, par consquence, la quinte
au-dessous des clarinettes en ut ou en si bmol.
C'est un trs-bel instrument qu'on regrette de ne pas
rencontrer dans tous les orchestres bien composs.
Clarinette-Basse. C'est une clarinette encore plus
grave que la clarinette-alto, et qui est l'octave basse
de la clarinette en si bmol. Il
y
en a une en ut, l'oc-
tave basse de la clarinette en ut; mais celle en si bmol
est beaucoup plus rpandue.
La 'construction de cette clarinette basse et celle de la
clarinette contrebasse fut modifie entirement par
Ad. Sax en 1838. Cette nouvelle clarinette basse embrasse
trois octaves et une sixte et la clarinette contrebasse
descend jusqu'au dernier sol de la contrebasse cordes.
Les notes basses de cet instrument sont les meilleures.
M. Meyerbeer a fait exprimer la clarinette basse un
loquent monologue dans le trio du cinquime acte des
Huguenots.
Selon la manire dont il est crit et le talent de l'ex-
cutant, cet instrument peut emprunter au grave le
timbre sauvage des notes basses de la clarinette ordi-
naire, ou l'accent calme, solennel et pontifical de certains
registre de l'orgue. Il est donc d'une frquente et belle
application. Il donne d'ailleurs, si on en emploie quatre
ou cinq l'unisson, une sonorit onctueuse, excellente,
aux basses des orchestres d'instruments vent.
Glaronceau. Espce de trompette d'nn son mordanl
en usage avant le rgne de Louis XIV.
CLA
121
Clavecin. Le clavecin est, en gnral, compos d'une
caisse et d'une table d'harmonie sur laquelle les cordes
se trouvent tendues. Les petites plaques colles sur les
touches sont ordinairement d'os de buf pour les touches
du genre diatonique, et d'bne pour les touches chro-
matiques. La barre qui rgle l'lvation des sautereaux,
et par consquent l'abaissement des touches, est une
planche troite et massive en bois de tilleul, dont le des-
sous est garni de deux ou trois lisses de drap^ qui emp-
chent d'entendre le choc des sautereaux contre la burre.
Le son mle, robuste, argentin et doux de toutes les
cordes dpend de la bont de la table, de la justesse du
chevalet du diapason, et de la manire d'adapter les barres
qui se trouvent colles contre la table d'harmonie..
Le squelette intrieur qui soutient tout le corps du
clavecin est en bois de sapin ou en tilleul; les deux che-
valets du diapason, ainsi que ceux placs auprs des
leviers, sont presque toujours en bois- de chne, avec
cette diffrence que le chevalet de l'octave est beaucoup
plus bas et plus prs des leviers que l'autre; le sommier,
qui est l'endroit o les leviers sont adapts, est en bois
dur, tel que du chne, de l'orme, etc., et il se trouve
solidement fix des deux cts pour soutenir la tension
des cordes; les registres et les guides intrieurs sont en
bois de tilleul : les registres sont aussi garnis de peau
pour empcher le bruit des sautereaux, qui sont en poi-
rier le plus lisse et le plus uni que l'on puisse trouver.
Dans le clavecin, les cordes rsonnent au moyen de
petits becs de plume de corbeau placs dans les lan-
guettes des sautereaux. Aujourd'hni, cet instrument a
cd la place au piano. (Voir Piano.)
Clavecin Acoustique. (Invent par Verbes Paris,
en 1795).
Ce clavecin pouvait imiter plusieurs instru-
cordes/ vent et percussion.
Clavecin a archet. (Invent par le mme).
Cet
instrument tait mont de cordes de boyau qu'on faisait
rsonner au moyen d'un archet sans fin, garni de crin et
mis en mouvement par une roue.
Clavecin a marteau. (Invent par un facteur de
Catane, en Sicile, en
1754.)
Dans cet instrument les
sautereaux venaient marteler la corde avec tant de
vivacit qu'ils lui faisaient rendre un son aussi fort,
aussi brillant que celui que l'on obtenait prcdemment
de la plume.
122
t
CLA
Clavecin Anglique. (Invent par le mme.)
Dans
cet instrument les cordes au lieu d'tre attaques par
des plumes de corbeau taient branles par de petits
morceaux de cuir recouverts de velours.
Clavecin a orchestre. (Invent par Blaha, Prague,
en 1780.)
Clavecin auquel tait appliqu :
1
une
mousqueterie, cymbales, triangles, sonnettes, tambou-
rin
;
2
un registre de flte avec son clavier
;
3
un
tambour avec fifre, une machine servant imiter la
cornemuse et les castagnettes, etc., etc.
Clavecin a touches brises. (Invent par Bonis, en
Toscane, en 1661.)
Instrument qui suivant le P. Mer-
senne pouvait s'accorder dans une justesse parfaite
suivant les proportions mathmatiques des intervalles.
Clavecin bonacordo. (Invent par le mme).
Cla-
vecin sur lequel l'espace des octaves pouvaient s'adapter
aux petits doigts des enfants.
Clavecin clestino. (Invent par Walker, en Alle-
magne, en 1784).
Sorte de clavecin archet. Un
cordon de soie plac sous les cordes tait mis en mouve-
ment au moyen d'une roue, et de petites poulies mises
au bout de chaque touche approchaient ce cordon des
cordes et les faisaient vibrer.
Clavecin constant accord. (Invent par J. Daniel
Bertin, Memel, en 1756). On prtend qu'il ne chan-
geait jamais de ton quelle que ft la temprature et l'air.
Clavecin d'amour. (Invent par le mme).
Instru-
ment dont les cordes taient de moiti plus longues que
celles du clavecin ordinaire.
Clavecin diviseur. (Invent par Pesaro, de Venise,
en J567.)
Cet instrument fut construit la demande
de Zerlino
;
le ton se trouvait divis en cinq parties par
le nombre des touches du clavier.
Clavecin double. Cet instrument a la forme de deux
clavecins rapprochs l'un de l'autre, et chaque extr-
mit il existe un ou deux claviers au-dessus l'un de
l'autre, de faon que deux personnes peuvent jouer en
mme temps.
Clavecin double rsonnante. (Invent par Frdrici,
Acrona, en 1770.)
Cet instrument tait muni d'un
mcanisme l'aide duquel ou obtenait d'une seule corde
une double rsonnance harmonique.
Clavecin lectrique. (Invent par La Borde J. B.,
en 1755).
C'tait un carillon avec un clavier dont
GLA 123
chaque touche correspondait un timbre particulier. Le
clavier faisait mouvoir les verges qui frappaient les
timbres et les touches n'taient mises en action que par
une commotion lectrique.
Clavecin harmonieux. (Invent par Gomel, en 1842).
Pouvant se dplacer pour jouer dans tous les tons
avec le mme clavier.
Clavecin harmonique. (Invent par Verbes, Paris,
en 1798).
Clavecin imitant les instruments vent et
percussion quoiqu'il n'et ni tuyau, ni marteau, ni
pdales.
Clavecin luth. (Invent par Hildebrand, Saxon, en
1785.)
Instrument construit d'aprs les ides de
J. Sbastien Bach.
Clavecin luth. (Invent par Fleicher, Hambourg,
en 1715).
Clavecin mont d'un double rang de cordes
en boyau.
Clavecin oculaire et Clavecin a couleurs. Le
P. Louis-Bertrand Castel, inventeur de cet instrument,
avait distribu entre les touches les couleurs d'aprs
une certaine gradation, de manire que chaque touche,
au moyen de la pression, produisait une couleur selon
les principes qu'il avait tablis.
Clavecin organis. (Invent par Delitz, Dantzig.)
Consistait dans un jeu de flte ajout au clavecin et
en divers changements.
Clavecin parfait accord. (Invent par Luzzasco
Luzzaschi, Ferrare, en 1557.)
Cet instrument avait
un clavier dont les touches taient disposes de faon
pouvoir excuter de la musique dans les trois genres,
diatonique, en harmonique et chromatique.
Clavecin parfait accord. (Invent par Trasuntino
de Venise, en 1606).Construit pour le comte de Novel-
lara. Il avait quatre octaves d'tendue et pouvait jouer
dans les trois genres. Chaque octave tait divise en
trente-et-une touches.
clavecin parfait accord. (Invente par Ger. Goer-
mans, en
1781.)
Cet instrument possdait vingt-et
une touches par octave : c'est--dire sept pour les notes
naturelles, sept pour les notes dizes et sept pour les
notes bmoltses.
Clavecin royal. (Invent par Wagner, Dresde, en
1786.)
Ce n'tait que l'adjonction d'un jeu de flte au
124 CLA
clavecin. Ide- dj mise en pratique par Dclilz, mais
amliore.
Clavecin transpositeur. (Invent Catane, en
1750.)
Dans cet instrumeut plusieurs hausses ou
chevalets mobiles mis en mouvement par une pdale
donnaient le moyen de changer le ton de tout le diapason
de l'instrument la fois.
Clavecin vertical. (Invent par le mme.) Instru-
ment dans lequel des baguettes ttes recourbes et
ajustes la touche par une fourchette allaient frapper
les cordes dans le sens de leur position sur la table
d'harmonie.
Clavecin-vielle. (Invent par Gerli; en 1789.)
Instrument en forme de clavecin dont les cordes taient
mises en vibration par des roues qui attaquaient les
cordes.
Clavecin violle. (Invent par Jean Heyden, en 1600.)
Prtorius donne la figure de cet instrument dont le
mcanisme consistait en petits archets cylindriques mis
en mouvement par une grande roue que faisait agir une
pdale. Cette invention fut reprise en 1754 par Hohfeld.
Clavecin violle. (Invent par Risch, Weimar, en
1710). Instrument mont de cordes de boyau mises en
vibration par de petites roues enduites de colophane,
mises en mouvement par une plus grande.
Clavi-accord. Appareil s'appliquant sur l'orgue
nomm aussi organiste de village parce qu'il le supple,
il fut imagin par Lebeau d'Aubel en 1857.
Glavicitherium. Cet instrument qui tait clavier
tait form par une harpe renverse dont les cordes taient
de boyau. 11 est parl de cet instrument dans la
Musurgia de Nactigall, ouvrage imprim dans la pre-
mire moiti du 16
9
sicle.
Clavicor. Instrument inaugur en
1838,
par Danays
pour remplacer YOphiclide alto. Arm de pistons il
tait sonore, doux et plus facile jouer que l'Ophi-
clide.
Clavi-cylindr.e. Cet instrument imagin parChladni
en
1793, tait touche et avait peu prs la forme d'un
piano carr, le son tait produit par un long cylindre de
verre qui frottait au moyen d'une manivelle sur des
touches aboutissant sur toute la longueur du cylindre.
Clavi-cymbalum. Espce de temponum ressemblant
assez au clavicorde.
CLA
,
123
Clavicorde. Ancien instrument corde de forme
triangulaire, que l'on jouait comme l'pinette.
Clavier. Le clavier est l'assemblage de toutes les
touches du piano, lesquelles reprsentent tous les sons
qui peuvent tre employs dans l'harmonie.
Les instruments clavier sont l'orgue, le piano, la
vielle
;
les carillons ont aussi des claviers. Celui du
piano a gnralement six octaves et demie, qui com-
mencent par Y ut plac au-dessous de l'extrme mi grave
de la contrebasse quatre cordes, et finisent l'aigu
au
fa
ou au sol qui se trouve immdiatement au-dessus
du dernier
fa.
On l'ait maintenant des pianos de sept
octaves et mme de huit octaves.
On appelle aussi clavier la porte gnrale ou somme
des sons de tout le systme qui rsulte de la position
relative des sept clefs. Au Conservatoire de Paris, ce nom
est donn une classe de piano consacre aux lves
chanteurs.
Clavier de poche. (Invent par Philcox, en 1856.)
Clavier pour faciliter le mouvement des doigts sur les
instruments touche.
Clavier gomtrique. (Invent par Folly, en 1845.)
Clavier harmonique transpositeur. (Invent par
Masson, en 1846.)
Mme genre que celui de Gomel,
mais destin l'orgue.
Clavier mil-accords. (Invent par l'abb Laroque, en
1844.)
Au moyen d'une ou deux touches on faisait
rsonner plusieurs languettes dans le mme tuyau.
Clavier pneumatique. (Invent par Talon, en 1855.)
Clavier transpositeur a piston. (Invent par
Darche, en 1845.)
C'est une bote renfermant deux
ranges de pistons, les uns s rvant excuter les mor-
ceaux dans les tons majeurs, les autres dans les tons
mineurs. En appuyant sur un piston on obtenait la note
et l'accompagnement. Les pistons correspondaient des
rouleaux en bois faisant mouvoir des baguettes qui fai-
saient agir des pelotes en bois qui appuyaient sur le
clavier de l'instrument sur lequel on posait le mca-
nisme.
Clavi grade. (Invent par Lahausse, en 1S55.)
Appareil compos d'une srie de cinq touches se raidis-
sant volont au moyen d'un ressort boudin au moyen
d'une vis, et servant l'exercice des doigts.
Clavi-harpe.
Espce de piano vertical dont les
5.
126
CLE
cordes au lieu d'tre frappes taient pinces et imitaient
le son de la* harpe. Cet instrument fut construit par
Dietz, en 1814.
Clavi-lyra. Instrument imagin par Jos. Bateman,
en 1814, n'tait qu'une espce de harpe arme de touches
qui agissaient sur la corde comme un plectruni.
Clavi-mandore. Instrument clavier construit par
Mahr en 1788,
Wiesbaden.
Cla-viola. Piano sans corde, imagin en
1847,
par
Papelard. A
l'extrmit de chaque touche, se trouvait
un sautereau arm d'un bec en acier, servant pincer
le bout d'une lame sonore.
Cla-violn. Etait un instrument clavier imagin
par Gh. Schmidt, en 1824, imitant les effets d'un instru-
ment archet.
Glaviphone. Espce d'orgue expressif portant souf-
flet et double clavier, imagin par Le Toulat, en
1847.
Glavi-tube. Instrument de cuivre compos d'un tube
allong et recourb en trois parties. Son tendue tait
de si bmol au-dessus de la clef de sol jusqu'au sol au-
dessous de la porte des cinq lignes, son auteur tait
M. AsteHallory, en 1817.
Clef. Caractre de musique qui se met au commen-
cement d'une porte, pour dterminer le degr d'lva-
tion de cette porte dans le clavier gnral, et indiquer
les noms de toutes les notes qu'elle contient dans la
ligne de cette clef. Ce caractre, en faisant connatre les
noms et les degrs d'intonation que l'on doit donner aux
notes, ouvre pour ainsi dire la porte du chant, et c'est
cause de cette proprit qu'il a reu le nom mtapho-
rique de clef.
Le nombre de clefs est de sept, savoir : deux clefs de
fa,
quatre clefs d'ut, et la clef de sol
;
on se servait au-
trefois d'une huitime clef, celle de sol sur la premire
ligne. Mais on l'a supprime comme inutile, attendu
qu'elle donnait les mmes rsultats que celle de
fa
qua-
trime ligne.
Le nombre des clefs est gal celui des voix, il existe
entre elles la diffrence d'une tierce qui se rencontre
aussi dans le diapason d'une voix celle qui la suit imm-
dia tement; par ce moyen on peut maintenir chaque voix
dans l'tendue de la porte, sans avoir recours trop sou-
vent aux lignes additionnelles.
GLO 427
Ainsi, la clef de sol prsente le diapason du premier
dessus
;
La clef d'ut sur la premire ligne, celui du second
dessus. On se sert aussi de la clef d'ut sur la premire
ligne pour crire le premier dessus;
La clef d'ut sur la deuxime, celui du contralto
de
femme
;
La clef d'ut sur la troisime, celui de la haute-contre;
La clef d'tit sur la quatrime, celui du tnor
;
La clef de
fa
sur la troisime ligne celui du baryton
ou basse-taille
;
Enfin la clef de
fa
sur la quatrime reprsente le dia-
pason de la voix de basse, la plus grave de toutes.
La clef de
fa
sur la troisime ligne est abandonne, et
et l'on a pris l'habitude d'crire les parties de baryton
sur la clef de basse. La clef d'ut sur la deuxime ligne
ne sert plus qu'au cor anglais, et les parties de contralto
s'crivent avec la clef d'ut sur la troisime ou la pre-
mire ligne. On se sert nanmoins de ces deux clefs dans
la transposition.
Clef. On appelle encore clef une espce de croix de
fer, perce par l'un de ses bouts d'un trou carr dans
lequel on fait entrer la tte des chevilles des harpes,
des pianos, des guitares, pour monter ou lcher les
cordes.
Clefs. Soupapes de mtal, adaptes certains instru-
ments vent, tels que les hautbois, la flte, le basson,
pour ouvrir ou fermer les trous que leur position rend
inaccessibles aux doigts.
Cliquettes. Espce de claque bois, drivant des cas-
tagnes.
Cloche Instrument de mtal destin annoncer les
crmonies du culte divin. Les plus grandes cloches
vinrent de la Campanie et de la ville de Nola.
Les cloches ont t introduites dans l'instrumentation
pour produire des effets plus dramatiques que musicaux.
Le timbre des cloches graves convient aux scnes solen-
nelles ou pathtiques
;
celui des cloches aigus, au con-
traire, fait natre des impressions plus sereines : elles
ont quelque chose d'agreste et de naf qui les rend pro-
pres surtout aux scnes religieuses de la vie des champs.
C'est pourquoi
Rossini a employ une petite cloche en
sol haut (du tnor) pour accompagner le gracieux chur
du second acte de Guillaume-Tell, dont le refrain est :
128
COD
Voici la nuit
;
tandis que Meyerbeer a d recourir
une cloche en
fa
grave, pour donner le signal du mas-
sacre des
Huguenots, au quatrime acte de l'opra de
ce nom. Il a eu soin, de plus, de faire de ce
fa
la quinte
diminue de si bcarre frapp au-dessous par les bas-
sons et qui, aid par les sons graves de deux clarinettes
en la et en si bmol, lui donne un timbre sinistre d'o
naissent la terreur et l'effroi.
Sabinien, successeur de saint Grgoire, l'an 606,
fut
le
premier pape qui ordonna que le peuple fut averti
pour venir au service divin, par le son d'une cloche, que
l'on plaa sur une petite lvation, au-dessus de la porte
de
l'glise. Le pape Jean XV institua l'usage de bnir
les cloches en 986,
et Jean IV en 639,
imagina l'anglus
en l'honneur de la Vierge, en faisant sonner trois fois la
cloche matin et soir.
Clochette. Ce petit corps sonore tait en usage chez
les anciens Hbreux. Les prtres le portaient dans leurs
habillements.
Les paens s'en servirent aussi, et cet
usage fut imit par les prtres catholiques des premiers
temps.
Maintenant les clochettes sont employes comme
jeu dans les orgues.
Clochettes (Jeu de).
On se sert quelquefois, dans
la musique,
d'un certain nombre de clochettes disposes
diatoniquement sur lesquelles on excute quelques m-
lodies
simples et assez lentes au moyen d'un marteau
lger. On fait de ces espces de carillon dans diffrentes
gammes : les plus aigus sont les meilleurs.
On appelle aussi Jeu de clochettes ou Glockenspiel un
instrument clavier en forme de piano, o les cordes
sont remplaces par un trs-grand nombre de petites
clochettes ou timbres, semblables des timbres de pen-
dules.
Mozart a donn une partie importante au jeu de
clochettes dans son opra de la Flte enchante.
A Paris, lorsqu'on a donn l'informe pastiche des
Mystres d'Isis, on a remplac les clochettes par des
barres
d'acier, et l'on a obtenu un son doux, mystrieux,
d'une finesse extrme qui, sous tous les rapports, tait
infiniment
prfrable au jeu de clochettes proprement
dit.
Cobeth. Luthier de Mantoue, imitateur de Stradiva-
rius, travaillait en 1714.
Coda, queue. On nomme ainsi une priode ajoute
celle qui pourrait finir un morceau, mais sans le terminer
COM 129
aussi compltement et avec autant d'clat. Dans les me-
nuets, les rondeaux et tous les morceaux reprises, on
vient la coda aprs avoir t'ait toutes les reprises selon
l'usage ordinaire. Quelquefois on met au-dessus de la
coda, ces mots : pour finir.
Colisson. Instrument invent en Pologne il
y
a quel-
ques annes, et qui ressemble un clavecin vertical
arm de cordes de boyaux. Au lieu d'un clavier, on
trouve entre les cordes de petits btons en bois de pru-
nier, qu'on touche avec la main couverte d'un gant en-
duit de colophane. Le mouvement de vibration des btons
se communique aux cordes qui rendent un son sem-
blable celui de Yharmonica.
Collecte. C'est l'oraison du jour, que le prtre rcite
aux messes basses et psalmodie aux messes hautes, im-
mdiatement avant l'ptre.
Colochon. Instrument, driv du luth, compos d'un
petit corps sonore surmont d'un manche excessivement
long, et portant deux trois cordes en boyaux.
Colophane, deColophon, ville d'Ionie, renomme pour
sa rsine, ce mot sert aujourd'hui nommer cette rsine
sche et transparente, dont se servent les artistes pour
frotter les archets.
Colore. On dit musique colore par opposition ce
qu'on appelle musique monotone
;
colore, c'est--dire
varie par des piano et des forte qui forment des
nuances bien entendues.
Coloris. Ce mot, dans l'art du chant, signifie que le
chanteur doit conformer sa voix au sentiment qui do-
mine dans la composition et dans chaque phrase en par-
ticulier.
Comarchjos. Sorte de nome pour les fltes dans l'an-
cienne musique des Grecs.
Come prima, come sopra. Expressions italiennes, qui
signifient comme auparavant, comme ci-dessus.
Comes. L'gale rptition
d'un thme de fugue, dans
un autre ton.
Comique. En musique, le comique consiste dans une
application
particulire des expressions mlodieuses et
harmonieuses
de l'art, au moyen desquelles on tche
d'veiller chez
l'auditeur le sentiment de la gaiet. Le
chant parlant,
qui s'approche le plus de la manire de
parler ordinaire,
est un des plus srs moyens d'arriver
ace rsultat.
130
COM
Comirs. Farceurs provenaux, sachant la musique,
jouant des instruments, et dbitant les ouvrages des
troubadours. (Voyez Jongleurs, Pantomime.)
Comma. Petit intervalle dont on ne peut faire usage
dans la musique pratique, mais dont les thoriciens sont
obligs de tenir compte dans le calcul des proportions
de l'chelle musicale.
Cependant, mme en musique pratique, le comma
produit un effet certain. Entre re bmol et v.t dise, par
exemple, il n'y a qu'un comma d'intervalle, et ce comma
suffit pour que re bmol, qui est plus bas que ut dise,
ait une tendance descendante, et pour que ni dise, qui
est un comma plus lev que re bmol, ait une tendance
ascendante. Ces tendances diffrentes ont une grande
importance par rapport la modulation, (Voyez ce mot.)
Commissura. Mot latin qui signifiait autrefois une
union harmonique de sons, dans laquelle, entre deux
consonnances, on trouvait une dissonance.
Commodo, Commodment. Mot italien qui indique un
mouvement intermdiaire entre la lenteur et la vitesse.
Compagnie dugonfalon. Espce de confrrie fonde
Rome en
1264, qui reprsentait un drame en musique,
pendant la semaine sainte.
Comparaison des rapports. Dans la science canoni-
que, il arrive quelquefois qu'on doit comparer la puis-
sance des rapports des intervalles et dterminer leur dif-
frence. Le moyen le plus facile pour pratiquer cette
opration, c'est la soustraction, dont nous parlerons
dans un article spcial.
Compensateur. Est un appareil imagin par Ad. Sax,
consistant dans un petit mcanisme qui s'applique aux
instruments de cuivre de son systme, permettant de
modifier volont le son par la longueur du tube.
Complainte.
Espce de romance populaire, d'un genre
pathtique. Ce petit pome est ordinairement le rcit
d'une histoire lamentable, qu'on suppose fait par le per-
sonnage mme.
Complment. Le complment d'un intervalle est la
quantit qui lui manque pour arriver l'octave; ainsi la
seconde et la septime, la tierce et la sixte, la quarte et
la quinte sont complments l'un de l'autre.
Complexio. On se servait de ce mot pour indiquer
qu' la fin
d'une priode on devait en rpter le com-
mencement.
COM 131
Compucato, Compliqu. On dit qu'une musique est
complique lorsque l'enchanement des parties qui la
composent est soigneusement tudi et plein d'imitations
artificielles.
Gomponium. Sorte d'orgue cylindre improvisant des
variations sur un thme donn. Cet instrument extraor-
dinaire mrita de la part de MM. Blot et Cotel un rap-
port l'Institut. Il fut inaugur et excut Amsterdam
en
1820,
par Winkler, mcanicien hollandais,
Composer. Inventer de la musique nouvelle selon les
rgles de l'art.
Compositeur. Celui qui compose de la musique d'a-
prs les rgles de l'art. Mais tout l'art, toute la science
possibles ne suffisent point sans le gnie qui les met en
uvre. Quelque effort que l'on fasse, il faut tre n mu-
sicien, autrement on ne fera jamais rien que de m-
diocre.
Composition musicale. Pris dans un sens gnral,
ce mot exprime l'art d'inventer et d'crire des chants,
de les accompagner d'une bonne harmonie, de faire, en
un mot, une pice complte de musique avec toutes ses
parties. C'est donc l'invention, la puissance cratrice
qui constituent le compositeur de gnie. Ayez des ides
neuves, parez-les de formes sduisantes, trouvez des
mlodies simples, gracieuses, tendres et passionnes
;
offrez aux sens, l'intelligence et nu cur une brillante
srie de tableaux, d'images et de sentiments; ces con-
ditions vous prendrez rang parmi les gnies crateurs
;
la foule rptera vos chants, et votre nom deviendra po-
pulaire. Mais si, au lieu de toutes ces qualits, vous
n'avez votre disposition que des lieux communs, des
banalits musicales, de ces phrases toutes laites qui ont
couru dans toutes les partitions; si vous ne sentez en
vous le souffle potique, cette harmonie instinctive, ce
dmon musical qui fait pressentir des uvres grandes et
belles, croyez-nous, n'abordez pas la carrire de la com-
position :
Soyez plutt maon, si c'est votre mtier.
On nat compositeur comme on nat pote. En mu-
sique, comme en posie, les connaissances les plus ten-
dues et les combinaisons les plus savantes ne sauraient
remplacer le gnie. Une composition musicale vraiment
132 COM
distingue, suppose le dveloppement et l'exercice des
plus hautes facults intellectuelles; elle exige la fois
de l'esprit, de l'ara e et du got : l'esprit qui cre et in-
vente, l*me qui s'meut et se passionne, le got qui
choisit et dispose dans un ordre convenable les ides,
les images. Tous les grands matres ont possd un
degr minent ces diverses facults.
Cependant il ne faudrait pas conclure de ceci que l'-
tude, ce qu'on appelle la science musicale, dt tre re-
jete comme inutile. Bien loin de l, la profonde connais-
sance des rgles dictes par l'exprience et la raison,
dveloppe les ides du compositeur le mieux dou de la
nature, et dcuple les ressources de son gnie en l'habi-
tuant se jouer sans efforts des combinaisons les plus
abstraites. Mais si une intelligence, mme suprieure, a
besoin du secours d'une ducation forte et solide pour
fconder ses heureuses qualits, il faut bien se garder
de tomber dans le fatal excs o quelques compositeurs
modernes se sont laisss entraner, en sacrifiant l'inspira-
tion la science du contre-point. Erreur funeste, et qui
a t fconde en dceptions. La science ne saurait mou-
voir si elle n'est vivifie par l'imagination et le cur. On
remarquera que le plus grand nombre des compositeurs
dont les uvres ont acquis une juste popularit, ne
semblent avoir dploy qu'une rudition extrmement
borne. Dans leurs productions, l'aridit de la science
disparat sous les fleurs de la posie.
Les thoriciens distinguent en musique deux sortes de
compositions : les compositions idales et les composi-
tions rigoureuses. Dans les premires le compositeur se
livrant entirement son imagination, n'envisage gn-
ralement qu'une partie principale, o toutes les ides ne
sontlies entre elles que selon les rgles du got et de la
cohrence, rgles auxquelles on peut mme droger, soit
pour l'expression, soit pour l'effet, et o toutes les par-
ties sont absolument accessoires. Tels sont un air d'o-
pra, un solo de concerto, etc. Dans les compositions ri-
goureuses, le musicien traite, selon des lois trs-prci-
ses, toutes les parties del composition, lesquelles, bien
que tendant produire un effet unique et gnral, doi-
vent se trouver disposes de faon ce que chacune pr-
sente un intrt particulier. C'est ce qui constitue l'art
d'crire plusieurs parties relles.
La composition se fait divers nombres de parties.
COM 133
On spcifie ordinairement ce nombre par les termes de
compositions deux, trois et quatre parties. Mais Ton
comprend gnralement sous le nom de composition
grand nombre celle qui est forme de plus de quatre
parties. Parmi les compositions grand nombre, on
regarde comme la plus parfaite la composition neuf
parties relles, il est presque impossible de faire mouvoir
un plus grand nombre de parties sans doubler le dessin
de l'une ou de plusieurs d'entre elles.
Toute composition est vocale ou instrumentale. Dans la
musique vocale, on doit d'abord avoir dgard l'tendue
des voix. Dans les pices d'un style svre, dans les fu-
gues, dans les churs, cette tendue ne doit pas excder
une dixime, parce qu'au-del de cette limite le choriste
crie dans le haut ou ne se fait pas entendre dans le bas.
Dans les grands airs ou autres compositions libres, il est
permis d'tendre l'chelle des mlodies, mais en ayant
soin de circonscrire les phrases principales dans le diapa-
son naturel des voix, et de n'aborder les sons aigus
qu'accidentellement.
Dans la musique instrumentale, l'tendue des parties
se rgle sur l'tendue des instruments. L'Allemagne
excelle surtout dans la musique instrumentale. Haydn,
Mozart et Beethoven ont port la symphonie ses der-
nires limites.
La composition musicale se divise encore en composi-
tion religieuse, composition dramatique, composition
de concert ou de salon.
Les compositions religieuses doivent avoir une phy-
sionomie grave, svre, imposante, approprie aux sen-
timents qu'elles expriment, la majest des difices o.
elles sont excutes. On retrouve ce caractre dans les
canons et les fugues des treizime et quatorzime sicles;
mais c'est surtout l'poque de la renaissance que la
musique religieuse prit de beaux dveloppements. Pa-
lestrina en fut alors le reprsentant le plus brillant et le
plus lev. Plus tard, Pergolse imprima ce genre de
composition cette teinte de tendresse et de mlancolie qui
formait le caractre distinctil de son talent.
En Allemagne, Jean-Sbastien Bach, le plus illustre
membre de cette famille si fconde en grand musiciens,
parut au dix-huitime sicle, et nous a laiss, dans le
genre svre, des uvres qui serviront ternellement de
modles. En Italie, l'cole napolitaine, o ont brill Lo,
134 GOM
Durante, Scarlatti, Iomelli, a produit des chefs-d'uvre.
Mozart, dans son Requiem si clbre; Gherubini, dans
ses messes, ont encore agrandi le domaine de la musique
religieuse. De nos jours, Rossini, dans son Stabat, a su
allier le sentiment religieux aux formes gracieuses de la
musique moderne
;
et Donizetti a prouv, dans son Mi-
serere, que le style svre de l'glise lui tait aussi fami-
lier que les effets brillants du thtre.
Indpendamment de la composition religieuse propre-
ment dite, il en existe une autre qui participe la fois de
la musique religieuse et del musique dramatique
;
nous
voulons parler de l'oratorio. Haendel, dans le Messie et
le Judas Machabe; Haydn dans la Cration et les Sai-
sons; Beethoven dans le Chrits au mont des Oliviers,
Mendelssohn dans Paidns et Elias, ont laiss sous ce
rapport des modles accomplis.
La passion, le mouvement, la verve, le coloris, l'clat
des images, tels sont les caractres que doivent avoir les
compositions dramatiqnes. Ce genre est sans contredit le
plus difficile de tous. Suivre le drame dans toutes ses
phases, peindre toutes les situations, s'identifier tous
les personnages, animer les masses chorales et les faire
participer l'action
;
marier les instruments et les voix,
de manire ce que l'intrt se soutienne constamment,
telle est la tche du compositeur dramatique. Pour la
remplir avec succs, il faut une grande puissance de ta-
lent.
L'Allemagne, l'Italie et la France ont rivalis d'clat,
de verve et d'originalit dans la musique dramatiqne.
Parlons maintenant des compositions de concert et de
salon. On comprend dans cette catgorie les sonates, les
concertos, et ce qu'on appelle aujourd'hui fantaisies
pour le piano, pour le violon, pour la harpe, etc.
Le caractre de ces productions est la coquetterie, la
lgret et la grce.
Parmi les compositions de concert et de salon, n'ou-
blions pas de mentionner la Romance. Sous ce rapport,
l'cole franaise s'est place, sans contredit, au premier
rang, dans le monde musical. Rien n'gale la vogue et
la popularit dont jouissent en Europe quelques-uns de
nos compositeurs de romances.
En Allemagne, les lieders de Schubert ont ouvert une
route nouvelle aux compositeurs de salon et de concert.
Sous l'influence des dlicieuses mlodies de ce matre,
CON
135
le caractre de la romance franaise s'est agrandi et d-
velopp.
Compos. Ce mot se rapporte : I
e
aux intervalles, et
l'on nomme intervalle compos ou redoubl, celui
qui passe l'tendue de l'octave
;
2
e
A la mesure et aux
temps, et l'on appelle mesures composes celles qui sont
dsignes par deux chiffres.
Comus. Nom d'un air de danse des anciens.
Con anima. Avec me, en donnant toutes les notes
l'expression ncessaire, et en renonant mme l'obser-
vation scrupuleuse de la mesure, si par ce sacrifice on
peut produire plus d'effet et d'expression.
Con brio. Avec clat, force, vivacit.
Concentus. (Voyez Accord.)
Concert. Ce mot vient du latin concinere, et signifie
une runion de musiciens qui excutent des morceaux
de musique vocale et instrumentale. En Italie un con-
cert se nomme Aademia.
Concerts. (Socit des concerts du Conservatoire).
Cette Socit se compose d'une runion d'instrumentistes
et de chanteurs reus socitaires la majorit des suf-
frages des membres prsents. Elle fut fonde par M. Ha-
beneck an, et son premier concert eut lieu au commen-
cement de janvier 1828, dans la salle dite des Menus-
Plaisirs, au Conservatoire de Musique de Paris. La
symphonie hroque de Beethoven servit de discours
d'ouverture et fit sensation. Le premier concert produi-
sit 1060 fr.
;
la recette du second s'leva
3,000 fr. Dans
ce second concert, on excuta la symphonie en ut mineur.
L'effet en fut foudroyant. Ds ce moment, le nom de Bee-
thoven fut consacr et la Socit des concerts conquit le
rang suprme parmi nos institutions musicales. M. de
Larochefoucault envoya M. Habeneck une mdaille d'or
sur laquelle taient gravs ces mots: donn par le Roi
pour les concerts de 1828. Cette Socit est sans rivale
en Europe.
Aprs la mort de M. Habeneck, M. Girard fut nomm
chef d'orchestre de la Socit des concerts, et aprs la
mort de M. Girard M. Georges Hainl hrita de cette
position, et il l'occupe encore aujoud'hui.
La Socit des Concerts est fonde sur le principe de
l'galit absolue. Les bnfices sont partags par por-
tions gales entre les socitaires, et s'ils ont chacun des
droits gaux, ils sont tous soumis aux mmes charges,
136 CON
aux mmes devoirs. C'est toujours dans la salle de spec-
tacle des Menus-Plaisirs qu'ont lieu les sances de la
Socit des Concerts. Elles commencent tous les ans
dans les premiers jours de janvier, et se poursuivent de
quinzaine en quinzaine jusqu' la semaine qui suit le
jour de Pques.
Concert spirituel. Concert o l'on ne chante que la
musique d'glise, et d'o l'on exclut les morceaux d'o-
pra. Le concert spirituel a t fond en
1725,
par
Anne Dunican, dit Philidor, musicien de la chambre
du roi et frre an du musicien de ce nom.
On est convenu de nommer concerts spirituels les
deux sances du vendredi-saint et du jour de Pques au
Conservatoire, et gnralement tous autres concerts
donns du dimanche des Rameaux au mardi de Pques
inclusivement. Jadis les exercices de Choron et les
sances du prince de la Moskowa, taient de vritables
concerts spirituels.
Concertante, concertant. Se dit particulirement
d'un morceau de musique dans lequel les diffrentes
parties brillent alternativement. Ainsi, l'on dit : un duo,
un quatuor concertant, pour indiquer des pices dans
lesquelles deux ou quatre parties concertent.
Concertare, Concerter. Exercice de deux ou plu-
sieurs voix ou instruments ensemble, afin que l'excu-
tion de la composition soit plus uniforme, plus gale, et
qu'elle ait la mme force et la mme expression.
Concert. Ce mot, d'origine italienne, signifie un
style de musique d'glise plus brillant que le style svre
capella (de chapelle.)
Concertino. Dans quelques pays d'Italie on appelle
concertino la partie du premier violon, chef d'orchestre,
o se trouvent marqus tous les passages obligs des
instruments.
On appelle aussi concertino un petit instrument
soufflet, que l'on joue avec les deux mains la ibis,
l'aide de touches places ses deux extrmits, et peu
prs semblable celui que nous appelons accordon. Cet
instrument est particulirement en usage en Angleterre.
Il
y
a le concertino-baryton, qui s'tend depuis le sol
jusqu' Yut
;
le concertino-basse, qui est d'une octave
plus bas que le baryton, et le concertino-tnor, une
octave plus haut que ce dernier. Le premier qui a jou
cet instrument en Angleterre est Giulio Rx'cgondey.
CON
137
Concertiste. Celui qui joue ou chante dans un con-
cert.
Concerto. On appelle concerto une pice de musique
faite pour quelque instrument particulier, avec accom-
pagnement d'orchestre. Il
y
a des concertos de piano, de
violon, de flte, etc. Un concerto est ordinairement com-
pos d'un allgro, d'un adagio et d'un rondeau. Le
concerto a pris, depuis quelque temps, plus de dveloppe-
ment et s'est lev presque la hauteur de la sym-
phonie.
Le concerto a t invent pour placer en premire
ligne l'instrument favori, et le prsenter de la manire
la plus avantageuse, en tablissant des contrastes entre
l'ensemble d'un orchestre nombreux et les doux accents,
les brillantes priodes du virtuose. Le concerto est le
morceau de musique qui exige le plus de talent pour
l'excution. On nomme tutti les passages du concerto
pendant lesquels l'orchestre joue seul.
Goncerto-grosso. Nom que l'on donnait dans le
sicle dernier des symphonies avec violon principal et
d'autres parties obliges ou non.
Concinni, Inconcinni. La voix humaine a deux espces
de sons : les sons articuls et les sons -moduls. Les
sons articuls, appels en latin inconcinni, sont ceux de
la parole, qui, par leurs mouvements continuels, ne
peuvent pas tre apprcis par l'oreille. Les sons mo-
duls, appels concinni, sont au contraire ceux du chant,
qui, par leur mouvement modr, peuvent tous tre
apprcis.
Concomitants. Se dit des sons que l'oreille dis-
tingue, outre le son principal quand on fait vibrer une
corde.
Concordant. On nommait anciennement ainsi l'es-
pce de voix qui est entre la taille et la basse-taille, et
qui peut chanter l'une et l'autre partie.
Concours. Assemble de musiciens et de connaisseurs
autorise, dans laquelle une place vacante de matre de
chapelle, de violoniste, etc., est emporte la pluralit
des suffrages par le concurrent le plus habile.
Conduit. Tube par lequel le vent passe des soufflets
dans les sommiers. Un fragment de musique qui ramne
une ide principale s'appelle aussi conduit.
Conduite. C'est dans un morceau de musique, l'art
d'agencer une ide principale avec les ides accessoires,
138
CON
de
ramener le motif propos sans en abuser, d'en-
chaner ses modulations, en ne leur donnant ni trop ni
trop peu d'tendue.
Con espressione. Avec expression.
Conjoint se dit d'un intervalle ou degr. On appelle
degrs conjoints ceux qui se suivent dans l'ordre de la
gamme
;
et
mouvement conjoint, la marche qu'accom-
plissent ces degrs.
Con moto. Ces mots, joints celui qui indique le
mouvement d'un morceau de musique, signifient que
l'on doit donner un degr de plus en vitesse au mouve-
ment indiqu.
Connaisseur. Le connaisseur est celui qui non-seule-
ment sent le beau dans les uvres de l'art, mais qui
possde aussi, sur la partie mcanique et esthtique, des
connaissances
suffisantes pour pouvoir juger sainement
du
mrite des ouvrages.
,
Consquente. La deuxime partie d'une figure.
Conservatoire. C'est le nom que l'on donne aux
grandes coles de musique, parce qu'elles sont destines
propager l'art et le conserver dans toute sa puret.
C'est en Italie que furent fonds, au xvn
e
sicle, les
premiers
Conservatoires. Ceux de Naples fournirent un
grand nombre de chanteurs clbres et de compositeurs
minents. Il suffit de citer Scarlatti, Porpora, Durante,
Lo,
Pergolse, etc. Mais lus plus beaux jours de ces
tablissements sont malheureusement passs.
Aprs
les Conservatoires de Naples venaient ceux de Venise,
qui taient entirement consacrs aux femmes, comme
ceux de Naples l'taient aux hommes. On en comptait
quatre : YOspedale dlia piet
t
le Mendicanti, le Incu-
rabili et YOspedaetto di sau Giovanni. Deux de ces
Conservatoires cessrent dans les dernires annes de la
Rpublique.
Celui des
Mendicanti exista jusqu' l'-
poque de la rvolution. Celui de la Piet, o sont les
enfants trouvs,
existe encore aujourd'hui.
Le
Conservatoire de musique de Paris fut fond en
1793,
par Sarette, celui de Milan en 1807, celui d'Es-
pagne en 1830,
ceux de Vienne et de Varsovie en
18-21.
Quelques autres Conservatoires ont t fonds dans ces
derniers temps, sous divers titres, Prague, Saint-
Ptersbourg, Varsovie, Berlin, Londres et Bruxelles.
Presque tout ce qu'il
y
a en France de plus habile en
chanteurs, en compositeurs, en instrumentistes, pro-
CON
139
fessent au Conservatoire de Paris. C'est, de tous les
tablissements de ce genre, celui qui est conu
sur le
plan le plus vaste. 11 a rendu de grands services la
nation, et form des milliers d'instrumentistes.
Le
Conservatoire de Paris, fond par le vnrable Sarrette,
dirig ensuite par M. Perne, et plus tard par Chrubini.
auquel succda M. Auber, est aujourd'hui plac sous la
direction de M. Ambroise Thomas.
Consonnances. On appelle consonnances
certains
intervalles qui plaisent immdiatement l'oreille, parce
que leur constitution saisit l'esprit d'un mpport parfait
de tonalit, et dveloppe en mme temps en nous le sen-
timent de repos et de sens fini.
Les intervalles consonnants rpondent plus ou moins
parfaitement cette ide : aussi les divise-t-on en con-
sonnances parfaites et en consonnances
imparfaites.
La quinte et Yoctave sont des consonnances parfaites.
Par extension on donne aussi ce nom l'unisson, bien
qu'il ne soit pas un intervalle.
Les consonnances imparfaites sont : la tierce majeure
ou mineure [ut, mi naturel, et la, ut), la quarte (sol ut),
et les sixtes (ut, la et mi, ut). (Voyez les mots Inter-
valles et Dissonances.)
Consonn'ant, Consonnante. Un intervalle conson-
nant est celui qui donne une consonnance. Un accord
consonnant est celui qui n'est compos que de conson-
nances.
Consonnante. Nom donn un instrument de mu-
sique invent par l'abb Dumont, qui participait du cla-
vecin et de la harpe. Sa forme tait celle d'un grand
piano pos plomb sur un pidestal, les cordes taient
places des deux cts de la table que l'on touchait
comme celles de la harpe.
Contra, Contre. Ce mot signifiait anciennement la
voix d'alto. Il tait appliqu particulirement toutes les
parties destines faire harmonie avec une autre, ou
plutt contre une autre.
Contra-horne. Espce de Sax-hom alto, construit
Berlin en
1843, par Lamferhoff.
Contralto signifie haute-contre. Mais on a conserv
ce mot italien pour l'appliquer la haute-contre des
femmes, et la distinguer ainsi de celle des hommes. Ces
deux sortes de voix diffrent ensemble d'une tierce en-
140 CON
viron. Le contralto s'lve jusqu'au mi, les bornes de la
haute-contre sont fixes Vut.
Le contralto est pour les femmes ce que la voix de
basse est pour les hommes, la plus grave de toutes. Son
tendue est la mme, une octave plus haut.
Contraste. C'est la runion de choses opposes les
unes aux autres, qui, en arrivant tout coup, arrtent
d'abord l'attention de l'auditeur et se rendent agrables
par leur air de nouveaut. Par exemple, le forte produit
un plus grand effet aprs le piano, et le piano aprs le
forte, si toutefois l'un suit immdiatement l'autre.
Contrebasse. La contrebasse est l'instrument le plus
grand de la famille des violons. Les sons rsonnent
l'octave basse de ceux du violoncelle. La contrebasse est
le fondement des orchestres. Aucun autre instrument ne
saurait le suppler. La richesse de ses sons, son attaque
pleine de franchise et de pompe, et surtout l'ordre admi-
rable qu'elle porte dans les masses harmoniques, signa-
lent partout sa prsence.
11
y
a deux espces de contrebasse : l'une trois cordes
et l'autre quatre. Leur tendue est de deux octaves et
une quarte, du mi grave del voix de basse au la aigu
du tnor, en comptant toutefois, pour les contrebasses
trois cordes, deux notes de moins au grave. Mais il faut
observer que le son de l'une et de l'autre est plus grave
d'une octave que la note crite.
La contrebasse quatre cordes est plus gnralement
employe dans les orchestres. Comme elle est accorde
en quartes, on peut excuter une gamme entire sans
dmancher
;
elle possde ensuite, au grave, deux ou mme
trois sons, dont la contrebasse trois cordes est prive.
La contrebasse est destine, en gnral, faire en-
tendre la basse de l'harmonie. On peut l'isoler des vio-
loncelles et mme du quatuor des instruments cordes,
et l'associer aux instruments vent qu'elle soutient avec
beaucoup d'effet et de plnitude. A l'glise, on l'emploie
aussi pour soutenir les voix du chur, et quelquefois la
marier au son de l'orgue.
La contrebasse n'est pas propre aux traits rapides.
On a le tort, aujourd'hui, de lui en donner quelquefois
qui sont peu prs inexcutables pour la plupart des
contrebassistes. Aussi qu'arrivc-t-il ? Les uns simpli-
fient ces traits d'une manire, ceux-ci d'une autre, ceux-
l cherchent rendre le passage avec fidlit, et tout
CON 141
cela runi produit le plus abominable chaos de grogne-
ments sourds et rauques qui puisse pouvanter l'imagi-
nation.
Le trmolo des contrebasses est quelquefois d'un effet
dramatique saisissant; il donne l'orchestre une phy-
sionomie menaante, mais il faut viter de le prolonger
trop .longtemps, cause de la fatigue qu'il apporte aux
excutants zls et fidles.
D'aprs Bottesini, qui a publi une excellente m-
thode de contrebasse, si la contrebasse acquiert par
l'addition d'une quatrime corde une plus grande exten-
sion dans les sons graves, cette exteusion ne s'obtient
qu'au dtriment de la sonorit, qui, naturellement, di-
minue d'autant qu'on augmente le nombre des cordes.
Les principaux contrebassistes virtuoses tels que Dra-
gonetti et Bottesini, se sont toujours servis de la con-
trebasse trois cordes.
Contrebasse. Jeu d'orgue dont les tuyaux sont de
seize ou trente-deux pieds, ouverts ou ferms selon la
qualit de l'orgue.
Contrebasson. Instrument qui donne l'octave du
basson.
Contredanse. La contredanse est forme de diverses
figures rsultant de la position des danseurs. En France
on donne ces figures les noms de pantalon, t, trnis,
pastourelle, chasse-crois, galop. (Voyez Quadrille.)
Contrepoint. A l'poque o la musique plusieurs
voix reut son premier perfectionnement, on marqua sur
les lignes des points au lieu des notes. Quand on voulait
ajouter une mlodie une ou plusieurs voix, on ajoutait
aux points qui existaient dj d'autres points l'un sur
l'autre, ou l'un contre l'autre, et c'est ce qu'on appelait
contrapimtare. Cette expression a t conserve comme
une expression technique, en sorte qu'aujourd'hui le
mot contrepoint, dans son acception la plus tendue,
dsigne tout ce qui appartient 5 la partie harmonique de
la composition musicale.
Par le mot contrepoint, pris dans le sens le plus res-
treint, on entend une composition deux ou plusieurs
voix, crite sur un chant donn. On dpasse rarement le
nombre de huit voix. Si les voix sont disposes de ma-
nire ce qu'on puisse les renverser, c'est--dire ce
que la voix suprieure devienne voix fondamentale, et
vice versa, alors on l'appellera contrepoint double. On
5..
142 GOR
lui donnera au contraire le nom do contrepoint simple,
si le renversement ne peut avoir lieu sans choquer les
rgles de l'art. Le contrepoint simple deux ou plusieurs
voix, ayant des notes d'une gale valeur places les unes
contre les autres, s'appelle contrepoint gal ou note
contre note. En mettant deux ou quatre notes contre
une note de la mlodie, il prendra le nom de contrepoint
ingal ou figur. En crivant sur le chant donn des
mlodies composes de diverses valeurs, on aura le con-
trepoint fleuri.
Contrepointiste. Le contrepointiste, dans la vri-
table acception du mot, est celui qui, d'aprs les rgles
scolastiques, combine l'union des sons, observe exacte-
ment l'ortographe lorsqu'il trace leurs signes sur le pa-
pier, et ne s'occupe enfin que de la partie scientifique de
l'art
Contre-sens. Vice dans lequel tombe le compositeur
quand il rend une autre pense que celle qu'il doit
rendre. C'est donc un contre-sens dans l'expression,
quand la musique est triste lorsqu'elle devrait tre gaie,
lgre lorsqu'elle devrait tre grave, et rciproquement.
Contre-temps. La partie faible de la mesure ou du
temps. Dans la plupart des accompagnements, la basse
frappe le temps, les autrs parties marquent le contre'
temps.
On dit aussi aller contre-temps, pour dire que les
excutants manquent la mesure et qu'ils ne marchent
pas avec le chef d'orchestre.
Copier. Transcrire un morceau de musique. Ce mot
dsigne, en outre, le plagiat d'un compositeur qui s'ap-
proprie des passages entiers d'autres compositeurs, et
les fait passer pour siens, comme s'ils taient sortis de
sa plume.
Copiste. Celui qui fait profession de copier de la mu-
sique, d'extraire des parties spares d'une partition,
ou qui les double pour qu'elles s'excutent avec orches-
tre. Le copiste doit possder d'abord une criture bien
lisible, et doit, nim-seulement crire correctement les
notes, mais encore, tous les points, les signes, les lignes
et les paroles.
Cor. Instrument vent et embouchure. Consacr
la chasse ds son origine, le cor a t appel depuis de
plus hautes destines, e\ a pass des mains du chasseur
dans celles des plus habiles excutants. Cette voix rau-
COR 143
que et sauvage, la terreur des htes des bois, s'est adou-
cie au point de nous ravir par des sons flatteurs. L'art
des Punta, des Duvernoi, des Dauprat, des Gallay, lui
donnant une nouvelle existence, l'a enrichi d'une multi-
tude de tons que la nature semblait lui vouloir refuser.
Biillant et sonore dans tout ce qui rappelle sa destination
primitive, le cor est tendre et pathtique dans le canta-
bile. Un clbre corniste, M. Vivier, a trouv le secret
de tirer du cor plusieurs sons simultans.
Le cor tant un tuyau sonore ouvert par les deux
bouts, et priv des trous qui, dans le hautbois et la clari-
nette, servent modifier les sons, tfest au moyen de la
pression des lvres sur l'embouchure et de l'introduction
de la main dans le pavillon qu'on parvient rendre des
sons diffrents; mais comme de cette manire on ne
peut faire rsonner que la tonique et les aliquotes, on se
verrait rduit demeurer constamment dans le mme
ton, si l'on n'avait recours divers corps de rechange,
qui. en s'adaptant l'instrument, servent h lever ou
abaisser son intonation.
Le cor s'crit sur la clef de sol et sur la clef de
fa,
avec
cette particularit, tablie par l'usage, que la clef de sol
est considre comme tant plus grave d'une octave
qu'elle ne l'est rellement.
Tous les cors, l'exception du cor en ut, sont des ins-
truments transpositeurs
;
c'est--dire que les notes cri-
tes ne reprsentent pas les sons qne l'on obtient. Nous
renvoyons aux ouvrages spciaux pour l'explication d-
veloppe de cette pratique, qui est, au reste, une conven-
tion commune beaucoup d'instruments. (Voyez le mot
Transpositeur
)
Le cor a deux espces de sons d'un caractre trs-dif-
frent : les sons ouverts et les sons bouchs. Les pre-
miers sont l'effet de la rsonnance naturelle des divisions
harmoniques du tube do l'instrument, et sortent sans
autre secours que celui des lvres et du souffle de l'excu-
tant
,
les seconds s'obtiennent en fermant plus au moins
le pavillon du cor avec la main.
Non-seulement les sons bouchs diffrent entirement
des sons ouverts, ils diffrent encore beaucoup entre eux.
Ces diffrences rsultent de l'ouverture plus ou moins
grande laisse au pavillon par la main de l'instrumen-
tiste. Pour certaines notes, le pavillon doit tre bouch
del moiti, du tiers, du quart : pour d'autres, il faut le
144 COR
fermer presque entirement. Plus l'orifice laiss au pa-
villon est troit, plus le son est rauque, sourd, dificile
attaquer avec certitude et justesse.
Le cor est un instrument noble et mlancolique. Au-
cun matre n'a su en tirer un parti plus original,
plus potique et plus complet que Weber. Dans
ses trois chefs-d'uvre Oberon, Euryante et le
Freischutz, il lui prte un langage aussi admirable que
nouveau, et que Mhul et Beethoven seuls paraissent
avoir compris avant lui. De tous les instruments de l'or-
chestre le cor est celui que Gluck crivait le moins bien.
Cependant il faut citer comme un clair de gnie les trois
notes du cor imitant la conque de Caron, dans l'air d' Al-
ceste, Caron t'appelle ! Ce sont des ut du mdium,
donns l'unisson par deux cors en r; mais l'auteur ayant
imagin d'en faire aboucher les pavillons l'un contre
l'autre, il en rsulte que les deux instruments se servent
mutuellement de sourdine et que les sons en s'entrecho-
quant prennent un accent lointain et un timbre caver-
neux de l'effet le plus trange et le plus dramatique.
Cor anglais. Cet instrument tient, dans la famille du
hautbois, la mme place que la viole dans celle du vio-
lon. Le cor anglais a t invent par Joseph Ferlendis,
de Bergame, et il
y
a peine soixante ans qu'il est en
usage dans les orchestres. Le cor anglais a la forme du
hautbois, dans des proportions plus fortes : il est un peu
recourb, et son pavillon se termine en boule au lieu
d'tre vas comme celui du hautbois. Le cor anglais
sonne une quinte plus bas que le hautbois, cause de la
longueur de son tube. Les sons du cor anglais propres h
la tendresse, la mlancolie, ne se font admettre dans
l'orchestre que pour l'excution de quelques solos.
Cor de basset, en italien, corno di bassetto. Cet
instrument, qui unit la douceur du son quelque chose
de srieux et de sombre, a t invent, en 1770, Pas-
saw en Bavire. En 1782, M. Lotz, Presbourg, a
beaucoup contribu son perfectionnement. Le cor de
basset est de la nature de la clarinette, et n'en diffre
qu'en ce qu'il est un peu plus grand, et en ce que sa
forme est un peu recourbe
;
mais il ressemble la cla-
rinette, non-seulement dans les parties constitutives et
dans le son, mais encore dans ce qui regarde l'intona-
tion, l'embouchure, le doigt, de faon que tout clarinet-
tiste peut jouer de cet instrument sans difficult.
COR
145
Cor a pistons. L'inventeur du cor h pistons est due
Jean-Henri Sllzel, qui tait originaire de Scheilbem-
berg en Saxe, o il naquit en 1777. En
1806, il conut
ride de perfectionner les instruments de cuivre, en
augmentant leur chelle diatonique et chromatique.
Il
fit entendre Breslaw, en Silsie, un cor sur lequel il
avait appliqu son nouveau systme. Sa dcouverte ayant
t gote, il la publia en
1814, et joua dans plusieurs
concerts.
Voici les bases sur lesquelles a t construit le cor
pistons. Ne rien changer au caractre du cor ordinaire,
conserver les bonnes notes, rectifier la justesse de celles
qui sont fausses, rendre l'clat aux sourdes et remplir
toutes les lacunes.
Le cor pistons fait toutes les notes ouvertes au moyen
d'un mcanisme particulier dont l'action consiste chan-
ger instantanment le ton du cor. Ainsi l'emploi de tel
ou tel piston transforme le cor en
fa,
en un cor en
mi,
en mi bmol, etc.
;
d'o il suit que les notes ouvertes de
tous les tons se trouvant ajoutes les unes aux autres,
on obtient toute la gamme chromatique en sons ouverts.
De plus, les pistons ajoutent, au grave, six demi-tons
l'tendue du cor ordinaire. Il en est ainsi de tous les
instruments en cuivre, trompettes, cornets, trombones,
etc., auxquels le systme des pistons a t appliqu.
Le timbre du cor pistons diffre un peu de celui du
cor ordinaire et ne saurait le remplacer.
Les Allemands appellent le cor h pistons cor chroma-
tique.
Cor a cylindres. Le cor cylindres ne diffre du
prcdent que par son mcanisme. Cette diffrence est
toute son avantage pour le timbre et l'agilit. Les sons
de ce cor ne sont rellement pas diffrents des sons du
cor ordinaire, et peut le remplacer avantageusement, au
moins pour les sons ouverts.
Cor russe. Les Russes ont une musique de cor d'un
effet tonnant. Vingt, trente, quarante musiciens ont
chacun une espce de cor ou de trompette, ou plus exac-
tement un tube de mtal, qui ne donne qu'une seule
note. Ces cors sont accords de telle manire qu'ils four-
nissent, comme les tuyanx de l'orgue, toutes les notes
ncessaires pour excuter un morceau de musique avec
les accompagnements.
Cette espce d'orchestre rend un
son plus fort, plus nourri que nos instruments vent.
5...
146
COR
Par un temps calme, on entend cette musique une
grande distance. Un habile orchestre russe peut excu-
ter des
quatuors, des symphonies, des concertos, des fu-
gues, et faire les traits et les trilles avec la plus grande
nettet.
Cordaulolion. Ou harmonicorde , instrument qui
avait la forme d'un piano vertical
;
il tait mont de
cordes mtalliques mises en vibration par le frottement
d'un cylindre ou par une roue que l'excutant faisait
mouvoir avec les pieds.
Corde
gnratrice. C'est ainsi qu'on appelle une
corde dont on fait entendre toutes les parties aliquotes,
toutes les divisions harmoniques.
Corde ennemie. Quelques matres de chant italien
nomment ainsi (Corda nemica) le premier son du regis-
tre de la voix de tte, cause de la difficult qu'on
prouve l'atteindre, en
y
passant du registre de la
voix de poitrine.
Corde sonore. Corde tendue qui sert faire des ex-
priences physiques et acoustiques, au moyen desquelles
on explique la thorie du son.
Cordes. Les cordes des instruments sont de diverses
matires, selon la manire dont on doit exciter en
elles le frmissement ncessaire pour produire le son
et faire vibrer l'air dans les tables d'harmonie.
Les cordes attaques par frottement sont faites avec les
boyaux de certains animaux
;
telles sont les cordes du
violon, de la viole, de la basse. Les cordes frappes
sont toujours de mtal. On met des cordes de laiton aux
octaves basses du piano
;
celles d'acier servent pour les
tons moyens, et les tons levs. Les cor'des pinces sont
de boyau, de mtal et de soie, selon l'instrument auquel
on les destine. La harpe et la guitare sont montes avec
des cordes de boyau et des cordes de soie
;
la mandoline
avec des cordes mtalliques.
La contexture d'une corde influe sur le son qu'elle doit
produire. Une chanterelle de violon, recouverte dans
toute sa longueur avec un fil de laiton trs-dli, sert
de quatrime corde au mme instrument. Les cordes fi-
les de la harpe et de la guitare sont de soie.
On dit aussi : cette mlodie est crite dans les bonnes
cordes de la voix.
Cordes sonores. Si on tond convenablement deux
cordes sur une table d'harmonie et que l'on en fasse
COR 147
varier leur longueur l'aide d'un chevalet mobile, on re-
connat
\
que si deux cordes sont de mme grosseur,
de mme matire, et tendues galement, le nombre de
leurs vibrations dans un temps donn sera en raison in-
verse de leur longueur. 2
U
Que toutes choses gales d'ail-
leurs, la rapidit de ces mmes vibrations et par cons-
quent leur nombre, crot proportionnellement la racine
carre des poids que Ton emploirait pour les tendre.
3
Enfin que ce nombre est rciproque au diamtre de
ces cordes, lorsqu'elles ne diffrent entre elles que sous
ce rapport.
Une proprit remarquable des cordes sonores est que
si le chevalet qui divise une corde en deux parties inga-
les ayant un commun diviseur, la presse assez lgrement
pour permettre aux vibrations imprimes l'une des di-
visions de se transmettre l'autre, alors, au lieu du son
que devraient rendre l'une et l'autre portion on entend
celui qui rpond la plus grande aliquote commune aux
deux parties. En supposant que ces parties sont entre
elles comme 3 :
2,
elles devraient en rsonnant simulta-
ment faire entendre la quinte
,
sol,
;
or, le son produit
est sol, parce que la plus grande partie se sous-divise en
trois et la plus petite en deux
;
d'o, rsultent cinq sous-
divisions qui ayant la mme longueur se trouvent h l'u-
nisson.
Cordomtre. Instrument au moyen duquel on peut
mesurer la grosseur des cordes pour maintenir l'accord
d'un instrument dans un gal degr de force. Il
y
en a
de plusieurs espces. Le meilleur cordomtre est celui
qui est form de deux petits morceaux de fer ou de cui-
vre, He la longueur de six sept pouces environ, qu'on
attache avec des vis aune de leurs extrmits, et qui sont
loigns l'autre extrmit, de trois, quatre lignes et da-
vantage, de faon qu'il existe un vide qui va toujours en
diminuant et se perd tout fait auprs des vis.
^
Chorique. Espce de flte qui accompagnait autre-
fois les dithyrambes.
Corista (nom italien du diapason). On donne le nom
de diapason un petit instrument monotone, ayante
peu prs la forme d'une petite fourche, et qui est fait
d'acier tremp. On le met en vibration en frappant l'une
de ces branches, ou en les cartant l'une de l'autre avec
violence, et l'on donne de l'intensit au son qu'il pro-
duit en appuyant son manche sur un corps dur. Ce son
J48 COR
est l'unisson du la
;
et selon que ce la est plus ou
moins lev, on dit que le diapason est haut ou bas.
Cornemuse. Instrument vent avec des chalumeaux
anche.
Les parties de la cornemuse sont la peau de
mouton, qu'on enfle comme un ballon, et le vent n'a
d'issue que par trois chalumeaux qui
y
sont adapts.
Cornet. Jeu d'orgue compos de quatre tuyaux, qui
rsonnent la fois sur chaque touche, et qui sont accor-
ds l'octave, la double quinte et la triple tierce.
Cornet. Le cornet est le plus ancien de tous les
instruments qui sont actuellement en usage. Sa forme
est trs-simple. Il est fait en corne et perc de sept
trous, dont un sert au pouce de la main gauche. Il est
de la longueur de deux pieds environ, et on enjou
comme de la trompette. L'tendue du cornet, dans toute
la gamme diatonico-chromatique, est depuis le la, clef
de violon au-dessous des lignes, jusqu'au mi au-dessus
des lignes.
Cornet a bouquin. Cet instrument ne se distingue du
cor de chasse que par sa dimension plus petite et son
embouchure qui est attache au corps du cornet.
Cornet a pistons. Le cornet pistons doit sa
naissance la trompette
;
car le cornet n'est autre chose
qu'une petite trompette qui possde des tons plus aigus.
Le mcanisme du cornet pistons est semblable en tous
points celui de la trompette, c'est--dire que les
pistons remplissent les mmes fonctions. L'instrument
offrant par sa nature des sons plus aigus que ceux de la
trompette, son tendue est par consquent renferme
dans un espace moins grand. Le rapport qu'on peut
tablir entre eux est celui qui existe entre le violon et
l'alto.
Le son du cornet pistons est un peu vulgaire
;
il est
presque inadmissible dans le style srieux. Employ
dans l'harmonie, au contraire, il se fond trs-bien dans
la masse des instruments en cuivre.
Corniste. Musicien qui joue du cor.
Cornone. Nom donn un grand cor en
fa
grave
devant servir de basse d'orchestre construit en 1835 par
Serveny's de Kcnecgsgroff.
Cornoon. Espce de cor rendu chromatique au moyen
d'un appareil imagin par Serveny's.
Corfs d'harmonie. C'est ainsi qu'on appelle quelque-
fois un corps de musique militaire.
COS 149
Corps de voix. Les voix humaines ont diffrents
degrs de force et de volume. De deux voix semblables
qui forment le mme son, celle-l aura plus de corps
qui se fera entendre davantage et une plus grande
distance.
Corps sonore. On appelle ainsi tout corps qui rend
ou peut rendre du son. Il ne suit pas de cette dfinition
que tout instrument de musique soit un corps sonore.
On ne doit donner ce nom qu' la partie de l'instrument
qui sonne elle-mme, et sans laquelle il n'y aurait point
de son. Ainsi, dans un violoncelle et dans un violon,
chaque corde est un corps sonore
;
mais la caisse de
l'instrument, qui ne fait que reprsenter et rflchir les
sons, n'est point le corps sonore et n'en fait point partie.
Correct. Se dit de cette perfection qu'on apporte dans
le travail d'un ouvrage o l'on a suivi avec la plus
grande exactitude possible toutes les rgles de l'art. Une
composition musicale est correcte toutes les fois qu'on
observe les rgles prescrites par la mlodie et l'har-
monie.
Coryphe. Chanteur qui, aprs avoir excut les
solos dans les churs, se joint ensuite aux simples
choriste dans l'ensemble.
Cosaque. Danse des cosaques en mesure de
2(4, et
dont la mlodie est deux reprises, de huit mesures et
d'un mouvement modr.
Costa. P. luthier de Trvse, qui travaillait de 1660
1680.
Costumes dans leurs rapports avec l'opra. Sous
Louis XIII et Louis XIV, les acteurs, dans la comdie,
taient vtus sur le thtre comme la ville. Dans la
tragdie, leur costume ne ressemblait en rien la
ralit. Dans l'opra, le costume des personnages mytho-
logiques offrait un mlange bizarre et incohrent dont
il serait difficile de rendre compte. La mode et son
inconstance influrent sur ces costumes imaginaires, et
l'on vit, sous Louis XV, les nymphes et les faunes
venir danser sur nos scnes lyriques avec des paniers et
des bouffants, tous couverts de gaze bouillonne avec
des rubans. Quelques artistes voulurent introduire des
rformes dans les costumes de thtre
;
mais l'amliora-
tion qu'ils
y
apportrent se borna exclure les paniers
des actrices et les chapeaux plumes des acteurs
;
in-
troduire dans les sujets asiatiques tantt un habit turc,
150
COU
tantt une peau do tigre en forme de manteau
;
puis
l'habit franais du seizime sicle pour les sujets relatifs
la chevalerie.
Ces amliorations taient bien loin d'atteindre les
perfectionnements que Ta] ma fit adopter vers 1791. La
tragdie de Charles IX, joue alors au Thtre-Fran-
ais, est le premier ouvrage o Ton ait suivi le costume
avec une rigoureuse exactitude. Cette innovation lut
tellement gote du public, qu'elle s'tendit, bientt
d'autres thtres, et notamment l'Acadmie royale de
musique.
Cependant, on doit avouer que le zle ne se soutint
pas en tout point. Ainsi, on vit l'Opra la Smiramis,
de Catel joue clans un palais d'architecture corinthienne
dont les jardins se trouvaient remplis de plantes d'Am-
rique. Un trne tait plac sous une draperie de mau-
vais got, ressemblant ce qu'on nommait, il
y
a
cinquante ans, un baldaquin la polonaise.
Aujourd'hui, dans beaucoup de nos thtres, les
principaux acteurs ont un costume assez conforme
leur rle.
M. Duponchel, grce aux conseils de l'intelligent
artiste Nourrit, introduisit l'Opra une nouvelle
rforme. La svrit des costumes ne s'est pas borne
celle des habits et des coiffures
;
la mme exactitude a
t
apporte dans les meubles et dans tous les acces-
soires. Des amliorations analogues ont eu lieu
T Opra-Comique, et le Thtre-Italien maintenant com-
mence h nous habituer un certain luxe de costumes et
de dcors.
Couleur locale. C'est donner la musique d'un
opra, d'un ballet, le caractre de la musique du pays
o se passe la scne.
Couleur des sons. (Voyez Timbre,)
Coup. On dit en musique coup de langue, coup de
gosier, coup d'archet. C'est une manire de lancer le
son pour la voix et pour les instruments. Le coup de
langue pour les instruments h vent a besoin d'tre net,
dtach, rapide.
Le coup d'archet pour les instruments cordes a besoin
d'tre dictinct, ferme, moelleux. Le coup de gosier
demanderait encore des prcautions plus grandes. Mais
cette expression n'est plus en usage, et ne sert mainte-
nant qu' dsigner ces grands clats de voix que les
COU
loi
chanteurs du temps de Rameau prodiguaient
dans notre
anciennne musique. La voix ne doit pas tre jete avec
effort, elle doit tre porte naturellement
sans tre tra-
ne ni saccade, et ne pas prsenter l'ide d'un coup.
Coup de fouet. C'est un certain effet plus fort, plus
plus brillant que tout le reste, par lequel on termine
un
morceau de musique pour obtenir des
applaudissements.
C'est pour donner le coup de fouet qu'on place quelque
fois des transitions vers la fin des morceaux de musique
et qu'on les termine presque toujours par un
forte et
mme par un fortissimo. Le grand crescendo n'a pas
d'autre but. Il
y
a pourtant certains morceaux
qu'on ne
pourrait terminer par un coup de fouet sans en dtruire
entirement l'expression, comme un sommeil, un noc-
turne, une cavatine pleine de sentiment et de suavit, et
toute espce de chant qui doit finir piano. Ces morceaux
n'en seront pas moins applaudis, s'ils sont
d'ailleurs
bien faits. Au surplus, ce n'est pas aux
bravos d'un
moment que prtend l'homme de gnie, mais une
estime durable.
Couplet. Nom qu'on donne dans les romances
et les
chansons cette partie du pome qu'on appelle
strophes
dans les odes.
Coupure. Suppression que l'on fait d'un certain
nombre de priodes dans le courant d'un
morceau de
musique, pour en rendre la marche plus rapide. C'est
aux dernires rptitions d'un opra que se font habi-
tuellement les coupures. Celles-l son rgles sur le
besoin que l'on a de passer plus vite de telle situation
telle autre, et d'activer ainsi le jeu de la scne.
On les
demande au compositeur, qui du premier coup d'oeil
voit ce qu'il doit sacrifier, et qui d'un trait de plume a
bientt rajust les deux bouts.
Courante. Air trois temps, propre une danse
ainsi nomme cause des alles et des venues dont elle
tait remplie. C'est air n'est plus en usage, non plus que
la danse dont il porte le nom.
Couronne, Trait en demi-cercle qui couronne le point
d'orgue et le point d'arrt ou de repos. Les Italiens
nomment souvent couronne, corona, le point d'orgue
lui-mme.
Couvert. Ce mot indique qu'on doit couvrir d'un
drap les timbales, afin d'en amorlir le son.
Il
y
a des octaves et des quintes que, dans les coles
152
CRI
d'harmonie, on appelle couvertes ou caches
;
on t'ait
une quinte ou une octave cache, lorsqu'on marche la
quinte ou l'octave par mouvement direct.
Crcelle. Espce de moulinet n bois dont on tire
un son aigre et bruyant, en l'agitant fortement avec la
main. 11 remplace les cloches dans les glises, le jeudi
et le vendredi de la Semaine-Sainte.
Crembalum. Instrument des Romains, qui, selon
quelques-uns, ressemblait aux castagnettes, et, selon
plusieurs autres, n'tait qu'une guimbarde.
Crescendo. Ce mot italien signifie en croissant, en
augmentant. Le crescendo consiste prendre le son
avec autant de douceur qu'il est possible, et le conduire
par degrs imperceptibles jusqu'au plus grand clat. Cet
effet est fort beau, et termine bien une symphonie.
Presque toutes les ouvertures d'opra arrivent leurs
derniers effets par un crescendo.
Crescere (monter). On dit en italien qu'un chanteur
cresce, qu'un instrumentiste cresce (joue ou chante trop
haut), lorsque leur intonation est plus leve qu'elle ne
doit tre. La cause de ce dfaut est naturelle ou acciden-
telle.
Crible. Planche perce de trous, qui est destine
maintenir les tuyaux dont les embouchures sont places
dans le sommier de l'orgue.
Crier. C'est exagrer la force des sons de la voix, en
chantant. Ce dfaut est celui des chanteurs dont la voix
ne se produit point avec facilit.
Crista (J. P.). Luthier Munich, en 1730.
Cristallocorde. Nom d'un clavecin construit en
1781, Pans, par un allemand nomm Boyer. Cet ins-
trument avait des cordes de cristal. Il remplaa le jeu
des clochettes que Mozart avait introduit dans la Flte
enchante.
Cristofora. Luthier florentin, vivait en 1725.
Critique musicale. La vritable critique musicale
suppose de grandes et profondes connaissances dans
l'art, ainsi qu'un got exquis. Elle ne se contente pas
seulement d'examiner les compositions d'aprs leur
forme extrieure et technique, mais encore elle les ap-
prcie d'aprs leur caractre esthtique. Si en outre cette
critique est impartiale, claire, crite dans un langage
convenable, dgage de toute passion, elle encouragera
l'art, perfectionnera le got.
GRO
153
Grodias. Nom grec des fltes.
Crois. Les parties se croisent, lorsque la plus leve,
en descendant, se trouve plus basse que la partie qui
tait auparavant plus grave, laquelle, en montant, de-
vient son tour la plus leve.
Croix. Signe qui marquait le trille dans l'ancienne
musique. On se sert d'une petite croix pour dsigner dans
un basse chiffre les intervalles augments. La quarte
augmente se chiffre par un quatre prcd d'une croix,
*4. Quelques auteurs chiffrent l'accord de la septime
dominante par un sept avec une croix au-dessous. La
petite croix indique presque toujours que c'est une note
sensible qui forme l'intervalle indiqu.
Gromamtre Instrument servant accorder un piano
sans tre oblig de faire unepartition, qui fut invent par
Holler en 1827.
Cromorne. Mot tir de l'allemand, et qui signifie
cor tordu. Cet instrument est reprsent comme une
corne de buf tordue, avec quatre trous dans la partie
infrieure. C'est aussi le nom d'un jeu de l'orgue- Il
joue l'unisson de ia trompe, mais donne un son moins
clatant. Il se place au clavier du iwsitif. (Voyez
Orgue.)
Cronomtre. Ainsi se nomment en musique les
instruments qui servent marquer la mesure.
Gronomtre-musical. Instrument propre mesurer
le temps et le son, imagin Berlin en
1797,
par Barja,
professeur de mathmatiques.
Croque-Note. Nom qu'on donne par drision ces
musiciens ineptes qui, verss dans la combinaison des
notes, et en tat de rendre livre ouvert les composi-
tions les plus difficiles, excutent au surplus sans senti-
ment, sans expression, sans got. Un croque-note, ren-
dant plutt les sons que les phrases, lit la musique la
plus expressive sans
y
rien comprendre, comme un ma-
tre d'cole pourrait lire un chef-d'uvre d'loquence
crit avec les caractres de sa langue, dans une langue
qu'il n'entendrait pas.
Crotales. Instrument de percussion compos de
deux pices de fer ressemblant assez deux cuelles
rondes, fort paisses et peu concaves. On en joue de la
mme manire que des cymbales. Les crotales sont en-
core en usage en Provence, o elles ont reu le nom de
Chaplachoon. (Voyez Cymbales antiques.)
G
154 CYM
Grouth. Espce de rebec. Il
y
en existait de deux es-
pces, le crouth trihant ou trois cordes et le croutli
six cordes rput plus noble que le premier. Le barde
Ed. Tones en donne la description dans ses crits : a
Un
joli coffre, avec un archet, un lion, une touche, un che-
valet. Il a la tte arrondie comme la courbe d'une roue
et le renflement de son dos est semblable celui d'un
vieillard. Six chevilles pour tendre les cordes.
Gruma. Les Latins donnaient ce nom certains ins-
truments forms de plusieurs vases de terre en forme
d'hutres, ou autrement; en les frappant les uns contre
les autres, ils produisaient un son.
Gruscitiros. C'est le nom d'une chanson de danse des
anciens Grecs, accompagne de fltes.
Cuvette. La cuvette est une partie de la harpe qui
sert de base l'instrument; elle contient le mouvement
par lequel les pdales attirent les tringles qui mettent en
jeu le mcanisme renferm dans la console. A chaque
ct de la cuvette figurent les pdales : il
y
en a quatre
droite et trois gauche.
Cymbale. Jeu d'orgue bouche et en tain. Il est
compris parmi les jeux de mutations et diffre seu-
lement de la fourniture par la grosseur moindre de ses
tuyaux.
Cymbales. Instrument de percussion compos de
deux plaques circulaires d'airain, d'un pied de diamtre
et d'une ligne d'paisseur, ayant chacune leur centre
une petite concavit et un trou dans lequel on introduit
une double courroie. Pour jouer de cet instrument,
on passe les mains dans ces courroies, et l'on frappe
les cymbales l'une contre l'autre du ct creux. Le son
qu'elles rendent, quoique trs-clatant, n'est pas appr-
ciable.
On runit les frappements des cymbales ceux de la
grosse-caisse, pour marquer le rhythme, ou seulement
la mesure, dans les marches guerrires, les airs de danse
fortement caractriss, et les ouvertures, symphonies et
churs qui ont une couleur militaire.
Les sons frmissants et grles des cymbales, dont le
bruit domine tous les autres bruits de l'orchestre, runis
eux sifflements aigres de la petite flte et des coups bien
rhythms des timbales ou des tambours, expriment avec
une vrit effrayante, soit des sentiments de frocit, soit
une orgie bachique o la joie tourne la fureur. On con-
DAG 155
nat le prodigieux effet produit par les cymbales dans le
chur des Scythes, de Gluck.
Cymbales antiques. Elles sont fort petites, dit
M.
Berlioz, et leur son est d'autant plus aigu qu'elles
ont plus
d'paisseur et moins de largeur. J'en ai
vu au muse de Pomp, Naples, qui n'taient pas
plus grandes qu'une piastre. Le son de celles-l est si
aigu et si faible qu'il pourrait peine se distinguer,
sans un silence complet des autres instruments. Les
cymbales servaient, sans doute, dans l'antiquit, mar-
quer le rhythme de certaines danses, comme nos casta-
gnettes modernes.
Czacan. Espce de flte en forme de canne, qui a
eu de ]a vogue en Allemagne, vers 1800, et pour la-
quelle on a crit beaucoup de musique. Le son en tait
trs-doux.
D
D, d, sol r, ou d la r. Ces expressions, qui d-
rivent de l'ancienne manire de solfier, dsignent le se-
cond degr de la gamme diatonique, lequel, dans le sol-
fge moderne, s'appelle r.
Da. On nomme ainsi un coup frapp faiblement sur
un tambour avec la baguette gauche, par opposition au
ta qui est produit avec plus de force par la main droite,
le Da se figure en tympanonique au moyen d'une noire
pose entre la seconde et la dernire ligne de la porte.
Da Gapo, ou par abrviation d c (au commencement).
Ces mots indiquent, qu'ayant fini un morceau de musi-
que ou un motif principal, il faut le reprendre depuis le
commencement jusqu' l'endroit o est la fin vritable.
Dactyle. C'tait le nom d'un acte ou de la division
principale du morceau de musique excut par les con-
currents dans les jeux pythiques.
Dactyles idens. Lorsque Cadmus passa de la Ph-
nicie en Grce, il amena avec lui, parmi sa suite, des
hommes appels Corybantes ou Curets, qui, dit-on,
furent les premiers introduire la musique dans le culte
des divinits grecques. Leur musique consistait dans de
hauts cris accompagns par des tambours et par d'autres
456 DAN
instruments bruyants. La fable raconte que les Curets,
entre les mains desquels on mit Jupiter pour tre lev,
le cachrent sur le mont Ida, et pour empcher que les
cris de l'enfant ne parvinssent jusqu'aux oreilles de
Saturne, ils firent un grand bruit avec des instruments,
dansant en mme temps des pas mesurs, appels dactyles.
C'est cause de ces pas et du mont Ida, qu'ils reurent
le nom de dactyles idens.
Dagtylion. Instrument ressort invent par
M.
Henri Herz, qui sert adonner plus d'extension la
main, dlier et fortifier les doigts, les rendre ind-
pendants les uns des autres, donner enfin au jeu, cette
galit sans laquelle il n'y a pas de belle excution sur le
piano. L'exprience dmontre merveilleusement qu'une
heure de leon par jour avec le dactylion suffit pour
amliorer rapidement les progrs des lves, et contri-
buer d'une manire sensible la facilit du jeu chez les
artistes eux-mmes.
Dactylographe. Instrument imagin en 1827 par
Pienne, pour transmettre, au moyen du toucher, les signes
de la parole entre un sourd et un aveugle.
Dap. Instrument de musique percussion dont on fait
usage dans les Indes.
Daire ou Def. Instrument persan qui ressemble
notre tambour.
Daneforica. Hymne des anciens Grecs, chant par les
vierges, au moment o les prtres portaient les lauriers
au temple d'Apollon. Cette crmonie se clbrait en
Botie tous les neuf ans.
Danse. (Voyez Ballet.)
Danse (musique de). La musique des ballets tait jadis
restreinte aux cadres uniformes decertaiusairs de danse,
tels que les chacones, les passe-pieds, les menuets, les
gavottes, les gigues. Les airs de danse ne sont plus cal-
qus sur un modle connu
;
le compositeur s'accorde
avec le chorgraphe pour les formes, le caractre et
l'extension qu'il convient de leur donner. Le pas des
Scythes 'Ipliignie en Tauride, de Gluck, celui des Afri-
cains de Smiramis, de Gatel, les gavottes ^Orphe et
d'Armide, ont offert tour tour des modles dans le style
nergique et gracieux.
Dans un ballet pantomime, la symphonie, destine
peindre l'action et les sentiments des personnages, diffre
DAN im
beaucoup des airs destins aux pas excuts par les dan-
seurs
;
ces airs reprsentent les cavatines, les duos, les
trios des chanteurs placs au milieu des rcitatifs. Des
fragments de symphonies, des ouvertures tout entires,
des airs connus, sont placs quelquefois avec bonheur
dans un ballet. La musique domine dans un opra, elle
n'occupe que le second rang dans une composition cho-
rgraphique
;
le danseur est l'objet intressant, et l'on
fait moins d'attention la mlodie qui rgle ses pas.
Plusieurs compositeurs ont brill particulirement
dans les airs de danse. Le comte de Gallemberg leur dut
sa rputation
;
i] n'a crit que des partitions de ballet.
Les musiciens franais ont russi dans cette partie de
l'art d'une manire d'autant plus remarquable qu'ils ont
chou plus souvent dans les airs de chant vocal. On
peut citer une foule de jolis airs de danse parmi les pro-
ductions de certains musiciens franais, qui n'ont jamais
donn un air, une cavatine, un duo d'opra de quelque
valeur.
La contredanse, la valse et le galop, sont les airs que
l'on entend le plus souvent dans les bals. La contredanse
nous vient de l'Angleterre, et s'est tablie en France au
commencement du sicle dernier. Elle s'excute huit, .
douze, seize personnes, dont la moiti de chaque sexe,
sur un air, un rondeau deux-quatre, ou six-huit alle-
gretto, compos le plus souvent de trois reprises de huit
mesures chacune. La contredanse se joue quatre fois de
suite, pour que ceux qui la dansent puissent excuter
leur tour les figures, d'aprs le dessin du chorgraphe.
La valse est un air trois temps. Le galop est un deux-
quatre fort anim, dont la cadence doit faire sentir vive-
ment le frapp et le lev de la mesure. On arrange en
contredanse, valses et galops, les airs d'opra.
Danse aux flambeaux et quelques autres danses du
seizime sicle. Marguerite de Valois, pouse de
Henri IV, qui dansait si merveilleusement, que les con-
teurs d'anecdotes font partir Don Juan des Pays-Bas
dont il tait gouverneur, et o venait d'clater une grande
rvolution, pour venir incognito Paris surprendre cette
reine dans un bal, Marguerite de Valois excellait au
branle de la torche ou du flambeau, de mme que dans
toutes les danses srieuses. Je me souviens, dit Bran-
tme, qu'une fois tant Lyon, au retour du roi de Polo-
gne, Henri III, aux noces d'une de ses filles, elle dansa
158 DAN
ce branle devant force trangers de Savoie, de Pimont,
d'Italie et autres, qni dirent n'avoir rien vu de si beau
que cette reine, si belle et grave danse, ajoutant que cette
reine n'avait pas besoin, comme les autres dames, du
flambeau qu'elle tenait la main
;
car celui qui sortait
de ses beaux yeux, qui ne mourait point comme l'autre,
pouvait suffire.))
Alors la danse se divisait en haute et en basse danse.
La premire, compose de sauts et de gambades, rser-
ve aux baladins de profession
;
la seconde noble et
pose, tait celle de la bonne compagnie. Les plus
fameuses danses du seizime sicle taient la pavane
espagnole, fire et bravache comme un hidalgo, et qui a
donn naissance l'expression proverbiale se pavaner;
les villanelles napolitaines, les pjadouanes, les gaillardes,
les Canaries, les voltes et courantes, les allemandes et les
matassins, espce de ballet arm que Molire a introduit
dans son Pourceaugnac.
La pavane tait pour Marguerite de Valois un nou-
veau sujet de triomphe. Le roi Charles IX, dit Bran-
tme, la menait ordinairement danser le grand bal. Si
l'un avait belle majest, l'autre ne l'avait pas moindre.
Je l'ai vu assez souvent danser la pavane d'Espagne,
danse o la grce et la majest font une belle reprsenta-
tion. Mais les yeux de toute la salle ne se pouvaient
soler, ni assez se ravir par une si agrable vue
;
car les
passages taient si bien danss, les pas si sagement con-
duits, et les arrts faits de si belle sorte, qu'on ne savait
que plus admirer, ou de la belle faon de danser, ou de
la majest de s'arrter.
Timolon de Goss, comte de Brissac, et aprs lui le
jeune La Molle, faisaient fureur la cour deCharlesIX,
soit dans les branles, soit dans la pavane, soit dans la
gaillarde ou les Canaries. Les deux dernires jouissaient
alors d'une grande vogue. Le roi Charles, dit Bran-
tme, s'avisa un jour, aprs dner, de faire retirer tout
son monde, la rserve de MM. de Strozzi et de Brissac,
et d'un petit nombre de familiers. Cela fait, il ordonna
au premier de toucher du luth, et au second djouer des
pieds
;
et quand il en eut assez, il se tourna vers un de
ses courtisans, et fit cette sage rflexion : Voil comme
aprs que
f
ai tir du service de mes deux braves colonels
la guerre, j'en tire du plaisir la paix.))
Danse d'ours. On dsigne par ce terme certaines
DAN 159
compositions dans lesquelles on a cherch imiter l'effet
des airs de musette jous par ceux qui font danser les
ours. Cet effet consiste faire ronfler les basses, les
bassons, les cors en pdales, tandis qu'un instrument
voix blanche, tel que le hautbois, le violon, excute
l'aigu un chant villageois et montagnard. Ce chant ne
part ordinairement qu' la quatrime ou cinquime
mesure, et cesse de temps en temps pour laisser entendre
le bourdonnement continu de la pdale grave et de l'har-
monie intermdiaire.
Le beau finale de la seizime symphonie de Haydn,
en r mineur
y
est une danse d'ours.
Danseurs, danseuses. Ces mots dsignent en gnral
toutes les personnes des deux sexes qui se livrent
l'exercice de la danse. Mais il s'applique surtout celles
qui la cultivent comme art et en font profession. C'est
sur la scne magique de l'Opra que brillrent nos plus
clbres danseurs et danseuses de toutes les poques. Il
est assez remarquable que dans le privilge de non-dro-
geance, accord par Louis XIV aux personnes de famille
noble qui chanteraient l'Acadmie royale de musique,
les sujets de la danse n'aient pas t compris. Cet oubli
s'expliquerait d'autant moins que le monarque lui-mme
aurait, non pas chant, mais dans avec ceux de ce spec-
tacle sur le thtre de la cour. Mais Lulli, qui sollicita
et obtint ces lettres-patentes, prenait beaucoup plus
d'intrt aux excutants de ses airs, de ses duos et de ses
chants, qu'aux danseurs figurant dans des divertis-
sements qu'on regardait alors comme une partie trs-
accessoire de ces reprsentations. Le got de Louis XIV
pour la danse thtrale a t partag par des person-
nages qui, d'autres titres, auraient sembl aussi faire
peu de cas d'un pareil amusement. On dit que dans le der-
nier sicle, le philosophe Helvtius dansa en amateur
sur le thtre de l'Opra, en sauvant, la vrit, au
moyen du masque, le dcorvm de la philosophie
moderne. Jusqu' la fin du dix-huitime sicle, la danse,
malgr quelques grandes renommes, telles que celles
des Pcourt, des Salle, des Gamargo, n'avait tenu
l'Opra qu'un rang trs-secondaire. Les compositions de
Noverre et de Garde! commencrent la placer sur la
mme ligne que la musique, sa sur. Depuis quelques
annes une sorte de rvolution s'est opre dans la danse
thtrale, au dsavantage des hommes et au profit des
160 DEC
femmes. Au commencement du sicle actuel, la rivalit
de deux danseurs, Vestris et Duport, avait occup toute
la capitale. Aujourd'hui, la danse masculine est peu
gote en gnral, et la laveur publique adopte presque
exclusivement les danseuses.
Danso-musicomane. Nom donn h certaines petites
ligures trs-lgres que Ton pose sur la table d'harmonie
d'un piano et qui se meuvent et dansent en mesure quand
onjoue l'instrument.
Darabooka. Espce de petit tambour en usage encore
aujourd'hui en Egypte. Il se compose d'une feuille de
parchemin, fixe sur un pot de terre, ressemblant beau-
coup la pomme d'un arrosoir. On en retrouve la
reprsentation sur les plus ancien bas-reliefs Egyptiens.
Dardelli (Pietro). Clbre luthier, travaillait
Mantoue en 1500.
Dbut. Premier pas d'un artiste dans la carrire
qu'il parcourt. Premire apparition d'un acteur sur un
thtre.
Dcacorde. Instrument dix cordes appel aussi
harpe de David. L'abb Vogler croit que cette harpe
tait accorde dans les tons de si, clef de basse, seconde
ligne, do, r, mi,
fa,
sol, la, si, do, r.
Dcacorde. Est galement le nom d'une espce de gui-
tare dix cordes, imagine en
1328,
par Carulli^ et cons-
truite par Lacoste.
Dechant. Nom que Ton donnait' dans le XIII
e
et le
XIV
e
sicle, l'accompagnement d'une ou plusieurs
parties sur le plain-chant ou sur un chant donn. Le
dechant ressemblait un contrepoint improvis par les
chanteurs.
Deghanteur. Nom donn anciennement l'accompa-
gnateur qui improvisait une seconde partie.
Dchiffrer. Lire la musique pour la premire fois.
Dechler (David). lve de Stainer, acquit une beVe
rputation Rome, dans l'art de la lutherie. Il travaillait
de 17t5 1740.
Dclamation. La dclamation thtrale est l'art de
reprsenter la scne le rle d'un personnage, avec la
vrit et la justesse d'intonation qu'exige la situation.
On n'attend point ici le dtail de cette immense varit
d'inflexions dont la voix humaine est susceptible, et que
l'on doit employer dans les diffrentes occasions pour
DEC 161
rendre avec justesse tant de penses, tant de sentiments
innombrables. Il est galement inutile de donner sur ce
sujet des prceptes qui, justes pour nous, pourraient tre
pour les autres, incertains ou trompeurs. Chacun doit,
selon son naturel, diversifier ses inflexions confor-
mment son propre sentiment. C'est donc en pntrant
dans le fend de notre me que nous saurons trouver ces
tons vrais qui remuent les auditeurs, cette sorte de lan-
gage, d'accent qui, par la seule inflexion, indique les
sentiments, la passion qui nous dominent. Mais la voix
n'est pas le seul moyen dont se serve l'art pour expri-
mer ces impressions de l'me. Les yeux, le geste, sont
aussi les interprtes des mmes sentiments
;
il est indis-
pensable de joindre l'loquence des yeux et le mouvement
du corps l'enthousiasme de la dclamation, et leur con-
cours ajoutera la vrit des intonations de la voix.
Quant la ncessit de bien prononcer, d'articuler d'une
manire nette et distincte, d'avoir une connaissance
exacte de la prosodie et de possder un organe flexible et
sonore, elle est tellement comprise de tout le monde,
qu'il est inutile de s'y arrter. Le chanteur ou le trag-
dien, qui ne peut se corriger de quelques dfauts essen-
tiels, tel qu'une voix sourde et enroue, doit s'abstenir
de paratre en public.
Parmi nos chanteurs dramatiques, il en est quelques-
uns qui ont pouss l'art de la dclamation un trs-haut
degr de perfection. Nourrit, surtout, ce grand artiste
que regrette encore le monde musical, avait atteint, sous
ce rapport, une tonnante supriorit
;
Duprez a pouss
plus loin encore, peut-tre, la dclamation dans le
rcitatif; mais le premier excellait dans l'art d'impres-
sionner vivement le public, par le prestige de son jeu et
les inflexions varies de son organe.
Decombre. Luthier imitateur de Stradivarius
;
tra-
vaillait Tournay, en Belgique, de 1700 1735.
Dcompter. Lorsqu'en solfiant sans instrument, la
voix ne peut saisir un intervalle un peu loign, il faut
dcompter, c'est--dire faire passer la voix par tous les
degrs qui sparent cet intervalle, depuis la note d'o
l'on part jusqu' celle o l'on veut arriver
;
par
exemple, dans la gamme d'ut, si du sol que tient ma
voix je veux descendre sur un r, et que mon oreille ne
me rappelle pas la distance de cet intervalle, je
dcompte, et je dis : sol
fa
mi r, en donnant chacune
6.
162 DEC
de ces cordes la juste intonation qu'elle doit avoir. Le
son du r tant une fois trouv, je remonte au sol pour
descendre ensuite d'un seul saut sur ce r, dont l'impres-
sion subsiste encore dans mon oreille.
Dcorations dans leurs rapports avec l'opra.
On peut appliquer au thtre, et notamment l'Opra,
ce que La Fontaine a dit de l'amour sur la quantit de
personnes que runit une reprsentation dramatique,
Pour une qu'on prend par l'oreille.
On en prend mille par les yeux.
C'est surtout une poque o le matrialisme des sens
fait irruption jusque dans les plaisirs de l'esprit, que
l'art dramatique et l'art musical sont contraints d'ap-
peler leur secours le luxe des dcorations et leur
charme attractif pour la trs-grande majorit des specta-
teurs. Aussi peut-on dire que, dans bien des thtres, le
dcorateur est l'auteur principal, sinon de la pice, au
moins du succs.
Au reste, il est juste d'ajouter que de nombreuses
tudes et beaucoup de connaissances qui se rattachent
son art, sont ncessaires au peintre de dcorations qui
veut s'lever au-dessus de la mdiocrit. Il ne lui suffit
pas de possder fond la perspective linaire et arienne,
l'habile emploi des clairs obscurs, des grandes masses
d'ombre et de lumire, desavoir combattre les difficults
que lui opposent pour ces divers effets les trop vives
clarts des lustres de nos salles, des lampes de la scne.
Ayant retracer tant d'difices et de sites diffrents, le
peintre dcorateur doit connatre parfaitement l'archi-
tecture et le paysage. Il faut ensuite qu'il sache bien des-
siner la figure, car il aura plus d'une fois orner ses
dcors de statues et de bustes. On sait assez combien
il est ncessaire qu'il connaisse aussi l'antique et les di-
vers styles d'architecture, pour ne pas les confondre.
Sans cette tude approfondie, parfois des erreurs cho-
quantes pourraient lui chapper
;
et de temps en temps,
ainsi que nous avons pu le voir, un sujet grec serait re-
prsent dans un difice romain, et vice versa; ou bien
les armes, les productions d'un pays se trouveraient trans-
portes dans un autre.
Il n'est pas jusqu'aux modes du jour, celles au moins
qui concernent les constructions, la disposition des ap-
DEC
163
partements, leurs accessoires d'embellissement, que le
peintre-dcorateur ne doive avoir bien observes pour les
retracer avec fidlit. Il faut qu'il sache aussi bien re-
produire sur la toile, un boudoir moderne qu'un temple
de l'antiquit, ou un monument du moyen-ge.
Les auteurs et les compositeurs dramatiques ont quel-
quefois l'imagination trop exigeante, et demandent au
peintre de dcorations ce que son art ne peut excuter.
Il est contraint alors de les ramener aux bornes du pos-
sible. Il arrive aussi parfois qu'il corrige ou modifie
dans ses compositions ce qui, dans leurs programmes,
serait trop bizarre ou de mauvais got. Aussi plusieurs
de nos anciens potes, compositeurs et faiseurs de bal-
lets, avaient-ils senti que c'est surtout au thtre que
la posie, la musique et la peinture doivent tre surs.
On voit par les opras, et les prfaces de Corneille qui
prcdent ce qu'on appelait ses pices machines, qu'ils
n'taient pas rests trangers un art qui devait secon-
der le leur, et qu'ils pouvaient donner eux-mmes des
conseils utiles aux artistes chargs d'excuter les dco-
rations de leurs ouvrages.
Nous savons peu de chose sur le plus ou moins d'ha-
bilet avec laquelle les anciens dcoraient leurs scnes.
Les tableaux trouvs Herculanum doivent toutefois
nous faire prsumer que Rome avait aussi ses talents
dans cet autre genre de peinture, utile auxiliaire de l'art
musical
;
malheureusement, leurs productions n'ont pu
nous tre conserves.
L'usage et la confection des dcorations thtrales
taient en quelque sorte perdus au quinzime sicle. Il
est vrai que l'art dramatique tait alors dans son enfance,
et les uvres plus religieuses que profanes de cette
poque, ne comportaient gure le luxe de la mise en
scne moderne. Ce fut Balthazar Preuzzi, n en
1481,
Vol terre, en Italie, qui fut le restaurateur de cet art. Il
eut dans cette contre de dignes successeurs, parmi les-
quels on peut citer Parigi Florence, Bibiena Rome.
Ajoutons que les Italiens furent jusqu' ces derniers
temps nos matres dans cette partie. Le gnie de Servan-
doni, aprs avoir lev dans notre capitale le beau por-
tail de Saint-Sulpice, montra aussi, sur la scne de
l'Acadmie royale de Musique, tout ce que pouvait faire
natre de prestiges la baguette magique du grand pein-
tre dcorateur.
164
DEG
La France, dans ces dernires annes, a fait faire un
grand pas Fart de la dcoration appliqu au thtre.
Nous avons indiqu plus haut les diverses connais-
sances que doit possder le peintre de dcorations. Est-
il besoin de dire que le got, cette premire condition
de ses succs, lui est indispensable encore ? Il est fcheux
d'ajouter qu'il faut en outre, son me d'artiste, une
sorte d'abngation de la gloire venir. La sienne est, si
l'on peut s'exprimer ainsi, en dtrempe comme ses ou-
vrages. Aussi, bien diffrent du musicien et du pote,
doit-il viser davantage l'effet du moment qu' celui
que confirment l'examen rflchi et le temps : c'est l
sans doute qu'il est permis de frapper fort plutt que
juste. Le mrite du peintre-dcorateur, c'est de parler
aux yeux avec une loquence vive, saisissante, improvi-
se, tandis que le musicien s'adresse l'imagination et
au cur par le prestige des sons, et par tout ce que la
langue musicale a de sductions et de charmes.
Dcousu. Ce terme appartient galement la rhto-
rique et la musique. On dit qu'un style est dcousu,
quand les ides rassembles par le compositeur man-
quent entre elles de liaison, quand elles sont incohrentes
et disparates, en un mot quand le sujet est mal conduit.
Ce dfaut est le propre des compositeurs, qui, avec peu
d'imagination, enfantent pniblement leur musique,
phrase phrase et des intervalles loigns. Leur
esprit, qui ne peut plus retrouver la mme situation, ne
produit que des penses dtaches qui ne s'amalgament
jamais bien. Chaque phrase aura, si l'on veut, l'expres-
sion juste de chaque vers; mais le tout manquera d'en-
semble et d'unit.
Decrescendo. Ce mot italien signifie le contraire de
crescendo, c'est--dire une diminution progressive d'in-
tensit des sons dans l'excution de la musique.
Dduction. Terme de l'ancien plain-chant. La dduc-
tion est une suite de notes montant diatoniquement, ou
par degrs conjoints.
Degr. Ce mot est l'quivalent de note ou son :
ainsi, on peut dire : le premier, le deuxime, le
troisime degr de la gamme
;
il est aussi quelquefois
l'quivalent d'intervalle, et alors il signifie la diffrence
de position ou d'lvation qui se trouve entre deux notes
places dans une mme porte. Sur la mme ligne ou
dans le mme espace, elles sont au mme degr,elles
y
se-
DEM 165
raentencore, quand mmel'une des deuxserait hausse ou
baisse d'un demi-ton, par un dise ou par un bmol. Au
contraire, elles pourraient tre l'unisson, quoique poses
sur diffrents degrs, l'aide d'un changementdeclefou par
l'emploi des dises et des bmols, comme
fa
bmol et
m*, ut dise et r bmol, etc., etc. Si deux notes se sui-
vent diatoniquement, de sorte que l'une tant sur une
ligne, l'autre soit dans l'espace
voisin, l'intervalle est
d'un degr, de deux si elles sont la tierce, de trois si
elles sont la quarte, de sept si elles sont l'octave.
Ainsi, en tant 1 du nombre exprim
par le nom de l'in-
tervalle, on a toujours le nombre des degrs diatoniques
qui sparent les deux notes. Ces degrs diatoniques, ou
simplement degrs, sont encore appels degrs conjoints,
par rapport aux degrs disjoints qui sont composs de
plusieurs degrs conjoints.
Dli. (Voyez le mot Sciolto.)
Dmancher. C'est, sur les instruments manche, tels
que le violon, le violoncelle, la guitare, ter la main
gauche de sa position naturelle pour l'avancer sur une
position plus haute ou plus l'aigu.
Demande, ou Proposition. On appelle quelquefois
ainsi, dans une fugue ou dans tout autre morceau o
l'imitation est employe, le sujet que l'on propose imi-
ter
;
et la phrase qui
y
correspond se nomme rponse.
Cette phrase propose se nomme aussi le sujet, le motif.
La demande et la rponse se rencontrent aussi dans des
morceaux de musique non fugues, et qui n'offrent pas
mme la simple imitation.
Demi-Diton. Signifiait dans la musique ancienne la
moiti du Biton ou deux tons; c'est--dire une tierce
majeure.
Demi-Jeu, A demi-jeu. Terme de musique instru-
mentale qui indique une manire de jouer tenant le
milieu entre le forte et \q piano
;
c'est ce que les Italiens
appellent me
:zo-
forte.
Demi-Ton. Intervalle de musique valant peu prs la
moiti d
:
un ton. Il
y
a deux sortes de demi-tons
;
le
demi-ton diatonique,
c'est celui qui existe d'une note
l'autre, comme d'ut r bmol, et le demi-ton chroma-
tique, qui existe d'une note la mme note subissant
une altration comme d'ut ut dise.
Demi-Mesure. Espace de temps qui dure la moiti
166 DES
d'une mesure. Il n'y a proprement de demi-mesure que
dans les mesures dont les temps sont en nombre pair.
Demi-Pause. Caractre de musique qui marque un
silence dont la dure doit tre gale celle d'une demi-
mesure quatre temps, ou d'une blanche. Gomme il
y
a
des demi-mesures de diffrentes valeurs, et que celle de
la demi-pause ne varie point, elle n'quivaut la moiti
d'une mesure que quand la mesure entire vaut une
ronde, la diffrence de la pause entire qui vaut tou-
jours exactement une mesure grande ou petite.
Demi-Soupir. Caractre de musique qui marque un
silence dont la dure est gale celle d'une croche ou de
la moiti d'un soupir.
Demi-Temps. Valeur qui dure exactement la moiti
d'un temps. Il faut appliquer au demi-temps, par rap-
port au temps, ce que nous avons dit prcdemment de
la demi-mesure par rapport la mesure.
Denis d'or. C'est le nom d'un clavecin pdales in-
vent dans la premire moiti du sicle dernier. On pr-
tend que cet instrument imitait presque tous les instru-
ments cordes et vent, de cent trente manires.
Dsaccorder. Dtruire l'accord d'un instrument. On
dsaccorde un piano en frappant trop fort et d'une ma-
nire ingale sur les touches. On dsaccorde un violon
en tournant les chevilles droite ou gauche, sans
donner aux cordes le degr de tension qu'exige l'accord.
De grandes secousses, le drangement des tuyaux, la
poussire, le duvet de la peau des registres, et tous les
corps trangers qui s'introduisent dans les tuyaux, ds-
accordent l'orgue.
Descendante (gamme). C'est la suite des tons et demi-
tons dont se compose la gamme en allant de haut en bas,
par opposition la gamme ascendante, qui procde par
le mouvement contraire.
Descendre. C'est baisser la voix, c'est faire succder
les sons de l'aigu au grave, ou du haut en bas.
Desharmonie. Mot nouveau, imagin par Napolon I
er
pour indiquer la discordance soit en musique, soit dans
les affaires publiques.
Dessin. C'est l'invention et la conduite du sujet, la
disposition de chaque partie et l'ordonnance gnrale du
tout. Ce n'est pas assez de faire de beaux chants et une
bonne harmonie, ii faut lier tout cela par un sujet prin-
cipal, auquel se rapportent toutes les parties de l'ou-
DIA 167
vrage. C'est donc dans une distribution bien entendue,
dans une juste proportion entre toutes ]es parties, que
consiste la perfection du dessin, et c'est surtout sous ce
rapport que l'illustre Mozart a fait preuve d'intelligence
et de got. Son Requiem, sa Clmence de Titus, ses
Noces de Figaro, sont, dans trois genres diffrents,
trois chefs-d'uvre de dessin galement parfaits. Cette
ide du dessin gnral d'un ouvrage s'applique aussi en
particulier chaque morceau qui le compose : ainsi, on
dessine un air, un duo, un chur.
Dessiner. Faire le dessin d'une pice ou d'un morceau
de musique.
Dessus. La plus aigu des parties vocales de la musi-
que. Le dessus est chant par les femmes, les enfants et
les soprani italiens.
Le diapason du dessus est ordinairement de deux oc-
taves. C'est la seule voix qui contienne les trois espces
de registres, savoir :
Premier registre. Quatre sons de poitrine, de Vut au-
dessous des lignes (la clef tant celle de sol) jusqu'au
fa,
premier interligne.
Deuxime registre. On prend la voix de mdium au
sol sur la seconde ligne, jusqu' l'octave de Vut.
Troisime registre. Pass cet ut, la voix change encore
et peut s'lever jusqu' l'octave de ce mme ut, et mme
au r
qui le suit l'aigu ce qui formerait alors plus de
deux octaves.
Le dessus se divise en premier et second dessus. Le
second dessus, ou bas dessus, a deux tons de plus au
grave que le premier, et son diapason s'lve au
fa
sur
la cinquime ligne, ou au sol qui le suit.
Deux-quatre. Mesure qui contient deux noires ou
deux fois la quatrime partie d'une ronde.
Dtach. Mot qui exprime le mode d'excution des
instruments ou de la voix, dans lequel on spare les
sons par une mission brve et non prolonge.
Dtonner. Sortir du ton, manquer la justesse des
intonations.
Diable (Cadence du). Voyez Diavolo (cadenza del).
_
Diagommatique.
Epithte donne au genre de tran-
sitions harmoniques au moyen desquelles la mme note
venant en apparence sur le mme degr, monte ou des-
cend d'un comma en passant d'un accord un autre.
168 DIA
Diacoustique. C'est la recherche des proprits du
son rfract en passant travers diffrents milieux.
Diagramme. C'tait, dans la musique ancienne, la ta-
ble ou le modle qui prsentait l'il l'tendue gnrale
de tous les tons d'un systme, ou ce que nous appelons
aujourd'hui chelle, clavier.
Dialogue. Composition deux voix ou deux instru-
ments qui se rpondent l'un l'autre, et qui souvent se
runissent.
Un opra n'est en quelque sorte qu'un dialogue conti-
nuel. Les rcitatifs, les chants deux ou plusieurs
voix, les churs mme
y
sont dialogues. Dans les airs,
la voix dialogue souvent avec l'orchestre. L'art de faire
dialoguer les voix entre elles, les instruments entre eux,
et de faire concourir la perfection du dialogue les par-
ties vocales et iustrumentales runies, doit donc tre une
des principales tudes du compositeur dramatique.
Diapason. Nom grec de l'octave. On appelle aussi de
ce nom l'tendue d'une voix ou d'un instrument.
Diapason. Petit instrument d'acier qui donne le son
d'aprs lequel on accorde tous les autres instruments.
(Voyez le mot Corista.) Il
y
a aussi un jeu d'orgue qui
porte le nom de diapason.
Diapason cum diapente. La douzime.
Diapason cum diatessaron. La onzime.
Diapason omnicorde. Imagin en 1854 par Gaichard,
donnant d'une manire exacte le son des quatre cordes
du violon, mi, la, r, sol.
Diapason Wolfsohn. Imagin Paris, en 1844,
d'a-
prs un nouveau systme, par Wolfsohn.
Diapazorama. Machine construite en
1828,
par Matrol,
donnant un accord invariable et d'une justesse aussi
rigoureuse que possible, cet appareil est compos de
seize diapasons accords chromatiquement par demi-ton,
avec l'observation du temprament.
Diapente. Nom grec de la quinte naturelle, autre-
ment appele dioxie.
Diapente est aussi un jeu
d'orgue.
Diapente col ditono. La septime majeure.
Diaphonie. Par ce terme, les Grecs entendaient les
dissonances, parmi lesquelles ils comptaient les tierces
et les sixtes.
Dans les onzime et douzime sicles, le
mot diaphonie indiquait la voix de soprano, et aprs
DID 169
l'invention de l'harmonie, ce nom dsigna une composi-
tion deux parties.
Diaplose. Mot qui signifie, dans le plain-chant, une
intercidence ou petite chute, ou note de passage qui se
fait sur la dernire note d'un chant, ordinairement
aprs un grand intervalle en montant.
Diaspasma. C'tait chez les anciens, une pause entre
les diffrents vers d'un chant.
Diastaltique. Dans la musique grecque ancienne, il
dsignait le sublime.
Diastme. Nom grec de l'intervalle simple, par oppo-
sition l'intervalle compos qu'on appelait systme.
Diatessaron. Nom grec de la quarte naturelle.
Diatonique. Le genre diatonique procde par tons et
par demi-tons naturels c'est--dire sans altration. Ainsi
les deux demi-tons qui se trouvent dans la gamme sont du
genre diatonique
;
et la gamme, soit en montant, soit
en descendant, se nomme gamme ou chelle diatonique.
Quoique, dans le genre diatonique, le moindre inter-
valle soit d'un degr conjoint, cela n'empche pas que les
parties ne puissent procderpar de plus grands i n tervalles.
pourvu qu'ils soit tous pris sur des degrs diatoniques.
Le mot diatonique vient du grec, dio (par) et tonos
(ton), c'est--dire d'un ton un autre.
Diaule. Flte double des anciens Grecs, appele ainsi
par opposition monaule, qui tait la flte simple.
Diavolo (Cadenza del). Nom que l'on donnait autre-
fois une espce de trille extraordinaire pratiqu sur le
violon, et qui consistait dans une note tenue par le
doigt annulaire, sur laquelle frappait le petit doigt, pen-
dant que les deux premiers doigts excutaient des notes
diffrentes sur la corde voisine. La grande difficult que
prsente pour les doigts l'excution de ces divers mou-
vements a fait donner ce trille le nom de cadenza del
diavolo, trille du diable. On prtend que ce trille a t
invent par Tartini, et quelques auteurs parlent mme
d'un rve qui est relatif cette invention.
Diazeuxis. On appelait ainsi, dans la musique des an-
ciens, la disjonction des deux ttracordes successifs qui
n'taient pas unis au moyen du mme son.
Didascolos cyclidos. Nom grec de celui qui instrui-
sait les chanteurs du chur.
Didymennes. C'taient des ftes grecques dans la
ville de Milet (Asie Mineure), ou Apollon avait un tem-
170
DIM
pie qu'on appelait Didymon. A l'occasion de ces ftes
avaient lieu des luttes musicales.
Diehl. Luthier assez en renom, travaillait Darms-
tadten 1730.
Dise. Caractre de musique qui est form par deux
petites lignes verticales coupes par deux lignes horizon-
tales, et indique qu'il faut lever d'un demi-ton la note
devant laquelle il se trouve. Il
y
a deux manires d'em-
ployer le dise : Tune accidentelle, quand dans]e cours
du chant on le place gauche d'une note
;
dans ce cas il
n'altre que la note qu'il touche et les notes du mme nom
qui se trouvent dans la mme mesure. L'autre manire
est d'employer le dise la clef, et alors il n'est plus ac-
cidentel, mais essentiel au ton du morceau de musique
auquel il est appliqu. C'est pourquoi il agit dans la suite
du morceau, et sur toutes les notes du mme nom,
moins que ce dise ne soit dtruit accidentellement par le
bcarre, ou que la clef ne vienne changer.
Les dises se posent la clef de quinte en quinte dans
l'ordre suivant :
Fa, ut, sol, r, la, mi, si.
Diser. C'est armer la clef de dises pour changer
l'ordre et le lieu des demi-tons majeurs, ou donner
quelque note un dise accidentel, soit pour le chant, soit
pour la modulation.
Dieuseugmenon. Nom du quatrime ttracorde du
systme grec.
Dieuseugmenon diatonos. Nom grec de notre r,
clef de violon au-dessous des lignes.
Digital. Petit appareil construit en 1845 par Magner
pour faciliter le travail des doigts sur tous les instru-
ments de musique.
Dilettante. Amateur de musique. Ce mot a pass de
la langue italienne dans la langue franaise.
Dimension. Autrefois les instruments taient ordinai-
rement diviss d'aprs les quatre voix humaines princi-
pales. C'est pourquoi ils avaient quatre dimensions dif-
frentes. Les instruments modernes ont, eux aussi, en
gnral, leurs diffrentes dimensions, et en Allemagne
le trombone les conserve encore toutes quatre. Celle du
soprano est cependant trs-rare.
Diminu (intervalle). Lorsque l'intervalle naturel qui
spare deux notes est altr par un dise, un bmol ou un
D1R 171
bcarre, on dit qu'il est diminu quand le signe qui l'al-
tre diminue son tendue naturelle.
On donne spcialement ce nom aux intervalles mineurs
dont l'tendue naturelle est diminue. (Voyez le mot in-
tervalle.)
Diminuendo, en diminuant. C'est passer du fort au
piano et du piano au pianissimo, par une gradation insen-
sible, en adoucissant les sons, soit sur une tenue, soit sur
une suite de notes, jusqu' ce qu'ayant atteint le point qui
sert de terme au diminu, on s'arrte pour finir le mor-
ceau de musique ou pour reprendre le jeu ordinaire.
Diminution. Division d'une note longue en plusieurs
notes de moindre valeur. Aprs avoir vari en croches
un air crit en blanches et en noires, on fait une nou-
velle diminution en donnant une variation en doubles
croches.
Dinamica. Doctrine du mouvement des voix.
Dionysies argadiques. Ftes des anciens Romains,
dans lesquelles la jeunesse rcitait des pices thtrales
accompagnes de musique.
Dioxie. Nom que les anciens donnaient quelquefois
la consonnance de quinte.
Direct. Un intervalle direct est celui qui fait un har-
monique quelconque sur le son fondamental par lequel il
est produit. Ainsi, la quinte, la tierce majeure, l'octave
et leurs rpliques, sont rigoureusement les seuls inter-
valles directs
;
mais, par extension, l'on appelle encore
intervalles directs tous les autres, tant consonnants que
dissonnants, que fait chaque partie avec le son fondamen-
tal pratique, qui est ou doit tre au-dessous d'elles.
L'accord direct est celui qui a le son fondamental au
grave, et dont les parties sont distribues, non pas selon
leur ordre le plus naturel, mais selon leur ordre le plus
rapproch.
Il
y
a en musique trois mouvements entre les parties
qui constituent l'harmonie, le mouvement direct, le
mouvement oblique et le mouvement contrai?*e. Le mou-
vement direct, ou semblable, est celui que font deux
parties qui montent ou descendent en mme temps.
Directeur de thtre. En France, c'est celui qui
tient du gouvernement le privilge en vertu duquel il di-
rige ses risques et prils, en fournissant caution, un
thtre subventionn ou non subventionn. En Italie, on
l'appelle imprsario et c'est lui qui cautionne la subven-
172 DIS
tion vote parla municipalit. Il doit se soumettre aux vo-
lonts d'une direction qui prside aux spectacles. Ordi-
nairement ce sont les nobles, les dignitaires, les magis-
trats, en un mot les personnages les plus distingus de
la ville, qui sont appels former cette commission ou
direction. Elle choisit les artistes sur une liste que l'en-
trepreneur, c'est--dire Yimpresario doit prsenter une
poque convenue, et fait elle-mme la rpartition de leurs
appointements. Voil pourquoi en Italie les artistes dits
de cartello gagnent des sommes considrables, tandis
que la masse vit presque de privations.
Dis. Nom du r dise dans la solmisation des Alle-
mands
;
c'est ainsi qu'ils dsignent quelquefois le ton de
mi B.
Disgant ou Dchant. C'est--dire double chant. C'-
tait, dansnosanciennes musiques, cette espce de contre-
point que composaient sur-le-champ les parties suprieu-
res en chantant impromptu sur le tnor ou la basse. Dans
les compositions crites pour deux voix, on appelait dis-
cant la voix qui accompagnait le chant principal.
Discord. Qui n'est pas d'accord : un violon discord,
un piano discord.
Discordant. On appelle ainsi tout instrument dont on
joue et qui n'est pas d'accord, toute voix qui chante faux,
toute partie qui ne s'accorde pas avec les autres.
Discorde. Instrument des peuples de l'antiquit, par-
ticulirement des gyptiens. Il avait la forme d'uu luth
aplati, avec un long manche, et il tait form de deux
cordes.
Discorder. tre discordant.
Disdiapason. Double octave : on donne aussi ce nom
un jeu d'orgue.
disjoint. Les intervalles disjoints sont ceux dont les
sons qui les composent ne se suivent pas immdiate-
ment, mais sont spars par des degrs intermdiaires,
comme ut, mi
; fa,
la.
Disjonction. Espace qui sparait dans l'ancienne
musique la mse de la paramse et en gnral un ttra-
corde voisin, lorsqu'ils n'taient pas voisins.
Disposition. Ce mot dsigne un certain degr de
facults innes pour apprendre une chose. 77 a des dis-
positions pour la musique, signifie il possde les dons
de la nature pour faire des progrs, en s'appliquant
cet art.
DIT 173
Dissonance. On entend en gnral par ce mot un
intervalle qui cause l'oreille une sensation plus ou
moins fcheuse. Cependant la dissonance n'exclut pas
compltement les sensations agrables. Mnage avec
got, elle embellit la composition, et fait disparatre
cette monotonie fatigante qui rsulterait del continuit
d'accords consonnants.
Aux intervalles dissonants appartiennent :
1
la quarte
naturelle, si elle est un retard de la tierce
;
2
la quinte
diminue avec son renversement, la quarte augmente
;
3
la quinte augmente et la quarte diminue :
4
la sixte
augmente
;
5
toutes les secondes et les septimes
;
6
toutes les neuvimes
;
7
la onzime et la treizime.
Les dissonances doivent-elles se rsoudre toujours en
descendant? Presque tous les thoriciens rpondent d'une
manire affirmative. Par une consquence immdiate de
cette rgle, on dtend de retarder aucune note que l'on
veut faire monter, si le retard produit une dissonance.
En effet, on ne peut pas la faire monter si toute disso-
nance doit se rsoudre en descendant.
On n'excepte que la sensible dont l'attraction vers la
tonique absorbe la sensation de la dissonance, et celle-ci
non-seulement ne blesse pas l'oreille dans son mouve-
ment ascendant, mais la satisfait par une des cons-
quences les plus ncessaires de la loi de tonalit. En
effet, la tonalit exige que la sensible se rsolve en
montant vers la tonique. Cette rgle souffre peu d'excep-
tions.
Dissoner. Il n'y a que les sons qui dissonent, et un
son dissone quand il forme dissonance avec les autres.
On ne dit pas qu'nn intervalle dissone, on dit qu'il est
dissonant.
Dital-harpe. Espce de harpe construite en 1799 en
Angleterre, par Leight sur laquelle se faisaient sans
pdale les demi-tons par le seul moyen des doigts. Le
mme nom fut donn en
1830,
par Brinmayer, une
espce de petite harpe portative.
Dithyrambes. Danses accompagnes de chant et de
musique instrumentale, excutes en l'honneur de Bac-
chus.
Dithyrambique. C'tait, dans l'ancienne musique
grecque, un certain style qu'on appelait aussi bachique,
parce qu'il tait ddi Bacchus. Selon quelques thori-
174
DIX
tiens, ce style tait caractris par l'emploi des sons
moyens du systme.
Diton. Tierce majeure.
Dittanaclasis. Ce nom fut donn une espce de
piano, construit Vienne, en
1800,
par Muller. Cet
instrument compos de deux claviers avait des cordes
accordes l'octave l'une de l'autre. Il s'y trouvait
galement une lyre monte de cordes de boyau.
Dittonklasis. Nom donn par le mcanicien Muller,
de Vienne, un clavecin invent par lui en 1800. Cet
instrument tait compos de deux claviers dont les
cordes taient accordes l'octave l'une de l'autre : il s'y
trouvait aussi une lyre avec des cordes de boyau.
Diva. Mot emprunt l'italien qui signifie divine
et dont on se sert quelquefois en parlant d'une excellente
cantatrice.
Divertissement. C'est un terme gnrique dont on
se sert pour dsigner tous les petits pomes mis en
musique pour des ftes particulires, et les danses
mles de chant qu'on plaait la fin des opras.
Divertissement. Morceau de musique d'un genre
lger et facile, compos pour un ou plusieurs instru-
ments. Le divertissement n'est quelquefois qu'une suite
d'airs connus, ajusts les uns aux autres et mls de
variations.
Divertissement. On appelle aussi divertissement les
passages de la fugue d'cole qui servent de transitions
pour promener le sujet principal dans diffrents tons.
Divisarium. Nom latin du quatrime ttracorde du
systme des Grecs.
Divisi (diviss). Lorsque ce mot se trouve dans les
parties des premiers violons, au-dessus de passages
entiers crits, avec leur octave, il signifie que l'excution
de ces passages est divise en deux, c'est--dire que l'un
des excutants joue les notes suprieures de l'octave, et
l'autre les notes infrieures.
Division des rapports. Les intervalles peuvent tre
classs sous trois espces de divisions diffrentes, savoir :
la division arithmtique, la division harmonique et la
division gomtrique. Les deux premires ont entre
elles ceci de commun, que le nombre majeur est attribu
au son fondamental, et occupe la premire place dans le
calcul.
Dixime. Intervalle qui comprend dix sons, ou la
DOL
175
tierce de l'octave. En harmonie, la dixime est toujours
considre
comme la tierce et porte toujours ce nom,
except
1
dans la basse chiffre, quand la neuvime
monte la tierce
;
on la marque alors avec un dix, et on
l'appelle une dixime
;
2
dans le contre-point double,
attendu que le renversement ne se fait jamais la tierce
mais toujours la dixime.
Dix-huitime. Double octave de la quarte.
Dix-neuvime. C'est la double octave de la quinte.
Dix-septime. Double octave de la tierce.
Do. Syllabe que les Italiens substituent en solfiant
celle de ut dont ils trouvent le son trop sourd. Cette
substitution est adopte aujourd'hui en France par les
professeur de chant.
Docteur en musique. Les dignits acadmiques de
la musique ne se trouvent que dans deux universits, dans
celle d'Oxford et dans celle de Cambridge, en Angle-
terre. Le titre de bachelier est le grade infrieur de ces
dignits, et le titre de docteur en est le grade suprieur.
Il n'y en a pas d'intermdiaires.
Pour tre reu bachelier en musique il faut prouver
par acte authentique que l'on a tudi et pratiqu la
musique pendant sept ans. Une fois bachelier, pour pr-
tendre au doctorat, il faut avoir prolong les tudes et
la pratique de la musique cinq autres annes et avoir
compos un chant de huit parties et l'avoir fait excuter
avec voix et instruments dans une solennit publique.
Dodegachordon. Espce de lyre ou cithare ancienne
ayant douze cordes.
Dodecacorde. Systme de musique par lequel on
ajoute quatre nouveaux tons aux huit qui existent dj
dans le chant ecclsiastique romain.
Doigter. C'est faire marcher d'une manire conve-
nable et rgulire les doigts sur quelque instrument, et
notamment sur l'orgue et le piano, pour en jouer le plus
facilement et le plus nettement qu'il est possible. Sur
les instruments manche, tels que le violon et le violon-
celle, la plus grande rgle du doigt consiste dans les
diverses positions.
Dolce (doux). Ce mot, plac sous une phrase de
chant, indique une manire d'excuter douce, moelleuse,
expressive, gracieuse et caressante, qui n'exclut pas une
certaine vigueur dans le son, sans le porter nanmoins
au-del du mezzo forte.
176 DOQ
Dominante. C'est des trois notes essentielles du ton,
celle qui est une quinte au-dessus de la tonique. La
tonique et la dominante dterminent le ton
;
elles
y
ont
chacune la fondamentale d'un accord particulier, tandis
que la mdiante, qui constitue le mode, n'a point d'ac-
cord elle, et fait seulement partie de celui de la
tonique.
On a donn ce nom de dominante la quinte du ton,
attendu qu'elle domine toujours et s'emploie dans une
inimit d'accords qui n'admettent pas la tonique.
Dominante. C'est, dans le plain-chant, la note que
l'on rebat le plus souvent, quelque degr que l'on soit
de la note finale.
Le premier ton du plain-chant a sa dominante la
quinte de la finale.
Le second la tierce mineure,
Le troisime la sixte mineure,
Le quatrime la quarte,
Le cinquime la quinte,
Le sixime la tierce majeure,
Le septime la quinte,
Et le huitime la quarte.
C'est la diversit des dominantes qui, jointe aux
cordes mlodiques parcourues parla modulation, depuis
la finale du ton jusqu' sa dominante, et vice versa,
donne chacun des huit tons du plain-chant le caractre
de tonalit qui lui est propre.
Dominicelli. Luthier de Ferrare, lve d'Amati,
y
travailla de 1695 1715.
Dongolah (Musique des habitants de). La mlodie du
chant des habitants de Dongolah, dans l'intrieur de
l'Afrique, est plutt douce et mlancolique qu'elle n'est
bruyante et gaie. L'instrument dont ils s'accompagnent
est une lyre antique grossirement fabrique. L'effet de
cet instrument est assez harmonieux
;
il se tient et se
pince de la main gauche. Une courroie, attache aux
deux branches de l'instrument, sert le soutenir et
appuyer le poignet, tandis que les doigts agissant de la
main droite frappent les cordes avec unplectrum.
Doppioni. Sor^e de hautbois anciennement en usage
en Italie.
Doquet ou Toquet. Nom que l'on donne la qua-
trime partie de trompette clans un morceau de fanfare
pour musique de cavalerie.
DOU 177
Dorien. Un des quatre modes principaux des anciens
;
il servait aux choses graves, svres, honntes, reli-
gieuses. IJ tait propre galement exciter les affec-
tions belliqueuses. Ce mode fut invent par Lamiras
clbre musicien de Thrace qui vivait avant Homre. Ce
fut lui qui le premier maria le chant aux sons de la
Harpe.
Double. Les intervalles doubles ou redoubls sont
tous ceux qui excdent l'tendue de l'octave.
Double est encore un mot employ pour dsigner les
acteurs qui remplacent les premiers sujets dans les rles
que ceux-ci quittent par indisposition ou pour d'autres
motifs.
Double-corde. Manire de jouer du violon, alto ou
violoncelle en touchant deux cordes la lois, et faisant
ainsi deux parties.
Double-emploi. Nom donn par Rameau aux deux
diffrentes manires dont on peut considrer l'accord de
sous-dominante.
Doublement des notes des accords, c'est en harmonie
l'emploi simultan du mme son fait par deux ou plu-
sieurs parties diffrentes.
En gnral, moins d'une intention particulire, il
faut que les parties soient combines et fondues entre
elles, de manire former un ensemble suave et harmo-
nieux.
Le doublement de quelques notes peut tre amen
par la ncessit de faire marcher les parties d'une
manire facile et naturelle, par les exigences de la pen-
se, enfin par le choix libre du compositeur. Le got,
l'tude des modles et l'exercice enseigneront trs-vite ce
qu'il est bon de faire cet gard.
Lorsqu'un accord n'est point renvers, le doublement
le plus harmonieux est celui de la note fondamentale
l'octave. C'est la note fondamentale, plus que toute autre
qui donne l'accord sa vritable physionomie
;
son dou-
blement produit toujours un bon effet.
.Lorsqu'un accord est renvers, les doublements les
plus harmonieux sont encore ceux de la note fondamen-
tale tonique ou dominante, et celui de la partie sup-
rieure une octave au-dessous d'elle.
Dans l'accord de dominante, on ne double pas le
4'
degr ni la sensible, parce que ces notes sont presque
toujours assez fortement accuses par elles-mmes, et
178 DUI
parce que n'ayant qu'une seule manire de se rsoudre
i] serait gauche de faire marcher identiquement deux
parties l'octave l'une de l'autre.
Doubler. Les premiers acteurs sont doubls par les
seconds, et ceux-ci par les troisimes, en sorte que,
quelque accident qui arrive, un opra peut toujours tre
reprsent tant bien que mal.
Dans la musique
plusieurs parties, doubler veut dire reproduire plusieurs
sons dans un.
Doubles-mains. Mcanisme aussi simple qu'ingnieux
que l'on adapte aux nouvelles orgues un clavier, et au
moyen duquel, en baissant une touche, on fait baisser
en mme temps celle de l'octave en dessus. Comme
l'action de la double-main est rciproque, si l'on fait
parler l'octave de la touche haute, la touche qui lui
correspond au grave parlera aussi. Le clavier de l'orgue
est divis en deux parts gales qui ont chacune leur
mcanisme particulier, en sorte que, dans quelque posi-
tion que les mains de l'organiste se trouvent, tout le
clavier est occup. Sont-elles runies au centre, les
octaves extrmes se font entendre
;
sont-elles cartes,
les mcanismes agissent sur le milieu. Les doubles-
mains sont la disposition de l'organiste au moyen d'un
registre
;
il s'en sert au besoin pour renforcer les effets.
Doublette. Jeu d'orgue compris parmi les jeux de
mutations. Il est d'tain, et sonne l'octave du prestant.
Ce jeu n'est que d'une octave, et reprend par cons-
quent d'octave en octave.
Doux. Mot qui en musique est oppos fort. Le doux
a trois nuances : le demi-jeu, le doux et le trs-doux.
Douzime. Intervalle de douze sons
;
c'est l'octave de
la quinte, il conserve souvent le nom de quinte. Ce
n'est que dans le contre-point double qu'il porte le nom
de douzime.
Drame lyrique. (Voyez Opra.)
Dramatique. Cette pithte se donne la musique
imitative, propre aux pices de thtre, et destine
exprimer les divers mouvements du cur humain.
Duettino. Ce mot italien, qui signifie petit duo, d-
signe une composition musicale deux parties obliges,
ordinairement trs-courte.
Duiffopruger. N dans le Tyrol s'tablit comme
luthier Bologne en 1510
;
il construisit un certain
nombre d'instruments pour la Chambre et la Chapelle
DUR
*
179
de Franois i
er
et vint en France en 1517, appel par ce
prince.
Dulcian. C'tait, dans les seizime et dix-septime
sicles, le nom du basson, qui n'tait alors compos que
de quatre pices avec deux clefs, et qui avait quatre
dimensions diffrentes.
Duo. Composition musicale deux parties obliges.
Le duo vocal est presque toujours accompagn par
l'orchestre, ou un instrument tel que le piano, la harpe,
la guitare. Le duo instrumental est compos de deux
parties rcitantes, et peut tre aussi accompagn par
l'orchestre.
Les mmes sentiments, les mmes situations qui,
dans l'opra, animent l'air, donnent lieu aux duos, aux
trios, aux quatuors. Ce sont des tableaux plusieurs
personnages, conus d'aprs les mmes principes et les
divers plans
;
les dtails de l'air, les images mme
qu'il nous reprsente, conviennent parfaitement tous
ces morceaux, qui, dans un cadre plus tendu, ne sont
pour ainsi dire que des airs plusieurs voix. La seule
diffrence que l'on
y
remarque, c'est que le concours
des interlocuteurs animant le discours musical, le com-
positeur ne se trouve point oblig de recourir si souvent
au chant instrumental, aux traits d'orchestre, pour faire
reposer le chanteur et lui donner le temps de prendre
haleine.
Duplex. Nom donn en
1855,
par Petitti de Milan,
un instrument de cuivre ayant double pavillon, double
combinaison, mais une seule embouchure.
Duplication. Terme de plain-chant. L'intonation
par duplication se fait par une sorte de periclse en dou-
blant la pnultime note du mot qui termine l'intona-
tion.
Dur. On appelle ainsi tout ce qui blesse l'oreille par
son pret : il
y
a des voix dures et glapissantes, des
instruments aigres, durs, des compositions dures. La
duret du si naturel, lorsqu'on
y
arrive en montant
diatoniquement . partir du
fa,
lui fit donner autrefois
le nom de B dur
;
il
y
a des intervalles durs dans la
mlodie. La duret prodigue rvolte l'oreille et rend
une musique trs-dsagrable
;
mais mnage avec art,
elle sert au clair-obscur et ajoute l'expression.
Durantistes. A l'poque o Lo et Durante diri-
geaient Naples, l'un le conservatoire de la Pieta,
180
EGH
l'autre celui de Sant-Onofrio, il s'tait form
deux
partis, celui des Durautistes et celui des Listes,
qui
soutenaient chacun un systme diffrent sous le rapport
de la composition musicale : les premiers taient pour
la modulation et l'effet, les seconds pour la richesse des
accords. Le premier parti triompha.
Dutka. Double-flte des paysans russes, compose de
deux roseaux d'ingale longueur, percs chacun de trois
trous.
E
E. Troisime note de la gamme diatonique, et cin-
quime de la gamme diatonico-chromatique, appele
dans le solfge mi. En Italie, on la nomme aussi e, la,
mi.
Eberle (Ulricus). Luthier en renom, travaillait
Prague en 1780.
Ecbole. C'tait, dans la plus ancienne musique
grecque, un accident qui levait de cinq quarts de ton
la note devant laquelle il tait plac.
Echappement (double). Ainsi se nomme dans la
facture du piano, le moyen mcanique par lequel un
marteau , est repris dans sa marche descendante
pour retourner la corde, avant que la touche ne soit
arrive sa place horizontale. Le premier chappement
est d Sbastien Erard
;
il
y
a aujourd'hui beaucoup
de systmes de double chappement.
Echelle. C'est le nom qu'on a donn la succession
diatonique des sept notes, ut, r, mi,
fa,
sol, la, si, de
la gamme note, parce que ces notes se trouvent ranges
en manire d'chelons sur les portes de notre musique.
Cette numration de tous les sons diatoniques de
notre systme, rang par ordre que nous appelons
chelle, les Grecs l'appelaient, dans le leur, diagramme,
diagramma, c'est--dire par lettres, attendu qu'ils
reprsentaient leurs diverses chelles de sons par les
lettres de leur alphabet. Ils avaient plusieurs diagram-
mes : le plus usit dans la pratique tait le ttracorde
parce que, en effet, cette chelle n'tait compose que
EGO
181
de quatre sons et, pour former de plus grands dia-
grammes, ils ajoutaient plusieurs ttracordes l'un
l'autre, et rptaient ainsi ces quatre sons de ttracorde
en ttracorde, comme nous le faisons d'octave en octave.
Echelette ou Rgale. Instrument compos de diff-
rentes lames de bois dur qui rpondent aux diffrents
tons de la gamme, et qu'on touche avec une petite boule
d'ivoire attache une petite baguette.
Echo. Son renvoy ou rflchi par un corps solide, et
qui se rpte et se renouvelle l'oreille. Ce mot vient du
grec chos, son. On appelle aussi cho le lieu o la rp-
tition se fait entendre.
Le nom d'cho se transporte en musique ces sortes
d'airs ou de pices dans lesquelles, l'imitation
de
l'cho, on rpte une ou plusieurs fois certains passages
en diminuant chaque fois l'intensit du son. C'est sur
l'orgue qu'on emploie le plus communment cette ma-
nire djouer, cause de la facilit qu'on a de faire des
chos sur le positif. Dans la musique de ballet on
appelle cho certaines portions d'un air de danse.
Echomtre. Espce de rgle ou d'chelle croise en
plusieurs parties dont on se sert pour mesurer la dure
des tons et pour dterminer leurs intervalles et tous
leurs rapports. Cet instrument fut imagin en
1701,
par
Sauveur.
Eclatante. Se dit d'une musique bruyante et so-
nore.
Eclepsis. Intervalle descendant.
Eclisses. Petites planches minces sur lesquelles
reposent les tables des violons, des basses, des guitares,
etc.
Eclyse. C'tait dans l'ancienne musique grecque, un
accident qui faisait baisser une note de trois quarts de
ton.
Egmlte. Du grec ex et melos, son sans mlodie, ou
voix parlante, par opposition emmlie, du grec eu et
melos, qui signifie le son du chant. Emmlie est aussi le
nom d'une certaine danse introduite dans la tragdie.
Ecole. Comme il
y
a en peinture diffrentes coles,
il
y
en a en architecture, en musique, et gnralement
dans tous les beaux-arts. En musique, par exemple,
tous ceux qui ont suivi le style d'un grand matre, peu-
vent tre regards comme appartenant l'cole de ce ma-
tre
;
on dsigne encore par le terme d'cole la runion de
6...
182
ECO
tous les matres d'un pays. Ainsi, l'ou dit Ycole
fran-
aise, Vcole italienne, Vcole allemande.
Les musiciens illustres voyageant dans toute l'Eu-
rope, les communications tablies entre les Virtuoses,
l'change continuel des uvres qui, dans chaque pays,
ont acquis de la clbrit, sont autant de raisons pour
que la musique tende partout ses progrs dans des
proportions gales. Les dcouvertes ne sont plus des
mystres que des matres jaloux ne rvlaient qu' un
petit nombre de disciples. L'art est partout le mme, et
le terme de musique franaise ne s'applique plus mainte-
nant qu'aux compositions qui ont vu le jour avant la
venue de Gluck. Les trois coles principales ont nan-
moins conserv chacune un caractre particulier. L'cole
allemande se distingue par une harmonie savamment
travaille, unie des chants pleins de force et d'expres-
sion
;
l'cole italienne par une mlodie toujours suave,
une facture lgante
;
l'cole franaise a adopt un genre
mixte, qui tient de la vigueur allemande et de la grce
italienne.
Un morceau d'cole est une composition dans laquelle
on s'est attach plus particulirement aux effets de l'har-
monie qu'aux grces du chant.
Ecosse (La musique en). On peut diviser la musique
primitive de l'Ecosse en guerrire, pastorale et joyeuse.
La premire consistait en des marches que l'on excutait
en prsence des gnraux d'arme, et par lesquelles on
rappelait les combats qu'ils avaient dirigs. Tout
y
res-
pirait une telle fureur d'enthousiasme, que l'auditeur,
irrsistiblement entran, s'abandonnait aux sentiments
d'excitation hroque que lui inspiraient ces chants.
Le caractre de la musique pastorale tait bien diff-
rent. Les accents en taient mlancoliques et gracieux,
les modulations naturelles et les mouvements lents.
La musique \q joyeuse consiste aujourd'hui en contre-
danses et en valses, qui ont un caractre et une expres-
sion tout particuliers, lorsque ces morceaux sont excu-
ts par des artistes habiles. Ils sont ordinairement com-
poss de deux reprises qui comprennent chacune huit
ou douze mesures.
Les instruments employs par les Ecossais sont la
harpe, le cruth et la musette. La musette surtout est
devenue l'instrument national des montagnards cossais
qui s'en servent dans les ftes champtres et mme dans
EFP 183
les batailles, et alors ils la joignent au tambour.
La
musette cossaise diffre un peu de la ntre. Elle est
ordinairement compose de trois bourdons et d'un cha-
lumeau perc de huit trous, dont sept placs en-dessus
et un en dessous. L'chelle la plus basse du chalumeau
est forme par les sons sol, la, si, do, r, mi
t
fa,
sol. Le
premier bourdon fait entendre un sol grave, le second
donne un si, et le troisime un sol l'octave au-dessus
de celui que fait entendre le premier. Cet accord impar-
fait forme l'accompagnement continu des airs nafs que
les montagnards jouent sur leur instrument.
Ecriture musicale des grecs anciens. Les signes
ou lettres, qui servaient d'alphabet musical, taient
rangs sur deux lignes dont la suprieure tait pour le
chant et l'autre pour l'accompagnement.
Guido d'Arrezzo trouva l'invention de les crire sur
la porte
;
ses notes ne furent d'abord que des points o
il n'y avait rien qui en marqut la dure.
Mais Jean de Meurs, n Paris, en 4350, et qui vivait
sous le rgne du roi Jean, trouva le moyen de donner
ces points une valeur ingale par les diffrentes figures
de rondes, de blanches, de noires, de croches, de dou-
bles-croches, etc.
,
qu'il inventa et qui ont t adoptes
par les musiciens de toute l'Europe.
Edicomos. Danse accompagne de chant chez les
anciens Grecs.
Ediles. C'tait, au temps des premiers empereurs
romains, le nom de certains magistrats ou censeurs,
qui, outre l'inspection des difices publics dont ils taient
chargs, devaient aussi examiner et approuver toutes les
comdies et les compositions musicales avant leur repr-
sentation.
Edlinger. Luthier lve et imitateur de Stainer, tra-
vaillait Augsbourg, en 17o5.
Effet. Impression agrable et forte que produit une
excellente musique sur l'oreille et l'esprit des auditeurs.
Il n'y a que le gnie qui trouve les grands effets. C'est
le dfaut des mauvais compositeurs d'entasser parties
sur parties, instruments sur instruments, pour trouver
l'effet qui fuit, et d'ouvrir, comme disait un ancien,
une grande bouche pour souffler dans une petite flte.
Vous diriez voir leurs partitions si charges, si
hrisses, qu'ils vont vous surprendre par des effets
prodigieux; et si vous tes tonns en coutant tout
184
EGA
cela, c'est d'entendre une petite musique maigre, ch-
tive, confuse, et plus propre tourdir les oreilles qu'
les charmer.
L'une des parties de la musique les plus mobiles, les
plus susceptibles des vicissitudes du temps, c'est l'effet.
Comme il n'est rien par lui-mme, mais seulement par
une impression produite sur les organes, il existe diff-
rents degrs selon que ces organes ont plus ou moins de
dlicatesse et de culture, selon qu'ils ont t frapps plus
ou moins habituellement par des motions antrieures,
et que l'exercice, ou, si l'on veut, l'exprience de l'oreille,
a resserr ou tendu le cercle de ses sensations et de ses
besoins.
Les effets sont relatifs chaque modification du son.
Ainsi l'on distinguera les effets d'intonation, les effets
de rhythme, les effets d'intensit, les effets de timbre,
les effets de caractre. A ces cinq espces, il faut ajouter
encore ceux qui naissent de l'harmonie ou de la runion
de plusieurs sons. On nomme
effets
simples ceux qui
proviennent d'une seule de ces causes, et effets
composs
ceux qui proviennent de deux ou de plusieurs causes la
fois.
Les effets sont la musique ce que les figures sont au
discours oratoire. On doit donc donner les mmes avis
en ce qui concerne leur emploi. Le premier est de ne
point trop les prodiguer, parce qu'ils ne tardent pas
produire la fatigue et le dgot; le second est de les
employer avec adresse, de manire ce qu'il puissent
tre bien sentis.
~
Le conseil le plus sage que l'on
puisse donner aux jeunes compositeurs, est d'attendre,
pour employer les effets, qu'ils aient acquis l'exprience
;
autrement ils courront le risque de produire des effets
tout diffrents de ceux qu'ils s'taient proposs.
Effort. Dfaut qui est, dans le chant vocal, le con-
traire de l'aisance. On le fait par une contraction violente
de la glotte. L'air, pouss hors des poumons, s'chappe
tout la fois, et le son semble alors changer de nature.
Il perd la douceur dont il tait susceptible et acquiert
une duret fatigante pour l'auditeur. L'effort dfigure
les traits du chanteur, le rend vacillant dans l'intonation,
et souvent l'en carte.
gal. Nom donn par les Grecs au systme d'Aris-
toxne, parce que cet auteur divisait gnralement
chacun de ses ttracordes en trente parties gales.
GY
185
GALiT. C'est une des qualits les plus essentielles de
la voix. Il n'en est point qu'on puisse appeler belle, si
tous les sons qu'elle peut rendre, dans l'tendue qui lui
est propre, ne sont entre eux d'une parfaite galit.
L'galit est un don rare de la nature ,
mais l'art peut
y
suppler, lorsqu'il s'exerce de bonne heure sur un
organe que l'ge n'a pas endurci.
Egersis. Hymne que les nouveaux maris chantaient
leur lever, en Grce.
gyptiens (Musique des). S'il faut en croire quelques
crivains dont le tmoignage mrite d'tre pris en srieuse
considration, c'est aux Phniciens (voir
Phniciens)
que les gyptiens empruntrent leur systme musical.
On peut induire ce fait d'une table de
Dmtrius de
Phalre, d'o il semble rsulter que les sept voyelles des
langues orientales servaient ces peuples de caractres
de musique, et mme de sons pour solfier. On a trouv
Milet une inscription mystrieuse qui renferme des
invocations musicales adresses aux sept plantes. Chaque
plante est dsigne par un mot compos de sept voyelles,
et commenant par la voyelle consacre la plante
invoque. Ces invocations, dit M. Pabre d'Olivet, dans
une dissertation sur la gamme phnicienne, sont trs-
prcieuses en ce qu'elles prouvent l'existence des modes
diatoniques et leur application dans l'antiquit la plus
recule.
Les prtres de l'Egypte, dit Dmtrius de Phalre,
chantent les dieux par les sept voyelles qu'ils font rson-
ner. Ce son leur tient lieu
;
par son harmonie, de la flte
et de la lyre.
Lors mme que les gyptiens secourent le joug des
rois pasteurs, il ne parat pas qu'ils aient renonc
cette manire d'crire et de chanter la musique. On sait
que ce peuple avait le plus grand loignement pour les
nouvauts, quelles qu'elles fussent. Aussi les chan-
gements apports dans le gouvernement n'exer-
crent qu'une faible influence sur la forme du systme
musical. Le peuple avait l'habitude de certains chants
qu'il et t dangereux de vouloir lui ter.
Le mode phnicien, appel li/n, tait fort usit en
Egypte, sous le nom de maneh, qui tait une pithte
donne la lune.
D'ailleurs, les prtres gyptiens gardaient le souvenir
des troubles civils qui, aprs avoir ravag la terre,
186 L
avaient caus si longtemps l'asservissement de leur
pays, et la prudence leur conseillait de ne pas laisser
la disposition du vulgaire des connaissances dont il pou-
vait faire un usage funeste. Ils ensevelirent donc dans
le secret du sanctuaire les principes de toutes les sciences,
et ne reprsentrent aux yeux que des symboles assez
ingnieux pour piquer la curiosit, mais jamais assez
clairs pour tre compris.
Ainsi les principes de la musique, comme ceux de
toutes les autres sciences, taient renferms avec soin
dans les sanctuaires de l'Egypte. Ce fut dans ces sanc-
tuaires qu'Orphe les connut, et que Pytbagore mrita
de les recevoir aprs Orphe.
Il nous est parvenu quelques fragments de musique
qu'on prsume avoir appartenu aux gyptiens. Il en est
un surtout que le savant Burette a dchiffr sur la note
grecque. Il en attribue les paroles un certain pote
nomm Dyonisius Iambos, qui fut presque contemporain
d'Aristote.
Ce morceau antique, dit toujours M. Fabre d'Olivet,
est en mode solaire, c'est--dire que sa toniqne naturelle
est la corde mi.
Comme nous l'avons vu plus haut, Orphe et Pytha-
gore empruntrent l'Egypte son systme musical, et
l'enrichirent de perfectionnements nombreux. (Voir ce
sujet l'article Grce.)
Ela. C'tait, dans l'ancien solfge, lem*, clef de violon,
quatrime espace, qu'on chantait quelquefois sur la
syllabe la.
E la. fa. Ancienne dnomination du mi b, dont les
Italiens se servent encore.
E la mi. C'tait, dans l'ancien solfge, le mi, clef de
basse, troisime espace, et le mi, clef de violon, premire
ligne, qu'on chantait tantt sur la syllabe la, et tantt
sur la syllabe mi.
lgie. Genre de posie compose sur des sujets d'un
caractre triste et mlancolique, et accompagne d'un
chant analogue, tel que le Lac de Nidermeyer. Chez les
anciens, Ovide, Horace, Catulle, et chez nous Millevoye
et Andr Chnier, ont laiss des chefs-d'uvre dans ce
genre de posie. On nommait galement lgie, un genre
de musique ancienne, sorte de nome pour les fltes.
lment. Le mot lment, pris en gnral, comme
EMB 187
matire technique de l'art, indique l'ensemble de tous
les sons possibles, aigus ou graves.
Les lments, dans leur signification particulire, sont
les premires notions de l'enseignement, tant pour la
lecture musicale que pour le chant.
lment mtrique. C'est une partie de la mesure
rsultant de la division d'un temps en deux ou trois
notes de mme valeur. Par consquent, les lments
mtriques de la mesure deux temps sont des quarts de
ronde, c'est--dire des noires. Dans la mesure deux-
quatre, ce sont des huitimes, c'est--dire des croches.
lvation. L'lvation de la main ou du pied, en
battant la mesure, sert marquer le temps faible, et
s'appelle proprement lev.
lever. Le ton d'un morceau, c'est le transposer,
pour qu'on puisse l'excuter sur un ton plus haut que
celui dans lequel il est compos.
On donne aussi le nom d'lvation certains motets
qu'on chante pendant le sacrifice de la messe, au mo-
ment o le prtre lve l'hostie, comme : salutaris
hostia. Le morceau qu'on excute ce moment sur l'or-
gue s'appelle aussi lvation.
jLicon de Ptolme. C'tait le nom d'une figure de
gomtrie par laquelle Ptolme faisait connatre les
diffrents intervalles avec leur rapports.
line. Nom grec de la chanson des tisserands.
Ellipse. Suppression d'un accord que rclame l'har-
monie rgulire.
lodicon. Instrument invent, il
y
a environ vingt
ans, par M. Eschembach. Le principe de cet instru-
ment consiste faire vibrer, non des cordes tendues,
mais des lames mtalliques au moyen d'un soufflet. On
y
avait runi les effets du clavicorde avec ceux de l'or-
gue. C'est le mme principe de vibration des lames
mtalliques par l'action de l'air qu'on a reproduit depuis
dans plusieurs autres instruments.
Embaterie.
Marche Spartiate en allant la charge.
Embouchure. La partie des instruments vent que
l'on met contre les lvres ou dans la bouche pour en
jouer. Chaque instrument vent a son embouchure
particulire
;
celles de la trompette, du cor, du trom-
bone, sont de mme nature, dans des proportions
diffrentes. Ces embouchures ressemblent assez un
petit entonnoir. La flte s'embouche par un trou ovale
188 EMP
fait l'instrument mme, le flageolet par un bec, la
clarinette par un bec qui porte une anche. Le hautbois,
le cor anglais, ont une anche pour embouchure.
Comme c'est de la manire de gouverner l'embou-
chure que dpend la qualit du son, on dit qu'un cor-
niste, un fltiste, a une belle embouchure, quand il tire
de beaux sons de cet instrument.
mission de voix. Acte par lequel on met au dehors
un son de l'organe vocal.
Empirisme. Dans l'histoire de l'harmonie, on appelle
Empirisme l'enseignement de l'harmonie par l'tude des
faits accomplis dans les uvres des compositeurs. Cette
mthode consiste prendre l'un aprs l'autre tous les
accords employs par les grands compositeurs, les
enregistrer, les coordonner, les graver dans la m-
moire, ainsi que toutes les circonstances de leur emploi
;
puis, lorsqu'on s'est longtemps fatigu pour comprendre,
formuler, grouper et retenir ces innombrales faits harmo-
niques, les imiter dans ses propres compositions, c'est
une mthode empirique dans toute la force de ce mot. Elle
peut enseigner l'harmonie, mais elle est longue, fati-
gante, irrationnelle. En revanche, elle possde deux
avantages inapprciables
;
elle prolonge ordinairement
les jours de ses adeptes
;
car, si elle les fatigue dmesu-
rment et pendant de longues annes, elle russit, en
gnral, touffer si parfaitement leur imagination et
leur gnie, que ces deux choses dvorantes sont dsor-
mais sans influence sur eux
;
ensuite, comme elle ne
rend jamais compte de rien, elle n'est jamais embar-
rasse.
Cette mthode n'est point un fantme imagin
plaisir
;
elle a t suivie par des harmonistes clbres,
dont les principaux sont: Godefoy Weber, en Allemagne,
et Reicha, ancien professeur au Conservatoire de Paris.
Godefoy Weber, que personne ne confondra avec Marie
de Weber, l'illustre auteur de Freyschtitz, l'a employe
d'une manire exclusive
;
aussi ne nous
y
arrterons-nous
point. Reicha ne l'a point suivie d'une manire aussi com-
plte. Il a fait choix de treize accords qu'il appelle fonda-
mentaux et auxquels il s'efforce de ramener tous les autres.
Cependant, c'est encore de l'empirisme
;
car ses accords
soi-disant fondamentaux, sont en difnitive, mme pour
lui, de simples faits harmoniques qu'il emprunte aux
uvres des compositeurs, et non des donnes fournies
EMP 189
par le raisonnement,
les mathmatiques ou les phno-
mnes observs dans les corps sonores. Ensuite, l'encha-
nement de ces accords, leur but et les circonstances
innombrables de leur emploi, toutes choses si essentielles
en harmonie, ne lui sont connues que par l'tude empi-
rique des compositeurs. Il n'y a rien dans ses accords
fondamentaux, absolument rien qui lui fournisse cet
gard une loi quelconque, une conclusion, une simple
induction. Enfin, le choix mme de ses treize accords
fondamentaux est compltement arbitraire. Rien ne
prouve qu'ils le soient plus que d'autres, et, en effet, bon
nombre d'entre eux ne diffrent des autres que par des
altrations purement facultatives
;
ceux qui les connais-
sent en conviendront, et la question n'est pas assez
importante pour en parler davantage en faveur de ceux
qui ne les connaissent point. En rsum, le systme de
Reicha ne mrite pas la rputation qu'il s'est acquise
;
il
est moins acceptable encore que l'empirisme exclusif de
Weber. S'il affiche l'orgueil d'une thorie, il n'en est pas
plus raisonn; et il ajoute aux difficults quelquefois
inextricables d'une thorie sans base, sans liaison, sans
fcondit.
Cette dernire et importante rflexion doit tre appli-
que tous les traits d'harmonie, quels qu'ils soient,
o la science n'est point appuye sur le fondement
inbranlable et vrai de la tonalit moderne. (Voyez le
mot Harmonie).
Emploi. On dit au thtre qu'un acteur a l'emploi de
tnor, de baryton, de basse, pour dire qu'il joue et
chante tous les rles crits pour le tnor, le baryton ou
la basse.
Empoongwa. La musique des habitants d'Em-
poongwa, dans l'intrieur de l'Afrique, et encore dans
un tat de barbarie. L'encho/ubre, le seul instrument
qui leur soit particvilier, ressemble la mandoline. Il a
cinq
cordes faites de racines de palmier. Le manche se
compose de cinq morceaux de bambou auxquels les cordes
sont attaches. En faisant tourner les bambous, l'ins-
trument
s'accorde facilement, mais non pas d'une
manire
trs-solide. On le joue avec les deux mains. Ses
sons, assez agrables d'ailleurs, offrent peu de varit.
Dansson voyage Empoongwa, Al. Bowdich rencontra
un
musicien ngre de la contre, aussi dgotant par
son
aspect que sa musique tait tonnante. 11 avait une
7
190 ENS
harpe monte de huit cordes faites avec les racines
fibreuses du palmier, dont le son tait harmonieux et
rond. 11 parcourait avec agilit un grand nombre de
notes, et faisait monter sa voix au-del de la harpe.
Tout a coup il commena avec force YAllluia de Haendei
.
Entendre ce chur au milieu des dserts de l'Afrique,
dit M. Bowdich, qui nous laissons la responsabilit de
ce rcit, et l'entendre excuter par un pareil tre,
produisit sur moi un effet extraordinaire.
Enchanement harmonique. On emploie ce mot
quand la basse excute un mouvement progressif, de
faon qu'un, deux, ou trois sons, composant un accord,
demeurent invariables dans l'accord suivant.
Encomiaque. Style des anciens Grecs, destin aux
hymnes et aux louanges.
Endmatie. C'tait l'air d'une sorte de danse particu-
lire aux Argiens.
Enharmonie. Nom donn au troisime genre de la
musique des Grecs.
Enharmonique. Le genre enharmonique est le pas-
sage d'une note une autre, sans que l'intonation de la
note ait t change d'une manire sensible. L'accord de
septime diminue est celui qui produit le plus naturel-
lement le genre enharmonique, puisqu'il peut se prsen-
ter sous quatre faces diffrentes, sans qu'il
y
ait eu de
changement sensible dans l'intonation.
Chez les Grecs, le genre enharmonique rsultait d'une
division particulire du ttracorde. Les intervalles taient
plus petites que ceux du diatonique et du chromatique.
C'tait le plus difficile comme le plus agrable, dit-on,
des trois genres.
Enharmonique (Modulation). Voyez Modulation,
(n4).
Enseignement. Science qui consiste en musique
faire passer dans l'esprit et dans l'oreille des autres ce
que l'on sait.
Il
y
a plusieurs sortes d'enseignements : le
particu-
lier, le mutuel, le simultan. On entend par enseigne-
ment particulier, les leons qu'un professeur donne en
ville ou chez lui un seul lve. L'enseignement
mutuel
s'applique gnralement dans les coles, avec le
systme
Wilhem. Ici, le directeur musical forme des
moniteurs,
choisit parmi les lves les plus intelligents,
puis il en
fait autant de matres ou chefs de pelotons, qui
instrui-
ENT
191
sent
eux-mmes leurs camarades, par groupes de dix
ou quinze. Dans l'enseignement simultan, l'instruction
des lves n'est point confie des moniteurs, mais bien
l'action directe d'un professeur instruit, qui, lui seul,
comme un chef militaire, gouverne et met en mouve-
ment une arme de deux ou trois cents chanteurs, en-
fants ou adultes. Pour des cours nombreux, cette m-
thode nous semble la meilleure.
Ensemble. C'est le rapport convenable de toutes les
parties d'un ouvrage entre elles et avec le tout. Ce terme
s'applique encore l'excution, lorsque les concertants
sont si parfaitement d'accord, soit pour l'intonation, soit
pour la mesure, qu'ils semblent tous tre anims d'un
mme esprit. La socit des concerts du Conservatoire
offre presque toujours cet ensemble merveilleux.
Ensemble (Morceaux d'). Ce sont tous les morceaux
dramatiques excuts par plus d'une voix. Ainsi, les
duos, les trios, quatuors, quintettes, sextuors, etc., sont
des morceaux d'ensemble, pourvu que chaque partie
y
soit distincte, dialogue avec les autres, et soit excute
par une seule voix. Les churs, quoique composs de
plusieurs parties, ne sont pas qualifis de morceaux
d'ensemble.
Entente. Se dit de l'arrangement mthodique des
diverses parties d'une uvre musicale.
Enthousiasme. Exaltation de fam qu'on ne saurait
dfinir. Dans cet tat, une production musicale marche
avec la plus grande facilit. Les ides, pour ainsi dire,
accourent en foule, se dessinent et se disposent avec la
rapidit de l'clair, cle faon que, sans songer aux r-
gles, tout se trouve plac dans le plus bel ordre.
Entonner. Mettre un air sur le ton. Dans la musique
religieuse, entonner se dit pour chanter le commence-
ment d'un psaume ou d
:
un hymne.
Entr'acte. Espace de temps qui s'coule entre la fin
d'un acte d'opra et le commencement de l'acte suivant,
et durant lequel l'action est suspendue. On donne aussi
ce nom ce morceau de musique instrumentale qu'on
excute dans l'intervalle de deux actes d'un opra, d'une
tragdie, d'un ballet et d'une comdie.
Pris en ce dernier sens, l'entr'acte n'est point une
partie essentielle du drame lyrique; le compositeur ne
consulte cet gard que son gnie et mme son caprice.
Il est parfaitement libre de faire garder le silence l'or-
192 OL
chestre pendant que la scne reste vide. Beaucoup de nos
opras n'ont point d'entractes symphoniques. Quand le
musicien, ne rencontre pas le sujet d'un morceau de ce
genre qui promette de l'effet, il se borne reproduire,
avec une harmonie plus riche et plus travaille quelques
motifs heureux qu'on a dj entendus. Quelquefois
encore, le musicien compose une petite symphonie con-
certante o les instruments vent se font entendre
tour tour, comme celle que Mhul a place dans Joseph;
ou bien de nombreuses variations sur un thme tir de
l'opra mme.
Entre. Partie d'un ballet, destine produire le
mme effet que les scnes dans les ouvrages dramati-
ques. L'on disait autrefois : danser une entre, comme
on dit jouer une scne, chanter un air.
Entre est aussi l'action d'un personnage qui entre
sur la scne. Il faut que la musique qui signale une en-
tre soit d'une couleur dcide, et prsente de grands
rapports avec le caractre du personnage que l'on at-
tend.
Entre se dit aussi du moment o chaque partie com-
mence se faire entendre. Le fltiste a manqu son en-
tre.
Entremets. Ainsi se nommaient anciennement de pe-
tits divertissements, souvent mls de musique, qui se
donnaient entre les diffrents service d'un repas d'ap-
parat afin d'amuser les convives pendant que les servi-
teurs enlevaient les anciens plats et les remplaaient par
des nouveaux.
oli-courtier. Instrument double clavier avec souf-
flet et lames vibrantes, construit en 1844 par Courtier,
de Paris.
olien. C'est un des modes de la musique grecque.
Invent par Dmon l'athnien, neveu de Dmosthne,
d'autre disent par Polymneste pote et musicien. On
l'emploie encore aujourd'hui dans les mlodies des psau-
mes et dans le Magnificat. Dans le culte des protestants,
plusieurs plain-chants se chantent aussi dans ce mode.
oline. Instrument clavier et anches libres, cons-
truit en 1816 par Schlimbuch, facteur Ohrdruff.
olodion. Instrument construit Purth prs Nurem-
berg en
1821,
par Reich, sur les principes du phyhar-
monica clavier. Il avait six octaves et des timors va-
ris.
PI 193
phsies. Ftes clbres par les Grecs phse, ville
de l'Asie Mineure, en l'honneur de Diane. Des concours
de musique avaient lieu l'occasion de ces ftes, aux-
quelles, sous le rgne de l'empereur Yespasien, on en
joignit d'autres appeles Barbyliennes.
i^picDE. Nom d'une chanson funbre des Grecs.
piconion. Instrument des Grecs quarante cordes.
pilne. Danse accompagne de chant excute par
les Grecs en l'honneur de Bacchus, l'poque des ven-
danges.
pimlion. Nom grec de la chanson des meuniers.
Epinette. Sorte de petit clavecin dont on se servait
avant l'invention du piano.
Epinette. Espce de clavicorde, qui reut le nom d'-
pinette parce que l'on avait arm les sauteraux d'un petit
morceau de plume taill en pine. Cet instrument eut,
dans son origine, vingt-cinq touches conformment l'-
chelle de guide, sa forme tait carre ou trapzode.
Epinette archet (l'). Fut construite en 1743. Tin
sieur Renaud, natif d'Orlans
y
appliqua un archet sans
fin form d'un tissu de crin cousu sur une courroie. Les
touches par la pression faisaient baisser les cordes sur
l'archet.
h-pinette a marteau (l'}. Fut imagine en Angle-
terre, vers l'anne 1750. Cet instrument possdait six
rangs de sauteraux plumes et un rang de sauteraux
marteaux. Les sauteraux en plumes attaquaient la mme
corde des dislances diffrentes, ce qui changeait la qua-
lit du son. Cet instrument fut import en France
par un nomm Virbes.
Epinette a orchestre (l'). Con truite Paris en 1748,
tait un instrument runissant dans son corps deux vio-
lons, un alto, et un violoncelle, que des archets mus par
une pdale faisaient rsonner.
Epinette expressive (l'). Imagin en 1740 Greno-
ble, par Berger. L'essai de cet instrument soumis l'aca-
dmie reut son approbation.
pinicion. Chant de victoire par lequel on clbrait
chez les Grecs le triomphe du vainqueur.
Epiodie. Chanson funbre des Grecs.
pique. On appelle ainsi une composition musicale ne
prsentant qu'un tableau idal qui plait et charme, grce
sa forme rgulire et sa beaut absolue, sans qu'on
y
194 ESP
remarque quelque chose de bien dtermin qui excite
notre sympathie.
pisinaphe. Les Grecs appelaient ainsi la conjonction
de trois ttracordes conscutifs.
pisode. Sous le nom d'pisode, on dsigne commu-
nment ces sujets incidents qui font partie d'une compo-
sition musicale, sans cependant que leur existence soit
absolument ncessaire.
pithalame. Chant nuptial qui se chantait autrefois
la porte des nouveaux poux pour leur souhaiter une
heureuse union.
pitrite. C'tait, dans la musique grecque, ce rap-
port d'intervalle qu'on appelle aussi propositio sesqui-
tertia.
pogodus. Nom du rapport d'intervalle 9 : 8.
Eptacorde. Intervalle de septime. On appelle aussi
Epiacorde la lyre des anciens, monte de sept cordes.
quisonnange. C'est la consonnance de deux sons
semblables entre eux, comme l'octave, la double octave,
etc. L'quisonnance peut tre employe sans scrupule,
attendu que l'octave et la double octave produisent sou-
vent l'oreille la mme sensation que l'unisson.
Ermosmenon. Les Grecs indiquaient par ce mot le sens
moral de leurs morceaux de musique.
Ernst (Praiz Ant.). Luthier dont les instruments ont
eu de la rputation. Il travaillait Gotha en 1778.
rotidies. Ftes des Grecs en l'honneur de Cupidon,
clbres dans la ville de Thespie, en Botie. Elles avaient
lieu tous les cinq ans sur le mont Hlicon : on
y
assistait
des luttes musicales.
Espace. Intervalle blanc qui se trouve dans la partie
entre les cinq lignes.
Espagne. (De la musique en). Parmi les nations euro-
pennes, il n'en est point qui possde une plus belle
organisation musicale que le peuple espagnol. Cepen-
dant, quelque incontestable que soit son aptitude pour
la musique, l'Espagne est loin de rvaliser avec l'Italie,
l'Allemagne et la France, pour le nombre et le mrite
de ses compositeurs. Un concours de circonstances parti-
culires l'a empche d'acqurir, sous ce rapport, le d-
veloppement auquel ses heureuses facults lui permet-
taient d'arriver.
Ds les premiers temps du moyen-ge, la nation espa-
gnole cultiva la musique, et le fondateur de son cole est
ESP
195
Alphonse, roi de Castille, auquel ses peuples donnrent
le nom de Sage. Il fonda une cole de musique l'uni-
versit de Salamanque. Dans les xi
v
a
et xv
e
sicles, les
Espagnols eurent aussi leurs dcidores ou troubadours.
A la requte de Jean 1
er
,
roi d'Aragon, deux troubadours
furent envoys du collge de Toulouse Barcelone, o
ils fondrent une cole de musique qui subsista jusqu'
la mort de Martin, successeur de Jean. Le marquis de
Samt-Sulliane (vulgairement appel Santilana),
qui
crivit un Trait sur la posie castilane, vers
1440,
parle avec loge d'un compositeur nomm Don Jorge
Saint-Sorde, de Valence, qui vivait cette poque. Il cite
aussi plusieurs autres musiciens, quelques-uns parleurs
noms, et les autres pour leurs ouvrages ou les circons-
tances de leur vie.
Mais de tous les matres de l'harmonie espagnole, celui
qui se distingua le plus cette poque fut Franois
Salinas, n Burgos, et qui, quoique aveugle ds son
enfance, n'en devint pas moins le premier contrepointiste
de l'Espagne, et mme un des savants les plus distingus
et des littrateurs les plus remarquables de cette poque.
Salinas consacra trente annes de sa vie, la thorie de
la musique. Les ouvrages de Boce furent les principales
bases de ses travaux et de ses tudes. Mais comme on
apprend moins dans les livres des rudits que dans celui
de la nature, sa doctrine est moins praticable que spcu-
lative, et souvent elle manque de prcision et de clart.
Cristofo Morales rivalisa avec Salinas, moins pour le
mrite de ses ouvrages didactiques que par l'clat de son
talent comme compositeur. Sous ce dernier rapport, il
fit faire des progrs remarquables la musique espagnole
pendant le quinzime sicle. Son motet, Lamentabar
Jacob, religieusement conserv dans les archives de la
chapelle pontificale, Rome, est chant chaque anne
dans une des plus grandes solennits de l'glise.
Le meilleur harmoniste aprs lui fut Louis Vittoria,
auteur de motets trs-estims : il en composa pour cha-
cune des ftes de l'anne. Les messes dont il est l'auteur
ne sont pas moins belles, et l'on remarque surtout celle
appele Mtssa di Morti, excute longtemps Rome,
ainsi que ses Psaumes del pnitence.
Au seizime sicle, l'Espagne fut fertile en grands
musiciens, dont quelques-uns rivalisent avec les plus
brillantes illustrations des coles flamande et italienne.
196 ESP
C'est aussi cette poque que la musique dramatique
commena tre cultive dans la pninsule ibrique
;
mais elle n'y jeta pas un grand clat. Le peu d'encoura-
gement donn par le gouvernement aux compositeurs
dramatiques est la principale cause de l'intriorit du
peuple espagnol sous ce rapport.
Mais en revanche
la musique religieuse prit, au seizime sicle, de beaux
dveloppements, grce aux riches dotations qu'elle reut
du clerg et de particuliers opulents. Charles Patigno,
Juan Noldan, Vincenzo Garcia, Mathias-Juan Viana,
Franois Gherrero, don Joseph Nebra, ont laiss des
messes, des motets, des cantates d'une grande beaut.
Plusieurs de ces artistes ne lurent pas seulement des
compositeurs remarquables, ils furent aussi des chan-
teurs minents, de trs-habiles instrumentistes, et quel-
ques-uns furent employs la chapelle du pape, h
Rome.
Mais une fois arrive ce haut point de splendeur, l'Es-
pagne dchut rapidement. Cependant, malgr sa dca-
dence, l'art espagnol conserve encore quelques vestiges
de son antique beaut. Qui ne connat, au moins par
quelques fragments, ces chansons populaires, empreintes
de la posie des traditions locales, ces copias, ces sara-
bandas, o. se montre toute la gaiet du caractre espa-
gnol! Qui ne connat ces fandangos, ces bolros, ces se-
guidillas qui se dansent et se chantent encore avec ac-
compagnement de guitares et de castagnettes ! C'est dans
ces chansons et ces danses populaires que se rvle d'une
manire remarquable le gnie espagnol.
La guitare est l'instrument favori de ce peuple. On
peut mme dire que jusqu' ces derniers temps c'est
peu prs le seul qu'il ait cultiv. Cependant les autres
organes de l'harmonie commencent se rpandre en Es-
pagne, mais seulement dans les hautes classes de la so-
cit. Quant au peuple, son plus grand bonheur est de
jouer de la guitare, et quand un artisan a fini sa journe,
il se rend sur la place publique, et se dlasse de son tra-
vail en jouant sur cet instrument des bolros et des se-
gudillas.
Qui sait quels magnifiques rsultats l'Es-
pagne pourrait arriver, si un gouvernement ami des arts
s'appliquait dvelopper et diriger le got passionn
qu'prouve le peuple espagnol pour les jouissances de
l'art musical. Si les dons de la nature taient fconds
par les bienfaits de l'ducation, nous n'en doutons pas,
EUM J97
]e gnie de l'antique lbrie aurait un glorieux rveil, et
sa musique subirait une brillante mtamorphose.
L'Espagne a perdu, il
y
a quelques annes, un com-
positeur d'un mrite distingu, qui promettait de tirer
la musique dramatique de l'tat de dcadence o elle est
tombe dans son pays, Gomis a pass quelque temps
Paris, et tous ceux qui l'on connu savent quel composi-
teur minent l'Espagne aurait eu en lui, si la mort n'-
tait venue l'enlever tout coup dans la force de l'ge et
dans toute la maturit du talent. A l'exemple de la
France, l'Espagne a fond plusieurs journaux de musi-
que, qui doivent contribuer la vulgarisation de cet art,
dans ce pays labour par les rvolutions politiques.
Esthtique. L'esthtique a pour objet la doctrine du
beau, du sublime, du got et du jugement dans les arts:
elle est exactement la philosophie des arts.
Estribilho. Chanson favorite des Portugais, en me-
sure de
6/8.
tendue. C'est la distance plus ou moins consid-
rable qu'il
y
a entre le son le plus grave et le plus aigu,
ou la somme de tous les sons propres une voix ou un
instrument, compris entre les deux extrmes.
touffer. Se dit des sons que l'on rend moins cla-
tants.
touffoir. Petites pices de drap qui servent dans
un piano amortir les sons donns par le marteau frap-
pant sur les cordes.
tude. Action de familiariser sa voix ou ses doigts
avec les difficults d'un morceau de chant ou d'instru-
mentation qu'on veut excuter. Qui sait tudier, sait ap-
prendre; il ne s'agit pas tant d'tudier longtemps que
de bien tudier. L'tude consiste dchiffrer d'abord,
puis s'efforcer de rendre exactement le mouvement, les
nuances, l'expression d'un morceau. Pour un lve in-
telligent l'tude vaut la leon. Le matre lui donne la
clef de la science; l'tude lui donne l'habitude de se
servir de cette clef pour ouvrir toutes les portes de ]a
musique.
On appelle tudes un recueil ou ensemble
d'exercices progressifs sur chacune des principales diffi-
cults du mcanisme de l'excution vocale ou instrumen-
tale. Plusieurs grands matres ont consacr leurs loisirs
ce travail si ingrat et si utile.
Eumatia. Espce d'harmonica de verre qui avait deux
7.
193 EXG
octaves avec les demi-tons. Il fut construit vers la fin
du sicle dernier.
Eumlia. lgance de toutes les parties chantantes.
Eunides. Compagnie de musiciens qui jouaient d'une
espce de luth, Athnes, l'occasion des sacrifices.
Euphone. Instrument frottement, du genre de l'har-
monica, invent par le docteur Chladni, Witthemberg,
en 1790. Il consiste en une caisse carre d'environ un
mtre et haute de trente centimtres, qui contenait qua-
rante-deux petits cylindres de verre, dont le frottement,
et par suite la vibration s'oprait par un mcanisme in-
trieur.
Euphonicon. Instrument imagin Londres en 1842,
par Bele, associ de la maison Cramer. Il runissait les
qualit de la harpe et du piano.
Euphonicon est ga-
lement le nom donn par Valiez, en
1850, une espce
d'orgue lames vibrantes.
Euphonium. Instrument en cuivre, espce d'octav-
ophiclide avec ventelle, long de trois mtres, construit
par Serveny's, en 1843.
On donne aussi ce nom un instrument lames vi-
brantes imagin, par Valiez en 1850.
Euphotine. Instrument imagin, en
1852,
par Petit.
Il tait compos d'une srie de diapasons de diffrentes
grandeurs, mis en jeu par un clavier et une soufflerie.
Eurythmie. C'est le bel ordre, la belle proportion des
parties homonymes qui composent un tout; et symtrie,
c'est l'galit et le rapport intelligible de ces mmes
parties.
Euterpe. Celle des neuf muses qui prside la mu-
sique.
viter. viter une cadence, c'est ajouter une disso-
nance l'accord final pour prolonger la phrase. Dans
l'cole, on appelle surtout cadence vite, la chute d'une
septime dominante sur une autre septime dominante.
volution. Renversement des parties dans les di-
verses espces de contrepoints doubles.
Exception. On connat cet ancien adage : Toute rgle
a ses exceptions. Nanmoins il semble que ce proverbe
se confirme plus particulirement lorsqu'il s'agit de r-
gles musicales tablies par les anciens et mme par les
modernes sur le contrepoint et sur les progressions har-
moniques. Le P. Martini, dans son Saggio fondamen-
tale pratico di contrapunto sopra il canto fermo,
aprs
EXE 199
avoir tabli les rgles de ce style, n'hsite pas dire que
les exceptions employes en temps et lieu sont le plus bel
ornement de l'art.
Excutant. Musicien qui excute la musique l'glise,
au concert ou au thtre, comme chanteur ou comme
instrumentiste.
Excuter. Excuter une pice de musique, c'est chan-
ter et jouer toutes les parties qu'elle contient, tant vo-
cales qu'instrumentales, dans l'ensemble qu'elles doivent
avoir, et la rendre telle qu'elle est note sur la partition.
Excution. L'action d'excuter une pice de musique.
L'excution de la musique a non-seulement une grande
influence sur son succs
;
mais, comme la musique n'existe
rellement pour le plus grand nombre des auditeurs que
lorsqu'elle est excute, l'excuter mal ou contre-sens,
c'est non-seulement la dfigurer, mais l'anantir.
Si le compositeur est la merci de l'ignorance ou du
mauvais vouloir des excutants, il l'est aussi de leur faux
savoir et de leur mauvais got. Ce qu'ils ajouteraient
ce qu'il a crit serait quelquefois plus pernicieux que ce
qu'ilsypourraient omettre. Ce qu'ils omettront toujours,
s'ils ne sont que des gens du mtier, et non de vritables
artistes, c'est l'expression propre de chaque morceau,
et pour ainsi dire l'accent de chaque passage. L o ils
ne verront que des notes, ce ne seront aussi que des notes
qu'ils feront entendre; et tel air, tel duo, tel morceau
d'ensemble, ou telle pice de musique instrumentale, de-
vait toucher profondment le cur, qui, grce une ex-
cution froide et inanime, ne fera qu'effleurer inutile-
ment l'oreille.
On appelle encore excution, la facilit de lire et d'ex-
cuter une partie vocale et instrumentale, et l'on dit qu'un
musicien a beaucoup d'excution lorsqu'il excute correc-
tement, sans hsiter et la premire vue les choses les
plus difficiles.
On dit aussi qu'un artiste, instrumentiste ou chanteur,
a beaucoup d'excution lorsqu'il excute facilement les
difficults.
Exercices. Pices de musique composes sur un trait
difficile pour la voix, ou une manire de doigter parti-
culire et scabreuse pour les instruments, que l'on essaie
sur tous les degrs de l'chelle et sur toutes les positions,
en suivant diverses modulations. Les exercices n'tant
destins qu' familiariser l'lve avec les difficults qu'il
200
EXP
rencontrera dans les uvres des matres fameux, on ne
s'attache nullement les rendre agrables pour l'oreille.
Exharmonique. C'tait, chez les anciens Grecs, une
mlodie faible et insipide.
Expression. C'est la posie de la musique. C'est ce
qui donne une uvre ce caractre de vrit et d'ner-
gie dont l'attrait irrsistible survit toutes les variations
du got, tous les caprices de la mode et qu'on remarque
dans les productions des grands compositeurs du sicle
dernier et de notre poque, notamment de Gluck, de
Mozart, de Rossini, de Spontini, de Mhul, de Meyer-
beer, d'Auber, d'Halvy, d'Adam, de Gounod, de Fli-
icien David, d'Ambroise Thomas, de Donizetti, de Ricci,
de Verdi.
L'essor donn de nos jours l'expression musicale l'a
malheureusement porte quelquefois un degr d'exag-
ration qui passe toute limite. Qu'on le sache bien, la v-
ritable inspiration ne procde pas par des cris forcens,
par une instrumentation bruyante : sans doute, il est
des situations o l'orchestre doit dployer toutes ses
ressources, la voix humaine toute sa puissance, et les
passions leurs transports les plus fougueux. Mais le
drame lyrique serait en dehors de la nature et de la v-
rit, si les effets taient prodigus sans discernement et
sans mesure; pour frapper fort, il faut que le composi-
teur frappe juste
;
c'est--dire que la musique soit tou-
jours en harmonie avec la situation. On peut surprendre
le public par un luxe prodigieux d'instrumentation et
d'effets, mais on ne l'meut, on ne le captive, on ne l'in-
tresse rellement que par une expression vraie, juste et
naturelle. Aprs la protestation nergique des hommes
comptents, vient le dgot gnral qui fait promptement
justice de tout ce qui est faux ou exagr.
Il
y
a une expression de composition et une d'excu-
tion, et c'est de leur concours que rsulte l'effet musical
le plus puissant et le plus agrable.
Pour donner de l'expression ses ouvrages, le compo-
siteur doit saisir et comparer tous les rapports qui peu-
vent se trouver entre les traits de son objet et les pro-
ductions de son art; il doit connatre ou sentir
l'effet de tous les caractres, afin de porter exactement
celui qu'il choisit au degr qui lui convient. Comme un
bon peintre ne donne pas la mme lumire tous ses
objets, l'habile musicien ne donnera pas non plus la
FAU 201
mme nergie tous ses sentiments, ni la mme fore
tous ses tableaux; il placera chaque partie au lieu qui
lui convient, moins pour la faire valoir seule que pour
donner un plus grand effet au tout.
Quant l'expression vocale, il
y
a des voix fortes qui
imposent par leur ampleur, d'autres, sensibles et dli-
cates, vont au cur par des chants doux et pathtiques.
En gnral, les voix leves sont plus propres exprimer
la tendresse et la douceur; les basses et les concordants
interprtent mieux l'emportement et la colre.
Les instruments ont aussi des expressions trs-diff-
rentes, selon que le son en est faible ou fort, que le tim-
bre en est aigre ou doux, que le diapason en est grave ou
aigu et qu'on en peut tirer des sons en plus grande ou en
moindre quantit. La flte est douce, la clarinette d'une
noble tendresse, le hautbois naf et pastoral, la trompette
guerrire, le cor sonore et mlancolique, le trombone
solennel, majestueux et propre aux grandes expres-
sions, etc. Mais il n'y a point d'instrument dont on tire
une expression plus varie et plus universelle que le
violon.
Extension. Facult relative d'allonger les doigts sur
le manche ou sur le clavierdes instruments, pour
y
saisir
de grands intervalles. L'exercice dveloppe cette fa-
cult.
F
F. Cette lettre a deux significations en musique :
1
elle reprsente le son sur le quatrime degr de l'-
chelle diatonique du ton d'ut, c'est--dire la note
fa
;
2
elle est l'abrviation du mot forte (fort).
Fa. Quatrime note de l'chelle en ut. Dans l'alphabet,
elle correspond la lettre F.
Fa la. Mot compos des noms de deux notes, et que
l'on donne, en Angleterre, de petits airs avec un es-
pce de refrain, o le nom de ces deux notes est rpt
d
:
une manire
insignifiante et bizarre, comme
fa,
la,
la,
la,
fa,
la, la, la.
202
FAG
Fa ut. C'tait dans l'ancien solfge, le
fa.
clef de basse,
quatrime ligne, sur lequel on chantait, tantt la syllabe
/a, tantt la syllabe ut.
Face. Combinaison, ou des sons d'un accord en com-
menant par un de ces sons, et en prenant les autres selon
leur suite naturelle, ou des touches du clavier qui for-
ment le mme accord. D'o il suit qu'un accord peut
avoir autant de faces qu'il
y
a de sons qui les composent,
car chacun peut tre le premier son tour.
Facile. On appelle composition facile celle dont l'ex-
cution ne rclame pas un haut degr d'habilet artifi-
cielle. Quelquefois on emploie aussi le mot facile par op-
position ce qui est d'une grande importance, et l'on
entend alors une composition faite sans aucune prten-
tion.
Facteurs d'instruments. On dsigne particulire-
ment sous ce nom, les fabricants de pianos, d'orgues et
de harpes. Ceux qui font des violons, des altos, des vio-
loncelles, des contre-basses, des guitares, ont conserv
le nom de luthiers, parce qu'autrefois le luth tait l'ins-
trument la mode. Il
y
a des fabricants spciaux pour
les instruments en bois, tels que hautbois, clarinettes,
bassons, fltes, flageolets, etc.
;
d'autres, pour les ins-
truments en cuivre, tels que trompettes, cors, trom-
bones.
Au seizime sicle, les facteurs d'instruments de mu-
sique furent runis en corps de jurande, et le roi leur
donna des statuts qui ont t imprims. Avant cette
poque, ils ne pouvaient employer pour la fabrication
des instruments que l'tain, le cuivre et le bois. S'ils se
servaient d'argent ou d'or, ils taient querells par les
orfvres
;
s'ils se servaient de nacre ou de bois colori,
ils taient querells parles tabletiers.
Facture. Ce mot exprime la manire dont un mor-
ceau de musique est compos. Il s'entend de la conduite
et de la disposition du chant, comme de celle de l'har-
monie. La facture d'une pice de musique, par rapport
au chant, exprime l'art avec lequel les motifs bien
choisis sont enchans entre eux, ramens propos
dans une tendue convenable. Par rapport l'har-
monie, ce mot exprime l'enchanement heureux et
savant des modulations, l'emploi des accords les plus
inattendus prsents sans duret. Les churs des orato-
FAN
203
riosde Haende!
;
de a Cration, de Haydn
;
des Requiem,
de Mozart et de Chrubin i : les churs de Guillaume
Tell, de Robert le Diable, de la Juive
;
le septuor d'Her-
nani le quatuor de Rigoletto, le final (XHamlet sont
d'une belle facture. C'est aussi le mrite des ouvertures
de Freyschutz, de la Flte enchante surtout,
et des
symphonies de Haydn, de Mozart, de Beethoven.
Ffa (A). Danse portugaise qui ressemble au fan-
dango. (Voir A chula.)
Fagotto. Ce mot, qui drive du latin fascie (faisceau),
dsigne l'assemblage de plusieurs choses lies ou runies
ensemble
;
et c'est probablement par cette raison que les
Italiens ont donn ce nom au basson, cause de la res-
semblance qu'ont les parties de cet instrument avec un
fagot, lorsqu'elles sont dmontes. (Voyez Basson).
Fagottons, Contre-basson. Instrument vent et
anche du genre du basson, et qui, par ses dimensions,
sonne l'octave infrieure du basson. Il est au hautbois,
ce que le violoncellb est au violon.
Faire. Manire et style du compositeur.
Fandango. Air de danse trois temps, d'un mouve-
ment assez vif. C'est l'air favori des Espagnols. Ni les
pyrrhiques voluptueuses tant courrues des Homains, ni
ces danses des Saliens tant clbres par Denis d'Hali-
carnasse, n'approchrent jamais du fandango espagnol.
Mais, pour qu'il plaise, il faut que le fandango soit bien
dans, bien excut
;
que la tte, les pieds, les bras, le
corps de la danseuse se meuvent d'ensemble. Les Espa-
gnols racontent, au sujet du fandango l'anecdote sui-
vante : La cour de Rome, scandalise de voir une nation,
cite pour la puret de sa foi, tolrer une danse aussi
voluptueuse, rsolut de la proscrire, sous peine d'excom-
munication. Les cardinaux s'assemblent, le procs du fan-
dango s'instruit
;
la sentence va tre mise aux voix, quand
un des juges observe qu'on ne doit pas condamner un
coupable sans l'entendre. L'observation paratjuste, elle
est accueillie.
On fait comparatre devant l'assemble un couple espa-
gnol arm de castagnettes, et on le somme de dployer en
plein tribunal toutes les grces du fandango. La svrit
des juges n'y tient pas, les fronts se drident, les visages
s'panouissent. Leurs minences se lvent
;
des pieds,
des mains, elles battent la mesure. La salle du Consis-
toire se change en salle de bal, et le fandango est absous.
204 FAN
On a fait de cette aventure un fort joli vaudeville qui fait-
fureur, chaque fois qu'on le joue, au-del des Pyrnes.
Fanfare. Mot dont l'tymologie est reste mal clair-
cie, et que des crivains ont suppos avoir t produit
par harmonie imitative, pour exprimer un brillant effet
d'instruments de cuivre. On a employ le verbe
fanfa-
rer, pour signifier donner de la trompe, gambader. Le
mot nous vient des Espagnols, et peut-tre des Maures.
Les fanfares, prises dans le sens de concerts militaires,
s'appliquaient la marche des comparses dans les car-
rousels et les tournois; elles s'appliquaient aussi, depuis
l'ordonnance du 1
er
mars 1768, certains signaux de ca-
valerie. Aujourd'hui, c'est un genre d'effet musical
connu de la cavalerie et de l'infanterie, et qui diffre des
sonneries d'ordonnance. Celles-ci sont d'invariables mor-
ceaux que le cuivre fait entendre sans le secours d'une
clef. Les fanfares sont des airs variables, capricieux, de
circonstance, que produisent dans l'infanterie les clairons
clef, et que produisent dans la cavalerie les bugles
clef, les cors, les ophiclides, les trombones, les trom-
pettes. Aujourd'hui, ce mot fanfare s'applique plus sp-
cialement aux musiques de cavalerie, composes unique-
ment d'instruments de cuivre. Fanfare se dit aussi en
terme de chasse, de l'air qu'on sonne au lancer du
cerf.
Fantaisie. Les grands matres, tel que Bach et Mo-
zart, ont eu recours la fantaisie pour ouvrir un champ
plus vaste la* fcondit de leur gnie, et trouver
ainsi le moyen d'employer une infinit de recherches
harmoniques, de modulations savantes et hardies, de
passages pleins de fougue et d'audace, qu'il ne leur tait
pas permis d'introduire dans une pice rgulire. Telle
tait la fantaisie entre les mains de ces compositeurs il-
lustres. Elle a bien dgnr depuis. Ce n'est plus main-
tenant que la paraphrase d'un air connu, d'un refrain
qui court les rues, que l'on varie de toutes les manires.
Ce genre, que l'absence du talent et l'impuissance de
crer une bonne pice, originale, ont pu seule mettre en
crdit pendant quelque temps, est aujourd'hui peu
cultiv par les compositeurs clbres.
Parmi les fantaisies les plus remarquables, nous de-
vons citer particulirement celles mises la mode par
Steibelt, qui publia, vers 1815, sa fameuse fantaisie sur
les airs de la Flte enchante, Peu de morceaux de
FAR 205
piano ont obtenu un pareil succs. Le mme composi-
teur en crivit d'autres sur le mme modle
;
cent pia-
nistes se jetrent dans cette carrire, et tous les di-
teurs de musique voulurent avoir des fantaisies.
Depuis cette poque, l'ancienne, la belle fantaisie de
Bach et de Mozart a reparu avec la brillante parure que
l'art moderne peut lui donner.
On entend par musique de fantaisie celle o. se trouve
un grand nombre d'ides et de cantilnes qui sont pr-
sentes sous des formes nouvelles, avec des combinai-
sons inusites, et faisant un emploi particulier des ins-
truments. Dans cette musique on voitquel'esprit du com-
positeur agit avec une grande libert, eten quelque sorte
selon sa fantaisie.
Fantastique (musique). On appelle musique fantasti-
que celle qui est applique des sujets o sont mis en
jeu des tres de l'ordre surnaturel. On trouve des mod-
les de ce genre de musique dans le Don Giovanni, de Mo-
zart, le Freyschutz eiYObron, de Weber, le troisime
acte de Robert, de Meyerbeer, le quatrime acte de
Charles VI, d'Halevy, le Faust, de Berlioz, le Macbeth,
de Verdi, et YHamlet, d'Ambroise Thomas.
Farandole. Espce de danse excute sur un allegro
six huit par un grand nombre de personnes en formant
une longue chane l'aide de mouchoirs, que chaque
maintient droite et gauche, except cependant celles
qui se trouvent aux extrmits, La farandole se com-
pose de vingt, de soixante, de cent personnes pla-
ces, autant qu'il est possible, une de chaque sexe alter-
nativement. Cette chane se met en mouvement, parcourt
la ville ou la campagne au son des instruments, et re-
crute des danseurs partout o elle passe. Chacun danse,
ou saute de son mieux en cadence. On ne se pique pas
de mettre une grande rgularit dans les pas
;
mais on
a soin de former avec exactitude les diffrentes figures
que commande celui qui est en tte de la farandole, et
qui lui sert de guide. Ces figures consistent principale-
ment runir les bouts de la chane et danser en rond,
la pelotonner en spirate, a la faire passer et repasser
dans une espce d'arc form par plusieurs danseurs qui
lvent les bras, sans abandonner les mouchoirs.
La farandole n'est en usage que dans la Provence et
une partie du Languedoc. Elle a lieu la suite des ncces
et des baptmes et dans les rjouissances publiques.
206 PET
Farce en musique. Sorte de petit opra bouffe en un
acte, en usage en Italie.
Farcia, Epistola cum Farcia. Les pitres avec
farce
taient des cantiques ou des complaintes en langue vul-
gaire, entremls de latin, dont on introduisit l'usage
dans les glises de France, lorsque le peuple commena
perdre l'intelligence de lalangue latine. On les chantait
dans les glises auxprincipales ftes de l'anne.
Fascies Eclisses. Petites planches minces sur les-
quelles reposent les tables des violons, des basses, des
guitares.
Fausser. Chanter faux ou jouer faux d'un instru-
ment.
Fausset. C'est cette espce de voix surlaryngienne,
appele plus exactement voix de tte, qu'un homme fait
entendre lorsque sortant l'aigu du diapason de sa voix
naturelle, il imite celle de la femme. (Voir l'art. Voix.)
Faux. On donne cette pithte, qui est oppose ajuste :
4
une voix qui entonne ou trop haut ou trop bas l'-
gard des autres sons
;
2
une corde qui produit de
mauvaises oscillations
;
3
une mauvaise relation
;
4
l'accord des cordes d'un instrument ou des tuyaux d'or-
gue qui ne correspond pas l'accord des autres instru-
ments.
Faux-Bourdon. Dsigne :
1
une musique plusieurs
parties, mais simple et sans mesure, dont les notes sont
presque toutes gales et dont l'harmonie est toujours
syllabique
;
2
un chant o l'on mettait au-dessous d'une
maxime, c'est--dire d'une note de huit mesures, plu-
sieurs syllabes, et rarement des dissonances
;
3
un
genre de composition sur le plain-chant, o le chant
tait excut par une voix du mdium, ordinairement
par le tnor, avec un contrepoint figur chant par les
autres voix.
Feinte. Altration d'une note ou d'un intervalle par
un dize ou un bmol. C'est le nom commun et gnri-
que du dize et du bmol accidentel.
Fte de sainte Ccile. Sainte Ccile cultivait la mu-
sique et s'accompagnait des instruments en chantant les
louanges du Seigneur. C'est cause de cela que les mu-
siciens l'ont choisie pour leur patronne. Le pote San-
teuil a compos trois belles hymnes pour le jour de la
fte de cette sainte, quia lieu le 22 novembre.
FIG 207
Ftes des trompettes. On croit gnralement que
cette fle, dont parle le chap. xxix du livre IV de Mose,
a t institue par les Hbreux pour la solennisation de
la rcolte.
Feu. Vivacit, chaleur, verve d'une composition mu-
sicale.
Fiasco (faire). C'est chouer compltement comme
compositeur ou comme excutant.
Fifre. Instrument de musique militaire, emprunt
des Suisses, et dont le nom est originaire de la langue
allemande. Le fifre est une petite flte traversire per-
ce de six trous. Elle a t en usage dans l'infanterie
franaise, partir de Louis XIII. Les dragons et les
mousquetaires s'en sont servis depuis leur cration jus-
qu' l'poque o ils ont renonc au tambour. Quant
l'infanterie, elle a tour tour abandonn et repris le
fifre selon que l'ont voulu les rglements et la mode. Il
ne s'en est vu depuis les guerres de la rvolution que
dans quelques corps, et seulement par le fait du caprice
des colonels. Ainsi, il
y
en a eu dans la garde du Direc-
toire et des Consuls, dans lagarde impriale et dans celle
de Paris, dans les Cent-Suisses, etc.
Pendant longtemps cette petite flte, comparable
l'ancien galoubet quant l'usage, sinon quant la forme,
a t musicalement le dessus du tambour. Le mot fifre
dsigne la fois l'instrument jou et l'homme qui le
joue. Si on prend le terme dans la premire acception,
et comme objet inanim, il a t synonyme de arigot
;
si on le conoit comme un tre anim, il est synonyme
de pifre. 11 a produit, en souvenir de l'intemprance des
musiciens, le verbe populaire s'empiffrer, et la triviale
locution hoire tire-l'arigot.
Figure courte. On appelait autrefois figure courte
toute figure compose de trois notes
;
dont l'une valait
autant que les deux autres. La note la plus longue pou-
vait tre au commencement, au milieu, ou la fin de la
figure.
Figur. Se dit d'une partie o se trouve une figure
particulire de notes dominantes. On appelle contre-point
figur celui dans lequel on emploie plusieurs figures de
notes, tandis que le chant donn ne fait entendre qu'une
seule note.
Figur (contre-point). Ou fleuri, celui o les diverses
208 FiN
parties procdent par des valeurs et par des rhythmes
diffrents.
Figur (Trait). Trait dans lequel on fait passer, par
marche diatonique, d'autres notes que celles de l'accord
actuel.
Figure (Basse). Basses dont les notes portant accord
sont subdivises en plusieurs autres notes de moindres
valeurs.
Figure (Harmonie). Celle o l'on fait passer plusieurs
notes sur un accord.
Figures de musique. On donne ce nom aux notes de
diffrente valeur dont il sera question l'article notes,
aux silences et gnralement tous les signes employs
dans l'criture musicale.
Filer un son. C'est le prolonger aussi longtemps que
l'haleine peut le permettre, en observant de commencer
pianissimo, de l'enfler insensiblement jusqu'au forte, et
de le diminuer avec les mmes gradations.
Fin. Ce mot se met ordinairement la fin d'une p-
riode que l'on doit recommencer plus tard, pour indiquer
l'endroit o il faudra s'arrter.
Finale. Les airs, les duos ouvrent bian un opra, et
figurent ensuite avec avantage dans les premires
scnes de chaque acte. Mais lorsque les rcits de l'expo-
sition ont tout expliquent que l'intrigue, marchant avec
rapidit, tend s'embrouiller
;
lorsque le nud de la
pice va se former ou se dnouer, et que tous les res-
sorts mis en jeu pour
y
parvenir amnent des incidents
qui changent les situations, et font refluer vers la fin de
l'acte les grands tableaux, les effets produits par l'ex-
pression du contentement, de l'ivresse, de la tristesse, de
la fureur, du tumulte et du dsordre
;
lorsque le moin-
dre rcit frappe tellement les personnages dont l'agita-
tation est au comble, qu'ils ne peuvent l'entendre sans
manifester soudain leurs sentiments; lorsque l'action et
les passions occupent tour tour la scne, et des inter-
valles si rapprochs qu'on ne saurait passer subitement
du chant au rcitatif ou au dialogue parl, pour reve-
nir ensuite la mlodie, le compositeur traite toute cette
fin d'acte en chant proprement dit, lie les scnes les unes
aux autres, et fait une suite non interrompue d'airs, de
duos, de trios, de quatuors, de quintettes, de sextuors
de churs mme, en observant d'crire en chant vocal
tout ce qui exprime les passions, rservant la dclama-
FLA 209
tion mesure
qui s'unit aux traits d'orchestre et le rci-
tatif pour le dialogue en action et pour les rcits. Ce mor-
ceau de musique, le plus long que la scne lyrique puisse
nous
offrir, s'appelle finale.
C'est Logroscino, composi-
teur, qui florissait du temps de Pergolse, qui en fut
l'inventeur.
Paisiello est le premier qui l'ait introduit
dans l'opra srieux.
Fioritures. Mot italien francis, qui signifie orne-
ments du chant, et que les anciens appelaient doubles
diminutions.
Fistula elvetica. Ancien nom delafltetraversire.
Fistula panis C'est le mme instrument que les an-
ciens Grecs appelaient syrinx.
Flageolet. Petit instrument vent, de bois, d'ivoire,
de toute sorte de bois dur, qui a un bec par lequel on
l'embouche. On varie les sons du flageolet au moyen des
six trous dont il est perc, outre l'embouchure, la lu-
mire, et celui de la patte ou d'en bas.
C'est aussi un des jeux de l'orgue. Le tuyau est aussi
large que ceux d'toffe. Il est d'tain fin et ouvert. Le
flageolet est ce qu'on appelle un jeu de bouche ou de
mutation.
De flageolet,
qu'ils appelaient
flageol,
nos aeux for-
mrent le verbe flageoler
(jouer du flageolet). Ce mot si-
gnifiait aussi mentir, railler, faire des contes, conter des
sornettes, flatter, flagorner.
Flageolet double. Fut construit Londres en 1810,
par Bainbridge, qui prit un brevet en France pour cet
instrument en 1816. Letort. de Limoges, en
1825,
adapta au flageolet une clef, qui baissait la note d'un
demi -ton.
Flandre (De la musique en). La Flandre se glorifie
avec raison de possder l'cole musicale la plus ancienne.
Les plus remarquables contrepointistes des quatorzime
et quinzime sicles taient Flamands. Cette anciennet
d'cole a dtermin plusieurs auteurs dire que les Fla-
mands ont t les premiers matres qui aient appris la
musique aux autres peuples de l'Europe. Cette assertion
cependant ne saurait tre admise sans restriction.
Les chefs de l'cole flamande sont : Jacob Obrecht,
Jean Ockeneim, et Josquin, le plus remarquable de tous,
qui tait gnralement appel princeps musicorum, le
prince des musiciens.
210
FLU
Jean Ockeneim se fit particulirement admirer par une
messe trente-six voix avec des motets et des canons.
Toute cette composition tait cependant l'onde sur le
calcul, et presque entirement dpourvue de chant. Jos-
quin est le plus grand compositeur de son sicle. Il est
considr comme le pre de
l'harmonie moderne, et non-
seulement il crivit beaucoup d'ouvrages, cent ans avant
Palestrina, mais encore ses compositions sont plus ori-
ginales, plus nergiques et plus chantantes que celles de
ses
prdcesseurs.
Les compositeurs
flamands les plus remarquables
du
seizime sicle sont : Nicolas Combert, lve de Josquin,
qui se distingua
beaucoup dans la composition des
fugues; Cornlius Canis, Harnold de Prug, Adrien
Vilart, Sbastien
Hollander. Au dix-septime sicle pa-
rut le clbre
Jean Tinctor, qui donna une vive impul-
sion la musique de son pays et de l'Europe entire.
Depuis ce temps, l'cole flamande a cess de produire
de grands musiciens; cependant dans les villes princi-
pales, on cultive la musique avec succs. Amsterdam
possde une Socit
philharmonique, un Opra hollandais
et un Opra franais. A Rotterdam, les concerts sont
bien composs et ont de nombreux souscripteurs. On
y
trouve aussi plusieurs bons chanteurs et des instrumen-
tistes habiles.
Enfin, dans toutes les villes de la Flandre,
l'on aime et l'on cultive l'art musical.
Flatter la corde d'un instrument, c'est la toucher
doucement, avec dlicatesse.
Flautino. Mot italien qui signifie petite flte. Il sonne
une octave plus haut que la flte ordinaire. (Voyez
Flte (petite.)
Flat. Nom anglais du bmol.
Flexibilit. Se dit, dans le chant, de cette espce
d'lasticit et
d'ondulation moelleuse qu'une voix doit
avoir pour augmenter ou diminuer, sans le moindre
effort, l'intensit des sons. On dit aussi d'un instrumen-
tiste qu'il a de la flexibilit dans les doigts.
Florentius.
Luthier dont les instruments ont eu
assez de vogue,
travailla Boulogne, de 1685 1715.
Fluide.
Qualit d'une composition o le jeu des sen-
timents
prsente sans cesse une marche douce et paisible.
On dit qu'une harmonie est fluide, lorsqu'elle est par-
faitement
claire, coulante et en quelque sorte limpide.
FLU
211
Flte. Instrument vent
;
son origine se perd dans
la nuit des temps. Qu'elle soit due au hasard, comme le
prtendent les potes, ou qu'on en soit redevable l'in-
dustrie humaine, c'est ce qu'il est impossible de vrifier.
Toujours est-il que l'usage de cet instrument remonte
la plus haute antiquit, et que c'est celui qui a t le
plus gnralement connu de tous les peuples de la terre.
Il appartient quatre poques bien distinctes.
Premire poque. Flte primitive ou flte de Pan. Sa
forme fut d'abord de sept tuyaux de roseaux d'ingale
longueur. Ces tuyaux taient joints ensemble par de la
cire. Ce nombre sept ne parat point avoir t arbitraire.
11 se rapportait celui des sept corps clestes, connus
sous le nom de plantes. Aussi, bien que cet instrument
ft celui dont le dieu Pan faisait usage, il n'en tait pas
moins ddi Apollon ou au Soleil, comme modrateur
de ces sept corps clestes. C'est du moins l'opinion de
Plutarque. Plus tard, on substitua ce simple et rusti-
que assemblage de roseaux, la flte un seul tuyau, soit
qu'elle ft tout d'une pice, ou de plusieurs corps joints
l'un l'autre, comme nos fltes modernes. C'est ici que
commence la deuxime poque.
Deuxime poque. Flte antique. On employa d'abord
la confection de cette flte les os de biche, apparem-
ment le tibia, de mme que celui de l'ne
;
11
y
en avait
aussi en mtal. Nanmoins, on ne tarda pas substituer
a ces matires, difficiles mettre en uvre, le bois jug
plus facile. Dans le principe, la flte fut simple, perce
de peu de trous. Varron assure qu'ils taient au nombre
de quatre seulement. Ovide, dans ses Fastes, nous ap-
prend que le bois dont on se servait tait le buis. 11 sem-
blerait, d'aprs les anciens eux-mmes, que cet instru-
ment n'tait rien moins que pastoral
;
car nous voyons
que les joueurs de flte, aux jeux pythiques, s'ver-
tuaient imiter les aigres sifflements du serpent Python.
Troisime poque. Flte du moyen-ge. Son organi-
sation actuelle ne remonte pas trs-haut. Nous voyons
dans Rabelais, au seizime sicle, que Gargantua jouait
de la flte d'Alleman neuf trous. Si les petites clefs
qu'on a inventes depuis pour amliorer l'instrument
avaient t en usage, le cur de Meudon n'et pas man-
qu de les mentionner. Ainsi, l'heureuse et ingnieuse
application des petites clefs l'effet d'tablir une indis-
pensable galit entre les tons et les semi-tons, ne re-
212 FLU
monte certainement pas un sicle. Seulement il est hors
de doute que nous sommes redevables aux Allemands
de cette prcieuse dcouverte, ainsi que celle d'une patte
au corps, qui donne deux notes de plus dans le grave de
l'instrument. Ces deux notes sont ut dise
et ut na-
turel.
Quatrime poque. Flte moderne. Elle est en r ou
en ut. Pour parler plus correctement, l'une descend au
r au-dessous des cinq portes, et la deuxime Yut na-
turel. Les Allemands, les Anglais et les Italiens ont,
depuis bien des annes, renonc la flte patte de r
comme trop mesquine. En France, nous avons t plus
rcalcitrants. La premire mthode o il soit fait men-
tion des trois petites clefs
(fa
naturel, la et si bmol) est
celle de MM. Hugot et Wanderlich. Elle a t publie
par le Conservatoire l'poque de la formation de cet
tablissement sous la Rpublique. C'tait l un heureux
commencement; mais l'opposition systmatique d'infati-
gables routiniers n apport bien des retards aux perfec-
tionnements dont la flte a t l'objet.
La flte moderne est de forme cylindrique, comme
celle du moyen-ge. Elle se compose de trois tubes ou"
corps creuss et spars. On les ajuste les uns dans les
autres au moyen i embotures et de tenons. Le premier
corps se nomme tte; il est perc sa surface d'un trou
unique
;
on le nomme trou de Vembouchure. Le deuxime
corps s'embote dans le premier
;
il est perc de six
trous sa surface et s'embote par son extrmit inf-
rieure dans le troisime corps ou patte, soit de r ou d'ut,
soit de tout autre. Le premier
f
j
t le troisime corps sont
garnis de viroles d'ivoire ou d'argent. La patte en r est
perce d'un seul trou assez large
;
il est ferm par une clef
qu'on fait agir avec le petit doigt de la main d'en bas.
La patte ,en ut, outre ce trou dont nous venons dparier,
en a encore deux autres, l'un pour Yut naturel, l'autre
pour Yut dise Les clefs sont en sens contraire celle de
r dise. Elles restent ouvertes, mais on les bouche
chaque fois qu'on veut obtenir les deux notes pour les-
quelles elles sont tablies. C'e^t encore par le moyen du
petit doigt, toujours d'en bas, que ces clefs jouent.
A une poque plus rapproche encore, grce l'habi-
let de quelques facteurs et au procod de fabrication mis
en usage par Bohm, d'aprs la dcouverte de Gordon,
en 1834, la flte est devenue un instrument aussi com-
FLU
213
plet, aussi juste, et d'une sonorit aussi gale qu'on
puisse le dsirer.
Les sons de la flte n'ont pas une expression trs-ca-
ractrise
;
cependant ils sont doux et purs, et peuvent
rendre avec bonheur certaines nuances dlicates qu'on
ne saurait attendre de la navet d:i haut-bois, de la gra-
vit du cor anglais, ni de la force clatante de la clari-
nette. Tel est, par exemple, le chant triste et dsol, mais
humble et doux que Gluck, dans son Orphe, prte aux
ombres qui habitent les Champs-Elyses. La flte est
employe aussi d'une manire heureuse dans le chur
des prtres, au premier acte d' dipe, de Sacchini :
vous que l'innocence
;
dans la cavatine du duo de la Ves-
tale, de Spontini : Les dieux auront piti: et dans une
foule de passages de Freyschutz, de Weber. surtout pen-
dant la mlancolique et suave prire d'Agathe.
La flte a donn lieu beaucoup de perfectionnements.
En 1806,
Laurent construisit des fltes dont le corps
tait en cristal, qui eurent une grande rputation. En
1840,
Cur donna le nom de flte franc
aise h un instru-
ment dont la perse tait conique
,
et mont des clefs de
formes nouvelles qui avaient double effet; l'embouchure
avait galement t modifie.
En
1855, Roth , de
Strasbourg, construisit une flte excessivement longue,
qui descendait jusqu'au sol et il lanomma^Mfe^/owr.
Flte harmonique. Nom donn une espce
d'accordon, imagin en
1829,
par Bouvret.
Flte (petite). Elle est l'octave haute de la prc-
dente.
La petite flte a un timbre perant dont on abuse au-
jourd'hui comme de tout ce qui clate d'une manire
bruyante. Ses notes aigus sont excellentes dans un
for-
tissimo de tout l'orchestre, pour obtenir les effets dchi-
rants dans un orage ou dans une scne d'un caractre
froce. Beethoven dans la Symphonie pastorale, et Gluck
dans la tempte ilphignie en Tauride, en ont fait
usage avec bonheur.
Spontini, dans la clbre
bacchanale des Danades, a
joint un cri bref et perant des fltes avec un coup sec
des cymbales. Cela dchire comme un poignard.
Flut. On appelle son fltes ceux que l'on produit
sur les instruments
corde? ou archet, en appuyant
lgrement le doigt sur les cordes et en faisant un mou-
7.
214 FOR
veulent particulier avec l'archet qu'on approche davan-
tage du chevalet,
Fluteole. Espce de flte construite par Goste, en
1847,
dont la perce tait conique.
Flutet. Flte que l'on jouait avec le tambourin. Sor-
te de galoubet.
Flutina. Espce de petit accordon double clavier,
un suprieur, et un infrieur, construit en
1842, par
Wender.
Flutina-polka. Instrument double jeu de lames
vibrantes imagin par Busson, en 1851.
Fltiste. Musicien qui joue del flte.
Folies d'Espagne. Air qui se dansait autrefois en Es-
pagne avec des castagnettes. Les uns l'attribuent au c-
lbre violoniste Corelli, d'autres Broschi (Ricardo),
frre de l'admirable chanteur Farinelli {dit Carlo Bros-
chi), mais il n'appartient pas plus l'un qu' l'autre.
Son auteur est inconnu. Le claveciniste franais d'An-
glebert avait publi vingt-deux variations sur ce thme,
en
1689, et l'uvre 5 de Corelli, qui contient vingt-
quatre variations sur la Follia, ne parut Rome qu'en
1700. Cet air, dit Castil-Blaze, dans son Molire musi-
cien, est tabli sur des modulations d'un usage alors fr-
quent et presque gnral, modulatious qui rglaient la
marche de la mlodie et donnaient un air de famille toutes
les petites pices de ce genre. La chanson provenale :
Fai te lou tegne blu, panturla, dont la musique remonte
au xn
e
sicle, prsente les types des Folies d'Espagne
;
type dont il semble que Pergolse ait subi l'influence en
crivant le premier duo de son Stbat Mater. Ce duo
procde et module exactement comme les Folies d'Es-
pagne.
Fondamental. Le son fondamental est celui qui sert
de fondement l'accord ou au ton. La basse fondamen-
tale est celle qui sert de fondement l'harmonie. L'ac-
cord fondamental est celui dont la note la plus basse est
fondamentale.
Force. Qualit du son appele aussi intensit, qui le
rend plus sensible et le fait entendre de plus loin.
Forcer la voix. C'est un dfaut qu'on rencontre sou-
vent chez les chanteurs, surtout lorsqu'ils sont indispo-
ss. Us crient alors au lieu dchanter, et ils dtonnent
facilement, attendu que leur voix sort de son tendue
naturelle.
FRA 215
Forme. Les compositions musicales se distinguent par
leurs formes. La symphonie a une forme diffrente du
concerto
;
l'air a une toute autre forme que le rondeau, etc.
Fort-bien. Nom donn par Frdric, facteur d'orgue
Gra, en 1758, au premier piano cord qui fut alors
construit.
Forte. Adverbe italien qui signifie
fort ;
est employ
dans, la musique par opposition au mol piano, pour in-
diquer qu'il faut augmenter le son et chanter pleine
voix.
Forte-campano. Instrument imagin par Lemoine,
en 1825,
rendait des sons doux et sonores, et pouvait
parfaitement en mme temps imiter le son des grosses
cloches. Le son tait produit par des tiges mtalliques.
Forte-piano. C'est le nom par lequel on a dsign
pendant longtemps le piano. Il fut appel ainsi par les
premiers inventeurs.
Fourche. Terme dont on se sert l'gard du doigt
des instruments vent et trous, pour indiquer la po-
sition des trois grands doigts, dont les extrmes sont
poss sur les trous, tandis que celui du milieu est lev.
Fourniture. Jeu d'orgues qui entre dans la compo-
sition du plein jeu, et qui est compos de plusieurs tuyaux
d'un son aigu accords la quinte, l'octave, la tierce
et la double octave du son principal avec des redouble-
ments.
Foyers de thtre. C'est ainsi que l'on nomme les
pices ou salons faisant partie de l'difice consacr un
spectacle, et qui servent de lieu de runion. Chaque
thtre a deux foyers : celui des acteurs, voisin de la
scne, o ils attendent le moment d'y paratre, et celui
du public, o les spectateurs viennent s'asseoir ou se
promener pendant les entr'actes. Le foyer des comdiens
de l'ancien Thtre-Franais, o figuraient les Prville,
les Dazincourt, les Dugazon, fut renomm jadis pour
l'attrait de ses causeries. Le malin et spirituel Hoffmann
fit souvent le charme
du foyer public de l'Opra-Co-
mique, o chaque soir on assistait, grce lui, une
sorte de cours de bonnes plaisanteries et d'amusantes
narrations.
Fracas. Ce mot dsigne simplement un bruit d'une
nature particulire
(fragor), mais sans rupture, frac-
ture ou dgt d'aucune sorte. 11 ne s'applique gure dans
ce cas qu'aux dtonatious successives de la foudre pen-
216 FRA
dant un orage. L'action d'un corps en mouvement peut
aussi causer du tracas ou en fracasser un autre, sans que
cette opration soit accompagne d'un bruit sensible. Ce
mot, en musique, se prend ordinairement en mauvaise
part. On dit qu'un orchestre fait du fracas lorsqu'une
produit qu'un bruit sans effet.
Fragment. Ainsi se nommait anciennement un drame
lyrique dont chaque acte offrait une action spare.
France* (Notice historique sur la musique en).
L'origine de la musique franaise remonte une haute
antiquit, ainsi que le prouvent les plus anciennes chro-
niques. Les vieilles chansons des Francs taient gnra-
lement crites en langue latine : elles avaient beaucoup
d'analogie avec les ballades des Goths; cependant on
y
remarque une vivacit qui leur est particulire. Dans les
ftes publiques, les Francs se servaient d'un grand nom-
bre d'instruments, et les victoires des premiers rois
taient clbres par des chants.
L'orgue fut introduit en France en 757, lorsque l'em-
pereur Constantin VI en envoya un en prsent Ppin,
pre de l'empereur Charlemagne. Peu de temps aprs, le
chant grgorien fut import de Rome. Charlemagne,
dont le puissant gnie ne ngligeait rien de ce qui pou-
vait illustrer la France, s'adressa au pape Adrien pour
en obtenir des chanteurs qui fussent capables d'enseigner
le chant grgorien; ce pontife lui envoya deux cbantres,
Thodore et Benot, qui apportrent un antiphonaire
not par saint Grgoire lui-mme. D'aprs l'ordre de
l'empereur, tous les livres de chant ecclsiastique de
l'empire furent corrigs au moyen de cet antiphonaire,
et le chant grgorien fut gnralement adopt.
A la mme poque, les baladins et les musiciens am-
bulants taient en grand nombre en France; ce n'taient
pas seulement les musiciens, mais les historiens du
royaume. Ils rcitaient dans leurs chansons les princi-
paux vnements de l'histoire du pays, et clbraient les
actions hroques des rois.
Les chansons de guerre des Francs furent longtemps
*
Nous avons crit cette notice, sur la musique en France,
pour un dictionnaire traduit de l'italien, qui a paru en 183y.
Nous reprenons aujourd'hui ce travail, qui est notre proprit,
pour le transporter ici, aprs l'avoir complt et modifi dans
quelques parties.
FRA
217
les seules que le peuple rpta; elles taient conformes
au got barbare de cette poque. Ces
chansons militaires
s'appelaient chansons de geste, parce qu'elles clbraient
les hauts laits des preux. De ce nombre est la chanson
de Roland.
Les chansons badines sont moins anciennes que les
chansons de geste; cependant on ne peut dterminer
avec prcision le temps o elles
commencrent tre en
usage.
Parmi les musiciens qui fleurirent en France depuis le
temps de Charlemagne jusqu' celui de Gui d'Arezzo,
on remarque Rabanus et Haymar de Halberstadt, con-
temporains des chanteurs envoys par le pape Adrien;
Heris, disciple de Rabanus, Rmi d'Auxerre, l'un des
membres les plus savants de l'glise latine la fin du
neuvime sicle; Hucbald, moine de Saint-Amand, con-
temporain de Rmi, et Odon, abb de Cl uni en Bour-
gogne, qui vcut un peu plus tard. Mabillon place ce
dernier au nombre des hommes qui exercrent le plus
d'influence sur la littrature et les beaux-arts, pendant
la premire partie du dixime sicle. Rmi et Hucbald
ont crit des traits sur la musique qui se trouvent la
Bibliothque nationale Paris. On remarque dans l'ou-
vrage d'Hucbald quelques exemples d'harmonie qui
prouvent que le chant en consonnance a t invent
avant le temps de Gui. L'glise romaine fait encore
usage d'une partie des hymnes et des antiennes compo-
ses par Odon.
Philippe de Vitry, vque de Meaux, mort en 1361,
passe pour tre le mme que l'auteur latin, Vitriacus,
qui fut, vers le milieu du quatorzime sicle, Fun des
commentateurs de Francon. Cet crivain est moins
connu que Jean de Mris, docteur de l'Universit de
Paris, qui a pass pendant longtemps pour l'inventeur
de la musique mesure et qui tient la premire place
parmi les crivains franais du moyen-ge sur la mu-
sique.
Dans le douzime sicle, la langue romane tait for-
me, et les potes, qui taient presque tous musiciens,
s'en servaient uniquement pour les chansons et les po-
sies rimes auxquelles ils ajoutaient de la musique.
Cette langue, qu'on appelait en gnral la langue d'Ol,
tait diffrente d'une autre langue qu'on parlait dans
le midi de la France et qui s'appelait la langue d'Oc. Les
7...
218
FRA
troubadours provenaux et toulousains se servaient de
celle-ci, qui existe encore intacte dans le Midi, et les
trouvres et mnestrels proprement dits faisaient usage
de
l'autre.
En 1323, les sept premiers troubadours toulousains
formrent la compagnie supergaye, qui donna naissance
aux jeux floraux. Cette compagnie qui, chaque diman-
che, tenait ses sances dans un jardin, dcerna des prix
qui se distribuaient le 1
er
mai. Le premier qui fut ac-
cord consistait en une violette d'or qu'un troubadour,
nomm Arnauld Vidal, obtint, en
1324,
pour une espce
de romance la Vierge. Cette institution subsiste encore,
mais elle n'est plus que potique.
Presque toutes les chansons franaises des douzime
et treizime sicles sont crites pour une seule voix. Peu
de trouvres taient assez instruits en musique pour en
faire trois ou quatre voix. L'un d'eux pourtant, nomm
Adam de Le Haie, et surnomm le Bossu d'Arras, h
cause de sa difformit et du lieu de sa naissance, se dis-
tingua, vers 1280,
comme auteur de chansons et de
motets trois parties.
Les motets de ce trouvre nous offrent aussi plusieurs
particularits remarquables. Ils se composent du plain-
chant, d'une antienne ou d'une hymne, mis la basse
avec les paroles latines, et sur lequel une ou deux autres
voix font une espce de contrepoint fleuri, et, ce qui peint
bien le got de ces temps barbares, ces voix suprieures
ont des paroles franaises de chansons d'amour. Ces mo-
tets se chantaient dans les processions.
Les mnestrels et les trouvres formrent des associa-
tions sous les noms de menstrandie, cours d'amour, etc.
Les mnestrels ou mntriers fondrent, vers 1330,
la
confrrie de Saint-Julien-des-Mntriers; l'anne sui-
vante, elle fonda l'hpital qui a port ce nom et choisit
un chef qui prit celui de roi des mntriers. Les actes de
cette confrrie furent enregistrs au Chtelet, le 23 no-
vembre 1331. On appelait alors, mnestrandie une so-
cit nombreuse qui se composait de chanteurs
,
de
joueurs d'instruments, et mme de baladins et de fai-
seurs de tours. La confrrie de Saint-Julien-des-Mn-
triers ne cessa d'exister qu'en 1689;
depuis lors il n'y a
plus de mntriers en France.
Vers la tin du quatorzime sicle, la musique plu-
sieurs parties avait fait peu de progrs en France. 11
FRA 219
existe un monument de l'art, tel qu'il tait alors, dans
un manuscrit des posies de Guillaume de Machault,
qui, suivant l'usage de ce temps, tait la fois pote
et musicien. La plupart de ces morceaux sont remplis
de fautes grossires d'harmonie, qui prouvent que
depuis Adam de Le Haie l'art d'crire la musique
plusieurs voix ne s'tait pas perfectionn, et mme que
les qualits par lesquelles brillent les compositions de
ce musicien pote n'avaient pas t apprcies par les
Franais.
Vers le milieu du quinzime sicle on remarque des
progrs trs-sensibles parmi les musiciens franais.
L'un d'eux, nomm Giles ou Egide Binchois, fut le con-
temporain du compositeur flamand Guillaume Dufay, et
parait avoir partag avec lui et l'anglais Dunstaple la
gloire de certaines amliorations assez importantes dans
l'harmonie et dans le systme de la notion. Ce musicien
vivait vers 1440.
Aprs Binchois on trouve Antoine Busnois, matre
de chapelle de Charles-le-Tmraire, duc de Bourgogne,
qui brillait vers 1470.
Jean Mouton et Antoine Brumel occuprent ensuite
le premier rang parmi les musiciens franais. Ils taient
contemporains du fameux Josquin-des-Prs, qui faisait
la gloire des Pays-Bas, et tous deux brillaient dans les
dernires annes du quinzime sicle et au commence-
ment du seizime. Jean Mouton tait matre de chapelle
de Louis XII. Antoine Brumel avait eu pour matre
Jean Ockenheim, clbre musicien flamand et matre de
chapelle de Louis XI.
Sous le rgne de Franois I
er
,
l'art prit un essor nou-
veau. Ce prince, vers 1530, avait deux matres de cha-
pelle; le premier s'appelait Claude de Sermisy ou de
Servisy, et le deuxime Aurant. 11 ne reste rien de leurs
ouvrages, mais on peut s'en consoler avec les composi-
tions de Clment Jannequin, le plus habile, le plus c-
lbre des musiciens de cette poque, et l'un des premiers
de qui l'on peut dire qu'ils ont eu rellement 'du gnie.
Ce compositeur publia, en 1544, un recueil de ses ou-
vrages sous le titre justement appliqu &Inventions mu-
sicales quatre ou cinq parties. C'est dans ce recueil que
se trouve ]a pice si originale qui a pour titre ta Bataille
ou Dfaite des Suisses la journe de Marignan. Tous
les termes militaires dont on se servait alors dans un
220 FRA
combat
y
sont employs, et l'on
y
trouve une imitation
fort plaisante et fort pittoresque du canon, des trom-
pettes, des tambours et du cliquetis des armes.
Quelques recueils imprims en 1529 et dans les annes
suivantes, par Pierre Atteignant, imprimeur de Paris,
font connatre les noms et les uvres de plusieurs com-
positeurs franais, contemporains de Clment Janne-
quin, et qui eurent dans ce temps la rputation de mu-
ciens habiles. Ces compositeurs furent Hesdin, Rouse,
matre Gosse, Certon, Hottinet, A. Mornable, G. Le
Roy, Vermont. Manchicourt, L'Hritier, Guillaume Le
Heurteur et Philibert Jambe-de-Fer.
Goudimel, n Besanon vers 1520, fut un de ces
hommes ns pour se placer la tte des artistes de leur
temps. lev dans la religion catholique, il fut d'abord
matre de chapelle dans sa ville natale, s'y livra la
composition de la musique d'glise, puis alla Rome o
il eut la gloire de devenir le matre de Palestrina. De
retour en France, Goudimel, prit malheureusement
l'poque de la Saint-Barthlmy, en 1572. Il tait alors
Lyon
;
Mandelot, gouverneur de cette ville, le fit jeter
dans le Rhne.
L'anne 1581 est une poque remarquable dans l'his-
toire de la musique franaise, par le premier essai d'une
espce de drame musical : cet ouvrage fut fait et repr-
sent au Louvre, l'occasion du mariage du duc de
Joyeuse avec mademoiselle de Vaudemont. Bathazarini,
clbre violoniste pimontais, de son temps, avait t
envoy par le marchal de Brissac Catherine de Mdi-
cis, qui le nomma intendant de sa musique. Ce fut lui
qu'on chargea du soin d'organiser une fle musicale et
dramatique pour les noces du favori du roi, et il traa le
plan d'une pice machines laquelle il donna le nom
de Ballet comique de la royne. Il s'associa deux musi-
ciens de la chambre de Henri III, nomms Beaulieu et
Salmon, qui composrent une partie des airs de danses
et des chants plusieurs voix, et l'ouvrage fut excut
par une partie des seigneurs et des dames de la cour. Il
produisit une vive impression : rien de semblable n'a-
vait t entendu en France jusque-l. Ce fut le premier
germe de l'Opra, qui n'eut d'existence relle Paris
que prs d'un sicle plus tard.
Le rgne de Henri IV fut peu favorable au progrs de la
musique. Ce prince, bien quil ne ft pas ennemi des
FRA 221
arts, tait trop occup des affaires de l'tat pour avoir
du temps donner aux plaisirs des spectacles. Il est
certain que c'est de ce moment que la musique fran-
aise commena dcliner et devint infrieure celle
des autres nations, et particulirement des Italiens.
Louis XIII tait bon musicien, et mme il composait de
la musique plusieurs parties
;
nanmoins il fit peu de
chose pour cet art qu'il aimait de prfrence
;
parce que,
ne prenant par lui-mme aucune dtermination, il lais-
sait Richelieu jusqu'au soin de protger les arts. Ce
ministre ombrageux, qui ne s'tait fait le Mcne
des gens de lettres et des potes qu' la condition qu'il
chanteraient ses louanges, n'avait rien attendre des
musiciens
;
aussi ne fit-il rien pour eux. L'abandon o
languirent les artistes sous la longue domination de ce
prtre, joint aux ridicules prtentions du roi des mn-
triers et l'obligation de se faire recevoir matre
danser pour avoir le droit d'exercer la profession de
musicien, furent les causes principales de la dcadence
de l'art, qui se continua jusqu' la majorit de
Louis XIV. Le ministre de Mazarin ne put mme rani-
mer l'art ni les artistes, bien que le prlat italien et
apport de son pays le got de la musique, et qu'il et
essay de la faire revivre la cour de Marie de Mdicis.
Les circonstances taient d'ailleurs peu favorables. Une
rnovation sociale et politique s'oprait alors en France
et dans toute l'Europe
;
une vive agitation se manifestait
dans les partis qui taient opposs la cour
;
les guerres
de la Fronde et les vicissitudes qui en taient la suite,
tout cela n'tait point favorable aux progrs d'un art qui
vit de luxe et de repos.
Les instruments qui furent de mode au commen-
cement du dix-septime sicle taient le luth, la viole,
le violon et le clavecin . Jacques Mauduit tait fort instruit
sur le luth, ou du moins passait pour l'tre. On remar-
quait aussi la cour de Henri IV deux cossais, nomms
Jacques et Charles Hedington, qui passaient pour tre
des luthistes d'un grand mrite. Ils avaient pour rival
Julien Perrichon qui, dit-on, excellait surtout dans
l'accompagnement. Les deux Gauthier vinrent ensuite et
excitrent l'admiration de Louis XIII et de ses cour-
tisans
;
enfin on cite aussi comme des luthistes distingus
de la mme poque, Hemon et Blancrocher. Parmi les
violistes, ceux qui se sont fait la plus brillante rputation,
222 FRA
au commencement du dix-septime sicle, sont Hotte-
mann et Laridelle.
Trois frres nomms Louis, Franois et Charles Cou-
perin, furent de trs-habiles organistes pour leur temps,
sous le rgne de Louis XIII, et formrent la souche d'une
famille de musiciens qui s'est illustre pendant deux cents
ans.
Il parat que le clavecin fut cultiv avec plus de succs
en France, au commencement du dix-septime sicle,
qu'aucun autre instrument. Thomas Champion et son
fils Jacques Champion faisaient alors les dlices de la
cour et de la ville
;
mais ils furent surpasss et laisss
fort en arrire par leur fils et petit-fils Champion de
Chambonnires, dont il a t grav quelques recueils de
pices qui prouvent en faveur de son talent. Au reste
Chambonnires appartient plutt la minorit de
Louis XIV qu'au rgne de son pre.
En 1645, le cardinal JYlazarin fit connatre pour la
premire fois aux Franais l'opra italien, qui existait
depuis plus de cinquante ans, mais qui n'avait pas encore
t imit en France, bien que le premier essai de spec-
tacles en musique, par Baltasarini, et d mettre sur la
voie de ces spectacles. Une troupe de chanteurs italiens
que le cardinal avait fait venir grands frais, joua au
palais Bourbon deux opras, le premier dans le genre
bouffe, intitul la Festa teatrale dlia fuita
pazza; la
seconde tait YOrfeo ed Euridice de Monteverde, les
Parisiens ne gotrent point ce spectacle, et le cardinal
qui l'aimait beaucoup, fut oblig d'y renoncer et de ren-
voyer ses chanteurs en Italie. La nation franaise n'tait
pas assez avance dans la connaissance de la musique,
pourprendre du plaisir en entendre d'un genre srieux
pendant prs de cinq heures; car il parat que la repr-
sentation de ces pices ne durait pas moins. Ce ne fut
que quinze ans plus tard, c'est--dire en 4 660,
aux ftes
du mariage de Louis XIV, que Mazarin fit venir de nou-
veau des chanteurs italiens qui reprsentrent au
Louvre une tragdie lyrique en cinq actes, intitule
Ercole Amante. Il parat que cette fois le cardinal fut
plus heureux et que la cour prit plaisir entendre cette
musique.
Si la persvrance de Mazarin faire goter aux
Franais la musique de son pays ne produisit pas tout
l'effet qu'il en attendait, elle eut du moins pour rsultat
FRA 223
de
leur donner une musique nationale. Cambcrt, orga-
niste de l'glise Saint-Honor, et musicien de la mre de
Louis XIV,
aprs avoir entendu les opras italiens,
conut le projet de les imiter en franais, et s'tant
associ avec Perrin, matre de crmonie de Gaston, duc
d'Orlans, il crivit une pastorale qui fut reprsente
Issyenl659, et qui fut applaudie. Cet heureux essai
valut aux auteurs de cette pastorale, un privilge pour
l'tablissement du premier opra franais. Ils formrent
une socit avec le marquis de Sourdca qui avait du
gnie pour les machines, el ouvrirent leur spectacle dans
la salle du jeu de paume de la rue Mazarine en 167J
,
par l'opra de Pomone. L'anne suivante, ils donnrent
les Peines et les Plaisirs de l'amour, pastorale, et le pu-
blic parut prendre got ces ouvrages mais les auteurs
des paroles et de la musique n'taient pas destins
jouir longtemps de leur privilge
;
Lulli, qui jouissait
'de la faveur de Louis XIV, eut le crdit de le leur
enlever.
Jean-Baptiste de Lulli, n prs de Florence en 1633,
avait
reu les premires leons de musique et de guitare d'un
cordelier ami de sa famille. Il apprit ensuite jouer du
violon et
y
montra d'heureuses dispositions. Le chevalier
de Guise, voyageant en Italie, fut charm des talents du
jeune Lulli, et l'amena Paris lorsqu'il n'tait encore
g
que de treize ans. Mademoiselle, nomme la Grande
Mademoiselle, ayant entendu parler au chevalier de son
protg, le lui demanda, et eut la singulire fantaisie de
le placer dans ses cuisines, au rang des marmitons.
Dou du caractre Je plus gai, Lulli amusait ses cama-
rades et charmait quelquefois leurs ennuis par les sons
de son violon. La princesse l'entendit un jouravec beau-
coup de plaisir et lui donna des matres de clavecin et de
composition nomms Mtru et Roberday, tous deux
organistes Paris. Louis XIV voulut entendre un
musicien dont tout le monde parlait avec admiration, et
il fut si satisfait du jeu de Lulli, sur le violon, qu'il
s'empressa de l'attacher son service. Il lui donna
l'inspection, de sa musique, et
particulirement celle
d'une nouvelle bande de musiciens. qu'on nomma les
petits violons, pour les distinguer des vingt quatre
grands violons, espce de mntriers qui ne savaient pas
lire la musique. Forms par Lulli, ces nouveaux musi-
ciens firent, depuis lors, le service de la chapelle et de
224 FRA
la chambre du roi, et les anciens violons ne conservrent
d'autre privilge que celui d'corcher les oreilles de la
cour, le jour de la fte de Louis XIV.
Lulli commena par composer quelques airs pour les
ballets qu'on excutait la cour et les divertissements
des comdies de Molire. Charg des dtails des ftes de
la cour, il crivait aussi beaucoup de symphonies qu'on
y
excutait. Enfin l'opra franais prit naissance; Lulli
comprit ce qu'on en pouvait faire
;
mais pour en tirer
tout l'avantage qu'il voulait, il lui fallait un pote qui
comprit ses ides et qui voulut s'y soumettre; il en trouva
en Quinault.
Le premier ouvrage qui rsulta de l'association de ces
deux nommes clbres, fut la pastorale intitule, les
ftes
de Vamour et de Bacchus, reprsente en 1672. Elle fut
suivie de Cadmus, d'Alceste, de Thse, iAstys cVlsis,
de Psych, de Bellrophon, de Roland, enfin d' Armide,
reprsente en 1686, et qui est considre comme le plus
bel ouvrage de Lulli. Ce compositeur crivit en outre
plusieurs pastorales et vingt-cinq ballets. Cette fcondit
paratra prodigieuse, si Ton considre, que Lulli tait la
fois compositeur, chef d'orchestre, matre de chant, de
dclamation et chorgraphe de son thtre. A l'poque
o il prit la direction de l'opra, il n'existait en France
ni chanteurs, ni danseurs, ni choristes, ni musiciens
d'orchestre, et il forma tout cela par sa rare intelligence
et son activit.
Si l'on envisage Lulli comme compositeur, on ne peut
nier qu'il et un mrite fort remarquable dans la dcla-
mation chante, c'est--dire dans le rcitatif. A l'gard
de la mlodie de ses airs et de son instrumentation, il ne
doit pas tre plac parmi les inventeurs, car il a imit le
style de Carissimi et de Cavalli. Mais telle tait l'igno-
rance o Ton se trouvait en France sur les productions
musicales l'tranger, qu'on tait persuad qu'aucun
musicien ne pouvait lutter de gnie avec Lulli, et ce pr-
jug pardonnable en 1675, se conserva pendant plus de
cinquante ans. Il n'y eut pas d'espoir de succs pour les
compositeurs qui vinrent aprs lui, moins qu'ils ne se
fissent ses imitateurs; aussi n'y eut-il rellement en
France qu'un genre de musique dramatique depuis
Lulli jusqu' Rameau, c'est--dire en 1672 jusqu'en
1733. Beaucoup de compositeurs remplissent l'intervalle
entre ces deux hommes habiles
;
les plus remarquables
FRA
225
sonl Celasse (1687-1706), Charpentier, Desmarels, Cam-
pra, Goste et Dtouches (1692-1710), Bertiez
(1706),
Mouret
(1714),
Monteclair
(1716), Rbel et Francur
(1725-1760),
deBlamont
(1731)
et plusieurs autres dont
les noms, bien qu'assez obscurs, sont encore plus connus
que leurs ouvrages. Tous l'exception de Campra qui
avait de l'originalit dans ses ides, ont t des imita-
teurs de LuJli, mort Paris le 22 mars 1687 des suites
d'une blessure qu'il s'tait faite au pied.
Le prjug des Franais en faveur de Lulli, se repro-
duisit en faveur de Lalande le pi us habile compositeur de
musique d'glise sous le rgne de Louis XIV, et dont le
style servit longtemps de modle aux nombreux compo-
siteurs franais de son temps, qui suivirent ses traces
dans ce genre de musique.
Sous le rjgne de Louis XTV, la musique instrumentale
lit quelques progrs, et plusieurs artistes de mrite prpa-
rrent une voie de perfectionnement leurs successeurs.
Les clavecinistes les plus clbres de cette poque furent
Franois Couperin, Hardelle, d'Anglebert et Buret.
Les instruments archet furent aussi cultivs avec
succs. Marais et Foiqueray se distingurent sur la viole
pour laquelle ils ont publi plusieurs suites de pices.
Senaille, n en
1688, fut le premier violoniste de France
qui mrita d'tre mis en parrallle avec les violonistes
italiens : il crivit de bonnes sonates pour son instru-
ment. Leclair fut son contemporain et mrita, comme
lui, les applaudissements des gens de got. Ces deux ar-
tistes doivent tre considrs comme les fondateurs de
l'cole franaise du violon.
A l'gard du chant, c'tait un art inconnu en France,
et il le fut encore longtemps. Lambert, clbr dans les
vers de Boileau, et dont Lulli avait pous la fille, pas-
sait pour le meilleur matre de Paris; ce n'tait pas
beaucoup dire. Aprs lui venait Camus, Dambray, et
Bacilli. Aucun d'eux ne connaissait les principes de la
pose de la voix et de la vocalisation.
Sous la rgence, la musique dramatique et religieuse
resta stationnaire. Il tait rserv au rgne de Louis XV
d'tre tmoin d'une sorte de rvolution dans la musique
de thtre : ce l'ut Rameau qui la lit. Jean-Philippe
Rameau, n Dijon le 25 octobre 1683, tudia comme
enfant de chur les principes de la musique dans sa ville
natale, puis voyagea en Italie, o il n'alla pas plus loin
S
226 FRA
que Milan. De retour en France, il fut organiste Cler-
mont, en Auvergne, et ensuite
'Paris. Habile dans l'art
djouer de l'orgue, il se fit remarquer par les pices de
clavecin qu'il publia et qui taient d'un genre neuf. Mais
ce qui fixa surtout l'attention sur lui, fut la publication
d'un Trait d'harmonie qui parut en 1722, et qui tait
fond sur une thorie nouvelle. Bien qu'il ft reconnu
comme un savant et habile musicien, et peut-tre
cause de cela, Rameau ne pouvait parvenir trouver un
pome d'opra pour en composer la musique. 11 avait
cinquante ans lorsqu'il put enfin satisfaire son dsir: son
opra d'Hippolyte et Aricie ne fut reprsent qu'en
1733. Vingt-deux opras composs par Rameau, dans
l'espace de dix-sept ans, prouvrent une fcondit rare
chez un artiste dj g ds son dbut. Les partisans de
Lulli se dchanrent contre l'artiste qui osait s'carter
de la route trace par son prdcesseur, et se crer une
manire nouvelle. Ils trouvrent son harmonie dure et
baroque, ses mlodies tourmentes, son rcitatif trop
chantant, et ses airs pas assez. Lulli conserva beaucoup
de partisans, mais Rameau eut les siens, et les habitus
de l'Opra se partagrent en deux camps qui se firent la
guerre jusqu' ce qu'un comptiteur clbre vint de
l'Allemagne les taire oublier l'un et l'autre.
Les compositeurs franais, contemporains de Rameau,
furent les derniers qui crivirent de la musique dans le
style purement franais. Ces compositeurs furent Mon-
donville (1742-1758), Berton (1755-1775), d'Auvergne
(1752-1773), Trial (1765-1771), et quelques autres moins
connus. En 1752, l'arrive d'une troupe de chanteurs
italiens Paris, opra dans le got de la musique fran-
aise, une rvolution dont les rsultats ne se firent pas
sentir tout de suite, mais qui ne fut pas moins relle.
Ces chanteurs, qui donnaient des reprsentations
l'Acadmie royale de musique alternativement avec
l'Opra franais, firent entendre pour la premire fois,
aux habitus de l'Opra la Serva padrona de Pergolse,
et d'autres ouvrages des meilleurs compositeurs italiens
de cette poque. Une partie de la socit, c'est--dire
cette portion intelligente qui devance toujours le temps
o elle vit, montra la plus vive admiration pour cette
musique lgante, spirituelle, dans laquelle la vrit de
diction, la forme gracieuse de la mlodie et la conve-
nance de l'instrumentation s'unissaient pour former un
FRA 227
tout sduisant pour l'oreille et pour l'esprit. De leur ct,
les enthousiastes de la musique franaise furent fort
scandaliss de l'atteinte qu'on osait porter aux objets de
leur admiration. Une guerre s'alluma entre les deux
partis, et le parterre se divisa en deux camps qui se dsi-
gnrent sous les noms de coin de la reine et coin du roi,
parce qu'ils taient rangs prs des loges de la reine et du
roi. A la tte du coin de la reine taient J.-J. Rousseau
et le baron de Grimm. La thse soutenue par Grimm et
Rousseau tait que, non-seulement la musique franaise
ne pouvait lutter avec l'italienne, mais qu' proprement
parler, il n'y avait point de vritable musique franaise,
et qu'il ne pouvait
y
en avoir. Ces assertions ne rest-
rent point sans rponse, et les partisans de cette musique
dont on niait l'existence, ripostrent par une multitude
de pamphlets. Cette guerre dura prs de deux ans, aprs
quoi l'on s'aperut des progrs sensibles que faisait le
got de la musique italienne, et les chanteurs ultramon-
tains furent renvoys.
Toutefois, le coup tait port, et le besoin de la musique
italienne se fesait sentir. L'Opra-Gomique franais, qui
ne venait que de natre, s'empara de ce que le grand
Opra avait ddaign, et vcut avec les traductions des
opras qu'on ne pouvait plus entendre dans la langue
originale. Un compositeur italien, Duni, sorti de la
mme cole que Pergolse, vint Paris en 1757, et com-
posa l'un des premiers opras-comiques originaux, le
Peintre amoureux de son modle; son succs, d princi-
palement la musique simple et naturelle de Duni,
engagea ce musicien se fixer en France, et successive-
ment il donna YIle des Fous, Mazet, le Milicien, les
Chasseurs, la Fe Urgle, la Clochette, les Moissonneurs
et les Sabots. Ce que Duni avait commenc, Philidor
l'acheva en donnant, dans le got italien et avec une
certaine force d'harmonie inconnue alors
(1759),
Biaise
le savetier, suivi du Soldat magicien, du Marchal, de
Sancho Pana, du Bcheron, de Tom Jones et des Fem-
mes venges. La mlodie de Philidor manquait* quelque-
fois de grce, mais elle tait dramatique.
Un autre compositeur franais, venu dans le mme
temps que Philidor, Monsigny, contribua beaucoup aussi
faire oublier le style lourd et soporifique de la musique
franaise. Les Aveux indiscrets, qu'il fit reprsenter en
1759, commencrent sa rputation. Encourag par un
228 PRA
premier succs, il donna en 1760, le Matre en droit et\e
Cadi dup, remarquables par l'esprit et la finesse de la
musique
;
enfin, On ne s'avise jamais de tout, le roi et le
Fermier, Rose et Colas, le Dserteur, et Flix, mirent
le comble sa rputation, et prparrent la nation fran-
aise une grande rvolution musicale qui tait immi-
nente.
Grtry, n Lige en 1743, avait pass plusieurs annes
de sa jeunesse en Italie, lorsqu'il arriva Paris en 1766.
Dj le mouvement tait imprim vers la voie de perfec-
tionnement
;
ce musicien, organis pour traiter la musi-
que d'une manire spirituelle, convenable pour des Fran-
ais, acheva l'uvre commence par ses prdcesseurs, et
jeta dans cinquante opras de tout genre, une multitude
de mlodies heureuses, de traits d'un excellent comique
et d'une expression touchante. Son premier opra, repr-
sent en 1768, fut le Huron. Parmi les autres, les meil-
leurs sont le Tableau parlant
(1769),
Zmire et Azor
(1771),
l'Ami de la maison
(1772),
la Rosire de Salency
(1774),
la Fausse magie
(1775),
l'Amant jaloux
(1778),
la Caravane
(1783),
Richard
(1785)
et Anacron
(1797).
De tous les compositeurs d'opras-comique, Grtry est
celui dont la musique a obtenu les succs les plus bril-
lants, et dont les ouvrages sont rests le plus longtemps
en faveur : soixante ans ne les ont pas uss.
Pendant que la musique faisait du progrs en France
par rOpra-Gomique, l'ancienne musique franaise sem-
blait s^tre rfugie l'Acadmie royale de musique,
c'est--dire au Grand-Opra, comme dans un fort inexpu-
gnable. Mais la ncessit d'une rforme se faisait sentir de
plus en plus, et le moment vint o il fallut qu'elle s'oprt.
Ge fut un musicien tranger qui se chargea de ce soin.
Gluck, compositeur allemand, venait de faire entendre
Vienne un style absolument original et beaucoup plus
dramatique que ce que l'on connaissai t jusque-l en France
et mme en Italie; dj les opras 'Alceste et d'Or-
phe, dans lesquels Gluck avait essay son style nou-
veau, avaient produit une vive impression sur la cour
impriale. Les directeurs de l'Opra de Paris, convain-
cus de la ncessit de changer le genre de pices qu'on
reprsentait sur leur thtre, appelrent Gluck leur
secours. Il vint, et vit que tout tait rformer. Un
systme de chant surann, une excution instrumentale
fort mauvaise, une musique lourde et fatigante, voil ce
FRA 229
qu'on trouvait l'Opra. Homme de gnie et dou d'une
volont inbranlable, il sut persuader aux artistes de
l'Opra qu'ils devaient renoncer leurs anciennes habi-
tudes, et son Iphignie en Aulde fut rendue peu prs
comme il le voulait. On reprsenta cet opra le
19 avril 1774; son succs fut immense, et la rvolution
fut acheve aussitt que commence.
Pendant que Gluck obtenait ces succs, quelques
amateurs lui reprochaient de manquer de grce dans sa
mlodie; l'arrive de Piccinni, Paris, en 1777, leur
parut favorable pour faire triompher leur critique.
Piccinni, l'un des compositeurs italiens les plus renom-
ms de cette poque, arrivait en France aprs avoir fait
reprsenter plus de cent ouvrages. On lui confia celui de
Roland dont il composa la musique, et qui fut repr-
sent peu de mois aprs YArmide de Gluck. Une guerre
de plume commena alors entre les partisans de ces
compositeurs. La Harpe, Marmontel, Suard, l'abb
Arnaud et Ginguen
y
prirent part et publirent une
multitude de brochures et d'articles de journaux qui
sont maintenant oublis. Atys, et suviouDidon, de
Piccinni, restrent au thtre; nanmoins les ouvrages
de Gluck tinirent par l'emporter dans l'opinion gnrale,
et la part de gloire la plus grande lui fut dvolue.
Telle tait la situation de la musique dramatique
l'aurore de la rvolution franaise de 1789. A l'gard de
la musique d'glise, elle tait faible de style en France,
parce que les tudes srieuses de contrepoint et d'har-
monie taient faites dans un mauvais systme. Gossec,
seul, mrite d'tre distingu.
L'art du chant, toujours ignor, n'avait point encore
pntr chez les Franais. Avec de belles voix, Larri-
ve, Jliotte, mademoiselle Laguerre, et plus tard
Legros, Ghardini, mademoiselle Arnould et d'autres
encore ne furent que des chanteurs mdiocres.
La rvolution de la musique franaise contemporaine
de l'autre, eut pour instigateurs Mhul, Ghrubini et
Spontini.
Enthousiaste de la musique de Gluck, et dispos par
la nature sentir avec force tout ce qui appartenait .
l'expression dramatique, Mhul, n Givet dans le
dpartement des Ardennes, Mhul qui, sans avoir fait
des tudes solides, avait l'instinct d'une harmonie
lgante et pure
,
comprit que ce qui avait manqu
230 PRA
jusqu'alors la musique franaise tait indpendam-
ment de cette harmonie dont il avait le sentiment, l'adop-
tion de quelques formes italiennes, les morceaux d'en-
semble dvelopps, les airs rguliers et l'instrumentation
brillante dont Mozart avait donn l'exemple quelques
annes auparavant dans les Noces de Figaro et dans Don
Juan. Le rsultat de ses mditations fut l'opra
'Euphrosine ou le Tyran corrig, qu'il fit reprsenter
en 1790. Stratonice (179i), Phrosine et Mlidor
(4794),
Ariodant
(1799),
et Joseph
(1807),
achevrent de dve-
lopper dans toutes ses consquences le nouveau systme
introduit par Mhul dans la musique franaise.
Ghrubini. n Florence, et venu Paris en 1788
avec un nom dj clbre, exera une influence trs-ac-
tive sur la rvolution qui s'oprait alors dans la musique
franaise, en
y
appliquant les qualits particulires de
son talent solide et profond, comme il apparut dans l'opra
de Lodoska qu'il fit reprsenter en 1791. Ce talent se d-
ploya avec toute son nergie dans le Mont Saint-Bernard
(1794),
dans Mde
(1797),
et dans les deux Journes
(1800).
Spontini ds Tanne 1806 posa en France les bases de
sa renomme et imprima notre musique dramatique
le sceau de sa puissante individualit. Continuateur de
Gluck, prcurseur de Rossini, il a lgu l'art deux
beaux chefs-d'uvre, la Vestale et Fernand Corts.
Ces ouvrages compltrent la rvolution de la musique
en France.
Mhul, Ghrubini et Spontini avaient t suivis dans
leur systme par M. Lesueur, qui nanmoins avait mis
un cachet d'originalit dans la Caverne
(1798),
Paul et
Virginie
(1794),
Tlmaque
(1790),
et par M. Berton,
qui jetait les fondements de sa renomme dans les Ri-
gueurs du clotre, Montano et Stphanie et le Dlire.
Roeldieu prludait ses brillants succs par Zoraime
et Gulnar\ enfin l'cole franaise avait agrandi son do-
maine.
L'art du chant, longtemps ignor en France, com-
mena
y
tre connu et cultiv avec succs vers le
mme temps. Ce fut encore la musique italienne que
l'cole franaise fut redevable de cette amlioration im-
portante. En voici l'occasion. En 1789, Lonard, coiffeur
de la reine, obtint, on ne sait pourquoi, le privilge d'un
thtre d'opra italien. Viotti, clbre violoniste italien,
FRA 231
alors tabli Paris, fut charg de l'organisation de la
troupe, et il mit tant de zle et d'intelligence dans sa
mission, qu'il parvint runir une partie des meilleurs
chanteurs qui existaient alors. Le nouveau thtre s'ou-
vrit en 1790 dans une espce de bouge de la foire Saint-
Germain, en attendant qu'on et bti la salle Feydeau
qui lui tait destine. Raffanelli, Mandini, Viganoni,
Rovedino et madame Morichelli composaient une partie
de cette troupe, la meilleure qu'il ft possible de runir
alors. Ces excellents chanteurs excutaient les dlicieuses
compositions de Cimarosa, de Sarty et de Paisiello. Un
orchestre excellent compos des meilleurs artistes de
France,' et dirig par Mestrino, ajoutait au charme des
reprsentations
;
enfin rien ne manquait l'ensemble de
ce spectacle, le plus parfait qui et jamais exist Paris.
Le chanteur le plus tonnant que la France ait pro-
duit, Gart, qui venait de se lancer dans le monde mu-
sical, allait former son got et sa mthode l'cole de
ces virtuoses et se prparait fonder l'excellente cole de
chant d'o sont sortis tous les artistes qui depuis ont
brill sur les thtres franais. Ci chanteur joignait
l'organisation la plus parfaite qu'on puisse imaginer, une
accentuation merveilleuse, et cette expression de vrit
qui est l'me de la musique franaise.
Tel tait l'tat de l'art musical en France lorsque toutes
les matrises des cathdrales furent supprimes par suite
de la rvolution, ce qui dtruisit l'ducation publique de
la musique dans toute la France. Aprs la chute de Ro-
bespierre, le 9 thermidore an III, la Convention natio-
nale dcrta l'organisation du Conservatoire de musique
sur le rapport de Ghnier, pour remplacer ces anciennes
coles.
En peu de temps la nouvelle cole donna des rsultats
remarquables, et ds l'an IV les concours des lves
furent assez brillants pour que le ministre de l'intrieur
se charget de faire lui-mme une distribution solennelle
de prix dans la salle de l'Opra. Cette crmonie se r-
pta pendant plusieurs annes, et excita vivement l'mu-
lation des lves. Une multitude d'instrumentistes de
mrite fut forme en peu de temps
;
les orchestres se re-
crutrent et s'amliorrent d'une manire sensible
;
des
chanteurs suprieurs ceux qu'on avaient entendus jus-
que-l peuplrent les thtres, et l'on vit successivement
dbuter l'Opra et l'Opra-Comique M
me
Branchu,
232
FRA
MM. Nourrit, Drivis, Roland, Despramont, M
me
Du-
ret , M
me
Boulanger, MM. Ponchard, Levasseur,
M
me
Rigaut, M
Ue
Ginti (depuis M
me
Damoreau), et beau-
coup d'autres chanteurs qui ont t la gloire de l'cole
franaise.
La fin du rgime rvolutionnaire et la raction qui
s'ensuivit se firent sentir dans la musique et surtout
dans la musique dramatique. Aprs les vives motions
qu'on avait ressenties, on prouvait le besoin du calme
et des sensations douces
;
or il n'est gure de besoin dans
la socit qui ne soit bientt satisfait. Un jeune musi-
cien, que rien n'avait fait connatre encore, se lana tout
coup sur la scne et russit dans son premier essai de
manire causer des inquitudes aux compositeurs les
plus renomms. Ce musicien se nommait Della-Maria.
Son Prisonnier ou la Ressemblance fut accueilli avec un
enthousiasme difficile dcrire, grce la musique
simple et naturelle qu'il
y
avait adapte, et qui causa une
sensation d'autant plus vive qu'elle tait en opposition
directe de svstme avec celle qui depuis plusieurs annes
tait seule en possession du thtre. Tel fut le succs de
oet ouvrage que, presque subitement, les autres compo-
siteurs changrent de manire pour en adopter une plus
douce et plus analogue la direction nouvelle que pre-
nait la socit sous le consulat de Bonaparte. Mhul lui-
mme esseya de modifier son talent et donna des ouvra-
ges d'un genre tout diffrent des premiers, tels que
l'Irato, Une folie et le Trsor suppos. Boeldieu, n
pour la musique gracieuse et spirituelle, donna succes-
sivement le Calife de Bagdad, Ma tante Aurore, Jean
de Paris et le Nouveau Seigneur de village. Deux ac-
teurs, aims du public, Elleviou et Martin, tous deux-
chanteurs agrables et dous de belles voix, ne furent
pas trangers cette mtamorphose de la musique dra-
matique. Ils aimaient celle qui tait favorable au dve-
loppement de leur talent, et c'tait la musique lgre
qui leur convenait le mieux. Or, ils procuraient des suc-
cs, il tait naturel qu'on travaillt pour eux; de l la
raction complte qui se fit sentir dans l'Opra comique.
Cette raction fut mme telle qu'on reprit les ouvrages
de Grtry, dlaisss depuis longtemps, et que le public
les revit avec enthousiasme. Dalayrac, qui avait aussi
crit dans le mme genre, eut sa part de triomphe
;
enfin,
de nouveaux compositeurs, parmi lesquels on remar
Fll 233
quait Nicolo, (souard. Hrold, mort en janvier 1833, et
Kreutzer, dont les dbuts avaient t fort heureux, pri-
rent aussi la direction qui plaisait au public, et la mu-
sique franaise se rpandit l'tranger avec succs.
La musique franaise tait moins brillante dans le
genre instrumental, et mme, il faut le dire, elle n'a
rien encore produit en ce genre qui ait pu la faire com-
parer l'cole allemande.
Un des premiers soins des professeurs du Conserva-
toire avait t de rdiger des mthodes lmentaires pour
les diverses parties de la musique, en l'absence d'ou-
vrages satisfaisants pour cet objet. C'est ainsi qu'on vit
paratre une Mthode de violon par Kreutzer, Rode et
Baillot, une Mthode de piano par Adam, une Mthode
de musique et des solfges auxquels avaient coopr tous
les professeurs, une Mthode de chant, et enfin une
Mthode d'harmonie, fruit des mditations de Catel.
La rvolution opre par Rossini dans la musique
dramatique, ne fut connue en France que longtemps
aprs qu'elle eut t opre
;
mais enfin on entendit le
Barbier de Sville, Otello, Smiramis, et aprs que
cette musique originale eut essuy bien des critiques,
elle devint l'objet de l'imitation. Insensiblement les faits
rsultant de la nature de ces partitions se classrent, et
les compositeurs n'en prirent que ce qui tait une source
de richesses nouvelles. Rossini lui-mme changea de
style et de manire quand il vint en France composer
pour notre grand Opra. Ce qu'il ajouta au Sige de
Corinthe et au Mose, crits en Italie et transports en-
suite sur la scne franaise, annonait dj cette glo-
rieuse transformation qui se complta par le Comte Or
y
et Guillaume Tell.
Des compositeurs exclusivement franais, entre autres,
Hrold, Boeldieu, Grisar, Halevy, Auber, Ad. Adam,
Amb. Thomas, Gounod, Clapisson, J. Mass. Berlioz, F.
David, ont chacun, dans des manires diffrentes, con-
tribu donner de l'clat notre cole franaise.
Fredonner. Chanter voix basse, entre les dents et
sans suite, quelque passage d'air ou de chanson.
Fricattel. Sorte de danse populaire mle de panto-
mime, encore en usage la fin du 18
e
sicle.
Fritsch. Luthier de grande rputation, lve de Hun-
ger, travaillait Leipsig en 1780.
8.
234 FUR
Froid. Composition ou excutant qui manque de feu,
d'me, d'expression.
Fugue. L'objet essentiel de la fugue est d'enseigner,
au moyen d'imitations de divers genres artistement com-
bines^ dduire une composition toute entire d'une
seule ide principale, et par l d'y tablir en mme
temps l'unit et la varit. L'ide principale s'appelle le
sujet de la fugue. On appelle contre-sujet d'autres ides
subordonnes la premire, et l'on donne le nom de r-
ponse aux diverses imitations de sujets et de contre-su-
jets. On conoit d'aprs cela qu'il
y
aura un grand nom-
bre d'espces de fugues, selon la manire dont se fera la
rponse.
Cette premire considration nous conduit en remar-
quer quatre espces principales, savoir: la i'ugue du ton,
la fugue relle, la fugue rgulire module, et la fugue
d'imitation. La fugue du ton est celle dans laquelle le
sujet module de la tonique la dominante : la rponse
doit moduler de la dominante la tragique. La fugue
relle est celle dans laquelle la rponse se fait la quinte
suprieure, ou la quarte infrieure, note pour note,
intervalle pour intervalle. La fugue rgulire module
est fonde sur la tonalit moderne. Telles sont presque
toutes les fugues de Jomelli, de Chrubini, de Haendel,
de Bach. Enfin la fugue d'imitation, dans laquelle la
rponse imite le sujet un intervalle quelconque.
Pour faire une fugue en autant de parties que ce soit,
il faut considrer cinq choses :
1
le sujet ou thme
;
2
la rponse, c'est la reprise du sujet, transpos, selon
l'espce, dans une autre partie de fugue
;
3
le contre-
sujet, qui accompagne le sujet
;
4
la modulation
;
5
le
contrepoint dont on remplit l'espace d'une modulation
l'autre, et qui s'appelle divertissement, pisode.
La fugue est oblige ou libre. Elle est oblige, quand
on ne traite que le sujet pendant toute la fugue, en ne le
quittant que pour le mieux reprendre, soit entier, soit en
partie. Elle est libre, quand on ne traite pas le sujet seul
et qu'on le quitte de temps en temps pour passer
une autre ide, qui, bien qu'elle ne soit pas tire du su-
jet, est nanmoins en parfait accord avec lui.
Furie. En Italie, les compositeurs de ballets se ser-
vent de ce mot pour indiquer certains morceaux de
musique de mouvement vif, avec des couleurs et desac-
GAL
235
cents forts, analogues l'action des passions violentes,
comme la colre, la vengeance.
Fuse. Trait rapide en montant ou en descendant. Ce
mot tait en usage dans l'ancienne musique franaise.
On ne s'en sert plus aujourd'hui.
Fut. Baguette d'un archet.
G. Cette lettre est le signe par lequel on indique en-
core la cinquime note de la gamme d'ut, o'est--dire le
sol danslasolmisation allemande et anglaise.
G r sol. Ancien nom du sol dans la solmisation
franaise.
Gabicelis (Joseph). Luthier dont les instruments se
recommandent par un son nergique et agrable, tra-
vaillait Florence, en 1760.
Gagliano (Jiovani). Luthier distingu de Naples. On
a des instruments qui portent la date de 1740 et 1750.
Gagliano (Nicolo) travaillait dans la mme ville de
1700 1740.
Gagliano (Ferdin.), fils du prcdent, 1740 1780.
Gagliano (Alex.), lve de Stradivarius, travaillait
Naples de 1695 1725.
Gai. Rpond en musique au terme italien allegro et
sert marquer le rhythmeet le caractre d'un air.
Gaillarde. Ancien air de danse d'un mouvement
anim, en mesure ternaire. Il se jouait dans les seizime
et dix-septime sicles aprs la pavane et autres danses
lentes.
Gajo, Gai. Cette expression italienne, place en tte
d'un morceau de musique, signifie que le mouvement et
le caractre du morceau doivent tre vifs et anims.
Galope. Espce de danse anciennement usite et qui
de nos jours a pris le nom de Galop.
Galoubet. Instrumenta vent dont l'usage est fort an-
cien en France, et qui depuis plus de deux sicles n'est
cultiv que dans la Provence. Le galoubet est le plus
gai de tous les instruments champtres et le plus aigu
des instruments vent. Ce n'est qu' force de travail et
236
GAM
de soins que l'on parvient bien jouer de cet instrument
qui
n'emploie que la main gauche, et sur lequel il faut
former deux octaves et un ton avec trois trous seulement
Le
galoubet ne va pas sans le tambourin, sur lequel
l'excutant marque le rhythme et la mesure en le frap-
pant avec une baguette.
Les joueurs de galoubet sont trs-communs en Pro-
vence et dans quelques parties du Languedoc
;
il
y
en a
d'une force extraordinaire et qui excutent des concertos
de violon sur leur instrument. On en rassemble jusqu'
vingt-cinq dans une fte champtre, et quoique leur mu-
sique soit toujours gaie et rapide, l'ensemble le plus
parfait ne cesse jamais d'exister entre eux.
Gamma. Troisime lettre de l'alphabet grec, qui cor-
respond
notre G. Anciennement on donna le nom de
gamma h l'chelle imagine par Guido l'Aretin, d'A-
rezzo, en Toscane, en 1026. Cette chelle ne se compo-
sait que de six degrs de Yut au la. Ce fut Lemaire qui
introduisit le si o la corde la plus grave tait marque
par le sol et appele
hypo-proslambanomenos.
Gamme. Tout systme de musique ou tonalit possde
une espce de formule appele gamme, qui le rsume et
le
reprsente. Ainsi la gamme des Grecs rsume et re-
prsente leur systme de musique
;
ainsi notre gamme
moderne rsume et reprsente notre tonalit moderne.
Une gamme est une srie ascendante ou descendante
de sons, que l'on a dispose d'une manire conforme la
tonalit qu'elle doit reprsenter.
Notre gamme est compose de huit notes, dont la hui-
time est la rptition de la premire l'octave, nom qui
vient du latin octavus huitime, et que l'on donne l'es-
pace entier occup
par la gamme, parce que celle-ci est
compose de huit notes, et la huitime de ces notes en
haut ou en bas, par la bonne raison qu'elle est la hui-
time.
Ces huit notes sont dsignes par ces huit syllabes :
ut ou do, r, mi,
fa,
sol, la, si, ut.
Ces notes sont spares les unes des autres par des in-
tervalles qui ne sont pas tous gaux : les uns ont une
certaine tendue appele un ton comme d'ut r, etc.
;
et les autres, une tendue moiti plus petite, peu prs,
qu'on appelle demi-ton, comme de mi
fa,
etc. La
gamme tout entire e?t compose ainsi : un ton, un ton,
GAM 237
un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-
ton.
La premire tierce infrieure d'une gamme peut tre
compose de deux tons, comme d'ut mi naturel ou
d'un ton et demi, comme d'ut mi bmol. Bille est ap-
pele majeure dans le premier cas, et mineure dans le
second. Si elle est majeure, la gamme est dite du mode
majeur et si elle est mineure, la gamme est dite du mode
mineur.
La gamme ut, r, mi,
fa,
sol, la, si, ut est le type des
autres gammes employes dans la tonalit moderne, et
celles-ci doivent en offrir une exacte reproduction prati-
que. Cette reproduction est obtenue au moyen de signes
conventionnels appels dises, bmols, bcarres, qui l-
vent ou qui abaissent les notes de la gamme typique,
prcisment comme il faut qu'elles le soient, en pratique
pour former les gammes nouvelles. Ainsi, par exemple,
en levant d'un demi-ton, par un dise, la note
fa
de la
gamme typique, on obtient une gamme nouvelle sol, la,
si, ut, r, mi,
fa
dise, sol, qui est l'exacte reproduction
pratique de la gamme typique. Il en est ainsi des autres
gammes.
Chacune de ces gammes individuelles forme prcis-
ment ce que l'on appelle un ton quand on dit, par exem-
ple, que tel morceau de musique est dans tel ton. Ainsi,
le ton d'ut de r, de mi, etc., n'est pas autre chose que
la gamme particulire dont ut, r, ou mi, est la pre-
mire note.
L'origine de la gamme moderne, c'est--dire l'ordre
dans lequel les tons et les demi-tons
y
sont disposs n'a-
vait pu encore tre expliqu d'une manire satisfaisante par
aucun de nos thoriciens, avant les remarquables travaux
de M. Ftis. Le nom de gamme qui a t donn cette
chelle vient d'une lettre de l'alphabet grec. V, que
Guido d'Arrezzo choisit pour dsigner la corde qu'il
ajouta au grave du diagramme des grecs, et dont il Ot la
base de son systme musical. Les anciens se servaient
de sept lettres de l'alphabet pour marquer les diffrents
degrs de l'chelle musicale, et comme le nombre de ces
lettres ne suffisait pas l'tendue de leur gamme, il les
changeaient de lorme ou les redoublaient pour indiquer
la position respective de chaque degr par rapport aux
diffrentes octaves. Dans notre systme musical mo-
derne,
nous n'avons galement que sept lettres, C, D,
238 GAM
E, F, G, A, B pour le si bmol, H pour le si naturel,
ou sept syllabes, ut, r, mi,
fa,
sol, la, si, pour dsigner
les cinquante degrs apprciables de l'tendue instru-
mentale comprise entre l'octave grave du sol de la con-
tre-basse et le sol aigu de la petite flte. Mais pour ob-
vier cet inconvnient et marquer d'une manire indu-
bitable la position relative de chaque degr, on emploie
des lignes parallles qu'on divise de cinq en cinq, l'aide
de certains signes appels clefs.
Les gammes sont d'un usage frquent et indispensa-
bles en musique. Quels que soient le genre d'un
morceau, la couleur ou le sentiment d'une mlodie, il est
bien rare d'en parcourir plusieurs mesures sans rencon-
trer une gamme ou une parcelle de gamme. Les
gammes des
deux genres sont un excellent exercice pour
l'tude de la musique instrumentale ou vocale, sous le
rapport de l'excution. On ne saurait trop en recomman-
der l'usage aux personnes qui dsirent atteindre un
certain degr de perfection. C'est par l'exercice trs fr-
quent des gammes dans tous les tons que la voix d'un
chanteur ou les doigts d'un instrumentiste peuvent ac-
qurir cette soupless
p
,
cette flexibilit, cette agilit qui
les rendent propres l'excution irrprochable des pas-
sages les plus difficiles. De nos jours, les cantatrices
abusent des gammes chromatiques dans leurs roulades.
Elles ont d'autant plus tort, que les gammes de ce
genre ne peuvent tre rendues d'une manire satisfai-
sante que sur les instruments clavier, a cordes et. sur
quelques instruments vent. Quant la voix, elle se
prte peu une succession rapide de demi-tons, qui exi-
gent tant de nettet, de justesse et de prcision.
On peut dterminer la vitesse des traits en gammes or-
dinaires et en gammes chromatiques que peut excuter
un artiste sur le piano.
Vitesse des traits en gammes diatoniques.
Vitesse ordinaire 640 notes par i
Grande vitesse 896 id.
Vitesse extrme 960 id.
Vitesse des tierces ou
maximes 608 id.
Vitesse des octaves 480 id.
Vitesse du trille 736 id.
GEN 239
Gammes chromatiques.
Vitesse ordinaire 720 notes par minute.
Grande vitesse 800 id.
Gamme chromatique. Gamme procdant par demi-
tons successifs.
Gamme diatonique. C'est la gamme ordinaire, proc-
dant par tons et demi-tons.
Gamme enharmonique. Cette gamme, qui n'existe
pour ainsi dire que pour l'oeil, offre la succession sui-
vante : ut, r bmol, ut dise, r, mi bmol, r
dise, etc.
Gasaph. Espce de chalumeau ou cornemuse des ctes
de la Barbarie.
Gaspard di Salo. Ainsi nomm parce qu'il tait n
dans la petite ville de Salo, est un des plus anciens lu-
thiers dont les instruments jouissent encore d'une belle
rputation. 11 travaillait Brescia, de 1540 1615.
Gavani (Michel-Ange). Luthier, Bologue, lve d'A-
mati, travailla de 1695 1715,
Gavotte. Sorte de danse dont l'air est deux temps
et d'un mouvement modr. Les gavottes d'Annide et
d'Orphe sont des modles de grce. Celle de Panurge
a eu une vogue prodigieuse qu'elle doit son rhythme
fortement marqu, qualit prcieuse pour les danseurs
vulgaires. Cette gavotte n'a pas de seconde partie, et
pour
y
suppler, l'auteur fait redire la premire la
quarte.
Gedler (Gugemmos) et (Joh Benedictus) taient deux
luthiers, lves de Stainer qui travaillaient Fssen, en
Bavire, en 1756 et 1796.
Geigen-clavicymbal. Instrumenta clavier sons pro-
longs, l'aide d'un archet continu, imagin par Hans
Haydn, en 1610.
Gnie musical. Le gnie, en musique, c'est la facult,
la puissance de cration. Le musicien de gnie est celui
qui sait trouver des ides nouvelles, et ouvrir l'art des
routes inexplores. La nature et le cur humain offrent
sans cesse une mine abondante et riche aux explorations
de l'artiste
,
mais il n'est qu'un petit nombre de privil-
gis qui sachent recueillir cet or pur, le sparer de tout
alliage, le faonner avec habilet et le marquer d'une
empreinte ineffaable.
Cette facult de cration indique la diffrence qui
240 GN
existe entre le musicien de gnie et celui qui n'a que du
talent. Le premier, marchant dans sa force et dans sa li-
bert, fait entendre au monde des chants nouveaux et
des mlodies inconnues. Le second s'empare de cette
uvre commence, la perfectionne et la complte. A
l'un la gloire des dcouvertes, l'initiative des ides;
l'autre l'habilet de la mise en uvre.
L'histoire a enregistr les noms des hommes d'lite
qui ont agrandi par leurs travaux le domaine de l'art
musical
;
mais il faut le dire, ces hommes minents n'ont
pas toujours recueilli le fruit de leurs efforts. Suprieurs
leurs contemporains, la foule a quelquefois refus de
les suivre dans leur essor hardi vers des sphres incon-
nues
;
et, longtemps incompris, ils ont eu lutter contre
l'indiffrence ou le ddain du public dont ils froissaient
les prjugs et les habitudes. On sait quelles prven-
tions, quels obstacles eut vaincre le gnie de Gluck
avant qu'il lui ft possible de se dployer sur notre scne
lyrique; on sait quelles temptes de rcriminations sou-
levrent les chefs-d'uvre de ce grand musicien. On con-
testa la haute valeur de ses travaux, on mconnut son
originalit puissante, on proscrivit ses innovations les
plus heureuses, et l'on ne craignit pas mme d'appeler
un galimatias stupide ses plus clatantes et ses plus su-
blimes beauts. Mais l'illustre compositeur ne se dcou-
ragea pas
;
il tint tte l'orage avec cette attitude calme
et fire que donne la conscience d'une grande suprio-
rit; et peu peu les prventions cessrent : aux injures
succda l'admiration, et le nom de Gluck est arriv jus-
qu' nous entour d'une glorieuse aurole.
Ce ddain de la foule pour tout gnie novateur n'a pas
mme pargn l'un des plus grands musiciens de notre
temps, Rossini. Personne n'ignore qu' l'poque de son
apparition, Guillaume Tell fut peu got par la masse
des dilettantes; et cependant Guillaume Tell est regard
aujourd'hui comme la cration la plus admirable de
Rossini, comme celle o l'illustre compositeur a dploy
le plus de sve et d'originalit.
Ces exemples prouvent qu'en dpit des prjugs, des
habitudes prises, des prventions de la mdiocrit et de
l'ignorance, le gnie vritable est toujours sr d'arriver
au succs
;
et souvent mme ce succs est d'autant plus
clatant, d'autant plus durable, qu'il a t plus lent et
plus difficile obtenir.
GES 241
Genres. Il
y
a trois genres dans la musique, le diato-
nique, le chromatique et l'enharmonique, Le genre dia-
tonique procde par tons et par demi-tons naturels,
c'est--dire sans altration. Ainsi, les deux demi-tons qui
se trouvent dans la gamme, sont du genre diatonique,
et la gamme, soit en montant, soit en descendant, se
nomme gamme ou chelle diatonique. Le genre chroma-
tique ne procde que par demi-tons, Ainsi, une gamme,
en montant ou en descendant par demi-tons, se nomme
gamme ou chelle chromatique. On emploie en montant
le chromatique par dises, et en descendant le chroma-
tique par bmols, suivant la manire la plus naturelle.
On peut l'employer cependant des deux faons, en
montant et en descendant. Le genre enharmonique est le
passage d'une note l'autre, sans que l'intonation de la
note ait t change d'une manire sensible, comme par
exemple, d'ut dise r bmol, demi naturel
fa
bmol,
de si dise ut naturel, etc.
Genre pais ou serr. Dnominations anciennes des
genres chromatique et enharmonique, o les sons se
trouvent plus serrs que dans l'chelle diatonique, appe-
le pour cela genus rarum.
Genus epitrictum. Espce de rhythme de la musique
grecque, dont les temps taient en raison sesquitierce,
ou de 3 4.
Geste. L'art du geste a t considr par les anciens
comme un art indpendant; il est intimement li la
musique, la danse, l'art dramatique et l'loquence,
mais il n'en est pas insparable; en effet, un chanteur
peut avoir une belle voix et chanter avec expression, sans
donner ses gestes le mouvement qui leur convient. Un
danseur peut se mouvoir avec habilet, sans exprimer
par la pantomime le caractre, l'esprit, la pense du pas
qu'il excute; mais d'un autre ct, un chanteur, s'il ne
sait s'accompagner de gestes expressifs, ne remplira
jamais convenablement son rle. Un orateur, possdt-il
les trsors d'loquence de Dmosthne et de Gicron, ne
pourra impressionner fortement son auditoire par le
simple dbit de ses paroles, s'il ne sait faire usage des
gestes et des mouvements de la physionomie.
Suivant Yaron, saltatio ou la pantomime, l'art du
geste, tait chez les Romains une imitation savante et
raisonne de tous les mouvements du corps et des diff-
rentes expressions de la physionomie. Cet art se subcli-
SMtt
GES
visait en plusieurs espces, et avait produit chez les Ro-
mains un si grand nombre de danses et de pas, que
Meursius a compos de leurs noms et de leurs genres un
dictionnaire entier. Nous lisons dans quelques historiens
que l'art du geste tait de tous les arts libraux celui que
les anciens aimaient et pratiquaient le plus
;
car on l'en-
seignait tous, l'histrion de bas tage comme l'ora-
teur distingu
;
mais cet art n'tait pas le mme pour
tous. Aussi Quintilien dit-il ce sujet qu'il ne faut pas
qu'un orateur prononce comme un comdien, ni qu'il
fasse des gestes comme un danseur.
L'art du geste se divisait en deux classes, en naturel
et en artificiel. Le geste naturel tait celui dont on se ser-
vait enchantant ou en dclamant, pour donner plus de
force au discours
;
comme, par exemple, en parlant de la
Divinit, d'lever les yeux et une main vers le ciel. Le
geste artificiel tait celui des acteurs pantomimes, et il
consistait tracer dans l'espace ou dcrire, en em-
ployant tels ou tels signes intelligibles, l'objet qu'on
avait l'intention de reprsenter.
Le jeu de la physionomie, que nous comprenons dans
l'art du geste, n'avait pas d'importance pour les anciens,
au moins sur le thtre, car on sait qu'ils portaient des
masques. L'expression du visage, qui nous charme tant
sur nos scnes lyriques, tait, chez les anciens, tout a
fait inutile
;
en effet, les salles de spectacle taient si
grandes, et les acteurs s'y trouvaient par consquent si
loigns du public, que les mouvements des yeux et les
changements des traits eussent pass inaperus.
Gicron, qui avoue lui-mme avoir appris l'art du geste
du comdien Roscius, dit que celui qui se destine d-
clamer ou chanter en public, ne doit point ngliger cet
art, le plus utile de tous. L'orateur Hortensius, rival de
Cicron, avait reu des leons de la clbre danseuse
Dyonisia.
L'art du geste thtral, chez les anciens se divisait en
trois genres :
1
le geste tragique;
2
le geste comique
;
3
le geste satirique. Ces trois divisions faisaient partie
de la mimique ancienne, divise elle-mme en hypocri ti-
que, c'est--dire celle qui servait de base l'art du geste,
et en rhythmique, qui indiquait les temps en marquant
les mouvements de cet art.
Chez les anciens, les auteurs et compositeurs dramati-
ques crivaient sur leurs manuscrits, au-dessous de leurs
GIG 243
vers et de leurs notes de musique, les gestes que les ac-
teurs devaient faire en les rptant. L'art du geste tait
pouss a un tel point, que le chanteur ou le comdien
qui se serait tromp en faisant
mouvoir les jambes ou les
bras, ou la tte, et t hu par les spectateurs, comme
s'il et chant faux ou mal prononc une phrase. C'est
ce qui adonn lieu au proverbe grec : faire un sol-
cisme avec la main. Les anciens avaient mme des ins-
truments pour rgler les gestes des acteurs. Ammien
Marcellin dit ce sujet : On ne voitplus que chanter et
faire de la musique. Partout on ne voit que des lyres,
des fltes et des instruments qui servent rgler les
gestes des acteurs.
C'est alors que la saltation ou l'art du
geste reut ne tels perfectionnements qu'on se mita jouer
toute sorte de pices sans ouvrir la bouche. On nomma
ces acteurs pantomimes, ou imitateurs de tout. Un pote
composa ce sujet cette pigramrae clbre :
Tous les membres du corps d'un pantomime sont
autant de langues, l'aide desquelles il parle sans ouvrir
la bouche.
Les faits et les exemples que nous venons de citer,
montrent quelle importance avait chez les anciens la
gesticulation considre comme accessoire de l'art th-
tral, de la musique, de la dclamation et de la danse. Elle
formait une science particulire qui avait ses systmes
et ses professeurs spciaux. Les rivalits des mimes et
des danseurs donnrent souvent litu des discussions ora-
geuses sur les thtres de l'antiquit. On sait quels longs
dbats soulevrent, chez les Athniens, les danseurs
Pyrrhus et Bathyle, qui, tous deux, excellaient dans la
gesticulation.
Aujourd'hui, on semble avoir perdu les traditions de
cet art qui jadis savait animer la danse par les sduc-
tions du geste. Les gestes d'expression des pas de carac-
tre dans les ballets du seizime, du dix-septime et du
dix-huitime sicle, ont disparu pour faire place aux
mouvements monotones et froids qu'on a nomms figures
de la contredanse franaise.
Cependant, depuis l'apparition de danseuses originales,
telles que Mesdames Taglioni, Essler, Carlotta Grisi,
l'art chorgraphique semble se tracer une route nouvelle
;
le rgne des danseurs est fini, celui des danseuses com-
mence.
Gigue. Air d'une danse du mme nom, dont la me-
244
GL
sure est six-huit et d'un mouvement assez rapide. La
gigue n'est plus en usage qu*en Angleterre. Corel li a fait
un grand nombre de gigues.
Gigue. Instrument dont il est souvent parl dans les
anciens crivains.
tait-ce un instrument cordes,
tait-ce un instrument vent? Les auteurs sont diviss
d'opinion. Cependant si l'on remarque que le nom de
gigue est driv du mot allemand de geige qui dsignait
tous les instruments cordes de la famille des violes et
plus tard des violons, nous sommes port croire que
la gigue tait monte de cordes. Cet instrument semble
avoir t archet, de petite dimension et mont de
trois cordes.
Giocoso (enjou). Cet adjectif italien exprime l'all-
gresse, le mouvement vif, lger, badin.
Gittith. Mot hbraque, qu'on trouve parfois en tte
de quelques psaumes. Ce terme n'est problement que le
premier mot d'une ancienne chanson qui tait gnrale-
ment connue au temps de David, et d'aprs laquelle on
devait chanter ces psaumes.
Glas, du celtique clasa ou du grec KXauo pleurer ou
du latin classicum trompette. C'est le son de toutes les
cloches la fois, c'est le tintement lugubre qui annonce
l'agonie ou la mort d'une personne.
Gle (mot anglais qui se prononce glie). C'est un
chant joyeux particulier l'Angleterre. Tous les artistes
distingus de ce pays ont crit des gles, et des hommes
mme de gnie se sont adonns ce genre de composi-
tion. Ce chant a donn naissance Londres une socit
compose de riches amateurs, qui s'efforcent de conser-
ver les traditions de ce genre de musique et d'en rpan-
dre le got. Le mot gle indiquant une forme particu-
lire dans la composition musicale, ne se trouve employ
dans ce sens que vers 1667, dans un ouvrage publi par
Playfort, qui consistait dans la runion de scnes, gles,
airs, ballades pour deux, trois ou quatre voix. Selon le
docteur Burney, un gle est un chant de deux ou trois
parties sur un sujet triste ou gai, dans lequel toutes les
voix commencent et finissent ensemble, en chantant les
mmes mots; et il ajoute que lorsqu'on
y
rencontre des
sujets de figure ou d'imitation, et que la composition est
plus travaille qu'un simple contrepoint, le chant est
moins un gle qu'un madrigal, et on doit lui donner ce
nom surtout si le sujet est d'un genre srieux; car un
GON 24S
gle srieux semble tre un solcisme et offrir une con-
tradiction directe avec le mot. Le mot gle, dans les dic-
tionnaires saxons, allemands et anglais, tant anciens que
modernes, signifie joie, allgresse. Le gle ne peut ja-
mais tre chant en chur; c'est un morceau pour deux,
trois
,
quatre ou cinq voix uniques
,
sans aucun
accompagnement. On en trouve cependant dans des op-
ras anglais qui sont accompagns par l'orchestre, mais
alors l'emploi de ce mot est une usurpation que rien ne
peut expliquer. Les plus clbres compositeurs de gles
.
furent Atterburg , Danby
,
Baildon
,
Harrington
,
B. Gook, son fils, Robert Mornington, Samuel Webbe,
Gaicott, Stevens, Horsley, Beale, etc.
Gloria. Sur ce mot latin qui entre dans la messe, on
crit deux diffrents morceaux de musique : le premier
sur les paroles Gloria in excelsis Deo, le second sur celles
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Glose. Quelques anciens auteurs se servent de cette
expression en musique, pour indiquer un ornement vi-
cieux et de mauvais got.
Glotte. Embouchure des instruments vent chez
les Grecs. C'est aussi cette partie de l'organe de la voix
situe la partie suprieure du larynx qui est destine
donner passage l'air et dont les mouvements contri-
buent l'articulation des sons.
Gluckistes. Partisans du systme musical de Gluck,
par opposition aux partisans de Piccinni. Les gluckistes
et les piccvmiistes partageaient le parterre de l'Opra en
deux factions.
Gobetti. Luthier, lve de Sradivarius, travaillait
Venise de 1690 1720.
God save the Ktng (Dieu sauve le Roi). Chant na-
tional anglais. On prtend que la mlodie est emprunte
un opra de Lulli et que Haendel ne fit que l'adap-
ter aux vers anglais qui commencent cette phrase pour
le roi.
Gofriller (Mathieu et Franois). Sont deux frres
luthiers dont les instruments taient extrmement solides
et bons. Ils travaillaient Crmone vers la fin du sicle
dernier.
Goguette. Lieu de runion ou le peuple va boire et
chanter.
Gong. Instrument de mtal en forme d'arc, dont on
joue avec un batail en bois. C'est aussi l'instrument
246 GOU
chinois consistant en une plaque de mtal dont on tire
des sons clatants en le frappant avec une baguette gar-
nie de peau et que nous nommons tamtam.
Gorge (chanter de ]a). C'est ne savoir modifier sa
voix qu'en resserrant la gorge avec effort.
Voix de
gorge.
Voix que l'on ne modifie que de cette ma-
nire.
Gorgheggio. Mot italien par lequel l'on dsigne un
passage rapide excut avec la voix. Il s'emploie aussi
dans le sens vocalise.
Got. Chaque homme a un got particulier par lequel
il donne aux choses, qu'il appelle belles et bonnes, un
ordre qui n'appartient qu' lui. L'un est plus touch des
morceaux pathtiques, l'autre aime mieux les airs gais;
l'un cherchera la simplicit dans la mlodie, l'autre fera
cas des traits recherchs. Cette diversit vient tantt de
la diffrente disposition des organes, tantt du caractre
particulier de chaque individu, tantt de la diffrence
d'ge et de sexe. Dans tous ces cas, chacun n'ayant que
son got opposer celui d'un autre, il est vident qu'il
n'en faut pas disputer.
Mais il
y
a aussi un got gnral sur lequel tous les
hommes bien organiss s'accordent, et c'est celui-l
seulement auquel on peut donner absolument le nom
de got. Faites entendre un concert des oreilles
suffisamment exerces, le plus grand nombre des au-
diteurs s'accordera, pour l'ordinaire, sur le jugement
des morceaux et sur l'ordre de prfrence qui leur
convient. Demandez chacun raison de son jugement,
il
y
a des choses sur lesquelles ils la rendront d'un
avis presque unanime : ces choses sont celles qui se
trouvent soumises aux rgles
;
mais il
y
en a d'autres
l'gard desquelles ils ne pourront appuyer leur juge-
ment sur aucune raison solide et commune tous, et ce
dernier jugement appartient l'homme de got : si l'u-
nanimit parfaite ne s'y trouve pas, c'est que tous ne
sont pas galement bien organiss.
Le gnie cre, mais le got choisit; sans got en
peut faire de grandes choses. Mais c'est lui qui les rend
intressantes. C'est le got qui fait saisir au composi-
teur les ides du pote, c'est le got qui fait saisira l'ex-
cutant les ides du compositeur, et c'est le got qui
donne l'auditeur le sentiment de toutes les conve-
nances.
GRA 247
Gou vernail. Fil de fer qui sert accorder des tuyaux
d'anches et qui avance ou recule pour rgler la longueur
de la partie libre de la languette.
Gracioso. Mot italien qui signifie gracieux. Plac
la tte d'un air, il indique le mouvement qui tient de
Yandante et de Vandantino, et la nuance d'expression
qu'il convient de lui donner.
Gradation. Mlodie dans laquelle l'expression
monte, pour ainsi dire, au moyen d'une progression
successive de figures qui se ressemblent.
Graduel. Chant qui se rcite dans l'office solennel de
la messe aprs l'ptre.
Grammaire musicale. Rsum des rgles qui ensei-
gnent disposer les matriaux de la musique, c'est--
dire combiner scientifiquement, en suivant les rgles
de l'art, les sons et les accords.
Grand-chantre. Dignit du premier chantre d'une
cathdrale.
Grand-cornet. L'un des jeux de l'orgue.
Grand-jeu. Ou grand chur, de l'orgue. Voir jeu et
chur.
Grand-Opra. Nom par lequel on dsignait autrefois
l'Opra de Paris, pour le distinguer de TOpra-Gomique.
On dit maintenant l'Opra. (Voyez Acadmie Impriale
de musique).
Granzlni frres. Luthiers en renom, travaillaient
Milan, de 1620 1650.
Grasseyement. Dfaut de l'organe qui gte la pronon-
ciation ordinaire, celle que nous dsirons dans la dcla-
mation et le chant. On chante gras lorsqu'on double les
r, et qu'on prononce les l comme s'il
y
avait un
y,
en
disant : perre, merre, aurorre, famiye.
caryon. Le
grasseyement sur les autres lettres, quoique plus suppor-
table, n'en est pas moins un dfaut.
Dans le chant, le grasseyement est encore plus vicieux
que dans le langage ordinaire. Le son donner change,
parce que les mouvements que le grasseyement
emploie
sont trangers celui que forment, pour rendre IV, les
voix sans dfaut. Le premier soin des matres de chant
devrait donc tre de donner aux lves une prononcia-
tion mlodieuse, en dlivrant leurs organes des entraves
et de la duret du grasseyement.
Gratis (Spectacles). Ce gratis-l du moins n'a rien
de fallacieux, et tient la lettre ce qu'il promet pour les
248 GRA
spectateurs, car le gouvernement se charge d'indemniser
les directeurs de thtre pour ces reprsentations gra-
tuites : il leur alloue ordinairement, en pareil cas, le
montant d'une recette calcule au maximum.
Dans l'ancien rgime, les spectacles gratis offraient
un vif attrait au peuple, qui avait peu de thtres bon
march. La raret de ces reprsentations, qui n'taient
gure donnes qu' l'poque de naissance ou de mariage
des princes de la famille royale, ajoutait ainsi leur
charme et leur effet. L'amour-propre de la classe inf-
rieure
y
tait en outre agrablement flatt, en voyant
deux de ses corporations ouvrires occuper, dans ces
solennits dramatiques, les loges du roi et de la reine.
Pendant la rvolution, cette vanit avait un autre
aliment dans la pompeuse rdaction des affiches, o les
reprsentations gratuites taient annonces en gros
caractres dans ces termes : Dimanche, pour le peuple.
Un fait maintenant avec lui moins de faon : quand un
modeste gratis par ordre, en caractres ordinaires, l'a
convoqu l'une de ces ftes de la petite proprit, les
places sont au premier occupant
;
mais la prudente
administration du thtre a fait fermer d'avance son
lgant foyer.
C'est principalement vers l'Opra, dont le haut prix
est habituellement moins accessible pour elle, que la
foule se dirige dans ces occasions.
Grave. Ce mot marque la lenteur dans le mouve-
ment, et de plus une certaine gravit dans l'excution.
Grave, Fugue grave. C'est celle dont le mouvement
est lent, et les notes d'une longue valeur : cette espce
de fugue est fort rare.
Grav, e, Musique grave. C'est par la gravure,
plutt que par l'impression en caractres mobiles, qu'on
est dans l'usage de multiplier aujourd'hui les exem-
plaires des ouvrages de musique que l'on veut mettre
au jour. Cet usage ne remonte gure qu'au commence-
ment du dix-huitime sicle. Tous les opras de Lulli et
de ses contemporains furent imprims : la gravure ne
commena que pour la musique instrumentale. C'est ce
moyen qui nous transmit les uvres de Corelli, deLoca-
telli, de Tartini, et c'est la France qu'on en doit l'in-
vention. Comme on ne gravait alors que sur cuivre, et
que cette pratique tait excessivement dispendieuse, on
ne pouvait gure l'employer que pour des ouvrages peu
GRE 249
volumineux ;
mais on trouva bientt le moyen de la
rendre plus
conomique en se servant de Ptaia, et l'on
en vint, graver des opras entiers.
Graveur,
Graveuse.
Celui ou celle qui fait profes-
sion de graver de la musique.
Gravit. C'est cette
modification du son par laquelle
on le considre
comme grave ou bas, par rapport
d'autres sons
qu'on appelle haut ou aigu3. La
gravit du son dpend du nombre de vibrations que le
corps sonore excute dans un temps donn
;
plus il est
petit, plus le son est
grave ou bas. Autrefois on avait
fix 32 oscillations ou 16 vibrations par seconde la
limite des sons graves perceptibles. Grce aux travaux
de M. Savart, on distingue, fort bien des sons corres-
pondants 15 ou 16 oscillations par seconde. Il est trs-
probable qu'en augmentant leur intensit, on pourrait
distinguer des sons plus graves encore.
Le mouvement vibratoire est naturellement plus lent,
mesure que le corps vibrant est plus massif ou plus
long : voil pourquoi on dit aussi que la gravit des
sons dpend du volume et de la masse des corps
sonores.
Grecs anciens (Musique des). La Grce reut sa mu-
sique des mains des Phniciens, qui lui en communiqu-
rent le systme peu peu, et mesure que le permirent
les circonstances et l'tat de la civilisation. Pour bien
comprendre ce systme et pouvoir en
;
;vre les dvelop-
pements, il faut savoir que le moi
Lyre, qu'on a depuis
appliqu un instrument de musique en particulier,
n'tait d'abord qu'un terme gnrique donn la
musique elle-mme, et transport par extension l'ins-
trument scientifique, au moyen duquel on en dtermi-
nait les lois. Le mot grec lyra exprimait tout ce qui est
harmonieux et concordant. Ce qu'on entendait par la
lyre trois ou quatre cordes ne s'appliquait pas l'ins-
trument de musique dont on jouait, mais celui qui en
constituait l'accord fondamental.
La lyre trois cordes dont parle Diodore de Sicile,
dsignait le systme des ttracordes conjoints. C'tait le
systme le plus ancien. Ces trois cordes taient si, rai,
la. La lyre quatre cordes, dont il est question dans
Boce, indiquait le systme des ttracordes disjoints.
Ces quatre cordes taient mi, ta, si, mi, ou bien la, r,
3.
250 GRE
mi, la. Indiquer la lyre, c'tait indiquer le systme;
c'tait tout indiquer. Car la disposition d'un ttracorde
tant mathmatiquement fixe dans le genre diatonique,
on ne pouvait pas se tromper. Or, cette disposition tait
pour chaque ttracorde, en allant de l'aigu au grave la
manire des Phniciens, de deux tons successifs et d'un
semi-ton.
Dans les deux systmes des ttracordes conjoints et
disjoints, le mode fluctuant entre les toniques la et mi
s'arrte de prfrence sur le la
;
ce qui est trs-conforme
aux ides qu'on a de ce mode consacr la nature fmi-
nine. Cependant, comme la finale, ou grave du systme.
des ttracordes conjoints, s'arrtait sur le si et laissait
un moment dominer le principe assimil la nature
masculine, les Phniciens voulurent effacer encore cette
dominance, et, pour cet effet, ils ajoutrent au grave une
corde qui se trouva tre la double octave du son le plus
aigu du systme des ttracordes disjoints, c'est--dire un
la fondamental. Ainsi ils communiqurent aux Grecs
leur mode favori, appel locrien, le citant de l'alliance,
clbre par son effet mlancolique. Au moyen de l'ad-
jonction de ces deux cordes, les deux systmes furent
fondus en un seul.
Ce systme musical, qu'on peut appeler ionien, tant
parvenu sa perfection, resta longtemps en cet tat
parmi les Grecs. Il parat constant que toute la modula-
tion de ces peuples se bornait d'abord faire passer
les mlodies des ttracordes conjoints aux disjoints, et
alternativement. Souvent mme ils ne modulaient pas,
et alors ils chantaient sur la lyre trois et quatre cordes,
suivant qu'ils voulaient admettre le diapason de septime
ou de l'octave. Comme la mlodie se renfermait dans l'-
tendue du ttracorde, le chant tait simple et facile. Il
suffisait souvent au chanteur de se donner le son des
cordes principales des lyres si, mi, la ou mi, la, si, mi,
pour improviser le remplissage des cordes secondaires.
Il serait difficile de dire combien de temps la musique
ionienne resta dans sa simplicit. Tout ce qu'on peut af-
firmer de raisonnable cet gard, c'est que ces variations
suivirent celles de la secte qui l'avait adopte comme un
symbole de son alliance. Cette secte ne tarda pas se di-
viser, et il se fonda une foule de systmes diffrents, parmi
lesquels ceux qu'on nomma lydien, phrygien, dorien,
furent les principaux. Ces systmes consistaient
dans
GRE 251
une srie de ttraco-rdes, tantt par une simple transpo-
sition, soit au grave, soit l'aigu.
Telle est la confusion que le grand nombre de ses sys-
tmes entrana, et le peu de soins que les crivains qui
en ont parl ont mis les distinguer, que mme parmi
les trois principaux, le lydien, le phrygien et le dorien,
il est impossible de dire aujourd'hui rigoureusement si
la tonique du lydien tait mi ou ut, et celle du dorien
ut ou mi. Il n'y a pas un auteur qui sur ce point ne con-
tredise l'autre, et ne se contredise souvent lui-mme.
Dans ce conflit d'opinions contradictoires, on en distingue
pourtant deux qui autorisent donner au lydien la toni-
que mi
t
et au dorien la tonique ut. La premire est celle
d'Aristoxne, qui dit que les doriens excutaient le mme
chanl un ton plus bas que les phrygiens, et ces der-
niers un ton plus bas que les Lydiens. La seconde,
qui confirme la premire, est du judicieux Saumaise,
qui dans son Commentaire sur les comdies de Trence,
nous apprend que la musique adapte ces comdies
s'excutait sur des fltes appropries chaque mode
;
les unes servant au mode phrygien, les autres au dorien,
plus grave que le phrygien, et la troisime au lydien,
plus grave que les deux autres modes. Zarlin, en Italie,
Sax, en Allemagne, et J.-J. Rousseau, en France, ont
adopt cette opinion.
Grecs modernes (Musique des). Les Grecs modernes
n'emploient dans leur musique ni les notes dont nous
faisons usage, ni les lettres de leur alphabet, ainsi que
le faisaient leurs anctres, mais ils se servent de ce qu'ils
appellent accents. Une pareille notation a beaucoup d'im-
perfections, car elle n'indique que la gravit et l'acuit
des sons, sans en fixer la dure.
Les principaux signes sont :
1
Vison, qui dsigne le
ton fondamental de leur gamme diatonique. L'ison est le
principe, le milieu et la fin, ou plutt le systme de tous
les tons ou signes
;
car sans lui on ne peut produire au-
cun son;
2
Yoligon, signifie en gnral son aigu, et
3
Vapostrophe, son grave.
La musique des Grecs modernes est extrmement
grossire. Le fifre criard, le monotone tambour, et mme
l'inharmonieux
monocorde slave, produisent sur eux le
plus grand effet. Et c'est par une semblable mlodie que
dans la nouvelle Grce un voyageur est ft pendant
toute la journe par la socit dans laquelle il se trouve.
252
GUI
Grgorien. (Voyez le mot Chant grgorien.)
Grelots. Boulet de cuivre ou d'argent creux et fendu
que dans le xv
e
et xvi
e
sicles on ajoutait aux casta-
gnettes et aux tambourins.
Gros-bois. Instruments qui jadis taient
employs
comme basse des hautbois et dpendaient de leur syst-
me, ou provenaient de familles instrumentales drives
de la leur.
Gros fa. Certaines vieilles musiques d'glise en
notes carres, rondes ou blanches, s'appelaient jadis du
gros
fa.
Grosse-caisse. Instrument percussion
;
gros tam-
bour dont on se sert aujourd'hui dans l'orchestre, et
qu'on n'employait autrefois que dans les musiques mili-
taires. On l'utilise encore sur le thtre pour imiter le
bruit du tonnerre.
Groupes. Plusieurs notes runies ensemble par leur
queues, au moyen d'une ou plusieurs barres, forment un
groupe. Il
y
a des groupes de deux, de trois, de quatre
et de six notes. Les fuses et les gammes chromatiques
prsentent des groupes de trente-deux, de soixante, de
quatre-vingt notes.
Grupetto. Mot italien qui signifie petit groupe. C'est
un agrment de chant compos de trois petites notes pri-
ses quelquefois sur la valeur de la note qui en est affec-
te, quelquefois au lever de la mesure qui prcde cette
note.
Guadanini (Jean-Baptiste). Luthier en renom, travailla
Placentia, de 1755 1785.
Guarnerius. Famille de luthiers renomms, et dont
les instruments sont encore fort recherchs. Guarnerius
(Andr) lve d'Amati (Nicolas) travaillait Crmone en
1650 et 1696.
Guarnerius (Joseph), fils du prcdent,
travailla de 1690 1730.
Guarnerius (Pierre) frre
d'Andr, 1690 1725. Guarnerius (Joseph) dit del Jesu,
lve de Stradivarius de 1720 1745. Guarnerius
(Pierre), fils de celui-ci, de 1725 1740, Milan.
Guddok. Nom d'un violon rustique trois cordes en
usage parmi les paysans russes.
Gugenenq. Imitateur deStainer, travaillait Fssen,
en Bavire, en 1756.
Guide. C'est une partie sur laquelle on indique toutes
les entres des instruments, et qui sert au chef d'or-
GUI 253
chestre, lorsqu'il ne conduit pas sur la grande parti-
tion.
Guide-accord.
Appareil imagin en 1856 par l'abb
Couturas, consistant dans une srie de treize diapasons
donnant exactement les douze demi-tons de la gamme.
Ces diapasons sont monts sur une caisse sonore.
Guide-archet
imagin par Guhmann, et cons-
truit par Gautrot, en
1855,
pour les instruments
cordes et archet.
Guide-doigt, construit en
1754,
par Temple, pour les
instruments cordes.
Guide-main. C'est une espce de barre attache au
piano devant le clavier, destine donner plus d'lasti-
cit aux poignets et empcher qu'on ne joue du coude.
Ce procd a t invent et pratiqu par M. Kalkbren-
ner.
Guidon. Petit signe de musique qui se met l'extr-
mit de la porte, sur le degr o sera place la note
qui doit commencer la porte suivante. Si cette premire
note est accompagne accidentellement d'un dise, d'un
bmol ou d'un bcarre, il convient d'en accompagner
aussi le guidon.
Guimbarde. Petit instrument en acier compos de
deux branches recourbes, entre lesquelles est une lan-
guette qui produit des sons lorsqu'on la touche.
La
guimbarde tait galement le nom d'une ancienne danse
laquelle succda la bourre.
Guitare. Instrument six cordes, dont on joue en
pinant. Il est form de deux tables parallles, l'une en
sapin, l'autre en rable ou en acajou, assembles par une
clisse dont la valeur varie de trois quatre pouces. A
Tune des extrmits est adapt un manche divis par des
touches sur lesquelles on pose les doigts de la main gau-
che, tandis qu'on pince avec ceux de la main droite. Ce
manche est termin par un sillet, et garni de chevilles
pour monter ou descendre les cordes qui sont fixes
l'autre extrmit de l'instrument sur un chevalet fort
bas. Au milieu de la tabte suprieure est pratique une
ouverture appele rosaceou. rosette. Les cordes sontaccor-
des par quartes justes en montant, except la quatime
et la cinquime, entre lesquelles il n'y a que l'intervalle
d'une tierce majeure. L'accord de l'instrument est donc,
en partant du grave, mi, la, r, sol, si, mi. La musique
8...
254 GUZ
crite pour Ja guitare est note sur la clef de sol, mais se
joue un octave plus bas.
On ne sait rien de certain sur l'origine de cet instru-
ment. On pense gnralement qu'il est aussi ancien que
la harpe (voy. ce mot), et que les Maures l'ont apport
en Espagne, d'o il s'est ensuite rpandu en Portugal et
en Italie. Du temps de Louis XIV, il tait fort la mode
en France; mais la vogue qu'il eut fut de courte dure,
et aprs avoir brill d'un clat tout nouveau, il
y
a quel-
ques annes, sous les doigts d'artistes fort habiles, il est
aujourd'hui presque compltement abandonn.
Guitare d'amour. Espce de viole dont les cordes
taient attaques par un archet, construite Vienne en
1823,
par Staufer.
Guitare allemande. Espce de cistre mont d'abord
de cinq cordes mais qui plus tard en eut sept.
Guitare a clavier. Imagine en
1780,
par Bachmann
de Berlin. Cet instrument portait vers la droite de la
table, un mcanisme au moyen duquel les cordes taient
frappes par de petits marteaux.
Guitare-cho. Fut construite par un nomm Alix,
qui vivait Aix, vers le milieu du xvn
e
sicle. Il excuta
un squelette qui, par un mcanisme cach, jouait d'une
guitare, tandis que lui-mme avait une autre guitare
accorde l'unisson. Quand il jouait, le squelette rappe-
lait ses modulations.
Guitare-harmonica. Appareil imagin par Villeroy
de Lille, en 1821, s'adaptant au manche de la guitare,
et permettant de tirer les sons harmoniques avec nettet
et grande facilit.
Guitare latine. Guitare qui ressemble beaucoup
la mauresque mais qui possde cinq et six cordes.
Guitare-lyre. Nom donn diverses guitares cons-
truites en 1811, par Mougnet, de Lyon
;
en
1825,
par
Levien
;
en
1851,
par Ventura, Londres.
Guitare mauresque. Elle diffrait du luth, en ce que
son corps sonore plat et uni en dessus comme en dessous,
tait chancr sur les cts; n'ayant que trois cordes.
Guitarion. Instrument de l'espce guiare, imagin
en 1831 par Franck
;
les cordes pouvaient se pincer ou
tre frottes par un archet.
Gusli ou Gussel. Harpe russe qui a la forme du psal-
trion allemand.
Guzla. Instrument champtre des Morlaques, sur
HAL 255
lequel il n'y a qu'une corde de crin tresse. Cet instru-
ment sert accompagner les chants nationaux appels
pisines.
Gymnase du piano, appareil imagin en
1846,
par
Zeiger. Ce
mcanisme avait pour but de faire marcher
avec un seul doigt, une ou plusieurs octaves du piano.
Gymnase du doigt, appareil pour exercer l'agilit des
doigts. Imagin en
1856,
par Barrois.
Gymnopdje.
Danse nu, accompagne de chant,
que les jeunes filles Spartiates dansaient dans certaines
occasions.
H
H. Lettre qui dsigne en Allemagne le si naturel.
Hache (Pas de). On donna ce nom une danse forte-
ment caractrise, cette espce de pyrrhique moderne
qui est excute par une troupe de soldats, de Scythes,
de sauvages, de cyclopes ou de bacchantes, arms de
toutes pices ou couverts de peaux de btes, et tenant des
haches, des massues ou des thyrses la main. Les airs
des pas de hache sont rhythms avec force, et d'un ca-
ractre fier, martial ou sauvage. On les accompagne
d'instruments de percussion, tels que timbales, tambours,
cymbales, triangles, tambours de basque, dont les frap-
pements rhytnmiques, les vibrations argentines donnent
de l'clat ces compositions.
Les danses des soldats romains dans la Vestale, celles
des Scythes dans Iphignie en Touride, l'entre des
Africains dans Smiramis, sont des pas de hache.
Halali. Nom du cri de chasse que Ton sonne pour
annoncer que la bte se rend. Les chasseurs crient alors :
halali halali! halali! c'est--dire victoire! victoire!
victoire !
Mhul s'est servi du halali pour terminer sa belle ou-
verture du Jeune Henri. Cet air
y
forme le motif que
tous les iustruments vent attaquent fortissimo aprs
le point d'arrt. Philidor et Haydn ont aussi fait en-
tendre le halali dans la chasse de Tom Jones, et dans
celle de l'oratorio des Saisons.
256 HAR
Harmatias. Nom d'un nome dactylique de la musique
grecque, invent par le premier Olympe phrygien.
Harmodion. Chanson que les Athniens chantaient
en faveurd'Harmodius, pou ravoir dlivre Athnes du joug
des Pisistrates.
Harmomello. Nom d'une espce de piano d'une forme
verticale, imagin et construit en
1806,
par Pfeiffer.
Harmonica. Instrument de musique, d'origine alle-
mande, qui consistait d'abord en une certaine quantit
de verres ingalement remplis d'eau et placs par demi-
tons, dans une caisse. Ces instruments produisent sur
les sens un effet en quelque sorte magntique. L'harmo-
nica donnait des sons mlodieux lorsqu'on trempait les
doigts clans l'eau et qu'on les passait lgrement sur le
bord des verres aprs l'avoir humect avec une ponge
mouille. Le degr de perfectionnement auquel cet ins-
trument est arriv aujourd'hui, doit tre attribu surtout
au clbre Franklin. C'est Paris qu'on le fit connatre
pour la premire fois en 1765. Les derniers perfection-
nements sont de MM. Lenormand, Chladni et Dietz;
celui du premier consiste placer des lames de verre de
diffrentes dimensions par demi-tons, et les frapper
avec un petit marteau de lige envelopp de taffetas.
Harmonica a clavier. Cet instrument construit par
Nicola, en 1765, tait fort remarquable par sa pression
et les moyens mcaniques employs le faire fonction-
ner.
Harmonica a cordes. Instrument clavier invent
en
1788,
par Stein.
Cet harmonica consiste dans un excellent piano, ac-
cord et uni avec une espce d'pinette qu'on peut jouer
seule ou conjointement avec le piano. Cette union pro-
duisait un effet agrable.
Harmonica a touches. Instrument construit par
Klein, professeur Saint-Ptersbourg, en 1798. Il- con-
sistait dans une grande caisse traverse dans sa longeur
par une verge o se trouvait fixe une srie de cylindres
de verre, au nombre de 48,
allant en diminuant chacun
de
grandeur
;
sur le devant rgnait un clavier, dont les
touches
correspondaient des liges qui approchaient des
cylindres par la pression de la touche.
'Harmonica-accordon a bouche.
Perfectionn et
imagin en
1836,
par Paris, de Dijon.
Harmonica de dois. Instrument import en France
HAR 257
par Gusikoff, en 1831. 11 se composait d'une srie de
barres de bois d'une gale grosseur, qu'il plaait sur des
petits rouleaux de paille, et il obtenait de ces barres des
tons d'une nettet et d'une sonorit remarquables.
Harmonica de bouche.
Aussitt que le physharmo-
nica (voir ce mot), de Haechl eut paru, un aubergiste de
Bade, s'empara de l'ide principale, et construisit le
moult-harmonica, qui n'tait alors qu'une pice ronde
contenant trois languettes, et donnant la tonique, la
tierce et la quinte par l'aspiration et la respiration
;
plus
tard, l'inventeur
y
ajouta l'octave.
Harmonica celestina. Fut construit Hesse- Ham-
bourg, en
1800,
par Zinck, il avait trois claviers, et imi-
tait plusieurs espces d'instruments.
Harmonica double. Cet instrument tait compos
d'une caisse de deux pieds de longueur, et dont la hau-
teur tait en rapport avec les petites cloches de verre ou
de mtal qu'elle contenait : on faisait rsonner ces clo-
chettes au moyen d'un archet de violon, dont les crins
taient enduits de colophane ou de trbenthine, ou de
savon
.
Harmonica mtallique. Construit en
1827,
par Can-
dide Buffet, c'tait ce que l'on nomma plus tard accor-
don.
Harmonica mtorologique. Invent en 1765 par
J. Csar Gattoni, Rome. Il fit attacher quinze fils de
diffrentes grosseurs une tour trs-leve, et forma ainsi
une espce de harpe gigantesque, qui allait jusqu'au
troisime tage de sa maison, vis--vis de la tour
;
elle
tait accorde de manire pouvoir excuter de petites
sonates. Le tout russit merveille. Mais l'influence des
vicissitudes atmosphriques et d'autres circonstances
rendirent sans effet cette dcouverte; l'abb Gatoninese
servit de cet instrument que pour faire des observations
mtorologiques, et pour prdire avec ses sons harmo-
nieux les divers changements de l'atmosphre.
Harmonica virginal. Construit par un nomm Stiffel,
cherchait imiter la voix humaine.
Harmonicello. Nom donn une espce de viole
d'amour, imagin en
1794,
par Bischof, de Dessau.
Harmonicon. Sorte d'harmonica clavier, construit
en Allemagne en
1793,
par Muller, qui avait ajout
l'harmonica ordinaire deux jeux de flte et de hautbois.
Harmonicorde. Piano queue pos verticalement et
258 HAR
accompagn d'un mcanisme qui se meut au moyen d'un
pied. Cet instrument produisait des sons qui avaient
quelques rapports avec ceux de l'harmonica.
Harmonie. Ce mot a plusieurs sens. Il signifie la
runion de plusieurs accords (voy. ce mot)
;
c'est en ce
sens que l'on dit : suave harmonie, harmonie aigre et
discordante, le pouvoir de Viiarmonie, etc.
Il signifie encore Vart d'crire des accords, de les en-
chaner entre eux et de les faire concourir avec la mlo-
die, l'expression des penses et des sentiments du
compositeur. C'est la science enseigne dans les traits
d'harmonie.
Les traits de ce genre sont presque innombrables, et
il n'entre en aucune faon dans le plan de cet ouvrage
de les analyser tous, ni mme de les numrer. Les prin-
cipaux thoriciens qui font autorit, sont Rameau, Mar-
purg, dont les ides ont t reproduites par Choron et
Uelafage; Tartini, Vaotti et son cole, Vogler et son
cole, Godefroi Weber, Catel, Reicha, et aujourd'hui
MM. Ftis et Franois Bazin.
Presque tous ont essay de donner une base scienti-
fique Tharmonie, dont la vraie base est pour nous la
tonalit moderne.
La tonalit moderne est l'ensemble des rapports mu-
tuels qui existent entre les notes de la gamme moderne:
nous avons dvelopp cette dfiniton au mot tonalit.
De ces relations mutuelles, comme d'une source fconde,
jaillit tout entire la vraie thorie de l'harmonie mo-
derne. En voici le rsum :
Lorsqu'on entend simultanment la tonique d'un ton,
sa tierce, sa quinte, sa septime, et, si l'on veut, son oc-
tave, par exemple, ut
9
mi, sol, ut, dans le ton d'ut, l'in-
telligence prouve le sentiment du repos. C'est un fait
connu.
Au contraire, lorsqu'on entend simultanment la do-
minante d'un ton, sa tierce, sa quinte, sa septime, et,
si l'on veut, son octave, par exemple, sol, si, r,
fa,
sol
dans le ton d'ut, l'intelligence prouve le besoin du
mouvement et le dsir dpasser un autre accord : c'est
encore un fait connu.
Ainsi, rapport de repos entre trois notes de la gamme
moderne, et rapport de mouvemement entre ces quatre
autres notes, tels sont, nos yeux, les lments constitu-
HAR 259
tifs de la
tonalit moderne, et, par suite, de l'harmonie
moderne.
Est-ce h dire que l'harmonie soit une chose mono-
tone? Non, certes! elle offre un tel nombre de varits
d'effets qui la rendent pleine d'intrt.
Si elle n'a que deux accords principaux employer
successivement dans le mme ton, elle peut les modifier
d'une foule de manires. Elle peut les employer alter-
nativement dans le mode mineur et le mode majeur du
mme ton; elle peut doubler ou retrancher quelques-
unes de leurs notes, et les disposer de plusieurs ma-
nires; elle peut les crire dans leur tat naturel, comme
nous l'avons indiqu plus haut, ou les modifier par le
renversement, les altrations, multiples, le retard, l'an-
ticipation, la substitution, les appogiatures, les notes de
passage, les
pdcles et les progressions. (Voyez chacun
de ces mots.
)
On peut employer isolment ces modifications nom-
breuses, ou les combiner entre elles.
Le changement de ton fournit des ressources plus
grandes encore. Outre les effets multiplis et nergiques
qu'il produit par lui-mme, il permet d'employer de
nouveau toutes les richesses harmoniques que nous ve-
nons d'numrer, et peut se renouveler son tour aussi
frquemment qu'on le dsire. (Voyez le mot modula-
tion.)
Enfin, comme l'harmonie et les autres parties de la
musique forment un seul langage, sont solidaires et se
prtent un secours mutuel, l'harmonie hrite de tous
les moyens de varit que le reste de la musique pos-
sde, et qui sont galement nombreux. Tels sont, par
exemple, les formes infiniment variables de la mlodie;
les diffrents genres de compositions musicales; le
nombre et la marche des parties harmoniques; les di-
verses combinaisons possibles des voix et des instru-
ments; la mesure, le mouvement, le rhythme, les nuances
d'excution; l'accompagnement, dont les formes sont
infiniment variables, comme celles de la mlodie; le m-
lange habile des churs, solos, duos, trios, quatuors,
quintettes, etc.
;
et cent autres moyens qu'un bon matre,
un bon livre, l'exercice et l'tude des modles feront bien
vite connatre.
Veut-on une preuve vidente, palpable, irrfragable
de cette varit infinie? Voyez les uvres de tous les
260
HAR
grands
matres : toutes se rduisent l'application des
deux
principes
noncs plus haut, et, cependant, nous
le
rptons,
quelle varit infinie !
Indpendamment de ce qui vient d'tre dit, il
y
a en
musique
diffrentes acceptions du mot harmonie. Ainsi,
on
l'emploie pour dsigner la masse des instruments
vent
qui entre dans la composition d'un orchestre; on
le
prend aussi, quoique tort, comme synonyme de
composition.
Harmonie.
Terme de facteur d'orgue. On entend par
harmonie,
dans la confection des divers jeux de l'orgue,
la
qualit de sons qui convient chaque jeu, soit jeu
d'anches ou jeu bouche; on ne dit point : ce jeu est
d'un bon timbre,
d'une belle qualit; mais on dit : ce
jeu a une belle harmonie, il est d'une harmonie ronde,
moelleuse,
grle, sourde, clatante.
Harmonie
directe. C'est celle o la basse est fonda-
mentale, et o les parties suprieures conservent l'ordre
direct
entre elles et avec cette basse.
Harmonie
d'Orphe. Espce de physharmonica, cons-
truit Vienne, en 1818, par Lonard Malzel, frre de
l'inventeur du
mtronome.
Harmonie
figure. C'est celle o l'on fait passer plu-
sieurs notes sous un accord.
Harmonie
premire. Quelques auteurs ont donn ce
nom l'accord parfait, en appelant ensuite son premier
renversement
harmonie seconde, et son deuxime ren-
versement
harmonie troisime.
Harmonie
rapproche, Harmonie spare. La
premire a les sons de l'accord trs-rapprochs, et la
seconde les prsente diffremment.
Harmonie renverse. C'est celle o le son fonda-
mental est dans quelques-unes des parties suprieures,
et o quelque autre son de l'accord est transport
la
basse au-dessous des autres.
Harmonie simultane. C'est la percussion
d'un
accord.
Harmonie successive. Succession de plusieurs ac-
cords.
Harmonieux. Tout ce qui fait de l'effet dans l'har-
monie : plusieurs voix runies dans
l'excution d*un
morceau de musique plusieurs parties, rendent un son
harmonieux.
Harmoniflute ou
accordon-piano.
Construit en
BAH 26*
1852,
par Boulon, de Paris.
On donne galement ce
nom un orgue cylindre et tuyaux construit en 1853
par Corvi.
Harmoniphon. L'harmoniphon a t invent en 1837,
par M. Paris, de Dijon. L'harmoniphon est un instru-
ment vent et clavier, de quinze pouces de longueur
sur cinq de large et trois de hauteur, dont les sons res-
semblent ceux du hautbois. Il se joue avec la bouche,
au moyen d'un tube lastique qui sert
y
introduire
l'air , en mme temps que les doigts agissent sur le
clavier, qui est exactement semblable celui du piano.
L'harmoniphon produit plusieurs sons en mme
temps, et parat se prter aux accords les plus compliqus.
Harmoniques (Sons). Espce singulire de sons
qu'on tire de certains insruments, tels que le violon, la
viole, le violoncelle, par un mouvement particulier de
la main et de l'archet, qu'on approche davantage du
chevalet, et en posant lgrement la main sur certaines
divisions de la corde. Ces sons sont fort diffrents, pour
le timbre et pour le ton, de ce qu'ils seraient si l'on ap-
puyait tout fait le doigt : quant au ton, par exemple,
ils donneront la quinte, quand ils donneraient la tierce,
la tierce, quand ils donneraient la sixte, etc.; quant au
timbre, ils sont beaucoup plus doux que ceux qu'on tire
pleins de la mme division, en faisant porter la corde sur
le manche.
Les sons harmoniques de la harpe s'obtiennent en at-
taquant la corde son milieu avec la partie infrieure du
pouce.
Harmonista. Disposition mcanique imagine en
i853, par Brunt, afin de faire pour les orgues avec une
simple manivelle, toutes les harmonies dsires.
Harmoniste. Musicien savant dans l'harmonie.
Haendel, Bach, Mozart, Haydn, Gherubini, sont de
grands harmonistes.
Harmonium. Nom donn par Debainun instrument
compos de plusieurs jeux d'anches libres, qui commu-
niquent avec des gravures l'intrieur d'un sommier
formant cases sonores, lesquelles reprsentent les sons
des anches et produisent l'effet des tuyaux d'orgues; au
moyen de registres placs au-dessus du clavier, les jeux
de l'harmonium imitent diffrents jeux d'orchestre.
Harmoxomtre.
Instrument propre mesurer les
rapports harmoniques.
262 HAR
Harpe. C'est un des plus antiques instruments que
nous connaissions et dont l'criture-Sainte, ainsi que
les ouvrages des anciens font dj une mention particu-
lire. On lui donnaient diffrents noms, tels que kinnor
chez les Hbreux, la cithare chez les Grecs, la cnnara
chez les Romains, le nablum, la sambuqve et la harp
ou harpa chez les Celtes et les Cimbres. Il est de forme
triangulaire, mont de cordes de boyaux, disposes ver-
ticalement, et qui, tant pinces avec les deux mains,
donnent les sons. On sait bien que le roi David chantait
la gloire du Seigneur, et dansait mme en s'accompa-
gnant de la harpe.
Quatre pices principales composent la harpe, savoir:
la console
,
la colonne, le corps sonore et la cuvette;
cette dernire
,
en runissant les deux prcdentes
dans leur partie infrieure, forme la base de l'instru-
ment. Le corps sonore est une caisse convexe faite de
bois d'rable, plus large la base qu'au sommet, et re-
couverte d'une planche de sapin. Cette planche, sur la-
quelle se trouvent fixs les boutons qui servent atta-
cher les cordes, s'appelle table d'harmonie. Quant la
console, c'est une bande courbe en forme d's, et garnie de
chevilles qui servent monter les cordes fixes l'extr-
mit oppose sur la table d'harmonie. Pour la colonne,
enfin, elle est un montant solide ou creux, selon que la
harpe est simple ou mouvement.
La harpe ancienne n'avait d'abord que treize cordes
accordes selon l'ordre de la gamme diatonique. Plus
tard, on en ajouta d'autres, et on apporta tour tour
plusieurs perfectionnements cet instrument, dont les
principaux datent du dix-huitime sicle, et sont dus
MM. Hochbruker, Naderman, Erard. b'aprs ces ar-
tistes, la harpe dite simple mouvement (c'est -dire
ayant sept pdales, dont une pour chaque note de la
gamme), se trouve monte de quarante-trois cordes dis-
poses sur un seul rang et accordes en mi bmol. Les
crochets
y
sont remplacs par des fourchettes deux
bascules, de sorte que chaque corde peut recevoir trois
intonations, le bmol, le bcarre et le dise. On accorde
la harpe comme le piano, c'est--dire par temprament.
Quand il ne s'agit pas d'une musique intime, destine
tre coute de prs, l'effet des harpes est d'autant
meilleur qu'elles sont en plus grand nombre.
Les notes, les accords, les arpges qu'elles jettent au
HAH 263
travers de l'orchestre, sont d'une extrme splendeur.
Rien de plus sympathique aux ides de pompes religieu-
ses et de ttes potiques que les sons d'une grande masse
de harpes ingnieusement employes. De tous les timbres
connus, c'est le timbre des cors, des trombones et, en
gnral, des instruments en cuivre qui se marie le mieux
avec le leur. Les cordes infrieures, part celles de l'ex-
trmit
grave, ont un son pntrant, riche et mystrieux
dont on pourrait tirer un parti magnifique, et, cepen-
dant on les nglige presque toujours!
Les cordes de la dernire octave suprieure ont un son
dlicat, cristallin, plein de fracheur et de volupt. Mais
c'est condition qu'un pince les cordes avec douceur; car
si on les pince avec force, elles rendent un son sec et dur,
semblable celui de vitres qu'on brise.
Les sons harmoniques de la harpe , et surtout de
plusieurs harpes l'unisson, ont bien plus de magie
encore.
Rien ne saurait tre compar l'effet de ces notes
mystrieuses et feriques runies aux doux accords de la
clarinette et de la flte jouant dans le mdium.
Harpe chromatique. L'tendue de cet instrument,
invent au commencement de ce sicle, par un mdecin
saxon nomm Pfranger, est de cinq octaves. Les cordes
de la gamme diatonique sont d'une couleur blanche, et
celle de la gamme chromatique d'une couleur rougetre.
Harpe D'ole, ou Harpe olienne, Instrument dans
lequel les cordes rsonnent au moyen d'un courant d'air
qui les frappe. Aussitt qu'il fait un peu de vent, ses
cordes commencent rsonner l'unisson
;
mais
mesure que le vent augmente, elles font entendre un
charmant mlange de tous les sons de la gamme diato-
nique, ascendants et descendants, et l'on entend aussi
des accords harmonieux et des crescendo et des dcres-
cendo inimitables.
Harpe double. Instrument compos de deux harpes
runies, en usage dans le seizime sicle.
Harpe harmonica-forte. Invente par M. Keyser
de Lisle, en 1809. C'est une harpe ordinaire, laquelle
on a ajout trente-quatre cordes de laiton, accordes
deux deux, qui forment une espce de contre-basse de
dix-sept demi-tons, et qu'on fait raisonner avec le pied,
au moyen de dix-sept touches correspondant autant de
marteaux en contact avec les cordes.
264 HAU
Harpe irlandaise. Les grands dommages occasionns
en Irlande par l'irruption danoise furent rpars par
O'brien Boiromh' mort en 1014. Il rtablit les collges
des Bardes, et s'occupa de la musique avec un soin par-
ticulier. On prtend que la harpe dpose dans le collge
de la Trinit, Dublin, appartient O'brien. La forme
en est gracieuse, et le travail exqfuis. La harpe irlan-
daise resta dans le mme tat pendant plusieurs sicles
;
mais dans le quinzime sicle, elle fut sensiblement
amliore par le jsuite Nugent, qui demeura quelques
temps en Irlande. Henri VIII, quand il fut proclam roi
d'Irlande, adopta pour armoiries une harpe.
Harpo-lyre. Cet instrument, qui a la forme d'une
lyre antique, est mont de vingt-et-une cordes rpar-
ties sur trois manches. Les cordes du manche du milieu
sent les mmes que celles de la guitare, six cordes, et
sont accordes de la mme manire. La conformation de
l'instrument, permettant de dmancher plus facilement
que sur la guitare, a donn la facilit d'y ajouter quinze
cordes de plus, ce qui en porte le nombre vingt-et-
une. Ces quinze autres cordes sont rparties sur deux
autres manches, et forment dans l'ensemble de l'instru-
ment quatre octaves et demie. L'on obtient sur ces deux
manches des effets nouveaux. La harpo-lyre a t inven-
te, en J829,
par M. Salomon, professeur de musique
Besanon.
Hassard. Luthier qui vivait Eisnach, en J76o.
Hausse. Petit morceau de bois qui porte la vis de
rappel de l'archet du violon ou du violoncelle.
Haut. Ce mot signifie la mme chose qu'aigu, et ce
terme est oppos bas. C'est ainsi qu'on dit que le ton
est trop haut, qu'il faut
monter Vinstrument plus haut.
Hautbois. Instrument de musique vent, en cdre,
en chne, et le plus souvent en buis. Il
y
a deux espces
de hautbois, l'ancien et le moderne. L'ancien avait la
taille plus basse d'une quinte que le dessus, et avait un
trou de moins, le huitime ne se bouchant point : sa
longueur tait de quatre pieds deux pouces. Il
y
avait
encore la basse du hautbois, qui avait cinq pieds, et onze
trous. Le hautbois ancien se divisait en quatre espces,
le hautbois ordinaire, le hautbois de Poitou, le hautbois
des forts et le hautbois d'amour. Le hautbois moderne
a le son plus fort que la flte : sa cavit intrieure est
HAU 265
pyramidale, et se termine par le bas comme une trom-
pette.
Le hautbois est form de trois pices entrant les unes
dans les autres
;
l'anche fait la quatrime. Sa longueur
est de vingt-et-un pouces huit lignes, sans compter
l'anche : son tendue est l'unisson du violon
;
elle con-
tient deux octaves et quatre demi-tons. Le hautbois de
foret . ressemble beaucoup au hautbois militaire : il se
dmonte en cinq pices; il a la mme tendue de ton
;
mais le son, quoique agrable, est moins sonore et plus
velout. Rien n'est plus suave que le chant simple et
champtre de cet instrument.
Le hautbois est essentiellement candide, naf, simple,
innocent, et exprime encore trs-bien une joie simple et
tranquille
;
mais il est ridicule de lui demander des
accents belliqueux, triomphants, ou trop fortement pas-
sionns. Gluck et Beethoven ont admirablement compris
et employ le hautbois. Tels sont, par exemple, le solo
de hautbois qui accompagne l'air d'Agamemnon, Peu-
vent-ils ordonner qu'un pre, dans Iphignie en Aulide,
de Gluck; et la fameuse ritournelle de l'air d?Iphignie
en Tauride, malheureuse Iphignie
;
et ce cri tonnant
qui vient rveiller dans Alceste mourante le souvenir de
ses jeunes enfants. Tels sont aussi les solos de hautbois
que Beethoven a mis dans le scherzo de la symphonie
pastorale, dans le scherzo de la symphonie avec chur,
surtout dans l'air de Fidelio, o Florestan, mourant de
faim, en proie une dlirante agonie, se croit entour
de sa famille en larmes, et mle ses cris d'angoisse aux
gmissements du hautbois.
L'tude du hautbois est longue : il faut une grande
persvrance pour arriver une excution bien nette.
Le systme Bohm a abrg les difficults.
Hautbois. Jeu d'orgue compris parmi les jeux d'an-
ches
;
il ne tient que la moiti du clavier, le jeu du
basson lui servant de basse.
Haute-contre. Celle des quatre parties de la musique
correspondantes aux quatre principales voix de l'homme
qui est entre le dessus ou soprano de la taille ou tnor.
Haute-taille, ou plutt taille, deuxime des quatre
parties de la musique, en comptant du grave h l'aigu.
Quand la taille se divise en deux parties, l'infrieure
prend le nom de basse-taille ou concordant, et la sup-
rieure haute-taille.
266 HB
Hbreux (Musique des). Mose remonte, comme on
sait, jusqu'aux temps antrieurs Abraham pour l'his-
toire de l'art hbraque. Ce lgislateur appelle Jubal le
pre de ceux qui jouaient du kinnor et de Vugab. Par ce
nom il entend sans cloute le premier ou le plus habile
joueur, ou l'inventeur de ces instruments. Chaque auteur
a ensuite traduit sa guise les mots kinnor et ugab
t
les
uns par harpe et orgue, les autres par cithare et luth.
Depuis l'histoire de Laban et de Jacob jusqu'au pas-
sage de la mer Rouge, priode de deux cent quarante-
huit ans environ, la Bible ne signale aucun fait impor-
tant qui ait rapport la musique. A l'occasion du pas-
sage de la mer Rouge, Mose et les enfants d'Isral
chantrent un hymne adress Ttre-Suprme. Mariam
la prophtesse, soeur d'Aaron, prit en main un tambou-
rin, tofcl toutes les autres femmes, formant des churs
de danse, la suivirent avec des tambourins.
Aprs la mort de Mose et de Josu, c"est--d ire sous
les Juges, il n'est pas question de musique dans la Bible.
On parle seulement d'un cantique ou hymne excut par
la prophtesse Dbora et Baruk. Sous le rgne de David
la musique hbraque devint florissante, et eu prince
rendit Jrusalem le centre du culte divin. On fit la pre-
mire et la seconde translation de l'arche au son d'un
grand nombre d'instruments.
La musique parvint un haut degr de splendeur
sous le rgne de Salomon, qu'on peut appeler le sicle
d'Auguste des Hbreux. La construction du temple fut
la premire entreprise remarquable de ce prince qui,
pour la conscration de ce monument, fit fabriquer un
nombre prodigieux d'instruments. S'il faut en croire
l'historien Josphe, on comptait dans cette crmonie
quarante mille harpes, autant de sistres d'or, deux cent
mille trompettes d'argent, et deux cent mille chanteurs,
en tout quatre cent quatre-vingt mille musiciens.
Aprs la mort de Salomon, on ne voit dans la Bible
aucune circonstance o la musique ait t employe et
qui puisse faire juger de ses progrs. Enfin, Nabucho-
donosor ayant conquis et dtruit la ville de Jrusalem,
amena la plus grande partie du peuple Babylone.
Cette captivit porta le dernier coup aux Hbreux qui,
pendant soixante-dix ans, oublirent leurs chants et leurs
crmonies. Revenus possesseurs de leur ville, mais
aussitt retombs en captivit une seconde fois
;
de nou-
HON 267
veau libres, puis successivement vaincus par les Egyp-
tiens, les Perses et les Romains, les Hbreux n'eurent
plus ni le pouvoir ni le loisir de se livrer la culture
des arts.
Hlicon. Nom donn par Stoxoaller, facteur de
Vienne, une basse d'harmonie en cuivre, imagin en
1855.
Hell-hom. Nom donn en 1843 par Hell, facteur
autrichien une espce d'Octavophiclide, dont fut
import de Silsie l'instrument primitif par Sommer.
Ce fut un nomm Franois Bock qui l'acheva, et Hell ne
fit que le perfectionner.
Helmer, lve d'Eberle, construisit de bons violons,
Prague, en 1760.
Heptagorde. Nom donn une espce de lyre des
anciens Grecs qui tait monte de sept cordes; on a
galement donn de nos jours le nom 'heptacorde,
fespce de basse de viole, imagine en
1828,
par Raoul
et excute par Vuilaume. L'instrument mont de sept
cordes, donnait la chanterelle r et la, mi, ut, sol,
r, la.
Hexacorde. Instrument six cordes, ou systme
compos de six tons, tel que l'hexacorde de Guido
d'Arezzo.
Hialemos. Nome grec chant en l'honneur d'Apollon.
Hippothoros. Chant excut par les Grecs, l'poque
de l'accouplement des chevaux.
Homoeoptoton. Ce terme signifiait, chez les anciens
Grecs, une pause gnrale avec une cadence, homta-
letcton, la pause qui suivait cette mme cadence.
Homonophicon. Appareil pour accorder les anches
mtalliques, imagin en
1845,
par Schneider.
Homophonib. Nom grec du chant excut par plusieurs
voix l'unisson.
Hongrie (De la musique en). La musique jeta peu
d'clat en Hongrie jusqu'au temps de Mathias Corvin,
fils du fameux Corvin
;
il rendit les Hongrois rivaux des
autres nations clans les sciences et dans les arts, qu'il
cultivait lui-mme avec succs. Le nonce du pape qui
vint Bade, en
1483,
pour rtablir la paix entre l'empe-
reur Frdric et Corvin, combla d"loges les chanteurs
de la chapelle hongroise, dans une lettre adresse au
souverain pontife.
Sous les rois Ladislas VI et Louis II, la musique,
268
IOT
quoique cultive avec soin, Ttait avec moins d'clat. On
diminua le nombre des artistes de la chapelle de la
cour.
Gomme tous les autres peuples, les Hongrois n'avaient
d'abord qu'un chant sans mesure et sans mode dter-
min, sur une posie sans harmonie. Du reste, tandis
que toutes les autre nations, notamment celles du Nord,
aimaient les sons vifs et aigus, le? Hongrois, au con-
traire, aimaient les sons moyens et les mouvements lents.
Le chant rgulier fut plus tard import en Hongrie avec
la religion chrtienne et les belles-lettres.
Aujourd'hui les Hongrois dansent beaucoup : la danse
est leur passion
;
aussi la musique nationale est-elle,
pour ainsi dire, une musique de danse. Elle a ordinaire-
ment un caractre mlancolique, mais souvent aussi elle
est bruyante et semble exciter la guerre. Les Hongrois
se plaisent aux modes mineurs
;
et si une danse commence
en mineur, elle tombe bientt en majeur : ils aiment
aussi beaucoup les triolets.
Les Slaves, qui habitent une grande partie du pays,
et les Valaques en Transylvanie, aiment beaucoup la
cornemuse. Les Grecs qui sont en Hongrie aiment aussi
la danse nationale
;
mais ils en ont une qui leur est propre.
Les nouveaux Grecs dansent en cercle avec les genoux
replis, et les paysans valaques sautillent en rond avec
leurs btons : c'est comme une danse d'ours.
En Hongrie, les chansons nationales sont pour la plu-
part plaintives et passionnes
;
cependant il
y
en a beau-
coup de celles du bas peuple qui sont grossires, froces
et obscnes.
Tout ce qui vient d'tre dit n'est applicable qu'au bas
peuple, car la musique est cultive par la bourgeoisie et
la noblesse avec autant de zle que dans les principales
villes d'Allemagne, d'Italie et de France.
Hom regulares. Heures fixes auxquelles on excu-
tait, dans les couvents et dans les glises capitulaires,
certains chants de pratique.
Hottentots (Musique des). Les Hottentots ont une
musique et des danses particulires trs-caractristiques.
Dans leurs danses, les Hottentots, se tenant par la main,
composent une chane plus ou moins longue propor-
tion du nombre des danseurs et des danseuses placs
toujours avec beaucoup d'ordre. La chane tant forme
lesdanseurs se mettent en mouvement, tournent de ct
HYM
269
et d'autre, se quittent de temps en temps sans cepen-
dant rompre la chane, pour marquer la mesure en frap-
pant dans leurs mains, et leurs voix, s'unissant aux sons
des instruments, rptent continuellement : IIoo, hoo.
Les Hottentots terminent ces divertissements par une
danse gnrale o la chane se rompt, et o chacun
danse ple-mme et s'abandonne la plus grande joie.
Les principaux instruments des Hottentots, sont : le
rabuchin, qui est une planche triangulaire sur laquelle
on attache trois cordes de boyaux soutenues par un che-
valet, et tendues volont au moyen de chevilles. Le
rampelot, instrument le plus bruyant des Hottentots,
est form d'un tronc d'arbre creux d'environ deux ou
trois pieds de hauteur; . l'une de ses extrmits se
trouve une peau de mouton bien arrange et bien tendue
que l'on frappe avec un bton ou avec les poings. Le
gorali, instrument trs-curieux, est une longue baguette
avec une corde de boyaux de chat tendue d'un bout
l'autre de manire se courber lgrement, peu prs
comme l'archet du violon
;
au bas de la corde est atta-
ch un tuyau de plume d'autruche qui runit le bout de
la corde la baguette. Ce tuyau se place entre les
lvres, et on le tait vibrer en aspirant et en respirant
fortement. Lorsqu'il est jou avec soin, le son du gorah
approche de celui du violon.
Huit-pieds. On nomme ainsi un orgue dont les
tuyaux les plus grands ont huit pieds de haut. La qua-
trime corde du violoncelle sonne l'unisson du huit-
pieds.
Hymne. Chanson nuptiale des Grecs.
Hymeos. Chanson des anciens meuniers de la Grce.
Hymne. Chant en l'honneur des dieux et des hros. Il
y
a cette diffrence entre l'hymne et le cantique, que
celui-ci se rapporte plus communment aux actions, et
l'hymne aux personnes. Les premiers chants de toutes
les nations ont t des cantiques ou des hymnes. Orphe
et Linus passaient chez les Grecs pour auteurs des pre-
miers hymnes, et il nous reste parmi les posies d'Ho-
mre un recueil d"hymnes en l'honneur des dieux.
Hymne s'emploie ordinairement au fminin en parlant
des hymnes qu'on chante dans l'glise : entonner une
hymne, chanter une, hymne , une belle hymne. Santeuil a
compos un grand nombre de belles hymnes
,
parmi
lesquelles un remarque celle pour le jour de la Purifica-
9.
270
ILL
tion, Stupete gentes, et une pour la fte de sainte Ccile,
Festis lta sonent.
Hypocriticos. Partie de la musique grecque, qui se
rapportait la danse et la mimique.
Hyposproslambanomenos. Nom d'une corde ajoute
par Guido d'Arezzo, un ton plus bas que la proslam-
banomne, ou dernire corde grave des Grecs, qui son-
nait le la. L'auteur de cette nouvelle corde l'exprima
par la lettre gamma de l'alphabet grec, et de l nous est
venu le nom de la gamme.
Jacinthies. Ftes annuelles clbres Amycls,
sur le territoire lacdmonien, en l'honneur d'Apollon,
dans lesquelles on faisait entendre le son des fltes et de
certains instruments cordes.
Ialme. Sorte de chant funbre, en usage jadis parmi
les grecs comme le sinos chez le mme peuple et le
moneros chez les Egyptiens.
Iambgie. Espce de cithare triangulaire des anciens.
Tambique. Nom d'un acte ou d'une partie principale
d'un morceau de musique vocale, excut dans les luttes
musicales des jeux publics.
Ide. L'ide musicale est ordinairement un trait de
chant qui se prsente l'esprit du compositeur avec tous
les accessoires qu'il comporte. On voit par l qu'il
y
a
plusieurs espces d'ides diffrentes selon le genre d'ef-
fets, soit simples, soit composs, qu'on se propose. On
doit aussi distinguer les ides, en ides principales et en
ides secondaires : les premires sont propres faire la
base ou le fond d'une composition, les autres destines
au dveloppement de l'ide principale.
Illusion. Quelques crivains ont essay de rendre
l'opra ridicule cause de ses invraisemblances, endisant
qu'on ne chante pas au moment de se donner la mort ou
de se quereller. 11 faut distinguer ce sujet la vrit
d'art et la vrit de nature. On ne trouve dans la nature
ni des airs cadencs, ni des chants avec accompagne-
IMA 271
ment
;
on n'y trouve pas non plus les vers de Virgile ou
l'Apollon du Belvdre. Un travail parfait d'art est une
uvre de l'esprit humain levant les objets les plus
ordinaires une plus haute signification, une dignit
plus sublime.
Il est certain que le plus grand effet de l'art dpend de
l'illusion. Le compositeur qui veut faire agir l'illusion
sur.les autres, doit d'abord en sentir lui-mme toute la
puissance, c'est--dire que l'illusion doit subjuguer son
esprit et son cur par de vives images.
Imagination. L'imagination, considre en gnral,
est la facult de retenir l'impression des objets, d'en
arranger les images et de les combiner en mille manires.
Tous les sens fournissent des secours l'imagination;
mais ceux de la vue et de l'oue l'enrichissent plus que
tous les autres, parce que, rapprochant les distances
ou franchissant les intervalles, multipliant nos rapports
avec l'extrieur, embrassant presque dans le mme
moment le ciel et la terre, ils nous font toucher un
plus grand nombre de choses qui se gravent dans notre
esprit et
y
dposent leurs images.
L'imagination joint la rflexion et la combinaison la
mmoire. Loin de se borner subir l'influence de la
premire impression des objets ou des sons, elle s'excite
en recevoir do nouvelles
;
elle recueille et raisonne ses
propres sensations, les rejette ou les admet dans les
cadres qu'elle leur a tracs. Autour d'une ide qui la
domine, elle cherche veiller une foule d'ides acces-
soires. Son coup d
;
il rapide et sr dcouvre de gran-
des distances les rapports jusqu'alors inaperus entre
deux objets. Elle les rapproche et les unit, et leur im-
prime dans ses imitations le cachet de la nature.
L'imagination du musicien et du pote, rgle par
le got, fait en petit ce que le crateur a fait en grand
;
elle applique ses uvres la mme conomie que Dieu
l'ordonnance du monde : c'est surtout cette facult qui
paraissait aux anciens un don des dieux, ingenium
quasi int . une inspiration divine. L'imagination
qui invente avec grandeur, mdite avec profondeur, f-
conde avec patience, dispose avec sagesse et enchane
avec habilet, est du gnie. Dans les sciences, elle donne
des Newton
;
dans les lettres, des Homre
;
dans les
arts, des Beethoven, des Rossini. Et qu'on ne soit point
choqu de ce rapprochement : on dira peut-tre qu'il
y
a
272
IMI
plus de grandeur dcouvrir les lois de l'univers qu'
composer la symphonie hroque ou Guillaume Tell
;
et
cependant le musicien vivra aussi longtemps que le phi-
losophe, et restera comme lui au rang de ces organisations
suprieures dont la nature se montre avare.
Que le jeune musicien ne cherche point ce que c'est
que
l'imagination. En a-t-il? la sent-il en lui mme?
Le gnie du grand compositeur soumet le monde entier
son art; il peint tous les tableaux par des sons, il lait
parler le silence mme, il rend les ides par des senti-
ments les sentiments par des accents; et les passions
qu'il exprime, il les excite au fond des curs. La
volupt par lui prend de nouveaux charmes; la douleur
qu'il l'ait gmir arrache des cris.
Mais pour que l'imagination produise ces grands
effets, il faut qu'elle soit rgle par le got. L'imagina-
tion cre, mais le got choisit, et un gnie trop abondant
a besoin de son secours pour ne point abuser de ses
richesses. Sans got, on peut faire de grandes choses en
musique; mais c'est lui qui les rend intressantes. C'est
le got qui fait saisir au compositeur les ides du pote,
c'est le got qui metchaquechoselaplacequi luiconvient
et fait des diverses parties d'une composition musicale un
tout homogne, un ensemble harmonieux. Sans le got,
il n'y a point de chef-d'uvre complet.
indpendamment de la grande imagination qui in-
vente, dispose, dessine et colore sous les yeux de la
raison, il existe une imagination de second ordre qui est
celle des dtails. Cette imagination jette beaucoup d'agr-
ment dans un ouvrage; elle sait parfois mettre en
uvre avec beaucoup d'habilet les ides les plus vieillies
et leur faire subir une heureuse mtamorphose; mais
seule, elle ne saurait constituer des ouvrages vraiment
suprieurs.
Imitation. Si tous les sentiments ont des tons qui
leur sont propres, et si le compositeur peut se servir de
ces tons pour exprimer les sentiments, la musique,
quoique borne dans ses imitations, n'est pas moins un
art imitatif, attendu que la nature lui prsente ses
modles avec les moyens pour les reproduire.
Outre l'imitation de la nature, il
y
en a encore une
autre qui consiste suivre l'exemple d'autres composi-
teurs en les prenant pour modles. A cet gard, on dis-
lingue l'imitation
libre et l'imitation service. L'imitateur
IND 273
servile peut tre un homme de talent, tandis que l'imi-
tateur libre peut suivre les inspirations et les lans- du
gnie.
L'imitation est un artifice musical qui l'ait que plu-
sieurs parties reproduisent le mme chant des dis-
tances et des intervalles diffrents.
Immusical. Contraire la musique.
Imperfection. C'tait, dans l'ancienne musique, la
soustraction de la troisime partie de la valeur d'une
note.
Improvisateur mcanique. Machine notation pour
les improvisateurs. CeUe machine s'adapte au piano, et
tout ce que l'on joue sur cet instrument s'imprime en
mme temps.
Improviser. C'est composer et excuter impromptu
un morceau de musique. Il convient d'tre profondment
initi aux ressources de l'art; il faut en outre, tre
matre absolu de l'instrument sur lequel on improvise,
possder une me qui s'exalte aisment et une grande
prsence d'esprit, afin qu'il
y
ait de l'unit dans un
morceau cr de cette manire.
Incompos. Un intervalle incompos est celui qui ne
peut se rsoudre en intervalles plus petits, et n'a pas
d'autre lment que lui-mme. Nous n'avons dans notre
systme qu'un seul intervalle incompos, le demi-ton.
Incorrect. On appelle composition musicale incor-
recte, celle qui pche contre les rgles de l'art.
Inde (Musique de 1'). Les Hindous croient que la
musique a t invente par Brahma lui-mme, ou par
son pouvoir actif Fereswati, la desse de la parole, et
que leur fils Nared fut Tinventeur du vina, le plus ancien
des instruments en usage dans l'Hindoustan. Parmi les
mortels inspirs, le premier musicien, disent-ils, fut le
eage Bhrat, inventeur des natacs ou drames mls de
chants et de danses, et auteur d'un systme qui porte
son nom. Il
y
avait, ce qu'il parat, dans l'ancienne
musique des Hindous, quatre principaux matas ou sys-
tmes, et chaque royaume ou province avait presque un
genre de mlodie particulier, des noms diffrents pour
les modes, et une manire diffrente de les classer.
Indiens. (De la musique chez les). Il existe une si
grande analogie entre le systme astronomique et musi-
cal des Indiens et celui des gyptiens et des Chinois,
qu'un peut logiquement leur attribuer une commune
274
1ND
origine. La forme du gouvernement tant la thocratie,
]a connaissance de la musique, comme celle de toutes les
sciences et de tous les arts, n'est rserve qu'aux pr-
tres
;
c'est pourquoi la musique est lie troitement la
religion, et soumise des lois fixes et invariables.
La gamme des Indiens ne procde pas, comme celle
des anciens Grecs, par ttracordes, mais par octaves
comme la ntre. La plus grande partie de leurs gammes
ne contient que cinq ou six sons stables, et ressemble
par l l'ancienne gamme chinoise. Ces gammes, si
simples, peuvent tre considres comme les premiers
essais d'un peuple qui aime le chant, mais qui n'a pas un
systme d'acoustique complet.
Les indiens ne connaissent pas notre harmonie. Leurs
diverses espces de musique pratique sont les rectahs,
teranas, tuppas raagnies. Les deux premiers portent le
cachet d'un chant facile et rgulier. Les Hindous ont
trente-six mlodies d'un genre particulier, appeles,
rangs ou ragas, et raugines ou raffinas. Des trois
genres grecs, celui auquel elles ressemblaient le plus
tait le genre enharmonique. Il est extrmement difficile
de noter la musique des Rangs ou Raugines, parce que
notre systme ne fournit point de signes qui puissent
exprimer la petitesse de leurs intervalles. La mesure en
est rompue et irrgulire, et les modulations frquentes
et pour ainsi dire sauvages. On dit que ces chants
avaient encore plus de puissance que la musique d'Or-
phe.
Le instruments de musique en usage chez les Indiens
sont destins ou h la religion, ou des divertissements.
Les plus simples instruments dont les Bramines font
usage dans leurs temples sont le song et le gautha. Le
premier est un buccin dans lequel il soufflent de toutes
leurs forces pour appeler le peuple : le second, qui sert
au mme objet, est une petite clochette en bronze, orne
d'une tte et de deux ailes, que les Bramines font rson-
ner soir et matin dans les vestibules du temple, avant
de commencer ls sacrifices. Quelquefois on entend aussi
.le buccin dans les bazars et les marchs
;
mais alors ce
sont les Fakirs qui annoncent ainsi leur arrive.
Le Kortal es! un des plus anciens instruments des In-
diens : il est prsumable qu'ils en font usage dans leurs
crmonies religieuses, car beaucoup de leurs anciennes
idoles sont reprsentes avec cet instrument. Les indiens
INF
275
ont encore connu la lyre, la flte et le tambour. Il parat
que le violon fut aussi en usage au commencement du
dix-septime sicle dans quelques parties de cette contre.
Il
y
a dans l'Inde des chanteurs qui parcourent les
rues, et s'arrtent aux portes des maisons en chantant les
amours et les hauts laits de leurs aeux
;
ils ac-
compagnent souvent leurs chants du son de quelque ins-
trument. Ils sont vtus peu prs comme les musulmans,
et ont ordinairement une besace dans laquelle ils mettent
le riz, les fruits et tout ce qu'ils reoivent de leurs audi-
teurs.
La musique en usage aujourd'hui dans toutes les par-
ties de l'Inde soumises la domination de l'Angleterre,
ne diffre point de celle qu'on cultive en Europe. Cal-
cutta, particulirement, a t visit par des artistes dis-
tingus, chanteurs et instrumentistes. On joue dans cette
ville beaucoup de quatuors, et surtout ceux de Haydn.
Indigitament. Quelques auteurs prtendent "que ce
mot dsignait, chez les anciens romains, les chansons o
l'on trouvait plusieurs noms de divinits; d'autres affir-
ment que ces chansons taient chantes en l'honneur des
demi-dieux.
iUENOE de l musique. L'histoire de tous les
temps nous offre une foule d'exemples de la prodi-
gieuse influence de la
musique sur la civilisation, les
murs, les passions, les maladies et l'hrosme guerrier.
El] est un des principaux moyens employs pour adou-
cir le caractre de l'homme; elle s'associe h son ducation
physique et gymnastique, et dveloppe en lui les organes
de la voix, en augmentant la force de ses poumons et de
sa poitrine
;
elle s'associe galement son ducation mo-
rale et intellectuelle, en rveillant clans son cur des
sentiments de bienveillance et d'amour, et en donnant
son intelligence plus de mouvement et de vivacit.
La musique est aujourd'hui employe dans l'ducation,
particulirement en Allemagne, en Suisse en Belgique et
en France, comme un puissant moyen d'adoucir les
murs.
L'enseignement de la musique fait partie maintenant
en France de l'enseignement universitaire.
L'homme n'est pas le seul tre anim qui soit sensible
aux accents de a musique, beaucoup d'animaux mani-
festent le plaisir qu'ils prouvent en l'coutant. La mu-
sique anime le cheval pendant le combat
;
le chasseur se
276 INS
sert du chant et du cor pour charmer les cerfs, de la
flte pour les rennes, et apprivoise la frocit de l'ours
mme au moyen du chalumeau. Le chien retient en
trs peu de jours les airs de chasse qui ont presque tous
une signification particulire, et ne les confond jamais.
Inhambam (Musique des naturels d'). Dans le voyage
du capitaine Oiven, on lit qu' Inhambane, ville situe
aux bords de la rivire du mme nom, et qui forme,
sous le rapport de la salubrit, un des meilleurs tablis-
sements portugais sur cette partie des ctes orientales
de l'Afrique, les naturels du pays ont une danse trs-
sauvage, et c'est au son du tambour qu'ils se livrent ce
plaisir. Leur principal instrument est la marimbah. Il
consiste en dix morceaux ou baguettes d'un bois trs-
dur, qui sont fixs dans un cadre. Une petite calebasse
creuse sert chaque baguette de moyen de rsonnance:
le tout ressemble peu prs un harmonica. Un autre
instrument, qui s'appelle cassanga, est encore plus r-
pandu chez ce peuple. Il consiste dans une caisse vide
dont le dessus est garni d'un certain nombre de ba-
guettes en fer de diverses longueurs, et que l'on frappe
des doigts.
Inharmonie. Dfaut, manque d'harmonie.
Innogentemente, Innocemment. Cet adverbe italien,
plac au commencement d'un morceau de musique, in-
dique un mouvement modr et un caractre simple et
sans ornements.
Inspiration. Sentiment, pense, enthousiasme qui
surgit tout coup dans l'me du compositeur.
Institut. Voici son origine. L'Acadmie franaise fut
fonde en
1635,
par Richelieu, pour fixer et polir le lan-
gage. Eile se composait de quarante membres.
L'Acadmie des inscriptions et belles-lettres, fut
fonde en 1663 par Colbert
;
L'Acadmie des sciences, en
1666,
par Colbert en-
core
;
L'Acadmie de peinture et de sculpture en 1648
;
Celle d'architecture en J671
;
Ces diverses Acadmies avaient t supprimes en
1793 : elles ont t rorganises en Tan IV (25
octobre
1795), et runies en un seul corps sous le nom iInstitut
de France. L'Institut comprend aujourd'hui cinq acad-
mies, Acadmie franaise, Acadmie des inscriptions et
belles-lettres, Acadmie des sciences, Acadmie des
INS
277
beaux-arts qui runit la peinture, la sculpture, l'archi-
tecture, la gravure et la musique, et enfin l'Acadmie
des sciences morales et politiques.
Tous les ans, les cinq acadmies de l'institut se ras-
semblent pour donner une sance solennelle qui attire
l'lite de la socit parisienne.
Outre cette sance, chacune des acadmies sa sance
publique. Dans la sance publique de l'Acadmie des
Beaux-Arts on excutait grand orchestre la cantate
compose par l'lve ayant obtenu le grand prix de
Rome.
Mais depuis quelques annes un jury spcial juge les
cantates; cet examen n'est plus dans les attributions de
l'Acadmie des Beaux-Arts. (Voyez Acadmie).
Instruments de musique. On nomme instrument de
musique toute machine invente et dispose par l'art
pour exprimer des sons. La famille des instruments
de musique est nombreuse
;
elle se compose de trois
branches principales, bien distinctes Tune de l'autre,
quoique chacune d'elles ait t cre dans le mme but,
celui de rendre des sons musicaux, c'est--dire appr-
ciables par leur fixit.
Pour les dsigner particulirement, on emploie ces
diffrentes dnominations : instrument vent, cordes,
de percussion.
Pour les construire, on fait usage de matires de diff-
rentes natures, ayant de la sonorit, et possdant la fa-
cult de rendre un son fixe et apprciable.
Des instruments vent. Tous les instruments vent
se composent d'un ou plusieurs tubes agencs les uns au
bout des autres. Les tubes sont, dans la majeure partie
des instruments, percs de distance en distance de petits
trous que l'excutant ouvre ou bouche volont avec le
bout des doigts, selon la nature du son qu'il veut pro-
duire. Dans plusieurs d'entre eux, de petites soupapes
ei> mtal, et se mouvant sur un ressort, sont places sur
les tubes des distances voulues, et servent au mme
usage que les doigts, qui les font mouvoir alors, pour
ouvrir ou boucher les trous selon le besoin. On les
nomme clefs. A l'une des extrmits de l'instrument,
celle du haut, se trouve place l'ouverture par laquelle
on introduit l'air
;
cette ouverture se nomme embou-
chure.
Les instruments vent les plus connus sont : la flte
278 INS
de Pan, la petite flte, la flte ordinaire, le flageolet, le
fifre, le galoubet, le hautbois, la clarinette, le cor anglais,
le clairon, la trompette droite, la trompette recourbe,
le cor de chasse ou trompe, le cor pistons, le basson, le
serpent, le trombone, Pophielde, etc.
Ces embouchures sont libres dans la flte, armes
d'un sifflet dans les flageolets, d'un bec garni d'une
seule anche dans la clarinette, de deux anches superpo-
ses dans le hautbois, d'un bocal dans les cors, etc.
Des instruments cordes. Les instruments cordes
sont presque toujours construits en bois. Les cordes avec
lesquelles on les monte sont ou de boyaux, ou de mtal,
ou quelquefois de soie, recouvertes et entoures par un
fil d'argent. Ces dernires portent le nom de cordes
files. Toujours elles sont retenues d'une manire fixe
une des extrmits de l'instrument, et de l'autre bout
tournes sur une cheville mobile qui sert les hausser ou
les baisser volont. Dans l'une des parties de leur
longueur, except dans la lyre antique et dans toutes les
harpes, elles reposent sur une petite pice qui porte le
nom de chevalet. Presque tous les instruments cordes
sont composs de deux tables d'harmonie : celle du
dessus est presque toujours en bois sonore, tel que
celui du sapin, et celle du dessous en bois plus compacte,
tel que celui de l'rable. Ces tables, places au-dessus
l'une de l'autre, et loignes selon le besoin, sont soute-
nues par des tasseaux et des bordures auxquelles on
donne le nom ddisses. Dans quelques-unes, au-dessous
du chevalet, et dans l'intention d'opposer une rsistance
au poids que la tension des cordes l'ait supporter la ta-
ble de dessus, on place aussi comme soutien une petite
colonne en bois, laquelle on donne le nom 'me. L'on
pratique dans presque tous les instruments cordes des
ouvertures la table du dessus pour donner une issue
au son, qui sans ce moyen ne pourrait sortir de l'instru-
ment.
Pour faire vibrer les cordes, trois moyens sont en
usage :
1
l'archet,
2*
les marteaux ou sautereaux, que les
touches du clavier font mouvoir
;
3
l'attaque des cordes
opre par le pinc;
Les instruments cordes les plus connus sont pour
ceux archet, le violon, l'alto, la viole d'amour, la basse
ou violoncelle, fa contre-basse
;
pour ceux touches et h
clavier, l'orgue, le clavecin, l'pinette, le piano, le clavi-
INS 279
corde, la vielle
;
pour ceux de pizzicato, la lyre, la harpe,
la guitare, la mandoline.
Des instruments de percussion. On entend par cette
dnomination toute espce d'instruments de musique,
aptes seulement rendre un seul son, quelques excep-
tions prs, et chez lesquels on n'emploie d'autre moyen
que celui du battement ou du frottement, comme pour
le tambour et pour les cymbales.
Les instruments de percussion se font avec toutes les
matires sonores, les mtaux, le bois, etc.
Les instruments de percussion les plus connus sont,
pour ceux baguettes frappantes, le tympanum, le
triangle, le tambour, le tambourin, la grosse caisse, le
tambour chinois
;
pour ceux baguettes frappantes ou
roulantes, la caisse roulante ou tambour; pour ceux
battants, les sonnettes, les cloches, les pavillons chinois
;
pour ceux marteaux, les timbres, les carillons; pour
ceux h frottement, les cymbales, les cloches
;
les timbres
et les timbales s'accordent et font entendre tous les sons
de la gamme.
Instrumentation. C'est l'art de distribuer dans une
partition les diffrents instruments qui entrent dans la
composition d'un orchestre, de manire produire toute
sorte d'effets, soit par la douceur des timbres et la va-
rit des dtails, soit par la force et l'nergie des masses.
Dans ce sens, le mot instrumentation est de cration
moderne.
Avant Haendel, Mozart et Haydn, les compositeurs se
bornaient dans leurs accompagnements soutenir les
voix
;
d'ailleurs, le nombre des instruments tait trs-
limit. La musique instrumentale sommeillait dans l'en-
fance. Haydn, le pre de la musique instrumentale, et
Mozart, le crateur de l'accompagnement dramatique,
furent les premiers qui surent tirer parti de l'instru-
mentation, celui-l dans ses belles symphonies, celui-ci
dans ses opras.
Une bonne instrumentation exige bien des conditions
du compositeur, qui prvoit, par la seule puissance de
ses facults intellectuelles, l'effet de son orchestre,
comme si cet orchestre se faisait rellement entendre
dans l'instant o l'artiste se livre ses inspirations;
il doit possder indpendamment de ces connaissances
approfondies en harmonie, la connaissance non moins
indispensable de tous les instruments qui composent un
280 INT
orchestre, savoir leur tendue respective, leurs timbres
et leurs diffrentes qualits de son; connatre les bonnes
et les mauvaises notes de chacun, et l'effet qui peut
rsulter de leurs diverses combinaisons.
Le systme ordinaire des instruments d'orchestre se
divise en deux masses, celle des instruments cordes et
celle des instruments vent. La premire se compose de
deux parties de violon, une ou deux d'alto, et deux de
violoncelle et contre-basse
;
la seconde, de deux parties
de flte, deux de hautbois, deux de clarinettes, deux de
bassons, deux ou quatre de cors, deux de trompettes et
trois de trombones : on
y
ajoute quelquefois une partie
de timbales et d'ophyclide.
Instrumentiste. Musicien qui se livre la culture
d'un ou plusieurs instruments.
Intendant de musique. C'est presque toujours un
emploi de cour. L'intendant remplit quelquefois les fonc-
tions de directeur de musique.
Intense. Les sons intenses sont ceux qui ont le plus
de force, qui s'entendent dplus loin
;
ou bien ce sont
ceux qui, tant rendus par des cordes fort tendues ou
par des tubes puissants et sonores, vibrent par cela mme
plus fortement.
Intermde. C'est le nom gnrique de tout ce qui se
trouve intercall entre les actes d'un ouvrage dramati-
que, danses, couplets, etc. Les churs des tragiques
grecs rentraient aussi dans ce genre. L'intermde tait
fort la mode dans le sicle de Louis XIV. Molire dut
en placer dans toutes celles de ses pices qui furent
joues d'abord la cour. Dans le sicle dernier, on don-
nait aussi le nom d'intermdes aux petits opras en un
acte, tels que la Servante matresse, le Devin du village
,
etc. C'est l'Acadmie royale de Musique qui, tout en
drogeant jusqu' l'opra villageois ou comique, avait
voulu sauver sa dignit en leur donnant ce titre inusit.
Il n'y a plus aujourd'hui d'intermde dans ce sens, et le
Philtre est qualifi d'opra sur l'affiche, comme don
Juan, Guillaume Tell, la Muette ou Robert le Diable.
Interprte musical. Est un appareil imagin par
Guerout en
1845, s'adaptant aux pianos et facilitant la
tenue de la mesure.
Intervalle. Rapport de deux sons ingaux, eu gard
leur degr d'lvation, par opposition l'unisson qui
est celui de deux sons gaux. Ces rapports sont appr-
JNT
281
ciables par l'oreille; de mme que celui de deux points
confondus ou spars dans l'espace, est apprciable par
les yeux. L'intervalle est donc la distance qui existe entre
un son et un autre son plus grave ou plus aigu, distance
exprime en musique par le nom que porte chacun de
ces intervalles qui se mesurent en degrs de l'chelle
diatonique, et c'est le nombre de ces degrs qui sert
nommer l'intervalle. Ainsi, l'on appelle seconde l'inter-
valle form des deux sons les plus rapprochs, tierce
celui qui se trouve compris entre deux sons spars par
un troisime, quarte celui qui renferme quatre sons,
quinte celui qui en comprend cinq, et ainsi, mesure
que la distance s'accrot d'un son, sixte, sejjtime, octave,
neuvime, dixime, etc.
Les intervalles peuvent tre modifis de diffrentes
manires, selon que les sons dont ils se composent sont
eux-mmes modifis par un bmol, un bcarre ou un
dise. De l leur classification en diminus, mineurs,
majeurs et augments, termes qui expriment leurs diff-,
rents degrs d'extension par rapport au mode ou la
tonalit.
Intonation. Action d'entonner. L'intonation peut tre
juste ou fausse, trop haute ou trop basse, trop forte
ou trop faible, et alors le mot intonation,
accompagn
d'une pithte, s'entend de la manire d'entonner.
Introduction. Morceau de musique d'un mouvement
grave, compos d'un petit nombre de phrases, souvent
mme de quelques mesures ou de quelques accords
solennels destins annoncer le premier allegro d'une
symphonie, d'une ouverture, d'une sonate ou de toute
autre pice instrumentale. L'ouverture 'Iphignie en
Aulide, celle de la Flte enchante,
commencent par une
introduction. Quelques compositeurs dramatiques, don-
nant plus d'extension et un mouvement plus anim
l'introduction, lui on fait tenir la place de l'ouverture,
dont elle n'a pourtant ni la forme, ni les dveloppements.
Lorsque la pice tale en commenant un grand spec-
tacle, lorsqu'elle dbute par quelque pompe triomphale,
par l'arrive d'une fouie innombrable, une entre magni-
fique, quelque sacrifice solennel, quelque crmonie
auguste, quelque phnomne terrible de la nature,
comme un naufrage, une tempte, tous ces objets sont si
beaux, que le musicien peut les montrer d'abord sans les
annoncer; il n'en frapperont pas davantage. C'est ainsi
282
1NV
que Gluck a supprim, dans Iphignie en Tauride, l'ou-
verture
proprement dite, pour
y
substituer la reprsen-
tation du premier vnement de la pice. Son drame
dbute par le grand tableau du calme, d'une tempte qui
lui succde, de la foudre qui clate, de la mer souleve,
de la dsolation d'iphignie. Celte manire de commen-
cer un opra est trs-brillante.
Il
y
a deux sortes d'introductions : la premire est
purement symphonique, nous en avons dj parl; c'est
l'bauche d'une ouverture. L'introduction de la seconde
espce est faite, au contraire, pour captiver l'attention du
spectateur au lever du rideau en lui prsentant de magni-
fiques images, une action dj lie et l'expression des
sentiments, quand il ne s'attend qu'aux rcits de l'expo-
sition
;
ces rcits viendront ensuite, et on leur donnera
tous les dveloppements
ncessaires pour l'instruire de
ce qui s'est pass et de ce que l'on va faire.
Introt. Prires que le prtre dit aussitt qu'il est
.mont l'autel et qui sont chantes par le chur au
commencement des grandes messes en musique.
Invention. On nomme invention l'art, ou pour mieux
dire, la facult de trouver des ides. Ce terme indique
suffisamment que nous la regardons entirement comme
un don de la nature. On ne peut point prescrire de
rgles ce sujet, mais seulement tracer quelques obser-
vations.
On distingue l'invention dans le plan, clans la conduite,
dans l'allure d'un morceau, et cette invention qui con-
siste seulement imaginer des dtails frais, ingnieux,
et par cela mme neufs et
originaux. La premire est
plus puissante et a plus de grandeur; la seconde, qui
nglige quelquefois la nouveaut dans la forme pour ne
s'attacher qu' une sorte de nouveaut dans le mouve-
ment de la phrase, dans l'originalit du rhythme, dans
la marche de l'harmonie, produit une impression moins
forte et n'est quelquefois apprcie que par ceux qui ont
tudi les ressources et nous dirions presque les mystres
de l'art.
Pour que l'invention soit complte, il faut qu'elle
rside la fois dans la forme et dans les dtails. Il ne
i'aut pas que le dsir de Yinvention fasse tomber dans
Y
excentricit, c'est--dire dans des bizarreries que le
got rprouve.
Inversion. L'inversion consiste prendre un sujet ou
1HL 283
trait quelconque de mlodie, dans un ordre diffrent de
celui o il est propos. Cette opration se nomme autre-
ment imitation inverse.
Il
y
a quatre sortes d'inversions : la premire se nomme
inversion simple
;
elle consiste renverser tous les
intervalles d'un trait de mlodie, de manire que ceux
qui sont ascendants dans le sujet soient descendants dans
la rponse, et rciproquement. Cette inversion peut se
faire l'octave, la quinte, la seconde ou l'unisson.
La seconde est appele inversion stricte; elle se fait
comme la prcdente, mais sans prendre aucune licence,
et de manire que les tons rpondent aux tons, et les
demi-tons aux demi- tons. Pour cela, il faut commencer
l'inversion la septime, la sixte ou la tierce majeure
en dessus, et laisser les demi-tons sans altration dans la
partie rpondante.
La troisime espce d'inversion se fait en copiant toutes
les notes, commencer par la dernire, en rtrogradant
jusqu' la premire inclusivement, soit sur le mme
degr, scit sur un degr plus haut ou plus bas, selon
que l'exige la modulation. Cette inversion se nomme
rtrograde.
Enfin, la quatrime espce d'inversion est celle o l'on
renverse cette troisime sorte par mouvement contraire,
depuis la premire jusqu' la dernire note. On la nomme
inversion rtrograde et contraire.
Lwitatorium. Nom de l'antienne avec laquelle on
rpond, dans l'glise romaine, au psaume Venite exul-
temus.
lo Bacchus, Chanson en l'honneur de Baechus,
que les anciens chantaient dans les l'tes et les sacrifices.
Un rptait souvent dans ces chansons les mots lo et
Bacclius.
Ionien. Le mode ionien tait, en comptant du grave
l'aigu, le second des cinq modes moyens de la musique
des Grecs.
Irlande (Del musique en). Les compositions orien-
tales sont d'une grce, d'une mollesse, d'un raffinement
d'expression et de sentiment dont n'approche aucun au-
tre peuple ancien ni moderne.
La ressemblance qui existe entre la langue et les airs
d'Irlande et la langue et la musique d'Orient, se retrouve
284
IRR
galement dans les posies et les images qui l'embellis-
sent, en sorte qu'elles sont une preuve nouvelle de l'ori-
gine orientale du peuple de cette le.
Spencer appelle les chansons irlandaises un pome
parsem de petites fleurs
qui se donnent de la grce et
de la beaut les unes aux autres. Le langage en est
chaste, lgant et pur
;
les nuances qu'elles retracent
sont d'une rare fracheur, et on
y
retrouve plus d'un
trait sduisant du caractre national, et surtout l'inspi-
ration de la belle et riche nature d*rin. L'blouissante
neige dont au printemps la vgtation couvre les arbres,
le murmure des cascades, le plumage des oiseaux, la gra-
cieuse et mlancolique verdure de l'le d'meraude, sont
les ternels objets de descriptions riches et vraies.
Au milieu de tous les malheurs de cette belle et po-
tique contre, la main de fer des oppresseurs n'a pu,
travers les sicles,
y
touffer les plus tendres, les plus
nobles sympathies du cur : le despotisme n'y a point
alourdi les ailes de la pense. Cependant quelques por-
tions de l'Irlande peuvent seules prtendre tre encore
aujourd'hui appeles la terre de la chanson. La musique
et la posie ont suivi les destines de la langue, et se sont
comme elle replies devant la conqute politique et reli-
gieuse de l'Angleterre, pour se retirer dans les comts
o la langue ancienne et la foi catholique ont survcu
aux perscutions. La posie nergique et plaintive, celle
qui chante le courage et le patriotisme, celle qui se la-
mente sur les tombeaux et les ruines, l'ode et l'lgie
sont restes au Munster, dans le Waterford dans le
Kerri, dans les pays de Clare et de Limerick. La chan-
son, celle qui dcrit la fleur des champs, la fracheurdes
bocages, l'azur des lacs, la grce et la beaut des femmes,
est reste dans le Gohvay, le Alayo, leConnaugth. Le
Connaugth est vritablement la terre de la chanson :
c'est l que de gnration en gnration se perptuent
quelques chants dont l'air et les paroles sont antrieurs
au quatorzime sicle, et quelques autres dont la tradi-
tion a perdu l'origine, mais qui par le sujet semblent ap-
partenir l're du paganisme.
Irrgulier. On appelle dans leplain-chanttons irr-
guliers, ou plutt pices irrgulires, certains chants
dont il est difficile de dterminer le ton, parce qu'ils pa-
raissent appartenir en mme temps plusieurs tons de
plainchant. De ce nombre sont :
1
le chant du psaume
ITA 285
In exitu Isral et son antienne;
2
l'antienne Hc dies
des jours de Pques.
Italie (De la musique en). Quand la musique reparut
dans le moyen-ge, sa nouvelle existence fut due la re-
ligion. Exile de Rome paenne, la musique se rfugie
dans le sein de Rome chrtienne, d'o, l'aide des Au-
gustin, des Ambroise et des Grgoire, elle remonte au
rang qu'elle est appele occuper dans les temples. Elle
n'eut alors ni moins de puissance, ni moins de popularit
que chez les Grecs, et ce fut encore le mode diatonique
qu'elle employa pour exercer son empire. Ce mode, elle
l'avait reu des Grecs. Mais le genre chromatique, consa-
cr par ce peuple clair et sensible aux arts, au thtre,
aux plaisirs de la vie, fut longtemps ignor la renais-
sance de la musique : car dans les temps d'affliction et
de douleur o l'Europe, et surtout l'Italie, se trouvrent
quand les barbares parurent, le sentiment qui dominait
l'me accable n'tait ni celui de la joie, ni celui du
plaisir.
Cependant les invasions des barbares cessent. La mu-
sique, introduite dans les glises, est un des plus puis-
sants auxiliaires de la religion. Des cathdrales sont
fondes, des chapitres dots, et le clerg s'efforce de
faire fleurir celui de tous les arts qui lui est le plus effi-
cacement utile. Bientt il ne se borne point au chant
grgorien et l'orgue dont il le fait accompagner dans
les Te Deum, les motets, les vpres et les messes
;
mais
il imagine d'honorer plus solennellement encore le Sei-
gneur en faisant reprsenter en musique la passion du
Christ, les adorations de la Vierge, celles des anges. De
l le retour de la musique dramatique et du genre chro-
matique des Grecs, galement dus l'glise.
Vilani, historien du quatorzime sicle, et l'Amirato,
rapportent que le cardinal Riario fit reprsenter Rome
la Conversion de saint Paul, pice dont la musique fut
compose par Francesco Baverini.
Au rapport de Quadrio, ds l'an
1480, on commena
dans cette ville reproduire sur la scnn des sujets pro-
fanes
;
mais on
y
jouait depuis deux sicles des sujets
sacrs.
Ds cette poque, la noblesse ne brigua pas moins que
le clerg l'honneur d'instituer, de fonder, la musique
dramatique. Albertino Muffato de Padoue dit qu'en 1300
on rcitait dj en musique sur les thtres, les faits et
0..
286 iTA
gestes des grands capi Laines, crits en langue vulgaire,
mais versifie. AngePolitien, cet crivain si lgant dans
une langue qui dj n'tait plus parle en Europe que
par les savants, compose, en 1475, son drame intitul :
Orpheo. En 1480, on reprsente Rome une tragdie en
musique, et neuf ans plus tard le clbre Bergonzio
Botta, de Tortone, s'immortalise par la plus clatante
des ftes qu'il donne dans son palais Milan, l'oc-
casion du mariage de Jean Galeas Visconti, souverain de
ce duch, et d'Isabelle d'Aragon, fille d'Alphonse, duc
de (Jalabre.
En 1555,
Alpbonso Viola met en musique, pour la
cour de Ferrare, il sacrificio, drame pastoral, dont Agos-
tino Beccari avait fait les paroles. Mais il convient d'ob-
server que le drame lyrique n'avait encore pour musique
qui lui ft propre que celle de l'glise, qu'on lui appli-
quait tant bien que mal.
L'poque historique de la naissance de la musique
dramatique fut celle de l'invention du rcitatif, ou mu-
sique parle, la seule qui devait donner la tragdie ly-
rique son vritable langage et sa constitution spciale et
positive. Cet vnement est trs-important dans l'his-
toire de l'art dramatique et musical.
Dans le treizime sicle, trois gentilshommes floren-
tins, aimant les arts avec enthousiasme et le thtre
avec passion, peu satisfaits des efforts tents jusque-l
pour perfectionner le drame lyrique, se proposrent de
faire composer un ouvrage par le meilleur pote et le
plus habile compositeur de musique qu'on pt trouver
dans ce temps. Octave Rinnucciniet Jacques Pri furent
choisis pour excuter ce travail. Le premier ft le pome
de Baphne, auquel le second appliqua une dclama-
tion note qui n'avait pas tout le soutien et la mesure de
la musique, mais qui en avait ce qu'on appelle la tona-
lit. Cette pice fut reprsente en 1597.
Tandis que Florence prludait si heureusement l'in-
vention du grand opra, Rome suivait son essor; elle
faisait excuter, en forme d'oratorio, un opra compos
par un de ses citoyens, nomm Emiiio ciel Cavallire, et
qui portait pour titre le nom singulier de l'Anima e il
Corpo.
Mais nous touchons l'poque o la musique dramati-
que va briller d'un vif clat.
A partir du seizime sicle, la musique italienne entra
ITA 287
vraiment dans une voie de progrs et de rgnration.
Rome, Naples, Florence, Milan, Turin, Venise, toutes
les villes de l'Italie, s'associrent pour rendre un culte
fervent l'harmonie renaissante, et quelques-unes d'en-
tre-elles portrent le drame lyrique son plus haut de-
gr de perfection.
L'cole Napolitaine mrite la premire de fixer notre
attention.
Jusqu'au commencement du dix-septime sicle la
musique dramatique n'avait subi Naples que trs-peu
de perlectionnements. Il fallait qu'un homme de gnie
vnt lui frayer une route originale. Ce compositeur pa-
rut : c'tait Alexandre Scurlatti
;
fcond autant qu'il fut
ingnieux et neuf dans ses compositions, il ne brilla pas
moins dans la musique d'glise que dans celle de la
scne. Il a compos plus de deux cents messes pour
l'une, et pour l'autre un grand nombre d'opras, dont
les plus beaux sont : Mithridate, Cyrus, Regulus et
celui de la Princesse
fidle.
Dans le mme sicle que ce grand homme, vcurent
d'autres gnies clbres : tels furent Lo Durante, Gae-
tano-Graco, Feo, Lonard Lo. etc.
Au dix-huitime sicle, l'cole napolitaine fut gale-
ment fertile en compositeurs minents. Le premier de
tous dans l'ordre chronologique, est Nicolas Porpora,
un des plus brillants lves d'Alexandre Scarlatti. Ses
principaux ouvrages sont Ariana et Teseo, Smiramis,
Tamerlano, Il Trionfo di Camillo.
Mais de tous les compositeurs que l'cole de Naples
vt s'lever pendant la premire moiti du dix-huitime
sicle, Pergolse est sans contredit celui qui a le plus
contribu au progrs de l'art musical. Au nom de Pergo-
lse, les images les plus pures, les plus suaves de la m-
lodie se prsentent en foule h la pense.
Pendant la seconde moiti du dix-huitime sicle, on
vit natre encore un grand nombre d'artistes plus ou
moins distingus, tels que Jomelli, Caffaro, Farjetta,
Majo, Fiorello, et surtout Piccinni, dont le gnie souple
et fcond a exerc tant d'influence, non-seulement sur
son pays natal, mais encore sur la musique franaise.
A partir de Piccinni, l'cole napolitaine ne cesse
de marcher dans une voie de progrs : les chefs-
d'uvre abondent, les grands matres se succdent.
Parmi ces derniers, il faut signaler Gasparo Sacchini,
288 ITA
Paisiello, Cimarosa, Spontini, l'illustre auteur de la
Vestale et de Fernand Cortez, Caraffa, Dlia Maria et
Fioravanti, qui a laiss la scne franaise une preuve
de son gracieux talent en crivant / virtuosi ambulanti.
Aprs Nnples, Venise est une des villes de la pnin-
sule qui prirent le plus de part au mouvement de rg-
nration musicale. Au dix-septime sicle, la musique
dramatique acquiert Venise de grands dveloppe-
ments. Francesco Gavalli introduit le got de l'opra
dans cette partie de l'Italie, Stradella le seconde avec
ardeur dans cette tche importante et difficile.
L'opra continue pendant tout le cours du dix-sep-
time sicle subir d'heureux perfectionnements. Bene-
detto Marcello dbute, Venise, par l'opra de Do-
rienda, qui obtient un magnifique succs. Antonio Cal-
dara, Vivaldi, Pietro Porfiri, illustrent aussi la mme
poque l'cole de Venise
;
on distingue encore le clbre
violoniste Giuseppe Tartini, si connu par sa dcouverte
du troisime son.
Gorelli, Bacranello, Angelo, Via, Salieri, compltent
la brillante srie des compositeurs de l'cole vnitienne.
Aprs cet aperu sommaire des progrs de la musique
Venise, jetons un coup d'il sur l'cole de Florence.
L'cole de Florence, quoique beaucoup moins consid-
rable que les prcdentes par le nombre des ouvrages
qu'elle a produits, est manifestement leur ane. En
effet, c'est Arezzo, une des villes de la Toscane, qu'est
n Guido, auquel l'Europe doit les premiers lments
de la musique moderne.
Gomme nous l'avons dj dit, Giacomo Pri fut le
premier compositeur qui jeta quelque clat sur l'cole
florentine
;
il introduisit le premier les airs dans l'opra.
Gorsi brilla conjointement avec Pri.
Au dix-huitime sicle, l'cole de Florence vit clore
de brillants compositeurs. Signalons parmi eux Antonio
Pistorini, qui, dans les intermdes et l'opra bouffe, fit
preuve d'un talent plein de grce et de flexibilit
;
Ber-
nardo Mengozzi, qui a donn la scne franaise de
charmantes compositions, la Dame voile, une fautepar
amour
;
enfin, l'illustre Cherubini, un des plus pro-
fonds musiciens de ce sicle.
Les premiers compositeurs de l'cole romaine, et le
plus grand de tous, Palestrina, se vourent exclusive-
mont la musique d'glise.
JAV 289
Pendant le seizime sicle, Rome vit fleurir Dlia
Viola, clbre dans la musique de thtre, et sans con-
tredit le premier compositeur dramatique de l'cole
romaine. Carissimi, Allegri, Benevoli, Nicoletti, illus-
trrent par leurs travaux cette cole au dix-septime
sicle.
Au
dix-huitime parat Sarti, auteur de plusieurs
opras, dont la mlodie est agrable, dont les airs sont
faciles et doux. A la mme poque, Antonio Buroni
composa galement plusieurs opras, dans lesquels il
joignit la solidit de son cole l'clat, la facilit et la
grce de celle de Naples. Citons encore Bernardo Porta,
qui a fait pour la scne franaise les Horaces et le Conn-
table de Bourbon, ouvrages bien accueillis l'Acadmie
royale de Musique, et le Diable quatre, qui obtint un
trs-grand succs TOpra-Comique.
Compltons cette brillante galerie par les noms des
compositeurs de l'Italie moderne : Par, Mercadante,
Pacini, Donizetti, les frres Ricci, Bellini, ce grand
artiste qui s'est teint, comme Lopold Robert, dans
toute l'effervescence, du gnie
;
Rossini, le puissant pro-
moteur de lu rvolution musicale qu'a vu s'accomplir
le dix-neuvime sicle
;
enfin Verdi, qui a trouv des
formes nouvelles pour le chant, donn plus de vrit aux
rcits et rpandu dans l'orchestre un intrt particulier.
Iulos. Chansons des moisonneurs grecs, chantes en
l'honneur de Crs.
Javanais (Musique des). Les Javanais ont port la
musique un haut degr de perfection
;
on le voit vi-
demment par la construction de leurs instruments de
musique. Ces instruments sont de trois espces : vent,
archet et de percussion. La fabrication des deux pre-
mires espces est encore dans l'enfance, et c'est unique-
ment dans la dernire qu'il faut chercher la perfection
de la musique des Javanais.
Le tambour est l'instrument national : mais il a diff-
290 JAV
rents noms, suivant les divers dialectes. Outre les diff-
rentes espces de tambours qui leurs sont propres, les
Javanais en ont encore emprunt aux Arabes et aux
Europens. Ceux du pays se battent avec les mains, et
paraissent avoir un son faible et peu harmonieux.
Le tambour le plus connu est celui qu'on appelle
gongs ou goung. La matire dont il est fait est une
composition de zinc, de cuivre et d'tain. Beaucoup de
goungs ont l'norme diamtre de quatre cinq pieds, et
au milieu un bouton qu'on frappe avec des fuseaux dont
la tte est garnie de gomme lastique ou d'un tampon de
laine. Le son de cet instrument est d'une force et d'un
effet extraordinaires
;
c'est peu prs l'instrument que
nous nommons tamtam.
Le kromo ou bonang est un autre instrument qui con-
siste en plusieurs bassins dont le diamtre est gal
celui du goung, et dont le son est fort, mais doux en
mme temps.
La dernire classe des instruments percussion s'ap-
pelle staccaios. Le staccato de bois se compose d'un certain
nombre de btons de bois durs et sonores, disposs par
ordre de grandeur au-dessus d'une cuelle de bois, et
qu'on frappe avec un petit marteau. Une seconde espce
de staccato ne diffre de la premire qu'en ce que les
btons ou baguettes, au lieu d'tre de bois, sont de
mtal. Le son du staccato de bois est doux, mais sans
intensit, tandis que le staccato de mtal a le son plus
fort et plus dur.
Quant au caractre de la musique javanaise , on
remarque que les instruments ont tous le mode dans
lequel sont les plus vieilles mlodies cossaises, irlan-
daises, celles de la Chine, et quelques-unes des Indes
orientales et de l'Amrique septentrionale. Il parat donc
que toute la musique vritablement indigne de Java est
compose dans le genre ordinaire enharmonique.
Les mlodies ont presque toutes une mesure simple.
Plusieurs des cadences rappellent la musique cossaise
pour la musette
;
d'autres, en mineur, offrent cette sin-
gularit, que l'intervalle entre les septime et huitime
degrs est d'un ton entier, ce qui montre videmment
leur antiquit. 11 est presque inutile d'ajouter que chez
les Javanais, comme chez tous les insulaires indiens,
l'art d'crire les notes est inconnu : tous leurs airs, qui
sont en grand nombre, se jouent de mmoire.
JEU 29|
Jrmies. On donne ce nom aux parties ou leons de
l'office de la semainesainte, composes avec des fragments
du prophte Jrmie. On emploie, pour chanter ces
leons, une espce de rcitation mlodique plus varie
que ia psalmodie, et soutenue ordinairement par un
instrument grave, tel que le basson ou le violoncelle.
Les
jrmies sont notes dans les livres du plain-
chani.
Quelques compositeurs ont crit des jrmies en
musique.
Jet. Les morceaux de musique d'un seul jet sont ces
rares coups de gnie dont toutes les ides sont si
troitement lies, qu'elles n'en forment pour ainsi dire
qu'une seule, et ne pourraient pas se prsenter l'esprit
du compositeur l'une sans l'autre. Tels sont
,
par
exemple, le chur du premier acte dans la Clmence de
Titus, de Mozart, et la magnifique ouverture de la Flte
enchante.
Jeu. Nom que l'on donne un groupe de tuyaux
d'orgues rangs sur un mme registre.
Tous les tuyaux du mme jeu rendent des sons qui ne
diffrent que du grave l'aigu, tandis que les tuyaux
d'un autre jeu rendent des sons d'un autre timbre.
Les jeux, outre les noms qui les distinguent les uns
des autres, comme jeu de flte, jeu de trompette, pren-
nent encore une dnomination de la longueur en pieds
de leur plus grand tuyau.
On les divise en deux classes, savoir : les
j
'eux bouche
qui forment le fond de l'orgue, etlesjeux d'anche, ainsi
nomms parce que l'embouchure de chacun de leurs
tuyaux est arme d'une anche en mtal.
On appelle encore jeu, l'association de certains jeux
disposs pour tre entendus ensemble : le grand jeu,
le plein jeu. On dit d'un instrumentiste en parlant de
son excution qu'il a un yAijeu.
Jeu cleste. Qualit de son trs-agrable et d'une
grande douceur que l'on obtient sur l'orgue et le piano,
au moyen de la pdale qui fait avancer des languettes de
buffle entre les cordes et les marteaux. Le jeu cleste est
d'un effet encore plus flatteur, si, pour prolonger les
sons, on joint cette pdale celle qui lve les touflbirs,
et que l'on nomme vulgairement grande pdale.
Jeux chrysantiniques. C'taient des ttes grecques
clbres Sardes, capitale de Lydie, conjointement
des concours de musique.
292 JON
Jeux isthmiques. Ces jeux taient clbrs tous les
trois ans, pendant la nuit, Corinthe.
Jeux nmens. A Argos, on clbrait tous les deux
ans les jeux nmens en l'honneur d'Hercule, vainqueur
du lion de Nme.
Jeux olympiques. Les Grecs clbraient tous les
quatre ans les jeux olympiques prs de l'ancienne ville
de Pisa et du fleuve Alphe, dans la vaste plaine
d'Otympie, aussi dlicieuse par sa position que par les
chefs-d'uvre de l'art qu'elle renfermait. Dans ces ftes
populaires, on dcernait des prix aux concurrents de
musique.
Jeux pythiques. Pour ce qui avait rapport la mu-
sique, les jeux pythiques taient les plus importants.
Consacrs ds le commencement au chant, ils taient
le vrai sige des concours de musique, quoique les
courses de chevaux, de char, l'escrime et les autres
exercices gymnastiques lissent aussi partie de ces jeux.
Jongleurs. Joueurs d'instruments qui, au dbut de
notre posie, se joignaient aux troubadours ou potes
provenaux, et couraient avec eux la province.
L'histoire du thtre franais nous apprend qu'on
nommait ainsi des espces de bateleurs qui accompa-
gnaient les trouvres fameux ds le onzime sicle.
Comme ils jouaient de divers instruments, ils s'asso-
cirent avec les potes et les chanteurs pour excuter les
ouvrages des premiers
;
et ainsi de compagnie, ils s'in-
troduisirent dans les palais des rois et des princes, et en
tirrent de magnifiques prsents. Leurs jeux consistaient
principalement en gesticulations, tours de passe-passe,
etc., ou en quelques mauvais rcits du burlesque le plus
trivial. Leurs excs ridicules et extravagants les firent
tomber dans une telle dconsidration, que, pour dsi-
gner alors une chose mauvaise, folle, vaine et fausse, on
l'appelait jonglerie. Philippe-Auguste les chassa
;
ses
successeurs souffrirent qu'ils revinssent en France. On
en trouve la preuve dans le tarif fait par saint Louis,
pour rgler les droits de page dus l'entre de Paris,
sous le Petit-Chatelet. Ce tarif, dans un de ses articles,
porte que les jongleurs seront quittes de tout page en
rcitant un couplet de chanson, ou en
faisant gamba-
der leur singe devant le pager.
Vers 1400, les trouvres et les jongleurs se spa-
rrent. On ne parla plus de ceux-ci, que l'on appela en-
JOU 293
suite bateleurs, cause des tours surprenants qu'ils
s'taient adonns faire avec des pes ou d'autres
armes.
Jouer des instruments. C'est excuter sur ces ins-
tuments des airs de musique, surtout ceux qui leur sont
propres, ou les chants nots pour eux. Le mot jouer
tant devenu gnrique, s'applique maintenant tous
les instruments.
On disait autrefois : jouer du violon, pincer la harpe,
toucher l'orgue, donner du cor, sonner de la trompette,
blouser les timbales, battre le tambour, etc. Le mot
jouer a remplac tous ces termes, et il en rsulte un
double avantage :
1
de simplifier le langage et de pr-
venir toute fausse application;
2
de pouvoir consacrer
ces mmes termes des actions tout fait trangres
l'art musical, quoiqu'elles s'oprent par les moyens
qu'il fournit. Ainsi, nous disons sonner de la trompette,
donner du cor, battre du tambour, lorsqu'il s'agit d'une
charge de cavalerie, d'une chasse au cerf, ou de l'appel
d'un rgiment.
Journaux de musique. Les premiers journaux de
musique qui parurent en France n'offraient qu'un m-
diocre intrt. Le Journal hebdomadaire, le Journal des
Troubadours, le Journal d'Euterpe, le Chantre du Midi,
et quelques autres productions du mme genre, n'ont eu
chez nous qu'une dure phmre.
Il faut le dire, la plupart de nos journalistes littra-
teurs se sont longtemps efforcs de nous faire passer
pour des ignorants en musique. Analyses ridicules,
grossires mprises, absurdits, faux raisonnements
drivant d'un systme faux sur tous les points, voil ce
qu'on trouvait jadis dans certains feuilletons
,
quand
leurs rdacteurs ne se bornaient pas au protocole ds
longtemps adopt, lequel consiste dire que la musique
d'un opra est belle, dlicieuse, admirable, ou qu'elle est
mauvaise, pitoyable, etc.
Pendant que la France tait encore si arrire, l'Alle-
magne faisait un pas immense dans la carrire du jour-
nalisme musical. Nous devons mentionner particulire-
ment la Gazette musicale de Berlin, la Gazette musicale
de Vienne, la Gazette musicale des tats d'Autriche, et
surtout l'excellente Gazette de Leipsig
,
s
recueil d'un
mrite trs-remarquable, entrepris en 4798, et dont la
294 KAR
rdaction a t confie pendant vingt ans au savant cri-
vain, Frdric Rochlitz.
En France, quelques crivains se sont efforcs de sui-
vre cet illustre modle. En 1827,-
M. Ftis publia la
Revue musicale, dont il a t le directeur et le principal
rdacteur jusqu' la iin de 1833. Ce recueil a rendu de
grands services la musique. Il parat encore mainte-
nant sous le titre de Revue et Gazette musicale de
Paris. En 1838 a paru la France musicale, sous la di-
rection des frres Escudier. Ce recueil a marqu, ds son
dbut, une phase nouvelle dans la critique, et sa rdac-
tion l'a class parmi les bons journaux de cette spcia-
lit. L'art musical et le Mnestrel occupent aujourd'hui
un rang honorable dans la presse musicale franaise.
La presse musicale a pris depuis quelques annes une
certaine extension en Italie, en Angleterre, en Belgique,
en Espagne; les tats-Unis mme comptent desjournaux
de musique soigneusement rdigs.
Juste. Cette pithte se donne gnralement aux in-
tervalles dont les sons se trouvent exactement dans le
rapport qu'ils doivent avoir, et aux voix qui entonnent
toujours ces intervalles dans leur justesse.
Juste. Chanter juste, jouer ju?te.
K
Kalamaca. Danse favorite des Hongrois, d'un mou-
vement anim et en mesure 3[4.
Elle est compose de
deux parties, chacune de quatre mesures avec des re-
prises.
Kalliste-Organon. Instrument construit en
1827,
sur les principes du Physharmonica par Sylvestre.
Kambel. Luthier Darmstadt, travaillait dans cette
ville en 1635.
Kanoun. Instrument arabe cordes, ayant une forme
triangulaire, qui se pinait avec les doigts.
Karabo. Petit tambour des Egyptiens et des Abys-
sins.
Karaklansithyron. Chanson que les anciens Grecs
chantaient devant la maison de leur fiance.
KOU 293
Kas. Espce de tambour des peuples d'Angola (Afri-
que), qui, au rapport de quelques voyageurs, est le seul
instrument de musique qu'ils possdent.
Katakeleusnos. Nom d'une des parties principales
d'un morceau de musique excut dans les concours
musicaux des jeux isthmiques.
Kehraus. Ancienne danse d'invention allemande avec
laquelle on termine quelquefois les bals.
Keman. Nom d'un violon turc trois cordes.
Keou-Kin. Espce de guimbarde chinoise que l'on
nommait anciennement trompe de Barn.
Keraulophone. Jeu d'orgue imitant le frottement
de l'archet sur la corde, imagin par Dawson en 1851,
et produit par la vibration de l'air dans un tuyau fendu
son extrmit suprieure.
Kerlino. Luthier h Brescia en 1450. C'est sans doute
au mme artiste que Laborde,a, dans son Histoire de la
Musique donn une origine bretonne, tromp sans
doute par la syllabe Ker,
Kerrena. Trompette indienne qui, selon Bonnet, a
un tube de quinze pieds de longueur; d'autres assurent
qu'elle n'a que quatre pieds de longueur, et un son trs-
fort.
Kinnor. Instrument des anciens Hbreux. C'est une
espce de harpe ou de lyre.
Kithara. Instrument des Grecs anciens, d'o est
venu le nom franais de cithare et puis ensuite de gui-
tare,
Klotz (iEgidus), deMitterwald, fut un luthier assez
habile, il travaillait en 1754.
Klotz. (Mathias) Elve de Stainer, habitait le Ty-
rol. On a de lui des instruments la date de 1670 et
1696.
Klotz. (Georges,) (Sbastien,) (iEgidus) Fils du pr-
cdent, travaillrent galement sous le chef de l'cole
duTyrol et produisirent des instruments qui eurent de
la rputation.
Knittixg. Bon luthier, qui travailla Milterwald
en 1750.
Kolditz. (Mathieu) Luthier qui construisit de bons
violons Munich en 1748.
Kooranko. (Musique des habitants de) Quelques
voyageurs ont assur que la musique occupe une place
importante dans les crmonies publiques de ce pays.
296 LA
Ces peuples ont des chants et des danses particulires,
et un grand nombre de musiciens ambulants, qui pa-
raissent dous un degr remarquable du talent de l'im-
provisation.
La musique de cette nation, ainsi que ses instruments,
dont le meilleur est une espce de guitare ou violon fait
d'une calebasse avec des cordes de crins, sont encore peu
perfectionns; mais nanmoins on trouve dans quelques-
uns de leurs chants nafs, une douceur qui n'est pas sur-
passe par les modulations de peuples plus civiliss.
Cependant, en gnral, le bruit surpasse chez eux l'har-
monie, et l'effet de tant de voix et d'instruments qui se
runissent souvent, est tourdissant.
KussiER. Instrument turc, compos de cinq cordes
tendues sur une peau qui couvre une espce d'assiette.
Kyrie. Mot grec qui signifie seigneur au vocatif, et
par lequel commencent les messes en musique. On s'en
sert souvent comme d'un substantif, ou comme si c'tait
le nom d'une pice de musique. Voil un beau Kyrie,
un Kyrie bien travaill.
La. Note de musique appele simplement a par les
Allemands et les Italiens. C'est le sixime degr de noire
chelle musicale. IJ porte accord parfait mineur, et
s'emploie en harmonie, ou comme sixime degr de la
gamme majeure d'ut, ou comme premier degr du relatif
mineur de cette mme gamme. La est aussi le nom de
la seconde corde du violon et de la chanterelle, ou pre-
mire corde de la viole, du violoncelle et de la contre-
basse. Gest sur cette note, prise dans l'octave du m-
dium de notre systme sonore, que s'accordent tous les
instruments sans exception, et que sont rgls les diapa-
sons. Il ne s'ensuit pourtant pas que tous les diapasons
donnent exactement le mme son, quoiqu'ils soient tous
accords sur cette mme note la. Au contraire, ils va-
rient selon les lieux, et quelquefois selon les orchestres;
mais la diffrence est fort lgre, et excde rarement un
LAM 297
quart de ton au plus. On dit donner le la, prendre le ta,
pour donner et prendre l'accord.
Lacasso (Ant), bon luthier de Milan, travaillait en
1634.
Lai. Petit pome gaulois. Quoique nos vieux potes
franais variassent en une infinit de formes les pices
de posie qu'ils livraient leurs lecteurs, ils adoptaient
presque exclusivement la narration, soit qu'ils eussent
reproduire une anecdote, un bon mot, ou mme expri-
mer un sentiment. Ces formes, souvent bizarres, mais
constantes pour chaque espce, paratraient indiquer que
chacune de ces pices de posie se conformait dans l'o-
rigine un rhythme musical, un air consacr, l'un au
rondeau, l'autre au lai, celui-ci au chant royal, etc. On
sait, en effet, que lespomes des trouvres taient chan-
ts par des jongleurs, et accompagns sur des instru-
ments, le rebec ou violon, la rote ou vielle, par des m-
ntriers. L'usage du chant tait perdu
;
les pices de
posie, quoique ayant cess d'tre chantes ou accompa-
gnes des instruments, auront conserv leurs formes en-
core longtemps, jusqu' ce que l'imitation classique ayant
prvalu, elle les ait fait tomber en dsutude. Parmi ces
posies, la plus ancienne parat tre le lai, emprunt aux
bardes de l'Armorique. Marie de France, femme pote
du treizime sicle, a compos, ou plutt traduit plu-
sieurs de ces anciens lais bretons. Les lais que nous a
laisss Marie de France ne sont que des fabliaux ou
contes en vers de huit syllabes. Plus tard, les potes
donnrent au lai une forme nouvelle, qui consistait
intercaler, des distances rgulires, de petits vers entre
d'autres vers d'une mesure plus longue. Quand l'ordre
adopt par le premier couplet changeait, c'est--dire
quand on faisait tourner ou virer, selon l'expression
d'alors, les grands vers en petits vers et les petits en
longs, la pice devenait un virelai.
Lame vibrante. Petite peau de mtal, battue, ten-
due en long, que l'on place en la maintenant par une de
ses extrmits sur une case sonore. On lui imprime la
vibration, soit par le souffle, comme dans les orgues,
soit par la percussion, comme dans les harmoniums. On
donne galement ces lames le nom de anches libres.
Lamentabile, Lamentable. Ce mot, que Ton fait
prcder quelquefois par adagio ou largo, indique,
10
298
LAN
mme quand il est seul, un mouvement grave et une
expression triste et pour ainsi dire dsespre.
Lamentations de Jrmie. lgies que Ton chante
dans la semaine sainte : trois le mercredi, trois le jeudi,
et trois autres le vendredi. Ordinairement, en Italie sur
-
tout, on les excute en plain-chant avec accompagnement
de viole, de violoncelle et de piano, ou bien en musique
figure une seule voix, ou avec chur, ou plusieurs
voix. Le mme nom sert indiquer les diflrentes com-
positions.
Landler. Espce de valses en usage dans l'Autriche
et dans quelques autres contres de l'Allemagne. Leur
mlodie, dont le caractre est d'une gaiet sautillante,
s'excute dans un mouvement modr, en mesure 2/4.
Landolfi (Carlo). Imitateur de Guarnerius, travail-
lait Milan, de 1750 1760.
Langoureux. Ce mot indique un mouvement un peu
lent et une excution sans vibration et sans recherche
dans les agrments.
Langue musicale. Gomme tous les arts libraux, la
musique peut tre considre sous un double point de
vue : comme instrument de plaisir et comme moyen
d'expression. Considre sous ce dernier rapport, elle
est un langage vritable qui, au moyen des sons et des
silences, peint l'oreille et traduit l'intelligence la plu-
part des peines, des sentiments et des images que la pa-
role exprime avec des mots : souvent mme elle les tra-
duit avec une profondeur et une nergie que cette
dernire est incapable d'atteindre.
La langue musicale possde tous les lments et toutes
les parties des autres langues
;
elle a ses mots, sa gram-
maire lmentaire, sa syntaxe, sa posie et sa thorie,
sa philosophie et son histoire.
L'tude des sons ou mots de la musique et des autres
signes qu'elle emploie, constitue l'enseignement
lmen-
taire de cet art. Il est assez connu
;
nous n'en parlerons
pas.
La syntaxe musicale correspond la syntaxe des
langues proprement dites : c'est l'art de runir convena-
blement les signes du langage musical pour en former
des phrases correctes. Elle se divise en deux
parties,
dont l'une enseigne crire la mlodie, et l'autre Vhar-
monie,
La littrature musicale correspond
la littrature
LAN 299
proprement dite et se divise, comme elle, en deux par-
ties essentiellement distinctes : la littrature gnrale
qui traite, au point de vue musical, du bon got, des
styles, des coles, du but et de la valeur relle des rgles,
du classique, du romantique et de cent autres questions
musicales dont l'numration est inutile
;
et la littra-
ture particulire qui enseigne crire convenablement
chaque genre de musique. Cette dernire partie s'appelle
aussi composition : on
y
attache ordinairement les rgles
de la mlodie.
La philosophie de la musique consiste rechercher les
rapports secrets des sons avec nos sentiments et nos pen-
ses. L'existence de ces rapports ne peut pas tre contes-
te, puisque la musique exprime rellement des senti-
ments et des penses au moyen des sons. C'est une
science peine bauche.
Enfin, la musique et l'harmonie ont leur histoire, o
les thories et les uvres pratiques, les thoriciens et les
compositeurs, les ttonnements de l'inexprience, les b-
vues de l'erreur, les succs du talent et les progrs de la
science musicale apparaissent tour tour.
Madame Layne a publi, il
y
a quelques annes,
Paris, un ouvrage intitul : Grammaire musicale, base
sur les principes de la grammaire franaise. Dans son
livre, l'auteur donne aux lettres le nom de sons
;
l'al-
phabet, celui de gamme
;
les articles sont comme les
trois clefs
fa,
do, sol. Elle appelle substantifs les notes
;
adjectifs superlatifs les dises; adjectifs diminutifs les
bmols, adjectifs comparatifs les bcarres. Les mesures
sont les verbes actifs
;
celles trois temps les verbes
passifs
;
celles deux temps les verbes neutres et ainsi
de suite.
On doit M. Sudre une invention au moyen de la-
quelle avec les sept notes de la gamme il tait arriv
transmettre toute espce de phrase dans quelque lan-
gue que ce ft.
Languette. Nom du petit morceau de bois des sau-
tereaux d'un clavecin ou d'une pinette, o se trouve in-
troduit un morceau de plume de corbeau. C'est aussi le
nom d'un petit morceau de mtal mobile qui vibre dans
les anches de certainsjeux d'orgue.
On nomme ga-
lement languette une petite soupape ressort qui sert
ouvrir
ou fermer les trous de quelques instruments
vent.
300
LAU
Lapa. Nom turc des tubes en cuivre, longs d'environ
huit ou neuf pieds, se terminant comme nos trompettes
et servant dans la musique.
La r. Ces syllabes dsignaient dans l'ancien solfge
cette mutation d'aprs laquelle on se servait, en chan-
tant, de la syllabe r pour les sons la r,
et non de la
syllabe la.
Largo. Ce mot, crit la tte d'un air, indique un
mouvement plus leut que Yadagio, et le dernier de tous
en lenteur.
Le diminutif larghetto annonce un mouvement moins
lent que largo et plus lent que Yandante.
Le largo n'a souvent pas plus de lenteur que l'adagio;
mais il a quelque chose de plus dcid dans le caractre.
L'adagio semble devoir tre plus onctueux, plus sensible,
plus affectueux
;
il a autant de noblesse que le largo,
mais celui-ci a plus de fiert.
Le largo convient ce qui est religieux, l'adagio ce
qui est tendre et d'une tristesse passionne.
Larigot. Jeu d'orgue, l'un des plus aigus. Il sonne la
quinte au-dessus de la doublette. Cejeu, qui est compris
parmi les jeux bouche, est d'tain et a quatre octaves
et demie d'tendue, ce qui forme tout le clavier.
Larigot. Espce de petit flageolet qui n'est plus en
usage, il tait ordinairement accompagn du son de
tambourin.
Larynx. Organe de la voix. Il est situ sur la ligne
mdiane du corps, la partie suprieure et antrieure
du cou. Il a la forme d'un cne tronqu et renvers qui
surmonte la trache-artre avec laquelle il communique.
Le larynx livre passage l'air, par l'acte de la respira-
tion, et il lui imprime certaines modifications qui consti-
tuent la voix.
La sol. Mutation des deux syllabes la et sol sur le son
r.
Lauda sion salvatorem. Suite de versets ou prose
que l'on chante dans l'glise romaine, le jour de la Fte-
Dieu.
Laudi, (Laudes). On entend par le mot italien Laudi,
les cantiques que l'on chantait en Italie au temps de
Laurent de Mdicis, qui en composa plusieurs, et de
saint Philippe de Nri. Ce genre de posie tait trs-
estim en Italie au quinzime sicle. La musique en
LEP 301
tait toujours simple
;
on adapta quelquefois ces com-
positions potiques les ariettes profanes les plus gotes.
Lausa (Ant. Marea). Luthier de Brescia qui
y
exerait
brillamment son tat de 1 650 1715.
Leon. On dsigne parce mot tous les exercices qu'un
matre prescrit son lve, en lui enseignant jouer d'un
instrument de musique. Les morceaux de musique im-
prims sous le titre de leons ne sont autre chose qu'un
moyen de rappeler l'lve les instructions du matre.
Leons des nocturnes de l'office des morts. Le-
ons de la semaine sainte que l'on a coutume de chanter
en musique figure voix seule, ou mme plusieurs
voix avec churs.
Legato. Quand ce mot se trouve en tte ou dans le
courant d'un morceau de musique, il faut en lier les notes
avec soin.
S'il
y
a sempre legato, il faut conserver jusqu' la fin
le mme genre d'excution.
Lgende. Ce mot qui signifiait d'abord les versets que
l'on rcitait dans les leons des matines, fut donn plus
tard aux vies des saints et des martyrs, parce qu'on de-
vait les lire dans les rfectoires et les chanter dans les
chapelles des communauts. Des monastres, elles se r-
pandirent parmi les fidles, enthousiasmrent leur zle
et le portrent jusqu'au fanatisme. Tout ce que le peu-
ple avait recueilli dans ses souvenirs ou potis dans son
imagination trouva place dans ces histoires, qui sont la
vritable mythologie du christianisme. Les traits d'h-
rosme chrtien qu'on
y
trouve raconts avec une simple
navet, pars du prestige de la posie et de la musique,
rchauffrent la foi et la charit. Si l'histoire en a rejet
la plupart comme monuments apocryphes, elle leur doit
toutes profond respect et vive reconnaissance.
Lgrement. Cet adverbe indique qu'on doit toucher
l'instrument doucement.
Lemme. Silence ou Pause d'un temps bref dans cer-
tain rhythme.
Lento. Ce mot signifie lentement, et marque un mou-
vement lent comme le largo. Les Allemands indiquent
ce mouvement par langsaen, et les Anglais par slow.
Lepsis. Se disait chez les anciens grecs, d'une des
parties de la mlope. C'est par la lepsis, que le composi-
teur discerne s'il doit placer le chant dans les tons bas
ou aigus ou moyens.
302 LIC
Lev. C'est le temps de la mesure o on lve la main
ou le pied. C'est toujours le dernier temps del mesure;
par consquent les temps levs sont : deux temps, le
second
;
trois, le troisime
;
quatre, le quatrime.
Liaison. Il
y
a liaison d'harmonie et liaison de chant.
La liaison a lieu dans l'harmonie, lorsque cette harmo-
nie procde par un tel progrs de sons fondamentaux,
que quelques-uns des sons qui accompagnent celui qu'on
quitte, demeurent et accompagnent celui o l'on passe.
Il
y
a liaison dans les accords de la tonique et de la
dominante, attendu que le mme son sert de quinte
l'une, et d'octave l'autre. Enfin, il
y
a liaison disso-
nante toutes les fois que la dissonance est prpare,
puisque cette prparation elle-mme n'est autre chose
que la liaison.
La liaison dans l'excution instrumentale ou dans le
chant a lieu toutes les fois qu'on passe deux ou plusieurs
notes d'un seul coup d'archet, de langue ou de gosier,
et se marque par un trait recourb dont on couvre les
notes qui doivent tre lies ensemble.
Licences. Libert que prend le compositeur et qui
semble contraire aux rgles, quoiqu'elle soit dans le
principe des rgles
;
car voil ce qui distingue les licences
des fautes. Par exemple, c'est une rgle gnrale de ne
pas faire marcher deux quintes justes de suite entre les
mme parties et par un mouvement semblable. Berton a
enfreint cette rgle dans l'ouverture du Dlire. C'est une
licence qu'il a prise pour produire plus d'effet.
Comme les rgles de l'harmonie ont subi des modifi-
cations mesure que l'art s'est perfectionn, ce qui tait
licence autrefois est permis aujourd'hui. Nous nous ser-
vons avec succs de la quinte augmente, qui aurait
offens l'oreille de nos timides devanciers.
Lichara. Instrument unique d'une tribu de Gafres.
C'est une espce de flte forme d'un roseau, accorde
au moyen d'un petit tampon mobile plac la partie
infrieure, et ayant au bout suprieur une ouverture
coupe transversalement. On ne peut rendre qu'un son
sur cet instrument
;
il
y
en a un pour chaque note, et
lorsque plusieurs sons se trouvent runis, une partie
joue l'unisson, pendant que les autres font entendre
diffrents sons de l'chelle musicale. L'intervalle compris
entre les plus hautes et les plus graves de ces fltes est
d'environ douze notes.
LIR 303
Lies. On appelle notes lies celles qu'on passe d'un
seul coup d'archet sur le violon, ou d'un seul coup de
langue sur les instruments vent, en un mot, toutesles
notes qui sont sous une mme liaison.
Ligature. Se disait anciennement d'un groupes de
notes runies sous un trait; la valeur de ces notes
variait selon leurs positions et leur formes.
Ligne. Les lignes de musique sont ces traits horizon-
taux et parallles qui composent la porte, et sur
lesquels, ou dans les espaces qui les sparent, on place
les notes selon leurs degrs. La porte du plain-chant
n'est que de quatre lignes, celle de la musique a cinq
lignes stables et continues, outre les lignes additionnelles
qu'on ajoute au-dessus et au-dessous de la porte, pour
les notes qui passent son tendue.
Les lignes, soit dans le plain-chant, soit dans la musi-
que, se comptent en commenant par la plus basse. La
plus basse est la premire, la plus haute est la quatrime
dans le plain-chant, la cinquime dans la musique.
Limma. Intervalle de la musique grecque, lequel est
moindre d'un comma que le semi-ton majeur, et retran-
ch d'un ton majeur, laisse pour reste l'apotome.
Linarolli (Venturi). Habile luthier, qui existait
Venise en 1520.
Linographe. Instrument destin tracer des lignes
de musique, imagin en 1839 par Violette de Brest. Une
molette en cuivre, portant sur sa circonfrence une ou
deux portes de musique.
Linon asma. Chanson funbre des Egyptiens sur
Manros, appel Linos par les Grecs. On croit qu'il tait
le fils du premier roi des anciens Egyptiens, et qu'il
mourut la fleur de l'ge.
D'autres crivains disent Linus, fils d'Apollon et de
Terpsichore; il substitua dans la lyre les cordes de boyau
aux cordes de lin. Ce fut lui qui enseigna la musique
Hercule, mais le disciple ayant t rprimand trop
svrement, cassa la tte de son matre.
Lire. Lorsqu'on veut excuter une partie que l'on n'a
jamais vue, il faut d'abord s'tre exerc trois espces
de travaux intellectuels, ncessaires pour lire facilement
premire vue, presque sans s'en apercevoir. On doit,
en dchiffrant les notes,
1
embrasser d'un coup d'oeil
l'alternation continuelle des sons aigus et des sons gra-
ves
;
2
les comparer et les classer selon leur valeur res-
304 LOTJ
pective; et
3
rendre cette valeur relativement la
mesure indique. On appelle cette science : dchiffrer,
lire la musique,
Lirone. Etait comme la viola di Gomba, un instru-
ment grave du systme des violes.
Litanies. On dsignait autrefois par ce mot le Kyrie
eleison. Aujourd'hui encore les litanies commencent par
le Kyrie eleison, mais comme on fait suivre les invoca-
tions en l'honneur de la Vierge, des saints, etc., on les
appelle litanies de la Vierge, des saints, etc.
Lithographie. Depuis quelques annes, la lithogra-
phie a t applique la musique. Les planches d'tain
au moyen d'un procd, sont dcalques sur la pierre et
la musique est reproduite avec une nettet irrprochable,
soit par des presses la main, soit par des presses
vapeur.
Livre ouvert, a livre ouvert. Chanter ou jouer
livre ouvert, c'est excuter toute musique qu'on vous
prsente en jetant les yeux dessus, et par consquent
sans prparation.
Loco. Lorsqu'aprs un passage marqu pour tre
excut l'octave aigu ou basse, on trouve ce mot latin
ou italien loco, il signifie que l'on doit excuter ce qui
suit, au lieu mme o les notes sont crites sans trans-
positions d'octaves.
Lolichmium. difice public, situ prs de la ville
d'Olympie, qui tait ouvert en tout temps ceux qui
voulaient prendre part au concours de musique.
Longue. C'tait une note qui, dans la musique
ancienne, valait quatre mesures; dans le mode mineur
parfait elle avait la valeur de trois brves, et dans le
mode mineur imparfait, de deux.
Lotues. Espces de trompettes qui servaient dans les
marches guerrires, que l'on trouve mentionnes dans
l 'or-cher-ographie de Thoinot Arbeau crite en 1589.
Loure. Nom que l'on donnait anciennement une
espce de cornemuse.
Loure. Sorte de danse dont l'air tait assez lent, et
qui se marquait ordinairement par la mesure six-
quatre. Quand chaque temps porte trois notes, on pointe
la premire, et l'on fait brve celle du milieu
;
ce qui est
exactement le rhythme de la sicilienne, qui semble avoir
succd la loure.
Lourer. C'est nourir les sons avec douceur, et mar-
LUT 305
quer la premire note de chaque temps plus sensible-
ment que la seconde, quoique de mme valeur, et en
liant.
Cette manire d'excuter est encore en usage pour les
pastorales et toutes les compositions qui ont le caractre
rustique et montagnard.
Lucornario. Nom de l'antienne que l'on chante
vpres, selon le rite ambroisien, avant le Dixit.
Lumire. On donne ce nom une ouverture par
laquelle le vent entre dans les tuyaux d'un orgue.
Lupot (F.). Luthier Stuttgard, construisit Cette,
des instruments qui eurent une belle rputation, il tra-
vailla de 1725 1750.
Lura. Instrument des anciens Grecs, dont plus tard
on a fait lyre, c'est le mme que le xlus. (Voir ce mot).
Lustre, (chevaliers du). Nom donn par ironie aux
claqueurs gage d'un thtre, parce qu'ils se placent
ordinairement sous le lustre.
Luth. Instrument trs-cultiv autrefois, et dont on ne
joue plus depuis un sicle. La guitare et la harpe l'ont
fait dlaisser. Il tait mont de vingt-quatre cordes sur
un corps arrondi en dessous, en forme de tortue, et res-
semblant celui de la mandoline, qui en tait le diminu-
tif. Ces vingt-quatre cordes composaient treize groupes
;
son manche tait large et renvers dans son extrmit.
Huit de ces cordes, places en dehors du manche, ne se
touchaient qu' vide.
Comme la lyre antique, le luth, en cessant de servir
aux musiciens, a laiss son nom aux potes, qui le font
figurer souvent dans leurs stances, et mme dans l'po-
pe.
Luthier. Artiste qui fait des violons, des violes, des
violoncelles, des contre-basses, des guitares. Ce nom,
qui signiQe facteur de luths, est rest par synecdoche
ces sortes d'artistes, parce qu'autrefois le luth tait l'ins-
trument le plus commun et le plus rpandu.
Lutrin. Pupitre de chur sur lequel on met les livres
de chant dans les glises. Ce mot vient de lectrum, dont
on a fait lectrinum, de l lettrin, et puis lutrin par cor-
ruption :
Sur ce rang d'ais serrs qui forment sa clture,
Fut jadis un lutrin d'ingale structure,
Dont les flancs largis de leur vaste contour
Ombrageaient
pleinement tous les lieux d'alentour.
10.
306 LYR
Derrire ce lutrin, ainsi qu'au fond d'un antre,
A peine sur son banc on discernait le chantre,
Tandis qu' l'autre bout, le prlat radieux,
Dcouvert au grand jour, attirait tous les yeux.
Boileau.
Le Lutrin,
Luttes musicales. Les anciens peuples professrent
une grande estime pour la musique. Les Grecs, particu-
lirement, la regardaient comme un des moyens nces-
saires pour former l'ducation, et adoptaient, avec
empressement, tout ce qui pouvait contribuer ses
progrs
;
ils croyaient que des concours de musique, qui
avaient lieu devant les assembles nombreuses, taient
un des moyens les plus favorables pour arriver ces
rsultats. On clbrait donc, certaines poques, des
ftes populaires, o l'on dlivrait des prix aux concur-
rents en musique. Les jeux olympiques, mythiques,
nme'ens et isthmiques taient les principales de ces ftes.
(Voir ces mots.)
Les juges appels porter un jugement sur le mrite
des chanteurs qui se distinguaient dans le concours, leur
dcernaient pour prix une couronne de laurier ou de
feuilles de chne, et toute la Grce les comblait d'hon-
neurs et de gloire. On rigea mme quelques-uns des
monuments aux frais de l'tat. Plus tard, on intro-
duisit aussi dans ces ftes, des concours pour la musique
instrumentale.
Plusieurs ftes solennelles, fondes par les anciens
Romains, taient galement clbres par des luttes
musicales. Nron, surtout, constitua Rome des con-
cours de musique qui jetrent un grand clat.
Lydien. Nom d'un des Modes de la musique des
Grecs, lequel occupait le milieu entre YEolien et VHyper-
dorieyi. Le caractre du mode Lydien tait anim,
piquant, mais pathtique et propre la molesse, aussi
Platon le bannit-il de la Rpublique.
Lyra. Instrument appartenant au systme des violes,
et qui en formait la basse.
Lyre. Instrument de musique, de forme triangulaire,
dont la mythologie attribua l'invention Mercure.
Quelques auteurs ont accord tour tour
l'honneur de
sa dcouverte Orphe, Amphion, Apollon, Polym-
nice. D'autres ont dit que c'tait une caille de tortue,
LYR 307
qu'Hercule vida, pera, et monta de cordes de boyaux,
au son desquels il accordait sa voix.
La lyre a beaucoup vari par le nombre de ses cordes
;
celle d'Olympe et de Therpandre n'en avait que trois.
L'addition d'une quatrime rendit le ttracorde complet.
Pollux attribue aux Scythes, l'invention du pentacorde.
L'heptacorde fut la lyre le plus en usage et la plus clbre.
Simonide ajouta une huitime corde, pour produire l'oc-
tave
;
et, plus tard, Timothe de Milet, contemporain de
Philippe et d'Alexandre, multiplia les cordes jusqu'
douze. On les touchait de trois manires, ou en les pin-
ant avec les doigts, ou en les frappant avec le plectrum,
espce de baguette d'ivoire ou de bois poli, ou en pinant
les cordes de la main gauche, tandis qu'on les frappait
de la droite arme du plectrum. Les anciens monuments
reprsentent des lyres de diffrentes formes, montes
depuis trois cordes jusqu' vingt. Cette dernire ne ser-
vait, dit-on, que pour clbrer les dieux et les hros.
On a essay de faire revivre cet instrument, en lui
donnant le manche de la guitare six cordes. Sa forme
lgante et pittoresque avait d'abord tent nos belles
musiciennes
;
mais on est revenu la guitare, qui est
plus commode tenir, et dontl'harmonieestplus pleine et
plus agrable.
La lyre et luth retentiront encore longtemps dans les
uvres des potes, quoique les progrs de l'art musical
les aient condamns un ternel silence. Le violon a
fait disparatre tous ces instruments imparfaits, qui
n'taient, en quelque sorte, que les essais des facteurs et
des musiciens, les uns prludant l'art de la lutherie,
et les autres celui de charmer l'oreille.
Lyre a bras. Instrument archet, de la dimension
de l'ancienne viole de tnor sept cordes, et qui aujour-
d'hui n'est plus en usage.
Lyre allemande. Cet instrument, dont on ne se sert
plus, consiste est une caisse de forme oblongue, ressem-
blant la partie infrieure d'une viole d'amour. Aux
parois latrales de cette lyre, il
y
a dix douze touches
qui servent raccourcir les quatre cordes attaches dans
l'intrieur de l'instrument, et forment une tendue de
sons diatoniques qui galent le nombre de touches. On
fait rsonner les cordes au moyen d'une roue frotte de
colophane, que la main droite fait tourner avec un levier,
308 MAC
tandis que les doigts de la gauche font mouvoir les tou-
ches.
Lyre barberina. Instrument invent au dix-septime
sicle, par un praticien florentin, nomm Donis, et dont
on ne se sert plus depuis longtemps.
Lyre organise. Fut imagine en 1806 par Le Dhny,
facteur Coucy-le-Chteau. Les deux montants de l'instru-
ment formaient manches et il en existait un troisime au
milieu des deux autres. Cet instrument tait mont de
quinze cordes diverses sur les trois manches.
Lyre ventura. En 1851 Ventura donna ce nom
une guitare dont il doublait les six cordes dont cet instru-
ment est ordinairement mont, de sorte que chaque note
se composait de deux cordes.
Lyrique. Cette pithte se donnait autrefois la posie
faite pour tre chante et accompagne par le chanteur
de la lyre ou de la cithare, comme les odes et autres
chansons. Sous ce rapport, la posie lyrique diffrait
essentiellement de la posie dramatique ou thtrale, qui
tait accompagne avec des fltes, par d'autres que par
le chanteur. Aujourd'hui l'pithte lyrique s'applique
toujours aux odes, dithyrambes, chansons, couplets.
Mais comme nous avons des pices de thtre qui se
chantent, on appelle drame lyrique ou opra, le drame
expressment compos pour tre mis en musique.
Lyro-guitare. Instrument invent Paris, au com-
mencement de ce sicle, et qui a le manche del guitare
six cordes. Sa forme lgante et pittoresque avait
d'abord fait sa fortune; mais ensuite on en revint la
guitare, plus commode tenir, et dont l'harmonie est
plus pleine et plus agrable.
M
Macabre (Danse). Se dit d'une ronde infernale danse
par des morts de toutes conditions. Cette ronde se
trouve reprsente, au moyen-ge, dans un grand nombre
de cimetires et sur les parois des vitrines des glises.
Ces reprsentations sont fort intressantes pour Tarcho-
MAG
309
logie musicale, puisqu'elles fournissent les dessins des
diffrents instruments employs cette poque.
Maghicotage. Cest ainsi qu'on appelle, dansleplain-
chant, certaines additions et compositions de notes qui
remplissent, par une marche diatonique, les intervalles
de tierces et autres. Le nom de cette manire de chant
vient des ecclsiastiques appels machicots,
qui l'excu-
taient autrefois aprs les enfants de chur.
Madrigal. Sorte de pice de musique travaille et
savante, qui tait fort la mode en Italie au seizime
sicle. Les madrigaux se composaient pour les voix,
trois, quatre, cinq, six et mme sept parties, toutes obli-
ges, cause des imitations et dessins dont ces pices
taient remplies.
Le style madrigalesque tient de la fugue, sans lui
ressembler entirement. La diffrence la plus essentielle
consiste en ce que, mme dans les madrigaux voix
seule, qui sont les plus svres de tous, on prend des
licences que la fugue proprement dite ne comporte pas.
On donnne au chant des tournures lgres et animes,
et l'on suit le sentiment et l'expression des paroles, ce
qui ne s'observe pas dans la fugue.
La composition des madrigaux remonte la plus haute
antiquit. Les matres de l'cole flamande s'y sont
distingus; mais les auteurs qui ont atteint la perfection
de ce genre sont : Adrien Willart, Palestrina, Luca
Marenzino,' Monteverbe, le prince de Venouse, enfin A.
Scarlatti.
Lotti, B. Marcello, Durante, Steffani ont excell
dans le madrigal accompagn, qui comporte plus de
libert que l'autre, cause de la basse continue qu'on
y
ajoutait, mais qui exige, raison de cela beaucoup plus
d'expression.
Madrigalesque. Expression par laquelle on dsignait
au XV
e
sicle le contre-point vigoureux des madrigaux.
Maestoso, Majestueux. Un morceau de musique de
ce caractre demande un mouvement plus lent et une
excution semblable au grave.
Magade. Est une espce de flte ou de trompette; la
similitude des noms a souvent tabli une confusion entre
ces deux genre d'instruments.
Magadiser. Se disait anciennement au lieu de chanter
l'octave comme le font les voix d'hommes et d'enfants
mles ensemble.
310 MAI
Magasin de musique. Boutique o l'on vend des
livres, des compositions manuscrites et imprimes, des
instruments de musique et tous les accessoires qui
y
ont
rapport, tels que cordes, papier rgl, etc.
Magini (Grav. Paul). Luthier en renom de Brescia, v
travaillait de 1560 1640.
Magini (Piestro Santo). fils du prcdent continua
l'tat de son pre de 1630 1680.
Magnificat. Nom d'un morceau de chant, dont les
paroles ont t tires du premier chapitre de saint Luc,
et qui, dans la traduction latine commence ainsi : magni-
ficat anima mea Dominum.
Magraphe. Instrumenta vent des Hbreux qui, d'aprs
la description donne par le Tabnud, ressemblait notre
orgue.
Maigre. Se dit d'une harmonie qui manque d'am-
pleur, qui est sche et aride.
Main harmonique. C'est le nom que donna Guido
la gamme qu'il inventa, pour montrer le rapport de ses
hexacordes, de ses six lettres et de ses six syllabes avec
les cinq ttracordes des Grecs. Il reprsente cette gam-
me sous la figure d'une main gauche, sur les doigts de.
laquelle taient marqus tous les sons de la gamme, tant
par lettres correspondantes, que par les syllabes qu'il
y
avait jointes, en passant, par la rgle des nuances, d'un
ttracorde ou d'un doigt l'autre, selon le lieu o se
trouvaient les deux demi-tons de l'octave par le bcarre
ou par le bmol, c'est--dire selon que les ttracordes
taient conjoints ou disjoints.
Matre de musique. Musicien gag pour composer de
la musique ou la faire excuter. C'est le matre de musi-
que qui bat la mesure et dirige les musiciens. Il doit
savoir la composition, quoiqu'il ne compose pas toujours
la musique qu'il fait excuter.
On donne encore le nom de matre de musique au chef
de la musique d'un rgiment. Il fait partie de l'tat-ma-
jor, et a le rang d'officier.
Matrise. Logement rserv au matre de musique
d'une cathdrale, et dans lequel un certain nombre de
jeunes gens sont entretenus aux frais du chapitre, pour
y
recevoir une bonne ducation musicale, et tre emplo-
ys en mme temps au service religieux comme enfants
de chur.
Quand on songe l'tat de dcadence dans lequel les
MAJ 311
matrises sont progressivement tombes dans notre pays,
on n'est plus surpris que le got et l'intelligence de l'art
musical se perdent peu peu dans nos provinces. Les
bienfaits du Conservatoire ne s'tendent pas au-del de
l'enceinte de Paris
;
tandis que, places sur tous les
points du royaume, les matrises offraient le moyen de
recueillir et de cultiver les grands talents et les belles
voix dans les lieux mmes o la nature se plaisait les
produire. Depuis leur suppression presque totale, la
ppinire des bons musiciens n'existe plus; l'art dg-
nre et languit dans nos dpartements.
L'cole de musique religieuse classique fonde en
1853 par M. Niedermeyer, quelque utile qu'elle soit,
remplace difficilement les matrises qui s'tendaient sur
toute la surface de notre pays catholique.
Majadis. Espce de lyre en usage chez les anciens
Grecs, qui avait vingt et une cordes selon le dired'Att-
nie, accordes l'octave deux par deux.
Majeur. Les intervalles susceptibles de variations
sont appels majeurs, quands ils sont aussi grands qu'ils
doivent l'tre, d'aprs la juste apprciation du systme
gnral des intervalles.
L'octave, la quinte et la quarte ne varient pas sans
devenir dissonauces. Les autres intervalles peuvent, sans
changer de nom et sans cesser d'tre justes, varier de
quatre manires diffrentes, auxquelles on donne le nom
de : genres, dont deux sont selon la nature du mode o
on les pratique, et deux sont artificiels, attendu qu'ils
participent de deux modes la fois. Ces quatres genres
sont : diminu, mineur, majeur et augment. Les deux
genres naturels sont le majeur et le mineur. Le diminu
et l'augment forment les deux genres artificiels.
Les intervalles variables sont au nombre de quatre,
savoir : la seconde, la tierce, la sixte et la septime.
Un intervalle majeur est toujours plus grand d'un
demi-ton que le mineur. Un intervalle augment est plus
grand d'un demi-ton que le majeur; plus grand d'un
ton que le mineur, et plus grand d'un ton et demi quele
diminu
;
de mme que l'intervalle diminu est moindre
d'un demi-ton que le mineur, moindre d'un ton que le
majeur, et moindre
d'un ton et demi que l'intervalle aug-
ment.
Majeur se dit aussi du mode, lorsque la tierce de la
312 MAN
tonique est majeure, et alors seulement ]e mot mode ne
fait que se sous-entendre.
On dsigne encore par le mot de majeur pris substan-
tivement, la partie d'un air, d'un duo, d'une sonate, d'une
symphonie qui se trouve traite en mode majeur.
Maldonner. Luthier Fussen en Bavire, a laiss de
bons instruments qui portent la date de 1770.
Malgaches (Musique chez les). Les Malgaches aiment
beaucoup ]a musique et la danse. Celle-ci, grave chez
les hommes, parat souvent exprimer quelque action
dramatique
;
elle est mesure, et les pas, rarement pr-
cipits, sont diversifis suivant le caractre de l'air,
comme les contredanses franaises.
La danse des femmes, quelquefois gaie et lascive, ne
consiste d'ordinaire qu'en un balencement du corps,
avec de continuels mouvements des bras et des mains
accompagns d'un lger trpignement de pieds.
Leur musique a un caractre de mlancolie tenant
peut-tre au sujet de leurs chansons qui roulent tou-
jours sur l'amour. Les femmes ont la voix douce et
mlodieuse, chantent en parties et font des accords
suivis que l'on n'entend pas sans plaisir.
Manche. Pice de bois colle l'extrmit du corps
de certains instruments cordes, tels que le violon, le
violoncelle, la guitare. Le manche sert tenir l'instru-
ment, porte les cordes et les chevilles, et c'est en posant
les doigts sur ces cordes et en les pressant contre le
manche, que l'on forme les diffrents tons.
Mandoline. Instrument de musique plus petit que le
luth et de la mme forme. Il s'accorde comme le violon,
avec cette diffrence, que ses cordes sont de laiton et
doubles. On en joue avec un petit morceau d'corce de
cerisier ou un bout de plume taill comme un cure-dent
plat. Le timbre de la mandoline est d'une finesse mor-
dante qui la rend trs-propre accompagner les chants
d'amour. Il
y
avait deux espces de mandolines, l'une se
nommait mandoline milanaise qui avait cinq rangs de
cordes et la mandoline napolitaine qui n'en portait que
quatre rangs. Le plus lev avait des cordes en boyaux,
le second des cordes d'acier, le troisime des cordes de
cuivre tordu et le quatrime des cordes en boyaux recou-
vertes de fils d'argent.
Mandore ou Mandille. Espce de petit luth. Il se
joue comme cet instrument, mais s'accorde diffrem-
MAR 313
ment. La mandore n'a que huit groupes de cordes
boyau
;
ce qui fait en tout seize cordes.
La mandore n'est plus en usage depuis longtemps.
Maneros. Chant lugubre des anciens gyptiens,
appel de Maner fils unique du premier roi d'Egypte
qui mourut prmaturment.
Manichordion. Sorte d'pinette dont les sautereaux
taient arms de petits morceaux de cuivre. Cet instru-
ment tait mont de soixante-dix cordes dont plusieurs
l'unisson taient recouvertes de bandes de drap qui
en rendait le son sourd et doux.
Marabba. Instrument corde et archet des Arabes,
il est mont de deux cordes l'unisson et dont le corps
est recouvert des deux cts d'une peau tendre.
Marche. Morceau de musique, compos pour tre
excut par un grand nombre d'instruments, pendant
la marche d'une troupe militaire ou d'un cortge nom-
breux, et servant rgler le pas de ceux qui le com-
posent.
La marche est plus particulirement du domaine de
la musique militaire que de l'orchestre complet. Cepen-
dant on introduit souvent des marches dans les compo-
sitions dramatiques.
Brillante et lgre dans le style martial, majestueuse
et solennelle dans le style religieux, triste et gmissante
pour les pompes funbres, la marche prend divers
caractres, selon que sa destination change.
La mesure de la marche est ordinairement deux
temps, et son mouvement allgro maestoso. Quelques
marches religieuses d'un mouvement trs-lent sont
trois temps.
Dans le style militaire on distingue deux sortes de
marches, savoir : la marche dont la mesure et le temps
marquent le pas ordinaire, et la marche double, dont la
mesure et les temps sont doubls
;
son mouvement est
du double plus rapide que celui de la marche.
Une belle marche, excute par d'excellents musi-
ciens, annonce d'une manire brillante la troupe qui va
dfiler sous les armes. Ces accents belliqueux, cette
harmonie clatante s'unissent admirablement aux ides
qu'inspire l'appareil militaire. On croit assister aux
anciens tournois. L'imagination nous transporte aux
ftes triomphales de la Grce et de Rome.
Mais laissons la musique guerrire pour nous occu-
314
MAR
per de la scne dramatique, o la marche parat avec
les plus grands avantages. Elle
y
prend une couleur
diffrente, selon le temps et le lieu o se passe l'action
scnique. Au thtre, la marche se runit souvent au
chur, et beaucoup de churs dramatiques, tels que
ceux de la Vestale : De lauriers couvrons les chemins
;
Prisse la vestale impie ! sont dessins en marches.
On appelle aussi marche un mouvement symtrique
et
rgulier des diverses parties de l'harmonie.
Marche de Basse. (Voyez le mot Progression).
Marche des parties harmoniques. En gnral, lors-
que l'on compose trois parties ou davantage, elles ne
doivent pas monter ni descendre toutes la fois, moins
qu'il n'y ait unisson ou que la pense ne l'exige ainsi.
Il suffit toutefois que l'une d'elles soit immobile pendant
que les autres montent ou descendent.
Il est bien que le dessus et la basse procdent par
mouvements contraires, ou du moins par mouvements
obliques.
En tous cas, les parties harmoniques doivent marcher
d'une manire simple, naturelle et sans contorsion. Il
est ridicule et prilleux la fois de leur donner des into-
nations difficiles et hasardes.
Marcher. Ce terme s'emploie figurmenten musique
et se dit de la succession des sons ou des accords qui se
suivent dans un certain ordre.
Marseillaise. Nom donn un hymne patriotique et
guerrier dont les paroles et la musique furent compo-
ses Strasbourg par Rouget de Liste, en 1792.
Martaban (Musique du). Les habitants du Martaban,
province de l'empire Birman, paraissent aimer beau-
coup notre musique, dont la leur se rapproche plus que
celle d'aucun autre peuple de l'Inde. Les instruments
dont ils se servent mritent d'tre observs. Ils ont un
luth avec deux cordes de laiton, qu'ils,] ouent tantt avec
un archet, tantt avec les doigts. Ils possdent encore
un instrument qu'on peut appeler chat, parce qu'il
reprsente ce quadrupde avec les jambes ployes sous
lui et la queue ramene en demi-cercle au-dessus de son
dos. C'est sur cette queue que les cordes sont attaches.
Ils ont aussi nos espces de fltes, des flageolets, des
tam-tams et des cloches qu'ils appellent gongs.
Marteau. Instrument qui a le manche perc comme
une clef, avec lequel on tend ou on lche les cordes des
MAZ 315
instruments chevilles, pour les accorder. C'est aussi le
nom de certaines pices de la mcanique du piano qui
attaquent les cordes.
Martellement. Sorte d'agrment du chant en usage
dans l'ancien franais.
Masques. Par ce nom on entendait, chez les anciens
Grecs et Romains, certaines figures postiches qui repr-
sentaient, dans les thtres, les traits des personnages
figurant dans l'action dramatique. Ces masques taient
en mtal, et l'on s'en servait pour donner plus d'clat et
plus de force la voix. /
Masses. Masses, dans la musique vocale et instru-
mentale, se dit de plusieurs parties considres comme
ne formant qu'un seul tout. Les arpges des violons et
des violes, lies par les tenues des instruments vent,
forment de belles masses harmoniques. Un solo de
hautbois plane et se dessine avec grce sur les masses
de l'orchestre.
Matraca. Enorme crcelle, en usage en Espagne, et
surtout au Mexique, pendant la semaine-sainte. Elle
remplace les cloches. C'est une roue de plusieurs palmes
de diamtre, dont la circonfrence est arme de mar-
teaux de bois mobile, de sorte qu'en tournant la roue,
ces petits marteaux frappent quelques petits morceaux
de bois plants comme des dents dans la circonfrence
de la roue.
Maxime. Nom de tout intervalle plus grand que le
majeur, pour ceux qui n'admettent pas le degr de
augmente, et plus grand d'un demi-ton que l'augment,
pour ceux qui admettent ce degr de plus.
Maxime. C'est une note faite en carr long horizontal
avec une queue au ct droit, laquelle valait huit me-
sures deux temps, c'est--dire deux longues, et quel-
quefois trois, selon le mode.
Cette sorte de note n'est
plus en usage, depuis qu'on spare les mesures par des
barres, et qu'on marque avec des liaisons les tenues ou
continuits des sons,
Mayerhoff (Andras). Luthier fort en renom dont les
quelques instruments sont parvenus jusqu' notre
poque, travaillait Salsbourg en 1760.
Mazurka. La mazurka possde un rhythme particu-
lier qui consiste marquer souvent le deuxime temps
de la mesure
;
la priode se termine sur le deuxime
temps. Elle est plus lente que la valse.
316 ML
Medard. Fut un habile luthier, il habitait Nancy et
y
exera son tat de 1680 1720.
Mdes. (Voyez le mot Assyriens.)
Mdiante. C'est la corde ou la note qui partage en
deux tierces l'intervalle de quinte qui se trouve entre la
tonique et la dominante. L'une de ces tierces est ma-
jeure, l'autre mineure, et c'est leur position relative qui
dtermine le mode. Pour simplifier cette dfinition, nous
dirons que la mdiante est la troisime note d'une
gamme.
Mdiation. Partage de chaque verset d'un psaume
en deux parties, l'une psalmodie ou chante par un ct
du chur, et l'autre par le ct oppos.
Mdium. Milieu de la voix, galement distant de ses
deux extrmits au grave et l'aigu. Le haut de la voix
est plus clatant, mais il est quelquefois forc. Le bas
est grave et majestueux, mais il est plus sourd. Un beau
mdium donne les sons les mieux nourris, les plus mlo-
dieux.
Mlange tait le nom d'une des trois parties de la
musique des Grecs.
Mlodon. Varit des orgues expressifs perfectionns
en 1849, aux Etats-Unis d'Amrique, par Austin.
Mlodiga. Instrument clavier avec un registre de
flte
;
cet instrument descend jusqu'au sol grave du
violon.
Mlodie. La mlodie est la succession de plusieurs
sons diffrents qui, dans leurs rapports de tonalit, con-
courent former un ensemble agrable et flatteur pour
l'oreille, ravissante pour le cur et l'imagination.
D'o vient-elle, cette reine de l'art lyrique, avec son
cortge d'motions, son sourire fleuri, ses arabesques
de tous les temps que l'il embrasse et admire? A quelle
source de posie l'enchanteresse a-t-elle puis ses
charmes ? La mlodie est fille du mystre
;
c'est une
brise chappe un monde inconnu
;
elle porte avec elle
la fracheur de l'aurore, le feu du soleil et la srnit de
la nuit. Tous les arts ont leur langage et leur modle :
langage matriel, modles vivants ou morts
;
la parole
d'un ct, la nature de l'autre. Ptrarque, l'Arioste, le
Tasse, Chiabrera, Gthe, Byron, Ghteaubriant, Hugo
et Lamartine, tons enfants de la renomme, ont fleuri
leurs vers des plus belles images, ont revtu la pense
humaine des plus riches vtements
;
mais au service de
ML 317
leurs inspirations, ils avaient ou ils ont encore des
mots, un langage, un vocabulaire tout entier
;
Michel-
Ange, Lonard de Vinci, Raphal, le Gorrge, Ruberis,
Lopold Robert, Ingres, Vernet, tous illustres parmi
les plus illustres, vous n'avez fait que copier la nature,
et votre gloire est d'avoir t aussi vrais que la nature
elle-mme
;
vous aviez des couleurs, vous aviez des pin-
ceaux Encore une fois, la mlodie n'a ni vocabulaire,
ni pinceaux, ni modles
;
elle est tendre et amoureuse,
comme le pote le plus tendre et le plus amoureux
;
elle
est rveuse, emporte, dchirante comme les songes qui
bercent la tte, ou les temptes qui agitent le cur
;
elle
a des larmes pour la douleur, des sourires pour l'amour;
elle est lgre, coquette, douce, capricieuse, foltre,
insouciante, enthousiaste , ardente
;
elle est dans le
pass
;
elle est dans le prsent
;
elle vivra aussi long-
temps que vivront les toiles, aussi longtemps que les
roses garderont leurs couleurs, les arbres leur verdure,
le printemps son soleil. Elle reviendra d'o elle est
venue, et ceux qui assisteront sa fin, seuls connatront
son origine.
La mlodie se divise en trois catgories
; la mlodie
fugitive, la mlodie religieuse et la mlodie dramatique,
c'est--dire applique au drame lyrique. Il
y
a la mlo-
die lgre, la mlodie gracieuse, la mlodie passionne,
et, au milieu de tout cela, nous avons la mlodie banale
qui veut tout exprimer, qui n'exprime rien et qui revient
de droit aux musiciens sans valeur potique. Des mlo-
dies fugitives, Schubert en est un modle merveilleux.
Lisez, relisez ces petits pomes o l'me pure et calme
a rpandu son parfum
;
l point de futilits, point de
notes contresens, point d'exagration, toujours la
vrit
;
l, c'est le cur qui chante, c'est du cur que
part l'inspiration. Schubert se fait un petit cadre et il le
remplit toujours des plus dlicieuses peintures
;
ne lui de-
mandez pas des dveloppements, de la grandeur, de
l'espace : son haleine est courte et ne peut pas affronter
un long voyage
;
laissez-lui sa douce rverie, son amour
mlancolique. 11 vous dira le songe d'un enfant, la
prire d'une chaste fille, la promenade deux, sous le
ciel toile, la douleur d'une mre
r
et nul mieux que lui
ne rendra tous les sentiments de l'enfant joyeux, de la
jeune'Tille regardant le ciel, des amoureux isols, de la
mre en pleurs. Schubert ne dpasse jamais le but, et il
318
ML
l'atteint toujours
;
ses tableaux sont des miniatures,
mais des miniatures qui quelquefois par leurs beauts,
s'lvent aux proportions des grands tableaux
;
celui-l
possde la vraie mlodie, que ne donnent ni la science, ni
l'tude, et qui ne reoit ses rgles que du gnie et du
got.
A l'Italie la mlodie religieuse et la mlodie drama-
tique. La mlodie religieuse vous la trouvez dans les
vieilles basiliques, au milieu de la foi des croyants, s'-
levant comme une glorification cleste au-dessus de la
tte du Christ. Dans la mlodie religieuse, point de luxe,
point de formes sensualistes, point de coquetterie, point
de fantaisie. La mlodie religieuse respire le recueille-
ment, la mditation, un amour sacr, celui de Dieu, une
aspiration brlante vers l'infini : allez dans la ville ter-
nelle, coutez le Miserere d'Allegri, les psaumes de Mar-
cello, les prires sublimes de Pergolse, les cantiques,
les louanges, les hymnes au Seigneur, de Palestrina, les
chants inspirs de Mozart et de Cherubini
;
les caprices
du monde sceptique n'ont pas souill de leurs ailes vaga-
bondes le gnie de ces compositeurs dvous la mu-
sique la plus imposante, la plus grandiose, la plus noble,
la musique qui puise son inspiration dans la croyance du
bonheur ternel, dans le respect et l'amour de la divinit.
L est la foi chrtienne, l est la vrit.
La mlodie dramatique est un mlange de toutes les
passions terrestres
;
ses effets sont plus varis, ses formes
plus saisissables, et plus accessibles l'intelligence hu-
maine. La mlodie dramatique, soumise ds sa naissance
une marche progressive, a commenc pour ainsi dire
Scarlatti, car jusque-l la musique dramatique n'exis-
tait pas ou peu prs. Le compositeur, mettant de ct
la routine et se frayant une route nouvelle travers
l'ignorance, fonda pour ainsi dire en Italie une cole
nouvelle
;
tour tour vinrent rayonner Antonio Gavalli,
Stradella, 1b comte Angelo, Antonio Lotti, Giacomo
Pri, Gorsi, Porpora, Dominico Sarri, Leonardo di Vinci,
Pergolse, Egilio Duli, Fiorillo, Piccinni, Sacchini, Pai-
siello, Cimarosa, Pioravanti, Spontini, Carafa, Rossini,
Bellini, Donizetti et Verdi. Nous en passons certaine-
ment; mais il
y
a eu une abondance telle de composi-
teurs Naples, Florence, Venise et dans presque
toutes les villes italiennes, que c'est la plus curieuse his-
toire de l'art contemporain.
ML 319
C'est dans la musique de thtre que le gnie peut ou-
vrir ses ailes. Exprimer des sensations, des sentiments,
des passions ;
charmer par la suavit, mouvoir par
l'expression, voil en deux mots le drame lyrique. On
peut avoir le gnie de la composition sans tre un musi-
cien dramatique. Que de ressources a le compositeur
pour dployer son gnie, quand il a du gnie ! Le mou-
vement, le geste, l'action doublent l'effet de la musique.
Il a fallu deux sicles pour lever l'art lyrique au point
o il est arriv de nos jours
;
certes, aucun art n'a subi
plus de
transformations que l'art musical appliqu au
thtre; le progrs s'est opr peu peu, lentement;
chaque compositeur a eu son genre. Qu'elle est belle,
simple, intressante, toute cette cole italienne, inspire
par une mlodie lgante, vive, caressante et toujours
pleine de sductions. Elle a toujours march vers le pro-
grs : Bellini, Donizetti, Rossini, Rossini surtout, l'ont
leve un degr de splendeur inou; et lorsqu'on
croyait que le feu s'tait teint dans cette braisire mu-
sicale, Verdi apparat; Verdi, l'homme de la scne,
l'homme qui donne la vie aux personnages, qui anime
les situations
;
Verdi qui fait de la mlodie l'application
la plus noble, et dont le gnie s'applique surtout ex-
primer la vrit du drame : c'est tout une transforma-
tion.
L'harmonie et le rhythme constituent la partie scien-
tifique de l'art musical
;
la mlodie en est la partie ani-
me, vivante et potique. L'harmonie et le rhythme ont
t soumis des calculs positifs, des principes fixes,
des rgles immuables. La mlodie ne peut recevoir de
rgles que du gnie et du got. Ici le caprice, la fantai-
sie, la spontanit de l'inspiration jouent un rle im-
mense. Ici se dploie toute l'originalit du compositeur.
La mlodie est la musique ce que l'expression et le
coloris sont la peinture
;
elle l'anime et la vivifie, la
pare et l'embellit. Elle assure son empire sur les sens et
sur l'imagination. Elle communique, en un mot, aux
productions do l'art cette tincelle de vie, cette flamme
divine, ce don d'immortalit, qui leur font traverser les
gnrations et les sicles, sans qu'elles perdent rien de
leur jeunesse, de leur fracheur et de leur clat.
Pour qu'un tableau excite un grand intrt ou une
vive admiration, il ne suffit pas qu'il soit remarquable
par la puret des lignes, la perfection du dessin et une
320 ML
disposition savante des effets, de l'ombre et de la lumire,
il faut, de plus, qu'il se distingue par l'expression des
physionomies, parle sentiment de l'idal ou des beauts
de la nature, et qu'on voie circuler partout le mouve-
ment et la vie.
Ce que nous disons des arts du dessin s'applique par-
faitement la musique; de mme qu'on reconnat aux
qualits que nous venons d'numrer les peintres mi-
nents, de mme on reconnat l'abondance, la ri-
chesse, l'originalit des mlodies, les musiciens vrai-
ment suprieurs.
Malgr l'insuffisance des documents qui nous sont
parvenus sur la musique des anciens, on ne saurait dou-
ter qu'ils n'aient connu la puissance del mlodie. A cet
gard, la fable, malgr ses exagrations et ses mensonges
ingnieux, peut servir de supplment l'histoire. Qu'est-
ce qu'Orphe adoucissant les monstres et attirant les fo-
rts par ses accents divins, si ce n'est une personnifica-
tion de cette douce mlodie qui avait tant de charme pour
les Grecs? Et les sirnes, ces sduisantes femmes qui,
au milieu des mers, fascinaient les voyageurs par la ma-
gie de leurs chants, et les attiraient sur les cueils les
plus dangereux de l'Afrique, ne rappellent-elles pas le
souvenir des femmes d'Athnes, de ces courtisanes en-
chanteresses qui, par leurs voluptueuses chansons, amol-
lissaient les curs, troublaient la raison des sages et des
philosophes, et charmrent souvent les loisirs de Socrate
et de Pricls ? Oui, ou trouve dans les mythes et les
fictions de l'antiquit le plus clatant hommage qui ait
t rendu la mlodie.
Aprs avoir brill d'un vif clat chez les anciens, elle
disparut tout coup dans les premiers sicles du chris-
tianisme. Les essaims de Barbares qui se prcipitrent
alors sur l'Europe en bannirent la douce mlodie. Et
qui donc aurait entendu sa voix au milieu de ces hommes
de fer, dans ce choc d'armures?...
Quand la paix eut succd au bruit des armes, la m-
lodie renaissante ne trouva d'abord d'asile que dans les
temples chrtiens. Mais austre comme la religion nou-
velle, ddaignant tout ce qui peut mouvoir l'imagination
et les sens, elle s'exhala en froides psalmodies, en plain-
chant monotone
;
elle n'eut rien en un mot de cette
coquetterie, de cette grce, de ce charme entranant
qu'elle avait possd chez les Grecs. Pendant la longue
ML 321
priode du moyen-ge, les chants tour tour nafs, pas-
sionns, mlancoliques des mnestrels, des troubadours,
des bardes, des minnesingers, offrent seuls quelques r-
miniscences de l'antique mlodie.
Tandis que l'art vgtait en Europe, dans un tat
d'immobilit et de langueur, l'Italie s'ouvrit la premire
une route nouvelle sur les ailes de la mlodie
;
un essaim
de compositeurs minents s'lana tout coup dans des
sphres inconnues
;
et, pendant trois sicles, le gnie
italien prit un essor qu'aucun peuple n'a atteint depuis,
si on en excepte l'Allemagne.
La mlodie est reste longtemps chez nous dans un
tat de faiblesse et d'infriorit qui a lait dire quel-
ques trangers, prvenus ou irrflchis, que nous tions
le peuple le plus anti-musical de l'Europe : malgr les
efforts de Lulli, notre grand Opra n'tait encore, au
dix-septime sicle, qu'une machine lourde et compli-
que
;
et au dix-huitime, toute la science de Rameau ne
put donner un peu d'animation et de vie l'Acadmie
royale de musique. C'est qu'il manquait ce grand har-
moniste ce qui sduit, ce qui charme dans toute com-
position musicale, une abondante et riche mlodie.
Sous ce rapport, Gluck et Piccinni, et de nos jours
Rossini et Verdi ont trac au gnie national une route
nouvelle, et plusieurs compositeurs franais sont entrs
avec succs dans cette voie. Mhul, Grtry, Hrold,
Monsigny, Dalayrac, Boeldieu, Auber, Halvy, Ad.
Adam, A. Thomas, Reber, Glapisson, Grisar, F. David,
Ch. Gounod, ont produit des uvres qui unissent aux
sductions de la mlodie les calculs de la science. C'est
grce cette alliance de l'harmonie et de la mlodie, que
quelques-unes des compositions de Grtry ont rsist de-
puis un demi-sicle toutes les variations du got,
tous les caprices de la mode, et qu'elles sont toujours
admires comme l'poque de leur apparition.
Mlodina. Instrument clavier avec lames vibrantes
et souflet. Construit en
1850,
par Fourneaux.
Mlodiste. On dsigne ainsi le compositeur dont les
uvres se distinguent par des mlodies heureuses. Mais
le musicien qui est tout simplement mlodiste ne pos-
sde qu'une des parties essentielles de l'art, et ses u-
vres n'obtiendront jamais un vritable succs, s'il ne
joint l'harmonie la mlodie, la science des accords
l'inspiration.
10..
322
ML
Mlodium (orgues). Espce d'Harmonium construit
par MM. Alexandre, pre et fils.
Mlodium a timbres. Nom donn en 1847
,
par
Nunn's et Fischer, de New-York, un instrument dans
lequel ils avaient combin un jeu de timbre avec les
cordes d'un piano.
Mlodore. Nom import en 1847 par Goste, une
espce de clarinette-alto, dont le corps tait de bois, et
le pavillon en cuivre.
Mlographe. Machine construite pour retracer sur le
papier les inspirations du compositeur. Le premier mca-
nisme est du Unger en 1749
;
Hohlfeld en imagina une
autre en 1752; un prtre anglais, Greed, en conut ga-
lement une en 1747
;
Freekc, chirurgien, rclama cette
mme anne la priorit sur l'ide de Greed
;
le P. En-
gramelle publia en 1770 un moyen mlographe
;
Mer-
lin, mcanicien de Londres, construisit en 1771 un appa-
reil analogue;
en 1783, Gattey tenta la solution du
mme -problme. Ces tentatives, toutes infructueuses,
furent souvent reprises sous divers noms et sous di-
verses formes.
Mlomanie. Manie de la musique.
Le mlomane
n'est pas toujours un musicien habile; il n'a le plus sou-
vent que des prtentions l'habilet et au savoir. Tou-
jours son poste dans les concerts, aux premires re-
prsentations des opras nouveaux, il excite, encourage,
blme, critique tour tour des yeux, du geste, de la
voix. 11 se pose en aristarque, en juge souverain, infail-
lible, et ses dcisions ont cass plus d'une fois les arrts
de la critique et du public.
Personne ne possde
comme lui ce sens exquis, ce tact parfait, ce sentiment
du beau qui sait distinguer le vritable talent de la m-
diocrit. A l'en croire, il est le conseiller intime de tous
nos grands artistes; Rossini lui doit ses plus dlicieuses
mlodies
;
Meyerbeer, ses plus belles inspirations
;
Au-
ber, ses rhythmes les plus coquets
;
Halvy, ses chants
les plus passionns
;
Donizetti. ses cantilnes les plus
suaves.
Nous avons seulement parl jusqu'ici du mlomane
qui se pose en connaisseur. C'est, comme vous voyez,
un personnage trs-original, et mme quelque peu as-
sommant pour ceux qui l'coutent. Mais c'est ma loi
bien pis encore, quand le mlomane aspire au titre de
chanteur, de virtuose, de compositeur. Si vous tes avec
MN 323
lui dans un salon, et que vous le voyiez aller au piano,
ou sur le point de fredonner un de ses airs, de roucouler
une de ses romances, alors sauvez-vous vite, pour peu
que vous ayez les oreilles sensibles et les organes dli-
cats
;
ou plutt restez, si vous tes curieux d'assister au
tohu-bohu le plus trange, le plus divertissant...
Toutefois, la critique que nous faisons ne s'adresse
point indistinctement tous les mlomanes; il en est quel-
ques-uns qui, malgr leurs singularits et leurs ridicules,
sont des hommes de got et de talent. Mais, part ces
rares et honorables exceptions, la musique n'est le plus
souvent chez le mlomane qu'une passion malheureuse.
Mlope. C'tait, chez les anciens, l'art ou les rgles
de la composition du chant, dont la pratique et l'effet
s'appellent mlodie.
Mlope signifiait donc la com-
position des chants, et mlodie le chant compos.
Mlophilon. Nom donn en 4846 par Piron, aune
espce d'instrument anches libres dont les so'mmiers
et les jeux taient placs verticalement.
Mlophone. Instrument invent par Leclerc, horlo-
ger, en 1837. C'tait un grand accordon ressemblant
pour la forme une paisse guitare. Contenant un double
soufflet mis en action au moyen d'une longue verge, les
registres taient ouverts par des fils correspondant des
boutons adapts le long du manche de l'instrument.
Mlophonorgue. Ainsi se nommait un instrument
imagin en 1854 par Leterme, qui ne consistait que dans
deux sries d'anches rsonnant ensemble distance d'un
quart un neuvime de ton plus ou moins.
Memphitique (danse). Se disait, chez les anciens
Egyptiens, d'une danse guerrire qui s'excutait au son
instruments militaires.
Mnestrels. Potes et musiciens qui florissaient en
France ds le huitime sicle.
Le matre de chapelle
du roi Ppin, pre de Charlemagne, tait un mnestrel.
Chanteurs et virtuoses la fois, les mnestrels obtinrent
pendant longtemps de grands succs. A la suite des
preux chevaliers dans les batailles, les tournois, les car-
rousels, ils clbraient leurs exploits, et se rendaient les
interprtes des sentiments exalts, patriotiques qui fai-
saient alors battre les curs.
Ils jouaient aussi un
rle dans les cours d'amour, les combats potiques et
tous les jeux brillants du moyen-ge.
Admis dans les
324 MES
salons de l'aristocratie, ils faisaient l'admiration et les
dlices des sentimentales chtelaines.
Cette vogue des mnestrels dura tant que leur nombre
n'excda pas certaines limites; mais mesure qu'ils se
multiplirent, ils perdirent peu peu de leur crdit et
de leur empire sur les imaginations. Il faut dire que
plusieurs d'entre eux s'attirrent le mpris public par
des excs et des dsordres qui provoqurent souvent la
rigueur des lois.
Dchus de leur ancien prestige, exclus des chteaux
et des palais, les mnestrels formrent une corporation
dont les membres, dissmins sur les divers points de
la France, se mirent utiliser leurs talents le plus fruc-
tueusement possible. Runis en groupes de quinze ou
vingt, ils parcouraient les bourgs, les villages, chantant
et jouant de la viole et de la lyre; puis, quand le soir
tait venu, ils partageaient en bons camarades leur re-
cette de la journe.
Les mnestrels survcurent aux troubadours. Mais
mesure que la musique ft des progrs en France, ils
perdirent peu peu toute considration. Connus encore
aujourd'hui sous le nom de mntriers, ils sont relgus
au dernier rang de la hirarchie musicale, et leur archet
ne sert plus qu' dfrayer les ftes rustiques.
Menuel. tait un diminutif du Cor.
Menuet. Air de danse d'un mouvement modr et
trois temps.
Le menuet est d'origine franaise; il se
dansait deux, et avait autant de grce que de noblesse.
Le menuet ftaudet a t longtemps clbre.
On nomme aussi menuet un morceau, ordinairement
le troisime, d'une symphonie ou d'un quatuor
;
il est
aussi trois temps, mais d'un mouvement trs-rapide.
Les menuets de Mozart, de Haydn, de Beethoven,
sont presque tous des chefs-d'uvre. Celui que Mozart
a plac dans le premier finale de Don Juan est d'un got
exquis.
Merline. Orgue cylindre, qui sert siffler les merles
et les bouvreuils. Il est plus fort que celui qu'on emploie
pour le serin, parce que la voix des bouvreuils et des
merles est plus grave.
Mese. Signifiait, dans la musique ancienne, une des
sept cordes de la lyre, celle du milieu qui tait consacre
au Soleil. Ce mot dsignait galement le son du milieu
du systme musical des Grecs.
MET 325
Messe. Composition musicale, en plusieurs morceaux
dtachs, que l'on chante dans les glises catholiques
pendant le saint sacrifice de la Messe.
Les paroles de la Messe sont fort belles et favorables
au langage vari de la musique; elles fournissent des
contrastes dont un compositeur habile sait tirer parti. Le
Kyrie est une prire affectueuse, le Gloria s'ouvre par
un chant clatant, le Credo, majestueux d'abord, passe
de l'expression d'un sentiment tendre celle d'une pro-
fonde tristesse. Les effets bruyants du Resurrexit con-
trastent avec l'abattement de la douleur
;
la trompette
du Jugement fait entendre ensuite ses accents terribles
et solennels, et le discours musical a pour proraison un
final brillant et rapide dans YEt Vitam, ordinairement
trait en fugue; le Sanctus et VAgnus Dei, sont deux
prires
;
l'un a le caractre imposant, l'autre est d'une
expresssion suave et tendre.
Parmi nos compositeurs modernes, les messes deLe-
sueur et Chrubini sont justement admires.
La Messe des morts se compose ordinairement de sept
parties.
Mesure. Rgle qui tablit le rapport des sons entre
eux, quant leur dure. (Voyez Temps.)
Mesur. Mot que l'on crivait autrefois sur les par-
tions pour indiquer l'endroit o cessait le rcitatif et o
reprenait le chur.
Mthode. Spcialement appliqu la musique, ce
mot dsigne une srie de rgles et de prceptes qui en-
seignent tirer tout le parti possible des aptitudes natu-
relles.
Dans la musique vocale, on dit qu'un chanteur a une
belle, une excellente mthode, pour indiquer que des
tudes fortes, habilement diriges et fondes sur une
science profonde, ont dvelopp, assoupli son organe,
et l'ont rendu propre l'excution des plus grandes dif-
ficults. L'on pourrait citer beaucoup d'artistes, qui,
sans possder des facults suprieures, sont arrivs de
beaux rsultats, grce une mthode parfaite. Ce n'est
pas dire pourtant que la mthode puisse suppler
d'heureuses dispositions, mais elle double l'effet et la
puissance des belles voix, et corrige, transforme, modi-
fie les voix dfectueuses.
Dans l'enseignement de la musique, on appelle aussi
mthode les prceptes qui servent de base l'ducation
10...
326
MIN
musicale, et qui ont pour objet de faire parcourir pro-
gressivement l'lve toutes les difficults de l'art.
Dans l'excution instrumentale , les mthodes sont
nombreuses et varies. L'on peut dire que chaque ar-
tiste minent a la sienne.
Mthode. Se dit galement de la manire d'excuter.
Mtromtre. Instrument servant battre la mesure
et les temps de tous les airs. Il fut invent en
1732,
par
Oms-Embray.
Mtronome. Instrument propre mesurer le temps
musical, dont Malzel se dit l'inventeur, en 1815; mais
l'invention fut rclame par Winkel, Hollandais.
Mezzadi (Alex.). Luthier Ferrare,
y
travailla de
1690 1720.
Mezzo-Mezza. Mot italien qui veut dire moyen : ainsi
mezza voce signifie demi-voix
;
mezzo forte, modr-
ment.
Microphone. Se dit des instruments destins aug-
menter l'intensit du son, comme font la plupart des
instruments vent, tel que le porte-voix.
Microscome musical. Mcanisme invent et cons-
truit en
1770,
par Triklir, de Dijon, au moyen duquel
on pouvait mettre tous les instruments cordes l'abri
des variations de l'air.
Milani (Francesco). Imitateur scrupuleux de Stradi-
varius, travailla Milan en 1742.
Minime. On employait autrefois ce mot pour indiquer
une note valant deux noires ou la moiti d'une ronde.
On appelle intervalle minime celui qui est moindre que
l'intervalle mineur ou diminu pour ceux qui sont sus-
ceptibles d'admettre ce degr.
Minnesinger (c'est--dire chantre d'amour). Nom
usit en Allemagne pendant le moyen-ge pour dsigner
cette sorte de potes nomms en France troubadours ou
trouvres. Les mianesingers taient
,
pour la plupart,
des chevaliers, ou tout au moins des hommes nobles, et
vivaient la cour des princes. L'empereur Frdric II,
l'archiduc d'Autriche, Lopold IV, le roi de Bohme
Wenceslas, etc., se rendirent clbres par la protection
qu'ils accordrent aux minnesingers. Parmi les plus an-
ciens de ces potes, on cite Henri de Veldeck, qui floris-
sait vers 1180. Les plus distingus vcurent la tin du
douzime sicle et au commencement du treizime.
A
MOD 327
la fin de ce dernier on admirait Conrad de Wurzbourg et
Jean Hadloub.
Mise de voix. Tenue faite sur une des notes les plus
sonores du diapason, en passant insensiblement du pia-
nissimo au forte et du forte au pianissimo.
Mixis. On donnait ce nom, chez les Grecs, la partie
de la mlope qui enseignait l'art de combiner les inter-
valles et les modes.
Mixo-Lydien. Se disait d'un des modes de l'ancienne
musique grecque appel galement hyperbonien et mile-
sien.
Modales (cordes ou notes). Sont celles qui font en-
tendre le mode, la tierce et la sixte.
Mode. Ce mot veut dire manire d'tre et dsigne la
manire d'tre du ton.
Un ton donn peut exister de deux manires, qui sont
toutes deux caractrises par la premire tierce de sa
gamme. Ainsi l'on dit qu'il est du mode majeur si la
premire tierce de sa gamme est majeure, et qu'il est du
mode mineur si la premire tierce de sa gamme est mi-
neure.
Changement de mode.
C'est un artifice harmonique
trs-usit, et quoique fort simple, souvent du meilleur
effet.
On peut, son gr, employer successivement les deux
modes du ton dans lequel on est, c'est--dire rendre
son gr majeurs ou mineurs les deux accords du ton
dans lequel on se trouve.
L'expression de l'accord parfait est trs-diffrente dans
les deux modes : le mode mineur lui donne une teinte
marque de mlancolie et de tristesse.
L'accord de dominante est compos des mmes notes
dans les deux modes; mais son expression est galement
diffrente, parce qu'il prend la teinte du mode et de l'ac-
cord pariait.
Modification dfs accords. Voyez Accords (Modi-
cation des).
Modulation. Moduler, c'est changer de ton.
La modulation est peut-tre la partie la plus impor-
tante de l'harmonie, et la source la plus fconde de ses
richesses et de ses beauts.
Pour moduler, on prend l'accord de dominante du ton
o l'on veut aller, et on le rsout dans l'accord parfait
de ce ton. Cette rgle est la seule qui existe : ce qu'on
328 MON
peut
y
ajouter n'en est que le dveloppement et l'appli-
cation.
Les altrations accidentelles introduisent dans un ton
donn des attractions qui lui sont trangres et qui four-
nissent un moyen facile de moduler dans les tons aux-
quels elles appartiennent. (Voyez Altration.)
En pratique, on prend l'une pour l'autre, deux notes
spares par l'intervalle enharmonique d'un comma,
telles que ut dise et r bmol, si naturel et ut bmol, etc.
Toutefois, leurs tendances sont compltement diffrentes
et mettent en rapport les tons les plus loigns. Ainsi, ut
dise a une tendance ascendante vers r, et peut tre
considr comme la sensible du ton de r; r bmol, au
contraire, bien que synonyme pratique de ut dise, aune
tendance descendante vers ut naturel, et peut tre consi-
dr comme le quatrime degr du ton de la bmol. L'i-
dentit pratique de ces notes et de celles qui leur sont
analogues runie la divergence de leurs attractions
tonales, est, pour les compositeurs habiles, un des plus
riches et des plus puissants moyens d'effets que l'har-
monie puisse fournir.
Moduler. C'est parcourir les cordes d'un ton ou de
plusieurs, l'un aprs l'autre, en les employant mlodi-
quement ou harmoniquement, ainsi qu'il arrive dans les
prludes, ou d'une manire plus rgulire, comme dans
les morceaux de diffrents caractres.
Moduler, c'est dans la vritable acception du mot,
faire usage d'une modulation ou de plusieurs successi-
vement.
Moldavie (Musique del). La musique de ce peuple
est peu importante. Elle consiste en quelques mlodies
d'une extension trs-borne et d'un caractre mlanco-
lique. Il
y
a parmi le peuple de ce pays quelques troupes
de Bohmiens qui font usage du violon, du fifre, de la
flte, de la clarinette et d'une espce de guitare. Les
classes riches ont adopt l'usage gnral du piano.
Mondaine (musique). Nom donn par quelques an-
ciens philosophes l'harmonie ou l'accord parfait de
toutes les parties de ]a nature.
Monocorde. Instrument de bois ou de cuivre, sur
lequel il n'y a qu'une seule corde tendue et divise selon
certaines proportions pour faire connatre les diffrents
intervalles des sons.
Monocorde se dit aussi des ins-
MOT
329
truments une seule corde, tel que la trompette ma-
rine.
On nommait monocorde dans l'antiquit un instru-
ment en usage chez les Grecs, auxquels il servait de dia-
pason. Il servait galement pour la mesure ou pour le
ton. Dans la suite, on
y
mit plusieurs cordes en conser-
vant toujours son nom.
Monologue. C'est une scne chante par un seul ac-
teur qui, s'tant identifi avec le personnage qu'il repr-
sente, en exprime les divers sentiments avec vrit. Cette
scne se compose ordinairement d'un rcitatif instru-
ment avec soin, suivi presque toujours d'une cavatine
ou d'un air de plusieurs mouvements.
Monotonie. Uniformit, galit ennuyeuse de ton dans
la musique, soit vocale soit instrumentale.
Montade (Gregorio). Excellent lve et imitateur de
Stradivarius, qui travaillait Crmone en 1726.
Montagiano (Dominique). Habile luthier de Cr-
mone, qui fut ensuite Mantoue, o il exerait son art en
1715, et termina sa carrire Venise.
Monter. Aller du grave l'aigu par intervalles con-
joints ou disjoints.
On dit galement monter un instrument, c'est--dire
y
mettre des cordes. Monter un opra, faire les rptitions
et les prparatifs ncessaires pour sa mise en scne et sa
reprsentation.
Montre. Jeu d'orgue dont les tuyaux paraissent la
faade de l'instrument. La montre appartient l'espce
des jeux de flte.
Mordant. Agrment trs-souvent employ, qui con-
siste en deux ou plusieurs petites notes, places imm-
diatement avant une note quelconque. Le mordant s'ex-
cute de plusieurs manires, et l'on se sert de diffrents
signes pour l'indiquer.
Mordant. Se dit galement d'une voix dont le timbre
est sonore et pntrant.
Morella-Morglato. Luthier, travaillait Mantoue,
en 1550.
Motet. Morceau de musique dont le chant, adapt
des paroles tirs de l'criture et des Psaumes, tait au-
trefois destin tre excut par deux, trois, quatre,
cinq, six voix seules ou accompagnes uniquement de
l'orgue. On imagina seulement, dans le dernier sicle,
330
MUE
d'accompagner ces morceaux de chant avec d'autres ins-
truments.
Aprs les messes et les oratorios, les motets sont la
partie la plus importante de la musique religieuse : ils
en ont mme toujours t et en seront toujours la partie
la plus usuelle et la plus cultive.
Presque tous les compositeurs clbres ont compos
des motets. On distingue, entre tous, ceux de Scarlatti,
Lo, Durante, Pergolse, Haydn, Mozart , Lesueur,
Chrubini, etc.
Motif. Ide primitive et principale par laquelle com-
mence ordinairement un morceau de musique. On em-
ploie le mot thme dans la mme acception.
Mouvement. On dsigne ainsi le degr de vitesse ou
de lenteur dans lequel on excute un morceau de musi-
que. Les diffrents degrs de mouvement se divisent en
cinq espces principales
1
largo ou lento
;
2
adagio
;
3
andante;
4
allegro
;
5
presto. Tous les autres mouve-
ments, comme par exemple le grave, le larghetto Yan-
dantino, Yallegretto, ne sont que les modifications des
cinq espces que nous venons d'indiquer.
Mouvement harmonique. On entend par ce mot la
marche de deux ou d'un plus grand nombre de sons dans
leur progression d'un son un autre son. Il
y
a trois es-
pces de mouvements, savoir : le mouvement direct,
quand les parties montent et descendent en mme temps;
le mouvement contraire, lorsqu'une partie monte pen-
dant que l'autre descend
;
enfin, le mouvement oblique,
quand une partie tant immobile, l'autre monte ou des-
cend.
Muances. Changement du nom des notes dans l'an-
cienne solmisation, lorsque le chant sortait des bornes
de Vheacorde. Depuis l'adoption de la note si qui com-
plte la gamme on ne se sert plus des muances.
Mue de la voix. La nature opre un changement
dans la voix l'poque o les individus des deux sexes
passent de l'enfance la pubert. L'poque de ce chan-
gement n'est point fixe, ni chez les uns ni chez les au-
tres. Ce qui est constant toutefois, c'est que la voix des
hommes, aprs la mue, change tout fait de nature et
prend un caractre oppos h celui qu'elle avait, tandis
que la voix des femmes n'prouve point une mutation
pareille. Le seul changement qui s'opre en elles con-
MUS 331
siste donner cette voix plus de force et d'tendue,
sans qu'elle change ordinairement de nature.
Mullerphone. Nom donn par l'inventeur Muller
un basson, sorte de contrebasse anche, dont le pavillon
tait en cuivre.
Musards. Nom anciennement donn certains musi-
ciens tous provenaux qui chantaient, jouaient des ins-
truments, et rcitaient des vers.
Musette. Instrument de musique vent et anche,
compos d'une peau de mouton de la forme d'une vessie,
de chalumeaux, d'un bourdon, de plusieurs anches et
d'un soufflet. Cet instrument a t fort en usage en
France, vers le milieu du xvin sicle.
On appelle aussi musette un air convenable l'instru-
ment de ce nom, dont la mesure est ordinairement
6[8,
le caractre naf et doux, le mouvement un peu lent, et
soutenu par une basse en pdale.
Musicien. Ce nom se donne galement celui qui
compose la musique et celui qui l'excute.
Musicographe. Instrument au moyen duquel on peut
crire la musique.
M. Guichen en imagina un en
1857.
Musique. Musique drive du mot musa, muse
;
l'art
enseign par la muse par excellence, celle qui prsida
la civilisation dans l'enfance des socits.
Le son est, si l'on peut s'exprimer ainsi, la matire
musicale. Les diverses combinaisons d'agencement qui
peuvent concourir tablir l'ordre dans lequel on veut
faire succder un son un autre son, soit dans leurs
rapports du grave l'aigu, ou de l'aigu au grave,
ou du grave au mdium, ainsi que de la dure de temps
que l'on veut assigner chacun d'eux en particulier,
constituent la partie spculative de l'art.
La musique se compose de trois parties bien distinctes.
1
De la mlodie, ou succession de plusieurs sons diff-
rents qui, dans leurs rapports de tonalit, concourent
former un ensemble agrable et flatteur pour l'oreille
;
2
Du rhythme, ou de l'ordre choisi dans lequel on
tablit la succession des sons, leurs dures et leur pla-
cement aux temps faibles, forts et au temps des mesures;
3
De l'harmonie, audition simultane de plusieurs
sons diffrents qui, d'accord entre eux, viennent former
un harmonieux ensemble.
La musique est, de tous les beaux-arts, celui sur le-
332 MUS
quel on a Je plus dissert sans s'entendre. C'est aussi ce-
lui qui a donn lieu au plus grand nombre de thories et
de systmes. L'incertitude que ces diverses opinions et
ces jugements contradictoires ont jete dans les esprits
est, sans contredit, une des principales causes des obsta-
cles qui ont longtemps arrt les progrs de l'art musi-
cal.
La musique a plus besoin d'tre sentie que raisonne.
Pour nous mouvoir, elle s'empare toujours de nos sens
avant de parler notre esprit. Elle est, par son essence,
purement idale. Le vague qu'elle semble porter en elle
est une volupt pour l'auditeur, et les sentiments de
pit, d'amour, de fiert, de joie, de fureur ou de gloire
qu'elle sait si bien exprimer, ont dj pntr notre me
bien avant que notre raison en vienne sanctionner les
effets. Les fables mmes dont s'enveloppe la mmoire des
premiers musiciens, attestent les prodiges enfants par
cet art, avant que les hommes eussent appris trans-
mettre leurs expriences et leurs ides autrement que par
la tradition. Orphe passa pour le fils d'un dieu, bien
avant qu'Homre et obtenu des autels; et sans doute
plus d'un berger amoureux avait chant les plaisirs et les
charmes de sa matresse, quand Dibutade imagina de
fixer sur la pierre l'ombre incertaine des traits de son
amant. Si, ds l'enfance du genre humain, la sculpture
sortit grossire des mains de l'idoltrie, ce fut par suite
du besoin qu'prouvait l'homme d'adresser aux images
des dieux des hymnes composs en leur honneur
;
et les
lambris du premier temple qu'leva l'architecture re-
tentirent des mmes concerts que la Divinit agrait de-
puis longtemps sous la vote religieuse des forts. Il est
donc hors de doute que si l'on peut contester la musi-
que un rang de prdominance parmi les beaux-arts, on
ne saurait du moins lui refuser celui de l'antriorit.
Eman de la reconnaissance des hommes, ce bel art prit
naissance avec le monde : il fallait une langue univer-
selle pour exprimer un sentiment universel; Dieu cra
la musique.
S'il est bien reconnu que la musique, par son magi-
que pouvoir, agit sur nos sens avant de parler notre
intelligence, l'on doit aisment concevoir qu'il a t plus
difficile de fixer ses rgles que celles des autres arts. Ce-
pendant il est des parties qui ont pu tre analyses
;
la
succession des accords ou la science de l'harmonie, et la
mus xa
puissance du rhylhme ont t soumises des calculs po-
sitifs et des rgles immuables.
Quant la mlodie, elle ne peut recevoir do rgles que
du gnie et du got. Le gnie ne peut s'acqurir
;
le
got peut se former par l'exprience et la comparaison.
La musique tant considre comme un langage par-
ticulier, a eu besoin d'un alphabet particulier qui pt lui
servir transmettre ses penses, et lui offrir le moyen
de reprsenter et de peindre nos yeux la varit des
sons dont elle sait faire choix pour charmer nos oreilles.
Dans le langage parl, plusieurs signes diffrents, tels
que les lettres, les points, les virgules, les accents, ser-
vent reprsenter toutes les varits de l'organe de la
parole; dans le langage musical, plusieurs signes diff-
rents, tels que les portes, les notes, les clefs, les dises,
lesbmols les bcarres, les pauses, les soupirs, servent
reprsenter toutes les varits de l'organe chantant.
Longtemps la voix humaine a sans doute t seule en
possession de faire entendre des sons musicaux
;
mais le
gnie inventif de l'homme, activ par ce besoin de tout
connatre qui le porte incessamment tenter de pntrer
les mystres de la cration, lui a dvoil les premires
lois de l'acoustique, et d'efforts en efforts, de sicle en
sicle, il est parvenu par imitation crer des voix fac-
tices auxquelles il a donn le nom d'instruments de mu-
sique.
Les diffrentes natures des voix humaines dpendent
surtout de celles des sexes. Chez les hommes particu-
lirement, ces diffrences dpendent de celles de l'ge.
L'importance de ce dernier sujet nous forant le trai-
ter d'une manire spciale et approfondie, nous ren-
voyons le lecteur l'article. (Voix).
Musique coups de canon. L'emploi du canon canon-
isant en musique, date de 1788. Ce fut un Italien qui, le
premier, tenta cette innovation. Le clbre Sarti appel en
1784 Saint-Ptersbourg, en qualit de matre de chapelle,
y
organisa un orchestre formidable pour donner son b-
nfice personnel, un grand concert spirituel. En
1788,
l'occasion de la fte clbre pour la prise d'Okrakow,
il composa un grand Te Deum qui fut excut dans le
chteau imprial par une nombreuse runion de chan-
teurs et d'instrumentistes, auxquels se joignit un orches-
tre de cors russes. Pour augmenter l'effet de cette mu-
sique grandiose, Sarti fit placer dans la cour du chteau
334 MUS
des canons de diffrents calibres, dont les coups tirs en
mesure des intervalles donns, formaient la basse de
certains morceaux.
Charles Stamitz, clbre par son talent sur l'alto et la
viole d'amour, excuta Nuremberg une grande musi-
que vocale et instrumentale de sa composition, dont la
pompe tait releve par l'accompagnement oblig de
coups de canons.
En d836, au camp de Plaisance de Krasnoje-Selo, en
Russie, il
y
eut une grande solennit musicale dont cent
vingt coups de canon formrent l'introduction. Puis,
pendant les morceaux de chants excuts par les masses
chorales, des coups de canon tirs rgulirement, bat-
taient la mesure.
Musique avant le dluge. A l'article Origine de la
musique, nous dirons que cet art, comme celui de la pa-
role, ou du langage parl, venait du crateur de toutes
choses. Si nous ne connaissons point de matres humains
qui enseignassent la musique dans les premiers sicles
du monde, c'est que Dieu lui-mme voulut bien ensei-
gner lui-mme ce langage ses cratures bien aimes.
D'aprs Mose, il cra l'homme pour l'aimer et le servir :
il lui apprit clbrer sa toute puissance et les merveilles
de la cration par des chants primitifs, mais pleins de
vie, d'expression, d'enthousiasme. Plus tard, il permit
que Jubal inventt des instruments de musique et ensei-
gnt cet art sublime au peuple de son choix. Bientt Ja-
bel, Tubalcan, la jeune Noma firent cercle autour du
fils de Lamech, et l'art musical devint une science, chez
les Hbreux, qui ft probablement des progrs consid-
rables pendant les seize cents annes et au-del qui s'-
coulrent entre la cration et la grande catastrophe du
dluge.
On sait que l'instrument champtre a donn l'ide de
l'orgue moderne, dont chaque registre prsente assez
bien l'il la forme de la flte tant de tuyaux. Il
y
avait donc, dans ces temps reculs, des instruments
vent et cordes et certainement ceux percussion exis-
taient aussi. Quant la musique vocale, il est hors de
doute qu'elle tait en usage alors, puisqu'il est dit que
dans le temps de Seth, vers Tpoque de la naissance
d'Enos, les hommes commencrent clbrer le nom du
Seigneur. Nous croyons mme, comme nous l'avons dit
plus haut, que cet acte de reconnaissance avait t ac-
NAS
33.",
compli ds les premires annes de Tre Judaque. En
offrant ses sacrifices l'ternel, Abel, comme son pre
et sa mre, dut chanter les louanges de celui qui bnis-
sait ses troupeaux. La chronique d'Alexandrie dit que
les fils de Seth invoqurent le Seigneur avec l'hymne
des anges. D'aprs Calmet, le sens de ces paroles est
qu'ils commencrent rciter l'hymne du Seigneur :
Saint, saint, saint
;
et, comme le dit le P. Martini,
hymne signifiant la runion de la posie et de la musique,
il est clairement prouv qu'il est ici question de ce der-
nier art.
Mutation (Jeux de). On appelle ainsi les registres de
l'orgue dont les tuyaux ne sont point accords au diapa-
son des jeux de fonds, et qui sonnent ou la tierce, ou la
quarte, ou la quinte de ceux-ci, et quelquefois plusieurs
de ces intervalles la fois. Le cornet, la cymbale, la four-
niture, sont des jeux de mutation.
Mutation. Se disait dans la musique ancienne des
transitions de la musique des Grecs, qui taient au
nombre de cinq.
N
Nabla ou Nebel. Ancien instrument des Hbreux,
que Luther a traduit par psaltrion. On croit gnrale-
ment que c'tait la lyre des anciens. Il se composait d'un
cadre sonore triangulaire , dont un des angles tait
tronqu. Les cordes taient tendues perpendiculaire-
ment dans la partie vide du triangle.
Nacatre. Non anciennement donn aux tymbaes.
Nafiri. Nom d'une trompette indienne.
Nagaret. Espce de timbales enusage dansl'Abyssinie.
On les frappe avec un bton courb, long de trois pieds,
et on les attache sur des mulets de selle.
Nasard. Jeu d'orgue qui tire son nom de sa qualit de
son nasillard : il sonne la quinte du ^restant
; c'est pour-
quoi on lui donne quelquefois le nom de quinte. Le na-
sard est de l'espce des jeux d'orgue qu'on appelle jeux
de mutation.
336
NEX
Naturel. Voy. les mots accident, chant,
intervalle.
Naturel.
Labeaut de l'art consiste dans l'imitation
de la nature. Cependant, comme l'art ne rejette pas le
beau idal et ne repousse pas les inspirations de la fan-
taisie, il arrive que l'artiste, en imitant la nature, l'em-
bellit, et l'lve pour ainsi dire l'idal.
Naturels. Se dit des tons qui se forment de la gamme
ordinaire sans aucune altration. On dit aussi notes na-
turelles, celles qui ne sont affectes ni d'un dize, ni d'un
bmol.
Nechiloth. Nom gnrique des instruments vent
en hbreu, comme le mot nginoth est le nom gnrique
des instruments cordes.
Nel. Espce de flte traversire faite de roseau, en
usage chez les turcs.
Nella (Raphal) de Brescia, tait un luthier fort ha-
bile qui vivait en 4680. On reconnat ses violons ce
que les ttes sont toujours sculptes et que les clisses
sont remplies d'inscriptions.
Nronennes. Ftes romaines institues par Nron,
dans lesquelles avaient lieu des luttes musicales.
Neume. C'est un terme employ dans le plain-chant.
Le neume tait une figure mlodique que l'on plaait sur
une voyelle et le plus souvent sur la dernire voyelle du
mot Allluia. C'est un chant sans paroles, autoris par
le catholicisme d'aprs un passage de Saint-Augustin,
qui dit que
a ne pouvant trouver des paroles dignes de
a Dieu, l'on fait bien de lui adresser des chants confus de
jubilation.
Le neume s'entend aussi d'une pause, d'un comma,
d'un signe final.
C'est aussi un terme de l'une des six anciennes critu-
res musicales qui ont prcd la notation de Guid'Arezzo.
Les neumes taient de petits signes placs au-dessus des
paroles, dent chacun exprimait une formule de chant.
Neuvime.
Intervalle dissonant de neuf degrs, ou
l'octave de la seconde; il est de trois espces :
1
la neu-
vime mineure, comme mi, clef de basse, troisime es-
pace, et
fa,
clef de violon, premier espace :
2
la neu-
vime majeure, comme do, clef de basse, et r, au-dessus
de la porte :
3
la neuvime augmente, comme
fa,
clef
de basse, quatrime ligne, et sol, clef de violon, seconde
ligne.
Nexus. Nom antique de la mlodie, consistant en une
NOG 337
succession alterne de sons qui procdaient ou par degrs
ou par sauts. Lorsqu'ils montaient, ils se nommaient
nexus rectus
;
lorsqu'ils descendaient, on les nommait
nexus anacamptus
,
et lorsqu'ils montaient et descen-
daient nexus circumstans.
Nez (chanter du). C'est naziller, chanter d'une ma-
nire dsagrable comme si le nez tait bouch.
Nicolo. i\om que l'on donnait anciennement une
sorte de hautbois, qui tait le contralto de cet instrument
et qui a cess d'tre en usage.
Nicordo. Instrument corde qui fut invent Flo-
rence, en 1650 par Franois Nigelli.
Ninfali. Espces de petites orgues en usage ancienne-
ment en Italie. Monteverdi s'en est servi en 1607 dans
son opra d'Eurydice.
Noble. Le style musical est noble lorsqu'il s'lve au-
dessus de l'expression commune et que les formes vul-
gaires et insignifiantes en sont exclues.
Dans l'excu-
tion, la noblesse consiste viter l'emploi des agrments
inutiles, marquer sans affectation l'accent oratoire,
exposer avec aisance et dignit toutes les priodes d'un
morceau de musique,
La noblesse doit tre exprime naturellement, sans
vulgarit, mais aussi sans emphase ni affectation, autre-
ment on tombe dans le style manir, qui consiste
excuter un chant simple de sa nature en le chargeant
d'ornements affects, et par consquent de mauvais
got.
Nocturne. Morceau de musique destin tre excut
de nuit en srnade ou dans les salons. Le nocturne vo-
cal s'crit deux, trois et quatre voix
;
on le dispose
quelquefois de manire ce qu'il puisse tre chant sans
accompagnement.
Le nocturne tant fait pour ajouter
aux charmes d'une belle nuit ou des runions intimes,
son caractre s'loigne autant de la gaiet vive et
bruyante que de la tristesse et du mouvement imptueux
des grandes passions. Une mlodie gracieuse et suave,
tendre et mystrieuse, des phrases simples, une harmo-
nie peu travaille, mais pleine, onctueuse, telles sont les
qualits que l'on doit rencontrer dans le nocturne, et
s'il est excut par de bons chanteurs, son effet sera d-
licieux.
Le nocturne est encore une pice instrumentale crite
pour harpe et cor, hautbois et piano, flte et piano, etc.
338 NOT
Ces nocturnes ne sont, proprement parler, que des fan-
taisies dialogues.
Nocturne. Partie de l'office des matines qui se divise
en trois nocturnes, ainsi appels parce que les premiers
chrtiens les chantaient pendant la nuit en trois temps
diffrents.
Nodales (lignes). Ce sont celles qui se trouvent pro-
duites par la srie des points de repos la surface d'une
verge rigide mise en vibration.
Noels. Airs destins certains cantiques chants aux
ftes de Nol. Les airs des nols doivent avoir un carac-
tre champtre et pastoral, en harmonie avec la simpli-
cit des paroles et avec celle des bergers, qu'on suppose
les avoir chants en allant rendre hommage l'enfant
Jsus dans la crche.
Noeud. On appelle nuds les points dtermins par
lesquels une corde sonore, mise en vibration, est divise
en parties aliquotes vibrantes, qui rendent des sons diff-
rents de ceux produits par la corde entire.
Noire. Note de musique qui vaut deux croches ou la
moiti d'une blanche. Dans l'ancienne musique, on se
servait de plusieurs sortes de noires : noire queue,
noire carre, noire en losange. Ces deux dernires esp-
ces sont demeures dans le plain-chant
;
mais dans la
musique moderne, on ne se sert plus que de la noire
queue.
Nome. Espce d'air des anciens Grecs, dont on ne pou-
vait changer en rien la mlodie. Les nomes contenaient
les principales lois de la vie civile, ou des louanges en
l'honneur de quelque divinit imaginaire.
None. Partie de l'office divin, une des heures cano-
niales.
Non troppo, Pas trop. Expression italienne qui se
joint aux indications du mouvement de vitesse ou de len-
teur ou aux modifications de force et de douceur. Ainsi
non troppo allegro
signifies trop vite
;
non troppo
adagio, pas trop lent, etc.
Notation. Art de reprsenter aux yeux et l'intelli-
gence le son musical et ses diffrentes modifications, de
telle faon que l'excution reproduise ensuite au moyen
de la voix ou des instruments, les penses crites par le
compositeur. On crivait dans l'antiquit, chez les
Grecs, la musique l'aide des caractres de l'alphabet
;
au vi
e
sicle de l're chrtienne, le pape Grgoire subs-
NOT 339
titua aux lettres de l'alphabet grec, les lettres de l'al-
phabet romain, mais comme ces lettres ne se prtaient
point au got des ornements, des roulades, des fiori-
tures qui domina ensuite, chaque nation en adopta une
particulire : ainsi il
y
eut la notation celtique, la nota-
tion saxonne, la notation lombarde, les neumes, etc, etc.
Quand le dsordre fut son comble, un moine toscan,
Guido d'Arezzo imagina un systme trs-simple qui mit
lin cette anarchie; il imagina la porte, les notes, les
clefs, qui forment le germe de la notation usuelle adop-
te par tous les peuples. Le P. Souhaisty voulut changer
cette notation et il proposa de remplacer le nom des notes
par les sept premiers chiffres, etJ.-J. Rousseau marcha
un moment sur les traces du Jsuite innovateur et adopta
l'ide des chiffres, mais ayant reconnu l'impossibilit
d'galer la simplicit, la rectitude de la notation usuelle,
il l'a condamna. Cette criture par chiffre fut reprise par
Galin, non comme thorie, mais seulement comme
moyen pdagogique. Plus tard, MM. Paris et Ghev,
adoptrent la donne du chiffre et voulurent faire
dominer leur chiffrage et remplacer la notation usuelle
rpandue dans tout l'univers, par un nouveau langage
musical. Ce systme n'a pas mieux russi.
Note sensible. Est celle qui est une tierce majeure
au-dessus de la dominante, ou un demi-ton au-dessous
de la tonique. On l'appelle note sensible parce qu'elle
fait sentir le ton et la tonique sur laquelle, aprs l'accord
dominant, la note sensible, prenant le chemin le plus
court, est oblige de monter.
Noter. C'est crire de la musique avec les caractres
destins cet usage et appels notes. Il faut distinguer
noter de copier. Le musicien note ce qu'il compose ou ce
qu'il a retenu de mmoire : celui qui crit la musique
dj note, et d'aprs un exemplaire qu'il a sous les yeux,
est tout simplement un copiste.
Notes. Signes ou caractres dont on se sert pour crire
la musique. Les Grecs se servaient des lettres de leur al-
phabet pour noter la musique. Les Latins les imitrent
dans cette pratique. Ce ne fut que dans le onzime sicle
qu'un bndictin d'Arezzo, nomm Guido, substitua
ces lettres dus points poss sur diffrentes lignes paral-
lles, chacune desquelles une lettre servait de clef :
dans la suite, on grossit ces points
;
on s'avisa d'en poser
310 NOT
aussi dans les espaces compris entre les lignes, et Ton
multiplia, selon Je besoin, ces lignes et ces espaces.
Les notes n'eurent, pendant un certain temps, d'autre
usage que de marquer les degrs et les diffrences de
l'intonation
;
elles taient toutes, quant la dure, d'-
gale valeur, et ne recevaient cet gard d'autres diff-
rences que celles des syllabes longues et brves sur les-
quelles on les chantait.
Cet tat de choses dura jusqu'en 1338, poque o Jean
de Murris, docteur et chanoine de Paris, donna diff-
rentes figures aux notes pour marquer les rapports de
dure qu'elles devaient avoir entre elles. 11 inventa aussi
certains signes de mesure, appels modes ou prolations,
pour dterminer dans le cours d'un chant, si le rapport
des longues ou brves serait double ou triple. Plusieurs
de ces figures ne subsistent plus, on leur en a substitu
d'autres en diffrents temps, jusqu' ce que la division
en mesures de valeur gale soit venue donner une marche
fixe et rgulire au chant not.
On ne donne le nom de notes qu'aux caractres qui re-
prsentent les sept notes do, r, mi,
fa,
sol, la, si.
Notes accidentes. C'est--dire accompagnes d'un
des signes que l'on nomme accidents.
Notes a double queue. Ces notes se trouven t habituel-
lement dans les parties de violons, de violes, de guitares.
On les excute sur la corde vide. La double queue in-
dique qu' la corde vide on doit unir son unisson cor-
respondant, et l'effet dsir s'obtient en pressant avec le
doigt la corde voisine.
Notes de passage. Les notes de passage sont ainsi
appeles, parce qu'en remplissant les intervalles qui se
trouvent entre des notes qui procdent par degrs dis-
joints, elles servent de liaison pour passer plus aisment
de Tune l'autre : elles donnent les moyens de varier la
mlodie par des suites de notes, de roulades composes
alternativement des notes de l'accord et de celles qui les
sparent. De l vient que cette roulade ou tout autre
trait de chant est dsign par le nom de passage.
Notes surabondantes. Quelques auteurs donnent ce
nom aux triolets et aux sextolets, et dans quelques
cas aux notes marques 5 pour
4,
7 pour
4,
9 pour
8,
etc.
Noteurs. Autrefois on appelait ainsi les musiciens qui
taient employs dans les chapelles crire la musique
OCT 341
qu'on distribuait aux excutants. Ce nom n'est plus
en usage, on l'a remplac par celui de copiste.
Novello (Petrus et Marc-Ant.) Furent d'habiles lu-
thiers qui habitrent Venise, et dont les instruments
sont rares et bons. Us travaillaient au commencement
du xyiii sicle.
Noyau. Partie d'un tuyau d'orgue ou l'on place
l'anche.
Numerus sectionalis. Ces mots latins signifient le
nombre des mesures qui appartiennent chaque mem-
bre parfait du rhythme de la mlodie.
Nunnie. Chez les Grecs on appelait nunnie la chanson
particulire aux nourrices.
0. Cette lettre est dans la musique ancienne le signe
de ce qu'on appelait temps parfait (tempus perfectuiri)^
ou du temps compos de trois semi-brves (rondes).
Le signe o dsigne la corde vide sur le violon; mais,
dans ce cas, il est employ comme zro.
Quelques auteurs, en parlant de la position de la
main, se servent de la lettre o pour indiquer le pouce.
Dans l'art de lire 1* harmonie reprsente par des
chiffres, on marque par ce signe o la note qui ne doit
pas tre accompagne
;
mais, dans ce cas encore, il est
employ comme zro, pour indiquer nant, c'est--dire
pas d'accord.
Oblige. On appelle partie oblige celle qu'on ne sau-
rait retrancher sans gter l'harmonie ou le chant : elle se
distingue des parties de remplissage, en ce que celles-ci
ne sont ajoutes que pour donner plus de perfection
l'harmonie.
Ochetus. C'tait autrefois une espce de chant tron-
qu ou interrompu par des pauses, dont le mot corres-
pondant en franais pourrait tre hoquet, d'o il drive.
Octacorde. Division par octaves runies, c'est--dire
division o le dernier son de ia premire octave consti-
tue le premier son de l'octave suivante.
11.
342 OCT
Octave. Ton loign d'un autre de huit degrs, les
deux extrmits comprises. La premire des conson-
nances dans l'ordre de leur gnration. L'octave est
la plus parfaite des consonnances. Elle est, aprs
l'unisson, celui de tous les accords dont le rapport est le
plus simple.
Il
y
a trois espces d'octaves comme
d'unissons : i l'octave juste
;
2
l'octave augmente
;
3
l'octave diminue. (Voyez quinte).
Octave (rgle d'). Dans l'ancienne musique tait une
formule d'accompagnement qui consistait prendre les
sixtes sur chaque degr de la gamme l'exception du
premier et du cinquime auxquels on fait, porter l'ac-
cord parfait. Rgle d'octave est aussi le nom que l'on
donne la rgle qui enseigne la manire de chiffrer la
gamme, et qui dicte par consquent, les accords que
peuvent ou que doivent recevoir les notes qui la compo-
sent.
Octaves (rgle des deux). On ne doit pas faire succ-
der deux octaves de suite dans l'harmonie, surtout par
mouvement direct, quand les parties harmoniques ne
sont point l'unisson ou l'octave par la volont
expresse du compositeur. Ces deux octaves seraient d'un
effet trop nul et trop plat.
Octavier. C'est faire entendre l'octave haute d'un son,
soit en forant le vent dans les instruments vent, ou
soit en jouant prs du chevalet avec l'archet
Octavin. Petite flte qui donne l'octave de la grande
flte. L'octavin dont on fait usage l'orchestre est dia-
pasonn en r comme la grande flte, mais il rend les
notes une octave plus haut qu'elles ne sont crites.
. Octavine. Nom que l'on donnait une petite pinette
qui n'avait que les octaves suprieures.
Octeophone. Instrument imagin Londres en 1789,
par un mcanicien Viennois, nomm Vanderburq.
Ogtohasse Contre-basse volumineuse, imagine par
Dubois, artiste de l'Acadmie royale de musique, en
S 83i, avec un mcanisme spcial consistant dans une
roue qui place prs du chevalet etau-dessous des cordes,
les attaquait avec plus ou moins d'nergie, l'aide d'un
levier de renvoi. Des pdales correspondantes saisissaient
les cordes diffrentes distances, les faisaient abaisser
et les pressaient plus ou moins fortement contre la
roue.
VuUlaumc reprit cette ide en 1851
;
ei lui faisan' su-
OFP
343
bir divers perfectionnements, il dota son instrument de
leviers qui venaient placer sur les cordes des espces de
barres, en sorte que l'excutant dans chaque position de
la barre avait toujours sa porte trois degrs.
OCTOCORDUM PYTHAGORALE, OU LYRE PYTAGOR1QUE.
Les anciens Grecs comprenaient sous ce nom un systme
d'instrument trs-ancien et trs-born, invent par
Pythagore. Il comprenait huit sons : c'est--dire des
ttracordes disjoints.
Octoecus. Nom d'un livre d'glise chez les Grecs, qui
renferme tout ce que l'on chante pendant les offices,
selon les huit tons du chant.
Ode. Mot grec qui signifie chant ou chanson. Il
y
a
l'ode-symphonie, qui est un pome musical ml de
chant, de rcitatif not et parl, et dans lequel l'orches-
tre joue un rle trs important. (Voyez Chanson.)
Odon. difice public Athnes et dans d'autres
villes de la Grce, o les musiciens essayaient leurs mor-
ceaux avant de les excuter en public.
Le premier odon fut construit Athnes par les ordres
de Pricls. Apollodore et Domiton construisirent deux
odons Rome.
Odestrophdon. Instrument Anches libres, cons-
truit Saint-Etienne, en
1842,
par Reverchon et Merla-
vaud.
OEfuphone. Instrument de la famille du physarmo-
nica, construit par Dietz, en 1828
;
il le perfectionna en
donnant au son plus d'intensit.
OEuvre. Par ce mot on dsigne les compositions mu-
sicales d'un auteur.
OEuvre est du genre fminin, quand il s'agit d'une
seule composition d'un auteur. Il est du genre masculin,
quand il s'applique tous les ouvrages produits par un
artiste. Ainsi l'on dit l'uvre entier de Beethoven, de
Mozart, de Rossini, etc., etc.
Offertoire. C'est cette partie de la messe qui se
trouve entre le Credo et le S.anctus, pendant laquelle le
chur garde le silence. L'orgue remplit cet intervalle
;
ou bien on excute une pice compose exprs pour
y
tre place, et cette pice, pour ce motif, prend le nom
d'offertoire.
Office divin. On dsigne par ce mot tout ce qui a rap-
port aux rites religieux, au chant, etc. Il
y
a l'office am-
brosien, grgorien, mosarabique. Ce dernier a t intro-
344
OP
duit au commencement du seizime sicle par Franois
Ximens, archevque de Tolde.
Oliphant. Etait une espce de trompe compose d'une
corne d'ivoire, d'o est venu son nom, du mot lphant.
Olophyrmos. Chanson funbre des anciens Grecs.
Ombre, nuance de la voix. C'est ainsi qu'on appelle
en italien les diffrentes gradations des fortes et despj'a-
nos, dont en doit alternativement faire usage dans les
cantilnes pour leur donner un peu de relief, comme les
ombres et les demi-teintes servent en peinture faire
ressortir les couleurs.
Omerli. Instrument de l'Inde, archet, mont de
deux cordes. Le corps est form d'une noix de coco dont
on a enlev le tiers et dont on a aminci les parois. Qua-
tre ouvertures elliptiques sont pratiques la partie an-
trieure. La table est forme d'une peau de gazelle bien
prpare et bien unie.
Omnes. Mot latin qui signifie tutti et que l'on trouve
quelquefois au lieu de celui-ci dans l'ancienne musique
sacre.
Ondes sonores. Srie continue des ondulations de
mme nature, se dveloppant simultanment dans une
colonne d'air mise en vibration. La longueur des ondes
sonores est sensiblement gale l'espace parcouru par le
son, pendant la dure de la vibration
;
aussi on obtiendra
cette longueur en divisant par le nombre de vibrations
excutes dans un temps donn, l'espace parcouru par
le son pendant le mme temps.
Ondulation. Ce mot signifie peu prs la mme
chose que trmolo, avec cette diffrence que le mouve-
ment en est plus grave, et que l'on met les sons et la
voix avec plus de latitude.
Onzime. Rplique ou octave de la quarte. Cet inter-
valle s'appelle onzime, parce qu'il faut passer onze sons
diatoniques pour aller de l'un de ces termes l'autre.
Opra. C'est, clans le sens le plus tendu, un drame
musical. Il se distingue de la comdie et des autres
ouvrages dramatiques, en ce qu'il ne peut se passer du
concours de la musique, qui, dans la comdie et le
drame, n'est qu'accidentelle et soumise aux exigences
passagres du sujet. Dans l'opra, au contraire, la mu-
sique est la partie essentielle, non toutefois de manire
dominer la' posie, mais seulement pour les mettre
OP 345
toutes deux en relation intime et les l'aire marcher d'ac-
cord.
Les principales qualits d'un pome d'opra Font : une
esquisse exacte et facile des caractres, un grand fonds
de situations lyriques habilement varies, et surtout un
choix d'expressions musicales appropries au caractre
des diffrents personnages. Nous ne parlons pas du
laisser-aller de la pense, de l'lgance du rhythme : ce
sont l des qualits que doit possder toute posie
lyrique.
m
La musique de l'opra doit s'lever la hauteur de la
posie, et mme celle du drame
;
c'est ce qui lui impose
la ncessit d'tre plus caractristique et plus svre que
toute autre espce de musique. Soumise la nature du
pome, la musique doit revtir son caractre dominant.
Par exemple, la Flte enchante, de Mozart, se distin-
gue par un style solennel et svre, auquel ne portent
pas atteinte quelques airs simples et nafs.
Outre les qualits gnrales que tout pome drama-
tique doit possder, l'opra en exige quelques autres qui
lui sont spciales : les plus importantes sont une action
et une division favorables aux dveloppements de la par-
tie musicale. M. Halvy nous fournit dans un travail
destin l'Acadmie des beaux-arts, quelques rflexions
excellentes sur ce double sujet.
Il ne faut pas que, dans un drame destin la mu-
sique, Vaction soit trop complique. Il faut que le sujet
soit simple, et plus passionn qu'accident. S'il
y
a beau-
coup d'action dans un opra; s'il est charg d'vne-
ments; si les situations se succdent rapidement et sans
laisser, pour ainsi dire, respirer le spectateur, la mu-
sique ne trouve plus sa place
;
elle est touffe entre les
incidents
;
et quelque vifs et concis que puissent tre les
morceaux de musique, ils ralentissent ou du moins
semblent ralentir Vaction, La musique est le dveloppe-
ment d'une situation donne et un repos dans Yaction.
Il faut donc que l'auditeur ne soit pas trop press, par
Yaction elle-mme, d'arriver aux scnes suivantes
;
il
faut aussi que l'intrt de la situation elle-mme lui per-
mette d'couter sans impatience ce dveloppement
musical. C'est au compositeur, de son ct, apprcier
la situation, et ne pas lui donner plus de musique
qu'elle n'en comporte.
Le public franais est svre cet gard
;
un public
346 OP
italien donne plus de place la musique et plus de latti-
tude au compositeur.
Il
y
a dans un drame de quelque importance des
situations capitales aprs lesquelles l'action doit s'arrter,
se reposer, pour ainsi dire, pour continuer ensuite avec
plus de force et avec le surcrot d'intrt que la situation
nouvelle a d apporter au drame. Ces points de suspen-
sion qui mnagent l'attention de l'auditoire et excitent sa
curiosit, introduisent dans l'action dramatique des divi-
sions naturelles.
Chacune de ces divisions a reu le nom d'acte. C'est au
point de vue du drame lyrique seulement que nous envi-
sageons Yacte.
Aprs les conditions essentielles du drame lui-mme,
c'est--dire l'intrt des situations et leur aptitude ins-
pirer le musicien, la condition la plus dsirable pour le
compositeur, c'est la varit. Non seulement chaque
acte devra lui fournir une couleur bien tranche, et tout
fait diffrente de celle de Yacte qui a prcd ou de celui
qui doit suivre, mais il faut encore que dans l'acte consi-
dr isolment, railleur sauve au musicien le danger de
l'uniformit. Ainsi donc, dans un opra, chaque acte,
quoique ne formant qu'une partie d'un tout, doit offrir
un ensemble satisfaisant, aussi complet que possible, et
une distribution intelligente et bien entendue des effets
dont peuvent disposer et le musicien et le thtre sur
lequel son uvre devra se produire.
Un bon acte d'opra renfermera donc au moins une
situation importante, qui sera comme le pivot de Yacte,
et sur laquelle le musicien devra concentrer tous ses
efforts et toute la puissance de son art. Les autres scnes
devront, sans tre sacrifies, concourir faire ressortir
l'clat de ce point lumineux
;
ainsi, le beau trio de Guil-
laume Tell est habilement amen et mnag. Il estinutile
d'ajouter que la scne capitale dont nous parlons devra
arriver la fin ou vers la fin de Yacte. L'auditoire,
encore sous le coup de l'impression qu'il aura prouve,
sera, ds le dbut de Yacte suivant, plus accessible aux
motions nouvelles, et s'associera avec plus de chaleur
et de sympathie au dveloppement du drame et aux ins-
pirations du musicien.
Aprs ces considrations gnrales, nous entrerons
dans quelques dtails sur la contexture purement musi-
cale d'un acte d'opra.
OP 347
L'auteur et la compositeur doivent s'y tudier
varier les combinaisons offertes par les voix diffrentes
des personnages qui prennent part l'action. Il faut vi-
ter, autant que possible, qu'un air succde un air, un
duo un duo; il faut donc faire entendre alternativement
les voix isoles, combines, et les masses chorales.
Le morceau de musique qui commence un acte reoit
le nom cY introduction
\
il doit avoir un certain dvelop-
pement, une certaine importance musicale. Ceci s'ap-
plique surtout au morceau qui commence le premier
acte et succde l'ouverture. Il doit tre trait avec soin.
Ordinairement, une introduction se compose de plu-
sieurs scnes varies et se termine par un ensemble
vocal
.
Gomme nous l'avons dit plus haut, l'auteur aussi bien
que le compositeur, doivent, en tablissant le plan gn-
ral de l'ouvrage se proccuper beaucoup de la fin de
chaque acte. Il faut, autant que possible, laisser l'audi-
toire sous l'impression d'une vive motion. Chaque fois
que le rideau se baisse, il importe qu'aucun des actes ne
se termine froidement. Dans un opra en cinq actes, il
faudra donc cinq fois agir puissamment sur le public et
par des moyens varis : c'est une tche difficile.
Quand un acte se termine par un morceau de musique
dvelopp, compos de plusieurs scnes et auquel pren-
nent part les personnages et le chur, ce morceau reoit
le nom de final.
Les opras de Quinault, crateur du drame lyrique
en France, taient diviss en cinq actes. Ils sont habile-
ment coups. Second par l'instinct de Lulli, Quinault
avait devin que clans un ouvrage de longue haleine, le
compositeur, comme nous l'avons dit, a surtout besoin
de varit. En effet, la diversit du spectacle, le change-
ment frquent du lieu o la scne se passe, les caractres
diffrents des personnages introduits dansle drame, tout
cela est ncessaire au musicien; ce sont des lments
dont il profite aussi bien que le spectateur lui-mme,
et l'opposition qui en rsulte, en mme temps qu'elle
plat l'auditeur, vient en aide au compositeur et ferti-
lise son imagination, en lui fournissant des inspirations
nouvelles.
On se tromperait beaucoup, cependant, si l'on croyait
qu'alors la tche du compositeur fut ce qu'elle est
aujourd'hui, dans la production d'un opra en cinq actes.
348
OP
Outre que Faction tait plus simple, et, par consquent,
comptait moins de situations musicales, les situations
elles-mmes taient moins dveloppes par le pote;
puis la musique ne ncessitait pas le dveloppement que
l'art moderne exige. Si Ton abuse quelquefois aujour-
d'hui de ce dveloppement, que les progrs de la science,
l'art du chant, la dclamation lyrique ont rendu en quel-
que sorte ncessaire, il est juste de dire qu'alors les
situations, aussi bien que les mlodies, n'taient, pour
ainsi dire, qu'indiques, les compositeurs n'avaient pas
encore trouv ces belles phrases musicales, compltes
pour l'oreille comme pour l'esprit et l'intelligence, qu'on
admire dans Mozart, dans Gimarosa, dans Rossini. Il
en rsulte qu'un seul acte d'un opra moderne renferme
beaucoup plus de musique que les cinq actes d'un opra
tout entier de Lulli.
Rameau, et aprs lui, Gluck, donnrent une plus
haute importance la phrase musicale. Les actes, par
consquent, prirent plus d'tendue, et les opras eurent
plus de dure.
Depuis Gluck jusqu' nos jours, on a jou l"Opra
des tragdies lyriques en trois, en quatre et en cinq actes.
On
y
reprsente aussi de petits ouvrages en un ou deux
actes, que l'on dsigne quelquefois sous le nom d'opra
de genre, et que l'on donne avant les ballets.
On joue sur le thtre de l'Opra-Gomique des opras
en un, deux ou trois actes, et quelquefois, exception-
nellement, en quatre et mme en cinq actes. Les Italiens
crivent gnralement leur opras, aussi bien srieux
que bouffes, en deux actes, assez dvelopps pour con-
tenir un grand nombre de morceaux; il
y
a cependant
des exceptions, et l'on compte aussi parmi les beaux
ouvrages dont nous a dots l'Italie, des opras en trois et
quatre actes.
On reprsente ordinairement en Italie, entre les deux
actes d'un opra, un ballet tout fait tranger l'action
de ces opras. En France, le ballet fait partie de l'opra
et de l'action. C'est au pote et au compositeur s'en-
tendre pour que chaque acte ait des lments suffisants
de curiosit, en donnant une place importante la danse
dans un acte, quelquefois dans deux, et en rservant
pour ]es autres parties de l'ouvrage tout l'intrt des
situations, toute la puissance de la musique !
On distingue le grand opra de l'opra comique par la
OPE
349
nature du sujet. Quoiqu'en gnral le premier se rap-
proche de la tragdie, et le second de la comdie, cepen-
dant jamais un grand opra ne sera aussi grave, aussi
simp'e qu'une tragdie; et jamais un opra comique ne
comportera une action aussi complique que celle d'une
comdie. La musique parle plus au sentiment qu' la
raison. Le comique pur qui a son origine dans la rflexion,
ne peut, sans un mlange lyrique, remplir un opra.
Mais le burlesque, le grostesque mme lui conviennent
parfaitement. 11
y
a en outre un style intermdiaire qu'il
n'est pas facile de limiter. La Vestale, de Spontini, doit
tre classe parmi les grands opras; il matrimonio
segretto, parmi les opras comiques ou bouffes et YEnl-
vement au srail, de Mozart, parmi les opras du genre
intermdiaire, ou semi-seria.
Les arts, comme les institutions sociales, sont assu-
jettis des transformations priodiques. Tout ce qui est
de ce monde nat, s'accrot, arrive, point brillant, son
znith, puis plit et dcrot sur une pente rapide. La
musique est, de tous les arts, celui qui parat affect des
mutations les plus frquentes. Comme le Prote de la
fable, elle marche de mtamorphoses en mtamorphoses.
Tous les vingt-cinq ou trente ans, des rvolutions, sinon
radicales, du moins trs-prononces, s'introduisent dans
cette merveilleuse expression de ce que l'me humaine
renferme en ses profondeurs de sentiments les plus
intimes. Presque aussitt uses qu'adoptes, les formes
mlodiques, comme la fleur qui se fane ds qu'elle est
panouie, vieillissent et veulent tre remplaces. Et
qu'on ne croie pas que nous venions faire ici une satire
du plus fugitif et cependant du plus pntrant de tous les
arts. C'est justement parce que ses formes sont inpuisa-
bles, qu'elles apparaissent et passent comme des fantai-
sies ailes. De mme que la vie radicale, toujours une,
toujours absolue, rayonne dans le multiple infini des
tres qui naissent en son sein crateur, la musique tou-
jours immuable dans ses lois, la musique, voritabego-
mtrie phontique, si on la considre dans ses rgles,
livre incessamment aux caprices du changeant et du
variable ses combinaisons harmoniques et les tournures
inpuisables de ses mlodies passagres. Rameau suc-
cde Lulli : Gluck, Sacchini, Piccinni s'assoient bientt
sa place
;
puis voici venir Rossini qui les dtrne et
gale Mozart mme.
350 OP
Touchons-nous l le terme de toutes ces pripties?
Gardons-nous de le croire. Une rvolution
nouvelle, une
rvolution qui n'a pas encore, il est vrai, gagn la
France, promne depuis quelque temps son drapeau
novateur sur toute l'Italie. Prenant Verdi pour solennel
et vigoureux interprte, la musique dramatique, la musi-
que prcise par la scne, motive par la situation, a
chass compltement la mlodie indtermine, les chants
vagues, et qui ne tirent leur effet que de leur valeur
abstraite et intrinsque.
La marche que, dans cette rnovation, la musique a
suivieen France, nous semble bizarre. Partisans arrires
d'un vain luxe musical, nous voulons maintenir aujour-.
d'hui la culture de la plante exotique que nous avons
longtemps repousse
;
nous prtendons, du moins quant
l'opra italien, renvoyer en terre trangre celle que
nous devons presque regarder comme indigne; nous
disons presque, car avant que Gluck, dans la tragdie
lyrique, et Grtry, dans Topera comique, eussent popu-
laris la musique dramatique en France, Pergolse en
avait donn le modle dans la Serva Padrona.
Mais l'Italie, cette terre o tout chante, o des voix
passionnes sortent de tous les points de l'espace et
vibrent dans tous les chos, l'Italie ne put rester long-
temps emprisonne dans les liens prcis et traditionnels
d'un systme musical immuable. Semblable son napo-
litain Vsuve, son gigantesque volcan de Sicile, la
spontanit mlodique
y
fit ruption, et elle put s'crier,
comme notre pote :
Et la lave de mon gnie
Dborde en torrents d'harmonie
Et me consume en s'chappant.
De l ce luxe immodr de fioritures dictes par la
fantaisie du chanteur, accueillies par l'enthousiasme du
public, entretenues par quelques talents hors ligne, cet
amas de traits, de roulades, de points d'orgue, abus de
richesse sous lequel le dessin mlodique disparat, sem-
blable ces monuments dont les lignes brises par une
ornementation sans got et sans retenue, ne laissent plus
apercevoir que formes insaisissables et confuses. Cette
espce d'enivrement de la musique, de la musique sans
rapport avec la parole qu'elle devait exprimer, prise part,
pour elle-mme, et spare de la situation qu'elle avait a
OP
351
rendre, quelquefois mme en contradiction avec la scne
laquelle elle devait s'adapter, except dans les chefs-
d'uvre devenus classiques des Paisiello, des Cimarosa,
des Mozart, etc.
;
cet enivrement, disons-nous, ne pou-
vait manquer d'amener une raction salutaire. Le grand
matre Rossini parut; mais, avec la finesse de tact qui
le distingue, il comprit que les ractions ne se font pas
tout coup et sans transitions pralables. Mnageant
donc le got du public, et voulant garantir ses uvres
des carts de quelques interprtes parfois ignorants et
malhabiles, lui-mme se mit jeter pleine main les
fleurs, les perles, les diamanssurle canevas si ingnieu-
sement tissu de sa brillante musique, et, tout en le ra-
menant par moments la vrit de la scne, trouva le
secret de changer en moyen d'expression ce qui jusque-
l Tavait presque touffe; je veux parler de ces voca-
lises sans fin, de ces fioritures entasses, de ces agilits
vocales, avant lui prodigues au hasard. C'est ainsi qu'a-
prs avuir prpar sa rvolution, aujourd'hui accomplie
par del les monts, lui-mme en donna le signal dans
l'immortel chef-d'uvre de Guillaume Tell. De l Norma
il n'y avait plus qu'un pas
;
et une fois Fart rentr dans
la voie de la vrit dramatique, devait ncessairement
arriver, le matre ayant mission de l'y maintenir, sans
s'accorder la moindre excursion au dehors, mme peu
lointaine, sans se permettre une note dont la valeur ne
soit en rapport avec le mot qui la soutient.
Bellini, Donizetti, Mercadante. Meyerbeer, Halevy,
Ambroise; Thomas, Auber, Verdi, Ch. Gounod, P. David,
ont maintenu le grand art lyrique, dans une sphre leve.
Un matreallemand Richard Wagner, systmatiquement
oppos aux formes dramatiques acceptes jusqu' ce jour
et se posant en novateur, a jet dans le monde musical,
des crations lyriques d'une science profonde
;
mais o la
mlodie apparat trop rarement. Les initis seuls savent
dcouvrir cette fleur suave travers les labyrinthes du
contrepoint. M. Richard Wagner n'en est pas moins une
individualit puissante.
Opra comique. C'est un drame d'un genre mixte,
qui tient la comdie par l'intrigue et les personnages,
et l'opra par le chant dont il est ml.
L'origine de
ce spectacle remonte aux premiers thtres de la foire,
dont l'apparition date de 1617. Honor, matre chande-
lier de Paris, aprs avoir fourni pendant plusieurs
352 OPH
annes des lumires de sa fabrique au thtre, voulut en
entreprendre un son tour
;
et, en 1624, il obtint le pri-
vilge d'un nouvel Opra-Comique. Il ne jouajamais lui-
mme, mais il eut dans sa troupe des acteurs remarqua-
bles. En 1627, il cda son privilge Ponton, qui porta
]"Opra-Gomique sa perfection, grce au bonheur qu'il
eut de trouver de bons auteurs, des acteurs excellents et'
des musiciens d'une rare habilet.
L'Opra-Comique fut supprim en 1745; mais en
1752, le privilge en fut rendu Jean Monnet. Le plan
qu'il avait form a t fidlement suivi par les directeurs
qui lui ont succd. Ils ont lait subir des amliorations
considrables certaines parties de dtails que Monnet
ne pouvait pas voir seul, et ont ramen ce genre de
spectacle les femmes, effarouches par le style quelque-
fois graveleux des anciens opras comiques. C'est sur ces
objets principalement que s'est porte la sollicitude des
directeurs.
Leur ardeur prvenir les dsirs du public leur a
attir pendant plusieurs annes un si grand concours de
monde, que les autres spectacles de Paris se trouvaient
peu prs dserts. La Comdie-Italienne surtout, qui se
voyait sans spectateurs, obtint enfin, en
1762, que
l'Opra-Comique ft runi son thtre.
Depuis cette poque, l'Opra-Comique, genre minem-
ment franais, n'a cess de marcher dans une voie de
progrs et de prosprit. Il n'est pas aujourd'hui de
scne dans le monde entier qui possde un rpertoire
aussi riche et aussi vari.
Oprette. Mot qui, dit-on, a t forg par Mozart,
pour dsigner les compositions en miniature, dans
lesquelles on ne trouve que des chansons ou des cou-
plets de vaudeville. Mozart disait qu'un musicien bien
constitu pouvait composer deux ou trois ouvrages de
cet le force entre son djeuner et son dner.
Ophibaryton. Espce de serpent imagin par Bach-
man en 1840.
Ophiclide. Instrument en cuivre d'origine hano-
vrienne, qui, depuis 1820,
fait partie des musiques de
l'arme franaise. Adopt d'abord dans les rgiments de
la garde royale, il fut admis ensuite dans ceux de l'in-
fanterie de ligne et de cavalerie. Il en devint la contre-
basse et remplaa les anciens serpents d'glise. C'est,
proprement parler, un serpent clefs, comme l'indique
ORA 353
Ja racine grecque de son nom. Les olefs sont au nombre
de neuf.
Oratorio. C'est une espce de drame dont le sujet est
religieux et qui est destin tre excut par des chan-
teurs, avec accompagnement d'orchestre. Les anciens
compositeurs n'avaient qu'un seul objet auquel ils pus-
sent consacrer les inspirations de leur gnie : la religion.
Aussi cette poque est-elle fconde en productions de
musique sacre de tout genre
;
et, depuis Palestrina jus-
qu' Haendel, Haydn et Mozart, on trouve tout ce qui a
t compos de plus beau et de plus parfait. On ne se
bornait pas alors mettre en musique les paroles de la
messe : outre les cantiques, les hymnes, les psaumes, on
avait imagin ces espces de drames religieux appels
oratorios, dont le sujet tait tir de l'Histoire Sainte, et
qu'on excutait dans les glises. Voici ce qui donna lieu
l'invention de ces sortes de pices : saint-Philippe de
Nri, qui fonda, en 1540, la congrgation de l'Oratoire
Rome, voyait avec douleur les fidles dserter l'glise
pour courir aux spectacles. Connaissant le got des
Romains pour la musique, il eut l'ide de faire composer
par un bon pote des intermdes, dont le sujet tait
puis dans l'criture sainte, et les ayant fait mettre en
musique, il les fit excuter dans l'glise. La foule
y
cou-
rut; le succs fut prodigieux; et ce genre de drame s'ap-
pela oratorio, du nom de 1 glise de l'Oratoire, o il fut
jou pour la premire fois.
Les oratorios n'taient d'abord qu'une simple allgorie,
une cantate plusieurs personnages, qu'on n'excutait,
soit l'glise, soit au thtre, que comme une pice de
concert. Dans la suite ils prirent plus de dveloppement
et acquirent toutes les proportions d'un vrai drame,
sauf le clinquant des costumes et la pompe thtrale.
Quant la musique, qui participe la fois du genre
libre et du genre svre, elle se compose de rcitatifs
simples et obligs, de solos, duos, trios, morceaux d'en-
semble et churs.
Les plus clbres compositeurs qui ont illustr le^enre
de l'oratorio, sont Emilio del Cavalire, Alexandre Scar-
latti
;
Lo, Iomelii, Cimarosa; Haendel, Bach, Haydn,
Beethoven et Mendelsohn. On cite, parmi les oratorios
les plus remarquables, le sacrifice d'Abraham, de Scar-
latti, celui de Cimarosa; sainte Hlne au calvaire, de
Lo ;
le Messie, de Haendel
;
la Passion, selon saint Ma-
SU GRC
thieu, de Bacb, conception musicale de la plus haute
porte
;
la Cration, de Haydn
;
le Christ au jardin des
Olives, de Beethoven
;
le Paulus et l'Elias, de Men-
delssohn.
Orchestration. Science du maniement d'un or-
chestre, et manire dont les parties d'un orchestre sont
combines entre elles.
Orchestre. L'orchestre dans les thtres modernes
est un retranchement plus ou moins grand qui rgne
autour de ce qu'on appelle la rampe de a scne; c'est la
place des symphonistes. Cette enceinte est construite
d'un bois sonore, du sapin ordinairement, afin de taire
vibrer le son des instruments. C'est absolument la tubie
d'harmonie d'un clavecin, car cette espce de grand
coffre sans couvercle est tabli sur un vide avec des arcs-
boutants.
L'orchestre franais ne date vritablement que du
sicle de Louis XIV; ce fut Lulli qui l'organisa. On doit
Lulli l'introduction des timbales et des trompettes dans
l'orchestre, et plus tard, Gluck, celle de la clarinette,
dont on usait si sobrement qu'elle ne se faisait gure
entendre que dans les ballets.
Que les temps sont
changs ! quel admirable orchestre nous avons de nos
jours ! il compte au moins 80 instruments
;
il runit,
comme par enchantement, tous les bruits, tous les sons,
toutes les voix de la nature, dont la musique n'est qu'une
imitation.
Le Violon possde d'immenses ressources :
il simule la voix humaine
;
c'est lui qui, avec la viole, le
violoncelle et la contre-basse, rgne exclusivement dans
un orchestre. La viole repose, par la gravit de ses sons,
des brillants clats du violon; le violoncelle, quand il
chante, exprime la prire et le recueillement des marches
religieuses; la flte, pleine de tendresse, rend les amou-
reux dsirs
;
le haulb' >is est pastoral, propre la danse des
villageois et des nymphes; la clarinette accompagne or-
dinairement les danses gracieuses et les ballets enjous,
le cor chevaleresque et rom.intique, appelle a chasse
Henri IV ou Robin des Bois; l'ophiclde gmit; le
trombone, aux poumons de cuivre, annonce de grandes
catastrophes.
Par ce nombre d'instruments si varis, nos orchestres
aujourd'hui sont un monde, o les passions, les senti-
ments dploient toutes leurs expressions, et o la nature
fait entendre toutes les voix.
ORG
35S
Orchestrino.
Nom donn par
M. Poulleau, en 1808,
un piano archet de son invention, lequel imitait le
violon, la viole d'amour et le violoncelle.
Orchestrion. Nom de deux claviers qui ont t in-
vents vers la fin du dix-huitime sicle. Le premier est
un orgue portatif compos de quatre claviers, chacun de
soixante-trois touches et d'un clavier de pdales de
trente-neuf touches. Il fut construit Prague par les
frres Still. Le second est un piano uni quelques regis-
tres d'orgue.
Orchestrion. Est galement le nom d'une espce
d'orgue expressif construit par Fourneau, en 1844.
Merklin et Schulze, donnrent aussi le nom d'orches-
trion en 1853 un orgue perfectionn.
Oreille. Ce mot s'emploie figurment en musique.
Avoir de l'oreille, c'est avoir l'oue sensible, fine et
juste, en sorte que tant pour l'intonation que pour la
mesure, on soit choqu du moindre dfaut, et qu'aussi
l'on soit frapp des beauts de l'art quand on les en-
tend. On a l'oreille fausse, lorsqu'on chante constam-
ment faux, lorsqu'on ne distingue pas les intonations
fausses des intonations justes, ou lorsqu'on n'est point
sensible la prcision de la mesure, qu'on la bat ingale
ou contre-temps.
Organino. Petit orgue que l'on peut transporter d'un
lieu un autre, et dont les plus grands ont deux pieds
de haut et un seul soufflet. Il fut imagin par Debain.
On appelle encore de ce nom un petit orgue cylindre
avec une manivelle, qui, arm de dnis, remplace le
mouvement des doigts.
Organiste. Celle ou celui qui joue de l'orgue. Un
grand organiste n'a pas seulement le talent d'excuter
avec perfection toute la musique qui est propre cet
instrument, mais celui bien plus rare d'improviser tout
ce qu'il joue.
Rameau, D'Aquin, Couperin, Ralbatre, Sjean, Mo-
zart, Keller, Bach, Haendel, sont des noms fameux dans
les fastes de l'orgue.
Autrefois on comptait en France un assez grand
nombre de bons organistes
;
ils deviennent de jour en
jour plus rares, parce qu'on nglige de faire des tudes
que demande ce grand art.
Organo. Instrument imagin Rome en
1675, par
356 ORG
Todlni. Mais son mcanisme compliqu, en rendit l'a-
sage incommode.
Organo (archi-). Instrument construit Venise en
1561 par Vicentino, sur lequel on pouvait excuter les
trois genres de musique.
Organo-Chordon. L'abb Vogler donna l'ide de cet
instrument qui fut construit d'aprs ses plans parRook-
witz, vers la mme poque que le prcdent.
Organo-Lyricon. Instrument invent Paris en
1810. Sa forme tait celle d'un secrtaire cylindre
;
il
contenait un piano ordinai re, autour duquel se groupaient
quelques instruments vent.
Organo-Violine. Instrument construit en J 814 par
Eschembeck, de Knigshofen, dont la construction tait
base sur l'emploi de l'anche libre.
Organum. Instrument de musique des anciens. C'est
le mme que la flte de Pan, laquelle se trouvait
adapt un soufflet.
Orgia. Ftes en l'honneur de Bacchus. Le chant, ac-
compagn de la lyre et de la flte,
y
figurait comme une
des parties essentielles de la fte.
Orgue. Instrument h vent, le plus parfait de tous
pour diriger et soutenir le chant religieux, et celui dont
les sons se marient le mieux avec les voix. Dans un espace
restreint, sous les doigts d'un seul homme, on peut avec
l'orgue obtenir la puissance, la diversit, la justesse, que
ne pourraient produire trente ou quarante instruments
runis. Ses accents sont graves et clvotieuoc, comme dit
Montaigne. Il embrasse toute l'chelle des sons, et peut
s'unir tous les genres de voix; il a des jeux varis,
tour tour doux et clatants, suaves ou terribles. Ses
trompettes sonores semblent annoncer le jugement de
Dieu; ses fltes lointaines paraissent l'cho des concerts
des anges. L'orgue est l'orchestre que demande le plain-
chant.
La musique instrumentale fut peu gote dans les
premiers sicles du christianisme; les fidles se bor-
naient alors former des churs de voix. C'est seule-
ment sous le pape Vitalien I
er
que l'orgue fut connu en
Italie : il fut introduit en France sous le rgne de Ppin,
pre de Charlemagne; mais cet instrument resta long-
temps imparfait. Bdos de Celles, dans le sicle dernier,
et, de nos jours, MM. Cavaill-Coll et Debain, l'ont en-
richi d'amliorations importantes.
ORG
357
L'orgue est un instrument vent et clavier; il a
plusieurs jeux ou registres, et un trs-grand nombre de
tuyaux : il a un, deux, trois, et mme quatre claviers
composs de quatre octaves et demie; il
y
a, de plus, un
clavier de pdaies qui contient une ou deux octaves. Le
jeu principal, que nous nommons vulgairement bour-
don, est en huit pied, en seize pieds, et mme en trente-
deux pieds. L'orgue a encore des soufflets, des ven-
tilles.
Pendant le moyen-ge on soutenait le chant religieux
avec l'orgue seul
;
plus tard on
y
ajouta d'autres ins-
truments. Sous Louis XIV, un chanoine de Sens ou
d'Auxerre inventa le serpent, et cet instrument rauque,
pre, ingal, variable dans ses intonations, vint s'tablir
dans nos churs,
y
rendre le chant lourd et tranant, et
y
faire rgner la plus fatigante monotonie. Quel spec-
tacle, en
effet, que celui d'un homme qui, les joues gon-
fles, le visage dform, roulant ses yeux dans leur orbite,
touffe entre ses bras la figure d'un animal immonde, et
semble lui arracher de lugubres hurlements! L'ophi-
clde a, dans beaucoup d'endroits, dtrn le serpent.
Cet instrument n'est pas plus agrable entendre
;
enfin,
plusieurs paroisses adoptent maintenant la contre-basse.
Tous ces instruments prsentent le mme inconvnient
qui doit en faire abandonner l'emploi, c'est de rsonner
l'unisson des voix graves, par consquent de ne pas
convenir la voix du peuple. L'orgue est rest seul en
possession de la faveur des masses dans nos temples
catholiques, seul il a le privilge d'exciter l'a ferveur, le
recueillement, l'enthousiasme religieux.
L'emploi naturel de l'orgue, c'est l'accompagnement
des voix; en Allemagne, en Italie, en Belgique, il rem-
plit toujours cette lonction, et le chur
y
est partout
insparable de l'instrument. Dans les vastes basiliques
de l'Italie, on a des orgues que l'on roule, et qui suivent
le chur dans les diverses chapelles o il se transporte
pour chanter l'office. Dans ces glises tout s'excute avec
accompagnement : non-seulement les hymnes sacres,
mais encore le chant de l'officiant, les rponses du peu-
ple, la prface, etc.
Il faut le dire, les pays dont nous parlons sont bien
suprieurs la France sous le rapport de la musique
sacre. Chez nous, part quelques grandes villes qui
font une honorable exception
,
quelques voix isoles
11..
358 ORG
chantent le Kyrie, l'orgue rpond par une fantaisie de
la faon de l'artiste, Dieu sait quel fantaisie!... Le prtre
entonne le Gloria in Excelsis Deo, l'organiste continue
par une rminiscence de quelque air la mode. Voil le
rle que joue souvent l'orgue en France. Cependant le
tableau n'est pas partout le mme, nous l'avons dit, il
y
a des exceptions
;
des organistes au style grave, austre,
ont conserv les belles traditions de l'art religieux.
Orgue a clavier grgorien. Invent en
1853,
par
Nizard, muni d'un appareil transpositeur pour le plain-
chant, dont la tonalit se dtermine par la dominante et
la finale.
Orgue a cylindre. C'est celui qui va par le moyen
d'un cylindre, sur lequel on a not un certain nombre
de morceaux de musique avec des pointes. Ces pointes
font mouvoir les touches d'un clavier qui leur est appro-
pri. C'est au moyen d'une manivelle tournante que le
cylindre se meut et prsente successivement, ou simul-
tanment, ses pointes aux touches qui rpondent aux
tuyaux. Les orgues cl' Allemagne, les orgues de Barbarie^
dont les chanteurs des rues s'accompagnent, les seri-
nettes, les merlines, sont des orgues cylindre.
Orgue a jeu de Chambord. Invent en 1856,
par
Warren de Montral. Instrument contenant un jeu de
flte d'espce nouvelle.
Orgue a percussion. Invent en
1834,
par Martin,
de Provins. Orgue dans lequel la vibration est donne
aux lames l'aide d'un marteau, et continue par le
vent.
Orgue a piston. Invent en
1791,
par Luxeuil. Orgue
dont chaque tuyau parle par la seule impulsion d'un pis-
ton de bois que la touche fait monter, vitant ainsi les
soufflets.
Orgue a rpercussion. Invent en 1853, par Jaulin.
Orgue autophone. Invent en
1851,
par Dawson,
Londres. Orgue dont les tuyaux sont en carton.
Orgue Barestale. Invent en lS51,par Duci, de
Florence. Le mme tuyau produisait la note et son oc-
tave
;
et les douze demi-tons intercalaires manaient
galement du mme tuyau.
Orgue Diaviton. Invent en
1851,
par Holdich. Le
nom de cet instrument provient d'un jeu de flte octa-
viant.
ORG 359
Orgue enharmonique. Invent en
1851,
par Robson.
Orgue pouvant jouer les trois genres de musique.
Orgue expressif. L'effet de ces orgues est de la plus
grande beaut.
M. Erard a mis le comble la perfection
de l'orgue, en runissant, dans un instrument qu'il avait
construit sous la Restauration, pour la chapelle du roi,
le genre de l'expression de la pdale sur les deux claviers
du grand orgue l'expression par la pression des doigts
sur un troisime clavier. Dans cet tat, l'orgue est vrai-
ment l'instrument le plus beau, le plus majestueux, le
plus puissant qui existe.
Orgue guide (accompagneur du lutrin). Invent en
1855,
par Fourneaux. Espce d'orgue dont le titre
indique le but.
Orgue hydraulique. Celui dont les soufflets ou les
cylindres sont mis en jeu par le moyen de l'eau. Gomme
l'humidit est extrmement nuisible aux orgues, ce
moyen n'est plus employ. Au reste, on manque de ren-
seignements certains sur cet instrument dont parlent
seulement quelques anciens auteurs.
Orgue mcanique. Invent en
1745,
par Langsaw.
Ce sont des cylindres mcaniques, nots, que l'on peut
appliquer aux grandes orgues. Haendel composa quel-
ques morceaux qui furent points par Langsaw.
Orgue mtallique. Invent en
1789,
par Clagget,
Londres. Cet orgue tait compos de fourchettes d'acier,
ressemblant pour la forme nos diapasons modernes,
qui taient mises en vibration par le frottement.
Orgue pantophone. Espce d'orgue dont le cylindre
est garni de chevilles mobiles avec lesquelles on peut
y
noter volont de nouveaux airs.
Orgue phonochronique. Invent en
1855,
par Lo-
renzi. offrant l'expression par l'enfoncement de la touche.
Orgue-piano. Invent en
1854,
par Maillard.
Orgue pneumatique. C'est l'orgue ordinaire, celui o
le son est produit par le vent.
Orgue poly-harmonique. Invent en
1859,
par Bruni
et Jalbert, pour accompagner le chant grgorien.
Orgues portatives. Ancien instrument compos de
quelques tuyaux et d'un soufflet que l'on portait sus-
pendu au col, par une courroie. On voit encore les petits
savoyards porter leurs pinettes.
Orgues positives. Ancien instrument qui, le premier
360
ORP
fut introduit dans les glises
;
il avait plusieurs jeux, un
clavier et deux soufflets.
Orgues rgales. On nommait ainsi une varit de
jeux de l'orgue positif.
Orgues reproductives. Inventes en
1855,
par
Mazolo. Imprimant en notes connues le son qui est pro-
duit l'aide d'un double cylindre, l'un muni d'une cr-
maillre correspondante des leviers chaque touche,
l'autre servant d'enrouJement au papier.
Orgue soutien de la voix. Invent en 1851
,
par
Baudot, contenant une gamme chromatique par accord,
permettant djouer dans tous les tons.
Orgue trompette. Invent en
1824,
par Van-Ocklen.
Orgue cylindre, compos de vingt trompettes, accom-
pagnes par deux tambours, un triangle et une paire de
cymbales.
Orguettes. Cet instrument tait compos d'une caisse
plus haute que longue renfermant une ou deux ranges
de tuyaux au nombre de sept ou huit. C'tait un petit
orgue muni d'un clavier et un soufflet compltait l'appa-
reil.
Originalit. L'originalit dans les arts et dans la
musique en particulier, c'est la nouveaut dans les
ides et dans la faon de les exprimer, de les agencer,
de les combiner
;
c'est en un mot, la force cratrice
et l'individualit du gnie. (Voyez Imagination. Gnie
musical)
.
Origine de la musique. La musique est une langue
universelle, qui fut donne l'homme par le Crateur,
ds le commencement du monde, pour exprimer des
ides et des sensations qu'aucune autre langue ne peut
traduire. On ne peut douter qu'Adam et Eve, qui
avaient tant d'actions de grces rendre Dieu, aient
chant ses louanges dans le Paradis terrestre. No et sa
famille, la sortie de l'Arche, firent de mme
;
et plus
tard, Mose et les Hbreux, aprs le passage de la mer
Rouge. Avant qu'on et bti des temples la divinit,
la nature entire, et son Roi en tte, unissaient ici-bas
leurs concerts ceux des anges. (Voyez le mot Musique.)
Orphon. Instrument de musique mont avec des
cordes de boyau, que l'on fait parler au moyen d'un cla-
vier et d'une roue qui porte un archet
;
il a la forme d'un
trs-petit piano.
Orphon. C'est le nom donn une institution muni-
OUV 361
cipale de la ville de Paris, dont le but est d'enseigner la
musique vocale aux enfants des deux sexes qui frquen-
tent les coles communales, et aux ouvriers adultes.
L'orphon a t fond en 1820, et la direction en fut
confie Wilhem, qui avait conu l'ide premire de cet
enseignement, et en avait apprci l'utilit. Il avait t
second par son ami,, l'illustre chansonnier Branger,
dont le patronage et l'appui constant lui fut d'un grand
secours. Wilhem composa pour l'orphon une mthode
en tableaux qui est encore employe. C'est un enseigne-
ment simultan, et les tableaux sont combins de telle
sorte, que des lves de force ingale peuvent chanter
ensemble. Wilhem est mort en 1842. La direction de
Yorphon passa, aprs sa mort, entre les mains de
M. Hubert, lve lui-mme de l'orphon. M. Gounod
fut ensuite directeur de l'orphon, et MM. Bazin et Pas-
deloup lui ont succd. M. Halvy a compos sous ce
titre : Leons de lecture musicale , un ouvrage qui est
adopt pour les coles orphoniques.
11
y
a tous les ans une sance publique de l'orphon
;
on runit tous les lves, enfants ou adultes, dans une
des grandes salles de Paris
;
ils excutent des churs
sans accompagnement.
Orphoron. Instrument de la famille des luths,
arm de huit cordes de mtal. Il n'est plus en usage. Il
diffrait du luth en ce qu'il avait le dos plat avec un
encadrement festonn sur les cts et des cordes de m-
tal.
Orphoron. Instrument de la famille des luths, il
tait mont de huit cordes de mtal.
Orphimonoclede. Genre de serpent, perfectionn par
Coffet, en 1828.
Ouverture. Composition instrumentale qui sert de
dbut aux opras et aux ballets.
L'ouverture doit se conformer au drame d'une manire
gnrale
,
et peut se lier quelquefois aux premires
scnes qui la suivent immdiatement. L'ouverture fera
connatre d'abord le caractre de l'opra qu'elle pr-
cde, et donnera ensuite des pressentiments sur la
nature des vnements, le caractre des passions qui
doivent occuper la scne, et quelquefois mme sur les
personnages, le lieu et le temps o se passe l'action.
Ainsi. l'ouverture lphignie en Avlide nous dispose
une action vive, intressante et d'une grande noblesse
;
li...
362 PAN
celle de Guillaume Tell peint le calme de la vie cham-
ptre troubl par une fanfare de trompettes qui appelle
les paysans la conqute de la libert
;
celle de la Pie
voleuse commence par une marche militaire
,
qui
annonce le retour du soldat dans ses foyers.
Un allgro de symphonie, brillant et passionn, suc-
cdant une introduction d'un mouvement grave, telle,
est la coupe gnralement adopte pour les ouvertures.
Ceux qui rduisent l'ouverture une espce d'intro-
duction, s'loignent de l'ide qu'on doit concevoir d'un
morceau de ce genre. Le compositeur doit
y
dployer
toute sa science : facture savante, dessin pur et vigou-
reux, harmonie pleine, varie et riche d'effets, telles
doivent tre les qualits principales d'une ouverture.
Oxiphonos. C'est ainsi qu'on appelait chez les anciens
Grecs celui qui possdait une voix aigu.
P. Par abrviation, signifie piano, c'est--dire doux.
PP. Signifie pianissimo, c'est--dire trs-doux.
Palalaika. Guitare monte de deux cordes, trs-
rpandue parmi la basse classe du peuple en Russie.
Plastieri (Pietro et Thomas). lves et imitateurs
de Stradivarius travaillaient Crmone de 1710 1750.
Palettes. Ainsi se nommaient anciennement les
touches de la gamme naturelle dans l'orgue et le cla-
vecin.
Les palettes taient noires et les feintes
blanches.
Panaulon. Flte de grande dimension construite
Vienne en 1815,
par Trexler.
Pandore. Instrument de musique cordes, de la fa-
mille du luth, mais dont le chevalet tait oblique, ce qui
rendait les cordes ingales dans leur longueur. Le dos
de cet instrument tait plat comme celui de la guitare.
La pandore a t dlaisse depuis longtemps, comme le
luth et le thorbe.
Panharmonico mathmatique. Instrument invent
en
1711,
par Bulyowski, de Durluch, en Hongrie, pr-
PAN 363
sente l'Empereur Lopold, le facteur fut richement
rcompens.
Panharmonicon. Espce d'orgue imagin par Maelzel,
en
1804,
qui fut vendu par son auteur 60,000 fr.
Pan-harmonicon. Cet instrument, au moyen d'un
double soufflet et d'un cylindre mis en mouvement par
un poids, imite assez naturellement une musique d'ins-
truments vent et de percussion.
Pan mlodion. Instrument cylindre construit
Vienne, en
1810,
par Leppich.
Panormok. Espce de guitare enharmonique, cons-
truite en Angleterre, en 1851.
Pantalon. Espce de clavecin vertical dont le corps
tait plus troit que celui d'un clavecin ordinaire et
invent en
1713,
par Pantalon Hbenstrest.
Pantalon. Instrument de musique de l'espce du
tympanon, mais beaucoup plus grand, puisqu'il a prs
de quatre pieds de large. Le pantalon est garni d'un
grand nombre de cordes d'acier que l'on touche avec
deux petites baguettes de bois.
Le mot pantalon est aussi employ pour dsigner une
figure de contredanse. (Voyez Quadrille).
Pantomimes. Comdiens, ainsi nomms parce qu'ils
imitaient et exprimaient tout ce qu'ils voulaient dire
avec les gestes qu'enseignait l'art de la Saltation, sans
employer le secours de la parole. L'art des pantomimes
naquit Rome, sous l'empire d'Auguste. Lesdeux pre-
miers instituteurs du nouvel art furent Pylade et
Bathyle , dont le nom devint fort clbre parmi les
Romains. Le premier russit mieux dans les sujets tra-
giques, et l'autre dans les comiques.
Cassiodore appelle les pantomimes des hommes dont
les mains disertes, avaient, pour ainsi dire, une langue
au bout de chaque doigt, des hommes qui parlaient en
gardant le silence et qui savaient faire un rcit entier
sans ouvrir la bouche.
Les pantomimes furent les premiers comdiens chez
les Franais, ils commencrent paratre la foire de
Saint-Germain, vers la fin du VI
e
sicle, mais la licence
de leurs jeux les lit exclure de la vie civile et ils ne
purent rsister aux divers dits rendus contre eux. Ils
furent remplacs par les troubadours, les jongleurs, les
mntriers, dont les reprsentations taient mles de
posie, de danse, de chants et d'instruments.
364 PAR
Papier rgl. On appelle ainsi le papier prpar avec
les portes toutes traces pour
y
noter la musique.
Parfait. Ce mot, dans la musique, a plusieurs sens.
Joint au mot accord, il dsigne l'accord form par la
tonique, le troisime degr et le cinquime degr d'une
gamme, dans les deux modes
;
par exemple, ut, mi, sol
ou la, ut, mi. Joint au mot cadence, il exprime celle qui
porte la note sensible, et de la dominante tombe sur la
finale. Joint au mot consonnance, il dsigne un inter-
valle juste et dtermin, qui ne peut tre altr sans
cesser d'tre consonnant. Joint au mode, il marquait,
dans l'ancienne musique, la mesure trois temps.
Parodie, Parodier. C'est ajuster un air de chant
de nouvelles paroles, dont le sens n'a souvent pas le
moindre rapport avec celles qu'il
y
avait d'abord. Il
sufft que le parodiste se conforme au caractre des
morceaux de musique, et s'applique surtout calquer
son dessin sur celui du musicien, pour qu'il
y
ait une
parfaite concordance entre les images. Le mot parodie
en musique n'a aucun rapport avec la parodie qu'on
reprsente au thtre, et qui est l'imitation grotesque,
bouffonne et critique d'un drame srieux.
Parolier. Ce mot, dontCastil-Blazeafait le premier
l'application, exprime parfaitement un auteur de paroles,
de livret, un librettiste enfin, c'est--dire celui qui com-
pose le pome d'un ouvrage lyrique : opra, opra-
comique, oratorio, ode-symphonie, etc.
Partie. La musique tant une langue o plusieurs
discours peuvent se faire entendre la fois, non seule-
ment sans se nuire, mais en se servant naturellement,
s'ils ont t dispess d'aprs les rgles de l'art, il s'en
suit que chacun de ses discours est comme la portion
d'un grand tout qui se forme de leur runion. De l
vient le nom e partie donne chacune des portions de
ce tout, et qui est elle-mme un tout plus ou moins
complet , selon l'importance de la partie et selon la
manire dont elle est conue.
Il
y
a quatre parties principales dans la musique
vocale qui sont : le dessus, la haute contre, la taille ou
tnor et la ba?se
;
dans la musique instrumentale les
quatre parties principales se nomment le premier dessus,
lesecond dessus, la quinte et la basse.
On dit : morceaux deux parties, trois parties, etc.
Le, partie est donc, la lettre, ce que chaque artiste
PAS 365
chante ou joue sur son instrument dans l'excution d'un
morceau de musique. Le copiste extrait chaque partie
de la partition, qui est la runion de toutes les parties.
(Voyez Partition).
Partition. Collection de toutes les parties d'une
pice de musique, o Ton voit, par la runion des por-
tes correspondantes, l'harmonie qu'elles forment entre
elles. On crit pour cela toutes les parties, porte por-
te, l'une au-dessous de l'autre, avec leurs clefs, de
manire que chaque mesure d'une porte soit place per-
pendiculairement au-dessus ou au-dessous de la mesure
correspondante des autres parties, et enferme dans les
mmes barres prolonges de l'une l'autre, afin qu'on
puisse voir d'un coup d'il tout ce qui doit s'entendre
la fois.
Quelque ordre que l'on donne aux parties dans une
partition, celle de la basse doit tre au-dessous de tout,
et celle du chant vocal immdiatement au-dessus de celle
de la basse et de celle de violoncelle, s'il
y
en a une pour
l'instrument. Plusieurs compositeurs placent les parties
de violon en tte d'une partition. Les Italiens
y
mettent
quelquefois les cors et les trompettes.
La diversit des clefs est un moyen excellent pour
donner de la clart une partition. Les clefs d'ut signa-
lent le basson et la viole
;
les clefs de sol, sans dises ni
bmols, indiquent sur-le-chant les parties des cors et des
trompettes. Les voix se trouvent classes selon leur
diapason, et l'il peut les distinguer assez facilement,
grce la physionomie particulire de chaque clef.
La partition runit en faisceau les forces vocales et
instrumentales. Tout est class avec ordre, et chaque
partie suit paralllement celles qui concertent avec elle.
Le chef d'orchestre embrasse tout d'un coup d'il, il
s'attache particulirement aux voix et aux instruments
qui rcitent. Sans ce prcieux secours, on ne peut excu-
ter la musique de thtre, les symphonies, les messes,
les cantates, les oratorios.
Pas de deux. Danse excute par deux danseurs.
C'est le duo de la danse. Le pas russe est un pas de
deux.
Pas de trois. Danse excute par trois danseurs. C'est
le trio de la danse.
Pas seul. Danse excute par un seul danseur.
Passacalle. Espce de chaconne dont le chant tait
3G0 PAS
plus tendre et le mouvement plus lent que celui des cha-
connes ordinaires. Cet air de danse que Ton retrouve
encore dans les opras de Gluck, n'est plus en usage. Ce
mot vient de l'espagnol Passa Colle.
Passage. Ornement que l'on ajoute un trait de chant.
On appelle encore ainsi chaque portion d'un morceau
qui prsente un sens. Les notes de passage, comme les
appogiatures, sont des notes qui se trouvent dans les
parties harmoniques sans appartenir l'harmonie. Ce
qui les distingue c'est que les premires se trouvent aux
temps faibles de la mesure ou aux parties faibles des
temps, au lieu que les secondes se trouvent aux temps
torts de la mesure ou aux parties fortes des temps.
Les notes de passage servent lier entre elles les notes
harmoniques et orner la mlodie. Leur emploi et leur
nombre dpendent du bon got du compositeur.
Passage d'un ton dans un autre. (Voyez le mot Modu-
lation.)
Passe-Pied. Air d'une danse du mme nom dont la
mesure tait trois temps. Cet air n'est pas en usage.
Pasta (Gaetano). Bon luthier de Brescia qui exerait
en 1700.
Pastiche. On appelle ainsi une composition musicale
dans laquelle le musicien fait entrer plusieurs phrases ou
morceaux d'autres compositions, ou dans laquelle il a
imit, soit dessein, soit sans le vouloir, le style d'un ou
de plusieurs matres. 11 se prend presque toujours en
mauvaise part.
Pastorale. Opra champtre, dont les personnages
sont des bergers, et dont la musique doit tre en harmo-
nie avec la simplicit de got et de murs qu'on leur
suppose. Composer une pastorale dans le style des airs
champtres que l'on admire dans Don Juan, n'est pas
chose facile.
Une pastorale est aussi un morceau de musique ins-
trumentale, dont le chant imite celui des bergers, en a la
douceur, la tendresse, et nous rappelle les effets de leurs
instruments rustiques. Le troisime concerto de piano de
Steibelt est termin. par une pastorale dont le sujet est
une danse villageoise interrompue par un orage.
Pastourelle. Nom donn une des figures de la con-
tredanse franaise. On nommait anciennement Pas-
tourelle, une sorte de comdie spirituelle et religieuse
qui tait excute autrefois dans plusieurs glises aux
>D 361
laudes de Nol. Ces comdies furent abroges par la
iaoult de thologie de Paris.
Pathtique. Genre de musique dramatique et th-
trale qui tend peindre les grandes passions, et particu-
lirement la douleur et la tristesse.
Patte. Instrument qui sert rgler du papier de
musique en traant la fois les cinq lignes de la porte,
on donne galement le nom de patte l'ouverture inf-
rieure des instruments vent, tels que la flte, le haut-
bois, etc., etc.
Pause. Intervalle de temps qui, dans l'excution, doit
se passer en silence pour la partie o la pause est mar-
que. La pause est le silence d'une ronde, mais elle indi-
que aussi le silence d'une mesure entire quelle que soit
la valeur de cette mesure. La pause se marque par un
irait trs-court, mais fortement marqu, appliqu sousla
troisime ou quatrime ligne de la porte, et dont l'pais-
seur prend la moiti de l'espace compris entre cette ligne
et celle qui est immdiatement au-dessous.
Pavane. Air d'une danse ancienne, qui depuis long-
temps n'est plus en usage. Le nom de pavane lui fut
donn parce que les danseurs faisaient, en se servant de
leur cape et de leur pe, une espce de roue, la ma-
nire des paons.
Pavillon. C'est la partie vase, en forme d'enton-
noir, qui termine certains instruments vent, tels que
le cor, la trompette, le trombone, le hautbois, la clari-
nette.
Pavillon chinois. Instrument de musique percus-
sion. C'est dans sa forme une espce de chapeau de
laiton termin en pointe et garni de plusieurs rangs de
clochettes. Le pavillon chinois est fix sur une tige de
fer au moyen d'une coulisse. Celui qui veut en jouer le
tient d'une main par cette tige, et lui donne avec l'autre
un mouvement de rotation sur lui-mme
;
ou bien il le
secoue fortement en cadence, de manire que toutes les
clochettes frappent ensemble sur le temps fort de la
mesure.
Le pavillon chinois, comme son nom l'indique, nous
vient de la Chine. On l'emploie avec succs dans la mu-
sique militaire.
Pdale. On appelle ainsi chaque touche du clavier
des pieds que l'orgue contient. On nomme aussi pdales
les jeux qui rpondent ce clavier. Pdale se dit gale-
36S PEN
ment des petits leviers qui font mouvoir la mcanique
de la harpe et de ceux qui servent modifier le son du
piano. Ces divers leviers ont t nomms pdales, parce
que ce sont les pieds qui les font agir.
Pdale. C'est un son prolong la basse, sur lequel
on fait passer des accords qui lui sont trangers, mais
qui de temps en temps doivent contenir la note prolon-
ge, sans quoi l'effet de la pdale serait dsagrable. La
pdale se fait sur la tonique et sur la dominante. Elle
doit commencer par un accord consonnant appartenant
au son qui fait la pdale.
Pelitti-Fero. Instrument vent en bois, recouvert
de peau trs-fine avec trois cylindres, imagin en 1843,
par Pelitti de Milan.
Pelittone. Sorte de contrebasse en ut trois cylin-
dres, construite Milan, en 1848.
Penorion. Instrument dans le genre de VEuphonion,
se terminant en entonnoir arrondi peu prs comme le
cor anglais construit par Schverny's, en 1848.
Pension. Revenu annuel donn quelqu'un. Pour
rcompenser les compositeurs, les auteurs, les chanteurs
et les instrumentistes de leurs succs ou de leurs ser-
vices, les gouvernements leur accordent des pensions.
Les compositeurs clbres taient pensionns autrefois
par le roi sur sa cassette particulire. Plus tard il fut
tabli que les compositeurs et les auteurs dramatiques
qui auraient donn l'Opra trois ouvrages, faisant cha-
cun spectacle complet et reprsents quarante fois,
obtiendraient une pension annuelle de 1,000 fr. En
1830,
les pensions des compositeurs et des auteurs
furent supprimes ainsi que celles des choristes, des
danseurs et des artistes de l'orchestre de l'opra. Le
droit une pension existait aprs vingt-cinq ans de ser-
vice pour les artistes jouant des instruments cordes,
et aprs vingt ans pour ceux qui jouaient des instru-
ments vent.
Lorsque les acteurs de l'Opra-Comique cessrent
d'exploiter le thtre en socit, des pensions furent
donnes ceux qui avaient t socitaires. Les profes-
seurs du Conservatoire imprial de musique ont une
pension aprs trente ans de service. 3,000
fr. de pen-
sion sont faits pendant cinq annes aux jeunes compo-
siteurs auxquels l'Acadmie des Beaux-Arts a dcern
le grand prix de composition.
PEU
369
Au Conservatoire musical de Paris il
y
a deux sortes
de pensionnaires : les pensionnaires, du sexe fminin,
qui, sans tre loges dans l'cole, reoivent une pension
du gouvernement
;
et les pensionnaires du sexe masculin
qui sont compltement entretenus dans le sein mme de
l'tablissement pendant tout le temps de leurs tudes
aux frais de l'Etat.
Pensionnaire. On appelle pensionnaire le composi-
teur, l'auteur, le chanteur, l'instrumentiste ou l'lve
qui reoit une pension d'un prince, d'un Etat, etc., etc.
(Voyez le mot Pension).
Pentacorde. Fspce de lyre grecque cinq cordes
invente et mise en usage au sicle de Sapho et cT Alle.
Le,pentacorde tait intermdiaire entre la lyre primi-
tive et la lyre des poques postrieures qui en avait sept.
Pentalon. On nommait ainsi un genre de tympanv.m.
construit par Heberstect, en J70o, qui le lit entendre
chez Ninon de l'Enclos.
Pentecontachordon. Ancien instrument de musique
qui avait cinquante cordes ingales.
Percussion. Choc de la dissonance frappant sur le
premier temps de la mesure. On distingue dans l'emploi
de la dissonance au temps fort, trois circonstance,
remarquables, savoir : la prparation, la percussion et
la rsolution. On nomme instruments de percussion
ceux dont on joue en les frappant, comme le tambours
les timbales, la grosse caisse, etc.
Perdendo si, En se perdant. Quand ce mot est crit
sous un passage de musique, on doit l'excuter en fai-
sant succder Je pianissimo au piano avec une gradation
insnsible, et laisser teindre le son peu peu, de ma-
nire n'tre plus entendu
;
car c'est l le vritable
sens du mot : Perdendo si.
Perfidia, Perfidie. Signifie en musique une obsti-
nation faire toujours la mme chose et suivre le
mme dessein. Contrapunto perfidiato, fuga
perfidiata
sont des contrepoints et des fugues o l'on s'obstine
suivre le mme dessein. Cela s'appelle aussi pertinacia,
opinitret.
Prilse. Terme de plain-cbant. C'est l'interposi-
tion d'une ou de plusieurs notes clans l'intonation de
certaines pices de chant, pour en assurer la finale et
avertir le chur que c'est a lui de reprendre et pour-
suivre ce qui suit.
42
370 PH
Priode. Phrase musicale compose de plusieurs
membres dont la runion, forme un sens complet. La
'priode carre est proprement celle qui est compose de
quatre membres. Mais on ne laisse pas d'appeler p-
riode carre toute priode nombreuse et forme avec de
bons lments bien ajusts ensemble.
Perl. Signifie excuter dans la perfection un cadence
une roulade, en dtacher toutes les notes et les faire pour
ainsi dire tomber une une. On dit : jeu perl.
Cadence perle.
Proraison. Ce mot emprunt la rhtorique, signi-
fie la conclusion d'un discours d'loquence
;
on l'emploie
dans le mme sens l'gard du discours musical. Les
proraisons de Mozart sont d'un effet ravissant. Celles
de la Flte enchante, de l'ouverture des Noces de Fi-
garo, du premier finale de Don Juan, doivent tre ran-
ges parmi les productions les plus sublimes en ce
genre. Le mot proraison est quelquefois synonyme de
strette, et dans ce sens il s'applique l'allgro final des
morceaux les plus importants de l'opra, tels que le
finale, l'introduction, le sextuor, etc.
Perses. (Voyez le mot Assyriens.)
Phniciens (musique des). La musique des Phniciens
d'aprs Fabre d'Olivet, qui est notre guide dans ce tra-
vail historique, se divisa en autant de branches et forma
autant de systmes particuliers qu'il
y
eut de sectes. Ces
diverses sectes qui donnrent leurs noms aux peuples
chez lesquels elles dominrent, servirent aussi dsi-
gner l'espce de musique qu'elles adoptrent de prf-
rence. De l le mode lydien, le phrygien, le dorien,
l'ionien, etc., etc. C'est--dire le mode de Vnus ou de
la facult gnratrice universelle
;
celui du chef ou du
roi-pasteur; celui de la libert ou de la force mle; celui
de la colombe ou de la nature fminine. Les divers
modes que l'on retrouve chez les Grecs eurent chacun
leur caractre propre. Celui de tous qui parait avoir t
le plus gnralement adopt en Phnicie, tait le mode
appel vulgairement commun et que les Grecs ont connu
sous le nom du mode locrien, ce qui signifie mode carac-
tristique de l'alliance. La corde fondamentale de ce
mode tait le la, celle qui dominait sur le systme musi-
cal phnicien, la premire l'aigu, et mme au grave
quand elle
y
eut t ajoute. Comme cette corde tait
assimile la lune, qui tenait le premier rang parmi les
PH
371
divinits de ces peuples amazones, c'est--dire dvous
la nature fminine, on donna au mode qu'elle consti-
tuait le surnom de lyn qui veut dire astre nocturne et
suivant l'usage de ces temps, on en fit un personnage
mythologique, qui passant par la suite pour un fameux
musicien, fut cit comme le matre chanter d'Hercule.
Cependant Hrodote dit formellement
que c'tait une
sorte de chant usit en Egypte, qui, du sein de la Ph-
nicie avait pass en Europe. Cette sorte de chant qu'il
appelle limos, tait selon lui d'un caractre triste et
mlancolique. Ceci revient prcisment l'ide que les
Chinois modernes conservent encore de ce mode phni-
cien
,
dont ils dsignent la tonique la par l'pithte
expressive de kou-si, lamentation occidentale.
Au moment o les pasteurs dmembrrent l'empire
indien, et formrent la fameuse secte qui donna nais-
sance la nation phnicienne, il parat qu'ils choisirent
pour dsigner les sept sons diatoniques de leur systme
musical les sept voyelles de leur alphabet, de manire
que la premire de ces voyelles alpha ou A, tait appli-
que au principe cyprien
fa
qu'ils regardaient
comme le
premier, et que la dernire, in, que les Grecs rendent
par omga et que nous remplaons par ou, tait appli-
que au principe saturnien si qu'ils considraient comme
le dernier. On peut croire que ce fut par une suite natu-
relle de cette manire de noter les deux cordes musicales
assimiles aux deux principes de l'univers, que^ naquit
le fameux proverbe mis dans la bouche de l'tre su-
prme pour dsigner sa toute puissance et son immensit :
Je suis l'Alpha et l'Omga.
Cependant, soit que les Phniciens eussent deux ma-
nires de noter les sons, soit qu'ils les considrassent
comme procdant par intervalles harmoniques, si-mi-la-
r-sol-ut-fa, ou diatoniques, si-ut-r
-mi-fa-sol-la
,
ou
bien que le temps ou les rvolutions politiques et reli-
gieuses eussent apport quelques changements leur
notation, on voit clairement, par plusieurs passages des
anciens, que la corde la, assimile la lune et tonique
du mode commun ou locrien, tait note par la voyelle
A
;
en sorte que la gamme entire chante de l'aigu au
grave se solfiait sur le son des sept voyelles phni-
ciennes, inconnues
aujourd'hui, et en allant de l'aigu au
grave, par consquent de droite gauche, au lieu du
372
PHR
grave l'aigu et do gauche droite. Les pasteurs, en se
sparant de l'Empire indien, prirent cette mthode,
qu'ils communiqurent tous ceux qui dpendirent
d'eux, soit directement, soit indirectement. Les Egyp-
tiens, les Arabes, les Assyriens, les Grecs les Etrusques,
la reurent et la conservrent pius ou moins longtemps,
suivant les circonstances. Les Arabes et tous ceux qui ont
reu le joug de l'islamisme, la suivent encore aujourd'hui.
Philosophie de la musique. Elle consiste rechercher
les rapports secrets des sons avec nos sentiments et nos
penses (Voyez Langue musicale.)
Phonique. Art de combiner les sons d'aprs les lois
de l'acoustique.
Phonomtre. Instrument propre mesurer l'inten-
sit du son ou de ]a voix.
Phonorganon. Nom donn un automate jouant de
la trompette, construit en
1812,
par Robertson.
Phrase. Suite de chant ou d'harmonie qui forme
sans interruption un sens plus ou moins achev, et qui
se termine sur un repos par une cadence plus ou moins
parfaite.
Phraser. C'est, dans l'excution de la musique, pr-
senter la priode musicale avec lgance et noblesse,
l'orner de tous les agrments inspirs par le got, et la
conduire avec art depuis son dbut jusqu' sa conclusion.
Phrnologie (la) applique la musique. La physio-
nomie et les crnes humains offrent-ils des signes cer-
tains, infaillibles, pour prciser les dispositions, les
facults, le degr d'intelligence des individus, et spcia-
lement des hommes qui se livrent aux arts de l'imagi-
nation ? Les observations recueillies par Gall et par
Lavater constituent-elles une science positive ? A cet
gard, il
y
a contradiction, doute, incertitude parmi les
savants
modernes, et sans doute ce problme ne sera
pas rsolu de longtemps. Quoi qu'il en soit, l'anecdote
suivante, qui nous a t donne comme authentique, et
qui se rattache un homme minent dans l'art musical,
est un argument de plus en faveur des assertions de la
science
phrnologique.
On sait que Gall, l'illustre fondateur de cette cole,
ne sortait jamais d'un salon sans avoir interrog minu-
tieusement le crne et les protubrances caractris-
tiques de toutes les personnes qui s'y trouvaient runies.
Chacun se prtait de bonne grce cette opration, et
P1A 373
pour en fixer les rsultats, le clbre phrnologue avait
constamment sur lui un portefeuille, sur lequel il inscri-
vait le nom de tous les sujets soumis ses expriences
et les remarques qu'il avait faites sur chacun d'eux. Or,
pendant un sjour de quelques mois qu'il fil Milan, il
y
a trente ou trente-cinq ans, Gall avait particulire-
ment
remarqu
dans un des salons de cette ville un
trs-jeune musicien qui faisait les dlices de la socit
par son esprit, ses saillies et son talent. Voici ce qu'il
crivit sur ses tablettes propos de ce jeune homme ;
OEil rayonnant. Sourire intelligent et fin. Front
bomb. Prominente inspiration. Gnie crateur. Ener-
gie. Grce. Fcondit. Souplesse.
Ptossini tait le nom du jeune musicien en question,
nom parfaitement inconnu cette poque
;
et pourtant,
tait-il impossible de faire une numration plus com-
plte des qualits diverses qui ont brill depuis dans les
productions du grand maestro ?
Physharmonica. Petit instrument anches libres,
imagin Vienne, par le facteur Hachel, en 1818.
Pianino. Piano vertical de petite dimension import
d"Angieterre, en
1830,
par Camille Pleyel.
Pianiste. Celui qui joue du piano. Si l'on donnait ce
nom tous ceux qui metient les mains sur cet instru-
ment, on pourrait compter plus de cinquante mille pia-
nistes Paris seulement.
Il
y
a le pianiste-professeur, le pianiste de concert, le
pianiste-accompagnateur, le
pianiste-improvisateur. La
premire classe est trs-nombreuse; la seconde classe
s'augmente tous les jours. La troisime classe, qui devrait
tre la plus importante, est trop peu recherche par les
pianistes. Les bons accompagnateurs sont trs-rares et il
y
en a beaucoup trop encore de mauvais. Il est vrai que
ce rle est ingrat et peu brillant. Or, la plupart des pia-
nistes aiment briller. Pour tre excellent accompagna-
teur, il faut d'abord tre musicien profond, lire la parti-
tion d'orchestre et la rduire livre ouvert; transposer
la volont du chanteur
;
se faire le trs-humble servi-
teur de la voix; jamais ne la couvrir, toujours lui servir
de cortge; tre bon harmoniste et capable, au besoin,
d'improviser ou de suppler Un accompagnement. La
quatrime classe est encore plus faible que la troisime.
Il semble qu'on ait perdu le secret des Beethoven, des
Mozart, des Hummel, des Boeldieu. C'est qu'ici encore
374 PIA
il faut une tude longue et persvrante, seconde par
une nature exceptionnelle. L'homme de gnie, lui-mme
a besoin de longs ttonnements avant d'arriver impro-
viser en matre. Il faut s'y exercer de trs-bonne heure
et tous les jours, sans se rebuter des difficults qui
naissent chaque nouveau pas dans cette pineuse car-
rire. Du reste, l'improvisation, lorsqu'on a franchi tous
les obstacles, procure tant de jouissances, que les jeunes
gens bien organiss devraient s'y livrer avec plus d'ardeur.
Piano. Instrument de musique cordes et clavier,
qui a succd au clavecin. Les uns attribuent l'invention
du piano au florentin Gristofori, en
1718, ou Silberman,
facteur d'orgue, saxon, en 1750. Dans le clavecin et l'pi-
nette, les cordes taient pinces par un bec de plume ou
de cuir
;
dans le piano ce sont des marteaux mis en jeu
par la touche et divers chappements qui viennent les
attaquer. La corde pince donnait des sons trop unifor-
mes, tandis que le marteau e?t aux ordres de celui qui
sait le matriser, et que le son acquiert plus ou moins
d'intensit selon que la corde est frappe avec plus ou
moins de vigueur. Le piano donnant des moyens
d'expression jusqu'alors inconnus dans les instruments
clavier, et modifiant les sons du piano ou forte par
degrs imperceptibles, reut d'abord le nom de piano
forte ou forte piano, comme exprimant les deux qualits
qui le distinguaient. Ds le moment de son invention, le
nouvel instrument remporta une victoire complte sur le
clavecin, qui disparut tout fait.
Si le piano ne peut se montrer avec avantage dans
une vaste enceinte et au milieu d'une foule d'instru-
it*
le nom des principaux pianos qui ont t
construits,
les lieux o ils ont t fabriqus; le nom de Vinstrument
DESIGNATION
DES INSTRUMENTS
Piano basque
balancier
clavier double. .
clavier bascule.
DATES
1841
1855
1850
1836
PIA 375
ments, il prend bien sa revanche dans les salons, o il
l'orme lui seul une harmonie complte. Si le violon est
le roi des orchestres, le piano est le trsor de l'harmonie
et du chanteur la ville, la campagne surtout. Que de
soires drobes l'ennui et embellies des charmes de la
musique ! On chercherait en vainformer un quatuor
;
le
piano est l, c'est le point de raliement.
Les jeux brillants et varis de cet instrument, les
licences que la main droite a pu se permettre la faveur
des groupes harmonieux excuts par la main gauche, se
sont introduits peu peu dans l'orchestre dont ils ont
augment la puissance.
Le piano commena se rpandre en France vers
1780. Mais il
y
avait loin des premiers essais encore
informes qui furent alors tents, aux instruments super-
bes, excellents, qui sortent aujourd'hui des ateliers de
nos habiles facteurs.
Le piano forme de clavecin, vulgairement appel
piano queue, est celui que l'on doit prfrer. Les cor-
des tant frapps dans le sens de leur longueur, on
obtient des vibrations plus fortes et plus prolonges. La
forme de ce piano est lgante et pittoresque, elle repr-
sente une harpe couche horizontalement.
Le grand piano donnant un volume de sons plus con-
sidrable et prolongeant les vibrations, on peut relle-
ment excuter des mlodies larges sur cet instrument.
Ses moyens sonores et la moindre facilit que prsentent
les touches de son clavier donnent plus de solidit au
talent de l'excutant, et le forcent en quelque manire a
acqurir un beau style.
avec la date de leur invention, les noms de leurs auteurs,
indique sa qualit et son but et rend une description inutile.
NOMS
DES FACTEURS
Sormani
Eisenmenger
Vandercruyssen
Monvoisin
LIEUX
DE PROVENANCE
Paris
Id.
Bruxelles
Paris
376
PA
DSIGNATION
DES INSTRUMENTS
DATES
Piano clavier demi-ovale.
clavier gomtrique
clavier tournant. .
clavier de pdale .
carr
compact square. . .
Clara
clavi
cledi-harmonique. .
colonne
conducteur
concertina
cordes croises . .
idem
idem
cordes plates. . . .
sans cordes
idem
idem
-
idem
constant accord. . .
idem
corps rsonnant. ,
corps sonore. . . .
cylindre
crampons
demi-inclin
droit
droit double. . . . .
diaphonique. . . . .
diplophone
dittanaclasis
doucine
double
double clavier. . .
idem
double et cylindre.
4794
1845
1836
1789
1758
1851
1836
1825
1839
1812
1831
1839
1839
1847
1851
1852
1825
1847
1847
1847
1846
1854
1834
1854
1834
1855
1855
1830
1851
1855
1849
1801
1840
1779
1736
1821
1812
PIA
?77
NOMS
DES FACTEURS
Schleger
Folly
Dcbain
Bellmann
Frederici
Stodart
Marqueron
Charreyre
Boisselot
Erard
Tri que t
Alexandre
Vandermeer
Vogelsangs
Lichtenthal
Russel
Pape
Hill
Nann's
Papelard
Alliaume
Laborde
Greiner
Laprevotte
Henry et Martin
Sholtos
Eisenmenger
Roller
Jones
Donald
Lacout
Muller
Wirth
Hofmann
Buhier
Erard
Erard
LIEUX
DE PROVENANCE
Paris
Id.
Dresde
Gra
Londres
Paris
Paris
Marseille
Paris
Paris
Paris
Bruxelles
Bruxelles
Saint-Ptersbourg
Londres
Paris
Londres
New-York
Paris
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Londres
Luisbourg
Paris
Vienne
Paris
Gotha
Wurtemberg
Paris
Id.
i2.
378 PIA
DSIGNATION
DES INSTRUMENTS
Piano double chappement. . .
double son
double table d'harmonie
double grand
double traction
double queue
droit double
cran
enharmonique
idem
elliptique
elliptique quatre cordes
olien
idem
olique
idem
sans fond
fortissimo
giraffe
harmonomtre
harmonica . .
harmomelo
jalousies
~
lyre.
maniqus
idem
mtagophone
mlographe
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
DATES
1823
1843
1844
1851
1848
1839
1851
1836
1791
1837
1825
1827
1829
1838
1855
1856
1838
1844
1804
1844
1803
1806
1855
1839
1786
1848
1824
1823
1826
1827
1836
1837
1838
1840
1844
1843
PIA 379
NOMS
LIEUX
DES FACTEURS DE
PROVENANCE
Erard Paris
Boisselot Marseille
Roller Paris
Pirson Id.
Rheinlander Id.
Roller Id.
Jones Londres
Debain Paris
Rohdler Friedland
Tonnel Paris
Eulriot Id.
Dietz Id.
Kayser Id.
Isouard Id.
Melhop Londres
Chambry
Paris
Moul Id.
Dubois Id.
Bleyer Londres
Brasil n
Scheevds Nassau
Pfeiffer Paris
Huxtable Londres
Fischer Paris
Milchmayer Mayence
Debain Paris
l'abb Trentin Venise
Masera Montefiascorie
Pape Paris
Baudoin Id.
Miles Berry Londres
Carreyre Paris
Wetzel Id.
Duprat de Treboz Id.
Gurin Id.
Pape Id.
380
PIA
DSIGNATION
DES INSTRUMENTS
DATES
Piano mlographe
michrocordon . . . ,
miniature
Mozart
oblique
demi-oblique
octaviant
idem
idem
idem
organis ,
orgue ,
pdale ,
pdalier
idem
idem
idem
idem
phonographe. . . .
pianographe ....
pdale expressive.
piccolo
planicorde
portatif
pyramide
queue vertical . .
queue
rgulateur
rond
rptition continue
rptition
indfinie
secrtaire cylindre
secrtaire
scand
Sirnien
1855
1854
1857
1854
1846
1845
1840
1855
1839
1855
1839
1855
1827
1846
1848
1849
1855
1857
1840
1844
1851
1831
1849
1820
1804
4856
1797
1853
1836
4 854
1855
1842
1844
1855
4825
PIA 381
NOMS
DES FACTEURS
LIEUX
DE PROVENANCE
Coliard
Scholtus
Andr
Vogelsangs
Kriegelstein
Pape
Blondel
Blanchet
Zeiger
Pape
Jaulin
Schleip
Hesselbein
B]anc
Erard
Lodd
Pleyel et Wof
Duprat de Treboz
Gurin
Mercier
Lichtenthal
Boisselot
abb Trentin
Ward
Dietz
Erard
PifFaut
Pape
Schwander
Grus
Erard
Martin
Lentz
Pramberger
Londres
Paris
Francfort
Bruxelles
Paris
Id.
Id.
Id.
Colmar
Paris
Id.
Berlin
Paris
Id.
Id.
Orlans
Paris
Id.
Id.
Id.
Bruxelles
Marseille
Venise
Londres
Paris
Id.
Nouvelle-Orlans
Paris
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Allemagne
382
PIA
DSIGNATION
DES INSTRUMENTS
DATES
Piano sommier isol
sons soutenus volont
sons prolongs
sons soutenus
systme trembl . . . .
touches d'accident . . .
en table
table bombe
tambourin
tonmuld
mcanique . . .
tromba
transpositeur
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem ,
idem ,
trmolo
trmolophone ,
unicorde
vertical
idem
vertical double clavier ,
viole
violiiio
de voyage
1827
1843
1838
1812
1852
1854
1834
1855
1799
1844
1851
1820
1820
1836
1837
1837
1843
1846
1846
1847
1851
1851
1851
1851
1851
1851
1851
1842
1825
1795
1853
1825
1830
1851
1852
PIA
383
NOMS LIEUX
DES FACTEURS DE PROVENANCE
Trquet Paris
Boisselot Marseille
Lichtenthal Bruxelles
Erard Paris
Heaffer Bruxelles
Valz Paris
Pape Id.
Souffleto Id.
Smith Londres
Lud Beregsza Pesth
Greiner Londres
Roller
Paris
Wagner Id.
Rouchette Bruxelles
Grillet
Paris
Lacroix Bruxelles
Le Bihan Paris
Carteau Id.
Montai Id.
Bardier Id.
Addison Londres
Barry Id.
Mercier Paris
Montai Id.
Harwar Londres
Scufert Id.
Hopkinson Id.
Ph. Girard Paris
Pleyel ld.
Stodart Londres
Laussebat Clermont-Ferrand
Charreyre Paris
Lichtenihal Bruxelles
Wold New-York
Jenkins Londres
384 PIZ
Pianorgue. Petit instrument anche libre pouvant
s'ajouter un piano, construit en
1846, par Faulin.
Pichler. Bon lve et excellent imitateur de Stainer,
travailla en 1663, et il eu la faiblesse d'apposer aux
instruments qu'il construisit pendant la maladie du
matre, l'tiquette imprime de Stainer.
Picolo. Petite flte en r bmol, employ dans les
musiques militaires.
Pice. Ouvrage de musique instrumentale d'une cer-
taine tendue, compos de plusieurs morceaux formant
un ensemble et un tout pour tre excut de suite. Une
symphonie est une pice, une sonate est une pice. Ce
mot ne s'applique gure qu' des compositions destines
l'orchestre ou l'orgue, au piano, la harpe, etc.
Piffaro. Instrument vent en usage en Italie, qui
rpond la haute contre du hautbois.
Pilote. Dans les pianos et dans les orgues est une
baguette plus ou moins grande servant transmettre
l'action des touches aux marteaux ou aux soupapes.
Pincer. C'est employer les doigts, au lieu de l'archet,
pour faire sonner les instruments qui n'ont ni touche ni
archet, et dont on ne joue qu'en les pinant
;
tels sont la
harpe et la guitare. On pince aussi quelquefois les ins-
truments archet, et on l'indique dans la partition et
dans la partie en crivant pinc, ou pizzicato. (Voyez ce
mot.)
Pipeau. Instrument champtre form de l'assemblage
de plusieurs tiges creuses coupes dans leur longueur,
suivant des rapports harmoniques.
Piqu, Pique. Les notes piques sont des suites de
notes montant ou descendant, ou rebattues sur le mme
degr, sur chacune desquelles on met un point allong
pour indiquer qu'elles doivent tre marques gales par
des coup de langue ou d'archet secs et dtachs.
Piston. Cylindre de mtal ordinairement de cuivre et
qui entre sans frottement clans le corps d'un tube. On en a
fait l'application sur les instruments vent en cuivre
pour ouvrir ou fermer les divers tons dont ils sont
munis.
Piu, Plus. Pin presto, plus vite; piu lento, plus
lent
;
piu stretto, plus serr.
Pizzicato. Ce mot, qui signifie pinc
,
avertit qu'il
faut pincer les cordes du violon ou du violoncelle, de la
viole ou de la contre-basse, au lieu de les faire rsonner
PLI
385
avec l'archet. Ces mots coll'arco, ou simplement arco,
marquent le lieu o l'on doit reprendre de l'archet..
Plagal (ton). C'est une rgle fondamentale que toute
pice de plain-chant doit tre renferme dans l'tendue
d'une octave, ou tout au plus d'une neuvime. Cela
observ, il peut arriver deux cas, savoir, que la finale
occupe le plus bas degr de cette octave, ou qu'elle en
occupe le milieu. Dans le premier cas, le ton est authen-
tique, et lorsque la finale occupe le milieu, le ton est
appel plagal ou collatral.
Plagale (cadence). C'est, la basse, le mouvement du
quatrime degr sur la tonique, ces deux notes portant
l'accord parfait. La cadence plagale est une rminiscence
du plain-chant et peut s'accorder cependant avec les exi-
gences del tonalit moderne.
Plagiat. C'est le nom qu'on donne un larcin d'ides
musicales. En musique comme en littrature, il faut dis-
tinguer les ides cres, les phrases filles de l'imagina-
tion, d'avec les lieux communs de l'cole. On ne saurait
s'approprier les premires sous aucun prtexte
;
les
phrases toutes faites appartiennent tout le monde.
Plain-Chant. (Voyez Chant-ecclsiastique.)
Planche. Se dit d'une plaque de cuivre ou d'tain,
sur laquelle on grave la musique.
Plectroelphon. Instrument clavier et archeteon-
tinu, mu par une manivelle, invent Nantes en 1827,
par (jama.
Plectro-lyra. Instrument cordes pinces imagin
Philadelphie en 1833 par Trajetta.
Plectrum'. Morceau de bois ou d'ivoire, termin par
un crochet dont on se servait pour faire rsonner les
cordes de la lyre et de la cithare.
Plein jeu. C'est dans l'orgue la runion des jeux de
cymbale et de fourniture. Pour que \q plein jeu produise
un effet satisfaisant, il faut qu'il soit soutenu par de bons
fonds, c'est--dire par le bourdon de seize pieds, la
montre et les prestants.
Pleximtre. Instrument du genre mtronome, ima-
gin en
1824,
par Finazzi d'Omgna en Sardaigne. Il ne
diffrait du mtronome de Malzel qu'en ce qu'il mar-
quait les premiers temps de chaque mesure par un
chappement.
Plique. Sorte de ligature dans notre ancienne musi-
que. La plique tait un signe de retardement ou de len-
386
POL
leur
;
elle se faisait en passant d'un son un autre,
depuis le demi-ton jusqu' la quinte, soit en montant,
soit en descendant. Telle est la dfinition donne par
J.-J. Rousseau
;
mais on croit plus gnralement que la
plique des anciens tait une espce d'ornement sembla-
ble, peu prs, notre trille. C'est ainsi, du moins, que
l'a dfini Marchetto de Padoue.
Pochette. Petit violon de poche, qui a le mme man-
che que le violon, et dont les matres de danse se servent
comme tant plus commode porter. Il sonne l'octave
du violon ordinaire.
Poco, Peu. Poco poco, peu peu.
Pome. Ouvrage crit en vers et destin tre mis en
musique. On ne donne le nom de pome qu' des ouvra-
ges d'une certaine tendue, tels qu'un opra, un oratorio,
une cantate; tandis que le mot paroles, qui a la mme
signification, s'applique galement un opra et une
chanson.
Pokilorgue. Espce de jeu de lames vibrantes, imi-
tant la flte, ou le hautbois, mises en vibration par un
soufflet, adapt au piano et imagin par Gavaill-Goll,
en 1834.
Point. Le point augmente la note qui le prcde de la
moiti de sa valeur ou de sa dure. Quand il
y
a plusieurs
points de suite, le second ne vaut que la moiti du pre-
mier, le troisime la moiti du second.
Point d'orgue. Passage brillant qui fait la partie
principale dans un solo. Le point d'orgue se place sur un
repos, ou vers la fin d'un morceau de musique. Les airs
de bravoure de l'cole italienne se terminaient autrefois
par un point d'orgue, ou cadence. Cet usage s'est perdu
peu peu.
Pointu, Pointue. On se sert de ce mot figurment et
dans la conversation familire, pour dsigner une voix
qui ne donne que des sons grles, et n'a de dveloppe-
ment que dans la partie aigu.
Politique (musique). C'est surtout l'poque de notre
premire rvolution que la musique politique a jou un
grand rle. C'tait en juillet 1789. On venait de prendre
la Bastille. Le peuple clbrait sa victoire par des chants
joyeux, par des cris d'enthousiasme
;
mais depuis
quelque temps, l'Htel-de-Ville, les lecteurs s'taient
rassembls et exeraient une magistrature provisoire.
Les premiers ils commandrent un ouvrage lyrique des-
POL 387
tin immortaliser cette victoire populaire : ils charg-
rent un nomm Dsaugier-Janson de composer un hiro-
drame, ou drame sacr, retraant autant que possible les
pisodes les plus remarquables de la prise de la Bastille.
Cet ouvrage fut excut en grande pompe dans l'glise
Notre-Dame, et jouit pendant quelque temps d'une cer-
taine popularit.
Une innovation est remarquer propos de l'uvre
dont nous parlons
;
une grosse cloche d'un timbre sonore
comptait parmi les instruments de l'orchestre, et rendait
au naturel les sons lugubres du tocsin.
Traons maintenant l'histoire des deux airs fameux au
dbut de la rvolution franaise, le premier chant par
tous les amis du roi, le second par tous les amis de la
nation
;
nous voulons parler du bel air : Richard,
mon roi, l'univers fabandonne ! et du carillon national
a ira.
Le mlodique Grtry tait alors dans toute la maturit
de son talent
;
son triomphe avait t Richard Cur-de-
Lion, dont les paroles toutes monarchiques contrastaient
singulirement avec l'esprit dmocratique qui se taisait
jour chez le peuple. Les nobles, ou pour parler le lan-
gage du temps, les aristrocrates en consolidrent le
succs, et, peine les tats-gnraux taient assembls,
que dans tous les salons on chantait l'air du fidle Blon-
del au pied de la tour qui renferme son royal matre.
Quelque courtisans affectrent de le faire entendre dans
les modestes soires que Louis XVI donnait Versailles.
Il devint bientt une sorte de ralliement sous la bannire
monarchique. Mais cette allusion ne se faisait d'abord
que secrtement
;
une occasion se prsenta de la rendre
publique.
En
1790, les gardes-du-corps donnrent un banquet
aristocratique dans l'Orangerie de Versailles. Aprs le
toast, on chanta l'air : Richard, et on ft serment de
dlivrer Louis XVI. Ds ce moment, il devint une Mar-
seillaise royaliste.
Quand Louis XVI eut t enferm au Temple, des
joueurs d'orgue vinrent chanter sous les fentres du
monarque l'air du troubadour, tant et si bien que, sous
la Terreur, les musiciens ambulants durent l'enlever de
leur rpertoire, sinon passer pour suspects et aller en
prison.
Tel a t le sort de cet air, qui dut beaucoup de son
388
POL
succs la politique. Occupons-nous maintenant de son
rival, le a ira.
Depuis* la prise de la Bastille, le peuple manifestait
hautement sa haine contre les nobles. L'expression
a ira tait ordinairement employe toutes les ibis qu'il
lanternait, c'est--dire accrochait au rverbre un ennemi
de la constitution. Pendant les prparatifs qui prcd-
rent la fdration du 14 juillet
1790,
a ira fut mis en
chanson avec un grand nombre de variantes quant aux
paroles. Le a ira officiel est celui que l'on attribue
Dupuis, l'auteur de l'Origine des cultes.
Bientt cet air s'entendit dans toutes les rues. Si l'on
assassinait un aristocrate, si l'on plantait un mai de la
libert, le a ira tait chant. Ouvrez le Journal de
Paris du temps, aux annonces, voici ce que vous
y
trou-
verez : Nouvelles variations pour le clavecin, sur l'air
a ira
;
rondeau sur l'air a ira. Le a ira vcut jus-
que sous le Directoire.
Aux clubs, on faisait souvent del musique; elle se
composait le plus souvent de symphonies ayant pour
basses continues des roulements de tambours, des voci-
frations et des dcharges de mousqueterie.
De la dchance de Louis XVI la Terreur, il n'y eut
qu'un pas. Cependant au point de vue de l'art musical,
la Terreur fut une poque part. Les quatorze armes
bordent et dfendent nos frontires menaces par la coa-
lition des rois trangers
;
la France fait un effort sur
elle-mme : et quel stimulant plus efficace que la musi-
que peut inspirer les manifestations du courage? Nous
ne suivrons pas ces nouveaux soldats sur les champs de
bataille : la Marseillaise leur suffisait, et dans toutes les
occasions prilleuses, l'hymne fameux redoubla leur
courage et les mena la victoire.
Et maintenant qu'on nous suive l'Opra sous la
Terreur, voici les pices qu'on entendra : le Sige de
Thionville, musique de Jadin, VOfj'rande la Libert,
scne religieuse de Gossec, et Fabius, tragdie mise en
musique par Mreaux. A cette poque, la musique poli-
tique a plus que jamais envahi le thtre.
Sous la Terreur, le catholicisme avait t remplac,
d'abord par le culte de la Raison, ensuite par celui de
l'tre- Suprme, tous deux inaugurs par des ftes solen-
nelles.
La fte de la Raison fut clbre dans
l'glise Notre-
POL 389
Dame
;
phi sieurs compositeurs concoururent la partie
musicale. Un tmoin oculaire nous a assur que les airs
qu'on chantait dans ces solennits taient vraiment
imposants, et que les motifs en taient d'une admirable
simplicit.
La Fte de l'tre-Sujprm, qui suivit d'assez prs
celle de la Raison, l'ut plus remarquable sous le point de
vue musical
;
on
y
entendit des strophes en manire de
cantiques, dans lesquelles Gossec se surpassa. Sous le
Directoire, le Consulat, l'Empire, la Restauration, le
rgne de Louis-Philippe, la Rpublique et le second Em-
pire, la musique politique n'a pas jou un grand rle.
Elle a cd le pas la musique srieuse qui a t fconde
en chefs-d'uvre. La Parisienne, les Girondins, Par-
tant pour la Syrie, voil tout ce qui mrite d'tre signal
pendant cette priode, dans l'histoire del musique poli-
tique.
Polka (la). C'est une danse originaire de Bohme,
une danse de paysans. Elle a
w
tous les signes du type ori-
ginal, des allures vives, brusques, tumultueuses, rudes,
mais gaies et souvent voluptueuses. La cadence de ses
mouvements suit la mesure deux quatre. Elle se ralentit
et mle sa vivacit une dlicieuse mollesse. La polka,
comme l valse, est deux, se spare du bruit et s'isole
de la foule. Elle tourne sur elle-mme, lance au loin ses
jambes Tune aprs l'autre, de ct, et du pied sur lequel
elle se repose elle saute deux fois par saccades prcipi-
tes et en frappant le sol avec le talon, le plus coquette-
ment du monde. Elle procde de la Cracovienne et de la
Mazurka.
Polka. Espce d'accordon perfectionn.
Pologne (de la musique en). Une grande nation pr-
sida longtemps aux destines des peuples du Nord
;
elle
possdait de riches provinces, cultivait avec clat les let-
tres et les arts. Aujourd'hui elle a tout perdu, elle gmit
sous ses ruines,
Dans cet tat de chose, la musique a d faire peu de
progrs en Pologne. Avant la chute de Varsovie, il
y
avait un Conservatoire bien organis, qui avait produft
d'excellents lves. Il tait dirig par Soliva, Italien,
homme de talent. Joseph Elsner, excellent composi-
teur, tait au nombre des professeurs. Lui aussi a rendu
de trs-grands services l'cole de musique polonaise
;
aim et ador de ses lves, il compte parmi les meil-
390 POM
leurs, Gh. Turpinski, Chopin, Orlowki, Wycocki. etc.
Outre ces noms dj connus, on ci le Varsovie une
foule djeunes talents et de compositeurs distingus;
mais n'ayant ni unit ni but, ils ne peuvent agir sur
l'avenir de Fart en Pologne.
Juger Topera polonais par ce qui se fait maintenant,
ce serait donner une bien fausse ide de la scne et sur-
tout de l'opra national. Quand on songe avec quelle
svrit le gouvernement russe proscrit tout ce qui porte
l'ombre de nationalit, on s'tonne mme qu'il permette
djouer des opras traduits en polonais; car c'est dj
avouer qu'il existe des Polonais et une langue polonaise.
Avant la dernire rvolution, Elsner, Turpinski,
Stephani, Danze, alimentaient la scne nationale;
aujourd'hui on ne joue que des traductions. Les opras
d' Elsner et de Turpinski sont l' index.
Avant 1830, il
y
avait quatre thtres qui jouaient
la fois, le Grand-Opra, le Thtre-Franais, les Varits-
Polonaises et l'Opra-Allemand. Aujourd'hui, deux
peine peuvent exister.
Le thtre de l'Opra est un des plus grands de l'Eu-
rope. Dans ces dernires annes le Conservatoire de Var-
sovie a t rorganis sous la direction de M, Apollinaire
de Kontsky.
Polonaise. Air de chant et de danse mesur trois
temps et d'un mouvement modr. La Polonaise nous
vient de la Pologne, ainsi que l'indique son nom
;
elle se
distingue par un rhythme boiteux, que Ton obtient en
syncopant les premires notes de la mesure.
Polycorde. Instrument archet invent en 1799 par
Helsner de Leipsick, ressemblant la contrebasse et
pouvant en tenir lieu.
Polyplectrum. Instrument construit par Dietz en
1827,
dans lequel on avait cherch la possibilit de pro-
longer le son et d'en modifier les accents, au moyen d'un
archet continu.
Polysonor. Mcanisme imagin en
1848,
par Zeiger,
pour faire rendre au piano plusieurs sons par la mme
touche.
Poly-toni-clavicordjum. tait un instrument du
mme genre que la Mlodica (voir ce mot) il fut cons-
truit par Stem d'Augsbourg en 1760.
Pompe. C'est, dans le cor et la trompette, un fragment
de tuyau en forme de Ter cheval, qui par ses deux
POR
391
extrmits vient s'emboter avec une grande prcision
sur les deux bouts forms par une section faite vers le
milieu du corps de l'instrument, et les recouvre entire-
ment. En enfonant plus ou moins cette pompe, on
allonge ou on racourcit le grand tuyau, ce qui lve ou
abaisse le ton.
Dans la flte, la clarinette, le basson, la pompe est
une emboture en mtal, place entre les principales
pices pour les runir, et qui sert aussi donner plus
d'extension l'instrument, et baisser par consquent
son intonation.
Ponctuation, Ponctuer. C'est, en terme de compo-
sition, marquer les repos plus ou moins parfaits, et divi-
ser tellement les phrases, qu'on sente par la modulation
et par les cadences leurs commencements, leurs chutes
et leurs liaisons plus ou moins grandes, comme on
sent tout cela dans le discours l'aide de la ponctuation.
Ponticello. C'est le nom italien du Chevalet (voyez
ce mot). On trouve quelquefois dans les partitions : sut
ponticello, sur le chevalet.
Pont-Neuf. On appelle ainsi de petits airs et mme de
simples refrains gothiques, sans mesure, sans rhythme,
d'une modulation triviale et vulgaire. Les ponts-neufs
ont t quelquefois admis l'Opra-Comique,
et l'on a
applaudi avec transport Toto Carabo, Auclairdela
lune,
Malboroug, Ah! vous dirai-je,
maman, que quelques
compositeurs ont daign mler leur priodes harmo-
nieuses. Le peuple parisien cria au miracle. Mais les
connaisseurs ne tolrent ces sortes d'emprunts que
quand un travail harmonique, lgant et pur, un dessin
hardi vient leur servir d'excuse.
Port de voix. C'est ce que les Italiens appellent por-
tamento. 11
y
a deux manires de porter la voix ou les
sons
;
la premire, lorsqu'on lie plusieurs sons d'gale
valeur, qui procdent par degrs conjoints ou disjoints;
la seconde se pratique entre deux sons qui forment un
intervalle plus ou moins grand, et qui procdent par
degrs disjoints seulement. Elle consiste faire glisser
la voix promptement par une liaison fort lgre, qui part
de l'extrmit de la premire des deux notes, pour passer
celle qui la suit, en l'anticipant.
Porte. La porte ou ligne de musique est compose
de cinq lignes parallles, sur lesquelles ou entre les-
quelles les diverses positions des notes en marquent les
392 PR
degrs. Ce nom de porte a t donn la ligne de mu-
sique, parce qu'elle renferme exactement la porte ou
l'tendue d'une voix ordinaire.
Porte-voix. Instrument destin porter la voix au
loin. C'est un tuyau de forme conique, largement vas
par sa partie infrieure, dans lequel on parle en portant
la petite extrmit la bouche. Avec un porte-voix de
1 mtre 33 on peut se faire entendre 500 pas gom-
triques; avec un porte-voix de 5 mtres 50,
on se fait
entendre 1,600.
Portugal (de la musique en). La musique des Por-
tugais, drivant de la mme source que la musique espa-
gnole, participe de ses qualits et de ses dfauts. Ce
peuple possde un grand nombre d'airs assez beaux et
fort anciens; ses airs nationaux sont les Tadunes et les
Madinhas; ceux-ci se sparent compltement des airs
des autres nations. La modulation en est tout fait ori-
ginale. Les mlodies portugaises sont simples, nobles et
trs-expressives.
De Costa, Fronchis et Schiopetta, sont les meilleurs
compositeurs portugais de l'poque actuelle. Il
y
a Lis-
bonne un Opra-Italien originairement tabli par
Jomelli, o ont t reprsents les meilleurs ouvrages du
rpertoire lyrique.
Positif. Petit orgue que l'on place devant le grand
orgue quand il est assez considrable pour tre divis en
deux.
Position. Lieu de la porte o est place une note,
pour fixer le degr d'lvation du son qu'elle reprsente.
C'est aussi Tordre dans lequel les sons d*un accord sont
disposs au-dessus de ]a basse.
Pot-Pourri. Suite d'airs pris en totalit ou en partie
a et l dans les compositions de divers matres, et
mme parmi les refrains que l'on chante dans les rues,
et cousus les uns aux autres par quelques phrases con-
jonctionnelles.
Prlude, Prluder. C'est en gnral chanter ou
jouer quelque trait de fantaisie irrgulier et assez court,
mais passant par les cordes essentielles du ton, soit
pour l'tablir, soit pour disposer sa voix; ou bien poser
sa main sur un instrument, avant de commencer un
morceau de musique. Mais sur l'orgue et le piano, l'art
de prluder est plus considrable; c'est composer et
jouer impromptu des morceaux chargs de tout ce que
PRO 393
la composition a de plus savant en dessin, en fugue, en
imitation, en modulation et en harmonie.
Premier. (Battre), c'est une des batteries du tam-
bour, qui dsigne galement battre aux champs.
Prparation. On appellf ainsi, dans les mthodes
harmoniques fondes sur l'exprience, l'obligation de
faire entendre d'abord certaines notes des accords dis-
sonants, avant de les attaquer.
Prparation au chant. On donne ce nom aux tudes
du solfge et de la vocalisation. Ces tudes servent
former l'lve la lecture de la musique, faonner
sa voix, la rendre gale sur tous les points, lui don-
ner du corps et de l'agilit, affermir son intonation,
avant de lui confier l'excution des compositions vocales.
. Prparer. C'est l'action que forme harmoniquement
une consonnance avant une dissonance, dans une ou
plusieurs parties aigus ou moyennes sur une note de
basse.
Presser. C'est en musique augmenter de vitesse; on
presse le mouvement, on presse la mesure.
Prestant. Jeu d'orgue
;
il est d'tain et ouvert. Son
plus grand tuyau a quatre pieds de longueur. Il sonne
Yut Toctave au-dessus du bourdon de huit. Le prs-
tant entre dans presque toutes les associations de jeux
de l'orgue.
Presto. Ce mot, crit la tte d'un morceeu de mu-
sique, indique le plus prompt et le plus anim des cinq
principaux mouvements de la musique. Presto signifie
vite
;
son superlatif prestissimo, trs-vite, marque un
mouvement encore plus press et le plus rapide de
tous.
Prima donna. Titre de la premire et principale can-
tatrice qui remplit un rle important dans un opra.
Principal, Principale. On donne cette pithte la
partie rcitante d'un concerto et la partie concertante,
pour les distinguer des parties desinstruments de mme
nature qui ne doivent figurer que dans les accompagne-
ments. Violon principal, clarinetteprincipale
,
cor prin-
cipal.
Prise du sujet. C'est l'instant o une partie s'empare
du sujet de la fugue pour faire son entr
Professeur. Celui qui enseigne ou exerce la musique
prend le titre de professeur, du mot profession ou de
l'art qu'il professe.
12..
394 PRO
Progrs de la fugue. C'est ainsi que Ton appelle la
suite de la fugue, partir du point o toutes les parties
ont t'ait chacune leur entre, et o tous les fils du dis-
cours musical sont lis ensemble.
Progression (ou marche) de Basse. C'est un mor-
ceau d'harmonie dans lequel toutes les parties marchent
avec une telle symtrie, que l'intelligence, exclusive-
ment attentive cette symtrie parfaite, oublie de pen-
ser la nature et l'enchanement des accords employs,
et les souffre tous.
On crit sous la forme que l'on veut deux ou trois
accords parfaitement rguliers qui forment le thme de
la progression et qu'on reproduit plusieurs fois, en mon-
tant ou en descendant.
Prolation. C'tait dans l'ancienne musique une ma-
nire de dterminer la valeur des notes demi-brves sur
celle de la brve, ou des minimes sur celle de la demi-
brve. Cette prolation se marquait aprs la clef, par un
cercle ou un demi-cercle, ponctu ou non ponctu.
Prologue. Sorte de petit opra qui prcde le grand,
l'annonce et lui sert d'introduction.
Prolongation. La prolongation en gnral consiste
continuer une ou plusieurs notes d'un accord sur un ou
plusieurs accords suivants. (Voyez le mot Retard).
Proposition. Terme que l'on emploie pour dsigner
la premire phrase d'une fugue, contenant le sujet et
tous les contre- sujets, quel qu'en soit le nombre.
Proprement. Signifie en musique, avec justesse et
facilit. On dit jouer proprement, excuter proprement.
Proprit. Avant l'invention de la notes* se disait
de la disposition de la mlodie quand au ton. Il
y
avait
troit sortes de proprits : la proprit de nature, celle
du bmol et celle du bcarre.
Prose. L'usage des proses tait trs-frquent dans
les premiers temps de l'glise. L'office romain n'en a
conserv que trois : Victim paschali laudes, pour le
jour de Pques, Veni sancte spiritus, pour la Pentecte,
Lauda, Sion, Salvatorem, pour la fte du Saint-Sacre-
ment. On les chante souvent en musique. Le Stabat Ma-
ter et le Dies ir sont plus clbres encore. Tous les
amis de la grande musique connaissent ceux de Pales-
trina, de Pergolse, de Haydn, deRossini, etc., etc.
Proslambanomenos. Nom du la ajout par les Grecs
au-dessous du si, par lequel commenait leur systme.
PSA 395
Guido ayant plac un sol au-dessous de ce la, ce sol fut
appel kypo-proslambanomenoS) c'est--dire sous-pros-
]ambanomne.
Prosodie. La voix de l'homme est naturellement une
succession de notes ou degrs musicaux, lors mme qu'il
parle ou met sa pense. C'est la plus grande preuve de
la prsence d'une me qui donne ses passions h la matire.
Il est impossible, si la premire langue parle par
l'homme fut l'hbraque, qu'Adam, dans cet idiome, ait
manifest son admiration pour Eve, sans accentuer vive-
ment sa parole, sans l'animer de longues et de brves,
tantt plus lentes, tantt plus rapides, enfin sans la
chanter en quelque sorte. La musique fut depuis une
extension de cette prosodie naturelle. Elle se sert mme
quelquefois du verbe prosodierpour exprimer les diver-
ses mesures et rhythmes de son chant. Toutefois la musi-
que, par son art, perfectionna et fixa, depuis, la prosodie
inne dans chaque idiome. Les vers et la musique sont le
dpt conservateur de la prosodie gnrale chez tous les
peuples.
Prote. (Voir cimbalo et ncordo.)
Proverbe musical. Air ou fragment d'air populaire
qui rappelle les paroles jointes la mlodie.
Psallette. Du grec YaXXw (je chante) lieu o l'on
lve, o l'on exerce les enfants de chur.
Psalmodicon. Espce de serpent ayant vingt cinq
clefs construit en 1828 par Weinvich cordonnier en
Thuringe.
Psalmodier. C'est chanter ou rciter les psaumes et
l'office d'une manire particulire; la psalmodie tient le
milieu entre le chant et la parole. C'est du chant parce
que la voix est soutenue
;
c'est de la parole, parce qu'on
garde presque toujours le mme ton, et que l'on observe
exactement le dbit oratoire.
Psaltrion. Instrumenta cordes fixes, qui a la forme
d'un triangle tronqu par en haut, et dont chaque note
a deux cordes de laiton ou d'acier. Il se joue des deux
mains, en mettant aux doigts des anneaux plats, d'o
sort un fort tuyau dplume pointu.
Psaumes. Hymnes ou cantiques crits en hbreu, et
dont le roi David passe gnralement pour tre l'auteur.
David dansant devant l'arche, ou retir dans son palais,
ou mme assis la table des festins, chantait ses posies
nationales et sacres au son du kinnor (la grande harpe),
396 QUA
et dans e temple les clatants buccins, les doux psalt-
rions, les vibrantes cymbales, les churs mlodieux de
4,000
lvites les accompagnaient de leur puissante har-
monie.
Durant la captivit de Babylone, des Juifs moururent
de tristesse de ne pas entendre les belles louanges du
Dieu de leurs pres. Leurs regards se levaient incessam-
ment vers les saintes montagnes. Le Super flumina
Bbylonis faisait ruisseler sur leurs joues un torrent de
larmes. Aujourd'hui encore indiffrentsquenoussommes,
nous ne lisons pas ces plaintes harmonieuses sans avoir
l'me navre de tristesse. C'est la plus touchante lgie
qu'aient enfante la douleur, la captivit de l'exil.
Beaucoup de compositeurs clbres ont mis des
psaumes en musique. A leur tte, brille Marcello, un
des plus beaux gnies qui aient illustr l'Italie. Une admi-
rable expression potique, beaucoup d'originalit et de
hardiesse dans les ides, enfin une grande richesse et
une grande varit de moyens, ont fait considrer les
cinquante psaumes qu'il a publis, non-seulement comme
son chef-d'uvre, mais comme une des plus belles pro-
ductions de l'art.
Les Miserere d'Allegri, de Bai, de Paisiello, de
Jomelli, qui en a fait quatre ou cinq, parmi lesquels on
remarque surtout celui deux voix, sont clbres.
Psautier. Recueil des cent cinquante chants bibli-
ques qui portent le nom de psaumes.
Pupitre. Meuble dont on se sert pour poser les livres
de musique, les partitions, les parties spares, dans
une situation commode pour tre lus.
Quadricinium.
Composition quatre parties.
Quadrille. Danse d'un caractre trs-gai. d'un mou-
vement vif, dont la mlodie est de
2/4,
et qui a deux
reprises de huit mesures chacune. On appelle aussi
quadrille un groupe de quatre danseurs et de quatre
danseuses qui figure dans les ballets et les grands bals,
et qui se distingue des autres groupes par un costume
QUA 397
particulier. Le quadrille se compose de cinq figures ayant
chacune son caractre spcial. On les nomme
1
Panta-
lon,
2
t, 3
a
Poule,
4
Pastourelle ou Trnis, Final.
Le Pantalon s'crit
6/8,
rarement 2/4.
L't s'crit
2[4
souvent, et so joue plus lentement que le pantalon.
La Poule s'crit 6[8 ;
elle a un caractre srieux et sa
phrase est ondule. La Pastourelle est d'un mouvement
plus vif que celui de la Poule. Le Final doit avoir de
l'entrain
;
il est permis d'en presser la mesure, sans ce-
pendant faire courir les danseurs.
Quadruple croche. Note de musique valant le
huitime d'une croche. Les quadruples croches sont cro-
ches quatre crochets, ou quatre barres qui en tien-
nent lieu, quand elles sont plusieurs de suite.
Qualit du son. La qualit du son ne saurait tre d-
termine, car les diverses matires qu'on peut employer
pour la confection des instruments, la manire de les
jouer, ou d'autres inventions peuvent rendre le son tout
fait diffrent de celui qu'ont tous les instruments en
usage de nos jours.
Quantit des sons musicaux. Si l'on entend par l
l'extension des sons musicaux, cette extension n'tant
pas borne, il n'est pas possible de la dterminer, car on
peut inventer des instruments qui rendent des sons plus
aigus ou plus graves (toujours apprciables cependant)
que ceux que l'on connat aujourd'hui.
Quart de soupir. Chaque note, suivant sa valeur, a
un silence correspondant. Les silences des diverses va-
leurs ont. des noms qui leur sont particuliers. Ainsi, par
exemple, on appelle pause celui de la ronde, demi-pause
celui de la blanche, soupir celui de la noire, demi-sou-
pir celui de la croche, quart de soupir celui de la double
croche, etc.
Quart de ton. Quatrime partie de l'intervalle d'un
ton, qui n'est employe ni dans la mlodie ni dans l'har-
monie, attendu que notre oreille n'est point habitue
mesurer ces petits intervalles. On dit, en parlant d'une
intonation dfectueuse, que le musicien monte ou baisse
d'un quart de ton.
Quarte de nasard. Jeu d'orgue qui sonne la quarte
au-dessus du nasard, et l'octave au-dessus du prestant.
Ce jeu fait partie de ceux qu'on appelle jeux de muta-
tion.
Quarte. Intervalle de quatre degrs. La quarte peut
12...
dm qua
tre de trois espces : la naturelle, la diminue, Yaug-
mente.
Tant que la quarte ne forme pas un retardement de la
tierce de l'accord suivant, elle est toujours consonnance
et doit tre considre comme telle aprs la quinte natu-
relle dans son usage harmonique; elle est cependant su-
jette, ainsi que la dissonance, une progression limite.
Ceci donna lieu, dans le sicle dernier, beaucoup de
controverses sur la question de savoir si la quarte est ou
n'est pas une consonnance; mais il est vident qu'elle
est consonnance quand elle fait partie d'un accord par-
fait
;
elle est dissonance quand elle est introduite, comme
retard, dans un accord, dont, naturellement, elle ne fe-
rait pas partie. La quarte double ou transpose l'oc-
tave s'appelle onzime.
Quarter. C'tait chez les anciens musiciens une ma-
nire de procder dans le dchant ou contre-point, plu-
tt par quartes que par quintes.
Quasi, Presque. Ce mot sert indiquer le mouve-
ment
;
par exemple, andante quasi allegretto.
Quasi-Syncope. Ancien nom de la figure dans laquelle
on rptait la mme note divise par la barre de mesure,
sans tre unie par la liaison.
Quaternaire. Ce qu'on appelle le quaternaire sacr
de Pythagore comprend les nombres d,
2, 3,
4,
qui in-
diquent les proportions relatives de l'octave, de la quinte
et de la quarte. Ces nombres correspondent aux notes
do, do, sol, do, et on trouve en eux, de 1
2,
la propor-
tion de l'octave, de 2 3 celle de la quinte, et de 3 4
celle de la quarte.
Quatorzime. Septime, augmente d'une octave.
Quatre mains. On appelle sonate quatre mains une
pice compose pour tre excute par deux personnes
sur un mme piano
;
elles se placent l'une ct de l'au-
tre, et se divisent le clavier par moiti. L'octa\e ajoute
cet instrument ouvre un champ plus vaste la sonate
quatre mains, et donne chaque excutant une ten-
due de trois octaves. 11 existe de trs-belles sonates
(maire
mains de Mozart; on a arrang des symphonies
de Haydn, et des ouvertures d'opra quatre mains pour
le piano.
Quatricinia. Nom de petits morceaux de musique
pour quatre cors ou trompettes.
Quatuor. Morceau de musique vocale ou instrumen-
QUA 399
taie compos pour quatre parties. Dans son acception la
plus tendue, ce mot s'applique toute espce de musi-
que crite pour quatre voix ou pour quatre instruments,
quelle que soit d'ailleurs l'importance relative de cha-
cune des parties. Mais, dans un sens plus restreint et
plus particulirement usit, il ne s'applique qu'aux com-
positions dont toutes les parties sont concertantes ou
obligs. C'est dans ce sens que J.-J. Rousseau, dont au
reste les connaissances musicales taient incompltes et
fort errones, dit qu'il n'existe point de vrais quatuors,
ou qu'ils ne valent rien. Cette assertion, trop absolue
pour tre juste, prouve tout au plus que le clbre phi-
losophe a voulu jouer sur le mot, ou que la porte de
ses vues en musique ne s'tendait pas au-del du cercle
rtrci qui servait alors de limite l'art musical.
Le quatuor concertant, lorsqu'il est crit pour des
voix, peut tre accompagn par l'orchestre. Quant au
quatuor instrumental, il est ordinairement excut par
les seuls instruments pour lesquels il a t crit Cepen-
dant il peut tre galement accompagn par l'orchestre,
et s'il est conu dans des proportions instrumentales
brillantes, le morceau prend le nom de symphonie con-
certante.
Il n'y a pas longtemps que les quatuors et autres
morceaux d'ensemble sont usits en France. Les opras
de Gluck ne prsentent mme, l'exception des chur?,
que du rcitatif, des airs, quelques duos, et presque ja-
mais des trios et des morceaux d'ensemble. C'est encore
l'Italie que nous devons l'introduction de cette partie
si intressante de l'art.
Le premier trio qui parut fut entendu dans un opra
bouffon, compos par Logroscino et excut en J750. Le
succs n'eut rien de bien remarquable, mais la route
tait indique
;
une nouvelle carrire s'ouvrait au gnie,
et depuis Piccinni jusqu' Paisiello et Mozart, les pro-
grs lurent immenses. On se souvient encore de l'en-
thousiasme qu'excita le fameux septuor du Roi Thodore
de Paisiello, et les quatuors, sextuors et finales des diff-
rents opras de Mozart, Spontini et Weber montrent
quel point il est possible de rpandre du charme et de
l'intrt sur les scnes lyriques plusieurs personnages.
L'illustre Haydn, qu'on a si justement surnomm le
pre de la symphonie, peut aussi juste titre tre regard
comme le crateur du quatuor instrumental. Aprs lui
400 QUE
Mozart, Beethoven, Mendelssohm, ont dignement
conti-
nu l'uvre qu'il avait commence, et port ce genre de
musique un point de perfection qui ne laisse rien d-
sirer.
Querelles musicales. Les querelles musicales les plus
clbres sont celles qui eurent lieu dans le sicle dernier
entre les Lullistes et les Ramistes, et plus tard par les
Gluckistes et les Piccinnistes. Nos lecteurs nous sauront
gr sans doute d'entrer dans quelques dtails sur ce
dernier sujet.
Gluck, en venant en France avec son lphignie en Au-
lide d'abord, ensuite avec Orjjhe'e arrang pour notre
thtre, tout en nous apportant de nouvelles jouissances,
flattait aussi notre orgueil national
;
il rendait son clata
un titre presque effac de notre gloire.
Iphignie en Aidide fut reprsente en 1774. Le suc-
cs croissait de reprsentation en reprsentation, et les
critiques croissaient aussi tous les jours. Ces critiques
n'taient pas seulement celles de l'envie, c'taient celles
de dix douze hommes de lettres, dont les jugements
avaient beaucoup d'autorit, et qui entranrent leur
suite une foule d'amateurs et de dilettanti. Ces hommes
ne pouvaient plus concevoir une autre musique que celle
dont ils avaient got le charme dans leur jeunesse;
d'autres affirmaient que Piccinni avait atteint les der-
nires limites de l'art, et criaient : Italiam, Italiam,
comme si Gluck tait un barbare, parce qu'il tait Alle-
mand, parce qu'il sacrifiait de vains ornements l'ex-
pression vraie des paroles et de la situation.
C'tait un avantage et non un inconvnient pour
Gluck d'tre n dans cette Allemagne, organise et pas-
sionne pour tous les genres de musique, et qui a donn
l'Europe de savantes leons et d'clatants modles de
l'harmonie la plus belie et la plus varie. C'en fut un
autre pour lui de s'tre transport tout jeune en Italie,
cette vraie patrie de la musique et o florissaient alors de
clbres coles et d'excellents matres. 11 tudia Milan,
sous la direction de J.-B. San-Martini, compositeur ha-
bile et fcond. C'est Milan qu'en 1741, Gluck lit re-
prsenter Artc erse, son premier opra.
La naissance, la formation et l'entier dveloppement
des vues musicales de Gluck furent prcisment les r-
sultats de ces croisements de tous les pays. Jl tait na-
turel ceux qui avaient concouru crer ou rappro-
QUE
401
cher du moins les lments du gnie de Gluck, placs
une grande distance, de prendre un intrt plus parti-
culier et plus vit' ses crations; et lorsqu'ils eurent' en-
tendu sa musique avec des transports de plaisir, il leur
tait naturel d'en parler avec des transports d'enthou-
siasme. D'anciennes habitudes, les prventions qu'elles
donnent, les prjugs qu'elles tablissent, pouvaient seuls
faire penser que des compositeurs ns en Italie avaient
le privilge exclusif de nous donner une musique qui
convnt notre langue, nos oreilles et notre scne
lyrique.
"
Les premiers s'appuyaient sur l'autorit des faits, si
puissants sur nos jugements, et sur celle des impressions,
si puissantes sur notre me. Les seconds n'avaient pour
appui que des doctrines et des ouvrages que l'es Piccinni
et les Sacchini pouvaient faire un jour, mais qu'ils
n'avaient pas faits encore. Ces derniers, tous crivains
renomms, taient en grand nombre. Parmi les premiers,
l'abb Arnaud et Suard parurent longtemps seuls dans
la lice. Mais le plus habile dfenseur de la musique de
Gluck l'ut, sans aucun doute, l'auteur anonyme d'une
srie d'articles qui parurent dans la Gazette de Paris,
sous ce titre : Petites lettres, par un habitant de Vav.gi-
rard. Rien de plus solide et de plus piquant que cette
correspondance, qu'on attribue gnralement Diderot.
Depuis les dix-huit petites lettres de Pascal, qui firent
une si glorieuse rvolution dans la langue, dans la plai-
santerie et dans l'loquence franaises, jamais petites
lettres n'ont t, depuis la premire, attendues avec plus
d'impatience
;
on courait de toutes parts aux cafs de Foy
et du Caveau , et l'on en faisait des lectures publiques
;
on
s'touffait pour mieux entendre
;
on battait des mains
avec des transports et avec des bravos.
Pendant que tout ceci se passait, des scnes d'un ca-
ractre plus grave et plus srieux avaient lieu dans la
salle de l'Acadmie royale de Musique
;
on applaudissait
avec fureur, on sifflait avec acharnement, et les jeunes
gens, les vieillards mme en venaient quelquefois aux
mains.
Queue. On distingue dans les notes la tte et la queue ;
la tte est le corps mme de la note
;
la queue est le trait
perpendiculaire qui lient la tte, et qui monte ou qui
descend indiffremment travers la porte. Dans le
plain-chant, la plupart des notes n'ont pas de queue
;
402 QUI
mais dans la musique figure moderne, il n'y a que la
ronde qui n'en ait point. Dans la composition de la fu-
gue on appelle queue les notes ajoutes un sujet pour
amener sa rponse. On appelle aussi queue, ce que les
Italiens nomment coda, pour dsigner la fin, la prorai-
son d'un morceau.
Queue de violon, de violoncelle. C'est la partie
de ces instruments laquelle les cordes sont atta-
ches, tandis qu'elles sont roules de l'autre ct des
chevilles.
Quidantus (Jean). Luthier, chef de l'cole des luthiers
de Florence, travailla d'abord Boulogne, en 4720. On
reconnat ses instruments une couche paisse de
vernis.
QUINQUATRIA MINORA OU QuiNQUARTUS MINUSCULE.
Nom que l'on donnait, Rome, la fte des joueurs de
flte, pendant laquelle on se promenait dans les rues de
la ville, vtu d'un costume particulier ce jour, pour
aller ensuite se runir au temple de Minerve.
Quinque. Nom qu'on donnait autrefois en France a un
morceau de chant cinq voix
;
aujourd'hui on dit quin-
tetto ou quintette.
Quinte. La seconde des consonnances dans l'ordre de
leur gnration. La quinte est une consonnance parfaite
;
son rapport est de 2 3
;
elle est compose de quatre de-
grs diatoniques, arrivant au cinquime son, d'o lui
vient son nom de quinte. Son intervalle est de trois tons
et demi.
On compte trois espces de quintes, i la quinte juste
ou inaltre, ou simplement quinte
;
2
la quinte dimi-
nue, que l'on appelait autrefois fausse quinte
;
cet inter-
valle est compos de deux tons et deux demi-tons; 3 la
quinte augmente
;
cet intervalle est compos de trois
tons et deux demi-tons.
Quintes (leur influence sur la voix). Une des tudes
les plus essentielles pour assouplir la voix est celle des
quintes. Lorsque l'lve peut l'excuter d'une manire
correcte avec toute l'nergie et la nettet convenables, il
faut doubler la vitesse du mouvement, et faire dire trois
quintes avec la mme respiration.
Outre les rsultats que cet exercice doit faire obtenir
quand il est bien dirig, il en est un qui concourt d'une
manire bien essentielle au mcanisme vocal. C'est la
puissance de l'inspiration. Comme toutes les autres par-
QUI 403
ties de l'organisation humaine, les poumons sont suscep-
tibles d'habitudes, et, par consquent, soumis .une
sorte d'ducation. Les plongeurs qui se tiennent sous
l'eau peudant plusieurs minutes sont, on le conoit, des
hommes dont l'appareil respiratoire est dou d'une
grande vigueur; mais, quelle que soit l'excellence deleurs
organes, il ne faut pas croire que ces hommes arrivent
tout naturellement suspendre les mouvements de
leurs poumons pendant un intervalle de temps qui pa-
ratrait fabuleux ceux qui n'en ont pas t tmoins
;
ils
ne parviennent au dernier degr de leur art qu'au moyen
d'exercices gradus, par lesquels ils obtiennent peu peu
de leurs poumons toute la puissance inspiratrice dont ils
sont susceptibles.
Il est juste de dire que les vigoureux poumons d'un
individu arriv tout son dveloppement organique,
n'ont besoin d'aucune extension pour suffire la lon-
gueur d'expiration que ncessite l'excution des trois
quintes dont nous venons de parler. Mais chez les sujets
moins dvelopps ou moins favoriss par la nature,
l'appareil respiratoire peut paratre au premier abord
dfectueux, sans qu'il le soit en effet. 11 faut les habituer
peu peu donner leurs poumons l'extension normale
de toutes leurs facults. Pour arriver ce but, la tenue
d'une note serait insuffisante
;
il faut une succession de
sons, telle que les quintes ascendantes ou descendantes.
Mais cet exercice exige de la part du matre une pru-
dence qui est en quelque sorte du domaine de la mde-
cine
;
car il
y
a dans la nature humaine des limites qu'on
ne peut franchir sous peine de mort, et qu'il faut cepen-
dant atteindre pour obtenir d'indispensables rsultats.
Le moindre abus, provenant de l'inexprience du matre
et des efforts exagrs de l'lve, peut entraner, mme
dans de bonnes organisations, des dsordres dont le
moindre effet est l'affaiblissement et la perte de la voix.
On voit, au rsum, combien l'tude des quintes est
essentielle, puisque ses rsultats sont d'assouplir la
voix avec une merveilleuse promptitude, de donner au
trait son vritable caractre de nettet et d'nergie,
d'galiser toutes les notes de la voix, et d'habituer les
poumons fournir de longues expirations.
En harmonie , la grammaire musicale dfend la
succession immdiate de deux octaves et de deux quintes
par mouvement direct. Cependant dans une composition
404
QUI
quatre parties, elle peut tolrer quelquefois deux
quintes successives par mouvement contraire
;
mas elle
ne permet deux octaves par mouvement contraire que
dans les morceaux cinq parties ou plus de cinq
;
il
faut, en outre, que ces octaves se trouvent entre les
voix intermdiaires, ou tout au plus entre une voix
extrieure et une voix intermdiaire.
On dfend les deux octaves par mouvement direct,
parce que c'est une pauvret qui n'ajoute rien l'har-
monie. On dfend les quintes, parce quelles produisent
une duret.
Quintette. Morceau de musique compos pour cinq
instruments ou cinq voix , et dont chaque partie est
concertante ou oblige. Les quintettes sont ordinaire-
ment composs d'un allgro ou moderato
;
d'un andanie
d'un menuet ou scherzo, et d'un finale.
Sans parler dans un sens absolu, on peut dire que le
mrite de ce genre de composition consiste autant dans
le charme et la varit de la mlodie que dans l'exposi-
tion, l'arrangement et le dveloppement des ides, la
conception d'un plan droul avec art, et enfin dans
l'intrt d'une instrumentation nuance avec got.
Boccherini a compos un grand nombre de quintettes
trs-remarquables par la navet, la grce et l'origina-
lit du style. Georges Onslow a su se crer, dans le
mme genre, un style et une manire. Reicha a aussi
compos plusieurs quintettes pour flte, haut-bois, cla-
rinette, cor et basson, qui jouissent d'une rputation
bien mrite.
11 est fort difficile de composer un bon quatuor ou un
bon quintette, et tel musicien qui compte au thtre
des succs brillants et mrits, serait fort embarrass
d'en produire un passable. Ce genre de musique exige
des tudes toutes particulires; il a des mlodies et des
tours de phrases qui lui sont propres, des rhythmes
d'accompagnement qui ne conviennent qu' lui, et enfin
des moyens d'expression qui, partout ailleurs, seraient
dpourvus d'nergie.
Quinticlave. Instrument vent, en cuivre, du genre
ophiclde, ayant cinq clefs.
Quinton. Espce de violon, d'une forme plus ramas-
se et plus haute que celle du violon ordinaire.
Quinzime. Double octave. On donne aussi ce nom
un registre de l'orgue.
RAN
405
Quolbet. On entendait autrefois par ce mot des mor-
ceaux de musique d'un caractre comique et trivial.
Ainsi, par exemple, on unissait deux voix, dont l'une
chantait des paroles tout fait diffrentes de celles que
chantait l'autre. Un tel ensemble produisait des jeux de
mots ridicules. Aujourd'ui on donne aussi ce nom un
centon musical.
R
Raban. Espce de timbales dont se servent les
femmes indiennes pour accompagner leur chant.
Racler. Terme de mpris, par lequel on dsigne la
mauvaise manire de jouer d'un instrument, tel que le
violon ou la basse, en faisant crier les cordes sous l'ar-
chet.
Ragleur.
Musicien qui joue avec duret du violon
ou de la basse.
Rallentando. Ce mot signifie qu'on doit aller en
retardant
peu peu la mesure, comme on diminue peu
peu la force des sons dans le diminuendo.
Ramage. On dsigne par ce nom le chant modul des
oiseaux chanteurs, tels que le rossignol, la fauvette, le
serin, etc.
Ramage
se prend en mauvaise part, lorsqu'il s'agit
d'un chanteur qui ne plat pas. C'est en ce sens qu'on
dit : L'ennuyeux ramage de cet homme me fatigue.
Ranz des vaches. C'est un air bucolique, sans art,
grossier quelquefois
,
que les bouviers de la Suisse
jouent avec dlices sur la cornemuse, en menant patre
leurs vaches sur les rochers, o ils sont ns ainsi qu'elles.
Cet air est devenu fameux, europen mme par les effets
sympathiques qu'il exerait sur les montagnards helv-
tiens, au temps de l'ge d'or de l'Helvlie, il
y
a un peu
plus d'un demi-sicle. Dans les rgiments suisses la
solde de la France, sitt que la cornemuse s'enflait pour
jouer cet air, une douce joie brillait dans les yeux de ces
tiers soldats; mais ils n'entendaient pas plutt ses sons
rustiques et si connus que rptrent si souvent les chos
de leurs montagnes, que la patrie, leurs chalets, leurs
13
406 RAT
rochers, leur enfance, leurs surs, leurs vieux pres,
leurs fiances, se refltaient dans leur me avec tant de
vivacit, qu'une mlancolie profonde succdait cette
premire joie: La plupart d'entre eux n'y pouvait rsis-
ter. Les uns dsertaient, d'autres tombaient dans une
langueur incurable, et beaucoup mouraient. Ds lors le
code militaire dfendit de jouer cet air, sous peine de
mort.
Rapport des intervalles. C'est le calcul exact
du degr de distance entre deux sons diffrents, exprim
par des chiffres.
Rapsodes
,
Rapsodies
,
Rapsodistes. Quand les
pomes d'Homre furent rpandus dans la Gx-ce, les
rapsodes, renonant composer eux-mmes, se bor-
nrent chanter les divers pisodes de l'Iliade et de l'O-
dysse. Ils cousaient ses chants l'un la suite de l'autre,
suivant les dsirs de leurs auditeurs. Par exemple, ils
faisaient suivre la colre d'Achille, devenue le premier
chant de l'Iliade, par le combat de Paris et de Mnlas,
qui en forme le troisime. Chacun de ces chants pris
part, s'appelait une rapsodie.
Les rapsodes taient fort recherchs par les Grecs, si
passionns pour les arts et pour les jouissances qu'ils
procurent. On les invitait aux ftes et aux sacrifices
publics, o ils chantaient les pomes d'Orphe, de Mu-
se, d'Hsiode et surtout d'Homre. Les rois et les
princes en avaient leurs gages pour chanter durant les
repas. Ils taient fort soigneux de leurs parures, et ne
se montraient jamais qu'avec de riches habits, quelque-
fois mme, l'imitation des potes, avec une couronne
d'or sur leur tte.
Rasette. Fil de fer qui sert accorder dans les or-
gues les jeux d'anches.
Rasgado. Prlude que les Espagnols excutent en
attaquant successivement toutes les cordes de la guitare
avec le pouce, et en suivant la mesure et le rhythme des
bolros et des seguidillas. Le rasgado est la ritournelle
ordinaire de ces sortes d'airs.
Rats de ballet. Ce sont de petites femmes qui agi-
tent les jambes, qui lvent les bras et font peu prs
quelque chose qui ressemble de la danse. Le rat est
lve de l'cole de danse, et si on l'a ainsi nomm, c'est
probablement parce qu'il est l'enfant de la maison, qu'il
y
vit, qu'il
y
grignote; parce qu'il ronge et gratigne les
RC 407
dcorations, raille et troue les costumes et commet une
foule de dommages inconnus.
Rayanastron. Instrument archet, d'origine in-
dienne, compos d'un cylindre de bois de sycomore
creus de part en part; sur un des cts est tendue une
peau de serpent qui forme la table d'harmonie. Une tige
de bois qui traverse le cylindre forme manche. Il porte
deux cordes.
R. C'est le second degr de notre chelle musicale.
Il porte accord parfait mineur, et s'emploie en harmo-
nie comme second degr de la gamme majeure naturelle
d'ut, ou comme quatrime degr du relatif mineur de
cette mme gamme. Dans ce dernier cas, on lui fait
quelquefois porter l'accord parfait majeur, pour viter
la seconde augmente que ferait sa tierce mineure,
fa
naturel^ avec le sol dise sensible du ton.
R est aussi le nom qu'on donne la troisime corde
du violon et la seconde de l'alto, du violoncelle et de la
contre-basse, parce que dans l'accord ordinaire, ces cordes
sonnent l'unisson ou l'octave de cette mme note.
Rebab. Instrument archet arabe, dont le corps est
form de quatre clisses sur lesquelles sont tendues deux
parchemins qui forment la table et le dos. Le manche
est cylindrique et ne fait qu'une seule pice avec la tte.
Il est garni de deux cordes.
Rebec. Instrument d'une forme peu prs semblable
celle du violon, dont on faisait usage en France dans
le moyen- ge, et qui ne fut abandonn par les mn-
triers qu' la fin du dix-septime sicle. Le rebec tait
mont de trois cordes accordes de quinte en quinte; il
y
avait des dessus, des tailles et des basses de rebec.
L'usage du violon tait interdit tout mntrier non
reu matre dans la corporation des joueurs d'instru-
ments, sous peine de saisie et d'amende.
Rcit. Cette expression a vieilli et n'est plus en usage
aujourd'hui; elle est remplace par le mot italien solo
(seul) qui parait plus convenable, puisque rciter dans
l'ancien langage signifiait chanter ou jouer seul, par op-
position au chur ou la symphonie, qui, comme on
sait, sont excuts par un nombre plus ou moins consi-
drable de concertants.
Rcitant. Celui qui chante un rcit. Ces deux mots
se prennent dans l'ancienne acception du mot rcit.
Rcitatif. Un opra entirement compos d'airs
408
RED
chants sans interruption, nous ennuierait et nous fati-
guerait la seconde scne, malgr le charme, la beaut,
l'expression qui pourraient se trouver runis dans ces
airs; pour remdier ce grave inconvnient, il faut
avoir recours au dialogue parl, ou imaginer un langage
de convention qui tienne le milieu entre la parole ordi-
naire et la parole musicale, un moyen d'union, enfin, qui
fasse disparatre ce qui nous choque dans la transition
immdiate de la parole au chant. Le rcitatif semble
remplir toutes ces conditions. C'est une sorte de dcla-
mation note, soutenue par une basse ou qu'accompagne
l'orchestre, et contre laquelle il n'y aurait rien dire si
elle n'tait quelquefois, trop souvent mme, monotone
dans son accentuation, et pauvre dans ses formes mu-
sicales, dont les combinaisons sont extrmement res-
treintes. Tel qu'il est encore aujourd'hui, le rcitatif
offre cependant quelquefois des passages remarquables,
surtout lorsqu'il est entreml de traits de symphonie
qui lui donnent de l'expression et lui impriment ce ca-
ractre nergique et vrai qui, seul, le rend supportable.
Le rcitatif, cependant, n'exclut pas l'inspiration, tant
s'en faut, et il
y
a de magnifiques rcitatifs dans les
chefs-d'uvre des grands matres. Ceux de Gluck se-
ront toujours cits, ceux (TOtello, de Guillaume Tell
sont admirables.
Il
y
a deux espces de rcitatifs, celui qui n'est accom-
pagn que par la basse ou le piano, quelquefois par tous
les deux ensemble, et qu'on appelle rcitatif libre ou
simple, et celui qui est accompagn par l'orchestre, et
dont les intervalles de repos sont remplis par des traits
de symphonie. Il prend alors le nom de rcitatif oblig.
Les Italiens faisaient autrefois usage du premier, ils ne
l'emploient plus aujourd'hui que dans les opras bouffes
;
le second est plus particulirement usit dans les trag-
dies lyriques, les drames et les opras d'un caractre
mixte, tels que nos opras comiques franais. Tout le
mrite du rcitatif rside dans l'expression et l'nergie
de l'accentuation.
Rciter. Chanter un rcit.
Redoublement. C'est dans l'harmonie l'emploi simul-
tan du mme son fait par deux parties diffrentes (Voyez
le mot Doublement).
Redowa. C'est une danse trois temps
;
elle a beau-
coup d'analogie avec la Mazurka, et elle en a les mmes
RG 409
proportions. C'est sur le troisime temps que doit porter
la mlodie.
Reductio modi. Autrefois, lorsqu'on composait un
morceau de musique dans un ton transpos, et qu'on vou-
lait examiner s'il tait trait conformment son ton
originaire, on le transposait de nouveau dans son ton
primitif. Ce procd s'appelait reductio modi.
Rduction. Suite de notes qui descendent diatonique-
ment.
Rduire. C'est arranger une composition un ou
plusieurs instruments d'une nature diffrente, comme
rduire un concerto pour piano. 11 se dit principalement
de la rduction d'une partition pour le piano, ou d'un
morceau plusieurs voix, pour une seule voix.
Rel. Quelques matres de chant donnent le nom de
sons rels ceux qui sont produits par le registre de la
voix de poitrine, et sont directement lancs par toute la
force du souffle; ils appellent, par opposition, sons de
fausset ceux de la voix de tte, attendu qu'tant forms
par la partie suprieure de la trache et ne pouvant rece-
voir le mme volume d'air, ils sont maigres et sans force.
Dans une mlodie, on appelle notes relles, les notes
de cette mlodie faisant partie des accords qui l'accom-
pagnent.
On appelle dans une composition plusieurs voix,
parties relles, les parties qui marchent sans former
entre elles plusieurs unissons ou octaves de suite, c'est-
-dire qui ont chacune leur allure bien distincte et aussi
lgante que possible : on dit d'une fugue qu'elle est,
par exemple, six, huit parties relles pour dire qu'il
n'y a pas de partie oiseuse, et purement de remplissage.
Refrain. Terminaison d'un couplet ou d'un air de
vaudeville, qu'on rpte ordinairement deux fois, et
qu'on chante quelquefois en chur.
Rgale. Jeu d'anche, le plus ancien de tous les jeux
d'orgue. Il n'est plus employ dans les orgues modernes.
Rgiment (Musique de). La musique a t regarde
dans tous les temps comme un puissant moyen d'action
sur les sentiments belliqueux. Quoi de plus propre, en
effet, seconder l'lan, chauffer l'enthousiasme du
guerrier? Non-seulement elle l'lectrise, l'enflamme et
lui fait affronter les prils, mais elle le dlasse des fti-
410 RG
gus de la guerre, ou l'aide supporter patiemment et
avec courage les longues marches, les travaux les plus
pnibles.
On sait combien est grande, sous ce rapport, l'in-
fluence du rhythme. Le marchal de Saxe voulait que
l'on fit travailler les soldats au son du tambour et des
instruments en cadence.
Depuis longtemps, en Europe, la musique de rgiment
a pris une grande extension, et il n'y a pas aujourd'hui
un peuple qui ne possde dans ses armes des corps de
musique militaire. C'est en Italie et en Allemagne
qu'elle reut d'abord un accroissement remarquable.
Pierre-le-Grand , s'occupant de l'organisation de ses
armes de terre et de mer, fit venir en Russie des trom-
pettes et des timbales, des hautbois et des bassons. A
chaque rgiment il affecta un corps de musique dirig
par un chef, qui, en dehors de ses fonctions, tait tenu
de choisir parmi les enfants de troupe un certain nombre
de sujets, auxquels il devait enseigner un des instruments
dont se composait alors la musique militaire. Au moyen
de cette disposition, tous les rgiments russes furent en
peu d'annes pourvus de musiciens recruts dans l'arme
elle-mme.
Les anciennes musiques des rgiments franais se sont
accrues successivement d'emprunts faits aux milices
trangres. On devait l'arigot ou fifre aux Suisses, le
tambour et le basson aux Italiens, la trompette aux
Maures de la pninsule, les cymbales et la grosse caisse
aux Orientaux
;
la cornemuse vient des Anglais, la cla-
rinette et le hautbois sont une importation de l'Alle-
magne. Toutefois il ne parat pas qu'en empruntant aux
Allemands quelques-uns de leurs instruments, les Fran-
ais leur aient pris en mme temps leur manire d'en
jouer; car Jean-Jacques Rousseau nous apprend que,
clans la guerre de 1756, les paysans autrichiens et bava-
rois, ne pouvant croire que des troupes rgles eussent
des instruments si faux et si dtestables, prirent tous les
vieux corps pour de nouvelles leves qu'ils commen-
crent mpriser.
De nos jours, o l'art musical est parvenu en France
un si haut degr, les musiques militaires des rgi-
ments d'infanterie sont restes dans un tat d'infriorit
en prsence de celles d'Allemagne, de Russie, d'Angle-
terre et d'Italie. Cependant de notables amliorations
RG 411
ont t introduites dans l'organisation de la musique de
ces rgiments
;
car la suite des nouvelles adjonctions
d'instruments qui eurent lieu soue; l'Empire et la Res-
tauration, le nombre des musicien?, qui en 1807 tait
de huit seulement, fut port successivement douze et
vingt-sept.
Nous devons dire que, grce l'ducation donne au
Conservatoire de Musique de Paris, de grands progrs
se sont accomplis dans cette branche de l'art. Mainte-
nant, le chef de musique a rang d'officier, le sous-chef ce
lui d'adjudant. La musique des rgiments d'infanterie,
outre ces chefs, se compose de 5 musiciens de premire
classe, rang de sergent- majors; 8 de seconde classe,
rang de sergents
;
10 de troisime classe, rang de capo-
raux, et 15 lves ayant rang de musiciens de quatrime
classe, en tout 40. Pour les rgiments de cavalerie, la
musique se compose de 4 musiciens de premire classe;
8 de deuxime; 8 de troisime, et 7 de quatrime, for-
mant un total de 27 musiciens.
Registre. Diversit du timbre dans la voix du chan-
teur. Une voix de dessus a trois registres
;
celle de tnor
en a deux, et les voix de basse et contre-alto n'ont qu'un
seul registre.
Registre d'orgue. Les registres sont des rgles de
bois que l'organiste tire ou pousse, et qui font agir
certains mouvements pour ouvrir et fermer les jeux
de l'orgue, selon qu'il prouve le besoin de les faire
chanter ou de les rduire au silence. La poigne par la-
quelle l'organiste ouvre ou ferme un registre s'appelle
tirant.
Rgle. Prescription ou prcepte auquel on doit con-
former la composition et l'excution.
Rgle d'octave. Formule d'harmonie tablie pour
l'accompagnement des gammes , majeure et mineure,
tant en montant qu'en descendant, pour faciliter l'ex-
cution de la basse non chiffre celui qui joue de la basse
continue, et pour simplifier l'art ordinaire de chiffrer
l'harmonie. (Voyez Octave.)
Rgleur. Ouvrier qui trace les portes sur le papier
pour crire la musique.
Rgulier. Tout ce qui est renferm dans les rgles
et dans de justes limites, ou qui suit une progression
uniforme. C'est pourquoi on appelle cadence rgulire
celle qui s'accomplit selon les formules usites
;
marche
412 REP
rgulire, une progression de basse portant des accords
se succdant par une marche identique; imitation rgu-
lire, celle dont les parties s'imitent bien, etc.
R la. Dsigne dans l'ancien solfge la nuance de ces
syllabes sur le son r ou la.
Relation. Rapport entre un son qui vient d'tre en-
tendu dans une partie vocale et instrumentale, et un
autre son qu'on entend actuellement dans une autre.
Lorsque ces deux sons concourent laisser dans l'oreille
la sensation d'une consonnance exacte, la relation est
bonne. Quand il rsulte de leur rapport une conson-
nance altre, la relation est fausse; les fausses relations
sont proscrites dans la composition scolastique.
Relation non harmonique. Les anciens appelaient
de ce nom une mauvaise succession de sons.
Rentre. Retour du sujet, aprs quelques pauses de
silence, dans une fugue, une imitation ou dans quelque
autre endroit. Toute les fois qu'une partie a gard le si-
lence pendant une ou plusieurs phrases, elle forme sa
rentre soit qu'elle reproduise le sujet ou non.
Renversement. Un accord est renvers quand sa
note fondamentale n'est pas la basse. L'accord parfait
a deux renversements, et l'accord de dominante, trois.
Les renversements et leurs positions ont tous une ex-
pression particulire; leur choix est dtermin parles
exigences de la pense, par celle du mouvement naturel
et facile des parties, et par la pense du compositeur.
Rpercussion. C'est la premire entre de chacune
des parties de la fugue, soit qu'elles fassent entendre le
sujet, soit qu'elles contiennent la rponse.
Rplique. Signifie octave, quand il s'agit d'un son
redoubl, et reprise du sujet, quand on parle d'une
fugue.
On nomme galement rplique la rptition que fait
un instrument d'une phrase de chant dj excute par
un autre instrument ou par une voix pour avertir l'ex-
cutant du moment de sa rentre.
Rpons. Espce d'antienne redouble qu'on chante
l'glise aprs les leons de matines, et qui finit en
manire de rondeau, par une reprise appele rclame.
Rponse. C'est, dans une fugue, la rentre du sujet
par une autre partie. Si le sujet est dans le ton de' la
tonique, la rponse doit tre dans le ton de la dominante
et vice versa
;
dans une contre-fugue, c'est la rentre du
RS 413
sujet qu'on vient d'entendre , aprs l'avoir renvers.
(Voyez le mot Fugue).
Repos. C'est la terminaison de la phrase, terminaison
sur laquelle le chant se repose plus ou moins parfaite-
ment. Le repos ne peut s'tablir que par une cadence
sur la tonique ou sur la dominante. Si la cadence est
vite, il ne peut
y
avoir de vrai repos, car il est impos-
sible l'oreille de se reposer sur une dissonance. On voit
par l qu'il
y
a prcisment autant d'espces de repos
que de sortes de cadences pleines. Ces diffrents repos
produisent dans la musique l'effet de la ponctuation dans
le discours.
Reprise. Au sens propre, c'est toute partie d'un
morceau de musique qui doit tre joue ou chante deux
fois. Mais gnralement on applique cette dnomination
la premire ainsi qu' la seconde division d'un mor-
ceau, quoique cette dernire ne s'excute presque jamais
qu'une fois. Dans un sens plus restreint, ou entend
quelquefois par reprise la seconde partie seulement.
C'est dans ce sens qu'on dit : La reprise de cette ouver-
ture est mieux faite que la premire partie.
Reprise d'un opra. Reprsentation d'un opra qu'on
donne aprs tre rest plus ou moins longtemps sans
tre jou.
Requiem. Prire que l'Eglise fail pour les morts, et
dont l'introt commence par ce mot. Il
y
a de sublimes
musiques composes sur ce thme, par Jomelli, Mozart,
Cherubini.
R sol. Dsignait dans l'ancien solfge le changement
de ces deux syllabes sur le son r ou sol.
Rsolution. La rsolution consiste en ce que la dis-
sonance frappe descend quelquefois, mais rarement, et
monte d'un degr conjoint sur la consonnance voisine.
On dit aussi qu'un accord se rsout sur un autre, la
septime dominante se rsout sur la tonique ou sur la
su-dominante, ou sur une autre septime, etc. (Voyez
Dissonance et Accords (des).
Rsonnance. Prolongement ou rflexion du son
,
soit.
par les vibrations continues des cordes d'un instru-
ment, soit par les parois d'un corps sonore, soit par la
collision de l'air renferm dans un instrument vent.
Rsonnance multiple. Proprit que possde un son
d'en faire entendre plusieurs autres. On dit rsonnance
J3.
414 RHY
sous-multiple quand deux sons en produisent un troi-
sime.
Respiration. C'est l'action que font les poumons pour
attirer ou repousser l'air. Cette action se divise en deux
mouvements alternatifs, Vaspiration et Vexpiration.
Dans l'aspiration, les poumons se dilatent pour intro-
duire l'air extrieur dans la poitrine, et dans l'expira-
tion, ils s'affaisent pour le faire sortir.
On ne saurait trop recommander aux lves de s'oc-
cuper de la respiration. Elle est tout pour le chant. Sans
un grand volume d'air, qu'on doit savoir comprimer et
mnager longtemps avec adresse, il n'est point de force
ni de timbre dans la voix
;
de plus, sans cette facult, il
n'est gure possible de bien phraser un chant.
Retard. On retarde, dans un accord, une note con-
sonnante par une note prise dans l'accord, prcdent.
Le retard peut tre aussi purement mlodique, et ne pas
figurer dans l'harmonie sur laquelle se droule le chant.
L'art des retards est celui de la coquetterie en musique,
ils ont pour objet de faire dsirer un son dont l'appari-
tion satisfait l'oreille.
Le retard est l'empitement du lev sur une partie du
frapp
;
presque tous les retards sont produits par
l'effet des prolongations.
Retranchement de notes dans les accords. Au-
cune loi n'oblige d'crire toutes les notes d'un accord :
on peut donc en retrancher quelques-unes
;
grce l'en-
chanement des accords et au sentiment de la tonalit,
un accord incomplet possde, aux yeux des habiles, la
physionomie et la signification de l'accord complet. Il
les possde tout entires, malgr leur ralit physique
moins accuse et moins saillante.
Lorsqu'on retranche une note de l'accord pariait, on
conserve ordinairement la tierce de la tonique, parce
qu'elle indique le mode et caractrise l'accord. Dans un
duo, on conserve habituellement les notes qui sont la
tierce ou la suite l'une de l'autre, comme ut mi, mi
sol, mi ut, sol mi. Les notes de l'accord de dominante
peuvent toutes se retrancher successivement, et toutes
s'associer les unes avec les autres : chacun de ces grou-
pes possde une nuance particulire d'expression. Les
anciens compositeurs supprimaient souvent la tierce
dans l'accord final.
Rhythme. Le rhythme n'est autre chose quelasym-
RIG 415
trie applique au mouvement, la diffrence de vitesse
ou de lenteur modifie d'une manire symtrique, et
dont les formes se reproduisent certains intervalles
disposs dans un ordre assez rgulier pour former une
sorte de mesure cadence. Tout mouvement qui succde
ainsi nous affecte dj agrablement, mme sans le
secours d'aucune espce de sonorit musicale. Quel
charme n'aura pas ce mme mouvement, si nous appli-
quons chacun des temps qui le composent des sons
choisis, et dont la succession soit telle qu'elle flatte
l'oreille ! nous jouirons alors d'une vritable mlodie,
au lieu de la psalmodie vague et monotone que nous
laisserait l'absence du mouvement rhythmique.
On donne aussi le nom de rhythme en musique,
certaines formules ou dessins d'accompagnement qui se
reproduisent symtriquement pendant un certain espace
de temps.
Rhythmique. Une musique rhythmique est celle qui
est ordonne avec une parfaite symtrie dans les mem-
bres dont se composent ses priodes. Un accompagne-
ment rhythmique est celui dans lequel le compositeur
fait entendre constamment le groupe uniforme
,
l'ar-
pge adopt, tandis que l'harmonie varie ses accords.
Gluck, qu'on doit souvent citer pour le dessin des
accompagnements, nous a donn les premiers modles
dans le genre rhythmique.
Rhythmomtre. Machine destins indiquer la divi-
sion des temps de la musique , elle fut invente Paris,
en
1782,
par DucJos, horloger, et employe l'Ecole
royale de chant dont Gossec tait alors directeur.
Rhythmope. Partie scientifique de la mlodie qui
apprend l'arrangement des parties mlodiques relative-
ment leur extension, afin qu'elles puissent avoir entre
elles un rapport agrable.
Ricercata. Est une espce de fugue dans laquelle on
propose ]a premire moiti du sujet, comme dans la
fugue ordinaire, mais o la seconde moiti se travaille
en inversion simple ou stricte.
Ricergato. En italien signifie recherch. On donne ce
nom tout genre de composition o sont employes les
recherches du dessin musical. Mais on l'applique plus
particulirement aux compositions madrigalesques, qui,
outre les recherches du dessin, offrent encore celles du
416
ROL
got et de l'expression. L'cole italienne possde une
grande quantit d'ouvrages en ce genre.
Rigaudon. Sorte de danse dont l'air, imagin par un
nomm Rigaud est deux temps, d'un mouvement gai,
et se divise ordinairement en deux reprises phrases de
quatre en quatre mesures, et commenant par la der-
nire note du second temps.
Rinforzando, en renforant. C'est passer du piano
au fort, et du fort au trs-fort, non tout d'un coup,
mais par une gradation continue, en enflant et augmen-
tant les sons, soit sur une tenue, soit sur une suite de
notes, jusqu' ce qu'ayant atteint le point qui sert de
terme au renforc, l'on reprenne ensuite le jeu ordi-
naire.
Le rinforzando produit le mme effet que le crescendo
;
mais son emploi est diffrent. On se sert plus particu-
lirement de celui-ci dans les grandes priodes, tandis
que le rinforzando ne s'emploie que pour de petits
groupes de notes, et mme pour une note seule.
Ritardando, en retardant. (Voyez Rallentando).
Ritournelle. De l'italien ritornello, petit retour,
parce que autrefois l'accompagnement se bornait 5 rp-
ter la dernire phrase du chanteur. La ritournelle a
acquis avec le temps un plus haut degr d'importance
;
c'est aujourd'hui une sorte de prlude instrumental, un
trait de symphonie plus ou moins dvelopp, qui annonce
le dbut d'un chant vocal, ou remplit les repos et les
silences que dans toute musique bien sentie le composi-
teur a su mnager la voix
;
ou bien encore elle com-
plte d'une manire brillante, expressive ou piquante le
morceau, aprs que la voix a cess de se faire entendre.
Les ritournelles sont d'un effet admirable dans la musi-
que dramatique
;
elles expriment souvent les affections
de l'me avec bien plus de force et d'nergie que la
parole. Mais c'est surtout dans les airs dclams et le
rcitatif qu'elles montrent jusqu' quel degr de puis-
sance elles peuvent atteindre, en traduisant merveilleu-
sement la pantomime, le jeu de physionomie, et mme
jusqu'aux regards de l'acteur, ces moments suprmes
d'une scne pathtique o la- parole devient impuissante
exprimer les motions de l'me.
Rococo se dit en gnral de toute musique vieille, et
hors de mode.
Rle. Le papier spar qui contient la musique que
ROM 417
doit excuter un concertant, et qui s'appelle partie dans
un concert, s'appelle rle l'Opra. Ainsi on doit dis-
tribuer une partie chaque musicien, et un rle a
chaque acteur.
Rle signifie tout ce que doit chanter ou rciter un
acteur dans une pice de thtre.
Romains (de la Musique chez les), Rome, quelque
austres que fussent ses lois, reconnut, mme ds son
berceau, le pouvoir de la musique
;
mais elle consacra
ses naissantes institutions dans cet art son dieu favori,
Mars. Le plus pacifique de ses rois, celui qu'on doit
regarder comme son lgislateur religieux
,
Numa
,
ordonna que les prtres de ce dieu chanteraient, en por-
tant en procession Vancile, ou le bouclier sacr tomb
du ciel pour servir d'gide la ville ternelle. Plus tard,
on voit le Napolitain Andronicus, affranchi de Livius
Salinator, composer, pour apaiser les dieux irrits
contre les Romains, un hymne qui fut solennellement
chant par un chur de jeunes vierges, dont la beaut,
dit un historien, ajoutait au charme de la posie et del
musique.
Les jeux scniques furent institus Rome l'instar
de ceux de la Grce, et ils eurent pour cause la religion.
La population romaine, dvore par une peste sous le
consulat de Sulpicius Pelicus et de Licinius Stolon, eut
recours des prires, des sacrifices et des crmonies
extraordinaires pour flchir l'inclmence des dieux. Elle
n'avait point de chanteurs
;
elle en fit venir de l'Etrurie
pour tablir des ftes funbres. L'histoire ne nous dit
point si ces ftes apaiseront le couroux des dieux, et si
on leur dut la cessation du terrible flau
;
mais ce qu'elle
ne nous laisse pas ignorer, c'est que la jeunesse romaine
gota beaucoup ces jeux, qui taient scniques, puisque
ceux qui
y
figuraient se montraient en public sur un
thtre, et qu'ils reprsentaient des pices qui furent
considres comme satiriques, cause des vrits sou-
vent amres que renfermaient les vers qa'on
y
dbitait,
et dont l'harmonie tait soutenue par les sons des fltes
et des lyres.
Quelques annes aprs, sous le consulat d'un des des-
cendants de Paul Emile, on voit la musique, admise
jusque-l dans Rome comme une simple trangre,
laquelle, en rcompense de ses talents, on accorde l'hos-
pitalit, acqurir enfin les nobles droits de cit dans la
418 ROM
ville ternelle. Ce fut, en effet, ds ce moment, qu'on
l'appela l'honneur de clbrer la naissance, le mariage
et mme la mort des matres du monde
;
elle vint mler
sa joie la gaiet de leurs festins, donner plus d'clat
leurs triomphes, et prter le charme de la mlodie
leurs funrailles.
Enfin parurent les jours si beaux pour les arts, o
commena le rgne d'Auguste. Avant ce grand vne-
ment, il venait de s'en passer un non moins important,
l'assassinat de Jules Csar, suivi de ses funrailles si
remarquables par la douleur du peuple et l'artificieux et
loquent discours d'Antoine. Ce fut dans cette circons-
tance qu'un nombre considrable de musiciens, attachs
au dictateur par leur emploi et par l'admiration qu'ins-
piraient ses talents et son gnie, jetrent', aprs s'en
tre servis pendant les funrailles, leurs instruments
dans le bcher dont les flammes venaient de consumer
les restes d'un grand homme, comme si, aprs avoir
clbr sa gloire et ses triomphes, ces organes de la
mlodie ne devaient plus avoir aucun autre emploi.
Sous le rgne d'Auguste, Rome ordonna que le
pome qu'Horace avait compos en l'honneur de Diane
serait chant par deux churs, l'un de jeunes filles,
l'autre de jeunes garons, tous fils de patriciens. Les
beaux vers de l'hritier de la lyre de Pindare furent
embellis par une musique dont on ignore les auteurs.
Mais cette circonstance montre que cet art, tendant son
empire sur le peuple romain, et suivant les progrs de
la civilisation et du luxe, allait jouir encore de plus
d'honneur sous les empereurs que pendant la rpu-
blique.
Sous le rgne de Tibre, la musique dut ncessaire-
ment tre atteinte de ce marasme qui paralyse tous les
arts sous un tyran
;
et cependant, sous Caligula, digne
hritier de cet empereur, elle semble s'veiller de sa
longue lthargie. C'est que ce prince avait pour cet art
un got trs-prononc, et presque une passion. Caligula
aimait la musique autant qu'il aimait le sang, et cette
runion dans un mme homme d'un got aimable et
d'une fureur sanguinaire n'est pas, de tous les mystres
de l'esprit humain, le moins difficile expliquer.
Nron cultiva lui-mme la musique en artiste con-
somm
;
il consacrait une partie de son temps l'exer-
cice de son art favori. Tous les jours, s'enfeimant avec
ROM 419
Terpanum, le joueur de flte et de cythare le plus
renomm qu'i)
y
et alors, il prenait des leons de chant
qui se prolongeaient jusque dans la nuit. Quoique sa
voix fut grle et voile, il fit de tels progrs, que dans
la troisime anne de son rgne il ne balana point
chanter en public. Il dbuta sur le thtre de Naples, et
y
acquit tant de rputation, que des musiciens accou-
rurent de toutes les contres pour l'entendre et admirer
son talent. Il en retint cinq mille, qui, ds ce moment,
restrent attachs son service. Il leur donna un costume
uniforme, et leur apprit mme, chose incroyable, si
Sutone ne l'attestait, de quelle manire il entendait
tre applaudi. Le peuple romain le pria un jour de chan-
ter dans une des rues de Rome o il passait, et Nron,
qui lui aurait refus la vie de Trasias, s'il la lui avait
demande, ne refusa point de lui faire entendre sa voix
divine. Des applaudissements vifs et prolongs furent
le prix de cette complaisance inoue. Ds ce moment, le
matre du monde se mit lui-mme au rang des com-
diens, et accepta sa part des rtributions' publiques des-
tines payer leur talent. Non content des applaudisse-
ments donns sa voix comme chanteur, il brigua les
suffrages du public comme compositeur
;
il voulait trai-
ter le sujet de la prise de Troie, et l'on prtend mme
qu'il fit mettre le feu Rome, afin de pouvoir imiter
avec plus de vrit les voix et les cris dchirants des
victimes de l'incendie. C'est l'aspect du plus affreux
tableau que puissent contempler les yeux de l'homme,
et qui, pour lui, n'tait qu'un brillant" modle, qu'il eut,
dit-on, le plaisir en jouant sur sa flte, de composer ce
qu'on appelle d'aprs nature.
A la mort de Nron, le peuple romain, dont l'irrita-
tion tait extrme, prtendit mettre au rang des com-
plices de cet empereur la musique, et, comme telle, la
bannit de Rome avec tous les musiciens. Ainsi proscrit,
l'art musical se rfugia au sein *de l'glise naissante,
qui l'pura en lui donnant un asile et en simplifiant sa
notation.
Romance. Des milliers, des myriades de pices de ce
genre ont t fabriques et livres l'apptit glouton
des amateurs.
Une romance, que la mode porta sur son aile lgre,
a commenc la rputation de Boeldieu
;
et qui n'a senti
son cur palpiter en coutant, en chantant les jolies
420 RON
romances : S'il est vrai que d'tre deux
;
Bouton de
rose, de Pradher
;
Je t'aime tant, de Gart
;
Te bien
aimer, ma chre Zlie, de Plantade
;
Un jeune Trovs-
badour, de Dalvimare; Charmant ruisseau, de Dom-
nich; Partant pour la Syrie, de la reine Hortense
;
La
Suissesse au bord du lac, de Goul
;
Fleuve du Tage, de
Pollet
;
et de nos jours, on peut citer quelques charmantes
compositions de ce genre, de M
lle
Losa Puget, et de
MM. Th.-Labarre, Grisar, Masini, Glapisson, Monpou,
Henrion, P. Brat.
Le nom de romance est bien ancien en France
;
on
l'avait abandonn pendant un sicle. On appelait bru-
nettes les chansons rimes sur un sujet plein de ten-
dresse et de sentiment. Dans les anciens recueils de
Ballard, du temps de Louis Xll et de Louis XIV, toutes
les romances portent le nom de brunettes.
Les romances, les brunettes destines aux amateurs
de haut parage, taient dsignes sous le titre airs de
cour
;
les chansons prenaient celui de voix de ville, dont
ont a fait plus tard vaudeville.
Ronde. Sorte de chanson ordinairement mle de
galanterie, compose de divers couplets qu'on chante
dans une runion nombreuse, debout, formant le rond,
en se tenant tous par la main. Chacun chante son cou-
plet, et l'on fait chorus en reprenant le refrain sur lequel
on danse en mme temps. La ronde a t introduite
dans nos opras comiques, o elle fait beaucoup d'effet.
On cite les rondes de Cendrillon, du Chaperon rouge,
de la Neige, du Postillon de Lonjumeau, des Porche-
rons, etc.
Ronde. Note blanche et ronde, sans queue, laquelle
vaut une mesure entire quatre temps , c'est--dire
deux blanches ou quatre noires. La ronde est de toutes
les notes d'un usage habituel celle qui a le plus de valeur.
Autrefois elle tait celle qui en avait le moins, et s'appe-
lait semi-brve. Les rondes, les blanches et les noires
furent imagines par Jean de Meurs, vers l'anne 1350.
Rondeau. Sorte d'air vocal n en Italie, qui de l
passa en Allemagne et en France. Il tait autrefois un
des ornements de la scne lyrique, la volupt des dilet-
tanti. Le rondeau est compos ordinairement d'une pre-
mire, d'une seconde et d'une troisime parties ou repri-
ses, dont la premire se rpte aprs la seconde et la
ROU 421
troisime. Il est aujourd'hui pass de mode, et les compo-
siteurs modernes l'ont employ rarement.
Les grands coryphes du rondeau scnique sont les
Gluck, les Piccinni, lesSacchini, les Paisiello, les Cima-
rosa, les Mozart, les Rossini. Quant au rondeau instru-
mental, dont les mai 1res sont Haydn, Mozart, Beethoven,
Onslow, il suit les rgles du rondeau vocal. Beethoven
seulement que dbordait sa fcondit, multiplia souvent
les reprises de ses rondeaux.
Rosalie. On donne ce nom la rptition d'une mme
phrase de chant, sur les cordes qui sont un degr plus
haut. On a banni de toutes les compositions de bon got
les rptitions fastidieuses et banales, trop faciles devi-
ner ou prvoir.
Rose. Nom que l'on donne l'ouverture circulaire
pratique sur la table des clavecins, des thorbes, des
luths, des guitares.
Rossignol. Sorte de petite flte piston, qui se fait
ordinairement avec un tuyau d'corce dtach d'une
branche de bois vert.
Rote. Ancien instrument qui participait de la harpe
et du psaltrion. Il avait la forme d'une harpe diminue.
Il tait mont de cordes de boyaux. La rote tait trian-
gulaire comme la harpe, avec une table et une caisse so-
nore perce d'oues.
Roue-Archet. On appelle ainsi une roue pleine,
frotte de colophane, qui dans la vielle tient lieu d'ar-
chet.
Roulade. C'est le nom vulgaire donn en musique
ces traits rapides imits de la musique instrumentale,
et qu'on place ordinairement dans les points d'orgue
pour faire briller le talent du chanteur, ou dans toute
autre circonstance, pour donner plus de grce la m-
lodie ou plus de force l'expression. Les Italiens sont
prodigues de cet ornement de la musique vocale. Il est
vrai que la langue italienne est remplie de syllabes so-
nores sur lesquelles on peut prolonger la voix.
En franais nous n'avons que les o, les et les a sur
lesquels on puisse convenablement placer un trait de
chant, et comme ces voyelles ne se prsentent pas assez
frquemment dans notre versification lyrique, on est
souvent oblig de passer plusieurs notes sur des i, des
u, et mme des e muets, ce qui est fort disgracieux.
La roulade n'est pas toujours dplace dans une situa-
422
RUS
tion triste et pathtique, surtout lorsque la chanteuse
runit la force l'agilit. Il
y
a telles scnes dans les-
quelles elle donne certains passages une expression d'-
nergie qu'on n'aurait certainement pas obtenue avec une
mlodie simple. Et cela se conoit; lorsqu'une me
est trop affecte, elle ne trouve plus de paroles et ne
peut s'exprimer que par des interjections.
Roulement. Le roulement s'excute sur le tambour
et la timbale par le mouvement alternatif de deux ba-
guettes, et en frappant deux coups avec chacune. Le
roulement de timbale produit un effet surprenant dans
le crescendo et le forte
d'un orchestre nombreux
;
il
y
a
quelque chose de mystrieux et de sinistre, s'il est l'ait
pianissimo, ou si les timbales sont voiles. On l'emploie
avec succs de cette manire dans un morceau lent, sur-
tout dans une marche funbre.
Plusieurs symphonies de Haydn commencent par un
roulement de timbales.
Roulement. Se dit galement de plusieurs tons diff-
rents pousss d'une mme haleine, soit en montant, soit
en descendant.
Routinier. On donne ce nom aux mntriers de vil-
lage et aux acteurs d'opra qui, sans avoir appris la
musique, et guids seulement par un instinct plus ou
moins heureux, parviennent jouer ou chanter de rou-
tine un certain nombre de contredanses et de valses, ou
des airs de chant, et mme des rles d'opra.
Rubebe. tait un instrument d'une nature plus grave
que la vielle et n'ayant que deux cordes.
Ruggeri (Giovanni-Baptista). Elve d'Amati, tra-
vailleur consciencieux et qui mrite une place dans le
nombre des grands luthiers de l'poque, vivait encore
en 1709.
Ruggeri Vincenzius dit il Fer, travailla de
1645 1650.
Runa. C'est le nom d'une mlodie qui, depuis les
temps les plus reculs, est en usage en Finlande.
Russie (de la Musique en). Parmi les peuples qui
s'occupent de musique et qui possdent des chants natio-
naux, on doit sans aucun doute placer la Russie. L,
l'artisan, le marinier, le soldat clans la marche, l'agri-
culteur, le postillon, le voiturier, enfin toute la popula-
tion chante en se livrant ses divers travaux.
Pendant que Pierre-le-Grand fut sur le trne, ses
rformes s'tendirent .jusque sur la musique. Il fit venir
S 423
d'Allemagne toute sorte d'instruments, institua une
compagnie de jeunes Russes destins apprendre Ja
musique, encourageant principalement la musique mili-
taire.
L'impratrice Anne porta sur le trne le got de l'art
musical. Dans les premires annes de son rgne, en
1737, Araja, compositeur napolitain, mit en scne le
premier opra italien qui ait t excut en Russie, inti-
tul : Abijazare, et l'anne suivante, Smiramide.
Sous Catherine II, la musique acquit une nouvelle
splendeur. On reprsenta, en 1702, Y Olympiade, de
Manfredini, et la salle tait toujours remplie par plus
de trois mille spectateurs. Des intermdes italiens et
des comdies russes et franaises alternaient avec
l'opra.
Sarfi fut matre de chapelle de la cour depuis 1785
jusqu'en 1801. L'impratrice le combla d'honneurs et de
biens, et le nomma directeur d'un nouveau Conservatoire
de musique , avec une augmentation d'appointements
assez considrable.
En
1843, l'empereur de Russie institua un Opra-
Italien Saint-Ptersbourg, et cette nouvelle institution
fut accueillie par les Russes avec enthousiasme. Depuis,
le thtre italien de Saint-Ptersbourg n'a pas cess
d'tre compt au nombre des plus importants qu'il
y
ait
en Europe. Les meilleurs artistes ont paru successive-
ment sur cette grande scne. L'empereur les avait pris
sous sa protection particulire.
Aujourd'hui le Thtre-Italien de Saint-Ptersbourg
est livr la spculation particulire. Il a son impres-
sario responsable, et les engagements ne se font plus par
ordre du dlgu du Czar.
S. Cette lettre, crite alternativement avec le T, si-
gnifie solo, tandis que l'autre signifie tutti.
On donne aussi le nom de 5 au tuyau d'anche du bas-
son, parce que sa forme ressemble celle de cette lettre,
424 SAL
et aux ouvertures pratiques dans le corps du violon et
du violoncelle.
S. travers obliquement par une barre, est employ
quelquefois comme signe de renvoi.
Sabot. C'est dans la harpe une espce de crochet de
laiton qui a la forme d'un bec de canne, et dont l'office
est d'accrocher la corde pour la raccourcir d'une lon-
gueur relative l'augmentation d'un demi-ton. Il
y
a
dans la harpe autant de sabots qu'il
y
a de cordes.
Salle de spectacle. C'est le lieu o l'on reprsente
les opras, les drames, les comdies, etc., etc. La plus
belle en France est celle de l'Opra, qui a t btie dans
les rues Granges-Batelire et Lepelletier, pour servir de
thtre provisoire. En 1850, elle a t restaure avec un
certain luxe.
C'est M. Fould, ministre d'tat qui a ordonn ces r-
parations importantes et qui les a fait excuter aux frais
de l'Etat. Les dpenses se sont leves 350,000 francs.
Le style architectural qui domine maintenant dans la
salle de l'Opra est le style de la fin de Louis XVI mari
celui de l'Empire. L'ensemble est un peu lourd, mais
les dtails en sont extrmement soigns et surtout trs-
brillants.
On a construit une nouvelle salle destine au grand
opra, sur la place Scribe, sous la direction de M. Gar-
nier, architecte, en remplacement de celle del rue Lepel-
letier. Ce monument, dont les frais s'lveront de trente
trente-cinq millions, est un des plus riches et des plus
grandioses des deux mondes.
La salle de l'Opra-Comique est tablie sur la place
Favart, entre la rue Favart et la rue Grtry
;
elle peut
contenir environ dix-sept cents personnes. Celle du Th-
tre-Italien a t leve sur la place Ventadour et c'est
certainement une des plus lgantes de Paris. Elle a la
mme forme et la mme dimension que celle de l'Opra-
Comique.
Les salles de spectacle en Italie sont plus grandes,
plus belles et surtout beaucoup mieux construites que les
ntres. Leur forme est, en gnral, celle d'un cercle par-
fait, coup par son diamtre rgulier, dont une moiti
appartient aux spectateurs, l'autre la scne. On n'a pas
en Italie, comme en France, la dtestable manie d'tran-
gler l'avant-scne entre deux normes massifs de cons-
tructions colonnes normes, ou pilastres pleins plus
SAN 425
lourds encore, qui masquent la scne aux personnes pla-
ces dans les quatre ou cinq premires loges des deux
cts, du haut en bas. Les Italiens ont une excellente
manire de construire leurs salles de spectacles
;
ainsi
dans la salle Saint Charles, Naples, la plus grande de
toutes, on compte six rangs de loges, quarante-deux
loges chaque rang, pouvant contenir douze personnes
chacune, et malgr cette prodigieuse dimension, on en-
tend parfaitement de toute part.
La salle du thtre royal de Turin est vaste, mais elle
droge par la forme, qui est un peu ovale. Dans sa cons-
truction il n'est entr que de la pierre et du fer, et elle
se trouve ainsi l'abri des dangers de l'incendie.
La plus vaste salle, aprs San-Carlo, est celle de la
Scala Milan. A Florence, on admire celle de la Pergola,
Rome, celle d'Argentina
;
Venise, celle de la. Fenice;
Gnes, celle du Carlo Alberto,
Salo (Gaspardi). Luthier Brescia,
y
travailla de
iolO 1550. Ses instruments ont une grande rputation.
Salpicta. Mot grec qui signifie trompettiste, c'est--
dire, qui joue de la trompette.
Salpinc-Organium. Espce d'orgue- trompette cons-
truit par Van-Ockelen, en 1824.
Salpinx. Ancienne trompette grecque, qui avait la
forme d'un cube conique, long d'environ deux pieds,
avec un pavillon qui transmettait le son
.
Saltarelle. Mot driv de l'italien salto, qui signi-
fie saut, et qui s'emploie pour indiquer un mouvement
trois temps vite, ou six-huit, ou une musique pointe,
et surtout celle o la brve est en frappant. On trouve
des saltarelles dans les forlanes de Venise, dans les
siciliennes et dans quelques gigues anglaises.
Salve regina. Antienne ou hymne qu'on chante dans
l'glise catholique, la fin des vpres, du samedi de la
Pentecte jusqu' l'Avent.
Le salve regina de Pergolse est clbre, bien qu'il ne
le soi t pas autant qu'il le mrite. Moins connu que le Sta-
bat du mme auteur, il est regard, par les connaisseurs
comme une composition plus parfaite et d'un mrite su-
prieur.
Sambuque. Instrument cordes des anciens Grecs.
Quelques auteurs croient que c'est le barbiton.
Sangtus. Ce mot latin, rpt trois fois, se chante
pendant la messe aprs la prface.
426
SAU
Sandale. Espce de chaussure en bois ou en 1er, dont
les
directeurs de musique ou les batteurs de mesure
garnissaient leurs pieds chez les anciens, et qui tait
destine rendre la percussion rhythmiqueplus clatante.
SANONi(Joh.-Baptistus).
Luthier de Vrone, travail-
lait dans cette ville vers 1650.
Santur. Instrument cordes turc, qui ressemble au
psaltrion allemand.
SANZA(Santino).
Luthier de l'cole de Milan, dont on
a des instruments qui portent la date de 1634.
Saquebute.
Ancienne trompette dont la tige se re-
pliait sur elle-mme de faon que le tuyau ou le pavil-
lon tait parallle au tuyau de l'embouchure, et de la
mme longueur que ce dernier.
Sarabande. En espagnol zarabanda, air d'une danse
grave,
portant le mme nom, et qui parat nous tre ve-
nue
d'Espagne, elle se dansait autrefois avec des casta-
gnettes. L'air de la sarabande tait trois temps.
Sarrusophone.
Imitation du saxophone de Sax, ima-
gin en 1856,
par un sieur de Sarrus.
Saut, en italien Salto. Tout passage d'un son un
autre par degrs disjoints est un saut.
Tous les sauts sont permis dans la mlodie, pourvu que
chaque note trouve sa consquence et sa rsolution dans
celle qui la suit. Les airs de bravoure, les concertos de
violon, de flte, de basson, de clarinette, renferment
souvent des sauts de dixime, et de plus grands encore.
Dans l'harmonie les sauts doivent tre bien amens,
pour qu'il n'y ait pas d'incohrence dans les parties.
Sauteuse. Espce de valse deux temps et d'un mou-
vement
trs-rapide. On faisait succder la sauteuse la
valse
ordinaire. Ce nom lui vient de ce qu'on la dansait
en sautant. La valse russe, qui se danse peu prs de la
mme
manire a fait dlaisser la sauteuse.
Sauter. On fait sauter le ton, lorsqu'en donnant trop
de vent dans une flte ou dans un tuyau d'un instru-
ment vent, on force l'air se diviser et faire rson-
ner, au lieu du ton plein de la flte ou du tuyau, quel-
ques-uns seulement de ses harmoniques. Quand le saut
est d'une octave eutire, cela s'appelle octavier. Il est
clair que pour varier les sons du cor et de la trompette
il faut ncessairement
sauter, et ce n'est encore qu'en
sautant qu'on obtient certaines octaves sur le basson, la
flte, etc.
SAU
427
Sautereau. Lame de bois mince, arme d'un petit
morceau de plume ou de peau de buffln qui, dans les
clavecins, tait pousse contre les cordes, irappait et pro-
duisait le son en s'chappant.
Sauvages (musique des). On sait bien que les peupla-
des sauvages n'ont pas de vritable musique
;
elles ne
se servent gure que d'instruments percussion.
Les Esquimaux, qui taient aussi prs de l'tat de
barbarie que possible, lorsque le capitaine Parry les vi-
sita, taient cependant passionns pour la musique.
Us n'avaient pour tout instrument, qu'une espce de
tambour ou de tambourin. Us chantaient des airs; mais
on
y
trouvait ni varit, ni tendue, ni mlodie caract-
rise.
Les Mexicains, lors de la conqute de leur pays par
les Espagnols, n'taient gure plus avancs sous Te rap-
port musical. Leurs principaux instruments taient deux
tambours, l'un nomm le hueheutl, l'autre le teponaztli.
Ils avaient aussi des trompes, des coquilles marines, des
petites fltes qui rendaient un son aigu, et un instru-
ment dont se servaient leurs danseurs, appel ajacaztli.
C'tait une sorte de vase rond ou ovale, perc de petits
trous et contenant un certain nombre de petites pierres,
instrument peu prs du mme genre que le hochet des
enfants.
M. Weld, dans sa notice sur les Indiens du nord-ouest
de l'Amrique, donne la description suivante d'une
danse dont il fut le tmoin, un soir, dans l'le des Bois-
Blancs :
Trois vieillards, assis sous un arbre, taient les prin-
cipaux musiciens; l'un d'eux battait un petit tambour
form d'un morceau de bois creux couvert d'une peau,
et les deux autres frappaient la mesure de concert avec
le tambour, au moyen d'une sorte de crcelle faite d'une
courge sche remplie de pois. En mme temps, ces trois
hommes chantaient un air, et tous les danseurs se joi-
gnaient eux.
Ce que nous savons des naturels des les de la mer du
Sud, quand elles furent dcouvertes par le capitaine
Cook, prouve galement la grossiret et la simplicit
de la musique des tribus sauvages qu'elles renfermaient.
Quatre personnes jouaient sur deux fltes faites debom-
bous creux, d'environ un pied de long, n'ayant que deux
trous, et ne pouvant donner par consquent que quatre
428 SAX
notes divises par demi-tons. On s'en servaitcomme nous
nous servons de la flte allemande, avec cette diffrence
que l'excutant, au lieu de l'appliquer ses lvres, souf-
flait dedans avec une de ses narines pendant qu'il bou-
chait l'autre avec le pouce. A ces instruments se joi-
gnaient quatre chanteurs qui observaient fort bien la
mesure. Dans un concert on n'excutait souvent qu'un
seul air.
Dans les les des A mis il
y
avait des femmes qui chan-
taient et s'accompagnaienten faisant claquer leurs doigts.
La musique de ces peuples est encore maintenant aussi
barbare que lorsqu'ils furent visits par le capitaine
Gook.
Les Indiens du Chili se servent de fltes faites avec les
os des ennemis qu'ils ont tus dans les combats
;
ils en
font aussi avec des os d'animaux
;
mais les guerriers in-
diens ne dansent qu'au son des premires. Ils chantent
tous l'unisson, et la fin de chaque air ilsjouent de
la flte et d'une espce de trompette; nos ritournelles
ont le mme but.
Les habitants de l'le de Tougo chantent souvent une
chanson, espce de rcitatif, dont les ides sont assez
potiques, et qui est dite par les hommes et les femmes
tout la fois. Ils ont aussi un air mlancolique, sorte de
complainte qu'ils chantent prs des morts, comme le
Lies ir.
Une tribu de Gafres, les Bachapins, n'ont qu'un seul
instrument appel lichaka, fait de roseau, et ne rendant
qu'un seul son. Il
y
en a un pour chaque note, et lors-
que plusieurs excutants sont runis, une partie joue
l'unisson pendant que les autres font entendre diffrents
tons de l'chelle musicale.
Cet usage rappelle assez l'emploi de la pdale dans les
orgues modernes.
Ce qui frappa le plus les sauvages, c'est le rhythme :
on a pu s'en convaincre en assistant aux danses de ceux
qui sont venus, il
y
a quelques annes, amuser les pa-
risiens.
Sauver les dissonances. Voyez le mot Dissonance
(rsolution des).
Sawardin. Chanson des Kalmouks, qu'on chante en
dansant.
Sax. C'est le nom d'un facteur belge qui est venu s'-
tablir Paris, et a dot la facture instrumentale d'une
SAX 429
srie d'instruments vent, dont la famille s'appele Sax.
On dit : Le saxhorne, le saophonelescueotromba le sa-
tuba, etc.. M. Sax a reu pour ses nombreuses inven-
tions des rcompenses . toutes les expositions.
Saxhorn.
Instrument en cuivre bocal, arm d'un
mcanisme de cylindres. Ad. Sax a institu une famille
entire qui parcourt une immense tendue de l'aigu au
grave. Le plus lev est en si bmol, l'octave suprieure
de l'ancien bugle en si bmol ou de la clarinette en si b-
mol, ou encore une quinte au-dessus du petit bugle en
mi bmol. Le plus grave est le saxhorn contre-bourdon en
si bmol, deux octaves au-dessous de l'ophiclde.
Les soxhorns forment les fonds de l'orchestre de fan-
fares-Sax.
Saxojihone.
Le saxophone est un nouvel instrument
en cuivre, invent et construit par Ad. Sax, et il est
arm de dix-neuf vingt-deux clefs et qui se joue au
moyen d'un bec anche dans le genre de celui d'une
clarinette. Son tendue est de deux octaves et une sixte.
Le cne de l'instrument est parabolique, le doigter pro-
cde par octave comme celui de la flte. Il existe des
saxophones peu prs dans tous les tons, ils se divisent g-
nralement pour le ton et le diapason en saxophone
basse si bmol ou ut, en saxophone baryton mi bmol ou
fa,
en saxophone tnor si bmol ou ut, en saxophone
alto mi bmol ou
fa,
en saxophone soprano si bmol ou
ut, et enfin en saxophone suraigu mi bmol ou
fa.
Saxotromba.
Instrument en cuivre bocal, arm
d'un mcanisme de cylindres. Cet instrument a t in-
vent par M. A. Sax, vers 4843. 11 comporte une famille
de sept membres allant de l'aigu au grave, diviss par
quinte et quarte.
Les proportions du saxotromba sont entirement nou-
velles, et sa voix tient, en quelque sorte, le milieu entre
le timbre des trompettes, des trombones, d'une part, et
de l'autre, des bugles et des ophicldes.
Le saxotroniba-alto remplace le cor avec un immense
avantage, ayant une bien meilleure sonorit, et n'exi-
geant pas, beaucoup prs, autant de talent de la part
de l'artiste. Le doigt est le mme pour tous les membres
de la famille.
Saxtuba.
Instrument de cuivre bocal arm d'un
mcanisme de cylindres. Cet instrument fut invent par
Ad. Sax, vers 1850, l'occasion de l'opra de M.
Ha-
13..
430
SC
lvy : le Juif
erraat. Sa famille comporte sept membres
de l'aigu au grave, comme celle du saocotromba. La
forme des sax tubes a de l'analogie pour la forme avec
celle des tubas romains. Au moyen de ses cylindres, leur
chelle est chromatique.
Saynette. Petite comdie mle de chansons que l'on
reprsente en Espagne. Les saynetes sont des espces
d'intermdes comiques, jous par trois ou quatre acteurs,
et quelquefois
mme par un seul.
Sgala (Thtre de la). Le thtre de la Scala, Mi-
lan, est, sans contredit, une des scnes les plus impor-
tantes de l'Europe. Malgr son immense dveloppement,
cette salle est fort sonore; ce qui est d, sans doute,
l'absence de ces rangs de galeries et de loges ouvertes,
qui absorbent une grande partie du son dans nos th-
tres. Lorsque le public veut bien couter, ce qu'il ne fait
gure que par fraction, hormis certains moments con-
venus, la plus faible mission de son arrive jusqu'aux
dernires limites de la salle. A la Scala, des artistes
dous de peu de voix sont parfaitement entendus.
L'orchestre de la Scala se distingue avant tout par une
merveilleuse science d'accompagnement
;
et c'est un im-
mense mrite. L, les individualits ne cherchent pas
isolment briller, et tout l'amour propre consiste dans
le bon ensemble de la masse. Vous entendriez souvent
chanter tout un air, un duo, sans songer qu'il existe un
orchestre, tant il se mesure suprieurement sur les
nuances du chant. Cette supriorit discrte dans les ac-
compagnements ne l'empche pas d'tre nerveux, puis-
sant, chaleureux dans les moments voulus.
Scalischin.
Instrument percussion des anciens
Hbreux dont il est fait mention dans le triomphe de
David.
Scander. Excuter un trait de manire en distin-
guer les temps de chaque mesure, les diverses articula-
tions, tant en marquant les couls, les piqus, que les
divers rhythmes provenant de la progression linaire ou
ternaire des notes.
Scne. Division du pome dramatique,
dtermine
par l'entre d'un nouvel acteur. On divise une pice en
actes, et les actes en scnes. Au concours
dcomposition
musicale de l'Acadmie des Beaux-Arts, on donne sou-
vent le nom de scne la posie que les concurrents met-
tent en musique.
SGH 431
Dans les scnes plusieurs personnages, le chant doit
avoir autant de caractres diffrents qu'il
y
a d'interlocu-
teurs. I] faut rendre dans les scnes, non-seulement le
caractre de la passion qu'on veut peindre, mais celui de
la personne qu'on fait parler. Ce caractre s'indique, en
partie, par le genre de voix qu'on approprie chaque
rle; car le tour de chant d'un tnor est diffrent de celui
d'une basse. On met plus de gravit dans les chants de
bas-dessus, et plus de lgret dans ceux des voix aigus.
Mais outre ces diffrences, le compositeur vraiment ha-
bile en trouve d'individuelles qui caractrisent ses per-
sonnages.
Sch.enion. Morceau de musique des anciens Grecs,
d'un caractre doux.
Scherzando, En badinant. Ce mot italien dsigne
une excution lgre et badine.
SCHERZI MUSICALI, PLAISANTERIES MUSICALES. L'art de
plaisanter savamment en musique a toujours t un des
privilges des hommes de gnie. Parmi les charmants
badinages enfants par la verve des compositeurs, il
faut citer particulirement le caprice de Marcello, les
canons burlesques du P. Martini, les fugues trilles de
Porpora, etc.
Scherzo, Badinage. On donne ce nom un morceau
de musique de peu d'tendue et d'un style lger et badin.
Le scherzo est assez souvent un menuet d'un caractre
plus bizarre que celui des menuets ordinaires.
Schisma. C'est le nom d'un petit intervalle qui n'est
pas usit dans la musique pratique, mais qu'on emploie
dans la science canonique.
Schmidt. Ancien luthier Cassel copiait les violons
de Bachmann qui ressemblaient ceux de Stradivarius
dont ils taient des copies exactes. On trouve souvent ces
violons portant l'tiquette de Stradivarius.
Schofar. Instrument des Hbreux fait avec la corne
d'un blier ou d'un buf, et dont le son trs-clatant
servait annoncer les crmonies du culte divin.
Schonger. Luthier Erfurth, travaillait d'aprs les
modles de l'cole de Crmone. Ses instruments ont
assez de valeur.
Schotisch. C'est une sur del polka; mais on la
danse plus lentement. Son caractre rhythmique est bi-
naire, c'est--dire qne le pas change de nature chaque
432
SDR
deux mesures. On crit la schotisch 2{4 ou quatre-
temps.
Schryari. Espce de hautbois anciennement en usage
en Italie.
Schyari. Sorte d'instrument vent en usage il
y
a
quelques sicles, dont la structure ressemblait celle
de la cornemuse, si ce n'est qu'il tait ouvert dans la
partie infrieure.
Sciolto, Dli, Affranchi, Libre. Ce mot, plac
sous un trait de musique, indique que les notes doivent
en tre dtaches.
Sciolto
contrapunto, Canone sciolto. Contre-
point, canon affranchi des rgles strictes que Ton a im-
poses ces sortes de compositions.
Sclah. C'est une opinion peu prs gnrale, que ce
mot hbraque, qui se trouve si souvent dans les psau-
mes, a une signification musicale, sans cependant qu'on
puisse dterminer quel est son vritable sens. Les uns
croient que c'est notre da capo ou le signe de la reprise,
d'autres prtendent que cette expression indique un
changement de ton ou de temps, un silence, etc.
Scolies. Chez les anciens grecs on appelait ainsi les
chansons dithyrambiques. Dans la suite on donna ce
nom aux chansons morales.
Scordatura. Ce mot italien ne peut se traduire en
franais que par dsaccor-dment, qui n'est pas reu dans
notre langue
;
il signifie l'action de dsaccorder un
instrument cordes. Comme rien de faux n'est admis en
musique, ce dsaccordment consiste donnera l'instru-
ment un accord qui, sans tre faux, n'est cependant pas
celui qui lui convient et qu'on lui donne de coutume. La
scordatura se pratique pour tendre les limites de l'ins-
trument, ou faciliter certaines positions que l'accord or-
dinaire ne permet pas de prendre, et produire par ce
moyen des effets nouveaux et extraordinaires. Paganini
en faisait un grand usage.
Sdrucciolo, enharmonique. Cette expression ita-
lienne indique la manire de glisser enharmoniquement
avec la voix sur quelques sons. Cet agrment, qui n'est
pas toujours de bon got, est particulirement employ
dans le cantabile. Mais on doit, pour qu'il produise un
effet attrayant, n'en faire usage que de la tonique la
quarte, et, ce qui est encore plus convenable, de la
quarte la tonique. On peut encore s'en servir en pas-
* SM 433
sant d'un son celui qui le prcde immdiatement dans
l'chelle musicale ascendante, par exemple, de l'octave
la septime mineure, et de la quinte la quarte mineure.
Second. Epithte qui, entre deux parties ou voix
gales, indique la plus basse, comme second violon, se-
conde viole.
Seconde. Intervalle d'un degr conjoint; ainsi, les
marches diatoniques se font toutes sur les intervalles de
seconde.
On distingue quatre sortes de secondes :
1
la seconde
majeure forme d'un ton entier :
2
la seconde mineure,
forme d'un demi-ton
;
3
la seconde augmente, forme
d'un ton et demi
;
4
Enfin la seconde minime qui ap-
partient au genre enharmonique, et ne peut pas tre em-
ploye dans la musique.
Secousse. Explosion que l'air fait en entrant dans un
tuyau d'orgue.
Segno, Al segno, Au signe. Ces mots signifient que
Ton doit reprendre le morceau partir du signe indiqu.
Segue, Suit. Cette expression italienne, place au bas
d'une page ou entre deux morceaux de musique, indique
qu'on doit continuer excuter ce qui suit sans aucune
interruption.
Seguidille, en espagnol Seguidilla. Air de chant et
de danse fort en usage en Espagne. La mesure en est
trois temps, et le mouvement anim. Cet air est moins
tendu que le bolro et le fandango, dont il a le caractre.
C'est, proprement parler, une chanson. La ritournelle
se fait entendre au commencement et mme au milieu de
chaque couplet, ou estrivillo.
Seing. Espce de cloche dont on faisait usage au
treizime sicle et que l'on plaait dans la tour de l'-
glise.
Semanteron. Instrument de percussion des Grecs,
qui consistait en une planche sur laquelle on frappait
avec un marteau. On s'en sert encore chez les Grecs mo-
dernes qui habitent parmi les Turcs, il remplace les clo-
ches, dont l'usage est interdit par les disciples de Maho-
met.
Smiographe. La smiographie musicale, ou des-
cription des signes, comprend : la porte, les clefs, les
notes, les silences, les accidents, les points d'orgue, les
points d'arrts, les signes d'agrment, les barres et l'or-
thographe musicale.
13...
434 SER
*
Semslo-melodium. Instrument de musique destin
pour
l'enseignement construit par Pruh, en 1857.
Semi. Cette expression latine, qui signifie demi, s'a-
joute plusieurs mots, comme semi-brve, semi-mi-
nime, etc.
Sensibilit. Disposition de l'me qui inspire au com-
positeur les ides vives dont il a besoin, l'excutant la
vive expression des beauts et des dfauts de la musique
qu'on lui fait entendre.
Septime. Intervalle dissonant de sept degrs. Il
y
a
trois sortes de septimes, la septime mineure, la
septime majeure et la septime diminue.
Septuor. Composition sept parties obliges.
Le septuor vocal est toujours accompagn par l'or-
chestre ou le piano. Le septuor instrumental se borne
aux sept instruments pour lesquels il est compos.
Nous possdons d'excellents septuors de Beethoven, de
Kalkbrenner, de Bertini, etc.
Sraphin (Sanctus). Le meilleur lve de Stradivarius
dont les instruments trs-estims, portent la date de
Venise 1707.
Sraphine. Instrument anche libre, imagin en
1842,
par Bazin, de Canton (Amrique du Nord).
Srnade. Les srnades sont des concerts donns la
nuit en plein air. Aussi l'tymologie de ce mot semble-
t-elle venir du mot italien sereno. Il
y
a peu de condi-
tions essentielles pour la composition des morceaux
excuts en srnade. On peut cependant dire que l'on a
gnralement choisi des mlodies tristes et langoureuses
de nature laisser la personne qui on offrait cet hom-
mage dans un vague demi-sommeil qui lui permettait
peine dans cette occasion de distinguer la ralit du rve.
Les tons bmoliss, surtout ceux de mi et de la, dont la
douce harmonie s'accorde bien avec le mystre dont les
excutants cherchent d'ordinaire s'environner, seraient
heureusement employs.
La vritable patrie de ces concerts nocturnes, c'est
l'Espagne et l'Italie. Voil o il faut chercher l'origine
de la srnade. Elle se plaisait surtout dans les chaudes
contres, o la nuit est l'instant de toutes les intrigues
d'amour. A Venise, les gondoliers ont conserv les tra-
ditions de la srnade dans les barcarolles que la nuit ils
l'ont entendre sur les lagunes.
Serinette. Trs-petit orgue cylindre, qui joue des
SIA
435
airs sans accompagnement, et qui sert l'ducation mu-
sicale des serins.
Serpent. Instrument vent que l'on embouche par
le moyen d'un bocal. Le serpent est un cornet repli
pour le rendre moins long, et pour que les doigts puis-
sent atteindre les trous qui en rglent l'intonation. Ses
replis et sa forme lui ont fait donner le nom de serpent.
On se sert de cet instrument dans les glises pour sou-
tenir le chur, et il tait en usage autrefois dans les
musiques militaires pour excuter avec le trombone la
partie de contrebasse.
Serrure de transposition. Appareil pour donner
aux pianos la proprit de transposer, imagin en
1847,
par Bardies.
Sextuor. Composition six parties obliges.
Le sextuor vocal est accompagn par l'orchestre ou le
piano. Le sextuor instrumental se borne toujours aux
six instruments pour lesquels il est compos.
Boccherini a crit des sextuors pour flte, deux vio-
lons, viole et deux violoncelles. Les sextuors pour deux
clarinettes, deux cors et deux bassons, sont d'un bon effet.
Sextuple (mesure). Mesure deux temps compose
de six notes gales, dont trois pour chaque temps.
Si. Note de musique que les Allemands dsignent par
la lettre A, lorsqu'elle est sans altration, et par la lettre
l>, lorsqu'elle est altre d'un bmol. C'est le septime
degr de notre chelle musicale dans le mode majeur, et
le second dans le mode mineur. Il porte accord parfait
diminu, et s'emploie en harmonie dans les deux modes,
en suivant toujours une marche diffrente.
Si. Septime syllabe du solfge moderne. Cette sep-
time note fut ajoute aux six de Gui d'Arezzo, par un
nomm Lemaire. Ds l'anne 1671, on rencontre le si
dans les partitions de diffrents opras reprsents pen-
dant le rgne de Louis XIV.
Siamois (Musique chez les). Les Siamois paraissent
avoir fait plus de progrs dans
la
musique que les autres
nations de l'Asie. Leurs mlodies gnralement vives et
brillantes, ne sont pas dpourvues de charme, mme
pour l'oreille exerce d'un Europen. Il
y
a beaucoup de
douceur, d'agrment et de simplicit dans la musique
des Siamois. Elle diffre de celle des autres nations
orientales barbares
,
en ce qu'elle est en gnral dans le
mode mineur. Le but des musiciens siamois est de tou~
436
SIS
cher le cur, d'intresser l'esprit et d'exciter les pas-
sions. Pour
y
parvenir, ils ont plusieurs espces d'airs,
qu'ils emploient selon l'effet qu'ils cherchent produire.
Leurs morceaux de musique sont en trs-grand nombre.
Sicilienne. C'est une danse napolitaine
6[8
qui doit
s'excuter allgro. Le dessin mlodique est binaire,
c'est--dire semblable de deux en deux mesures. Elle a
les mmes proportions que ses surs, la polka et la
mazurka, c'est--dire trois priodes et huit ou seize me-
sures terminatives aprs Je rappel du premier motif,
quelquefois des deux premiers.
Sifflet. Petit instrument avec lequel on siffle
;
c'est
une manire de manifester son improbation.
Signes. Ce sont en gnral les divers caractres dont
on se sert pour noter la musique.
Silence. Nom gnrique des signes qui correspondent
aux diffrentes valeurs des notes, et marquent l'inter-
ruption des sons pendant toute la dure de ces mmes
valeurs. Le silence d'une ronde se nomme pme, et se
marque par une petite barre horizontale; celui d'une
blanche, demi-pause, et se figure de mme, cela prs
de la diffrence de position sur la porte. Le silence
d'une noire s'appelle soupir, celui d'une croche demi-
soupir, ainsi de suite.
Simple. Dans la musique, tout double ou compos a
son simple, et tout simple a son double ou compos,
comme contrepoint simple ou double, figure simple ou
double, etc.
Sirne. Instrument imagin en 1820 par Gagnard de
]a Tour pour valuer le nombre de vibrations correspon-
dant un ton donn.
Sirenion. Piano d'une forme et d'une construction
particulire, tabli en
1828,
par Frost, de Strasbourg,
qui avait imit dans cet instrument celui que construisit,
en Allemagne, Pramberger.
Sirvente. Sorte de posie ancienne des troubadours
et des trouvres, ordinairement satirique, et qui est
presque toujours divise en strophes ou couplets desti-
ns tre chants. (Voyez Troubadour.)
Sistre. Ancien instrument de percussion des Egyp-
tiens, dont on se servait dans les crmonies religieuses
et dans la musique militaire; il tait ovale, sa forme tait
semblable aune raquette, et fait d'une lame de mtal so-
nore, dont la circonfrence tait perce de divers trous
SOC
437
opposs, par lesquels passaient plusieurs baguettes de
mtal. On agitait le sistre en cadence pour lui faire rendre
un son.
Socits de musique. C'est surtout en Allemagne que
les socits de musique ont pris un grand dveloppe-
ment. La musique n'est cependant pas inne chez le
peuple allemand, comme on le croit
gnralement en
France. Elle est plutt le rsultat de l'ducation pri-
maire et du protestantisme. Les enfants des deux sexes
prennent chaque jour deux leons de chant dans l'cole
publique, qu'ils aient de la voix ou non.
Il n'est pas une ville en Allemagne, si petite qu'elle soit,
qui n'ait au moins sa socit dirige par un amateur distin-
gu, ou par un matre de l'cole primaire. Ces socits
se composent djeunes gens et djeunes personnes dans
la fleur de l'ge. Comme on se cotise pour couvrir les
frais de l'tablissement, chaque membre, homme ou
femme, paye un nombre gal de florins par an. Ce fonds
sert acheter de la musique, payer les copies, le salon
o l'on s'assemble, et mille autres choses qui sont la
disposition du directeur.
On se runit une ou deux fois par semaine, et Ton
s'exerce chanter des churs et des oratorios. Les so-
cits composes seulement d'hommes chantent les
quatuors sans accompagnement. Souvent la socit est
forte de trois ou quatre cents membres. Alors les fonds
sont considrables
;
les soires et les bals plus nombreux.
Chaque nouveau membre
y
entre par ballotage et aprs
avoir subi un examen
;
car s'il n'a pas une voix excel-
lente, il faut au moins qu'il soit bon musicien et qu'il
sache lire a prima vista. Pour ceux qui ont de la voix,
on est plus indulgent, mais on leur enseigne part des soli.
De temps en temps les diffrentes socits se runis-
sent, soit pour excuter un grand oratorio au thtre,
soit pour chanter au bnfice des malheureux. A Franc-
fort, par exemple, le matre de chapelle n'a qu' donner
un ordre, et toutes les socits de chant se runissent au
thtre avec les churs , et composent un ensemble
d'environ six sept cents personnes. On voit alors de
jeunes bourgeoises rivaliser avec les premiers artistes.
Il en est de mme des socits instrumentales, o les
amateurs viennent une fois par semaine pour excuter
les symphonies de Beethoven et de Mozart. 11 faut avoir
entendu la marche triomphale de Titus, de Mozart, ex-
438
SOL
cute h Francfort, sous la direction do M. Guhr, matre
de chapelle, par trois cents amateurs, cinquante musi-
ciens de l'orchestre du thtre, cent de la ligne, et cin-
quante de la garnison autrichienne, tout cela aprs une
seule rptition : on ne se figure pas l'effet produit par
ces masses vocales et instrumentales. Qu'on se repr-
sente M. Guhr faisant excuter la cration de Haydn
par sept cents voix et trois cents musiciens. 11 ordon-
nait, et le lendemain une rptition ava$ lieu dans l'-
glise Sainte-Catherine, le surlendemain on assistait la
reprsentation.
Tous les
printemps on donne des ftes musicales
Heidelberg,
Dusseldorf, Trves, Mayence, Cologne, Bonn,
Carlsruhe et autres villes au bord du Rhin, o sixsept
cents chanteurs et cantatrices se runissent pour excu-
ter de la musique svre et religieuse. Un grand com-
positeur dirige ordinairement les churs et l'orchestre,
et les premiers artistes se chargent des soli. Les chan-
teurs font souvent des voyages de trente quarante
lieues, et les habitants de la ville s'engagent leur don-
ner l'hospitalit.
Les socits de musique se multiplient aussi en France
depuis quelques annes, grce au mouvement musical
imprim par l'Orphon de Paris aux institutions orpho-
nistes de la province.
Il existe en Belgique d'excellentes socits chorales.
Les plus renommes sont celles de Bruxelles, d'Anvers,
de Lige, et de Gand.
Sol. cinquime note de la gamme d'ut.
Solfge, Solfier. On nomme solfge, ou plutt sol-
fges, tout recueil d'exercices, d'tudes ou d'airs dispo-
ss le plus ordinairement dans un ordre progressif, et
destins tre solfis,
c'est--dire chants, en pronon-
ant les syllabes qui servent de dnomination aux notes.
Le nom de solfge s'applique galement aux livres l-
mentaires qui enseignent les principes de la musique en
gnral, et qui contiennent des leons pour exercer les
lves solfier. Toute bonne ducation musicale doit
commencer par une longue pratique des solfges, mme
quand on doit se borner apprendre jouer d'un ins-
trument quelconque; car il n'y a rien de comparable
aux exercices de solmisation pour acqurir le sentiment
de la mesure et la justesse de l'intonation. Presque tous
les peuples de l'Europe, hors les Allemands, emploient
SON 439
pour solfier les syllabes correspondantes au* sept notes
de la gamme de Guido d'Arezzo, si ce n'est qu'ils rem-
placent la premire syllabe du premier degr ut par
cette autre do, comme moins sourde et plus douce
prononcer.
Solmisation. C'est l'action de solfier ou. solmiser.
Dans l'cole franaise, comme dans celle d'Italie, on sol-
fie les notes en les nommant par leur nom : ut, r, mi,
fa,
sol, la, si. Il est remarquer que ces sept lettres
correspondent aux sept syllabes de l'hymne de Saint-
Jean.
Ut queant Iaxis Solve polluti
Resonare fibris, Labii reatum,
Mira gestorum Sancta Joannis
Famuli tuorum, Etc., etc.
Le mot sohnisation, comme le solfge, vient de ce que
l'chelle diatonique sur laquelle tait bas ce genre d'tude
commenait par sol. Il en est de cette tymologie comme
de celle du mot alphabet, qui vient du nom des deux
premires lettres grec alpha et bta, dont on a compos
le terme qui est en usage dans notre langue. Les Alle-
mands et les Anglais se servent pour solfier des lettres
romaines A, B, G, D, E, F, G, substitues par saint
Grgoire, au VI
e
sicle, aux lettres grecques.
Solo. Mot italien qui signifie seul. On s'en sert dans
la langue franaise pour exprimer un morceau de mu-
sique qui s'excute par un seul instrument ou par une
seule voix. Solo se prend aussi pour l'instrumentiste ou
le chanteur.
Sommerophone. Instrument vent bocal, espce
d'ophiclede avec vantille, construit Vienne, en 1843,
par Sommer.
Son. Le son n'est point un corps ou un tre matriel,
mais seulement une proprit d'autres corps, notamment
de l'air qui le produit sous l'influence des agents qui le
font entrer en vibration
;
car on sait qu'il n'y a pas de
son possible dans le vide. L'on sait de mme que toute
espce de son est incontestablement dtermine par la
vibration des corps lastiques, et que son plus ou moins
grand caractre d'unit dpend du nombre plus ou
moins grand de ces vibrations. L'air n'est pas le seul
vhicule du son, quoiqu'il en soit le plus ordinaire, et
l'on sait mme, depuis Descartes, qu'il se transmet plus
440
SON
rapidement
par le moyen des liquides que par celui des
gaz et des fluides. La transmission par ces derniers,
notamment
par l'air, est surtout bien moins rapide que
par les solides, tels que le bois, le fer, par exemple. On
distingue
trois choses dans un son : son intensit qui
dpend de l'tendue des vibrations, son timbre qui varie
avec la nature mme du corps vibrant et le ton qui est
dtermin par la vitesse des vibrations.
Les nuances des sons varient l'infini, comme le
nombre des vibrations qui les produisent. On nomme
intervalle le rapport d'un son un autre, ou plutt le
rapport entre les nombres de vibrations qui produisent
ces sons. Les intervalles prennent diffrents noms, rela-
tivement au nombre de sons qui se trouvent entre ceux
que l'on compare. On les nomme seconde, tierce, quarte,
quinte, sixime, septime, octave, quand les sons com-
poss se suivent immdiatement, ou quand l'oreille peut
intercaler 1, 2, 3, 4, 5,
6 sons intermdiaires.
Le mot bruit, pris quelquefois pour synonyme de
son, est spcialement consacr caractriser, en fait de
sons, tous ceux qui ne sont pas ce qu'on nomme musi-
caux
proprement dits.
Son de voix, Ton de voix. Ces deux expressions,
synonymes en ce qu'elles expriment les affections carac-
tristiques del voix, ont cependant entre elles des diff-
rences considrables. Le son de voix est dtermin
par la construction physique de l'organe
;
il est doux ou
rude, agrable ou dsagrable, etc. Le ton de voix est
une inflexion dtermine par les affections intrieures
que l'on veut peindre. Il est, selon l'occurrence, imp-
rieux ou soumis, fier et humble, vif ou froid, srieux ou
ironique, triste ou gai.
Sonate. La sonate, du mot italien suonare, sonner,
s'applique au jeu de tous les instruments
;
c'est une
pice de musique instrumentale, quelquefois avec accom-
pagnement. Elle prend le nom de trio, quand elle est
accompagne par un troisime instrument. La sonate
se compose ordinairement de deux ou trois morceaux :
1
allgro
;
2
adagio
;
3
rondo ou presto. Toutefois,
Sbastien Bach a compos des sonates quatre et mme
cinq morceaux, qui ont .obtenu longtemps un grand
succs.
La sonate se rapproche du concerto et de la fantaisie,
en ce sens qu'elle est un morceau d'excution compos
SOU 4-41
pour faire briller l'artiste; mais le style en est plus
svre; de sorte qu'elle est en mme temps une vri-
table tude, un exercice , et quelquefois une pice fort
difficile pour un seul instrument. Quelque resserr que
soit le cadre dans lequel se renferme cette composition
musicale, un harmoniste habile peut
y
jeter des effets
d'une certaine puissance
;
il doit mme s'attacher h tem-
prer la svrit un peu pdagogique du genre par de
gracieuses mlodies, des thmes originaux et des accom-
pagnements varis.
La sonate demande tre joue avec une irrprocha-
ble prcision
;
elle ne souffre ni broderies, ni priphrases,
ni aucun de ces traits brillants, mais parasites, dsigns
dans l'cole sous le nom de fioritures.
Presque tout le dix-huitime sicle fut l'esclave de la
sonate, et chacun connat la boutade que ce culte exclu-
sif pour une idole maintenant tombe, inspira Fonte-
nelle. De notre temps, M. Ftis, parodiant l'exclamation
comique de l'ingnieux auteur de la Pluralit des
mondes, a pu dire : Sonate, o es-tu? Et de fait, la sonate
est morte, morte petit bruit, sans funrailles, sans
oraison funbre.
Sonatine. Sonate destine aux commenants
Sonomtre. Instrument destin mesurer l'intensit
des sons
;
le premier sonomtre fut imagin en 1699 par
Louli, musicien attach Mademoiselle de Guise. On
en possde aujourd'hui un grand nombre de diffrentes
constructions, mais dont le but est toujours le mme.
Sonomtre. Appareil compos de plusieurs cordes
parallles, supportes par des chevalets mobiles, qui sert
pour trouver les rapports de tous les intervalles har-
moniques.
Sonorit. Proprit qu'ont certains corps de renforcer
les sons en les repercutant.
Sonotype. Espce de diapason destin guider l'ac-
cordeur dans son opration; cet appareil fut imagin en
1854 par Delsarte.
Sons antiphones. Ce sont ceux qui, la distance
d'une ou plusieurs octaves, font consonnance entre eux.
Sotto-voce. Expression italienne signifiant sous la
voix et qu'on emploie en gnral pour demi voix.
Soufflerie. Se dit de l'ensemble des soufflets d'un
orgue.
M
442 STR
Soupape. Est dans les instruments vent ce qui sert
donner passage au vent et empcher qu'il ne rentre.
Soupir. Pause, silence qui vaut une noire.
Surdeline. Espce de musette italienne garnie de
quatre chalumeaux qu'on peut ouvrir ou fermer
volont.
Sourdine. Petit instrument de bois, que l'on enchsse
sur le chevalet du violon, de la viole ou du violoncelle,
pour en intercepter les vibrations et en diminuer par
consquent le son. La sourdine en affaiblissant les sons,
change leur timbre et leur donne un caractre sombre et
mlancolique.
Sous-dominante. Quatrime note d'un ton.
Sphre harmonique. Instrument destin donner la
mesure exacte de l'intervalle des sons et faire voir
leurs rapports avec les distances et les mouvements des
astres, imagin en 1799 par Montu, il reut en 1802 l'ap-
probation de l'institut qui accorda 12,000 francs l'in-
venteur. Cet instrument se trouve actuellement au con-
servatoire de musique.
Spiccato. Qui signifie piqu, en italien, indique, en
langue musicale, les passages qui doivent tre excuts
en dtachant les notes.
Spondante. Ainsi se nommait chez les anciens grecs,
le musicien qui jouait de deux fltes la fois pendant
les sacrifices.
Stabat. Premier mot d'une hymne que l'on chante le
jeudi de la semaine sainte. Cette hymne a t mise en
musique par les plus clbres compositeurs : Pergolse,
Haydn, Hsendel, Rossini.
Staccato. Mot italien qui, mis sur une partition,
indique qu'il faut attaquer la corde brusquement avec
l'archet.
Stahlspiels. Instrument clavier, compos de lames
d'acier mises en vibration par le frottement, invent en
1780 Torgau par Lingko.
Stainer (Jacob). Luthier chef de l'cole duTyrol. On
ignore de qui il est lve. On croit que ce fut d'Albani;
ses instruments ont une grande rputation, il travaillait
en 1663.
Son fils Marius travailla Inspruck.
Storionus (Laurenzius). C'est le dernier luthier de
l'cole de Crmone, il travaillait en 1778.
Stradivarius (Antoine). Le clbre luthier, lve
d'Amati, travailla Crmone de 1640 1726.
SUB
143
Strette. Mot qui vient de l'italien et qui signifie
troit, serr. Il se rapporte au mouvement d'un morceau
de musique,
et indique une marche plus serre, plus
rapide que celle que Ton suivait dj.
Strophe. Couplet ou stance d'une ode ou d'une pice
de vers lyriques, dont le sujet est noble.
Style. Manire particulire chaque artiste d'expri-
mer ses penses et de leur donner une certaine forme.
C'est le style qui caractrise une uvre musicale.
Substitution. Dans l'accord de dominante sol, si, r,
fa,
sol, et dans tous les autres semblables, au lieu de
rpter la dominante sol l'octave suprieure, on peut
lui substituer le sixime degr la.
Quand la dominante fondamentale est crite, la note
substitue doit en tre une neuvime relle; quand
elle n'est pas crite, on a l'accord de septime de sensi-
ble si, r,
fa,
la, dont l'emploi est soumis aux rgles
suivantes :
Si le mode est majeur et si la note substitue n'est pas
abaisse d'un demi-ton par une altration, elle doit se
trouver toujours une distance de septime de la sensi-
ble.
Si ce mode est mineur ou si la note substitue est
abaisse d'un demi-ton par une altration quelconque,
on peut trs-bien l'crire une distance de seconde de la
sensible.
On appelle aussi substitution dans quelques anciens
traits, toute espce de prolongation ou de retard, c'est-
-dire toute introduction dans un accord quelconque
d'une note trangre cet accord, pourvu que les rgles
de la prparation et de la rsolution soient bien obser-
ves.
La substitution peut avoir lieu dans tous les tons et
dans tous les modes.
Subvention. C'est la part d'argent que donne le Gou-
vernement des scnes privilgies, pour les aider
marcher glorieusement dans la voie du progrs musical
et dramatique. Les thtres subventionns Paris sont:
l'Acadmie impriale
de musique, le thtre de l'Opra-
Comique, le Thtre-Lyrique, le Thtre-Italien,
le
Thtre-Franais
et l'Odon. Ce mot s'applique aussi aux
Conservatoires de musique placs sous la surveillance du
Gouvernement. Celui de Paris est entirement subven-
444
SU1
tionn par l'tat
;
ceux dos dpartements le sont en partie
par l'tat et en partie par les administrations locales.
En Italie, la subvention (dote) est plus ou moins forte
selon le rang qu'occupent les cits dans l'ordre gogra-
phique, ou bien selon les circonstances qui prsidente
l'ouverture des salies de thtre. C'est la commune qui
donne la dote et le Gouvernement qui fixe la somme.
Comme nos centimes additionnels dans nos budgets des
dpartements ou d'arrondissements, les subventions
thtrales sont proportionnelles aux produits du pays,
son commerce, sa population. Le gouvernement ne
refuse jamais son approbation aux demandes qu'on lui
adresse l'occasion des foires, qui sont les saisons les
plus favorables aux entreprises de thtre. Par l'attrait
du plaisir, on fait natre la concurrence dans les affaires,
et souvent la fortune publique se trouve lie la renom-
me des artistes choisis par les entrepreneurs.
Sude (de la musique en). L'art musical est considr
par les Sudois comme une partie importante de l'du-
cation, surtout parmi le-s femmes. Les professeurs de
musique jouissent de beaucoup de considration, et sont
accueillis avec honneur dans les classes les plus leves
de la socit. Dans les montagnes, les bergers sudois se
servent d'une espce de longue trompette faite d'corce
de bouleau qu'ils appellent rar. Cet instrument qui a
quelquefois quatre pieds de long, rend un son trs-per-
ant, et dans un temps calm il peut tre entendu une
grande distance. Quoique le son de cette trompette soit
trs-forb et destin loigner les btes sauvages, il n'est
pas dsagrable.
Malgr leur got pour la musique, les Sudois n'ont
point, jusqu'aujourd'hui, manifest de gnie pour cet
art. Il
y
a un thtre Stockholm, mais on n'y repr-
sente que des opras italiens ou franais. Cette capitale
possde une acadmie de musique fonde en 1772 par
Gustave III.
Suite. Nom que l'on donnait autrefois une collec-
tion de morceaux de musique pour clavecin et qui diff-
rait de la sonate proprement dite. La plupart de ces
suites contenaient des airs de danse prcds par Yalle-
mande. Les suites de Hsendel traverseront les sicles, h
cause des belles fugues dont elles sont enrichies et qui
sont des modles dans ce genre.
SYM
445
Sujet. Phrase qui commence une fugue et qui lui
sert de thme ou de motif.
Suraigue. Se dit d'une voix de femme dont le diapa-
son comprend l'aigu une octave de plus que les voix
ordinaires.
Suspension. Marche de tout accord sur la base du-
quel on soutient un ou plusieurs sons de l'accord prc-
dent avant de passer ceux qui appartiennent l'accord
actuel.
Symphonia. Ancien instrument dsign par Saint-
Isidore. C'tait une espce de gros tambour.
Symphoniaste. Compositeur de plain-chant. Ce terme,
employ par l'abb Lebuf, tait autrefois technique,
on ne l'emploie gure aujourd'hui.
Symphonie. Pice divise en trois ou quatre morceaux
et compose pour l'orchestre.
La symphonie commence le plus souvent par une
courte introduction d'un mouvement lent, qui contraste
avec la vivacit, l'clat, la vhmence, l'entranante ra-
pidit du premier allegro qu'elle prpare. Vient ensuite
un andante vari, un cantabile ou un adagio suivi d'un
menuet
;
un rondo vif et brillant, un finale plein de
mouvement et de vigueur, terminent cette uvre, une
des plus importantes en musique. Rien qui meuve, qui
entrane comme une belle symphonie, traduisant avec
des gradations habilement mnages toutes les nuances
du sentiment.
Au dix-huitime sicle, Corelli, Geminiani, Vivaldi, en
composant leurs concerti grossi, avaient ouvert la ca-
rire de la symphonie. Mais, malgr l'incontestable ta-
lent de ces virtuoses clbres, ce genre de composition
prsentait encore toutes les imperfections d'un premier
essai. Il lui restait acqurir une forme plus originale,
prendre un essor plus vigoureux, plus hardi. Haydn
lui donna une vie nouvelle, l'anima du souffle ardent de
son gnie, l'leva, en un mot, un haut degr de per-
fection. Ses symphonies sont d'admirables chefs-
d'uvre, qui ont toujours d'irrsistibles sductions,
mme pour les oreilles les moins familiarises avec les
dlicatesses de l'art.
Mozart et Beethoven ont fait des symponies qui sont
des crations sublimes, et o l'on retrouve cette verve,
cette abondance d'ides, cette fcondit inpuisable, cette
varit de style et de coloris qui distinguent ces grands
446 SYM
compositeurs. Mendelssohn doit tre encore cit de nos
jours comme un des meilleurs compositeurs dans ce
genre de composition, qui exige la fois de l'habilet, de
l'inspiration et une science profonde.
Richard Wagner a crit des symphonies o l'on ren-
contre parfois des effets grandioses, mais d'un style in-
gal et bizarre que l'on ne saurait prendre pour modles.
Nous devons citer encore Robert Schumann, un com-
positeur de l'cole de Richard Wagner dont les uvres
brillent plus par la science que par l'inspiration.
Bien qu'elle n'ait abord le genre de la symphonie que
longtemps aprs l'Italie et l'Allemagne, la France a dj
obtenu de brillants succs sous ce rapport. Une des il-
lustrations de l'cole franaise, un de nos premiers com-
positeurs dramatiques, Mhul, a fait des symphonies qui
ne sont pas un de ses moindres titres de gloire. Et de nos
jours, quelques-unes de M. Berlioz brillent par des effets
nouveaux, par la hardiesse de la conception, par une ins-
trumentation habile et savante. MM. Flicien David,
Ch. Gounod, Th. Gouvy, Henri Reber, Onslow, ont com-
pos aussi des symphonies qui mritent d'tre signales.
Le Conservatoire a travaill avec succs populariser
chez nous les symphonies des grands matres.
Une institution de frache date sous la direction de
M. Pasdeloup, la Socit des concerts populaires, pro-
page avec clat les uvres symphoniques.
Symphonie caractristique. Cette composition se
propose pour but la peinture de quelque caractre mo-
ral, comme le Distratto de Haydn ou de quelque phno-
mne physique, par exemple, la tempte, l'incendie
;
ou bien elle a une couleur bientranche, un coloris
qui lui est propre, comme la symphonie turque de
Haydn, les magnifiques symphonies pastorales ou
hroques et les Ruines d'Athnes, de Beethoven.
Symphonie concertante. Morceau concert pour
plusieurs instruments obligs, avec accompagnement
d'orchestre.
Symphoniste. Celui qui compose des symphonies.
Ce mot s'applique aussi au musicien qui joue des instru-
ments de musique, qui est plutt un bon musicien d'en-
semble qu'un soliste, ou bien encore qui compose des
uvres qu'on joue sur ces instruments.
Symphonium. Appareil imagin par Debain, en
1845,
pour runir les jeux de l'orgue celui du piano.
TAB
447
Synaphe. C'tait, dans l'ancienne musique, la con-
jonction de deux ttracordes, au moyen de laquelle la
quatrime corde d'un ttracorde devenait en mme
temps la premire du ttracorde suivant.
Syncope. Prolongement sur le temps fort d'un son
commenc sur le temps faible. Ainsi, toute note synco-
pe est contre-temps, et toute suite de notes syncopes
est une marche contre-temps.
Synnemenon. Nom du troisime ttracorde de l'an-
cien systme grec, lorsqu'il tait conjoint au second.
Synnemenon diatonos. C'tait, dans le genre diato-
nique, le nom qu'on donnait la troisime corde de ce
mme ttracorde, et qu'on nommait aussi parante syn-
nemenon.
Syringes. Ancien nom de la flte de Pan, compose
de douze seize tuyaux de diverses grandeurs tous rap-
prochs les uns des autres et que l'on joue en prsentant
successivement ces tuyaux devant la bouche.
Systme. Tout intervalle compos ou conu comme
compos d'autres intervalles plus petits, lesquels consi-
drs comme les lments du systme s'appellent dias-
tme. Le systme gnral de la musique embrasse huit
octaves et demie; celui du violon comprend trois octaves
et une sixte.
Syzyga. C'tait, dans l'ancienne musique, une union
consonnante de sons.
T. Cette lettre, crite alternativement avec s, signifie
tutti, et alors s signifie solo. Quant t est runi s,
comme ts
y
cela veut dire tasto solo
(
touche seule).
Tablature. Arrangement de certains signes dont
on se servait anciennement pour marquer le chant
de ceux qui chantaient ou jouaient des instruments. On
nommait tablature alphabtique de l'emploi qu'on a fait
pendant longtemps des lettres de l'alphabet pour noter
les parties du luth, de la guitare, etc. , etc. On figurait les
cordes par plusieurs cordes parallles. A, sur la ligne
m
TAM
d'une corde indiquait qu'on devait la pincer vide. B,
qu'il fallait mettre un doigt de la main gauche sur la
premire touche du manche, etc., etc. Tablature dsigne
aujourd'hui un tableau reprsentant un instrument
vent et trous, et qui indique quels trous doivent tre
bouchs ou ouverts pour produire toutes les notes.
Table d'harmonie. C'est dans les clavecins, les
pianos, les harpes, une planche de sapin assez mince qui
sert de couverture l'espce de caisse destine recevoir
l'air agit par les vibrations des cordes, et augmenter
ainsi la sonorit de l'instrument. Le dessus du violon, de
la viole, du violoncelle, de la contre-basse, de la guitare,
est une table d'harmonie.
Tacet. Ce mot latin s'crit dans la musique pour in-
diquer le silence d'une partie pendant l'excution d'un
morceau.
Taille. Nom que l'on donnait autrefois en France
la voix du tnor. On dit encore basse-taille, qui signifie
tnor grave.
Tambour. C'est un des instruments militaires les plus
anciens. Il tait en usage chez tous les peuples de l'anti-
quit, except chez les Grecs et les Romains, qui le rem-
plaaient par les timbales et par la buccine. Les premiers
Francs ne connurent que l'usage du clairon.
Le tambour a t import en Europe parles Sarrasins
et par les Maures. Les Allemands, les Anglais, les Ita-
liens et les Espagnols s'en servirent ensuite les premiers;
il n'apparat en France qu'en 1347, lors de l'entre d'E-
douard III, roi d'Angleterre, Calais. C'est partir de
cette poque qu'on a cr des tambours dans l'infanterie,
et que l'usage de la caisse s'y est introduit avec rapidit,
Avec cet instrument, on bat le rappel ou la gnrale,
pour runir les corps
;
la retraite, pour annoncer, le
soir, l'heure de rentrer la caserne, et, sur le champ
de bataille, la fin d'un combat
;
la charge, pour marcher
en avant et contre l'ennemi, attaquer une position, un
fort, une redoute, un village. Les autres batteries de
caisse sont la diane, la breloque autrefois appele fascine,
parce qu'elle servait avertir les travailleurs
;
le roule-
ment, aux champs, au drapeau, Rassemble, le ban, qui
se bat l'entre des troupes dans les places o elles vont
tenir garnison, ou pour recevoir un officier la tte
des troupes.
Tambour (gros), vulgairement appel grosse Caisse
TAM Ud
ou simplement caisse. C'est un tambour d'une grande
dimension que l'on emploie dans la musique militaire, et
dont les frappements rguliers marquent la mesure et le
rhythme. Rossini et les musiciens de son cole ont in-
troduit le gros tambour dans les iinales et autres mor-
ceaux d'opras.
La grosse caisse est d'un admirable effet quand on
remploie habilement, dans un vaste orchestre
;
et lors-
que le rhythme s'est fortifi peu peu par l'introduction
successive des instruments les plus sonores, l'entre
crescendo de la grosse caisse peut lui donner une phy-
sionomie grandiose et formidable. Les notes pianissimo
de la grosse caisse, frappes de longs intervalle au mi-
lieu d'un andante de l'orchestre, ont quelque chose de
solennel et de mystrieux qui saisit l'imagination. Frap-
pe seule au contraire, et pianissimo, la grosse caisse
prend une expression menaante et ressemble un coup
de canon lointain.
De tous les instruments percussion, la grosse caisse
estceluidont on aie plus abus depuisune vingtaine d'an-
nes. On l'emploie maintenant dans tous les morceaux
d'ensemble, dans tous les finales, dans tous les churs et
mme dans les airs de danse. Frapper platement les
temps forts de la mesure, dit un critique clbre, la
faon des joueurs de gobelets, des saltimbanques, des
avaleurs de sabres et de serpents, craser l'orchestre, ex-
terminer les voix, touffer la mlodie, l'harmonie, c'est
le comble de la draison et de la brutalit.
Tambour roulant ou Caisse roulante. Tambour du
diamtre des tambours ordinaires, mais plus haut de la
moiti environ. Ce tambour s'emploie dans la musique
militaire. Le son qu'il rend est fort doux.
Tambour de basque. On dsigne ainsi une sorte de
petit tambour qui n'a qu'un fond de peau tendue sur un
cercle de bois, autour duquel il
y
a des plaques de cui-
vre et des grelots, et dont on joue avec le bout des doigts
ou en l'agitant. Les Bohmiens s'en servent en dansant
leur sarabandes. Quelques commentateurs prtendent
que Marie, sur de Mose, frappait un semblable tam-
bour en chantant le cantique de joie du 15
e
chapitre de
l'Exode.
Tambourin. Espce de tambour moins large et plus
long que le tambour ordinaire, sur lequel on bat avec
14.
450
TAR
une seule baguette, et qu'on accompagne ordinairement
avec une petite flte pour faire danser les villageois.
Tamtam. Instrument de musique percussion, origi-
naire des Indes orientales ou de la Chine. Il se compose
d'un large plateau de mtal, sur lequel on frappe avec
un marteau ou avec une forte baguette garnie d'un tam-
pon de peau. Le son qui en rsulte est d'un caractre lu-
gubre. Il a d'abord une trs-grande force, qu'il perd en-
suite dans des vibrations prolonges. Ce son trange qui
rveille un sentiment de terreur, ces vibrations lentes et
continues sont dues la combinaison des mtaux dont
l'instrument est forg, et plus encore la manire dont
il est tremp. L'analyse de plusieurs tamtams venus
d'Orient a fait reconnatre qu'il entre dans la composition
de cet instrument quatre parties de cuivre jaune et une
partie d'tain mle d'un peu de zinc, selon les uns, et sans
autre mlange, suivant d'autres. Quantla trempe, elle se
pratique en sens inverse de la manire dont on s'en sert
ordinairement avec les autres mtaux, c'est--dire que le
refroidissement, au lieu d'tre subit, s'opre par grada-
tion et trs-lentement. Le tamtam, fort en usage chez les
Orientaux, ne s'emploie chez nous que bien rarement,
avec beaucoup de rserve, et seulement dans la musique
funbre, ou dans certaines scnes de musique dramati-
que destines produire des effets d'un caractre som-
bre et terrible.
Tapon. Gros tambour en usage dans les Indes Orien-
tales, qu'on frappe avec le dos de la main.
Tarantelle. Air de danse napolitain, d'un caractre
gai, en mesure
6[8,
et d'un mouvement vif. La taran-
telle est ordinairement accompagne de tambour de
basque.
Tarentisme. Le tarentisme est le nom del maladie
singulire attribue la piqre de cet insecte, espce
d'araigne qui se trouve en Italie, et particulirement
dans la Pouille. Le charlatanisme qui pntre partout,
a voulu faire de la musique un remde universel. C'est
ce charlatanisme qu'il faut attribuer la fable de l'effica-
cit de la musique contre la morsure de la tarentule.
Baglivi, clbre docteur italien
,
parle d'une femme
mordue par la tarentule. Elle fut mordue dans une
cave, mais elle ne sentit pas cette morsure l'instant, et
elle revint chez elle sans s'en tre aperue. L'aprs-midi,
il lui vint la jambe une petite tumeur, grosse comme
TEL 451
une lentille, accompagne de dfaillance. Elle se jeta sur
un lit et commena trembler si fort, que deux hommes-
vigoureux pouvaient peine la tenir. Elle sentit ensuite
des douleurs aux pieds et aux mains. On alla chercher
un mdecin qui fit ouvrir la tumeur et employa quelques
empltres; ce remde ne produisit aucun effet. Les pa-
rents, souponnant d'abord que leur fille avait t mor-
due de la tarentule, envoyrent chercher des musiciens.
Ceux-ci essayrent d'abord deux ou trois airs sans le
moindre rsultat
;
mais au quatrime, la malade parut
attentive. Ensuite elle commena danser d'une manire
si extravagante et avec tant de vigueur et de rapidit,
qu'elle fut bientt dlivre de tout mal. Depuis cette gu-
rison, ajoute Baglivi, elle jouissait de la meilleure sant.
Malgr l'opinion de Baglivi et d'un grand nombre
d'auteurs anciens qui ont crit sur le tarentisme, on ne
croit plus maintenant l'origine de cette maladie. L'opi-
nion actuelle des mdecins est tout en faveur de l'inno-
cuit de la piqre de la tarentule.
Tasto solo (
touche seule). Mots italiens qu'on
crit dans la partie de l'organiste, pour lui faire conna-
tre qu'il ne doit pas accompagner la basse par les accords
de la main droite.
Taun. Instrument en usage sur les ctes de la Bar-
barie.
T. Une des quatre syllabes dont les Grecs se ser-
vaient pour solfier, T, ta, ti, to.
Te Deum. Cantique attribu saint Augustin et
saint Ambroise.
Tlphonie, de tle\
loin, et phon,
voix. C'est
une tlgraphie vocale oa moyen de correspondre de
longues distances par la puissance du son, invent par
M.
Sudre. A l'aide de toute chose apparente ou sonore,
M.
Sudre pouvait transmettre des phrases, des ordres
et donner des avis.
Ce moyen consiste donner au sept notes de la mu-
sique une valeur quivalente peu prs celle des si-
gnaux configurs par les branches du tlgraphe. L'in-
vention de M. Sudre a sur celle des frres Chappe
l'avantage d'tre perceptible par trois sens au lieu d'un
seul, savoir par l'oue au moyen des sons, par la vue
au moyen des signaux fournis "par les doigts et corres-
pondant aux notes, enfin par le toucher, au moyen de
ces mmes signaux rendus sensibles par le contact.
452
TEM
Tliochorde. Instrument clavier, imagin Lon-
dres en 1775,
par Glagget. Il tait accord sans aucune
considration de temprament et les diffrences enhar-
moniques se faisaient sentir au moyen d'une pdale.
Temprament. On appelle temprament une altra-
tion
presque insensible de la valeur du dise et du bmol,
pour les faire concider au mme point dans les instru-
ments sons fixes, tels que les pianos, les orgues, les
harpes, etc. Dans leur tat naturel, ut dise et r b-
mol ne concident pas : ut dise est plus^ lev que r
bmol. Il fallait donc altrer un peu cet tat naturel
pour ne pas multiplier l'infini les touches du clavier,
et pour le rendre accessible aux mains des pianistes.
Temprament. Dans le systme moderne, appel tem-
pr, on trouve que tous les intervalles ne peuvent pas
tre pratiqus dans leur justesse parfaite, mais qu'ils
perdent tantt sur un point, tantt sur un autre, quel-
que chose de leur acuit ou gravit. En effet, l'exprience
nous montre qu'une suite de tierces majeures et mi-
neures, de quintes et de quartes, accordes avec une
justesse rigoureuse, lorsqu'elles arrivent un terme
donn, produisent un son ou trop haut ou trop bas, re-
lativement aux premiers. C'est pour obvier cet incon-
vnient que l'on est dans la ncessit d'altrer l'un ou
l'autre son, afin de combiner les intervalles d'un mode
avec ceux de l'autre; et c'est le rsultat de cette opra-
tion qu'on appelle temprament.
Tempo. Mot italien qai signifie temps et s'emploie
ainsi, tempo di marcia, mouvement de marche, andante
maestoso deux temps; tempo di minuetto, mouvement
de menuet, mesure jadis trs-modre, mais aujour-
d'hui il est trs-rapide
;
tempo di polacca, mouvement
de polonaise, allegretto anim; tempo giv.sto, mouve-
ment exact et modr; a tempo ce temps indique qu'il
faut revenir au mouvement primitif, quand on l'a mo-
mentanment quitt.
Temporiser. Ceux qui accompagnent et ceux qui
dirigent sont souvent obligs, pour seconder le chanteur
ou le concertiste, de s'carter de l'exacte observation de
la mesure et d'alionger ou d'abrger la justesse du temps.
Cette manire de procder s'appelle en italien tempo-
riser.
Temps fort. C'est le nom que l'on donne la partie
la plus sensible de la mesure, par opposition celle qui
TER 453
est la moins sensible, et qu'on appelle temps faible.
Dans la mesure deux temps, c'est le premier qui. est
fort
;
dans la mesure trois et quatre temps, le premier
et le troisime sont forts.
Temps, Mesure. La mesure est la division des sons
en espace de temps gaux, et on l'indique au moyen
d'une ligne appele barre, qui traverse la porte. Le
signe qui se trouve marqu immdiatement aprs la clef,
qualifie la mesure, en indiquant :
1
en combien de parties
elle est divise ;
2
de quelle valeur de notes chacune de
ces parties est forme.
On distingue deux sortes de temps ou mesures, lesw*e-
sures paires et les mesures impaires. Les mesures paires
sont celles qui se divisent en deux ou quatre parties,
comme la mesure de deux noires, etc. Les mesures im-
paires sont celles qui se divisent en trois parties, comme
la mesure de trois croches, la mesure de neuf noires, etc.
Tempus imperfectum. Nom ancien de la mesure
temps pairs, o une brve avait la valeur de deux semi-
brves.
Tempus perfegtum. C'est ainsi qu'on appelait autre-
fois la mesures temps impairs, o la brve valait deux
semi-brves.
Tempus vacuum. C'tait , dans l'ancienne musique,
le silence que l'on pratiquait dans certaines mlodies,
lorsque le vers final manquait d'une syllabe, afin de
conserver un mouvement gal dans la mesure.
Teneidos. C'est le nom grec d'un morceau de musique
pour la flte.
Tenue. Note soutenue pendant un certain nombre de
mesures ou de temps.
Ternaire (mesure). Mesure divise en trois temps.
Terpodium. Instrument appartenant l'espce de cla-
vi-cvlindre, invent en 1817 par David Buschmann, de
Gotha.
Terpolium. Instrument qui n'avait que des lames
de bois pour corps sonore qui taient mises en vibration
par friction. Il fut imagin par Loeschmann, Londres,
en 1817.
Tertia conjongtarum. Nom latin de la seconde
corde du ttracorde synnemenon.
Tertia divisarum. Seconde corde du ttracorde
dieuzeugmenon.
454
TH
Tertia excellentium.
Nom latin de la seconde corde
du ttracorde
hyperbolacon.
Ter unca. Nom ancien de la double croche.
Testatore, surnomm il vecchio, auquel on doit le
dveloppement du violon,
vivait Milan vers la fin du
quinzime sicle.
Testore (Carlo Giuseppe). Bon luthier de l'cole
milanaise, travaillait en
1750; il est plac au rang des
bons facteurs de cette cole.
Testudo. Nom latin du luth.
Tte. La tte ou le corps d'une note est cette partie
qui en dtermine la position, et laquelle tient la queue,
quand elle en a une.
Ttracorde. Ce mot grec vient de ttra, quatre, et
cord,
corde.
Ttracorde tait galement le nom donn la lyre
d'Olympe et de Terpandre qui n'avait que trois cordes.
Ttradiapanos. Nom grec de la triple octave.
Ttraoedios. Les Grecs appelaient de ce nom un
morceau de musique compos de quatre strophes, cha-
cune desquelles se chantait dans un ton diffrent des
autres.
Ttratonon. Nom grec de la quinte augments, ou
sixte mineure.
Thtre italien. La premire troupe d'opra italien
fut appele en France par le cardinal Mazarin, qui ne
laissait
chapper aucune occasion de faire sa cour la
reine Anne d'Autriche. Elle dbuta Paris en 1645,
sur
le thtre du Petit-Bourbon, par la Festa teatrale et la
Finta Pazza.
La reine Anne d'Autriche avait un tel
got pour le spectacle, qu'elle
y
allait incognito, mme
pendant le deuil, aprs la mort de Louis XIII, son poux.
Depuis cette poque, les italiens ne ngligrent jamais
les occasions
de venir faire fortune en France, o on tait
heureux de les possder et de les enrichir. L'cole mu-
sicale franaise est en grande partie redevable de ses
progrs l'cole musicale italienne, implante en France
par les uvres des meilleurs compositeurs et les exem-
ples des plus clbres chanteurs ultramontains. N'ou-
blions pas non plus que c'est un Italien, Servandoni, ha-
bile machiniste attach au service de Louis XV, qui
introduisit sur nos thtres les pantomimes dcora-
tions et tableaux. (Voyez Italie.)
TH 455
Thme. Sujet ou partie mlodique dterminant le
caractre de la composition musicale, ou contenant le
motif de l'ide principale qui
y
est exprime, et laquelle
se joignent ensuite les autres ides accessoires du mor-
ceau.
Thorbe. tait une sorte de grand luth qu'on appelait
galement luth-basse et quelquefois chitarome il avait
deux, manches droits accols paralllement sous un
grand nombre de cordes, le premier manche et le plus
petit semblable celui du luth portait six rangs de cordes
de laiton, le second manche plus long soutenait huit
cordes de boyaux qui servaient pour les basses.
Thorbe-Glavecin. Invent en 1700 par Jean Fleis-
cher, tait un instrument clavier, ayant trois registres,
dont deux de cordes boyau et le troisime de cordes
d'acier.
Thorie musicale. Le mot thorie vient du grec
thria (contemplation), et ainsi comprend la partie
contemplative, spculative d'une science ou d'un art. Ce
terme est ordinairement pris dans le sens oppos du
moi pratique.
En musique, il
y
a deux manires bien tranches
d'envisager la thorie : la premire consiste recher-
cher comment le son se produit et se propage, et quels
sont les rapports des sons entre eux. c'est la science de
Vacoustique; la seconde s'occupe de combiner les sons
pour faire prouver l'me une impression dplaisir ou
de peine, en d'autre termes pour mouvoir, c'est Yart
musical proprement dit.
Sans prtendre nier les avantages de l'acoustique et
tout en reconnaissant, au contraire, les importantes
dcouvertes ralises par les travaux des Pythagore, des
Euler, des Lagrange, des Chladni, des Savart, des Sau-
veur, etc. Nous pensons que cette branche des connais-
sances physico-mathmatiques doit demeurer le domaine
exclusif des savants, et qu'elle n'est rien moins qu'utile
au compositeur. C'est donc tort, suivant nous, que
certains matres prtendent baser uniquement sur
l'acoustique la thorie de l'art musical, et croient devoir
entrer en matire par un dluge de dmonstrations
arithmtiques et algbriques, o il n'est question que de
puissances, de racines et d'quations; autant vaudrait,
pour un peintre, commencer l'tude de son art par la
thorie de la lumire, des couleurs, des droites et des
456 TH
courbes, etc. Encore une fois, tout cela n'est dans ce cas,
qu'un vain et strile talage de science : on peut tre un
habile thoricien, un excellent contrepointiste, un grand
compositeur, on peut tre Mozart ou Haydn, Bach ou
Palestrina, Gluck ou Beethoven, Meyerbeer ou Rossini,
Halvy. Thomas ou Verdi, sans connatre les rapports
mathmatiques des sons, sans savoir, par exemple, que
la quinte est dans la proportion de 3 : 2.
Mois en rejetant l'acoustique de l'enseignement pure-
ment musical, cet enseignement prsente encore deux
objets bien distincts et d'un intrt gal, ou pour mieux
dire, dont l'un n'est que le moyen d'arriver la ralisa-
tion de l'autre : nous entendons parler ici de la partie
technique ou matrielle, et de la partie esthtique ou idale.
La premire tudie les diverses modifications dont le
son est susceptible quant la hauteur, la dure,
l'intensit et au timbre; les diverses combinaisons qu'il
offre relativement la succession ou la simultanit,
c'est--dire la mlodie et Yharmonie. La seconde, qui est
l'expression la plus leve de la thorie, qui en est le
rsultat, le but, en un mot la mise en uvre, apprend
faire des prceptes une juste application, et des lments
un emploi convenable sous le rapport potique et philo-
sophique de l'art
;
c'est elle qui exprime les sensations,
qui peint les mouvements de l'me, aussi bien que )es
scnes de la nature, c'est elle qui parle ce langage si
souple, si vari, si riche et si puissant, dont tous les
hommes ont instinctivement l'intelligence.
Enfin la thorie musicale embrasse encore dans sa
gnralit l'art d'excuter une uvre et les procds
d'excution. La musique a pour interprtes la voix et les
instruments
;
la fabrication de ces derniers constitue
donc, ce titre, l'une des branches les plus intres-
santes de la science musicale; mais en gnral, les
individus qui s'y consacrent en font leur spcialit pres-
que exclusive, et se bornent fournir aux excutants les
instruments dont ceux-ci ont besoin
;
voil pourquoi on
ne peut gure admettre l'art du facteur que dans la
partie mathmatique de la thorie; nous ne laisserons
pas d'observer toutefois qu'un bon facteur doit tre
autant que possible acousticien, musicien et mme pra-
ticien, afin de dcouvrir les dfectuosits des instru-
ments, et de pouvoir
y
remdier, ainsi que pour tre
mme d'inventer des instruments nouveaux.
TH
457
Quant l'excution, son rle par rapport la musique
est bien plus important encore que ne l'est la dclama-
tion pour la posie, la littrature et le thtre. En effet,
un livre n'a aucunement besoin d'tre rcit, ni une pice
d'tre reprsente : la simple lecture suffit pour mettre
le public en communication avec la pense de l'auteur.
Une partition musicale, au contraire, n'est qu'une lettre
morte pour la plupart des lecteurs : l'excution seule
peut vivifier l'uvre endormie et faire subir l'inerte
chrysalide une brillante transformation. Ce n'est donc
pas sans motif que l'tude du chant et le jeu des instru-
ments tiennent une si grande place dans la thorie
musicale; il ne viennent toutefois qu' la suite des
dmonstrations qui ont pour objet Yart de composer.
Ainsi que nous l'avons dit en commenant, cet art est
des plus difficiles et des plus complexes : il comprend les
principes lmentaires, la mlodie, le rhythme Yharmo-
nie, la haute composition (le contrepoint et la fugue),
Yinstrumentation, la coupe et la forme des morceaux,
enfin les diffrentes espces de style dont on peut faire
usage en tel ou tel cas. A la connaissance de tout ce qui
prcde se rattachent encore les crits relatifs l'art mu-
sical sous le point de vue esthtique, historique ou
critique. Ainsi, -Ja considrer dans son ensemble, il n'y
a pas de science plus vaste ni plus leve que celle qui se
rattache la thorie musicale.
Vouloir indiquer ici tous les thoriciens clbres et les
uvres qui les ont illustrs, se serait nous engager
donner une histoire complte de la musique. Le trs-
petit nombre d'ouvrages que l'antiquit nous a transmis
sur cette matire prouve qu'
cette poque les considra-
tions spculatives l'emportaient gnralement sur la
dmonstration pratique. Au moyen-ge on commena
tenir quelque compte des dfinitions, prsenter des
rgles sur quelques faits isols, et adonner des exemples
de leur application. Mais ce n'taient encore, vrai dire,
que des bauches imparfaites. Dj l'cole nerlandaise
avait rpandu son systme, dj Monteverde avait
accompli une rvolution par l'emploi de la septime, et
pos les bases d'une tonalit nouvelle, sans que la
thorie crite et fait de bien grand progrs.
Les matres servaient de modles, et l'enseignement
oral compltait le plus souvent l'ducation des musiciens.
Cependant aux seizime et dix-septime sicles, et
458 TH
dj mme vers la fin du quinzime, on vit paratre quel-
ques ouvrages qui favorisrent puissamment les tudes
musicales et que l'on peut considrer comme des monu-
ments prcieux pour l'histoire de l'art
;
tels sont les traits
deGaforio, de Zarlino, dePrsetorius et autres. Enfin, au
dix-huitime sicle, Rameau ft faire un pas immense
la didactique; un grand nombre de savants subirent
l'influence de ses ides, et de toutes parts on s'occupa
d'approfondir et de perfectionner la thorie musicale.
On doit ce noble lan les travaux de Mattheson, de
Marpurg, de Knecht, de Kirnberger, de Sabbatini, de
Sorge, de Daube, de Vogler, de d'Alembert, de J.-J.
Rousseau, etc. En
1802,
Catel publia Paris un Trait
$Harmonie
,
qui eut un grand succs de vogue et d'es-
time. Cet ouvrage est bien rdig, mais il est appuy sur
une thorie qu'on peut trouver incomplte. Parmi les
crivains distingus qui marchrent sur ses traces, il
faut citer Berton, auteur d'un Trait d'Harmonie suivi
d'un Dictionnaire des accords. Un peu plus tard, Rei-
cha importa en France l'empirisme de Gottfried Weber,
et jouit longtemps d'une rputation de science aujour-
d'hui trs-conteste. Ghrubini publia ensuite un trait
de contrepoint et de fugue, fruit d'une longue exprience
et d'un savoir pur.
Les thoriciens dont les uvres sont aujourd'hui le
plus estims, sont M. Ftis dont tout le monde connat
les savants et importants travaux, M. Kastner, crivain
instruit et consciencieux, MM. Berlioz, Zimmermann,
Barbereau, Franois Bazin, Gewaert, Savart, Ehvart,
et quelques autres.
Sous le rapport purement thorique, l'Allemagne, au
dix-neuvime sicle, n'a rien envier la France, avec
Gottfried Weber, Logier, Andr, Marx, Fink, Schnei-
der, etc., et elle possde en outre une foule d'crivains
distingus qui ont fort ingnieusement approfondi les
mystres de l'esthtique musicale.
Pour ce qui est des mthodes particulires de chant
ou d'instruments, le nombre en est si considrable, que
nous devons renoncer toute citation de cette nature.
Nous nous bornerons observer que des hommes sp-
ciaux et tout fait comptents n'ayant pas ddaign d'y
appliquer les ressources de leur talent et de leur exp-
rience, tous les enseignements les plus infimes comme les
plus importants et les plus levs
y
tiennent leur place, et
TIM 459
offrent l'lve des sujets d'tude aussi varis que com-
plets.
Tel est le rsum succinct des matires qui composent
la thorie musicale. Nous n'en avons indiqu que les
principales divisions et subdivions pour viter des dve-
loppements que ne comporte point la nature de cet ou-
vrage.
Thsis (en frappant). Un des deux temps de la mu-
sique des Grecs. Per thesin indique surtout un chant
ou contrepoint o les notes montent du grave l'aigu.
Thsang. Instrument chinois, compos d'une certaine
quantit de petits tubes, munis d'anches libres et de
diffrentes longueurs. II est enferm dans un vase ayant
peu prs la forme d'une thire, dont le goulot sert in-
troduire le vent avec la bouche. Cet instrument a donn
naissance Porgue expressif.
Tibia. Ancien nom latin des instruments vent avec
des trous, tel que la flte.
Tibia multisonans. Flte d'un ton fort, en usage
ches les anciens Egyptiens.
Tibia sisticinum. Flte employe par les anciens
dans les funrailles.
Tibi/e bifores et tible conjonct\e. Doubles fltes.
Tible pares. Espce de flte double des anciens,
forme de deux fltes d'une gale grandeur, jointes en-
semble.
Tibilustrium. C'est le nom de la fte des joueurs de
flte des anciens Romains, qui se clbrait tous les ans,
le 15 juin.
Tierce. C'est une des heures canoniales, ou partie de
l'office divin, dont les psaumes se mettent en musique
et s'appellent psaumes de tierce.
Tierce. Intervalle de trois degrs. On distingue plu-
sieurs espces de tierces, savoir : la tierce majeure, la
tierce mineure et la tierce diminue, la tierce augmen-
te ou superflue et la tierce de Picardie qui est la tierce
majeure frappe au lieu de la mineure, la finale d'un
morceau compos en mode mineur.
Timbales. Instrument import en France par les
Sarrasins et les Maures; elles parurent sous le rgne de
Charles VII. Elles se composent de deux bassins sph-
riques, en cuivre, sur lesquels on adapte des peaux for-
tement tendues au moyen d'un cercle de fer et de plusieurs
crous. En frappant successivement sur l'une et l'autre
460 TIR
de ces peaux avec des baguettes, on obtient deux sons
trs-distincts. Leur diffrence provient de l'ingalit des
bassins. En serrant plus ou moins les crous du cercle
de fer, on parvient changer le ton des timbales, et
dans certains tons on les accorde de manire que la to-
nique soit la quarte au-dessous, ou la dominante h la
quinte suprieure, ce qui revient au mme.
Le roulement de timbales s'excute par le mouvement
alternatif des deux baguettes, en frappant deux coups avec
chacune d'elles. Le roulement de timbale produit un effet
surprenant dans le crescendo et le forte d'un orches-
tre. Il
y
a quelque chose de mystrieux et de sinistre,
s'il est fait pianissimo, ou si les timbales sont voiles.
Timbales. Jeu d'orgue dont les tuyaux sont en bois.
Il sonne l'unisson du bourdon de seize pieds. En accor-
dant le jeu des timbales un peu plus haut que ceux des
bourdons, on obtient une espce de tremblement qui
ressemble assez au roulement des timbales.
Timbre. Son d'une cloche, d'une lame mtallique ou
d'un ressort dont l'intonation peut tre apprcie.
Timbre est aussi la qualit sonore d'un instrument ou
d'une voix. On dit : ce violon a du timbre; cette voix est
bien timbre. On dit aussi d'une voix pntrante, qu'elle
a un timbre mtallique.
On donne encore le nom de timbre la double corde
boyau place contre la peau infrieure du tambour et qui
vibre avec elle.
Timbres. Nom que les vaudevillistes donnent aux airs
connus sur lesquels ils composent leurs couplets.
Tintinnabulum. Instrument des anciens, compos
d'un certain nombre de cloches.
Tipo, Type. Nom de la corde gnratrice du systme
musical.
Tirade. Nom que Ton donnait autrefois une suite
de plusieurs notes de mme valeur, se suivant par degrs
conjoints en montant ou en descendant.
Tirana, Tonadilla. Chansons espagnoles qui se
chantent et ne se dansent pas. La mesure de ces airs
est trois temps, d'un mouvement un peu lent et d'un
rhylhme syncop.
Tirasse. Clavier de pdales qui, dans les petites or-
gues, fait baisser seulement les basses du clavier la
main.
TON 461
Tira tutto. Registre qui ouvre tous les jeux de
l'orgue la fois,
Tocgate. Ancienne pice de musique crite pour le
clavecin, l'orgue ou le piano. Elle ne diffre de la sonate
qu'en ce qu'elle n'est compose le plus souvent que d'un
seul morceau.
Toccato. Mot italien dont on fait en franais toquet
ou doquet, qui est le nom de la quatrime partie de
trompette d'une fanfare.
To ho to. Espce d'intonation militaire de la trom-
pette, qui produit un effet semblable au son de ces
syllabes.
Ton. Ce mot a plusieurs acceptions en musique. Il
signifie d'abord un intervalle form par deux notes dia-
toniques, comme do, r,
etc. Dans la seconde acception,
il dsigne le mode ou la constitution d'une gamme quel-
conque, avec les signes qui la caractrisent. Enfin le ton
est le degr d'lvation ou d'abaissement d'un instru-
ment, rsultant de sa construction et de son accord.
Chaque ton a un caractre particulier. De l nat une
source de varits et de beauts dans la modulation.
Faut-il du gai, du brillant, du martial
,
prenez les tons
de do, r, mi. Faut-il du touchant, du tendre, prenez
les tons de la bmol, mi bmol, si bmol.
Tonalit. La tonalit est l'ensemble des rapports
mutuels qui existent entre les notes d'une gamme. Cette
dfinition a besoin d'tre un peu dveloppe.
La nature produit des sons en nombre immense, par
des moyens galement nombreux et avec une varit
infinie d'acuit et de gravit, d'intensit, de timbre et
d'expression.
Les sons produits dans la nature ne peuvent pas tous
appartenir h la musique. Les sons musicaux doivent
tre nettement apprciables l'oreille, conformes au
got, la raison, h l'organisation intellectuelle et artis-
tique de l'homme.
Les sons musicaux peuvent tre combins entre eux
de plusieurs manires. Les systmes de musique qui
ont rgn et qui rgnent encore dans le monde musical,
celui des Grecs, celui du plain-chant, le ntre, sont
quelques-unes de ces combinaisons possibles.
Toute manire de combiner les sons musicaux et
d'en former un systme de musique, se nomme une
tonalit.
462
TOU
En combinant les sons musicaux d'une manire qui
lui est
propre, en les groupant les uns ct des autres
d'une
certaine faon particulire, la tonalit moderne
cre
naturellement entre eux certaines relations mu-
tuelles qui lui appartiennent en propre, qui la caract-
risent, qui la distinguent des autres tonalits et qui for-
ment les lments constitutifs les plus intimes. Elle est
donc Yensemble des rapports qui existent entre les notes
de la gamme moderne ;
car la gamme est la formule qui
reprsente et rsume une tonalit. (Voyez le mot Har-
monie.
)
Tone. Espce de composition musicale des anciens
Grecs, dans laquelle on excutait plusieurs syllabes
successives sur le mme ton.
Tonique. Ease ou premire note de la gamme du
ton. Tous les airs finissent communment par cette note
surtout la basse.
Tons relatifs. Ceux dont la gamme prsente de
l'affinit avec le ton principal.
Tons de l'glise. Manire de moduler le plain-chant
sur telle ou telle finale pose dans le nombre prsent.
Ils sont au nombre de huit. Ils se divisent en tons au-
thentifies,
qui sont ceux o la tonique occupe peu
prs le plus bas degr du chant. On nomme tonsplagauoc
ceux o le chant descend trois degrs plus bas que la
tonique.
Tons ouverts. Se dit des sons que l'on obtient sur
le cor sans mettre la main dans le pavillon, les autres se
nomment tons bouchs.
Toph ou Tof. Ancien instrument des Hbreux, qui,
selon quelques auteurs, ressemblait au tambourin.
Torropit.
Nom de la guimbarde dans l'Estonie.
Touche.
La touche des instruments archet est la
partie
suprieure de leur marche, recouverte en bne,
et sur laquelle les doigts appuient les cordes pour varier
leurs intonations. Les touches de la guitare sont les
petits filets d'ivoire ou de cuivre, incrusts dans le
manche, et qui marquent les positions o il faut mettre
les doigts pour former les intonations. Les touches du
clavier, du piano ou de l'orgue, sont les leviers sur
lesquels les doigts agissent pour faire parler les notes.
Toucher. Jadis on disait toucher de certains instru-
ments
aujourd'hui on dit jouer de tous les instruments,
cependant on dit encore d'un artiste qu'il a un toucher
TRA 403
dlicat, un toucher brillant. Nanmoins il vaut mieux
dire un jeu brillant, un jeu dlicat.
Tournebout. Instrument ancien en l'orme de crosse
compos d'un tuyau de bois muni d'une anche renferm
dans une bote
,
for au milieu comme celle de quelques
chalumeaux.
Tourne-feuille. Petit instrument dont on se sert
pour tourner commodment les feuilles d'un cahier de
musique.
Tractus. Nom ancien d'un certain air triste qu'on
chantait autrefois dans l'Eglise catholique aprs l'ptre,
la place de l'alleluia. en prolongeant la voix en signe
de plainte.
Trait. On donne ce nom, en musique, aux divers
ouvrages classiques qui traitent avec mthode de la
thorie et de la pratique de la musique en gnral ou de
quelques-unes de ses parties, telles que l'harmonie, le
contrepoint ou la fugue.
Traits. Suite de notes rapides qu'on excute sur les
instruments ou avec la voix. Se dit aussi des phrases
mlodiques ou de successions brillantes d'harmonie.
Transition. Passage d'un ton un autre. L'art de
faire succder agrablement une modulation celle qui
la prcde est une des parties essentielles de l'tude de
la composition.
Transition enharmonique. C'est celle o une ou plu-
sieurs des parties font un intervalle enharmonique,
comme ut dise et
r
bmol. Les transitions enharmo-
niques produisent beaucoup d'effet la scne, surtout
lorsque les personnages prouvent une grande surprise,
ou qu'un vnement imprvu change tout coup leur
situation.
Transitus. Sons et accords qui tombent sur le temps
faible.
Transitus irregularis. Mauvaise succession de sons
ou d'accords.
Transitus regularis. Notes d'agrment.
Transmetteur du son. Espce de tambour acous-
tique, imagin Boston, en
1834,
par Suwyer.
Transposer. C'est noter ou excuter un morceau de
musique dans un autre ton que celui o il a t crit par
le compositeur.
Les tons et les demi-tons n'tant pas rgulirement r-
partis dans la gamme, l'intercalation d'un mme nombre
464
t
TRI
d'intervalles entre deux notes successives suffisantes la
vue ne le sont pas pour l'oreille et l'on est oblig d'aug-
menter l'un ou de diminuer l'autre, on
y
parvient
l'aide des di?es et des bmols.
Transpositeurs (Instruments). Un appelle ainsi les
instruments de musique dont le son est diffrent de la
note crite. Les principaux sont : la contrebasse, toutes
les fltes autres que la flte ordinaire, le cor anglais,
toutes les clarinettes autre que la clarinette en tit, le
basson quinte, le contre-basson, tous les cors autres que
le cor en ut aigu, certains cornets piston, toutes les
trompettes autres que la trompette en ut, en si, et en la.
les cornets simples, tous les ophiclides autres que
l'ophiclide en ut, le serpent, la guitare, les tnors et
les basses quand on les crit sur la clef de sol.
Treizime. Intervalle de treize degrs, ou l'octave de
la sixte.
Tremblant. Modification des jeux de l'orgue
,
qui
semble les faire trembler volont. Il
y
a deux espces
de tremblant, l'un vent ouvert et autre vent clos.
Trembler. Remuer avec art les doigts sur les trous
d'un instrument vent.
Trmolo. Le trmolo est un effet que l'on produit
sur les instruments archet, en faisant aller et venir
sur les cordes l'archet avec tant de rapidit que les sons
se succdent les uns aux autres, sans laisser remarquer
aucune solution de continuit.
Les effets du trmolo se rendent parfaitement sur le
piano, en frappant au moins deux touches alternative-
ment et avec un mode d'excution trs-rapide.
Triangle. Instrument de percussion qui consiste en
une petite tringle de fer plie en forme du triangle, sur
laquelle on frappe avec une baguette de mme mtal
pour en tirer du son
;
pour que les vibrations du
triangle ne soient pas interrompues, on a soin de le
tenir suspendu un cordon.
On fait aujourd'hui un grand abus de cet instrument,
comme de tout ce qui perce, mugit, clate, tonne,
grince et siffle. Son timbre mtallique ne convient
qu'aux morceaux trs-brillants dans le forte, et d'une
bizarrerie sauvage dans le piano. Weber en a fait un
usage heureux dans ses churs de Bohmiens de Pr-
ciosa, et Gluck, bien mieux encore, dans le majeur de
son effrayant ballet des Scythes.
TRI
465
Cependant, on entend avec plaisir le timbre cristallin
et un peu mordant du triangle au milieu des airs de
danses. Il s'allie on ne peut mieux, ce nous semble, avec
les allures piquantes, les poses voluptueuses et les cam-
brures hardies des prtresses de Terpsychore.
Trigbalac, Instrument de percussion, compos de
deux marteaux qui frappent sur une planchette. On en
fait usage Naples pour accompagner les chants de
Pidcinella.
Trcinium. Nom de petits morceaux de musique pour
trois cors ou pour trois trompettes.
Trigonon. Instrument cordes en forme triangulaire
d'origine gyptienne, dont se servaient les Grecs.
Trille. Mouvement alternatif et acclr sur deux
notes voisines, qu'on indique par les deux lettres tr. Les
plus belles qualits du trille sont la rapidit, la souplesse
et la parfaite galit. Le trille vocal est trs-difficile
;
il
demande une tude longue et persvrante
;
un trille
prolong et bien nuanc manque rarement son effet
sur le public. Les instrumentistes aussi cultivent le
trille, qui donne beaucoup de brillant l'excution. On
-peut, sur le piano et sur le violon, faire des trilles
doubles, en tierces ou en sixtes. Le trille se nomme
aussi quelquefois cadence, parce que le trille arrive
naturellement sur l'accord de dominante qui fait chute,
cadence, sur la tonique.
Trimeles. Les anciens Grecs entendaient par ce mot
un morceau de musique vocale accompagn de la flte
et form de trois strophes, dont la premire tait crite
dans le mode dorien, la seconde dans le mode phrygien,
et la troisime dans le mode lydien.
Trinolon. Instrument cordes des anciens Grecs, il
avait la forme triangulaire, et a donn naissance la
harpe.
Trio. Composition musicale trois parties, dont
chacune revt le caractre de voix principale, ou compo-
sition deux voix concertantes accompagnes d'une
troisime qui leur sert de voix fondamentale. Le trio
vocal est presque toujours accompagn par l'orchestre,
ou par un instrument tel que le piano, la harpe, etc.
Le trio instrumental n'est compos que de trois parties
rcitantes.
Le trio est regard comme la plus parfaite de toutes
les compositions, parce que c'est celle qui produit le plus
14..
466 TRO
d'effet proportionnellement aux moyens employs.
On cite parmi les trios clbres, le charmant trio du Ma-
trimonio Segreto, de Cimarosa, pour trois voix de
femmes; le magnifique trio de Guillaume Tell
,
pour
trois voix d'hommes; le trio bouffe de YHtellerie por-
tugaise, de Ghrubini
;
le trio des Papatacci, de Ylta-
liana in Algeri. Ces exemples suffisent pour montrer
quel effet peuvent produire trois voix entre les mains
d'hommes de gnie, qui toutes les ressources de l'art
sont familires, et qui trouvent facilement, ou pour
mieux dire sans les chercher, et par une sorte d'intui-
tion, des ides qui se prtent toutes les combinaisons
vocales; mais il faut en outre beaucoup d'tudes et une
grande exprience.
On nomme aussi trio, une partie du menuet sympho-
nique ou instrumental qui occupe le milieu du morceau,
et aprs laquelle on reprend le premier motif.
Triolet. Groupe compos de trois notes pour deux,
et sur lequel on place souvent un 3. Ainsi, par exemple,
dans la mesure de deux noires, marqu
2/4,
une mesure
peut tre compose de cinq et mme de six croches, si
l'on
y
introduit un ou deux triolets. Les trois croches
n'ont pas plus de dure que les deux croches qu'elles
remplacent, et il faut par consquent les passer plus
vite.
Triphon. Instrument de musique qui a la forme d'un
clavecin droit. Le son que cet instrument produit est
agrable et ressemble celui de la flte.
Triphonie. On nommait ainsi dans l'ancienne mu-
sique, celle crite trois voix, ou trois portes.
Trite, dans la musique ancienne, tait le nom de la
troisime corde du ttracorde , en allant de l'aigu au
grave; mais ce mot n'tait usit que lorsque l'on parlait
des trois ttracordes suprieurs.
Triton. Intervalle dissonant, compos de trois tons
entiers.
Tritonicon. Espce de basson, construit en Bohme
en 1853,
par Perveny's.
Tro. Instrument de musique, espce de violon en
usage dans le royaume deSiam.
Trochlon. Nom donn par Dietz, en 1812,
un ins-
trument de forme ronde, garni de touches mtalliques,
mises en vibration par un archet circulaire ou continu
moyen d'une pdale.
TRO 467
Trombone. Cet instrument vent en cuivre, non
perc de trous, avec une large embouchure, a aujour-
d'hui encore presque la mme forme qu'il avait il
y
a
trois sicles. Ses tuyaux, introduits dans une pompe
deux branches qui se recouvre sur une longueur de vingt-
cinq pouces environ, s'allongent et se raccourcissent
volont, et donnent le moyen d'attaquer les tons aigus et
les tons graves de son diapason. Il
y
a quatre espces de
trombones, qui portent le nom de quatre voix humaines :
le trombone soprano, le trombone alto, le trombone
tnor et le trombone basse. Le trombone soprano et
et le vrai trombone basse sont peu prs inconnus en
France, et le trombone alto
y
est peu employ; cepen-
dant on emploie toujours dans nos orchestres trois trom-
bones, dont deux trombones tnors et un trombone
dit basse. On peut complter ce qui manque dans le
grave du dernier trombone, par l'emploi de i'ophiclide,
que dans les partitions modernes on unit souvent aux
trombones.
Les trombones sont propres l'expression la plus so-
lennelle, et produisent un trs-bel effet dans les churs
guerriers et religieux, dansles marches triomphales, etc.
Un trouve dans les uvres des matres, de magnifiques
exemples de l'emploi des trombones. Telle est la fou-
droyante gamme en r mineur sur laquelle Gluck a des-
sin le chur des furies au second acte ftlphignie en
Tauride. Tel est, plus sublime encore, le cri immense
des trois trombones unis, rpondant comme la voix cour-
rouce et formidable des dieux infernaux l'invocation
d'Orphe : Spectres! Larves! Ombres terribles!
Trombotonar. Espce de contre-basse d'harmonie
imagine et construite en 1855 par Besson.
Trompe. Instrument employ dans la musique de
chasse. La trompe est aujourd'hui un instrument trs-
perfectionn. Il n'est pas tonnant que des sons, habile-
ment dirigs, produisent une agrable harmonie. Cepen-
dant nos aeux, qui se servaient du hochet, voire mme
de la corne de buf ou de blier, avaient tout autant de
plaisir que nous. Les anciens livres de chasse sont rem-
plis d'exclamations sur le bonheur d'entendre la musique
en pleine fort.
Sous Louis XIII, on ne savait pas tirer un grand parti
de la trompe. Salnove, dans sa Vnerie royale, fait un
grand loge de ce roi, parce qu'il inventa une mthode
468
TRO
nouvelle de sonner pour le renard. Elle consistait en trois
tons
grles termins par un gros ton.
La trompe, trop petite sous Charles IX, devint trop
grande au temps de Louis XIV
;
on passa d'un excs
un autre. Ces grandes trompes taient fort incommodes,
surtout pour les valets pied obligs de traverser des
fourrs garnis d'pines. Il les bosselaient, et quelquefois
cet instruent monstre les empchait de suivre en droite
ligne les chiens et la bte. L'exprience fit arriver un
juste milieu
;
on revint un peu sur ses pas, et l'on trouva
la trompe dont nous nous servons aujourd'hui.
La tablature de la trompe se compose des harmoniques
du ton dans lequel on joue. Ce ton est celui de r pour
la trompe; il est invariable, puisque l'instrument n'a
pas de corps de rechange. On a choisi celui de r, parce
qu'il est assez clatant sans tre aigu. Les harmoniques
sont r, celui que l'on prend sur le violoncelle, en met-
tant le premier doigt sur la quatrime corde, la qui suit
ce r l'aigu, r,
fa,
la, r, mi,
fa,
sol, la, et le si par
extension. La musique est note toujours en ut, et par
consquent le
fa
que l'il voit sur le papier, reprsente
le sol que l'oreille entend. A cette tablature, il faut ajou-
ter le si bmol, qui reprsente l'oreille un ut naturel.
C'est une fort belle chose entendre que vingt trompes
se rpondant au milieu des bois, et signalant toutes les
pripties du drame dont un pauvre cerf est le hros. Sa
mort tant ncessaire au dnouement du cinquime acte,
tous les chasseurs qui ne veulent pas faire fiasco ou re-
venir bredouille, concourent au succs de la pice
grand renfort de poumons. Ces trompes, dissmines
tant que le drame se joue, font connatre chaque cir-
constance aux chasseurs et aux chiens loigns. On sonne
la vue, le retour, le volcelet, le dbuch, etc. Tout le
monde comprend ce que chacun veut dire, et les chas-
seurs, galopant travers les bois, manuvrent, quoique
spars, aussi bien qu'un rgiment sous les yeux de son
colonel.
Ces trompes, dont les sons vous charment en dtail,
produiront un plus bel effet encore, lorsque runies pour
le hallali, pour la cure, elles feront entendre leur chant
de victoire.
Trompette. Instrument vent, sans trous, compos
d'un tube en cuivre d'une gale grosseur partir de
l'embouchure jusqu'au pavillon, et deux fois repli, afin
ro
m
de pouvoir, en jouant, le tenir plus commodment. La
trompette a les mmes sons harmoniques que le cor,
mais une octave plus haut dans la plupart des trous.
La trompette a un son hroque, guerrier et joyeux.
Elle donne plus d'clat aux magnificences d'une fte.
Elle ajoute la vivacit de la musique et se joint assez
bien au jeu solennel des timbales. La trompette est em-
ploye dans l'opra, surtout dans les passages brillants,
dans les morceaux fortes passions, dans les churs,
dans les finales, etc.
On emploie aujourd'hui aussi la
trompette pistons ou cylindres, qui fait toutes les
notes de la gamme chromatique, ce qu'on nomme pour
cette raison, trompettes chromatiques, en Allemagne et
en Italie. (Voyez Trompette a piston.)
Trompette. Jeu d'orgue de la classe des jeux d'an-
ches, qui sert d'unisson au principal.
Trompette chinoise. Franois Gemelli, dans le troi-
sime volume de ses voyages, dit que les Chinois ont un
instrument en bois qu'ils estiment beaucoup, dont la
forme est celle d'une cloche de trois pieds de longueur et
entoure de cercles en or.
Trompette marine. Instrument mont d'une seule
corde trs-grosse, qu'on joue avec un archet, en ap-
puyant sur cette corde avec le pouce de la main gauche.
La forme de cet instrument est fort allonge, et son dos
est termin en poire. La trompette marine est surtout
clbre par la prdilection du Bourgeois gentilhomme.
Trompette a pistons. Le mcanisme de la trompette
pistons ressemble celui des instruments vent qui
forment leurs sons par le secours de trous ou de clefs,
puisque les pistons sont disposs de manire qu'en les
faisant agir on modifie volont le degr d'lvation du
son. Par ce mcanisme la trompette se trouve enrichie
d'une grande quantit de notes qu'il lui tait impossible
de produire auparavant.
Trompette romaine. Cet ancien instrument des
Romains, d'une forme droite, se terminait en une ouver-
ture vase et un peu recourbe, ainsi qu'on le voit sur
la gravure de plusieurs mdailles et sur quelques sculp-
tures de marbres anciens.
Trompette paphlagonique. Ancien instrument grec
d'un son grave et dont le pavillon ressemblait une tte
de buf.
14...
470 TUB
Trompettine. Petit cornet de poste construit en 1854
Ingolstadt par Stegmaer.
Trompettiste. Artiste, qui, dans un orchestre, excute
la partie de trompette.
Troubadours. Potes provenaux des XI
e
,
XII
e
et
XIII
e
sicles, ainsi appels du mot troubar, trouver,
inventer : ils nommaient leur art la gaie science. Les
plus clbres d'entre eux furent P. Vidal, Arnaud
Daniel, Janfred Rudel, Bertrand de Born, Anselme
Fayditt, Raimond Branger, comte de Provence, Richard
Cur-de-Lion, Thibaut, comte de Champagne et Guil-
laume IX, comte de Poitiers. Leurs posies, qui, pour
la plupart appartiennent au genre lyrique et sont trs-
courtes, se composaient de sirventes, plaints, tensons,
ballades, novas (ou nouvelles). Ils chantaient surtout la
chevalerie et l'amour.
Le troubadour de profession allait de chteau en ch-
teau rciter ou chanter ses vers, en s'accompagnantd'un
instrument, ordinairement d'une espce de guitare :
souvent aussi il se faisait accompagner d'un jongleur
(Comir), par lequel il faisait chanter ses vers. Les trou-
badours taient rpandus dans le Midi de la France : Ils
florissaient surtout Toulouse, Narbonne, Aix en
Provence. Us parlaient la langue d'Oc, ou le languedo-
cien.
Trouvres. Potes du nord de la France, qui du XI
e
au XV
e
sicle ont compos en roman-wallon ou langue
d'Ol (le vieux franais)
;
ils existaient en mme temps
que les troubadours, etleurnomale mme sens {trouver,
troubar). Mais, tandis que les troubadours ont surtout
brill dans le genre lyrique, c'est la posie pique que
les trouvres se sont livrs de prfrence. Us ont admi-
rablement russi clans la grande pope, qui a pris par
excellence le nom de roman, et dans les fabliaux, qui
sont souvent chez eux' des chefs-d'uvre d'originalit,
de navet, de gaiet. Les trouvres ont aussi lait
quelques posies lyriques, tels que lais, virelais et bal-
lades; enfin on leur doit les romans de chevalerie en
prose. Les plus clbres trouvres sont Wistace ou
Wace, Lambert, Alexandre de Bernay, Renaud, Gau-
der, Gilbert de Montreuil, Jehan deFlagy, Guillaume de
Lorris et Jean de Meung, dit Clopinel.
Tuba. Espce de trompe romaine, dont le son tait
TYM 471
trs-born, mais qui donnait des sons trs-forts et trs-
clatarils.
Turquie (De la musique en). Il est certain que les
Turcs aiment beaucoup la musique, sans lui donner
cependant une valeur d'art comme en France, en Alle-
magne, en Italie, etc., etc. Aujourd'hui, il est de bon ton
Gonstantinople de trouver un plaisir la musique, et
de savoir jouer de quelque instrument. Les Turcs bien
levs chantent peu, et les hommes du peuple beaucoup.
Mais si aux yeux des premiers c'est chose dshonorante
que de chanter en public pour de l'argent, ils aiment
nanmoins se faire entendre dans les cercles intimes et
dans leur harem. C'est tort que quelques crivains ont
prtendu que les Turcs n'ont aucune thorie musicale. Il
est vrai que la plupart apprennent chanter et jouer
par le seul secours de l'oreille. Mais ils n'en ont pas
moins des signes rguliers pour noter les sons, un
rhythme particulier dans leur mlodie. Leur chant a
une juste intonation et leur excution une mesure conve-
nable. Pour noter leurs sons, ils se servent de nom-
bres, comme les anciens, et leurs chansons populaires les
plus rpandues sont notes de cette faon.
La musique turque, comme celle de toutes les nations
qui ignorent l'art vritable, ne sort pas des deux extr-
mes. Elle est trs-douce ou bien excessivement heurte
et bruyante. L'amour et la guerre, voil les ternels
textes des chansons turques, et leurs harmonies dpas-
sent rarement l'accord de la dominante, ou celui du
mode relatif en mineur, et vice versa. Les chants d'a-
mour et les chants militaires sont toujours dans le
mineur, caractre propre des nations qui ne connaissent
pas l'art musical.
TuTTf. Mot italien qui signifie tous et qui sur les par-
titions indique que toutes les parties doivent se faire
entendre ensemble.
Tuyaux d'orgue. Tubes de bois, d'tain ou d'autre
mlange mtallique appel
toffe,
qui rendent des
sons, lorsque le vent des soufflets
y
est introduit.
Tympanjscho. Ancien instrument en usage chez les
franais
;
selon le dire de Pretorius, il se composait de
trois petites planches trs-minces, jointes grossirement
sous la forme de pyramide trs-alonge. Sur la plan-
chette suprieure tait tendue, une longue corde de
boyau que Ton faisait vibrer par le moyen d'un archet de
472 UKR
crin enduit de colophane. On ajoutait quelquefois une
seconde corde plus courte, accorde l'octave aigu.
Tympanum. Ancien instrument dont les cordes taient
mises en vibration par de petits btons garnis leurs
extrmits de boules d'toupe dont on frappait les cordes
avec les mains.
Typotone. Nouveau diapason invent par M. Pin-
sonnt, Amiens. Ce diapason est form d'une petite
plaque en nacre, perce d'une ouverture en biseau, sur
laquelle est applique une petite lame mtallique. Cette
plaque se met entre les dents, en tournant le ct de la
lame vers l'intrieur de la bouche
;
et le moindre souf-
fle suffit pour en tirer un la assez semblable celui que
produirait un hautbois.
Tyrolienne. Espce de valse ou mlodie note en
triolets, en mesure trois temps et d'un mouvement
modr. Les chansons tyroliennes ont peu prs toutes
la mme allure et s'excutent ordinairement avec une
voix de tte assez particulire, et que les nationaux
appellent dudeln. La tyrolienne de Guillaume Tell est
clbre.
U
Ugab. C'tait, chez les Hbreux, le nom gnral des
instruments vent.
Ukraine (Chants populaires de 1'). Les airs de l'U-
kraine respirent la douceur, le calme et la tristesse. Le
peuple vaincu et perscut pleure dans ses chants la
perte de sa libert. Ses dumki sont comme les derniers
rayons de son bonheur pass que la tyrannie n'a pu bri-
ser. On n'y retrouve point, comme dans les chants
Kosacks ou Serbes, cette soif de la vie active et aventu-
reuse qui leur est commune avec les Klephtes et les Mon-
tngrins
;
chez les paysans d'Ukraine, la passion des
armes cde au got paisible de la vie agricole : le foyer
domestique est prfr tous les prestiges de la gloire;
les femmes et les hommes du peuple sont potes et musi-
ciens. Partout le travail du jour finit par une chanson,
et souvent le^ sentiments de la vie simple, sans acci-
UND 473
dents ni prils, se transforment en affections pures, qui
s'exhalent en lgies plaintives, remplies de tendresse et
d'amour.
Ce qui ajoute encore la douce tristesse de ses airs
nationaux, c'est que l'Ukraine est couverte de nombreux
tertres tumulaires (mogily) sous lesquels reposent les
guerriers morts pour la patrie.
La langue du peuple d'Ukraine est favorable la
musique
;
elle tient le milieu entre la langue polonaise
et la langue russe. Quant aux airs avec lesquels on berce
les enfants, ils se sont perptus de gnration en gn-
ration, sans avoir t nots.
Les femmes de l'Ukraine ont un got prononc pour
leurs dumki. Elles bercent leurs enfants avec ces mlo-
dies douces et mlancoliques, et c'est ainsi qu'elles
restent jamais
graves dans la mmoire et dans le
cur. Les Adieux du Kosack, la dumka si touchante de
Hyrco, les Plaintes du Voisin, les Regrets d'une jeune
Marie, etc.
, tous ces chants, souvenirs prcieux de
l'enfance, ne s'oublient jamais.
Plusieurs autres chants sont cits galement, comme
venant de la patrie des Kosacks : Le bal et VOrage, le
Kosack et la Dziuba, que Ton chante en s'accompagnant
sur la bandura, espce de thorbe russe. Ces chants sont
plus gais et ont, par cela mme, moins de caractre que
les dumki.
L'instrument favori du peuple d'Ukraine est la
sensla, qui est d'origine slave. Cet instrument n'avait
d'abord que trois cordes mtalliques sur lesquelles on
jouait avec des btons. Le nom de guslarz qui veut dire
devin, ou diseur de bonne aventure, drive de cet instru-
ment, qui s'appelait, en langue slave, guz'e ou huszle.
Ultima conjunctarum. Quatrime corde du ttra-
corde synnemenon.
Ultima divisarum.
Quatrime corde du ttracorde
dizeugmenon.
Ultima excellentium.
Nom latin de la quatrime
corde du ttracorde hyperbolon
du systme des anciens
Grecs.
Unca. Nom ancien de la croche.
Unda maris. C'est le nom d'un jeu d'orgue de tuyaux
anches de huit pieds, accord un peu plus haut que les
autres jeux, et, cause de cela
4
formant avec eux une
474 UNI
sorte de battement qui a quelque analogie avec le mou-
vement des flots.
Unighordum. Nom de la trompette marine.
Union des registres. L'union des registres de la
voix humaine doit tre en gnral le rsultat de l'tude
et de l'art. Elle consiste s'exercer continuellement
retenir la voix de poitrine, et forcer peu peu la voix
de tte, pour tablir, entre la premire et la seconde,
l'galit la plus parfaite possible. Cependant, dans le cas
o la voix de poitrine, serait plus faible que celle de
tte, il faut renforcer l'intonation des dernires cordes
de poitrine, et dans une juste proportion leur joindre
les premires de fausset. Cette runion des registres est
une qualit rare chez les chanteurs, et lorsqu'elle n'est
pas un don naturel, il faut beaucoup de temps ou
d'tudes persvrantes pour l'acqurir.
Unisson. Rapport de deux sons sur le mme degr,
c'est--dire d'gale lvation ou gravit. L'unisson est
produit par un gal nombre d'oscillations de deux corps
gaux vibrant dans un gal espace de temps. Si donc
une corde faisant cent vibrations dans une seconde,
rend un do, une autre corde de ]a mme longueur et
grosseur, ayant la mme tension, fera dans Je mme
temps le mme nombre d'oscillations et rendra le mme
do. Ainsi, deux ou plusieurs voix ou instruments faisant
entendre le mme son, font des unissons.
Le mot unisson, et son abrviation unis, s'crivent
dans la partie d'orgue pour indiquer que les notes doi-
vent tre joues sans accompagnement, et que les
octaves seulement doivent tre redoubles. Le mme
mot, crit dans une partition
,
indique que l'on doit
jouer les mmes notes qui sont crites dans la ligne
suprieure, ou infrieure, ou dans une partie que l'on
indique.
Unit. L'unit est le premier des deux grands prin-
cipes sur lesquels repose l'harmonie, non-seulement
dans la musique, mais encore dans tous les arts. Sans
unit, tout est pour ainsi dire dcousu
;
l'enchanement
heureux des phrases, dont l'une semble dcouler de
l'autre, produit chez l'auditeur le sentiment de l'unit.
Avec l'unit et la varit, tout marche dans les arts et
dans chacune de leurs parties. Ce sont tes deux balances
dont l'homme de gnie doit faire un continuel usage.
Cette rgle, qui prescrit que l'action doit tre une, et
V 475
que l'intrt se porte toujours sur le mme objet, est
parfaitement applicable aux compositions musicales. Un
thme musical peut servir produire une symphonie
entire, et si les modulations sont prpares avec art, si
d'heureux changements dans l'harmonie lui donnent de
la varit dans les retours, si la gradation des demi-
teintes amne de grands effets, il n'y a point craindre
que les rptitions du thme fatiguent les auditeurs. On
les entendra toujours, au contraire, avec un nouveau
plaisir. Dans les uvres des grands matres, on trouve
une infinit de morceaux composs sur un seul motif.
Quelle unit dans la marche de ces compositions ! Tout
se rattache au sujet
;
c'est une chane dont on ne pour-
rait enlever un anneau sans la dtruire. Il n'y a que
l'homme de gnie, le grand compositeur, qui puisse
accomplir une semblable tche, aussi admirable que
difficile.
Univoques (consonnances) sont celles qui portent le
mme nom, comme l'octave et ses rpliques.
Uomo (primo). Nom par lequel on dsigne parfois un
sopraniste castrat.
Uranion. Instrument invent^
,
en
1810,
par M. Bus-
chmann, en Saxe, long de quatre pieds, large de deux,
et haut d'un pied et demi. Il a une tendue de cinq
octaves et demie, en commenant par le
fa,
clef de
basse, au-dessous de la porte.
11 a un cylindre cou-
vert de drap et mis en mouvement par une roue et une
pdale. Les sons de Vuranion sont fort doux et s'obs-
tiennent par le frottement du bois.
Ut. Premire note de la gamme de ce nom. On a
adopt aujourd'hui gnralement pour solfier, la syllabe
do plus favorable l'mission de la voix que la syl-
labe ut.
V. Cette lettre est une abrviation des mots violino,
volti; W indique violini
;
V
uni S (vs) indique volti
subito.
476
VAU
Valeur des notes. Dure du son dtermine par la
figure diffrente des notes. Les silences ont aussi leurs
valeurs, et chaque figure de note a un silence qui lui
correspond. La pause a la valeur d'une ronde, la demi-
pause a la valeur d'une blanche, le soupir de la
noire, etc.
Variation. C'est une composition musicale dans
laquelle une cantilne appele thme est successivement
orne de diffrentes manires.
Rien de plus facile que de composer des variations d'une
faon commune et vulgaire. Il suffit de s'emparer d'un
thme invent par un autre, et de lui faire subir toutes
les
transformations d'usage, tantt sous la figure dcro-
ches, doubles croches, tantt sous la figure de triolets,
de sextolets, tantt avec quelque basse figure, des arp-
ges, des octaves, sans oublier l'adagio dans le mode rela-
tif, et le temps la polonaise. On pourrait dire qu'il n'y
a rien de moins vari que de semblables variations. Mais,
quelque strile qu'il soit de sa nature, un thme cesse
de l'tre entre les mains d'un habile compositeur, d'un
savant contrepointiste. Les trente variations de Jean
Sbastien Bach seraient des titres suffisants pour rendre
son nom clbre. C'est ainsi que Haydn, Vogler, Beetho-
ven, Mozart, et aprs eux, Cramer, H. Herz, Kalkbren-
ner, Moschels, S. Thalberg, Doehler Gottschalk, Liszt,
Prudent, Paganini, de Briot, Vieuxtemps, Alard,
Tulou, etc., etc., ont donn des variations qui, suivant
les instruments auxquels ils les ont adaptes, offrent un
vif intrt.
Varier. Ajouter un chant simple des ornements,
soit en divisant les notes d'une plus grande valeur en
notes d'une valeur moindre, soit en changeant quelque
chose dans l'accent, dans la force, etc. On emploie par-
ticulirement cette mthode, quand une cantilne revient
plus d'une fois, ou qu'on rpte un morceau de musique.
Ce
sont surtout les points d'orgue qu'il faut savoir
varier. 11 faut pour cela beaucoup de got et une grande
excution. Les compositeurs aussi doivent savoir varier
l'harmonie, les rentres, le systme d'accompagnement,
quand le mme motif se reproduit plusieurs fois.
Vaudeville. Il existe une foule de dictons populaires,
qui en France ont presque force de loi, et dont l'autorit
repose sur de lourdes erreurs. Combien de gens ont
rpt depuis Boileau que le Franais n malin avait
VEL 477
cr le vaudeville, et ne savent pas que ce vaudeville
dont parlait le pote n'a aucun rapport avec le genre de
composition dramatique auquel ce nom a t donn par
induclion.
La rhtorique dfinit le mot vaudeville ou valdevire:
couplet qui court les rues. Le mot lui-mme, pour ceux
qui connaissent un peu l'ancien langage, indique suffi-
samment sa signification par ses racines. Il est driv
du vieux terme vau ou val, dont on a fait le terme nauti-
que aval, courant. Ainsi le vaudeville fut tout simple-
ment un couplet, et non une runion de couplets relis
par une action scnique. Entre les ponts-neufs dont
parle Boileau et les pices dsignes de nos jours sous le
nom de vaudeville, il
y
a tout un abme.
Le vaudeville donc que les Franais croient avoir
invent, le vaudeville tel que nous le comprenons enfin,
est d'origine italienne. Il est le frre an de l'opra
comique.
Considr sous le rapport musical, le vaudeville est un
petit pome, le plus souvent d'un caractre plaisant et
satirique, auquel on adapte des mlodies connues, soit
analogues la situation, soit en opposition avec elle. Le
sujet du vaudeville est la parodie d'une pice joue avec
succs ou tombe; un vnement remarquable du temps,
qui donne prise la satire. Peu de jours aprs l'ex-
cution de la Cration, d'Haydn, il parut un vaudeville
intitul la Rcration. La premire reprsentation de
la Vestale de Spontini fut suivie d'une parodie, la Mar-
chande de modes. Le nom de l'auteur demeura inconnu
quelque temps, et ce ne fut pas sans une grande sur-
prise qu'on apprit que M. de Jouy, l'auteur des paroles
de la Vestale, tait aussi l'auteur del parodie.
Velches (Musique des). Les Velches, ou habitants du
pays de Galles, passent pour tre les descendants de ces
Celtes qui ont tant occup les savants des dix-septime
. et dix-huitime sicles, et don t on a cru retrouver les traces
chez les Bas-Bretons de France. On ne peut nier un fait
fort singulier, c'est que le langage des Bas-Bretons et
celui du pays de Galles ont de tels rapports, que les habi-
tants des deux pays s'entendent sans aucune difficult,
tandis qu'il n'y a pas la plus lgre analogie entre le
langage des habitants du pays de Galles et celui des
autres provinces anglaises. Un autre fait non moins
digne de remarque, c'est que la langue velche ou
galloise
15
478 VR
s'est conserve jusqu' ce jour dans sa puret, et que le
pays de Galles possde encore des potes qui crivent
avec facilit dans cette langue.
La musique du pays de Galles a la mme originalit
que la posie, soit sous le rapport des formes de son
chant, soit sous celui du rhythme et du mode d'excution,
soit enfin sous celui de la forme des instruments et des
modulations. La plupart des pices de chant des Gallois
sont des stances qu'ils apppellent penillons. On ne con-
nat rien dans la musique d'aucun peuple moderne qui
puisse donner l'ide du chant de ces penillons. Il faut
l'avoir entendu pour s'en faire une ide
;
car il dpend
autant de la manire dont il est excut que de la compo-
sition.
Deux instruments sont particuliers au pays de Galles.
L'un est la harpe triple rang de cordes, l'autre est une
espce de viole d'une forme trs-bizarre qu'on appelle
cruth. Le cruth est un instrument archet, qu'on croit
avoir donn naissance aux diffrentes violes et aux vio-
lons. Il a la forme d'un carr long, dont la partie inf-
rieure forme le corps de l'instrument; deux montants
placs aux cts de la partie suprieure se rattachent
dans le haut avec un manche isol dans le milieu. Cet
instrument est mont de quatre cordes et se joue comme
le violon, mais avec plus de difficult, parce qu'il n'a
point d'chancrure pour laisser passer l'archet.
Ventilabro. Nom italien de soupapes au moyen des-
quelles s'ouvrent et se ferment les canaux du sommier,
dans l'orgue, pour donner passage l'air.
Venturine. Petite guitare imagine et construite en
1851 par Ventura Londres.
Vpres. Une des sept heures canoniales. Ce nom vient
de l'toile vesper, parce que c'est vers le coucher du
soleil qu'on est dans l'usage de chanter ces prires.
Vrit d'art. Ce n'est pas la vrit absolue, mais
une ressemblance embellie que nous demandons aux
arts. C'est nous donner mieux que la nature que l'art
s'engage en l'imitant. La posie affectionne le langage
des vers, elle rpand les images et se soutient un ton
plus lev que la nature. La peinture l^ve galement le
ton de la couleur et corrige ses modles. La musique,
elle aussi, se permet de pareilles licences. Elle soutient
la voix par des accompagnements, fait des cadences,
toutes choses qui ne sont pas dans la nature. Assur-
VIE 47!>
ment a vrit de l'imitation en est altre, mais sa
beaut
y
gagne, et de l rsulte dans la copie un charme
que la nature refuse l'original. Au reste, le but que se
propose la musique, n'est pas l'imitation de la nature,
mais l'expression vraie des sentiments.
Vermillon. Ancien instrument compos de huit dix
verres choisis d'aprs l'chelle diatonique, ou bien accor-
ds d'aprs cette mme chelle, en les remplissant d'eau.
On pose cet instrument sur une planche rocouverte de
drap, et on enjou avec un petit bton galement enve-
lopp de drap. C'est ce qu'on nomme aussi harmonica.
On a fait plusieurs combinaisons d'instruments dans
lesquels le son est produit par le verre mis en vibration.
Le son ainsi produit, ne manque pas de charme, et on
pourrait employer plus frquemment, quoique avec
modration, ces sortes d'instruments, qui donnent quel-
quefois un cachet particulier la mlodie.
Verset. Ordinairement on divise le Gloria, les psau-
mes, etc., en divers morceaux d'ensemble, et en solos,
duos, etc. Ce sont ces derniers que l'on appelle versets,
A la messe, aux vpres et dans les autres crmonies,
on morcelle le Kyrie, le Dixit, etc., de manire qu'al-
ternativement une partie est chante par le chur, et que
pour l'autre c'est l'orgue qui rpond. Ces rponses se
nomment versets
;
et ce ne sont que de petites priodes
musicales, de petites figures improvises ou composes
et imprimes sous ce nom.
Vibration. (Voyez Son.)
Vide, Corde a vide. C'est sur les instruments man-
che, tels que le violon, la viole, la guitare, le son qu'on
tire de la corde dans toute sa longueur, depuis le sillet
jusqu'au chevalet sans
y
placer aucun doigt.
Vielle (La) est un instrument fort ancien
;
cepen-
dant nous ne croyons pas que ce fut aux sons de la vielle
que tombrent les murs de Jricho
;
nous doutons ga-
lement que la vielle fut l'instrument dont se servait
Amphion
;
nous nous permettons de chicaner Jean de
Meung, quand il dit dans son Roman de la Rose, en
parlant d'Orphe, qu'il faisait aprs soi aller les bois
par son foawviELLER. Nous suspectons mme Alexandre
de Bernai, dit de Paris, qui vivait- sous Philippe-Au-
guste, et, qui, dans son roman d'Alexandre le Grand,
fanant la description d'un palais occup par son hros,
480
VIE
parle de deux statues, dont une reprsentait un
joueur
de vielle :
L'un tient une vielle, Tarcon fu de saphir
;
Li autre une harpe
;
moult fut bonne or.
La vielle est un instrument trop compliqu pour qu'il
n'ait pas subi bien des perfectionnements; enlevons-lui
ses diffrentes parties, et nous la rduisons un corps
concave arm d'un manche, sur lequel des cordes sont
tendues. Retrouvons-nous chez les anciens quelque chose
de semblable? Oui, le canon ou le chelys, monocorde que
l'on voit figurer sur une foule de monuments de la plus
haute antiquit; le chelys antique est donc la souche de
la cythare ou la guitare, de la rubeble, de la vielle, et
l'on voit que le chelys est le pre de tous les instruments
de musique corps concave et manche, soit qu'on
mette leurs cordes en vibration en les frappant en les
pinant ou en les frottant.
De quelque manire que la vielle se soit forme par
degrs, il paratrait, selon M. Burette, membre de l'A-
cadmie des belles-lettres, dans le tome 8 du recueil des
Mmoires, que les anciens ont connu la vielle; car il dit
que
les anciens avoient sur quelques instruments une
espce de bourdon qui soutenoit le chant en faisant son-
ner Yoctave quinte, bourdon o se trouv it aussi la quarte,
par la situation de la corde du milieu. Puis il ajoute :
Les anciens, la vrit, ne nous ont rien laiss par
crit, touchant ces sortes de bourdons
;
mais nos vielles
et nos musettes, qui, vraisemblablement nous viennent
d'eux, suffisent pour appuyer une telle conjecture. Si
nous consultons le Dictionnaire de Puretire, l'article
Vielle, il est dit que les anciens la nommaient par excel-
lence symphonie. La vielle tait encore nomme, au
treizime sicle, syphonie, cifonie et cyfoine, par cor-
ruption du nom primitif. Cet instrument s'appelait aussi
sambuque.
L'excution de la vielle tait lente, d'o est venu le
proverbe, long comme une vielle, long dans tout ce que
l'on fait. On disait galement pour dsigner un homme
dont l'humeur est aise, accommodante, faisant tout ce
que l'on dsire : Il est du bois dont on fait les vielles,
comme aujourd'hui, on dit : Il est du bois dont on fait
des fltes.
VIO 481
Vielleur, vielleuse.
Celui ou celle qui joue de la
vielle.
Vilanelle. Ancienne danse champtre accompagne
de chant.
Villancico. Espce d'ode sacre que les Espagnols
chantent dans les glises pour les ftes de Nol.
Vimercati (Pietro). Luthier de l'cole de Venise, tra-
vaillait en 1660. Ses violons sont extrmement vots,
l'instar de ceux de Brescia.
Viola di spalla. On faisait usage de cet instrument
dans les premires annes du sicle dernier avec les ins-
truments vent les plus grands. Il servait dans la mu-
sique instrumentale l'excution de la partie principale.
Il tient le milieu entre la viole et le violoncelle. Ceux
qui en jouaient se l'attachaient avec une lanire passant
sur la poitrine, et la rejetaient sur l'paule.
Viola pomposa. Instrument archet en usage vers le
milieu du sicle dernier, invent par Jean-Sbastien
Bach. Elle tait plus grande que la viole ordinaire, et
avait des cordes plus leves, et cinq cordes accordes
en do, clef de basse au-dessous des lignes, et sol, r, la,
rni.
Viola tenore. Anciennement on employait dans la
musique vocale deux espces de violes, celle en clef d'alto
qui marchait l'unisson avec la voix d'alto et celle crite
en clef de tnor l'unisson avec la voix de tnor.
Viole. Cet instrument, dont l'usage est si tendu, et
qui dans la musique grand orchestre forme une des
quatre parties principales, ne diffre pas du violon quant
son doigt. Il en diffre cependant par sa dimension,
qui est plus grande, et par l'accord de ses quatre cordes
dont les deux dernires sont recouvertes de fil de mtal.
Ces cordes sont accordes en do, clef de basse second es-
pace, puis par quinte sol r la. Mais c'est surtout la qua-
lit du son qui est diffrente, prcisment cause de sa
grandeur et de ses cordes moins tendues. Cette manire
d'accorder fait que l'on crit la partie de la viole en clef
d'alto, et de l lui vient encore le nom d'alto, d'alto-
viola.
La viole fut longtemps nglige par les compositeurs
de l'ancienne cole. Haydn et Mozart lui donnrent enfin
le rang qui lui appartenait et qu'elle occupe aujourd'hui
dans les ouvrages des compositeurs distingus. Ses sons
482 VIO
tendres et mlancoliques produisent un excellent effet
dans ia marche des parties intermdiaires, et s'accordent
bien avec la clarinette, le cor, le basson.
Viole. Jeu d'orgue de tuyau bouche, ouvert de qua-
tre pieds, qui sert d'unisson l'octave.
Viole (Basse de). Cet instrument extrmement rare
diffre du violoncelle par son accord de six et quelque-
ibis sept cordes en r clef de basse au-dessous des lignes
sol mi la r, et par ses sons criards et nasillards.
Viole btarde. Trs-ancienne espce de viole. Elle
avait six cordes accordes en do, clef de basse au-des-
sous des lignes
fa
do mi la r. Elle avait le corps plus
long et plus troit que la viole.
Viole d'amour. Cet instrument est plus grand que la
viole ordinaire, et a un manche plus long. 11 en diffre
encore dans l'accord de ses sept cordes en sol. clef de
basse premire ligne
;
do sol do mi sol do ou sol do mi
la r sol do.
Violet anglais. Etait de la mme famille que la viole
d'amour, mais il ne portait que six cordes au lieu de
sept.
Violiclmbalo. Instrument invent en 1609 par Jean
Haydn, Nuremberg. Il voulut faire participer le piano
l'avantage qu'ont les instruments archet ou vent de
soutenir plus longtemps le son et de le modifier clans sa
faiblesse ou dans sa force. 11 inventa donc le violicem-
balo, qui a la forme du piano. L'abb Trentin, Venise,
attira de nouveau l'attention sur cet instrument par les
rformes qu'il
y
fit il va quelques annes.
Violo-clave. Instrument anches libres, imagin en
1847, par Morin de la Guerinire.
Violon. Le violon est le roi de l'orchestre, il occupe
la premire place dans toute symphonie. Nous croyons
devoir chercher tablir son origine.
Les instruments cordes manches et archet com-
posent aujourd'hui une famille spciale
;
leur auteur nous
vient de l'occident, disent les uns, de l'orient disent les
autres. Les manuscrits, crits ou figures qui nous res-
tent des peuples qui ont habit l'Orient n'ont pu fournir
jusqu' prsent aux savants, aux archologues, la moin-
dre trace authentique de l'usage de l'archet parmi les
Egyptiens, les Grecs et les Latins. D'autres monuments
tablissent au contraire que cet usage remonte en Eu-
VIO 483
rope une hauts antiquit. Tout porte croire que l'ar-
chet est originaire de l'Inde, et que, s'tant rpandu en
Asie, il a ensuite pass en Europe. Dans l'Inde, il n'y a
pas de doute possible, car les instruments existent, ils
y
conservent encore les caractres de leur originalit na-
tive. Si l'on veut trouver l'instrument archet dans son
origine, il faut le prendre dans sa forme la plus simple
et dans ce qui n'a pas exig le secours d'un art perfec-
tionn.
On le retrouve, dit ce sujet M. Ftis, dans le Rava-
nastron compos d'un cylindre de bois de sycomore
creus de part en part. Sur un des cts de ce
cylindre est tendue une peau de boa cailles larges,
qui sert de table d'harmonie. Le cylindre est tra-
vers de part en part, au tiers de sa longueur vers la
table, par une tige qui sert de manche, arrondie dans sa
partie infrieure; plate dans le haut, et lgrement ren-
verse la tte de ce manche est perce de deux trous pour
les chevilles, non sur le ct, mais le plan de table. Deux
grandes chevilles servent tendre deux cordes de boyau,
lesquelles sont fixes une lanire de peau de serpent atta-
che au bout infrieur de la tige. Un petit chevalet taill
en biseau, plat dans la partie qui pose sur la table, sup-
porte les cordes. L'archet est form d'un bambou mince,
lgrement courb en arc dans la partie suprieure, et
droit l'infrieure. Un creux taill dans la tte sert
fixer une mche de crins qui est tendue et fixe l'autre
extrmit par vingt tours d'une tresse de jonc trs-
flexible. Voil sans doute le type du violon.
A une poque postrieure au Ravanastron, arriva
Vamorti autre instrument archet mont de deux cordes.
Le corps est form d'une noix de coco, dont on a enlev
le tiers, dont on a aminci les parois, et qu'on a polie in-
trieurement et extrieurement. Quatre ouvertures ellip-
tiques, et une autre dans la forme d'un losange sont pra-
tiques la partie antrieure du corps pour servir d'ouies.
La table d'harmonie se compose soit d'une peau de ga-
zelle, soit d'une planchette de bois satin maille trs-
fine. Gomme clans le Ravanastron, le manche est form
d'une tige en sapan qui traverse le corps de l'instrument,
et supporte deux cordes; le chevalet sur lequel elles pas-
sent est exactement semblable celui du Ravanastron.
L'archet plus long que celui de ce dernier instrument est
fait de bambou. Nous retrouvons Vamorti dans le
484 VIO
Kemdngeh gouz des arabes, c'est le mme instrument
avec sa noix de coco et ses ouvertures, la seule diffrence
est que ces ouvertures sont petites et en trs- grand
nombre. Le manche est une tige cylindrique, dont la
tte est creuse comme celle de Vomerti pour
y
placer
deux chevilles. La tige du manche fore longitudinale-
ment reoit un cylindre de 1er qui traverse le corps de
l'instrument, se prolonge extrieurement pour former un
pied sur lequel repose l'instrument. Les cordes sont for-
mes chacune d'une mche de crins noirs fortement ten-
due. L'archet est compos d'une baguette de figuier-sy-
comore, faonne au tour et courbe en arc. Voil les
instruments primitifs. Vient ensuite le Rebab. (Voir ce
mot).
Voyons maintenant en Europe, consultons les anciens
manuscrits, et les premiers renseignements recueillis
sur les instruments archet. Il est trs-probable que le
violon
y
fut introduit par les arabes en 740
;
il resta
longtemps dans un tat presque sauvage. Ce ne fut
qu'aprs avoir franchi plusieurs sicles qu'il parvint,
non sans peine, la forme qu'il possde aujourd'hui.
Les uns prtendent que cette forme drive de la viola
diminue de volume. D'autre ne veulent pas remonter
au del du v
e
sicle. Cependant son origine arabe est
constate par son nom. Les arabes apportrent en Eu-
rope leur rebab, dont les Espagnols firent leur rabel, et
les Franais rebec. Cet instrument fut d'abord mont de
trois cordes seulement. Quand l'art se perfectionna, on
y
ajouta une quatrime corde
;
mais il ne fut permis
qu'aux matres, reus tels dans la corporation de joueurs
d'instruments, d'en faire usage. Le rebec trois cordes
resta l'instrument des mntriers et des aveugles. Jus-
qu'au xvi
e
sicle les violonistes ne se servaient que de la
gamme qui se trouve dans la voix de soprano
;
ce n'est
que plus tard que l'on parvint surmonter les difficul-
ts de position et de faire usage de la seconde. Voil sans
doute la cause qui retarda le parfectionnement du vio-
lon. Ce n'tait pas dfaut de luthiers habiles, mais d'ar-
tistes qui pussent tirer parti des instruments.
De tous les instruments, le plus beau, le plus harmo-
nieux, le plus flexible, le plus riche en modulations, tour
tour nergiques, tendres et passionnes, c'est sans con-
tredit la voix humaine. Parmi les organes de la mlodie,
mme les plus perfectionns, en est-il un seul qui, pour
VIO 485
]a puissance, la vigueur, l'clat, le charme, la grce, la
varit, le prestige des ornements, puisse rivaliser avec
la voix d'un chanteur minent, quand cette voix a t
exerce, assouplie, fortifie par un travail persvrant?
S'il est un instrument qui pour l'abondance et la varit
des richesses mlodiques, puisse tre jusqu' un certain
point compar la voix humaine, c'est assurment le
violon. Entre tous les autres il est le plus harmonieux, le
plus richement dot, et telles sont la supriorit de son
organisation et la fcondit de ses ressources, qu'il peut
remplir d'une manire brillante le rle assign chacun
des autres organes de la mlodie. Passant par une srie
d'tonnantes mtamorphoses, il peut, comme la trom-
pette, clater en sons belliqueux, jeter comme la harpe
des myriades de notes tendres et passionnes, ou soupi-
rer comme la flte les naves amours des villageois. Et
non-seulement le violon est le plus vari de tous les ins-
truments, sous le rapport de l'expression, il est encore
le plus rpandu, le plus populaire. Il brille dans les con-
certs, fait le charme de toutes les runions particulires;
mais c'est surtout dans les grandes solennits musicales,
c'est sur nos scnes lyriques que sa puissance se dploie,
au milieu de l'orchestration la plus riche et la plus puis-
sante.
Le violon est mont sur quatre cordes de boyau, dont
la plus grave sonne le sol. Les trois autres portent r,
la, mi, par quinte du grave l'aigu. La corde sol est
ileen laiton. Le diapason du violon est de trois octaves
et une sixte. Il commence au troisime sol du piano. Ses
quatre cordes suffisent pour donner plus de quatre oc-
taves, plus de trente-deux notes du grave l'aigu. Elles
se prtent toutes les exigences du chant, toutes les
varits de la modulation. Au moyen de l'archet qui met
les cordes en vibration, et peut en faire parler plusieurs
la fois, il unit aux sductions de la mlodie le charme
des accords, et l'avantage si grand de prolonger le son,
d'en doubler la puissance et l'nergie, la grce et la sua-
vit.
Quelques artistes clbres n'ont pas accord le violon
par quinte
i
ainsi qu'on le fait ordinairement. Pour en
obtenir une sonorit plus clatante, Paganiui haussait
toutes les cordes d'un demi- ton et jouait en r naturel
,
par exemple, quand l'orchestre tait en mi bmol
;
en la
naturel quand l'orchestre tait en si bmol. Par ce fa-
15.
486
VIO
cilo artifice, il conservait la plupart de ses cordes
vide
;
et Ton sait que la eonorit de ces cordes est bien
plus clatante que celle des cordes o les doigts sont
appuys. De Beriot haussait souvent le sol d'un ton
,
dans ses concertos. Baillot , au contraire
,
baissait quel-
quefois le sol d'un demi-ton
,
quand il voulait obtenir
des effets doux et graves , Winter a mme employ
,
dans le mme but , le
fa
naturel au lieu du sol.
Les trilles sont praticables sur tous les degrs de la
vaste chelle du violon. Mais ils deviennent trs-difici-
les sur les notes les plus aigus : on les redoute , et il
est prudent de ne jamais les employer l'orchestre.
Les accords de deux
,
trois ou plusieurs noies qu'on
peut frapper ou arpger sur le violon sont trs-nom-
iDreux et produisent des effets trs-diffrents. Les ac-
cords de deux notes
,
qui rsultent de ce qu'on appelle
la double-corde , conviennent aux dessins mlodiques
,
aux phrases soutenues , aux accompagnements et au
trmolo. Les accords de trois ou plusieurs notes pro-
duisent un assez mauvais effet dans le piano
,
mais ils
ont de la richesse dans le forte : l'archet peut les faire
vibrer alors d'une manire simultane. Les accords que
l'on dsirerait obtenir entre le sol et le r graves
,
sont
impossibles chaque instrument isol
,
puisqu'il n'y a
qu'une corde : en ce cas, on divise les violons. A partir
du r grave
,
tous les intervalles de seconde
,
de tierce,
de quarte
,
de quinte
,
de sixte
,
de septime et d'octave
sont praticables : ils deviennent seulement plus difficiles
mesure qu'on s'lve dans l'chelle des sons.
L'unisson n'est vraiment facile et vraiment trs-so-
nore que sur les trois notes r, la, mi, parce qu'alors
une des deux cordes au moins est vide. Les autres
unissons n'ayant pas de cordes vide , sont difficiles et
rarement trs-justes.
Le trmolo des violons produit plusieurs excellents
effets, dans l'orchestre surtout. Il exprime le trouble,
l'agitation , l'pouvante
,
quand on l'crit sur une ou
deux des trois cordes sol
,
r, la
,
qu'on ne s'lve pas
au-dessus du si bmol du mdium
,
et qu'on l'excute
piano , mezzo-forte ou fortissimo. Il
y
a quelque chose
de violent
,
d'orageux , dans le fortissimo
,
sur le m-
dium de la chanterelle et de la 2
e
corde. Il devient
arien
,
au contraire
,
si on l'emploie plusieurs parties
et pianissimo sur les notes aigus de la chanterelle.
VIO
487
Le trmolo du bas et du mdium de la troisime
et
la quatrime cordes , dit un critique clbre , est bien
plus caractris dans le fortissimo, si l'archet attaque
les cordes prs du chevalet. Dans les grands orchestres
et lorsque les excutants veulent se donner la peine
de le bien rendre
, il produit un bruit assez semblable
celui d'une rapide et puissante cascade. Il faut indi-
quer le mode d'excution par ces mots : prs du che-
valet.
Une magnifique application de cette espce de tr-
molo a t faite dans la scne de l'oracle, au premier
acte de YAlceste de Gluck. L'effet du tremblement des
seconds violons et des altos est encore redoubl, dans
ce passage, par la progression grandiose et menaante
des basses ,
le coup frapp de temps en temps par les
premiers violons
,
les entres
successives des instru-
ments vent
,
et enfin par le sublime rcitatif que ce
bouillonnement d'orchestre accompagne. Nous ne con-
naissons rien en ce genre de plus dramatique ni de
plus terrible. Seulement l'ide du trmolo prs du che-
valet n'ayant pas t exprime par Gluck dans sa par-
tition, l'honneur en revient M. Habeneck
,
qui, en
dirigeant au Conservatoire l'tude de cette scne magni-
fique, exigea des violons ce mode nergique d'excution.
On fait quelquefois usage du trmolo bris
,
sur une
ou sur deux cordes
, dans certains accompagnements
dramatiques d'un caractre trs-agit.
Enfin il existe une dernire espce de trmolo dont
Gluck a tir un parti admirable dans ses rcitatifs et
qui est aujourd'hui tombe en dsutude. Elle consiste
dans l'mission peu rapide de notes lies entre elles sur
le mme son et sans que l'archet abandonne la corde.
Les excutants ne peuvent pas se rencontrer dans le
nombre des notes qu'ils font entendre chaque mesure,
puisque l'accompagnement est un vrai trmolo non-me-
sur
,
et il rsulta de ces diffrences une espce de fluc-
tuation et d'indcision
,
parfaitement propres peindre
l'inquitude et l'anxit.
Les coups d'archet sont d'une grande importance
dans la musique de violon. Ils influent
normment
sur la sonorit et l'expression des traits et des mlodies :
il faut donc les indiquer avec le plus grand soin. Les
principaux sont : le dtach , le li de deux en deux
notes
,
le grand li qui runit un certain nombre de
488 VIO
notes; le staccato ou dtach lger qui s'excute pen-
dant la dure d'une seule longueur d'archet , au moyen
de petits coups successifs
;
le grand dtach port qui
donne la corde la plus grande sonorit possible, en lui
permettant de vibrer aprs que l'archet l'a fortement
attaque
;
les mmes notes rpercutes deux , trois ou
plusieurs fois , et quelques autres moyens d'excution
qu'il serait trop long d'expliquer, tel que la pointe de
Varchet
y
avec le talon de l'archet, avec toute la longueur
de l'archet, sur la touche, etc.
On a quelquefois employ le bois des archets pour
frapper les cordes et en obtenir une sonorit moiti
horrible et moiti grotesque. Ce moyen bizarre est em-
ploy trs-rarement.
On appelle sons harmoniques ceux que l'on fait natre
en effleurant les cordes avec les doigts de la main
gauche, sans les mettre en contact avec la touche.
Les sons harmoniques ont presque tous un caractre
singulier de sonorit arienne et de mystrieuse dou-
ceur. Nous renvoyons leur tude, qui est intressante
mais assez longue, aux traits spciaux sur le violon.
Les sourdines sont de petites machines en bois que
l'on place sur le chevalet des instruments corde pour
affaiblir leur sonorit. Elle leur donne un accent triste
et doux qui est d'une application frquente et souvent
heureuse dans tous les genres de musique.
Le pizzicato, dont le nom indique la nature, est
galement d'un usage frquent. Les chanteurs aiment
beaucoup cette espce d'accompagnement : lie ne cou-
vre point leur voix et l'environne d'une sonorit cristal-
line et presque toujours gracieuse. Il fautcependantvit'T
le pizzicato l'extrme aigu et l'extrme grave : ici,
l'effet en est sourd, l, gile, sec et cassant.
Les violonistes qui ont laiss ou laisseront un nom
sont assez nombreux; citons entr'aulres : Giovan-Bap-
tista surnomm del violino ; Constantin, le roi des violo-
nistes franais; P. Gastrovillari, religieux de Padoue;
Walter, que ses ouvrages font mettre au rang des artistes
les plus habiles du xvu
e
sicle, Jean-Baptiste Bassani,
qui se distingua par le beau style de sa musique instru-
mentale et qui eut la gloire d'initier Corclli aux secrets
de son art; Leclerc
(1697),
Locatelli
(1693),
et dans ce
sicle fcond : Viotti, Rode, Kreutzer. Lafont, Baillot,
VIO 489
Spohr, Paganini, Habeneck, de Ejeriot, Vieux-Temps,
Sivori, Alard, Joachim.
Archangelo Corelli
,
dit M. Ftis
,
grand artiste,
qui, par l'lvation de ses ides et la perfection de son
jeu, s'est plac la tte de l'cole du violon, et a mar-
qu le temps de ses plus rapides progrs. Archangelo
Corelli! nom justement clbre dans les fastes de la
musique, et qui traversera les sicles sans rien perdre
de son illustration
,
quelles que soient les rvolutions
auxquelles cet art sera soumis! le grand artiste qui le
porta, non moins admirable compositeur que violoniste
prodigieux pour son temps, naquit au mois de f-
vrier 1653, Fusignano
,
petite ville des Etats de
l'Eglise, et mourut Rome le 18 janvier 1743. Ses con-
temporains ne furent pas ingrats pour sa gloire, car
l'Europe entire salua son talent par d'unanimes accla-
mations, et ses compatriotes placrent ses restes au
Panthon , et lui levrent un tombeau prs de celui de
Raphal. Aprs un sicle et demi
,
Corelli est encore
considr comme le type primitif des bonnes coles de
violon
;
aujourd'hui mme, bien que l'art se soit enrichi
de beaucoup d'effets inconnus de son temps et que le
mcanisme se soit perfectionn
,
l'tude de ses ouvrages
est encore une des meilleures qu'on puisse faire pour
acqurir un style large et majestueux. Son uvre cin-
quime, compos de douze sonates pour violon seul,
avec accompagnement de basse continue pour le clave-
cin
,
qui parut Rome en
1700, est un chef-d'uvre en
son genre.
a L'art de jouer du violon , et la composition de la
musique pour cet instrument, continurent, pendant
toute la dure du xvm
e
sicle , d'tre dans une progres-
sion ascendante. Au commencement de ce sicle, il
y
avait en Italie peu de villes o l'on ne trouvt quelque
violoniste distingu. Le gnie de Corelli avait anim
celui de tous ces artistes : Pise
,
c'tait Constantin
Clari, non moins remarquable comme compositeur que
comme excutant; Florence, Franois Varacini
;
Bologne, Jrme Laurenti; Modne, Antoine Vitali
;
Massa di Carrara , Cosme Perelli et Franois Ciampi
;
Lucques
,
Lombardi; Crmone
,
Visconti , dont les
conseils furent, dit-on, fort utiles au clbre luthier
Stradivari pour la fabrication de ses instruments;
Pistoie
,
Giacopino
;
Naples, Michel Mascitti. D'au-
496 VIO
trs , tels que Mathieu Alberti , Thomas Albinoni
,
Charles Tessarini et Antoine Vivaldi, tous lves de
Corelli, furent la fois des virtuoses de premier ordre
pour leur temps et de grands compositeurs de musique
instrumentale. Vivaldi, dont on vient de lire le nom,
fut un de ces artistes prdestins qui impriment l'art
de leur poque une direction nouvelle. Le concerto lui
dut ses premiers perfectionnements; car le Concerto
grosso de Corelli est une uvre o toutes les parties
concertent entre elles et s'emparent tour tour de l'in-
trt. h'Estro armonico de Vivaldi , compos de douze
concertos pour quatre violons, deux violes, violoncelle,
et basse continue pour l'orgue, est dans les mmes con-
ditions; mais dans ses uvres 6, 7
e
, 8%
9
e
,
10
e
,
11
e
et
12
e
,
le gnie de l'auteur prend un autre essor et trouve
des formes nouvelles. La partie principale attire elle
l'intrt du morceau
,
et bien qu'il n'y ait point encore
de division en solos et tutti
,
le rle de cette partie prin-
cipale domine tous les autres. Les mlodies de Vivaldi
ont aussi un caractre modernis que Somis et Gemi-
niani imitrent.
Au milieu de tous les artistes distingus qui vien-
nent d'tre nomms, le violoniste modle de la premire
moiti du xvm
e
sicle fut Joseph Tartini. N Pirano
on Istrie, le 12 avril
1692,
il eut une jeunesse agite;
mais ayant eu l'occasion d'entendre le clbre violoniste
Varacini, qui se trouvait b Venise en mme temps que
lui, sa vocation se rvla
;
il se retira Ancne pour
y
travailler en libert, et dans sa solitude il fit de cons-
tantes observations qui le conduisirent aux principes
fondamentaux du maniement de l'archet; principes qui,
depuis lors, ont servi de base toutes les coles de
violonistes d'Italie et de France. Fix Padoue, en
1721, comme violon solo et chef d'orchestre de la cha-
pelle de la clbre glise du Saint, il
y
passa paisible-
ment quarante-neuf annes, uniquement occup des
travaux de son art, et
y
mourut le 16 fvrier 1770. En
1728 il avait tabli dans cette ville une cole de violon
qui devint clbre dans toute l'Europe, et d'o sortirent
une multitude de violonistes distingus, parmi lesquels
on cite Nardini, Pasqualino Bini, Alberghi, Dominique
Ferrari, qui passe pour avoir t l'inventeur des sons
harmoniques, Carminati, Gapuzzi, Mme de Sirmen, et
les violonistes franais Pagin et La Houssaye. Tartini
vio
m
n'a pas moins contribu an perfectionnement de Fart de
jouer du violon par ses compositions pour cet instru-
ment que parles lves qu'il a forms. Son style est en
gnral lev, ses ides ont de la varit, et son har-
monie a de la puret sans scheresse. Le nombre de ses
concertos publis ou manuscrits s'lve prs de cent
cinquante. Il
y
a aussi de lui environ cinquante sonates
au nombre desquelles est la fameuse Sonate du Diable
dont l'anecdote n'est peut-tre pas trangre certains
bruits ridicules qui ont couru sur Paganini
;
il la racon-
tait lui-mme en ces termes : Une nuit, en 1713, je
revais que j'avais fait un pacte, et que le diable tait
mon service. Tout me russissait souhait; mes
volonts taient toujours prvenues, et mes dsirs
taient surpasss par les services de mon nouveau
)> domestique. J'imaginai de lui donner mon violon pour
voir s'il parviendrait me jouer de belles choses;
mais quel fut mon tonnement lorsque j'entendis une
sonate si singulire et si belle, excute avec tant de
supriorit et d'intelligence, que je n'avais mme rien
conu qui pt entrer en parallle ! J'prouvais tant de
surprise, de ravissement, de plaisir, que j'en perdais
la respiration : je fus rveill par cette violente sensa-
tion
;
je pris l'instant mon violon, esprant de
)> retrouver une partie de ce que je venais d'entendre;
mais ce fut en vain. La pice que je composai alors
est la vrit, la meilleure que j'aie jamais laite, et je
l'appelle encore la Sonate du Diable
;
mais elle est si
iort au-dessous de ce qui m'avait frapp, que j'eusse
bris mon violon et abandonn la musique si j'eusse
t en tat de m'en passer.
Parmi les lves de Corelli, un des plus habiles fut
Geminiani, n Lucques, vers 1680. Aprs avoir ter-
min ses tudes de violon, sous le clbre matre, il
passa en Angleterre en
1714,
y
forma quelques bons
lves, et mourut Dublin, le 17 septembre 1762,
l'ge de quatre-vingt-trois ans. Son talent d'excution
tait la fois brillant et solide
;
mais il manquait d'ima-
gination dans ses ouvrages, qui ne sont qu'une imitation
assez faible du style de Vivaldi. Somis, autre lve de
Corelli, tait n dans le Pimont vers la fin du
.xvn
e
sicle, et avait visit dans sa jeunesse Rome et
Venise, pour entendre les virtuoses de cette poque.
Corelli lui fit tudier ses sonates, et d'abord Somis
492 VIO
s'attacha son style
;
mais lorsqu'il entendit Vivaldi, il
se modifia d'aprs sa manire et l'imita dans ses compo-
sitions. Somis fut le fondateur de l'cole pimontaise du
violon qui, aprs la mort de Tartini, exera une trs-
grande influence sur l'art de jouer de cet instrument.
Baptiste Anet, plus connu simplement sous le nom de
Baptiste, qui avait aussi reu des leons de Corelli,
arriva Paris vers 1700, et
y
passa pour un prodige, ce
qui n'tait pas tonnant une poque ou suivant l'opi-
nion de Lulli, les meilleurs violons de V Opra et de la
musique du roi n'taient pas capables de jouer leur
partie sans l'avoir tudie. Assez mdiocre musicien,
Baptiste ne forma pas d'autre lve que Senaill, en
sorte qu'il ne fit que peu de chose pour la formation
d'une cole franaise de violonistes. D'ailleurs il ne
vcut pas Paris plus de cinq ans. Une position qui
lui fut offerte en Pologne, le dcida se fixer dans ce
pays.
La gloire de poser les bases d'une cole de violon en
France tait rserve Jean- Marie Lecler, lve de
Somis, et violoniste de grand talent, qui naquit Lyon,
en 4697. Le violon ne lui avait servi d'abord que pour la
danse; car dans sa jeunesse il avait dbut comme dan-
seur au thtre de Rcuen; mais ayant t appel
Turin, en qualit de matre de ballets, Somis le prit en
affection aprs avoir entendu quelques airs de danse de
sa faon, et lui donna des leons de violon qui lui firent
faire de rapides progrs. Aprs deux annes d'tudes, le
matre dclara l'lve qu'il n'avait plus rien lui
apprendre; mais Lecler continua son travail de mca-
nisme avec persvrance, et parvint la possession d'un
beau talent. Arriv Paris en 1729,
Lecler fut attach
l'orchestre de l'Opra, puis la musique du roi. Les
lves qu'il forma, et la publication de ses sonates, de
ses duos et de ses trios, sont le point de dpart de l'cole
des violonistes franais. Jean-Baptiste Senaill eut aussi
de l'influence sur les premiers dveloppements de cette
cole. N Paris, le 23 novembre 1687,
il eut d'abord
des leons de Queversin, un des vingt-quatre violons de
la grande bande du roi, puis devint lve de Baptiste
Anet. Le grand renom des violonistes italiens de cette
poque le dcida ensuite se rendre Modne pour
y
prendre des leons d'Antoine Vitali. Son talent fit une
vive sensation dans cette ville, et la grande-duchesse
VIO
403
l'attacha au service de la cour. De retour Paris en
1719, il
y
fit quelques bons lves au nombre desquels
fut Guignon, et peut-tre Guillemain, qui eut de la
clbrit par d'excellentes sonates pour son instru-
ment.
De tous les lves de Corelli, celui qui s'loigna le
plus de sa manire, et qui, par son audace, arriva aux
rsultats les plus extraordinaires, fut Pierre Locatelli,
violoniste justement clbre, n Bergame, en 1693. Au
surplus, il n'a pu recevoir qu'un petit nombre de leons
de son illustre matre, car il n'tait g
que de seize ans
lorsque Gorelli descendit au tombeau. Plein de hardiesse
et d'originalit, il inventa de nouvelles combinaisons pour
l'accord du violon, la double corde, les arpges et les
sons harmoniques. L'ouvrage le plus important o il
dposa le rsultat de ses dcouvertes dans ces choses
diverses a pour titre : Arte di nuova modulazione. Les
ditions franaises qu'on a faites de cet ouvrage ont pour
titre : Caprices nigmatiques.S
Locatelli, mort en Hol-
lande en 1764, ne forma pas beaucoup d'lves, cause
des grands difficults de sa musique, il eut pour imita-
teurs, en quelques parties, Lolli, Fioriilo, en surtout
Paganini, dont le talent a t le dveloppement le plus
complet des tendances du modle.
L'cole pimontaise, fonde par Somis, tait desti-
ne devenir la plus productive en talents de premier
ordre. Outre Lecler, ce professeur avait form son ne-
veu Schabran ou Ghabran, qui brilla Paris en 1751,
Giardini, modle de grce, et surtout Pugnani, dou
d'une organisation grande et forte qui n'eut pas moins
d'influence dans l'art, par la grandeur de son style d'ex-
cution et par la varit de son archet, que par les per-
fectionnements qu'il introduisit dans la forme du con-
certo sous le rapport de l'effet de3 solos. Devenu chef
de cette cole du Pimont, Pugnani porta sa gloire son
apoge en formant le talent si beau, si pur, si tendre, et
si brillant h la fois de ce Viotti qui devint ensuite le
modle et le dsespoir des violonistes de tous les pays.
u Contemporain de Pugnani
,
Gavinis faisait pour
l'cole franaise Paris ce que le violoniste pimontais
faisait Turin pour l'cole italienne. Mcanisme d'ar-
chet qui lui permettait de se jouer des plus grandes
difficults; justesse parfaite, style imposant, enfin ex-
pression pleine de charme et de sensibilit, telles furent
494 VIO
les qualits qui frapprent Viotti lorsqu'il eut entendu
Gavinis, et qui le lui firent appeler le Tartini
franais.
Le talent de cet artiste se fit particulirement apprcier
sa juste valeur dans diverses occasions o il se fit en-
tendre au concert spirituel, aprs d'autres violonistes
d'un mrite incontestable. C'est ainsi que la palme lui
fut donne aprs ses luttes avec Pugnani, Dominique
Ferrari et Jean Stamitz.
L'arrive de Viotti Paris
y
produisit une im-
pression difficile dcrire. Jamais on n'avait entendu
de talent qui approcht de cette perfection
;
jamais ar-
tiste n'avait possd un son plus btau, une lgance
aussi soutenue, une verve, une varit semblable. L'i-
magination qui brillait dans ses concertos ajoutait en-
core au plaisir qu'il procurait son auditoire; car ses
compositions pour son instrument tait aussi sup-
rieures ce qu'on connaissait auparavant, que son ex-
cution tait au-dessus de celle de ses rivaux. Ds qu'on
connut cette belle musique, la vogue des concertos de
Jarnowick disparut, et l'cole franaise de violon s'en-
gagea dans une voie plus large. Les lves de cet artiste
sont en petit nombre
;
mais il en est un qui seul valut
toute une cole : je veux parler de Rode, talent fin, d-
licat, brillant, qui rappelait souvent celui du matre sous
lequel il s'tait form. Il existe aujourd'hui bien peu de
personnes qui aient entendu cet admirable talent dans
toute sa beaut, lorsqu'il se produisit dans les concerts
de la rue Feydeau et de l'Opra
;
mais les artistes qui
ont joui de ce plaisir n'oubliront jamais le modle de
perfection dont ils furent alors merveills. Il
y
a une
remarque intressante qui me parat devoir tre faite,
c'est que depuis Gorelli jusqu' Rode il n'y a pas de la-
cune dans l'cole; car Gorelli fut le matre de Somis,
Somis de Pugnani, Pugnani de Viotti, et Viotti de
Rode.
A l'poque o brillait Rode, deux autres violonistes
de la plus haute valeur illustraient l'cole franaise. Le
premier en date tait Rodolphe Kreutzer, fils d'un mu-
sicien de la chapelle du roi, et qui tait n Versailles
en 1766, Elve d'Antoine Stamitz, violoniste allemand
qui a fond une cole, Kreutzer prit d'abord le style un
peu troit de son matre; mais lorsqu'il eut reu des
conseils de Gavinis et entendu Viotti, il largit sa ma-
nire, devint brillant, hardi et presque chevaleresque.
VIO
495
Sa qualit do son tait nourrie plutt que moelleuse, et
sa manire de chanter tait moins remarquable que sa
hardiesse dans les difficults. Ses grandes qualits
taient d'tre original, de n'avoir suivi aucune cole et
de n'obir qu' l'impulsion de son sentiment nergique.
Kreutzer a fait cole et a produit beaucoup de bons
lves qui se sont assimil ses qualits, et qui, en gn-
ral, ont du brillant dans l'excution.
Baillot, dont il me reste parler, ne fut pas seule-
ment un grand violoniste par le mcanisme le plus riche
et le plus vari qu'on puisse imaginer, mais en mme
temps il fut pote par le sentiment le plus exquis des
beauts de la musique, et par la conception prompte du
style d'excution le mieux en rapport avec le caractre
de chaque composition. Pollani, lve de Nardini, fut
un de ses matres de violon; mais il est vrai de dire que
les grandes qualits du talent de Baillot furent celles
qu'il puisa en lui-mme. Grand violoniste solo, il ne
put jamais s'lever toute sa hauteur lorsque la valeur
de l'uvre qu'il excutait ne l'mouvait pas. A l'Opra,
par exemple, o il devait jouer des solos pour la danse,
il perdait une grande partie de son talent et n'tait que
l'ombre de lui-mme; mais dans ses sances annuelles
de quatuors et de quintetti, lorsque le gnie de Bocche-
rini, de Haydn, de Mozart et de Beethoven faisait battre
son cur, il devenait sublime et sans gal par la varit
d'accents, les nuances de sentiment et la posie des
ides. Son archet tait magique, et les sons devenaient
sous ses doigts d'loquentes inspirations. Baillot ne fut
pas seulement un grand artiste : ce fut un grand pro-
fesseur. Le nombre d'excellents violonistes qu'il a forms
est trs-considrable. De sa premire cole sortirent Ha-
beneck et Mazas, qui furent aussi 2 grands artistes.
Devenu lui-mme professeur au Conservatoire de Paris,
et successeur de son matre, Habeneck a form de bons
lves, la tte desquels se place Alarcl, aujourd'hui
chef de l'cole franaise.
Et vous aussi, Lafont, vous ftes une desplusbeles
gloires de l'cole des violonistes franais! D'abord lve
de Kreutzer, Lafont ne trouva pas dans le sentiment de
ce matre les qualits qui pouvaient sympathiser avec le
sien ; il ne tarda pas passer de cette cole dans celle de
Tlode, qui semblait faite pour dvelopper ses qualits
naturelles de grce, de puret, d'lgance et de charme;
496 VIO
qualits qui parvinrent, par 3a suite de ses tudes, au
dveloppement le plus complet, et conduisirent l'artiste
un rare ensemble de perfection. La justesse de ses
intonations tait si sre; la douceur de son archet avait
tant de sduction
;
il
y
avait tant de got dans les orne-
ments de son jeu, que si Je sentiment de la grandeur
laissait quelque chose dsirer, on s'en apercevait
peine, ravi qu'on tait par la grce et par la dlicatesse.
Une cole nouvelle s'est forme : nous voulons par-
ler de l'cole belge du violon, qui compte un peuple de
hros la tte duquel se placent De Beriot et Vieux-
temps, l'honneur de leur patrie.
L'Allemagne a produit plusieurs coles de violo-
nistes, dont les qualits principales ont t la justesse
et la nettet du jeu, mais qui, dans le xvni
e
sicle sur-
tout, ont laiss dsirer un son plus puissant, et plus
d'ampleur dans le style d'excution. Les prodiges inven-
ts par Wagner au xvn
e
sicle ne paraissent pas avoir
laiss de traces chez ses successeurs. L'Italie et la
Bohme furent les berceaux des deux coles de violo-
nistes allemands d'o sont sortis les autres.
Corelli, qui a laiss partout des preuves de sa grande
influence, tait premier violon de la chapelle du margrave
d'Anspach en
1699, lorsque Pisendel, qui
y
tait enfant
de chur, devint son lve, et fit de si rapides progrs
sous sa direction, qu'il put tre engag en 1702 comme
premier violon de la chapelle. Ce mme Pisendel, de-
venu trs-habile violoniste, fut attach au service de la
cour de Saxe en qualit de matre de concerts, et ouvrit
Dresde une cole de violon. Il
y
transmit la tradition
de son matre, mais en la modifiant par le style un peu
manir qui avait alors beaucoup de vogue la cour de
Dresde. C'est dans cette cole que se forma le talent de
Jean-Thophile Graun, frre du clbre compositeur de
ce nom, et matre de concerts de Frdric-le-Grand, roi
de Prusse. Graun avait un talent solide, dont il a donn
des preuves, et par les lves qu'il a forms, et par vingt-
neuf concertos de violons rests en manuscrit, mais dont
j'ai vu quelques-uns qui donnent une haute opinion de
son habilet. Dans sa jeunesse, au sortir de l'cole de
Pisendel, il tait all en Italie, et il
y
avait reu des le-
ons de artini, dont il avait adopt la manire, (i).
(i) F. J. Ftis.
VIO 497
C'est au talent du plus habile facteur de la renaissance
Stradivarius, et aux efforts runis des Amati, des Guar-
nerius, des Bergunzi, des Steiner, des Gappa, des Sa-
lues, que le violon doit sa constitution dfinitive. Sous
les mains intelligentes de ces artistes fameux, le violon
s'anima d'un souffle puissant, et son invention, son
mcanisme ingnieux ne sont pas une des conqutes les
moins prcieuses du seizime sicle, cette poque bril-
lante de mouvement intellectuel et de rnovation artis-
tique.
De nos jours en France, M. Vuillaume ajoutant la
science de l'acoustique aux grandes traditions des fac-
teurs clbres qui l'on prcd, a fait entrer la facture
du violon dans une voie nouvelle o il s'est signal par
des rsultats dont l'avenir, nous n'en doutons pas, con-
sacrera le vritable mrite !
Violon. Jeu d'orgue de tuyaux bouche, ouvert de
deux pieds, qui sert d'unisson au principal.
Violoncelle. Cet instrument doit son origine
quelques changements faits la basse de viole. Il fut
invent par le P. Tardieu, de Tarascon, au commence-
ment du dernier sicle. Il avait alors cinq cordes, do,
sol, r, la, r. Aujourd'hui, il n'en a plus que quatre,
dont les deux dernires sont revtues de fif de mtal.
Elles sont accordes en do, clef de basse au-dessous de la
porte : sol, r, la.
Le violoncelle a un caractre grave et sensible. Son
chant, touchant et majestueux, charme et lve l'me.
Il se prte tous les jeux de l'harmonie, de la double
corde et de l'arpge. Dans les accompagnements, il sert
de base pour dterminer l'effet de l'harmonie o il
occupe une place particulire. Le violoncelle figure
encore tour tour dans le solo, la sonate, le concerto,
l'air vari, le quatuor et le quintette.
Violon-cymbalo. Instrument corde clavier avec
archet continu mu par une manivelle, imagin Venise,
par l'abb Trentin.
Violone. Etait un instrument semblable Yacordo,
qui servait dans les orchestres, excuter la basse
d'harmonie.
Violone. Instrument de grande dimension, qui ser-
498
VIO
vait autrefois de conlre-bassc aux diffrentes espces
de
violes.
Violon-olien. Instrument dont les cordes taient
mises en vibration par un courant d'air, imagin et
construit en
1835,
par Isouard.
Violon piccolo. Accord en do, au-dessous des lignes
sol, r, la. Il n'est plus en usage.
Violon-trompette. Instrument cordes et vent
runies. Dans le corps du violon se trouvaient renferms
les tubes d'une trompette, l'une des extrmits suivait le
manche et sortait par la tte, cette originalit est due
Ilell, de Vienne, qui la produisit en 1854.
Virtuose. Ce nom s'applique en musique ceux qui
possdent un talent remarquable d'excution dans le
chant comme dans le jeu des instruments.
Virtuose de chambre. C'est ainsi qu'on dsigne
ordinairement
,
dans les cours ultramontaines
,
les
chanteurs et les excutants de concerts attachs leur
service.
Vitaliens. Nom du chur de musiciens romains,
institu par Vitalien pour l'usage de la musique sacre.
Vivace, Vivement. Epithte souvent jointe au mot
allegro, et qui indique une excution pleine d'entrane-
ment, analogue au sentiment dominant du morceau du
musique.
Vocalisation. Espce de solfge qui ne se chante que
sur la voyelle a.
Vocaliser. Chanter sur une voyelle en ne se servant
que de l'a. Cet exercice est ncessaire au perfectionne-
ment du chant aprs l'tude du solfge. Pour cela, il
faut :
1
savoir bien attaquer le son
;
2
passer d'un
registre l'autre d'une manire insensible
;
3
porter la
voix
;
4
excuter tous les agrments avec grce, lg-
ret et prcision
;
5
phraser le chant musical.
Voix. La voix humaine prend naissance dans la glotte
moyennant une expiration un peu force/ L'air, chass
des poumons, s'achemine d'abord par un canal assez
large, mais qui bientt se resserre et doit enfin traverser
une troite fente. Les bords de cette ouverture sont deux
lames vibrantes qui, semblables celles des anches,
permettent ou interceptent de temps en temps le pas-
V01 499
sage de l'air
;
et ainsi, par ces alternatives, elles doivent
dterminer des ondulations sonores dans le courant d'air
qui les frappe. Outre le palais, la langue, les dents, les
lvres, tous organes utiles au mcanisme de la voix, la
trache-artre, les poumons, le larynx, les sinus fron-
taux et maxillaires, les fosses nasales, concourent aussi
sa formation.
L'acuit, la force, l'agrment, et le caractre indivi-
duel de la voix dpendent de l'organisation et de l'al-
tration de l'organe principal de la voix, qui est le
larynx.
La voix se divise :
1
relativement aux quatre princi-
pales voix de l'homme, en voix de soprano, d'alto, de
tnor et de basse
;
2
relativement au registre, en voix de
poitrine, de tte, et mme de mdium
;
3
relativement
sa qualit, en voix bonne, c'est--dire, claire, sonore
ou argentine, pleine, juste, agile, flexible, vigoureuse,
forte, agrable, douce, riche, tendue, etc.
;
et en voix
mauvaise, c'est--dire, faible, mince, criarde, trop forte,
nasillarde, gutturale, lourde, voile, etc.
;
4
relative-
ment son acuit et sa gravit, en voix grave,
moyenne, aigu.
La voix humaine est le plus beau moyen d'excution
que possde la musique. Les instruments ne servent qu'
l'imiter ou l'accompagner. Semblables, pour ainsi dire,
aux esclaves qui prcdent ou suivent leurs matres, les
instruments ne font entendre leurs accents sur le thtre
que pour annoncer le chanteur et lui servir de cortge.
Chaque espce de voix ayant une qualit propre, elles
fournissent au compositeur les moyens de varier les effets.
La chose essentielle est de ne pas les forcer en les jetant
hors de leur tendue naturelle. A la richesse des moyens,
aux ressources de la science et du travail se joint encore,
chez certains individus, la magie d'une remarquable
sonorit dans la voix. Ceux qui ont entendu les grands
chanteurs italiens ne perdront jamais le souvenir des
vives jouissances que leur ont fait prouver leurs suaves
accents.
On a beaucoup dissert sur les moyens les plus pro-
pres assurer la conservation de la voix.
C'est l une question d'hygine trop importante pour
que nous ne la traitions pas au moins sommairement
dans ce livre la fois historique, thorique et didactique.
500
VOI
Le docteur Second, qui a fait des tudes spciales sur
la constitution de la voix humaine, nous fournit des ren-
seignements dont nous profitons d'autant plus volontiers,
qu'ils ont t labores sous les yeux d'un matre juste-
ment estim. M. Manuel Garcia; les chanteurs
y
puise-
ront d'utiles prceptes.
La vie de J'homme se maintient par deux fonctions
principales qui mettent incessamment son organisme en
rapport avec le monde extrieur. Le poumon, d'une
part, donne accs une matire gazeuse, l'oxygne de
l'air qui passe, par endosmose, des vsicules pulmonaires
dans le torrent de la circulation
;
l'estomac, d'autre part,
reoit les matires solides et liquides qui doivent servir
la nutrition.
Puisque, chez le chanteur, l'une de ces deux fonctions
s'excute avec exagration, il est trs-important d'exa-
miner quelles seront les modifications que cette surac-
tion fera subir l'organisme.
Pendant bien des sicles, une grande incertitude a
rgn dans l'explication physiologique de ces phnom-
nes
;
aujourd'hui, plus de vague, plus de vains raisonne-
ments
;
la lumire nous est venue, et c'est aux chimistes
modernes que nous la devons en grande partie.
Il rsulte des expriences de Lavoisier et de Sguin,
qu'un homme adulte absorde neuf cent quatre-vingt-
quatorze grammes d'oxygne par jour. Malgr l'absorp-
tion de cette norme quantit de gaz, on peut s'assurer
qu'au bout de vingt-quatre heures, le mme homme n'a
pas sensiblement augment de poids, et cependant il a,
en outre, introduit dans son estomac une certaine quan-
tit d'aliments.
Qu'est devenu l'oxygne?
Que sont devenues les matires nutritives intro-
duites dans l'estomac?
L'oxygne, transport dans tous les organes, se fixe
sur le carbone et l'hydrogne, et le poumon le restitue
l'air sous forme d'une combinaison carbone ou hydro-
gne, acide carbonique et eau.
Comment l'homme pourvoit-il la consommation
continuelle de ces deux lments constitutifs? Par l'ali-
mentation. Manger, c'est faire provision de carbone et
d'hydrogne;
respirer, c'est consommer ce mme car-
bone et ce mme hydrogne.
YOI
501
Si vous respirez beaucoup, il faudra que vous man-
giez en proportion; car, si vous ne restituez pas l'or-
ganisme tout le carbone et l'hydrogne que l'oxygne
aura dvor, celui-ci, ne devant sortir du corps que
combin avec ces deux lments, attaquera votre propre
substance.
Ces principes une fois tablis, nous avons l'explica-
tion d'un grand nombre de faits que tout le monde a
bien souvent constats, mais que personne n'avait con-
venablement tudis avant les savantes
recherches des
chimistes de notre sicle et du sicle dernier.
L'enfant, dont les organes respiratoires sont si actifs.
mange proportionnellement beaucoup plus qu'un adulte,
L'oiseau, dont le poumon fonctionne si bien, ne peut
souffrir longtemps la faim
;
priv de nourriture, il
meurt le troisime jour. Le reptile, au contraire avec sa
respiration lente et paresseuse, supporte impunment la
faim pendant un temps trs-long.
L'on peut concevoir, ds prsent, l'importance de ces
faits dans l'hygine du chanteur
;
car il nous sera facile
de prouver qu'il respire, au point de vue de l'absorp-
tion de l'oxygne, d'une manire vraiment exception-
nelle.
L'tude des phnomnes chimiques de la respiration
amne invinciblement reconnatre une relation parfaite
entre cette fonction et l'alimentation
;
et, d'aprs ce que
nous avons expos, l'on comprend que tout dsaccord
entre ces deux fonctions doit invariablement produire
une perturbation de la sant. Un homme, par exemple,
qui respirerait de manire consommer quatre cent cin-
quante grammes de carbone par jour, et qui n'en rem-
placerait que quatre-cent quarante par l'alimentation,
mourrait lentement de faim.
La quantit d'oxygne absorbe dpend surtout du
nombre et de l'amplitude des inspirations. Celui dont le
poumon fonctionnera de manire introduire dans la
circulation, deux kilogrammes d'oxygne, devra restituer
au corps deux fois plus de carbone que celui qui n'en
aura absorb qu'un kilogramme.
Si nous tudions la respiration du chanteur, nous
voyons que son poumon, pendant qu'il exerce mthodi-
quement sa voix, est travers par des masses d'air con-
sidrables.
15..
502 VOI
La quantit du mouvement respiratoire ne peut tre
value qu'approximativement, attendu qu'elle varie
pour chaque individu, suivant les particularits de son
organisation. Aussi, les physiologistes qui ont tudi
cette question ne sont-ils pas arrivs des rsultats
semblables. Sguin value le nombre des inspirations de
quinze vingt par minute, Lannec de onze quinze,
Menziers quatorze, Magendie quinze; Allen et
Papys dix-neuf, Dalton vingt, Davy vingt-six. En
nous arrtant dix-huit, nous avons le terme moyen du
nombre des inspirations.
Si nous examinons la question au point de vue de la
quantit d'air qui pntre le poumon, nous voyons, d'a-
prs les expriences d'Abilgaard, de Wurzer, de Herbst,
de 'Bostock, etc., qu'elle s'lve, terme moyen, 18
pouces cubes par respiration.
Le poumon, dans les conditions les plus gnrales,
est donc travers en une minute par plus de 300 pouces
cubes d'air, c'est--dire plus de 466,000 pouces cubes en
vingt-quatre heures. Ces chiffres, dj normes, sont
bien intrieurs ceux que fournit la respiration du chan-
teur. Celui-ci ne pouvant bien dire de longues phrases
de chant qu' la condition d'avoir une grande tendue
de respiration, habitue ses poumons contenir la plus
grande quantit d'air possible. Cet exercice, augmentant
l'activit des organes de la respiration, dtermine bien-
tt leur accroissement, et la plupart des chanteurs pr-
sentent un grand dveloppement de la cavit thoracique.
Mais, sans mme tenir compte de cette diffrence de ca-
pacit, si nous recherchons quelle est la quantit d'air
que le poumon peut contenir, nous apprenons qu'elle
dpasse de beaucoup la moyenne que nous avons pose
plus haut en tudiant la respiration,normale. Ainsi, nous
savons que Herbst, ayant fait expire six jeunes gens
avec toute la force possible, aprs une inspiration des
plus profondes, trouva que le minimum de l'air expir
tait de 120 pouces cubes, et le maximum de 244, ce qui
donne 167 pour terme moyen.
Un bon chanteur, qui fait des exercices ou qui phrase
une cavatine, ne respire pas autrement. Il introduit
chaque respiration, dans son poumon, 167 pouces cubes
d'air; mais admettons qu'il n'en prend que 100, et qu'il
ne fait que dix inspirations de ce genre par minute
;
malgr cette dduction, on trouve qu'il a respir plus
VOI 503
d'rir en vingt minutes, qu'une personne qui ne chante
pas et qui respire normalement n'en peut respirer en
une heure.
Qui pourra nier devant ces chiffres, les conditions
spciales dans lesquelles se trouve plac le chanteur?
Evidemment, il n'est peut-tre pas d'tat physiologique
dans lequel la respiration soit aussi exagre; ds-lors,
on comprend tout le soin que le chanteur devra apporter
h son alimentation
;
car, que rsulte-t-il de l'ignorance
de ces principes? c'est que beaucoup djeunes artistes
et de dilettantes, se livrant avec ardeur l'tude du
chant, pensent mnager leur larynx en mnageant leur
estomac. Au bout de quelque temps l'puisement arrive,
la voix s'teint; ils s'imaginent que le travail ou une
mthode vicieuse la leur a brise, tandis que la vritable
cause de cet affaiblissement est une alimentation insuffi-
sante.
Il n'y aurait que demi-mal s'ils en taient quittes pour
une extinction de voix
;
mais ne sait-on pas que les ma-
ladies les plus graves peuvent rsulter de ce dfaut
d'harmonie entre les fonctions les plus essentielles au
maintien de la vie ? Nous ne voulons pas effrayer le
chanteur par la triste numration des affections qui se
dveloppent, avec une dplorable promptitude, au mi-
lieu de l'puisement gnral de l'organisme
;
mais nous
devons le prmunir contre elles et lui donner les moyens
de conserver l'intgrit son corps, et, par suite, la
vigueur aux organes de la voix.
Si l'on a bien saisi la liaison intime que nous avons es-
say d'tablir entre la respiration et la nutrition, on
sera naturellement conduit penser que le chanteur doit
consommer une quantit d'aliments considrable, et nous
entendons beaucoup de personnes se rcrier et nous ac-
cuser de vouloir faire des Apicius ou des Hliogabales
de tous nos potiques chanteurs. Loin de nous la pense
de transformer ainsi ces belles organisations, qui sem-
blent n'exister que pour ressentir les plus douces sensa-
tions, et pour les exprimer de la manire la plus suave !
Ils voudraient ne manger que pour vivre, mais ils
doivent aussi manger pour chanter.
Voici quelles sont les substances clans lesquelles le
chanteur trouvera les lments d'une complte rpara-
tion. Les chimistes les ont divises en deux classes : les
aliments azots et les aliments non azots. Les premiers.
504 VOI
appels aussi plastiques, constituent l'aliment propre-
ment dit : introduits dans l'organisme, ils ont seuls la
proprit de se convertir en sang et de donner naissance
aux principes des organes. Les aliments de la seconde
classe ont t appels respiratoires, cause de la grande
proportion de carbone qu'ils contiennent.
Les aliments proprements dits sont :
La fibrine (chair et sang des animaux),
L'albumine (blanc d'oeuf),
Le gluten (crales),
La matire caseuse (lait).
Les substances alimentaires de second ordre sont :
La graisse,
La gomme,
Les sucres,
La bire,
Le vin, etc.
Avec cette seconde classe d'aliments, le chanteur fera
facilement provision de carbone et d'hydrogne.
Beaucoup de personnes racontent avec tonnement
que tel chanteur ou telle cantatrice prend du vin de Bor-
deaux et du vin de Madre en grande proportion
;
qu'on
fasse chanter ces mmes personnes pendant trois heures,
et nous verrons si elles ne trouvent pas que le bon vin
est un excellent rparateur des forces dpenses pendant
la suraction de l'appareil respiratoire. Hippocrate, ce
grand mdecin de toutes les poques crivait, il
y
plus
de vingt sicles, que le vin appaise la faim. Famen iho-
rexis solvit. (Secte II, aph.
21).
Les vins, en effet, ceux du Midi surtout, offrent l'or-
ganisme, sous une forme extrmement favorable, une
quantit notable de carbone.
Est-il besoin d'observer que les liqueurs qui contien-
nent une trop grande proportion d'alcool, agissent d'une
manire funeste sur les cordes vocales? Chacun connat
l'expression triviale par laquelle on dsigne une voix
casse par les spiritueux.
La gomme et les sucres seront galement trs-propres
la rparation. Mais, c'est dans la chair des animaux
que le chanteur trouvera son vritable aliment. Il la pr-
frera toujours aux substances vgtales, et il choisira
surtout les viandes noires, parce qu'elles portent avec
VOI
505
elles un principe d'excitation trs-favorable au dvelop-
pement des forces. Celles-ci, comme l'a parfaitement d-
montr M. Edwards, sont en rapport avec la quantit
des aliments. Ce savant a constat avec le dynamo-
mtre, qu'aprs une forte nourriture, un bon consomm,
par exemple, la force est plus considrable, les mouve-
ments plus srs, plus faciles, plus nergiques qu'aprs
l'ingestion d'aliments lgers.
Ce que nous vsnons d'exposer pour le chanteur, s'a-
dresse, jusqu' un certain point l'artiste dramatique
qui, cherchant exprimer un passage de Racine, par
exemple, fouille dans les trsors de son cur pour en
tirer l'expression la plus vraie, l'accent le plus sympa-
thique, et rpte ce passage de mille manires. Il res-
pire alors beaucoup plus que dans les conditions ordi-
naires. Les avocats, les orateurs de tribune, les profes-
seurs, les prdicateurs pourront galement profiter de
ces considrations.
Nous pourrions donner un grand dveloppement
toutes ces questions
;
mais ce que nous en avons dit
suffira pour persuader le chanteur que c'est par une
nourriture suffisante qu'il conservera sa sant et sa voix.
L'alimentation imparfaite a pour premier effet d'amoin-
drir les muscles, de les priver de leur contractilit et de
les rendre rigides et impropres tout acte de vigueur et
de souplesse. Quand le corps est affaibli, la voix devient
pauvre et languissante, l'expression dramatique ple et
uniforme
;
l'me de l'artiste, secouant vainement les
organes, ne peut se traduire que par des vibrations
flasques et chancelantes
,
et l'auditeur, impassible
,
frapp seulement par l'impuissance, ne subit aucun
charme, aucun entranement.
Ces rflexions, biens graves pour un chanteur, sont
moins srieuses que celles qu'on peut faire sur l'puise-
ment gnral. Il s'agit surtout ici de la sant du chan-
teur. Veiller l'quilibre de ses fonctions, c'est aussi
veiller la conservation et au dveloppement de sa
voix.
Voix Anglique. Jeu d'orgue qui sonne l'octave du
jeu de voix humaine.
Voix blanche. Expression mtaphorique qui in-
dique l'intensit et lo caractre de certaines voix et
de certains instruments. Les voix de soprano et d'alto
sont des voix blanches. L'octavin, la flte, le hautbois,
306 VOL
la clarinette, la trompette, le violon, sont des instru-
ments voix blanches.
Voix de poitrine. C'est dans la voix humaine l'ten-
due des sons produits par la situation naturelle des
organes de la voix, avec la poitrine pleine et la bouche
ouverte, la diffrence de ces sons plus aigus forms
par un effort de ces mmes organes, et que l'on appelle
voix de tte ou fausset.
Voix extrieures. C'est le nom des voix principales
les plus aigus ou les plus graves d'une composition
musicale, comme dans les churs, le soprano et la
basse.
Voix humaine. Jeu d'orgue, ainsi nomm parce qu'il
imite assez bien la voix de l'homme. Dans les sicles
passs, on donnait galement ce nom, en Italie, au vio-
lon de concerto, pour le distinguer du violon d'orchestre
qu'on appelait voix argentine. En Italie, on donne aussi
le nom de voce umana au cor anglais.
Voix intermdiaires. Ce sont celles qui se trouvent
entre la voix la plus aigu et la plus grave, comme dans
les churs, la voix d'alto et de tnor.
Voix principale. Ce mot indique :
1
la partie d'une
composition musicale qui exprime plus particulirement
son caractre propre
;
ton les les autres lui servent
d'appui, d'expression et d'accompagnement harmonique;
2
toute voix qui, dans un morceau de musique, se dis-
tingue des autres par une mlodie qui lui est propre.
Voix solo. Voix principale d'un morceau de musique,
excut par une seule personne.
Volate, Volatine. Excution rapide de plusieurs
sons successifs sur une mme syllabe, au moyen de la
simple vocalisation.
Volte. Ancienne danse hors d'usage, du genre de la
gaillarde, et dont l'air tait crit en mesure trois
quatre.
Volti presto. Le volti presto est un pupitre propre
soutenir le cahier de musique auquel le mcanisme
moteur est attach dans la partie infrieure. Ce pupitre
porte un nombre quelconque de tringles mobiles.
Chaque tringle, porte droite, se recouvre d'un feuillet
ju-qu'au commencement du morceau. Lorsque cette
disposition premire est faite, il ne s'agit plus que de
presser le levier avec le pied, le genou ou la main a
volont pendant l'excution, et Je mouvement de feuillets
XAC 307
do droite gauche s'opre l'instant. Lorsqu'il s'agit
de
recommencer le morceau, un autre levier produit
l'effet
contraire
Volume. C'est la masse de son que donne une voix
ou un instrument sur chacun des degrs de son dia-
pason.
Voyelles prohibes. Dans le solfge italien les
voyelles dfendues sont i, u.
W
W. Double majuscule, qui sert quelquefois indi-
quer les parties des violons dans une partition.
Walnica. Chalumeau en usage parmi les paysans de
la Russie, qui consiste en une vessie de buf, o l'on
place deux ou trois roseaux.
Walzer valse. Air de danse trois temps, d'un
caractre gai, avec deux reprises de huit mesures cha-
cune, et d'un mouvement modr. La valse est origi-
naire d'Allemagne. Il parat qu'elle n'a t introduite en
France que vers 1790.
Il
y
a aussi la valse deux temps,
c'est la moins gracieuse, et dans le sens de la mesure c'est
une monstruosit, par la raison fort simple qu'elle est un
dfi jet la musique.
La coda d'une valse est le
rappel de ses diverses fractions mlodiques.
La valse
est deux. La polka doit tre range parmi les valses.
(Voyez Polka).
Webeb. C'est un violon mont de deux cordes, dont
on joue sur les ctes de Barbarie, comme de notre vio-
loncelle.
Withalm. Luthier imitateur de Stainer, travaillait
Nuremberg, en 1720. I] copiait Stainer d'une manire
si habile que ses instruments sont souvent vendus comme
provenant de son matre.
Xacaua. C'est le nom d'un air espagnol qu'on chante
et danse en mme temps.
508 ZUR
Xelus. Nom ancien donn la lyre parce que sa base
ressemblait l'caill d'une tortue, animal dont la figure
dit-on, avait donn la premire ide de cet instrument.
Xenorphica. Nom d'un clavecin archet, invent par
M. Rllig, en
1801, Vienne, vers la fin du sicle der-
nier.
Xilomelodigor. Espce d'harmonica , imagin en
1848, en Prusse, par Ntr.
Xitarganon. (Voir Xylorganon).
Xylharmonicon. Instrument invent par M. Uthe, il
y
a quelques annes, et qui ressemble l'euphone du
docteur Chladni.
Xylorganon. Espce de claquebois avec une touche.
Il est aussi appel xitarganon.
Xyloustron. Instrument qui avait la l'orme d'un
grand piano, construit par Uthe, en 1808.
Za. Syllabe dont on se servait autrefois pour dsigner
le si bmol.
Zampogne. Espce de cornemuse qui ne diffre de
cette dernire que par quelques dtails de construction.
Zistre. Guitare allemande en usage en 1800,
monte
de sept cordes accordes sol, mi, ut, sol,
fa,
ut,
fa.
Zither. Mandoline allemande ayant cinq cordes
mtalliques.
Zither plan. Espce de Cystre sans manche construit
Vienne, en 1851
,
par Huther.
Zurna. Instrument turc, qui par sa forme, et la qua-
lit de ses sons, ressemble nos hautbois.
FIN.
MEAUX.
IMPRIMERIE J. CARRO.
ii^mw&M:
,
Lon
mnair-
W'\
borique et
histc kl
S
PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLJPS FROM THIS POCKET
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
ss
*-*/ /irx-
Vous aimerez peut-être aussi
- Encyclopédie de La Musique Et (... ) Lavignac Albert bpt6k123719d PDFDocument619 pagesEncyclopédie de La Musique Et (... ) Lavignac Albert bpt6k123719d PDFMohamed Amine Bouallagui100% (1)
- Encyclopédie de La Musique Volume 1 PDFDocument1 382 pagesEncyclopédie de La Musique Volume 1 PDFMaurice AmaniPas encore d'évaluation
- Musique espagnole: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandMusique espagnole: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Musiques d'inspiration chinoise: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandMusiques d'inspiration chinoise: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Dictionnaire des Musiciens : les Interprètes: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire des Musiciens : les Interprètes: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Deux petites Sonates pour violon et clavier: Compilées et arrangées par Micheline CumantD'EverandDeux petites Sonates pour violon et clavier: Compilées et arrangées par Micheline CumantPas encore d'évaluation
- Dictionnaire des Instruments de musique: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire des Instruments de musique: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les Couperin: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandLes Couperin: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Chansons populaires: Recueillies dans les Alpes françaisesD'EverandChansons populaires: Recueillies dans les Alpes françaisesPas encore d'évaluation
- Musiques de l'Asie du Sud-Est: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandMusiques de l'Asie du Sud-Est: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les RECITS CACHES DE RICHARD WAGNER: Art poétique, rêve et sexualité du Vaisseau fantôme à ParsifalD'EverandLes RECITS CACHES DE RICHARD WAGNER: Art poétique, rêve et sexualité du Vaisseau fantôme à ParsifalPas encore d'évaluation
- Musique et évolution: Les origines et l'évolution de la musiqueD'EverandMusique et évolution: Les origines et l'évolution de la musiquePas encore d'évaluation
- La naissance du blues: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLa naissance du blues: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les comédies musicales: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLes comédies musicales: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Musiques de l'Islam: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandMusiques de l'Islam: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Notation musicale: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandNotation musicale: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Tempo Du ClassiqueDocument48 pagesTempo Du ClassiqueFranck DijeauPas encore d'évaluation
- Frédéric Chopin: Un hommage au maître de la musique romantique par Franz LisztD'EverandFrédéric Chopin: Un hommage au maître de la musique romantique par Franz LisztPas encore d'évaluation
- Les pianistes célèbres silhouettes & médaillonsD'EverandLes pianistes célèbres silhouettes & médaillonsPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de la Renaissance: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire de la Renaissance: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Musique traditionnelle pour accordéon diatonique: Philippe BruneauD'EverandMusique traditionnelle pour accordéon diatonique: Philippe BruneauPas encore d'évaluation
- Histoire de la Marseillaise: Nombreuses gravures documentairesD'EverandHistoire de la Marseillaise: Nombreuses gravures documentairesPas encore d'évaluation
- 60 questions étonnantes sur la musique et les réponses qu'y apporte la science: Un question-réponse sérieusement drôle pour déjouer les clichés !D'Everand60 questions étonnantes sur la musique et les réponses qu'y apporte la science: Un question-réponse sérieusement drôle pour déjouer les clichés !Pas encore d'évaluation
- Mémoires de Hector Berlioz comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre, 1803-1865D'EverandMémoires de Hector Berlioz comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre, 1803-1865Pas encore d'évaluation
- Dictionnaire des Musiciens: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire des Musiciens: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- De La Musique - PlutarqueDocument264 pagesDe La Musique - PlutarqueAmin ChaachooPas encore d'évaluation
- Dictionnaire des Compositeurs: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire des Compositeurs: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- L'Art HarmoniqueDocument584 pagesL'Art HarmoniqueJosé Menéndez GalvánPas encore d'évaluation
- Facture instrumentale: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandFacture instrumentale: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Vie de Beethoven: édition intégrale avec correspondanceD'EverandVie de Beethoven: édition intégrale avec correspondancePas encore d'évaluation
- Le Classicisme en Musique Et La Transition Vers Le Romantisme Avec BeethovenDocument4 pagesLe Classicisme en Musique Et La Transition Vers Le Romantisme Avec BeethovenÎmÀd ÀvëïrøPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de La Musique PDFDocument3 901 pagesDictionnaire de La Musique PDFhaykalham.piano9588100% (2)
- (Traités Inédits Sur La Musique Du Moyen Age) Vol. 1Document28 pages(Traités Inédits Sur La Musique Du Moyen Age) Vol. 1mafesan5Pas encore d'évaluation
- Traité de Composition Musicale - Livre IDocument24 pagesTraité de Composition Musicale - Livre IEmmanuelIstace100% (1)
- D'Olivet, La MusiqueDocument63 pagesD'Olivet, La MusiqueGiovanni50% (2)
- Vocabulaire en Espace de La Musique Electroacoustique 2006Document231 pagesVocabulaire en Espace de La Musique Electroacoustique 2006姚熙Pas encore d'évaluation
- Musique Baroque FrançaiseDocument5 pagesMusique Baroque FrançaisescdscphjpcsPas encore d'évaluation
- Musique Écrite, Musique Orale, Musique PhonographiqueDocument15 pagesMusique Écrite, Musique Orale, Musique PhonographiqueandreacirlaPas encore d'évaluation
- These OnlineDocument524 pagesThese Onlineliaroques100% (1)
- Carra de Vaux GhazzaliDocument344 pagesCarra de Vaux GhazzaliAhmed Berrouho100% (2)
- Le Siècle de La Renaissance - Batiffol, Louis, 1865-1946Document436 pagesLe Siècle de La Renaissance - Batiffol, Louis, 1865-1946Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Pacte de Famine (Volume 2) - Berthet, Elie, 1818-1891Document328 pagesLe Pacte de Famine (Volume 2) - Berthet, Elie, 1818-1891Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Seizième Siècle en France. Darmesteter, Arsène, 1846-188Document720 pagesLe Seizième Siècle en France. Darmesteter, Arsène, 1846-188Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Schisme Oriental Du XIe Siècle - Bréhier, Louis, 1868-1951Document360 pagesLe Schisme Oriental Du XIe Siècle - Bréhier, Louis, 1868-1951Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Sumérisme Et L'histoire BabylonienneDocument171 pagesLe Sumérisme Et L'histoire BabylonienneAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Carra de Vaux Les Penseurs de L'islam 1Document402 pagesCarra de Vaux Les Penseurs de L'islam 1Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Pacte de Famine (Volume 1) - Berthet, Elie, 1818-1891Document318 pagesLe Pacte de Famine (Volume 1) - Berthet, Elie, 1818-1891Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Abrégé de L'histoire D'italie Depuis La Chute de L'empire Romain Jusqu'en 1864Document569 pagesAbrégé de L'histoire D'italie Depuis La Chute de L'empire Romain Jusqu'en 1864Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Abbés Galants Et Libertins Aux 17e Et 18e Siècles Gravigny, JeanDocument424 pagesAbbés Galants Et Libertins Aux 17e Et 18e Siècles Gravigny, JeanAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- (1885) Le Mahdi Depuis Les Origines de L'islam Jusqu'a Nos JoursDocument140 pages(1885) Le Mahdi Depuis Les Origines de L'islam Jusqu'a Nos JoursHerbert Hillary Booker 2nd100% (1)
- Abraham Lincoln - Lesperut, ADocument32 pagesAbraham Lincoln - Lesperut, AAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Agnès Sorel Et La Chevalerie Par M. CapefigueDocument250 pagesAgnès Sorel Et La Chevalerie Par M. CapefigueAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Edmund Burke - Réflexions Sur La Révolution de FranceDocument493 pagesEdmund Burke - Réflexions Sur La Révolution de FranceKoltchak91120Pas encore d'évaluation
- Petit de Julleville Histoire de La Langue Et de La Littérature Française XVIième SiècleDocument625 pagesPetit de Julleville Histoire de La Langue Et de La Littérature Française XVIième SiècleAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Alfred Poizat Le Symbolisme de Baudelaire À ClaudelDocument210 pagesAlfred Poizat Le Symbolisme de Baudelaire À ClaudelAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Alain Viala Pour Une Grammaire Du DiscoursDocument18 pagesAlain Viala Pour Une Grammaire Du DiscoursAhmed Berrouho100% (1)
- Alain Viala Ah, Quelle Était Jolie...Document18 pagesAlain Viala Ah, Quelle Était Jolie...Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Nouveaux Contes Cruels Et Propos D'au Delà - Villiers de l'Isle-Adam, Auguste, Comte De, 1838-1889Document334 pagesNouveaux Contes Cruels Et Propos D'au Delà - Villiers de l'Isle-Adam, Auguste, Comte De, 1838-1889Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Alain Viala Stylistique Et Sociologie Classe de PosturesDocument11 pagesAlain Viala Stylistique Et Sociologie Classe de PosturesAhmed Berrouho100% (1)
- Alain Viala À Propos Du Champ Littéraire. Histoire, Géographie, Histoire LittéraireDocument13 pagesAlain Viala À Propos Du Champ Littéraire. Histoire, Géographie, Histoire LittéraireAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Petit de Julleville Histoire de La Langue Et de La Littérature Française XVIième SiècleDocument928 pagesPetit de Julleville Histoire de La Langue Et de La Littérature Française XVIième SiècleAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Alain Viala Effets de Champ Et Effets de PrismeDocument9 pagesAlain Viala Effets de Champ Et Effets de PrismeAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Paul Valéry Exposition N5839347 PDF 1 - 1DMDocument145 pagesPaul Valéry Exposition N5839347 PDF 1 - 1DMAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- La Recherche D'une Première Vérité Fragments Posthumes Jules Lequier (1814-1862)Document426 pagesLa Recherche D'une Première Vérité Fragments Posthumes Jules Lequier (1814-1862)Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Albert Thibaudet - G. Flaubert - Sa Vie-Ses Romans-Son StyleDocument360 pagesAlbert Thibaudet - G. Flaubert - Sa Vie-Ses Romans-Son StyleLucie Anne Ghanem100% (1)
- La République Des Professeurs Par Albert Thibaudet - B. Grasset (Paris) - 1927Document285 pagesLa République Des Professeurs Par Albert Thibaudet - B. Grasset (Paris) - 1927Ahmed Berrouho100% (1)
- La Monadologie Avec Notice Sur La Vie, Les Écrits Et La Philosophie de Leibnitz Par M. E. Segond,... - V. Palmé (Paris) - 1883Document278 pagesLa Monadologie Avec Notice Sur La Vie, Les Écrits Et La Philosophie de Leibnitz Par M. E. Segond,... - V. Palmé (Paris) - 1883Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Gustave Flaubert Albert Thibaudet - Gallimard (Paris) - 1992Document314 pagesGustave Flaubert Albert Thibaudet - Gallimard (Paris) - 1992Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Mysticisme Du SonDocument93 pagesLe Mysticisme Du SonlilmauwPas encore d'évaluation
- Jacobs Flow ScoreDocument2 pagesJacobs Flow ScoreManel ArocasPas encore d'évaluation
- Accords Jazz & NotationDocument3 pagesAccords Jazz & NotationDominique ReyPas encore d'évaluation
- Gaulin - Initiation Ö L'improvisation - Clarinette (Ou Autres Instruments en Sib)Document12 pagesGaulin - Initiation Ö L'improvisation - Clarinette (Ou Autres Instruments en Sib)MichelDelcourtPas encore d'évaluation
- Guy Lacour - Précis Pour L'étude Dea GammesDocument24 pagesGuy Lacour - Précis Pour L'étude Dea GammesGabriele RotaPas encore d'évaluation
- Adorno (1937) - Sur La Musique PopulaireDocument20 pagesAdorno (1937) - Sur La Musique PopulaireChristophe MagisPas encore d'évaluation
- Petit Trait D HarmonieDocument19 pagesPetit Trait D HarmonieVincent Degroote100% (3)
- ED Mus 3ème - L1 - La Tonalité de La MineurDocument4 pagesED Mus 3ème - L1 - La Tonalité de La MineurWHOLY S ROGER KOALAPas encore d'évaluation
- MORTIER Roland, Hasquin Hervé: Autour Du Père Castel Et Du Clavecin Oculaire" PDFDocument231 pagesMORTIER Roland, Hasquin Hervé: Autour Du Père Castel Et Du Clavecin Oculaire" PDFAlessioZanfardinoPas encore d'évaluation
- Growing (Score) John PatitucciDocument22 pagesGrowing (Score) John Patitucciluis2segura-3Pas encore d'évaluation
- Christophe Poudras - L Harmonie JazzDocument71 pagesChristophe Poudras - L Harmonie JazzZele Isaac LandryPas encore d'évaluation
- 04 - Le TimbreDocument4 pages04 - Le TimbreJuPas encore d'évaluation
- May 2022 Exam For PCMDocument12 pagesMay 2022 Exam For PCMzhlewis123Pas encore d'évaluation
- 39 Stuctures Grieg Et DeliusDocument12 pages39 Stuctures Grieg Et DeliusJerome RossiPas encore d'évaluation
- 2.2 Anatole Et Ses DerivesDocument5 pages2.2 Anatole Et Ses DerivesTRIO NosekéPas encore d'évaluation
- 3° - Séquence - Hier, Aujourd'hui, Demain (2) ComplétéeDocument5 pages3° - Séquence - Hier, Aujourd'hui, Demain (2) ComplétéeHajar Wali AlamoPas encore d'évaluation
- De La Musique Au Son Pure Makis SolomosDocument15 pagesDe La Musique Au Son Pure Makis SolomosTeo ToroPas encore d'évaluation
- La TonalitéDocument3 pagesLa TonalitémoyeasaelkouadioPas encore d'évaluation
- Batipopo Pour Rien ScoreDocument23 pagesBatipopo Pour Rien Scoremusico1991Pas encore d'évaluation
- Happy-Birthday-Variations - Full Score PDFDocument6 pagesHappy-Birthday-Variations - Full Score PDFsoporanPas encore d'évaluation
- Les Accords Dans Le Mode MineurDocument3 pagesLes Accords Dans Le Mode Mineurayissi jeanPas encore d'évaluation
- Les Progressions DDocument8 pagesLes Progressions DFrelon Mercure27100% (2)
- Iordanou Charis 2011 TheseDocument627 pagesIordanou Charis 2011 TheseArnold DgPas encore d'évaluation
- Analyse Clementi Op.38 N°1Document12 pagesAnalyse Clementi Op.38 N°1haykalham.piano9588100% (1)
- Dubois, Théodore - Traité de Contrepoint Et de FugueDocument316 pagesDubois, Théodore - Traité de Contrepoint Et de FugueEdgar Espinoza, Jr.100% (1)
- Cours HarmonieDocument200 pagesCours Harmoniepeetermansp7683100% (1)
- Les Modulations 1Document5 pagesLes Modulations 1ayissi jeanPas encore d'évaluation
- Matter Molenaar en Bonne HarmonieDocument19 pagesMatter Molenaar en Bonne HarmonieadrienPas encore d'évaluation
- We Are The WorldDocument44 pagesWe Are The WorldLuis Sanchez SabiotePas encore d'évaluation