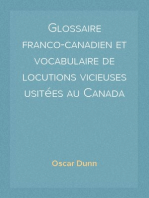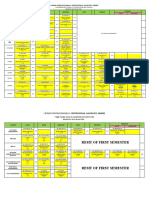Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
DELF B2 Transcription Audios 1
DELF B2 Transcription Audios 1
Transféré par
AhlamGharibaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
DELF B2 Transcription Audios 1
DELF B2 Transcription Audios 1
Transféré par
AhlamGharibaDroits d'auteur :
Formats disponibles
DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS
Transcription des documents audio
S’ASSURER AVANT DE COMMENCER L’ÉPREUVE QUE TOUS LES CANDIDATS SONT PRÊTS.
NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes.
Le surveillant ne doit donc pas intervenir sur l’appareil de lecture avant la fin de l’épreuve.
[mise en route de l’appareil de lecture]
Ministère de l’éducation nationale / Centre international d’études pédagogiques.
DELF niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective.
Exercice 1
Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ.
Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions.
Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.
Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions.
Vous écouterez une seconde fois l’enregistrement.
Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.
Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
(pause d’1 minute)
Première écoute
Jérôme Godefroy : Nous allons maintenant parler des portables à l’hôpital. Bonjour professeur Michel Drancourt.
Michel Drancourt : Bonjour.
Jérôme Godefroy : Vous êtes professeur de microbiologie à l’Université de Marseille. Vous êtes l’invité de RTL midi car il
y a une étude anglo-saxonne, britanique et américaine, qui affirme que le portable, le téléphone portable peut être une voie
importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux, et ces travaux confirment vos propres observations.
Michel Drancourt : Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le
même sens et qui montre qu’effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être
contaminés avec des bactéries ou des virus qui sont eux-mêmes… qui peuvent eux-mêmes être responsables d’infections
ensuite chez les patients, qu’on appelle des infections nosocomiales.
Jérôme Godefroy : Alors, pourquoi le portable justement, parce que c’est un objet qui va partout, qui va a l’extérieur, qui
revient…
Michel Drancourt : Oui.
Jérôme Godefroy : Voilà, c’est ça, hein ?
Michel Drancourt : Tout à fait. Et puis c’est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux, c’est un objet qui
en pratique n’existait pas quasiment il y a une dizaine d’années, par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c’est
un sujet qui n’avait pas été véritablement étudié jusqu’à présent. D’autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l’objet
de recherches de même nature, mais pas le téléphone portable jusqu’à présent.
Jérôme Godefroy : D’autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses là.
Michel Drancourt : Oui, tout à fait, voilà. On est entouré… lorsqu’on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un
hôpital, on est entouré par tout un tas d’objets, ceux que vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants :
les ordinateurs, par exemple. Les claviers d’ordinateur ont beaucoup été étudiés, ils sont porteurs, sans surprise je dirais, de
microbes, voire de virus.
Élizabeth Martichoux : Alors, les infections se transmettent de patient à patient, via les soignants à cause de ces portables.
Sujet_démo_B2TP
Michel Drancourt : Voilà, oui. Disons qu’il faut… ceci étant…il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça, si vous
voulez. Tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble sont… peuvent être contaminés par
des virus ou des bactéries. Mais ensuite il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient, pour donner une
infection au patient. Et en réalité le passage se fait beaucoup, beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins,
des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient.
Élizabeth Martichoux : Des mains qui ne sont pas désinfectées ? Des mains qui ne sont pas lavées entre chaque
opération ? Chaque acte ? C’est ça le problème ?
DELF B2 Page 1 sur 3
DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS
Michel Drancourt : C’est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison, c’est un point clé actuellement de la pré-
vention des infections que de convaincre tous les soignants, tous les soignants, en permanence, d’avoir une très bonne
hygiène de leurs mains, et en pratique il y a un geste qui est très simple en théorie mais qui n’est pas si facile que ça à
implanter, qui est de se passer les mains à ce qu’on appelle des solutions hydro-alcooliques…
Élizabeth Martichoux : On les connaît bien avec le H1N1.
Michel Drancourt : Et donc, c’est un point clé. Et donc, vous voyez bien qu’en réalité la bactérie, staphylocoque par
exemple, qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d’une infection
chez un patient, il faut qu’elle soit en contact avec le patient, et qu’en pratique la seule façon, bien entendu, c’est que les
mains qui ont touché le téléphone portable, ensuite touchent directement le patient sans hygiène. Donc, le point clé c’est
le passage par les mains du personnel et donc l’hygiène des mains du personnel.
Élizabeth Martichoux : On tombe un peu de sa chaise, parce qu’on pensait quand même que c’était fait systématique-
ment après un coup de fil au portable et avant d’examiner un patient, on devrait se laver les mains !
Michel Drancourt : Vous avez tout à fait raison. Et là, pour être vraiment précis, ça semble un détail mais ça ne l’est pas,
plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon de… laver, ça laisse supposer en gros de l’eau et du savon schéma-
tiquement… en réalité il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus rapide que ça, qui est de se frotter les mains
avec ces fameuses solutions hydro-alcooliques. Et donc, vous avez raison, il faut que ça soit fait comme ça. Malheureu-
sement, ce geste qui est pourtant très simple, très rapide, facile puisque maintenant je dirais toutes les cliniques, tous les
hôpitaux sont équipés de solutions hydro-alcooliques, et bien, malheureusement n’est pas fait dans 100% des cas, comme
cela devrait, il reste des brèches, et c’est à ce moment-là que le virus ou la bactérie peut passer du téléphone portable, ou
bien d’autres objets inanimés d’ailleurs, vers le patient.
Jérôme Godefroy : Professeur, donc si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et
uniquement le portable, ce sont les pratiques que vous mettez en cause.
Michel Drancourt : Disons les deux. Le téléphone portable est un objet supplémentaire en quelque sorte qui est introduit…
Élizabeth Martichoux : Un nouveau vecteur.
Michel Drancourt : Voilà, un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n’existait pas, encore une
fois, dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années, hein, finalement, qui était très peu répandu,
tout au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé, donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être
une source de microbes et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l’usage ou la proximité des patients, mais ça n’est
pas suffisant et il faut également renforcer encore l’hygiène des mains du personnel, et moi, je dirais que dans ce sens-là,
la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement importante, parce qu’un acteur important de ça, c’est le patient lui-
même. C’est-à-dire que c’est au patient de vérifier…
Élizabeth Martichoux : Exiger, on va exiger des soignants qu’ils se lavent les mains avant tout examen sur
nous-mêmes.
Michel Drancourt : Je crois que vous avez raison, c’est important… l’hygiène est faite pour les patients, elle n’est pas faite
pour les soignants. Elle est faite pour protéger.
Élizabeth Martichoux : En tout cas, pas question d’interdire les portables à l’hôpital, ça ne serait pas possible. C’est
irréversible.
Michel Drancourt : Non, je pense qu’il faut le limiter simplement. D’une part, c’est irréversible et deuxièmement, je pense
qu’il faut simplement en limiter l’usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l’hôpital. Entre se servir
du portable dans un couloir de circulation, c’est une chose, dans une salle d’opérations, ça serait d’autre nature. Donc, on
est d’accord qu’il y a une graduation des choses, et que simplement il faut trouver le point raisonnable.
Élizabeth Martichoux : Merci beaucoup Michel Drancourt d’avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je rappelle que vous êtes
professeur de microbiologie à l’Université de Marseille.
Michel Drancourt : Merci à vous.
RTL
Sujet_démo_B2TP
(pause de 3 minutes)
Seconde écoute
(pause de 5 minutes)
DELF B2 Page 2 sur 3
DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS
Exercice 2
Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 minute 30 à 2 minutes.
Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions. Après l’enregistrement vous aurez 3 minutes pour répondre aux
questions. Répondez en cochant la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée.
Lisez maintenant les questions.
(pause d’1 minute)
Journaliste : C’est la journée mondiale du don du sang. Nous sommes à la veille des vacances d’été. Les stocks s’épuisent,
alors l’Établissement français du sang tente de nous sensibiliser sur l’importance de ce don dans le traitement de milliers
de maladies. L’année dernière, 11 000 dons ont été effectués et cette année, il organise le « Festival Globule » dans 24
grandes villes en France, dont Paris. Émilie Valès, vous vous êtes rendue dans le 12e arrondissement.
Émilie Valès : Oui, et sous la grande tente blanche de l’Établissement français du sang, installée Cour Saint-Émilion, 50
bénévoles s’activent autour des donneurs. Une aiguille dans le bras, Alain, retraité de 60 ans, donne son sang.
Alain : Je suis en bonne santé pour le faire, donc, je le fais. L’idée, c’est que mon sang soit utilisé pour soigner des gens,
voilà. C’est un acte citoyen, il me semble que c’est important de le faire. Pour moi ce n’est pas contraignant. D’abord, ce
n’est pas douloureux, ça prend une demi-heure en tout avec l’entretien, le don et puis la collation après, ça prend une
demi-heure maximum.
Émilie Valès : Alors, monsieur, ça s’est bien passé, ça va bien ?
Alain : Très bien, pas de problème.
Émilie Valès : Le docteur François Charpentier, responsable des collectes en Île-de-France, il s’attend à une belle mobi-
lisation.
Docteur François Charpentier : Globalement, on estime qu’une journée comme aujourd’hui... la fréquentation de nos
collectes est entre 120 et 200% de ce qu’elle est habituellement. Donc, voilà en termes de chiffres ce qu’on attend.
Émilie Valès : Et ces dons sont essentiels. L’an dernier, 1 million de malades en ont bénéficié.
Docteur François Charpentier : Tout un pan de la médecine ou de la chirurgie aujourd’hui ne pourrait exister s’il n’y avait
pas la transfusion. Les besoins sont incessants et quotidiens. On en a, côté chirurgical, dans l’accidentologie évidemment
– on pense tout de suite à ça –. Mais également des spécialités comme la chirurgie cardiaque, aujourd’hui on ne pourrait
pas transfuser les malades en globules rouges ou en plasma, la chirurgie cardiaque n’existerait pas. En Île-de-France, il
faut 1 800 dons tous les jours, au plan national 9 500 dons.
Émilie Valès : Alors pour donner son sang, deux conditions : avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos.
Journaliste : Merci beaucoup Émilie Valès. Un numéro de téléphone utile si vous voulez vous renseigner sur ces dons de
sang : 0810 150 150, 0810 150 150.
RTL
(pause de 3 minutes)
Sujet_démo_B2TP
L’épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l’épreuve de compréhension écrite.
[Arrêt de l’appareil de lecture]
DELF B2 Page 3 sur 3
Vous aimerez peut-être aussi
- İnformatika Bələdçi (I VƏ II Hissə Cavablar) PDFDocument29 pagesİnformatika Bələdçi (I VƏ II Hissə Cavablar) PDFVefa Rasulova0% (3)
- Contrôle de SVT N°1: L'Homme Face Aux Micro-Organismes CorrectionDocument3 pagesContrôle de SVT N°1: L'Homme Face Aux Micro-Organismes Correctionsalama201188% (8)
- Fabrication de La Provende Pour VolaillesDocument15 pagesFabrication de La Provende Pour VolaillesTakoubo David100% (10)
- Compréhension de L'orale: Exercice 1Document2 pagesCompréhension de L'orale: Exercice 1Mai NguyenPas encore d'évaluation
- b2 Exemple5 SurveillantDocument3 pagesb2 Exemple5 Surveillant11松老 雲閑Pas encore d'évaluation
- Communication CommercialeDocument26 pagesCommunication CommercialeNancy GUELDRY100% (3)
- Delf Dalf b2 TP Candidat Coll Sujet Demo PDFDocument13 pagesDelf Dalf b2 TP Candidat Coll Sujet Demo PDFArShadPas encore d'évaluation
- Delf b2 TP Correcteur Coll Exemple2Document2 pagesDelf b2 TP Correcteur Coll Exemple2Maria BiancaPas encore d'évaluation
- Delf B2 PDFDocument8 pagesDelf B2 PDFVaryzaa ChaniagoPas encore d'évaluation
- Delf Dalf b2 TP Examinateur Sujet Demo PDFDocument3 pagesDelf Dalf b2 TP Examinateur Sujet Demo PDFKatherine AlvaradoPas encore d'évaluation
- TP22 B2 Examinateur3 PDFDocument8 pagesTP22 B2 Examinateur3 PDFsaulPas encore d'évaluation
- Violence Télé DELF B2Document1 pageViolence Télé DELF B2Ana Maria100% (1)
- Delf Dalf b2 TP CandidatDocument13 pagesDelf Dalf b2 TP CandidatAlvaro BMPas encore d'évaluation
- 2015LIL2C019Document177 pages2015LIL2C019Anonymous nZmocNmgPas encore d'évaluation
- b2 Example2 TP CandidatDocument10 pagesb2 Example2 TP CandidatFrederico de CastroPas encore d'évaluation
- Dalf c2 Candidat Lettres Sciences Humaines Comprehension Productions EcritesDocument12 pagesDalf c2 Candidat Lettres Sciences Humaines Comprehension Productions EcritesAgustina Fernández AgosteguiPas encore d'évaluation
- Exemple DELF B2Document12 pagesExemple DELF B2DanPas encore d'évaluation
- DELF B2 EntraînementDocument5 pagesDELF B2 EntraînementMai ĐoànPas encore d'évaluation
- Latitudes 3Document4 pagesLatitudes 3josepachaPas encore d'évaluation
- Exemple CE DELF B2Document3 pagesExemple CE DELF B2Mai NguyenPas encore d'évaluation
- b2 Exemple6 ExaminateursDocument4 pagesb2 Exemple6 ExaminateursTeresa Barón GarcíaPas encore d'évaluation
- Delf B2Document9 pagesDelf B2Arma AnPas encore d'évaluation
- Environnement: LeçonDocument14 pagesEnvironnement: LeçonPhuong Khanh DangPas encore d'évaluation
- (Lớp 10) Quốc Học Huế 2013 (Có Đáp Án)Document23 pages(Lớp 10) Quốc Học Huế 2013 (Có Đáp Án)Nhi KieuPas encore d'évaluation
- Dalf-C2 Sujet-Demo2 Candidat Coll Pe PDFDocument12 pagesDalf-C2 Sujet-Demo2 Candidat Coll Pe PDFCarlos A MuriesPas encore d'évaluation
- Delf B2 Marqueurs Presentation OraleDocument1 pageDelf B2 Marqueurs Presentation OraleMustapha Mektan100% (1)
- Delf Dalf b2 TP Candidat Ind Sujet Demo PDFDocument2 pagesDelf Dalf b2 TP Candidat Ind Sujet Demo PDFKatherine AlvaradoPas encore d'évaluation
- b2 SJ Exemple1 Candidat PDFDocument11 pagesb2 SJ Exemple1 Candidat PDFYuli SentanaPas encore d'évaluation
- ACTIVITE 5 Synthèse de Documents en ArabeDocument4 pagesACTIVITE 5 Synthèse de Documents en ArabeNawfal LamPas encore d'évaluation
- DALF C1 Exemple2Document2 pagesDALF C1 Exemple2ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣPas encore d'évaluation
- DELF B2 Epreuveblanche1-Pro Web Mai-2018Document9 pagesDELF B2 Epreuveblanche1-Pro Web Mai-2018poorgodrileyPas encore d'évaluation
- Biblio Delf DalfDocument3 pagesBiblio Delf DalfluamayerPas encore d'évaluation
- 2020 - Dalf C2 - La Domotique - Une Maison Intelligente Au QuotidienDocument8 pages2020 - Dalf C2 - La Domotique - Une Maison Intelligente Au QuotidienmohamedPas encore d'évaluation
- La Sieste - Thanh NganDocument2 pagesLa Sieste - Thanh NganNguyễn Thanh NgânPas encore d'évaluation
- b2 Exemple4 SurveillantDocument3 pagesb2 Exemple4 Surveillant11松老 雲閑Pas encore d'évaluation
- Delf B2Document11 pagesDelf B2aszaPas encore d'évaluation
- Delf b1 TP Candidat Coll Exemple1 1Document12 pagesDelf b1 TP Candidat Coll Exemple1 1Steve BensonPas encore d'évaluation
- Dapanduyenhai Phap 11Document8 pagesDapanduyenhai Phap 11Hà NguyễnPas encore d'évaluation
- Faits DiversDocument1 pageFaits DiversGheorghe GeorgianaPas encore d'évaluation
- Exercice 1Document2 pagesExercice 1Mohamed Amine BaccarPas encore d'évaluation
- Demo C1Document20 pagesDemo C1GUANYU LUPas encore d'évaluation
- Lettre - Tourisme Dans La VilleDocument2 pagesLettre - Tourisme Dans La VilleIlakshi TalwarPas encore d'évaluation
- Teste Francais QCMDocument7 pagesTeste Francais QCMkahinaPas encore d'évaluation
- Knock de Jules Romains (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandKnock de Jules Romains (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses usitées au CanadaD'EverandGlossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses usitées au CanadaPas encore d'évaluation
- Enjeux de la place des savoirs dans les pratiques éducatives en contexte scolaire: Compréhension de l’acte d’enseignement et défis pour la formation professionnelle des enseignantsD'EverandEnjeux de la place des savoirs dans les pratiques éducatives en contexte scolaire: Compréhension de l’acte d’enseignement et défis pour la formation professionnelle des enseignantsPas encore d'évaluation
- Structure Multifonctionnelle: Les futurs systèmes de l'armée de l'air seront intégrés dans des cellules matérielles multifonctionnelles avec capteur intégré et composants de réseauD'EverandStructure Multifonctionnelle: Les futurs systèmes de l'armée de l'air seront intégrés dans des cellules matérielles multifonctionnelles avec capteur intégré et composants de réseauPas encore d'évaluation
- Delf b2 TP Surveillant Coll Exemple2Document3 pagesDelf b2 TP Surveillant Coll Exemple2Maria BiancaPas encore d'évaluation
- Cours Sur Prévention-Contrôle Des Infections AIE1Document29 pagesCours Sur Prévention-Contrôle Des Infections AIE1Mama GueyePas encore d'évaluation
- HYGIENEDocument27 pagesHYGIENEBassirou NdiayePas encore d'évaluation
- 1 Introduction A La Prevention de L'infectionDocument5 pages1 Introduction A La Prevention de L'infectionsokhnatouba99Pas encore d'évaluation
- Examen de Fin de ModuleDocument14 pagesExamen de Fin de ModuleNicole sifuentes100% (1)
- Presentation DO FiniDocument109 pagesPresentation DO FiniChifa MusrataPas encore d'évaluation
- Prevention Des Infections MR Faye Prevention Des Infections MR FayeDocument111 pagesPrevention Des Infections MR Faye Prevention Des Infections MR Fayeantaafall464Pas encore d'évaluation
- Hygiene XXDocument5 pagesHygiene XXkhalid shater100% (1)
- Hygiene HospitaliereDocument8 pagesHygiene Hospitalieretnkwjvm6xhPas encore d'évaluation
- 3corr - Plan Du Cours GE 2Document1 page3corr - Plan Du Cours GE 2OruinPas encore d'évaluation
- DM Limiter Les Risques de ContaminationDocument2 pagesDM Limiter Les Risques de ContaminationladurellianPas encore d'évaluation
- AsepsieDocument38 pagesAsepsiemira dentistePas encore d'évaluation
- Cas 15 CorrigéDocument7 pagesCas 15 CorrigéCAUDRONPas encore d'évaluation
- Benin A1 QualitéDocument16 pagesBenin A1 QualitéElfridPas encore d'évaluation
- JDG 20221015 KDHFGRDocument48 pagesJDG 20221015 KDHFGRceriserPas encore d'évaluation
- Présentation Du Dossier de StageDocument2 pagesPrésentation Du Dossier de Stagedéchamps100% (1)
- Cat1 - Cat2 Questions Et ReponsesDocument50 pagesCat1 - Cat2 Questions Et Reponseskhadim goumbalaPas encore d'évaluation
- Composition 2Document21 pagesComposition 2Axelle BédiaPas encore d'évaluation
- Candide, VoltaireDocument2 pagesCandide, Voltaireressmy100% (1)
- Budget Une Rousse A La RescousseDocument1 pageBudget Une Rousse A La RescoussegoncalvesPas encore d'évaluation
- NOTES EXPLICATIVES DE LA FICHE DE PREPARATION D'UNE SEANCE D'ENSEIGNEMENT (Corrigé)Document7 pagesNOTES EXPLICATIVES DE LA FICHE DE PREPARATION D'UNE SEANCE D'ENSEIGNEMENT (Corrigé)Aigle DilanePas encore d'évaluation
- Classements Complets Rondes Du Canal 2022Document2 pagesClassements Complets Rondes Du Canal 2022Remi MARCHALPas encore d'évaluation
- La Collection-Miroir de L'ameDocument6 pagesLa Collection-Miroir de L'ameliviuisrPas encore d'évaluation
- SAM ProductionDocument16 pagesSAM Productiongeorge samPas encore d'évaluation
- Diner de ConDocument14 pagesDiner de ConAllamand JeremyPas encore d'évaluation
- Construire Son Temple IntérieurDocument10 pagesConstruire Son Temple IntérieurGile88Pas encore d'évaluation
- Les 150 PsaumesDocument132 pagesLes 150 PsaumesSection TransitPas encore d'évaluation
- Licence Professionnelle IstaDocument2 pagesLicence Professionnelle Istajoress teteufoPas encore d'évaluation
- Geologie ch4 CristalloDocument21 pagesGeologie ch4 CristalloAyeb GhassenPas encore d'évaluation
- Attachment 1Document78 pagesAttachment 1epopikss100% (1)
- Abattre Un Travail de TitanDocument6 pagesAbattre Un Travail de TitanSellé GueyePas encore d'évaluation
- SaphirDocument3 pagesSaphirBeatriz Andres PenaPas encore d'évaluation
- Systeme Fiscal PDFDocument66 pagesSysteme Fiscal PDFCharles OctavePas encore d'évaluation
- Religion Nordique AncienneDocument11 pagesReligion Nordique AncienneLonie WissangPas encore d'évaluation
- Clustering de Basculement Dans Windows ServerDocument49 pagesClustering de Basculement Dans Windows ServerFernando JorgePas encore d'évaluation
- Le Petit Prince Scenario PDFDocument28 pagesLe Petit Prince Scenario PDFCristina Núñez RamosPas encore d'évaluation
- Doc66-Modele FACTURE CNE Juillet15Document2 pagesDoc66-Modele FACTURE CNE Juillet15mounir.7oumiPas encore d'évaluation
- Catalogue Technique FOCDocument76 pagesCatalogue Technique FOCSam100% (2)