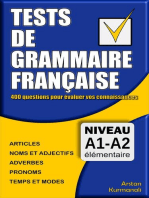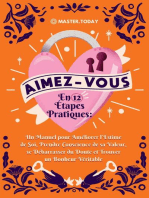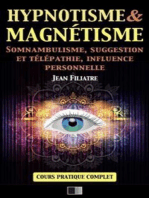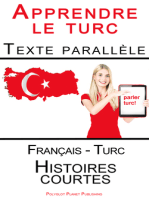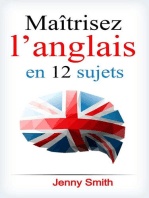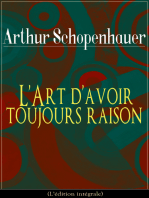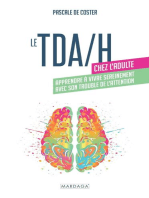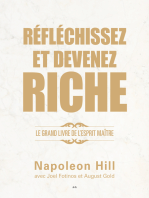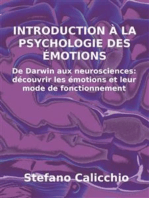Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Hom 0439-4216 1966 Num 6 4 366850
Transféré par
Jaime Abad MontesinosTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Hom 0439-4216 1966 Num 6 4 366850
Transféré par
Jaime Abad MontesinosDroits d'auteur :
Formats disponibles
L'Homme
Tzvetan Todorov, « Recherches sémantiques », Langages, 1966,
n° 1
Oswald Ducrot
Citer ce document / Cite this document :
Ducrot Oswald. Tzvetan Todorov, « Recherches sémantiques », Langages, 1966, n° 1. In: L'Homme, 1966, tome 6 n°4. pp.
120-121;
https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1966_num_6_4_366850
Fichier pdf généré le 09/05/2018
120 COMPTES RENDUS
au lecteur une information qui sans être impartiale, ni universelle, se veut pertinente et
large.
Que résulte-t-il de cette confrontation avec le programme initial de Martinet ?
Il ne pouvait être question, dès cette première livraison, d'aborder tous les sujets qui,
par la suite, pourront avoir droit de cité en la revue. Si la linguistique appliquée ne se trouve
pas représentée, les différentes contributions de linguistique pure, dans leur diversité,
répondent à l'impératif d'hospitalité posé par Martinet. Et pourtant, l'écueil du disparate qui
aurait pu s'ensuivre semble avoir été évité : toutes ces études comportent, explicite ou
implicite, la « moralité de portée générale » justifiant leur insertion dans une revue de linguistique
structurale et fonctionnelle.
Appréciant dans la variété des exposés l'homogénéité qui en résulte, il nous semble que
cette revue destinée à des spécialistes engagés doit contribuer à mieux définir concepts et
méthodes linguistiques. Nul n'en niera l'urgence.
Madeleine de La Tribonnière
Tzvetan Todorov, « Recherches sémantiques », Langages, 1966, n° 1, Larousse,
128 p., 23 X 15 cm.
Le premier numéro de la revue Langages — dont la composition a été confiée à Tzvetan
Todorov — a pour thème « Recherches sémantiques ». Le pluriel et l'absence d'article qu'on
remarque dans le titre, montrent clairement quel a été le but de Todorov : il ne s'agit pas
de défendre une théorie sémantique particulière, il ne s'agit pas non plus de faire le point,
de façon exhaustive, sur l'ensemble des recherches sémantiques actuellement en cours, ce
qui condamnerait à n'en exposer aucune en détail. (Les recherches non proprement
linguistiques sont notamment exclues de cet ouvrage.) Todorov a simplement choisi de présenter
un certain nombre d'approches, assez peu connues en France, qui lui semblent prometteuses,
et qui, à ses yeux, permettent « de croire que la sémantique est et sera une science ».
Le numéro comprend quatre articles, auxquels est jointe une précieuse bibliographie.
On trouve d'abord un article de présentation, dû à Todorov, qui comprend d'une part un
historique de la recherche sémantique en linguistique depuis Hjelmslev, et d'autre part un
exposé détaillé de la théorie élaborée par deux linguistes américains de l'école de Chomsky,
Katz et Fodor. Suivent deux traductions d'articles récents, qui illustrent deux des tendances
dégagées dans la partie historique de l'introduction. L'article du lexicologue russe J. Apre-
sjan, «Analyse distributionnelle des significations et champs sémantiques structurés », montre
comment la technique du distributionalisme américain peut être appliquée aux problèmes
du signifié, et rendre plus rigoureuses et plus convaincantes les descriptions de champs
sémantiques réclamées, il y a assez longtemps déjà, par J. Trier. Quant à l'article de
l'Américain F. G. Lounsbury, « Analyse structurale des termes de parenté », il utilise l'analyse
componentielle (recherche de traits pertinents de signification, parallèles aux traits distinctifs
du signifiant mis en relief par la phonologie) pour structurer un champ sémantique donné,
le vocabulaire de la parenté dans une tribu iroquoise. Le dernier article est une contribution
originale de Todorov, qui étudie, dans la perspective de Katz et Fodor, le problème des
« anomalies sémantiques ». Il entend par « anomalies sémantiques » des phrases,
grammaticalement correctes, et même susceptibles de recevoir un sens, mais qui ne manquent pas
d'éveiller chez le lecteur ou chez l'auditeur un certain sentiment d'étrangeté, par exemple :
« II écoute la musique qui reluit sur ses chaussures » (Breton et Éluard) ou : « C'est le cheval
qui est le soleil » (Artaud). Les exemples étudiés par Todorov sont généralement empruntés
à des poètes surréalistes, qui utilisaient systématiquement ce type de phrases dans l'intention
arrêtée de transgresser les lois du langage. En cherchant à classer ces anomalies selon les
causes qui les engendrent, Todorov est ainsi amené, indirectement, à formuler certaines des
lois qui composent la structure sémantique de la langue.
COMPTES RENDUS 121
Chacun des articles, même si l'on peut faire des réserves sur son contenu, laisse
l'impression, recherchée par Todorov, que l'approche linguistique des problèmes de la signification
peut sans conteste prétendre au caractère scientifique : elle est en mesure de définir des
critères de vérité, et de fournir des cadres pour des discussions précises. Mais il faut noter
en même temps que cette possibilité de rigueur est liée à l'importance accordée, dans chacun
de ces articles, à la notion de signe. Le distributionalisme détermine les lois de combinaison
des signes. L'analyse componentielle cherche à faire, pour chaque terme de parenté,
l'inventaire des traits distinctifs qu'il contient. Quant à la théorie de Katz et Fodor, dans le
prolongement de laquelle se situe le travail de Todorov sur les anomalies, elle prend pour point
de départ un dictionnaire dont chaque rubrique est consacrée à un signifiant du discours :
toutes ces recherches adoptent donc une perspective très différente de celle qui commande
l'ouvrage de Greimas analysé dans ce même numéro, et dont le thème central est une critique
de l'idée de signe. On ne peut nier que l'étude des signes donne une base expérimentale
solide à la sémantique puisque le signe est repérable de façon précise : il comporte un
signifiant qui permet de le localiser dans la chaîne parlée. Cet avantage n'a-t-il pas pour
contrepartie une simplification excessive de la réalité linguistique ? Est-il bien sûr que la langue
soit avant tout la jonction de certaines unités de sens et de certaines unités de son ? Telle est
sans doute la question qui domine la sémantique linguistique actuelle.
O. Ducrot
A. J. Greimas, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Larousse, Paris,
1966, 262 p., 21 x 15 cm.
La linguistique peut-elle proposer ses méthodes en modèle aux autres sciences humaines ?
Il devient de plus en plus banal aujourd'hui de donner à cette question une réponse positive.
La sociologie, l'ethnographie, la psychanalyse se sont habituées à considérer une institution,
un mythe ou un rêve comme étant, dans une large mesure, des ensembles signifiants dont il
faut, avant tout, établir la signification ; la linguistique, étude des langues naturelles, c'est-
à-dire de purs systèmes de signification, peut donc sans paradoxe prétendre être le paradigme
de la science humaine. Aussi n'est-ce pas cette prétention qui suffirait à faire l'originalité du
livre de A. J. Greimas. Ce qui est original, c'est la façon dont elle y est justifiée. D'abord
parce que l'auteur met la main à la pâte : il ne se contente pas de considérations
méthodologiques générales, mais il applique les méthodes linguistiques à des exemples précis. Elles
lui permettent notamment de remanier, et de rendre beaucoup plus claires et plus cohérentes,
d'une part la célèbre analyse du conte populaire russe de Propp, d'autre part l'étude — faite
par M. Safouan — d'une série de psychodrames, et enfin la description de l'univers
imaginaire de Bernanos proposée par Thasin Yiïcel.
Une deuxième originalité de l'ouvrage de A. J. Greimas concerne le point d'insertion
de la linguistique dans les sciences humaines. Une fois admis qu'un mythe, par exemple, est
un système de signification, il faut lui reconnaître deux aspects complémentaires, un
signifiant et un signifié. Or l'application la plus naturelle de la linguistique semblerait devoir
porter sur le signifiant. On peut facilement envisager, par exemple, qu'un procédé analogue
à la commutation phonologique permette de distinguer, parmi les événements qui composent
le récit mythique, ce qui est pertinent (ce qui contribue à véhiculer le sens) et ce qui n'est
qu'une variante dépourvue de valeur significative. Mais les méthodes proposées dans
Sémantique structurale visent tout autre chose. C'est d'une analyse du signifié, du contenu, qu'il
s'agit. Le problème n'est pas de déterminer l'organisation la plus cohérente du signifiant,
mais de décrire la signification. L'auteur cherche avant tout à construire un certain nombre
de concepts permettant d'exprimer, avec autant de cohérence et de netteté que possible,
ce que le récit mythique dit d'une façon enveloppée, allusive, et qui souvent même apparaît
contradictoire. La tâche dernière qu'il se fixe, c'est de créer un langage où l'on puisse,
objectivement, parler du sens.
Vous aimerez peut-être aussi
- Méthodes D'analyse Des Discours PDFDocument18 pagesMéthodes D'analyse Des Discours PDFDORBANEPas encore d'évaluation
- De L'apprentissage Au Développement de L'cquisition. Une Approche InteractionisteDocument18 pagesDe L'apprentissage Au Développement de L'cquisition. Une Approche InteractionisteJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Hjelmslev Et Le Concept de Texte en LinguistiqueDocument15 pagesHjelmslev Et Le Concept de Texte en LinguistiqueJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- L Analyse Du Discours Et Ses FrontieresDocument12 pagesL Analyse Du Discours Et Ses FrontieresThibério ArrudaPas encore d'évaluation
- Mots-9683 Propositions Pour Une Méthode D'analyse Du Discours TélévisuelDocument11 pagesMots-9683 Propositions Pour Une Méthode D'analyse Du Discours TélévisuelJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Frédérique Sitri. Expressing Agreement Through Concession A Discourse Analysis ApproachDocument17 pagesFrédérique Sitri. Expressing Agreement Through Concession A Discourse Analysis ApproachJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Ja207 - p038 - Audemar Biographie LangagiereDocument13 pagesJa207 - p038 - Audemar Biographie LangagiereJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Le Corpus - Un Outil Inductif Pour L'enseignement-Apprentissage de La GrammaireDocument13 pagesLe Corpus - Un Outil Inductif Pour L'enseignement-Apprentissage de La GrammaireJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- GRIN François 2004 Rapport Enseignement Langues Étrangères en EuropeDocument127 pagesGRIN François 2004 Rapport Enseignement Langues Étrangères en EuropeSilvia GomezPas encore d'évaluation
- Hom - 0439-4216 - 1966 - Num - 6 - 4 - 366851 A. J. Greimas, Sémantique Structurale. Recherche de Méthode PDFDocument4 pagesHom - 0439-4216 - 1966 - Num - 6 - 4 - 366851 A. J. Greimas, Sémantique Structurale. Recherche de Méthode PDFJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Hom 0439-4216 1966 Num 6 4 366850Document3 pagesHom 0439-4216 1966 Num 6 4 366850Jaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Apliu 0248-9430 1999 Num 18 3 2293 PDFDocument24 pagesApliu 0248-9430 1999 Num 18 3 2293 PDFJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Mise Au Point Terminologique - Pour en Finir Avec La Dichotomie Acquisition - Apprentissage en Didactique Des LanguesDocument17 pagesMise Au Point Terminologique - Pour en Finir Avec La Dichotomie Acquisition - Apprentissage en Didactique Des LanguesJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Guide RechDidactBaT 06092011 PDFDocument523 pagesGuide RechDidactBaT 06092011 PDFAhmed MadiPas encore d'évaluation
- Airdf 1260-3910 1993 Num 12 1 1096Document4 pagesAirdf 1260-3910 1993 Num 12 1 1096Jaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Individualisation Et Initiative de L'apprenant Dans Des Environnements (Et Des Dispositifs) D'apprentissage Ouverts Une Expérience D'autoformation GuidéeDocument10 pagesIndividualisation Et Initiative de L'apprenant Dans Des Environnements (Et Des Dispositifs) D'apprentissage Ouverts Une Expérience D'autoformation GuidéeJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Ja202 p033 MedioniDocument11 pagesJa202 p033 MedioniJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Airdf 1260-3910 1993 Num 12 1 1095Document7 pagesAirdf 1260-3910 1993 Num 12 1 1095Jaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Précis Du Plurilinguisme Et Du Pluriculturalisme PDFDocument75 pagesPrécis Du Plurilinguisme Et Du Pluriculturalisme PDFJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- C Bemporad and D Moore 2013 Identites PLDocument17 pagesC Bemporad and D Moore 2013 Identites PLJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Conception Dun Cours en Ligne de PhonetiDocument75 pagesConception Dun Cours en Ligne de PhonetiJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Colan 0336-1500 2003 Num 135 1 3184Document9 pagesColan 0336-1500 2003 Num 135 1 3184Jaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Airdf 1260-3910 1993 Num 12 1 1099Document4 pagesAirdf 1260-3910 1993 Num 12 1 1099Jaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Praticiens - Chercheurs A L'ecoute Du Sujet PDFDocument161 pagesPraticiens - Chercheurs A L'ecoute Du Sujet PDFJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- 3502-Article Text-17230-2-10-20201018 PDFDocument9 pages3502-Article Text-17230-2-10-20201018 PDFJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- 3502-Article Text-17230-2-10-20201018 PDFDocument9 pages3502-Article Text-17230-2-10-20201018 PDFJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Hom - 0439-4216 - 1966 - Num - 6 - 4 - 366851 A. J. Greimas, Sémantique Structurale. Recherche de Méthode PDFDocument4 pagesHom - 0439-4216 - 1966 - Num - 6 - 4 - 366851 A. J. Greimas, Sémantique Structurale. Recherche de Méthode PDFJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- L'auto-Apprentissage Des Langues Au Lycée Ou Comment Devenir Plurilingue - Colloque - Goethe - Institut - 2009Document4 pagesL'auto-Apprentissage Des Langues Au Lycée Ou Comment Devenir Plurilingue - Colloque - Goethe - Institut - 2009Jaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Individualisation Et Initiative de L'apprenant Dans Des Environnements (Et Des Dispositifs) D'apprentissage Ouverts Une Expérience D'autoformation GuidéeDocument10 pagesIndividualisation Et Initiative de L'apprenant Dans Des Environnements (Et Des Dispositifs) D'apprentissage Ouverts Une Expérience D'autoformation GuidéeJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- Introduction Sociolinguistique PDFDocument14 pagesIntroduction Sociolinguistique PDFmohamed ouichouPas encore d'évaluation
- 2951781475766264Document172 pages2951781475766264Pablo RincónPas encore d'évaluation
- Agota KristofDocument15 pagesAgota KristofLuciana100% (1)
- M. Arrivé. Saussure, Un Langage Sans VoixDocument12 pagesM. Arrivé. Saussure, Un Langage Sans Voixمختار زواويPas encore d'évaluation
- Sans Concession Ni Adoucissement Volontaire, CetDocument48 pagesSans Concession Ni Adoucissement Volontaire, CetrichardPas encore d'évaluation
- Les Déterminants - GrammaireDocument8 pagesLes Déterminants - GrammaireBreton FLORA SOPHIEPas encore d'évaluation
- La Confection de Vêtements - Guillerme GuilsonDocument9 pagesLa Confection de Vêtements - Guillerme GuilsonMaria MüllerPas encore d'évaluation
- Edmond Desmolins - A Quoi Tient La Supériorité Des Anglo-Saxons ?Document503 pagesEdmond Desmolins - A Quoi Tient La Supériorité Des Anglo-Saxons ?Pascal MbongoPas encore d'évaluation
- Article Riza Dan Kak NuriDocument9 pagesArticle Riza Dan Kak NuriRezaPas encore d'évaluation
- Charte de La FondationDocument2 pagesCharte de La FondationPaul BrownPas encore d'évaluation
- Exposition ConstantineDocument60 pagesExposition ConstantineLeghmouche AsmaPas encore d'évaluation
- Apocrypha 3 - 1992 PDFDocument279 pagesApocrypha 3 - 1992 PDFNovi Testamenti Lector100% (1)
- Cours RTADocument45 pagesCours RTAAlain-Michel100% (2)
- Tourisme 2.0Document4 pagesTourisme 2.0Itachi emøtiønłessUchihaPas encore d'évaluation
- Paroles Et Sagesses D'islamDocument22 pagesParoles Et Sagesses D'islamAdel MahouchePas encore d'évaluation
- Elboudrari - Entre Symbolique Et Histoire, KhidrDocument16 pagesElboudrari - Entre Symbolique Et Histoire, KhidrdemaistrePas encore d'évaluation
- (Tome 2) "L'Islam, Ses Véritables Origines", Par L'abbé Joseph BertuelDocument161 pages(Tome 2) "L'Islam, Ses Véritables Origines", Par L'abbé Joseph BertuelvbeziauPas encore d'évaluation
- Groupe MedvekineDocument32 pagesGroupe MedvekineLucas MurariPas encore d'évaluation
- Orwell, Anarchiste Tory Suivi de A Propos de 1984 by Michéa, Jean-ClaudeDocument155 pagesOrwell, Anarchiste Tory Suivi de A Propos de 1984 by Michéa, Jean-ClaudeSciarium Numero1Pas encore d'évaluation
- Elise HUET - Projet de RechercheDocument1 pageElise HUET - Projet de RechercheSoelPas encore d'évaluation
- Bardèche Maurice - Petite Histoire de Defense de L'occidentDocument9 pagesBardèche Maurice - Petite Histoire de Defense de L'occidentAmiral KoltchakPas encore d'évaluation
- Le Discours en Interaction - Catherine Kerbrat-OrecchioniDocument476 pagesLe Discours en Interaction - Catherine Kerbrat-OrecchioniArabicuser Youcef100% (28)
- Publication Scientifique AmazigheDocument8 pagesPublication Scientifique AmazigheZemmouri HoussamPas encore d'évaluation
- Séance Les InterférencesDocument5 pagesSéance Les InterférencesAli Boutamina100% (1)
- Stany Mazurkiewicz, Hegel Et La FamilleDocument5 pagesStany Mazurkiewicz, Hegel Et La FamilleDétour RadicalPas encore d'évaluation
- Kabbale Pour Un Goy Tome 1Document88 pagesKabbale Pour Un Goy Tome 1arisa70100% (10)
- GT 6 Pre Actes EMF 2019 PDFDocument151 pagesGT 6 Pre Actes EMF 2019 PDFDame DiopPas encore d'évaluation
- Licence Philosophie Parcours HumanitésDocument6 pagesLicence Philosophie Parcours HumanitésBaver BaverPas encore d'évaluation
- Quelles Stratégies Pour Apprendre Comment Enseigner Le VocabulaireDocument6 pagesQuelles Stratégies Pour Apprendre Comment Enseigner Le VocabulaireAlain MetryPas encore d'évaluation
- Nedim NalbantogluDocument10 pagesNedim NalbantogluAriel_BarbanentePas encore d'évaluation
- Tests de grammaire française: 400 questions pour évaluer vos connaissancesD'EverandTests de grammaire française: 400 questions pour évaluer vos connaissancesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (3)
- Améliorer votre mémoire: Un Guide pour l'augmentation de la puissance du cerveau, utilisant des techniques et méthodesD'EverandAméliorer votre mémoire: Un Guide pour l'augmentation de la puissance du cerveau, utilisant des techniques et méthodesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Aimez-Vous en 12 Étapes Pratiques: Un Manuel pour Améliorer l'Estime de Soi, Prendre Conscience de sa Valeur, se Débarrasser du Doute et Trouver un Bonheur VéritableD'EverandAimez-Vous en 12 Étapes Pratiques: Un Manuel pour Améliorer l'Estime de Soi, Prendre Conscience de sa Valeur, se Débarrasser du Doute et Trouver un Bonheur VéritableÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- Anglais Pour Les Nulles - Livre Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos de los Koalas pour apprendre anglais vocabulaireD'EverandAnglais Pour Les Nulles - Livre Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos de los Koalas pour apprendre anglais vocabulaireÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- DELF B1 - Production Orale - 2800 mots pour réussirD'EverandDELF B1 - Production Orale - 2800 mots pour réussirÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (12)
- Hypnotisme et Magnétisme, Somnambulisme, Suggestion et Télépathie, Influence personnelle: Cours Pratique completD'EverandHypnotisme et Magnétisme, Somnambulisme, Suggestion et Télépathie, Influence personnelle: Cours Pratique completÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (8)
- Vocabulaire DELF B2 - 3000 mots pour réussirD'EverandVocabulaire DELF B2 - 3000 mots pour réussirÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (34)
- Le livre de la mémoire libérée : Apprenez plus vite, retenez tout avec des techniques de mémorisation simples et puissantesD'EverandLe livre de la mémoire libérée : Apprenez plus vite, retenez tout avec des techniques de mémorisation simples et puissantesÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (6)
- Force Mentale et Maîtrise de la Discipline: Renforcez votre Confiance en vous pour Débloquer votre Courage et votre Résilience ! (Comprend un Manuel Pratique en 10 Étapes et 15 Puissants Exercices)D'EverandForce Mentale et Maîtrise de la Discipline: Renforcez votre Confiance en vous pour Débloquer votre Courage et votre Résilience ! (Comprend un Manuel Pratique en 10 Étapes et 15 Puissants Exercices)Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (28)
- Neuropsychologie: Les bases théoriques et pratiques du domaine d'étude (psychologie pour tous)D'EverandNeuropsychologie: Les bases théoriques et pratiques du domaine d'étude (psychologie pour tous)Pas encore d'évaluation
- L'Ombre à l'Univers: La structure des particules élémentaires XIIfD'EverandL'Ombre à l'Univers: La structure des particules élémentaires XIIfPas encore d'évaluation
- Magnétisme Personnel ou Psychique: Éducation de la Pensée, développement de la Volonté, pour être Heureux, Fort, Bien Portant et réussir en tout.D'EverandMagnétisme Personnel ou Psychique: Éducation de la Pensée, développement de la Volonté, pour être Heureux, Fort, Bien Portant et réussir en tout.Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Vocabulaire DELF B2 - 300 expressions pour reussirD'EverandVocabulaire DELF B2 - 300 expressions pour reussirÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (7)
- Apprendre le turc - Texte parallèle (Français - Turc) Histoires courtesD'EverandApprendre le turc - Texte parallèle (Français - Turc) Histoires courtesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Le fa, entre croyances et science: Pour une epistemologie des savoirs africainsD'EverandLe fa, entre croyances et science: Pour une epistemologie des savoirs africainsÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (6)
- Géobiologie de l'habitat et Géobiologie sacrée: Pour un lieu sainD'EverandGéobiologie de l'habitat et Géobiologie sacrée: Pour un lieu sainÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- La Pensée Positive en 30 Jours: Manuel Pratique pour Penser Positivement, Former votre Critique Intérieur, Arrêter la Réflexion Excessive et Changer votre État d'Esprit: Devenir une Personne Consciente et PositiveD'EverandLa Pensée Positive en 30 Jours: Manuel Pratique pour Penser Positivement, Former votre Critique Intérieur, Arrêter la Réflexion Excessive et Changer votre État d'Esprit: Devenir une Personne Consciente et PositiveÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (12)
- Manipulation et Persuasion: Apprenez à influencer le comportement humain, la psychologie noire, l'hypnose, le contrôle mental et l'analyse des personnes.D'EverandManipulation et Persuasion: Apprenez à influencer le comportement humain, la psychologie noire, l'hypnose, le contrôle mental et l'analyse des personnes.Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (13)
- L'Art d'avoir toujours raison (L'édition intégrale): La dialectique éristique - L'art de la controverse qui repose sur la distinction entre la vérité objective d'une proposition et l'apparence de véritéD'EverandL'Art d'avoir toujours raison (L'édition intégrale): La dialectique éristique - L'art de la controverse qui repose sur la distinction entre la vérité objective d'une proposition et l'apparence de véritéÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (177)
- Le TDA/H chez l'adulte: Apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attentionD'EverandLe TDA/H chez l'adulte: Apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attentionPas encore d'évaluation
- Réfléchissez et devenez riche: Le grand livre de l’esprit maîtreD'EverandRéfléchissez et devenez riche: Le grand livre de l’esprit maîtreÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (509)
- L'Interprétation des rêves de Sigmund Freud: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandL'Interprétation des rêves de Sigmund Freud: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Anglais ( L’Anglais Facile a Lire ) 400 Mots Fréquents (4 Livres en 1 Super Pack): 400 mots fréquents en anglais expliqués en français avec texte bilingueD'EverandAnglais ( L’Anglais Facile a Lire ) 400 Mots Fréquents (4 Livres en 1 Super Pack): 400 mots fréquents en anglais expliqués en français avec texte bilingueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Transformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitD'EverandTransformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (14)
- Introduction à la psychologie des émotions: De Darwin aux neurosciences: découvrir les émotions et leur mode de fonctionnementD'EverandIntroduction à la psychologie des émotions: De Darwin aux neurosciences: découvrir les émotions et leur mode de fonctionnementPas encore d'évaluation