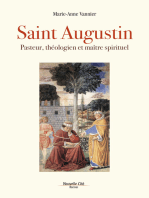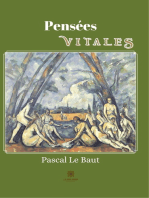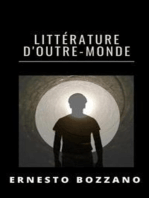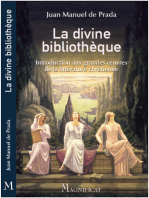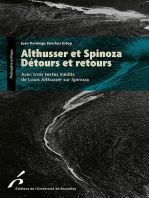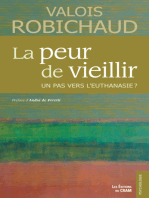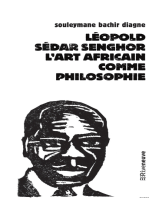Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cps 359
Transféré par
Antonin JoeyKaneTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cps 359
Transféré par
Antonin JoeyKaneDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg
42 | 2017
Jean-Luc Nancy
Penser la mutation
Jérôme Lèbre et Jacob Rogozinski (dir.)
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/cps/359
DOI : 10.4000/cps.359
ISSN : 2648-6334
Éditeur
Presses universitaires de Strasbourg
Édition imprimée
Date de publication : 1 novembre 2017
ISBN : 978-2-86820-968-9
ISSN : 1254-5740
Référence électronique
Jérôme Lèbre et Jacob Rogozinski (dir.), Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017, « Jean-
Luc Nancy » [En ligne], mis en ligne le 03 décembre 2018, consulté le 23 septembre 2020. URL : http://
journals.openedition.org/cps/359 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cps.359
Ce document a été généré automatiquement le 23 septembre 2020.
Cahiers philosophiques de Strasbourg
1
SOMMAIRE
Présentation
Jérôme Lèbre et Jacob Rogozinski
Phraser la mutation : entretien avec Jean-Luc Nancy
Juan-Manuel Garrido
Hommage à Werner Hamacher
Werner Hamacher est mort le 5 juillet 2017 à l’âge de 69 ans
Jean-Luc Nancy
Mutations, mutismes
Werner Hamacher
L’âme à la lettre – mutation de l’entre-deux (autour de Jean-Luc Nancy)
Marcia Sá Cavalcante Schuback
Le désir du monde Jean-Luc Nancy et l’Éros ontologique
Boyan Manchev
Mutants, mythants
Jérôme Lèbre
La mutation infinie du sens
Juan-Manuel Garrido
L’adresse de l’entre-nous : l’interprétation plastique de Hegel chez Jean-Luc Nancy
Yuji Nishiyama
« Seul le permanent change »
Mutations et histoire chez Jean-Luc Nancy
Andrea Potestà
Apocalypse et croyance en ce monde
Monde, finitude et christianisme chez Nancy et Blanchot*
Aïcha Liviana Messina
Adorer en vérité ?
Jacob Rogozinski
Une disparition. Plus intime que le visage, le visage
Danielle Cohen-Levinas
« [L]’ars poetica en tant que tel » : de quelques enjeux philosophiques de la poésie pour elle-
même
Isabelle Alfandary
La mutation du sens de la danse
Miriam Fischer-Geboers
Compte rendu
La Part inconstructible de la Terre
Seuil, coll. « Anthropocène », 2016
Sophie Gosselin
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
2
Présentation
Jérôme Lèbre et Jacob Rogozinski
1 Jean-Luc Nancy est reconnu aujourd’hui comme l’un des plus importants philosophes
français contemporains. Ces dernières années, son œuvre a fait l’objet, en France et
dans plusieurs pays étrangers, de rencontres suivies de publications. Il était temps
qu’un colloque international consacré à son travail ait lieu à l’Université de Strasbourg,
où il a enseigné pendant plus de trente ans. Ce colloque s’est tenu en novembre 2015
avec la participation de Jean-Luc Nancy qui l’a accompagné de sa présence attentive et
amicale. L’Université s’était associée pour l’occasion avec le Collège international de
philosophie dont Nancy est resté proche.
2 Ses œuvres sont toutes singulières et exigent de saisir l’universalité sous la forme
éclatée du « singulier pluriel ». Il s’ensuit que l’on ne peut centrer sur son identité
d’auteur une recherche collective portant sur son travail et tenter d’atteindre une
vérité théorique par la synthèse d’un corpus déjà constitué. Une rencontre autour de
Jean-Luc Nancy se devait donc de laisser s’exprimer des pensées singulières, le sens
naissant justement de leurs confrontations et de leurs croisements. Cette exigence
reconnue et admise, il fallait lui donner un tour nouveau. Il nous a semblé que l’idée de
mutation pouvait nommer ce « tour » et ouvrir une piste féconde qui pouvait être suivie
tout au long de cette rencontre.
3 Dans son acception biologique, une mutation est un changement qui peut être spontané
ou provoqué par un agent extérieur, et peut être continu – héréditaire – ou brusque. La
mutation se dégage de toute finalité préconçue, résiste à toute synthèse, diverge en une
pluralité irréductible de voies. Elle déstabilise donc une histoire qui serait fondée sur la
présupposition de l’identité et de la permanence de l’humanité. En insistant sur le fait
que l’homme n’est pas seulement un être vivant particulier, mais qu’il est jeté dans la
vie en expérimentant sa propre finitude (ce que Nancy nomme « l’expérience de la
liberté »), les pensées de l’existence ont profondément transformé la philosophie
contemporaine. C’est ainsi que, selon Nancy, nous sommes tous ex‑posés au monde et
dans le monde, et donc exposés les uns aux autres, com‑paraissant ensemble. Le néant
qui précède et termine la vie se trouve alors tout autant entre nous : il n’y a rien entre
nous et tout est dans cette proximité sans fusion identitaire des êtres singuliers. Il en
découle que l’existence accélère la mutation en dégageant dans un temps bref des
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
3
styles d’être différents. La pensée de l’existence ne précipite pas seulement la
mutation : elle fait muter et c’est ainsi qu’elle aide à comprendre ce que l’on peut
désigner comme la mutation actuelle de l’humanité.
4 Notre monde est en pleine mutation, nous mutons : cela ne veut pas simplement dire
que la mutation, concept biologique, aurait par ailleurs un sens historique ; mais plutôt
que, ici et maintenant, la possibilité de saisir le sens de l’histoire, telle qu’elle s’est
ouverte, établie et confirmée depuis le siècle des Lumières, vacille. Il semble alors que
le sens se perde, que nous traversons une crise du sens qui nous interdit de nous
comprendre nous-mêmes, de savoir où nous allons. Ainsi naissent les différentes
variantes d’un désespoir politique qui peut se transformer en nostalgie d’un temps où
le monde faisait sens, où chacun savait d’où il venait, où il allait. De là la tendance
générale à croire – sans y croire vraiment – à la possibilité d’un changement, d’une
transformation du monde, voire d’une révolution, alors que toute transformation a été
entièrement absorbée par l’impératif global de production et de « croissance ». Mais
c’est justement quand le sens s’érode au point de sembler disparaître qu’il fait valoir
son irréductibilité. La mutation est toujours celle du sens ; elle est un changement où
change le sens même de ce que veut dire changer. Il en découle une imprévisibilité
radicale, une absence totale de maîtrise sur le devenir du monde qui tranche avec les
succès actuels de la science et de la technique. Cela ne veut pas dire que rien n’est plus
possible : la mutation actuelle nous montre bien plutôt que le sens du monde, que l’on
croyait détenu par l’Occident, n’a rien d’assuré ; qu’il ne peut venir que de nous, de ce
que nous faisons du monde – donc aussi de nous-mêmes. L’existence est devenue
exigence de sens, d’un sens qui ne se saisit qu’en se faisant. On comprend dès lors que
cette époque qui est la nôtre soit aussi celle où devait s’imposer la pensée de toute vie
comme vie mutante, inventant sans cesse de nouvelles formes qui échappent à la
stabilité des espèces ; et que cette échappée des formes se laisse observer aux marges
d’une politique de plus en plus gestionnaire, en particulier dans l’inventivité artistique
ou littéraire. La pensée de Nancy nous invite à être attentif à tout ce qui advient et à
réexprimer, d’une manière à chaque fois singulière, ce qu’est pour nous cette mutation
du sens.
5 Les intervenants de la rencontre de Strasbourg savaient que celle-ci était une relance :
qu’ils ne se réunissaient pas pour affirmer un héritage, une tradition qui les aurait
inscrits en même temps que Jean-Luc Nancy dans une succession de générations (Hegel
qui genuit Marx, Heidegger qui genuit Derrida, etc.), mais plutôt de se considérer eux-
mêmes comme des mutants, ce qui implique une rupture dans le fil de l’hérédité
comme de l’histoire, aujourd’hui où, comme l’écrit Nancy, toutes les générations qui
coexistent « ne se savent ni ne se sentent ‘générées’, mais plutôt déposées, lâchées,
sinon larguées », et obligées de faire avec.
6 L’entretien entre Jean-Luc Nancy et Juan-Manuel Garrido, réalisé dans le contexte de la
préparation de ce colloque, traverse ainsi la vie et l’histoire, et parle de notre humanité
désorientée, tout en insistant sur la nécessité de toujours relancer la parole, de
répondre à ce « désir inextinguible de sens » qui implique le « passage incessant à la
limite du sens, ou bien au sens comme limite ».
7 Werner Hamacher s’était vu confier la conférence d’ouverture. Nous publions avec
émotion ce qui fut son dernier texte, puisque ce philosophe d’importance majeure vient
d’être emporté par la maladie. Il reste cependant parmi nous et ce qu’il écrit le dit
également, puisqu’il montre que ce « nous » déborde toujours la communication et le
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
4
langage – que l’« être-avec » s’articule silencieusement avec un « être sans ». Nous
sommes reconnaissants envers Jean-Luc Nancy de nous avoir permis de publier, en
ouverture de ce numéro des Cahiers philosophiques de Strasbourg, le texte qu’il a écrit à la
suite de la mort de son ami.
8 Plusieurs interventions situent ensuite les mutations entre la vie et l’existence : Marcia
Sá Cavalcante Schuback montre que Nancy renouvelle profondément l’idée
traditionnelle de transformation, au profit d’une animation de l’âme en contact charnel
avec le monde. Boyan Manchev décèle chez Nancy une érotique philosophique et
Jérôme Lèbre s’interroge sur la relation entre vie, mythe et histoire à l’époque de la
génétique, de la biotechnologie et des greffes. Les mutations politiques et historiques
sont l’objet spécifique de trois études : Juan Manuel Garrido aborde la mutation en
montrant comment Nancy dépasse le constat de la « crise du sens » pour inviter à son
élaboration active. Yuji Nishiyama expose comment Nancy a transformé la philosophie
de l’histoire hégélienne ; tandis qu’Andrea Potestà délivre la conception de l’histoire de
toute finalité pour ressaisir le rôle des événements dans les mutations qui mènent sans
continuité d’une époque à l’autre. Les mutations historiques impliquent celles des
religions : Aïcha Liviana Messina confronte donc les perspectives de Blanchot et de
Nancy sur la question du christianisme et de la fin du monde ; et Jacob Rogozinski se
demande si la déconstruction du christianisme engagée par Nancy et l’absentement du
divin qu’elle présuppose ne l’empêchent pas d’appréhender le phénomène du
fanatisme, qui est pourtant une composante fondamentale de l’actuelle mutation du
religieux. En accord avec Nancy, pour qui la relance de la parole est aussi poétique, la
dernière perspective abordée est celle des mutations dans l’art et la littérature. Danielle
Cohen-Levinas montre que l’esthétique est menée au-delà d’elle-même par Nancy dès
qu’il se consacre au portrait, dans la mesure où le visage peint ouvre sur un sens infini
qu’aucune vérité de l’art ne peut cerner. Isabelle Alfandary souligne la proximité entre
philosophie et poésie chez Nancy, rendue possible parce que le sens poétique est
toujours en avance sur soi. Quant à Miriam Fischer-Geboers, elle analyse la mutation du
sens de la danse dans ses rapports aux mutations contemporaines de la pensée.
9 Le soir du 13 novembre 2015, cinq jours avant cette rencontre, alors que tout semblait
prêt, programmé, prévisible, un commando terroriste se faisait exploser au Stade de
France, un autre mitraillait des terrasses à Paris et un troisième le public du Bataclan.
130 morts, 413 blessés. C’était le temps du deuil. Se réunir en colloque comme si de rien
n’était semblait absurde. Tentés d’annuler le colloque, nous avons fait à l’inverse le pari
d’une rencontre possible. La première journée a été consacrée à une tentative de
réflexion commune sur les attentats. Nous tous, Français ou étrangers, gardions en
esprit les attaques et leurs victimes. Elles étaient et restent une dimension de notre
présent, à chaque fois rompu, bouleversé par elles ; elles sont entraînées par la
mutation de ce monde, partie intégrante des conflits violents qui le traversent. Venir à
bout de la violence est sans doute une tâche impossible ; penser comment notre monde
mute dans tous ses aspects (économiques, politiques, religieux, esthétiques…) l’est
également. Au moins pouvons-nous mesurer par là que l’impossible n’est jamais qu’un
possible en mutation.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
5
BIBLIOGRAPHIE
NANCY Jean-Luc, La Remarque spéculative (un bon mot de Hegel), Paris : Galilée, 1973.
NANCY Jean-Luc, « Identité et tremblement », in : Hypnose, Paris : Galilée, 1984.
NANCY Jean-Luc, Des lieux divins, Mauvezin : TER, 1987.
NANCY Jean-Luc, L’expérience de la liberté, Paris : Galilée, 1988.
NANCY Jean-Luc, La Communauté désœuvrée, Paris : Christian Bourgois Éditeur, 1986.
NANCY Jean-Luc, Une pensée finie, Paris : Galilée, 1990.
NANCY Jean-Luc, La Comparution, avec Jean-Christophe BAILLY, Paris : Christian Bourgois Éditeur,
1991.
NANCY Jean-Luc, Le Sens du monde, Paris : Galilée, 1993.
NANCY Jean-Luc, Les Muses, Paris : Galilée, 1994.
NANCY Jean-Luc, Être singulier pluriel, Paris : Galilée, 1996.
NANCY Jean-Luc, Hegel : l’inquiétude du négatif, Paris : Hachette, 1997.
NANCY Jean-Luc, Corpus, Paris : Métailié, 2000.
NANCY Jean-Luc, L’intrus, Paris : Galilée, 2000.
NANCY Jean-Luc, La Pensée dérobée, Paris : Galilée, 2001.
NANCY Jean-Luc, La Visitation, Paris : Galilée, 2001.
NANCY Jean-Luc, La Communauté affrontée, Paris : Galilée, 2001.
NANCY Jean-Luc, L’« il y a » du rapport sexuel, Paris : Galilée, 2001.
NANCY Jean-Luc, La Création du monde ou la mondialisation, Paris : Galilée, 2002.
NANCY Jean-Luc, À l’écoute, Paris : Galilée, 2002.
NANCY Jean-Luc, « Seul(e) au monde », avec Mathilde MONNIER, in : ROUSIER Claire (dir.), La Danse en
solo. Une figure singulière de la modernité, Pantin : CND, 2002.
NANCY Jean-Luc, L’Extension de l’âme, Strasbourg : Le Portique, 2003.
NANCY Jean-Luc, Noli me tangere, Paris : Bayard, 2003.
NANCY Jean-Luc, « Entretien avec Jean-Luc Nancy », par Véronique F ABBRI, in : Penser la danse
contemporaine, Rue Descartes, n° 44, Paris : PUF, 2004.
NANCY Jean-Luc, Au fond des images, Paris : Galilée, 2005.
NANCY Jean-Luc, La Déclosion (Déconstruction du christianisme, 1), Paris : Galilée, 2005.
NANCY Jean-Luc, Allitérations. Conversations sur la danse, Paris : Galilée, 2005.
NANCY Jean-Luc, La Naissance des seins, suivi de Péan pour Aphrodite, Paris : Galilée, 2006.
NANCY Jean-Luc, Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément… Petite conférence sur l’amour, Paris :
Bayard, 2008.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
6
NANCY Jean-Luc, « Générations, civilisations », Vacarme, n° 47, 2009.
NANCY Jean-Luc, « Don d’organes ou transmission de vie ? », in : T HIEL Marie-Jo (dir.), Donner,
recevoir un organe, Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2009.
NANCY Jean-Luc, L’Adoration (Déconstruction du christianisme, 2), Paris : Galilée, 2010.
NANCY Jean-Luc, « Déshérence », Les Carnets du Portique, 2011, p. 101-109.
NANCY Jean-Luc, « Que faire ? », Bulletin de la Société française de philosophie, n° 106, 2012.
NANCY Jean-Luc, L’Équivalence des catastrophes (Après Fukushima), Paris : Galilée, 2012.
NANCY Jean-Luc, La Communauté désavouée, Paris : Galilée, 2014.
NANCY Jean-Luc, Demande. Littérature et philosophie, Paris : Galilée, 2015.
NANCY Jean-Luc, « Après Fukushima », in : Philosophy of Post-Fukushima, MURAKAMI Katsuzo (éd.),
Tokyo : Akashi Syoten, 2015.
NANCY Jean-Luc, « Méthode et vertige », Conséquence, n° 1, Saint-Germain-le-Vieux, 2015.
NANCY Jean-Luc, « Savoir écouter le silence des intellectuels », Libération, 22 septembre 2015.
NANCY Jean-Luc, « History, Improvised : A Short Dialogue », avec CAVALCANTE Marcia Sá, Philosophy
Today, n° 60-4, 2017.
AUTEURS
JÉRÔME LÈBRE
Collège international de philosophie
JACOB ROGOZINSKI
Université de Strasbourg
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
7
Phraser la mutation : entretien avec
Jean-Luc Nancy
Juan-Manuel Garrido
Juan-Manuel Garrido : En novembre prochain, l’Université de Strasbourg et le Collège
international de philosophie organisent un colloque international autour de ton travail. Le
sujet du colloque est proposé avec la formule « Mutations ». Dans une tribune récemment
publiée dans Libération1, où il est question de la crise des réfugiés en Europe, tu parles « des
migrations, des exils, des mutations, des déroutes, des fuites et des refuges » de la pensée.
Quelle(s) question(s) vois-tu s’esquisser sous l’idée de « mutations » ?
Jean-Luc Nancy : Mutation, cela signifie changement profond, voire complet. C’est
plus que « transformation » et même que « métamorphose ». C’est ce qui arrive
spontanément (comme on dit) dans des ensembles génétiques où un gène disparaît,
change de place, etc. On reconnaît les mutations comme une cause importante de
l’évolution des espèces vivantes. Nous savons bien que les mondes végétaux et
animaux ont muté – si même il ne faut pas aussi parler de mutations géologiques,
climatiques, tectoniques…, c’est-à-dire des ruptures et recompositions structurelles
même si non génétiques. Nous savons aussi que l’humanité a muté, d’abord dans sa
propre formation (Néanderthal et Sapiens, etc.) et ensuite dans sa « préhistoire » (en
fait déjà son histoire) : le néolithique, les âges du bronze, du fer… Mais on est moins
porté à penser que l’histoire de la civilisation méditerranéenne-occidentale a été le
fait d’une série de mutations. Nous sommes beaucoup trop habitués à y voir un
processus continu, évolutif et progressif (dans tous les sens de ce dernier mot).
Pourtant nous parlons de « révolution industrielle » et aujourd’hui « informatique »
de même que nous parlons de « révolution démocratique » : mais dans toutes ces
expressions le mot « révolution » a de manière assez étrange un sens à la fois fort, de
rupture et d’inauguration, et faible puisqu’au fond tout nous apparaît comme
l’avancée d’un grand mouvement commencé avec les Grecs et le logos.
Or nous ne mesurons pas assez combien les Grecs furent des mutants : avec eux s’est
rompu, complètement, un monde qui était celui du sacré omniprésent (sacrifice,
hiérarchie, etc.). Il a fallu quelques siècles pour que ce monde se trouve un relatif
équilibre avec Rome où la cité et le droit ont réussi à absorber pour leur compte le
sacré. Mais cela n’a pas tenu car en même temps la fin des sacralités et l’extension
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
8
démesurée – pour l’époque – d’un domaine qui n’était plus territoire, ni localité, ni
presque « lieu », mais bien plus extension formelle de propriétés juridiques et
techniques. Ça a craqué : la population de cette région du monde s’est pensée comme
« humanité » et cette « humanité » était déboussolée, privée de repères telluriques et
cosmiques. Le monothéisme, lentement mûri entre la philosophie et la pensée juive, a
constitué la mutation nommée « christianisme ». L’homme chrétien n’est plus
l’homme antique. Il est l’homme qui a l’infini dans ses gènes. Après un temps pour
essayer d’adopter un tout autre mode de fonctionnement – précisément local et
sacral, la féodalité venue du Nord – cet homme a pris ostensiblement les commandes
d’une nouvelle culture : celle de l’infini de la production.
Aucune autre culture n’avait connu cette mutation. On avait connu l’accumulation, et
le profit, mais pas proprement la production c’est-à-dire l’investissement au service
d’un développement exponentiel non seulement de fins données (l’éclat de la
richesse et du pouvoir) mais de moyens à trouver pour accroître une puissance
indéfinie. La mutation est triple : capitalisme, technique, démocratie. L’ordre des
trois termes n’a pas de signification : ce sont trois aspects d’un même processus, celui
de la production. Celle-ci s’analyse en : conception – réalisation – extension ; ou en
d’autres termes : projet (promesse) – performance (prestation) – prospective
(projection). On va du « pro » au « pro » : le « plus » et le « mieux », le « neuf » et
l’«inédit » sont les catégories qui remplissent ces « pro ». Quant à la « duction »,
conduite, guidage, gouvernement, elle s’avère de plus en plus celle du « pro »
autonomisé (soit ce qu’on nomme « la technique ») et qui débarrasse complètement
la place de tout pouvoir en quelque façon relié à une sacralité, c’est-à-dire aussi à une
légitimité donnée d’ailleurs que de la production elle-même. Celle-ci fait de la
mutation un de ses procédés : vapeur, électricité, atome, informatique sont les
principales mutations internes de ce processus toujours en marche.
Le mot de Lénine – « Le communisme, c’est les soviets plus l’électricité » – résume
assez bien l’esprit du processus : le gouvernement de tous avec la puissance de la
maîtrise technique. Comme cette maîtrise est congénitalement illimitée (tout au
moins dans sa conscience d’elle-même ; n’oublions pas que pour Aristote la tekhnè est
forcément limitée tandis que l’illimitation est le principe même de notre technique :
voilà un indice flagrant de mutation) sa puissance ne peut manquer d’entraîner avec
elle sa gestion, et le gouvernement de tous prend les formes symétriquement
trompeuses de la bureaucratie ou bien de la représentation populaire. L’une après
l’autre se dissolvent dans une technocratie inévitable.
C’est cela qui s’expose, voire qui se déclare et se proclame sous le nom de
« globalisation ». Or cette déclaration ouverte, affichée, exigeante produit un effet en
retour : l’absence de finalité de la production éclate au grand jour en même temps
que l’absence de gouvernance autre que technique. Et comme l’humanité – et non elle
seule, mais sans doute aussi et à sa manière toute la « nature » – n’est pas insensible
elle réagit et commence à entrer dans une autre mutation : une qui pourrait bien
déboucher sur une toute autre façon de – disons le plus simplement, de se
comporter… À moins que cette mutation soit létale, comme il arrive chez les vivants.
Et pourquoi pas ? Pourquoi l’humanité ne serait-elle pas en fin de compte un essai ou
un jeu, une variation qui atteint sa propre limite ? L’humanité, ou bien peut-être la
vie entière ? Avant une complète redistribution des énergies… ?
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
9
J.-M. G. : Mais ne faut-il pas distinguer entre cette grande mutation de l’humanité qui aura
été l’introduction de l’infini – dans les monothéismes, dans le miracle grec de la science,
dans la philosophie – et les mutations qui nourrissent l’histoire de ce même infini, l’histoire
des mutations à l’intérieur de l’histoire ?
J.-L. N. : Certainement. Je me demande s’il ne faut pas dire qu’après un certain
nombre de mutations de grande ampleur – comme celle du néolithique, celle du
bronze –, il s’est produit une mutation par étapes – l’Égypte, les Grecs, Israël, Rome –
dont le judéo-christianisme a été le résultat, ouvrant la mutation occidentale. Celle-ci
à son tour a connu des étapes, tout en se considérant elle-même comme une longue
continuité – ce qui est un des phénomènes nouveaux attachés à cette mutation et que
tu incites à nommer « l’histoire ». C’est-à-dire un rapport à soi de la mutation en tant
que telle. Rapport dans lequel se mélangent une conscience (et/ou un désir) de
fondation ou d’origine (« le miracle grec », « la Révélation chrétienne ») et une
conscience (et/ou une crainte) de caractère accidentel, mal assuré (l’authenticité
« grecque » ou « chrétienne » toujours menacée de perte ou de trahison). C’est-à-dire
qu’au fond de la mutation occidentale il y a une conscience inquiète de soi. En
revanche les mutations qui en procèdent au cours de l’histoire se manifestent d’abord
plutôt comme des assurances et des conquêtes, avant de s’inquiéter d’elles-mêmes
comme elles le font aujourd’hui.
J.-M. G. : Or ne penses-tu pas que l’infini lui-même, et avec lui notre civilisation, sont très
loin d’être mourants ? Personne ne peut et peut-être ne veut renoncer à l’infini pour penser
le monde. Cherche-t-on à s’opposer au capitalisme ? On plonge alors dans une imagination
de mondes possibles qui touche à tout sauf au pouvoir même d’imaginer la croissance et le
développement ou de s’imaginer cette même imagination comme puissance vitale.
Dénonce-t-on les inégalités économiques ? On le fait au nom et dans le cadre d’une
rationalisation illimitée des ressources terrestres et humaines, destinée à conjurer toute
dépense « insensée » ou « irrationnelle » dans le système productif. Sur le plan politique, les
vides provoqués par la gérance technique semblent tous prêts à être remplis, à droite et à
gauche, par des « mouvements » populaires s’opposant tout d’abord au politique lui-même,
toujours saisi comme déchu et perverti, incapable de porter la promesse d’une réalisation
directe des idées de justice, d’égalité, de vie, de peuple. Même l’imagination de la
catastrophe totale ne semble pouvoir se faire que suivant le schème d’une réalisation de
l’infini. La science-fiction annonce une révolution imminente de l’intelligence surhumaine
des machines qui prendront la relève de la vie telle que nous la connaissons et par
conséquent de l’histoire. Ou bien, identiquement – alors qu’on pourrait croire qu’il s’agit de
quelque chose se plaçant aux antipodes de ces rêves –, le programme de destruction de
l’histoire mené par l’État Islamique. Il ne s’agit toujours que des mutations qui veulent
dépasser les précarités de la vie, surmonter la finitude et l’histoire, réaliser l’infini. Les
mutations de l’humain ne semblent pouvoir être pensées ou vécues qu’à l’intérieur de
l’horizon de l’infini, nommément comme des réalisations, des approfondissements, des
perfectionnements, des rationalisations et des radicalisations de l’infini lui-même. L’infini
est la chose qui vit chez l’humain, qui fait vivre l’histoire, mais que lui-même vit d’une vie
parfaite ou en tout cas immortelle, c’est-à-dire morte ou non vivante, puisqu’elle n’a besoin
que de soi pour se nourrir et s’accroître.
J.-L. N. : Ce qui semble loin d’être mourant peut se trouver en réalité proche de
l’extinction… Cependant j’accepte tout à fait de suivre ta voie. De même peut-être que
l’espèce “homme” n’est pas mourante – même si depuis bientôt un siècle elle se
représente, pour la première fois, qu’elle est en mesure de se détruire elle-même (je
pense au Freud de Malaise dans la civilisation). Il n’est certainement pas plus possible à
l’humanité de se représenter sa mort que cela ne l’est à chacun d’entre nous. Mais
justement, ce n’est pas une affaire de représentation. C’est une affaire de réel et je ne
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
10
vois pas, au fond, pourquoi l’ensemble formé par la vie et la vie parlante (la vie
comme « vie de l’esprit » pour faire allusion à Hegel et donc aussi au christianisme)
ne finirait pas par mourir si la mort est inscrite dans la vie comme son sens même :
l’absentement du sens en tant qu’effectuation, accomplissement, satis-faction. N’est-
ce pas d’ailleurs autour de la mort qu’a tourné la mutation occidentale – depuis
l’Égypte jusqu’à la Résurrection chrétienne ? Il s’est agi d’une rupture avec toutes les
formes de rapport à la mort qui situaient la présence des morts quelque part dans le
monde, fût-ce dans un monde enfoui et inaccessible. Avec la mutation, cette présence
devient à la fois absence intégrale au monde et présence métamorphosée en une
autre vie, la « vie de l’Esprit » justement…
Qu’est-ce qui nous interdirait de penser que le monde, l’évènement-monde – et en lui
l’évènement-vie, l’évènement-parole – s’achève comme il a commencé : ex nihilo in
nihilum ? Évidemment cette pensée penserait ce qui la dépasse infiniment,
absolument – conformément à l’argument d’Anselme en faveur de l’existence de
Dieu. Et justement, cela ne signifierait-il pas que le Dieu si singulier du monothéisme
occidental – le Dieu mutant ou la mutation de tous les dieux – absorbe toute divinité
dans l’infini qui peut aussi bien être compris comme sa propre annihilation ?
Mais je reviens tout de même à ta voie. Tu as raison de désigner la politique car elle
est bien le nom sous lequel, depuis qu’il ne s’agit plus de Dieu (ou bien depuis qu’on
revendique une politique divine, que ce soit au nom de l’islam, au nom de
l’hindouisme, parfois aussi du christianisme – mais sans jamais être capable de
rendre compte du double registre de la technique et de la religion). La politique est
bien cela dans quoi s’est d’abord opérée la mutation occidentale : dissociation entre
cité humaine et loi divine, auto-fondation de la cité humaine, droit, puis
souveraineté, c’est-à-dire recours à la logique de la hiérarchie absolue (je veux dire
de l’autorité sacrée – hiérarchie) en régime désacralisé tous les artifices des sacralités
monarchiques des âges classiques se dénoncent d’eux-mêmes en leur temps même, et
c’est bien ainsi justement que se forme la théorie de la souveraineté : comme un
procédé presque ouvertement déclaré pour affirmer l’autonomie du pouvoir
politique.
La politique a pu pendant longtemps conserver la puissance de l’autorité sacrée, soit
qu’elle s’imposât au peuple avec l’aide de la religion, soit qu’elle fût elle-même utilis
ée et manipulée par les forces socio-économiques (ce qu’on a nommé « la
bourgeoisie »). Il est remarquable que la politique soit pour le premier Marx le nom
d’une illusion à supprimer comme celle de la religion. Pour le dernier Marx, elle aura
trouvé les mérites de formes d’action – mais la disparition de l’État n’en restera pas
moins, selon toutes sortes de versions, l’idée régulatrice des socialismes et
communismes. Aujourd’hui, on peut dire que l’État a bel et bien été destitué de son
autorité sacrée. C’est d’ailleurs pourquoi la « souveraineté nationale » est désormais
un concept si ambivalent – d’un côté brandi contre les puissances de domination
mondiale, d’un autre côté récusé comme le nom même de la domination arbitraire.
L’État a été destitué parce que le mouvement réel de la Staatsmachinerie (comme dit
Marx) c’est-à-dire de la constitution et du fonctionnement d’un appareil fait pour
assurer la domination s’est de plus en plus révélé – voire déclaré… – comme le
mouvement de la puissance techno-économique. Or cette puissance n’est ni
religieuse, ni politique. Elle est la puissance de la production – sans qu’il soit possible
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
11
de désigner ni l’objet, ni la finalité de cette production (qui produit des choses, des
modes de vie, des représentations, etc.).
C’est pourquoi il me semble que ce que tu décris, la poursuite renouvelée de l’infini
compris comme réalisation (asymptotique ?) d’une vie juste, égale et digne (ou
heureuse…) ne pourra pas, me semble-t-il, se contenter d’une politique renouvelée –
qu’elle soit “populaire” ou “partisane”, “souveraine” ou bien accordée à une religion
– car la catégorie de “politique” n’a plus de véritable contenu, ni même
d’emploi. Certes, on pourrait appeler « politique » une action qui viserait à s’emparer
des leviers de commande de la machine productrice. Mais il faudrait que cette
politique-là soit considérablement rechargée (comme on parle de recharger une
batterie) en possibilités de désigner des priorités, des finalités (autres que les vagues
« justice », « égalité », « bonheur »). Autrement dit, il ne peut s’agir que d’une
mutation dans ou de la « vie de l’esprit »… Ce qui veut dire aussi bien l’esprit de la
vie. Ce qui veut dire aussi que nous sommes toujours contemporains du Marx qui
parlait de « l’esprit d’un monde sans esprit »… Sauf que Marx semble, dans cette
phrase, savoir quelque chose de cet « esprit » qui manque à ce monde – au moins
peut-il employer le mot – alors que nous n’osons guère nous servir d’un mot pareil.
J.-M. G. : Où repère-t-on les craquements de l’infini, les symptômes ou les mutations qui
seraient en train d’annoncer une mutation majeure de notre civilisation, c’est-à-dire de
l’infini lui-même comme horizon, projet, promesse de vie ?
J.-L. N. : Il me semble que l’infini nous montre de lui-même ses « craquements ». Car
ça craque, oui, ça résonne de bruits qui signalent une faiblesse, une rupture possible…
Tout simplement d’abord dans le mot « infini » : on sait comment il est toujours
exposé à la division hégélienne entre « bon » et « mauvais » infini. (Une division que
Marx retrouve au sein du capital dans les Grundrisse.) Cette division – qui précède
d’environ un demi-siècle les découvertes de Cantor – représente peut-être la forme
moderne de la duplicité inherente à l’infini selon Aristote : qu’il existe en un sens
mais en un autre n’exise pas. Si l’existence en effet implique l’actualité et la
détermination de cette actualité, l’infini excède l’existence (par au-delà ou par en
deçà). Ne faudrait-il pas penser que la mutation occidentale est justement celle d’une
exposition de l’exister à une possible non-détermination ? Ne sommes-nous pas
aujourd’hui dans une tension – un craquement – très sensible entre le mauvais infini
(l’indéterminé, l’indéfini de la production, le sans-fin) et le bon infini (l’actualité
pleine de l’exister, jusque dans l’instant…) ?
J.-M. G. : Tu fais référence à une distinction hégélienne… Cela est peut-être indicatif de ceci,
que n’avons d’autres ressources pour comprendre ce qui arrive à notre civilisation que
celles que notre civilisation elle-même nous fournit : le logos, la science, la technique, la
philosophie, l’art, le corps, la politique, la démocratie… bref l’infini. En ce qui concerne la
philosophie, il est clair pour moi, comme je crois il doit l’être pour toi, qu’aucune décision
concernant la nature de notre civilisation et de l’infini qui lui est constitutif nous épargnera
d’avoir, à chaque fois, à inventer une pratique de penser. Car il ne s’agit pas de délibérer sur
le sens des idées ou des concepts, il ne s’agit pas de décider ou de donner ses opinions,
mais il s’agit de saisir ce qui n’a pas encore été saisi, de comprendre ce qui n’a pas été
compris, ce qui ne peut se faire que par une pratique qui laisse la pensée entièrement
exposée à ce qui vient. La question de la philosophie semble être aujourd’hui la même que
depuis toujours : une question d’action philosophique, de pratique, de méthodologie, de
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
12
chemin, d’écriture, d’expérimentation. Où en es-tu par rapport à la question de la pratique
de la pensée ?
J.-L. N. : Ta question me frappe car j’en suis précisément… je ne sais pas où mais à
coup sûr en un lieu de trouble, d’agitation. Je suis de plus en plus persuadé que nous
n’avons pas tiré les implications de ce que Heidegger a nommé « la fin de la
philosophie » : la fin des images/conceptions du monde. À la fois nous avons compris
que l’élaboration de systèmes métaphysiques ne peut jamais que refléter – et donc
soutenir quelque temps – un certain état de la représentation et de l’activité de la
part dominante de l’humanité mais se heurte forcément à la transformation de cet
état et par conséquent à un défi renouvelé au sujet de ce qu’on nomme « la vérité ».
Pour autant, nous ne savons pas ce que « penser » veut dire si ce n’est assigner le réel
sous des significations, alors même que nous éprouvons leur labilité ou leur
inconsistance.
En revanche nous savons – ou peut-être faut-il dire nous éprouvons – autre chose : la
même parole qui dépose ses significations fragiles, usées ou vidées ne cesse pourtant
pas de se relancer elle-même en tant qu’appel et échange, exhortation ou émotion,
désir inextinguible de sens et passage incessant à la limite du sens, ou bien au sens
comme limite… Cela résonne plus du côté de la poésie que de la philosophie mais
aucune culture, aucune configuration d’humanité n’a jamais été exempte de ce que le
mot « poésie » désigne si mal et si bien (lui aussi déchiré comme l’infini). Sans doute
toute philosophie a-t-elle toujours été poésie autant que concept, chant autant que
système. Et après tout, comme dit Kant, les systèmes sont vivants… Aujourd’hui,
redevenir délibérément poètes… qu’est-ce que cela voudrait dire ? Bien sûr, ni
Parménide, ni Lucrèce, ni Hugo. Ni même Nietzsche, ni Kierkegaard, ni Heidegger (et
justement il faudrait s’arrêter sur le lien chez lui de la poésie et de la politique…).
Rien que je sois capable de nommer – mais au moins savoir que nous sommes dans cet
élément-là.
J.-M. G. : Quoi qu’il en soit des troubles que tu éprouves, tu ne les ressens pas en tant que
poète, elles ne proviennent pas des défies ou apories d’une œuvre ou pratique poétique ; il
doit s’agir d’apories de la pensée, du travail philosophique.
J.-L. N. : Peut-être dois-je d’abord revenir au temps où j’ai commencé à sentir une
distance avec les étudiants à l’université : des pesanteurs institutionnelles, sociales et
culturelles ont transformé ce qui pour moi dans les années 1970 et 1980 avait été une
symbiose continue entre l’enseignement et l’écriture, les échanges, etc. La vie
philosophique ne vivait plus beaucoup à l’Université. En même temps elle a
commencé à s’étioler dans l’espace public. Les préoccupations liées au début de la
décroissance et aux crises financières, aux profonds déplacements géopolitiques et
géoéconomiques, bref tout ce que je pense aujourd’hui être le début d’une mutation
de civilisation a déplacé de manière considérable l’espace et le climat du travail
philosophique. L’université s’est alourdie dans la formation professionnelle. La
philosophie dite « analytique » a conquis des territoires universitaires de plus en plus
larges – elle qui représente une façon de se tenir hors du monde dans un univers
formel qui me reste étranger. Mais elle n’a pas pour autant occupé l’espace public,
lequel au contraire a été envahi par toutes sortes de recours à la philosophie comme
à une sorte de réservoir de ressources éthiques, esthétiques et vaguement politiques.
Des magazines, des lieux de rencontre, des demandes venues de milieux artistiques
ou sociaux ont beaucoup changé les attentes et les demandes adressées aux
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
13
philosophes. Il s’est créé une zone incertaine, guettée par les dangers de la
simplification / vulgarisation et pourtant aussi propice à des rencontres nouvelles.
Je préfère souvent parler à des publics moins techniciens de philosophie mais plus
désireux de parler du monde réel. J’éprouve par exemple beaucoup d’intérêt à
essayer de faire partager une pensée qui veut se dégager de l’attente d’un « sens »
final de la vie – plus qu’à développer, comme je l’ai fait dans des textes,
l’argumentaire philosophique de ce « sens » du « sens »… Et lorsque je vois
aujourd’hui se propager une mode qui veut affirmer un nouveau « réalisme » (dit
« spéculatif » par Quentin Meillassoux, au demeurant un excellent philosophe, en
outre fin, discret et pénétrant) je reste songeur car je ne vois pas que les philosophes
de Husserl et Heidegger jusqu’à Deleuze, Derrida, Lacoue-Labarthe et bien d’autres
aient délaissé le réel ! Chacun est dans le réel, n’est que là, immergé dedans, se d
ébrouillant à sa manière avec l’opacité et le poids du réel…
Mais bien sûr cela demande de dire à nouveau le « réel », de le phraser, de le
nommer, de l’éprouver et de dire cette épreuve. Et alors on retrouve l’aiguillon d’une
attente d’écriture, d’expression, de mots où le réel puisse respirer ou transpirer…
C’est aussi pourquoi j’ai commencé à m’intéresser à un « objet » ou à un « thème »
assez éloigné de ce que j’avais travaillé jusqu’ici – le sexe, quelque chose qui prolifère
dans l’espace médiatico-spectaculaire mais qui invite à des méditations où l’intérêt
de penser « la vie » (pourquoi « la vie » nous hante-t-elle tant ?) côtoie un terrain de
perplexités, d’angoisses, de désarrois… Ou bien je veux aussi revenir à la question de
la « politique » précisément parce qu’elle est partout et nulle part, partout invoquée
et partout méprisée… « politique » : un mot qui n’a presque plus de sens à force de les
avoir tous…
Mais chacun de ces points, et d’autres encore (comme ce qui bourdonne autour de
l’art dit « contemporain » ou bien autour de la question « que faire ? » en tant que
question aujourd’hui peut-être vaine…) sont des points de butée ou d’aporie parce
qu’on ne peut pas se contenter de les « traiter » : ils sont devenus intraitables au sens
français où ce mot veut dire que ça résiste, qu’on ne peut rien en faire ou rien y
faire. Comment bien articuler que la « politique » n’est pas l’espace d’ensemble du
sens, du bonheur, de la vérité – pas plus qu’elle n’est le lieu exclusif des luttes pour le
pouvoir et des manœuvres pour le garder ? Comment refaire ou inventer une forme
neuve de cette notion, « politique » ? Ce genre de questions ne mène pas d’abord ni
essentiellement à parcourir les discours et les concepts philosophiques. Il s’agit
plutôt de sensibilité à ce qui nous arrive, à ce qui arrive à ce monde qui se sent si d
érouté par sa propre transformation, par sa propre histoire qui depuis un siècle lui a
réservé plus de surprises, plus d’imprévus, plus de déstabilisations que pendant les
siècles précédents, quelques riches en événements qu’ils aient été. Qu’est devenue
l’histoire ? Comment s’est-elle faite aussi agitée, aussi traversée de soubresauts et de
stupeurs ?… La sensibilité se joue en deçà et au-delà des concepts, bien qu’elle les
traverse. Par moments, écrivant ou parlant, j’ai envie de couper le discours, de crier
ou bien de rire, de prendre un rythme, de me taire…
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
14
NOTES
1. Jean-Luc NANCY, « Savoir écouter le silence des intellectuels », Libération, 22 septembre 2015.
AUTEUR
JUAN-MANUEL GARRIDO
Université A. Hurtado – Santiago du Chili
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
15
Hommage à Werner Hamacher
Werner Hamacher est mort le 5 juillet 2017 à l’âge de 69 ans
Jean-Luc Nancy
NOTE DE L'AUTEUR
Texte écrit en allemand et auto-traduit par Jean-Luc Nancy, d’abord publié sur internet
dans les deux langues par la revue Diacritik le 20 juillet 2017 (https://diacritik.com/
2017/07/20/jean-luc-nancy-hommage-a-werner-hamacher-am-siebzehnten-juli-2017/).
Nous remercions l’auteur et la revue de nous avoir autorisé cette publication.
1 Le 17 juillet 2017,
2 Werner,
Werner, toi ici avec nous, toi si proche et si lointain, aussi lointain que proche,
Werner, plus loin…
Werner je suis sans parole – et tu dis aussitôt : « Qui est sans parole a dans sa privation
même quelque chose de la parole ».
Quelque chose ou peut-être tout vas-tu dire car on ne parle qu’à partir du manque de
parole et on cherche sa propre disparition.
Parce que je suis sans parole, je me trouve là où tu veux. Là où il est question de
« l’aphasie structurelle du langage » – c’est ton langage – et donc là où il est dit : « le
langage est l’auto-préservation, l’auto-récusation de la mort »1.
Et plus loin : « Un Je, un Tu, Lui, Elle, Nous, Vous, Eux – voilà ce qui ne se trouve que
dans l’auto-éloignement de la mort que le langage est ».
3 Ici nous sommes dans la proximité de la mort. Et du mort.
4 Toi – que nous ne pouvons plus vraiment tutoyer même si nous le faisons.
5 « Toi » – qui résonne ici et maintenant comme une erreur ou une ironie ou bien un
délire, car nous sommes ici et maintenant dans une privation de langage qui appartient
à la justice du langage – ton prochain livre.
6 Nous savons pourtant, et nous le savons grâce à tes mots, grâce à ta langue propre
incroyablement idiomatique, idiolectique et idiosyncratique, que le langage « fait plus
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
16
que parler » ; et que ce « plus », cet excès dans la vacance du langage d’un
« surlangage » qui avec une « exubérance folle » fait plus que parler, ce plus se consume
et se tait dans le deuil.
7 Se taire à partir de tes paroles… – ou mieux encore : parler de tes paroles de telle façon
que chaque mot devienne comme ce Häm de Celan à propos duquel tu écris qu’« en lui
tout mot se trouve brisé et ainsi soumis à une économie de l’anéconomique » 2.
8 À la mort de Jacques Derrida – un des plus grands de nos amis communs, un de notre
communauté d’amis sans être-commun, comme tu dirais –, tu as souligné combien à
chaque mort on éprouve la limite de notre rapport avec le mort, les occasions
manquées et comme tu dis, « ce que j’aurais aimé dire et que pourtant je n’ai pas dit » 3.
Avec toi je n’ai pas conscience de circonstances semblables mais la seule conscience ne
suffit pas. Je pense en revanche, ce que tu sais toi-même, qu’une telle imperfection du
rapport ou de la rencontre appartient par nécessité à la rencontre – et aussi à la plus
forte des rencontres dans l’amitié ou dans l’amour. C’est ainsi que fonctionne
l’anéconomie.
9 Tu répliques : il n’y a pourtant aucun motif d’en faire sortir une économie accomplie.
Au contraire. Et tu as raison. L’excédence de toute totalité – que ce soit dans l’ordre de
la signification ou de l’être, du monde ou du savoir – a toujours formé ton angoisse et
ton désir suprême, elle a fourni la puissante énergie de ton hyper-énergétique pensée,
parole et écriture.
10 De quelque façon tu l’avais déclaré d’emblée dès 1978 avec Plérôma. Ce livre se présente
comme une simple introduction à des écrits de Hegel mais en réalité il est beaucoup
plus long que ceux-ci car il fait bien plus que les présenter. C’est un livre sur le repas, le
manger, l’incorporation et la nécessaire Exkretion.
« Il y a toujours un reste qui ne disparaît pas dans le mouvement du Même mais
dont la plus-ou-moins forte présence écœure le cercle du Même ». À quoi
appartient le système digestif qu’à travers Hegel tu interprètes comme la
rumination. Tu vas jusqu’à relever une note marginale où Hegel se demande si les
animaux ruminants ont un pancréas. Tu remarques là une « inquiétude » de Hegel :
un estomac multiple exclut-il ou non un pancréas, qui contribue lui aussi à la
digestion ? Mais toi tu surmontes l’inquiétude car tu sais très bien que « quiconque
mange, quiconque lit, rumine d’une manière ou d’une autre ».
11 Et c’est ce que tu n’as pas cessé de faire ; c’est de quoi physiologiquement tu es mort –
et je t’entends déjà demander ce que « physiologique » peut vouloir dire ici qui devrait
être séparé d’un registre noologique, philologique ou philosophologique – d’une
manière ou d’une autre.
12 L’excessive répétition du Même – du plérôme – va toujours jusqu’à nuire au Soi-même,
ce qui appartient à celui-ci sans être de son appartenance. Alors arrivent les douleurs.
Alors arrive, tu l’écris, « un langage de la douleur, qui ne peut dire que ceci : il ne
devrait que bredouiller mais il déroge à sa propre loi : il ne porte pas la douleur au
langage mais le langage à la douleur »4.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
17
13 Bredouiller vient des derniers vers du poème de Celan, « Tübingen, Janvier » que tu as
cité auparavant :
Il pourrait
Seulement bredouiller et bredouiller
Toujours, rebredouiller tou-
jours, jours
(„Pallaksch, Pallaksch“).5
14 Comme Häm, Pallaksch est un mot sans signification, qui ne se présente qu’en tant que
ne signifiant rien et ainsi comme douleur du parler. Tu lis et tu manges ces mots, ces
paroles, la langue humaine, finie, infinie avec ton appétit géant – de nourriture, de
lecture, de parole, d’amour.
15 Nous écoutons et nous te remercions pour ton aller géant, pour ta présence géante et
même pour l’énorme absence désormais ouverte. Car elle t’appartient aussi, toujours et
toujours.
16 Toi. Qui ? Pas de question ! TOI Werner. Et une fois encore avec Celan : « … un TU, sans
mort, / à même qui tout moi vient à soi »6. Mais de nouveau, forcément de nouveau, un
écho, une écholalie de toi, Werner : « En chaque nom est déjà à l’œuvre une ruineuse
antonomasie […] non un démonstratif mais un monstre […] du langage par lequel se
déclare ceci, qu’il ne parle pas proprement ; un monstre sans monstratum 7.
NOTES
1. Jean DAIVE & Werner HAMACHER, Erzählung des Gleichgewichts 4W, Urs Engeler, 2006.
2. Werner H AMACHER, « Häm. Ein Gedicht Celans mit Motiven Benjamins », in : Jüdisches Denken in
einer Welt ohne Gott – Festschrift für Stéphane Mosès, Vorwerk 8.
3. Id., « Pour dire un mot à la fin », Rue Descartes n° 48, 2005.
4. Id., 95 Thesen zur Philologie.
5. Paul C ELAN, « Tübingen, janvier », Revue littéraire mensuelle Europe, septembre-octobre 2016,
n° 1049-1050, p. 188-189, traduction de Jean-Pierre Lefebvre. Cf. Werner H AMACHER, Entferntes
Verstehen: Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan.
6. Paul CELAN, « Die Silbe Schmerz ».
7. Werner HAMACHER, op. cit.
AUTEUR
JEAN-LUC NANCY
Université de Strasbourg
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
18
Mutations, mutismes
Werner Hamacher
NOTE DE L’ÉDITEUR
Cet article a été traduit de l’allemand par Jérôme Lèbre. Christian Ferrié a traduit les
variantes apportées à la dernière version.
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1 L’attitude de la philosophie face à ce qu’elle rencontre ne doit pas être seulement celle
d’une philosophie parmi d’autres. Elle doit être celle de la philosophie en général et par
suite de toute philosophie, d’où qu’elle vienne. Conformément à la logique du double
génitif, elle doit donc être l’attitude déterminée par la philosophie et celle qui la
détermine. C’est qu’elle doit mettre en lumière la Chose qu’elle rencontre : non pas une
chose parmi d’autres, mais à chaque fois la Chose de la Chose-même, son caractère de
Chose. Et elle ne peut l’éclairer, devrait-on penser, que si elle en fait l’expérience
comme sa Chose, si elle saisit cette Chose qui est la sienne comme Chose philosophique,
comme Chose déterminée par la philosophie et pour elle. La Chose de la philosophie
serait donc la philosophie implicite de la Chose. La philosophie serait l’explicitation de
chaque philosophie non explicitée avant même qu’elle en arrive au stade de sa
réflexion spéculaire.
2 Ainsi la philosophie ne pourrait pas se prendre elle-même pour thème sans s’être
référée à chaque fois à elle-même avant de se thématiser ainsi. La relation qu’elle
entretient avec le cours des étoiles ou avec l’architecture du langage est proprement la
relation à soi ou encore la relation kat’exochen et donc la relation même de toutes les
relations. La philosophie est – c’est du moins ce qu’on devrait penser d’elle – depuis ses
premières auto-déterminations autarkía, et ce dans sa praxis théorique aussi bien que
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
19
politique, telle que Platon, dans la République (III, 387d) la caractérise : málista autòs auto
autárkes, auto-fondation, maîtrise et jouissance de soi éminentes, indépendantes du
temps et de tout autre. C’est pourquoi la philosophie n’adopte pas une attitude
indifférente et interchangeable face à ses thèmes, à ses thèses et à la rythmique de son
déploiement. Elle n’est pas une feuille changeante qui se tourne au gré des vents de
l’histoire pour couvrir toujours la même nudité. Elle est plutôt le vent, la feuille et la
nudité : philosophie de la philosophie, d’une manière immédiate et par-delà toutes les
médiations. Elle est le tout qui fait le tour de son propre cercle : l’eukyklos sphaira, la
sphère bien circulaire de Parménide (Fr. VIII, 43) qui articule tous ses membres, même
ivres. Avant même qu’elle n’oppose un dedans et un dehors, elle est, cette Enzyklika,
l’ésotérique en tant que tel ; le procès même du souvenir intériorisant, dont Hegel parle
à la fin de la Phénoménologie de l’esprit en le nommant « savoir absolu » : un savoir qui est
absolu parce qu’il se détient lui-même, parce qu’il est soi. La philosophie n’a pas une
attitude qui peut changer ou même s’abandonner ou se perdre, elle est l’attitude de
toutes les attitudes, elle ne peut pas être ce qu’elle revendique afin d’être. Elle doit,
c’est ainsi qu’on devrait la penser, être sophia et non philosophia.
3 Héraclite ne parle pas de philosophie. Il parle d’un anèr philósophos, d’un homme qui
aime le sóphon, le Sage. Rien n’assure encore que ce philein suffise à l’amant chez Platon
lui-même. Dans sa conférence de 1955, « Qu’est-ce que la philosophie », d’abord
destinée à un public français, Heidegger écrit à ce propos, sans plus d’explication ni de
justification : « philein, aimer, signifie ici au sens d’Héraclite : homologein, donc parler
comme le logos parle, ou correspondre au logos ». Et il continue : « ce correspondre
s’accorde avec le sophón. Et cet accord est l’harmonia. Ce qui fait qu’un être se joint avec
un autre et réciproquement, si bien qu’originellement ils s’ajointent, parce qu’ils sont
ajointés l’un à l’autre, cette harmonie est ce qui caractérise le philein pensé par
Héraclite, l’amour »1. Par conséquent aime la sagesse qui aime le logos, et il l’aime en
lui correspondant, comme il correspond au langage, et parce qu’il tient à lui : au logos
en tant que relation. L’interprétation heideggérienne de cette relation d’amour pensée
par Héraclite se fonde donc sur un homologein qui ne s’accomplit que dans l’horizon du
logos et qui détermine ce logos comme relation mutuelle d’ajointement et d’accord liant
l’un à l’autre, l’un l’autre.
4 Aimer le sage, le sophón, signifie donc dire tout ce que le dire dit de lui-même, et le dire
de telle sorte qu’il soit dit comme un tel dire. « Tout dire » signifie cependant : dire tout
ce qui est, le dire dans sa totalité et son unité, dans son être en commun. C’est pourquoi
Heidegger peut continuer : « Le sage dit : tout étant est dans l’être ; pour le dire plus
précisément : l’être est l’étant. Ici le “est” se dit d’une manière transitive et signifie
autant que “rassemble”. L’être rassemble l’étant en cela, qu’il est l’étant. L’être est le
rassemblement – le logos. » Or, si l’être rassemble, comme Heidegger l’entend, alors son
acte de rassembler est legein : un homologein. Et puisque cet homologein est en même
temps un aimer au sens de l’amour mutuel, liant l’un à l’autre, l’un l’autre, l’anèr
philósophos doit être celui qui correspond au logos même. Il ne fait pas que parler, mais
il parle le parler : il ne parle pas un langage parmi d’autres, ne discute pas dans un
idiome parmi d’autres qui tous se valent, mais parle le seul « langage » ; il idiomatise
l’idiome, rassemble l’ensemble, et accomplit cette transition de l’un à l’autre – qui ne
s’appelle pas autrement que transcendance –, que Heidegger caractérise comme être
transitif. « L’être est le transcendant comme tel »2 ; cette explication au début d’Être et
temps nous dit aussi qu’il faut comprendre l’être comme legein, homologein, philein. Celui
qui aime et a fortiori celui qui aime le Sage, transcende : il passe, il est le passage à
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
20
l’autre, et sur le mode de l’un à l’autre, de l’un l’autre et de la mutualité. Il correspond :
Heidegger utilise dans sa conférence ce mot français pour accentuer l’écriture en deux
mots de l’Ent-sprechung3 ; il rassemble dans son homologein, il collecte. Il est lui-même la
collection du collectif. Lui, lui-même, est le correspondre de cette correspondance.
5 Qu’il soit seulement capable d’une telle correspondance signifie directement qu’il est
appelé, dès le commencement, par le langage et donc par l’être comme assemblement
de l’étant. S’il peut se mettre en accord ou consonance avec lui, c’est seulement parce qu’il
est déjà déterminé comme rappel de l’être de l’étant, affirme Heidegger : « ce qui nous
rappelle, se fait entendre comme voix de l’être, est voué à nous correspondre ». Ce
dernier traduit lui-même en français cet être-déterminé ou être-voué par « être
disposé », en rajoutant ce commentaire : « Dis-posé, signifie ici littéralement : posé l’un
hors de l’autre, éclairé et ainsi ayant dé-placé ce qui est » 4. Seul celui qui est dis-posé de
cette façon, qui est exposé hors de soi et tenu ouvert à l’autre que soi, se tient en
relation à l’être de l’étant. Exposant l’un hors de l’autre, il est lui-même le seul passage
à l’autre. Comme ce passage, sit venia verbis, il est tout aussi bien altération et retour à
soi : ce qui arrive dans l’arrivée de l’autre ou de soi, ou, mutatis mutandis, ce qui se passe
dans cette arrivée, d’une manière homologue, mutuelle, réciproque.
6 C’en est fini avec Aristote et déjà chez Platon : le philein de l’ anèr philósophos est
remplacé par l’orexis, l’effort à fournir pour être un Sage, sophón. L’accord originaire
avec le Logos devient un effort tendu vers lui, pense Heidegger, et cette mutation de
l’avec au vers demeure dans l’histoire celui qui doit être nommé désormais, de la
manière la plus pertinente, Philosophie. Depuis lors, la philosophie est l’événement qui
dérive d’une approche échouant avant d’arriver à l’un comme à l’autre, à l’un l’autre,
auxquels se refusent l’assemblement, le logos et la transitivité constitutive. La question
peut demeurer de savoir si c’est une « libre suite » ou un procès dialectique nécessaire
qui a provoqué ce changement de la pensée originaire. Les deux hypothèses, celle de
Heidegger et celle de Hegel, s’accordent pour dire que la philosophie demeure la même 5
sur le fond de ce changement, qu’elle demeure aussi une philosophie des mutations
affectant la relation à l’avec, la relation de l’un à l’autre et de l’un l’autre, bref une
philosophie de la tenue face aux modalités de l’être ensemble. L’effort vers le Logos,
l’assemblement et l’être sont également un mode de l’avec, et un tel mode est aussi ce
que Heidegger appelle la « libre suite » qui place la philosophie aristotélicienne après
celle d’Héraclite, en tant qu’elle est, dans sa généralité, une « suite ».
7 Ce qu’il y a de singulier dans l’universalité de la philosophie ne peut se justifier que si,
sous ce titre général, des philosophies plurielles et rassemblées ont d’abord cet être en
commun. Aussi profondément qu’elles puissent différer, elles sont encore des
philosophies de la différence, qui pensent le différer précédant le différent et le
pensent donc comme transition, transcendance, renvoi, correspondance, relation. La
relation de l’un (à) l’autre, de l’avec, se maintient, et ce qu’elle soit simplement
impliquée sans être questionnée dans ce qui est dit ou pensé, ou qu’elle soit thématisée
d’une manière explicite, du diapheron d’Héraclite à la différance de Derrida. Pour la
philosophie, l’être est depuis toujours être-avec, être-avec-l’autre, être-avec-soi-
comme-autre. Qu’elle soit un mode de la philia ou de l’orexis, de l’eris ou de l’eros, du
logos ou de la vox, du concept, de la volonté ou de l’intention, elle est relation : elle est
l’articulation ouverte ou fermée de la relation qui se trouve au fond de toutes les
relations.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
21
8 Après Heidegger, après Sartre qui a réduit Heidegger en l’hégélianisant, après le
tournant ultra-heideggérien de Lévinas, Jean-Luc Nancy a porté plus loin cette pensée
dans une succession sans temps morts de travaux. Il a lui-même caractérisé son
attitude vis-à-vis de l’ensemble complexe de questions qu’amène cette pensée : c’est
une « remise en chantier ». Deux affirmations pertinentes esquissent d’une manière
moins artisanale et moins poiétologique son programme. Citons un texte de 2002, À
l’écoute :
« Il doit être très clair que toute l’analyse que je propose […] risque à chaque instant
de ne pas se distinguer de ce cercle typiquement métaphysique qui n’opère rien de
moins que la résolution de la présence à soi en même temps que celle de la
sensibilité de l’intelligible et l’intelligibilité du sensible » 6.
9 Il est clair ici que le risque de ne pouvoir établir de différence entre les analyses de
Nancy et les analyses « typiquement métaphysiques » n’est pas esquivé, mais abordé
directement et comme une nécessité. On ne peut s’empêcher de le penser : ces analyses,
à l’intérieur même de la typique métaphysique, mettent en mouvement une différence
non-métaphysique entre la présence à soi et un autre qui n’est réductible ni à un soi ni
à sa présence. Dans Être singulier pluriel (1996), on lit : « Il faut réécrire Sein und Zeit : ce
n’est pas une prétention ridicule, et ce n’est pas “la mienne”, c’est la nécessité des
œuvres majeures, en tant qu’elles sont nôtres »7. Cela veut dire en premier lieu que les
grandes œuvres sont grandes pour nous et par nous en raison de la teneur universelle
de leur questionnement, de leur insistance et de leur prégnance, teneur rendue
indubitable par la traversée d’un doute massif. En second lieu, cela veut dire que la
raison pour laquelle elles nous appartiennent ne peut pas consister dans ce qu’elles sont
ou ce qu’elles entendaient être, mais dans le fait qu’elles sont à nouveau exposées par
un Nous, qui peut seulement être expérimenté comme le Forum de leur métamorphose,
de leur mutation, de leur réécriture. Qui écrit sur l’être et le temps – et personne n’écrit
jamais sur autre chose – réécrit Être et temps et l’écrit de nouveau, comme Pierre
Ménard : s’il réécrit le Don Quichotte de Cervantes en reprenant exactement chaque mot,
chaque virgule, il écrit encore un autre livre, incomparable même. En troisième lieu, il
est également dit par-là que le Nous qui réclame ici pour lui toutes les œuvres – et donc
pas seulement les grandes – conserve et retient, en elles et en lui, quelque chose d’un
Nous qui accorde et qui expose, quelque chose qui ne se laisse réduire à rien de durable,
à aucun instant qui perdurerait dans sa présence, et qu’ainsi il conserve et garde ce qui
ne peut demeurer ni nunc stans ni nos stans, ni même nous au sens grec, ni noesis noeseos
(Métaphysique, 1074b).
10 Dans l’écriture de Nancy, le nous français implique toujours un jeu de mots silencieux
avec le grec nous et – qui sait – peut-être aussi avec le Nu mystique de la théologie
négative ou ultra-positive allemande qui voit en lui l’instant et le clin d’œil d’une
communauté avec Dieu. Mais qu’il joue avec une telle homophonie et une telle
homologie ou qu’il se laisse prendre à leur jeu, son nous est, nolens volens et selon une
nécessité que lui-même accorde, une réécriture de tous les autres nous, nous, Nu ou
encore nu. Ceux-ci, une fois entendus, prononcés, écrits, sont réécrits et pris dans le
réseau des correspondances, lequel rassemble la pluralité des étants en vue de
l’harmonie de l’être. Cette réécriture doit par conséquent, selon la nécessité de ce qui
ne cesse pas de cesser, être le médium des mutations qui fait à chaque fois surgir un
nouveau nous, en lequel se maintient le même nous, bien qu’il soit différent de tout
autre. Elle doit demeurer le lieu de la constance et de la consistance des différents
étants comme de leur être, et donc constituer une topologie de l’être, une
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
22
homotopologie et tauto-topologie, qui s’écrit elle-même en se différenciant d’elle-
même. Elle doit donc être, qu’elle le sache et le veuille ou non, le medium de sa propre
« immédialité » et de sa propre immédiation. Elle doit révéler en chaque nous et en
chaque Nu un nous et un Nu incomparables. Elle ne peut donc être rien d’autre que son
propre devenir autre : l’altération de ce qu’elle a en propre, donc sa dé-propriation, son
ex-propriation et sa trans-propriation. Cette réécriture autorise instantanément à chaque
fois un autre nous : elle est dès le commencement un re-nou-er et un re-nou-veller.
11 Un célèbre passage de la Phénoménologie de l’esprit permet de comprendre que
l’homophonie entre le nous français, le nous grec et le Nu allemand est bien loin de se
réduire à un simple « jeu de mots » qu’un mot d’esprit un peu facile se complairait à
mettre en avant. Hegel y analyse la structure de la conscience de soi en partant de la
définition formelle du Moi comme Moi=Moi par Fichte. Le Moi comme conscience y
apparaît en relation à soi comme à son objet immédiat et, donc, il est en relation à soi
comme conscience autre, c’est-à-dire objectale, tout en étant en relation à la conscience
qui a cette conscience autre de ce dont elle est l’objet. C’est pourquoi le Moi ne peut être
qu’une conscience de soi dédoublée, et réciproque dans son dédoublement, une
conscience de soi-même comme d’une autre conscience : explicitement ou
implicitement, il ne peut qu’être conscience de soi et, comme tel, il lui faut être un
plurale tantum. Pour Hegel, le Moi n’est par suite jamais « seul » : dans l’acte
apparemment isolé de son autoposition originaire, il est déjà com-position avec un
autre Moi qui, au sein même de son objectivation, s’avère indépendant de cette
objectivation et qui, grâce à son indépendance, s’affirme non seulement comme l’autre
du Moi, mais comme un autre Moi ; il n’est pas tout seul [allein] : il est tout-un [All-eins].
Il n’est pas simplement conscience, il est conscience de soi comme l’unité de la même
conscience différente de lui. Hegel saisit cette unité différentielle, cette unité d’une
différence essentiellement homogénéisante, à travers la formule d’élargissement : Moi
qui est Nous et Nous qui est Moi. L’identité à soi-même, qui fait l’expérience du Moi dans le
Nous et du Nous dans le Moi, est caractérisée par Hegel comme substance universelle
indestructible, l’essence mobile identique à soi, et en même temps comme esprit. Par
conséquent, « Nous » est ce qui, chez Aristote, est tout autant hypokeimenon qu’ousía, et
c’est avant tout leur substrat : nous. C’est pourquoi son raisonnement ne manque pas
d’évoquer le présent, et à vrai dire un présent tout aussi ponctuel que mouvementé de
manière vivante : non pas un Nu « mystique », mais bien un Nu spéculativement
dialectique. C’est la phrase de conclusion de l’introduction à la section de la
Phénoménologie de l’esprit sur la conscience de soi :
« La conscience atteint dans la conscience de soi comme concept de l’esprit le
tournant qui la fait avancer depuis l’apparence colorée de l’ici-bas sensible et la
nuit vide de l’au-delà suprasensible jusqu’au jour spirituel du présent 8 ».
12 Rendre immédiatement plurielle la première personne du singulier en la transformant
en première personne du pluriel, ou encore en transformant le Moi-conscience en
Nous-conscience de soi et donc en esprit, comme Hegel le donne à penser avec son
tournant vers le jour spirituel du présent, cela ne peut que se heurter chez Nancy à la
barrière de l’incommensurabilité de chaque Moi avec d’autres Moi et de chaque Nous
avec d’autres Nous. Dès qu’on parle d’un incommensurable « avec », il n’est plus question
d’un simple avec, ni d’un substantiel être-avec et être-ensemble de différentes
consciences : l’essence mobile identique à soi du Nous, de l’esprit, du présent ne maintient
plus ensemble le Moi avec soi-même et d’autres Moi. L’incommensurable « avec » de la
réécriture exigée est bien plutôt réécrit non au sens d’un renversement, mais au sens de
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
23
l’entourage d’un écrit par des guillemets, et il a cédé dans cette réécriture son identité à
soi-même, et avec celle-ci tout autant la réciprocité de ses éléments que son essence, et
ce en faveur d’une différence à soi-même qui ne peut être supprimée parce qu’elle seule
ouvre un accès à un Moi et à une communauté avec d’autres. Aussi insensé et
impensable que cela puisse paraître, l’incommensurable « avec » dont parle Nancy 9 doit
être un avec qui ne peut pas même coexister avec soi-même s’il doit pouvoir fonder,
comme il le faut, la coexistence du Moi avec cet avec lui-même. Grâce à la réécriture de
Nancy, grâce à la citation du « avec » et la réécriture de toute l’ontologie classique du
Nous qui s’y condense, les deux formules d’existence, de consistance et de réciprocité
Moi=Moi et Moi=Nous se sont décomposées en une inégalité qui rend incommensurable
chacun de leurs éléments avec chacun de leurs éléments. C’est uniquement parce qu’ils
sont incommensurables et aussi longtemps qu’ils le sont que leur est accordée la chance
de pourtant se rencontrer, possibilité qui ne peut être fondée dans aucune essence, ni
donc assurée de manière catégoriale.
13 Il faut réécrire veut donc dire : être-nous autrement, être-nous autrement que tout autre
nous, et donc : autrement qu’être. Lévinas n’est pas devenu pour autant l’autorité qui
fonde l’appel de Nancy à la réécriture. Circonscrite par Heidegger, cette détermination
de l’être-avec a été rendue plus explicite encore par Nancy qui est parvenu dans Être
singulier pluriel à en pousser l’écriture plus loin dans un double sens : en poursuivre
l’écriture tout en s’en éloignant. Voici cette détermination : l’être, puisqu’il est à
chaque fois absolument singulier et sans mesure avec un autre être, doit être autre que
chaque être autre, il doit être autrement que l’être saisi par un concept universel, il
doit aussi être autrement que chaque être « concret » (être des étants ou du Dasein) ; il
doit dès lors être autrement que l’être. Ainsi est-il historial, selon une nécessité
incontournable située en deçà de tous les impératifs seulement moraux et de toutes les
possibilités catégoriales. Car rien de ce qui est permanent ou présente simplement une
modification, une transformation ou une métamorphose d’un être substantiel ne peut
se trouver soumis à la nécessité d’être autrement et d’être autrement qu’être, sinon un
tel être, un tel nous – qui ne peut jamais être consistant en soi et avec soi. C’est
pourquoi il faut inévitablement concéder que l’être-avec – logique, topologique et
ontologique – est un être inconsistant et que son caractère est « d’être » inconsistant.
« Être » sa propre inconsistance signifie cependant : en chaque instant, chaque instance
ou chaque stance ne plus se tenir dans cet instant, cette instance et cette stance. Cela
signifie donc : rester en chaque instant, chaque instance, ouvert à l’autre autant qu’à
l’autre indéfini et par-là à l’autre de l’autre, et donc rester ouvert à l’ouvert même. La
définition de l’être-avec repose dans son indéfinition : sa détermination est de ne pas
avoir de voix constamment propre qui soit auto-déterminée. Son horizon est le
commencement d’un autre, hors de toute horizontalité.
14 L’être est historial en tant qu’il est la consistance aporétique de ce qui est, sans limite,
inconsistant. Il est historial en raison de sa dis-position, qui n’est pas seulement la sienne
– qui n’est jamais durablement la nôtre –, et en raison de son ek-sistence et donc de
l’être-hors et l’être-au-delà de chaque nous. Il est historial en raison de cet hors-de-soi
insistant, en lequel il demeure autre que ce qu’il n’a jamais été ou ne deviendra jamais.
« Autrement » veut dire : être-avec-un-autre et être-avec-autre-qu’un-autre, et donc
être dans une altération, une mutation qui précède chaque être-avec, aussi substantiel,
subsistant et essentiel soit-il : une mutation qui précède chaque statut, chaque
instance, chaque Nu et chaque Nous et les précédant tous, leur échappe ; être dans une
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
24
alter-altération, une muta-mutation. Il n’y a d’être que comme être-avec avec l’autre, il
n’y a d’être-avec que comme mutation historiale, il n’y a de mutation que comme
mutation de l’être-avec. Cette brève série de propositions peut préparer à une pro-
position de plus, qui devrait indiquer que la structure de l’être-avec historial implique
un autre « avec », lequel de son côté n’a aucune communauté avec l’« avec ». Cette
proposition devrait risquer une affirmation qui se sépare clairement du cercle
typiquement métaphysique. Elle dit en effet que l’être-avec-un-autre est être-avec-un-
autre-que-l’être-avec, ou bien être-avec-le-sans-être-avec, ou encore, dit en trois mots :
avec-sans-avec. Ce dernier ne peut être saisi ni comme communauté substantielle, ni
comme « avec » contingent, comme peut l’être une contiguïté métonymique. Il devrait
plutôt ouvrir une relation infra-contingente à la relation, sans déjà contenir celle-ci,
sans tenir à elle, sans pouvoir l’imposer.
15 Le texte d’Être singulier pluriel révèle de multiples manières de prendre en compte cette
historialité de l’être-avec. Dès les premières pages, il est établi d’une manière
programmatique – cette fois-ci par la réécriture d’une phrase ou d’un syntagme de
Nietzsche – : « Nous sommes désormais – nous autres… “Nous” dit – et nous disons –
l’unique événement dont l’unicité et l’unité consistent dans la multiplicité » 10. Le tenir
et le tenir-ensemble (« consister ») de l’événement singulier dans sa multiplicité – ou
dans ses multiples multiplicités – ne suppose pas une médiation entraînant cette
pluralité. La pluralité est première : ses pluralisations structurelles ou historiques
(aucune différence ici entre structure et histoire, l’une comme l’autre assumant
entièrement leur différenciation), ses altérations et ses alter-altérations sont co-
primaires. Elles ne sont donc pas mises en relation par un medium pré-existant ou une
médiation réciproque qui viendrait ensuite se rajouter, relation qu’assumaient le
mélange et la metexis antiques, puis la convenance ou la médiation modernes. L’être
pluriel peut donc seulement être pensé comme immédiatement médiatisé : comme
découverte médiatisée par elle-même plutôt que comme médiation d’une pluralité déjà
donnée. L’être ne se meut pas dans le donné, il (se) meut comme donation. Il ne reporte
pas de donné ou de date : il donne, il date. C’est pourquoi Nancy écrit dans le même
ouvrage :
« L’être est donc aussitôt, immédiatement, médiatisé de soi, soi-même médiation :
médiation sans instrument, et donc, non-dialectique : dia-lectique sans dialectique.
Négativité sans emploi, […] la pliure plurielle de l’origine » 11.
16 La tournure « négativité sans emploi » se présente comme une réécriture de Bataille et de
Blanchot, qui l’utilisaient dans leur confrontation avec Hegel. Elle indique ici
silencieusement une négativité qui n’a pas le statut d’un moyen ou d’un instrument,
parce qu’elle caractérise immédiatement et, par-là de manière non-instrumentale,
l’être dans son être-avec-l’autre comme éloignement, spatialisation et temporalisation :
elle ne le caractérise donc pas comme négativité de l’opposition qui se pose en contrant
l’autre, mais comme négativité de la dis-position envers l’autre qui se pose hors de soi en
dis-cutant avec l’autre. Elle n’est pas le moyen-terme entre deux ou plusieurs êtres,
mais leur être-hors-de-soi sans médiation, sans centre, sans fin et sans début, éradiqué.
Cette « négativité sans emploi » implique une médiation sans emploi, une sui-médiation
et une alter-médiation immédiates. Elle désamorce toute médiation secondaire ou
réflexive, toute médiation de la médiation. En d’autres termes, il ne peut y avoir de
médiation assurée par un quelconque médiateur qui pourrait répondre de la co-
originarité structurelle de l’étant-l’un-avec-l’autre dans son être-avec.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
25
17 La médiation immédiate est au plus proche des êtres qui se médiatisent les uns les
autres : elle n’est pas une médiation entre eux. Par suite, toute médiation avec l’être-
avec n’est pas seulement additionnelle ou superficielle, elle est structurellement
infondée et contraire à la logique de l’avec, recouvrante et excluante. Elle fait de la
médiation immédiate un déjà médiatisé, un autre mis à l’écart de la liaison qu’entraîne
la médiation, un exposant autonome et hypostasié de ce lien. Il en découle cette
situation :
« “Avec” est la permutation de ce qui reste à sa place, chaque un et chaque fois.
“Avec” est la permutation sans Autre. Autre est toujours le Médiateur : son
prototype est le Christ. Il s’agit au contraire ici de la médiation sans médiateur […].
La médiation sans médiateur ne médiatise rien : elle est mi-lieu, lieu de partage et
de passage, c’est à dire lieu tout court et absolument. Non pas le Christ, mais seulement
un tel mi-lieu : et ce ne serait plus la croix, mais seulement le croisement,
l’intersection et l’écartement, l’étoilement à la di-mension même du monde » 12.
18 Cette première esquisse, du reste entièrement mise entre parenthèses, du grand projet
intitulé Déconstruction du Christianisme peut étonner pour deux raisons au moins.
D’abord, elle définit l’« avec » comme permutation et, sans penchant excessif pour
l’écoute segmentaire, le contexte chrétien aidant, on peut entendre ici père-mutation.
Ensuite, il s’agit d’une permutation de ce qui « reste à sa place », de ce qui a déjà son
lieu, qui demeure en ce lieu, un lieu qui est son milieu même, qui est absolument le
même que lui et qui, de cette manière, est le monde. L’avec reste certes partage et
passage. Il demeure – à proximité de la croix – un croisement, et tout aussi proche des
étoiles, un étoilement. Il demeure, à proximité d’une certaine dissection, qui le déchire
et qui disperse ce qu’il assemblait au centre de son mi-lieu, une intersection, mais cet
avec, cette permutation, reste à sa place. L’être-avec, c’est bien ce qu’exprime l’axiome d’
Être singulier pluriel, reste être-avec. Il reste être-avec, avec un autre être, mais cet être-
avec ne peut être avec l’Autre, écrit avec un grand A, qui se serait délivré, dégagé,
délivré de son lieu ou de sa demeure. L’argument se référant dans ce contexte au Christ
comme prototype du médiateur, on n’est pas loin de soupçonner que la réduction menée
ici s’oppose à une christianité restreinte pour libérer la voie d’une christianité
généralisée : une médiation sans médiateur reste en effet toujours une médiation. Elle
reste même pour cette raison attachée à la prototypique du christianisme : elle ne peut
donc qu’être plus chrétienne que le christianisme – plus chrétienne, pourrait-on dire,
que le pape. Ainsi cette réduction ontologique touche à son fondement et à son but :
faire d’elle-même la réduction à l’archétype, la permutation et la père-mutation d’une
médiation demeurant en son lieu d’origine.
19 Le soupçon que la « déconstruction du christianisme », telle qu’elle est ici esquissée,
mette en œuvre une archi-christianisation, se trouvera renforcé par la seconde
particularité étonnante de l’argumentation citée. Cette déconstruction exige en effet
que la permutation reste en son lieu et qu’elle y reste en mouvement, mais sans laisser
de place à un autre : elle est « permutation sans autre ». Ce qui est indéniablement
équivoque : « La médiation sans médiateur ne médiatise rien ». La permutation est donc
aussi pensée comme mutation et cette mutation-médiation est celle d’un rien, mais qui est
une Chose, une res, qui parce qu’elle est déclose marque le centre vide du lieu en lequel
l’être-avec se meut et change. Ainsi l’instance de l’Autre est étendue à celle de l’autre
déterminé, à autrui. Cet Autre généralisé, ou plus exactement ultra-généralisé, est de
son côté caractérisé de telle manière qu’il assume une position éminente, mais
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
26
contraire à la structure de l’être-avec : la position exorbitante d’un étant-rien. L’être-
avec est ainsi l’être avec le rien de cet être.
20 L’être-avec est l’être avec son rien. Même si elle ne se trouve pas dans Être singulier
pluriel et ne peut s’y trouver, tout dans cette œuvre mène pourtant à cette formule dont
on peut dire qu’elle structure la topographie, l’hétérauto-topographie de son mi-lieu.
Cette formule équivoque affirme, d’une part, qu’il y a un et un seul autre à l’horizon de
l’être-avec, que cet autre soit le prétendu grand Autre du Médiateur christique ou
proto-christique, ou l’autre d’une altérité quelconque que l’on rencontre dans les sons,
les couleurs, les odeurs, les pierres, les végétaux et les animaux, qu’il soit,
indifféremment, l’Autre d’un soi ou l’autre d’un autre : en tout ce qui se nomme autre,
pierre ou cadavre, poussière ou lumière, l’expérience est touchée d’un rien et d’un rien
de l’expérience. Cela revient à dire ce qu’Être singulier pluriel et d’autres ouvrages
ultérieurs de la même veine ne disent pas vraiment, à savoir : il n’y a aucune différence
structurelle à ce qu’il y ait un médiateur ou seulement une médiation immédiate.
D’après l’argumentation non seulement de la Logique de Hegel, mais encore d’ Être
singulier pluriel, même la médiation immédiate doit être une médiation dont
l’immédiateté est infiniment médiatisée : ses étapes, ses instances et ses institutions
servent toutes sans exception de médiation tout en étant immédiates en même temps,
de sorte que l’être-avec est a limine chaque fois être-avec Dieu et être-avec
l’impossibilité de Dieu. Cela peut bien sembler être une compréhension extravagante
du christianisme de découvrir encore une trace de divinité même dans cette
impossibilité de Dieu et donc dans son inexistence factuelle. Mais la structure
fondamentale de la légende chrétienne tout comme son traitement par la philosophie
chrétienne jusqu’à Hegel et même Kierkegaard, Nietzsche et Heidegger font apparaître
une telle compréhension comme la plus courante. Cela revient pourtant à dire que
l’être-avec doit être de part en part être-avec-l’autre, qu’il soit écrit autre ou Autre, et
que cet être-avec, explicitement ou implicitement, n’est pas seulement partage et
passage, mais précisément de ce fait qu’il est être-autre encore, il est au-delà du passage
et du partage tout comme il est devenir-autre au-delà de l’être. Si le sens de l’être-avec
et donc de l’être est partage, alors la transmission et la distribution de l’avec aux
autres, la dépense de l’avec pour les autres, l’altération jusqu’à la psychose et la
débilité, sont l’être-autre. Être est être-autre : l’univers de la chrétienté est par là même
réécrit comme espace de l’être-avec. L’ontologie de l’être-avec et, à vrai dire, chaque
ontologie de chaque être-avec est hétérontologie de l’être-autre. Or cet être-autre, qui
se dépasse en allant vers l’autre et est l’autre, transitif, en passant de cette manière en
lui, implique la fusion, même conflictuelle, avec cet autre et, dans cette fusion, la
destruction de l’avec et de ses éléments : de ce fait, cet être-avec comme être-autre est
nécessairement être-avec son rien. Les études particulières qui sont assemblées dans
Être singulier pluriel sont autant d’alertes concernant ce collapsus de l’avec. Tout en
essayant d’en préserver l’avec, elles attestent que ce collapsus appartient d’une
manière indissociable à la structure de l’« avec ». Le co et le cum de l’ego sum = ego cum,
être = co-n-être, communication, commerce, concours, concurrence, conscience, confusion,
conformisme13 n’est pas seulement occasionnellement ou épisodiquement en conflit avec
la co-existence. Ce co- est d’une manière constitutive le collapsus toujours aigu de la co-
existence. La permutation est en effet mutation à sa place, prise dans un passage sans
issue, sans autre son que celui d’un accord avec l’harmonie mono-onto-théo-logique du
monde entier.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
27
21 Aucun dieu, ni aucun mi-dieu non plus, aucun homme et aucune humanité ne peut se
sauver ou « nous » sauver d’être un Nous au sens d’une con-science et, par-là en même
temps au sens de concurrence et de concours, un Nous au sens du capital comme de sa
faillite. Aucune philosophie, aucun anèr philósophos, ne peut « nous » sauver, car la
mission de l’une, la profession de l’autre consistent précisément à assurer cet accord
avec l’assemblement des étants en leur être et avec la disparité de cet Être. La
philosophie, qui rejoint sa pratique dans cette compréhension de soi, se comporte
toujours aussi comme l’actrice de ce collapsus. Contre elle aucune alerte, aucune
réserve, aucune révolte ne peuvent venir en aide, car chacune peut a priori être rendue
conforme ou commercialisée.
22 « Nous sommes » veut dire : Nous autres, veut aussi dire précisément de ce fait : nous
étions (waren), et c’est pourquoi ça veut dire en outre : nous, les marchandises (Waren).
L’avec est, transitivement, sans-avec. Cette formule indique la fin endogène de l’être-
avec, de la philosophie, de l’histoire, du monde. Cette formule, qui ne provient pas d’
Être singulier pluriel et qui est y esquissé cependant dans ses traits fondamentaux, est
une fois encore équivoque. Elle caractérise l’immanence absolue de la transcendance du
Dasein comme être-avec, elle ne caractérise pas moins son Émanence absolue. Ce terme,
Émanence, indique que la permutation ne reste pas à sa place dans l’espace ou le lieu
d’une permutation à sa place : il indique l’être-en souffrance-de-soi, l’ex-position hors de
la sphère – l’eucyclos sphaira – d’une transcendance vers l’autre. Il indique donc une ex-
position qui n’est pas passage à l’autre, mais passage à l’impassable qui « dans » ce
passage n’est pas transcendance, mais le transcender sans transcendance et, donc, ex-
cédance en un sens qui est peut-être proche de Lévinas mais qui reste, d’une manière
muette, différent.
23 Dans la phrase, « la médiation ne médiatise rien », il est d’abord dit que rien ne sort de
la médiation, du partage et du commerce de l’avec ; qu’il n’y a pas de substance pré-
existante ni de sujet présupposé de la médiation, mais seulement une médiation
immédiate et instantanée ; et que la médiation est celle d’un être toujours déjà
médiatisé et qu’en ce sens, elle est tout et le Tout. Mais puisque cette phrase, comme
d’innombrables autres phrases d’Être singulier pluriel, affirme l’exclusion rigoureuse
d’un rien hors du processus médiatisant, elle dit aussi, nolens volens, que ce processus
médiatise cette in-substantialité et cette non-subjectivité, et donc ce qui ne peut être
médiatisé : elle médiatise la co-inexistence ou l’in-coexistence. La médiation ne médiatise
rien, cela veut donc dire aussi bien : La médiation médiatise rien.
24 Dès ses premières pages, Être singulier pluriel se pose la question de l’origine du monde,
de sa création, et comme elle n’autorise aucun recours à un monde pré-existant, à une
substance ou à un sujet, cette question devient celle de l’origine ou de la création ex
nihilo. La réponse tombe, semble-t-il, sans équivoque : « Le nihil de la création est la
vérité du sens, mais le sens est le partage originaire de cette vérité » 14. Ce qui est
partagé, distribué et communiqué dans le medium de l’avec est donc un nihil qui ne
serait pas une quantité ou une étantité négligeable ; il n’est pas un étant parmi d’autres
étants, ni l’étant d’un être passé ou à venir dans la modification négative d’un non-
étant, mais le rien de chaque étant et donc le rien de chaque être comme de chaque
être-avec. Ce nihil est ainsi caractérisé par ceci qu’il ne connaît aucun complément,
aucune correspondance et aucune consistance qui le lierait à soi-même ou à un autre
et, par-là même il ne connaît rien qui soit de la nature de l’unité ou de l’être-ensemble.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
28
25 C’est pourquoi le me on a été le scandale absolu de la pensée au moins depuis
Parménide. C’est pourquoi également son questionnement n’a jamais reçu de réponse
satisfaisante. Du rien, on ne peut dire ce qu’il est, car de lui on ne peut dire qu’il est, et
même la dénégation qui pourrait lui être opposée n’est qu’un dérivé et une simulation
du non-être. Le nihil de la creatio ex nihilo ne peut donc “être”, d’une manière
excessivement aporétique, que le nihil de la création elle-même, un nihil ex creatione. Il
ne peut pas précéder la création comme la friche de l’être possible, telle que les Grecs
l’ont pensée en la nommant hyle et chora plutôt que topos. Il doit être un Rien-avec-la-
création et cette création doit être une création-avec-rien, donc une création avec le
sans-avec et par suite une dé-création ou ex-création. Être singulier pluriel s’approche de
cette pensée dans la phrase que nous venons de citer et dans celle qui la suit :
« Le nihil de la création est la vérité du sens, mais le sens est le partage originaire de
cette vérité. Explosion du rien, en effet : espacement du sens, espacement comme
sens et circulation »15.
26 Le monde n’est donc pas création ex nihilo, mais explosio nihili : le rien « est » le simple
un-hors-de-l’autre qui fait qu’il y a quelque chose. Ainsi ce que Platon nommait chora,
Thomas diffusio et distributio, Heidegger spatialisation et é-loignement est maintenant
caractérisé comme espacement, c’est-à-dire comme espacement du rien, puis avancé
comme espacement du sens, espacement comme sens. Avec cette transmutation du rien en
sens, en chaque sens, ce rien est certes passé sous silence, mais il reste silencieusement
conservé dans le sens comme événement espaçant et temporalisant du nihil. Nihil est
donc interprété non pas comme le rien compact du nihil negativum, imaginarium ou
rationis, mais comme le nihil originarium étendu et s’étendant par le partage d’un être-
avec structuré. L’être-avec est ainsi d’abord et toujours l’être-avec-le-non-être, avec-
sans-avec : il est – rien, l’événement sans l’être.
27 S’il peut donc être question d’une première association, c’est que celle-ci émerge de la
dissociation et avec elle, et elle ouvre un monde dont le sens premier et résistant doit
être le maintien et la multiplication du rien. Le désert croît, mais qu’il croisse, qu’il
s’étende dans l’espace et le temps et le langage, c’est cela qui le fait d’abord être désert.
L’inversion de la phrase de Nietzsche rapproche plus de la vérité – et peut-être de la
vérité dont Être singulier pluriel parle : le croître se désertifie. L’extension anéantit. L’un-
hors-de-l’autre offre d’abord la possibilité d’un autre, mais cependant de telle sorte que
les autres disparates se comportent les uns avec les autres comme des modes de l’un-
hors-de-l’autre. L’un-hors-de-l’autre singularise, mais il singularise le Nihil.
28 Contre la doxa ontologique et méontologique, il n’y a jamais au commencement un
Néant unique et singulier, mais toujours une pluralité de néants ou de riens singuliers
qui ne tiennent pas en soi ou simplement ensemble : ce sont des extensions de l’étendre
qui ouvrent les dimensions de l’être-avec ; non pas toutes les dimensions, mais plus que
toutes, car la propagation de cet anéantissement ne peut être qu’infra-singulière et
ultra-universelle. Le me et le ouk sont aussi, ce qu’Aristote ne dit pas, dits de plusieurs
manières : légetai pollachos. Autant pour l’être, autant pour le néantiser. Autant pour
l’être-avec, autant pour le néantiser-avec. La tournure qu’Être singulier pluriel utilise aussi
souvent, « la totalité de l’étant » ou « les étants en totalité », appartient certes depuis
l’Antiquité à la tradition bien établie de l’ontologie. Mais à présent elle rend justice au
mouvement ex-créatif contre la genèse, à l’exogénèse de cet étant, ou encore à la
structure de la tradition, aux transmutations de nihila sans permanence. Ils sont à
chaque fois plus et moins qu’eux-mêmes, ils ne connaissent donc aucune mesure, ils
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
29
sont par suite toujours trop peu, mais ils sont aussi toujours trop nombreux, puisqu’on
peut toujours dire d’eux qu’ils sont ou ne sont pas. Cette équation illusoire : autant
l’un… autant l’autre, bouge dans les charnières de ces « autant ». Dans le mouvement de
l’altération immédiate, il ne peut jamais venir d’« autant » qui ne serait pas déjà
dépassé et tout autant manqué : l’équation s’effondre donc. Avec elle s’écroule
l’inégalité qui compare un « trop » et un « pas assez » en supposant la possibilité
catégoriale d’une juste mesure. Ce qui demeure, c’est seulement le non-demeurer du
mouvement sans mesure de l’être-avec comme être-avec-rien. Puisque cet avec-rien
appartient non sans ambiguïté à la sphère du logos, il ne se donne que comme Mutum :
non comme voyelle, mais seulement comme consonante, comme consonne occlusive ou
explosive et donc finalement comme zone de silence. Ce qui reste doit être l’explosion
du rien, en effet. La mutation de l’avec avec les Muta.
29 Penser la création comme explosion du rien n’est pas une idée passagère qui se serait
inscrite dans les marges d’Être singulier pluriel. Six ans plus tard, dans Ex nihilo summum
(2002), on peut lire un passage qui évoque une politique sans sujet en s’appuyant sur la
formule de Bataille, « La souveraineté n’est RIEN » : « Le souverain ne peut pas être un
père – ou bien le père doit être la personne même du rien (rien ou “personne ”, c’est la
même “chose”) »16. Il faudrait étudier dans tous leurs détails le tiret (silencieux) de
cette phrase, le « ou », le « ou bien » et les innombrables gestes de pensée structurés de
la même manière dans d’autres textes, pour saisir plus précisément comment une
alternative se transforme en une altération fondamentale : une réécriture, ou une
mutation de ce qui a été dit tout d’abord. Pas un père – ou bien le père la personne même du
rien. Le père, prototype du passage de l’oikos à la polis, du domus à la civitas, de la sphère
privée à la sphère publique, d’Aristote jusqu’à Hobbes et Hegel, devient dans cette
phrase la personne du rien. Comme la langue l’autorise, ce Rien s’avère n’être
personne, le rien et la personne de la souveraineté, le rien ni personne rassemblés sous
elle. C’est là la per-mutation et la père-mutation du rien. C’est son élévation et sa
réduction au mutisme. Les conséquences politiques de cette mutation du père sont
aussi diverses que contradictoires. La personne même du rien et par suite le souverain
ne peuvent être un simple Rien, mais uniquement un rien (s’) articulant à l’infini, donc
infiniment articulé, segmenté, multiplié. Tout un chacun, dans l’expansion perpétuelle
de sa pluralité interne et externe, est son rien, et ne peut faire autrement que de se
montrer et se retirer dans son être-rien. Chacun montre son retrait, chacun prononce
sa manière de se taire. C’est pourquoi la souveraineté d’un chacun et la souveraineté de
l’être-avec ne peuvent arriver que comme espacement. C’est pourquoi cette arrivée
n’est jamais concentrée dans un seul être singulier, réduit à une ponctualité rigide.
30 L’être-avec est par constitution ex-centrique. Comme il est dit dans Être singulier pluriel,
il est bizarre : bizarre, parce qu’historial ; historial, parce que son événement ne peut
trouver de forme ou de position établies. La politique souveraine et historiale de l’être-
avec – donc de l’être-avec-rien – doit être une politique de la mutation de toutes les
positions et personnes en positions et en « personnes du rien ». Elle doit être une
politique d’insurrection du rien : Ex nihilo summum la nomme, d’une manière moins
abstraite, mais pas moins susceptible de malentendu, révolte du peuple. En bref, elle doit
être la mutation de personne en ce quelqu’un qui « est » son être-personne. L’axiome
métontologique se formule ainsi : un ex nihilo vaut pour chacun dont on peut dire qu’il
est ou qu’il n’est pas. Par conséquent, pour chacun vaut également le fait qu’il est son
nihilum.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
30
31 Puisque l’événement de l’avec-rien n’est que venue et partance, il doit se présenter sur
le mode d’une venue de sa partance. Le rien, autrement dit, doit se montrer, le mutisme
se remarquer, serait-ce aussi par le retrait de toute marque. Ce qui est acted out dans
l’opération étatique de décapitation du monarque, dans la légende freudienne du
meurtre du père ou dans le mythe d’Acéphale chez Bataille sont des fantasmes ontiques
qui présupposent ce qu’ils sont censés expliquer ou régler. Le père doit déjà être mort,
le roi déjà décapité, le souverain n’être déjà rien, pour que la horde des frères puissent
le faire passer de vie à trépas. Ces mythes, ces légendes et ces opérations ne sont pas le
paradigme de l’apparition d’un rien : ils le recouvrent, et pourtant ils l’attestent dans le
même mouvement. Dans Summum ex nihilo, la structure de cette attestation est
caractérisée d’une manière claire et distincte :
« Ce qui est rien est ce qui subsiste en deçà ou au-delà de la subsistance, de la
substance et du sujet. C’est ce qui réalise ou ce qui réifie l’existence là où elle se
détache de sa propre position : là où elle excède la stance, la station et la stabilité de
l’étant. Ce point est son contact avec l’être qui la transit : c’est le point d’annulation
de la différence ontologique. Mais – ici culmine la réflexion – cette différence ne
s’annule qu’à s’aiguiser infiniment. C’est donc le point où l’existence existe comme
la mise en jeu de son être même »17.
32 Punctum saliens : le point en lequel l’être – non-étant, non-étant-avec – se réalise et se
solidifie en une chose étante, étant-avec, c’est précisément le point où elle s’arrête
d’être une chose et commence à s’ouvrir à son être, à son être-avec. La différence de
l’être et de l’étant, dite ontologique, et plus précisément métontologique, s’annule en
ce que Heidegger nomme un être étant dans l’Introduction à la métaphysique. Mais elle ne
s’annule que dans la mesure où l’être qui était assuré par là comme néantisant brise son
siège dans l’étant. Dans l’Introduction à la métaphysique toujours, le commentaire du
premier stasimon d’Antigone a donné à ce processus une caractérisation hautement
dramatique : « l’être-là de l’homme historial signifie : être-posé comme la brèche, dans
laquelle la surpuissance de l’être fait irruption en apparaissant, de façon à ce que cette
brèche se brise à même l’être ».
33 Ce qui se nomme brèche, chez Heidegger, se nomme point chez Nancy. Si chez l’un
l’apparaître de l’être – du non-étant – brise l’être-là, chez l’autre l’être du dasein est
« mis en jeu » en chaque apparition. Dans les deux interprétations, la différence
« ontologique » est annulée, car l’être-là l’est autant que son être. Dans les deux
interprétations, cette différence ne s’annule pourtant qu’à s’aiguiser infiniment, parce
que la brisure et sa menace deviennent la structure permanente de l’être-là historial.
Dans cette seule brisure, l’expérience n’est plus celle de l’étant, c’est à chaque fois, et à
chaque fois autrement, celle de l’être. L’être-avec ne fait pas exception à cette brisure
structurelle : tant qu’il est expérimenté comme être-avec, quelque communauté de cet
être-avec et des étants est mise en jeu et elle doit émerger, qu’elle soit point ou brèche.
Si l’on peut donc parler d’un être-avec-l’autre et d’Être avec l’Autre, d’être ensemble ou
d’être-avec, ce n’est jamais autrement que là où on ne peut pas en parler.
34 L’être étant n’est ni une tautologie ou homologie, ni un paradoxe épisodique : il n’est ni
le renforcement ni l’interruption passagère d’un ensemble donné, qui pourrait ensuite
être réparé. Il est plutôt l’aporie fondamentale et a-fondamentale telle quelle, qui
structure et déstructure chaque être de l’avec. Quand on parle, comme le fait Être
singulier pluriel, d’un contact [de l’étant] avec l’être qui le transit et de sa concrétude, alors
ce co- est en fait un « avec », mais qui ne repose sur rien, qui ne croît avec rien, ne tient
à rien qui lui corresponde. Rien n’est plus problématique que la correspondance au sein
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
31
de l’être-avec qui est suggérée par le co- ; rien n’est plus questionnable que la
communauté et l’universalité que ce co- affirme ; rien n’est plus douteux que la
concession selon laquelle c’est son être – donc son être propre – qui se trouve « mis en
jeu », comme le maintient Heidegger. L’être-avec est, car autrement il ne pourrait être
brisé, libre de correspondance, indépendant de tout consensus, sans concrétion. Avec
est à penser comme dérivé d’un d’avec, d’une différence d’avec…, même si c’est… rien. Il
est, et Être singulier pluriel le répète emphatiquement, incommensurable, même avec lui-
même.
35 Chaque co- est inchoatif, début d’une fin sans similitude. Quand la « différence
ontologique » s’annule dans l’aporie d’un être étant, elle s’annule dans un cercle dont le
milieu n’est pas seulement vide, mais dont chaque point est au point de rupture de la
circonférence. L’avec, en bref, marque la relation à l’absence de relation. C’est une
relation sans corrélation : c’est bien plutôt, sit venia verbis, une chora-relation ou une hors-
relation. Une différence, mais non une différence homo-onto-logique, ni une différence
qui se laisserait réduire à une differentia specifica entre deux classes d’entités singulières
de puissance différente ; bien plutôt, il s’agit d’une différence infra-singulière et ultra-
universelle qui, restant incommensurable avec elle-même, peut être caractérisée
comme differentia differentiae : une différence qui ne correspond pas à elle-même, mais
se brise et brise son avec. On pourrait tenter de penser ce rien comme minimum de l’é
tantité, sans pour autant le convertir en un étant, dans la mesure où l’on ajoute que,
même pour le calcul infinitésimal, il n’y a de minimum qu’à l’infini et que même l’infini
ne suffirait pas pour clore la différence métontologique.
36 Cette rupture de l’avec entraîne une suite de conséquences et d’inconséquences
respectives qui ne sont pas facilement compatibles avec certaines des thèses d’Être
singulier pluriel. On se contentera ici d’en repérer deux : l’une concerne la figure du
symbole et de sa symbolicité, l’autre la catégorie de l’être-tel. Dans le contexte de la
critique du situationnisme et plus précisément de celle qu’il a lui-même lancée de la
« société du spectacle », Être singulier pluriel juge que l’appropriation symbolique serait
seulement la version rétrécie d’une simple appropriation productrice et que le concept de
symbole serait détaché de la force ontologique, constitutive de chaque être-avec :
symbole, est-il remarqué, « au sens fort, c’est-à-dire lien de reconnaissance, instance
ontologique de l’en-commun »18. Plus loin, il est question d’une « révolution
copernicienne » – et peut-être co-père-nicienne – : précisément, celle « de l’“être
social” tournant désormais autour de lui-même, ou sur lui-même, et non plus autour
d’autre chose (Sujet, Autre ou Même) ». Il est dit, à nouveau à titre de définition :
« La vertu propre du symbolique est de faire symbole, c’est-à-dire lien, ajointement,
et de donner figure à cette liaison, ou de faire image en ce sens. Le symbolique est le
réel du rapport en tant qu’il se représente, et parce qu’en effet le rapport en tant
que tel n’est rien d’autre que sa propre représentation »19.
37 Toute une série d’affirmations sont faites sans équivoque : 1. l’être-avec est une figure ;
2. il est une figure représentante ; 3. il n’est pas une figure parmi d’autres, mais la
figure de la figuration ; 4. celle-ci est la seule figure de l’être-avec, en laquelle le réel,
l’imaginaire et le symbolique trouvent leur représentation identificatrice et donc leur
présentation originaire ; 5. l’être-avec est structuré comme symbole.
38 Cette supposition ne contredit pas seulement toutes les différences classiques entre la
figure et le figuré, et non seulement les distinctions lacaniennes : elle contredit d’abord
et surtout la conception de la structure en faille ou en brèche de l’être-là et de l’être-
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
32
avec, selon laquelle ils sont tous deux constitués non pas seulement par une différence
ontique, mais par une différence ontologique. Être singulier pluriel continue dans le
même sens en affirmant que la « société », entre guillemets, « fait symbole avec elle-
même, paraissant face à elle-même pour être ainsi tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle a
à être. […] Son unité est toute symbolique : elle est toute de l’avec. L’être social est l’être
qui est en paraissant face à lui-même, avec lui-même : il est com-parution » 20. Dans Urbi
et orbi, six ans plus tard donc, la même pensée s’amplifie et devient impérative : « Notre
tâche aujourd’hui n’est rien de moins que la tâche de créer une forme ou une
symbolisation du monde »21. De là vient l’exigence de créer un monde ou un monde de
l’avec dont chaque élément serait le complément pur de chaque autre, de telle sorte
que leur ensemble ou leur unité, tels qu’ils sont ou doivent être, aient la forme et
uniquement la forme du symbole. La correspondance à soi circulaire de l’être-avec dans
le cercle du symbole en lequel, comme le signale Être singulier pluriel, les amis se
« reconnaissent » les uns les autres dans leur séparation, n’est pas moins qu’une reprise
de l’eucyclos sphaira de Parménide, de la reconnaissance hégélienne et de l’homologie,
harmonie et correspondance de l’étant en son être affirmées par Heidegger. Elle
contredit la conception métontologique selon laquelle l’être – ainsi que l’être-avec –
n’est pas un étant, et elle ne tolère pas la réduction de la brèche et du point de
jaillissement à un simple agent de continuité entre co-étants.
39 Nancy parle dans ce contexte d’une tâche, d’une mission ou d’une exigence : cela peut
être lu comme le symptôme de la duplicité du symbole. Car exiger la symbolisation du
monde, c’est présupposer que sa structure fondamentale est donnée, connue et
reconnue, alors qu’elle ne peut être ni donnée ni reconnue en tant qu’elle est seulement
exigée et prévue pour l’avenir. Le symbole et avec lui l’auto-complémentation de l’être-
avec n’est donc jamais suffisamment symbole, la reconnaissance n’est jamais la
structure de l’être-avec. Le syn- ne suffit pas pour caractériser la structure du syn-. S’y
essayer a pour prix l’ontologisation de la substantialisation et de l’« étantisation » de ce
qui ne peut être ni étant, ni objet, ni sujet d’une ontologie. L’être-avec ne peut pas être
pensé autrement que comme Être-là-avec : comme partage d’un là qui n’est ni ibi ni ubi,
ni arché ni telos, mais là-vers un autre sans-lieu et au-delà dans un autre inoccupable.
C’est seulement ainsi qu’il est co-ek-sistence : comme non-coexistence et co-
inexistence22.
40 L’être-avec ne peut pas être structuré comme symbole. Même quand on pense l’avoir
saisi comme hyperbolique ou parabolique, il reste soumis à la mesure d’une figure
rhétorique ou d’une forme qui ne peut qu’échouer sur l’être-avec comme non-étant. Le
travail de Walter Benjamin, L’origine du drame baroque allemand, qui analyse le déclin du
symbole classique et classissiste tout comme l’essor de l’allégorie dans l’art, la théologie
et la politique modernes, culmine dans le chapitre conclusif « Ponderación misteriosa »
avec la vision d’une singularité absolue qui ne connaît aucune communauté avec
d’autres, mais uniquement une communauté inaccessible aux autres. L’emplacement
ouvert – surtout quand il est pensé comme ouverture à des emplacements –, l’ouvert
circonscrit par Heidegger dans son essai sur l’œuvre d’art 23, ne trouve sa
correspondance en aucune figuration, mais sa cor-respondance (Ent-sprechung)
seulement dans l’ad-figuration ou l’a-figuration : dans l’ouverture à la figuration, dans
la résistance envers la figuration (le a- de l’adversité) et l’adieu de la figuration. La
manière qu’a Heidegger de scinder l’équivalent allemand de correspondance par un
trait d’union, ent-sprechen, donne au moins un indice du fait que la signification de
« correspondre » ne peut lui être attribuée qu’à la condition que se fasse entendre avec
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
33
« correspondre » ce qui ne parle pas, mais se retire de tout parler. Le correspondre doit,
pour être tel, s’ouvrir à un non-parler. L’être-avec n’est pas l’être-un-avec-l’autre des
étants. Il « est » leur non-avec, un avec-rien. Aussi peu le rien de la res appartient-il à
l’ordre des choses présentes, aussi peu le reor du dire appartient-il au système du dit et
de la prédication. Il n’y a un « tel », et un « tel-que » comme constitutif du symbole,
qu’à partir d’un zéro : à partir de (ce qu’) il n’y a pas.
41 Ainsi l’on parvient à la seconde conséquence de la destructuration de l’être-avec : celle
qui concerne la catégorie de l’être-tel. La formule d’Aristote qui l’a découverte est le tó
tí én tò èkásto eínai : le « qu’était-ce pour être (comme tel) ? » (Métaphysique, VII, 4,
1029b 1-12). Cette formule aristotélicienne que ses commentateurs scolastiques ont
traduite par quod quid erat esse24 a été rendue par Ross en anglais par what was it to be so-
and-so et par Seidl en allemand, peut-être sous l’influence de Ross et de Meinong, par
Sosein (être-tel)25. Même dans sa version courte, tó tí én heínai, cette caractérisation n’est
pas par hasard une question ouverte et non une affirmation déterminée. Elle se
rapporte à ce qu’il nomme protè ousía, la première essence, et la désigne avec eínai
comme quelque chose qui maintient son passé (le én) dans l’actualité d’une mise en
question. C’est pourquoi Thomas la détermine comme actus essendi 26. C’est par
conséquent l’être actif, arrivant, d’un étant singulier, visé comme en tant que tel, donc
comme ce qui est dit de lui-même, légetai kath’ autó. Cela implique l’exigence que l’étant
lui-même, en soi, sans subordination à l’universalité d’un genre, sans propriété et sans
détermination supplémentaire, soit évoqué sans être nommé et sans perdre sa
singularité dans sa nomination.
42 L’être-tel de la surface ne consiste manifestement pas en ce qu’elle est une surface
blanche vu qu’il y a d’autres surfaces blanches. Son être-tel ne peut pourtant pas non
plus être dénommé comme étant-surface, car son être (entendu au sens verbal) ne
serait pas dénommé comme un étant et cet étant comme un être-étant et, donc, il serait
séparé de son propre advenir et ne serait plus saisi comme advenir de l’être-surface.
Aristote utilise le tabou constamment réitéré de la double prédication tautologique
pour réfuter cet échec à saisir l’être-tel : « cette énonciation […] est, pour chaque chose,
énonciation de son être-tel dans lequel cet être-tel est énoncé sans y être lui-même
contenu. » (Métaphysique, VII, 4, 1029b 20-21). Si l’être de la surface – ou du Bien, de
l’Un, de l’Être – était contenu dans l’énonciation de l’être, alors ce ne serait
précisément pas l’être de cette surface – ou du Bien, de l’Un, de l’Être –, mais, séparé de
cet être, un autre être que celui qui doit être énoncé ; et cet autre être serait à son tour
le thème d’autres énonciations possibles parmi lesquelles aucune ne pourrait énoncer
l’être-tel de la chose visée. La conséquence de cette régression ontologique à l’infini
qu’Aristote caractérise comme apeiron (1032a 3) serait la scission de l’être et de l’étant
et, par conséquent, la perte tout autant de l’être que de l’étant au profit d’un autre
indéterminé. La dissociation de ce qui est par rapport à ce qu’il est, c’est-à-dire la
division entre l’étant et son être : tò ónti kai tò ón [eínai] (1031b 1), devrait rendre
insaisissables l’être-tel et l’ousía de la chose singulière. Cette disparité ontologique ne
peut pas être supprimée par des harmonisations onomatistiques, car l’attribution d’un
nom à chaque fois particulier à un être à chaque fois particulier reviendrait
précisément à dédoubler cet être par le nom de cet être avec pour conséquence de ne
pas nommer cet être-tel particulier par une dénomination particulière
(1031b 28-1032a 3). Comme les noms au sens où Aristote les entend ne peuvent dire que
ce qui est commun à des choses homogènes (1040a 10 sq.), ils ne peuvent que manquer
l’être-tel de la chose particulière qui est visée. Si la formule qui interroge l’être-tel,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
34
« qu’était-ce pour être à chaque fois comme tel ? », doit maintenir la continuité par une
parenthèse temporelle entre ce qui était et ce qui est, alors ce maintien peut bien être
introduit par des noms, des concepts constitués de noms et des définitions opérant avec
des noms qui énoncent en effet ce qu’il y a de commun entre l’être au prétérit et au
présent. Mais, comme les noms communs ne peuvent qu’impliquer en même temps une
plus grande généralité que celle de la chose singulière dans sa durée particulière, l’être-
tel de cette chose singulière ne peut être énoncé ni par des noms, ni par des concepts,
ni par des définitions. Cette exigence, pour l’énonciation, de maintenir la continuité
avec soi-même de la chose à chaque fois singulière sans la dupliquer pour autant,
Aristote en tire la conséquence en soutenant qu’il ne peut pas y avoir de définition et
de preuve des choses singulières (1040a 2-3) et il en conclut que la généralité énoncée
n’est en rien substance : ton kathólou legoménon oudèn ousía (1041a 4).
43 Comme ni le général, ni le particulier ne sont capables de correspondre à l’être-tel,
l’être-tel ne peut apparaître que comme leur intermédiaire différentiel qu’Aristote
caractérise comme eidos, c’est-à-dire comme figure, forme, aspect : « j’appelle eidos
l’être-tel et l’essence première d’une chose (dans sa singularité et son unité) » (eidos dè
légo tò tí en einai ekástou kaì tèn próten ousían : 1032b 1-2). Cicéron ayant traduit le terme
grec d’eidos par species au sens d’aspect et de forme, cet usage a prévalu dans la
terminologie médiévale puis moderne : à la suite de quoi, l’être-tel de la chose
singulière n’est pris en considération que comme espèce ou variété d’un genre et le
singulier ne se distingue du général que par sa différence spécifique. Il en résulte la
difficulté suivante : malgré la définition aristotélicienne, l’ousía du singulier lui-même
n’est pas énoncée en son être-tel, mais bien plutôt elle est simplement énoncée de
manière plus précise et correcte en son eidos qu’en son genos. Aristote l’explique bien
plus clairement dans les Catégories que dans la Métaphysique : « l’espèce est plus essence
que le genre » (Catégories, 5, 2b 22). Plus essence et, par là, plus forme déterminée et
effectivité (voir Métaphysique, IX 8, 1050b 2), mais pas pour autant celle-ci, ni le
singulier dans son unicité. En bref, l’être-tel au sens de l’eidos ne désigne pas pour
Aristote l’étant singulier en son être. Il faudrait déduire à l’inverse que celui-ci n’est pas
ce qu’il était et n’entretient aucun rapport de continuité à ce qu’il a été, mais qu’il
advient toujours à nouveau et jamais selon un paradigme donné par avance. La
question tí hén einai, « qu’était-ce pour être à chaque fois comme tel ? », reste sans
réponse capable de généralité et sans réponse capable de singularité. Aristote a fourni
ainsi une définition de l’événement singulier de l’être, mais qui ne peut être appliquée
que d’une manière aporétique à cause de l’assimilation dogmatique de l’individu à l’
eidos. Tous ses arguments le montrent clairement : ce qu’il faut nécessairement dire
comme être singulier, et ce au début de l’ontologie pour que l’ontologie puisse valoir
comme ontologie et donc comme philosophie, cela ne peut tout simplement jamais être
dit comme il le faudrait pour que ce qui est dit corresponde à l’être-tel du singulier. Du
singulier, on ne peut dire que le non-singulier, et ce sur le mode d’une réécriture sans
original qui, pour sa part, ne peut être l’original d’une seconde réécriture. L’issue
ambiguë que le philosophe emprunte mène du légetai kath’ autó à l’analogie, donc à une
manière de parler qui se tient seulement « à côté », « à proximité », et pourtant aussi
dans une distance irréductible au dire de l’être-tel du singulier. L’être-tel, il faut le
concéder, ne se laisse pas dire comme tel, et se laisse encore moins définir, à moins
d’être manqué dans son être-tel et montré dans ce manquement. L’être-tel est, en bref,
seulement lui-même dans son autrement-qu’être-tel, ou comme être-tel-avec-un-autre.
L’être-avec ne peut être énoncé comme être-avec en soi ou comme ce qui peut être
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
35
nommé « être-avec », parce que la pluralité des êtres singuliers reste impossible à
exprimer si ce n’est par analogie : l’être-avec est désinstallé, surnommé, il mute et n’est
susceptible d’une adresse que dans le silence. Être singulier pluriel choisit une autre
explication pour cet être-tel en s’appuyant sur l’interprétation d’Agamben dans La
communauté qui vient :
« La pensée qui saisit l’être en tant qu’être rétrograde vers l’étant sans lui ajouter
une détermination supplémentaire […] : en le saisissant dans son être-tel, dans le
pur milieu de son en tant que, elle saisit la parfaite non-latence, la pure extériorité.
Elle ne dit plus quelque chose comme “quelque chose”, mais amène à la parole cet
en tant que lui-même »27.
44 Être singulier pluriel se met dans le fil de cette interprétation bien qu’elle soit à peine
compatible avec le questionnement d’Aristote et les thèses que l’on trouve dans
d’autres parties d’Être singulier pluriel. L’ouvrage parle sans prise de distance, en
s’inspirant de Mallarmé, de « la présence comme telle de chaque fleur en chaque
bouquet », pour en tirer la conséquence suivante :
« Toute parole amène à la parole cet “en tant que lui-même”, c’est-à-dire
l’exposition et la disposition mutuelle des singularités du monde […]. Le langage est
l’élément de l’avec comme tel : l’espace de sa déclaration – et celle-ci, à son tour
comme telle, revient à tous et à personne, revient au monde et à sa co-existence » 28.
45 Pourtant, s’il y a bien une « disposition mutuelle des singularités » (comme telles), il n’y
a pas de singularités sans que leur mutualité ne les généralise, ne les désinstalle, ne les
désingularise et ne les conduise au silence. La mutualité fait immédiatement de la
mutation un mutisme. Le mutisme des singuliers, de l’être-tel dans sa pluralité, ne peut
être amené à la parole, car il n’appartient à la parole que dans la mesure où il ne peut
lui appartenir.
46 La mutualité, si elle est dans un strict sens ontologique « comme telle », si elle peut être
nommée telle, introduit une mutation qui interdit peut-être même de parler du langage
sans se taire sur elle et à son propos. La tournure « amener au langage » qu’Être singulier
pluriel utilise avec Agamben à la suite d’Acheminement vers la parole de Heidegger ne
stipule pas que quelque chose (quoi que ce soit et avant tout le singulier), se retrouve
dans le langage ou débouche comme tel en lui, mais seulement qu’il est amené vers lui.
Cet acheminement au langage ne peut pas être lui-même d’un bout à l’autre langagier.
Il peut encore moins être le processus intégral ou la circulation tournante d’une
communication pleine de langage et de signification : il peut encore moins amener lui-
même comme tel à la parole, sans avoir toujours déjà sombré en lui, dans son élément,
dans son mutisme et, de cette manière, sans ne pas être. Le langage ne parle pas
autrement qu’en s’accompagnant de son silence structurel, donc de son mutisme : un
langage, qui est d’abord à dire, un chemin qui est d’abord à frayer, une mutation qui se
meut à la fois dans et contre le sens de ses Muta (« choses tues ») et de ses mutismes.
Même le katá du légetai kath’ autó indique un « envers… à » de la chose au langage et un
« vers… jusqu’à » du langage à la chose, qui n’atteint jamais son but dans un simple
« tel » ou « comme tel ». Heidegger note ainsi dans Contributions à la philosophie (de
l’avenance) : « L’essence de la logique est donc la sigétique », ou encore, « l’amuissement
a des lois plus hautes que toute logique ».
47 Cet « amuissement » dont parle Heidegger ne se trouve pas dans Être singulier pluriel
mais plus tard dans À l’écoute. On le rencontre, il ne pourrait en être autrement, comme
rencontre du langage avec soi : langage qu’elle n’est pas, vers lequel elle ne tend pas et
qu’elle ne signifie pas. Comme déjà Vox clamans in deserto, À l’écoute analyse les
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
36
conditions préalables de tout langage possible, donc qui puisse être compris comme
événement au sens intentionnel et phénoménologique. L’attention dans les deux textes
est dirigée vers la simple profération – le ton, la résonance, la voix – et par là vers
l’expérience du sens, entendu d’abord comme sens sensible, aisthesis, affecté par la
phasis et le kléos, et non par la noesis qui prendra sa source en lui. La question qui en
ressort ne concerne ni la sémantique, ni la couche sémiotique du langage, en laquelle
les significations, la structure des prédications et le contenu de la communication
trouvent leur genèse, mais la genèse qui précède cette genèse : la genèse de l’aisthesis
comme sens précédant tout sens noético-noématique, ou la genèse comme auto-genèse
du logos. L’argument est préparé par un résumé schématique de l’analyse qu’avait
proposé Granel du texte de Husserl, La phénoménologie de la conscience intime du temps. Il
s’énonce ainsi : dans le présent vivant saisi d’après Husserl en écoutant une mélodie,
l’unification du flux temporel et de ses moments différentiels « passé » et « futur » est
constituée par des actes de rétention et de protention de la conscience. Mais cette unité
même, le présent vivant de l’intentionnalité, ne peut être constitué que par une
différence intime, de soi-à-soi, s’il doit pouvoir se déployer en rétentions et en
protentions. Cette différence à soi est « oubliée » chez Husserl et cet oubli implique que
le présent vivant soit déjà lui-même le résultat d’une présentification. Dans la
terminologie de Heidegger, das Anwesende doit être le don des Anwesens ; dans la
terminologie de À l’écoute, le présent est le don de la présence. Si l’expérience du temps de
l’écoute n’est pas d’abord l’expérience de l’unité des différentes dimensions du temps,
mais l’expérience de leur différence, alors l’attention doit se tourner vers ce dont
l’intentionnalité phénoménologique se détourne : « le “retrait” originel de chaque trait,
unité et diversité, qui ne s’offre pas comme tel mais plonge au contraire dans ce que
Granel nomme “le Tacite” ou “la différence silencieuse qui fructifie en tout perçu” » 29.
48 Cette révocation du comme tel – donc aussi du comme tel de la première substance –
dans « le Tacite », dans le calme et le silence de la différence, indique une faiblesse
principielle qui ne concerne pas seulement la prima philosophia classique mais aussi la
plus récente, la phénoménologie, et ses concepts d’intention, de rétention et de
protention : une faiblesse n’exige pas moins que « la remontée outre-
phénoménologique – c’est-à-dire ontologique, toujours au sens où l’être y diffère
continûment de tout être-ici-et-maintenant [et] ne cesse de différer cette différence
elle-même »30. Ce qui se nommait précédemment differentia differentiae conduit donc
certes dans le silence d’une ultra- ou d’une outre-phénoménologie, mais qui est censée
rester un retour ontologique. Si pourtant la surdité de la phénoménologie trahit « une
anesthésie ou une apathie philosophique » ou « une anesthésie philosophante » 31, c’est
uniquement parce que le sens même, aisthesis, est comme sens différent de lui-même,
« outre-sens ou sens qui passe outre la signification »32. Dès lors, celui-ci n’exige pas
seulement une remontée outre-phénoménologique et outre-philosophique, mais également
une remontée outre-ontologique qui ferait retour devant le tò ón et son logos : retour
donc à une écoute du silence, de l’amuissement et du mutisme, à une écoute de ce qui
ne se laisse pas entendre comme tel, mais sans lequel on ne pouvait aussi jamais écouter
quoi que ce soit.
49 À l’écoute reste concentré sur la résonance comme archi-sonorité et comme
« transcendantal non sensible de la sonorité signifiante » et l’analyse de la résonance se
tourne en définitive vers la signification comme « renvoi du son à soi en soi », donc
vers le « cercle typiquement métaphysique » dont les protagonistes explicites sont
Schelling et Hegel. Mais chaque « renvoi du son à soi en soi » est expérimenté, dans le
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
37
même texte, non dans l’intentionnalité d’un « à soi en soi », mais dans l’ex-position et
« l’ouverture d’un corps » à d’autres corps, donc à autre chose qu’à des résonances
sensibles33. Il est certes question ici de « résonances mutuelles » (celle des
« Correspondances » de Baudelaire), mais aussi d’un « au-delà de l’accord ou de
l’harmonie » : cet au-delà dépassant ce qui, selon Heidegger, détermine la structure
fondamentale de la relation philosophique authentique, il est au-delà du philein, du
legein et de l’homologein. Si cet au-delà des résonances, correspondances, accord, harmonie
est limité à un au-delà du seul sens signifiant, et si l’archi-écriture de Derrida est
interprétée comme « une voix qui résonne »34, alors on n’est pas loin de penser que
l’écart propre à la différence outre-sensible est si rétréci, qu’elle n’est plus « différence
silencieuse » : le « Tacite », rappelé dans le même texte avec Granel, est « oublié ».
50 À l’écoute ne touche pas seulement au « tacite » et au silence, qui peuvent tous les deux
s’accorder avec des actes intentionnels. Il est aussi question du mutisme structurel,
non-intentionnel, même si ce n’est que sur ses bords, dans une note de bas de page et
dans un préambule qui porte pour titre Interlude : musique mutique. Dans ce préambule il
est écrit, sans autre commentaire : « Mutisme, motus, amuir, amuissement : celui du t à la
fin du mot “mot” »35. Ce t à la fin du mot ne s’entend pas. Il n’a pas de voix, ne résonne
pas, ne vibre pas, reste sans écho. Il n’a aucune chance de retentir en accord avec lui-
même, ni à retardement, ni comme son harmonique, même atonal ou disharmonique.
Le t muet peut bien avoir sa fonction dans le corps résonnant de la langue française,
celle que les linguistes appellent signe zéro, mais dans ce cas c’est une marque qui
fonctionne comme différence infra-sensible ou bien outre-sensible, qui n’est pas un son
et ne peut en suggérer un. Sans une telle différence aphone, il n’y a pas de langage
articulé, pas de musique, ni même de bruit, pas de silence significatif parce que voulu
ou susceptible d’être voulu, et qui aurait sa propre résonance. Un tel silence – sans sens
sensible ni intelligible – structure chaque dire, mais aussi chaque pensée, chaque
tentative de philein, legein, homologein, qu’elle appartienne au champ de la proto-
ontologie d’Héraclite ou de la prima philosophia. Sans ce qui ne se laisse pas entendre, et
qui donc n’est pas un étant, il n’y aurait rien – et aucun rien – qui pût donner la
moindre impulsion à penser ou à agir et encore moins à être.
51 De tels silences sont constitutifs et destitutifs pour le langage. Mais l’histoire et le
monde ne sont pas démentis parce que l’attention s’éloigne d’eux et se tourne vers leur
nomination, comme il arrive dans une note de bas de page du même texte. Il y est écrit
en deux questions aussi importantes qu’ambiguës :
« Et comment ne pas ajouter que le mot “mot” lui-même vient de mutum, qui
désigne un son privé de sens, le murmure émis en répétant la syllabe mu ? […] Si la
différence silencieuse se retire au sein de la musique, le son privé de sens ne se
retire-t-il pas au sein (mais non du sein) de la parole censée vouloir dire ? » 36
52 Même si les philologues auraient raison quand ils dérivent le mot « mot » de mutum et
mu, ils dérivent un son d’un autre son et ne le dérivent pas de l’ana- ou a-phénomène
du mutisme. Ils ne peuvent donc justifier qu’ils parlent d’un son privé de sens, bien que la
nécessité structurelle de quelque chose de non-sensible et de non-sensé interdise de
parler de privation. La différence silencieuse ne peut se mettre en parallèle avec un son
privé de sens, car chaque différence doit provenir de ce son, susceptible de prendre sens.
53 Or la question de Nancy portant sur le sens et encore plus sur le jeu qui s’instaure entre
sens, son, sensé, au sein et du sein, en particulier lié à l’outre de l’outre-sens ou au sens qui
passe outre la signification, ce qui « en jeu » dans À l’écoute s’en trouve indiqué. Cet outre
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
38
en effet, qui dans ce texte – peut-être consciemment, intentionnellement – est utilisé
avec une insistance et une intensité inhabituelles, est un mot qui prend sens dans et à
travers son contexte particulier. Dégagé de ce contexte, outre est le dérivé absolument
homophone de deux ou peut-être même quatre mots latins, qui selon toute apparence
sont à peine reliés entre eux, ne sont pas des « homologues » : ultra ou uter (sac de peau
de bouc), qui pour sa part entretient le plus étroit contact avec uterus (gastér en grec),
notamment avec uterus maternus, et d’une manière métonymique, avec sein ; ou encore
uter au sens de « l’un parmi deux », rejoignant aut (ou) et alter, l’autre. Sans aller plus
loin ici dans les intrications des différentes connotations et résonances de ce mot dans
À l’écoute (ni plus loin dans les raisons qui font que ce titre devrait peut-être être réécrit
pour devenir À l’écoutre), on doit souligner que l’outre-sens ou sens qui passe outre (le
sens), lequel exige une « remontée outre-phénoménologique et outre-philosophique »,
mène dans ce texte à l’hypothèse d’une « constitution matricielle de la résonance »,
d’une « constitution résonante de la matrice »37, plus loin à une auscultation du
« ventre d’une mère »38 et plus loin encore d’un « ventre qui s’écoute »39. Car : « qu’est-
ce que le ventre d’une femme enceinte, sinon l’espace ou l’antre où vient à résonner un
nouvel instrument, un nouvel organon […]. Mais, […] plus matriciellement, c’est
toujours dans le ventre que nous […] finissons par ou commençons à écouter. » Et
finalement : « L’oreille ouvre sur la caverne sonore que nous devenons alors » 40.
54 L’oreille ouvre, elle est une ouverture, l’ouverture – transitive, outre-passante – d’une
autre ouverture, celle du ventre ou de l’antre d’un autre ou d’une autre, et c’est
seulement comme une telle ouverture qu’elle est le commencement possible d’un nous,
qui peut pour sa part s’ouvrir à nouveau comme une oreille. Une oreille entend ce
qu’entendent d’autres oreilles. Mais – et cela demeure non-dit – l’écoute de cette oreille
ne peut pas s’entendre elle-même, l’oreille n’est pas l’organe d’une auto-affection
immédiate : dans toutes les relations que l’on peut expérimenter ou penser, elle est
toujours l’organe d’une relation à l’autre. La correspondance d’oreille à oreille,
également celle entre oreille, ventre ou antre, outre, caverne, sein, la résonance vibrante
d’un timbre, finalement la correspondance phonétique entre l’« or » de l’oreille, du
sonore et de l’alors (« L’oreille ouvre sur la caverne sonore que nous devenons alors »)
mènent à l’idée, infiniment suggestive, que l’oreille s’affecte elle-même et que l’utérus
se féconde par génération spontanée, ou se régénère. Elle suggère aussi la possibilité
d’identifier au niveau des principes l’un et l’autre, le père, la mère, l’enfant dans une
vraie fusion familiale. Cette fusion dans le « cercle métaphysique » d’une eukyklos
sphaira ne connaît pas d’autre, pas de quatrième terme, et surtout ne connaît pas d’
outre-sens, qui ne serait pas seulement un silence intentionnel, mais un mutisme
structurel.
55 Cependant, pour qu’une caverne puisse devenir une caverne sonore et un ventre qui s’
écoute, elle doit d’abord être cave, creuse, grotte sans sonorité. Elle doit être vide et ne
peut être une matrice. Cela ne signifie pas que ce cave devrait déjà être donné « de lui-
même » avant tout ton et avant tout avec, mais il faut bien qu’il le soit avec celui-ci, avec
ce sans-avec. Il faut que l’outre-sens soit l’outre de tout outre – au sens d’uter et d’uterus,
ses homophones. Il faut que la remontée outre-philosophique devienne une remontée
outre-matricielle, outre-résonante, outre-nous. Puisque nous veut dire : être-avec, il
faut abandonner l’anagrammatique cave de l’avec avec son être, pour pouvoir penser un
outre-être, un outre de l’être plus qu’un être de l’outre – un outre, en plus, sans génitif
et sans génération. Outrance et outrance : rien d’autre que le mouvement de l’être dans
sa différance, rien d’autre que le Mutum – ne serait-ce aussi que le minuscule t à la fin du
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
39
mot mot, un autre mot pour logos. N’outrance – ou n’oustrance : ainsi pourrait s’écrire,
dans le style de Finnegans Wake, le mouvement de l’être-avec et de l’être-nous au-delà
de l’avec, du nous et de l’être : écrire en séparant de sorte que le non-écrit et le non-
entendu puissent être lus, l’intervalle, les marques diacritiques, les Muta. Car même le
nous français ne se prononce qu’avec un s silencieux.
56 Ce Mutum doit, comme on dit, être motivé, mais motivé seulement par le langage, qui se
nomme lui-même en lui-même, et qui pourtant fait l’ellipse de lui-même dans ce qu’il
nomme et même déjà dans l’acte de nommer. Ces mutismes doivent pouvoir
accompagner, scander, traverser tout bruit, tout son, toute résonance audibles ou
possibles ; mais ils ne se font pas entendre, ils ne sonnent et ne résonnent pas eux-
mêmes et jamais qu’avec eux-mêmes. C’est pourquoi la consonantique des Muta est
d’une autre sorte que la contiguïté métonymique – ou metér-nymique : elle est, d’une
manière irréductible infra-contingente, comme ce que l’on appelle mort ou néant. Muta
n’appartiennent pas à l’ordre du phénoménal, mais au dés-ordre de l’aphanisis 41,
aphonisis, asemiose ou asomiose : elles sont, même si elles ne le restent pas toujours,
inouïes42.
57 L’urgence de penser un outre-être et un outre-être-avec telle qu’elle se profile dans À
l’écoute mais aussi dans des travaux antérieurs ou postérieurs de Jean-Luc Nancy,
découle forcément de la pensée que l’être-avec est être-avec-des-autres, qu’il ne peut
être-avec de tels autres que si ces autres sont incommensurables et ne partagent pas le
même avec, pas la même entente et pas le même sens de l’« avec » que les autres. Dans
la mesure où il est avec-des-autres-avec, l’être-avec doit donc être structuré de telle
sorte qu’il soit toujours aussi avec-autre-chose-qu’avec et a limine avec-sans-avec.
Néanmoins, la formule « avec-sans-avec » concède encore trop de force constitutive à
l’être-avec en ne laissant apparaître le sans-avec que comme modification négative de
sa co-existence. C’est que le sans doit nécessairement être compris dans un sens qui ne
marque pas seulement la privation d’un être-avec supposé primaire, mais qui soit, à
partir de l’altérité non-programmable de l’avec-autre-avec, comme un sans autre que
privatif ou affirmatif : il faut le laisser ouvert comme sans autre, autre-que-sans et, de ce
fait, comme incapable de détermination ; comme un sans qui n’opère pas comme sans et
ne peut être compris ni au sens d’un comme apophantique, ni au sens d’un comme
herméneutique, et encore moins au sens d’un comme si, pour pouvoir lui correspondre.
Il faut partir de cette correspondance du sans, de ce sans-sans-sans, afin de faire
l’expérience du sens de l’être-avec : nous ne sommes pas nous, mais bien plutôt exposés
au sans-nous en son être-sans, livrés au sans-être-avec et, de ce fait, complices d’un
non-ensemble non-délimitable et complices à partir de lui. Ce n’est donc pas à partir de
l’avec qu’il faut penser le sans-avec comme privation pesante bien que passagère : au
contraire, c’est à partir du sans-avec qu’il faut encore et toujours penser tout avec ainsi
que ses paramètres ontologiques. Ce tournant qui porte non sur l’être de la
communauté, mais sur son absence, reste depuis longtemps déjà à venir.
58 Il y a eu récemment quelques avancées dans cette autre direction, par exemple dans
Monsieur Teste de Valéry : « Ce sont des savants, des amants, des vieillards, des
désabusés et des prêtres ; tous les absents possibles, et de tous les genres. On dirait qu’ils
recherchent leurs éloignements mutuels. Ils doivent aimer de se voir sans se connaître,
et leurs amertumes séparées sont accoutumées à se rencontrer43 ». Dans Sein und Zeit
(1927), Heidegger déclare : « Comme possibilité absolue, la mort isole uniquement afin,
comme possibilité indépassable, de faire comprendre le pouvoir-être des autres à l’être-
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
40
là comme être-avec »44. Le commentaire exhaustif qu’exigeraient ces deux citations est
ici remplacé par un troisième passage qui est tiré de l’esquisse de postface que Georges
Bataille a rédigée en 1953 en vue d’une réédition de L’Expérience intérieure : « insister sur
l’idée de communauté négative : la communauté de ceux qui n’ont pas de
communauté »45. Ces trois passages notent une aporie insoluble. Ils parlent d’un avec
du sans-avec, d’un être-avec de ceux qui ne peuvent s’accorder un tel être-avec,
d’« éloignements mutuels » qui ne sont pas des déficits, mais les données imprévisibles
de tous les rapports « linguistiques » et « sociaux ». Le chemin, le chemin sans chemin
qu’ils ont frayé, leur diaporie, ne va pas dans la même direction que celui emprunté par
la philosophie depuis Aristote. Ce chemin ne peut être dit « retourner en arrière » que
dans le sens où cette direction est la seule à initier le mouvement qui est seul en mesure
de tracer un chemin.
59 Réécriture de la tradition ontologique : elle ne le deviendra que là où elle procède
comme écriture en arrière, effacement de l’écriture, cor-écriture ou, pour reprendre le
terme très expressif de Nancy, comme excriture. Dès qu’une parole est énoncée, elle est
exposée à sa cor-respondance ; dès qu’elle est pensée, elle est également co-pensée. Mais
les deux mouvements ne s’effectuent pas nécessairement de manière complémentaire.
Ce qui peut être compris comme mouvement contraire, inversion ou négation, n’est pas
nécessairement en corrélation avec un mouvement ou une position préalable.
L’éloignement, l’absoluité et la négativité dont parlent Valéry, Heidegger et Bataille, ne
sont pas secondaires et ils ne sont pas négatifs sans être par là même déjà positifs. Ils
pourraient être caractérisés comme ultra-négations ou infra-négations, car ils ne
posent et ne nient pas, mais ouvrent le champ qui rend possibles positions et négations,
qualifications et disqualifications, acceptations et refus. Ce qui est impliqué par
l’incommensurabilité de l’être-avec dans la parole, dans la pensée et même dans
l’élucidation de la pensée appelée philosophie, ce n’est pas la négation formelle du
parler, du penser et du philosopher, mais quelque chose qui échappe aux classements
généalogiques, étiologiques et plus généralement catégoriaux. « L’incommensurable
avec » dont parle Être singulier pluriel est la fin de l’ontologie, sans en avoir été pour
autant le but. C’est la fin de l’anèr philósophos tel qu’il est harmonieusement présenté
par Heidegger. Cette autre incommensurabilité est peut-être le début d’une outre-
philosophie qui ne parlerait pas un langage compact, univoque, clos sur lui-même, mais
parlerait de nombreux langages non coordonnés entre eux. Ceux-ci s’ouvriraient
encore à d’autres et à nul autre. Ce seraient des langages livrés au « peut-être » de leur
correspondance réciproque comme de leur correspondance avec un langage qu’ils
visent, mais qu’ils ne peuvent être.
60 Quelques phrases au début d’Être singulier pluriel parlent d’une telle relation, qui passe
d’une relation à la non-relation, qui est l’errance du passage, sans terme relatif – donc
libre d’elle-même, indépendante, inconditionnée –, d’un tel passage, d’une telle
transcendance, pourtant trans-sans-trans et donc impassible face à chaque évasion
transcendantale ou transcendante. Celles-ci interrogent une « pensée impossible,
pensée qui ne se retient pas dans la circulation qu’elle pense, pensée du sens à même le
sens ». Puis viennent des parenthèses : « (Comme, à l’instant où j’écris, un chat blanc et
roux traverse le jardin, emportant ma pensée avec la sienne, d’un glissement
moqueur.) »46 Ce chat entre parenthèses n’est pas un chat qui se soumet aux conditions
de l’objectivité : c’est un chat de tout un chacun, qui est son être-personne et son être-
rien, un chat du pas d’être, du sans-sens, un chat de la parole et du non-parler. Il ne
tient pas et ne se tient pas, il glisse. Il marque, démarque et se moque en même temps,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
41
toujours, « au moment où j’écris ». « Mund, comme le dit À l’écoute en plusieurs langues,
mouth – mucken, mokken, mockery, moquer. »47 Le t de ce chat aussi est muet.
61 Du mutisme dans le langage et hors de lui, du « peut-être » d’un langage et d’autre
chose encore, parle un poème de Paul Celan qui a été publié pour la première fois dans
ses écrits posthumes. Il porte le titre MUTA. On ne peut le traduire en français, parce
qu’il est déjà partiellement écrit en français. À la différence de Seul, qui ouvre ce
poème, ce qui suit avec sa dernière lettre muette est au pluriel. Non seulement on ne
peut le traduire, mais on ne peut pas non plus le prononcer entièrement. Ce premier
Seul est, ainsi est-il écrit, parlé à trois et, donc, il n’est pas seulement adressé par les
trois, mais aux trois : probablement à une femme, à son enfant et à celui qui parle lui-
même, lesquels forment ensemble une triade familiale. Néanmoins, l’archer dont il est
ensuite question, « tendu dans le peut-être d’une parole », est dirigé vers ce peut-être
comme vers cette parole une comme quatrième instance qui pourrait aider les trois
autres et donc celui qui parle à trouver une parole : une parole dont n’aurait pas disparu
le peut-être, le peut-être dont ils pourraient être redevables de permettre au Seul
singulier de muter en un Seuls pluriel à même son mutisme 48.
MUTA
Seul – : zu dreien gesprochen, stummes
Vibrato des Mitlauts.
Seuls.
.................................................................
Ein Bogen, hinauf
Ins Vielleicht einer Sprache gespannt,
aus der ich, souviens-
t-en, – aus der ich
zu kommen
glaubte. Und
une corde (eine Saite, eine
Fiber) qui
répondrait.
BIBLIOGRAPHIE
BATAILLE Georges, Œuvres complètes, V (La Somme Athéologique), Paris : Gallimard, 1973.
BENJAMIN Walter¸ Gesammelte Schriften, II, 1, Frankfurt : Suhrkamp, 1977.
CELAN Paul, Die Gedichte aus dem Nachlass, Frankfurt : Suhrkamp, 1997.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Die Phänomenologie des Geistes [La Phénoménologie de l’Esprit],
Hamburg : Hoffmeister, 1952.
HEIDEGGER Martin, Holzwege [Chemins qui ne mènent nulle part], Frankfurt : Klostermann, 1950.
HEIDEGGER Martin, Was ist das – die Philosophie?, Pfullingen : Neske, 1956.
HEIDEGGER Martin, Einführung in die Metaphysik [Introduction à la métaphysique], Tübingen :
Niemeyer, 1966.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
42
HEIDEGGER Martin, Sein und Zeit [Être et temps], Tübingen : Niemeyer, 1986.
HEIDEGGER Martin, Gesammelte Werke [Œuvres complètes], Frankfurt : Klostermann, 1989.
LACAN Jacques, Écrits, Paris : Seuil, 1966.
NANCY Jean-Luc, Être singulier pluriel, Paris : Galilée, 1996.
NANCY Jean-Luc, La Création du monde ou la mondialisation, Paris : Galilée, 2002.
NANCY Jean-Luc, À l’écoute, Paris : Galilée, 2002.
SEIDL Horst, Aristoteles’ Metaphysik, I [La Métaphysique d’Aristote], Hamburg : Meiner, 1989.
VALÉRY Paul, Œuvres II, Paris : Gallimard, 1960.
NOTES
1. M. HEIDEGGER, Was ist das – die Philosophie?, p. 13.
2. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, p. 38.
3. M. HEIDEGGER, Was ist das – die Philosophie?, p. 21.
4. Id., p. 23.
5. Cf. id., p. 18.
6. J.-L. NANCY, À l’écoute, p. 57.
7. Cf. J.-L. NANCY, Être singulier pluriel, p. 20.
8. G. W. F. HEGEL, Die Phänomenologie des Geistes, p. 154.
9. J.-L. NANCY, Être singulier pluriel, p. 113.
10. Idem, p. 22-23.
11. Idem, p. 118.
12. Idem, p. 118-119.
13. Cf. idem, p. 98.
14. Idem, p. 21.
15. Ibidem.
16. J.-L. NANCY, La Création du monde, p. 167.
17. Idem, p. 159.
18. J.-L. NANCY, Être singulier pluriel, p. 71.
19. Idem, p. 78-79.
20. Idem, p. 80.
21. J.-L. NANCY, La Création du monde…, p. 59.
22. Lacan, dont Nancy se distancie dans le passage cité, a entrepris dans son Discours de Rome
(1953) en suivant de près les analyses de Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss, sans parler de la
référence à Heidegger, de rendre justice à cette structure de la « coexistence » en la caractérisant
par l’absence d’usage de l’« objet symbolique ». Les hirondelles de mer forment déjà un groupe
du fait qu’elles ne mangent pas le poisson qu’elles se passent de bec en bec. Dans le champ de
l’humanisation, cette absence d’usage s’est, selon Lacan, radicalisée en ce que la parole parle d’un
absent et à un absent et que les structures sociales constituées par la parole supportent cet
absent comme « trace d’un néant ». Ce qu’il appelle l’« ordre symbolique » n’est pas un ordre de
complémentarité symbolique, mais l’ordre d’une impossibilité structurelle – et de l’incapacité
psychique qui en résulte – d’accorder exactement les parties d’un symbole les unes aux autres.
S’il y a bien quelque chose comme une « trace d’un néant », alors les langues et sociétés humaines
sont caractérisées par un Avec-l’impossibilité-d’un-avec. Dans l’usage que Lacan fait ou non de
son concept, le symbole est un antonyme. L’imaginaire, et donc tout le domaine de la figuration,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
43
sert au refoulement, à la dénégation et au rejet de l’impossibilité d’un être-avec consistant avec
soi. Voir Jacques J. LACAN, Écrits, p. 272, p. 276, p. 279.
23. M. HEIDEGGER, Holzwege, p. 41 sq., Chemins qui ne mènent nulle part, p. 59.
24. C’est le cas chez Thomas D’AQUIN, De ente et essentia, 1, 30-34. Après avoir constaté que le nom
de l’essence a été transformé par le philosophe en nom de l’être-tel (quiddité) : nomen essentie a
philosophis in nomen quiditatis mutatur, il poursuit : et hoc est etiam quod Philosophus frequenter
nominat quod quid erat esse, id est hoc per quod aliquid habet esse quid. Dans la traduction de Franz Leo
BEERETZ : « Et celle-ci est également ce que le philosophe appelle fréquemment ce par quoi était
l’être, c’est-à-dire que l’être est ce par quoi quelque chose a de la quiddité » (Stuttgart, 1979, p. 7).
25. Dans le passage ici discuté du premier livre de la Métaphysique d’Aristote sur la substance, il
n’y a pas pratiquement pas de phrase dont l’interprétation fasse l’unanimité parmi les
commentateurs. Le concept central de tò tí en einai passe pour certains d’entre eux pour
« l’expression la plus obscure pour ne pas dire la plus grotesque de la conceptualité
aristotélicienne » (H. SCHMITZ, Aristoteles. Kommentar zum 7. Buch der Metaphysik, Bonn, 1985, p. 13).
En plus des explications qui sont apportées par les contributions recueillies dans Metaphysik. Die
Substanzbücher (éd. Christof Rapp, Berlin, 1996), voir en particulier l’étude subtile de Friedrich
BASSENGE, « Das tò heni einai […] und das tò tí en einai bei Aristoteles », in : Philologus, n° 104 (1960),
p. 14-47, p. 201-222, tout comme l’article « to ti ên einai » de Jean-François C OURTINE et Albert
RIJKSBARON dans Vocabulaire européen des philosophies (éd. Barbara Cassin, Paris, 2004 ;
p. 1298-1304). L’interprétation dont les grands traits sont esquissés ici n’est redevable à aucun de
ces commentaires.
26. Cf. le commentaire de Horst SEIDL in : Aristoteles’ Metaphysik, vol. 1, p. 387.
27. J.-L. NANCY, Être singulier pluriel, p. 112.
28. Ibidem.
29. J.-L. NANCY, À l’écoute, p. 41.
30. Idem, p. 43.
31. Idem, p. 59, p. 60.
32. Idem, p. 59.
33. Idem, p. 55-57.
34. Idem, p. 69.
35. Idem, p. 47.
36. Idem, p. 43.
37. Idem, p. 72.
38. Idem, p. 79.
39. Idem, p. 82.
40. Idem, p. 72-73.
41. Le concept d’aphanisis a été proposé par Ernest Jones pour préciser le concept freudien de
castration et réutilisé par Lacan. Il est ici employé, comme on le voit, dans un sens élargi.
42. Cet inouï, l’inauditus, l’inaudible, jamais-entendu, hors du commun, joue dans La Communauté
désœuvrée de Nancy un double rôle bien particulier. D’une part, cela caractérise l’« exigence de la
communauté » dont il est dit « qu´elle nous est encore inouie, qu’elle nous reste à découvrir et à
penser » et même que la promesse de l’œuvre communautaire manque déjà « le “sens” inoui de la
“communauté” » et, par suite, que « rien n’est encore dit, nous devons nous exposer à l’inouï de
la communauté ». D’une part, cet inoui caractérise la structure fondamentale de toute société,
c’est-à-dire son caractère linguistique et même social, selon un modèle qui ne peut taire son
origine dans la conception hégélienne de l’extériorisation immédiate. Car, c’est l’argument, tout
discours expose (manifestement au sens d’une extériorisation) le dedans au dehors, sans lequel
dehors il n’y aurait pas de dedans. La parole n’est donc pas un moyen de partager, mais ce
partage et la communauté de ce partage. D’après cet argument, la communauté ne peut jamais
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
44
être manquée, elle ne peut pas être une promesse vide, puisqu’elle advient toujours déjà en tant
qu’« exposition » (au sens d’extériorisation) « jusqu’au silence » et, à vrai dire, comme le précise
une parenthèse : « (pareille à ce mode du chant des Eskimos Inuits, qui font résonner leurs cris
dans la bouche ouverte d´un partenaire) ». Inouï ou Inuits, ce n’est pas ici la question, car ils
doivent être le même et pourtant incompatibles. La Communauté désœuvrée, Paris, 1990, p. 59-60,
p. 68, p. 77. La tension entre les arguments hégéliens et heideggériens traverse presque tout le
corpus des travaux de Nancy.
43. P. V ALÉRY, Œuvres, t. II, p. 35. (C’est Valéry qui souligne absents dans « tous les absents
possibles ».)
44. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, p. 264. (souligné par WH)
45. G. BATAILLE, Œuvres complètes, t. V, La Somme athéologique, p. 483.
46. J.-L. NANCY, op. cit., p. 22.
47. Idem, p. 48.
48. Le poème de Celan est publié dans Paul C ELAN, Die Gedichte aus dem Nachlass, p. 63. Voir à ce
propos ma contribution au recueil paru en hommage à Stéphane Mosès : « HÄM. Ein Gedicht
Celans mit Motiven Benjamins », in : éd. Jens Mattern, Gabriel Motzkin, Shimon Sandbank,
Jüdisches Denken in einer Welt ohne Gott, Festschrift für Stéphane Mosès, Berlin, 2000, p. 177-178 et,
en particulier, passim le problème du Muter compris en tout et en aucun sens. En outre, je me
permets à propos du motif d’une relation sans relata de renvoyer à W. H., Entferntes Verstehen, par
ex. p. 10, p. 24, etc. Concernant le complexe du Avec-sans-avec sur lequel je suis revenu par
ailleurs de manière assez approfondie dans Was zu sagen bleibt (non publié), j’indique les
réflexions perspicaces et importantes de Marcia Sá Cavalcante Schuback dans le volume qu’elle a
édité sous le titre Being With the Without (Stockholm, 2013), ouvrage sur lequel Irving Goh a attiré
amicalement mon attention pendant la rédaction du présent texte.
RÉSUMÉS
L’essai se confronte à la nécessité de rendre plus précise et, par là même, de transformer la
notion nancyenne d’être-avec-les-autres. C’est seulement s’il implique un être avec les autres qui
ne puisse jamais appartenir à aucune communauté que l’être-avec-les-autres se présente comme
la relation absolue et absolument indissoluble : la relation de toutes les relations qui est
immédiatement une relation dont le corrélat n’est pas donné. Selon la structure infra-négative de
cet être-avec-sans, les communautés ne peuvent se soumettre à des systèmes « symboliques », ni
être saisies « comme telles » par elles-mêmes ou par les autres, ni se présenter ou se représenter
elles-mêmes dans un corpus philosophique. L’être-avec-les-autres est l’être-sans que l’on appelle
« philosophie ».
The essay deals with the necessity to render more precise and thereby transform Nancy’s notion
of being-with-others. Only if it implies a being with others which remains unable to belong to any
community, being-with-others presents itself as the absolute and absolutely undissolvable
relation: the relation of all relations, which is at once the relation to no given relatum. In
accordance with the infra-negative structure of this being–with–its–without, communities are
unable to be aligned with “symbolic” systems, unable to be grasped “as such” by themselves or
by others, unable to present or represent themselves in a philosophical corpus in which its
reasons resound. Being-with-others is the being-without what is called “philosophy”.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
45
AUTEUR
WERNER HAMACHER
Université de Francfort
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
46
L’âme à la lettre – mutation de
l’entre-deux (autour de Jean-Luc
Nancy)
Marcia Sá Cavalcante Schuback
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1 Il y a des œuvres qui sont formatrices. Elles le sont parce qu’elles aident à donner une
forme à l’âme. Il y a d’autres qui sont animatrices, au sens qu’elles donnent vie aux âmes
plus ou moins formées. En fait, il faudrait mieux dire qu’une « œuvre animatrice » est
celle qui anime l’âme, c’est-à-dire qui donne âme à l’âme, [plus ou moins] formée. La
différence entre « œuvre formatrice » et « œuvre animatrice » n’est pas une opposition,
mais une interaction : en donnant âme à l’âme, l’âme se forme ; de même que, en se
formant, l’âme reçoit de l’âme, l’âme s’anime. Cette différence qui apparaît dans un
rapport d’interaction se laisse plutôt décrire comme une différence d’intensité. Former
l’âme et donner âme à l’âme sont des degrés d’intensité dans une transformation.
Parler d’âme formée, de forme animée, d’âme et forme intensifiées c’est en fait parler
de transformation. Et c’est bien autour du rapport entre âme et forme que les
philosophies de la transformation se sont élaborées, de Platon et Aristote aux
Romantiques, de Kant, Goethe et Nietzsche aux philosophies contemporaines du
devenir et de la plasticité, même quand au mot « âme » se sont substitués ceux d’esprit,
force, vie, désir, dynamique, possibilité, etc.
2 Dire que les philosophies de la transformation se sont élaborées autour du rapport âme
et forme, c’est reconnaître l’« animisme » de ces philosophies. Pour comprendre
l’animisme de la transformation au cœur des philosophies de la transformation, il faut
envisager comment l’idée de transformation est tributaire d’une doctrine de l’âme dont
la matrice est la reformulation donnée par Platon à une tradition mystérieuse,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
47
orphique de l’âme. Dans cette matrice doctrinale, l’âme – psychè – a été comprise
comme la source d’une formation transformatrice et d’une transformation formatrice
que l’on appelle « vie ». Ainsi, quand le Socrate de Platon définit la philosophie comme
« soin de l’âme » (épiméleia tès psychès)1, il se réfère au soin de la source et du principe
de vie selon lequel la vie se forme en se transformant et en se transformant garde la
forme de sa propre transformation. Décisive dans la doctrine platonicienne de l’âme est
cette « vie des formes » comme la seule forme de la vie, où ce qui se forme ne se forme
qu’en se transformant, c’est-à-dire en devenant autre. Mais la condition du devenir
autre, et donc du fait de se transformer, est de garder la forme de la transformation et
ainsi de rester le même. En ce sens, Platon parle de « l’un se différenciant lui-même »
(to hen gar […] diaphéromenon hauto), formule qu’il attribue à Héraclite dans le Banquet 2. Il
parle aussi bien de métempsychose, dont la signification première est l’âme se
différenciant elle-même en formes multiples plutôt qu’un passage de l’âme d’un corps à
l’autre, selon la compréhension commune. Et il pense à l’idée, à la forme, en termes
d’un rapport entre génos et eidos, genèse et aspect, formation et forme. En tant que
principe d’une formation par transformation qui garde la forme de sa transformation
dans toutes ses formes, en tant que l’un se différenciant lui-même, en tant que
mouvement disons « métempsychotique », l’âme est un « mouvement qui se meut lui-
même », comme le dit Platon dans les Lois3. En se mouvant soi-même, l’âme se
différencie elle-même, se retrouvant dans toutes les choses. C’est ce que reconnaît
Aristote lorsqu’il dit que « l’âme est (en) toutes choses » (hè psychè ta onta pôs esti
panta)4. Comme ce mouvement « métempsychotique » ou animiste de la transformation
garde ce sens de transformation dans toutes les transformations, tout peut bien se
transformer, sauf la transformation elle-même. Ainsi compris, le vocabulaire de la
transformation, son économie – de la métabolè à la transsubstantiation, de la
transfiguration à la métamorphose – reproduit ce sens non-transformé de la
transformation dans toutes ses variations et toutes ses nouvelles formations. En ce
sens, Aristote a reconnu dans la Physique qu’« il ne peut y avoir ni un mouvement du
mouvement, ni une genèse de la genèse, ni un changement du changement » (ouk esti
kinéseos kinèsis oude généseos génésis, oud’ holôs metabolè metabolès) 5.
3 Cette économie de la transformation qui ne s’est pas laissée transformer au long de
l’histoire de l’Occident suppose, d’une part, une archi-téléologie du mouvement, et de
l’autre une typographie du mouvement, pour reprendre l’expression de Lacoue-
Labarthe6. Transformation signifie passer d’une forme à une autre et garder un rapport
avec la forme précédente juste en passant de l’une à l’autre. Et même quand Goethe
propose de transformer cette économie métaphysique de la transformation avec son
concept romantique de métamorphose, il ne fait que le garder encore plus
intensivement, car sa compréhension de forme se formant, forma formans, ne réussit pas
à transformer l’idée animiste de transformation. Passer d’une forme se formant et se
mouvant à une autre forme se formant et se mouvant est toujours passer d’une forme à
l’autre, en suivant le sens archi-téléologique et typographique de la transformation.
Passer de l’organique à l’inorganique, de l’inorganique à l’organique, d’un organisme à
l’autre, c’est toujours passer de…à. Ce qui ne passe pas est ce sens de passer et passage,
comme venant d’un lieu pour aller à un autre et cela en reproduisant le mouvement de
formation. De cette manière, le principe de transformation se garde in-transformé,
justement par et dans ses incessantes transformations. En fait, « un mouvement qui se
meut soi-même », est un « moteur qui ne se meut pas », ou kinouménon kinei : c’est pour
Aristote la conséquence inévitable de la définition platonicienne de l’âme du monde.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
48
Ceci vaut également pour la pensée de la métamorphose, car « la métamorphose elle-
même ne se métamorphose pas », ou metamorphoseoumenon metamorphosei. Tout ce qui a
été pensé en termes de transformation et métamorphose, ancré sur l’ancienne doctrine
platonicienne de l’âme, Marx l’a reconnu des siècles après comme la physico-chimie du
capitalisme moderne, de plus en plus claire dans notre monde mondialisé. Car le
transformateur de tout – le capital - ne se transforme pas. Une transformation qui
transforme tout avec la plus grande vélocité et ubiquité ne fait que garder in-
transformé le principe de transformation. Nous vivons l’époque d’une constante
transformation, l’âge du statu quo de la transformation, en laquelle la transformation de
tout partout et tout le temps ne produit que l’équivalence de tout avec ce principe in-
transformé de transformation.
4 Bien des philosophes aiment à dire que l’Occident européen s’est compris comme
philosophia, au sens socratique du « soin de l’âme ». Cela reviendrait donc à dire qu’il
s’est compris comme seuil du soin d’une source et d’un principe de vie, comme ce qui
transforme tout, sauf la forme de cette transformation. Si l’Occident européen est le
seuil – le cap, le siège, le lieu, la scène, l’écran – d’une pensée de l’identité et de l’unité,
de la permanence et de l’essence, ce n’est que dans la mesure où il pense la
transformation comme le pouvoir de tout transformer sauf la transformation elle-
même. L’Occident européen est plutôt la forge d’une idée puissante de transformation
elle-même impuissante à se transformer. C’est ce qui devient de plus en plus clair
lorsque l’Occident européen se mondialise, cherchant en tout et partout des nouvelles
formes pour garder son principe de transformation, son âme, in-transformé. C’est en
relation à cette impuissance à transformer le sens puissant de la transformation, qui
définit l’Occident européen, que j’entends la demande de ce colloque sur les
« mutations – autour de J.-L. Nancy ».
5 L’insistance de J.-L. Nancy sur les « mutations » autour de nous, à notre époque
comprise comme « mutation de civilisation » et « mutation du temps », ne montre sa
radicalité que si on comprend par là la mutation d’une civilisation forgée et forgeant
cette idée animiste de transformation. Il en découle d’une part l’impuissance de toute
philosophie de la transformation à saisir ce qui se passe, à appréhender ce qui nous
arrive, et d’une autre, l’expérience que ce qui nous arrive et se passe fait signe vers un
régime tout autre que celui de l’animisme de la transformation. La « Mutation » de la
civilisation et du temps signifierait donc que cette civilisation ne se reconnaît plus dans
le langage de la transformation, mais n’a pas d’autre langue pour dire ce qui se passe.
Faudrait-il donc parler en termes d’une transformation de la transformation, d’une
métamorphose de la métamorphose, d’une métempsychose de la métempsychose et
ainsi multiplier à l’infini les miroitements du régime animiste de la
transformation jusqu’au point entropique de son évidement et de son épuisement ? La
pensée de J.-L. Nancy propose une voix et une voie tout autres : ni donner un autre
sens, ni pousser le sens vers son évidemment. Il propose le défi d’une pensée de la
mutation qui touche à la source de cet animisme de la transformation – de cette
performance de l’âme se transformant elle-même pour garder la transformation elle-
même in-transformée. Touchant à la source de cet animisme, cette pensée de la
mutation n’est pas une pensée de la transformation de la transformation mais une
pensée de la touche d[e l]’âme.
6 Pensée de la mutation, pensée de la touche d[e l’]âme : on pourrait dire qu’il est
question d’une mutation de l’âme, comme si l’âme avait changé d’âme, par analogie
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
49
avec les mues d’un serpent. Cette mutation de l’âme n’est pas la perte de sens de l’âme
que d’habitude on rapproche non seulement à notre époque mais à la modernité de
toutes époques. Valéry revenait souvent dans ses Cahiers sur le délaissement où se
trouve la notion d’âme. Il note ceci : « L’âme : donner un sens à ce vieux nom du
souffle »7. Les deux points situés après « L’âme : » marquent non seulement une
interruption du sens, mais indiquent aussi que le mot « âme » et l’expression « donner
un sens à un vieux nom du souffle » ont le même sens. Valéry cherche à donner un sens
à ce vieux mot de souffle, et ainsi à transformer son sens de manière à le garder. La
pensée d’une mutation de l’âme – telle qu’on l’apprend avec Nancy – est tout autre :
c’est une pensée touchée non seulement par l’interruption de l’identification entre
« âme » et « donner un sens » mais aussi par l’interruption de la machine interprétative
qui travaille pour donner et redonner du sens au donner du sens. Dans sa mutation,
l’âme ne donne pas du sens. Elle ne fait pas le travail de l’esprit qui est de souffler la vie
aux lettres, tel que l’a voulu toute une tradition de Saint Paul à Fichte et jusqu’aux
herméneutiques contemporaines. C’est un tout autre sens du sens qui apparaît dans
cette mutation de l’âme. Car il ne s’agit pas d’une absence de sens, soit par manque ou
par exténuation du sens, soit par aliénation ou par excès de sens, soit par folie ou par
fétichisme du sens, une absence qui pourrait être reprise ou surpassée, oubliée ou
révélée, formée ou transformée. Il s’agit tout autrement d’une âme-sens, du souffle d’un
sens qui n’est pas au-delà des vieux mots ou de la lettre, mais qui est simplement l’être
en train d’être, le ‘est’ en train d’être « est ».
7 C’est ce que le thème de l’extension de l’âme dans la pensée de J.-L. Nancy cherche à
formuler. Car « l’extension », traitée sous l’inspiration de la note posthume de Freud –
Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon, « Psyché est étendue, n’en sait rien » – veut dire
l’étendue du « est » en train d’être. Cette étendue, cette extension, n’en sait rien. Ce
thème se reconnaît lui-même comme extension ou étendue de ce que Heidegger a
essayé de penser comme la « transitivité de l’être »8, ce qui revient à dire que « l’être
est l’étant », que « ce qui se transmet c’est l’acte d’être, c’est l’actualité de l’existence :
que l’existant existe », comme le propose Nancy dans Le Sens du monde 9. Cet acte (ou
actualité) ne doit pas être compris par opposition à la puissance ou à la possibilité mais
comme « l’être est étant », comme « l’est » en train d’être « est ». C’est dans ce sens que
l’extension de l’âme en tant qu’étendue et extension de l’être en train d’être, n’en sait
rien. Elle ne sait rien qui puisse être mesurée par une topo-chronologie, par des
chronotopes ou même par une entropie, rien qui puisse être conçu comme distension
ou contraction, gonflement ou évidement. Elle n’en sait rien parce que toutes ces
mesures de mouvement et de savoir supposent une « intériorité », un « dedans », un
« soi-même », qui seraient-ils décrits comme forme archétypique ou comme essence,
resteraient tout à fait étranger à l’être en train d’être. En fait, comment penser un
dedans de l’être en train d’être, c’est-à-dire de l’âme ainsi mutée ? On a appris depuis
des siècles que l’âme peut entrer et sortir du corps et ainsi qu’elle se trouve dans le
corps. L’âme a été le concept même de l’intériorité : l’âme du monde, l’âme des vivants,
l’âme de l’homme, l’âme comme ce qui bat et pulse dans le monde, dans les vivants,
dans l’homme, tel un cœur. En portugais, au lieu du mot « cœur » pour dire cette
intériorité de l’âme, on peut dire âmago, un autre mot provenant d’âme, pour le dedans
des choses.
8 Tout autre que cette idée de l’âme intérieure, de l’intériorité de l’âme, est le sens de
l’âme comme extension et étendue. J.-L. Nancy insiste sur le fait que l’âme n’est que le
corps en tant que dehors, en tant qu’ouvert. Car l’ouvert, l’extase, le dehors appelé
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
50
« corps » n’est aucun point, soit-il mouvant ou vivant, rien de fermé et resserré sur soi-
même, aucune auto-concentration impénétrable, sédimentée et substantielle telle une
« tumeur » selon la suggestion d’Augustin ou une « masse », un amas comme l’a élaboré
la pensée moderne. L’ouvert, le dehors, l’extase appelée « corps » n’est que le « sentir
se sentant ». Pas une intériorité qui sent mais un sentir se sentant, un « ça » pousse. La
difficulté de dire, penser, décrire ce sentir se sentant, ce sentir en train de sentir réside
dans cette impossibilité de le reconduire à un dedans qui sent, à un dedans capable
d’engendrer ou donner un sens. Pour souligner cette impossibilité de recourir à une
pensée de l’intériorité, du sujet, de l’essence, de l’identité, J.-L. Nancy insiste sur l’« ex »
d’« extension », « exposition », « extase », « exil », « excription », « expropriation »,
parmi d’autres expressions. Mais l’ex de toutes ces expressions ne dit pas seulement le
dehors du dehors, le dehors sans aucun dedans ou l’ouvert sans aucune fermeture ; ce
qu’il dit surtout c’est le son soufflant de l’est en train d’être, un son qui s’entend sonner,
un son se sonnant, un son sonnant. Dire, penser, décrire cette extension et étendue de
l’âme, de l’en-train-d’être n’est possible qu’en étant à l’écoute 10. La pensée de la
mutation est une pensée de l’être à l’écoute – et c’est de l’écoute, dans une écoute, en
écoutant qu’il devient possible de dire, penser, décrire « la mutation » sans faire usage
de la pensée animiste de la transformation. Car en étant à l’écoute, on fait l’expérience
d’un pas et d’un passage sans origine et sans destin, sans avant et sans après, sans
même une « destinerrance » ou une « fugue errante » – car écoute n’est qu’écoute du
son sonnant, du sentir se sentant, de l’est en train d’être « est ». Écouter c’est entendre
l’étendue de l’âme. Ainsi l’ex, si souligné, si écrit, s’entend comme on regarde en lisant
la lettre x, un croisement ou chiasme de sens, en même temps ici et là, avant et après,
division et participation, déconnection et comptage, un et autre. C’est l’ex de la
résonance du sens, c’est-à-dire du son qui s’entend sonner, du son sonnant, l’ex de la
saisie de l’insaisissable de l’être en train d’être, de l’être qui est étant.
9 Dans ce croisement chiasmatique – en rien fantasmatique – dire la transitivité de l’être
en termes de l’être est étant, c’est faire résonner l’être est temps, deux expressions qui
dites à haute voix en français ont du mal à se distinguer. Être étant, être temps – la
différence entre étant et temps, – tellement décisive pour Heidegger si on la dit en
allemand [das Seiende und die Zeit] – dit cependant en français elle-même qui dans son
même est un autre, dit « étant est temps », il est le temps étant, il est en train d’être est.
Il ne s’agit ni d’une nouvelle formation ni d’une transformation du sens, ni d’une
métamorphose ni d’une transsubstantiation du sens mais de l’expérience que « l’être se
sent…être », et que « c’est là le sens même »11. Il s’agit du temps étant, du sens se
sentant, du son sonnant, de l’entente s’entendant. J.-L. Nancy dirait plutôt qu’ici nous
avons affaire à une « révolution du sens » qui n’est que le « présent même du temps »,
du « maintenant », qu’il fait revenir au sens étymologique du « tenant à la main » :
cadeau, « présent » du temps étant. Pourtant demeure en question l’écoute, non de l’un
se différenciant lui-même, mais du même-autre12 du « maintenant »13, du même-autre du
temps présent, du temps étant, de ce qui se passe et arrive. La difficulté de cette
entente du même-autre, est la difficulté de toute écoute : celle de distinguer l’autre dans
le même sans les séparer en deux, car le son, le signe, le chiffre sont les mêmes. C’est la
difficulté de distinguer « l’équivalence insignifiante » – où tout devient n’importe quoi
– et la « signifiance égalitaire, singulière et commune » de chacun, pour reprendre les
formules de la Création du monde14. C’est la difficulté d’entendre que « le sans-raison
puisse prendre la double face du capital et de la rose mystique qui représente la valeur
absolue du sans-raison »15. La question est que les sons, les signes, les chiffres de
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
51
l’équivalence générale de tout et tous, de l’équivalence marchande « catastrophique »
qui atomise des « sujets », sont les mêmes qui rappellent et appellent à « l’égalité des
incommensurables », au « communisme de l’inéquivalence », pour suivre les
discussions rapportées dans l’Équivalence des catastrophes 16. Il faut entendre ainsi
comment la « valeur » – aujourd’hui réduite absolument à la valeur monétaire et
monnayante fait elle-même entendre l’estime, comment la réduction de tout et tous au
principe intransformé de la transformation par lequel tout n’est rien de manière à
pouvoir devenir n’importe quoi afin d’être utilisé par n’importe qui, n’importe où et
n’importe comment – comment cette réduction fait elle-même entendre que les
« “singuliers” […] ne sont pas des individus ni des groupes sociaux mais des
surgissements, des venues et de départs, des voix, des tons – ici et maintenant, chaque
fois »17. Il s’agit de saisir dans le même son, le même signe, le même chiffre, le même-
autre du temps et de l’étant, de la valeur et de l’estime, de l’équivalence et de
l’inéquivalence égale de chacun, de la finalité sans fin(s) (au double sens de fin et
finalité) et du sans-raison de l’en train d’être chacun, où chaque chose et chacun se
présente non comme chose ou comme l’abstraction d’une unité individuée mais comme
une « venue », une « approche ». La révolution du sens serait ainsi l’écoute du même-
autre du maintenant, de ce qui se passe et arrive. Cette écoute du même-autre est
l’écoute d’une tension entre deux « tables » de sens, qui les tient ensemble en les
laissant séparées, tels ces petits morceaux de bois dans les instruments à corde qui,
mettant en communication les deux tables de l’instrument, leur permet de sonner, ces
petits morceaux de bois qu’on appelle aussi techniquement « âme ». Écoute de la
tension de l’entre-deux, cela veut dire : écoute, regard, pensée, écriture attentive à
cette tension, au même-autre, à l’est en train d’être est – à ce qui n’a pas de forme ou
figure qui puisse être « saisie » comme un étant. Cette écoute du même-autre – « à
hauteur du présent »18 – regarde, pense et écrit plutôt comme une touche, comme le
tracer d’être en train d’être19. Il ne s’agit plus d’une écriture de la trace mais d’un tracer
du tracer – peut-être d’une réécriture, qui serait plus proche d’une esquisse. L’esquisse
est plus – ou si on veut, moins – qu’un ouvrage non achevé ou un ouvrage « où les
figures, les traits, les effets de lumière et d’ombre sont indiqués par des touches
légères », comme le propose la définition de Littré. L’esquisse est plutôt un tracer du
tracer, un mouvement où des figurations et configurations sont laissées et où en étant
laissées des configurations s’ébauchent. Au moment où la demande d’un sens du
monde, de la création du monde, est plus que jamais convulsive, impliquant d’une part
une exigence de configuration et de l’autre l’exigence de faire résistance à toute
figuration/présentation d’un corps souverain, à toute la figuration/présentation « des
identités indexées sur le sang, le sol, et le soi » 20, la question de la figure, de la forme, de
l’idée se voit bouleversée car nous nous retrouvons devant la demande d’une
configuration sans figure, d’une forme sans forme21, ou pour rappeler une autre
formulation dans Le Sens du monde, la demande d’un « nouage » ou même d’un nuage
« de sens de cela qui n’a pas de sens identifiable » 22. Parler de configuration sans
figuration, de forme sans forme serait insuffisant car ce qui est en question est plutôt
un tracer du tracer – une esquisse (traduction la plus juste d’Entwurf, mais peut-être
aussi la plus proche de l’anglais drawing qui dit justement tirant, traçant), où le pas est
lui-même passage, où la main tenant le mouvement ne peut le faire que dans la mesure
où elle est elle-même mouvementée par ce mouvement. Ce qui est en question, plutôt
que le temps d’être, c’est plutôt le temps de l’en train d’être, de l’apparaissant. Dans
l’esquisse, qui trace le tracer, on « apprend à désapprendre », comme le dit un vers de
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
52
Fernando Pessoa, les sens figés de l’étant et du temps ; nous faisons l’expérience du
temps étant, du temps étant esquisse et rythme du sens en train de se sentir, du son en
train de sonner, du dire en train de dire, du penser en train de penser. Être à l’écoute
du temps étant – maintenant, présent – du présent des venues et des approches, du
murmure de tant des personnes, de lieux, de souffrances, de passages, de migrations, de
strates de formation et dis-formation, de réfugiés de toutes sortes de violence – c’est
être à l’écoute de l’âme s’efforçant d’être âme, de l’âme à la lettre, que J.-L. Nancy a
entendu comme n’étant qu’un murmure, « âmmmmm » : un murmure à la lettre, le
murmure d’être en train d’être23 ; « âmmmmm », lettre de l’âme.
10 Pour « conclure », il faudrait dire que la pensée de la mutation révélée par J.-L. Nancy
et que je propose ici de comprendre comme une pensée de l’en-train-d’être, se
détourne des pensées catastrophiques et de celles du désastre, des pensées fondées sur
une « méthode apocalyptique », au sens où elles se fondent et se forment sur une
vision-désir de la fin d’un monde de sens. Si, dans une certaine mesure, on peut
reconnaître que l’histoire de la philosophie est l’histoire des propositions du sens par le
moyen d’une méthode apocalyptique, selon laquelle le sens – vrai, juste, nouveau, réel,
possible – ne se laisse révéler que vis-à-vis de la fin d’un monde de sens et d’un sens du
monde, il faut bien distinguer la méthode de Nancy de l’histoire de la philosophie. Sa
pensée de la mutation trace un tout autre sens de la méthode. Dans un texte intitulé
« la méditation de méthode », il approfondit la pensée de Bataille sur la méthode en
tant que méditation en la libérant de toute idée de méditation comme intériorité
fusionnelle où le sujet et l’objet deviendraient un24. Loin d’une médiation ou d’une
fusion intérieure, la méthode est une méditation plutôt au sens de « mouvement par
lequel le vrai se fraye son passage selon les inflexions, les attentions et les passions de
chacun qui médite ». La méditation de méthode est plutôt « en acte » qu’un acte, car
elle est « une démarche effective et concrète où le corps s’engage autant que l’âme, où
l’âme témoigne au mieux de cette étendue qui, selon Descartes, est la sienne et la
dispose en toutes les parties du corps. Elle est la pensée en son acte de peser – selon son
étymologie – c’est-à-dire aussi bien de soupeser la chose (l’être, le sens, le vrai) que de
s’appesantir sur elle, en elle »25. Il s’agit d’une méthode sans méthodologie, une
méthode sans méthode, car ce qui est en question c’est non pas l’accès au sens et à sa
vérité mais le se laisser saisir par la circulation du sens, le sens qui « se fraye des
chemins toujours neufs et toujours reparcourus ; leurs interruptions, leurs
enfouissements au fond des bois, des océans, des galaxies ou des cœurs, leurs suspens et
leurs effondrements sont autant de points véridiques, autant de naissances et de morts
qu’en compte l’immensité d’espace-temps devant ou plutôt dans laquelle un vertige
nous prend – un vertige de vérité, de la vérité et infiniment plurielle. Pour comprendre
cette méthode sans méthode de la circulation du sens, cette « méditation de méthode »,
il vaudrait mieux parler d’une mét(h)ode, d’une méta-ode. La mét(h)ode de Nancy est
celle d’une voix-voie, d’une pensée écho-mouvante, un chemin esquissé par le dire-
écoute, par une écoute elle-même disant où le sens gérondif d’être en acte ne se laisse
plus saisir comme un ou des actes mais comme une touche d’âme. Il s’agit en fait de
l’ode de la pensée, du son touchant de l’âme, du corps, de la vie, devenant pensée pour
la vie. La mét(h)ode de pensée de J.-L. Nancy est celle de l’entente de l’âme à la lettre.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
53
BIBLIOGRAPHIE
ARISTOTE, De l’Âme, Paris : Les Belles Lettres, 1966.
ARISTOTE, Physique, Livres V-VIII, Paris : Les Belles Lettres, 1931.
BORGES Jorge Luis, L’Auteur et autres textes : El hacedo, traduit de l’espagnol par Roger Caillois, Paris :
Gallimard, 1965.
GARRIDO Juan-Manuel, La Formation des formes, Paris : Galilée, 2008.
HEIDEGGER Martin, « Was ist das – die Philosophie? », in : Identität und Differenz, Gesammtausgabe Bd.
11, Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2006.
LACOUE-LABARTHE Philippe, Le Sujet de la philosophie : Typographies 1, Paris : Flammarion, 1979.
LACOUE-LABARTHE Philippe, L’Imitation des modernes : Typographies 2, Paris : Galilée, 1985.
PLATON, Apologie de Socrate, Classiques en Poche, Paris : Les Belles Lettres, 2003.
PLATON, Œuvres complètes, Le Banquet, Paris : Les Belles Lettres, 1989.
VALÉRY Paul, Cahiers, Paris : Gallimard, 1987.
NOTES
1. PLATON, Apologie de Socrate, 29e.
2. PLATON, Banquet, 187a.
3. PLATON, Lois, 895a-896d.
4. ARISTOTE, De l’âme, 431b21.
5. ARISTOTE, Physique, 225b 15-16.
6. Ph. LACOUE-LABARTHE, Le Sujet de la philosophie : Typographies 1 et L’Imitation des modernes :
Typographies.
7. P. VALÉRY, Cahiers, p. 157.
8. M. HEIDEGGER, « Was ist das – die Philosophie ? », p. 14.
9. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 47.
10. J.-L. NANCY, À l’écoute.
11. « Être se sent et se sait être : on peut bien dire que c’est là le sens même », J.-L. NANCY, Le Sens
du Monde, p. 58.
12. L’expression même-autre ici proposée se trouve proche de ce qui a été pensé par Jorge Luis
Borges lorsqu’il nous rappelle dans son Art Poétique que « L’art est encore pareil au fleuve
interminable / Qui passe et qui demeure et qui reflète un même / Héraclite changeant, qui est à
la fois même / Et autre, tout comme le fleuve interminable », in J. L. BORGES, L’Auteur et autres
textes : El hacedor.
13. Conférence sur « Le présent du temps », donnée par J.-L. Nancy à l’Universidad del Norte au
Mexique, le 23 octobre 2015 dans le cadre de l’Encuentro Internacional de Filosofia y Estudios
Literarios.
14. J.-L. NANCY, La Création du monde ou la mondialisation, p. 51.
15. Idem, p. 53.
16. J.-L. NANCY, L’Équivalence des catastrophes (Après Fukushima), p. 68-69.
17. Idem, p. 69.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
54
18. J.-L. NANCY, La Création du monde ou la mondialisation, p. 17.
19. « Fragment d’un monde dont la matière est le frayage même ou la fractalité des fragments,
lieux et avoir-lieux. Aussi le tracé de cette signature est-il toujours un corps, une res extensa en
tant qu’extension – aréalité, tension, exposition – de sa singularité », J.-L. NANCY, Le Sens du monde,
p. 98.
20. Idem, p. 188.
21. Pour une étude approfondie de la forme sans forme voir J.-M. GARRIDO, La Formation des formes.
22. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 188.
23. J.-L. NANCY, À l’écoute, p. 47.
24. Ce texte est paru d’abord dans une traduction brésilienne : cf. « Meditação de método », in : Alea.
Estudos Neolatinos, vol. 15, n° 2, 2013, Rio de Janeiro. En français, il a été publié sous le titre
« Méthode et vertige », Conséquence n° 1, 2015.
25. Ibidem.
RÉSUMÉS
Cet article présente une discussion sur la pensée de la mutation chez Jean-Luc Nancy, elle-même
une mutation des idées philosophiques traditionnelles sur la transformation. Il entend montrer
que devant le sens intransformé de transformation dans la tradition philosophique de Platon à la
philosophie contemporaine, Jean-Luc Nancy ouvre une autre voie lorsqu’il comprend
transformation plutôt comme touche de l’âme. Loin de soumettre la mutation à une arche-
téléologie des significations, la pensée de la mutation, une pensée de la touche de l’âme, trouve le
sens de la mutation dans l’« en train de se faire », plutôt que dans la quête de forme et de
figuration. C’est dans la mutation du sens de l’entre-deux compris comme « en train d’être », que
le sens d’une mutation de sens se donne à voir dans son non-figuration. Par-là, on découvre dans
la pensée de Nancy non plus un autre sens d’âme, mais comment l’âme du sens touche le monde.
This article presents a discussion about the thought of mutation in Jean-Luc Nancy, understood
as a mutation of traditional philosophical ideas about transformation. It proposes that, facing the
untransformed meaning of transformation in the philosophical tradition from Plato to
contemporary philosophy, Jean-Luc Nancy opens another path, when comprehending
transformation rather as a touch of the soul. Far from subscribing mutation to an arche-teleology
of meanings, the thought of mutation, a thought of the touch of the soul, finds the sense of
mutation rather in the is-happening than in the search for form and figuration. It is in the
mutation of the in-between, understood as the meanwhile of the is-being, that the mutation of
senses appears in its own non-figuration. Thereby it is possible to discover in the thought of
Nancy not another meaning of the soul but how the soul of the sense touches the world.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
55
Le désir du monde Jean-Luc Nancy
et l’Éros ontologique
Boyan Manchev
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1 La question du désir se pose selon l’exigence d’une érotique philosophique. Jean-Luc
Nancy introduit le thème ou plutôt la notion d’érotique philosophique dans « Nudité »,
l’ouverture de La Pensée dérobée : le syntagme « érotique philosophique » apparaît elle-
même dans une note en bas de la page 18, « renvoyant à ce qui fut dit plus haut de
l’érotique philosophique ». Il s’agit ici de beaucoup plus que d’une note de passage
lançant un concept prometteur, voire potentiellement explosif : mon hypothèse de
départ est que dans le corpus de l’œuvre de Nancy il existe un noyau de limites
incertaines, secret mais déterminant, déterminant secrètement la prolifération
conceptuelle et thématique qui s’effectue dans son œuvre à partir des années 1990. Ce
noyau est un corpus ou plutôt une nébuleuse érotique : ce qui fait du corpus un corps
(et ce n’est aucunement un hasard si le livre central de cette « nébuleuse » ne porte
autre titre que Corpus)1. Non, il ne s’agit pas simplement d’un nombre d’œuvres traitant
de thèmes érotiques, donc introduisant le « domaine » de l’érotique en tant qu’objet de
la philosophie, tout à fait légitime d’ailleurs ; il s’agit d’essais, de livres où l’érotique
apparaît en tant que modalité dominante – des ouvrages où l’érotique s’invite ou plutôt
se déploie, s’éclôt en tant que modalité de la pratique philosophique stricto sensu. Non
pas comme objet, mais comme mode philosophique si j’ai recours à la distinction de la
Poétique aristotélicienne. L’érotique en tant que modalité de la pratique philosophique,
en tant que sa manière ou son caractère donc, son ethos.
2 Cette nouvelle modalité mobilise rétroactivement et reconfigure dans un nouvel
horizon une grande partie des rapports conceptuels et des enjeux philosophiques des
œuvres nancyennes des précédentes décennies.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
56
3 L’hypothèse de ce texte va se décliner donc en trois phases qui détermineront les trois
parties de mon exposé :
1. Le désir sera approché d’abord comme force constitutive de la philosophie : la pulsion de la
pensée philosophique, son élan, philein, ou bien son excès même ;
2. ensuite, le désir sera abordé comme une force ontologique : comme désir du monde ;
3. pour aboutir enfin à la question : Quel rapport entre le désir de la philosophie et le désir du
monde ? S’agit-il d’un mimétisme structurel ? La volonté philosophique se greffe-t-elle sur la
volonté du monde ?
Le désir en philosophie et le désir de la philosophie : le
cas de Nancy
4 L’« ouverture » de La Pensée dérobée, « Nudité », est ouverte par un paragraphe de
Christian Prigent, modulant la fameuse phrase de Bataille, qui apparaît en exergue du
livre – « Je pense comme une fille enlève sa robe » :
« La libre variation de Christian Prigent sur une phrase où Bataille s’efforça de
capter l’élan de sa pensée module la double tonalité de cette phrase, ou les deux
aspects de sa fièvre : une gaieté, une allégresse, et une tension douloureuse. Ce
double ton est celui du désir, en général, et il est donc aussi celui du désir de la
pensée, ou plutôt de la pensée comme désir, autrement dit de ce que depuis presque
deux millénaires nous autres Occidentaux auront nommé “philosophie”. »
5 Et, deux pages plus loin :
« L’instant et le geste de la robe qui tombe forment l’expérience qui, dès qu’elle a
lieu, ne cesse de se répéter, et dont la répétition est elle-même, identiquement, le
désir et la vérité – vérité du désir et désir de la vérité, philosophie qui d’elle-même ne
peut que passer outre elle-même, c’est-à-dire encore désirer et penser, penser
comme désirer. Hors ce désir, et le mouvement qui retire la robe, il n’y a pas de
pensée. Il est parfaitement possible, et il est même nécessaire de commenter le mot
de Bataille par les textes de l’érotique platonicienne. L’élan de l’âme philosophique
– son philein même – s’éveille et s’élève, se dresse ou se répand comme l’élan de la
fièvre sensuelle, mais non pas seulement à son image : c’est comme agitation des
sens qu’il commence, à même l’ardeur amoureuse et à travers elle » 2.
6 Nous ne pouvons pas nous arrêter ici sur la généalogie du désir en philosophie, ce qui
serait un parcours passionnant et révélateur en soi, des Présocratiques, à travers Platon
et Aristote jusqu’à Spinoza, Leibniz, Kant, les Romantiques, Nietzsche, Freud, Bergson,
Bataille, Deleuze. Insistons donc sur la singularité du désir philosophique chez Nancy et
tout d’abord sur la modulation philosophique du désir (du désir « proprement »
érotique, donc de l’érotique-« objet » du discours philosophique). D’abord, l’Éros de
Nancy est très différent de l’Éros violent et tragique de Bataille : il est ondulant,
modulant, il s’imprime dans les nuances, les variations, les vibrations, les imbrications
de la matière désirante, tout en s’excrétant des différences infimes, au lieu de se
manifester par l’apothéose virile des déchirures ou de la rupture. La Naissance des seins,
ce livre assez particulier ne parlerai au fond que de cela : Éros est une auto-
modalisation plastique de la matière qui fait des corps ; qui donne corps aux corps, qui
donne corps au monde, qui donne le monde au monde en tant que corps. Je ne pourrais
songer à un meilleur exemple que celui du premier paragraphe de La Naissance des seins
:
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
57
« Une élévation interminable, insensible mais appuyé sans hésitation, un
soulèvement, une tension légère et souple jusqu’à l’extrémité de sa propre
terminaison qui ne l’arrête pas mais l’élève encore et qui la resserre soudain, que la
colore et qui la fonce, qui la fronce et qui la strie méticuleusement pour résoudre sa
saillie en la réplique close, symétrique, d’une bouche ouverte tendue, desserrée
pour prononcer le mot qui se détache à lui seul – le sein – comme la présence nue,
hors et très loin de tout langage, de l’élévation elle-même en soi simplement
accomplie, apaisée, d’une pesée légère et mobile – un accomplissement lui-même
toujours en devenir, ne cessant de se répéter »3.
7 Le désir chez Nancy excède donc sa matrice structurelle, notamment l’orientation vers
un objet (y compris les versions extrêmes de cette orientation – la fusion et la
déchirure : associables, pour ainsi dire, à l’exigence excessive de Bataille) ; il n’est donc
plus caractérisé par ses traits conventionnels mais par son nouveau caractère modal,
par ses modalités qui concernent en effet la modalité de la modalité même : la
modalisation et la réflexivité. On peut aller jusqu’à affirmer que le désir chez Nancy est en
effet la puissance modale même : la modalité de la modalité. Une puissance de
modalisation et de réflexion : la déclinaison, le clinamen même de la force par laquelle la
force a lieu.
8 Or, dans « Nudité », Nancy est déjà suffisamment clair :
« Cet élan sans réserve – philosophia aphthonos, sans retenue, qui ne se refuse rien –
est à lui-même, plus que tout autre accomplissement, sa destination et son but
d’emblée situé au-delà des buts en général. […] la nudité se retire toujours plus loin
que toute mise à nu, et c’est ainsi qu’elle est nudité. Elle n’est pas un état, mais un
mouvement, et le plus vif des mouvements – vif jusque dans la mort, dernière
nudité »4.
9 Nous pouvons comprendre donc cette force, la force érotique, aussi comme un « élan
sans réserve », comme un « élan vital » fini qui est un schéma dynamique, voire
technique (techno-érotique) du corps, la force même de la finitude, ou bien de la
finitude en tant que force : hypothèse qui transformerait radicalement toute idée de
transcendance. La pensée dérobée se fonde donc sur un schéma dynamique, et l’archi-
schème de cette dynamique n’est évidemment autre qu’Éros. L’érotique générale serait
donc également un métabolisme généralisé (metabolé : changement, métamorphose) : un
processus de transformation immanent au corps. Sans le désir, rien ne peut changer : le
désir est la force même du changement ; mais changement veut dire mouvement
complexe, modal, réflexif.
Ontologie modale
10 Le schéma dynamique ou modal de la pensée du corps, de Corpus et La Pensée dérobée à
La Naissance des seins et Noli me tangere apparaîtrait en fin de compte, de manière
surprenante ou pas, également comme un schéma (quasi-)ontologique. J’ai fait de mon
mieux en tant qu’archéologue de cette figure dynamique, pour parvenir à la décrire par
une formule de passage de Nancy de Corpus, en tant qu’« ontologie modale », en
correspondance avec mes propres obsessions philosophiques. Le concept d’ontologie
modale est tracée dans le chapitre de Corpus « Corpus : autre départ » où le terme
« modal » apparaît en tant qu’attribut possible d’une ontologie, évidemment dans le
contexte de la réflexion sur le corps : « Ici, l’ontologie est modale – ou modifiable et
modifiante – de manière essentielle, entière et exclusive » 5. Avec « l’ontologie modale »
il s’agit donc d’une possibilité qui n’a jamais été, à ma connaissance, examinée à la
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
58
hauteur de son exigence et dont les enjeux sont décisifs pour toute pensée
philosophique et politique qui se propose d’articuler la puissance comme principe actif :
la possibilité d’une pensée sur le monde qui ne procéderait pas de l’idée d’une
actualisation de la puissance, mais de l’idée d’une modalisation pure, d’une puissance de
transformation. Avec « l’ontologie modale » il ne s’agit pas d’autre chose que de penser
la métamorphose comme le régime ontologique même.
11 Je reviendrai ici brièvement sur un paragraphe de Corpus dont j’ai déjà essayé d’aborder
les enjeux et les conséquences conceptuels et où cette dynamique s’annonce sous le
régime singulier de la modalisation, s’associant à son tour au concept d’une ontologie
modale6. Il s’agit du chapitre « Corps glorieux », singulier dans sa richesse et sa
puissance mais aussi dans son énigme, chapitre qui trace une image inédite de la
création du monde :
« Que Dieu crée le limon [la terre, la glaise, la boue], et que du limon il façonne le
corps, cela veut dire que Dieu se modalise ou se modifie, mais que son soi n’est lui-
même rien d’autre que l’extension et l’expansion indéfinie des modes. Cela veut
dire que la « création » n’est pas la production d’un monde à partir d’on ne sait
quelle matière de néant, mais qu’elle est ceci que la matière (cela même qu’il y a)
essentiellement se modifie : elle n’est pas une substance, elle est l’extension et
l’expansion des « modes », ou bien, pour le dire de manière plus exacte, elle est
l’exposition de ce qu’il y a »7.
12 On le voit bien : le moment modal est non seulement directement lié à une vision
inédite de la création, mais il en est le seul principe : la création du monde est
modalisation et, par conséquent, le monde n’est qu’une auto-modalisation. C’est vrai que
le « sujet » ou le principe d’auto-modalisation est désigné ici par le nom Dieu, le plus
chargé qui soit ; supposons cependant que cette désignation n’a d’autre tâche que
d’affirmer irréductibilité de la puissance ou plutôt de la force auto-modalisante à un
principe totalisant. Elle est affirmée comme la force d’un monde absolument
immanent, mais dont l’immanence « absolue » n’est que celle de son excès illimité sur
soi. Non sans surprise, dans le paragraphe cité Dieu se rapproche d’un autre terme – la
matière :
« Cela veut dire que Dieu se modalise et se modifie, mais que son soi n’est lui-même
rien d’autre que l’extension et l’expansion indéfinie des modes. […] [L]a matière
(cela même qu’il y a) essentiellement se modifie : elle n’est pas une substance, elle est
l’extension et l’expansion des “modes” »8.
13 Répétition ou plutôt résonance tout à fait frappante, saisissante : Dieu est la matière, la
matière est Dieu. Et en effet oui : bien avant que le dieu unique du monothéisme ne les
expulse, les anciens dieux multiples se métamorphosent sans arrêt, lieux divins ou
singularités-modes irréductibles, non totalisables à une substance, à un principe absolu
sacré. On ne s’étonnera donc pas à la proposition radicale de Nancy, formulée plus loin :
« Donc, oublions Dieu »9. C’est sous cet aspect que se trace un rapport important avec la
pensée de Lacoue-Labarthe, le penseur exemplaire de la plasticité, son archéologue
même. Cependant, à travers les propositions métacritiques majeures de Lacoue-
Labarthe se pose un problème qui parfois a l’air d’aporie insoluble – notamment, la
question de la force “derrière” la figure, la question si vous voulez du restant (si l’on
prend appui sur un concept important de Jacob Rogozinski10) de la forme, de la Gestalt,
de ce qui meut la figure, ce qui la fait se tracer ou bien émerger, sur un fond : la
question de la puissance plastique, ou bien de la force formatrice qui produit la forme.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
59
14 J’ai déjà consacré à ce problème une étude, dont la première version était présentée
toujours à Strasbourg, il y a 6 ans, au colloque consacré à Philippe Lacoue-Labarthe en
2009, toujours à l’invitation de Jacob Rogozinski autour de la question de la force de la
Darstellung – de son excès ou de sa folie11. Je peux également évoquer ici une
intervention spontanée de Nancy dans le cadre des discussions au même congrès (à ma
connaissance il n’existe pas d’enregistrement, je cite donc de mémoire) : il a tenté
d’établir une distinction entre Lacoue-Labarthe et lui-même, en mettant l’accent
précisément sur la question de la forme : « Lacoue était toujours du côté de la forme (de
la pensée de la forme) tandis que moi (Nancy) – de la transformation » (thèse qui
m’encourageait dans mon effort méta-critique de cette époque). Cependant, à étudier
de près les textes de Nancy, on peut nuancer historiquement cette affirmation sans
aucun doute révélatrice : cette distinction ne devient nette qu’à la fin des années 1980 –
début des années 1990 quand ce que je viens d’appeler « schéma dynamique » s’impose
de force chez Nancy, modalisant de manière singulière les questions du monde, de la
présence et de la finitude, avec les Lieux divins, Corpus, La Pensée dérobée, La Naissance des
seins. Cette distinction entre forme et transformation, ajoute donc un élément crucial :
la question de la force comme question implicitement centrale chez Nancy. La force, ce
qui excède la forme et ce qui a donc la puissance de provoquer le changement ou bien
la transformation de la forme. Ce qui fait la forme s’excéder – mais aussi ce qui fait la
forme tout court. Ce qui forme la forme. Ce qui, de la forme même, force la forme se
former.
La force du monde, le désir
15 Une question s’impose donc de force : la question de la force. Quelle est la force qui
donne la pulsion de la métamorphose ou de la modalisation ? Quelle est la modalité in-
tensive qui cause l’extension des modes – leur cause efficiente ? La modalité propre de
la modalisation ? Dans mon paragraphe favori de Corpus, que j’ai cité à maintes reprises,
paragraphe d’un spinozisme cryptique et d’un matérialisme radical jamais répété (où
même Dieu, à l’instar de Spinoza ou de Bataille, est réduit à un principe matériel
métabolique, autoplastique, auto-modalisant), cette force est entièrement immanente à
la matière plastique. On peut la décrire précisément en tant que force d’auto-
modalisation : l’impossibilité de (d’un sujet, ou d’un substrat de) rester identique à soi-
même, de se con-tenir en soi. J’évoquerai ici un texte où Jean-Luc Nancy formule de
manière nette et directe cette question voire cette exigence pour la pensée, la question
du désir, en tant que question ontologique : il s’agit de notre entretien « La
métamorphose, le monde », publié dans le numéro 67 de Rue Descartes. Je cite une
réponse de Nancy :
« Si tu demandes : “que nous veut le monde ?”, je crois que je répondrais : il se veut
en nous, comme nous, à travers nous et tous nos mondes. Mais “il se veut” n’est
alors ni subjectif, ni volontaire. Autant dire : “ça pousse” (où on peut d’ailleurs
entendre “pousser” au sens de la force directionnelle et au sens de la croissance
biologique). La poussée se pousse : c’est-à-dire qu’elle pousse, tout simplement. Elle
exerce la pression, la tension qui provoque un écart et par cet écart un rapport » 12.
16 Ici, il n’est décidément pas question d’une simple réduction psychologisante de la
question du monde ; au contraire, il s’agit d’une thèse sur la matière du monde elle-
même. Or l’insistance de Nancy sur le moment réflexif n’est donc aucunement
aléatoire. Supposons qu’elle est liée à un problème fondamental propre à la
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
60
problématique de la métamorphose. On peut en saisir les enjeux par un retour
clarifiant à Aristote. Or, le Stagirite postule dans la Métaphysique qu’il n’existe pas de
changement du changement : il n’y a pas de metabolé de la metabolé (Livre XI, 1068a-b).
Metabolé n’est donc pas réflexive. Cependant, selon Nancy « la poussée se pousse ». Or,
c’est le « se », la réflexivité même de la poussée, qui apparaît en tant que cause motrice,
la cause du changement : paradoxale cause efficiente immanente.
17 Comme si le moment réflexif chez Nancy venait en réponse au « blocage » aristotélicien
(nécessaire pour bien visser la machinerie de l’actualisation). Avec le moment réflexif
chez Nancy il ne s’agit aucunement d’une sorte de « meta-metabolé » mais du
changement – de l’altération – comme seule immanence du « flux héraclitéen » du
monde. Mouvoir le mouvement veut dire per-sister à même le flux. Or, le flux n’est pas
fluidité ; il est dynamique effective : l’opération altérante s’y effectue. Cette dynamique
effective ou bien ce mouvement complexe ou réflexif décèle une puissance plastique,
formatrice (ou bien, une cause formelle) : « Forme veut dire que le corps s’articule […]
comme un rapport à autre chose que lui-même. Le corps est un rapport à un autre
corps – ou un rapport à soi »13.
18 Ce déplacement du motif modal, la transformation du mouvement modalisant en
mouvement réflexif affecte aussi la figure de Dieu, qui n’apparaît de nouveau que pour
se transformer à son tour en opération réflexive : « Dieu se voit comme ce corps, le
mien, le vôtre. […] Si Dieu est la pensée de l’étendue, c’est parce qu’il est l’étendue de la
pensée »14. Cette transformation d’envergure permet de mieux comprendre aussi le
retour « réflexif » à la substance spinozienne dans Corpus. La substance ne serait pas
autre chose que cette capacité de se rapporter à, le ferment du « se » qui est aussi, en
même temps, la puissance de l’« ex », de la sortie de soi, et donc de la métamorphose.
En un mot, la substance n’est que le moment auto-réflexif du corps : de l’« étendue »
(et) de la « pensée ». Mais (se) rapporter à, c’est-à-dire sortir de soi, c’est-à-dire
s’exposer ou être exposé(e) veut dire s’« individuer ». Ainsi la substance – en tant que
liberté – est mue par un principium individuationis :
« La liberté matérielle » est, on l’a vu, celle « de l’extension indéfinie d’un principium
individuationis tel que les individus eux-mêmes ne cessent pas de s’in-dividuer, toujours
plus différents d’eux-mêmes, toujours donc plus semblables et plus substituables
entre eux, jamais pourtant confondus en substances sans que la substance, avant
que de rien soutenir, ni soi, ni autre, ne vienne à être exposée ici : au monde. […]
(C’est-à-dire : la liberté) »15.
19 La plus fidèle description de la « substance »-modalisation sera alors la dynamique des
singularités irréductibles, tandis que la comparution sera le nom de la totalité non
totalisable des rapports-expositions. Pour parler avec les mots de Bailly et de Nancy :
« L’ontologie du “commun” et du “partage” ne serait pas autre chose que l’ontologie de
l’“être” radicalement soustrait à toute ontologie de la substance, de l’ordre et de
l’origine. »16 Sans surprise, ce concept fort de la substance-modalisation apparaît
également dans un paragraphe-clé de La Naissance des seins, paragraphe qui élabore de
manière à la fois poétiquement libre et systématiquement rigoureuse, radicalement
critique, suivant l’exigence romantique, le topos du « soi », de la réflexivité :
« Soi surgissant, levé et par là même hors de soi mais tout autant et identiquement
recourbé sur soi. La vague n’est pas une modification, ni de l’eau ni de l’air. L’île
n’est pas une modification, ni de la terre ou du feu, ni de l’air ou de l’eau. Il n’y a pas
d’éléments suivis de leurs modifications. Mais la modification est élémentaire. La
pensée est la modification : la levée d’un mode, c’est-à-dire d’une mesure, cadence,
rythme, scansion, forme, contour, motif, figure, façon, tournure, manière. Ce qui,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
61
de soi, se modalise, se mesure et se découpe. Ce qui se modifie sans avoir encore été
rien de modifiable – ou bien : rien que le modifiable, la substance étale sans soi. Ce
qui se… – un saut dans soi là où il n’y avait pas d’être pour soi. Un saut hors de soi
dans soi, et qui se saute aussi, passe par-dessus soi, se manque ou s’élide ou s’évide
en même temps. Ni aséité, ni perséité, ipséité peut-être. Mais dans ipse, il n’y a pas
de se, pas de soi-même. Ipse, c’est is (celui-ci) avec pse (“particule de reforcement”).
Celui-ci particulièrement renforcé. Lui même, ainsi accentué, relevé, dressé,
distingué, séparé. Flexion sans réflexion. Préreflexif, irréfléchi, surgi » 17.
20 Cette flexion sans ré-flexion, ce pli, ce changement ou modulation, serait un autre nom
de la poussée se poussant, ou du désir se désirant et ainsi ouvrant les modes, s’ouvrant,
s’étendant, se donnant corps, forme et temps : se donnant monde. Comme le dit Nancy
dans un livre tout récent, l’entretien avec Mathilde Girard Proprement dit : « Non plus
“désir de soi” mais soi comme désir. En tant que désir, “soi” échappe à la problématique
du retour sur soi »18. Le désir, la pulsion, la poussée du monde vient ici donc comme un
autre nom, révélateur, de l’extension des modes du monde, du mouvement de la
métamorphose, qui n’est pas, cependant, un nouveau nom de l’affection aristotélicienne
(« [u] ne propriété selon laquelle on peut être modifié, comme le clair et l’obscur, le
doux et l’amer, la gravité et la légèreté », Métaphysique, ∆, 21). Cette thèse ne veut pas
affirmer que la pulsion est le désir de la matière (donc la matière en tant que sujet, ou
substance – une auto-affection donc) mais, inversement, que ce désir – cette pulsion,
cette poussée, on peut ajouter – cette intensité, cette énergie – est la matière du monde
elle-même.
21 Le ton de cette pensée étonnante de la modalisation puise-t-il à la même source que les
premières impulsions de la pensée philosophique ? Le sens commun voit à l’origine de
la philosophie une pensée sur les éléments ou les principes. Mais en réalité, chez
Anaximène ou chez Héraclite il s’agit avant tout de penser une modificabilité première
de la matière du monde, en lui donnant le nom d’air ou de feu. « L’air prend un aspect
différent selon qu’il est condensé ou raréfié, car, lorsqu’il atteint un certain degré de
raréfaction, il devient feu ; en revanche, les vents sont de l’air condensé et le nuage est
formé à partir de l’air par condensation. » (Anaximène) ; « [L] es transformations du
feu : d’abord, mer, de la mer une moitié terre, une moitié souffle brûlant » 19. Les
anciens ont appelé cette modifiabilité de la matière « densité », avant que le concept
scientifique de densité n’apparaisse, deux millénaires plus tard, chez Newton. La
densité est l’affection de la matière qui nomme son caractère originairement multiple,
non-élémentaire, divisible indivisible, pour reprendre les mots d’Héraclite. C’est cette
pensée des modifications – ou plutôt des modalisations – qui impulse les premiers pas
de l’activité qui va être connue plus tard comme « philosophie ».
22 S’agit-il dès lors, avec Corpus de Nancy, d’un retour à la pensée préscientifique de la
matière – la pensée sur la modalisation matérielle ? Même plus que cela. Car, si la
modalisation est l’autre nom de la création (telle est la pointe de l’affirmation du
chapitre « Corps glorieux ») et si par conséquent la modalisation est la seule matière,
alors, la matière est elle-même création. La pensée de la modalisation ontologique
affirme l’existence de la matière non pas comme principe opposé à l’idée ou à la forme ;
elle ne se propose pas d’effectuer de nouveau une réduction ontologique pour rendre le
tout explicable et pour le soumettre au déterminisme, toujours fataliste au bout du
compte, de la nécessité. Au contraire, la pensée de la modalisation affirme la matière
non pas comme substrat assujetti ou bien comme masse dure de la nécessité mais
comme possibilité de l’émergence libre du nouveau, de la fermentation de l’avenir, seul
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
62
« substrat » de la création du monde – métamorphose sans substance. « [L] a liberté
matérielle – la matière comme liberté – n’est pas celle d’un geste, encore moins d’une
action volontaire, sans être aussi celle de deux nuances de mica, de millions de
coquilles dissemblables, et de l’extension indéfinie d’un principium individuationis »
(Corpus, p. 34). Si je puis me permettre de répéter ici une affirmation de L’altération du
monde20, la pulsion serait donc non seulement une « simple » pulsion matérielle ou bien
une « simple » manifestation de la force plastique de la volonté ; cette pulsion serait
l’effet d’une intensité de la matière elle-même, inséparable de la matière du désir (qui
est désir de transformer celle-ci, de l’altérer : celui-ci transporte le désir de celle-là).
Pour une Érosophie
23 Le nom mythique mais aussi philosophique, depuis Platon, à travers Aristote et Ficin
jusqu’à Nietzsche, Bataille et Deleuze, de cette force voire de ce principium
individuationis n’est autre qu’Éros. Selon les anciens, Éros est bel et bien la cause et la
force de la métamorphose, la force de la metabolé, une cause motrice immanente. Éros,
dieu ou bien démon tout-puissant de la flexion, nomme la force même de la réflexivité.
Si Chaos était prima materia, Éros, le vieux Éros, une des trois entités les plus archaïques
et non-générées – Chaos, Éros, Gaia – serait la force de la modalisation de ce qui est : de
ce qui est sous-jeté, de la matière-chaos. La matière ne devient active que par le principe
érotique, même si Chaos apparaît lui-même comme une force première de distinction, à
même l’indistinction du hiatus premier. Toutefois, c’est une force pesante, ne retenant
pas la puissance dynamique en soi ; ce serait Éros, contemporain de Chaos, qui
modaliserait la matière de Gaia. Éros distingue, trace des formes et des figures, sépare
et unit, unit en séparant ; il dédouble, multiplie, compose. (Sa puissance serait donc le
paradigme de la « comparution », de ce que j’ai décrit en tant que « dynamique des
singularités irréductibles ».)
24 Éros n’est que le nom d’une force multiple et au bout du compte irréductible à un nom :
la force ou la puissance même du multiple. Sa formule est : « Je suis Légion » (Marc 5,9)
– la formule paradigmatique du démonique. Éros étant lui-même le paradigme du
daimonique (non du démoniaque), le daimon de l’excès et de l’excès sur soi, où seulement
le “soi” d’un sujet pourrait apparaître : flexion démonique. (Les lieux divins de Nancy
seraient donc également des lieux démoniques ou bien des lieux érotiques, ce qui
revient au même. Ils disent l’irréductibilité de la force et de la matière désirante –
d’Éros à un schéma, à une figure, à une matrice transcendante ou à un rapport matriciel
du sujet à l’objet).
25 Parlons donc, d’Érotosophie, ou bien, forçant quelque peu la grammaire, d’Érosophie tout
court, au lieu de Philosophie : Éros serait la force de plus-que-philein, la force qui excède
la pensée toujours à la démesure du monde, du désir du monde, du désir qui fait
monde, du désir-monde. L’Érosophie : toucher à la sagesse et non seulement aspirer à
elle ; erao [Grec : désirer, aimer passionnément] au lieu de phileo [aspirer à ; aimer ; aimer
bien]. Mais que veut dire toucher à la sagesse ? Que veut dire avoir un rapport avec la
sagesse ? Est-ce possible ? Cela veut dire avoir accès à ce noyau de puissance qui agit
dans la sagesse : comprendre la puissance, l’éprouver ; agir à même la puissance. Et si la
sagesse ne consistait que dans – n’était autre chose – que ce creusement, cette flexion du
désir sur soi, ce toucher qui se plie sur soi pour se donner forme, ou corps, et donc pour
augmenter sa puissance ? Le schème dynamique de cette opération ne serait autre que
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
63
l’altération, l’alloiosis, le devenir-autre, la définition même de l’aisthesis, de l’âme
sensible, désirant, et donc érotique dans Peri Psykhe d’Aristote ; l’activité qui déclenche
la sagesse du toucher même, de ce « se » qui touche en se rapportant à « soi », en se
rapportant tout court : con-sonnant, résonnant (comme le veut Jean-Christophe Bailly) ;
le ton, la touche et le toucher en tant que résonance, flexion, clinamen.
26 Or quand Nancy formule la phrase de laquelle procède ce texte, parlant de « la pensée
comme désir, autrement dit de ce que depuis presque deux millénaires nous autres
Occidentaux auront nommé philosophie », il prend sans aucun doute un risque
conceptuel important : il sait parfaitement que philo-sophia veut dire « aspirer à la
philosophie », « aimer la philosophie » (suivant l’inventeur du mot « philosophe »,
Héraclite ou Pythagore, dont le but était sans doute de tracer une ligne de démarcation
nette par rapport aux sophistes, exprimant ainsi une certaine humilité ; le mot qui a été
généralisé par la suite de toute probabilité par Platon en tant que philosophie).
Toutefois, Nancy sans doute sait très bien aussi que le verbe phileo veut dire non
seulement « aimer », mais qu’il s’approche dans sa deuxième signification d’erao – le
verbe où résonne le nom d’Éros – notamment embrasser, caresser, ‘toucher’. Embrasser
Sophia ? De ce point de vue erao apparaîtrait en tant qu’un degré d’intensité supérieure
de phileo. La philosophie ne pourrait donc pas être déclarée, sans crier gare, en tant que
co-substantielle du désir ; toutefois, comme le dit Nancy à juste titre, c’est une affaire
de désir ; le désir y fait son travail. Ce « lapsus conceptuel » est donc incontestablement
sinon prémédité, du moins symptomatique. Il a sa propre logique : et elle n’est autre
que la logique de l’érosophie. Telle est la vérité secrète de La Pensée dérobée.
27 J’ose dire donc que Nancy était et reste toujours un de ceux qui portent l’empreinte des
touchers de Sophia tout comme d’Éros, de ce double toucher se touchant soi, le
touchant lui, Jean-Luc Nancy ; un messager – un dernier ou un premier – un ange ou un
démon donc, de cette érosophie qui nous inspire ou qui, au juste, nous désire.
BIBLIOGRAPHIE
FERRARI Federico et NANCY Jean-Luc, Nus sommes : La peau des images, Paris : Klincksieck, 2006.
GIRARD Mathilde et NANCY Jean-Luc, Proprement dit. Entretien sur le mythe, Paris : Lignes, 2015.
HÉRACLITE, Fragments (Citations et témoignages), traduction et présentation Jean-François Pradeau,
Paris : Flammarion, 2002.
MANCHEV Boyan, « La métamorphose du monde. Jean-Luc Nancy et les sorties de l’ontologie
négative », in : Michaud Ginette (dir.), Europe, avril 2009.
MANCHEV Boyan, « La matière du monde et l’aisthesis du commun », in : Berkman Gisèle et Danielle
Cohen-Levinas (dir.), Figures du dehors. Autour de Jean-Luc Nancy, Paris : Éditions Cécile Defaut,
2012.
MANCHEV Boyan, L’Altération du monde. Pour une esthétique radicale, Paris : Lignes, 2009.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
64
MANCHEV Boyan et NANCY Jean-Luc, « La métamorphose, le monde », Rue Descartes n° 64 : « La
métamorphose », Paris : PUF, 2009.
ROGOZINSKI Jacob, Le Moi et la Chair. Introduction à l’ego-analyse, Paris : Éditions du Cerf, 2006.
NOTES
1. En voici le corpus : Corpus (1992), La Naissance des seins (2006 [1996]), La Pensée dérobée (2001),
L’« il y a » du rapport sexuel (2001), Nus sommes (avec Federico Ferrari, 2002), Je t’aime, un peu,
beaucoup, passionnément… Petite conférence sur l’amour (2008) et, dans un sens plus large Les Muses
(1994), La Visitation (2001), et Noli me tangere (2003).
2. J.-L. NANCY, La Pensée dérobée, p. 11, p. 13.
3. J.-L. NANCY, La Naissance des seins, p. 11.
4. Ibid., p. 12.
5. J.-L. NANCY, Corpus, p. 48.
6. Cf. B. MANCHEV, « La métamorphose du monde. Jean-Luc Nancy et les sorties de l’ontologie
négative » (2009) et « La matière du monde et l’aisthesis du commun » (2012).
7. J.-L. NANCY, idem, p. 55.
8. Ibid., p. 55.
9. Idem, p. 119.
10. Cf. J. ROGOZINSKI, Le Moi et la Chair. Introduction à l’ego-analyse, 2006.
11. Cf. B. MANCHEV, « Le dernier romantique ou De l’anarchie poétique », 2010.
12. B. MANCHEV, « La métamorphose, le monde. Entretien avec Jean-Luc Nancy », p. 85.
13. « De l’âme », Corpus, p. 115.
14. Idem, p. 119.
15. Idem, p. 34.
16. J.-C. BAILLY et J.-L. NANCY, La Comparution, p. 57.
17. La Naissance des seins, p. 36-37.
18. M. GIRARD et J.-L. NANCY, Proprement dit. Entretien sur le mythe, p. 59.
19. HÉRACLITE, Fragments, p. 131.
20. Cf. B. MANCHEV, L’Altération du monde. Pour une esthétique radicale, 2009.
RÉSUMÉS
Dans le corpus de l’œuvre de Jean-Luc Nancy, il existe un noyau de limites incertaines,
déterminant secrètement la prolifération conceptuelle et thématique qui s’effectue dans son
travail à partir des années 1990 : B. Manchev voudrait le décrire en tant qu’érotique philosophique.
Il ne s’agit pas simplement de textes traitant de thèmes érotiques, les introduisant en tant
qu’objet philosophique ; il s’agit d’essais et de livres où l’érotique apparaît en tant que modalité
dominante de la pratique philosophique. L’article se propose de développer cette hypothèse
initiale en aboutissant à l’idée d’une érotique philosophique générale.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
65
One can identify in Jean-Luc Nancy’s work a nucleus of uncertain limits, secretly determining the
conceptual and thematic proliferation that takes place in his work from the 1990s on: B. Manchev
would describe it as philosophical erotic. This “nucleus” is not simply a number of works dealing
with erotic themes; it is a series of essays and books in which erotic appears rather as the
dominant modality of philosophical practice. The article proposes to develop this initial
hypothesis in order to arrive at the idea of a general philosophical erotic.
AUTEUR
BOYAN MANCHEV
Université des Arts – Berlin
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
66
Mutants, mythants
Jérôme Lèbre
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1 Un texte de Jean-Luc Nancy, la postface d’un colloque organisé à Strasbourg et consacré
au don d’organes, me semble particulièrement révélateur de l’usage qu’il fait de la
« mutation » :
« Je ne prétends pas construire un modèle de culture (encore moins une culture-
modèle !). Je veux uniquement rendre sensible la dépendance culturelle de ces
termes – don d’organes – et de leurs notions, et cela parce que la culture dont ils
dépendent (en gros, la culture moderne occidentale) est précisément en train de
changer ou d’être en passe de changer très profondément. Qu’on se tourne vers le
droit, la politique ou l’art, on ne peut que percevoir l’agitation de ces changements.
En réalité, c’est une civilisation entière qui entre en mutation. Et de même que
l’esclavage a pu faire partie de grandes cultures, de même que les prêtres ont pu
détenir une large autorité sociale, de même que les lignées, clans ou communautés
ont pu prévaloir sur les individus, de même il est fort possible que ne s’imposent
plus, un jour, les significations et les repères qui sous-tendent l’idée du “don
d’organes”. Mais il y a plus : c’est le don d’organes lui-même qui engage, avec mille
autres mobiles techniques, culturels et sociaux, le mouvement de cette mutation » 1.
Une approche : du don d’organes à la mutation d’une
civilisation tout entière
2 Ce texte s’inscrit dans un tissu de contingences : la parole est donnée en dernier au
philosophe greffé du cœur à Strasbourg. Il lui faut restituer le sens d’un travail collectif,
redonner son témoignage de receveur d’organe, tout en offrant plus qu’une restitution
ou une redondance. Dans ce champ où la demande est généralement supérieure à
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
67
l’offre, son offre excède ce qu’on lui demande puisqu’il fait du don d’organes le facteur,
parmi d’autres, d’une mutation qui s’étend à une civilisation tout entière.
3 On attend la réflexion qui appuiera cette affirmation, mais on en aura deux, chacune
allant au-delà de ce qui était attendu. La première va à l’encontre des analyses que le
colloque avait pu faire des troubles de l’identité succédant aux greffes :
« Depuis bientôt dix-huit ans greffé du cœur je n’ai jamais rencontré auprès des
autres greffés que je croise (lors de nos bilans réguliers à l’hôpital) la moindre
manifestation d’un trouble de l’identité. Pas plus n’ai-je éprouvé moi-même pareil
trouble »2.
4 La psychologie du don d’organes se trouve ainsi dépourvue de son objet, du vécu dont
elle avait besoin. La greffe ne trouble pas l’identité de l’âme ou du sujet, c’est plutôt le
moi qui se maintient dans et par un corps altéré, quitte à devenir la série des
troubles physiques entraînés par la présence intime d’un organe étranger : « Je finis par
n’être plus qu’un fil ténu, de douleur en douleur et d’étrangeté en étrangeté » 3, lit-on
dans l’Intrus. Et ici :
« Autant les troubles physiques liés à la pharmacopée lourde qui nous investit
peuvent être sensibles, autant les troubles psychiques me sont restés étrangers chez
moi et chez tous ceux et celles que j’ai croisés jusqu’ici ».
5 L’autre réflexion précède toute expérience individuelle de la greffe :
« Lorsqu’une pratique comme la greffe atteint la durée et l’ampleur qu’elle atteint
aujourd’hui, il n’est pas possible qu’elle ne produise pas sa propre acculturation,
pour parler un vieux langage ethnologique. C’est-à-dire qu’elle s’impose comme une
pratique normale, efficace et pour laquelle il n’est pas – ou ne devrait pas – être
nécessaire de recourir à des motivations morales d’exception comme celles
qu’induit l’appel au don ».
6 C’est encore plus inattendu. Le colloque retrouvait dans le don d’organes les
dimensions de ce que Mauss appelle « l’esprit » du don : la pression subie par les
donneurs, qui se sentent (ou doivent se sentir) obligés de donner, de leur vivant ou
après leur mort ; l’impression d’une dette, d’un contre-don impossible, du côté des
receveurs, que leurs donneurs soient vivants ou morts. Il s’interrogeait sur ce que serait
un vrai don, un don sans contre-don, exigence éthique clairement formulée par
Derrida, héritant également avec ou sans croyance des trois monothéismes, et libérant
le donneur de toute pression, le receveur de toute dette. Mais après avoir dégagé le don
d’organe du trouble psychique, Nancy le dégage de toute dimension morale qui
prétendrait s’extirper de la pratique normale. Il désamorce l’appel au don à même le
don, si bien qu’on peut se demander s’il faut encore parler de don. Ce dégagement seul
était selon l’Intrus de l’ordre du vécu : après la greffe « toute la symbolique douteuse du
don de l’autre, d’une complicité ou d’une intimité secrète, fantomatique, entre l’autre
et moi, s’effrite très vite »4. L’esprit du don s’en trouve aussi érodé que l’âme du
receveur. Ainsi s’engage sans supplément d’âme ou d’esprit un mouvement qui porte le
don d’organes au-delà de lui-même et concerne une pluralité indéfinie d’êtres
singuliers, receveurs d’organe ou non, donneurs d’organes ou non, eux-mêmes pris par
ce biais dans une mutation de la culture moderne occidentale tout entière.
7 Le don d’organes dépasse l’expérience singulière de chaque receveur sans s’étendre
jusqu’à ce que Mauss appelait un phénomène social total. Certes, ces phénomènes, pour
Mauss, sont plus pluriels que totalisant : dès qu’on les repère « tout s’y mêle », chacun
implique une « multiplicité de choses sociales en mouvement » 5, ils sont « juridiques,
économiques, religieux, et même esthétiques, morphologiques, etc. » 6 Mais en même
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
68
temps ils sont stables, et c’est ainsi que le don est « l’un des rocs humains sur lesquels
sont bâties nos sociétés »7. Ce roc est à vif dans les sociétés archaïques, où on ne donne
pas que des produits mais des rites, des femmes, des enfants, des fêtes, où cette
économie est à la fois collective et autonome, menant jusqu’au sacrifice de ce que l’on
donne en vue d’une rétribution d’ordre symbolique. L’histoire de l’Occident est alors
celle de l’érosion de l’échange à la sphère économique et juridique, jusqu’à ce que
s’impose le « constant et glacial calcul utilitaire »8 qui réduit la loi de l’offre et de la
demande à la corrélation des besoins et des produits. Seulement, l’érosion ne peut être
totale. « Les choses vendues ont encore une âme »9, écrit Mauss. Tout échange entraîne
encore avec lui l’esprit du don, son économie spirituelle, symbolique et mythique, qui
donne au devoir de donner, de recevoir, de rendre, une force de cohésion sociale. Les
sociétés archaïques font s’incarner cet esprit dans un animal totémique chargé du don
ou dans un animal sacré donné rituellement, telle la vache dans le védisme. Dans le
capitalisme on le retrouve dans la dimension non calculable et non monnayable des
échanges de biens et de services : la reconnaissance des artistes, la solidarité envers les
travailleurs sans emploi, etc. Pour Mauss ce maintien de l’esprit du don n’est pas « un
trouble mais un retour au droit »10 qui est aussi retour au mythe, et dans le mythe au
sens moral intangible du don, exprimé par l’impératif : « donne autant que tu prends ».
Or chez Nancy, ni le don ni les « mille autres mobiles techniques, culturels et sociaux »
qui le soutiennent ne forment une totalité. S’il est une forme ultime, catégorique, elle
est sans forme, ou n’a pas d’autre forme que sa dissémination dans la multiplicité de ces
facteurs ou de ces mobiles. On peut la nommer sens, ou même esprit : mais tout comme
l’âme n’est que l’extension du corps organique, cet esprit n’est bien que l’extension des
phénomènes sociaux. Et dès lors, l’histoire n’est dominée par aucune constance et ne
rend aucun retour possible.
8 C’est, en quelque sorte, le seul vrai acquis du capitalisme, de son développement depuis
Mauss ou depuis Marx : il a laissé l’âme des choses, qu’on la considère ou non comme
agissante ou fantomatique derrière lui. Il se caractérise par un dénuement radical du
réel qui ne laisse rien, sinon l’extension indéfinie des biens échangeables, et donc
équivalents, quantifiables selon cet équivalent universel qu’est la monnaie. Il est
fondamentalement désanimant et démythifiant. À la rigueur, pour le capitalisme,
même le corps n’a pas d’âme, et c’est ainsi qu’il est indéfiniment aliénable : c’est ainsi
que se développent des techniques du corps bien différentes de celles dont parlait
Mauss, puisqu’au lieu de le façonner elles l’assujettissent sans limites et sans
subjectivation. Parmi ces techniques se trouve cette pratique normale, médico-
chirurgicale de la greffe, à laquelle Nancy donne l’ampleur d’un phénomène
d’acculturation. En continuant dans la même veine cette pratique normale peut mener
jusqu’à l’idée, défendue par certains lobbys, que la solution à la pénurie de dons
d’organes se trouve dans l’encadrement juridique de leur commerce. Il faut bien aller
jusque-là, jusqu’à l’immonde, qui est déjà là et toujours présent, pour comprendre que
s’il y a un esprit du capitalisme, celui-ci a déjà réduit à l’extrême l’esprit du don,
plaçant les hommes dans un monde de biens commercialisables, les exténuant, les
menant à un dénuement qui a érodé autant que possible le sens même du monde.
9 « Tout le sens est à l’abandon », écrit Nancy ailleurs, précisant que « c’est de cela même
que nous vivons d’être exposés à cet abandon du sens »11. Cet abandon est le contraire
du don : aucun sens n’est plus donné. Il en découle une demande de sens qui se solde
toujours par le retour à un esprit disparu, redonnant sens à ce qui n’en a plus. Il faut
alors résister à cette restitution ou ce rappel. Ce qui reste, alors, c’est la résistance du
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
69
sens lui-même à sa propre disparition : un sens vide, indéfiniment ouvert,
indéterminable, mais présent à même les mille mobiles qui font que quelque chose
comme une civilisation continue au-delà de son érosion totale, que la vie continue. Ce
stade, le nôtre, est inouï et peut se nommer fin de l’histoire, ou même fin du monde, car
le monde n’a plus de signification ou d’esprit assignable, sinon qu’« il y a » encore un
monde. Et c’est cette situation qui se nomme mutation.
10 On est proche de l’usage que Heidegger fait de ce terme. La mutation (Wandel) est selon
lui plus qu’historique, puisqu’il a fallu une première mutation pour rendre l’histoire
possible : le passage du mythe à la métaphysique. Le mythe témoigne d’un effroi des
hommes devant les puissances naturelles, devant la surpuissance du monde qui les
entoure. La métaphysique ravale ces puissances au rang d’étants appartenant au
monde, stabilisés par des étants supérieurs mais objectivables, les idées, ou Dieu comme
principe de la création. Elle fige ainsi la différence entre ces étants et l’être du monde,
lequel était accessible dans chaque puissance mythique mais devient étranger à tous les
étants. Ainsi l’homme trouve une position vis-à-vis de la nature et de dieu, laquelle
évolue en différentes époques dans l’histoire de la métaphysique et de la civilisation
occidentale. Dans la civilisation moderne, l’homme est devenu sujet : un « étant » qui
maîtrise la nature, s’approprie l’être. Ce sujet devient le moteur de l’histoire politique,
comme de celle des sciences, des religions, de l’art. Et cette histoire prend fin dans
l’époque actuelle, celle de la technique, qui a rendu tous les étants disponibles,
échangeables, transformables : même l’homme n’est plus vraiment sujet puisqu’il est
aussi l’objet de la technique, qu’il peut être réifié et transformé par elle. Jamais l’être
qui donne sens au monde n’a été autant oublié. Et pourtant, jamais il n’a été à ce point
sur le point d’être présent, puisque tous les étants se présentent sous la forme dénudée
de ce qui est là, prêt à être utilisé, sans qu’aucune utilisation ou transformation ne
change cela : ils sont là. L’il y a, « es gibt », implique alors une mutation qui dépasse
l’histoire, une mutation de l’être même, qui retiré de toute transformation, se donne en
elle et à travers elle. Ce nouveau mode de donation est encore plus révolutionnaire
qu’une révolution. Celle-ci implique encore la volonté d’un sujet de l’histoire qui
s’approprie le monde en le transformant ; la mutation elle, est ouverte à l’événement, à
l’inappropriable en tant que tel. La tâche de la philosophie n’est alors plus de
transformer le monde, mais de laisser être la mutation, d’être ouvert à elle afin de
muter elle-même12. Ainsi ce qui change dans chaque mutation, c’est toujours le sens de
la mutation : à chaque fois l’homme, existant dans le monde, se positionne
différemment en lui et n’est plus le même homme. Dans le dépassement de la
métaphysique, différent de celui du mythe, il se découvre, non comme simple étant du
monde mais comme existant, c’est-à-dire comme ouvert au monde, à l’être tel qu’il se
donne. Il s’éloigne de lui-même, s’ouvre à l’être en préservant son aspect
inappropriable13.
11 La pratique « normale » du don d’organes montre alors que la mutation a encore
changé de sens. Elle désamorce l’appel au don. À l’horizon, il n’y a pas plus de don que
de contre-don, pas plus d’exigence éthique d’un don sans contre-don que de donation
originelle de l’être. La mutation du sens est en train de délaisser tous les sens de la
donation. Dans Le Sens du monde Nancy disait que la pensée a toujours oscillé entre deux
donations, le sens déjà donné dans le mythe ou le désir d’un sens à venir :
« appropriation de la donation même et donation de l’appropriable même configurent
le chiasme originaire de la philosophie, ou du sens » 14. Il semble alors qu’on ne puisse
sortir de ce chiasme quand sacrifiant le désir du don et le don du désir, mais dans ce
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
70
sacrifice rien n’est sacrifiée que la logique du sacrifice. Le résultat insacrifiable, se
nomme, « dans une langue balbutiante » existence. Ce même langage gagne de
l’assurance à propos du don d’organes :
« Donner un organe » n’est donc pas céder pour rien un morceau de mon bien.
Transmission de vie serait plus juste que « don d’organe ». On y entendrait mieux le
passage et le partage, qui ne relève pas d’une décision généreuse mais de la
reconnaissance entre nous d’une communauté d’existence qui précède et qui suit
nos « personnes ».
12 Le don d’organes mute et devient « transmission de vie ». D’autres termes peuvent
convenir, comme celui de « transplantation », au sens où la mutation ne peut être qu’
approchée. Ces termes approchent un sens que le don ne donne plus, ils évitent tout
retour à un sens antérieur mythique ; ils sortent aussi de la terrible ambivalence 15 de la
mutation entraînée par la technique : ou l’on va vers l’immonde (le commerce des
organes) ou vers le monde, vers la transmission ou transplantation, qui ne répond plus
à aucune forme d’échange. La question est alors la suivante : la mutation, comme
dévoilement de l’existence dépassant le mythe et le don, entraîne-t-elle le sens de la
vie, est-elle une mutation de la vie ? Ou encore : l’existence est-elle devenue vie ?
La vie mutante, au-delà du mythe
13 Nancy ne manque pas d’ironie sur ce qu’il faut nommer le mythe des mutants, lesquels
trancherait ici la question par le nombre et par la force :
« je deviens comme un androïde de science-fiction, ou bien un mort-vivant, comme
le dit un jour mon dernier fils. Nous sommes, avec mes semblables, de plus en plus
nombreux : les commencements d’une mutation en effet »16.
14 Mais comment articuler vraiment la mutation de notre civilisation et celle de la vie ?
D’un côté, il y a eu d’abord la vie, laquelle a engendré dans une suite de mutations un
être vivant particulier, l’homme, lequel est devenu homo faber puis homo sapiens sapiens,
et qui dans ce mouvement constant de dénaturation finit par (de) transformer
techniquement la vie elle-même, en une série de pratiques biologiques, médicales (les
greffes, mais dit aussi Nancy, le « don » de sang et le « don » de sperme, le « prêt »
d’utérus) dont certaines ne transmettent d’ailleurs pas immédiatement la vie : pose de
prothèses artificielles ou prise de médicaments, lesquels ne sont d’ailleurs pas donnés
(mais vendus, et chers). La seule menace à ce stade est alors celle que nous faisons peser
sur nous-mêmes : notre corps est construit d’étrangetés, il est à la fois vivant et
technique. Ce qui est effrayant dans cette mutation, c’est donc l’homme lui-même,
devenu tenant et aboutissant de la technique.
« L’homme devient ce qu’il est, écrit Nancy dans l’Intrus : le plus terrifiant et le plus
troublant technicien, comme Sophocle l’a désigné depuis vingt-cinq siècles, celui
qui dénature et refait la nature, qui recrée la création, qui la ressort de rien et qui,
peut-être, la reconduit à rien. Celui qui est capable de l’origine et de la fin » 17.
15 Certes la mutation de la vie précède de loin, de très loin, la mutation de notre
civilisation. Mais d’un autre côté il ne pouvait être question de mutation de la vie qu’à
la fin de cette histoire. L’histoire est donc l’intruse dans la mutation de la vie, la
mutation de la vie est l’intruse dans l’histoire, et nous en sommes là : à ce stade où cette
double intrusion interrompt tout mythe des origines, mais devient ce mouvement qui
ne sort de rien et ne mène à rien : une mutation de la vie comme de la civilisation.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
71
16 Il faudrait ici retracer l’histoire occidentale de la vie, telle qu’elle se dégage du mythe et
de la religion. On partirait de l’homme qui trouve des remèdes contre les maladies dans
le même chant de Sophocle, pour le retrouver chez Hippocrate, lequel prépare le
triomphe du corps-machine, de Galien à Descartes. Ce mécanisme s’avère alors
indissociable d’un principe de vie transcendant (Dieu donne la vie à l’âme, animant un
corps-machine). La vie se passe de Dieu en devenant interne à l’organisme, et c’est ainsi
que Lamarck peut expliquer à la fois la continuité génétique des espèces et le
développement des organismes individuels, bref, comprendre la vie comme évolution :
c’est la naissance de la biologie. On verrait dans cette histoire tout le débat sur les
appareils médicaux qui peuvent ou remplacer mécaniquement des organes, ou
simplement réduire fractures et plaies le temps que la vie organique cicatrise la peau
ou reforme les os. On verrait le rôle charnière de Darwin, dégageant un champ qui pour
lui n’est tout simplement pas de l’ordre du connaissable : les variations fluctuantes et
contingentes, repérables uniquement dans leurs effets, et donc fondamentalement
mystérieuses dans leurs causes, qui rendent l’évolution possible. Après Darwin, avec et
contre lui, la mutation viendrait alors inscrire sa propre histoire dans celle de la
biologie, confrontée à la tâche de saisir les causes profondes de l’évolution, donc les lois
dynamiques qui réduisent la contingence des variations. Elox Axel Carlson 18 retrace
cette histoire, qui va de Mendel à Bateson et de Vries jusqu’à aujourd’hui, en signalant
que la mutation a changé de sens à chaque génération de biologistes. En deçà des
grandes mutations organiques les lois s’exercent au niveau de la cellule (l’approche est
biologique) puis des protéines de la cellule (approche biochimique) puis des séquences
d’ADN produisant ses protéines (approche moléculaire).
17 Ce qui s’avère alors, et nous en sommes là, c’est que la biologie a éradiqué le vitalisme
qui lui a donné naissance, au profit de ce que l’on pourrait nommer un mécanisme sans
dieu et sans esprit, mais non sans vie. La vie reste le sens de ces systèmes qui se
configurent en intégrant une suite de niveaux discontinus (molécules, enzymes, gènes,
cellules, organes, fonctions). Ainsi l’évolution de la vie s’inscrit dans l’évolution
chimique, car même la chimie est évolutive, selon les principes de la
thermodynamique. Mais ce qui permet cette intégration, c’est tout aussi bien la
technique. Le pouvoir de destruction des rayons X s’avère agir au niveau de la cellule,
puis plus profondément, provoquer des mutations en dissociant et déplaçant les gènes
chromosomiques. Le chromosome est analysé et compris par l’effet de ces mutations
artificielles : son élaboration conceptuelle est indissociable de cette application
technique. Ensuite, c’est le schème du programme informatique qui permet de décoder
les chromosomes, et on ne peut alors tout simplement plus distinguer l’emprise de
l’informatique sur la société et sur la vie. Il en découle qu’on ne peut plus distinguer
biologie génétique et biotechnologie. Enfin, si tous les niveaux de la vie s’intègrent ainsi
techniquement, l’intégration reste celle de discontinuités. Et si la biochimie n’a plus
besoin de faire de la vie un principe transcendant et un « fantôme dans la machine »,
elle doit résister à la tentation de faire de la continuité entre matière et vie un autre
fantôme19. La vie demeure alors, justement, comme une suite de sauts indéfiniment
intégrables, une succession d’écarts : elle est la discontinuité physico-chimique dans la
matière même, puis entre les structures vivantes, puis, aux niveaux supérieurs, entre
l’être vivant et son environnement. C’est ainsi que le règne technologique du code, du
message, bref, de la communication est aussi et de plus en plus clairement celui de
l’écart qui rend la communication possible. C’est alors bien cet écart qui se pourrait se
nommer existence, ou transmission de vie.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
72
18 Cela ne fait pas de l’existentialisme un vitalisme. Heidegger montre déjà clairement 20
que l’on passe à côté de l’existence tant qu’on en reste à une philosophie de la vie.
Celle-ci étage tous les niveaux du vécu comme si la vie elle-même, comme genre d’être,
ne posait pas problème. Autant croire que l’anthropologie et la psychologie entrent
dans une « biologie générale » qui repose en fait sur la tendance métaphysique à placer
l’homme au sommet de la chaîne des êtres, comme cet animal qui additionne corps,
âme et esprit et peut ainsi s’élever jusqu’à dieu. Bien plutôt la vie ne peut être pensée
que si l’homme devient ce qu’il est, un être au monde qui est plus que vivant. Ainsi
l’existence implique une interprétation privative de la vie, située à son bord, comme
« rien-que-vivre ». Mais dès lors, comme le signale Derrida 21, la vie n’est ni l’inerte ni
l’existant, ce qui rend insituable son genre d’être : entre l’animal qui dans son monde
environnant reste privé de monde, et la pierre, qui est sans monde. Le problème
rejaillit sur l’existence : elle excède le « rien que vivre », sa vie ne peut plus se dire en
termes de vie, et cet excès, cette sur-vie est toujours de l’ordre de l’esprit, donc d’une
différence entre le vivant et le spirituel. Cet esprit marqué négativement par la vie est
un esprit non-vivant, un mort-vivant, voire un simple spectre. C’est bien ce rapport à la
mort qui fait de l’existant chez Heidegger un existant fini s’interrogeant sur son être,
tandis que l’animal ne fait que vivre ou arrêter de vivre. Le dasein de Heidegger ne
donnera donc jamais ses organes, d’abord parce qu’il ne décide que de son vivant,
ensuite parce qu’il « n’arrête pas de vivre »22 enfin parce qu’il n’a pas vraiment
d’organes. On ne le fera pas non plus muter. La vie ne peut muter que dans la
succession des générations, que si la mort est programmée génétiquement. Or, s’il y a
une historialité propre à l’existence chez Heidegger, c’est parce que les générations
survivent spirituellement, que leurs spectres demeurent. Il n’est alors pas étonnant que
la mutation de l’existant accompagnant celle de la civilisation soit une migration qui
n’est pas celle des oiseaux, une mue qui n’est pas celle des serpents, et surtout une
métamorphose qui garde la structure existentiale du dasein à l’abri de toute mutation
génétique.23 Ouvert au don, le dasein retombe dans l’existence (comme le dit Blanchot
de Grégor Samsa24) en passant finalement à côté de la vie.
19 Comme il est difficile de ne pas passer à côté de la vie ! Pour cela, il faudrait vraiment
du côté de la vie, puisqu’il n’y a pas d’autre côté, rien du côté de la mort 25. En ce sens,
écrit Derrida26, l’existence comme « être pour la mort » est du même côté que l’être
pour la vie, même si « malheureusement » Heidegger ne peut le dire. Derrida lui-même
s’efforce de passer du côté de la vie, de la vie pour la vie. C’est pour lui un devoir, une
exigence, qui lui vient de l’animal même : seul l’animal que donc je suis, dans tous les
sens du terme, donc aussi au sens de l’évolution et de la mutation, doit enfin donner
sans contre-don à tout animal son droit à l’existence. Mais Derrida se dit aussi
« convaincu de mort », c’est-à-dire à la fois condamné à mort et sûr de la vérité de la
mort. Il ne peut croire qu’à la survie, ce qui rend irréductible sa croyance aux fantômes.
Ainsi Spectres de Marx entend ressaisir dans la pensée de la révolution celle d’une
mutation de la société27, tout en la comprenant comme une transmutation : la monnaie
qui remplace l’or se transmue en or fantomatique, comme la marchandise en valeur
d’échange28 et ce devenir immatériel de la matière laisse le passage à tous les spectres
dont la révolution ne peut se défaire, à tous les morts-vivants qui planent sur l’avenir
de la politique comme de la philosophie. Derrida pense donc la mutation comme
« survivance irréductible »29. Si ces spectres sont conjurés par Marx, c’est au sens où « il
ne veut pas y croire. Mais il ne pense qu’à ça »30, comme Derrida.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
73
20 Mais avec Nancy, la mutation a encore changé de sens. Elle n’est plus transmutation
mais transmission de la vie. Elle fait disparaître tous les fantômes au profit de morts-
vivants qui sont vraiment du côté de la vie. Bien sûr, la tentation serait alors d’exalter
la vie, comme dans le Saint-Antoine de Flaubert : « ô bonheur, bonheur, j’ai vu naître la
vie, j’ai vu le mouvement commencer. Le sang de mes veines bat si fort qu’il va se
rompre… ». Cette exaltation de la vie est celle de la sensibilité, mais c’est aussi la plus
retorse et la pire négation du sens : « il y a une négation du sens qui en appelle à la vie,
à un sens vivant de la vie »31. Le désir de se sentir vivant n’est autre que le désir de
mythe à l’état pur, ou la donation du sens à l’état pur : « le sens comme sangsue de soi »
32
. C’est ainsi que les avant-gardes des années trente exaltent la vie dans l’art et l’art
comme vie, dans la lignée de la recherche romantique d’une nouvelle mythologie, qui
unirait dans une même vie la science, la poésie, et l’État. Cette tentation mythique est
révélée telle quelle dans le mythe nazi, qui fait du Reich une œuvre vivante trouvant sa
configuration dans la race allemande. Le mythe de la race n’est même plus de l’ordre du
langage mais du sang et du sentiment du sens, du sentiment de soi comme expérience
vécue (Erlebnis) et cette vie garde, est-il dit entre parenthèses, « le darwinisme en toile
de fond »33. C’est vrai : un mythe s’est créé autour de Darwin34, comme si le principe de
la sélection naturelle exaltait la vie et la force dans l’humanité, le combat des races
pour leur espace vital, alors que de fait il lamine tout vitalisme : il rend possible le
passage au concept de mutation, lequel rend intenable toute définition biologique de la
race et provisoire toute définition de l’homme.
21 Sortir des mythes, c’est alors résister à une double tentation, qui fait encore de nous
des mythants. La première est de combler l’écart à soi de la vie, le seul à faire sens, par
un sentiment vécu. L’autre de s’écarter de la vie au point de passer à côté d’elle, au
profit de la mort. Or « mort ou vie, c’est la même épaisseur expressive »35, le même
vécu, le même sacrifice, la même force mythique. Le mythe est toujours à la fois
exaltation de la vie et de la mort, fondant la vie sur la mort, la vie de la communauté sur
la mort des individus, sur leur don ou leur sacrifice. C’est ce qui fait que le mythe est au
fond du sentiment communautaire qui fait que l’on se sent vivre dans la communauté
et pour elle. En ce sens, l’humanité risque toujours d’être mythante. Dans la
Communauté désœuvrée, Nancy, dans la suite de Blanchot et de Bataille, trouve alors
encore dans la mort l’expérience impossible qui dégage la communauté d’elle-même,
l’interdit de devenir œuvre vivante, la désœuvre. Mais il n’est pas étonnant que
maintenant, il considère comme encore mythante une forme d’exaltation du non-
rapport qui se trouve chez Blanchot, lequel finalement refait œuvre de la politique au
prix d’un glissement vers la communauté des amants, sans sexe et de fait sans vie. Cette
vie qu’il faut garder ne peut alors elle-même échapper au mythe que si elle est
vraiment ce qu’elle est, écart par rapport à soi, et donc aussi écart entre le vécu et le
non-vécu, et donc à la fois sentiment et non-sentiment de soi : « à chaque pas, il faut
gagner de la distance – cette distance qui est celle du monde : s’écarter du « se sentir »
sans cesser d’être affecté à même soi par l’espacement du monde ».
22 Même quand Nancy semble exalter la vie « archigone », qui s’engendre sans relâche,
qui fait qu’il n’y a rien de mort dans l’Univers, cette vie originaire est « premier pas »,
première prise de distance qui s’éprouve comme distance : c’est l’étrangeté à soi de la
vie qui fait qu’elle s’affecte sans se rapporter à soi dans son affection, « dans son
extériorité de particules et de rapports ». Ainsi l’homme, les autres êtres vivants, même
les pierres, sont en rapport, le rapport de la vie et de la non-vie est relation au monde
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
74
dans l’extension du monde. « Pas d’animisme donc » 36, pas d’âme des choses : mais une
différence à soi qui fait de tous les corps le « corps inorganique du sens ». Et c’est ainsi
que ce corps inorganique est tout aussi bien vivant et organique, sans cesser alors
d’être existentiel, l’âme n’étant que l’extension du corps, son aréalité. Dans cet à-côté
qui ne cesse ici de se transmettre, le sujet lui-même n’est qu’un point singulier,
transitoire, à côté de quantité d’autres, dans un vaste champ de transition qui est la vie,
organique et inorganique, touchant à l’inorganique. Le sujet, le « je » dit Nancy, l’âme
devenue sujet à l’époque moderne, est devenu « l’index formel d’un enchaînement
invérifiable et impalpable »37.
23 Ainsi le sens, celui de la mutation, de la vie comme de la civilisation, est à la fois ce qui
affecte et ce que l’on ne sent pas passer 38. J’expliquerai ainsi pour finir la tournure du
texte que j’ai cité en commençant mon exposé :
« De même que l’esclavage a pu faire partie de grandes cultures, de même que les
prêtres ont pu détenir une large autorité sociale, de même que les lignées, clans ou
communautés ont pu prévaloir sur les individus, de même il est fort possible que ne
s’imposent plus, un jour, les significations et les repères qui sous-tendent l’idée du
“don d’organes” ».
24 Les formes de domination dont il est question dans cette phrase ce sont toujours fait
sentir, avec toute la violence d’un pouvoir toujours prêt à se transformer en droit de
vie ou de mort. Elles ont toujours ordonné la vie communautaire à la mort. Cette
domination n’a jamais simplement laissé vivre, comme le dit Foucault, car laisser vivre
s’est toujours accompagné d’une donation de sens s’imposant comme expérience : la
différence anthropologique (Aristote) ou raciste (la colonisation moderne) entre maître
et esclave, la communion (Dieu donnant sa vie aux hommes), ou le mythe
communautaire, comme donation de la vie commune à l’individu, impliquant pour
l’individu le sacrifice de soi.
25 En un sens, cela continue, s’impose, se fait sentir aujourd’hui de la manière la plus
violente et la plus cruelle. Le mythe, comme puissance productrice de la communauté,
comme exaltation de la vie et de la mort, comme donation immédiate ou imposée d’un
sens « sangsue de soi » menant au sacrifice de soi et des autres est toujours là, dans
chaque conflit, chaque guerre, chaque acte de terrorisme ; et si la civilisation
occidentale n’est plus structurée par la domination des prêtres, le monde d’aujourd’hui
n’en a pas pour autant fini avec l’influence éclatée, très problématique pour le clergé
des trois religions monothéiste, de prêtres, de rabbins ou d’imams radicaux, pas plus
que ce monde n’en a fini avec l’esclavage. Ce qui s’impose aussi et encore aujourd’hui,
c’est la loi démythifiante de l’offre et de la demande, pour laquelle tout a un prix, un
prix de plus en plus bas, le travail comme la vie. Il s’avère alors que si une chose ne
s’impose pas, au sens où elle ne s’est jamais imposée, c’est la vie elle-même : chaque
jour elle est détruite ou marchandée, et toujours directement visée, et comme
existence, comme susceptible de faire sens. C’est l’aspect immonde de notre présent,
c’est l’envers de la mutation du monde.
26 La mutation elle ne peut s’exalter, vociférer, sacrifier, car si elle se sent, elle est aussi ce
qui ne se sent pas passer. Elle est celle de la vie, et précisément de cette vie qui ne
s’impose pas, qui résiste à toute imposition ou domination : à la donation de sens
« mythante » comme à l’érosion économique du sens. La mutation ne veut pas donc pas
dire qu’une nouvelle liberté s’impose (dans une révolution autoritaire) ou que la vie
s’assujettit à elle-même, dans une biopolitique qui prétend faire vivre les individus et
qui de fait est aussi ancienne que la technique, puisqu’on ne peut séparer vie et
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
75
technique, vie et dénaturation. Elle signifie que la vie continue sans s’imposer. La
transmission de la vie se révèle (mais ce n’est pas une révélation, c’est une expérience
« remise à ce qu’elle n’est pas »39) comme la loi sans loi de cette mutation.
27 Ainsi la vie passe et se passe sans qu’on la sente passer. Elle est l’origine non-mythique
du sens, parce qu’elle se partage sans jamais être simplement donnée. On peut toujours
prendre la vie, on peut toujours (on a toujours pu) donner la mort, laisser vivre ou faire
vivre, mais hors de ces mutations de la souveraineté qui n’en sont pas, la vie est
l’affirmation que la souveraineté n’est rien, affirmation du franchissement du sujet
souverain, émancipation de l’homme par l’homme. Cette vie a pu se nommer vie divine,
mais qu’il faudrait maintenant concevoir comme dégagée de toute imposition d’un
principe transcendant, également de tout clergé, et donc dégagée de dieu lui-même.
C’est là, selon Nancy tout le mouvement « non mythique » du christianisme, du
christianisme comme expansion de l’athéisme. Il fallait la mort de dieu pour que la vie
devienne une vie divine qui n’a de divin que le nom. « Oserait-on dire : l’esprit, ou la
vie ? »40 demande Nancy et un athéisme qui ne se prive de rien ose les deux : la vie de
l’esprit, ou vie in-finie, qui se traverse la vie du sujet fini, interrompt le mythe et
continue la communauté au-delà de toute donation.
28 Dans cette mutation, la vie, détruite, exploitée dans le monde entier, continue donc.
C’est ce que nous dit le cinéma de Kiarostami et au-delà d’autres films, d’autres arts, ou
d’autres textes, qui déploient, plus que jamais la possibilité d’une vie qui, par sa fiction
même, par le fait que la fiction s’expérimente sans aucune exaltation, interrompt le
mythe et accompagne la mutation.
BIBLIOGRAPHIE
CARLSON Elof Axel, Mutation—the History of an idea from Darwin to genomics, Cold Spring Harbor, New
York : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2011.
DERRIDA Jacques, De l’esprit : Heidegger et la question, Paris : Galilée, 1987.
DERRIDA Jacques, HC pour la vie, c’est-à-dire, Paris : Galilée, 2002.
DERRIDA Jacques, Spectres de Marx, Paris : Galilée, 2006.
HEIDEGGER Martin, Être et temps, trad. fr. F. Vezin, Paris : Gallimard, 1986.
MAUSS Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris : Presses universitaires de France, 2003.
MALABOU Catherine, Le Change Heidegger – Du fantastique en philosophie, Paris : L. Scheer, 2004.
PICHOT André, Histoire de la notion de vie, Paris : Gallimard, 1993.
NOTES
1. J.-L. NANCY, « Don d’organes ou transmission de vie ? », p. 380.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
76
2. Idem.
3. J.-L. NANCY, L’Intrus, p. 40.
4. Idem, p. 29.
5. M. MAUSS, Sociologie et anthropologie, p. 147.
6. Idem, p. 274.
7. Idem, p. 149.
8. Idem, p. 272.
9. Idem, p. 259.
10. Idem, p. 261.
11. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 11.
12. C. MALABOU, Le Change Heidegger – Du fantastique en philosophie, p. 351.
13. Idem, p. 358.
14. J.-L. NANCY, op. cit, p. 88.
15. Idem, p. 66.
16. J.-L. NANCY, L’Intrus, p. 43.
17. Idem, p. 43-44.
18. E. A. Carlson, Mutation—the History of an idea from Darwin to genomics, passim.
19. A. PICHOT, Histoire de la notion de vie, p. 938.
20. M. HEIDEGGER, Être et temps, § 10.
21. Cf. J. DERRIDA, Heidegger et la question, p. 19 sq., p. 168.
22. M. HEIDEGGER, op. cit., p. 301.
23. Cf. C. MALABOU, op. cit., p. 143, p. 106, p. 273.
24. Idem, p. 291.
25. M. HEIDEGGER, op. cit., § 49.
26. J. DERRIDA, H.C. pour la vie, p. 78.
27. Cf. J. DERRIDA, Spectres de Marx, p. 119, p. 155, p. 168.
28. Idem, p. 241-242.
29. Idem, p. 235.
30. Idem, p. 83.
31. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 243.
32. Idem, p. 244.
33. Idem, p. 62.
34. A. PICHOT, op. cit., p. 763.
35. J.-L. NANCY, op. cit., p. 244.
36. J.-L. NANCY, op. cit., p. 103 ; id. pour la citation suivante.
37. J.-L. NANCY, L’Intrus, p. 36.
38. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 246.
39. J.-L. NANCY, L’Expérience de la liberté, p. 115.
40. J.-L. NANCY, La Déclosion, p. 9.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
77
RÉSUMÉS
Nous sommes des mutants : la science des mutations du vivant reste indissociable des techniques
qui rendent nos corps modifiables. Nous sommes des mythants : nous gardons la tendance à nous
réapproprier la vie en lui donnant un sens qui la surplombe, si bien que le don de la vie comme
celui des organes restent pris dans la logique mythique du don et du sacrifice. Nous sommes dans
une mutation, dit J.-L. Nancy : dans une époque où la vie s’exploite ou se transmet, se marchande
ou se partage, où elle (se) demande sans s’imposer. C’est ainsi qu’une mutation historique sort de
l’histoire.
We are mutants: the scientific discovery of biological mutations is linked with the technical
abilities to modify our bodies. We are mythants: we have still the tendancy to bring life back to
us, as if it was our property, and to submit it to an overhanging meaning, so that the gift of life or
of organs is still resumed in the logic of gift and sacrifice. We are in a period of mutation, says J.-
L. Nancy: in a time when life can be exploited or transmitted, merchandized or shared, when life
demands without dominating. That is how a historical mutation goes beyond history.
AUTEUR
JÉRÔME LÈBRE
Collège international de philosophie
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
78
La mutation infinie du sens
Juan-Manuel Garrido
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1 1. Dans les premières lignes d’Être singulier pluriel, J.-L. Nancy écrit : « On répète
aujourd’hui que nous avons perdu le sens, que nous sommes en manque, et par
conséquent en besoin et en attente de sens »1. Au début de Le sens du monde, on peut
lire : « Il y a peu de temps encore, on pouvait parler de “crise du sens” (ce fut une
expression de Jan Patočka, et il est arrivé à Vaclav Havel de la reprendre) » 2.
2 La supposée crise du sens affecte notre capacité de produire des représentations
généralisées de la vie individuelle et collective, représentations censées nous aider à
comprendre notre présent historique et à déterminer l’action, la foi et la connaissance
humaines en vue de la construction du futur. La crise du sens est une crise de
l’humanité, de sa capacité à produire son avenir propre à partir de la production de son
sens.
3 Cependant, on doit tout d’abord dire qu’une telle demande de sens constitue déjà, en
elle-même, une source pour produire des représentations de ce genre ; en particulier,
celle de l’humanité comme productrice de sens, du sens du monde et du sens de soi
comme humanité. Quand on dit des phrases telles que celles-ci : « il faut conduire la
pensée vers la quête d’un sens pour tous, un sens pour la vie », ou bien : « il faut
construire des horizons nouveaux, des idées nouvelles pour les gens et le monde », on
propose, en réalité, des lignes directrices assez concrètes à la philosophie et à l’action, à
la science, à la technologie, à l’économie et à la politique. On présuppose ouvert un
horizon de compréhension commun (disons : nous-mêmes ou l’humanité) ; on cherche
à innover, à renouveler les possibilités de la vie humaine. On ne cherche pas à ne rien
chercher, à s’exposer à l’inconnu. Au contraire on présuppose, comme étant acquis, la
communauté humaine se reconnaissant dans l’appartenance à une tâche commune,
celle de construire son sens propre. On présuppose la signification intersubjectivement
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
79
valide des mots « devoir », « vie », « humanité » ou « futur ». Ces mots fonctionnent
comme la forme d’un contenu à construire, à déterminer. Ils possèdent le sens d’une
tâche. La crise du sens pose les questions : « que faire ? », « quel sens ? », « quel
futur ? », « quelle humanité ? », « quelle nature ? », « quelle politique ? », « quelle
économie ? », etc. ; mais elle ne met pas en question la provenance et les conditions de
sens de ces questions elles-mêmes – à savoir, du sens comme horizon d’autoproduction.
Elle ne met pas en question le sens du sens, elle ne fait pas la critique du sens.
4 2. La « crise du sens » ne fait rien d’autre que présenter, d’une part, l’auto-
compréhension de l’humanité comme tâche de sens et, d’autre part, le mode d’être ou
le sens du sens lui-même comme tâche. L’humanité saisie comme attente, demande,
nécessité ou manque de sens (bref la crise du sens) exhibe, dénude, exprime ou
présente cette auto-compréhension. Qu’est-ce qu’elle comprend, l’humanité ? Ceci, que
le manque de sens propre est le contenu lui-même de son sens propre. Ou bien, que le
sens du sens est tâche de sens. Sens signifie tâche. Sens est tâche de sens.
5 Appelons cette tâche de sens, qui correspond à un manque a priori de contenu, la
structure formelle du sens, tout en gardant à l’esprit que peut-être il n’y a pas de
structure du sens ou que la structure formelle du sens fournit le contenu essentiel du
sens. Le défi principal d’une analyse du sens serait alors de clarifier cette structure
formelle. Mon hypothèse est que ce sont au moins deux hypothèses qui guident en
général le travail de Nancy quand il s’occupe de la question de la structure formelle du
sens.
6 J’explique d’abord la première hypothèse. Les propos sur la crise du sens dénoncent ou
se scandalisent devant une mutation du sens de l’humanité. Notre civilisation, pense-t-
on, se trouverait dans un moment négatif ou transitionnel, celui d’avoir perdu le sens
et d’être en attente d’un sens nouveau. Mais, en réalité – celle-ci serait la première
hypothèse de Nancy –, il faut plutôt repérer une mutation de notre rapport au sens ou
de notre compréhension du sens : les propos concernant la crise du sens mettent à nue la
structure formelle du sens. En effet :
7 a) Les propos concernant la crise du sens possèdent au moins cette efficacité, propre à
la structure formelle du sens, qu’ils nient l’état des choses ou le monde donné comme
pouvant fournir du sens (« on a perdu le sens »). Ils nient que le monde tel quel et que
l’humanité telle quelle puissent offrir une image satisfaisante et désirable du monde et
de l’avenir. Privés de contenu, à l’attente ou en demande de nouveaux contenus, les
propos sur la crise du sens s’avèrent ainsi comme détermination nihiliste de la structure
formelle du sens. Car la demande de sens peut éventuellement être remplie par…
n’importe quel sens. Écrits il y a plus de 20 ans, ces mots prémonitoires de Jean-Luc
Nancy sur les dangers sous-jacents aux propos concernant la perte du sens offrent un
diagnostic assez exact :
« Il y a dans ce temps », écrit Nancy, « tous les risques de l’attente de sens, de la
demande de sens (comme cette banderole à Berlin, sur un théâtre, en 1993, “Wir
brauchen Leitbilder” : “nous avons besoin d’images directrices”), avec les pièges
redoutables que peut tendre une telle demande (sécurité, identité, certitude,
philosophie comme distributrice de valeurs, de visions du monde, et, pourquoi pas,
de croyances ou de mythes) »3.
8 b) Quiconque déplore la perte de sens et revendique la nécessité de réinventer ou de
retrouver le sens, présuppose que cette perte de sens et que la demande de sens font
sens, pour lui et pour autrui. Le discours sur la perte de sens fait sens, participe d’un
échange effectif de sens, d’une communication. Ainsi la « crise du sens » n’affecte pas,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
80
mais elle met en évidence, la structure par laquelle le sens fait sens. « Qu’il le sache ou
non, [celui ou celle qui parle de la crise du sens] fait beaucoup plus et il fait tout autre
chose : il met au jour ceci que “le sens”, ainsi employé absolument, est devenu le nom
dénudé de notre être-les-uns-avec-les-autres. Nous n’“avons” plus de sens parce que
nous sommes nous-mêmes le sens, entièrement, sans réserve, infiniment, sans autre
sens que “nous” »4.
9 Une fois la structure formelle du sens mise à nue, reste à en déterminer la logique.
Voici la deuxième hypothèse, grâce à laquelle la pensée de Jean-Luc Nancy ne cessera
jamais de faire sens : la mutation du sens qui met à nue la structure formelle du sens
avère que cette structure formelle est elle-même celle d’une mutation. C’est ce que je
vais expliquer dans l’espace qui me reste.
10 3. Si l’attente du sens – le besoin, le désir de sens – fait sens, c’est que le sens du sens
doit précéder et excéder le sens donné comme perte de sens et comme tâche de
remplissement. Le besoin, le désir de sens fait sens par-delà le dit, par-delà ce qui peut
être dit. Le sens précède et excède le vouloir-dire. Le besoin, le désir de sens est le
vouloir du sens précédant et excédant le vouloir-dire, ou bien c’est par où le vouloir-
dire fait sens avant de proprement dire ou de vouloir. L’attente du sens fait sens : donc
le sens se fait, se produit, se transforme pendant qu’on l’attend. L’attente de sens fait
déjà sens, un sens qui n’est pas seulement celui de l’attendu ni celui de l’attente en tant
que tâche de sens. Ce point est décisif : la structure formelle du sens est indépendante de la
structure d’une tâche. Autrement dit le sens n’est pas un horizon. La formalité du sens
n’est pas horizontalité (attention, intentionnalité, Idée, etc.).
11 « Horizon » il y a lorsqu’il y a un multiple (un « contenu ») s’unifiant en vue d’une
normativité idéale (une « forme »). L’horizon est totalité (idée, forme séparée)
contenant (synthétisant) l’infinité posée par l’être fini demandant et attendant le sens.
L’horizontalité est l’interprétation de la structure formelle du sens comme normativité
pure. Cette interprétation néglige pourtant le fait que la demande, l’attente, le besoin
ou le désir de sens font sens indépendamment du fait de se poser comme horizon. Or le
sens fait sens comme mouvement pur, indéfini, indéterminé, an-horizontal, comme
mutation disséminant le vouloir dire, précédant ou excédant toute normativité et
idéalité du sens.
12 L’horizontalité comme interprétation particulière de la structure formelle du sens peut et
doit être pensée elle-même comme le résultat d’une mutation du sens. Une mutation
majeure, si l’on veut, voire fondatrice. À suivre un ancien motif de la Krisis de Husserl,
répété et déplacé après coup par Derrida, cette horizontalité résulte de la mutation qui
a produit la philosophie et la science occidentales : « le miracle grec », l’arrivée de
l’Idée permettant la manipulation de l’infini par les moyens finis de la raison. C’est
l’introduction dans l’histoire (humaine, finie) d’horizons infinis, ou d’horizons tout
courts. Husserl écrit (et je vais traduire à dessein trois mots différents par
« mutation ») :
« Avec le surgissement de la philosophie grecque et de sa première formulation, par
une idéalisation correspondante (in konsequenter Idealisierung), du nouveau sens de
l’infini, s’est accompli, de ce point de vue, une mutation durable (eine fortgehende
Umwandlung) qui emporta dans son terrain toutes les idées de la finitude et avec
elles toute la culture spirituelle et son humanité. C’est pourquoi il y a pour nous
européens beaucoup d’idées infinies (si on peut s’exprimer ainsi) en dehors de
celles qui appartiennent à la sphère strictement philosophico-scientifique (tâches,
objectifs, vérifications, vérités infinies, « vraies valeurs », « biens authentiques »,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
81
normes « absolument » valides), mais qui doivent leur caractère d’infini à la
mutation de l’humanité (Umbildung des Menschentums) grâce à la philosophie et ses
idéalités. La culture scientifique guidée par les idées de l’infini a impliqué (bedeutet)
une révolution de toute la culture, une révolution de la façon même où l’humanité
produit la culture. Elle a impliqué aussi une révolution de l’historicité, qui
désormais est l’histoire de l’extinction (Entwerden) de l’humanité finie et sa
mutation (Werden) en humanité des tâches infinies » 5.
13 Pour Husserl, tout comme, peut-être, pour Platon, le surgissement de la philosophie et
de la science grecques est la mutation irréversible qui fait entrer l’Idée de ce qui ne
mute plus, de ce dont l’histoire consiste dans son raffinement infini. Voudrait-on
provoquer, voire tout simplement imaginer, une mutation, une révolution « radicale »
qui nous libérerait de l’horizon inmuable du sens ? On ne trouverait alors que les
ressources apportées par l’idéalité elle-même, qui sont les outils de toute pensée et de
toute pratique signifiante radicale. Même l’exercice phénoménologique employé à
imaginer des variations catastrophiques du monde – la fin de tout, y compris la fin du
sens et de la possibilité de toute mutation dedans ou dehors le sens – s’avère contingent
à l’égard de cette mutation majeure qu’aura été le surgissement de l’idéalité, qui
restera non moins idéale et non moins infinie. Comme l’écrit Derrida, « l’hypothèse de
la catastrophe mondiale pourrait même servir en ce sens de fiction révélatrice » 6.
14 La découverte de la structure formelle du sens comme mutation (deuxième hypothèse)
est loin d’être un retour au pré-fondateur, au pré-originaire, à l’en deçà de l’origine, ou,
alternativement, un saut vers une nouvelle origine qui ne serait pas contaminée par
l’infini de la science (ou techno-science) et de la philosophie (l’idéalisme). Si mutation il
y a, si mutation nous sommes en train de subir, elle ne peut venir que d’un
approfondissement, d’une radicalisation de l’infini. Cette radicalisation consiste à sur-
idéaliser l’infini, à l’in-définir, le libérant de son horizontalité.
15 L’in-finitisation de l’infini est ce qui, chez Nancy, ne cesse de se penser avec les
concepts de communication, communauté, mondialisation, sens, etc. C’est le sens
comme demande / désir / besoin / volonté de sens précédant et excédant
l’horizontalité du sens, interrompant l’idéalisation du sens. « Vouloir » qui pousse et
interrompt le « dire » dans le « vouloir-dire ». Je dirais que c’est la faim du sens, pour
bien souligner qu’il s’agit d’une demande pure ou sans attente, sans attention. Sans
idée, sans horizon, sans normativité.
16 4. Nous autres nous habitons, en effet, un monde où l’infini (le “mauvais” infini),
l’indétermination, la potentialité de la croissance et de la destruction, de l’économie, du
politique, du droit, de la guerre, de la jouissance, de la techno-science, de la bio-
ingénierie, de l’informatique, etc., ne semblent plus contenus sous la forme
déterminante et actuelle d’une horizontalité (du “bon” infini). C’est le monde d’une
infinitisation sans tâche et sans horizon.
17 L’infini affranchi de l’Idée : a-t-on appris à penser cela, nous philosophes, nous
penseurs ? L’infini affranchi de l’Idée est non seulement l’infini affranchi de Dieu et de
l’Humanité, de la Nature et de l’Histoire, de « la métaphysique de la présence », mais
aussi l’infini affranchi de nous-mêmes et des questions sur nous-mêmes, bref de la
philosophie. Notre mutation (à la différence de celle « de la science et de la
philosophie » grecques) n’est peut-être plus aussi celle de la philosophie. Peut-être
notre mutation est celle de l’extinction de la philosophie, si j’ose emprunter les mots
que Husserl utilise pour décrire la mutation de l’humanité finie en humanité des tâches
infinies. Mais l’extinction de la philosophie, elle mute en quoi ?
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
82
« Je suis de plus en plus persuadé, explique J.-L. Nancy, que nous n’avons pas tiré les
implications de ce que Heidegger a nommé « la fin de la philosophie » : la fin des
images / conceptions du monde. À la fois nous avons compris que l’élaboration de
systèmes métaphysiques ne peut jamais que refléter – et donc soutenir quelque
temps – un certain état de la représentation et de l’activité de la part dominante de
l’humanité, mais se heurte forcément à la transformation de cet état et par
conséquent à un défi renouvelé au sujet de ce qu’on nomme « la vérité ». Pour
autant, nous ne savons pas ce que “penser” veut dire si ce n’est assigner le réel sous
des significations, alors même que nous éprouvons leur labilité ou leur
inconsistance »7.
BIBLIOGRAPHIE
DERRIDA Jacques, « Introduction », in : E. Husserl, Origine de la géométrie, Paris : PUF, 1961.
GARRIDO Juan Manuel, « Phraser la mutation : entretien avec Jean-Luc Nancy », blog de Médiapart,
13 octobre 2015.
HUSSERL Edmund, Die Krisis des Europäischen Menschentums und die Philosophie, Husserliana Bd. VI –
trad. fr. : La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Paris : Gallimard,
1976.
NOTES
1. J.-L. NANCY, Être singulier pluriel, p. 19.
2. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 11.
3. Ibid., p. 2.
4. J.-L. NANCY, Être singulier pluriel, p. 19.
5. E. HUSSERL, Die Krisis des Europäischen Menschentums und die Philosophie, p. 365.
6. J. DERRIDA, « Introduction », in : E. HUSSERL, Origine de la géométrie, p. 94-95.
7. J.-M. GARRIDO, « Phraser la mutation : entretien avec Jean-Luc Nancy ».
RÉSUMÉS
Cet article analyse la notion de « sens » chez Jean-Luc Nancy à partir du constat suivant : le
phénomène du sens et de la supposée « crise du sens » qui traverserait aujourd’hui l’humanité
révèle que le sens du sens est lui-même celui d’une mutation. Face à cette révélation, il ne s’agit
plus de poser la question : « que faire ? », « vers où aller ? » ou « comment orienter une nouvelle
mutation ? ». Il s’agit d’entamer la critique du sens, la recherche des conditions de possibilité de
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
83
la production et de transformation du sens, c’est-à-dire du monde lui-même par la pensée, la
connaissance et l’action.
The paper analyzes the notion of “meaning” in Jean-Luc Nancy, based on the following
observation: the phenomenon of meaning and of the so-called “crisis of meaning” that humanity
would be today undergoing reveals that the meaning of meaning is itself that of a “mutation.”
Faced with such revelation, it is no longer a question to ask: “what to do?”, “Where to go?”, “How
to shape a new mutation?”; rather, we should try to begin a critique of meaning, an exploration
of the conditions of possibility for the production and transformation of the meaning of the
world by thought, knowledge and action.
AUTEUR
JUAN-MANUEL GARRIDO
Université A. Hurtado – Santiago du Chili
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
84
L’adresse de l’entre-nous :
l’interprétation plastique de Hegel
chez Jean-Luc Nancy
Yuji Nishiyama
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1. Jean-Luc Nancy, lecteur de Hegel
1 Jean-Luc Nancy n’a cessé de développer une pensée originale sur la communauté, le
corps, le sens, la liberté, le technique, le monde ou le christianisme, en dialogue non
seulement avec la philosophie, mais aussi avec la religion, l’art, la psychanalyse ou la
politique, etc. Nous traitons ici notamment la philosophie de Hegel en tant que force
motrice qui a causé des mutations dans la pensée de Nancy.
2 D’abord, nous faisons un bref rappel des travaux que Nancy a consacrés à Hegel. En
1963, Jean-Luc Nancy a rédigé son mémoire Figure et Vérité : Le problème de la
représentation dans l’analyse hégélienne de la religion révélée sous la direction de Paul
Ricœur. Dans la religion révélée, le corps du Christ, immanent, accède à l’universalité
pour soi grâce à la valeur symbolique que lui donne la communauté de l’Église. Nancy
met en cause la structure du christianisme, qui permet à l’esprit de passer de la religion
à la philosophie grâce au Christ qui est à la charnière entre figure et vérité,
représentation et vérité. Est-il exagéré de dire que l’on peut déjà deviner la tournure
que prendront par la suite les recherches de ce jeune Nancy qui essaie d’analyser Hegel,
en refusant aussi bien l’interprétation athée d’Alexandre Kojève que l’exégèse
chrétienne d’Henri Niel ? Est-il excessif de voir là l’une des matrices de la
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
85
déconstruction du christianisme, à savoir la réflexion sur les relations entre religion et
philosophie, entre théisme et athéisme ?
3 Ensuite, son premier ouvrage La Remarque spéculative (un bon mot de Hegel) (1973), rédigé
en se basant sur une communication dans le séminaire de Jacques Derrida, concernera
précisément la dialectique de Hegel. Nancy analyse minutieusement le premier
chapitre « Être » dans La Science de la logique de Hegel, essaie d’interpréter à sa manière
l’expression « Aufhebung » qui fonctionne au cœur de la dialectique. Nancy fera souvent
par la suite référence au philosophe allemand, dans plusieurs articles. En 1997, il a
publié un petit ouvrage Hegel : l’inquiétude du négatif, qui porte sur tout le système
philosophique de Hegel, y compris la logique, le temps, la liberté, voire la communauté.
2. L’initiation à la philosophie de Hegel
4 Nancy a essayé de dialoguer avec Hegel en s’appuyant sur les textes principaux tels que
La Phénoménologie de l’esprit, La Science de la logique, l’Encyclopédie des sciences
philosophiques ou Les Principes de la philosophie du droit. Dans le préambule de La
Remarque spéculative, il pose une question fondamentale, « Qu’est-ce que lire
Hegel ? », et cherche une réponse dans l’introduction de La Phénoménologie de
l’esprit1. Selon Hegel, la proposition philosophique se lit le plus souvent suivant le
rapport ordinaire entre le sujet et le prédicat. Il s’agit de style démonstratif d’ajouter le
prédicat comme accident au sujet stable. Or, si l’on pose Dieu comme sujet, il est
impossible d’ajouter une détermination finie à cette substance infinie. Le Dieu n’est
déterminé que par l’intuition intellectuelle ou par la foi, de sorte que cette façon de
penser ne peut qu’aller dans un mauvais infini. Ce style fait s’égarer les lecteurs entre le
fini et l’infini et déplorer les difficultés des ouvrages philosophiques. Mais, selon Hegel,
le vrai lecteur doit répéter la lecture jusqu’à ce que la forme de la proposition soit
transformée. La philosophie nécessite non pas une pensée formelle qui combine le sujet
substantiel et le prédicat accidentel, mais le concept au sens hégélien, à savoir le
mouvement qui saisit la proposition autrement par son contenu. Dans la proposition
« le Dieu est l’être », c’est en réalité « l’être » comme substance qui met en cause le
sujet, ce qui produit le mouvement du concept : « Qu’est-ce que l’être (qui est le
Dieu) ? » Le sujet se développe ainsi lui-même et retourne en soi-même, ce mouvement
dialectique est donc exigé par la proposition philosophique.
5 En tenant compte de cette interprétation hégélienne, Nancy ajoute encore « Lire Hegel,
c’est donc, sinon le réécrire, du moins en répéter plastiquement l’exposition » 2. Le
système hégélien consiste dans l’auto-mouvement de ses concepts. Nancy, tout en
suivant Hegel, essaye de découvrir des moments qui provoquent un tremblement le
plus définitivement dans ce système. L’interprétation de Nancy est une transformation
répétitive de Hegel, il serait dès lors indispensable de considérer à quel endroit il entre
dans la philosophie hégélienne : « le problème de l’introduction à la philosophie de
Hegel, c’est toute la philosophie de Hegel »3.
6 Tout en répétant d’une manière plastique les textes de Hegel, comment Nancy
introduit-il à la philosophie de Hegel ? Ce qui est intéressant dans l’interprétation de
Nancy consiste en ce fait que Hegel semble toujours double à ses yeux. Hegel est à la
fois un philosophe qui conduit le sujet à son achèvement et un philosophe qui ouvre la
clôture du sujet comme l’Un. Dans « la proposition » de Cahiers confrontation : Après le
sujet qui vient, Nancy détermine une fois Hegel comme un philosophe du sujet.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
86
« La définition majeure du sujet est pour moi celle de Hegel : “ce qui est capable de
retenir en soi sa propre contradiction”. Que la contradiction soit propre (on
reconnaît la loi dialectique), c’est-à-dire que l’aliénation ou l’extranéation soit
propre, et que la subjectivité consiste à ré-approprier ce propre être-hors-de-soi,
voilà ce qu’engage la définition »4.
7 Le sujet hégélien ne cesse de s’approprier tous les autres d’une manière téléologique
par le mouvement dialectique qui relève la propriété et la non-propriété, de sorte que
même l’autre le plus étranger s’inscrit déjà dans le Soi hégélien. Tout en accompagnant
ce mouvement circulaire du Soi, Nancy cherche « la chance de trouver, par surprise, la
chance dans Hegel »5, à la fois l’ouverture et la fin de la philosophie de Hegel. Comme
Derrida l’a bien montré, pour Nancy aussi, Hegel est toujours déjà déconstruit dans ses
limites.
3. L’individu et la communauté
8 Parmi les moments partagés par ces deux philosophes de différents siècles, par
exemple, les questions de l’individu et de la communauté sont les plus significatives.
9 Dans l’article « Identité et tremblement »6, Nancy analyse la naissance de l’individu
selon Hegel. Nancy cite le § 405 sur l’âme (Seele) dans l’Encyclopédie, l’étape ténébreuse
avant que l’esprit ne se manifeste en tant que conscience. Il y réfléchit sur un embryon
du point de vue du partage originel avec sa mère. Un embryon sans soi reste l’âme
sensible au sein de sa mère. L’embryon est un individu sans propriété, sans soi positif
qui est capable de réagir à sa mère. L’individualité de l’embryon n’est qu’une âme qui
dépend de sa mère. À son origine, cet individu sans soi n’est autre que le tremblement
causé par l’autre individu.
« La passivité n’est pas individuelle : on peut être actif seul, mais on peut être passif
qu’à deux ou à plusieurs. La passivité est, de l’individu, ce qui tremble et s’écarte de
lui, l’écartant de soi, l’espaçant d’un battement. C’est le cœur, en effet, comme le
rythme d’un partage »7.
10 Ensuite, tournons les yeux vers la phrase de Hegel : « La mère est le génie (Genius) de
l’enfant ». Cette phrase ne veut pas simplement dire que la mère donne les émotions
immédiates à son enfant, car les deux sont encore identiques tout en étant séparés l’un
de l’autre. Le génie n’est pas en effet le terme communautaire qui comprend
totalement la mère et son enfant, mais la communauté même qui tremble et affecte
tous les deux qui s’interpénètrent. L’enfant sans soi reste dans le ventre de la mère,
exposé extrinséquement à la communauté nommé le génie. La logique de la frontière de
l’individu est donc mise en cause par ce tremblement entre le soi de la mère et le non-
soi de l’enfant.
11 Nancy propose l’expression « à même soi » pour la traduction française de « an sich » 8.
La préposition « an » n’implique pas par essence la signification de l’identité. « An sich »
ne veut pas dire le soi qui se replie sur soi-même sans relation avec les autres, comme
on l’a pensé souvent. Pour Nancy, « an sich » est l’état où le soi touche son bord. Sans
doute, il n’y a pas de trait plein qui trace le bord de soi, mais ce bord constitue le
passage qui ferme l’intérieur de soi et ouvre vers l’extérieur. Le processus dialectique
hégélien commence par « an sich », où le soi hégélien s’expose à l’autre tout en restant
auprès de soi comme une communauté entre la mère et son embryon. Nancy remarque
que « du reste, l’ontologie de la communauté n’a pas d’autre tâche que de radicaliser,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
87
ou d’aggraver jusqu’au défoncement, et via la pensée hégélienne du Soi » 9. Pour lui, le
soi hégélien est un moment pour mettre en cause l’individu et la communauté.
4. L’inquiétude de la philosophie de Hegel
12 Pour Nancy, Hegel n’est pas un philosophe impassible qui totalise le monde, ni un
penseur qui a préconisé le mouvement dialectique tendant à conduire l’humanité à « la
fin de l’histoire ». La philosophie de Hegel est plutôt celle qui n’achève jamais l’Histoire
au nom de l’Absolu. Elle ne cesse de produire le sens du monde, sans aucuns donnés
telles que « nature », « dieux » ou « communauté », en relation inséparable avec notre
existence. Chez Hegel, paradoxalement, « le sujet se constitue et se libère dans la
dimension et selon la logique de la négation du « donné » en général » 10. Dans un livre
intitulé Hegel : l’inquiétude du négatif, Nancy choisit le terme « inquiétude / Unruhe »
comme le mot-clé pour interpréter toute la philosophie de Hegel. Nancy explique ce
terme à partir de l’addition de § 378 dans L’encyclopédie : « L’esprit n’est pas quelque
chose qui est en repos, mais bien plutôt ce qui est absolument sans repos (unruhig),
l’activité pure, la négation ou l’idéalité de toutes les déterminations fixes de
l’entendement »11. Selon Hegel, l’esprit a conscience de la séparation avec soi, et
s’éprouve comme un monde de la séparation. L’inquiétude du négatif signifie ici le
développement dialectique par lequel l’esprit se retourne en soi grâce à la séparation
de soi.
13 Or, n’est-ce pas un fait simple par essence que la philosophie de Hegel se trouve sans
cesse dans un devenir inquiétant ? Son système philosophique consiste en effet en un
mouvement dialectique qui relève la contradiction dans les choses. Prenons l’exemple
du devenir dans La science de la logique de Hegel. « L’être pur » reste encore un vide sans
différence, n’ayant qu’une détermination la plus simple d’être ; « le néant pur », lui
aussi, est un vide parfait, sans aucune détermination. Il est vrai que « l’être pur » et « le
néant pur » semblent précisément opposés, mais les deux sont les mêmes
déterminations pures. Cette contradiction entre l’identité et la non-identité permet de
produire « le devenir » en double passage de l’être au néant et du néant à l’être. Ce
double mouvement ne reviendra jamais à nouveau à l’être pur, ni au néant pur, dans la
mesure où le devenir reste « l’inquiétude sans appui » (1-1-1-3) poussée par une
contradiction en soi. Au commencement de l’ontologie du devenir chez Hegel, la
contradiction entre l’être et le néant « ne peut s’exprimer qu’en tant que l’inquiétude
incompatible » (1-1-1-note 2).
14 Quelle mutation l’interprétation de Nancy donne-t-elle donc au devenir dialectique
hégélien ? Nancy met l’accent sur le mot « inquiétude/Unruhe » dans son analyse de
Hegel, afin d’introduire une ouverture ontologique dans le système hégélien, en
référence à la notion de « l’Être » chez Heidegger. La philosophie de Hegel ne décrit pas
la présence de l’Absolu comme la présence de l’Être, mais le passage inquiétant où
l’esprit s’expose à la présence de l’Absolu, en creusant un vide ontologique.
« L’inquiétude sans appui », cette fois comme « étrangeté inquiétante » (Freud), met à
l’épreuve la philosophie de Hegel. Nancy lit Hegel à la limite où le mouvement hégélien
de l’esprit s’expose « hors du soi ». Cette interprétation audacieuse ne se réduit-elle
pas, aux yeux de Hegel, au « mauvais infini » ? Suivant Hegel, il faudrait éviter « le
mauvais infini » où le fini n’arrive pas à saisir l’infini, alors que « le vrai infini »
contient tous les finis par le retour à soi. Non, Nancy ne tombe pas dans « le mauvais
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
88
infini », car il n’en appelle pas à l’infini hors des finis, mais il remarque la philosophie
de Hegel comme le monde sans extériorité transcendante, justement basé sur les
existences finies. Nancy affirme pleinement « le vrai infini », à savoir le monde sans
commencement ni fin, en même temps, l’infini s’ouvre donc comme une destination de
toutes les existences dans le monde. Il s’agit d’une brisure du monde, produite par
chaque arrivée de l’infini dans le vrai infini : cet événement que Nancy montre bien
avec le mot « l’inquiétude ». Le préfixe « ex » que Nancy utilise souvent désigne le
dehors dans le vrai infini : « Comment l’esprit est le fini qui se trouve lui-même infini
dans l’ex-position de sa finitude, voilà ce qui est à penser – c’est-à-dire : voilà ce que
c’est que “penser” »12.
5. L’espacement de l’entre-nous
15 Nancy conclut son livre Hegel avec le chapitre « Nous », en référence à la préface et à
l’introduction de La Phénoménologie de l’esprit. Comme l’a bien remarqué Alexandre
Kojève, La Phénoménologie consiste en un double point de vue : une description
empirique que l’esprit donne « pour la conscience » dans le développement dialectique,
et une description donnée par le philosophe Hegel qui a déjà abouti au savoir absolu,
c’est-à-dire une description scientifique « pour nous », Hegel et ses lecteurs. Cette
structure narrative maintient La phénoménologie de l’esprit, dont la préface et
l’introduction sont décrites en position de « nous ». Dans « Hegel et son concept de
l’expérience », Heidegger en donne une interprétation ontologique. Il cite un passage
de Hegel « l’Absolu est, depuis le début, en et pour soi auprès de nous, et veut
être auprès de nous »13, qui veut dire l’être illuminé par l’Absolu, à savoir la lumière de
la vérité. Cet être-présent auprès de nous (bei uns), la parousie, signifie, selon
Heidegger, se trouver à la présence de l’Absolu en son absoluité. « Cet être-auprès-de-
nous, c’est déjà et en lui-même la façon dont la lumière de la vérité, l’absolu lui-même,
nous illumine. La connaissance de l’absolu qui se trouve sous le trait de cette lumière, le
rend et le reflète, et est ainsi, en son essence, le trait irradiant lui-même, et non pas un
« milieu » quelconque à travers lequel le rayon aurait d’abord à passer » 14.
16 Tout en citant le même passage, Nancy, lui, remarque : « C’est nous qui sommes
exposés, et ainsi c’est à nous que nous sommes exposés » 15. Il met l’accent sur
l’exposition des infinis à l’Être, pour introduire l’espacement de l’« entre-nous ». Il
interprète ce « nous » hégélien comme l’inquiétude même de chaque singularité
existante.
« L’absolu est entre nous. Il y est en et pour soi, et l’on peut dire : le soi lui-même
est encore nous. Mais « le soi lui-même est l’inquiétude » : entre nous, rien ne peut
être en repos, rien ne peut s’assurer d’une présence ni d’un être, et nous passons les
uns après les autres tout autant que les uns dans les autres. Les uns avec les autres,
les uns auprès des autres : l’auprès de l’absolu n’est rien d’autre que notre auprès les
uns des autres »16.
17 Auprès de l’absolu, « nous » exposons chaque fois notre propriété l’un à l’autre, dans le
devenir du monde. Pour Nancy, l’Absolu chez Hegel n’est pas la parousie de « nous »
présents dans la lumière de la vérité, mais l’« entre-nous » où la finitude des existants
s’adresse à leur intervalle ontologique. Nancy arrive donc à découvrir l’« entre-nous »,
une communauté ontologique, dans l’inquiétude du négatif chez Hegel. Le partage
radical entre nous, sans substance rigide, ni lien unificateur, produit le sens du monde
à partir de cette distance et distension ontologiques. La proximité sans continuité entre
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
89
les existants rend possible chaque fois l’horizon du sens, l’élément où toutes les
significations se produisent et circulent.
6. L’infini actuel comme mutation du monde
18 Concernant l’attentat du 11 septembre à New York, Nancy a fait un diagnostic
philosophique, selon lequel nous ne nous trouvions pas dans une guerre de
civilisations, mais dans une guerre civile. La notion même de civilisation a bien échoué,
en laissant une profonde déchirure dans notre monde. Il s’agit de « la béance du sens,
de la vérité ou de la valeur » causée par le fait que la pensée de l’Un pratiquée par
l’Occident mondialisé a atteint la dernière limite.
« Il ne s’agit ni de culpabiliser l’Occident ni de revendiquer un Orient mythique : il
s’agit de penser un monde en lui-même et par lui-même brisé, d’une brisure qui
provient du plus reculé de son histoire et qui doit bien d’une manière ou d’une
autre, pour le pire et peut-être – qui sait ? – pour l’un peu moins pire, constituer
aujourd’hui son sens obscur, un sens non pas obscurci, mais dont l’obscur est
l’élément. C’est difficile, c’est nécessaire. C’est notre nécessité aux deux sens du
mot : c’est notre pauvreté et notre obligation »17.
19 Nancy ose appeler « guerre civile » la situation post-11 septembre, car il lui semble que
l’« entre-nous » judéo-christiano-islamique s’affronte lui-même et apporte « l’obscur
singulier » à notre monde. Il éveille l’attention de ne pas « bander la plaie avec les
oripeaux habituels » tels que « toute-puissance » ou « toute-présence ». Il est très
sensible à la brisure du sens qui nous fait entrevoir le mauvais infini du monde. Dans La
création du monde ou la mondialisation, il n’analyse pas uniquement la globalisation
accélérée ces dernières années dans les perspectives des innovations technologiques ou
de la croissance économique. Dans un sens plus vaste, la mondialisation présente peut
être définie par le processus de l’élargissement de l’Occident basé sur le monothéisme
judéo-christiano-islamique, qui a démarré le capitalisme et lui a permis de se
développer. Le système capitaliste n’a cessé de répéter, avec le mécanisme des plus-
values, une circulation infinie de l’investissement, de l’exploitation et du
réinvestissement, afin d’augmenter l’accumulation du capital. Nancy reconnaît
l’essence de la mondialisation dans ce processus d’autoproduction qui continue à se
fonder elle-même et à poser un nouveau but devant soi, un but tel qu’on peut l’appeler
« le mauvais infini » au sens hégélien.
20 Pour penser autrement cette mondialisation plutôt techno-économique, Nancy indique
l’autre infini : « l’infini actuel, celui par lequel une existence finie accède, en tant que
finie, à l’infini d’un sens ou d’une valeur qui est son sens ou sa valeur les plus propres »
18
. « L’infini actuel » s’opère justement dans « ce monde » composé par les existants, qui
est « un fait sans raison, sans fin ». Comme on l’a vu dans l’interprétation par Nancy de
Hegel, ce monde auquel notre finitude s’expose est créé à chaque fois à partir de rien,
sans aucune instance transcendante, sans fondation absolue. « Le monde est créé de
rien. […] Dans la création, une croissance croît de rien et ce rien prend soin de lui-
même, cultive sa croissance »19. La création d’un nouveau monde se révèle dans la
mesure où les existants finis touchent au néant sans fondement. Différent de l’image du
monde capitaliste, pour Nancy, cet « infini actuel » créateur est la mutation la plus
radicale du monde, dégagée de toute finalité.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
90
7. Après la catastrophe de Fukushima
21 Jean-Luc Nancy est l’un des premiers philosophes qui a répondu aux problèmes
compliqués soulevés par le grave accident à la centrale nucléaire à Fukushima le
11 mars 2011. Tout en témoignant du respect à sa réflexion sur cette catastrophe, nous
allons conclure notre discussion sur ce sujet. Dans L’équivalence des catastrophes, écrit
après l’accident de Fukushima, il met l’accent sur le lien étroit qui existe entre désastre
naturel et accident humain. L’intitulé L’équivalence des catastrophes ne dit pas que toutes
les catastrophes sont équivalentes. Bien entendu, chaque catastrophe constitue un
événement singulier qui a lieu dans son propre contexte, avec des victimes
particulières. Pourtant, toute catastrophe, qu’elle soit naturelle ou humaine, non
seulement exerce une grande influence technique, économique ou politique, mais
montre également que la configuration civilisée est celle où l’homme et la nature
s’enchevêtrent à l’échelle planétaire. Marx nomme « équivalence générale » l’argent,
qui permet d’échanger tous les biens. Nancy, pour sa part, considère que cette logique
de convertibilité s’étend à tous les domaines humains tels que la force, le sens ou les
valeurs, etc. Le capitalisme et la technologie économique s’interpénètrent dans tous les
coins du monde, les significations et les valeurs se mélangent de façon complexe les
unes avec les autres. C’est là ce que Nancy nomme « l’équivalence générale ». C’est
précisément cette condition d’équivalence qui fait qu’une catastrophe locale génère un
enchaînement de catastrophes sur un périmètre très étendu. Étymologiquement,
d’ailleurs, « catastrophe » dérive du mot grec katastrophè : bouleversement,
renversement ou retournement décisif. L’équivalence des catastrophes, telle que Nancy
l’a nommée, pourrait causer la mutation bouleversante du monde dans notre
civilisation moderne.
22 La catastrophe de Fukushima a révélé de nouveau le problème de l’énergie nucléaire,
non seulement lors d’un accident, mais aussi en temps ordinaire : les déchets
nucléaires. Nous devons garder les déchets nucléaires, pour laisser passer la durée de
demi-vie de la substance radioactive, à savoir, la durée nécessaire pour que la moitié
des noyaux radioactifs d’une source se soient désintégrés (30 ans pour le Césium 137,
29 ans pour le Strontium 90, 24 000 ans pour le Plutonium 239…). Les déchets
hautement nucléaires se produisent non seulement de la stabilisation de la centrale
nucléaire détruite, mais aussi de la dépollution des maisons, des écoles, des rues, des
champs, etc. En réalité, des milliers et des milliers de grands récipients noirs de déchets
couvrent de plus en plus les paysages à Fukushima. Les déchets nucléaires ne sont rien
d’autre que « la négativité sans emploi », selon les termes proposés par Bataille contre
la logique de la dialectique de Hegel. Il est extrêmement malaisé de trouver des lieux
pour se débarrasser en sécurité une grande quantité de déchets nucléaires plusieurs
centaines de milliers d’années durant. On attendait beaucoup de la technologie de
recyclage nucléaire qui consiste à retirer à nouveau de l’énergie des déchets nucléaires.
Après bien des échecs, il nous semble enfin que ces projets dialectiques sont
impossibles à réaliser pour l’humanité.
23 La mutation catastrophique qui a radicalement bouleversé la vie à Fukushima n’a pas
eu lieu un instant, mais ses effets actuels ou virtuels ne sont pas encore achevés. Devant
cette réalité du « mauvais infini », comment devons-nous retrouver un sens à la mesure
de l’Humanité et de sa finitude ? Dans « Après Fukushima », Nancy définit l’accident
comme une sorte de mutation dans les civilisations de la production. Concernant
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
91
l’« après » Fukushima, cet « après » ne peut être que semblable à l’« après » du monde
grec par rapport aux mondes mésopotamiens, hittites, égyptiens, étrusques ou celtes.
C’est-à-dire l’« après » d’une rupture ou d’une « mutation ». « Fukushima – après
Hiroshima, Auschwitz, le délabrement de tout l’ordre colonial et les mutations
techniques et spirituelles du XXe siècle – devient le nom de l’inopiné qu’on avait
pourtant déjà commencé à soupçonner : le nom d’un processus (progrès ?
entraînement ? affolement ?) qui se connaît à la fois imprévisible et trop prévisible – ne
pouvant, pour finir, que prévoir sa propre catastrophe ».
24 Ici aussi, avec Nancy qui interprète plastiquement Hegel, nous devrions nous
confronter à la question de la décision pour prévoir l’avenir après Fukushima. Il est vrai
qu’il n’est pas aisé de trouver un moment de décision dans la philosophie de Hegel, car
tout y est médiatisé d’une façon dialectique. Mais Nancy parle d’une sorte de liberté de
la décision chez Hegel. Je ne me décide pas librement pour des possibles, mais je me
décide hors du moi, en me libérant. Je me décide quand je sors de l’infinité de la
subjectivité et réalise la singularité avec les autres. La décision aurait lieu entre le soi et
l’autre, pour commencer et recommencer le sens du monde.
« La décision est l’acte de la singularité concrète, et le devenir de la libération. Son
savoir seulement le savoir absolu : savoir absolument concret, de tous en tant que
de personne, qui nie absolument l’indépendance et la consistance de toute certitude
de soi. Savoir de l’inquiétude, savoir sans repos – mais ainsi, et pas autrement,
savoir »20.
25 Afin de sortir du mauvais infini après Fukushima, comment pouvons-nous donc nous
imaginer l’adresse de notre décision, c’est-à-dire ma décision singulière avec les autres,
y compris les morts passés ou les enfants futurs ?
BIBLIOGRAPHIE
DERRIDA Jacques, Glas, I, Paris : Denoël, 1981.
HEGEL G. W. F, La phénoménologie de l’esprit, I, trad. J. Hyppolite, Aubier, 1941.
HEGEL G. W. F, Encyclopédie des sciences philosophiques, III, Philosophie de l’esprit, trad. B. Bourgeois,
Paris : Vrin, 1988.
HEIDEGGER Martin, « Hegel et son concept de l’expérience », Chemins qui ne mènent nulle part, Paris :
Gallimard tel, 1962.
NOTES
1. Cf. J.-L. NANCY, La Remarque spéculative (un bon mot de Hegel), p. 19 et suivantes.
2. Idem, p. 22.
3. J. DERRIDA, Glas, I, p. 5.
4. J.-L. NANCY, « Présentation », p. 9.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
92
5. J.-L. NANCY, La Remarque spéculative, p. 17. Peut-on être surpris devant l’événement, si le système
hégélien prévoit tous les événements ? Voir aussi « Surprise de l’événement », passim.
6. J.-L. NANCY, « Identité et tremblement ».
7. Idem, p. 43.
8. J.-L. NANCY, La Remarque spéculative, p. 111-113.
9. J.-L. NANCY, La Communauté désœuvrée, p. 205.
10. J.-L. NANCY, Hegel : l’inquiétude du négatif, p. 7.
11. G. W. F. HEGEL, Encyclopédie des sciences philosophiques, p. 381.
12. J.-L. NANCY, Hegel, p. 45.
13. G. W. F. HEGEL, La Phénoménologie de l’esprit, p. 66.
14. M. HEIDEGGER, « Hegel et son concept de l’expérience », p. 162-163.
15. J.-L. NANCY, Hegel, p. 116.
16. Idem, p. 117.
17. J.-L. NANCY, La Communauté affrontée, p. 20.
18. J.-L. NANCY, La Création du monde ou la mondialisation, p. 45.
19. Idem, p. 55.
20. J.-L. NANCY, op.cit., p. 112.
RÉSUMÉS
La philosophie de Hegel est la force motrice qui a causé des mutations dans la pensée de Jean-Luc
Nancy. Nancy a traité de Hegel, entre autres, depuis son mémoire Figure et Vérité jusqu’à Hegel :
l’inquiétude du négatif, pour réfléchir sur le christianisme, la dialectique, la logique, le temps, la
liberté, l’individu et la communauté, etc. Quelle mutation l’interprétation de Nancy donne-t-elle
au devenir dialectique hégélien ? Nancy met l’accent sur le mot « inquiétude/ Unruhe » dans son
analyse déconstructive de Hegel, afin d’introduire une ouverture ontologique (l’espacement de
l’entre-nous) dans le système hégélien.
The philosophy of Hegel is a motive force that has caused mutations in the thought of Jean-Luc
Nancy. From his dissertation, Figure and Truth, to Hegel: The Restlessness of the Negative,
among others, Nancy has discussed Hegel to reflect on such topics as: Christianity, dialectic,
logic, time, liberty, the individual and community, etc. How has Nancy’s interpretation mutated
the Hegelian dialectical movement? Nancy emphasizes the word “restlessness/ Unruhe” in his
deconstructive analysis of Hegel, to introduce ontological openness (the spacing of “between-
us”) into the Hegelian system.
AUTEUR
YUJI NISHIYAMA
Université de Tokyo
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
93
« Seul le permanent change »
Mutations et histoire chez Jean-Luc Nancy
Andrea Potestà
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
Sommes-nous héritiers de quoi que ce soit –
d’une histoire, d’une culture ? […]
Nous ne savons rien de ce qui fait passage ou
plutôt de ce qui se passe dans le passage.
Jean-Luc Nancy, « Déshérence », Carnets du
Portique.
1 Dans le petit texte « Déshérence », publié en 2011 dans les Carnets du Portique, Jean-Luc
Nancy, pour répondre à la question « Sommes-nous héritiers […] d’une histoire, d’une
culture ? », affirme – et c’est la phrase finale du texte – qu’il n’y a « ni héritage, ni
déshérence, ni transmission, ni interruption, mais passage, survenue, échappée » 1.
Cette liste de mots et l’opposition qui s’y annonce indiquent peut-être de la manière la
plus directe, même si énigmatique, la relation de Nancy à l’histoire et la complexité
inhérente au terme « mutation ».
2 Où réside la complexité mentionnée ? Dans le fait qu’une limite constitutive s’impose
lorsqu’on cherche à indiquer une véritable mutation historique et à reconnaître les
tendances qui s’affirment dans l’histoire présente. On n’est probablement jamais
vraiment à même d’isoler et de montrer du doigt une mutation comme telle. S’il y a
mutation dans le monde qui nous entoure, nous n’en savons en vérité rien de défini,
rien qui fasse de ce qui est passé ou qui vient de se passer le véritable indice d’un
mouvement, d’une séquence, d’ une évolution. Nous n’avons jamais prise sur
l’avènement du nouveau, du différent. Et nous n’avons pas cette prise, parce que ce qui
se passe ne fait pas corps unique, ne s’offre pas dans une consistance adéquate au
savoir historique. Ce qui arrive n’est en rien de l’ordre du savoir : lorsqu’un savoir veut
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
94
interpréter le présent, ou tout simplement détacher un événement du fond de ce qui advient
afin de montrer une supposée « orientation » de l’histoire, cela ne peut se faire qu’en
franchissant la limite de la fiction, de la narration inventive. La mutation paraît donc
insaisissable en tant que telle.
3 En même temps, on a l’impression de reconnaître constamment dans l’actualité les
signes d’événements décisifs. Tel attentat ou acte de guerre, tel passage de mandat entre
un président et un autre, entre un parti et un autre, telle crise diplomatique indiquant
la nouvelle orientation des relations internationales entre ces pays, etc. : il s’agit là, à
bien des égards, d’indices capables de signaler une transformation ou un changement
définis. Même si nous n’avons pas les mots pour le nommer, le sentiment de ce passage,
le frémissement ou la secousse de voir le monde se transformer, n’en sont pas moins
évidents et clairs. Le monde, tel qu’on le connaît, est à la dérive et vit une rupture épocale,
dit-on. On peut ne pas avoir encore de noms adéquats pour ce qui arrive, ou on peut en
avoir plusieurs qui restent vagues ou qui ne font que partiellement allusion à ce qui se
passe réellement – on peut invoquer, pour expliquer ce qui se passe, le colonialisme,
l’impérialisme, la démocratie et son trou noir, la guerre sainte, la guerre profane, la
crise du Moyen Orient, la mystification du sacrifice, le populisme, l’inéluctable
remontée du mystique dans l’exercice de la souveraineté, et milles autres récits qui
nous mettent dans la fiction d’une compréhension de ce qui se passe –, mais, même
dans la difformité de toutes les lectures, ce qui est à nos yeux certain c’est que quelque
chose se transforme, que quelque chose déstabilise le sens que nous avons connu et nous livre à
une nouvelle époque où la sociabilité, la vie commune, la culture, le savoir, ne sont
probablement plus régis sur les mêmes équilibres qu’auparavant et où la manière de s’y
livrer a été résolument affectée. Une mutation – nous disons –, même si insaisissable,
est en tout cas clairement en cours, et par là nous voulons indiquer qu’il nous paraît
incontestable qu’un changement radical est à l’œuvre, que l’ordre des choses a été
bouleversé, qu’une nouvelle preuve et une nouvelle tâche s’entrouvrent pour nous.
4 Or, c’est là que se fait évidente l’ambivalence de la notion de mutation : elle nomme
quelque chose d’innommable, d’insaisissable, alors même qu’elle paraît indiquer
quelque chose d’évident et palpable. Si nous analysons la transformation qui se fait
autour de nous et affirmons qu’une mutation est en cours, nous courrons le risque de
nous maintenir dans une superficialité ou, pire, dans une compréhension idéale de
l’actualité, dans la mesure où penser le temps présent, le raconter selon des
orientations générales, nous confronte constamment au risque de nous maintenir dans
une surestimation des événements, ou même dans une superstition qui voit partout le
sens de tout. Le spectre de l’hégélianisme y demeure et risque de banaliser la
compréhension que nous portons de l’histoire et de l’actualité. Il faut, devant ce risque,
concevoir un outil plus précis qui nous fournisse les moyens pour, si ce n’est pas
« mesurer », du moins se mettre en relation avec ce qui se prétend transformateur de
notre monde. Il est clair que tout n’est pas révélateur de tout et qu’il n’y a pas non plus
une force unique qui transporterait les événements vers leur accomplissement. La
mutation n’est pas une puissance qui viendrait orienter les événements ou les ordonner
dans un suivi sensé et téléologique. S’il y a mutation, elle ne doit pas être conçue
comme quelque chose qui s’ajoute au monde, mais, transitivement, comme sa propre
modalité d’existence. Autrement dit : que « ça craque » est synonyme du fait que « ça
existe ».
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
95
5 Ce petit constat nous oblige déjà à ne pas pouvoir nous tenir dans une relation
d’opposition ou d’appréciation quelconque de ce qui arrive. La mutation, pourrait-on
dire en suivant Nancy, c’est l’être lui-même hors de son essence, le fait de ce qui
n’existe qu’en advenant. De ce point de vue, ce qui mérite d’être questionné n’est pas la
mutation comme telle, mais la qualité d’événement transformateur de ce qui la rend
possible. Doit-on qualifier de rupture épocale une bombe, un attentat, un nouveau
mandat présidentiel ? On ne se demande pas, bien entendu, si un attentat est assez
important pour « faire événement historique », mais on s’interroge sur la
« nommabilité » d’un fait présent comme révélateur de futur, ou comme révélateur du
chemin que l’histoire « aurait pris », c’est-à-dire, de la possibilité qu’un fait singulier
devienne légitimement à nos yeux indice d’une tendance ou d’une mouvance ou d’une
orientation qui aurait déjà commencé à transformer notre présent dans quelque chose
d’encore inouï. La question est alors : qu’est ce qui autorise à indiquer quelque chose
qui arrive aujourd’hui comme une étape, un moment d’un passage ou, au contraire,
comme pur accident qui ne révèle rien de la mutation que nous vivons ?
6 Il ne s’agit donc pas seulement de l’événement lui-même, ni de l’histoire dans son
ensemble, mais précisément de la relation d’une chose à l’autre : la question de
l’histoire (ou du processus) comme ensemble de ruptures et de la crise (ou de
l’événement) comme partie d’un mouvement. Voici l’enjeu du mot « mutation » :
l’exigence de penser la relation de l’histoire avec les événements, sans courir le risque
de tomber dans la simplicité d’une lecture linéaire et dialectique. L’héritage hégélien a
montré que les pires justifications politiques, les pires simplifications totalisantes ou
totalitaires de l’histoire, se sont appuyées sur une banalisation relative à ce passage, ou
au passer de ce qui se passe. Toutefois, si cela veut dire que nous ne devons pas
concéder à l’histoire et à son mouvement général quelque pouvoir que ce soit sur les
faits, cela vaut aussi, bien évidemment, pour les instants qui la fracturent. L’histoire,
comme l’enseigne la dérive idéologique heideggérienne (entre autres), n’est pas faite de
moments décisifs, ou ne se résume pas à cela. Ou alors, le « décisif » d’un instant dépend
de quelque chose d’extérieur à lui (et certainement pas d’une appropriation
devançante, comme dans l’historicité authentique cherchée dans Être et temps).
7 Ainsi, l’histoire n’est ni autonome, ni décidée par l’intensité des instants. Les deux
manières de penser le mouvement, selon l’histoire linéaire ou selon les fractures
instantanées, mettent identiquement en abîme le manque de nécessité et de « sens
plein » par lequel advient ce qui se passe. Il faut, comme le dit Nancy dans La création du
monde ou la mondialisation, « penser l’histoire autrement que selon les schèmes épuisés
du progrès et/ou du déclin, de l’accident heureux et/ou malheureux » 2. On ne peut
recourir ni au progrès ni au déclin ; ni penser selon des avancées ou des crises, parce
qu’il n’y a, à la rigueur, ni progression ni rupture, ni accident heureux ni malheureux :
l’histoire bouge au-delà de ces termes isolés.
8 Mais, justement, que veut dire une histoire au-delà des faits et sans non plus unité de ces
faits ? L’histoire n’est pas pensable précisément comme la mouvance des progrès et des
déclins, des avancés et des crises ? N’est-elle pas précisément la somme des accidents
« heureux et malheureux » qui la composent et lui donnent son cours ? Ou alors,
comment échapper à une telle réduction ?
9 C’est à cela, il me semble, que répond la notion de mutation de Nancy. « Une mutation –
dit-il – est une transformation qui ne se laisse pas qualifier en bien ou en mal. Elle se
dérobe aussi à l’inscription dans un processus continu » 3. La mutation rendrait ainsi
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
96
possible la pensée d’une transformation sans processus. Elle serait en ce sens à même de
dessiner un infléchissement clair et irréversible de l’histoire, plus ou moins doué de
sens, vers un avenir qui en dépend, mais elle ne ferait pas synergie ou unité
d’orientation. Elle indiquerait les ruptures et les recompositions structurelles qui
permettent de considérer les puissances de civilisation et les expressions des époques,
et elle décrirait un présent ouvert à son advenir, sans toutefois concevoir une nécessité
définie qui lierait ce présent à ce futur, et sans recourir à des reconstructions
progressives ou téléologiques. La mutation ne surdétermine le présent, mais le laisse
fuir vers ce qui n’est pas encore donné :
« le présent que j’évoque ainsi – dit Nancy – n’est pas le présent de l’immédiat, celui
de la pure et simple position inerte où la raison et le désir se figent dans la stupeur
ou dans la réplétion, sans passé ni avenir, et il n’est pas non plus celui de l’instant
fugace ou fulgurant de la décision […] : ce présent-là est celui dans lequel on
s’échappe vers un futur qu’on désire et qu’on veut ignorer à la fois » 4.
10 J’ai voulu mettre cet enjeu sous le signe d’un titre/citation : « Seul le permanent
change ». Nur das Beharrliche wird verändert. L’affirmation est de Kant, depuis la
première analogie de l’expérience, à propos de la substance 5 et, avant lui, peut-être déjà
d’Héraclite, qui disait justement que « rien n’est permanent, sauf le changement » ; il
s’agit d’une affirmation extérieurement contradictoire, d’une complexité due à
l’apparente opposition de ses termes (le mouvement et la permanence) et qui consiste à
considérer que seul ce qui ne bouge pas peut être le sujet d’une mutation ou d’un
changement ; car, inversement, nous ne pourrions même pas parler de mutation à
propos de ce qui est complètement instable et sans continuité. La mutation suppose une
variation, c’est-à-dire, une altération, une Veränderung, un « se faire autre », une
permutation, et donc l’immobilité étirée d’un seul temps ou la diversité raccordée de
plusieurs instants du temps qui se laissent lier par (et subsumer dans) une contiguïté ou
une continuité.
11 La phrase – au-delà du contenu contextuel de l’indication kantienne – nous dit alors
que tout mouvement ne peut se faire que sur un fond de permanence, que quelque
chose change seulement en relation à quelque chose qui ne change pas. Ou, pour le dire
dans les termes que nous avons déjà introduit auparavant, on peut dire que l’histoire
est un flux d’événements à la seule condition de reconnaître que ces événements la
suspendent et l’obligent à interrompre le flux ou à l’excéder. Il n’y a de flux (historique)
que quand il n’y a plus un flux (parce que l’événement surgit et brise l’histoire). Les
deux choses doivent être pensées en même temps, comme dans la mutation de Nancy
qui, comme on l’a dit, ne transforme et ne donne forme au présent qu’à condition de le
dérober à toute processualité homogène.
12 La double obligation que nous venons de nommer ici semble identique à celle par
laquelle Jacques Derrida, sur l’histoire, s’opposait aussi bien à Foucault qu’à Heidegger ;
à l’un pour avoir défini l’époque classique comme l’époque de la scission entre raison et
folie, en prétendant ainsi trouver le trait d’union unique qui compose une époque
comme telle ; à Heidegger, pour avoir cherché dans l’histoire de la métaphysique des
« événements fondateurs » et pour avoir voulu une « historicité authentique » (c’est
l’objet du cours de 1964-1965, publié récemment6). L’idée de la constitution d’un ordre
historique, fut-il seulement esquissé ou pleinement décisif, contraste chez Derrida avec
l’idée d’une contamination nécessaire des récits et des faits, et surtout avec l’idée d’une
saturation du contexte : chez Foucault, tout comme chez Heidegger, il s’agit de
regarder l’histoire en « saturant son sens », alors même qu’un contexte, en vertu de sa
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
97
propre nature de contexte, n’est ni saturable ni pensable dans son ensemble comme
une totalité organique. Nous ne pouvons jamais toucher, selon Derrida, une émergence
pleine et achevée du sens.
13 Or, en niant la possibilité de la dérive et de l’origine comme telles, on est amené à
considérer la singularité de l’événement en étant qu’irréductible à toute histoire
linéaire, ce qui confirmerait, selon Derrida, la tentation métaphysique d’une
domination sur son mouvement ; et, en même temps, il ne s’agit pas non plus de
s’abandonner à l’idée d’un événement unique et fondateur, ce qui rejouerait
identiquement le présupposé de la métaphysique. Il faut pour Derrida renoncer à
l’histoire pleine comme mouvement linéaire, autant qu’à l’événement unique et décisif
et demeurer dans l’intervalle de la fiction assumée, c’est-à-dire dans la
« destinerrance » infinie et irréductible de l’advenir.
14 Que reste-t-il alors ? Comme le dit Derrida, dans le premier volume de La bête et le
souverain « ni continuité du passage, ni interruption ou simple césure », tout cela,
rajoute-t-il, « nous commande de repenser la figure même du seuil », et appelle à « une
plus grande vigilance à l’endroit de notre irrépressible désir du seuil, d’un seuil qui soit
un seuil, un seul et solide seuil »7. Le désir du seuil unique : voici, donc, la tentation
ultime qu’il s’agirait de mettre en question selon Derrida. En interprétant l’histoire ou
l’actualité, nous ne pouvons que « raconter des histoires »8 : les faits ne pourront jamais
s’entendre pleinement et l’histoire n’est alors qu’une métaphore que doit être détruite 9.
15 Or, même si la complexité et l’ambiguïté vue par Derrida paraissent analogues à celle
qui s’annonce dans la notion de mutation de Nancy, d’un autre côté, Nancy, ne se
limitant pas à indiquer la fiction de tout récit et, en prétendant au contraire décrire les
effectives mutations de la civilisation, semble ainsi tomber dans ce que Derrida décrit
comme le désir de tracer un seuil solide dans le flux des évènements, c’est-à-dire de
représenter de manière univoque l’orientation des faits présents. On retrouve en effet
chez Nancy l’intention de nommer les ruptures qui agissent effectivement en tant que
présages d’une transformation radicale des relations, du temps, des vies, de la
configuration territoriale et politique, du sens même de l’agir et de l’activité culturelle.
Nancy nomme au travers des mutations, les événements qui viennent impacter et
briser la certitude de nos convictions et qui annoncent la venue d’un inconnu. Cette
venue, quand bien même elle n’est pas nécessaire et définie, n’en appelle pas moins une
compréhension radicale.
16 C’est le cas, par exemple, quand il présente la notion d’Occident. L’Occident pensé
comme événement dans l’histoire s’est inauguré, selon Nancy, par un fait précis,
observe-t-il, qui aurait cassé en deux le temps : le « départ des dieux », leur échappée
dans l’absence. L’Occident serait né d’une une relation déterminée avec
l’incommensurabilité divine, autour de laquelle tout se serait organisé. Telle
incommensurabilité, se lit dans La création du monde, « articule l’échappée ou l’absence
comme régime général de l’incommensurable »10. Toute l’histoire de la métaphysique
s’est en somme jouée, observe Nancy dans ce texte, comme la recherche d’une
articulation de cette incommensurabilité, et le départ des dieux aurait donc constitué le
seuil ouvrant de toute la métaphysique. Ou encore, pour citer un autre exemple, dans le
texte « Générations, civilisations » paru chez Vacarme, Nancy n’hésite pas, pour décrire
le présent, à parler d’« époques ».
« Nous sommes entrés – dit-il – dans une mutation de la civilisation comparable à
celle qui fit apparaître le monde méditerranéen des Phéniciens puis des Grecs ou à
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
98
celle qui fit disparaître, quelque seize siècles plus tard, ce même monde au profit de
ce qui allait devenir le nôtre »11.
17 Il y aurait donc un mouvement temporel d’institution du sens, de Stiftung pleine : le
sens s’y dépose et à la fois s’en étale, et circule en faisant sens.
18 Comment la notion de « mutation » de Nancy peut-elle supporter le poids de la
contradiction vue par Derrida et pousser la notion de seuil plus loin ? Qu’est-ce qui
autorise à parler d’époques et à reconnaître les événements qui déchirent le tissu du
présent et qui appellent à une interprétation définie de ce qui les pousse ? Peut-on
vraiment prétendre opérer un partage des époques historiques et distinguer leur trait
dominant ? Cela ne suppose-t-il pas justement, comme l’indiquait Derrida, de
réintroduire une domination de l’histoire alors même que l’histoire échappe à toute
domination ? Comment est-ce évadé le risque de que la mutation donne un support à ce
qui se passe, en ouvrant aux « seuils uniques » déconstruits par Derrida ?
19 C’est peut-être sur ce point que se joue la spécificité du geste de Nancy concernant
l’histoire. Si pour Derrida nous devons renoncer à tout projet d’historicité non fictive et
à tout récit « décisif » de l’histoire quitte à réintroduire une superstition historique,
pour Nancy, nous pouvons et devons risquer de telles lectures du présent. Et c’est
précisément la notion de mutation qui rend possible ce geste : la mutation, comme on
l’a dit, ne tombe pas dans l’extrême d’un sens ordonné et progressif, mais en même
temps elle ne renonce pas non plus à penser ce qui se fait, ce qui a lieu, dans une poussée
épocale. Comme le dit Nancy lui-même,
« après un certain nombre de mutations de grande ampleur – comme celle du
néolithique, celle du bronze –, il s’est produit une mutation par étapes – l’Égypte,
les Grecs, Israël, Rome – dont le judéo-christianisme a été le résultat, ouvrant la
mutation occidentale. Celle-ci à son tour a connu des étapes, tout en se considérant
elle-même comme une longue continuité […]. Au fond de la mutation occidentale il
y a une conscience inquiète de soi »12.
20 L’argument proposé ici est encore, bien entendu, susceptible de l’accusation de
réintroduire des seuils marqués et marquants, qui prétendent identifier des faits au-
delà des récits et d’indiquer la tendance épocale où nous nous trouvons. Ou de manière
encore plus décidée, dans un petit texte de 2012 qui s’appelle Que faire ?, Nancy affirme
que
« les chances aujourd’hui sont plus que jamais celles de l’inouï. Plus que jamais
l’oiseau de Minerve s’envole au crépuscule. Un monde est en train de finir, c’est ce
que veut dire philosophiquement le phénomène nommé “mondialisation”. Nous
sommes pareils à des vieux stoïciens du Ve siècle qui ne pouvaient rien pressentir,
par-delà ce qu’ils nommaient l’inclinatio de Rome, d’un devenir en train de
s’amorcer »13.
21 Dans cet argument, de manière encore plus directe, se stipule la venue imminente d’un
événement plein, ou d’un seuil en train de se dessiner pleinement et pour nous tous :
une mutation épocale.
22 Mais en même temps, et je retrouve ici l’un des possibles enjeux de la mutation, il nous
faut sortir du préjugé qui veut que toute vision historique viendrait surdéterminer ce qui se
passe, et est nécessairement confiné à une narration. L’histoire, chez Nancy, n’est pas
seulement le récit intempestif de celui qui cherche à connecter des événements en leur
assignant un sens qu’ils n’ont pas nécessairement : elle est plutôt le fait du rapport et
n’existe que dans l’immanence de celui-ci. Si l’on court ici le risque de convoquer
l’oiseau de Minerve hégélien, donc, ce n’est qu’au nom d’un rapport qui, loin de se
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
99
prétendre capable de déterminer la réalité dans sa nécessité, se limite à tenir ouvert
l’accident à une continuité future. L’« être n’est rien que le sens de l’histoire ou du
rapport où il s’engage »14.
23 Voilà, alors, l’histoire selon Nancy : elle consiste dans « la réalité d’un mouvement et
d’une temporalité qui ne seraient pas écartelés entre la nécessitation téléologique et
l’accidentalité aveugle et close sur sa propre discontinuité » 15. L’histoire existe entre
ces deux extrêmes, entre la nécessité et l’accident. Ou selon la nécessité de l’accident et
l’accidentalité du nécessaire. La mutation doit donc être pensée non pas comme un
nouveau récit, mais comme la permanence qui « consiste dans l’extrême instabilité et
mutabilité de ce qui est ainsi désamarré (la contingence forme ainsi la nécessité de
cette “histoire”) »16. Point d’indistinction entre permanence et changement, ou alors
permanence du changement, dans le double sens du génitif, la mutation n’a rien d’un
accomplissement, et n’est pas non plus une anticipation visionnaire ou divinatoire 17,
mais répond à l’exigence de penser l’histoire comme ce que nous sommes, avant même
que comme ce en quoi nous nous trouvons. Dans ce sens l’histoire n’est pas seulement
celle qu’on raconte, avec le déphasage fictionnaire obligé, bien vu par Derrida, mais bel
et bien ce qui nous délivre à un horizon d’invention et de répétition, de pivotements, de
basculements du sens.
24 Détachée de l’indétermination du processus, où chaque instant est d’avance relevé dans
l’infini de son mouvement, et détachée aussi de l’intensité affirmative du projet, qui
charge le présent d’une prégnance qui ne peut qu’être fictive et idéologique, l’histoire
devient ainsi le véritable terrain de la finitude18 : espace du rapport, du partage du sens
et de son absence, elle n’est pas le récit des actions, mais l’être lui-même. Comme déjà
proposé dans La Communauté désœuvrée, dans le chapitre « Histoire finie » 19, l’histoire ne
peut être comprise qu’à partir de la finitude :
« L’histoire finie est l’arrivée du temps de l’existence, ou de l’existence comme
temps, espaçant le temps, espaçant la présence et le présent du temps : elle […] est
ainsi “essentiellement” exposée, infiniment exposée à sa propre arrivée finie
comme telle »20.
25 L’histoire s’ouvre comme monde, comme espace de partage et d’institution, et la
mutation n’est ainsi que le nom de la mise en jeu du sens, sa circulation, sa façon
d’insister dans l’existant. La phrase que nous citions au tout début trouve ici son sens :
« ni héritage, ni déshérence, ni transmission, ni interruption, mais passage, survenue,
échappée ». Dit autrement : il n’y a pas de « seuil unique », comme disait Derrida, (ni
continuité ni rupture) ; mais, oui, le passage, la survenue et l’échappée. En d’autres
termes, l’histoire comme mutation permanente que nous sommes invités, par Nancy, à
penser comme l’espace de notre partage.
BIBLIOGRAPHIE
DERRIDA Jacques, La Bête et le Souverain I, Paris : Galilée, 2010.
DERRIDA Jacques, Heidegger : la question de l’être et l’histoire, Paris : Galilée, 2013.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
100
KANT Emmanuel, Critique de la raison pure, Paris : PUF, 1993.
NOTES
1. J.-L. NANCY, « Déshérence », p. 109.
2. J.-L. NANCY, La Création du monde ou la mondialisation, p. 114.
3. J.-L. NANCY, « Générations, civilisations », p. 50.
4. Cf. J.-L. NANCY, L’Équivalence des catastrophes, p. 64.
5. E. KANT, Critique de la raison pure, A 187, B 230-231, p. 181 [traduction modifiée].
6. J. DERRIDA, Heidegger : la question de l’être et l’histoire, 2013.
7. J. DERRIDA, La Bête et le Souverain I, p. 442-443.
8. Cf. J. DERRIDA, Heidegger : la question de l’être et l’histoire, p. 64 sq.
9. Idem, p. 325.
10. J.-L. NANCY, La création du monde, p. 122-123.
11. J.-L. NANCY, « Générations, civilisations ».
12. J.-L. NANCY, J.-M. GARRIDO, Phraser la mutation.
13. J.-L. NANCY, « Que faire ? », p. 20.
14. J.-L. NANCY, La Création du monde, p. 92.
15. Idem, p. 108.
16. Idem, p. 126.
17. Cf. J.-L. NANCY, L’Équivalence des catastrophes, p. 38 : « L’anticipation visionnaire ou divinatoire
n’existe pas. Ce qui paraît après coup anticipé a seulement été bien vu sur le moment ».
18. Cf. J.-L. NANCY, M. SÁ CAVALCANTE, « History, Improvised: A Short Dialogue », p. 829 sq.
19. J.-L. NANCY, La Communauté désœuvrée, p. 235-278.
20. Idem, p. 261-262.
RÉSUMÉS
Sur la notion de « mutation », Jean-Luc Nancy a insisté assez régulièrement dans des textes
récents sur l’actualité et sur l’histoire. Plus qu’une simple transformation et qu’une
métamorphose, la mutation est conçue comme une notion capable d’indiquer les ruptures et les
recompositions structurelles qui permettent de considérer les puissances de civilisation et les
expressions des époques, en évitant tout recours à des mouvements progressifs ou téléologiques,
mais aussi sans réduire l’histoire à une simple fiction narrative. La mutation rejoue, dans l’espace
du rapport, l’advenir historique.
Jean-Luc Nancy has regularly insisted in recent texts on the notion of “mutation” in current
events and in history. More than a simple transformation and a metamorphosis, the mutation is
conceived as a notion capable of indicating the structural ruptures and recompositions which
make possible to consider the powers of civilization and the expressions of the epochs, avoiding
any recourse to progressive or teleological movements. It avoids too to reduce history to a mere
narrative fiction. In the space of the relationship, the mutation replays the historical coming.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
101
AUTEUR
ANDREA POTESTÀ
Pontificia Universitad Católica de Chile – Santiago du Chili
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
102
Apocalypse et croyance en ce
monde
Monde, finitude et christianisme chez Nancy et Blanchot*
Aïcha Liviana Messina
NOTE DE L'AUTEUR
Ce travail a été financé par le ministère de l’Éducation du Chili, dans le cadre du projet
Fondecyt 1140113.
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1 Dans son dernier ouvrage sur la communauté, La Communauté désavouée, qui est aussi
son dernier ouvrage sur Blanchot, Nancy élabore une critique pour ainsi dire radicale
de Blanchot, puisqu’il y affirme que la pensée blanchotienne de la communauté n’en est
pas une. Pour Nancy, la « communauté inavouable » de Blanchot serait une
communauté qui se désavoue1 ; ce serait une pensée qui dédit le commun qu’elle
prétend pourtant surélever, en le disant inavouable. L’ouvrage de Nancy surprend à
plus d’un titre. Il surprend le lecteur blanchotien qui avait toujours voulu lire Nancy et
Blanchot dans un souci commun (à défaut d’être identique) de la communauté. Il
surprend par son propos, mais plus encore par ses arguments. L’un d’eux, sur lequel je
voudrais me concentrer, consiste à montrer que c’est dans un certain christianisme de
Blanchot qu’est logé ce désaveu de la communauté. En prenant plus au sérieux qu’on ne
l’avait fait jusqu’à présent la seconde partie de La Communauté inavouable où il est
question de l’amour et où le rôle des figures féminines semble être – entre autres –
celui de soustraire la communauté à un dire, à un sens, celui, donc, d’emporter la
communauté dans l’inavouable, Nancy repère, au sein même de cet alliage entre le
féminin et l’inavouable, une sorte de christianisme crypté de Blanchot par lequel ce
dernier, d’une façon tout aussi cryptée, finit par dédire tout souci du commun. Le
christianisme – ce christianisme que l’on trouve crypté dans la seconde partie de La
Communauté inavouable, celui où l’on devine le Christ dans la figure de Madame
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
103
Edwarda, serait celui qui affirme la passion plutôt que l’exigence de justice, le cœur
plutôt que la Loi, mais aussi et surtout la solitude et la transgression plutôt que l’être en
commun.
2 On est surpris cette fois non pas de la lecture que Nancy fait de Blanchot, mais que le
christianisme soit un argument de divergence autour de la question de la communauté.
À bien lire La Communauté désavouée, le christianisme (inavouable) de la seconde partie
de La Communauté inavouable maintiendrait la question de la communauté (désavouée)
dans une certaine apoliticité. Or, cette apoliticité (ce manque de communauté), et là est
bien l’inavouable, n’en devient que plus politique : faute de penser, d’affirmer la
communauté, la politique de Blanchot serait aristocratique et non démocratique 2. Elle
ne romprait donc pas avec ses positions d’avant-guerre, mais élaborerait, sans le dire,
de façon inavouable et inavouée, une sorte de nouvelle pensée de droite 3. Le
christianisme de Blanchot recèle pour Nancy, dans son apparente apoliticité, une
inavouable politique de droite. Ne peut-on penser toutefois que le christianisme
implique au contraire une dimension politique absente (ou moins évidente) par
exemple d’un certain judaïsme ? Le christianisme n’est-il pas ce qui permet de penser le
commun au-delà d’une pensée qui se dirigerait seulement vers l’autre, c’est-à-dire ce
qui permet de penser la politique au-delà de l’éthique ? La pensée de Blanchot n’a-t-elle
pas par ailleurs contribué à l’exposition nancyenne de la « déconstruction du
christianisme » ?
La finitude comme « opérateur » de la
« déconstruction du christianisme »
3 Comme on le sait, pour Jean-Luc Nancy, la déconstruction du christianisme ne relève
pas d’une opposition au christianisme. Elle ne conduit ni vers une destruction, ni vers
un dépassement, pas plus qu’elle ne se produit comme sécularisation. « Déconstruire le
christianisme », comme écrit Nancy, c’est « saisir en lui, en lui sortant de lui, l’excédant
lui-même, le mouvement d’une déconstruction »4. En d’autres termes, le christianisme
contient le principe de sa déconstruction. Pour cela même, déconstruire n’est pas
détruire mais ouvrir : rejoindre ce qui disjoint le christianisme de lui-même et qui
l’ouvre à son avenir.
4 Si l’on considère ensemble les gestes de Blanchot et de Nancy vis-à-vis du
christianisme, ce qui est intéressant est de remarquer que l’un et l’autre, bien que par
des voies et par des formes différentes, non seulement trouvent dans le christianisme le
principe de sa déconstruction mais trouvent dans la finitude au moins un des fils
conducteurs de cette déconstruction. Si l’on pense à Blanchot, à propos de qui on n’est
pas habitué à parler de « déconstruction du christianisme », on voit que le thème de la
mort nous met doublement sur la voie d’une telle déconstruction. Mettant en question
la possibilité de penser la fin au sens d’un terme, d’une limite, Blanchot parle de mourir
plutôt que de mort. Or, la différence entre mort et mourir a pour effet de rendre
impensable la frontière entre un ici-bas et un au-delà, le temps séculier de la vie finie et
celui de la vie éternelle, et elle entraîne l’éternité chrétienne dans ce qu’il appelle
l’éternité d’absence ou l’immortalité du mourir5. Pour Blanchot, comme pour Nancy, la
finitude est infinie et empêche ainsi de penser l’au-delà en opposition avec l’ici-bas.
Pour cette raison, Blanchot pourrait dire, avec Nancy, que « Tout le poids – énorme – de
la représentation religieuse ne peut pas faire que l’“autre monde” ou l’“autre du
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
104
monde” ne furent jamais un second monde ni un arrière-monde, mais l’autre du monde
(de tout monde : de toute consistance liée dans l’étant et dans la communication), l’autre que
tout monde »6. En d’autres termes, en pensant la mort, qui est au cœur de la théologie
du salut, sous l’égide du thème de la finitude infinie, le christianisme se vide de toute
teneur métaphysique. Les thèmes de l’au-delà et de l’éternité ne relèvent plus d’un
outre-monde, mais peuvent, comme le fait Nancy, non sans résonance avec le
vocabulaire de Blanchot, être pensés en termes de « Dehors » 7. On voit en quoi Blanchot
et Nancy se rejoignent dans la déconstruction du christianisme, et en quoi la différence
blanchotienne entre la mort et le mourir aura nourri la réflexion nancyenne sur le
christianisme. Le premier volume de la déconstruction du christianisme, ainsi que
l’ouvrage Noli me tangere déploient les différentes ramifications de cette déconstruction
rendue possible par le thème de la finitude. Si l’on peut par exemple penser une
résurrection de la mort et non des morts comme le suggère Nancy dans une réflexion
directement inspirée de Blanchot8, c’est parce que la mort n’étant pas à elle-même un
terme, l’absence est sans fin et constitue une expérience, à même la finitude, de
l’éternité9.
5 Mais si Nancy et Blanchot partagent ce qui fait le cœur de la déconstruction du
christianisme, quel type de christianisme crypté repère Nancy dans La Communauté
désavouée ? En fait, si le thème de l’infinie finitude qui permet de penser au-delà de
l’opposition du séculier et du religieux est ce qui constitue le point de convergence
entre Nancy et Blanchot, c’est aussi un thème qui constitue un point de divergence – et
c’est ce que, d’une façon indirecte, et sans nécessairement le relier au thème du
christianisme, s’attache à dire Nancy dans La Communauté désavouée. En effet, d’une
façon surprenante (surprenante car le reproche pourrait ne s’appliquer qu’à cette
deuxième partie de La Communauté inavouable intitulée « la communauté des amants »),
Nancy reproche à Blanchot d’avoir pensé la mort non comme ce qui sépare de soi et met
ainsi en rapport (l’écart à soi faisant de l’impossible ce qui « nous » arrive et non ce qui
seulement me sépare de l’autre) mais comme ce qui me sépare de l’autre, confinant le
« moi » devenu à son tour impossible, dans une « solitude essentielle » 10. Le reproche
est surprenant, puisque toute la première partie de La Communauté inavouable consistait
à montrer, continuant ainsi un thème élaboré aussi bien par Nancy que par Blanchot,
que la mort est ce que nous avons en partage11. Mais ce point de divergence que Nancy
repère dans la seconde partie de La Communauté inavouable et afin de montrer comment
cette seconde partie dédit la première, joue un rôle crucial dans ce qu’on peut appeler
ces deux gestes de déconstruction du christianisme. En effet, si comme le dit Nancy, la
mort, la finitude, est ce qui me sépare de l’autre, alors la communauté est inavouable
parce que seulement impossible. Elle n’est pas désœuvrée : elle est ce qui ne se défait
jamais parce qu’elle ne peut tout simplement jamais se faire. Elle ne constitue jamais un
reste.
6 C’est cela qui conduit Nancy à penser que le christianisme de Blanchot n’est pas celui de
la communion, mais celui de l’aristocratie12. Or, ce point de divergence donne bien
l’esquisse de deux types de christianisme très différents. Chez Blanchot, la finitude –
qui coïncide plus avec l’impossibilité du présent qu’avec l’impossibilité du rapport – est
ce qui finalement rend impossible l’ici-bas, et donc un monde. Chez Nancy, la finitude
est aussi ce qui rend impossible le présent, mais en insistant sur la précédence du
rapport par rapport à la séparation, l’impossibilité du présent ne se ferme pas aux
possibles, c’est-à-dire au monde. Au contraire, non seulement par la finitude « quelque
chose nous est commun »13 (et cela, Blanchot le concèderait), mais dans ce désaveu de
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
105
la solitude, dans ce primat du rapport, l’impossibilité du présent devient aussi « l’infime
suspens du temps où s’échangent des regards, se touchent des corps, des voix et des
silences »14. En d’autres termes, le geste blanchotien de déconstruction du
christianisme est un geste apocalyptique, un geste qui, en affirmant l’impossibilité de
l’ici-bas, du temps, et du rapport, semble s’en tenir à la fin du monde. En revanche, en
insistant sur le primat du cum15, Nancy, sans revenir à une métaphysique de la
présence, pense l’impossibilité du présent comme l’avènement même d’un écart, du
cum, et donc du monde. « Dans ce suspens – écrit Nancy, quelque chose apparaît – un
monde, si on veut – et ne disparaît pas »16. Le christianisme de Blanchot, aristocratique
et même anti-démocratique, comme le suggère très explicitement Nancy, serait
apocalyptique ; celui de Nancy, procédant du primat du rapport, concourrait à
l’avènement du monde. Il oblige au « sens du monde », à adorer le monde – c’est-à-dire
à accueillir cela même qui constitue l’ouverture du sens. Situés tous deux au lieu d’une
finitude infinie, ces christianismes suivent la voie du désastre ou de l’adoration, de
l’apocalypse ou de la croyance en ce monde17.
7 Mais peut-on vraiment croire en ce monde ? Ne faut-il pas tout de même penser la fin du
monde ? N’y a-t-il pas de la part de Nancy, sinon une métaphysique inavouée du monde
sous-jacente à sa déconstruction du christianisme, du moins une confiance excessive au
monde18 ? L’en-commun qui constitue le « sens du monde » n’est-il pas ce qu’il y a de
plus fragile ? N’y a-t-il pas des situations – de solitude, de douleur, de violence – qui
attestent d’une perte de monde ?
« Rien est ce qu’il y a » : désastre et adoration du rien
8 Que Nancy soit le penseur du monde n’implique certes pas qu’il ignore l’« avènement »
de la « fin du monde ». C’est d’ailleurs dans Le Sens du monde que Nancy écrit : « Nous
sommes à la fin, mais la fin du sens veut dire que nous ne pouvons penser cette fin ». Ce
qui revient à dire – je cite de nouveau Nancy – que « c’est la fin du monde, mais nous ne
savons pas en quel sens »19. Pour Nancy, l’être-avec fait monde. Il fait le monde comme
ouverture du sens. Mais ce sens n’est justement pas celui des téléologies, pas plus qu’il
ne relève d’un principe métaphysique. Ce sens n’est pas un principe extérieur au
monde qui viendrait le fonder et l’orienter ; il est au contraire, tout au contraire,
indissociable de cette absence de fond, de fondement, de principe et donc de sens, que
découvre la déconstruction du christianisme. Ainsi, pour Nancy, le sens n’est rien
d’autre que la touche, le « renvoi (le rapport, la relation, l’adresse, la réception – la
sensibilité, le sentiment) »20, c’est-à-dire cet entre-écartement du commun qui fait
monde21 ; et le sens, qui est privé de tout « sens du sens » 22 est indissociable de la fin du
monde, de la fin du monde conçue comme totalité sensée, orientée. Parler de « sens du
monde » ne présuppose aucun principe métaphysique. C’est tout le contraire : le « sens
du monde » est cette absence de garantie par quoi les existants sont ouverts les uns aux
autres, et ainsi font monde23. Ce n’est donc que parce que « c’est la fin du monde » que
nous sommes exposés au sens du monde. Si ce qu’il nous incombe de penser est la
mutation et non la transformation, c’est bien que, la fin du monde nous privant d’un
principe téléologique pour penser la fin, ce qui arrive est destitué d’un horizon de sens
à l’aune duquel nous pourrions en mesurer la nouveauté. En d’autres termes, le « sens
du monde » est le lieu d’une mutation de la question du sens comme de celle du monde.
Il n’est pensable que parce que la pensée elle-même mute 24.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
106
9 Mais Nancy et Blanchot s’opposent-ils vraiment comme un penseur apocalyptique et un
penseur du monde ? En un sens, il faudrait abonder dans cette direction. Il est en effet
remarquable que pour Nancy, la déconstruction du christianisme ouvre sur le monde et
non sur un autre monde. En effet, tandis que, chez Blanchot, le thème de l’infinie
finitude en destituant de tout « outre monde » destitue finalement de tout monde,
Nancy pense le dehors du monde comme ce qui ouvre le monde. Dès lors, le
christianisme déconstruit, loin d’entraîner au-delà du monde, constitue la trame de ce
que Nancy appelle « l’au-milieu du monde ». Dieu, le dieu du monothéisme, loin d’être
le principe du mundus, c’est-à-dire du monde comme totalité signifiante, devient le
principe de la déconstruction du monde compris comme mundus, et, plus précisément,
de la mutation du mundus en Welt, en « milieu du monde », c’est-à-dire en monde ouvert
comme « être avec » : « Dieu, écrit Nancy dans L’Adoration, n’est autre chose […] que cet
avec lui-même »25.
10 En abondant en ce sens, on découvre que ce qui fait problème n’est peut-être pas tant la
confiance de Nancy dans le monde que celle de Blanchot dans la fin du monde. En effet,
que le monde soit fragile, que son sens tienne seulement à l’abîme de sa fin, Nancy le
soutient ; et il le soutient au-delà de la tentation de substantialiser le non-sens, et donc
finalement de croire en la fin du monde. Si l’adoration du monde peut être tout le
contraire d’une façon d’idolâtrer le monde, en revanche il est toujours possible
d’adorer le désastre. Cela arrive lorsque la fin du monde devient la négation de tout
sens : lorsqu’elle devient une façon d’hypostasier le « rien » du sens.
11 À ce stade, le lieu de la divergence entre Blanchot et Nancy (et de cette divergence dans
la croyance) réside cette fois-ci non pas dans la compréhension de la finitude mais dans
celle du rien. Il en va de deux gestes différents vis-à-vis de Heidegger. À ce propos,
remarquons qu’une même phrase revient dans L’Adoration, qui est le second volume de
la déconstruction du christianisme, et dans L’Écriture du désastre, qu’on pourrait aussi
considérer comme le second volume blanchotien de la déconstruction du
christianisme : « Rien est ce qu’il y a »26. Une même phrase qui pourrait constituer deux
plis différents de la pensée de Heidegger. En effet, lorsque Nancy affirme dans
L’Adoration « rien est ce qu’il y a » 27, il cherche avant tout à penser que ce qui ouvre la
pensée, la surprise qui la suscite, n’est pas l’alternative entre être et non être (ce qui
amènerait à choisir entre une ontologie et une autre, entre une onto-théologie ou un
nihilisme hypostasié), mais le fait que l’être est immédiatement – immémorialement –
pluriel. Le « rien » de l’être, le rien que l’être est, la néantité qui se produit avec être, ne
nous maintient pas dans une alternative stérile ou dans un dualisme ; elle est
productive des êtres. L’être n’étant rien, il est ce par quoi toute chose n’est qu’en
rapport avec une autre, sans former pour autant une totalité. Au contraire, l’être
n’étant rien, il expose à « l’infini d’un sens »28. Ainsi « rien est ce qu’il y a » ne referme
pas le sens dans un nihilisme. Il renvoie à la surprise de l’« être singulier pluriel » au
« don de ceci : qu’il y ait quelques choses, les choses, tous les étants » 29. En revanche,
lorsque Blanchot écrit « rien est ce qu’il y a », ce que l’écriture produit immédiatement
n’est pas la surprise d’un monde (« qu’il y ait quelques choses, les choses, tous les
étants » comme écrit Nancy), mais son effondrement.
12 À la différence de Nancy qui recentre sa lecture de la différence ontologique sur le
primat du thème heideggérien du Mitsein, Blanchot ne se déplace pas dans Heidegger : il
s’oppose à Heidegger. Pour Blanchot, il s’agit en effet de penser que le rien de l’être
empêche tout rapport, tout monde, toute possible compréhension. « Rien est ce qu’il y
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
107
a » n’est pas tant le fin mot de la fin (puisque la fin est infinie) que celle de
l’impossibilité du tout, de tout, y compris de l’être-avec qui permet de penser le monde
comme exposition à « l’infini d’un sens ». Ce rien est ce qui apparaît d’une façon
seulement différée (et donc impossible) à même l’écriture fragmentaire. S’il est vrai
qu’on peut le penser comme le milieu du rapport (le rien étant bien aussi l’expérience
de l’Autre), ce n’est pourtant pas ce que Nancy appelle le « au milieu du monde ». À
même l’écriture fragmentaire en effet, le rien se produit comme ce qui empêche à
jamais le sens de se faire et entraîne vers un « effondrement de tout langage » 30. Or,
« hors langage »31, il n’est précisément plus de monde à construire.
13 Doit-on pour autant en conclure que Blanchot hypostasie le rien ? Dans ce cas, on se
trouverait véritablement devant une apocalypse (une révélation du rien) et là où, chez
Nancy, le christianisme déconstruit annonçait la mutation du mundus en Welt, chez
Blanchot ce christianisme apocalyptique ne pourrait nous mener qu’en enfer ou dans
l’Éden, c’est-à-dire dans une sorte de vide ininterrompu qui devient alors une forme de
plénitude. Ou bien, Blanchot ne cherche-t-il pas plutôt à donner une voix à la fin du
monde, à faire résonner cette fin, à même un monde qui, pour fragile qu’il soit, doit
pouvoir être dit et pensé dans ce qui en a entamé la possibilité ?
Consolation
14 Pour répondre à cette question, j’aimerais revenir à la question à laquelle j’ai pourtant
déjà répondu, celle qui concerne la confiance au monde. On peut en effet trouver un
nouveau point de convergence entre Nancy et Blanchot là où ils semblaient jusque là
diverger radicalement. Le texte « Consolation, désolation » inséré dans le premier
volume de la Déconstruction du christianisme, répond à une question analogue à celle que
nous posions sur la confiance au monde qu’on trouve chez Nancy. C’est la question que
pose Derrida dès les premières pages de Chaque fois unique, la fin du monde. Pour Derrida,
même conçue comme anastasis, c’est-à-dire comme « levée des corps », le thème de la
résurrection chez Nancy relève encore d’une sorte de confiance au sens qui aurait un
effet consolateur incapable d’assumer l’abîme que représente la mort, c’est-à-dire
incapable d’assumer la fin du monde que représente chaque disparition. Ainsi, pour
Derrida, l’anastasis « continue, fût-ce avec la rigueur de quelque cruauté, de consoler.
Elle postule et l’existence de quelque Dieu et que la fin d’un monde ne serait pas la fin
du monde »32.
15 Or, à cette question, Nancy ne répond pas en s’en tenant à la façon dont il élabore le
thème de la résurrection, c’est-à-dire en affirmant qu’il s’agit de penser la résurrection
de la mort et non des morts, ou, en termes blanchotiens, qu’il s’agit de penser l’éternité
d’absence, et non le retour à la présence. L’argument de Nancy consiste à montrer qu’il
n’y a de salut que dans la désolation, c’est-à-dire, dans une épreuve qui est sans
consolation. Le mort étant en effet l’unique, sa disparition désole en tant qu’elle rend à
« l’isolement total »33. L’unicité du mort nous abandonne à la « fin du monde ». Dans ce
sens, celui qu’on salue dans la mort n’est pas celui qui reste ou qui revient, mais celui
qui dévaste, désole. Le deuxième volet de l’argumentation de Nancy consiste à dire que
si celui qu’on salue est celui qui dévaste, si celui qui se sauve est celui qui désole, alors
« le salut se dresse et s’adresse au point exact où il ne reste rien à dire » 34. En d’autres
termes, la mort fait naître le langage aux confins de la disparition absolue. Ce que
Blanchot énonce d’une autre façon dans L’écriture du désastre en rapportant l’avènement
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
108
du langage à l’expérience de son effondrement : « nous parlons sur une perte de
parole »35. Penser la résurrection, ce n’est donc pas chercher la consolation, mais
penser que le lieu même d’où l’on parle – et donc vit en commun – est la perte. Mais
l’expérience de la perte – de la perte sans salut, sans consolation – se fait toujours dans
un monde : sans être « consolable », elle situe dans la consolation 36, c’est-à-dire dans ce
que Nancy appelle la « restauration d’un possible ». Nous ne sommes certes pas
consolés par la résurrection. Cependant, parce que l’expérience de la perte est ce dans
quoi s’origine le langage et donc le commun, elle nous tient aussi, d’une certaine façon,
dans la consolation, dans le domaine du possible, du monde. Elle nous rappelle, sans
nous y faire tenir, au monde. Dans la mesure, écrit Nancy, où « le salut […] proclame
quelque chose, plus exactement quelqu’un […] quoiqu’il veuille et quoiqu’il prétende
faire, il ne se peut qu’il ne console et qu’il ne se console » 37.
16 En quoi ce passage par la consolation répond-il à la question que nous adressions à
Blanchot ? L’écriture du désastre ne constitue-t-il pas justement l’épreuve radicale de la
perte de consolation et, en cela, moins qu’un geste de déconstruction du christianisme :
un geste anti-chrétien ? Je pense que l’effort que fait Blanchot pour évoquer la perte
qui est au fond du langage répond justement à l’objectif de ne jamais permettre de
substantifier le rien38. S’il est vrai que l’écriture fragmentaire constitue un
« effondrement du langage » dans l’exercice renouvelé de « combattre l’Un » 39, c’est-à-
dire, entre autres, l’unité du sens, l’écriture pour Blanchot est aussi ce qui met en
mouvement cet effondrement, qui empêche l’égalité dans le rien, c’est-à-dire la
complaisance dans le nihilisme. Si le rien du sens est ce qui entraîne dans une chute
hors du monde, hors du présent, pour Blanchot, ce rien, ce « sens absent » qu’aura
beaucoup cité Nancy40, est aussi ce qui fait l’essence de la communication. Comme
l’indique un des derniers fragments de L’écriture du désastre – « Partageons l’éternité
pour la rendre transitoire » –, le rien est cette fin du monde par quoi nous glissons hors
du temps mesurable, mais qu’il faut dire, partager. L’apocalypse blanchotienne, en ce
sens, ne consiste pas tant dans la révélation du rien, dans son hypostase, que dans la
nécessité d’en faire l’élément d’une « autre histoire »41.
17 Que conclure alors de cette divergence et de cette convergence entre Nancy et Blanchot
au sujet du christianisme ? La distance que prend Nancy par rapport à Blanchot tient à
la question de la communauté et donc du monde. Pour Nancy, le problème n’est pas que
Blanchot soit subrepticement chrétien, mais que ce christianisme qui se trame dans La
communauté inavouable de Blanchot délaisse l’être-avec et le monde qu’ouvre en dépit
de tout, l’être en commun. Cette divergence ne définit toutefois pas une opposition.
Dans la pensée du monde doit résonner « la fin du monde ». Il ne s’agit pas de cette
tendance au catastrophisme qui empêche toute pensée42, mais bien de cette idée que la
pensée ne peut reposer sur rien de garanti de même que ce qui nous lie l’un à l’autre ne
constitue en rien la garantie d’un monde sensé. En ce sens, l’adoration ne va pas sans le
désastre. Mais il faut dire aussi que penser, parler, écrire, pour différents que soient tous
ces gestes, nous situent déjà dans le commun, dans le monde, si bien qu’on ne pourrait
rien dire du désastre si nous n’étions encore au monde. Ce qui importe dans ces deux
lectures du christianisme – et d’un christianisme qui est en pleine mutation et qui, pour
Nancy, constitue peut-être la grammaire d’une mutation à venir ou en cours – ce sont
les conséquences politiques, mais aussi époquales que recèlent leurs divergences.
Détournée du monde par un rien qui ne cesse de faire échec au langage, la pensée de
Blanchot semble nous reconduire vers un nouvel Eden. Si Blanchot ne pense pas à la
figure paulinienne d’un « nouvel Adam » – puisqu’il s’agit de faire un geste au-delà de
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
109
l’humanisme43 – il situe le « changement d’époque » dans la nécessité de faire entendre
le silence du langage, c’est-à-dire l’infans, l’Éden, le monde inentamé par la langue, la
loi, la faute44. En ce sens, bien que cherchant à rompre radicalement avec la tradition, la
pensée de Blanchot demeure finalement, et contre ses propres prétentions, liée à une
idée de rédemption. S’il ne s’agit pas pour Blanchot de chercher une issue à la finitude,
à certains égards sa pensée se cherche (sans se trouver) en deçà du langage, et donc de
la Loi et de la faute. En revanche, en pensant le Dehors comme l’ouverture même du
monde, en pensant le rien comme cette surprise devant le fait « qu’il y ait quelques
choses, les choses, tous les étants », Nancy nous oblige non à la pensée de l’Éden mais à
celle de la mondialisation. Faut-il en déduire que, pour Nancy, la mutation en cours
tient à la nécessité de penser le sens non en termes temporels mais en termes spatiaux,
et de substituer à la pensée de l’histoire celle du monde ? C’est peut-être ce que veut
dire Nancy lorsqu’il affirme dans L’Équivalence des catastrophes que « notre pensée ne
doit plus être ni de crise ni de projet », qu’il faut en finir en ce sens avec tous les
« finalismes »45 (y compris ceux de la finitude infinie). Pour Nancy en effet, plutôt que
de penser la fin – et donc le temps – il faut penser le présent entendu comme « lieu de
la proximité »46, et en ce sens l’espace. Mais cela est-il possible ? Pouvons-nous ne
penser que la proximité, comme le suggère Nancy lorsqu’il affirme que « ce qui serait
décisif, en revanche, ce serait de penser au présent et de penser le présent » 47 ? La
pensée n’est-elle pas ouverte par le lointain, fût-ce le lointain de ce qui est le plus
proche ?
BIBLIOGRAPHIE
BLANCHOT Maurice, L’Entretien infini, Paris : Gallimard, 1969.
BLANCHOT Maurice, Le Pas au-delà, Paris : Gallimard, 1973.
BLANCHOT Maurice, L’Écriture du désastre, Paris : Gallimard, 1980.
BLANCHOT Maurice, La Communauté inavouable, Paris : Les éditions de Minuit, 1983.
DERRIDA Jacques, Chaque fois unique la fin du monde, Paris : Galilée, 2003.
FOESSEL Michaël, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Paris : Seuil, 2012.
FOESSEL Michaël, Le Temps de la consolation, Paris : Seuil, 2015.
MESSINA Aïcha Liviana, “The apocalypse of Blanchot”, in : Philosophy Today, volume 60, n° 4,
printemps 2016.
NOTES
1. « L’aveu inavouable de Blanchot revient à désavouer la communauté », écrit Nancy dans La
Communauté désavouée, p. 128.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
110
2. Nancy place ainsi cette seconde partie de La Communauté inavouable sous le signe d’une
« élévation aristocratique, d’un dédain – en fin de compte – pour la société, ses fonctions, son
État, ses lois », c’est-à-dire d’un certain « anarchisme de droite » (idem, p. 127).
3. « À cet égard, quelque chose du Blanchot des années 1930 résiste opiniâtrement, en 1983, à la
démocratie simplement égale à elle-même » (idem, p. 128).
4. J.-L. NANCY, La Déclosion (Déconstruction du christianisme, 1), p. 21.
5. La différence entre mort et mourir ainsi que la conception blanchotienne de la disparition
permettent de penser autrement ces deux notions chrétiennes, immortalité et éternité. En
refusant de penser la mort comme moment fini, Blanchot nous amène à penser que la disparition
qui advient avec la mort confronte à une absence sans termes, une absence éternelle. Mais cette
absence éternelle n’a pas non plus lieu du sein d’un temps fini ou séculier. Le mourir est cette
imminence qui, dans le temps, rend le temps impossible – impossible à mesurer. C’est pourquoi,
paradoxalement, Blanchot rapporte le mourir à l’immortalité. Ainsi lit-on dans Le pas au-delà :
« Mourir selon la légèreté de mourir et non par la pesanteur anticipée de la mort – le poids mort
de la chose morte –, serait mourir en rapport avec quelque immortalité » (Maurice B LANCHOT, Le
Pas au-delà, p. 152).
6. Ibidem.
7. « Le christianisme peut se résumer, ainsi que Nietzsche, par exemple, l’a fort bien su, au
précepte de vivre dans ce monde comme hors de lui – étant entendu que ce « dehors » n’est pas,
n’est pas étant » (ibid.).
8. « Donnons-nous d’emblée le ton majeur : la résurrection dont il s’agit n’échappe pas à la mort,
ni ne sort d’elle, ni de la dialectise. Elle forme au contraire l’extrémité et la vérité du mourir. Elle
va, dans la mort non pour la traverser, mais pour, s’enfonçant en elle de manière irrémissible, la
ressusciter elle-même. Ressusciter la mort diffère de tout au tout de ressusciter les morts.
Ressusciter les morts consiste à les rendre à la vie, à faire ressurgir la vie là où la mort l’avait
supprimée. C’est une opération prodigieuse, miraculeuse, qui substitue une puissance
surnaturelle aux lois de la nature » (Jean-Luc NANCY, « Résurrection de Blanchot » in : La Déclosion,
p. 135-136).
9. À ce sujet, voir note 5.
10. Dans La Communauté désavouée, Nancy écrit ainsi : « Si la mort se comprend comme séparation
des autres plutôt que de soi, l’“impossible” se trouve compris comme ce qui s’exclut et exclut
chacun de tout rapport (se retournant à l’occasion en exclusion générale de toute exclusion…) »
(op. cit., p. 158).
11. À première lecture, il semble curieux que Nancy décrive le thème de la mort chez Blanchot
comme ce qui sépare des autres plutôt que de soi. La première partie de La Communauté inavouable
ainsi que bien des fragments du Pas au-delà mettent en jeu l’idée inverse ainsi que l’idée
chrétienne d’une mort partagée. Ce qui est vrai toutefois c’est que chez Blanchot le commun est
toujours de l’ordre d’une « solitude essentielle ». C’est l’impossibilité de mourir qui me voue au
rapport, mais dans ce rapport, comme Nancy le suggère dans les dernières pages de La
Communauté désavouée, il n’y a pas nécessairement d’autres. Le commun reste ainsi chez Blanchot
l’expérience d’une solitude sans fin.
12. Dans La Communauté désavouée, Nancy écrit : « Le christianisme conforte l’anarchisme
aristocratique, lequel subsume en lui le christianisme » (op. cit., p. 140).
13. Idem, p. 158.
14. Idem, p. 153.
15. Idem, p. 159.
16. Idem, p. 153.
17. Ce que Blanchot appelle « désastre » et ce que Nancy appelle « adoration » ne s’opposent pas
si simplement, bien entendu, et exigent même certaines précisions sur le sens précis qu’ils ont
dans les œuvres de Blanchot et Nancy. Selon L’Écriture du désastre de Blanchot, le désastre est ce
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
111
qui ne vient pas, ce qui, dans sa passivité, se soustrait à toute advenue et à toute lumière, c’est-à-
dire à tout sens (L’Écriture du désastre, p. 7 et 9). Or, si l’apocalypse est la révélation, cette
définition du désastre rend impossible l’association entre le désastre et l’apocalypse puisque le
désastre se soustrait à tout avènement et à tout sens. Il semble même que la conception
nancyenne de l’« adoration » soit plus proche de la possibilité d’une apocalypse. Nancy dit en
effet de l’adoration qu’elle est la « louange du sens infini » (L’Adoration, p. 22). Mais plus qu’une
reconnaissance d’un sens qui serait donné et postulé métaphysiquement, l’adoration a
simplement trait au fait que nous appartenons à l’ouvert, qu’être c’est être-à, et en ce sens, c’est
être déjà ouverts à la venue, adressés (idem, p. 32) – adresse ou exposition qui, pour Nancy, est le
sens. S’il serait incorrect d’opposer, dans le sens précis qu’ils prennent dans les œuvres de Nancy
et de Blanchot, « désastre » à « adoration » en les identifiant respectivement à l’apocalypse et à la
croyance en ce monde, il est intéressant en revanche de remarquer que le concept nancyen
d’« adoration » se rapproche du « sens du monde », et en constitue une réitération (adorer
signifier être adressés au sens du monde), tandis que l’idée blanchotiene de « désastre »,
affirmant la « non-venue », nous retire le monde.
18. « Le monde est simplement la présence de tous les présents » écrit Nancy dans L’Adoration
(Jean-Luc Nancy, L’Adoration, p. 69).
19. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 15.
20. J.-L. NANCY, L’Adoration, p. 22.
21. « Le monde, écrit Nancy dans L’Adoration, est l’exposition de ce qui existe à la touche du sens
qui ouvre en lui l’infini d’un ‘dehors’ » (idem, p. 11).
22. « Il n’y a pas de sens du sens : ce n’est pas, tous comptes faits, une proposition négative. C’est
l’affirmation même du sens – sensibilité, sentiment, signifiance : l’affirmation selon laquelle les
existants du monde, en renvoyant les uns aux autres, ouvrent sur l’inépuisable jeu de leur
renvois » (idem, p. 22).
23. « Le sens du monde n’est rien de garanti, ni de perdu d’avance : il se joue tout entier dans le
commun renvoi qui nous est en quelque sorte proposé. Il n’est pas ‘sens’ en ce qu’il prendrait
références, axiomes ou sémiologies hors du monde. Il se joue en ce que les existants – les parlants
et les autres – y font circuler la possibilité d’une ouverture, d’une respiration, d’une adresse qui
est proprement l’être-monde du monde » (idem, p. 12).
24. Dans Le Sens du monde, cette mutation de la pensée s’énonce de deux façons dont il faudrait,
pour comprendre comment nous pouvons affronter ce qu’il a de problématique dans l’idée de
penser la mutation de la pensée elle-même (sachant que nous ne sommes précisément pas en
pouvoir de penser cette mutation), analyser précisément l’articulation. Pour Nancy en effet, la fin
du sens du monde veut dire que, tandis que le monde n’a plus de sens, il est le sens. La mutation
de la pensée doit donc se comprendre dans ce qui nous fait passer du régime de l’« avoir » à celui
de l’« être ». Or, ce changement de régime est aussi ce par quoi la pensée mute de son rôle
herméneutique à son effet pratique. S’il ne s’agit plus de penser que le monde a un sens, « il ne
s’agit plus de lui prêter ou de lui donner un sens de plus, mais d’entrer dans ce sens, dans ce don
de sens qu’il est lui-même ». Ainsi, pour Nancy, « la fin du monde du sens ouvre la praxis du sens du
monde » (op. cit., p. 19).
25. J.-L. NANCY, op. cit., p. 61.
26. On trouve en effet cette même phrase dans L’Adoration de Jean-Luc Nancy (p. 23) et dans
L’Écriture du désastre (p. 117 et 178).
27. J.-L. NANCY, op. cit., p. 23.
28. J.-L. NANCY, L’Adoration, ibid.
29. Ibid.
30. J’emprunte cette formule au Pas au-delà de Maurice Blanchot (p. 134).
31. Blanchot évoque « l’écriture hors langage » dans L’Entretien infini (en particulier dans le
chapitre « L’athéisme et l’écriture, l’humanisme et le cri »). Il faut préciser que ce que Blanchot
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
112
appelle « écriture hors langage » ne constitue pas une rupture définitive avec le langage. Il s’agit
bien pour Blanchot de se tenir toujours dans une forme de bilinguisme (tel qu’il en évoque le
terme dans L’amitié) où il s’agit, non tant de parler deux langues, mais plutôt, parlant, de faire
échos à une parole non-parlante. L’« écriture hors langage » fait donc l’épreuve, du dedans du
langage d’un certain Dehors. Mais il n’empêche que ce Dehors ne permet pas à un sens de se faire,
qu’il s’agit plutôt toujours d’affirmer son inanité, et l’inanité de cette inanité, ce qui confine dans
une sorte d’interdit du monde.
32. J. DERRIDA, Chaque fois unique, la fin du monde, p. 11, cité par Jean-Luc Nancy dans La Déclosion,
p. 148.
33. J.-L. NANCY, La Déclosion, p. 149.
34. Idem, p. 152.
35. M. BLANCHOT, L’Écriture du désastre, p. 39.
36. À ce sujet, il faut commencer à entendre le terme consolation non comme ce qui fait taire la
douleur mais comme ce qui la restitue à un monde. C’est ce que fait Michaël Foessel dans Le
Temps de la consolation en montrant que « la consolation est, de part en part, un apprentissage de
l’altérité » c’est-à-dire ce par quoi dans l’affliction, un regard autre est possible. C’est pourquoi,
comme le précise Michaël Foessel, la consolation est aussi « une promesse d’altérité » car, c’est
en « regardant autrement ce qui afflige » que « la désolation du présent ne sature par le champ
des possibles » (Michaël Foessel, Le Temps de la consolation, p. 25). Entendue dans ce sens, la
consolation n’est pas un opium contre la douleur mais ce qui permet d’ouvrir un nouveau regard
sur et avec la douleur. C’est pourquoi, pour Michaël Foessel il est possible de penser que la
consolation n’accule pas à la passivité, mais rend possible des praxis politiques.
37. Op. cit., p. 149.
38. D’ailleurs, Blanchot écrit : « ‘rien est ce qu’il y a’ interdit de se laisser dire en tranquille et
simple négation (comme si à sa place l’éternel et simple traducteur écrivait : ‘Il n’y a rien’) »
(Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre, p. 178).
39. Idem, p. 212.
40. Terme qui revient à plusieurs reprises dans La Déclosion et qui est cité en exergue de Le Sens du
monde.
41. Je me permets de renvoyer à ce propos à mon article « The apocalypse of Blanchot » publié
dans Philosophy Today, volume 60, n° 4, printemps 2016.
42. À ce sujet, dans Les Sens du monde, Jean-Luc Nancy montre très bien que les pensées
apocalyptiques, celles qui annoncent la fin du monde, appartiennent toujours au régime du sens
du monde dont elles professent la fin. Elles n’assument donc aucune fin ; elles ne pensent pas la
mutation : « Une telle pensée est encore prise tout entière dans le régime d’un sens signifiant,
qu’il se propose pour finir comme “non-sens” ou comme “révélation” » (Jean-Luc NANCY, op. cit.,
p. 14). Quand la « fin du monde » a un sens apocalyptique, elle ne propose donc rien de nouveau ;
elle n’ouvre sur aucune pensée, aucun possible. C’est pourquoi il est urgent de penser « après la
fin du monde » pour faire écho à l’important ouvrage de Michaël Foessel. En plus de figer le sens
de la fin, les catastrophismes sont tout entiers tournés vers le problème de la survie plutôt que
vers celui de la création de mondes possibles. Ce sont des pensées (et des politiques)
conservatrices. Voir Michaël FOESSEL, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique.
43. Voir par exemple le texte de BLANCHOT « L’athéisme et l’écriture, l’humanisme et le cri » dans
L’Entretien infini.
44. En plus de nombreux fragments évoquant en sourdine le problème de l’innocence, et donc de
l’Éden, un fragment du Pas au-delà suggère que l’écriture dans la mesure où elle se situe dans un
rapport de transgression avec le langage (et donc avec la Loi), fait écho a ce qui est en deçà du
langage, de la Loi : « Tous les mots sont adultes. Seul l’espace où ils retentissent, espace
infiniment vide comme un jardin où, bien après qu’ils ont disparu, continueraient de s’entendre
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
113
les cris joyeux des enfants, les reconduit vers la mort perpétuelle où ils semblent naître
toujours » (Le Pas au-delà, p. 31).
45. J.-L. NANCY, L’Équivalence des catastrophes, p. 58.
46. Ibid., p. 63.
47. « Non plus la fin ou des fins à venir, ni même une heureuse dispersion anarchique des fins,
mais le présent en tant que l’élément du proche. La fin est toujours éloignée, le présent est le lieu
de la proximité – avec le monde, les autres, soi-même. Si on veut parler de « fin », il faut dire que
le présent a sa fin en lui-même – comme la technique, en somme, mais sans addition de
représentations « finales ». Le présent a sa fin en lui-même aux deux sens du mot « fin » : son but
et sa cessation. Finalité et finitude conjointes – ce qui veut dire, si on y pense bien, ouverture de
l’infini. Connaissance de l’existence comme capacité infinie de sens. Pensée du « sens » comme ce
qui n’est aucune fin à atteindre, mais ce dont il est possible d’être proche. Fukushima interdit
tout présent : c’est l’effondrement de visées d’avenir qui force à travailler à d’autres avenirs.
Essayons de travailler en effet à d’autres avenirs – mais sous condition de présent toujours
renouvelé », ibid.
RÉSUMÉS
Cet article se propose d’analyser l’enjeu de la critique qu’élabore Nancy au sujet du problème du
christianisme chez Blanchot. Nous nous proposons de montrer que, s’il y a une convergence
entre les pensées de Blanchot et de Nancy autour de la question du christianisme, leur
divergence se concentre en fait sur la question du monde et sur le problème de sa fin. Tandis que
la finitude est, chez l’un et chez l’autre, un opérateur de déconstruction du christianisme, elle
définit aussi deux rapports au monde quasiment opposés. Toutefois, on montre aussi que tout en
étant opposés, ces points de vue sur le monde sont indissociables.
This article aims at analyzing the relevance of the critique Nancy addresses Blanchot in relation
to the problem of Christianity. We argue that while there is a convergence between Nancy and
Blanchot on the question of Christianity, they diverge on the question of the world and on the
problem of its end. While, for both thinkers, finitude is what makes possible the deconstruction
of Christianity, it also defines two opposed relationships to the world. Yet, we finally argue that,
although opposed, theses points of view are inseparable.
AUTEUR
AÏCHA LIVIANA MESSINA
Université Diego Portales – Santiago du Chili
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
114
Adorer en vérité ?
Jacob Rogozinski
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1 « Mais l’heure vient, elle est là, où ceux qui vraiment adorent adoreront le Père dans le
souffle et en vérité (en pneumati kai alèthéia). »1 Comment redonner vie à ces paroles
exsangues, épuisées d’avoir trop servi, ressassées par tant de sermons pendant tant de
siècles ? Avant tout en demeurant au plus près du texte, en évitant par exemple de
traduire pneuma par « esprit », comme la plupart des traducteurs ; ce qui revient à
plaquer sur ce texte de l’Évangile de Jean la dichotomie du corps et de l’esprit,
profondément étrangère à ce qu’il nous dit. Adorer en vérité, c’est d’abord adorer dans
le souffle, se laisser porter par lui, emporter par ce que le Nazaréen appelle le « souffle
de vérité », cette vérité qui « vous fera libres ». Est-elle encore dé-cèlement et en quel
sens, cette alèthéia non-grecque, déportée en grec depuis une langue étrangère ? Vérité
inspirée, insufflée dans le souffle, aspirée dans nos gorges depuis le grand vent de
l’Autre. Faudrait-il parler ici d’une parole soufflée, en laissant à cette expression toute
l’ambiguïté dont jouait Derrida dans son texte sur Artaud2 ? Parole « soufflée » par
l’Autre qui m’inspire, mais aussi, du même coup, subtilisée, dérobée par cet Autre, ce
Malin Génie qui m’arrache mes propres mots, mon propre souffle… C’est un geste
critique qui se profilerait alors, celui qui dénonce la religion comme expropriation du
propre de l’Homme, aliénation de son essence.
2 Ce n’est pas dans cette voie que je m’engagerai. Je me contenterai de relever ce qu’il y a
d’énigmatique dans ce logion : « adorer en vérité ». Il ne nous appelle pas à adorer la
vérité, ce qui reviendrait à en faire un fétiche, une idole, l’évidence massive,
incontestable, d’un dogme. Simplement à adorer en vérité, comme dans cette autre
expression que le Nazaréen emploie si souvent : « en vérité, je vous le dis » (que l’on se
gardera bien de confondre avec la phrase favorite du mystagogue ou du démagogue :
« je vous dis la vérité »). Comme si la vérité dont il s’agit ne se laissait pas enfermer
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
115
dans un énoncé ou une doctrine révélée ; comme si ce mot désignait ici une manière ou
un geste singuliers, le ton ou l’accent d’une voix, le rythme d’un souffle. Que signifie
cette insistance sur l’adoration vraie ? Y aurait-il donc d’autres manières d’adorer, dans
le mensonge, l’imposture, l’idéologie, la névrose, l’idolâtrie, le fanatisme mortifère, bref
dans la non-vérité ?
3 Tout cela, cher Jean-Luc, tu le suggères toi aussi, dans ce livre où tu accordes une place
éminente à l’adoration, entendue comme parole adressée, « parole de souffle » et de
salut, déposition et abandon, ouverture au don du monde, décision d’exister. Car tu
n’omets pas de le signaler : il y a une « caricature de l’adoration : admiration,
vénération, fascination, aliénation en tous les sens du mot » 3. Et tu ajoutes que
« l’adorant n’est pas un adorateur : il ne s’engage pas dans la vénération d’une idole » ;
son adoration ne se confond pas avec l’exaltation du fanatique ou la « fureur fasciste »,
qui « est adulation, non adoration »4. Mais comment distinguer l’adoration et son
simulacre, puisque l’adorant et l’adorateur se vouent tous les deux au même geste
d’adorer ? Comment distinguer une parole inspirée par le souffle de vérité et une
parole portée par les vents mauvais de la fureur et de la haine ? C’était déjà la question
de Kant, lorsqu’il tentait de définir trois relations différentes à l’objet de la foi : la pure
foi éthique, le culte statutaire des religions instituées et ce qu’il appelle la « folie
religieuse » (Religionswahn). C’est aussi, de manière plus tendue et paradoxale, le sens de
l’interrogation de Kierkegaard sur le sacrifice d’Abraham, sur l’absence de tout critère
permettant de distinguer la foi d’Abraham et le geste meurtrier d’un fanatique ou d’un
fou. Et peut-être est-ce la même question qui sous-tend ce passage des Holzwege où
Heidegger évoque les différents modes de la vérité, ses différentes manières de
s’installer dans le monde : dans l’œuvre d’art, le questionnement de la pensée, la
politique fondatrice, le sacrifice essentiel et la proximité de « ce qui est le plus étant
dans l’étant »5 ; c’est-à-dire la proximité du divin, car c’est ainsi qu’il le caractérise le
plus souvent. Cet étant divin dont l’approche permet à la vérité de se dé-celer et
d’advenir dans le monde, qui est-il ? S’il ne s’agit pas du Dieu des philosophes et des
savants, celui de l’onto-théologie, s’agit-il du dieu des poètes ou bien du dieu de la foi
(qui n’est peut-être pas le même), et de quelle foi ? Annonce-t-il ce que Heidegger allait
bientôt nommer, énigmatiquement, le « dernier dieu » ? Impossible, faute de temps,
d’aborder ici une telle question.
4 Heidegger propose ici de comprendre l’essence de la vérité comme un « combat
originaire » qui met aux prises la vérité elle-même, déterminée comme Unverborgenheit,
dé-cèlement, et sa réserve primordiale, son cèlement (Verbergung) qui est la lèthè, la
latence de l’a-lèthéia. Ce cèlement advient de deux manières différentes : dans la non-
vérité initiale de l’énigme, comme « dérobement » (c’est ainsi que je traduirais
Versagen) – mais aussi comme Verstellen, dissimulation, défiguration, c’est-à-dire contre-
vérité, contre-essence égarante de la vérité. Comment parvenir à déceler dans la vérité
de l’art et de la pensée, de la politique, du sacrifice et de la foi, la contre-vérité de cette
vérité ? « Le cèlement, répond Heidegger, peut être un dérobement ou bien n’être que
défiguration » et « nous n’avons jamais la certitude directe de savoir s’il est l’un ou
l’autre »6. Affirmation redoutable, surtout si nous tentons de l’impliquer dans d’autres
modes de déclosion que l’œuvre d’art, ce qu’il se garde bien de faire. Elle pourrait
signifier que, dans le feu de la décision et de l’action, il n’y a aucun critère qui permette
de distinguer une véritable politique fondatrice (mais quelle serait-elle ?) et sa
Verstellung, sa défiguration monstrueuse. Ce qui prend un sens très particulier si l’on
veut bien se rappeler que ce texte date de 1936 : des années où Heidegger commençait à
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
116
prendre ses distances avec la politique des nazis, tout en maintenant son adhésion à un
archi-nazisme « historial »…
5 Cette ambiguïté du cèlement, cet entrelacs indiscernable de la non-vérité et de la
contre-vérité se retrouvent sans aucun doute dans les autres modes de dé-cèlement, et
notamment dans l’approche du divin. Si l’affirmation de Heidegger est fondée, rien ne
permettrait de distinguer le dérobement initial du dieu, qui est l’énigme de son retrait,
et la grimace qui le défigure. Cette contre-vérité où la vérité du divin se dissimule et
s’égare, de quel nom faut-il la nommer ? À cette question, Heidegger ne donne aucune
réponse, sinon en incriminant la philosophie et le Dieu des philosophes, déterminé
comme causa sui, comme un étant absolu et tout-puissant, capable de se fonder lui-
même ; ce qui n’est certainement pas faux, mais insuffisant. Dans l’histoire de
l’Occident, la contre-vérité du divin a pris un autre nom : elle a été inlassablement
dénoncée par les trois monothéismes comme culte des faux dieux, tels qu’ils se donnent
à voir dans le visible, en transgressant ainsi ce qu’il est convenu d’appeler « l’interdit
de la représentation »7. Pour le dire en grec, cette transgression se nomme idolâtrie.
Terme lui-même ambigu où le rejet d’une certaine approche (« païenne ») du divin se
conjoint, déjà chez les Pères de l’Église, avec la condamnation platonicienne de l’eidôlon
et de la mimésis.
6 La question qui se pose est alors la suivante : la critique de l’idolâtrie suffit-elle pour
déterminer ce qui est en jeu dans ce mode de la contre-vérité ? En opposant l’idole à
l’icône, comme on le fait parfois, l’on présuppose qu’il serait possible de trancher dans
l’ambiguïté de la mimésis, de discerner avec certitude la vraie image de Dieu en la
dissociant de ses simulacres. Et le rejet radical de toute image sacrée, dont se réclament
le judaïsme, l’islam et la Réforme protestante, parvient-il pour autant à se soustraire à
la violence de la contre-vérité ? Ne tend-il pas au contraire à l’exacerber ? Une certaine
critique de l’idolâtrie ne risque-t-elle pas de remplacer une idole par une autre,
d’autant plus féroce qu’elle appelle ses fidèles à traquer partout de prétendus
« idolâtres » ? Pour le dire de manière plus directe : des Bouddhas de Bamian aux ruines
de Palmyre, nous sommes aujourd’hui confrontés à des briseurs d’« idoles » dont
l’ardeur iconoclaste se conjugue avec l’implacable fureur du fanatique.
7 Je viens d’énoncer un terme latin qui, tout comme la superstition et la religion – mais
aussi la république – n’a aucun équivalent en grec, ni d’ailleurs en hébreu. Peut-être ce
mot permet-il, mieux qu’« idolâtrie », de nommer et de comprendre cette violence
haineuse qui se déchaîne au lieu de la foi. Le fanaticus est d’abord un prêtre ou un
desservant du culte, l’homme du fanum, de l’enclos sacré qui sépare le lieu divin de
l’espace profane, c’est-à-dire du domaine situé au-dehors du fanum : celui des choses qui
ont été pro-fanées, retirées du lieu sacré pour être offertes à l’usage des hommes. C’est
cette pro-fanation primordiale qui rend possible une vie profane, un monde séculier –
voire une République laïque… – et elle serait déjà l’indice d’un retrait ou d’un
dérobement originaires du divin8. Puis, assez tardivement semble-t-il, ce mot se charge
à Rome d’une signification péjorative. Il en vient à désigner les débordements d’une
dévotion excessive, extravagante, étrangère à l’antique pietas de la religion romaine :
celle des cultes extatiques venus d’Orient. « Fanatique » nomme alors une sorte d’excès
du religieux sur lui-même, le franchissement d’une limite, cette outrance que suggère
également le préfixe du mot superstitio : en latin, superstare, c’est littéralement se tenir
au-dessus ou au-delà ; et superstes signifie le survivant, celui qui est passé par-delà
l’épreuve de mort.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
117
8 Comment prendre la mesure d’un tel excès ? En repérant une disjonction interne au
religieux, une ligne de fracture qui traverse les pratiques religieuses, les rites et les
cultes, en traçant une limite entre l’adoration du divin « en vérité » et sa défiguration,
la critique du fanatisme ne permet-elle pas d’envisager la possibilité que la religion
nous sauve d’elle-même, de l’exaltation fanatique qui la menace toujours ? La
possibilité encore inouïe que ce soit l’islam, un islam encore à venir, un islam de paix et
de liberté, de justice et de raison, qui nous délivre un jour de l’islamisme… De tout cela,
notre modernité occidentale ne veut rien savoir. La transgression fanatique de la
religion par elle-même, elle l’a en effet identifiée à la religion comme telle, dans toutes
ses manifestations, depuis que le siècle des Lumières a condamné indistinctement
comme « fanatisme » l’ensemble des croyances et des rites religieux. L’on sait où cette
condamnation a conduit nombre de prêtres et de fidèles dans la France de Robespierre
ou l’URSS de Lénine et de Staline : à l’échafaud ou dans les camps. De même qu’il y a
une critique des idoles qui est encore idolâtre, il y a une critique du fanatisme religieux
qui autorise un fanatisme profane dans ses déchaînements les plus sanguinaires. Si la
notion d’idolâtrie ne se laisse pas facilement circonscrire, si elle tend toujours à
resurgir dans ce qui prétend s’opposer à elle, il en va de même, en fin de compte, de la
notion de fanatisme. C’est qu’il est très difficile de repérer cette limite où le sens du
fanum s’inverse, où la religio s’exalte, se laisse déborder par sa propre ferveur, où elle
devient superstitio, rage et folie meurtrière, contre-vérité défigurée de sa vérité. Voilà
qui confirmerait l’affirmation de Heidegger sur l’absence de tout critère permettant de
distinguer Versagen et Verstellen, de différencier les deux modes de (re-)cèlement de la
vérité du divin.
9 Ne serait-il pas possible, sur ce chemin ouvert par Heidegger, d’aller plus loin ? Qu’il
s’agisse de dérobement ou de défiguration, il y va de la vérité du divin, une vérité qui se
révèle à chaque fois en s’arrachant à son cèlement originaire, mais sans jamais
s’exposer en pleine lumière. Jamais en effet le divin ne devient un étant disponible
parmi d’autres, que l’homme pourrait connaître et maîtriser, dont il pourrait disposer à
sa guise. Un tel « dieu » ne serait plus qu’une chose dans le monde. Lorsque les hommes
s’engagent dans l’approche du divin, ils peuvent l’aborder de différentes manières : soit
en respectant le Versagen, le dérobement du dieu dans l’énigme de son retrait (sans
doute est-ce cette réserve, cette retenue respectueuse que désignait le mot religio) ; soit
au contraire en cherchant à forcer l’accès, à s’emparer du nom et de la manifestation
du divin. En voulant se l’approprier, ils s’égarent au point de croire que l’ouverture
singulière où il s’est donné à eux est son unique mode d’accès possible. C’est cette
appropriation exclusive de la vérité et du nom du dieu qui est sa Verstellung la plus
radicale, la matrice du fanatisme. Le plus grand blasphème contre le divin, sa contre-
vérité la plus égarante s’accomplit ainsi au nom de la vérité, d’une « vérité » que l’on
prétend unique et exclusive, en rejetant comme « infidèles » ou « impies » les autres
approches de la vérité du divin.
10 Ce qui ne veut pas dire que le fanatisme caractériserait seulement les religions qui
révèrent le nom d’un Dieu unique, les religions monothéistes. Il se pourrait d’ailleurs
que l’opposition entre « monothéisme » et « polythéisme » soit inconsistante : aucune
religion connue ne s’est jamais définie par l’affirmation de la pluralité de ses dieux. Le
plus souvent, les dispositifs de croyance affirment l’existence d’un Principe divin aux
nombreux visages dont les différentes figures s’entrelacent ou s’engendrent ; dont les
multiples noms peuvent, jusqu’à un certain point, s’entre-exprimer, se traduire . Il
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
118
conviendrait alors de distinguer les religions « inclusives » des religions « exclusives » :
les dispositifs qui autorisent une traduction sans limite des noms divins et ceux qui
restreignent ou interdisent cette traduction, en privilégiant un Nom unique « au-dessus
de tous les noms »9. Mais ce critère ne saurait suffire : une religion aussi inclusive que
l’hindouisme a aussi ses fanatiques dont l’intolérance et la rage sanguinaire se
déchaînent toujours plus violemment aujourd’hui en Inde. Il semble plutôt que la ligne
de partage traverse tous ces dispositifs de croyance que l’on appelle des religions. Quels
que soient les noms qui lui sont donnés et sa manière de se donner, toujours et partout
la vérité du divin s’expose au risque de sa défiguration.
11 C’est sur cela que j’aimerais t’interroger, cette ambiguïté presque indécidable où
l’approche du divin « dans le souffle et en vérité » vient se nouer à la violence sauvage
de sa contre-vérité. Comment opérer un partage entre ces deux approches ? Qu’y a-t-il
dans ton travail qui permette de les différencier ? Certes, il t’arrive d’évoquer la
fascination ambivalente pour la cruauté du sacrifice (par exemple celle de Bataille) ;
mais tu sembles penser que cette ambivalence ou cette ambiviolence – pour reprendre
un mot de Joyce – n’affecterait plus la déclosion du divin ; qu’elle caractérise désormais
d’autres mises en jeu de l’alèthéia, dans le champ politique ou dans les œuvres les plus
extrêmes de la modernité artistique10. Pourquoi n’abordes-tu pas la question de la
violence religieuse, d’une cruauté qui se déchaînerait au nom de Dieu ? Sans doute
parce que, pour toi, l’affaire est entendue : comme tu le déclarais déjà il y a trente ans,
« il n’y a plus rien à dire de Dieu »11 ; tous les noms sacrés, tous les lieux divins nous
font à jamais défaut ; la place de Dieu est désormais « ouverte, vacante, abandonnée »,
et il ne suffit plus de proclamer que « Dieu est mort », encore faut-il ajouter qu’il ne se
survit que « paralysé, fou, aliéné, à ce point figé dans la posture anticipée de la mort […]
qu’il ne pouvait plus jamais ressusciter »12. Autant d’affirmations « a-théologiques » qui
devraient en principe t’interdire de t’interroger sur un possible retour du sacré dans
toute son ambiguïté et sa folle violence. Je dis bien en principe – car il y a au moins un
texte où tu l’envisages : au début de La Déclosion, lorsque tu mentionnes
« la possibilité d’une surrection religieuse et hyperreligieuse […] qui ne demande
qu’à s’enflammer sur un mode messianique, mystique, prophétique, divinatoire et
vaticinatoire »
et
« dont les effets d’incendie seraient plus impressionnants encore que ne l’ont été
ceux des exaltations fascistes »13.
Possibilité qui nous place, disais-tu, devant une alternative : ou bien un
« hyperfascisme » théocratique, ou bien une « invention radicale », une réinvention de
la démocratie, redéployée à l’échelle du monde.
12 Ce diagnostic lucide, comment ne pas y adhérer ? Je me demande simplement si la
déconstruction du christianisme que tu as entreprise nous permet de comprendre ce
qui est en jeu dans cette « surrection hyperreligieuse ». Comment penser le retour
menaçant du sacré, d’une certaine manière de sacraliser le meurtre, alors que tu crois
repérer dans notre modernité une sortie du religieux, un « absenthéisme », une
irréversible « désertion » de Dieu et des dieux ? Et comment appréhender la forme
singulière que prend ce retour, comment élucider ce qui s’engage sous le nom d’
islamisme, alors que ton travail se centre sur une déconstruction du christianisme ? Je
sais quelles réserves t’inspirent le motif du « retour du religieux », et tu as
certainement raison d’affirmer que rien ne revient jamais comme le même ; que
« l’identique perd d’emblée son identité dans son propre retour » 14. L’islamisme
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
119
djihadiste en est une illustration significative. Dans le fantasme d’un retour à l’islam
des origines – celui des compagnons du Prophète et des premiers califes – la nostalgie
d’un âge d’or fusionne avec l’exaltation meurtrière qu’éveille la certitude de
l’imminence de la fin des temps. Conjonction hautement explosive d’un mythe
d’origine et de l’annonce d’une apocalypse : le christianisme l’a souvent rencontrée au
cours de son histoire et elle génère aujourd’hui un millénarisme sacrificiel qui est
étranger à la tradition de l’islam (du moins de l’islam sunnite : je n’en dirais pas autant
de certains courants du shi’isme). Même si elle s’enracine dans une croyance religieuse,
dans l’attente du Jour du Jugement, cette prédication de l’apocalypse ne déborde-t-elle
pas le champ du religieux ? Ne tend-elle pas inévitablement à se politiser, à se traduire
en une théologie politique (au sens de Schmitt) où son sens initial s’efface ? Si le terme
« religion » désigne un dispositif de croyance orienté vers le salut de l’âme dans un
« autre monde » transcendant, il faut alors reconnaître que l’islamisme djihadiste n’est
pas un mouvement religieux. Par la dimension politique de son action, mobilisée toute
entière vers la fondation d’un État et/ou d’un Empire, par son exercice de la terreur,
par sa volonté de contrôler et de façonner intégralement la manière de vivre et de
penser de tous ceux qui subissent sa domination, il s’apparente plutôt aux mouvements
totalitaires du XXe siècle. Prenons toute la mesure du paradoxe : c’est au moment même
où il proclame le califat et la guerre sainte contre les « infidèles » que l’islamisme
politique s’inscrit d’autant plus sûrement dans cet effacement du divin, cette
sécularisation du monde qu’il ne cesse de dénoncer…
13 Il n’en reste pas moins que quelque chose fait ici retour, dont nous nous pensions
délivrés pour toujours, et qui nous sidère par son extrême violence et sa cruauté.
Retour d’une politique fondée directement sur un mythe religieux, ce qui n’était pas le
cas de ces « religions séculières » que furent le fascisme et le communisme. Retour d’un
sacré archaïque, plus ancien sans doute que les trois monothéismes, où la rage de tuer
s’unit à la jouissance de l’auto-sacrifice. Il me paraît donc très difficile d’affirmer que
notre époque serait celle d’un absentement irrévocable du sacré, d’un retrait-sans-
retour du divin. Et pourtant, je te l’accorderai volontiers, nous n’assistons pas
aujourd’hui à un « retour du religieux » ; mais pour une autre raison : parce qu’il ne
nous a jamais vraiment abandonnés. Si l’on admet, comme tu le fais dans La Déclosion,
que notre modernité est « de part en part chrétienne », y compris dans la dénégation la
plus véhémente de sa provenance chrétienne, cela voudrait dire que nous ne sommes
jamais sortis du christianisme. Dès lors, il ne faudrait plus parler d’un retour, bien
plutôt d’une mutation – voire d’une mythation – du religieux. Mais, comme toute
mutation, toute rupture et toute révolution, celle-ci implique en même temps une
répétition et un retour : après s’être sécularisés dans ces religions politiques qu’étaient
le communisme et le fascisme, les dispositifs de croyance se manifestent à nouveau
sous leur forme pré-moderne, dans la résurgence réactive de l’islam, mais aussi celles
du judaïsme et du christianisme, sans oublier l’hindouisme. L’on a affaire ici à un geste
paradoxal où ce qui fait retour s’altère et revient malgré tout comme le même à travers
son altération. Ni simplement rupture et dépassement, ni simplement retour, quelque
chose comme une « rupture mimétique »15 ou un retour-sans-retour.
14 L’on peut alors se demander si un tel « retour » n’est pas requis par l’essence de la
religion, et d’abord par son nom. S’il est vrai que « les dieux sont partis depuis
longtemps », le nom de religion est celui de leur rappel, à tous les sens de ce mot :
remémoration de ce qui a été oublié, ré-évocation de ce qui s’est éloigné. En s’appuyant
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
120
sur une étymologie tardive qui dérive religio de religare (relier), Thomas d’Aquin pouvait
ainsi écrire que « relier, c’est attacher à nouveau ce qui, dénoué, avait commencé à
s’échapper ». Il semblerait plutôt que ce terme provienne de relegere : re-cueillir ce que
l’on avait déjà accueilli, le privilégier, l’élire en le mettant à l’écart pour le respecter, le
révérer. Le verbe latin legere (cueillir, assembler, choisir, dérober…) est de la même
famille que le legein grec ou le lesen allemand, et la religio des Romains consonne ainsi
avec le sens initial du Logos grec. Si ce n’est que religio y ajoute une dimension qui
n’apparaît pas en grec, ni en allemand, celle de la répétition, du retour. Quelle que soit
son étymologie, qu’elle fasse signe vers le renouement d’un lien qui s’est défait ou bien
vers la retenue respectueuse, la reprise qui revient pour mettre à l’écart, dans tous les
cas la re-ligio aurait prescrit depuis toujours son rappel, la loi de son retour. De sa
teshuvah, dirait-on dans une autre langue, une autre foi, étrangère à l’aire gréco-
germano-latine (« revenez vers moi, dit Elohim, et je reviendrai vers vous »). Dans tous
les cas, religion nomme ce qui revient, qui ne cesse pas de revenir, pour notre malheur
ou notre chance : ce qui n’en finira plus de hanter une époque et un monde qui
croyaient s’en être émancipés.
15 De là ma question : ta déconstruction du christianisme nous aide-t-elle à penser ce qui
nous arrive, ici, maintenant ? Je n’en suis pas certain. Non seulement parce qu’elle fait
fonds sur l’hypothèse d’une sortie irréversible du religieux, mais aussi parce qu’elle se
focalise sur une seule des religions. Ne faudrait-il pas élargir le champ, intégrer dans
ton projet les deux autres monothéismes, et tout autant les religions de l’Inde, de la
Chine ou de l’Afrique ? Substituer à la déconstruction du christianisme une
phénoménologie du divin ou du sacré ? Tu me répondras probablement qu’un tel
élargissement n’est pas nécessaire. Car ce qui advient aujourd’hui au christianisme
serait seulement l’indice d’un « devenir-athée » affectant l’ensemble des religions : il y
aurait « une sorte de vecteur d’athéisme qui (les) traverse » et en ferait les témoins et
les victimes d’un épuisement irrémédiable du divin16. La déconstruction du seul
christianisme pourrait donc valoir pour toute religion. Tu m’accorderas que cette
affirmation ne va pas de soi. À supposer que ce devenir-athée soit effectivement le
destin fatal du christianisme (et comment en être certain ?), l’on pourrait se demander
si les autres religions ne s’efforcent pas au contraire de résister à un tel destin, y
compris par la violence et la terreur. Pourquoi ne pas reconnaître, avec Derrida, que
« le judaïsme et l’islam seraient peut-être les deux derniers monothéismes à
s’insurger contre tout ce qui, dans la christianisation de notre monde, signifie la
mort de Dieu »17 ?
16 De quel droit accorder alors au christianisme une valeur exemplaire, le privilège de
révéler la vérité ultime de toutes les religions ? Précisément, me diras-tu, parce qu’il est
la plus athée de toutes ; qu’il est travaillé dès l’origine par un mouvement interne
d’auto-déconstruction, de démythologisation, de déclosion de sa propre clôture, et
atteste ainsi de l’irréversible absentement de Dieu et des dieux.
« J’appelle ‘christianisme’ la posture de pensée selon laquelle ‘Dieu’ demande à être
effacé ou à s’effacer de lui-même […]. Dieu qui se fait homme, délaissant sa divinité
jusqu’à la plonger dans la condition mortelle18. »
17 Cela même que la tradition chrétienne désigne comme la sarkose, le devenir-chair du
Fils ; et, plus radicalement encore, comme la kénose, l’évidement de Dieu, de Celui qui en
Dieu « s’est vidé hors de lui-même », a renoncé à sa forme divine pour prendre une
forme humaine et mourir sur la Croix. Et ceci est notre corps, puisque le corps de
l’homme devient par cette kénose le lieu de l’évanouissement de Dieu 19. Et ceci est notre
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
121
monde, s’il est vrai que la possibilité même d’un monde (et d’un sens du monde hors de
ce monde) s’origine dans la kénose, dans le devenir-monde d’un Dieu qui, finalement,
s’absente de ce monde qu’il est devenu20.
18 Cette analyse, je la partage – à deux réserves près. Et d’abord celle-ci : tout cela ne
revient-il pas à accorder au christianisme un étrange privilège, celui de révéler, par son
auto-déconstruction kénotique, la vérité de (la mort de) Dieu ? Le christianisme : religion
du Dernier Dieu, religion absolue ou religion de l’Absolu, d’un Absolu négatif qui va
jusqu’à s’absoudre de lui-même et s’abolir dans son absolution. Ce qui ferait de la
déconstruction du christianisme, telle que tu la conçois, une réplique inversée de la
philosophie de la religion de Hegel, qui maintient tout en l’inversant sa position
christianocentrique. L’on a certes le droit d’être hégélien. Mais pourquoi serions-nous
obligés de vous suivre, Hegel et toi, sur ce chemin ?
19 Voici ma seconde réserve : je me demande si ton interprétation de la kénose, qui
soutient toute ta problématique, ne repose pas sur une méprise, ou du moins sur un
forçage. Est-il possible de dissocier ainsi les deux moments, la phase d’auto-évidement
et d’abaissement du Fils dans son Incarnation et sa Passion, et celle de sa Résurrection
dans la gloire du dimanche ? Que serait une kénose sans anastasis, sans la promesse
d’une résurrection ? Ne faut-il pas admettre que le dieu des chrétiens ne meurt que
pour ressusciter, ne s’absente que pour faire retour, comme tant d’autres dieux ? À
cette objection, tu as déjà répondu, en refusant de voir dans l’anastasis du Christ un
mythe de régénération21. Celui qui, de son vivant, déclare « je suis la résurrection et la
vie » n’annonce pas sa re-naissance future, à la manière d’un Osiris ou d’un Dionysos. Il
ne prétend pas triompher de la mort par un tour de magie divine, mais nous appelle au
contraire à partager, dans son exposition à la mort, la condition d’une existence finie
(qui est peut-être ce que Derrida et toi désignez comme une finitude infinie). « La
résurrection n’est pas un retour à la vie. Elle est la gloire du sein de la mort » :
surrection, soulèvement, levée du corps-mort, relèvement sans relève dialectique, qui
« ne porte pas la vie supprimée à la puissance d’une vie supérieure », mais affirme à
travers la mort la singularité de chaque existence. En ce sens, « la résurrection n’est pas
une apothéose, c’est au contraire la kénose continuée » et il devient alors possible
d’enraciner le devenir-athée de Dieu dans le mouvement même de sa kénose.
20 Cette analyse profonde et belle, je n’ai pas l’intention de la contester ou de la
contredire : de quel droit le ferais-je, moi qui ne suis pas chrétien ? Car elle vaut
seulement pour une foi kénotique, une foi qui se fonde sur l’affirmation de l’auto-
évidement du divin, et comment pourrions-nous (« nous », juifs, musulmans,
hindouistes, bouddhistes, incroyants ou athées…) partager une telle foi ? Ce qui ne veut
surtout pas dire que « nous » ne serions pas confrontés, « nous » aussi, à une mutation
radicale du divin, à ce que j’ai appelé son retour-sans-retour, avec les déchaînements de
violence qu’il peut impliquer. Cela signifie simplement que cet événement qu’un
penseur chrétien peut appréhender comme la mort de Dieu, sa kénose, son auto-
déconstruction ou sa déclosion, il nous est donné de l’approcher autrement, par
exemple comme une éclipse de Dieu (c’est le titre d’un livre de Buber), comme sa
contraction, son retrait au plus profond de soi (son tsimtsoum, dirait un kabbaliste) ou
comme son avatar (sans que je sois certain de bien comprendre ce concept fondamental
de l’hindouisme). Car la mutation du divin peut se présenter de plusieurs façons,
comme un dérobement ou une défiguration, un retrait ou un retour, une bonne
nouvelle ou un désastre ; et elle s’éprouve à chaque fois de manière différente, dans la
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
122
prière et l’extase, le chant, l’étude, la danse et le poème, dans la confiance, la fidélité,
l’infidélité, l’abandon, le deuil, l’angoisse, le délire, le désespoir, l’espérance, la joie,
l’amour. En tout ce qui nous appelle à adorer dans le souffle et en vérité.
BIBLIOGRAPHIE
AGAMBEN Giorgio, Profanations, Paris : Payot-Rivages, 2006.
ASSMANN Jan, Le Prix du monothéisme, Paris : Aubier-Flammarion, 2007.
DERRIDA Jacques, « La parole soufflée », in : L’Écriture et la différence, Paris : Seuil, 1967.
DERRIDA Jacques, « Foi et savoir », in : DERRIDA, Jacques et VATTIMO, Gianni, La Religion, Paris :
Seuil, 1996.
HEIDEGGER Martin, « L’origine de l’œuvre d’art » (1936), in : Chemins qui ne mènent nulle part, Paris :
Gallimard, 1962.
HEIDEGGER Martin, « De l’essence de la vérité » (1943), in : Questions, t. I, Paris : Gallimard, 1968.
NOTES
1. Évangile de Jean, 4, 23.
2. J. DERRIDA, « La parole soufflée », L’Écriture et la Différence.
3. J.-L. NANCY, L’Adoration, p. 30.
4. Ibid., p. 69 et 114.
5. « L’origine de l’œuvre d’art » (1936), in : Chemins qui ne mènent nulle part, p. 69.
6. Ibid., p. 59 (traduction modifiée). Dans De l’Essence de la vérité (1943), Heidegger adopte une
terminologie un peu différente en distinguant deux modes de la non-vérité : comme cèlement
(Verbergung) et comme errance (Irre), cf. Questions t. I, p. 182-189. Il précise que « c’est dans la
simultanéité du décèlement et du cèlement que domine l’errance » et que celle-ci est « la contre-
essence (Gegenwesen) essentielle de l’essence originelle de la vérité » : cela même que je définis
comme contre-vérité de la vérité.
7. Un interdit que tu as analysé dans Au fond des images, p. 57-100, en le mettant en rapport avec
la possibilité de « représenter » l’horreur de la Shoah.
8. Sur la signification de la profanatio dans la Rome ancienne, cf. les remarques d’A GAMBEN – qui en
tire des conclusions différentes des miennes – dans Profanations, p. 95-122.
9. Je m’appuie ici sur les analyses éclairantes de J. A SSMANN, dans Le Prix du monothéisme.
10. C’est ainsi que je comprends l’analyse que tu proposes de « l’insacrifiable » (cf. Une Pensée
finie, p. 79-91).
11. Dès les premières pages de ce très beau texte de 1987, Des Lieux divins.
12. J.-L. NANCY, Une Pensée finie, p. 354.
13. J.-L. NANCY, La Déclosion, p. 12.
14. Ibid., p. 9.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
123
15. Tu as recours à cet oxymore dans « L’insacrifiable », afin de penser la « transfiguration » du
sacrifice archaïque en « auto-sacrifice » (cf. Une Pensée finie, p. 71-86).
16. J.-L. NANCY, L’adoration, p. 44-45. Position qui n’a pas varié depuis Des lieux divins : « Dieu est
mort dans l’Occident et de lui […]. Mais partout ailleurs, les dieux se sont depuis longtemps –
peut-être depuis toujours – épuisés » (p. 47-48).
17. J. DERRIDA, « Foi et savoir », in : La Religion, p. 20-21.
18. J.-L. NANCY, L’Adoration, p. 45.
19. J.-L. NANCY, La Déclosion, p. 127 – cf. aussi les analyses de Corpus sur la « décorporation » du
corps glorieux de Dieu comme avènement d’un monde des corps exposés et finis.
20. Cf. La Création du monde, notamment p. 32-40.
21. Je renvoie ici à l’un de tes plus beaux livres, Noli me tangere.
RÉSUMÉS
Que signifie « adorer en vérité » ? Comment parvenir à distinguer la vérité de l’adoration et sa
contre-vérité, cette défiguration de la foi que l’on peut nommer le fanatisme ? À cette question, il
semble que J.-L. Nancy ait refusé de se confronter. Il repère en effet dans notre modernité une
sortie du religieux, un « devenir-athée » irrévocable. Cette thèse n’est-elle pas la conséquence
d’une conception christocentrique de la religion? Ne nous empêche-t-elle pas de penser les
mutations qui s’opèrent aujourd’hui dans le champ du religieux ?
What does it mean “to adore in truth”? How can we distinguish truth of adoration from its
untruth, from this disfigurement of faith that can be called fanaticism? To this question, it seems
that J.-L. Nancy refused to confront. Indeed, he points out in our modernity an exit from the
religious, an irrevocable “becoming-atheist”. Is not this thesis a consequence of a christocentric
conception of religion? Could it forbid us to think about the mutations that are happening today
in the field of religion?
AUTEUR
JACOB ROGOZINSKI
Université de Strasbourg
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
124
Une disparition. Plus intime que le
visage, le visage
Danielle Cohen-Levinas
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
« À coup sûr, il nous faut penser. »
Jean-Luc Nancy, Demande. Littérature et philosophie
1 Nous tenterons de décrire ici une structure d’effacement qui lie irrémédiablement une
pensée privée de sa présence à des figures de vérités dont les traits s’anamorphosent en
point de fuite. Mon propos ressemble à s’y méprendre à une narration qui tente un
sauvetage : sauver les restes d’un retrait dont on ne sait plus très bien s’il concerne les
dieux – « Un jour les dieux se retirent »1 –, ou s’il concerne la vérité laissée à sa seule
privation : « La vérité devient : ‘qu’est-ce que la vérité ?’ »2.
2 Comment comprendre un tel énoncéqui semble attester chez Jean-Luc Nancy d’un
retournement de la philosophie en non philosophie, postulant pour, non pas une
altération du sens, mais rien de moins que sa disparition ? Tout l’art du philosophe
consisterait à s’affranchir de la question, pour autant que ce franchissement emporte
avec lui le tracé d’un récit qui efface jusqu’à ses propres traces. On parlera d’un défaut
de pensée où viendrait s’abîmer toute figuralité. Le sauvetage dont je parle est celui d’un
élan, d’un soulèvement quasi primitif qui arrache au sens et interrompt les signifiants
de l’histoire. Nancy le rappelle : « Pour qu’un prisonnier sorte de la caverne de Platon,
il faut quelque violence »3. On l’aura compris, la disparition dont je parle n’est rien
d’autre que l’insurrection de la pensée et dans la pensée. Celle-ci esquisse les traits et
por-traits d’un espacement du sens que Jean-Luc Nancy a souvent décrit sous les espèces
d’une disposition de présences et d’une comparution dont le mouvement répond aux
alternances de la venue et du retrait. Comment comprendre un tel énoncéqui semble
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
125
attester chez lui d’un retournement de la philosophie en non-philosophie et qui
postule, non pas une altération du sens, mais rien de moins que sa disparition ?
3 On comprendra d’emblée que ce qui est en jeu relève d’un phénomène de
déconstruction, voire de dislocation de ce que Nancy appelle « le sens du monde », qu’il
met immédiatement en rapport avec « le sens de la vie » comme ce qui permet la
circulation des appartenances, des identités et des généalogies, sans jamais figer celles-
ci dans des significations closes. « Monde » et « vie » en tant que ces deux occurrences
s’espacent entre elles afin de se partager leurs différences. Ce que Nancy désigne par le
mot « sens » n’est pas de l’ordre d’un résultat et d’une résolution des différences en
question. Il est l’exact punctum de ce qui les sépare et les ajointe d’un seul tenant,
mettant en rapport un quelque chose avec autre chose. Il y a manifestement chez
Nancy une pensée modulante du paradoxe qui s’exprime dans l’ouverture même de ce
qui efface le sens, de ce qui précisément le fait disparaître. À ce titre, le « sens du
monde » n’est pas sans rappeler ce que Jan Patočka avait nommé la « crise du sens » 4, à
savoir une interrogation sur ce qui manque au « monde de la vie » dès lors que l’on ne
peut plus nier que l’Europe est une proie à une désorientation radicale du sens même
du monde et de la vie. Le « manque » est donc une notion-pivot, qui articule sens en
non-sens, jusqu’à un point de rupture. La question posée par Patočka peut se résumer
de la façon suivante : qu’est-ce qui manque au monde de la vie pour que vivre en vue du
sens devienne un enjeu majeur de la philosophie ? Dans Liberté et sacrifice, un premier
élément de réponse consiste à réfuter l’idée même de « monde de la vie » (Lebenswelt)
avancée par Husserl :
« Le manque ne concerne rien de présent, rien qui se présente là-devant nous en
chair et en os […]. Ce qui manque au monde naturel de Husserl n’est rien de
« positif », mais bien plutôt le monde même, en son projet primordial, qui se tient caché
derrière la doxa. Husserl a beau affirmer l’existence d’une structure d’essence qui se
maintiendrait, identique, dans tous les mondes ambiants, il n’y a pas à vrai dire de
monde naturel, pas de monde de la vie. »5
4 Nancy déplace la question. On passe de « comment vivre en vue de préserver le sens » à
« comment faire disparaître le sens en vue de vivre » ? Il s’agit de souligner à quel point
la vérité du sens n’est jamais adéquate. L’accès au sens n’appartient pas à un ordre
phénoménologique. La vie, pour Nancy, précède le phénomène de l’existence. Si
Patočka replie la question de la vie sur le sens, Nancy la sépare, suscitant ainsi un écart
irréconciliable. Peut-on encore exhiber du sens ou ne faut-il pas au contraire se risquer
à affronter sa nudité, son extrême épuisement, son incapacité à maintenir le monde
dans des figures d’enchantement ? Sans doute est-ce dans ce processus de disparition
de sens que réside, encore, la possibilité du philosophème. Mais par « disparition », je
n’entends pas l’oubli ou le retrait du sens. Ce serait poser la question du sens du monde
de Nancy au cœur d’une situation historiale dont il cherche à se déprendre. Jean-Luc
Nancy s’emploie donc à mettre fin à cette fable qui consiste à croire que le monde dans
lequel nous vivons est toujours en quête de sens. Cependant, en dépit de la perte, de
l’épuisement, du mouvement ininterrompu d’absentement et de dissolution du sens,
cette question, quant à elle, ne disparaît pas du discours et de la parole philosophique de
Nancy. Autre paradoxe constitutif de cette pensée : plus le sens disparaît, moins on ne
peut renoncer à parler du monde et de la vie. C’est ici le mouvement même de la pensée
qui se voit hyperbolisé sous la pression et la violence qu’exerce le fait de tenir à l’écart
le sens, de l’empêcher de se reconstituer sous la forme de l’infini, ce qui reviendrait à y
faire entrer du sens. D’où la formule saisissante : « Il n’y a plus de sens du monde » 6.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
126
5 « Il n’y a plus ». Comprenons par là : inutile de chercher du sens. Nous ne trouverons
que des représentations esseulées. Cherchons le sens dans l’effacement du sens,
autrement dit, entre le deuil du sens et du monde et l’ouverture à de nouvelles
possibilités qui ne s’alignent plus sur le cours de l’histoire du monde, du salut ou d’un
horizon de sens. Ces nouvelles possibilités sont décrites par Nancy comme ce qu’il y a
de plus intime pour la pensée, l’écriture, la création, la politique et, bien sûr, pour
l’être-en-communauté, pour le commun, le préfixe cum que Nancy se plaît à décliner, à
portraitiser, à figurer, visager, dévisager, former, déformer sous des profils divers et
variés, à commencer par le cum de communauté bien sûr, mais aussi le cum de
communion, comparution, communisme, compassion, communication, etc. Bref, si
quelque chose fait sens, c’est bien que nous sommes, certes des étants, mais aussi et
avant tout des « cum ». Nous sommes un préfixe qui nous met d’emblée en présence
d’une intimité avec l’Autre, sans pour autant que le noyau dur de ce cum ne soit réduit à
un a priori dans lequel le sujet aurait une position, une thesis. Il s’agit bien plutôt d’une
pensée du « cum » comme pensée du lien, ou, pour user d’un mot cher au vocabulaire
de Nancy, comme rapport, comme mise en jeu d’une différence entre le sujet que nous
sommes et ce avec quoi nous sommes-avec ; ce par quoi nous sommes toujours conviés,
appelés à aller au-delà de nous-mêmes, à accueillir cette ouverture dont parle Nancy.
Ouverture comme Révélation du rapport, même si cette Révélation s’avère être un
événement ajourné ou différé. Dès lors, on comprend jusqu’où la question du Mitsein -
que Heidegger lui-même considère comme première, à savoir qu’avant d’être seuls au
monde, nous sommes avec – est fondamentale pour Nancy, et comment ce cum comme
Mitsein auquel il ne renonce pas traverse la philosophie, la précèdeet précède tout
autant l’esthétique et le politique.
6 Sans doute trouverait-on un écho éloquent à cette précédence, à ce Mitsein antérieur
dans la manière dont Jean-Luc Nancy et Jean-Christophe Bailly déconstruisent l’idée
communiste dans La comparution. Si le communisme est une pensée qui n’est pas
révolue en ce sens qu’elle se présenterait toujours comme à venir et en devenir, c’est
précisément parce que nous sommes en présence d’une pensée du lien, d’un Mitsein
infini auquel la philosophie ne peut déroger puisque cette pensée du politique est aussi
une pensée de l’être. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il me semble que ce que
Nancy nomme « être » n’est rien d’autre que le sens même du « cum », autrement dit du
commun, et par conséquent, du communisme, mais d’une espèce de communisme qui
n’a pas encore eu lieu. Communisme coextensif à nos existences, qu’elles soient
individuelles ou collectives. Communisme qui ne se donne pas exclusivement à
entendre du point de vue politique, mais aussi dans le rapport que le politique établit
avec l’être en commun. C’est un communisme de struction dirons-nous (je me risque à
prononcer ce terme), au sens où il a tous les traits d’un commun composite, inconstruit,
an-archique (expression de Levinas). Un commun composite en tant qu’il fait lien avec
la co-originalité des singuliers que pour Nancy nous sommes.
7 Bien que, dans La Comparution, il soit surtout question du communisme de Marx, Nancy
et Bailly s’attachent à montrer que « communisme » est un mot qui n’a pas encore
trouvé un avenir philosophique. D’où l’idée que le communisme soviétique n’aura pas
épuisé les contenus et la substance du syntagme. Rappelons ce passage emblématique :
« Le communisme, sans doute, est le nom archaïque d’une pensée toute entière à
venir ». Je laisse de côté les analyses très subtiles de Nancy et de Bailly sur cette pensée
du communisme « toute entière à venir » et je reviens à la question du sens devant
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
127
laquelle Nancy ne capitule jamais et dont on sait que pour lui elle « ne date pas
d’aujourd’hui, ni même d’hier »7. L’œuvre de Nancy peut être interprétée comme un
éloge à ce qui vient surseoir au retrait des dieux ; au retrait de ce qui n’est pas un pur
absentement, comme on pourrait dire par exemple : « Je m’absente pour un temps
indéterminé. Je m’absente, je vais voir ailleurs ce qui se passe ». Le retrait dont parle
Nancy est d’une autre nature. Certes, le mouvement de retrait des dieux demeure, mais
il se déplace de l’extérieur à l’intérieur : « Les Dieux se retirent de leur propre
présence », écrit Nancy dans Demande. Littérature et philosophie. « Ils s’absentent
dedans »8.
8 Que reste-t-il alors de cette présence qui s’est absentée et qui, le faisant, s’expose,
s’ouvre à une monstration dont elle ne connaît rien ou quasiment rien ? À cette
question névralgique, Nancy semble apporter un élément de réponse, fondateur dans sa
pensée de ce qui n’appartient plus à l’ordre d’une fondation de sens et de signification :
« Ce qui reste de leur présence, c’est ce qui reste de toute présence lorsqu’elle s’est
absentée. Il reste ce qu’on peut en dire. Ce qu’on peut en dire est ce qui reste
lorsqu’on ne peut plus s’adresser à elle : ni lui parler, ni la toucher, ni la regarder, ni
lui faire un présent ».
9 La question du sens se manifesterait comme un défaut, ou un excès, ou un retrait du
sens, mais cependant – c’est là un des gestes les plus exemplaires de Jean-Luc Nancy, un
reste d’hégélianisme à l’œuvre dans le travail du sens – il s’agit encore de sauver le
sens, non plus en l’arrimant à une vérité, mais en lui répondant et en répondant de lui,
comme s’il nous fallait soutenir les figures d’absentement, ne pas les laisser à leur
propre abandon. Je fais donc l’hypothèse que la philosophie telle que la vit et la pense
Jean-Luc Nancy n’est rien d’autre que la confrontation d’avec une disparition. C’est
l’épreuve et la traversée de cette disparition dans un contexte de désenchantement, de
perte du chant du sens. Si l’idée même de sens s’avère une nomination désastreuse
pour désigner ce mouvement de retrait, il nous faut accepter cette disparition du sens,
par-delà son effacement ou sa vérité historiale. Seule condition pour réapprendre de
nouveaux chants.
10 Je cite à nouveau un passage de Demande qui résume selon moi, avec une tonalité
lyrique, ce que j’appelle un battement : battement entre l’écriture du sens, son tracé, sa
figure et son excriture, son infigurable, car toute vérité de sens pour Nancy s’expose à
un dehors irreprésentable. Ce passage suit de près l’évocation d’un chant de Lucrèce
extrait du De rerum natura. Citons pour commencer les vers de Lucrèce en traduction
française :
« Sur des bûchers dressés pour d’autres,
des hommes plaçaient à grands cris
ceux de leur sang,
approchaient la torche, engageaient des luttes
sanglantes plutôt que d’abandonner les corps. »
11 Reprenant le motif de l’abandon des corps, Nancy précise :
« Ne pas abandonner les corps, et peut-être au mépris de l’œuvre, telle est la tâche.
Ne pas abandonner les corps des dieux sans pourtant désirer rappeler leur
présence. Ne pas abandonner l’office de la vérité ni celui de la figure, sans pour
autant combler de sens l’écart qui les sépare. Ne pas abandonner le monde qui se
fait toujours plus monde, toujours plus traversé d’absence, toujours plus en
intervalle, incorporel, sans pour autant le saturer de signification, de révélation,
d’annonce ni d’apocalypse »9.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
128
12 Il ne faut donc rien lâcher, rien abandonner, mais il nous faut en revanche accepter que
ce « rien » disparaisse en permanence, à l’infini. Car la question de la présence au
monde est une affaire de corps, plus exactement de corps à l’approche, et non plus de
corps dans une position de corps. Nous pourrions le formuler autrement et le dire de
manière plus saisissante : ne pas abandonner signifie ne pas abandonner les corps
morts depuis le profond Jadis dont parle Paul Valéry. Ce qu’il est convenu d’appeler la
mort de Dieu ne correspond pas pour Nancy à un moment d’assomption du sujet. La
mort de Dieu n’est certes pas la mort de l’homme, mais elle est néanmoins l’effacement
d’une forme idéale de représentation de l’homme en tant que sujet : sujet du monde au
monde ; sujet politique ; sujet de l’histoire, autrement dit : sujet du sens qui disparaît en
laissant des traces. Le sujet à qui on parle, à qui on s’adresse, avec qui on vit, dont on
fait le portrait10 s’excède de sa mêmeté. Il se dérobe, se dissout, s’efface, se retire à son
tour et s’en va « vers le fond » dit Nancy. Comprenons par là qu’il se retire avec les
fondements métaphysiques, comme engloutis par eux : « Il se soustrait ostensiblement
à la mêmeté »11, écrit Nancy dans L’Autre portrait. Question de glissement, d’écart et de
déplacement du sens : de même qu’il ne faut pas abandonner les corps, il ne faut pas
abandonner le portrait.
13 Je voudrais m’arrêter sur ce que j’appelle le moment du portrait chez Jean-Luc Nancy,
et, par-delà la question du portrait, c’est sur la question du visage telle que Nancy
l’aborde dans L’Autre portrait que je souhaite m’entretenir (question aux résonances
éminemment lévinassiennes). Une lecture attentive de L’Autre portrait nous conduit à
retrouver quelques motifs chers à Jean-Luc Nancy qui éclairent d’un jour nouveau la
question de la crise du sens, laquelle devient crise de la représentation, au sens où la
représentation du visage de l’homme par exemple tendrait vers un infigurable. Nancy
dit de cet infigurable « qu’il est à la fois propre à chacun et commun à tous ». On
retrouve ici une autre question chère à Nancy, celle du singulier/pluriel, placée au
registre du portrait et du souci (Sorge) de l’autre que soi. J’utilise à dessein le
vocabulaire heideggérien, auquel j’affecte d’emblée le sens latin du terme : cura, qui
signifie à la fois souci et soin. Souci et soin adressés d’un même tenant et d’un même
soulèvement à la mêmeté de soi et à la mêmeté de l’autre que soi qui s’est retiré dans sa
propre figure. Les mots ont ici un poids considérable. La question de propre telle que la
travaille Nancy n’est pas fortuite. Elle fait signe selon moi, bien que Nancy n’y fasse pas
explicitement référence, à la question heideggérienne de l’Eigentlichkeit. Ce mot peut
être considéré comme un néologisme en allemand qui signifie le fait d’être ce que l’on
est, au sens propre du terme – ce que l’on traduit le plus souvent par « authenticité »,
mais qui peut aussi être traduit par « propriété ».
14 Si le thème du « propre » traverse l’œuvre de Nancy, il me semble nécessaire de
souligner qu’elle traverse également toute l’œuvre de Heidegger, depuis l’Eigentlichkeit
jusqu’à l’Ereignis. Dans l’effort philosophique qui consiste à montrer l’intrication de la
mêmeté et de l’altérité, à même la question du portrait, ainsi que dans l’effort qui
consiste à mesurer l’écart à soi-même dont le portrait serait un témoignage exemplaire
dans notre civilisation occidentale ; dans cet effort qui consiste à faire du portrait le
paradigme de la notion d’écart, toujours dans l’intervalle de soi à soi, puisque le propre
du portrait que je regarde regarde le propre du portrait que je suis, réside une béance
que Nancy nomme dans son dernier livre, Sexistence, un inapproprié. Comme une
coïncidence entre deux inextricables : le propre et le désa-propre.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
129
15 Rappelons néanmoins que le portrait selon Nancy est dépourvu de regard, ou du moins,
ce n’est pas un regard posé sur une perspective. C’est un regard qui relie l’étant à l’être,
le phénomène à sa phénoménalisation, tout imprégné qu’il est d’une grammaire
significative, recouverte par une visée intentionnelle. C’est donc un regard qui excède
tout regard, qui excède la face dit Nancy. En l’excédant, ce regard ne fait rien d’autre
que manifester son absence, sa disparition. Il a, pourrait-on dire sans jeu de mots, perdu
la face. En tout premier lieu, « perdre la face » signale la perte d’un quelque chose qui
n’appartient plus à l’ordre du figurable, mais à l’ordre de l’intimité, à ce que
j’appellerais volontiers l’intimitable. Par « intimitable », je veux dire : ma face est plus
intime que moi-même. D’où le fait que la « face » se dérobe à toute représentation.
Perdre la face revient donc à s’absenter de sa propre mêmeté, à faire l’expérience du
désa-propre. Ne reste alors que la trace intime de notre intimité, autrement dit, l’
intimitable. Cette présence-à-soi dans le portrait qui se double, se creuse selon
l’expression de Nancy, se spectralise d’une absence, me semble s’inscrire dans le
prolongement de la question du propre chez Heidegger. Mais Jean-Luc Nancy – c’est là
un point remarquable – ne reconduit pas cette question à ce que l’on pourrait appeler
un privilège métaphysique. Privilège du sens ou de la valeur de la vérité, car de même
que pour Heidegger la non-vérité est plus originelle que la vérité et l’inauthenticité
plus originelle que l’authenticité, pour Jean-Luc Nancy, l’ouverture du sens, la levée du
sens, sa désapropriation est plus originelle que sa propriation. Le sens n’est donc plus
un donné. Il s’écarte de soi, il se distend, il s’absorbe dans son effacement. De sorte
qu’avec le portrait, on se retrouve dans un face-à-face paradoxal, au cœur même d’un
mystère – autre mot cher à Jean-Luc Nancy pour dire combien la figure qui s’absente
dans le portrait se donne pour le retrait dont elle est la trace, ou l’image, ou le dessin,
ou la figure, ou l’objet (objet de la mimésis).
16 Arrêtons-nous sur cette occurrence : face-à-face. Je pourrais à son sujet paraphraser
Jacques Derrida lorsqu’il écrit : « Je n’ai qu’une seule langue, ce n’est pas la mienne » 12,
et dire : « Je n’ai qu’une seule face, ce n’est pas la mienne ». Mais précisément, je peux
le dire et je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que Jean-Luc Nancy n’a pas
intitulé son livre Le portrait de l’Autre, mais L’Autre portrait. S’il existe dans l’œuvre de
Nancy un sérieux ébranlement de la métaphysique de la présence, et plus qu’un
ébranlement, un traumatisme, il n’existe pas en revanche de mouvement hyperbolique
d’éthicité de l’éthique et l’extériorité absolue, le dehors absolu, n’est pas une
apologétique de l’Autre. Le travail du concept chez Nancy répond à un mouvement
d’anamorphose – les anamorphoses de l’ontologie – qui tend à retenir l’Autre dans le
Même de manière à ne pas l’abandonner. Là encore, nous ne devons pas nous
méprendre quant à la nature et à la vocation de cette retenue. Elle n’est pas de l’ordre
d’une rétention au sens phénoménologique du terme. On ne trouverait nulle part chez
Nancy une synthèse des identifications. Contrairement à Derrida qui dans La voix et le
phénomène substitue à la philosophie de la présence la pensée de la « non-présence »,
Jean-Luc Nancy n’abandonne pas le mot présence, sans pour autant retourner à une
philosophie de la présence. Il y aurait, non pas la présence, mais des espèces de
présence au monde. Nancy parle de « disposition de présences » 13. Cette expression
implique d’emblée la notion d’intervalle, d’écart, d’espacement, de dynamique même,
de rythme. Il y aurait une coappartenance de la présence et de la comparution sous des
espèces et des dispositions plurielles, puisque la présence n’est jamais une pure
position. Il y a chez Nancy un usage fréquent des préfixes, une passion du pré- : mit,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
130
cum, etc. Il en résulte une écoute combinatoire et paramétrique de la langue, et pas
seulement étymologique. Prenons deux exemples.
17 1. Pré- : pour Nancy, le mot « présence » se construit sur le préfixe pré-, qui, loin de
renvoyer à une antériorité, fait signe en direction d’une proximité et, ajouterai-je,
d’une intimité : « Ni avant ni après, mais auprès, arrivant auprès, et la spatialité du
« auprès » est elle-même une spatialité temporelle, une venue, une approche. » Quelle
leçon tirer de ce mode d’approche concernant la question du portrait ? Le regard qui
dans le portrait me regarde tout en s’absentant, ne me regarde pas dans un face-à-face
– expression biblique que se dit en hébreu panim el panim. Ce regard singulier est dans
sa spatialité même, c’est-à-dire, auprès de moi. C’est un regard à l’approche, qui
m’envisage ou me dévisage, me figure ou me défigure. En ce sens, en partant de soi, ce
qui revient à partir de l’Un, il n’est pas du tout assuré que l’on arrive un jour à l’Autre.
Si on y parvient, ce n’est certes pas dans un face-à-face, ni dans un portrait-à-portrait
ou un trait-à-trait. C’est par le truchement d’une donnée originaire que représente un
être-là-avec, autrement dit un Mitdasein, un être-avec-l’autre, un autre-là.
Contrairement à l’éthique de Levinas, l’œuvre de Nancy n’appelle pas à se présenter au
commandement ou à la comparution de l’Autre, car on est d’emblée sous les espèces du
commun avec l’autre-là.
18 2. Le deuxième exemple de préfixe chargé pour Nancy d’un spectrum de significations
larges, allant des désignations les plus figurables aux désignations les plus infigurables
est le préfixe por- de « portrait ». Nancy appogiature14 le por- de portrait. Cet Autre
portrait fut d’abord entendu dans la langue italienne : L’Altro Rittrato 15. Le préfixe por-
de portrait aurait pour « trait » ou encore pour privilège d’appogiaturer, d’intensifier le
tracé d’une figure considérée dans son retrait, dans son absentement. Il s’agit donc
d’intensifier une disparition, que j’entends comme étant la métaphore du risque et de
la chance qu’encourent aujourd’hui la philosophie et la politique. Jean-Luc Nancy
précise également que « rittrato » signifie non seulement le retrait, mais également la
rétraction ou le retirement. Comment interpréter cette figure de retirement ? Entre le
Même et l’Autre, entre la présence et l’absence, entre l’écriture et l’excriture, entre
l’extériorité et l’intimité, entre le Dasein et le Mitsein se jouerait et se nouerait une
intrigue philosophique inouïe, l’équivocité du sens même. Entre le portrait et le rittrato
se nouerait aussi ce que Nancy appelle une « intrigante complexité sémantique » 16. Mais
entre l’intensification (por-trait) et la disparition (rittrato), nul choix n’est possible, nul
tranchement. Il s’agit de tenir l’écart, autrement dit, il s’agit de n’abandonner ni l’une
ni l’autre.
19 J’en viens pour conclure à la question du visage, de la face telle qu’elle se présente dans
l’essai de Jean-Luc Nancy, L’Autre portrait. Nancy écrit :
« Que le portrait soit associé au visage (ce dernier mot a d’ailleurs eu jadis le sens
du premier : un visage fut un portrait avant d’être une face) ne signifie pas
seulement que le portrait montre la face la plus visiblement individuante et
expressive de la personne, mais que cette face est aussi celle sur laquelle paraît le
regard. Le visage fait voir la vision qui cependant reste en lui invisible au sens strict
car l’œil n’est pas encore « lui-même » la vision. »
20 Nancy affirme donc que le visage a été d’abord un portrait avant d’être une face. La
distinction faite ici me paraît hâtive d’un point de vue herméneutique et philosophique,
car elle engage notre perception. Prenons le cas de la tradition juive. La Bible hébraïque
a recours au même mot pour dire « visage » et « face » : panim 17. Ce mot recouvre
diverses significations selon les textes du Pentateuque. Il peut signifier par exemple :
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
131
devant, surface, vers, face, visage, en face de, par devers moi, en présence de, loin,
figure, trait… Il a été relevé mille huit cent quatre-vingt-trois versets dans la Bible
hébraïque dans lesquels figure le mot panim. Prenons quelques exemplesextraits de la
Torah :
« La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface (panim) de
l’abîme et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus (panim) des eaux. » (Genèse 1, 2)
« Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la face (panim) de toute la terre et ils
cessèrent de bâtir la ville. » (Genèse 11, 8)
« Tout le pays n’est-il pas devant toi (panim) ? » (Genèse 13, 9)
« Abraham tomba sur sa face (panim) » (Genèse 17, 17)
« Jacob appela ce lieu du nom de Peniel : car, dit-il, j’ai vu Dieu face-à-face (panim el
panim) et mon âme a été sauvée. » (Genèse 32, 30)
« L’Éternel parlait avec Moïse face-à-face (panim el panim) comme un homme parle à
son ami. » (Exode 33, 11)
« Tu ne saurais voir ma face (panim) car nul homme ne peut me voir et vivre. »
(Exode 33, 20)
« Seul Moïse vit Dieu face-à-face (panim el panim) et nul autre depuis. » (Deutéronome
34, 10)
21 Précisons un point de langue : l’hébreu ne connaît pas la forme au singulier du mot
panim. Visage se décline de facto au pluriel. La notion de pluralité est constitutive de la
formation de l’homme par Dieu, car il existe plusieurs visages pour une même entité,
homme ou concept. La pluralité des visages que chaque singulier est, et sera,
représente la modalité la plus déterminante de l’existence. Le pluriel compris dans le
singulier signifie le visage en tant que ce dernier aura toujours été déjà avec. Chaque
visage est pris dans un réseau de relations, du plus intérieur au plus extérieur, car
panim peut s’entendre également en hébreu comme « les intérieurs » tout en étant
traduit par « l’intérieur ». La face, ou le visage, est co-originaire des autres que chaque
singulier est. Echo troublant à la problématique de Jean-Luc Nancy dans Être singulier
pluriel qui pense l’identité exclusive du « nous singulier », questionnant ainsi les
membres d’une même communauté : « Singularité plurielle : en sorte que la singularité
de chacun soit indissociable de son être-avec-à-plusieurs, et parce que, de fait et en
général, une singularité est indissociable d’une pluralité » 18.
22 Dans cet ordre d’idée, la face comme le visage est le pivot de l’interdiction de
représentation. Panim met en défection le mot tselem (image) qui signifie aussi idole,
divinité, ressemblance, simulacre, ombre, figure. Eloigner la tentation de l’image
(tselem), la repousser au dehors de l’existence à la fois singulière et plurielle : telle est la
vocation de panim. Aussi, ce mot est-il aux antipodes du portrait (tselem) qui implique le
réel même fantasmé ou transcendé ou recomposé de d’image, de l’icône, du modèle,
qu’il soit profane ou sacré, cependant que le texte biblique indique bien que l’homme
fut fait à l’image (tselem) de Dieu : « Dieu créa l’homme à son image (tselem), il le créa à
l’image (tselem) de Dieu, il créa l’homme et la femme. » (Genèse 1, 27). Le visage, à
l’opposé du portrait, perce la forme plastique. Intimité plus intime que l’intimité elle-
même, le visage comme la face interrompt dans la tradition juive la prolifération du
Même, sans pour autant nous dégager de notre mêmeté. C’est la raison pour laquelle le
visage chez Levinas, plus exactement le visage d’autrui, est considéré comme
n’appartenant pas à l’ordre du phénoménal. Il est, dit Levinas, « moins qu’un
phénomène » (Autrement qu’être). Entendons par là que, en retenant autrui dans
l’expérience sensible, l’humanité de l’homme ne disparaît pas derrière les déterminités
de la rationalité occidentale. Le visage comme anti-portrait ou contre-portrait oppose
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
132
des résistances au principe de chosification de l’image. La chose disparaît derrière une
subjectivité parlante. On peut y voir un chiasme entre l’interior intimo meo d’Augustin
que Jean-Luc Nancy commente dans L’Autre portrait, et le visage/face dont la perception
précède toute forme et toute figure, et selon lequel l’in-forme n’est pas le contraire de
la forme ou de ce qui déforme. Hors du champ de la mimésis, l’interior intimo meo
d’Augustin, dans un mouvement d’analogie avec le visage tel qu’il est décliné dans la
Bible hébraïque, opère un renversement des formes figurales. Le visage devient ici le
lieu d’un renvoi « à la figure que je suis moi-même »19. Renvoi ou merveille de la
transfiguration ?
23 L’Autre portrait, plus exactement l’Autre du portrait, a ceci de singulier qu’il déchire et
fait disparaître le sensible de son apparition manifeste. L’Autre, selon Nancy, se
caractérise par la possibilité d’une auto-expression venue du dehors. Paradoxe du
portrait : l’auto-portrait dans le portrait ne se laisse pas saisir dans le trait. Le sujet du
por-trait, pour autant qu’il y en ait un, comparable en ce sens au sujet de l’énonciation
et non de l’énoncé, est comme dégagé de tout trait descriptif, performatif, informatif
ou imitatif. Le sujet qui se présente dans le portrait n’est ni objet, ni concept. Il diffère
de tout contenu naturel ou idéal, susceptible d’être thématisable, classé ou rangé. Reste
ce que l’on pourrait appeler l’inflexion du portrait plus que le portrait lui-même. Il y va
d’une forme de déconstruction qui touche au point où « ça vire », selon l’expression de
Nancy. Dans les pages de L’Autre portrait où il est question de Dürer, Goya et Rembrandt,
Nancy considère que ce virement est de l’ordre d’un indécidable. Entre ce qui s’exhibe
et ce qui se retient, entre une face qui se montre et une face qui se retire, entre un trait
qui se déchiffre et un trait qui dissout les significations, l’Autre portrait serait par lui-
même comme lui-même, à savoir, il ne cesserait de combler les manques, les retraits et
soustraits, les troubles de l’identité. Il veillerait sur l’énigme du vivant et la crypte des
morts. Le portrait comme palimpseste et astreinte qui ordonne le monde selon des
critères qui semblent perdurer, envers et contre toutes les disparitions. La
multiplication des portraits résulte donc de ce long processus historique d’où s’est
écrit, s’est dessiné, s’est peint, s’est tracé la tradition occidentale, de la peinture
pariétale jusqu’à l’époque moderne, en passant par la mimésis aristotélicienne, le
caractère irreprésentable du Dieu monothéiste ou encore les représentations
multiformes et multifigures de la Passion du Christ, pour ne citer que quelques
exemples. Ainsi le philosophe verrait-il chez le peintre, le photographe, le sculpteur
l’inquiétude à l’œuvre dans ce qui se voit et s’écrit alors même que le regard se dérobe,
que l’écriture est comme apostrophée par l’ombre des portraits antérieurs recueillis
dans les collections muséales et imaginaires et que la pensée est comme empêchée par
le sentiment imminent d’une disparition à l’approche. Ce que l’on ne peut penser, il
faut le portraitiser dans l’autre.
BIBLIOGRAPHIE
DERRIDA Jacques, Le Monolinguisme de l’autre, Paris : Galilée, 1996.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
133
PATOČKA Jan, La Crise du sens. Comte, Masaryk, Husserl, Paris : Ousia, 1985.
PATOČKA Jan, Liberté et sacrifice. Écrits politiques, Grenoble : J. Millon, 1990.
NOTES
1. J.-L. NANCY, Demande. Littérature et philosophie, p. 37.
2. Idem, p. 39.
3. Ibid.
4. Cf. J. PATOČKA, La Crise du sens. Comte, Masaryk, Husserl.
5. J. PATOČKA, Liberté et sacrifice, p. 196.
6. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 13.
7. J.-L. NANCY, « Entretien avec Jean-Luc Nancy », Revue Esprit, Paris, mars/avril 2014.
8. Cf. J.-L. NANCY, Demande. Littérature et philosophie.
9. Idem, p. 41.
10. Cf. J.-L. NANCY, L’Autre portrait.
11. Idem, p. 66.
12. Cf. J. DERRIDA, Le Monolinguisme de l’autre.
13. J.-L. NANCY, Demande. Littérature et philosophie, p. 225.
14. Terme musical que j’utilise à dessein pour dire « appuyer ».
15. L’Autre portrait est paru dans sa première version en italien dans le catalogue intitulé L’Altro
Rittrato. Il s’agit du catalogue de l’exposition qui s’est tenue au Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Rovereto et de Trento en 2014, dont Jean-Luc Nancy fut le commissaire.
16. J.-L. NANCY, L’Autre portrait, p. 15.
17. On trouve très rarement, notamment dans le Livre de Daniel, le mot anaph, que l’on traduit
plus communément par « face » : « Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face (anaph) et se
prosterna devant Daniel, et il ordonna qu’on lui offrît des sacrifices et des parfums » (Daniel 2,
46).
18. J.-L. NANCY, Être singulier pluriel, p. 9.
19. J.-L. NANCY, L’Autre portrait, p. 49.
RÉSUMÉS
Une réflexion en forme de coda : l’esthétique comme relance de la pensée de Jean-Luc Nancy au
lieu même où le sens a disparu. Faisant l’expérience d’un visible qui se dérobe au regard à travers
la question du portrait (L’Autre portrait), Nancy interroge la place et la vocation du portrait dans
la tradition occidentale. N’y aurait-il pas dans la question du portrait la mise en œuvre de l’infini
du sens qui réfute les désignations et nominations de la vérité de l’art comme de la vérité
philosophique et politique ?
A reflection in the shape of coda: the esthetics as the relaunching of the thought of Jean-Luc
Nancy in the place where the sense disappeared. Making the experience of the visible which shies
away from the look through the question of portrait (The Other Portrait), Nancy questions the
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
134
place and vocation of the portrait in the western tradition. Would not there be in the question of
portrait an implementation of the infinity of the sense which refutes the names and
appointments of the truth of art, as well as those of the philosophic and political truth?
AUTEUR
DANIELLE COHEN-LEVINAS
Université Paris-IV
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
135
« [L]’ars poetica en tant que tel » : de
quelques enjeux philosophiques de
la poésie pour elle-même
Isabelle Alfandary
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
1 L’œuvre philosophique de Jean-Luc Nancy n’a cessé de frayer dans les parages de la
littérature et de la poésie depuis ses commencements. Dans Demande, un ouvrage paru
récemment, Jean-Luc Nancy, aidé par Ginette Michaud, a rassemblé des textes épars
récents ou plus anciens sur « Littérature et philosophie » qui s’étendent sur près de
« trente-cinq années »1. C’est sur le rapport entre littérature et philosophie que je
voudrais revenir pour m’interroger sur un aspect singulier : le rapport que la
philosophie de Jean-Luc Nancy entretient à la littérature et à la poésie pour elles-
mêmes.
2 Pour entrer dans le vif du sujet, je ne peux résister à l’envie de citer in extenso la page
d’introduction à Demande, véritable pré-préface, antichambre du livre qui se présente
pourtant sous le titre de « Cauda », comme si l’antécédence de l’écriture – j’y reviendrai
– était toujours déjà prise dans la circularité d’un dire :
« Philosophie, littérature : demandes
Demandes de l’une à l’autre : désir, attente, sollicitation, prière, exigence éperdue.
Chacune demande la vérité. Chacune demande aussi la vérité de l’autre, de deux
manières : chacun interroge l’autre sur sa vérité, chacune détient la vérité de
l’autre. Elles se demandent la vérité comme un service, comme une aide, un
exemple, une illustration ou une explication ou comme une révélation. Chacune sait
pourtant qu’elle n’a rien à attendre de l’autre mais n’en persiste pas moins dans sa
demande car chacune se sait aussi bien avoir sa vérité hors d’elle.
Chacun sait aussi que ce dehors ne nomme ni science ni religion. Il se nomme pour
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
136
chacune par le nom de l’autre. (Le nom « art » flotte entre les deux, vérité pour sa
part manifeste mais silencieuse. Ce dehors silencieux, c’est ce que chacune des deux
ne renonce pas à dire »2.
3 Si je me suis permis de lire l’incipit de Demande, c’est pour donner à entendre la qualité
proprement poétique de la prose nancéenne, de la laisser résonner dans sa chambre
d’écho propre qu’est la page. Les énoncés à caractère théorique qui s’enchaînent sont
servis par le travail de la langue, la performance de l’anaphore, une syntaxe légèrement
paratactique, la mise en espace des signes dans l’écrin de l’espace typographique. Cette
page de philosophie est écrite à plus d’un titre. Elle s’écrit en même temps qu’elle se
met à l’écoute d’une certaine dimension de la langue, d’un certain faire de la parole,
d’une technè, d’un poeïn qui ne s’ignore pas comme tel. Ce faire poétique relève de ce
que Hegel cité par Nancy dans Les Muses décrit « comme une conciliation qui s’effectue
bien sous la forme d’une représentation spirituelle, mais au sein même de la
phénoménalité réelle »3. Analysant la nature de l’expérience que constitue la poésie
pour la pensée, Nancy précise :
« Pour cela même, la pensée se sent (éprouve son poids, sa gravité) deux fois hors
de soi : une fois dans la chose « même » (c’est-à-dire, qui est la même que la pensée
en tant qu’elle se fait sentir « chose-dehors », impénétrable, intouchable comme
impénétrable), et une seconde fois dans la poésie (en tant que l’assomption sensible
du sens même que la pensée ne fait que penser, ou en quelque sorte que « pré-
sentir » : mais toute la rigueur hégélienne est de ne pas laisser s’infiltrer ici un
« pressentiment » romantique, ou une effusion artiste de la pensée) » 4.
4 Ce pré-sentir qui n’est pas tout entier réductible au pressentiment romantique ni à
l’émotion hyperbolique loge au cœur de l’expérience de la poésie, de l’expérience que
constitue la poésie pour la pensée. Nancy a salué dans Les Muses la rigueur hégélienne
qui l’a gardé de s’engager sur la pente glissante du « pré-sentir ». Il semble pourtant
que ce soit ce terrain risqué pour un philosophe que Jean-Luc Nancy se décide à
emprunter dans Demande. Les différents textes qui composent cet ouvrage manifestent
une attention extrême, une sensibilité aiguë au travail de la poésie dans ce que Nancy
désignait déjà dans Les Muses comme « l’essence sensible » de la production du sens :
« La production, au singulier et absolument, n’est rien d’autre que la production du
sens. Mais elle s’avère dès lors comme pro-duction, comme tension littéralement
intenable vers un en-avant (ou un en-arrière du sens) en tant que ce qui le
« produit » comme tel, c’est d’abord qu’il soit reçu, éprouvé, bref senti comme sens
(on pourrait dire : le sens se sent, et la vérité, la touche de la vérité, est
l’interruption du « se sentir »). Cette tension est intenable, et c’est pourquoi il n’y a
pas de poésie qui ne porte que l’extrémité de sa propre interruption, et qui n’ait ce
mouvement pour loi et pour technique. Rimbaud est ici forcément exemplaire » 5.
5 Cette analyse de la pro-duction du sens propre à la poésie, cette pro-tension intenable
du sens entre touchant et touché, cet « en-avant » entre sensation et sens rendent
compte philosophiquement du procès du sens à l’œuvre dans le poème et justifient ce
que Nancy nomme sa « loi » et sa « technique », dont on comprend à quel point elles
sont inextricablement enchaînées l’une de l’autre. Le rapport de la poésie à
« l’interruption » qui va de la syncope, terme qu’affectionne Nancy, à la scansion et que
d’aucuns pourraient être tentés de considérer comme simple caprice ou pure
convention répond à une nécessité tensionnelle qui résulte des conditions
phénoménales et sensibles de cette pro-duction du sens en poésie.
6 Si donc le dire du poème est phénoménalement en avance sur son dit, le récit de fiction
est structurellement en retard sur son origine ; poésie et littérature étant toutes deux –
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
137
il faudrait d’ailleurs tenter de débrouiller leurs fils – frappées au sceau de la non-
concordance des temps. Il appartient en effet à la structure de tout récit – que Nancy
tient pour définitoire du littéraire – que de supposer l’antécédence et se poser comme
sa relève :
« Le récit aura commencé avant son récitant, lequel pourtant doit l’avoir précédé :
telle est la leçon de la littérature – une leçon que la philosophie refuse par principe,
reposant elle-même sur la décision d’être contemporaine de son commencement.
Le récit, au contraire, dissocie l’origine et le commencement. Quand il commence, il
a déjà son origine derrière lui »6.
7 Le récit en tant qu’il est la marque de la littérature, qu’il constitue la littérature comme
re-marque de la marque, relève du toujours déjà ainsi que la première phrase – d’ailleurs
citée par Nancy – d’un célèbre roman français l’atteste : « Longtemps je me suis couché
de bonne heure ». La Recherche du temps perdu s’écrit, se narre dans l’après, l’après-coup
de ce temps auquel nous n’aurons jamais accès, ce temps du « longtemps » qui aura été,
sinon sans témoin, du moins sans contemporain, ce qu’avec Lacoue-Labarthe Nancy
désigne comme la structure distendue et la part irrécupérable inhérente à toute
récitation, cette « distension du présent, cette dilatation de la présence » 7. On pourrait
citer – réciter – de mémoire d’autres incipit. Plusieurs d’entre eux affluent sous la plume
de Nancy8 dans Demande.
8 Dans le même temps qu’elle exclut la coïncidence, la littérature n’ignore pas que « rien
n’a précédé » : elle n’idéalise, n’essentialise, ne sacralise pas l’événement originaire que
pourtant elle suppose : « L’écriture se consacre à considérer l’événement qui n’a pas eu
lieu ou dont l’avoir lieu ne peut que rester conjectural tant il est reculé en deçà de tout
vestige, de toute trace qu’on en pourrait trouver. Car l’événement en effet n’est lui-
même que l’amorce de la trace, l’entame du langage : l’envoi du sens » 9. L’événement
dont il s’agit pour la littérature, qui agit et agite l’écrivain, le met en mouvement est si
reculé qu’il pourrait aussi bien ne pas avoir eu lieu. L’avoir-lieu cesse d’être le critère,
s’indifférencie dans le procès de l’écriture.
9 La proposition nancéenne selon laquelle « [L] a littérature sait que rien n’a précédé »
paraît intimement solidaire de celle qui veut que « la suppléance a toujours déjà
commencé »10 comme le soutient l’auteur de De la Grammatologie. Entre ces deux
énoncés, ces deux savoirs co-extensifs et consubstantiels, l’écriture littéraire se pro-
duit. Le désir du « midi absolu »11, de l’origine absolue dont parle Derrida à propos de
Rousseau, la littérature ne le connaît pas : elle n’y a pas renoncé, elle ne le tient pas
même pour désirable. La différance que sous-tend un différend sourd et ancien entre
littérature et philosophie, tient à ce non-rapport à l’origine. Le midi absolu de
l’écriture, s’il se rencontre au présent passant de l’écriture de fiction ou de poésie, ne
coïncide avec rien d’autre que lui-même. Écrire, comme y insiste Nancy, ne consiste pas
« à transcrire des données préalables – des événements, des situations, des objets, leurs
signification – mais à inscrire des possibilités de sens non données, non disponibles,
ouvertes par l’écriture elle-même »12. Cette proposition critique n’est pas une
proposition parmi d’autres : la singularité que l’écriture signifie et qu’elle acte – et dont
Jean-Luc Nancy déplie une à une les implications implicites – procède d’une dislocation
entre littérature et événement, d’une disjonction entre écriture et avoir-lieu.
10 Philippe Lacoue-Labarthe dans La Poésie comme expérience ne dit pas autre chose au sujet
du poème : « Un poème n’a rien à raconter ; ni rien à dire : ce qu’il raconte et dit est ce à
quoi il s’arrache comme poème. Si l’on parle d’« émotion poétique », il faut la
comprendre comme émoi, ce qui veut dire : absence ou privation de moyens » 13. D’une
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
138
certaine manière, ce que Lacoue-Labarthe soutient pour le poème peut être étendu à la
littérature tout entière – ce dernier d’ailleurs ne semble pas l’exclure 14 : ce que raconte
la fiction n’est pas un récit comme un autre ; non que La Recherche du temps perdu ne
procède d’un vouloir dire, mais d’un vouloir sans doute plus intransitif qu’il n’y paraît
et dont le « pur vouloir-dire » comme dit Lacoue-Labarthe du poème pourrait faire
figure de paradigme.
11 Qu’il s’agisse de l’émotion poétique ou de l’expérience littéraire, celles-ci ne portent
pas, – ne portent jamais – sur un événement qui pourrait être retranscrit, qui aurait été
rapporté. La littérature exclut précisément le mode du discours rapporté, même dans le
cas où le poète, – c’est le cas de Hölderlin ou de Gertrude Stein –, se laisse traverser par
l’altérité d’une parole qui parle en lui, lui dicte ses vers ou ses phrases. Quand même
Proust aurait eu l’intention de raconter son enfance, le narrateur Marcel l’en aurait
immanquablement empêché : l’écriture en tant qu’elle relaie, instancie, toujours
déplace, fait dévier, dériver, différer de soi tout projet simplement mimétique, issu de
la bonne mimesis platonicienne que Philippe Lacoue-Labarthe a commentée. Le même
Lacoue-Labarthe n’a pas hésité à qualifier la poésie d’« interruption de la mimésis » 15,
non sans ajouter :
« L’acte poétique consiste à percevoir, non à représenter. Représenter, selon au
moins certaines des « anciennes rumeurs », cela ne peut se dire que du déjà présent.
Ce qui est « en train d’apparaître » ne se représente pas ou alors il faut accorder un
tout autre sens à la représentation »16.
12 Si la littérature ne raconte, ni ne représente pas, de quoi s’entretient-elle ? De l’aura
été. Le futur antérieur qu’épingle Jean-Luc Nancy comme temps paradigmatique de la
littérature, ce temps que le poème « commémore »17, pour reprendre le mot de Lacoue-
Labarthe, est le temps de l’immémorial, dont Littré précise qu’il qualifie un temps si
ancien qu’il n’en reste aucune mémoire. Ce temps si prisé du coup de dés mallarméen
(« RIEN N’AURA EU LIEU QUE LE LIEU »18) est le temps de la supplémentarité par excellence, la
forme de la « structure de supplémentarité »19 que distingue Derrida : « Car d’autre
part, la supplémentarité qui n’est rien, ni une présence, ni une absence, l’ouverture de
ce jeu qu’aucun concept de la métaphysique ou de l’ontologie ne peut comprendre » 20.
C’est là le comble de l’écriture que de suppléer à une mémoire immémoriale, à une
mémoire à jamais perdue dont elle s’oblige cependant à témoigner dans l’espace du
poème ou de la fiction. La notion d’« inévènement » qu’avance Lacoue-Labarthe permet
de rendre au plus juste le sens de cette mémoire paradoxale que Nancy appelle du nom
de « vestige », que Lacoue-Labarthe qualifie de « vertige » : « En sorte que le vertige est
ici l’indice de cet inévènement dont la mémoire, non le simple souvenir, est la
paradoxale restitution »21.
13 Il y a dans les pages de Demande un souci de la lettre et de son faire propre, son poeïn, un
soin porté à la langue, à sa technè, à son travail singulier. Ce souci ne se rencontre pas
couramment dans un discours philosophique, sous la plume d’un philosophe. Non que
les philosophes manquent de style, d’un style philosophique qui laisse son empreinte
dans la langue – je pense par exemple à la grammaire cartésienne, au parfait équilibre
et à la constance quasi-rythmique de la phrase reconnaissable entre toutes. Mais
l’écoute poétique de la langue, fût-elle celle d’un texte philosophique, n’est pas donnée
à tout philosophe, ne serait-ce parce le travail du philosophe suppose une
neutralisation de la dimension poétique, sensible de la langue.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
139
14 « Philosophie demande » ; « littérature demande » écrit Jean-Luc Nancy (« Philosophie
demande sans cesse que la vérité s’accomplisse (système, architectonique, certitude).
Littérature demande qu’elle se poursuive (récitatif, récitation récital) » 22 : ces
demandes, on l’entend, ne sont pas toutes de même nature. Ce que « littérature »
demande est intransitif, ne porte pas à proprement parler sur un objet autre qu’elle-
même, si tant est qu’elle puisse se constituer en objet. Littérature et philosophie ne
sont pas dans un rapport symétrique à la demande. Mais l’asymétrie est inscrite dans la
nature même de la demande : ce titre, cette notion, ce singulier à valeur d’insistance de
la demande consonne avec la demande dans son articulation au désir telle que Lacan
l’élabore dans le séminaire sur « Les formations de l’inconscient », depuis son écart, sa
différenciation d’avec le besoin. La demande, si l’on suit Lacan, commence à se formuler
à partir de l’Autre23. Cependant la demande n’est pas sans faire problème entre elles,
car ainsi que l’écrit Nancy, si « la raison demande la poésie » 24, la poésie, quant à elle, ne
demande rien.
15 Plus encore, la poésie nie que l’accès au sens puisse passer par une autre voie que la
sienne propre, ce qui n’est pas le cas de la philosophie. Et Nancy de citer de mémoire
Descartes : « Il y a en nous des semences de vérité : les philosophes les extraient par
raison, les poètes les arrachent par imagination, et elles brillent alors avec plus d’éclat
(récité de mémoire). La poésie n’admet rien de réciproque » 25. La poésie est en tant
qu’elle refuse (« ce refus est la poésie »26), est pour autant qu’elle est « inadmissible »,
pour reprendre le vocable dont l’a superbement affublée Denis Roche.
16 Dans Demande, Nancy semble chercher à embrasser toutes les dimensions de la
littérature, et pas seulement de la Littérature majuscule : du livre au poème, de la
création à la réception, poétique et esthétique sont inlassablement tenues ensemble,
traversées dans leurs entrelacs, leurs recoupements, leurs plis infinis : la passion de la
littérature qui s’y éprouve est inséparable du désir d’entendre la demande de la
littérature pour elle-même, d’embrasser la multiplicité des dimensions du fait et du
procès littéraire, sans négliger des aspects couramment négligés par la philosophie, et
volontiers relégués, abandonnés à la critique littéraire telle que la lecture ou la
prosodie. Là réside sans doute la singularité de l’approche propre à Nancy : circonscrire
l’événement de la littérature comme l’événement de sa demande. J’en veux pour preuve
ce bref article de 2013, sobrement intitulé « Pour ouvrir le livre », qui considère les
positions de la lecture et s’ouvre sur un mode quasi-oulipien à la manière d’un « Livre,
mode d’emploi » :
« Lorsque le livre est fermé, on a trois possibilités. Ce mini-traité de
phénoménologie de la lecture qui envisage tour à tour la lecture comme récitation,
comme sondage, comme déchiffrement continu appréhende en les dédoublant les
modalités que recouvre ce que lire veut dire : “Nous pratiquons les trois possibilités,
simultanément, alternativement, sans toujours le savoir. Nous lisons en
psalmodiant doucement le texte quelque part au fond de la camera oscura qui filme
le texte, nous sommes saisis au hasard par un mot, par un tour de langue où nous
recueillons une espèce d’augure qui ne concerne pas notre vie mais le sentiment
d’un possible et inédit surcroît de sens. Et nous continuons à tourner les pages,
gardant le livre ouvert, pour autant du moins que nous désirons poursuivre. Et nous
le désirons si nous sommes entrés dans le livre” » 27.
17 Le « rapport » du livre au lecteur, rapport complexe, asymétrique et rapport
d’inclusion, n’est pas indifférent à l’expérience poétique, ni à la littérature comme
expérience, même s’il ne se limite pas à elle. « Un texte de pensée – ce qui ne veut pas
dire un document d’information – ne va pas sans rythme, sans allure, sans inflexion ni
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
140
sans évocation d’images ni mobilisation d’affects ». Jean-Luc Nancy cite deux phrases
de Merleau-Ponty qu’il commente : « Seul le motif central d’une philosophie, une fois
compris, donne aux textes du philosophe la valeur de signes adéquats ? Il y a donc une
reprise de la pensée d’autrui à travers la parole, une réflexion en autrui, un pouvoir de
penser d’après autrui, qui enrichit ses pensées propres » 28.
18 Cet exemple (« par exemple ») que convoque et glose Nancy a pratiquement valeur
d’hapax dans l’histoire de la philosophie. La poéticité, l’efficace poétique du texte
philosophique lues du point de vue de la phrase, de cette unité rhétorique, quasi-
prosodique, sont exceptionnellement l’objet d’un commentaire philosophique. La
philosophie en effet procède du tabou de la langue pour elle-même, du refoulement de
la dimension du signifiant, du travail de la lettre dont Nancy montre pourtant combien
il n’est pas indifférent à la production du sens philosophique. Les deux phrases de
Merleau-Ponty n’ont certes pas été choisies au hasard : la notion de « signes adéquats »
mérite qu’on la commente dans le contexte qui nous occupe. L’adéquation du signe au
sens, cette adéquation qui est l’objet de toute écriture philosophique, dont la possibilité
est la condition de la philosophie ne va pas sans croiser, recouper le champ incertain et
inédit du signe comme poème. « Cette phrase, nous n’en comprenons pas seulement le
sens, mais elle se communique à nous sensiblement par des mots comme « reprise » ou
« réflexion en », par les italiques de « d’après », etc. On pourrait dire que la phrase fait
ce qu’elle dit… »29. Se mettre à l’écoute d’une phrase philosophique, d’un énoncé
philosophique du point de vue de son efficace performative n’est déjà pas monnaie
courante, se rendre attentif à son phrasé, ce que Nancy appelle explicitement son
rythme, l’est moins encore. Dans ce commentaire précis et plus largement dans
Demande il apparaît que la poéticité telle qu’envisagée par Nancy ne se réduit pas à la
seule performativité de l’énoncé qui relèverait d’un modèle idéal de communication, où
l’adéquation du mot à la chose serait alignée sur le modèle de l’aedequatio rei et
intellectus. La communication philosophique pour ce qui concerne sa part « sensible »
ne relève pas uniquement d’un modèle performatif. Cette mise en acte de la lettre que
signifie la littérature (« Car cette dernière ne porte pas son nom pour rien : elle met la
lettre en acte »30) n’est pas réservée à la parole littéraire ; elle n’exclut, ni n’épargne la
discursivité philosophique, quand même la philosophie s’en défend. En tant qu’elle
s’écrit en langues, la philosophie n’est pas à l’abri, ni à l’écart du travail de la lettre
même si ce n’est pas là sa visée propre ni primordiale. Le signifié pur n’existe pas ainsi
que le soutient Derrida :
« [M]ême s’il n’y a jamais de signifié pur, il y a des rapports différents quant à ce qui
du signifiant se donne comme strate irréductible du signifié. Par exemple, le texte
philosophique, bien qu’il soit en fait toujours écrit, comporte, précisément, comme
sa spécificité philosophique, le projet de s’effacer devant le contenu signifié qu’il
transporte et en général enseigne »31.
19 Le texte philosophique n’est pas un exemple parmi d’autres : il se propose et se produit
comme neutralisation de la dimension du signifiant ; c’est de l’idéal de transparence du
signifié à lui-même qu’il procède et c’est cet idéal qui fonde la possibilité même du
discours philosophique comme discours sans équivoque, ni séduction. La querelle
platonicienne avec la figure du Sophiste inaugure cet idéal d’un discours sous le midi
du sens. Ce que Derrida appelle le « surplomb de la langue » 32 auquel chaque écrivain
est soumis33 – et par écrivain il faut entendre chaque auteur de discours qu’il soit
littéraire ou philosophique : « Le philosophe, le chroniqueur, le théoricien en général,
et à la limite tout écrivant est ainsi surpris »34.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
141
20 De ce point de vue, du point de vue du surplomb aveuglant qui est celui de la langue
pour quiconque la parle et a fortiori la parle à l’écrit, la performativité n’est pas
toujours, ni simplement heureuse, comme dans le cas du performatif, ce qu’Austin
appelle d’un adjectif superbe felicitious. Cette part en tant qu’elle excède est de l’ordre
d’un reste, d’un point aveugle, d’une surprise (Derrida). Une part de ce qui est dit dans
ce qui est dit échappe, surprend, excède la visée de l’écriture tout en y participant, y
prenant sa part. Cette part est la part poétique, poématique, la part d’un poeïn qui
s’ignore en tant qu’il s’excède, qu’il ne se domine pas, ne se réduit pas : irréductible,
incommensurable et inséparable de l’économie et de l’empreinte propre de toute
marque, de chaque style, qu’il soit philosophique ou littéraire. Même si cette part, la
part du poème, du poétique ou du poématique est délibérément refoulée dans l’écriture
philosophique, elle reste irréductible, inexpugnable à toute parole – fût-elle
spéculative.
21 Dans une note qui pourrait passer inaperçue tirée du chapitre « Calcul du poète », après
avoir déclaré que « [L]a poésie est autre chose que la poésie, autre chose aussi que la
pensée », Nancy précise le sens de cet apparent paralogisme par un détour :
« C’est ainsi que je passe ici, délibérément, à côté de l’interprétation heideggerienne
de Hölderlin. Je ferai seulement remarquer que cette interprétation, considérée
indépendamment de ses thèmes, laisse toujours de côté, pour sa part, la poétique de
Hölderlin, même lorsqu’elle y fait, rarement, allusion […], et même lorsqu’elle
prend des précautions au sujet de la nature poétique des textes qu’elle interprète
philosophiquement (par exemple dans l’interprétation au cours sur l’hymen
“Germanie”. Je reviendrai ailleurs sur le rapport ou non-rapport de Heidegger à l’
ars poetica en tant que tel. Par ailleurs, je risque ce bref essai en franc-tireur (c’est-à-
dire en ignorant) des études proprement techniques de la poétique hölderlinienne
[…]. D’une manière générale, toutefois, je ne prétends pas proposer, une véritable
“interprétation de Hölderlin” : je laisse volontairement trop d’aspects de sa pensée.
Hölderlin est ici à mi-chemin entre le thème et le prétexte » 35.
22 Ce faisant, Nancy se démarque de Heidegger. La poésie occupe dans l’œuvre
heideggerienne une place tout à fait singulière. C’est le cas d’Acheminement vers la parole,
où Heidegger lit longuement des poèmes de Georg Trakl et de Stefan George.
L’« expérience poétique » est conçue comme un accès privilégié à la parole :
« l’expérience poétique de Stefan George nomme quelque chose d’archi-ancien, qui a
déjà atteint la pensée et, depuis, la tient prisonnière – mais d’une manière toutefois qui
nous est devenue autant habituelle que méconnaissable »36. Poésie et pensée sont
envisagées dans la tradition schlegelienne depuis leurs affinités électives.
23 Le commentaire qu’Heidegger livre des poèmes de Georg Trakl ou de Stefan George ne
prend pourtant que peu en compte les aspects stylistiques ou prosodiques 37 et évacue la
question de la forme sur un mode purement descriptif38. Heidegger ignore ou feint
d’ignorer la dimension énonciative et prosodique du poème et ne s’acquitte de la forme
poétique que par un rapide relevé. Rien dans sa lecture ne renvoie au genre poétique
proprement dit, ne prend en compte la forme versifiée dans sa relation au sens. La
signification ne s’élabore que depuis la séquence de la phrase, l’énoncé, avec une
insistance particulière sur le mot. Ce que Heidegger appelle « Poème », qu’il écrit en
recourant à la majuscule supposément lyrique, ne doit pas grand-chose à son
appartenance générique, mais s’entend comme l’héritage de la conception de l’
Athenaeum39. Le vocable « Poème » recouvre sous la plume de Heidegger la Littérature
avec une majuscule, ce que Lacoue-Labarthe et Nancy appellent « la littérature
considérée comme l’essence de l’art »40. Dans la conception romantique dont il hérite,
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
142
« Le Genre littéraire est la Littérature elle-même, L’Absolu littéraire – la « vraie
littérature »41. C’est l’intention poétique qui fait le Poème, non la structure prosodique,
tenue pour pratiquement ornementale.
24 Déclarant non sans une certaine provocation que « la poésie est autre chose que la
poésie », Nancy constate que la poésie est lue philosophiquement, et que cette lecture
manque une dimension de la poésie que je qualifierais d’« en tant que telle ». Il y a dans
cet oubli de la prosodie qui caractérise un certain type de lecture philosophique une
manière d’approche du poème qui resterait sourde à sa « demande » : Heidegger insiste
au sujet d’un poème de Trakl sur son caractère « intelligible » manifestant son
attention du contenu, réduisant le poème à son énoncé. À propos de Hölderlin, Nancy
souligne d’ailleurs les limites philosophiques non tant de la lecture que de celles du
texte lui-même :
« À cet égard, on peut être tenté de penser que Hölderlin, dans l’ordre de la pensée
– et que cette pensée concerne l’ars poetica ou bien des motifs proprement
philosophiques –, s’essouffle bien souvent dans la recherche d’une construction
dialectique et spéculative dont il ne trouve à proprement parler ni la figure ni la
démarche exacte, à la différence de ses deux amis philosophes tout proches,
Schelling et Hegel, avec lesquels il a partagé le commun idéal post-kantien du
“système”. On n’aura sans doute pas tort d’y voir une espèce de maladresse et
d’impasse de la voie philosophique comme telle. Hölderlin ne sait pas vraiment y
faire en ars philosophica »42.
25 L’ars poetica n’est donc pas simplement traduisible, ni interprétable en ars philosophica :
le « comme tel » du poème n’équivaut pas au « comme tel » du discours du système, de
la « question philosophique »43. L’ars poetica ne se limite pas à la technè poétique mais
s’avère la condition, voire la forme du calcul de la poésie, calcul aussi incalculable que
minuscule : « C’est toujours, en quelque sorte, le calcul d’un point exact de fuite ou de
tangence : la coïncidence du sens incalculable et d’une brève parole » 44. Même si le
philosophe se défend de ne pouvoir parler avec « une grande précision technique de la
langue ni de la prosodie de Hölderlin, c’est-à-dire en fin de compte de son ars poetica »,
il ajoute : « Mais on ne saurait trop insister sur le fait que c’est en elles, langue,
prosodie, rythmique, c’est à même les mots et le chant que se disposent le ton et le tact
de sa poétique – c’est-à-dire de sa pensée, le dehors de sa pensée, sa pensée hors de
pensée »45. Ce « ton » et ce « tact », effets du calcul poétique, de l’unité prosodique,
n’est pas simplement technique, ni métrique ou rimique. À cet égard, le poète est un
technicien paradoxal, un technicien de l’impossible : « Le poète doit être technicien de
ce kairos. […] Une technè qui sache s’y prendre avec le kairos » 46. La mesure du poème se
communique au-delà, en deçà de la description, de l’explicitation de la prosodie
savante. Quelque chose de la mesure échappe à toute mesure. C’est à ce point exact,
exquis que le philosophe-lecteur peut toucher à la pensée poétique, à la pensée en tant
que poème, sans la rabattre à toute force sur l’ordre d’une discursivité thétique.
26 Les unités prosodiques sont ici considérées pour elles-mêmes : le « Calcul du poète » est
l’objet du pari philosophique que fait Jean-Luc Nancy. Celui de spéculer sur le sens de la
rime, sur « la conjonction – la rime – de ce face-à-face » 47, sur « la coupe, oui – le vers »
48
. C’est à ce prix que l’ars poetica devient partageable entre philosophie et poésie ; la
condition étant de le considérer pour lui-même, d’interroger le sens de ce qui est tenu
habituellement pour conventionnel, de prendre au sérieux ce que les poéticiens
désignent du nom de « contrainte » que sont rime, mètre et syncope. « [C]ondition
d’unité et de passage »49 comme les qualifie Nancy, mètre et rime procèdent d’un
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
143
schème qui n’est pas de pure convention, mais ordonne le désordre de l’expression, la
mesure de l’incommensurable : « La grandeur absolue est l’exactitude de la réunion
d’une convenance et d’un écart : la convenance de l’écart selon lequel une présence,
l’être-même se présente, se tient là, évidente, et s’éclipse en ce même lieu, en ce même
instant, dans l’unique passage du sens »50. La singularité de la langue est prise en charge
par l’ars poetica, par l’ars poetica comme dimension de l’« en tant que tel » qui dit la
singularité pure, injustifiable, incalculable du poète qui ne peut que s’excuser, ainsi que
le fait Hölderlin, de ne pas pouvoir « faire autrement »51. Notons que dans « Calcul du
poète », Nancy est l’auteur de la plupart des traductions des vers qu’il commente : le
geste réflexif devient dès lors inséparable d’un traduire qui n’est pas une traduction en
langue philosophique mais d’une traduction vers la langue maternelle du philosophe-
traducteur. Ce mouvement n’est pas de pure forme : il trahit, traduit, manifeste un
transfert irrésistible qu’a suscité la réflexion tout sauf dialectique des formes de la
poétique sur la littérature « en tant que telle ».
BIBLIOGRAPHIE
AUSTIN John Langshaw, Quand dire, c’est faire, Paris : Seuil, 1991 (1 re éd. 1962).
DERRIDA Jacques, De la grammatologie, Paris : Minuit, 1967.
LACAN Jacques, Le Séminaire : Livre V. Les formations de l’inconscient, Paris : Seuil, 1998.
LACOUE-LABARTHE Philippe, La Poésie comme expérience, Paris : Christian Bourgois, 2004 (1 re éd. 1986).
LACOUE-LABARTHE Philippe et NANCY Jean-Luc, L’Absolu littéraire, Paris : Seuil, 1978.
MALLARMÉ Stéphane, « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », Œuvres complètes, Paris :
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.
PROUST Marcel, À la recherche du temps perdu, t. 1, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
1987.
ROCHE Denis, La Poésie est inadmissible, Paris : Seuil, 1998.
NOTES
1. J.-L. NANCY, Demande. Littérature et philosophie, p. 9.
2. Ibid.
3. J.-L. NANCY, Les Muses, p. 55.
4. Idem, p. 56.
5. Idem, p. 53-54.
6. J.-L. NANCY, Demande. Littérature et philosophie, p. 9.
7. Idem, p. 74.
8. Au début de « Répondre du sens », Jean-Luc Nancy rappelle et glose l’ incipit de l’ Illiade :
« Chante, déesse, la colère d’Achille… » (ibidem, p. 209).
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
144
9. Idem, p. 82.
10. J. DERRIDA, De la grammatologie, p. 308.
11. « Ne pouvant simplement se résoudre à ce que le concept d’origine n’occupe qu’une fonction
dans un système situant en soi une multitude d’origines, chaque origine pouvant être l’effet ou le
rejeton d’une autre origine, le nord pouvant devenir le sud pour un site plus nordique, etc.,
Rousseau voudrait que l’origine absolue soit un midi absolu » (id., p. 311).
12. Idem, p. 82.
13. Ph. LACOUE-LABARTHE, La Poésie comme expérience, p. 33.
14. « Pour le dire autrement : il n’y a pas d’« expérience poétique » au sens d’un « vécu » ou d’un
« état » poétique. Si quelque chose de tel existe, ou croit exister – et après tout c’est la puissance,
ou l’impuissance, de la littérature que d’y croire ou d’y faire croire –, en aucun cas cela ne peut
donner lieu à un poème. À du récit, oui ; ou à du discours, versifié ou non. À de la « littérature »,
peut-être, au sens tout au moins où on l’entend aujourd’hui » (ibidem).
15. Idem, p. 99.
16. Ibidem.
17. « C’est la raison pour laquelle le poème commémore. L’expérience qu’il est, est une
expérience de mémoire » (ibidem, p. 35).
18. S. MALLARMÉ, « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », in : Œuvres complètes, p. 474-475.
19. J. DERRIDA, op. cit., p. 348.
20. Idem, p. 347.
21. Ph. LACOUE-LABARTHE, op. cit., p. 36.
22. J.-L. NANCY, Demande. Littérature et philosophie, p. 11.
23. J. LACAN, Le Séminaire : Livre V. Les formations de l’inconscient, p. 94.
24. J.-L. NANCY, op. cit., p. 177.
25. Idem, p. 145.
26. Idem, p. 159.
27. Idem, p. 97.
28. Idem, p. 98.
29. Idem, p. 99.
30. Ibidem.
31. J. DERRIDA, op. cit., p. 229.
32. J.-L. NANCY, op. cit., p. 99 : « Quand nous parlons de l’écrivain et du surplomb de la langue
auquel il est soumis, nous ne pensons pas seulement à l’écrivain dans la littérature ».
33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. Idem, p. 111-112.
36. Idem, p. 169.
37. À propos du poème de Trakl « Un soir d’hiver » : « Le poème est formé de trois strophes. Leur
mètre et leur versification peuvent être exactement déterminés d’après les schémas de la
métrique et de la poétique. Le contenu du poème est intelligible » (idem, p. 19).
38. Au sujet du poème de George, « Le mot » : « Le poème consiste en sept strophes de deux vers.
Les trois premières sont clairement détachées des trois suivantes ; les deux triades, à leur tour,
s’opposent ensemble à la septième et dernière strophe. Le mode sur lequel nous allons ici
brièvement – mais aussi tout au long des trois conférences – parler avec le poème ne prétend en
aucune manière être scientifique » (idem, p. 146).
39. Le commentaire heideggerien du Poème comme parole pure peut se lire comme
l’accomplissement de la maxime schlegelienne consignée au fragment 252 de L’Entretien sur la
poésie.
40. J.-L. NANCY et Ph. LACOUE-LABARTHE, L’Absolu littéraire, p. 265.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
145
41. Idem, p. 277.
42. J-.L. NANCY, Demande. Littérature et philosophie, p. 212.
43. Idem, p. 113.
44. J-.L. Nancy, Demande. Littérature et philosophie, p. 116.
45. Idem, p. 125.
46. Idem, p. 172.
47. Idem, p. 130.
48. Idem, p. 173.
49. Idem, p. 131.
50. Idem, p. 130.
51. « Il faut aussi rappeler ce que lui a même écrit en tête de « Fête de paix » : « Si pourtant
certains devaient trouver ce langage trop peu conventionnel, je dois leur avouer que je ne puis
faire autrement. Dans une belle journée, presque toutes les façons de chanter se font entendre et
la Nature, d’où cela est issu, le reprend aussi » (idem, p. 126).
RÉSUMÉS
Cet article tente d’appréhender le rapport que la philosophie de Nancy entretient avec la
littérature et la poésie en tant que telles. Nancy a théorisé les conditions de production du sens
poétique comme protension du sens en avance sur soi par opposition au récit de fiction
structurellement en retard sur son origine. Ces temporalités littéraires marquées au sceau de la
non-concordance des temps renvoient à une origine sans contenu, ni forme. La sensibilité
nancyenne au dire du poème, au faire de la langue, la distingue dans l’histoire de la philosophie.
La part sensible de l’écrit philosophique est par définition neutralisée, sous-tendue par l’idéal de
transparence du signifié qui fonde la possibilité et la singularité du discours philosophique
comme discours sans séduction, ni équivoque.
This article aims at addressing the ways in which Nancy’s philosophy deals with literature and
poetry per se. Nancy has theorized the conditions of production of poetic meaning as protension
of meaning ahead of itself as opposed to those of fiction narrative which is structurally belated.
These literary temporalities marked by the mismatch of tenses point to an origin without
content, nor form. Nancy’s taking into account of poetic diction as well as of the agency of
language distinguishes him in the history of philosophy. The literary aspect of the philosophical
text is neutralized by definition as a result of the transparency ideal of the signifier which
grounds the possibility and singularity of philosophical discourse as a discourse characterized by
its lack of seduction or equivocity.
AUTEUR
ISABELLE ALFANDARY
Université Paris-III
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
146
La mutation du sens de la danse
Miriam Fischer-Geboers
NOTE DE L'AUTEUR
Les références des œuvres de Jean-Luc Nancy figurent dans la bibliographie liminaire
du présent volume.
Parler de « mutation » (Introduction)
1 « Mutation » est un concept ou un mot biologique qui veut dire, comme l’ont écrit les
organisateurs, « changement rare, spontané ou provoqué par l’extérieur, continu
(héréditaire) ou brusque », et ils poursuivent : « la mutation se dégage de toute finalité
préconçue, elle résiste à toute synthèse, elle diverge en une pluralité irréductible de
voies à la fois spécifiques et individuelles, elle déstabilise l’histoire, etc. ». – La danse, en
quoi peut-elle y contribuer ? Jean-Luc Nancy utilise le mot « mutation »
presqu’exclusivement dans le contexte historique, politique, éthique et philosophique.
Dans L’Intrus, il parle des « commencements d’une mutation de l’humanité » pour dire
que l’homme recommence à passer infiniment l’homme, qu’il « devient le plus
terrifiant et plus troublant technicien […] qui dénature et refait la nature, qui recrée la
création, qui la ressort de rien et qui, peut-être, la reconduit à rien […,] qui est capable
de l’origine et de la fin1. » Et bien sûr, les attentats de Daech nous montrent qu’il y a
lieu une mutation radicale et profonde de notre société, de nos pays, de notre monde,
de la vie…
2 L’argumentaire du colloque fait aussi le lien avec les arts et à l’esthétique : nous ne
sommes pas seulement des « mutants », mais aussi des « mythants ». On pourrait
entendre ce don ou cette faculté « mythante » comme une mutation spécifique de
l’humanité : l’art comme « exposition de l’exposition » – c’est la définition que Jean-Luc
Nancy nous donne – mute l’exposition (de l’existence, du sens) comme telle. Ma
question est alors : Est-ce que l’on pourrait concevoir l’art comme une mutation
spécifique, singulière et aussi plurielle de l’existence humaine ?
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
147
3 Dans ce texte, je tente d’abord de comprendre cette « mutation » de l’art ; ensuite, en
affirmant que la danse a un statut particulier parmi les arts, je voudrais parler de la
« mutation » du sens de la danse2.
4 Dans mon approche de la danse, je ne parlerai pas de son développement comme forme
ou genre – c’est-à-dire de ses mutations dans le cadre d’une « histoire de la danse » qui
serait sans doute très intéressante, parce qu’elle a vécu en effet une mutation décisive
dans les vingt dernières années. Il suffit seulement de penser à « The last
performance » de Jérôme Bel où personne ne danse plus, ou aux spectacles de Xavier le
Roy, et l’on pourrait nommer beaucoup d’autres – pour montrer que la danse en tant
qu’art se trouve non seulement en développement historique, mais en mutation. Elle
n’est plus forcément de la « danse », elle est aussi théâtre, musique, vidéo,
« installation », etc., et l’on trouve même des pièces de danse où personne ne danse
plus, c’est-à-dire qu’aujourd’hui une chorégraphie ne veut pas forcément dire qu’il y ait
des corps dansants sur scène (ou bien, il faudrait élargir le concept de danse et avouer
que danser est aussi se tenir debout, parler, marcher…).
5 Dans mon approche de la danse, je me concentrerai plutôt sur « l’aspect corporel et
sensible de la mutation ». Le corps dansant, que Nancy entend à partir de sa pensée du
sujet (l’existence comme être ex) et du sens (sens en tous sens), ce corps dansant – et
c’est ma thèse fondamentale – nous présente, nous expose une « mutation » : le corps
dansant est un « mutant-mythant » qui (pour revenir encore à l’argumentaire du
colloque) « se dégage de toute finalité préconçue, résiste à toute synthèse, diverge en
une pluralité irréductible de voies à la fois spécifiques et individuelles et déstabilise
l’histoire, etc. ».
La mutation de l’art
6 L’art3, selon Nancy, est une affaire de sens. Je ne vais pas ici me référer à toute
l’ontologie du sens de Nancy. Je rappelle seulement qu’il souligne les nombreuses
significations du mot « sens » (« direction », « sensation », « signification », etc.), et
qu’il tente de les concevoir comme les différents aspects d’un phénomène singulier.
C’est sur l’arrière-fond de cette conception large du sens que Nancy pense l’art et les
arts (parce que l’art est toujours pluriel). Or, l’art ne produit pas du sens intelligible,
mais du « sens en tous sens ». Il suspend même la distinction entre l’intelligible et le
sensible. « L’enjeu véritable de l’art – non pas renvoyer à un sens (intelligible), mais
produire du sens en un sens ni sensible ni intelligible, en un sens qui se dérobe à cette
différence4. » Nancy définit « l’affaire de l’‘art’ en général : aucun art qui ne soit pas
d’un toucher clair au seuil obscur du sens. […] Le toucher est clair / obscur de tous les
sens, et du sens, absolument5. » Il se sert donc ici des oppositions cartésiennes du
« clair / obscur » et du « distinct / confus » pour souligner la position intermédiaire de
l’art : il « touche » à l’« entre-deux » des deux substances cartésiennes, à la « relation
des res (res cogitans, res extensa) » : là où l’intelligible touche au sensible. Selon lui, l’art,
en tant qu’affaire de sens, « touche au toucher lui-même »6. L’art touche à la division
interne de l’existence (et du sens) : « l’art est ouvert à cette fragmentation du sens que
l’existence est »7. Ce « toucher n’est autre chose que la touche du sens tout entier, et de
tous les sens. Il est leur sensualité comme telle, sentie et sentante. […] Il fait sentir ce
qui fait sentir (ce que c’est que sentir) » 8. L’art est donc le « toucher du toucher » : l’art
fait sentir la sensibilité, la sensualité et le sentiment du sens.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
148
7 Ce « sens en tous sens », que l’art nous fait sentir, est un sens naissant : un sens, qui
naît, entre nous, à la présence. L’art est donc toujours « la naissance de l’art » 9. Nancy
souligne le caractère natif, voire naïf de l’art ; il parle même, dans Les Muses , de
« l’enfance de l’art »10. Et il nous y donne encore une autre définition de l’art comme
« l’apparaître de l’apparaître » ou « la présentation de la présentation » 11 : l’art
présente du sens qui naît à la présence (la naissance du sens). « Art » est seulement ce
qui prend pour thème et pour lieu le frayage du sens comme tel à même sa sensualité 12.
Comme l’art est l’affaire d’un sens « en genèse » qui est en même temps « sensuel »,
« sensible », « sens en tous sens », il est clair qu’il s’agit là « d’une signification plus
ancienne que toute intentionnalité donatrice de sens »13. Ce sens naissant est
exposé / exposant, et, pour cela même, ni intelligible ni sensible. Ainsi on pourrait dire
aussi que l’art expose l’ex-position – la position « ex » – du sens. L’art serait donc
« l’exposition de l’exposition ». Et comme il produit et présente un sens « en genèse »
ou bien (selon les mots de Merleau-Ponty) un sens in statu nascendi, c’est aussi un sens
qui « sort du point », qui (s’)échappe (ex-ire), et nous n’arriverons jamais à le « fixer » ; à
le « posséder », à le « savoir » ou à le définir clairement et distinctement.
8 Le fait que l’art soit toujours naissance de l’art signifie aussi que l’art est toujours
« mutant ». Si on dit – avec Nancy, mais aussi avec Merleau-Ponty – que l’art a affaire à
une « signification plus ancienne que toute intentionnalité donatrice de sens », on
comprend que l’art transgresse ou suspend, ou bien mute toutes les significations
ordinaires du monde de la vie. Nancy précise que l’art est l’ouverture d’un monde »,
mais aussi « l’ouverture et la transgression du monde »14. C’est pourquoi on pourrait
entendre l’art ou les arts aussi comme une « mutation du monde » dans un sens
particulier : le monde s’ouvre sur des voies singulières plurielles, exposant la naissance
du « sens en tous sens ». Pour illustrer cette transgression ou mutation que l’art est, et
pour lier ces réflexions à la danse, je voudrais donner trois exemples. Je cite brièvement
Merleau-Ponty, Valéry et Mallarmé qui parlent de la danse dans le sens d’une
« mutation » :
9 1) Merleau-Ponty écrit dans la Phénoménologie de la Perception que la danse ouvre un
espace esthétique ou anthropologique (et aussi ici on pourrait faire référence à la
mutation de l’humanité) qui signifie en même temps la suspension de l’histoire, son
Aufhebung. La danse mute l’espace(ment), le temps, la relation homme-monde, et même
le corps.
10 2) Paul Valéry dit, dans ses réflexions sur la danse, que la danseuse se trouve dans un
« autre monde », dans « une demeure qui est créée par ses propres mouvements » et
qui n’a rien à voir avec le temps du monde de la vie. Rien n’existe en dehors du
système, du monde qu’elle se crée par ses pas et par ses gestes. Valéry dit que la
danseuse trouve son « asile », sa « demeure », dans le « tourbillon » ; dans le
« mouvement », en tout cas dehors, plus précisément, comme il dit : « en dehors de
toutes les choses ». La danseuse, selon lui, ne représente rien – et représente tout. On
pourrait dire que, d’après Valéry, la danseuse mute en « l’acte pur des
métamorphoses ».
11 3) Mallarmé va encore plus loin et affirme que la danseuse n’est même pas une femme
et qu’elle ne danse pas. Elle mute en « danse pure », et cela veut dire qu’elle s’est libérée
de toutes les significations et catégories du monde ordinaire : du temps, de l’espace, des
caractéristiques d’une personne, même des définitions de l’art ou des arts. La danse,
selon Mallarmé, n’est pas de la danse. Mais ce qui se présente, c’est l’idée pure, la
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
149
métamorphose absolue, l’énergie, l’arabesque, ou pour parler avec d’autres mots (avec
les mots de Nancy) : ce qui se présente, ce n’est rien d’autre que l’exposition du sens
naissant, la performance pure du sens (en tous sens).
La philosophie de la danse de Jean-Luc Nancy15
12 La philosophie de la danse de Nancy se fonde, comme je l’ai déjà dit dans l’introduction,
sur sa pensée du sujet (l’existence comme être ex) et sur son ontologie du sens (en tous
sens). Je vais brièvement esquisser ces deux points.
13 Jean-Luc Nancy réserve à la danse un « privilège particulier » (sans évoquer une
hiérarchie des arts, puisque chaque art a son privilège) : « c’est que la danse expose
l’exposition comme telle »16. Cela renvoie d’ailleurs aussi à la définition de l’art comme
« exposition de l’exposition ». Il recourt ici à la conception heideggérienne de
l’existence comme exposition :
« La danse serait ce dedans allant dehors, dans ce dehors du monde, ce dehors qui
est en même temps le dedans du monde. Quelque chose donc où on ne peut pas
départager le dedans et le dehors, mais où il s’agit de l’exposition […]. [Ce thème]
est lié à celui de l’existence ou l’existence comme exposition […] : c’est l’être comme
l’être au dehors de soi »17.
14 Comme il l’explique aussi dans son texte L’extension de l’âme qui se réfère à Descartes,
mais aussi à Heidegger, et qui d’ailleurs pourrait être lu comme un traité sur la danse,
le sujet n’est pas un ego cogito, mais un être ex-, une ex-position, une ex-istence (ego sum,
ego ex-isto). « Exister, c’est sortir du point. »18 C’est pourquoi le sujet (s’)échappe aussi
toujours : « il vient en tombant hors de soi », ce que Nancy nomme « l’échéance du
sujet ».19 Cet ego ne se sait pas, mais il se meut, il s’é-meut et il s’é-prouve dans le
mouvement de l’exister (ex-ire). « Exister » signifie alors « exire », « (s’)exposer » et
aussi « (s’)excrire » [Corpus]. C’est ce mouvement de l’ex- que la danse expose.
15 Pour le dire avec d’autres mots : c’est exactement le fait qu’un sujet ou un sens ne
coïncide jamais avec soi-même (ne figure jamais un « point ») que la danse présente.
L’art de la danse est donc en effet la « présentation de la présentation » :
« La danse s’occupe de la possibilité qu’il y ait des gestes qui prennent en charge
une présence au monde, l’exposition au monde. La danse est surtout un
développement ou un désenveloppement. Je sors et je m’ouvre au monde et je
l’ouvre aussi »20.
16 Nancy définit l’art de la danse également (comme tous les arts) comme une « affaire de
sens ». Il précise qu’elle est une « manière de faire immédiatement du sens avec le
corps »21, ou encore la « production du corps en tant qu’il participe de… de quoi ? Du
sens, de la pensée, de l’être »22. Il est évident que la danse n’est pas la production ou la
présentation d’un sens défini ou définissable (d’un « point fixe »), mais au contraire la
production et la présentation d’un sens qui « sort du point » et qui, pour cela même,
(s’)échappe. La danse est toujours « naissance de la danse ». Elle expose d’une certaine
manière du « sens avant le sens » ou bien du « sens partant hors du sens » 23,
l’« échappée du sens »24. L’affaire de la danse est donc de « faire du sens hors du sens »
25
. C’est pourquoi Nancy, dans une conversation avec Mathilde Monnier, dit que la
danse est le « geste qui précède le sens », l’appelant « l’avant-geste » 26.
17 Or s’il affirme que la danse est une « manière de faire immédiatement du sens avec le
corps », il faut souligner le mot « immédiatement ». Il fait référence ici non seulement à
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
150
l’immédiateté » de cette production de sens, mais aussi à l’« immédiation » 27 de la
danse : la danse n’est pas seulement un phénomène immédiat dans un sens
(spatio-)temporel (« il est là ou il n’est pas ») ; elle est aussi immédiate au sens où elle
n’admet pas de médium : « le propre de cet art est de produire son sens en retrait de
tout médium et par là d’effacer le plus possible l’effet de signification que produit un
médium »28. C’est d’ailleurs pourquoi Nancy considère la danse avec Mallarmé comme
« danse pure »29. La danse est donc aussi « immédiat » dans le sens que le médium ne se
distingue pas de l’exercice de cet art. Et c’est pourquoi elle a un statut privilégié parmi
les arts. Il explique que, « lorsque ce médium est le corps propre de l’artiste […], on est
d’emblée porté au moins à soupçonner une autre configuration. Le moyen et la fin se
rapprochent, voire se recouvrent »30. Le corps dansant se prend lui-même comme fin et
comme but – et on pourrait dire que c’est « l’autre monde » de la danseuse valéryenne
qu’elle a créé, absolument et simplement, par les pas et les gestes de son corps : « Non
pas le corps comme origine, ni comme instrument, mais comme but de la danse, comme
cela à quoi elle doit arriver : envoyer un corps dans l’espace (dans l’espace d’une
pensée) »31. Le danseur ou la danseuse se trouve donc « dans un rapport immédiat à
soi : im-médiat, sans médiation par un médium ». D’où le fait que le danseur ou la
danseuse soit un(e) artiste particulièrement « auto-référencié(e) » 32.
18 C’est dans ce mouvement « auto-référentiel » où le corps ne dispose d’aucun autre
médium que de soi-même (même pas d’une pensée) – que le corps, selon Nancy, est
pensée. Le corps dansant est un corps pensant puisqu’il (se) « réfléchit » :
« l’écart de soi à soi du corps dansant – cet écart qui fait sa pensée, qui en fait un
corps pensant – n’est pas une “médiation” : il n’y a pas de médiateur, pas de tiers
sujet ou de tierce puissance motrice de l’écartement »33.
19 Le corps dansant sort de soi pour revenir à soi et, en faisant cela, il devient un autre (ou
bien soi-même). C’est un corps qui danse sa propre naissance, son devenir :
« Danse : métamorphose, transformation, [j’ajouterais : mutation], plasticité,
fluidité, malléabilité, devenir. […] Le corps dansant est tout à venir […]. C’est un
devenir-corps »34.
20 Il s’agit d’« un corps […] qui n’est pas encore advenu, qui ne fait que venir, devenir,
revenir à soi pour repartir vers un ailleurs qui est encore ‘soi’, toujours plus éloigné » 35.
Analogue à « l’échéance du sujet » et à « l’échappée du sens », le corps dansant est
« envoyé hors de lui »36 Et pendant qu’il danse, « le corps devient l’incorporel d’un sens
qui pourtant n’est pas ailleurs qu’à travers le corps »37. C’est exactement cette mutation
du corps en pensée que la danse expose. Le corps dansant mute en performance du sens,
mute en pensée : « le corps devient l’incorporel d’un sens qui pourtant n’est pas ailleurs
qu’à travers le corps ».
La danse comme pensée
21 Mais comment caractériser cette pensée que la danse selon Nancy est ? À la différence
d’Alain Badiou (qui se réfère à Nietzsche), Nancy entend la danse tout autrement que
comme métaphore de la pensée38. La danse n’est pas la représentation d’une pensée,
mais elle est elle-même pensée : « Quand je dis que la danse est une pensée, il faut bien
entendre qu’elle l’est en tant que danse, et non pas parce qu’elle produirait ou
nourrirait des pensées. […] Lorsque je marche, je ne pense à rien, ou plutôt mes pensées
se dissolvent dans la marche. Plus encore si je danse. C’est cette dissolution, ou bien
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
151
cette dissipation ou distraction de la pensée – distraction par attraction dans le corps –,
qui est alors véritablement la pensée : l’épreuve du sens ou de la vérité » 39. La danse est
donc une « pensée du corps » ou bien une « pensée-en-corps » 40. En d’autres termes : Si
le corps danse, il y a une « auto-référentialité », une « réflexivité » ou une « réflexion »
du corps qui fait sa pensée. Et il s’agit là d’une « véritable pensée » puisque la vérité de
cette pensée (ou de ce sens) s’éprouve (se sent). Jean-Luc Nancy renvoie ici encore à
Descartes qui, dans une lettre à Élisabeth, constate que l’épreuve de la vérité de l’union
de l’âme et du corps ne se sait ni s’imagine, mais s’éprouve (l’épreuve s’éprouve). Si nous
comprenons la danse comme pensée, il ne s’agit là évidemment pas d’une pensée claire
et distincte, mais plutôt d’une pensée obscure et confuse dont la vérité ou l’épreuve
s’éprouve.
22 Mais Nancy – et il se trouve en ce point très proche de Valéry et du Descartes des
Lettres, mais très loin du Descartes de la métaphysique – met en relief le côté matériel
de toute pensée. Il dit dans un entretien :
« La pensée est autre chose, aussi manuelle qu’intellectuelle, de même que la danse
est autre chose que l’exercice physique ou que les règles du ballet. Je parle de la
pensée dans le sens précis où le mot ‘penser’ vient de ‘peser’, du latin pensare
(penser) »41.
23 Et dans son livre Le poids d’une pensée, il nous explique que seul une « pensée qui pèse
[…] le poids du sens »42 est une véritable pensée. Si Nancy nous dit qu’il « nous faut un
art […] de l’épaisseur et de la pesanteur »43 – un art donc qui soit une « pensée qui pèse
le poids du sens », je crois pouvoir affirmer qu’il comprend la danse, absolument et
simplement, comme un tel art, comme une telle pensée. Car la danse, en tant qu’art et
en tant que pensée, n’a pas pour but de « penser » le sens (d’en élaborer la
signification), mais de le laisser peser, tel qu’il arrive, tel qu’il passe, « lourd ou léger,
ou toujours à la fois lourd et léger »44.
24 C’est d’ailleurs pourquoi la compréhension de la danse n’est possible que si l’on prend
part (cela renvoie d’ailleurs au partage du sens en général). On n’arrive pas à
« comprendre » les mouvements de la danse si l’on reste à distance parce que le sens de
la danse ne se conçoit pas intelligiblement (par une conscience pure ou une pensée
claire et distincte). Mais il faut participer, en chair et en os et avec tous les sens, à cette
production et présentation de « sens en tous sens », puisque le sens de la danse se sent
et s’éprouve. Il s’agit d’une reproduction de l’autre en moi : l’autre « résonne » en moi,
« j’éprouve en moi ses mouvements ». « Comprendre » de la danse signifie donc que
cette performance de sens ou cette pensée performative (que la danse est) m’émeut, me
meut, m’excite, me fait entrer dans la danse, dans la pensée de la danse –
insensiblement ou sensiblement. Et c’est pourquoi Nancy finit son texte Allitérations par
ses mots : « Le sens de la danse est de faire, ici même, entrer dans la danse » 45.
25 Or, cette réflexion sur la danse comme pensée est aussi une réflexion sur la pensée en
général, mais surtout sur la pensée philosophique. La « véritable pensée » est alors
(comme il l’a souligné dans Le poids d’une pensée, Le sens du monde, Les muses, L’extension
de l’âme, Allitérations et ailleurs) toujours une pensée dont on éprouve l’épreuve de la
vérité, dont on sent le sens, dont on pèse le poids du sens. C’est-à-dire, si l’on veut, que
la danse, ou au moins la réflexion sur la danse comme pensée (et comme pesée du sens),
mute, d’une certaine manière, aussi la philosophie. Pourrait dire que la danse et la
philosophie, étant toutes les deux une « véritable pensée », sont devenues – à travers de
et grâce à la pensée de Jean-Luc Nancy – des mutantes qui se rapprochent 46 ?
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
152
BIBLIOGRAPHIE
FISCHER-GEBOERS Miriam, Denken in Körpern. Grundlegung einer Philosophie des Tanzes, Freiburg :
Alber, 2010.
FISCHER-GEBOERS Miriam, « Jean-Luc Nancy : la danse comme pensée », in : G IOFFREDI, Paule (éd.) : À
l(a r)encontre de la danse contemporaine. Porosités et résistances, Paris : L’Harmattan, 2009.
NOTES
1. Dans son texte L’Intrus, Nancy parle de la mutation de l’humanité. Il écrit : « Nous sommes,
avec tous mes semblables de plus en plus nombreux, les commencements d’une mutation, en
effet : l’homme recommence à passer l’infiniment l’homme (c’est ce qu’a toujours voulu dire la
‘mort de dieu’, en tous ses sens possibles). Il devient de qu’il est : le plus terrifiant et plus
troublant technicien […] qui dénature et refait la nature, qui recrée la création, qui la ressort de
rien et qui, peut-être, la reconduit à rien. Celui qui est capable de l’origine et de la fin » (L’Intrus,
p. 48).
2. Je me réfère dans ce texte à mes recherches exposées dans Denken in Körpern. Grundlegung einer
Philosophie des Tanzes, et dans « Jean-Luc Nancy : la danse comme pensée », p. 155-174.
3. L’art, selon Nancy, n’existe que dans la pluralité des arts. Mais il ne propose pas une hiérarchie
des arts. Au contraire, il critique la tendance fréquente à justifier le primat d’un art par le primat
d’un sens. La pluralité des arts ne correspond pas à la pluralité des sens.
4. J.-L. NANCY, Allitérations, p. 28.
5. J.-L. NANCY Le Sens du monde, p. 132.
6. J.-L. NANCY, Les Muses, p. 36.
7. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 212.
8. J.-L. NANCY, Les Muses, p. 34-35.
9. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 199.
10. J.-L. NANCY, Les Muses, p. 168.
11. Ibid., p. 60 et p. 62.
12. J.-L. NANCY, Le Sens du monde, p. 207.
13. J.-L. NANCY, Les Muses, p. 60.
14. « Chaque œuvre est à sa façon… l’ouverture d’un monde » (Les Muses, p. 58).
15. Jean-Luc Nancy n’a pas seulement publié plusieurs ouvrages sur la question du corps, mais il
s’est aussi beaucoup intéressé à la danse contemporaine, notamment au travail de la chorégraphe
Mathilde Monnier. Du travail commun et de l’échange d’idées qui a eu lieu entre Jean-Luc Nancy
et elle est née la pièce « Allitérations » (2004), et aussi le livre intitulé Allitérations. Conversations
sur la danse qui contient non pas seulement le texte que Nancy a écrit pour la pièce et qu’il lisait
sur scène, mais aussi toute la correspondance qui avait eu lieu à l’avance entre Monnier et Nancy.
Mais il y a aussi d’autres ouvrages de Nancy qui ont inspirés des chorégraphes, notamment
Corpus. La chorégraphe Wanda Golonka a utilisé pour la pièce « For sale » (2005-2006) le texte « 58
indices sur le corps » qui a été ajouté à la troisième édition de Corpus.
16. J.-L. NANCY, Entretien avec Véronique Fabbri, p. 66.
17. J.-L. NANCY, Seul(e) au monde, p. 55.
18. J.-L. NANCY, L’Extension de l’âme, p. 31.
19. Idem, p. 27.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
153
20. J.-L. NANCY, Seul(e) au monde, p. 69.
21. J.-L. NANCY, Entretien avec Véronique Fabbri, p. 66.
22. J.-L. NANCY, Allitérations, p. 55.
23. Idem, p. 78.
24. Idem.
25. Idem, p. 20.
26. Idem, p. 79.
27. Idem, p. 34.
28. Idem, p. 29.
29. Idem, p. 108.
30. J.-L. NANCY, Allitérations, p. 29-30.
31. Idem, p. 114.
32. Idem, p. 30.
33. Idem, p. 33.
34. Idem, p. 109.
35. Idem, p. 55.
36. Idem, p. 115.
37. Idem, p. 60.
38. « La danse n’est pas une métaphore pour la pensée » in : Entretien avec Véronique Fabbri, p. 76.
39. J.-L. NANCY, Allitérations, p. 111.
40. Corpus, op. cit., p. 100.
41. J.-L. NANCY, Seul(e) au monde, p. 61.
42. J.-L. NANCY, Le Poids d’une pensée, p. 5.
43. Idem, p. 15.
44. Idem, p. 13.
45. J.-L. NANCY, Allitérations, p. 150.
46. En tout cas, dans un entretien au CND, Nancy n’hésite pas à affirmer : « Sans aucune tricherie,
je peux dire que quand je pense, je danse. », Seul(e) au monde, p. 61.
RÉSUMÉS
Miriam Fischer-Geboers montre que le corps dansant – que Nancy aborde à partir de sa pensée du
sujet et du sens – nous présente une « mutation » : le corps dansant mute en performance du sens,
mute en pensée ; « le corps devient l’incorporel d’un sens qui pourtant n’est pas ailleurs qu’à
travers le corps ». La réflexion sur la danse comme pensée mène finalement à une réflexion sur la
pensée en général, et surtout sur la pensée philosophique. L’auteure met en relief que la
« véritable pensée » est, selon Nancy, toujours une pensée dont on éprouve la vérité, dont on sent
le sens, dont on pèse le poids du sens. Elle se demande si, en conséquence, il faut penser la
relation entre la danse et la philosophie d’une nouvelle manière.
Miriam Fischer-Geboers shows that the dancing body–which Nancy approaches from his
thoughts on the subject and the meaning–expresses a “mutation”: the dancing body mutates in
performance of the meaning, mutates in thought; “the body becomes the incorporeal of a sense
that is not other than through the body.” His meditation on dance as thought finally leads to a
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
154
meditation on thinking in general, and especially on philosophical thinking. The author
highlights that “real thought” is always, according to Nancy, thinking which we experience the
truth, which we feel the meaning, which we weighs the weight of meaning. She wondered,
therefore, whether we have to think in a new way the relationship between dance and
philosophy.
AUTEUR
MIRIAM FISCHER-GEBOERS
Université de Bâle
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
155
Compte rendu
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
156
La Part inconstructible de la Terre
Seuil, coll. « Anthropocène », 2016
Sophie Gosselin
RÉFÉRENCE
Frédéric Neyrat, La Part inconstructible de la Terre, critique du geo-constructivisme, Seuil,
coll. « Anthropocène », 2016.
Des usages de la Terre – critique de la raison
constructiviste
1 Le livre de Frédéric Neyrat La Part inconstructible de la Terre constitue une réponse
incontournable à la nécessité contemporaine de s’émanciper d’une domination
planétaire aujourd’hui portée à visage découvert par l’idéologie posthumaniste et la
géo-ingénierie. Ce livre permet de mettre en lumière les nouvelles lignes de partage
que cette domination dessine, notamment à travers l’extension du processus de
production industriel à l’ensemble du vivant. Ce déplacement dans les lignes de partage
et de conflictualité, les concepts et conceptions politiques traditionnelles ne
permettent pas d’y répondre1, tant du point de vue des résistances et stratégies de
luttes mises en oeuvre que de l’imaginaire qui les porte. Les forces critiques et
émancipatrices se trouvent aujourd’hui pour une grande part dépourvues face à ces
nouvelles formes de domination. Repenser et redessiner les lignes de conflictualité
apparaît donc comme un préalable à tout processus émancipateur.
2 Or, c’est à côté de cette nécessité que me semble passer la critique formulée par Pierre
Charbonnier dans son article « Constructivisme et urgence environnementale » 2. Cette
critique est intéressante à plus d’un titre, notamment parce qu’elle pointe la nécessité
d’une clarification sur la notion de « constructivisme ». Mais elle est aussi révélatrice
d’une certaine incompréhension des enjeux soulevés par le livre de Neyrat, notamment
de l’ampleur de la recomposition (bio)politique contemporaine. Le présent texte
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
157
constitue une tentative d’expliciter les enjeux sous-jacents au projet critique entrepris
par Neyrat.
1. Le constructivisme en question
3 L’article de Charbonnier vise à défendre le constructivisme en tant qu’il a largement
contribué à déconstruire une conception essentialiste ou substancialiste de la Nature
pensée comme ordre naturel prédonné. Et en effet, ce geste de déconstruction a
accompagné et soutenu un ensemble de processus d’émancipation (les luttes
minoritaires en particulier) en remettant en question des normes sociales établies par
des rapports de pouvoir, par des stratégies et techniques de domination, normes qui se
présentaient comme « naturelles », comme appartenant à un ordre pré-donné auquel il
s’agissait de se conformer pour pouvoir exister socialement.
4 De ce point de vue, le « constructivisme » correspond à l’idée ou à la théorie selon
laquelle ce qui se présente sous le mode de l’actualité comme la « réalité » (et en
particulier la réalité humaine et sociale), les partages qui la déterminent, sont le
résultat d’une production, non seulement de l’esprit humain, mais aussi des rapports
sociaux.
5 Charbonnier soutient une position que l’on pourrait qualifier de naïve lorsqu’il dit que
le constructivisme ne fait que décrire la manière dont se sont historiquement formées
des catégories et représentations du monde sans que cela ait la moindre incidence sur
ce que l’on appelle la « réalité ». Ce qui serait en jeu, ce ne serait que notre perception
de la réalité, mais pas la réalité elle-même qui subsisterait intacte. Cette conception du
constructivisme cherche à sauvegarder l’autonomie de la science, en l’occurrence des
sciences sociales, en lui donnant la fonction d’observateur neutre, extérieur aux enjeux
de savoir-pouvoir qui structurent le partage des mots et des choses.
6 Or, le constructivisme auquel s’attaque Neyrat sous les noms de géoconstructivisme et d’
écoconstructivisme, est un constructivisme de part en part opératoire. À travers la critique
du constructivisme, Neyrat cherche à mettre en lumière la métaphysique sous-jacente
au posthumanisme et à la géo-ingénierie, métaphysique qui déborde largement ces
deux formations idéologiques jusqu’à pénétrer et structurer la grande majorité des
discours contemporains d’inspiration « écologique ». Le constructivisme ici en jeu n’est
pas simplement épistémologique, comme celui dont Hacking a pu chercher à faire la
synthèse. L’article de Wikipedia sur le constructivisme mentionne d’ailleurs l’existence
d’un « constructivisme radical » ignoré par Hacking, constructivisme qui se développe à
partir des travaux de la cybernétique. C’est à cette forme de constructivisme qu’il faut,
me semble-t-il, remonter pour comprendre la matrice métaphysique commune au
géoconstructivisme et à l’écoconstructivisme. Par « constructivisme opératoire », je
désigne un type de discours qui rompt avec l’idée traditionnelle d’autonomie de la
science, avec l’idée de posture observatrice, pour au contraire prendre en charge, en
s’appuyant sur la science, la transformation effective de la réalité. Ce constructivisme
opératoire ne cherche pas simplement à décrire des catégories de pensée mais à
organiser pratiquement l’appropriation et la reconstruction artificielle des conditions
de la vie sur Terre. Or je tenterais de montrer, dans la continuité du travail de Neyrat,
en quoi ce processus engage un déplacement des enjeux et problématiques politiques
traditionnels, ainsi que, et c’est là l’essentiel, des perspectives d’émancipation.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
158
2. Généalogie du constructivisme radical
7 L’hypothèse que je formulerai ici vient compléter l’analyse proposée par Neyrat dans
son livre. Son analyse consiste à repérer un ensemble de motifs théoriques communs et
convergents qui se trament à travers des discours en apparence très différents, non
seulement en termes de discipline (sciences de la nature, ingénierie, sociologie,
anthropologie, philosophie), mais aussi en termes de lieu d’émergence (USA, Europe).
L’analyse de Neyrat dessine l’état d’un ensemble de discours contemporains dominants
aujourd’hui la sphère intellectuelle et politique par rapport à la problématique
environnementale et climatique, discours qui contribuent tous à alimenter le grand
récit de l’Anthropocène. Mais s’il est en effet possible de retracer la généalogie de ces
discours dans le grand récit de l’Anthropocène qui marque l’époque moderne, il me
semble que, de manière plus précise, les motifs mis en lumière par le livre, au cœur
desquels se situe l’enjeu technologique, trouvent leur source dans le tournant qui s’est
produit dans la première moitié du XXe siècle, et qui est directement en lien avec la
crise des sciences analysée par Husserl. Ce tournant est celui qui marque le passage de la
science à la technoscience.
8 Ce passage correspond au tournant opératoire de la science explicité par Werner
Heisenberg dans son texte de 1962 intitulé La Nature dans la physique contemporaine :
« L’ancienne division de l’univers en un déroulement objectif dans l’espace et le
temps d’une part, en une âme qui reflète ce déroulement d’autre part, division
correspondant à celle de Descartes en res cogitans et res extensa, n’est plus propre à
servir de point de départ si l’on veut comprendre les sciences modernes de la
nature. C’est avant tout le réseau des rapports entre l’homme et la nature qui est la
visée centrale de cette science ; grâce à ces rapports, nous sommes, en tant que
créatures vivantes physiques, des parties dépendantes de la nature, tandis qu’en
tant qu’hommes, nous en faisons en même temps l’objet de notre pensée et de nos
actions. La science, cessant d’être le spectateur de la nature, se reconnaît elle-même
comme partie des actions réciproques entre la nature et l’homme » 3.
9 Ici se trouve mis en jeu le partage constitutif de la science moderne entre sujet d’un
côté et objet de l’autre. Chez Kant, l’objectivité de l’objet réside moins dans
l’adéquation entre la représentation et la chose telle qu’elle existe réellement (en soi)
qu’entre la représentation et les lois universelles qui régissent l’entendement humain.
L’objectivité, au sens de ce qui a valeur universelle, est située du côté du sujet
connaissant considéré en tant qu’être rationnel. Elle reste fondée en nature : dans la
nature de la rationalité humaine. Or, Heisenberg met en question l’idée même d’une
telle objectivité, c’est-à-dire l’idée qu’il existerait des lois universelles inscrites dans la
nature, que celles-ci soient du côté de la chose étudiée ou du côté du sujet. Heisenberg
met l’accent sur la relation dynamique et productrice entre sujet et objet tout en
conservant ce partage puisqu’il dissocie l’homme en tant qu’objet de la nature («
créature vivante physique ») de l’homme en tant que sujet capable de penser et d’agir
sur la nature, partage qui recoupe celui entre corps et esprit. Aussi la relation entre le
sujet et l’objet n’est pas seulement une relation entre deux substances déjà existantes
en soi, mais une relation qui produit, qui engendre à la fois le sujet et l’objet. La relation
produit la dualité sujet-objet tout en reconduisant le rapport dissymétrique qui installe
l’homme en position de pouvoir par rapport à une nature encore considérée comme
ensemble d’objets. C’est alors que s’opère « la transformation d’une science qui vise la
représentation en une science active, opératoire. La part de théorisation de cette
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
159
science-technique concerne non plus le réel en soi, mais les interactions du scientifique
avec le réel »4. Selon Gilbert Hottois, cette rupture marque l’avènement de la techno-
science, c’est-à-dire d’une science qui vise moins à dévoiler la vérité qu’à transformer le
réel. Aussi, loin de remettre en question la domination de l’homme sur la nature, ce
déplacement a pour conséquence de déployer une anthropologisation générale de la
nature elle-même. Le renversement paradoxal auquel procède la technoscience
consiste à penser que si le réel est inaccessible en tant que tel au savoir humain, alors le
savoir humain n’a plus aucune limite extérieure à son savoir, savoir dont la validité
réside dans sa capacité à informer le réel selon ses propres critères. L’information tirée
de la nature se retourne en processus qui informe le réel au gré des opérations
algorithmiques. L’information au double sens de donnée et de capacité de
transformation prend le pas sur le sujet et l’objet : elle les produit comme les deux
pôles d’une relation dynamique. La donnée est le résultat calculé d’un processus de
transformation qui se déploie à travers un ensemble de dispositifs techniques et
sociaux.
10 Ce tournant opératoire de la science a été pris en charge par l’invention de la
cybernétique (à l’origine de l’invention des TIC), théorie qui se veut déjà plus qu’une
science, puisqu’elle vise d’abord à transformer le réel. Ainsi, lorsque la cybernétique
procède à la fusion de l’homme et de la machine via le vecteur informationnel, cela
n’est pas simple métaphore ou analogie (comme cela pouvait encore être le cas chez
Descartes) : cette fusion s’opère à même les corps à travers l’implantation de prothèses
jusqu’à la réécriture du génome conçu comme information manipulable,
programmable. Avec le concept d’information, on passe du signe au code : celui-ci agit
et se veut productif de part en part, il vise à produire des effets 5. Ce qui prend alors le
dessus, avec la technoscience, est ce que Michel Tibon-Cornillot appelle la « raison
militante » du projet scientifique moderne, raison active, qui vise effectivement à
transformer la planète en laboratoire à l’échelle 16.
11 Si négation de la nature il y a donc, comme ne cesse de l’affirmer Neyrat, c’est en ce
sens que le savoir devient opérateur de transformation en agissant pratiquement à
même les corps, les recodant à travers des processus opératoires et informationnels. Le
géoconstructivisme est l’héritier direct du versant ingénierial de la cybernétique, alors
que l’éco-constructivisme hérite de son versant plus théorique et transdisciplinaire
(physique, biologie, sciences de l’ingénieur, anthropologie, philosophie, psychologie,
sociologie). Et il est possible de retracer l’ensemble des motifs théoriques mis en
lumière par Neyrat dans cette théorie du contrôle et de la communication dans l’animal
et la machine ou théorie des systèmes : concepts de turbulence, de chaos, de désordre
(qui renvoient à l’idée d’entropie : degré de désordre à l’intérieur d’un système),
incertitude programmée (information, programme), théorie du tout (système,
rétroaction)7.
3. Vers une politisation de la nature
12 Mais la cybernétique se veut dès le départ quelque chose de plus qu’une technoscience,
elle se veut aussi, pour reprendre le terme employé par Neyrat, une «
technopolitique ». Du grec « kubernetes » qui veut dire « gouvernail », la cybernétique se
veut théorie et pratique de gouvernement, d’un gouvernement qui ne porte plus
seulement sur les hommes mais sur l’ensemble des vivants. En ce sens, le projet
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
160
politique de la cybernétique est fondamentalement biopolitique. Ce gouvernement
n’est plus essentiellement mené par des hommes, puisqu’il est pensé comme devant
s’auto-organiser à partir de l’implantation généralisée de dispositifs informationnels et
qu’il se confond de plus en plus avec une gestion économique (la main invisible se serait
matérialisée dans le réseau). Ce déplacement me paraît essentiel, car c’est lui, en
particulier, qui bat en brèche les réponses et partages politiques traditionnels issus de
la modernité. C’est ce déplacement que le livre de Neyrat contribue à prendre en
charge.
13 En quoi consiste ce déplacement ?
14 Il consiste à étendre le champ du politique à l’ensemble de la nature via l’économie,
c’est-à-dire à organiser la mainmise de l’homme sur l’ensemble des corps naturels par
et à travers le développement d’une industrie dont l’objet de production devient le
vivant en général (comme Marx parlait du travail « en général »). Or, les partages
politiques traditionnels se pensent encore à l’aune de la conception traditionnelle de la
politique, c’est-à-dire relativement à la société des humains. Car le champ du politique
c’est d’abord celui où les êtres humains décident ensemble de leur avenir commun : le
champ de la polis, de la Cité. Le projet politique de la cybernétique vise la mise en place
d’une gouvernance mondiale, d’une gouvernance qui, alliée à l’industrie, organise le
contrôle, à l’échelle planétaire, des humains et des non humains. Aussi, cette extension
du politique à l’ensemble de la nature via l’économie n’est pas sans conséquence sur la
manière de penser l’être humain. Elle engage nécessairement de porter à son point de
rupture l’articulation précaire qui s’est construite à l’époque moderne d’une Humanité
ancrée dans l’espèce humaine. Comme l’a mis en lumière Agamben, l’espace politique
s’articule autour d’une exclusion-inclusive de la zoé (vie naturelle). Dans l’Antiquité,
l’articulation zoé-bios était marquée par une différence de nature entre la zoé et la bios,
entre la vie naturelle et la personne politique. À l’époque moderne, notamment avec la
théorie du droit naturel, on assiste à une redéfinition de l’articulation zoé-bios : la bios
(la forme de vie politique, la personne) trouve son fondement dans la zoé (l’espèce) : la
personne humaine (au sens moral et politique) appartient à l’espèce humaine 8. La
politisation de la nature via sa dissolution dans l’économie implique un effacement de
la différence entre bios et zoé, entre la personne politique et l’être vivant. C’est ce
processus d’effacement de la frontière entre personne et vivant qui s’exprime dans le
projet post ou transhumaniste, cet enfant de la cybernétique. Ce projet porte
l’articulation bios/zoé à son point de rupture en cherchant à soumettre l’espèce, et
avec elle l’ensemble des espèces vivantes, à la loi du Genre humain objectivée dans les
dispositifs technologiques. On passe alors du zoon politikon, de la conception
aristotélicienne de l’homme comme animal politique (c’est-à-dire de l’homme se
distinguant des autres animaux par sa disposition politique) à une politisation du zoon
qui cherche à soumettre ou à dénier ce qui de la condition d’espèce échappe à toute
possible (re)construction (l’anima de l’animalité, la libre poussée non constructive des
conditions de la vie).
15 Ce projet peut être interprété comme une tentative de réponse au traumatisme
provoqué par la seconde guerre mondiale. C’est en effet radicalement défigurée que
l’Humanité est sortie de cette guerre. Face à la catastrophe qui a vu les corps défigurés
par la bombe atomique rejoindre les corps défigurés par le projet nazi, Norbert Wiener,
pionnier de la cybernétique, va s’engager à redonner figure à l’homme et au monde en
le (re)configurant. C’est comme si, après la seconde guerre mondiale, l’humain ne
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
161
pouvait plus s’apparaître à lui-même que sous la forme d’un être monstrueux. L’être
humain s’est défiguré lui-même ainsi que le projet humaniste qu’il portait. Sans doute
ne lui est-il permis de retrouver figure que dans la (con)figuration de son propre
dépassement. La cybernétique se constitue alors comme relève paradoxale d’un certain
humanisme, de cet humanisme qui croyait en la science et la technique comme moteur
de progrès. Mais cette relève s’accomplit dans un geste apparemment paradoxal, celui
d’un dépassement de l’humain par son « amélioration » dans le post-humain. La figure
du cyborg (cyber organisme) vient donner corps à cette mutation vers une post-
humanité. Elle s’érige sur le dénie de la condition d’espèce en tant qu’elle nous renvoie
à notre condition corporelle. Le fantasme transhumaniste procède à une tentative de
négation des espèces en tant qu’elles sont porteuses d’une faille ou d’une inadéquation
irréductible : c’est-à-dire en tant qu’elles sont des corps, corps sensibles et sentants,
corps touchés et touchants, corps vulnérables.
16 Le projet posthumaniste n’est que l’expression pathologique d’une crise traversée par
un modèle de société qui s’est globalisé : crise de l’anthropos, crise qui porte sur le sens
même de ce que cela veut dire d’être humain. Crise qui est donc bien plus
anthropologique et métaphysique que politique.
17 C’est cette crise qu’il s’agit aujourd’hui de prendre en charge, et à laquelle le livre de
Neyrat contribue à tenter de donner des réponses. Poser et penser la question de la
nature aujourd’hui, cela n’est pas revenir à l’idée d’un ordre naturel prédonné, mais
prendre en charge cette existence corporelle et sensible, cette vulnérabilité qui est la
nôtre, prendre en charge le corps, c’est-à-dire ce par quoi nous habitons le monde et le
partageons avec d’autres formes de vie (non humaines). Penser la nature, depuis la
nature, c’est d’une certaine manière tenter de renverser le processus de politisation et
d’économisation de la nature. C’est ce déplacement de perspective qui s’indique dans la
tentative de penser depuis la « Terre ».
4. Des usages de la Terre
18 Qu’est-ce qui s’indique dans ce déplacement ? Quel processus émancipateur s’y trouve
mis en jeu ? Ce qu’il s’agit d’émanciper ce sont les corps, la variété infinie des corps
sensibles qui forment ce que traditionnellement on appelle « nature ». De quel joug
s’agit-il d’émanciper les corps ? Du joug de la marque humaine (ou plus précisément,
pour parler comme G. Bataille, de la marque imposée par « les hommes de la
production »), marque ou marquage qui s’objective sous la forme d’opérations et de
dispositifs technologiques et biotechnologiques, et qui trouve dans la modification
génétique son expression la plus frappante.
19 La question dépasse dès lors la sphère du politique. Elle nous conduit même aux bords
du politique, elle nous conduit à repenser ce que l’on entend par « politique », c’est-à-
dire cette sphère du vivre ensemble conditionné par la parole et le dialogue entre
humains. La crise que nous traversons et l’enjeu émancipateur qui s’ouvre à nous ne
peut que nous conduire à remettre en question l’idée même du politique que nous
héritons de la Grèce antique, pour repenser d’autres modalités d’être-avec entre
humains et non humains. C’est la question du commun qui se trouve dès lors remise en
jeu, de ce commun que le droit romain excluait du domaine d’extension de la loi
humaine, le commun des « choses communes », de ces choses qui, se trouvant par-delà
les frontières de la Cité, se confondaient avec la « nature ». Comme le rappelle le juriste
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
162
Benoit Jadot, les choses communes se distinguaient, dans le droit romain, des res nullius
en tant qu’elles correspondaient « à ces choses que la nature a produites pour l’usage
de tous. Elles sont données au genre humain et présentent des caractéristiques
inépuisables : l’air, la lumière du soleil, l’eau courante, la mer et ses rivages, les
animaux sauvages »9. Ainsi les res communis ne peuvent être appropriées. Elles doivent
être préservées dans leur globalité pour qu’elles puissent se régénérer 10 et l’on ne peut
en user que localement et temporairement d’une façon passive ou active : respirer l’air,
puiser de l’eau, pêcher des poissons dans la mer. L’enjeu n’est plus seulement celui,
marxiste, d’améliorer les conditions de vie des hommes sur Terre. Ce sont aujourd’hui
les conditions de la vie elle-même qu’il s’agit de préserver, c’est-à-dire la Terre en tant
qu’elle est porteuse des conditions de la vie.
20 Si le projet moderniste et son aboutissement actuel consiste à coloniser et à épuiser cet
espace du commun qui échappe au contrôle de l’homme, l’enjeu émancipateur
d’aujourd’hui consisterait à renverser ce processus en libérant le commun du joug de
l’Homme.
21 Il faut reprendre les analyses lumineuses et d’une actualité brûlante d’Hannah Arendt
sur le déclin de l’État-nation (dans Les origines du totalitarisme), mais en proposant une
réponse qui irait à l’inverse de la sienne. Que dit Arendt ? Que la multiplication des
sans-droits, des apatrides, à l’échelle planétaire, est la conséquence inéluctable de la
mondialisation, conséquence inéluctable, « parce qu’il n’y avait plus un seul endroit
“non civilisé” sur terre, parce que, bon gré mal gré, nous avons vraiment commencé à
vivre dans un Monde Un »11. Ainsi, celui qui se trouve exclu de la Cité politique, se
trouve par là-même déchu de son statut de citoyen et réduit à sa pure condition
animale, c’est-à-dire à sa condition d’espèce. « La perte de patrie et de statut politique
[revient] à être expulsé de l’humanité tout entière » en étant réduit à « la nudité
abstraite d’un être humain et rien qu’humain »12. Pour Arendt, cette réduction de
l’homme à sa condition animale est la grande catastrophe de la condition de l’homme
moderne. Et l’enjeu consiste pour elle à repenser une politique capable de «
réintégrer » dans le champ de la citoyenneté, tous les humains qui en ont été exclus. Or
ne faudrait-il pas, au contraire, tenter de repenser le vivre-avec depuis cette condition
« hors citoyenneté », c’est-à-dire depuis la prise en compte du non humain ?
22 De ce point de vue, les apports de l’anthropologie critique contemporaine paraissent
essentiels, parce qu’ils reposent la question de l’humain, de ce que cela veut dire d’être
humain en s’appuyant sur d’autres traditions de pensée que celle de la culture
occidentale. Ce qui veut dire qu’ils permettent potentiellement de repenser des
modalités de vivre-avec qui ne se fondent pas sur une conception biologisante
(naturaliste) de l’homme (telle que l’on peut la voir encore à l’œuvre dans
l’antispécisme par exemple), et qui sortent de la dialectique zoé-bios, nature-culture,
dans laquelle la pensée politique et métaphysique occidentale semble enfermée. Les
travaux d’anthropologues tels que Viveiros de Castro, Descola, Ingold, Brunois,
Glowczewski, Poirier, etc. nous permettent d’accueillir d’autres manières de penser
l’être-avec des existants et donc d’imaginer et d’inventer d’autres modalités d’être-
avec.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
163
5. De l’inconstructible
23 Il me paraît ici important de signaler une des limites de la critique globale formulée par
Neyrat à l’encontre des approches anthropologiques post-structuralistes (notamment
celle de Philippe Descola) mais aussi de la sociologie d’un Bruno Latour, en tant
qu’approches constructivistes. Bien qu’elles partagent ou reprennent au
constructivisme opératoire d’inspiration cybernétique ou systémique un ensemble
d’opérateurs théoriques, elles s’en distinguent par une certaine mise en suspens de
l’impératif prospectif qui le définit. Il faudrait distinguer à l’intérieur du
constructivisme, différents niveaux d’articulation, et la possibilité de mettre l’accent
sur un niveau plutôt qu’un autre. Je distinguerais trois niveaux d’articulation : niveau
prospectif qui renvoie à une démarche active et volontariste visant à déterminer les
conditions concrètes d’apparition et d’existence des êtres présents et à venir (visée que
ne partage pas l’anthropologie d’un Descola qui s’inscrit de ce point de vue dans une
certaine tradition de « neutralité » scientifique) ; niveau ontologique qui consiste à
définir la nature des êtres et leurs relations en proposant un vecteur de liaison
homogène entre tous les êtres du monde (par exemple la circulation de l’énergie /
information dans la théorie cybernétique) ; un niveau analytique et / ou critique
permettant de dégager de nouvelles distinctions et de déplacer les problèmes (par
exemple la critique du concept de société par Latour permettant d’ouvrir à l’idée de
collectifs composés d’humains et de non humains). Le problème que pose le
constructivisme opératoire de la cybernétique consiste à mettre en son cœur le niveau
prospectif et à mobiliser la dimension ontologique et critique au service de
l’opérativité, ce qui a pour effet paradoxal de naturaliser une ontologie constructiviste.
Ce faisant, la cybernétique et la systémique peuvent intégrer dans son processus
opératoire toutes les contributions théoriques qui privilégient les autres niveaux
d’articulation. Ce qui veut dire, de manière plus simple et directe, qu’elle a le pouvoir
de récupérer et d’intégrer toute élaboration théorique qui ne s’en démarque pas
radicalement.
24 C’est pourquoi la critique de Neyrat à l’encontre du constructivisme en général me
semble en définitive assez juste, puisque tant que l’on reste sur le terrain du
constructivisme l’on ne peut que contribuer (de manière directe ou indirecte) à
alimenter cette ambition prospective.
25 La seule chose qui (au-delà de l’idée d’une nature pré-donnée) puisse faire barrage au
constructivisme opératoire, c’est précisément ce qu’il ne cesse de dénier ou de refouler,
ce qu’il ne peut que dénier et refouler pour pouvoir s’affirmer et qui pourtant le rend
possible : la part inconstructible.
26 Pour comprendre cette idée il faut sans doute revenir à celui qui n’a cessé d’interroger
et de mettre en crise toute idée de « construction », c’est-à-dire à Jacques Derrida. Que
nous dit Derrida ? Qu’il ne peut y avoir de déconstruction ni de construction que parce
qu’il y a toujours déjà une différance, un espacement inobjectivable, un écart
irréductible qui échappe à toute appréhension positive (sous la forme d’une « relation »
par exemple) et donc constructive, et qui pour cela même ouvre la possibilité du jeu, de
l’anachronie, de l’événement13. Cet écart irréductible Michel Foucault et Gilles Deleuze
l’ont pensé sous le nom de « dehors »14. Ce dehors ne renvoie pas à l’extériorité du
monde comme l’objet s’oppose au sujet. Le dehors précède et rend possible le partage
même du sujet et de l’objet, les traversant et les creusant de « l’intérieur » : « dehors
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
164
plus lointain que tout monde extérieur, parce qu’il est un dedans plus profond que tout
monde intérieur »15. La part inconstructible de la Terre dirait la persistance du dehors qui
traverse les corps, dehors par lequel ils s’inscrivent toujours déjà dans le mouvement
d’une nature qui les déborde.
27 Le problème du constructivisme consiste à oublier ou même (dans sa version
géoconstructiviste particulièrement) à tenter de verrouiller cette part inconstructible
pour mettre l’accent sur la seule dimension opératoire (et donc maîtrisable, positive,
objectivable) de la construction comme de la déconstruction. Or, si Derrida nous dit
qu’il ne peut y avoir de déconstruction comme de construction que depuis l’espacement
de la différance, c’est qu’elle seule permet la suspension d’un mode opératoire de
penser et d’agir, elle seule permet la suspension d’un mode de domination. Ce qui
s’indique sous les noms de différance, de dehors ou de part inconstructible, c’est la
possibilité de l’événement. Ce n’est que depuis l’écart que de l’événement peut survenir
et provoquer la suspension de l’ordre institué. Penser depuis la possibilité de
l’événement, cela veut dire ne pas chercher à déterminer toutes les conditions d’une
existence, d’une manière de vivre ou de penser, comme s’il s’agissait simplement de
mettre en lumière des modes opératoires pour pouvoir ensuite les modifier, mais à
accueillir la persistance d’un écart qui ouvre la possibilité d’une rencontre et d’une
transformation. Il n’y a donc d’émancipation possible que depuis un écart. Toute
émancipation s’ouvre depuis un événement, depuis l’irruption d’une force, d’une
puissance qui, du dehors, vient mettre en crise les conditions de possibilité pré-
données pour ouvrir de nouveaux possibles. La part inconstructible de la Terre, ce
serait cet écart, cette inadéquation qui fait de ce corps cosmique un corps habitable, un
corps capable d’accueillir d’autres corps, un corps hospitalier 16. Cet écart, je lui donne
le nom de « naturer »17 pour mettre l’accent non plus sur la nature comme ordre pré-
donné mais sur le mouvement d’émergence et de co-advenue des corps. Laisser vivre la
part inconstructible de la Terre, c’est laisser vivre cette puissance inobjectivable qui se
déploie à travers la multiplicité des corps qui habitent la Terre, laisser vivre cette
puissance de génération et de régénération commune à tous les existants et que l’on
appelle traditionnellement la « vie ». La part inconstructible de la Terre ne dit pas un
refuge ou un retrait, mais ce à partir de quoi il est possible de réinventer les conditions
de l’être-avec. L’enjeu d’aujourd’hui est bien de faire barrage politiquement au
posthumanisme tout en repensant le politique depuis la prise en compte d’une
dimension cosmique, c’est-à-dire de repenser les limites et les modes d’articulation du
politique depuis du hors politique. Laisser vivre la part inconstructible de la Terre, ce sera
rendre possible l’invention de techniques de la vie à la fois humaines et non humaines
qui engagent de nouvelles manières d’être-avec prises dans le mouvement persistant
du naturer.
NOTES
1. Notamment les conceptions citoyennistes, marxistes, ou anarchistes, qui prennent toutes sens,
chacune à leur manière, au sein d’une tradition humaniste.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
165
2. Article paru sur le site La Vie des Idées : http://www.laviedesidees.fr/Constructivisme-et-
urgence-environnementale.html.
3. W. HEISENBERG, La Nature dans la physique contemporaine, trad. U. Karvélis et A. E. Leroy,
Gallimard, 1962.
4. G. HOTTOIS, Philosophies des sciences, philosophies des techniques, Odile Jacob, 2004, p. 143.
5. Le modèle de cela est le programme informatique.
6. M. TIBON-CORNILLOT, Les Corps transfigurés, mécanisation du vivant et imaginaire de la biologie, éd. MF
– dehors, 2010.
7. Ce n’est donc pas pur hasard si, à un moment donné, la sociologie de Bruno Latour et sa théorie
du réseau rencontre la théorie du Breakthrough Institute.
8. Ce qui permit de défendre l’égalité naturelle et d’aller contre l’esclavage qui était toléré dans
l’Antiquité.
9. B. JADOT, « L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun à
tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir », in : Quel avenir pour le droit de
l’environnement ? Actes du colloque organisé par le CEDRE et le CIRT, sous la direction de François
OST et Serge GUTWIRTH, Bruxelles : Facultés universitaires Saint Louis, 1996.
10. Et éviter le risque d’extinction.
11. H. ARENDT, L’Impérialisme, Seuil, 1973, p. 599-600.
12. H. ARENDT, ibid.
13. J. DERRIDA, Marges de la philosophie, Éd. de Minuit, 1967.
14. M. FOUCAULT, La Pensée du dehors, Fata Morgana, 2009.
15. G. DELEUZE, Qu’est-ce que la philosophie, p. 59, Éd. de Minuit, 2005.
16. Et non plus une planète à fuir, cf. Hannah ARENDT, prologue de Condition de l’homme moderne.
17. Le concept de « naturer » est développé dans un ouvrage à paraître prochainement aux
éditions Dehors co-écrit avec David gé Bartoli intitulé Le toucher du monde – les techniques du
naturer.
AUTEURS
SOPHIE GOSSELIN
CREΦAC
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 42 | 2017
Vous aimerez peut-être aussi
- Raisons d'être. Le sens à l'épreuve de la science et de la religionD'EverandRaisons d'être. Le sens à l'épreuve de la science et de la religionPas encore d'évaluation
- Saint Augustin: Pasteur, théologien et maître spirituelD'EverandSaint Augustin: Pasteur, théologien et maître spirituelPas encore d'évaluation
- LE SCANDALE ET L'INCOMMENSURABLE: Engendrement et assujettissement par la parole chez Hervé Bouchard, Pierre Perrault et Hector de Saint-Denys GarneauD'EverandLE SCANDALE ET L'INCOMMENSURABLE: Engendrement et assujettissement par la parole chez Hervé Bouchard, Pierre Perrault et Hector de Saint-Denys GarneauPas encore d'évaluation
- Réinventer les rituels: Célébrer sa vie intérieure par l'écritureD'EverandRéinventer les rituels: Célébrer sa vie intérieure par l'écriturePas encore d'évaluation
- L' ESPRIT EST SON PROPRE MÉDECIN: Le pouvoir de guérison de la méditationD'EverandL' ESPRIT EST SON PROPRE MÉDECIN: Le pouvoir de guérison de la méditationPas encore d'évaluation
- Transfert: Exploration d’un champ conceptuelD'EverandTransfert: Exploration d’un champ conceptuelPascal GinPas encore d'évaluation
- Créativités autochtones actuelles au Québec: Arts visuels et performatifs, musique, vidéoD'EverandCréativités autochtones actuelles au Québec: Arts visuels et performatifs, musique, vidéoPas encore d'évaluation
- A l'heure des synchronicités: Psyché quantique & Expérience perceptive directeD'EverandA l'heure des synchronicités: Psyché quantique & Expérience perceptive directePas encore d'évaluation
- La notion de Souffle-Energie à travers la Pensée ChinoiseD'EverandLa notion de Souffle-Energie à travers la Pensée ChinoisePas encore d'évaluation
- (Sur Kundera) Pârlea, Vanezia - Milan Kundera Ou LInsoutenable Corporalité de LÊtre (LHarmattan) (2020)Document137 pages(Sur Kundera) Pârlea, Vanezia - Milan Kundera Ou LInsoutenable Corporalité de LÊtre (LHarmattan) (2020)AKILIPas encore d'évaluation
- L'Au-delà et la survivance de l'être: une lecture philosophique, théosophique, et spirite, de la vie après la mortD'EverandL'Au-delà et la survivance de l'être: une lecture philosophique, théosophique, et spirite, de la vie après la mortPas encore d'évaluation
- Ontologie trinitaire: Penser et vivre à la lumière de la TrinitéD'EverandOntologie trinitaire: Penser et vivre à la lumière de la TrinitéPas encore d'évaluation
- Hexis d'un Soir: Ou de la prénotion d'un retour de l'Esprit dans la scienceD'EverandHexis d'un Soir: Ou de la prénotion d'un retour de l'Esprit dans la sciencePas encore d'évaluation
- Habiter le monde au féminin: Entre récits et phénoménologieD'EverandHabiter le monde au féminin: Entre récits et phénoménologiePas encore d'évaluation
- Humain, trop humain de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandHumain, trop humain de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Théorie De L'esprit Unique - L'infini Avant Le CommencementD'EverandThéorie De L'esprit Unique - L'infini Avant Le CommencementPas encore d'évaluation
- Mourir l'âme en paix Plaidoyer pour des choix éclairésD'EverandMourir l'âme en paix Plaidoyer pour des choix éclairésPas encore d'évaluation
- Colloque NietzscheDocument1 pageColloque NietzscheEmmanuel SalanskisPas encore d'évaluation
- Entre les portes: Rêve lucide, projection astrale et corps de Lumière dans l’ésotérisme occidentalD'EverandEntre les portes: Rêve lucide, projection astrale et corps de Lumière dans l’ésotérisme occidentalPas encore d'évaluation
- Le Gai Savoir de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Gai Savoir de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Nihilime Jean-Luc NancyDocument21 pagesNihilime Jean-Luc NancyJosé Pablo Alvarado BarrientosPas encore d'évaluation
- Le réveil démocratique (Essais): Le cas tunisien du printemps arabeD'EverandLe réveil démocratique (Essais): Le cas tunisien du printemps arabePas encore d'évaluation
- Phénoménologie de La Vie, Volume 1 de La Phénoménologie by Michel HenryDocument217 pagesPhénoménologie de La Vie, Volume 1 de La Phénoménologie by Michel Henrywaga7100% (1)
- Revue théologique des Bernardins - Tome 30: La traceD'EverandRevue théologique des Bernardins - Tome 30: La tracePas encore d'évaluation
- N Fernand-Couturier 6Document312 pagesN Fernand-Couturier 6Jordy Arnold NiatyPas encore d'évaluation
- Essai D'autobiographie Spirituelle - Nicolas Berdiaev - Berdi Aev, Nikolaĭ, 1874-1948 - 1958 - (Paris) - Buchet - Chastel Corrêa - Anna's ArchiveDocument436 pagesEssai D'autobiographie Spirituelle - Nicolas Berdiaev - Berdi Aev, Nikolaĭ, 1874-1948 - 1958 - (Paris) - Buchet - Chastel Corrêa - Anna's ArchiveJamie PoultonPas encore d'évaluation
- L' ARCHIVE PARADOXALE: Penser l’existence avec le roman francophone subsaharienD'EverandL' ARCHIVE PARADOXALE: Penser l’existence avec le roman francophone subsaharienPas encore d'évaluation
- Basarab Nicolescu, Lima de Freitas Et Le Grand Jeu de La TransdisciplinaritéDocument9 pagesBasarab Nicolescu, Lima de Freitas Et Le Grand Jeu de La TransdisciplinaritéBasarab NicolescuPas encore d'évaluation
- Althusser et Spinoza : Détours et retours: Avec trois textes inédits de Louis Althusser sur SpinozaD'EverandAlthusser et Spinoza : Détours et retours: Avec trois textes inédits de Louis Althusser sur SpinozaPas encore d'évaluation
- Confiance dans l'azur: Essai sur la convergence des découvertes scientifiques et de la Bonne Nouvelle depuis 2000 ansD'EverandConfiance dans l'azur: Essai sur la convergence des découvertes scientifiques et de la Bonne Nouvelle depuis 2000 ansPas encore d'évaluation
- Science et spiritualité, l'alliance nécessaire!: de A à ZD'EverandScience et spiritualité, l'alliance nécessaire!: de A à ZPas encore d'évaluation
- De la tyrannie et Correspondance, Leo Strauss et Alexandre Kojève: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandDe la tyrannie et Correspondance, Leo Strauss et Alexandre Kojève: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- André Tosel - Spinoza Ou L'autre (In) Finitude (2009, L'Harmattan) PDFDocument285 pagesAndré Tosel - Spinoza Ou L'autre (In) Finitude (2009, L'Harmattan) PDFEser KömürcüPas encore d'évaluation
- Pratiques du présent: Le récit français contemporain et la construction narrative du tempsD'EverandPratiques du présent: Le récit français contemporain et la construction narrative du tempsPas encore d'évaluation
- Généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandGénéalogie de la morale de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- religions et cultures, ressources pour imaginer le mondeD'Everandreligions et cultures, ressources pour imaginer le mondePas encore d'évaluation
- Ziller, Carlos (1995) - L'Harmonie Du Monde Au XVIIe SiecleDocument321 pagesZiller, Carlos (1995) - L'Harmonie Du Monde Au XVIIe SiecleLucas Santos100% (1)
- Léopold Sédar Senghor: L'art africain comme philosophieD'EverandLéopold Sédar Senghor: L'art africain comme philosophiePas encore d'évaluation
- Juan-Manuel Garrido, Jean-Luc Nancy-Chances de La Pensée-Editions Galilée (2011)Document121 pagesJuan-Manuel Garrido, Jean-Luc Nancy-Chances de La Pensée-Editions Galilée (2011)meacuerdoPas encore d'évaluation
- Expérience du temps et historiographie au XXe siècle: Michel de Certeau, François Furet et Fernand DumontD'EverandExpérience du temps et historiographie au XXe siècle: Michel de Certeau, François Furet et Fernand DumontPas encore d'évaluation
- Basarab Nicolescu, Hommage À Jean-François MalherbeDocument8 pagesBasarab Nicolescu, Hommage À Jean-François MalherbeBasarab NicolescuPas encore d'évaluation
- La vérité sur le bonheur: Déjà des milliers de lecteurs convaincus !D'EverandLa vérité sur le bonheur: Déjà des milliers de lecteurs convaincus !Pas encore d'évaluation
- La Structure sémantique: Le lexème coeur dans l'oeuvre de Jean EudesD'EverandLa Structure sémantique: Le lexème coeur dans l'oeuvre de Jean EudesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Devoir Prof - ChedletDocument10 pagesDevoir Prof - Chedletcherilus PetesonPas encore d'évaluation
- Noýj Noýj Noýj Noýj: Noýj Noýj Noýj NoýjDocument14 pagesNoýj Noýj Noýj Noýj: Noýj Noýj Noýj NoýjAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Livre1 2004Document160 pagesLivre1 2004Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- La Philosophie Africaine Comme Devoir-ÊtreDocument4 pagesLa Philosophie Africaine Comme Devoir-ÊtreAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Leportique 1381Document13 pagesLeportique 1381Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Pphs 2 DibiDocument26 pagesPphs 2 DibiAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Actes de La Conférence Scientifique Internationale: 13 - 15 Mars 2019 Hôtel Azalaï, Cotonou, BéninDocument546 pagesActes de La Conférence Scientifique Internationale: 13 - 15 Mars 2019 Hôtel Azalaï, Cotonou, BéninAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Echanges N7 V1Document335 pagesEchanges N7 V1Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Respeth 52 DiaDocument26 pagesRespeth 52 DiaAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Intervenants Du 4 Mai 2018 - Audios 1Document2 pagesIntervenants Du 4 Mai 2018 - Audios 1Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Echanges N7 V1Document335 pagesEchanges N7 V1Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Li 010 Metatexte V1Document9 pagesLi 010 Metatexte V1Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Le Rythme Une Des Formes Concretes Du TempsDocument10 pagesLe Rythme Une Des Formes Concretes Du TempsAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- PDFDocument20 pagesPDFamadou dialloPas encore d'évaluation
- Actes de La Conférence Scientifique Internationale: 13 - 15 Mars 2019 Hôtel Azalaï, Cotonou, BéninDocument546 pagesActes de La Conférence Scientifique Internationale: 13 - 15 Mars 2019 Hôtel Azalaï, Cotonou, BéninAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- DETTODocument13 pagesDETTOAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Le Corps Jean Luc-Nancy PDFDocument8 pagesLe Corps Jean Luc-Nancy PDFBernardo BejaPas encore d'évaluation
- Sexe Et Existence: Sexistence, Ou Encore, Sexe Et Langage Au Seuil de L'intouchableDocument9 pagesSexe Et Existence: Sexistence, Ou Encore, Sexe Et Langage Au Seuil de L'intouchableAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Jean-Luc NancyDocument4 pagesJean-Luc NancyscribdPas encore d'évaluation
- Trois Manières de Toucher La Chose: Nancy, Cixous, Derrida: Che Cos'è La Pittura ?Document32 pagesTrois Manières de Toucher La Chose: Nancy, Cixous, Derrida: Che Cos'è La Pittura ?Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Elfe 11 AppelDocument5 pagesElfe 11 AppelAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Deus Ex Machina Dominique Collin Revue ÉtudesDocument2 pagesDeus Ex Machina Dominique Collin Revue ÉtudesAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Programme de La 2e Session Du Colloque Les Habits Neufs de La Vie Septembre 2021Document12 pagesProgramme de La 2e Session Du Colloque Les Habits Neufs de La Vie Septembre 2021Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Proteus03 4Document10 pagesProteus03 4Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- 6MEI No 21MEI-21Document18 pages6MEI No 21MEI-21Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- PROG ENJEUX 13 Mars Version WEB-1Document32 pagesPROG ENJEUX 13 Mars Version WEB-1Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- APRES LA TERREUR-introduction-Leaves1Document10 pagesAPRES LA TERREUR-introduction-Leaves1Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- La Foi Rencontre de Dieu Et Engagement Envers Dieu Selon L Ancien TestamentDocument15 pagesLa Foi Rencontre de Dieu Et Engagement Envers Dieu Selon L Ancien TestamentAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- L Univers Rival de L Homme DieuDocument13 pagesL Univers Rival de L Homme DieuAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Le Bateau Imaginaire . Imaginaire Et Mémoire Dans La Transformation Sociale Et PolitiqueDocument32 pagesLe Bateau Imaginaire . Imaginaire Et Mémoire Dans La Transformation Sociale Et PolitiqueAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Spinoza Et La Méthode Générale de M. Gueroult - DeleuzeDocument13 pagesSpinoza Et La Méthode Générale de M. Gueroult - DeleuzedekknPas encore d'évaluation
- Rendiconti Del Circolo Matematico Di PalermoDocument85 pagesRendiconti Del Circolo Matematico Di PalermoGeorgePas encore d'évaluation
- La Grande Priere Majeure de Belkis Et de Salomon PDF - PDF - Infini - Métaphysique - 1638456880353Document5 pagesLa Grande Priere Majeure de Belkis Et de Salomon PDF - PDF - Infini - Métaphysique - 1638456880353CissePas encore d'évaluation
- Huit - La Philosophie de La NatureDocument593 pagesHuit - La Philosophie de La NatureMarco PogacnikPas encore d'évaluation
- Book 1131754772Document5 pagesBook 1131754772SOUMAGNINA DORONGSOU LévyPas encore d'évaluation
- Durabilité Et Anthropologie ÉconomiqueDocument6 pagesDurabilité Et Anthropologie ÉconomiquebigbendbomPas encore d'évaluation
- Buathier Abbé - Le SacrificeDocument197 pagesBuathier Abbé - Le Sacrificepiafou630% (1)
- Escalier Des SagesDocument29 pagesEscalier Des SagesEmm Tsai100% (2)
- Introduction Aux Methodes Dapres Lenseignement de Grigori Grabovoi LivreDocument30 pagesIntroduction Aux Methodes Dapres Lenseignement de Grigori Grabovoi LivreEdwige Sebeck100% (1)
- Steiner Rudolf - La Quatrième Dimension Mathématique Et Réalité PDFDocument326 pagesSteiner Rudolf - La Quatrième Dimension Mathématique Et Réalité PDFjean-loïc100% (2)
- Dumoulié - Esthétique de Lexcès Et Excès de LesthétiqueDocument12 pagesDumoulié - Esthétique de Lexcès Et Excès de LesthétiquekspcautePas encore d'évaluation
- Considération KabbalistiqueDocument165 pagesConsidération KabbalistiqueMarcel PirardPas encore d'évaluation
- La Mort Et La RésurrectionDocument30 pagesLa Mort Et La RésurrectionGilbert100% (2)
- En Quoi Le Mal Nous Rend Plus Humain ?Document360 pagesEn Quoi Le Mal Nous Rend Plus Humain ?Christine MarsanPas encore d'évaluation
- Exposé SoutenanceDocument11 pagesExposé Soutenancelorena souyrisPas encore d'évaluation
- Remarques Sur La Commande Basée Sur La Fonction de Lyapunov Et Avec Des Contraintes de SortieDocument5 pagesRemarques Sur La Commande Basée Sur La Fonction de Lyapunov Et Avec Des Contraintes de SortieLiva RAFANOTSIMIVAPas encore d'évaluation
- Grecs 4 ElementsDocument7 pagesGrecs 4 ElementsJean-Loïc BauchetPas encore d'évaluation
- LIVRE II, Chant 1 - L'escalier Du Monde - Savitri en FrançaisDocument10 pagesLIVRE II, Chant 1 - L'escalier Du Monde - Savitri en FrançaisRoland KagboPas encore d'évaluation
- Dom Guillerand Silence CartusienDocument44 pagesDom Guillerand Silence CartusienΦΧΦΠ100% (1)
- La Vie Divine 2 PDFDocument447 pagesLa Vie Divine 2 PDFD'Jeepy Orgyen DorgePas encore d'évaluation
- Les Differents PlansDocument9 pagesLes Differents PlansJean-Loïc BauchetPas encore d'évaluation
- La Doctrine Secrete de La Deesse Tripura PDFDocument166 pagesLa Doctrine Secrete de La Deesse Tripura PDFtchouang_zu100% (5)
- Astrologie Initiatique Et Pratique Kléa Z LibraryDocument1 032 pagesAstrologie Initiatique Et Pratique Kléa Z LibraryemilegoungoungaPas encore d'évaluation
- 0 File52dca594384c6 PDFDocument28 pages0 File52dca594384c6 PDFherve kangaPas encore d'évaluation
- Delbos, Le Spinozisme, 1913Document234 pagesDelbos, Le Spinozisme, 1913hugomaxEPS100% (1)
- Fiche de Lecture (P. Duhem)Document2 pagesFiche de Lecture (P. Duhem)Dano LauynayPas encore d'évaluation
- Point Et Ligne Sur PlanDocument36 pagesPoint Et Ligne Sur PlanCAROLINEGRIMPREL75% (4)
- Axiomatique - Greg EganDocument394 pagesAxiomatique - Greg EganRimaldoPas encore d'évaluation
- Anatomie Comparée Des Anges-français-Gustav Theodor FechnerDocument20 pagesAnatomie Comparée Des Anges-français-Gustav Theodor Fechnergabriel brias buendiaPas encore d'évaluation
- Finance de Marché Modele Mathématiques A Temps DiscretDocument40 pagesFinance de Marché Modele Mathématiques A Temps DiscretAyoub Bamo75% (4)