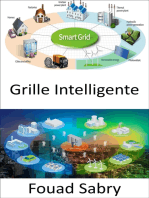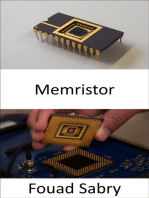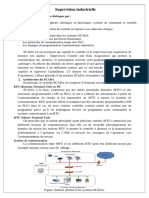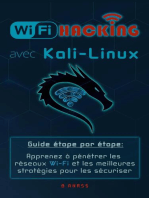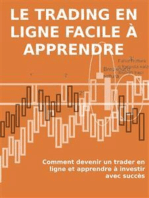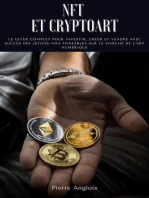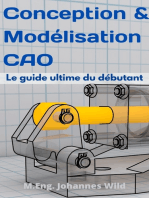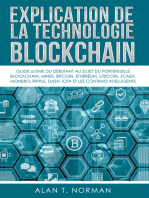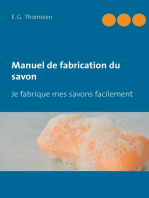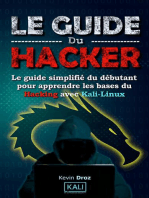Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Automatismes Et Reseaux Industriels 2022 Bac2 RT
Transféré par
Junior NgongoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Automatismes Et Reseaux Industriels 2022 Bac2 RT
Transféré par
Junior NgongoDroits d'auteur :
Formats disponibles
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI
COURS D’AUTOMATISME ET
RESEAUX INDUSTRIELS
(BAC2 RT)
PAR MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE DJAMBA
JANVIER 2O22
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
DESCRIPTIF DU COURS D’AUTOMATISME ET RESEAUX
INDUSTRIELS BAC 2 RT
FACULTE : SCIENCES INFORMATIQUES
PROMOTION : BAC2 RT
INTITULE : AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS
VOLUME : 3 CREDITS
TITULAIRE : CT TUNDA-OLEMBE DJAMBA
I. PRE-REQUIS
RESEAUX INFORMATIQUES, ARCHITECTURE DES MICROPROCESSEUR ET
ELECTRONIQUE
II. LIMINAIRE
L’environnement de l’ingénieur informaticien travaillant dans les
installations industrielles de production (Mining, Brasserie, Eau minérale, Savonnerie,
Limonadière, etc.) est très varié. Actuellement, presque tous les équipements de
production industrielle sont contrôlés et commandés par ordinateurs industriels. Une des
préoccupations primordiales des entreprises industrielles est le bon fonctionnement des
automatismes (ordinateurs industriels) et des réseaux industriels. C’ est pourquoi le but
principal du cours d’automatisme et réseaux industriels est de permettre aux étudiants de
cerner les bases fondamentales nécessaires à la compréhension de la structure et du
fonctionnement des systèmes automatisés contrôlés et commandés par des ordinateurs
industriels et des réseaux industriels. A cela, il faut un but secondaire d’initier les étudiants
à l’ Internet industriel et à l’ Ethernet industriel.
Le cours d’automatisme et réseaux industriels appartient au domaine de
l’informatique industrielle. L’informatique industrielle couvre l’ensemble de la technique
conception, d’analyse, de programmation et de mise en œuvre des systèmes informatiques
à vocation industrielle. Les applications de l’informatique industrielle sont multiples : les
systèmes embarques sont utilisés dans les appareils électroniques et électriques, les
avions, les automobiles, les avions, les locomotives et les portables ; les automates
programmables industriels, les systèmes numériques de commande, la supervision des
réseaux des automates et l’Internet industriel sont utilisés dans les systèmes de production
industrielle ; ....
III. OBJECTIFS DU COURS
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
a) Objectifs généraux :
1. L’étudiant doit comprendre et maitriser les concepts et la terminologie en
automatisme et en réseaux industriels ;
2. L’étudiant doit comprendre la structure et la modélisation ses systèmes automatisés
linéaires et logiques ;
3. L’étudiant doit comprendre la structure et le fonctionnement des automates
programmable industriel ;
4. L’étudiant doit comprendre la structure et le fonctionnement des réseaux des locaux
industriels et l’Internet industriel.
5. L’étudiant doit comprendre la structure et le fonctionnement des systèmes
d’information industriels.
6. L’étudiant doit comprendre et maitriser les aspects matériels et logiciels de
l’informatique dans le contexte d’applications à usage industriel, afin de lui permettre
de concevoir, et de mettre en œuvre les automatismes, les réseaux industriels et
système d’information industriel .
b) Objectifs spécifiques :
1. L’étudiant doit être capable d’analyser et de modéliser les systèmes automatisés
linéaires et logiques ;
2. L’étudiant doit être capable de sélectionner et de mettre œuvre un automate
programmable industriel ;
3. L’étudiant doit capable de concevoir, de mettre en œuvre, d’exploiter et d’ améliorer
les automatismes ; les réseaux industriels et système d’information industriel ;
L’étudiant doit capable de concevoir, de mettre en œuvre, d’exploiter et d’ améliorer
les automatismes ; les réseaux industriels et système d’information industriel ;
4. L’étudiant doit être capable d’analyser et d’ exploiter un système automatisé de
production industrielle contrôlé et commandé par les ordinateurs industriels; et
5. L’étudiant doit être capable d’analyse un système d’ information industriel .
IV.METHODE DE COMMUNICATION
1. Cours théorique orienté vers la pratique ;
2. Travaux et discussions en groupe ;
3. Organisation TD et TP ;
4. Autoformation.
5. Lecture du support du cours
V. METHODE D’EVALUATION
1. Travaux dirigés et pratiques ;
2. Interrogations ; et
3. Examen
VI. PLAN DU COURS
- Chapitre 1 : Introduction à l’informatique industrielle (Introduction aux automatismes et
aux réseaux industriels );
- Chapitre 2 : Automatique et automatisme ;
3
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
- Chapitre 3 : Les Automates programmable industriels
- Chapitre 4 : Les réseaux industriels, l’Ethernet industriels et l’Internet industriel
VII. BIBLIOGRAPHIE
1. BARTHELEMY F. : cours sur les automates , Département informatique,
CNAM/ France, Année 2015.
2. NOUVEL DAMIEN : cours d’introduction aux automates , Département informatique ,
Université François Rabelais, TOURS / France, Année 2015.
3. BERGOUGNOUX L. : cours sur les automates programmables industriels , POLYTECH
Marseille, année 2014.
4. LONGEOT ET AL. : Automatique industrielle, Edition DUNOD , Paris, 2006.
CHAP.1 : INTRODUCTION A L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
(AUTOMATISMES ET RESEAUX INDUSTRIELS )
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.1 INTRODUCTION A L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
I.1.1 PRESENTATION DE L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
I.1.1.1 DEFINITION
L’informatique Industrielle étudie les systèmes informatiques et informatisés avec
lesquels l'homme coopère, destinés à la perception, l'observation, l'aide à la
décision, la conduite et la commande de systèmes dynamiques et des systèmes de
production industrielle. Dans ce cadre, l’informatique industrielle a comme champs
d'investigation tous les sujets ou domaines qui relèvent traditionnellement de
l'Automatique et de l’ingénierie des systèmes informations et établit des concepts,
spécifie des modèles, élabore des méthodes, développe des outils en vue de la
conception , de la réalisation et de’ l’exploitation des systèmes commandés et
contrôlés par des ordinateurs.
I.1.1.2 APPLICATIONS DE L’INFORMATIQUE
a) Généralités sur les applications
La variété des mises en œuvre matérielles et logicielles est immense : automate
programmable pour les systèmes de production, carte à microprocesseur pour des
applications industrielles ou liées à la domotique, systèmes de supervision pouvant
traiter en temps réel les informations issues d'un grand nombre de capteurs et
assurer la commande de multiples actionneurs (centrales de production d’électricité,
systèmes industriels continus, contrôle de trafic aérien ou ferroviaire), robots
industriels et autonomes, applications embarquées pour l’automobile ou l’avionique,
etc.
Optimiser la chaîne de production
Dans les ateliers de production industrielle, les automates règnent en maîtres. Ces
différentes machines sont pilotées par des ordinateurs qui leur permettent de
dialoguer et de fonctionner. C'est ce qu'on appelle l'informatique industrielle. Elle est
omniprésente depuis la conception des produits jusqu'à leur livraison, en passant par
leur fabrication. Le rôle de l'informaticien industriel : optimiser le déroulement du
processus de production afin d'améliorer la productivité de l'entreprise.
b) Informatiser des ateliers
L'informaticien industriel conçoit l'architecture matérielle des ateliers automatisés,
décidant que tel ordinateur commandera tel bras de robot ou que tel autre pilotera le
chariot qui permet de transporter des pièces. Il assure la partie logicielle, en adaptant
des modules standard ou en créant des logiciels spécifiques. C'est aussi lui qui crée
un programme fixant le planning de production de l'atelier. Son périmètre d'activité
peut toucher à la CAO (conception assistée par ordinateur), à la FAO (fabrication
assistée par ordinateur) et à la GPAO (gestion de production assistée par
ordinateur)...
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
c) Anticiper les évolutions technologiques
L'informaticien industriel doit parallèlement veiller au fonctionnement au jour le jour,
et prévoir l'évolution du système. Il améliore et fiabilise les équipements existants en
modifiant des programmes et en intégrant de nouveaux matériels.
I.2 INTRODUCTION A L’AUTOMATIQUE ET AUX AUTOMATISMES
I.2.1 GENERALITES SUR L’AUTOMATIQUE ET LES AUTOMATISMES
I.2.1.1 DEFINITIONS DE L’AUTOMATIQUE ET EXEMPLES
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
10
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.2.1.2 CLASSIFICATIONS DES SYSTEMES AUTOMATISES
11
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
12
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
13
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.2.1.4 INTRODUCTION AUX SYSTEMES AUTOMATISES DE
PRODUCTION
14
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.2.1.5 DESCRIPTION DES PARTIES D’UN SYSTEME AUTOMATISE
SEQUENTIEL
1. LA PARTIE OPERATIVE
2. PARTIE COMMANDE
3. PARTIE RELATION (OU IHM : INTERFACE HOMME MACHINE)
15
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.2.1.6 EXEMPLES DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISE
SEQUENTIEL
16
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.2.2 INTRODUCTION A LA ROBOTIQUE
17
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
18
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
19
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
20
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.2.3 INTRODUCTION AUX AUTOMATES PROGRAMMABLES
INDUSTRIELS
21
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
22
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
23
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
24
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
25
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
26
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
27
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
28
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
29
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.3 INTRODUCTION AUX RÉSEAUX LOCAUX INDUSTRIELS
3.1. Généralités sur les réseaux locaux industriels (RLI)
Une définition simple d’un réseau industriel pourrait être : Réseau de
communication numérique reliant entre eux différents types d’équipements
d’automatisme.
Il est important de signaler que l’utilisation des RLI n’est pas limitée aux seules
entreprises industrielles. On pourra retrouver des RLI dans des produits du
commerce (comme dans des véhicules automobiles) ainsi que dans des
immeubles automatisés (hôpitaux, sièges sociaux de grandes entreprises…)
Historiquement, le but initial de ces RLI était le remplacement, dans le cadre
de certaines applications, des boucles de courant 4-20mA (voir figure 2.1).
EXEMPLE D’ARCHITECTURE D’AUTOMATIQUE UTILISANT UNE BOUCLE DE COMMANDE 4-20 mA
Nœud de commande/contrôle
centralisé
Moteur Variateur Capteur Ampèremètre Voltmètre
Figure 1.1 : exemple d’architecture basée sur les boucles de commande
4-20mA
Cette architecture centralisée, apparue dans les années 60, pouvait se révéler
coûteuse et complexe à déployer lorsque le nombre et les fonctionnalités des
équipements reliés augmentaient. Le rajout d’un équipement obligeait une
reprogrammation complète de celle-ci. Le coût et la complexité du câblage
30
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
point à point limitaient son extension et sa souplesse, surtout lorsque la
distance entre les équipements augmentait.
En 1970 apparurent les premiers liens réseaux entre les nœuds de
commande/contrôle et les postes opérateurs (WDPF : Westinghouse
Distributed Processing Family). Ces liens permettaient aux opérateurs de
commander et de contrôler plusieurs architectures d’automatique à partir d’un
seul terminal. Ces réseaux pouvaient ainsi permettre d’augmenter la
productivité des opérateurs, mais ne permettaient pas de résoudre les
problématiques précédemment citées liées à l’utilisation des boucles de
commande.
L’émergence des Réseaux Locaux Industriels eut lieu dans les années 80.
Ces réseaux permirent d’améliorer l’évolutivité de certaines architectures
d’automatique (voir figure 2.2).
EXEMPLE D’ARCHITECTURE D’AUTOMATIQUE UTILISANT UN RESEAU LOCAL INDUSTRIEL
Nœud de commande/contrôle
centralisé
Bus de terrain
Capteur
Moteur Variateur Ampèremètre Voltmètre
Légende : Interfaces Analogique RLI
Câblage analogique
Câblage et équipements
d’interconnexion RLI
Figure 1.2 : exemple simplifié d’architecture basée sur un réseau local
industriel
31
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
La diminution du câblage et de sa complexité est sensible, chaque
équipement est relié à l’interface analogique RLI par un seul câble via
lequel circule les différents types de trafic.
L’évolution des Réseaux Locaux Industriels permet aujourd’hui le rajout ou le
retrait d’un équipement sans reprogrammation complète de l’architecture,
chacun pouvant être traité comme un objet, présent ou non sur le réseau.
Depuis plusieurs années, la tendance est à une collaboration entre les RLI et
les autres des entreprises. Cette coopération permet la mise à la disposition
des utilisateurs de données d’exploitation, via par exemple un navigateur
Web, pour augmenter leur productivité. Outre cette cohabitation entre les RLI
et les réseaux « orientés bureautique », le besoin d’un RLI capable de
supporter des équipements hétérogènes est aujourd’hui clairement exprimé.
Le terme de Réseaux Locaux Industriels (RLI) regroupe plus d’une
cinquantaine de spécifications de réseaux différentes qu’il serait possible de
classer en trois grandes familles, qui correspondent chacune à des besoins
différents. Parmi les critères de classification, nous distinguerons les fonctions
à réaliser, le type des données à transmettre et le type de contrainte
temporelle.
3.2. La prépondérance du profil « temps-réel » dans les RLI
La notion de profil temps-réel est inhabituelle dans la plupart des réseaux (hors contexte
multimédia), excepté dans les RLI. Les réseaux Ethernet – TCP/IP, par exemple, proposent
(optionnellement) des mécanismes de contrôle de flux, de contrôle d’erreur… Mais pas de
gestion du temps (et ce, malgré les nouveaux protocoles à gestion de priorité).
Le rôle d’un RLI est de faire communiquer entre eux divers équipements en fournissant des
services contraints par le temps (réseaux et systèmes « temps-réel »).
Les systèmes temps-réel nécessitent, en plus du contrôle de la validité des informations, le
contrôle de la validité de la date d’application de ces informations. Les applications temps-
réel pourront être classées en trois catégories selon la criticité de cette contrainte [Blu00] :
- Les systèmes temps-réel à contrainte stricte : le non-respect d’un
échéance ne peut pas être toléré ;
- Les systèmes temps-réel à contrainte relative : ils peuvent, par opposition,
tolérer certains dépassements des échéances ;
- Les systèmes temps-réel à contrainte mixte : certaines contraintes seront
fixes, d’autres relatives.
32
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
Prenons l’exemple du réseau d’entreprise schématisé ci-dessous (figure 2.3) :
EXEMPLE SIMPLIFIE DE RLI INTEGRE AU RESEAU LOCAL DE L’ENTREPRISE
Routeur
Serveurs et LAN WAN
stations de travail Réseau global,
Internet…
Réseau local
Nœuds de commande / contrôle Passerelle ou
routeur RLI LAN
RLI
Interfaces
numérique RLI
Capteurs et actionneurs
Moteur Variateur
Figure 2.3 : exemple simplifié d’architecture réseau d’une entreprise industrielle.
3.3. Classification des différentes spécifications de RLI
3.3.1 La pyramide CIM
Les automaticiens ont défini un modèle d’architecture permettant l’intégration des RLI dans
un réseau d’entreprise : la pyramide CIM (Computer Integrated Manufacturing).
Cette pyramide (figure 2.4) nous permet de simplifier le classement des spécifications de
RLI en déterminant quel est le type de rapport débit/temps dont l’application a besoin en
fonction du type d’équipements mis en oeuvre.
33
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
PYRAMIDE CIM
Réseau Ethernet – TCP/IP
QUANTITE DE DONNEES
TEMPS DE TRANSMISSION
Gigaoctets
Internet Environnement réseau par minute
global
STATION
PC SERVEUR DE TRAVAIL Megaoctets
par minute
Réseau Ethernet – TCP/IP
Environnement bureautique
Kilooctets
PONT par minute
Réseau Ethernet – TCP/IP
Ou MAP
Environnement industriel
PASSERELLE octets
par seconde
PC ROBOT ROBOT Fieldbus, Profibus, FIP, …
Environnement de la cellule
Quelques octets
par milliseconde
CONTROLEURS Bus capteurs / actionneurs
LOGIQUE PROGRAMMABLE CAN, Interbus-S, Sercos, …
Environnement machine
bits
par microseconde
ENTREES/SORTIES
(CAPTEURS ET ACTIONNEURS)
NOMBRE DE NOEUDS
Figure 2.4 : La pyramide CIM (Computer Integrated Manufacturing).
Cette pyramide nous permet de mieux comprendre quelles seront les contraintes des
différents RLI, en fonction des différents types d’équipements d’automatisme qui doivent
communiquer entre eux et donc de la nature des coopérations et des données échangées.
Nous pourrons aussi en déduire les contraintes temporelles liées aux différents types de
flux.
Elle nous permet aussi de mettre en évidence le manque d’homogénéité des RLI : Il
n’existe pas, contrairement à ce qui existe dans les réseaux à vocation « bureautique », de
spécification capable de rendre les services attendus par tous les niveaux de l’architecture.
Les passerelles et les ponts qui permettront aux différents réseaux de communiquer entre
eux devront être spécifiquement adaptés aux différentes spécifications retenues dans le
cadre des applications industrielles de l’entreprise ou du « produit » concerné. Il en
résultera des difficultés d’évolution des architectures (protocoles pouvant être incompatibles
entre eux).
µ
34
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
3.3.2 Classification en terme de fonction à réaliser
Un moyen de déterminer la famille de spécifications de RLI qui est la mieux adaptée à son
besoin est de définir quelle sera la fonction de ce réseau :
- doit-il relier entre eux des équipements simples tel que des capteurs et des
actionneurs?
- doit-il relier entre eux des capteurs, des actionneurs, des nœuds de
contrôle/commande, dans une architecture d’automatique complète ?
- doit-il permettre des relier entre elles plusieurs architectures d’automatique
(cellules) dans le cadre d’une chaîne de fabrication industrielle?
CLASSIFICATION EN TERME DE FONCTION A REALISER
Fonctions associées
Réseau de terrain
Pilotage de processus
(Fieldbus)
Bus d’équipements
(Devicebus)
Pilotage de machines
Bus de capteurs / actionneurs
(Sensorbus)
Equipements reliés
Simples Complexes
Figure 2.5 : Les trois grandes familles fonctionnelles de RLI.
Les trois principales familles de fonctions à réaliser sont détaillées ci-dessus par la figure
2.5.
35
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
CHAP.II AUTOMATIQUE ET AUTOMATISMES
II.1. AUTOMATIQUE DES SYSTEMES LINEAIRES
II.1.1 INTRODUCTION
II.1.2 NOTIONS DE SYSTEME
1. CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES
36
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
2. DEMARCHE D’ANALYSE DES SYSTEMES LINEAIRES
37
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.1.3 NOTIONS D‘ ASSERVISSEMENTS LINEAIRES ANALOGIQUES
38
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.1.4. Schéma fonctionnel général d’un système d’asservissement
II.1.5 Asservissement et régulation
39
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
I.1.6 Propriétés et performance d’un système asservi
40
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
41
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.1.7 INTRODUCTION AUX SYSTEMES AUTOMATISES NUMERIQUES
(ASSERVISSEMENTS NUMERIQUES OU COMMANDE NUMERIQUE DES
SYSTEMES)
II.1.7.1 GENERALITES
42
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.1.7.2 MISE EN ŒUVRE DES ASSERVISSEMENTS NUMERIQUES
43
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
44
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.1.7.3 NUMERISATION DES SIGNAUX ANALOGIQUES
1. ECHANTILLONNAGE ET QUANTIFICATION
2. BRUIT DE QUANTIFICATION
45
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
3. PROBLEME D’ECHANTILLONNAGE
46
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.1.7.4 TECHNOLOGIE DES ASSERSSIMENTS NUMERIQUES
47
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.1.8 MODELISATION DES SYSTEMES LINEAIRES ANALOGIQUES
48
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
49
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.1.9 ANALYSE DES SYSTEMES LINEAIRES ANALOGIQUES
50
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
51
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
52
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
53
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
54
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
55
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
56
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
57
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
58
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
59
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.2 AUTOMATISMES (O SYSTEMES AUTOMATISES LOGIQUES)
II.2.1 LES FAMILLES ET LES CONSTITUANTS D’AUTOMATISMES
II.2.2 FONCTIONS TRAITEMENTS DE DONNEES
60
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.2.3 EXEMPLE DE LA LOGIQUE CABLEE
61
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
62
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.3.3 ELEMENTS DE LA LOGIQUE CABLEE ET DE LA LOGIQUE
PROGRAMMEE
63
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
64
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
65
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
66
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
67
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
68
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
CHAP.III LES AUTOMATES PROGRAMMABLES INDUSTRIELS
1- Introduction
Les Automates Programmables Industriels (API) sont apparus aux
Etats-Unis vers 1969 où ils répondaient aux désirs des industries de
l’automobile de développer des chaînes de fabrication automatisées
qui pourraient suivre l’évolution des techniques et des modèles
fabriqués.
Un Automate Programmable Industriel (API) est une machine
électronique programmable par un personnel non informaticien et
destiné à piloter en ambiance industrielle et en temps réel des
procédés industriels. Un automate programmable est adaptable à
un maximum d’application, d’un point de vue traitement, composants,
language. C’est pour cela qu’il est de construction modulaire.
Il est en général manipulé par un personnel électromécanicien. Le
développement de l’industrie à entraîner une augmentation constante
des fonctions électroniques présentes dans un automatisme c’est
pour ça que l’API s’est substitué aux armoires à relais en raison de sa
souplesse dans la mise en œuvre, mais aussi parce que dans les
coûts de câblage et de maintenance devenaient trop élevés.
2- Pourquoi l'automatisation ?
L'automatisation permet d'apporter des éléments supplémentaires à
la valeur ajoutée par le système. Ces éléments sont exprimables en
termes d'objectifs par :
Accroître la productivité (rentabilité, compétitivité) du système
Améliorer la flexibilité de production ;
Améliorer la qualité du produit
Adaptation à des contextes particuliers tel que les
environnements hostiles pour l'homme (milieu toxique,
dangeureux.. nucléaire...), adaptation à des tâches physiques
ou intellectuelles pénibles pour l'homme (manipulation de
lourdes charges, tâches répétitives parallélisées...),
Augmenter la sécurité, etc...
69
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
Figure 4.1 : Automate SIEMENS S5-95U
3– Structure générale des API :
Les caractéristiques principales d’un automate programmable
industriel (API) sont :
coffret, rack, baie ou cartes
Compact ou modulaire
Tension d’alimentation
Taille mémoire
Sauvegarde (EPROM, EEPROM, pile, …)
Nombre d’entrées / sorties
Modules complémentaires (analogique,
communication,..)
Langage de programmation
70
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
Figure 4.2 : Aspect extérieur d'un automate S7-200 CPU222
Des API en boîtier étanche sont utilisés pour les ambiances
difficiles (température, poussière, risque de projection ...)
supportant ainsi une large gamme de température, humidité ...
L’environnement industriel se présentent sous trois formes :
environnement physique et mécanique (poussières,
température, humidité, vibrations);
pollution chimique ;
perturbation électrique. (parasites
électromagnétiques)
71
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
Figure 4.3 : Automate Modulaire
4- Structure interne d'un automate programmable industriel (API)
:
Les API comportent quatre principales parties (Figure 4.4) :
Une unité de traitement (un processeur CPU);
Une mémoire ;
Des modules d’entrées-sorties ;
Des interfaces d’entrées-sorties ;
Une alimentation 230 V, 50/60 Hz (AC) - 24 V (DC).
La structure interne d’un automate programmable industriel (API)
est assez voisine de celle d’un système informatique simple, L'unité
centrale est le regroupement du processeur et de la mémoire
centrale. Elle commande l'interprétation et l'exécution des instructions
programme. Les instructions sont effectuées les unes après les
autres, séquencées par une horloge.
Deux types de mémoire cohabitent :
- La mémoire Programme où est stocké le langage de
programmation. Elle est en général figée, c'est à dire en lecture
seulement. (ROM : mémoire morte)
- La mémoire de données utilisable en lecture-écriture pendant le
72
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
fonctionnement c’est la RAM (mémoire vive). Elle fait partie du
système entrées-sorties. Elle fige les valeurs (0 ou 1) présentes sur
les lignes d’entrées, à chaque prise en compte cyclique de celle-ci,
elle mémorise les valeurs calculées à placer sur les sorties.
Figure 4.4 : Structure interne d'un automates programmables
industriels (API)
5- Fonctionnement :
L'automate programmable reçoit les informations relatives à l'état du
système et puis commande les pré-actionneurs suivant le programme
inscrit dans sa mémoire.
Généralement les automates programmables industriels ont un
fonctionnement cyclique (Figure 4.5). Le microprocesseur réalise toutes
les fonctions logiques ET, OU, les fonctions de temporisation, de comptage,
de calcul... Il est connecté aux autres éléments (mémoire et interface E/S)
par des liaisons parallèles appelées ' BUS ' qui véhiculent les informations
sous forme binaire.. Lorsque le fonctionnement est dit synchrone par
rapport aux entrées et aux sorties, le cycle de traitement commence par la
prise en compte des entrées qui sont figées en mémoire pour tout le cycle.
73
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
Figure 4.5 : Fonctionnement cyclique d'un API
6– Description des éléments d'un API :
6.1- La mémoire :
Elle est conçue pour recevoir, gérer, stocker des informations issues des
différents secteurs du système que sont le terminal de programmation (PC
ou console) et le processeur, qui lui gère et exécute le programme. Elle
reçoit également des informations en provenance des capteurs.
Figure 4.7 : La mémoire
Il existe dans les automates deux types de mémoires qui remplissent des
fonctions différentes :
- La mémoire Langage où est stocké le langage de programmation. Elle est
74
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
en général figée, c'est à dire en lecture seulement. (ROM : mémoire morte)
- La mémoire Travail utilisable en lecture-écriture pendant le
fonctionnement c’est la RAM (mémoire vive). Elle s’efface automatiquement
à l’arrêt de l’automate (nécessite une batterie de sauvegarde).
Répartition des zones mémoires :
Table image des entrées
Table image des sorties
Mémoire des bits internes
Mémoire programme d’application
6.2- Le processeur :
Son rôle consiste d’une part à organiser les différentes relations entre la
zone mémoire et les interfaces d’entrées et de sorties et d’a
part à exécuter les instructions du programme.
6.3- Les interfaces et les cartes d’Entrées / Sorties:
L’interface d’entrée comporte des adresses d’entrée. Chaque capteur est
relié à une de ces adresses. L’interface de sortie comporte de la même
façon des adresses de sortie. Chaque préactionneur est relié à une de ces
adresses. Le nombre de ces entrées est sorties varie suivant le type
d’automate. Les cartes d’E/S ont une modularit´e de 8, 16 ou 32 voies. Les
tensions disponibles sont normalisées (24, 48, 110 ou 230V continu ou
alternatif ...).
75
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
Figure 4.8 : Les interfaces d'entrées/sorties
76
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
CHAP.IV LES RESEAUX INDUSTRIELS, L’ ETHERNET
INDUSTRIEL ET L’ INTERNET INDUSTRIEL
IV.1 INTRODUCTION
77
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
Figure 1 NIVEAUX ET CARACTERISTIQUES RESEAUX DES ORGANES D'AUTOMATISMES ET
DE CONTROLE
78
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
79
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
80
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
81
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.2 LE BUS DES CAPTEURS ET DES ACTIONNEURS : NIVEAU 0
IV.2.1 PRESENTATION DU BUS DE CAPTEURS ET ACTIONNEURS (ASI)
Les bus de capteurs et des actionneurs sont connus surtout avec leur
appellation en anglais Actuator Sensor Interface (ASI) :
82
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
Caractéristique du bus ASI :
- Nature d’information échangé : bytes ;
- Débit : quelques bits / seconde ;
- Distance : maximum 100 m ;
- Temps de réaction : 10 –3 secondes ;
- Fabriquant: AS-I; PROFIBUS PA; CAN; SERIPLEX; …..
II.2.2 ARCHITECTURE DU BUS DE CAPTEURS ET ACTIONNEURS (ASI)
83
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.2.2 MISE EN OEUVRE DU BUS DE CAPTEURS ET ACTIONNEURS (ASI)
84
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
85
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.3 BUS ET RESEAUX DE TERRAIN
IV.3.1 BUS DE TERRAIN (FIELDBUS) : Niveau 1
Le bus de terrain ou Fieldbus est un terme générique qui désigne un support de
communication numérique qui remplace progressivement dans l’industrie le concept
de transmission analogique appelé couple 4-20 mA par un bus série numérique
bidirectionnel susceptible de relier les dispositifs indépendants sur terrain tels que les
périphéries d’automatismes (variateur de vitesse, démarreur, robot…), le coupleur
(module entrée-sortie), les capteurs, les actionneurs et les contrôleurs.
Caractéristique du bus terrain :
86
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
- Nature d’information échangé : mots (word) ;
- Débit : quelques octets / seconde ;
- Distance : maximum 1000 m ;
- Temps de réaction : 10 –2 secondes ;
- Fabriquant: FIPIO; PROFIBUS DP; MODBUS ; UNTEL WAY ;….
87
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
88
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
EXEMPLE DU BUS DE TERRAIN : LE PROFIBUS DP DE SIEMENS
II.3.2 RESEAU DE TERRAIN (DEVICE BUS) : Niveau 2
II.3.2.1 DEFINITION DU RESEAU DE TERRAIN (BUS EQUIPEMENT)
IV.3.2.2 CARACTERISTIQUE DU RESEAU DE TERRAIN :
- Nature d’information échangé : messages ;
- Débit : quelques kbits / seconde ;
- Distance : maximum 10000 m ;
- Temps de réaction : 10 –1 secondes ;
89
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
- Fabriquant: FIPWAY; PROFIBUS DP; MODBUS +; …..
IV.3.2.3 ARCHITECTURES CENTRALISEES ET DECENTRALISES DE RESEAU DE
TERRAIN
90
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
91
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
92
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.4 RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS : NIVEAU 3 (SYSTEME NUMERIQUE DE
CONTROLE ET COMMANDE SNCC)
IV.4.1 GENERALITES SUR SNCC
IV.4.3 ARCHITECTURE MATERIELLE SNCC
93
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
NB. SNCC= DCS
94
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.4.3 COMPOSITION DU SNCC
IV.5 RESEAUX D’ ENTREPRISE ET LA PYRAMIDE CIM : NIVEAU 4 (GESTION
ENTREPRISE)
IV.5.1 GENERALITES SUR LA PYRAMIDE CIM
95
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
96
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.5.2 MISE EN ŒUVRE DE LA PYRAMIDE CIM
97
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.5.3 EVOLUTION DE L’ARCHITECTURE DE LA PYRAMIDE CIM
IV.5.3 ARCHITECTURE DE LA PYRAMIDE CIM APLANIE
98
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.6 LE RESEAU DES CAPTEURS SANS FIL ET LE RFID
IV.6.1 LE RESEAU DES CAPTEURS SANS FIL
99
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
100
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
101
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
102
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.6 2 LE RFID
103
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
104
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.7 ETHERNET INDUSTRIEL (ETHERNET EN TEMPS REEL EN
MILIEU INDUSTRIEL)
IV.7.1 PRESENTATION DE L’ETHERNET INDUSTRIEL
105
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
106
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.7.2 LES SERVICES ET PRINCIPAUX CONSORTIUMS
107
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.7.3 ARCHITECTURE DE L’ETHERNET INDUSTRIEL
Légende : Ethernet industriel en jaune et Ethernet standard en
rouge
108
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.8 INTERNET INDUSTRIEL (ETHERNET TCP/IP AVEC ACCES
INTERNET)
IV.8.1 PRESENTATION DE L’INTERNET INDUSTRIEL
IV.8.2 ETHERNET MODBUS TCP ET LES SERVICES
ETHERNET INDUSTRIEL
109
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
110
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
IV.9 DESCRIPTION GENERALE ET EVOLUTION COMMUNICATION
111
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
112
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
II.10 L’IMPACT NTIC ETLE STANDARD OPC
113
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
114
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
FIN
115
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
COURS D’ORGANES D’AUTOMATISME ET RESEAUX INDUSTRIELS BAC2 RT
116
UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI MASTER ING CIVIL TUNDA-OLEMBE
Vous aimerez peut-être aussi
- Grille Intelligente: Échange d'électricité et d'informations entre les maisons et les centrales électriquesD'EverandGrille Intelligente: Échange d'électricité et d'informations entre les maisons et les centrales électriquesPas encore d'évaluation
- Cours API & SupervisionDocument155 pagesCours API & SupervisionMos TachePas encore d'évaluation
- Memristor: Une nouvelle ère d'applications au-delà de la loi de Moore pour l'informatiqueD'EverandMemristor: Une nouvelle ère d'applications au-delà de la loi de Moore pour l'informatiquePas encore d'évaluation
- Chapitre V1Document10 pagesChapitre V1Amir DridiPas encore d'évaluation
- Avion À Propulsion Ionique: Aucune pièce mobile dans le système de propulsionD'EverandAvion À Propulsion Ionique: Aucune pièce mobile dans le système de propulsionPas encore d'évaluation
- Cours Temps Réel Chap2 Arti2 V EtudiantsDocument21 pagesCours Temps Réel Chap2 Arti2 V EtudiantsRãẻd khắtẻrchiPas encore d'évaluation
- Le système d'approvisionnement en terres dans les villes d'Afrique de l'Ouest: L’exemple de BamakoD'EverandLe système d'approvisionnement en terres dans les villes d'Afrique de l'Ouest: L’exemple de BamakoPas encore d'évaluation
- Cours IdentificationDocument78 pagesCours IdentificationSara FarahPas encore d'évaluation
- Chapitre III Les Automates Programmables Industriels 201718Document12 pagesChapitre III Les Automates Programmables Industriels 201718KadiPas encore d'évaluation
- Systéme de ContrôleDocument41 pagesSystéme de Contrôleالشريف يحياويPas encore d'évaluation
- Automate Programmable PDFDocument62 pagesAutomate Programmable PDFElkhalil OunarhiPas encore d'évaluation
- TP Super GSIDocument17 pagesTP Super GSImaliPas encore d'évaluation
- Diagnostic Etude de CasDocument18 pagesDiagnostic Etude de CasMouad MalhiPas encore d'évaluation
- Chiii Système ScadaDocument26 pagesChiii Système Scadahit masterPas encore d'évaluation
- Introduction Automatisme Industriel-1 PDFDocument15 pagesIntroduction Automatisme Industriel-1 PDFTarik JaizPas encore d'évaluation
- Système À Évènements Discrets Système À Évènements Discrets: Faculté de TechnologieDocument107 pagesSystème À Évènements Discrets Système À Évènements Discrets: Faculté de TechnologieLem AhPas encore d'évaluation
- Busi2c EnsamDocument28 pagesBusi2c EnsamIsmail KlilaPas encore d'évaluation
- Chapitre II - Diagnostic - PDF Version 1Document5 pagesChapitre II - Diagnostic - PDF Version 1org 2019Pas encore d'évaluation
- Lonworks ProtocolDocument11 pagesLonworks ProtocolAnnwvyn100% (1)
- Labview Une Plateforme Pour La Mise en Oeuvre Dun TP de Supervision Par Protocole Modbustcp Dune Application AutomateDocument5 pagesLabview Une Plateforme Pour La Mise en Oeuvre Dun TP de Supervision Par Protocole Modbustcp Dune Application AutomateDieguin Francis Ck TeranPas encore d'évaluation
- Chapitre 03 Description Des API Et Les Logiciels STEP7 Et WINCCDocument22 pagesChapitre 03 Description Des API Et Les Logiciels STEP7 Et WINCCMohammed Amdjed DjebliPas encore d'évaluation
- Chapitre1 - Terminologie Du DiagnosticDocument8 pagesChapitre1 - Terminologie Du DiagnosticJunior IssonguiPas encore d'évaluation
- Sed 2016 2017Document87 pagesSed 2016 2017Ayat HSEPas encore d'évaluation
- Projet TTDocument65 pagesProjet TTAtifi ChaimaPas encore d'évaluation
- Guide de Conception Des Reseaux Electrique Industriels by Genie Electromcanique ComDocument6 pagesGuide de Conception Des Reseaux Electrique Industriels by Genie Electromcanique ComAymen Hssaini100% (1)
- Livre 1.0Document15 pagesLivre 1.0Nantenaina RasoamananjaraPas encore d'évaluation
- Ch2 Modeles Pour Les SED Avec Supervision 2Document25 pagesCh2 Modeles Pour Les SED Avec Supervision 2milanoramoPas encore d'évaluation
- SCADADocument7 pagesSCADASaidi ZohraPas encore d'évaluation
- TPN2Document2 pagesTPN2Selmane SaoudPas encore d'évaluation
- Introduction Informatique Industrielle AutomatismesDocument5 pagesIntroduction Informatique Industrielle AutomatismesSabrine Ns100% (1)
- LabVIEW - TP A1 - 2007Document55 pagesLabVIEW - TP A1 - 2007thientuyettinhPas encore d'évaluation
- Cours SEDDocument43 pagesCours SEDAbdellah Lazreg100% (1)
- Chapitre 1Document5 pagesChapitre 1youssef BohaPas encore d'évaluation
- Scada 2009Document51 pagesScada 2009LAHKIM FATIMA-ZAHRAEPas encore d'évaluation
- Cours Automates Réseaux IndustrielsDocument9 pagesCours Automates Réseaux Industrielspro.kadirciritci7Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Avec Exemples D'applicationsDocument10 pagesChapitre 1 Avec Exemples D'applicationsMohammed ALMUSHIAAPas encore d'évaluation
- Découverte Platform Node RedDocument19 pagesDécouverte Platform Node RedHajar ElattariPas encore d'évaluation
- 05 01 ServomoteurDocument7 pages05 01 ServomoteurSalem SaidiPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Diagnostique GénéralitésDocument5 pagesChapitre 1 Diagnostique GénéralitésAyoub K12Pas encore d'évaluation
- Module Automatique Et Régulation IndustrielleDocument59 pagesModule Automatique Et Régulation IndustrielleYoussef MakmoulPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 SEDDocument40 pagesChapitre 1 SEDfaissal rahliPas encore d'évaluation
- ChapII.1 M2 AII SED EtudDocument11 pagesChapII.1 M2 AII SED EtudUsb MasPas encore d'évaluation
- CPT ErDocument18 pagesCPT ErMohamed BenrahalPas encore d'évaluation
- Chapitre 03-Cours 02Document32 pagesChapitre 03-Cours 02Kamel EddinePas encore d'évaluation
- Tpn02 DiagDocument7 pagesTpn02 DiagAhmed Mehdi DALI100% (1)
- Cours4 MPLABX IDE V2.25 PDFDocument21 pagesCours4 MPLABX IDE V2.25 PDFYoussef HaidaPas encore d'évaluation
- Introduction Sur Les Systèmes MécatroniquesDocument20 pagesIntroduction Sur Les Systèmes MécatroniquesAnas AsranPas encore d'évaluation
- Memmadi MehdiDocument53 pagesMemmadi Mehdisara BenPas encore d'évaluation
- Automate Programmable Miii Word2016Document25 pagesAutomate Programmable Miii Word2016WajihPas encore d'évaluation
- STM32-Dr. ELHAMIDI-2Document38 pagesSTM32-Dr. ELHAMIDI-2fadoua.madarissePas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Réseaux IndustrielsDocument24 pagesChapitre 2 Réseaux Industrielsnour yazidiPas encore d'évaluation
- Indpet1mas Lessons-Identification DebbahDocument67 pagesIndpet1mas Lessons-Identification Debbahhamza elgarragPas encore d'évaluation
- Reseaux de TerrainDocument3 pagesReseaux de TerrainmaropPas encore d'évaluation
- IC1 Poly 2007Document204 pagesIC1 Poly 2007AIIPas encore d'évaluation
- Labview Une Plateforme Pour La Mise en Oeuvre Des TP Sur Les Bus de Terrains IndustrielsDocument7 pagesLabview Une Plateforme Pour La Mise en Oeuvre Des TP Sur Les Bus de Terrains IndustrielsWalidAdrarPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 RLIDocument7 pagesChapitre 2 RLINourallah AouinaPas encore d'évaluation
- Mécatronique Métier Et FormationDocument7 pagesMécatronique Métier Et FormationtsmecaPas encore d'évaluation
- Cours Bac S Si - Acquerir L Information - Les Capteurs PDFDocument27 pagesCours Bac S Si - Acquerir L Information - Les Capteurs PDFAFAFPas encore d'évaluation
- SupervisionDocument7 pagesSupervisionSaadia IchouPas encore d'évaluation
- Cours - M2RT - Réseaux Industriels Et IntelligentsDocument30 pagesCours - M2RT - Réseaux Industriels Et IntelligentsRoland FoyemtchaPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument10 pagesIntroductionJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Resume Fonctions Plusieurs Variables - IDocument4 pagesResume Fonctions Plusieurs Variables - IJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Windows Server 2012 R2 Installation WDS Sans Active DirectoryDocument10 pagesWindows Server 2012 R2 Installation WDS Sans Active DirectoryJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Suite TP 10 PHP Mysql Inserer Des Donnees A Partir Dun CompressDocument3 pagesSuite TP 10 PHP Mysql Inserer Des Donnees A Partir Dun CompressJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Fiche D'interrogation Deuxieme Bachelier Réseaux Et TélécommunicationDocument1 pageFiche D'interrogation Deuxieme Bachelier Réseaux Et TélécommunicationJunior NgongoPas encore d'évaluation
- HT Geyser Spares CatalogueDocument11 pagesHT Geyser Spares CatalogueJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Doctype HTML-wps OfficeDocument1 pageDoctype HTML-wps OfficeJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Cours de Os2 Upl 2022Document63 pagesCours de Os2 Upl 2022Junior Ngongo100% (1)
- Cours de ACST - UPL2022Document76 pagesCours de ACST - UPL2022Junior NgongoPas encore d'évaluation
- Seigneur, À Quel Autre - Parce Qu'Il Vit - Arr. Héritage - Inconnu - Bill Et Gloria GaitherDocument1 pageSeigneur, À Quel Autre - Parce Qu'Il Vit - Arr. Héritage - Inconnu - Bill Et Gloria GaitherJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Près de Toi - Stéphane Hoareau - Sébastien CornDocument1 pagePrès de Toi - Stéphane Hoareau - Sébastien CornJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Rapport Atelier de Validation - Produits ClimatiquesDocument14 pagesRapport Atelier de Validation - Produits ClimatiquesJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Rien Ne Peut Sauver Mon Âme - Arr. Héritage - Robert LowryDocument1 pageRien Ne Peut Sauver Mon Âme - Arr. Héritage - Robert LowryJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Tu Es Dieu Depuis Toujours - Sylvain FreymondDocument1 pageTu Es Dieu Depuis Toujours - Sylvain FreymondJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Quel Est L'enfant - Arr. Héritage - William Chatterton DixDocument1 pageQuel Est L'enfant - Arr. Héritage - William Chatterton DixJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Kibula OdetteDocument13 pagesRapport de Stage Kibula OdetteJunior Ngongo0% (1)
- 02 Bricks & Mortar CalculationDocument2 pages02 Bricks & Mortar CalculationDrancyPas encore d'évaluation
- Formations AudioDocument22 pagesFormations AudioJunior NgongoPas encore d'évaluation
- Physique Tout en Un PDFDocument654 pagesPhysique Tout en Un PDFAchilles KamelPas encore d'évaluation
- Notes IntegersDocument55 pagesNotes Integersladabd2Pas encore d'évaluation
- Exemple Plan de Rapport de StageDocument15 pagesExemple Plan de Rapport de StageMounkaila Ai BoubacarPas encore d'évaluation
- ABCsonorisation SIDocument72 pagesABCsonorisation SIbouwazraPas encore d'évaluation
- Rapport Haider Abdes SamadDocument56 pagesRapport Haider Abdes SamadTurki DallaliPas encore d'évaluation
- Cours de Statistique DescriptiveDocument36 pagesCours de Statistique DescriptiveJunior NgongoPas encore d'évaluation
- L3 Poly06Document118 pagesL3 Poly06NourDine Ait Zengui100% (1)
- Maintenance Application Protection Des EquipementDocument94 pagesMaintenance Application Protection Des EquipementelzomilkPas encore d'évaluation
- KX DT521 DT543 DT546 PDFDocument24 pagesKX DT521 DT543 DT546 PDFمحمد الأمينPas encore d'évaluation
- 9 Presentation KecharDocument70 pages9 Presentation KecharwissemPas encore d'évaluation
- Mettre en Oeuvre Le vSANDocument13 pagesMettre en Oeuvre Le vSANstaojrPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document19 pagesChapitre 1M'hmed ChouiniPas encore d'évaluation
- Définition de Mandat Projet GarageDocument4 pagesDéfinition de Mandat Projet GarageMichael Byamungu MasilyaPas encore d'évaluation
- WEG CFW ManDocument287 pagesWEG CFW ManArnoud NegraoPas encore d'évaluation
- INSA Toulouse 1A Algorithme ADA TD 1Document10 pagesINSA Toulouse 1A Algorithme ADA TD 1purplera1n100% (1)
- Evaluation Système AutomatiseDocument2 pagesEvaluation Système AutomatiseKaled MRASSI100% (1)
- Moteur Tu5jp4Document13 pagesMoteur Tu5jp4José RodriguesPas encore d'évaluation
- Architecture de La Carte MèreDocument15 pagesArchitecture de La Carte MèreRachida MebarkiPas encore d'évaluation
- Histoire de BMW: L'Excellence Allemande Dans L'automobileDocument2 pagesHistoire de BMW: L'Excellence Allemande Dans L'automobileGiovanni ScaringellaPas encore d'évaluation
- Tuyaux, Embouts Et Equipements: Catalogue 4400/FRDocument488 pagesTuyaux, Embouts Et Equipements: Catalogue 4400/FRNecati Yunus OrbayPas encore d'évaluation
- Infos FRDocument3 pagesInfos FR1234scr5678Pas encore d'évaluation
- 10 Bonnes Pratiques JavaScript - JS Attitude - Formations JavaScript Qualitatives Et Sympathiques PDFDocument13 pages10 Bonnes Pratiques JavaScript - JS Attitude - Formations JavaScript Qualitatives Et Sympathiques PDFscottnjrPas encore d'évaluation
- Partie III. GNS3 Réseau N° 1Document8 pagesPartie III. GNS3 Réseau N° 1Moïse GuilavoguiPas encore d'évaluation
- BRO-Ranger RaptorDocument7 pagesBRO-Ranger Raptorarnaudtouloumdjian13Pas encore d'évaluation
- B1 - Vocabulaire TéléphoniqueDocument4 pagesB1 - Vocabulaire TéléphoniqueorleanseliPas encore d'évaluation
- SambaDocument11 pagesSambaOlympyPas encore d'évaluation
- Lettre de MotivationDocument1 pageLettre de MotivationIlyes AYACHE60% (5)
- Sujet SessionDocument3 pagesSujet SessionClement MINOUGOUPas encore d'évaluation
- L'Évolution Du Paiement Électronique en Algérie Pendant La Pandémie Du COVID-19Document16 pagesL'Évolution Du Paiement Électronique en Algérie Pendant La Pandémie Du COVID-19faroudja ait hamouPas encore d'évaluation
- Kabasele Kalala Dieu MerciDocument7 pagesKabasele Kalala Dieu MerciCongo télécom engineering SARLU100% (2)
- Le Livre Des Techniques Du Son Tome 2Document32 pagesLe Livre Des Techniques Du Son Tome 2Maurice AmaniPas encore d'évaluation
- Wifi AdministrationDocument22 pagesWifi AdministrationMOHAMMEDAMINE BENCHEIKHLEHOCINEPas encore d'évaluation
- CV Aubriel BoulinguiDocument1 pageCV Aubriel BoulinguiBOULINGUI NGOTPas encore d'évaluation
- Lib OFaqDocument158 pagesLib OFaqSarhro ELPas encore d'évaluation
- Bet OgcDocument10 pagesBet OgcAbdoul AzizPas encore d'évaluation
- Calcul Poteau BADocument4 pagesCalcul Poteau BAJacquesMartialNdindjockPas encore d'évaluation
- Algo1 - Partie1Document94 pagesAlgo1 - Partie1Ousmane KeitaPas encore d'évaluation
- Wi-Fi Hacking avec kali linux Guide étape par étape : apprenez à pénétrer les réseaux Wifi et les meilleures stratégies pour les sécuriserD'EverandWi-Fi Hacking avec kali linux Guide étape par étape : apprenez à pénétrer les réseaux Wifi et les meilleures stratégies pour les sécuriserPas encore d'évaluation
- Comment analyser les gens : Introduction à l’analyse du langage corporel et les types de personnalité.D'EverandComment analyser les gens : Introduction à l’analyse du langage corporel et les types de personnalité.Pas encore d'évaluation
- Le trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsD'EverandLe trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (19)
- Apprendre Python rapidement: Le guide du débutant pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur Python, même si vous êtes nouveau dans la programmationD'EverandApprendre Python rapidement: Le guide du débutant pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur Python, même si vous êtes nouveau dans la programmationPas encore d'évaluation
- Technologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandTechnologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Secrets du Marketing des Médias Sociaux 2021: Conseils et Stratégies Extrêmement Efficaces votre Facebook (Stimulez votre Engagement et Gagnez des Clients Fidèles)D'EverandSecrets du Marketing des Médias Sociaux 2021: Conseils et Stratégies Extrêmement Efficaces votre Facebook (Stimulez votre Engagement et Gagnez des Clients Fidèles)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Dark Python : Apprenez à créer vos outils de hacking.D'EverandDark Python : Apprenez à créer vos outils de hacking.Évaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Python | Programmer pas à pas: Le guide du débutant pour une initiation simple & rapide à la programmationD'EverandPython | Programmer pas à pas: Le guide du débutant pour une initiation simple & rapide à la programmationPas encore d'évaluation
- Hacking pour débutants : Le guide complet du débutant pour apprendre les bases du hacking avec Kali LinuxD'EverandHacking pour débutants : Le guide complet du débutant pour apprendre les bases du hacking avec Kali LinuxÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (4)
- Wireshark pour les débutants : Le guide ultime du débutant pour apprendre les bases de l’analyse réseau avec Wireshark.D'EverandWireshark pour les débutants : Le guide ultime du débutant pour apprendre les bases de l’analyse réseau avec Wireshark.Pas encore d'évaluation
- Le Bon Accord avec le Bon Fournisseur: Comment Mobiliser Toute la Puissance de vos Partenaires Commerciaux pour Réaliser vos ObjectifsD'EverandLe Bon Accord avec le Bon Fournisseur: Comment Mobiliser Toute la Puissance de vos Partenaires Commerciaux pour Réaliser vos ObjectifsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- L'analyse fondamentale facile à apprendre: Le guide d'introduction aux techniques et stratégies d'analyse fondamentale pour anticiper les événements qui font bouger les marchésD'EverandL'analyse fondamentale facile à apprendre: Le guide d'introduction aux techniques et stratégies d'analyse fondamentale pour anticiper les événements qui font bouger les marchésÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (4)
- Piraté: Guide Ultime De Kali Linux Et De Piratage Sans Fil Avec Des Outils De Test De SécuritéD'EverandPiraté: Guide Ultime De Kali Linux Et De Piratage Sans Fil Avec Des Outils De Test De SécuritéPas encore d'évaluation
- La communication professionnelle facile à apprendre: Le guide pratique de la communication professionnelle et des meilleures stratégies de communication d'entrepriseD'EverandLa communication professionnelle facile à apprendre: Le guide pratique de la communication professionnelle et des meilleures stratégies de communication d'entrepriseÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- L'analyse technique facile à apprendre: Comment construire et interpréter des graphiques d'analyse technique pour améliorer votre activité de trading en ligne.D'EverandL'analyse technique facile à apprendre: Comment construire et interpréter des graphiques d'analyse technique pour améliorer votre activité de trading en ligne.Évaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (6)
- NFT et Cryptoart: Le guide complet pour investir, créer et vendre avec succès des jetons non fongibles sur le marché de l'art numériqueD'EverandNFT et Cryptoart: Le guide complet pour investir, créer et vendre avec succès des jetons non fongibles sur le marché de l'art numériqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (5)
- Guide Pour Les Débutants En Matière De Piratage Informatique: Comment Pirater Un Réseau Sans Fil, Sécurité De Base Et Test De Pénétration, Kali LinuxD'EverandGuide Pour Les Débutants En Matière De Piratage Informatique: Comment Pirater Un Réseau Sans Fil, Sécurité De Base Et Test De Pénétration, Kali LinuxÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Conception & Modélisation CAO: Le guide ultime du débutantD'EverandConception & Modélisation CAO: Le guide ultime du débutantPas encore d'évaluation
- WiFi Hacking : Le guide simplifié du débutant pour apprendre le hacking des réseaux WiFi avec Kali LinuxD'EverandWiFi Hacking : Le guide simplifié du débutant pour apprendre le hacking des réseaux WiFi avec Kali LinuxÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Explication De La Technologie Blockchain: Guide Ultime Du Débutant Au Sujet Du Portefeuille Blockchain, Mines, Bitcoin, Ripple, EthereumD'EverandExplication De La Technologie Blockchain: Guide Ultime Du Débutant Au Sujet Du Portefeuille Blockchain, Mines, Bitcoin, Ripple, EthereumPas encore d'évaluation
- Hacking pour débutant Le guide ultime du débutant pour apprendre les bases du hacking avec Kali Linux et comment se protéger des hackersD'EverandHacking pour débutant Le guide ultime du débutant pour apprendre les bases du hacking avec Kali Linux et comment se protéger des hackersPas encore d'évaluation
- Créer Son Propre Site Internet Et Son Blog GratuitementD'EverandCréer Son Propre Site Internet Et Son Blog GratuitementÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Manuel de fabrication du savon: Je fabrique mes savons facilementD'EverandManuel de fabrication du savon: Je fabrique mes savons facilementÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- Le guide du hacker : le guide simplifié du débutant pour apprendre les bases du hacking avec Kali LinuxD'EverandLe guide du hacker : le guide simplifié du débutant pour apprendre les bases du hacking avec Kali LinuxÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Le trading des bandes de bollinger facile à apprendre: Comment apprendre à utiliser les bandes de bollinger pour faire du commerce en ligne avec succèsD'EverandLe trading des bandes de bollinger facile à apprendre: Comment apprendre à utiliser les bandes de bollinger pour faire du commerce en ligne avec succèsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Forex Trading facile à apprendre: Le guide d'introduction au marché des changes et aux stratégies de négociation les plus efficaces dans l'industrie des devises.D'EverandForex Trading facile à apprendre: Le guide d'introduction au marché des changes et aux stratégies de négociation les plus efficaces dans l'industrie des devises.Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)