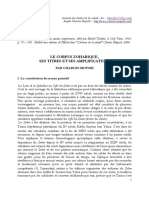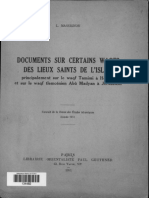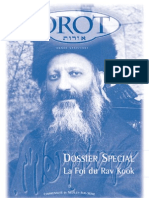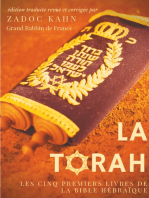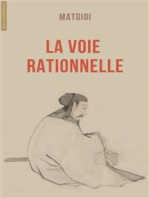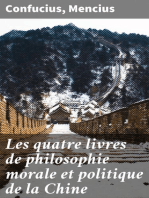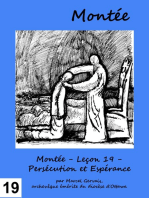Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Une Loi Toujours Actuelle Le Processus H
Transféré par
rakotovahinyonjatolotraTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Une Loi Toujours Actuelle Le Processus H
Transféré par
rakotovahinyonjatolotraDroits d'auteur :
Formats disponibles
Une Loi
toujours actuelle :
le processus
halakhique
Jeffrey R. Woolf
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 64 13/08/12 14:58
A CONDITION ESSENTIELLE DE L’ALLIANCE BIBLIQUE entre Dieu et Israël n’est
L autre que l’acceptation et l’observance de la Loi. Dès avant la Révélation
sinaïtique, le Tout-Puissant déclare : « Maintenant, si vous obéissez à
Ma voix et que vous observez Mon alliance, alors vous serez pour Moi un
peuple spécial parmi tous les peuples, bien que toute la terre soit à Moi.
Et vous serez pour Moi un royaume de desservants et une nation sainte »
(Exode 19, 5-6). L’observance des commandements (mitsvot), qui constituent
un système holistique imprégnant tous les aspects de la vie humaine, est
présentée par la Torah (Lévitique 26, 3-46) comme la condition de pérennité
du peuple juif à travers l’histoire. La tradition rabbinique soutient que Dieu
a transmis à Moïse non seulement la Torah écrite (Torah she-bi-khtav, soit le
Pentateuque), mais aussi un corpus additionnel composé de règles d’her-
méneutique légale et de précisions sur certains commandements venant
compléter ce que le texte biblique édicte explicitement. Cette Torah orale
(Torah she-be-‘al peh) est en expansion constante à mesure que s’accumulent
savoirs et interprétations, actes de jurisprudence et traditions religieuses
diverses : c’est à travers elle que la Loi conserve son caractère dynamique et
peut s’appliquer aux circonstances toujours mouvantes. En retour, ceux qui
se consacrent à elle sont perçus comme s’inscrivant dans la continuité des
prêtres législateurs auxquels la Torah confie cette charge interprétative et
qu’elle investit de l’autorité afférente : « Si quelque chose te dépasse dans la
loi […], tu te lèveras et tu monteras au lieu que l’Éternel ton Dieu choisira.
Tu iras chez les desservants lévites et chez le juge qui sera là à cette époque,
tu expliqueras ton cas et ils te diront quelle est la loi. »
Tout ce savoir était à l’origine destiné à demeurer oral, comme l’exprime le
Talmud de Babylone (Gittin 60b) : « Ce qui est écrit, tu n’as pas la permission
de le réciter par cœur, et ce qui est oral, tu n’as pas la permission de l’expri-
mer par écrit. » Les vicissitudes de l’histoire ont cependant contraint les
savants à composer des recueils de la Torah orale : tout d’abord sous la forme
de « textes » fixés dans leur formulation mais encore uniquement trans-
mis oralement, puis, bien plus tard, sous la forme d’écrits. Les trois princi-
paux exemples de ces recueils sont la Mishna (littéralement « enseignement
répété »), composée en Palestine romaine vers l’an 220 de l’ère courante,
65
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 65 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
et les deux Talmuds (« études »), le Talmud dit de Jérusalem, produit par
la yeshiva de Tibériade vers l’an 400, et le Talmud dit de Babylone, produit
par les yeshivot mésopotamiennes de Sura et Pumbedita vers l’an 500. Ces
deux Talmuds se présentent au premier abord comme un commentaire de
la Mishna et des corpus voisins, les beraïtot (« enseignements extérieurs »
[au corpus mishnique]), qu’on retrouve souvent dans la Tossefta (« complé-
ment ») et dans les midrashim halakhiques ; mais ils en sont venus à englober
l’ensemble des manifestations du judaïsme rabbinique. Cela est particulière-
ment vrai du Talmud de Babylone, élaboré plus tard et sur un laps de temps
plus long, et qui devait s’imposer à partir du milieu du IXe siècle comme la
pierre de touche de tout développement halakhique ultérieur, à la suite des
efforts volontaristes des yeshivot babyloniennes et de leurs directeurs, les
Geonim, dorénavant basés à Bagdad, qui mirent tout en œuvre pour faire
de « leur » Talmud la référence ultime de toutes les communautés juives de
diaspora. Le Talmud de Babylone et, à un degré moindre, le Talmud de Jéru-
salem et les autres corpus secondaires comme les midrashim, furent ainsi
considérés comme l’autorité à laquelle devaient se conformer chaque inter-
prétation et chaque décision halakhiques : ces dernières devaient être fon-
dées sur des sources talmudiques, précisément sur une lecture cohérente de
celles-ci, même si d’autres références restaient envisageables.
Ce dernier point est essentiel. En effet, dès avant la rédaction et la promul-
gation finales du Talmud, il n’existait plus d’instance centrale dont l’autorité
halakhique se serait imposée à l’ensemble du monde juif ; les divergences
d’avis et la controverse en étaient venues à faire partie intégrante du proces-
sus halakhique. Certes, les yeshivot babyloniennes prétendirent un temps
détenir le monopole de l’interprétation correcte du Talmud et se réserver
le privilège de dire la norme pratique ; mais elles échouèrent à faire dura-
blement admettre cette autorité et la halakha connut une décentralisation
incontestable, ce qui fit naître en retour toute une série de questionne-
ments qui marquèrent profondément la jurisprudence juive dans tous les
domaines, et ce, jusqu’aujourd’hui. L’objet de ce chapitre est de mettre en
lumière ces différentes problématiques d’un système juridique décentralisé
et les réponses qu’y ont apportées les principales traditions halakhiques.
Tout ce que nous allons développer est valable autant pour la période
antique que pour le temps présent ; nous nous concentrerons cependant sur
ce qu’on pourrait appeler l’âge classique du judaïsme, entre la clôture défi-
nitive du Talmud et sa diffusion vers l’an 700, et les prémices du judaïsme
contemporain vers 1700.
66
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 66 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
Mosaïque d’une synagogue de Re’hov, aux VIe et VIIe siècles. Le texte indique quels produits
agricoles doivent être soumis aux prélèvements bibliques en fonction des saisons et du
lieu de production. Le texte est très proche, dans le fond comme dans la forme, de ce que
nous ont transmis les textes rabbiniques comme le Sifré ou la Tossefta. Placée dans un lieu
de grande affluence populaire, cette inscription illustre l’interpénétration de la culture
rabbinique et de la culture synagogale, ainsi que la place du discours halakhique dans la
vie quotidienne des communautés juives.
L’AUTORITÉ « RABBINIQUE »
La tradition rabbinique elle-même postule que ne sont dépositaires de l’au-
torité « rabbinique » et juridico-légale que les individus qui s’inscrivent dans
une chaîne de tradition et qui ont reçu l’ordination ou semikha. Cette semikha
authentique ne peut être reçue qu’en terre d’Israël et de la part d’une per-
sonne ayant elle-même reçu cette semikha, la chaîne remontant jusqu’à
Moïse ; elle aurait existé, ininterrompue, jusqu’au début du Ve siècle de l’ère
courante. Ces maîtres avaient autorité pour juger dans tous les domaines
de la Loi juive (voir T. B. Sanhédrin 5a-b ; Maïmonide, Mishneh Torah, Hilkhot
67
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 67 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
Sanhédrin ch. 4). Ceux des savants qui n’avaient pas reçu la semikha mosaïque
étaient également investis d’un pouvoir décisionnaire, mais celui-ci était
limité aux lois rituelles et à certaines affaires de droit civil relevant de l’arbi-
trage, à l’exclusion de la majeure partie du droit civil et du droit pénal et cri-
minel. De telles contraintes rendaient l’établissement d’un système judiciaire
opérant extrêmement difficile, voire impossible, en dehors de la terre d’Israël.
C’est pourquoi les autorités babyloniennes mirent en place des bases théo-
riques qui faisaient des rabbins de la diaspora des « délégués des Sages de la
terre d’Israël » habilités, à ce titre, à juger un nombre plus étendu, quoique
toujours restreint, d’affaires civiles, matrimoniales et criminelles (T. B. Baba
Kama 84b). Cette théorie de la délégation d’autorité devait servir de modèle à
d’autres entreprises similaires destinées à préserver la viabilité et l’applicabi-
lité futures de la halakha.
En 425, l’office de patriarche (nassi) de la terre d’Israël fut aboli par les
empereurs byzantins. Le nassi, dont la charge était héréditaire, était à la fois
l’autorité politique suprême de la communauté et le président du Sanhédrin
ou tribunal suprême. La disparition de cette charge impliquait la fin abrupte
de la chaîne traditionnelle de semikha, engendrant une crise institution-
nelle d’une ampleur inouïe depuis la destruction du Temple quelque trois
cent cinquante ans plus tôt : de vastes pans de la Loi juive tombaient en effet
théoriquement en désuétude. S’il n’y avait plus de maîtres détenteurs de la
semikha en terre d’Israël, comment les rabbins de la diaspora pourraient-ils
se présenter comme leurs délégués ? La foi profonde en la validité et l’appli-
cabilité éternelles de la Loi amena pourtant les savants de la terre d’Israël et
de Babylonie à mettre en place des palliatifs de l’absence de la semikha. Dans
certains cas, on détermina que la semikha n’était pas, en dernier recours,
indispensable pour juger ; dans d’autres, on adopta des décrets communau-
taires obligeant les membres de la communauté à se conformer aux déci-
sions des tribunaux rabbiniques même si les juges qui y siégeaient n’étaient
pas, faute de semikha, pleinement habilités à y siéger. Enfin, par un tour de
force conceptuel, l’idée finit par s’imposer que les maîtres des générations
antérieures avaient fait de leurs successeurs leurs représentants légaux, et ce,
jusqu’à la fin des temps (Rav A’hai Gaon, Sheïltot, no 58, s. v. baram ; Tossafot sur
Gittin 88b, s. v. de-shekhi’ha).
La disparition de la semikha continua de soulever des difficultés aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté juive. Son inexistence
fournissait un angle d’attaque idéal aux polémistes chrétiens, puisqu’elle leur
semblait appuyer la thèse supersessioniste, c’est-à-dire la thèse de la caducité
de l’ancienne Alliance et de l’Église chrétienne comme nouvel Israël. C’est
ainsi qu’en ouverture de la célèbre dispute de Barcelone en 1263 l’apostat
68
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 68 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
Pablo Christiani insista sur le fait que son interlocuteur, Nahmanide, ne pos-
sédait pas de semikha : cela, arguait-il, mettait en cause sa légitimité à repré-
senter le « vrai » judaïsme et prouvait a contrario la véracité de l’interprétation
chrétienne du verset « Le sceptre ne s’écartera pas de Yehuda jusqu’à ce que
vienne Shilo » (Genèse 49, 10), ce dernier terme désignant le Messie. Pour les
chrétiens, le fait que toute légitimité politique et juridique institutionnelle
ait disparu dans la communauté juive après l’époque de Jésus prouvait la
messianité de ce dernier.
Mais la question de la semikha préoccupait également les Geonim de
Babylonie. À l’époque de leur pleine puissance, soit de 750 environ à la
mort de Rav A’hai Gaon en 1038, ils se consacrèrent pleinement à asseoir
l’autorité du Talmud de Babylone, à préserver leur monopole sur l’étude
et l’interprétation dudit Talmud, à promouvoir les traditions halakhiques
de Babylonie au détriment de celles de la terre d’Israël et à consacrer leurs
institutions comme les arbitres suprêmes dans toute dispute halakhique.
Dans cette optique centralisatrice, ils recouraient avec insistance au langage
de la semikha traditionnelle quand ils procédaient à des nominations ou
mettaient en scène leur autorité. On peut ainsi lire, sous la plume du Gaon
rav Sherira, au Xe siècle, cette audacieuse assertion : « Le premier rang [de
la yeshiva] équivaut au Sanhédrin et son directeur occupe la place de notre
maître Moïse. » (Iggeret Rav Sherira Gaon, éd. B. M. Lewin, p. xxviii.) Cepen-
dant, des cérémonies d’ordination formelles se tiennent également loin de
la Babylonie des Geonim, dans l’Espagne du XIe siècle, au cours desquelles
les étudiants se voient conférer un ersatz de semikha (R. Yehuda al-Barce-
loni, Sefer ha-Shetarot, p. 131-132). Tous ces efforts étaient néanmoins symbo-
liques et ne pouvaient nullement prétendre remplacer réellement la semikha
mosaïque authentique.
On doit à Maïmonide l’élucidation des conditions théoriques d’une réins-
titution de la semikha originelle, d’abord dans son commentaire de la Mishna
(Bekhorot 4, 3) puis dans son Mishneh Torah (Hilkhot Sanhédrin, 4, 11). Ses propo-
sitions devaient fournir les arguments essentiels de R. Ya‘akov Beirav quand
celui-ci tenta de ressusciter et la semikha et le Sanhédrin, à Safed en 1538. Sa
tentative échoua cependant, principalement à cause de l’opposition des rab-
bins de Jérusalem.
Finalement, donc, tant dans les sphères babylonienne et espagnole que
dans le monde franco-germanique, les étudiants méritants se contentaient
de la reconnaissance par leurs maîtres de leur capacité à répondre à des pro-
blèmes halakhiques, ce qui prenait parfois l’aspect formel d’une hatarat horaa
(« autorisation de formuler la Loi »). On considérait cette reconnaissance
comme suffisante pour leur permettre d’officier en tant que législateurs et
69
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 69 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
juges, hormis dans les domaines, pénaux et autres, qui avaient toujours été
réservés aux détenteurs de la vraie semikha. Autrement dit, l’autorité rabbi-
nique avait mué, n’étant plus fonction que de l’érudition et de la piété indivi-
duelles attestées par le maître. Ce qui sous-tendait cette mutation, c’était un
charisme de l’étude et de la relation maître-disciple, lui-même rendu opé-
rant par l’adhésion volontaire et sans faille des membres de la communauté
au respect de la halakha (la question du rabbinat officiel et communautaire,
pour être liée, dépasse largement le cadre de ce chapitre ; on se reportera
à celui d’Elisheva Carlebach, « Les institutions juives au début de l’époque
moderne », p. 358).
L’un des marqueurs majeurs de ce changement de paradigme peut être
identifié dans les démarches du maître viennois R. Meïr b. Barukh ha-Lévi
(m. 1404). Dans le sillage de la Peste noire (1349-1350), le judaïsme allemand
avait été secoué par une série de massacres qui rendait nécessaire une réor-
ganisation des structures rabbiniques et la mise à l’écart de figures charis-
matiques à la légitimité douteuse. Il ordonna donc que les seuls individus
autorisés à servir comme rabbins, officiellement ou de manière informelle,
seraient ceux ayant reçu une licence leur permettant d’émettre des avis juri-
diques. Cette licence, qu’on vint à appeler populairement semikha bien
qu’il fût clair qu’elle ne remplaçait pas la semikha mosaïque, redéfinissait
la nature de l’investiture rabbinique qui avait jusqu’alors relevé de la seule
relation entre un disciple et ses maîtres. De nombreuses disputes devaient
naître de cet écart entre l’ancien usage et la nouvelle norme au cours des
deux siècles suivants. La plus célèbre de ces controverses opposa le grand
rabbin de Paris, R. Yo’hanan Treves (m. 1429), et R. Yeshaya Astruc de Savoie.
Ce dernier, qui avait reçu la nouvelle semikha de R. Meïr de Vienne, enten-
dait déposer le premier au motif qu’il ne détenait pas cette nouvelle licence.
La bataille devait faire rage jusqu’à l’expulsion des Juifs du royaume de
France en 1394. Avec le temps, cette notion selon laquelle un rabbin devait
obligatoirement être capable de se prévaloir de la reconnaissance formelle
d’une autorité halakhique reconnue se répandit dans toute l’Europe cen-
trale et orientale.
Dans l’aire séfarade, la situation était sensiblement différente dans la
mesure où un tel rabbinat institutionnalisé semble avoir existé dès le haut
Moyen Âge. Pourtant, la capacité d’un individu à trancher la loi ou à sié-
ger dans un tribunal rabbinique (beit din) restait bien déterminée par la
reconnaissance du maître personnel de l’individu. De plus, même dans les
cercles ashkénazes, la piété et l’érudition continuèrent de se voir accorder
une valeur bien plus grande que n’importe quel diplôme ou certificat, et
l’on connaît maintes autorités halakhiques de premier plan dont on sait
70
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 70 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
qu’elles n’ont jamais reçu de tel diplôme, qu’on l’appelle hatarat horaa ou
semikha.
DE L’HUMILITÉ À LA RESPONSABILITÉ
L’acte de rendre une décision halakhique place le rabbin au cœur d’un grave
dilemme religieux. D’un côté, il est extrêmement présomptueux de prétendre
interpréter et trancher la Loi de Dieu, puisque cela revient à dire que l’on
connaît la volonté divine. D’un autre côté, c’est bien au savant que revient
cette lourde tâche d’appliquer la Loi, de « faire connaître [au peuple] la voie
qu’il convient de suivre et ce qu’il doit faire » (Exode 18, 20). Le Talmud (T. B.
‘Avoda Zara 19b) exprime ce paradoxe par une formule frappante : « Le verset
(Proverbes 7, 26) “Car nombreux sont les cadavres qu’elle [la fausse science]
a fait chuter” désigne le disciple qui n’a pas encore atteint le niveau requis
pour rendre des décisions et qui le fait quand même ; la suite du verset “et
imposant ceux qu’elle a tués” désigne celui qui a atteint ce niveau et qui s’abs-
tient cependant de rendre des décisions. » Certes, les conséquences des déci-
sions d’un ignorant peuvent se révéler dramatiques ; mais celles qui découlent
du refus de se prononcer de celui qui est pourtant compétent sont égale-
ment désastreuses. Dans chaque génération, les halakhistes sont amenés à
surmonter cette yir’at horaa, cette « peur de la décision », en prenant appui
sur la conviction qu’ils ont le devoir, malgré leurs limitations, de dire la Loi.
Après tout, comme le dit le Talmud (T. B. Rosh ha-Shana 25b), chaque généra-
tion ne peut que se référer aux autorités contemporaines, et « Jephté [la plus
médiocre figure de l’époque des Juges] en sa génération a autant d’autorité
que Samuel en la sienne ».
Cette dialectique est clairement exprimée dans les propos liminaires du
plus important halakhiste franco-italien de la seconde moitié du XVe siècle,
R. Yossef Colon Trabotto, dit le Maharik (1420-1480) : « Quoique je ne sois pas
un expert public (mum’heh la-rabbim) et que je ne me considère pas non plus
tel, D.ieu préserve, […] néanmoins, dans la mesure où vous m’avez chargé
de cette tâche [de dire quelle est la loi dans tel cas] […], si je m’abstenais de
répondre, je commettrais un péché, D.ieu préserve. Pour autant, ainsi que
tu l’écris toi-même, je ne prétendrai pas, par mon avis, exprimer le verdict
définitif et authentique de la Torah, D.ieu préserve ! Car les autorités ont déjà
écrit qu’aujourd’hui les juges doivent éviter de décider selon la stricte Loi de
la Torah. Si cette maxime était déjà vraie au temps des Tannaïm [les maîtres
de la Mishna], dont le cœur était large, a fortiori était-elle vraie au temps
des Amoraïm, a fortiori au temps des Geonim, et ô combien a fortiori à notre
71
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 71 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
Tétradrachme frappé au moment de la révolte de Bar Kokhba, dans la dernière phase des
guerres contre Rome, vers l’an 135. Frappée par les insurgés, cette pièce figure sur une
face le Temple de Jérusalem détruit soixante-cinq ans avant et dont les Juifs espèrent
la reconstruction ; le Temple est surmonté d’une étoile, symbolisant le « messie » Bar
Kokhba, le « Fils de l’Étoile ». Sur l’autre face figure un lulav, c’est-à-dire un bouquet
de palme, de myrte et de saule, et un étrog, c’est-à-dire un cédrat – les quatre espèces
que l’on agite lors de la fête de Sukkot. Il est surtout intéressant de noter que le lulav
comporte une seule branche de myrte et une seule de saule, contrairement à la coutume
actuelle qui requiert trois branches de myrte et deux de saule. Si l’on se réfère à la Mishna
(Sukka 3, 4), le lulav figuré ici est conforme à l’avis de Rabbi ‘Akiva – qui se trouvait être le
principal soutien de Bar Kokhba.
époque, génération d’orphelins fils d’orphelins, en laquelle nos nombreux
péchés auraient dû causer l’oubli de la Torah, n’était-ce la grande miséri-
corde dont D.ieu, qui demeure avec nous, nous a assurés… » (Teshuvot Maha-
rik n0 90.)
Le halakhiste exprime ainsi sa méfiance envers toute tentative de déter-
miner la volonté divine, tout en admettant la faute grave que constituerait
un refus de statuer : faute contre son prochain et faute contre le Créateur.
Si le maître résout le dilemme en acceptant de se prononcer, il le fait avec
une conscience aiguë de la lourde responsabilité qu’il est amené à endosser.
LA NATURE DE LA VÉRITÉ HALAKHIQUE
On distingue en réalité deux écoles de pensée quant à savoir ce que doit viser
précisément le rabbin à qui l’on demande de statuer. Y a-t-il une seule et
unique réponse objectivement vraie dont il doit s’approcher le plus possible
72
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 72 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
ou existe-t-il plusieurs solutions à un problème halakhique donné ? Globa-
lement, les divergences d’approche recoupent la distinction entre autorités
ashkénazes et séfarades.
Les autorités séfarades, qui s’inscrivaient dans la tradition des Geonim
de Babylonie, affirmaient que la vérité halakhique est une. Le rôle du savant
est de mettre au jour cette vérité préexistante qui s’impose de manière uni-
verselle. Cette position a priori eut un certain nombre de répercussions
essentielles. Tout d’abord, elle explique pourquoi ce sont, au Moyen Âge, des
savants du monde babylonien et séfarade qui se sont attelés à la composi-
tion des codes halakhiques systématiques les plus importants : les Halakhot
Gedolot de R. Shim‘on Kayyara (v. 825), les Hilkhot ha-Rif de R. Isaac al-Fassi
(1013-1103), le Mishneh Torah de Maïmonide (1135-1204) et enfin le Shul’han
‘Arukh de R. Yossef Caro (1488-1575 ; le Shul’han ‘Arukh est lui-même le résumé
de son commentaire monumental sur les Arba‘a Turim, le Beit Yossef). Chacun
de ces codes manifeste le désir d’établir définitivement un verdict unique et
universel sur le moindre point de la halakha. On comprend bien que seul un
auteur qui croit au caractère unique de la vérité peut entreprendre un code
exprimant des verdicts unilatéraux. Le grand code que nous n’avons pas cité
ici est les Arba‘a Turim (abrégé en Tur) de R. Ya‘akov b. Asher. Ce code est un
hybride : son auteur est d’origine allemande et a vécu presque toute sa vie en
Espagne. Si l’approche ashkénaze est très présente dans son œuvre, certaines
sections sont cependant plus séfarades : ’Hoshen Mishpat, la section sur le
droit civil et commercial, en particulier, relève d’un esprit en soi étranger à la
tradition halakhique ashkénaze dans la mesure où ces sujets sont le domaine
par excellence de la jurisprudence et non d’une vérité déterminée a priori.
Cette idée que pour chaque problème halakhique il n’existe qu’une seule
solution vraie influença également l’attitude séfarade envers la controverse
halakhique (ma’hloket). Pour le dire brièvement, la divergence d’opinion est
mauvaise. Au mieux, elle est le signe d’une paresse intellectuelle ; au pire, elle
frôle le blasphème contre le Dieu Un, « dont le sceau est Vérité ». Ce senti-
ment est particulièrement présent dans la démarche de Maïmonide qui vise,
en composant le Mishneh Torah, à résoudre apodictiquement et une bonne fois
pour toutes l’ensemble des controverses subsistant dans la tradition légale
juive telle qu’elle s’exprime dans le Talmud et la littérature ultérieure. Il faut
évincer la controverse, signe d’infamie pour la tradition juive. Ainsi qu’il l’écrit
dans Le Guide des égarés (I, 71) : « Même la Loi traditionnelle, tu en es bien
conscient, n’était pas à l’origine couchée par écrit, conformément à la règle
selon laquelle “ce qui est oral, tu n’as pas la permission de l’exprimer par écrit”.
Du point de vue de la Loi, cette règle était fort opportune, puisqu’elle prému-
nissait des maux qui devaient émerger par la suite, à savoir la grande diversité
73
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 73 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
d’opinions, l’ambiguïté de l’écrit, les erreurs de scribes, les dissensions au sein
du peuple, la naissance de nouvelles sectes et la confusion des notions à pro-
pos des sujets pratiques. » (Voir également son Introduction au commentaire de
la Mishna, éd. Y. Shilat, Jérusalem, 1997, p. 40-41.)
On pourrait attribuer cette position maïmonidienne à l’influence des
courants philosophiques de l’Andalousie ; le fait que ce même appel à l’uni-
formité légale et au rejet de la controverse se retrouve sous la plume de
R. Yossef Caro, par ailleurs fervent kabbaliste, montre qu’il n’en est rien. À la
suite de l’expulsion d’Espagne en 1492 et des tribulations qu’elle engendra,
il se lamente dans son introduction au Beit Yossef : « Nous avons été transva-
sés d’un récipient à un autre et jetés sur les routes de l’exil ; des calamités se
sont abattues sur nous […] la Torah et ses disciples sont sans recours car ce
ne sont plus deux Torahs que nous avons, mais des Torahs innombrables… »
Par ses deux magna opera, le Beit Yossef et le Shul’han ‘Arukh, R. Y. Caro entend
mettre de l’ordre dans le chaos des controverses et faire pénétrer la lumière
dans le sombre maquis des opinions divergentes.
La position ashkénaze typique était totalement à l’opposé de cette vision ;
on peut même dire que la quête d’une vérité halakhique universelle était
totalement étrangère à la Weltanschauung ashkénaze. Les savants de l’aire
franco-germanique médiévale se mouvaient avec aisance au sein d’un
monde fait d’une multiplicité d’interprétations, de verdicts et d’avis. La
controverse n’était pas perçue comme l’expression d’un échec intellectuel
toléré à regret, mais comme le signe d’une authentique et légitime explora-
tion des différents niveaux de sens contenus dans la Torah. La revivification
de la méthode dialectique talmudique par R. Ya‘akov b. Meïr, dit Rabbeinu
Tam, et ses disciples ne fit qu’accentuer et approfondir ce trait en donnant
naissance à un univers du discours halakhique en constante expansion et
ne visant finalement plus de but autre que la recherche elle-même. Cette
optique est superbement exprimée par un commentaire que nous ont pré-
servé les écrits d’un talmudiste français du XIIIe siècle, Rabbeinu Perets de
Corbeil. Auteur d’études majeures sur le Talmud dans la tradition des Tos-
safistes, considéré par la postérité comme l’un des représentants par excel-
lence de la tradition halakhique française, il écrit, à propos de la célèbre
formule talmudique « Les unes comme les autres sont les paroles du Dieu
vivant » (T. B. ‘Eruvin 13b) : « Comment concevoir que l’une comme l’autre
opinion soient les paroles du Dieu vivant quand l’une autorise ce que l’autre
interdit ? On explique en fait (voir Midrash Tehillim 12, 4) que, quand Moïse
est monté recevoir la Torah, on lui a montré que pour chaque cas il existait
quarante-neuf approches pour interdire et quarante-neuf approches pour
permettre. Et quand il a interrogé le Saint, béni soit-Il, à ce sujet, Il lui a
74
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 74 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
répondu que la tâche serait confiée aux Sages d’Israël de chaque génération
de déterminer la Loi selon leurs vues. » R. Shelomo Luria (Pologne, 1510-1573)
exprima le même sentiment trois siècles plus tard en invoquant le principe
kabbalistique selon lequel chaque Juif présent à la Révélation sinaïtique avait
reçu une Torah légèrement différente et adaptée à sa spécificité et ses capaci-
tés (introduction au Yam shel Shelomo). La conclusion inéluctable est que les
différences d’avis font partie intégrante de la Torah, même dans son expres-
sion céleste, et que c’est ainsi qu’elle a été confiée aux humains.
Cette conviction donna à la littérature halakhique ashkénaze son visage
si particulier. Les érudits ashkénazes produisirent à partir du XIe siècle un
foisonnant corpus de littérature proprement halakhique et non pas vouée
exclusivement à l’exégèse talmudique. Cependant, ces ouvrages ressem-
blaient plus à des recueils jurisprudentiels qui ne disaient pas la Loi dans
l’absolu mais collationnaient verdicts, responsa, interprétations talmudiques
et exempla à partir desquels le juriste était supposé former son propre juge-
ment. Ils étaient typiquement arrangés selon l’ordre des traités du Talmud,
attestant ainsi que la Loi doit idéalement être déduite du Talmud lui-même.
On n’y tentait pas d’organiser systématiquement les sources contradictoires,
encore moins de trancher entre elles : il s’agissait juste de fournir le plus de
grain à moudre aux rabbins des générations futures. Les ‘Amudei ha-Gola de
R. Mosheh b. Ya‘akov de Coucy (milieu du XIIIe siècle), plus connus sous le
titre de Sefer Mitsvot Gadol ou Smag, constituent un exemple parlant de cette
démarche. Son modèle avéré est l’œuvre maïmonidienne, qu’il suit servile-
ment en précisant les sources talmudiques sciemment omises par Maïmo-
nide et en y adjoignant les traditions de la France des Tossafistes. Au surplus,
il met un point d’honneur à préciser, dès son introduction à la partie sur les
commandements positifs, que son œuvre ne doit surtout pas être considé-
rée comme le mot de la fin dans la discussion halakhique ; au contraire, ce
qu’il propose au lecteur, c’est d’y trouver le point de départ d’une étude plus
approfondie. Le contraste est saisissant avec la célèbre proclamation de Maï-
monide dans l’introduction du Mishneh Torah, à savoir que la publication de
celui-ci rendait inutile le recours à quelque autre code halakhique que ce soit
pour décider du permis et de l’interdit.
Ce malaise, sinon ce rejet, face à la prétention d’avoir atteint l’expression
ultime de la vérité halakhique fut à l’origine de la réaction ashkénaze à la
diffusion des codes rédigés dans l’aire séfarade. Cette réaction prit la forme
déjà annoncée par le Sefer Mitsvot Gadol : l’adjonction à ces codes séfarades de
copieuses gloses reflétant les traditions ashkénazes. C’est ainsi que deux dis-
ciples de R. Meïr b. Barukh de Rothenburg (1215-1293), R. Meïr ha-Kohen de
Rothenburg (actif v. 1280), auteur des Hagahot Maïmuniyyot, et R. Mordekhai
75
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 75 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
b. Hillel ha-Kohen (1240-1298), auteur du Mordekhi (ou Mordekhai), compo-
sèrent leur œuvre sous la forme de gloses du Mishneh Torah et des Hilkhot
ha-Rif respectivement. Les Hagahot Maïmuniyyot comme le Mordekhi sont de
gigantesques et précieux compendiums des traditions ashkénazes depuis
le Xe siècle – mais elles utilisent des ouvrages séfarades pour transmettre
les traditions de l’aire franco-germanique. Cela a pour résultat de mettre
en échec, ipso facto, la finalité de ces codes qu’ils font mine de compléter,
puisqu’ils introduisent une multiplicité d’opinions dans des ouvrages pré-
tendant à une vérité univoque. Ainsi que le disait R. Meïr de Rothenburg
(Teshuvot Maharam, Berlin, n0 223 et 286), « la Loi suit toujours le Rif – sauf
quand les Tossafot sont en désaccord »…
Le même motif se répète dans le monde ashkénaze du XVIe siècle, main-
tenant centré sur la Bohême et la Pologne. La publication du Shul’han ‘Arukh
suscita deux réactions liées l’une à l’autre. R. Yehuda Loew de Prague, dit le
Maharal (1525-1609), et les membres de son cercle lancèrent une campagne
agressive contre l’idée même de la composition de codes : selon eux, tout
processus de décision halakhique devait s’ancrer dans une étude serrée
du Talmud et de ses commentaires classiques avant de passer à la prise en
considération des débats ultérieurs pour en arriver finalement à un verdict.
Tel était également le principe méthodologique exprimé par R. Shelomo
Luria dans son Yam shel Shelomo.
Une critique plus nuancée de l’entreprise de R. Y. Caro fut formulée par
R. Mosheh Isserles (1525-1572). Avant que le Beit Yossef ne fût publié, il avait
envisagé d’écrire un commentaire des Arba‘a Turim, une sorte de mise à jour
de ce classique du XIVe siècle. Cependant, contrairement à l’auteur du Beit
Yossef, il n’entendait pas parvenir à des conclusions définitives mais simple-
ment rassembler toutes les approches afin de fournir aux décisionnaires le
matériau de base qui leur permettrait de formuler leurs propres conclusions
– démarche analogue à celle du Smag. Quand il reçut un exemplaire du Beit
Yossef, il se rendit compte que son projet était rendu redondant par le chef-
d’œuvre de R. Y. Caro et décida de se limiter à la rédaction de compléments
et de remarques sur le Beit Yossef, lesquels porteraient le titre de Darkei Mos-
heh. Cet ouvrage rassemblerait les opinions légales et les pratiques deve-
nues coutumières dans le monde ashkénaze mais différentes de l’habitude
séfarade.
Les gloses de R. M. Isserles sur le Beit Yossef, prolongées par ses notes
sur le Shul’han ‘Arukh intitulées Ha-Mappa, sont le reflet d’une méthodolo-
gie typiquement ashkénaze : rarement un avis halakhique est-il présenté
comme seul vrai ; il n’a préséance que parce qu’il reflète la pratique courante
(on retrouve souvent l’expression ve-khen nohagin, « ainsi a-t-on coutume
76
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 76 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
d’agir en pratique »). Le refus d’exprimer un avis définitif transpire de
chaque ligne. L’apport des gloses de R. M. Isserles relève donc d’une ironie
de l’histoire. On a coutume de dire qu’en complétant l’œuvre de R. Y. Caro
par la mention des traditions halakhiques ashkénazes elles ont permis
au Beit Yossef et, plus encore, au Shul’han ‘Arukh de faire autorité dans l’en-
semble du monde juif connu (à l’exception du Yémen, alors coupé du reste
du monde et qui devait rester fidèle à une halakha strictement maïmoni-
dienne). Tout cela est très vrai : mais, paradoxalement, l’autorité du Shul’han
‘Arukh n’a pu s’imposer que parce que les gloses de R. M. Isserles l’avaient
dépouillé de sa raison d’être même, à savoir la quête de l’unité et de l’uni-
formité halakhiques.
Qu’on la célèbre ou qu’on la déplore, la multiplicité des avis constituait un
trait dominant de la halakha médiévale. Elle s’enracinait dans la myriade de
controverses sur lesquelles les rédacteurs finaux du Talmud s’étaient abstenus
de prendre position et se nourrissait de l’immense littérature d’exégèse talmu-
dique et de verdicts halakhiques que produisait la diaspora. Si la tradition des
Geonim fournissait quelques règles indiquant comment trancher les débats
entre différents maîtres du Talmud tels Rav et Shemuel ou Abayé et Rava, il
n’existait aucun critère pour se repérer au milieu des opinions des Geonim
eux-mêmes et a fortiori parmi celles de leurs successeurs. Chaque commu-
nauté, chaque tradition devait voir se développer un kaléidoscope de telles
règles de préséance entre les différents auteurs et autres méthodes de décision
halakhique. Nous nous limiterons ici aux aspects les plus importants.
L’AUTORITÉ DES SOURCES : LE TALMUD
À partir du Xe siècle, l’autorité du Talmud de Babylone était universellement
reconnue comme suprême et constituait le point de départ de toute discus-
sion halakhique. Aucun argument ne pouvait être avancé s’il ne s’appuyait pas
sur une source talmudique implicite ou explicite. Ce n’est que quand le Tal-
mud de Babylone s’avérait in fine muet sur un sujet qu’il devenait légitime de
recourir à d’autres sources rabbiniques comme le Talmud de Jérusalem. Le
processus qui éleva le Talmud de Babylone à cette position hégémonique
fut long et complexe, et il existe plusieurs théories qui se proposent de dire
pourquoi, en dernier ressort, le Talmud de Babylone est effectivement supé-
rieur à toutes les autres sources. À la fin du traité ‘Eruvin, R. Isaac al-Fassi
explique que c’est parce qu’il est, objectivement, qualitativement supérieur à
tous les autres textes, notamment parce qu’il est plus exhaustif et qu’il prend
en compte, de manière critique, les apports des maîtres des générations
77
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 77 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
précédentes, en particulier celui du Talmud de Jérusalem, compilé plus tôt.
Rashi adopte la même approche (cf. T. B. Baba Metsi‘a 86a, s. v. sof horaa). Maï-
monide, pour sa part, postule que le Talmud aurait été ratifié par l’ensemble
du peuple juif et aurait ainsi acquis la même autorité que les décrets solen-
nels de l’antique Sanhédrin (« Introduction » au Mishneh Torah, s.v. nimtsa
Ravina ; cf. Hilkhot Mamrim 2, 3). Ce sentiment est partagé aussi bien par
R. Mosheh de Coucy (Smag, « Introduction aux commandements négatifs »,
s.v. u-v-yemei Rabbeinu) que par R. Yossef Caro (Kessef Mishneh sur Hilkhot
Mamrim 2, 1).
Quoi qu’il en soit, le Talmud se trouvait au-delà de toute controverse et
faisait systématiquement autorité. La question se posa alors de savoir si les
maîtres des périodes postérieures à la clôture du Talmud jouissaient d’une
autorité similaire. À l’époque où les Geonim de Babylonie dominaient le dis-
cours halakhique, en particulier dans les pays d’Islam, certains professaient
que leurs avis avaient automatiquement force de loi, sans qu’il fût possible
de critiquer leur raisonnement. Ce n’est qu’à partir du XIIe siècle qu’on vit
naître un autre consensus, à savoir que le Talmud constituait chronologi-
quement la dernière instance absolument indiscutable. Certes, les sages pos-
térieurs, en particulier les Geonim mais aussi le Rif ou les Halakhot Gedolot,
devaient être abordés avec crainte et déférence ; mais leur avis pouvait néan-
moins être réfuté sur la base d’arguments suffisamment convaincants (cf. le
Rosh sur T. B. Sanhédrin 4, 6).
LES RISHONIM, « DES NAINS JUCHÉS SUR LES ÉPAULES DE GÉANTS »
L’absence d’une instance décisionnaire unique et universellement recon-
nue imprima un tour fortement décentralisé au processus de décision
halakhique. On attendait des spécialistes qu’ils soumettent à un regard cri-
tique l’ensemble des sources talmudiques et post-talmudiques traitant d’un
problème donné et qu’ils en tirent une conclusion argumentée. Le verdict
qui en découlait était valable dans la mesure où il ne présentait pas de failles
logiques ; il ne constituait pas pour autant une jurisprudence sur laquelle
on aurait pu se fonder sans nouvel examen. Ainsi que l’exprime R. Samuel
b. Meïr (Rashbam, v. 1080/5-v. 1174), « il faut décider en fonction de son avis
propre, car ein la-dayan é la ma she-‘einav ro’ot, “le juge n’a rien d’autre que ce
que ses yeux voient.” » (Rashbam sur T. B. Baba Batra 131a, s. v. ve-lo tigmeru.)
Ou, selon les mots de Maïmonide : « Si l’un des Geonim détermine que tel
verdict est le bon et qu’il apparaît à un tribunal plus tardif que ledit verdict
est incompatible avec les conclusions légales qui se déduisent du Talmud,
78
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 78 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
alors il ne doit pas se fonder sur le premier avis mais sur celui qui lui appa-
raît le plus rationnel, qu’il soit plus ancien ou plus récent. » (« Introduction »
au Mishneh Torah, s. v. nimtsa Ravina.)
Néanmoins, partout et en chaque génération, ces halakhistes indépen-
dants témoignaient d’une profonde révérence pour l’avis des savants des
générations précédentes, qu’ils considéraient comme supérieurs à eux-
mêmes. Dans le Talmud même, on trouve fréquemment exprimée la notion
que les générations précédentes étaient d’une plus grande valeur, et cette
idée devint un leitmotiv de la littérature halakhique médiévale : « Le cœur
des Anciens était large comme la porte du ulam [l’antichambre du Temple],
celui des générations suivantes seulement comme la porte du heikhal
[la partie médiane du Temple], et le nôtre n’est pas plus large qu’une tête
d’épingle. » (T. B. ‘Eruvin 53a.) Maïmonide lui-même, pourtant le parangon
de l’indépendance halakhique, se défend dans une lettre d’avoir différé de
l’avis de R. Isaac al-Fassi sur plus d’une dizaine de points (Iggerot ha-Ram-
bam, Jérusalem, Y. Shilat, 1987, p. 435). De même, son contemporain R. Abra-
ham b. David de Posquières (v. 1125-1198), l’un des talmudistes médiévaux
les plus critiques et indépendants, voua aux gémonies son voisin et collègue
R. Zera’hia ha-Lévi de Gérone (auteur du Sefer ha-Maor sur le Rif ), pour avoir
eu l’audace de critiquer les Geonim (Sefer ha-Maor sur Rif 12a s. v. Bava Revi‘a
et Hassagot ha-Raavad, ad loc). Plus tard, Nahmanide composa un contre-
commentaire du même Sefer ha-Maor intitulé Mil’hemet ha-Shem (La Guerre
du Saint Nom), dans lequel il entendait démontrer l’inanité de toutes les cri-
tiques de R. Zera’hia sur les conclusions du Rif.
Malgré tout, il n’y avait pas, avant la seconde moitié du XIVe siècle, d’ob-
jection de principe à la capacité d’érudits, même mineurs, à suivre leurs
propres conclusions, même si ces dernières s’avéraient contraires à l’avis de
géants de la halakha. La logique qui sous-tendait une telle attitude a été for-
mulée sur un mode désormais fameux par un maître tardif du Moyen Âge
italien, R. Yesha’ya dit Trani l’Ancien, dit le Rid (1200-v. 1260). Dans un res-
ponsum souvent repris, il justifie son rejet d’un verdict émanant de Rabbeinu
Tam, qui était déjà une légende à l’époque : « Même quand il me semble
avoir critiqué avec raison l’avis d’un maître des générations précédentes, je
ne pousse pas l’arrogance jusqu’à prétendre, D.ieu préserve, que “ma sagesse
plaide pour moi” (Qohélet 2, 9). Je m’applique plutôt la maxime des philo-
sophes : “Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants” […] Nous
connaissons leur sagesse et nous nous fondons sur elle ; c’est par la vertu de
leur sagesse que nous sommes devenus suffisamment sages pour dire ce
que nous disons ; mais de là il ne découle nullement que nous sommes plus
grands qu’ils ne l’étaient. » (Teshuvot ha-Rid, n0 62.) En recourant à ce proverbe
79
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 79 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
issu de la scolastique chrétienne, le Rid déférait ainsi à la supériorité innée
des grandes figures du passé tout en préservant sa liberté d’interprétation et
de décision halakhiques.
La révolution maïmonidienne
Dans les années 1170, alors qu’il réside en Égypte, le talmudiste et philo-
sophe R. Mosheh b. Maïmon, dit Maïmonide ou Rambam, rédige un code
de loi appelé à révolutionner l’étude. Le titre est en lui-même un pro-
gramme : le Mishneh Torah (Récapitulation de la Torah) vise à rien de moins
qu’à synthétiser dans un code logiquement ordonné tout le savoir biblique,
talmudique et post-talmudique – en fait, comme Maïmonide l’exprime
quasi explicitement dans son introduction, à supplanter le Talmud. « Mish-
neh Torah » est aussi un terme qui désigne le Deutéronome, le dernier livre
du Pentateuque, dans lequel Moïse, avant sa mort, récapitule aux enfants
d’Israël toute la Loi donnée au Sinaï… Ce « péché d’orgueil » est encore
aggravé, aux yeux des contemporains de Maïmonide, par le fait qu’il ne se
réfère jamais (à de très rares exceptions près) aux sources talmudiques ou
extratalmudiques auxquelles il prétend puiser, ce qui rend difficile le débat
rabbinique et, surtout, interdit au lecteur d’opérer une lecture critique de
l’œuvre en la confrontant à ses sources. L’ouvrage donne lieu à l’écriture de
gloses critiques notant les divergences possibles, en particulier les Hassagot
de Raavad (III). Il n’en demeure pas moins que l’opus, en quatorze parties
qui couvrent l’ensemble de la Loi, même les aspects non applicables après la
destruction du Temple, s’impose comme une œuvre absolument majeure,
non seulement en tant que référence légale, mais aussi en tant qu’expres-
sion de raisonnements talmudiques implicites, souvent beaucoup plus ré-
volutionnaires qu’il n’y paraît, que les générations de talmudistes ultérieurs
vont s’attacher à expliciter. C’est ainsi que le Mishneh Torah va s’imposer
autant comme l’une des sources principales du Shul’han ‘Arukh que comme
outil privilégié d’étude talmudique, en particulier dans l’école de Brisk.
DES RISHONIM AUX A‘HARONIM
L’historiographie rabbinique traditionnelle distingue deux ères distinctes
dans l’histoire post-talmudique : celle des Rishonim, littéralement « les pre-
miers », et celle des A’haronim, « les derniers ». C’est R. Yossef Caro qui est
généralement considéré comme la figure charnière, à cheval sur les deux
80
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 80 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
Page d’un des manuscrits autographes du Mishneh Torah de Maïmonide retrouvés dans
la geniza de la synagogue Ben ‘Ezra de Fustat (vieux Caire), la fameuse Geniza du Caire.
L’existence de plusieurs de ces manuscrits autographes, portant trace de nombreuses
corrections, atteste de la longue élaboration de ce code qui en est venu, pour les généra-
tions ultérieures, à constituer une grille de lecture privilégiée du Talmud.
époques. Les A’haronim diffèrent des Rishonim selon deux aspects. Tout
d’abord, les Rishonim sollicitent directement le texte talmudique (prenant
seulement appui, à l’occasion, sur le commentaire de Rashi) alors que les
A’haronim lisent le Talmud à travers le prisme des divers commentaires des
Rishonim. De ce fait, l’essentiel de leur tâche consiste à élucider les com-
mentaires des Rishonim et les options exégétiques qui les sous-tendent, et
à les défendre ainsi contre les objections de leurs collègues. Par ailleurs, les
A’haronim considèrent par principe que l’avis des Rishonim est souverain et
ils ne s’autorisent généralement pas à adopter des positions qui n’auraient
pas d’appui explicite ou implicite dans les écrits des autorités médiévales.
Si l’on adopte ces critères, il nous semble que la frontière entre le monde des
Rishonim et celui des A’haronim doit être déplacée en amont dans le temps,
deux siècles plus tôt, dans la seconde moitié du XIVe siècle. Là, on observe tant
dans le monde ashkénaze qu’en Espagne un changement de paradigme qui
81
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 81 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
amène les halakhistes à se considérer comme fondamentalement inférieurs en
intelligence et en autorité à ceux qui sont pour eux les Rishonim, les maîtres
des trois siècles précédents. Les écrits de ces derniers deviennent la grille de
lecture incontournable du Talmud et la critique de leurs diverses approches
n’est plus acceptable. Cette évolution peut être expliquée par plusieurs fac-
teurs. Le XIVe siècle vit le monde juif secoué par des révoltes, des persécutions
et des errances, que ce fût en Allemagne à la suite de la Peste noire de 1348-1349
ou en Espagne à la suite des émeutes antijuives de Tolède et Barcelone en 1391.
Ces événements pourraient bien avoir amené les générations des survivants à
se représenter leurs prédécesseurs comme des modèles inatteignables. Mais
en même temps, la littérature rabbinique d’Espagne et d’Allemagne composée
dans les décennies précédant ces événements tragiques montre déjà quelques
signes d’épuisement. Autrement dit, il est plausible que l’approche immédiate
du Talmud, qui caractérisait le travail des Rishonim, soit arrivée à son terme
naturel, nonobstant l’apport révolutionnaire de la dialectique tossafiste. La
canonisation du corpus des Rishonim serait donc née des mêmes causes, tant
externes qu’internes, que celles qui avaient entraîné la clôture du Talmud. La
créativité devait dorénavant s’exprimer dans l’exploration des voies nouvelles
ouvertes par la constitution des Rishonim en corpus.
Ce changement de focale, du gros plan talmudique au plan large des com-
mentaires des Rishonim, donna l’impulsion de la casuistique talmudique de
la fin du Moyen Âge, connue dans le monde ashkénaze sous le nom de pilpul
et sous celui de ‘iyyun dans l’aire séfarade. L’un comme l’autre postulaient
que les Rishonim étaient infiniment supérieurs aux écrivains postérieurs :
leurs commentaires étaient supposés avoir été rédigés avec une précision
absolue, une attention à chaque mot qui exprimait non seulement les idées
explicitement présentes dans leurs discours, mais chargeait celui-ci de tous
ses développements possibles et de la réfutation de toutes les objections
qu’on pourrait vouloir lui opposer. Il s’agissait donc de scruter la formu-
lation précise des Rishonim pour y lire de nouvelles strates de sens et des
débats inédits.
Les conséquences de cette approche novatrice se firent sentir de manière
particulièrement profonde dans le domaine de la halakha ashkénaze. L’in-
tense sentiment de révérence sacrée face aux autorités de l’ère précédente
qui animait les halakhistes ashkénazes du Moyen Âge tardif les conduisit à
se refuser absolument à choisir entre les avis concurrents des divers Risho-
nim. Les décisionnaires se retrouvaient alors dans une position intenable,
puisqu’on ne pouvait ni faire abstraction des Rishonim, ni suivre l’un plutôt
que l’autre. Il fallait pourtant bien décider et ne pas s’abandonner à la yir’at
82
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 82 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
horaa. La résolution de ce nouveau dilemme fut rendue possible par l’élabo-
ration de stratégies nouvelles.
La première de ces stratégies se dénomme hashvaat ha-de‘ot (« faire conver-
ger les approches »). Sa prémisse est que l’évidente multiplicité des avis, sou-
vent contradictoires, des Rishonim sur chaque point de la Loi ne préjuge pas
de leur accord dans certains cas précis. Tout l’art du décisionnaire consiste
donc à mobiliser les ressources du pilpul pour démontrer que les divergences
générales se résolvent dans l’examen des cas concrets et que les divers Ris-
honim conduisent tous, chacun par un cheminement propre, aux mêmes
conclusions pratiques. Ainsi, les divergences entre Rishonim sont pure-
ment conceptuelles mais n’entraînent aucune dissonance dans la pratique
du décisionnaire, qui n’a donc pas à choisir entre elles. Il faut noter que plus
tard, en particulier dans le monde des yeshivot lituaniennes, c’est l’approche
inverse qui sera favorisée : on postulera que chaque Rishon majeur incarne
une approche talmudique globale, cohérente et irréductible à celle de ses
collègues, même si une lecture rapide peut donner l’impression qu’ils disent
plus ou moins la même chose. On cherchera à préciser les postulats fonda-
mentaux implicites de chaque Rishon dans son approche d’un passage talmu-
dique donné, et l’on contrôlera que les approches ont bien été différenciées
en vérifiant qu’elles aboutissent à des conséquences halakhiques différentes,
comme on vérifie une équation : après tout, si deux démarches conceptuelles
ne produisent pas des effets différenciables, alors elles sont invérifiables.
On fit aussi largement appel aux règles heuristiques traditionnelles de
décision de la halakha dont on trouve la trace dès les premières strates du
Talmud. Parmi celles-ci, la règle d’avis majoritaire, énoncée dans la Bible
à propos du fonctionnement d’un tribunal dont la décision suit le vote de
la majorité (selon une lecture midrashique d’Exode 23, 2), puis étendue aux
controverses entre les maîtres de la Mishna, ensuite au débat entre Risho-
nim ; mais aussi les règles gouvernant l’état présomptif d’une situation, par
exemple en cas de dispute monétaire (uqi mamona be-’hezkat mareh, « une
somme d’argent est présumée appartenir à celui qui la détient actuellement,
et en cas de doute le statu quo est préservé »), celles qui gouvernent la résolu-
tion des doutes (sfeka de-Oraita le-’humra, sfeka de-rabbanan le-kula, « si le doute
porte sur une loi d’origine biblique, on se montre strict, s’il porte sur une loi
rabbinique, on se montre accommodant »), et ainsi de suite. À leur tour, ces
préoccupations qui venaient à prendre une place plus essentielle qu’aupa-
ravant donnèrent naissance à une littérature nouvelle consacrée aux prin-
cipes généraux de la halakha, les kelalim. L’application technicienne de ces
principes, perçus comme faisant partie intégrante de l’héritage halakhique
des Rishonim ashkénazes, permit aux A’haronim de décider entre des avis
83
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 83 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
contradictoires sans que cela requît d’eux d’assumer la responsabilité spiri-
tuelle ou morale que suppose ordinairement la charge de décisionnaire. Les
halakhistes ultérieurs iront même plus loin : s’inspirant de la notion exposée
plus haut selon laquelle toute controverse halakhique a une origine céleste,
ils expliqueront qu’une divergence entre Rishonim, et plus largement tout
débat talmudique non résolu, doit être appréhendée non comme un accident,
mais comme un doute factuel, aussi réel que tout autre doute pouvant sur-
gir quant au statut d’un objet ou d’une situation, et ayant les mêmes consé-
quences halakhiques, par exemple pour la combinatoire de doutes cumulés
(sfek sfeka), objet de très nombreuses analyses. R. Yossef Teomim (1727-1792), en
particulier, fera de cette réification de la controverse halakhique un des outils
majeurs de ses investigations (cf. Pri Megadim, Siftei Da‘at sur Yoreh De‘a 110,
Kuntress ha-sefekot ha-me’hudashim 3, ou encore Peti’ha le-hilkhot ta‘arovet 1, 1).
HILKHATA KE-BATRAEI, « LA HALAKHA SUIT LES AUTORITÉS DERNIÈRES VENUES »
De tous ces outils mis en œuvre pour aussi bien garantir la révérence et la
déférence envers les Rishonim que préserver l’indépendance du décision-
naire, il en est un qui se distingue, c’est la règle énonçant que hilkhata ke-batraei
(« la halakha suit les autorités dernières venues »). Il s’agit d’une règle d’ori-
gine géonique, bien qu’elle ait des antécédents talmudiques (Teshuvot ha-Geo-
nim, Sha‘arei Tsedek IV, 3, n0 31 ; ’Hiddushei ha-Ritva sur Sukka 2a s. v. ve-yesh). La
logique en est que si les Geonim eux-mêmes se déclaraient incompétents pour
trancher un débat entre des Amoraïm des premières générations, comme Rav
et Shemuel, les Amoraïm des générations suivantes, c’est-à-dire du IVe siècle et
après, comme Abayé et Rava, étaient suffisamment proches des premiers pour
évaluer et décider de la validité des avis respectifs. Dans l’exemple donné, la
halakha suivait l’avis de Rav ou de Shemuel retenu par Abayé et Rava comme
base de leurs propres débats. On a vu que c’est le même argument que R. Isaac
al-Fassi avait convoqué pour justifier la préséance du Talmud de Babylone
sur celui de Jérusalem : c’est précisément parce qu’il était venu après qu’on
était fondé à supposer que, quand il optait pour des conclusions différentes,
c’était pour de bonnes raisons, et en pleine connaissance des élaborations
de son prédécesseur. L’application de ce principe resta cependant confinée
aux générations des maîtres cités dans le Talmud, qui relevaient d’un ordre
qualitativement différent de celui des époques postérieures, celle des Geonim
et plus encore celle des Rishonim. On n’aurait jamais songé à préférer l’avis
d’un gaon à celui d’un Amora, même s’il lui était postérieur. Au demeurant,
à l’intérieur du Talmud lui-même, un Amora n’était pas censé s’opposer à un
84
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 84 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
Tanna sauf s’il pouvait s’appuyer sur l’avis d’un autre Tanna. La seule exception
était la génération de transition entre Tannaïm et Amoraïm, dont faisait partie
Rav ; c’est ainsi que Rav Tanna u-palig (« Rav est aussi un Tanna, et il peut dès
lors contredire un autre Tanna »). Dans les limites mêmes de la période des
Rishonim, celle-ci voyait foisonner un nombre tellement important d’ap-
proches indépendantes, dans un contexte historique et géographique telle-
ment éclectique, que l’application de ce principe à court terme en était rendue
pratiquement impossible.
Le milieu du XIVe siècle, que nous avons identifié comme la charnière entre
l’ère des Rishonim et celle des A’haronim, vit ce principe revenir en force. Les
massacres endurés par les Juifs allemands après la Peste noire, tout comme
les expulsions répétées des Juifs du domaine royal capétien en 1306, 1322 et
1394, firent naître le sentiment que les maîtres des générations d’avant étaient
les derniers d’une époque qui prenait fin d’une manière abrupte. R. Meïr de
Rothenburg et ses élèves, en particulier, furent considérés comme ayant été les
mieux placés pour évaluer de manière critique les différentes approches des
Tossafistes et autres maîtres des siècles précédents et pour retenir les avis à
suivre dans la pratique. Leurs décisions obligeaient donc les générations ulté-
rieures. Le principal héraut de cette approche, R. Yossef Colon Trabotto, dit
le Maharik (1420-1480), allait jusqu’à préciser que l’avis des derniers décision-
naires faisait autorité même s’il contredisait les conclusions de la majorité des
Rishonim (Teshuvot Maharik nos 84 et 94). Mais ces « derniers décisionnaires »
étaient par définition les ultimes maîtres d’une époque définitivement révo-
lue, en aucun cas des contemporains ni même des quasi-contemporains :
il s’agissait comme toujours de trouver un équilibre entre la révérence des
maîtres anciens et la préservation d’une possibilité vitale de choisir entre leurs
avis contradictoires. Ce sentiment de déférence trouva à s’exprimer sur un
mode ironique dans les limites mêmes de ses conditions d’application. Dans
un responsum qui nous a été préservé par R. M. Isserles, le Maharik note que la
logique même de la règle hilkhata ke-Batraei repose sur le postulat que l’auto-
rité dernière avait connaissance de la totalité des avis de ses prédécesseurs.
Si, à l’inverse, le décisionnaire contemporain se trouvait découvrir l’avis d’un
Rishon dont il était clair que l’autorité dernière n’avait pas, ou pas pu, avoir
connaissance, alors le débat n’était pas clos et l’on pouvait s’appuyer sur le ver-
dict nouvellement découvert en supposant que l’autorité dernière aurait pu
s’y conformer si elle en avait eu connaissance (Rema sur ’Hoshen Mishpat 25, 2).
En se conformant systématiquement à ces règles techniques, les décision-
naires ashkénazes s’épargnaient ainsi de devoir réévaluer l’intégralité de la
jurisprudence et du cheminement halakhique sur un sujet donné, du Talmud
jusqu’aux Rishonim les plus tardifs – et cette attitude fut vigoureusement
85
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 85 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
critiquée par les membres du cercle du Maharal de Prague. Les savants séfa-
rades et orientaux, pour leur part, ne les suivirent pas dans cette stratégie
et développèrent diverses méthodes de décision halakhique sur le pourtour
du bassin méditerranéen et au Moyen-Orient, méthodes qui ont été encore
peu étudiées. On peut néanmoins en esquisser quelques traits. La diffusion
de l’imprimerie, en particulier, donna accès à un nombre de sources sans
commune mesure avec ce à quoi les générations précédentes pouvaient avoir
accès. Cette abondance de matériau demandait à être maîtrisée et évaluée,
encourageant les décisionnaires à mettre l’accent sur la maîtrise encyclo-
pédique du plus grand nombre d’avis possible plutôt que sur l’évaluation
critique d’un nombre restreint de sources. De ce fait, on fit également un
usage prépondérant du jugement à la majorité des décisionnaires, tandis
que d’autres règles défendues par les maîtres ashkénazes, telles que hilkhata
ke-Batraei, étaient adoptées avec plus de parcimonie.
CONSIDÉRATIONS MÉTAHALAKHIQUES
Au cœur de la conscience religieuse juive se trouve la relation dialectique
tendue entre l’essence de la religion et sa manifestation, entre le judaïsme
comme architecture légale et le judaïsme comme expérience historique. La
halakha est l’inévitable manifestation, la concrétisation obligatoire d’une essence
spirituelle qui l’étaie et la dépasse, cette force religieuse tout à la fois volatile,
magnétique et incompressible qu’on appelle judaïsme. (Twersky, 1974, p. 69.)
La halakha assure stabilité et uniformité tandis que la spiritualité (la aggada)
sensibilise l’individu à la nature profonde de l’expérience religieuse et
imprègne l’observance de la Loi religieuse de signification et de contenu
expérientiel. Différentes disciplines ont, au long des siècles, fourni ce
nécessaire contenu spirituel : le commentaire biblique, l’éthique, la philo-
sophie, la mystique, le piétisme, etc. Quelles qu’elles aient pu être, il a tou-
jours été clair, implicitement, qu’une division du travail s’opérait entre elles
et la halakha, cette dernière étant supposée fonctionner comme un système
clos et autonome. Les considérations idéologiques ou spirituelles n’étaient
pas censées exercer une influence sur l’acte formel du verdict halakhique ;
elles devaient se contenter de fournir une interprétation idéelle de la Loi
qui leur préexistait et de servir à l’édification spirituelle de l’individu qui
s’y adonnait.
À une exception près, cette imperméabilité du domaine halakhique fut
respectée par toutes les disciplines métahalakhiques. Ainsi, chez Maïmonide,
86
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 86 13/08/12 14:58
UNE LOI TOUJOURS ACTUELLE : LE PROCESSUS HALAKHIQUE
on observe bien que son magnum opus halakhique, le Mishneh Torah, témoigne
d’un profond souci philosophique et reflète sa conviction que la philosophie
constitue la source et l’expression authentiques de la spiritualité juive (Guide
des égarés I, 71 et Mishneh Torah, Hilkhot Yessodei ha-Torah 4, 13) ; pourtant, les
considérations et les idées philosophiques ne jouent pratiquement aucun
rôle dans la détermination des verdicts et des arguments halakhiques qui les
composent. Tout au plus Maïmonide fait-il entrer l’étude de la philosophie
dans l’obligation générale d’étudier la Torah (Hilkhot Talmud Torah 13, 13 et
Hilkhot Rotsea’h 7, 1) et s’abstient-il de codifier (ou alors sur un mode ratio-
naliste) des passages talmudiques qui ont un parfum de superstition ou de
théurgie (Hilkhot Tefillin, Mezuza ve-Sefer Torah 6, 13).
La seule exception à cette étanchéité des disciplines, et c’est une excep-
tion de taille qui devait avoir des conséquences majeures, fut constituée par
la kabbale à partir du Zohar. Le Zohar enseignait que la moindre pointe de
lettre de la Torah, le moindre détail halakhique et rituel, exprimaient, incar-
naient et rendaient présentes des significations ésotériques incommensu-
rables, reflets de réalités célestes éternelles et ineffables. Il était donc d’une
importance cruciale que la halakha fût conforme aux significations secrètes
que les kabbalistes lui attribuaient, ce qui était généralement le cas. Il exis-
tait cependant de nombreux cas où la halakha telle qu’elle se déduisait du
corpus des Rishonim structuré par les règles de décision classiques contre-
disait les impératifs ésotériques. La Torah (Deutéronome 25, 5-10) décrit ainsi
l’obligation du lévirat ou yibbum, qui lie une veuve qui n’a pas eu d’enfants
de son mari au frère de ce dernier, lequel doit soit l’épouser « afin de perpé-
tuer le nom de son frère », soit la délier par la cérémonie du déchaussement
ou ’halitsa. Le Talmud, qui conçoit essentiellement cette institution biblique
comme un moyen de réguler les conflits d’héritage, dispute de savoir s’il
convient, a priori, de privilégier le yibbum ou la ’halitsa (T. B. Yevamot 39b).
Longtemps débattue, la question fut tranchée en pratique différemment
dans le monde ashkénaze, où l’on interdit la pratique du yibbum et où l’on
rendit la pratique de la ’halitsa obligatoire, du monde séfarade et oriental
où l’on donna la priorité au yibbum, la ’halitsa restant possible à défaut. Ces
coutumes divergentes trouvaient cependant l’une comme l’autre leur origine
dans des arguments purement halakhiques. Survinrent alors les kabbalistes
qui, dès Nahmanide (lequel est antérieur à l’émergence du Zohar sur la scène
de l’histoire), affirmaient avec force que le yibbum constituait un devoir spi-
rituel suprême, puisqu’il permettait à l’âme du défunt de se réincarner dans
sa « descendance » (Ramban sur Genèse 38, 8 s. v. ve-yabbem) : il avait donc
halakhiquement priorité sur la ’halitsa.
Dans ce cas comme dans d’autres, les halakhistes d’inclination kabbaliste
87
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 87 13/08/12 14:58
AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
cherchaient à unifier les approches ésotérique et légale. Les maîtres espa-
gnols en vinrent ainsi à énoncer des principes heuristiques selon lesquels,
notamment, le Zohar avait préséance sur toutes les autres sources dès lors
qu’il ne contredisait pas une conclusion explicite du Talmud de Babylone.
Par ce biais, la kabbale fut cooptée par le discours halakhique, privilège que
ne connut jamais aucune autre littérature spirituelle (Teshuvot Beit Yossef, tes-
huvot R. Yits’hak Caro n0 1 et Beit Yossef sur Ora’h ’Haim 31).
UNE MENTALITÉ DE CONTINUITÉ
La Mishna (Yoma 7, 1) raconte qu’à Yom Kippour, après avoir lu les passages
prescrits pour ce jour dans le rouleau de la Torah, le grand prêtre déclarait :
« Il y a dans ce rouleau bien plus que ce que je vous ai lu. » La même remarque
s’impose alors que nous concluons ce bref survol des processus de décision
halakhique de l’âge classique. Avant de clore cette discussion, il nous semble
important de dire un dernier mot de l’ambiance psychologique et religieuse
qui vit se développer la halakha de l’époque prémoderne. Il est essentiel
d’avoir à l’esprit que l’inviolabilité, la sainteté et l’intégrité de la Loi juive
étaient bien plus que des hypothèses de travail. Elles constituaient la trame
intime de l’existence quotidienne et unissaient les Juifs du monde entier dans
la conscience d’une unité qui ignorait les distances géographiques et tem-
porelles. Cette conscience psycho-spirituelle et métatemporelle est la toile
de fond de l’univers discursif qui vit la Loi juive se développer génération
après génération. Plus que tout, il faut comprendre que les Juifs du Moyen
Âge concevaient l’étude et l’observance de la Loi, la pratique de la décision
halakhique et du commentaire, comme des modalités très réelles du culte
rendu au Créateur. C’est cette fidélité sans faille qui unissait les différentes
expressions sociales de la vie juive et qui fait toute la différence entre leur
époque et la nôtre.
Frontispice d’une des premières éditions du Shul’han ‘Arukh, imprimée à Venise en 1598.
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 88 13/08/12 14:58
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 89 13/08/12 14:58
La matrice
de l’interprétation
talmudique
Ephraïm Kanarfogel
Judaïsme_170x240_exe_19-07-12.indd 90 13/08/12 14:58
Vous aimerez peut-être aussi
- Esquisse de Théologie Biblique Bon1Document516 pagesEsquisse de Théologie Biblique Bon1FredMotta100% (3)
- Le Guide de La OmraDocument16 pagesLe Guide de La OmraadelPas encore d'évaluation
- Glossaire Des Termes HébraïquesDocument5 pagesGlossaire Des Termes HébraïquesMiguel ChamosaPas encore d'évaluation
- 3000 Hadiths Et Citations Coraniques (1/2)Document311 pages3000 Hadiths Et Citations Coraniques (1/2)SAM90% (20)
- 1 Halakha TermesDocument2 pages1 Halakha Termeshanisim8126Pas encore d'évaluation
- VAR 57257 1001 - 06 05 2015 - 11 47 41 - AbbyyDocument22 pagesVAR 57257 1001 - 06 05 2015 - 11 47 41 - AbbyySteve KkmapPas encore d'évaluation
- TalmudDocument8 pagesTalmudSteve KkmapPas encore d'évaluation
- La Loi Du Secret 301108Document209 pagesLa Loi Du Secret 301108Messan acerPas encore d'évaluation
- PhaddadDocument10 pagesPhaddadblockchaincontinentalPas encore d'évaluation
- 2 Talmud PDFDocument2 pages2 Talmud PDFaccime24Pas encore d'évaluation
- Evangile de BarnabeDocument114 pagesEvangile de BarnabeLe Turc100% (1)
- Devoir de I G A T2Document13 pagesDevoir de I G A T2Denise KoliePas encore d'évaluation
- Junes Emile (DR.) - Etude Sur La Circoncision Rituelle en IsraëlDocument24 pagesJunes Emile (DR.) - Etude Sur La Circoncision Rituelle en IsraëlNunussePas encore d'évaluation
- Emmanuel Lévyne - Lettre D'un Kabbaliste À Un RabbinDocument19 pagesEmmanuel Lévyne - Lettre D'un Kabbaliste À Un RabbinAnonymous FaJ8Z8fPas encore d'évaluation
- Bulletin 06Document4 pagesBulletin 06AbdouPas encore d'évaluation
- Droit HébraiqueDocument8 pagesDroit Hébraiquesabatier56Pas encore d'évaluation
- Tora Orale VerbatimDocument6 pagesTora Orale VerbatimGeorges NiamadjomiPas encore d'évaluation
- Intro PentateuqueDocument10 pagesIntro PentateuqueDengo DengoPas encore d'évaluation
- Mohammed Arkoun - Le Fait CoraniqueDocument9 pagesMohammed Arkoun - Le Fait CoraniqueBob ElbrachtPas encore d'évaluation
- TBC 4Document1 pageTBC 4KOUGA ManePas encore d'évaluation
- LeTalmud1 TextDocument424 pagesLeTalmud1 Text70natcPas encore d'évaluation
- L'enseignement de David Halivni: À L'écoute Des Stammaïm Dans Le Talmud BabliDocument30 pagesL'enseignement de David Halivni: À L'écoute Des Stammaïm Dans Le Talmud BabliFlorian_LPas encore d'évaluation
- Que Sais-Je - Histoire Du Judaisme - Smilevitch EricDocument65 pagesQue Sais-Je - Histoire Du Judaisme - Smilevitch EricSamir EssghaierPas encore d'évaluation
- TalmudDocument2 pagesTalmudssymbolePas encore d'évaluation
- Hebreos Católicos: Libro de Paul Drach - La Armonía Entre La Iglesia y La Sinagoga (Volumen 1)Document613 pagesHebreos Católicos: Libro de Paul Drach - La Armonía Entre La Iglesia y La Sinagoga (Volumen 1)Hebreos Católicos de ArgentinaPas encore d'évaluation
- Marie Miran, Wahhabiyya en Côte D'ivoireDocument56 pagesMarie Miran, Wahhabiyya en Côte D'ivoireMarieMiran100% (1)
- Le Fiqh de L039imam As-Sadiq A.S Volume Numero 2Document178 pagesLe Fiqh de L039imam As-Sadiq A.S Volume Numero 2HanifPas encore d'évaluation
- La France Retournée-Edit - Royal - VayechevDocument8 pagesLa France Retournée-Edit - Royal - VayechevPaxiFlore100% (1)
- Le Shabbat Et La Terre: Sylvaine LACOUTDocument11 pagesLe Shabbat Et La Terre: Sylvaine LACOUTrenel belottePas encore d'évaluation
- Le Dialogue InterreligieuxDocument8 pagesLe Dialogue InterreligieuxAlexandre SimmerlingPas encore d'évaluation
- Zohar - Le Corpus Zoharique (C. Mopsik)Document31 pagesZohar - Le Corpus Zoharique (C. Mopsik)3am100% (1)
- Le Don de La Tora - Rav AshlagDocument18 pagesLe Don de La Tora - Rav AshlagBenhayim100% (1)
- Le Raisonnement TalmudiqueDocument34 pagesLe Raisonnement TalmudiqueAnonymous wMEqc7xTPas encore d'évaluation
- Les Normes Juridiques en IslamDocument57 pagesLes Normes Juridiques en IslamAdnane BOUKHOUBZAPas encore d'évaluation
- Résumé de Module Droit Musèlement (Y.Z) - Copie 2023Document6 pagesRésumé de Module Droit Musèlement (Y.Z) - Copie 2023Bilal hajloutiPas encore d'évaluation
- L'institution Des Synagoges Exposé PDFDocument10 pagesL'institution Des Synagoges Exposé PDFHyppolite Mboubou KuatePas encore d'évaluation
- Adolphe Neubauer. La Géographie Du Talmud (Khazarzar)Document504 pagesAdolphe Neubauer. La Géographie Du Talmud (Khazarzar)Bibliotheca midrasicotargumicaneotestamentaria100% (1)
- Debut de La Lutte Des Juifs Chrétiens Pour L'évangile de JésusDocument70 pagesDebut de La Lutte Des Juifs Chrétiens Pour L'évangile de JésusVasile Mesaros AnghelPas encore d'évaluation
- Etienne Lamotte Le Traite de La Grande Vertu de Sagesse de Nagarjuna Vol. II (1949)Document123 pagesEtienne Lamotte Le Traite de La Grande Vertu de Sagesse de Nagarjuna Vol. II (1949)Marcel RobertPas encore d'évaluation
- Documents Sur Certains WaqfsDocument50 pagesDocuments Sur Certains Waqfsludovic1970Pas encore d'évaluation
- La Torah: Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (texte intégral)D'EverandLa Torah: Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (texte intégral)Pas encore d'évaluation
- Torah Cours O. ArtusDocument301 pagesTorah Cours O. ArtusEric Zamith50% (2)
- Chapitre Préliminaire - de L'apparition Au Droit À L'héritage RomainDocument14 pagesChapitre Préliminaire - de L'apparition Au Droit À L'héritage RomainDaouda GassamaPas encore d'évaluation
- Orot PDFDocument20 pagesOrot PDFspéculairePas encore d'évaluation
- Le Rite Islamique Des Bicephalies Du ArDocument23 pagesLe Rite Islamique Des Bicephalies Du ArSoudanPas encore d'évaluation
- Le tabernacle de l’unitéDocument26 pagesLe tabernacle de l’unitéalexandre NikolicPas encore d'évaluation
- CORBIN_Islamisme et religion Arabie_1964_num_77_73_18209Document9 pagesCORBIN_Islamisme et religion Arabie_1964_num_77_73_18209Ulisse SantusPas encore d'évaluation
- Le Sahîh d'Al-BukhârîDocument4 pagesLe Sahîh d'Al-BukhârîAlexandre ThiryPas encore d'évaluation
- Modeles de Religiosite Dans L Ouest SahaDocument17 pagesModeles de Religiosite Dans L Ouest SahaTariq KiassiPas encore d'évaluation
- La Torah (édition revue et corrigée, précédée d'une introduction et de conseils de lecture de Zadoc Kahn): Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (texte intégral)D'EverandLa Torah (édition revue et corrigée, précédée d'une introduction et de conseils de lecture de Zadoc Kahn): Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (texte intégral)Pas encore d'évaluation
- Islam et politique: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandIslam et politique: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les quatre livres de philosophie morale et politique de la ChineD'EverandLes quatre livres de philosophie morale et politique de la ChinePas encore d'évaluation
- Confucius et Mencius: Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la ChineD'EverandConfucius et Mencius: Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la ChinePas encore d'évaluation
- Regard sur la Franc-Maçonnerie et l'Islam: Dialogue impossible ?D'EverandRegard sur la Franc-Maçonnerie et l'Islam: Dialogue impossible ?Pas encore d'évaluation
- Ancien et Nouveau Testament: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAncien et Nouveau Testament: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Mise en Garde Contre Le Livre - Revivification Des Sciences de La Religion (Ihyâ Uloûm Ad-Dîn)Document3 pagesMise en Garde Contre Le Livre - Revivification Des Sciences de La Religion (Ihyâ Uloûm Ad-Dîn)bismillah03100% (1)
- Dons SpirituelsversionrevueamplifieeDocument71 pagesDons SpirituelsversionrevueamplifieeVoldis LoykoPas encore d'évaluation
- Théologie - Prospérité - 32pDocument32 pagesThéologie - Prospérité - 32pGerald KoudamenouPas encore d'évaluation
- Le Coran Une Guérison Et Une Miséricorde Pour Les Croyants Abbas Al BostaniDocument223 pagesLe Coran Une Guérison Et Une Miséricorde Pour Les Croyants Abbas Al BostaniDiallolampelPas encore d'évaluation
- De La Vallee Poussin Musila Et Narada PDFDocument34 pagesDe La Vallee Poussin Musila Et Narada PDFDavid CarpenterPas encore d'évaluation
- Philippe de Vos Profile FinalDocument17 pagesPhilippe de Vos Profile FinalAli Benz0% (2)
- Michel Valsan L Islam Et La Fonction de Rene Guenon Article CompletDocument25 pagesMichel Valsan L Islam Et La Fonction de Rene Guenon Article CompletMostafa MenierPas encore d'évaluation
- L'amour Fraternel - Noyau La Source 28-11Document3 pagesL'amour Fraternel - Noyau La Source 28-11Olivier KangoPas encore d'évaluation
- Aaron Kayayan - Théologie Réformée de La LoiDocument7 pagesAaron Kayayan - Théologie Réformée de La LoiFleury FenoldPas encore d'évaluation
- UnknownDocument442 pagesUnknownPricopi Victor100% (1)
- LA CONVERSION ET LE CARÊME - DANS L'ÉGLISE ORTHODOXE - Les Lamentations D'adam PDFDocument7 pagesLA CONVERSION ET LE CARÊME - DANS L'ÉGLISE ORTHODOXE - Les Lamentations D'adam PDFdebolyPas encore d'évaluation
- Les Noms D'origine Gauloise, La Gaule Des Dieux - Jacques LACROIXDocument269 pagesLes Noms D'origine Gauloise, La Gaule Des Dieux - Jacques LACROIXLaur Elin100% (1)
- Adolf Hitler Testament Politique 2eme Guerre Mondiale LivresDocument58 pagesAdolf Hitler Testament Politique 2eme Guerre Mondiale LivresJérôme Le Ḃřiĺĺẫňt AdingraPas encore d'évaluation
- Comprehension de La PhenomenologieDocument29 pagesComprehension de La PhenomenologieFidèle MenzanPas encore d'évaluation
- La FoiDocument7 pagesLa FoiEric LissomPas encore d'évaluation
- MERLIN Alfred Nouvelle Statuette en Bronze Découverte À Mahdia (Tunisie) 1910Document3 pagesMERLIN Alfred Nouvelle Statuette en Bronze Découverte À Mahdia (Tunisie) 1910tamaradefaultPas encore d'évaluation
- L'orgueil Et L'humilité°6Document6 pagesL'orgueil Et L'humilité°6nicolas djob li ngue bikobPas encore d'évaluation
- Ibn Taymiyya Une Figure Anti-Soufie PDFDocument31 pagesIbn Taymiyya Une Figure Anti-Soufie PDFccshamiPas encore d'évaluation
- Biais Materialistes Et Mystiques-Guillemant PDFDocument9 pagesBiais Materialistes Et Mystiques-Guillemant PDFChri ChaPas encore d'évaluation
- Al Bayaan 13Document4 pagesAl Bayaan 13joejordanPas encore d'évaluation
- 7. José Gentil Da Silva, L' historicité de l' enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σ. 119.Document124 pages7. José Gentil Da Silva, L' historicité de l' enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σ. 119.Babis PapaioannouPas encore d'évaluation
- QUICHERAT, Jules - Procès de Condamnation Et de Réhabilitation de Jeanne D'arc.2Document498 pagesQUICHERAT, Jules - Procès de Condamnation Et de Réhabilitation de Jeanne D'arc.2Giuliano Lellis Ito SantosPas encore d'évaluation
- Imbroglio Juridique Et Destin Post ECCDocument37 pagesImbroglio Juridique Et Destin Post ECCtomadoss2Pas encore d'évaluation
- 60 QUESTIONS Sur La DIVINITE Avec Réponses Bibliques PDFDocument4 pages60 QUESTIONS Sur La DIVINITE Avec Réponses Bibliques PDFNancy Dobe100% (1)
- 1970 Economie Du Salut Dans La LiturgieDocument288 pages1970 Economie Du Salut Dans La LiturgieLupuPas encore d'évaluation
- De René Guénon A Henry CorbinDocument8 pagesDe René Guénon A Henry CorbinIbrahima SakhoPas encore d'évaluation