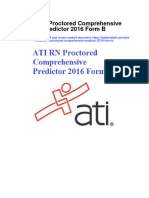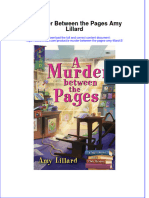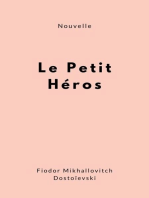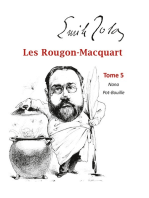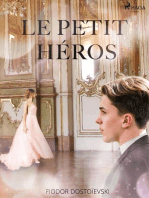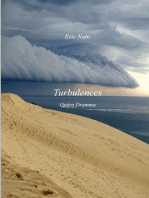Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Full Download Ati RN Proctored Adult Medical Surgical Form C 2016 PDF
Transféré par
charles.norris476100%(14)100% ont trouvé ce document utile (14 votes)
57 vues23 pagesebook
Titre original
Full download Ati Rn Proctored Adult Medical Surgical Form C 2016 pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentebook
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
100%(14)100% ont trouvé ce document utile (14 votes)
57 vues23 pagesFull Download Ati RN Proctored Adult Medical Surgical Form C 2016 PDF
Transféré par
charles.norris476ebook
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 23
ATI RN Proctored Adult
Medical-Surgical Form C 2016
Visit to download the full and correct content document: https://testbankbell.com/dow
nload/ati-rn-proctored-adult-medical-surgical-form-c-2016/
ATI RN Proctored Adult
Medical-Surgical Form C 2016
Visit to download the full and correct content document: https://testbankbell.com/dow
nload/ati-rn-proctored-adult-medical-surgical-form-c-2016/
Another random document with
no related content on Scribd:
moment le comte leva les yeux et nous aperçut. Quelque chose
comme un sourire passa sur ses lèvres.
—Messieurs, dit-il aux trois joueurs qui faisaient sa partie,
voulez-vous me permettre de me retirer? Je me charge de vous
envoyer un quatrième.
—Allons donc, dit Paul; tu nous gagnes quatre mille francs, et tu
nous enverras un remplaçant qui se cavera de dix louis. Non pas,
non pas.
Le comte, à moitié levé, se rassit; mais au premier tour, un des
joueurs ayant engagé le jeu, le comte fit son argent. Il fut tenu.
L’adversaire du comte abattit son jeu; le comte jeta le sien sans le
montrer en disant: J’ai perdu, poussa l’or et les billets de banque
qu’il avait devant lui en face du gagnant, et, se levant de nouveau:
—Suis-je libre de me retirer cette fois? dit-il à Paul.
—Non, pas encore, cher ami, répondit Paul qui avait relevé les
cartes du comte et regardé son jeu, car tu as cinq carreaux, et
monsieur n’a que quatre piques.
—Madame, dit le comte en se retournant de notre côté et en
s’adressant à la maîtresse de la maison, je sais que mademoiselle
Eugénie doit quêter ce soir pour les pauvres, voulez-vous me
permettre d’être le premier à lui offrir mon tribut? A ces mots, il prit
un panier à ouvrage qui se trouvait sur un guéridon à côté de la table
de jeu, y mit les huit mille francs qu’il avait devant lui, et les présenta
à la comtesse.
—Mais je ne sais si je dois accepter, répondit madame M...; cette
somme est vraiment si considérable.....
—Aussi, reprit en souriant le comte Horace, n’est-ce point en
mon nom seul que je vous l’offre; ces messieurs y ont largement
contribué, c’est donc eux plus encore que moi que mademoiselle
M... doit remercier au nom de ses protégés. A ces mots, il passa
dans la salle de bal, laissant le panier plein d’or et de billets de
banque aux mains de la comtesse.
—Voilà bien une de ses originalités, me dit madame M...; il aura
aperçu une femme avec laquelle il a envie de danser, et voilà le prix
dont il paie ce plaisir. Mais il faut que je serre ce panier; laissez-moi
donc vous reconduire dans le salon de danse.
Madame M... me ramena près de ma mère. A peine y étais-je
assise, que le comte s’avança vers moi et m’invita à danser.
Ce que venait de me dire la comtesse se présenta aussitôt à
mon esprit; je me sentis rougir, je compris que j’allais balbutier; je lui
tendis mon calepin, six danseurs y avaient pris rang; il retourna le
feuillet, et comme s’il ne voulait pas que son nom fût confondu avec
les autres noms, il l’inscrivit au haut de la page pour la septième
contredanse; puis il me rendit le livret en prononçant quelques mots
que mon trouble m’empêcha d’entendre, et alla s’appuyer contre
l’angle de la porte. Je fus sur le point de prier ma mère de quitter le
bal, car je tremblais si fort, qu’il me semblait impossible de me tenir
debout; heureusement un accord rapide et brillant se fit entendre. Le
bal était suspendu. Listz s’asseyait au piano.
Il joua l’invitation à la valse de Weber.
Jamais l’habile artiste n’avait poussé si haut les merveilles de
son exécution, ou peut-être jamais ne m’étais-je trouvée dans une
disposition d’esprit aussi parfaitement apte à sentir cette composition
si mélancolique et si passionnée; il me sembla que c’était la
première fois que j’entendais supplier, gémir et se briser l’âme
souffrante, dont l’auteur du Freyschütz a exhalé les soupirs dans ses
mélodies. Tout ce que la musique, cette langue des anges, a
d’accens, d’espoir, de tristesse et de douleur, semblait s’être réuni
dans ce morceau, dont les variations, improvisées selon l’inspiration
du traducteur, arrivaient à la suite du motif comme des notes
explicatives. J’avais souvent moi-même exécuté cette brillante
fantaisie, et je m’étonnais, aujourd’hui que je l’entendais reproduire
par un autre, d’y trouver des choses que je n’avais pas soupçonnées
alors; était-ce le talent admirable de l’artiste qui les faisait ressortir?
était-ce une disposition nouvelle de mon esprit? La main savante qui
glissait sur les touches avait-elle si profondément creusé la mine,
qu’elle y trouvait des filons inconnus? ou mon cœur avait-il reçu une
si puissante secousse, que des fibres endormies s’y étaient
réveillées? En tout cas, l’effet fut magique; les sons flottaient dans
l’air comme une vapeur, et m’inondaient de mélodie; en ce moment
je levai les yeux, ceux du comte étaient fixés de mon côté; je baissai
rapidement la tête, il était trop tard; je cessai de voir ses yeux, mais
je sentis son regard peser sur moi, le sang se porta rapidement à
mon visage, et un tremblement involontaire me saisit. Bientôt, Listz
se leva; j’entendis le bruit des personnes qui se pressaient autour de
lui pour le féliciter; j’espérai que, dans ce mouvement, le comte avait
quitté sa place; en effet, je me hasardai à relever la tête, il n’était
plus contre la porte; je respirai, mais je me gardai de pousser la
recherche plus loin; je craignais de retrouver son regard, j’aimais
mieux ignorer qu’il fût là.
Au bout d’un instant le silence se rétablit; une nouvelle personne
s’était mise au piano; j’entendis aux chuts prolongés jusque dans les
salles attenantes que la curiosité était vivement excitée; mais je
n’osai lever les yeux. Une gamme mordante courut sur les touches,
un prélude large et triste lui succéda, puis une voix vibrante, sonore
et profonde, fit entendre ces mots sur une mélodie de Schubert:
«J’ai tout étudié, philosophie, droit et médecine; j’ai fouillé
dans le cœur des hommes, je suis descendu dans les
entrailles de la terre, j’ai attaché à mon esprit les ailes de
l’aigle pour planer au-dessus des nuages; où m’a conduit
cette longue étude? au doute et au découragement. Je n’ai
plus, il est vrai, ni illusion ni scrupule, je ne crains ni Dieu ni
Satan: mais j’ai payé ces avantages au prix de toutes les
joies de la vie.»
Au premier mot, j’avais reconnu la voix du comte Horace. On
devine donc facilement quelle singulière impression durent faire sur
moi ces paroles de Faust dans la bouche de celui qui les chantait:
l’effet fut général, au reste. Un moment de silence profond succéda
à la dernière note, qui s’envola plaintive comme une âme en
détresse; puis des applaudissemens frénétiques partirent de tous
côtés. Je me hasardai alors à regarder le comte; pour tous peut-être
sa figure était calme et impassible, mais pour moi le léger
froncement de sa bouche indiquait clairement cette agitation
fiévreuse dont un des accès l’avait pris pendant sa visite au château.
Madame M... s’approcha de lui pour le féliciter à son tour; alors son
visage prit l’aspect souriant et insoucieux que commandent aux
esprits les plus préoccupés les convenances du monde; le comte
Horace lui offrit le bras et ne fut plus qu’un homme comme tous les
hommes; à la manière dont il la regardait, je jugeai que de son côté il
lui faisait des complimens sur sa toilette. Tout en causant avec elle, il
jeta rapidement de mon côté un regard qui rencontra le mien; je fus
sur le point de laisser échapper un cri, j’avais en quelque sorte été
surprise; il vit sans doute ma détresse et en eut pitié, car il entraîna
madame M... dans la salle voisine et disparut avec elle. Au même
moment, les musiciens donnèrent de nouveau le signal de la
contredanse; le premier inscrit de mes danseurs s’élança vers moi,
je pris machinalement sa main et je me laissai conduire à la place
qu’il voulut; je dansai, voilà tout ce dont je me souviens, puis deux
ou trois contredanses se suivirent, pendant lesquelles je repris un
peu de calme; enfin une nouvelle pause destinée à un nouvel
intermède musical leur succéda.
Madame M... s’avança vers moi; elle venait me prier de faire ma
partie dans le duo du premier acte de Don Juan; je refusai d’abord,
car je me voyais incapable en ce moment, toute timidité naturelle à
part, d’articuler une note. Ma mère vit ce débat, et, avec son amour-
propre de mère, vint se joindre à la comtesse, qui s’offrait pour
accompagner; j’eus peur, si je continuais à résister, que ma mère ne
se doutât de quelque chose; j’avais chanté si souvent ce duo, que je
ne pouvais opposer une bonne raison à leurs instances; je finis donc
par céder. La comtesse M... me prit par la main et me conduisit au
piano, où elle s’assit: j’étais derrière sa chaise, debout et les yeux
baissés, sans oser regarder autour de moi, de peur de retrouver
encore ce regard qui me suivait partout. Un jeune homme vint se
placer de l’autre côté de la comtesse, je me hasardai à lever les
yeux sur mon partner; un frisson me courut par tout le corps: c’était
le comte Horace qui chantait le rôle de don Juan.
Vous comprendrez quelle fut mon émotion; cependant il était trop
tard pour me retirer, tous les yeux étaient fixés sur nous; madame
M... préludait. Le comte commença; c’était une autre voix, c’était un
autre homme qui chantait, et lorsqu’il commença: Là ci darem la
mano, je tressaillis, espérant que je m’étais trompée, et ne pouvant
pas croire que la voix puissante qui venait de nous faire frémir avec
la mélodie de Schubert pouvait se plier à des intonations d’une gaîté
si fine et si gracieuse. Aussi, dès la première phrase, un murmure
d’applaudissement courut-il par toute la salle; il est vrai que, lorsqu’à
mon tour je dis en tremblant: Vorrei e non vorrei mi trema un poco il
cor, il y avait dans ma voix une telle expression de crainte, que les
applaudissemens contenus éclatèrent; puis on fit tout-à-coup un
silence profond pour nous écouter. Je ne puis vous dire ce qu’il y
avait d’amour dans la voix du comte, lorsqu’il reprit: Vieni, mio bel
diletto, et ce qu’il mit de séduction et de promesses dans cette
phrase: Io cangierò tua sorte; tout cela était si applicable à moi, ce
duo semblait si bien choisi pour la situation de mon cœur,
qu’effectivement je me sentis prête à m’évanouir, en disant: Presto
non so più forte: certes la musique avait ici changé d’expression; au
lieu de la plainte coquette de Zerline, c’était le cri de la détresse la
plus profonde; en ce moment je sentis que le comte s’était
rapproché de mon côté, sa main toucha ma main pendante près de
moi, un voile de flamme s’abaissa sur mes yeux, je saisis la chaise
de la comtesse M... et je m’y cramponnai; grâce à ce soutien, je
parvins à me tenir debout; mais lorsque nous reprîmes ensemble:
Andiamo, andiam mio bene, je sentis son haleine passer dans mes
cheveux, son souffle courir sur mes épaules; un frisson me passa
par les veines, je jetai en prononçant le mot amor un cri dans lequel
s’épuisèrent toutes mes forces, et je m’évanouis....
Ma mère s’élança vers moi; mais elle serait arrivée trop tard, si la
comtesse M... ne m’avait reçue dans ses bras. Mon évanouissement
fut attribué à la chaleur; on me transporta dans une chambre voisine,
des sels qu’on me fit respirer, une fenêtre qu’on ouvrit, quelques
gouttes d’eau qu’on me jeta au visage me rappelèrent à moi;
madame M... insista pour me faire rentrer au bal, mais je ne voulus
entendre à rien; ma mère, inquiète elle-même, fut cette fois de mon
avis, on fit avancer la voiture et nous rentrâmes à l’hôtel.
Je me retirai aussitôt, dans ma chambre; en ôtant mon gant je fis
tomber un papier qui y avait été glissé pendant mon
évanouissement, je le ramassai et je lus ces mots écrits au crayon:
Vous m’aimez!... merci, merci!
IX.
Je passai une nuit affreuse, une nuit de sanglots et de larmes.
Vous ne savez pas, vous autres hommes, vous ne saurez jamais
quelles angoisses sont celles d’une jeune fille élevée sous l’œil de
sa mère, dont le cœur, pur comme une glace, n’a encore été terni
par aucune haleine, dont la bouche n’a jamais prononcé le mot
amour, et qui se voit tout-à-coup, comme un pauvre oiseau sans
défense, prise et enveloppée dans une volonté plus puissante que
sa résistance; qui sent une main qui l’entraîne, si fort qu’elle se
raidisse contre elle, et qui entend une voix qui lui dit: Vous m’aimez,
avant qu’elle n’ait dit: Je vous aime.
Oh! je vous le jure, je ne sais comment il se fit que je ne devins
pas folle pendant cette nuit; je me crus perdue. Je me répétais tout
bas et incessamment:—Je l’aime! je l’aime! et cela avec une terreur
si profonde, qu’aujourd’hui encore je ne sais si je n’étais pas en
proie à un sentiment tout-à-fait contraire à celui que je croyais
ressentir. Cependant il était probable que toutes ces émotions que
j’avais éprouvées étaient des preuves d’amour, puisque le comte, à
qui aucune d’elles n’avait échappée, les interprétait ainsi. Quant à
moi, c’étaient les premières sensations de ce genre que je
ressentais. On m’avait dit que l’on ne devait craindre ou haïr que
ceux qui vous ont fait du mal; je ne pouvais alors ni haïr ni craindre
le comte, et si le sentiment que j’éprouvais pour lui n’était ni de la
haine ni de la crainte, ce devait donc être de l’amour.
Le lendemain matin, au moment où nous nous mettions à table
pour déjeuner, on apporta à ma mère deux cartes du comte Horace
de Beuzeval: il avait envoyé s’informer de ma santé et demander si
mon indisposition avait eu des suites. Cette démarche, toute
matinale qu’elle était, parut à ma mère une simple manifestation de
politesse. Le comte chantait avec moi lorsque l’accident m’était
arrivé: cette circonstance excusait son empressement. Ma mère
s’aperçut alors seulement combien je paraissais fatiguée et
souffrante; elle s’en inquiéta d’abord; mais je la rassurai en lui disant
que je n’éprouvais aucune douleur, et que d’ailleurs l’air et la
tranquillité de la campagne me remettraient, si elle voulait que nous
y retournassions. Ma mère n’avait qu’une volonté, c’était la mienne:
elle ordonna que l’on mît les chevaux à la voiture; vers les deux
heures nous partîmes.
Je fuyais Paris avec l’empressement que, quatre jours
auparavant, j’avais mis à fuir la campagne; car ma première pensée,
en voyant les cartes du comte, avait été qu’aussitôt que l’heure où
l’on est visible serait arrivée, il se présenterait en personne. Or, je
voulais le fuir, je voulais ne plus le revoir; après l’idée qu’il avait prise
de moi, après la lettre qu’il m’avait écrite, il me semblait que je
mourrais de honte en me retrouvant avec lui. Toutes ces pensées
qui se heurtaient dans ma tête faisaient passer sur mes joues des
rougeurs si subites et si ardentes, que ma mère crut que je
manquais d’air dans cette voiture fermée, et ordonna au cocher
d’arrêter, afin que le domestique pût abaisser la couverture de la
calèche. On était aux derniers jours de septembre, c’est-à-dire au
plus doux moment de l’année; les feuilles de certains arbres
commençaient à rougir dans les bois. Il y a quelque chose du
printemps dans l’automne, et les derniers parfums de l’année
ressemblent parfois à ses premières émanations. L’air, le spectacle
de la nature, tous ces bruits de la forêt qui n’en forment qu’un,
prolongé, mélancolique, indéfinissable, commençaient à distraire
mon esprit, lorsque tout-à-coup, à l’un des détours de la route,
j’aperçus devant nous un cavalier. Quoiqu’il fût encore à une grande
distance, je saisis le bras de ma mère dans l’intention de lui dire de
retourner vers Paris,—car j’avais reconnu le comte;—mais je
m’arrêtai aussitôt. Quel prétexte donner à ce changement de
volonté, qui paraîtrait un caprice sans raison aucune? Je rassemblai
donc tout mon courage.
Le cavalier allait au pas, aussi le rejoignîmes-nous bientôt.
Comme je l’ai dit, c’était le comte.
A peine nous eut-il reconnues, qu’il s’approcha de nous, s’excusa
d’avoir envoyé de si bonne heure pour savoir de mes nouvelles;
mais devant partir dans la journée pour la campagne de monsieur de
Lucienne, où il allait passer quelques jours, il n’avait pas voulu
quitter Paris avec l’inquiétude où il était; si l’heure eût été
convenable, il se serait présenté lui-même. Je balbutiai quelques
mots, ma mère le remercia.—Nous aussi nous retournions à la
campagne, lui dit-elle, pour le reste de la saison.—Alors vous me
permettrez de vous servir d’escorte jusqu’au château, répondit le
comte. Ma mère s’inclina en souriant; la chose était toute simple:
notre maison de campagne était de trois lieues plus rapprochée que
celle de monsieur de Lucienne, et la même route conduisait à toutes
les deux.
Le comte continua donc de galoper près de nous pendant les
cinq lieues qui nous restaient à faire. La rapidité de notre course, la
difficulté de se tenir près de la portière, fit que nous n’échangeâmes
que quelques paroles. Arrivé au château, il sauta à bas de son
cheval, aida ma mère à descendre, puis m’offrit sa main à mon tour.
Je ne pouvais refuser; je tendis la mienne en tremblant; il la prit sans
vivacité, sans affectation, comme il eût pris celle de toute autre; mais
je sentis qu’il y laissait un billet. Avant que je n’aie pu dire un mot ni
faire un mouvement, le comte s’était retourné vers ma mère et la
saluait; puis il remonta à cheval, résistant aux instances qu’elle lui
faisait pour qu’il se reposât un instant; alors, reprenant le chemin de
Lucienne, où il était attendu, disait-il, il disparut au bout de quelques
secondes.
J’étais restée immobile à la même place; mes doigts crispés
retenaient le billet, que je n’osais laisser tomber, et que cependant
j’étais bien résolue à ne pas lire. Ma mère m’appela, je la suivis. Que
faire de ce billet? Je n’avais pas de feu pour le brûler; le déchirer, on
en pouvait trouver les morceaux: je le cachai dans la ceinture de ma
robe.
Je ne connais pas de supplice pareil à celui que j’éprouvai
jusqu’au moment où je rentrai dans ma chambre: ce billet me brûlait
la poitrine; il semblait qu’une puissance surnaturelle rendait chacune
de ses lignes lisibles pour mon cœur, qui le touchait presque; ce
papier avait une vertu magnétique. Certes, au moment où je l’avais
reçu, je l’eusse déchiré, brûlé à l’instant même sans hésitation; eh
bien! lorsque je rentrai chez moi, je n’en eus plus le courage. Je
renvoyai ma femme de chambre en lui disant que je me
déshabillerais seule; puis je m’assis sur mon lit, et je restai ainsi une
heure, immobile et les yeux fixes, le billet froissé dans ma main
fermée.
Enfin je l’ouvris et je lus:
«Vous m’aimez, Pauline, car vous me fuyez. Hier vous
avez quitté le bal où j’étais, aujourd’hui vous quittez la ville où
je suis; mais tout est inutile. Il y a des destinées qui peuvent
ne se rencontrer jamais, mais qui, dès qu’elles se
rencontrent, ne doivent plus se séparer.
»Je ne suis point un homme comme les autres hommes: à
l’âge du plaisir, de l’insouciance et de la joie, j’ai beaucoup
souffert, beaucoup pensé, beaucoup gémi; j’ai vingt-huit ans.
Vous êtes la première femme que j’aie aimée, car je vous
aime, Pauline.
»Grâce à vous, et si Dieu ne brise pas cette dernière
espérance de mon cœur, j’oublierai mon passé et j’espérerai
dans l’avenir. Le passé est la seule chose pour laquelle Dieu
est sans pouvoir et l’amour sans consolation. L’avenir est à
Dieu, le présent est à nous, mais le passé est au néant. Si
Dieu, qui peut tout, pouvait donner l’oubli du passé, il n’y
aurait dans le monde ni blasphémateurs, ni matérialistes, ni
athées.
»Maintenant tout est dit, Pauline; car que vous
apprendrais-je que vous ne sachiez pas, que vous dirais-je
que vous n’ayez pas deviné? Nous sommes jeunes tous
deux, riches tous deux, libres tous deux; je puis être à vous,
vous pouvez être à moi: un mot de vous, je m’adresse à votre
mère, et nous sommes unis. Si ma conduite, comme mon
âme, est en dehors des habitudes du monde, pardonnez-moi
ce que j’ai d’étrange et acceptez-moi comme je suis, vous me
rendrez meilleur.
»Si, au contraire de ce que j’espère, Pauline, un motif que
je ne prévois pas, mais qui cependant peut exister, vous
faisait continuer à me fuir comme vous avez essayé de le
faire jusqu’à présent, sachez bien que tout serait inutile:
partout je vous suivrais comme je vous ai suivie; rien ne
m’attache à un lieu plutôt qu’à un autre, tout m’entraîne au
contraire où vous êtes; aller au devant de vous ou marcher
derrière vous sera désormais mon seul but. J’ai perdu bien
des années et risqué cent fois ma vie et mon âme pour arriver
à un résultat qui ne me promettait pas le même bonheur.
»Adieu, Pauline! je ne vous menace pas, je vous implore;
je vous aime, vous m’aimez. Ayez pitié de vous et de moi.»
Il me serait impossible de vous dire ce qui se passa en moi à la
lecture de cette étrange lettre; il me semblait être en proie à un de
ces songes terribles où, menacé d’un danger, on tente de fuir; mais
les pieds s’attachent à la terre, l’haleine manque à la poitrine; on
veut crier, la voix n’a pas de son. Alors l’excès de la peur brise le
sommeil, et l’on se réveille le cœur bondissant et le front mouillé de
sueur.
Mais là, là, il n’y avait pas à me réveiller; ce n’était point un rêve
que je faisais, c’était une réalité terrible qui me saisissait de sa main
puissante et qui m’entraînait avec elle; et cependant qu’y avait-il de
nouveau dans ma vie? Un homme y avait passé, et voilà tout. A
peine si avec cet homme j’avais échangé un regard et une parole.
Quel droit se croyait-il donc de garrotter comme il le faisait ma
destinée à la sienne, et de me parler presque en maître, lorsque je
ne lui avais pas même accordé les droits d’un ami? Cet homme, je
pouvais demain ne plus le regarder, ne plus lui parler, ne plus le
connaître. Mais non, je ne pouvais rien... j’étais faible... j’étais
femme... je l’aimais.
En savais-je quelque chose, au reste? ce sentiment que
j’éprouvais était-ce de l’amour? l’amour entre-t-il dans le cœur
précédé d’une terreur aussi profonde? Jeune et ignorante comme je
l’étais, savais-je moi-même ce que c’était que l’amour? Cette lettre
fatale, pourquoi ne l’avais-je pas brûlée avant de la lire? n’avais-je
pas donné au comte le droit de croire que je l’aimais en la recevant?
Mais aussi que pouvais-je faire? un éclat devant des valets, des
domestiques. Non; mais la remettre à ma mère, lui tout dire, lui tout
avouer... Lui avouer quoi? des terreurs d’enfant, et voilà tout. Puis
ma mère, qu’eût-elle pensé à la lecture d’une pareille lettre? Elle
aurait cru que d’un mot, d’un geste, d’un regard, j’avais encouragé le
comte. Sans cela, de quel droit me dirait-il que je l’aimais? Non, je
n’oserais jamais rien dire à ma mère...
Mais cette lettre, il fallait la brûler d’abord et avant tout. Je
l’approchai de la bougie, elle s’enflamma, et ainsi que tout ce qui a
existé et qui n’existe plus, elle ne fut bientôt qu’un peu de cendre.
Puis je me déshabillai promptement, je me hâtai de me mettre au lit,
et je soufflai aussitôt mes lumières afin de me dérober à moi-même
et de me cacher dans la nuit. Oh! comme malgré l’obscurité je fermai
les yeux, comme j’appuyai mes mains sur mon front, et comme,
malgré ce double voile, je revis tout! Cette lettre fatale était écrite sur
les murs de la chambre. Je ne l’avais lue qu’une fois, et cependant
elle s’était si profondément gravée dans ma mémoire, que chaque
ligne, tracée par une main invisible, semblait paraître à mesure que
la ligne précédente s’effaçait; et je lus et relus ainsi cette lettre dix
fois, vingt fois, toute la nuit. Oh! je vous assure qu’entre cet état et la
folie il y avait une barrière bien étroite à franchir, un voile bien faible
à déchirer.
Enfin, au jour je m’endormis, écrasée de fatigue. Lorsque je me
réveillai, il était déjà tard; ma femme de chambre m’annonça que
madame de Lucienne et sa fille étaient au château. Alors une idée
subite m’illumina; je devais tout dire à madame de Lucienne: elle
avait toujours été parfaite pour moi; c’était chez elle que j’avais vu le
comte Horace, le comte Horace était l’ami de son fils; c’était la
confidente la plus convenable pour un secret comme le mien; Dieu
me l’envoyait. En ce moment la porte de la chambre s’ouvrit, et
madame de Lucienne parut. Oh! alors je crus vraiment à cette
mission; je me soulevai sur mon lit et je lui tendis les bras en
sanglotant: elle vint s’asseoir près de moi.
—Allons, enfant, me dit elle après un instant et en écartant mes
mains dont je me voilais le visage, voyons, qu’avons-nous?
—Oh! je suis bien malheureuse! m’écriai-je.
—Les malheurs de ton âge, mon enfant, sont comme les orages
du printemps, ils passent vite et font le ciel plus pur.
—Oh! si vous saviez!
—Je sais tout, me dit madame de Lucienne.
—Qui vous l’a dit?
—Lui.
—Il vous a dit que je l’aimais!
—-Il m’a dit qu’il avait cet espoir, du moins; se trompe-t-il?
—Je ne sais moi-même; je ne connaissais de l’amour que le
nom, comment voulez-vous que je voie clair dans mon cœur, et
qu’au milieu du trouble que j’éprouve j’analyse le sentiment qui l’a
causé?
—Allons, allons, je vois que Horace y lit mieux que vous.—Je me
mis à pleurer.—Eh bien! continua madame de Lucienne, il n’y a pas
là dedans une grande cause de larmes, ce me semble. Voyons,
causons raisonnablement. Le comte Horace est jeune, beau, riche,
voilà plus qu’il n’en faut pour excuser le sentiment qu’il vous inspire.
Le comte Horace est libre, vous avez dix-huit ans, ce serait une
union convenable sous tous les rapports.
—Oh! Madame!...
—C’est bien, n’en parlons plus; j’ai appris tout ce que je voulais
savoir. Je redescends près de madame de Meulien et je vous envoie
Lucie.
—Oh!... mais pas un mot, n’est-ce pas?
—Soyez tranquille, je sais ce qui me reste à faire; au revoir,
chère enfant. Allons, essuyez ces beaux yeux et embrassez-moi...
Je me jetai une seconde fois à son cou. Cinq minutes après,
Lucie entra; je m’habillai et nous descendîmes.
Je trouvai ma mère sérieuse, mais plus tendre encore que
d’ordinaire. Plusieurs fois, pendant le déjeuner, elle me regarda avec
un sentiment de tristesse inquiète, et à chaque fois je sentis la
rougeur de la honte me monter au visage. A quatre heures, madame
de Lucienne et sa fille nous quittèrent; ma mère fut la même avec
moi qu’elle avait coutume d’être; pas un mot sur la visite de madame
de Lucienne, et le motif qui l’avait amenée ne fut prononcé. Le soir,
comme de coutume, j’allai, avant de me retirer dans ma chambre,
embrasser ma mère: en approchant mes lèvres de son front, je
m’aperçus que ses larmes coulaient; alors je tombai à genoux
devant elle en cachant ma tête dans sa poitrine. En voyant ce
mouvement, elle devina le sentiment qui me le dictait, et, abaissant
ses deux mains sur mes épaules, et me serrant contre elle: —Sois
heureuse, ma fille, dit-elle, c’est tout ce que je demande à Dieu.
Le surlendemain, madame de Lucienne demanda officiellement
ma main à ma mère.
Six semaines après, j’épousai le comte Horace.
X.
Le mariage se fit à Lucienne, dans les premiers jours de
novembre; puis nous revînmes à Paris au commencement de la
saison d’hiver.
Nous habitions l’hôtel tous ensemble. Ma mère m’avait donné
vingt-cinq mille livres de rentes par mon contrat de mariage, le
comte en avait déclaré à peu près autant; il en restait quinze mille à
ma mère. Notre maison se trouva donc au nombre, sinon des
maisons riches, du moins des maisons élégantes du faubourg Saint-
Germain.
Horace me présenta deux de ses amis, qu’il me pria de recevoir
comme ses frères: depuis six ans ils étaient liés d’un sentiment si
intime, qu’on avait pris l’habitude de les appeler les inséparables. Un
quatrième, qu’ils regrettaient tous les jours et dont ils parlaient sans
cesse, s’était tué au mois d’octobre de l’année précédente en
chassant dans les Pyrénées, où il avait un château. Je ne puis vous
révéler le nom de ces deux hommes, et à la fin de mon récit vous
comprendrez pourquoi; mais comme je serai forcée parfois de les
désigner, j’appellerai l’un Henri et l’autre Max.
Je ne vous dirai pas que je fus heureuse: le sentiment que
j’éprouvais pour Horace m’a été et me sera toujours inexplicable: on
eût dit un respect mêlé de crainte; c’était, au reste, l’impression qu’il
produisait généralement sur tous ceux qui l’approchaient. Ses deux
amis eux-mêmes, si libres et si familiers qu’ils fussent avec lui, le
contredisaient rarement et lui cédaient toujours, sinon comme à un
maître, du moins comme à un frère aîné. Quoique adroits aux
exercices du corps, ils étaient loin d’être de sa force. Le comte avait
transformé la salle de billard en une salle d’armes, et une des allées
du jardin était consacrée à un tir: tous les jours ces messieurs
venaient s’exercer à l’épée ou au pistolet. Parfois j’assistais à ces
joûtes: Horace alors était plutôt leur professeur que leur adversaire;
il gardait dans ces exercices ce calme effrayant dont je lui avais vu
donner une preuve chez madame de Lucienne, et plusieurs duels,
qui tous avaient fini à son avantage, attestaient que, sur le terrain, ce
sang-froid, si rare au moment suprême, ne l’abandonnait pas un
instant. Horace, chose étrange! restait donc pour moi, malgré
l’intimité, un être supérieur et en dehors des autres hommes.
Quant à lui, il paraissait heureux, il affectait du moins de répéter
qu’il l’était, quoique souvent son front soucieux attestât le contraire.
Parfois aussi des rêves terribles agitaient son sommeil, et alors cet
homme, si calme et si brave le jour, avait, s’il se réveillait au milieu
de pareils songes, des instans d’effroi où il frissonnait comme un
enfant. Il en attribuait la cause à un accident qui était arrivé à sa
mère pendant sa grossesse: arrêtée dans la Sierra par des voleurs,
elle avait été attachée à un arbre, et avait vu égorger un voyageur
qui faisait la même route qu’elle; il en résultait que c’étaient
habituellement des scènes de vol et de brigandage qui s’offraient
ainsi à lui pendant son sommeil. Aussi, plutôt pour prévenir le retour
de ces songes que par une crainte réelle, posait-il toujours avant de
se coucher, quelque part qu’il fût, une paire de pistolets à portée de
sa main. Cela me causa d’abord une grande terreur, car je tremblais
toujours que, dans quelque accès de somnambulisme il ne fît usage
de ces armes; mais peu à peu je me rassurai, et je contractai
l’habitude de lui voir prendre cette précaution. Une autre plus
étrange encore, et dont seulement aujourd’hui je me rends compte,
c’est qu’on tenait constamment, jour ou nuit, un cheval sellé et prêt à
partir.
L’hiver se passa au milieu des fêtes et des bals. Horace était fort
répandu de son côté; de sorte que, ses salons s’étant joints aux
miens, le cercle de nos connaissances avait doublé. Il
m’accompagnait partout avec une complaisance extrême, et, chose
qui surprenait tout le monde, il avait complétement cessé de jouer.
Au printemps nous partîmes pour la campagne.
Là nous retrouvâmes tous nos souvenirs. Nos journées
s’écoulaient moitié chez nous, moitié chez nos voisins; nous avions
continué de voir madame de Lucienne et ses enfans comme une
seconde famille à nous. Ma situation de jeune fille se trouvait donc à
peine changée, et ma vie était à peu près la même. Si cet état n’était
pas du bonheur, il y ressemblait tellement que l’on pouvait s’y
tromper. La seule chose qui le troublât momentanément, c’étaient
ces tristesses sans cause dont je voyais Horace de plus en plus
atteint; c’étaient ces songes qui devenaient plus terribles à mesure
que nous avancions. Souvent j’allais à lui pendant ces inquiétudes
du jour, ou je le réveillais au milieu de ces rêves de la nuit; mais dès
qu’il me voyait, sa figure reprenait cette expression calme et froide
qui m’avait tant frappée; cependant il n’y avait point à s’y tromper, la
distance était grande de cette tranquillité apparente à un bonheur
réel.
Vers le mois de juin, Henri et Max, ces deux jeunes gens dont je
vous ai parlé, vinrent nous rejoindre. Je savais l’amitié qui les
unissait à Horace, et ma mère et moi les reçûmes, elle comme des
enfans, moi comme des frères. On les logea dans des chambres
presque attenantes aux nôtres; le comte fit poser des sonnettes,
avec un timbre particulier, qui allaient de chez lui chez eux, et de
chez eux chez lui, et ordonna que l’on tînt constamment trois
chevaux prêts au lieu d’un. Ma femme de chambre me dit en outre
qu’elle avait appris des domestiques que ces messieurs avaient la
même habitude que mon mari, et ne dormaient qu’avec une paire de
pistolets au chevet de leur lit.
Depuis l’arrivée de ses amis, Horace était livré presque
entièrement à eux. Leurs amusemens étaient, au reste, les mêmes
qu’à Paris: des courses à cheval et des assauts d’armes et de
pistolet. Le mois de juillet s’écoula ainsi; puis, vers la moitié d’août,
le comte m’annonça qu’il serait obligé de me quitter dans quelques
jours pour deux ou trois mois. C’était la première séparation depuis
notre mariage: aussi m’effrayai-je à ces paroles. Le comte essaya de
me rassurer en me disant que ce voyage, que je croyais peut-être
lointain, était au contraire dans une des provinces de la France les
plus proches de Paris, c’est-à-dire en Normandie: il allait avec ses
amis au château de Burcy. Chacun d’eux possédait une maison de
campagne, l’un dans la Vendée, l’autre entre Toulon et Nice; celui
qui avait été tué avait la sienne dans les Pyrénées, et le comte
Horace en Normandie; de sorte que, chaque année, ils se recevaient
successivement pendant la saison des chasses, et passaient trois
mois les uns chez les autres. C’était au tour d’Horace, cette année, à
recevoir ses amis. Je m’offris aussitôt à l’accompagner pour faire les
honneurs de sa maison, mais le comte me répondit que le château
n’était qu’un rendez-vous de chasse, mal tenu, mal meublé, bon
pour des chasseurs habitués à vivre tant bien que mal, mais non
pour une femme accoutumée à tout le confortable et à tout le luxe de
la vie. Il donnerait, au reste, des ordres pendant son prochain séjour
afin que toutes les réparations fussent faites, et pour que désormais,
quand son année viendrait, je pusse l’accompagner et faire en noble
châtelaine les honneurs de son manoir.
Cet incident, tout simple et tout naturel qu’il parût à ma mère,
m’inquiéta horriblement. Je ne lui avais jamais parlé des tristesses ni
des terreurs d’Horace; mais, quelque explication qu’il eût tenté de
m’en donner, elles m’avaient toujours paru si peu naturelles, que je
leur supposais un autre motif qu’il ne voulait ou ne pouvait dire.
Cependant il eût été si ridicule à moi de me tourmenter pour une
absence de trois mois, et si étrange d’insister pour suivre Horace,
que je renfermai mon inquiétude en moi-même et que je ne parlai
plus de ce voyage.
Le jour de la séparation arriva: c’était le 27 d’août. Ces messieurs
voulaient être installés à Burcy pour l’ouverture des chasses, fixée
au 1er septembre. Ils partaient en chaise de poste et se faisaient
suivre de leurs chevaux, conduits en main par le Malais, qui devait
les rejoindre au château.
Au moment du départ, je ne pus m’empêcher de fondre en
larmes; j’entraînai Horace dans une chambre et le priai une dernière
fois de m’emmener avec lui: je lui dis mes craintes inconnues, je lui
rappelai ces tristesses, ces terreurs incompréhensibles qui le
saisissaient tout-à-coup. A ces mots, le sang lui monta au visage, et
je le vis me donner pour la première fois un signe d’impatience. Au
reste, il le réprima aussitôt, et, me parlant avec la plus grande
douceur, il me promit, si le château était habitable, ce dont il doutait,
de m’écrire d’aller le rejoindre. Je me repris à cette promesse et à
cet espoir; de sorte que je le vis s’éloigner plus tranquillement que je
ne l’espérais.
Cependant les premiers jours de notre séparation furent affreux;
et pourtant, je vous le répète, ce n’était point une douleur d’amour:
c’était le pressentiment vague, mais continu, d’un grand malheur. Le
surlendemain du départ d’Horace, je reçus de lui une lettre datée de
Caen: il s’était arrêté pour dîner dans cette ville et avait voulu
m’écrire, se rappelant dans quel état d’inquiétude il m’avait laissée.
La lecture de cette lettre m’avait fait quelque bien, lorsque le dernier
mot renouvela toutes ces craintes, d’autant plus cruelles qu’elles
étaient réelles pour moi seule, et qu’à tout autre elles eussent paru
chimériques: au lieu de me dire au revoir, le comte me disait adieu.
L’esprit frappé s’attache aux plus petites choses: je faillis m’évanouir
en lisant ce dernier mot.
Je reçus une seconde lettre du comte, datée de Burcy; il avait
trouvé le château, qu’il n’avait pas visité depuis trois ans, dans un
délabrement affreux; à peine s’il y avait une chambre où le vent et la
pluie ne pénétrassent point; il était en conséquence inutile que je
songeasse pour cette année à aller le rejoindre; je ne sais pourquoi,
mais je m’attendais à cette lettre, elle me fit donc moins d’effet que
la première.
Quelques jours après, nous lûmes dans notre journal la première
nouvelle des assassinats et des vols qui effrayèrent la Normandie;
une troisième lettre d’Horace nous en dit quelques mots à son tour;
mais il ne paraissait pas attacher à ces bruits toute l’importance que
leur donnaient les feuilles publiques. Je lui répondis pour le prier de
revenir le plus tôt possible: ces bruits me paraissaient un
commencement de réalisation pour mes pressentimens.
Bientôt les nouvelles devinrent de plus en plus effrayantes; c’était
moi qui, à mon tour, avais des tristesses subites et des rêves
affreux; je n’osais plus écrire à Horace, ma dernière lettre était
restée sans réponse. J’allai trouver madame de Lucienne, qui depuis
le soir où je lui avais tout avoué, était devenue ma conseillère: je lui
racontai mon effroi et mes pressentimens; elle me dit alors ce que
m’avait dit vingt fois ma mère, que la crainte que je ne fusse mal
servie au château avait seule empêché Horace de m’emmener; elle
savait mieux que personne combien il m’aimait, elle à qui il s’était
confié tout d’abord, et que si souvent depuis il avait remerciée du
bonheur qu’il disait lui devoir. Cette certitude qu’Horace m’aimait me
décida tout-à-fait; je résolus, si le prochain courrier ne m’annonçait
pas son arrivée, de partir moi-même et d’aller le rejoindre.
Je reçus une lettre: loin de parler de retour, Horace se disait forcé
de rester encore six semaines ou deux mois loin de moi; sa lettre
était pleine de protestations d’amour; il fallait ces vieux engagemens
pris avec des amis pour l’empêcher de revenir, et la certitude que je
serais affreusement dans ces ruines, pour qu’il ne me dît pas d’aller
le retrouver; si j’avais pu hésiter encore, cette lettre m’aurait
déterminée: je descendis près de ma mère, je lui dis que Horace
m’autorisait à aller le rejoindre, et que je partirais le lendemain soir;
elle voulait absolument venir avec moi, et j’eus toutes les peines du
monde à lui faire comprendre que, s’il craignait pour moi, à plus forte
raison craindrait-il pour elle.
Je partis en poste, emmenant avec moi ma femme de chambre
qui était de la Normandie; en arrivant à Saint-Laurent-du-Mont, elle
me demanda la permission d’aller passer trois ou quatre jours chez
ses parens qui demeuraient à Crèvecœur; je lui accordai sa
demande sans songer que c’était surtout au moment où je
descendrais dans un château habité par des hommes que j’aurais
besoin de ses services; puis aussi je tenais à prouver à Horace qu’il
avait eu tort de douter de mon stoïcisme.
J’arrivai à Caen vers les sept heures du soir; le maître de poste,
apprenant qu’une femme qui voyageait seule demandait des
chevaux pour se rendre au château de Burcy, vint lui-même à la
portière de ma voiture: là il insista tellement pour que je passasse la
nuit dans la ville et que je ne continuasse ma route que le
lendemain, que je cédai. D’ailleurs, j’arriverais au château à une
heure où tout le monde serait endormi, et peut-être, grâce aux
événemens au centre desquels il se trouvait, les portes en seraient-
Vous aimerez peut-être aussi
- Baudelaire SpleenDocument171 pagesBaudelaire SpleenNing SunPas encore d'évaluation
- Fagus - La Danse Macabre - PoèmeDocument166 pagesFagus - La Danse Macabre - PoèmeOCorpoNegroPas encore d'évaluation
- Vivien Une Femme M ApparutDocument77 pagesVivien Une Femme M ApparuthelledeltaPas encore d'évaluation
- La Chronique Des Bridgerton (TOME 7) HyacintheDocument321 pagesLa Chronique Des Bridgerton (TOME 7) HyacintheEspérant NDUNDAPas encore d'évaluation
- Smoke On The Water - BassDocument2 pagesSmoke On The Water - BassJuliaPas encore d'évaluation
- TP ADS Ampli Transistors 1Document8 pagesTP ADS Ampli Transistors 1kaimissPas encore d'évaluation
- Il Est Temps de Vivre La Vie Qu - Christine MichaudDocument231 pagesIl Est Temps de Vivre La Vie Qu - Christine MichaudAnatolie IavorschiPas encore d'évaluation
- Bustin LooseDocument5 pagesBustin LooseMarco MazzaiPas encore d'évaluation
- Державний гімн України для духового оркестру - Партитура и партииDocument25 pagesДержавний гімн України для духового оркестру - Партитура и партииАндрій МітроховPas encore d'évaluation
- 15 Popular Christmas Trios BB TubaDocument25 pages15 Popular Christmas Trios BB TubaLorna Velasco RazaPas encore d'évaluation
- Sofyly, As in A Morning Sunrise - Wilbur Ware PDFDocument6 pagesSofyly, As in A Morning Sunrise - Wilbur Ware PDFyellowsunPas encore d'évaluation
- Mosbys Drug Guide For Nursing Students 14Th Edition Linda Skidmore Roth Download 2024 Full ChapterDocument23 pagesMosbys Drug Guide For Nursing Students 14Th Edition Linda Skidmore Roth Download 2024 Full Chaptergary.wesley812100% (13)
- Full Download Ati RN Proctored Comprehensive Predictor 2016 Form B PDFDocument23 pagesFull Download Ati RN Proctored Comprehensive Predictor 2016 Form B PDFcharles.norris476100% (17)
- Imagerie Medicale Radiologie Et Medecine Nucleaire Reussir Les Ecni College National Des Enseignants de Biop Et Al Download 2024 Full ChapterDocument48 pagesImagerie Medicale Radiologie Et Medecine Nucleaire Reussir Les Ecni College National Des Enseignants de Biop Et Al Download 2024 Full Chapterbrandon.davidson232100% (10)
- Infertilite Prise en Charge Globale Et Therapeutique Frydman Download 2024 Full ChapterDocument47 pagesInfertilite Prise en Charge Globale Et Therapeutique Frydman Download 2024 Full Chapterbrandon.davidson232100% (11)
- He Matologie: Réussir Ses Ecni, Le Cours Officiel + Entraînements Types Corrigés (Les Re Fe Rentiels Des Colle Ges) 3Rd Edition Norbert IfrahDocument48 pagesHe Matologie: Réussir Ses Ecni, Le Cours Officiel + Entraînements Types Corrigés (Les Re Fe Rentiels Des Colle Ges) 3Rd Edition Norbert Ifrahjennifer.mckinney784100% (13)
- Adaptabilite Totale Keith Ferrazzi Download 2024 Full ChapterDocument47 pagesAdaptabilite Totale Keith Ferrazzi Download 2024 Full Chapterpaul.acosta376100% (12)
- 2019 Schweser Kaplan Cfa Level 1 Study Notes 1 5 Full ChapterDocument22 pages2019 Schweser Kaplan Cfa Level 1 Study Notes 1 5 Full Chapterida.taylor647100% (40)
- Imagerie Medicale College Medical Francais Des Professeurs Danatomie Download 2024 Full ChapterDocument47 pagesImagerie Medicale College Medical Francais Des Professeurs Danatomie Download 2024 Full Chapterbrandon.davidson232100% (11)
- Imagerie Des Urgences Imagerie Medicale Pratique French Edition Taourel Download 2024 Full ChapterDocument47 pagesImagerie Des Urgences Imagerie Medicale Pratique French Edition Taourel Download 2024 Full Chapterbrandon.davidson232100% (9)
- Kinetics in Materials Science and Engineering 1St Readey Solution Manual PDF Docx Full Chapter 2024Document22 pagesKinetics in Materials Science and Engineering 1St Readey Solution Manual PDF Docx Full Chapter 2024georgia.clay423100% (10)
- Ebook Introduction To Probability and Statistics Metric Version PDF Full Chapter PDFDocument67 pagesEbook Introduction To Probability and Statistics Metric Version PDF Full Chapter PDFelena.smith644100% (19)
- Free Download Marketing Management 15Th Edition Philip Kotler Full Chapter PDFDocument51 pagesFree Download Marketing Management 15Th Edition Philip Kotler Full Chapter PDFeileen.cooper698100% (25)
- Interventions Et Therapies Breves 10 Strategies Concretes Crises Et Opportunites 2E Edition Edition Betbeze Download 2024 Full ChapterDocument47 pagesInterventions Et Therapies Breves 10 Strategies Concretes Crises Et Opportunites 2E Edition Edition Betbeze Download 2024 Full Chapterfaye.kauffman119100% (12)
- Full Download Ebook PDF Modern Diesel Technology Heavy Equipment Systems 3Rd Edition Ebook PDF Docx Kindle Full ChapterDocument22 pagesFull Download Ebook PDF Modern Diesel Technology Heavy Equipment Systems 3Rd Edition Ebook PDF Docx Kindle Full Chaptervelma.tarrant212100% (36)
- Full Educational Research 5Th Edition Creswell Test Bank PDFDocument23 pagesFull Educational Research 5Th Edition Creswell Test Bank PDFmichael.suzuki903100% (17)
- Full Download Book Econometric Analysis Global Edition PDFDocument22 pagesFull Download Book Econometric Analysis Global Edition PDFdeborah.arnaud284100% (15)
- Discovering Computers 2018 Misty E Vermaat Et Al Full ChapterDocument67 pagesDiscovering Computers 2018 Misty E Vermaat Et Al Full Chapterronald.allison470100% (15)
- Textbook Ebook Nephrologie Hertig All Chapter PDFDocument43 pagesTextbook Ebook Nephrologie Hertig All Chapter PDFvirginia.scott676100% (3)
- Full Download Deviance 1st Edition Today Thio Calhoun Conyers Test Bank PDF Full ChapterDocument34 pagesFull Download Deviance 1st Edition Today Thio Calhoun Conyers Test Bank PDF Full Chapterfeasiblenadde46r66100% (16)
- Full Download Book Williams Hematology PDFDocument22 pagesFull Download Book Williams Hematology PDFronald.jewell170100% (15)
- Full Test Bank For Intermediate Accounting Vol 2 Kin Lo George Fisher PDF Docx Full Chapter ChapterDocument34 pagesFull Test Bank For Intermediate Accounting Vol 2 Kin Lo George Fisher PDF Docx Full Chapter Chapterstephaniehornxsoiceygfp100% (11)
- Read online textbook A Murder Between The Pages Amy Lillard 2 ebook all chapter pdfDocument22 pagesRead online textbook A Murder Between The Pages Amy Lillard 2 ebook all chapter pdfemily.zwagerman245100% (7)
- Descriptif 2023Document18 pagesDescriptif 2023NCECPas encore d'évaluation
- Le Mariage inattendu de Chérubin: Comédie en 3 actes et en proseD'EverandLe Mariage inattendu de Chérubin: Comédie en 3 actes et en prosePas encore d'évaluation
- Recapitulatif Classe de 1G1 BBDocument14 pagesRecapitulatif Classe de 1G1 BBmymyPas encore d'évaluation
- Le chanteur parisien: Recueil des chansons de L.A. PitouD'EverandLe chanteur parisien: Recueil des chansons de L.A. PitouPas encore d'évaluation
- Textes À TransposerDocument20 pagesTextes À TransposerTiste LarPas encore d'évaluation
- Éric Emmanuel Schmitt Quand Je Pense Que Beethoven Est Mort Alors Que Tant de Crétins Vivent...Document84 pagesÉric Emmanuel Schmitt Quand Je Pense Que Beethoven Est Mort Alors Que Tant de Crétins Vivent...o_dutel4595Pas encore d'évaluation
- IndesingDocument6 pagesIndesingqdarkmarioPas encore d'évaluation
- CHANSONSDocument37 pagesCHANSONSÉtalo AtelierPas encore d'évaluation
- Le Misanthrope de Molière - Acte V, scène 4: Commentaire de texteD'EverandLe Misanthrope de Molière - Acte V, scène 4: Commentaire de textePas encore d'évaluation
- Devoir de Type Brevet Des CollègesDocument3 pagesDevoir de Type Brevet Des CollègesOghmius OgmaPas encore d'évaluation
- GSR Eabt 1STMG1Document12 pagesGSR Eabt 1STMG1Sheima HPas encore d'évaluation
- Mon Tour Du Monde (Charlie Chaplin) (Z-Library)Document147 pagesMon Tour Du Monde (Charlie Chaplin) (Z-Library)LegrandPas encore d'évaluation
- Théophile Gautier - La CafetiereDocument6 pagesThéophile Gautier - La CafetiereAlexandra DeacPas encore d'évaluation
- Les Frères Chantemesse: Tome I - Un caprice de Madame de PompadourD'EverandLes Frères Chantemesse: Tome I - Un caprice de Madame de PompadourPas encore d'évaluation
- Le Chat Passe MurailleDocument769 pagesLe Chat Passe MurailleZouheirMoufdiPas encore d'évaluation
- TIRANT LO BLANC - Percussion 4 PDFDocument5 pagesTIRANT LO BLANC - Percussion 4 PDFPablo Mena EscuderoPas encore d'évaluation
- Analyse de Film - La Fémis 2023Document3 pagesAnalyse de Film - La Fémis 2023Reset The WorldPas encore d'évaluation
- CHAP 2 - Systemes RADIOCOMDocument43 pagesCHAP 2 - Systemes RADIOCOMmayssahadjhassen26Pas encore d'évaluation
- Tres Danzas Colombianas: Pasillo de SalónDocument6 pagesTres Danzas Colombianas: Pasillo de SalónOSCARPas encore d'évaluation
- Nostalgie Julio IglesiasDocument1 pageNostalgie Julio IglesiasОле ДимитровскаPas encore d'évaluation
- GMEA 2020 - SB Tenor SaxDocument2 pagesGMEA 2020 - SB Tenor SaxBrendan PittsPas encore d'évaluation
- BACK ON MY FEET-kimberoseDocument2 pagesBACK ON MY FEET-kimberoseJérôme CarrièrePas encore d'évaluation
- Variations of A Theme of WeberDocument3 pagesVariations of A Theme of WeberZairaPas encore d'évaluation
- Eval 4 2éme Annee - SEMESTRE 1Document1 pageEval 4 2éme Annee - SEMESTRE 1kakaPas encore d'évaluation
- Nouvelles Fonctionnalités FL Studio 20.6Document3 pagesNouvelles Fonctionnalités FL Studio 20.6Derveau KASSAPas encore d'évaluation
- O Come, All Ye Faithful - CelloDocument2 pagesO Come, All Ye Faithful - CelloNguyễn SơnPas encore d'évaluation
- Sandrine Willems-Consoler Schubert-NashvilleDocument83 pagesSandrine Willems-Consoler Schubert-NashvilleKi WiPas encore d'évaluation
- JIMI Dendrix 1BDocument1 pageJIMI Dendrix 1BOjas UploadingPas encore d'évaluation
- Reaktor 5 Getting Started FrenchDocument150 pagesReaktor 5 Getting Started FrenchGuillaume BadartPas encore d'évaluation
- Etude de La Commande MLIDocument20 pagesEtude de La Commande MLIloubna lamrabetPas encore d'évaluation
- Catalogue AXCEO Systems Automatismes Accessoires - EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE POUR RECEPTEUR RADIOBAND RU - Ref RADIOBAND TBX - Notice InstallationDocument30 pagesCatalogue AXCEO Systems Automatismes Accessoires - EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE POUR RECEPTEUR RADIOBAND RU - Ref RADIOBAND TBX - Notice InstallationPhilPas encore d'évaluation
- EVIDENCIAS PIANO - Partitura CompletaDocument1 pageEVIDENCIAS PIANO - Partitura Completajames bondPas encore d'évaluation
- SPM Pianoforte 2Document108 pagesSPM Pianoforte 2Giacomo FerrariPas encore d'évaluation
- SOLDADO FERIDO - Clarinet in BB 1Document2 pagesSOLDADO FERIDO - Clarinet in BB 1Nilton LuizPas encore d'évaluation
- BalanceTonQuoi-Paroles - 1Document2 pagesBalanceTonQuoi-Paroles - 1Angeline BussonPas encore d'évaluation
- Projet de Thèse 2022Document20 pagesProjet de Thèse 2022Didier RotellaPas encore d'évaluation
- El Señor Es Mi Luz y Mi Salvación, VocesDocument1 pageEl Señor Es Mi Luz y Mi Salvación, Voceshernan_nPas encore d'évaluation
- DELFA1 Epreuve01Document10 pagesDELFA1 Epreuve01GERESPas encore d'évaluation