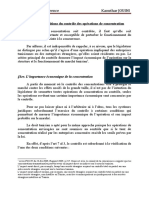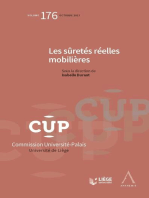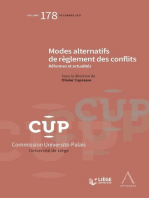Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours
Cours
Transféré par
Mehereen AubdoollahCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours
Cours
Transféré par
Mehereen AubdoollahDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours : Le contrat et la libert contractuelle
Les ides librales qui guident la rvolution de 1789, se manifestent sur le plan philosophique et sur le plan conomique. Dun point de vue philosophique, .! . "ousseau affirme dans son #uvre Du contrat social que lhomme est naturellement bon et quil faut laisser faire les choses. Dun point de vue conomique, on croit $ la prsence dune % main invisible & qui guide le march pour le bien de tous et la satisfaction de lintr't gnral. (haque individu est donc libre. La libert ne)clut pas lassu*ettissement $ des obligations, si cet assu*ettissement prend sa source dans la volont de celui qui sengage
Article 1101 du Code Civil : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent, envers une ou plusieurs autres personnes, donner, faire ou ne pas faire quelque chose
1) Les fondements du droit des contrats
Le droit des contrats repose sur la libert contractuelle , qui est la consquence de lautonomie de la volont. Lautonomie de la volont est un principe de notre droit selon lequel la volont est seule cratrice de droits et dobligations +elon ce principe, lhomme est un 'tre libre , il ne peut pas 'tre soumis $ des obligations autres que celles quil a voulues. a) Les diffrents aspects de la libert contractuelle Le principe de lautonomie de la volont induit deu) consquences en ce qui concerne la formation des contrats - la libert contractuelle et le consensualisme. La libert contractuelle comporte trois aspects qui sont la libert de contracter ou de ne pas contracter, la libert de choisir son cocontractant, celle de choisir les clauses de son contrat. Le consensualisme est un principe selon lequel le contrat tant form par la seule rencontre des volonts, lcrit nest pas ncessaire la formation du contrat. b) Les limites la libert contractuelle 1. Lordre Public (ependant lautonomie de la volont peut avoir des effets pervers dans les contrats o. les rapports de force ne sont pas gau). La partie la plus forte peut imposer % sa loi & $ la partie la plus faible. Lordre public va poser des r/gles qui ont pour but de limiter lautonomie de la volont afin de dfendre lintr't du plus grand nombre ou les intr'ts des plus faibles. Lordre public peut prendre deu) formes diffrentes lordre public de direction constitu par les r/gles au mo0en desquelles l1tat influence lconomie , lordre public de protection par lequel le lgislateur entend protger la partie la plus faible au contrat.
Cours : Le contrat et la libert contractuelle
(ertaines r/gles dordre public vont apporter des limites au principe de la libert contractuelle en imposant lobligation de contracter, en interdisant le libre choi) du contractant, en contr2lant le contenu des contrats. 2. La remise en cause de la libert contractuelle La libert contractuelle est au*ourdhui largement remise en cause. Dabord, certains contrats sont obligatoires , par e)emple, les contrats d3 assurance 4nsuite, le choi) du cocontractant nest pas tou*ours libre. 5ar e)emple, un emplo0eur nest pas totalement libre dembaucher la personne de son choi). 6 non discrimination par e)emple7. 4nfin, les clauses de nombreu) contrats sont imposes par la puissance publique ou des organismes professionnels. 5ar e)emple, dans la vente $ distance, le consommateur dispose dun % dlai de repentir &. (e droit de rtractation lui permet dannuler la vente sans subir de contraintes. (ette clause fait partie dun corps de r/gles qui a vocation $ sappliquer imprativement au) relations noues entre les partenaires. Ces rgles impratives forment lordre public. 8uand des parties concluent un contrat, cest pour quil soit e)cut. Le)cution est donc un moment important de la vie du contrat. 9outefois, dans certains cas, la parole donne nest pas respecte et le contrat est ine)cut.
2. Lexcution du contrat
Le (ode civil veille $ le)cution du contrat. : cette fin, il pose deu) principes celui de leffet obligatoire du contrat , et celui de leffet relatif du contrat.
a)
Leffet obligatoire du contrat
Le contrat est la loi des parties. 9outefois, dans un souci dquilibre, le (ode civil limite la porte de cette % loi & en e)igeant que les contrats soient e)cuts de bonne foi . ;u) termes de larticle 11<=, alina 1er, du (ode civil - % Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi $ ceu) qui les ont faites. & (e te)te pose le principe de la force obligatoire des contrats passs entre les personnes. Le contrat est donc la loi des parties, $ condition, toutefois, quil ait t rguli/rement form. 4n vertu de ce principe, les parties sont tenues de)cuter larrangement contractuel quelles ont ngoci. De m'me, elles ne peuvent pas modifier unilatralement le contrat.
Le dernier alina de larticle 11<= prvoit que les conventions doivent tre e cutes de bonne foi !. 4st de bonne foi celui qui parle avec sincrit ou bien encore celui qui agit avec droiture, franchise, honn'tet. La *urisprudence tire de cette disposition des consquences pratiques - les parties doivent e)cuter lo0alement les obligations mises $ leur charge. 5ar e)emple, un chauffeur de ta)i doit emmener son client $ destination en empruntant le chemin le plus court.
Cours : Le contrat et la libert contractuelle
b) Leffet relatif du contrat Le contrat na deffet quentre les parties contractantes. Ce principe dit de leffet relatif re>oit des e)ceptions. ". Le principe ;u) termes de larticle 11?@ du (ode civil, % les conventions nont deffet quentre les parties contractantes &. Le contrat ne cre donc ni droits ni obligations $ lgard des tiers 6personnes trang/res au contrat7. 5ar e)emple, le nouvel occupant dun logement nest pas tenu de poursuivre le contrat de tlphone de lancien locataire , ce contrat ne lie que les parties signataires. #. Les e ceptions au principe Des tiers peuvent 'tre concerns par le contrat. $n contrat peut crer une c%arge pour autrui - par e)emple, les hritiers qui acceptent la succession sont tenus par les contrats passs par le dfunt comme sils les avaient passs eu)! m'mes , ils succ/dent au) droits et crances du dfunt. Als sont aussi tenus des dettes, sauf sils refusent la succession.
3. Linexcution du contrat
La libert contractuelle laisse les parties libres de contracter ou de ne pas contracter. Bul ntant forc de contracter, celui qui a donn sa parole contractuelle doit la respecter. Dans le cas contraire, il peut 'tre forc $ respecter son engagement ou $ indemniser son cocontractant. a) Lexcution force Au cas o le dbiteur refuserait de sexcuter, le crancier peut exercer sur lui une contrainte pour lobliger respecter les obligations mises sa c arge. 5ar e)emple, lacheteur oblige son vendeur $ livrer le matriel , dans ce cas, on parle de)cution force. Le crancier va donc rclamer le)cution en nature du contrat. Le)cution force suppose la runion de deu) conditions Dune part, il faut une mise en demeure. Al sagit dun acte qui constate le retard du dbiteur et qui apporte la preuve du caract/re volontaire de ce retard. (e constat est effectu par divers mo0ens, notamment la sommation. (et acte, signifi par huissier, a pour ob*et de mettre le dbiteur en demeure de)cuter ses obligations. Dautre part, il faut un titre e cutoire. (e titre, qui prend la forme dun *ugement ou dun acte notari, permet de recourir, si besoin, $ la force publique 6e). - une saisie mobili/re7. b) Lexcution par quivalent Dans certaines situations, le)cution en nature nest pas possible. 5ar e)emple, une pi/ce unique ob*et du contrat 6tableau ou bi*ou7 ne peut pas 'tre remplace par un ob*et identique si cette pi/ce est perdue. Al faut avoir recours $ une autre forme de rparation - le)cution par quivalent. (elle!ci se traduit par le versement de dommages!intr'ts par le dbiteur au crancier. Les dommages!intr'ts correspondent $ une somme dargent verse au crancier et qui est destine $ compenser le pr*udice subi du fait de line)cution du contrat.
3
Vous aimerez peut-être aussi
- 6) Concentration 2Document5 pages6) Concentration 2Geek DudePas encore d'évaluation
- Civil Approfondi 2 MasterDocument70 pagesCivil Approfondi 2 MasterعابرةسبيلPas encore d'évaluation
- APC RefaitDocument2 pagesAPC RefaitNada TarikPas encore d'évaluation
- La responsabilité du travailleur, de l’employeur et de l’assuré socialD'EverandLa responsabilité du travailleur, de l’employeur et de l’assuré socialPas encore d'évaluation
- L'autonomie de La VolontéDocument3 pagesL'autonomie de La VolontéOth ManPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document5 pagesChapitre 2Irénaëlle PromitorPas encore d'évaluation
- Modes alternatifs de règlement des conflits: Réformes et actualitésD'EverandModes alternatifs de règlement des conflits: Réformes et actualitésPas encore d'évaluation
- Responsabilité, indemnisation et recours: CUP 174 - Morceaux choisisD'EverandResponsabilité, indemnisation et recours: CUP 174 - Morceaux choisisPas encore d'évaluation
- L’assurance R.C. auto: Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989D'EverandL’assurance R.C. auto: Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989Pas encore d'évaluation
- Mesures d'exécution et procédures collectives: Confrontation des règles de l'exécution et du droit des entreprises en difficultéD'EverandMesures d'exécution et procédures collectives: Confrontation des règles de l'exécution et du droit des entreprises en difficultéPas encore d'évaluation
- Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesD'EverandLe contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesPas encore d'évaluation
- Lien de CausalitéDocument23 pagesLien de CausalitéWalid AmraniPas encore d'évaluation
- Le Bail Commercial S5 PDFDocument28 pagesLe Bail Commercial S5 PDFTamih TamihPas encore d'évaluation
- Resp Civile Cours en FrançaisDocument28 pagesResp Civile Cours en FrançaisSelma Bakr100% (1)
- CP Les Peines Alternatives Font Leur Entrée Dans Le Code PénalDocument3 pagesCP Les Peines Alternatives Font Leur Entrée Dans Le Code Pénalammokhles_996017479Pas encore d'évaluation
- S. Pimont, Chapitre 2 Les Effets de La Clause PenaleDocument33 pagesS. Pimont, Chapitre 2 Les Effets de La Clause PenalebernardPas encore d'évaluation
- Liberté ContractuelleDocument8 pagesLiberté ContractuelleMohammed SaoudiPas encore d'évaluation
- Pratiques Anticoncurrentielles FinalDocument9 pagesPratiques Anticoncurrentielles Finaljihane amraniPas encore d'évaluation
- Contencieux Cambiare - WordDocument10 pagesContencieux Cambiare - WordHind Amhaouch100% (1)
- Droit Du CréditDocument41 pagesDroit Du CréditMus Hamadouche100% (1)
- Chapitre 4 Représentation Des SalariésDocument8 pagesChapitre 4 Représentation Des SalariéssihemPas encore d'évaluation
- Techniques ContractuellesDocument8 pagesTechniques ContractuelleslegaldesignmadaPas encore d'évaluation
- Le Devoir de Loyauté Du Dirigeant SocialDocument74 pagesLe Devoir de Loyauté Du Dirigeant Socialsalma AzrourPas encore d'évaluation
- MA Moire Adeline Villain - L Immixtion Du Juge Dans Le ContratDocument116 pagesMA Moire Adeline Villain - L Immixtion Du Juge Dans Le Contratjamal eddine raoufPas encore d'évaluation
- 537db1c7cf5bcDocument24 pages537db1c7cf5bczineb lemhainiPas encore d'évaluation
- Droit Public Des AffairesDocument48 pagesDroit Public Des AffairesRodrigo JeremiasPas encore d'évaluation
- Les Pactes D'actionnairesDocument24 pagesLes Pactes D'actionnaireshedhli zaynebPas encore d'évaluation
- Analyse de ContratDocument15 pagesAnalyse de ContratKoolibalyPas encore d'évaluation
- Droit Des Relations Individuelles Du TravailDocument64 pagesDroit Des Relations Individuelles Du TravailSuper LatifPas encore d'évaluation
- Abus de Majorite Minorite EgaliteDocument21 pagesAbus de Majorite Minorite EgaliteArnaud Desire BADOPas encore d'évaluation
- Droit de La ConcurrenceDocument5 pagesDroit de La ConcurrenceimanitaPas encore d'évaluation
- Droit de La ConcurrenceDocument12 pagesDroit de La ConcurrenceZineb KorchiPas encore d'évaluation
- L'Evolution de La Notion D'associeDocument4 pagesL'Evolution de La Notion D'associeCristina-Mihaela ArdeleanPas encore d'évaluation
- Lettre de ChangeDocument26 pagesLettre de ChangeYOUSSEFPas encore d'évaluation
- Autonomie de La VolonteDocument13 pagesAutonomie de La VolonteAsmae BoulartalPas encore d'évaluation
- Relation Professionelle Au MarocDocument35 pagesRelation Professionelle Au MarocLazrek HibaPas encore d'évaluation
- Le Ministère PublicDocument2 pagesLe Ministère PublicMehdi Hajoui Taalibi100% (1)
- Contrats CommerciauxDocument2 pagesContrats CommerciauxabdelhakimPas encore d'évaluation
- Exposé Droit Du TravailDocument15 pagesExposé Droit Du TravailGODONOU EmmanuelPas encore d'évaluation
- La Résolution Unilatérale Du Contrat VFDocument15 pagesLa Résolution Unilatérale Du Contrat VFSanae MarikhPas encore d'évaluation
- Tableau Du Contrat D'adhésionDocument2 pagesTableau Du Contrat D'adhésionRéda El khechabiPas encore d'évaluation
- Cours Droit Du Travail-ConvertiDocument53 pagesCours Droit Du Travail-ConvertiPurple SocialPas encore d'évaluation
- Clause Penale Et DommagesDocument13 pagesClause Penale Et DommagesGilbert Massiri100% (1)
- Résumé Droit PénalDocument41 pagesRésumé Droit PénalAmeni WannésPas encore d'évaluation
- TGO Fiche 4 La Circulation de L'obligationDocument6 pagesTGO Fiche 4 La Circulation de L'obligationReda MansouriPas encore d'évaluation
- Le DolDocument5 pagesLe DolDouba DoumbouyaPas encore d'évaluation
- Cours Formation Et Condition de Validite Des ContratsDocument3 pagesCours Formation Et Condition de Validite Des ContratsEva DamePas encore d'évaluation
- Droit Des AffairesDocument6 pagesDroit Des AffairesImane SaimPas encore d'évaluation
- Existence ConsentementDocument9 pagesExistence ConsentementsihemPas encore d'évaluation
- Droit Cambiaire 2Document9 pagesDroit Cambiaire 2Cherni AsmaPas encore d'évaluation
- 100 Ans Du Droit Du Dpi MarocDocument5 pages100 Ans Du Droit Du Dpi MarocKaoutaruPas encore d'évaluation
- Droit Des AffairesDocument3 pagesDroit Des AffairesMouhcine RhouiriPas encore d'évaluation
- Article Procédures Collectives Et Contentieux de L'impayéDocument9 pagesArticle Procédures Collectives Et Contentieux de L'impayéNaoual Ep ElammariPas encore d'évaluation
- Droit Cambiaire 0Document11 pagesDroit Cambiaire 0Cherni AsmaPas encore d'évaluation
- Adil Hind 2010 These PDFDocument350 pagesAdil Hind 2010 These PDFYoussefdrm Bessadimr0% (1)
- Delit de Banqueroute - 0Document2 pagesDelit de Banqueroute - 0ISSA BRROUPas encore d'évaluation
- M1 - Contrats SpéciauxDocument100 pagesM1 - Contrats SpéciauxJerem Nowina KonopkaPas encore d'évaluation
- L Effet Relatif Des ContratsDocument2 pagesL Effet Relatif Des ContratskouatPas encore d'évaluation