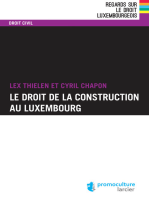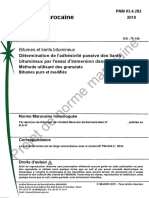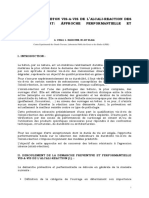Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Guide Dapplication Beton NF en 206-1 Sur Les Chantiers Dern Version
Guide Dapplication Beton NF en 206-1 Sur Les Chantiers Dern Version
Transféré par
Dark Hobbit0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
16 vues27 pagesTitre original
Guide Dapplication Beton Nf en 206-1 Sur Les Chantiers Dern Version
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
16 vues27 pagesGuide Dapplication Beton NF en 206-1 Sur Les Chantiers Dern Version
Guide Dapplication Beton NF en 206-1 Sur Les Chantiers Dern Version
Transféré par
Dark HobbitDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 27
GUIDE DAPPLICATION PRATIQUE
DE LA NOUVELLE NORME BETON
NF EN 206-1
SUR LES CHANTIERS
MARS 2005
Guide dapplication pratique de la nouvelle norme bton :
NF EN 206-1 sur les chantiers
Introduction
Ce document, tabli la demande de la FNTP en collaboration troite avec EGF-BTP, a pour
objet dattirer lattention des Entrepreneurs sur les principales modifications apportes par la
mise en place de la nouvelle norme bton NF EN 206-1 en France par rapport aux pratiques
habituelles de chantier en matire de fabrication de bton et de rception de bton prt
lemploi fabriqus en usine.
Les diffrents points dtaills couvrent la fois :
- les principales modifications apportes par la nouvelle norme ;
- les dispositions prendre lors de la rdaction des commandes de BPE ;
- le transfert de proprit la rception du bton ;
- les contrles du bton destin louvrage (annexe technique pouvant tre jointe la
commande).
Liste de fiches pratiques
Fiche n1 : Marquage CE et Marques de certification (NF) ;
Fiche n2 : Protocole daccord entre le SNBPE et les Fdrations dEntrepreneurs.
Fiche n3 : La spcification des btons ;
Fiche n4 : Classes exposition et enrobages ;
Fiche n5 : Utilisation de graves pour la fabrication des btons.
Fiche n6 : Mode prfrentiel de spcification de la consistance du bton frais ;
Fiche n7 : Justification du respect de la norme vis vis de la spcification sur leau efficace.
Fiche n8 : Prparation des prouvettes pour crasement du bton ;
Fiche n9 : Choix du nombre des prouvettes pour essais sur btons ;
Fiche n10 : Exemples de comparaison du nombre dessais de rsistance entre producteur et
utilisateur (DTU 21).
Fiche n11 : Le liant quivalent vu sous laspect performantiel du bton ;
Fiche n12 : Familles largies.
Fiche n13 : Incidence financire.
Fiche n14 : Dispositions complmentaires ncessaires lapplication de la NF EN 206-1
pour le BPE (transport et transfert de proprit).
Fiche n1 : Marquage CE et Marques de certification (NF)
AU PLAN GENERAL
1/ Du fait de la Directive europenne Produits de Construction 89/106, le Marquage CE est
obligatoire pour les produits de construction concerns.
Pour tre mis sur le march, tout produit de construction pour lequel la Commission
Europenne a donn mandat au Comit Europen de Normalisation dtablir une norme
harmonise, doit tre marqu CE.
Les normes de produits contiennent la fois des spcifications dapplication volontaire et des
spcifications harmonises rglementaires dont la liste, objet du mandat, est donne dans une
annexe - traditionnellement repre par les lettres ZA - qui prcise en outre le niveau
retenu pour le systme dattestation de conformit.
Le Marquage CE, appos par le fabricant correspond - selon le systme et avec le niveau
dattestation de conformit dcid pour ce produit par la Commission Europenne (avec
intervention ou non dun organisme extrieur notifi) - aux seules spcifications
harmonises.
Ainsi le Marquage CE sur un produit, obligatoire sa mise sur le march, ne constitue
quune simple dclaration de conformit au contenu de lannexe ZA.
Les ouvrages dans lesquels un produit CE est incorpor sont rputs respecter a priori les six
exigences essentielles de la Directive Produits de Construction (DPC 89/106) :
- Rsistance mcanique et stabilit - Scurit en cas dincendie
- Hygine, sant et environnement - Scurit dutilisation
- Protection contre le bruit - Economie dnergie et isolation thermique
2/ La Marque NF est une Marque volontaire de certification sur la base dun rfrentiel.
Les Marques de certification volontaires - comme par exemple la Marque NF- nont en aucun
cas vocation se substituer au Marquage CE, ou rciproquement.
Elles peuvent coexister, en tant complmentaires, sous deux conditions :
1. les exigences de la Marque de certification ne peuvent qutre suprieures aux
exigences rglementaires du Marquage CE,
2. les exigences de la Marque de certification ne doivent pas constituer dentrave la
libre circulation des produits.
Il peut sagir par exemple de garantir des niveaux de performance qui correspondent aux
classes dusage dfinies dans la partie volontaire de la norme europenne, ou de demander
nationalement un niveau dattestation suprieur celui prvu par la partie harmonise.
Par exemple, la marque NF-Liants Hydrauliques a t maintenue, en concomitance avec le
marquage CE obligatoire depuis avril 2001 pour les ciments courants.
CAS PARTICULIER DU BETON
Il ny a pas de Marquage CE sur le bton car la norme EN 206-1 na pas fait lobjet dun
mandat de la Commission. La norme est 100 % volontaire, sans partie rglementaire
harmonise, ni donc dannexe ZA.
Il na en effet pas t jug souhaitable dintroduire de distorsion commerciale entre le bton
prt lemploi - qui est formellement un produit au sens de la DPC car mis sur le march -
et le bton fabriqu sur le chantier qui nen est pas un.
Par contre, il existe toujours une certification spcifique au bton prt lemploi (Marque NF-
BPE), dont le rfrentiel a t rcemment modifi pour prendre en compte la nouvelle norme
bton NF EN 206-1.
Fiche n2 : Protocole daccord entre le SNBPE et les
Fdrations dEntrepreneurs
Lancien protocole daccord de juillet 1979 sign entre les deux Fdrations du BTP et le
Syndicat du bton prt lemploi (SNBPE) a t rvis dbut 1995, suite la publication en
1994 dune premire dition de la nouvelle norme exprimentale XP P 18-305 consacre au
BPE. La nouvelle dition daot 1996 de ce texte na pas eu dincidence sur ce protocole.
Ce protocole sign le 02 mars 1995 par les Prsidents de la FNB ( lpoque Fdration
Nationale du Btiment), de la FNTP, du SNBATI ( lpoque Syndicat National du Bton
Arm des Techniques Industrialises et de lEntreprise Gnrale), de lUNM ( lpoque
Union Nationale de la Maonnerie), et du SNBPE, nest pas abrog dbut 2005.
En plus dun engagement rciproque dinciter au plus large recours possible des btons
certifis (Marque NF), ce protocole de quatre pages constitue une charte des bonnes relations
entre fournisseurs et utilisateurs de bton prt lemploi fabriqu en usine.
En substance il traite :
- du contrat,
- des dlais de livraison,
- des indemnits de retard, dattente, ou de dure excessive de dchargement,
- des accs aux chantiers,
- de la garantie de quantit,
- de la garantie de qualit (consistance et rsistance),
- du refus de fourniture.
Il ny a pas de raison particulire pour changer a priori les principes de ce protocole,
suite la mise en vigueur de la norme NF EN 206-1.
Toutefois, le champ trait par la norme NF EN 206-1 - dapparence plus tendu que le
prcdent par la prise en compte de tous les btons - ne couvre plus, pour le BPE, la totalit de
celui que couvrait lancienne norme XP P 18-305.
La norme NF EN 206-1 est, en effet, une norme de fabrication de matriau, ne traitant pas
totalement des sujets en aval la fabrication comme par exemple du transport, de la
livraison, des critres de rception sur le chantier ou de la conformit du bton destin
louvrage.
La rdaction dune norme spcifique au BPE est envisage pour permettre,
prochainement, de retrouver la totalit du champ prcdemment trait.
Ce nest qu la vue de cette norme, dont la rdaction est amorce, quil sera possible
dactualiser le protocole.
Fiche n3 : La spcification des btons
La norme NF EN 206-1 dfinit le rle et les responsabilits techniques du prescripteur vis--
vis du matriau bton.
Sur les chantiers, le prescripteur final est toujours lentrepreneur puisque cest lui qui met
au point la formulation dans le cadre dune fabrication en propre, ou passe la commande au
fournisseur de BPE. Cest lentrepreneur qui assure la synthse et la cohrence entre :
les spcifications concernant la durabilit du bton durci de louvrage, qui doivent
tre tablies en amont par le Matre dOeuvre,
et les proprits requises pour le bton frais (consistance, pompabilit,) ou au
jeune ge (rsistance court terme) qui dpendent directement des mthodes de
mise en uvre et ne peuvent donc tre prcises que par lentrepreneur.
En pratique, avec lavnement de la norme NF EN 206-1 et dans la mesure o le Fascicule
65A reprend dsormais le mme vocabulaire pour ce qui concerne les classes dexposition, la
spcification amont tablie par le Matre dOeuvre et matrialise dans le CCTP du March
devrait se contenter de spcifier par type de bton les seuls lments suivants :
classes dexposition de chaque partie douvrage,
nature de lagressivit chimique pour les classes XA,
niveau de prvention vis--vis de lalcali- raction.
La mention de la classe dexposition implique le respect des clauses de formulation du tableau
NA.F.1 et correspond une durabilit estime 50 ans au sens de la norme NF EN 206-1 et
implicitement de 100 ans au sens du fascicule 65A.
Ces spcifications obligatoires peuvent si ncessaire tre renchries par les complments
suivants :
aspect de parement sur la base de la P 18-503,
spcification particulire (sur les granulats par exemple),
voire mme rsistance en compression 28 jours.
Au-del de ces exigences, le Matre dOeuvre peut souhaiter pntrer dans le domaine de la
spcification du ou des btons de louvrage, en imposant des prescriptions complmentaires
aux textes normatifs et rglementaires. Ces prescriptions ne doivent toutefois tre ni dun
niveau infrieur ni en contradiction avec les textes applicables. Elles ne sont utiles que si elles
les compltent et si elles nentranent pas dincompatibilits techniques.
Il est important pour lentrepreneur de clarifier avec le Matre duvre, au stade de la
soumission et de la revue de contrat :
la cohrence de la spcification amont,
ladquation avec un rsultat optimal au niveau de louvrage.
Dans un deuxime temps, et en fonction des mthodes de mise en uvre, lentrepreneur
complte la spcification avec les lments suivants :
rsistance mcanique en compression 28 jours et ventuellement aux jeunes
ges ;
type de ciment ;
classe de chlorure ;
consistance ;
dimension maximale du granulat : D
max ;
type de bton BPS ou BCP.
Les prescriptions complmentaires suivantes sont joindre, si ncessaire, lintention du
producteur (liste non exhaustive) :
rsistance au jeune ge,
qualit des granulats,
pompabilit,
maintien de la consistance dans le temps,
teinte,
dosage minimum en liant et en fines (lments infrieurs 0,063 mm)
Note : Lattention est attire sur le fait quune mention explicite BPS par le matre
doeuvre conduirait de fait imposer du BPE et interdire le bton de chantier, voire la
prfabrication.
Fiche n4 : Classes exposition et enrobages
Les classes dexposition sintressent la durabilit des btons vis vis des agents agressifs
potentiels :
- Concernant le matriau bton : Gel/dgel avec ou sans sels de dverglaage (XF), Eau
de mer (XS), agressions chimiques (XA)
- Concernant le risque de corrosion des armatures des btons arms et prcontraints :
Carbonatation (XC), Chlorures (XD et XS), Sels de dverglaage (XS).
Pour ces dernires, lpaisseur effective denrobage est un point important non pris en compte
par la norme bton NF EN 206-1. Les rglements actuellement en vigueur (BAEL et BPEL)
modulent les valeurs denrobage en fonction des conditions environnantes.
Une modulation de lpaisseur denrobage en fonction de la gamme effective du bton retenu
est dvelopp dans lannexe franaise du futur EUROCODE 2 (EN 1992-1-1). A noter quun
supplment denrobage par rapport une valeur nominale spcifie sur EC 2 ne permet pas de
considrer un bton correspondant une classe dexposition infrieure. En revanche,
lutilisation dun bton de rsistance suprieure celle impose pour la classe dexposition
considre peut permettre de diminuer lpaisseur denrobage.
Note : Lattention est attire sur le fait que les lments prfabriqus sont rgis par la norme
NF EN 13369 et les normes harmonises rattaches, ou par les Agrments Techniques
Europens (ATE). Les dispositions constructives de ces rglements peuvent, dans certains
cas, prvoir des paisseurs denrobage infrieures celles prconises dans lEC2, et quune
attention particulire doit donc tre porte la cohrence densemble des spcifications
internes chaque march.
Cest ainsi que par exemple en France et pour une poutre, la solution coulage en place ou la
prfabrication foraine conduisent respecter un enrobage minimal conforme lannexe
nationale franaise de lEC2, tandis que la solution prfabrication en usine (marquage CE)
conduit respecter un enrobage minimal conforme aux normes produits harmonises
dcoulant de la norme EN 13369 ou lATE spcifique, indpendamment des spcifications
franaises (et donc ventuellement avec un enrobage infrieur).
Fiche n5 : Utilisation de graves pour la fabrication des
btons
La nouvelle norme limite lutilisation des graves telles que dfinies dans la norme granulats
NF EN 12620 au paragraphe 3.3 : granulat compos dun mlange de gravillons et sables.
Note : Il peut tre produit sans passer par des fractions spares de gravillons et de sables ou
par mlange de gravillons et de sables .
Le paragraphe NA.5.2.3.2 limite le D
max
dune grave pour bton 6,3 mm pour toutes les
classes de rsistance des btons. Il en rsulte que la ralisation dun bton avec un D
max
suprieur 6,3 mm ne peut tre envisage quavec le recours, minima, une grave et un
gravillon, soit deux catgories de granulats.
Il en rsulte, en particulier, limpossibilit a priori dutiliser les mlanges connus
prcdemment sous le nom de paveurs et qui correspondaient des graves dont le D
max
tait non limit.
Rappel des dfinitions de la norme granulats pour bton NF EN 12620 :
- Gravillon : dsignation des classes granulaires pour lesquelles D est suprieur
ou gal 4 mm et d est suprieur ou gal 2 mm .
- Sable : dsignation des clases granulaires pour lesquelles D est infrieur ou
gal 4 mm.
Note : Le sable peut rsulter de laltration naturelle des roches massives ou meubles
et/ou de leur concassage ou de traitement de granulats artificiels .
Fiche n6 : Mode prfrentiel de spcification de la
consistance du bton frais
Les essais de mesure de consistances du bton les plus courants sont lessai daffaissement
et lessai dtalement, dont il faut noter que les valeurs sont dsormais donnes en
millimtres, mme si les protocoles dessais sont globalement peu changs.
Deux autres essais (Vb et indice de serrage) ne sappliquent qu des btons trs fermes.
Dans la pratique courante des chantiers, lessai de rfrence reste la mesure de
laffaissement au cne dAbrams pour des valeurs infrieures 210 mm. Lessai
dtalement la table secousses (15 chocs) avec le cne DIN est fortement recommand
pour le contrle des btons fluides. Il ne faut pas le confondre avec lessai dtalement au
cne dAbrams ( slump-flow ) prconis pour les btons autoplaants.
Le tableau suivant donne les correspondances entre les anciennes et les nouvelles
terminologies pour lessai daffaissement.
XP P 18-305 NF EN 206-1
Classes Valeurs cible (tolrances)
(exemples indicatifs)
Classes
Bton ferme 1 4 cm (F) 30 (10) mm S1
Bton plastique 5 9 cm (P) 70 (20) mm S2
Bton trs plastique 10 15 cm (TP) 130 (30) mm S3
Bton fluide = 16 cm (Fl) 180 (30) mm S4
Les valeurs daffaissement suprieures 210 mm (donc a fortiori la classe S5) sont
proscrire.
Les valeurs cibles doivent toujours tre privilgies par rapport aux classes de
consistance. A noter que les valeurs cibles du tableau sont donnes titre dexemple en
correspondance avec les anciennes classes. Elles doivent tre adaptes en fonction des
besoins du chantier.
Les tolrances sur les valeurs limites des classes de consistance ntant garanties qu 85 %
par les critres de production en usine, lutilisation de valeurs cibles permet (article NA 5.4.1)
de bnficier de tolrances rduites. Lexemple ci-dessous illustre clairement lintrt de
spcifier systmatiquement des btons avec des valeurs cibles de consistance. A dfaut les
critres de conformit dun bton, correspondant une classe de consistance, la rception
sur chantier devront tre clairement spcifis lors de la commande.
Exemple :
- Spcifier un bton S3 (100 150 mm) signifie que la plage dacceptation est
donc gale : [100 20 ; 150 + 30] = [80 mm ; 180 mm].
- Spcifier un bton avec une valeur cible daffaissement de 120 mm, signifie
que la plage dacceptation est gale : [120 30 ; 120 + 30] = [90 mm ; 150
mm].
Fiche n7 : Justification du respect de la norme vis vis de
la spcification sur leau efficace
Lancienne norme XP P 18-305 nimposait que le respect dune valeur nominale sur le
rapport E
efficace
/L
quivalent
. La nouvelle norme NF EN 206-1 impose dsormais une valeur
maximale ce rapport avec une tolrance de 0,02 pour chaque charge de bton produit. La
justification du respect des exigences du tableau NA.F.1 passe par la disponibilit
systmatique des bons de peses de chaque charge de bton utilis dans louvrage (que le
bton soit fabriqu sur chantier ou en usine).
EXEMPLE
A lissue dune tude de laboratoire la formule de bton en poids secs suivante de C30/37
XA1 est propose :
- CEM I 52,5 : 300 kg/m
3
- Cendres volantes : 50 kg/m
3
(comptes avec k = 0,5)
- Sable 0/4 : 845 kg/m
3
- Gravillon 4/12 : 330 kg/m
3
- Gravier 10/20 : 720 kg/m
3
- Eau totale (hors adjuvant) : 178 kg/m
3
- Adjuvant : 3,5 kg/m
3
- Poids total: 2426,5 kg/m
3
Lors de la fabrication du bton les matriaux granulaires sont naturellement humides. En
supposant que les humidits mesures et mentionnes sur le bon de pese soient de 5 % pour
le sable, de 1,3 % pour le gravillon 4/10 et de 0,9 % pour le gravier 10/20, les quantits peses
devant donc apparatre sur le bon de peses (aux tolrances prs) seront donc les suivantes :
- CEM I 52,5 : 300 kg/m
3
- Cendres volantes : 50 kg/m
3
- Sable 0/4 : 887,3 kg/m
3
- Gravillon 4/12 : 334,3 kg/m
3
- Gravier 10/20 : 726,5 kg/m
3
- Eau dapport : 124,9 kg/m
3
- Adjuvant : 3,5 kg/m
3
- Poids total: 2426,5 kg/m
3
Par consquent, la vrification de la formule de bton et le calcul du E
efficace
/L
quivalent
seffectue de la manire suivante :
Constituants Pese (gche 1 m
3
) Formule bton Poids secs
CEM I 52,5 300 300
Cendres volantes 50 50
Sable 0/4 887,3 887,3/1,05 = 845
Gravillon 4/12 334,3 334,3/1,013 = 330
Gravier 12/20 726,5 726,5/1,009 = 720
Eau de gchage 124,9
Adjuvant 3,5 3,5
Eau Totale 124,9+(42,3+4,3+6,5) = 178
Si ladjuvant a un extrait sec de 30 %, donc il y a 3,5 x 0,7 = 2,5 litres deau apporte par
ladjuvant.
En supposant que les absorptions des granulats sont respectivement de 0,3 % sur le sable et de
0,8 % sur les deux gravillons. Leau absorbable par les granulats est gale 845 x 0,003 +
(330 + 720) x 0,008 = 11 litres
Leau efficace est donc gale 178 11 + 2,5 = 169,5 litres/m
3
Le rapport E
efficace
/L
quivalent
est donc gal : 169,5 / (300 + 0,5 x 50 ) = 0,52
Pour un bton de classe dexposition XA1, le rapport E/C maximal est gal 0,55. Par
consquent, lors de la production du bton, aucune valeur individuelle ne devra tre
suprieure 0,55 + 0,02 = 0,57.
Le dosage maximal en eau efficace est gal 185,3 litres/m
3
, ce qui laisse une marge de 15,8
litres/m
3
( noter que cette valeur est infrieure la valeur de 20 litres/m
3
donne dans le
rfrentiel de la marque NF du BPE) sur le dosage en eau par rapport la valeur nominale.
Remarque : La formule nominale de bton doit tre cale pour permettre le respect du ratio
E
efficace
/L
quivalent
en tenant compte des tolrances de dosages sur les constituants ( 3 % sur le
liant et sur leau dans 90 % des cas). En pratique, cela correspond retenir une valeur
nominale de E
efficace
/L
quivalent
infrieure de 0,02 0,05 par rapport aux valeurs spcifies.
Fiche n8 : Prparation des prouvettes pour crasement
du bton
La norme NF EN 206-1 permet dutiliser plusieurs types dprouvettes pour le contrle de la
rsistance du bton.
Pour un contrat donn, le producteur doit dclarer le type dprouvettes utilises (cubes ou
cylindres) pour son auto-contrle de production. Il convient de lui demander de prciser la
dimension des prouvettes et leur nombre retenu par prlvement, ainsi que le cas chant
leur mode de prparation avant crasement. Ce choix fait, il ne doit plus tre modifi.
Cas des Cylindres
Les cylindres 160 mm / 320 mm (ou de 110 mm / 220 mm pour des btons dont le D
max
est
infrieur 22,4 mm) ncessitent une prparation avant la ralisation de lessai dcrasement.
Les prouvettes 16 x 32 sont dsormais confectionnes en trois couches avec un piquage de
25 coups pour chaque couche dans le cas dun serrage manuel, et les prouvettes 11 x 22
sont confectionnes en deux couches.
En ce qui concerne la prparation des prouvettes avant la ralisation de lessai de
compression, les faces d'appui doivent tre prpares par rectification (mthode de rfrence)
ou par surfaage (jusqu des performances attendues suprieure environ 50 MPa). La
norme NF EN 12390-3 stipule cependant que dautres mthodes de prparation des faces
d'appui peuvent tre utilises si elles sont valides par rapport la rectification.
Il est possible dutiliser pour des btons de performances mcaniques suprieures 50 MPa le
surfaage au soufre HP puisquil sagit dune approche conservatrice en terme de
performances mcaniques. Il convient cependant de garder lesprit que ce mode de
surfaage est pnalisant par rapport la rectification au lapidaire (de lordre de 5 %).
Pour un C
X/Y
, la rsistance caractristique obtenir sur cylindre 16 x 32 est de
X
MPa. Dans
le cas dutilisation de cylindres 11 x 22, les valeurs mesures sont diminuer de 1,0 MPa
pour des rsultats infrieur 50 MPa, ou multiplier par 0,98 partir de 50 MPa.
Exemple : pour un C30/37, une valeur mesure de 36,0 MPa sur cylindre 11 x 22 est
ramener 35,0 MPa (pour une rsistance caractristique de 30 MPa).
Cas des Cubes
Les cubes de 150 mm (ou de 100 mm pour des btons dont le D
max
est infrieur 22,4 mm) ne
ncessitent pas de prparation avant la ralisation de lessai dcrasement.
Ainsi, dans le cas dun C
X/Y
, la rsistance caractristique obtenir sur cube de 150 mm est de
Y MPa. Dans le cas dutilisation de cubes de 100 mm, les valeurs mesures sont diminuer
de 1,5 MPa si
Y
< 50 MPa, ou multiplier par 0,97 partir de 50 MPa.
Exemple : pour un C30/37, une valeur mesure de 40,5 MPa sur cube de 100 mm est a
ramener 39 MPa (pour une rsistance caractristique de 37 MPa).
Fiche n9 : Choix du nombre des prouvettes pour essais
sur btons
Contrairement lancienne norme franaise BPE XP P 18-305, la nouvelle norme bton
ne fixe pas le nombre dprouvettes utiliser pour raliser les essais sur btons durcis.
Lancienne norme considrait comme rsultat dun essai de compression la moyenne
arithmtique de trois essais dcrasement au moins avec limination des rsultats
correspondants des tendues suprieures 20% de la valeur moyenne. Il en rsultait, de fait,
une dispersion rduite de lcart type estim de la distribution des rsistances note s .
Le maintien de la pratique actuelle avec trois prouvettes changerait peu les rfrences
habituelles. Mais le passage une seule prouvette pourrait conduire des dispersions
majores de lordre de 70%, tandis que le passage deux prouvettes correspondrait environ
20%.
La majoration des dispersions pourrait alors atteindre les valeurs suivantes suivant loption
retenue :
1 seule prouvette 2 prouvettes
seulement
3 prouvettes comme
auparavant
1,70 1,20 1,00
Soit pour une dispersion de base prise antrieurieurement gale 2,5 MPa, un dcalage de la
valeur moyenne de :
1 seule prouvette 2 prouvettes
seulement
3 prouvettes comme
auparavant
4,3 MPa 3,0 MPa 2,5 MPa
Il semble donc raisonnable de ne pas descendre en dessous dune valeur de deux prouvettes
pour ne pas majorer excessivement les critres de valeurs moyennes respecter sur les btons.
Cest loption retenue par le nouveau DTU 21 via la procdure dite dalerte.
Fiche n10 : Exemples de comparaison du nombre dessais
de rsistance entre producteur et utilisateur (DTU 21)
Trois exemples :
1/ Chantier catgorie B de 2 000 m
3
de bton en 4 mois
2/ Chantier catgorie B de 4 000 m
3
de bton en 7 mois, dcompos en 2 lots de (1500 + 2500
m
3
) en simultan sur 7 mois
3/ Chantier catgorie C de 6 000 m
3
de bton en 9 mois
Explicatif du tableau :
Dans le tableau comparatif ci-dessous, les premires lignes correspondent aux nombres
dessais fixs en fonction du critre du volume V de bton, les deuximes correspondent aux
nombres dessais fixs en fonction du critre de la dure ( M en mois ), et les troisimes
retiennent la valeur la plus dfavorable.
Nota : les chiffres sont arrondis suprieurement.
Pour le BPE, la production moyenne mensuelle continue a t fixe par hypothse
4 000 m
3
/mois, ce qui entrane, pour un chantier donn de volume V de bton et de dure M
en mois, une probabilit de contrle de V / 4000 x M.
Pour lexemple 1 : 2 000 / (4 000 x 4) = 0,125
Pour lexemple 2 : 4 000 / (4 000 x 7) = 0,143
Pour lexemple 3 : 6 000 / (4 000 x 9) = 0,167
Tableau du nombre dessais
En usine BPE
( tableau 13 NF EN 206-1 )
Sur chantier
( tableau 2 du DTU 21 NF P 18 210 )
Numro
Exemple
BPE certifi BPE non
certifi
BPS
certifi
BPS
non certifi
BCP
1
Cat. B
5
18x0,125=3
5
14
90x0,125=12
14
1+2
1+4
5
1+4
1+4
5
1+8
1+4
9
2
Cat. B
10
32x0,143=5
10
27
157x0,143=23
27
(1+2)+(1+3)
(1+7)x2
16
(1+3)+(1+5)
(1+7)x2
16
(1+6)+(1+10)
(1+7)x2
18
3
Cat. C
15
41x0,167=7
15
40
202x0,167=34
40
1+6
1+9
10
1+12
1+9
13
1+40
1+9
41
Le BPS certifi livr par un BPE est davantage contrl sur le site par lutilisateur que
statistiquement en usine par le producteur.
Note 1 : Le cot des contrles correspond, dans le cas du BPS, au cumul du cot du contrle
de production (qui nest que statistiquement appliqu au bton effectivement livr sur le
chantier concern) ralis par le BPE et de celui ralis par lentrepreneur sur le bton
effectivement utilis pour louvrage.
Note 2 : Les rsultats dauto-contrle du fournisseur ne peuvent pas tre incorpor dans la
justification du bton de louvrage lorsque ce dernier a recours la notion de famille.
Fiche n11 : Le liant quivalent vu sous laspect
performantiel du bton
La norme NF EN 206-1 conserve une approche de spcification de moyens mais introduit la
possibilit de justifier les formulations partir dune dmonstration de la durabilit par des
essais performantiels : pour une classe dexposition donne, on peut droger au tableau
NA.F.1 si on justifie dune performance satisfaisante au regard de la durabilit.
En particulier, le concept de performance quivalente du bton permet de moduler les
exigences nonces dans la norme en ce qui concerne le dosage minimal en ciment et le
rapport maximal eau/ciment (dans les cas o une addition spcifique est utilise avec un
ciment spcifique dont l'origine et les caractristiques de chacun sont clairement dfinies et
consignes). Dans ce cas, il doit tre prouv que le bton a une performance quivalente
celle d'un bton de rfrence, en ce qui concerne son comportement vis--vis de sa rsistance
aux agressions de la classe d'exposition concerne.
L'annexe E de la norme NF EN 206-1 prcise la faon de choisir le bton de rfrence : par
exemple dans le cas de recomposition en centrale de CEM I et daddition, le bton de
rfrence serait formul base dun CEM II comportant un pourcentage voisin de la mme
addition. Les spcifications de moyens seraient alors assouplies dans la mesure o lon
pourrait considrer le liant quivalent avec un coefficient k = 1 pour une quantit daddition
telle que la composition soit conforme un des types de ciment de la norme EN 197-1 (pour
les cendres volantes, par exemple, la limite serait de 55 % du liant total qui constitue le ratio
maximal obtenu pour les ciments de type CEM IV). Cette voie permettrait de valoriser les
additions courantes (cendres volantes, filler calcaire) qui sont habituellement affectes dun
coefficient k minorateur lorsquelles ne sont pas mlanges en cimenterie.
La principale difficult de la dmarche est de justifier de la pertinence de lessai performantiel
retenu. Toutefois, il existe aujourdhui des mthodes reconnues pour certaines agressions :
- gel et sels de dverglaage : Recommandations pour la durabilit des btons soumis
au gel (LCPC 2003).
- pntration des chlorures, carbonatation : Conception des btons pour une dure de
vie donne des ouvrages (AFGC 2003)
Il est dores et dj possible de sappuyer sur ces documents pour proposer une dmarche de
dmonstration dquivalence de performance. La mise en uvre de cette dmarche ncessite
le soutien technique dun service ou laboratoire spcialis et une volont commune
doptimisation technique.
Il faut noter que de telles dmarches ont dj t mises en uvre sur des chantiers importants.
Des programmes de recherche sont en cours pour complter les mthodes de justification
bases sur le concept dquivalence de performance, un guide dapplication est en cours de
rdaction.
Fiche n12 : Familles largies
La norme europenne EN 206 dfinit au paragraphe 3.1.14 les familles de btons comme un
groupe de compositions de bton pour lesquelles une relation fiable entre les proprits
pertinentes a t dmontre ; cette dmonstration tant consigne par crit et conserve .
Lannexe K (informative pour la version europenne) prcise cette dfinition en indiquant
quelques prcautions dutilisation en cas dexprience limite :
Ciment dun seul type, dune seule classe de rsistance et dune seule origine ;
Granulats similaires de faon dmontrable et additions de type I ;
Btons sans ou avec adjuvant rducteur deau/plastifiant ;
Toute la gamme des classes de consistance ;
Btons avec un domaine limit de classes de rsistance.
Cette mme annexe conseille que les relations de passage utilises soient testes sur des
donnes de production antrieure pour prouver quelles donnent un contrle de production et
de conformit adquat et efficace .
Lannexe franaise NA.K, qui a t rendue normative en France, offre la possibilit dlargir
la notion de famille lensemble des btons courants de lunit de production sous rserve, en
particulier, que la production fasse lobjet dune certification de produits accrdite. Cette
extension intgre alors la possibilit de prendre en compte des btons formuls avec diffrents
ciments au sein dune mme famille largie.
Il faut remarquer que le pralable impos de certification limitera peu le recours la pratique
des familles largies puisque les exigences du tableau 13 de la norme en matire de
frquence minimale dchantillonnage pour lvaluation de la conformit imposent de fait
la gnralisation de la certification pour des raisons conomiques assez videntes.
Outre que lexprience des familles de bton nexiste pas en France la mise en place de cette
nouvelle norme, il faut noter quune telle pratique ne concerne lvidence que le seul
contrle de fabrication lusine tel que dtaill au chapitre 8 de la norme avec son systme
statistique. Par ailleurs, la pratique du BPE en France est quasiment toujours associe du
transport de bton frais en toupie sur des distances trs variables mme pour des btons de
formulation similaire au sens de la dfinition limite de la famille donne en annexe K
informative.
Il est vident, dans ces conditions, que seuls les contrles la rception sont prendre en
compte pour vrifier la conformit de la livraison la commande. Un systme adapt de tels
contrles la rception doit donc tre mis en place pour les BPE qui sort du cadre de la norme
Bton limite aux seuls contrles de fabrication en usine.
Ce systme de contrle la rception tait intgr lancienne norme BPE franaise XP P 18-
305 dont un certain nombre de clauses doivent tre conserves dans les contrats de commande
de BPE (mme si le rglement particulier de la marque reprend ces items) afin de couvrir le
cas de retrait du droit dusage de la marque en cours de contrat (voir fiche N 14). Il est
intressant terme de reprendre ces lments dans la norme spcifique au BPE qui simplifiera
la rdaction des commandes de btons prts lemploi.
Fiche n13 : Incidence financire
Le passage de la XP P 18-305 la NF EN 206-1 comporte des modifications dont certaines
peuvent avoir une incidence financire sur le prix de revient du BPE et du bton de chantier.
1) Cas du BPE
Les modifications en jeu sont les suivantes :
augmentation de la garantie sur la rsistance mcanique (95% au lieu de
90%) pour les BPS de rsistance infrieure ou gale C30/37
dfinition plus prcise des contrles de rsistance effectuer en production
possibilit de ne faire que 1 ou 2 prouvettes (au lieu de 3) par chance
diminution des temps de malaxage pour les btons courants
Les rsistances mcaniques pour les BPS de rsistance infrieure ou gale C30/37 doivent
dsormais tre cales en valeur moyenne au minimum 1.64 au-dessus de la rsistance
caractristique au lieu de 1.28 .
Avec un cart-type usuel sur ce type de bton compris entre 3 et 4 MPa, ceci conduit
augmenter les rsistances mcaniques moyennes denviron 1 MPa.
Le surcot correspondant peut donc tre valu sur la base de la diffrence de rsistance
moyenne, un C25/30 suivant la norme europenne correspondant un B26 suivant lancienne
norme.
La diffrence de prix de vente entre un B25 et un B30 tant en gnral de lordre de 3 /m
3
, la
plus-value pour 1 MPa supplmentaire est de lordre de 0.6 /m
3
.
Pour ce qui concerne les contrles, en se basant sur ce qui est prvu par la marque NF pour les
centrales certifies (les centrales non certifies doivent en passer par les mmes contrles pour
garantir effectivement aux utilisateurs les performances mcaniques des BPS), la norme NF
EN 206-1 prvoit un prlvement tous les 400 m
3
ou chaque semaine (le critre le plus svre
est retenir) pour chacune des familles de bton produites. La norme XP P 18-305 et le
rfrentiel NF-BPE demandait trois prlvements par mois ou un par 1500 m
3
pour le BCN le
plus couramment fabriqu, et des contrles moins soutenus sur les autres BCN sans prciser
les frquences. Par ailleurs, les fournisseurs de bton considrent que lensemble des btons
courants produits par une centrale donne appartiennent une mme famille (notion de
famille largie ajoute leur demande dans les amendements franais de la norme). Dans le
cas dune centrale ayant une production moyenne (la valeur moyenne sur lensemble des
centrales en France est de lordre de 2000 m
3
/mois), il faut donc faire 5 prlvements par mois
au lieu de 3 par le pass, soit une augmentation de 66%.
Il faut donc considrer quun producteur ayant dj mis en place un systme de contrle
rigoureux de ses BPS ne sera pas amen faire significativement plus de contrles. Par
ailleurs, les prlvements peuvent ne donner lieu qu une ou deux prouvettes (au lieu de
trois) ce qui fait que le nombre global dprouvettes raliser ne devrait pas sen trouver
augment. On rappelle galement que le cot dun prlvement peut tre grossirement valu
160 (cot estim de fabrication dprouvettes sur chantier et crasement par un laboratoire
extrieur), ce qui donne un prix au m
3
de 0.4 /m
3
. Lventuelle plus-value est donc faible et
dans tous les cas nettement infrieure 0.4 /m
3
(Une valeur de 0.2 /m
3
pourrait tre admise
en considrant que le nombre de contrles est effectivement doubl).
Enfin, le temps de malaxage minimum tait de 55 secondes pour la majorit des btons
courants (centrales certifies ou non) alors quil passe 35 secondes pour les centrales
certifies et peut mme tre rduit davantage dans le cas des centrales non certifies. Ceci
procure des gains de productivit aux centrales de BPE, en particulier dans la priode de
dbut daprs- midi qui correspond au pic de demande des chantiers de btiment. Ainsi pour
une centrale qui produit plein rgime pendant 3 heures avec un malaxeur d1m
3
, la cadence
passe (sur lhypothse dun temps de cycle de 120 secondes) de 30 m
3
/h 36 m
3
/h. Cela
correspond donc un gain quivalent 18 m
3
soit 0.5 heure de production, soit une conomie
de main duvre value au minimum 30 /j (sur la base de deux personnes 30 /h) pour
une production globale journalire vraisemblablement infrieure 150 m
3
. Le gain minimum
est de 0.2 /m
3
. Il faut noter que cette valeur peut tre sensiblement plus leve sur de grosses
installations.
En conclusion, le passage la norme NF EN 206-1 ne devrait pas engendrer de plus-value
significative et au global on peut considrer quun ordre de grandeur raisonnable se situe
autour de 0.5 /m
3
pour les btons de classe de rsistance infrieure ou gale C30/37. Pour
les btons de classe de rsistance suprieure C30/37, lincidence financire est trs faible.
2) Cas du bton fabriqu sur chantier
Le passage la nouvelle norme NF EN 206-1 explicite un certain nombre de dispositions qui
doivent tre normalement respectes pour produire un bton de chantier de qualit mais
ntaient pas dcrites dans les documents rglementaires et normatifs jusqu prsent. Ceci
concerne en particulier les points suivants :
dition des bons de pese
ralisation dessais priodiques sur les granulats (granulomtrie, propret)
mise en place dune sonde hygromtrique sur le sable ou essai de schage quotidien
utilisation dau moins deux coupures granulaires (un sable et un gravillon)
obtention dune rsistance suprieure dau moins 6 MPa par rapport la rsistance
caractristique lors des essais initiaux
prise en compte des classes dexposition et limitation des rapports eau sur liant
quivalent (respect du tableau NA F1)
En outre, les prescriptions concernant le contrle de rsistance des BCP sont plus svres que
dans lancien DTU 21 :
un prlvement tous les 250 m
3
(ou tous les mois) au lieu de 800 m
3
pour les ouvrages
de moyenne importance
un prlvement tous les 150 m
3
(ou tous les mois) au lieu de 500 m
3
(ou tous les mois)
pour les ouvrages de grande importance
Ainsi la norme NF EN 206-1 nentrave pas la fabrication du bton sur chantier et na pas non
plus de grosses incidences financires dans le cas de BCP. Dans le cas o le client impose un
BPS, les frquences peuvent tre sensiblement majores :
un prlvement tous les 150 m
3
(ou tous les jours) dans le cas o la production
journalire moyenne est suprieure 50 m
3
un prlvement par semaine dans le cas o la production journalire moyenne est
infrieure 50 m
3
Dans le cas dune production journalire moyenne de 30 m
3
pour un ouvrage de moyenne
importance, la frquence est ainsi de 1 pour 150 m
3
pour un BPS au lieu de 1 pour 250 m
3
pour un BCP.
Fiche n14 : Dispositions complmentaires ncessaires
lapplication de la NF EN 206-1 pour le BPE (transport et
transfert de proprit)
1 Domaine d'application
Le prsent document s'applique aux btons, labors en centrales fixes ou mobiles, dsigns
dans la suite du document par l'expression Btons prts l'emploi, par des producteurs qui
n'en assurent pas eux- mmes la mise en uvre.
En complment aux spcifications de la norme bton NF EN 206-1, le prsent document a
pour objectif de prciser certaines conditions de fabrication des btons prts l'emploi, den
fixer certaines caractristiques ainsi que les qualits garanties et les essais aptes vrifier ces
dernires lors de la rception sur chantier.
Il a aussi pour objet de fixer les conditions de livraison - l'exclusion des oprations de
manutention et de stockage, qui sont du domaine des cahiers des charges particuliers,
notamment la manutention par pompage - et les conditions de transport qui font l'objet, le cas
chant, de prescriptions complmentaires celles du prsent document.
Les btons prts l'emploi viss par le prsent document sont des btons dont tous les
composants sont doss et malaxs dans une installation appele centrale pour tre transports
et livrs prts tre mis en place.
Ces btons sont :
- soit transports de la centrale au lieu d'utilisation dans des vhicules spcialement
quips de cuves tournantes (btonnires ou agitateurs ports), ou dans des vhicules
bennes munies ou non d'agitateurs ;
- soit livrs directement sur le lieu d'emploi dans tout instrument de levage ou de
manutention (benne de grue, blondin, pompe,...).
Le prsent document rgle, dans la limite des questions traites, le rapport entre le producteur
de bton prt l'emploi et l'utilisateur. En l'absence de conventions particulires, les
dispositions prvues dans les conditions gnrales de vente annexes au protocole d'accord en
vigueur entre les Fdrations du Btiment et des Travaux Publics et le Syndicat National des
Producteurs de Bton Prt l'Emploi sont applicables.
2- Rfrences normatives
Ce document comporte par rfrence date ou non date des dispositions d'autres
publications. Ces rfrences normatives sont cites aux endroits appropris dans le texte et les
publications sont numres ci-aprs. Pour les rfrences dates, les amendements ou
rvisions ultrieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent ce document que
s'ils y ont t incorpors par amendement ou rvision. Pour les rfrences non dates, la
dernire dition de la publication laquelle il est fait rfrence s'applique.
NF EN 206-1 Bton Partie 1 - : Spcification, performances, production et conformit
(indice de classement : P 18-325-1).
FD P 18-457 Fascicule de documentation AFNOR Bton Guide dapplication des mthodes
dessais.
3- Dfinitions
En complment celles de la norme NF EN 206-1, les dfinitions suivantes s'appliquent :
3.1 : instant de la livraison
L'instant de la livraison est le moment o le producteur cde sa fourniture l'utilisateur, dans
les conditions prvues par les accords conclus entre les parties. Il est matrialis par la
signature du bon de livraison par un reprsentant habilit de lutilisateur.
3.2 : lieu de livraison
Le lieu de la livraison est la cent rale lorsque l'utilisateur assure lui- mme le transport du bton
de la centrale jusqu'au lieu de l'emploi ou le lieu de mise disposition fix la commande,
dans les autres cas.
3.3 : volume unitaire du bton prt l'emploi
En complment de la dfinition donne en 3.1.15 de la norme NF EN 206-1, le volume
unitaire de bton prt l'emploi figurant sur le bon de livraison est le mtre cube de bton
compact refus avec les moyens de serrage correspondant ceux utiliss sur le lieu de
livraison.
3.4 : masse volumique conventionnelle du bton prt l'emploi
La masse volumique conventionnelle du bton prt l'emploi est la masse de son volume
unitaire. Elle est exprime en tonnes par mtre cube.
3.5 : lot
Fraction d'une fourniture correspondant un ouvrage ou une partie d'ouvrage que
l'utilisateur dsire individualiser.
Les lots sont dfinis la commande. En labsence de dfinition, lensemble des parties
douvrage ralises avec un mme bton est rput constituer un lot.
3.6 : prlvement de bton la livraison
Quantit de bton, rpute homogne, prleve dans une charge en une seule fois la
livraison conformment larticle NA 5.4.1 de la norme NF EN 206-1, et destine aux essais
de contrle de rception.
4- Dsignation des btons prts lemploi
4.1 Cas des btons proprits spcifis (BPS)
Les spcifications de larticle 6.2 de la norme NF EN 206-1 sont compltes par la
dsignation normalise (conforme la norme NF EN 197-1) du ciment en tant que donne de
base.
Exemple de dsignation de BPS sans caractre complmentaire :
BPS : NF EN 206-1 Rfrence au prsent document - Marque NF - XF1 (F) - Cl 0,40 - C25/30 cyl -
CEM II/B (S) 32,5 N CE - S : 130 mm - D
max
22,4 mm
ce qui signifie :
BPS : NF EN 206-1 Bton proprits Spcifis selon NF EN 206-1
Marque NF Bton provenant d'une centrale titulaire du droit d'usage de la marque NF-BPE.
XF1 (F) Classe d'exposition (Version franaise)
Cl 0,40 Classe de chlorures
C25/30 cyl Classe de rsistance du bton et mode de contrle (cylindre)
CEM II/B (S) 32,5 N CE Nature et classe du ciment, marquage CE
S : 130 mm Classe ou valeur cible daffaissement (S) ou dtalement (F)
D
max
22,4 Dimension maximale du granulat
Exemple de dsignation de BPS avec caractre complmentaire :
BPS : NF EN 206-1 - Rfrence au prsent document - Marque NF - XF1 (F) - Cl 0,40 - C25/30 cyl -
CEM II/B (S) 32,5 N CE - S : 130 mm - Dmax 22,4 mm - avec adjuvant PRE - destin tre pomp
La dsignation en abrg des spcifications complmentaires peut faire l'objet d'une
convention entre le producteur et l'utilisateur.
4.2 Cas des btons composition prescrite sur tude (BCPE)
Les spcifications de larticle 6.3 de la norme NF EN 206-1 sont compltes par la
dsignation du BCPE qui comprend au minimum les lments suivants :
- dnomination du bton (numro ou autre),
- composition dtaille du bton incluant la dsignation, lorigine et le dosage de tous
les constituants,
- les spcifications complmentaires ventuelles (temps de malaxage, conditions
spcifiques de livraison, etc),
Elle est accompagne des informations suivantes devant figurer sur la commande :
- socit ou laboratoire ayant ralis ltude,
- date de ralisation de ltude,
- nom du producteur de bton et adresse de la centrale,
- date et signature du reprsentant lgal du client.
Ltude doit tre ralise conformment aux prescriptions de la norme NF EN 206-1 par un
prescripteur expriment disposant dune relle comptence dans la formulation du bton.
La dsignation en abrg des spcifications complmentaires peut faire l'objet d'une
convention entre le producteur et l'utilisateur.
5- Conditions complmentaires de fabrication et de transport du BPE
5.1 : Dosage des constituants
Le dosage des constituants solides est effectu d'aprs la masse des matriaux secs et calcul
sur la base de 1 m
3
de bton compact refus, les corrections ncessaires tant apportes pour
tenir compte de l'humidit des granulats au moment du malaxage.
En complment du tableau 21 des articles 9.7 et NA.9.7 de la norme NF EN 206-1, les
tolrances 90 % par classe granulaire sur les charges sont les suivantes :
- gravillon ou sable : 4 %,
- sable correcteur ou gravillon intermdiaire (moins de 15 % de celle de lensemble des
sables ou gravillons suivant le cas) : 11 %
De plus, les tolrances 100 % sur chaque gche pour tous les constituants sont le double de
celles relatives 90 % des charges.
Charge 90% (voir
norme NF EN 206-1)
Gche (pour 100% des
gches)
Ciment +/- 3% +/- 6%
Addition + ciment +/- 3% +/- 6%
Eau pese (dapport) +/- 3% +/- 6%
Sable (sauf correcteur) +/- 4% +/- 8%
Gravillon (sauf
intermdiaire)
+/- 4% +/- 8%
Sable correcteur +/- 11% +/- 22%
Gravillon intermdiaire +/- 11% +/- 22%
Ensemble des granulats +/- 3% +/- 6%
Adjuvants - +/- 5%
Les additions sches et fillers d'apport secs sont, dans le cas d'une bascule unique, pess en
cumul aprs le ciment.
Lenregistrement des peses est obligatoire et son dition doit tre possible avec toutes les
informations utiles.
Dans le cas o l' enregistrement des peses mentionne l'eau efficace, les pourcentages ou les
coefficients d'absorption pris en compte pour chacun des constituants doivent tre galement
enregistrs.
Les constituants du bton sont identifis de manire pouvoir en assurer la traabilit.
Les frquences minimales de vrification du respect des tolrances de peses dcrites dans les
documents qualit sont au minimum d'une fois par mois sur au moins 5 charges de prfrence
conscutives. Des vrifications continues peuvent tre acceptes sur justification.
5.2 : Mlange des constituants et transport de bton
5.2.1 Malaxage des constituants
Lunit de production doit tre quipe dun dispositif de malaxage poste fixe.
Pour les malaxeurs de capacit nominale infrieure 1 m
3
, le volume minimal de chaque
gche est gal ou suprieur la moiti de la capacit nominale du malaxeur. Pour les
malaxeurs de capacit nominale suprieure ou gale 1 m
3
, le volume minimal de chaque
gche est au moins de 0,5 m
3
.
Sauf justification particulire accepte par lutilisateur, le temps minimum de malaxage est de
35 secondes.
Le malaxage est port 55 secondes minimum dans lun des cas suivants :
- BPS de rsistance suprieure C30/37,
- btons comportant un adjuvant ou une addition et dont la classe daffaissement
spcifie est infrieure S3 ou avec un affaissement cible spcifi infrieur 150 mm,
- prsence de plus de deux adjuvants,
- prsence dun entraneur dair ou dun rtenteur deau ou utilisation dun adjuvant en
dehors de la plage de dosage prconise par le fournisseur dadjuvants,
- utilisation de fumes de silice,
- absence de transport en btonnire porte ou transport en btonnire porte avec
moins de 5 minutes de temps de transport,
- malaxeur arbre horizontal unique.
Le dbut du malaxage est par convention la fin de lintroduction de tous les constituants. La
fin du malaxage correspond au dbut d'ouverture de la trappe de vidange du malaxeur.
5.2.2 Transport
Sauf justification spcifique accepte par lutilisateur, la dure du transport (compte partir
de l'introduction du ciment de la premire gche) au lieu d'utilisation, ne doit pas tre
suprieure 1 h 30 min. La dure cumule du transport et de l'attente ventuelle sur chantier,
jusqu' la fin de la vidange, ne doit pas tre suprieure 2 h.
Note : Ces dures sont donnes pour une temprature voisine de 20C.
Le bton est protg efficacement, en cours de transport, contre les risques d'vaporation, de
dlavage par temps de pluie et de sgrgation.
6- Information du producteur lutilisateur
Sur demande crite de lutilisateur, le producteur de BPE est tenu de lui communiquer la
composition nominale du bton, par indication de la nature et du dosage en ciment, en
additions, en granulats, en eau et en adjuvants. Le producteur est tenu, avant livraison,
d'aviser l'utilisateur de tout changement apport la nature et lorigine des constituants du
bton en cours de fourniture et d'obtenir son accord sur cette modification, mme si la
composition de ces btons est laisse son initiative (cas notamment des BPS).
Sur demande crite particulire, formule au plus tard 90 jours aprs la livraison, le
producteur est tenu de communiquer lutilisateur, au plus tard 4 jours ouvrs aprs rception
de la demande, les bons de pese correspondant aux bons de livraison spcifis dans cette
demande, indiquant le dosage effectif en granulats, en ciment, en additions, en eau et en
adjuvants.
Dans le cas o les granulats incorpors prsentent certaines caractristiques intrinsques de
Code C ou D, le producteur devra explicitement en aviser lutilisateur.
7- Essais de contrle la livraison
Ces essais ont pour but de contrler la conformit du bton d'un lot aux dfinitions, aux
spcifications et aux prescriptions complmentaires ventuelles du bton concern. Ils sont
excuts l'initiative de l'utilisateur et sont contradictoires, le producteur tant tenu inform
de tout contrle pour qu'il puisse assister, s'il le dsire, aux prlvements, aux essais sur bton
frais et la confection dprouvettes, qui sont effectus par un personnel qualifi,
conformment aux normes en vigueur et selon les indications complmentaires du fascicule
de documentation FD P 18-457.
7.1 : Contrle de la consistance
Lessai de consistance est effectu sur le lieu de dchargement du bton et interprt
conformment larticle NA 5.4.1 de la norme NF EN 206-1. Il est ralis pendant la priode
conventionnelle de dchargement du bton sur le chantier (voir 5.2.2).
7.2 : Contrle de la rsistance
La confection des prouvettes de contrle est termine au plus tard 40 min aprs l'arrive du
camion au chantier. Il est admis que les prouvettes de bton soient conserves avant
dmoulage l'abri des intempries, dans un local dont la temprature est comprise entre 15 et
30C. Dans les trois heures suivant le dmoulage, qui est ralis avant 48 h (hors jours non
ouvrs), les prouvettes sont places en atmosphre normalise.
Des prlvements et essais inopins non contradictoires sont possibles, mais ils doivent alors
tre effectus :
- soit par un laboratoire accrdit par le COFRAC ;
- soit par un laboratoire choisi d'un commun accord par les deux parties.
Les rsultats de tous les essais sont communiqus au producteur dans un dlai maximal de 15
jours aprs la date d'crasement des prouvettes de compression.
En ce qui concerne lidentification des prouvettes, un numro (en ordre croissant
chronologique) est affect chaque prlvement, et port sur chacune des prouvettes
correspondant ce dernier. Le responsable qualifi, que l'utilisateur a charg du prlvement,
de la confection des prouvettes et de l'excution des essais de contrle la livraison, tient sur
place un cahier de contrle indiquant, en regard du numro affect au prlvement, tous les
renseignements ncessaires l'identification du bton contrl ou l'exploitation ultrieure
des rsultats de contrle par exemple :
- le numro du bon de livraison et l'usine productrice ;
- les caractristiques du bton command (dosage, granularit, consistance, rsistance
caractristique, adjuvant ventuel, etc.) ;
- la date et l'heure du prlvement ;
- le nombre et la nature des prouvettes ;
- les rsultats des essais ;
- l'emplacement de la charge en question dans l'ouvrage ;
- les observations diverses (dmoulage, conservation, date, etc.).
Sauf dispositions contraires figurant aux pices crites du march de travaux douvrage, le
critre dacceptation du bton est dfini par le tableau suivant :
Nombre de prlvements
pour un lot de bton
Rsultat individuel dessai fci en MPa Moyenne rsultats bruts fcm en MPa
n = 2 fci fck 4,0 fcm fck 1,0
n = 3 fci fck 4,0 fcm fck + 1,0
n = 4 fci fck 4,0 fcm fck + 2,0
n = 5 fci fck 4,0 fcm fck + 2,5
n = 6 fci fck 4,0 fcm fck + 3,0
n = 9 fci fck 4,0 fcm fck + 3,5
n = 12 fci fck 4,0 fcm fck + 4,0
n ?15 fci fck 4,0 fcm fck + 1,48 s
Note : la valeur de s correspond lcart type estime de la distribution des n charges
contrles. Par ailleurs, pour les ouvrages entrant dans le cadre dapplication du DTU 21, les
valeurs allant jusqu n=6 sont inchanges par rapport aux exigences de cette norme.
Les consquences ventuelles de la non-conformit d'une fourniture aux spcifications de la
commande passe conformment au prsent document sont celles prcises dans le contrat
entre le producteur et l'utilisateur.
8- Commande et livraison
8.1 : Commande
L'unit de base des transactions est le volume unitaire de bton prt l'emploi, conformment
la dfinition 3.3.
Le producteur prcise la masse volumique conventionnelle du bton livr, exprime avec
deux dcimales conformment la dfinition 3.4.
En dehors des clauses commerciales (quantit, prix, dlais, cadence, etc.) la commande
spcifie :
- la rfrence au prsent document et s'il y a lieu, la marque NF ;
- la dsignation du bton suivant la terminologie du prsent document ;
- le mode de transport et le lieu de livraison du bton ;
- si possible, les parties douvrage auxquelles le bton est destin ;
- la dfinition des lots de rception et le programme des essais de contrle
correspondants ;
- ventuellement, les consquences de la non-conformit d'une fourniture aux
spcifications du prsent document.
8.2 : Livraison
8.2.1 Contenu du bon de livraison
Chaque livraison est accompagne d'un bon de livraison numrot, tabli en deux exemplaires
au moins, comprenant en plus des demandes de larticle 7.3 de la norme NF EN 206-1, les
complments suivants :
- la quantit de bton livr, exprime en mtres cubes de bton compact refus ;
- l'heure convenue de mise disposition du bton sur le chantier ;
- l'heure limite contractuelle de fin de mise en uvre.
Les deux exemplaires du bon sont complts sur le chantier par les informations suivantes :
- l'heure effective d'arrive du vhicule sur le chantier (complte sur le chantier) ;
- les heures de dbut et de fin de dchargement
- le cas chant, des ajouts ventuels incorpors au bton au moment de la livraison
8.2.2 Signature du bon de livraison
Le bon de livraison est sign par l'utilisateur : un exemplaire est remis au commissionnaire
pour tre retourn au producteur ; l'autre est conserv par l'utilisateur.
Cette signature matrialise le transfert de proprit du bton entre le producteur et lutilisateur
sans prjuger de la conformit des performances spcifies pour le bton.
Vous aimerez peut-être aussi
- Norme Beton NFEN206Document148 pagesNorme Beton NFEN206Tarek Taibi100% (1)
- Dtu NF P 14-301Document15 pagesDtu NF P 14-301h_diab100% (3)
- Modele de CV UEDocument2 pagesModele de CV UEPaky Maiga100% (3)
- Les Classes D'expositions Et Caractéristiques Des BétonsDocument4 pagesLes Classes D'expositions Et Caractéristiques Des Bétonsfanion47Pas encore d'évaluation
- Afnor: NF EN 771-1/A1Document15 pagesAfnor: NF EN 771-1/A1MehdiPas encore d'évaluation
- Formulation Des BetonsDocument17 pagesFormulation Des BetonsMajid BelkadiPas encore d'évaluation
- DT 15-825 Dallages-FibresMétalliquesDocument13 pagesDT 15-825 Dallages-FibresMétalliqueskikaPas encore d'évaluation
- Chapitre 05 PDFDocument50 pagesChapitre 05 PDFHam HAM100% (1)
- 2021 09 29 Normes Matieres PremieresDocument11 pages2021 09 29 Normes Matieres PremieresAmakhand EloyePas encore d'évaluation
- MG de Sulfate 1Document28 pagesMG de Sulfate 1Safa EgoPas encore d'évaluation
- Essai de Labo BetonDocument2 pagesEssai de Labo BetonChafiq Oufrid100% (1)
- Na 443 PDFDocument6 pagesNa 443 PDFazeerPas encore d'évaluation
- Les Lois Utiles de Notre ProjetDocument7 pagesLes Lois Utiles de Notre ProjetNesma BendjemaaPas encore d'évaluation
- Na 238Document13 pagesNa 238taibiPas encore d'évaluation
- Norme BétonDocument152 pagesNorme BétonAlaaeddine FoughaliPas encore d'évaluation
- 20.0270 DeformometreDocument1 page20.0270 DeformometreCONSULABPas encore d'évaluation
- Beton HydroliqueDocument9 pagesBeton HydroliqueKhadidja DoujaPas encore d'évaluation
- NF en 13057Document10 pagesNF en 13057Morched TounsiPas encore d'évaluation
- 10.1.371 en 934 1Document11 pages10.1.371 en 934 1Ahmed JemkarryPas encore d'évaluation
- NF en 14647Document33 pagesNF en 14647Fayçal OuazinePas encore d'évaluation
- Eau de GachageDocument10 pagesEau de GachageYassine Elmourad100% (1)
- AT442 - Houda LAMRANI - Montée en Cohésion Des Émulsions de Bitume en Couches D'accrochage PDFDocument19 pagesAT442 - Houda LAMRANI - Montée en Cohésion Des Émulsions de Bitume en Couches D'accrochage PDFsaid100% (1)
- TP 03&04 Le Béton À L'état DurciDocument11 pagesTP 03&04 Le Béton À L'état DurciAbdelhak MahdiPas encore d'évaluation
- LCE 308 - IM Remblai PrimaireDocument4 pagesLCE 308 - IM Remblai PrimairekhaoulaPas encore d'évaluation
- Avpn Na en 933 3 PDFDocument14 pagesAvpn Na en 933 3 PDFsamsimPas encore d'évaluation
- Som MaireDocument6 pagesSom MaireAdam El'merzoukiPas encore d'évaluation
- Etude Expérimentale D'un Béton Bitumineux Modifié Par La Poudrette de CaoutchoucDocument11 pagesEtude Expérimentale D'un Béton Bitumineux Modifié Par La Poudrette de CaoutchoucmiloudPas encore d'évaluation
- Cure Du BétonDocument6 pagesCure Du BétonGerardPas encore d'évaluation
- Indice de Segregation PDFDocument9 pagesIndice de Segregation PDFTaieb ZânouniPas encore d'évaluation
- En10248 1Document20 pagesEn10248 1makaya josiasPas encore d'évaluation
- F67-III - 2012-05-30 CCTG FranceDocument109 pagesF67-III - 2012-05-30 CCTG FranceSmail RutePas encore d'évaluation
- Norme AdhésivitéDocument10 pagesNorme AdhésivitéABOULFADLPas encore d'évaluation
- Utilisation Béton Fibre de VerreDocument8 pagesUtilisation Béton Fibre de VerreMohamed AkrourPas encore d'évaluation
- Catalogue Des Normes - 2011Document335 pagesCatalogue Des Normes - 2011Fatima Hafid100% (1)
- FR Brochure Plastifiants Superplastifiant Beton Pret EmploiDocument8 pagesFR Brochure Plastifiants Superplastifiant Beton Pret EmploiDavid HoffmanPas encore d'évaluation
- NM 10.1.277 Confronter en 1097-2Document4 pagesNM 10.1.277 Confronter en 1097-2Boulayad imadPas encore d'évaluation
- Recommandations Générales Pour Le Choix Du GéotextileDocument18 pagesRecommandations Générales Pour Le Choix Du Géotextilesam had100% (1)
- En 933-8+a1Document21 pagesEn 933-8+a1mouraddz12350Pas encore d'évaluation
- (C 02 14) Boucetta Tahar AliDocument224 pages(C 02 14) Boucetta Tahar AliAnonymous 9BFZkySwPas encore d'évaluation
- NF EN 1744-4 Sensibilité À L'eau Des Fillers Pour EnrobésDocument18 pagesNF EN 1744-4 Sensibilité À L'eau Des Fillers Pour EnrobésKader Bendjebbar Kb100% (1)
- NF en 13108-2Document28 pagesNF en 13108-2Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- PR NM 10.1.302Document10 pagesPR NM 10.1.302Younes El-BouznaniPas encore d'évaluation
- PR NF en 934-5 - Octobre 2003Document41 pagesPR NF en 934-5 - Octobre 2003Laboratoire LTGCPas encore d'évaluation
- NF EN 13398 Retour Elastique - AOUT 2010Document12 pagesNF EN 13398 Retour Elastique - AOUT 2010Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Cahier Fosse SeptiqueDocument4 pagesCahier Fosse SeptiqueMAHMOUDI ABDELKRIMPas encore d'évaluation
- Le Béton - Méthodes de FormulationDocument22 pagesLe Béton - Méthodes de FormulationRabia RavaPas encore d'évaluation
- Risque AlcaliDocument17 pagesRisque AlcaliomarPas encore d'évaluation
- NF en 14023Document25 pagesNF en 14023BENAHMED HouariPas encore d'évaluation
- Guide AxiomDocument67 pagesGuide AxiomezeazeazeaePas encore d'évaluation
- NM 10.1.169 (2020) PropretéDocument6 pagesNM 10.1.169 (2020) PropretéRabie SouidiPas encore d'évaluation
- Norme NA 442 V 2013Document13 pagesNorme NA 442 V 2013Toufik MansouriPas encore d'évaluation
- Béton Imprimé 0/2 Ou 0/3: DescriptionDocument8 pagesBéton Imprimé 0/2 Ou 0/3: DescriptionKoulala KamilaPas encore d'évaluation
- Guide D'application Pratique de La Nouvelle Norme Béton NF EN 206-1 Sur Les ChantiersDocument44 pagesGuide D'application Pratique de La Nouvelle Norme Béton NF EN 206-1 Sur Les Chantiersbarouniamine100% (1)
- Commentaires - Norme Béton NF EN 206-1 - CIM BETON (Interessant)Document19 pagesCommentaires - Norme Béton NF EN 206-1 - CIM BETON (Interessant)Pascal BaudinPas encore d'évaluation
- Norme NF 206 CN P 19Document27 pagesNorme NF 206 CN P 19bou100% (1)
- Norme NF 206 CN PDFDocument27 pagesNorme NF 206 CN PDFallaouiPas encore d'évaluation
- Gros OeuvreDocument8 pagesGros Oeuvrehalim.savecontrol6179Pas encore d'évaluation
- CT T43.10 24Document15 pagesCT T43.10 24benahmedlaboPas encore d'évaluation
- Specification BetonsDocument24 pagesSpecification BetonsWalid FekiPas encore d'évaluation
- 34 FR Prescription FormulationDocument12 pages34 FR Prescription FormulationIDESOL IDESOLPas encore d'évaluation
- Demarche Qualite Pour La Realisation Dinfrastructures DurablesDocument17 pagesDemarche Qualite Pour La Realisation Dinfrastructures DurablesPaky MaigaPas encore d'évaluation
- Covadis16 NouveautesDocument6 pagesCovadis16 NouveautesPaky MaigaPas encore d'évaluation
- 2-DURAND Affouil V2 PDFDocument24 pages2-DURAND Affouil V2 PDFPaky MaigaPas encore d'évaluation
- Citations Du Hadith Et CoranDocument2 pagesCitations Du Hadith Et CoranPaky MaigaPas encore d'évaluation
- Psa Synthese Cerle NaraDocument18 pagesPsa Synthese Cerle NaraPaky MaigaPas encore d'évaluation
- Formation Mémoire Technique Note Méthodologique Pour PME PDFDocument3 pagesFormation Mémoire Technique Note Méthodologique Pour PME PDFPaky Maiga100% (1)
- Ligne InfluenceDocument16 pagesLigne InfluencePaky MaigaPas encore d'évaluation