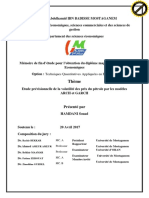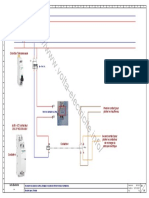Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Formateur Flashover
Transféré par
Pierre-LouisLamballaisCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Formateur Flashover
Transféré par
Pierre-LouisLamballaisDroits d'auteur :
Formats disponibles
FORMATION
« FLASHOVER »
Former des formateurs
Former des stagiaires en toute sécurité
Stage formateurs – Août 2008 – CTO Brasilia (Brésil)
Introduction..................................................................................................................................................... 3
Former les sapeurs-pompiers ....................................................................................................................... 3
La remise à niveau..................................................................................................................................... 3
La formation de base ou de passage de grade ....................................................................................... 4
Le recyclage ou le maintien des acquis ................................................................................................... 4
Les techniques de lances.............................................................................................................................. 4
Formation de Formateurs.............................................................................................................................. 5
Un travail collaboratif ..................................................................................................................................... 5
Schéma de Principe Général .................................................................................................................... 5
Tantad.com .................................................................................................................................................... 5
Le package pédagogique .............................................................................................................................. 6
Partie théorique – Niveau 1....................................................................................................................... 6
Sujets ...................................................................................................................................................... 6
Matériel fourni......................................................................................................................................... 6
Partie pratique – Les lances Niveau 1...................................................................................................... 6
Sujets ...................................................................................................................................................... 6
Matériel fourni......................................................................................................................................... 6
Partie pratique – Caissons feu réel (« flashover ») ................................................................................. 7
Documents généraux................................................................................................................................. 7
Questions – Réponses .................................................................................................................................. 8
Annexe............................................................................................................................................................ 9
Version 2.00 du 22/04/2010 – Page 2 sur 9
http://www.tantad.com
Introduction
La formation aux Progressions Rapides du Feu (également appelée « formation flashover ») est une
formation motivante pour tous les sapeurs-pompiers. Mais s’il est plus plaisant de passer du temps au
milieu de la fumée et des flammes, il n’en demeure pas moins que la pédagogie pour adulte demande
nécessairement une masse documentaire importante, adaptée et évolutive.
Ce document va présenter la formation des formateurs « flashover » telle qu’elle est réalisée de façon
commune au sein de plusieurs écoles, dans plusieurs pays. Mais voyons d’abord les cours que les
formateurs ainsi formés, peuvent dispenser.
Former les sapeurs-pompiers
Les formateurs formés via ce cursus sont principalement aptes à dispenser trois type de formations :
• Les remises à niveau
• Les formations de base ou de passage de grade
• Les recyclages et le maintien des acquis
La remise à niveau
La cohésion du personnel doit jouer en faveur du changement. En effet, dans une équipe, si le chef
est remis à niveau mais pas le personnel, il sera impossible de mener à bien une mission avec les
nouvelles techniques. Et si c’est le personnel exécutant qui est formé et pas la hiérarchie, il en sera de
même. Quelle que soit la manière dont le problème est abordé, la conclusion est toujours la même:
tout le monde doit être remis à niveau et cette remise à niveau doit se faire le plus rapidement
possible pour n’avoir des disparités que sur une période très courte.
Combien de caissons ?
Le caisson « flashover » étant un outil indispensable, c’est lui qui va constituer le goulet
d’étranglement, dans lequel tout le monde devra passer. Pour des raisons de qualité pédagogique, il a
été constaté que 6 stagiaires par exercice, encadrés par 3 formateurs, constituait un nombre idéal.
Il suffit de prendre le nombre de sapeurs-pompiers que vous devez recycler, de diviser par 6 et vous
obtiendrez le nombre de jours de cours nécessaires.
A moins que vous n’ayez un effectif très réduit, vous arriverez à la conclusion qu’avec un seul
caisson, la remise à niveau prendra beaucoup de temps. L’idéal est donc d’avoir plusieurs caissons.
Les caissons utilisés par les écoles suivant ce cours, ont été aménagés par les formateurs eux-
mêmes. Ils reviennent approximativement à 2500 Euros, transport compris, le coût de l’aménagement
ne dépassant pas 1000 Euros. Les formateurs qui suivent le cours décrit dans ce document ont à leur
disposition des documents expliquant la fabrication des caissons (aménagement).
La solution la plus souple consiste à remettre le personnel à niveau, équipe par équipe, afin qu’une
équipe formée puisse tout de suite travailler en mettant en application les nouvelles techniques. Dans
le cursus que nous avons mis en place, cette remise à niveau dure une journée. Cette durée
n’entraîne pas trop de perturbations dans les unités opérationnelles et l’impact budgétaire est réduit
au maximum. La journée est constituée d’une partie théorique d’environ 2 heures, suivie d’une
démonstration des phénomènes sur un mini-simulateur, ce qui valide la partie théorique. L’après-midi
est consacrée, pendant plus de deux heures, à l’apprentissage de 5 techniques de lances, et enfin les
stagiaires passent en « caissons flashover » pour pratiquer les techniques apprises.
Version 2.00 du 22/04/2010 – Page 3 sur 9
http://www.tantad.com
Technique de lances – Formation des élèves officiers – Brasilia - 2008
La formation de base ou de passage de grade
Elle se déroule sur deux jours et concerne le personnel en train de suivre une formation complète. Il
en existe plusieurs suivant le grade des stagiaires : un stage de deux jours pour les nouvelles recrues,
un stage de deux jours pour le passage au grade de chef d’équipe (généralement Caporal) etc… Ces
formations prennent les mêmes éléments de base que la remise à niveau, mais ceux-ci sont
développés de façon plus approfondie, la pratique étant constituée de 2 voir 3 passages en caissons
(suivant les stages)
Le recyclage ou le maintien des acquis
C’est le fait de pratiquer le plus souvent possible, afin de ne pas perdre les acquis. Le principe dépend
des possibilités des services incendies, mais en tout cas, même sans caisson flashover, il est possible
de travailler les techniques de lances.
Dans tous les cas, les formateurs reçoivent l’ensemble des documents pédagogiques leur permettant
d’organiser et d’assurer l’ensemble de ces types de formations.
Les techniques de lances
Les techniques de lances qui sont enseignées,
n’ont pas été choisies au hasard, en fonction
d’un matériel existant ou de « bonnes vieilles
habitudes ». Le choix a été fait en partant des
incendies et en cherchant à trouver des
solutions pour les éteindre, quel que soit leur
type et quel que soit leur degré d’évolution. Des
plans d’habitation ont été étudiés, en imaginant
le feu à divers emplacements et en cherchant
des solutions pour l’atteindre et l’éteindre.
Ci-contre : fourni aux formateurs sous forme de
poster A3, ce plan leur permet de présenter les
différentes techniques de lance dans le contexte
d’un incendie, avec pour chaque technique,
l’endroit de son utilisation
Ces recherches, menées à l’échelle internationale, ont permis de déterminer 5 techniques,
complémentaires :
- le passage de porte qui permet d’entrer dans la structure, puis de passer les portes
intermédiaires
- la progression, qui permet d’avancer en refroidissant les zones chaudes et en créant des
zones protégées
- L’attaque nommée « pulsing-penciling » qui permet la maîtrise rapide du foyer, à condition
que celui-ci soit assez peu alimenté en comburant. Dans le cas contraire, cette solution n’est
pas assez rapide.
- L’attaque « combinée », qui permet la maîtrise des feux correctement ventilés (Note : c’est
l’attaque ZOT du GNR Français)
Version 2.00 du 22/04/2010 – Page 4 sur 9
http://www.tantad.com
- La position de protection. Dernière solution en cas de problème, lorsque la fuite n’est plus
possible.
Note : nous constatons que ces 5 techniques permettent de faire face à l’ensemble des situations. Il
est donc hors de question de n’en prendre qu’une partie, au risque de faire courir de grands risques
aux intervenants. A noter que la formation est conforme au GNR Français, en imposant des lances
permettant un débit de 500lpm.
Formation de Formateurs
- Contenu pédagogique de qualité, directement utilisable
- Système d’évolution de ce contenu
- Participation de l’ensemble des formateurs à cette évolution
- Gestion et valorisation de l’aspect international de cette formation
Un travail collaboratif
L’objectif est de suivre un cours précis (stage formateur) et de bénéficier d’une masse documentaire
importante, directement utilisable en formation (formation de sapeurs-pompiers publics, privés,
militaires…) et dont la production et les mises à jour se font au profit de tous.
Le challenge est d’outre passer les conflits de
langues ou de nationalités, tout en ayant un
système au sein duquel les utilisateurs pourront
fournir un retour d’information rapide et précis.
Schéma de Principe Général
1 – Formateurs - Rédacteurs
2 – Formateurs
3 – Stagiaires (sapeurs-pompiers par ex.)
A – Au sein des écoles référencées, les
formateurs rédacteurs forment les formateurs et
leur fournissent le matériel pédagogique.
B – Les formateurs forment les stagiaires, en
utilisant librement le matériel pédagogique
C – Les formateurs ont accès aux dernières
versions des documents pédagogiques, via le
site internet
D – Les formateurs remontent les informations
vers les formateurs-rédacteurs (erreurs
constatées, propositions d’améliorations…)
E – Les formateurs rédacteurs analysent les
retours, modifient les documents et les remettent
à disposition sur internet.
Tantad.com
L’ouverture du site http://www.tantad.com met en avant l’objectif de partage et de reconnaissance.
Version 2.00 du 22/04/2010 – Page 5 sur 9
http://www.tantad.com
• Site multi langue.
• Accès sécurisé pour les formateurs leur donnant accès aux mises à jour des documents.
• Accès à la Lettre des Formateurs, organe de liaison entre formateurs. Elle précise des points
de la documentation, indique les modifications à prendre en compte, relate les déboires ou
réussites des formations. Elle permet la diffusion rapide des informations avant que les
documents pédagogiques ne soient mis à jour.
• Descriptif des cours et liste des formateurs agréés.
• Mise en ligne des calendriers de cours formateurs, pour toutes les écoles
• Diffusion des comptes-rendus des réunions, des tests et des recherches menées dans le
cadre des échanges internationaux entre formateurs.
• Etc…
Le package pédagogique
Le package pédagogique Version 3.00 (version de l’année 2010) est composé d’une trentaine de
documents. Aucun de ces documents n’est constitué de photocopies d’ouvrages : ce sont tous des
documents originaux, faisant l’objet d’un dépôt légal.
Important : la formation utilise des scénarios pédagogiques du même type que ceux utilisés en France
(format DDSC) et conformes aux principes de formation de type TWI (Training Within Industry).
Chaque séquence devant être commentée et justifiée, les scénarios sont associés à des documents
qui fournissent ces commentaires et ces justifications, avec des explications complètes. Ces
documents présentent également les matériels pédagogiques liés aux séquences (schémas à
reproduire, posters…).
Voici la liste des documents du package pédagogique. A noter que les cours utilisent également des
mini-simulateurs en bois. Pour ces mini-simulateurs, il y a usage d’un kit « Mini-Maison » qui contient
les plans, le dosage du combustible, le déroulement etc… pour la réalisation des démonstrations.
Partie théorique – Niveau 1
Sujets
• Rappel de combustion appliquée aux feux de locaux (flamme de diffusion et de pré-mélange,
feux contrôlés par le combustible ou le comburant, la production de fumée,etc…)
• La famille des flashover : flashover et flashover induit par la ventilation
• La famille des backdraft avec les différents modes de déclenchement
• La famille des FGI (Fire Gas Ignition) avec le flash-fire et la smoke-explosion
Matériel fourni
• Scénario pédagogique
• Document avec les « commentaires et justifications » liés aux séquences du scénario
• QCM pour le rappel sur la combustion et sur les phénomènes. Les QCM sont en deux pages :
l’un avec les questions, l’autre avec les corrections
Partie pratique – Les lances Niveau 1
Sujets
• Présentation du matériel
• Technique de progression et de création de zone « fraîches »
• Technique d’attaque en local incorrectement ventilé (pulsing penciling)
• Technique d’attaque en local correctement ventilé (attaque combinée ZOT)
• Technique de passage de porte
• Technique de protection
Matériel fourni
• Scénario pédagogique
• Document avec les « commentaires et justifications » liés aux séquences du scénario
Version 2.00 du 22/04/2010 – Page 6 sur 9
http://www.tantad.com
• Quatre posters grand format : zones dans la structure, courbe de puissance d’un feu, les
différentes zones de combustible et le danger du passage de porte.
• QCM sur les lances
• Grilles de validation. Grilles pour la validation d’exercices complets avec progression et
attaque, progression et découverte de victime…
Partie pratique – Caisson feu réel (« flashover »)
• Manuel de mise en place d’un plateau technique avec caisson : comment le choisir, le placer,
le modifier, les éléments annexes etc…
• Fiche de brûlage type CS-01. Descriptif d’un brûlage d’attaque pour initiation, avec position et
dosage du combustible, déroulement pédagogique et consignes de sécurité.
• Fiche de brûlage type CS-02. Descriptif d’un brûlage d’attaque avec forte concentration de
fumées, avec position et dosage du combustible, déroulement pédagogique et consignes de
sécurité.
• Suivi de brûlage. Document à remplir à chaque brûlage avec liste des formateurs, liste des
stagiaires, sens du vent, etc…
Documents généraux
Ces documents concernent l’ensemble de la formation
• Proposition d’amélioration. Permet aux formateurs de faire remonter les informations
concernant des erreurs, des suggestions…
• Sécurité générale. Consigne de sécurité à lire en début de stage de recyclage (une journée) :
déroulement de la journée, alertent sur la prise de médicaments, l’hydratation…
• Sécurité après-midi. Consigne de sécurité à lire en début d’après-midi, donc au début de la
seconde partie d’une journée de recyclage.
• Inaptitude incendie. Document permettant de prévenir la hiérarchie d’un problème survenu
avec un stagiaire.
• Document Formateur. Document récapitulant tous les autres, donnant des conseils généraux.
Il comporte aussi une partie « Questions réponses » pour résoudre tout un ensemble de petits
problèmes qui nous sont relatés au fur et à mesure des formations.
• Livret Stagiaire. Personnalisable pour chaque école, il est basé sur l’idée de l’ouvrage de
l’Armée Britannique « Survive to Fight ». Ce livret se veut un « pense-bête », rapide à lire,
permettant aux stagiaires ayant suivi le cours de se rappeler des techniques de lance.
Note : les deux documents de sécurité sont fournis en format Word afin que chaque école puisse le
modifier en fonction de ses particularités (emplacement des douches, lieu de repas…). Il en est de
même pour le document « Inaptitude incendie ».
Version 2.00 du 22/04/2010 – Page 7 sur 9
http://www.tantad.com
Questions – Réponses
Q - L’usage des documents est-il gratuit ?
R - Oui. Les documents sont remis aux formateurs lors des stages formateurs et l’usage qu’ils en font
est libre et gratuit.
Q - Puis-je personnaliser les documents ?
R - Certains sont fournis en format Word et sont donc personnalisables pour que vous puissiez y
mettre par exemple votre logo. C’est le cas des documents que les formateurs transmettent à leurs
stagiaires. Les autres documents ne sont pas modifiables.
Q - Si je découvre une erreur dans un document, puis-je le modifier ?
R - Non car dans ce cas les autres formateurs ne bénéficient pas de votre découverte. Vous devez
faire remonter l’information aux rédacteurs (contact@tantad.com), qui prendront en compte votre
demande et rediffuseront les documents à tous les formateurs.
Q - Si j’ai des idées d’amélioration, puis-je les incorporer aux documents ?
R - Là encore, il faut prendre en compte le principe de travail collaboratif. Vos améliorations peuvent
servir à d’autres, tout comme vous bénéficiez des améliorations proposées par les autres. Remonter
l’information aux rédacteurs (contact@tantad.com) Si votre suggestion est justifiée, elle sera
incorporée dans les documents et via la mise à jour, tout le monde en profitera.
Q - Puis-je vendre les documents ?
R - Non. Mais rien ne vous empêche de vendre la prestation de formation utilisant ces documents.
Q - Dans quelles langues les documents sont-ils disponibles ?
R - Le kit pédagogique est disponible en Français et en Portugais. Des traductions dans d’autres
langues sont en cours (Anglais et Espagnol).
Q - J’aurais besoin des documents, mais dans une autre langue…
R - Contacter les rédacteurs afin de voir avec eux les modalités de traduction.
Q - Puis-je former des formateurs ?
R - Non. Les formateurs sont formés dans les Ecoles qui ont été choisies par les rédacteurs des
documents. Vous pouvez y envoyer vos formateurs, mais, à leur retour ils ne pourront former que des
stagiaires et pas d’autres formateurs, ceci afin de conserver un niveau qualitatif optimal. Cependant,
la demande était très forte, nous envisageons d’organiser des stages de « Formateurs de
formateurs ».
Q - J’ai un centre de formation très éloigné des Ecoles formant actuellement des formateurs. Est-il
possible de venir former des formateurs dans mon centre de formation?
R - Oui. Vous pouvez contacter les rédacteurs qui analyseront votre demande (contact@tantad.com).
Si elle est retenue, ils pourront, avec vous, organiser des stages de formateurs dans votre école.
Dans ce cas les dates des stages de votre centre de formation seront communiquées avec les dates
des stages des autres écoles.
Q - Si une école se met à former des formateurs sans passer par le système collaboratif ?
R - Si elle avait l’accord de former, celui-ci lui est immédiatement retiré. De toutes façons, les
formateurs qu’elle formera ne seront pas référencés sur la base de données mondiale et n’auront pas
accès aux mises à jours. Ils se rendront donc très vite que l’école les a trompés.
Q - Tous les formateurs reçoivent-ils la même formation ?
R - Oui. Les formateurs qui suivent les stages formateurs, quelle que soit l’école qui organise ce
stage, reçoivent tous la même formation. Lorsque celle-ci évolue, les « anciens formateurs » sont mis
à niveau via le recyclage annuel.
Q - Puis-je faire travailler dans mon centre de formation, des formateurs ayant suivi le stage formateur
mais travaillant dans un autre centre de formation ?
Version 2.00 du 22/04/2010 – Page 8 sur 9
http://www.tantad.com
R - Sur le principe, oui, puisque vos formateurs et ceux des autres centres auront reçu une formation
« formateur » strictement identique. Tout est ensuite affaire d’entente entre l’autre école et la vôtre !
Q - Les formateurs utilisant des documents d’une autre langue que celle de mes formateurs, ont-ils les
mêmes informations ?
R - Oui. Les documents ne sont pas « adaptés », mais traduits. Le cours est donc strictement le
même.
Q - Où peut-on suivre les stages formateurs?
R – La liste des écoles avec les dates de stage est disponible sur le site http://www.tantad.com
Q - Quelle est la durée du stage formateur?
R - La durée minima est de 9 jours, mais chaque école peut allonger ce stage pour ajouter plus de
pratique.
Q - Combien y a-t-il de stagiaire par session?
R - Le stage peut comporter 8 stagiaires. A condition d’avoir au moins deux caissons, il est possible
d’avoir jusqu’à 12 stagiaires.
Q - Quel est le prix du stage ?
R - Le prix du stage est défini par chaque école tout comme les prestations annexes (repas,
hébergement…)
Q - Est-ce qu’il y a des pré-requis pour suivre le stage formateur?
R - Idéalement, avoir suivi une formation pédagogique pour adulte, type FOR-1 Français ou formation
de spécialisation pédagogique.
Q - Les recyclages doivent-ils se faire dans le centre dans lequel le formateur a été formé ?
R - Non. Les formateurs peuvent aller se recycler dans le centre de leur choix.
Q – Puisqu’il existe des écoles à l’étranger, peut-on envisager des échanges?
R – Oui, bien sûr, certaines ont déjà eu lieu
Annexe
Vous trouverez ci-après des pages extraites des divers documents pédagogiques du kit : quelques
pages de séquence, des pages des documents « commentaires et justifications », des extraits de
fiches de brûlage etc… Ces documents sont en Français mais sont disponibkes à l’identique dans les
autres langues (il n’y a pas « adaptation » mais traduction).
Vous désirez mettre en place un caisson, vous avez besoin d’aide, vous cherchez
des formateurs, vous désirez organiser un stage, vous avez déjà un caisson et vous
souhaitez une expertise ?
N’hésitez pas à nous contacter !
contact@tantad.com
Version 2.00 du 22/04/2010 – Page 9 sur 9
http://www.tantad.com
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU - THEORIE NIVEAU 1 - PREMIERE PARTIE (A) – GENERALITES SUR LES FEUX DE LOCAUX
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° A5 : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable d’expliquer pourquoi un feu de local Durée : 12 minutes
fume beaucoup plus qu’un feu d’extérieur
Séquence : La production de fumée d’un feu de local
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES DUREE SUPPORTS A RETENIR - INFORMATIONS
ACTIVITE DE DECOUVERTE 5 min Tableau «Qu’est ce qui explique la grande différence de production de fumée
Question à la cantonade entre un feu extérieur et le même feu dans un local ? »
Laisser les apprenants prendre conscience que la sous-oxygénation
générale d’un feu n’explique pas la production de fumée car un feu dans
une cheminée ne fume pas plus lorsque l’arrivée d’air est diminuée.
ACTIVITE DE DÉMONSTRATION : 6 min Tableau Flamme : lieu de transformation des produits gazeux de la pyrolyse.
Dessin de l’évolution du Production de CO2 puis de CO (en haut) qui vont empêcher l’oxygénation
Explication sur la production des fumées feu dans un local du haut de la flamme de diffusion. Les gaz non transformés forment la
(rappel de l’objectif précédent) à l’aide (cf doc commentaires) fumée.
d’un schéma. Les éléments qui touchent la flamme de diffusion la perturbent également
Interrogation des apprenants au fur et à (murs, meubles, mais surtout plafond…) et font qu’elle émet de la fumée.
mesure du dessin, pour reprendre les
objectifs précédents (oxygène, production Remarque: le manque de comburant n’explique pas la présence de
de CO, flamme de diffusion…) fumée..Ne pas confondre la sous-oxygénation du haut de la flamme avec
un éventuel manque général qui ralenti simplement le feu.
ACTIVITÉ D’APPLICATION :
Q1 - Que va faire un feu que l’on va sous- 1 min Questions orales R1 - Il va baisser en intensité
ventiler ?
Q2 - Que va faire la flamme de diffusion R2 – Elle va être perturbée et va donc émettre des fumées carbonées
lorsqu’elle va toucher un objet ?
Version 2.70 du 20/08/2008 – Page 8 sur 17
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU - THEORIE NIVEAU 1 - PREMIERE PARTIE (A) – GENERALITES SUR LES FEUX DE LOCAUX
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° A6 : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de citer les 5 caractéristiques des Durée : 7 minutes
fumées
Séquence : Les 5 dangers de la fumée
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES DUREE SUPPORTS A RETENIR - INFORMATIONS
ACTIVITE DE DECOUVERTE 1 min Tableau «Quels sont les caractéristiques de la fumée ? »
Question à la cantonade
Dangers de fumées : COMIX
ACTIVITE DE DÉMONSTRATION : 5 min Tableau o Chaudes. Car elles viennent du feu et sont émises dans le flux de
Les dangers sont listés en même temps convection. Elles sont en haut (Loi de Charles : les gaz chauds se
qu’ils sont découverts par les apprenants. dilatent, les gaz froids se contractent)
Recopier les lettres et o Opaques. Chargées de particules de carbone. Opaques à la vue
mettre à côté les termes mais aussi à l’ouïe (effet « coton »)
correspondants o Mobiles. Car elles sont chaudes donc légères et sensibles aux
pressions
o Inflammables. Car elles contiennent du carbone
o toXiques. Le port de l’ARI est obligatoire même pendant le
déblais. La durée de survie des victimes est de l’ordre de
quelques dizaines de secondes.
Les fumées contiennent deux des côtés du Triangle du Feu.
Information : Volume de fumée : 1kg de papier = 1000m3, une paire
d’après-ski = 2500m3.
ACTIVITÉ D’APPLICATION :
Q1 - Que signifie « COMIX » ? 1 min Question orale R1 - Ce sont les 5 dangers de la fumées : C-Chaude, O-Opaque, M-
Mobile, I-Inflammable, X-toXique
Version 2.70 du 20/08/2008 – Page 9 sur 17
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU - THEORIE NIVEAU 1 - PREMIERE PARTIE (A) – GENERALITES SUR LES FEUX DE LOCAUX
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° A7 : A la fin de la séquence, le stagiaire saura faire la différence entre un feu contrôlé par le Durée : 15 minutes
combustible et un feu contrôlé par le comburant et en aura compris l’impact sur les incendies
Séquence : Feu contrôlé par le combustible et feu contrôlé par le comburant
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES DUREE SUPPORTS A RETENIR - INFORMATIONS
ACTIVITE DE DECOUVERTE 1 min Tableau « Au départ du feu, quel est l’élément qui est disponible en sur-quantité,
- Question à la cantonade le comburant ou le combustible? »
- Retour d’expérience
Au départ
ACTIVITE DE DÉMONSTRATION : 13 min Tableau o Le comburant est disponible en sur-quantité, le feu est donc
« contrôlé » par le combustible
Tableau avec l’évolution o Essentiellement sur une base de combustible « solide »
de la situation o Propagation lente sur un combustible fixe
(cf. doc commentaires) o Peu d’influence des ouvertures créées
Progressivement il devient :
o Contrôlé par le comburant
o Essentiellement sur une base de combustible gazeux (Classe C)
o Propagation rapide dans un combustible mobile
o Grande influence des ouvertures crées
Remplir le tableau colonne par colonne, en indiquant les évolutions des
différents paramètres
En Europe, le double vitrage (crise pétrolière des années 70) a changé
l’évolution des feux. Dans les pays chauds, l’usage de l’air conditionné
(fenêtres toujours fermées) et les grilles, souvent présentes aux fenêtres,
ACTIVITÉ D’APPLICATION : compliquent beaucoup l’approche.
Q1- Au début le feu est contrôlé par 1 min Questions orales
quoi ? R1 - Par le combustible
Q2 - Qui est comment ? R2 - Solide
Q3 - Ensuite le feu est contrôlé par ? R3 - Le comburant
Q4 - Le combustible est alors comment ? R4 - Gazeux.
Un QCM récapitulant la totalité de la partie A, peut être proposé aux stagiaires avant d’aborder la partie suivante.
Version 2.70 du 20/08/2008 – Page 10 sur 17
COMMENTAIRES
JUSTIFICATIONS
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU
THEORIE 1
Première partie – A A4 – Flamme de pré-mélange et de
Généralités sur les feux de locaux diffusion
Le plus simple consiste à partir du chalumeau car le mélange y est logique. Il suffit ensuite de
demander ce qui se passe sur la bougie ou l’allumette pour que la notion de captation de l’oxygène
par la périphérie, devienne évidente.
Recopiez les deux schémas. Indiquez la provenance du comburant et
demandez ce qui se passe au niveau de la zone avec la croix.
Y indiquer le mot « mélange » puis noter « flammes de pré mélange ».
La flamme de pré mélange n’est pas sensible à son environnement. Elle
peut exister dans un milieu sous oxygéné. Ainsi, on peut souder sous
l’eau (à condition qu’il y ait apport de comburant via une bouteille et bien
sûr pas par aspiration comme avec le Bec Bunsen).
Indiquez la provenance du comburant et écrivez « flamme de
diffusion ».
La flamme de diffusion est sensible à son environnement. On ne peut
pas allumer de bougie dans l’eau. Lorsque l’on touche une flamme de
diffusion, elle se met à fumer. Par exemple lorsque l’on touche une
flamme de bougie avec une assiette.
Note : parmi les différences, certains indiqueront sans doute la différence de « puissance » entre ces
deux types de flammes. Ceci n’est pas à écarter car les flammes qui se propagent dans les fumées
sont des flammes de pré-mélange et ont donc effectivement un rendement thermique sans doute
assez important. Mais attention de ne pas insister là-dessus à ce stade de la formation : à ce stade du
cours, ces types de flammes (roll-over, flammes fantômes…) ne sont pas encore connus.
La qualité de l’oxygénation influe aussi sur la couleur des flammes.
o Jaune quand elles sont bien oxygénées
o Orange lorsqu’elles le sont juste suffisamment
o Rouge lorsqu’elles commencent à manquer d’oxygène
Le type des matériaux qui brûlent a aussi une influence sur la couleur de la flamme.
Expérience
Allumer une bougie, constater qu’elle ne fume pas. Toucher la flamme avec un objet (assiette par
exemple), montrer que cela émet de la fumée et que l’objet est noirci.
Version 3.00 du 16/09/2008 – Page 7 sur 22
COMMENTAIRES
JUSTIFICATIONS
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU
THEORIE 1
Première partie – A A5 – La production de fumée
Généralités sur les feux de locaux d’un feu de local
Suite à la question relative à la grande différence de fumée entre un feu extérieur et un feu intérieur, la
réponse qui sera certainement donnée en premier sera « c’est à cause du manque de comburant ». Il
faut rebondir sur cette réponse en indiquant deux choses :
- Dans le cas d’un chalumeau oxy-acétylene diminuer l’arrivée d’oxygène produit des fumées.
Mais dans la réalité, le feu cherche à s’équilibrer (Principe de Lechatelier). Quand on diminue
l’oxygène, le combustible devrait donc naturellement diminuer. Le chalumeau est donc une
mauvaise représentation d’un feu car il force un apport de combustible supérieur en quantité
supérieure à ce que le feu peut traiter, et ne laisse donc pas le feu s’équilibrer.
- Lorsque l’on ferme l’entrée d’air de la cheminée à foyer fermé, le feu baisse en intensité mais
ne fume pas. Si l’arrivée d’air permet de brûler 10 morceaux de bois et que l’on ferme l’arrivée
d’air pour ne plus fournir assez d’air que pour brûler 5 morceaux de bois, alors le feu ne
brûlera plus que 5 morceaux. Les autres éléments, chauds, continueront à pyrolyser donc
fumeront blanc. Or un feu de local fume très noir.
La diminution générale du comburant n’est donc pas une explication satisfaisante.
Recopier le schéma ci-contre et le faire évoluer pour
montrer l’évolution du feu.
Rappel des acquis précédents
Au départ que va faire le fauteuil ? sécher, pyrolyser
puis s’enflammer. Que va produire le feu ? CO et CO2.
Ces gaz sont chauds donc où vont-ils aller ? En haut.
Rappel des acquis précédents
Comme elle reçoit toujours du comburant, que va faire
la flamme ? Elle va grandir. C’est une flamme de quel
type ? diffusion. Est-elle sensible à l’environnement ?
Oui. La zone en haut est-elle oxygénée ? Non.
Le bas de la flamme (A) est correctement oxygéné
(jaune), donc le feu progresse. Mais le sommet de la
flamme (B) est sous oxygéné (orange) et va commencer
à émettre des fumées.
Toujours bien oxygéné en bas, le feu progresse. La
flamme de diffusion touche désormais le plafond. Elle
émet du carbone en très grande quantité car elle est
abîmée par le contact et en plus la zone sous oxygénée
(B) augmente beaucoup.
Le feu est donc bien oxygéné en bas, mais pas en haut.
Note : indiquez que le temps qui s’écoule entre le moment ou la flamme atteint le plafond, alors qu’il
n’y a pas de fumée et le moment ou le plafond de fumée noire est à 1 m du sol, est de l’ordre de
seulement 1 à 2 minutes (durée la plus courte observée en caisson à Jurbise : 8 secondes !). En cas
de passage en caisson, cela sera facilement observé, tout comme le fait que la flamme est jaune en
bas et orange en haut.
Version 3.00 du 16/09/2008 – Page 8 sur 22
COMMENTAIRES
JUSTIFICATIONS
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU
THEORIE 1
Seconde partie – B B2 – Flashover induit par la ventilation
Flashover
Tracez la courbe du flashover et celle du flashover induit par la ventilation (ci-dessous), afin de
pouvoir comparer les deux.
2
Le flashover ne peut se déclencher que si la puissance nécessaire est atteinte (15 à 25kw par m au
sol environ). Mais pour cela, il doit y avoir assez de renouvellement de comburant donc une bonne
ventilation. Or, si la ventilation est suffisante, le flashover se produit dans un délai maximal d’une
dizaine de minutes après la mise à feu, donc avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Nous en avons d’ailleurs la preuve avec les multiples vidéos montrant des essais avec feu de
canapé : le temps qui s’écoule entre la mise à feu et le flashover est toujours très court.
Courbe du flashover « théorique » ou Courbe du flashover induit par la ventilation. La
« expérimental ». Il se produit rapidement, pour première « pointe » montre la présence d’un
peu que la ventilation soit correcte. Dans le cas volume initial de comburant assez important. Mais
contraire, il ne peut être que légèrement retardé pas assez pour atteindre le seuil. Ensuite la
(de quelques minutes, tout au plus). C’est ce puissance du feu se met à baisser et il ne dépend
type de flashover qui est observé dans la mini- que des ouvertures (ce que l’on nomme le profil
maison. de ventilation).
C’est le changement de ce profil qui redonne assez de comburant et permet au feu de reprendre une
évolution qui cette fois, peut lui permettre d’atteindre le seuil et donc le flashover, ou tout autre
phénomène lié à la chaleur et à la fumée.
La pointe initiale (avant la phase notée « Attente ») est le résultat de la consommation du comburant
présent dans le volume. Nous avons une certaine période durant laquelle le feu peut consommer plus
de comburant que n’en renouvellent les ouvertures, car il y a le volume initial du local, qui sert de
« zone tampon ». Comme une personne gagnant à la loterie pourrait dépenser plus que son salaire,
pendant un certain temps.
Il n’est pas possible de trouver un « réglage » des ouvertures qui permettrait le déclenchement du
flashover en 1 heure par exemple. Ce point est important : il montre bien que le fait que les sapeurs-
pompiers soient confrontés au flashover est difficilement envisageable si les ouvertures permettent
dés le départ l’occurrence de ce phénomène.
Puisque, si le local est assez ventilé, le flashover se produit avant l’arrivé des secours, la seule
hypothèse valide quant au fait qu’il se produit en présence des sapeurs-pompiers, c’est que le profil
de ventilation a évolué. En clair, le feu progresse, mais manque de comburant, les secours arrivent
puis ouvrent pour « voir » et provoquent la reprise du foyer donc sans doute à terme, le flashover.
C’est le flashover induit par la ventilation.
Cette phase de la formation doit faire prendre conscience de l’impact des actions. Mais comme ces
actions sont liées au comburant donc à une présence « gazeuse » invisible, tout ceci devient assez
compliqué : la simple ouverture d’une porte, geste naturel « pour voir ce qui se passe » peut devenir
une action catastrophique. La rupture des vitres « pour ventiler », même si elle est bien intentionnée,
peut également avoir des conséquences dramatiques.
Version 3.00 du 16/09/2008 – Page 16 sur 22
COMMENTAIRES
JUSTIFICATIONS
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU
THEORIE 1
Troisième partie – C C3 – Le backdraft
Backdraft Cas particulier - backdraft avec
exutoire
Relier systématiquement la notion de backdraft avec celle d’espace clos est très limitatif. Tout est
fonction de dosage : une porte ouverte et une fenêtre également ouverte ne sont pas le signe d’un
local exempt de risque de backdraft car le pouvoir fumigène de la combustion en cours peut dépasser
largement la capacité d’extraction des fumées et l’apport de comburant par la porte peut être
insuffisant par rapport à la demande. Dans ce cas, même si visuellement et « humainement », le local
semble ventilé, du point de vue du feu, ce n’est pas toujours le cas. Il existe plusieurs cas de backdraft
2 2
dans des zones de dimensions moyennes (supermarché d’environ 1500m à 2000m par exemple),
alors même que le toit de la structure est éventrée et laisse s’échapper fumées et flammes.
Cas d’un local clos. Les signes sont présents : fumées sortant par la
porte, fumée jusqu’au sol etc….
Avec un exutoire, le plafond de fumée est remonté. La fumée sous-
pression ne sort plus par la porte, les sons sont nets. Pourtant l’entrée
d’air n’existe pas et la pyrolyse continue.
Plus gênant, à l’ouverture de la porte, l’entrée d’air va être facilitée par le
fait que les fumées ne vont pas sortir par la porte donc ne vont pas
occuper de surface sur celle-ci, laissant toute la porte disponible pour
l’entrée du comburant.
Note : il est nécessaire de démontrer également cela sur la mini-maison.
La présence initiale d’un exutoire n’est pas forcément le signe que le backdraft sera évité car l’exutoire
doit être suffisant pour extraire les fumées plus vite qu’elles ne sont produites dans le local, ou en tout
cas pour en diminuer suffisamment la concentration. L’expérience pourra être faite dans la mini-
maison, avec ouverture de l’exutoire pour démontrer que celui-ci est insuffisant pour empêcher le
backdraft et que, de plus, il perturbe l’observation des signes précurseurs.
Marche à suivre
Si un exutoire est présent à l’arrivée sur les lieux, toujours se dire qu’il risque de perturber la détection
des signes. Il faut donc redoubler de vigilance et créer d’autres exutoires. Cela permettra rapidement
de voir si l’exutoire initialement présent était suffisant ou non, suivant la fumée qui sortira de ceux que
nous aurons créés « en plus ».
Lieu Situation Action
Leo’s Supermarket Supermarché avec toit percé. Feu à Pénétration d’un binôme par l’avant.
(Bristol - Grande l’arrière dans le local de préparation de Apport d’air et déclenchement d’un
Bretagne) la viande. Attaque menée par l’arrière. backdraft (une SP décédée)
Supermarché Aldi- Supermarché avec toit percé. Feu sur Bris de vitre en façade. Apport d’air et
Covee (Braine le côté dans un petit local (bureau). déclenchement d’un backdraft très
L’Alleud - Belgique) Flamme et fumée sortant par le toit. violent. Pas de blessé.
Note : ces variations de ventilation, montrent bien qu’il existe d’un côté le flashover, de l’autre le
backdraft, mais qu’entre les deux se trouvent tout un ensemble de phénomènes qui ne sont pas tout à
fait l’un, ni tout à fait l’autre. C’est ce que nous nommons « la zone grise ».
Version 3.00 du 16/09/2008 – Page 20 sur 22
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU
Théorie sur la combustion - 2
Nom Prénom
Centre de secours Date
N° Vrai Faux
1 COMIX signifie Chaud, Opaque, Mobile, Inflammable et toXique ! !
2 Les dangers du COMIX sont les dangers de la fumée ! !
3 La convection c’est l’émission de la chaleur vers le haut ! !
Le fait qu’un feu soit proche d’un mur n’a pas d’influence sur la perception
4 ! !
de la chaleur
5 Lorsque l’on perturbe la flamme de diffusion, elle se met à fumer ! !
6 Plus une flamme de diffusion est jaune, plus elle est oxygénée ! !
7 Au plafond les flammes sont toujours des flammes de diffusion ! !
8 Les fumées peuvent prendre feu spontanément en sortie du local ! !
9 Les fumées, grasses et chaudes, sont lourdes et tombent au sol ! !
10 L’air chaud est plus léger que l’air frais ! !
Remarques
Version 1.00 du 13/01/2009
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU - LES LANCES - TROISIEME PARTIE (C) – PROGRESSION ET PROTECTION
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N°C1 : A la fin de la séquence le stagiaire saura tenir le rôle du porte-lance et de l’équipier. En Durée : 14 minutes
tant que porte-lance, il saura progresser avec une lance, dans un local, conformément aux directives et saura traiter les
objets en cours de pyrolyse. En tant qu’équipier, il saura veiller à la sécurité du porte lance en surveillant l’environnement.
Séquence : Position, progression et création de zones tampons
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES DUREE SUPPORTS A RETENIR - INFORMATIONS
ACTIVITE DE DECOUVERTE 1 min Poster 2 (zones dans la « Pour vous rendre du point d’entrée au point de feu, comment allez-
- Question en montrant le poster 2 structure) vous procéder ? »
(plan d’habitation)
ACTIVITE DE DÉMONSTRATION :
4 min Lance, tapis, meuble… Les fumées vont venir croiser les secours qui entrent (différence de
- Démonstration temps réel pression entre extérieur et intérieur). Progresser avec précaution sur
- Démonstration commentée-justifiée Poster 2 (zones dans la tout le trajet car c’est sur ce trajet que se produisent les accidents.
- Reformulation (facultative) structure) - Chaque côté du tuyau, à genou
Poster 1 (zones de feu) - Débit minimum (environ 150lpm sur la majorité des lances)
La démonstration se fait en binôme, - Jet ouvert à 60° (généralement tout à gauche et retour d’1 cm)
chacun pouvant commenter ses actions - Lance à 45° par rapport au sol
- Impulsion, attente-observation, avance
- L’équipier surveille tout autour
- On ferme les portes que l’on trouve ouvertes sur son passage
La durée de l’impulsion peut varier avec la hauteur du plafond. On ne
doit pas le toucher (surproduction de vapeur qui va pousser les
fumées sur nous). Si la situation ne s’améliore pas, repulsez, et si cela
ne s’améliore pas, reculez.
ACTIVITÉ D’APPLICATION :
Chaque stagiaire passe comme porte 9 min A surveiller :
lance puis comme équipier. Le groupe - Tenue de la lance bras tendu
commente lorsque le passage est Lance, tapis, meuble… - Geste précis pour l’ouverture et la fermeture
effectué. Si le temps le permet, faire - Inclinaison de la lance
passer 2 fois chaque stagiaire. - Surveillance des arrières, par l’équipier
Version 2.60 du 29/07/2008 – Page 8 sur 13
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU - LES LANCES - TROISIEME PARTIE (C) - PROGRESSION ET PROTECTION
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N°C2 : A la fin de la séquence le stagiaire saura adopter la position de protection, aussi bien en Durée : 9 minutes
tant que porte lance qu’en tant qu’équipier, en respectant les consignes établies
Séquence : Position de protection
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES DUREE SUPPORTS A RETENIR - INFORMATIONS
ACTIVITE DE DECOUVERTE 1 min Poster 2 (zones dans la « Vous êtes dans l’impossibilité de sortir de la structure et la situation
- Question en montrant le poster 2 structure) se dégrade très rapidement en allant vers le flashover. Que pouvez-
(plan d’habitation), zone 2 ou 3. vous faire ? »
ACTIVITE DE DÉMONSTRATION :
2 min Lance, tapis, meuble… La chaleur va certainement venir du plafond. Il va falloir réaliser un
- Démonstration temps réel écran de protection entre vous et cette chaleur. Cet écran devra
- Démonstration commentée-justifiée Poster 2 (zones dans la empêcher le passage du flux thermique. Il peut être réalisé devant soit
- Reformulation (facultative) structure) si le front de flamme vient de cette direction.
Poster 4 (Protection) - Ouvrir la lance (même si le débit et jet ne sont pas encore
La démonstration se fait en binôme, corrects, cela protégera) et s’allonger vers l’avant, le plus possible
chacun pouvant commenter ses actions Lance, zone assez grande visage contre le sol
Jet diffusé de protection - Relever la lance
Débit maximal - Régler le jet en débit maximum (absorption thermique maximale).
(poster 4 – Protection)
- Tourner le jet pour le mettre en protection
- Avertir (radio, balise de détresse)
- Lorsque la situation s’améliore, se sauver
Seul un débit de l’ordre de 400 à 500lpm peut bloquer le flux dégagé
par un simple feu de chambre et donc offrir une protection suffisante.
ACTIVITÉ D’APPLICATION :
Chaque stagiaire passe comme porte
lance puis comme équipier. Le groupe 6 min Lance en eau A surveiller :
commente lorsque le passage est Surface au sol assez grande - Les stagiaires doivent se coucher vers l’avant
effectué. Si le temps le permet, faire Si possible un support pour - La lance doit être bien relevée
passer 2 fois chaque stagiaire. éviter de s’allonger dans l’eau - Il faut se coucher le plus possible visage contre terre
Version 2.60 du 29/07/2008 – Page 9 sur 13
COMMENTAIRES
JUSTIFICATION
Kit Pédagogique Réf : KPED-COM-1.10
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU – LANCES NIVEAU 1
Les schémas
Ils sont disponibles sous forme de poster format A3 et sont principalement destinés à être utilisés
dans les activités de découvertes des différentes séquences. En voici le descriptif.
Poster 1 - Les zones de feu
1 - Combustible solide. C’est le générateur de la
colonne de flammes. C’est l’objectif final. Feu de
Classe A.
2 - La colonne de flammes. Elle est sans arrêt
renouvelée par la zone solide. Il est donc inutile
de chercher à l’éteindre puisqu’elle reviendra tant
que la zone 1 ne sera pas éteinte.
3 - Les gaz chauds. Fumées plus ou moins en feu
qui gênent l’approche. Il faudra les refroidir, avant
qu’elles ne prennent feu. Feu de Classe C.
4 - Les éléments qui pyrolysent : ils risquent de
prendre feu, parfois derrière nous.
Nous avons donc plusieurs sortes de combustibles, placés à ces endroits différents et qu’il faudra
traiter différemment. Les éléments 4 et 3 seront rencontrés sur le trajet menant à l’élément 1. Ce
poster servira pour illustrer la progression ainsi que les attaques.
Poster 2 - Les zones dans la structure
1 - Porte d’entrée. Son ouverture va amener
du comburant et les fumées vont être attirées
dans sa direction. Une fois passée, il faudra la
refermer sur le tuyau pour éviter le plus
possible la ventilation.
2 - Trajet de progression. Refroidir les fumées
durant ce trajet et être attentif. C’est ici que se
produisent les accidents (manque d’attention,
ventilation involontaire, mélange fumées-air).
3 - Un meuble pyrolyse ? Il faudra le refroidir
4 - Point d’attaque. Destination de la
progression. Il est possible d’attaquer de
l’intérieur, mais parfois il faut attaquer de
l’extérieur (en cas de risque d’effondrement
par exemple)
Ce poster servira à illustrer toutes les techniques de lances (passage de porte en 1, progression en 2,
badigeonnage du meuble en 3, attaque en 4).
- Dans la pièce en feu, il y a risque de flashover ou de backdraft suivant les ouvertures
- Dans la zone de progression (2-3) il y a risque de flash-fire.
- Dans les autres pièces (chambre en bas à droite par exemple) il y a risque de smoke-
explosion
- La mise en eau se fait à l’extérieur de la structure : la progression commence dès qu’il y a un
plafond. Dans le cas de plusieurs étages (immeuble) la mise en eau se fait au demi étage ou
à l’étage inférieur.
Version 2.60 du 29/07/2008 – Page 2 sur 19
COMMENTAIRES
JUSTIFICATION
Kit Pédagogique Réf : KPED-COM-1.10
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU – LANCES NIVEAU 1
Quatrième partie – D D1 – Attaque combinée (TOZ)
Techniques d’attaque
Cette technique porte plusieurs noms : « Combination attack » chez les Américains, donc « Attaque
combinée » chez les Canadiens. Les Français la nomment parfois « crayonnage » (ce qui génère une
confusion avec la technique du pulsing-penciling) ou « attaque massive ». Nous la nommerons
« Attaque combinée » ou « TOZ » ou « ZOT ».
2
De gauche à droite : Z pour une surface d’une trentaine de m , O pour une surface d’une vingtaine de
2 2
m et T pour une surface d’une dizaine de m .
Préparation Se mettre sur une surface assez grande, si possible face à une zone permettant de
juger de la hauteur d’un local (caisson par exemple).
Sur le poster 2 (zones dans la structure), nous sommes au point 4.
Sur le poster 1 (zones de feu), nous allons travailler sur l’ensemble donc aussi bien
sur 3 (gaz chauds) que sur 1 (combustible solide).
Nous pouvons aussi être à l’extérieur, pour attaquer par la fenêtre, de la même
manière. Cela revient alors à l’attaque indirecte (dont le ZOT est initialement
dérivé).
Démonstration Position à genou, de part et d’autres du tuyau. Lance réglée en jet diffusé avec un
temps réel angle d’environ 30°. Cet angle correspond au petit dessin sur les lances, au cran ou
à l’indication « flashover » sur certaines lances (jet d’iffusé d’attaque). Le débit est
maximal (400 à 500lpm suivant les lances). Pour la démonstration, deux tracés de
Z, attente, deux tracés de O, attente, deux tracés de T.
Démonstration Il existe trois gestes. D'abord le « Z ». C’est la lettre la plus longue. Elle dure
commentée environ 2 secondes et demi. Nous la commençons en haut à gauche pour la finir en
justifiée bas à droite.
2
Nous utiliserons cette lettre dans les grands volumes. Environ 30m . Il faut refermer
la lance assez rapidement, mais pas trop brusquement sinon les tuyaux éclatent
car le travail se fait à débit maximum 500lpm (coup de bélier)
Lorsque le volume est plus petit, nous utilisons la lettre « O ». Elle commence en
2
haut, nous tournons dans le sens des aiguilles d'une montre. Environ 20m .
2
Pour un local encore plus petit, nous traçons un « T ». Environ 10m .
Pour un local allongé, par exemple un couloir en feu, nous pouvons tracer un « I »
Une fois le tracé effectué (une seule lettre, une seule fois), nous observons le
résultat. Les finitions se font généralement avec un débit plus faible, en
s’approchant et en badigeonnant (« painting ») comme pour le meuble qui pyrolyse
lors de la progression.
Version 2.60 du 29/07/2008 – Page 10 sur 19
COMMENTAIRES
JUSTIFICATION
Kit Pédagogique Réf : KPED-COM-1.10
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU – LANCES NIVEAU 1
La vitesse de tracé est toujours la même mais comme les lettres sont plus ou moins
longues, la durée générale du tracé varie. Possibilité de monter cela en enchaînant
un Z, un O et un T : la durée change mais le déplacement de la lance se fait
toujours à la même vitesse.
Bien insister sur l’ampleur du geste, surtout pour la Z : la surface à couverte doit
être importante.
Avantages
- Ne nécessite pas de rentrer dans le local en feu
- Permet de traiter des volumes importants
- Permet de traiter des locaux de grande surface
- Faible consommation d’eau (le Z consomme environ 25 litres d’eau)
Inconvénients
- Grosse production de vapeur
- Risque de détérioration des tuyaux
- Recul important.
- Débit incompatible avec un bon refroidissement de la zone de fumée. En
effet, à 500 lpm, le refroidissement des fumées produit un volume de
vapeur supérieur au volume gagné par la contraction des fumées lors de
leur refroidissement. En clair, il y aura toujours surproduction de vapeur,
donc effet « cocotte minutes »
Erreurs constatées
- Ouverture progressive de la lance ce qui génère un début de jet de
mauvaise qualité
- Fermeture précoce de la lance (le jet est de mauvaise qualité en fin de
tracé)
- Manque d’ampleur du geste. Souvent pour le Z la partie haute est assez
large mais le trait du bas est plus petit)
- Fin du geste trop au sol.
A retenir
Cette technique ne se pratique que si le local possède des ouvertures suffisantes autres que
celles où se trouvent positionnés les intervenants. Dans le cas contraire (locaux mal ou non-ventilés)
il y a un fort risque de brûlures pour les intervenants.
Cette méthode correspond en fait à l’extinction d’un feu contrôlé par le combustible.
Pour que cette méthode soit efficace, les ouvertures doivent se situer de l’autre côté du feu (ou à
défaut, sur le côté), afin de permettre à la vapeur générée de passer « sur le feu » et donc d’en
réaliser l’inertage.
Note : la « combination attack » fait l’objet d’un article assez long disponible sur
http://www.flashover.fr. La durée des gestes (donc la quantité d’eau) a été estimée en partie sur la
base des calculs de puissance ramenée à la surface, en fonction de la quantité de comburant
disponible, pour une pièce avec une hauteur de plafond de 2.50m.
Version 2.60 du 29/07/2008 – Page 11 sur 19
COMMENTAIRES
JUSTIFICATION
Kit Pédagogique Réf : KPED-COM-1.10
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU – LANCES NIVEAU 1
Cinquième partie – E E1 – Passage de porte
Passage de porte
Préparation Cadre de porte. Idéalement, écrire sur celui-ci, à la peinture, « ORTA »
Poster 2 : nous sommes au point 1 ou à la porte du local 4.
Démonstration - Approche sur quelques mètres en progression (1 impulsion suffit)
temps réel - Placement de chaque côté de la porte
- Observation Rotative (marquage éventuel à la craie). Bien montrer que l’on
observe.
- Toucher de bas en haut (sans retirer son gant !)
- Arroser de bas en haut
- Se positionner pour pulser dans l’ouverture
- Dialoguer
- Deux impulsions, ouverture, impulsion longue, fermeture.
- Dialoguer à nouveau et attendre environ 5 secondes
- Recommencer 3 fois puis entrer à la 4éme fois
- Impulsions rapides dès le passage
- Avancer d’1 ou 2 mètres, maxi.
- Fermeture de la porte
- Continuer une ou deux impulsions. Ne pas faire d’attaque car cela prend du
temps et ce n’est pas le sujet de la démonstration.
Démonstration Avancement en pulsant, c'est la progression
commentée Les portes sont des éléments perturbants pour les mouvements gazeux. En haut
justifiée des portes, les turbulences ont tendance à augmenter la puissance thermique.
Refroidir la zone intérieure du local, juste derrière la porte, avant de pénétrer dans
Version 2.60 du 29/07/2008 – Page 15 sur 19
PRF - Lances – Validation Collective – Progression
Situation: Victime inconsciente, dans un couloir d’accès à un lieu en feu. Couloir droit et sans obstacle (Exercice de Progression)
Consignes à la victime: Consigne à l'équipe : Vous devez pénétrer dans Composition de l'équipe
! Vous êtes allongée, sur le dos, à environ 3m le couloir pour atteindre le foyer qui est au bout.
du point de départ, la tête vers celui-ci. Vous Porte-lance ……………………………………
êtes visible dés l’entrée.
Equipier ……………………………………
Matériel: Divers : L’établissement est en place, mais pas
Tuyaux, Lance, Auto-pompe, ARI, tenue de feu alimenté.
complète
CRITERES Oui / Non OBSERVATIONS
Chef
! S’équipe correctement de son ARI
! Tenue parfaite (gants, cagoule, …)
! Vérification croisée avec son équipier
! Teste la lance et la tient correctement
! Avance en pulsant, lentement et en observant
! La lance est bien règle (jet et débit)
! Ressort en protégeant la victime et son
équipier avec sa lance
Equipier
! S’équipe correctement de son ARI
! Tenue parfaite (gants, cagoule, …)
! Vérification croisée avec son chef
! Se place de l’autre côté du tuyau
! Fait avancer le tuyau à la demande, sans
pousser le porte lance
! Observe tout autour et en partie haute
! Tire la victime tout en tirant aussi le tuyau pour
aider à le sortir
Grade, nom, prénom et signature du formateur
Version 1.00 du 11/08/2008
Code Brûlage Remarques générales
Lieu
Date SUIVI DE BRULAGE
Heure CAISSON SIMPLE
Heure entrée V. 3.00 – 16/09/2008
Durée totale
Durée totale= depuis l’allumage jusqu’au début du déblai.
Tmp. Ext. en°C Nom Formateur Prénom Centre de Secours Signature
Météo (pluie…) 1
Humidité 2
Vent (km/h, sens) 3
Remarques météo
Indiquez le sens du vent
Nom Prénom Grade V-P Centre de Secours Sexe Poids Age Anc. Remarques (équipement, médicaments…)
1
2
3
4
5
6
V-P : volontaire ou pro. Anc. Nombre d’années (ou de mois) de service
Vérification Qui Visa Vérification Qui Visa
Parc ARI-Hydratation, bancs… 3-S Lecture des consignes de sécurité 3
Vérification du caisson (intérieur, extérieur) 1-2 Etirements 3
Balayage et mise en place du combustible 3-S Vérification des tenues (cagoule, gants, veste…) 3
Mise en œuvre moyens hydrauliques 3-S Explications dans le caisson (« sortie, ça tourne ») 1
Vérification combustible et mise en place allumage 1-2 Vérification à l’entrée avec 3 flexions sous ARI 3
Vérification moyens hydrauliques 1-2 Réglages des ouvertures (portes) 3
Seau (un pour les mains, un pour nettoyer) 3 Allumage 2
Dans la colonne « Qui » le chiffre indique le numéro des formateurs, S désigne les stagiaires.
FICHE DESCRIPTION
BRULAGE CAISSON
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU – CAISSON
Code : CS-01 « Observation – Progression – Attaque »
Type de caisson : 12m (40’), simple, sans exutoire, avec ventilation par portes arrières
Description : Observation et usage de lance en espace incorrectement ventilé. Pas de stratification
de fumées pendant l’usage des lances.
Pré-requis : Théorie 1, Lances 1, être à l’aise sous ARI
Combustible (plaques d’aggloméré)
Larg. (cm) Haut. (cm) Ep (mm) Zone(s)
125 210 15 ZB2 (verticale)
125 210 15 ZC2 (verticale)
125 210 15 ZP1 – ZP2
125 210 15 ZP2 – ZP4
125 80 15 ZB1 (en partie haute)
125 80 15 ZA2 (en partie haute)
Note : Les plaques en ZB1 et ZA2 peuvent être constituées des chutes des plaques plus grandes.
2
Des chutes ou des restes de précédents brûlages peuvent être placées en petite quantité (1m
maximum) en ZP3.
Allumage
Foyer d’allumage situé en ZB2-ZC2. Trois feuilles de journal, environ 5 lamelles de cartons, 1 cagette
ou des bûchettes, 5 demi-lattes de palettes, 14 lattes entières. Allumage du papier journal au briquet.
Attention : en cas de température extérieure > 25°C, réduire le combustible d’allumage (moins
de carton et pas de cagette) sinon le foyer démarre trop vite.
Rappel : l’allumage se fait sous ARI en tenue de feu complète et uniquement lorsque tout le personnel
est en place (autres formateurs et stagiaires). Reculer face au feu pour revenir en place. Ne pas
mettre d’accélérant (essence…). Pas de préchauffage du caisson.
Positions initiales et ouvertures
X= foyer, S=stagiaires, F = Formateurs, L = lances Portes du caisson vue
de l’extérieur.
Déroulement pédagogique
Action Remarque
Réglages des portes P3 ouverte. P1, P2, P4 fermées mais non verrouillées
Allumage Sous ARI quand tout le monde est en place (à genou)
Démarrage du feu Observer la couleur des flammes
Bois qui sèche + pyrolyse Fumées blanches, visualisation du courant de convection
Flammes qui montent en plafond Changement de couleur en haut (orange)
Flammes qui touchent le plafond Production de fumée
« On se lève doucement» Fumée chaude et opaque
« On redescend doucement » Nettoyer glace de l’ARI
Test du plafond par le formateur F1 Impulsion au plafond pour montrer que le test est souvent
délicat (perturbation des fumées)
« Ouverture » Le formateur 3 ouvre P2+P4. L’ouverture se fait lorsque les
flammes atteignent le côté gauche de la plaque située en
ZB2, à environ 1,20m du sol
Version 2.00 du 16/09/2008 – Page 1 sur 2
FICHE DESCRIPTION
BRULAGE CAISSON
PROGRESSIONS RAPIDES DU FEU – CAISSON
Code : CS-02 « Progression – Attaque »
Le formateur 3 fait passer sa lance Les stagiaires prennent la lance de la façon habituelle (donc
(L2) entre les stagiaires les gauches la prennent à gauche). Le formateur F1 garde sa
lance (L1)
« Impulsion » Bien viser avant la zone de feu
Sortie optionnelle Permet de vérifier les stagiaires quand tout le monde est
passé aux impulsions
Attaque avec pulsing-penciling Afin que le geste soit complet (impulsion en haut, enchaînée
immédiatement avec attaque en bas), le formateur désigne
une zone de feu en bas (plaques tombées) et demande de
l’éteindre en alternant une impulsion en haut, une en bas
etc…. puis laisse faire le stagiaire. Au fur et à mesure, on
peut avancer.
Déblai Un formateur reste avec deux stagiaires, puis on change
Rotation des formateurs : les formateurs peuvent changer de rôle et donc de position en cours
d’exercice. A chaque changement, le 3 devient 2, le 2 devient 1 et le 1 devient 3. Il est possible de
changer à l’ouverture, puis juste avant l’attaque. Attention, le maintien fermé des portes P1 et P2 fait
que la chaleur revient fortement par l’arrière. Le formateur 3 est donc soumis à une forte contrainte.
Consignes à lire aux stagiaires
Vous serez placés les uns derrières autres, à genou, 2 par 2. Interdit de se lever sauf ordre du
formateur - Interdit de se toucher - Le port de gourmette, collier, bracelet etc.. est interdit. En sortie,
ouvrez votre veste de feu pour vous aérer et buvez. Vous devez impérativement rester sur les bancs
prévus à cet effet. Tout votre matériel (serviette, tee-shirt de rechange, eau…) doit être apporté avant
l’exercice car il est interdit de vous éloignez lorsque vous sortez du caisson.
Si vous vous sentez mal, prévenez le formateur le plus proche de vous, sortez, et allongez-vous.
Lorsque vous êtes à genou, tirez sur le tissu de votre pantalon pour conserver une couche d’air, qui
vous protégera.
Pour donner l’ordre d’évacuation, l’un des formateurs frappe la paroi du caisson en criant «sortie ».
La sortie est immédiate, à quatre pattes, en reculant, face au feu.
Pour que tout le monde passe devant, vous changerez de place durant l'exercice. Le formateur 1
donne l'ordre "ça tourne". Les stagiaires se déplacent alors à genou face au feu, sans se toucher.
Nous allons répéter cela avant l’allumage.
Lorsque le plafond de fumée sera bien formé, nous ventilerons le feu pour qu’il progresse plus vite,
puis nous pulserons dans les fumées afin de refroidir celle-ci et faire parfois apparaître les flammes
qui s’y trouvent.
C’est le formateur numéro 1 qui indique quand pulser et combien de fois. Il donnera l’ordre
« Impulsion ! ».
Lorsque tout le monde sera passé, nous attaquerons. Puisque nous sommes dans un local avec
ventilation incorrecte, nous utiliserons l’alternance d’impulsions en jet diffusé en haut (le pulsing) et
d’impulsions en bas en jet étroit (le penciling). C’est le formateur 1 qui indiquera où viser en partie
basse afin que les premiers stagiaires n’éteignent pas trop vite.
Le déblai se fait entièrement sous ARI. Les déchets sont étalés à la pelle pour découvrir les zones
chaudes que l’on va noyer comme lors du badigeonnage (le painting) de la progression.
Important
Dans la zone de feu, les plaques d'aggloméré au plafond, ne sont là que pour produire un plafond
gazeux mais ne sont pas représentatives de la réalité puisque dans un feu, le combustible est
uniquement en bas. Elles ne doivent jamais être touchées par le jet.
Version 2.00 du 16/09/2008 – Page 2 sur 2
Fiche d’observation
Feux en espaces clos et semi-clos
Nom Prénom Grade Centre de Secours
Lors de la formation relative aux Progressions Rapides du Feux (formation « flashover ») qui s’est
déroulée le ……………………… à ………………………………. les formateurs ont constaté les points
suivants lors de l’exercice sur feu réel compartimenté :
! Equipement de protection individuelle non fourni par le service, ou incompatible avec la
pratique incendie
! Gants de feu
! Bottes
! Cagoule
! Veste de feu
! Pantalon de feu
! Casque
! Autre…
! Aptitude opérationnelle
! Difficultés à la mise en place de l’ARI (position, fuites…)
! Incapacité à s’équiper correctement (tenue mal mise…)
! Stress trop important
! Refus de participer à l’exercice
! Autre…
! Aptitude physique
! Essoufflement important
! Résistance physique
! Souplesse et déplacement
! Malaise
! Autre…
! Le stagiaire a participé partiellement à l’exercice (défaillance constatée durant cet exercice)
! Le stagiaire a participé à l’exercice feu réel (prêt de matériel)
! Le stagiaire a participé à l’exercice feu réel avec du matériel personnel (validé par les
formateurs mais qui devrait lui être fourni par son service incendie)
! Le stagiaire n’a pas participé à l’exercice
Les formateurs relèvent que ces points peuvent être préjudiciables à la bonne marche des opérations
dans le cadre de la lutte contre des incendies en volume clos ou semi-clos, et qu’il y a lieu d’y
remédier, pour la sécurité du sapeur-pompier et de son équipe.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller dans l’amélioration de ces points et pour
réaliser ultérieurement une autre vérification.
Formateur 1 Formateur 2 Formateur 3 Le responsable
Vous aimerez peut-être aussi
- Connaitre - Et - Faire - Face - Aux - Risques - Des - Organismes - Stockeurs - Filiere - Agricole - TOME - 2 PDFDocument62 pagesConnaitre - Et - Faire - Face - Aux - Risques - Des - Organismes - Stockeurs - Filiere - Agricole - TOME - 2 PDFLoic FerlandaPas encore d'évaluation
- Gto FDF 1e Edition 2021 Bdfe DGSCGCDocument124 pagesGto FDF 1e Edition 2021 Bdfe DGSCGCOlivier Printemps100% (1)
- GNR Sauvetage Et DéblaiementDocument88 pagesGNR Sauvetage Et DéblaiementZeBlackTiger100% (2)
- La Vulnérabilité, Un Concept Central de L'analyse Des Risques Urbains en Lien Avec Le Changement ClimatiqueDocument15 pagesLa Vulnérabilité, Un Concept Central de L'analyse Des Risques Urbains en Lien Avec Le Changement ClimatiqueRudic Domenco100% (1)
- L'impact Des Risques Socioprofessionnels Sur La Santé Des Salariés de L'unité Secondaire de Sidi-Aich PDFDocument75 pagesL'impact Des Risques Socioprofessionnels Sur La Santé Des Salariés de L'unité Secondaire de Sidi-Aich PDFDjamal MohammediPas encore d'évaluation
- COURS FLE Aux EnfantsDocument111 pagesCOURS FLE Aux EnfantsSylvie de Dreuzy-goussard100% (1)
- Fiche AccDocument5 pagesFiche AccDIJOUXPas encore d'évaluation
- Initiation À La Programmation Objet Avec JavaDocument105 pagesInitiation À La Programmation Objet Avec JavaBoud ElhassanPas encore d'évaluation
- Rapport de Formation A MCK v2Document21 pagesRapport de Formation A MCK v2Hien SansanPas encore d'évaluation
- Bilan Projet de Classe Inversee 3eDocument21 pagesBilan Projet de Classe Inversee 3emariaaitkechPas encore d'évaluation
- 4a SDPDocument67 pages4a SDPBoucharebKarimPas encore d'évaluation
- Cours Fle EnfantsDocument116 pagesCours Fle Enfants2727mara2727Pas encore d'évaluation
- Dossier - La Classe InverséeDocument40 pagesDossier - La Classe InverséeSonPhamPas encore d'évaluation
- Exercice Securite CivileDocument70 pagesExercice Securite Civileanon_503539485100% (1)
- Guide de Formation Des Éléveurs - FILDocument97 pagesGuide de Formation Des Éléveurs - FILISSAMPas encore d'évaluation
- 2021-06-23 - Webinaire PafDocument57 pages2021-06-23 - Webinaire PafVincent BuylePas encore d'évaluation
- Rapport Programme en CDocument9 pagesRapport Programme en CAbdoulaziz PorgoPas encore d'évaluation
- Annexe DeuxDocument12 pagesAnnexe Deuxfrederic.duvnjakPas encore d'évaluation
- Techniques de Gestion de Groupe ExemplesDocument60 pagesTechniques de Gestion de Groupe ExemplesCathy Vande kerckhovePas encore d'évaluation
- Fos - CoursDocument112 pagesFos - CoursLéa V.Pas encore d'évaluation
- Montage D'exercices Cadre Et TerrainDocument70 pagesMontage D'exercices Cadre Et TerrainassanekrmPas encore d'évaluation
- 9782340-024144 - 001 - 396.indd 1 04/05/2018 15:27:28Document32 pages9782340-024144 - 001 - 396.indd 1 04/05/2018 15:27:28Simo RaissPas encore d'évaluation
- MetasploitDocument62 pagesMetasploitAms syllaPas encore d'évaluation
- Cool APC Manuel BEPC Français 3emeDocument131 pagesCool APC Manuel BEPC Français 3emefanta kambire50% (2)
- OpaleDocument10 pagesOpaleHaby Minos HenryPas encore d'évaluation
- Note À L'attention de Mesdames, Messieurs Les Directeurs Et Responsables D'institutions Et Services ProvinciauxDocument7 pagesNote À L'attention de Mesdames, Messieurs Les Directeurs Et Responsables D'institutions Et Services ProvinciauxZaboza BelmekkiPas encore d'évaluation
- Guide Usages ThermoptimDocument125 pagesGuide Usages Thermoptimrahim onePas encore d'évaluation
- Analyse de Cas - A23Document3 pagesAnalyse de Cas - A23maryse.bousquet19Pas encore d'évaluation
- Observation Et Guidage de ClasseDocument140 pagesObservation Et Guidage de ClasseAxel Rousseau100% (5)
- Canevas TD1 M1Document26 pagesCanevas TD1 M1Manuel Suzarte MarinPas encore d'évaluation
- Transport de Chaleur2 FR LowRes For Web2Document66 pagesTransport de Chaleur2 FR LowRes For Web2ffsPas encore d'évaluation
- Guide Danimation JOUR 3 23-05Document8 pagesGuide Danimation JOUR 3 23-05stephanie.racherPas encore d'évaluation
- AFSC Fiches Peda Lacquisition de ProceduresDocument11 pagesAFSC Fiches Peda Lacquisition de ProceduresJeanPas encore d'évaluation
- Livret Púdagogique InitiateurDocument16 pagesLivret Púdagogique InitiateurYANN BEREZIATPas encore d'évaluation
- Act-2007 13931Document10 pagesAct-2007 13931Axel AlexPas encore d'évaluation
- Planification Et Modelisation Des Zones de Stock-Ages de Dechets Et Materiaux Sur Le Site DfipDocument79 pagesPlanification Et Modelisation Des Zones de Stock-Ages de Dechets Et Materiaux Sur Le Site DfipLotfi OusmerPas encore d'évaluation
- Formations Doctorales SPI 2018Document8 pagesFormations Doctorales SPI 2018CaioPas encore d'évaluation
- Enseignement Aux Grands GroupesDocument27 pagesEnseignement Aux Grands GroupesfilmaryPas encore d'évaluation
- Physique Chimie 1re STI2D-STL - Livre Professeur - Ed.2011 PDFDocument88 pagesPhysique Chimie 1re STI2D-STL - Livre Professeur - Ed.2011 PDFinter100% (3)
- Tera Informatique 1 C - D Support de Cours Theorique Et PratiqueDocument7 pagesTera Informatique 1 C - D Support de Cours Theorique Et PratiqueJOEL LOICPas encore d'évaluation
- Ssiap 2Document2 pagesSsiap 2From AfricaPas encore d'évaluation
- Larabi M 2010 PDFDocument217 pagesLarabi M 2010 PDFAYOUB EL IDRISSIPas encore d'évaluation
- Annales DCG (Certaines Matières)Document271 pagesAnnales DCG (Certaines Matières)Warren100% (1)
- ReussirleSSIAP 1Document218 pagesReussirleSSIAP 1Ropet 17Pas encore d'évaluation
- Didactique Speciale 2021Document46 pagesDidactique Speciale 2021ELeBeng FRAnk100% (1)
- TP Initiation À PostGIS - v2Document31 pagesTP Initiation À PostGIS - v2Kamel Abbassi100% (1)
- Mémoire de Fin de CycleDocument59 pagesMémoire de Fin de CycleloicPas encore d'évaluation
- Catalogue Formation 2019 PDFDocument78 pagesCatalogue Formation 2019 PDFTRIQUEREPas encore d'évaluation
- Énoncé 1Document21 pagesÉnoncé 1forPas encore d'évaluation
- Première Année: (Titre Du Document)Document17 pagesPremière Année: (Titre Du Document)api-633389505Pas encore d'évaluation
- Apprendre L'evacuationDocument12 pagesApprendre L'evacuationMounirPas encore d'évaluation
- Catalogue Intec 21-22Document38 pagesCatalogue Intec 21-22desiréPas encore d'évaluation
- Exercices Incendie PDFDocument12 pagesExercices Incendie PDFM'hammed AbouzianePas encore d'évaluation
- Méthodologie O1 - CAPEPS Externe VfinaleDocument18 pagesMéthodologie O1 - CAPEPS Externe VfinaleElbakkouriPas encore d'évaluation
- Concevoir Une Formation - Progression Pédagogique Et Animation 3e Éd. (Chantal Perrin-Van Hille)Document298 pagesConcevoir Une Formation - Progression Pédagogique Et Animation 3e Éd. (Chantal Perrin-Van Hille)alain100% (2)
- 83932tgpa0109 PDFDocument172 pages83932tgpa0109 PDFChamsoudine ThientaPas encore d'évaluation
- Ift-2007 A16 91229Document11 pagesIft-2007 A16 91229Jorge D. NontolPas encore d'évaluation
- Formateur OccasionnelDocument18 pagesFormateur OccasionnelFranco FrancoPas encore d'évaluation
- Calcul D'incertitude MultimetreDocument20 pagesCalcul D'incertitude Multimetreyann virgil TCHETCHEPas encore d'évaluation
- 5 Chapitre 1Document16 pages5 Chapitre 1Larbi HammounPas encore d'évaluation
- TP N1Document9 pagesTP N1hhhhhhhhhhhhhhgPas encore d'évaluation
- Cours 3C ProfDocument106 pagesCours 3C ProfAouine RabiePas encore d'évaluation
- Fiche de Progression 1ère AnnéeDocument4 pagesFiche de Progression 1ère AnnéeOscard KanaPas encore d'évaluation
- Rapport Final PDFDocument34 pagesRapport Final PDFDjaha EmmanuelPas encore d'évaluation
- Abdouni El HoucineDocument64 pagesAbdouni El HoucineCharnelle kadjaPas encore d'évaluation
- Chromatographie Op PDFDocument41 pagesChromatographie Op PDFAbdelhakim BailalPas encore d'évaluation
- Energie CinetiqueDocument13 pagesEnergie CinetiquetheProffesorisHerePas encore d'évaluation
- DS 2015 EM1 Correction Version FinaleDocument10 pagesDS 2015 EM1 Correction Version FinaleKahina DahmaniPas encore d'évaluation
- Fampianarana-D - Pannage - Lectronique-100.pdf Filename - UTF-8''fampianarana-dépannage-électronique-100Document81 pagesFampianarana-D - Pannage - Lectronique-100.pdf Filename - UTF-8''fampianarana-dépannage-électronique-100ʬɸʬ Leoncio ʬɸʬPas encore d'évaluation
- Thème: Présenté ParDocument147 pagesThème: Présenté ParMenel BouzegzaPas encore d'évaluation
- Les PompesDocument3 pagesLes Pompesjawad_ensamPas encore d'évaluation
- Td3 Machine AsynchroneDocument5 pagesTd3 Machine Asynchronehassankch100% (2)
- Pendule de TorsionDocument9 pagesPendule de TorsionyessinePas encore d'évaluation
- Utc 15-106 TerreDocument20 pagesUtc 15-106 TerreHAY2019 INJABPas encore d'évaluation
- Contact LinkyDocument1 pageContact LinkyYao N'GoranPas encore d'évaluation
- Examen RattrapageDocument1 pageExamen RattrapageahmedPas encore d'évaluation
- BUP ÉnergieDocument44 pagesBUP ÉnergieKader MédjahdiPas encore d'évaluation
- 16 Pignon ChaineDocument1 page16 Pignon Chaineommasa2006100% (2)
- Rapport Audit Energetique-Samia BouseksouDocument55 pagesRapport Audit Energetique-Samia BouseksouENTREPRISE HALISPas encore d'évaluation
- Technoi 06 SoudageDocument109 pagesTechnoi 06 SoudageElie Kahamba100% (1)
- Reservoire Inox Gamme de FabricationDocument24 pagesReservoire Inox Gamme de FabricationDanem HalasPas encore d'évaluation
- Gazoduc Algerie EuropeDocument33 pagesGazoduc Algerie EuropeSofianePas encore d'évaluation
- Catalogue Industrie FRDocument100 pagesCatalogue Industrie FRAnonymous M0OEZEKoGiPas encore d'évaluation
- 2004 Maroc Sujet Exo1 Pile Electrolyse CuDocument3 pages2004 Maroc Sujet Exo1 Pile Electrolyse Cuhakima032Pas encore d'évaluation
- Dynamique Des Fluides VisqueuxDocument10 pagesDynamique Des Fluides VisqueuxAhmed Ben AlayaPas encore d'évaluation
- Ecole Supérieure de Technologie de Meknès: 1 Années en Finance Banque Et AssuranceDocument29 pagesEcole Supérieure de Technologie de Meknès: 1 Années en Finance Banque Et AssuranceDIAE ELGRAOUIPas encore d'évaluation
- CA - EATON AFDrives Booklet 6 PagesDocument6 pagesCA - EATON AFDrives Booklet 6 PagesAdriana Nicoleta ZamfirPas encore d'évaluation
- Circuits Electriques EXAMEN THEORIQUE 2Document20 pagesCircuits Electriques EXAMEN THEORIQUE 2Anbari MehdiPas encore d'évaluation
- Volvo Code Evc-D Tous Moteur Sauf Boitier 128Document358 pagesVolvo Code Evc-D Tous Moteur Sauf Boitier 128Ted Theodore100% (1)