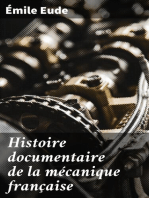Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lectricit Auto
Lectricit Auto
Transféré par
سليم عبد العزيزCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lectricit Auto
Lectricit Auto
Transféré par
سليم عبد العزيزDroits d'auteur :
Formats disponibles
Eleetricite Automoblle
Capyt/gllt@E.D;C. OMEGA
E.D. C OMEGA: Cite des Molldjahirjine n·o 32 BEN AKNOUN-ALGER
Telephone:
(02) 78.29.87
Courtier ..
Case postale 142 ROSTOMlA I ,-;IjBE
l.S.BiN. 9961-925-06-8 Depot Legal .. 4e trimestre 1996
Table des matieres
Chapitre 1 : Notions d'electricite
1 - Gemeralites : 9
2 - Elements de I'electlicite , 10
3 - Elements de l'elactronlque 15
4 - L'electromagnetlsme , 21
5 - Principales lois de l'alectricite 22
6 - Principaux symboles utihses en electricite automob.ile .. 25
Chapltre 2: Rappe1s sur les moteurs
1 • Le rnoteur ell essence 27
2 - Lemoteur diesel , 32
Chapitre 3 : les batteries
.
.
1 - Generalites _ 35
2 - Les batteries au pJomb 35
3 - Les batteries alcalines 38
4 • Principales caracteristiques des batteries 39
5 - Entretlen, pannes et reparation 41
Chapitre 4 : Le circuit de charge avec altemateur
1 - Generalites _ 51
2 - L'alternateur , 52
3 - Principe de fonctionnement , 53
4 - La regulation 54
5 - Diagnostic des pannes 57
6 - Interventions pratiques 59
Chap'itre 5 : Le demarreur
1 - Generalites , 67
2 - Constitution 67
3 - Diagnostic des pannes _ 72
4 -Interventions pratiques 74
Cha.pitre 6 : L'aUumage
1 - Introduction 83
2 - Le systems d'allumage ~ 83
3 - Principe de l'allumage 93
4 - L'allumage electronique 94
5 -L'avance it I'allumage _ ~ , 95
6 - Correcteurs d'avance it I'allumage 96
7 - Oepannage cu circuit d'allumage 98
Chapltre 7 : L'eclairage automobile
1 - Propagation de la lurniere 111
3 - Les projecteu rs 113
4 -Les lampes 114
5 - t.es projecteurs antibroulllard 118
6 - Les feux clignotants , 119
7 - L'~clairag.e du tableau de bord et de I'.habitacle 120
a - Reglage des projecteurs 120
Chapitre 8: Las accessoires
1 - La planche de bard 127
2 - Les Klaxons 132
3 - Les essuie-glaces 133
4 - Les lave-glaces 135
5 ~ Les~ve-glaces 135
6 -Le chauffag.e de laluneHe arnere 136
7 - La boTtea fusibles _ , 137
8 - La cllmatisation , 138
Avant-ppopo~
L'automoblleest la plus bene conquete de I.~homme'.
Malheureusement, cette merveille qui roouit les distanoes et economise Ie temps S8 cermet parfois quelques caprices pour nous rappeler toute sa dellcatesse.
Cet ouvrage, destine a un large public, est autant un recueil des. principes de base dufonctionnement des moteurs qu'un repertoire des pannes las plus rencontrees sur les vehlcules a essence et de la conduite a ten1r devarit chacune-d'elles. Tout y passe: de la batterie au circuit de charge, du demar.rage a I'allumage, de I'eclairage aux acoessoires,aveo, en prime, quelques rappels d'electriclte, d'electromsqnetlsme, d'electronique et de mecanique.
L'auteur, dent Ie souoi majeur est de mettre entre toutes les mains un outilaussi complet que possible, vous invite, chers lecteurs.a lUi ,faIre part de vas remarques et suggesti.ons a l'adresse de l'edlteur.
Chapitre 1
Notions d'electrici'te
1 - General ites
Lecourant electnque resulte d u ceplacement des electrons entre lesbornes d'un generateur, d'une prise de courant au d'une batterie d'accumulateurs.
II existe deux types de courant:
- Ie courant continu : son arnplltude reste con stante dans Ie temps :
- Ie courant alternatlt : sao amplitude vartedans Ie temps en foncfion d'une loi rnathematique. Uri courant alternatif p.eut litre slnusotdal, carre, triartqulaire, etc.
I Par convention, le ccurantclrcule de la borne positive vers
la borne negative. .
Pour aller d'un pOle a un autre, les electrons ant besoin d'un support dlt "conducteur' de courant,
Les conducteurs les pius utilises sont Ie cuivre, Ie fer et l'alurniniurn.
Un matMau qui ne conduit pas Ie courant' est dit isolant. Le verre, Ie bois et r;ebonlte sont des lsoiants.
Certains corps ne sont ni conducteurs ni isolants. On les deslgne par aerni-conductaurs et sont a Is base de
10
Elec/ricite automobile
l'electroniq'Ue moderne. les plusconnus d'entre eux sont Ie Sl!iciumet Ie Germanium.
2- Elements del'el.ectricite
Les e149ments de l'electriciM classlque sont :
- la resistance ;
-Ie condensateur ;
-Ia bobine.
2.1 - La res ista nee
La resistance electricue d'un corps 8' >:prime en Ohms (Q)et caraoterlse son opposition au paes~e dU courant.
Un corps dereststance ohmique R, trslllersi!J.pa,r un courant d'intensile I, provoque uns chute de tension A sea bomes de valeur U.
u
U = VA -VB = R . I
I
I
-1 -
-2-
Fig. 1 : Dlfferentsaspects des resistances.
NoUal1S d'iledrl'c.ile
L.e corps d'une resistance porte en general quatre bandes decouleurs (fig. 2) representant sa valeur ohmiqueet sa
tolerance, .
Mil Itipl ieateur T-olCJanet
ler chHfre signin.clIHf
2e cl:iiifresignificmf
Fig. 2 : Marquage d'un.e resistance.
Lequivalencecouleur!chlffre est don nee parla table de code des couleurs cl ... apras :
Couleur
Chlffre correspondant
Noir
a
Marron (Snm)
1
Rouge
2
Orange
3
Jaune
4
Vert
5
Sial!
Violet
7
Gris
Blanc
9
12
Eleetrioitiautamobiie
La bande de tolerance est de couleur ARGENT pour les resistances 10%et de oouleur OR pour las 5%. Aif)sl, une resistance codee ORAtJGElBLANc!JAuNe!oR est une resistance de:
On decouvrs dans fa figure 1 un autre type de reelstances dltes "resistances variables". Les C\jLlstables (F g,1.2) se rencontreat a l'intsneur des appareils electroniqlles. lors que les potentiometres (Fig. 1.3) portent un axe qui permst de faif'e les reglages de l'exterisur des barbers.
2.2 - Le condensateur
Un condensateur est caracterlse par sa c cite electrlque
Cexprimee en Faraday (F).
Fig. 3 : Quelques aspects des eondenaateurs.
2.2.1 - Charge d'un condensateur
Un condensateur est generalement utilise pour emmagasiner de renergie. Cette charge se rait comme indique ci-aprss :
Nations d'electricite
v
L'equation de charge est :
v '" E ( 1 - e-th: )
avec e = R.C (constante de charge)
Le condensateur estconsidere eomme etant completement oharge apres un temps de charge t = 5. :
v = E- (1 - e ~ 5 )= 99 % E
2.2.2 - Decharge d'un condensateur
, Un co~densateur de charge initiale Vo, brancne aux bornes dune resistance R. se decharge dans cette derhiere selon I'equation:
v = \/.0 e -tl-c v
113 v,
14
£leclricite automobile
2.3 - La bobine
Une bobineest caracterisee par son hi.dUctanoe magnetique L expnrnee en Henry (H).
En circuit, laboblne a un comportement electrlque assez semblable a celui ducondensateur.
v
II R
E jV1l3E
Remarque
On ne parle jamais de charge ou de decharge q:u~e bo~ine.
Ce phenomene est dO. au champ magnetique qUi S e~abht au moment della fermeture du circuit Apres un temps relatlvernent court ("" 5"1"), la bobine se comporte exactement comme un courtcircuit.
On constate, done, que la boblne n'est ~s ?'une g~nde u~lite en courant continu. C'esl en alternatff qu on en tire Ie plus grand profit.
Fig. 4 : DIff8rents types de boblfj~s.
Notlon« d'e.lectricite
15
3 - Ele-ments de I'electronique
L'electricite moderne fait appel, en plus des resistances, condensateurs at 'bobines, ell des elements a base de semiconducteurs. Les plus utilises de ces elements sont :
- les dioses ;
- les transistors ;
- les circuits integres.
3.1 - Les dlodes
Une ,diode est cornposee d'une anode et d'une cathode.
Schematiquement, elle est representee par :
Anode [::>:1 Cafhode
Son comportement electrique depend essennellernent de fa tension a ses barnes. Si cettedfffetence de potentiel est positive, la diode est asslmllee a un court-ctrcut. Sit par contre, elle est negative, aUCUR courant ne passe et I'on pourra l'assirnilsr alors a un clrcuu ouvert,
I
1=0
Cette partioularite est utilisee pour redresser des tensions alternatives.
16
E(ectricite automobile
Redress~ur simple alternance
Redresseur double slterllsnce
La difference de potentiel rninlrnale pour rendre une diode conductrice est de 0,7 volts pour les diodes au Silicium et 0,3 volts pour celles au Germanium.
Les diodes' de redressernent ne sont qu'unexemple d'exploitation de la technotoqle des diodes. En effet, il en existe d'autres typ,?s repondant a des besoins bien parttcuflers, telle la regulation de tension qui fait tres souvent appal aux diodes Zener. Cas diodes presentent la partlcularite de se comporter en court-circuit torsque leur tension Inverse attelnt un certain seuil liJit "tension de claquage".
v < Vz ~l=O V> Vz ---).1> 0
1 : Couranttnverse V : Tension Inverse Vz : Seuit Zener
Rep~entatJon ,scMmatique dec/a diode Zener.
Remarque : en polarisation directe, une diode Zener se cornporte cornrne une diode normale.
Notions d'eleatrictte
3.2 - Les transistors
l7
Un transistor est constitue d'une base, d'un emetteuret d'un collecteur. Scnematiqueroent, II est represente par:
Collecteui C E
Base
B
Emetteur E C
Transistor NPN Transistor PNP Le comport.ement 9'lectrique daRend en premier lieu de la difference de potantiel entre la base et l'ernetteur, Cette tension doit ~tre superieure au egale a D,7 volts pour un transistor NPN et infeneure ou egale a - 0,7 volts-pour un transistor PNP pour que ce dernier conduise.
C
I C
E
E
E
c
Un transistor est esseJ'lltiellement CC!'racterisapar :
- sa tension collecteur-emetteur.
- son gain statique 13;
18
EleClricite automobile
3.2.1- Latenston coliecteuremetteurVCE
Catte tension exprlme Ie mode de tenctlonnernent du transistor.
veE = + E
transistor bloque
V CE ::; 0,3 V transistor saturn
0,3 V -c VeE -c +E trensistoret: amplification
3.2.2 - Le gain statique p
Aussl appele gain en courant, p est le'~pport entre Ie courant colleotsur et Ie courant de base iorsque Ie transistor travdille en amplification,
Ie (E - VeE) I Rc
Il.----
P _. -
Is (E -0,7) I Ra
Tout comme lies diodes, certains transistors sont specialement concus pour travalller dans des conditions bien speclttques et ron defjnit ajnsi touts une classlflc:::atiorn selon les foncdons qu'ils rernpllssent,
otions d'eJectf'ieite
:L9
._
,0< ~·O
IDutut 0 ~
0.,11" 0
T018 T066 T092c E-.line
0 Q '0
C D ~i
, E 0
roie T066t '-,096 T0126 Fig. 5: Exemples de boitiers pour transistors.
3.3 - Les circuits integres
Un ,circuit integre, souvent designe par «PUCE», est une pasfill~ de semi-conduoteur sur taquellasont «graves» plusieurs transistors at qui remplit une fonctlon bien definie. Hcomporte un nombre de broches pouvant aller au-deta de la centaine et se presents sous divers aspects (tig. 6),
II existe deux principaux types de circuits integres :
• Las circuits TTL: circults fonctlonnant a 5 voltset delivrant des courants assez forts en lntensite. Ces circuits sont surtout utilises en electronique de puissance.
• Les ctrcutts CMOS : aussi dits circuits a faible consommation, ils peuvent fonctionner sous des tensions allant [usqu'a 16 volts, mais l'lntensite du courant delivre est extremsrnent faible. Leur dernaine d'utlllsation par excellence est l'eleGtronique nurnerique.
III
20
EfeClricile automobile
"" 100 J
.;
.1
r- ~~
-
1 ,.&
...
i J
1,4 • ~ • Z,II ,
Fig. 6 : Principaux types de boitiers pour circuits int6gres.
Notions d'electric itd
2J
4 - L'electrornagnetisme
Le magnetisme est la propriete de certains minerats a attirer Ie fer. C'est une sorts de force dont Ie Iprinclpal agent est Ie mouvement qes electrons dans la matiere. Un corps qui presents cette particulante est dit.almant,
Un airnant dispose de deux poles : Nord at Sud. Deux aimants places cOte a cote s'attirent si les pOles rapproches sont de natures differentes et se repoussent s'ils sont de merne nature.
attraction
repulsion
repulsion
L'electromagnetlsme est Ie terme utilise P0U( decrire les pnenornenes mettant enjeu un courant slectrique at un champ rnaqnetlque. En effet, on a remarque que:
1 - si un conducteur est parcouru parun couranteteotrique, ll se cree autour de lui un champ magnetique ;
2 - si un conducteur se trouve al'interieur d'un champ rnaqnetique, il se cree en lui un courant elecntque .
La premiere remarque est ala base de tous les moteurs ~Iectriques, 'Ies alternateurs et les dynamos. La secondeest exploitee par les transfonnateurs de tension et Jes bobines d'sllumage. Nous reviendrons sur cas deux points precis un peu plus loin dans eet ouvrage.
Bien evldement, un champ magnetique suppose toujours ,'existence d'une fame dont Ie sens estdonne pana figure ci-apres.
22
EUwtyicite automobile
. iFmce .~ouranLelectrique ~
Champ magnetique
5- Prlnejpeles lois de I'electricne
5.1 - Lois de Kirchhoff
Le diviseur de tension
I R1 i V1 V1 R1 E
=
III R1+R2
E
i V2 V2 = R2 E
R2 R1+R2 Le dlviseur de courant
R2
11 = I
R1 R2
12=
R1 R1+R2
R1 11
R2 12
'ations d'electrieite
23
5.2 - Assocfation de resistances
Un circuit comportant plusieurs resistances peutetre assimile a un circuit comportant unesellie et unique reslstance dite «resjstance equlvalente».
Association serle
Globalement
Association parallels
CS'lobalement
R1
Req·= Ri + R2 N
Req == I R Ii
i = 1
R2
1 1 1
-.- = - +
Req R1 R2
1 Req
-J\NWvReq
~ Req
24
£lectricile·(l1JiOmobile
5.3 .. Association de cendensateurs
- . -- - --
Association serle
C1
C2
1 1 1
Ceq C1 + C2
GJobalement
1 Ceq
N 1
= L
r 0: 1 C" I
Association para/lela
Globalement
Ceq = C1 + C2 N Ceq"" Lei f= 1
-u---
Ceq
Notion« d!Jlectricite.
25
6 ... Principaux symboles utilises en electricite a.utomobile
® Generaleur de ,~ Pompa aessenee
courant altematif electtique
(IJ Generateur de --c=:J- Hesistance
courant continu
® Moteuracourant ~ Resistance
alternatif va ria:bI"e
® Moteur a courant -c::S.- Polenliometre
conHnu
.-{::::+- Diode ....fYYL Sabine
-{:::f- -- Bobineavec
Diode Zener ....fYY'L_ noyaiJ
-() Transistor -H- Condensateur
bipolaire NPN
-() Transistor -II~ Condansateur
blpolalre PNP ·eleclrolytique"
Bougie 1~12V~1 Batterie
f-. ....- d'allumage d'accumuleteurs
~ Feu de position, 0 Voltmelfe
dignot!3uf
[}::7 Avertissaur 0 Amperemetfe
® Phare 0 Ohmmelre 26
Eleen'idte muomobi!«
+t Crolsement de conducteurs sans connexlon
, +
Croisement de condieteurs avec connexlon
-<e>- Contact ouvart
-;yb- Conta_a ferme
,
~ Contact de commutation
-
-t-+- Conducteur blinde
r
- Courant contiriu
,
ru \ Courant alternatff
-+.- Sens du courant
"
0 sens sortant
ffi Sens entrant I
nL Masse
'I j_ Terre
-
-
I
I I FU$ible
-®- Lampe
, -8- 'I Lampe de contrOle- 'Chapitre 2
Rappels sur lesmoteurs
1 - Le moteura essence
Le rnoteur aessence, aussi dit a explosion, tire sa puissance de I'inflammation d'un melange qazeux (essenoe + air) dans ta chambre de combustion.
melanse aC" el eue~ce _ert titS cyUndr .. s
Fig. 1 : Admission du melange air + essence dans la charnbre de combustlon.
28
Elect"icile automobile
L'operation de conversion de I'energie calorifique nee de la combustion du melaAge air -I' essence en energie mecaniqua (rotation du moteur) s'effectue enquatre temps:
1 • L'admission : la soupape.dadmtsstcn s'ouvre. Le piston passe du 'PMHl (Point Mort Haut) vers Ie PMB2 (Point Mort Bas) at aspire un melange gazeux (air + essence) dans Ie cylfndre.
2· La compression ~ la soupape d'admlsslon se ferme. Le piston passe du PMB au PMH et comprirne Ie melange gazeux.
3 • La combustion : Ie melange gazeux a.yant attaint sa compression optimale, une bouqie provoqueson inflammation en y envoyant une ·etincelle·. La grande pression, nee de (a combustion, exerce une force qui pousse teplston vers le,PMB.
4 - L'echappement : la soupape d'echappement s'ouvre.
Le piston passe du PMB au PMH et chasse les gaz brOtas hors du cyHndre, et ie cycle recommence.
Echappement Combustion
Compression
Admission
1 • PMH; La plus hauL nlveau attaint par IE;! piston dans la chambre de combustion.
2 - PMB: Le plus bas niveau atteint par ie pi$~on dans la chambre de cornbusuon.
nappei.s sur les muteuJ's
29
6
15 - sortie gaz brutes 7 - ptsten
8- bielle
9 - vUebrequin
1 - soupape d'admission 2 - e.ntFe~ melang~ gaze~x 3 - chambre de comb\!lstion 4 -bougie 5 - so~pape:d'echappement
Fig. 2 : Princlpaux elements d'un moteur a explosion
30.
Electricile automobile
Dans Ie cycle que nous venons de decrre, tout est relatiF au mouvement du piston entre Ie PMH e~ Ie PMB. Ce mouvement, assure par la rotation du vllebrequin, de.pend de la pression exercee SUf Ie piston a la sulte de la combustion.
Ce qui se passe en realile est quecetteforce qui pousse Ie piston versle bas (PMB) rarnene, en rneme temps, Ie plston d'un autre cylindre vers Ie haut {PMPI).le melange gazeux s'y trouvant est ainssi cempnrne et une autrecombustion a lieu.
1 ~ Piston 2 - Bleile
3 - Volant rnoteur
4 - Ceuronne 5 - V1lebreqll n
6 - Poulie d'alternateur
Fig. 3 : Equipage mobile.
Un moteur a explosion com porte en general quatre cyUndres dent I'ordre d'aflumage est 1-3-4-2. La figure en page 28 montre les positions relatives des pistons a I'interieur des cylindres.
31
Ruppel. sur l.esmolelw$
4' V de't""iUee d'un moteur it essence.
Fi!:l. : ue ..
32
Eleclricite automobile
l'ordrs d'allumage pour les moteurs 6 et 8 cyllndres est Ie
suivant :
,6 cy'lindres : 1-5-3-6~2-4 ou 1-2-3-6-5-4
8cylindres en ligne : 1-B-2-5-8~3-7-4
8 cylindres en V : 1-8-3-6-7-2-5-4
L'ouverturs et la fermeture des soupapss est comrnandee par I'arbre ill carries, sntratne par Ie vitebrequtn via un jeux d'engrenage. La vitesse de l'arbre a camesestegale ala moitia de celie du vilebrequin.
culbule",r
came
2 .. Le moteur diesel
Le moteur diesel se distlngue par I'allumage SQUS pression d'un melange carbure constitue cl'atr et de gazole,
Comme pour Ie moteur ill essence, il existe en theorie deux types d'injections pour lemateur diesel :
- l'injection directe :Ie melange gazeux est injecte sous forte pression dans une chambre de combustion tras compacte pour rsdulre au maximum les surfaces en contact avec Ie melange carbure et.facillter I'allumage.
'Rappe Is sur les moteurs
33
I - Arbre Ii: cames 2 - [njccte.lr
3 - Bougie de prechaulIage 4. Eau de n~froidissen1ent 5 - Cylindre
6· Bielle
? _ Pomp!! Ii. hulle
8 - 8oUeC:ltur d'admission
9 • Culbuteur 10 - Soupape
II - ColiccletLf d'echllPpcment
11· PistOil
13 • Yilcbrequin
14. Manet0l1 de vllebrequin 15 - Carter d'hui Ie
Fig- 5: Vue en coupe d'un moteur diesel.
34
EleC4ricile automobile
- "injection Indirecte : la 1 pression d'injection en jeuest beaucoup plus falblsmais, comma lessurfaces en contact avec Je m~lange carburEt sent plus lmeortantes par suite, de transitpasla charnbre de precombustion, Ie d~marrage
a froid est pratiquement lrnposslble. _
Mslgr~ sa consommation moindre et ses facilit~s de d~marrage, l'injection directs n'sst pas trills repandu sur 1'9S vehleules diesel par suite d'lnconvenlents importants : torte pression d'injeetion,grande precision de la pompe a Injection, necessite d'Une trss ;fine- pulverisatlon du carburant exigesl'1t des lnjecteurs a orifices extrl!Jmement petits se bouchant facilerflent,lmoteur tres bruyant au ralenti et au dernarraqe.
Pour palier au demarrage a froid de I'injection mdlrecte, la solution 18 plus utirisee est celie qui consists a employer des boug,[es de rechauffage qui sent en rea Ute des resistances electriques qui aident Ie melange gazeux clIaUeindre son point d'inflammation par effetjol.lle ..
Chapitre 3
Les batteries
1 .. GeneraUtes
Une batterie d'accumulateurs est un dispOsttif qui Iperrnet d'emmaga_siner de I'.energie eleotiique, sous forme chirnique, en vue d'une 'utilisation ult.erieure.
Une battefile est,en genera'l, constltuee de deux (t,)2) electrodesplongees dans une solutlondtte « electrolyte». t'ensemble (eleetrodes/elec_trblyte)eslenferme dans un bac en el;lonite, rnateriau [scIant et.imperm~iable.
11 existe deux types de batteries:
-Ies batteriasau plomb ;
- les batteries alcalines.
2 ... Les batteries au plomb
Ce sont, dellOin, iles batteriesles plus li tlli sees en automobile.
36
Eleciricite automobile
2.1 - Constitution
Unsbatterle au plomb est afnsi appelee, car ses electrodes sont a base de plomb. L'electrolyte est, dans ce cas, de l'acide sUlfurJque dllue dans de I'eau disfillae,
Une batterie d'automobile est, en r~alite, eonstituee de 3, 6 ou 12 batteries elementaires au «(ehflments de batterie».
Un element ("figure 1) comporte deux groupes de plaques (positives et negatives) entrelacees, Les plaques positives forment "electrode positive et les plaques negatives forment l'electrode negative. La difference de potentiel entre ces deux electrodes est de deux (02) volts.
Electrode negative
Plaques posltlVes
Plaques negatives
Fig. 1 : Element de baUerie.
37
cloison
electro! Ie
rompe de bouchons
borne
borne negalive
2
bee en
$Eiporoteur microporeux 2
Fig. 2 : Vue eclatee d'une batterie.
38
El~ctricite aulonwbile
2.2 - Fonctionnement
Le principe de fonctionnementd'un,e batterie au plomb repose sur I'action chimique de l'acide sulturique sur le,plomb. En effet, cette reaction conduit a l'ionisatiOn de l'eJectrolyte et les ions alnsi crees iront se deposer sur les plaques des electrodes.
Pour recueillir cette Mergie (char§es,des ions), il suffrt de relier les barnes de la batterie ell un circuitd'1.Itli.fsatlon externe.
R (circuit d'utllls~~lonl
Electrode nAgative ~ Electrode positive
DepOt de sulfate de plomb
Fig. 3 : Principe de fonctionnement d'une batterie au plomb.
3- Les batteries alcalines
Les batt.eries alcalines sent des aocumulateurs dent les electrodes sonten Cadmium-Nickel. EUes se dlstinguent par:
1'.{1,\~. batteries
39
- une capacite de charge de 50% plus Qrande par wnite de
poids des plaques i
- absence de sulfatation :
- charge pratiquement sans surveillance;
~ h~gerete;
- robustesse.
Malheufeusemell~ leur prix de revient eleve et l'important encornbrernent qu'elles provoquent font qu'elles ne sent pas tras employees en pratique.
4 - Principales caracterlstiquas des batteries
Une batteri.eest essentiellement caractertsee par:
- sa tensionnornmale :
- sa capacite nominale ;
- son rendement.
4.1 - La tension nominale
La tension rrorni nele d' u ne batterie est l'expression en volts de la difference de potentiels entre ses barnes positive at negative, Cette caracterisuq ue est directernent,liee au nornbre d'elernents dont elle se compose.
40
Elecuicite auiomobile
En effet, une batterie a 12 eh~mellts pressnte ,!me tension nominate de 24 volts, alors qu'une autre a 3 elements ne presente qae 6 volts entre ses barnes.
4.2 - La capacite nominale
La capaclte nomlnale d'une batterie exprlmesa capaclte a produire un courant d'lntenslte donnas durant un temps de decharge donne.
Une batterie dont la capacita nomina1e est de 60 Ah (Ampere-heure) peut fournir un courant de :
- 1 A pendant 60 heures ;
- 3 A pendant 20 heures ;
- 6 A pendant 10 heures ;
- 10 A pendant 6heurres.
~
II
I II
4.3. - Le rendement
Le rendement d'une batterie exprime le rapport entre I'energie foumie a la batterle lors de sa charge et celie qu'elle nOUS restltue durant son utilisation (decharge).
Ce rendement, de I'ordre de 75 % dans des cond{ti'ons d:utilisation norrnales, est cependant fortament tributalre :
-du taux de decharge ;
- de la temperature d'utilisation.
Les batteries
41
Le taux de decnarge
Le tatlX de,decharge est en relation directe avec Ie courant de deeharqe. En effet, sl I'intenslte de ce courant est trap forte (cas des courts-circuits). les reactions chimiques sontamenees asaturaUon avant que l'electrolyte n'ait au le temps d'attaquer en prctondsur les plaques des electrodes, ce qui raduit ccnstderablementle rendement energetique global.
La temperature d'utilisatlon
Toute reaction chimique depend de la temperature a laquelle elle se deroule. A titre d'exernple, et en prenant comme reference I'efficadte dune batterie a la temperature normale (25"C), cette efflcaclte est de rnoltre moindre a -20" C,
5 - Entretien, pannes et reparation
5.1 - Entretien des batteries
L'el1tretien d'une batterie .demandejuste un peu d'atterrtion, Les can sells ci-apras sont cependant if observer avec la plus grande rig,l1Ieur.
1 - Surveiller regulierement la denslte de l'electrolyte et n'utlliser que de J'eau distillee pour' le rernettre a.ntvsau,
42
lSiectricire automobile
2 - Toujours sponger les dabordernents d'electrolyte sur Ie oouvercle avec un chiffon imbibe Qe soude au d'ammoniac.
3 - En cas de suitatafton, demonter les cosses et les gratter.
Gralter aussi les pOles de la batterie at, anrss avoir rernonte les connexions en place, les proteqer avec de la vaseline.
4 - S'assurer que la ba.lterie estsolldsrrrentfixee dans son Goffre.
5.2 - Pannes relatives a l'electro,lyte
En dehors de la sulfatation, Ie seul moyen de savoir si Iia batterie est responsable d'une panne (refus de dernarraqe) est de mesurer !Ia den site de son electrolyte. Celt'€! operation fait appel au denslmetre represents en figl!lre 4.
Son utilisation consiste ~ plonger Ie tube d'asplrafion en caoutchouc dans un element de ta batterie et de ramsner, grace a la paire de pression, une q uantite d' electrolyte da ns ta pJpette en verre. t.'areometre va alors plonqer pl.us au mains profondernent enfonction de la denslte de cet electrolyte.
Helever la valeur indiquee par ,'areometre et refaire la marne operation avec taus les autres elements de la batterie,
Remarque : iI est ihdispe rsable de garder.le densimetre en position verticale et de rernettre, apres lecture, I'electrolyte preleve dans la batterie.
Les botterie s
43
1
1 - Poire ; 2 - Pipette; 3 - Graduations; 4 - Areometre
Fig.4: Le densimetre
44
EleclriciN automobile
SI 1~lbatterie est completernent chargee, la valeur indlquee par Ie densirnetre est voislne de 1,28 pour 'taus les elements. Gette valeur chute.a 1,22 pour une battena a mOilie dl!!cnar,gee et a 1,15 sl la batterie est totalemerit dechargee. Sur un vehicule regulierement utilise, la denslte de "electrolyte est de I'ordre de ~,25.
Certains densirnetres sont gradues en degres Baume (OBe).
Pourobtenir la densite de I'electro'lyte par rapport a l'eaua l,partlr d'une valeur en degres Baume, on utilise la formule sulvante :
d =' 145 145-D
d.: denslte par rapport a I'eau o : densite en degres Baume
Charge Charge de derni- decharqe
complete fonctionnernent dechar@e totale
G:l 1,28 1.25 1,22 1,15
I. ID 32° 29° 26° 19~ 5.3 - Autodec.harge et decharge de fonctionnement
L'autodecharqe d'une batterie survient au bout de trois mois d'inactivite (arret au garage). Elle est due aux interactions chimiques entre les plaques des electrodes et l'eJect~olyte.
Les batteries
45
Cette decharqs peut aussi ~tfe due a des courts-circuits internes ou externes (mauvais entretlen) et est plus ou mains aoeeleree par la temperature selon qu'elle monte au baisse.
La decharge de fonctionnement survient normalement apres de longs mois d'utllisation. Ble peut aussi survenir suite a un usage abusif des accessoires (autoradio, eaairage) ou de demarrages trop fre_quents.
En effet, la batterie n'est en general sollicitee que pendant la phase- de dernarraq e d u vshlcute et l'energie prelevee par Ie dernerreur est restituee par I'altemateur au, surles anciens vehicules, la dynamo. Mais si on lui demande davantage qu'eIle ne peut fournir ow qu'on ne laisse pas au vehicule lie temps de la recharger, ators, la batteriel'init par se decharper totalemenl et till test, au densirrretre, confirmera Ie diagnostic.
5.=\.1 - Recharge des batteries
La recharge d 'une batterie fait appal ell un apparel I j ustement appale "chargeur de b?ltterie" dont Ill! synoptique est Ie suivant:
~. \
r MIA S1
22DV-
!
6V
12V
T
Fig. 5 : Schema synoptique d'un chargeur de batterie.
46
ElectriciJe automobile
Les batteries
47
On y oecouvfe :
5.3.2 - IDjfferents modes de chargement
- un linterrupteur MIA de mise sous tension;
- un cornrnutateur S1 de calibrage du courant de
charge;
- un arrrperemetre A indiquant I'intensite aU courant de charge;
- un cornrnutateur S2 de salection de Is tension de sortie;
- un voltmetre V indiquant la tension de sortie ;
- un transformateur T permettant de ramener Ie 220 volts
alternat,if du secteur vers 12 volts alternatif:
- un circuit a base dequatre diodes pourla conversion du courant alternatifen courant continu.
II existe trois modes de chargement des batteries :
- la charge totale normale ;
-Iacharge d'appoint;
-Ia charge d'entretien.
La charge totale normale
La charge totale normale est Ie mode de charge ufllise lorsquela batterie est totalement decharqee (d = 1,15),
Cet appareih (Ie chargetJr) se presents gE:!neralement SQUS I'aspect indique ci-apres :
Avant d'exposer les details de cette me,thode, il convient derappeler deux chases :
-Ia capacite nornlnale : energie que peut delivrer la batterle;
• Ie rendement : rapport de l'energie foumie a celie recue.
Ce qui revient a dire, en appslant X I'energle foumie a la batterie pendant sa charge, que :
IJJM @.jA
II
C 3
- = 75 % = - ou
X 4
4 X=- C 3
81 S2
Autrement dit, une ibatterie de 90 Ah, doit ~tre chargee a 120 Ah. Cette charge va se faire en deux tranches :
Fi,g. 6 : 'Chargeur de battl1lries.
1m tranche:
charger pendant 10 heures avec un courant d'intensrte constante I = C/10. A IStiA de cette tranche, labatterie va se rmettre a Ibouillonner avec degagement gazeux.
48
EleClricile automobile
2e tranche: raduire de mottle i'lntenslte du courant de charge et continuer l'operation pendant 6 heures.
Remarques .:
1 - Avant de commencer la charge, enlever tQujours les bouchons de remplissage pour permettre aux gaz de s'achapper,
2 - Le degagement gazeux, produit de I'electrolyse de l'eau, est hautement exploslf. Eviter de produire la rnoindre i3tincelle (cigarette, chalurneau ... )
3 - La temperature de I'electrolyte ne doit en autun cas depasser 40° C.
Silan de charge
Tranche 1 :
X1 = (intensite x duree)
;11 x 10=Cf10x10=C
X2 = 12 x 6· = C/20 x 6 = 311 Q C
Trarlche 2 :
'I
I '1
Charge totale: X = X1 + X2 = 13/10 C "" 413 C
Duree de charge = tranche1 + tranche 2 = 16 heures
La charge d'appoint
C'est la methode de oharge conseulee lorsque ta voiture a des dlfflcultes a dernarrer et qu'une verification de I'electrolyte revele une densite voisine de 1,24.
Les batteries
49
Ce mode permet de charger la batterie avec juste assez d'energie pour que Ie vehicule dernarre, Elle se resume a anvoyer un courant de tres forte intenslte (<::l 80 A) pendant un temps relativement court (molns d'une heure),
La charge d'entretien
La charge d'entretien consiste a sournettre la batterie, taus les trois mois environ, a un courant d'intenstte de 1 ou 2 amperes pendant quelques heures (pourquoi pas Ie solr, entre la fin de la journee de travail et Ie moment d'aller se coucher?).
Ce mode de charge est dit "d'entretlen", ear il permet, en plus de compenser lespertes dues a I'auto,decharge, I'autoradio et la climatlsation, de garder une charge assez importanteentre les plaques pour reduire Ie faux de sulfatation et porter ainslla durse de v,ie de la batierie au-dela des 2 a 3 ans hablteels,
Chapitre 4
II .
I
Le circuit de charge avec alternateur
1 - Generalites
Un circuit de charge est un disj;1ositif qui permet de :
- restituer a la batterie ,'energle prise- par le,demarreur ;
- garder constamment aux bornes de la batterie une
tension sufflsante ;
- alimenter Ie vehieuie en ~mergie electrique aussl longtemps que Ie moteur'toume.
Ces di~positjfs, dits generateurs dynamiques, transforment I'energie rnecanlquedu rnoteur en €mergie eleotdque. II en exlste prineipalernent deux types: la dynamo et l'alternateur.
Les progres lechnologiques aidant,I'altemateur est devenu, et de'loin.Ie maitre lneonteste des circuits de charge.
5-2
BliJctricite automobile
2 - L'a Iternateur
poulie d"entrainemenl mue
r Ie mofeur
rotor
a riffes.,
stator
balais
venfiloleur
enrou lemenl d' excitation
bagues
co II ec trice 5
Fig. 1 ; Vue d'ensernble- d'un alternateur.
Le Ci~it de charge avec alternateur
53
Unaltemateur (fig. 1) est essentieUem.ent constitue de :
- uncircu.it inducteur ,: c'estIe rotm de I'altemateur. II est compose d'un noyau ferramagnetique comportant 8 au 12 petes at sur lequel est dispose un enroulement cancentrique.
un circu;td'induit : c'est le stator de "alte.rnateur. II se compose d'un cylindre' creuxa base de tOles minces avec des encoches pour abriter les enroulements de'fi'ls ~Iectrlques.
- un circuit de redresseme.nt .: circuit statique a base de diodes semiconduotrices.
- un n!gu/ateur de tension : dispositltelectroniqueeu e1ectromagnetique de contrOle de charge.
3 - Principe de foncttonnernent
Moteur a I'arret : La diode d'isolernent etl'interrupteur K deconnectent I'altemateur de la batterie (figure 2).
Moteur en marche : t'interrupteur K se 'ferme (contact) et la batterle atirnente Ie clreult lnducteur via ta resistcmce d'amorcsqe, La lampe temojn s'allume .. Lecircuitd'indu it delivre alors une tenslbn slnusotdale dcntle module est praportlormel a la vitesse de rotation du rnoteur, Cette tension, redresses par les diodes D1, 02, .... 06, va polariser en direct la diode d'isolement. Cette derrnere rentre en conduction at ceci aura pour consequences:
- la resistance d'amorr;age est'court-eiroultee ;
Electriatte automobile
- la tampe ternoin s'etelnt :
- I'inducteur n'est plus allrnente par la batterie, rnais par
te circuttd'ind\lit lul-rrerne ;
- Is tension redresses etantsupeneure a celie de 1,la batterie, cette derniere 56 met en chqrge
,Inducteur
Induit
Fig. 2 : SYOoptJql.le d'un alternateur.
4 - La regulation
La tenslondelivree par I'altemateur estfonctlon directe de Ja vltesse de rotation du rnoteur. En effet, a grande vitesse, la tension lnduite risque de detrulre aussi bien fa batte-rieque le reste des composants electriqu6s et electrenfques.
LB circuit de charge avec nlternateur
55
Le regll'lateuf de tension est ,Ie dispositif qui ~e~et ~e redtllre Ie courant inducteur chaqua foisque la tension induite sort de la limite de s6curite admise.
" existe deux types de' regula,telJrs pour alte-rnateurs d'automobile :
~ les regulateurs electTomagnetiques ; -Ies regulateurs electroniques.
4.1 - Le rE!gulateur elec.tromagnetique
Aussi dit n§gulateur a palette vibrante, son principe de fonctiormement est Ie suivant :
Flg.3: Schema de principe d'un regulateur elec1romagnetique-.
Au repos,Ie circuit inducteur est alimente sous la tension de debit de I'indult. Le ressort Cferme la palette sur Ie contact A
56
Eleetrtcite automobile
Lorsque la vTtesseaugmente, la tension induite U augmente elle ausst jusqu'a atteindre un seuil qui permet a la tJobine L de vaincrela force exercee par Ie ressort sur la palette. Le contact en A s'ouvre et la resistance H entre dans Ie circuitinducteur, reduisant ainsi I'intensite du courant y clrcutant et, par consequent, la tension de debit de I'induit diminue.
4.2 - Le regulateur electronique
II existe une multitude de montages pour la regulation eleetrcntque de la tension de debit des alternateurs, Naus ne reproduirons iei que Ie schema de principe oe ces regulateurs.
Fig. 4 : ScMma de principe d'un reQulateur electronique. L'element de base de ce montage est Ia diode Zener Oz.
Tant que sa tension de claquage n'est pas atteinte, Ie transistor T2 reste bloque. Le transistor T1, dont Ie base est reliee a la tension induite par la resistance H1, permet ill I'alternateur de charger la batterie.
Le circuit de charge avec: alternateur
57
Des que la tension de debit devient trap forte, Dz conduIt. , . t T2 dO'venu passant reduit te courant de base de
Le trans's or ,v - , ..'
T1, ce qui entraine une chute de ta tension induite.
5 - Diagnostic des pannes
Un dysfonctlonnement du dispositif de charge est,le PiluS souvent irnmediatemeoueperable sur Ie table,au de bard. En effet ia 'lampe ternofn doit s'allumer des qu'on met Ie contact
et s'eteindre torsque Ie moteur demarre.
Le tableau suivant est un precieux outil dans Ie diagnostic des pannes de tout alternateur.
58
Electricite lIIltonwbile
, .
Le circuit de charge avec alternateur
59
6 • Interventions pratiques
6.1 - Depose de l'alternateur
Certains travaux exigeant la depose de raltemateut il est recommande, pour ce fairs, de respecter la demarche suvante :
_ debranol;!er te c~ble de masse de la batterie;
_ desserrer tes fixations de I'alternateur sur ses supports; _ desserrer Ie boulon de reglage du tendeur de courroie
(fig. 5);
-deposer la courrole d'entrainement,
_ debrancher les connexions electriques de I'alternateur;
_ degager ,'alternateur.
1- poulie du ventilateur 2 - ComTOie
3 - polJlie motrlce
4 - Poulie de I'altemateur 5 - Axe du rotor
6 -Chape
7 - Flasque amere 8 - Flasque avant 9 - Rainure flletee
10 - Boulon de feglage
Fig. 5 : Schema de mohtage de la courroie d'altemateur.
,
60
Elect";cite aZilomoblle
6.2 - Intervention sur I'induit Un lnduil peut presenter trois pannes :
= une coup~re ~e circl1(it dans un en'roulement .
un co~rt-crrcult dans une phase' 1
- une m.1$e a la masse d'un bObln~ge.
Test de circuit ouvert
Ge test, conduit a I'oh et .
phases 2 a 2 et a chercher mcemJI re: conSlste a brancher Jes
_ e qUI est defectueuse :
- faiblereSistanoe: pas de circuit ouvert dans le b b'
- tres grande resistance (500MQ)' homage.
, p. ase couoee.
Fig. 6 : verificatiOn de "jo""'it • I' ..
.. u., ,a Q,,,mmetre.
Le circuit de charge avec alternateur
61
Test de court-circuit
En dehors des court-circuits francs (bobinages brOles). une phase peut ~tre en court-circuit partielsur etle-merne sans que eela ne soit.visible al'csil nu. Cette defectuos.iteesta suspecter lorsque Ie courant de debit est relatlvement faible, entrafnant une decharge trap rapids de la batterie.
Normalement, une phase en court-circuit partlel devralt presenter une resistance ohrilique inferieure a celie d'une phase en bon etat Malheureusement,ces reslstahcessoht si1faibles_ (0,1 ohms) que rneme les rasultats des onmmetres les plus precis ne sont absolument pas fiables.
Pour detourner cette difficulte, I'alternateur est rernonte en partie puis entralne au bane. On se sert alors d'un voltmeir'€! alternatif pour mesurer Iia tension deJivree par chaque phase. Cette tension se devant d'l§tre la rnems sur les trois phases pour un alternateur en bon stat
N.B: Ce test est a mener parun spaclallste convenablement eoulpe avec obligation de respecter ell la lettre les instructions du constructeur.
Test de mise a la masse
Ce test permet de deceter les everrtuellesmassesentre la carcasse de I~induit et leslbobin~ges. II falt appel au montage de la figure 7.
Si la resistance entre la carcasse et l'une quelconque des trois Phases est faible, ceei est revelate,ur d'une masse. Dans Ie cas contraire, les trois mesures serant de I'ordre de plusleurs dizaines de MQ (mega-ohms).
I!
62
Electrici(e tnuomobtte
Fig. 7 : V6rifi~ation. de II'induital'ohmmatra
6.3 - Intervention sur I'inducteur
Le circuit lnducteur est, I'ui aussl, sujet ~ :
- une coupure de circuit;
- un CQurt-Circuit ;
- une mise a la masse.
Test de circuit ouvert
Un inducteur est en circuit ouvsrt 51 :
- ,'enroulement Inducteur est coupe .
- un flI de liaison avec les bagu~s collectrlces est
cessoude.
Le circuit de charge avec alternateur
63
Dans un cas comme dans "autre, Ie testconsiste a mesurer la Iresistance entre les deux bagues collectrices, avec un onrnmetre. tel qu'indlque a 1a figure ci-apres,
Fig. 8 : Verification de l'lnducteur a t'ohmmetre
Si Ie circuit inducteur est coupe, l'ohrnrnetre Indiquera une resistance infinie. "faudta, alors, rem placer Ie rotor. Dans Ie cas oontrstre, Ie resultat de la rnesura sera de quelques ohms.
Test de court-circuit
La recherche de courts-circuits dans le bobinage inducteur est aussi a mener avec Ie montage de la figure 8. La valeur affichee par I'ohmmetre sera comparee avec celie lndtquee par Ie constructeur, Au cas ou I'ecart entre tes deux vateurs dapasse la tolerance admise, Ie rotor est a remplacer.
64
Etectricile automobile
A titr~ d'exem~Ie, ~'induQteur d'un alternateur 14 volts, monte sur un vehIcu Ie utilitalre avecune battene de 12 volts presente une resistance del'o~dre de 4 ohms. La toletance admise par les conslructeurs vane, en general, de 5 ~ 10 %.
Test de mise a la masse
Ce t:st CC;lnsiste a rechercher "eventllelle presence d'un contact electnque entre Ie bobinage inducteur et J'arbre du rotor.
Fig. 9 : Veriflcati0ll de "'nducteur a "ohm metro.
, Si J'inducteur est en bon stat, les deux lectures faites a 'Iohmmefre seront infinies. Dans Ie cas contraire (valeur rue: quelques ohms). Ie rotor est a remplacer.
Le circuit de charge avec alternateur
65
6.4 - Intervention sur Ie circuit redresseur
Le test du circuit redresseur etant ceilli de ses diodes, on sa contentera de rappeler que:
- une diode en parfait stat conduit dans un seul sens (resistance indiquee tras faibIe au nune dans Ie sens passant at infinie dans lie sens indirect);
- une diode en cou rt-circu it conduit dans les deus sens;
- une diode en circuit ouvert ne conduit pas du tout.
6.5- Intervention sur les balais, les porte-balals et Ie collecteur
Verifier que:
- la resistance entre chaque balai (charbon) et son gl,lide dans Ie porte-balai est nulle ;
- la resistance entre les deux balais est inflnie.
Nettoyer:
- les charbons avec un chiffon imbibe d'une solution de trichlorethylene;
- ,Ie colJecteur au trichlorethyl~me et Ie poUr avec du papler de verre fin (ne jamais utiliser de toile emerl).
I~
66
EJectJ'icileaulmnobile
6.6 -Interventlon sur Ie re~lulateur
L'intervenfion sur Ie regulateurse lImite a eontrOlerlatension regulee. En ettet, Ie qepannage at Ie reg lege des reg~lateurs ne pouvant ~tre effectues que par un speciatlste convenablement equlpe, on ne saurait done les exposer sans sortir du cadre de eet ouvrage.
Si, apres avoir teste tous :Ies autreselernents du circuit de charge, rien d'anormal n'a els detecte et avant de prendre 18 decision de changer de r.egulateur, remonter l'alternateur, en prenant bien soln de :
- remettre en place toutes les connexlons electriqLles;
- reg ler correctement la tension de courrole en conformlte avec les specifications cu constructeur.
Ced etant, effectuer maintenant ce dernier test:
- lire la tsnslon de batterie;
- dernarrer Ie moteur et monter er:u.egime jusqu'a ce que le voltmetre lndique une tension entre 13,5 et 15 volts;
- brancher tous les accessoires (radio ... ) ;
- lire a nouveau la tension.
Si la tension chute en dessous de 13 volts, Ie regulateur est a remplacer. La rnerne constat est a faire si la batterie est boulllonnante ou exige trap souvent une remise a nlveau de son electrolyte (ajout d'eau qistilh~e).
Chapitre 5
Le demarreur
1 - Generatites
moteur d'un vehicLlle puisse tou,rner d~ .f8lton
pour qu~ le . .. . donner une vitesse initlale mmlmale,
autonome, II faudr;:lIt lui d 100 a 200 tr/mn. Cet effort Initial
dite de Ia,ncementl tallan.tle~mqUe I·ustement appele dem.arreur. est rourm par un rno eur e
2· - Constitution
Un demarreurest essen.tiellement constitue d'dun ;moteurr , . I·t de commande u ianceu .
electrique, d'un lanceur et d un ClrCtli .' .
2.1 - Le moteur electrique
Comme tout moteur electrique, il est constnue de :
tator . tepresente p. ar ta Gu'asse qui porte les
- un's . t·
masses polaires at les bobines Indue noes;
68
Elearicite automobile
- un rotor: represente par I'induit et son colledteur,
- un PQrt~ balais : organa de couplement electrique avec
la battene via les balais frotteurs et Ie coUecteur. .
. Ce moteur. electr.iquese devant de produire un couple puissant.en relle son inducteuret son induit en serls afin d'avoir un courant de forte intensite dans I'induit. Ce genre de moteur est dft a excitation ssrie.
Vers cOllec1l:lI,1r
Vers collecteur
Fi~. 1 : _Differents modes de branchement
des bobmes lnductrtces d'un alternateur tetrapolaire.
2.2 - Le lanceur
, C'est I'org_ahe assurant Ie couplage mecamque entre Ie moteur electrique du demarreur et Ie vllebrequln du rnoteur thermlque (essence au dleset),
"se compose e~sen~iellement d'un pignon qui communique Ie mouvement~otat~ d~ I'indutt a unecouronne dentee mantee sur Ie volant a I extremlte du vilebrequin.
Le demarrellr
69
Le rapport entre Ie pignon monte sur Ie demarreur et la couronne du volant est de 1/15 a 1 f1;B ; ce qui impose une vitesse de rotation de 2000 a 3000 tr/ri11n au moteurel~trique pour avoir \es 150 trlmn necessaires au demarrage .
Roue Ilbre
I;'
I i I
1 L_.J
fig. 2 : Positions relatives plgnonlroue dentee du volant moteor.
2.'3 _ Le circuit de commande du lanceur
Le ~ispositif de commande dll lanceur ciait assurer deux fonctions:
1 _ engagerle pignon du demafil'eurdans la.courannedentee du volant juste avant que Ie moteur electrique ne soft
aliments 81" courant;
70
Eleciricite aUlr"nohlle
2 - rompre la llaison prgnon-couronlle dentea des que Ie moteur thermlq,ue du vehlcule demarre.
Ces deux contralntes dolvent absoJument etre reallsess. car leur tlefaut entrafnerait:
,I
1 - Ie pig non s'engageraita grande vitesse dans la couronne et Ie choc ainsi produit concuiralt ill une usure trop rapide
du lanceur. '
2 - Ie moteu r therrmque, tournant a pi us de 1000 tr/mn 1 etant au contact du pignon; II entratneralt alors Ie rnoteur electrique du dernarreur a la vitesse vertigineuse de 20 000 trlmn qutsous l'acuon de "inertie, Ie feralt volsr en eclats.
Le dispositif de cornmande qui realise ces deux fonctions est compose de :
Ver& demarr~ur
1 - Bobines du solanorde 2 - Noyau plongeur
3 -Fourchene
4 - Rossor! de rappel
5- Roue nbre
6 - Contact de fin de course 7 - Pignon
Fig. 3 : Circuit de commande du demarreur.
Le dbnarl'elIl'
71
- un solenolde;
_ un noyau plongeur; - une fourchette;
- un ressort.
2.4 - Principe de fonctionnement d'un tanceur a solino'ide
Au 5 les interrupleurs K 1 et K2 sent ouverts etle pig non
repo • .
est desengage de la eourcnne (FIg. 4).
La bobiflage L 1 .du solenolde est d\t ~e~roulement. d'appel" et est constitue par un fil de grande section. ,Le 'boblnage L2
. t·tu s; ,pa' un til fin et porte Ie nom d enroulement de
est, lUI, oons I = "
maintien.
L1
Fig. 4 : Synoptique de fon~tio~nement d'un demarre\ilr a solenoide.
["
72
Eiectnctt« ausnnobi!e
Lorsq ue Ie conducteu r tourne la cle de contact, ['I n terru pte u r K 1 se ferme. La bobine L 1, raversee par un courant de fOrte lntensits, attire energiquementle noyau N, entrarnant ainsi ume rotation de la fourche auteur de raxe I et donc I'engagement du pignon dans Ita roue dentee du volant
En fin de course, Ie noyau N ferme l'internrpteur K2, entrainant ainsi :
- la fermeture du circuit d'alimantatien dlrecte du mateur electrlque qui se met en rnarche.
- le court-cirouit de la bobine d'appel L 1.
Le contact K2 est maintenu ferme parla bobine de maintien L2. Das que Ie moteurthermique dernarre.le canducteur lache Ie contaot et I'interrupteur K1 s'ouvrs. Le champ magnetique a l'interieur du solenorde est compose du champ de labobine L2, qui tend a garner K2 ferme, et de celui de L 1, qui tend a I'ouvrir. La resuttante de ces deux forces stant inferiel!Jre a celie exercee par Ie .ressart C sur K2, ce dernier s'ouvre et coupe l'allrnentation du dernarreur Le noyau plongeur, dans son rnouvernent vers sa position de repos, desengage Ie pignon de la couronne dentee grticea 5011 action sur la fourchette.
3 - Diagnostic des pannes
a,u'on se Ie dise tout de suite, II est bien plus que rare qu'un dernarreur refuse brutalement de fo:nctionner. En effet, cette etape n'est atteinte qu'a la fin d'un processus dant les slgnes avant-coureurs sonf
- manque de puissance;
- echauffement anorrnal ;
- bruits.
Le demarreur
73
L.eur Intenslte diminue torsou'cn met' Ie oontact
Verifier I'etat de la batterle etdes cannexions electriques
Demarr·eur defectueux
d t . Ie demarreur ne peut entrainer te moteur, Ie
Cepen an. ~tl de consulter I'organigramme cl-avant. SI
plas sage serat .. f rt· . '1 faut
I'hypothese d'une panne de ~ema~eur est con 0 ee, I
alers se referer au tableau suivant .
symptome Origine de la eanne
I
_ connexlonselectrjques
Le dernarreur ne defectueu5es
tou me ,pas. _ solenotde defectueux ,
,
. _ lndult en court-circuit au a la
,
Le dem;arreur tourne, masse
_ collecteur defectueux
rnais ne peut enttarr:ler _ chamonsgrippes au
Ie moteur. defectueux
_ pallers glfippes au defectueux 74
EleClricil-e automobile
4 - Interventions pratiques
4.1 - Depose du demarreur
Certains travaux exigeant la depose du demarreur, it est recomrnance, pour ce faire, de respecter Ia detnarche suivante:
1 - debrancner 'Ia batterie en devissant I'ecrou a oreilles de la 'borne negative;
2 - debrancher les connecdons electrtques du demarreut; 3 - deposer les vis de fixatIon;
4 - extralre!e demarreur.
1 - Couvercla arriere 2 -Porte-baJais
3 - Tirant d'assemblaqe 4 - Balais
5 - lnduit (Rotor)
6 - Inducteurs (Stator)
7 - Palier jntermBdiaire ·8- Pignon
9 - Soh!lnoi'de 10 - Fot.lrchette 11 - Nez
12 - Douille
Fig. 5 : Eclate d'un demarreur.
75
Le demarreur
4.2 _ 'Intervention sur nnduit
Uinduit d'un demarreur,peut t!tre sLljet a:
- un court-circuit _ un circuit ouvert
_ une mise a la masse
_ un oollecteur defectueux
Le test de court~circuit
t
I
t
i
Fig. 6 : Le grognard, un Dutil fort utile dans Ie test des rotors.
Un induit grille est signale par un aspeot noiratre, suite a 'Ia fusion de !'isolant.
III I
I[
I II
76
Electricite automobile
La recherche de courts-circuits partiels dans un lndult de dernarreur sa tait au grognard. Ce test consiste a toumer [e rotor lentement, a la main, dens la structure en V de I'ClPpareil,
tout en maintenant, dessus,une fine lame d'acier. .
La presence d'un court circuit est signalee par des vibrations de la lame metallique. Tout induit grille ou court-circuite est a remptacer.
Le test de circuit ouvert
II est extrernernent rare qu'un induit soit I'objet d'un circuit ouvert. En effet, un tel problerne fait Ie plus sauvent sute a la presence d'un corps ~tranger au au dessoudage d'une connexion sur Ie collecteur.
Le test consiste a mesurer a I'ohmmetre la "resistance" entre deux lames adjacentes du collecteur. Une lecture inffnie est synonyme d'un circuit ouvert.
Le test de mise a la masse
Ce t-est est auss' a mener a l'ohmmetre. La "resistance" a mesurerest celie entre Ie noyau de I'indl.lit et les difterents segments du collecteur.
ll y a mise a la masse, si la valeur lndlqueen'est pas '1nfjnie".
Un induit affecte d'une mise a la masse est a remplacer.
Le test du collecteur
Un collecteuren bon stat est de couleur brune, La test de depistaqe est done essentieltement vtsuet at porte sur la recherche des traces de brCilures et de piquages.
77
En cas de probh~mes, 'e~ollecteur est rectifi9 au tour et ses entre-lames mica sont fra1595.
L'lntervention sur'le collecteur 58 te~ine par un nettoyage avec un chiffon imbibe de trich1orethylene.
4.3 .. Intervention sur les inducteurs
Les bobines d'un demarreur peUVE;lnt ~tre "objet:
- d'un court-circuit;
_ d'une mise a la masse; _ d'une coupure de circuit.
Le test de court-circuit
La recherche de courts-circuits p.artiels dans les bobines lnductnces oMit au cheminement sUlvant :
1 _ consulter les donnees du constructeur sur lie type de branchement des boblnes inductrices et leur resistance
ohmique.
2 _ denuder lege:rement la connexion entre bobin,es et mesurer a I'ohmmetre la resistance de cnacune d elles.
3 _ comparer les resuttats ainsi obtenus a c~ux du construct~ur. Oil rappelle que la resistance eqUlvalente de deux r~sistances en sene est ~gale a I~ somrn~ des deux et que celie de deux .resistances paralleles est egale au !Tappert de leur prodult sur leur somme.
78
Electncite airfomohile
Dans Ie cas 00 l'on h (f
preoonlsaes a I'usine on p~~::tose pas des vsteurs reelles
obt~nlles a I'ohmmetre· entre el7,!sar comp~raison' des vafeurs paruel est celle qui presents u ~ ~a bobine en court-circut autres. ne r sistance plus faible que les
Le test de mise a la masse
. Le lest de mise ala m .
ohrnique entre la carca:sse consiste a.rnesurer la resistance
Inductrices. Une mise a I:e et 'chacune. des quatre bobines par une resistance "non infi~:;~se est slgnalee a l'ohmmetre
le test de circuit ouvert
La section du til des bobi e . .,.'
est done bien plus que ra ns d mductnces etant importante i1
d' .' re e rence t .' '
emarreur en circuit ouvert . n rer un mducteur de
Le test est a mener en parallel .
de co~rts-Circuits. En effet si I' e avec c~llIl d~ la recherche
coupee, sa resistance oh~iqUeune td;Sfib0blnes inductrlces est es In Inle".
4.4 - Intervention sur Ie pignon
Le pig~on .etant une piece ure . "
d~faut ~UI puisse l'atteindre esr d ment mecamque, Ie seul
visuel et consists iii inspecter I'etatodnecs ~:t~~ure. La test est
. Si.le pigmon est legeremet:1t abime .' .
~(em,ler temps pour une sim Ie ' ?n peut opter dans un
I une d"elies est cas see I . P correction des dents; mais 51
, e remplacement du pignon s'irnpose.
L:intervention sur Ie pign •
une solution de trfchlorethYI~n s aCh~ve par un nettoyage avec ene au d essence,
1
I
79
Le de.marr(wr
4~5 _ 'ntervention sur Ie so,eno·ide
Un solenolde en mauvais etat peut etre responsable de 3 types de pannes :
1 -Ie pignon ne s'engage pas dans la couronne. 2 _ te pignc:lnest trop au pas assez engage .
3.-le pignon est correctement engage. rnaisle demarreur
ne tourns pas.
Lepigr'lon oe s'engage pas dans te couronne
Cette panne peut avoirdeux origines distinctes :
_ tes bobines du solemo'ide sont defectueuses ;
_ \a fOl!lrchette de commande ne communique pas Ie
rnouvement au pig non.
Dans Ie premier cas, le test consiste a mesurer les resistances des bobinages et ales com parer avec les valeurs du C0nstructeur. En cas de coupure ou de court-circuit,
remplacer le bobinage en cause.
Certains solenoldes sont se:rtis a la fabrication et ne sont donc pas demontables. Leur reparation stant impossible I on ne peut proceder que par substitution a I'equivalence.
Le deux:ieme cas appells une ,inteNention beaucoup plus facile. La fo.urchette etanten liaison avec Ie noyau plongeur, Ie nez du demarreur et la doumej .il su:ffit done de verifier I'etat de
ces trois connexions.
Le ptgnon est trop OU pas assez engage
Un pignon trap au pas aSS8Z engage presente des traces d'usure; Ie demarrel!lf est bruyant et, si la bat:terie n'est pas
i ~'
82
E'lec/ric!te automobile
- les baJalis coullssent.. -
reSpectifs; facllement dans leurs guides
- 18 tension des ressorfs d .
raiDle; e bala,s n'est ni trop forte nltrop
-Ie degre d'usure des ba)ais
remplacement s','m . . (en dessous de a rnm Je
J k-.' pose et s effectu' ,
- a i<;:;:)lstance ohmiQue e t. ' e par lelJ compJet).
"b I if' nre.:
... a a,carcasse est infinie .
balar/balal est Infinie ' '
un balai et son guide 'est nuJle.
Chapitre 6
L'allumage
1 -Introduction
L'allumage est l'operanon qui consists a fournlr, ~ partir des 12 volts centlnu de la battene, plus de 20 000 volts a une bougie rnontee sur un cyHndre en etat 3 (compression du melange caroure).
2 .. Le systeme d'alluma'ge
On designe par "systems d'allumagett I'ensemble des e:lements qui permettent I'allumage. Ce disposltit cornporte :
- un allumeur (DELCO) : coupe regulierement le circuit primaire de la bobine at dlstribue tes'impulsions H.T. issues de cetle demiere aux differentes 'bougies.
- uno bobine d'induction : genera l'lrnpulsion H.T.
- des bougies (une par cylindre) : allument Ie melange
oarbure.
II
t
84
E/~c:tricire aulo1lltJhiie
:;;
lIP
~
C
~
C o v
....
.L 'allumage
85
2.1 - L'allumeur (DELCO)
L'allumeur(DELCO), entratne par l'arbre ~ carnes via un pignon de renvoi, est constltue des elements suivants :
- un rupteur;
- un condensateur ;
- un distributeur,
Le rupteur
Leruptsur est un inretrupteur meeanlque qui a pour fonction de couper Ie courant primaire de la bobine d'allumage a un momentbten precis. II «om porte ;
- une came de rupture: solidaire de I'axede l'allumeur, elle porte autant de bossages qu'iI y a de cyfindres (4 en general).
- une pstr« de contacts de rupture: ccrnmunement appelees«vis pIa tin ees» , elles existent sous differentes formes (une piece, deux parties, cassette). Le contact fixe est relie a la masse et Ie contact mobile est monte sur un Iinguet mobile autour d'un axe. La rupture du courant primaire de la bobine.a lieu lorsque Ie toucheau entre en contact avec un bossage de lacarne.
Contact mobl!e Contact FIXe
Toucheau
Fig. 2 : Synoptlque d'un rLlpteur.
I' I
86
Electricile autOillo!Jile
3
1 - Vis de fixation ; 2 - Contacts de rupture; 3 - Plateau des contacts de rupture
Fig. 3 : Vue eclatee d'un I'lIpteur.
le condensateu r
". t~~ forme eylindrique, Ie condensateur est soft contenu if dIn. eneur de, "allumeur; soit aceola a son baTtier. Son rOle est f e re~rder, ~ ~sure des contacts de rupturs en empechant Ia
orma IOn d etrncelles au moment de la rupture. '
L'allumage
87
condensateur
Fig. 4 : Un condensateur integra a I'allumeur .
Le distributeur
ifel que son nom l'indlque, Ie distrlbuteur est I'element de l'atlurneur qui permet de disfr'lbuer Ie courant haute tension, issu de la bobine d'allumage, aux differentes bougies. II comporte:
- une tete de distributeur : elle dispose d'trne borne centrale d'arrivee de la haute tension et de quatrebomes peripheriques de sortie de tension vers res bougies d'allurnage.
- un rotor: il coiffe l'arbre de l'alturneur et tourne avec lui.
La tension HT est communiques aux bougies par un doigt solidaire du rotor.
Ainsi, lorsqu'une impulsion HT arrive sur. ta borne centrale du dlstributeur, elle est comrnuniquee au doigt du rotor via un ressort et un charbon. Le doigt. stant en rotation, passe devant un plot relie a une borne de sortie et alimente une bougie bien speolfique.
88
Electricire automobile
1 - Cable HT de la borne centrale ; 2 - Cables HT des barnes peripheriques : 3 - Tete de distributeur ; 4 - Plot HT ;
5 - Dojgt de distributeLlr : 6 - CIlEIrbOI1 : 7 - !3ougie.
Fig. 5 : Le dlstributeur.
L'allumage
89
90
Etectricu« automobile
2.2 - La bobine d'induction
IL.a bobme d'lnductlan est en raalite un transtormateur haute tension Elle se compose, done, d'un noyau ferrornaqrratque recevant deux enroulements : Ie pnmaire et Ie secondaire.
, L'enroulernent primajre est constltue ,par.quelque 400 spires dun fil de 9\osse se~lon ( 1 mm). Le secondaire com porte 15 a 20 000 spires €Ie fO de falble section ( 0,1 rnm).
. Schematique,mentl elle S9 compose d'l:Jne borne positive rel~ee alia battene Vj~ ta clef de contact, d'une borne negative rellee au rupteur et.d une borne centrale reliee au dlstributeur.
deport HT .... ers Ie di!tribul8Uf
colli~(
de fi .. olion
borne po~ili ... e
emovleur pnmou·e
noyou
en fer do .. ,.,.;
enroule ... r S8tondolre
Fig. 7 • La bpbine.d'induction.
91
L 'allllmage
2.3 - La bougie
La bougie est run des elements clesdel'a'IlUmage. De son etat dependent [a bonne marche du moteur et la TeQularite de \'allumage. Elle est .co~posee dl~ne ~Iectrode centrale relieea un capuchon du dlstnbuteuretd une electrode de masse reliee eli la masse du I/ehicule par le vlssaqe du culot sur Ie moteur. L'ecart entre les deux electrodes est de
mains de 1 mm.
On parte souventde chaleur d'une, bOLl~ie.: Ce te~me defin~t fa facilite avec laquelle la chaleur, a I extremlte de,llsGllant au jaillit I'etincelle, est communiquee .. a~ sys.teme ,de refroidissement du moteur. Cette caractenstique dlffere d un mateur a un autre et depend essel1tiellement de la gamme de
vitesse et du taux de compression.
1 _ Joint metalloplastique ; 2 - Isolant ; 3 - Electrode centrale: 4 -Electrode de masse
Fig. 8 : Aspect exlerne d'une bougie.
92
Electricile automobile
5
8
t 'allumage
93
3 - Principe de I'allumage
Contact
•
8atterie
BObine
Fig. 10 : Schema de principe de l'aUumage,
Lorsqu'on tourne la cle de contact! la borne + de la bobine d'allumage est reliee a la batterie et un champ rnaqnetique constant s'y cree,
L'axe de I'allumeur, entratne par l'arare a cernes, met en rotation la came de rupture et Ie rotor du distribtlteur. Les contacts de rupture. s'ouvrent lorsqu'un bassage soulevale linguet de rupture at, pendant un laps de temps tres court, Ie circuit prima ire de la bobine se retrouve ouvert, Cette perturbation du champ maglletique IndlJitune tension de I'ordre de 250 V dans Ie bobirtage, primaire, convertie en plus de 20 000 V sur Ie secondaire.
\)4
ElectricUe automohiL~
Cette impulsion HT passe dans la borne centrale du dlsnibuteur, quil'erwoie vers une bougie d'allun;age.
4 - L'aUumage electronique
. En allumage electronique, il n'existe pratlquement pas de
montage de base paul/ant servlr de modele. Dans ret ouvrage, nous n'etudisrons done que les deux prineipes de base des allUrneurs electronlques.
Avec rupteu.r classique
Ce montage est juste une amelioration de I'allumage elassique, puisqu'iI permet d'envoyer des courants de forte intenslte dans Ie pnrnalra de la bobine (regime eleva du moteur) sans Ie rnolndrs risque de deterioration des contacts de ru pture (18 plus grande partie du courant passe darrs le transistor T).
_f_ BaUene
~
o 0 Di$bll.teur
Rupteuf
F-j,g .. 11 : Synoptique d'un allumeur alectronique a rupteur claselque.
95
L~allumage
Avec rupteur e/ectromagnef;que
Distributeur
a 0
c
o
a a
Fig .. 12 : Synoptique d'un allumeur IHectronlque a rupteur electromagnetique.
II se compose d'u n disque A mOr;Jte~ur l'.arbre de 1'.anum~iJr, Oe disque ferme periodiqueme~t Ie, CIrCUit . m~~ nettque d .un aimantperrnanent B. 'U 11 courant induit est r~uelili par la. bobine C qui en'loie ces impulsions vers .un boTtter ~lectrontql!Je O. Apres traitement, I'electronique d~lill~·\~,ten·sl.on HT qui sera aC.heminee vers la bougie via Ie dlstnbuteuf.
5 ... L'avance a l'aUumage.
Si les bougies ne produisaient les etincell.es. d:a~or9age de la combustion qU'unefoisque Ie piston aura attemt te PMH, ce dernier aura Ie temps d'amorcer sa desceote vers le PMB~va~t la detente des gaz et une perte de pu!ssar:i~. s'en ~UlVratt:
L'avanoe a: I'allurnage revlent done a generer I Impulsion ~T, par ouverture du circuit primaire d~ .1a boblne, ,ay~nt que Ie piston n'amve au PMH. Cette condition est satlsfalte par un positionnement aoenust de ta came de rupture par rapport au plateaU support des vis platlnees.
96
Electrioiti automobUe
,6 - Correcteurs d'avance a I'allumage A grande vitesse rnerne
I'allumage un piston 'pe t t. ~vec une avance initiale a
descente ~vant le debut dUe ,a t~ ndbre _ r~ PMH et arnorcer sa a corn uston.
En effat, i1 faudralt que raven I •
merna sens que la vitesse de oetaet.a I :"umage vane dans Ie
red . rorauon au moteur IPO
n ement en puiss-ance soit I , . . ur que Ie
e p us Important possible.
Correcteurs mecaniques
1 - Plateau fixe
2 - Plateau rnoblle
3 - Came de rupture
4 - Masselottes 5 - Ressort
Fig. 13 : Disposltif d'
, avance centrifuge a I'allumage.
97
L 'cJilumage
Un COfrecteur d'avance mecanique est caracterise par:
_ un plateaU fixe solidaire de \'arbre de I'allumeur: _ un plateau mobile portant ta carne de rupture.
A grande vitesse, les masselottes S'€!cartent saus I'effet de la lorce centrtfuge. Ie plateau mobile prend une avance sur Ie plateau fixe at les contacts de rupture s'ouvrent plus tot
Correcteurs it depression
1 Capsule
2 " Membrane elastique 3 - Vets carburateur
4· Ressort
5 - Tige de commande
{5 - Plateau 'Ills platinees
Fig. 14 : Oispositif d'avance a \'aUumage a depression.
98
EleClricile automobile
Le dispositlf de correction agit Sur Ie plateau SUpportanlles vis platinees. II est compose d'tJne capsule dlv;see en deux chambres par une membrane Ifllastrque dont Ie mouvement depend de la depresSion dans la tublliure d'admission (carbUrateur), elJe meme fonction de ~a vltessa et de la charge du vehicLlle.
Une ~ge metallique reliele plateau des vis platinees a la membrane elastique et assure Is correction de I'avance a I'allumage.
7 .. Depannage du circuit d'allumage
Avant de s'attaquer au circuit d'allumage, it est important de s'assurer que I'essence arrive au carbu~teur et que la batterie est suffisamment chargee.
Le tableau sllivant regroupe I'essentlel des pannes imputables au circuit d'allumage.
Panfle Origine
,
1 - Le rnoteur ne - Defaut dans Iss connexians
rourne pas I s'arrete sur batteries, contact, bobine,
Spontanement I I rupteur, fils.
, presente des rates - Sabine defectueuse.
a tous les regimes - Rupteur defecrueux.
(marche saccadee). ' - Condensateur en court-circuit .
- Grains des linguets piques all
encrasses. I. 'allumage
99
,I Panne Origine
1 - (suite) - Masse imparfaite de
, l'aUumeur.
I . - Cable bobine-distributeur mal
lsote. .
- C~bles distributeur-bougies
. mal isoles. _
I M Tete de distrtbuteur felee ou
humide.
2 - Le moteur a des rates - Tension du ressort dullnguet
mobile trap faible. ..
a regime eteve. - Ecart trap grand entre les VIS.
3 - Le moteur est bruyant. - Avance initiale trap impa.rtante. I
- Ressorts d'avance centnfuge
trap faibles.
- Correcteur d'avance a
depression defectueux.
I
j Le rnoteur chauffe at - Avance ,initiale trap faible ..
4- - Ressorts d'avance centrifuge
, manque de ,
trap forts.
puissance. . - BbUgies trap chaudes.
~
I - Distribution mal caiee.
5 - Le moteur ne part pas - Fils des bougies intervertis. ,
apres revision.
l:
100
Eleotricite automobile
Organigramme de test systematique
Le moteur ne part pas au
s'arrete brusquement.
Haute tension prssente sur Oui
les cables des bougies?
Non
Controler I'etat des
bougies.
Haute tension presente sur Oui
Ie secondaire de lla bobine?
Non ContrOler l'etat:
- du rotor du distributeur
-du charbon
I _ des cables
La rupture se produit Oui
correctement au primaire?
Non
Controler : Controler la bobine.
- vis platinees
- condensateur
- cables L'alillmage
lOt
7 ... 1 - Intervention sur la bobine
Une bobine peut etre affectse par les defauts suivants:
- enroulements coupes au en court-circuit;
- connexions encrassees, humides au endomrnaqees.
Pour tester une boblne, la faccn la plus pratique consiste 1I la rernplaeer par une neuve et, sl Ie moteur refuse toujours de tourner, la panneest a rechercher en amant (rupteur) au en aval (distrlbuteur, bougles). On peut aussl proceder comme suit:
- enlever Ie chapeau et Ie rotor du distrlbuteur ;
- mettre Ie cable d'arrlvee de la haute tension a 5 mm d'une
masse;
- fermer Ie contact general sans lancer le dernarreur i
- ecarter et relacher Ie Unguet mobile de rupture plusieurs
10'ls. de suite.
A
Masse
Batterie
Allumeur
Fig. 15 : Schema de test de la bobtne.
102
Electricite automobtl«
SI des enncelles eclatent en A, /a booine est en boo etat, sinon e:lle est a remplacer.
I
f I
I
!
I
7.2 ~ Intervention surl'allumeur (DELCO)
L'allumeur ou ostco peul presenter des dysfonctlonnernents au niveau du :
- rupteur (v,is platinees) ;
- condensateur .
- distributeur.
Test du rupteur (vis platinees)
Le ruptsur est sujet a :
- usure des pointes de contact;
- desaUgnement des pointes de contact ;
- tension lncorrecte du lil'lguet mobile;
- ecart des pointes de contact incorrect.
Des polntes de contact en bon etat et bien alignees sont de couleurgrls ardolse avec une marque au centre (iu contact plat.
Contact Contact convexe plat
MOIrque de contact
Fig. 16 : Les faces de contact des vis platinees.
L'allumag«
103
Si oette marque n'est pas au centre, les contacts sont desaligfles et la correction se faIt en tordantte contaot fixe (jamais Ie IInguet mobile) a l'aided'un outll approprie.
La tension du linguet sa rnesurs avec une balance a ressort, Cet outil donne la force (en Newton) necessalre pour ouvrir les contacts de rupture.
une tension plus grande que celie specifies par Ie constructeur retarde )'allumage et precipite l'usure des pointes de contact. Une tension trap faible provoque, a regime elevs, une rupture desordonnee, suite au flottement des pomtes : Ie vehicule epouse une marche saccadee.
Fig. 17 ; La balance it ressorl
La correction se fait par action sur la position du ressort du linguet par rapport a son pivot. On s'etaigne de eet axe pour a,ugmenter la tension et on s'en rapprccha pour la dirnlnuer (fig. 18).
L'ecart des polntes se rnesure et se corrige avec un compteurd'anglede saturation, avec OBLlGA'TIONDERESPECTER A LA L£TTRE LE$ INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR,
Une autre methode (approximative) consiste a tourner la came de rupture jusqu'a ce que Ie contact mobile atteigne son plus haut niveau (ecart maximum) ; on lnsere alors un calibre entre les polntes et on regie l'ecaTt par action sur Ie contact fixe. A Signaler que cette methode est deconseillee par tous les constructeurs.
104
Electricite automobile
L'allumage
tos
Le test consists a calculerla capacne nfleUe du condensateur et ~ la comparer avec celle don nee par Ie constructeur. " existe deux faQons d'operer :
-Ie calcul direct avec un capacimetre;
-Ie calcul indirect grace au montage suivant :
I
1-
l
4
1,: Vis de fixation; 2 - Vis de r8g18ge ; 3 - Ressort ; 4 -- Axe du mgu,et ; 5 - Lingual mobile; 6 - Pointe de linguet ; 7- Poin1e reglal3Je: 8 - Toucheau : 9 ~ Came de rupture.
Fig. 18 : Structure des pOintes de rupture,
c=
21tfU
I :'Intensile mesurea a l'amperemetre alternatrf. U: Tension rnesuree au vottrnetre altematif.
r : F.fequence de la tension de test.
Un condensateur detectueux ne peut etre que rernplace.
Test du condensateur
Un condensateur peut etre suJet a :
Te-st du distributeur
- un oourt-clrcuit
- un circuit ouvert;
- una diminution de .la capactte par vieHlissement du
condensateur.
Le distributeur n'ay,ant pour rote que de vehiculer la haute tension qui arrive sur sa borne centrale vers tes dlfferentes bougies, ses defaillances S6 resument en :
_ absence de liaison entre Ie rotor et la borne centrale;
_ absence de liaison entre Ie rotor et tes plots des barnes periph8riques.
Un court-circultdu.condansatsur asta suspectersi lemoteur ne peut demarrer suite a "absence de rupture au niveau de la tension prirnalre de la bobine. Le circuit ouvert et fa diminution de la capaclte par vieil1issement se repercutsnt sur l'etat des vis platlnees (usura trap rapide).
La test est done en grande partie visuel et consiste a contrOler l'etat du charbon, du ressort, du bras du rotor et des plots des bornes peript;,eriques.
1~6
Electricite automobile
7.3 -Intervention sur les bougies
L'apparence d'une bougie revet One importance capita Ie, aussi bien pour son propre etat de fonctionnement que celul du moteuren general.
Des electrodes et un bout d'isolant de couleur brun clair indiquent une bougie qui "respire la sante", Une couleur blanchatre au gris ciair indique un melange trQP pauvre. Un depOt nolratrs indique un melange trap riche (usage abusif du starter ou dereglage d u ca rburateu r). Un encrassement notratre et charbonneux est synonyme d'un exces d'huile brOlee,
Avant d'accabler une bougie de la respcnsabulte des problernes d'allumage, il est corrseille de faire Ie test sulvant
1 ~ dsbrancher les cables des bougles ; 2 - les mattre a 5 mm d'une masse;
3 - 'lancer Ie moteur au dernarreur,
Fig. 19 : 'Montage de test des bougies.
Une bougie n'est defectueuse que sl Ie cable qui lUi est associe produit des etincelles en A lars du test
107
L'alZ.umage
Les carences que peut presenter une bougi.e sont : _ trop grand scart entre les electrodes,
_ encrassemeni dll a I'huile €it au carburant.
L'interventlon suit'le cheminement suiVclnt : . b 'f-
. _ nettoyer tes electrodes et Le culot avec du papier a rasr ,
_ les plonger dans un bain d'essence ;
_ laisser secner ; . . _ rectifier avec une 'Petl~e lime lJelectrod~ ~e m?5Se , _ verifier !'ecart entre 4195 electrode~, a I a.lde d un [eu
de eales d'epaisseur, et rectifier ~1 besom.
Remarques : eta _ Une bougie dont les electrodes sont endommag es es
remplacer. k
_ Les bougies sont a remplacer taus les 15 OO~ m. ,
_ Avant de les remonter, enduire,Ie filetage dune gralsse
graphite (ne jamais utiliser d'hulle).
7.4 - Calage de l'aUumage
L I ge de l'allumage est I'oparation quic6nsiste a fagler
e ?a as de contact du rupteur, de telle fa~on que j'etince!le
:~~~:~: bon moment, entre les electrodes de la bonne bougie.
Lapremtere etape dans Ie calage de I'allumage consist~ a
'" d'· r jusqu'a oe que Ie repere
tourner Ie moteur, sans Ie ema~e ~ .
mobile de reglage Salt en1ace d un ,Index fixe.
Le repere mobile est sltue, selon les modeles, sur la poulie en bout de ,vilebrequln en avant du moteur, sur Ie \lOl?nt ~otellr
dumper en bout de vHebrequln. Le repere rxe se ou sur un
trouve sur Ie bloc cyllndres ou sur le carter.
108
Electriclle automobtle
Fig. 20 : Repere mobile sur poulie en bout de vIlebrequin.
Fig. 21 : Repsre mobile sur volant moteur.
109
Damper
Pouliede v!lebrequln
Fig. 22: Rapere mcbitesur dumper.
Pourtourner un moteur sans Ie darnarrer, trois cas de figure peuvent S9 presenter:
1 - transmission automatique : tourner avec une cle Ie
boulon de oiocaqe de la poulie en bout de vilebrequin ·81 ce boulon n'est pas accessible, donner de brefs coups de oemarreurn, apres avoir dabrancne l'un des fils de la bobine et mls la bofte de Vitesse en position neutre.
2 - transmission manuelle : reprendre la demarche precedents ou pousser sur la roue du venicule.
3 - forte cyJindree : dernonter les bougies et tourner Ie vilebrequin ell la main.
La deuxlerne etape concerne les reglages electriques.
Ells s'exscute, rnoteur a "arret, ell "aided'une lampe temotn places entre la masse du vehicule et la borne marquee «RUP) ou {(-'» de la babine. La procedure de reglage est la selvante :
I I
110
Etectricite automobile
1 - desserrer avec une ciS- ,plate l'ecrou bloquant rernbase de t'allurrteur; juste assez pour qu'il tOlLlme librement ;
2 - tourner Ie corps de I'allumeur, dans Ie sens de rotation
du doigt eu rupteur, en Ie tenant solidernent par la capsule Ch apitre 7 a depression, jusqu'a obtention du point exact de
basculement extinction/aJlumage de la lampe temoin: 3 - resserrer l'ernbase de l'allumeur (DELCO).
~
I:
7.5 - Reglage de ('avance a I'allumage
Le manque de puissance sur un vehicule peut etre attribue ell une trap Faible avance a I'allumage, de rnsrne qu'une avance trap grande se traduit par des cliquetis (moteur bruyant).
.1
Dans l'operafion de calage de d'allurnaqe, nous avons vu que la prerntsre etape consistait a aligner deux reperes en face I'un de I'autre.
Pour reoulre au augmenter I'avance a I'allumage,il suffit done de mettre Ie repers mobile de quelques degres (2 au 3 au maximum) en avance au en retard sur I'index fixe et de refaire Ie calage dell'allu:r:nage.
L'eclairage automobile
1 _ Propagation de la lumiere
Parent latumiere S8 Dans un milie{] homogene et trans .
propage.en ligne droite.
bl de refl9chir de la
On appelle miroir tout corps capa e -
lumiere.
. . \an est refleeh1 Un faisceau lumi)1eux qui ren:o~tre un mlrOlf P
I Onal a celui de l'lncldence. sous unang e '"'::I
Falsceall incident
Falsceau reflech~
Mlroir
F. t : R s; fle)(ion de la lumiere par un rnirolr plan. Ig .. ~
112
Elec/ricite aUlOl1'Iobile
?~appeJle paraboie toute cou
eq~!d!stants d'l:m point fixe a. rbe dont les points sent drolte directriee. Ppele FOYER et d'une drolte dfte
p
x'
x
o
Fig. 2 : La P8r'ahole.
F : Foyer
A : droite directrice xx' : axe de la parabo/e
p'. . •.
. prcJecuon orthogonale de M sur (£\)
Un faisceau lumineux dont la s .
parabolique est refleehi parallel ouree ~st Ie foyer d'un miro;r
. ement a r axe de la para bole.
Fig. 3 : RefJexion par u .'.
d'un fai n mlrOJr parabolique
scea~ lumlneux dant la source est au oyer de Is parabole.
L 'ec1aiFage automobile
113
2 - L'eclairage automobile
La lumiare amise par un projecteur d'automobile dolt ectalrer la route et Ie bas cOte, suffisammellt loin davant Ie conducteur, pour que ee demier vole tous les obstacles qui se dressent sur la route assez tOt pour les (Niter, mais II ne raut pas non plus que I'intensne de eet eclairage gll:!ne las autres automobilistes.
Lalreglementation en matiere d'ecIairage.automobile exige la presence, sur tous res vehicules, de deux types de faisceaux d'eclairage :
- I'ecfairage route: utilise quand la vole est degagee dans lies deux sens de la circulation. " est caractertse par un { faisceau de trss forte intensite.
- I'ec/airage code: utilise en presence de plusieurs usagers sur la route. Cet eclairage, aussl dit de craisement, doit reveler au conducteur tous les obstacles sur une distance de 25 a 80 metres devant lui, sans pour autant eblouir un conducteur situe a la limite de ce champ (80 metres).
3 - Les projecteurs
Un projecteur d'automobile est I.e dlspositif qui permet I'eciairage sur la route d'un veniculs, " est essentieuernent compose de:
- un bloc optique : comporte un miroir parabolique, Une glace et un porte-lampe. Les trois elem~nts sont maintenus ensemble par une porte (enjo_liveur) fixee· au cuvelage.
114
Electrlclte automobile
- une lampe: de formes et de tailles dlverses, c'est elle la source lumineuse.
- un connecteur : reille la lampe au circuit electrique du vehicule.
- un cuve.lage : encastre dans la carrosserie et supporte Ie bloc optique.
Lampe Porte-lampa Mlralr Coimooleur CWelage
Fig. 4: Vue eclatee d'un projecteur.
4 .. Leslampes
L~ lam pes utilisees en eclpilCilge autbmobile sont de 2 types :
- les ram pes a incandescence;
-Ies lam pes a haloqenes.
4.1 - Les lam pes a incandescence
Un filament en tungstene,lporte a incandescence par passage d'un courant. constitue I'essentiel d'une lampe a incandescence.
L 'ec/airage automobile
115
1950
3 boss~g~
de posil'onnement
Bar tie de mBSse
Ba~tette de connexion dU 'faisceau cia croiselTlenr
Fig.5: Structure d'une lampe route-code a incandescence.
Fig. 6 : Structure d'une lampe route-codea halogime.
U6
Electric ile tltfl(JJjlQblle
L 'eclail'age automobile
117
4.2 - Les lampes a halogenes
La partitularlte de ces lampes reside dans I'emplol de gaz rares de la ,famille des h?llogenes (brame. fluor, lode) pour Ie
remplissage de I'ampoule.
Dans unelampe a incandescence classique, lEI tUngstene se vaporise et constdue, along terme, una oouche sombre sur Ie verre de I'ampoule. Cette vaporisation du tunqstene reduit 18 duree de vie de la lampe at la couche sombre qu'elle entraine
attenue son ec~airerilent.
Qu'elle soit a tncsndescence ou a haloqene, une lampe ,out~-code comporte deux filaments, utilises, I'un pour I ecl;:lIrage route et "autre pour I'eclairage code
Le filament route est en forme de V,alars que Ie filament code, contenu dans une coupelle, est rectl!igne et se trouve en avant et legerement sureleve par rapport au filament route.
Plus petites et plus robustes, les larnpes a halogitln8 Qffrent aussi des performanoes d'eclalrement nettement superleures a celles des lam pes a incandescence.
4.4 - Le chemin optique du fatsceau route
Dans une lampe a halogenes, Ie tungstene, en se vsportsant, se combine au gaz haloQene rsnterrne dans rarnpoule pour former une molecule instable qt:ll, au contactdu filament, se decompose pour y deposer Ie tungstene.
Lalarmpe route-code est placee dans Ie bloc optique, de telle 50~e que ~e r:'ament route cotneide avec Ie foyer du rniroir parabollque. Amsi place, la portee du faisceau est maximale car tou.s les rayons sont reflechis parallelernent a I'ax~ parsbolloue.
4.5 -Le chemin optique du fafsceau code
4.3 - La lampe route-code
1 • Filament route 2 - Filament code
3 - Coupelle metalique
4 - Connexlon foul 5 • Conns)(IOIl cod 6- masse
M : Miroir parabolique C: Coupelle
S : Source (fllamenl)
F : Foyer dela parabole
Fig. 1 : Structure d'une lampe route.(lO ,
Fig. 8: Reflexlon par un miroir parabolique d'un faisceau lumlneux dont Ja source est en avant du foyer de fa parabole.
118
L 'eclairage automobile
119
Les feux cllqnotants sont utilises pour rndiquer aux autres usaqers de Iia route que Pan s'apprete a prendre Ie prochain Vlrage. Us sont au. nombre de quatre (2 a I'avant, 2 a l'arriere) et sont commandes par un bottler dit centrale clignotante.
Electricite automobile
Lefi lament est place en avant du foyer du miroir parabolique; position qui, cornblnee a I'ouverture de la coupells, oriente le faisceau vers Ie bas.
6 - Les feux clignotants
La forme du faisceau code depend de I'angle d'ouverture de la coupelle.
OUVertUr:8 0) 195' :;- __ ___::~~~~~::=====~;;;:
AVG
Fig. 9 : Aspect du faisceau code- en Ionctlcn de l'ouverturade la coupe'lle.
Les lam pes a coupelle ell 1950 permettent une coupure nette du faisceau sur Ie cOte gauche at une meilleure visibllite sur Ie cote droit.
5 - Les projecteurs antibrouiUard
Les projecteurs antibrouillard sont utillses, comme leunnorn I'indlque, lorsque Ie brouillard g~ne Iavislbilite. En effet, les gouttelettes d'eau dont est constitua 'Ie brouillard devient !e faisceau tumlneux et rendent impossible "evaluation correcte de la position d'un obstacle sur la route.
ARG
AVG : Avant Gauche TG: Ternom Gauche ARG : Arriare Gauche
AVD : Avant Dioit TO : remain Droit ARD : Amers Droit
Les projecteurs antibrouillard sent des projecteurs a coupure exfrernemant nette, places trss bas et regles paraltslernent a la route.
AVD
TO
ARD
Fig. 10 :Synoptique d'une centrale clignotante.
L20
Ele 'Iricite automobile
La centrale anume les cllgnotants avant gauche et arriere gauohe pour signaler un vlrage ~ gauche, Pour un virage a droite, ce sent les clignotants avant droit et arrisre droit qui sonl rnls sous tension.
Ces centrales, de plus en plus electronlques, offrent d'autres options telles que Ie signal de (Jetresse (Ies quatre lampes chgn~tent en meme temps) et Ie changement de la frequence de clignoternent lorsque l'une des Iarnpes est encomrnaqee {frequ ence normale - 80 a 1 DO dig notemen ts pa r min LJ te).
7 - L'eclairage du tableau de bard et de l'habltacla
Une ou plusieurs petites lampes placee(s) derriere Ie tableau de bard diffuse(nt) suffisamment de lurniere pour eclairer les outils de contrOle et de commande du tableau.
L'eclairage de I'habftacle est assure par de petites lampes sur les montants des portieres el qui s'allument lorsqus ces dernieres s'ouvrent. On trouve aussi une lampe de plafond munie d'un interrupteur de mise SOUs tension,
8 ... Reglage des projecteurs
Le bloc optique d'un projecteur est fixe' au cuverage par trots points, dont deux au mains sont mobiles et permettent la correction de I'assiette du projecteur et la direction du faisceaulumineux.
~L 'eclal~age automobile
121
z
Zo'
x
t I t
t
u : angle de correction de 'a direction du falsceau par rotation auteur de- "axe Oz.
~ : angle de correction de l'assiette du projeaeur par rotation auteur de "axe Oy.
8.1 -Reglage sans equipement
Tout ce dont on a besoir- pour effectuer .ces reglages est une surface horizontale plane et un rnur qui lui est Ie plus perpendiculaire possible (un garage reoond asse.z bien a ces exlgences).
On trace sur Ie 501 deux bandes paralleles, droites et separses par une distance egate a cede entre les roues avant (au arrlere),
Fig. 11 : Principe de reglage des projecteurs.
122
Hlectricite aUlomohi le
On place Ie vehicule sur ces bandes en prenant soin de positionner son axe Ie plus parallelement possible aces dernleres.
Connsissant la position des projecteurs par rapport au sol, et la distance qui les separe (donnees par Ie constructeur), on trace, sur Ie rnur; les centres theortques des faisceaux route.
H
till _ ~
L
H : hauteur Ipar rapport a I'horizontale. L ; espace inter-projecteurs.
Fig. 12 : Reglsge des proje<:teurs.
APres stetre assure que les pn.eumatiques sont a la bonne tension et que Ie vehicule n'est pas charge, an allume Ie faisceau route et on verlfie sa positlon par rapport au centre theortque trace sur Ie rnur; La correction se fait par action sur les vis de reglage horizontal et vertical.
Vis de reglage vertical
" .
Vis de n~glage horizontal
Ag.13 : Reglage des projecteul'S.
L'ecillirage automobile
123
8.2 .. Regl'age au regloscope
Fig. 14 : La nigloscope at Ie luxmetre.
La regloscope ~st un appareil optique qui permet un reglage ext~mement precls et fiable des projecteufS d'eclairage.
Faisceau theorlque Ecran fictif
t }_.PP-- -
-1 \ \
J
I='lg. 15 :Prlncipe de fonctionnementdu regloscope.
124
Electl'iciJe automobile
Le contrOle s'effectue projecteur par projecteur et est toujours pr~€!de par la v~rificatlon de la charge cu vehicute et de la tension des pneus.
La procedure de reglage suit Ie chemlnement suivant :
1 - placer Ie reglascope sur I'echelle de mesure du faisceau route ,
2· placer la lentille du regloscape Ie plus pres possible du projeoteur et essayer.de confondre I'axe de cette lentitle avec celui de la glace (repere grace aux rayures sur la glace) ;
3 - reculer Ie reglosoope de 50 em et parfalre Palignement ; 4 - allumer lefaisceau route. La grande echeue du tuxmetre devrait sublr une deviation maximale et sortir de Ia zone ROUGE~
5 -agir sur la vis de reglage de direction pour avoir la plus grande deviation possible;
6 - si, lers ,des etapes 4 et 5, "aiguilJe de deviation du luxmetre ne sort pas de la zone ROUGE, vertifier "etat de charge de la batterie, I'usure du miroir parabolique au, a defaut d'arguments, changer la lampe;
7 - passer en faisceau code;
8 - activer "echelle de mesure du taisceau code (petite ecnelte) ;
9 -Ia deviation ne doit jamais entrer dans la zone rouge de la pdtlte echelle ;
'eciairage automobile
125
10 _ par actjon sut la vis de reglage vertical, r'e~ler ta coupure du falsceau lurnlneux de sorte qu'elle soit paral1~le (au confOndue) a Sa coupure de I'eeran du REGLOSCOPE.
Faisceau code
Faisceauroute
Fig. 16: positionnement des faisceaux d'eclairage sur I'ecran du regloscope.
Chapitre 8
Les accessoires
1 - La plancha de bord
La planche de bard, aussi designee par tableau de bord au combine d'instruments, est un ensemble d'outlls permettant au conoucteur de controler, tlI tout instant, l'etat de fonctionnement de son lJehit:ule.
Une planche de bard est generalement eornposee de :
- un lndlcateur de vltesse ;
- un compteur kilome'trique au odornetrs :
- un indieat:eur de nlveau de carburant;
- un indtcateur de hiveau d'huile ;
- un Indicateur de pression dfhtlife :
- une mantra ;
- diversss lampes tl!moins (altemateur, clignotant, etc.),
1.1 - Depose de la planche de bord
Certaines interventions exigeantla depose de la planehs de bord, la demarche ell suivre lors de cetre operation est la suivante :
128
Eler:tf'icite automobile
1 - V;sJere
2 - Platfna support 3 - Circuit imprlme 4 - Compte-tours 5 - Tachy:melre
6 - Transmetteur de lachymetre
7 - ifhermometre d'eau a - Montre
9 ~ Jauge d'ess...<>nce 1 0 - Bloc de controle 11 - StabiUsateur
,Fig. 1 : Eclate d'un tableau de baret
Us accessoires
129
- debrancner la bome negative de la batterie ;
- extraire Ie volant de direction (sur certains modeles de
vehicules, il soffit de Ie basculervers sa position basse);
- extralre la visiere, en introduisant un totJmevis de diarnetre adequat dansles fentes laterales prevues a cet effet. (Cette etape est quelque fois precedee par la depose du cache plastique autourde la visiere) ;
- degager Ie combine d'jnstruments en Ie tirant vers soi et en prenant bien soin de debrancher les connexlons electriques et Ie cable du tachymetre,
1.2 - L"indicateur de vitesse
L'indicatetlf de vitesse est compose d'un taehyrnetre qui donne la vitesse instantanee du vehlcule et d'un odometre.qul camptabilisela distance parcourue par Ie venlcule.
Uri cable flexible. relie a la eotte de vitesse, imprime un mouvement rotatlf a un axe s6lidaire d'un amant permanent Le courant ainsi indult cree un champ rnagnstlque qui exerce une force sur Ilaiguille de I'lndicateur de vitesse. La force exercse est de module propornonnel alia vitesse du vehicule. Un ressort de rappel rarnene I'aigullle ell la position 0 (zero) lorsque la volture est a l'arret,
le rnerne axe entraine dans son mouvement, grace a un jeu d'engrenages, un systerne de roues permettant Ie compte de la distance parcourue par Ie vehicute. Ce systerne di ODOMETRE est concu de sorte qu'une roue tourne de 36° lorsquecelle se trouvant a sa droite effeotue un tour camplet.
Le defaut Ie plus frequent sur cet ensemble est relatif au cable flexible (rupture, desengaqernent). On remplace a ]'identique et l'operation exige la depose de la planche de bordo
'130
Eleclricite automobile
Fig. 2 : Disposjtion des roues de I'odometre.
1.3 - lndicateur de niveau de carburant
L'indlcateur de niveau de carburant est constitue de deux blocs irnplantes l'un dans Ie reservoir etl'autre dans la planche de bard.
L~
Reservoir
.L Contact ± Batterie
..
I'
Fig. 3 : Indicateur de niveau d'essence.
,
Au niveau du reservoir, un flottBur plonge plus ou mains
profondement, selon Ie volume de carburant disponibla.
Les accessoires
131
Ce mouvement du floUeur entrafne celul d'une resistance variable R. Selon la valeur de eet angle de rotation, Ie rappel a la masse du circuit des electroaimants L1et L2 change et une fbrce slectromagnetique est exercas, dans un sens au I'autre, surl'.aiguille de I'indlcateur de la planche de bard.
1.4 -Indicateur de la pression d'huile
Le circuit indlcateur de la pression d'huile est tres proche de celui du niveau de carburant. En effet, Iia difference entre las deux reside au niveau de la resistance de rappel a la masse I!:lu circuit des electroaiman(s.
_L
...L ...J:...
•
Fig. 4 : Indicateur de pression d'hulle.
Une membrane flexible S8 defame saus I'effet de la epression de I'huile, ee qui entratne fa rotation, par rapport ill on 8Ke, du contact mobile de la resistance variable.
I I I
I
1'32
Eleclridte automobile
1.5 _ tndlcateur de la temperature de I'eau
L'indlcateur de la temperature de I'eau dans 1~5 chernis~s du systerne de refroidissement utilise une resls~nce. dlte THERMISTANCE. dont la valeur change en fbnctlon de la
temperature.
2 - Les Klaxons
UnKlaxon est un avertisseur sonore qui parrnet Ia production de sons pour avertir les autres automobi~istes des eventuels nsques d'accidents (crois~mentdans un Vlrag~ de montagne). II en existe plusieurs types, rnais nous ne ~resenterons dans cet ouvrage que les Klaxons electromagnetlques.
A
x
L
K
Fig. 5 : Schema de principe d'un Klaxon.
Les accessoires
133
rnitialement. Ie contact Kest feli1TIe. A la mise sous tension de 113 bobine L, Ie champ magnetique attire la lame A qui, dans son mouvement de rotation auteur de "articulation X, ouvre Ie contact K. La bobine n'etant plus anmentee, la lame A revlent e sa position de repos, ce qui ferme a nouveau Ie contactK et Ie cycle recommence.
une membrane mstalllque Best couplee a Ia lame A et subit un mouvement vibratoire tradu it a la sortie .des trornpes aooustiq ues C par des variations de la pression de l'air et done production dun signal sonore.
3 - Les essuie-glaces
Unessuie-glace a pour role prlnclpa' d'assurer une bonne visibilite sous la pluie.Les gouttelettes d'eau, en s'amassant sur Ie pare-brtse, genent Ie conducteur et limitent son champ de vlston J ce qu i rend lieu r elTrmination plus qu'indispensa.ble si I on veut eviter I'irreparable.
Un essule-qlace est essentiellement compose d'un moteur slectrlque, d'un bras et d'une raclette: Le mouvement de gauche o droite .du bras at de la raclette est assure par Ie moteur ('Iedtrique via un dispositif rnecaniqua de conversion de rnouvernsnt.
B
Fig. 6 : M~c~ni9me·d'esSuie.glace.
Eleci,. idll automobile
134
Dans son mouvement de rotation, Ie moteur lmprime un mouvement de va-et-vient a Ie fourchette F (Fig. 6) autour de I'axe X. Une bielle B, amculee a I'extremite ~bre d,e la fourchette. communique ce mouvement au bras de 1 essule-glace et a la
raclette.
1 - Moteur
2 - Support mecanisme 3 - Bielle d'entrainement
4 - Tringles 5 - Bras
6 - Raclette
Fig. 7 : Eclat9 d'un essuie-glace.
Les accessoires
135
4 - Les lave-glaces
Un lave-qlaee facllite Ie travail d'un essuie-glace lorsque Ie pare-brise est rempli de bOUB, Son rOle est dane de prajeter de I'eau sur Ie pare-brise pour diluer les saletes qu i y siegent. II se compose d'un moteur electrtque qui commande IlJne turbine places dans Ie reservoir d'eau.
5 - Les leve-glaces
Un leve-glace est compose d'un moteur electrique, d'un circuit de commands du sens de rotation et d'un dispositif de coupure de Paliri:)!lntation du meteor en fin de course.
Fig. 8 : Mecanlsm.e d'unl~ve-glace.
Lorsque l'interrupteurest en position "O",1"e rnoteur electrique n'est pas ali mente et ne toume done pas.
Interrupteur en position 1, la borne A du moteur est rellee au plus (+) de 18 battene et la bobine B alia masse,
Jnterrupteur en posttion 2, la borne A du mateur est rellee a la masse et la borne B au plus (+) de la batterie.
136
Ei~ctricite aulomobilr!
En fin de course, Ie courant qui circule dans Ie moteur augmente; Ie thermoeontact ehaLlffe par effet Joule et coupe
l'alimentatioJ1.
6 - Le chauffage de la lunette arrlere
La lunette arriere est la grande glacearrlere qui perm.et au eonducteur de voir ee qui se passe juste derriere son vehleule.
En hiver et par temps de froid, la difference de temp'er~ture del'air entre l'interieur et \'exterieur du "shieule, recouvre les vitres d'une buse qui smpeche une visibili1e correcte.
Cette cuee, peu genante sur les vitres laterale~ et suppnrnee du pare-brise par tes essuie-glaces, pose l:jlil seneu)( probleme
sur la lunette arriere.
Fil resistant
I
Glace
I
I
I
Fig. 9 : Chauffage dela lunette arriere.
Les accessoires
I 7
La parade a cet etat de fait reside dans I'implantatlon sur I. surface de cette glace de resistances chauffantas sous form de fils fins at paralleles.
7 .. La boite it fuslbles
Fusible est un motqul quaUfle tout objet susceptible de fondre. Fusible est aussl le nom d'un cornposant electriqUe qui fond lorsqu'll est traverse par un courant de forte intensit6. C'e un dispositlf de protection centre les surinterrsites.
La majorite des montages electriques et eleetronlqu 8 oomportent des fusibles, On les retrouve dans les circuit d'eclairage, de leve-'Vitre, de climatlsatlon, de planche de bord, de pompe a injection. etc.
Un .fusible est caractertse par deux grandeurs: la tension et l'lntenslte de fusion. On ne peut done remplacer un fusible que par son identique
La boite a fusibles.reunit tous les fusiblss du vehicule et s trouve, selonles rnodeles, dans ia doublure d'aile avant gauch I a gauche du compartiment auvent au sous 1"'1 plancha de bard. Elle content entre 14 et 25 fusibles et p;:jrfol_s merne quelq usauns de rechange.
,Les fusibles etant des elements de protection Us sont dono
. '
les premiers a suspecter en cas de panne du vehicule. Avant
de rem placer un fusible, n taut toujours bien lire sa tension t son intensite de fusion et de ME JAMAIS COURT-CIRCUITER SES BDRNES par du papier aluminium.
138
Electricile aulqIIWbile
8 - La c'limatisation
Par clirnatlsation, on entend Ie chauffage de I'interieur du vehiClile lorsqu'il fait froid et son rafratchissement par un temps de chaleur. UI;J climatiseur comporte done deux blocs: un bloc pour rechauffer I'alr et un autre' pour re refro1dir,
La climatisationd'hiver -cornporte un moteur eJectrlque entraTnant un ventilateur. L'air froid aspire par ce darnier est rechauffe-au contact du radiateur, puis fadirige vers I'interieur
de I'habltacle.
Fig. 10 : Prin,clpe de la cUmatisation d'hiver.
Les accessoires
La climatlsatlon d'ete est basee sur Ie refroidls8 m nl f'air au contact d'un circuit de canatlsatlon, au ciroul un refrigerant dit FREON.
Le dispcsltif de climatisation d'ete cornprand U 1 compresseur qui fixe la temperature d'ebuilltion du -r on II valiant sa pression. A grande pression, Ie Freon sa r~oh u
et passe a "etat gazeux (9 froid, lie Freon est liquide). C
est ensuite envoye dans Ie circuit de canallsaton, 00 il s d t ntl at passe a lletat liquide. Ce changement d'etat s'accornp n par I'absorption de la chaleur de I'air arnblant, Cet air ,refrol I est ensuite red,irige vers I'interieur de I'habitacle p r un ventilateur.
hcute preUlon
bane preuion
Fig. 11 : Principe de la climaUsation d'et6.
D. BENABDL"S$ELAM
Vous aimerez peut-être aussi
- MECANIQUE AUTOMOBILE - Débutant PDFDocument126 pagesMECANIQUE AUTOMOBILE - Débutant PDFIkeo95% (41)
- Les Differents Systemes D'un Vehicule ProfDocument9 pagesLes Differents Systemes D'un Vehicule Profapi-3764092100% (21)
- Technologie Fonctionnelle de L'automobile - Tome 1Document301 pagesTechnologie Fonctionnelle de L'automobile - Tome 1Nicola Vitulli82% (11)
- Cours Mecanique AutoDocument78 pagesCours Mecanique AutoAkram Ferchichi100% (38)
- Électrotechnique | Pas à Pas: Bases, composants & circuits expliqués pour les débutantsD'EverandÉlectrotechnique | Pas à Pas: Bases, composants & circuits expliqués pour les débutantsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Technologie AutomobileDocument40 pagesTechnologie AutomobileElie Kahamba88% (32)
- Montage Et Démontage MoteurDocument14 pagesMontage Et Démontage Moteursouissia90% (31)
- Lautomobile Pour Tous Entetien Et Dépannage Pas À Pas - Bruno CollombDocument223 pagesLautomobile Pour Tous Entetien Et Dépannage Pas À Pas - Bruno CollombNadonio Boubou100% (2)
- Cours Redressement Non CommandéDocument8 pagesCours Redressement Non CommandéOualid Zaouich71% (7)
- Hubert Mèmeteau-Technologie Fonctionnelle de Automobile. Tome 2, La Transmission, Le Freinage, La Tenue de Route Et Équipement Électrique by DiagnoFAST - Com (2014)Document316 pagesHubert Mèmeteau-Technologie Fonctionnelle de Automobile. Tome 2, La Transmission, Le Freinage, La Tenue de Route Et Équipement Électrique by DiagnoFAST - Com (2014)Ahcene Zerarak100% (2)
- Bases de L'électricité - AutomobileDocument8 pagesBases de L'électricité - AutomobileAyb Cha Kri92% (13)
- Cours de Technologie AutomobileDocument61 pagesCours de Technologie Automobilecheefenger87% (23)
- Mecatronique D'automobileDocument80 pagesMecatronique D'automobilePanneau solaire100% (26)
- Cours InjectionDocument21 pagesCours InjectionRachid Amansag90% (21)
- Cours Mécanique AutomobileDocument242 pagesCours Mécanique AutomobileHind Moukhafi100% (7)
- Generalites Du MoteurDocument24 pagesGeneralites Du MoteurZied Ktari100% (8)
- Electricité Industriel de BaseDocument54 pagesElectricité Industriel de BaseKhalid Tami67% (3)
- Je M Exerce PDFDocument208 pagesJe M Exerce PDFdwalhin100% (1)
- CAPTEURS Capteurs AutomobileDocument33 pagesCAPTEURS Capteurs AutomobileMouncef El Marghichi100% (4)
- 3-Cahier Technique Automobile - Electricité T1Document36 pages3-Cahier Technique Automobile - Electricité T1Aboukikiss KikissPas encore d'évaluation
- Moteur Et AuxiliairesDocument16 pagesMoteur Et AuxiliairesDany Izi0% (1)
- Manuel de Reparation 21214 36Document218 pagesManuel de Reparation 21214 36jcfmhery100% (15)
- E-Book Devenir Technicien en Diagnostic Et Maintenance AutomobileDocument53 pagesE-Book Devenir Technicien en Diagnostic Et Maintenance AutomobileEdidjo Darwin75% (4)
- Electronique Aplliquée Au MoteurDocument38 pagesElectronique Aplliquée Au Moteurschwarzuma100% (12)
- Moteur Diesel. Caractéristiques. GénéralitésDocument26 pagesMoteur Diesel. Caractéristiques. Généralitésapi-376711685% (13)
- Les Systemes D'allumage Des Moteurs Essence.Document36 pagesLes Systemes D'allumage Des Moteurs Essence.mechergui100% (8)
- Expertise Du Moteur ThermiqueDocument38 pagesExpertise Du Moteur Thermiquehamidoun1292% (13)
- Electricité Automobile - Électronique AutomobileDocument48 pagesElectricité Automobile - Électronique AutomobileHakim Hachemi100% (2)
- Electronique AutomobileDocument8 pagesElectronique AutomobileSaid Gahi100% (1)
- Initiation AutomobileDocument104 pagesInitiation Automobilesocoban100% (5)
- Injection DiaporamaDocument16 pagesInjection Diaporamaapi-376409295% (19)
- Constitution MoteurDocument21 pagesConstitution MoteurMounir Frija100% (12)
- Guide Verification MecaniqueDocument158 pagesGuide Verification Mecaniquemilou88Pas encore d'évaluation
- L' Injection électronique: Tutoriel et GuideD'EverandL' Injection électronique: Tutoriel et GuideÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Conception automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandConception automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Transformateur À Semi-Conducteurs: Révolutionner le réseau électrique pour la qualité de l'électricité et l'efficacité énergétiqueD'EverandTransformateur À Semi-Conducteurs: Révolutionner le réseau électrique pour la qualité de l'électricité et l'efficacité énergétiquePas encore d'évaluation
- Analyse Des Circuits Électronique AnalogiqueDocument64 pagesAnalyse Des Circuits Électronique Analogiqueayoub chhahPas encore d'évaluation
- Notion D'ElectroniqueDocument15 pagesNotion D'ElectroniqueLivre techniquePas encore d'évaluation
- Electricite 1Document53 pagesElectricite 1abderazak_2008Pas encore d'évaluation
- Cours Electronique de Base, AMGHAR KamalDocument34 pagesCours Electronique de Base, AMGHAR KamalKhouloud BenjaddaPas encore d'évaluation
- Commande Electronique Des Machines ElectriquesDocument28 pagesCommande Electronique Des Machines ElectriqueshassenbbPas encore d'évaluation
- Cours D'électricité 1Document46 pagesCours D'électricité 1Salah Samih100% (1)
- TP Electronique REDRESSEMENT FILTRAGE Par Armel-Sitou AfanouDocument11 pagesTP Electronique REDRESSEMENT FILTRAGE Par Armel-Sitou Afanouarmel-afanou-793886% (37)
- 1 EEP - GM 2020 - Chap1&2 PDFDocument30 pages1 EEP - GM 2020 - Chap1&2 PDFO ZPas encore d'évaluation
- M11 Electronique de BaseDocument20 pagesM11 Electronique de Baseredouanekhasmi20Pas encore d'évaluation
- Chapitre 01 Généralités Sur L'électricitéDocument8 pagesChapitre 01 Généralités Sur L'électricitéRano RaniaPas encore d'évaluation
- Chap 07 - Les Circuits A Courant Continu DiaposDocument10 pagesChap 07 - Les Circuits A Courant Continu Diaposluffycapitaine0221Pas encore d'évaluation
- Exercice Esa PDFDocument53 pagesExercice Esa PDFAnonymous z1YdjrQt7Q50% (2)
- Chapitre 1 - Electricté Générale en Régime VariableDocument7 pagesChapitre 1 - Electricté Générale en Régime Variableleemax_83Pas encore d'évaluation
- TD1 - Montage Redresseur Parallele Simple TriphaseDocument2 pagesTD1 - Montage Redresseur Parallele Simple Triphasetoufik7toto100% (1)
- Cours Rappels D'électroniqueDocument32 pagesCours Rappels D'électroniqueelhassan aboulkhair100% (2)
- Projet D'électroniqueDocument11 pagesProjet D'électroniquemoutchqueren5Pas encore d'évaluation
- Cours D'electronique Automatique de BaseDocument45 pagesCours D'electronique Automatique de BaseArnauld LefortPas encore d'évaluation
- Les PilesDocument7 pagesLes PilesDriss EL FadilPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document54 pagesChapitre 2lefebvre100% (1)
- Cours D'électronique - 1Document61 pagesCours D'électronique - 1Boubacar TomotaPas encore d'évaluation
- Cours Secu ElectriqueDocument40 pagesCours Secu ElectriqueAlaz FofanaPas encore d'évaluation
- ملصق الندوة العنفDocument42 pagesملصق الندوة العنفBZ SifdinePas encore d'évaluation
- Pro C Université Abdelmalek Essaâdi-1Document14 pagesPro C Université Abdelmalek Essaâdi-1BZ SifdinePas encore d'évaluation
- MNecole Hachette Istra PDFDocument10 pagesMNecole Hachette Istra PDFBZ SifdinePas encore d'évaluation
- Catalogue Scolaire PrimaireDocument56 pagesCatalogue Scolaire PrimaireBZ SifdinePas encore d'évaluation
- Extraits MN Hachette-IstraDocument28 pagesExtraits MN Hachette-IstraBZ SifdinePas encore d'évaluation
- Nouveau Code de La Route Au MarocDocument6 pagesNouveau Code de La Route Au Marocspiritualbeing100% (1)
- Algorithmique PDFDocument304 pagesAlgorithmique PDFBZ SifdinePas encore d'évaluation
- Besoins Four Inf BC 2010sahnounDocument2 pagesBesoins Four Inf BC 2010sahnounBZ SifdinePas encore d'évaluation