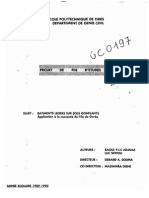Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Urbanisme & Développement de L'urbanité - Essai BONETTI1997
Transféré par
susCitiesTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Urbanisme & Développement de L'urbanité - Essai BONETTI1997
Transféré par
susCitiesDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Laboratoire de sociologie urbaine générative
4 avenue du Recteur Poincaré
75782 Paris cedex 16
Tél : 01.40.50.29.27
Fax : 01.40.50.28.86
LABORATOIRE DE SOCIOLOGIE URBAINE GENERATIVE
DE L’URBANISME AU DEVELOPPEMENT
DE L’URBANITE
Michel Bonetti
Novembre 1977
Article Urb&paysage/MB 1977 – De l’urbanisme au développement de l’urbanité
2
L’enjeu de la réflexion sur l’incidence des formes urbaines et de l’architecture sur le rapport
des usagers à la ville réside à mon sens dans le passage d’une approche en terme d’urbanisme
à une approche en terme de développement de l’urbanité. Un tel changement de mode de
pensée revient à s’interroger sur les conditions de construction (ou de reconstruction) de
l’espace public.
Mais avant d’aborder ce thème, il est nécessaire de remettre en cause certains poncifs qui
circulent dans notre société et qui obèrent la réflexion sur ces problèmes.
Le premier concerne le discours selon lequel on aurait des banlieues, des formes urbaines, des
HLM complètement homogènes, identiques, où il se passerait à peu près la même chose :
délinquance, violence, etc. C’est totalement faux. Il existe une très grande différenciation des
situations sociales, des modes d’appropriation de ces espaces dans les quartiers et même à
l’intérieur d’un quartier. Cela appelle des stratégies et des modes d’action fondamentalement
différents.
Par ailleurs, on tend à établir une corrélation mécaniste entre le chômage, la présence des
immigrés ou la concentration de familles nombreuses et l’acuité des tensions sociales. Or ceci
n’est absolument pas vérifié. Bien entendu le chômage est un facteur qui peut accroître les
difficultés de la vie sociale, mais deux quartiers connaissant des taux de chômage équivalents
peuvent fonctionner de façon fondamentalement différente. Evitons donc ce genre de court-
circuit qui facilite la pensée.
Troisième idée fausse : la représentation selon laquelle ces quartiers seraient trop denses. En
réalité, ils ont une très faible densité pour la plupart. Le vide prévaut, et un vide qui n’est pas
aménagé, qui est laissé à l’abandon, n’est plus un espace public. De plus ce vide qui coûte
cher car on n’a pas les moyens de l’entretenir.
Autre représentation qui circule : on tend à stigmatiser certains quartiers car il y a des
manifestations de violence. Or les quartiers les plus problématiques ne sont pas
nécessairement ceux qui font la une de la presse. Certains quartiers sont effectivement assez
« vivants », les agressions sont fréquentes, ils flambent parfois : cela veut dire qu’il y a de la
vie, et c’est bien parce que l’on n’a pas su entendre, écouter et répondre à ces demandes qui
s’expriment ainsi que cette énergie se transforme en violence. A mon sens, les quartiers les
plus inquiétants sont sans doute ceux ou il ne se passe apparamment rien. Certains sont atteint
d’une sorte de dépression collective parce que les habitants n’ont jamais été écoutés. Ils sont
confrontés à la boutade de Schultz : « The answer is no, but don’t stop asking ! » (La réponse
est non, mais continuez à demander).
Autre fausse corrélation : l’existence de revendications dans un quartier exprimerait
nécessairement une profonde insatisfaction des habitants. Or certaines enquêtes montrent que
la demande et les revendications des habitants peuvent être très fortes, et simultanément leur
satisfaction peut être relativement élevé, lorsque les services publics ont une réelle capacité
d’écoute et de réponse face à ces demandes.
Article Urb&paysage/MB 1977 – De l’urbanisme au développement de l’urbanité
3
Deux mots sur les formes urbaines et la vie sociale. J’appuie ce que disait André Bruston. Les
formes urbaines ne produisent pas mécaniquement les relations sociales, elles ne sont pas à
l’origine des conflits. Cela a été la croyance notamment du fonctionnalisme et ce n’est pas par
hasard si les urbanismes ou les architectes se sont emparés de cette conception sociologique.
Cela leur conférait un rôle majeur dans la production de la société. Certaines recherches
prétendaient même établir des corrélations entre le nombre d’étages ou la forme de la rue et la
sociabilité ou entre la densité urbaine et les modes de relations sociales. A propos de ces
recherches, Pierre Bourdieu dirait : « Ce n’est même pas faux ». Effectivement, il y a des
corrélations entre ces phénomènes, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il y ait des
relations de causalité. C’est une confusion fréquente. En fait, il y a des processus d’interaction
extrêmement complexes entre les formes urbaines et la vie sociale. A mon sens, quatre
sphères interagissent :
• Les modes d’organisation de l’espace.
• Les caractéristiques des populations, mais celles-ci sont elles-mêmes extrêmement
complexes en raison de leur mode de constitution, de leur composition et de leurs cultures.
• Le fonctionnement du système de gestion urbaine.
• Le mode de gestion politique des quartiers.
Actuellement le fonctionnement du système de gestion urbaine est particulièrement
problématique, or il n’est pas au coeur de la politique de la ville. Des actions sont menées
dans ce domaine, mais on ne l’a pas posé comme l’enjeu central. Il se pose notamment un
grave problème d’adaptation du fonctionnement des services municipaux et d’adaptation de la
gestion et de la maintenance des organismes d’HLM. Cet enjeu n’est pas au coeur des
politiques mises en oeuvre, parce que cela renvoie à des modes d’organisation, à des
corporatismes, à des enjeux de pouvoir auxquels il est très difficile de toucher. On a parlé de
l’école : cela fait partie des enjeux majeurs. Tant que l’on n’aura pas un véritable programme
national de transformation de ces organisations et de formation de leurs agents on peut
investir des milliards et des milliards dans le réaménageaient de l’espace sans que cela ne
change grand chose. Je travaille dans des quartiers où il faut 2 ou 3 ans pour parvenir à
changer un gardien d’immeuble déficient. Et pour muter un responsable de gestion tout à fait
incompétent, il faut 10 ans ! Pendant ce temps, la situation continue à se dégrader.
Dans ma jeunesse j’ai fait de la sociologie traditionnelle naïve. J’analysais les relations entre
les habitants. J’ai beaucoup appris depuis que j’ai eu l’occasion de passer de l’autre côté de la
scène, dans les arrière-cuisines, pour analyser le fonctionnement des organismes de
logements, des services municipaux et de différents services publics. J’ai été très surpris. J’ai
découvert un univers qui coproduisait le lien social dans cette interaction entre l’espace et une
population. Ces organisations sont en fait coproductrices des problèmes sociaux. Elles ne font
pas face aux problèmes qu’elles veulent régler : elles les coproduisent par leur fonctionnement
même. Je peux vous montrer comment des organismes produisent des impayés de loyers, des
tensions sociales, des conflits.
Article Urb&paysage/MB 1977 – De l’urbanisme au développement de l’urbanité
4
La gestion politique des quartiers constitue un autre enjeu fondamental. J’adhère tout à fait à
la formule de M. Delalande quand il dit « Les élus sont les garants de la cohésion sociale ». Je
pense que les maires sont encore plus : ils sont les symboles par lesquels passe et se construit
l’appartenance à la collectivité locale. S’il n’y a pas de possibilité d’identification symbolique
même conflictuelle, il n’y a pas de possibilité d’appartenance à la collectivité locale prise au
sens plein du terme, c’est à dire, non pas uniquement administratif, mais sociologique.
Les évaluations que nous avons faîtes sur un ensemble de quartier montrent que l’on est face à
une situation de vide politique dans de nombreux quartiers. Bien entendu, cela ne concerne
pas les gens présents ici. Quand on a ce genre de débat, on se retrouve effectivement avec des
élus qui investissent dans ces quartiers, comme en témoigne leur présence. Mais il y a certains
quartiers dans lesquels les maires ou les élus mettent rarement les pieds.
J’ai été sollicité par le maire d’une grande ville de 100.000 habitants pour traiter le problème
d’un quartier de 20.000 habitants. Il m’a dit : « Faites un projet, je vous finance, on aura les
moyens, etc... ». Je lui ai répondu : « Si vous voulez vraiment faire un projet et non une
opération, il faut lancer tout le travail d’élaboration de ce projet par un moment symbolique
fort en tenant un Conseil Municipal sur le quartier ». Il m’a arrêté tout de suite : « Vous aurez
tous les moyens voulus pour faire des projets, élaborer des opérations, mais ne comptez pas
sur moi pour m’afficher politiquement sur ce quartier ». Ce maire peut mettre tout l’argent
qu’il voudra dans ce quartier, il ne changera rien parce que son attitude traduit un déni de
citoyenneté.
Les déficiences du système de gestion urbaine entraînent également une situation de vide
institutionnel dans certains quartiers. On voit bien actuellement qui vient remplir le vide
institutionnel et politique : le Front National, les intégristes. Nous, coproduisons donc cette
situation.
Cela ne veut pas dire, par ailleurs, que les formes urbaines n’ont pas d’incidences sur la vie
sociale. Elles sont le support, la scène sociale sur laquelle se construisent ces relations. On
hérite, d’une certaine manière, d’un urbanisme rationaliste formel qui avait pour mot d’ordre,
en quelque sorte, d’organiser l’espace et d’y mettre de l’ordre sur un modèle rationaliste. Ces
espaces offrent de grandes perspectives, des formes architecturales lisses, sans aspérité,
identiques, etc... Or nous n’avons pas rompu avec cette idéologie, elle est toujours à l’oeuvre
y compris dans les réhabilitations puisque c’est ma même conception normative qui prévaut.
C’est un rationalisme qui nie la différence. Il n’y a plus de support à l’imaginaire. On pourrait
dire qu’en fait on est dans un système, un urbanisme, une architecture dominée par le
symbolique, en tant que code de correspondance entre des éléments produisant un sens
univoque. Le symbolique a en quelque sorte annulé, détruit l’imaginaire. Il n’y a plus de
support à l’imaginaire dans ces quartiers et le seul imaginaire qui subsiste est effectivement
mortifère.
Cela ne veut pas dire que cette architecture est criminogène, mais il est porteur d’un
imaginaire dépressif. On peut analyser les révoltes des jeunes comme de la production de
sens, d’un imaginaire, avec les matériaux dont ils disposent. Vous fabriquez votre vie, votre
sens, votre imaginaire avec ce que vous avez sous la main. Quand ce n’est qu’un univers
laissé à l’abandon, qui ne vous donne pas du sens, le seul moyen de produire de l’imaginaire
est de le détruire.
Article Urb&paysage/MB 1977 – De l’urbanisme au développement de l’urbanité
5
L’autre problème important concernant cet urbanisme normatif qui annule la différence, c’est
l’absence d’historicité. Vous me direz que c’est normal, c’est neuf, il n’y a pas d’histoire. En
réalité on a construit contre l’historicité. On a isolé ces quartiers de la ville, heureusement,
elle les rattrape maintenant, et on les a construits formellement, morphologiquement en
rupture, en opposition à la confusion, à la diversité, à la richesse urbaine. On a volontairement
crée des quartiers atemporels au nom d’une modernité qui devait être éternelle. Alors, les
habitants, y compris à travers la violence, dans des échanges, dans des relations conflictuelles
font, comme l’on dit « des histoires », mais ils créent ainsi de l’histoire, parce qu’il n’ont pas
d’autre moyen. Là aussi, on crée l’histoire avec ce que l’on a sous la main.
Je voudrais, pour terminer, revenir à l’urbanité. Penser le développement de l’urbanité cela
veut dire ne plus penser la ville à partir de règles formelles. L’urbanisme est, pour moi, le
mort qui saisit le vif. Il conçoit l’espace comme un objet figé, mort. Dans sa conception, il
oublie que des gens y vivent, y travaillent, qu’il y a des activités, des acteurs sociaux,
politiques, économiques. Il ne conçoit pas le développement de la ville comme un lieu
d’activité, de vie, d’échanges, de conflits, etc... mais comme une espèce de monstre inerte,
d’objet froid sur un plan où tout cela est annulé.
Actuellement, se multiplient des projets soi-disant de développement urbain. Or il s’agit là
d’un abus de langage. Le terme développement signifie développement des capacités, des
potentialités économiques, sociales, politiques, culturelles. Cela suppose de s’appuyer sur ce
qui existe pour le développer et, à partir de stratégies, de projets, de finalités, repenser
l’espace et l’adapter. Quand on a une démarche de ce type, il faut procéder à des
modifications fines de ces espaces, travailler dans la dentelle. Cela signifie de renoncer à la
réalisation d’un grand projet urbain au profit d’une multitude d’actions différentes focalisées
par cette préoccupation. Or, les urbanistes restent en fait prisonniers d’un modèle
d’aménagement urbain : ils pensent en terme d’infrastructures. Il est extraordinaire de voir le
langage de l’urbanisme actuellement : tout est structurant. Il y a des axes, des équipements,
des espaces structurants, mais on en reste à des concepts qui sont ceux des années 60. Croire
qu’un axe va structurer quoi que ce soit est une aberration. Cela dépend de la façon dont il
s’inscrit dans un processus, dont il est géré, des rapports sociaux auxquels il correspond, etc...
Le mythe des équipements structurants reste en fait vivace. J’en ai encore eu récemment la
preuve lors d’un jury de projet urbain, où un architecte a proposé de créer un équipement
socio-culturel structurant dans le quartier. Or cet équipement n’allait rien structurer du tout !
On est encore submergé par ce genre de croyances effrayantes, et une révolution culturelle est
nécessaire en matière d’urbanisme. J’ai enseigné à des étudiants en urbanisme. Ils devaient
faire des mémoires sur des ZAC. J’étais terrifié ! Ils avaient 25 ans et leurs modèles de pensée
étaient ceux des années 60 parce que leurs professeurs continuent à adhérer à ces modèles. On
est dans un processus de reproduction d’un modèle de pensée complètement archaïque.
L’enjeu à mon sens revient à considérer que les habitants sont coproducteurs de la ville.
Produire de la ville, c’est produire de la différence dans toutes ses composantes. On peut
penser l’espace, les formes urbaines en partant de la façon dont les gens vivent, en analysant
leurs attentes, en pensant à partir de la réalité, en partant de leurs capacités potentielles, mais
pas en déconnectant complètement ces espaces des processus sociaux, culturels et
économiques qui s’y développent, dont ces espaces sont les supports.
Article Urb&paysage/MB 1977 – De l’urbanisme au développement de l’urbanité
Vous aimerez peut-être aussi
- Emoto Masaru - Fliege Jurgen - Le Pouvoir Guerisseur de L EauDocument108 pagesEmoto Masaru - Fliege Jurgen - Le Pouvoir Guerisseur de L EauHOUETONIAL100% (6)
- 6 Conseils Pour Devenir Un Pro Du TradingDocument76 pages6 Conseils Pour Devenir Un Pro Du TradingSaad Tate100% (3)
- La PonctuationDocument10 pagesLa PonctuationVanya SimeonovaPas encore d'évaluation
- Technique de Communication 2Document8 pagesTechnique de Communication 2SamyChemala100% (1)
- L'inconscientDocument5 pagesL'inconscientVieilleChamelle100% (1)
- Sujet: Dans Quelle Mesure Le SEO Est-Il Un Facteur D'accompagnement À La Transformation Digitale de Nestlé ? Le Cas deDocument93 pagesSujet: Dans Quelle Mesure Le SEO Est-Il Un Facteur D'accompagnement À La Transformation Digitale de Nestlé ? Le Cas debapstPas encore d'évaluation
- Sols Gonflants PDFDocument97 pagesSols Gonflants PDFAT NMPas encore d'évaluation
- GUI Environnement & Étude D'impact - Guide Complet 157p - Mate2001actDocument157 pagesGUI Environnement & Étude D'impact - Guide Complet 157p - Mate2001actsusCities100% (1)
- These LoussakoumounouDocument529 pagesThese LoussakoumounouYannick Demeo Goli100% (1)
- INF2012 Livre Blanc Climat2012 - FRDocument57 pagesINF2012 Livre Blanc Climat2012 - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- GUI2008 Réseaux D'assainissement & Charte Qualité - FRDocument32 pagesGUI2008 Réseaux D'assainissement & Charte Qualité - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- guide d - أ©purationDocument44 pagesguide d - أ©purationnassima100% (1)
- EU - Manuel de Formation Etude D'impact EnvironnementalDocument630 pagesEU - Manuel de Formation Etude D'impact EnvironnementalsusCities100% (7)
- EU - Manuel de Formation Etude D'impact EnvironnementalDocument630 pagesEU - Manuel de Formation Etude D'impact EnvironnementalsusCities100% (7)
- 14-Puits D'infiltration (Nonc)Document2 pages14-Puits D'infiltration (Nonc)Anass NfifakhPas encore d'évaluation
- GUI2002 Guide D'auto-Diagnostic Environnemental - DeltaDocument56 pagesGUI2002 Guide D'auto-Diagnostic Environnemental - DeltasusCitiesPas encore d'évaluation
- GUI2005 Vulnérabilité Des Bâtiments Face Au Risque D'inondation - FRDocument37 pagesGUI2005 Vulnérabilité Des Bâtiments Face Au Risque D'inondation - FRsusCities100% (1)
- GUI2000 Aménagement Urbain & Réduction de L'insécurité - FRDocument5 pagesGUI2000 Aménagement Urbain & Réduction de L'insécurité - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- REG1986 Circulaire Du 23 Juillet 1986 Relative Aux Vibrations Mécaniques Des Industries - FRDocument27 pagesREG1986 Circulaire Du 23 Juillet 1986 Relative Aux Vibrations Mécaniques Des Industries - FRsusCities100% (1)
- GUI2001 Risques Naturels & Environnement Industriel - Séismes, Inondations, Mouvements de Terrain & Tempêtes - FRDocument59 pagesGUI2001 Risques Naturels & Environnement Industriel - Séismes, Inondations, Mouvements de Terrain & Tempêtes - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- Calculs Commerciaux (Résumé) 2pp - Suscities2023Document2 pagesCalculs Commerciaux (Résumé) 2pp - Suscities2023susCitiesPas encore d'évaluation
- GUI2005 Déchetteries & Évaluation Du Risque Sanitaire - FRDocument124 pagesGUI2005 Déchetteries & Évaluation Du Risque Sanitaire - FRsusCities100% (1)
- GUI2004 Tourisme & Bonnes Pratiques Environnementales & Sociales - UNDocument29 pagesGUI2004 Tourisme & Bonnes Pratiques Environnementales & Sociales - UNsusCitiesPas encore d'évaluation
- REG2002 Directive Européenne Du 25 Juin 2002 Relative À L'évaluation & À La Gestion Du Bruit Dans L'environnement - EUDocument14 pagesREG2002 Directive Européenne Du 25 Juin 2002 Relative À L'évaluation & À La Gestion Du Bruit Dans L'environnement - EUsusCitiesPas encore d'évaluation
- EXA2002 Catastrophes Naturelles & Retour D'expérience - FRDocument28 pagesEXA2002 Catastrophes Naturelles & Retour D'expérience - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- IND2008 Croissance Éco-Efficace - Définition & Indicateurs - FRDocument1 pageIND2008 Croissance Éco-Efficace - Définition & Indicateurs - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- INF2004 Transport Routier & Réduction Du Trafic - Intérêt de Privatiser Les Routes - JancoviciDocument4 pagesINF2004 Transport Routier & Réduction Du Trafic - Intérêt de Privatiser Les Routes - JancovicisusCitiesPas encore d'évaluation
- GUI2002 Nuisances Sonores & Solutions Techniques - CSTBDocument48 pagesGUI2002 Nuisances Sonores & Solutions Techniques - CSTBsusCitiesPas encore d'évaluation
- EXA2004 Bilan de L'économie Sociale & Solidaire en Rhône-Alpes - InseeDocument4 pagesEXA2004 Bilan de L'économie Sociale & Solidaire en Rhône-Alpes - InseesusCitiesPas encore d'évaluation
- INF2006 Critères Pour Une Charte D'économie Sociale - FRDocument2 pagesINF2006 Critères Pour Une Charte D'économie Sociale - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- EXA2009 Textile Recyclé & Insertion Sociale - FRDocument4 pagesEXA2009 Textile Recyclé & Insertion Sociale - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- REG1999 OHSAS18001 Spécifications - AfnorDocument28 pagesREG1999 OHSAS18001 Spécifications - AfnorsusCitiesPas encore d'évaluation
- GUI2003 Centre-Ville & Modération Du Trafic Automobile - CHDocument19 pagesGUI2003 Centre-Ville & Modération Du Trafic Automobile - CHsusCitiesPas encore d'évaluation
- INF2004 Transport Routier & Réduction Du Trafic - Intérêt de Privatiser Les Routes - JancoviciDocument4 pagesINF2004 Transport Routier & Réduction Du Trafic - Intérêt de Privatiser Les Routes - JancovicisusCitiesPas encore d'évaluation
- INF2008 Commerce Équitable - FRDocument9 pagesINF2008 Commerce Équitable - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- INF2006 Critères Pour Une Charte de Commerce Équitable - FRDocument2 pagesINF2006 Critères Pour Une Charte de Commerce Équitable - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- GUI2003 Identification Des Pressions & Impacts Sur L'environnement - FRDocument140 pagesGUI2003 Identification Des Pressions & Impacts Sur L'environnement - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- GUI2004 Cadrage Théorique de L'étude D'impact - FRDocument40 pagesGUI2004 Cadrage Théorique de L'étude D'impact - FRsusCitiesPas encore d'évaluation
- GUI2002 Fiche Méthodologique Pour Les Études D'impact de Voirie - DDEDocument12 pagesGUI2002 Fiche Méthodologique Pour Les Études D'impact de Voirie - DDEsusCitiesPas encore d'évaluation
- EXA2008 Biodiversité & Entreprises - Initiatives Innovantes Dans Le Monde - IfbDocument29 pagesEXA2008 Biodiversité & Entreprises - Initiatives Innovantes Dans Le Monde - IfbsusCitiesPas encore d'évaluation
- Gestion D'un Feu TricoloreDocument9 pagesGestion D'un Feu TricolorelfadliPas encore d'évaluation
- Cours DiapoDocument34 pagesCours DiapoluciePas encore d'évaluation
- Adri 2021 Correto PDFDocument11 pagesAdri 2021 Correto PDFAdriana SouzaPas encore d'évaluation
- Histoire de La Communication Communication Ch2 Les Differents MediaDocument29 pagesHistoire de La Communication Communication Ch2 Les Differents MediaFanny GaboryPas encore d'évaluation
- Panorama 3 - Cahier Dexercices - Leccon 3Document10 pagesPanorama 3 - Cahier Dexercices - Leccon 3Elena TerzievaPas encore d'évaluation
- Objets Et Classes C++Document60 pagesObjets Et Classes C++Anas Yassine100% (1)
- Club Sportif AmateurDocument9 pagesClub Sportif AmateurMam OunPas encore d'évaluation
- EssaiDocument422 pagesEssaiPhilippe BeugniezPas encore d'évaluation
- Rapport de Jury CGL Histoire 2022Document3 pagesRapport de Jury CGL Histoire 2022Croco BochuPas encore d'évaluation
- Algebre 2022 CoursintegralDocument74 pagesAlgebre 2022 CoursintegralBoulitoPas encore d'évaluation
- Tests Psy Syllogisme @FTDocument5 pagesTests Psy Syllogisme @FTfatou tinePas encore d'évaluation
- Préparer Un Entretien D'embaucheDocument4 pagesPréparer Un Entretien D'embaucheAbril DíazPas encore d'évaluation
- Comment Configurer SARDocument5 pagesComment Configurer SARaurorion_adminPas encore d'évaluation
- 1958 Les Musulmans en Amérique D'avant Christophe ColombDocument8 pages1958 Les Musulmans en Amérique D'avant Christophe ColombneferisaPas encore d'évaluation
- Individus Et Descriptions. Contributions À Une Histoire Du Problème de La Connaissance Des Individus Dans La Philosophie NéoplatonicienneDocument38 pagesIndividus Et Descriptions. Contributions À Une Histoire Du Problème de La Connaissance Des Individus Dans La Philosophie NéoplatonicienneEliseo22Pas encore d'évaluation
- Feuille TageDocument1 pageFeuille TageAissa Aimene100% (1)
- Différence Entre Une Société Et Une EntrepriseDocument6 pagesDifférence Entre Une Société Et Une EntrepriseKaramPas encore d'évaluation
- Plan D' Affaire - Le Saule EnergetiqueDocument33 pagesPlan D' Affaire - Le Saule EnergetiqueLorena GoguPas encore d'évaluation
- Chapitre 4-La Gestion Des ConflitsDocument28 pagesChapitre 4-La Gestion Des ConflitsMaroPas encore d'évaluation
- M1 TP1 VHDLDocument21 pagesM1 TP1 VHDLboulainine houriaPas encore d'évaluation