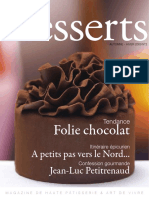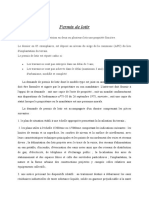Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Réparation Et Entretien Des Automabiles PDF
Réparation Et Entretien Des Automabiles PDF
Transféré par
ARSENETitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Réparation Et Entretien Des Automabiles PDF
Réparation Et Entretien Des Automabiles PDF
Transféré par
ARSENEDroits d'auteur :
Formats disponibles
116617 COUV
3/10/08
19:35
Page 1
Le taux de frquence des
accidents du travail dans le secteur
de la rparation automobile est
suprieur la moyenne nationale, tous
secteurs confondus de la mtallurgie.
Cette activit comporte
des risques trs varis.
Les responsables dans cette profession
constitue de trs nombreuses
entreprises de petite taille
doivent assurer,
le plus souvent seuls,
les diverses fonctions de
lentreprise et notamment
lorganisation de la prvention.
Cette brochure est destine
aider les employeurs et les
responsables dateliers de rparation
et dentretien des vhicules automobiles
prendre des mesures prventives,
afin damliorer la scurit
dans leur tablissement.
Rparation et entretien
des vhicules automobiles
Institut national de recherche et de scurit
pour la prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 Tl. 01 40 44 30 00
Fax 01 40 44 30 99 Internet : www.inrs.fr e-mail : info@inrs.fr
dition INRS ED 755
4e dition (2008)
rimpression octobre 2008 8 000 ex. ISBN 978-2-7389-1639-6
116617 COUV
3/10/08
19:35
Page 3
LInstitut national de recherche et de scurit (INRS)
Dans le domaine de la prvention des risques professionnels,
lINRS est un organisme scientifique et technique qui travaille,
au plan institutionnel, avec la CNAMTS, les CRAM-CGSS
et plus ponctuellement pour les services de ltat ainsi que
pour tout autre organisme soccupant de prvention
des risques professionnels.
Il dveloppe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires
quil met la disposition de tous ceux qui, en entreprise,
sont chargs de la prvention : chef dentreprise, mdecin du travail,
CHSCT, salaris. Face la complexit des problmes, lInstitut
dispose de comptences scientifiques, techniques et mdicales couvrant
une trs grande varit de disciplines, toutes au service
de la matrise des risques professionnels.
Pour commander les films (en prt), les brochures et les affiches de lINRS,
adressez-vous au service prvention de votre CRAM ou CGSS.
Services prvention des CRAM
ALSACE-MOSELLE
BRETAGNE
NORD-EST
(67 Bas-Rhin)
(22 Ctes-dArmor, 29 Finistre,
35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)
(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne,
52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle,
55 Meuse, 88 Vosges)
14 rue Adolphe-Seyboth
BP 10392
67010 Strasbourg cedex
tl. 03 88 14 33 00
fax 03 88 23 54 13
236 rue de Chteaugiron
35030 Rennes cedex
tl. 02 99 26 74 63
fax 02 99 26 70 48
prvention documentation@cramalsace-moselle.fr
drpcdi@cram-bretagne.fr
www.cram-bretagne.fr
(57 Moselle)
CENTRE
3 place du Roi-George
BP 31062
57036 Metz cedex 1
tl. 03 87 66 86 22
fax 03 87 55 98 65
(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre,
37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)
Ainsi, lINRS labore et diffuse des documents intressant
lhygine et la scurit du travail : publications (priodiques
ou non), affiches, audiovisuels, site Internet Les publications
de lINRS sont distribues par les CRAM.
Pour les obtenir, adressez-vous au service prvention de la Caisse
rgionale ou de la Caisse gnrale de votre circonscription,
dont ladresse est mentionne en fin de brochure.
www.cram-alsace-moselle.fr
LINRS est une association sans but lucratif (loi 1901) constitue
sous lgide de la CNAMTS et soumise au contrle financier de ltat.
Gr par un conseil dadministration constitu parit dun collge
reprsentant les employeurs et dun collge reprsentant les salaris,
il est prsid alternativement par un reprsentant de chacun
des deux collges. Son financement est assur en quasitotalit par le Fonds national de prvention
des accidents du travail et des maladies professionnelles.
AQUITAINE
(68 Haut-Rhin)
11 avenue De-Lattre-de-Tassigny
BP 70488
68018 Colmar cedex
tl. 03 89 21 62 20
fax 03 89 21 62 21
www.cram-alsace-moselle.fr
(24 Dordogne, 33 Gironde, 40 Landes,
47 Lot-et-Garonne, 64 Pyrnes-Atlantiques)
80 avenue de la Jallre
33053 Bordeaux cedex
tl. 05 56 11 64 36
fax 05 57 57 70 04
AUVERGNE
Les Caisses rgionales dassurance maladie (CRAM)
et Caisses gnrales de scurit sociale (CGSS)
Les Caisses rgionales dassurance maladie et les Caisses
gnrales de scurit sociale disposent, pour participer
la diminution des risques professionnels dans leur rgion,
dun service prvention compos dingnieurs-conseils
et de contrleurs de scurit. Spcifiquement forms
aux disciplines de la prvention des risques professionnels
et sappuyant sur lexprience quotidienne de lentreprise,
ils sont en mesure de conseiller et, sous certaines conditions,
de soutenir les acteurs de lentreprise (direction, mdecin du travail,
CHSCT, etc.) dans la mise en uvre des dmarches
et outils de prvention les mieux adapts chaque situation.
Ils assurent la mise disposition de tous
les documents dits par lINRS.
service.prevention@cram-nordest.fr
NORD-PICARDIE
(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise,
62 Pas-de-Calais, 80 Somme)
36 rue Xaintrailles
45033 Orlans cedex 1
tl. 02 38 81 50 00
fax 02 38 79 70 29
11 alle Vauban
59662 Villeneuve-dAscq cedex
tl. 03 20 05 60 28
fax 03 20 05 79 30
prev@cram-centre.fr
www.cram-nordpicardie.fr
CENTRE-OUEST
NORMANDIE
(16 Charente, 17 Charente-Maritime,
19 Corrze, 23 Creuse, 79 Deux-Svres,
86 Vienne, 87 Haute-Vienne)
4 rue de la Reynie
87048 Limoges cedex
tl. 05 55 45 39 04
fax 05 55 79 00 64
(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche,
61 Orne, 76 Seine-Maritime)
Avenue du Grand-Cours, 2022 X
76028 Rouen cedex
tl. 02 35 03 58 21
fax 02 35 03 58 29
doc.tapr@cram-centreouest.fr
catherine.lefebvre@cram-normandie.fr
dominique.morice@cram-normandie.fr
LE-DE-FRANCE
PAYS DE LA LOIRE
(75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines,
91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-SaintDenis, 94 Val-de-Marne, 95 Val-dOise)
(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire,
53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vende)
17-19 place de lArgonne
75019 Paris
tl. 01 40 05 32 64
fax 01 40 05 38 84
documentation.prevention
@cramaquitaine.fr
81 85 rue de Metz
54073 Nancy cedex
tl. 03 83 34 49 02
fax 03 83 34 48 70
2 place de Bretagne
BP 93405, 44034 Nantes cedex 1
tl. 02 51 72 84 00
fax 02 51 82 31 62
prevention@cram-pl.fr
prevention.atmp@cramif.cnamts.fr
(03 Allier, 15 Cantal,
43 Haute-Loire, 63 Puy-de-Dme)
48-50 boulevard Lafayette
63058 Clermont-Ferrand cedex 1
tl. 04 73 42 70 76
fax 04 73 42 70 15
preven.cram@wanadoo.fr
BOURGOGNE
et FRANCHE-COMT
LANGUEDOC-ROUSSILLON
(11 Aude, 30 Gard, 34 Hrault,
48 Lozre, 66 Pyrnes-Orientales)
29 cours Gambetta
34068 Montpellier cedex 2
tl. 04 67 12 95 55
fax 04 67 12 95 56
RHNE-ALPES
(01 Ain, 07 Ardche, 26 Drme, 38 Isre,
42 Loire, 69 Rhne, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie)
26 rue dAubigny
69436 Lyon cedex 3
tl. 04 72 91 96 96
fax 04 72 91 97 09
preventionrp@cramra.fr
prevdoc@cram-lr.fr
(21 Cte-dOr, 25 Doubs, 39 Jura,
58 Nivre, 70 Haute-Sane, 71 Sane-et-Loire,
89 Yonne, 90 Territoire de Belfort)
ZAE Cap-Nord
38 rue de Cracovie
21044 Dijon cedex
tl. 03 80 70 51 32
fax 03 80 70 51 73
prevention@cram-bfc.fr
SUD-EST
MIDI-PYRNES
(09 Arige, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrnes,
81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)
(04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes,
06 Alpes-Maritimes, 13 Bouches-du-Rhne,
2A Corse Sud, 2B Haute-Corse, 83 Var,
84 Vaucluse)
2 rue Georges-Vivent
31065 Toulouse cedex 9
tl. 0820 904 231 (0,118 /min)
fax 05 62 14 88 24
35 rue George
13386 Marseille cedex 5
tl. 04 91 85 85 36
fax 04 91 85 75 66
doc.prev@cram-mp.fr
documentation.prevention@cram-sudest.fr
Services prvention des CGSS
Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite sans le consentement de lINRS,
de lauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.
Il en est de mme pour la traduction, ladaptation ou la transformation, larrangement ou la reproduction,
par un art ou un procd quelconque (article L. 122-4 du code de la proprit intellectuelle).
La violation des droits dauteur constitue une contrefaon punie dun emprisonnement de trois ans
et dune amende de 300 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la proprit intellectuelle).
INRS, 2008. Photos INRS et AFORPA.
GUADELOUPE
GUYANE
LA RUNION
MARTINIQUE
Immeuble CGRR
Rue Paul-Lacav
97110 Pointe--Pitre
tl. 05 90 21 46 00
fax 05 90 21 46 13
Espace Turenne
Radamonthe
Route de Raban,
BP 7015
97307 Cayenne cedex
tl. 05 94 29 83 04
fax 05 94 29 83 01
4 boulevard Doret
97405 Saint-Denis
cedex
tl. 02 62 90 47 00
fax 02 62 90 47 01
Quartier Place-dArmes
97210 Le Lamentin cedex 2
tl. 05 96 66 51 31
05 96 66 51 33
fax 05 96 51 81 54
prevention@cgssreunion.fr
prevention972@cgssmartinique.fr
lina.palmont@cgssguadeloupe.fr
116617
3/10/08
20:35
Page 1
Rparation et entretien
des vhicules automobiles
ED 755
janvier 2008
116617
3/10/08
20:35
Page 2
Auteurs
Claude Guillemin, INRS. Mise jour 2007 :
Henri Lupin et collaborateurs INRS.
Cette brochure a t ralise aprs
consultation des syndicats professionnels
et nous remercions le CCFA, le CFBP,
le CNPA et la FNA de leur participation
et lAFORPA pour la mise disposition
de ses locaux et lves pour les photos.
116617
3/10/08
20:35
Page 3
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1 GNRALITS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Rgles gnrales dhygine
Circulation. tat des sols
Incendie. Explosion
Installations et matriels lectriques
Bruit
Produits dangereux
2 TRAVAUX GNRAUX DATELIER
6
8
9
11
13
16
22
2.1 Levage et manutention
2.1.1 Manutentions manuelles
2.1.2 Manutentions mcaniques
2.1.2.1 Ponts lvateurs
2.1.2.2 Chariots automoteurs
2.1.2.3 Crics. Chandelles
22
22
23
23
24
25
2.2 Outils et outillages
26
2.3 Machines et appareils spciaux
2.3.1 Rgles gnrales
2.3.2 Appareils spciaux
2.3.3 Meules et machines meuler
2.3.4 Circuit dair comprim. Compresseur. Soufflette
28
28
28
29
30
2.4 Soudage
32
3 TRAVAUX SPCIFIQUES DIVERS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Mise en uvre de fluides sous haute pression
Lavage. Nettoyage. Dgraissage
Fosses de visite
Prparation et peinture des vhicules
Accumulateurs au plomb
Rparation et entretien des garnitures de frein
Interventions sur vhicules au GPL
Interventions sur vhicules au GNV
Interventions sur vhicules quips de coussins gonflables
de scurit et de prtendeurs (ou prtensionneurs) de
ceinture (systme airbag)
4 LISTE DE CONTRLE
36
36
37
39
41
46
47
50
52
52
54
116617
3/10/08
20:35
Page 4
116617
3/10/08
20:35
Page 5
INTRODUCTION
Cette brochure est destine aider les
employeurs et responsables dateliers de
rparation et dentretien des vhicules
automobiles prendre des mesures
prventives, afin damliorer la scurit
dans leur tablissement.
Cette profession, tant constitue de trs
nombreuses entreprises de petite taille, les
responsables, dans leur grande majorit,
doivent assurer seuls les diverses
fonctions de lentreprise et ne peuvent
donc pas toujours mettre en place une
organisation efficace de la prvention.
Or, les risques sont nombreux et trs
varis, aussi il en rsulte un taux de
frquence des accidents suprieur la
moyenne nationale.
De plus, au-del des rglementations qui
s'imposent aux employeurs, le combat
pour l'amlioration de la scurit et des
conditions de travail des salaris rejoint et
renforce celui de la qualit du travail et de
la productivit.
Ainsi, pour amliorer la performance
globale de l'entreprise dans
l'environnement rglementaire, social et
concurrentiel actuel, il est essentiel de
matriser les risques et leur cot induit.
En outre, au jour o de trs nombreux
chefs d'entreprises s'apprtent passer
la main, nous rappelons qu'une entreprise
qui respecte les concepts d'hygine et de
scurit sera plus facilement valorisable
lors des ngociations de vente.
D'autre part, pour amliorer les conditions
de sant et de scurit au travail au sein
des entreprises, celles-ci peuvent obtenir,
sous certaines conditions, une aide
financire en signant un contrat de
prvention avec leur Caisse rgionale
d'assurance maladie (CRAM) ou leur
Caisse gnrale de scurit sociale
(CGSS).
STATISTIQUES
1. RPARTITION
60 000 entreprises employant
335 000 salaris dont
92 % dentre elles
ont moins de 10 personnes.
2. VOLUTION
Effectifs : aujourd'hui 40 % des artisans
de la branche de la distribution et des
services de l'automobile ont plus de
50 ans. Les dparts la retraite sont donc
particulirement nombreux.
Entreprises : la complexit croissante
des vhicules, des outils et des
techniques de rparation contraint
aujourd'hui le rparateur disposer
d'un quipement minimum suprieur
au petit outillage d'autrefois et implique
une lvation des niveaux de formation.
Le professionnel pour tre comptitif et
assurer au client le srieux indispensable
la scurit doit ainsi s'adapter
constamment l'volution technique
du secteur.
3. PRVENTION
Daprs les statistiques de la CNAMTS,
au cours des trois dernires annes, le
taux de frquence dans ce secteur
dactivit recule lgrement pour stablir
28,03 en 2006. Il reste suprieur au taux
moyen, tous secteurs confondus de la
mtallurgie (24,7 en 2006).
En 2006, on a enregistr prs de
14 700 accidents avec arrt de travail soit
1 accident pour 20 salaris alors que la
moyenne nationale, tous secteurs
confondus, est de 1 accident pour
23 salaris.
O SE PROCURER
- les textes officiels :
Journal officiel,
26 rue Desaix
75727 Paris cedex 15
tl 01 40 58 75 00
- les normes :
AFNOR, 11 avenue de Pressens
93571 Saint-Denis La Plaine cedex
tl 01 41 62 76 44
- les publications INRS :
auprs de votre CRAM ou
CGSS (adresses en fin de
brochure)
116617
3/10/08
20:35
Page 6
1. GNRALITS
1.1 RGLES GNRALES DHYGINE
RGLES
GNRALES
DHYGINE
Le respect des
rgles dhygine est
un facteur important
de scurit. Le Code
du travail prvoit
notamment :
a) Nettoyage rgulier
des locaux de travail
et annexes.
b) Installations sanitaires dans un local
ar, chauff et isol des locaux de travail
et de stockage (fig. 1).
En outre, les savons datelier mis la
disposition du personnel pour le nettoyage
des mains doivent tre conformes aux
normes franaises NF T73-101 et 73-102.
c) Aration des locaux :
les rgles de ventilation respecter sont
dfinies par larticle R. 4222-6 du code du
travail
dans un atelier avec ventilation
mcanique, le dbit minimal dair neuf par
occupant ne doit pas tre infrieur
60 m3 par heure.
d) Chauffage : choisir des systmes de
chauffage non susceptibles denflammer
dventuelles atmosphres inflammables.
Par exemple :
chauffage central eau,
racteur thermo-catalytique (fig. 2).
Les locaux doivent tre maintenus ferms
et chauffs de faon garantir une
temprature convenable. Aujourd'hui, de
nombreux dispositifs permettent d'assurer
les impratifs commerciaux et le confort
des salaris.
e) clairage conu et ralis de manire
viter :
des accidents au poste de travail et lors
des dplacements,
la fatigue visuelle et des affections de la
vue (voir tableau ci-contre). Le niveau
dclairement doit tre dtermin en
fonction de la nature de lactivit relle de
travail des personnes et en fonction de
leurs besoins physiologiques.
VALEURS DCLAIREMENT SUIVANT LES LOCAUX
Espaces et
locaux concerns
Circulations extrieures (entres, cours, alles)
Aires de travail extrieures (ex. quais)
Circulations intrieures (couloirs, escaliers)
Vestiaires, sanitaires
Ateliers o les tches ne ncessitent pas
de perception de dtails
Locaux affects des tches ncessitant
la perception de dtails
Bureaux (administratifs, secrtariat)
Dont 250 lux au moins assurs par lclairage gnral
1. Ces armoires-vestiaires, double compartiment,
ont t spcialement conues afin de pouvoir sparer
les vtements de ville des vtements de travail
116617
3/10/08
20:35
Page 7
BIBLIOGRAPHIE
X
Valeurs dclairement en lux
Valeurs prconnises
Valeurs minimales
pour lclairement moyen
rglementaires
maintenir Em (en lux)
(en lux)
40
10
150
40
100-150
40-60
200
120
300
200
500-1000
300-500
2. Racteurs thermo-catalytiques tudis pour le
chauffage des locaux prsentant un risque
datmosphres inflrmmables ou explosives
Rglementation
Code du travail :
Utilisation des lieux de travail :
R. 4221-1
Installations sanitaires :
R. 4228-1 R. 4228-18
Aration, assainissement des lieux de travail :
R. 4222-1 R. 4222-6
Ambiance thermique :
R. 4223-13 R. 4223-15
clairage :
R. 4223-1 R. 4223-13.
Normes
NF T73-101 Dtergents datelier sans
solvant pour lavage des mains
NF T73-102 Dtergents datelier avec
solvant pour lavage des mains
NF EN 12464- 1 Lumire et clairage.
clairage des lieux de travail. Partie 1 :
Lieux de travail intrieur.
Publications INRS
ED 657 Guide pratique de ventilation n 1.
Lassainissement de lair des locaux de
travail.
ED 950 Conception des lieux et des
situations de travail. Dmarches, mthodes
et connaissances techniques
TJ 5 Aide-mmoire juridique
Aration et assainissement des lieux de
travail
TJ 13 Aide-mmoire juridique.
clairage des lieux de travail
3. Chauffage par arotherme
116617
3/10/08
20:35
Page 8
1.2 CIRCULATION. TAT DES SOLS
BIBLIOGRAPHIE
CIRCULATION
TAT
DES SOLS
Dans la rparation
automobile, les
dplacements des
salaris sur leurs
lieux de travail
occasionnent 22 %
des accidents avec
arrt de travail.
Le rangement et la propret de latelier
doivent tre assurs en continu.
La circulation du personnel ainsi que son
vacuation en cas de sinistre doivent se
faire sans risque.
Il est ncessaire de :
1. dfinir et matrialiser visiblement des
alles de circulation en sparant celles
rserves aux pitons de celles prvues
pour les vhicules (fig. 4),
2. avoir un sol non glissant, facile nettoyer
ds que se produisent des flaques dhuile
ou des dpts de graisse et le maintenir en
bon tat : boucher les trous, couvrir les
caniveaux, retirer tous les objets saillants,...
3. viter lencombrement des sols en
prvoyant des aires de rangement pour les
organes dmonts et les pices en attente
de montage ou remontage.
4. Sparation matrialise
des alles de circulation pour pitons et vhicules
Rglementation
Code du travail :
Conception des sols : R. 4214-3
et R. 4214-4
Norme AFNOR/P 05A-doc 118
Voies de circulation :
R. 4214-9, 4214-10, 4214-13,
R. 4214-17, 4214-18
Signalisation : R. 4214-11,
R. 4214-12, 4214-14
Publications INRS
ED 975
La circulation en entreprise
116617
3/10/08
20:35
Page 9
1.3 INCENDIE. EXPLOSION
De nombreux
produits
combustibles, tels
que les
INCENDIE
hydrocarbures,
EXPLOSION
peintures, produits
de nettoyage,
solvants, etc.,
utiliss dans les
garages et les
ateliers de rparation automobile,
constituent un risque important dincendie
et/ou dexplosion.
personnel (en particulier au maniement
dextincteurs),
- interdiction de fumer, ...
5. Poste scurit incendie avec notamment RIA et
extincteur bien reprs
Lincendie est une combustion qui se
dveloppe dune manire incontrle dans
le temps et dans lespace en engendrant
de grandes quantits de chaleur, des
fumes et des gaz polluants.
Parmi les nombreuses sources dnergie
susceptibles de provoquer un incendie,
signalons :
- les travaux par points chauds (soudage,
oxycoupage),
- les installations lectriques,
- les tincelles (meulage),
- les tempratures leves (moteurs, pots
dchappement), etc.
6. Extincteur en permanence son emplacement,
accessible et bien signal
Pour prvenir lincendie ou pour lutter
contre lui, on retiendra principalement les
dispositions suivantes :
- conception et construction des locaux
(compartimentage, sparation des activits,
dsenfumage, etc.),
- moyens dextinction (extincteurs portatifs,
RIA, etc.), rpartis dans tout le local,
en des endroits facilement accessibles
et bien mis en vidence, les matriels
seront maintenus en bon tat dutilisation
(fig. 5 et 6),
- interdiction des feux nus hors des postes
de travail amnags ; de plus, les
oprations de travaux par points chauds
nauront lieu que dans des conditions
dfinies par les consignes internes,
- tablissement de consignes de scurit et
de procdures dvacuation, formation du
116617
3/10/08
20:35
Page 10
Par ailleurs, les produits mis en uvre,
sous forme de gaz, vapeurs ou poussires,
peuvent former des mlanges explosifs
avec lair et provoquer de violentes
explosions.
En fonction, entre autres, des locaux
(ventilation, etc.) et de la nature des
composs et de leurs caractristiques
d'explosivit, il conviendra de dterminer
les zones risque d'explosion et de choisir
les modes de prvention ou de protection
les plus appropris (cf. rglementation
relative aux zones ATEX). De faon
gnrale, elles sont assures par :
- la suppression des sources dnergie (cf.
incendie),
- llimination des atmosphres explosives
(captage, nettoyage, etc.),
- la mise en place de moyens de
suppression ou dattnuation dexplosion
adapts, etc.
CONSIGNE DINCENDIE
Elle devra tre affiche dans chaque local
et comporter en particulier :
a) le plan de ltablissement avec
indications :
des points dangereux,
des moyens dintervention,
des issues avec litinraire dvacuation ;
b) des renseignements gnraux
concernant lentreprise :
installations de fourniture de lnergie,
stockage des combustibles et des
carburants,
moyens fixes et mobiles de lutte contre
lincendie ;
c) des indications prcises pour toutes les
personnes travaillant dans les locaux :
qui, par quel moyen et comment
donner lalarme,
comment intervenir immdiatement,
quand et comment vacuer le local.
VRIFICATIONS RGLEMENTAIRES
Pour les vrifications priodiques,
se reporter la brochure INRS ED 828.
10
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Code du travail :
- Conception des locaux de travail
prvention des incendies et des
explosions : R. 4216-1 R. 4216-34
- Amnagement des lieux de travail
prvention des incendies et des
explosions : R. 4227-1 R. 4227-57
- Arrt du 28 juillet 2003 relatif aux
conditions dinstallation des matriels
lectriques dans les emplacements o
des atmosphres explosives peuvent
se prsenter
Code de lenvironnement :
- Art. L .511-1 L. 517-2
- Rubriques ventuellement
concernes en fonction des quantits
et/ou des superficies :
2925 Ateliers de charge
daccumulateur
2930 Ateliers de rparation et
dentretien de vhicules moteur, y
compris les activits de carrosserie et
de tlerie
1412 Stockage en rservoirs
manufacturs de gaz inflammables
liqufis
1414 Installations de remplissage ou
de distribution de gaz inflammables
liqufis
1432 - Stockage en rservoirs
manufacturs de liquides inflammables
1434 - Installation de remplissage ou de
distribution de liquides inflammables
2920 - Installations de rfrigration ou de
compression fonctionnant des
pressions effectives suprieures 105 Pa
2564 - Nettoyage, dgraissage,
dcapage de surfaces (mtaux,
matires plastiques, etc.) par des
procds utilisant des liquides
organohalogns ou des solvants
organiques
2575 - Emploi de matires abrasives
telles que sables, corindon, grenailles
mtalliques, etc., sur un matriau
quelconque pour gravure,
116617
3/10/08
20:35
Page 11
dpolissage, dcapage, grainage
Ministre de lIndustrie :
- Arrt du 30 septembre 1998 :
Rgles techniques et de scurit des
stations de distribution de carburant
liqufi non classes
- Arrt du 21 mars 1968 modifi :
Rgles techniques et de scurit
applicables au stockage et
lutilisation de produits ptroliers dans
les lieux non viss par la lgislation
des installations classes et la
rglementation des ERP
Publications INRS
ED 410 a brle
ED 663 Guide pratique de ventilation
n 9 - Ventilation des cabines et
postes de peinture
ED 990 Incendie et lieux de travail
ED 929 Consignes de scurit
incendie. lments de rdaction et de
mise en uvre dans un tablissement
ED 828 Principales vrifications
priodiques
ED 911 Les mlanges explosifs
ED 802 Les extincteurs dincendie
portatifs et mobiles (disponible
uniquement sur le site de lINRS
www.inrs.fr)
ED 945 ATEX. Mise en uvre de la
rglementation relative aux atmosphres
explosives. Guide mthodologique
7. Armoire lectrique avec affiches et interrupteur
rapidement et facilement accessible permettant la
mise hors tension de linstallation lectrique
1.4 INSTALLATIONS ET MATRIELS
LECTRIQUES
INSTALLATIONS
ET
MATRIELS
LECTRIQUES
Llectricit peut
tre la cause
daccidents graves
et dincendies.
Mme en basse
tension, llectricit
peut tre mortelle et
en particulier lorsque :
le matriel utilis nest pas en parfait
tat (attention notamment au matriel
lectro-portatif),
loprateur travaille dans un
environnement particulier : locaux mouills,
enceintes conductrices exigus, etc.,
linstallation ne comporte pas les
dispositifs de protection automatique
prvue par la rglementation.
Toutes les installations lectriques doivent
tre conformes :
aux dispositions du dcret n 88-1056
du 14 novembre 1988 concernant la
protection des travailleurs dans les
tablissements qui mettent en uvre des
courants lectriques et ses arrts
dapplication,
aux rgles de lart, en appliquant pour
les raliser la norme NF C 15-100
Installations lectriques basse tension.
Rgles.
Dans tous les cas, le chef dtablissement
devra :
1. Assurer une surveillance des
installations lectriques ayant pour but
principal de :
veiller au maintien en bon tat des
installations,
remdier aux causes de dfectuosit ou
anomalies.
2. Faire vrifier annuellement par une
personne ou un organisme qualifi toutes
les installations lectriques.
Ces vrifications font l'objet de rapports
qui doivent tre annexs au registre de
scurit.
11
116617
3/10/08
20:35
Page 12
3. Sassurer de la formation suffisante du
personnel habilit intervenir sur les
installations lectriques.
4. En cas danomalie constate dans
linstallation ou le matriel, intervenir
immdiatement ou mettre hors tension
linstallation ou le matriel (fig. 7).
5. Prendre des dispositions particulires
certains emplacements de travail.
6. Veiller au bon tat des cbles
prolongateurs et ne pas les employer
dautres usages que celui auquel ils sont
destins.
7. Nutiliser que des baladeuses
conformes la norme NF EN 60-598-2-8.
Dans les enceintes exigus de carrosserie,
les baladeuses doivent tre alimentes
une tension infrieure 50 V obtenue par
un transformateur de scurit conforme
la norme NF EN 61558-2-9.
Ce transformateur doit tre plac
lextrieur de lenceinte.
8. Veiller la mise la terre de tous les
appareils lectriques.
Toutes les masses des appareils devront
tre interconnectes et relies une prise
de terre.
Les prises de courant doivent tre
protges par un dispositif diffrentiel
haute sensibilit 30 mA dans les cas
suivants :
- prises de courant infrieures ou gales
32 A
- toutes les prises de courant dans les
locaux mouills
- toutes les prises de courant des
installations temporaires
- toutes les prises de courant installes
dans les vhicules automobiles.
9. Installer un clairage de scurit
conforme larrt du 26 fvrier 2003.
12
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Dcret 88-1056 du 14 novembre
1988 Protection des travailleurs
dans les tablissements qui
mettent en uvre des courants
lectriques
Arrt du 26 fvrier 2003 relatif
aux circuits et installations de
scurit
(Pour les risques dexplosions,
voir 1.3)
Normes
NF C 15-100 Rgles des
installations lectriques basse
tension
NF EN 60598-2-8 Baladeuses
(remplace NF C 71-008)
NF EN 61558-2-9 Scurit des
transformateurs, blocs
dalimentation et produits
analogues Partie 2-9 : rgles
particulires pour les
transformateurs pour
baladeuses de classe III pour
lampes filament de tungstne
Publications INRS
ED 325 Accidents dorigine
lectrique
ED 548 Llectricit. Comment
sen protger
ED 723 Protection des
travailleurs dans les
tablissements qui mettent en
uvre des courants lectriques
116617
3/10/08
20:35
Page 13
1.5 BRUIT
BRUIT
8. Exemple de protecteur doreilles pliant de poche
Lexposition
prolonge
du personnel
des bruits excessifs
peut conduire
des surdits
professionnelles
caractre irrversible.
Le tableau 1 indique les dures dexposition
aux bruits que peuvent supporter les
employs sans dommage pour lappareil
auditif, ainsi que les niveaux sonores
engendrs par des matriels courants.
Il est ncessaire de connatre les seuils
dexposition suivants, pour une exposition
sonore de 8 heures par jour ou de
40 heures par semaine :
le niveau global de 80 dB(A) ou de
135 dB(C)
en crte (*) doit tre considr comme
le seuil applicable en dessous duquel
aucun risque apprciable de surdit
professionnelle nest craindre,
le niveau global de 90 dB(A) ou de
140 dB(C) en crte doit tre considr
comme le seuil au-dessus duquel existe un
risque apprciable de surdit professionnelle.
(*) Le dcibel (dB) est lunit logarithmique qui
permet dvaluer les niveaux sonores. Dans la
pratique, on mesure les niveaux sonores
globaux en dcibel A (dB(A), cest--dire selon
une courbe de pondration A qui tient
compte de la subjectivit de loue humaine
aux sons de diffrentes frquences. Les
niveaux acoustiques de crte sont mesurs
en dB(C). (La courbe C est la pondration
applique aux niveaux levs)
Remarque : le dcret n2006-892 du 19 juillet 2006 introduit un lment nouveau qui est la valeur
limite ne dpasser en aucun cas. Elle est fixe 87 dB (A) et 140 dB (C) pour une journe de travail
de 8 heures.
TABLEAU 1
sources de bruit
Perforatrice pneumatique
Ponceuse disque (mesur 1 m)
Cabine dun engin de terrassement
Cabine dun gros dumper
Perceuse lectrique main
Habitacle dune voiture 100 km/h
Groupe de soudage larc
Cabine dun petit camion
Habitacle dune voiture 80 km/h
expositions aux bruits
niveau sonore en dB(A)
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
dure dexposition maximale
pour une semaine de 40 heures
46 secondes
2,4 minutes
7,5 minutes
24 minutes
75 minutes
4 heures
13 heures
40 heures
13
116617
3/10/08
20:35
Page 14
La rglementation fonde lesprit de la
prvention sur les deux principes suivants :
1. rduction du bruit au niveau le plus bas
possible,
2. exposition sonore compatible avec la
protection de loue.
Dune manire gnrale, lemployeur devra
prendre les dispositions suivantes :
Identifier tous les travailleurs pour
lesquels :
- lexposition sonore quotidienne atteint
ou dpasse le niveau de 80 dB(A),
- ou le niveau de pression acoustique de
crte atteint ou dpasse le niveau de
9. Compresseur dair dans local isol des ateliers et insonoris
14
135 dB(C).
Cette identification ralise,
Fournir, ces salaris exposs, des
protecteurs individuels.
Le port effectif de ces protecteurs peut
faire lobjet dune mention dans le
rglement intrieur ou dans les consignes
de scurit de ltablissement (fig. 8).
Par exemple, le port du casque anti-bruit
sera indispensable pour lutilisation de
certains outillages pneumatiques tels que
burins, boulonneuses, cls chocs pendant laquelle le niveau de 85 dB(A) est
dpass.
116617
3/10/08
20:35
Page 15
Les informer et leur dlivrer une
formation adapte.
Leur offrir un examen audiomtrique.
Ds lors que l'exposition sonore
quotidienne atteint ou dpasse le niveau
de 85 dB(A), ou le niveau de pression
acoustique de crte atteint ou dpasse
137 dB(C) : soumettre le salari une
surveillance mdicale approprie.
Baliser par des panneaux les lieux et
emplacements de travail o les niveaux
sonores sont susceptibles de dpasser
ces seuils dexposition.
Sassurer du port des protections
individuelles contre le bruit.
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Code du travail : Prvention des
risques dexposition au bruit :
R. 4431-1 R. 4437-4
Publications INRS
ED 707 Vos gueules les
dcibels !
ED 962 Techniques de rduction
du bruit en entreprise. Quelles
solutions, comment choisir
ED 997 Techniques de rduction
du bruit en entreprises.
Exemples de ralisation
TC 110 Une nouvelle
rglementation sur le bruit au
travail (DMT n107)
tablir un programme de rduction de
lexposition au bruit.
Ce programme pourra comporter
notamment :
1. le choix d'quipements ou de procds
silencieux ,
2. la suppression des bruits leur source
chaque fois que cela est possible
(silencieux sur chappement dair
comprim, choix doutillages moins
bruyants...),
3. lisolement des machines ou appareils
(encoffrement ou installation dans un local
indpendant) quand leur utilisation le
permet (compresseurs...) (fig. 9),
4. lattnuation des bruits leur source
lors de linstallation et de lentretien des
machines et appareils divers,
5. le traitement acoustique des lieux de
travail par lemploi dcrans, dabsorbants
acoustiques en plafond ou sur les parois...
Pour raliser ce programme, il est conseill
aux employeurs de prendre contact avec
des techniciens ou des entreprises
spcialiss dans la conception et la
ralisation de travaux disolation ou de
correction acoustique (cf. Bibliographie).
15
116617
3/10/08
20:35
Page 16
1.6 PRODUITS DANGEREUX
La diversit des
oprations
effectues expose
PRODUITS
les salaris des
DANGEREUX
risques importants
dus principalement
lutilisation ou
lmission de
produits dangereux
tels que hydrocarbures, huiles et graisses,
peintures, produits de nettoyage...
Le tableau 2 indique les principaux
produits employs et les risques quils
engendrent.
D'une manire gnrale, il est ncessaire de :
1. Former et informer le personnel sur les
risques et les moyens de prvention. Cela
pourra tre fait grce la notice tablie,
par le chef d'entreprise, pour chaque poste ou
situation de travail susceptible d'exposer des
10. Armoire anti-feu ventile pour un stockage peu
important de produits inflammables
11. Dispositif daspiration des gaz dchappement
avec enrouleur automatique
TABLEAU 2
OPRATIONS
SOURCES DEXPOSITION
Interventions sur carburateur
Distribution de carburant
Interventions avec moteur
en marche
Dgraissage des pices
PRODUITS
DANGEREUX
MANIPULS OU MIS
RISQUES
PRINCIPAUX
Gazole, essence,
(renfermant du benzne)
Incendie - explosion
Effets sur le sang (dont leucmie)
Gaz dchappement contenant
principalement oxyde de carbone,
oxyde dazote et particules fines
Maux de tte, fatigue, vertiges
nauses, perte de connaissance,
irritation des voies respiratoires
Hydrocarbures halogns
Solvants divers (white spirit,...)
Troubles neurologiques, cutans,
hpatiques, rnaux, cancers
Troubles neurologiques ou cutans
Mise en uvre de peintures,
apprts, mastic, vernis, colles
Xylne tolune
Troubles gastro-intestinaux
Solvants divers (white spirit, thers Troubles neurologiques ou cutans
de glycol...)
Pigments base de plomb
Saturnisme
(dans certaines peintures)
Emploi de certaines rsines
ou mastics
Isocyanates, rsines epoxy,
amines
Allergie : asthme, eczma
Ponage de carrosserie
Poussires
Affections cutanes, oculaires,
bronchopulmonaires
Vidange - graissage
Huiles et graisses
Affections cutanes
Changement ou nettoyage de
garnitures de frein et dembrayage
Fibres damiante
Cancers, abestose
Charge et entretien des batteries
Acide sulfurique
Hydrogne
(dgag pendant la charge)
Brlures
Explosion, incendie
16
116617
3/10/08
20:35
Page 17
116617
3/10/08
20:35
Page 18
produits chimiques. Les notices doivent
notamment faire apparatre les risques lis
l'exposition ces produits, les consignes
relatives l'utilisation des moyens de
prvention collectifs ou individuels et les rgles
d'hygine applicables. L'laboration de la
notice est obligatoire et elle doit tre actualise
chaque fois que cela est ncessaire.
2. Substituer les produits dangereux par
des produits non dangereux ou moins
dangereux partir du moment ou cela
est techniquement possible.
Dans le cas des produits classs comme
cancrognes, mutagnes ou toxiques
pour la reproduction, l'entreprise doit
pouvoir justifier qu'elle a bien effectu
une dmarche de prvention.
3. Mettre disposition du personnel les
fiches de donnes scurit des produits
dangereux utiliss.
4. Stocker tout produit dangereux dans
un ou plusieurs locaux spars de latelier.
Ces locaux seront correctement ventils,
construits en matriaux ignifuges et
lappareillage lectrique sera conforme aux
normes de scurit. Dans le cas de
stockage peu important de produits
inflammables, linstallation dune armoire
anti-feu ventile peut tre une solution
intressante (fig. 10). Dans le cas d'un
stockage de liquides dangereux (liquide
de refroidissement, huile, etc.), il est
recommand de raliser ce stockage
sur rtention.
5. Ne stocker proximit des postes
de travail que la quantit de produit
ncessaire une journe de travail
au maximum.
6. Prvoir des dispositifs de protection
collective (dispositifs de captage des
polluants leur point d'mission)
en particulier, un dispositif d'aspiration
la source des gaz d'chappement avec
rejet l'extrieur en un endroit tel qu'ils
ne puissent nuire au voisinage (fig. 11).
7. Mettre la disposition du personnel
tous les quipements de protection
individuelle ncessaires (lunettes, appareils
de protection respiratoire, gants, tabliers,
chaussures, bottes) suivant le type
d'opration effectuer. Prconiser l'usage
de gants notamment en cas de risque
de contact avec des huiles de moteur
usages qui contiennent des substances
18
12. Signaux de forme ronde,
fond bleu et schma blanc
impliquant une obligation
a. Port de lunettes obligatoire (
placer par exemple prs dun
poste de meulage)
b. Port dun casque antibruit
obligatoire (utilisation doutils
pneumatiques bruyants, bancs
dessais moteurs...)
c. Port de gants obligatoire
(soudage, manipulation
dlectrolyte des batteries...)
12a
12b
12c
116617
3/10/08
20:35
Page 19
13. Signaux de forme ronde et
de couleur rouge, fond blanc,
schma noir impliquant une
interdiction.
a. Feu nu et clairage non
protg interdits (stockage et
cabines de peinture, local de
charge des batteries...)
b. Dfense de fumer
15. Signaux de forme triangulaire,
fond jaune et schma noir
avertissant dun danger
a. Attention risque de feu (
placer par exemple sur la porte du
local de stockage de produits
inflammables)
b. Attention risque de commotion
lectrique ( placer sur les portes
dune armoire de distribution lectrique)
13a
15a
13b
15b
14. Signaux de forme rectangulaire (ou carre) fond
vert indiquant les itinraires dvacuation et les moyens de
secours : exemple, issue de secours situe sur la gauche
14a
14b
19
116617
3/10/08
20:35
Page 20
reconnues comme
cancrognes.
8. Veiller ce que le
personnel puisse se laver
correctement avec de leau
et du savon. Interdire, pour
cet usage, lemploi
dessence, gas-oil et de tout
solvant.
9. Respecter la priodicit
des visites mdicales
obligatoires.
10. Interdire de fumer.
11. Faire connatre la
signification des signaux de
scurit qui font lobjet de la
norme NF X 08-003 (fig. 12
15).
Les signaux sont dfinis par
leur couleur et par leur forme.
Couleurs :
rouge : interdiction
jaune : danger
vert : scurit
bleu : obligation-information
Formes circulaire :
interdiction ou obligation,
triangulaire : avertissement
de danger, carre ou
rectangulaire : information.
12. Faire connatre la
signification des symboles et
des couleurs des tiquettes
figurant sur les rcipients.
Les symboles noirs sur fond
orang-jaune
(rglementation europenne)
signalent des produits
dangereux : toxique, corrosif,
nocif, irritant, inflammable,
comburant et explosif (fig. 16
et 17).
13. Remettre aux
ramasseurs agrs les huiles
uses, car il est interdit de
les brler compte tenu de la
nocivit des rejets de
combustion.
14. Ne pas rejeter de dchets
dangereux liquides dans
le rseau d'assainissement
ou dans le milieu naturel.
20
NOM ET ADRESSE
DU FABRICANT
OU DU DISTRIBUTEUR
OU DE LIMPORTATEUR
NOM DE LA PRPARATION
Facilement inflammable
FACILEMENT INFLAMMABLE
Conserver dans un endroit bien ventil.
Conserver lcart de toute source dignition Ne pas fumer.
16a
NOM ET ADRESSE
DU FABRICANT
OU DU
DISTRIBUTEUR
OU DE
LIMPORTATEUR
Irritant
Facilement inflammable
NOM DE LA PRPARATION
Contient une RSINE POXYDIQUE
Produit de raction du bisphnol A et de lpichlorhydrine
(poids molculaire moyen 700).
FACILEMENT INFLAMMABLE
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU
PEUT ENTRANER UNE SENSIBILISATION
PAR CONTACT AVEC LA PEAU
Conserver lcart de toute source dignition Ne pas fumer.
Porter des gants appropris.
16b
16. Modles indicatifs dtiquettes :
a. pour un mlange de solvants
b. pour une peinture dont le point dclair est infrieur 21C
116617
3/10/08
20:35
Page 21
T+-Trs toxique
T-Toxique
Xn-Nocif
Xi-Irritant
O-Comburant
E-Explosif
F-Facilement
inflammable
F+-Extrmement
inflammable
C-Corrosif
N-Dangereux pour
lenvironnement
17. Symboles apposer
sur les tiquettes correspondant aux dangers prsents
par les substances ou prparations
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Code du travail : Prvention du
risque chimique : R. 4411-1
R. 4412-164
Mesures particulires de protection
contre les risques lis l'amiante :
R. 4412-94 R. 4412-148
Aration et assainissement
des lieux de travail : R. 4221-1
R. 4222-6
Normes
NF X 08-003-1 Symboles
graphiques et pictogrammes.
Couleurs de scurit et signaux
visuels de scurit. Partie 1 :
Principes de conception
NF X 08-003-3 Symboles
graphiques et pictogrammes.
Couleurs de scurit et signaux
visuels de scurit. Partie 3 :
Signaux visuels de scurit
normaliss
Publications INRS
CD Rom Les fiches
toxicologiques de lINRS,
CD 613, dition 2003 (aussi
disponibles lunit ou sur le
site Internet www.inrs.fr)
ED 744 Produit mchant.
votre travail ou chez vous, vous
utilisez des produits chimiques
ED 745 Produit mchant. Moi,
dans mon entreprise, jtiquette
TJ 5 Aration et assainisement
des lieux de travail
ED 753 Stockage et
transvasement des produits
chimiques dangereux
ED 809 Exposition lamiante
dans les travaux dentretien et
de maintenance. Guide de
prvention
ED 871 Vapeurs dessence...
Ne vous faites plus de mauvais
sang
ED 872 Les vapeurs dessence
sont nocives pour votre sant
ND 2174-188-02 Exposition au
benzne chez les mcaniciens.
valuation atmosphrique et
surveillance biologique
TJ 23 Prvention du risque
chimique sur les lieux de travail
Dossier web Amiante et fibres
Autre publication
Le guide de l'Environnement du
CNPA
21
116617
3/10/08
20:35
Page 22
2. TRAVAUX GNRAUX DATELIER
2.1 LEVAGE ET MANUTENTION
LEVAGE
ET
MANUTENTION
Dans la rparation
automobile,
4 accidents sur 10
interviennent lors
des manutentions et
principalement des
manipulations
manuelles.
Aussi, il est indispensable de :
1. Respecter les conseils numrs au
chapitre 1 et tout particulirement, veiller
au bon tat du sol (absence de trous) et
sa propret (absence de graisses et huiles).
2. Informer de manire approprie les
travailleurs chargs de la mise en uvre
ou de la maintenance des quipements
de travail et notamment des conditions
dutilisation des quipements de travail,
des instructions ou consignes les
concernant. Ces dispositions sont prvues
par larticle R. 4323-2 du code du travail.
3. Ne confier la conduite des appareils de
levage quaux personnes ayant reu une
formation adquate. Cette formation doit
tre complte et actualise chaque fois
que ncessaire.
4. Vrifier les appareils de levage, en
application de larrt du 1er mars 2004.
Cet arrt prvoit :
- Une vrification lors de la mise en
service, effectuer lors de la premire
utilisation de lappareil, neuf ou
doccasion, dans
ltablissement.
- Une vrification lors de la
remise en service, effectuer
lors de dmontage et
remontage, modification,
rparation importante ou
accident provoqu par la
dfaillance de lappareil.
20 bis. Dtail des dispositifs
de blocage des bras
22
- Des vrifications gnrales priodiques,
effectues intervalle rgulier, visant
dceler en temps utile toute dtrioration
susceptible de crer un danger.
Ces vrifications concernent les appareils
mus mcaniquement ainsi que les
appareils mus par la force humaine.
Le rsultat des vrifications doit tre
consign sur le registre de scurit ouvert
par le chef dtablissement.
Lorsque les appareils sont dfectueux, ils
doivent tre interdits dusage ou rpars
immdiatement.
2.1.1 MANUTENTIONS MANUELLES
Il convient de prendre certaines
prcautions :
pour viter les lombalgies et tours de
reins, former le personnel afin quil adopte
une position telle quelle ne fasse pas
travailler la colonne vertbrale en flexion
(stage gestes et postures),
mettre la disposition du personnel les
protections individuelles ncessaires,
- chaussures de scurit de prfrence en
matriaux insensibles aux hydrocarbures,
- gants de protection, etc.,
pour effectuer des tches rptitives,
adopter ou adapter des appareils destins
en faciliter leur excution et les rendre
moins pnibles et aussi plus rapides.
Exemples : supports de fts roulettes,
rtelier pour les pices dtaches,
ventouses poignes pour la manutention
des pare-brises, etc.,
116617
3/10/08
20:35
Page 23
utiliser un appareil de
manutention chaque fois
que cela est possible.
Exemples : portiques,
potences pivotantes,
palans, etc. (fig. 18).
2.1.2 MANUTENTIONS
MCANIQUES
Il est interdit de soulever,
hors essais ou preuve,
une charge suprieure
celle marque sur lappareil.
2.1.2.1 Ponts lvateurs
Outre les mesures de
scurit communes
lensemble des
quipements de travail, des
mesures particulires
concernant lutilisation des
appareils de levage sont
contenues dans les articles
R. 4323-29 R. 4323-57
du code du travail.
18. Grue datelier ou girafe , aide efficace
pour toutes manipulations de pices lourdes
19. Vrin de fosse hydraulique
Les points suivants
ncessitent une attention
particulire :
1. Zone de dplacement
de la plate-forme dlimite
et maintenue dgage en
permanence.
20. Pont lvateur 2 colonnes bras pivotants. Les consignes dutilisation sont inscrites
en un endroit parfaitement visible du pont (prs de la commande)
2. Dispositif de scurit
automatique et dun
contrle facile empchant
toute descente
intempestive.
3. Dispositif de retenue du
vhicule efficace ds la
monte.
Pour ce qui concerne les
contrles rglementaires
rguliers, voir la brochure
INRS ED 828.
23
116617
3/10/08
20:35
Page 24
Cas particuliers des ponts lvateurs
2 colonnes bras pivotant (fig. 20) :
Ils doivent tre munis dun dispositif de
verrouillage des bras mobiles interdisant la
modification de langle form par ceux-ci
sous un effort latral, une fois les points
de prise sous coque du vhicule dfinis.
Ce verrouillage doit tre automatique
(fig. 20 bis).
Le personnel doit tre mis en garde
contre le risque de renversement des
vhicules, surtout lorsquon enlve un
organe important tel que le moteur.
Arrter immdiatement tout pont lvateur
qui prsente une anomalie de
fonctionnement et notamment si
lappareil :
- monte par saccades,
- monte ou descend plus lentement
quhabituellement,
- prsente une fuite dhuile.
2.1.2.2 Chariots automoteurs
Compte tenu du poids des pices
dplacer, il est parfois utilis des chariots
automoteurs.
Leur mauvais usage peut tre lorigine
daccidents graves, aussi il est ncessaire
de :
21. Chandelle tripode
conue pour effectuer des calages
24
Ne confier la conduite des chariots
automoteurs quaux personnes formes et
ayant reu une autorisation de conduite
dlivre par lemployeur.
Larrt du 2 dcembre 1998 prvoit que
lautorisation de conduite soit dlivre aprs :
- un examen daptitude mdicale,
- un contrle des connaissances de
loprateur pour la conduite en scurit
(le CACES prconis par la Caisse nationale
de lassurance maladie est un bon moyen
pour satisfaire cette obligation),
- une connaissance des lieux et des instructions respecter sur le site dutilisation.
Pour la dlivrance de lautorisation de
conduite, se rfrer la recommandation
R 389 de la Caisse nationale dassurance
maladie.
Ne pas utiliser le chariot pour le transport
et llvation de personnes. Un chariot ne
doit servir qu lever, dposer ou dplacer
une charge.
Vrifier priodiquement les chariots tous
les 6 mois.
Respecter les rgles de conduite (voir
brochure INRS ED 766, Manuel de conduite
des chariots de manutention automoteurs).
2.1.2.3 Crics. Chandelles
Trs utiliss dans la rparation automobile,
les crics sont souvent mal entretenus.
22. Sommier roulant
permettant de travailler sous un vhicule
116617
9/10/08
11:48
Page 25
Un cric ne doit tre employ que sur un
sol nivel, sec, propre et plac de telle
manire que la charge lever ne puisse
pas chapper.
Il faudra veiller particulirement ce que :
1. la charge maximale dutilisation soit
inscrite sur le cric,
2. la vrification de chaque cric soit
effectue :
- tous les ans dans le cas gnral
(utilisation sur un mme site)
- tous les 6 mois en cas de changement
de site d'utilisation
- immdiatement aprs une utilisation
dans des conditions particulires,
notamment sil y a eu une surcharge
accidentelle.
Les crics ne doivent servir qu lever ou
descendre le vhicule.
Dans le cas dun travail sous un vhicule
lev :
- disposer un calage de manire protger
le personnel de la descente intempestive du
vhicule (chandelles, ...) ainsi que dun
dplacement horizontal (fig. 21),
- placer un dispositif signalant la prsence
dun travailleur,
- porter, si ncessaire, des lunettes de
protection et une coiffe,
- utiliser un sommier roulant (fig. 22).
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Code du travail : Utilisation des
quipements de travail : R. 4321-1
R. 4324-45
Vrification priodique : R. 4323-3
R. 4323-27
Maintien en conformit des quipements
de travail : R. 4322-1
Arrt du 1er mars 2004 fixant les
conditions de vrifications des
quipements de travail utiliss pour le
levage de charges, llvation de poste
de travail.
Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005
relative l'application de l'arrt du
1er mars 2004 relatif aux vrifications
des appareils et accessoires de levage,
de l'arrt du 2 mars 2004 relatif au carnet
de maintenance des appareils de levage.
Arrt du 2 mars 2004, relatif au carnet de
maintenance des appareils de levage.
Arrt du 2 dcembre 1998 relatif la
formation la conduite des quipements
de travail mobiles automoteurs et des
quipements de levage de charges ou
de personnes.
Normes
EN 1493 de dcembre 1998 lvateurs de
vhicules.
EN 1494 Crics mobiles ou dplaables et
quipements de levage associs.
EN 1726-1 Scurit des chariots de
manutention. Chariots automoteurs de
capacit n'excdant pas 10 000 kg et
tracteurs dont l'effort au crochet est
infrieur ou gal 20 000 N.
Partie 1 : Prescriptions gnrales.
EN 1726-1/A1 Scurit des chariots de
manutention. Chariots automoteurs de
capacit n'excdant pas 10 000 kg et
tracteurs dont l'effort au crochet est
infrieur ou gal 20 000 N.
Amendement 1 : systmes de retenue
de l'oprateur. Spcification et procdure
d'essai.
Publications INRS
ED 766 Chariots automoteurs de
manutention. Manuel de conduite
ED 812 Chariots automoteurs de manutention. Guide pour le choix et lutilisation
ED 828 Principales vrifications priodiques
25
116617
3/10/08
20:35
Page 26
2.2 OUTILS ET OUTILLAGES
Tout employeur est
responsable du bon
tat des outils et
outillages.
OUTILS
Les outils et
ET
outillages sont
OUTILLAGES
lorigine de
nombreuses
blessures
(particulirement
aux mains) occasionnant plus de 10 %
des accidents avec arrt de travail. Aussi,
il est indispensable de prendre les
prcautions suivantes :
1. Sinformer des capacits dutilisation et
des risques propres chaque outillage.
2. N'utiliser que des outils adapts
chaque utilisation et respecter les
prconisations d'usage du constructeur.
3. Utiliser les protections individuelles
ncessaires en fonction du travail
effectuer. Ex. : lunettes pour meulage,
masque de soudage, etc. (fig. 23 et 24).
4. Ne pas dtourner lattention dune
personne en train dutiliser un outillage.
5. Ne pas utiliser doutils dfectueux.
Ex. : manche de marteau abm, burin
ayant la tte crase, cl plate dforme...
6. Toujours garder les outils en conformit
avec leurs caractristiques d'origine (il en
va de mme pour les machines utilises
dans les garages).
7. En ce qui concerne les outillages
lectriques portatifs, choisir de prfrence
du matriel de classe II double isolation.
Ces appareils doivent porter le symbole
sur leur plaque signaltique et dans ce
cas ne doivent pas tre relis la terre.
- Sassurer quun dispositif de commande
action maintenue permet loprateur
de les arrter tout moment.
23. Utiliser pour le polissage un systme pneumatique aspiration intgre et des lunettes compltement fermes
26
116617
3/10/08
20:35
Page 27
Il serait souhaitable que tous ces appareils
soient conus de manire viter tout
dmarrage intempestif lorsque la tension
dalimentation est rtablie aprs une
interruption.
- Ne pas tirer sur le cble dalimentation
pour le dbrancher.
- Dbrancher tout appareil inutilis mme
pendant une courte priode.
BIBLIOGRAPHIE
Publications INRS
ED 940 La main et la machine,
8. Utiliser de prfrence de loutillage
pneumatique pour viter le risque
lectrique.
24. Ne jamais meuler sans protection
27
116617
3/10/08
20:35
Page 28
2.3 MACHINES ET APPAREILS
SPCIAUX
Certains
tablissements,
selon leur
MACHINES
importance, utilisent
ET
diffrentes machines
APPAREILS
et appareils
SPCIAUX
spciaux qui
peuvent se classer
dans les familles suivantes :
Machines-outils pour les travaux de
mcanique gnrale : tour, fraiseuse,
perceuse, rectifieuse.
Machines ou appareils spciaux
tels que :
- machines river les garnitures
- appareils dmonte-pneus
- bancs dessais : moteurs, pompes
injection, dmarreurs, alternateurs...
Presses pour le dmontage ou le
remontage de roulements ou organes
mcaniques...
Machines meuler.
Machines portatives : perceuses,
visseuses, poneuses...
Compresseurs dair.
Pour les autres machines, celles-ci
devront tre au moins conformes aux
dispositions des articles R. 4324-1
R. 4324-23 du code du travail qui fixent
les prescriptions techniques auxquelles
doivent satisfaire les machines et
quipements de travail en service ou
vendus doccasion.
2.3.1 RGLES GNRALES
Les machines mises en service ltat
neuf partir du 1er janvier 1995 sont
soumises aux dispositions des articles
R. 4311-1 R. 4314-15 du code du travail.
Cette rglementation issue de directives
europennes, impose aux constructeurs
Pour les machines quilibrer les
roues : disposer un protecteur asservi la
marche de la machine pour viter la
projection des cailloux qui auraient pu
demeurer dans le pneumatique (fig. 25).
dune part, deux types dobligations :
- le respect des rgles techniques listes
et dfinies dans lannexe 1 de
lart. R. 4312-1,
- le suivi de procdures de certification de
conformit dfinies dans les articles
R. 4313-1 R. 4313-58. noter que
lAutocertification CE concerne une trs
grande majorit de machines
et, dautre part, des formalits
respecter, savoir :
- tablir une dclaration CE de
conformit et la remettre au preneur lors
de la mise disposition de la machine,
- apposer un marquage CE de
conformit sur la machine de manire
distincte, lisible et indlbile,
- tablir une documentation technique.
28
2.3.2 APPAREILS SPCIAUX
Sont regroups sous cette dnomination
des machines et appareils spcialement
conus pour le montage-dmontage ou le
rglage dorganes de vhicules
automobiles.
noter, en particulier :
Pour les appareils dmonte-pneus (cf.
brochure sur les pneumatiques ED 961) :
- prvoir un dispositif de commande
action maintenue, cest--dire tel que le
mouvement sarrte ds que loprateur
cesse dappuyer sur le bouton marche,
- disposer, quand cela est possible, des
protecteurs dans les zones qui prsentent
un risque de coincement ou de
cisaillement.
Pour les presses destines dmonter
et monter les roulements, bagues,
axes... : mettre en place un protecteur
dune rsistance suffisante pour sopposer
la projection dclats mtalliques
conscutifs la rupture, par exemple,
dune cage de roulement.
Pour les appareils tarer les injecteurs :
installer devant ceux-ci un protecteur
asservi afin que loprateur ne puisse tre
bless par le jet sortant de linjecteur
(cf. 3.1 Mise en uvre des fluides sous
haute pression). Louverture du protecteur
devra donc arrter la pompe pour faire
chuter la pression.
Pour les bancs dessais de freinage :
installer des protecteurs conus de
manire ce que les employs ne
puissent pas tre entrans par les
rouleaux (fig. 26).
116617
3/10/08
20:35
Page 29
2.3.3 MEULES ET
MACHINES MEULER
Leur utilisation et leur
entretien sont soumis
aux prescriptions de
textes rglementaires
(dcret n 2003-158 du
25 fvrier 2003) et ne
doivent tre confis qu
des ouvriers qualifis.
MEULES
25. Aprs montage de la roue, loprateur doit remettre en place le protecteur
pour faire fonctionner la machine
26. Banc dessais de freinage muni de protecteurs mobiles
1. tiqueter chaque
meule (date de livraison).
2. Stocker dans un local
sec non soumis de
brusques variations de
temprature.
3. Avant montage,
effectuer un examen
visuel de toutes les
meules, contrler et
sonner les meules
vitrifies avec un maillet
en bois : si le son rendu
est mat (sans
rsonance), la meule
doit tre rejete.
4. Aprs montage, faire
tourner la meule la
main et vrifier quelle
ne prsente ni voile ni
faux rond.
MACHINES MEULER
1. Inspecter
priodiquement les
machines meuler et
veiller rgler le support
de pice 2 mm de la
meule et le pare-tincelles
6 mm de la meule.
2. Arrter toute machine
meuler sil est constat
une anomalie quelconque
et particulirement en cas
de vibrations.
3. Vrifier que les
dispositifs de protection
sont en place et en bon
tat (fig. 27).
4. Porter des lunettes
de protection.
29
116617
3/10/08
20:35
Page 30
5. Sassurer que le rglement datelier fixant
toutes les consignes de scurit relatives
lutilisation des machines meuler est
affich. Cet affichage est obligatoire (arrt
du 28 juillet 1961).
De plus, en ce qui concerne les machines
meuler portatives, il est ncessaire de
vrifier que :
1. le rgulateur de vitesse est efficace en
contrlant la vitesse vide de la broche
laide dun tachymtre (meuleuses
pneumatiques),
2. la vitesse maximale dutilisation
indique sur la meule est suprieure ou
gale celle de la broche,
3. la pression dair est correcte (cas des
meuleuses pneumatiques),
4. les meules destines des travaux de
trononnage ne sont pas utilises pour
dautres travaux (barbage par exemple).
En outre, il ne faut pas poser brutalement
la machine et prvoir aux postes de travail
un support afin dviter les chocs qui
peuvent endommager la meule.
2.3.4 CIRCUIT DAIR COMPRIM.
COMPRESSEUR. SOUFFLETTE
Tous les ateliers sont munis dun rseau
de distribution dair comprim dont les
utilisations sont multiples :
- gonflage des pneumatiques
- alimentation de certains outillages : cls
27. Touret meuler avec ses dispositifs de protection
30
chocs, soufflette...
- distribution des graisses et huiles
- pistolets de pulvrisation pour la peinture.
COMPRESSEUR
Le ou les compresseurs alimentant ce
rseau seront du type insonoris ou alors
installs dans un local spar.
De plus, ils seront munis dorganes de
protection adapts.
Lorsquils sont quips dun rservoir,
ils sont soumis :
soit la rglementation concernant les
rcipients pression simple (arrt
ministriel du 14 dcembre 1989 modifi
portant application de la directive
n 87-404 CEE) si la cuve rpond aux
critres de dfinition de ces rcipients,
soit la rglementation sur les
quipements sous pression :
- dcret n 99-1046 du 13 dcembre 1999
modifi relatif aux quipements
sous pression et arrt ministriel
du 21 dcembre 1999 relatif la
classification et lvaluation
des quipements sous pression pour
les compresseurs mis en service aprs
le 29 mai 2002,
- dcret du 18 janvier 1943 modifi
portant rglement sur les appareils
pression de gaz et arrt ministriel du
23 juillet 1943 rglementant les appareils
116617
9/10/08
11:25
Page 31
de production, demmagasinage ou
de mise en uvre des gaz comprims
ou dissous pour les compresseurs
mis en service avant le 29 novembre 1999,
- lun ou lautre des deux dcrets et
arrts prcits pour les compresseurs
mis en service entre le 29 novembre 1999
et le 29 mai 2002.
Les dispositions rglementaires concernant
lexploitation des compresseurs munis dun
rservoir sont fixs :
- par larrt du 15 mars 2000 modifi
pour les compresseurs soumis la
rglementation sur les quipements sous
pression,
- par le dcret du 18 janvier 1943 modifi
et larrt ministriel du 14 dcembre 1989
modifi pour les compresseurs soumis
la rglementation sur les appareils
pression simples.
En outre, il faudra vrifier priodiquement
le fonctionnement des organes de
contrle et de scurit et particulirement
le manomtre et la soupape de scurit.
Aucune vanne ne doit tre place entre le
rservoir et la soupape de sret.
Des inspections priodiques ralises par
un organisme habilit ou par une personne
comptente de lexploitant doivent tre
effectues tous les 40 mois et des
requalifications priodiques (ou des
rpreuves pour les appareils pression
simples) doivent tre ralises par un expert
dun organisme agr tous les 10 ans.
D'autre part, d'une manire gnrale, il est
obligatoire de tenir un registre de scurit
des machines qui permet, entre autres,
l'archivage des documents attestant de leur
contrle.
SOUFFLETTE
La soufflette air comprim, couramment
utilise peut savrer dangereuse car elle
disperse les poussires et les liquides
sous forme darosols.
Sans proscrire lusage de soufflettes en
toutes circonstances, il est conseill de :
- les alimenter une pression infrieure
2,5 bars (dtendeur en amont),
- utiliser des modles munis de diffuseur, afin
de limiter la projection de matires solides.
Par contre, en interdire lusage dans les
cas principaux suivants :
Schage des pices
Aprs dgraissage, celles-ci seront
sches dans une hotte aspirante.
Schage des vtements de travail
Lorsquun mcanicien a son vtement de
travail souill par du gas-oil ou un solvant
il peut tre tent de le scher laide
dune soufflette.
Cette pratique peut tre trs dangereuse
car lair comprim pntre dans les
cellules du corps humain et peut entraner
des lsions graves.
Dpoussirage des freins.
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Code du travail :
Utilisation des quipements de travail :
L. 4321-1 L. 4321-5, R. 4321-1
R. 4324-45
Obligation de scurit, certification, rgles
techniques de conception et de construction
des quipements de travail : L. 4321-1,
R. 4311-1 R. 4314-5
Vrifications priodiques des quipements de
travail : R. 4323-23 R. 4323-27
Maintien en conformit des quipements de
travail : R. 4322-1
Normes
NF EN 792-7 Meuleuses portatives non
lectriques
NF EN 792-9 Meuleuses doutillage portatives
non lectriques
NF EN 13218 Machines meuler fixes
NF EN 50144-2-3, NF EN 50144-2-3/A1, NF
EN 50144-2-3/A2 Scurit des outils
lectroportatifs moteur. Rgles particulires
pour les meuleuses, ponceuses de type
disque et lustreuses
Publications INRS
ED 54 Les machines neuves CE
ED 113 Les machines doccasion et les
accessoires de levage
ED 770 Machines et quipements de travail.
Mise en conformit
ED 804 Conception des quipements de
travail et des moyens de protection
ED 807 Scurit des machines et des
quipements de travail. Moyens de protection
contre les risques mcaniques
ED 961 Oprations d'entretien et de
remplacement des pneumatiques.
Guide de scurit.
31
116617
3/10/08
20:35
Page 32
2.4 SOUDAGE
- Explosion ou incendie du fait du travail
en point chaud et de lutilisation de gaz
combustibles et comburants.
RISQUES
PRINCIPAUX
MESURES PRVENTIVES
- Toxicit des
fumes et des gaz
SOUDAGE
produits par le
soudage.
- Projection des
particules
mtalliques
brlantes particulirement lors des
oprations de dcoupe.
- Contact avec des pices chaudes ou la
flamme du chalumeau.
- Rayonnement mis par larc pouvant
affecter les yeux (coups darc) et la peau
(coups de soleil).
- Rayonnement lectromagntique d au
courant de soudage.
1. Disposer des extincteurs prs des
emplacements de soudage
(cf. 1.3 Incendie et lutte contre le feu).
2. Ne pas entreprendre des travaux de
soudage proximit de produits
inflammables (notamment des rservoirs
dessence et de gas-oil) ou dans une
atmosphre prsentant des dangers
dexplosion.
3. Prvoir des dispositifs daspiration des
fumes, permettant de capter celles-ci au
plus prs de leur source dmission et les
vacuer directement au dehors du local
de travail (fig. 29).
Intensit du courant en ampres
Procd
1,5
10
15
30
lectrodes
enrobes
40
60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
MAG
8
8
TIG
10
9
11
10
11
10
MIG sur
mtaux lourds
12
12
10
MIG sur
alliages lgers
11
10
Gougeage
air-arc
11
10 11
Coupage au
jet de plasma
Soudage
micro-plasma
4
1,5
5
6
10
6
15
30
7
40
10
10
11
14
12
11
13
13
13
12
13
12
14
13
12
12
11
13
14
14
14
15
13
12
60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Intensit du courant en ampres
Ce tableau permet loprateur de lire lintersection de la colonne correspondant lintensit du courant et de la ligne
mentionnant le procd de soudage, le numro du filtre qui doit guider son choix. Loprateur devra, partir de cette
indication, procder un essai direct et, le cas chant, accrotre ou diminuer lopacit dun chelon pour obtenir les
conditions de vision qui lui conviennent pour lexcution de la tche quil a accomplir
28. Guide pour le choix de filtres de protection oculaire en fonction du procd de soudage larc et de lintensit
du courant (daprs la norme NF EN 169)
32
116617
3/10/08
20:35
Page 33
29. Poste de soudage quip
dune buse mobile daspiration des fumes
116617
9/10/08
11:25
Page 34
une valeur l'tat fonc prdtermine
par l'oprateur lorsque l'arc de soudage
est amorc (voir la norme NF EN 379) ;
- automatiques, qui commutent leur
facteur de transmission dans le visible
une valeur l'tat fonc rgle
automatiquement en fonction de
l'clairement lumineux gnr par l'arc
de soudage (voir la norme NF EN 379).
4. Sassurer du nettoyage des pices
assembler (les peintures, solvants et
graisses pouvant propager la flamme et
dgager des fumes toxiques).
5. En cas de soudage en atmosphre
confine, utiliser des masques
respiratoires et ventiler nergiquement.
6. Mettre la disposition du personnel
des moyens de protection individuelle
adapts tels que gants, gutres, lunettes
de sret, masques, etc.
Lopacit des filtres de soudage sera
choisie en fonction de la technique de
soudage utilise (fig. 28, 28 bis et 28 ter).
Pour le soudage l'arc, sont disponibles
sur le march des filtres :
- possdant un n d'chelon l'tat clair
et l'tat fonc prdtermins par
construction (voir la norme NF EN 169) ;
- commutables, qui commutent leur
facteur de transmission dans le visible
Il est recommand de se rapprocher
des fabricants de ce type de protection,
tant pour le choix que pour dfinir les
conditions de l'utilisation, en particulier
pour les protections commutables et
automatiques.
Pour les procds tels que l'oxycoupage,
le soudage au gaz et le soudo-brasage,
le n d'chelon de la protection doit
tre dtermin en fonction des dbits
des chalumeaux, selon les tableaux 28 bis
et 28 ter.
28 bis. Numros dchelon a) utiliser pour le soudage au gaz et le soudo-brasage
q 70
TRAVAIL
70 < q 200
200 < q 800
q > 800
Soudage et soudo-brasage
4
NOTE q = dbit dactylne en litres par heure.
a) Selon les conditions duitlisation, le numro dchelon immdiatement suprieur ou le numro dchelon
immdiatement infrieur peuvent tre utiliss.
28 ter. Numros dchelon
TRAVAIL
a)
utiliser pour loxycoupage
900 q 2000
Oxycoupage
5
NOTE q = dbit doxygne en litres par heure.
2000 < q 4000
4000 < q 8000
a) Selon les conditions duitlisation, le numro dchelon immdiatement suprieur ou le numro dchelon
immdiatement infrieur peuvent tre utiliss.
7. Les courants mis en uvre par les
procds de soudage l'arc ou par
rsistance sont l'origine de champs
lectriques et magntiques. La protection
des oprateurs contre cette exposition
doit tre assure.
L'valuation des moyens de soudage, en vue
de leur mise sur le march, est prsente :
- pour les procds de soudage l'arc :
dans le projet de norme 50444
- pour les procds de soudage par
rsistance : dans le projet de norme 50505
Cependant, l'valuation de l'exposition en
situation relle doit tre ralise au poste
de travail afin de respecter les exigences
de la directive 2004/40/CE*.
Cette valuation tant complexe, seul le
fournisseur du matriel de soudage est en
mesure de la raliser pralablement et de
donner les consignes d'installation et
d'utilisation appropries son matriel de
soudage.
(*) Cependant, la directive 2008/46/CE reporte la transposition de la directive 2004/40/CE, initialement prvue au 30-42008, au 30-4-2012. Mais, la directive 2004/40/CE nest pas annule, elle va tre revue sur le fond dici le 30-4-2012.
34
116617
3/10/08
20:35
Page 35
Ces consignes peuvent recouvrir, par
exemple, l'installation des cbles, les
distances de scurit minimales
respecter tant par rapport aux cbles
qu'au matriel de soudage, pistolets et
torches dans les diffrentes postures de
soudage. Des recommandations
particulires applicables lors de rparation
ou de certaines oprations de
maintenance doivent aussi tre fournies.
Une attention particulire doit tre
apporte au personnel implant avec un
implant actif (dfibrillateur, pacemaker,
pompe insuline). Dans ce cas une
valuation particulire doit tre ralise au
cas par cas en prsence du mdecin du
travail et du mdecin qui a ralis
l'implantation.
Les implants passifs (prothses diverses)
constitus de matriaux mtalliques
peuvent aussi s'chauffer du fait des
courants induits dans ces matriaux.
L'utilisation d'outillages en matriaux
ferromagntiques ou paramagntiques
doit tre proscrite dans des environnements
ou l'induction magntique est susceptible
de dpasser 3mT, afin d'viter le risque de
projection de ces objets.
Le public (les clients) ne doit pas tre
autoris s'approcher des zones de
soudage, pour les mmes raisons.
C'est pourquoi ces zones doivent tre
largement dlimites.
SOUDAGE ET COUPAGE AUX GAZ
1. Stocker les bouteilles de la manire
suivante :
- dans un local sec, bien ventil, loign
de tout matriau combustible et de toute
source de chaleur, et spar de latelier
de rparation,
- verticalement, robinet ferm, muni de
leur chapeau de protection, stockes de
manire ne pouvoir tomber et de faon
ce que leur identification soit
parfaitement visible.
Les couleurs normalises, pour les gaz
les plus usuellement utiliss dans les
garages sont :
Oxygne = blanc
Actylne = marron clair
Argon = vert fonc
- en sparant les bouteilles pleines des
bouteilles vides ces dernires devant, elles
aussi, tre stockes robinet ferm et
munies de leur chapeau de protection.
2. Vrifier le bon tat des tuyaux,
manomtres, chalumeaux, liminer tout
appareil douteux et sassurer que laiguille
des manomtres revient zro aprs
purge des canalisations.
3. Nutiliser que des chalumeaux munis de
dispositifs anti-retour de gaz et pareflamme.
4. Ne pas utiliser loxygne pour ventiler,
ce qui risquerait denflammer les corps
gras ou chiffons.
Pour la mme raison ne pas graisser les
dispositifs (robinet, manomtre, etc.) en
contact avec loxygne pur.
SOUDAGE ET COUPAGE LARC
1. Installer autour de lemplacement de
soudage des crans de protection
incombustibles pour viter les coups
darc aux personnes circulant aux
alentours ainsi que les projections de
mtal en fusion.
2. Peindre les murs des emplacements de
soudage avec un peinture absorbant le
rayonnement ultra-violet : couleur noir mat
par exemple.
3. Dbrancher la batterie du vhicule en
retirant dabord la borne ngative et
interconnecter la pice souder les
masses et les lments conducteurs
avoisinants afin dassurer une liaison
quipotentielle.
BIBLIOGRAPHIE
Publications INRS
ED 83 Le soudage manuel
larc avec lectrodes enrobes
ED 87 Codage couleur des
bouteilles gaz transportables
ED 668 Guide pratique de
ventilation 7. Oprations de
soudage larc
ED 742 Soudage et coupage au
chalumeau
35
116617
3/10/08
20:35
Page 36
3. TRAVAUX SPCIFIQUES DIVERS
3.1 MISE EN UVRE DE FLUIDES
SOUS HAUTE PRESSION
Lutilisation de fluide
sous haute pression
engendre
essentiellement le
risque dinjection
accidentelle de fluide
dans les tissus du
corps humain.
Par exemple,
linjection de produit dans un doigt peut
avoir comme consquence extrme
lamputation du doigt ou son atrophie
(fig. 30).
MISE
EN UVRE
DE FLUIDE
SOUS HAUTE
PRESSION
Plusieurs types de fluides peuvent tre mis
en uvre sous haute pression, notamment
dans les oprations suivantes :
1. Lavage sous haute pression (jusqu
100 ou 150 bars) avec de leau froide ou
chaude additionne le plus souvent de
produits auxiliaires (dtergents,
dtartrants, plastifiants autoschants...)
pour le nettoyage des vhicules ou
dorganes mcaniques, la prparation
avant peinture, la protection des surfaces.
2. Graissage des vhicules avec un
pistolet haute pression (250 350 bars).
3. Peinture au pistolet par diffrentes
mthodes (sous pression air-less,
lectrostatique, pneumo-lectrostatique),
des pressions pouvant atteindre 400 bars,
selon les peintures et solvants utiliss.
4. Tarage des injecteurs de moteur diesel.
30. Blessure lindex par pistolet de graissage
a) La plaie cause par lentre de la graisse
est parfaitement visible
b) Aspects de la blessure aprs une premire intervention
consistant en une greffe de peau.
Latrophie du doigt est associe une perte de sensibilit
c) Aprs une deuxime intervention, la sensibilit est
redevenue bonne et la mobilit suffisante ;
cependant, le doigt conserve une difformit
36
116617
3/10/08
20:35
Page 37
MESURES PRVENTIVES
Il est ncessaire, lors de la mise en uvre
de fluides sous haute pression, de :
1. Vrifier priodiquement les dispositifs de
scurit des groupes gnrateurs :
manomtres, soupapes, clapets de sret,
dispositifs darrts durgence...
2. Vrifier particulirement le dispositif de
commande action maintenue de tous
les pistolets.
3. Vrifier le bon tat des flexibles et
pendant leur utilisation se mfier des
artes et angles vifs qui peuvent les
dtriorer.
4. Ne jamais mettre la main devant un
pistolet (mme avec un chiffon) une buse,
un injecteur lorsque linstallation laquelle
ils sont raccords est en pression.
5. Ne jamais tenter de dmonter un
appareil sans sassurer que la pression est
nulle.
3.2. LAVAGE. NETTOYAGE.
DGRAISSAGE
Diverses oprations
de nettoyage
peuvent tre
LAVAGE
excutes :
NETTOYAGE
Lavage du
DGRAISSAGE
vhicule lui-mme
qui peut seffectuer
avec des machines
travaillant
diffrentes pressions et tempratures
deau additionne le plus souvent de
produits dtergents.
Nettoyage des sous-ensembles
dmonts avant deffectuer leur rparation
impliquant un lavage, un dgraissage ou
un dpoussirage pralable.
Dpoussirage interne des vhicules.
RISQUES
1. Projection de corps trangers (boues,
graviers...) par leffet dynamique du jet
deau ou du jet dair lors de lutilisation
des soufflettes air comprim.
2. Blessures causes par limpact du jet
liquide dont la pression peut atteindre
150 bars (cf. 3.1).
3. Brlures causes par le jet deau
chaude ou de vapeur et par contact avec
la lance de lavage.
4. Troubles pulmonaires ou cutans dus
aux produits dtergents ou dgraissants.
5. Chutes causes par glissades sur le sol
mouill.
MESURES PRVENTIVES
1. Faire porter aux oprateurs des lunettes
et des vtements de protection adapts.
2. Organiser le poste de travail de manire
ce que les employs circulant
proximit de laire de lavage ne puissent
tre atteints par le jet.
3. Sassurer du bon tat de linstallation
lectrique et de la mise la terre de tous
les appareils.
37
116617
3/10/08
20:35
Page 38
4. Revtir les aires de lavage dun matriau
antidrapant et donner au personnel des
chaussures adaptes.
5. Prvoir une ventilation du poste de
lavage si cette opration est effectue
lintrieur dun btiment.
6. S'assurer de la prsence ou de
l'efficacit du systme de prtraitement
des eaux uses (eaux de lavage des
voitures ou du sol du garage) dont le rejet
l'gout doit tre accept par l'organisme
en charge du rseau l'aide d'une
autorisation de dversement.
Ce systme dvacuation devra comporter
un dshuileur et un bac de dcantation
(ventuellement combins en un seul
appareil) dont la fonction est de retenir :
- les hydrocarbures
- les terres et corps solides dont sont
charges les eaux uses.
7. Ne jamais utiliser de produits
inflammables pour nettoyer une pice.
8. Dans le cas de nettoyage de pices par
trempage, utiliser des installations
ventiles, quipes de bacs de trempage
avec couvercles articuls et bacs de
rtention.
9. Concernant l'activit de rparation
mcanique, pour le dgraissage des
pices, utiliser de prfrence des
fontaines dites biologiques (sans
solvant et utilisant un systme de
rgnration de la solution par
biodgradation).
31. Escalier de fosse de visite : les marches sont constitues de caillebotis antidrapants
(la disposition de lescalier dans le sens longitudinal de la fosse permettrait un accs plus
ais dans celle-ci)
38
116617
3/10/08
20:35
Page 39
3.3 FOSSES DE VISITE
FOSSES
DE
VISITE
Dune manire
gnrale il est
prfrable de
disposer de ponts
lvateurs (cf. 2.1)
plutt que de fosses
de visite. Cependant
celles-ci sont
encore couramment
utilises.
RISQUES
Les fosses sont lorigine daccidents
souvent graves dont les causes principales
sont les suivantes :
- chutes dans les fosses
- incendies et parfois explosions
- intoxication par les gaz dchappement.
MESURES PRVENTIVES
1. Prvoir chaque extrmit de la fosse
un escalier afin den faciliter laccs.
Ces escaliers seront munis de marches
antidrapantes (mtal dploy, bton
revtu de grains de corindon...). Lusage
du bois est fortement dconseill, car il
devient rapidement glissant en prsence
de produits gras (fig. 31).
2. Quand la fosse est inutilise, lentourer
dun garde-corps solide
(ou ventuellement la recouvrir, ce qui
souvent nest pas fait car il faut alors
manutentionner des pices lourdes).
Une solution lgante consiste installer
des barrires relevables (fig. 32).
Ce type de barrire peut sinstaller sur
tous les types de fosses.
32. Fosse de visite quipe dune barrire de protection escamotable
39
116617
3/10/08
20:35
Page 40
3. Entourer la fosse dune plinthe qui
sopposera la chute des outils.
BIBLIOGRAPHIE
4. Nettoyer la fosse et ses dispositifs
daccs (sol lgrement en pente avec
regard dvacuation).
Publication INRS
R 331 Recommandation de la
CNAM. Fosses de visite pour
vhicules automobiles
5. Sassurer du bon tat de linstallation
lectrique qui doit rsister aux chocs
mcaniques ainsi qu la prsence
ventuelle deau et dhydrocarbures.
Lclairage sera install de prfrence
sous verre dormant.
6. Brancher les dispositifs de captage des
gaz dchappement chaque fois que
lon effectue un rglage de moteur.
7. Interdire le nettoyage de pices dans la
fosse et au-dessus de celle-ci.
8. Ne pas introduire de flamme nue dans
la fosse.
9. Installer un dispositif de ventilation au
fond de la fosse.
10. Installer un extincteur chaque
extrmit de la fosse.
11. Sassurer que la position du vhicule
sur la fosse nobstrue pas les dispositifs
daccs.
40
116617
3/10/08
20:35
Page 41
3.4 PRPARATION ET MISE EN
PEINTURE DES VHICULES
RISQUES
PRPARATION
ET MISE EN
PEINTURE
DES
VHICULES
La mise en peinture
des vhicules et les
oprations
prliminaires quelle
ncessite (dgraissage, dcapage,
ponage...)
prsentent des risques importants :
Intoxication par ingestion ou surcharge
pulmonaire par inhalation de poussires
provoques par le ponage ou le piquage
de carrosseries ou de sous-ensembles.
Intoxication par inhalation de produits
toxiques, solvants de peinture en
particulier (cf. 1.6. Produits dangereux et
toxiques).
Ces intoxications peuvent provoquer un
certain nombre de maladies
professionnelles rsumes dans le
tableau 3 ci-aprs.
TABLEAU 3. Tableau des maladies professionnelles retenir pour les travaux de peinture
Produits
Utilisation
n de tableau
Maladies
plomb et composs
du plomb
pigments
de certaines peintures
troubles digestifs
(coliques de plomb),
neurologiques
(paralysie priphrique
et troubles crbraux),
rnaux et
hmatologiques
(anmie)
tolune, xylne,
solvants contenus dans
certaines peintures
4 bis
troubles gastrointestinaux apyrtiques
hydrocarbures
halogns
produits de dgraissage
12
troubles neurologiques,
cutano-muqueux,
rnaux, hpatiques,
cardio-respiratoires
et digestifs
solvants divers
(thers de glycol, alcools,
ctones, hydrocarbures
aliphatiques, etc...
peintures, diluants
produits de dcapage,
nettoyage et rebouchage
des carrosseries
84
atteintes cutanes
et neurologiques
isocyanates
durcisseurs (peintures
polyurthannes)
62
rhinopharyngite,
bronchite, asthme
rsines poxydiques
produits de rebouchage
pour carrosseries
51
dermites, eczmas
amines aliphatiques
et alicycliques
- durcisseur des rsines
poxydiques
- amines de neutralisation
(peintures en phase aqueuse)
49, 49 bis
dermites, asthme
amines aromatiques
durcisseur des rsines
poxydiques
15, 15 bis,
15 ter
dermites, troubles
neurologiques
et hmatologiques,
cancers
41
116617
3/10/08
20:35
Page 42
Incendies dans les installations de mise
en peinture (cabine de pulvrisation et de
schage, bac de prparation de peintures,
stockage des produits et des dchets, etc.)
Explosion due aux vapeurs de solvants
inflammables (cf. 1.3 Incendie, Explosion).
RGLEMENTATION
Art. R. 4312-3 R. 4312-22 du code
du travail relatifs aux cabines de peinture.
Arrt du 3 mai 1990 pris en application
des art. R. 4311-4-7 et R. 4312-7
al. 1 du code du travail prcisant
les vitesses de ventilation des cabines
de projection destines lemploi
de peintures liquides ou de vernis.
Dcret 47-1619 du 23 aot 1947
modifi visant la protection des travailleurs
qui excutent des travaux de peinture,
ou de vernissage par pulvrisation.
33. Poste de prparation des peintures (pese) avec aspiration frontale.
En arrire plan, le stockage des peintures en pots.
42
116617
3/10/08
20:35
Page 43
Arrt du 11 juillet 1977 fixant la liste
des travaux ncessitant une surveillance
mdicale spciale.
Rubrique n 2930.2 : Application,
cuisson, schage de vernis, peinture,
apprt sur vhicules et engins moteur.
MESURES PRVENTIVES
1. Stockage des produits
(peintures, diluants et solvants)
- stocker les produits dans un local
indpendant et bien ventil dont lclairage
sera conu sous verre dormant et ny
utiliser et installer que des appareils
lectriques utilisables en atmosphre
explosible,
- y interdire de fumer et afficher clairement
cette interdiction,
- veiller ne mettre disposition sur les
lieux dutilisation que les quantits de
produits ncessaires un jour de travail,
- prvoir une rtention.
2. Prparation des produits
La prparation des peintures ncessite
deffectuer des mlanges de produits et
de les agiter pour les rendre homognes.
Prvoir un local, indpendant de celui du
stockage, muni d'une ventilation naturelle
permanente et d'une ventilation mcanique
pour l'extraction de l'air pollu.
Un captage localis enveloppant les zones
o sont effectues les oprations de
prparation (pesage, mlange, pulvrisation,
nettoyage, etc.) doit tre mis en uvre
selon le principe du dosseret aspirant
de faon assurer un balayage horizontal
de l'air (fig. 33).
Avec l'utilisation de peintures hydrodiluables,
les techniques de nettoyage changent et ne
ncessitent plus d'aspiration frontale (fig. 34).
34. Poste de nettoyage des pistolets de pulvrisation de peinture hydrodiluable.
43
116617
3/10/08
20:35
Page 44
35. Travaux de peinture dans une cabine ventile
3. Rcupration des dchets
Les dchets rcuprs aprs des travaux
de peinture sont de deux types :
- dchets liquides : solvants et diluants
uss, fonds de peinture...
- dchets solides : papiers ayant servi de
caches, chiffons sales...
Rcuprer sparment ces deux types de
dchets dans des conteneurs mtalliques
munis de couvercles tanches.
Les solvants usags tant considrs
comme dchets dangereux, il est
indispensable de leur faire suivre une filire
de traitement adapte ; donc de les faire
collecter par un prestataire autoris.
44
4. Peinture des vhicules
La mise en peinture de la totalit ou dune
partie seulement dun vhicule doit toujours
tre effectue en atmosphre salubre dans
une cabine ventile, conformment au
dcret du 23 aot 1947 relatif aux travaux
de peinture (fig. 35).
Les cabines neuves ou doccasion
installes depuis le 1er octobre 1990 doivent
satisfaire aux exigences des articles
R. 4312-3 R. 4312-18 du code du travail.
Les critres techniques respecter sont
prciss dans le guide de ventilation n 9.1
de lINRS (ED 839).
116617
3/10/08
20:35
Page 45
Assurer correctement lentretien de la
cabine en utilisant le carnet fourni cet effet
par le constructeur qui prvoit notamment :
- le remplacement priodique des filtres
dair considrs alors comme dchets
dangereux,
- lexamen au moins une fois par an, de
ltat intrieur des conduites dextraction
dair en aval des filtres.
En effet des dpts de peinture dans
les gaines sont la principale source des
incendies observs dans les installations
de peinture.
Le nettoyage de ces conduits se fera de
prfrence laide dun moyen mcanique
et dans tous les cas sans laide dun
solvant inflammable.
Les rejets dair doivent respecter les rgles
de protection de lenvironnement et ne pas
constituer une nuisance pour le voisinage.
Les matires solides et/ou les vapeurs de
solvant doivent tre retenues par des filtres.
Assurer le contrle de la sant du
personnel par un mdecin qui procdera
aux examens et notamment :
- tablira un certificat daptitude avant
dadmettre un employ effectuer des
travaux de peinture au pistolet,
- renouvelera ce certificat un mois aprs
lembauche et effectuera une visite
mdicale tous les six mois (art. 6 et 7 du
dcret du 23 aot 1947).
Mettre la disposition du personnel tout
le matriel de protection ncessaire et
sassurer de son bon entretien.
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Code du travail :
- Aration assainissement des locaux :
R. 4222-1 R. 4412-164
- Cabines de projection
par pulvrisation, cabines et
enceintes de schage de peintures
liquides, de vernis, de poudres
sches et cabines mixtes : R. 4312-3
R. 4312-22
- Prvention des explosions :
R. 4227-42 R. 4227-57
Dcret n 47-1619 du 23 aot 1947
modifi Travaux de peinture ou de
vernissage par pulvrisation
Arrt du 3 mai 1990 prcisant les
prescriptions relatives aux vitesses de
ventilation des cabines
Arrt du 11 juillet 1977 Liste des
travaux ncessitant une surveillance
mdicale spciale
Rglementation des Installations
classes pour la protection de
lenvironnement :
Rubrique n 2930.2 : Application,
cuisson, schage de vernis, peinture,
apprt sur vhicules et engins moteur.
Publications INRS
TJ 19 Les maladies professionnelles
(rgime gnral)
ED 839 Guide pratique de
ventilation 9.1. Ventilation des
cabines dapplication par
pulvrisation de produits liquides
ED 955 Peintures en phase aqueuse
(ou peintures l'eau)
ED 956 Peintures en poudre
ED 971 Peintures en solvants
Contrler priodiquement le systme
daration des cabines de peinture
conformmet larticle R. 422-20 du code
du travail et larrt du 8-10-1987.
45
116617
3/10/08
20:35
Page 46
3.5. ACCUMULATEURS AU PLOMB
La manutention et la
charge des batteries
daccumulateurs au
ACCUMULATEURS
plomb sont causes
AU
daccidents dus
PLOMB
principalement :
1. Au poids des
batteries ellesmmes et leur dpose souvent malaise
compte tenu de leur emplacement sur le
vhicule.
2. lnergie lectrique de laccumulateur,
libr sous la forme dun arc lectrique cr
lorsque des outils ou des pices mtalliques
viennent au contact des deux bornes de la
batterie.
3. Au dgagement dhydrogne (et
doxygne) important pendant la charge et
surtout pendant la surcharge des batteries
et une heure aprs la charge. Aussi, il est
conseill de desserrer les bouchons afin de
profiter de la non-tanchit du filetage pour
lvacuation des gaz et viter le risque
dclatement par suppression.
Compte tenu du risque dexplosion que
prsente le dgagement dhydrogne, les
locaux de charge de batteries
daccumulateurs doivent tre :
implants dans des zones loignes de
toute flamme et tincelle ;
dimensionns pour permettre des
interventions aises et limiter la
concentration de lhydrogne dans lair
moins de 10 % de la LIE (4 %), soit
0,40 % ;
ventils mcaniquement si ncessaire
pour limiter la concentration de lhydrogne
dans lair moins de 0,40 % en prvoyant
lintroduction dair neuf en partie basse et
du ct oppos, lvacuation des gaz en
partie haute.
Pour le calcul de la concentration en
hydrogne, voir la recommandation
CNAMTS R 215.
Ces locaux doivent en outre tre construits
en matriaux incombustibles.
Les locaux de charge seront quips de
supports de batteries, dun dispositif de
manutention (palans par exemple) de
scurit en atmosphre explosive, de
46
cbles de charge poste fixe prs de la
batterie recharger. Seront dfinies les
zones risque dexplosion conformment
au dcret 2002-1553 du 24 dcembre 2002
et tout le matriel lectrique sera conforme
aux zones concernes (dcret n 96-1010
du 19 novembre 1996).
Ne pas entreprendre de travaux de soudage
au chalumeau ou larc proximit de
batteries daccumulateurs.
La cration dun local spcifique rserv
exclusivement la charge de batteries peut
tre facultative dans un atelier ou un
entrept o les conditions suivantes sont
simultanment assures :
le volume de latelier est gal ou
suprieur 250 fois le volume total
dhydrogne dgag lors de chaque
opration de charge ce qui limite la
concentration en hydrogne 0,4 % sous
rserve que la partie haute de latelier ne
comporte aucune zone pouvant former une
poche daccumulation dhydrogne, et que
latelier ne comporte pas une autre source
gnratrice datmosphre explosive ;
lair de latelier est entirement renouvel
au minimum une fois entre deux oprations
de charge conscutives soit par des
dispositifs statiques daration naturelle, soit
par des dispositifs mcaniques de
ventilation gnrale ;
lemplacement de charge est situ dans
une zone protge de latelier et amnage
cet effet (sol anti-acide, vacuation des
eaux, lave-il...) labri des risques lis aux
activits voisines (heurts par circulation
dengins, manutentions...).
Remarque
Lorsque la puissance maximale du courant
continu utilisable pour la charge des
accumulateurs est suprieure 10 kW, les
ateliers de charge des accumulateurs
relvent de la rubrique 2925 concernant les
installations classes pour la protection de
lenvironnement.
MESURES PRVENTIVES
Ne pas fumer.
Dbrancher les batteries en
commenant par la borne ngative.
116617
3/10/08
20:35
Page 47
Les dposer sur un chariot spcial
pour en faciliter le transport.
3.6 RPARATION ET ENTRETIEN DES
GARNITURES DE FREIN
Les placer dans un local de
charge qui
doit tre :
- indpendant du reste de latelier
- bien ventil
- clair par des appareils lectriques
Le sol de ce local doit tre
impermable et conu dune
manire telle quil permette une
rcupration facile des lectrolytes
en cas dpandage accidentel. Les
alles sur une largeur denviron
0,60 m seront garnies de caillebotis
isolants.
Les garnitures de
friction des freins et
de lembrayage
peuvent encore
contenir des fibres
damiante qui
peuvent tre
libres soit par
usure normale soit
au cours de leur usinage. Linhalation de
ces fibres est particulirement dangereuse
car elle peut provoquer des maladies dont
certaines, trs graves, sont du type
cancer. Ces maladies sont inscrites aux
tableaux n 30 et 30 bis.
Pour les salaris susceptibles d'tre
exposs une formation spcifique au
risque amiante (appele squence
amiante ) est obligatoire.
Desserrer les bouchons des bacs.
Faire si ncessaire le complment
dlectrolyte et en cas de
manipulation dacide sulfurique se
souvenir de la rgle Pas deau dans
lacide , ce qui vite les projections
trs dangereuses dacide.
Mettre disposition du personnel :
- des gants de protection contre
lacide
- des lunettes de protection pour les
oprations de manipulation
dlectrolyte et dacide.
RPARATION
ET
ENTRETIEN
DES
GARNITURES
DE FREIN
36. Enceinte de dpoussirage
adapte lutilisation dair comprim (soufflettes)
Installer un dispositif lave-yeux ou
fontaine oculaire.
Avant de rejeter llectrolyte
effectuer sa neutralisation chimique.
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Art. L. 511-1 L. 517-2 du code
de lenvironnement
Rubrique 2925 Atelier de charge
daccumulateurs
Publications INRS
ED 717 Batteries... chargez !
ED 746 Guide pratique de
ventilation 11. Accumulateurs au
plomb
R 215 Recommandation
de la CNAMTS. Batteries
daccumulateurs
47
116617
9/10/08
10:19
Page 48
En consquence il doit tre formellement
proscrit demployer une soufflette air
comprim pour nettoyer les tambours et
mcanismes de frein (cf. 2.3.4).
quiper les oprateurs dun appareil
filtrant de protection respiratoire contre les
poussires de classe P3 (demi-masque
filtrant FF P3 par exemple).
Nettoyer les garnitures de frein laide
dun aspirateur dot dun filtre trs
haute efficacit de classe H13 suivant la
norme NF EN 1822.
Lorsque laspiration nest pas suffisante,
procder
- par lavage ou essuyage humide (fig. 37),
- laide dun dispositif spcial sadaptant
sur le tambour (fig. 36).
BIBLIOGRAPHIE
Rglementation
Code du travail : Mesures
particulires de protection contre
les risques lis l'amiante :
R. 4412-94 R. 4412-148.
Code de la Scurit sociale
annexe II, tableaux n 30 et
30 bis. Affections
professionnelles conscutives
linhalation des poussires
damiante.
Publications INRS
Dossier web Amiante et fibres
ED 809 Exposition lamiante
dans les travaux dentretien et
de maintenance. Guide de
prvention.
quiper toutes les machines utilises
pour lusinage des garnitures de
dispositifs daspiration efficace.
Lair et leau rejets contenant des fibres
damiante devront tre filtrs et dcants
afin de limiter la pollution de
lenvironnement.
Avant damnager les postes de travail
consultez votre mdecin du travail ou le
Service Prvention de votre CRAM.
37. Dpoussirage des garnitures de frein par voie humide
48
116617
3/10/08
20:35
Page 49
49
116617
3/10/08
20:35
Page 50
3.7. INTERVENTIONS SUR VHICULES
AU GPL (pour plus de dtails, voir fiche
pratique de scurit ED 111)
INTERVENTIONS
SUR VHICULES
AU GPL
Certains vhicules
utilisent comme
carburant des gaz
de ptrole liqufis,
communment
appels GPL.
Lappellation GPL
(pour "gaz de ptrole liqufi") applique
des combustibles liqufis sous pression,
est rserve au propane (C3H8), au
butane (C4H10) et leurs mlanges. En
France, le carburant GPL est un mlange
propane-butane (50/50 environ), liqufi
sous 4 bars de pression 20 C.
RISQUES
1. Risques dus la vaporisation
La phase liquide, au contact de la peau
provoque des "brlures". La phase
gazeuse, haute dose, peut avoir un effet
lgrement anesthsiant et/ou asphyxiant
(par dplacement de loxygne).
2. Risques dus aux fuites
Les fuites peuvent tre lorigine
dexplosion et dincendie.
3. Risques dus un chauffement
accidentel (incendie)
Un fort chauffement conduit une
augmentation considrable de la pression
interne ainsi qu un accroissement du
volume occup par la phase liquide. Ces
deux phnomnes peuvent entraner
lclatement des rcipients, raison pour
laquelle ils sont quips dun dispositif
limiteur de surpression (soupape).
MESURES PRVENTIVES GNRALES
1. Formation
Une formation concernant le GPL est
dlivre par les constructeurs automobiles
ou par certains centres de formation
spcialise, et recommande par le
comit franais du butane et du propane
(CFBP). Seules les personnes ayant suivi
cette formation spcifique doivent tre
autorises intervenir sur les rservoirs
50
GPL automobiles. De plus, ceux
possdant une attestation de qualification
du CFBP valide et travaillant dans un
atelier agr CFBP sont autoriss
intervenir sur le rservoir et quiper au
GPL les vhicules essence.
2. quipements de protection
individuelle (EPI)
Les oprateurs doivent porter des EPI
adapts, cest--dire des vtements
couvrants, exempts de fibres synthtiques
(polyacryliques) gnratrices dlectricit
statique, ainsi que des chaussures
antistatiques. Pour viter le contact avec
la peau ou les muqueuses, les
intervenants porteront gants de type
ptrolier et lunettes ou visire de scurit.
3. Toutes les interventions
susceptibles dengendrer des fuites
devront seffectuer lextrieur dans
un lieu dgag de toute matire
combustible.
4. Pour travailler en scurit,
appliquer les recommandations
suivantes :
- avant lintervention, ouvrir toutes les
portes et tous les capots du vhicule,
- sassurer visuellement du bon tat des
accessoires et du rservoir,
- viter les sources dignition proximit
de la zone de travail,
- disposer dau moins un extincteur
poudre et dune lance eau pulvrise
proximit,
- placer les panneaux "interdiction de
fumer" en tous points de la zone de
scurit,
- vrifier labsence de dtrioration du
circuit GPL (notamment pour les vhicules
accidents).
MESURES PRVENTIVES
SPCIFIQUES
1. Pour une intervention sur un
rservoir GPL carburant (cf. ED 111 de
lINRS et fiche 170 du CFBP)
Rappel : Les interventions de ce type
doivent tre ralises par un oprateur
ayant suivi une formation spcifique.
116617
3/10/08
20:35
Page 51
- Avant toute intervention sur un rservoir
GPL, il faut procder au brlage et au
dgazage laide dune torchre (brleur)
(cf. ED 111).
Si le brlage et/ou le dgazage se rvlent
impossibles, il faut alors faire appel une
personne qualifie ayant reu la formation
spcifique.
- Avant douvrir des circuits, liminer le
GPL restant dans les conduits en faisant
tourner le moteur jusqu son arrt aprs
avoir dbranch llectrovanne du
rservoir.
- Ne pas porter le GPL contenu dans le
rservoir des tempratures suprieures
50 C.
- Veiller la qualit des raccords, le GPL
tant trs fluide.
- Effectuer un contrle de fonctionnement
et dtanchit laide dun dtecteur de
fuites.
- Proscrire le stockage dun rservoir
rempli voire vide mais non dgaz.
Stocker le rservoir de prfrence
lextrieur et loin de toute matire
combustible ou comburante.
N.B. : Indpendamment de la formation
reue par les intervenants, cette
intervention devra seffectuer lextrieur
(hors voie publique), en respectant la
distance lie la puissance du brleur.
2. Pour des interventions ne
concernant pas linstallation GPL
(travaux de carrosserie, etc.)
Ces interventions peuvent seffectuer en
vitant :
- dendommager les canalisations gaz ou
le rservoir et doccasionner une fuite non
contrle (sinon, il sera en particulier
ncessaire de vidanger les canalisations
concernes et/ou le rservoir) ;
- dchauffer le contenu du rservoir ;
- de soumettre le rservoir des
contraintes mcaniques.
Passage en cabine de peinture
- Lors dun passage du vhicule en cabine
de peinture, par prcaution, dposer le
rservoir ou bien procder au brlage et
au dgazage.
Remarque : il pourra tre admis, si on
travaille moins de 50 C, de laisser le
rservoir en place, sous rserve quil soit
rempli moins de 70 % de sa capacit.
Si un matriel doit tre utilis pour
permettre le schage de mastic, apprt,
peinture, proximit du rservoir GPL,
lors doprations de retouche par
exemple, il est impratif de procder au
brlage et au dgazage du rservoir GPL.
MESURES DURGENCE
En cas de contact du liquide avec la peau :
- arroser longuement la zone atteinte
leau tide,
- envelopper la partie lse dans un linge
strile,
- demander rapidement un avis mdical.
En cas de contact du liquide avec les
yeux :
- laver immdiatement et abondamment
leau pendant au moins 15 minutes,
- couvrir lil avec une compresse strile,
- demander rapidement un avis mdical.
En cas de fuite de gaz seule :
- couper le contact,
- sortir le vhicule du local,
51
116617
3/10/08
20:35
Page 52
- isoler le vhicule lair libre, lcart de
toute habitation (lintervention des services
de scurit pompiers pouvant tre
ncessaire si la situation ne peut tre
contrle),
- si la fuite ne peut tre tanche
facilement, disperser le nuage de gaz avec
un jet deau pulvrise et maintenir une
zone de protection de non feu dau moins
10 m autour du vhicule,
- supprimer toute source dignition et tout
point chaud et ne toucher aucun appareil
lectrique.
En cas de fuite avec flamme :
- au dbut, teindre le feu avec un
extincteur poudre polyvalente et
nteindre le feu que si lon peut stopper
la fuite (risque dexplosion),
- sil est impossible dteindre, appeler
les secours et sloigner du vhicule
de plusieurs dizaines de mtres et,
si possible, en attendant les secours,
refroidir le rservoir avec un jet deau
pulvrise (robinet dincendie arm)
et protger lenvironnement pour viter
la propagation de lincendie.
3.8 INTERVENTIONS SUR DES
VHICULES FONCTIONNANT AU
CARBURANT GAZ NATUREL (GNV)
INTERVENTIONS
SUR LES
VHICULES
FONCTIONNANT
AU CARBURANT
GAZ NATUREL
Certains vhicules
utilisent comme
carburant le gaz
naturel appel le
GNV (gaz naturel
pour vhicules) ou
CNG (carburant gaz
naturel).
Le GNV est du gaz naturel comprim
200hp (200 bars) ; il est d'origine fossile et
il est compos essentiellement de
mthane (CH4) ; il est plus lger que l'air.
La brochure de l'INRS Vhicules
fonctionnant au gaz naturel ED 6003
prsente les bonnes pratiques pour
intervenir en scurit sur ces vhicules.
3.9. INTERVENTIONS SUR LES
VHICULES QUIPS DE COUSSINS
GONFLABLES DE SCURIT
ET DE PRTENDEURS
(OU PRTENSIONNEURS)
DE CEINTURE (SYSTME AIRBAG)
(cf. brochure ED 916)
BIBLIOGRAPHIE 3.7
Rglementation
Aration et assainissement des
lieux de travail : R. 4222-1
R. 4222-6 du code du travail
Prvention du risque chimique :
R. 4411-1 R. 4412-164 du code
du travail
Amnagement des lieux de travail.
Prvention des incendies et des
explosions : R. 4216-1 R. 4216-34
et R. 4227-1 R. 4227-57 du
code du travail
Publication INRS
ED 111 Vhicules au GPL
intervenir en scurit (fiche
pratique de scurit)
Publication CFBP
Fiche 170
52
39. Coussin gonflable de scurit et prtendeur de ceinture
(PSA Peugeot Citron Dir com)
116617
3/10/08
20:35
Page 53
Le concept des
coussins gonflables
de scurit est
relativement simple :
en cas de choc du
vhicule, des
coussins
judicieusement
placs se remplissent dun volume de gaz
suffisamment rapidement pour protger
les occupants. Lairbag constitue le
complment indispensable des ceintures
de scurit dont lefficacit est amliore
par des prtendeurs pyrotechniques.
INTERVENTIONS
SUR LES
VHICULES
QUIPS DE
COUSSINS
GONFLABLES
DE SCURIT
Une collision est dtecte par des
capteurs qui dclenchent la mise feu du
systme pyrotechnique des airbags et des
prtendeurs par lintermdiaire dun botier
lectronique. Lactivation est ralise en
quelques millisecondes pour un
prtendeur et en quelques dizaines de
millisecondes pour un airbag (gonflement).
RISQUES
Le risque principal pour les travailleurs
rside dans un dclenchement inopin
dont les consquences peuvent savrer
dangereuses.
Mme si ce risque dactivation
intempestive dun module pyrotechnique
est faible, des rgles simples de
prvention peuvent encore le rduire.
Les risques principaux sont ceux lis aux
principes de fonctionnement :
1. libration de beaucoup dnergie
mcanique en un temps trs rduit, ce qui
peut causer des blessures en cas de
proximit immdiate de personnes ;
2. combustion de composants pour
produire tout ou partie du gaz, ce qui peut
occasionner des brlures en cas de contact
direct avec le corps du gnrateur de gaz.
Matriser les risques implique de matriser
les facteurs qui peuvent induire un
fonctionnement intempestif par la mise en
action de la raction pyrotechnique par un
courant lectrique :
1. une mise sous tension intempestive,
2. des chocs sur les dispositifs de
commande,
3. llectricit statique,
4. lenvironnement lectromagntique,
5. la chaleur et les flammes,
6. les chocs et les chutes, etc.
MESURES PRVENTIVES
Cette technologie rcente demande des
connaissances techniques et
rglementaires qui ne sont pas habituelles
dans le milieu de la rparation automobile.
Il importe donc que lensemble des
salaris soient forms afin de connatre
en particulier les procdures respecter
vis--vis des dispositifs pyrotechniques
de scurit.
Avant le dbut de tous travaux de
rparation, il faut imprativement :
1. mettre la cl sur STOP et lenlever ;
2. dbrancher les bornes de toutes les
batteries et les isoler avec soin ;
3. dposer le connecteur de branchement
de la centrale en attendant au moins
10 minutes aprs la dpose de la batterie.
Pour le stockage : en attendant dtre
remonts sur les vhicules, les dispositifs
dclenchement pyrotechnique doivent
tre stocks plat dans une armoire
rserve ce type de matriel et, si
possible, ferme.
Pour toute intervention sur les dispositifs
du systme (airbag, prtendeur, botier
lectronique), il importera de respecter
toutes les prconisations fournies par les
constructeurs automobiles.
BIBLIOGRAPHIE
Publication INRS
ED 916 Airbags. Coussins
gonflables de scurit.
Prtendeurs de ceinture
53
116617
3/10/08
20:35
Page 54
4. LISTE DE CONTRLE
Cette liste a pour but
daider les responsables
effectuer un bilan
sur les dispositions
prises ou prendre
dans ltablissement.
Elle ne prtend pas
faire linventaire complet
des risques susceptibles
de sy rencontrer.
Pour lvaluation des risques,
en complment de ce
questionnaire,
vous rfrer la brochure
ED 840 intitule
valuation des risques
professionnels.
Aide au reprage des
risques dans les PME-PMI.
54
116617
3/10/08
20:35
Page 55
Remarque : toute rponse ngative doit entraner des mesures de prvention adaptes.
OUI NON sans objet
1.1 RGLES GNRALES DHYGINE (page 6)
Les locaux de travail sont-ils ventils correctement ?
(60 m3/h/occupant)
Sont-ils chauffs convenablement ? (15 C mini)
Sont-ils nettoys quotidiennement ?
Les vestiaires et lavabos sont-ils installs dans un local
indpendant des ateliers ?
Les dimensions des vestiaires sont-elles suffisantes
pour sparer les vtements souills des vtements propres ?
Lclairage des diffrents locaux est-il suffisant ?
Les dtergents datelier mis la disposition du personnel
sont-ils conformes aux normes NF T 73-101 et 73-102 ?
Les alles de circulation sont-elles dfinies et bien repres ?
Les zones de travail et de circulation prsentent-elles une
surface antidrapante ?
Sont-elles nettoyes aussitt que se produisent des flaques
dhuile ou des dpts de graisse ?
Sont-elles exemptes de trous et dobjets ?
Avez-vous fait linventaire des produits inflammables
utiliss dans votre tablissement ?
Avez-vous tudi les risques dincendie propres votre
tablissement ?
1.2 CIRCULATION. TAT DES SOLS (page 8)
1.3 INCENDIE. EXPLOSION (page 9)
Quels sont les moyens de lutte contre lincendie ?
- Sont-ils adapts et suffisants ?
- Sont-ils contrls rgulirement ?
55
116617
3/10/08
20:35
Page 56
OUI NON sans objet
Les consignes et procdures ont-elles t tablies et affiches ?
Les travailleurs connaissent-ils les consignes en cas dincendie ?
Les interdictions de fumer sont-elles affiches et respectes ?
Existe-t-il une procdure de permis de feu
pour les interventions par point chaud ?
Les travailleurs ont-ils suivi une formation la scurit incendie ?
Connaissent-ils le fonctionnement des extincteurs ?
Comment sont les locaux de stockage ?
- loigns ?
- protgs ?
- compartiments ?
Les matriaux de construction sont-ils
- incombustibles ?
- rsistants au feu ?
Existe-t-il des zones risque dexplosion ?
Existe-t-il un systme de dsenfumage ?
La ventilation et laration sont-elles suffisantes ?
Un responsable est-il charg de la surveillance des
installations lectriques ?
Le personnel est-il inform des risques encourus par
lemploi des installations et matriels lectriques ?
Les installations lectriques sont-elles visites annuellement
et les rsultats de ces visites sont-ils consigns sur un registre ?
Les travaux prconiss ont-ils t effectus ?
Les baladeuses sont-elles conformes
la norme NF EN 60-598-2-8 ?
Les cbles prolongateurs sont-ils maintenus en bon tat ?
1.4 INSTALLATIONS ET MATRIELS LECTRIQUES (page 11)
56
116617
3/10/08
20:35
Page 57
OUI NON sans objet
1.5 BRUIT (page 13)
Les produits dangereux sont-ils stocks
dans un local spcialement rserv et conu cet usage ?
La quantit de produits stocks proximit des postes
de travail est-elle limite une journe ?
Est-il interdit de se laver les mains avec des produits
tels quessence ou trichlo ?
La priodicit des visites mdicales obligatoires
est-elle respecte ?
Est-il interdit de fumer tous les emplacements de travail
o cela est dangereux ?
Existe-t-il un dispositif daspiration des gaz dchappement
aux emplacements o lon effectue des rglages de moteurs ?
Le personnel est-il inform de la signification des
tiquettes des produits ?
Les fiches de donnes scurit sont-elles mises disposition ?
Le stockage des produits est-il scuris ?
Le niveau sonore des emplacements de travail est-il infrieur
80 dB(A) ?
Sinon, avez-vous
- supprim les bruits leur source chaque fois que
cela est possible ?
- isol les machines bruyantes dans un local indpendant ?
- mis la disposition du personnel des appareils de
protection individuelle appropris ?
- rduit le temps dexposition au bruit de chaque travailleur
une valeur admissible ?
- dfini un programme de rduction de lexposition au bruit ?
Connaissez-vous les entreprises spcialises susceptibles de
vous aider tablir ce programme ?
1.6 PRODUIT DANGEREUX (page 16)
2.1 LEVAGE ET MANUTENTION (page 22)
Avez-vous fait linventaire de manutentions manuelles qui
pourraient tre aides par un dispositif ou appareil adapt ?
57
116617
3/10/08
20:35
Page 58
OUI NON sans objet
Les matriels de manutention sont-ils vraiment
adapts aux tches effectuer ?
Le personnel est-il inform des risques inhrents aux
manutentions ?
Les appareils de levage sont-ils visits annuellement et les
rsultats des visites sont-ils consigns sur un registre ?
Le personnel a-t-il sa disposition des gants de protection ?
Le personnel porte-t-il des chaussures de scurit ?
Disposez-vous de ponts lvateurs adapts aux vhicules
que vous rparez ?
La consigne : Il est interdit de stationner sous un pont
lvateur en mouvement est-elle affiche ?
La charge maximale ainsi que la pression hydraulique
de service sont-elles indiques clairement ?
Les personnes ayant le droit de manuvrer les ponts
ont-elles t nommment dsignes ?
Le dispositif de commande action maintenue
est-il en bon tat ?
Le chariot nest-il pas employ des tches pour
lesquelles il nest pas conu ?
Le chariot est-il entretenu et vrifi convenablement ?
La charge maximale dutilisation est-elle inscrite clairement
sur ces appareils ?
Les crics sont-ils vrifis priodiquement ?
2.1.2.1 Ponts lvateurs (page 23)
2.1.2.2 Chariots automoteurs (page 24)
Les conducteurs de chariot automoteur sont-ils
en possession dune autorisation de conduite ?
2.1.2.3 Crics. Chandelles (page 25)
58
116617
3/10/08
20:35
Page 59
OUI NON sans objet
Dans le cas dun travail sous un vhicule lev le personnel
cale-t-il au pralable le vhicule ?
Ces chandelles de calages sont-elles aussi vrifies
priodiquement ?
Tout outillage dfectueux est-il mis immdiatement de ct ?
Les appareils lectriques portatifs sont-ils :
- double isolation ?
- munis dun dispositif darrt en bon tat ?
Les meules sont-elles stockes et tiquetes correctement ?
Sont-elles sonnes avant leur montage ?
Leur montage est-il effectu et vrifi correctement ?
2.2 OUTILS ET OUTILLAGES (page 26)
Le personnel dispose-t-il de lquipement individuel de
protection adapt lutilisation de ces appareils ?
2.3 MACHINES ET APPAREILS SPCIAUX (page 28)
Les machines sont-elles :
- munies dune marque de conformit ?
- accompagnes dun certificat de conformit ?
2.3.2 APPAREILS SPCIAUX (page 28)
Avez-vous analys les risques que comportent ces
machines et appareils ?
Cette analyse a-t-elle t effectue pour :
- les appareils dmonte-pneus ?
- les machines quilibrer les roues ?
- les presses extraire les roulements ?
- les appareils tarer les injecteurs ?
- les bancs dessais de freinage ?
2.3.3 MEULES ET MACHINES MEULER (page 29)
59
116617
3/10/08
20:35
Page 60
OUI NON sans objet
Les machines meuler sont-elles quipes de leurs
diffrents dispositifs de protection (support de pice,
cran, pare-tincelles, dispositif de dpoussirage) ?
En particulier est-il formellement interdit de meuler sans
lunettes et cette interdiction est-elle affiche ?
Les consignes de scurit relatives lutilisation des machines
meuler sont-elles affiches ?
2.3.4 CIRCUIT DAIR COMPRIM. COMPRESSEUR. SOUFFLETTE (page 30)
Les poulies et courroies du compresseur sont-elles munies
dun carter enveloppant ?
Ses appareils de contrle et de scurit sont-ils vrifis
priodiquement ?
Son rservoir est-il purg rgulirement ?
Les preuves rglementaires du rservoir sont-elles
effectues et leur rsultat consign sur un registre ?
Lusage des soufflettes est-il limit au strict minimum ?
Sont-elles alimentes en basse pression ?
Sont-elles munies dun diffuseur ?
Le personnel est-il averti des dangers que prsentent
les jets dair comprim ?
Les bouteilles de gaz sont-elles stockes dans un local
spcialement rserv cet usage ?
Des crans sont-ils disposs autour des emplacements
de soudage ?
Le personnel a-t-il sa disposition le matriel de protection
ncessaire tels que masques, lunettes, gants, etc. ?
Les tuyaux, manomtres, chalumeaux sont-ils vrifis
rgulirement ?
Les chalumeaux sont-ils munis de dispositifs anti-retour et
pare-flammes ?
2.4 SOUDAGE (page 32)
60
116617
3/10/08
20:35
Page 61
OUI NON sans objet
Les pices devant tre assembles par soudage lectrique
sont-elles mises systmatiquement la masse ?
Toute opration de soudage est-elle interdite proximit
de produits inflammables ?
Le personnel dispose-t-il des moyens de protection
individuelle ncessaires ?
Les aires de soudage sont-elles munies de dispositifs
daspiration des fumes ?
3.1 MISE EN UVRE DE FLUIDES SOUS HAUTE PRESSION (page 36)
Le personnel est-il inform des dangers causs par
lutilisation de fluides sous haute pression ?
Les installations de graissage sous pression sont-elles
vrifies priodiquement ?
Le protecteur du banc dessais des injecteurs est-il asservi
la mise en pression de ceux-ci ?
Le personnel dispose-t-il de vtements de protection adapts ?
Les personnes circulant proximit du poste de travail
sont-elles hors datteinte du jet de lavage ?
Linstallation lectrique est-elle particulirement vrifie ?
Les aires de lavage sont-elles revtues dun matriau
antidrapant ?
Le nettoyage par trempage seffectue-t-il dans un local
spar et bien ventil ?
Est-il employ, pour le nettoyage des pices, des
produits non inflammables ?
Existe-t-il un systme dvacuation comportant un
dshuileur et un bac de dcantation ?
3.2 LAVAGE. NETTOYAGE. DGRAISSAGE (page 37)
61
116617
3/10/08
20:35
Page 62
OUI NON sans objet
3.3 FOSSES DE VISITE (page 39)
Les fosses sont-elles, chacune de leurs extrmits, munies
descaliers fixes marches antidrapantes ?
Sont-elles recouvertes ou bien entoures dun garde-corps
lorsquelles sont inemployes ?
Sont-elles nettoyes rgulirement ?
Lclairage des fosses est-il conu sous verre dormant ?
Sont-elles ventiles correctement ?
Est-il interdit de fumer dans les fosses ?
Un extincteur est-il plac dans chaque fosse ?
A-t-il t vrifi que le vhicule nobstrue pas la fosse ?
Les produits ncessaires la peinture des vhicules sont-ils
stocks dans un local spcialement amnag ?
Disposez-vous dun local indpendant pour effectuer
la prparation des mlanges et llaboration des chantillons ?
Peut-on y effectuer les nettoyages et rglages des buses de
pulvrisation ?
chacun des postes de travail la quantit de produits
est-elle au plus gale une journe de travail ?
Avez-vous install pour la rcupration des dchets liquides
et solides des conteneurs spciaux ?
Disposez-vous dune cabine conforme la rglementation ?
Son entretien est-il effectu priodiquement ?
Les conduits dextraction dair en aval des filtres sont-ils
nettoys au moins une fois par an ?
Les rejets dair de la cabine ne causent-il pas de nuisances
lenvironnement ?
Le personnel effectuant les travaux de peinture est-il soumis
un contrle mdical particulier ?
Dispose-t-il des matriels de protection individuelle adapts
et suffisants ?
3.4 PRPARATION ET PEINTURE DES VHICULES (page 41)
62
116617
3/10/08
20:35
Page 63
OUI NON sans objet
3.5 ACCUMULATEURS AU PLOMB (page 46)
Le local de charge des batteries est-il :
- indpendant du reste de latelier ?
- bien ventil ?
- clair par des appareils utilisables en atmosphre explosive ?
Le personnel est-il averti des risques engendrs par les
accumulateurs au plomb ?
Dispose-t-il :
- de moyens de manutention adapts ?
- des quipements de protection individuelle ncessaires :
gants, lunettes ?
3.6 RPARATION ET ENTRETIEN DES GARNITURES DE FREIN (page 47)
tes-vous quip dun appareil de protection respiratoire adapt ?
Les machines utilises pour la rparation et lusinage des garnitures
sont-elles munies de dispositifs daspiration defficacit suffisante ?
tes-vous inform des risques que prsentent les fibres
damiante contenues dans les garnitures de frein ?
Lusage de la soufflette est-il interdit lors du dpoussirage
des tambours et garnitures de frein ?
3.7 INTERVENTIONS SUR VHICULES AU GPL (page 50)
Les intervenants ont-ils reu une formation spcifique ?
Le brlage et le dgazage laide dune torchre
avant intervention a-t-il t prvu ?
Les oprateurs disposent-ils des quipements
de protection individuelle adapts ?
3.9 INTERVENTIONS SUR VHICULES QUIPS DE COUSSINS GONFLABLES
DE SCURIT ET DE PRTENDEURS (OU PRTENSIONNEURS)
DE CEINTURE (SYSTME AIRBAG) (page 52)
Le personnel a-t-il reu une formation spcifique ?
Une armoire rserve ce type de matriel (systme airbag)
a-t-elle t prvue pour son stockage ?
63
116617
3/10/08
20:35
Page 64
Achev dimprimer par Corlet, Imprimeur, S.A. - 14110 Cond-sur-Noireau
N dImprimeur : 116617 - Dpt lgal : octobre 2008 - Imprim en France
116617 COUV
3/10/08
19:35
Page 3
LInstitut national de recherche et de scurit (INRS)
Dans le domaine de la prvention des risques professionnels,
lINRS est un organisme scientifique et technique qui travaille,
au plan institutionnel, avec la CNAMTS, les CRAM-CGSS
et plus ponctuellement pour les services de ltat ainsi que
pour tout autre organisme soccupant de prvention
des risques professionnels.
Il dveloppe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires
quil met la disposition de tous ceux qui, en entreprise,
sont chargs de la prvention : chef dentreprise, mdecin du travail,
CHSCT, salaris. Face la complexit des problmes, lInstitut
dispose de comptences scientifiques, techniques et mdicales couvrant
une trs grande varit de disciplines, toutes au service
de la matrise des risques professionnels.
Pour commander les films (en prt), les brochures et les affiches de lINRS,
adressez-vous au service prvention de votre CRAM ou CGSS.
Services prvention des CRAM
ALSACE-MOSELLE
BRETAGNE
NORD-EST
(67 Bas-Rhin)
(22 Ctes-dArmor, 29 Finistre,
35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)
(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne,
52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle,
55 Meuse, 88 Vosges)
14 rue Adolphe-Seyboth
BP 10392
67010 Strasbourg cedex
tl. 03 88 14 33 00
fax 03 88 23 54 13
236 rue de Chteaugiron
35030 Rennes cedex
tl. 02 99 26 74 63
fax 02 99 26 70 48
prvention documentation@cramalsace-moselle.fr
drpcdi@cram-bretagne.fr
www.cram-bretagne.fr
(57 Moselle)
CENTRE
3 place du Roi-George
BP 31062
57036 Metz cedex 1
tl. 03 87 66 86 22
fax 03 87 55 98 65
(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre,
37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)
Ainsi, lINRS labore et diffuse des documents intressant
lhygine et la scurit du travail : publications (priodiques
ou non), affiches, audiovisuels, site Internet Les publications
de lINRS sont distribues par les CRAM.
Pour les obtenir, adressez-vous au service prvention de la Caisse
rgionale ou de la Caisse gnrale de votre circonscription,
dont ladresse est mentionne en fin de brochure.
www.cram-alsace-moselle.fr
LINRS est une association sans but lucratif (loi 1901) constitue
sous lgide de la CNAMTS et soumise au contrle financier de ltat.
Gr par un conseil dadministration constitu parit dun collge
reprsentant les employeurs et dun collge reprsentant les salaris,
il est prsid alternativement par un reprsentant de chacun
des deux collges. Son financement est assur en quasitotalit par le Fonds national de prvention
des accidents du travail et des maladies professionnelles.
AQUITAINE
(68 Haut-Rhin)
11 avenue De-Lattre-de-Tassigny
BP 70488
68018 Colmar cedex
tl. 03 89 21 62 20
fax 03 89 21 62 21
www.cram-alsace-moselle.fr
(24 Dordogne, 33 Gironde, 40 Landes,
47 Lot-et-Garonne, 64 Pyrnes-Atlantiques)
80 avenue de la Jallre
33053 Bordeaux cedex
tl. 05 56 11 64 36
fax 05 57 57 70 04
AUVERGNE
Les Caisses rgionales dassurance maladie (CRAM)
et Caisses gnrales de scurit sociale (CGSS)
Les Caisses rgionales dassurance maladie et les Caisses
gnrales de scurit sociale disposent, pour participer
la diminution des risques professionnels dans leur rgion,
dun service prvention compos dingnieurs-conseils
et de contrleurs de scurit. Spcifiquement forms
aux disciplines de la prvention des risques professionnels
et sappuyant sur lexprience quotidienne de lentreprise,
ils sont en mesure de conseiller et, sous certaines conditions,
de soutenir les acteurs de lentreprise (direction, mdecin du travail,
CHSCT, etc.) dans la mise en uvre des dmarches
et outils de prvention les mieux adapts chaque situation.
Ils assurent la mise disposition de tous
les documents dits par lINRS.
service.prevention@cram-nordest.fr
NORD-PICARDIE
(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise,
62 Pas-de-Calais, 80 Somme)
36 rue Xaintrailles
45033 Orlans cedex 1
tl. 02 38 81 50 00
fax 02 38 79 70 29
11 alle Vauban
59662 Villeneuve-dAscq cedex
tl. 03 20 05 60 28
fax 03 20 05 79 30
prev@cram-centre.fr
www.cram-nordpicardie.fr
CENTRE-OUEST
NORMANDIE
(16 Charente, 17 Charente-Maritime,
19 Corrze, 23 Creuse, 79 Deux-Svres,
86 Vienne, 87 Haute-Vienne)
4 rue de la Reynie
87048 Limoges cedex
tl. 05 55 45 39 04
fax 05 55 79 00 64
(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche,
61 Orne, 76 Seine-Maritime)
Avenue du Grand-Cours, 2022 X
76028 Rouen cedex
tl. 02 35 03 58 21
fax 02 35 03 58 29
doc.tapr@cram-centreouest.fr
catherine.lefebvre@cram-normandie.fr
dominique.morice@cram-normandie.fr
LE-DE-FRANCE
PAYS DE LA LOIRE
(75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines,
91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-SaintDenis, 94 Val-de-Marne, 95 Val-dOise)
(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire,
53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vende)
17-19 place de lArgonne
75019 Paris
tl. 01 40 05 32 64
fax 01 40 05 38 84
documentation.prevention
@cramaquitaine.fr
81 85 rue de Metz
54073 Nancy cedex
tl. 03 83 34 49 02
fax 03 83 34 48 70
2 place de Bretagne
BP 93405, 44034 Nantes cedex 1
tl. 02 51 72 84 00
fax 02 51 82 31 62
prevention@cram-pl.fr
prevention.atmp@cramif.cnamts.fr
(03 Allier, 15 Cantal,
43 Haute-Loire, 63 Puy-de-Dme)
48-50 boulevard Lafayette
63058 Clermont-Ferrand cedex 1
tl. 04 73 42 70 76
fax 04 73 42 70 15
preven.cram@wanadoo.fr
BOURGOGNE
et FRANCHE-COMT
LANGUEDOC-ROUSSILLON
(11 Aude, 30 Gard, 34 Hrault,
48 Lozre, 66 Pyrnes-Orientales)
29 cours Gambetta
34068 Montpellier cedex 2
tl. 04 67 12 95 55
fax 04 67 12 95 56
RHNE-ALPES
(01 Ain, 07 Ardche, 26 Drme, 38 Isre,
42 Loire, 69 Rhne, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie)
26 rue dAubigny
69436 Lyon cedex 3
tl. 04 72 91 96 96
fax 04 72 91 97 09
preventionrp@cramra.fr
prevdoc@cram-lr.fr
(21 Cte-dOr, 25 Doubs, 39 Jura,
58 Nivre, 70 Haute-Sane, 71 Sane-et-Loire,
89 Yonne, 90 Territoire de Belfort)
ZAE Cap-Nord
38 rue de Cracovie
21044 Dijon cedex
tl. 03 80 70 51 32
fax 03 80 70 51 73
prevention@cram-bfc.fr
SUD-EST
MIDI-PYRNES
(09 Arige, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrnes,
81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)
(04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes,
06 Alpes-Maritimes, 13 Bouches-du-Rhne,
2A Corse Sud, 2B Haute-Corse, 83 Var,
84 Vaucluse)
2 rue Georges-Vivent
31065 Toulouse cedex 9
tl. 0820 904 231 (0,118 /min)
fax 05 62 14 88 24
35 rue George
13386 Marseille cedex 5
tl. 04 91 85 85 36
fax 04 91 85 75 66
doc.prev@cram-mp.fr
documentation.prevention@cram-sudest.fr
Services prvention des CGSS
Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite sans le consentement de lINRS,
de lauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.
Il en est de mme pour la traduction, ladaptation ou la transformation, larrangement ou la reproduction,
par un art ou un procd quelconque (article L. 122-4 du code de la proprit intellectuelle).
La violation des droits dauteur constitue une contrefaon punie dun emprisonnement de trois ans
et dune amende de 300 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la proprit intellectuelle).
INRS, 2008. Photos INRS et AFORPA.
GUADELOUPE
GUYANE
LA RUNION
MARTINIQUE
Immeuble CGRR
Rue Paul-Lacav
97110 Pointe--Pitre
tl. 05 90 21 46 00
fax 05 90 21 46 13
Espace Turenne
Radamonthe
Route de Raban,
BP 7015
97307 Cayenne cedex
tl. 05 94 29 83 04
fax 05 94 29 83 01
4 boulevard Doret
97405 Saint-Denis
cedex
tl. 02 62 90 47 00
fax 02 62 90 47 01
Quartier Place-dArmes
97210 Le Lamentin cedex 2
tl. 05 96 66 51 31
05 96 66 51 33
fax 05 96 51 81 54
prevention@cgssreunion.fr
prevention972@cgssmartinique.fr
lina.palmont@cgssguadeloupe.fr
116617 COUV
3/10/08
19:35
Page 1
Le taux de frquence des
accidents du travail dans le secteur
de la rparation automobile est
suprieur la moyenne nationale, tous
secteurs confondus de la mtallurgie.
Cette activit comporte
des risques trs varis.
Les responsables dans cette profession
constitue de trs nombreuses
entreprises de petite taille
doivent assurer,
le plus souvent seuls,
les diverses fonctions de
lentreprise et notamment
lorganisation de la prvention.
Cette brochure est destine
aider les employeurs et les
responsables dateliers de rparation
et dentretien des vhicules automobiles
prendre des mesures prventives,
afin damliorer la scurit
dans leur tablissement.
Rparation et entretien
des vhicules automobiles
Institut national de recherche et de scurit
pour la prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 Tl. 01 40 44 30 00
Fax 01 40 44 30 99 Internet : www.inrs.fr e-mail : info@inrs.fr
dition INRS ED 755
4e dition (2008)
rimpression octobre 2008 8 000 ex. ISBN 978-2-7389-1639-6
Vous aimerez peut-être aussi
- 7 Erreurs Financières Que Les Riches Ne Commettent JamaisDocument9 pages7 Erreurs Financières Que Les Riches Ne Commettent JamaisCherif Sylla100% (2)
- Budget de Tresorerie + Cas CorrigeDocument9 pagesBudget de Tresorerie + Cas CorrigeNassima Nait Slimane74% (19)
- Sciences de L Education Et Philosophie de L EducationDocument30 pagesSciences de L Education Et Philosophie de L EducationPFE100% (2)
- Caces CatégorieDocument112 pagesCaces CatégorieARSENEPas encore d'évaluation
- La Santé MentaleDocument23 pagesLa Santé MentaleRachid DarouichiPas encore d'évaluation
- 2-Desserts 2 CompressedDocument40 pages2-Desserts 2 CompressedCwt ChanPas encore d'évaluation
- Pont RoulantDocument57 pagesPont RoulantHatim Ettaib100% (3)
- Evluation Des Risques Professionnels PDFDocument32 pagesEvluation Des Risques Professionnels PDFالطاهر فرديPas encore d'évaluation
- Ed812 PDFDocument112 pagesEd812 PDFImedooImed100% (1)
- La DistillationDocument21 pagesLa Distillationwacabama83% (6)
- Manutention PortDocument68 pagesManutention PortDeanna Barrett50% (2)
- Ed6009 PDFDocument38 pagesEd6009 PDFRached Douahchua100% (2)
- Ed 949Document64 pagesEd 949surfewavePas encore d'évaluation
- Manutention Manuelle PDFDocument20 pagesManutention Manuelle PDFMira Reda100% (1)
- ED847-Conception Des Lieux de Travail-Aspects EconomiqueDocument52 pagesED847-Conception Des Lieux de Travail-Aspects Economiquemguisse100% (1)
- 05ed802 - ExtincteursDocument61 pages05ed802 - Extincteursmanu2933Pas encore d'évaluation
- INRS Conception Des Lieux de Travail PDFDocument110 pagesINRS Conception Des Lieux de Travail PDFbenfoukPas encore d'évaluation
- ED874 Electricite StatiqueDocument107 pagesED874 Electricite StatiqueyliosePas encore d'évaluation
- Théorie Des ContraintesDocument11 pagesThéorie Des Contraintesnassy13Pas encore d'évaluation
- Mémento de L'élingueur PDFDocument67 pagesMémento de L'élingueur PDFBecha MouradPas encore d'évaluation
- DesautelDocument20 pagesDesauteletd_1988100% (1)
- Desenfumage Des Lieux de TravailDocument0 pageDesenfumage Des Lieux de TravailcmdiPas encore d'évaluation
- Securité de MachinesDocument90 pagesSecurité de MachinesCarolina GarretoPas encore d'évaluation
- INRS Conception Des Lieux de Travail PDFDocument110 pagesINRS Conception Des Lieux de Travail PDFMiraPas encore d'évaluation
- ED790 Aide-Mémoire Du BTPDocument136 pagesED790 Aide-Mémoire Du BTPyliose100% (1)
- M03 Procédés Généraux de Construction AC TSGO-BTP-TSGODocument201 pagesM03 Procédés Généraux de Construction AC TSGO-BTP-TSGOOussama MaachPas encore d'évaluation
- Communication des risques météorologiques et climatiquesD'EverandCommunication des risques météorologiques et climatiquesPas encore d'évaluation
- Processus de RecrutementDocument8 pagesProcessus de Recrutementnassy13100% (1)
- Le Marché FinancierDocument6 pagesLe Marché Financiernassy13Pas encore d'évaluation
- Construire Son Projet Professionnel PDFDocument3 pagesConstruire Son Projet Professionnel PDFlolipop722220% (1)
- Situations de Travail Exposant À L'amianteDocument60 pagesSituations de Travail Exposant À L'amianteTic TacPas encore d'évaluation
- Examen Conduite de Chariot Automoteurs PDFDocument44 pagesExamen Conduite de Chariot Automoteurs PDFCécile BOUYEPas encore d'évaluation
- Amélioration Et Fiabilisation de La Ligne CDCDocument88 pagesAmélioration Et Fiabilisation de La Ligne CDChamza elgarragPas encore d'évaluation
- ED956 Les Peintures en Poudre PDFDocument16 pagesED956 Les Peintures en Poudre PDFWalid Rahmouni100% (1)
- SILOS FARINE - Prévention Des Risques D'incendieDocument18 pagesSILOS FARINE - Prévention Des Risques D'incendieylaala8010Pas encore d'évaluation
- Marché MonétaireDocument11 pagesMarché Monétairenassy1367% (3)
- En 12681 PDFDocument22 pagesEn 12681 PDFImane KhammouriPas encore d'évaluation
- Memento ELINGAGE INRS PDFDocument67 pagesMemento ELINGAGE INRS PDFAbdellah IDMANSOURPas encore d'évaluation
- Decret 65 PDFDocument162 pagesDecret 65 PDFAlix Sossou100% (1)
- FR P2 PRAC 2017 SamplePaper2 Rationale v1.8.1Document24 pagesFR P2 PRAC 2017 SamplePaper2 Rationale v1.8.1ibghodbanePas encore d'évaluation
- Ed 911Document96 pagesEd 911Mohammed Ben AliPas encore d'évaluation
- Ed 596Document0 pageEd 596casaouis02Pas encore d'évaluation
- Ed 799Document0 pageEd 799casaouis02100% (1)
- Aide Mémoire JuridiqueDocument30 pagesAide Mémoire JuridiqueBertrand CharletPas encore d'évaluation
- Inrs ConsignationDocument0 pageInrs ConsignationPhilippe Ergaud100% (1)
- Ed990 PDFDocument99 pagesEd990 PDFfgfPas encore d'évaluation
- Ed 828Document121 pagesEd 828FatmaOriflameCristianLayPas encore d'évaluation
- RestaurationDocument36 pagesRestaurationMEP EngineeringPas encore d'évaluation
- Ed6173 PDFDocument68 pagesEd6173 PDFKamel BelhibaPas encore d'évaluation
- TJ13 Aide Mémoire Juridique Eclairage Des Locaux de TravailDocument23 pagesTJ13 Aide Mémoire Juridique Eclairage Des Locaux de TravailWalid RahmouniPas encore d'évaluation
- Ed6048 PDFDocument62 pagesEd6048 PDFina heriPas encore d'évaluation
- Usines Eau PotableDocument56 pagesUsines Eau PotablefaycalPas encore d'évaluation
- Ed6038 Machines Réfelxion Sur ArretsDocument27 pagesEd6038 Machines Réfelxion Sur Arretspma61Pas encore d'évaluation
- Inrs Ed 783Document41 pagesInrs Ed 783jimmyantoine2910Pas encore d'évaluation
- TJ23 Aide Mémoire Juridique Préventions Du Risque ChimiqueDocument52 pagesTJ23 Aide Mémoire Juridique Préventions Du Risque ChimiqueWalid RahmouniPas encore d'évaluation
- Ed 6173Document72 pagesEd 6173DomoinaPas encore d'évaluation
- Ed6018 Vibration Et Mal de DosDocument34 pagesEd6018 Vibration Et Mal de DosMichael BledPas encore d'évaluation
- Livre - Inrs LeanDocument56 pagesLivre - Inrs LeanCar YamooPas encore d'évaluation
- Ed944 PDFDocument59 pagesEd944 PDFGuillaum_978Pas encore d'évaluation
- ED6021 - Incendie Et Explosion Dans L'industrie Du BoisDocument67 pagesED6021 - Incendie Et Explosion Dans L'industrie Du BoisHwauei Mate10Pas encore d'évaluation
- Ed 995Document36 pagesEd 995StanePas encore d'évaluation
- Ed807 Securite Machines EquipementsDocument103 pagesEd807 Securite Machines Equipementspma61Pas encore d'évaluation
- Ed 830Document54 pagesEd 830beey2001Pas encore d'évaluation
- ED866 Pollution de SolsDocument214 pagesED866 Pollution de SolsyliosePas encore d'évaluation
- ED840 Evaluation Des Risques ProfessionnelsDocument32 pagesED840 Evaluation Des Risques ProfessionnelsyliosePas encore d'évaluation
- Installations Sanitaires Des Entreprises - r46-Guides-InrsDocument24 pagesInstallations Sanitaires Des Entreprises - r46-Guides-InrselipholebPas encore d'évaluation
- Ed 999Document112 pagesEd 999Wassim SahraouiPas encore d'évaluation
- Ed 742Document31 pagesEd 742Metalmaster244100% (1)
- Ed950 Conception Des Lieux Et Des Situations de Travail. Santé Et Sécurité Démarche Méthodes Et Connaissances TechniquesDocument153 pagesEd950 Conception Des Lieux Et Des Situations de Travail. Santé Et Sécurité Démarche Méthodes Et Connaissances TechniquesJb FleckPas encore d'évaluation
- DésenfumageDocument23 pagesDésenfumageBOUKHATEM MARIAPas encore d'évaluation
- Extincteurs PDFDocument61 pagesExtincteurs PDFAnonymous 1FzIK5hPas encore d'évaluation
- Ed 770Document35 pagesEd 770meliodeetPas encore d'évaluation
- Tremblement: Dither : bruit visuel dans la vision par ordinateurD'EverandTremblement: Dither : bruit visuel dans la vision par ordinateurPas encore d'évaluation
- De Rome à Marcinelle: Santé-sécurité : hier, aujourd’hui et plus encore demain !D'EverandDe Rome à Marcinelle: Santé-sécurité : hier, aujourd’hui et plus encore demain !Pas encore d'évaluation
- Les Echanges InternationauxDocument21 pagesLes Echanges Internationauxnassy13Pas encore d'évaluation
- Fiscalite 120909111130 Phpapp02Document30 pagesFiscalite 120909111130 Phpapp02Nadia KaramPas encore d'évaluation
- Motivation Coes Fms 2012Document29 pagesMotivation Coes Fms 2012nassy13Pas encore d'évaluation
- OnepDocument4 pagesOnepnassy13Pas encore d'évaluation
- Processus de Gestion Des Approvisionnements Et Des StocksDocument6 pagesProcessus de Gestion Des Approvisionnements Et Des Stocksnassy13Pas encore d'évaluation
- Fnctions ConvexesDocument13 pagesFnctions ConvexesFatima DocPas encore d'évaluation
- Analyse ModaleDocument24 pagesAnalyse ModaleÃSsä LäPas encore d'évaluation
- t2948-1 Graphique Algerie VFDocument1 paget2948-1 Graphique Algerie VFRoza AGGADPas encore d'évaluation
- Screenshot 2021-02-01 at 11.18.13 PMDocument13 pagesScreenshot 2021-02-01 at 11.18.13 PMYousraPas encore d'évaluation
- Nouveau Document Microsoft Office WordDocument9 pagesNouveau Document Microsoft Office WordikramPas encore d'évaluation
- Guide D'aménagement Du Térritoire PDFDocument47 pagesGuide D'aménagement Du Térritoire PDFfrisel AHISSOU100% (1)
- Guide GC Tableau-calcul-ID 2022Document2 pagesGuide GC Tableau-calcul-ID 2022Nassim ZoraiPas encore d'évaluation
- Support de Cours Ethique Et Déontologie Professionnelle - GTDocument14 pagesSupport de Cours Ethique Et Déontologie Professionnelle - GTGOGNO TOPOGRAPHIE SARL INTERNATIONALPas encore d'évaluation
- ElectrostatiqueDocument1 pageElectrostatiquesoufian ensetPas encore d'évaluation
- Métrologie Théorie - Slides - Séance 1 2Document31 pagesMétrologie Théorie - Slides - Séance 1 2Jordan Bessala NgahPas encore d'évaluation
- Exercices Algos 2020-2021Document7 pagesExercices Algos 2020-2021Mamadou yahya Barry0% (2)
- En 1442Document9 pagesEn 1442BERTRANDPas encore d'évaluation
- Economie Des ServicesDocument22 pagesEconomie Des ServiceskhaledPas encore d'évaluation
- Modes de Transmission Des Resistances BacteriennesDocument27 pagesModes de Transmission Des Resistances BacteriennesMélaine BETEPas encore d'évaluation
- Transformateurs MonophasésDocument51 pagesTransformateurs MonophasésDo OuPas encore d'évaluation
- Croix-Bleue Prevention Addictions Ecoles TDR 2021Document5 pagesCroix-Bleue Prevention Addictions Ecoles TDR 2021Luc Djedje DioroPas encore d'évaluation
- RarDocument45 pagesRaryoussefrafik220Pas encore d'évaluation
- Renault Captur 2013 FRDocument48 pagesRenault Captur 2013 FRMuhammad Reyhan AdiprasetyoPas encore d'évaluation
- Mba Finance Et Stratégie D'entrepriseDocument1 pageMba Finance Et Stratégie D'entrepriseMory CondePas encore d'évaluation
- Mengue Messi Jean Marie MATRICUL: 17J320 Philosophie 3 Enseignant: DR Azab À Boto ChristianeDocument2 pagesMengue Messi Jean Marie MATRICUL: 17J320 Philosophie 3 Enseignant: DR Azab À Boto ChristianeJo ColmanPas encore d'évaluation