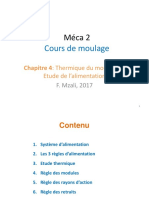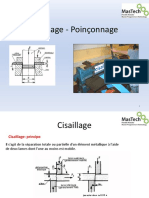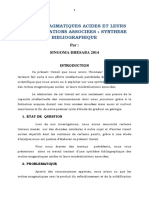Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Techniques de Production PDF
Cours Techniques de Production PDF
Transféré par
Firass ChafaiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Techniques de Production PDF
Cours Techniques de Production PDF
Transféré par
Firass ChafaiDroits d'auteur :
Formats disponibles
MINISTERE DE LENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE
DIRECTION DES ETUDES TECHNOLOGIQUES
Institut suprieur des tudes technologiques de Nabeul
DEPARTEMENT GENIE MECANIQUE
NIVEAU 2
labor par :
MHEMED SAMIR
Anne universitaire : 2004-2005
Techniques de production -CI Niveau2 Table des matires
PRESENTATION GENERALE DU COURS
DUREE :
22,5 heures
OBJECTIF
Au terme de ce cours, l'tudiant doit tre familiaris avec les techniques de production
mettant en valeur les procds de mise en forme par dformation et/ou par
assemblage.
CONTENU DE PROGRAMME
Mise en forme des mtaux
Mise en forme par dformation plastique des
mtaux en feuille (pliage, roulage,
emboutissage...)
Mise en forme par dformation plastique chaud
(forgeage, laminage, estampage...)
Obtention des bruts par moulage (moulage en sable, e coquille,...)
Mise en forme par assemblage (soudage)
Soudage nergie lectrique
Soudage nergie thermochimique
Soudage autre type d'nergie
Pr- requis
Techniques de production niveau 1.
Bibliographie
Prcis de construction mcanique, dition : AFNOR
guide du technicien en productique, Edition : Hachette
J. P TROTIGNONS, Prcis de construction mcanique, Edition AFNOR
R. VARISELLAZ, Soudage : lments de conception et de ralisation, Ed
DUNOD
J. TRIOULEVRE, Procds de forgeage, Ed DELAGRAVE
L. GIAI, BRUERI, Fonderie, Ed DUNOD
G. POMEY, G. SANZ, Aptitude l'emboutissage des tles minces
Pierre PIGNIOL, Soudage - collage
Jean CORNU, Soudage en continu
Techniques de production -CI Niveau2 Table des matires
TABLE DES MATIERES
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE PLIAGE ....................................6
1 PLIAGE .........................................................................................................7
1.1 GENERALITES ............................................................................... 7
1.2 DETERMINATION DE L EFFORT DE PLIAGE EN V .............................. 7
1.3 RETOUR ELASTIQUE ...................................................................... 8
1.4 ANALYSE DE LA DEFORMATION ...................................................... 9
1.5 LONGUEUR DEVELOPPEE ............................................................ 10
1.6 APPLICATION ............................................................................... 13
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : EMBOUTISSAGE .......................14
1 EMBOUTISSAGE......................................................................................15
1.1 DEFINITION ................................................................................. 15
1.2 PROCEDES D'EMBOUTISSAGE ............................................. 15
1.3 EFFORT D'EMBOUTISSAGE ................................................... 16
1.4 CALCUL DES FLANS ............................................................... 19
1.5 REDUCTION ADMISSIBLE EN PLUSIEURS PASSES . ......................... 25
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : CISAILLAGE- POINONNAGE
.........................................................................................................................................27
1 CISAILLAGE- POINONNAGE ..............................................................28
1.1 CISAILLAGE ................................................................................. 28
1.2 POINONNAGE ....................................................................... 29
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE SOUDAGE .............................32
1 SOUDAGE..................................................................................................33
1.1 DEFINITION ................................................................................. 33
1.2 DIFFERENTS MODES DE SOUDAGE ............................................... 34
Techniques de production -CI Niveau2 Table des matires
1.3 CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX PROCEDES DE SOUDAGE ......... 35
1.4 SOURCES D ENERGIE DE SOUDAGE ET APPLICATIONS
INDUSTRIELLES .............................................................................................. 36
1.5 PROCEDES DE SOUDAGE A L ARC ELECTRIQUE ............................ 42
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE MOULAGE .............................58
1 MISE UVRE DE ALLIAGE PAR COULEE LE MOULAGE ..........60
1.1 MOULAGE EN CONTINU ................................................................ 60
1.2 MOULAGE AVEC EMPREINTE ........................................................ 60
1.3 COMPARAISON DES TOLERANCES USUELLES DES DIFFERENTS
PROCEDES DE TRANSFOR MATION DES METAUX .............................................. 66
1.4 APPLICATIONS............................................................................. 67
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : FORGEAGE LIBRE ...................69
1 FORGEAGE LIBRE ..................................................................................70
1.1 MATERIEL UTILISE EN FORGEAGE LIBRE ....................................... 70
1.2 ANALYSE DES DEFORMATIONS..................................................... 70
1.3 ETUDE DU FORGEAGE LIBRE PAR PRESSE .................................... 71
1.4 ETUDE DU FORGEAGE LIBRE PAR MARTEAUX ............................... 71
1.5 EVOLUTION D UNE FORME PRISMATIQUE ...................................... 72
1.6 APPLICATIONS PRATIQUES DU FORGEAGE .................................... 74
1 EXAMEN 2003/04 SEMESTRE 2...............................................................
2 DEVOIR SURVEILLE 2004/05 SEMESTRE 1 .........................................
3 LEMENTS DE CORRECTION DU DS 2004/05 SEMESTRE 1..........
4 DEVOIR SURVEILLE 2004/05 SEMESTRE 2 .........................................
5 EXAMEN 2004/05 SEMESTRE 1...............................................................
6 EXAMEN 2004/05 SEMESTRE 2...............................................................
7 EXAMEN 2003/04 SEMESTRE 2 : CORRECTION ................................
Techniques de production -CI Niveau2 fiche de prparation : leon 1
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE PLIAGE
MATIERE:
Techniques de production
OBJECTIFS TERMINAUX:
Dtermination de la longueur dveloppe dun flan
Dtermination des caractristiques gomtrique
de loutillage.
OBJECTIFS SPECIFIQUES:
Analyse des dformations,
Prsenter les mthodes thoriques et empiriques
pour la dtermination des flans.
PREREQUIS:
Rsistance des matriaux
Mathmatiques lmentaires
AUDITEURS:
Etudiants des I.S.E.T,
Profil : Gnie mcanique,
Option : tronc commun,
Niveau : 2
DUREE:
1heure 30min x 2
EVALUATION:
Formative,
Sommative.
SUPPORTS MATERIELS:
Tableau ;
Rtroprojecteur,
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 6
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage
1 PLIAGE
1.1 GENERALITES
Le pliage permet l'obtention de pices dveloppables dont les plis sont obligatoirement
rectilignes (figure 1).
Deux techniques sont utilises :
Pliage en l'air (figure 2)
Poinon et matrice en V dont l'angle est infrieur celui du pli raliser.
Ce dernier est donn par la profondeur de pntration du poinon dans la matrice.
Pliage en frappe
Poinon et matrice en V dont l'angle est sensiblement gal celui du pli raliser.
L'paisseur de la tle est rduite l'endroit du pli. Cette rduction est fonction du rayon
R de pliage et de l'paisseur e du matriau.
F = effort vertical calcul
figure 1
figure 2
1.2 DETERMINATION DE LEFFORT DE PLIAGE EN V
Formule utilise pour le calcul de l'effort vertical de pliage
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 7
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage
Pliage en l'air
Le 2 Rm
F1 = k o :
a
k = 1,40 pour a =6e; e = paisseur plier (mm),
k = 1,33 pour a = 8e; L = longueur du pli (mm),
k = 1,24 pour a = 12e; a = ouverture du v (mm),
k = 1,20 pour a = 16 e ; Rm = rsistance la rupture du mtal plier (daN/mm2).
- Le rayon R obtenu est voisin de a/6 condition que Rp R.
Pliage en frappe
L'effort F2 fournir progresse avec l'paisseur. Il peut atteindre
F2 = 2 F1
1.3 RETOUR ELASTIQUE
Lorsque cesse l'effort de pliage, le produit garde une dformation permanente, qui est
d'autant plus loigne de celle obtenue par le flchissement maximum que l'lasticit
du mtal est grande. Ce retour lastique est appel ressaut.
Ces formules s'appliquent dans le cas de pliage de tle sans frappe fond, dans le cas
de pliage en frappe le retour lastique est quasiment supprim.
1.3.1 Dtermination des rayons
eo
ro + 1
2 =
r + eo r + eo
2 1+ 3 2 Re
eo E
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 8
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage
Valable lorsque r e 10
o
1.3.2 Dtermination des angles
e
A ro + o 2
=
Ao e
r+ o 2
Caractristiques mcaniques de la tle
Re : limite d'lasticit
E: module d'lasticit (ou module
d'Young)
figure 3 Gomtrie du pliage
ro : rayon initial
r: rayon intrieur aprs retour
lastique
1.4 ANALYSE DE LA DEFORMATION
Sous l'action du poinon, le mtal compris dans la section I est soumis aux forces de
compression et de traction pour H, leur intensit s'annule sur la fibre neutre et leur
valeur maximum est atteinte en E et K. Le maintien de l'quilibre des sections (l'une qui
augmente, l'autre qui diminue) provoque un dplacement de la fibre neutre vers le
rayon intrieur.
- Approximativement, la fibre neutre est situe :
e/2 si R/e 3
2 e/5 si R/e 2
e/3 si R/e 1
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 9
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage
figure 4
partir de cette remarque et toujours avec approximation, il est possible de dfinir :
- l'allongement support par les fibres les plus tendues,
- le dveloppement du flan thorique.
Allongement de la fibre extrieure
Il est dfini par la relation.
(R + e)a R + e a e
A% = 2
100 si R 3e soit encore A% = 2 100
e e
R + a R +
2 2
1.5 LONGUEUR DEVELOPPEE
1.5.1 Dcomposition en lments gomtriques simples
Si R1 et R2 sont les rayons de la fibre neutre (figure 5)
La connaissance de la position de la fibre neutre permet d'obtenir avec une bonne
approximation le dveloppement du flan.
2R1a 2R2a 2
L1 = l1 + + l2 + + l3 (a en )
360 360
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 10
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage
figure 5
1.5.2 Formules fondes sur la norme DIN 6935
n n 1
Ltot = li lj
i=1 j=1
Aj
lj = 2( rj+eo ) cot an (rj+ k eo )( Aj)
2
avec :
Ltot : longueur dveloppe totale
li : longueur d'une ligne de segment droit n i dfinie sur la figure ci-aprs
rj : rayon intrieur du pli n j compt partir d'une extrmit de la tle
eo : paisseur de la tle
Aj : angle intrieur correspondant au pli n j
k : coefficient prenant en compte le dplacement de la fibre neutre et dfini par
k = 0,1134 Ln (rj/ eo) + 0,3505 pour rj/ eo 3,8
k=0,5 pour rj / eo > 3,8
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 11
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage
figure 7 Tle dplies
figure 6 Tle plie
1.5.3 Dtermination de la longueur dveloppe : abaque
figure 8
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 12
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage
La figure 8 est extraite de l'ouvrage : Die Design Handbook, American Society of Tool
and Manufacturing Engineers, dit par Mc Graw Hill Book Company, p. 2-15.
Exemple d'utilisation
Donnes :
Rayon de pliage : r=5 mm; angle de pliage : a= 30 (ouvert); paisseur de tle : e = 1,5
mm.
Rsultat
La valeur de C est donne par la courbe situe l'intersection de la droite qui joint les
valeurs de r et de e et l'horizontale passant par a. Ici C = 1,5 mm
1.6 APPLICATION
Calculer la force de pliage en v de la pice donne par la fig. 9 et montrer l'aide
des schmas, le nombre et l'ordre des oprations.
On donne e = 3 mm ; Rm = 46 daN/mm 2 ;
k = 1,4 ; a = 6e ; (a= 90 ; R = 10 mm (le rayon au niveau de la fibre neutre)
figure 9
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 13
Techniques de production -CI Niveau2 Fiche de prparation : leon 2
FICHE DE PREPARATION DUNE
LEON : EMBOUTISSAGE
MATIERE:
Techniques de production
OBJECTIF TERMINAL:
Dtermination de diamtre dun flan
OBJECTIFS SPECIFIQUES:
analyse des dformations,
calcul des flans par diffrentes mthodes,
problmes demboutissage
PREREQUIS:
Rsistance des matriaux
Mathmatiques lmentaires
AUDITEURS:
Etudiants des I.S.E.T,
Profil : Gnie mcanique,
Option : tronc commun,
Niveau : 2
DUREE:
1heure 30min x2
EVALUATION:
Formative,
Sommative.
SUPPORTS MATERIELS:
Tableau ;
Rtroprojecteur,
Polycopie.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 14
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
1 EMB O UT ISSA GE
1.1 DEFINITION
L'emboutissage est un procd de formage par dformation plastique d'une surface de
mtal entrane par un poinon dans une matrice. Cette dformation est difficilement
rversible; de ce fait, on considre que la pice obtenue n'est pas dveloppable.
figure 10 figure 11
1.2 PROCEDES D'EMBOUTISSAGE
Il existe deux procds d'emboutissage suivant la forme de pice obtenir.
1.2.1 Emboutissage en expansion
Si la pice a une forme complexe mais de faible profondeur on peut bloquer le flanc
entre serre flan et matrice, si besoin est avec des joncs. La tle ne se dforme alors
que sur le poinon en s'allongeant dans une ou plusieurs directions et en
samincissant, nous disons que nous travaillons en expansion (Fig. 12).
1.2.2 Emboutissage en rtreint
Si la pice a une forme cylindrique droite (base circulaire ou quelconque) de forte
profondeur on laisse glisser le flan entre serre flan et matrice, la dformation sur le
poinon est limite aux rayons de poinon, la majeure partie de la dformation se fait
par rtrcissement sur la matrice, c'est l'emboutissage en rtreint (Fig. 13).
Une opration d'emboutissage quelconque est la combinaison de ces deux modes
Dans une opration mixte, un des gros problmes est de rgler le glissement sous
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 15
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
serre flan suffisamment faible pour permettre les dformations et viter les plis ,
suffisamment fort pour viter un tirage trop important qui conduirait la rupture.
figure 12 Emboutissage en expansion
figure 13 Emboutissage en rtreint
1.3 EFFORT D'EMBOUTISSAGE
1.3.1 Analyse des dformations
Au cours de l'opration d'emboutissage la tle est soumise des contraintes trs
complexes : de compression de direction tangentielle et de traction de direction radiale
(figure 14).
Pour qu'il y ait emboutissage sans dchirure, il faut que le fond de l'emboutissage
rsiste la pression du poinon (fig.15), si on prend (Fd) comme effort ncessaire pour
dcouper le fond, on peut admettre que l'effort d'emboutissage (Fe) ne doit pas
dpasser la moiti de cet effort : Fe <1/2 Fd
figure 14
figure 15
Pour la dtermination de l'effort ncessaire l'emboutissage on doit tenir compte
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 16
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
De la forme de l'emboutis
De la qualit et de l'paisseur de la tle
De la vitesse d'emboutissage (de 0.2 0.75 mm/s selon la nature de la
matire)
De la gomtrie de l'outil
De la pression du serre flan
De la lubrification
1.3.2 Dtermination des efforts et nergies ncessaires au formage
des tles
Le choix d'une presse dcoule directement de la connaissance de l'effort total (Ff) et
de l'nergie totale (Wf) requis par le formage de la pice. Cet effort (et cette nergie)
rsulte de la somme de l'effort de formage proprement dit (F) {dnergie (W)} et de
l'effort serre flan (Fst).
Le tableau 2 donne les formules permettant de calculer F et W dans les cas usuels et
le tableau 1 les valeurs de pressions serre flan Psf selon la nature du matriau.
Psf
MATIERE
N/mm2 bar
Acier doux 2.5 3 25 30
Laiton 2 20
Cuivre 1.5 15
Aciers inoxydables 3.5 7 35 70
Aluminium 1.2 12
Tableau 1
Ces valeurs sont minimales elles sont parfois insuffisantes pour viter la formation des
plis
Opration. Effort (N) nergie (J) Observations
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 17
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
Pice cylindrique
d/D 0.5 0.6 0.6
1er passe 5 5
K 1 0.8 0.7
6 2
h.Fe.k1
WE = K1 0.8 0.7 0.7
Fe = p.d.e.Rr.k 1000
7 4
d/D 0.7 0.7 0.8
5
K 0.6 0.5 0.4
K1 0.7 0.6 0.6
nme passe
7 4
h.Fe.k1
Fen = 0,5.Fen - 1 + Q .dn.e.Rr WE =
1000 dn/dn-1 0.7 0.75 0.8 0.85
Q 0.8 0.6 0.5 0.35
Pice KA=0.5 pour les emboutis peu
quadrangulaire profonds
=2 pour les emboutis dont h=5
6r
0,7.h.Fe
WE =
Fe = e.Rr.( 2.KA.r + K B.L) 1000 KB=0.2 pour un jeu important et
pas de SF
=0.3 0.5 si coulement facile
h = hauteur
et faible SF
L = 2(a+b)
=1 si fortes pressions SF.
h.Fe
Pice quelconque Fe = p.e.Rr WE =
1000
tableau2
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 18
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
1.4 CALCUL DES FLANS
La premire tape avant de lancer la fabrication (srie) consiste dterminer les
dimensions du flan, ceci pour des raisons conomiques (calcul de la quantit de
matire, dtermination du nombre de passe) et pour des raisons techniques (forme la
mieux adapte un bon coulement du mtal dans loutil).
Il existe un grand nombre de mthodes de calcul de flan, toutes bases sur le mme
principe (que l'emboutissage s'effectue avec ou sans diminution de l'paisseur), le
volume en matire de la pice produite est gal au volume du flan.
Plusieurs abaques et tableaux sont aisment utilisables pour la dtermination des flans
suivant la forme de l'emboutis.
1.4.1 Mthode analytique
Thorme de Guldin.
La surface engendre par une ligne plane tournant autour d'un axe situ dans son plan
et ne le traversant pas, est gale au produit de la longueur dveloppe de cette ligne
par la circonfrence dcrite par son centre de gravit.
Exemple : (cas des emboutis cylindriques fond plat)
figure 16 sans collerette figure 17 avec collerette
d
En ngligeant le rayon de raccordement de la paroi et du fond, si r
10
D2 d 2
D = d 2 + 4dh et h= D = d 2 + 4d(h + 0.57r + 0.57rc - 0.52(r 2 rc 2 )
4d
Pour dautres formes, voir tableau 3 page 21
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 19
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
Tableau 3
Exemple : recherche du diamtre du flan de l'embouti suivant en ngligeant le
d
rayon de raccordement de la paroi et du fond, ngligence acceptable si r
10
D2 d 2
D = d 2 + 4dh et h=
4d
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 20
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
1.4.2 Dtermination graphique du diamtre du flan.
Dans le cas de la figure 18, si r est le rayon du flan cherch, on peut donc crire
Surface du flan = surface de l'embouti
p r2=2p R (l1+l2+l3+...+l8)
ou encore r2 = 2R.Sl.
figure 18
Mthode de traage
voir page 23.
Pour rechercher R, on utilise la mthode du polygone funiculaire. Aprs avoir divis le
demi profil de la pice en lments simples, de dimension facile estimer et situ leur
centre de gravit (c.d.g.), on les reprsente comme des forces qui permettent de
construire le dynamique.
Les intersections des parallles aux rayons polaires avec les lignes verticales passant
par les c.d.g. prcdents permettent de tracer le polygone funiculaire et de trouver la
distance R du C.D.G. de la fibre neutre l'axe de rotation 0'0.
Aprs avoir ajout 2 R dans le prolongement de AB (dynamique), on obtient la droite
AC et le demi-cercle de rayon AC/2
La leve en B coupe le cercle en D et devient la hauteur du triangle rectangle
ACD.
La hauteur tant moyenne proportionnelle, entre les segments qu'elle dtermine sur
l'hypotnuse, on peut crire : r2 = 2R.Sl.
Qui dmontre que r est bien le rayon du flan.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 21
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
figure 19
Remarque : La position du c.d.g. des arcs lmentaires peut tre situe par les
relations suivantes.
180 R sina
a=
pa
180 R sina a a
b=( )tan = atan
pa 2 2
1.4.3 Mthode utilisant des abaques
Voir page 24 et 25
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 22
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
Abaque de dtermination du diamtre de lembouti sans collerette
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 23
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
Abaque de dtermination du diamtre de lembouti avec collerette
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 24
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
1.5 REDUCTION ADMISSIBLE EN PLUSIEURS PASSES.
Elle est limite par le phnomne d'crouissage
Ss
[ e% = 100 ]. Ce dernier augmente la rsistance du
s
mtal, mais diminue ses capacits d'allongement. Elle
peut tre continue si on limine e par un recuit de
recristallisation.
Sans recuit, on obtient approximativement pour h/d.
Acier doux : 3 4 - Cuivre : 6 7
Aluminium : 4 5 - Laiton : 7 8.
La mise en quation de ce paramtre tant dlicate, on
figure 20
utilise des coefficients pratiques permettant le calcul
rapide de la rduction de premire passe (transformation
du flan en embouti). De passes suivantes s'il y a lieu,
(transformation de l'embouti en un autre embouti de
diamtre infrieur) et cela jusqu' obtention du diamtre
cherch.
Si l'paisseur a t maintenue constante, la
hauteur du produit est simultanment
obtenue.
Deux cas peuvent cependant se prsenter :
Rduction avec outillage muni de serre flan
Utilisation du tableau :
Premire passe d = Dm
1 1
figure 21
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 25
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage
Passes suivantes
d 2 = d1 m 2 et d n = d (n 1) m 2
Matire m1 m2
Tle demboutissage
Ordinaire 0,60 0,80
Spciale 0,55 0,75
Tle acier inoxydable
Austnitique 0,51 0,80
figure 22
Ferritique 0,57 0,80
Cuivre 0,58 0,85
Laiton 0,53 0,75
Aluminium recuit 0,50 0,80
Duralumin recuit 0,55 0,90
Coefficients de rduction de 1re passe=m1, de passes suivantes=m2
Rduction avec outillage sans serre flan ( figure 22)
D d 20e
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 26
Techniques de production -CI Niveau2 Fiche de prparation : Leon 3
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON :
CISAILLAGE- POINONNAGE
MATIERE:
Techniques de production
OBJECTIFS TERMINAL:
Choix dun mode de dbitage.
OBJECTIFS SPECIFIQUES:
Principe de cisaillage,
Principe de poinonnage
Russir les applications
PREREQUIS:
Les outils mathmatiques (notions de gomtrie)
RDM
AUDITEURS:
Etudiants des I.S.E.T,
Profil : Gnie mcanique,
Option : tronc commun,
Niveau : 2
DUREE:
1heure 30min
EVALUATION:
Formative,
Sommative.
SUPPORTS MATERIELS:
Tableau ;
Rtroprojecteur,
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 27
Techniques de production -CI Niveau2 leon 3 :Cisaillage- poinonnage
1 CISA ILLA GE- PO INO NNA G E
1.1 CISAILLAGE
1.1.1 PRINCIPE
- Sous l'action de la contrainte impose par
la partie active des lames, il se produit une
dformation lastique, puis un glissement
avec dcohsion du mtal suivant deux
directions formant l'angle (fig. 23).
- L'angle , ainsi que la profondeur de la
dcohsion, varient suivant la nuance du
mtal et son tat.
- La lame poursuivant sa course provoque la
figure 23
rupture complte par celle du mtal
intercalaire.
1.1.2 MTHODES CLASSIQUES DE CISAILLAGE
1.1.2.1 Cisaillage avec lames parallles (fig.2).
Cisaillage simultan de toute la
longueur. Coupes gnralement
rectilignes. Effort important.
figure 24
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 28
Techniques de production -CI Niveau2 leon 3 :Cisaillage- poinonnage
1.1.2.2 Cisaillage avec lame oblique.
Intrt avoir un angle a
important puisque F dcrot.
Si a > 15 : le mtal peut se
drober (fig.25). Ncessit
d'tablir un compromis. La
partie dcoupe est fortement
flchie, donc dforme (fig.26).
figure 25
figure 26
1.2 POINONNAGE
1.2.1 PRINCIPE
Un poinon et une matrice (fig. 1)
remplacent les lames de cisaille.
Mme mcanisme de rupture.
Force appliquer :
F = L.e.Rc ,
avec en fabrication pour compenser
frottements et usure des parties
actives Rc remplac par Rm. L =
primtre dcoup.
figure 27
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 29
Techniques de production -CI Niveau2 leon 3 :Cisaillage- poinonnage
1.2.2 DSIGNATION DES OPRATIONS (fig. 2)
a. Poinonnage : le dchet est appel dbouchure, trous de petit diamtre.
b. Dcoupage : le produit obtenu est un flan (rcupr pour emboutissage ou pliage).
c. Crevage : dcoupage partiel.
d. Encochage : dcoupage dbouchant sur un contour.
e. Grignotage : poinonnage partiel par dplacement progressif de la pice ou du
poinon.
f. Arasage : dcoupage en reprise (prcision de cotes et d'tat de surface).
g. Dtourage : finition d'un contour dj bauch, modifi au cours d'une dformation.
figure 28
1.2.3 Applications
1/Soit une srie de pices emboutir (fig.29). En supposant que les pices sont en
acier inoxydable, paisseur de tle e = 0.5 mm, dterminer,
a) le diamtre du flan,
b) l'effort de dcoupage du flan.
Pour le calcul prenez RR , = 22 daN/mm ,
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 30
Techniques de production -CI Niveau2 leon 3 :Cisaillage- poinonnage
2/ Soit une srie de 25 000 pices emboutir (fig. 30).
En supposant que les pices sont en acier inoxydable, dterminer
a) le diamtre da flan,
b) l'effort de dcoupage du flan,
c) le nombre d'oprations,
d) l'effort, d'emboutissage pour la 1ere opration,
Pour les calculs prenez
M1 = 0,52 ; m 2 = 0,8 : Rm = 22 daN /mm2 .
Coefficient de rduction K selon le tableau suivant
d/D <0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80
K 1 0,86 0,72 0,60 0,50 0,40
figure 30
figure 29
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 31
Techniques de production -CI Niveau2 Fiche de prparation : Leon 4
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE
SOUDAGE
MATIERE:
Techniques de production
OBJECTIF TERMINAL:
appliquer les diffrentes techniques de soudage.
OBJECTIFS SPECIFIQUES:
prsenter les diffrentes techniques de soudage,
dsignation normalise dune technique de
soudage
dtermination des conditions de soudage.
PREREQUIS:
Les outils mathmatiques
Lecture dun dessin technique
Notions dlectricit.
AUDITEURS:
Etudiants des I.S.E.T,
Profil : Gnie mcanique,
Option : tronc commun,
Niveau : 2
DUREE:
1heure 30min x 3
EVALUATION:
Formative,
Sommative.
SUPPORTS MATERIELS:
Tableau ;
Rtroprojecteur,
Polycopie.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 32
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
1 SO UDA GE
1.1 DEFINITION
Les termes : soudure, brasure, soudo-brasure dsignent assemblage.
Soudage, brasage. soudo-brasage concernent l'excution de l'opration.
La soudure est un assemblage
caractris par l'effacement des
contours primitifs des bords
assembler. Fig.31
figure 31
La brasure est un assemblage diffrent
de la soudure, les bords du joint
conservent leur contour primitif il y a
toujours complment de mtal d'apport
plus fusible que les mtaux assembler
(l'assemblage est joint
capillaire).Fig.32
figure 32
La soudo- brasure est une brasure
excute de proche en proche par
dplacement de la source de chaleur.
(L'assemblage est joint ouvert.)Fig.33
figure 33
Le mtal de base constitue les parties assembler, de mme nature ou de nature
diffrente.
Le mtal d'apport identique ou diffrent du mtal de base peut intervenir partiellement
ou en totalit dans l'laboration du joint.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 33
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Le mtal du joint comprenant le mtal dpos et les bords fondus sont dilus.
Certains lments peuvent diffuser dans les parties adjacentes : enfin, au-del du joint,
une zone plus ou moins tendue (dite Z. A. T.), zone thermiquement affecte, peut
subir des modifications de structure.
1.2 DIFFERENTS MODES DE SOUDAGE
Pour obtenir la continuit atomique entre les deux parties assembler, on peut
envisager 2 modes de soudage
1.2.1 Par pression en phase solide
La liaison est obtenue
par dformation
froid, si le mtal est
suffisamment ductile,
ou chaud pour
amollir le mtal. La
dformation due la
pression concourt,
figure 34 Soudage en phase solide; (a) : par pression; (b) : par
dans certains cas, friction puis pression.
satisfaire la condition
de propret.
1.2.2 En phase liquide
Les deux faces assembler sont
mises en contact avec du mtal
liquide ou sont elles-mmes
amenes superficiellement l'tat
liquide. La plupart des procds de
soudage emploient ce mode qui
permet d'obtenir la fusion locale du
figure 35
joint.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 34
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
1.3 CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX PROCEDES DE SOUDAGE
Le tableau suivant classifie partir de la source d'nergie et des lments de
protection. Le nombre entre parenthses correspond au code numrique affect
chaque procd de soudage par l'Afnor (NF E 04 021).
Sources d'nergie Part de march actuellePart de march dans 3 ans
Flux solide Gaz inerte Gaz actif Sous vide Sans protection
T.I.G.* (141)
Electrodes
Soudage des
enrobes (111) M.I.G.** avec
goujons (731)
Arc lectrique fil lectrode M.A.G.*** avec
Automatique fusible (131) fil lectrode de
fusible(135) Avec lectrode
(1) sous flux solide
au carbone
M.A.G. avec fil Electrogaz(73)
(181)
fourr (136)
Plasma (15)
Par point (21)
Par bossage
(23)
Rsistance lectrique Par tincelage
(2) (24)
En
bout,rsistance
pure (25)
Bombardement
Optique (7) Laser (751) Laser (751)
lectronique
(76)
Oxyactylnique
(311)
Aluminothermie Plasma-arc Oxypropane
Thermochimique (3)
(71) non transfr (312)
Oxhydrique
(313)
Par friction (42)
Par pression
froid (48)
Par pression Par ultra sons
Mcanique (4)
froid (48) (41)
Par explosion
(441)
A la forge (43)
* Tungsten electrod - Inert Gas ** Mtal Inert Gas ***Mtal Active Gas
Tableau 1. CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX PROCDS DE SOUDAGE
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 35
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
1.4 SOURCES DENERGIE DE SOUDAGE ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES
1.4.1 Arcs lectriques
1.4.1.1 Principe
Un courant lectrique de
caractristiques dfinies, nature et
intensit, fait jaillir sous une tension
donne un arc entre 2 lectrodes,
au travers d'une colonne de gaz
ioniss, appele plasma d'arc.
Dans les procds de soudage
l'arc, les plus courants, l'une des
lectrodes est constitue par la
figure 36 Mcanisme de lmission lectronique
pice souder. La quantit de
dans les arcs lectriques libres
chaleur dgage par l'arc (5000
8000c) lectrique permet une
fusion instantane des bords des
pices souder et du mtal
d'apport.
1.4.1.2 nergie de soudage
1.4.1.2.1 nergie nominale (En)
C'est l'nergie fournie au niveau de l'arc pour excuter une soudure. Elle est fonction
de la tension d'arc entre les 2 lectrodes (U), de l'intensit du courant de soudage (I) et
de la vitesse de soudage (?), vitesse laquelle s'effectue le cordon de soudure
U I
En =
Elle s'exprime en joules/cm, avec U en volts, I en ampres et ? en cm/s.
Exemple
Soit U = 30 V I = 600 A ? = 0,5 cm/s
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 36
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
30 600
En = = 36 000 J / cm
0 .5
On peut galement l'exprimer en kilojoules/cm
60 U I
En =
1000
avec En en kJ/cm et ? en cm/min, soit pour l'exemple choisi (v = 30 cm/min)
60 30 600
En = = 36 kJ / cm
1000 30
1.4.1.2.2 nergie dissipe dans le joint soud (Ed)
L'nergie fournie au niveau de l'arc n'est pas entirement transmise aux pices
souder en raison des pertes par rayonnement et par convection de la colonne d'arc.
Ed = En
Le rendement nergtique de l'arc ?, varie en fonction du procd de soudage, de la
nature du courant, de celle du matriau et de l'paisseur des pices souder.
De nombreuses tudes exprimentales ont t faites dans ce domaine. On peut retenir
pour le rendement les valeurs donnes dans le tableau 2
Procds de soudage Mtaux Rendement de l'arc (?)
Automatique sous flux solide Aciers 0,90 0,99
A l'arc, avec lectrodes enrobes Aciers 0,70 a 0,85
M.I.G. Acier doux 0,65 0,85
Aluminium 0,70 0,85
T.I.G. Acier doux 0,22 0,48
courant continu Acier doux 0,36 0,46
courant alternatif Aluminium 0,21 0,43
Tableau 2
1.4.1.2.3 nergie quivalente (Eq)
Elle est dfinie par la relation
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 37
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Ed = En k
o k est un coefficient de correction qui tient compte de la gomtrie du joint souder.
La valeur du coefficient k est donne par le tableau suivant. Conventionnellement le
rendement d'arc ? est pris gal 1 pour les procds lectrodes enrobes ou sous
flux solide, 0,7 pour le M.I.G. et 0,5 pour le T.I.G.
Sur plats k=1
a
0 0.25 0.5 0.75 1
s
k 1 0.97 0.89 0.78 0.67
avec chanfrein
forme a 60 75 90 105
K 0.60 0.63 0.67 0.70
K 1.50 1.72 2 2.38
k 0.75 0.85 1 1.20
Tableau 3
1.4.2 Rsistance lectrique
1.4.2.1 Principe
Les diffrents procds de soudage lectrique par rsistance s'appuient sur la loi de
Joule
E = R I2 t
On cre, localement, une rsistance importante au passage du courant lectrique afin
de concentrer l'chauffement en un point. La rsistance dpend de la rsistivit et de
la gomtrie du conducteur.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 38
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
La rsistivit est fixe par la nature des pices souder. On cre une rsistance
leve en rduisant la section offerte au passage du courant entre les pices
assembler (rduction de la section des lectrodes au contact des pices souder
La rsistance de contact dpend de l'effort de compression, de la temprature et de la
nature du matriau. Plus la pression augmente, plus la rsistance de contact diminue.
A mesure que la temprature crot, sous l'effet de la pression la surface de contact
augmente, ce qui entrane une diminution de la rsistance. C'est entre les deux pices
souder que la rsistance de contact est maximale : R2 > R1 ; il s'en suit un grand
dgagement de chaleur et c'est donc dans cette zone que se localisera la fusion.
figure 37 .Soudage par points, principe (1. lectrodes en cuivre, 2. zone affecte par la chaleur,
3. zone fondue).
1.4.2.2 Principaux procds
1.4.2.2.1 Soudage par points ou par points multiples (Fig.39)
Ce procd s'applique au soudage des tles d'acier, d'acier inoxydable, de cuivre,
d'aluminium, etc. Les paisseurs souder peuvent atteindre selon les mtaux : e = 20
mm.
Pour le soudage des tles
d'acier, la distance entre 2
points (pas), afin d'viter
que le courant soit shunt
par le point voisin, doit tre
d'environ P 3 . La pince
d > 2 e + 4 vite
l'affaissement du mtal sur
figure 38 Soudage par points multiples : distance entre deux
les rives de la tle points et distance entre bord et point
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 39
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Applications (Fig.39) : tubes et fils en croix (bossages naturels) ; treillis souds,
chaises et tabourets en tubes mtalliques, fixation d'attaches sur tles ou pices
embouties. Soudage la molette (Fig.40)
2 molettes ou 2 galets tournant en sens inverse remplacent les lectrodes de soudage
par points. On effectue les soudures soit en points espacs (interruption du passage
du courant lectrique), soit en soudure continue (sans interruption du passage du
courant lectrique).
figure 39
Applications: Assemblage de tles par recouvrement (e 3 mm), fabrication des tubes
mtalliques partir d'un feuillard, forms et souds entre galets.
figure 40
1.4.3 nergie thermochimique
1.4.3.1 Soudage au gaz
Lnergie est fournie par une flamme obtenue partir de 2 gaz : un gaz combustible
(lactylne, lhydrogne, le propane) mlang un gaz comburant (loxygne).
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 40
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Le chalumeau de soudage permet de collecter en proportion adquate ces gaz et de
les faire passer par une buse l'extrmit de laquelle se forme la flamme.
1.4.3.1.1 Puissance spcifique de la flamme.
Le diamtre de l'orifice de la buse et la pression des gaz dterminent la puissance
calorifique de la flamme, ainsi que la vitesse des gaz. Ainsi on dfini les tailles de buse
donnant le dbit en litres de C2H2 par heure.
n 00 - de 10 63 I/h,
n 0 - de 100 400 1/h,
n 1 - de 250 1 000 1/h,
n 2 - de 1 000 4000 1/h,
n 3 > 4000 1/h
figure 41
1.4.3.1.2 Vitesse de soudage.
La vitesse laquelle s'effectue le soudage dpend essentiellement de la temprature.
La chaleur se transmet de la flamme aux pices souder par convection force et,
dans une moindre mesure, par rayonnement (15%).
En soudage bout bout, on peut l'exprimer par la relation V = k/e
V en m/h, e = paisseur en mm , avec k = 12 pour acier doux, k = 30 pour cuivre, k =
60 pour aluminium
1.4.4 Soudage par aluminothermie
Pour obtenir la chaleur ncessaire la fusion du joint souder, on utilise la proprit
de la rduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium suivant la raction
Fe2O3+2 AI A12O3+2 Fe+181500 cal.
Le soudage par aluminothermie s'applique aux trs fortes sections soudes bout
bout (rails, pices massives en constructions lourdes).
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 41
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Les pices assembler sont dsoxydes, enveloppes dans un moule, au droit du
joint. Aprs prchauffage des extrmits souder, la charge en fusion est introduite
dans le moule (pour que la raction exothermique se produise, le mlange doit tre
port 1 300 C environ).
figure 42 Soudage par aluminothermie; (a): moule prt pour la coule; (b): soudure
avant barbage
1.5 PROCEDES DE SOUDAGE A L ARC ELECTRIQUE
Cest de loin la source dnergie la plus utilise ; il sera, donc, tudi de manire plus
approfondie.
Les procds de soudage qui utilisent l'arc lectrique comme source d'nergie diffrent
dans leur principe en fonction d'un certain nombre de critres
le type d'arc utilis (arc libre ou plasma d'arc),
le mode de protection du bain de fusion (flux solide ou gaz),
le type d'lectrode (fusible ou non fusible),
la mise en oeuvre opratoire (manuelle, semi-automatique ou automatique).
figure 43 Soudage l'arc avec lectrodes enrobes : schma de principe
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 42
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
1.5.1 Type d'arc utilis
1.5.1.1 Arc libre
Voir arc lectrique Principe (Fig.36)
1.5.1.2 Plasmas darc
Si la colonne d'arc est soumise une
convection force, travers un orifice
de faible diamtre, l'tranglement de
l'arc "arc trangl" (Fig.44) conduit un
effet de striction et une concentration
de l'nergie dans la zone centrale de
l'orifice de la tuyre, ce qui a pour effet
d'accrotre la temprature (8000
25000k).
figure 44
1.5.2 Type d'lectrode
1.5.2.1 lectrodes enrobes
Llectrode comprend deux parties distinctes : l'me mtallique et l'enrobage.
1.5.2.2 Ame mtallique
Elle sert de conducteur du courant de soudage et de mtal d'apport, elle est
gnralement en acier. Son diamtre caractrise celui de l'lectrode.
1.5.3 Mode de protection
1.5.3.1 Enrobage
Il protge le bain de fusion. C'est un mlange trs complexe qui conditionne trs
largement la qualit du joint soud.
1.5.3.1.1 Diffrents types d'enrobage
Enrobage rutile
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 43
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Le produit de support de l'enrobage est base d'oxyde de titane (Ti O2) naturel (rutile)
avec trs souvent une faible proportion de cellulose.
C'est l'lectrode d'emploi gnral ; trs maniable en toutes positions, elle fonctionne en
courant alternatif basse tension vide (U0 = 45 50 V) et en courant continu. Le
dpt de mtal d'apport est de belle prsentation, avec de bonnes caractristiques
mcaniques et une vitesse de soudage excellente.
Enrobage volatil, ou cellulosique
Il est du type rutile, mais fortement charg en cellulose. Cela favorise le soudage
rapide, en position descendante, et permet, dans certains cas, une trs forte
pntration.
Enrobages acide et oxydant
A base de silicate de potassium (acide) ou d'oxyde de fer (oxydant) stabilisant l'arc,
ces lectrodes sont bas prix, produisant des soudures (soudage plat seulement)
appropries pour des travaux trs ordinaires. Elles sont actuellement peu utilises.
Enrobage basique
Cet enrobage est base de carbonate de chaux, avec addition de fluorure de calcium
pour fluidifiant. L'enrobage basique, qui ncessite un arc court, donne une fusion en
grosses gouttes.
Les lectrodes basiques prsentent les meilleures caractristiques mcaniques,
notamment en ce qui concerne la rsilience. Elles sont utilises pour les assemblages
de haute scurit et chaque fois que l'on a affaire des aciers difficilement
soudables (aciers mi-durs, certains aciers faiblement allis, etc.).
Enrobages spciaux
Ils sont trs souvent de type basique. En fait, chaque type d'enrobage correspond
une nuance particulire d'acier ou un emploi particulier.
lectrodes apport par l'enrobage et lectrodes poudre de fer
On introduit des lments sous forme de poudres mtalliques dans le bain de fusion,
partir d'une me en acier doux. Les lectrodes poudre de fer ont surtout pour but un
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 44
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
apport supplmentaire de mtal (rendement de 120 200 %) d'o leur intrt
conomique (plus de mtal, plus grande vitesse de soudage).
1.5.3.2 Flux de protection
Il remplit les mmes fonctions que l'enrobage de l'lectrode. Conducteur du courant
lectrique, chaud, il participe la formation du bain de fusion, et assure sa
protection.
Les flux sont en gnral de deux type : solide ou gazeux.
Soudage automatique sous flux lectroconducteur solide (arc submerg)
Le flux en poudre est dvers autour du fil lectrode. Un arc lectrique, libre, jaillit
l'intrieur du flux, assurant la fusion simultane des pices souder et du mtal
d'apport. Le transfert du mtal fondu dans l'arc de soudage a lieu par gouttelettes
enrobes de flux fondu. Protg par sa gangue de laitier, le mtal dpos est lisse et
brillant. L'excdent de flux qui n'a pas t fondu est rcupr par aspiration.
Soudage semi-automatique sous protection gazeuse (M.I. G. ou M.A.G.)
La chaleur ncessaire la fusion des pices souder est fournie par un arc lectrique
libre qui jaillit entre le fil lectrode et les pices. La protection de l'arc et du bain de
fusion est assure par un gaz inerte (argon) ou un gaz actif (C02) qui donnent leur nom
aux procds : M.I.G. (Mtal Inert Gas) ou M.A.G. (Mtal Active Gas).
figure 46 Soudage sous flux gazeux : schma de
figure 45 Soudage sous flux solide :
principe
schma de principe
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 45
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
1.5.4 Dtermination des conditions de soudage
1.5.4.1 Principaux paramtres de soudage
Les paramtres de soudage dans le cas de ces types de procds sont :
1.5.4.1.1 nergie de soudage
Elle ne doit tre ni trop faible, ni trop leve ; par exemple, pour les aciers, elle se situe
en gnral entre 20 et 35 kJ/cm, en fonction de la nature de l'acier souder.
1.5.4.1.2 Tension d'arc
Elle agit, dans une certaine mesure, sur la largeur du dpt ; cette dernire augmente
quand la tension de soudage crot. C'est elle qui conditionne le rgime de transfert du
mtal en fusion dans l'arc.
La tension d'arc dpend de l'intensit et varie de 20 40 V environ, en fonction du
procd.
1.5.4.1.3 Dimension du fil ou de l'lectrode
En soudage semi-automatique et automatique paramtres (U, I, v) constants, la
pntration est plus importante avec un diamtre de fil plus faible.
1.5.4.2 Dtermination des conditions de soudage
1.5.4.2.1 Pntration
La pntration est directement proportionnelle l'intensit. La figure 47 reproduit un
abaque qui donne la valeur de la pntration en fonction de l'intensit, pour un
diamtre de fil donn et pour diffrentes vitesses de soudage.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 46
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
figure 47 Courbes de dtermination de la pntration en soudage automatique sous flux solide.
Exemple
Soudage de deux tles en acier E24 d'paisseur e = 8 mm, bord bord sans chanfrein
et en deux passes (endroit, envers). Pour obtenir une pntration totale, on prendra:
1re passe, I=400 A, v=50 cm/min., soit une pntration P = 4 mm;
2e passe, I= 500 A, v = 50 cm/min, soit une pntration P= 6
figure 48 .(P 1+P2) > e
1.5.4.2.2 Largeur
La largeur du cordon est inversement proportionnelle la vitesse laquelle se dplace
la torche. L'abaque de la figure 49 (page suivante) indique, pour plusieurs valeurs de
l'intensit, la variation de la largeur du cordon en fonction de la vitesse de soudage.
Exemple
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 47
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Pour le soudage de deux tles avec chanfreins, la dernire passe de remplissage
devra, si cela est possible, avoir au moins la largeur des chanfreins au bord des tles.
Si, pour les deux tles, e= 20 mm, avec des chanfreins en V 60 , la distance entre
les bords sera l 22 mm ; l'abaque nous indique alors : v=40 cm/min pour 500 < I <
600 A.
1.5.4.2.3 Dtermination de la masse de mtal d'apport
Pour chaque type de chanfrein ou de soudure d'angle, existent des tableaux ou
abaques qui indiquent la masse linique ncessaire.
A titre d'exemple, la figure 50 (page suivante) reproduit un abaque qui permet de
dterminer la masse linique de mtal d'apport pour des soudures d'angle en fonction
de leur forme (concave ou sensiblement plate) et de la hauteur a de leur gorge, avec
un rendement d'environ 0,95 % (fils ou lectrodes enrobes classiques).
figure 49 Abaque de dtermination de la largeur
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 48
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
figure 50 . Abaque de dtermination de la masse de mtal dposer pour les cordons d'angle.
La figure 51, elle, donne, pour les soudures excutes avec des chanfreins en V, la
masse de mtal d'apport ncessaire en fonction de l'paisseur des pices souder.
(Pour apprcier par excs la quantit de mtal d'apport pour des joints avec chanfreins
en X, il suffira de doubler la quantit ncessaire pour des chanfreins en V.) Ce type
d'abaque ne s'applique pas aux lectrodes dont l'enrobage contient des lments
mtalliques d'addition (poudre de fer, chrome, nickel, etc.), qui ont un "rendement"
suprieur 100 %, pouvant aller jusqu' 200 % .
Exemples
Pour excuter une gorge de hauteur a = 8mm (cordon concave) et de 1 m de longueur,
il faudra environ 6x 100=600 g de mtal d'apport (Fig. 50). Pour souder deux tles
d'paisseur e=20 mm et chanfreines 70 sur une longueur de 1m, 22,5 . 100=2 250
g seront ncessaires (Fig. 51).
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 49
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
figure 51 . Abaque de dtermination de la masse linique du cordon, en fonction de langle des
chanfreins et de lpaisseur des tles.
1.5.4.2.4 Dtermination du nombre d'lectrodes ncessaires
La masse de mtal d'apport dpos par lectrode s'exprime en g, pour une longueur
d'lectrode donne. En gnral on considre la longueur totale de l'lec trode diminue
de 50 mm. Exemple : lectrode en acier doux 4, longueur 350 la masse de mtal
dpos par l'me mtallique sera d'environ 28 g, poids correspondant une longueur
de 300 mm.
Certaines lectrodes ont un enrobage qui cotent des lments d'addition (poudre de
fer, chrome, etc.) qui viennent s'ajouter la masse de l'me mtallique, d'o un
"rendement" qui varie d'un type d'lectrode l'autre. Ce dernier est gal au rapport de
la masse de mtal dpos la masse de mtal de l'me qui a t fondu, et s'exprime
en pourcentage
masse de mtal dpos
r= 100
masse de mtal de l' me fondue
Les lectrodes enrobes classiques ont en gnral un "rendement" d'environ 95 % ;
celui des lectrodes dont l'enrobage contient des poudres mtalliques peut atteindre
180 200 %*.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 50
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Exemple
Pour excuter une gorge de hauteur a=4 mm (cordon concave) sur une longueur de 1
m, la masse de mtal d'apport devra tre d'environ 150 g. Si l'on utilise des lectrodes
5, r= 95 %, longueur = 450 mm, ce qui correspond une masse de mtal fondu
d'environ 62 g, la masse de mtal dpos sera 62x95/100 58 g, soit un nombre
d'lectrodes ncessaires : 150/58 2,6 lectrodes.
1.5.4.2.5 Dtermination du nombre de passes
1.5.4.2.5.1 Soudage automatique
Les courbes de la figure 52 (page suivante) permettent d'apprcier, pour diffrents
diamtres de fils en acier doux et pour un courant de soudage continu, la masse de
mtal d'apport dpose par minute en fonction de l'intensit.
Exemple
Pour excuter une gorge de hauteur a=5 mm, cordon concave, il faut dposer 2,5 g/cm
de mtal d'apport (Fig. 50). Avec I=600 A, le dpt est d'environ 140 g/min ; si l'on
prend v=110 cm/min, le dpt par cm de cordon sera donc de : 140/110=1,27 g. Aussi
serait-il ncessaire pour obtenir le rsultat recherch d'excuter 2 passes (1,27 x 2 =
2,54 g/cm). Cette solution est carter ; nous adopterons une autre vitesse de
soudage, qui permette un dpt de mtal d'apport suffisant en une seule passe, soit : v
=140/2,5 = 56 cm/min.
1.5.4.2.5.2 lectrodes enrobes
On dtermine le nombre de passes pour dposer une masse de mtal d'apport
ncessaire partir du tableau 4, connaissant l'nergie de soudage minimale et la
consommation d'lectrode pour une longueur de cordon.
Exemple
On souhaite excuter un cordon d'angle concave, gorge de hauteur a=8 mm. Les
conditions de soudage imposes (facteurs mtallurgiques) exigent une nergie
nominale En 18 kJ/cm. On peut obtenir cette nergie avec une lectrode 5,
condition que pour 10 cm d'lectrode consomme, le cordon de soudure mesure 7 cm
(tableau4). D'autre part, pour excuter un tel cordon, la masse de mtal dpos doit
tre de 6 g/cm (Fig. 50). Celle d'une lectrode en acier 5 de longueur utile 40 cm
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 51
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
tant de 58 g, une consommation de 10 cm de cette lectrode correspond 58/4 =
14,5 g. A chaque passe, la masse de mtal dpos sera donc de : 14,5/7 = 2 g/cm.
D'o un nombre de passes gal : 6/2= 3.
figure 52 . Courbes de fusion. (Courant continu, polarit + llectrode).
En (kJ/cm)\ mm 2,5 3,2 4 5 6,3
6 6,4 10 16 21,2 -
8 4,7 8 12 16 23
10 3,8 6,5 9 12,7 18,3
12 3 5,2 8 10,6 16,8
14 2,5 4,5 6,5 9 14,4
16 - 3,8 5,6 7,9 12,7
18 - 3,4 5 7,1 11,2
20 - 3 4,4 6,3 10,1
25 2,4 3,5 5 8
30 - - 2,7 4,3 6,7
40 - - 2 3,2 5
50 - - - 2,6 4
Tableau 4.Valeurs de la longueur de cordon correspondant 10 cm d'lectrode
consomme, en fonction du diamtre de l'lectrode et de l'nergie nominale du
soudage. Les valeurs usuelles sont dans la zone colore. (D'aprs NF A 36.000.)
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 52
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
1.5.4.2.6 Temps consacr au soudage
Le temps total consacr au soudage comprend d'une part le temps de fusion (temps
pur de soudage), d'autre part les temps morts (temps de non soudage) pendant
lesquels s'excutent les manutentions des pices, les mises en position, les rglages,
le piquage du laitier, le changement d'lectrode, etc.,
1.5.4.2.6.1 Temps de fusion
1.5.4.2.6.1.1 Soudage automatique
Le temps de fusion est li la vitesse d'avance du chariot porte-tte de soudage. Cette
vitesse v s'exprime en cm/min ou en m/h, et l'on a la relation
longueur soude
=
temps de fusion
Cette vitesse peut s'exprimer aussi en masse de mtal dpos par minute.
1.5.4.2.6.1.2 Soudage semi-automatique
La vitesse de fusion du fil est souvent exprime en m/min, en fonction de l'intensit du
courant de soudage. On en dduit facilement le temps de fusion, connaissant la masse
de mtal d'apport dpose par minute.
Exemple
Excution d'une gorge de hauteur a=6 mm et d'une longueur de 1 m. La masse de
mtal d'apport ncessaire est d'environ 3,2 g/cm (Fig. 50); il faudra donc 320 g pour un
cordon de 1 m. Si l'on prend les paramtres I= 600 A, fil 4, la vitesse de fusion sera
de 140 g/min (Fig.52). On en dduit le temps de fusion : 320/140=2,28 min.
1.5.4.2.6.1.3 Soudage manuel avec lectrodes enrobes
Le nombre d'lectrodes ncessaires tant tabli et connaissant le temps de fusion
d'une lectrode, on peut dterminer aisment le temps pur de soudage. L'abaque de la
figure 53 donne pour diffrentes classes d'lectrodes le temps de fusion en fonction de
l'intensit du courant de soudage.
Exemple
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 53
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Pour excuter une gorge de hauteur a = 6 mm et de longueur 1 m, on prend une
lectrode en acier 6,3, enrobage rutile, r=95 % et de longueur utile 40 cm, ce qui
correspond une masse de mtal dpos de 93 g par lectrode. Comme 320 g de
mtal sont ncessaires (voir exemple ci-dessus), le nombre d'lectrodes ncessaires
est de: 320/93=3,5 lectrodes. Pour une intensit I=240 A, l'abaque (Fig. 53) nous
indique : t= 2,6 min/lectrode 6,3. Le temps de soudage est donc : 2,6 x 3,5 = 9,1
min.
figure 53 .Abaque de dtermination du temps de fusion d'une lectrode.
1.5.4.2.6.2 Temps morts
Au temps pur de soudage doivent s'ajouter les temps de non soudage : manutentions,
mise en position, rglages, changement d'lectrodes, piquage du laitier, etc.
Pour le soudage l'arc avec lectrodes enrobes, on admet un coefficient d'utilisation
du poste de soudage (facteur de marche) qui peut varier de 25 60 % environ suivant
les travaux. Le tableau 5 donne quelques valeurs.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 54
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Nature des travaux Atelier Chantier
% %
Charpente-chaudronnerie :
soudures courtes 30 20
soudures longues 35 25
Travaux de srie, sur positionneur 50
Travaux de rechargement 50 50 55
Soudage de tles paisses 50
Tableau .5. Coefficients d'utilisation d'un poste de soudage l'arc
Si nous reprenons l'exemple prcdent, le temps total de soudage, pour un coefficient
d'utilisation de 40% (soudures longues), sera donc de
9,1 100
t= = 22,7 min
40
1.5.4.2.7 Consommation d'nergie lectrique
Pour valuer la consommation d'lectricit ncessaire aux oprations de soudage
l'arc, il faut tenir compte la fois de la consommation de l'appareil de soudage vide
et en marche.
1.5.4.2.7.1 Consommation vide
Le poste tant branch sans qu'il ne soit gnr d'arc (non soudage), la consommation
est fonction des pertes vide, elle se situe entre 0,1 et 0,6 kWh environ.
1.5.4.2.7.2 Consommation en marche
Si on nglige les pertes dans les cbles et en tenant compte du rendement de
lappareil ?, on a:
U I
consommati on = Pa t = t
avec Pa puissance absorbe
Dans le cas du soudage avec lectrodes enrobes, si l'on ne connat pas avec
suffisamment de prcision U et I, on peut utiliser directement les valeurs donnes dans
le tableau 6
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 55
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Classe 2,5 3,15 4 5 6,3
R-B (rutile- 0,040 0,090 0,135 0,215 0,340
C (cellulosique) 0,036 0,080 0,120 0,190 0,300
A (acide) 0,030 0,068 0,105 0,160 0,260
Tableau 6.Consommation d'lectricit, par lectrodes d'acier en kWh
Exemple
On considre un temps de soudage de 20 min, les pertes dans les cbles secondaires
tant ngliges.
1. Soudage automatique : U= 30 V, I= 500 A, rendement moyen du transformateur : ?
30 500
Pa = = 25kW
= 0,6. On en dduit 0,6
20
consommati on d' lectricit = Pa t = 25 8,3kWh
60
2. Soudage avec lectrodes enrobes de type basique 4, I=160 A, nombre
d'lectrodes pour 20 min : 11, soit, d'aprs le tableau prcdent,
consommati on d' lectricit = 0,135 11 1,5kWh
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 56
Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage
Normalisation des procds de soudage
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 57
Techniques de production -CI Niveau2 fiche de prparation : Leon 5
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE
MOULAGE
MATIERE:
Techniques de production
OBJECTIF TERMINAL:
Appliquer les diffrents procds de moulage
OBJECTIFS SPECIFIQUES:
Prsenter les diffrents procds de moulage,
Critres de choix.
Comparaison des diffrents procds de moulage,
PREREQUIS:
Dessin technique
AUDITEURS:
Etudiants des I.S.E.T,
Profil : Gnie mcanique,
Option : tronc commun,
Niveau : 2
DUREE:
1heure 30min x 2
EVALUATION:
Formative,
Sommative.
SUPPORTS MATERIELS:
Tableau ;
Rtroprojecteur,
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 58
Techniques de production -CI Niveau2 fiche de prparation : Leon 5
Polycopie.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 59
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
1 MISE UVR E DE ALL IA GE PA R CO ULEE LE
MO ULA GE
1.1 MOULAGE EN CONTINU
Lalliage maintenu liquide, alimente une filire refroidie l'eau, l'avance du jet solidifi
se fait par squences successives (le pas d'avance est li au type de filire).
figure 54 Coule dun jet creux en alliage mtallique
figure 55 Ensemble de coule continue de jets pleins en fonte.
1.2 MOULAGE AVEC EMPREINT E
Obtention des pices mcaniques par remplissage d'une empreinte avec un alliage
mtallique en fusion.
Il existe deux formes de moulage
Moulage en moule non permanent : en sable (il est dtruit aprs l'obtention de la pice
dcochage)
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 60
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
Moulage en moule permanent : mtallique (coquille : il permet le moulage d'un grand
nombre de pices)
1.2.1 Moulage en moule non permanent
1.2.1.1 Moulage en sable
Le moulage en sable est un procd simple, adapt
au travail en petites sries
a la masse de la pice
a la matire de la pice
aux paisseurs de parois de la pice.
1.2.1.1.1 Moule
Les moules de ce type ne servent qu'une fois. Ils sont dtruits (dcochs) lors de
l'extraction de la grappe solidifie.
Le sable est constitu d'un mlange de sable rfractaire, d'un liant (argile +rsine) et
d'adjonctions susceptibles d'influencer les ractions entre la paroi et le mtal liquide.
Le sable maintenu dans un chssis, est serr sur un modle (forme de la pice +
retrait). On donne de la dpouille au modle afin de l'extraire facilement. Un jet de
coule permet le remplissage du moule.
figure 57 noyaux interne
figure 56
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 61
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
1.2.1.1.2 Obtention de lempreinte
1.2.1.1.2.1 Moulage avec noyaux
Les formes intrieures
des pices moules
sont obtenues par
noyaux raliss en
sable agglomr
Les moules sont
raliss partir de
modles ou de
plaques-modles en
bois, en rsine ou en
mtal selon
l'importance de la
figure 58 noyau externe
srie et le type de
procd de fabrication
du moule.
Les noyaux sont construits partir des boites noyaux
figure 59
1.2.1.1.2.2 Moulage en carapace
C'est un procd utilisant un mlange de sable siliceux sec 90% et de rsine
thermodurcissable, ce mlange est mis en contact avec une plaque modle
prchauffe 300c pendant 15 20 s la carapace ainsi forme, sche et rigide
constitue un demi moule. L'assemblage de deux parties constitue le moule complet.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 62
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
Aprs coule et refroidissement, la carapace est dtruite, ensuite la pice subit un
barbage.
Etape 3 :
Etape 2 :
Etape 1 : fermeture retournement et
chauffage
maintient
Etape 4 : ouverture Etape5 : Ejection de la carapace
figure 60 Exemple de prparation de la carapace
Cadence 50 60 pices / heure ; IT = 0.15 mm ; Carapace de 4 8 mm
1.2.1.1.2.3 Moulage en cire perdue
Moule en une seule partie, ralise autour d'un modle sans possibilit de dmoulage,
le modle comporte la forme de la pice ainsi du systme de remplissage et
d'alimentation, le moule et le modle sont dtruits dans le cycle de fabrication de la
pice moule.
les conditions d'emploi sont
pices complexes et lourdes (jusqu' 30kg)
Pas de joint
Excellent tat de surface et prcision dimensionnelle.
1.2.1.2 Cycle de fabrication
Prparation du modle ou des plaques modles et des boites noyaux
Confection de l'empreinte dans le chssis infrieur.
Extraction du modle.
Confection du chssis suprieur avec le chssis infrieur
Confection du systme de remplissage et d'alimentation (vents,
masselottes, chenaux, descentes)
Confection des noyaux
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 63
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
Remoulage (fermeture des moules)
Coule de l'alliage liquide
Dcochage de la pice
Ebarbage
Reprise de la confection de l'empreinte d'un nouveau moule.
1.2.1.3 Dfinition du brut moul
Plan de joint (plan dans la plus grande section de la pice)
Dpouille intrieure et extrieure (modle et noyaux)
1 3 pour les moules
5 pour le noyau, sont ncessaires pour le dmoulage.
Surpaisseur d'usinage
Sens de coule
Systme d'alimentation (pour viter la formation de retassures, il est compos de
masselotte: de refroidisseurs)
1.2.2 Moule permanent
On peut citer principalement trois techniques en moule permanent
Le moulage en coquille par gravit
Le moulage en coquille sous pression
Le moulage par centrifugation
La coule continue
On peut remarquer des points communs ces diffrents procds d'obtention de brut.
En particulier l'empreinte creuse qui donnera la forme dfinitive la pice ralise de
telle sorte quelle soit utilisable pour un grand nombre de coule. Ceci impose
principalement des contraintes gomtriques sur les formes moulantes de telle sorte
que les pices une fois solidifies soient encore extractibles.
1.2.2.1 Moulage en coquille par gravit
Un moule mtallique appel coquille dans lequel on verse un mtal l'tat liquide
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 64
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
qui pntre dans les diffrentes cavits formes par le moule sous l'action de la
pesanteur. Avantage :
Meilleur tat de surface (d la qualit des surfaces du moule)
Meilleur tenu mcanique grce des vitesses de refroidissement leves.
figure 61 Coule gravitaire dans une
coquille. figure 62 Remplissage dune coquille
gravitairement, moule joint vertical.
1.2.2.2 Moulage sous pression
figure 63 Moule mtallique en coule
sous pression sur machine chambre 1 Moule 2 Plateau mobile 3 Plateau fixe 4
froide piston horizontal Creuset 5 Groupe gnrateur d'nergie 6
Vrin d'injection 7 Colonnes de guidage 8 Systme de genouillres
figure 64 Machine couler sous pression chambre chaude
Le mtal en fusion est inject dans le moule par l'intermdiaire d'un piston d'injection.
On peut distinguer deux procds de moulage sous pression en fonction de la situation
du vrin d'injection par rapport au mtal. Si le systme d'injection est immerg dans
l'alliage en fusion, alors on parlera de coule sous pression en chambre chaude, dans
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 65
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
le cas contraire on parlera de moulage sous pression en chambre froide. La coule
sous pression prsente un intrt pour les grandes sries
Fermeture du moule Injection jection
1 Colonnes 5 Partie moule fixe 9 Four et creuset
2 Plateau fixe 6 Ejecteurs 10 Chemise d'injection
3 Plateau mobile 7 Piston d'injection plongeur 11 Grappe moule
4 Partie moule mobile 8 Col de cygne ou Gooseneck
figure 65 Moule d'une machine chambre chaude
1.3 COMPARAISON DES TOLERANCES USUELLES DES DIFFERENTS
PROCEDES DE TRANSFORMATION DES METAUX
figure 66
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 66
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
1.4 APPLICATIONS
1/Soit raliser la pice suivante par moulage. Quantit 50 pices (figure 67)
On demande de
choisir le procd de moulage adapt.
donner la reprsentation du modle.
reprsenter la boite noyaux.
reprsenter le moule prt au moulage
figure 67
2/Soit raliser la pice suivante par moulage. Quantit 1000 pices. Les trous de
diamtre 4 sont raliser par usinage. On demande de
choisir le procd de moulage adapt.
reprsenter le moule prt au moulage
figure 68
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 67
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage
3/ Soit raliser la pice suivante par moulage. Quantit 1000 pices. On demande de
Choisir le procd de moulage adapt.
Localiser le plan de joint
De reprsenter le moule prt au moulage
figure 69
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 68
Techniques de production -CI Niveau2 Fiche de prparation : Leon 6
FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : FORGEAGE
LIBRE
MATIERE:
Techniques de production
OBJECTIF TERMINAL:
Appliquer les diffrentes techniques de forgeage.
OBJECTIFS SPECIFIQUES:
connatre les diffrents procds de forgeage
analyse des dformations,
dimensionnements des presses.
PREREQUIS:
Les outils mathmatiques lmentaires
comportement des matriaux (notions lmentaires)
AUDITEURS:
Etudiants des I.S.E.T,
Profil : Gnie mcanique,
Option : tronc commun,
Niveau : 2
DUREE:
1heure 30min x 2
EVALUATION:
Formative,
Sommative.
SUPPORTS MATERIELS:
Tableau ;
Rtroprojecteur,
Polycopie.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 69
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre
1 FOR GEA GE L IB RE
1.1 M ATERIEL UTILISE EN FORGEAGE LIBRE
Deux types d'engins
engins travaillant par
choc
engins travaillant par
pression.
figure 70
1.2 ANALYSE DES DEFORMATIONS
En comparant les formes et les diamtres entre les deux types d'action, on constate
que le choc a un effet plus superficiel, alors que la pression prolonge l'action jusqu'au
coeur de la pice.
Si on conduit plus avant l'investigation par un examen macrographique (fig.71), on
remarque que les fibres sont dvies une certaine distance de la surface, que le
mtal se comporte comme si, l'intrieur de la section, un volume rest rigide servait
de complment aux outils de dformation.
Ces volumes sont frquemment dsigns par solides de frottement, leur enveloppe
limitant la sparation entre la matire en mouvement et celle immobile.
figure 71 Macrographie avant et aprs dformation
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 70
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre
1.3 ETUDE DU FORGEAGE LIBRE PAR PRESSE
1.3.1 Effort de dformation
On l'exprime par
F =S p
p la rsistance
spcifique la
dformation, est dduite
par le seuil de plasticit
(figure 72)
h1
k=
d1
Connaissant la surface figure 72
finale sur laquelle on
l'applique et la temprature du mtal, il est facile de situer la presse capable de fournir
l'effort
1.3.2 Energie ncessaire
h0
E = V.p.Log o V :volume V dplac par la rsistance spcifique la dformation p.
h1
Ce rsultat peut tre exprim par excs par la relation pratique
E = F.C
o F est la force prcdente, C le dplacement de h0 h 1(E = nergie)
1.4 ETUDE DU FORGEAGE LIBRE PAR MARTEAUX
1.4.1 Energie ncessaire
Etant donne la viscosit du mtal travaill, l'augmentation de la vitesse de frappe
entrane celle de l'effort ncessaire pour la dformation demande.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 71
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre
Cette remarque conduit, dans des conditions limites (presse trs lente et vitesse
d'impact leve) multiplier l'nergie de la presse par 2,5 pour produire le mme effet
par choc.
Il est ainsi possible de situer l'engin suffisant.
1.5 EVOLUTION DUNE FORME PRISMATIQUE
Les solides de frottement orientent le cheminement de la matire par la direction des
contraintes normales la surface de leur enveloppe.
Le mtal s'coulera vers la surface libre la plus proche, par le plus court chemin.Voici
quelques exemples.
1.5.1 Aplatissement total
Avec la diminution de h ( h/3), le prisme base carre tendra vers une base
circulaire. Le prisme base rectangulaire tendra vers une forme elliptique.
figure 73
1.5.2 Augmentation de la longueur par diminution de l'paisseur
La surface S est soumise une rduction de h0 qui tend vers h1, il se produit un
dcollement Y des parties extrieures non dformes par tirage.
L'galit des volumes (volume avant les coups = volume tir + volume restant
tirer), dfinit la forme gomtrique de cette volution qui est une courbe logarithmique
d'expression
?= 1/2 Log hl/h 0
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 72
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre
Cette expression est fausse par l'largissement C', sa prcision crot si C" devient
grande devant L ou C ou si l'largissement est vit par un outillage.
figure 74
1.5.3 Augmentation de la longueur par diminution de la section
Entre chaque action de l'outil, le lopin subit une rotation de, p /2. On observe une forme
en marches d'escalier qui est d'autant plus prononce que le rayon d'angle R est
petit, et que les frappes sont plus amplifies et moins nombreuses.
Si ces dfauts sont attnus, on obtient une courbe d'expression
? = I Log( hl/h0)
chaque rotation, l'largissement prcdent est rduit; ceci implique une suite
d'actions progressives qui liminent l'utilisation d'une presse mcanique course fixe.
figure 75
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 73
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre
1.5.4 Augmentation du diamtre par diminution partielle de
lpaisseur.
Les formes extrieures n'voluent pas librement. Elles sont tributaires de l'tirage de
l'anneau qui tend diminuer h0 (courbe C1) alors que le frettage de ce mme anneau
sur le mtal chass par le poinon, tend l'augmenter (courbe C2); d'o la tendance
la section de forme trapzodale et la courbe C thorique intermdiaire.
? = d/4 Log (hl/h 0).
figure 76
1.6 APPLICATIONS PRATIQUES DU FORGEAGE
(Seul, sera examin le forgeage au marteau-pilon ou la presse).
1.6.1 tirage.
Opration fondamentale du forgeage qui consiste diminuer la section d'un lingot ou
d'une pice pour augmenter sa longueur.
figure 77
Remarque.
L'coulement unidirectionnel produit des fibres. Ces dernires sont bnfiques pour la
rsilience en long, nfastes en travers.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 74
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre
Le taux de corroyage S/s = Section initiale/section finale qui est associ ces rsultats
est souvent limit, en grosse forge, entre 3 et 8 pour quilibrer les rsiliences.
1.6.2 tampage.
Opration terminale de l'tirage destine mettre au rond une section (fig. 12c). Pour
les moyennes et petites sections.
figure 78
1.6.3 Refoulement.
A l'inverse de l'opration prcdente, il rduit la longueur pour augmenter la section.
Combin avec l'tirage, il permet d'amliorer l'orientation du fibrage (cas du
refoulement des gros lingots en forge).
Il est intressant dans certains cas o la
diffrence des sections est importante et
o les fibres doivent tre parfaitement
orientes
.
Il est utilis comme mthode de
fabrication sur les machines horizontales figure 79
forger.
1.6.4 Dgorgeage.
Opration permettant d'obtenir une brusque diminution de section. Selon la forme
dsire, un ou deux outils peuvent tre utiliss, leur partie active tant plus ou moins
arrondie (fig. 15).
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 75
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre
figure 80 .Exemple : dgorgeage- tirage.
1.6.5 Poinonnage.
Opration qui permet de percer un trou de diamtre dtermin dans une pice pour
obtenir une pice creuse.
figure 81 poinons pleins pour petites
pices
figure 82 poinons creux pour grosses pices
1.6.6 Mandrinage.
Agrandissement des trous, calibrage
intrieur, souvent utilis aprs un
poinonnage
figure 83
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 76
Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre
1.6.7 Bigornage.
Permet l'accroissement du diamtre intrieur d'une bauche en crant une orientation
des fibres dans le sens tangentiel.
figure 84
Remarque : les oprations cites se pratiquent chaud, une temprature qui se
situe entre 800 et 1200 C suivant les aciers.
L'intrt que l'on porte au fibrage peut tre montr par l'exemple de la fabrication d'un
vilebrequin.
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 77
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
1 EXA ME N 2003/04 SE MEST RE 2
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 78
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
2 DE VO IR S UR VE ILLE 2004/05 SEMESTR E 1
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 79
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 80
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 81
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
3 LEME NTS DE C OR RECT IO N D U D S 2004/05
SEME STRE 1
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 82
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 83
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
4 DE VO IR S UR VE ILLE 2004/05 SEMESTR E 2
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 84
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 85
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 86
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 87
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 88
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
5 EXA ME N 2003/04 SE MEST RE 2
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 89
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 90
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 91
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 92
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
6 EXA ME N 2004/05 SE MEST RE 1
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 93
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 94
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 95
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 96
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 97
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
7 EXA ME N 2004/05 SE MEST RE 2
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 98
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 99
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 100
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 101
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 102
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 103
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
8 EXA ME N 2003/04 SE MEST RE 2 : C ORR ECT IO N
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 104
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 105
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 106
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 107
Techniques de production -CI Niveau2 Examens et devoirs surveills
Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 108
Vous aimerez peut-être aussi
- Classification Et Montage de La TuyauterieDocument121 pagesClassification Et Montage de La TuyauterieimenePas encore d'évaluation
- Pompes Booster.Document4 pagesPompes Booster.Chawki ZerroukiPas encore d'évaluation
- Cours ProgDocument43 pagesCours ProgATFP2013Pas encore d'évaluation
- Cours en Ligne Mise en Forme - ChapitreI-Soualem LMA FinalDocument15 pagesCours en Ligne Mise en Forme - ChapitreI-Soualem LMA Finalhello youPas encore d'évaluation
- Les carnets de construction et vol du cerf-volant: envie de voler plus hautD'EverandLes carnets de construction et vol du cerf-volant: envie de voler plus hautÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation
- Chap6 - Coupe Et Optimisation PDFDocument55 pagesChap6 - Coupe Et Optimisation PDFKamel BousninaPas encore d'évaluation
- Fonderie Cours Trace Des Bruts Et Conception Du MouleDocument20 pagesFonderie Cours Trace Des Bruts Et Conception Du MouleEdgard Varela EspinozaPas encore d'évaluation
- Foundry French PDFDocument84 pagesFoundry French PDFIlu SionPas encore d'évaluation
- Decoupage Mecanique Et Thermique Des PiecesDocument4 pagesDecoupage Mecanique Et Thermique Des Piecesfokou.simplicegmail.com Fokou Simplice100% (1)
- Chap 4 - Etude de L'alimentation 2017Document30 pagesChap 4 - Etude de L'alimentation 2017Yessine OmranePas encore d'évaluation
- Feuillard31 EmboutissageDocument6 pagesFeuillard31 EmboutissagemohamedPas encore d'évaluation
- Copie de Chap2 Outillages Pour Moulage en Coquille 2020Document36 pagesCopie de Chap2 Outillages Pour Moulage en Coquille 2020khaled AmeniPas encore d'évaluation
- 4 Procedes de MoulagesDocument7 pages4 Procedes de MoulageskarimPas encore d'évaluation
- Présentation SoudageDocument88 pagesPrésentation SoudageyounessPas encore d'évaluation
- PliageDocument10 pagesPliageAyoub ChebbiPas encore d'évaluation
- Le Formage ParDocument66 pagesLe Formage ParHamada HamadaPas encore d'évaluation
- M16 - Chap 01 - Representation Orthogonale en Tuyauterie - ProfDocument31 pagesM16 - Chap 01 - Representation Orthogonale en Tuyauterie - Profchaudronnier80% (5)
- Cours Forge Sec1Document38 pagesCours Forge Sec1Kawtar BihiPas encore d'évaluation
- Le CoudeDocument1 pageLe Coudesb aliPas encore d'évaluation
- Exercice 2 Corrigé VDocument4 pagesExercice 2 Corrigé VrabiiPas encore d'évaluation
- CFAO - Fraisage 2D & DemiDocument17 pagesCFAO - Fraisage 2D & DemiMeryem BelhassanePas encore d'évaluation
- FonderieDocument6 pagesFonderieWalid NASRIPas encore d'évaluation
- TD2021Forge1ère Année - Partie 2Document4 pagesTD2021Forge1ère Année - Partie 2taghrid taghridPas encore d'évaluation
- 9 Contact TribologieDocument60 pages9 Contact TribologieJaksMaksPas encore d'évaluation
- Exercices de Choix de MatériauxDocument12 pagesExercices de Choix de MatériauxOussama El yousoufiPas encore d'évaluation
- Memoire Arsene Munana Premiere PartieDocument12 pagesMemoire Arsene Munana Premiere PartieArsene Munana100% (1)
- TPE Matériaux Métalliques: Encadré Par: M. Salah MEZLINI Elaboré Par: Ala BEN SALAH Souha Abdellaoui Groupe: 1Document5 pagesTPE Matériaux Métalliques: Encadré Par: M. Salah MEZLINI Elaboré Par: Ala BEN SALAH Souha Abdellaoui Groupe: 1Derouich RahmaPas encore d'évaluation
- 128 Outil SuisseDocument2 pages128 Outil SuissefdgfdgdfgdgsPas encore d'évaluation
- Flambage Des Fonds 15033919Document22 pagesFlambage Des Fonds 15033919ptonnelPas encore d'évaluation
- Ingénieris Des Surfaces Examen Final Master 01 IMS 2018-2019 CorrectionDocument2 pagesIngénieris Des Surfaces Examen Final Master 01 IMS 2018-2019 CorrectionRayPas encore d'évaluation
- 01-Assemblage Par SoudureDocument17 pages01-Assemblage Par SoudureSkeleton JackPas encore d'évaluation
- C - Corrigé ESPTP CAPLP GI SM Int 2007 PDFDocument20 pagesC - Corrigé ESPTP CAPLP GI SM Int 2007 PDFserePas encore d'évaluation
- Harrouche Fateh PDFDocument148 pagesHarrouche Fateh PDFderghalPas encore d'évaluation
- Correction de Lexercice PliageDocument2 pagesCorrection de Lexercice PliageGhada Mouedhen0% (1)
- Cours D'analyse 2nd Ch-Ti 2020 ProfDocument21 pagesCours D'analyse 2nd Ch-Ti 2020 Proffokou.simplicegmail.com Fokou SimplicePas encore d'évaluation
- NF en 14015Document1 pageNF en 14015elamigosolitarioPas encore d'évaluation
- 05 Moulage PDFDocument30 pages05 Moulage PDFSamir KhPas encore d'évaluation
- Pliage CDocument42 pagesPliage Cchaudronnier100% (1)
- Concepts Fondamentaux de La Mécanique de La Rupture: Master Mécanique-Matériaux-Structures-ProcédésDocument36 pagesConcepts Fondamentaux de La Mécanique de La Rupture: Master Mécanique-Matériaux-Structures-ProcédésnacerazizPas encore d'évaluation
- 20 Conception Des Pieces MouleesDocument18 pages20 Conception Des Pieces MouleesMohamedAyoubPas encore d'évaluation
- 11 Usinage CoupeDocument21 pages11 Usinage Coupekarim100% (1)
- Techniques de L'ingénieur - Extrusion BivisDocument27 pagesTechniques de L'ingénieur - Extrusion BivisBenjamin FroquetPas encore d'évaluation
- 7968 Annexe Realisation Du Mors Mobile Dun Etau Serrage Rapide Ensps - 0Document4 pages7968 Annexe Realisation Du Mors Mobile Dun Etau Serrage Rapide Ensps - 0Aymen ZammaliPas encore d'évaluation
- Tribologie: Master II Ingénierie MécaniqueDocument4 pagesTribologie: Master II Ingénierie MécaniqueDjamel DjamPas encore d'évaluation
- Soudage Par Friction ExplosionDocument7 pagesSoudage Par Friction ExplosionThanos L'IncongruPas encore d'évaluation
- Examen Becm 2018 Pass PDFDocument9 pagesExamen Becm 2018 Pass PDFSoűFiane HãnnāøuiPas encore d'évaluation
- 4 Cisalliage PoinconnageDocument19 pages4 Cisalliage PoinconnageHamza RouihemPas encore d'évaluation
- Concours D'agrégation en Génie Mécanique gm2Document38 pagesConcours D'agrégation en Génie Mécanique gm2Walid Ben EzzinePas encore d'évaluation
- 2-TD-Butée de Commande-Brut Capable PDFDocument2 pages2-TD-Butée de Commande-Brut Capable PDFtagne simo rodriguePas encore d'évaluation
- Travaux de FabricationDocument7 pagesTravaux de FabricationDayang DayangPas encore d'évaluation
- Cours Procédés D'assemblage Non Soudés - Iset Sfax PDFDocument68 pagesCours Procédés D'assemblage Non Soudés - Iset Sfax PDFEl Bechir MsaddekPas encore d'évaluation
- Tribologie MasterDocument15 pagesTribologie Masterabderazak100% (1)
- Bureau Des MethodesDocument9 pagesBureau Des MethodesChahinez MoatesPas encore d'évaluation
- Defauts Soudage FusionDocument53 pagesDefauts Soudage Fusioncisar0007100% (1)
- Edf - Dri - Supportage Des TuyauteriesDocument59 pagesEdf - Dri - Supportage Des TuyauteriesANTHONY VERNAT100% (1)
- Estimation Dossier ProfDocument63 pagesEstimation Dossier ProfAurélien DjombouPas encore d'évaluation
- Chapitre IDocument10 pagesChapitre ISalah ZemaliPas encore d'évaluation
- Superalliage: Résistant à la chaleur de 2700 degrés Fahrenheit générée par les moteurs à turbine pour être plus chaud, plus rapide et plus efficaceD'EverandSuperalliage: Résistant à la chaleur de 2700 degrés Fahrenheit générée par les moteurs à turbine pour être plus chaud, plus rapide et plus efficacePas encore d'évaluation
- Chapitre 2-0-Pliage Des TolesDocument32 pagesChapitre 2-0-Pliage Des TolesHamza Liberados80% (5)
- 513825Document27 pages513825KOOPas encore d'évaluation
- 6a Moment InertieDocument4 pages6a Moment InertieKOOPas encore d'évaluation
- Bac Cours Sciences Ingenieur SM B Engrenage NajibDocument10 pagesBac Cours Sciences Ingenieur SM B Engrenage NajibKOOPas encore d'évaluation
- Fond Bouteille FAODocument11 pagesFond Bouteille FAOKOOPas encore d'évaluation
- 03 OxydoréductionDocument11 pages03 OxydoréductionIbrahim Labhar100% (1)
- Rapport de Stage Ocp PDFDocument29 pagesRapport de Stage Ocp PDFAnaibar TarikPas encore d'évaluation
- AA023 Patrimoines Vallées Des Cabardès N° 3 - 2008Document6 pagesAA023 Patrimoines Vallées Des Cabardès N° 3 - 2008grattepapiersPas encore d'évaluation
- Thèse PDFDocument147 pagesThèse PDFfaouzi sellaliPas encore d'évaluation
- PDF Exercices D Entrainement CorrigesDocument3 pagesPDF Exercices D Entrainement Corrigesla physique selon le programme Français100% (2)
- MAX Phase4 Month4 WorkoutJournalDocument5 pagesMAX Phase4 Month4 WorkoutJournalThe Fitness CoachPas encore d'évaluation
- Synthese Sur Les Matériaux Microporeux PDFDocument191 pagesSynthese Sur Les Matériaux Microporeux PDFRAFIKSKI100% (1)
- Les Traitements ThermiqueDocument12 pagesLes Traitements ThermiqueElbarbour WlidhaPas encore d'évaluation
- Concevoir Et Construire en Acier PDFDocument114 pagesConcevoir Et Construire en Acier PDFSimohamed Laimairi0% (1)
- GRILLAGEDocument32 pagesGRILLAGEAhmed Yassine Fellahi0% (1)
- B.P.U #Désignation Des Ouvrages U Prix Unitaires Travaux Préparatoires Et ObligatoiresDocument18 pagesB.P.U #Désignation Des Ouvrages U Prix Unitaires Travaux Préparatoires Et ObligatoiresoussamaPas encore d'évaluation
- Catálogo Bohler PulvimetalúrgicosDocument16 pagesCatálogo Bohler Pulvimetalúrgicosfbp81Pas encore d'évaluation
- Questions Réponses DocumentsDocument3 pagesQuestions Réponses DocumentsAbdelilah El Gmairi0% (2)
- MetauxetnonmetauxDocument1 pageMetauxetnonmetauxJoël MBOMOPas encore d'évaluation
- Poleas Dentadas ST Ciegas Paso Mtrico BehDocument4 pagesPoleas Dentadas ST Ciegas Paso Mtrico BehAndre CoelhoPas encore d'évaluation
- Designation Des MateriauxDocument4 pagesDesignation Des MateriauxAmmar BahijPas encore d'évaluation
- Al4sp31tewb0112 Sequence 04Document32 pagesAl4sp31tewb0112 Sequence 04salamPas encore d'évaluation
- Isolation 1Document37 pagesIsolation 1Rami RamiPas encore d'évaluation
- Fuss I RationDocument37 pagesFuss I Rationcisar0007Pas encore d'évaluation
- Farah Khelil Du Mode D Existence Des Objets TechiniquesDocument48 pagesFarah Khelil Du Mode D Existence Des Objets TechiniquesMargo SmithPas encore d'évaluation
- EtanchéitéDocument60 pagesEtanchéitéDriss DoudiPas encore d'évaluation
- Cours de Mine SouterraineDocument52 pagesCours de Mine SouterraineFerland Nya Ngongang94% (50)
- 13 Beton Precontraint Mixte PPT CopieDocument42 pages13 Beton Precontraint Mixte PPT CopieBenharzallah KrobbaPas encore d'évaluation
- Rédaction D'un D.M.O.S (EN ISO 15609 - 1)Document6 pagesRédaction D'un D.M.O.S (EN ISO 15609 - 1)sakina laabid50% (2)
- Travail Christian OriginalDocument55 pagesTravail Christian OriginalTanguy DoumbiaPas encore d'évaluation
- Fascicule de TP de Chimie 1Document28 pagesFascicule de TP de Chimie 1Karim Kisserli100% (1)
- Présentation OCPDocument12 pagesPrésentation OCPmuvubu100% (2)