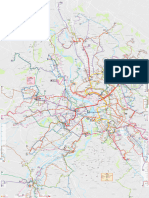Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Calvet LJ - Linguistique Et Colonialisme - J-L Doneux
Transféré par
Rayza GiardiniTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Calvet LJ - Linguistique Et Colonialisme - J-L Doneux
Transféré par
Rayza GiardiniDroits d'auteur :
Formats disponibles
Psychopathologie africaine, 1974, X, 2 : 291-292.
COMPTES RENDUS/Reviews
Louis-Jean CALVET — Linguistique et colonialisme. Paris, Payot, 1974, 250 p.
L’ouvrage traite des rapports, et de la complicité, entre la science linguistique et les attitudes co-
lonialistes. Certaines des thèses avancées paraissent justes, mais leur démonstration aurait sans
doute gagné à s’appuyer sur des enquêtes historiques et sociologiques plus approfondies.
Dans un domaine de la linguistique africaine, par exemple, des inexactitudes ou des omissions,
plus ou moins graves, apparaissent au cours des chapitres. Ainsi, la définition linguistique (et non
idéologique) des langues et des dialectes ne date pas d’hier ; depuis LEPSIUS au moins, toute l’école
allemande distingue clairement entre Sprache et Mundart. Malgré les affirmations de l’auteur, la quali-
fication de dialectes, patois ou baragouins, données aux langues dominées, paraît appartenir au
vocabulaire des milieux dits cultivés et non à celui des linguistes.
L’hypothèse selon laquelle les idées des frères SCHLEGEL sur la supériorité des langues euro-
péennes auraient régné un demi-siècle (assertion puisée chez MOUNIN) et même jusqu’à une date
récente chez les Africanistes (affirmation reprise à M. HOUIS) est également contestable. L’histoire
de la linguistique en Europe contredit cette affirmation, celle de la linguistique africaine également :
on ne trouve nulle trace d’évolutionnisme européo-centré dans la thèse de BLEEK sur le bantou en
1851 ; quant aux textes de DELAFOSSE et de WESTERMANN cités par M. Houis, du premier on ne
peut rien tirer sur le plan idéologique, et celui de Westermann est une citation malheureusement
tronquée. Dans le texte original, le savant allemand écrit à peu près le contraire de ce qu’on voudrait
lui faire écrire, à savoir que le proto-soudanais était une langue à monosyllabes. Westermann con-
clut clairement que la langue devait avoir à la fois des radicaux monosyllabiques et des radicaux
disyllabiques.
L’expérience de l’ “école mutuelle” en Algérie, en 1832, telle qu’elle est relatée, laisse penser que
les principes de ce courant pédagogique menaient nécessairement à la francisation, ce qui est
d’ailleurs apparemment exact dans le cas algérien, mais par un détournement politique opéré hors
des milieux mutualistes. Si l’auteur s’était référé à la tentative de Jean DARD au Sénégal à partir de
1820, qui prônait l’instruction en wolof, il aurait pu mieux montrer comment les idées mutualistes,
qui véhiculent une sorte de populisme pédagogique issu de la Révolution française, ne pouvaient
que s’effacer devant la montée de l’entreprise coloniale. Ce qui se passa effectivement au Sénégal.
Dernière imprécision relevée : l’attribution à l’ère coloniale de la mise en écriture du swahili ;
alors que cette langue fut décrite et écrite à l’époque des explorations et non à celle de la colonisa-
tion. D’une manière général, l’auteur ne semble pas avoir perçu l’originalité de la linguistique afri-
caine entre 1800 et 1880, ni la cassure qui se produit lorsque l’occupation de l’Afrique devient fait
accompli. Ceci aurait pourtant /p. 292/ donné vigueur à ses thèses, car il aurait pu déceler comment,
assez rapidement, les premiers linguistes africains (CROWTHER et d’autres) laissent la place aux
“informateurs”, lesquels ne sont souvent que des linguistes niés par l’idéologie coloniale.
Ces réserves faites, il faut reconnaître à L.-J. CALVET le mérite de poser crûment le problème de
ce qu’il nomme la glotophagie, et des rapports de cette pratique linguistique avec les idéologies
dominantes, singulièrement avec les idéologies coloniales et postcoloniales. Les quelques erreurs
que nous lui attribuons ici sont d’ailleurs les conséquences directes de la symptomatique pudeur qui
semble empêcher aujourd’hui la linguistique africaine de se pencher sérieusement sur son passé.
Nous croyons, pour notre part, que, lorsque les comptes seront faits, on s’apercevra mieux que les
rapports entre l’idéologie du linguiste et son œuvre scientifique sont moins directs, plus complexes
qu’on ne le suggère, que ne le suggère l’auteur. Les tentatives récentes faites pour dévoiler l’idéo-
logie au travail dans la production des chercheurs en sciences humaines négligent trop souvent le
fait que la construction scientifique est une réalité institutionnelle qui vit autant de ses propres lois
de développement que des nécessités de servir l’idéologie au pouvoir ; d’où proviennent des ten-
sions dont l’analyse ne peut faire fi. Lorsque C. MEINHOF lança son hypothèse sur les langues ha-
mites comme représentant l’influence du monde blanc en Afrique, il fut loin de recueillir
Louis-Jean Calvet — Linguistique et colonialisme (CR. : J.L. Doneux)
l’assentiment général des linguistes de son époque : trop de faits linguistiques s’opposaient à cette
vision qui, bien sûr, devait alimenter la légitimation du système colonial. La même chose peut être
dite à propos de la liaison entre une résistance linguistique nationaliste et la lutte des classes, liaison
que l’auteur – malgré quelques hésitations – voudrait voir aller de soi. Là, c’est l’hypothèse sociolo-
gique qui nous paraît trop tranchée : en Europe à plusieurs reprises, et en Afrique aujourd’hui, les
mouvements nationalitaires ont été tenus à bout de bras par des couches de la bourgeoisie concur-
rentes d’autres secteurs de la même classe sociale. Bref, il reste du chemin à faire pour éclairer tous
les rapports entre le langage et le reste du champ social. L’auteur s’est avancé sur ce chemin dans
une direction que nous croyons féconde ; il lui reste sans doute à mieux baliser ses étapes.
Jean Léonce DONEUX (C.L.A.D.)
2
Vous aimerez peut-être aussi
- Littératuresafricaines, Oral, Savoir 1705129673237Document18 pagesLittératuresafricaines, Oral, Savoir 1705129673237mkoffietranhanssaviolaPas encore d'évaluation
- Europe et traductionD'EverandEurope et traductionMichel BallardPas encore d'évaluation
- Boisacq - Dictionnaire Etymologique de Grec Moderne Part 1 PDFDocument382 pagesBoisacq - Dictionnaire Etymologique de Grec Moderne Part 1 PDFAnonymous uAJEGJW4p100% (1)
- Histoire de La Linguistique MalmbergDocument485 pagesHistoire de La Linguistique Malmberghmayda riad100% (2)
- La LinguistiqueDocument4 pagesLa LinguistiqueMaroua Benk99rimaPas encore d'évaluation
- Provenzano FrancophonieDocument17 pagesProvenzano Francophoniechilis32889Pas encore d'évaluation
- Manuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littéraireD'EverandManuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littérairePas encore d'évaluation
- Bilinguisme Et Diglossie Comment PenserDocument14 pagesBilinguisme Et Diglossie Comment PenserIdir SadouniPas encore d'évaluation
- Linguistique et psychologie: Lois intellectuelles du langageD'EverandLinguistique et psychologie: Lois intellectuelles du langagePas encore d'évaluation
- Des Steppes Aux OceansDocument137 pagesDes Steppes Aux OceansEkratoplanePas encore d'évaluation
- Interaction Kerbrat ORECCHIONIDocument18 pagesInteraction Kerbrat ORECCHIONIEliane_SoliPas encore d'évaluation
- La Guerre Des LanguesDocument6 pagesLa Guerre Des LanguesImane BoulahiaPas encore d'évaluation
- Manuel et anthologie de littérature belge à l’usage des classes terminales de l’enseignement secondaire: Manuel scolaireD'EverandManuel et anthologie de littérature belge à l’usage des classes terminales de l’enseignement secondaire: Manuel scolairePas encore d'évaluation
- Albert (Christiane), Dir., Francophonie Et Identités CulturellesDocument4 pagesAlbert (Christiane), Dir., Francophonie Et Identités Culturelles064331964aPas encore d'évaluation
- Ecrire en FrancaisDocument7 pagesEcrire en Francaisraluca89Pas encore d'évaluation
- Socius-Le Virage Social Dans Les Etudes Sur La TraductiDocument17 pagesSocius-Le Virage Social Dans Les Etudes Sur La Traductimauriciodc9Pas encore d'évaluation
- Roland Barthes, Linguistique Et LitteratureDocument7 pagesRoland Barthes, Linguistique Et LitteratureOana Chelaru-MurarusPas encore d'évaluation
- D'un monde l'autre. Tracées des littératures francophonesD'EverandD'un monde l'autre. Tracées des littératures francophonesMémoire d'encrierÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Relire Georges Mounin Aujourd'huiDocument17 pagesRelire Georges Mounin Aujourd'huiVasile SambritchiPas encore d'évaluation
- Langue OrphelineDocument24 pagesLangue OrphelineEmilia Barbara BaranPas encore d'évaluation
- Les Traits Principaux de La Tradition Linguistique FrançaiseDocument30 pagesLes Traits Principaux de La Tradition Linguistique FrançaiseAhmedPas encore d'évaluation
- BERMAN, Antione. L'épreuve de L'étranger PDFDocument318 pagesBERMAN, Antione. L'épreuve de L'étranger PDFBianca Czarnobai De Jorge91% (11)
- Le prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesD'EverandLe prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesPas encore d'évaluation
- Claude Hagege - La Structure Des Langues, 5e EditionDocument129 pagesClaude Hagege - La Structure Des Langues, 5e EditionCheval LaomaPas encore d'évaluation
- Alpatov, Vladimir (2007) - Saussure, Voloshinov Et BakhtineDocument15 pagesAlpatov, Vladimir (2007) - Saussure, Voloshinov Et BakhtineBlack AnnaisPas encore d'évaluation
- Lestransfertsculturelsfranco AllemandsDocument31 pagesLestransfertsculturelsfranco AllemandsBelén Sánchez DuréPas encore d'évaluation
- 1 3 HagègeDocument6 pages1 3 HagègeMihad BelmirPas encore d'évaluation
- La Littérature Comparée - Yves ChevrelDocument99 pagesLa Littérature Comparée - Yves ChevrelCharlotte Wang100% (1)
- Ali BenaliDocument346 pagesAli Benalimidou89Pas encore d'évaluation
- DR Yves-Abel Feze, Langues Et Interculturalité Dans La Littérature D'afrique FrancophoneDocument12 pagesDR Yves-Abel Feze, Langues Et Interculturalité Dans La Littérature D'afrique FrancophoneAnnalesPas encore d'évaluation
- Berman-La Traduction Au ManifesteDocument8 pagesBerman-La Traduction Au ManifesteUke AlzuetaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 SociolingDocument10 pagesChapitre 1 SociolingNihed BouhidelPas encore d'évaluation
- Les Créoles, Problèmes de GenèsDocument5 pagesLes Créoles, Problèmes de GenèsandrieuPas encore d'évaluation
- Les littératures africaines de langue francaise à l'époque de la postmodernité: Etat des lieux et perspectives de la rechercheD'EverandLes littératures africaines de langue francaise à l'époque de la postmodernité: Etat des lieux et perspectives de la rechercheHans-Jürgen LüsebrinkPas encore d'évaluation
- Du Structuralisme À La Linguistique de L'énonciation - Les Courants Linguistiques en MouvementDocument15 pagesDu Structuralisme À La Linguistique de L'énonciation - Les Courants Linguistiques en MouvementTar OuadPas encore d'évaluation
- Armand Colin Langages: This Content Downloaded From 129.174.21.5 On Thu, 16 Jun 2016 18:10:39 UTCDocument29 pagesArmand Colin Langages: This Content Downloaded From 129.174.21.5 On Thu, 16 Jun 2016 18:10:39 UTCafrascouPas encore d'évaluation
- Le Fils Du PauvreDocument25 pagesLe Fils Du Pauvrepqnamw0% (1)
- La Philosophie Bantoue PDFDocument10 pagesLa Philosophie Bantoue PDFPaulo MarquesPas encore d'évaluation
- AuerbachDocument11 pagesAuerbachdamianlopezPas encore d'évaluation
- Claude Hagège, La Structure Des Langues-2020Document128 pagesClaude Hagège, La Structure Des Langues-2020KouadioPas encore d'évaluation
- La Littérature Comparée - Yves ChevrelDocument98 pagesLa Littérature Comparée - Yves ChevrelRafael Francisco Braz100% (1)
- Cours I.ling l1 s1Document9 pagesCours I.ling l1 s1Lahlou BoussadPas encore d'évaluation
- LLL - Les Littératures en Langues Africaines Ou L'inconscient Des Théories Postcoloniales PDFDocument12 pagesLLL - Les Littératures en Langues Africaines Ou L'inconscient Des Théories Postcoloniales PDFdrago_rossoPas encore d'évaluation
- Lire Le Français D'hier - Manu de Paléographie Mod (XVe-XVIIIe Siècle) - Gabriel Audisio - Isabelle RambaudDocument251 pagesLire Le Français D'hier - Manu de Paléographie Mod (XVe-XVIIIe Siècle) - Gabriel Audisio - Isabelle RambaudMya Ben Queen100% (1)
- Un siècle d'enseignement du chinois à l'École des langues orientales: EssaiD'EverandUn siècle d'enseignement du chinois à l'École des langues orientales: EssaiPas encore d'évaluation
- Auroux, Sylvain - Le Paradigme NaturalisteDocument11 pagesAuroux, Sylvain - Le Paradigme NaturalisteVictoria GarcíaPas encore d'évaluation
- Textes Littéraires Et Enseignement Du Français - 1Document55 pagesTextes Littéraires Et Enseignement Du Français - 1gabvrielaPas encore d'évaluation
- Praxematique 979Document5 pagesPraxematique 979Papa Bemba KONATEPas encore d'évaluation
- 3 FrancophoniePlurielleDocument11 pages3 FrancophoniePlurielleMariana AlvesPas encore d'évaluation
- Résumé Du Roman Le Ventre de L'atlantiqueDocument24 pagesRésumé Du Roman Le Ventre de L'atlantiqueAlexis NdayitazirePas encore d'évaluation
- De Libera - Le Latin, Véritable Langue de La Philosophie PDFDocument23 pagesDe Libera - Le Latin, Véritable Langue de La Philosophie PDFNicolas BreuerPas encore d'évaluation
- J.L Joubert - Qu'est-Ce Qu'une Littérature Francophone - PDFDocument12 pagesJ.L Joubert - Qu'est-Ce Qu'une Littérature Francophone - PDFCarlos MoralesPas encore d'évaluation
- Linguistique Et Colonialisme 1974-2012 UDocument15 pagesLinguistique Et Colonialisme 1974-2012 UAyia WolfPas encore d'évaluation
- Francophonie Et Typologie Des SituationsDocument28 pagesFrancophonie Et Typologie Des SituationsAndreea AlbescuPas encore d'évaluation
- Cours de Linguistique Generale Texte Entier-1Document8 pagesCours de Linguistique Generale Texte Entier-11607106914Pas encore d'évaluation
- BERMAN FrançaisDocument22 pagesBERMAN Françaisimarques100% (1)
- La Vie littéraire à la toise: Études quantitatives des professions et des sociabilités des écrivains belges francophones (1918-1940)D'EverandLa Vie littéraire à la toise: Études quantitatives des professions et des sociabilités des écrivains belges francophones (1918-1940)Pas encore d'évaluation
- Lidiolecte Paulinien PDFDocument87 pagesLidiolecte Paulinien PDFIván Esteban BuitragoPas encore d'évaluation
- Du Malaise Condition Du Noire Dans La Societe FrancaiseDocument17 pagesDu Malaise Condition Du Noire Dans La Societe FrancaiseRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Himber C Poletti M L Adosphere 1 Guide Pedagogique PDFDocument106 pagesHimber C Poletti M L Adosphere 1 Guide Pedagogique PDFKaiJongin100% (4)
- Les Langues Du Congo BrazzavilleDocument10 pagesLes Langues Du Congo BrazzavilleRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Du Malaise Condition Du Noire Dans La Societe FrancaiseDocument17 pagesDu Malaise Condition Du Noire Dans La Societe FrancaiseRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Linguistique Et Post Colonialisme PDFDocument10 pagesLinguistique Et Post Colonialisme PDFAyia WolfPas encore d'évaluation
- En Littérature, Il Était Une Fois La ParitéDocument3 pagesEn Littérature, Il Était Une Fois La ParitéRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Liste Des Ressources PDFDocument1 pageListe Des Ressources PDFRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Parle Moi de Toi Oral ImparfaitDocument1 pageParle Moi de Toi Oral ImparfaitRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Oral ImparfaitDocument1 pageOral ImparfaitRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Les Sons Du Francais Rouge2 PDFDocument1 pageLes Sons Du Francais Rouge2 PDFRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- MondoLinguo Bataillenavaleverbes PDFDocument8 pagesMondoLinguo Bataillenavaleverbes PDFRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- ComparaisonDocument2 pagesComparaisonRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- ComparaisonDocument2 pagesComparaisonRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Batalha NavalDocument2 pagesBatalha NavalRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Echo - B1.1 - Lp-2e-Edition PDFDocument23 pagesEcho - B1.1 - Lp-2e-Edition PDFItalo Americo100% (4)
- M GM - Ene 2021 03Document92 pagesM GM - Ene 2021 03akrimabdssamedPas encore d'évaluation
- Webanalyse - Des Donnees A L'action - Antoine DenoixDocument218 pagesWebanalyse - Des Donnees A L'action - Antoine Denoixelric NoirtinPas encore d'évaluation
- CRM en B To BDocument41 pagesCRM en B To BechnagesecrPas encore d'évaluation
- Fiche D'exercices N°2 - Notion de Fonction DérivéeDocument1 pageFiche D'exercices N°2 - Notion de Fonction Dérivéezelda wegrzyniakPas encore d'évaluation
- Szymanowska Le MurmureDocument10 pagesSzymanowska Le MurmureBARNIKOLPas encore d'évaluation
- Questionnaire 2017Document85 pagesQuestionnaire 2017toto TOTOROTOPas encore d'évaluation
- BenchmarkingDocument47 pagesBenchmarkingJean-Paul LEGERPas encore d'évaluation
- Dosgae Etalonnage Permanganate CorrigeDocument2 pagesDosgae Etalonnage Permanganate CorrigeFERONPas encore d'évaluation
- Les Prodigieuses Victoires de La Psychologie - Pierre DacoDocument510 pagesLes Prodigieuses Victoires de La Psychologie - Pierre DacoMohammed Mankour100% (11)
- La Liste Complète Des Verbes Irréguliers Anglais (+ Fiche PDF) - Lea-EnglishDocument21 pagesLa Liste Complète Des Verbes Irréguliers Anglais (+ Fiche PDF) - Lea-EnglishFreshPas encore d'évaluation
- Plan Detaille ReseauDocument1 pagePlan Detaille ReseaulaomatteoPas encore d'évaluation
- Guide de Planification Du Cours de Mécanique Appliquée en Première E, F1, MA, MEMDocument33 pagesGuide de Planification Du Cours de Mécanique Appliquée en Première E, F1, MA, MEMESSOME ESSOME OLIVIER STEPHANEPas encore d'évaluation
- CredibilitéDocument132 pagesCredibilitéAssia BelhouchetPas encore d'évaluation
- BENJILALIDocument77 pagesBENJILALIelhagePas encore d'évaluation
- Hyphotheses de La RDMDocument6 pagesHyphotheses de La RDMallaouiPas encore d'évaluation
- Cours Réseaux MobilesDocument94 pagesCours Réseaux MobilesTig IkrPas encore d'évaluation
- GeomDocument28 pagesGeomIlyasse LemezaliPas encore d'évaluation
- Presentation Entree en RelationDocument36 pagesPresentation Entree en RelationIsmael NguetsopPas encore d'évaluation
- Histoire de L'électricitéDocument2 pagesHistoire de L'électricitéheneman100% (3)
- S1Document3 pagesS1Mawoussi AfekePas encore d'évaluation
- 1-Terre Dans Le Système SolaireDocument35 pages1-Terre Dans Le Système SolaireSohaib SfPas encore d'évaluation
- M'Hamed IssiakhemDocument257 pagesM'Hamed IssiakhemAdel BenzemaPas encore d'évaluation
- Elysun Kit 1800wDocument14 pagesElysun Kit 1800wChakchouk MED WALIDPas encore d'évaluation
- Les 10 Cles Du Developpement Personnel 1Document28 pagesLes 10 Cles Du Developpement Personnel 1TAKAMPas encore d'évaluation
- TP1 Transformations Lentes Ou Rapides 2-Correction PDFDocument5 pagesTP1 Transformations Lentes Ou Rapides 2-Correction PDFIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- Contribution À L'étude de La Gestion Des Ressources Humaines Et de L'intégration de La FormationDocument194 pagesContribution À L'étude de La Gestion Des Ressources Humaines Et de L'intégration de La FormationAmal Ben TaherPas encore d'évaluation
- POO en PHP5Document3 pagesPOO en PHP5Bash SumerPas encore d'évaluation
- Initiation À La Prospection Aut2019Document4 pagesInitiation À La Prospection Aut2019Ali GuelmamiPas encore d'évaluation
- 16094361327Document2 pages16094361327Amadou Kamafily DialloPas encore d'évaluation
- Prob3-Ondes EM Plasma1 CorrigéDocument15 pagesProb3-Ondes EM Plasma1 CorrigéAymane ESSALIMPas encore d'évaluation