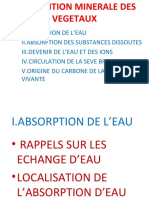Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Masses Volumiques Et Surfaces Specifiques Des Liants
Masses Volumiques Et Surfaces Specifiques Des Liants
Transféré par
Maryem Ben SalemTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Masses Volumiques Et Surfaces Specifiques Des Liants
Masses Volumiques Et Surfaces Specifiques Des Liants
Transféré par
Maryem Ben SalemDroits d'auteur :
Formats disponibles
Masses volumiques et
Manip3 :
surfaces spécifiques des liants
But :
Détermination de la masse volumique absolue du liant fourni et sa surface spécifique.
I. Masse volumique absolue :
On peut mesurer la masse volumique absolue à partir de deux méthodes, l’une est
basé sur la lecture des graduations : c’est le voluménométrie, et l’autre se base
que sur les pesées : c’est le pycnomètrie qu’on va l’utiliser lors de ce TP
- Détermination du volume intérieur utile V du pycnomètre pour cela :
• On a pesé le pycnomètre vide où on a trouvé une masse
m1 =43.412g
• On a la masse de pycnomètre rempli d’eau distillée est
m2=143.125 g
Avec V = m2 - m1 A.N : V = 143.125 - 43.412 =V
=99.713 cm2
- Détermination de la masse volumique du liquide inerte vis-à-vis du ciment
(l’éthanol) :
• On a rempli le pycnomètre d’éthanol et on l’a
pesé : m3 = 123.68 g
• La masse volumique de l’éthanol est :
ƿ1 = (m3-m1)/ V
A.N : ƿ1 = (123.68 – 43.412) / 99.713
ƿ1 = 0.805 g/cm2
- Détermination de la masse volumique du ciment ƿ :
• On a vidé à moitié le pycnomètre et
on a versé soigneusement une
masse m= 40 g de ciment très
lentement.
• Après agitation pour l’élimination
d’air entrainé par la poudre, on a
complété le niveau jusqu’au repère.
• On a séché le pycnomètre puis on l’a
pesé : m4=152.91 g
• La masse volumique de ciment est :
ƿ= (ƿ1*m)/ (m+m3-m4)
A.N : ƿ = 0.805*40/(40+123.68-152.91)
Ƿ =2.98 g/cm3
II. Mesure de la surface spécifique :
On appelle surface massique ou spécifique d’une poudre, la surface (exprimée en cm²)
d’un gramme de cette poudre dont tous les grains seraient développés. Nous ne nous
intéresserons dans ce TP à la méthode de Blaine.
Principe : La surface massique est d’autant plus grande que les grains sont plus petits.
Par ailleurs, la vitesse d’écoulement d’un fluide (air pour l’appareillage de Blaine) à
travers un corps granulaire est d’autant plus faible que les grains qui composent ce corps
sont fins. Il « suffit » donc de mesurer la vitesse d’écoulement de ce fluide à travers un lit
de poudre de matériau.
Mode opératoire : La méthode consiste à aspirer l’air au travers de la couche de poudre
par l’intermédiaire d’une poire en caoutchouc et d’un manomètre et de mesurer le débit
d’air susceptible de passer dans la poudre amenée à une compacité fixée.
Les mesures préliminaires :
- Détermination de la masse (W) de ciment à mettre dans la cellule :
W=d (1-e)*V
Avec d : masse volumique du ciment = 2.98 g / cm3
e : porosité à réaliser : 0.505±0.005
V=1.64 cm3
A.N : W=2.42 g
- Mesure de la surface spécifique :
Pour la mesure de la vitesse d’écoulement de l’air à travers la couche de ciment on a fait
Etape 1 : Placer la grille plus une rondelle de papier filtre, plus la quantité de ciment
(W) calculée. Ajouter une deuxième rondelle de papier filtre.
Etape 2 : Tasser et ôter le piston.
Etape 3 : Vérifier le niveau du liquide.
Etape 4 : Placer la cellule sur l’ajutage et s’assurer de l’étanchéité de l’ensemble.
Etape 5 : Aspirer le liquide et fermer le robinet.
Etape 6 : L’air traverse alors le ciment, mesurer le temps mis par le ménisque pour
descendre de la marque M2 à la marque M3 où on l’a trouvé t=7.89s
Etape 7 : Noter la température qui est 28°C : et on a déduit la valeur de la viscosité de
l’air, à partir des annexes de la norme qui est 1847 *10(-7)
Etape 8 : En déduire la surface massique par la formule suivante :
SW= (K4*√e3 *√t )/ ( d*(1-e)*√η)
Avec : K : constante de l ‘appareil = 34.055
η : la viscosité de l’air en Poise
t : le temps écoulé en s.
d : la masse volumique du ciment en g/cm3.
e : la porosité du ciment = 0,5
A.N : SW= (34.056*√0.53 *√7.89)/(2.98*(1-05)*√1847*10(-7))
SW=1712.43 cm2/g
III. Conclusion :
La surface massique des poudres est très variable : 2500 cm²/g < SW< 4500 cm²/g
pour les ciments courants et 1000 m²/g pour les argiles les plus fines. La surface
massique d’un ciment est un élément de control de fabrication ; elle conditionne par
exemple la durée et les moyens de broyage. D’autre part, on sait que les phénomènes
de prise des ciments sont d’abord des phénomènes superficiels : c’est la surface des
grains de ciment qui s’hydrate la première et le degré d’hydratation est lié à cette
surface.
Au cours de ce TP on a trouvé une valeur de SW inférieur à 2500 cm2/g puisque on a
travaillé avec un ciment stocké à l’air ambiant pendant une longue période ce qui lui
provoque une augmentation de la taille des grains et de degré d’hydratation.
Khouloud Abidi
Siwar Boukhris
Samar Ben Abdallah
GMAT2 S1 G1
Vous aimerez peut-être aussi
- TD CimentDocument10 pagesTD CimentGo Hamdi100% (1)
- Essai de VicatDocument6 pagesEssai de VicatYac Ine100% (1)
- TP MDCDocument17 pagesTP MDCSameh Hachaichi50% (6)
- TP1 - Essai de ConsistanceDocument3 pagesTP1 - Essai de ConsistanceAymane RbPas encore d'évaluation
- Les 5sDocument9 pagesLes 5sLamrani Mohamed100% (1)
- Ancien Noyau Sidi Okba 01Document2 pagesAncien Noyau Sidi Okba 01WALID SOUFIPas encore d'évaluation
- Chimie A Partir de Zero 486043 PDFDocument34 pagesChimie A Partir de Zero 486043 PDFTheo Wan100% (1)
- 4 RessuageDocument10 pages4 RessuageKhouloud AbidiPas encore d'évaluation
- LA NUTRITION MINERALE DES VEGETAUX LECON - Modif (1) .PpsDocument41 pagesLA NUTRITION MINERALE DES VEGETAUX LECON - Modif (1) .PpsMourad Ben HendaPas encore d'évaluation
- Tp1 Dreux GorisseDocument9 pagesTp1 Dreux GorisseGs XrPas encore d'évaluation
- TP HamidiDocument7 pagesTP HamidiamelPas encore d'évaluation
- Beton FraisDocument13 pagesBeton Fraisdjennatiali0% (1)
- 05-Los Angeles + Micro DevalDocument15 pages05-Los Angeles + Micro DevalSoufiane MouachiPas encore d'évaluation
- TP Formulation de Dreux GorisseDocument10 pagesTP Formulation de Dreux GorisseGhir Jdid غيير جديدPas encore d'évaluation
- Pfe Actuel Laye PDFDocument82 pagesPfe Actuel Laye PDFMeïssa Mbnb BeyePas encore d'évaluation
- Essai de PorositéDocument3 pagesEssai de Porositésabi100% (1)
- Rapport TP MDC: Benahmed Anouar Riyad Othmane Sedqui Omar Zeggani AymaneDocument28 pagesRapport TP MDC: Benahmed Anouar Riyad Othmane Sedqui Omar Zeggani AymaneOth RiyadPas encore d'évaluation
- Chap 3 - ER DefautDocument27 pagesChap 3 - ER DefautKamel Morid100% (1)
- TP MDCDocument10 pagesTP MDCManal TahriPas encore d'évaluation
- TP N°3. Essai de Perméabilité Aux Gaz Des BétonsDocument3 pagesTP N°3. Essai de Perméabilité Aux Gaz Des BétonsBerzigue Belabbes100% (1)
- Exposer Complet2Document12 pagesExposer Complet2Last WayPas encore d'évaluation
- Prise de CimentDocument4 pagesPrise de CimentamelPas encore d'évaluation
- Composition Du Béton TP07Document6 pagesComposition Du Béton TP07PRT OFFICIEL100% (1)
- MortiDocument13 pagesMortiIrok Chaima100% (1)
- Mesure de La Masse VolumiqueDocument5 pagesMesure de La Masse VolumiqueAmine Ouared0% (1)
- Emft KNDocument34 pagesEmft KNKhaoula BoudjellabaPas encore d'évaluation
- Essais D'écoulement D'une Pâte de CimentDocument12 pagesEssais D'écoulement D'une Pâte de CimentSidali MaallemiPas encore d'évaluation
- TP N°1. Porosité (ASTM)Document1 pageTP N°1. Porosité (ASTM)Berzigue BelabbesPas encore d'évaluation
- Analyse GranulométriqueDocument5 pagesAnalyse GranulométriqueTopina Rahim100% (1)
- Définition de Béton FibreDocument7 pagesDéfinition de Béton FibreChawkiPas encore d'évaluation
- Partie Annexe Essai Ciment Et BétonDocument29 pagesPartie Annexe Essai Ciment Et Bétonadel100% (1)
- TP BetonDocument8 pagesTP BetonYo Uc Ef JaMaiPas encore d'évaluation
- MDCDocument5 pagesMDCHi BaPas encore d'évaluation
- L'Analyse GranulométriqueDocument2 pagesL'Analyse Granulométriquemamado07Pas encore d'évaluation
- TP Mortier .Asd7560113755059913654Document15 pagesTP Mortier .Asd7560113755059913654Mohammed BelabbesPas encore d'évaluation
- YasmineDocument2 pagesYasmineHi BaPas encore d'évaluation
- TP Technologie Du Béton 1Document6 pagesTP Technologie Du Béton 1oussama douidi100% (1)
- Beton Autoplacant PDFDocument1 pageBeton Autoplacant PDFHatim ElPas encore d'évaluation
- ESSAI de ConsistanceDocument3 pagesESSAI de ConsistanceselmaPas encore d'évaluation
- Dernier TP DE TMCDocument4 pagesDernier TP DE TMCJasmine YasminePas encore d'évaluation
- Proctor NormalDocument4 pagesProctor NormalYoussef Elmoustaqim0% (1)
- TD BetonDocument10 pagesTD BetonSofiane BenaouadjPas encore d'évaluation
- TP 01-Méthode Dreux - GorisseDocument9 pagesTP 01-Méthode Dreux - GorisseFadiPas encore d'évaluation
- Mode Opératoire: Béton de Ciment ConsistanceDocument28 pagesMode Opératoire: Béton de Ciment ConsistanceIshak Baïche0% (1)
- TP Mds Essai OedometriqueDocument6 pagesTP Mds Essai Oedometrique3 éme infraPas encore d'évaluation
- Essai ProctorDocument11 pagesEssai ProctorManar YoussefPas encore d'évaluation
- MDC TP02Document9 pagesMDC TP02Blue DragonTVPas encore d'évaluation
- tp5 MdsDocument3 pagestp5 MdsfnsPas encore d'évaluation
- Essai D'affaissementDocument4 pagesEssai D'affaissementRaed NABLI100% (1)
- Béton Auto-PlaçantDocument10 pagesBéton Auto-PlaçantOumaïma El AbidiPas encore d'évaluation
- Nicot PierreDocument224 pagesNicot PierreAnonymous vpBmqrPas encore d'évaluation
- L'échantillonnage D'un Granulat TP 5Document6 pagesL'échantillonnage D'un Granulat TP 5Seif Eddine100% (1)
- Chapitre I Les Betons MDC IIDocument15 pagesChapitre I Les Betons MDC IIchouaib100% (2)
- MortierDocument2 pagesMortierUnes Jrd100% (1)
- Equivalent de SableDocument4 pagesEquivalent de SableAhmedEzzaytouniPas encore d'évaluation
- Équivalant de SableDocument9 pagesÉquivalant de SableAmmar RemiliPas encore d'évaluation
- Betons Fibres PDFDocument10 pagesBetons Fibres PDFimed cosanostraPas encore d'évaluation
- Mesure de La Propreté Des Granulats PDFDocument9 pagesMesure de La Propreté Des Granulats PDFamine100% (2)
- Essai Sur Beton FraisDocument9 pagesEssai Sur Beton FraisLalia MimiPas encore d'évaluation
- Consistance Normale PriseDocument9 pagesConsistance Normale PriseAhmed Chikh100% (1)
- Materiau FragmentationDocument9 pagesMateriau FragmentationBadra Ali SanogoPas encore d'évaluation
- TP No1. MASSE VOLUMIQUE DAADocument6 pagesTP No1. MASSE VOLUMIQUE DAAHad JerPas encore d'évaluation
- TP01Matériaux InnovantsDocument4 pagesTP01Matériaux InnovantsKhaoula Boudjellaba100% (1)
- IntroductionDocument4 pagesIntroductionBouchraMahmoudi100% (1)
- TP Matériaux Cimentaires PDFDocument20 pagesTP Matériaux Cimentaires PDFAmari vigouPas encore d'évaluation
- Masse VolumiqueDocument9 pagesMasse VolumiqueMohammed MadaniPas encore d'évaluation
- TP MatérauxDocument21 pagesTP Matérauxnizar bchiniPas encore d'évaluation
- These-Adjuvant de Broyage PDFDocument136 pagesThese-Adjuvant de Broyage PDFKhouloud AbidiPas encore d'évaluation
- Chapitre2 Theorie Elementaire de La RDM PDFDocument16 pagesChapitre2 Theorie Elementaire de La RDM PDFKhouloud Abidi100% (1)
- PDFDocument342 pagesPDFAbu OymaPas encore d'évaluation
- Chapitre 22 Peut-Il y Avoir Une Téléologie Non Métaphysique - CopieDocument26 pagesChapitre 22 Peut-Il y Avoir Une Téléologie Non Métaphysique - CopieghazalPas encore d'évaluation
- Presentation Projet Hybride 30kva Nickel Fer - MR RohatynDocument12 pagesPresentation Projet Hybride 30kva Nickel Fer - MR Rohatynj.allera45Pas encore d'évaluation
- Geologie Du Genie: I-Partie IDocument49 pagesGeologie Du Genie: I-Partie IGilles SondoPas encore d'évaluation
- Ndoumbe Ekeke Guy-ArnoldDocument82 pagesNdoumbe Ekeke Guy-ArnoldMedAnyoPas encore d'évaluation
- Dreux Gorisse Method'sDocument15 pagesDreux Gorisse Method'sAmir AmiroPas encore d'évaluation
- Thermodynamique ChimiqueDocument187 pagesThermodynamique ChimiqueAgent 470% (1)
- Thèse: Université François - Rabelais de ToursDocument203 pagesThèse: Université François - Rabelais de ToursWilson RobertoPas encore d'évaluation
- Traitement Des Condensats Série Aquamat: Pour Débits D'air Jusqu'à 100 M /minDocument5 pagesTraitement Des Condensats Série Aquamat: Pour Débits D'air Jusqu'à 100 M /minsav.bellignatPas encore d'évaluation
- تالللللفففغغهع٦paleogeggiqueDocument32 pagesتالللللفففغغهع٦paleogeggiqueSa LePas encore d'évaluation
- LA SPECIATION - RésuméDocument1 pageLA SPECIATION - RésuméAmor FaouziPas encore d'évaluation
- bn3050Document50 pagesbn3050myskyshepherdPas encore d'évaluation
- Energie HydrauliqueDocument9 pagesEnergie Hydrauliquemohamedmessahel754Pas encore d'évaluation
- Mesure de La Vitesse Par Effet DopplerDocument3 pagesMesure de La Vitesse Par Effet DopplerJalel KhediriPas encore d'évaluation
- Pfe 8Document49 pagesPfe 8Oumayma ElkanouniPas encore d'évaluation
- Onf RDVT 15Document72 pagesOnf RDVT 15Dominique FluzinPas encore d'évaluation
- ST TP Carto SD 1 2 3Document10 pagesST TP Carto SD 1 2 3mamywane9Pas encore d'évaluation
- Chapitre II Caractéristiques Des Matériaux Et Les Méthodes D PDFDocument19 pagesChapitre II Caractéristiques Des Matériaux Et Les Méthodes D PDFMoutiePas encore d'évaluation
- Hatimi 2002Document10 pagesHatimi 2002ⵎⵕⵟⴰⴼⴰ ⵎⵓⵙⵓⵜPas encore d'évaluation
- Livret Enseignant - L EAU ELLE A TOUT BON - Cycle 3Document32 pagesLivret Enseignant - L EAU ELLE A TOUT BON - Cycle 3maya ben mahmoudPas encore d'évaluation
- Tableau D'avènement Et Structure D'atomeDocument99 pagesTableau D'avènement Et Structure D'atomenounimed10Pas encore d'évaluation
- Cours Equilibre Dun Corps Sous Laction de 2 Forces 3Document10 pagesCours Equilibre Dun Corps Sous Laction de 2 Forces 3anoirPas encore d'évaluation
- T 14.2 HybridationDocument4 pagesT 14.2 HybridationMaeva SenePas encore d'évaluation
- Test Diagnostique 2APICDocument10 pagesTest Diagnostique 2APICprf ibrahim chahiPas encore d'évaluation
- 11 Cahier Des Clauses Environnementales Et SocialesDocument7 pages11 Cahier Des Clauses Environnementales Et SocialesNKWENTI FLAVIOUS TANUE100% (2)