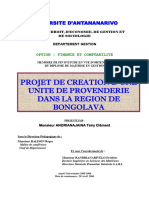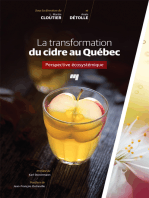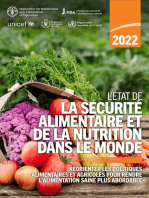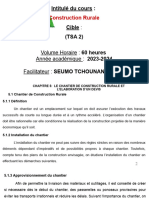Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Notes de Cours de Pilotage D'une Exploitation
Notes de Cours de Pilotage D'une Exploitation
Transféré par
mbessajunior15Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Notes de Cours de Pilotage D'une Exploitation
Notes de Cours de Pilotage D'une Exploitation
Transféré par
mbessajunior15Droits d'auteur :
Formats disponibles
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
PILOTAGE DUNE EXPLOITATION
Préparé et dispensé par
Christian Eloundou Etoundi
Ingénieur Agroéconomiste
Msc en Gestion des Institutions Financières
Doctorant en Sciences économiques à Université de Soa
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Table des matières
Objectif général du module ........................................................................................................ 4
Déroulement du module .............................................................................................................. 4
Travaux Pratiques ....................................................................................................................... 5
Témoignages ................................................................................................................................. 5
Chapitre 0. Généralités .............................................................................................................. 6
0.1. Le secteur Agropastorale et ses difficultés au Cameroun ....................................... 6
0.2. L’entreprenariat des Jeunes au Cameroun ................................................................ 6
0.1.1. Situation socio-économique des jeunes et leur emploi dans
l’agriculture. .......................................................................................................................... 7
0.1.2. Situation des entreprises. .................................................................................... 7
0.3. Les différentes formes d’entreprises en milieu rural ............................................... 8
0.3.1. GIC : Groupe Initiative Commune ...................................................................... 8
0.3.2. GIE : Groupements d’Intérêt Economique ......................................................... 9
0.3.3. La Coopérative ....................................................................................................... 9
0.3.4. Ets : Etablissement ............................................................................................... 10
0.3.5. SARL : Société À Responsabilité Limitée ......................................................... 10
0.3.6. SA : Sociétés Anonymes ...................................................................................... 11
0.4. Définition des concepts clés ....................................................................................... 12
0.4.1. Exploitation Agricole ........................................................................................... 12
0.4.2. Exploitation Familiale Agropastorale (EFA) .................................................... 13
0.4.3. Agroindustrie ....................................................................................................... 13
0.4.4. L'Entreprise ........................................................................................................... 13
0.4.5. Chef d’exploitation .............................................................................................. 14
0.4.6. Entrepreneur ......................................................................................................... 14
Chapitre I. Fonctionnement Globale d’une EAP dans son environnement .................. 15
1.1. Les Facteurs de Production en milieu rural ............................................................ 15
1.1.1. Le Foncier .............................................................................................................. 15
1.1.2. Le Travail............................................................................................................... 15
1.1.3. Les moyens de production ................................................................................. 16
1.2. L’exploitation agropastorale : les différents systèmes de production ................. 16
1.2.1. Système de Culture .............................................................................................. 17
1.2.2. Système d’élevage ................................................................................................ 20
1.3. Les Objectifs d’une EAP ............................................................................................. 26
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Chapitre II. Éléments de diagnostic d’une EAP ................................................................. 27
2.1. L’analyse systémique d’une EAP .............................................................................. 27
2.1.1. Le diagnostic : méthode ...................................................................................... 28
2.1.2. Les pièges du diagnostic ..................................................................................... 28
2.1.3. Une démarche : l’approche globale ................................................................... 29
2.1.4. Diagnostic INTERNE (couleur marron) .............................................................. 29
2.1.5. Diagnostic EXTERNE (couleur bleue) ................................................................. 31
2.2. L’analyse SWOT .......................................................................................................... 33
2.2.1. Comment identifier et étudier les 4 facteurs ? ................................................. 33
2.3. La caractérisation d’une EAP .................................................................................... 34
Chapitre III. La prise de décision et le chef d’exploitation(Manager) ........................... 36
3.1. Le management d’une entreprise ............................................................................. 36
3.1.1 Le Bon Manager ................................................................................................... 36
3.1.2. Les qualités d’un bon entrepreneur .................................................................. 37
3.2. La prise de décision et impact technico-économique ............................................ 37
3.3. La planification stratégique d’une exploitation ...................................................... 38
3.4. Notion d’élaboration de Budget prévisionnel............................................................ 39
3.4.1. Quelques notions de budget............................................................................... 40
Chapitre IV. Elaboration d’un Projet .................................................................................. 41
4.1. Définition d’un Projet ..................................................................................................... 41
4.2. Etude de faisabilité .......................................................................................................... 42
4.3. Différentes partie de rédaction d’un projet ................................................................. 44
4.4. Programmation et suivi (notion d’indicateurs) .......................................................... 44
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Objectif général du module : Utiliser des démarches et outils d’aide à la décision pour piloter
une exploitation agropastorale
De ce fait, les objectifs assignés sont les suivants :
- Décrire le fonctionnement global d’une exploitation ;
- Raisonner un système de production adapté au contexte de son territoire ;
- Analyser l’impact d’une prise de décision sur le système de production ;
- Analyser les mécanismes de mise en œuvre d’un projet agropastoral.
Ce module doit permettre :
- l’acquisition par les apprenants d’une méthode permettant la description du fonctionnement et
la réalisation du diagnostic d’une exploitation agricole dans son environnement d’une part et
l’étude des modalités et de l’impact d’une décision stratégique déjà prise sur l’exploitation
D’autre part;
- la transposition de ces outils à l’exploitation de stage ;
- la préparation à l’examen de Brevet de Technicien Supérieur.
Déroulement du module
Ce cours se fera de manière participative, il se subdivisera en trois temps à savoir : (i) phase
théorique où l’apprenant est appelé à recueillir un ensemble de connaissance sur les notions et
concepts de base au pilotage d’une Entreprise Agro-Pastorale (EAP), (ii) phase d’apprentissage,
il sera question pour l’apprenant d’être amené à bâtir des outils de compréhension de
l’environnement de l’EAP et de prise de décision afin d’orienter une entreprise , d’autre part les
apprenants devront suivre des témoignages des entrepreneurs du milieu rural afin de juger les
Forces-Faiblesses et/ou Menaces-Opportunités de ces derniers et enfin une (iii) phase de
descentes de terrain ,ces descentes se feront auprès de trois structures (GIC agropastoral, une
EFA, un Etablissement de provenderie) en six sous-groupes afin de mettre en pratique les
enseignements reçus sur la description du fonctionnement global d’une EAP et diagnostiquer la
gestion des ressources mais aussi d’apprécier avec la matrice SWOT(Forces/Faibles et/ou
Menaces/Opportunités) la gestion de ces structures.
Logistique exigé aux apprenants : un ordinateur, papiers conférences, paquet de feutres, formats,
crayons, stylos, appareil photo, clé internet.
-
4
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Travaux Dirigés
- Élaboration d’un diagnostic d’EAP en sous-groupes et restitution en plénière sur
papier conférence;
- Planification des activités (Opérationnelle et Stratégique) d’EAP en sous-groupes
et restitution en plénière sur papier conférence ;
- Passer d’un Diagnostic à l’élaboration d’un Projet de développement dans une
EAP.
Travaux Pratiques : Descentes de terrain et Témoignages
Diagnostic global d’une EAP (Provenderie, Transformation des fruits et OP de
Production Animale et Végétale) ;
Planification des activités des EAP ;
Montage d’un Projet d’EAP ;
Les descentes de terrain s’étaleront sur deux jours selon le planning suivant :
Horaires Sous-Groupe1 Sous-Groupe2 Sous-Groupe3 Sous-Groupe4 Sous-Groupe5 Sous-Groupe6
8-12H Provenderie1 OP1 PA OP1 PV Provenderie2 OP2 PA OPTransformation1
14H-18H OP1 PV Provenderie1 Provenderie2 OP1 PA OPTransformation1 OP2 PA
Témoignages
Un Entrepreneur de référence pris dans les environnements du département viendra
exposer sur ses activités et sa réussite dans le pilotage de son entreprise agropastorale
pendant 1 h et suivront des questions par les apprenants sous le regard vigilant de
l’enseignant.
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Chapitre 0. Généralités
Ce chapitre vient faire une présentation générale du secteur agropastorale au Cameroun
avec ses difficultés de développement en particulier la problématique de l’entreprenariat
des jeunes dans ce secteur. Plus loin, il sera important de discuter sur les différentes
formes d’entreprises en milieu rural au Cameroun et enfin une forme de glossaire
pourrait être proposée aux apprenants.
0.1. Le secteur Agropastorale et ses difficultés au Cameroun
L’agriculture tropicale, parce qu’essentiellement extensive et de subsistance, ne
parvient toujours pas à satisfaire convenablement les besoins alimentaires et
économiques des populations concernées. D’où la nécessité de la faire évoluer en
agriculture intensive. Mais ce passage se heurte à une série d’obstacles qui sont de
divers ordres : naturel, technique et économique ainsi que culturel. L’agriculture
camerounaise illustre bien ces difficultés.
Le Gouvernement a adopté en 2005 la stratégie de développement du secteur rural.
Il a en cette occasion dressé le constat d’une agriculture malade, structurellement
incapable désormais de nourrir la population camerounaise. Les contraintes
suivantes, qui bloquent la production, ont été identifiées : (i) difficultés d’accès à la
terre ; (ii) difficultés d’accès aux intrants (engrais, semences améliorées, etc…) ; (iii)
difficultés d’accès aux techniques agricoles modernes et aux autres innovations de
la recherche agronomique ; (iv) difficultés d’accès au crédit ; (iv) insuffisance des
infrastructures d’appui au développement du secteur rural (pistes, routes, magasins
de stockages, abattoirs, chaînes de froid etc.) ; (vi) difficultés de commercialisation de la
production, souvent du fait d’une chaîne de commercialisation trop longue qui accapare
l’essentiel de la valeur ajoutée agricole et freine le réinvestissement. (vii) vieillissement
de la population rurale, ce dernier induit une prise en compte des jeunes dans
l’entreprenariat agropastoral.
0.2. L’entreprenariat des Jeunes au Cameroun
Le secteur agricole camerounais constitue le principal moteur de la croissance
économique en milieu rural et dispose de nombreux atouts dont : la forte demande
intérieure et extérieure pour les produits vivriers, animaux et halieutiques, le
grand potentiel d’accroissement de la productivité, des conditions agro-écologiques
favorables permettant une grande variété de productions, et la disponibilité des terres
agricoles.
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Malgré la présence de telles potentialités, la moitié de la population rurale camerounaise
vit dans des conditions difficiles du fait des difficultés cités plus haut.
Les jeunes ruraux camerounais confrontés au manque d’opportunités en milieu rural, au
manque de qualification et de moyens, font partie des personnes les plus vulnérables, en
témoigne leur déferlement vers les centres urbains en quête d’amélioration de leurs
conditions d’existence. Les jeunes représentent pourtant 78% de la population, ce qui est
une main d’œuvre potentielle immense que malheureusement le système économique
ne parvient pas à absorber.
L’emploi des jeunes de façon générale, et dans le secteur agro pastoral en particulier, est
dès lors devenu pour le Cameroun, un enjeu majeur pour la réduction de la
pauvreté, la préservation de la cohésion et la paix sociale.
0.1.1. Situation socio-économique des jeunes et leur emploi dans l’agriculture.
La structure des emplois indique que les jeunes exercent essentiellement dans le
secteur informel agricole et se répartissent de la manière suivante selon les catégories
socioprofessionnelles:
- Travailleurs pour compte propre (44,0%). La grande majorité exploite la terre à des fins
productives.
- Les dépendants constitués d'aides familiaux et apprentis (42,8%). Ils travaillent dans des
unités dirigées par un parent vivant généralement dans le même ménage qu'eux et ne
perçoivent en général pas de rémunération fixe, qu'elle soit en nature ou en espèce.
- Patrons (1,8%). Ce sont des jeunes ruraux travaillant pour leur propre compte ou
avec des associés et qui emploient une ou plusieurs personnes salariées dans leur unité.
- Les jeunes salariés en milieu rural (11,5%). Ce sont des cadres (1,2%), des employés
qualifiés (5,6%) et des ouvriers (4,7%).
0.1.2. Situation des entreprises.
L’activité économique dans le pays reste dominée par le secteur informel qui
représente près de 70 % de l’emploi en milieu urbain et 75 % en milieu rural. En zone
rurale où les activités agro-pastorales sont largement dominantes, le secteur privé
formel n’occupe que 1,3 % des actifs contre 75 % pour le secteur informel agricole
et 20,7 % pour le secteur informel non agricole. Les entreprises du secteur primaire ne
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
représentent que 20,3 % des 1700 entreprises recensées au Cameroun en 2010 dans le
secteur formel.
Selon une étude gouvernementale, le nombre de jeunes âgés de 15 à 34 ans exerçant dans
le secteur agricole en milieu rural s’élève à près de 2 millions. Parmi ces jeunes, plus 889
400, dont près de 376 000 jeunes femmes, sont des exploitants agricoles c’est-à-dire des
propriétaires d’exploitation agricole, y compris d’élevage, exerçant à titre individuel ou
avec l’aide des membres de sa famille, ou encore employant une main d’œuvre salariée.
Du point de vue entrepreneurial, ils constituent des cibles potentielles intéressantes pour
la reforme engagé par le Programme AFOP et le nouveau Programme de Promotion de
l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA - Jeunes).
0.3. Les différentes formes d’entreprises en milieu rural
Le Cameroun a élaboré en 2009 une stratégie de développement des PME, de l’Economie
sociale de l’Artisanat. Il a aussi voté une loi en avril 2010, portant promotion des PME et
qui s’articule autour de l’appui à la création, l’incubation, l’appui au développement et
le soutien au financement des PME, tout en distinguant les PME sur la base de
deux critères (effectif et chiffre d’affaires hors taxes), en Toute Petite Entreprise (TPE),
Petite Entreprise (PE), et Moyenne Entreprise (ME).
Le secteur agropastoral peut donc prendre toutes ces catégorie et se régir en GIC, GIE,
Coopérative, Ets, SARL, SA…etc.
D’où il est important pour l’entrepreneur de se poser les questions de savoir : Quelle est
la forme juridique convenant le mieux à mon entreprise? Quels sont les avantages et les
inconvénients dont il faut tenir compte, dans le cas GIC, GIE, Coopérative, Ets, SARL,
SA? Quel sera votre régime fiscal? Quels coûts allez-vous devoir supporter ? Quelles
formalités accomplir ?
Notons de prime abord qu’il existe des Entreprises d’Economie Sociale (GIC &
Coopérative) et les Entreprises Commerciales (SA,GIE,SARL,Ets…etc.)
0.3.1. GIC : Groupe Initiative Commune
Les groupes d'initiative commune sont des organisations à caractère économique et social
de personnes physiques volontaires ayant des intérêts communs et réalisant à travers le
groupe des activités communes, cette forme d’association est régie par la loi Loi N°92/006
du 14 août 1992.
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Le GIC est une organisation de forme juridique simple et peu contraignante. Son
existence est un atout important pour le développement de l’agriculture. Cette forme
d’organisation légère permet de résoudre des problèmes et de lever certaines contraintes
que, seul, un exploitant ne peut pas affronter.
0.3.2. GIE : Groupements d’Intérêt Economique
Un GIE est une entité résultant d’une convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales, s’engagent à mettre en œuvre tout ou partie de leurs
moyens pour une période déterminée, en vue de faciliter et/ou développer leur activité
économique, chaque membre conservant sa personnalité juridique.
Avantages
- Simplicité dans la constitution de l’entreprise ;
- Tout type d’activité accepté ;
- Pas de capital social exigé au démarrage ;
- Souplesse fiscale ;
- En principe exonéré de l’impôt sur les sociétés.
Inconvénients
- Membres solidairement responsables des engagements du groupe ;
- Responsabilité illimitée des membres (un créancier peut les poursuivre jusque
dans leurs biens privés).
0.3.3. La Coopérative
Une société coopérative est, aux termes de la présente loi, un groupe de personnes
physiques et/ou morales qui s'associent librement pour atteindre des buts communs
par la constitution d'une entreprise dirigée de manière démocratique et à laquelle elles
sont liées par un contrat qui fixe notamment les règles :
• De leur activité avec cette organisation;
• De répartition équitable de son capital;
• De participation aux fruits et aux risques liés à ladite activité.
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
0.3.4. Ets : Etablissement
Un Ets peut être une entreprise individuelle ou une Société en Nom Collectif(SNC) ou
encore Société en Commandite Simple( SCS). En général les Ets sont constitués en
considération de la personne des associés, entre gens qui se connaissent et s’apprécient
en raison de la confiance qu’elles se témoignent les unes aux autres.
Avantages
- Simplicité dans la création. Deux pièces seulement sont essentielles dans la
constitution du dossier: immatriculation au registre de commerce et du crédit
mobilier, paiement de la patente. (N.B. : Une dérogation a été adoptée en 2005
pour exonérer les entreprises nouvellement créées de paiement de patente
pendant deux ans) ;
- Simplicité de fonctionnement, souplesse et rapidité dans la prise des décisions:
l’entrepreneur dirige lui-même son entreprise ;
- Toutes formes d’activités acceptées ;
- Aucun capital minimum exigé au démarrage ;
- Associés non nécessaires ;
- Non partage du bénéfice ;
- Contrôle total de l’entreprise par son promoteur.
Inconvénients
- Faible crédibilité vis-à-vis des partenaires ;
- Difficultés de croissance par autofinancement ;
- Responsabilité illimitée : l’entrepreneur est redevable envers les créanciers au-
delà du patrimoine de l’entreprise ;
- Risque de disparition de l’entreprise avec le décès de l’entrepreneur.
0.3.5. SARL : Société À Responsabilité Limitée
La SARL est un des grands types classique des sociétés commerciales. C’est un type
hybride de société compte tenu :
D’une part, elle tient des sociétés de personnes, car elle repose sur l’intuitu personae
(associé en petit nombre et se connaissant bien) ; leur capital n’est pas divisé en actions,
mais en parts sociales non négociables. Leur organe exécutif est une gérance.
10
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Mais d’autre part, la SARL se rapproche des sociétés de capitaux car ses membres qui ne
sont pas de commerçants ne sont responsables qu’à la concurrence de leurs apports. Un
associé peut ailleurs, céder ses parts sociales sans le consentement unanime des associés.
Avantages
- Responsabilité de chaque associé limitée à son apport dans le capital ;
- Crédibilité vis-à-vis des partenaires ;
- Evolution et continuité de l’entreprise en cas de décès d’un associé ;
- Formalités légères comparativement aux sociétés anonymes.
(Il existe aussi des SARL unipersonnelles).
Inconvénients
- Formalisme et rigidité dans la constitution de la société et son fonctionnement.
- Capital minimum exigé au démarrage : un million de Fcfa ;
- Limitation des types d’activités à exercer.
- Impossibilité de faire un appel du public à l’épargne.
- Pas d’apports en industrie ou en nature : il faut tout convertir en liquidité.
- Tout le capital doit être libellé au départ.
0.3.6. SA : Sociétés Anonymes
Dans le domaine des entreprises, la Société anonyme est le niveau le plus élevé. Comme
dans le cas des SARL, les associés sont nécessaires. Néanmoins, il y a aussi possibilité de
créer une SA unipersonnelle.
Avantages
- Crédibilité vis-à-vis des partenaires ;
- Prestige des postes des dirigeants : PCA, DG, etc.
- Admission du capital en nature ;
- Responsabilité limitée des actionnaires.
Inconvénients
- Capital minimum exigé au démarrage : dix millions de Fcfa ;
- Formalités lourdes à toutes les phases : création, gestion des ressources
financières et du personnel ;
- Lourde fiscalité ;
- Trop de charges fixes ;
11
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
- Nécessité d’un grand marché et d’importants débouchés.
NB : Toutes ces formes d’entreprises existent tant en milieu urbain qu’en milieu rural.
0.4. Définition des concepts clés
Il est important avant d’entrer au cœur de ce module de définir quelques concepts sur le
pilotage d’une exploitation à savoir : Exploitation Agricole, Exploitation Familiale
Agropastorale, Agroindustrie, Entreprise, Chef d’exploitation, Entrepreneur.
0.4.1. Exploitation Agricole
Selon Dufumier(1996), c’est une unité de production agricole dont les éléments
constitutifs sont la force de travail (familiale et salariée), les surfaces agricoles, les
plantations, le cheptel, les bâtiments d’exploitation, les matériels et l’outillage. C’est le
lieu où le chef d’exploitation combine ces diverses ressources disponibles et met ainsi en
œuvre son système de production agricole.
Pour la FAO(2000) c’est une unité économique de production agricole soumise à une
direction unique et comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée,
entièrement ou en partie, pour la production agricole, indépendamment du titre de
possession, du mode juridique ou de la taille. La direction unique peut être exercée par
un particulier, par un ménage, conjointement par deux ou plusieurs particuliers ou
ménages, par un clan ou une tribu ou par une personne morale telle que société,
entreprise collective, coopérative ou organisme d’état. L’exploitation peut contenir un ou
plusieurs blocs, situés dans une ou plusieurs régions distinctes ou dans une ou plusieurs
régions territoriales ou administratives, à condition qu’ils partagent les mêmes moyens
de production tels que main-d’œuvre, bâtiments agricoles, machines ou animaux de trait
utilisés sur l’exploitation.
Par contre selon le site internet wikipedia, une exploitation agricole, dans le domaine de
l'économie agricole, est une entreprise, ou partie d'une entreprise, constituée en vue de la
production agricole et caractérisée par une gestion unique et des moyens de production
propres. C’est la définition que nous utiliserons dans le présent module chaque fois que
nous parlerons d’exploitation.
12
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
0.4.2. Exploitation Familiale Agropastorale (EFA)
C’est une unité de production agricole organisée sur une base familiale, au sein de
laquelle les rapports entre personnes sont définis librement et ne sont pas régis par le
code de travail.
Ferraton et Touzard (2009) pensent que c’est une exploitation agricole dans laquelle seule
une main d’œuvre salariée fournit la force de travail utilisée pour la mise en œuvre du
système de production
0.4.3. Agroindustrie
C’est l'ensemble des industries ayant un lien direct avec l'agriculture. Cela comprend
donc l'ensemble des systèmes de productions agricoles et s'étend à toutes les entreprises
qui fournissent des biens à l'agriculture (engrais, pesticides, machines) ainsi qu'à celles
qui transforment les matières premières et les conditionnent en produits
commercialisables. En ce sens le secteur agro-industriel ne se limite pas aux
seuls produits alimentaires, domaine exclusif au secteur agroalimentaire, mais englobe
aussi tous les secteurs parallèles de valorisation
des agroressources : papiers, bioénergies, biomatériaux, cuirs, textiles, huiles
essentielles, cosmétiques, tabac…etc.
0.4.4. L'Entreprise
C’est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle
de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision,
notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.
Elle peut aussi être définit comme une organisation ou une unité institutionnelle, mue
par un projet décliné en stratégie ou en politiques et plans d'action, dont le but est de
produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou
usagers.
Pour ce faire:
l'entreprise s'organise, fait appel, mobilise et consomme des ressources (matérielles,
humaines, financières, immatérielles et informationnelles) ;
l'entreprise exerce son activité dans le cadre d'un contexte précis auquel elle doit
s'adapter: un environnement plus ou moins concurrentiel, une filière technico-
13
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
économique caractérisée par un état de l'art, un cadre socio-culturel et règlementaire
spécifique ;
l'entreprise peut se donner comme objectif de dégager un certain niveau de
rentabilité, plus ou moins élevé.
0.4.5. Chef d’exploitation
Dans les EFA, le chef d’exploitation est le véritable gestionnaire, il fixe les objectifs, prend
les décisions, pilote l’exploitation, mesure les résultats et veille à l’amélioration de la
performance de son exploitation, il assure donc la fonction de direction.
0.4.6. Entrepreneur
Le terme entrepreneur recouvre différentes significations connexes mais distinctes :
l'usage courant l'assimile à un chef d'entreprise, tantôt porteur
d'un projet d'entreprise en phase de démarrage, tantôt dirigeant d'une entreprise
davantage établie, à laquelle le plus souvent il s'identifie étroitement et
personnellement ;
l'entrepreneur correspond également à l'appellation donnée aux chefs d'entreprise
du secteur du bâtiment ou des travaux publics ;
en droit, l'entrepreneur (ou maître d'œuvre) désigne « la personne qui — dans un
contrat d'entreprise — s'engage à effectuer un travail en réponse à la demande
d'un maitre d'ouvrage ».
14
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Chapitre I. Fonctionnement Globale d’une EAP dans son environnement
Comment fonctionner au quotidien pour faire ce qu’on a à faire ? La question mérite
d’être posée. En effet, la traduction des orientations stratégiques et des principes en action
d’une Exploitation se heurte souvent aux contraintes quotidiennes qu’elles soient
organisationnelles, humaines, matérielles ou financières. Tel est l’objectif de ce chapitre
qui essayera d’entamer la discussion sur les facteurs de production en milieu rural puis
présentera les différents systèmes de production au Cameroun enfin conclura sur les
objectifs généraux d’une exploitation.
1.1. Les Facteurs de Production en milieu rural
Une exploitation agricole, dans son fonctionnement productif, doit réunir différents
éléments nécessaires pour qu’une production, végétale ou animale, puisse être entreprise.
Ces éléments, appelés facteurs de production, sont la terre (encore appelée le foncier), le
travail (humain) et tous les biens matériels utilisés au cours de la production (les moyens
de production).
1.1.1. Le Foncier
Le foncier de l’exploitation est constitué par l’ensemble des terres exploitées et de
superficies construites : Habitations, bâtiments pour le bétail, hangars, greniers, silos etc.
Il se caractérise :
- Par la nature des terres : c’est-à-dire les types de sols, la nature du sous-sol, le niveau
de fertilité, la pente, l’exposition, l’altitude, etc.
- Par la superficie des terres de l’exploitation, facteur de première importance pour
l’analyse économique de l’exploitation ;
- Par le mode de tenure des terres. Les terres en propriété appartiennent aux membres de
la famille. Sur les terres en métayage, la famille a un droit d’exploitation pendant
une certaine durée, en échange du versement d’une partie déterminée de la récolte
au propriétaire. Sur les terres en fermage, font l’objet d’un contrat (ou bail) entre
l’exploitant et le propriétaire pour une durée déterminée.
1.1.2. Le Travail
Le travail nécessaire aux activités productives de l’exploitation peut être fourni par la
main d’œuvre familiale ou extérieure à la famille : salariés, journaliers, groupes
d’entraide, etc. L’analyse économique d’une exploitation agricole demande une
15
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
évaluation quantitative du travail utilisé sur l’exploitation, parfois délicate à conduire.
Pour le recours à la main d’œuvre extérieure, on analysera les différentes modalités leur
importance relative et leur coût.
Pour effectuer les estimations, on a souvent recours à des normes standardisées. Par
exemple, un homme adulte= 1 actif, ou encore un enfant= ½ actif. Ces normes peuvent
variées d’une région à une autre.
1.1.3. Les moyens de production
Les moyens de production d’une exploitation (capital ixe, capital circulant) peuvent être
recensés et évalués grâce à un inventaire effectué à une date précise.
Les moyens de production représentent le capital que l’exploitant a dû investir. Ces
investissements ont pu être financés par les gains de l’exploitation agricole elle-même par
les revenus d’autres activités du foyer ou par le recours au crédit.
Parmi les moyens de production, on distingue :
- Le capital fixe d’exploitation : Qui est la valeur des biens servant à plusieurs cycles
de production : Outils, moyens de traction, bâtiments d’élevage, animaux
reproducteurs. etc.
- Le capital d’exploitation circulant (encore appelé consommation intermédiaires) est
la valeur des biens consommés pendant un cycle de production : semences,
engrais, aliments du bétail, etc.
1.2. L’exploitation agropastorale : les différents systèmes de production
Le système de production d’une exploitation se définit par la combinaison (nature et
proportions) de ses activités productives et de ses moyens de production (terre, capital,
travail). L’étude des systèmes de productions inclut donc l’étude des sous-systèmes
productifs (élevage, culture et transformation) qui sont caractérisés par la nature des
produits, les itinéraires techniques suivis et les rendements de ces productions.
L’évolution des systèmes de production peut être caractérisée par plusieurs paramètres
principaux : diversification/spécialisation (plus ou moins grande diversité des
productions), intensification/extensification (en travail, capital ou intrant par unité de
surface).
16
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Par ailleurs, le système de production selon Reboul, 1976 est un mode de combinaison
entre terre, force et moyens de travail à des fins de production végétale et animale,
commun à un ensemble d’exploitations. Ce terme système de production indique que
l’on s’intéresse à la fois à la structure, l’organisation et le fonctionnement des
exploitations agricoles : il s’agit de comprendre ce que font les agriculteurs, comment et
pourquoi et évaluer les résultats qu’ils obtiennent.
Etablir une typologie des systèmes de production, c’est distinguer les types
d’exploitations familiales agropastorales que l’on retrouve au sein d’un département ou
région en fonction des espèces cultivées, des races élevées et du niveau d’accès aux
facteurs de production. Il existe plusieurs formes à savoir :
Typologie structurelle basée sur la nature et les modalités d’organisation et de
combinaison des moyens de productions ;
Typologie fonctionnelle qui s’attache plus à l’analyse des processus techniques
de production (analyse des décisions techniques qui dépend des spéculations adoptées
et des conditions du milieu).
Un Système de Production (SP) = Système de Culture(SC) + Système d’Elevage(SE)
1.2.1. Système de Culture
Le concept de système de culture est particulièrement opérant pour décrire la façon dont
les agriculteurs gèrent leurs parcelles dans la durée, en observant certaines règles
implicites ou explicites. Il permet de caractériser la gestion technique d’un ensemble de
parcelles aux caractéristiques en général proches et auxquelles les agriculteurs appliquent
des techniques voisines. Un système de culture peut en effet être défini comme l’ensemble
des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de manière identique.
Chaque système de culture se définit par :
La nature des cultures et leur ordre de succession ;
Les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, ce qui inclut
le choix des variétés pour les cultures retenues.
17
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Exemple : Différents systèmes de culture en pur dans le département de la Lékié
Spéculation Localisation Surface Exploitant Objectifs
Cultures pérennes
* Vente exclusivement
En zone de forêt
pour le cacao
Cacao x fruitiers x (veille plantation) de
2 à 10 ha EFA * Autoformation et
banane-plantain forêt mixte et savane
vente du surplus pour le
(jeunes plantations)
reste
* Vente exclusivement
Localisés en zone de
* OP dans les OP
Palmier à huile forêt mixte et en 1 à 10 ha
* EFA *Autoconsommation et
savane
vente pour les EFA
Cultures annuelles
En début ou en fin de
cycle (mode le plus
répandu) sa culture * Vente exclusivement
Manioc 1 à 2 ha
courtier la périphérie * OP dans les OP
des forêts et la * EFA *Autoconsommation et
savane vente pour les EFA
Maïs Toujours en début de 1 à 20 ha
cycle que ce soit en
forêt mixte ou en
Riz savane après une ≤ 1/2 ha EFA Autoconsommation
jachère
* Vente exclusivement
Localisés en zone de
*OP dans les OP
Banane-plantain forêt mixte et en 1 à 5ha
* EFA *Autoconsommation et
savane
vente pour les EFA
18
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
En zone de savane en Autoconsommation et
Patate ≤1/4 ha EFA
2ieme campagne vente
Tomate * Vente exclusivement
Périphérie des cours * OP dans les OP
Pastèques ≈ 1 ha
d'eau * EFA *Autoconsommation et
Gombo vente pour les EFA
En savane et début
Igname
de cycle
Autoconsommation et
≤1/4 ha EFA
Concombre vente
En forêt mixte et en
début de cycle
Pomme de terre
Exemple : Système de culture mixte dans le département de la Lékié
Spéculation Localisation Surface Exploitant Objectifs
Manioc x arachides
Manioc x igname
Manioc x arachide x maïs x
gombo
Manioc x arachide x maïs x
sésame Localisés en
zone de forêt
Maïs x Manioc ≤ 1 ha EFA Autoconsommation
mixte et en
et vente
savane
Manioc x arachide
Maïs x arachide
Basilic x gombo
Plantain x Piment
Gombo x Folon x kelen-kelen
19
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
1.2.2. Système d’élevage
Un système d’élevage peut être défini comme l’ensemble des techniques et des pratiques
mises en œuvre par une communauté pour faire exploiter des ressources végétales par
des animaux dans un espace donné, en tenant compte de ses objectifs et de ses
contraintes. La caractérisation d’un système d’élevage passe alors par celle de trois pôles
constitutifs et de leurs relations : l’éleveur, le troupeau et le territoire.
20
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Exemple : Système d’élevage dans le département de la Lékié
ESPECES LOCALISATION/PRATIQUES CHEPTEL EXPLOITANT OBJECTIFS
Elevage du gros bétail
Ici, on rencontre:
- La transhumance qui est surtout pratiquée, en zone de savane
* Vente
arborescente ;
à Obala
Bovins ≈ 195 têtes EFA
- La stabulation contrôlée dans l'Arrondissement d'Elig-Mfomo.
*Autoconso
Le suivi sanitaire ici est approximatif avec une alimentation mmation
essentiellement fourragère et la main d’œuvre est permanente et
constitué des Mbororos.
Elevage du petit bétail
Elevage rencontré beaucoup plus en savane, il est de type mixte et
est pratiqué en majorité par les musulmans de manière contrôlée (à
la corde). * OP Autoconsom
Ovins ≈ 3 570 têtes
* EFA mation et
Le suivi sanitaire est aussi approximatif, avec une alimentation à base vente
du fourrage et la main d’œuvre permanente exclusivement familiale.
21
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
De type traditionnel et, amélioré par l'appui de l’organisme HEIFER,
l’élevage des caprins est beaucoup plus pratiqué par les autochtones.
Il est de type mixte (naisseur et engraisseur) et est rencontré presque
* OP Autoconsom
Caprins dans tout le Département surtout en zone de forêt. Les animaux sont ≈ 9 500 têtes
* EFA mation et
nourris au fourrage produit par les éleveurs et des compléments
vente
alimentaire. le suivi sanitaire est respecté. La main d’œuvre ici est
familiale
Traditionnel, semi-moderne et modernisé avec l'accompagnement
du Programme de Développement de la Filière Porcine et le PACA,
l’élevage porcin ici est de type naisseur, engraisseur et mixte. Ayant
une forte signification dans les mœurs de la localité, Il est rencontré
en zone d'habitation et pratiqué par près de 55% de la population.
L’alimentation est :
- Locale (animal en divagation se débrouille tous seul sans suivi
* OP Autoconsom
Porcins sanitaire) pendant l’intersaison des cultures ; ≈ 11 500 têtes
* EFA mation et
- Intermédiaire (dans, les loges en matériaux provisoires les animaux vente
sont nourris avec les restes de cuisine, la main d’œuvre est familiale
et les soins vétérinaires sont presqu’inexistants) ;
- Moderne (dans des bâtiments en matériaux définitifs, les animaux
sont nourris à base de l’aliment complet avec des apports
spécifiques. Il y a un programme de production et de prophylaxie. La
main d’œuvre est permanente)
22
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Volaille
De type mixte, il est fait en divagation et est rencontré en zone
Autoconsom
Poulets d'habitation. Les animaux se nourrissent tout seul et il n’existe aucun * OP
≈ 55 000 têtes mation et
traditionnels programme prophylactique. Cet élevage est pratiqué par plus de * EFA
vente
65% de la population
Elevage semi-moderne et moderne, uniquement engraisseur,
l’alimentation (eau de boisson et aliment servis automatiquement) est
Autoconsom
Poulets de contrôlée et on a un suivi sanitaire. Ici, on utilise des races produites ≈ 98 500 * OP
mation et
chair au Cameroun et à l’étranger. Il est rencontré un peu partout dans le têtes/bandes * EFA
vente
Département et pratiqué par environ 60% de la population. La main
d’œuvre est familiale et permanente.
Elevage moderne exclusivement pour la production des œufs de ≈ 8 500 têtes pour
Ponte table, utilisation de la MO salariale, pas fortement représenté mais une production ≈ Vente
* EFA
fait de façon intensive 233 000 œufs/mois
≈ 63 000 têtes, pour
Elevage moderne exclusivement pour la production massive des une production de
Production des
poussins d'un jour avec, utilisation de la MO salariale, des 590 000 œufs et 580
poussins d'un Vente
équipements modernes et des souches améliorées, pas fortement 000 poussins d'un * EFA
jour
représenté mais fait de façon intensive jour
trimestriellement
Productions halieutiques
23
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Elevage traditionnel, semi-moderne et moderne en cage en eau
profonde (appui des Japonais) Les espèces: clarias, le silure, le on peut avoir ≈ 450 Autoconsom
poisson vipère, le Kanga, le tilapia, en grande partie il s'agit des étangs actifs d'une * OP
Pisciculture mation et
étangs de grossissement en série (traditionnel) puis en dérivation moyenne d'environ * EFA
vente
avec fertilisation et, une MO temporaire et salariale 250 m² chacun
Traditionnelle et semi moderne avec l'utilisation des embarcations
Capture motorisées. Les espèces : les poissons vipères, les crevettes, les carpes, * OP Autoconsom
(pêche) les reptiles (serpents). Pratiquée à 75% par les étrangers (Niger) sur * EFA mation et
la Sanaga. vente
Elevage non conventionnel
Elevage semi moderne avec l'appui du PAPENOC/MINEPIA. Dans
Avec 04 unités de
les bâtiments construits en matériaux définitifs, les animaux sont
production, on * OP Autoconsom
Aulacodes nourris avec un suivi en santé. La MO est familiale. Cet élevage est
décompte environ * EFA mation et
pratiqué à faible pourcentage et est de type mixte (naisseur et
197 animaux vente
engraisseur). Environ 02% de la population.
Avec 08 unités de
production, on
Elevage essentiellement traditionnel pour grossissement d'une * OP Autoconsom
Escargots décompte environ
façon contrôlée. une MO familiale * EFA mation et
2 500 escargots par
vente
unité
24
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Avec 20 ruchets
pour 145 ruches,
Elevage essentiellement traditionnel pour la production du miel et nous avons une * OP Autoconsom
Apiculture
les sous-produits. une MO familiale. production totale * EFA mation et
d'environ 350 litres vente
par trimestre.
25
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
1.3. Les Objectifs d’une EAP
Une EAP peut avoir les objectifs suivants :
L’organisation de la production (appui TK), production en commun pour
les GIC (champs collectif, bâtiment d’élevage collectif)
Le financement de la production (prêt campagne)
La collecte, le stockage
La transformation
La commercialisation des produits
L’approvisionnement en intrants, matériel et équipement
La production d’intrants (semences, plants, poussins, alevins...) au profit
des tiers
En somme, voilà le fonctionnement d’une Exploitation
26
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Chapitre II. Éléments de diagnostic d’une EAP
Qu’est-ce qu’un diagnostic
« Identification d’une maladie par ses symptômes »
• Définition : « C’est un jugement porté dans un temps court sur une
situation en vue de guider l’action ».
• Le diagnostic c’est donc :
Un processus d’évaluation de la situation actuelle d’un territoire,
d’une OPA, d’un GP, d’une EFA, ...
Des méthodes et des outils spécifiques pour conduire le recueil et
l’analyse des informations (« L’étoile du conseil »)
2.1. L’analyse systémique d’une EAP
« L’approche systémique vise l’analyse des relations, la mise en évidence des niveaux
d’organisation, grâce à l’éclairage multidisciplinaire dépassant la spécialisation des
sciences et le cloisonnement des savoirs » (INRA-SAD, 1980).
Ou encore qui cherche à mettre en évidence les inter-dépendances entre les différentes
activités menées au sein d’une société et au sein même d’une exploitation agricole.
Approche analytique Approche systémique
- Isole, se concentre sur les éléments - S’intéresse aux interactions entre
éléments
- S’intéresse aux détails - S’appuie sur la perception globale
- Modifie une variable à la fois - Modifie des groupes de variables à la
fois
- Conduit à un enseignement par - Conduit à un enseignement
discipline pluridisciplinaire
La démarche du diagnostic
27
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
2.1.1. Le diagnostic : méthode
Comment faire un diagnostic ?
1. Cadrer les finalités
Pourquoi réaliser un diagnostic ? Sur quoi va porter le diagnostic ? Avec qui mener le
diagnostic ?
Valider les objectifs du diagnostic en lien avec les attentes des bénéficiaires
2. Collecter l’information
Quelle(s) méthode(s) employer ?
Documents internes, observations, enquêtes, sondages, entretiens, réunions.
3. Traiter et analyser l’information
Repérer les symptômes (partie visible de l’iceberg)
Identifier le/les problème(s)
Rechercher les causes réelles du problème
(partie invisible de l’iceberg)
Identifier / proposer des pistes de solutions
4. Restituer et partager les conclusions du diagnostic
5. Rechercher/valider les solutions, les options qui vont guider les choix et la décision
2.1.2. Les pièges du diagnostic
Quelques pièges à éviter …
- Le demandeur qui ne dit pas tout ;
- Le demandeur qui a une vision trop générale ou au contraire trop restrictive du
problème ;
- Le demandeur qui a d’emblée les solutions ;
- Le demandeur dont les attentes varient au cours du diagnostic.
28
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
2.1.3. Une démarche : l’approche globale
1. Le système de décision /cadre de références
Ce que vous voulez
2. L’entreprise (diagnostic interne)
Ce que vous pouvez
3. L’environnement ou territoire (diagnostic externe)
Ce que l’environnement veut
4. Le plan de développement
Ce que vous projetez
2.1.4. Diagnostic INTERNE (couleur marron)
1- Les moyens de production
Main d'œuvre
Nature de la main d’œuvre (familiale, salariée, temporaire)
Nombre / qualification
Organisation du travail / Qui fait quoi?
29
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Difficultés liées à la MO à l’organisation du travail
Autres moyens de production
Terres : surfaces, localisation, mode de faire valoir)
Infrastructures, équipements, matériel
Cheptel (animaux de trait, animaux de production)
Etat des équipements / Utilité / Adaptation
Difficultés et besoins exprimés
Principales difficultés rencontrées dans la mobilisation des moyens de production
(accès au foncier, au crédit, ressources mobilisées pour l’entretien, le
renouvellement)
Dispositions prises pour lever ces difficultés
Risques exprimés (aléas climatiques, marché, prix…)
2- Les performances technico-économiques
Productions / Services
Nature des productions, des services
Quantité, qualité
Techniques de production / savoir-faire
Stratégie de sécurisation des approvisionnements
Stratégie de commercialisation
Difficultés rencontrées
Résultats technico-économique
Quantités produites / rendements
Outils de gestion utilisés / indicateurs
30
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Marges brutes dégagées / Calcul du coût de revient
Coûts de production (charges)
3- La situation financière
Comment perçoit-il sa situation financière actuelle ?
Quels sont les outils de suivi et de prévision mis en place ?
Quels sont les besoins de financement de la campagne ?
Comment les investissements sont-ils financés?
Quelles sont ses relations avec les banques ?
Quels sont ses projets d’investissement (modernisation, développement)?
Quelle est la situation financière actuelle de l’entreprise?
Bilan (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, endettement)
2.1.5. Diagnostic EXTERNE (couleur bleue)
L’environnement = territoire, département, région, ...
1- Les politiques publiques, la réglementation
« On cherche à identifier les liens entre les activités de l’entreprise et son environnement
politique et économique (cadre incitatif et obligations réglementaires)
Obligations statutaires (PV AG, bilans…)
Réglementation des marchés (normes, qualité)
Règlementation en matière environnementale
Politiques incitatives (aides à l’investissement, subventions)
Fiscalité, taxes…
2- Le milieu local, le territoire
Infrastructures et ressources locales
31
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Infrastructures et voies de communication
Ressources du territoire (terres, eau, main d’œuvre, électricité …)
Services d’appui technique, services financiers
Structures d’approvisionnement, marchés
Programmes, projets de développement
Relations de l’entreprise avec son environnement
Relations avec les services étatiques, les ONG, les projets, programmes de
développement
Relations avec les banques, les structures d’approvisionnement
Partenaires/ Alliances
Types de partenaires, nature des alliances entre entreprises, autres?
Atouts (avantages tirés ou attendus) / contraintes
Evolution des partenariats
3 - Le marché, les filières, la commercialisation :
Le Marché :
Destination des produits, des services
Sécurisation des débouchés, circuits de commercialisation
Fixation des prix
Evolution des marchés, des filières (perceptions)
Difficultés rencontrées
Stratégie mise en œuvre
La connaissance des clients
32
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Nature et importance des clients
Comportement des clients / exigences (quantité, qualité)
Contrats passés avec les clients
Les actions commerciales
Actions commerciales mises en œuvre
Suivi des actions commerciales / indicateurs?
La Communication
Actions de communication mises en œuvre
La Concurrence
Principaux concurrents
Forces et faiblesses de la concurrence
2.2. L’analyse SWOT
L'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou AFOM (Atouts
– Faiblesses – Opportunités – Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il combine
l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d’une entreprise, d’un secteur, etc.
avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la
définition d'une stratégie de développement.
Le but de l’analyse est de prendre en compte dans la stratégie, à la fois les facteurs
internes et externes, en maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en
minimisant les effets des faiblesses et des menaces. La plupart du temps cette analyse est
conduite sous la forme de réunions rassemblant des personnes concernées par la stratégie
ou des experts.
2.2.1. Comment identifier et étudier les 4 facteurs ?
L'ordre et la manière d'identifier et d'étudier les 4 facteurs (forces, faiblesses,
opportunités, menaces) peuvent différer considérablement.
33
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Etude des forces
Les forces sont les aspects positifs internes que contrôle l'organisation ou le pays, et sur
lesquels on peut bâtir dans le futur.
Etude des faiblesses
Par opposition aux forces, les faiblesses sont les aspects négatifs internes mais qui sont
également contrôlés par l'organisation, et pour lesquels des marges d'amélioration
importantes existent. L'analyse SWOT étant basée sur le jugement des participants, elle
est par nature subjective et qualitative. Si l’étude des forces et celle des faiblesses
nécessitent d’être approfondies, deux outils peuvent être utilisés pour fournir des pistes
d’investigation : l’audit des ressources et l’analyse des meilleures pratiques (comparaison
à l’intérieur d’un pays entre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien suivant
certains indicateurs)
Etude des opportunités
Les opportunités sont les possibilités extérieures positives, dont on peut éventuellement
tirer parti, dans le contexte des forces et des faiblesses actuelles. Elles se développent hors
du champ d'influence du pays ou à la marge (ex : changement de goût des
consommateurs mondiaux concernant une production du pays, amélioration de
l'économie d'un pays "client", développement du commerce par Internet, etc.)
Etude des menaces
Les menaces sont les problèmes, obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent
empêcher ou limiter le développement du pays ou d'un secteur (ex : l'industrie). Elles
sont souvent hors du champ d'influence du pays ou à la marge (ex : désaffection des
consommateurs pour un produit important du pays, prix de l'énergie en forte
augmentation, baisse généralisée de l'aide au développement, etc.).
Opportunités et menaces se développent hors du champ d’influence de l’entreprise mais
influent sur ses choix
2.3. La caractérisation d’une EAP
Caractériser la situation initiale, c’est prendre « la photo de départ » de l’entreprise qui
permettra de mesurer les évolutions et changements intervenus en la comparant à une
situation ultérieure (Fiche de suivi ou d’évolution).
34
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
La caractérisation de la situation initiale ne donne qu’une vision statique de la situation
de l’entreprise à un moment donné.
Elle se différencie diagnostic qui donne une vision dynamique du fonctionnement de
l’entreprise pour identifier les problèmes à résoudre et rechercher les solutions à mettre
en œuvre.
35
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Chapitre III. La prise de décision et le chef d’exploitation(Manager)
La prise de décision est l’acte le plus important qu’un individu puisse prendre, dans le
temps et dans l’espace, quelle que soit la position sociale ou hiérarchique qu’il occupe
dans la société.
Au sein de l’entreprise, la prise de décision revêt une dimension encore plus importante
puisqu’elle se repose essentiellement sur les informations détenues par les dirigeants qui
leur permettent de prendre des décisions en adéquation avec les objectifs escomptés.
Chaque jour, le chef d’exploitation très occupé, doit analyser de nombreuses situations
et prendre plusieurs décisions plus ou moins importantes.
3.1. Le management d’une entreprise
La première question qui vient à l'esprit est :"Qu'est-ce que le management d'entreprise
?".Si on veut donner une définition, c'est une science dont l'ensemble des lois qu'elle
comporte permettent d'optimiser le rendement d'une entreprise. Le management
d'entreprise permet avant tout d'organiser les personnes. Les employés sont le cœur
d'une société, si ces employés ne sont pas gérés correctement, la société peut aller en avant
de problèmes plus ou moins sérieux. L'organisation des personnes est une chose très
importante et il en est de même pour l'organisation du travail. La mise en place de
procédures de fonctionnement est indispensable car elle permet aux employés d'avoir
constamment la maîtrise de ce qu'ils font. Lorsqu'on le prend dans sa globalité, le
management d'entreprise permet de perfectionner les méthodes de travail donc
d'améliorer le rendement de la société et donc d'augmenter son chiffre d'affaire.
3.1.1 Le Bon Manager
On peut distinguer globalement deux approches, deux définitions du "bon" manager.
La première, plutôt académique, met en avant la maîtrise intellectuelle des domaines-
clés de la gestion, comme la finance, le marketing, et le contrôle de gestion. Cette
définition rejoint le credo des écoles de management et des doctes revues de business
administration qui en sont le prolongement.
La deuxième approche est plutôt tournée vers les qualités personnelles du manager.
Le management de l’entreprise étant avant tout le management des hommes, le "bon"
manager doit être un individu à forte personnalité, charismatique et doué pour la
36
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
communication. Sans être inexactes, ces approches ne sont pas vraiment satisfaisantes,
comme chacun peut le constater.
3.1.2. Les qualités d’un bon entrepreneur
Existe-t-il un profil du créateur d'entreprise ? Pas vraiment, selon Patrick Jolly, co-
fondateur de particulier à particulier. Il affirme cependant que tous les chefs d'entreprises
qui se sont lancés dans l'aventure possèdent un certain nombre de qualités plus ou moins
affirmées, mais indispensables pour réussir. Inventaire de ce qui fait la différence à
savoir :
- La faculté d'adaptation
- Le goût du risque
- Le pragmatisme
- Une forte personnalité
- L'amour de l'argent
- Une imagination fertile
- La diplomatie : la qualité du repreneur
3.2. La prise de décision et impact technico-économique
La notion de décision a évolué dans le temps au fur et à mesure que ce sont transformées
et complexées les procédures de prise de décision Au sens classique du terme, on
assimile la décision à l’acte par lequel un individu (disposant du pouvoir de décider)
prend les mesures favorisant la création et la répartition des richesses dans une entreprise
en s’appuyant sur un certain nombre d’informations à sa disposition sur le marché.
On distingue traditionnellement trois grands types de décisions qui doivent être prises
dans une entreprise à savoir :
- les décisions stratégiques qui engagent l’entreprise sur une longue période puisqu’ elles
conditionnent la manière dont l’entreprise va se positionner sur un marché de manière à
retirer le maximum de profit des ressources qu’elle mobilise.
- les décisions administratives ou tactiques qui doivent permettre de définir comment les
ressources de l’entreprise doivent être utilisées pour réaliser les objectifs définis dans le
37
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
cadre des décisions stratégiques. Il s’agit alors d’organiser la collecte et l’affectation des
ressources matérielles, humaines et technologiques au sein de l’entreprise.
- les décisions opérationnelles qui s’appliquent au niveau de la gestion courante de
l’entreprise et concerne l’utilisation optimale des ressources allouées dans le cadre du
processus productif de l’entreprise (gestion de stocks, gestion de la production…).
Tous ces types de décision ont des caractéristiques qui conditionnent l’élaboration des
processus internes de prise de décision adaptés à l’environnement et à la conjoncture et
suivent les différentes étapes à savoir :
- l’analyse de l’objectif, première étape qui vise à définir de manière précise et formulable
l’objet de la prise de décision future (sur quoi porte la prise de décision).
- la collecte de l’information qui porte à la fois sur les facteurs externes (environnement
concurrentiel de l’entreprise) et sur les facteurs internes (inventaire des ressources
disponibles pouvant être utilisées dans le cadre de la décision prise).
- la définition des options possibles telle que l’analyse de l’information qui permet de
définir un ensemble de décisions susceptibles de fournir une réponse au problème posé.
- la comparaison et l’évaluation de ces options puisque dans le processus de décision, il
est nécessaire de pouvoir comparer les différentes options possibles ce qui nécessite bien
entendu, leur évaluation en termes de coûts et de gains probables.
3.3. La planification stratégique d’une exploitation
Pour Chandler (1962), fondateur de la stratégie d’entreprise consiste en la détermination
des buts et des objectifs à long terme d’une entreprise, l’adoption des moyens d’action et
d’allocation des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Cette définition met
l’accent sur deux éléments essentiels, les buts et les ressources, mais elle est incomplète
puisqu’elle ne comprend pas l’environnement dans lequel fonctionne l’entreprise. Or, un
des enseignements fondamentaux de l’approche systémique (global) est de situer
l’entreprise dans son environnement et de prendre en compte les interactions multiples.
La mise en œuvre d’une stratégie au sein d’une exploitation agropastorale peut se
schématiser ainsi :
38
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
3.4. Notion d’élaboration de Budget prévisionnel
Pour un agent économique (à savoir un individu, un ménage, une association, une
entreprise, un État...) ou une entité (à savoir un équipement, un service, un établissement,
un projet, une mission, une fonction...) le budget est un document récapitulatif des
recettes et des dépenses prévisionnelles déterminées et chiffrées pour un exercice
comptable à venir (généralement l'année).
Cependant, la gestion financière est le domaine qui pose le plus de problèmes aux petits
entrepreneurs. Pour que l’entreprise soit rentable et prospère, il est essentiel que le
propriétaire ou le gérant ait une idée précise de l’argent qui entre dans l’entreprise, de
l’endroit où cet argent est employé à tout moment et de l’argent qui sort.
Un budget de trésorerie prévisionnel représente la liquidité dans le futur de l’entreprise. Et
la liquidité est l’ensemble des ressources financières que j’ai sur mon compte en banque et dans
ma caisse.
Elle évolue en fonction des recettes que j’encaisse et des dépenses que j’effectue. Le suivi
des dépenses et des recettes donne mon solde de trésorerie.
Un budget « publique » s’équilibre toujours en dépenses et en recettes.
39
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
3.4.1. Quelques notions de budget
Vente :
Elle résulte du contrat entre deux personnes par lequel un bien (ou un service) est cédé
moyennant un prix. L'encaissement peut se faire au moment du contrat (paiement au
comptant) ou plus tard (paiement à terme).
Recette :
Entrée effective d’argent sur le compte bancaire ou en caisse consécutive à la vente de
biens et services, à l’encaissement de créances, à la réalisation d’emprunts, à des apports
faits par les associés, à la perception de subventions.
Achat :
Les biens et les services acquis par l’entreprise durant l'exercice.
Dépense :
Achats ou opérations pour lesquels il y eu une sortie effective d'argent correspondant :
à des achats de biens (approvisionnements, animaux, marchandises, ...) ;
à l’utilisation de services (location, transport...) ;
au remboursement de dettes ;
au paiement des investissements ;
aux prélèvements effectués par l’exploitant et sa famille ;
au paiement de cotisations, …
Exemple de Budget prévisionnel de mise sur pieds d’un poulailler :
Dépenses Montant Recettes Montant
Achat poussins 80 000 FCFA Ventes poulets 200 000 FCFA
Achat aliments 150 000 FCFA Ventes fientes 55 000 FCFA
Achat mangeoires 10 000 FCFA
Achat abreuvoirs 10 000 FCFA
Achat produits 5 000 FCFA
Vétérinaires
TOTAL 255 000 FCFA 255 000 FCFA
40
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
Chapitre IV. Elaboration d’un Projet
Il est possible de chercher à s'assurer qu'il sera donné toutes les armes pour réussir un
projet. Il est possible de réaliser une gestion de projet.
Un projet peut être régulé par un plan de développement ou planifié, ce qui cloisonne sa
progression par des contraintes, en le limitant à des objectifs et des paramètres
déterminés. La planification, l'exécution et le contrôle de projets de grande envergure
demandent parfois la mise en place d'une organisation temporaire, qui consiste en une
équipe de projet et une ou plusieurs équipes de travail. Un projet nécessite le plus souvent
des ressources humaines (ex: spécialiste aérodynamique), matérielles (ex: machine-outil),
logicielles (ex: progiciel de modélisation géométrique) et financières.
4.1. Définition d’un Projet
Le terme Projet est polysémique, il est défini en fonction du contexte qui l’évoque.
On appelle projet un ensemble finalisé d’activités et d’actions entreprises dans le but de
répondre à un besoin défini dans des délais fixés et dans la limite d'une enveloppe
budgétaire allouée.
Selon l’Agence Française des Normes ,le projet est un processus unique qui consiste en
un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de
fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques,
incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources. »Sous la norme X50-105.
Mais aussi le projet peut être défini comme est un ensemble d'actions à réaliser avec des
ressources données, pour satisfaire un objectif défini, dans le cadre d'une mission précise,
et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un début, mais aussi une
fin.
Un projet devrait toujours venir combler un ou plusieurs besoins, et ces besoins peuvent
être :
- des besoins exprimés (ce que le bénéficiaire dit) ;
- des besoins réels (ce qu’il veut dire) ;
- des besoins latents (ce à quoi il ne pense pas) ;
- des besoins rêvés (ce dont il rêverait) ;
- des besoins profonds (ce qui le motive concrètement)
41
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
4.2. Etude de faisabilité
L’étude de faisabilité essentiellement à répondre à une série de question à travers la
méthode Q Q O Q C C P(Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?)
1) Disposer de tous les éléments pour opérationnaliser une décision et donc rédiger un
plan d’actions
2) Ou bien cerner complètement un problème en répondant de manière complète aux
principales questions qui se posent car un problème bien posé est à moitié résolu)
En quoi consiste votre projet ?
• Quoi ? La nature du projet, quels investissements, quelles activités, …
• Qui ? Les acteurs et partenaires du projet
• Où ? Le lieu du projet
• Quand ? A quel moment ou quelle période, quelle durée, quelle fréquence
• Comment ? Sous quelle forme, quels moyens, quelle organisation, à quel
rythme
• Combien ? Le dimensionnement physique du projet, investissement, les
chiffres clés, ...
• Pourquoi ? Les objectifs qualitatifs et quantitatifs, les résultats attendus (au
niveau de l’entreprise)
De manière schématique, voilà e qu’on appelle une étude de faisabilité.
42
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
43
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Notes de Cours du Module : Pilotage d’une Exploitation
4.3. Différentes partie de rédaction d’un projet
Un document de rédaction d’un projet d’entreprise ou développement d’activité devrait
avoir les principales parties suivantes :
1- Titre du projet
2- Contexte
3- Bénéficiaires
4- Objectifs
5- Activités et chronogrammes d’activités
6- Analyse économique et financière (budget de trésorerie prévisionnel)
7- Plan de financement
8- Suivi et évaluation (Cadre logique)
4.4. Programmation et suivi (notion d’indicateurs)
Tout programme devrait contenir des objectifs précis, réalistes, atteignables et
mesurables. Les objectifs sont définis en examinant les données recueillies dans
l’évaluation de la situation. Le groupe de rédaction doit analyser cette information afin
de cerner les problèmes à régler dans le programme. Dans la recherche de solutions
appropriées aux problèmes, le groupe de travail devrait suivre une « approche
systémique ». Autrement dit, une approche qui considère le système comme un tout et
qui vise à repérer les interventions possibles.
Une programmation peut être fait sur un an (découpée en 12 mois) ou sur un mois et
découpée en semaine. Les programme doit prévoir les indicateur de suivi, le
chronogramme exact et éventuellement les responsables concernés par chaque activité.
Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide au suivi des activités (pilotage,
ajustements et rétro-correction) grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une
tendance, de façon relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou
l'espace
44
Pilotage d’une Exploitation, Avril 2016, Par M.Eloundou Etoundi Christian
Vous aimerez peut-être aussi
- Developper Une Activite de Valorisation de Legumes Et Petits Fruits en Circuit Court-Ilovepdf-Compressed 1Document24 pagesDevelopper Une Activite de Valorisation de Legumes Et Petits Fruits en Circuit Court-Ilovepdf-Compressed 1Mike MetzPas encore d'évaluation
- Etude Sur Lamelioration de Laviculture VDocument46 pagesEtude Sur Lamelioration de Laviculture VElder Lauchée SiefouPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Final Combo JacquesDocument30 pagesRapport de Stage Final Combo JacquesJackson KomboPas encore d'évaluation
- Feuillet 30110 PorcDocument15 pagesFeuillet 30110 PorcDestin SoussaPas encore d'évaluation
- Projet Produit Farine Groupe 1 FinalDocument53 pagesProjet Produit Farine Groupe 1 Finaldv2k6tw54vPas encore d'évaluation
- Fermes Natangue 220814 1 PDFDocument9 pagesFermes Natangue 220814 1 PDFMozeusMbayePas encore d'évaluation
- Projet D - Elevage de 500 Poules Pondeuses - PDF - Poulet - Œuf (Aliment)Document25 pagesProjet D - Elevage de 500 Poules Pondeuses - PDF - Poulet - Œuf (Aliment)DOSSOPas encore d'évaluation
- Cs Management Guide Novogen Brown Classic FR 074899200 1639 29062017 PDFDocument39 pagesCs Management Guide Novogen Brown Classic FR 074899200 1639 29062017 PDFAli Touatit100% (1)
- Formulation Aliment VolailleDocument9 pagesFormulation Aliment VolailleOscar BadobréPas encore d'évaluation
- CameroonDocument109 pagesCameroonRomaric Sougla100% (2)
- Projet AvicultureDocument20 pagesProjet AvicultureHenoc Falec100% (1)
- Fiche de Projet Sur La Chaine de Valeur Manioc: CabinetDocument3 pagesFiche de Projet Sur La Chaine de Valeur Manioc: CabinetThibault EZIANPas encore d'évaluation
- Poulailler YvesDocument1 pagePoulailler YvesLudovic NtomPas encore d'évaluation
- Projet PouletDocument5 pagesProjet PouletInnocent koffiPas encore d'évaluation
- Pprojet de Production de 3000 KG de Viande Par SemaineDocument7 pagesPprojet de Production de 3000 KG de Viande Par SemaineOtretemba Jean AISSAHPas encore d'évaluation
- BP Entrepreneurs Et VPC Vide (1) - 1Document15 pagesBP Entrepreneurs Et VPC Vide (1) - 1Benjamin Nomo100% (2)
- Cobb MV Male Management Supplement FrenchDocument28 pagesCobb MV Male Management Supplement Frenchassoumoudenis42Pas encore d'évaluation
- Guide Repro JVDocument43 pagesGuide Repro JVAnamaria PetreanPas encore d'évaluation
- Guide D'entretienDocument17 pagesGuide D'entretienlebon katentulaPas encore d'évaluation
- Andrianajainatc Ges m1 06Document120 pagesAndrianajainatc Ges m1 06cabinetpolygroupPas encore d'évaluation
- AlimentationDocument24 pagesAlimentationtenelus0% (1)
- Randrianaivoniainah Ges m1 05Document91 pagesRandrianaivoniainah Ges m1 05MIM StartUpPas encore d'évaluation
- Projet Lap Final 1Document22 pagesProjet Lap Final 1yasso Ngoundam 4Pas encore d'évaluation
- Micro Corrige 1Document76 pagesMicro Corrige 1Moubarak alani OladimedjiPas encore d'évaluation
- Mise en Place D'une Application Web de Gestion de Cours Dans Une Faculté Universitaire Cas de La Faculté de Sciences AppliquéesDocument73 pagesMise en Place D'une Application Web de Gestion de Cours Dans Une Faculté Universitaire Cas de La Faculté de Sciences AppliquéesOscar KngPas encore d'évaluation
- Support de CoursDocument97 pagesSupport de CoursomafannPas encore d'évaluation
- Broiler Management Guide FrenchDocument112 pagesBroiler Management Guide Frenchmehdi ali100% (1)
- MemoirDocument48 pagesMemoirBrice Chabi KinaPas encore d'évaluation
- Bovins Viande Lait SIMAGRI PDFDocument26 pagesBovins Viande Lait SIMAGRI PDFsaidou sannaPas encore d'évaluation
- COQUELETS - PDF - Alimentation Animale - MaïsDocument13 pagesCOQUELETS - PDF - Alimentation Animale - MaïsBayo SidikiPas encore d'évaluation
- AA BroilerHandbook2018 FR PDFDocument162 pagesAA BroilerHandbook2018 FR PDFTõ Gōd Lamberto BäwsPas encore d'évaluation
- Plan D Affaires Agricole Centre de Collecte de LaitDocument8 pagesPlan D Affaires Agricole Centre de Collecte de LaitSticle Artizanale100% (1)
- Rap FoReVA Riz Janvier 2013Document42 pagesRap FoReVA Riz Janvier 2013AMOUSSOU CédricPas encore d'évaluation
- Projet Viande Lait Ditinn FamoilaDocument35 pagesProjet Viande Lait Ditinn FamoilaSouleymane CamaraPas encore d'évaluation
- RAPORT SamassekouDocument54 pagesRAPORT SamassekouSamassekou Abdoul kassim100% (1)
- Couverture 1Document16 pagesCouverture 1Ranto Andriampenitra RasoamanambolaPas encore d'évaluation
- Brochure SPACE 2023 Vsite WebDocument28 pagesBrochure SPACE 2023 Vsite WebMAURICE100% (1)
- 3 - Formuler Aliment VolaillesDocument1 page3 - Formuler Aliment VolaillesGuy laroche KamdemPas encore d'évaluation
- Fabrication Artisanale de Provende ARTISANALDocument6 pagesFabrication Artisanale de Provende ARTISANALJunior N'guessan N'guessanPas encore d'évaluation
- L'aviculture en Republique Du Cameroun - TheseDocument202 pagesL'aviculture en Republique Du Cameroun - TheseCollins DjikePas encore d'évaluation
- Guide D'élevage Semi-Intensif de Poulets de ChairDocument69 pagesGuide D'élevage Semi-Intensif de Poulets de ChairDahirou100% (1)
- Agrotourisme Et Le Developpement TouristiqueDocument112 pagesAgrotourisme Et Le Developpement Touristiquerodrigue ntiboneraPas encore d'évaluation
- Prix Batiments Equipements Avicoles Cunicoles ReferentielDocument48 pagesPrix Batiments Equipements Avicoles Cunicoles ReferentielTek TarekPas encore d'évaluation
- Plan AB241Document12 pagesPlan AB241loïc MoulakaPas encore d'évaluation
- Rapport Activites 2021Document9 pagesRapport Activites 2021Jonas Mbome NguitePas encore d'évaluation
- Elevage AulacodeDocument123 pagesElevage AulacodebabiPas encore d'évaluation
- 2017 Ny AinaDocument25 pages2017 Ny AinaRicka AndrianPas encore d'évaluation
- FICHE DE PROPHYLAXIE-convertiDocument5 pagesFICHE DE PROPHYLAXIE-convertiDimitri KLOMEGAPas encore d'évaluation
- Soycam Business Plan PDFDocument18 pagesSoycam Business Plan PDFSoulé MfomegnamPas encore d'évaluation
- Rapport de Fin de Cycle de Camara Et Sacko Rev BMDocument39 pagesRapport de Fin de Cycle de Camara Et Sacko Rev BMboubacar maigaPas encore d'évaluation
- Bovins Viande Lait Afrique. BibliograpDocument11 pagesBovins Viande Lait Afrique. Bibliograpsaidou sannaPas encore d'évaluation
- Ovin-Caprin: Djaah Kouassi GeorgesDocument51 pagesOvin-Caprin: Djaah Kouassi GeorgesTroPas encore d'évaluation
- GounouDocument58 pagesGounouFlørès NamikazePas encore d'évaluation
- GP 19 - Elevage AulacodesDocument139 pagesGP 19 - Elevage AulacodesAmos YepikePas encore d'évaluation
- Memoire Corrigé SandiDocument33 pagesMemoire Corrigé SandiCornélius PanaPas encore d'évaluation
- Mission PAM: Mise en Place D'un Système de Régulation Sur Le Marché Du Riz À Madagascar (30 Mai 2005)Document68 pagesMission PAM: Mise en Place D'un Système de Régulation Sur Le Marché Du Riz À Madagascar (30 Mai 2005)HayZara MadagascarPas encore d'évaluation
- Formules Porcs Engraissement Avec Patate DouceDocument1 pageFormules Porcs Engraissement Avec Patate Doucelodibert borisPas encore d'évaluation
- Etude Cemac 2008Document272 pagesEtude Cemac 2008AHIANTAPas encore d'évaluation
- La TRANSFORMATION DU CIDRE AU QUEBEC: Perspective écosystémiqueD'EverandLa TRANSFORMATION DU CIDRE AU QUEBEC: Perspective écosystémiquePas encore d'évaluation
- L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2022: Réorienter les politiques alimentaires et agricoles pour rendre l’alimentation saine plus abordableD'EverandL’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2022: Réorienter les politiques alimentaires et agricoles pour rendre l’alimentation saine plus abordablePas encore d'évaluation
- UE-ISAGO Machinisme Agricole 1Document63 pagesUE-ISAGO Machinisme Agricole 1mbessajunior15Pas encore d'évaluation
- Quitus de Non Redevance ISAGODocument1 pageQuitus de Non Redevance ISAGOmbessajunior15Pas encore d'évaluation
- Feuille Des NotesDocument2 pagesFeuille Des Notesmbessajunior15Pas encore d'évaluation
- Isago Part I.5Document11 pagesIsago Part I.5mbessajunior15Pas encore d'évaluation
- TD Devis GoodDocument7 pagesTD Devis Goodmbessajunior15Pas encore d'évaluation