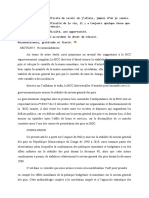Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Annale DCG 2023 Ue5 C
Annale DCG 2023 Ue5 C
Transféré par
Adissa OuattaraTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Annale DCG 2023 Ue5 C
Annale DCG 2023 Ue5 C
Transféré par
Adissa OuattaraDroits d'auteur :
Formats disponibles
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
UE 5 – ÉCONOMIE CONTEMPORAINE
SESSION 2023
Éléments indicatifs de corrigé
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 1 / 11
DOSSIER 1 – ANALYSE D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE
1) Mettre en évidence les mécanismes qui ont induit une hausse générale des prix
en France ces dernières années.
Il est attendu une réponse structurée de la part du candidat comprenant les éléments suivants :
- Une référence aux documents mobilisés pour répondre à la question (les documents 1, 2,
3, 4)
- Une définition économique d’un prix ou de la notion d’inflation
- Une explicitation du contexte économique des trois dernières années
- Une identification des sources (par exemple offre, demande, conjoncturelle, structurelle)
de la hausse générale des prix avec explicitation des mécanismes économiques sous-
jacents. La qualification des origines de l’inflation (inflation par les coûts, par la demande,
inflation structurelle, inflation d’origine monétaire) n’est pas attendue. Toutefois, si elle
apparaît, elle doit être valorisée.
Définition(s)
Le prix en économie est une information qui permet à chaque agent économique de faire des
arbitrages. Le prix informe sur la rareté du bien, et sur des marchés concurrentiels, il résulte de la
confrontation de l’offre et de la demande. Il est donc un signal qui permet de coordonner les
décisions des agents économiques.
L’INSEE mesure l’inflation en France, grâce à l’IPC, l’indice des prix à la consommation, en
collectant les informations sur les variations de prix des principales catégories de biens et de
services entre deux périodes, à partir d’un panier de biens de consommation.
Constat : une hausse générale des prix depuis la fin de l’année 2020
En ces temps de fortes instabilités économiques, provoquées par de récents chocs exogènes
(crise sanitaire, conflit en Ukraine), on constate une hausse de l’indice des prix à la consommation
(indice qui permet de mesurer l’inflation sur un territoire et une période donnés) depuis la fin de
l’année 2020 (cf. document 1).
L’inflation s’est accélérée en 2022 (elle passe de 3 % en janvier 2022 à 6 % environ en août 2022,
en glissement annuel, selon le graphique de l’INSEE). Plus particulièrement, les prix de l’énergie
sont à l’origine de cette hausse générale des prix avec une augmentation de 28,5 % en juillet 2022
en glissement annuel et de 22,2 % en août 2022, en glissement annuel (cf. document 1).
Mécanismes ayant conduit à cette hausse :
Cette augmentation générale des prix peut donc provenir de « déséquilibres sur les marchés des
biens et de services » (cf. document 3), découlant de chocs exogènes sur l’offre (restrictions
sanitaires, conflit géopolitique impactant la production de pétrole et de gaz de pays exportant ces
biens en Europe, cf. document 2), ou sur la demande.
Sur le marché européen de l’énergie (gaz et pétrole), le conflit entre l’Ukraine et la Russie, deux
producteurs et exportateurs d’énergie, a provoqué une baisse de l’offre d’énergie face à une
demande croissante, en pleine reprise de l’activité économique à la suite de la crise sanitaire, se
traduisant par une hausse des prix de l’énergie, et plus globalement des matières premières. Dans
de nombreux secteurs d’activité, cette hausse des coûts de l’énergie et des matières premières a
été répercutée sur le prix de vente des produits (alimentation, produits manufacturés et services, cf.
document 1).
Côté demande, la forte reprise de la consommation, après les périodes de restrictions dues à la
crise sanitaire, s’est heurtée à une offre inélastique du fait de rupture dans les chaînes
d’approvisionnement, notamment pour les matières premières et les produits semi-finis provenant
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 2 / 11
de Chine (révélant des déséquilibres structurels sur des produits stratégiques, comme les semi-
conducteurs).
Enfin, l’augmentation générale des prix peut avoir une origine monétaire. En effet, depuis la crise
des subprimes de 2008, les Banques centrales occidentales ont mis en œuvre des politiques
monétaires non conventionnelles (Quantitative Easing), augmentant la masse monétaire en
circulation dans les économies (document 4) par crainte de la déflation. Aujourd’hui, une partie de
l’inflation constatée aux Etats-Unis ou dans la zone euro peut être attribuée à cette dimension
monétaire.
Pour conclure, l’augmentation générale des prix constatée en France peut avoir différentes sources
découlant de déséquilibres sur les marchés et de phénomènes monétaires. Le prix étant une
variable essentielle dans les décisions économiques des agents, cela justifie les mesures prises par
les pouvoirs publics pour garantir un retour à la stabilité des prix.
2) Analyser les mesures monétaires mises en place par la BCE pour garantir la
stabilité des prix depuis 2017.
Il est attendu une réponse structurée de la part du candidat comprenant les éléments suivants :
- Une référence aux documents mobilisés pour répondre à la question (les documents 1, 3,
4, 5, 6)
- Une définition de « politique/mesure monétaire » et de la BCE (mission)
- L’identification de mesures monétaires, associées aux différents objectifs poursuivis par la
BCE depuis 2017
- Une explication des intérêts et des limites de ces mesures.
Définitions
La politique monétaire est un volet de la politique économique, comprenant un ensemble de moyens
mis en œuvre par un Etat ou une autorité monétaire pour agir sur l’activité économique par la
régulation de la masse monétaire, en circulation dans l’économie. Pour cela, différents instruments
(conventionnels/non conventionnels) peuvent être mobilisés selon les objectifs poursuivis.
Au sein de la zone euro, la Banque Centrale Européenne (BCE) a pour mission de garantir la stabilité
des prix, avec une inflation cible de 2 %. Elle agit essentiellement par le biais de la fixation des taux
d’intérêt directeurs et l’achat d’instruments financiers.
Mesures monétaires de 2017 à 2021 :
De 2017 à 2021, la BCE a mené une politique monétaire expansive face au risque
déflationniste (l’idée est attendue mais le candidat qui n’aura pas fait mention du terme « déflation »
ne sera pas pénalisé) :
- Maintien des taux d’intérêt directeurs à des niveaux très faibles voire négatifs :
Comme on peut le voir dans le document 5, le principal taux d’intérêt directeur de la BCE
était de 0% depuis le mois de mars 2016. La politique monétaire expansive avait pour but de
faciliter l’accès au crédit pour soutenir l’économie réelle, et se justifiait par un risque
déflationniste. Les banques pouvaient alors prêter à moindre coût, l’endettement était
encouragé pour stimuler la demande globale. Cela a permis l’augmentation de la masse
monétaire puisque lorsqu’un crédit est accordé par une banque de second rang, celle-ci crée
de la monnaie ex-nihilo.
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 3 / 11
- Programme massif de rachats d’actifs
Depuis 2015, la BCE avait mis en place une politique monétaire non conventionnelle
d’assouplissement quantitatif qui visait à racheter massivement des obligations, pour
relancer l’activité économique et éviter la déflation. En contrepartie de ce financement par
la BCE, celle-ci émettait de la monnaie. Il y avait donc augmentation de la masse monétaire
à travers ce programme de rachat d’actifs. En mars 2020 avec la crise du Covid-19, la BCE
met en place le PEPP pour injecter des liquidités dans des économies confinées, subissant
un choc d’offre et de demande.
Ces mesures ont permis d’éloigner le risque déflationniste et de maintenir une relative stabilité des
prix entre 2017 et 2021 : l’inflation est comprise entre 1 % et 2 % en glissement annuel jusqu’à la
crise du Covid-19, elle est proche de 0 % jusqu’à la fin de 2020 puis augmente tout au long de
l’année 2021 dépassant la cible de 2 % durant le deuxième semestre (cf. document 1).
Elles comportent cependant certains risques : la monnaie ainsi créée est venue se placer sur les
marchés financiers et immobiliers, entraînant une augmentation du prix de ces actifs (cf. document
3) et pouvant laisser craindre la création de bulles spéculatives sur ces marchés.
Mesures monétaires depuis 2022 :
A partir de 2022, la BCE prend une série de mesures pour lutter contre l’inflation, traduisant son
basculement vers une politique monétaire de rigueur :
- Fin du programme de rachat d’actifs (document 6)
La fin de ce programme le 1er juillet 2022 marque un tournant dans la politique monétaire, le
but étant de diminuer la masse monétaire pour diminuer l’inflation, et d’envoyer un signal aux
marchés financiers (forward guidance).
- Hausse des taux d’intérêts directeurs
A partir du mois de juillet 2022, la BCE a procédé à une hausse des taux d’intérêt directeurs
pour atteindre, 3 % en février 2023, et 3,25 % début mai 2023. En augmentant les taux
d’intérêt directeurs, la BCE pousse les banques commerciales à prêter à un taux d’intérêt
plus élevé. Il y a donc un durcissement du crédit, le but étant de diminuer les crédits
nouvellement émis de façon à diminuer la masse monétaire.
Ces mesures devraient permettre de contenir les pressions inflationnistes. Toutefois, une politique
monétaire restrictive présente non seulement des risques récessifs pour l’économie d’un pays, mais
elle alourdit également le coût de l’endettement public dans une zone euro dont les divergences
monétaires et réelles entre les pays membres sont toujours persistantes.
Par ailleurs, sur des marchés financiers globalisés, l’augmentation des taux d’intérêt dans la zone
euro impacte les flux financiers et les dynamiques des prix sur le marché des changes, avec des
répercussions sur le taux de change de l’euro par rapport aux autres devises, et in fine un impact
sur les soldes des balances commerciales des pays membres de la zone. Enfin, la remontée des
taux d’intérêts directeurs impacte le système bancaire et la situation financière de certaines banques
(par exemple, la SVB) via la valorisation des obligations détenues dans le portefeuille des banques
(phénomène de krach silencieux).
Pour conclure, la BCE est passée d’une politique monétaire expansionniste de 2017 à 2022 à une
politique monétaire de rigueur depuis juin 2022. Cette dernière, qui a pour but de faire face aux
tensions inflationnistes, comporte cependant certains risques.
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 4 / 11
3) Analyser les mesures budgétaires prises par les pouvoirs publics pour faire
face à la hausse générale des prix.
Il est attendu une réponse structurée de la part du candidat comprenant les éléments suivants
- Une référence aux documents mobilisés pour répondre à la question (les documents 7, 8,
9),
- Une définition de « politique/mesure budgétaire »,
- Une identification du type de politique économique mis en œuvre (politique de soutien à
la demande / politique de redistribution),
- L’identification de plusieurs mesures budgétaires, des objectifs poursuivis ainsi que
l’explication de leurs intérêts et de leurs limites.
Définition(s)
La politique budgétaire est définie comme toute action de l’Etat qui vise à utiliser son budget
(dépenses et recettes) afin d’atteindre des objectifs économiques, définis dans le Carré Magique de
Nicholas KALDOR :
- Croissance économique
- Plein emploi
- Stabilité des prix
- Excédent de la balance commerciale
La politique budgétaire peut aussi être utilisée pour atteindre des objectifs sociaux (Etat-
Providence) : les politiques de redistribution regroupent l'ensemble des opérations par lesquelles les
administrations publiques modifient la répartition des revenus versés aux ménages. La fixation du
SMIC, le versement de revenus de transfert ainsi que la production de services collectifs relèvent
de ces politiques.
Les pouvoirs publics au sens large (APU centrales, collectivités territoriales et APU de sécurité
sociale)
Analyse des mesures budgétaires prises :
Objectifs
L’Etat français utilise ainsi l’outil budgétaire, notamment la dépense publique pour faire face à
l’inflation, afin de soutenir la consommation des ménages et de limiter la dégradation du pouvoir
d’achat. Par ailleurs, l’inflation a un coût social (elle peut exacerber les inégalités économiques et
sociales), que des mesures budgétaires peuvent venir limiter.
Les mesures
L’Etat a mis en place une série de mesures principalement destinées aux ménages. Ces mesures
visent à limiter la dégradation du pouvoir d’achat des ménages, qui affecterait la consommation et
in fine la reprise de l’activité économique ainsi que l’emploi. En effet, dans le document 7, on observe
une baisse du revenu disponible brut réel pour l’année 2022 et 2023, et une très faible augmentation
de la consommation des ménages pour l’année 2023 de 0,9 % (en vol.) alors qu’elle était de 2,5 %
en 2022.
Ces mesures sont les suivantes (documents 7 et 9) :
- Revalorisation des prestations sociales et de l’indice de la fonction publique, aide de
rentrée exceptionnelle (augmentation des revenus de transfert)
- Suppression de la redevance télé, réduction puis suppression en 2023 de la taxe
d’habitation sur les résidences principales, baisse de cotisation des travailleurs
indépendants en 2023 (baisse des prélèvements obligatoires)
- Bouclier tarifaire qui concerne l’électricité et le gaz
- Chèque énergie
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 5 / 11
Type de politique économique
Les mesures prises par l’Etat relèvent donc d’une politique budgétaire expansive, de relance par la
demande (KEYNES). Elles soutiennent notamment les ménages modestes (qui ont une propension
marginale à consommer forte), et devraient permettre de maintenir le taux de pauvreté à un niveau
relativement bas (7,6 % en 2020) comparé aux autres pays de l’UE. Ces mesures visent à atteindre
les objectifs économiques de l’Etat (soutien du pouvoir d’achat et in fine de la croissance) et les
objectifs sociaux (empêcher une dégradation du taux de pauvreté stabilisé en 2020, en dépit du
Covid). Plusieurs de ces mesures relèvent plus précisément d’une politique de redistribution
(revalorisation des prestations sociales, augmentation du smic, aide de rentrée exceptionnelle).
Résultats
Ces mesures devraient permettre d’atteindre les objectifs en soutenant la consommation par leur
l’impact sur le revenu disponible ou sur les prix de l’énergie.
Le document 9 permet plus précisément d’évaluer l’impact du bouclier tarifaire sur l’activité
économique (le taux de variation du PIB, l’emploi, l’inflation et les inégalités), en France. Dispositif
critiqué pour son manque de ciblage, « la mesure est un bon compromis entre inflation, croissance,
pouvoir d’achat et inégalités » d’après les auteurs de l’étude.
La mise en place du bouclier tarifaire a permis de réduire les inégalités, et surtout de protéger les
ménages les plus pauvres qui ont une propension marginale à consommer forte. Ce sont ces
ménages qui sont principalement touchés par les augmentations de prix (leur panier de
consommation étant principalement constitué de dépenses alimentaires, et énergétiques). En outre
le bouclier tarifaire a permis de contenir l’inflation à 6,40% en 2022, (alors qu’elle aurait été de 7,50%
sans bouclier), et de maintenir la croissance à 2,85% (alors qu’elle aurait été de 1,10% sans bouclier),
« une croissance forte en emplois », selon les auteurs de l’étude. Par comparaison, une mesure
d’indexation des salaires sur les prix aurait contribué à la formation d’une spirale inflationniste qui
aurait « fragilisé la croissance et l’emploi ».
Limites
Toutefois, ces mesures ont un coût dans un pays où le poids de la dette publique s’élève à 111,6 %
du PIB (T4 2022), avec des interrogations sur les moyens mobilisés au regard des résultats obtenus.
Le document 9 montre ainsi le coût du bouclier tarifaire pour les finances publiques, en lien avec les
problématiques actuelles sur la soutenabilité de la dette publique.
Par projection en 2027 :
- La mise en place de ce bouclier tarifaire, se traduirait par une dette publique de 112,5% du
PIB.
- La mise en place d’une politique de relance par transferts ciblés se traduirait par une dette
publique de 119,30%.
Remarque (doc 9) : La mise en place d’une politique redistributive par transferts ciblés aurait
également pu être réalisée. Plutôt qu’une prise en charge d’une partie des prix des consommations,
celle-ci aurait ciblé les plus bas revenus.
Un « chèque énergie » d’un montant correspondant à une dépense incompressible versé aux
ménages en est un exemple. Cela aurait eu un effet beaucoup plus redistributif car les ménages les
plus aisés n’auraient pas vu l’intégralité de leur consommation d’énergie (potentiellement une
énergie consacrée à des activités de loisirs) subventionnée par l’Etat. Cette mesure aurait eu des
effets plus distorsifs sur les inégalités.
Pour conclure, différentes mesures budgétaires ont été prises par les pouvoirs publics avec des
objectifs économiques (contenir l’inflation, soutenir la demande et préserver la reprise de l’activité
économique, ainsi que l’emploi) et sociaux (limiter l’aggravation des inégalités économiques et la
hausse de la pauvreté), dans un contexte économique marqué par une forte incertitude.
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 6 / 11
DOSSIER 2 – QUESTION PROBLÈMATISÉE
Sujet : L’Etat peut-il intervenir efficacement aujourd’hui pour lutter contre les déséquilibres
sociaux ?
Introduction
Il est attendu une introduction comprenant les éléments suivants :
- Une contextualisation du sujet : le candidat peut montrer le lien entre l’analyse du dossier
documentaire de la première partie, le sujet traité et les enjeux actuels de celui-ci. Toute
accroche ou toute contextualisation cohérente sera acceptée.
- Une explicitation des termes clés du sujet : en l’espèce, les définitions de « Etat » (au sens
large), « déséquilibres sociaux », et une explicitation du terme « efficacement » et de
l’adverbe « aujourd’hui ».
- Une annonce du plan
Contextualisation possible du sujet
- A partir des documents 7 à 9, pour montrer que le retour de l’inflation fait peser un risque de
perte de pouvoir d’achat mais surtout potentiellement un risque d’aggravation de la pauvreté,
sans intervention de l’Etat, puisque cette inflation est particulièrement élevée sur les produits
énergétiques et l’alimentation, qui remplissent des besoins essentiels.
- A partir du document 7 mentionnant l’ajustement attendu sur le marché du travail en 2023
(perte attendue de 175 000 emplois) qui va accentuer les déséquilibres sur ce marché.
- Tout autre fait d’actualité économique, montrant une amélioration ou une aggravation des
déséquilibres sociaux (pauvreté, inégalités, chômage) du fait de la situation économique, ou
des choix d’intervention politique pour lutter contre ces déséquilibres.
NB : Un candidat qui n’aurait abordé qu’une forme de déséquilibre social pour mener sa
réflexion ne peut être pénalisé. En revanche, un candidat qui n’aurait abordé le sujet que
sous l’angle des arguments en faveur de l’intervention de l’Etat sans montrer les risques,
limites et marges de manœuvre restreintes devra être pénalisé.
Explicitation des termes du sujet :
- L’Etat désigne, au sens large, les pouvoirs publics (comprenant l’Etat central, les collectivités
territoriales et les organismes de protection sociale). C’est un acteur de la vie politique et
économique ayant des prérogatives larges, au-delà de ses fonctions régaliennes (sécurité
intérieure et extérieure et justice), il organise le cadre juridique qui encadre la vie économique
et peut utiliser ses ressources budgétaires pour intervenir conjoncturellement ou
structurellement en fonction de ses objectifs.
Cette définition peut être complétée par une brève présentation des différentes conceptions
du rôle de l’Etat (Etat-Gendarme, Etat-Providence) qui permet d’amorcer une
contextualisation du sujet, afin de valoriser les candidats capables d’ancrer le sujet dans des
débats de théorie économique.
- Les déséquilibres sociaux renvoient aux situations de chômage (forme de déséquilibre sur
le marché du travail), aux inégalités sociales, aux situations de pauvreté et de précarité. Le
corpus documentaire ancre le débat sur la problématique de la pauvreté, mais ce n’est qu’un
des aspects du sujet. Tout candidat capable d’appréhender ces différents types de
déséquilibres dans sa réflexion devra être valorisé.
- Le terme « efficacement » dans le sujet peut être défini par l’atteinte d’un objectif social
(limiter le chômage, les inégalités). Une politique économique sera efficace si elle atteint son
objectif. L’efficacité peut en plus, être appréhendée sous l’angle des finances publiques, dans
un processus de rationalisation des dépenses publiques. A cette contrainte financière,
s’ajoutent aujourd’hui les contraintes découlant de l’appartenance à l’UE et à la zone euro,
et les contraintes d’une économie globalisée, restreignant les marges de manœuvre des
Etats (référence à la dimension temporelle du sujet avec l’adverbe « aujourd’hui »).
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 7 / 11
Mise en évidence de l’intérêt du sujet (sous forme affirmative ou interrogative)
La forme interrogative peut intégrer la reprise de la question ou d’autres questions annexes :
- Dans quelle mesure l’Etat doit-il intervenir pour lutter contre les déséquilibres sociaux ?
- Dans quelle mesure l’intervention de l’Etat est-elle justifiée pour répondre à des impératifs
de justice sociale ?
- Quelles sont les mesures que l’Etat peut mettre en place pour lutter contre les déséquilibres
sociaux ? Quels sont les coûts de ces mesures et les effets escomptés ?
- L’Etat peut-il poser les bases d’une croissance économique inclusive ?
Annonce du plan :
Plans possibles :
Proposition 1 :
I – L’Etat dispose de nombreux moyens pour lutter contre les déséquilibres sociaux
II – Mais cette intervention n’est pas toujours efficace, car contrainte.
Ou proposition 2 (plan basé sur la typologie des fonctions de l’Etat de Musgrave) :
I – L’Etat a un rôle important dans l’allocations des ressources au sein d’une économie grâce
aux services publics.
II – L’Etat est le seul acteur capable d’influer fortement sur la répartition des richesses grâce
à la redistribution.
III – L’Etat peut stimuler le niveau de l’activité économique, principale source de création de
richesses, et agir en cas de crise conjoncturelle face à une aggravation des déséquilibres
sociaux.
Ou proposition 3 :
I – Il est possible de développer un « Etat-providence », susceptible de mieux protéger la
population contre les risques sociaux et la pauvreté.
II – L’Etat peut intervenir sur le plan macroéconomique pour favoriser une croissance
inclusive.
NB : Pour les propositions 2 et 3, une argumentation nuancée est attendue dans chaque sous-partie
mettant en avant les effets escomptés de l’intervention étatique compte tenu des marges de
manœuvre restreintes.
Autre formulation possible de la proposition 3 :
I. L’Etat peut intervenir pour lutter contre le chômage
II. L’Etat peut intervenir pour lutter contre les inégalités et la pauvreté
Ou proposition 4 :
I – Dans une économie capitaliste mondialisée, l’action de l’Etat est nécessaire pour modifier
la répartition des richesses…
II - … Mais elle est souvent insuffisante car parfois inefficace voire illégitime.
Développement :
Il est attendu une argumentation comprenant les éléments suivants :
- Un développement structuré en deux ou trois parties pertinentes par rapport au sujet et
relativement équilibré ;
- Chaque partie doit comporter au moins deux ou trois sous-parties, avec des titres apparents,
et des transitions explicitant le fil conducteur entre les parties ;
- Chaque sous-partie doit comporter au moins un argument construit à partir de savoirs
(théorie ou outil ou mécanisme explicité). Des exemples sont attendus dans l’argumentation.
Le vocabulaire doit être précis et l’argumentation fluide et démonstrative.
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 8 / 11
Les arguments possibles :
v L’Etat dispose de nombreux moyens pour lutter contre les déséquilibres sociaux
Idées :
L’Etat peut lutter contre les déséquilibres sociaux en favorisant une croissance économique
soutenue et inclusive
• L’Etat peut favoriser la croissance et le développement du pays grâce à des politiques
d’investissement à fortes externalités (croissance endogène grâce à la formation,
l’éducation, l’innovation, les infrastructures publiques).
• La redistribution des revenus est le principal outil de réduction de la pauvreté et des
inégalités
o La fiscalité est un outil puissant pour réduire les inégalités de revenu et de
patrimoine (exemple : impôt sur le revenu progressif, impôt sur la fortune ou
impôt sur la propriété immobilière, impôt sur les successions, taxes foncières et
droits de mutation, RSA, …), l’accroissement de ces formes d’inégalités pouvant
affecter négativement les trajectoires de croissance économique des pays.
o L’Etat peut développer les services publics gratuits ou quasi-gratuits :
§ afin de favoriser l’égalité des chances (exemple : politiques de lutte contre
l’échec scolaire)
§ afin de procurer aux ménages les plus pauvres des services leur
permettant d’occuper un emploi et de développer des compétences pour
améliorer leur employabilité et leurs revenus (exemples : crèches
subventionnées, aides pour la petite enfance, écoles maternelles et plus
globalement école et formation initiale gratuite, financement de l’université
et de formations professionnelles …)
o L’Etat peut développer la protection sociale et engager des transferts sociaux au
profit des plus modestes (ex : RSA, APL, bourses d’études, minimum
vieillesse…) ;
o L’Etat peut aussi utiliser la législation et la réglementation en faveur des plus
défavorisés (droit au logement, salaire minimum …) ;
• L’Etat : un amortisseur social en cas de crise
o Grâce à des politiques conjoncturelles agissant sur la demande (notamment la
consommation des ménages)
o Grâce à une politique de revenu impactant la répartition primaire de la valeur
ajoutée en faveur des salariés (fixation d’un salaire minimum et revalorisation du
salaire minimum)
o Grâce à une politique de l’emploi (mesures actives/passives) visant à faire
baisser le taux de chômage, à sécuriser le parcours professionnel des travailleurs,
à lutter contre les difficultés d’appariement entre offre et demande de travail, à
limiter la segmentation du marché du travail, à prendre en compte les
conséquences de la révolution numérique…
Références théoriques :
• Fonctions de l’Etat de R.Musgrave
• Keynes et le rôle des politiques budgétaires de relance en cas de crise économique
(propension à consommer plus élevée parmi les ménages pauvres, multiplicateur de la
dépense publique)
• Théories du marché du travail (chômage classique/keynésien, segmentation et polarisation
du marché du travail)
• Théories de la croissance endogène, en particulier les investissements en capital humain
(Becker, Lucas) et les infrastructures publiques (Barro).
• Nouvelle théorie de la croissance qui vise à repenser l’Etat en considérant la qualité du
capital humain et le rôle de l’investissement éducatif, comme déterminant de la croissance
potentielle (Aghion, Cohen).
• Rawls et la notion de justice sociale
• Piketty sur le rôle de la fiscalité pesant sur le patrimoine et de la rémunération du capital sur
les inégalités.
• Amartya Sen et l’importance des capabilités pour le développement humain ;
• Courbe de Kuznets montrant l’évolution de la relation entre croissance et inégalités en
fonction du niveau de développement.
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 9 / 11
Faits :
• La France est parmi les pays où les inégalités sont les moins fortes, selon l’indice de
Gini et où le taux de pauvreté ne dépasse pas 15% de la population active (mesuré
à 60% du niveau de vie médian) ou 9% (pour une mesure à 50%).
• Le système français de redistribution atténue très fortement le taux de pauvreté
monétaire, qui serait ainsi « spontanément » bien supérieur à 20 % de la population
(22,1 % en 2017, contre 14,1 % (à 60% du niveau de vie médian) après redistribution,
soit un impact estimé à 8 points).
• Le taux de chômage en Zone Euro était de 6.5 % en novembre 2022, de 7 % en
France, la situation s’est améliorée dans tous les pays européens avec un taux
d’emploi qui reste élevé. Cependant, cette situation pourrait changer (perte attendue
de 175 000 emplois en 2023 en France, cf. document 7).
v Mais cette intervention n’est pas toujours efficace
Idées :
Le coût et le financement de l’intervention de l’Etat
• La soutenabilité financière :
o L’Etat est limité dans ses capacités financières du fait d’un endettement public
déjà très important, la soutenabilité de la dette publique devient plus
problématique avec la hausse des taux d’intérêt et les contraintes
européennes de maîtrise des déficits et dettes publics (Pacte de stabilité et
de croissance, TSCG visant à éviter le laxisme budgétaire, règle d’or …)
o Un consentement à l’impôt en berne : le financement par une hausse des
prélèvements fiscaux ou sociaux peut devenir très impopulaire (ex : gilets
jaunes)
• Les problèmes de financement de la protection sociale : déficits publics, financement
des retraites par répartition posant le problème de la proportion actifs/retraités ;
L’inefficacité de l’Etat Providence et du système redistributif
• Même si la part des dépenses sociales est élevée (plus de 30% du PIB en France),
la pauvreté et l’exclusion demeurent.
• Injustice de la pression fiscale : la fiscalité n’impacte que peu la pauvreté et corrige
peu les inégalités du fait de la prédominance en France des impôts indirects (TVA,
TIPP…) socialement injustes.
• La politique de revenus de l’Etat crée des distorsions dans les mécanismes de
marché (par exemple, sur le marché du travail, débats sur le montant du SMIC, sur
la durée de l’indemnisation chômage et sur son montant…)
• La question de l’incitation au travail du fait des minimas sociaux (trappes à pauvreté) ;
• Le développement des cas de travailleurs pauvres (précaires et temps partiels en
dessous du seuil de pauvreté)
L’efficacité relative des politiques de l’emploi pour faire baisser le taux de chômage structurel.
La mondialisation et la libéralisation des échanges ont conduit à une mise en concurrence
des Etats Providence :
• Une protection sociale coûteuse peut être considérée comme un obstacle dans la
recherche de compétitivité d’une économie. En effet, les coûts de la protection sociale
peuvent peser sur la production et nuire à la compétitivité-prix d’un territoire dans un
contexte de concurrence internationale forte.
Exemples :
o Redressement de la compétitivité de l’Allemagne à partir des années 2000
grâce à une fiscalisation du financement de la protection sociale et la création
de mini-jobs (lois Hartz) ;
o Concurrence des pays à bas salaire et à faible protection sociale qui a
encouragé les délocalisations et les investissements directs à l’étranger
(exemple : textile).
• La mise en concurrence fiscale et sociale des territoires peut impacter l’attractivité
d’un pays (risque de moins disant).
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 10 / 11
Théories :
• Triple crise de l’Etat-providence de Rosanvallon : crise d’efficacité, crise financière et
crise de légitimité.
• Théories libérales qui considèrent que la redistribution peut être désincitative
(désincitation à l’offre de travail en cas de faible écart entre revenus de substitution
et revenus d’activité notamment) et inefficace.
• Ecole du Public Choice qui montre l’inefficacité inhérente à l’action publique du fait
du système électoral, et du rôle du lobbying.
• Courbe de Laffer : trop d’impôts tue l’impôt.
• Théories monétaristes qui préconisent en particulier la limitation des déficits
budgétaires et de la création monétaire afin de lutter contre l’inflation.
• Théories libertariennes : illégitimité de l’intervention étatique (Hayek, Nozick)
Faits :
• Le poids de l’Etat est très élevé en France avec des prélèvements obligatoires à
44.8 % du PIB, des dépenses publiques à 59% du PIB, une dette publique à 112.9 %
du PIB (données 2021). Néanmoins, on constate une dégradation de la satisfaction
des usagers des services publics, notamment pour la santé et l’éducation (édition
janvier 2023 du baromètre de l’Institut Paul Delouvrier).
• La question de la compétitivité de la France compte tenu du poids des prélèvements
obligatoires et des impôts de production qui pèsent sur les entreprises (en particulier
celui des charges sociales dans le coût du travail).
Éléments de conclusion :
Est attendue une synthèse des arguments permettant de répondre à la problématique mais pas
d’ouverture.
DCG 2023 UE5 Économie contemporaine - Corrigé Page 11 / 11
Vous aimerez peut-être aussi
- L'inflationDocument11 pagesL'inflationTriomphe AmoussouPas encore d'évaluation
- These Doctorat Oumar Fodé Dembelé Version Finale - Oumar Fode DEMBELEDocument184 pagesThese Doctorat Oumar Fodé Dembelé Version Finale - Oumar Fode DEMBELEDemba SYPas encore d'évaluation
- Corrige PES 18 19 PDFDocument2 pagesCorrige PES 18 19 PDFFati100% (1)
- Facture PP AsusDocument10 pagesFacture PP AsusLeslie HammondPas encore d'évaluation
- Bordereau de Confirmation de Transfert de VIRGILDocument1 pageBordereau de Confirmation de Transfert de VIRGILAziza Daho0% (1)
- Corrigés Officiels Jour 1 Amérique Du Nord Juin 2022Document8 pagesCorrigés Officiels Jour 1 Amérique Du Nord Juin 2022SOPHIE MOREL100% (1)
- Sektnirachdi PDFDocument119 pagesSektnirachdi PDFDeliah BardPas encore d'évaluation
- Voici 50 Questions À Choix Multiples en Economie GénéraleDocument47 pagesVoici 50 Questions À Choix Multiples en Economie GénéraleOrnel DJEUDJI NGASSAMPas encore d'évaluation
- Les Politiques ÉconomiquesDocument9 pagesLes Politiques Économiquesaicha abdillahiPas encore d'évaluation
- Devoir À Domicile Economie GénéraleDocument3 pagesDevoir À Domicile Economie Généralehiba achPas encore d'évaluation
- INFLATIONDocument10 pagesINFLATIONDacquinPas encore d'évaluation
- Note Polmon3t21Document14 pagesNote Polmon3t21Emmanuel DemosthenePas encore d'évaluation
- IMF Forecast 11octobre2022Document5 pagesIMF Forecast 11octobre2022Yao Koffi NorbertPas encore d'évaluation
- Annale DCG 2023 Ue5 SDocument11 pagesAnnale DCG 2023 Ue5 SAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- MPRA Paper 110698Document14 pagesMPRA Paper 110698hakim.hanidaPas encore d'évaluation
- Partie II Les Instruments de Lintervention Étatique 2013 2014 PDFDocument6 pagesPartie II Les Instruments de Lintervention Étatique 2013 2014 PDFAbdel Ghader Oumar M'HayhamPas encore d'évaluation
- Revision2quelles Politiques Economiques Dans Le Cadre EuropeenDocument4 pagesRevision2quelles Politiques Economiques Dans Le Cadre Europeenhk42jkskwsPas encore d'évaluation
- (PE) Politique MonétaireDocument12 pages(PE) Politique MonétaireGaliPas encore d'évaluation
- Eg 2Document1 pageEg 2ouegnin26Pas encore d'évaluation
- Claude Gnos: Repenser La Politique Monétaire en Référence À La Théorie Du CircuitDocument10 pagesClaude Gnos: Repenser La Politique Monétaire en Référence À La Théorie Du CircuitAtterresPas encore d'évaluation
- Note de Synthese Loi Notre BP 2023Document19 pagesNote de Synthese Loi Notre BP 2023Siham El JaouharyPas encore d'évaluation
- Travail FiniDocument10 pagesTravail Finienzoroudet39Pas encore d'évaluation
- 10 172ofceDocument26 pages10 172ofceSALMAPas encore d'évaluation
- Monnaie Et Financement de L'économie TD N° 4 PPDocument25 pagesMonnaie Et Financement de L'économie TD N° 4 PPVictorio QueijoPas encore d'évaluation
- CI 2021 EconomieDocument6 pagesCI 2021 EconomieN GPas encore d'évaluation
- DGT (2023) Perspectives MDocument12 pagesDGT (2023) Perspectives Mvigofo6174Pas encore d'évaluation
- MPRA Paper 109313Document10 pagesMPRA Paper 109313SALMAPas encore d'évaluation
- Analyse Empirique de L'impact de La Politique Monétaire Sur L'in Ation en Algérie de 2000 À 2019Document16 pagesAnalyse Empirique de L'impact de La Politique Monétaire Sur L'in Ation en Algérie de 2000 À 2019el kati Abdu El YemlahiPas encore d'évaluation
- 2 Les Instruments de L Intervention Etatique La Politique Economique PDFDocument3 pages2 Les Instruments de L Intervention Etatique La Politique Economique PDFAchraf LegdaniPas encore d'évaluation
- La Relation Inflation - Croissance Économique Cas de L'économie Algérienne (1970-2018)Document12 pagesLa Relation Inflation - Croissance Économique Cas de L'économie Algérienne (1970-2018)HAMED JamalPas encore d'évaluation
- Inflation Et Politique MonetaireDocument4 pagesInflation Et Politique MonetaireKaoutar AzzaouiPas encore d'évaluation
- Module PES 22-23Document35 pagesModule PES 22-23y.bendaoud2003Pas encore d'évaluation
- Inflation - La Finance Pour TousDocument7 pagesInflation - La Finance Pour TousSaid AglagalPas encore d'évaluation
- Cours Macro S2 2022-2023Document51 pagesCours Macro S2 2022-2023Ferdaous MalamanePas encore d'évaluation
- Lien Entre La Masse Monétaire Et L'inflation Dans Les Pays de l'UEMOADocument43 pagesLien Entre La Masse Monétaire Et L'inflation Dans Les Pays de l'UEMOAIssa NIARE100% (1)
- Déterminants Et Effets Économiques de L'inflation Dans La CEMACDocument17 pagesDéterminants Et Effets Économiques de L'inflation Dans La CEMACRaoudha AmriPas encore d'évaluation
- UE5 SujetZero ElementsCorrigeDocument8 pagesUE5 SujetZero ElementsCorrigemepo memoiPas encore d'évaluation
- Igpde Re2015 19mai SyntheseDocument20 pagesIgpde Re2015 19mai SyntheseHassan AsserrarPas encore d'évaluation
- Economie Mondiale Bilan 2021Document12 pagesEconomie Mondiale Bilan 2021Hervé MUKADIPas encore d'évaluation
- TextDocument14 pagesTextPrince Wilondja DoudouPas encore d'évaluation
- Document PBT 2024-2026 VF FR - Oct - 2023Document34 pagesDocument PBT 2024-2026 VF FR - Oct - 2023arrassenPas encore d'évaluation
- L'Intervention de L'etatDocument3 pagesL'Intervention de L'etatZaid El MezianiPas encore d'évaluation
- Dossier de Presse - Projet de Loi de Finances 2023Document104 pagesDossier de Presse - Projet de Loi de Finances 2023web designPas encore d'évaluation
- Local Media4582273154312036783Document185 pagesLocal Media4582273154312036783harena ZOARITSIHOARANAPas encore d'évaluation
- La Politique Economique Cours 1Document3 pagesLa Politique Economique Cours 1Hasna LaissawiPas encore d'évaluation
- Reco MefiDocument3 pagesReco Mefiramses nsanaPas encore d'évaluation
- Note de Conjoncture Hebdomadaire Du 04 Aout 2023Document20 pagesNote de Conjoncture Hebdomadaire Du 04 Aout 2023DannykankuPas encore d'évaluation
- INTRODUCTIONDocument3 pagesINTRODUCTIONrafik bejaiaPas encore d'évaluation
- Note Mensuelle de Conjoncture Économique Pays UEMOA Octobre 2021Document28 pagesNote Mensuelle de Conjoncture Économique Pays UEMOA Octobre 2021Hans DovonouPas encore d'évaluation
- Word GfiDocument8 pagesWord GfiAYA EL ABBADIPas encore d'évaluation
- Ch6 Partie 3.3 CorrigeeDocument5 pagesCh6 Partie 3.3 CorrigeeErmann64 -Pas encore d'évaluation
- Partie 2 Lintervention de Letat La Politique Économique 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion PDFDocument3 pagesPartie 2 Lintervention de Letat La Politique Économique 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion PDFAbdèlàziz100% (1)
- Politique MonétaireDocument4 pagesPolitique Monétairemira TamenePas encore d'évaluation
- Dossier 3 2024Document26 pagesDossier 3 2024A BenPas encore d'évaluation
- Rapport Orientations Budgetaires 2022 AubagneDocument32 pagesRapport Orientations Budgetaires 2022 Aubagnecamillechat25Pas encore d'évaluation
- Chap 7 CEJMDocument23 pagesChap 7 CEJMsirine.hamoudi01Pas encore d'évaluation
- La Politique Budgetaire Est-Elle Efficace, Sujet TraitéDocument3 pagesLa Politique Budgetaire Est-Elle Efficace, Sujet TraitéAlison KoumpenaPas encore d'évaluation
- Article Tanoh Ghislain Prix Abdoulaye F 2018 PDFDocument49 pagesArticle Tanoh Ghislain Prix Abdoulaye F 2018 PDFGhislain TanohPas encore d'évaluation
- Budget Économique Exploratoire 2024 (Version FR)Document23 pagesBudget Économique Exploratoire 2024 (Version FR)Youness BenasaidPas encore d'évaluation
- td2 Sujet 1Document5 pagestd2 Sujet 1Félix BangouraPas encore d'évaluation
- 2020 Heyer Evaluation de La Pandemie de Covid 19 Sur L Economie MondialeDocument50 pages2020 Heyer Evaluation de La Pandemie de Covid 19 Sur L Economie MondialeEL GUENAOUI YASSINEPas encore d'évaluation
- Politique MonetaireDocument14 pagesPolitique MonetaireMirela BuduPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 - II Pour Les ÉlèvesDocument5 pagesChapitre 6 - II Pour Les Élèveselytratitou0Pas encore d'évaluation
- La Politique Monetaire Dans La Zone Euro Avonsnous Agi Trop Tard Ou Se Pourraitil Que Nous en Fassions Trop AujourdhuiDocument6 pagesLa Politique Monetaire Dans La Zone Euro Avonsnous Agi Trop Tard Ou Se Pourraitil Que Nous en Fassions Trop Aujourdhuiissongo40Pas encore d'évaluation
- Année économique et politique mondiale - 2022: Les Grands Articles UniversalisD'EverandAnnée économique et politique mondiale - 2022: Les Grands Articles UniversalisPas encore d'évaluation
- Rapport sur l'investissement 2022/2023 – Principales conclusions: Résilience et renouveau en EuropeD'EverandRapport sur l'investissement 2022/2023 – Principales conclusions: Résilience et renouveau en EuropePas encore d'évaluation
- DCG Ue 9 2016Document9 pagesDCG Ue 9 2016Adissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Cor DSCG Ue 3 2018Document10 pagesCor DSCG Ue 3 2018Adissa OuattaraPas encore d'évaluation
- TD 7 Dépreciation IFRSDocument1 pageTD 7 Dépreciation IFRSAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- DSCG Ue 3 2017Document15 pagesDSCG Ue 3 2017Adissa OuattaraPas encore d'évaluation
- TD 6 Dépreciation IFRSDocument1 pageTD 6 Dépreciation IFRSAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Annale DSCG Ue3 2010 SujetDocument8 pagesAnnale DSCG Ue3 2010 SujetSallouniYassinePas encore d'évaluation
- TD 11 Depreciation. RevudocxDocument4 pagesTD 11 Depreciation. RevudocxAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Descogef 19 Compta Fin Appro Et Compta Des SocietesDocument6 pagesDescogef 19 Compta Fin Appro Et Compta Des SocietesAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Descogef 19 ManagementDocument4 pagesDescogef 19 ManagementAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Descogef 19 FiscalitesDocument5 pagesDescogef 19 FiscalitesAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Descogef 19 MathematiquesDocument4 pagesDescogef 19 MathematiquesAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- IAS 40 Immeuble de PlacementDocument6 pagesIAS 40 Immeuble de PlacementAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Essentiel Bases Du Calcul de ProbabilitesDocument1 pageEssentiel Bases Du Calcul de ProbabilitesAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Decogef2 2022 2023Document1 pageDecogef2 2022 2023Adissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Cours de ProbabilitesDocument91 pagesCours de ProbabilitesAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Decogef 2 Gestion Financière 23 24Document56 pagesDecogef 2 Gestion Financière 23 24Adissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Devoir de Maison Licence 1 Decogef 2023Document2 pagesDevoir de Maison Licence 1 Decogef 2023Adissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Descogef TCADocument6 pagesDescogef TCAAdissa OuattaraPas encore d'évaluation
- Macro Inter - Chapitre 2Document21 pagesMacro Inter - Chapitre 2abayeabdou94Pas encore d'évaluation
- Monnaie Unique PDFDocument8 pagesMonnaie Unique PDFKAYA charlyPas encore d'évaluation
- Economie Droit Et Géographie - Sujet - Mai 2016Document11 pagesEconomie Droit Et Géographie - Sujet - Mai 2016AsmaaBoutsmoumtPas encore d'évaluation
- La Dépréciation Du Franc CongolaisDocument13 pagesLa Dépréciation Du Franc CongolaisMuhindo Mboylo MechackPas encore d'évaluation
- GFI - Chapitre 1&Document51 pagesGFI - Chapitre 1&Za KaPas encore d'évaluation
- Balance Des Paiements Et Position Extérieure Globale Du Sénégal 2020Document58 pagesBalance Des Paiements Et Position Extérieure Globale Du Sénégal 2020Cheikh Fatma DiopPas encore d'évaluation
- Ecoweek Du 22 Janvier 2022Document17 pagesEcoweek Du 22 Janvier 2022Aixcalibur13Pas encore d'évaluation
- TD MMDocument11 pagesTD MMJIHANE LAFTAHPas encore d'évaluation
- Correction de La Série 1 Économie MonétaireDocument5 pagesCorrection de La Série 1 Économie Monétaireboutaina benghezalPas encore d'évaluation
- Lien Entre La Masse Monétaire Et L'inflation Dans Les Pays de l'UEMOADocument43 pagesLien Entre La Masse Monétaire Et L'inflation Dans Les Pays de l'UEMOAIssa NIARE100% (1)
- Support Cours Etudiants MMF M1Document54 pagesSupport Cours Etudiants MMF M1s889mkx7jyPas encore d'évaluation
- Bank Al MaghribDocument4 pagesBank Al Maghribel kati Abdu El YemlahiPas encore d'évaluation
- Mise en Oeuvre de La Politique MonétaireDocument7 pagesMise en Oeuvre de La Politique MonétaireBilelPas encore d'évaluation
- Série TD EMF S3 2021 - EtudiantsDocument7 pagesSérie TD EMF S3 2021 - EtudiantsabdellahotPas encore d'évaluation
- La Politique MonetaireDocument23 pagesLa Politique MonetaireBoutaina SouhailPas encore d'évaluation
- Annual Report Fr0013297546 FraDocument864 pagesAnnual Report Fr0013297546 FraShamsheer AliPas encore d'évaluation
- Thème 4.3 - Qui Crée La Monnaie ?Document8 pagesThème 4.3 - Qui Crée La Monnaie ?Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Canaux de Transmission de La Politique Monétaire Au Maroc PDFDocument37 pagesCanaux de Transmission de La Politique Monétaire Au Maroc PDFأحلام المغربية100% (1)
- Cours Eco Monetaire 57pageDocument52 pagesCours Eco Monetaire 57pagetalhaoui faresPas encore d'évaluation
- La Politique Monétaire Et L'inflationDocument62 pagesLa Politique Monétaire Et L'inflationMizoo LiliPas encore d'évaluation
- Cours D'économie Monétaire PDFDocument50 pagesCours D'économie Monétaire PDFafnane ArrichPas encore d'évaluation
- Les Risques de Change Et La Liquidité Macroéconomique Sont Deux Concepts Importants Dans La Gestion Économique Des PaysDocument2 pagesLes Risques de Change Et La Liquidité Macroéconomique Sont Deux Concepts Importants Dans La Gestion Économique Des Payshtalibi031Pas encore d'évaluation
- La Politique Monétaire Covid-19 - Blaise Sary NgoyDocument239 pagesLa Politique Monétaire Covid-19 - Blaise Sary NgoyMatthieu MporePas encore d'évaluation