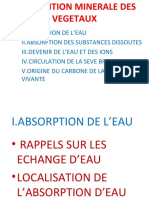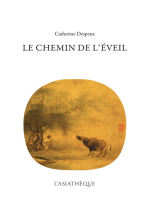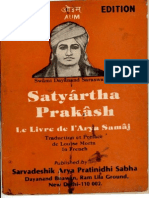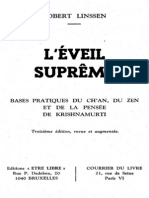Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Nagarjuna Et Vacuite
Nagarjuna Et Vacuite
Transféré par
tantravidyaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Nagarjuna Et Vacuite
Nagarjuna Et Vacuite
Transféré par
tantravidyaDroits d'auteur :
Formats disponibles
. ******************************************************* TO READ THIS FILE SAVE IT TO DISK FIRST; AND READ IT USING NOTEPAD OR ANY OTHER TEXT EDITOR.
******************************************************* . Nagarjuna et la doctrine de la vacuit Vivenza . Sub-section titles are in the form: L#: [ ]. These can be used to regenerate the structure using a Word Processor. . . ******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* . L1: [Table des Matires Dtaille] :L1 . L1: [Table des Matires Dtaille] :L1 L1: [Introduction] :L1 L1: [Premire partie La pense de Nagarjuna] :L1 L2: [1. Contexte et perspective de la pense de Nagarjuna] :L2 L3: [I. Nagarjuna: sa place dans l'histoire] :L3 L3: [II. Nagarjuna et le Trait du Milieu] :L3 L3: [III. L'absence de nature propre (svabhava-sunyata)] :L3 L4: [La ngation nagarjunienne de l'tre et de l'essence] :L4 L4: [La non-nature du vide] :L4 L3: [IV. L'objectif du Trait du Milieu] :L3 L2: [2. L'entreprise thorique de Nagarjuna] :L2 L3: [I. La non-consistance ontologique] :L3 L3: [II. La Voie du Milieu, face aux coles Vaibhashika et Sautrantika] :L3 L4: [Le ralisme Vaibhashika et l'idalisme Sautrantika] :L4 L4: [Un dilemme difficile] :L4 L4: [La rponse libratrice de Nagarjuna] :L4 L3: [III. Nagarjuna et le Yogacara] :L3 L3: [IV. Thorie des deux vrits] :L3 L3: [V. La logique du vide] :L3 L4: [La logique indienne] :L4 L3: [VI. La rfutation nagarjunienne de la logique indienne] :L3 L3: [VII. L'identit manquante de l'tre] :L3 L4: [La non-voie] :L4 L2: [3. La dialectique de la non-substance] :L2 L3: [I. La Loi (dharma) et la notion de loi] :L3 L3: [II. De l'ontologie ngative la ngation de l'ontologie] :L3 L3: [III. L'tre et le temps] :L3 L4: [Ngation catgorique] :L4 L4: [La ngation du temps] :L4 L3: [IV. Ngation ontologique et non-substantialit] :L3 L3: [V. Le non-tre comme vide de substance propre] :L3 L2: [4. La doctrine de la vacuit (sunyatavada)] :L2 L3: [I. La vrit manquante de l'tre absent] :L3 L4: [Ni tre ni non-tre] :L4 L3: [II. Le non-soi comme vide d'identit de l'tre et du non-tre] :L3 L4: [Ni production ni annihilation] :L4 L3: [III. Le Nirvana comme absence de Nirvana] :L3 L3: [IV. Le caractre propre du vide] :L3 L1: [DEUXIME PARTIE - La continuit historique de la doctrine nagarjunienne] :L1 L2: [5. L'hritage de la pense de Nagarjuna] :L2 L3: [I. Aryadeva: le matre de la ngation radicale] :L3
L4: [Ni cause ni effet] :L4 L4: [L'arme de la critique du Madhyamika] :L4 L4: [Un dsir vain] :L4 L4: [Tout est vide] :L4 L3: [II. Le dveloppement de la logique bouddhique aprs Nagarjuna] :L3 L4: [L'infrence rduite de Dignaga] :L4 L2: [6. Evolution de la doctrine Madhyamika] :L2 L3: [I. Les coles Svatantrika et Prasangika] :L3 L3: [II. Chandrakirti et le Madhyamakavatara] :L3 L4: [Les seize formes de vacuit] :L4 L3: [III. Shantideva et le Bodhicaryavatara] :L3 L4: [L'illusion chez Shantideva] :L4 L4: [L'analyse critique de Shantideva] :L4 L2: [7. Les ultimes aspects de la doctrine de la vacuit] :L2 L3: [I. Au Tibet] :L3 L3: [II. Le tantrisme (Vajrayana)] :L3 L3: [III. En Chine] :L3 L4: [Les sept coles] :L4 L4: [Les cinq grandes tendances] :L4 L4: [L'originalit du Ch'an] :L4 L3: [IV. Au Japon] :L3 L4: [La pratique de la vacuit (zazen)] :L4 L4: [La doctrine de la vacuit au c ur du Zen] :L4 L4: [La mtaphysique nagarjunienne du vide chez Dgen] :L4 L1: [Notes] :L1 L4: [I. Contexte et perspective de la pense de Nagarjuna] :L4 L4: [2. L'entreprise thorique de Nagarjuna] :L4 L4: [3. La dialectique de la non-substance] :L4 L4: [4. La doctrine de la vacuit (sunyatavada)] :L4 L4: [5. L'hritage de la pense de Nagarjuna] :L4 L4: [6. Evolution de la doctrine Madhyamika] :L4 L4: [7. Les ultimes aspects de la doctrine de la vacuit] :L4 L1: [Appendices] :L1 L2: [I. Le nant chez Matre Eckhart] :L2 L2: [II. La problmatique mtaphysique de l'tre et de l'essence] :L2 L2: [III. Ncessit et contingence selon Ren Guenon] :L2 L2: [IV. La contingence dans la mtaphysique occidentale] :L2 L2: [V. Bouddhisme et nihilisme] :L2 L2: [VI. Shankara et la non-dualit (advata)] :L2 L2: [VII. La philosophie du Lankavatara-sutra] :L2 L2: [VIII. Le Vimalakrtinirdesa (Vkn), et l'enseignement de Vimalakrti sur la vacu it] :L2 L2: [IX. La pense de Lin-tsi] :L2 . . ******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* . L1: [Introduction] :L1 . La doctrine de la vacuit n'est pas un thme, une notion que l'on puisse ranger faci lement au milieu des conceptions thoriques diverses qui croisent les rivages de l a rflexion mtaphysique. La pense de Nagarjuna, dans sa souveraine et fascinante dia lectique ngative, est de nature bouleverser les schmas classiques et souvent simpl istes l'aide desquels nous voudrions plier le monde notre vision. Nagarjuna est incontestablement un matre de l'esprit, une figure majeure parmi les figures de l a pense universelle. Disciple fidle de l'enseignement du Bouddha, dans les pas duq uel, prcisons-le, il voulut scrupuleusement et concrtement placer les siens, il a
contribu, plus qu'aucun autre, rendre de nouveau sensible la porte authentique du message de l'Eveill. Il tenta, sans aucun doute de manire incomparable, de redonne r une juste comprhension de la Voie qui conduit l'Eveil. . Certes, son langage, son discours, sa technique argumentaire sont parfois ardus et d'un accs difficile, la technicit de sa mthode analytique peut elle-mme crer comme un cran, un frein la pleine comprhension de son message. Mais ces obstacles dpasss, lorsqu'on est peu peu acclimat la phrasologie nagarjunienne, on dcouvre une rflexio n d'une immense et inpuisable profondeur. Une pense d'une richesse extraordinaire qui est de nature nourrir un authentique questionnement mtaphysique, et parallleme nt comme complmentairement, mais aussi invitablement, une vritable pntration de la Vo ie de l'Eveil elle-mme. . La doctrine de la vacuit, grce la rare plasticit formelle de sa dialectique, se per met, sans aucune crainte, de dnouer avec aisance et habilet l'ensemble des problmes que la raison ne manque pas de lgitimement se poser. Cependant, loin de fournir des rponses strotypes et finalement incompltes car limites, sources constantes de cris es et de dchirements multiples et nombreux, la pense nagarjunienne introduit direc tement dans une perspective libratrice incomparable. Bien sr, sa radicale original it peut surprendre, mais c'est l'enseignement mme du prince Gautama qui se dresse derrire les thormes de Nagarjuna. En effet, Nagarjuna est un rvlateur de la dimension relle du message transmis par le Bouddha, il ne se voulut pas un innovateur, mai s uniquement canal de restitution de l'essence exacte de la Doctrine de l'Eveill; cela explique sans doute qu'il soit aujourd'hui reconnu comme matre fondamental par l'ensemble des branches Mahayana du bouddhisme: les coles tibtaines Kagyupa, S akyapa, Nyingmapa, Gelugpa, l'cole tantrique (Vajrayana) et les coles chinoises et japonaises Tendai, Shingon, Ch'an et Zen. . Pour Nagarjuna, se pencher sur la question du sens du message du Bouddha tait une ncessit qui relevait quasiment d'un impratif doctrinal. Rendre de nouveau percepti ble le caractre exact des paroles prononces sous l'arbre de l'Illumination tait une mission qui ne pouvait faire l'objet d'un doute. L'importance d'une juste perce ption du souverain discours librateur commandait, prioritairement, toute action d 'approfondissement de la Voie qui conduit l'Eveil. Tel est le sens du travail tho rique de Nagarjuna, telle est l'origine de sa doctrine de la vacuit. Bien entendu , et on le remarque sans peine, l'enseignement de Nagarjuna n'est pas dtachable, isolable d'un contexte religieux spcifique, d'une tradition spirituelle bien prcis e, qui joueront un rle minemment important, tant dans sa formation que dans l'expr ession de son discours. Mais il ne serait pas juste, il ne serait pas objectif d e ne pas reconnatre, de ne pas percevoir la porte d'une telle pense, porte dont la v alidit ne s'arrte pas aux frontires du seul bouddhisme, mais dborde trs largement sur les larges domaines de la pense philosophique universelle. La doctrine de la vac uit n'a pas de sphre de validit limite, un territoire rserv l'intrieur duquel sa per ence s'exercerait; mme si, bien videmment, son ancrage historique n'est pas niable , si sa pertinence pratique semble difficilement extirpable des vhicules propres du bouddhisme Mahayana, elle s'applique nanmoins trs largement tous les domaines d e la pense, sans se cantonner aux frontires culturelles et spirituelles, aujourd'h ui parfois plus fictives que relles, de l'Orient. . La vacuit, vide de contenu, vide de tout concept, prsente la caractristique spcifiqu e d'tre vide d'elle-mme. Dpourvue de dtermination, elle ne peut, par la mme, faire l' objet d'une appropriation objectifiante puisque trangre toute position fixe. La va cuit ne se laisse donc pas possder, elle ne peut faire l'objet d'une conqute, elle c happe toute volont limitative; vide de spcificit, si ce n'est celle de ne pas en po ssder une, elle ne se donne que dans son abolition; vide d'elle-mme, aucune ralit ne lui est trangre. Si, d'autre part, elle ne peut pas tre l'objet purement livresque d'une spculation thorique abstraite, c'est que la doctrine nagarjunienne de la va cuit est, avant toute chose, une formidable entreprise de libration, la mise en oe uvre d'un processus rel de comprhension de la nature vritable du concret. Ce concre t fit d'ailleurs l'objet d'une tude trs serre de la part de Nagarjuna. En effet, at
tentif aux multiples aspects contradictoires du rel, il dveloppa sa doctrine avec un souci vigilant de comprendre les mcanismes complexes de la mouvante ralit phnomnal e. Il n'est pour cela qu se pencher sur les questions qu'il aborde dans sa rflexion : analyse des conditions et de la causalit, analyse du mouvement, analyse des fac ults de l'entendement, analyse des lments, analyse de l'agir et de l'agent, analyse du temps, etc. La liste est longue des domaines tudis par le penseur indien, elle l'est d'autant plus que sa vigilance, visant ne pas laisser voil le moindre aspe ct de l'tre, l'amnera tendre toujours plus avant sa recherche. L'lment cl de sa rfle n, qui introduit la totalit de son discours, est, bien videmment, la notion de pro duction conditionne (pratitya-samutpada), mais l'norme champ d'action de cette not ion oblige Nagarjuna embrasser de nombreux problmes, qui se trouvent tre en dpendan ce directe de cette notion premire. Ceci a pour effet de mettre en lumire les mcani smes complexes qui fondent secrtement la ralit et, de par cet clairage, permettre un e connaissance plus fine, plus profonde des lois existentielles. Permettre galeme nt une saisie trs claire de l'impermanence qui dirige l'tre, le commande et le sou met son imprative loi. Comprendre enfin que le fond de la question n'est rien d'a utre que l'absolue identit entre Nirvana et samsara; qu'il n'y a jamais eu un tem ps o le parfait Eveil ne ft dj accompli, que depuis toujours tout est apais, complteme nt ralis. . Nous le percevons aisment, les perspectives ouvertes par Nagarjuna sont extraordi nairement riches et profondes; de ce fait, l'actualit de sa pense reste minemment p ertinente, au moment d'ailleurs o s'imposent les problmes aigus d'un monde enferm d ans ses raisonnements quantitatifs et positifs, o est plus que jamais ncessaire un e attitude renouvele vis--vis de l'existence. De ce point de vue, la rflexion nagar junienne possde d'videntes qualits; parmi celles-ci, la plus frappante est certaine ment le caractre librateur de sa mthode. L'approche amicale du vide, laquelle nous invite le matre indien, peut, bien entendu et naturellement, surprendre, en ralit e lle ouvre un nouvel horizon aux dimensions insouponnables. Dans un premier temps, plus on intgre la mtaphysique nagarjunienne, plus se cre une vritable et chaleureus e intimit entre celui qui s'y risque et la vacuit elle-mme, puis, insensiblement, l a thorie se fait transparente jusqu disparatre, jusqu s'effacer et enfin devenir comme n'tant pas. Mystre incomprhensible de l'invisible dtachement du sunyata (vide); doc trine du vide vide d'elle-mme, absente de sa prsence, existante dans son inexisten ce. . On peut l'affirmer sans crainte, Nagarjuna se propose rien de moins que d'offrir la possibilit d'un nouveau rapport l'tre, non par une ontologie particulire, mais par l'auto-abolition de l'ontologie commune, non par une ontologie ngative, mais par la ngation de toute ontologie possible. Pense vide du vide, la doctrine de la vacuit est une pense de l'au-del de l'tre et du non-tre. Une pense souveraine de la ne science, une science libratrice de la non-pense. . En proclamant que tout ce qui existe est vide d'identit, Nagarjuna, de par une lo gique de l'enchanement extrmement pertinente, rend vidente la caducit des contradict oires traditionnels, des antinomies classiques (oui/non, lumire/tnbres, Nirvana/ sa msara, etc.). Cette attitude dbouche sur une comprhension plus fine, plus rigoureu se de la dialectique des opposs et, de ce fait, permet une vritable rvlation de la n ature sans nature propre des phnomnes, une perception prcise de l'absence de substa nce de toute chose, de la non-substance universelle. Non une pense du rien, mais une non-pense. La vacuit, insistons sur ce point, n'est pas une rhtorique rifie du na elle n'est pas une strile glose sur le vide. Bien au contraire, vide de tout con cept, elle ne s'attache aucun point de vue au sujet de ce qui ne se pense pas, r ejetant toute conception particulire elle n'en possde aucune. Pense sans pense, le s unyatavada est une pratique concrte du non-attachement, une discipline effective de la mise distance, une ascse de l'auto-abolition, une pense de la non-pense, une pense du trfonds de la non-pense, selon la clbre expression de Dgen Zenji. . Rendre perceptible l'imperceptible vrit, comprendre que tout chappe la comprhension, c'est la le sens rel de la Voie du Milieu; Voie au contenu invisible car situ nul
le part. Le signe de la vacuit, qui n'a pas de localisation particulire, agit comm e une dialectique perptuelle de la ngation; son mouvement ne connat pas de terme ca r il n'a jamais commenc; n'ayant jamais commenc, il n'est jamais apparu; n'tant jam ais apparu, il fut toujours prsent; tant toujours prsent, il est et demeure non vis ible; invisible dans sa visibilit, il a son sjour dans le Parfait Silence. . Si la Voie du Milieu a pu tre parfois qualifie de Voie extrme, c'est qu'en ralit elle est une Voie de l'extrme vrit. . ******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* . L1: [Premire partie La pense de Nagarjuna] :L1 L2: [1. Contexte et perspective de la pense de Nagarjuna] :L2 L3: [I. Nagarjuna: sa place dans l'histoire] :L3 . Nagarjuna, moine bouddhiste du IIe-IIIe sicle originaire de l'Inde, est clbre pour t re le fondateur de l'cole philosophique dite du Milieu. Sa vie, dont nous ne savons en ralit que peu de chose, nous est rapporte par un important corpus littraire hist orique, elle est, bien videmment, mle de lgendes et de mythes d'une richesse caractri stique des hagiographies religieuses traditionnelles1. Selon ces sources, Nagarj una tiendrait son nom de Nga, qui signifie serpent, et d'Arjuna, une varit d'arbre, ce qui, symboliquement, indiquerait qu'il serait n sous un arbre et que des serp ents fussent les instruments de la transmission de sa science et de son savoir. Ayant un jour guri Mucilinda, le roi des Nga, ces derniers, en remerciement, lui r emirent, dit la tradition, les cent mille vers du Prajnaparamita-sutra. On dit ga lement que dans le palais des Nga, Nagarjuna dcouvrit sept coffres prcieux contenan t de trs nombreux Mahayanasutra. En quatre-vingt-dix jours il mmorisa les cent mil le gth qui rsument l'essence de la doctrine de la Prajnaparamita. En forme de respe ct vis--vis de son savoir, et de reconnaissance pour son geste envers leur roi, p lus tard, lorsqu'il instruira ses disciples, les mmes Nga feront de leurs corps un e sorte d'ombrelle afin de le protger des morsures du soleil et de l'agression de s lments; ceci expliquant l'origine des trs nombreuses reprsentations iconographique s nous montrant Nagarjuna la tte nimbe de sa protection reptilienne caractristique. . Il semble, plus concrtement, qu'il soit originaire du Vidarbha, qui tait alors par tie intgrante du royaume d'Andhra, sur lequel rgnait la dynastie indienne du Dekka n, dont les rois, qui contrlaient toute la partie sud-est de l'Inde, taient de fer vents adeptes du bouddhisme. On dit qu'il fut l'lve d'un brahmane nomm Rhulabhadra, auteur d'un Prajnaparamita-sutra qui figure en tte de trs nombreux manuscrits sans krits. Parmi les nombreux crits2 que nous possdons de Nagarjuna, sont signaler bie n sr et en premier lieu son fameux Madhyamakakarika (Trait du Milieu), mais aussi le Suhrllekh (Lettre un ami), le Rajaparikatha-ratnamala (La Prcieuse Guirlande de s avis au roi) ainsi que le Vigrahavyavartini (Refus d'un dbat philosophique), ce dernier ouvrage se prsentant comme une vritable mthode de dialectique argumentaire , en rponse aux attaques des adversaires de son cole de la voie mdiane. Il prit l'o rdination monastique du mahasiddha Saraha Nalanda, et devint, apparemment en trs peu de temps, l'abb de l'universit. Il est vraisemblable, selon ce que nous en liv rent les tmoignages, que par l'effet de la protection royale dont il bnficiait, il ait pu sereinement finir sa vie Sriorvata dans un monastre. Le rayonnement et l'i mmense influence de sa pense lui permettent d'occuper aujourd'hui une place de pr emier ordre l'intrieur du bouddhisme Mahayana, tel point d'ailleurs que le bouddh isme tibtain le regarde comme l'un de ses matres les plus importants, et que le Ch 'an, ainsi que le Zen, le reconnaissent comme le quatorzime patriarche indien dan s la succession des matres depuis le Bouddha. . Se pencher sur l' uvre et la pense de Nagarjuna, c'est sans conteste dcouvrir une pe rsonnalit de premier ordre, un mtaphysicien de grande envergure et un redoutable d
ialecticien. Esprit brillant, il a le got de la prcision des formules, il cherche sans relche, lorsqu'il se penche sur un argument, pousser son maximum la rigueur analytique et l'examen critique des propositions tudies. On peut, sans crainte d'e xagration, affirmer que le visage du bouddhisme n'aurait certainement pas celui q ue l'histoire nous prsente actuellement, sans l'apport philosophique de la Voie n agarjunienne du Milieu. Rle central et moteur, influence capitale dans le dveloppe ment des thses fondatrices du Mahayana, telle est la place vritable que toutes les coles, unanimement, lui reconnaissent aujourd'hui. Le souci constant de Nagarjun a, qui l'habita dans l'ensemble de son uvre, qui commanda toute sa pense, fut de m aintenir fidlement la doctrine du Bouddha dans sa puret primitive, de lui conserve r sa force initiale et premire. Pour ce faire, il n'eut de cesse de combattre san s relche, inlassablement, les tendances qui travestissaient la pense originelle de l'Eveill. . A son poque, une multitude de courants et d'coles philosophiques se disputaient su r les sujets les plus divers, ainsi que sur les thmes classiques du dbat mtaphysiqu e indien. Bien videmment, les doctrines dominantes se situaient dans la perspecti ve de la tradition vdique et du substantialisme des Upanishad. On y trouvait galem ent les Nyayika et les adeptes des systmes logiques qui prnaient une mthode d'inves tigation rationnelle pour connatre les lois du rel, les crationnistes qui attribuai ent l'origine du monde un Etre premier, Dieu ou Ishvara. Les partisans de l'exis tence du soi ou de l'tman, de l'immortalit de l'me, du temps (kala} de l'ternit du mo nde, etc. Sans oublier les sceptiques, les matrialistes ou volutionnistes, qui plaa ient dans la matire ou la nature l'lment unique du mouvement et de la vie. En ralit, c'est l'ensemble des philosophies du Darshana3 indien qui sera vis par la critiqu e nagarjunienne, c'est la totalit de l'ontologie brahmanique qui fera l'objet d'u ne rfutation prcise et mthodique. . Toutefois, il serait faux d'imaginer que le travail thorique de Nagarjuna ne s'ad ressa qu'aux reprsentants des divers Darshana du systme vdique orthodoxe; en effet, Nagarjuna n'oublia pas de diriger le faisceau de sa critique en direction des co les et tendances bouddhiques qui, elles aussi, avaient la faveur du temps et des circonstances dvelopp des positions philosophiques inacceptables. Positions juges inacceptables car en contradiction directe avec la conception doctrinale initial e du Bouddha, c'est--dire l'affirmation primordiale qui fonde et structure la pos ition primitive du prince Gautama: l'enchanement causal et l'interdpendance rciproq ue des phnomnes comme seules et uniques lois de dtermination du rel, lois auxquelles est soumis l'univers dans son ensemble. . L'immense effort thorique de la dialectique (prasanga) nagarjunienne est de rendr e toute son ampleur cette loi de la production conditionne (pratityasamutpada), for mule pour la premire fois dans l'histoire par le Bouddha, loi qui dans la pense de Nagarjuna est absolument quivalente la vacuit (sunyata) elle-mme. Il est hors de qu estion pour lui, et il insiste vigoureusement sur ce point, que des disciples de Shakyamuni puissent se fourvoyer dans des formes insidieuses de restauration de s conceptions substantialistes. Ce serait perdre ainsi l'essence du message de l 'Eveill, et compromettre de ce fait toute possibilit de parvenir la libration (Nirv ana). C'est donc d'une question cruciale qu'il s'agit dans l'entreprise doctrina le de Nagarjuna: il en va tout simplement de la possibilit mme de mettre en uvre le processus de dlivrance. Or ce processus figure comme pierre angulaire de la Voie d e la libration, il en lgitime mme la validit. . La structure argumentaire des Quatre Nobles Vrits ne tiendrait plus, en effet, si la perspective de la cessation (Nirvana) venait tre compromise par une incomprhens ion du fondement principal du discours du Bouddha concernant l'origine de la sou ffrance (dukkha). Comprendre l'origine, c'est de manire quivalente comprendre galem ent l'extinction, cela se tient. L'origine de la souffrance est aussi l'origine de la libration; une seule erreur analytique, et c'est la validit et la possibilit mme de la Voie qui se trouvent remises en question. Nagarjuna ne lutte donc pas t horiquement pour le simple plaisir de manipuler des concepts et des ides, pour s'a
donner aux joies des joutes dialectiques, il est, bien au contraire, au service de la perspective intime de la mission du Bouddha: annoncer aux hommes, certes l 'origine, mais aussi, et surtout, la possibilit de la cessation de la souffrance. . L3: [II. Nagarjuna et le Trait du Milieu] :L3 . Nagarjuna, dans son principal ouvrage, le Trait du Milieu (Madhyamakakarika / MK)4, affirme que le principe de vacuit (sunyatavada) fonde la ralit, c'est--dire qu'il e n est la loi la plus essentielle, la plus intime. Nous verrons cependant plus lo in ce qu'il convient d'entendre, de comprendre, par ce terme de vacuit, qui donna l ieu, comme on le sait, une niasse norme de contresens. L'ouvrage, rdig dans un styl e exigeant, se compose de vingt-sept chapitres qui reprsentent quatre cent quaran te-sept stances (karika) auxquelles on doit ajouter deux stances ddicatoires cara ctre uniquement introductif. Les stances sont structures comme des distiques class iques, c'est--dire qu'elles prsentent un ensemble de doubles phrases, formant un s ens complet; le style mme du Trait d'ailleurs, c'est--dire le genre karika, relve d'un e conomie de moyens qui voisine troitement avec le dpouillement et la volont d'aller l'essentiel. Le Trait fut l'objet d'un nombre important de commentaires; on considr e cependant qu l'intrieur de cette masse impressionnante d'crits et de documents, qu elques auteurs se distinguent par leur valeur analytique; ces commentateurs maje urs sont: Devasharma, Gunamati, Gunashri, Sthiramati, Buddhapalita, Bhavaviveka et, certainement le plus connu et le plus illustre d'entre eux, Chandrakirti. . Le Trait, dont l'objectif est de battre en brche les opinions errones des penseurs su bstantialistes et des logiciens brahmaniques, est aussi dirig, plus prcisment encor e, contre les Abhidharmika qui, bien que relevant de la doctrine du Bouddha et p rofessant l'absence de ralit du moi, soutenaient nanmoins l'existence effective d'u n constitutif formel la base des phnomnes. En effet il est possible, tout en admet tant que les choses et les tres soient vides d'tman, que nul phnomne ne possde de soi , que la relativit universelle dtermine toute forme d'existence, de tomber tte prem ire dans le pige aportique visant faire de cette absence de substance, de ce non-so i, de cette non-substance, une essence. Les Abhidharmika en vinrent ainsi affirm er que, certes, les choses ne possdaient pas d'identit, qu'elles n'taient rien, mai s qu'elles avaient prcisment pour essence de possder en propre ce rien, que leur tre , leur essence taient de ne pas avoir de consistance. Face ce dangereux type d'er reur, Nagarjuna rpondit: ~ Les choses produites en relation sont vides, non seulement d'tman, mais encor e de nature propre (svabhava), de caractre propre (svalakshana). Il ne s'agit plu s de la vacuit de substance, de l'inexistence de principes permanents (...), mais de l'inexistence, en vrit vraie, du relatif comme tel: ce qui nat de causes ne nat pas en ralit. (...) La logique montre l'irralit du relatif5. .
L3: [III. L'absence de nature propre (svabhava-sunyata)] :L3 . Ce qui n'a pas de nature propre, ce qui est sans substance, relatif, qui est dpou rvu de consistance ontologique, ne possde mme pas pour essence cette absence de co nsistance. Dans la pense de Nagarjuna, le vide n'est pas une situation, n'est pas un constitutif formel concret; ce qui n'est pas, en toute logique, on ne peut a bsolument pas attribuer une identit propre. Le vide de nature est l'unique nature du vide, il n'en possde et ne peut en possder aucune autre. . Toute volont, imaginant fixer une dtermination spcifiante au vide, est une tentativ e voue irrmdiablement et radicalement l'chec et l'erreur. ce qui n'est que relatif, dpendant, caus, il ne peut tre permis de confrer une essence. Ce qui nat d'une cause n'est donc pas rellement existant pour Nagarjuna; natre en dpendance, pour lui, ce n'est pas natre vritablement, ce n'est pas possder d'existence propre. ce titre, ri en n'existe puisque tout relve de la relation de cration et de dpendance, et si don c rien n'existe, il ne peut y avoir d'attribution d'une essence nulle chose. Tel
est, en dfinitive, le sens de l'expression si frquemment rencontre chez Nagarjuna: absence de nature propre (svabhavasunyata). Dans cette optique, un tre contingent, un tre caus, dpourvu de nature propre, ne possde strictement parlant aucune essence ; en dernire analyse, il n'existe pas; ou plus justement il existe dans son inexist ence. . On cite trs souvent, afin d'tablir des parallles parfois risqus, car oublieux de la spcificit des traditions, la dfinition de Matre Eckhart au sujet de la nature des tre s, on ne peut cependant s'empcher de la rappeler tant sa formulation est identiqu e la doctrine nagarjurnienne de la vacuit: ~ Toutes les cratures sont un pur nant, affirme Matre Eckhart, je ne dis pas qu'e lles sont peu de chose, c'est--dire quelque chose, non je dis qu'elles sont un pu r nant. Ce qui n'a pas d'tre est nant. Mais aucune crature n'a d'tre (...)6. . L4: [La ngation nagarjunienne de l'tre et de l'essence] :L4 . C'est exactement ce que, d'une certaine manire, tente d'expliquer Nagarjuna: de p ar leur caractre contingent les tres sont vides de toute essence, ils sont un pur nant. Parler comme le fait Nagarjuna de l'inexistence en vrit vraie, c'est refuser l'existence ce qui est contingent, ce qui est caus, ce qui est relatif. L'essence , qui est considre en mtaphysique comme ce par quoi un tre est ce qu'il est en se di stinguant des autres tres, correspond gnralement la substance seconde, qui dsigne le ontenu intelligible de ce qui est apte exister en une chose et non une autre. Sa int Thomas d'Aquin dira: L'essence nonce que par elle et en elle, l'tre possde l'exi stence7. L'infrence de l'tre est donc subordonne l'essence, ceci impliquant bien que si les tres ne possdent pas d'essence ils ne peuvent prtendre participer de l'exis tence; dpourvus d'essence ils sont donc inexistants. . Sans essence il ne peut y avoir d'accs, pour personne et aucune chose, l'existenc e, car exister consiste toujours tre ceci ou cela, une chose ou une autre, un hom me, un animal, un vgtal ou un minral; tre c'est toujours tre quelque chose: L'existenc e n'est rien d'autre que la modalit d'tre propre l'essence prise en chacun des tats o elle se trouve8. Aristote, le premier en Europe, parlera des liens de dterminati on entre l'essence et l'existence, ce sera d'ailleurs la question de l'origine s ecrte de l'existence qui constituera l'objet formel de la recherche dveloppe dans s a Mtaphysique. Se demander qu'est-ce que l'tre?, c'est donc se demander en premier qu 'est-ce que cette essence qui existe?. Toute chose a de l'tre, toute chose est, ex iste, par prsence sensible, mais cette prsence, si on veut bien y tre attentif, n'e st rien d'autre que son essence, essence qui est l'acte concret, rel, de sa prsenc e au monde. Tout tre est d'abord en ce qu'il est, et par le fait qu'il soit, une essence, une nature individue, une forme distincte et spcifie. . L'existence se manifeste donc imprativement par l'essence, or si l'essence vient a faire dfaut, a disparatre, l'existence elle-mme disparat. Il ne peut y avoir d'tre dpourvu d'essence, la notion d'tre ne se situant invitablement qu l'intrieur d'une ess ence concrte. Il n'y a pas d'tre abstrait, si ce n'est les constructions de raison qui n'ont d'existence que mentale, l'tre est toujours l'tre de quelque chose. Le primat de l'essence sur l'tre est conscutif du constat que tout tre, de par le fait qu'il est, est d'abord une nature (homme, animal, vgtal, etc.). Tout tre qui exist e est une essence ralise et dtermine en son tre. Tout tre qui existe est une essence p ar laquelle il est ce qu'il est, par laquelle il subsiste dans l'tre. C'est de ce tte essence qu'il tient son tre, et par la mme son existence propre. Sans essence constitutive, pas d'existence possible, c'est une loi mtaphysique axiomatique. . Nier comme le fait Nagarjuna que les tres soient pourvus de svabhava, c'est--dire de nature ou d'essence, c'est donc nier qu'ils possdent en propre une nature ou u ne essence (et non que leur nature ou leur essence est de ne pas en avoir). Cela ne signifie bien videmment pas que les choses n'existent pas, mais qu'elles sont simplement, en tant que vides de nature propre, comme des apparences dnues de tou te consistance relle. La comprhension de la production en dpendance (pratitya-samut
pada) entrane la mise en miettes de l'difice conceptuel substantialiste. Il n'y a pas de production, car il n'y a pas de disparition, il n'y a pas de disparition, car il n'y a pas de production, la dialectique nagarjunienne est une dialectiqu e sans prdicat; les contraires se renvoient ds lors perptuellement entre eux, comme un jeu de miroir se projetant l'infini, une perspective auto-rflchissante de conv ergences, divergences et complmentarits. . L'enchanement sans fin des ngations et des affirmations aboutit la ruine de toute formule positive ou ngative fixe. Seul demeure ce qui ne demeure pas: au sein du vide, l'inconsistance sans production ni disparition est attributive de rien. On comprend que la dialectique nagarjunienne (n'ait) pas de valeur intrinsque et con stitue un simple moyen pour dblayer la voie de l'exprience mystique. L'absolu n'es t pas le vide, il est uniquement vide de dualit, de pluralit comme d'unit, en un mo t de tout concept. Nagarjuna ne soutient jamais l'annihilation, le rien, l'inexi stence en soi, mais seulement l'inexistence des constructions que nous surimposo ns la ralit. Seul celui qui se libre des dichotomies et des limites conceptuelles p eroit les choses telles qu'elles sont9. . L4: [La non-nature du vide] :L4 . C'est pourquoi la plus grande mprise des Abhidharmika consistera donc bien, aprs a voir accept la loi de production conditionne (pratitya-samutpada), de rifier cette lo i et, en se mprenant profondment sur sa porte vritable, d'attribuer aux phnomnes une e ssence par le fait qu'ils sont sans nature propre. Si les phnomnes sont vides de s ubstance propre, ils sont donc, par consquence et par quivalence, vides de toute e ssence. Leur essence n'est pas de ne pas possder de soi; de la facticit existentie lle des phnomnes, il ne peut tre possible de substantialiser une nature, fut-elle u ne nature du vide. Sur ce point, et en parfaite cohrence avec lui-mme, Nagarjuna s e montrera toujours d'une intransigeance inflexible. La vacuit, et Nagarjuna le r appellera constamment, n'est pas une base partir de laquelle on puisse faire sub sister une nature. L'absence de nature propre, c'est l'absence absolue de toute nature, car le vide ne possde pas et ne peut possder une nature. Il est mme radical ement erron de parler d'une nature du vide: le vide n'est rien, ne possde rien, ne se spcifie par rien, et tout particulirement ne se rduit ni l'absence ni la prsence , ni l'tre ni au non-tre, concepts dualistes, qui restent encore des modes limits d e l'ontologie substantialiste. . L'absence de nature propre est une vritable destitution de l'essence; la dominati on du relatif dans l'tre, regarde comme l'unique vrit des existants, aboutit a les v ider de toute essence singulire, et donc de toute existence relle. Pour asseoir so n affirmation, Nagarjuna utilisera un exemple devenu clbre: ~ Pousse et semence n'ont pas de naissance relle, puisqu'elles ne sont que la t ransformation d'tats vgtaux antrieurs, pas de disparition non plus, puisque leur dis parition apparente concorde avec l'apparition d'autres semences et d'autres pous ses; pas d'ternit, puisqu'elles sont en perptuel devenir; pas de devenir rel, puisqu 'elles tournent dans le mme cycle; pas d'unit, puisqu'elles ne cessent de se subdi viser en graines et en pousses nouvelles, et pas de pluralit relle, puisque la mme espce originelle les englobe10. . N'existe et ne subsiste donc dans l'tre que la relation en dpendance; permanente s uite de production, corruption et disparition, cycle sans origine et sans fin du mouvement et de sa cessation. Ni vie, ni mort, ni essence, ni existence, tout e st, et depuis toujours jusqu jamais, une suite ternelle du vide au sein de la vacui t. Comme il n'y a plus ni production ni destruction de phnomnes, les choses perdent toute consistance quoi on et pu encore se raccrocher11. En fait d'tre il n'y a que le vide, en fait d'essence il n'y a que l'absence; jamais dans l'histoire une si forte critique ne fut exprime l'encontre de la ralit et des phnomnes, jamais on n'en gagea un procs si radical de la substance et des concepts qui permettaient son ex pression. .
L3: [IV. L'objectif du Trait du Milieu] :L3 . Toutefois, malgr la perspective critique du Trait, Chandrakirti (comme nous l'avons signal, l'un des disciples les plus importants de Nagarjuna, fervent continuateur de la pense Madhyamika, auteur du principal commentaire du Trait, la Prasannapada s ur le Madhyamaka) juste titre rappellera que Nagarjuna composa son Trait en ayant p our objectif premier l'obtention de la ralisation et de l'Eveil: Dans le "Trait", d it-il, Nagarjuna ne discute pas par amour de la controverse, il montre l'ainsit en vue de la libration12. La libration, pour Nagarjuna, ne peut s'tablir que sur les r uines de la ralit mondaine (laulika sattva), sur l'effondrement des certitudes ill usoires et limites. C'est un vritable travail de dconditionnement auquel Nagarjuna invite son lecteur; il lui demande, et en cela son exigence est extrme, d'accepte r de rompre avec les schmes conceptuels classiques de la certitude ou de la convi ction. Nagarjuna propose de franchir une barrire gnosologique, qui est, en vrit, la mise en uvre d'un authentique saut qualitatif. Certes, cette exprience peut affole r la pense de celui qui accepte de la tenter, mais pass le premier moment d'tonneme nt et d'angoisse, devant la fuite et la disparition de toutes les certitudes, ap parat alors l'immense champ de l'Eveil, le domaine invisible, vide de substance p ropre, non diffrenci de la vacuit (sunyata}. . Etre conscient que le Trait du Milieu est ordonn la libration, est finalis la mis e d'un processus d'Eveil, est ncessaire afin de mieux cerner l'intention intime d e Nagarjuna. Le Trait a pour but de faire pntrer le lecteur dans la Voie, dans le che min subtil de la ralisation. Nous sommes donc en prsence d'une uvre, dont l'intenti on vritable est de permettre une dmarche qui a pour perspective de donner accs la c omprhension profonde des phnomnes, la juste vision, de contribuer l'apaisement de la multiplicit. C'est un ouvrage pratique, en ce sens qu'il propose un engagement, u ne orientation en vue de la cessation; le Trait est donc de ce fait, et en ralit, un authentique outil. Il convient de l'aborder comme tel, et de maintenir, lors de son tude, toujours prsente la mmoire cette dimension spcifique du texte. . Le Trait, trs certainement, est un livre d'une grande audace; non content de repense r et, par la mme, de renouveler toutes les problmatiques antrieures qui constituaie nt les fondements des anciennes coles bouddhistes, il dgage une immense perspectiv e hermneutique. Tordant le cou toutes les formes fixes, traquant les positions ar rtes, dtruisant les convictions les plus stables, il agit comme une dialectique per manente, mobile et insaisissable. Le Trait l'efficacit d'un vritable art martial pou 'esprit, s'en dgage de ce fait une mthode d'une tourdissante souplesse. Comprendre la pense Madhyamika, rentrer dans la doctrine du Trait, c'est en accepter la pratiqu e, on pourrait dire qu'il n'est pas possible de rentrer vritablement dans la doct rine du Trait sans pntrer soi-mme dans l'exprience de la vacuit. Il n'y a quasiment p d'en dehors, pas d'extriorit possible cette uvre. Il faut s'y donner, s'y livrer, s ous peine de n'en rien percevoir, elle ne se laisse dcouvrir qu'en la pratiquant. . Le Trait peut, sans aucun doute, tre qualifi d'acroamatique, il ne s'ouvre qu celui e mrite, et ce mrite se paie d'un seul et unique prix: l'exprience. Vouloir compren dre, c'est accepter qu'il puisse s'avrer tre ncessaire de pratiquer la doctrine, c' est accepter de cheminer dans la Voie, accepter, plus exactement et plus justeme nt encore, d'tre saisi par la Voie; c'est la galement le seul et unique objectif d u prsent ouvrage, permettre cette exprience vritable de l'engagement dans la Voie, inviter la vrification concrte des thses nagarjuniennes, leur offrir une possibilit de mise en uvre, les confronter la ralit elle-mme. . Pntrer la doctrine du Trait c'est donc, dans une certaine mesure, rendre vivantes les thses Madhyamika; vivantes non pas seulement par un usage purement abstrait, c'e st--dire en les utilisant comme une mcanique intellectuelle, mais en s'immergeant soi-mme au c ur de la vacuit, en entreprenant vritablement l'ascension du mont du Sil ence, celui de l'exprience libratrice. .
******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* .
L2: [2. L'entreprise thorique de Nagarjuna] :L2 L3: [I. La non-consistance ontologique] :L3 . On n'hsite pas aujourd'hui prsenter Nagarjuna comme l'un des plus importants philos ophes du bouddhisme, tant pour la profondeur et l'absolue rigueur de sa pense, qu e pour avoir labor un systme ontologique complet, cohrent, qui reprsente la grande rvo lution philosophique du Mahayana1. L'originalit de Nagarjuna est surtout de reveni r avec force l'enseignement du Bouddha. Pour ce faire, il reprendra, l'occasion de la rdaction de ses crits, la position du refus d'attribution de consistance ont ologique dvolue aux tres et aux choses, comme de faon parallle la position du refus de non-attribution. . La Voie du Milieu, labore par Nagarjuna, consiste mettre en lumire l'impossibilit d' asseoir un jugement exact au sujet des phnomnes, car la complmentarit des contraires interdit, en dernire analyse, qu'il puisse validement s'exprimer une opinion jus te si celle-ci est btie sur une position fragmentaire: ~ La vrit se trouve donc au milieu (...) dans le vide. La vacuit de l'univers se dmontre donc par la relativit des contraires, qui n'existent que les uns par les a utres, c'est--dire comme construction illusoire de l'esprit. D'o l'on ne peut que conclure l'inexistence relle des choses2. . L'inexistence des phnomnes fait l'objet d'une longue, profonde et patiente descrip tion tout au long du Trait de Nagarjuna, l'affirmation des huit ngations donne d'ail leurs une excellente image du discours nagarjunien: . \ ### \ Ni abolition, ni cration, ni anantissement, ni ternit, ni unit, ni multipli cit, ni arrive, ni dpart (MK, XXVI, 12)3. (i.e. Cette rfrence n est pas bonne. Il s agi es deux premires stances d introduction.) . \ ### \ Hommage au Parfait veill, \ Le Suprme Orateur, qui enseigne \ Que ce qui apparat en dpendance \ -- Est libre de cessation et de production, \ -- D'anantissement et de permanence, \ -- D'alle et de venue, \ -- De diversit et d'unit, \ -- L'apaisement de la pense discursive, la flicit. . \ ### \ "I salute him, the fully-enlightened, the best of speakers, who preac hed \ -- the non-ceasing and the non-arising, \ -- the non-annihilation and the non-permanence, \ -- the non-identity and the non-difference, \ -- the non-appearance and the non-disappearance, \ -- the dependent arising, the appeasement of obsessions and the auspi cious." . Cependant, il faut imprativement se garder de rifier, comme on beaucoup trop tenda nce le faire, la position de Nagarjuna l'gard de l'inexistence du monde, ~ la doctrine de la vacuit ne se confond aucunement avec l'inexistence ou le no n-tre (...) irrductible l'tre comme au non-tre la vacuit est l'vacuation de ces deux atgories4.
. Nagarjuna prcise mme avec fermet: . \ ### \ Dire existence est une vue de permanence, dire non-existence est une v ue d'annihilation. C'est pourquoi les sages ne demeurent pas dans l'existence ou la non-existence (MK, XV, 10). . \ ### \ 10. Dire existe est une saisie de permanence; \ Dire n'existe pas est une vue d'annihilation. \ C'est pourquoi les sages ne devraient pas demeurer \ Dans l'existence ou la non-existence. . \ ### \ "It is" is a notion of eternity. "It is not" is a nihilistic view. \ Therefore, one who is wise does not have recourse to "being" or "nonbeing." . La vacuit (sunyata) est donc une rfutation de tous les points de vue, l'essence du sunyata est de n'avoir aucune essence particulire, . \ ### \ les Vainqueurs ont dclar que la vacuit est l'extirpation de toutes les vu es, ils ont proclam incurables ceux qui font de la vacuit une vue (MK, XIII, 18). ( i.e. Cette rfrence n est pas bonne. Il s agit de 13:8) . \ ### \ 8. Les Vainqueurs ont dclar que la vacuit \ Est l'extirpation de toutes les vues \ Et ont proclam incurables \ Ceux qui font de la vacuit une vue. . \ ### \ Emptiness is proclaimed by the victorious one as the refutation of al l viewpoints; \ But those who hold "emptiness" as a viewpoint [the true perceivers] hav e called those "incurable" (asadhya). . L'objectif vident de Nagarjuna est de librer l'esprit de son lecteur de toute conc eption immobile, de tout concept fixe et fig. Sa rfutation de toutes les positions particulires deviendra d'ailleurs le thme central des commentaires qu'il effectue ra de la collection des textes dsigns sous le nom de Prajnaparamita-sutra5 (Sutra de la Sagesse qui atteint l'autre rive). . Nagarjuna fonde son attitude sur l'ide majeure que toute volont de possession, dan s un univers soumis intgralement au changement, l'volution et la mort, est non seu lement une faute grave, mais de plus une tragique futilit. Face au perptuel deveni r, la contingence universelle des tres et des choses, il ne peut tre envisageable de s'emparer vritablement d'une forme, d'un phnomne; nul bien, spirituel ou matriel, qui puisse constituer une proprit authentique, rien ne peut tre possd car il n'y a r ien, strictement et radicalement rien saisir; dans un monde soumis au changement , mme le Nirvana ne peut tre atteint, car de toute manire rien ne peut tre atteint p uisqu'il n'y a rien atteindre. . ~ Ceux qui craignent les souffrances engendres par la discrimination de la nais sance et de la mort (samsara), avait dj prvenu le Bouddha, recherchent le Nirvana, ignorant que samsara et Nirvana sont insparables. Voyant que toutes choses sujett es la discrimination n'ont aucune ralit, ils imaginent que le Nirvana consiste en une annihilation future des sens et de leur souffrance (Lankavatara-sutra, II, 18
). . Partant de ce principe, Nagarjuna affirmera que si rien n'existe, puisque tout e st vide de nature propre (svabhava), rien n'a besoin d'tre annihil; telle est l'es sence intime du sunyatavada nagarjunien, telle est galement la source originelle et mystrieuse du Zen, la dlivrance rside au c ur mme de la servitude; car, au niveau d e l'absolue vrit, la servitude c'est la dlivrance, et la dlivrance est elle-mme, auss i surprenant que cela puisse paratre, non diffrente de la servitude. . Nous sommes donc autoriss affirmer, en toute et lgitime raison, que l'absence de n ature propre supprime la ncessit d'une cessation perue comme une annihilation. Si l es choses n'ont pas d'existence, il n'est donc pas ncessaire qu'elles soient supp rimes. Si l'tre des choses est vide de nature propre, alors rien ne peut tre qualif i d'existant, ce qui explique finalement que l'existence soit synonyme de vide. P rcisons cependant que le vide, la vacuit pour Nagarjuna, n'est surtout pas prendre comme lment objectif, le vide c'est l'absence de vue propre, car il est impossibl e d'avoir une vue propre et spcifie sur ce qui ne possde en propre aucune nature. D u vide dont il est question, Nagarjuna dit: . \ ### \ On ne peut le qualifier de vide, ni de non vide, ou des deux ou d'aucu n, mais pour le dsigner on l'appelle le vide (MK, XV, 3)6. (i.e. Cette rfrence n est p as bonne. Peut-tre 22:11) . \ ### \ 11. On ne peut dire (Tathagata) est vide, \ Ni il est non vide, \ Vide et non vide la fois ou ni vide ni non vide. \ Ces (mots) ne servent que comme dsignations. . \ ### \ One may not say that there is "emptiness" (sunya) (1) \ nor that there is non-emptiness. (2)" \ Nor that both [exist simultaneously] (3), \ nor that neither exists (4); \ the purpose for saying ["emptiness"] is for the purpose of conveying knowledge. . L3: [II. La Voie du Milieu, face aux coles Vaibhashika et Sautrantika] :L3 . Pour parvenir cette affirmation, Nagarjuna exercera sur la ralit une attention par ticulirement aiguise. Les thses nagarjuniennes ne sont pas le pur produit d'une ima gination mtaphysique spcialement chauffe, bien au contraire elles relvent d'un examen objectif et scrupuleux des structures fondatrices du concret, d'une tude intrans igeante de ce qui dtermine l'existence, un examen sans concession des lois intime s de l'tre. Nous sommes trs loin, ici, d'un subjectivisme thologique, o le religieux viendrait saturer la rflexion par une coloration d'ordre apriorique, mme si, bien videmment, il ne saurait tre question d'oublier que Nagarjuna baigne profondment l 'intrieur d'une culture religieuse laquelle il est grandement redevable, et dont il ne peut tre spar. Nous savons que le Madhyamakakarika, qui d'ailleurs t crit pour utter contre les positions des anciennes coles substantialistes, dveloppe sa singu lire dialectique partir des bases argumentaires des coles Vaibhashika et Sautranti ka, tout en les dpassant de faon catgorique et en radicalisant et enrichissant leur s propres positions argumentaires. . L4: [Le ralisme Vaibhashika et l'idalisme Sautrantika] :L4 . Les coles Vaibhashika et Sautrantika sont deux coles philosophiques issues du Hnaya na (ou Vhicule des auditeurs), qui nous sont mieux connues par l'Abhidharma koa ast
ra (Le Fourreau de la mtaphysique), uvre compose au Cachemire vers le Ve sicle par V asubandhu. Ce texte, divis en deux parties, l'une de 600 vers, l'Abhidharma ko kari ka, qui compose le corps proprement dit du texte, suivi d'un commentaire en pros e, l'Abhidharma ko bhashya, est une sorte d'essai de mise en ordre, de classificat ion des doctrines et des positions philosophiques du bouddhisme initial. Cette tu de, qui frappe par son caractre trs dtaill et particulirement fouill des diffrentes op nions thoriques des coles historiques du bouddhisme, constitue certainement la plu s haute autorit en matire de dogmatique et de mtaphysique. Il est ainsi montr, dans ce texte fondamental, que l'cole des Vaibhashika tire son origine d'une des plus anciennes sectes du bouddhisme, celle des Sarvastivadin ou ralistes intgraux (de s arvam asti, qui signifie en sanskrit: tout existe). Les Vaibhashika, comme leurs m atres sarvastivadin, se caractrisent par un ralisme proclamant l'objectivit concrte d es phnomnes; ils se prsentent presque comme des positivistes: Le visible que voit un e personne, affirment-ils, peut tre vu par plusieurs, par exemple la lune, une re prsentation scnique, etc. Il est commun. Si nous regardons les objets comme commun s, disent-ils, c'est qu'ils peuvent l'tre7. La reconnaissance de l'existence vritab le des phnomnes passe donc pour cette cole par la mdiation des cinq sens; toutefois est-il prcis: L'objet n'en existe pas moins indpendamment des organes (...) mme quand un visible n'est pas pris comme objet (alambyate) par la connaissance visuelle, il reste objet, car, qu'il soit pris ou non comme objet, sa nature reste la mme8 . . II est, par ailleurs, intressant de voir comment s'applique pour cette cole raliste la thorie des deux vrits: ~ Bhagavat proclam deux vrits, disent-ils, la vrit relative (samvritisatya) et la it absolue (paramarthasatya). Si l'ide d'une chose disparat lorsque, par l'esprit, on dissout cette chose, cette chose doit tre regarde comme existant relativement. Par exemple l'eau; si dans l'eau nous retirons des dharma tels que couleur, save ur, etc., du point de vue relatif ou conformment l'usage conventionnel (samvritit as), sont donns diffrents noms. Si donc on dit, du point de vue relatif (samvritiv aena): il y a de l'eau, il y a une cruche, on dit vrai, on ne dit pas faux, car c eci est relativement vrai (samvritisatya). Mais lorsqu'une chose tant dissoute pa r l'esprit, l'ide de cette chose continue, cette chose existe absolument (paramar thasat); par exemple le rupa (l'ide de forme ou de matrialit). On peut rduire le rup a en atomes, on peut en retirer par l'esprit la saveur et les autres dharma, l'i de de la nature propre du rupa persiste. De mme en va-t-il de l'ide de sensation. C omme ceci existe absolument (paramarthasat), c'est vrai absolument (paramarthasa tya)9. . Le ralisme des Vaibhashika est, comme on le voit, d'une rare intransigeance en ce qui concerne l'objectivit des phnomnes, mme, ce qui peut paratre tout fait surprenan t, dans le cadre du domaine propre de la vrit absolue (paramarthasatya). Poursuiva nt dans le mme sens, et renforant encore plus, comme s'il en tait besoin, la positi on raliste, l'Abhidharma ko karika rapporte ce raisonnement des Vaibhashika, au suj et de la ralit objective des phnomnes: ~ Le Bouddha dit: la connaissance (vijnana) est produite en raison de deux cho ses, l'organe de la vue et le visible, l'oue et le son..., le manas et les dharma . Si les dharma... n'existaient pas, la connaissance mentale (manovijnana) qui l es a pour objet ne natrait pas... Etant donn l'objet, la connaissance peut natre, n on pas si l'objet n'est pas donnI0. . II est donc clairement affirm que la pense, les conceptions mentales sont secondes par rapport l'tre, que la pense est dtermine par le rel, que la pense provient du r et non l'inverse. . L'cole Sautrantika de son ct, en complte opposition avec les Vaibhashika, se spcifier a et se distinguera par sa volont de rester fidle la lettre mme des sutra du Bouddh a. Les historiens nous apprennent qu'elle fut constitue originellement par Kumrala bdha qui vivait, semble-t-il, au IIe sicle de notre re. L'opposition des Sautranti ka au ralisme des Vaibhashika est vritablement sans appel: le monde pour les Sautr
antika est une pure illusion, de par l'inconsistance des tats de conscience: ~ La srie (prabandha) des phnomnes conditionns (samskara), ou encore la srie des ta s de conscience (vijnana-samtana), chacun de ces tats n'existant que dans un deve nir infinitsimal. Cette srie, ce samtana, est sans samtanin, sans substrat qui rel ie entre eux les membres de la srie comme le fil relie les perles du collier. Ell e ressemble une ligne de fourmis. Son unit rside tout entire dans le rapport de cau se effet des tats d'esprit successifs dont elle est forme11. . Si les phnomnes apparaissent et disparaissent de manire simultane, c'est donc que no n contents d'apparatre l'existence pour une trs courte dure, ils ne sont en ralit qu' inexistants, sans dure. La srie phnomnale ne peut donc plus tre considre comme drive ssue d'une cause unique, d'une Cause premire, mais bien au contraire de causes su ccessives (pratitya-samutpanna): Chaque chose est une instantanit, parce qu'elle n' existe qu'au moment de sa production. On ne peut sparer en elle le caractre de l'a pparition de celui de la disparition. Le moi n'est donc que la srie successive des phnomnes qui, par leur simultanit, crent l'illusion de la permanence. Mais si cette permanence n'est, en ralit, qu'une pure et simple illusion, c'est que ce qui va s'a nantissant pendant un temps est tout de suite, dans ce mme temps, dj non existant12. . L4: [Un dilemme difficile] :L4 . On mesure donc trs bien, de par cette radicale divergence thorique entre les coles Sautrantika et Vaibhashika, comment se posa pour Nagarjuna la difficile question consistant savoir laquelle des deux avait raison, laquelle tait dans le vrai. Le dilemme intellectuel fut trs certainement vcu chez lui trs vivement, et devait san s aucun doute troubler galement les fidles et les moines de l'poque; d'ailleurs les consquences ngatives de ces opinions, strictement divergentes, se faisaient senti r jusque dans la problmatique touchant la notion ultime du Nirvana. . Le ralisme des Vaibhashika les amenait considrer comme des phnomnes positifs objecti fs les trois inconditionns, c'est--dire l'espace (ka) et les deux formes de cessation s des phnomnes (pratisamkhyanirodha, ou Nirvana, et apratisamkhyanirodhd); pour le s Sautrantika, au contraire, les inconditionns n'avaient qu'une valeur ngative: ~ Ce qu'on nomme espace, disaient-ils, c'est seulement l'absence du tangible ( sprashtavya): quand, ttons dans l'obscurit, nous ne rencontrons pas d'obstacle, on dit qu'il y a espace (...). Le Nirvana de mme est l'absence de renaissance, c'es t la non-production (anutpada)13. . Plus loin, afin de ne point trop s'loigner de l'orthodoxie ils ajoutaient: ~ Nous ne disons pas que les inconditionns ne sont pas. Ils sont, en effet, de la manire dont nous disons qu'ils sont. Par exemple, avant que le son ne soit pro duit, on dit: il est (ast) une inexistence (abhava) antrieure du son. Aprs que le s on pri, on dit: il est une inexistence postrieure du son. Et cependant il n'est pa s tabli que l'inexistence existe (bhavati). De mme pour les trois inconditionns. Bi en qu'inexistant, un inconditionn mrite d'tre lou, savoir l'absolue future inexisten ce. Cet inexistant, parmi les inexistants, est le meilleur, et les fidles doivent concevoir son endroit joie et affection 14. . On imagine, bien sr, la raction des Vaibhashika: ~ Si le Nirvana est inexistence, rpliqurent-ils, comment peut-il tre une des vrits? comment peut-il tre lou? Si les inconditionns sont des inexistants, la connaissanc e qui a pour objet l'espace et le Nirvana aura pour objet une non-chose! Si le N irvana est inexistence, nant (abhava), comment un moine qui obtient le Nirvana ds cette vie, peut-il dire l'avoir obtenu? . Les Sautrantika tenteront de rpondre en s'appuyant sur les textes sacrs: ~ Le Nirvana, ce n'est pas seulement l'abandon complet (aeshaprahna), la purific ation (vyantibhava), l'puisement (kshaya), le dtachement (virago), l'apaisement (v yupaama), le passage dfinitif (astagama) de cette douleur; c'est aussi la non-rena issance (apratisamdh), la non-prise (anupdna}, la non-apparition (aprdurbhava) d'une
autre douleur. Cela est calme (nta), cela est excellent (pranitam), savoir le rej et de toute catgorie ou conditionnement (upadhi), l'puisement de la soif (trishnsha ya), le dtachement (virga), la destruction (nirodha), le Nirvana. Le Nirvana est d onc avastuka, irrel, sans nature propre. Les docteurs Vaibhashika ne manqueront ce pendant pas de rappeler: ~ Si les textes sacrs disent qu'il n'y a plus apparition de douleur dans le Nir vana, ce locatif indique que le Nirvana est un lieu, une chose. Quant au terme a vastuka appliqu au Nirvana par les textes sacrs, il faut le traduire non pas par i rrel, sans nature propre, mais sans causalit, inconditionn15. . L4: [La rponse libratrice de Nagarjuna] :L4 . La Voie du Milieu nagarjunienne est donc, comme nous le voyons, une rponse direct e cette impossible conciliation des vues antagonistes, c'est une formulation sou veraine et libratrice face la difficile et, disons-le, irrsolue question consistan t connatre l'exacte vrit entre les opinions opposes. La Voie du Milieu ne peut se co mprendre vritablement si on mconnat la situation du dbat thorique qui agita le bouddh isme avant Nagarjuna. Dbat qui agitait le bouddhisme, non seulement dans le cadre des joutes oratoires entre les docteurs des diffrentes coles, mais qui de plus tai t la cause d'un trouble profond concernant la comprhension de la doctrine origine lle du Bouddha. . En engageant son entreprise thorique, Nagarjuna eut pour objectif de revenir l'es sence mme de l'enseignement de l'Eveill et donc, prioritairement, de permettre l'a uthentique mise en uvre du processus de libration rvl par le Bouddha. On mesure en ce la en quoi rside l'immense apport de la doctrine de Nagarjuna; en contribuant la redcouverte du processus propre l'enseignement du Bouddha, du dpassement de toutes les opinions parcellaires et vues contradictoires fragmentaires, elle rendait d e nouveau possible la ralisation effective de l'extinction de l'illusion et la li bration des identifications trompeuses. . Nagarjuna, dans son Trait, met en lumire la loi directrice de l'interdpendance univer selle des phnomnes, lesquels, vides de substance propre et apparaissant en une suc cession continuelle de morts et d'existences, ne peuvent tre qualifis ni d'existan ts ni de non existants: ~ Les choses, enseigne Nagarjuna, ne sauraient disparatre ni apparatre, se produ ire ni tre ananties. Aucun mouvement rel ne les commande. Seraient-elles alors terne lles? pas davantage. De mme elles ne sauraient tre ranges sous les catgories de l'un it ou de la pluralit (...) la critique nagarjunienne, partant des donnes du phnomnism e universel, va dtruire systmatiquement les conditions mmes de ce phnomnisme16. . Cependant, Nagarjuna regarde avec une impressionnante exactitude les mcanismes au xquels sont soumis les phnomnes. Les faits sont analyss avec une rigueur tout empre inte d'une stricte discipline, qui pourrait tre dfinie comme une disposition de la pense aux lois du rel. Sa critique des positions philosophiques des coles Abhidhar mika, comme nous l'avons vu dans un prcdent chapitre, est une rfutation de leurs vu es errones vis--vis de la ralit. C'est d'ailleurs l'argument principal de sa critiqu e; rien n'est plus important, pour lui que cette clarification exacte concernant la nature de l'tre des choses, car l'extinction (Nirvana), pour Nagarjuna, n'est rien d'autre que l'absence de vue fausse, c'est l'radication de l'incomprhension au sujet de la nature des choses, c'est la vritable perception de la nature de ce qui est. Ce n'est pas un anantissement, une absorption dans le rien, une dissolu tion, une disparition dans le vide informel. C'est, bien au contraire, la claire vision, la juste comprhension de la nature de ce qui est. Or, cette juste comprhe nsion permet en parallle la juste perception d'un principe immanent tous les tres: le principe d'impermanence. Qu'nonc ce principe, que rvle cette loi? Tout simplemen t que le rel n'est pas fixe, qu'il est en transformation perptuelle, qu'il change, se modifie, qu'il est entran dans le grand fleuve du devenir et du mouvement. . Puisque l'ensemble des tres et des choses baignent au sein de la relativit, dont l
e mouvement est l'unique force directrice, le rel ne doit donc jamais tre peru comm e une substance stable; non duel, il relve du vide, de l'absence de nature propre : ~ Comme Nirvana et samsara, toutes les choses sont non-deux. Il n'y a pas de N irvana sauf l o est samsara; il n'y a pas de samsara sauf l o est Nirvana. La condit ion de l'existence n'a pas un caractre mutuellement exclusif, c'est pourquoi tout es choses sont non duelles, comme Nirvana et samsara (Lankavatara-sutra, II, 28). . Cela signifie, aussi trange que cela soit au regard de la logique classique arist otlicienne, que les choses existent et que dans le mme temps elles n'existent pas. .
L3: [III. Nagarjuna et le Yogacara] :L3 . Prcisons nanmoins, car cela s'avre trs souvent ncessaire, que Nagarjuna n'est pas un idaliste, un irraliste; nous sommes trs loin avec lui des positions spiritualistes adoptes par le Yogacara, qui apparatront au IVe sicle, avec les matres Vasubandhu et Asanga, matres pour lesquels le rel n'tait qu'une vue de la pense, les phnomnes qu'un e construction de l'esprit. Nagarjuna, bien au contraire, maintient que si rien n'existe, alors la pense elle-mme ne peut pas tre dite existante; affirmer l'existe nce de la pense c'est retomber dans l'illusion spiritualiste. Lorsque les matres d u Yogacara soutiennent que si la pense est illusionne, si sa vision est par dfinitio n fausse, c'est donc que c'est une pense et qu'elle existe en tant que telle, immdi atement Chandrakirti, en fidle et consquent disciple de Nagarjuna, rfute avec vigue ur l'argument: ~ En raison de la prsence, pour le monde, d'une paisse ignorance semblable une n ue, les objets apparaissent faussement (...). De mme, sous l'influence des fautes de l'erreur l'intelligence de l'ignorant connat la varit des composs 17. . La doctrine du Yogacara, galement nomme Vijnanavada, c'est--dire l'cole qui enseigne la connaissance, affirme l'inexistence du monde extrieur, tout comme la Voie du Mi lieu, mais dans un sens bien diffrent. En effet, pour cette doctrine, le monde n' est que le fruit des constructions mentales, le monde n'est que le produit de la pense, il ne possde en soi aucune ralit autre que dans l'esprit, si toutefois cette prsence peut tre qualifie de ralit. Cet idalisme radical donn des uvres importan i lesquelles on peut citer: le Yogacarabhmisstra (Trait des terres du Yogacara), te xte clbre pour tre le plus long de toute la littrature bouddhique; le Mahayanastralan kra (L'Ornement des sutra du Mahayana), le Vimsatik-Vijnaptimtratsiddhi (La Preuve q ue tout n'est que connaissance), ainsi que le Dharmadharmat du Vibhanga, l'Uttara tantra et le Saptadabhmi. . Il importe de voir tout d'abord que le systme du Vijnanavada ne peut se concevoir , ne peut se comprendre sans la doctrine du Madhyamaka, qui sert de base de dpart aux penseurs idalistes. ~ Tous les phnomnes, avait proclam le Madhyamaka et l'on sait que le bouddhisme, repoussant l'absolu, n'admettait que des phnomnes , ne sont qu'une illusion, une va cuit. Soit, pense le Vijnanavadin, dont tel est aussi le point de dpart mais qu'es t-ce que l'illusion? un mirage intellectuel, donc une pense. Qu'est-ce que la vac uit? la vacuit de la pense, donc encore une donne psychique. L'existence de l'ide pur e, notera Vasubandhu, se trouve tablie par la connaissance mme qu'on a de l'irralit (objective) de l'ide (Vimakakarikaprakarana). Dire avec les Madhyamika que le mond e n'est qu'illusion et vacuit, c'est avouer qu'il n'est que reprsentation et pense (vijnapati, citta), esprit (mana), connaissance (vijnana). Et voila restaur, malg r le criticisme nagarjunien, grce mme ce criticisme, l'idalisme absolu (...)18. . II est donc permis d'affirmer avec justesse que ~ la doctrine du Vijnanavada est profondment originale et semble paradoxale. El le affirme en effet que l'univers tout entier est esprit, conscience pure (citta , qui correspond alors ainsit). Les choses et les sujets n'ont pas de ralit en euxmmes, mais ne sont que des dveloppements intellectuels, ils n'existent que dans la
pense que nous en avons. Ce que nous prenons pour le monde extrieur n'est que de l'esprit19. . On comprend facilement que cette position soit totalement rejete par les Madhyami ka; Chandrakirti l'exprime de la manire suivante: ~ De mme qu'il n'y a pas de connaissable, il n'y a pas de connaissance. C'est c e qu'il faut savoir. Si, sans objet et dpourvu de sujet, existent des essences dpe ndantes vides des deux, par quoi leur existence sera-t-elle connue20? . Les Vijnanavadin, pour affermir leur thorie, se fondaient, non sans quelque lgitim it, sur les paroles attribues au Bouddha: Ce triple monde n'est que pense (cittamtra) . Chandrakirti et les autres Madhyamika rtorquent cependant que, par cette formule prcise, les Ecritures voulaient uniquement faire comprendre qu'il n'y avait pas d'agent personnel, pas de sujet de la pense autre que la pense elle-mme. Il s'agiss ait donc seulement de dissocier dans la pense impersonnelle et impermanente l'age nt soi-disant personnel et permanent, nullement de confrer une valeur relle, la se ule valeur relle cette pense: ~ Le Hros pour l'veil de la terre connat que cette dclaration: "Les trois mondes n e sont que conscience", a pour but de faire comprendre qu'il n'y a pas en tant q ue crateur de soi permanent21. . Pour la doctrine de la Voie du Milieu, la pense pas plus que la matrialit n'ont de ralit, l'expression du Bouddha au sujet de la pense veut uniquement exprimer que la pense joue un rle prpondrant, nullement que l'objet de la connaissance doive tre ni e qu'il n'existe que la pense ou connaissance sans objet22. . L3: [IV. Thorie des deux vrits] :L3 . Pour Nagarjuna, prendre appui sur l'usage ordinaire de la vie, c'est la considrer en ce qu'elle est, c'est fonder son raisonnement thorique partir des formes donne s de la ralit concrte. Nagarjuna ne ngligera, pour ce faire, ni la spcificit du singul ier ni l'universalit des lois de l'tre; tout en niant toute affirmation et toute ng ation au sujet de ces lois. Cependant, il dgage de par sa rflexion propre une doub le dtente l'intrieur du rel, non pas un double langage, mais un double aspect du co ncret. Le consentement au rel, qui participe dans un premier temps de son attitud e d'ouverture objective face aux dterminations multiples de l'existence, amne Naga rjuna comprendre que la premire consquence de l'absence de nature propre aboutit l a distinction entre, d'une part, la vrit dite suprme (paramartha), celle que ralisen t les Eveills qui parviennent la ralisation de la pleine comprhension de l'absolu e n tant que vacuit (sunyata) et, d'autre part, la vrit conventionnelle (samvrti), qu i est le fait des tres qui restent plongs dans l'illusion et l'ignorance mondaine, l o rgnent encore les voiles de l'apparence. Ceci s'explique car, puisque notre lan gage et nos concepts sont relatifs au monde, ils sont impuissants exprimer la ral it supra-mondaine, et la ngation de tout ce qui constitue l'exprience ordinaire est donc la seule attitude approprie23. C'est d'ailleurs la mise en uvre de cette ngati on qui, d'une certaine manire, va mobiliser et surtout caractriser l'entreprise cr itique de Nagarjuna. . La subtilit de la thorie nagarjunienne vient du fait que si les coles antrieures con sidraient que Nirvana et samsara taient antithtiques l'un l'autre, constituaient qu elque chose de radicalement diffrent, pour la Voie mdiane, bien au contraire, le m onde de la ralit et le monde de l'illusion ou de l'ignorance sont un seul et mme mo nde, leur diffrence porte simplement sur le fait que la ralit est atteinte par l'Ev eil, et l'ignorance perue par les tres encore plongs sous le joug des apparences. . Il n'y a donc pas vritablement d'opposition entre Nirvana et samsara, ~ la dlivrance ne s'obtient pas par l'extinction du dsir et l'arrt de la roue inc essante de la transmigration, mais par la conversion de l'ignorance en illuminat ion, de la vrit conventionnelle en vrit suprieure24.
. Nagarjuna l'affirme avec une grande clart: . \ ### \ C'est en prenant appui sur deux vrits que les Bouddhas enseignent la Loi , d'une part la vrit conventionnelle et mondaine, d'autre part la vrit de sens ultim e. \ Ceux qui ne discernent pas la ligne de partage entre ces deux vrits, ce ux-la ne discernent pas la ralit profonde qui est dans la doctrine des Bouddhas (MK , XXIV, 8-9)25. . \ ### \ 8. L'enseignement de la Doctrine par les veills \ S'appuie parfaitement sur les deux vrits: \ La vrit relative du monde \ Et la vrit ultime. . \ ### \ The teaching by the Buddhas of the dharma has recourse to two truths: \ The world-ensconced truth (T1) and the truth which is the highest sen se (T2). . \ ### \ 9. Ceux qui ne comprennent pas \ La diffrence entre ces deux vrits \ Ne comprennent pas la profonde ainsit \ De la Doctrine de l'veill. . \ ### \ Those who do not know the distribution (vibhagam) of the two kinds of truth \ Do not know the profound "point" (tattva) (T3) in the teaching of the Buddha. . La ligne de partage, la ligne invisible entre les contraires, c'est finalement l a fameuse Voie mdiane o le rel se dvoile dans sa nature paradoxale et insaisissable. Si Nagarjuna reconnatra toujours une vrit au rel, c'est justement celle de la vacui t. La vacuit nagarjunienne, qui n'est pas quivalente au nant, montre simplement que les phnomnes, en tant que tels, existent comme apparence concrte d'un certain point de vue limit, et n'existent pas sous une perception plus profonde: ~ II existe donc deux niveaux de ralit (et d'existence, ce qui est indissociable ): une vrit conventionnelle et une vrit ultime. Si l'on se place au niveau de la pre mire, alors le monde des phnomnes et la doctrine bouddhique elle-mme possdent une cer taine valeur, ou, si l'on veut, une sorte de ralit empirique (...). Mais du point de vue de la vrit ultime, rien de cela n'existe, le Nirvana abolit toute diversit, ce qui inclut la loi de production en dpendance elle-mme. Mais Nagarjuna va encore plus loin, en montrant que le Nirvana et les phnomnes ne sont, en dernire analyse, que les expressions d'une mme non-ralit: ce qu'on appelle phnomne du point de vue du conditionn est Nirvana si l'on se place du point de vue de l'inconditionn26. . Le formidable mystre de l'quation d'quivalence entre Nirvana et samsara trouve ains i s'exprimer avec une force singulire dans la doctrine nagarjunienne. Ce mystre ha bite l'ensemble du corpus doctrinal du Mahayana, et se trouve expos avec force da ns les commentaires que Nagarjuna effectuera des Prajnaparamita-sutra, commentai res qui constituent sans aucun doute une synthse ingale du sunyata. Par le fait qu' elle participe d'une trs grande attention porte au changement et la perception de la complmentarit des contraires, l'entreprise thorique de Nagarjuna n'est donc pas un jeu intellectuel, une scolastique abstraite et purement thorique; c'est une vri table mthode de libration, une concrte discipline de l'esprit ayant pour objectif d e librer l'homme du pige des vues parcellaires et fragmentaires. C'est une rfutatio
n vigoureuse des doctrines philosophiques marques par l'attachement substantialis te et objectifiant, un essai ambitieux d'chapper au pervers processus des opinion s contraires et contradictoires, une maeutique incomparable de l'Eveil, une exprience religieuse aux limites de l'vanescence, une dialectique si intimement libratrice qu'elle se supprime en s'exerant: auto-abolitive27; il n'y a plus chez Nagarjuna d e croyance en la persistance d'une vrit unidimensionnelle et ontique, telle en part iculier que nous l'avons hrite d'Aristote28; l'existence pour lui est non-existence , la non-existence est existence. .
L3: [V. La logique du vide] :L3 . Cette affirmation d'quivalence entre existence et non-existence ne manque pas de plonger celui qui aborde la doctrine nagarjunienne dans une profonde et naturell e perplexit. Il importe donc de comprendre, en premier lieu, que cette logique es t une logique de l'impermanence, c'est pourquoi elle chappe toute tentative de co mprhension fonctionnant sur le mode binaire du oui ou non, du systme du tiers excl u, qui considre qu'une chose ne peut tre vraie et fausse en mme temps. Lorsque nous disons qu'elle chappe la raison binaire, nous sous-entendons qu'instruite des mo des opratifs de la logique exclusive, elle met en uvre un mcanisme original de dpass ement des impratifs catgoriques du sens commun, ce en quoi elle apparat comme profo ndment dsorientante pour un esprit constitu et form par le jugement habituel de la r aison ontique. En effet, la logique laquelle nous somme familiariss, celle qui st ructure profondment, non seulement notre mode d'tre mais aussi notre mode de pense r, obit depuis des sicles au principe de l'incompatibilit des contradictoires. Cett e logique puise ses fondements chez les Grecs, et plus prcisment chez Aristote, qu i fut certainement celui qui contribua le plus formaliser les lois du raisonneme nt analytique du concret. N'oublions pas, cependant, que l'Inde connaissait et u tilisait dj les mmes et quasiment identiques outils intellectuels, et que les logic iens indiens possdaient un appareil analytique en tout point comparable, pour ce qui est de sa capacit effective matriser les lois du rel, la logique aristotlicienne . . L4: [La logique indienne] :L4 . Le systme de la logique indienne, un des six systmes orthodoxes du Darshana hindou , t exprim dans les Nyaya-sutra qui sont attribus gnralement Akshapada. On pense qu a rdaction des sutra se situe dans une priode localise entre le IIe et le IIIe sicle de notre re, toutefois Gautama, qui passe pour tre le fondateur de cette cole, vcut entre le VIe et le IIIe sicle avant notre re. L'cole Nyaya avait pour objet de fou rnir un fondement rationnel aux multiples croyances du panthon indien; pour cela on mit en uvre un appareil argumentaire fonctionnant sur la base d'une logique de la causalit et du jugement analytique, qui seront placs l'origine de la science vd ique. Les diffrents sutra feront l'objet de nombreux commentaires, les plus clbres sont ceux de Vatsyayana au IVe sicle, Uddyotakara Bharadvaja au VIIe, Vacaspatimir a au IXe et Udayana au Xe, on mesure ainsi l'influence qu'exercrent ces textes. O n aurait cependant tort d'imaginer les Nyaya-sutra comme des textes uniquement c entrs autour des problmes du jugement analytique: La doctrine classique des Nyaya-s utra n'est pas la premire manifestation d'un souci de logique. Les controverses d ont les Upanishad et les plus anciens textes mdicaux dits de l'Ayurveda donnent m aints exemples ont dvelopp de bonne heure la critique de validit des jugements et d es opinions29. D'autre part, il est intressant de constater l'troite intimit, en Ind e, du dveloppement de la logique et de la mdecine, puisqu'il a t suppos que la logique avait pris naissance dans les milieux mdicaux (...), toutefois la mthode logique dborda trs rapidement ce contexte pour dboucher sur des thmes plus philosophiques, c ar un des exemples majeurs de raisonnement donn par ankara est une dmonstration de l'existence du soi-mme, cho manifeste d'une utilisation simultane de la logique des fins autres que la solution des problmes mdicaux de diagnostic et de pronostic, q uoique le problme de l'existence du soi-mme (tman) comme substrat de l'tre psychique (sattva) intresse l'Ayurveda qui considre l'homme dans son ensemble psychique et
corporel 30. . Rappelons que les Nyaya-sutra distinguent dans leur analyse seize fondements ou objets des mots (padartha): On traduit habituellement padartha plus ou moins heur eusement par catgorie ou topique selon qu'on veut voquer une analogie de l'analyse du Nyaya avec la logique d'Aristote ou avec celle de la scolastique mdivale; ces c atgories d'une grande prcision sont les suivantes, du moins pour ce qui concerne l es six lments premiers de l'tablissement du jugement: 1. Les pramana, terme qui rec ouvre les critres du jugement (pratyaksha: la constatation directe, anumna: l'infre nce, upamna: la comparaison assimilatrice, abda: le tmoignage de l'autorit); 2. Les prameya, les objets du jugements; 3. Samaya, le doute; 4. Prayojana, le motif; 5. Drshtanta, l'exemple; 6. Siddhnta, la conclusion tablie. Il n'est peut-tre pas inu tile de regarder un instant le septime padartha appel avayava, et qui correspond n otre syllogisme: ~ Les avayava, ou membres du raisonnement typique aboutissant l'infrence, sont au nombre de cinq et le raisonnement lui-mme est souvent appel nyaya dans l'Inde e t syllogisme en Occident, par comparaison avec les syllogismes d'Aristote. Les m embres avec l'exemple classique sont les suivants: La proposition (pratijna): la montagne du feu. La raison d'tre (hetu): du fait qu'elle fume. L'assertion exemp lifie (udaharana): tout ce qui fume du feu, comme la cuisine. L'application (upan aya): et c'est le cas. Le rsultat (nigamana): il est donc ainsi (qu'il a t avanc)31. . Comme on le voit, le systme de la logique possdait ses propres mcanismes et des out ils rflexifs extrmement dvelopps, on donc pu, et juste titre, dcrire cette mthode un examen critique des objets de la connaissance par la dmonstration logique (Vat syayana, Nyaya-Bhashya). . Il n'est toutefois pas inutile de rappeler que la logique indienne n'a pas les mme s buts que la logique aristotlicienne (sur laquelle elle n'a eu aucune influence) . Alors que la deuxime s'efforce de construire les rgles d'un raisonnement valide en lui-mme (d'o son nom de logique formelle), la logique indienne est une logique de connaissance32. Le Nyaya, ou cole de la logique, qui est bien l'art de raisonne r au sens classique du terme, est une authentique science de la pense, se particu larisant en ce sens qu'elle a pour but premier de dlivrer de l'erreur, de l'illus ion, et de travailler en affranchir l'esprit. Plus prcisment, l'infrence originale de la mthode de la logique indienne a pour but de montrer l'existence d'une chose invisible, en partant d'un signe rel, et cela en dmontrant le lien existant ncessa irement entre le signe et la chose invisible. La science indienne du concret est donc une logique qui renvoie la ncessit d'admettre une Existence premire, une Caus e initiale dans l'tre que les docteurs indiens nommrent Isvara. Cependant, si le Ny aya reconnat l'existence du Seigneur (Isvara), car il faut bien trouver une cause efficiente au jeu de la rtribution des actes, la thologie n'est pas l'objet propr e du Nyaya33. Effectivement cette science de la logique un objectif unique: parve nir la dlivrance finale (apavarga); le Nyaya est un instrument de raisonnement et de science, mais aussi instrument de salut spirituel car la dlivrance ne s'obtien t que par la connaissance correcte: on arrive la dlivrance finale (apavarga) quan d on cart successivement la fausse connaissance (mithyajnana), les fautes (dosa), l'activit (pravrtt), la naissance (janma) et le malheur (duhkha). Comme chaque ter me de la srie engendre le suivant, le malheur de l'existence est caus en dernire an alyse par la fausse connaissance34. Ce souci de libration, de dlivrance, qui spcifie la logique indienne, se retrouve galement dans la logique nagarjunienne. Mais, s i les objectifs sont identiques, les analyses, l'examen, s'avrent divergentes sur de trs nombreux points, pour ne pas dire, d'ailleurs, sur pratiquement tous les points. . Les raisonnements nagarjuniens relvent d'une position initiale totalement diffrent e l'gard de la ralit concrte. On cite assez rgulirement les Nyaya-sutra (II, I, 37-40 , qui voulurent rfuter les arguments des auteurs Madhyamika au sujet de la problma tique du temps. Comme nous le verrons, Nagarjuna critique vigoureusement la poss ibilit de l'existence du temps car le mouvement interdit la capacit de pouvoir se
saisir d'une chose qui serait nomme du titre de prsent: . \ ### \ On n'apprhende pas un temps variable, et puisqu'un temps invariable ne peut tre apprhend, comment dsignera-t-on un temps non apprhend? (MK, XIX, 5). . \ ### \ 5. On n'apprhende pas un temps variable, \ Et puisqu'un temps invariable \ Ne peut tre apprhend, \ Comment dsignera-t-on un temps non apprhend? . \ ### \ A non-stationary "time" cannot be "grasped"; and a stationary "time" which can be grasped does not exist. \ How, then, can one perceive time if it is not "grasped"? . Les logiciens indiens rpliqueront en faisant remarquer que sans le prsent, le pass et l'avenir ne peuvent exister, que leur existence ne peut plus tre soutenue, or le pass et le futur existent bien, disent-ils, en se fondant sur une preuve de crd ibilit tire de l'exprience immdiate de la vie: les tres et les choses ont bien un pas s, un futur et donc un prsent. .
L3: [VI. La rfutation nagarjunienne de la logique indienne] :L3 . C'est prcisment le c ur de l'argumentation de la logique indienne que rfute Nagarjuna . Prenant comme point de dpart l'absence de nature propre des tres et des choses, il dmontre l'impossibilit thorique d'un jugement qui voudrait asseoir une affirmati on partir d'une vue partielle et donc incomplte, ses yeux, de la ralit, c'est--dire ne tenant pas compte du fait que ce qui est relatif n'a pas de ralit. Face aux poin ts de vue (drst) soutenus par ses adversaires, la dialectique de Nagarjuna se dplo ie en rfrence un double critre: l'intelligibilit des noncs, leur positivit. L'intell bilit se subdivise, elle-mme, en deux aspects: la rigueur logique ou la cohrence pu rement formelle d'une part, la possibilit ou l'impossibilit relle d'autre part selo n que la prtention s'accorde avec l'exprience ou bien est dmentie par elle. Quant l 'autre ple, l'exigence de positivit, il consiste se demander: de quoi parle-t-on? C'est le constat factuel qui rpond35. Ce constat dmontre que par l'absence de natur e propre des phnomnes, il est thoriquement et pratiquement impossible de leur confre r l'tre qui leur fait dfaut. Pour Nagarjuna, nous sommes en face d'un vide, d'une vacuit, qui empchent que puisse tre exprime une affirmation de l'existence l'gard des tres et des choses. . Tout baigne dans une universelle absence de consistance ontologique, ceci imposa nt que soit imprativement observ, vis--vis de l'ensemble des tants, un juste silence . Le refus nagarjunien d'admettre la proprit d'une essence dvolue aux phnomnes expliq ue que leur unique ralit soit qu'ils n'en possdent aucune, mme pas celle de ne pas e n avoir. Cela aura de trs importantes consquences sur le systme logique de Nagarjun a, dont la premire, parmi un certain nombre d'autres, est d'interdire toute forme de position arrte, d'o l'utilisation permanente de la rfutation comme mthode privilgi de sa critique. Dans le cadre de son argumentaire, Nagarjuna utilise trois types de rfutation: l'impossibilit logique (na yujyate), l'impossibilit relle (nopapadyat e), le constat d'inexistence (na vidyate)36. Cette triple rfutation fonctionne com me un mcanisme trs efficace, on constate sans peine d'ailleurs que son rejet des p ositions ou opinions limites et fragmentaires est d'une rare puissance. Toute aff irmation, fonde en raison, peut se voir rduite quasiment rien sous l'effet de la t riple rfutation nagarjunienne, il suffit pour cela de constater comment l'ensembl e des propositions qui constituent le rservoir permanent des discours susbstantia listes cde trs aisment sous le poids de la triple attaque en ngation. Logique rcurren te, logique ablative, on n'en finirait pas d'accumuler les qualificatifs les plu
s expressifs et les plus frappants pour tenter de cerner l'exacte appellation de la mthode critique de Nagarjuna. Nous sommes indniablement en prsence d'un systme q ui possde parfaitement sa cohrence; face la mthode caractristique de la logique ngati ve de la non-substance, tout, absolument tout peut tre rfut, mme la rfutation elle-mme , et la rfutation mme de cette rfutation. . L3: [VII. L'identit manquante de l'tre] :L3 . La vacuit nagarjunienne, qui se dfinit par le fait de refuser et d'chapper tous les points de vue, trouve un tonnant prolongement opratif dans sa mise en uvre lorsqu' elle fait l'objet d'une utilisation l'intrieur d'un dbat thorique. Comme mthode logi que, elle se comporte comme un outil critique, utilisable universellement en con tre, ngation et rfutation. Applique l'analyse des phnomnes, cette mthode brise toute a thorie classique et habituelle de l'identit (que l'on rsume gnralement ainsi: est A , donc n'est pas B). Cependant une chose ou un tre n'tant jamais ce qu'ils sont po ur la thorie nagarjunienne, rien ne peut se voir attribuer une proprit dans l'tre (A n'est donc pas A). Logique abolitive, elle implique galement son auto-abolition (si n'est pas A, alors n'est ni ni B); Nagarjuna montre bien en quoi, dans son Tr ait, ce qui n'a pas d'identit n'est identifiable aucune proposition: . \ ### \ Les Vainqueurs ont dclar que la vacuit est l'extirpation de toutes les vu es, et ont proclam incurables ceux qui font de la vacuit une vue (MK, XIII, 18). (i .e. Cette rfrence n est pas bonne. Il s agit de 13:8.) . \ ### \ 8. Les Vainqueurs ont dclar que la vacuit \ Est l'extirpation de toutes les vues \ Et ont proclam incurables \ Ceux qui font de la vacuit une vue. . \ ### \ Emptiness is proclaimed by the victorious one as the refutation of al l viewpoints; \ But those who hold "emptiness" as a viewpoint [the true perceivers] hav e called those "incurable" (asadhya). . Cette vritable profession de foi conduit obligatoirement l'vacuation du principe d u tiers exclu, et donc l'adoption du principe de l'identit des contraires et de l a non-identit de l'tre. . L'aboutissement invitable d'une telle attitude est l'vacuation, la cessation de to ute formulation en affirmation ou en ngation au sujet de l'tre ou du non-tre. La se ule solution, laisse la disposition de celui qui entreprend de pntrer et de s'immer ger authentiquement dans la logique du vide, reste le silence. L'identit manquant e de l'tre ne permet plus de confrer une singularit personnelle, individuelle, part iculire A, c'est--dire au traditionnel symbole de l'objet identifi, la proposition universelle affirmative. . Il n'est pas inutile ici de prciser que la logique classique considre qu'une propo sition est universelle, particulire, ou singulire, en fonction de sa quantit. Ce mot de quantit peut d'ailleurs lgitimement surprendre, mais il dsigne une notion importan te qui est celle de l'extension du sujet, ceci expliquant qu'une proposition est appele universelle lorsque son sujet est lui-mme universel, c'est--dire pris dans to ute son extension; elle est nomme particulire lorsque son sujet est particulier, c'e st--dire pris dans toute son extension. Cependant, une proposition est dite indfini e quand l'extension de son sujet n'est pas prcise. Mais cette extension rsulte de l a matire de la proposition. En matire ncessaire et impossible, le sujet est pris un iversellement; en matire contingente et possible, il est pris particulirement. Par
ailleurs, les propositions singulires sont assimiles aux particulires dans la suit e de la logique. Si maintenant on combine la qualit et la quantit des propositions , on obtient quatre types de propositions qu'on dsigne (arbitrairement) par les q uatre premires voyelles: -- universelle affirmative, A, -- universelle ngative, E, -- particulire affirmative, I, -- particulire ngative, O37. . Les coles mdiviales forgrent d'ailleurs, afin de faciliter la mmorisation de ces lois par les tudiants, une formule versifie et concise, caractre purement technique que l'on retrouve pour la premire fois dans le manuel de Pierre d'Espagne au XIIIe s icle: -- asserit A, negat E, verum generaliter ambo -- asserit I, negat O, verum particulariter ambo. . On aura soin, toutefois, de bien distinguer, lors de l'utilisation de l'universe lle affirmative A, le sujet logique qui est ce que l'on affirme ou nie l'intrieur d'une proposition, du prdicat qui, lui, se rfre l'attribut du sujet dans cette mme proposition. . A donc, entendu comme modle de ce qui est quelque chose et non une autre, n'est p lus, dans le systme nagarjunien, qu'une convention grammaticale, une facilit de la ngage. Le syllemme qui, en logique, nonce une conjonction d'identit, A et B la foi s, n'est lui-mme plus en mesure de pouvoir cerner le moteur dialectique de la vac uit, et il est d'ailleurs refus par Nagarjuna lorsqu'il dnonce plusieurs reprises c et amalgame: . \ ### \ Un agent qui est et n'est pas n'effectue pas une (action) qui est et n 'est pas; o aurait-on, dans une seule (base), l'existence et l'inexistence, mutue llement contradictoires? un agent existant n'effectue pas une action inexistante ; \ Un agent inexistant n'effectue pas l'existant car il s'ensuivrait ici aussi les fautes dj exposes (MK, VIII, 7-8). . \ ### \ 7. Un agent qui est et n'est pas \ N'effectue pas une (action) qui est et n'est pas; \ O aurait-on, dans une seule (base), \ L'existence et l'inexistence, mutuellement contradictoires? . \ ### \ And a real-nonreal producer does not produce in a real-nonreal manner . \ For, indeed, how can "real" and "non-real," which are mutually contra dictory, occur in one place? . \ ### \ 8. Un agent existant \ N'effectue pas une action inexistante; \ Un agent inexistant n'effectue pas l'existant \ Car il s'ensuivrait, ici aussi, les fautes dj exposes. . \ ### \ A real producer (kartra) does not produce what is non-real, and a non -real producer does not produce what is real. \ [From that] indeed, all the mistakes must logically follow. . Remarquons, d'ailleurs, que Nagarjuna en cela est fidle au Bouddha, qui demandait
que l'on se tienne gale distance du il y a (astti), et du il n'y a pas (nastti). Ce sentence fait l'objet d'une reprise quasiment littrale dans le Trait du Milieu: . \ ### \ Dans son Instruction Katyayana, rappelle Nagarjuna en faisant rfrence l'p isode historique o le Bouddha renvoya dos dos les propositions contradictoires, l e Vainqueur transcendant, connaisseur des choses et des non-choses, rfut la fois l 'existence et la non-existence (MK, XIV, 7). (i.e. Cette rfrence n est pas bonne. Il s agit de 15:7.) . \ ### \ 7. Dans son Instruction Katyayana, \ Le Vainqueur transcendant, connaisseur des choses et non-choses, \ A rfut la fois \ L'existence et l'inexistence. . \ ### \ In "The Instruction of Katyayana" both "it is" and "it is not" are op posed \ By the Glorious One, who has ascertained the meaning of "existent" an d non-existent." . Ceci explique certainement l'attitude de Nagarjuna qui, rfutant une proposition, refuse catgoriquement d'adopter la contradictoire de la thse qu'il vient de rejete r; les purs Madhyamika, souligne G. Bugault, ceux qu'on appelle Prasangika, prati quent le prasajya-pratisedha, la rfutation pure et simple sans contrepartie posit ive. C'est le cas de Nagarjuna, poursuit-il, contrairement nos habitudes implici tes, il ne se croit nullement oblig d'endosser la contradictoire de l'hypothse qu' il vient de congdier. Aprs avoir montr l'inconsistance de l'nonc qu'il vient de ruine r, il se tait38. Nagarjuna se tait en effet, car la manire dialectique rpond l'usage exclusivement prparatoire et purificateur qu'en ont fait les Madhyamika les plus radicaux, singulirement Nagarjuna, Buddhapalita et Chandrakirti. Cette dialectiq ue n'est aucunement dogmatique et didactique, comme peut l'tre celle de Hegel. So n unique mais dcisive fonction est de dtruire les points de vue (drst) les uns par les autres et ainsi de faire place nette pour une ventuelle intuition libratrice, laquelle survient dans le vide, abruptement et instantanment39. L'articulation dia lectique de la logique nagarjunienne se dploie donc comme un mcanisme de la rfutati on permanente, impossible saisir; elle joue non sans une certaine aisance avec l es positions contradictoires: . \ ### \ Les Eveills ont mentionn: "Le je existe", ils ont aussi enseign: "Le je n 'existe pas"; mais ils ont encore proclam que n'existe aucun je ni non-je (MK, XVI II, 6). . \ ### \ 6. Les veills ont mentionn: Le je existe, \ Ils ont aussi enseign: Le je n'existe pas; \ Mais ils ont encore proclam \ Que n'existe aucun je ni non-je. . \ ### \ There is the teaching of "individual self" (atma), and the teaching o f "non-individual self" (anatma); \ But neither "individual self" nor "non-individual self" whatever has been taught by the Buddhas. . L4: [La non-voie] :L4 . La Voie du Milieu se prsente, paradoxalement, comme une absence de Voie, un refus
du dilemme regard comme une attitude mtaphysique rductrice et limite; incomplte. Dan s un exemple parfait de ce que la logique aristotlicienne appelle le ttralemme, c' est--dire une logique quadrangulaire (catuskati) o: 1. A est vrai, 2. A n'est pas vr ai, 3. A est vrai et faux, 4. A n'est ni vrai ni faux, Nagarjuna n'hsite pas crire : . \ ### \ Tout est vrai, non vrai, vrai et non vrai, ni vrai ni non vrai; tel es t l'enseignement de l'Eveill (MK, XVIII, 8). . \ ### \ 8. Tout est vrai, non vrai, \ Vrai et non vrai, \ Ni vrai ni non vrai; \ Tel est l'enseignement de l'veill. . \ ### \ Everything is "actual" (tathyam) or "not-actual," or both "acts actua l-and-not-actual," \ Or "neither-actual-nor-not-actual": \ This is the teaching of the Buddha. . Ceci s'explique sans peine, si l'on veut bien admettre les consquences naturelles de l'affirmation de la non-substantialit, car faute de trouver une nature propre dans les tres et faute mme d'y trouver une forme, ft-elle rsiduelle, de dtermination substantielle, Nagarjuna est donc oblig d'en conclure que, face une telle carenc e ontologique, il ne peut y avoir ni affirmation ni ngation exprimes l'encontre de n'importe quel phnomne ou de n'importe quel sujet; toute proposition du ttralemme est donc galement fausse. Mais si ni affirmation ni ngation ne sont possibles, alo rs, par cette mme et identique impossibilit, toute affirmation et toute ngation son t galement autorises. Nous sommes ici en prsence de la figure logique la plus rcurre nte et la plus stupfiante, anime par une constante mobilit et permanente circularit. Le ttralemme, en tant que forme acheve de logique auto-abolitive, est donc une to talit constituante reconnaissant comme vraie toute affirmation, toute ngation, tou te non-affirmation et toute non-ngation, et incluant galement la possibilit qu'une proposition soit tout la fois vraie et fausse en mme temps, ce qui est proprement insoutenable pour la logique aristotlicienne, et galement pour l'ensemble des log iques classiques. La science de la logique considre en effet que deux proposition s contradictoires ne peuvent tre vraies ensemble, ni fausses bien videmment ensemb le; si l'une est vraie l'autre est donc fausse, entre deux propositions contrair es il ne peut y avoir normalement identit. Aristote en donne l'argument thorique d e la manire suivante: Impossible que le mme attribut appartienne et n'appartienne p as au mme sujet en mme temps et sous le mme rapport40. C'est la ce qui prside au prin cipe suprme de la logique, la fameuse loi de non-contradiction, littralement et su perbement ignore par le ttralemme de Nagarjuna, loi qui constitue le fondement mme de toute science du raisonnement, nomme en langage scolastique principium identit atis et discrepantiae, qui sert de base l'esprit puisque posant les rapports pos sibles entre deux termes d'une proposition donne. Aristote affirme qu'une fois ni le principe de contradiction, il en rsulte qu'on ne sera forc ni l'affirmation ni l a ngation41, il ajoute mme: il est clair que la discussion avec un tel adversaire es t sans objet. Car il ne dit rien. Il ne dit ni ainsi ni non-ainsi, mais il dit a insi et non-ainsi42. Aristote en tire cette conclusion: S'il ne dit rien, il serai t ridicule de chercher un argument opposer quelqu'un qui n'argumente sur quoi qu e ce soit pour autant qu'il en est bien ainsi. Un tel homme, en tant que tel, es t pareil a une plante (...) S'il ne prend rien son compte, si c'est gal pour lui d'avoir une opinion ou de n'en avoir point, en quoi diffrera-t-il des plantes43? N agarjuna serait-il donc une plante? n'aurait-il donc rien dire? C'est ce qu'il s emble confirmer lui-mme dans la stance suivante: . \ ###
\ Ni identit, ni diversit, ni anantissement, ni permanence, tel est le nect ar de l'enseignement des Eveills, protecteurs du monde (MK, XVIII, 11). . \ ### \ 11. Ni identit, ni diversit, \ Ni anantissement, ni permanence, \ Tel est le nectar de l'enseignement \ Des veills, protecteurs du monde. . \ ### \ The immortal essence of the teaching of the Buddhas, the lords of the world, is \ Without singleness or multiplicity; it is not destroyed nor is it ete rnal. . Nagarjuna n'a donc en apparence rien dire, car les choses sont ce qu'elles sont, et en ultime analyse tout discours est jug par lui vain et inutile, mais ds qu'il se trouve face une opinion limite, ds qu'il rencontre une vue spcifique fragmentai re, alors il emploie avec une implacable matrise, et une science accomplie des mu ltiples rouages de la dialectique des contraires, l'outil aiguis de sa critique, dont le ttralemme incarne l'une des formes opratives. Son silence n'est donc pas a ssimiler une attitude qui relverait du vgtal; loin d'pouser une position d'indiffrent isme en matire philosophique, logique ou thorique, il combat au contraire avec vig ueur, pour parvenir la juste comprhension de la doctrine originelle de l'Eveill. S a logique est une arme place au service de la vrit intime de l'tre des choses, c'est le levier par excellence de sa critique, c'est la mthode mme de son discours mtaph ysique. Pour Nagarjuna la ralit est proprement indicible, elle oblige, de par sa n on-substantialit, refuser toute tentative de rduction logique. Nanmoins l'indicibil it, qui conduit bien videmment la vrit au point mme de ne pouvoir tre dite, ncessite m lgr tout, afin qu'elle soit exprime, qu'il puisse tre possible de parler en gardant le silence, ou si l'on prfre de rester muet tout en parlant. Le mutisme, regard av ec reproche par Aristote, s'il est celui du vgtal ne pose aucun problme d'ordre phi losophique particulier, si ce n'est de simplement constater qu'il est impossible de dialoguer avec l'incohrence ou la stupidit; mais le mutisme nagarjunien est d' un ordre bien diffrent, et c'est bien ce qui cre la difficult, car il ne saurait tre rduit au silence du rgne vgtal. Nagarjuna met bien videmment ainsi en lumire la dlica e, mais aussi surprenante, situation du penseur qui tente de cerner la vrit de la ralit, tout en sachant que cette vrit ne peut tre dite, puisque indicible, mais est c ontraint nanmoins de devoir exprimer ce qui ne peut l'tre en le disant. Le dire in dicible de la vacuit est dj, en lui-mme, la concrte et exemplaire situation de l'impo ssibilit du dicible s'agissant de l'absolu dans sa vrit. Du vide il n'y a videmment rien dire, car on ne peut possder une vrit, exprimer un dire, de ce qui ne possde en propre aucune essence existentielle. . Que nous rappelle Nagarjuna? Tout simplement qu'au sein de l'absence de nature p ropre, au c ur de la non-substance, toute parole est elle-mme non substantielle, to ut dire est condamn la non-signification, toute expression frappe de non-consistan ce. Comprendre cela, c'est comprendre qu'il n'y a pas d'accs l'incommunicable par la mdiation du langage conceptuel, qu'il n'y a pas de chemin l o nul ne chemine, q ue nulle parole ne parle de ce qui ne se dit pas, qu'aucune formule ne peut sign ifier ce qui ne se formule pas, qu'aucun discours ne peut traduire ce qui ne se traduit pas. La parole silencieuse de Nagarjuna, sa voix (voie) muette, n'est fi nalement que la juste formulation, l'unique possibilit offerte l'expression forme lle de la vacuit, c'est--dire au nectar de l'enseignement des Eveills. . . ******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* .
. L2: [3. La dialectique de la non-substance] :L2 L3: [I. La Loi (dharma) et la notion de loi] :L3 . Affirmer, comme le fait le bouddhisme, que les phnomnes sont soumis une dterminatio n causale, dtermination constitutive de l'existence mme de ce qui est, c'est sousentendre que tout est frapp par une loi universelle de conditionnement, que tout es t sous l'intgrale emprise du principe de causalit. C'est d'ailleurs sous l'angle p articulier de cette loi de ncessit (dharmadhtu) que s'articulent les Quatre Nobles Vrits, qui fondent l'ossature de la Doctrine du Bouddha, et qui sont, par effet de correspondance, l'essence de la Loi (dharma) au sens de Doctrine fondatrice de l'Eveill. . Les Quatre Nobles Vrits, considres comme l'essence mme de la Doctrine du Bouddha, rvle t, selon un ordre didactique et pdagogique: 1. que toute existence est douleur, 2 . ce que sont les causes de l'origine de la douleur, 3. la possibilit de la cessa tion de la douleur, et enfin, 4. le chemin qui conduit la cessation (Nirvana) de la douleur. La formulation de cet enseignement eut lieu lors du Sermon de Bnars, qui fit suite l'illumination du Bouddha. Ce premier sermon joue un rle fondamenta l dans la Doctrine puisqu'il prside la mise en route, la mise en mouvement, de la Roue de la Loi (dharma-chakra). Cette Roue est gnralement reprsente dans l'iconograph ie bouddhiste avec huit rayons symbolisant le Noble Sentier Octuple, Sentier con duisant la cessation de la douleur, divis de la manire suivante: Comprhension juste , Pense juste, Parole juste, Action juste, Moyens justes, Effort juste, Attention juste, Concentration juste. Le Sermon de Bnars, qui eut comme thtre le parc aux Gaz elles, est tout fait caractristique de l'ambigut dans laquelle se trouve l'Eveill. E n effet, dsireux de faire connatre son exprience, il tait ncessaire d'employer pour c e faire le langage conceptuel; or dcrire conceptuellement une exprience de la natu re de l'Eveil est une impossibilit dans les termes: ~ Cette difficult fondamentale explique que les textes canoniques paraissent tre des rptitions sans fin, car plutt qu'un expos synthtique et unique, impossible, c'es t l'assimilation progressive qui est recherche (...) Certains exgtes considrent qu par tir de son Illumination (si l'on excepte sa mort), l'histoire personnelle du Bou ddha Skyamuni est termine. C'est pourquoi le Lalitavistara, l'une des plus importa ntes biographies sanskrites du Bouddha, s'arrte ici: il est dfinitivement dtach l. . On comprend mieux pourquoi la Loi qu'enseigne le Bouddha est celle de la Disposit ion gnrale des choses (dharma), qui sont elles-mmes des dispositions naturelles des quelles nat la douleur et qu'il faut connatre en leur essence et leurs modes de pr oduction pour pouvoir chapper leur emprise2. une loi de dtermination causale, rpond la Loi de la Doctrine, le corps de la Loi (dharma-kaya), la Loi de la Voie propre vers l'Eveil. une forme rigoureuse, et universelle de lien structurel, tenant so us son emprise tous les tres, le Bouddha rplique par l'annonce de la Loi qui mne la c essation de l'illusion et de la souffrance. Cette Loi prend son socle sur la not ion d'Eveil, notion qui synthtise non seulement l'objectif, mais galement le sens mme de la Doctrine. ce titre la Loi, de par son quivalence, est rigoureusement syn onyme de la Voie. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'est rappel trs souvent que la Loi constitue, avec le Bouddha et la Communaut (sangha), l'un des Trois Joyaux de la Doctrine (triratna). . On aura soin tout de mme de prciser ici, tant son influence est grande au sein du bouddhisme Mahayana, que le Ch'an, de par sa mthode originale qui lui est caractri stique, c'est--dire, selon l'expression mme de Bodhidharma: Une transmission spciale en dehors des Ecritures, ne considre pas le Dharma du Bouddha (Bupp, jap.) comme u ne doctrine rationnelle pouvant tre enseigne de manire classique ou commune. Pour l e Ch'an, la Vrit relve d'un ordre insaisissable l'intelligence discriminante; seule l'intuition directe, l'illumination subite de l'Eveil (satori, jap.), permet d' apprhender vritablement l'authentique ralit de l'tre. On entend d'ailleurs dire trs so uvent que, pour le Ch'an et le Zen, celui qui ralis l'Eveil est semblable un muet q
ui aurait eu un rve. Le satori semble bien tre un vritable mysterium ineffabile, une forme radicalement insaisissable de comprhension, par-del toute conceptualisation , o tout discours logique classique apparat comme vain et inutile. Dans cette opti que, l'tre est prserv dans son indicibilit supra-conceptuelle; indicibilit qui ne com porte aucune possibilit de traduction positive. Pour le Ch'an / Zen, la vrit de l'tr e est inexprimable, elle est au-del de l'exprience personnelle; elle consiste en u n renversement catgorique du mode habituel de prsence au monde. Ce qui est ralis par l'Eveil relve uniquement de l'Eveil lui-mme. Forme unique d'accs ce qui ne comport e aucun accs, le Ch'an et le Zen, de par leur attitude et leur mthode, sont les di gnes hritiers de la pense nagarjunienne, non pas en se souciant d'approfondir conc eptuellement, certains diront, non sans raison, en pure perte, la thorie de la va cuit, mais dans un esprit pratique et concret, en l'incarnant dans une mthode rigo ureuse de libration effective du dualisme. . Toutefois, selon l'enseignement premier du Bouddha, exprim avec clart, la loi de c ausalit, dite aussi loi de disposition naturelle dont provient la douleur, place a u c ur de toute existence, frappe de son dterminisme la totalit des formes vivantes; son universalit est sans partage, elle s'applique sans aucune limite l'ensemble des tants. Bien videmment une multitude de lois rgissent le monde, les lois de la n ature en premier lieu, celles qui prsident au devenir organique et inorganique du cosmos, les lois de la pense, les lois sociales, etc. Cependant, les lois de cha que domaine de la ralit possdent des traits communs qui se situent dans le cadre de la notion de loi, dans son sens le plus large. Quels sont donc ces traits? . Une loi est avant tout un rapport, une connexion entre les tres. Mais une loi n'e st pas une connexion quelconque, c'est un rapport stable qui se rpte, elle caractri se une liaison gnrale entre les phnomnes, elle la nature de l'universel, elle imprim e aux choses un cours strictement dtermin. La loi est en fait un rapport ncessaire, dans le sens o l'on qualifie de ncessit tout processus qui ne peut manquer de se pro duire dans des conditions donnes. Nous touchons d'ailleurs ici au problme de l'troi te interdpendance entre la loi et la ncessit, qui occupe toute la problmatique doctr inale de l'enseignement du Bouddha. Cet aspect particulirement caractristique de l a Doctrine du Bienheureux demande une vigilante attention et un examen rigoureux , car il constitue l'axe du corpus analytique de sa pense. . Retenons, pour l'instant, qu'est qualifi de ncessaire tout processus qui ne peut m anquer de se produire dans des conditions donnes. Ainsi par exemple, si les phnomne s n'taient pas conditionns nous ne pourrions pas parler de loi vis--vis de leur pro duction. Professant le principe du dterminisme universel, Nagarjuna, la suite du Bouddha, entendra par la loi, la relation ncessaire entre tous les phnomnes qui, pa r son exercice constant, lie causalement leur ralit effective; tout ce qui la natur e de l'apparition, tout cela la nature de la cessation (Majhima-nikya).
Nagarjuna raffirmera que ~ c'est la loi de production conditionne que nous entendons sous le nom de vacu it. C'est la une dsignation mtaphorique, ce n'est rien d'autre que la Voie du Milie u 3. . Est-il donc, pour tre clair, affirm que tout ce qui se produit rsulte jusque dans l es moindres dtails d'une dtermination, d'une ncessit naturelle inluctable? Cela ne fa it aucun doute, si on comprend bien videmment qu'il est question d'une dterminatio n de condition (la finitude de notre nature, les limites imposes par la ralit, les enchanements rciproques, etc.). . Telle est la pense, en tout point conforme l'enseignement historique du Bouddha, du Madhyamakakarika de Nagarjuna. Est ncessaire, pour lui, ce qui dcoule de la rali t des choses et des tres, et prcisment cette ncessit porte justement sur la conditionn alit universelle des phnomnes, en quoi consiste la vacuit. La ncessit apparat ici comm un principe au sens exact o l'entendra saint Thomas d'Aquin: Un principe est ce d ont quelque chose procde, de quelque manire que ce soit4. Un principe est, de la mme
manire, selon Nagarjuna, ce dont dpendent les phnomnes dans leur existence. Le prin cipe ou la loi ne sont pas transcendants la ralit sensible, phnomnale, ils en consti tuent les rapports structurels, internes, essentiels. Hegel le redira dans un ton nant parallle: La loi ne se trouve pas en dehors, au-del du phnomne, mais lui est dir ectement immanente; le rgne de la loi est l'image calme du monde existant ou phnomn a15. Le bouddhisme repose galement en cela, non pas sur une conception idaliste d'u n rapport au divin, mais sur l'objectivit concrte d'une prise en compte des lois d u rel. Reconnatre, pour le bouddhisme, que les phnomnes, dans leur tre, sont dpendants radicalement de causes, c'est reconnatre invitablement que la ncessit, en tant que principe, rgne dans le monde, que la ncessit fait loi. . La ncessit, qui peut se rsumer l'affirmation de la dtermination sous laquelle se tro uvent soumises toutes les formes vivantes, sera toujours expose avec force dans l 'enseignement du Bouddha, mais recevra, comme lment d'quilibre, et cela ds les texte s les plus anciens, la possibilit, offerte au c ur mme de la dtermination, de vaincre la loi de ncessit: Tout ce qui est soumis la loi de l'origine est compltement soumi s la loi de cessation. Ainsi, par une trange rciprocit, qui s'panouira brillamment av ec Nagarjuna, le dharma, en tant que loi de dtermination causale et origine de la douleur, est galement, aussi surprenant que cela puisse paratre, l'essence de la Loi de la Doctrine. L'enseignement du Bouddha n'est pas, comme nous pouvons nous en rendre compte, diffrent de la loi immanente de l'univers: l'Eveil n'est pas d iffrent de l'impermanence (samsara), . \ ### \ le cycle ne se distingue en rien de l'au-del des peines (Nirvana). L'au -del des peines ne se distingue en rien du cycle (MK, XXV, 19). . \ ### \ 19. Le cycle ne se distingue en rien \ De l'au-del des peines. \ L'au-del des peines ne se distingue en rien \ Du cycle. . \ ### \ There is nothing whatever which differentiates the existence-in-flux (samsara) from Nirvana; \ And there is nothing whatever which differentiates Nirvana from exist ence-in-flux. . La dialectique de la non-substance fonctionne et agit continuellement en interdpe ndance des contraires; vertigineuse et infinie unit dialectique du dharma ternel. . L3: [II. De l'ontologie ngative la ngation de l'ontologie] :L3 . Insister, comme le bouddhisme, sur le fait que le principe de ncessit soumet l'app arition et la disparition tout tre par le simple fait qu'il est existant, c'est s ous-entendre, induire que, portant en lui-mme les germes de sa propre destruction , chaque tre se tient dans sa vie comme tant dj mort; les germes de la vie sont les germes de la mort. La causalit atteint, de cette manire, un statut moteur au centr e de l'argumentaire de la Voie; les liens de causalit, en dterminant de faon implac able la moindre forme vivante, dterminent galement la disparition et la cessation l'ensemble du cr. Le principe n'est donc pas extrieur au principe, tout est conditi onn, tout prend racine dans cette production conditionne (pratitya-samutpada), qui rg it la totalit du vivant. Tout se trouve engag, irrmdiablement, dans une relation d'i nterdpendance absolue, tout est dtermin par la loi universelle de non-substantialit. Inexorablement donc, notre acte d'tre est dj une prfiguration effective du ne-plus-t re, et le ne-plus-tre est paralllement la forme effective de l'tre: L'tre pur et le na nt pur, c'est donc la mme chose6; comme un cho lointain la pense de Nagarjuna, Heide gger, dans son ambitieuse tentative de dpassement de la mtaphysique occidentale, r
ejoint sans s'en douter l'intuition majeure de la Voie du Milieu. Cela n'est pas pour nous surprendre, lorsque l'on sait avec quelle nergie Nagarjuna lui-mme comb attu l'ontologisme brahmanique. Mais Nagarjuna ira plus loin encore puisque, plu s qu'une simple critique de l'ontologisme, il tente de montrer en quoi le plein exercice de la loi d'impermanence entrane en ralit l'impossibilit d'affirmer l'exist ence mme! . \ ### \ Que l'tre (bhava) existe rellement (svabhavena), c'est impossible, ou al ors il faudrait admettre que l'tre devient non-tre (MK, XXI, 17)7. . \ ### \ 17. Si une chose existe en soi, \ Qu'elle devienne une non-chose est illogique, \ Lors de l'au-del des peines, il y aurait anantissement \ Car le continuum du devenir est apais. . \ ### \ If there is self-existence of something which is intrinsically existi ng, then non-existence does not obtain. \ At the time of Nirvana there is destruction of the cycle of existence (bhavasamtana) as a result of the cessation. . Pour Nagarjuna, tre, au sens d'existant, c'est exister en dpendance, c'est tre caus, c'est--dire ne pas tre. Or, il n'est pas possible que l'tre devienne du non-tre: . \ ### \ Pour qu'un tre, humain ou autre, puisse tre accept comme existant, il fau drait, pour satisfaire aux exigences contradictoires des antinomies nagarjunienn es, qu'il ft la fois ternel (vata) et sujet la destruction (uccheda), car, s'il n'es t pas ternel, il est dj annihil, et s'il n'est pas dj annihil, c'est qu'il tait tern , XXI, 14)8. . \ ### \ 14. Admettre l'existence des choses \ A pour consquence les vues de permanence et d'annihilation \ Car les choses \ Seront ternelles ou transitoires. . \ ### \ For someone assuming an existent thing, either an eternalistic or nih ilistic point of view would logically follow, \ For that existent thing would be either eternal or liable to cessatio n. . L'affirmation de Nagarjuna ne manque pas de force: . \ ### \ L'tre ne saurait sortir de l'tre ni du non-tre, pas plus que le non-tre ne saurait sortir de lui-mme ou de l'tre (MK, XXI, 12)9. . \ ### \ 12. Une chose ne nat pas d'une chose, \ Une chose ne nat pas d'une non-chose, \ Une non-chose ne nat pas d'une non-chose, \ Une non-chose ne nat pas d'une chose. . \ ### \ An existent thing does not originate from [another] thing; \ and an existent thing does not originate from a non-existent thing.
\ Also, a non-existent thing does not originate from another non-existe nt thing; \ and a non-existent thing does not originate from an existent thing. . Cela signifie tout simplement que l'tre ne peut provenir de l'tre antrieur lui-mme s ans que celui-ci disparaisse, car il y aurait ce moment-la non une production ma is une continuit. Cependant, dans le cas contraire, si l'tre initial ou antrieur ve nait disparatre en engendrant l'tre produit, on se trouverait en face d'un tre qui surgirait du non-tre, ce qui est totalement impossible: Du rien rien ne vient10. Ef fectivement, surgir du nant c'est ne pas surgir du tout, puisque le nant est une p ure absence. Le nant n'est pas un tat, le nant n'est que nant. Pour venir l'tre, ce l'on implique en parlant d'une cration, il faudrait qu'il y ait dj de l'tre, et c'e st justement cet tre qui fait dfaut. Nagarjuna en conclut donc: . \ ### \ L'tre ne peut sortir de lui-mme ni d'autre chose, donc il ne peut se pro duire (MK, XXI, 13) 11. . \ ### \ 13. Les choses ne naissent pas d'elles-mmes, \ Elles ne naissent pas d'autres (choses); \ S'il existe une naissance de soi-mme et d'autres, \ Comment se produira-t-elle? . \ ### \ An existent thing does not originate either by itself or by something different. \ Or by itself and something different [at the same time]. How, then, c an it be produced? . Ainsi, en partant de l'analyse du principe de ncessit, Nagarjuna, par l'exercice d 'un stupfiant outil dialectique, parvient dmontrer l'impossibilit logique de l'affi rmation de l'tre. Son argumentation, souvent d'une grande habilet, interdit absolu ment la formation d'une certitude ontologique. Le socle mtaphysique de l'ontologi e classique est brusquement projet dans un abme sans fond, abme qu'il est impossibl e de pouvoir combler par des moyens rationnels. On n'est donc pas surpris de ret rouver sa ngation de l'ontologie (qui n'est en rien une ontologie ngative, c'est--d ire une thorie du rien comme tre, ou de l'tre comme rien) dans la dfinition mme du Bo uddha: . \ ### \ L'tre propre (svabhava) du Bouddha consiste ne pas avoir d'tre propre (a svabhava), en quoi son tre propre est identique celui du monde (MK, XXII, 16)12. . \ ### \ 16. La nature du Tathagata, \ Cela est la nature de ce monde; \ L'absence de nature propre du Tathagata \ Est l'absence de nature propre de ce monde. . \ ### \ The self-existence of the "fully completed" [being] is the self-exist ence of the world. \ The "fully completed" [being] is without self-existence [and] the wor ld is without self-existence. . La dfinition du Bouddha s'appliquant galement tous les tres, c'est la totalit de l'e xistence qui est, son tour, dnue d'tre propre; ce qui en toute rigueur de terme sig nifie que l'tre n'est pas lui-mme caractris par l'tre. L'absence d'tre propre est la d inition exacte de la vacuit, dont on ne peut absolument pas faire une base pour a
sseoir une essence. Sur le vide on ne peut rien fonder; le vide et l'absence d'tr e ne sont pas un tat dans l'tre, ou l'intrieur de l'tre, c'est bien plutt d'une total e htrognit qu'il faudrait parler, d'un tout autre mode de prsence/absence. Ne pas poss er de nature propre, c'est ne pas participer rellement de l'tre, c'est ne pas tre e t ne pas tre tout autant ce ne-pas-tre. Ngation de la ngation, qui n'aboutit mme pas une affirmation, puisque cette dernire est videmment impossible au sujet de ce qui jamais et en aucune manire ne possde de nature propre. La nature du vide est tout simplement de ne pas avoir de nature. L'preuve du dlaissement ontologique, laquel le nous convie Nagarjuna, est une preuve exigeante, elle oblige quitter radicalem ent et dfinitivement le domaine de la qualification existentielle. L'ordre du jug ement est donc profondment boulevers, dans la mesure o nous avons pour habitude d'va luer les tres l'aune de leur niveau de prsence ou de hirarchie dans l'tre. Les degrs d'tre, les tats multiples de l'tre13, sont pour Nagarjuna, en ultime et dernire analys e, rduits une seule et brutale considration gnrale: l'absence de nature essentielle (asvabhatha), qui a pour unique nom vacuit. L'universelle intercausation, la cont ingence, plongent les tres dans la momentanit (ksanabhanga) 14, momentanit fugitive et fragile du paratre (et non de l'tre), constituant les raisons spcifiques du refus o ntologique nagarjunien. La momentanit n'est finalement que la loi de ncessit traduit e en termes de temps, c'est l'image du temps en son paratre, en son non-tre, en so n non-temps. .
L3: [III. L'tre et le temps] :L3 . Point n'est besoin, pour en saisir toute l'importante porte mtaphysique, de trop i nsister sur le sens de cette intuition au sujet de l'identit dans l'impermanence entre l'tre et le temps. Le problme pour Nagarjuna consiste en cette affirmation s i l'tre n'a aucune substance vritable, le temps lui-mme ne peut trouver exister aut hentiquement, . \ ### \ si le temps dpend des choses, comment existera-t-il en l'absence des ch oses? (Si) aucune chose n'existe, comment le temps existera-t-il? (MK, XIX, 6). . \ ### \ 6. Si le temps dpend des choses, \ Comment existera-t-il en l'absence de choses? \ (Si) aucune chose n'existe, \ Comment le temps existera-t-il? . \ ### \ Since time is dependent on a thing (bhava), how can time [exist] with out a thing? \ There is not any thing which exists; how, then, will time become [som ething]? . La rfutation du temps selon son entit propre s'opre par la rfutation de la subdivisi on du temps en trois squences (pass, prsent, futur), squences dnues d'tre car vides de substance propre: . \ ### \ Si prsent et futur dpendaient du pass, prsent et futur existeraient dans l e pass, Si prsent et futur existaient dans le pass, comment prsent et futur en dpendra ent-ils? (MK, XIX, 1-2). . \ ### \ 1. Si prsent et futur \ Dpendaient du pass, \ Prsent et futur \ Existeraient dans le pass.
. \ ### \ If "the present" and "future" exist presupposing "the past," \ "The present" and "future" will exist in "the past." . \ ### \ 2. Si prsent et futur \ Existaient dans le pass, \ Comment prsent et futur \ En dpendraient-ils? . \ ### \ If "the present" and "future" did not exist there [in "the past"], \ How could "the present" and "future" exist presupposing that "past? . Si l'tre est dpourvu d'existence relle, le temps ne peut trouver se fixer, s'tablir, sur l'une quelconque de ses trois dimensions. Or, s'il lui est impossible de se fixer, de prendre prise sur l'un de ses aspects, le temps ne peut prtendre exist er pleinement. Si le temps ne peut tre qualifi que par son inconsistance ontologiq ue, comment, dit Nagarjuna, nommer un temps qui n'existe pas? . \ ### \ On n'apprhende pas un temps variable, et puisqu'un temps invariable ne peut tre apprhend, comment dsignera-t-on un temps non apprhend? (MK, XIX, 5). . \ ### \ 5. On n'apprhende pas un temps variable, \ Et puisqu'un temps invariable \ Ne peut tre apprhend, \ Comment dsignera-t-on un temps non apprhend? . \ ### \ A non-stationary "time" cannot be "grasped"; and a stationary "time" which can be grasped does not exist. \ How, then, can one perceive time if it is not "grasped"? . Un temps auquel on ne peut fournir de nom, qui n'est en fait l'lment palpable d'au cune situation, est un temps inexistant, ce n'est mme pas une absence de temps, c 'est un non-temps, une pseudo-reprsentation du temps, une chronologie imaginaire fonde sur l'vanescence et la disparition. La continuit exprimentable des tres ne peut prendre son appui sur l'affirmation du temps, elle droule son absence de nature au sein de l'impermanence. La fuite du temps n'est mme pas un devenir, devenir pa r lequel une chose deviendrait ce qu'elle n'est pas; non, la fuite du temps c'es t la non-existence du temps; l'insubstantialit de l'tre entrane, implique, impose, la non-existence du temps. . Dans une autre perspective, pour saint Thomas, le temps est solidaire du mouveme nt, ce qui explique son caractre continu. Cependant, de par le fait que le mouvem ent est apprhend en tant que distingu entre l'avant, l'aprs et le pendant, le temps est peru comme nombre dans le mouvement: Puisque dans tout mouvement il y a succes sion et une partie aprs l'autre, du seul fait que nous nombrons dans le mouvement l'avant et l'aprs, nous avons la perception du temps qui ainsi n'est rien d'autr e que le nombre de l'avant et de l'aprs dans le mouvement15. Or le nombre, c'est--d ire ce qui permet la mesure, n'est en tout tat de cause que la mesure du mouvemen t de l'tre, de l'tre concret existant. Le nombre ne peut donc trouver un champ d'a pplication sur du vide, de l'inexistant; il numre un changement, une succession, u ne continuit ou une fin dans l'tre. Le nombre dcrit un processus propre au vivant, il dcrit le processus de la gnration, comme celui de la corruption, il est intimeme nt li au devenir de l'tre. De l'tre, il manifeste le changement et l'volution, il en constate les modifications. Toutefois, il importe pour Nagarjuna que l'tre puiss
e tre pralablement reconnu comme tel avant qu'il soit possible de lui concder une f orme quelconque d'attribution, et c'est prcisment ce qui constitue le fond du prob lme, car loin d'tre reconnu, l'tre bien au contraire est ni, l'tre est destitu de son attribut majeur: la ralit. . L4: [Ngation catgorique] :L4 . Ainsi, si l'tre cesse d'tre affirm, s'il est ni, si l'tre n'est plus reconnu dans les formes mmes qui prtendaient tmoigner de sa ralit, alors l'troite imbrication de l'tre et du temps est vide de toute substance. Etre, en tant que prsentet (Anwesenheit), d it Heidegger, est dtermin par le temps16. La donation, qui joue un rle central dans la relation du temps l'tre l'intrieur de la perspective du philosophe allemand, pr end une dimension premire avec ce qu'il nomme la rsolution anticipante, forme conc rte du souci de l'tre-vers-la mort: La rsolution anticipante constitue l'tre originai re de l'tre-la (...) le sens profond de la rsolution anticipante, et donc de l'tre de l'tant que nous sommes, rside dans la temporalit. Etre pour l'tre-la, c'est tre te mporel 17. Cependant cette rsolution anticipante, ce sentiment de la mort, devienn ent inaptes raliser la subsistance ontologique d'une ralit, lorsque l'tre est dlog de sa matrialit existentielle. . D'autant plus que la puissance fondatrice de l'tre est situe au c ur du principe de causalit des catgories, catgories sous l'appellation desquelles la mtaphysique dsigne es genres suprmes de l'tre, c'est--dire, outre la substance (qui correspond approxi mativement ce qui s'avre apte exister en soimme et non dans un autre, et qui se di vise en substance premire: le sujet concret individuel, et la substance seconde: l'essence abstraite du sujet), galement les neuf accidents ou prdicaments: quantit, qualit, relation, action, passion, lieu, temps, situation et possession. L'exist ence d'tres substantiels est admise tant chez Aristote que chez saint Thomas, pou r lesquels c'est un fait d'vidence qu'impos l'exprience immdiate du cr. . La substance est ce qui par-del les changements suppose la permanence d'un substr at de nature dtermine: Tout changement qui n'affecte pas la nature la plus profonde des choses suppose la permanence de cette nature, c'est--dire la substance18. Cep endant la substance n'est pas de mme nature en fonction des tres dont on parle. Ar istote distingue les tres au sens premier qui ont l'existence par eux-mmes, et ceu x, contingents, qui ont l'existence en la recevant. Seul l'Etre premier possde l' existence en soi (en se), il est donc existant par soi (per se}, d'o l'appellatio n de persit; l'existence mme (ipsum esse) est donc dans son unicit existante en soi, on dira qu'elle est doue d'asit, les tres qui ne possdent pas cette facult se caractr sent par l'abalit (proprit d'tre ab alio), c'est--dire par autre chose qu'eux-mmes. Au sein de ces tres certains toutefois existent en soi, tout en existant par le biai s de l'Etre premier: ce sont les substances caractrises par l'insit (proprit d'tre en oi). On peut donc dire que le premier effet est l'tre mme, qui est prsuppos tous les autres effets, et ne prsuppose pas d'autres effets19. . L'tre est ainsi, traditionnellement, le dterminant formel, le premier en tant qu'i nitial pur, dont tout dpend. Ce lien en dpendance prsente le double intrt de mainteni r les catgories dans l'activit de leur source originelle et, auxiliairement, de fa ire de ce lien en dpendance un lien ontologique vritable. De la sorte, l'autonomie des catgories ne peut plus tre qu'un rve illusoire, les catgories, qui sont considres habituellement comme les modes analogiques de l'tre, qui constituent mme le cas t ypique de l'analogie d'attribution, perdent absolument toute prtention d'effectiv it si, bien entendu, l'tre qui les soustend vient manquer. Il nous faut donc consi drer que les catgories n'existent pas d'elles-mmes, elles n'existent que par l'tre q ui les dtermine. Soulignons rapidement que les catgories relevant du mode de l'acc identel prdicamental sont toutefois distinguer de l'accidentel prdicable qui ne co rrespond, lui, qu un mode logique et non analogique d'attribution. La relation du temps l'tre est donc clairement une relation en dpendance. Ceci prcis, il devient ai s de comprendre que l'tre est l'acte premier dont tout provient; de ce fait un tem ps qui serait dtach de son rapport l'tre n'est plus qu'une formule de langage, une
convention de vocabulaire vide de signification concrte. . L4: [La ngation du temps] :L4 . Nagarjuna, en toute rigueur logique, juge donc ncessaire de cesser d'affirmer l'e xistence du temps de par sa critique en ngation de l'ontologie. La ngation de l'on tologie entrane la ngation de la chronologie; sans tre, pas de continuit et de stabi lit, pas de devenir, et sans stabilit pas d'tre vritable. C'est de la ngation premire de l'tre que Nagarjuna infre la non-existence de l'ensemble des catgories d'attribu tion, et en particulier l'existence du temps. . La temporalit de l'tre, qui relve d'ailleurs d'une belle constance axiomatique trav ers l'histoire de la philosophie et de la pense, se verra donc chez Nagarjuna sin gulirement remise en question. Non pas d'une manire hsitante, mais bien au contrair e radicalement. L'analyse maintes fois reprise par Nagarjuna est d'une rare effi cacit: il s'agit de montrer comment toutes les catgories de l'tre s'effondrent les unes aprs les autres, ds lors que l'tre lui-mme est dpouill de son prdicat majeur, de on constitutif formel, c'est--dire la ralit de sa substantialit. La temporalit, qui r endait possible l'unit existentielle de l'tre et du devenir, qui constituait origi nairement le fondement de la question de l'tre, est rduite une pure facticit l'tre d ag, vid de substance propre, est chass de l'horizon de la pense. Vid de ses catgories il n'a plus qu'une attribution, le vide de toute attribution; mme pas un nant, l'tr e n'est ni lui-mme ni autre chose, il n'est pas, sans tre non plus, sans pouvoir s 'attribuer cette non-existence. . L3: [IV. Ngation ontologique et non-substantialit] :L3 . Emu par ce type de tourbillon argumentaire, qui constitue la forme mme de sa doct rine, Nagarjuna s'exprime ainsi dans La Prcieuse Guirlande des avis au roi20: L'Ambr oisie des enseignements des Bouddhas est appele profonde, une doctrine non connue allant loin au-del de l'existence et de la non-existence (p. 62). L'ami des Nga n' hsite pas mettre en garde ceux qui craindraient de s'engager dans la doctrine du vide: Effrays par cette doctrine sans fondement, se complaisant dans un fondement, n'allant pas au-del de l'existence et de la non-existence, les tres sans intellig ence se perdent, Craignant la demeure sans crainte, perdus, ils perdent autrui (pp. 76-77). Insistant plus encore, de faon convaincre son auditeur, Nagarjuna dclare: Comment ultimement le monde pourrait-il exister pourvu d'une nature qui est alle au-del du pass, du prsent et du futur, ne s'en allant pas lorsque dtruit, ne venant ni ne demeurant, serait-ce pour un instant? Puisqu'en ralit il n'est ni venue, ni aller, ni permanence, quelle diffrence ultime y a-t-il alors entre le monde et le Nirvana? (pp. 63-64). Poser la question c'est dj y rpondre, c'est pourquoi avec bea ucoup de calme Nagarjuna poursuit: S'il n'est pas de permanence, il ne peut y avo ir de production ni de cessation. Comment ds lors production, permanence et cessa tion pourraient-elles ultimement exister? (p. 65). . Sans tre, sans substance propre pouvant s'appliquer aucune chose existante, il n' est ni naissance ni mort, c'est--dire ni tre ni non-tre. L'absence de nature propre est synonyme de non-existence de l'tre et du non-tre; de la sorte, point de produ ction et point de cessation, pas de samsara ni de Nirvana. En ultime consquence, le refus ontologique nagarjunien aboutit la ngation des dualismes et des contradi ctions; Sans tre pas de temps possible, ni de non-temps, pas d'apparition ni de d isparition; sans apparition ni disparition, pas de production ni de cessation; s ans production ni cessation, pas de samsara ni de Nirvana. La ngation ontologique est finalement le rsultat vident de la plus haute forme de comprhension du princip e de non-substantialit. . L3: [V. Le non-tre comme vide de substance propre] :L3 .
La ncessit originelle, comme nous venons de le voir, relve donc des lois dont dcoule nt l'ensemble des rapports existentiels; c'est pourquoi toutes les lois sont ce titre, et en tant que principe, la manifestation de la ncessit laquelle sont subor donns les phnomnes. La causalit efficiente de la ncessit est la forme d'une dterminati n, comme nous essayons de le dmontrer, qui peut parfaitement tre assimile au princi pe de non-substantialit; si l'on veut bien admettre, tel que le fait le bouddhism e en gnral, et Nagarjuna en particulier, que le devenir contingent de l'tre soit sy nonyme de non-tre. Alors, en guise d'tre il n'y a strictement rien, un vide, le no n-tre. Non-tre n'est d'ailleurs pas prendre ici, rappelonsle, en tant que nant, mai s en tant que vide de substance propre, sujet la disparition et la mort: Tout ce qui est sujet la naissance, tout cela est sujet la disparition (Mahavagga Vinaya Pitaka, I, 6, 29). Le Tout est douleur, premire des Quatre Nobles Vrits du Bouddha, e st donc dduit du caractre transitoire et phmre de l'existence. Effectivement la conti ngence des tres crs dmontre plus qu'il n'est ncessaire la non-identit constitutive, le non-soi (antman) dont les tants sont viscralement frapps. . L'impermanence, vritable moteur dialectique de la thorie du non-soi, peut tre regarde de ce fait comme l'essence de la pense profonde de la doctrine bouddhique. Les ch oses et les tres sont dpourvus de substance propre car ils sont engags l'intrieur du grand mouvement du devenir universel. La vacuit pour le Bouddha n'est rien d'aut re que le devenir, la fluidit universelle de la ralit, sa transformation perptuelle travers le cycle de la vie et de la mort. Le prince Gautama montre qu'aucune cho se ne reste identique elle-mme, qu'il ne peut exister d'galit soi-mme, morte, fige, mmobile. Toute chose, au contraire, est en devenir, comme unit dialectique de l'tr e et du nant, de l'tre et du non-tre. Hegel, bien des sicles plus tard (et dans un cl imat intellectuel 21 trs diffrent bien videmment), dveloppera ce principe essentiel d e la dialectique en rendant hommage Heraclite et en critiquant ce qu'il nommait l e systme d'identit: Le profond Heraclite oppos cette abstraction simple et unilatra le concept total et suprieur du devenir en disant: l'tre n'est pas plus de chose q ue le nant, ou encore: tout coule, ce qui quivaut dire, tout est en voie de deveni r, tout devient22. La vie est le mouvement, et le mouvement est douleur, celui qui voit dukkha voit aussi la naissance de dukkha... (Samyutta-nikya, II, 1.) On peut , la lumire de ce qui vient d'tre dit, considrer l'enseignement du Bouddha comme un e des plus grandes rvolutions mtaphysiques de l'histoire, en ce sens qu'il fut le premier reconnatre que l'tre et le non-tre ne sont que des abstractions sans vrit, qu e la premire vrit est le devenir, au sens de non-permanence. L'importance de ce poi nt de dpart est considrable, car il permet un accs direct la comprhension du fait qu e l'tre et le nant sont une seule et mme chose. Etre et nant sont montrs comme consti tuant un couple indissoluble, l'un ne peut exister sans l'autre, la clart absolue ne diffre en rien de l'obscurit absolue23. . Si un terme rsume bien, en lui-mme, l'esprit de la pense originale et novatrice du Bouddha, c'est certainement celui d'impermanence. Or cette notion, que Nagarjuna , la suite de tous les docteurs de la Voie, souche, pourrions-nous dire, sur cell e de production en dpendance, ou galement nomme: coproduction conditionne (pratitya-sa mutpada), signifie que toute forme d'existence rsulte d'un mcanisme dterminant de c auses et de conditions (hetu-pratyaya-smagri). Ceci explique pourquoi Nagarjuna a ffirme: . \ ### \ C'est la coproduction conditionne que nous entendons sous le nom de vac uit. C'est la une dsignation mtaphorique, ce n'est rien d'autre que la Voie du Mili eu (MK, XXIV, 18)24. (i.e. Cette traduction est diffrente de celle donn plus bas. E t ici elle est fausse.) . \ ### \ 18. Nous appelons vacuit \ Ce qui apparat en dpendance. \ Cela est une dsignation dpendante. \ C'est la voie du milieu.
. \ ### \ The "originating dependently" we call "emptiness"; \ This apprehension, i.e., taking into account [all other things], is t he understanding of the middle way. . La loi de coproduction conditionne dbouche en ralit sur le constat du fait qu'il n'y a pas d'essence ni de substance derrire les choses: . \ ### \ Qui voit la production en dpendance voit la souffrance, l'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance, et la Voie (MK, XXIV, 40). . \ ### \ 40. Qui voit la production dpendante \ Voit la souffrance, \ L'origine, la cessation \ Et la voie. . \ ### \ He who perceives dependent co-origination (patytya-samutpada) \ Also understands sorrow (dukkha), origination, and destruction as wel l as the path [of release]. . Nagarjuna dira d'ailleurs que la doctrine du Bouddha n'est en ultime analyse qu' une affirmation du vide, de la vacuit (sunyata): Ce constat est tellement essentie l au bouddhisme qu'on peut penser que, dans le cas contraire, le Sermon de Bnars et tourn court, nous dit Guy Bugault, le constat de la douleur universelle (sarvam duhkham) se trouvant priv de son fondement. C'est dire, poursuit-il, combien le r ejet de l'identit, personnelle ou dans les choses, tient une place organique dans la voie bouddhique: son point de dpart comme motif de conversion, son terme comm e accomplissement25. La vacuit de l'existence s'exprime par la totale absence de s le rel est un na ubstance rsidant derrire les choses et les tres. Tout est vide d'tre t d'tre, une absence , c'est l'tre absent du monde qui est le monde rel de l'tre. Nul le base, nul socle sur lesquels faire reposer une essence, tout ce qui existe dev ient, et ce qui devient n'est ni soi ni autre26. . L2: [4. La doctrine de la vacuit (sunyatavada)] :L2 . Aborder la doctrine de Nagarjuna, c'est invitablement aborder les mcanismes comple xes de la pense du matre indien. Cependant, un simple dploiement des concepts utili ss, une traditionnelle consultation des ides exposes, s'ils sont de premire importan ce afin de cerner correctement la spcificit argumentaire du penseur de la vacuit, n e permettent pas toujours de percevoir les consquences et la porte vritable des thse s exprimes. Il est donc particulirement intressant, en ce qui concerne Nagarjuna, d e poursuivre notre approfondissement thorique au c ur mme du systme si original de la Voie du Milieu. . Pour ce faire, nous allons simplement essayer d'clairer d'une lumire plus vive la rflexion mise en uvre dans l'entreprise thorique de la doctrine du vide. Nous comme ncerons par une forme de dclinaison des thses nagarjuniennes, qui empruntera Nagar juna lui-mme la mthode et le mode de leur apparition au sein du discours du Trait du Milieu. Il convient donc de se pencher en premier lieu sur ce qui figure comme u n point central dans l'appareil dialectique de Nagarjuna: la notion de productio n en dpendance, de laquelle dcoule d'ailleurs l'ensemble du corpus thorique de la d octrine nagarjunienne. . L3: [I. La vrit manquante de l'tre absent] :L3 .
La production en dpendance, ou encore coproduction conditionne, est la conception cl de la pense de Nagarjuna, en elle prend naissance la quasi-totalit des thses spcifiq ues de la doctrine de la vacuit. L'analyse nagarjunienne ceci de spcifique qu'elle considre que les choses qui se produisent (utpadyante) en dpendance (pratitya), c 'est--dire qui sont issues d'une cause conditionnelle, sont dites et dfinies comme vides, dpourvues d'une nature propre. Pour la pense Madhyamika, la vacuit n'est, s ous cet aspect, rien d'autre que l'interdpendance universelle, l'intercausalit qui soumet l'ensemble des tants au sein d'une contingence gnrale. L'existence, intimem ent, n'est qu'un nant foncier, une structure momentane d'agrgats multiples destins l a mort. ce titre, il est tout fait significatif de voir quel point la conscience particulirement vive de la conditionnalit et de l'impermanence conduit les docteu rs bouddhistes, et plus particulirement Nagarjuna, affirmer l'absence de nature p ropre des choses et des tres. l'intrieur de leurs dmonstrations, rien ne put faire figure d'exception, rien ne put chapper la loi d'airain de la dtermination limitan te de l'existence. La contingence, qui en climat hellnistico-chrtien sera l'un des arguments principaux de la preuve de l'existence d'une Cause premire, d'un EtreActe pur que la religion nommera Dieu1, deviendra chez les penseurs bouddhistes un principe universel sous la domination duquel toute vie est contrainte de se s oumettre. Et lorsque nous disons toute vie, c'est effectivement d'une totalit qu' il est question, puisque de l'ensemble des existences cres, incres, humaines, divine s, etc., pas une n'chappe au rgne de la loi d'impermanence, pas une qui, par quelq ue modalit inexplique, par quelque rgle spciale, pourrait prtendre droger la loi univ rselle de la production et de la disparition; aucune cause qui soit sans cause. Tout, absolument tout est soumis au principe gnral de contingence et d'impermanenc e. Cette universalisation fonctionne comme une brutale et radicale sentence, con damnant toute vie au non-tre, toute essence l'absence de nature propre, ce qui im plique l'affirmation sans appel dclarant: il n'existe pas, et d'aucune manire, que lque chose qui soit constitu de ralit vritable. . L4: [Ni tre ni non-tre] :L4 . Les choses, dpourvues d'tre propre, sont donc non seulement sans essence, mais gale ment non substantielles ce qui, clairement, signifie qu'elles sont inexistantes. Cependant si les choses n'existent pas, devons-nous en conclure qu'il n'y a que du nant? En aucune manire, rpond ingnieusement Nagarjuna, car si l'tre n'est pas, de quoi le non-tre serait-il le non-tre? Une ngation ne se pose qu'en s'opposant un po sitif. Le positif une fois radicalement limin, le ngatif n'a pas de prise logique2. Nagarjuna tout la fois refuse l'ontologisme et le nihilisme, il se situe au mili eu, sans position, ni dans l'tre ni dans le non-tre, ni dans l'affirmation ni dans la ngation. Si Nagarjuna refuse de soutenir un point de vue, ce refus, interroge ront certains de ses adversaires, ne prsente-t-il pas lui-mme un point de vue? Pas le moins du monde, rtorque Nagarjuna, car de moi-mme je ne dis rien, ni oui ni no n, je ne parle qu'en ngation de tous les points de vue, mme de l'absence de point de vue. . Alors ne reste-t-il pas au moins le sujet pensant qui, lui, effectue cette ngatio n, ne reste-t-il pas cette absence de point de vue, qui est encore une vue, une opinion mentale, poursuivent les contradicteurs? Pas mme, rpond Nagarjuna, car si l e sujet connaissant existait, il devrait tre dans l'tre ou dans le non-tre: puisque ces deux tats ont t dclars inadmissibles, le sujet pensant l'est aussi 3, le sujet pe nsant est donc galement dlog de son existence, les lments des choses, les dhtu (...) s nt dclars ici ni existants ni inexistants, ni conditionns ni inconditionns: pareils en somme l'ka, l'espace vide, la pure vacuit (sunyata)4. Affirmer la vacuit inter empche que l'on admette la ralit d'un support permanent, d'une ralit vritable, cette v it serait-elle elle-mme une ralit mentale que cela ne changerait rien au problme. Le sujet pensant, pas plus qu'aucune autre chose, et peut-tre moins encore s'il se p eut, ne peut revendiquer une existence relle. L'esprit n'a pas plus de ralit que le s phnomnes; le sujet pensant ne pouvant s'tablir ni dans l'tre ni dans le non-tre, il n'est donc nulle part. L'esprit ne sjourne pas sur une hauteur partir de laquell e il pourrait juger des choses en tant dgag, hors d'atteinte de la non-substantiali
t. Sujet et objet, observant et observ, tous sont galement et au mme titre soumis la dtermination de la contingence universelle. Il n'est donc pas possible d'instaur er, de supposer une position de pure contemplation du spectacle, position l'intri eur de laquelle aurait son sjour le sujet pensant, isol royalement des contraintes de l'accidentalit. Il convient plutt de souligner qu'il n'y a pas d'extriorit possi ble; nul statut privilgi, prserv de l'emprise de la loi de dpendance, pas de position de repli, pas de cause incause, pas d'altrit au sein de la ralit. Toutes les ralits s nt impermanentes, avait dj dclar le Bouddha, l'impermanence est la ralit du Tout, rajo ute avec force Nagarjuna. . C'est d'ailleurs en se situant dans la logique mme de l'impermanence que Nagarjun a refuse tous les points de vue. chaque affirmation, dit-il, rpond une ngation; le vrai n'est donc nulle part, il ne possde pas de localisation fixe, car le vrai e st en n'tant pas, il n'est pas tout en tant, ni il est ni il n'est pas. Le vrai es t sans essence, car aucune prise, aucune proprit n'est possible sur ce qui est per ptuellement mouvant et changeant. On ne possde pas le vrai, il se dploie dans son a bsence, il se donne dans son retrait, il se contemple en tant que voil. Les condi tions de l'affirmation sont les conditions de la ngation, il n'y a ni vrit ni non-vr it, mais un simple et vaste mouvement du oui et du non, de l'existence et de la n on-existence. L'absence de point de vue n'est donc pas un point de vue, mais une absence de vue, une ngation auto-abolitive qui, en s'exprimant, s'annihile ellemme. . Ce regard port sur l'ensemble des vues, des opinions, est un regard port dans le mm e temps sur le monde des existants. C'est une comprhension de l'absence de ralit de s phnomnes qui apparaissent au jugement, c'est une pntration au c ur de la non-substan ce, au c ur de l'absence de nature propre des ralits phnomnales. Toujours conditionns, les phnomnes n'ont donc pas d'existence propre, la condition de leur existence est la preuve de leur non-existence. Ni tre ni non-tre, la production en dpendance est une dtermination causale vidant de leurs caractristiques ontologiques les existan ts. Natre en dpendance, ce n'est pas natre authentiquement, mourir en dpendance, ce n'est pas authentiquement mourir ni apparition ni disparition ni vie ni mort , ce qui est cr en dpendance ou ce qui disparat en dpendance n'existe pas et ne cesse pas d'exister. Ce qui est vide de substance propre n'est ni pourvu ni non pourvu d't re. Car si c'est en dpendance de l'tre qu'est tabli le non-tre, c'est en dpendance du non-tre que l'tre est tabli, le non-tre tant insaisissable, l'tre est imprdicable lui ussi5. Imprdicable, c'est--dire non situable, non conceptualisable, en retrait de l 'tant et en retrait de lui-mme, en retrait galement de son retrait, ni dans son ret rait ni dans la donation, ni non existant ni existant. En ralit l'tre n'est pas dan s ce qu'il est, et est dans ce qu'il n'est pas. Inqualifiable car sans qualifica tion positive, il ne cesse d'tre absent de son absence, et il ne cesse paralllemen t d'tre prsent dans sa non-prsence. Ni tre ni non-tre, l'existence est donc elle-mme n on prdicable. Le sunyata, c'est la contingence universelle, c'est l'interdpendance universelle des phnomnes. . Exister ainsi pour les existences, c'est ne pas vivre tout en tant existant, c'es t exister sans existence relle, c'est tre sans tre, c'est subsister sans subsistanc e ontologique vritable. Ceci implique, et explique galement, que la vrit de l'tre ne se tienne ni dans le oui ni dans le non, ni dans l'affirmation positive ni dans la ngation. La vrit nagarjunienne de l'tre, c'est la non-diffrence; sans position sta ble elle est fonde sur le vide et le non vide, l'absence d'tre propre. La vacuit n' est donc pas un principe metaphysique qui prendrait son socle sur une doctrine p ositive, elle n'est que la pleine comprhension de la non-nature du vide de substa nce propre. Nagarjuna ne poursuit pas un but, qui ne serait d'ailleurs qu'un mir age pistmologique consistant parvenir une position thorique dfinitive, fixe, immuabl e. Bien au contraire, son action thorique a pour effet de dtruire, carter, rduire to utes les opinions au nant. Pour Nagarjuna, tout phnomne est vide, en tant que rsultan te de conditions dtermines. Mais la voie ngative elle-mme ne peut s'en tenir la ngati on. Raliser la vacuit n'est possible que lorsqu'on rejet toute affirmation et toute ngation, en tant qu'elles relvent de la vrit conventionnelle, pour atteindre la vrit
ultime6. La vrit ultime de l'tre, c'est la vrit manquante de l'tre. C'est le silence p ononc sur le rien, l'vocation du vide sur la non-substance. Libre de toute positio n spcifique, la doctrine de Nagarjuna est une fluide et libre affirmation de la n on-permanence. Ni fixe ni non fixe, ni ngative ni positive, la vrit exprime de l'tre chez Nagarjuna est une vrit sur la non-vrit de l'tre, une vrit sur la vrit manquante . Cette vrit manquante de l'tre absent n'est d'ailleurs mme pas une forme particulire d e ngativit, elle est simplement l'expression de la vacuit. Ni voie ngative ni voie p ositive, la doctrine de la vacuit ne fait que proclamer la non-substantialit de to ute forme, de toute existence, de toute voie. Nagarjuna ne fait que constater le vide, son discours en dernire instance ne dit rien, il montre, mais de lui-mme il ne dit rien. Sa parole du vide est un vide sur le vide, une absence de point de vue sur l'tre et le non-tre, un nant sur l'abme, l'expression du parfait silence. .
L3: [II. Le non-soi comme vide d'identit de l'tre et du non-tre] :L3 . En essayant de montrer en quoi le plein exercice de la loi d'impermanence entrane l'impossibilit d'affirmer l'existence d'une ralit concrte, l'impossibilit d'affirmer l'existence d'une ralit ontologique vritable, Nagarjuna met indirectement en lumire une notion qui joue un rle majeur au sein du bouddhisme: la notion du non-soi. T outefois, loin de limiter cette notion au classique discours en rfutation d'une e xistence authentique d'un soi, Nagarjuna pousse son raisonnement jusqu inclure la totalit des existences dans cette inexistence du singulier. Conclure l'absence d' un constitutif formel que l'on nomme le soi n'est pas simplement un exercice de str ile rptition du catchisme bouddhiste pour Nagarjuna. Sa pense, bien au contraire, da ns son exigente dialectique, tente une mise en perspective gnrale d'une affirmatio n qui lui semble normment lourde de sens sur le plan de l'analyse de ce qui consti tue, de manire ultime, les existences. En disant constitutive, c'est bien videmmen t une facilit de langage car c'est d'une absence, c'est d'un vide d'tre propre que sont composs vritablement les tres, au regard de l'analyse objective. . Mais que peut bien signifier une affirmation de l'existence du vide? demandent c ertains contradicteurs de Nagarjuna. Le vide ne peut exister puisqu'il est le vi de. Effectivement, rpond l'ami des Nga, le vide n'existe pas, mais lorsque nous di sons des choses ou des tres qu'ils sont constitus de vide, nous disons par la mme q u'ils sont et qu'ils ne sont pas. Affirmer l'existence du vide, c'est affirmer l 'inexistence des phnomnes par le fait qu'ils existent. Dire que les tres et les phno mnes sont constitus par une absence, c'est dire qu'en tant qu'existants ils sont i nexistants, c'est dire qu'il n'y a ni tres ni phnomnes. Le non-soi n'est pas une fo rmule visant indiquer que se cache derrire les tres le vide; non, le non-soi est u ne faon de faire comprendre que les tres, les phnomnes, en tant justement qu'ils son t des tres ou des phnomnes, sont le vide, sont vacuit eux-mmes. Les phnomnes ne sont p s un voile, une illusion, un masque du vide. Les phnomnes ne sont pas diffrents du vide, et le vide lui-mme n'est pas diffrent des phnomnes, comme le rappellent fort p ertinemment les textes de la Prajnaparamita. . D'ailleurs, toute la puissance de ces multiples ngations de la ngation, et contrengations de l'affirmation ngative, se retrouve condense, rsume dans un des textes les plus clbres de la littrature bouddhique, qui fait d'ailleurs l'objet d'une authent ique dvotion et donne cours de nombreux rituels dans les monastres zen japonais, o il est rcit matin et soir: Le Sutra du C ur (MahaPrajnaparamita-Hridaya Sutra, skrt.; Hannya haramita Shingy, jap.). Ce sutra, traduit du sanskrit en chinois dit-on pa r Sanz Hshi Genjo, met en scne un dialogue entre le bodhisattva Avalokitesvara et S ariputra, un disciple du Bouddha. Ce dialogue, bien sr, n'a pas de relle historici t, mais cette mise en scne rpond un souci pdagogique vident, celui de permettre la ju ste comprhension de la vacuit dans toute l'ampleur de son application universelle. Rien n'est pargn dans ce court rcit; des vrits traditionnelles de la vrit mondaine, i ne reste plus aucune trace, tout est vigoureusement balay lors de son audition. Le texte s'ouvre par une affirmation dterminante: tous les phnomnes (shiki) sont no
n-substance (ku), mais la non-substance n'est pas diffrente des phnomnes. Toute exi stence est non-substance, toute existence le caractre de ku. Toutes choses faites avec les cinq lments sont non-substance, dit Avalokitesvara, il n'y a ni ce qui n at ni ce qui prit, ni puret ni impuret. Ni naissance ni commencement, ni croissance ni dcroissance, il n'y a pas non plus de phnomnes dans la non-substance. Pas de sen s, pas d'ide, pas de volont, pas de connaissance. Et les ngations s'ajoutent encore aux ngations: pas d' il, pas d'oreille, pas de nez, pas de corps. Pas de voix non plus, mais surtout ni savoir, ni ignorance, ni illusion, ni cessation de la souf france et donc pas de chemin pour supprimer la souffrance. Pas de contenu du sav oir; tous les Bouddhas, est-il proclam, c'est--dire tous ceux qui ralisent la comprh ension de la sagesse, atteignent le Nirvana, ce qui en ralit peut galement signifie r qu'aucun n'y parvient, puisqu'il n'y a rien atteindre, rien obtenir, nul samsa ra quitter. . On voit bien ici que les phnomnes sont le vide en tant que phnomnes, en tant qu'ils so nt phnomnes, qu'il n'y a pas d'autre vide qui serait une entit constitue, c'est--dire ui serait ceci ou cela, tout ce que l'on veut sauf du vide. Le vide n'est pas une forme positive qui soit utilisable ou situable dans un espace laiss vacant. Le vid e est absent de lui-mme, et dans cette absence il est parfaitement lui-mme, c'est--d ire non diffrent des phnomnes. L'absence d'identit propre, c'est la non-substantiali t de toute forme, mais toutes les formes sont la non-substantialit, prcisment parce que formes. . L'implication d'une telle comprhension thorique est, bien videmment, de nature reja illir sur une infinit de paramtres analytiques. Il ne s'agit pas, pour Nagarjuna, d'affirmer, dans une sorte d'attitude gratuite, l'identit du vide et de la forme, des phnomnes et de la vacuit, sans qu'il se rende compte des consquences qu'auront de telles considrations sur le sens mme de la doctrine de l'Eveill. Il en est d'ail leurs ce point conscient qu'il en arrive tendre jusqu'aux Quatre Nobles Vrits l'act ion de la vacuit, en repoussant point par point les affirmations fondatrices de l a doctrine exprimes lors du Sermon de Bnars. Si tout est vide, dit Nagarjuna, rien n'a besoin d'tre libr car tout est dj libr. Tout est dj, en tant qu'il est, c'est-de de contenu, libr. Si tout est libr, il n'y a plus de souffrance vaincre ou suppri mer, ni de libration atteindre. . \ ### \ La souffrance n'est pas seule inexistante selon les quatre modes; les choses extrieures galement n'existent pas selon les quatre modes (MK, XII, 10). . \ ### \ 10. La souffrance n'est pas seule \ Inexistante selon les quatre modes; \ Les choses extrieures galement \ N'existent pas selon les quatre modes. . \ ### \ Not only are the four [causal] interpretations not possible in respec t to sorrow (dukkha), \ [but also] none of the four [causal] interpretations is possible even in respect to external things (bhava). . L'architecture argumentaire de son discours ne sera ds lors qu'une absolue et rig oureuse application mthodique des principes de la vacuit appliqus aux opinions et l a ralit dans laquelle nous sommes immergs. La vacuit va fonctionner comme un princip e qui balaie absolument toute trace de certitude positive ou ngative sur son pass age. . \ ### \ L'existence du je, l'inexistence du je, la fois l'une et l'autre ou au cune des deux sont irrationnelles (MK, XXVII, 13),
. \ ### \ 13. Ainsi les vues du pass: \ L'existence du je, l'inexistence du je, \ A la fois l'une et l'autre ou aucune des deux, \ Sont irrationnelles. . \ ### \ Thus the view concerning the past which [asserts] "I have existed (1) ," or "I have not existed (2)," \ Both ["existed and not existed"] (3) or neither (4): this does not ob tain at all. . rappelle Nagarjuna. D'ailleurs, pour prciser son propos, il revient tout au long des nombreux chapitres de son Trait sur la problmatique du soi, ou du je, et il y r evient pour mieux en faire comprendre les retombes sur les fondements de la doctr ine de l'Eveill. Le non-soi est un rvlateur de l'ensemble du systme analytique nagar junien, il en montre les articulations multiples et l'absence de vue particulire. . \ ### \ Les Eveills ont mentionn: Le je existe, ils ont aussi enseign: Le je n'ex iste pas; mais ils ont encore proclam que n'existe aucun je ni non-je (MK, XVIII, 6). . \ ### \ 6. Les veills ont mentionn: Le je existe, \ Ils ont aussi enseign: Le je n'existe pas; \ Mais ils ont encore proclam \ Que n'existe aucun je ni non-je. . \ ### \ There is the teaching of "individual self" (atma), and the teaching o f "non-individual self" (anatma); \ But neither "individual self" nor "non-individual self" whatever has been taught by the Buddhas. . L4: [Ni production ni annihilation] :L4 . Au fond, la suite de son examen de la non-nature du soi, Nagarjuna s'exerce ne p lus laisser dans l'ombre le secret mme de sa pense, qui peut se formuler ainsi: . \ ### \ Ni identit, ni diversit, ni anantissement, ni permanence (MK, XVIII, 11). . \ ### \ 11. Ni identit, ni diversit, \ Ni anantissement, ni permanence, \ Tel est le nectar de l'enseignement \ Des veills, protecteurs du monde. . \ ### \ The immortal essence of the teaching of the Buddhas, the lords of the world, is \ Without singleness or multiplicity; it is not destroyed nor is it ete rnal. . Le je, le moi, le soi, n'ont pas d'tre, ils n'ont donc pas tre dtruits puisqu'ils n 'existent pas, mais plus encore c'est tout en existant pleinement qu'ils sont al ors parfaitement inexistants, car .
\ ### \ ce qui apparat en dpendance d'une chose, cela n'est pas cette chose et n 'est pas non plus diffrent d'elle. Par suite, il n'y ni annihilation ni permanenc e (MK, XVIII, 10). . \ ### \ 10. Ce qui apparat en dpendance d'une chose, \ Cela n'est pas cette chose \ Et n'est pas non plus diffrent d'elle. \ Par suite, il n'y a ni annihilation ni permanence. . \ ### \ Whatever exists, being dependent [on something else], is certainly no t identical to that [other thing], \ Nor is a thing different from that; therefore, it is neither destroye d nor eternal. . Dire qu'il y a un soi est une affirmation extrme, dire qu'il n'y a pas de soi est une autre affirmation extrme, affirmation et ngation sont galement fausses: Ainsi, ni soi ni non-soi ne sont apprhends comme vrais. C'est pourquoi le Grand Silencieu x rejet les vues d'un soi et d'un non-soi (La Prcieuse Guirlande, 103). . La loi de production en dpendance, qui dominait la thorie nagarjunienne, qui occup ait une place centrale au sein du raisonnement de Nagarjuna, en arrive disparatre du moment qu'elle est perue sous l'angle de la vrit ultime. cet instant prcis se dch ire le rideau trompeur qui lgitimait les conventions conceptuelles, et explosent, comme en un feu d'artifice, les contradictions argumentaires de la vrit mondaine. Nagarjuna rappelle qu'au niveau de la ralit ultime, disparaissent permanence et i mpermanence, disparaissent production ou annihilation: . \ ### \ Dire existe est une saisie de permanence; dire n'existe pas est une an nihilation. C'est pourquoi les sages ne devraient pas demeurer dans l'existence ou la non-existence (MK, XV, 10). . \ ### \ 10. Dire existe est une saisie de permanence; \ Dire n'existe pas est une vue d'annihilation. \ C'est pourquoi les sages ne devraient pas demeurer \ Dans l'existence ou la non-existence. . \ ### \ "It is" is a notion of eternity. "It is not" is a nihilistic view. \ Therefore, one who is wise does not have recourse to "being" or "nonbeing." . Tout est frapp d'invalidit, car tout est vide et non vide: . \ ### \ On ne peut dire (Celui-ainsi-all) est vide, ni il est non vide, vide et non vide la fois ou vide ni non vide. Ces mots ne servent que comme dsignations ( MK, XXII, 11). . \ ### \ 11. On ne peut dire (Tathagata) est vide, \ Ni il est non vide, \ Vide et non vide la fois ou ni vide ni non vide. \ Ces (mots) ne servent que comme dsignations. . \ ###
\ One may not say that there is "emptiness" (sunya) (1) \ nor that there is non-emptiness. (2)" \ Nor that both [exist simultaneously] (3), \ nor that neither exists (4); \ the purpose for saying ["emptiness"] is for the purpose of conveying knowledge. . En l'absence de nature propre, plus rien ne peut prtendre tre ni ne pas tre, plus r ien n'est dtermin ni dterminant, . \ ### \ l'absence de nature propre de Celui-ainsi-all est l'absence de nature p ropre de ce monde (MK, XXII, 16). . \ ### \ 16. La nature du Tathagata, \ Cela est la nature de ce monde; \ L'absence de nature propre du Tathagata \ Est l'absence de nature propre de ce monde. . \ ### \ The self-existence of the "fully completed" [being] is the self-exist ence of the world. \ The "fully completed" [being] is without self-existence [and] the wor ld is without self-existence. . Dans leur commentaire des stances du Trait, Tsongkhapa Losang Drakpa et Chon Drakpa Chdrub mentionnent pour mmoire le sutra intitul L'Ornement de la lumineuse sagesse f ondamentale, qui dveloppe la mme comprhension que Nagarjuna effectue au sujet de l'a bsolue vacuit: ~ La nature non ne est Celui-ainsi-all, Tous les phnomnes sont aussi semblables Ce lui-ainsi-all. ~ Les esprits purils apprhendent des signes, Ils errent dans un monde de phnomnes inexistants. ~ Celui-ainsi-all s'apparente au reflet Des qualits vertueuses immacules; II n'e xiste ici-bas ni ainsit ni Ainsi-ail. Tous les mondains voient des reflets7. . Rien ne nat, rien ne meurt, il n'y a donc ni soi ni non-soi, ni identit ni non-ide ntit. Nous ne voyons les choses que rflchies par un miroir, le miroir des fausses a pparences; nous vivons dans le reflet permanent. Lorsque la dialectique nagarjun ienne de la vacuit s'exerce dans toute son amplitude, elle renverse absolument to utes les formes fixes et non fixes, y compris celles qui constituent le corpus c anonique de la Doctrine de l'Eveill, car l'Eveill lui-mme est dpourvu de nature prop re. Et c'est justement parce que Nagarjuna parfaitement compris toute la dimensi on, et intgr, peru, le sens de l'enseignement du Bouddha, qu'il a totalement assimi l le vritable esprit de Celui-ainsi-all, qu'il se permet une telle attitude iconocl aste. La fidlit au sens mme de la parole du Tathgata, dans la mesure o Nagarjuna en p eru la lumire la plus cache, car la moins voile, l'oblige s'exprimer en respectant l a signification mme de l'enseignement; le comprendre c'est le dtruire. Comprendre le Bouddha, c'est tuer le Bouddha, tuer le Bouddha c'est faire vivre le Bouddha, faire vivre le Bouddha, c'est voir disparatre l'Eveil et le non-Eveil. C'est pou rquoi Nagarjuna juge ncessaire de dire que sur le plan de la vrit ultime l'Eveill n' a finalement rien enseign: . \ ### \ Dans l'apaisement de tous les objets d'observation, la pacification de la pense discursive. Les Eveills n'ont enseign aucune doctrine, nulle part, person ne (MK, XXV, 24). . \ ###
\ 24. (Dans) l'apaisement de tous les objets d'observation, \ La pacification de la pense discursive. \ Les veills n'ont enseign aucune doctrine, \ Nulle part, personne. . \ ### \ The cessation of accepting everything [as real] is a salutary (siva) cessation of phenomenal development (prapanca); \ No dharma anywhere has been taught by the Buddha of anything. . De nombreux textes viennent confirmer les propos de Nagarjuna: ~ O Shantamati, depuis la nuit o Celui-ainsi-all s'veilla compltement l'incomparab le, parfaite plnitude, jusqu la nuit o, sans attachement, il passa au-del des peines, l'Ainsi-all n'a pas prononc une seule syllabe, et il n'en prononcera pas8. . On rappelle toujours et encore la non-possibilit d'expression de ce qui ne peut tr e dit, puisqu'il n'y a finalement, au bout du compte, rien dire: ~ Tout est inexprimable, indicible, apais et pur de toute ternit9. . Si tout est apais de toute ternit, effectivement le Bouddha n'a rien dit ou du moin s son dire est un dire vide, un dire sans dire, une parole silencieuse, un disco urs sans contenu. La langue du Bouddha c'est la langue de l'Eveil, celle dont l' unique grammaire est le silence, celle dont l'absence de formulation est la seul e expression. La langue du Bouddha, c'est la langue qui d'elle-mme n'a jamais rie n dit, qui ne s'est jamais fait entendre et qui n'a jamais t perue. Vide de signifi cation elle ne fut jamais prche, jamais prche elle ne fut jamais comprise, jamais co mprise elle ne fut donc jamais transmise. L'indicibilit du vide ne peut faire l'o bjet d'aucune traduction positive, dire le vide c'est ne rien dire, c'est pourqu oi le Bouddha ne put s'exprimer. Le discours du vide c'est le vide de tout disco urs, l'enseignement de la vacuit est la vacuit de tout enseignement. Depuis toujou rs le silence rgne, et jamais il ne fut troubl. Tout est apais de toute ternit. . L3: [III. Le Nirvana comme absence de Nirvana] :L3 . A force de pousser toujours plus loin cette dialectique de la vacuit, Nagarjuna n e manque pas de poser lui-mme la question que nous pourrions qualifier de fatidiqu e: . \ ### \ Puisque ni la souffrance, ni son origine, ni sa cessation n'existent, par quelle voie obtiendra-t-on la cessation de la souffrance? (MK, XXIV, 25). . \ ### \ 25. Puisque ni la souffrance, ni son origine, \ Ni sa cessation n'existent, \ Par quelle voie obtiendra-t-on \ La cessation de la souffrance? . \ ### \ When sorrow (dukkha), origination, and destruction do not exist, \ What kind of path will obtain the destruction of sorrow (dukkha)? . La puissance dialectique du discours nagarjunien conduit jusqu remettre en cause l 'ide de conditionnalit et de libration des conditions. Le Vainqueur enseign la doctri ne pour montrer que l'on ne vient de nulle part et que l'on ne va nulle part (Samd hirjasutra, II, 2). Il devient donc naturel pour Nagarjuna de soutenir que le Nir vana n'est jamais atteint, car jamais perdu. Ce qui n'a jamais exist n'a pas beso in d'tre aboli, comprendre l'absence de production c'est comprendre l'absence de cessation: Puisqu'en ralit il n'est ni venue, ni aller, ni permanence, quelle diffre
nce ultime y a-t-il alors entre le monde et le Nirvana? (La Prcieuse Guirlande, 64). Sans venue ni sortie, il n'y a plus ni samsara ni Nirvana, ou plus exactement l e samsara est le Nirvana, le Nirvana est le samsara. Quand on produit la connaiss ance de l'identit du samsara et du Nirvana, alors, et pour cette raison, le samsa ra devient le Nirvana (Mahayana-samgraha, IX, 3). Il n'y a plus aucune diffrence e ntre les deux termes d'une alternative, termes qui en ralit n'existent pas et n'on t jamais exist. Sans production relle, la possibilit mme d'une cessation est parfait ement illusoire: S'il n'est pas de permanence, il ne peut y avoir production ni c essation. Comment ds lors production, permanence et cessation pourraient-elles ul timement exister? (La Prcieuse Guirlande, 65). . Mais dans ces conditions, que deviennent le karma et les lois d'enchanement et de causalit du moi lors de la transmigration? s'exclament les adversaires de Nagarj una. Si tout est impermanent, il n'y a plus d'me durable qui puisse hriter d'une e xistence passe le fruit de ses actes antrieurs, ni par la mme bnficier dans le futur de ses actes prsents. . \ ### \ Vous rejetez l'existence des fruits, le bien et le mal, disent les con tradicteurs de Nagarjuna, et toutes les conventions du monde (MK, XXIV, 6). . \ ### \ 6. Vous rejetez \ L'existence des fruits, \ Le bien et le mal \ Et toutes les conventions du monde. . \ ### \ You deny the real existence of a product, of right and wrong, \ And all the practical behavior of the world as being empty. . Expliquons-nous, rpond Nagarjuna, en essayant de calmer les esprits choqus: . \ ### \ Vous ne comprenez ni le but de la vacuit, ni la vacuit, ni le sens de la vacuit. C'est pourquoi vous vous tourmentez ainsi (MK, XXIV, 7). . \ ### \ 7. Expliquons-nous: vous ne comprenez \ Ni le but de la vacuit, ni la vacuit, \ Ni le sens de la vacuit. \ C'est pourquoi vous vous tourmentez ainsi. . \ ### \ We reply that you do not comprehend the point of emptiness; \ You eliminate both "emptiness" itself and its purpose from it. . L'enseignement, poursuit-il, s'articule sur deux vrits: la vrit relative et la ralit u ltime; ne pas comprendre cette diffrence, c'est ne pas comprendre la doctrine. . \ ### \ Ceux qui ne comprennent pas la diffrence entre ces deux vrits ne comprenn ent pas la profonde ainsit de la Doctrine de l'Eveill (MK, XXIV, 9). . \ ### \ 9. Ceux qui ne comprennent pas \ La diffrence entre ces deux vrits \ Ne comprennent pas la profonde ainsit \ De la Doctrine de l'veill. .
\ \ truth \ Buddha.
### Those who do not know the distribution (vibhagam) of the two kinds of Do not know the profound "point" (tattva) (T3) in the teaching of the
. Mais ajoute-t-il, . \ ### \ sans s'appuyer sur la convention, le sens ultime n'est pas ralis. Sans ra liser le sens ultime, l'au-del des peines n'est pas obtenu (MK, XXIV, 10). . \ ### \ 10. Sans s'appuyer sur la convention, \ Le sens ultime n'est pas ralis. \ Sans raliser le sens ultime, \ L'au-del des peines n'est pas obtenu. . \ ### \ The highest sense [of the truth] (T2) is not taught apart from practi cal behavior (T1), \ And without having understood the highest sense (T2) one cannot under stand Nirvana (T3). . En forme d'avertissement Nagarjuna n'oublie pas de rappeler: . \ ### \ La vacuit mal envisage perd les personnes de faible intelligence, comme le serpent maladroitement saisi ou la science magique mal applique (MK, XXIV, 11). . \ ### \ 11. La vacuit mal envisage \ Perd les personnes de faible intelligence, \ Comme le serpent maladroitement saisi \ Ou la science magique mal applique. . \ ### \ Emptiness, having been dimly perceived, utterly destroys the slow-wit ted. \ It is like a snake wrongly grasped or [magical] knowledge incorrectly applied. . Puis en ultime recours il dclare: . \ ### \ Sachant que la profondeur de cette doctrine serait trs difficile pntrer p our les esprits mdiocres, l'esprit du Puissant se dtourna de l'enseigner (MK, XXIV, 12). . \ ### \ 12. Pour cette raison, sachant que la profondeur de cette doctrine \ Serait trs difficile pntrer peur les esprits mdiocres, \ L'esprit du Puissant \ Se dtourna de l'enseigner. . \ ### \ Therefore the mind of the ascetic [Guatama] was diverted from teachin g the dharma, \ Having thought about the incomprehensibility of the dharma by the stu pid.
. Mais que cache en ralit l'attitude de Nagarjuna? En fait une conviction profonde, qu'il conserve relativement voile pour ne pas trop choquer ses auditeurs: c'est q ue l'on n'enseigne finalement rien ceux qui ne sont pas aptes comprendre certain es vrits. . \ ### \ Dans le systme pour lequel la vacuit est acceptable tout est acceptable; dans le systme pour lequel la vacuit est inacceptable rien n'est acceptable (MK, X XIV, 14 ab, cd). . \ ### \ 14ab. Dans le (systme) pour lequel la vacuit est acceptable \ Tout est acceptable; . \ ### \ When emptiness "works", then everything in existence "works". (A) . \ ### \ 14cd. Dans le (systme) pour lequel la vacuit est inacceptable \ Rien n'est acceptable. . \ ### \ If emptiness "does not work", then all existence "does not work". (B) . Ce qui l'amne revenir sur sa thse centrale: . \ ### \ Nous appelons vacuit ce qui apparat en dpendance. Cela est une dsignation dpendante. C'est la Voie du Milieu (MK, XXIV, 18). . \ ### \ 18. Nous appelons vacuit \ Ce qui apparat en dpendance. \ Cela est une dsignation dpendante. \ C'est la voie du milieu. . \ ### \ The "originating dependently" we call "emptiness"; \ This apprehension, i.e., taking into account [all other things], is t he understanding of the middle way. . Or, puisque tout est cr en dpendance, c'est indirectement raffirmer que tout est vid e; mais si pour vous, laisse-t-il entendre, cela n'est pas vide, alors effective ment tout ce que j'exprime vous semblera faux. En y regardant de plus prs, il app arat bien que les arguments en dfense de Nagarjuna n'en sont pas; intimement il ne considre pas comme acceptables les conclusions de la vrit relative, il cherche tem poriser, ne point trop effrayer, mais il n'y parvient que difficilement, sa crit ique n'pargne rien et il ne lui est pas possible de limiter le champ d'applicatio n de sa dialectique en ngation. La force de son discours, invitablement, renverse les convictions les plus anciennes et les dogmes vnrables; alors que le Nirvana to ujours t compris comme une extinction, un anantissement pur et simple10, Nagarjuna rvle la vritable identit de ce qui n'en comporte aucune: . \ ### \ Non produite, non dtruite, la nature des choses (samsara) est comme l'a u-del des peines (Nirvana) (MK, XVIII, 7). . \ ### \ 7. L'objet d'expression disparait
\ En se dtournant du domaine de la pense. \ Non produite, non dtruite, \ La nature des choses est comme l'au-del des peines. . \ ### \ When the domain of thought has been dissipated, "that which can be st ated" is dissipated. \ Those things which are unoriginated and not terminated, like Nirvana, constitute the Truth (dharmata). . Rien qui n'apparaisse, rien qui ne s'enfuie, rien qui demeure, rien qui ne cesse , l'absence est dans son tre en tant que prsence, c'est--dire vide d'elle-mme; la prs ence est dans son tre en tant qu'absence de nature propre, c'est--dire non substan tielle. La pense de l'tman et de l'antman, du moi et du non-moi est le rsultat d'une erreur. Non moins relatifs le plaisir et la douleur, les passions et l'mancipatio n des passions. La transmigration, les dlices du ciel ou les peines de l'enfer, t out cela provient de nos vues fausses sur le monde extrieur (que nous prenons pou r la ralit). Les six chemins de la transmigration n'ont qu'une valeur illusoire et toute conditionnelle. Comme le peintre peignant un monstre terrible se trouve l ui-mme terrifi, le vulgaire l'est par la transmigration. Comme un enfant stupide s e noie dans le bassin qu'il a creus, les tres se noient dans les fausses discrimin ations qu'ils ont cres sans pouvoir en sortir (Mahayana vimaka, II, 4) 11. . Rien qui ne soit, rien qui ne meure, . \ ### \ le cycle (samsara) ne se distingue en rien de l'au-del des peines (Nirv ana). L'au-del des peines ne se distingue en rien du cycle (MK, XXV, 19). . \ ### \ 19. Le cycle ne se distingue en rien \ De l'au-del des peines. \ L'au-del des peines ne se distingue en rien \ Du cycle. . \ ### \ There is nothing whatever which differentiates the existence-in-flux (samsara) from Nirvana; \ And there is nothing whatever which differentiates Nirvana from exist ence-in-flux. . Il n'y a ni souffrance ni cessation de la souffrance, le Nirvana n'est l'extinct ion de rien puisqu'en fait il n'y a jamais eu quelque chose qui existt un jour. . \ ### \ Comment la souffrance existerait-elle? Ce qui est dit souffrance, c'es t l'impermanent, qui n'existe pas dans la nature propre (MK, XXIV, 21). . \ ### \ 21. Si elle n'est pas produite en dpendance, \ Comment la souffrance existerait-elle? \ Ce qui est dit souffrance, c'est l'impermanent, \ Qui n'existe pas dans la nature propre. . \ ### \ Having originated without being conditioned, how will sorrow (dukkha) come into existence? \ It is said that sorrow (dukkha) is not eternal; therefore, certainly it does not exist by its own nature (svabbava). .
Rien n'est apparu, rien qui doive disparatre; au sein du vide il n'y a pas une su ccession possible d'tats, ce qui n'a pas de naissance ne prit pas (MahapariNirvana, III, 64). Dans le vide il ne saurait surgir une diffrence, une distinction entre arrive et fin. Le vide n'a pas de ternie car il est sans commencement, ce qui est sans commencement ne peut connatre l'arrt. Le propre du vide c'est de n'avoir pas d'tre propre, il n'est pas lui-mme son tre ni tre ni non-tre , rien jamais ne fut cessa d'tre. C'est pourquoi l'unique vacuit est celle qui consiste chapper tous les points de vue, puisque rien n'a de consistance ni d'tre. Sans tre rel, pas de vue pa rticulire envisageable, car tout est vrai, non vrai, ni vrai ni non-vrai en mme te mps et sous le mme et identique rapport. . On rapprochera d'ailleurs cette absence de point de vue particulier d'une forme originale de non-pense qui s'panouira dans le Ch'an (du sanskrit Dhyana) et quelques sicles plus tard dans le Zen, forme de non-pense qui se transformera en pratique de l'assise silencieuse, vide de toute forme, c'est--dire pratique de l'absence d e pense au sein de la pense (voir chapitre 7, IV). L'absence de pense ne consiste pa s ne rien penser, ne penser rien, ce qui serait une manire de s'attacher ce rien, mais penser toutes choses d'instant en instant avec un perptuel dtachement. Si le flux des penses s'interrompt et que la pense se fixe, on sera li; pour tre dli (libre , dlivr), il faut que les penses glissent perptuellement sur toutes choses sans jama is s'y fixer. Il est vain d'esprer mettre fin la pense en ne pensant rien, car com me tout ce qui meurt, la pense renatra ncessairement. Le nant de pense doit donc tre u ne pense totale et dtache. La vraie absence de pense c'est de penser tous les objets sans se laisser infecter par aucun d'eux. Devant le vieux dilemme chinois de la mobilit et de la quitude, de l'activit et de la passivit (tong et tsing, kinesis et stasis du platonisme, motus et quies de Nicolas de Cuse), l'cole de Houei-neng s e prononce (...) pour une concidence entre l'activit et la passivit, pour un chemin moyen qui les concilie12. . Pour revenir notre propos, raffirmons que ce qui ne provient de rien ne va vers r ien; ni dbut ni fin au sein du nant. Hors du vide, rien. En lui rien non plus, et depuis toujours jusqu jamais, nulle libration car nulle alination ce qui n'est pas e nchan n'a pas besoin d'tre libr , aucune entrave ne contraint ce qui n'est jamais venu l'existence, et donc jamais n'en sortira, car on ne sort pas de l o l'on n'est ja mais rentr. . \ ### \ Si tout cela est vide, l'apparition et la destruction n'existent pas. De l'abandon et de l'arrt de quels (facteurs) acceptera-t-on l'au-del des peines? ( MK, XXV, 1). . \ ### \ 1. Si tout cela est vide, \ L'apparition et la destruction n'existent pas. \ De l'abandon et de l'arrt de quels (facteurs) \ Acceptera-t-on l'au-del des peines? . \ ### \ If all existence is empty, there is no origination nor destruction. \ Then whose Nirvana through elimination [of suffering] and destruction [of illusion] would be postulated? . Ni apparition ni cessation, aucun facteur phnomnal ne doit cesser puisqu'il n'exis te et n'existera jamais aucun facteur. L'quation d'quivalence entre Nirvana et sam sara se comprend d'ailleurs beaucoup mieux si l'on peroit le signe d'galit comme gal ement un signe d'inexistence. On pourrait effectivement tout aussi bien dire, af in de remplacer l'galit ou l'quivalence entre Nirvana et samsara par un signe de nga tion: il n'y a ni Nirvana ni samsara. Nirvana = samsara = ni Nirvana ni samsara. Nirvana = samsara. Ce qui veut dire: le Nirvana n'est pas une ralit dtache; il est l a dimension absolue (suprieure, tant au samsara qu lui-mme, s'il est entendu comme o
ppos au samsara et c'est seulement ainsi en fonction de ce qui, l'gal de l'ther, es t infini, insaisissable, pareil au non-pareil, de ce qui est impondrable, de ce q ui n'est pas susceptible d'tre contamin, par quelque contamination que ce soit, de ce qui est, en n'importe quel mouvement, immobile c'est seulement ainsi, disons -nous, que le monde n'existe vraiment plus, que dans les formes, par lesquelles est pris celui qui est assujetti l'ignorance; il n'y a plus que la consistance d 'une apparition, d'un cho, d'un mirage qui se dessine dans la limpidit du ciel lib re. En son existence il n'existe pas; en son non-existence, il existe: ceci vaut autant pour le monde que pour celui qui est libration, pour le Tathgata. Tel est le sens de la formule qui revient dans le Vajracchedik: Ce qui t dclar inexistant, po ur ceci, prcisment, t dclar non existant, et c'est ainsi qu'il est dclar existant13 .
L3: [IV. Le caractre propre du vide] :L3 . Au sein de la vacuit il ne peut y avoir obtention ni non-obtention, aucune distin ction n'est possible pour ce qui radicalement ne se distingue de rien; la non-di ffrence de la vacuit lui confre une absence absolue, une souveraine absence absolue de dtermination et d'identification. Le vide d'tre propre du Nirvana ne se laisse pas dcomposer par des dfinitions limites au sujet de la cessation du samsara. Ici plus aucune place n'est laisse vacante pour une rduction consolante qui consistera it faire miroiter un devenir libr de toute entrave limitante. Ces pieuses rveries, qui n'ont qu'une vertu pdagogique prparatoire (et encore...), ne sont plus admises , si l'on veut bien considrer lucidement le caractre propre du vide. . \ ### \ Pour qui n'existent ni production de l'au-del des peines ni disparition du cycle, pour celui-la, comment le cycle serait-il? Comment l'au-del des peines serait-il? (MK, XVI, 10). . \ ### \ 10. Pour qui n'existent ni production de l'au-del des peines \ Ni disparition du cycle, \ Pour celui-l, comment le cycle serait-il? \ Comment l'au-del des peines serait-il? . \ ### \ Where there is a super-imposing of Nirvana [on something else], nor a removal of existence-in-flux, \ What is the existence-in-flux there? \ What Nirvana is imagined? . Non seulement il n'y a pas de Nirvana, mais il n'y a pas de cycle du samsara. No n seulement les phnomnes sont vides de substance propre, non seulement ils sont dpo urvus d'tre rel, mais l'extinction elle-mme est dpourvue de ralit, de substance relle. Sans samsara pas de Nirvana obtenir, pas de libration dsirer, pas de salut souhait er, pas de fin du cycle rechercher. Une vue des conditions est une vue limite, un e vue de l'annihilation est une vue limite: . \ ### \ II n'y a ni annihilation ni permanence (MK, XVIII, 10). . \ ### \ 10. Ce qui apparat en dpendance d'une chose, \ Cela n'est pas cette chose \ Et n'est pas non plus diffrent d'elle. \ Par suite, il n'y a ni annihilation ni permanence. . \ ### \ Whatever exists, being dependent [on something else], is certainly no
t identical to that [other thing], \ Nor is a thing different from that; therefore, it is neither destroye d nor eternal. . Il n'y a pas d'issue hors du cycle en utilisant une recherche de la sortie du cy cle; nul ne sort du cycle car nul n'y rentre, personne ne s'en libre car personne n'y est entr. . Ceci explique que rien ne doit tre libr car rien jamais ne fut alin, il n'y a pas de cessation esprer, car il n'y a jamais eu de production. Le subtil dtachement du Ta thgata est transparent et invisible, car Tathgata dsigne celui qui ne va nulle part et ne vient de nulle part, c'est pourquoi il est le Tathgata, le pleinement veill (V ajracchedik-sutra, XXIX). Tout est dj et depuis toujours libre; aucune ralit n'est tra ngre l'Eveil, car l'Eveil depuis toujours ne cessa jamais d'tre en son non-tre, et de ne pas tre en son tre. Aucun Eveil a atteindre non plus, car il n'y a jamais eu de non-veil a quitter. Pas de samsara diffrent du Nirvana, pas de souffrance dont on doive s'affranchir. Non n et non venu, l'tre jamais ne fut; en tant que jamais venu et non n, en tant que n'ayant jamais t existant, l'tre jamais ne cessa d'tre. P as de samsara quitter et donc pas de souffrance non plus dont il faudrait se libr er, pas de samsara diffrent du Nirvana, pas de Nirvana diffrent du samsara. Nulle extinction dsirer, car jamais rien n'est apparu, et rien jamais donc ne disparatra . Depuis l'origine tout est dj au sein de ce qui fut, reste et demeure le parfait Eveil. Depuis toujours rgne le silence, le parfait silence qui jamais ne fut trou bl. Tout est apais de toute ternit. . . ******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* . L1: [DEUXIME PARTIE - La continuit historique de la doctrine nagarjunienne] :L1 L2: [5. L'hritage de la pense de Nagarjuna] :L2 . On s'en doute sans peine, l' uvre de Nagarjuna va exercer une influence majeure su r les esprits. La nouveaut de ses thses, et leur vident pouvoir d'lucidation, s'agis sant de l'enseignement de l'Eveill, vont procurer Nagarjuna une audience considrab le. Ses textes sont rpandus, lus et comments, ses thses font l'objet de discussions passionnes et de recherches actives. La nouveaut de sa pense fait de lui la person nalit essentielle d'une authentique entreprise de mtamorphose du bouddhisme, et d' une comprhension incroyablement plus ample, plus large des concepts originels de la Doctrine. De nombreux disciples entourent le matre de la vacuit, et cette effer vescence autour de la pense nagarjunienne va crer les conditions du dveloppement d' une vritable cole philosophique laquelle le Mahayana doit peu prs tout de son origi nalit et de sa spcificit. . L3: [I. Aryadeva: le matre de la ngation radicale] :L3 . Au sein de ce milieu se dgage celui qui, parmi les lves de Nagarjuna, fut aussi son successeur immdiat: Aryadeva. Celui-ci vcut apparemment dans la premire moiti du II Ie sicle de notre re, et fut un redoutable polmiste et un virulent contradicteur. C 'est certainement, parmi les disciples de Nagarjuna, celui qui poussera le plus loin les consquences de la doctrine de la vacuit. Pour lui, nul frein ne doit entr aver la force dconstructive de la doctrine nagarjunienne; il n'hsitera d'ailleurs pas vritablement choquer de nombreux moines ou religieux, qui s'effraieront de le voir nier le Nirvana et la transmigration. Il semble bien cependant que, sur ce point prcis, Aryadeva ait parfaitement peru le sens profond, le sens le plus auth entique de la vacuit, il ne craindra d'ailleurs pas de le proclamer sans prudence particulire. On peut voir en lui une sorte de matre radical et absolu; droutant et constamment insaisissable, il maintient en permanence le moteur de la critique
ngative plein rgime. Ne respectant aucune rserve de prudence, aucune retenue vis--vi s du monde religieux, il tend sa fureur dialectique l'ensemble des formes qui inc arnaient, son poque, la transmission de la Loi du Bouddha. Il excelle visiblement dans son art de pousser la logique nagarjunienne du vide dans ses ultimes consqu ences. Il en aiguise les aspects les plus tranchants, les plus droutants, il en m et nu les aspects les plus vifs. Peu enclin mnager les susceptibilits et les convi ctions tablies, il n'hsitera pas nier les croyances traditionnelles, ce qu'il paie ra d'ailleurs du prix de sa vie, puisque la tradition rapporte qu'il prit assassi n par un brahmane excd par ses provocantes et incessantes ngations dialectiques. Ary adeva est toutefois connu, principalement, pour nous avoir laiss l'un des ouvrage s les plus importants de la seconde gnration Madhyamika: le Shata-Shastra (Trait de s cent vers). Il dploie dans ce texte, outre l'essence de sa critique ngative avec une vigueur et une force exceptionnelles, un rel talent argumentaire. . Cet ouvrage, se prsentant de la mme manire que les traits de l'cole nagarjunienne, es t en fait au premier abord une entreprise de rfutation systmatique des opinions de s diverses thories mtaphysiques qui taient dveloppes l'poque. Dans un premier temps, ryadeva combat les positions des matrialistes indiens qui prnaient la recherche im mdiate du plaisir comme forme d'objectif vritable de la sagesse. On imagine sans p eine la raction d'Aryadeva qui, non seulement en tant que bouddhiste, avait trs ce rtainement tendance considrer que tout tait douleur, mais de plus en fidle disciple de Nagarjuna percevait que rien n'tait produit de lui-mme. De ce fait, dit-il, le plaisir, le bonheur, n'existent nulle part, une chose ne peut (dharma) natre d'el le-mme, car elle tomberait dans l'erreur de la double cause, l'une qui est sa nai ssance en tant que telle, l'autre qui est la raison interne qui l'a fait natre. E t une chose ne peut non plus natre d'une autre, car ce qui n'existe pas par soi-mm e ne peut, fortiori, exister par autrui1. Dans les longues joutes argumentaires q ui structurent les chapitres de son Trait, Aryadeva se penche tour tour sur les arg uments substantialistes. Il revient, une fois encore, sur le problme de Yatman, d e la mmoire, de la pense, puis aborde, d'une manire il faut l'avouer assez neuve, d ans le troisime chapitre du Shata-shastra, la question de l'existence et de l'uni t des choses. Aryadeva se met analyser les rapports rciproques des trois notions d' objet, d'existence et d'unit pour montrer que, soit qu'on admette l'identit des no tions d'objet et d'existence, soit qu'on les spare, soit qu'on considre l'existenc e comme la caractristique gnrale (smanya lakshana) et l'objet comme la caractristique particulire (viesha lakshana), soit que ce soit l'inverse, dans tous les cas la n otion d'unit disparat2. . Cette rfutation de l'unit conduit une rfutation parallle des lments et des formes, de parties et du singulier. Ni unit, mais ni diversit non plus, ni particulier, ni t otalit. Ce qui signifie que, si l'existence, l'unit et la forme particulire sont di ffrentes, alors il n'y a rien qui existe. Une forme sans existence est une non-fo rme, un non-tre, toute la finesse rsidant de la part d'Aryadeva dans la distinction , l'opposition et les impossibilits qu'il a tablies entre la chose existante et l' ide d'existence abstraite, puis dans les antinomies qu'il trouve dans les relatio ns du tout et des parties, les parties ne pouvant tre ni le tout ni distinctes du tout3. . L4: [Ni cause ni effet] :L4 . La critique d'Aryadeva semble devoir embrasser l'ensemble du champ phnomnal; ngatio n du temps, de la perception, des objets, son apptit critique est insatiable. Si son examen de la problmatique du temps est de toute premire valeur, son procs de l' existence du temps, s'inscrivant dans le droit-fil de la pense nagarjunienne, lui donne nanmoins l'occasion d'un dveloppement encore plus sensible, puisqu'il en ddu it l'impossibilit de toute perception. Si la dure n'existe pas, c'est--dire si pass, prsent et futur ne constituent aucune vritable ralit concrte, de ce fait, il n'y a pa s de halte devant laquelle on aurait le loisir de percevoir des objets durables. Les dharma tant sans dure, il n'existe pas de fil de continuit de l'un l'autre; il faut les envisager comme des instantans sans lien entre eux et, ds lors, la perce
ption devient impossible4. Cette analyse permet Aryadeva de dmontrer l'absence de toute dtermination pralable dans les choses, de dmontrer l'erreur de la conception orthodoxe qui affirmait la prexistence de l'effet dans la cause et dont il ne fig urait, ainsi que le soutenait la thorie du satkryavada, qu'une forme de changement interne spcifique. C'est contre cette thse qu'Aryadeva crit: ~ Si au moment o nat l'effet qu'est le vase, la cause qu'est le bloc d'argile di sparat, alors il n'y a plus de cause. Si elle ne disparat pas, on ne peut plus dis cerner de diffrence entre le bloc d'argile et le vase (...), la chose en puissanc e et la chose en acte sont deux principes diffrents. De plus, si l'effet n'est qu e la cause prsente sous une forme, la cause sans plus, dans ce dterminisme rectilig ne le mrite et le dmrite disparaissent5. . Cette forte critique entrane celle de l'ide de cration qui, de faon inverse mais cep endant quivalente, pense l'effet comme un lment totalement htrogne ou nouveau par rapp ort la cause: ~ L'auteur Madhyamika trouve dans l'ide d'apparition de l'effet d'invincibles a ntinomies. Vous admettez, dit-il a ses contradicteurs, que le vase apparat au mom ent o il commence exister comme tel. Erreur! Le vase existait dj! Aryadeva reprend alors son propre compte, sous une forme peine modifie, la dcomposition nagarjunien ne de l'apparition en apparition prte apparatre, apparition apparaissante et appar ition apparue, dcomposition qui lui permet d'immobiliser le mouvement et d'empcher la production de toute apparition vritablement dynamique: si une chose se produi t, c'est qu'elle tait dj produite car si elle n'existait pas dj, comment apparatrait-e lle? Si vous dites que ce qui nat est demi n et demi non n, ces deux erreurs se con fondent avec la prcdente. Donc la naissance est impossible. Le principe, le milieu et la fin sont rciproquement conditionns. S'ils taient spars (dans le temps), commen t pourraient-ils exister? C'est pourquoi ils ne peuvent se produire en srie6. . Dans une vertigineuse dialectique de la ngation de la ngation, Aryadeva mobilise u ne incroyable et renversante analyse: L'effet coexiste-t-il avec la cause? Cette coexistence est la ngation de la chane des causes et des effets. L'effet apparat-il au moment o la cause disparat? Alors sa production ne diffre pas de la destruction de la cause, et la filiation ne peut se produire. Nat-il aprs la disparition de l a cause? Alors il n'y a plus de cause et ne peut natre, etc.7. Non content de perd re son contradicteur, Aryadeva en vient, pour conclure, pouser la premire thse qui faisait l'objet de sa rfutation initiale, il soutient maintenant que si l'effet ne prexistait pas dans la cause, la cause ne pourrait produire l'effet, car celui-c i, tant entirement diffrent d'elle, lui serait tranger8. Ce qui est exactement l'inve rse de ce que dfendait Aryadeva au commencement de sa rfutation! Que comprendre ce tte invraisemblable position? Il s'agit simplement pour Aryadeva, dans cet exerc ice droutant et contradictoire, de contraindre l'esprit de son adversaire reconnat re son impuissance, et donc de l'inviter cesser de vouloir adhrer une position fi xe et dtermine. . L4: [L'arme de la critique du Madhyamika] :L4 . Seule l'obtention d'un dsarmement des facults et des prtentions de l'esprit intresse Aryadeva; considrant que toute position en tant que telle est fausse et vraie gal ement, peu lui importe de soutenir le contraire de ce qu'il dfendait ardemment prcd emment. Si tout est vrai et faux la fois, sous le mme et identique rapport, l'aff irmation et la ngation n'ont alors qu'une vertu purement pdagogique, elles sont l' une et l'autre parfaitement limites et finalises par l'utilisation ponctuelle de l 'exercice argumentaire. . Elles n'ont en elles-mmes aucune essence vritable, ce ne sont que de simples conve ntions du langage dialectique, des outils dnus de toute authentique substance relle . Cependant, si la mise en uvre d'un tel criticisme est dj troublant pour les espri ts habitus possder des certitudes claires et certaines, ne serait-ce que portant s ur les sujets relatifs aux phnomnes conditionns (dharma samskrita), il sera bien pl us problmatique pour Aryadeva de formuler ses conclusions lorsqu'elles s'attaquer
ont aux phnomnes prtendument inconditionns (dharma asamskrita), aux principes considrs comme non attachs par des liens mondains, ainsi que se voit reprsent et dfini tradi tionnellement le Nirvana. . C'est ici peut-tre le passage le plus droutant, le plus surprenant de la littrature bouddhique, puisque l'arme de la critique du Madhyamaka n'pargne mme pas les conc epts les plus respectables, les plus vnrs de la Doctrine de l'Eveill. Eh quoi! s'crier a le hinayaniste, quand le dsir (littralement la "soif, trishn) et les autres passi ons (klea) ont t entirement dtruits, quand, de ce fait, la naissance et la mort, c'es t--dire tout le samsara et tout le karma ont disparu, le Nirvana n'est-il pas alo rs ralis? Non rpond Aryadeva, car si l'absence de klea est le Nirvana, le Nirvana n' est plus un inconditionn, mais une chose produite (dharma kritaka) comme toutes l es autres. En d'autres termes, si le Nirvana n'est que l'absence de tout phnomne, c'est simplement un phnomne ngatif, ce n'est plus le Nirvana 9. . Aryadeva poursuit en insistant de la manire suivante: ~ De plus, dans votre dfinition, tant que tout l'ensemble des phnomnes n'a pas t un iversellement teint, le Nirvana ne serait jamais rellement ralis. Enfin vous posez q ue le Nirvana est un effet dont la cause serait la cessation, l'absence de klea, de karma et des autres phnomnes. Comment une absence, une pure ngation la ngation de tout l'imaginable peut-elle tre une cause10? . L4: [Un dsir vain] :L4 . Afin de prciser sa pense, Aryadeva utilise une trange formulation pour un bouddhist e: ~ Si dans le Nirvana, il ne subsiste plus ni individus (sattva) ni objets (vas tu) dsirables, c'est un lieu mille fois plus redoutable pour nous que ce monde-ci . Pour quelle raison le dsirez-vous donc? Si le Nirvana est simplement l'abandon de tous les attachements, la destruction de tous les concepts, ce n'est ni l'tre ni le non-tre, ni une chose ni une non-chose, ce n'est rien qu'une extinction, co mme l'extinction d'une lampe 11. . Cela signifie, pour Aryadeva, que dsirer le Nirvana est une absurdit: le dsir de la cessation est vain puisqu'il est un dsir vide, un dsir du rien est un non-dsir, ca r le rien ne peut tre dsir puisque prcisment il n'est (si l'on peut dire!) rien. De l a sorte une aspiration au vide est un vide, une absence de toute aspiration. En ralit personne ne parvient au Nirvana, le Nirvana ne peut tre obtenu; vide, il ne p eut faire l'objet d'une obtention. Nul ne peut obtenir le Nirvana, car il n'y a pas de Nirvana obtenir. Rien dsirer, rien esprer non plus. De ce qui n'est pas, de ce qui n'existe pas, il n'est pas possible d'aspirer la possession: ~ Quand nous parlons d'obtenir le Nirvana, dit Aryadeva, ce n'est la qu'une ex pression mondaine, sans valeur mtaphysique12. . L4: [Tout est vide] :L4 . Les bases doctrinales les plus vnrables ne sont donc pas pargnes, comme on le consta te, par Aryadeva; brutalement il renverse les dogmes les plus sacrs, ceux qui son t entours du respect le plus dfrent. Rien esprer, rien attendre, rien non plus atte ndre, pas de Nirvana, pas de libration, pas de cessation, pas de samsara non plus . Tout est vide de nature propre, tout est vide de substance relle. Aryadeva pous se dans ses plus extrmes limites la dialectique ngative nagarjunienne. Si ses cont radicteurs, puiss par l'usage permanent de sa critique, lui rtorqueront que certes rien n'existe si l'on accepte son discours, mais que du moins il existe la ngatio n, Aryadeva expose alors que sa critique est une critique universelle auto-aboli tive, qu'en elle-mme elle n'existe pas, qu'elle n'a pas pour but de proposer une thse particulire, mais bien plutt de dtruire toute thse positive, sans rien proposer la place. En effet, qui n'admet de vrit que la pure vacuit peut critiquer autrui san s se rendre jamais vulnrable, puisque, se gardant de toute affirmation, il ne don ne prise aucune critique. La vacuit ne comporte d'autre dmonstration que celle, to
ute ngative, que constitue la rfutation des opinions positives, l'une aprs l'autre et l'une par l'autre 13. Dans un ultime sursaut, les adversaires d'Aryadeva dclare nt que n'affirmer aucune thse positive c'est encore soutenir une position sans s' en rendre compte, c'est peut-tre tre victime d'une illusion thorique suprieure en im portance l'ensemble des positions fixes. Nullement, rpond avec ironie Aryadeva, no us avons commenc par poser que toutes les choses qui naissent de production en re lativit (pratitya-samutpada) ont pour caractristique la non-existence. Ds lors nous n'avons avanc aucune affirmation et, partant, propos aucune thse. Prouver par voie ngative qu'aucune thse n'est valable, ce n'est pas poser une thse, pas plus qu'tabl ir la non-existence des choses, ce n'est doter la non-existence de je ne sais qu elle existence 14. . Ruins par cet incessant mouvement argumentaire, les contradicteurs conviennent qu e si tout est vide, si tout le caractre de la non-existence, alors mme la dialecti que ngative du Madhyamaka participe de cette non-existence gnrale: Est-ce dire que l a vrit soit le non-tre? Aryadeva ne l'admet pas plus que Nagarjuna. Le non-tre, ense igne-t-il, n'existe pas plus que l'tre; ou, si l'on prfre, le non-tre comme l'tre n'e st que vacuit15. Si ni tre ni non-tre, ni vide ni non vide existent et n'existent pa s tout la fois, quoi peut bien servir cet enseignement? s'interrogent non sans r aison les adversaires d'Aryadeva. On imagine aisment ce dernier rpondre avec un so urire: Votre esprit est bien proccup, pourrait-il dire, vous ne pouvez franchir l' obstacle qui vous spare (tout en ne vous sparant pas) de la vrit vraie, celle qui co nduit, parce qu'elle ne conduit justement pas la libration; quoi que vous fassiez vous ne pouvez parvenir l'universelle vacuit. . Aryadeva, en cela fidle son matre, mais encore plus brutalement que lui, reste jusq u'au bout en attitude de combat contre toute accalmie de l'esprit ou du c ur. C'es t avec une brutalit singulire qu'il dclare sans valeur l'ide de Nirvana. Aucune reli giosit ne vient temprer l'pret de sa logique ngative. La tradition ne nous tonne qu d quand elle nous apprend que ce fougueux polmiste fut tu par un de ses adversaires ...16. Aryadeva, parmi les disciples de Nagarjuna, est celui qui poussa son maxim um la doctrine de la vacuit, par-del toute religiosit, toute forme traditionnelle, toute limite identifiable. Ceux qui, aprs lui, se situeront dans la continuit de l a pense nagarjunienne, tout en respectant la dimension propre de la dialectique ng ative, vont l'intgrer au sein des coles bouddhiques et l'acclimater une pdagogie sp irituelle, que l'on peut sans peine qualifier de plus mesure. . L3: [II. Le dveloppement de la logique bouddhique aprs Nagarjuna] :L3 . Avant d'aborder les figures majeures de l'cole nagarjunienne, qui mergrent partir d u Ve sicle, il est ncessaire de prciser le contexte qui entoura la diffusion de la doctrine de la vacuit. Nous l'avons vu plus haut (chapitre 2, III), la doctrine V ijnanavada se singularisera en affirmant que la ralit est pure conscience (citta), que les tres et les choses n'existent qu'en fonction de la conscience, que l'esp rit dans son exercice est l'unique ralit effective. La ralit n'est donc, pour cette c ole, que pure conscience, qu'esprit uniquement. Il n'y a de rel, en dernire analys e pour cette position, que l'esprit et lui seul. Cette cole, fonde au IVe sicle par trois figures emblmatiques: Vasubandhu, Asanga et Maitreyantha, produisit un effo rt thorique et analytique intense, aboutissant la publication de trs nombreux trai ts. . En parallle de ce courant, se dveloppa galement sous l'influence de Dignaga et Dhar makirti une vritable cole spcifique de logique indienne, d'une trs grande originalit formelle. On considre que le travail effectu par Dignaga est l'origine de la logiq ue bouddhique mdivale; son uvre matresse, le Pramanasamuchchaya (Accumulation des cr itres de la connaissance juste), est un ouvrage dans lequel il entreprend une ana lyse systmatique du raisonnement dductif. Dignaga rduit donc les lments de connaissanc e deux (la perception et l'infrence), et il les spare radicalement. L'argument d'a utorit, comme source de connaissance, est rejet. Cependant la perception et le rai
sonnement ont valeur gale, et ne peuvent exister l'un sans l'autre, car la percep tion la plus simple contient l'activit synthtique de la pense. C'est pour cela que pour les logiciens bouddhistes, plus encore que pour leurs prdcesseurs brahmaniste s, tout jugement, mme le plus simple, peut tre trait en infrence, rduite trois membre s 17. . L4: [L'infrence rduite de Dignaga] :L4 . L'examen de cette infrence rduite est digne d'intrt, car il permet de mieux saisir l es subtilits de la logique bouddhique, subtilits qui la distinguent de la logique indienne traditionnelle. La logique traditionnelle reconnat en effet cinq parties l'infrence: a) la proposition, b) la raison, c) l'assertion, d) l'application, e ) le rsultat. Dignaga va rduire d'autorit ces cinq lments trois; toutefois cette rduc ion n'est pour lui qu'une infrence pour autrui. Cette infrence "pour autrui" n'est en aucune faon une source de connaissance, tout au plus une mtaphore. Elle n'est pas un procd pour tendre nos connaissances, puisqu'elle se rfre des phnomnes illusoires Dignaga) lui oppose l'infrence "pour soi", qui, elle, est vritablement une source de connaissance (...)18. L'infrence pour soi ceci de particulier qu'elle possde comme vertu premire d'tre une authentique source de comprhension, une source de connaiss ance radicalement nouvelle de la logique. Elle aussi comme fonction de favoriser , sur le plan gnosologique, les thses nagarjuniennes qui portent sur l'existence p hnomnale. Dignaga poursuit donc un objectif unique dans sa dmarche rflexive: permett re une juste comprhension du rapport entretenu par les ides avec la ralit. Ce rappor t, loin d'tre vident, est l'occasion de controverses multiples et d'opinions contr adictoires; le travail de Dignaga eut justement pour mission principale de clari fier cette question. Cette entreprise sera d'ailleurs poursuivie au VIIe sicle, n on sans un enrichissement thorique notable, par Dharmakirti, auteur du Pramanavar ttika (Explication des critres) et du Pramanavinishchaya (Dcision selon les critres ), ouvrages qui aborderont les aspects les plus essentiels de la connaissance lo gique. L'explication que Dharmakirti ralise des critres lui permet d'approfondir l a notion d'infrence pour soi, qu'il dtermine comme ncessaire avant toute rflexion trai tant de la connaissance de ce qui est. Son analyse ceci de particulier qu'elle d iscerne d'une part le principe d'identit et d'autre part le principe de causalit d es infrences ngatives. Ce qui revient mettre en lumire un type d'infrence qui peut tr e analytique, synthtique ou affirmative. L' uvre logique de Dharmakirti va avoir un e grande influence sur les tudes bouddhiques postrieures, c'est pourquoi, aprs elle , les auteurs Madhyamika seront contraints de modifier leur discours, en particu lier celui touchant l'existence ou la non-existence des phnomnes. . Les arguments des logiciens obligeaient un dbat thorique se situant au c ur mme des mc anismes de la comprhension de la Doctrine de l'Eveill. Les thses relatives au problm e de la connaissance sont l'objet d'affrontements entre des tendances et des sen sibilits fort diverses et trs souvent hostiles les unes aux autres. Les enjeux, il faut bien l'admettre, taient de trs grande importance puisqu'ils portaient prcismen t sur la juste interprtation de la Voie du Bouddha et de la thorie de la vacuit. On comprend mieux, ds lors, que les efforts conceptuels se soient dvelopps de manire s i consquente, puisqu'ils touchaient l'essence mme de la Doctrine. . . ******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* . L2: [6. Evolution de la doctrine Madhyamika] :L2 L3: [I. Les coles Svatantrika et Prasangika] :L3 . Parmi l'ensemble des tendances qui mergrent des grandes controverses thoriques rela tives la question de la connaissance, deux coles vont jouer un rle majeur: l'cole S vatantrika et l'cole Prasangika. L'cole Svatantrika signifie cole indpendante, mais de
quelle indpendance est-il question? Il s'agit tout simplement d'une conception c onsidrant que les preuves de la logique doivent rester indpendantes de la doctrine Madhyamika. Cette analyse fut dfendue principalement et en premier lieu par Bhav aviveka, qui affirma que les lments de la raison dductive sont utiles la comprhensio n des thses nagarjuniennes. Pour Bhavaviveka l'exprience du monde, si elle n'tait p as compltement nie, tait nanmoins considre comme non relle. Son approche empruntera au Yogacara son insistance l'gard de la position dterminante de la conscience au sein de la ralit. Cette utilisation des lments idalistes du Yogacara, combins aux principe s logiques, produisit une doctrine syncrtique nouvelle qui prsenta des traits surp renants, comme l'attention spciale porte la psychologie. L'apport de Bhavaviveka rs ide dans cette attention qu'il dploie afin de dmontrer l'inanit de la sparation arti ficielle, incarne par la dyade sujet/objet. Son examen des processus cognitifs l' amnera considrer la conscience comme partie intgrante de la ralit phnomnale. La ral on lui ne trouve pas son objectivit dans l'extriorit de son tre vis--vis de la consci ence, mais bien au contraire en incluant la conscience au sein de cette totalit e xistentielle. Il faut cependant prciser que les phnomnes, tant considrs comme illusoir es par Bhavaviveka, la conscience, phnomne parmi les autres, est elle aussi frappe de la mme et identique dtermination; sans statut particulier elle est ramene la pur e irralit. . Le discours de Bhavaviveka utilise nanmoins les outils de la logique formelle afi n de dmontrer la vracit de ses arguments. Cette utilisation deviendra d'ailleurs la caractristique propre de l'cole Svatantrika. Les thses de Nagarjuna ne subissent a ucune inflexion chez Bhavavika, mais dans sa dmarche, la doctrine de la vacuit se voit confirmer par des arguments extrieurs au systme analytique nagarjunien. C'est prcisment contre cette tendance que s'lvera Buddhapalita, qui refusera la soumissio n des thses nagarjuniennes la logique de Dignaga. Buddhapalita ne recherchera auc une conciliation ou concession avec les coles logiques qui triomphaient alors, et tentera de pousser jusqu l'absurde, c'est--dire jusqu leur ultime consquence, les pro positions thoriques de ses adversaires. . L'cole Prasangika tient de ce fait son nom de prasanga signifiant consquence, spcifia nt ainsi l'attitude de Buddhapalita et de ses disciples. Pour eux la pense de Nag arjuna est purgative, elle ne doit faire l'objet d'aucune dmonstration, fut-elle logique, extrieure la dialectique critique de Nagarjuna lui-mme. Les deux coles Sva tantrika et Prasangika sont extrmement reprsentatives des dbats qui agitrent le boud dhisme aprs Nagarjuna entre le Ve et le VIe sicle. . L3: [II. Chandrakirti et le Madhyamakavatara] :L3 . Incontestablement, Chandrakirti est le dfenseur par excellence, au VIe sicle, de l 'orthodoxie Madhyamika; son activit sera finalise par un seul et unique objectif: redonner la doctrine de Nagarjuna l'intgralit de son originalit et de sa radicalit i nitiale. En ce sens il se situe bien dans la rigoureuse continuit de Buddhapalita , en refusant comme lui de faire dpendre la thorie nagarjunienne d'une caution arg umentaire extrieure la thorie elle-mme. Concernant la vie de Chandrakirti, l'histoi re nous rapporte en ralit trs peu d'lments; on sait toutefois qu'il est natif de Sama nta, dans le sud de l'Inde, d'une famille de brahmanes. On prtend qu'il devint pl us tard abb de Nalanda. Comme toujours, les biographies que nous possdons rapporte nt de nombreux faits extraordinaires et fabuleux, comme en sont remplies les hag iographies orientales lorsqu'elles retracent la vie d'un personnage spirituellem ent important. . De loin beaucoup plus intressante et remarquable est l' uvre thorique que nous laiss e Chandrakirti et, se dtachant de celle-ci, outre la Prasannapada Madhyamakavrtti , qui est le commentaire le plus achev de la pense nagarjunienne, son Entre au Milie u (Madhyamakavatara), ouvrage complmentaire et introduction au Trait de Nagarjuna lui -mme. Ce deuxime texte est certainement celui qui exera l'influence la plus considra ble sur l'cole Prasangika, par la manire trs particulire dont Chandrakirti utilisa l
a mthode dite de consquence ncessaire (prasanga), en faisant preuve d'un art dialec tique trs efficace lors de ses dmonstrations. Sa capacit montrer la caducit de toute position partielle, sa matrise de la critique ngative nagarjunienne, ont fait de lui un des matres Madhyamika les plus rputs. . L'ouvrage de Chandrakirti est structur par les rfutations successives qu'il dvelopp e contre les doctrines considres comme errones. Il indique, dans une formule potique , que l'intelligence de son lecteur sera conduite au rang du Vainqueur si celleci veut bien se laisser guider comme un aveugle se laisse guider par un voyant. Chandrakirti engage son argumentaire, aprs de nombreux prliminaires de nature prven tive, dans les fondements de la vacuit par le raisonnement bas sur le non-soi des p hnomnes '. On reconnat immdiatement le discours nagarjunien dans ses rfutations rpte ne production partir de soi-mme, partir d'autre chose, partir de soi-mme et d'autr e chose, de mme que la rfutation d'une production sans cause. Nous sommes sans con testation au c ur du systme critique de la vacuit, mais se dgage de Chandrakirti une insistance particulire sur la distinction entre vrit relative et vrit ultime: Parce qu 'elle voile la nature (des choses), l'erreur est nomme "le relatif. En raison de cela ce qui, tant artificiel, apparat comme vrai, le Puissant l'a dclar "vrit relative ", et la chose artificielle "le relatif "2. Une assertion judicieuse est insre dans ce passage portant sur la distinction entre les vrits: Comme mme du point de vue de s deux vrits il n'y a pas de nature propre les (formes, etc.) ne sont ni permanent es ni annihiles3, une forme d'cho lointain mais trs intime de l'affirmation de Nagar juna portant sur l'absence de permanence et d'annihilation. Plus loin: L'Eveill en seigne le je et le mien; de mme les essences sont sans nature propre, mais en tan t que sens indirect, il enseigne leur existence 4. La conclusion contre ses diffre nts adversaires est relativement fine, sans tre dnue d'une pointe d'humour: En rsum, d e mme qu'il n'y a pas de connaissable, il n'y a pas de connaissance. C'est ce qu' il faut savoir5. . Au sujet de l'importance de la doctrine nagarjunienne de l'Eveil, la pense de Cha ndrakirti est sans dtour: Pour ceux, dit-il, sortis du chemin (trac par) le matre Na garjuna, il n'y a pas de moyen de paix. Ils ont chut des vrits relatives et ultimes , et par cette chute, la libration n'est pas accomplie6. La Voie du Milieu ne se f ixe pas, ne s'arrte aucune vrit; tout la fois dans la ngation et dans l'affirmation, elle maintient la thse d'une identit des contradictoires, les essences depuis l'or igine ne sont pas nes en ralit, quoique (pour) le monde elles soient nes7. Prcisant ce tte question, Chandrakirti va montrer que les aspirants la libration doivent comme ncer par rfuter l'inhrence du je, ce sera l'objet de son expos central ayant pour ob jectif d'tablir le non-soi. Voyant par l'intelligence que tous les maux et perturb ations ont comme origine la vue relative une collection destructible, reconnaiss ant qu'elle le je pour objet, l'adepte rfute le je 8. Sa dfinition du je, peru dans sa dpendance et donc chappant toute dfinition, est sans doute d'une grande justesse doctrinale Madhyamika: ~ N'tant pas une essence relle il n'est pas stable, il n'est pas instable, il ne nat ni ne prit, il n'y a pas non plus pour lui permanence, ni identit ni diffrence9 . . L4: [Les seize formes de vacuit] :L4 . L'originalit de Chandrakirti trouve s'exposer de faon significative l'occasion de l'criture de son chapitre portant sur l'explication des divisions de la vacuit. Re marquons pralablement, selon la tradition, que Nagarjuna aurait affirm que le nonsoi comporte de nombreuses divisions, il a d'ailleurs lui-mme, dans les textes de la Prajnaparamita, identifi dix-huit formes distinctives du vide. . Si Nagarjuna affirme, la suite du Bouddha, la vacuit de tous les dharma, il recen se cependant au sein de la vacuit dix-huit formes particulires, et ceci en mainten ant que la vacuit au sens absolu est vide d'elle-mme, c'est--dire vacuit de la vacui t. .
~ Les dix-huit vacuits, dit Nagarjuna, sont dix-huit manires de considrer les dha rma en tant que vides (...). Les dix-huit vacuits sont vides (sunya) et irrelles ( asadbhatalaksana). La Prajnaparamita elle aussi est irrelle. . Les dix-huit formes de la vacuit, identifies par Nagarjuna, sont les suivantes: ~ 1). La vacuit des dharma internes. ~ 2). La vacuit des dharma externes. ~ 3). La vacuit des dharma la fois externes et internes. ~ 4). La vacuit de la vacuit. ~ 5). La vacuit de la grande vacuit. ~ 6). La vacuit de l'absolu. ~ 7). La vacuit des conditionns. ~ 8). La vacuit des inconditionns. ~ 9). La vacuit de l'absolue vacuit. ~ 10). La vacuit des dharma sans commencement. ~ 11). La vacuit des dharma dispenss. ~ 12). La vacuit des essences. ~ 13). La vacuit des caractres spcifiques. ~ 14). La vacuit de tous les dharma. ~ 15). La vacuit consistant dans la non-perception. ~ 16). La vacuit du non-tre. ~ 17). La vacuit de l'tre propre. ~ 18). La vacuit du non-tre de l'tre propre. . Nagarjuna prend soin de prciser de la faon la plus claire son raisonnement, afin d e permettre une juste comprhension de sa distinction des dix-huit formes: ~ Si on parle en rsum (samksepena), il faut poser une unique vacuit, savoir la "v acuit de tous les dharma'' (sarvadharmasunyata, numro 14 de la liste). Si on parle au long (vistarena), il faut poser une vacuit pour chaque dharma: vacuit de l' il ( caksuhsunyata), vacuit de la couleur (rupasunyata], etc., bref un nombre considrab le. Pourquoi donc le Prajnaparamita-sutra ne pose-t-il que dix-huit vacuits? Rpons e: si on parle en rsum, le sujet n'est pas trait en entier; si on parle au long, il devient surcharg. Ainsi, quand on prend un mdicament (bhaisajya), si on prend tro p peu, on ne chasse pas la maladie (vyadhi), si on prend trop, on aggrave les to urments (upadrava). C'est en dosant le mdicament sur la maladie et en n'en prenan t ni trop ni trop peu (annndhikam) que l'on peut gurir la maladie. Avec la vacuit il en va de mme. Si le Bouddha ne parlait que d'une unique vacuit, on ne pourrait pas dtruire les multiples vues fausses (mithyadrst) et passions (klesa); s'il posait une vacuit propos de chaque vue fausse, les vacuits seraient trop nombreuses. Les hommes qui s'attachent au caractre de la vacuit (sunyatalaksanbhinvista) tombent da ns (l'excs) du nihilisme (ucchednta); parler de dix-huit vacuits, c'est atteindre e xactement la cible (laksya). . II en dcoule donc selon cette analyse que si ~ les dharma existent ainsi chacun en nombre dfini. C'est par dix-huit sortes d e dharma que l'on dtruit l'inclination (abhinives) leur endroit: c'est pourquoi on pose dix-huit vacuits10. . Se basant sur cet expos descriptif et analytique, Chandrakirti en tire argument s on tour pour pntrer dans le dtail d'une classification personnelle de seize formes de vacuit, trs proche de la classification nagarjunienne. . Ces seize vacuits sont, d'aprs Chandrakirti, les suivantes: 1. La vacuit de l'intrieur. 2. La vacuit de l'extrieur. 3. La vacuit de l'intrieur et de l'extrieur. 4. La vacuit de la vacuit. 5. La vacuit du grand. 6. La vacuit de l'ultime. 7. La vacuit du compos.
8. La vacuit de l'incompos. 9. La vacuit de ce qui est au-del des extrmes. 10. La vacuit de ce qui est sans commencement ni fin. 11. La vacuit de ce quoi il ne faut pas renoncer. 12. La vacuit de nature. 13. La vacuit de tous les phnomnes. 14. La vacuit des caractres spcifiques. 15. La vacuit du non-apprhensible. 16. La vacuit des non-choses. . A ces seize vacuits sont de plus adjointes quatre prcisions essentielles: 1. Les choses sont vides de choses. 2. Les non-choses sont vides de non-choses. 3. La nature est vide de nature. 4. Les choses autres sont vides de choses autres. . A la fin de cette longue liste, Chandrakirti prcise qu'en ralit il n'existe pas de vacuit ou de non-vacuit, il en profite pour rappeler deux stances de Nagarjuna: . \ ### \ On ne peut dire que Celui-ainsi-all est vide, ni qu'il est non vide, vi de et non vide la fois, ou ni vide ni non vide. Ces mots ne servent que comme dsi gnations (MK, XXII, 11); . \ ### \ 11. On ne peut dire (Tathagata) est vide, \ Ni il est non vide, \ Vide et non vide la fois ou ni vide ni non vide. \ Ces (mots) ne servent que comme dsignations. . \ ### \ One may not say that there is "emptiness" (sunya) (1) \ nor that there is non-emptiness. (2)" \ Nor that both [exist simultaneously] (3), \ nor that neither exists (4); \ the purpose for saying ["emptiness"] is for the purpose of conveying knowledge. . \ ### \ Si quelque chose tait non vide, il pourrait y avoir quelque chose vide; mais puisqu'il n'y a rien qui ne soit non vide, comment y aurait-il (une chose) vide? (MK, XIII, 7). . \ ### \ 7. Si quelque chose tait non-vide, \ II pourrait y avoir quelque chose vide; \ Mais puisqu'il n'y a rien qui ne soit non-vide, \ Comment y aurait-il (une chose) vide? . \ ### \ If something would be non-empty, something would [logically also] be empty \ But nothing is non-empty, so how will it become empty? . Aprs quoi il tient souligner: ~ Vide signifie priv d'existence inhrente. La premire stance indique qu'on ne peu t exprimer de thse d'tre en soi. S'il y avait quelque vacuit relle, son support, l'tr e en soi des choses, existerait. Mais la vacuit est un caractre commun tous les phn omnes, et comme il n'y a pas de phnomne qui ne soit non vide, la non-vacuit non plus n'existe pas11.
. Les seize vacuits sont l'objet d'une analyse rigoureuse o l'on regarde la spcificit de chacune d'entre elles; on peut d'ailleurs retenir quelques rflexions lumineuse s dont celle-ci: Puisque les termes initial, ou du dbut, et final n'existent pas, le cycle est dit sans commencement ni fin. Parce qu'il est priv d'alle et de venue , le devenir est pareil a un rve12. Chandrakirti conclut son ouvrage par un expos gnr al des seize vacuits, il revient sur les formes sans forme du vide, et redonne pa r son travail une nouvelle validit la doctrine de son matre Nagarjuna. . A la fin de son trait, Chandrakirti voque l'envol souverain de ceux qui ont obtenu l'Eveil grce la doctrine de la vacuit: ~ Ayant dploy les larges ailes blanches de la convention de l'asit, Ce Seigneur de s cygnes prcde les cygnes ordinaires et, avec la force du vent de la vertu, Avance vers le sublime rivage de l'ocan de qualits des Vainqueurs13. . L3: [III. Shantideva et le Bodhicaryavatara] :L3 . Celui qui aura cependant le plus d'influence parmi les derniers auteurs bouddhis tes indiens fut sans aucun doute Shantideva, qui sont attribues deux uvres, le Sik smuchaya (Le Recueil d'enseignements) et le Bodhicaryavatara (Introduction la vie menant l'illumination). La lgende raconte qu'il tait, avant de se faire moine, le fils d'un roi du sud de l'Inde. Figure de l'universit de Nalanda, Shantideva et son uvre, au VIIIe sicle, apparaissent comme une sorte d'ultime tmoignage du bouddh isme indien, avant que la puissante raction brahmanique ne contraigne les tenants de la Doctrine de l'Eveill se retirer dans d'autres contres. Le Bodhicaryavatara est d'ailleurs l'un des derniers grands textes de la pense Madhyamika, son import ance est considrable puisqu'elle exercera tout d'abord son influence sur les pens eurs et rformateurs de l'orthodoxie brahmanique, et en particulier sur celui qui en est certainement le plus reprsentatif sur le plan mtaphysique: Shankara14. . L4: [L'illusion chez Shantideva] :L4 . Le Bodhicaryavatara de Shantideva, qui tmoigne indniablement de l'influence percep tible de la pense shankarienne, deviendra le manuel de base de l'initiation dans les monastres tibtains. Le chapitre IX du Bodhicaryavatara, qui concerne directeme nt la doctrine de la vacuit, revient sur la distinction nagarjunienne entre vrit re lative et vrit absolue, mais l'originalit de Shantideva consiste mettre en lumire l' aspect illusoire de la ralit relative. ~ Les profanes, qui s'en tiennent la vrit errone ou sens commun, conoivent le mond e comme rel. Les contemplatifs ou mahayanistes, au contraire, qui recherchent la ralit absolue, ont compris que le monde n'est qu'un mirage, un rve, une cration magi que. Nous retrouvons ainsi sous la plume du dernier grand philosophe bouddhiste cette notion de la maya que le bouddhisme expirant va lguer ses vainqueurs hindou istes, et dont le chef de ceux-ci, Shankara, fera le pivot de son systme 15. . Poursuivant son dialogue avec les sectes hinayanistes, Shantideva patiemment rep rend les arguments de l'cole Madhyamika. On remarque, dans son texte, de par son attention porte au caractre illusoire du monde, des considrations nouvelles propos de cette question de l'illusion (maya) et prcisment en rponse des objections bouddho logiques. Ses arguments enrichissent notablement la rflexion du bouddhisme sur ce point. En effet, si les choses sont illusion, le Bouddha lui-mme est donc soumis la mme loi: ~ Si les cratures ne sont qu'une illusion magique; si, se trouvant de fait et e n ralit dj dans le Nirvana, elles ne continuent transmigrer qu'en apparence, en vert u d'une illusion, il s'ensuivra que le Bouddha lui-mme continue transmigrer ce qu i est absolument contraire au dogme. Shantideva rpond, comme plus tard dans le Ve dnta myavadin le fera Shankara, que, dans ce monde illusoire, tout se passe pratiq uement comme s'il tait rel 16. .
Shantideva prcise de la manire la plus rigoureuse: ~ Aussi longtemps que les causes n'en sont pas interrompues, aussi longtemps d ure cette illusion qu'est la pense, et c'est pour cela que les cratures, de fait i nexistantes, continuent transmigrer. Mais quand les causes sont dtruites, il n'y a plus production de cette magie de la pense, il n'y a plus existence de la cratur e, mme au point de vue de la vrit exprimentale (Bodhicaryavatara, IX, 14b-15a) 17. . L4: [L'analyse critique de Shantideva] :L4 . Point par point, avec patience et calme, Shantideva montre l'erreur des thories b rahmaniques; presque tous les Darshana sont tudis et rfuts, Smkhya, Nyaya, Vaiceshika , etc. Les protestations des docteurs orthodoxes l'encontre de Shantideva ne son t pas nouvelles, les plus vigoureuses portent sur la ngation du Nirvana qui se dga ge des crits du matre bouddhiste. ~ S'il n'y a pas de moi, s'offusquent les contradicteurs, il s'ensuit que l'ac te prit pour l'auteur de l'acte et que le fruit est mang par quelqu'un qui n'a pas accompli l'acte! On ne voit pas en effet, rpond tranquillement Shantideva, que l 'auteur de l'acte et celui qui mange le fruit soient le mme: autre celui qui meur t, autre celui qui renat18. . Les arguments de Shantideva, comme ceux de son matre Nagarjuna, obligent les brhma nistes une succession de questions qui aboutit toujours et invitablement la fatid ique remarque: si le moi n'existe pas, si les cratures ne sont que du vide, inexi stantes, pourquoi y aurait-il donc un Nirvana atteindre? La rponse de Shantideva est digne de Nagarjuna: II n'y a personne en dfinitive, et l'effort vers l'illumin ation procde de l'illusion, mais comme elle a pour effet l'apaisement de la doule ur, l'illusion du but n'est pas interdite19. Ce cynisme, non dissimul, heurte tout autour de lui; sa fureur vacuitaire nie le moi, les sensations, la transmigrati on, rien n'chappe la dialectique abolitive, mais de ce ngativisme radical, ou plutt de cette ngation de l'existence, une consquence inattendue dcoule: c'est que, puisq u'elles n'existent pas, les cratures, par leur nature, sont dj en tat d'absolu Nirva na20. L'apparente contradiction se fait illumination, le cynisme se transforme en juste comprhension, la ngation absolue s'panouit en Eveil absolu. . C'est pourquoi, et en cela Shantideva se situe dans l'exacte continuit de Nagarju na, le salut ne saurait avoir qu'une valeur purement ngative. Nous existons par l' illusion que nous avons d'exister, mais l'tre dlivr n'existe pas par une illusion q ui soit sienne. Existe en apparence ce qui semble dtermin par les causes; mais ce qui n'est plus dtermin par ces causes apparentes n'existe mme pas de l'existence ap parente (Bodhicaryavatara, IX, 108). Dtruisant lment par lment les arguments substanti alistes, Shantideva dveloppe, sans la limiter, sa critique, dans une continuelle mise en uvre de la ngation critique qui provoque chez ses auditeurs une angoisse. Or, c'est justement quand les notions de l'exprience sont entirement puises ou entirem ent dissoutes qu'il n'y a plus de point d'appui pour l'examen, ni pour aucune opr ation mentale, alors c'est la le Nirvana (Bodhicaryavatara, IX, 110). . La conclusion du trait de Shantideva est purement et authentiquement nagarjunienn e, niant tout la fois l'existence et l'inexistence Shantideva crit: ~ Tout cet univers est exempt de naissance comme de destruction. De ce fait, i l n'y a aucune diffrence relle entre les cratures dlivres et celles qui transmigrent. Aussi bien les cratures, en raison de leur vacuit, sont-elles dj nirvanennes. Les de stines successives des cratures sont illusoires comme des rves, vides comme la tige du bambou. Les choses sont vides, tout est vide (sunyata) (Bodhicaryavatara, IX, 142-153). . . ******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* .
L2: [7. Les ultimes aspects de la doctrine de la vacuit] :L2 . Avec Shantideva, d'une certaine manire, s'achve le dveloppement du bouddhisme indie n Mahayana. L'histoire de la Doctrine va se poursuivre dans d'autres terres, dan s d'autres contres dont, non seulement sur le strict plan gographique, le Tibet re prsente pour la transmission de la Loi tout la fois comme une frontire et un creus et exceptionnel. la fin du VIIIe sicle, des rudits vont exercer un rle dterminant da ns l'expansion et la diffusion de l'Enseignement du Bouddha; il s'agit tout d'ab ord de Santaraksita et de son disciple Kamalasila, puis du matre Padmasambhava, i ntroducteur de la tradition Dzog-chen (Grand Aboutissement), une mthode de l'Evei l immdiat prsentant de nombreuses analogies avec le Ch'an chinois, qui marquera du rablement les deux plus anciennes coles tibtaines: Nyingmapa et Kagyupa. . L3: [I. Au Tibet] :L3 . Santaraksita et Kamalasila taient trs nettement de tendance Madhyamika-Yogacara, f orme dominante l'poque en Inde. Santaraksita crivit non seulement un ouvrage le si tuant dans la pure tradition nagarjunienne, le Madhyamaklankra, mais il est galemen t et principalement connu pour tre l'auteur du Tattvasamgraha, importante recensi on encyclopdique critique de la philosophie indienne traditionnelle. On considre q ue Santaraksita posa dfinitivement les bases vritables du bouddhisme au Tibet. Ce qui explique, puisque la philosophie de Santaraksita est comme une sorte de socl e, de soubassement de la doctrine tibtaine, que le bouddhisme ait pris dans ce pa ys une tendance, une coloration trs nettement Madhyamika-Yogacara. Par ailleurs, il y eut un pisode tout fait curieux au sein du bouddhisme tibtain, aprs la dispari tion de Santaraksita, dont on nous dit qu'il retourna mourir en Inde son uvre de transmission accomplie. Nous assistons en effet cette priode l'mergence d'une sort e de dbat thorique, d'une discussion passionne entre adeptes du Ch'an (Dhyana), qui prnaient une voie directe non progressive et non discursive vers l'Eveil, et les disciples de Santaraksita ayant leur tte Kamalasila lui-mme, adeptes d'une mthode plus pdagogique et rflchie, pour tout dire plus progressive. Les uns et les autres t aient pleinement d'accord sur le fond de la doctrine au niveau absolu, mais ils se divisaient radicalement sur la faon d'y parvenir. La question des moyens, du c omment revenait comme un ternel problme qui, finalement, aujourd'hui comme hier, d istingue deux sensibilits, deux caractres et donc deux psychologies mthodologiques en permanence opposes. Comme il en tait alors l'usage, l'arbitrage de ce type de db at doctrinal revenait traditionnellement au roi; celui-ci finalement donna raiso n Kamalasila et ses disciples, faisant de la position gradualiste la position of ficielle du bouddhisme au Tibet1. . Il fallut attendre le XIe sicle, qui est considr comme une priode de renouveau, comm e une seconde phase d'expansion du bouddhisme, pour que l'cole Madhyamika bnficie d 'un nouvel lan. Ce fut toutefois, dans un premier temps semble-t-il, l'cole de Cha ndrakirti qui profita de cette nouvelle situation et qui put exprimer sa positio n avec le plus d'aisance. Paralllement, surgit une interprtation originale du Madh yamaka, qui prit le nom tibtain de Shentong (vacuit de l'autre) en opposition au R angtong (vacuit de soi), et qui sera promise une immense influence sur l'ensemble du bouddhisme au Tibet. Le Rangtong fondait son argumentation sur la notion de vrit ultime, concluant l'absence de nature propre de tous les phnomnes; l'cole Shento ng reconnaissait parfaitement cette analyse qu'elle faisait sienne, mais invoqua it un troisime cycle d'enseignement de l'Eveill, dans lequel celui-ci affirmait qu e tous les tres possdaient la nature de Bouddha. Deux versets du rGyud bLama (Ratn a-Gotra-Vibhaga) exposent trs clairement la position du Shentong: L'essence (de la Bouddhit) est vide des impurets passagres dont les caractristiques sont compltement s ares (d'elle; cette essence cependant) n'est pas vide de qualits insurpassables do nt les caractristiques ne sont en rien spares (d'elle) (RGVI, 154155)2. Dans le mme t exte il est prcis, que: si la Nature immuable est vide des impurets passagres qui lui sont tout fait trangres, elle n'est pas vide des qualits qui ne sont pas diffrentes d'elle. Cet enseignement reoit son nom de Shen-tong (gzhanstong, tib.), de par le
fait qu'il diffre du Rang-tong (rang-stong, tib.), en ce qu'il considre la vacuit comme non vide de qualits; c'est en quelque sorte une "vacuation de la vacuit", ou e ncore, une "vacuit de la vacuit", mais il faut dire expressment que cette cataphase , ou affirmation, ne vient qu'aprs l'apophase ou ngation. (...) La voie de la vacu it qualifie, dit F. Chenique, rejoint l'hyperthologie lumineuse de la tradition dio nysienne3. Ainsi s'explique que le Shentong soutienne que sur le plan de l'absolu , la vacuit est donc insparablement lie la clart, la claire lumire de l'Eveil. Pour ette cole, la vrit absolue n'est pas uniquement considre comme la vacuit dnue de tou nceptualisation, mais comme l'union indiffrencie de la vacuit et de la clart. Cette clart de l'esprit est synonyme de sa lucidit et la vrit absolue est dfinie comme: l'i nsparabilit de la clart et de la vacuit4. Il importe, pour les matres de cette cole, q e l'esprit retrouve sa vritable nature, qui est tout la fois vacuit et lumire, natur e de Bouddha (qui) est dsigne par trois aspects identiques en essence, corresponda nt aux diffrentes phases de sa purification. La nature de Bouddha en tant que fon dement: pure depuis l'origine, elle est l'union de la clart et de la vacuit, ident iques chez les Bouddha(s) et chez tous les tres. La nature de Bouddha en tant que chemin: par la pratique des moyens habiles, elle est progressivement libre des im purets contingentes qui la recouvrent. La nature de Bouddha en tant que fruit: lo rsque toutes les souillures sont disperses, la nature de l'esprit apparat dans tou te sa puret. C'est la ralisation directe du dharmakaya spontanment dou de toutes les qualits des Bouddha(s)5. . On voit sans peine immdiatement le danger d'une telle analyse qui, trs facilement, peut revenir au substantialisme et retomber dans tous les piges qui accompagnent ce type de position; position comme on le sait inlassablement combattue par Nag arjuna et les matres Madhyamika. C'est pourquoi on prcise souvent que ce savoir ne peut faire l'objet d'une connaissance livresque, et qu'il doit imprativement tre transmis de matre disciple, les risques d'incomprhension de cette notion de claire lumire tant, comme on l'imagine aisment, trs nombreux. Quoi qu'il en soit, cette tho rie, bnficiant d'un important dveloppement entre le XIVe et le XVIe sicle, participe ra directement la constitution thorique dfinitive des quatre grandes coles tibtaines , Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa et Gelugpa, qui reprsentent encore aujourd'hui une sorte de conservatoire vivant de la pense nagarjunienne. . Toutefois, on prendra soin de prciser que les plus anciennes des coles tibtaines, l es Nyingmapa (signifiant d'ailleurs anciens), avec sa branche dzogchen, et les Kag yupa (issus de Marpa, XIe sicle, tenants des enseignements oraux) semblent avoir t ne ttement influences, comme le montre le manuscrit de Touen-houang (Pelliot 117), p ar le Ch'an. Ceci explique d'ailleurs les critiques virulentes formules leur enco ntre par les Gelugpa, et surtout leur fondateur Tsongkhapa (1387-1414), qui les accusent d'tre des adeptes, de par leur fidlit Padmasambhava, de la doctrine du Ch' an. On pourrait sans doute voir en cela une indication assez vidente du profond a ttachement, jamais dmenti (d'autant que de nombreux lments indiquent que la traditi on des hva-an, soit les bonzes partisans de la mthode de Dhyana / Ch'an, malgr une certaine marginalit, est encore trs vivante), des plus anciennes coles tibtaines vis --vis de la pratique de l'Eveil immdiat par l'assise juste et la concentration (dh yana), pratique faisant de l'absence de pense discursive (avitarka, avilkalpa) l' essence du Trsor de la Loi. . L3: [II. Le tantrisme (Vajrayana)] :L3 . Par ailleurs, puisque la tradition tibtaine reste aujourd'hui son quasi unique dpo sitaire, avec il est vrai, mais dans une moindre mesure, les cole japonaises Shin gon et Tendai, on doit signaler l'immense dveloppement ralis par le tantrisme au se in du bouddhisme du IIIe au XIIe sicle, et son influence constante au sein du Mah ayana indien tout d'abord, et par la suite dans les coles tibtaines, chinoises et japonaises. De l'Inde du Sud le tantrisme porte les traces de son attachement la qute de la lumire, et du nord-est de l'Inde ce courant reoit en hritage le culte de la sexualit, ce qui explique bien sr l'iconographie spcifique que l'on peut dcouvri
r dans ses reprsentations visuelles, mais aussi l'attention porte l'union amoureus e, perue comme forme du jeu cosmique entre les opposs, comme l'nergie ternelle du pr incipe crateur, en lui-mme mle et femelle, qui doit faire l'objet d'une matrise rigo ureuse. Outre un aspect magico-rituel trs labor, le tantrisme prsente un grand intrt d e par l'influence qu'exera sur lui la pense Madhyamika. . L'cole tantrique, nomme galement Vajrayana (Vhicule de diamant), qui vise une prise en considration de la totalit du vivant, porte son attention sur la ralit dans ce qu 'elle a de plus global en ne laissant aucun aspect de cette dernire en dehors de sa dmarche libratrice. Ceci explique que soient intgrs, dans les pratiques de cette c ole, les phnomnes multiples de l'existence, parmi lesquels les plus lmentaires occup ent une place de premier ordre. On retrouve d'ailleurs dans les rites tantriques la prsence constante du vin (madya), de la viande (mnsa), du poisson (matsya), de crales ou d'aliments, parfois mme des excrtions humaines ou animales, ainsi que les gestes symboliques (mudra) et, bien sr, l'union sexuelle (maithuna). Le tantrism e s'adresse tout l'tre humain tel qu'il est dans ce monde, et d'abord son corps qu 'il faut transformer, consacrer, cosmiser, mais ne jamais mutiler. Puisque dans l'Eveil tout est gal, samsara et Nirvana, le tantrisme pose au dpart cette galit qu' il n'est plus ds lors que d'accomplir. C'est la le paradoxe du tantrisme qui, extr ieurement, apparat comme surcharg de pratiques rituelles complexes, matrielles, alo rs que dans toute son orientation profonde, et, visiblement, dans ses formes les plus hautes, il est pure qute de l'Eveil parfait, mais une qute o tout l'tre humain est impliqu6. Ceci explique que le Vajra (Diamant) symbolise, de par sa forme car actristique duelle et complmentaire, la vacuit en tant que puissance pure, l'unit ja mais perdue mais toujours voile, reprsente par le Diamant ternel, le Dorje (Seigneur des Pierres), qui tait l'origine l'arme du dieu Indra. Parmi son immense littratu re, dont les principaux textes sont le Mahavairocanasutra, le Manjusrmlakalpa, le Guhyasamja-Tantra, le Klachakra-Tantra, etc., l'cole tantrique insiste toujours sur l'galit du Nirvana et du samsara: ~ Grce elle, les yogin ne demeureront pas plus dans le Nirvana que dans l'ocan r edoutable et si difficile traverser du samsara, mais seulement dans l'essence mme de la suprme Ralit o, en sa totale perfection, apparat la plus pure et parfaite illu mination des Bouddhas, ingale, sans tache, au-del de tout changement. C'est l'galit e les cinq aggats, etc. , mai nvers toute chose; ce n'est pas s'accrocher aux choses s ce n'est pas non plus les abandonner. Le yogin ne doit pas contempler la vacui t, ni la non-vacuit. (...) Ce que le sage doit raliser dans la contemplation, c'est qu'il est en ralit, tel l'espace, sans changement, absolu, sans dsir, pur ternel, l ibre de toute construction mentale (Prajnopyaviniscayasiddhi, IVe section) 7. . Le riche panthon des divinits qui peuplent l'univers du tantrisme peut sans aucun doute surprendre, mais cet ensemble quelque peu baroque n'a d'autre existence que celle de la vacuit d'o elle tire sa ralit mme. La forme des dieux n'est qu'une manifes tation visible, un miroitement de la vacuit. Elle est en ralit sans nature propre s ubstantielle (Advayavajrasamgraha)8. Il en est de mme des vocations (mantra), des v isualisations, de l'exercice des gestes (mudra), de la complexe gomtrie des diagra mmes (mandala), qui participent tous de l'nergie cosmique non diffrencie du vide. E n ce sens l'Eveil et le Vajra sont semblables la vacuit, aucune ralit, mme la plus t riviale, n'est trangre ce qui ne possde pas de nature propre. Vhicule quasi indpendan t du Mahayana, le Vajrayana est l'expression la plus surprenante de la profonde comprhension du caractre absolu de la vacuit. Souvent qualifi de courant sotrique, le Vhicule de Diamant porte son attention vigilante sur l'homme dans sa totalit, corps , parole et esprit, qui est impliqu dans la qute de l'Eveil et cet Eveil, dont l'e xprience peut tre faite dans cette vie mme, doit tre la profonde prise de conscience que l'homme ne fait qu'un avec la vrit ultime, la vacuit, symbolise par le diamant inaltrable 9. Le tantrisme est incontestablement une des formes les plus droutantes o s'exerce de manire trs sensible la tradition non dualiste de la Prajnaparamita e t du Madhyamaka en particulier. . Poussant au plus loin dans sa logique le fait que rien n'est tranger ce qui ne po ssde pas de nature propre, le tantrisme engage de ce fait un travail spirituel de
l'Eveil, en englobant la totalit phnomnale constitutive du vivant, de l'tre dans ce qu'il a de premier, d'organique; sachant que le vide n'est pas diffrent des phnomn es et que les phnomnes ne sont pas diffrents du vide, rien pour cette cole ne doit, et surtout ne peut, tre cart de l'entreprise libratrice. .
L3: [III. En Chine] :L3 . L'introduction du bouddhisme en Chine est attribue An Shigao, prince hritier du ro yaume de Parthie qui prfra se faire moine plutt que d'assumer ses responsabilits dyn astiques. Lors de son arrive en Chine en 148 de notre re, il cre des sortes d'ateli ers de traduction des textes sanskrits, textes qui avaient pour particularit d'tre essentiellement des crits techniques propos de l'exercice de Dhyana, avec ses pr atiques prparatoires affrentes, comme celles relatives aux pratiques respiratoires (npnasati), ainsi que paralllement des traits concernant les catgories numriques tels les cinq agrgats (skandha) ou les six organes des sens (yatana). Il est frappant d e constater qu son origine, ses premiers dbuts sous l'influence de An Shigao, le bo uddhisme chinois est dj marqu par la pratique de Dhyana. Toutefois, ce n'est qu'au IVe sicle, c'est--dire aprs que l'empereur eut autoris que ses sujets reoivent l'ordi nation monastique, et que par la mme ils deviennent moines, que surgit un foisonn ement d'coles que la tradition nomme les six maisons et les sept coles, toutes profo ndment influences par l'tude du Prajnaparamita-sutra, et dveloppant des analyses exgti ques spcifiques de la doctrine de la vacuit. . L4: [Les sept coles] :L4 . Ces sept coles se partageaient de la manire suivante: l'cole des Phnomnes en tant que tels, l'cole des Impressions enregistres, l'cole des Illusions, l'cole du Non-tre de l'esprit, l'cole de la Combinaison causale, l'cole du Non-tre fondamental et l'cole rforme du Non-tre fondamental. La rencontre entre la vacuit nagarjunienne et le vid e (wu) taoste marquera durablement et profondment le bouddhisme chinois, d'autant que les concepts du Tao-te king se conjuguent admirablement bien, dans une certa ine mesure, avec l'essence de la pense Mahayana. Cependant c'est un rudit indien, Kumarajiva (344-413), que la Chine doit l'introduction vritable de la doctrine Ma dhyamika. En effet, cet infatigable traducteur fit connatre les textes fondamenta ux de Nagarjuna, en les enrichissant de nombreux et pertinents commentaires tech niques. Kumarajiva est donc vritablement l'origine directe de l'implantation d'un authentique courant Madhyamika chinois qui prit pour nom cole de San-lun, c'est-dire cole des Trois Traits, en rfrence aux trois uvres qui constituaient la base de s a pense, le Madhyamakakarika, le Dvadasadvara-shastra de Nagarjuna et le Shata-sh astra d'Aryadeva. Les principaux matres de cette cole, aprs Kumarajiva, furent Taosheng et Seng-chao. Tao-sheng occupe une place toute particulire au sein de l'cole San-lun, tant sa puissante personnalit intellectuelle lui permit d'laborer une an alyse l'originalit singulire. Pour lui, admettre que tous les tres possdaient la nat ure de Bouddha n'aurait su constituer une simple et abstraite affirmation de pri ncipe, mais devait tre compris dans son sens le plus concret, le plus absolu. Ain si, la comprhension de cette vrit premire ne doit supporter pour Tao-sheng aucune re lativisation, elle s'applique toutes les catgories d'tres, mme les tres les plus vil s, les plus ignorants, ou pire encore ceux qui sont sans foi (Iccantika), ceux q ui ayant vacu toute procupation leve ne se soucient plus de parvenir la bouddhit. L' umination soudaine de la vrit est donne intgralement et sans effort, car pour Tao-sh eng il n'y a pas d'tat atteindre que l'on ne possde dj. . Cette illumination est, pour lui, rvlation de l'unit profonde et essentielle du Nir vana et du samsara, de la nature identique entre le vide et les phnomnes. Le sujet et l'objet, la vacuit et la forme sont unies comme une seule et mme chose, une en tit complte qui relve de l'identit entre le monde et le Nirvana. La nature de Bouddh a c'est le monde phnomnal, le monde phnomnal n'est pas diffrent de la nature de Boudd ha. Pour Tao-sheng plus aucune distinction ne doit tre faite entre le samsara et le Nirvana. Atteindre l'autre rive, selon l'expression clbre du Sutra du C ur, devait s
entendre pour lui comme un vritable saut par-dessus l'abme consistant comprendre q ue l'Eveil jamais ne manqua. Cette prise de conscience est en ralit une comprhensio n soudaine qu'il n'y a rien atteindre, que l'expression atteindre l'autre rive sig nifie simplement comprendre qu'il n'y a pas et qu'il n'y eut en ralit jamais d'aut re rive. Il l'exprime admirablement de la faon suivante, qui n'est pas sans rappe ler la dialectique ngative de Nagarjuna: ~ De mme qu'en atteignant l'autre rive, si on l'atteint, on n'atteint pas l'aut re rive. Ne pas atteindre et ne pas ne pas atteindre sont en ralit atteindre... Si vous voyez le Bouddha, vous ne voyez pas le Bouddha. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de Bouddha, en ralit vous voyez Bouddha10. . En 434, Tao-sheng meurt en chaire en laissant tomber son bton, comme s'il voulait symboliser, par ce geste, la ncessaire et invisible continuit de la transmission de l'esprit d'Eveil. En 625, passant de Chine au Japon, par l'intermdiaire du moi ne coren Ekwan, l'cole San-lun prit pour nom cole Sanron, cole qui influena l'ensembl e des branches du bouddhisme japonais. Elle marqua galement profondment le prince Shtoku (574-622), auquel on doit l'unification du Japon. . L4: [Les cinq grandes tendances] :L4 . Retenons que pendant un millnaire les influences de la pense indienne baignrent la Chine; ces influences, dj trs diverses l'origine, iront en se diversifiant sur le v aste territoire de l'Empire du Milieu. On distingue de cet cheveau multiple et co mplexe un ensemble de cinq grandes tendances: T'ien-tai, Terre pure, Hua-yen, Ch 'an et Fa-shiang. Celle qui s'inscrit le plus directement dans la continuit thoriq ue du Madhyamaka, et qui donc seule nous intressera avec, mais pour une autre rai son, le Ch'an, est l'cole T'ien-tai (cole de la Plate-forme cleste). Cette cole, qui reconnat en Nagarjuna son premier patriarche, se rclame d'une conception dite des Trois Vrits, qu'elle attribue aux thses nagarjuniennes elles-mmes. Soulignant la va cuit de toute chose, le T'ien-tai affirme que les phnomnes sont l'authentique expre ssion de l'ainsit (Tathata). . L'cole dveloppe cette doctrine par une forme de conception tripartite de la vrit, ce tte vrit tripartite se dcomposant en trois aspects, en trois vrits. La premire est une sorte de constatation du caractre interdpendant des dharma et de leur vacuit. La s econde vrit prcise que bien que vides, les dharma. ont nanmoins une existence en tan t qu'ils sont des phnomnes et donc disposent d'une apparence existentielle, limite dans le temps bien videmment de par la finitude, mais apparence capable cependant d'tre perue par les sens. Enfin la troisime vrit est simplement la synthse des deux p remires, c'est donc une sorte de vrit mdiane, une vrit du milieu qui runit et concil vide et les phnomnes, comme on le retrouve de manire constante dans le Madhyamaka et dans toutes les coles qui relvent de la doctrine de Nagarjuna. Une vrit qui est, pour cette raison, considre comme l'ainsit elle-mme par l'cole T'ien-tai. De cette co nception l'cole T'ien-tai fait dcouler le principe d'universelle complmentarit des p hnomnes et du vide, l'union de la forme et de la vacuit. Toutefois cette cole prsente galement, par-del son caractre doctrinal, un autre aspect particulirement original: il s'agit de la pratique d'un exercice mditatif nomm Chih-kuan ou Zhiguan qui tra duit le sanskrit SamathaVipashyan, c'est--dire tranquillit et clairvoyance de l'esp rit. Des ouvrages extrmement techniques, crits ou traduits par les matres T'ien-tai , dveloppent les mthodes ncessaires pour pratiquer cette mditation, qui est devenue l'exercice de base du bouddhisme sino-japonais (voir p. 177, La pratique de la va cuit: zazen). . On doit constater que l'cole T'ien-tai, par sa capacit unique embrasser la totalit de l'norme corpus thorique de la littrature bouddhique, est considre comme la tendanc e la plus large, la plus universelle du bouddhisme asiatique, tendance confirme s ur un autre plan par sa conviction de la prsence en chaque forme vivante, mme la p lus infrieure, de la nature de Bouddha. Les ouvrages majeurs de l'cole T'ientai so nt le Maha-Shamata-Vipashyan, le Liu-miao-famen (Les six portes merveilleuses du Dharma), et de nombreux commentaires du SaddharmapundarkaSutra (Sutra du Lotus) rd
igs par Chih-i. Plus tard, au IXe sicle Saich (767-822), ou Dengyo Daishi (jap.), i mplanta l'cole T'ien-tai au Japon o elle prit le nom de Tendai. . Saich dveloppera la mthode du Shikan (Chihkuan), en invitant les moines de son cole le rejoindre sur le mont Hiei pour approfondir leur pratique. On doit souligner le rle trs important qu'il joua dans l'implantation du Zen dans le pays du Soleil Levant. En effet, au commencement de la transmission du Ch'an au Japon, entre le XIIe et XIIIe sicle, c'est dans les monastres Tendai que les premiers matres zen s 'installeront pour diffuser leur pratique nouvelle. . L4: [L'originalit du Ch'an] :L4 . Ceci nous amne tout naturellement parler du Ch'an, tout au moins de son rapport l a pense Madhyamika, avec laquelle il entretient des liens plus qu'troits, mme si le s matres de cette cole affichent, en apparence, quelques distances avec les proccup ations intellectuelles, en privilgiant l'attention sur la pratique de Dhyana, qui prside et rgne constament au c ur de la voie propre de cette tendance minemment orig inale. En effet, le Ch'an, conjuguant l'hritage vcu de la vacuit nagarjunienne ains i que les traditions du Lankavatara11 et du Vimalakrtinirdesa12 avec le pragmatis me du taosme chinois, donna naissance un courant d'une rare efficacit mthodologique . Cette Voie directe vers l'Eveil, introduite en Chine par Bodhidharma selon la tradition, s'enrichira des personnalits singulires qui faonnrent l'histoire de ce co urant pendant des sicles. Avec des matres d'une rare dimension spirituelle comme H ui-neng (638-713), Yung-chia (665-713), Ma-tsu (709-788), Huang-po (env. 850) ou mme Lin-tsi (env. 866)I3, le Ch'an est certainement l'exemple le plus pur, mais aussi le plus abrupt, de la mise en uvre concrte de la vacuit nagarjunienne et du v ide taoste. Cet aspect si particulier, si original de la Doctrine qui fconda le Ze n japonais, garda non seulement en permanence la mmoire vivante de Nagarjuna, mai s lui voua un respect constant au point de l'intgrer, en lui faisant une place de choix, au sein de sa ligne indienne des vingt-huit patriarches qui se seraient s uccd depuis le Bouddha jusqu Bodhidharma. . L'arrive de Bodhidharma en Chine relve certainement autant de la lgende que de la re lle apparition ou surgissement d'une forme de bouddhisme radicalement nouvelle. L'histoire rapporte la clbre entrevue qui eut lieu entre le patriarche indien, dep uis peu sur la terre chinoise, et l'empereur Wu de la dynastie Liang Nankin. L'e mpereur, qui se flattait d'avoir encourag et favoris le dveloppement du bouddhisme, pensa pertinent de poser quelques questions Bodhidharma. Les rponses qu'il reut d u matre indien marqueront tout jamais la tonalit spirituelle du Ch'an vis--vis de t outes les autres formes de bouddhisme. la premire question portant sur les mrites que l'empereur esprait lgitimement avoir acquis de par son action en faveur de la Doctrine de l'Eveill, Bodhidharma rpondit schement: Aucun mrite! Certainement branl p cette premire rponse relativement impertinente, l'empereur posa nanmoins une second e question portant sur le sens suprme de la Sainte Vrit; la rponse de Bodhidharma ne se fit pas attendre: Un seul sens: la vacuit, rien n'est saint! De plus en plus pe rplexe l'empereur continua malgr tout son interrogatoire en demandant Bodhidharma qui tait celui qui osait lui parler de la sorte; le moine indien lui dit inconti nent: Je ne sais pas! II tait vident qu'aprs une telle entre en matire, il ne restait lus Bodhidharma qu se retirer dans une solitude volontaire. Il le fit en se rendan t sur le mont Song o se trouvait le clbre monastre de Shao-lin; les critures nous dis ent qu'il se livra ensuite pendant neuf annes la mditation silencieuse face un mur . Ce qu'il importe de retenir, c'est que l'essence du Ch'an, de par l'attitude d e Bodhidharma, tait tablie, tant sur le plan doctrinal que sur la question de la mt hode concrte (c'est--dire l'assise silencieuse en tant que pratique fondamentale), sur des bases qui ne varieront plus. Ou du moins, le Ch'an voluera partir des lmen ts caractristiques de cette forme si originale et novatrice de bouddhisme; Bodhid harma se situant d'ailleurs comme le vingt-huitime patriarche de la ligne indienne du Ch'an et le premier de la ligne chinoise. . Le Ch'an cependant ne se dveloppa vritablement qu partir de Hui-neng (638-713), le s
ixime patriarche selon la libre chronologie de l'cole chinoise; un dveloppement qui doit tout autant la pratique de Dhyana, qu la pense du vide propre au taosme. Le Li u-tsu-ta-shih fapao-t'an-ching de Hui-neng mais aussi le Shinjin Mei de Seng-ts' an (env. 606) sont caractristiques d'une pense mlant Tao et Sunyatavada. Les succes seurs de Hui-neng, sous les dynasties T'ang et Sung, enrichiront considrablement le corpus littraire du Ch'an, comme nous en donne l'exemple Yung-chia Hsan-cheh (66 5-713), et son Shdka14 (Chant de la ralisation de la Voie), ouvrage dans lequel se font trs nettement sentir les concepts propres l'cole Madhyamika, sans oublier le Sandokai15 (L'interpntration des phnomnes et de l'essence) de Shih-t'ou Hsi-ch'ien ( 700-790), qui dans son intitul mme reprend une expression caractristique du langage nagarjunien. On distingue, au sein de la ligne de la transmission du sud, c'est-dire de la transmission de Hui-neng, cinq maisons et sept coles: l'cole Ts'aotung (St, jap.), l'cole Yn-men (Ummon), l'cole Fayen (Hgen), l'cole Kuei-tang (Igy), l'cole Lin tsi (Rinzai) et ses deux branches, l'cole Yang-chi (Ygi) et l'cole Huang-lung (ryo). Alors que le Ch'an perdra de plus en plus d'influence et de vitalit en Chine, au point de dispararatre, sous la dynastie Ming, en tant que ligne de transmission a prs sa fusion avec l'cole de la Terre pure, c'est en s'implantant au Japon qu'il r eut un second souffle, un dynamisme renouvel. . L3: [IV. Au Japon] :L3 . Lorsque le Ch'an fut introduit au Japon, au XIIe sicle, le bouddhisme y tait dj reli gion officielle depuis le rgne de Shtku-taishi (593-621). Au VIIIe sicle, poque de l' implantation Nara de la premire capitale relativement stable de l'histoire japona ise, on distinguait ds cette date au sein du bouddhisme nippon six principales col es: l'cole Sanron, l'cole Kusha, l'cole Jojitsu, l'cole Ritsu, l'cole Hosso et l'cole Kegon. Parmi ces six coles, deux seulement se revendiquaient, d'une certaine manir e, plus ou moins directement de l'hritage Madhyamika, il s'agissait des coles Sanr on et Jojitsu. Cependant, sous l'influence croise du pouvoir imprial et d'une sort e de penchant vers un syncrtisme de nature magico-religieuse, ces deux coles sombrr ent, hlas, dans une sorte de lthargie philosophique. Un peu plus tard, lors de l'po que Heian (794-1184), apparurent deux nouvelles grandes coles, Tendai et Shingon, qui seront appeles jouer un rle de premire importance dans l'histoire du bouddhism e japonais. Nous n'voquerons pas l'cole Shingon, marque par la figure charismatique de Kkai (774835), plus connu sous le nom de Kb Daishi, et qui dveloppa une synthse e ntre le shintosme et un bouddhisme immanentiste qui l'loigna compltement de la pense nagarjunienne. Par contre l'cole Tendai va s'imposer comme l'cole prpondrante dans le cadre de l'implantation du Ch'an au Japon; d'ailleurs son respect avou pour la pense Madhyamika n'y est certainement pas pour rien. Bien sr, au cours des sicles, la porte de l'cole Tendai ira inexorablement en s'amenuisant, jusqu ne plus prsenter qu'une caricature d'elle-mme. On doit nanmoins reconnatre, en toute objectivit, son immense rle dans l'mergence de la raction spirituelle du XIIe sicle. . C'est en effet un moine Tendai du mont Hiei, Eisai (1142-1215), que l'on doit l' introduction de la branche Rinzai du Ch'an chinois au Japon. Myan Eisai (Ysai) Zen ji, galement connu sous le nom de Senk (Zenko) Kokushi, effectua deux sjours en Chi ne, et c'est l'occasion de son second voyage qu'il reut le sceau de la confirmati on (Inka-Shmei) des mains du matre chinois Hs-an Huai-ch'ang de la ligne ry. Non seule ment Eisai son retour devint le premier abb du monastre de Kennin-ji Kyoto, mais i l est significatif de constater qu'il enseignait, outre le Zen Rinzai, mais galem ent les doctrines des coles Tendai et Shingon. La pense d'Eisai progressa considrab lement sous l'influence du Zen, dont il ne cachait pas qu'il le considrait comme une Voie suprieure toute autre. Ses analyses sont d'une finesse argumentaire d'un e remarquable prcision, il revient d'ailleurs dans ses principaux ouvrages, le Ko zen Gokokuron, le Ichidai Kyron Sshaku et le Kissa Yjki, sur les questions essentiel les qui traversent le bouddhisme. Remarquons ce propos qu'il y a souvent chez le s matres zen comme une sorte de coquetterie de la spontanit, car cette cole, qui ne manque pas de bases philosophiques et mtaphysiques, aime les laisser voiles, caches ou non dites. Or, les attitudes souvent les plus tranges, les propos apparemment
les plus incohrents qui caractrisent la stratgie spirituelle particulire de l'cole, ressortissent tous d'un substrat thorique des plus solides, substrat structur par les lments doctrinaux du Madhyamaka et les bases thoriques et mthodologiques du taosm e. Bien videmment, le respect exigeant du Zen l'gard de l'exprience indicible (Fuka setsu) de l'Eveil (Kensho) relve d'une haute attitude qui a pour but de montrer l 'impossibilit de toute formulation rationnelle concernant cette question. Wu-men Hui-k'ai (11831260) aimait rpter que celui qui reu le choc de l'Eveil est comparabl e un muet qui aurait eu un rve, c'est d'ailleurs ce mme Wu-men qui crira en forme de pome mortuaire l'pigramme suivant: ~ Le vide est non n Le vide ne passe pas. Quand tu connais le vide Tu es sembla ble lui. . Ceci explique l'extrme rserve de l'cole Zen vis-avis de tout attachement formaliste et trop rvrentiel envers les textes sacrs, qui a pour origine une immense comprhens ion du caractre ineffable du Fukasetsu. La dfinition du Zen est ce titre souvent v olontairement rduite quatre propositions fondatrices, que l'on attribue tradition nellement Bodhidharma et qui seraient peut-tre de Nan-chan P'uyan (748-835), rvlatric es de l'essence intime de l'cole: ~ Une transmission spciale en dehors des critures (jap. Kyge betsuden). Aucune dpe ndance l'gard des critures (jap. Fury monji). Se diriger directement vers l'me de l' homme (jap. Jikishi-ninshin). Contempler sa propre nature et raliser l'Eveil (jap . Kensh jbutsu). . C'est pourquoi on peut lgitimement affirmer que les moines Madhyamika indiens qui pensaient qu'il n'y avait finalement rien comprendre, comme le dira fort bien B havaviveka: II est ncessaire de raliser d'un trait (ekalaksana) que tous les dharma sont hors comprhension, c'est ce que l'on nomme pleine comprhension de la vrit (sat yabhisamaya), sont les matres initiaux des grandes figures ultrieures du Ch'an / Ze n. . Pntrs, de par leur passage dans les monastres Tendai, des textes de la Prajnaparamit a, les matres zen incarnent, avec l'aide non ngligeable de l'exemple comportementa l du sage taoste, la ralisation concrte de la doctrine du sunyata. . L4: [La pratique de la vacuit (zazen)] :L4 . A cet instant, il nous faut nous arrter quelque peu sur une pratique qui occupe u ne place de premier ordre au sein de la Voie du Bouddha: la pratique de zazen. C et exercice est ce point intime de la doctrine de la vacuit, qu'il en incarne cer tainement la ralisation la plus exacte et la plus juste, la traduction la plus co nforme et sans aucun doute la plus parfaite. Toutefois, si la pratique de la mdit ation silencieuse (zazen) va tre l'objet au cours des sicles d'un large dveloppemen t au Japon, et prendra l'importance que l'on sait, n'oublions pas qu'elle surgit aprs un long passage par l'Inde et la Chine. C'est pourquoi il est fort intressan t de se pencher un instant sur l'historique de cet exercice caractristique, deven u si central dans le Zen japonais, tel point qu'il en est comme l'image emblmatiq ue mme du bouddhisme nippon. . On trouve en Chine des traces crites dcrivant la mditation silencieuse ds le VIIIe s icle, c'est le cas du manuscrit, attribu Mahayana le matre zen, dcouvert dans les gr ottes de Toueng-houang qui porte le titre de: La porte d'entre immdiate au Zen (Dhy ana). Le texte nous dit: ~ Celui qui comprend (...) doit abandonner toute activit, s'asseoir seul dans u n lieu isol et silencieux, les jambes croises, le dos droit, sans dormir, le matin et le soir. Lorsqu'on entre en zazen, on regarde dans son propre esprit. N'tant que le non-esprit, on ne suit pas ses penses. Si des penses discriminantes apparai ssent, on doit s'en veiller. Comment pratiquer cet veil? Quelles que soient les pe nses qui s'lvent, on doit les examiner, qu'elles soient apparues ou non, qu'elles e xistent ou non, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient illusoires ou pures. Pas un phnomne, quel qu'il soit, ne doit tre examin. Si on s'veille de cett
e faon, on comprend l'absence de noumne. C'est ce qu'on appelle "aller sur le chem in du Dharma"16. . II est toutefois important de noter que les premiers exemples de transmission du Zen, comme pratique mditative et non comme cole constitue, remontent l'poque d'Asuka (593-710). Il faut mentionner en particulier la transmission Dsh (629-700). S'tant rendu dans la Chine des Tang et, aprs avoir tudi les doctrines Faxiang (Yogacara) et Chengshi (Tattvasiddhi), il se fit initier au Ch'an par Huiman (n.d.). Par la suite, l'enseignement de la ligne Puji (651-739), l'un des successeurs de Shenhu i (668-760), t transmis au Japon par l'un de ses mules chinois, Dao-xuan (702-760). Ce sont toutefois surtout les fondateurs japonais des coles bouddhiques de l'poqu e Heian et leurs successeurs qui ont pos les premiers fondements de la pratique d u Zen au japon: Kkai (774-835), le fondateur de l'cole Shingon, ainsi que Saich (76 7-822), le fondateur de l'cole Tendai. la suite de Saich, ce sont successivement E nnin (794-864) et Enchin (814891), tous deux plerins appartenant l'cole Tendai, qu i se sont rendus en Chine17. . Un peu plus tard, au XIe sicle, le matre chinois Wanshi crira le Zazenshin (Le poin t de zazen), qui insistera sur l'immdiatet de la perception directe de la ralit de p ar la pratique du zazen. Connatre sans toucher les objets, dit-il, cette connaissa nce est par elle-mme fine. Regarder sans envisager les relations: ce regard est p ar lui-mme dlicat, cette connaissance est par elle-mme fine, elle n'a jamais connu la moindre discrimination. Ce regard est par lui-mme dlicat, il n'a jamais connu l e moindre cart. Elle n'a jamais connu la moindre discrimination, cette connaissan ce n'est pas duelle mais une, il n'a jamais connu le moindre cart, ce regard comp rend sans choisir18. Cette technique de la non-pense, cette mthode du Dhyana, mme si elle tait introduite et connue depuis l'poque d'Asuka, deviendra nanmoins seulemen t partir du XIIIe sicle la pratique fondamentale du Zen japonais, elle en rsumera l'essence et se rvlera caractristique de son attitude intime l'gard du monde phnomnal . En effet, le zazen s'imposera en tant qu'exercice mme de l'Eveil du Bouddha et ir a jusqu devenir l'unique objet de l'activit des moines de la branche St du Zen, grce a ux efforts importants de Dgen Zenji. En effet lorsque Dgen revint de Chine, il rap porta la tradition du mokush-zen, c'est--dire l'exercice du Zen de l'illumination silencieuse, qu'il avait reu de son matre Juching (jap. Tende Nyj), qui restait un d es derniers enseigner la mditation silencieuse sous sa forme la plus pure et la p lus dpouille en tant que shikantaza (assise sans forme), juste s'asseoir. En impla ntant cette tradition au Japon, Dgen, tout en diffusant de manire rigoureusement f idle le zazen, allait contribuer en prciser, comme peut-tre jamais elle ne le fut, cette mthode de mditation dans des ouvrages qui resteront clbres comme le Fukan zaze n gi ou le Gakud yjin sh, ainsi que dans certains chapitres du Shbgenz. Le Fukan zazen gi (Recommandations gnrales concernant les rgles du zazen) fut crit en 1227. Texte relativement court, c'est un vritable manifeste portant sur la pratique exacte du zazen. Immobile assis dans le samdhi, dit Dgen, qu'on pense le fond de cette non-p ense. Comment penser le fond de la non-pense? Sans penser. Tel est l'art essentiel du zazen. Ce zazen n'est pas un exercice de mditation, ce n'est que la mthode du dharma de la tranquilit et de la joie. C'est la pratiqueralisation de l'accompliss ement de l'veil 19. . A la suite de Dgen, de nombreux auteurs japonais enrichiront galement l'immense co rpus littraire consacr la pratique du mokush-zen, et en premier lieu son propre suc cesseur dans la Voie, matre Ejo (1198-1280) qui crivit le Komyozo zan mai, dont ch aque ligne est d'une remarquable profondeur: Ne recherchez pas le satori. N'essay ez pas de chasser les phnomnes illusoires. Ne hassez pas les penses qui surgiraient, ne les aimez pas non plus et surtout ne les entretenez pas. De toute faon, quoi qu'il en soit, vous devez pratiquer la grande assise, ici et maintenant. Si vous n'entretenez pas une pense, celle-ci ne reviendra pas d'elle-mme. Si vous vous ab andonnez l'expiration et laissez votre inspiration vous remplir en un harmonieux va-et-vient, il ne reste plus qu'un zafu sous le ciel vide, le poids d'une flam me20. II n'est peut-tre pas inutile de signaler que ce texte fut conserv secret jus
qu l're Meiji, ne pouvant tre rvl qu'aux matres qualifis choisis pour recevoir le sc e la transmission. . Citons encore Keizan Jokin (1268-1325), ou bien Daichi Sokei (1290-1366) qui s'e xprime de la manire suivante dans son Daichi zenji hg: Pour en finir avec la grande affaire de la vie et de la mort, il n'y a qu emprunter la voie du zazen. Il n'y a pas plus court chemin. On place un coussin dans un endroit tranquille et on s'y assoit droit, le corps redress. Le corps ne fait rien, la bouche ne dit rien et l 'esprit ne rflchit ni au bien ni au mal. On passe ainsi les jours, assis juste tra nquillement face au mur. Il n'y a pas de vrit prodigieuse en dehors de cela. Et ce n'est pourtant pas passer son temps en vain21. Commentant la phrase tire du cinqu ime pome des Stances des cinq propositions (jap. go) du suzerain et du sujet de Tzan R ykai (807-869): Quant moi, dlaissant la sparation et la runion, je retourne m'asseoir parmi les cendres, E. Rommelure fait remarquer juste titre qu'il y aurait lieu de rflchir la reprsentation du corps mditatif dans la pense chinoise et de penser la mdi ation zen comme une reprsentation psycho-corporelle de la "Voie du Milieu". Tous les textes ne recommandent-ils pas de ne pencher ni gauche ni droite, ni en avan t ni en arrire, de ne penser ni au bien ni au mal, ni au pass ni au futur22?. . Ceci confirme le caractre proprement effectif et concret de la pratique du zazen en tant que forme relle de la doctrine Madhyamika (jap. Chd), exercice de la pense n on-pense structur en une mthode unique et incomparable de la vacuit. . L4: [La doctrine de la vacuit au c ur du Zen] :L4 . Par-del l'importance prise par l'exercice de la mditation silencieuse au cours de l'histoire du bouddhisme japonais, la rflexion sur les questions mtaphysiques ne c essera, au fil des sicles, de se faire encore plus marque, plus vidente; mme si l'on prtend que la perspective tant diffrente il est impossible d'identifier la problmat ique de recherche des matres zen avec le questionnement philosophique, il est nanm oins vident que les textes des matres les plus importants relvent tous indniablement d'une relle problmatique mtaphysique. Cette problmatique est d'ailleurs trs nettemen t sensible chez un disciple direct d'Eisai, disciple qui sera appel devenir la fi gure emblmatique du Zen St au Japon: Dgen Zenji (1200-1253). . Esprit suprieur, d'une finesse analytique remarquable de par sa rigueur, Dgen embr assa la vie monastique au mont Hiei ds l'ge de treize ans. Il passa toute son adol escence dans ce lieu, se pntrant des doctrines qui taient prsentes au sein de l'cole Tendai. Cependant, vers sa quinzime anne, une question devint pour lui obsdante. Si tous les tres possdent la nature de Bouddha, se disaitil, pourquoi donc est-il nce ssaire de pratiquer une voie, de se soumettre une discipline spciale pour l'obten ir? Toutes les rponses qu'il reut le laissant insatisfait, il se dcida de s'en ouvr ir Eisai, qui bnficiait d'une renomme de sagesse, et qui tait de nouveau au Kennin-j i Kyoto depuis le retour de son second voyage en Chine. la question de Dgen, Eisa i rpondit sous la forme d'une citation du matre chinois Nansen (784-834): Aucun Bou ddha n'a conscience de sa nature essentielle, seuls ceux qui sont semblables des animaux, c'est--dire qui se dupent volontairement eux-mmes, en sont conscients. Ce tte rponse provoqua comme un choc profond chez Dgen, ce qui eut pour effet immdiat non seulement de faire disparatre en lui ses doutes, mais aussi de le convaincre de la ncessit de se mettre sur-le-champ sous la direction spirituelle d'Eisai. Il y resta malheureusement peu de temps, car la mme anne Eisai mourut aprs une vie mon astique bien remplie. C'est donc sous la direction de Myzen (1184-1225), le succe sseur d'Eisai, que Dgen passa les huit annes suivantes. En 1223, Myzen et Dgen effec turent un voyage en Chine, voyage qui allait avoir une importance considrable dans l'histoire spirituelle de Dgen en particulier, et de l'cole du Zen japonais en gnra l. Myzen et Dgen furent reus en Chine au clbre monastre de Tien-tung, qui s'tait illus r par le renouveau instill par Ta-hui (10891163) l'encontre du Ch'an de l'cole Lintsi. Toutefois, le Zen qui tait propos par le successeur de Ta-hui, Wu-chi (env. 1 224), ne procura aucun lment satisfaisant Dgen. En 1225, soit trois ans aprs leur ar rive en Chine, Myzen dcda, laissant Dgen poursuivre seul son voyage. Aprs avoir effect
u quelques visites dans des monastres proches, Dgen revint au Tientung au moment o J u-ching (1163-1228) fut nomm abb en lieu et place de Wu-chi qui venait de mourir. Cette rencontre fut dcisive. Ju-ching (jap. Tend Nyj) tait un matre de l'cole Tsao-tun (jap. St), qui non seulement appliquait une discipline monastique svre, mais de plu s enseignait un Zen trs rigoureux, insistant particulirement sur la pratique du ts o-ch'an (jap. zazen), dans sa forme la plus pure, c'est--dire vide de tout conten u (Shikantaza). Dgen avait enfin trouv son vritable matre, mais en ralit, plus que cel a, au contact de Ju-ching il allait dcouvrir l'essence libratrice de la vacuit. . L4: [La mtaphysique nagarjunienne du vide chez Dgen] :L4 . A son retour au Japon, en 1227, Dgen n'eut de cesse de travailler au dveloppement de l'cole St, mais il ne ngligea pas pour autant de se pencher sur un certain nombre de problmes philosophiques fondamentaux, dont son uvre restera ternellement marque. Au sein de son Shbgenz (L' il du Trsor du Vrai Dharma), qui comporte un ensemble de 7 5 95 essais selon les versions, Dgen placera en bonne position des rflexions porta nt sur la MahaPrajnaparamita (Makahannya haramitsu], la Vacuit (Kuge), la Nature de Bouddha (Bussh), le Dynamisme total (Zenki), L'Espace vide (Koku), l'Ainsit (Im mo) ou plus significatif encore le Temps (Uji). On ne peut s'empcher d'tablir d'im mdiates correspondances avec les thmes qui constituent le Madhyamakakarika de Naga rjuna. L'exercice de mise en parallle de Uji et du dix-neuvime chapitre du Trait de N agarjuna, portant sur l'analyse du temps, est proprement clairant. De l'un l'autre c'est la mme et identique doctrine qui s'exprime, c'est la mme pense qui est dveloppe . Certes, Dgen teinte son propos de sa sensibilit personnelle, et l'analytique s'e nrichit chez lui d'une dimension nouvelle dfinie comme l'unit de l'tre et du temps: l'tre-temps. Ce concept fondamental, propre Dgen, pose les tres comme temps: Le temp est toujours dj tre, tout ce qui est est temps23, et un peu plus loin: Chaque tretemp s devient un (seul) temps. L'tre herbe est l'tre chose sont galement temps. Chaque t re et tous les tres sont l'univers entier24. L'instant de l'ternel prsent devient le maintenant vivant de l'tre-temps25. Confondus dans une temporalit ontologique, les phnomnes existentiels ne sont pour Dgen ni du pass ni du futur, ils sont toujours du prsent constant de par leur tre, et de l'tre de par le prsent. Le temps ne passe pa s pour Dgen, mais de la mme manire il n'advient jamais, le temps ne vient jamais, ne s'en va jamais26. L'tre-temps est combustion de l'ontologie positive, dissolution de l'ontologie ngative, comme l'exercice de zazen est combustion de la pense et d issolution de la non-pense. Sous cet angle l'univers et les phnomnes sont en n'tant pas, ils sont dans leur non-tre, ils demeurent dans la mobilit et passent dans l'i mmobilit, l'univers n'est ni en mouvement ni immobile, ni en progression ni en rgre ssion27. L'quivalent conceptuel de l'identit entre le Nirvana et le samsara se trad uit chez Dgen, dans sa langue inimitable, par: Tous les dharma(s) sont leur place dans l'ordre des dharma(s)28. Toutes les choses, tous les phnomnes, sont l o ils doiv ent tre, tout est comme il devait tre depuis toujours; rien n'est troubl. Etre et n on-tre sont tretemps, pas de devenir et pas de non-devenir, pas de lien et pas de dlivrance non plus. L'tre-temps est l'essentielle vacuit de l'tre-nant, et l'inessent ielle phnomnalit de l'tre-prsent. . Matre Dgen rapporte dans un chapitre de son Shbgenz, en 1241, une anecdote qui tmoigne de son attachement envers le matre du sunyata; il rappelle judicieusement qu'un jour, prchant ses disciples, Nagarjuna se transforma sous la forme de la pleine l une; revenu son apparence normale, Nagarjuna composa un pome que Dgen cite, non sa ns souligner sa sympathie l'gard de la formulation nagarjunienne: La prdication de la Loi (du Bouddha) n'a pas de forme, il n'est ni son ni couleur son explication (Shbgenz Bussh). Cela est en vrit un parfait cho aux huit ngations de la Voie du Mili (Madhyam-pratipad): ni abolition, ni cration, ni anantissement, ni ternit, ni unit, ni multiplicit, ni arrive, ni dpart. Les huit ngations sont comme l'octuple fondement cr itique de la doctrine de la vacuit, elles en rsument l'essence. partir d'elles peu t se dcliner l'ensemble des ngations et des contre-ngations possibles. Ni commencem ent ni fin, tout ce qui est est en n'tant pas. L'absence d'tre propre du relatif e st le signe visible de la vacuit, tout ce qui existe est vide d'identit; en tant q ue phnomnal, l'tre est non-tre. Rien n'apparat, rien ne disparat, l'tre-temps est touj
urs dj la, pas de samsara quitter, pas de Nirvana rechercher, car . \ ### \ il n'y a ni annihilation ni permanence (MK, XVIII, 10). . \ ### \ 10. Ce qui apparat en dpendance d'une chose, \ Cela n'est pas cette chose \ Et n'est pas non plus diffrent d'elle. \ Par suite, il n'y a ni annihilation ni permanence. . \ ### \ Whatever exists, being dependent [on something else], is certainly no t identical to that [other thing], \ Nor is a thing different from that; therefore, it is neither destroye d nor eternal. . Pas d'entrave dont il faudrait se librer, pas de lien briser, pas de rive atteind re; sans substance propre, l'tre-temps est comme n'tant pas, n'est pas comme ayant toujours t. Pas de naissance, pas de mort, rien ne fut jamais troubl. . Le Zen connatra partir du XIIIe sicle un dveloppement ingal l'intrieur duquel des ma es importants viendront apporter leur originalit l'difice historique de cette cole singulire. Nous pensons Hakuin (16861769), Torei (1721-1792), et de nombreux autr es qui emprunteront cette Voie qui ne mne nulle part, si on nous autorise paraphras er le titre d'un ouvrage de Martin Heidegger. Cette Voie, qui se situe toujours dans l'informulable voisinage du vide, dont Nagarjuna fit comprendre la subtile dialectique ngative, se dvoile dans l'incomprhensible mystre de la vacuit. C'est donc au contact de l'absence que se rvle le silence des saints (Aryatvsimbhava), celui le silence du chem qui n'est pas troubl, le Parfait Silence de la Voie du Milieu in solitaire des forts oublies , l'tat de simplicit et de dpouillement (Hakushi). Vide d'identit propre, le triomphe du sunyata, dans son invisibilit, est l'existence p hnomnale dans sa dtermination ontique; l'inexistence du vide dans sa permanente et t ernelle ngation ontologique. Pas d'existence, pas d'anantissement, rien qui ne soi t apparu, rien qui ne meure. Sur ce chemin parfois difficile, souvent imprvisible , Dgen prit soin, en forme de signe amical, de nous dire: Ne soyez pas perturbs par le nant. . \ ### \ Ce qui n'a ni dbut ni fin n'a pas de milieu. (MK, XI, 2) . \ ### \ 2ab. Ce qui n'a ni dbut ni fin, \ Comment aurait-il un milieu? . \ ### \ How could there be a middle portion of that which has no "before" and "after"; . . ******************************************************* ******************************************************* ******************************************************* . L1: [Notes] :L1 L4: [I. Contexte et perspective de la pense de Nagarjuna] :L4 . 1. La rocambolesque biographie de Nagarjuna (Lon-chou p'ou-sa tchouan, T 2047), a ttribue abusivement Kumarajiva, mle Nagarjuna d'invraisemblables aventures et le f
ait vivre plus de trois cents ans, chiffre que les biographies postrieures iront jusqu doubler (cf. L'Enseignement de Vimalakrti (Vimalakrtinirdesa), traduit et annot par Etienne Lamotte, Institut orientaliste de Louvain, 1987, p. 71). . 2. On divise gnralement les uvres de Nagarjuna en trois groupes distincts: 1) La se ction des conseils: La Prcieuse Guirlande des avis au roi (Rajaparikatha-ratnamala) , Lettre un ami (Suhrllekh), L'Arbre de sagesse (Prajnadanda), etc. 2) La section de s Hymnes: Hymne au Darmadhatu (Dharmadhatustotra), Louange du Supramondain (Lokatita svata), Hymne l'inconcevable (Acintyastava), etc. 3) La section dialectique: Stance s fondamentales sur la Voie du Milieu (Mula Madhyamakakarika), Soixante-dix stance s sur la Vacuit (Shnyatsaptat), Rfutation des objections (Vigrahavyavartini), Soixan ances de raisonnements (Yuktisastikakarika), Trait appel finement tiss (Vaidalyasutran ama). . 3. Darshana, de la racine sanskrite dr, voir, dsigne les six systmes philosophiques c lassiques indiens (Nyaya, Vaisheshika, Shnkhya, Yoga, Mimmsa et Vednta), qui relvent de la tradition vdique orthodoxe, car ils reconnaissent l'autorit tradition nelle des Veda, des Brahmana et des Upanishad, ce qui explique qu'on les dsigne du nom de croyance ou de foi (astikya), en opposition bien videmment la non-foi (nstikya). i le Nyaya et le Vaisheshika sont des Darshana analytiques, le Shnkhya et le Yoga sont considrs comme pratiques et synthtiques; le Mimmsa et le Vednta, s'intressant pr incipalement l'interprtation des Veda, ont un aspect plus directement spculatif et thorique. Souvent contradictoires entre eux, en ralit ils rpondent tous un objectif unique: rintgrer l'me (tman) dans son unit premire et originelle avec l'Absolu (Brahm an), auxiliairement mais prioritairement aussi la dlivrer du cycle ternel des mort s et des renaissances. . 4. Pour cette tude, sauf indication contraire, nous avons de prfrence utilis comme t exte de rfrence le Trait du Milieu (Madhyamaka-karik, en abrvation: MK), traduit par G orges Driessens sous la direction de Yonten Gyatso, Ed. du Seuil, 1995. Cet ouvr age t publi avec un commentaire d'aprs Tsongkhapa Losang Drakpa (1357-1419), Un ocan de raisonnement, et Chon Drakpa Chdrub (1675-1748), Un vaisseau pour s'engager sur Un ocan de raisonnement. Tsongkhapa, fondateur de la tradition Gelugpa du bouddhis me tibtain, insiste sur la validit de la convention en tant que simple relatif, sur l'existence des phnomnes comme simples dsignations, vides de nature propre et inte rdpendants; instructeur Madhyamika d'une trs grande dimension, penseur et thoricien de premier ordre, il est Fauteur de 18 volumes dont La Grande Explication des tape s de la Voie (Lamrim Chenmo) et La Grande Explication du Mantra secret (Ngagrim Che nmo). . 5. L. de La Valle Poussin, Note Ren Grousset (cf. Ren Grousset, Les Philosophiez in diennes, t. I, DDE, 1931, p. 203). . 6. Matre Eckhart, Traits et Sermons, GF Flammarion, 1993, p. 245. (Voir: Appendice I, Le Nant chez Matre Eckhart, p. 201.) . 7. Saint Thomas d'Aquin, De ente et essentia (Ch., I, 25), Vrin, 1991, p. 18. . 8. E. Gilson, L'Etre et l'Essence, Vrin, 1987, p. 132. (Voir: Appendice II, La pr oblmatique mtaphysique de l'tre et de l'essence, p. 204.) . 9. L. Silburn, Aux sources du bouddhisme, Fayard, 1997, p. 176. . 10. R. Grousset, op. cit., p. 206. . 11. Id., ibid, p. 209. . 12. Chandrakirti, L'Entre au Milieu (161 ab), Ed. Dharma, 1988, p. 261. . L4: [2. L'entreprise thorique de Nagarjuna] :L4
. 1. E. Guillon, Les Philosophies bouddhistes, PUF, 1995, p. 57. . 2. Ibid., p. 59. . 3. R. Grousset, Les Philosophies indiennes, t. I, op. cit. . 4. G. Bugault, L'Inde pense-t-elle?, PUF, 1994, p. 232. . 5. La collection des textes appele du nom de Prajnaparamitasutra reprsente une mas se impressionnante value quarante sutra, soit environ 300 000 vers, rassembls sous la mme dnomination car traitant les uns et les autres d'un identique thme: la comprh ension de la connaissance (Prajna). Si quelques sutra ont t conservs dans leur vers ion sanskrite, il faut nanmoins souligner que la majeure partie des textes auxque ls nous pouvons avoir accs aujourd'hui sont en tibtain ou en chinois. . 6. G. Bugault, op. cit., p. 275. . 7. Abhidharma koa, traduction de L. de la Valle Poussin, Socit belge d'tudes oriental es, 1925, in R. Grousset, op. cit., p. 163. . 8. Ibid., p. 165. . 9. Ibid., p. 184. . 10. Ibid. . 11. Ibid., p. 152. . 12. Ibid., p. 153. . 13. Ibid., p. 168. . 14. Ibid., p. 169. . 15. Ibid., p. 170. . 16. R. Grousset, op. cit., p. 206. . 17. Chandrakirti, L'Entre au Milieu (147 cd 148), Ed. Dharma, 1988, pp. 252-253. . 18. R. Grousset, op. cit., t. II, p. 10. . 19. E. Guillon, op. cit., p. 80. . 20. Chandrakirti, op. cit. (114-115), pp. 216-217. . 21. Chandrakirti, op. cit. (127), p. 233. . 22. R. Grousset, op. cit., p. 141. Chandrakirti l'crira d'ailleurs de nombreuses reprises, avec beaucoup de clart et de prcision, jamais le Bouddha n'a prtendu dire : la pense est seule existante et la matire (rupa) n'a pas de ralit vritable, puisque pour le Bouddha et selon son enseignement, la pense aussi peu d'existence que la matire: Si la matire n'existe pas ne concevez pas l'existence de l'esprit; si l'es prit existe ne concevez pas l'inexistence de la matire. L'Eveill les rejets ensembl e dans le discours de la Sagesse (Chandrakirti, op. cit. (135), p. 238). Il appar at donc vident, aux yeux des disciples de Nagarjuna, que la pense n'existe pas en s oi, elle est bien plutt cause par la nescience (avidya). . 23. J.-P. Schnetzler, La Mditation bouddhique, Albin Michel, 1997, p. 35.
. 24. F. Houang, Le Bouddhisme, Fayard, 1963, p. 37. . 25. Ces deux stances sont donnes selon la traduction de Guy Bugault, op. cit., p. 231. . 26. E. Guillon, op. cit., p. 59. . 27. G. Bugault, op. cit., p. 235. . 28. Ibid., p. 233. . 29. J. Filliozat, Les Philosophes de l'Inde, PUF, 1995, p. 82. . 30. Ibid., p. 83. . 31. Ibid., p. 85. . 32. F. Chenique, Sagesse chrtienne et Mystique orientale, Dervy, 1997, p. 523. . 33. Ibid. . 34. Ibid. . 35. G. Bugault, op. cit., pp. 221-222. . 36. Ibid., p. 223. . 37. R. Verneaux, Introduction gnrale la logique, Beauchesne, 1968, p. 84. . 38. G. Bugault, op. cit., p. 264. . 39. G. Bugault, La Notion de Prajna ou de sapience selon les perspectives du Mah ayana, Institut de civilisation indienne, 1982, p. 211. . 40. Aristote, La Mtaphysique, Y 3 1005 b 20, t. I, Vrin, 1964, p. 195. . 41. Ibid., T 1005 25, p. 200. . 42. Ibid., Y 1008 30-34, pp. 213-214. . 43. Ibid., F 1006 15, p. 198. . L4: [3. La dialectique de la non-substance] :L4 . 1. E. Guillon, op. cit., p. 16. . 2. J. Filliozat, op. cit., p. 36. . 3. G. Bugault, op. cit., p. 232. . 4. Saint Thomas d'Aquin, Summa theologica, Prima Pars, la33, 1, DDB.1936. . 5. G. W. F. Hegel, Phnomnologie de l'Esprit, I, Aubier, 1939, p. 135. . 6. M. Heidegger, Qu'est-ce que la mtaphysique?, Gallimard, 1967, p. 69. . 7. Nous employons volontairement, pour ce passage, la traduction du Trait du Milie u effectue par M. Walleser, et utilise par R. Grousset dans son ouvrage, mme si cett e traduction le dfaut vident de trop rapprocher le langage nagarjunien du discours
technique de la philosophie occidentale. Ce travail (M. Walleser, Die Minire Leh re (Madhyamika castra), des Nagarjuna nach der tibetischen Version ubersetz, Hei delberg, 1911) possde nanmoins le mrite de mieux nous faire percevoir la dimension ontologique propre, ou plus exactement la force de la ngation ontologique chez Na garjuna. (Cf. R. Grousset, t. I, op. cit., p. 254.) . 8. R. Grousset, op. cit., p. 254. . 9. Ibid., p. 253. . 10. Proclus, Elments de thologie, Aubier, 1965. . 11. R. Grousset, op. cit., p. 254. . 12. Dans sa traduction du texte tibtain du Trait du Milieu, Georges Driessens donne, comme suit, la version de cette stance: . \ ### \ La nature de Celui-ainsi-all (le Bouddha), \ Cela est la nature de ce monde; \ L'absence de nature propre de Celui-ainsi-all \ Est l'absence de nature propre de ce monde (MK, XXII, 16). . \ ### \ The self-existence of the "fully completed" [being] is the self-exist ence of the world. \ The "fully completed" [being] is without self-existence [and] the wor ld is without self-existence. . 13. Voir Appendice III: Ncessit et contingence selon Ren Guenon, p. 207. . 14. On lira avec profit, sur ce sujet spcifique, l'ouvrage de Katsumi Mimaki, La Rfutation bouddhique de la permanence des choses (sthirasiddhidsana) et La Preuve de la momentanit des choses (ksanabhangasiddhi), Institut de la civilisation indie nne, 1976. . 15. Saint Thomas d'Aquin, Summa theologica, la Pa, qu 10, A. I, BAC vol. 77, Mad rid, 1940: Cum enim in quolibet motu sit sucessio et una pars post altrant, ex hoc quod numeramus prius etposterius in motu apprehendimus tempus quod nihil aliud est quod numerus prions et posterions in motu. . 16. M. Heidegger, Temps et Etre, Question IV, Gallimard, 1976, p. 14. . 17. A. Boutot, Heidegger, PUF, 1989, p. 34. . 18. H. D. Gardeil, Initiation la philosophie de saint Thomas, t. IV, La Mtaphysiq ue, Cerf, 1966, p. 93. . 19. Saint Thomas D'Aquin, De Potentia, III, 4: Primus autem effectus est ipsum es se, quod omnibus aliis affctibus praesupponitur, et ipsum non praesupponit alique m alium effectum. . 20. Nagarjuna, La Prcieuse Guirlande des avis au roi, Ed. Yiga Tcheu Dzinn, 1981, pp. 16 sq. . 21. Avec pertinence, Guy Bugault fait remarquer: II est bien vrai que Hegel et Na garjuna prennent acte de la contradiction qui est au c ur des choses, et qui est c hez Hegel le moteur du devenir. Mais partir de la leurs procdures divergent. La d ialectique hglienne s'accomplit dans le temps, dans une volution, une histoire. Son horizon reste mondain. La dialectique nagarjunienne est atemporelle, involutive
, anhistorique. L'une est constructive, l'autre purgative, ablative, abolitive. Chez Hegel le mot "fin" correspond un achvement, une sampti, chez Nagarjuna un nir odha ou bhanga. Le mouvement dialectique est gnralement ternaire chez Hegel: posit ion ou affirmation, ngation, ngation de la ngation; quaternaire chez Nagarjuna, et encore la quatrime proposition du ttralemme ne fonctionne que comme une concession pdagogique et trs provisoire (G. Bugault, op. cit., p. 332). . 22. G. W. F. Hegel, Science de la logique, vol. I, Aubier, 1972, p. 74. . 23. Ibid., p. 85. . 24. R. Grousset, op. cit., pp. 259-260. . 25. G. Bugault, op. cit., p. 306. . 26. Ibid., p. 268. . L4: [4. La doctrine de la vacuit (sunyatavada)] :L4 . 1. Voir Appendice IV: La contingence dans la mtaphysique occidentale, p. 209. . 2. R. Grousset, Les Philosophies indiennes, t. I, op. cit., p. 224. . 3. Ibid., p. 225. . 4. Ibid. . 5. P. Demiville, Le Concile de Lhasa, une controverse sur le quitisme entre bouddh istes de l'Inde et de la Chine au VIIIe sicle de l're chrtienne, Institut des haute s tudes chinoises, 1987, p. 109. . 6. B. Faure, Bouddhismes, philosophies et religions, Flammarion, 1998, p. 150. . 7. Nagarjuna, Trait du Milieu, Seuil, 1995, p. 207. . 8. Ibid., p. 244. . 9. Ibid. . 10. Voir Appendice V: Bouddhisme et nihilisme, p. 214. . 11. Y. Susumu, Nagarjuna's Mahayanavimaka, Eastern Buddhist (Kyoto), vol. IV, 192 7, p. 169. (Cf. R. Grousset, op. cit., p. 264). . 12. P. Demiville, op. cit., p. 126. . 13. J. Evola, La Doctrine de l'Eveil, Arche, 1976, p. 259. . L4: [5. L'hritage de la pense de Nagarjuna] :L4 . 1. R. Grousset, Les Philosophies indiennes, t. I, op. cit., p. 275. Les citation s du Shata-Shastra, reproduites par Ren Grousset dans son ouvrage, et que nous ut ilisons galement dans ce chapitre, viennent d'une excellente tude de G. Tucci, Le Cente Strofe, Catastra, testa buddhistico Mahayana con Introduzione e Note, estrat to da: Studi e materiali di Storia dlie religioni, vol. I, Roma, Anonima Romana E ditoriale, 1925. . 2. Ibid., p. 284. . 3. Ibid., p. 286.
. 4. Ibid., p. 289. . 5. Ibid., pp. 289-290. . 6. Ibid., pp. 291-292. . 7. Ibid., pp. 292-293. . 8. Ibid., p. 293. . 9. Ibid., p. 296. . 10. Ibid. . 11. Ibid., p. 297. . 12. Ibid. . 13. Ibid, p. 299. . 14. Ibid., pp. 299-300. . 15. Ibid.,<p. 300-301. . 16. Ibid., p. 302. . 17. E. Guillon, op. cit., p. 85. . 18. Ibid., p. 86. . L4: [6. Evolution de la doctrine Madhyamika] :L4 . 1. Chandrakirti, L'Entre au Milieu, d'aprs la version tibtaine de Patsab Nyima Drag pa et Tilakakalasha, augmente de l'autocommentaire de Chandrakirti et l'exgse de Ts onghapa intitule L'Illumination de la pense. Traduction tablie sous la direction de Yonten Gyatso par Georges Driessens assist de Michel Zaregradsky, Ed. Dharma, 19 88, p. 144. . 2. Ibid. (71), p. 167. . 3. Ibid. (81 cd), p. 182. . 4. Ibid. (87), p. 193. . 5. Ibid. (H4cd),p. 216. . 6. Ibid. (122), p. 227. . 7. Ibid. (136), p. 240. . 8. Ibid. (163), p. 263. . 9. Ibid. (206), p. 302. . 10. E. Lamotte, Le Trait de la grande venu de sagesse (Mahaprainparamitasstra), Ins titut orientaliste de Louvain, t. IV, ch. XLII (suite)-XLVIII, 1979, p. 2043; cf . Pancavimsati, p. 24, 1. 10-17; Satasahasrik, p. 77, 1. 6-80, 1. 4, et pp. 20452046. .
11. Chandrakirti, L'Entre au Milieu, op. cit., p. 318. . 12. Ibid. (237), p. 324. . 13. Ibid. (269), p. 337. . 14. On ignore le lieu et la date exacte de la naissance de Shankara (Celui qui f ait l'apaisement), il est certain nanmoins qu'il figure comme le plus grand mtaphy sicien de l'Inde mdivale du VIIIe sicle. Si la tradition rapporte qu'il fut une rinc arnation du dieu Shiva, plus concrte est la forme mme de son existence qui, aprs se s tudes acheves, voit le matre hindou embrasser la voie du renoncenent (sannyasin), et se mettre en route pour prcher la doctrine de la non-dualit (advata). Ce prche, qui est dans un premier temps une vaste entreprise de rforme de l'hindouisme luimme, entach par de nombreuses pratiques magico-rductrices, est galement, dans un sec ond temps, directement orient contre le bouddhisme, cette poque encore largement d iffus. Non content de constituer plusieurs ordres d'asctes, Shankara crit un nombre important d'ouvrages thoriques ainsi que des commentaires des Brahmasutra (Brahm asutrabhashya) et de la Bhagavad-Gt. Voir Appendice VI: Shankara et la non-dualit (a dvatd), p. 216. . 15. R. Grousset, op. cit., p. 327. . 16. Ibid., p. 329. . 17. La traduction du Bodhicaryavcttra est celle de L. La Valle Poussin, Bodhicarya vatara, Paris, Geuthner, 1907, utilise par R. Grousset, op. cit., pp. 327-344. On lira par ailleurs avec intrt dans Comprendre la vacuit (Ed. Padmakara, 1993) deux commentaires contemporains, puisque crits par des disciples de Dza Patrul Rinpotc h (1808-1887), du chapitre IX du Bodhicaryavatara (La Marche vers l'Eveil) de Sha ntideva: L'Ambroisie des paroles de Manjushr de Khentchen Kunzang Palden, et Le F lambeau tincelant de Minyak Kunzang Seunam. . 18. Ibid., p. 334. . 19. Ibid., pp. 335-336. . 20. Ibid., p. 340. . L4: [7. Les ultimes aspects de la doctrine de la vacuit] :L4 . 1. propos de cette question de premire importance, puisqu'elle dterminera le deven ir mme du bouddhisme au Tibet, on lira l'ouvrage fondamental de Paul Demiville, Le Concile de Lhasa, op. cit.. . 2. Cf. F. Chenique, Sagesse chrtienne et Mystique orientale, op. cit., p. 143. . 3. Ibid., pp. 143-144. Franois Chenique, dans son texte, donne la traduction effe ctue par Khempo Tsultrim Gyamtso Rimpoch, concernant l'origine des expressions Gzh an-stong, et Rang-stong. Le Rang stong hrite son nom de la phrase tibtaine: chos t hams cad rang ranggi gno bas stongpa (tous les phnomnes [dharma} sont vides de nat ure propre), que l'on rsume par les deux mots souligns Rang stong. Et le Gzhan-sto ng de: gzhan glo bur gyi dri mas stong yang yon tan gyis mi stong (Bien que [la nature ultime de l'esprit] soit vide des impurets [ou imperfections] passagres [qu i lui sont] trangres, elle n'est pas vide de qualits); on rsume cette phrase par les deux mots souligns: Gzhan stong, que l'on peut rendre littralement par "vacuit d'im perfections". Nous prfrons cependant cette expression ambigu en franais, celle de "v acuit qualifie" qui semble mieux rendre l'ide principale de la dfinition tibtaine (cf. Khenpo Tsultrim Gyamtso, Mditation sur la vacuit, Ed. Dzambala, 1980, p. 54). . 4. Khenpo Tsultrim Gyamtso, Mditation sur la vacuit, Ed. Dzambala, 1980, p. 54.
. 5. Ibid., pp. 54-55. . 6. L. Silburn, Aux Sources du bouddhisme, Fayard, 1997, p. 288. . 7. Ibid., p. 297. . 8. Ibid., p. 290. . 9. D. Gira, Comprendre le bouddhisme, Bayard/Centurion, 1989, p. 199. . 10. Fong Yeou-lan, Prcis d'histoire de la philosophie chinoise, Le Mail, 1985, p. 230. . 11. Voir Appendice VII: La philosophie du Lankvatarasutra, p. 221. . 12. Voir Appendice VIII: Le Vimalakrtinirdesa (Vkn), et l'enseignement de Vimalakrt i sur la vacuit, p. 226. . 13. Voir Appendice IX: La pense de Lin-tsi, p. 232. . 14. Le Chant de l'Eveil, de Kodo Sawaki, commmentaires du Shdka, Albin Michel, 199 9. . 15. Sandokai, dans La Pratique du Zen, par matre Deshimaru, Albin Michel, 1981. . 16. Anthologie du bouddhisme St Zen, Les Fleurs du vide, textes runis et traduits p ar E. Rommelure, Grasset, 1995, p. 30. . 17. Takenki Gensh, Nihon zenshshi, pp. 2-3, pp. 5-6, in Michel Mohr, Le Trait de l' Inpuisable Lampe du zen de Torei (1721-1792), vol. 2, Institut belge des hautes tu des chinoises, 1997. . 18. Les Fleurs du vide, op. cit., p. 28. . 19. Ibid., p. 120. . 20. Komyozo zan mai de matre Ejo, in Le Trsor du Zen, textes traduits et comments p ar matre Taisen Deshimaru, Albin Michel, 1994, p. 33. . 21. Les Fleurs du vide, op. cit. p. 213. . 22. Ibid., pp. 35-36. . 23. Dgen, Shbgenz uji, traduit du japonais par Eid Shimano Rshi et Charles Vacher, Ed. Encre Marine, 1997, p. 43. . 24. Ibid., p. 49. . 25. Ibid., p. 53. . 26. Ibid., p. 69. . 27. Ibid., p. 73. . 28. Ibid., p. 67. . . ******************************************************* *******************************************************
******************************************************* .
L1: [Appendices] :L1 L2: [I. Le nant chez Matre Eckhart] :L2 . II est significatif de constater que la formule d'Eckhart: toutes les cratures son t un pur nant, je ne dis pas qu'elles sont peu de chose, c'est--dire quelque chose , non je dis qu'elles sont un pur nant. Ce qui n'a pas d'tre est nant. Mais aucune crature n'a d'tre (...), issue du Sermon n 4 II faut que Dieu se donne moi, est exact ment celle qui fit l'objet, parmi vingt-sept autres, de la bulle de condamnation In Agro Dominico, du pape Jean XXII, le 27 mars 1329. Figurant au n XXVI des formu les juges tmraires par le magistre, cette proposition (Omnes creaturae sunt unum purum nihil; non dico quod sint quid modicum vel aliquid, sed quod sint unum purum ni hil ) est cependant tout fait orthodoxe dans son affirmation du nant des cratures. Eckhart ne fait que pousser logiquement jusqu son terme le raisonnement de saint Augustin au sujet de la non-substantialit des tres crs. Sachez, dit saint Augustin, q ue vous tes homme, homme dont la conception est une faute, la naissance une misre, la vie une peine, et pour lequel mourir est une ncessit. (...) Le corps doit nous apprendre lui-mme ce qu'il est, ce qu'il offre aprs la mort, il le montre dj pendan t la vie. (Cf. Abb Barbier, Les Trsors de Cornlius A. Lapide, Julien Lanier, 1856, t . III, p. 382.) De la mme manire, Eckhart sait, comme saint Thomas, que si Dieu est l'Etre en soi, en se, en qui l'essence et l'existence concident, l'tre des crature s n'est qu'un tre particip, ens ab ali. (Cf. J. Ancelet-Hustache, Matre Eckhart et la mystique rhnane, Seuil, 1971, p. 59.) . La problmatique de la contingence des tres crs et de la suffisance de l'Etre incr est une question qui agita normment la mtaphysique mdivale; les arguments eckhartiens bnfi ient cependant du poids non ngligeable de l'Ecriture sainte, puisqu'il y est clai rement prcis, plusieurs reprises, non seulement que la crature n'est rien: Venus du nant vos uvres sont comme n'tant pas (Ecce vos estis ex nihilo, et opus vestrum ex e o quod non est) (Is, XLI, 24), Tu es poussire, et tu retourneras en poussire (Pulvis es, etinpulverem revertis) (Gen, III, 19), Tous les hommes ne sont que terre et cendre (Omnes homines terra et cinis) (Eccl XVIII, 31), mais galement que le Nom p ropre de Dieu est l'Etre lui-mme: Ego sum qui Sum (Ex, III, 14). Dire que l'essenc e divine est suffisante, c'est, dit Matre Eckhart, affirmer que Dieu est lui-mme s on tre, ou mieux qu'il est son propre tre: Deus autem ipsum suum esse. L'essentiel de la mtaphysique eckhartienne est acquis: Dieu est l'Etre lui-mme, l'Etre est Di eu, lui-mme qui est (Ifse est). L'Ipsit de l'Etre est donc un solipsisme, car il n' y a d'autre possibilit d'tre que d'tre en lui. En dehors de Lui, il n'y a rien: Ext ra ipsum nihil. N'tre rien c'est tre sans Lui. La vie de l'tre est en Lui qui est l 'tre lui-mme. Etre c'est donc tre Dieu en Dieu, c'est tre l'Ipse mme de l'tre (A. de L bra, Ipsit de l'tre et solipsisme ontologique chez Matre Eckhart, in Celui qui Est, prtation juives et chrtiennes d'Exode 3, 14, Cerf, 1986, pp. 158-159). N'oublions pas, nous fait, et juste titre, remarquer A. de Libra, que Matre Eckhart accomplit une synthse entre le no-platonisme d'Augustin et celui de Denys, d'autant lorsqu'il reprend son propre compte des passages entiers du De Consideratione de saint Be rnard; pour mmoire voici ce que dit saint Bernard: Qu'est-ce que Dieu? (Celui) san s lequel rien n'est. Il est autant impossible que quelque chose soit sans Lui qu e Lui sans Lui-mme. Il est l'tre de lui-mme et de toutes choses et ainsi, en quelqu e faon, Lui Seul est, qui est son propre tre et l'tre de toute chose (saint Bernard, De Consideratione, L. V, 6, 13). . Le fameux dtachement eckhartien trouve donc son origine dans cette absence d'tre q ui caractrise l'homme, car au nant existentiel du dtachement rpond, ou plus exacteme nt correspond, le nant essentiel de la crature. Ainsi, le dtachement ne peut plus tre compris comme une capacit de l'homme (et donc) comme une vertu au sens tradition nel, mais doit tre compris comme une manire d'tre Dieu. (...) Le dtachement vritable, en tant qu'tat le plus haut de l'esprit humain, ne possde pas de point de repre au quel il pourrait se rapporter, il n'a pas de support et il se trouve dans un nant
pur. Le dtachement se trouve dans un nant pur et est absolument semblable au fait qu'il se tienne au plus haut, parce que c'est seulement dans le nant, /'. e. dan s ce qui n'est pas dtermin mais qui peut tre dtermin, que Dieu peut et doit agir sans limite selon sa volont (M. Enders, Une nouvelle interprtation du Trait eckhartien du Dtachement, in Revue des sciences religieuses, USHS, n 1, janvier 1996, p. 14). Da ns cette mme et identique optique, E. Waldschiite avait galement montr que le nant ta it l'objet comme l'essence du dtachement (cf. E. Waldschte, Meister Eckhart, eine philosophische Interprtation der Traktale, Bonn, 1978, p. 384, n. 9-11), ce qui e xplique l'attitude de Matre Eckhart vis--vis de la prire: Quand je ne demande rien, je prie vritablement {Sermon 65, III, 35). (...) la s'atteint l'ultime de l'enseign ement eckhartien. L'homme n'est vrai, de vrit dernire, qu'en pousant de la sorte ce qui le constitue dans l'ultime ressaut de son tre son identit, d'origine et de ter me, avec cette "dit" antrieure "Dieu" mme, fondement du multiple qu'il est comme rep rsentation (G. Jarczyk et P-J. Labarrire, Une montagne de plomb effleure par le vent, in Matre Eckhart, Du Dtachement et autres textes, Rivages, 1994, pp. 21-22). Nous touchons ici au thme de la passivit et de l'abandon, o, pour Eckhart, il est beauco up moins question d'agir que de se laisser agir, de se laisser vider, plutt que d e se vider, de laisser faire plutt que de ne rien faire. Le dtachement tend vers un pur nant, (...) dans lequel Dieu peut agir en nous entirement sa guise. (...) Tou t notre tre n'est fond en rien d'autre que dans l'anantissement (Matre Eckhart, Sermo ns, t. IV, 167, et t. I, 85, trad. J. Ancelet-Hustache, Seuil, 1974 / 1979, p. 2 5 et p. 195). . L2: [II. La problmatique mtaphysique de l'tre et de l'essence] :L2 . On aura le souci de conserver l'esprit, sur l'ensemble des points qui regardent les notions propres de l'ontologie, que l'tre et le non-tre ne sont pas des concep ts simples et univoques. II y a tre et tre: il y a l'tre qui est, cet homme, ce chie n, cette table, ce vase; il y a l'tre par quoi l'tre est, la couleur de cet homme, la taille de ce chien, le contour de cette table ou de ce vase; il y a l'tre qui peut tre, la semence de cet homme ou de ce chien, qui peut tre cet homme ou ce ch ien, le bois de cette table, qui peut tre table, l'argile de ce vase, qui peut tre vase. Il y a non-tre, et non-tre: il y le non-tre pur et simple qui n'est rien et qui n'est pas; mais il y a le non-tre relatif, qui n'est pas ceci, parce qu'il es t cela. Et il y a deux sortes de non-tre-relatif: il y a le non-tre relatif, pur e t simple: une flte n'est pas un architecte; et il y a le non-tre relatif, qui peut tre ce qu'il n'est pas encore: un nouveau-n n'est pas un architecte, mais il peut ce que ne peut la flte devenir architecte (cf. P.-B. Grenet, Ontologie, analyse s pectrale de la ralit, Beauchesne, 1963, p. 25). Touchant cependant la problmatique de l'essence et de l'existence, la question se dploie selon un ordre de dterminati ons occupant un domaine qui est proprement celui de l'origine des tres crs en tant que prsents dans l'tre. En vrit, dit Aristote, l'objet ternel de toutes les recherches , prsentes et passes, la question toujours pose: qu'est-ce que l'tant (ti to on)? re vient ceci: qu'est-ce que V ousia? C'est cette ousia, en effet, dont les philoso phes affirment, les uns, l'unit, d'autres la pluralit, cette pluralit tant pour les uns limite en nombre, et pour d'autres, infinie. C'est pourquoi, pour nous aussi, notre objet capital, premier, unique pour ainsi dire, sera d'tudier ce qu'est l't ant pris en ce sens (Aristote, La Mtaphysique, Z, 1, 1028 b, t. II, Vrin, 1964, p. 239). Mais, pour Aristote, ousia est d'abord l'appellation de l'tre dans son tre, qu'est-ce que l'tre revient donc se demander qu'est-ce que sa quiddit, qu'est-ce que sa forme? C'est donc l'essence qui peut rpondre la question, c'est l'essence qui seule fournit la rponse la question sur ce qu'est l'tre. (...) les dterminations de l'existence suivent les dterminations de l'essence (...) en d'autres termes l 'essence est la mesure de l'existence conue comme sa simple modalit (E. Gilson, L'E tre et l'Essence, Vrin, 1987, p. 133). . Il convient toutefois de prciser que l'essence est ce par quoi une chose est intel ligiblement ce qu'elle est en se distinguant de toutes autres choses. Elle const itue donc l'intelligibilit de la substance premire. Elle n'est pas la substance el
le-mme, elle est plutt son rayonnement en faveur de l'intelligence. La substance e st en soi pour soi. Pour notre intelligence, elle est en soi par son essence. L' essence n'est donc pas construite posteriori partir de notre exprience du monde, mais elle est l'origine de toutes les dterminations que nous attribuons la substa nce (P. Gilbert, La Simplicit du principe, Culture et Vrit, 1994, p. 62). C'est d'ai lleurs exactement la dfinition traditionnelle de saint Thomas: L'objet de l'intell ect est ce qui est, c'est--dire l'essence de la chose (saint Thomas, Somme contre les Gentils, I, 47, 4), mais prcisons que, si on appelle essence l'intelligibilit i ntrinsque de la substance, la substance, elle, n'est pas connaissable si elle ne se donne pas comme telle dans les lments intelligibles que nous recueillons dans n otre exprience. La connaissance de l'tant rsulte (donc) d'un labeur intellectuel al li au don que la substance fait de soi intelligiblement au sein du monde. Cependa nt l'intelligibilit est priori acheve dans la substance. Elle n'est pas d'abord la mesure de notre intellect l'essence ne rsulte pas de l'idation de ses dtermination s par l'intellect elle nat de la substance, non des formes intellectuelles. (...) L'essence dfinit donc la substance en sa clart originaire (P. Gilbert, op. cit., p . 63). Ceci permet de mieux comprendre ce qui distingue la substance de l'essenc e: L'essence est la catgorie de la prsence de l'tant l'intellect, elle est la substa nce en tant que connaissable (E. Gilson, Le Thomisme, Vrin, 1945, p. 45.) . Cela dit, si l'on peroit correctement ce qui distingue l'essence de la substance, il est une question qui reste dlicate au sein de la mtaphysique, c'est le rapport de l'essence l'existence; or ce sujet est l'un des plus problmatiques. Au cours des sicles, les philosophes et les thologiens en ont dbattu sans relche, mais la ten sion s'accrut singulirement lorsque saint Thomas, en christianisant Aristote, tra nsforma une distinction logique, formule par le matre grec, en distinction ontolog ique. Aristote s'tait exprim en disant qu'une chose est de se demander ce qu'est u n tre, c'est--dire d'interroger ce qu'il est, par la formule Quid sit?, question l aquelle rpond la dfinition de son essence, ou de sa quiddit (ceci est un homme, un animal, une fleur etc.). Et une autre chose de se demander s'il existe, c'est--di re An sit (existet-il)? Or saint Thomas dclare dans son uvre fondatrice, le De Ent e et Essentia, que cette distinction logique est une distinction relle, une disti nction d'ordre ontologique. Tout ce qui, en effet, n'appartient pas au concept d' essence ou de quiddit lui advient de l'extrieur et compose avec l'essence, parce q ue nulle essence ne peut tre conue sans ses parties. Or, toute essence ou quiddit p eut tre conue sans que soit conue son existence: je puis en effet concevoir ce qu'e st l'homme ou le phnix, tout en ignorant si cela existe dans la nature des choses . Il est donc vident que l'existence est autre chose que l'essence ou quiddit, sau f peuttre s'il y a un tre dont la quiddit soit son propre exister lui-mme (saint Thom as, De Ente et Essentia, V, 77, Vrin, 1991, p. 56). Ceci signifie qu'une crature peut tre dote de telle ou telle essence sans que pour autant elle soit existante, sauf dans le cas de Celui dont l'essence est justement d'exister, l'Etre dont dpe ndent tous les tres dans leur tre. II faut donc qu'en tout ce qui n'est pas cette ra lit, autre soit son exister et autre sa quiddit, ou nature, ou forme (ibid., V, 80, p. 58.) La distinction thomiste rpond la thorie de la composition constitutive du fini. Pour qu'un tre fini soit possible, saint Thomas considre qu'il doit tre comp os: II faut qu'en lui un principe de perfection soit li un principe de limitation, de sorte que, par son principe de perfection, l'tre fini participe la perfection de l'tre et que par son principe de limitation, il appartienne au monde du fini (F . Van Steenberghen, Le Thomisme, PUF, 1992, p. 21). Saint Thomas affirme donc qu e dans chaque tre cr, l'tre est tout autre chose que l'essence, qu'il y a une diffren ce profonde de l'un l'autre, l'tre ne participe pas de la dfinition de l'essence. Cependant, parler de distinction entre deux choses, c'est laisser penser que cha cune possde sa ralit propre l'une indpendamment de l'autre. Mais que peut bien tre la ralit d'une essence dans un tre si elle est dpourvue de l'existence qui la rend act uelle? La crature est une unit, donc dire qu'elle est signifie invitablement ce qu' elle est; l'essence et l'existence sont insparables. Certes, saint Thomas rpond qu e l'essence est en puissance dissimule sous l'acte d'exister, et donc que la dist inction est une distinction d'origine, mais en ralit cette affirmation ne fait que redoubler la difficult car on se demandera alors comment une essence peut subsis
ter en puissance sous une existence devant l'actualiser, une chose en puissance ne pouvant tre en acte et en puissance en mme temps. Donc, de deux choses l'une: s oit l'essence possde l'existence, soit elle ne la possde pas; son essence c'est so n existence, son existence c'est son essence. .
L2: [III. Ncessit et contingence selon Ren Guenon] :L2 . Dans son ouvrage intitul Les tats multiples de l'tre, Ren Guenon expose l'essence de sa pense mtaphysique. Remarquons que si Gunon admet que la manifestation est purem ent contingente, elle possde nanmoins ses yeux sa ralit propre, sa ncessit en tant onde en principe dans la Possibilit universelle. Reconnaissant bien videmment que s i un tre n'a pas en lui mme sa raison d'tre, mme immdiate, ce qui au fond reviendrait dire qu'il n'est aucunement un tre vritable (Les Etats multiples de l'tre, Ed. Vga, 1 990, p. 102), Guenon ajoute toutefois que si la manifestation est purement contin gente en tant que telle, elle n'en est pas moins ncessaire dans son principe car, selon lui, de mme que, transitoire en elle-mme, elle possde cependant une racine a bsolument permanente dans la Possibilit universelle; et c'est la, d'ailleurs, ce qui fait toute sa ralit. S'il en tait autrement, la manifestation ne saurait avoir qu'une existence toute illusoire, et mme on pourrait la regarder comme rigoureuse ment inexistante. (...) Dire que la manifestation est ncessaire dans son principe , ce n'est pas autre chose, au fond, que de dire qu'elle est comprise dans la Po ssibilit universelle (op. cit., P- 97). . Afin de prciser sa pense il crit encore: C'est donc parce que la manifestation est i mplique dans l'ordre des possibilits qu'elle sa ralit propre, sans que cette ralit pu sse en aucune faon tre indpendante de cet ordre universel, car c'est la, et la seul ement, qu'elle sa vritable raison suffisante (ibid.). La manifestation est donc po ur Ren Guenon tout la fois ncessaire et contingente: il n'y a, ditil, aucune diffic ult concevoir que la manifestation soit ainsi la fois ncessaire et contingente (ibi d., pp. 97-98). Toutefois, la contingence, l'impermanence, la causalit, ne saurai ent pour Guenon frapper le Principe: le Principe, prcise-t-il, ne peut tre affect pa r quelque dtermination que ce soit, puisqu'il en est essentiellement indpendant, c omme la cause l'est de ses effets, de sorte que la manifestation, ncessite par son Principe, ne saurait inversement le ncessiter en aucune faon (ibid., p. 98). . Il en conclut que tout ce qui existe en mode transitoire dans la manifestation do it tre transpos en mode permanent dans le non-manifeste (ibid.). La conception gunon ienne est donc beaucoup plus proche en ce sens de l'ontologie brahmanique, puisq u'elle refuse de soumettre, par principe, la Possibilit universelle l'impermanenc e. De ce fait c'est reconnatre, grce l'action du Principe, la prsence du ncessaire d ans les choses cres et, par consquent en elle, d'un fondement permanent (d'un Soi); d'ailleurs Guenon ne dira-t-il pas: Ce sont essentiellement les tats de non-manif estation qui assurent l'tre la permanence et l'identit? Bien videmment, constate-t-i l, si l'on ne prend l'tre que dans la manifestation, sans le rapporter son princip e non manifest, cette permanence et cette identit ne peuvent tre qu'illusoires, pui sque le domaine de la manifestation est proprement le domaine du transitoire et du multiple, comportant des modifications continuelles et indfinies (ibid., p. 32) . Mais loin d'en rester ce simple constat et en rattachant la manifestation sa s ource premire et originelle, il montre en elle ce qui chappe au contingent et la l imite, ce qui relve du ncessaire par identit de nature, ou du moins par participati on avec la Possibilit. Cette position aboutit donc, sur le plan mtaphysique, confre r une permanence dans l'tre par infrence de la Raison suffisante, en soustrayant, de manire axiomatique, cette Raison la dtermination dont sont frapps les tres. . En revanche, remarquons que, pour le Bouddha, et c'est ce qui constitue la grand e diffrence d'avec l'ontologisme sous toutes ses formes, tous les dharma sont imp ermanents (sabbe dhamm anatt, Dhammapada, XX, 7), qu'ils soient manifests ou non ma nifests; ce titre la loi d'impermanence est absolue, et s'applique sans partage d ans toute la force de son extension totale. Nous avons montr cependant (chapitre
7, p. 157), que le bouddhisme tibtain, d'une certaine manire, rintroduit une forme de transcendance, nomme Claire Lumire, qui rconcilie le Principe inconditionn et le no n-soi. .
L2: [IV. La contingence dans la mtaphysique occidentale] :L2 . II est particulirement intressant de constater la diffrence de consquences thoriques qu'entranera la conscience de la contingence universelle du cr, en Europe et en Ori ent. Si, chez les matres bouddhistes indiens, le constat de la finitude du cr condu it plonger l'univers visible et invisible sous la domination de la loi d'imperma nence, il en va tout autrement dans la pense occidentale qui, la suite d'Aristote , ne perut dans l'tre non uniquement son principe d'existence, mais galement son pr incipe d'activit que l'on peut dfinir comme principe de causalit. Ce principe se fo nde sur une formulation logique, tirant de l'examen de l'existence sa justificat ion. L'tre, est-il dit, qui n'est pas par soi est ncessairement par un autre. C'es t la dfinition classique de la contingence du cr, or tous les tres qui nous sont don ns dans l'exprience sont des tres contingents, aucun ne possde de lui-mme l'existence . C'est la fameuse troisime voie de saint Thomas, qui insiste sur l'aspect corrupti ble des tres qui ne peuvent que dpendre d'un Etre ncessaire. Nous voyons des tres con tingents, c'est--dire des tres qui peuvent ne pas exister, nous avons un signe cer tain de leur contingence dans ce fait qu'ils n'existent pas toujours, mais au co ntraire naissent et meurent. Tels les minraux qui se dcomposent ou rentrent en con stitution d'un nouveau corps, tels les plantes, les animaux, les hommes. Voila l e fait (R. Garigou-Lagrange, Dieu, son existence et sa nature, Beauchesne, 1950, p. 269). . Ce fait de la reconnaissance de la contingence est commun aux traditions bouddhi stes et chrtiennes, mais la divergence apparat dans les conclusions apportes, dans les rponses qui succdent au constat du contingent. Pour saint Thomas, des tres pouva nt exister et ne pas exister n'existent en fait que par un tre qui existe par soi . Cet Etre doit exister par lui-mme, car s'il tait de mme nature que les tres contin gents, bien loin de pouvoir les expliquer il ne s'expliquerait pas lui-mme. Et pe u importe que la srie des tres contingents soit ternelle ou non; si elle est ternell e, elle est ternellement insuffisante, et ds toujours rclame un tre ncessaire (ibid.). Pour amplifier encore la force de son argument, saint Thomas fait intervenir au c ur de sa troisime preuve le problme du temps qui, nous l'avons vu, est totalement rf ut chez Nagarjuna. Saint Thomas fait remarquer: Aprs avoir constat l'existence dans le monde d'tres qui commencent d'exister, et qui ensuite cessent d'exister, s'il n'y a que des tres contingents il est impossible qu'ils existent depuis toujours. Exister sans commencement ne convient en effet, en propre, qu ce qui est par soi et cela ne pourrait convenir une srie d'tres contingents que s'ils recevaient l'ex istence d'un tre qui est par soi, c'est--dire d'un Etre ncessaire. Si donc il n'y a que des tres contingents, il fut un moment o rien du tout n'existait. Or si un se ul moment rien n'est, ternellement rien ne sera (ibid., p. 270). C'est la fameuse loi philosophique affirmant que du rien rien ne vient. II faut donc qu'il y ait que lque tre qui soit ncessaire, c'est--dire qui ne puisse pas ne pas exister; et si ce t tre n'est pas ncessaire par lui-mme, il tient sa ncessit d'un autre. Mais on ne sau rait ici non plus procder l'infini, il faut donc conclure l'existence d'un Etre q ui est ncessaire par lui-mme, et par qui s'explique l'tre et la dure de tout le rest e (ibid.). . On le voit, de l'indigence ontologique de la cration, la mtaphysique chrtienne l'ai de du principe de causalit va tirer un des arguments les plus efficaces pour dmont rer l'existence d'un Etre ncessaire. Du ncessaire au contingent, se dgage une struc ture en dpendance qui fonde la nature mme de la crature. La crature est dpendante fon , en tant qu'tre, et ainsi sous tous les rapports o elle participe de l'tre, on dir a que la crature est nant par elle-mme... (A. D. Sertillanges, L'Ide de cration et ses retentissements en philosophie, Aubier, 1945, p. 59). La notion de cration, qui surgit de la reconnaissance de la contingence du cr, tablit la crature dans une dpend
ance directe de l'Etre ncessaire, Etre duquel elle tient la vie, le mouvement et l'tre. La causalit devient, pour cette conception mtaphysique, le principe central et moteur du monde phnomnal, puisque toute forme vivante existe par donation, par rception, d'un tre, d'une existence qu'elle n'a pas, mais que recevant, elle perdr a fatalement et irrmdiablement un jour. C'est donc la cration qui est la source et l e principe dterminateur de toute activit dans le monde. Et parce que tout tre est d e Dieu fond et n'a de consistance en lui-mme que par sa dpendance de Dieu, sa susp ension Dieu: ainsi tout tre n'agit qu'en vertu de Dieu; son acte appartient tout Dieu... (ibid., p. 92). . La notion de causalit se rencontre dj chez Aristote dans ses Seconds Analytiques et sa Physique (II); pour lui la science tait par dfinition la connaissance par les causes. Le principe de causalit est donc un principe premier, en ce sens qu'il es t intimement li au principe d'identit. II est possible, dit Maritain, de rattacher logiquement le principe de raison d'tre au principe d'identit: par rduction l'absur de. En effet, l'expression par quoi une chose est s'identifie ce sans quoi elle n'est pas: ceci en vertu du principe de non-contradiction. Si donc une chose est qui n'a pas de raison d'tre, c'est--dire qui n'a pas, soit en elle-mme, soit en au tre chose, ce par quoi elle est, cette chose, la fois, est et n'est pas: elle n' est pas puisqu'elle n'a pas ce sans quoi elle n'est pas (J. Maritain, Sept leons s ur l'tre, Tqui, p. 112.) La causalit est donc essentiellement, pour la mtaphysique c hrtienne, une communication d'tre, un rapport de cration en dpendance d'une Cause nce ssaire, d'un Etre non contingent et incr dont tout provient en tant qu'tre. . C'est contre cette conception qu'une virulente critique va se faire jour, chez u n certain nombre de philosophes, qui refuseront catgoriquement les analyses justi ficatrices de la causalit transcendante. Pour Kant, lequel est trs certainement ce lui qui, dans sa clbre Critique, poussa le plus loin la rfutation des thses de la mta physique scolastique, la catgorie de la causalit ne possde de validit que par rappor t l'exprience phnomnale. Le principe de causalit n'a aucune valeur ni aucun critrium e son usage ailleurs que dans le monde sensible; or ici, il devrait servir prcisme nt sortir du monde sensible (E. Kant, Critique de la raison pure, Alcan, 1905, p. 501). Kant refuse que l'ordre ontologique soit une transposition pure et simple de l'ordre logique. Pour lui, il n'est pas possible d'infrer d'un ordre sur un a utre, c'est une opration philosophique irrecevable. On ne peut, pour Kant, d'une existence suppose, conclure une existence relle lorsque celle-ci n'apparat jamais d ans l'exprience. La raison ne peut prtendre, en se servant comme d'un levier du pr incipe de causalit, dpasser l'ordre phnomnal. . L'esprit ne peut effectuer un pareil saut de l'ontique l'ontologique, c'est une opration intellectuelle irrecevable; entre l'ordre de la nature et l'ordre de la sur-nature il y a une diffrence infranchissable pour les seules capacits humaines. De ce fait, l'existence de Dieu qui, si elle est relle, est de l'ordre de l'inco nditionn et non du conditionn ne peut tomber dans le champ de notre exprience en ta nt qu'objet issu de la raison humaine limite. L'Absolu ne saurait d'ailleurs en a ucune manire tre objectifi, puisqu'en tant qu'Absolu il est au-del de toute relation . L'ide transcendantale d'un tre premier ncessaire, absolument suffisant, est si imm ensment grande et si leve au-dessus de tout ce qui est empirique et toujours condit ionn qu'on ne saurait jamais trouver dans l'exprience assez de matire pour remplir un tel concept (ibid., p. 508). . Heidegger, un peu plus tard, et dans un premier temps sous l'clairage d'une analy se que l'on pourrait qualifier d'ontologie thique, verra dans la causalit l'achveme nt du nihilisme et le destin de l'oubli de l'tre. Le principe de raison, qui fond e la notion de causalit depuis les temps modernes, dtermine notre mentalit occident ale essentiellement technicienne, affirmera-t-il. Les prtentions contemporaines v oulant soumettre le monde des tants au pouvoir dmiurgique de la raison trouvent le ur origine dans le principe de causalit qui, voulant rduire aux dimensions de la s eule raison humaine la richesse multiple du monde et son inexplicable prsence, pe rdu le sens mme de l'tre.
. ~ Le nihilisme est un mouvement historial (...) le nihilisme meut l'histoire l a manire d'un processus fondamental. Le nihilisme n'est donc pas un phnomne parmi d 'autres, ou bien un courant spirituel qui, l'intrieur de l'histoire occidentale, se rencontrerait ct d'autres courants spirituels (...). Le nihilisme est bien plutt , pens en son essence, le mouvement fondamental de l'histoire de l'Occident (M. He idegger, Chemins qui ne mnent nulle part, Gallimard, 1992, p. 263). Sur le plan o ntologique proprement dit, l'tre est l'tre, et sur ce seuil s'arrtent les relations d'ordre ontique. Le malheur de la pense occidentale, c'est qu'elle voulu ramener l'tre l'tant. La diffrence ontologique entre l'tre et l'tant qui, dans l'histoire de la pense, pour Heidegger, ne fut jamais pense, est l'histoire mme de l'oubli de l't re qui ne fut lui-mme jamais pens en tant que tel, c'est--dire dgag de l'tant. L'essen e du nihilisme consiste en ce que de l'tre lui-mme, il ne soit rien. L'tre lui-mme, c'est l'tre en sa vrit, laquelle vrit appartient l'tre (ibid., p. 320). . En dernire instance, la philosophie heideggerienne rejoint paradoxalement la posi tion du bouddhisme initial qui, en l'tre, ne percevait outre l'impermanence et le devenir, ni fondement ni cause extrieure. L'tre est ce qu'il est; pour Heidegger, il est lui-mme ce qu'il est car, en ralit, il ne possde pas de nature propre, il es t en son retrait, il se donne en se retirant, autant d'expressions de l'ontologi e apophatique du matre allemand, qui pourraient parfaitement trouver place dans l a langue nagarjunienne. Que l'tre soit identifi au Nichts, chez Heidegger n'est pa s pour nous surprendre, le Nichts n'est d'ailleurs pas simplement le nant, il est l'Autre de l'tre en l'tre. Afin de prciser son sens, l'intrieur d'un surprenant dia logue entre un Japonais et un qui demande (sic), on trouve l'change suivant: Pour no us, dit le Japonais, le vide est le nom le plus haut pour cela que vous aimeriez pouvoir dire avec le mot: tre... Celui qui demande, c'est--dire Heidegger, lui rpon d ceci: ... en une tentative de pense dont les premiers pas sont encore aujourd'hu i incontournables (M. Heidegger, Acheminement vers la parole, d'un entretien de l a parole, Gallimard, 1990, p. 105). Le nant de Heidegger rsonne bien comme la vacu it de Nagarjuna, il est dans la prsence des choses, dans leur tre en tant qu'elles ne sont rien de l'tre. Le nant se rvle en propre avec l'tant, et tenant lui, comme ce qui chappe dans son ensemble (M. Heidegger, Qu'est-ce que la mtaphysique? Questions I, Gallimard, p. 69). . Il n'est donc pas surprenant de voir se dvoiler l'identit de l'tre et du nant chez H eidegger, confirmant la thse de la nonsubstantialit nagarjunienne: L'tre pur et le na nt pur, c'est donc la mme chose (ibid.), crit Heidegger. Cette approche amicale du rien est simplement signale en une sorte d'invitation l'exprience de l'abme par l'e xercice de la pense non-pense: Le vide est le mme que le Rien, savoir ce pur dploieme nt que nous tentons de penser comme l'Autre par rapport tout ce qui vient en prse nce et tout ce qui s'absente (M. Heidegger, Acheminement vers la parole, p. 104). Ce vide, ce nant ne sont pas diffrents de l'tre, car ils sont l'tre de l'tre. L'tre e st nant prcisment en tant qu'il est tre: Aber dises Nichts west ah dos Sein (Ce nant e st essentiellement l'tre) (M. Heidegger, Qu'estce que la mtaphysique? p. 76). Par une trange rencontre transhistorique, la pense de Heidegger se retrouve dans une s orte de convergence intime avec les intuitions orientales; c'est certainement un signe important dans l'histoire de la pense, et qui ne doit pas tre sous-estime. Cependant, n'oublions pas que la domination du principe de raison pendant plusie urs sicles dtermin le cours mme du destin mondial, et que la rencontre, par-del les c ultures, de la pense de l'tre heideggerienne et de la nonsubstantialit nagarjunienn e ne saurait modifier le cours de l'histoire, qui n'est autre d'ailleurs que le cours de l'histoire dtermine de l'oubli de l'tre, car il est dans la nature et le d estin de l'tre d'tre oubli. . L2: [V. Bouddhisme et nihilisme] :L2 . Aucune notion n'est plus sujette confusion que celle du vide. Pendant des sicles les penseurs europens identifirent le vide bouddhique au nant pur et simple; cela s
'explique certainement par la trs mauvaise connaissance des doctrines orientales qui caractrisa l'histoire de la pense occidentale jusqu nos jours. La dcouverte du bou ddhisme est un fait trs rcent de l'histoire occidentale, prcise Roger-Pol Droit dans son livre remarquable Le Culte du nant (Seuil, 1997, p. 11). Cet ouvrage, portan t sur l'analyse de cette longue incomprhension entre l'Orient et l'Occident, est en effet trs clairant sur ce point prcis de la mprise historique qui pesa lourdement dans le raisonnement philosophique en Europe. . En tudiant la frayeur du nant que les penseurs occidentaux ressentaient l'gard du b ouddhisme, Roger-Pol Droit, tout en soulignant que cette peur semble prsent oublie , fait nanmoins remarquer: On en trouve pourtant des marques multiples et diverses chez les philosophes allemands parmi lesquels Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, e ntre autres. Elle galement laiss des fortes traces chez les Franais, de Cousin Reno uvier, en passant par Taine et Renan. Tous ont en commun d'avoir considr le bouddh isme comme un nihilisme, dont il fallait avoir peur ou d'autant plus attirant qu 'il faisait peur, d'avoir li le bouddhisme et le pessimisme en une pense mortifre e t ngatrice, tout entire oppose l'ordre "normal" du monde occidental, chrtien, vivant , affirmatif... C'tait une mprise l'vidence. Mais quel fut son sens? (ibid., p. 16). . Le sens de cette erreur apparat trs clairement au fil des lignes: mesure que se ras semblaient et que se comparaient les textes des penseurs du XIXe sicle, il devena it vident que la dcouverte du bouddhisme, et surtout sa rlaboration sous la forme de cet impossible culte du nant, avait eu partie lie, dans la pense philosophique occ identale rcente, avec l'laboration du nihilisme et la distinction de ses registres de sens (ibid., p. 38). Il en dcoule une triple forme de nihilisme selon l'analys e de l'auteur, tout d'abord un nihilisme ne distinguant pas l'tre du nant, une sor te de nihilisme ontologique, un second nihilisme du refus volontaire de la vie, du rejet de l'existence et des existants, une pulsion de mort, une attirance ver s le rien et, enfin, un troisime nihilisme particulirement paradoxal, ressentant c omme une blessure toute interprtation de la vie ou du monde. Le sentiment de Roge r-Pol Droit, dans l'avance de son travail, est le suivant: Sous prtexte de parler d u Bouddha, ces textes ne parlaient pas seulement de l'Europe de leur temps, d'un XIXe agit de toutes sortes de turbulences, mais ils parlaient aussi de notre tem ps, du XXe sicle et de son "culte du nant" (ibid., p. 4l). On voit donc quel point il fut opr en Europe une surimpression l'endroit d'une pense qui tait en ralit trs d'un nihilisme formel qu'on voulait de toute force, et bien tort, lui attribuer , opration qui rpondait plus une ncessit spcifique aux penseurs europens, qu la vr Doctrine libratrice authentique de l'Eveill. .
L2: [VI. Shankara et la non-dualit (advata)] :L2 . Plus se dveloppera l'action rformatrice de Shankara, plus sa doctrine se prcisera e t s'affirmera comme l'expression d'un nondualisme absolu (kevaldvata), qui invite une comprhension renouvele des Veda. la suite de la classique cole du Vednta (fin du Veda) qui systmatise les conceptions philosophiques des Upanishad, il n'admet qu' un seul Principe, le Brahman suprme qu'il dfinit positivement comme Etre absolu (s at), Conscience pure (it) et Batitude ternelle (nanda) (B. Barzel, Mystique de l'inef fable, Cerf, 1982, p. 62). Shankara quant lui l'exprime de la manire suivante: Seu l existe le Brahman, l'Un sans second, dont la nature est sat-it-nanda...; en Lui, il n'y a pas de trace de dualit. Et qui ne peut tre atteint ni par le langage ni par l'intellect; en Lui il n'y a pas trace de dualit! Seul existe Brahman, l'Un s ans second, la suprme Ralit qui resplendit de son propre clat qui ne doit son existe nce qu Lui seul (Shri Shankararya, Viveka-Cda-Mani, Adrien Maisonneuve, 1946, p. 121). Contrairement aux bouddhistes qui rejetaient l'autorit des Ecritures, Shankara dpl oie une vigoureuse argumentation pour faire admettre l'importance premire des tex tes de la rvlation vdique. Rappelons que la Rvlation hindoue (ruti) comporte quatre Ve da qui sont le Rigveda (le Veda des strophes), le Yajurveda (le Veda des formule s), le Smaveda (le Veda des mlodies), et l'Adiarvaveda (le Veda de la magie). Le d ernier lment de cette Rvlation est constitu par les Upanishad, qui prsentent une dmarc
e trs nettement ontologisante et mtaphysique. Shankara pour sa part crira des comme ntaires de dix Upanishad majeures, la Brihadranyaka, la Chndogya, la Taittirya, l'A itareya, la Kena, la Katha, Yla, la Mundaka, la Prana et la Mndkya. Le Texte vdique es t infaillible (nirdosha), aime dire Shankara, il est moyen de connaissance. (Shan kara, Prolgomnes au Vednta, IPEC, 1977, 8, p. 49). Cependant, le matre hindou dvelopp era une analyse thorique qui, d'une certaine manire, permettra un accs direct et im mdiat la comprhension de la totale identit de toute chose avec le Brahman. Pour Sha nkara rien n'est en dehors de Brahman, tout est Brahman, aucune chose n'est diffr ente de l'Unique et Premier dans l'tre. Pour qui ralis la Vrit des vrits, o y aura ne entit autre que le Brahman, une entit indpendante du Brahman? Tout cet univers q ue l'Ignorance (avidya) nous prsente sous l'aspect de la multiplicit n'est pas aut re chose que le Brahman, jamais affranchi de toutes ces limitations qui conditio nnent la pense humaine. (...). L'univers tout entier n'est que l'effet de Brahman , l'unique Ralit; il n'est donc rien d'autre que Brahman. Cela est sa vritable subs tance, et le monde n'existe pas indpendamment de Cela. L'homme qui dit l'univers est reste sous l'influence de l'illusion (...). Assurment, tout cet univers est B rahman... Par consquent, tout ce qui existe est Brahman et rien d'autre que lui (S hankara, Viveka-Cd-Mani, pp. 67-69). Cette vision entrane, comme par un effet natur el, la prise de conscience d'une parfaite identit entre la crature et le Brahman, d'o la clbre expression: Cela tu l'es, toi aussi (fat tvam as), sousentendu: Toi galem nt, en tant que tu es ce que tu es, tu es Brahman, tu n'es pas diffrent de l'Un s ans second, du non-n ternel. Tout cet univers qui procde de Brahman l'unique Ralit Brahman Lui-mme et Brahman sans plus. C'est parce que rien n'existe hormis Brahm an c'est parce que Cela est la seule Ralit cette Ralit qui ne doit son existence qu le seule C'est parce que Cela est notre vritable soi, que tu es toi-mme ce suprme B rahman de paix et de puret l'Un sans second (ibid., p. 72). . Ceci a pour consquence de mettre en lumire une notion qui deviendra fondamentale c hez Shankara, la notion d'illusion (maya). Effectivement si tout est Brahman, si rien n'est diffrent de l'Un, alors les identifications au moi, telle ou telle fo rme, relvent toutes de l'illusion, de la fantasmagorie trompeuse, le monde de l'ex prience veille est, lui ausi, irrel; il n'est tout entier qu'un effet de notre propr e ignorance. (...) Ce dont, par erreur, nous imaginons l'existence en une chose quelconque, se rvle, lorsque la vrit correspondante nous est connue, comme le substr at lui-mme; cette chose n'est rien d'autre que ce substrat; elle ne diffre aucunem ent de lui (ibid., p. 72). De par la puissance propre de l'illusion, le monde est donc peru comme rel, alors qu'il n'est que du rve, qu'il n'existe pas rellement. No us sommes ici en prsence d'une forme trs pousse d'acosmisme o seul reste vrai, reste rel le soi identique au Brahman, unique vrit et donc unique ralit. L'ident du soi et du Brahman ne souffre aucune restriction d'aucune sorte, pleine et entire l'ident it est seule vritable, seule existante seule existence. C'est un principe fondament al du Vednta non dualiste, crit Michel Hulin, que de considrer le soi comme prsent e n droit avant toute intervention des moyens de connaissance droite, perception, infrence, etc., et comme la condition de possibilit mme de leur dploiement. Dans son Commentaire aux Brahmasutra I, 1, 1 Shankara dclare: "L'existence du Brahman est assure par le fait qu'il est le soi de toute chose. Chacun en effet conscience d e l'existence du soi et nul ne pense 'Je ne suis pas'. Si l'existence du soi n'ta it pas assure, chaque individu aurait conscience qu'il n'est pas. Or le soi, c'es t le Brahman." Il y a donc bien quelque chose comme un cogito vdntique. (...) Cett e omniprsence et cette immuabilit en chaque instant dsignent ainsi le soi comme mine mment vulnrable au ct illusoire de la surimposition. La constance de son mode de prs ence et le fait que, dans les conditions de l'exprience ordinaire, il n'apparaiss e jamais seul, son infinie banalit, en quelque sorte, le vouent tre sans cesse per du de vue, nglig, oubli. Cette dgradation de la notion de soi ou de Brahman visible, par exemple, dans l'abaissement du verbe tre au rang de simple copule dans le ju gement d'attribution reprsente l'une des consquences majeures du rgne de l'ignoranc e mtaphysique (M. Hulin, Qu 'est-ce que l'ignorance mtaphysique (dam la pense hindou e)?, Vrin, 1994, pp. 77-79). Ce rgne de l'ignorance n'est toutefois qu'un jeu (li l), pure spontanit d'une nature parfaite sans l'ombre d'une passivit ou d'une ordinat ion quelque fin intrinsque, libert, grcecharme, chatoiement de l'apparence et d'une
activit suspendue entre l'tre et le nant (O. Lacombe, L'Absolu selon le Vednta, Geut hner, 1937, pp. 122-123). . Shankara et sa lutte contre le bouddhisme. Remarquons, pour ce qui nous occupe, que si Shankara refuse que soit rejete, par les disciples de l'Eveill, l'autorit de s Ecritures, c'est surtout sur des points thoriques qu'il se montrera le plus vir ulent. Dans sa lutte contre le bouddhisme, Shankara n'hsitera pas employer les ou tils critiques de la logique argumentaire, en attaquant en particulier la thorie de l'impermanence: La conviction des partisans de l'impermanence veut qu l'appariti on de moments ultrieurs, ceux qui les prcdent cessent d'tre. Ce n'est pas par une te lle conviction qu'on pourra tablir un lien de causes et d'effets entre ce qui t antr ieurement et ce qui survient ultrieurement (Shankara, Discours sur le bouddhisme, traduction, prsentation et notes par Prithwindra Mukherjee, Ed. Trdaniel, 1985, p. 31). Il dirige par ailleurs directement le faisceau de sa rfutation contre les d isciples de Nagarjuna: Que la pense et les activits mentales soient engendres par un e cause quadruple devient (...) une conviction caduque. Si l'on reconnat que sans cause un effet peut se produire, dfaut d'entraves, donc, tout peut se produire n 'importe o (ibid,, pp. 35-36). P. Mukherjee rappelle, dans son commentaire du text e de Shankara, que, d'aprs Nagarjuna (MK, I, 2) les quatre conditions (pratitya-sa mutpada) sont: (a) alambana (rceptacle, soutien, simultanit de connaissance); (b) s amanantara (la connaissance antrieure engendre la connaissance ultrieure); (c) adh ipati (les perceptions sont souveraines); (d) sahakri (adjoint: la connaissance s e fait distincte) (ibid., p. 49). Tout l'effort contradictoire de Shankara porte, d'une certaine manire, sur le refus du caractre momentan du temps et de l'existenc e, caractre dont on sait l'importance qu'il a chez Nagarjuna. Il fait pour cela a ppel la nature, selon lui constante de la mmoire, car lie par dtermination un Sujet individuel: Par I assertion que toute chose est phmre les partisans de la cessation finissent par soutenir que le Sujet qui effectue les expriences est, lui aussi, p hmre. Ceci n'est pas possible. cause de la mmoire constante. Celle-ci merge en tant que rappel sur le sillage des expriences. Elle n'est possible que lorsque les expr iences appartiennent un sujet unique. On n'a jamais constat qu'un tiers Sujet se souvienne des expriences d'autrui (ibid., p. 37). La mmoire, sous cet aspect, est p erue comme preuve formelle non seulement de l'individualit, mais aussi comme forme vidente de la continuit existentielle du Sujet. Shankara agit de manire identique pour dmontrer l'impossibilit d'affirmer l'inexistence de ce qui est; c'est toujour s au solide bon sens qu'il fait appel: Si de l'inexistence l'mergence de l'existen ce tait effectivement dmontre, mme les gens les moins soucieux de la Vrit grce leur iffrence se verraient exaucs dans leurs ambitions. (Ceci) de par la facilit d'accs t ravers l'inexistence. Puis viennent les exemples concrets: Malgr le refus de labour er la terre, le cultivateur obtiendrait ses moissons. Malgr le refus de travaille r l'argile, le potier aurait ses pots fabriqus, etc. (ibid., p. 61). Ainsi pour Sh ankara rien ne peut surgir de l'inexistence, rien ne vient de ce qui n'existe pa s. Par cette rfutation, (la thorie que) l'existence merge de l'inexistence demeure i nvalide (ibid., p. 61). . Enfin, en conclusion de ses aphorismes, Shankara ne craint pas d'crire: quoi bon s 'tendre. Examine globalement et avec une mthode applique, la conclusion de l'imperma nence (des bouddhistes) s'effondre tel un puits sur la plage. Nous n'y trouvons rien d'admissible (ibid., p. 91). P. Mukherjee prcise dans son commentaire: amkara a tteint une dsinvolture dans son impatience d'infirmer l'enseignement bouddhiste. Il a ici pour cible les partisans de la vacuit (nihilisme) qui sont, cependant, c onnus pour leur prdilection de la voie moyenne (Madhyamaka), fidles au c ur du messa ge du Bouddha (ibid., p. 92). . On le voit aisment, les divergences entre Shankara et les bouddhistes furent trs c ertainement extrmement vives et, dans cette lutte, le mtaphysicien indien ne se fe ra pas faute d'employer la bonne grosse logique du sens commun afin d'asseoir se s thses contre l'absence de moi, et l'impermanence. juste titre P. Mukherjee mont re, dans son commentaire, l'usage un peu facile et grossier des arguments chez S hankara, face des adversaires qui, sur le plan thorique, dmontraient la ralit de l'i
mpermanence et l'absence d'existence relle des tres et des choses l'aide d'une mtho de dialectique relativement sophistique et prcise, ce qui d'ailleurs fut peut-tre u n facteur de son incomprhension. Il convient cependant de bien saisir que, dans c e combat, qui s'achvera par le retour triomphant de l'orthodoxie brahmanique en I nde, les thses bouddhistes en gnral, et nagarjuniennes en particuliers, fconderont d urablement la pense shankarienne qui s'en trouvera non seulement enrichie, mais a ussi singulirement redevable doctrinalement. C'est une grande date dans l'histoire de la pense indienne, dit Ren Grousset, que ce retour dlibr de toute l'lite intellect uelle aux vieilles doctrines des Upanishad, ou, comme disent les crivains brahman iques, l'orthodoxie. Le bouddhisme, pour eux, n'tait qu'une "hrsie" dont le long su ccs avait t un scandale pour l'esprit l'hrsie capitale du nairtmya, de la ngation de man. Restaurer (...) l'antique tman des Upanishad, c'est--dire l'me et la substance , tel fut leur but, telle fut leur uvre. (...) Le Vednta se prsente ainsi, aprs la l ongue prpondrance bouddhique, comme une restauration gnrale des notions et des valeu rs traditionnelles (...). Mais on ne biffe pas d'un trait une page de l'histoire humaine. Le mouvement de la pense bouddhique avait t trop intense pour qu'il n'en restt rien aprs elle. Elimine ou discrdite, elle laissa son hritage ses vainqueurs. O peut mme se demander si cette limination ne fut pas surtout une absorption... (R. Grousset, Les Philosophies indiennes, vol. II, DDB, 1931, p. 151). . L2: [VII. La philosophie du Lankavatara-sutra] :L2 . Le Lankavatara-sutra, c'est--dire Le sutra de la descente Ceylan, est un sutra cara ctris par son insistance particulire au sujet de l'illumination interne du Bouddha, i llumination considre dans ce texte comme seule capable d'oprer la libration de toute forme de dualit. La tradition rapporte que le Lankavatara-sutra fut transmis par Bodhidharma son disciple Houei-k'o (486-593) car contenant, selon le patriarche indien du Ch'an, l'essence de l'esprit. On ne compte aujourd'hui que trois traduc tions chinoises du sutra. La premire en quatre volumes fut donne sous la dynastie L ou-Soung (443 ap. J-C.) par Gunabhadra; la seconde, en dix volumes, sort de la p lume de Bodhiruchi, sous la dynastie luan-ouei (513 ap. J-C.), et la troisime, en sept volumes, est de Shikshnanda, sous la dynastie T'ang (700 ap. J-C.). (...), la premire est la plus difficile et c'est celle-la qui fut transmise par Bodhidha rma son disciple Houeik'o comme contenant "l'essence de l'esprit" (cf. D. T. Suzu ki, Essais sur le bouddhisme zen, vol. I, Albin Michel, 1954, p. 111). Il est no ter que le Lankavatara-sutra est l'origine d'une tendance spcifique au sein du bo uddhisme chinois, qui a son origine un certain Fachong (587-665), moine thaumatu rge contemporain de Daoxuan. Fachong se rclamait du "principe du Vhicule unique de l'Inde du Sud", ce qui semble tre une allusion la doctrine de la Prajnaparamita ( perfection de la sapience) qui tait l'origine de la tradition du Madhyamaka, tran smise en Chine par l'cole dite "des trois Traits" (Sanlun). Il semble avoir vis une synthse des thories du Lankavatara-sutra, du Ch'an et du Madhyamaka (cf. B. Faure, Le Trait de Bodhidharma, Le Mail, 1986, pp. 45-46). . C'est d'ailleurs sur les indications de Daoxuan, dans son Xu gaosengzhuan (Suite aux biographies des moines minents), compil en 645, que l'ide d'un Bodhidharma van tant les mrites du Lankavatara-sutra s'est installe durablement dans les esprits. Bernard Faure cependant montr le peu de crdit qu'il fallait accorder cette thse: Mal gr son apparente simplicit, dit-il, le texte de Daoxuan ne saurait tre considr comme une source historique de bon aloi. Il prsente en effet deux images diffrentes, pou r ne pas dire contradictoires, de Bodhidharma: comme quelqu'un qui, en tant que pratiquant intransigeant de la "contemplation murale", condamne tout recours la lettre crite; et comme un exgte du Lankavatara, un sutra de caractre particulirement technique (ibid., p. 15). En ralit cette attitude de Daoxuan rpondait un impratif tac tique ayant pour objectif de runifier et donc de pouvoir prsenter une ligne patriar cale du Ch'an homogne, ayant sa tte une figure emblmatique comme celle de Bodhidhar ma. En effet, prcise Bernard Faure, ds l'poque de Daoxuan, une communaut Ch'an s'tait dveloppe sur le mont de l'Est (Dongshan dans l'actuel Hunan), autour des matres de dhyana Daoxin (580-651) et Hongren (601-674) (ibid., p. 16). Il importait donc de
pouvoir inclure au sein d'une identique ligne des matres professant certes une do ctrine voisine, mais comportant toutefois des orientations plus que significativ es. . Quelle est donc la teneur de ce Lankavatara-sutra, pour qu'il soit l'objet d'aut ant de divergences son encontre? Tout le problme vient du fait que l'apophatisme et les multiples ngations prsentes au sein du Lankavatara-sutra, s'ils relvent bien d'une doctrine relativement pure, sont cependant tints d'un ontologisme rmanent o la notion d'esprit semble jouer un rle central. Mme si cet esprit se voit qualifier de vide et donc se rsorbe finalement dans l'absence d'esprit, cela ne permet pas, na nmoins, d'carter toute trace de tendance substantialiste qui donne ce sutra comme une teinture d'idalisme Yogacara tout fait perceptible. Le sujet principal du Lan kavatara-sutra est le contenu de l'Illumination (c'est--dire l'exprience intrieure, pratyatma-gat) du Bouddha sur la grande vrit religieuse du bouddhisme du Mahayana. (...) Il est vrai que le sutra reflte l'cole psychologique du bouddhisme prconis pa r Asanga et Vasubandhu, par exemple lorsqu'il dsigne l'Alaya-vijnana comme rserve de toutes les graines karmiques, reconnat le professeur Suzuki, mais, rajoute-t-i l, de telles rfrences et quelques autres ne constituent pas en fait la pense centra le du sutra; elles ne sont employes que pour expliquer la noble comprhension de l' exprience intrieure du Bouddha (pratyatm-rya-jnana] (op. cit., p. 113). L'essentiel du texte, il est vrai, est constitu par les dclarations du Bouddha au sujet de son Illumination intrieure (pratyatma-gat), et la situation de son tat spcifique, le to ut confi au bodhisattva Mahamati. O Seigneur, dit Mahamati s'adressant au Bouddha, instruis-moi dans ton systme de doctrine qui est fond sur la nature mme de l'espri t, instruis-moi dans la doctrine du non-ego, exempt de prjugs et de souillures, ce tte doctrine qui est rvle au plus profond de ta conscience. En rponse l'Eveill lui raf irme: C'est comme lorsqu'on voit sa propre image en un miroir ou dans l'eau, c'es t comme lorsqu'on voit sa propre ombre au clair de lune ou la clart de la lampe, c'est comme lorsqu'on entend sa propre voix renvoye par l'cho de la valle; lorsqu'u n homme se cramponne ses fausses prsomptions, il fait une discrimination errone en tre la vrit et la fausset; en raison de cette fausse discrimination il ne peut alle r au-del du dualisme des opposs; en fait il chrit la fausset et ne peut atteindre la tranquillit. Par tranquillit on entend unit de but (ou unit des choses), et par uni t du but on entend l'entre dans le hautement excellent samdhi, par quoi est produit l'tat de noble comprhension de la ralisation de soi-mme, qui est le rceptacle de l'ta t de Tathgata (tathgata-garbha) (ibid., pp 115-116). Le sutra insiste tout particul irement sur la question du dpassement de l'tre et du non-tre (nsty-asti-vikalpa). L'e la premire mesure i rreur fondamentale se situe la, dans l'attachement au dualisme ndispensable consiste s'en librer, afin d'atteindre l'tat de ralisation de soi-mme. L'erreur vient de ce qu'on n'aperoit pas cette vrit que toutes les choses sont vide s (shnyd), incres (an-utpada), non dualistes (a-dvaya) et n'ont aucun caractre indiv iduel immuable (nih-svabhava-lakshana). Par vide des choses on veut dire princip alement que leur existence, tant si essentiellement soumise une dpendance mutuelle , n'a abouti nulle part la fausse notion d'invidualit distincte, et que lorsque l 'analyse est pousse sa consquence logique, il n'existe rien qui puisse distinguer un objet d'un autre d'une faon dfinitive, c'est pourquoi il n'existe ni l'un ni l' autre, ni les deux (Svapar-bhay-bhavat) (ibid., pp. 116-117). . Est affirm dans un deuxime temps que les choses sont incres, parce qu'elles ne sont n i auto-cres, ni cres, par un agent extrieur. En troisime lieu, comme leur existence es t rciproquement conditionne, une conception dualiste du monde n'est pas la concept ion ultime; c'est donc une faute, due cette fausse discrimination (vikalpa), que de chercher le Nirvana en dehors du samsara (naissance et mort), et le samsara en dehors du Nirvana (ibid., 117). Enfin, le sutra dclare: Ce principe de condition nement mutuel signifie la ngation de l'individualit comme ralit absolue, car il n'y a rien dans l'existence qui puisse maintenir d'une faon absolue son individualit ri ge au-dessus de toutes les conditions de relativit ou de devenir mutuel; en fait e xister c'est devenir (ibid., p. 117). Dans la suite du texte le Bouddha s'exprime ainsi, renforant sa conception fondamentale portant sur l'unit entre illusion et Eveil, entre Nirvana et samsara: Allons plus loin, Mahamati, dit-il. Ceux qui, re
doutant les souffrances rsultant de la discrimination de la naissance et de la mo rt, recherchent le Nirvana ignorent que la naissance et la mort et le Nirvana ne doivent pas tre spars; et, comprenant que tout ce qui est objet de discrimination n'a pas de ralit, ils s'imaginent que le Nirvana consiste en une annihilation des sens et de leur zone de fonctionnement. Ils ne se rendent pas compte, Mahamati, que le Nirvana "est" Yalayavijnana o s'est produit un retournement par la ralisati on intrieure (Lankvatara-sutra, XVIII, in, T. D. Suzuki, Manuel de bouddhisme zen, Dervy, 1981, p. 52). . La nature non ne des choses devient le centre de l'argumentaire du Bouddha: Toutes choses sont non nes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de ralit, tant des manifest ations du Mental lui-mme; et, Mahamati, comme elles ne sont pas nes de l'tre ni du non-tre, elles sont non nes (Lankvatara-sutra, XIX, op. cit., p. 53). La dlivrance de l'tre et du non-tre, comme son dbut, reste l'objet premier du sutra, c'est pour ce texte la question qui conditionne la cessation de toutes les formes errones d'at tachement: Mahamati, incommensurable est notre profond attachement l'existence de s choses, ces choses que nous cherchons comprendre par les mots. Il y a, par exe mple, profondment enracin, un attachement aux marques de l'individualit, la causali t, la notion d'tre et de non-tre, la discrimination entre naissance et non-naissanc e, de cessation et de non-cessation, de vhicule et de non-vhicule, de samskrita et asamskrita, des caractristiques des stades et des non-stades. Il y a l'attacheme nt la discrimination elle-mme, l'attachement l'illumination, l'attachement la dis crimination tre et non-tre de laquelle les philosophes dpendent tellement, et l'att achement au triple vhicule et au vhicule unique qu'ils distinguent (Lankvatara-sutra , LXVIII, op. cit., p. 63). La conclusion du sutra se fait de plus en plus prcise et affirmative, une fois encore l'attachement dualiste est condamn. Fortement att achs ces discriminations, les ignorants et les esprits simples continuent discrim iner sans relche, comme le ver soie qui s'enroule dans son propre fil de discrimi nation et d'attachement, non seulement eux-mmes mais aussi les autres et ils y tr ouvent leur plaisir; ainsi, ces ignorants et ces esprits simples continuent s'at tacher fortement aux notions d'existence et de non-existence. (Mais en ralit), Mah amati, il n'y a ici pas de signes d'attachement profond ni de dtachement. Toutes choses doivent tre vues comme rsidant dans la Solitude, o il n'y a aucun processus de discrimination. Mahamati, le Bodhisattva-Mahasattva devrait se tenir en un en droit o il puisse voir toutes choses du point de vue de la Solitude (ibid.). Cet e ndroit o toutes choses sont vues du point de vue de la solitude, c'est l'tat de no n-attachement, le vritable lieu de l'illumination intrieure du Bouddha; on compren d mieux de la sorte pourquoi le sutra put exercer son influence sur les matres Ch 'an, tant sa conception et l'objectif mme de son discours font de lui un vritable trait en faveur du non-dualisme radical, en faveur du nonattachement, par-del l'tre et le non-tre. Il n'en reste cependant pas moins vrai que certaines formules, de par leur nette ambivalence, leur imprcision vocatrice, peuvent aisment favoriser u n lger penchant vers une forme tout fait perceptible d'idalisme Yogacara, qui d'ai lleurs refait parfois surface chez certains matres ch'an et zen. . L2: [VIII. Le Vimalakrtinirdesa (Vkn), et l'enseignement de Vimalakrti sur la vacu it] :L2 . Le Vimalakrtinirdesa (Vkn), qui date probablement du IIe sicle, est un sutra d'une extrme importance de par le rle majeur qu'il joue dans le dveloppement de la doctr ine de la vacuit. Par sa date relativement ancienne, par ses sources d'inspiration autant que par les thories qu'il dveloppe, le Vkn se range parmi les plus anciens Mahayanasutra. Comme la Prajnaparamita (...), il reprsente ce Madhyamaka l'tat br ut qui servit de base l'cole de Nagarjuna (E. Lamotte, Vimalakrtinirdesa, L'Enseign ement de Vimalakrti, Institut orientaliste Louvain-la-Neuve, 1987, p. 40). On rem arquera que le titre initial qui fut donn au Vkn, Yamakavyatyastbhinirhra, c'est--di re Production de sons coupls et inverss, est une manire de montrer le mcanisme dialect ique trs mouvant de ce sutra. Le Bodhisattva est habile en couple et inversion (ya makavyatyastakusala) car, en tant qu'il joue avec les savoirs et qu'il a obtenu
l'excellence de la perfection du savoir, il peut, tout en s'appuyant sur le Nirv ana, manifester les voies de la transmigration; bien qu'il possde un domaine abso lument dpourvu d'tre vivant, il ne cesse de faire mrir tous les tres. (...), Siksnand a interprte le sens et voit dans cette expression une allusion aux actes contradi ctoires du Bodhisattva, cette conduite double et inverse par laquelle le Bodhisat tva, tout en tant saint, agit en pcheur pour le bien des tres (ibid., pp. 35-37). Vi malakrti est, selon la tradition, un lac qui ostensiblement porte des vtements blan cs: un gentilhomme retir, un matre de maison avis, riche, respect, un banquier, un ho mme d'affaires dont les affaires ne salissent pas les mains, un bienfaiteur qui, s'il le faut, hante les mauvais lieux pour y faire uvre de salut, mais sans qu'a ucun contact impur puisse le souiller plus que la boue ne souille le lotus. Il rs ume le vieux dilemme chinois entre l'activisme et le quitisme. (...) Vimalakrti pa rticipe l'activit sans cesser d'tre dans la quitude; il s'adapte toute situation, rp ond, ragit tout appel extrieur sans s'en laisser troubler. Ses rflexes sont telleme nt dsintresss, sa libert si parfaite, il fait preuve d'une telle matrise de lui-mme et du monde que les lois de la morale vulgaire, voire celles de la nature, ne comp tent pas pour lui (ibid., pp. 439-440). La personnalit mme de Vimalakrti explique la place unique occupe par le sutra l'intrieur du Mahayana; le Vkn reprsente effectiv ement une pense authentiquement madhyamika. Etienne Lamotte mis en lumire de faon t rs convaincante dans son ouvrage sur le Vkn comment et en quoi le sutra avait pro fess toutes les thses du Madhyamaka. En une srie de six propositions distingues alph abtiquement de a F, il fait la dmonstration de la complte identit thorique et doctrin ale entre le Vkn et Nagarjuna. Proposition : Tous les dharma sont sans nature prop re (nihsvabhava), vides de nature propre (svabhavasunya). (...) Le Vkn revient c haque page sur l'inexistence des dharma. Proposition B: Tous les dhanna sont non ns (anutpana) et non dtruits (anirudha). (...) Le Vkn insiste son tour sur la non -naissance, la non-production des dharma, sur le pratitya-samutpada "au sens pro fond", lequel ne fonctionne pas. Proposition C: Tous les dharma sont originellem ent calmes (adisnta) et naturellement nirvans (prakrtipannirvrta). (...) Les mmes p ropositions sont formules par le Vkn: Ce qui est sans nature propre est sans natu re trangre... il n'y a pas un seul tre qui ne soit dj parinirvan. Proposition D: Les d harma sont sans caractre (alaksana) et, par consquent, inexprimables (anirvacaniya , anabhilpya) et impensables. Le Vkn exprime des vues identiques: La loi est sans marque; donc ceux qui poursuivent les marques des dharma ne cherchent pas la Lo i, mais cherchent les marques... La Loi ne peut tre ni vue, ni entendue, ni pense, ni connue. Proposition E: Tous les dhanna sont gaux (sama) et sans dualit (advaya ). Vides et inexistants, tous les dharma sont gaux. C'est en ce sens qu'il y a no n-dualit (advaya). Le Vkn revient sans cesse sur l'galit et la non-dualit de toutes choses. Proposition F: La vacuit n'est pas une entit. La Prajnaparamita et le Madh yamaka rejettent toute forme, avoue ou dguise, de monisme. Ils disent que les dharm a sont inexistants, mais ils se refusent hypostasier l'inexistence. La nature pr opre (svabhava) des dharma "qui ne naissent pas" (anutpdtmaka) n'est rien que ce s oit (akimcid), simple non-existence (abhavamtra): elle n'est pas. Le Vkn, lui aus si, refuse d'hypostasier la vacuit et ne reconnat l'exprience d'autre fondement que l'ignorance (ibid., pp. 40-50). La trame du Vkn s'appuie sur la prtendue maladie de Vimalakrti: Par un artifice salvifique, Vimalakrti se dclara malade (...) Il se f it cette rflexion sachant que l'Eveill ne resterait pas insensible sa pense: "Je su is malade, souffrant, couch sur un grabat et le Tathgata, saint, parfaitement et p leinement illumin ne se soucie pas de moi, n'a point de compassion et n'envoie pe rsonne pour s'enqurir de ma maladie" (ibid., p. 14l). . Vimalakrti tait clbre pour son radicalisme philosophique, pour lui l'illumination tai t dj acquise par tous les tres, de ce fait le problme du chemin, de la Voie vers l'i llumination ne se posait pas, tait le type mme de la fausse question. Lorsque le B ouddha dcida donc de lui envoyer ses plus minents disciples, afin de s'enqurir de s on tat de sant, tous mirent des rserves en relatant, les uns aprs les autres, les sit uations dans lesquelles Vimalakrti les avait mis en difficult. Ainsi de Sariputra, en passant par Ananda jusqu Maitreya, pour ne citer que les plus connus, tous fir ent les frais de la dialectique intransigeante de Vimalakrti; seul peut-tre Manjus r chappa la dconvenue thorique. Sariputra, Vimalakrti signifia: II ne faut pas s'ab
ber en mditation comme tu le fais. Ceci s'expliquant, prcise E. Lamotte, car Sariput ra tait pass matre en pratisamlayana (sieste, repos, retraite, solitude, l'cart de t ous les bruits du monde). Le pratisamlayana se pratiquait dans la jungle, au pie d d'un arbre, aprs la tourne d'aumnes et le repas de midi. Il se poursuivait durant les heures chaudes de l'aprs-midi, et le moine en sortait seulement vers le soir (ibid., p. 142). Maudgalyayana, Vimalakrti reprocha sa manire de prcher la Loi; ce qui reste d'une grande actualit... La loi (dharma) est sans essence (nihsattva) ca r elle exclut les souillures de l'tre (sattvarajas). Elle est sans substance, car elle exclut les souillures du dsir. Elle est sans principe de vie, car elle excl ut la naissance et la mort. Elle est sans individualit car elle exclut le terme i nitial (prvanta) et le ternie final (aparnta). On sait, fait encore remarquer E. L amotte, le rle de premier plan jou dans le bouddhisme ancien par la prdication et l 'audition de la loi, et Maudgalyayana, en reproduisant fidlement l'enseignement d e son Matre, s'attirait les loges de ce dernier. Toutefois, tel n'est pas l'avis d e Vimalakrti qui reproche au disciple sa faon de prcher aux lacs "comme une magie prc hant d'autres magies". Thoriquement, la loi bouddhique qui repose sur le pudgala et le dharmanairtmya ainsi que sur l'immobilisme absolu ne se prte pas la prdicatio n: il n'y a ni prdicateur, ni auditeur, ni objet prcher. (...) Pour la Prajnaparam ita, le Bodhisattva prche la loi dans le seul but d'extirper toutes les vues de l 'esprit, et non pour inculquer une doctrine de contenu positif (ibid., pp. 146-14 7). Mahaksyapa, Vimalakrti fait remarquer qu'il pratique de faon errone dans sa manir e de mendier la nourriture. C'est pour ne pas manger (apindya) que tu dois mendier ta nourriture. C'est pour dtruire chez les autres la croyance l'objet matriel (an yesm pindagrhaprahnya) que tu dois mendier ta nourriture. C'est en te reprsentant le village comme vide que tu dois entrer dans le village. (...) C'est en ne prenant rien qu'il faut prendre la nourriture. En lui signifiant six principes qui relven t du pur dtachement, voir les couleurs (rupa) comme les voit l'aveugle de naissanc e, etc. Vimalakrti conclut sa liste en disant: Ce qui est sans nature propre (svabh ava) et sans nature trangre (parabhava) ne brille pas, et ce qui ne brille pas ne s'teint pas (na smyat) (ibid., pp. 152-153). . Tous ces entretiens sont, pour Vimalakrti, une occasion de revenir, avec les disc iples les plus minents du Bienheureux, sur le sens rel des paroles du Bouddha, une occasion de dissoudre les fausses interprtations, de dissiper les erreurs de com prhension au sujet de l'Enseignement de l'Eveill. S'adressant Mahaktyayana, Vimalakr ti lui signale qu'il ne comprend pas les instructions du Bouddha concernant le p roblme de Fimpermanence, et que de ce fait ses commentaires sont inexacts. Rvrend Ma haktyayana, dit Vimalakrti, ne parle donc pas de dharma dous d'activit, munis de pro duction et munis de disparition. Pourquoi? (...) Absolument rien n'a t produit, n' est produit et ne sera produit; absolument rien n'a disparu, ne disparat et ne di sparatra: tel est le sens du mot "impermanent" (anitya). Comprendre que les cinq agrgats (skandha) sont absolument vides de nature propre (atyantasvabhavasunya) e t, par consquent, sans naissance (anutpana): tel est le sens du mot "douloureux" (duhkha). Tous les dharma sont absolument inexistants: tel est le sens du mot "v ide" (sunya). Savoir que le moi (tmari) et le nonmoi (antman) ne constituent pas u ne dualit (advaya): tel est le sens du mot "impersonnel" (antmari). Et il raffirme u ne fois de plus: Ce qui est sans nature propre et sans nature trangre ne s'enflamme pas, et ce qui ne s'enflamme pas ne s'teint pas; ce qui ne comporte aucune extin ction est absolument teint (atyantaprasnta): tel est le sens du mot "calme" (snta) ( ibid., pp. 166-167). Au Bouddha futur, Maitreya, le Bodhisattva de la 8e terre, \acala (terre sans recul), Vimalakrti rvle la manire d'tre, qui est sans naissance (an utpanna) et sans destruction (aniruddha), ne nat pas (notpadyat) et n'est pas dtrui te (na dirudhyat). Au moment o tu arriveras la suprme et parfaite illumination, dit Vimalakrti Maitreya, ce moment tous les tres, eux aussi, arriveront cette mme illu mination. Pourquoi? demande Vimalakrti. Parce que cette illumination (bodhi) est dj acquise (anubuddha) par tous les tres. (...) au moment o tu seras dans le Nirvana complet (pariNirvana), ce moment tous les tres seront eux aussi dans le Nirvana complet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul tre qui ne soit dj parinirvan, (... ) tous les tres sont originellement apaiss (adisnta) (ibid., p. 193). .
En ralit pour Vimalakrti personne ni ne s'approche ni ne s'carte de l'Eveil; dans ce s conditions chercher la Loi c'est se situer en dehors de la Loi, c'est s'loigner de la Voie. Vimalakrti l'exprime de la manire suivante Sariputra: La loi est exemp te de souillure et libre de souillure. Donc ceux qui s'attachent n'importe quel dharma, y compris le Nirvana, ne cherchent pas la loi, mais cherchent la souillu re du dsir. (...) La loi est sans prise et sans rejet (yhaniryhavigata). Dans sa note 4 du chap. V, 4, p. 245, E. Lamotte souligne: Vimalakrti rejette le dsir du Nirvan a, non pour des raisons morales, mais pour des raisons mtaphysiques. Samsara et N irvana ne sont que de simples dsignations (nmadheyamtra) et sont tous deux vides et irrels (III, 12); il n'y a pas un seul tre qui ne soit dj parinirvan (III, 51); si 'on est vraiment dli (abaddha), pourquoi chercher encore la libration (moksa)? (ibid ., p. 245). . Clbre pour son silence, Vimalakrti en fait un usage remarquable dans son entretien avec Manjusr; ainsi lorsque ce dernier lui demande d'exposer ce qu'est la doctrin e de la non-dualit (advayadharmamukha) Vimalakrti reste totalement muet: C'est cela l'entre des Bodhisattva dans la non-dualit, rpond Manjusr. En cette matire, les phonm es (aksara), les sons (svara) et les ides (vijnapti) sont sans emploi (asamudcra). E n note 43 (chap. VTII, 33), est prcis: Telle est bien la position du Madhyamaka. Au logicien qui lui demande s'il est vrai que les saints soient sans argument, andr akrti, dans sa Madh. vrtti, p. 5e, 7-8, fait la rponse suivante, qui confirme la j ustesse de l'attitude de Vimalakrti: "Qui donc pourrait dire si les saints ont ou n'ont pas d'arguments? en effet l'absolu, c'est le silence des saints. Comment donc une discussion avec eux sur ce sujet seraitelle possible (et comment pourri ons-nous savoir) s'ils ont ou n'ont pas d'argument en cette matire?" (ibid., pp. 3 17-318). .
L2: [IX. La pense de Lin-tsi] :L2 . Lin-tsi (env. 867) (jap. Rinzai) est sans doute le personnage le plus reprsentati f, au IXe sicle, du Ch'an chinois. Son enseignement nous livrant une pense d'une r are radicalit, et ceci dans une langue souvent brutale, insiste en permanence sur la simplicit de la Voie, l'immdiatet de la ralit, l'aspect naturel de l'Eveil. Peu e nclin la thorisation strile, le moine chinois aime librer ses disciples et ses audi teurs des piges permanents de la raison logique et analytique; ne craignant pas d e choquer, Lin-tsi est clbre pour ses interventions sans mnagement afin de faire ap paratre l'tre vrai des tres et des choses. Sa praxis est une praxis de l'Eveil subi t et instantan, une praxis libratrice. Le tmoignage de son enseignement nous est co nnu grce aux Entretiens que nous conservons de lui. Il ressort de ces textes de n ombreux lments qui, indniablement, font de Lin-tsi un matre vhment, certains diront fu rieux, de la vacuit libratrice. Sa vision de l'homme sans appui est elle seule un so mmet de la dialectique ngative vacuitaire. Un jour, nous disent les Entretiens, o n demanda au matre: Qu'est-ce que la vue juste? Le matre dit: Tchez seulement lorsqu e vous accdez tant la profanit qu la saintet, la souillure qu la puret, aux domai tous les Buddha, au pavillon de Maitreya comme au plan des choses de Vairocana, de voir que toutes choses, ft-ce mme les domaines de Buddha qui se manifestent en tous lieux, sont sujets formation, dure, destruction et vide. Si un Buddha apparat dans le monde, puis fait tourner la grande roue de la Loi, puis entre en Nirvan a, ne voyez la aucune marque d'aller ni de venir; si vous cherchez en lui la nai ssance et la mort, vous ne les trouverez jamais. Et mme si vous accdez au plan des choses qui sont sans naissance et que, parcourant tous les royaumes de Buddha, vous accdiez l'univers de l'Embryon de Fleur, sachez que tout cela porte la marqu e du vide et n'a aucune ralit. Seul existe rellement le religieux sans appui, qui e st la couter la Loi. Il est la mre de tous les Buddha, et en ce sens les Buddha na issent du sans-appui. Pour qui comprend le sans-appui, l'tat de Buddha n'est pas obtenir. Russir voir les choses ainsi, c'est cela la vue juste (Entretiens, 14, tr aduits du chinois et comments par Paul Demiville, Fayard, 1972, pp. 79-80). . Nous avons ici le parfait rsum de la pense de Lin-tsi, une sorte de synthse claire e
t prcise de sa conception profonde, conception qui nourrira l'ensemble de son dis cours et expliquera l'intransigeance de son attitude parfois droutante, toujours sans concession. Son discours est en dconstruction permanente, niant plaisir l'ex istence d'une Voie, pitinant sans aucune gne les saintes vrits du Bouddha. Ne ralisant pas cela, les apprentis s'attachent aux mots et aux phrases; ils se laissent ob struer par les mots de profane et de saint, ce qui fait cran et empche leur il de V oie d'y voir clair. Par exemple, le Dodcuple Enseignement n'est que discours de s urface (...). Tout cela est appui et dpendance. Si vous voulez tre libres de revtir ou d'enlever (comme des habits) les naissances et les morts, le dpart ou l'arrt, sachez vous en tenir l'homme qui est la couter la Loi, cet homme n'a ni forme ni marque, sans racine ni tronc, sans demeure dtermine, tout vif comme le poisson qui saute dans l'eau, lui dont l'activit ne se fixe nulle part au milieu de toutes c es surimpositions. C'est ainsi que plus on cherche, et plus on est loin; toute r echerche va fin contraire. C'est la ce que j'appelle un secret (Entretiens, 14 b, op. cit., pp. 81-82). L'homme sans appui c'est l'homme simple, l'homme sans aff aires, dlivr de l'ide mme de dlivrance, veill de l'illusoire pense de l'Eveil, l'homm l, sans condition. Sachez seulement mettre vos penses au repos, et ne plus cherche r au-dehors; quand les choses viennent vous mirez-les. Faites seulement confianc e celui qui agit en vous actuellement, et vous serez sans affaires (...) (Entreti ens, 15 b, op. cit., p. 89). Pour Lin-tsi, il n'y a rien chercher, rien hors de l 'esprit; rien non plus trouver dans l'esprit, pas de pratique cultiver, pas d'esp rit du Bouddha rechercher. Chercher le Buddha, chercher la Loi: autant d'actes fa bricateurs d'enfer: chercher le Bodhisattva, c'est aussi fabriquer de l'acte. Ou encore lire les Textes, lire l'enseignement fabrication d'actes (Entretiens, 16 a, op. cit., p. 93). Sa fureur critique s'attaque galement l'exercice de Dhyana, qu'il qualifie de wai-tao (voie du dehors), c'est--dire en langage clair de prati que non bouddhique. II y a certains chauves aveugles, dit-il en parlant des moine s au crne tondu, qui aprs avoir mang leur plein de grain, s'assoient en Dhyana pour se livrer des pratiques contemplatives. Ils se saisissent de toute impuret de pe nse pour l'empcher de se produire; ils recherchent la quitude par dgot du bruit. Ce s ont la procds hrtiques. Un matre patriarche l'a dit: Fixer l'esprit pour regarder la quitude, le relever pour mirer l'extrieur, le recueillir pour sa dcantation, le fig er pour entrer en concentration tout cela n'est que fabrication d'actes (Entretie ns, 16 b, op. cit., p. 94). Il rexprime la mme condamnation dans le passage suivan t: Quand je dis qu'il n'y a pas de Loi chercher au-dehors, les apprentis ne me co mprennent pas et en dduisent qu'il faut la chercher au-dedans d'eux-mmes. Alors il s s'assoient, appuys contre un mur, et restent sans bouger, plongs dans la mditatio n, la langue colle au palais; et c'est cela qu'ils prennent pour la mthode des pat riarches et la Loi du Bouddha. Quelle grande erreur! Tenir pour vraie la puret im mobile, c'est reconnatre pour seigneur et matre l'inscience (Entretiens, 27, op. ci t., p. 131). . L'homme vrai, l'homme sans appui de Lin-tsi, n'a pas tre soumis des pratiques ornes lon son expression en rfrence au Vajracchedik-sutra: Le Tathgata parle d'ornement, ma is c'est pour nier l'ornement (Vajracchedik, 10). Rien raliser, aucun but auquel pa rvenir, l'homme comme tel est parfait. Lintsi prconisait de brler les icnes bouddhi ques, les statues de Bouddha qui ornaient les temples, les objets de pit, etc., ma is plus concrtement il aspirait librer ses disciples des les encombrantes, des piges qui entravent la ralit effective. On dit de toutes parts, adeptes, qu'il y a une V oie cultiver, une Loi prouver. Dites-moi donc quelle Loi prouver, quelle Loi culti ver? Qu'est-ce qui vous manque en votre activit actuelle? qu'avez-vous complter pa r la culture? C'est parce qu'ils ne comprennent rien rien que de petits matres puns font confiance ces renards sauvages, ces larves malignes, et leur permettent de parler d'affaires bonnes entortiller autrui (...) Qui cultive la Voie ne la pra tique point (...). C'est pourquoi un ancien dit: C'est l'esprit ordinaire qui es t la Voie (Entretiens, 17, op. cit., p. 99). Cette dernire expression est d'ailleu rs attribuable au propre matre de Lin-tsi, Ma-tsou (709-788), qui tait connu pour son fort temprament et son intransigeance au sujet de la ralisation. S'il est affi rm si souvent que l'esprit du Bouddha c'est l'absence d'esprit, l'explication s'e n trouve dans le fait que, dans l'ide de Ma-tsou, comme celle de Lin-tsi, le Buddh
a n'est autre que notre propre esprit, notre pense condition que cet esprit soit ramen son unit fondamentale, c'est--dire la suppression de toute pense diffrencie. te indiffrenciation vaut aussi bien pour la pense qui se transmet de patriarche pa triarche, de matre disciple, que pour celle qui s'coule en chacun de nous de momen t en moment (ibid., p. 102). Un jour quelqu'un demanda Lin-tsi: Qu'est-ce que l'ab sence de diffrenciation d'esprit esprit? Le matre dit: Ds l'instant mme o vous vous d isposez poser cette question, il y a dj diffrenciation, et la nature des marques pa rticulires sont spares. Ne vous y trompez pas, adeptes: en toutes choses, qu'elles soient de ce monde ou supra-mondaines, il n'y a pas de nature propre, mais pas n on plus de nature de naissance: ce ne sont la que des noms vides, et les lettres qui forment ces noms sont vides elles aussi (Entretiens, 17 b, op. cit., p. 103) . . Ainsi rien ne semble pouvoir arrter la fureur libratrice mais aussi blasphmatoire d e Lin-tsi, comme en tmoigne ce clbre passage: Tout ce que vous rencontrez, au-dehors et (mme) au-dedans de vous-mmes, tuez-le. Si vous rencontrez un Buddha, tuez le B uddha! Si vous rencontrez un patriarche, tuez le patriarche! Si vous rencontrez un Arhat, tuez l'Arhat! Si vous rencontrez vos pre et mre, tuez vos pre et mre! Si v ous rencontrez vos proches, tuez vos proches! C'est la le moyen de vous dlivrer, et d'chapper l'esclavage des choses; c'est la l'vasion, c'est la l'indpendance! (Ent retiens, 20, op. cit., p. 117). De manire vhmente Lin-tsi rpte: Je vous le dis: il n' a pas de Buddha, il n'y a pas de Loi; pas de pratiques cultiver, pas de fruit pr ouver. Que voulez-vous donc tant chercher auprs d'autrui? Aveugles qui vous mette z une tte sur la tte! Qu'est-ce qui vous manque? (Entretiens, 21, op. cit., pp. 119 -120). Rien trouver, rien obtenir, il n'y a pas de plus grand ennemi la Voie que la Voie elle-mme: mon point de vue, pas tant d'histoires! Il surfit d'tre ordinair e: mettre ses vtements, manger son grain, passer le temps sans affaires. Vous ven ez de toutes parts avec l'ide de chercher la dlivrance, la sortie du Triple Monde. Sortir du Triple Monde, imbciles! pour aller o? (Entretiens, 21 b, op. cit., p. 12 1). Plus on cherche l'Eveil plus il s'loigne, plus on travaille l'illumination pl us on s'en carte, en ralit il n'y a ni naissance, ni mort, ni Eveil, ni non-Eveil, i l n'y a point de Buddha qui puisse tre cherch; point de Voie qui puisse tre accompl ie; point de Loi qui puisse tre obtenue. (...) Adeptes, le vrai Buddha est sans f igure; la vraie Voie est sans corps; la vraie Loi est sans marque particulire (.. .) (Entretiens, 31, op. cit., p. 145). Lin-tsi en arrive dire: Ne cherchez plus! S achez que de corps comme d'esprit, vous ne diffrez point du Buddha-patriarche, et aussitt vous serez sans affaires: c'est cela seul qu'on appelle obtenir la Loi (E ntretiens, 32, op. cit., p. 149). . Le fond de la pense de Lin-tsi est que la recherche du Bouddha ou de la Loi est u ne forme de maladie, la maladie du devenir, une maladie qui aveugle la vrit du prse nt auquel il ne manque rien. Dans le monde comme hors du monde, il n'y a ni Buddh a ni Loi qui jamais s'actualisent ni se perdent. S'ils existent, ce n'est que co mme noms et mots, paragraphes et phrases, bons attirer les petits enfants, super impositions fictives pour soigner la maladie, noms et phrases de surface (Entreti ens, 35, p. 155). . Le langage de Lin-tsi, afin de faire entendre la vrit de ce qui est ainsi et auque l il ne manque strictement rien, se fait incroyablement provocant: Adeptes, ne pr enez pas le Buddha pour un aboutissement suprme. Je le vois, moi, comme un trou d e latrine, et les Bodhisattva et les Arhat comme des tres qui lient les hommes av ec cangue ou chanes. (...) Adeptes, il y a certains chauves qui appliquent leur e ffort l'intrieur, s'imaginant chercher en eux-mmes une Loi de sortie du monde. Ils se trompent! Chercher le Buddha, c'est perdre le Buddha; chercher la Voie, c'es t perdre la Voie (...) (Entretiens, 38-39, pp. 161-163). . . ******************************************************* ******************************************************* *******************************************************
. [Fin]
Vous aimerez peut-être aussi
- Chap 3 - ER DefautDocument27 pagesChap 3 - ER DefautKamel Morid100% (1)
- Nagarjuna Traite Du MilieuDocument226 pagesNagarjuna Traite Du Milieukariku123100% (3)
- Nagarjuna Et VacuiteDocument131 pagesNagarjuna Et VacuiteMYSTIC100% (2)
- Manduk Ya UpanishadDocument29 pagesManduk Ya Upanishadmaharomain100% (1)
- Jabala Darshana UpanishadDocument6 pagesJabala Darshana UpanishadNaresh KumarPas encore d'évaluation
- Le Monde Hindou Et Le Sexe by Andre PadouDocument22 pagesLe Monde Hindou Et Le Sexe by Andre Padouhari hara100% (1)
- ShambhalaDocument11 pagesShambhalaFranco Alexandre DeFariaPas encore d'évaluation
- LA NUTRITION MINERALE DES VEGETAUX LECON - Modif (1) .PpsDocument41 pagesLA NUTRITION MINERALE DES VEGETAUX LECON - Modif (1) .PpsMourad Ben HendaPas encore d'évaluation
- Pfe Actuel Laye PDFDocument82 pagesPfe Actuel Laye PDFMeïssa Mbnb BeyePas encore d'évaluation
- Dialogue Entre Krishnamurti & Venkatesananda À Saanen en Juillet 1969Document44 pagesDialogue Entre Krishnamurti & Venkatesananda À Saanen en Juillet 1969Joop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Les Stances Sur La Reconnaissance Du Seigneur Avec Leur Glose Composées Par Utpaladeva by Dubois DaDocument271 pagesLes Stances Sur La Reconnaissance Du Seigneur Avec Leur Glose Composées Par Utpaladeva by Dubois DaFélix Boggio Éwanjé-ÉpéePas encore d'évaluation
- Étoiles de Sagesse: Méditation analytique, chants de réalisation et prières d’aspirationD'EverandÉtoiles de Sagesse: Méditation analytique, chants de réalisation et prières d’aspirationPas encore d'évaluation
- Trésor du Dharma: Un cours de méditation sur le bouddhisme tibétainD'EverandTrésor du Dharma: Un cours de méditation sur le bouddhisme tibétainPas encore d'évaluation
- Theosophie - Une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l'homme (traduit)D'EverandTheosophie - Une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l'homme (traduit)Pas encore d'évaluation
- Japa FR Sivananda PDFDocument115 pagesJapa FR Sivananda PDFliverdarkPas encore d'évaluation
- Coeur de La Yogini Mantrasamketa Yogini Hrdaya 2 Amrtanandanatha ViracitaDocument42 pagesCoeur de La Yogini Mantrasamketa Yogini Hrdaya 2 Amrtanandanatha ViracitaBen Williams100% (1)
- René Guénon - Études Sur L'hindouismeDocument238 pagesRené Guénon - Études Sur L'hindouismeAlmuric59Pas encore d'évaluation
- SpandakarikaDocument5 pagesSpandakarikaJulien FarachePas encore d'évaluation
- KabirDocument3 pagesKabirJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Science de La Force VitaleDocument129 pagesScience de La Force VitalefronegPas encore d'évaluation
- Advaya Taraka Upanishad (Document)Document5 pagesAdvaya Taraka Upanishad (Document)giovannagarritanoPas encore d'évaluation
- Kali Santarana Upanishad (Document)Document3 pagesKali Santarana Upanishad (Document)giovannagarritano100% (1)
- Kalagni Rudra Upanishad PDFDocument4 pagesKalagni Rudra Upanishad PDFJuliano CostaPas encore d'évaluation
- Le Yogi D El'Himalaya SaraswatiDocument300 pagesLe Yogi D El'Himalaya SaraswatiAppoloniusPas encore d'évaluation
- Isha Upanishad (Document)Document3 pagesIsha Upanishad (Document)giovannagarritanoPas encore d'évaluation
- Swami Vivekananda - L'HindouismeDocument28 pagesSwami Vivekananda - L'Hindouisme1001nuitsPas encore d'évaluation
- SP FrenchDocument410 pagesSP FrenchVirendra Agarwal100% (1)
- Le Nouveau Guide Du Pays Des Dakinis PDFDocument15 pagesLe Nouveau Guide Du Pays Des Dakinis PDFnatacha DeerPas encore d'évaluation
- Robert Linssen - L'éveil SuprêmeDocument157 pagesRobert Linssen - L'éveil SuprêmeJohn JONES100% (2)
- Atharvashikha Upanishad PDFDocument5 pagesAtharvashikha Upanishad PDFJuliano Costa100% (1)
- Padoux - Corps Yogin TantriqueDocument34 pagesPadoux - Corps Yogin Tantriquealastier0% (1)
- Le Catechisme Hindou SivaiteDocument272 pagesLe Catechisme Hindou SivaiteDidier Coutanceau100% (1)
- Jacques Dupuis SJ, Éveil À Soi - Éveil À Dieu Dans L'expérience Spirituelle D'henri Le Saux NRT 111-6 (1989) p.866-879Document13 pagesJacques Dupuis SJ, Éveil À Soi - Éveil À Dieu Dans L'expérience Spirituelle D'henri Le Saux NRT 111-6 (1989) p.866-879aminickPas encore d'évaluation
- Avyakta Upanishad (Document)Document4 pagesAvyakta Upanishad (Document)giovannagarritanoPas encore d'évaluation
- Shankara - Sur Âtmâ-BodhaDocument5 pagesShankara - Sur Âtmâ-Bodhazindabad7Pas encore d'évaluation
- Jung Bouddha OccidentalDocument6 pagesJung Bouddha OccidentalAudrey Vescovi-mouginPas encore d'évaluation
- Dohakosa de SarahaDocument3 pagesDohakosa de SarahanavatmanPas encore d'évaluation
- Le Soutra de La Terre Pure D' Amitabha - Version CourteDocument13 pagesLe Soutra de La Terre Pure D' Amitabha - Version CourtehomePas encore d'évaluation
- MahaVakya Upanishad0001Document4 pagesMahaVakya Upanishad0001Juliano CostaPas encore d'évaluation
- L'enseignement de Ramana Maharshi (Extraits)Document65 pagesL'enseignement de Ramana Maharshi (Extraits)Willy ComoPas encore d'évaluation
- # Le Plus Beau Fleuron PDFDocument187 pages# Le Plus Beau Fleuron PDFErik RivesPas encore d'évaluation
- La Vidya GitaDocument4 pagesLa Vidya GitanicolasPas encore d'évaluation
- Krishnamurti Et Les Fondements de La Mystique Tibétain, Par Robert LinssenDocument3 pagesKrishnamurti Et Les Fondements de La Mystique Tibétain, Par Robert LinssenJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Kshurika Upanishad0002Document5 pagesKshurika Upanishad0002Juliano CostaPas encore d'évaluation
- Alexandra David-Néel OeuvreDocument2 pagesAlexandra David-Néel Oeuvrelamphilpierre100% (1)
- Shiva.F9Document20 pagesShiva.F9Santé Kine Yoga-thérapiePas encore d'évaluation
- Brahmajāla SuttaDocument46 pagesBrahmajāla SuttajovanovskiklikPas encore d'évaluation
- Hayagriva Upanishad (Document)Document4 pagesHayagriva Upanishad (Document)giovannagarritanoPas encore d'évaluation
- Aphorismes de ShivaDocument3 pagesAphorismes de ShivaTiffany Brooks100% (1)
- Silburn Lilian La Bhakti 166pDocument164 pagesSilburn Lilian La Bhakti 166pSandrine SeyllerPas encore d'évaluation
- PADOUX La Conception Tantrique Du Corps HumainDocument6 pagesPADOUX La Conception Tantrique Du Corps HumainMarco PassavantiPas encore d'évaluation
- Bibliographie Du SHIVAÏSME DU CACHEMIREDocument18 pagesBibliographie Du SHIVAÏSME DU CACHEMIREChristian SeneclauzePas encore d'évaluation
- Le Seigneur de L AmourDocument293 pagesLe Seigneur de L AmourJivatmaDasPas encore d'évaluation
- Articles Yoga Pierre FeugaDocument45 pagesArticles Yoga Pierre FeugaerutircePas encore d'évaluation
- Les Textes Fondateurs Du Yoga (Texte de La Présentation)Document16 pagesLes Textes Fondateurs Du Yoga (Texte de La Présentation)oaxaca17Pas encore d'évaluation
- Kena Upanishad (Document)Document5 pagesKena Upanishad (Document)giovannagarritanoPas encore d'évaluation
- The Ashtavaka Gita PDFDocument17 pagesThe Ashtavaka Gita PDFDeroy GarryPas encore d'évaluation
- IsHa Upanishad Satyananda & A Avalon Def 221117Document59 pagesIsHa Upanishad Satyananda & A Avalon Def 221117kalaratri0100% (1)
- Pfe 8Document49 pagesPfe 8Oumayma ElkanouniPas encore d'évaluation
- COURS PCT 3eme APCDocument32 pagesCOURS PCT 3eme APCFamille BangoupPas encore d'évaluation
- 2 Hydrosysteme PDFDocument3 pages2 Hydrosysteme PDFFouad DimanePas encore d'évaluation
- Energie HydrauliqueDocument9 pagesEnergie Hydrauliquemohamedmessahel754Pas encore d'évaluation
- Memoire - 27 09 2020Document89 pagesMemoire - 27 09 2020Mounia AminePas encore d'évaluation
- Chapitre II Caractéristiques Des Matériaux Et Les Méthodes D PDFDocument19 pagesChapitre II Caractéristiques Des Matériaux Et Les Méthodes D PDFMoutiePas encore d'évaluation
- Thèse: Université François - Rabelais de ToursDocument203 pagesThèse: Université François - Rabelais de ToursWilson RobertoPas encore d'évaluation
- Traitement Des Condensats Série Aquamat: Pour Débits D'air Jusqu'à 100 M /minDocument5 pagesTraitement Des Condensats Série Aquamat: Pour Débits D'air Jusqu'à 100 M /minsav.bellignatPas encore d'évaluation
- Dreux Gorisse Method'sDocument15 pagesDreux Gorisse Method'sAmir AmiroPas encore d'évaluation
- Oct 14 Soyez Polis ContDocument6 pagesOct 14 Soyez Polis Contapi-177128821Pas encore d'évaluation
- T 14.2 HybridationDocument4 pagesT 14.2 HybridationMaeva SenePas encore d'évaluation
- Questionnaire de Révision Ecologie G-II SV5Document3 pagesQuestionnaire de Révision Ecologie G-II SV5Ashraaf MknsiPas encore d'évaluation
- L'Origine Des Éléments ChimiquesDocument1 pageL'Origine Des Éléments ChimiquesJustine CelantePas encore d'évaluation
- Livret Enseignant - L EAU ELLE A TOUT BON - Cycle 3Document32 pagesLivret Enseignant - L EAU ELLE A TOUT BON - Cycle 3maya ben mahmoudPas encore d'évaluation
- PDFDocument342 pagesPDFAbu OymaPas encore d'évaluation
- Tableau D'avènement Et Structure D'atomeDocument99 pagesTableau D'avènement Et Structure D'atomenounimed10Pas encore d'évaluation
- Projet Amenagement Mise en Valeur Parc Jean Drapeau PDFDocument34 pagesProjet Amenagement Mise en Valeur Parc Jean Drapeau PDFRadio-CanadaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document15 pagesChapitre 1ferdinandPas encore d'évaluation
- Cours Equilibre Dun Corps Sous Laction de 2 Forces 3Document10 pagesCours Equilibre Dun Corps Sous Laction de 2 Forces 3anoirPas encore d'évaluation
- bn3050Document50 pagesbn3050myskyshepherdPas encore d'évaluation
- Chapitre III - l1bcgs - 2023Document11 pagesChapitre III - l1bcgs - 2023Mouhamed SallPas encore d'évaluation
- Chimie A Partir de Zero 486043 PDFDocument34 pagesChimie A Partir de Zero 486043 PDFTheo Wan100% (1)
- Hatimi 2002Document10 pagesHatimi 2002ⵎⵕⵟⴰⴼⴰ ⵎⵓⵙⵓⵜPas encore d'évaluation
- تالللللفففغغهع٦paleogeggiqueDocument32 pagesتالللللفففغغهع٦paleogeggiqueSa LePas encore d'évaluation
- Ancien Noyau Sidi Okba 01Document2 pagesAncien Noyau Sidi Okba 01WALID SOUFIPas encore d'évaluation
- Soutien 5Document4 pagesSoutien 5Achak NawalPas encore d'évaluation
- C2 Opérations FondamentalesDocument28 pagesC2 Opérations FondamentalesayaPas encore d'évaluation