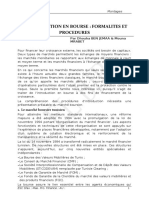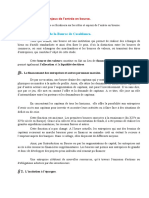Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Mondialisation Et Interdependances
Mondialisation Et Interdependances
Transféré par
Amos30Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Mondialisation Et Interdependances
Mondialisation Et Interdependances
Transféré par
Amos30Droits d'auteur :
Formats disponibles
MONDIALISATION ET INTERDEPENDANCES
Dfinition : La mondialisation est un processus multisculaire dinternationalisation des changes quils soient conomiques, financiers, politiques, culturels ou dinformations - qui engendre une mise en relation des diffrentes composantes territoriales du monde, dacteurs diffrents - Etats, FMN, institutions internationales, ONG - densembles gographiques divers - villes et rgions puissantes - qui sorganisent en rseau ou en archipel interdpendant la surface du globe tout en sarticulant en un systme trs hirarchis reposant sur des logiques dintgration ou de marginalisation diffrents niveaux spatial, social et diffrentes chelles. Un processus historique, ancien, progressif, en voie dacclration. Les Dbuts et la premire phase : On pourrait certes remonter lAntiquit, au monde grec ou lempire romain ou encore au Moyen-ge (Occident chrtien ou monde musulman) mais les aires restent lpoque rgionales ou continentales En fait le processus sentame vritablement avec les grandes dcouvertes de la fin du XVme et surtout au XVIme sicle avec lessor du capitalisme marchand. Seconde Phase : la rvolution industrielle et des transports entre 1840 et 1914, avec lessor du colonialisme au XIXme Troisime phase partir de 1950 : on passe progressivement dune conomie internationale reposant sur les changes entre tats-nations une conomie transnationale privilgiant les investissements directs ltranger et la mobilit croissante des activits productives mais aussi des hommes dans les annes 80 A partir des annes 90, lacclration est brutale Unification du march mondial au bnfice du libralisme suite leffondrement du communisme et la disparition de lconomie planifie et autarcique qui lui est associe : transition de lURSS et des PECO vers lconomie de march et conversion de la Chine une conomie plus ouverte, plus concurrentielle, de plus en plus capitaliste. Rvolution de la communication grce aux NTIC (Nouvelles technologies de linformation et de la communication) avec transmission instantane et universelle des informations par le tlphone, la tlvision et le satellite, lInternet surtout Extension au domaine culturel, y compris politique ou idologique, du fait de la facilit nouvelle de communication des sons et des images : la mondialisation prend alors une dimension Trois axes dtude envisager
Les flux et les rseaux de la mondialisation Les acteurs de la mondialisation Les territoires de la mondialisation
[Mondialisation Interdpendance]
Page 2/32
I. LES FLUX ET LES RESEAUX DE LA MONDIALISATION
A. LES FLUX HUMAINS : LES MIGRATIONS INTERNATIONALES.
Prs de 175 millions de personnes rsident actuellement dans un pays diffrent de celui o elles sont nes. Le nombre de migrants a plus que doubl entre 1975 et 2002. La plupart dentre eux vivant en Europe (56 millions), en Asie (50 millions) et en Amrique du Nord (41 millions). Carte :
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/migrations/migrat97.gif
1) Les types de flux migratoires internationaux sont multiples et complexes a) Les migrations conomiques
Environ 120 millions de migrants conomiques 1. Cause : le diffrentiel Nord / Sud de croissance dmographique et de richesse conomique
Pays dvelopps : accroissement dmographique naturel lent, populations vieillissantes,
parfois pnurie de main d'oeuvre.
Pays pauvres ou trs pauvres : accroissement naturel encore rapide, population jeune ou
trs jeune importante face un chmage ou un sous-emploi chroniques, information accrue des populations pauvres sur les modes de vie dans les pays du Nord et part du rve qui incitent migrer. 2. Effets 2.1. Pour le pays dorigine : Perte de forces vives de jeunes, Mais en mme temps des effets positifs moindre chmage sur place apport de capitaux considrables maintenant leur conomie sous perfusion (transferts vers la famille reste sur place) Les transferts de salaires contribuent de manire substantielle aux recettes en devises et sont un complment majeur au produit intrieur brut dun certain nombre de pays. Ainsi, en 2000, ces transferts ont fait saccrotre de plus de 10 % le PIB dEl Salvador, de lrythre, de la Jamaque, de la Jordanie, du Nicaragua et du Ymen, entre autres. 2.2. Pour le pays daccueil Main duvre bon march, surtout si elle est clandestine Pb dintgration de ces populations soit du fait de leur particularisme, de leur sentiment identitaire ou du dcalage socioculturel trop brutal, soit du fait des ractions hostiles des autochtones 3. Cas particulier : la migration des lites Phnomne N/N ou S/N 3.1. Limportance du phnomne 1.7 million dtudiants originaires de PED ne retournent pas dans leur pays dorigine, une fois leurs tudes termines 38 % des indiens installs aux USA ont un master ou un doctorat
[Mondialisation Interdpendance] 1/3 des africains diplms du suprieurs vivent hors dAfrique 25 % des Iraniens diplms vivent dans un pays de lOCDE
Page 3/32
3.2. Perte pour le pays dorigine Dficit de main duvre qualifie Cot de formation initiale non rcupr 3.3. Avantage pour pays daccueil Economie pour la formation initiale des lites, Main duvre moins exigeante en gnral et moins bien rmunre que la population autochtone travail gal
b) Les migrations dorigine politique : les rfugis.
Cartes : Le flot montant des rfugis dans le monde
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/refugiesmdv49
En Afrique des millions de rfugis
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/afriquerefugiesmdv51
Les rfugis en 1995 : pays dorigine, pays dasile
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartographie_html/4_page4dossiers/immigr_europe/03asile_c.html
la fin 2000, on dnombrait 16 millions de rfugis dans le monde, victimes des guerres
civiles ou internationales, des gnocides ou de la rpression politique. LAsie et lAfrique comptent le plus grand nombre de rfugis (9 millions et 4 millions respectivement) ; les Afghans constituent le groupe de rfugis le plus important au monde avec 4 millions de personnes et en Afrique, le Soudan vit un drame depuis une vingtaine dannes. 3 millions de rfugis se trouvent dans des pays dvelopps (Europe comprise suite au conflit yougoslave) Rfugis et demandeurs d'asile s'enfuient gnralement vers les pays voisins, esprant revenir chez eux un jour de telle sorte que les camps de rfugis fleurissent gnralement le long des frontires (Cambodgiens en Thalande par exemple, Tutsis du Rwanda au Congo) Populations dmunies souvent mal acceptes par les tats d'accueil. De plus en plus de rticence des pays daccueil, les pays riches souponnant une immigration conomique, les pays pauvres ne pouvant assumer cette contrainte supplmentaire.
c) Les flux touristiques internationaux
Carte
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/transport_communication/tourisme99.jpg
1. Lre du tourisme de masse 1.1. Croissance des effectifs concerns 69 millions darrives internationales en 1960 697 millions en 2000 715 millions en 2002 Mais seulement 8% de la population mondiale est concerne 1.2. Les espaces concerns : LEurope et lAmrique du N 80 % des mouvements lessentiel de la clientle du tourisme internationale et plus des 2/3 des destinations aussi
[Mondialisation Interdpendance] 10 premires destinations en 2001
Page 4/32
France Espagne EUA Italie Chine RU Russie Mexique Canada Autriche 2. Une activit de premier plan
% march mondial en 2001 11 7.1 6.6 5.6 4.8 3.3 2.9 2.9 2.8 2.6
Millions de touristes internationaux en 2000 75.6 48.2 50.9 41.2 31.2 25.3 21.2 20.6 20.4 18
Attraction des grandes mtropoles mondiales, des littoraux tropicaux et subtropicaux (les
et archipels notamment), des stations de ski, des sites naturels aux paysages splendides, des sites historiques et hauts lieux culturels, des grands parcs dattraction. Un poids conomique devenu considrable 500 milliards de $/an environ des millions demplois, directs ou induits Concentration et internationalisation : Groupe allemand TUI , chane franaise dhtels Accor Trs profitable aux rgions mettrices et rceptrices du Nord, (EUA, France, Espagne, Italie) mais un impact devenu vital pour de nombreux pays du Sud (Maroc, Tunisie, Maurice)
3. Mais des limites aussi 3.1. Une activit fragile dont la croissance sest ralentie depuis 2001 Effet de linscurit engendre par le terrorisme et les conflits : attentat du 11 septembre 2001, guerre en Irak, attentats sur lieux touristiques (Egypte, Bali, Tunisie) Epidmie de SRAS en Asie Situation conomique globale moins porteuse Baisse frquentation des zones risques 3.2. Des effets pervers Dfiguration de sites naturels Pollution Acculturation ventuelle
2) Les espaces concerns par les flux migratoires. a) Les pays du Sud fournissent 75 % des migrants.
Quelques grands foyers de dpart LAsie est le plus important lieu de dpart, notamment l'Asie du Sud et du Sud-est (Inde, Pakistan, Afghanistan, Indonsie, Philippines...), plus que l'Extrme-Orient (Core du Sud, Chine essentiellement) et le Moyen ou Proche-Orient (Turquie, Kurdistan) L'Afrique occupe le second rang : Afrique noire subsaharienne, Afrique du Nord.
[Mondialisation Interdpendance]
Page 5/32
L'Amrique centrale (Mexique) et du Sud (Colombie), ainsi que les Carabes sont aussi
des rgions d'migration. Des mouvements internationaux d'origine conomique apparaissent galement en Europe, principalement dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), depuis la libert de circulation retrouve en 1989 (Pologne, Roumanie, Hongrie...).
b) Les pays du Nord attirent la majorit des migrants :
Cartes : Les entres de migrants permanents
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/migrations/migrants9099.jpg http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/migrations/migrants90_2000.gif
1. Les pays riches traditionnellement attractifs
Outre les tats-Unis, premier ple mondial, et l'Europe occidentale, l'Australie, le Canada,
l'Afrique du Sud et Isral sont des pays attractifs. Ce sont les grandes mtropoles qui attirent le plus.
2. Les nouveaux pays riches .
Les pays ptroliers du golfe Persique, qui ont besoin de main-d'oeuvre pour l'exploitation
ptrolire et les chantiers d'amnagement du territoire Les nouveaux pays industrialiss (NPI) essentiellement asiatiques (Thalande, Malaisie...) qui ont accueilli des milliers de travailleurs voisins (Birmans, Philippins, Indonsiens).
3. Lattraction des pays du Sud est plus faible,
Le facteur de proximit est plus important : migrations plus courtes Cause conomique (par exemple du Mali vers la Cte-d'Ivoire) ou cause lie
linscurit : rfugis
3) Les acteurs du mouvement migratoire a) Une dmarche personnelle, familiale, souvent communautaire Une dcision individuelle :
Emigrer est une dcision lourde de consquences et difficile prendre : rupture avec
son pays, sa famille, ses amis et ses coutumes, cots et risques considrables, surtout si le passage est clandestin. Ce sont surtout les hommes de 20 35 ans qui sont concerns, mais la part des deux sexes tend dsormais squilibrer. Le rle de la famille La famille influence souvent fortement, moralement mais aussi financirement, dans l'espoir des complments de revenu qui pourront tre expdis de l'tranger par le membre migr. Une migration russie entrane des courants de dpart et des filires se mettent en place. Il est plus facile de migrer quand des membres de votre propre communaut peuvent vous accueillir larrive Parfois, la filire migratoire est cre directement par l'employeur tranger qui se charge lui-mme du recrutement.
b) Les diasporas, communauts transnationales
[Mondialisation Interdpendance]
Page 6/32
Une diaspora est lensemble des diffrentes communauts dun groupe ethnique ou
national dispers hors de son espace originel avec une relation reste forte par rapport au pays dorigine : mme n dans le pays daccueil, on reste concern par l'volution du pays d'origine. Les membres d'une diaspora ont l'origine migr la suite d'une catastrophe (gnocide armnien par les Turcs au dbut du XXme sicle, par exemple) et seule une minorit des habitants est alors reste sur place. Un comportement spcifique : Un rseau d'entraide souple et efficace, avec des relations troites entre communauts issues du mme espace et dissmines travers le monde : diaspora juive, palestinienne, libanaise, armnienne, chinoise, philippine, etc Des solidarits familiales fortes, notamment avec la partie de famille reste dans le pays d'origine. (exemple : la diaspora chinoise soit 30 millions de personnes sur tous les continents- a investi massivement en Chine depuis l'ouverture conomique des annes 1980 sans pour autant revenir y vivre systmatiquement.)
c) Les tats et leur politique migratoire
a) Des politiques avant tout nationales
Les mesures sont relvent dabord de lautorit des tats concernes et elles sont donc
varies Deux lignes directrices toutefois : La matrise et de la rgulation des flux L'intgration des migrants associe des cooprations internationales.
b) Les tendances des politiques migratoires 2.1. Dveloppement de la coopration internationale sur les questions lies aux migrations Exemple : lUnion Europenne Coopration intra europenne ( cf. Espace Shengen) Coopration entre lUE et dix pays asiatiques en 2002 avec mise en place dune position commune sur l'immigration. Il s'agit la fois de freiner l'migration (pays de dpart) et de lutter contre l'immigration clandestine (pays d'accueil). 2.2. Des politiques globalement plus restrictives Durcissement de la lutte contre l'immigration irrgulire (clandestine) et l'emploi illgal Renforcement des contrles aux frontires Restriction du droit dasile pour dcourager les demandes non fondes. Aides au retour Cependant rgularisation priodique et partielle des clandestins sans papiers 2.3. Les tats d'accueil s'efforcent de mieux intgrer les immigrs rguliers. A lintrieur, les politiques d'intgration passent Par l'acquisition de la langue du pays d'arrive, Par la lutte contre les discriminations (lois contre le racisme et la xnophobie), Par la naturalisation pour faciliter l'insertion. A lextrieur, des cooprations avec les pays d'origine se dveloppent. Objectif : vrifier et filtrer les flux par la slection (visas, recrutement de travailleurs, particulirement d'employs qualifis et hautement qualifis, changes de chercheurs, d'enseignants et d'tudiants)
[Mondialisation Interdpendance]
Page 7/32
L'aide au dveloppement est aussi, long terme, un moyen de ralentir la pression migratoire.
B. LES FLUX ECONOMIQUES : LES ECHANGES DE MARCHANDISES
Le dveloppement rapide du commerce et le progrs technique en matire de transports et de communication se sont mutuellement stimuls. Les cots de transport ont considrablement diminu. La facilit et le volume des changes se sont accrus, les flux se sont mondialiss. Le monde est en quelque sorte rtrci et plus fluide
1) La rvolution des transports et des communications a) Des progrs techniques spectaculaires et dcisifs depuis 1945 Augmentation de la rapidit des moyens de transports : avions raction, TGV,
autoroutes Augmentation de la capacit de transport : phnomne trs net dans le transport maritime avec les gants des mers, ptroliers ou minraliers, futur avion Airbus A380. Automatisation croissante de la manutention notamment dans le transport maritime Utilisation des conteneurs et de porte-conteneurs, pratique du transroulage (roll on roll off) Spcialisation des navires et des installations portuaires : ptroliers, minraliers, chimiquiers, bananiers, porte-conteneurs Une vritable rvolution des transports !
b) Spcialisation, complmentarit et concurrence des moyens de transport
1. Le transport maritime
Le moins cher de tous,
Il assure 2/3 des changes internationaux en valeur et les en tonnage. Importance de premier plan pour les pondreux (hydrocarbures, minerais) mais croissante pour les produits manufacturs) Usage important et problmatique aussi des pavillons de complaisance (Libria, Panama, Bahamas, Malte) Avantages rglementaires, fiscaux et sociaux Gros problmes sociaux et environnementaux (navires poubelles et pollution)
2. Le transport arien
Rapide mais coteux Liaisons lointaines Essor considrable et baisse des cots Transport de voyageurs surtout, marchandises lgres et chres aussi
3. Les conduites
Transport des fluides : oloducs, gazoducs, carboducs Continentales mais aussi sous-marines
4. Lautomobile
rgne sur les courtes distances et les milieux urbains
5. Le chemin de fer
[Mondialisation Interdpendance]
Page 8/32
En concurrence avec la route pour le transport des voyageurs sur de courtes distances En concurrence avec lavion sur les distances moyennes Trop rarement associ la route (pratique du ferroutage encore trop peu dvelopp)
c) Limpact spatial de la rvolution des transports
1. Valorisation et dveloppement des lieux de convergence des moyens de transport
Position particulirement stratgique des dtroits qui contrles les grandes routes
maritimes (Malacca, Ormuz, Gibraltar...) et des canaux internationaux (Suez, Panama) Attraction particulire : Des zones industrialo-portuaires Littoralisation des activits, Valorisation des zones portuaires, points de rupture de charge, et lieux privilgis dindustrialisation Des grandes villes, Des zones dactivits lies aux aroports, Des nuds autoroutiers, Des plates-formes logistiques (centres spcialiss dans la logistique c'est--dire le transport, le stockage, le tri, le conditionnement et la distribution de marchandises) Des plates-formes multimodales Phnomne li la gnralisation de lutilisation des conteneurs Association en un seul site du transport maritime, fluvial, ferroviaire, routier, arien Nuds de communication de premier plan lchelle internationale (port de Rotterdam, aroport de Dallas)
Usage croissant des dlocalisation industrielles vers des filiales ltranger ou des
2. Division internationale du processus productif PME sous-traitantes pour tout ou partie de la production Gestion distance et en rseau de la fabrication et de la distribution du produit (cf. automobile, informatique, tlphonie)
2) Les flux de marchandises : une croissance rapide a) Forte croissance du commerce international en volume depuis 1945 Dj au XIXme sicle les changes croissaient plus rapidement que la production
mondiale mais le phnomne sest acclr Entre 1950 et 2002 la valeur des exportations de biens et de services est passe de 9% du PIB mondial 28 % Ouverture et interdpendance plus grande des conomies Nombre croissant de pays intgrs dans la division internationale du travail
b) Evolution de la nature des flux
1. Les changes de matires premires
Un enjeu stratgique du fait de la nature mme des produits (nergie, produits agro-
alimentaires) Augmentation en tonnage mais diminution en valeur relative Poids tout particulier du march du ptrole Carte Principaux flux ptroliers en 2001
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/energie/petrole2001flux.jpg
[Mondialisation Interdpendance]
Page 9/32
Large dissociation des zones de production et des zones de consommation do des flux importants Les grandes zones de production : Le moyen Orient, en particulier lArabie Saoudite, la Russie, la mer du Nord, lAfrique du Nord, lAfrique noire du Golfe de Guine, lIndonsie, le Vnzuela et le Mexique, le Canada et les EUA Les grandes zones de consommation : les trois ples de la triade et lAsie du SE en pleine croissance (notamment la Chine) 2. Le commerce des produits manufacturs
Accroissement rapide 75% des exportations mondiales Machines et matriel de transport : 40 % des exportations mondiales
3. Les changes de services
Progression plus rapide que celle des changes de marchandises 21 % des transactions mondiales Transports, tourisme, services financiers, technologiques et culturels
c) De fortes disparits lchelle mondiale
Carte Les changes de marchandises en 2001
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/economie/commerce_mondial_2001.jpg
Activits domines par les pays de lOCDE qui assurent 69 % du commerce mondial et
par les trois grands ples majeurs que sont lAsie pacifique (de lEst et du SE), lEurope occidentale et les EUA La plupart des pays pauvres dAfrique et dAsie du Sud sont en marge des grands flux dchanges
C. LES FLUX INFORMELS : CAPITAUX ET INFORMATION 1) Les flux de capitaux, en pleine expansion a)Les grandes places financires au cur des flux de capitaux
Carte Capitalisation boursire des 20 premires places mondiales en 1997
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/finances/bourses97.jpg
1. Les bourses, centres dimpulsion de la finance interntionale
Lieux privilgis de lchange des capitaux, marchs financiers La capitalisation boursire est la somme de la valeur de la totalit des actions cotes sur
une place financire ; elle illustre le poids historique et lattractivit dun lieu. Interconnection des grandes places financires et notamment des grandes Bourses, 24 heures sur 24
2. Les trois ples de la triade dominent largement
Les EUA, avec la bourse de Wall Street, les indices Dow Jones et Nasdaq sont la premire
palce mondiale et donnent le ton en matire de cotations. En Europe occidentale, une forte capitalisation mais clate entre plusieurs places financires ( Londres, Paris, Francfort, Amsterdam, Zurich)
[Mondialisation Interdpendance]
Page 10/32
Le Japon : bourse importante mais en stagnation du fait dune dcennie de stagnation
conomique dans ce pays
b) La forte croissance des IDE1
1500 2000 milliards de $ sont changs au quotidien, IDE et capitaux spculatifs confondus 1. Une vritable explosion depuis les annes 1970, 2.1. Mise en place dun vritable systme financier transnational, La drglementation a engendr une plus grande libert de circulation des capitaux et les flux financiers se sont affranchis des frontires (fin du contrle des changes par exemple) Banques et fonds de pension exploitent les possibilits qui leur sont ainsi offertes. 40% de la capitalisation boursire sur Paris est sous le contrle des fonds de pension amricains Mise en place dune vritable logique financire et spculative dans les entreprises (recherche prioritaire du profit maximum pour donner satisfaction aux actionnaires), au dtriment des logiques industrielles (matrise dun mtier et dune filire) 2.2. Multiplication des dlocalisations, Dans lindustrie certes Dans les services de plus en plus (Inde : El dorado des socits de services informatiques avec prs de 80 % de ce march) 2. Une localisation lie la recherche davantages financiers
Moindre cot dexploitation des matires premires Moindre cot de la main duvre Pntration dun march haut niveau de vie avec contournement du
protectionnisme (EUA) ou dun march prometteur (Chine)
Meilleure rentabilit dun placement financier
En fait un seul moteur : la course la comptitivit 3. Les flux 3.1. Les pays dorigine dont des pays du Nord ou des NPI Une importance variable selon les pays, parfois considrable IDE en % du PIB EUA 8 Chine 18 RU 21 Espagne 25 Belgique 31 Malaisie 47 Singapour 73 30 tats contrlent 90 % des IDE dans le monde 3.2 Les rgions daccueil des IDE Les capitaux circulent essentiellement entre pays riches : les investisseurs vitent les zones pauvres, peu dveloppes, mal quipes mais aussi les zones instables et risque lev.
1
Investissements Directs lEtranger
[Mondialisation Interdpendance]
Page 11/32
Moins dun quart des IDE part destination des pays du Sud et 70 % dentre eux se
rpartissent sur une dizaine de pays seulement (dont 25 % pour la seule Chine)
c) Les flux financiers parallles et illicites
Cartes Production et trafic de drogues illicites : 2000-2001
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/drogue/drogues2001.jpg
Les paradis fiscaux en 2003
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/finances/04paradis_fiscaux2003.jpg
Le crime organis sest lui aussi mondialis, utilisant lui aussi les technologies modernes, et des filires complexes et nombreuses 1. Des activits diversifies
Capitaux qui cherchent chapper limpt pour se rfugier dans les paradis fiscaux Capitaux rsultant des trafics mafieux en tous genres :
Trafic des produits de contrefaon et de contrebande, Trafic de drogue Trafic darmes Trafic de voitures voles Trafic de main-duvre avec des passeurs peu scrupuleux Racket, Prostitution (y compris denfants mineurs) Flux financiers issus de la corruption, des pots de vin.
2. Des bases nationales clairement identifies
Les acteurs : Cosa Nostra sicilienne, Camorra napolitaine, mafias tchtchne, albanaise,
russe, japonaise, triades chinoises, cartels colombiens de la drogue Des rgions qui vivent au grand jour de cette conomie illgale : cocane des Andes, cannabis du Rif marocain, culture du pavot en Afghanistan ou dans la plaine de la Beeka syrienne, Triangle dOr en Asie (Birmanie, Thalande, Laos), prostitution enfantine de Manille ou de Bangkok De vritables plaques tournantes : Turquie, Albanie aussi pour les destinations europennes des trafics Un poids conomique difficile valuer par dfinition, mais norme les estimations varient entre 500 et 1000 milliards de $ ! (3 fois la valeur de la production mondiale de ptrole)
Remarque : la mobilit excessive des capitaux sur fond de spculation peut aussi savrer fort dangereuse (cf. crise financire asiatique de 1997-1998 ou faillite spectaculaire de lentreprise amricaine Enron en 2001
2) Les flux dinformation
Cartes Usagers Internet dans le monde : nombre pour 10000 habitants en 2001
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/culture_communication/usagers_intermet_pourcent01.jpg
Usagers internent dans le monde en milliers en 2001
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/culture_communication/usagers_internet_zoom01.jpg
a) Une importance capitale
1. Linformation, une activit stratgique.
Un outil de travail essentiel, aussi important que la main duvre ou les capitaux,
[Mondialisation Interdpendance] Caractre stratgique de la matrise de linformation au plan gopolitique,
Page 12/32
goconomique et culturel
Un impact majeur sur les socits et lopinion.
Une vritable rvolution en cours
Acclration de la vitesse de propagation de linformation Rvaluation des notions de proximit et de distance
La filire information-medias intgre :
La production de linformation : collecte, tri, traitement (rle capital des agences de
presse : Associated Press, Reuters, France Presse
La circulation de linformation : stockage, diffusion La vente de linformation : texte, son, vidos, donnes
2. Linformation et les nouvelles technologies. 2.1. La nouvelle conomie : Notion dveloppe la fin des annes 90 et en 2000, moins la mode depuis le krach des valeurs internet en 2001 Organisation autour de technologies de pointe multiples qui concourent cette explosion : satellites de communications, cbles trs haut dbit, chanes de tlvision, tlphonie mobile, Internet, mise en rseau des banques de donnes, 2.2. La Net conomie : plus proprement parler lie Internet Alliance informatique et tlcommunications Disponibilit instantane de linformation Extension rapide du rseau : 25 millions dinternautes en 1990 et 450 millions en 2003 2.3. Lconomie toute entire est affecte par les nouvelles technologies Gains de productivit Sous-traitance de certaines activits Gestion des stocks en flux tendus
b) Une avance trs nette des pays du Nord Une circulation plantaire mais un contrle troit par un oligopole de quelques grandes
entreprises de la Triade : Microsoft, AOL-Time Warner, Sony, Philips, Murdoch) Les EUA ont une capacit impressionnante produire des informations pour le reste du monde et disposent dune avance incomparable La fracture numrique Une fracture spatiale : Nord largement privilgi et Sud largement exclu surtout en Asie centrale et en Afrique Une fracture sociale : pauvres exclus.
[Mondialisation Interdpendance]
Page 13/32
II. LES ACTEURS DE LA MONDIALISATION
A. LES FIRMES TRANSNATIONALES2.
Cartes : Les 100 premires FMN et leur secteur dactivit en 2002
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/economie/01multinationales2002.jpg
Nombre de FMN par pays et chiffre daffaires en 2001
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/economie/multinationales_diagr2001.jpg
Les 100 premires FMN en 2004 : rpartition par lieux et par pays
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/cartemois/n24/carte.htm
1) Un rle fondamental et une influence croissante a) Quelques dfinitions : Firmes nationales : le march de lentreprise reste dans le cadre national Firmes internationales : une entreprise implante uniquement dans un pays ralise un
pourcentage important de son chiffre daffaires lexportation Firmes multinationales : une grande socit ralise une partie de sa production et de son chiffre daffaires dans des implantations ltranger. Firmes transnationales : la grande socit ralise la majeure partie de sa production et de son chiffre daffaires dans des implantations ltranger mais conserve le centre de dcision et la recherche-dveloppement dans le pays dorigine
b) Le poids des transnationales
1. Leur importance conomique :
Un nombre croissant :
nombre de socits mres x 10 nombre de filiales x 30 entre 1970 et 2002 63000 FTN contrlent 82000 filiales ltranger et 75 millions de salaris dans le monde Ventes, chiffres daffaires et profits en augmentation importante : le chiffre daffaires de bien des FTN est suprieur au PIB de nombreux tats !!! Elles contribuent aux 2/3 du commerce international
2. Elles sont lorigine dune nouvelle division internationale du travail
Recherche les meilleures conditions de conception et dlaboration des produits Mise en concurrence des tats et des rgions du monde
3. Les 100 premires :
20 % du PIB mondial 1/3 production mondiale 1/3 des IDE 6 millions demplois 57 amricaines, 28 europennes, 7 japonaises
FTN = Socits juridiquement, conomiquement et techniquement complexes dont le chiffre daffaires est gal ou suprieur 500 millions de $ et qui ralisent plus de 25 % de leurs changes avec des filiales localises dans 6 pays diffrents au minimum
[Mondialisation Interdpendance]
Page 14/32
2) Lorigine des FTN : La triade pour lessentiel Un ancrage national fort
Les 100 premires : 51 % de leurs ventes ltranger, mais 60 % des effectifs dans le
pays dorigine
Centres dcisionnels, Recherche-dveloppement, productions haute technologie et
haute valeur ajoute restent dans le pays dorigine
3) Limpact des FTN dans les pays daccueil
1. Avantages
Augmentation de lemploi Transferts de technologie Augmentation des exportations du pays
2. Inconvnients
Pollution ventuellement : les pays riches exportent volontiers leurs industries polluantes
vers les pays pauvres Une certaine fragilit du fait de la dpendance de la rgion ou du pays lgard de la stratgie dune socit qui peut du jour au lendemain dcider de se dlocaliser ailleurs.
B. LES ETATS 1) La marge dautonomie des tats sest rduite La fonction dencadrement et de rgulation sest largement substitue aux fonctions de
dcision qui se manifestaient prcdemment par le protectionnisme, les nationalisations, la planification, la dfinition de rgles particulires Intgration croissante dans des associations rgionales avec transferts de souverainet correspondants (cf. UE)
2) Les tats restent cependant des acteurs encore importants Dfense des intrts nationaux autant que faire se peut dans les ngociations
commerciales ou au sein des organismes internationaux supranationaux (cf. la France et sa dfense de lexception culturelle franaise dans les ngociations commerciales internationales) Cration dun environnement plus ou moins attractif pour les investissements trangers et la cration demplois qui en rsulte Politique sociale et ducative diffrencie Soutien plus ou moins actif aux entreprises (avantages fiscaux et subventions par exemple) Amlioration des quipements collectifs Les outils de lintervention Politique montaire (stabilit montaire, niveau des taux dintrt) Politique budgtaire, Lgislation conomique et sociale, Politiques damnagement du territoire variables et plus ou moins attractives pour les investissements trangers Une influence variable selon les tats, fonction de leur puissance : les tats puissants sont dominants, les tats pauvres et faibles domins.
[Mondialisation Interdpendance]
Page 15/32
3) Les grandes tendances Dveloppement du libre-change Politiques conomiques dominante librale Drglementation C. INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Face des problmes considrables qui se posent dsormais lchelle mondiale comme la pauvret, la faim, les grandes pidmies, leffet de serre et le rchauffement climatique par exemple, des rponses mondiales sont les seules qui puissent tre efficaces. La coopration et la solidarit internationales apparaissent donc de plus en plus ncessaires dans notre monde : problmes internationaux, solutions internationales. Les institutions et organisations internationales sont donc particulirement ncessaires face aux dfis plantaires contemporains, mme si lon peut bien entendu sinterroger sur leur efficacit.
1) Les institutions internationales drives de lONU
Objectif commun : permettre une meilleure gouvernance mondiale, jouer un rle de rgulateur de la mondialisation FMI, GIRD et AID, OMC, mais aussi FAO, UNESCO, OIT, CNUCED (Confrence des Nations Unies sur le Commerce et le Dveloppement), PNUD (Programme des NU pour le Dveloppement)
a) Le FMI, Fonds montaire international Fond officiellement le 27 dcembre 1945, l'issue de la Confrence de Bretton Woods
(1-22 juillet 1944). Sige : Washington Rle : assurer la stabilit du systme financier international en matrisant les crises aussitt que possible pour viter leur propagation crer les conditions d'une croissance conomique durable au bnfice de l'ensemble de ses membres. Pouvoirs Possibilit dimposer des dcisions telles que lapplication des rgles de la concurrence, le contrle de lendettement et de linflation, la mise en place de politiques structurelles, La ngociation reste cependant donc un principe fondamental et absolu au FMI, la prise de dcision devant se faire lunanimit. Le FMI nimpose que ce que les tats consentent !
b) La Banque mondiale
L'appellation Banque mondiale dsigne l'ensemble BIRD et AID. 1. BIRD : La Banque internationale pour la reconstruction et le dveloppement
Cre en juillet 1944 lors de la confrence montaire et financire de Bretton Woods. 184 pays membres Mission initiale : la reconstruction et dveloppement de lEurope Mission actuelle : financer des projets de dveloppement dans les PED pour rduire la pauvret (soit en consentant des prts soit en fournissant des garanties aux investisseurs privs)
[Mondialisation Interdpendance]
Page 16/32
Objectif : rduire le foss qui existe entre pays riches et pauvres en utilisant les
ressources des premiers pour assurer la croissance des seconds.
Moyen : appuyer les efforts dploys par les gouvernements des pays en
dveloppement pour construire des coles et des centres de sant, procurer eau et lectricit, combattre les maladies et protger lenvironnement. Action Lun des principaux bailleurs daide au dveloppement La BIRD a consenti des prts dun montant total de 11,5 milliards de dollars pour appuyer 96 projets dans 40 pays (exercice 2002) Plus de la moiti de ses prts rservs aux pays dits mergents, privilgiant l'Asie et l'Amrique latine sur l'Afrique.
2. AID : Association internationale de dveloppement,
Cre en 1960 Rle : permettre aux pays les plus pauvres, (revenu par habitant infrieur au seuil de 925
dollars/habitant en 1999) qui n'ont accs aucun march de capitaux, de bnficier de financements intressants sous forme de prts taux quasi-nul sur une dure de 35 40 ans. L'Aid a fourni 8,1 milliards de dollars de financement au titre de 133 projets dans 62 pays faible revenu (exercice 2002) 40% des ressources de l'Aid bnficient aujourd'hui l'Afrique subsaharienne.
c) LOMC, Organisation mondiale du commerce
Cration 1995 (succde au GATT) Sige : Genve 148 tats-membres (y compris la Chine, rcente adhrente) Fonctions : Lutter contre le protectionnisme et favoriser le libre-change, Eviter toutes formes de concurrence dloyale entre les Etats ou les Entreprises, Veiller aux accords passs entre les pays membres Juger des diffrents entre tats avec sa propre cour de justice Tous les secteurs sont concerns : agro-alimentaire, industrie, services, culture Remarques : La mise en concurrence de pays niveau de comptitivit trs diffrents peut savrer fcheuse pour les pays les plus faibles et constituer un blocage au dveloppement plus quune aide La mise en concurrence dans certaines activits peut tre contestable (transports, culture par exemple)
d) les autres organismes internationaux
1. LOCDE, Organisation de coopration et de dveloppement conomiques
L'OCDE regroupe 30 pays membres, tous attachs la dmocratie et l'conomie de
march. En relation avec plus de 70 autres pays, des ONG et la socit civile. Des publications et des statistiques rputes qui font autorit avec des tudes qui couvrent tout le champ conomique et social
2. Le G8
Confrence au sommet des sept pays les plus riches du monde, avec en outre la Russie Rle de concertation et de discussion plus que de dcision
[Mondialisation Interdpendance]
Page 17/32
3. Des forums de discussion plus ou moins informels :
ex : Le Forum conomique mondial dit Forum de Davos .
Il sagit dune runion informelle de chefs d'entreprises et de dcideurs politiques
dans un rassemblement qui tient la fois de la foire commerciale puisquon y tisse des liens daffaires, du sminaire de rflexion et des vacances d'hiver pour managers stresss... Davos est une station de sports dhivers suisse haut de gamme ) Un symbole de la globalisation conomique et de ses effets pervers donnant lieu une contestation de plus en plus ouverte... Il est vrai que Davos est une station de sports dhiver suisse particulirement huppe et haut de gamme et que le forum a vraiment lallure dun club de riches !
2) Les grandes organisations rgionales
Carte Principales organisations internationales rgionales en 2001
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/organisations_internationales/organisations_monde2001.jpg
a) Des structures intermdiaires Constitution de nombreuses organisations commerciales rgionales Solution intermdiaire entre la fragmentation du monde en 200 tats et la mondialisation Les plus actives correspondent celles qui se sont constitues autour des centres
dimpulsion mondiale Le poids du commerce intrargional est trs important : 70 % des changes des pays de lUE se font entre les pays membres Des accords interrgionaux existent par ailleurs qui favorisent les changes mondiaux : cest aussi le cas de lUE qui entretient ainsi plusieurs partenariats.
b) Les principales organisations se rpartissent en quatre types
1. Association avec intgration conomique, politique et sociale : L UE : Carte Cest le modle dunion rgionale le plus pouss March unique et monnaie unique Larges transferts de souverainet des Etats vers la communaut 25 membres dsormais 2. Les unions douanires (libre change + tarif extrieur commun) MERCOSUR Carte 1 Carte 2 3. Les zones de libre-change ALENA Carte Rduction de barrires douanires 4. Les zones de coopration conomique ASEAN APEC Carte 1 Carte 1 Carte 2 Carte 2
3) Les ONG, organisations non gouvernementales a) Qui sont-elles ?
[Mondialisation Interdpendance]
Page 18/32
Associations prives indpendantes de lautorit des gouvernements, reconnues par une
organisation internationale o elles disposent dun statut consultatif, dont les activits sont bnvoles et les objectifs dchelle internationale. Prs de 2000 dans le monde, de plus en plus nombreuses Elles vivent des dons des personnes prives mais surtout des aides et subventions publiques, nationales ou internationales Les 11 premires ONG mondiales sont par ordre dcroissant de budget : La Croix-Rouge, CARE-International, Oxfam, Save the children, Greenpeace, Secours catholique Caritas, Mdecins sans frontires, World Wild Fund, Mdecins du monde, Handicap international, Amnesty international
b) Leur rle
1. Alerter lopinion internationale sur les drames qui affectent le monde et intervenir sur place
Catastrophes humanitaires, sanitaires ou alimentaires, situation des plus dmunis, des
victimes des crises et des dsastres en tous genres) Environnement et pollution, Droits de lhomme, 2. Pratiquer laide et la solidarit transnationales
Agir au plus prs pour aider rsoudre des problmes sur place, avec lavantage de
la souplesse , Pallier les carences des Etats et chercher influencer leur action ; 3. Un cas particulier : laltermondialisme 3.1. Antimondialisme lorigine , altermondialisme dsormais : Lantimondialisme est une notion insense : comment peut-on tre contre un processus ? Les antimondialistes sen sont dailleurs rendus compte, qui ont chang de nom Laltermondialisme pose dailleurs un problme assez semblable : Quelle alternative existe-til par rapport la mondialisation ? Rponse : aucune alternative cohrente ce jour. On peut certes critiquer, on peut aussi amnager, corriger, retoucher, rectifier, mais en ltat actuel du monde la mise en place dun autre systme semble pour le moins utopique. 3.2. Une nbuleuse contestatrice trs htrogne Des mouvements contestataires (et non pas humanitaires) anticapitalistes et trs lis lultra-gauche Exemple : le mouvement ATTAC, Via campesina (association paysanne) Expression au travers de forums comme le forum social mondial de Bombay en 2004 avec 100 000 participants de 156 pays, ou des manifestations plus ou moins violentes hostiles celles de lOMC ou du G8 Un point commun constitu de diverses phobies avec toujours la mme constante : une critique vhmente de la mondialisation no-librale et la volont dexercer un contrle citoyen sur les phnomnes mondialiss La phobie de la dictature des marchs financiers La phobie de la drgulation gnralise du no-libralisme La phobie du dmantlement des services publics La phobie de la concurrence La phobie de l'OMC La phobie du FMI La phobie des organismes gntiquement modifis (OGM)
[Mondialisation Interdpendance]
Page 19/32
La phobie (justifie, mais mal cible) de la destruction de l'environnement La phobie de la domination mondiale de la culture amricaine La phobie de la politique internationale des Etats-Unis Quelques revendications Pour linstauration de taxes globales pour financer le dveloppement (taxe Tobin) Contre les paradis fiscaux et la criminalit financire Pour lextension des services publics et des droits sociaux
c) Leurs limites : Les ONG ne reprsentent que leurs adhrents, essentiellement issus des pays du Nord, et
vhiculent ainsi elles aussi dans le monde une idologie venue du Nord. Les ONG ne sont pas exemptes de critiques : opacit de la gestion, bureaucratie, niveau lev des rmunrations, drive financire dans le Charity-Business
[Mondialisation Interdpendance]
Page 20/32
III. LES TERRITOIRES DE LA MONDIALISATION : LORGANISATION GEOGRAPHIQUE DU MONDE.
La mondialisation est un processus de mise en relation des diffrents ensembles gographiques qui constituent le monde et cette mise en relation exploite toute une srie de diffrentiels lchelle mondiale dans le but de les valoriser. Certains territoires sont plus aptes que dautres russir dans ce cadre trs changeant en sachant faire fructifier un certain nombre de leurs avantages comparatifs et en profiter, mais dautres territoires peuvent tre pnaliss, dautres encore oublis. La mondialisation sappuie sur les ingalits de la plante, mais elle a aussi tendance les accentuer en favorisant les espaces les plus aptes, les plus dmunis tant marginaliss. Cette logique spatiale prexistait la mondialisation et ce fut dj le cas lors de la rvolution industrielle ; dsormais, cest lchelle qui a chang.
A LES CENTRES DIMPULSION DE LECONOMIE MONDIALE : UNE ECONOMIE DARCHIPEL 1) La Triade a) Trois ples majeurs
EUA, Europe Occidentale et Japon 1. Une domination incontestable :
14 % seulement des habitants de la plante 70 % de la production mondiale 90 % des oprations financires sy dcident 80 % des nouvelles connaissances sy laborent 80 % des changes sy effectuent Au total, les de la richesse mondiale Une domination organise selon un modle centre/priphrie lchelle internationale
b) Des priphries intgres gnralement en proximit
Ce sont des rgions participent la dynamique de la mondialisation
Canada, centre et Nord Mexique, autour des EUA Les PECO pour lEurope occidentale, et la faade mridionale et orientale de la
Mditerrane
La faade pacifique de lExtrme Orient asiatique avec les NPIA et la Chine ctire
autour du Japon
LAustralie et la Nouvelle-Zlande Les pays exportateurs de ptrole du Golfe Persique
c) Les pays du Nord
1. Les caractres spcifiques du centre
La richesse et le pouvoir
[Mondialisation Interdpendance] Cette puissance est un hritage ancien (XVI
me
Page 21/32
sicle puis rle capital des rvolutions
industrielles)
Ils organisent donc gnralement la mondialisation leur profit
Un trs haut niveau de dveloppement
A la puissance conomique sont associes de bonnes conditions de vie de la
population
IDH lev
10 pays dEurope du Nord-ouest dans les 15 premiers du classement Les trois premiers sont des pays nordiques : Norvge, Islande, Sude RNB/ hbt lev Les tmoins habituels du dveloppement Taux de mortalit infantile trs faible Esprance de vie trs leve Fcondit et natalit faibles Des problmes spcifiques aussi Le vieillissement de la population La suralimentation et ses effets nocifs sur la sant La capacit produire et imposer des modles au reste du monde : organisation du travail et des entreprises, urbanisme et architecture, consommation et quipement des mnages, sports, culture et loisirs en gnral Des valeurs dmocratiques et librales : le libralisme politique est associ au libralisme conomique
2. Une situation htrogne cependant 2.1. A lchelle internationale Lensemble est nettement domin par les EUA Ils sont la seule puissance globale avec le premier rang dans tous les domaines : conomique, financier, technique, culturel, diplomatique et militaire). 291 millions dhabitants 32% du RNB mondial LEurope et le Japon sont la fois des partenaires et des concurrents mais ils nont pas les moyens de projeter leur vision politique du monde ou dimposer un ordre plantaire global Le Japon : 128 millions dhabitants et 13.5 % du RNB mondial Forte puissance conomique mais relative exigut du march intrieur, difficults conomiques contemporaines profondes (10 ans de rcession), civilisation peu porte luniversalisme, rle politique et militaire trs secondaire LEurope : 455 millions dhabitants et 27 % du RNB mondial De remarquables ressources humaines, culturelles, commerciales, financires et techniques Le seul rival possible des EUA mais une puissance politique virtuelle, clate, trop faible. Il existe en fait des Nords : Ainsi la plupart des pays de lex-bloc communiste, Russie comprise, connaissent une situation conomique et sociale trs difficile ; la Roumanie, la Bulgarie ou lAlbanie pourraient facilement sapparenter des Suds
[Mondialisation Interdpendance]
Page 22/32
Certains pays du Sud ont intgr le Nord du fait de leur remarquable dveloppement conomique et social (Taiwan, Core du Sud, Singapour) 2.2. A lchelle rgionale ou locale Il existe aussi des priphries dans le centre comme il existe des centres dans les priphries Banlieues et quartiers dfavoriss Rgions en difficult : rgions de montagne, rgions enclaves, vieilles rgions industrielles en crise et en cours de reconversion
2) Les grandes mtropoles mondiales
La ville a toujours t le lieu privilgi du progrs, de quelque nature quil soit, technique, conomique, social, artistique, culturel, et le moteur du dveloppement
a) Des ples urbains de premier plan
1. Quest ce quune mtropole ?
Une mtropole est une grande aire urbaine centre sur une ville mre dote de
fonctions de commandement et de fonctions trs diversifies, exerant un rayonnement international voire mondial, (on parle aussi parfois de ville mondiale ou de ville globale . On y trouve une impressionnante concentration de pouvoir dcisionnel. Pouvoir politique Siges sociaux des grandes socits Services bancaires et financiers (bourses) Technopoles et grands ples de productions diversifies Importance du tertiaire suprieur : conseil, laboratoires, ingnierie Centres Universitaires et RD : des ples dinnovation Fonction culturelle En parallle, la fonction industrielle manufacturire dcline : dconcentration, dcentralisation puis dlocalisation. La mtropole sinscrit dans un rseau hirarchis La mtropole contrle et organise sa zone dinfluence : elle dispose gnralement du fait de sa puissance dune totale autonomie politique, conomique et financire au sein de lespace dans lequel elle sinscrit et quelle contrle par lintermdiaire dun rseau urbain hirarchis de villes de gabarit infrieur Elle est organise en rseau avec ses semblables en une sorte darchipel mtropolitain. La mtropolisation est donc un processus de concentration du peuplement et des activits dans les grandes villes qui exercent les fonctions de commandement et de service lchelle dune rgion, dun pays ou du monde. Autres dfinitions : Une mgapole est une ville gante de plusieurs millions dhabitants Une mgalopole est un espace urbanis polynuclaire organis autour de plusieurs mtropoles et grandes villes (Mgalopolis amricaine, japonaise, rhnane)
2. Laboutissement dune volution en plusieurs tapes 2.1. Une phase de concentration : la ville attire les activits et les hommes Densification de la ville centre Formation de lagglomration par extension des banlieues 2.2. Une phase de dconcentration : les espaces centraux perdent des habitants et la priurbanisation se dveloppe
[Mondialisation Interdpendance] Formation de couronnes priurbaines sous influence Dconcentration vers des priphries plus lointaines
Page 23/32
3. Des espaces urbaniss complexes
Les mtropoles urbaines juxtaposent richesse et pauvret, puissance et exclusion en leur
propre sein.
On y retrouve dimportantes ingalits de dveloppement. Ces contrastes et cette socit deux vitesses existent au Nord (banlieues dfavorises,
quartiers dgrads) mais les dsquilibres sont particulirement frappants dans les mtropoles du sud (bidonvilles)
b) Larchipel mtropolitain mondial (AMM) et la polarisation de lespace mondial
Carte Larchipel mgalopolitain mondial : les rseaux mondiaux
http://marienaudon.free.fr/cartereseaux.htm
1. 20 25 grandes villes au total, organises en rseau La notion darchipel : des les unies par des relations prfrentielles et fortes, les priphries forment par contraste un ocan qui entoure cet archipel mtropolitain A la tte de lArchipel mondial : Des villes mondiales de premier ordre : New York, Londres, Paris, Tokyo, Les autres mtropoles majeures du Nord comme les grandes villes de la mgalopolis amricaine, Chicago, Los Angeles, Milan, Francfort, Madrid, Barcelone, Zurich, Bruxelles, Moscou, Osaka, Hong-Kong, Singapour, Soul, Sidney Les autres grandes mtropoles relais au Sud : Sao Paulo, Mexico, Johannesburg, Bombay, Bangkok, Shanghai, Djakarta 2. Le centre dcisionnel de ces mtropoles est le CBD, Central Business District,
En plein centre de la ville, reconnaissable ses gratte-ciel, son urbanisme vertical Il peut cependant se fractionner avec des dveloppements priphriques sur les
nuds de communication du fait de la saturation et de la congestion du centre.
3) Les interfaces : espaces frontaliers et littoraux a) Les espaces frontaliers et rgions transfrontalires Certains espaces frontaliers sont favoriss par la complmentarit des activits (Ex :
frontire entre les EUA et le Mexique avec les maquiladoras)
Apparition de plus en plus de rgions transfrontalires avec des dynamiques spcifiques b) Les espaces littoraux sont trs attractifs Concentration des hommes sur les littoraux lie la diversit des activits et louverture
sur la mer qui facilite les communications Tendance actuelle trs nette la littoralisation des activits conomiques du fait de lampleur prise par le grand commerce maritime. Succs des faades dont lhinterland, c'est--dire larrire pays continental, est riche, diversifi, aisment accessible Localisation frquente de zones franches, atout fiscal qui sajoute au bas cot de la main duvre et la situation douverture. Cf. Zones Economiques Spciales (Z.E.S.) en Chine, ou Ile Maurice
B. LES SUDS EN MARGE DU DEVELOPPEMENT
[Mondialisation Interdpendance]
Page 24/32
La notion de dveloppement : Le dveloppement est un accroissement des richesses li la croissance conomique accompagn dun progrs des conditions sociales du plus grand nombre. Le dveloppement associe donc progrs conomique et progrs social, mais la croissance conomique nest pas forcment synonyme de dveloppement. La mesure du dveloppement : lIDH, Indice de Dveloppement Humain L'IDH combine l'esprance de vie, le niveau de connaissances mesur par le taux d'alphabtisation des adultes et le Taux brut de scolarisation (tous niveaux : primaire, secondaire et suprieur), le P.I.B. rel par habitant ajust en parit de pouvoir d'achat (PPA). Cest un indice composite calcul par le P.N.U.D., dont la valeur s'chelonne entre 0 et 1. LISDH, Indicateur sexospcifque de daveloppement humain, intgre les disparits de dveloppement entre hommes et femmes Lampleur du problme : Prs de 3 milliards de personnes vivent avec moins de deux par jour !
1) Les caractres communs du Sud : le drame du sous-dveloppement.
Un mme phnomne qui se caractrise par la pauvret et la misre du plus grand nombre. Cartes La pauvret dans le monde
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/pauvreteindimdv51
IDH 2001 par moyennes
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/developpement_economique/idh_2001.jpg
IDH 2001 par rangs
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/developpement_economique/02idhrang2001.jpg
LIDH est rvlateur (donnes 2001) La Norvge toujours en tte avec un indice de 0,944 La moyenne mondiale est de 0,722 Dans les 45 derniers, 36 pays dAfrique subsaharienne dont les 26 derniers La Sierra Leone au dernier rang : 0,275
a) Des expressions diverses, plus ou moins satisfaisantes
1. La terminologie ancienne
Tiers-monde
Notion dfinie par Alfred Sauvy dans les annes 50 Analogie avec la notion de Tiers-tat, les deux groupes privilgis tant les pays
industriels capitalistes et les pays industriels socialistes Notion dpasse du fait de la disparition du socialisme, de laccentuation des contrastes entre tats et de la diversification des situations PSD : Pays Sous-Dvelopps Notion associe celle de sous-dveloppement, qui met laccent sur les insuffisances et les retards du dveloppement, en tant sans doute la plus proche de la ralit des problmes Notion statique cependant, plutt pessimiste aussi, quil faut prendre soin de ne pas gnraliser aux civilisations bien entendu PVD : Pays en Voie de Dveloppement Notion plus dynamique et plus optimiste aussi, qui sest un temps substitue la prcdente
[Mondialisation Interdpendance]
Page 25/32
Notion sans doute trop vague qui ne tient pas compte de la diversit des situations ni
du fait que lcart entre les pus riches et les plus pauvres se creuse.
On utilise aujourdhui plutt la notion de PED, pays En Dveloppement
NPI : Nouveaux pays Industriels
Notion rcente qui prend en compte la russite remarquable dun certain nombre de
pays dont le dveloppement rel sest appuy sur lindustrialisation et qui prouvent dailleurs que le sous-dveloppement nest pas une fatalit Les NPIA : Nouveaux pays Industriels Asiatiques Premire gnration : les quatre Dragons Seconde gnration : les bbs-tigres Peut-on considrer le Brsil, le Mexique comme des NPI ? Un incontestable dveloppement industriel certes mais encore de larges phnomnes de sousdveloppement Mal-dveloppement Notion intressante de Ren Dumont, mais qui na gure eu le succs quelle mritait, peut-tre parce quelle sous-entend un jugement de valeur Se caractrise par la croissance conomique et labsence de dveloppement social parallle
2. La terminologie actuelle
Nord et Sud,
Notion neutre, aseptise, ne cherchant pas dfinir, juste classer Notion trouble et source de confusion puisque lAustralie et la Nouvelle-Zlande,
pays riches, sont dans lhmisphre sud, et que lInde ou Hati sont dans lhmisphre nord De toute manire, lessentiel des terres merges est dans lhmisphre nord Du fait de la diversification des situations au Nord comme au Sud, on utilise plutt maintenant le pluriel, c'est--dire les notions de Nords et Suds Les classifications en cours : PMA, pays intermdiaires, pays mergents, [cf ci-dessous dans le 2)] ne rendent pas ncessairement mieux compte de la ralit
b) Des conditions sociodmographiques tragiques
1. Les indicateurs cls : mortalit infantile, esprance de vie, analphabtisme
Une mortalit infantile trop leve (ONU 2003)
Cambodge 96 pour 1000 Pakistan 83 pour 1000 Yemen 79 Nigeria 110 Mauritanie 120 Congo 129 Sierra Leone 165 Une esprance de vie plus rduite, (F/H, en 2001) Inde 64/62 Bolivie 64/61 Ethiopie 53/51 Cte dIvoire 47/44 avec des ravages et des consquences trs lourdes du SIDA en Afrique : au Mozambique, lesprance de vie est dsormais infrieure 40 ans Le flau de lanalphabtisme
2. Une transition dmographique souvent inacheve
[Mondialisation Interdpendance]
Page 26/32
2.1. Une dmographie de phase 2 de transition dmographique Haute fcondit Forte natalit Faible mortalit gnrale Fort accroissement naturel 2.2. Des situations variables cependant, et des progrs et l Situation particulirement critique de lAfrique noire 2.3 Une population trs jeune Plus de la moiti de moins de 20 ans et plus des deux tiers de la population de moins de 30 ans Un atout par certains aspects, un handicap de lautre, do parfois des politiques antinatalistes (plus ou moins russies) Une ampleur considrable de linvestissement dmographique ncessaire (sant, ducation, formation) 3. Les drames du quotidien
La pauvret voire la misre :
Niveau de vie faible RNB/ habt 2001 Congo (RD) 80 Ethiopie 100 Mozambique 210 Laos 300 Vietnam 410 Chine 890 Prou 1980 Brsil 3070 Maurice 3830 Insuffisance de laccs aux soins en matire de sant, et ravages des pidmies Insuffisance de la matrise de leau insuffisante (traitement, distribution, pnurie, pollution) Absence ou insuffisance des quipements collectifs en ville, habitat de fortune avec bidonvilles et taudis, insalubrit, promiscuit Misre sociale et psychologique : Lexprience de linjustice, labsence de protection de toute nature La violence : prostitution, drogue, criminalit, bandes denfants, enrlement denfants dans des milices ou de pseudo armes Misre psychologique : lexprience quotidienne de la dpendance, de la honte, de lhumiliation, Sous-alimentation et malnutrition 840 millions de victimes, 14 % de la population mondiale, 33 % des Africains, 16 % des Asiatiques Zimbabwe particulirement touch ( population sous-alimente soit 6 7 millions sur 12,3 du fait de la politique raciste dexpropriation des fermiers blancs) et toute la corne de lAfrique aussi Sous emploi et chmage Assujettissement et alination des femmes Fragmentation des familles Travail des enfants, abandons ou ventes denfants
c) Retards et dpendance conomique
[Mondialisation Interdpendance]
Page 27/32
1. Les faits 1.1. Les retards et les faiblesses conomiques Dans lagriculture Insuffisante productivit, archasme de certaines techniques (agriculture itinrante sur brlis par exemple) Insuffisance des cultures vivrires au profit des cultures commerciales dexportation, et concurrence aussi des produits de lagriculture du Nord subventionne (amricaine ou europenne) Structures agraires contrastes et souvent sclrosantes (latifundia/microfundia dAmrique latine) Dans le secteur industrie, la dualit Un secteur traditionnel de PME souvent peu comptitives Un secteur moderne souvent li aux investissements du Nord qui fournit technologie et capitaux, le Sud fournissant la main doeuvre Dans le secteur tertiaire Plthorique et productivit insuffisante Activits informelles dominantes (activits de survie) 1.4. Domination et dpendances Echange ingal entre le nord et le sud : la dtrioration des termes de lchange PED souvent spcialiss dans lexportation de produits bruts (agricoles, miniers, nergtiques) aux cours fluctuants et peu valorisants, sauf exception (cf. le ptrole en ce moment) Pays dvelopps et NPI plutt spcialiss dans lexportation de produits manufacturs et de services haute valeur ajoute March ingal : absence dorganisation et dispersion spatiale des producteurs de produits bruts (sauf OPEP) face la concentration de la dcision dans le Nord. Endettement auprs des organismes internationaux : Problme de la dette du tiers-monde et de sa rsorption Les intrts de la dette : un gigantesque transfert financier du Sud vers le Nord 2. Les Causes 2.1. Les causes externes : La colonisation ? Elle a pu introduire des blocages dans le dveloppement en dstabilisant les civilisations concernes par le contact brutal de la civilisation occidentale, de ses valeurs et de ses mcanismes (proprit prive, conomie montaire) en rservant lindustrialisation la mtropole et en spcialisation la colonie dans lexportation de produits bruts (cf. : cas de lInde par exemple dont lindustrie textile na pas pu spanouir) Elle ne saurait tre tenue pour responsable car elle a aussi apport sur place des lments positifs Progrs en matire de sant publique et diminution de la mortalit Progrs en matire dducation Progrs en matire dinfrastructures de transport facilitant louverture de lconomie Transferts de technologie (cf. hydrocarbures et ptrochimie) La mondialisation ? Elle a certes contribu accentuer certaines ingalits et laiss en marge de nombreux pays sont rests, mais faut-il incriminer pour autant la rendre responsable de tous les maux de la plante ?
[Mondialisation Interdpendance]
Page 28/32
Globalement, la croissance a t tire par la mondialisation, du fait de la croissance des changes et des investissements Dans les PED, en un demi-sicle, les progrs sont certains :
Lesprance de vie moyenne sest globalement accrue de 20 ans passant de 41 64 ans La mortalit infantile a t rduite de moiti La part des populations nayant pas accs leau potable a t rduite de 65 20 % La production et la consommation alimentaires ont progress plus que la dmographie Depuis 40 ans, le revenu mondial par habitant a augment de 250 % hors tats riches
2.2. Les causes internes : Remarque : Pas de causes dordre naturel (conditions climatiques, gologiques, pdologiques ou autres, car ce sont toujours les hommes qui sont responsables et qui parviennent avec plus ou moins de succs matriser leur milieu ces conditions peuvent tre contraignantes, elles ne sont jamais dterminantes.) Lincurie des gouvernements, c'est--dire leur ngligence, leur laisser-aller, mais aussi leur incomptence ou leurs choix politiques dsastreux : Au sortir de la guerre de Core, la Core du Nord et celles du Sud taient au mme niveau. Aujourdhui la Core du Sud est un pays dvelopp et la Core du Nord, dictature communiste militarise et autarcique est un PMA La Tunisie et le Maroc sont beaucoup plus avancs que lAlgrie : cest la faute du FLN qui dirige depuis plus de 40 ans le pays, des dirigeants corrompus et de leurs choix catastrophiques (agriculture sacrifie, priorit lindustrie lourde, selon un modle sovitique dont on sait quoi il a men) La corruption, plus ou moins gnralise Corruption des dirigeants prdateurs pillant leur propre pays leur profit, La fortune du Gnral Mobutu, prsident vie de lex Zare, place en Suisse et en Europe tait suprieure la dette de son propre pays En 1991 la fortune de Saddam Hussein tait dj estime plus de 10 milliards de $ et il disposait de 65 tonnes dor entreposes dans les coffres-forts de la Confdration Helvtique Corruption des administrations (Municipalits, sant, ducation, police) et fonctionnement mafieux de lEtat. La fuite des cerveaux vers le Nord Les guerres et autres conflits ethniques : Seule la paix permet le dveloppement : la guerre est toujours mre de pauvret, seuls les marchands de canons et autres trafiquants y trouvent un bnfice Le Mozambique, lAngola, le VietNam, le Cambodge, le Rwanda, la Cte dIvoire, la Sierra Leone et tant dautres pays en savent quelque chose Le poids des religions fatalistes Les religions fatalistes, Islam, Hindouisme, constituent un frein au dveloppement Linfriorit dans laquelle est maintenue la femme dans de nombreux pays musulmans est catastrophique aussi en termes de dveloppement Des structures sociales et des traditions sclrosantes Systme des castes en Inde
2) Les Suds : une diffrenciation croissante des situations a) Les PMA
[Mondialisation Interdpendance]
Page 29/32
49 au total, en Afrique subsaharienne surtout, en Asie aussi (Afghanistan, Laos, Npal,
Core du Nord,) en Amrique parfois (Hati) 3 critres PIB < 500 $/an/hbt Industrie : < 10 % du PIB Taux dalphabtisation <20% Une situation particulirement grave et inquitante : La pauvret et la misre gnralises : 50% de la population vit avec moins de un dollar par jour Faible intgration lconomie mondiale mais endettement trs fort Stagnation ou dclin du potentiel industriel et commercial Ravages des maladies endmiques : paludisme, dysenterie, SIDA Crise urbaine trs forte, la croissance urbaine tant gonfle par lexode rural mais aussi par une forte fcondit
b) Les pays intermdiaires ou PED
Situation moins critique mais trs prcaire et peu porteuse Pas de vritable dcollage conomique Intgration partielle la mondialisation Spcialisation dans lexportation de produits bruts aux cours fluctuants (Cte dIvoire, Nigeria) Investissements trangers cantonns dans secteurs lis lexportation (Total et le ptrole du Gabon)
c) Les pays mergents
Des lments positifs avec des perspectives de dveloppement intressantes 1. Les NPI
Les quatre dragons sont dsormais rattachs au Nord (Taiwan, Core du Sud,
Singapour et Hong-Kong) Les bbs tigres sont la seconde gnration de NPIA : Indonsie, Thalande, Malaisie, Philippines Brsil, Mexique, Chili en Amrique latine Ile Maurice en Afrique 2. Des pays qui progressent et sintgrent dans la mondialisation
Tunisie, Turquie, Maroc, Afrique du Sud Des signes encourageants de dveloppement conomique mais
3. Les pays ptroliers haut revenu et faible population du Golfe Persique
Emirats Rente ptrolire utilise pour le dveloppement conomique et la mise en place de
grandes infrastructures dquipement Tendance la diversification conomique en dveloppant le tourisme ou les services financiers Un sous-dveloppement encore prsent cependant (forte fcondit, trs fortes ingalits sociales, situation dinfriorit des femmes) 4. Les deux gants, Chine et Inde 4.1. Des facteurs de puissance spcifiques Dimension continentale
[Mondialisation Interdpendance] Poids dmographique impressionnant (40 % de la population mondiale) Puissances nuclaires Dcollage rapide mais srieuses fragilits aussi
Page 30/32
4.2. Chine : Premier pays industriel du Sud, Forte croissance des provinces littorales, Des taux de croissance conomique impressionnants depuis 10 ans (environ 10 % par an en moyenne), un RNB multipli par 4 en 20 ans Une tonnante capacit tirer profit de la mondialisation, Dans un premier temps un pays atelier avec fabrication de produits de grande consommation (50% des TV et 25% des machines laver dans le monde, jouet, habillement, chaussures) Premier producteur de nombreux produits me 5 exportateur mondial Aujourdhui un vritable saut technologique avec lindustrie des semiconducteurs (puces lectroniques) dont elle devrait devenir le premier fabricant lhorizon 2008. (devant les EUA, lEurope tant dj dpasse) 4.3. Inde : Industrie diversifie avec des secteurs de pointe, avec ouverture aux capitaux trangers, Intgration lconomie mondiale : attraction des dlocalisations et forte capacit dexportation dans le secteur des technologies de linformation et des services informatiques. (rgion de Bangalore par exemple)
Conclusion
Le processus de la mondialisation est donc un phnomne majeur de notre temps qui suscite les controverses et dchane mme parfois les passions. Cest un processus irrversible et lourd de consquences, mais il nest pas le seul phnomne contribuer lorganisation de lespace mondial. Les aires de civilisation et les dynamiques culturelles sont multiples, de nouvelles logiques voient le jour face aux enjeux de lavenir, comme par exemple la notion de dveloppement durable, soucieuse la fois de justice et de repect de lenvironnement. Paralllement la mondialisation dautres logiques dorganisation de lespace mondial existent donc et quelle que soit limportance de limpact de la mondialisation, luniformisation des cultures ne constitue pas une menace vritablement crdible. Lun des dbats contemporains nest-il dailleurs pas dopposer choc des civilisations et mtissage des cultures ?
[Mondialisation Interdpendance]
Page 31/32
TABLE DES MATIERES
I. LES FLUX ET LES RESEAUX DE LA MONDIALISATION....................................... 2
A. LES FLUX HUMAINS : LES MIGRATIONS INTERNATIONALES. ...........................................2 1) Les types de flux migratoires internationaux sont multiples et complexes ....................................2
a) Les migrations conomiques............................................................................................................................ 2 b) Les migrations dorigine politique : les rfugis............................................................................................... 3 c) Les flux touristiques internationaux ................................................................................................................. 3
2) Les espaces concerns par les flux migratoires. ............................................................................4
a) Les pays du Sud fournissent 75 % des migrants. ....................................................................................... 4 b) Les pays du Nord attirent la majorit des migrants : .................................................................................. 5
3) Les acteurs du mouvement migratoire..........................................................................................5
a) Une dmarche personnelle, familiale, souvent communautaire ......................................................................... 5 b) Les diasporas, communauts transnationales.................................................................................................... 5 c) Les tats et leur politique migratoire ............................................................................................................... 6
B. LES FLUX ECONOMIQUES : LES ECHANGES DE MARCHANDISES .....................................7 1) La rvolution des transports et des communications .....................................................................7
a) Des progrs techniques spectaculaires et dcisifs depuis 1945 ......................................................................... 7 b) Spcialisation, complmentarit et concurrence des moyens de transport.......................................................... 7 c) Limpact spatial de la rvolution des transports................................................................................................ 8
2) Les flux de marchandises : une croissance rapide.........................................................................8
a) Forte croissance du commerce international en volume depuis 1945................................................................. 8 b) Evolution de la nature des flux ........................................................................................................................ 8 c) De fortes disparits lchelle mondiale .......................................................................................................... 9
C. LES FLUX INFORMELS : CAPITAUX ET INFORMATION ........................................................9 1) Les flux de capitaux, en pleine expansion ....................................................................................9
a)Les grandes places financires au cur des flux de capitaux.............................................................................. 9 b) La forte croissance des IDE............................................................................................................................. 10 c) Les flux financiers parallles et illicites ........................................................................................................... 11
2) Les flux dinformation .................................................................................................................11
a) Une importance capitale .................................................................................................................................. 11 b) Une avance trs nette des pays du Nord ........................................................................................................... 12
II. LES ACTEURS DE LA MONDIALISATION ............................................................... 13
A. LES FIRMES TRANSNATIONALES................................................................................................13 1) Un rle fondamental et une influence croissante ..........................................................................13
a) Quelques dfinitions :...................................................................................................................................... 13 b) Le poids des transnationales ............................................................................................................................ 13
2) Lorigine des FTN : .....................................................................................................................14 3) Limpact des FTN dans les pays daccueil ...................................................................................14 B. LES ETATS..........................................................................................................................................14 1) La marge dautonomie des tats sest rduite ...............................................................................14 2) Les tats restent cependant des acteurs encore importants ............................................................14 3) Les grandes tendances..................................................................................................................15 C. INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES ....................................................15 1) Les institutions internationales drives de lONU.......................................................................15
a) Le FMI, Fonds montaire international ............................................................................................................ 15 b) La Banque mondiale ....................................................................................................................................... 15 c) LOMC, Organisation mondiale du commerce ................................................................................................. 16
[Mondialisation Interdpendance]
Page 32/32
d) les autres organismes internationaux................................................................................................................ 16
2) Les grandes organisations rgionales ...........................................................................................17
a) Des structures intermdiaires........................................................................................................................... 17 b) Les principales organisations se rpartissent en quatre types ............................................................................ 17
3) Les ONG, organisations non gouvernementales ..........................................................................17
a) Qui sont-elles ? ............................................................................................................................................... 17 b) Leur rle......................................................................................................................................................... 18 c) Leurs limites : ................................................................................................................................................. 19
III. LES TERRITOIRES DE LA MONDIALISATION : LORGANISATION GEOGRAPHIQUE DU MONDE.......................................................................................... 20
A LES CENTRES DIMPULSION DE LECONOMIE MONDIALE : UNE ECONOMIE DARCHIPEL...........................................................................................................................................20 1) La Triade .....................................................................................................................................20
a) Trois ples majeurs ......................................................................................................................................... 20 b) Des priphries intgres gnralement en proximit ....................................................................................... 20 c) Les pays du Nord ....................................................................................................................................... 20
2) Les grandes mtropoles mondiales...............................................................................................22
a) Des ples urbains de premier plan ................................................................................................................... 22 b) Larchipel mtropolitain mondial (AMM) et la polarisation de lespace mondial ............................................. 23
3) Les interfaces : espaces frontaliers et littoraux .............................................................................23
a) Les espaces frontaliers et rgions transfrontalires ........................................................................................... 23 b) Les espaces littoraux sont trs attractifs ........................................................................................................... 23
B. LES SUDS EN MARGE DU DEVELOPPEMENT............................................................................23 1) Les caractres communs du Sud : le drame du sous-dveloppement.............................................24
a) Des expressions diverses, plus ou moins satisfaisantes ................................................................................. 24 b) Des conditions sociodmographiques tragiques ............................................................................................... 25 c) Retards et dpendance conomique.................................................................................................................. 26
2) Les Suds : une diffrenciation croissante des situations ................................................................28
a) Les PMA ........................................................................................................................................................ 28 b) Les pays intermdiaires ou PED ...................................................................................................................... 29 c) Les pays mergents ......................................................................................................................................... 29
Dernire mise jour au 17 octobre 2004
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Montage FinancierDocument30 pagesLe Montage FinancierNabila OïPas encore d'évaluation
- Marchés FinanciersDocument15 pagesMarchés FinanciersMathiasin100% (1)
- Rapport de Stage BMCIDocument44 pagesRapport de Stage BMCIEtt Dilal100% (3)
- Cadrage Du Projet de Refonte Du Système D'information Front To Back TitresDocument75 pagesCadrage Du Projet de Refonte Du Système D'information Front To Back TitresSara El AydouniPas encore d'évaluation
- Emf II - Résumé (Ch1, Ch2, Ch3)Document12 pagesEmf II - Résumé (Ch1, Ch2, Ch3)OmàrZiràriPas encore d'évaluation
- Correction TD MondialisationDocument2 pagesCorrection TD MondialisationEstebane MAILELT67% (3)
- TD 1 La MondialisationDocument5 pagesTD 1 La MondialisationEstebane MAILELT100% (1)
- La Mondialisation Économique 2Document17 pagesLa Mondialisation Économique 2Estebane MAILELT100% (3)
- Lecture 1: MondialisationDocument17 pagesLecture 1: MondialisationEstebane MAILELTPas encore d'évaluation
- Cours D'économieDocument148 pagesCours D'économieEstebane MAILELT100% (6)
- Croissance, Capital Et Progrès TechniqueDocument19 pagesCroissance, Capital Et Progrès TechniqueEstebane MAILELT100% (1)
- La Mondialisation ÉconomiqueDocument12 pagesLa Mondialisation ÉconomiqueEstebane MAILELT100% (4)
- La Mondialisation ÉconomiqueDocument6 pagesLa Mondialisation ÉconomiqueEstebane MAILELT100% (3)
- Cours ch3Document19 pagesCours ch3vtjyopmailcomPas encore d'évaluation
- Géographie HUMAINE Géographie UrbaineDocument30 pagesGéographie HUMAINE Géographie UrbaineEstebane MAILELT100% (8)
- Introduction en Bourse Modalité Et Cadre Règlementaire PDFDocument12 pagesIntroduction en Bourse Modalité Et Cadre Règlementaire PDFOthmane FerroukhiPas encore d'évaluation
- TD 6 Eléments de RéponseDocument7 pagesTD 6 Eléments de RéponseAyman AmariPas encore d'évaluation
- Cotation en Bourse 1Document26 pagesCotation en Bourse 1pfe1Pas encore d'évaluation
- Fiscalité II S6 FC Chapitre1-Converti PR - Moussaif LoubnaDocument14 pagesFiscalité II S6 FC Chapitre1-Converti PR - Moussaif LoubnaLahcen ElallamiPas encore d'évaluation
- Se - Ance 8 Organisation Et Fonctionnement de La BVCDocument31 pagesSe - Ance 8 Organisation Et Fonctionnement de La BVCMeryemPas encore d'évaluation
- Introduction Générale: Groupement de Recherche Européen (Gdre) #335Document10 pagesIntroduction Générale: Groupement de Recherche Européen (Gdre) #335walidaarab150Pas encore d'évaluation
- Chapitre1 BOURSEDocument8 pagesChapitre1 BOURSEhicham elouhabi100% (1)
- 3ACD904784E7BBD4Document34 pages3ACD904784E7BBD4Josue IlungaPas encore d'évaluation
- Une Synthèse Des Principales Lois Et Réglementations Du Marché Monétaire Au MarocDocument7 pagesUne Synthèse Des Principales Lois Et Réglementations Du Marché Monétaire Au MarocdekuPas encore d'évaluation
- Places, Marches Et BoursesDocument9 pagesPlaces, Marches Et Boursesملاك نزار الحشيشةPas encore d'évaluation
- Financial MarketDocument344 pagesFinancial Marketlucy_haagenPas encore d'évaluation
- La BourseDocument4 pagesLa BourseakdjaskdjbasPas encore d'évaluation
- Thème 1. L'introduction en Bourse (Formalités Et Procédures)Document27 pagesThème 1. L'introduction en Bourse (Formalités Et Procédures)Ismail LouatiPas encore d'évaluation
- Chap I. Gestion Des IF EtudiantsDocument15 pagesChap I. Gestion Des IF Etudiantssoumaya saidaniPas encore d'évaluation
- Microstructure Des MarchésDocument30 pagesMicrostructure Des MarchésThierryPas encore d'évaluation
- Leçon 2 - La Microstructure Des MarchésDocument17 pagesLeçon 2 - La Microstructure Des MarchésSaraPas encore d'évaluation
- ChangesDocument38 pagesChangesAymen HsPas encore d'évaluation
- La Bourse de BeyrouthDocument122 pagesLa Bourse de Beyrouthab2oPas encore d'évaluation
- 14740640614c0bc8feb1815 PDFDocument72 pages14740640614c0bc8feb1815 PDFJohnson JongPas encore d'évaluation
- La NégociationDocument3 pagesLa NégociationEya Ben ChaiebPas encore d'évaluation
- Wolski Kalixt de - La Russie Juive (1887)Document148 pagesWolski Kalixt de - La Russie Juive (1887)Nunusse100% (1)
- Essai Empirique Sur La Relation Dynamiqu PDFDocument68 pagesEssai Empirique Sur La Relation Dynamiqu PDFFal BrahimPas encore d'évaluation
- Cours Droit Boursier SuiteDocument18 pagesCours Droit Boursier SuiteMouad RoknePas encore d'évaluation
- LA PRATIQUE aDU MARCHE FINANCIER SUPPORT ETUDIANTS IPEC 4 SOIR SCI ORIGINALDocument37 pagesLA PRATIQUE aDU MARCHE FINANCIER SUPPORT ETUDIANTS IPEC 4 SOIR SCI ORIGINALApollinaire KouassiPas encore d'évaluation
- Marche Derives Au MarocDocument5 pagesMarche Derives Au Marocreda El100% (1)