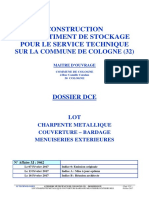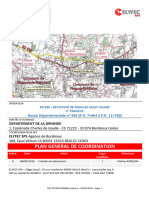Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ed695 PDF
Ed695 PDF
Transféré par
nesrine10Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ed695 PDF
Ed695 PDF
Transféré par
nesrine10Droits d'auteur :
Formats disponibles
Principes gnraux de ventilation
GUIDE PRATIQUE DE VENTILATION
COLLECTION DES GUIDES PRATIQUES DE VENTILATION
0. Principes gnraux de ventilation ED 695
1. Lassainissement de lair des locaux de travail ED 657
2. Cuves et bains de traitement de surface ED 651
3. Mise en uvre manuelle des polyesters stratifis ED 665
4. Postes de dcochage en fonderie ED 662
5. Ateliers dencollage de petits objets ED 672
(chaussures)
6. Captage et traitement des arosols de fluides de coupe ED 972
7. Oprations de soudage larc et de coupage ED 668
8. Espaces confins ED 703
9. 1. Cabines dapplication par pulvrisation ED 839
de produits liquides
9. 2. Cabines d'application par projection ED 928
de peintures en poudre
9. 3. Pulvrisation de produits liquides. ED 906
Objets lourds ou encombrants
10. Le dossier dinstallation de ventilation ED 6008
11. Srigraphie ED 6001
12. Seconde transformation du bois ED 750
13. Fabrication des accumulateurs au plomb ED 746
14. Dcapage, dessablage, dpolissage au jet libre en cabine ED 768
15. Rparation des radiateurs automobiles ED 752
16. Ateliers de fabrication de prothses dentaires ED 760
17. Emploi des matriaux pulvrulents ED 767
18. Sorbonnes de laboratoire ED 795
19. Usines de dpollution des eaux rsiduaires ED 820
et ouvrages dassainissement
20. Postes dutilisation manuelle de solvants ED 6049
21. Ateliers de plasturgie ED 6146
0
Institut national de recherche et de scurit
pour la prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles
65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris
G
Tl. 01 40 44 30 00
www.inrs.fr
G
e-mail : info@inrs.fr
dition INRS ED 695
3
e
dition (1989)
G
rimpression juillet 2013
G
2 000 ex.
G
ISBN 978-2-7389-1649-5
SOMMAIRE
LEXIQUE ............................................................................................................................................................ 2
COMMENT ABORDER LTUDE DUN SYSTME DE VENTILATION .............................................................. 3
1. POSTE DE TRAVAIL .................................................................................................................................... 4
1.1. Diminution de la pollution par action sur le processus polluant ......................................................... 4
1.2. Analyse du poste de travail ................................................................................................................. 4
2. POLLUTION ................................................................................................................................................. 4
2.1. Rglementation .................................................................................................................................... 4
2.2. Risque .................................................................................................................................................. 4
2.2.1. Risque dintoxication ............................................................................................................... 4
2.2.2. Risque dexplosion ................................................................................................................... 5
2.2.3. Risques dus lexposition au chaud et au froid ..................................................................... 6
2.3. Autres causes dinconfort ................................................................................................................... 6
3. CAPTAGE ..................................................................................................................................................... 6
3.1. Techniques de ventilation .................................................................................................................... 6
3.2. Ventilation locale .................................................................................................................................. 7
3.2.1. Principes .................................................................................................................................. 7
3.2.2. Solutions .................................................................................................................................. 9
4. TRANSPORT DES POLLUANTS ............................................................................................................... 14
4.1. coulement de lair dans les canalisations ....................................................................................... 14
4.1.1. Pression statique et pression dynamique .............................................................................. 14
4.1.2. Vitesse de lair ........................................................................................................................ 15
4.1.3. Pertes de charge .................................................................................................................... 15
4.2. Conception du rseau ....................................................................................................................... 16
4.3. quilibrage de linstallation ............................................................................................................... 18
4.4. Ambiances explosives ....................................................................................................................... 18
4.4.1. Extraction des gaz et vapeurs inflammables ......................................................................... 18
4.4.2. Extraction des poussires inflammables ............................................................................... 18
4.5 Bruit .................................................................................................................................................... 18
5. VENTILATEURS ......................................................................................................................................... 19
5.1. Gnralits ......................................................................................................................................... 19
5.2. Point de fonctionnement dun ventilateur ......................................................................................... 19
5.3. Choix ................................................................................................................................................. 19
5.4. Bruit ................................................................................................................................................... 20
6. REJET ........................................................................................................................................................ 20
7. AIR DE COMPENSATION .......................................................................................................................... 21
7.1. Rle de la compensation .................................................................................................................. 21
7.2. Compensation et confort thermique ................................................................................................. 22
8. VENTILATION GNRALE ....................................................................................................................... 22
8.1. Principes ............................................................................................................................................ 22
8.2. Solutions ............................................................................................................................................ 23
9. IMPLANTATION DU MATRIEL ................................................................................................................. 24
10. CONTRLES ET ENTRETIEN DUNE INSTALLATION DE VENTILATION ................................................. 24
10.1. Paramtres contrler .................................................................................................................... 24
10.2. Contrle dune installation sur site .................................................................................................. 24
10.3. Techniques de contrles quantitatives ............................................................................................ 24
10.3.1. Dtermination des dbits dair par exploration des champs de vitesse dair
dans une conduite ferme .................................................................................................. 27
10.3.2. Dtermination des dbits dair par exploration du champ de vitesse au niveau
des bouches dextraction ou dintroduction dair .............................................................. 27
10.3.3. Dtermination du dbit dair et de contrle dune installation par mesure de
la pression statique en un point ......................................................................................... 27
10.3.4. Estimation du dbit dair partir de la mesure de la vitesse de rotation du
ventilateur et de la puissance consomme par le moteur lectrique ................................ 27
10.4. Techniques de contrle qualitatives ................................................................................................ 27
10.5. Appareils de mesure de vitesse dair .............................................................................................. 28
10.6. Appareils de mesure de pression .................................................................................................... 28
10.7. Registre de contrle dune installation de ventilation ..................................................................... 28
10.8. Causes possibles de mauvais fonctionnements dcels lors du contrle dune
installation ........................................................................................................................................ 28
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 29
ANNEXE 1. tude comparative de deux rseaux dextraction .................................................................... 30
ANNEXE 2. Informations utiles ..................................................................................................................... 33
Pour obtenir en prt les audiovisuels et multimdias et pour commander les brochures et les aches
de lINRS, adressez-vous au service Prvention de votre Carsat, Cram ou CGSS.
Carsat ALSACE-MOSELLE
(67 Bas-Rhin)
14 rue Adolphe-Seyboth
CS 10392
67010 Strasbourg cedex
tl. 03 88 14 33 00
fax 03 88 23 54 13
prevention.documentation@carsat-am.fr
www.carsat-alsacemoselle.fr
(57 Moselle)
3 place du Roi-George
BP 31062
57036 Metz cedex 1
tl. 03 87 66 86 22
fax 03 87 55 98 65
www.carsat-alsacemoselle.fr
(68 Haut-Rhin)
11 avenue De-Lattre-de-Tassigny
BP 70488
68018 Colmar cedex
tl. 03 88 14 33 02
fax 03 89 21 62 21
www.carsat-alsacemoselle.fr
Carsat AQUITAINE
(24 Dordogne, 33 Gironde,
40 Landes, 47 Lot-et-Garonne,
64 Pyrnes-Atlantiques)
80 avenue de la Jallre
33053 Bordeaux cedex
tl. 05 56 11 64 36
fax 05 57 57 70 04
documentation.prevention@carsat-
aquitaine.fr
www.carsat.aquitaine.fr
Carsat AUVERGNE
(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire,
63 Puy-de-Dme)
48-50 boulevard Lafayette
63058 Clermont-Ferrand cedex 1
tl. 04 73 42 70 76
fax 04 73 42 70 15
preven.carsat@orange.fr
www.carsat-auvergne.fr
Carsat BOURGOGNE
et FRANCHE-COMT
(21 Cte-dOr, 25 Doubs, 39 Jura,
58 Nivre, 70 Haute-Sane,
71 Sane-et-Loire, 89 Yonne,
90 Territoire de Belfort)
ZAE Cap-Nord, 38 rue de Cracovie
21044 Dijon cedex
tl. 08 21 10 21 21
fax 03 80 70 52 89
prevention@carsat-bfc.fr
www.carsat-bfc.fr
Carsat BRETAGNE
(22 Ctes-dArmor, 29 Finistre,
35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)
236 rue de Chteaugiron
35030 Rennes cedex
tl. 02 99 26 74 63
fax 02 99 26 70 48
drpcdi@carsat-bretagne.fr
www.carsat-bretagne.fr
Carsat CENTRE
(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre,
37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)
36 rue Xaintrailles
45033 Orlans cedex 1
tl. 02 38 81 50 00
fax 02 38 79 70 29
prev@carsat-centre.fr
www.carsat-centre.fr
Carsat CENTRE-OUEST
(16 Charente, 17 Charente-Maritime,
19 Corrze, 23 Creuse, 79 Deux-Svres,
86 Vienne, 87 Haute-Vienne)
37 avenue du prsident Ren-Coty
87048 Limoges cedex
tl. 05 55 45 39 04
fax 05 55 45 71 45
cirp@carsat-centreouest.fr
www.carsat-centreouest.fr
Cram LE-DE-FRANCE
(75 Paris, 77 Seine-et-Marne,
78 Yvelines, 91 Essonne,
92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis,
94 Val-de-Marne, 95 Val-dOise)
17-19 place de lArgonne
75019 Paris
tl. 01 40 05 32 64
fax 01 40 05 38 84
prevention.atmp@cramif.cnamts.fr
www.cramif.fr
Carsat LANGUEDOC-ROUSSILLON
(11 Aude, 30 Gard, 34 Hrault,
48 Lozre, 66 Pyrnes-Orientales)
29 cours Gambetta
34068 Montpellier cedex 2
tl. 04 67 12 95 55
fax 04 67 12 95 56
prevdoc@carsat-lr.fr
www.carsat-lr.fr
Carsat MIDI-PYRNES
(09 Arige, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrnes,
81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)
2 rue Georges-Vivent
31065 Toulouse cedex 9
tl. 0820 904 231 (0,118 /min)
fax 05 62 14 88 24
doc.prev@carsat-mp.fr
www.carsat-mp.fr
Carsat NORD-EST
(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne,
52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle,
55 Meuse, 88 Vosges)
81 85 rue de Metz
54073 Nancy cedex
tl. 03 83 34 49 02
fax 03 83 34 48 70
documentation.prevention@carsat-nordest.fr
www.carsat-nordest.fr
Carsat NORD-PICARDIE
(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise,
62 Pas-de-Calais, 80 Somme)
11 alle Vauban
59662 Villeneuve-dAscq cedex
tl. 03 20 05 60 28
fax 03 20 05 79 30
bedprevention@carsat-nordpicardie.fr
www.carsat-nordpicardie.fr
Carsat NORMANDIE
(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche,
61 Orne, 76 Seine-Maritime)
Avenue du Grand-Cours, 2022 X
76028 Rouen cedex
tl. 02 35 03 58 22
fax 02 35 03 60 76
prevention@carsat-normandie.fr
www.carsat-normandie.fr
Carsat PAYS DE LA LOIRE
(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire,
53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vende)
2 place de Bretagne
44932 Nantes cedex 9
tl. 02 51 72 84 08
fax 02 51 82 31 62
documentation.rp@carsat-pl.fr
www.carsat-pl.fr
Carsat RHNE-ALPES
(01 Ain, 07 Ardche, 26 Drme, 38 Isre,
42 Loire, 69 Rhne, 73 Savoie,
74 Haute-Savoie)
26 rue dAubigny
69436 Lyon cedex 3
tl. 04 72 91 96 96
fax 04 72 91 97 09
preventionrp@carsat-ra.fr
www.carsat-ra.fr
Carsat SUD-EST
(04 Alpes-de-Haute-Provence,
05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes,
13 Bouches-du-Rhne, 2A Corse-du-Sud,
2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)
35 rue George
13386 Marseille cedex 5
tl. 04 91 85 85 36
fax 04 91 85 75 66
documentation.prevention@carsat-sudest.fr
www.carsat-sudest.fr
Services Prvention des CGSS
CGSS GUADELOUPE
Immeuble CGRR, Rue Paul-Lacav, 97110 Pointe--Pitre
tl. 05 90 21 46 00 fax 05 90 21 46 13
lina.palmont@cgss-guadeloupe.fr
CGSS GUYANE
Espace Turenne Radamonthe, route de Raban,
BP 7015, 97307 Cayenne cedex
tl. 05 94 29 83 04 fax 05 94 29 83 01
CGSS LA RUNION
4 boulevard Doret, 97704 Saint-Denis Messag cedex 9
tl. 02 62 90 47 00 fax 02 62 90 47 01
prevention@cgss-reunion.fr
CGSS MARTINIQUE
Quartier Place-dArmes, 97210 Le Lamentin cedex 2
tl. 05 96 66 51 31 et 05 96 66 51 32 fax 05 96 51 81 54
prevention972@cgss-martinique.fr
www.cgss-martinique.fr
Services Prvention des Carsat et des Cram
1
GUIDE PRATIQUE DE VENTILATION N 0 - ED 695
0. Principes gnraux
de ventilation
Document tabli par un groupe de travail comprenant des spcialistes des
CRAM et de lINRS, en collaboration avec les syndicats professionnels. Il
pose les diffrents problmes lis la mise en place ou ltude
dun systme de ventilation et prsente une dmarche pour aborder ces
problmes et les rsoudre.
Au sommaire : poste de travail, captage, transport des polluants, venti-
lateurs, rejet, air de compensation, ventilation gnrale, implantation du
matriel, contrles et entretien.
En annexe : comparaison de deux rseaux dextraction.
Le prsent document a t tabli par un groupe de travail constitu sous lgide de
la Caisse nationale de lassurance maladie (CNAM) et comprenant des
spcialistes en ventilation et nuisances chimiques de la CNAM, des Caisses rgio-
nales dassurance maladie (CRAM) et de lINRS.
Lors de son laboration, les organismes professionnels suivants ont t
consults :
Syndicat de laraulique,
Centre technique des industries arauliques et mcaniques (CETIAT),
Centre technique des industries mcaniques (CETIM).
Ce document nest pas un trait technique visant linstallateur, spcialiste en calcul
et en dimensionnement dinstallations de ventilation, mais un guide
destin fournir des rponses pratiques toute personne qui se pose un
problme de conception, dentretien, de fonctionnement et de contrle dune
telle installation. Son objectif est daider le lecteur bien poser les problmes
lis ltude et la mise en place dun systme de ventilation et lui proposer
une dmarche pour aborder ces problmes et les rsoudre.
Remarque importante
Ce guide ne sintresse quaux principes gnraux de ventilation et la manire
daborder ltude dun systme de ventilation. Pour les problmes spcifiques de
captage de lair pollu, le lecteur pourra se rfrer aux autres guides de cette srie,
parus ou paratre.
Guide for ventilating practice. 0.
General principles of ventilation
Document drawn up by a working group
comprising specialists from Regional Health
Insurance Funds and the INRS in
collaboration with the relevant trade
associations. It considers the diffrent
problems involved in setting up or
designing a ventilation system and sets out
a procedure for approaching and solving
these problems.
The subjects covered include: work
station, capture of pollutants, pollutant
transport, fan units, discharge, air
replacement, general ventilation, plant
installation, testing and maintenance.
The first appendix compares two
extraction networks; the second one
gives useful informations.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 1
2
LEXIQUE
Arotherme : appareil de chauffage dair
refoulant dans le local comprenant un groupe
motoventilateur et une batterie de rchauffage.
Ailettes : barreaux profils permettant le guidage
de lair au travers dun orifice dentre ou de sor-
tie dair.
Air extrait : air ambiant rejet lextrieur.
Air neuf : air pris lextrieur et exempt de
pollution.
Air primaire : air sortant dune bouche.
Air secondaire : air ambiant entran par le flux
dair primaire.
Air recycl : air repris dans le local pour y tre
rintroduit, gnralement aprs traitement.
Armoire : se dit dun groupe de traitement dair,
du type vertical, plac habituellement dans le
local traiter.
Aubes directrices : lments de guidage rap-
ports placs dans les coudes brusques des
gaines dair de grande section.
Batterie : lment chauffant comprenant soit
une ou plusieurs ranges de tubes ailetts par-
courus par un fluide caloporteur et destin
modifier la temprature de lair le traversant, soit
un ensemble de rsistances lectriques.
Bouche : dispositif par lequel lair est souffl,
repris ou extrait dun local. Elles comportent
gnralement des lments dorientation de lair
souffl et parfois de rglage du dbit. Les
bouches peuvent tre murales, plafonnires ou
solidaires des rseaux de transport et appareils
terminaux.
Buse : bouche de petite section vhiculant de
lair haute vitesse.
Caisson : appareil de traitement de lair dont
les composants fonctionnels sassemblent par
juxtaposition.
Caisson de rpartition : volume de traitement
dair (ou centrale) assurant la rpartition des
vitesses de lair le traversant.
Carneau : conduit horizontal dvacuation de
grande dimension.
Chauffage direct : chauffage dun fluide direc-
tement au contact de la source dnergie (la
totalit de lnergie est transmise).
Clapet : lment mobile dobturation partielle ou
totale dune gaine, commande manuelle ou
automatique.
Climatiseur : appareil autonome permettant la
production et la distribution dair conditionn.
Convecteur : lment chauffant utilisant le
principe de la convection.
Convection : mouvement naturel de lair
dun local provoqu par des diffrences de
temprature.
Dflexion : modification de lpanouissement
naturel dun jet dair la sortie dune bouche
de soufflage par linterposition dailettes. La
dflexion peut tre simple, dans un seul plan, ou
double, verticale et horizontale.
Dpoussirage : gnralement utilis pour
dfinir la rduction notable de la concentration en
poussires dun flux dair industriel.
Diffuseur : bouche de soufflage particulire
ayant un fort taux dinduction interne.
Diffusion : action de distribuer de lair avec une
forte proportion dair secondaire.
changeur : dispositif permettant le transfert
dnergie dun fluide un autre sans contact.
On distingue les changeurs statiques ( plaques,
batterie, caloducs), dynamiques (rotatifs) et
thermodynamiques (pompes chaleur).
Filtre : dispositif de sparation des particules
solides ou liquides en suspension dans lair
permettant, selon sa qualit, une puration plus
ou moins efficace. Les filtres peuvent tre en
caisson ou en gaine, plans, didres, droule-
ment automatique, mdia sec ou humide,
poche rgnrable ou jetable, lectrostatiques.
Gaine : conduit de ventilation souvent ralis en
tle ou en matires plastiques ou maonn.
Gnrateur dair chaud : appareil de production
de chaleur indirecte quip dune chambre de
combustion, dun changeur, dun ventilateur de
soufflage et dun plnum de distribution dair.
Une chemine assure lvacuation des gaz
brls.
Grille : voir bouche.
Groupe : synonyme dappareil (groupe de
traitement dair, groupe frigorifique).
Hotte : dispositif de captage rcepteur plac
au-dessus des sources, se basant en gnral sur
les mouvements naturels de convection.
Humidificateur : dispositif permettant laug-
mentation de la teneur en eau de lair.
Inclineur : ensemble daubes rglables places
sur loue daspiration dun ventilateur et permet-
tant de modifier, en conservant un rendement
acceptable, ses caractristiques arauliques.
Induction :
en soufflage : phnomne dentranement de
lair secondaire par lair primaire, le taux dinduc-
tion caractrise le quotient air vhicul total/air
primaire ;
en captage : action de mettre en mouvement
lair distance dun orifice dextraction.
Laveur dair : dispositif dhumidification eau
recycle ou dpuration comprenant une ou
plusieurs rampes de buses de pulvrisation,
un bac formant rserve deau et une pompe de
pulvrisation.
Louvre : prise dair extrieure comportant des
lames inclines formant pare-pluie.
Manchette : pice de raccordement entre deux
lments de gaines ou dappareils. Les man-
chettes souples vitent la transmission des vibra-
tions.
Make up : gnrateur dair chaud direct
brleur gaz en veine dair.
Mdia : matriau filtrant.
Pavillon : accessoire plac laspiration dun
ventilateur diminuant les pertes de charge.
Piquage : branchement secondaire sur une
gaine principale.
Plnum : voir caisson de rpartition.
Plot (antivibratile) : support lastique plac sous
les chssis des ventilateurs.
Porte : distance partir de laquelle la vitesse
minimale du jet dair passe en dessous dune
limite sensible (0,25 0,30 m/s en gnral).
Pression totale : se reporter au texte du
paragraphe 4.1.1.
Projection : action de distribuer de lair avec la
proportion la plus faible possible dair secondaire
afin den augmenter la porte.
Registre : voir clapet.
Section libre : section de passage utile de lair
dans une bouche donne, exprime en % de la
section totale.
Section totale : section gomtrique relle de la
bouche mesure lintrieur du cadre.
Silencieux : lment plac dans un flux dair
diminuant la transmission du bruit arien dans
les gaines.
Sorbonne (ou hotte de laboratoire) : enceinte
ventile dont la face avant peut souvrir.
Laspiration est gnralement rpartie sur la face
arrire (haute et basse).
Tourelle : extracteur mcanique plac en
toiture.
Ventilateur : se reporter au texte du chapitre 5.
Ventilation tempre : voir make up.
Ventilo-convecteur : appareil de chauffage ou
de refroidissement terminal dont la convection
est force au travers des batteries par un ventila-
teur de soufflage.
Virole : corps cylindrique plac autour des
ventilateurs hlicodes et permettant leur raccor-
dement sur des gaines.
Volet : dispositif permettant le rglage de la
rpartition de lair dans une drivation : par
extension utilis comme synonyme de clapet
(voir ce mot).
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 2
3
Lutter contre la pollution dans les
ateliers et les locaux de travail consiste
rduire, un niveau le plus faible possible,
la quantit des polluants dont les effets
sur lhomme sont reconnus ou soupon-
ns ; cest le rle de linstallation de
ventilation.
La conception dune installation de venti-
lation est une opration dlicate dans
laquelle interviennent de nombreux fac-
teurs techniques, conomiques, nerg-
tiques et humains. Elle ncessite, de la part
du concepteur, une connaissance parfaite
du poste de travail ou du local traiter et
aussi la matrise des diffrentes techniques
mises sa disposition pour rsoudre le
problme. Le concepteur devra donc la
fois prendre prendre en compte :
1 Le poste de travail.
2 La pollution.
3 Le captage.
4 Les rseaux de transport.
5 Les ventilateurs.
6 Lpuration et le rejet.
7 Les prises dair.
8 La ventilation gnrale, lapport dair et
le chauffage.
COMMENT ABORDER LTUDE DUN SYSTME DE VENTILATION
Fig. 1. Schma type dune installation (les chiffres cercls renvoient aux numros des chapitres).
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 3
4
On pourra alors aborder ltude dun sys-
tme de ventilation en suivant la
dmarche suivante :
dfinition prcise du poste de travail ou
du local traiter avec un inventaire com-
plet des donnes immuables et des
contraintes lies au processus industriel,
aux hommes, lenvironnement, etc. ;
dtermination et classification par
niveau de risque des sources de
pollution caractristiques physico-
chimiques des polluants ;
dtermination de la solution technique
de captage et de ventilation en tenant
compte dune part des volutions possi-
bles du processus industriel et des
modifications quelles entraneront sur le
dispositif de ventilation et dautre part des
incompatibilits ventuelles de certains
polluants (poussires et humidit, cya-
nures et acides...) qui ncessitent la spa-
ration des circuits... ;
dtermination des paramtres (vitesses
dair, dbits, chauffage...) et calcul de
linstallation (diamtres, pertes de charge,
puissance installer...) ;
choix des composants (bouches, cana-
lisations, matriaux, ventilateurs) ;
implantation et localisation des compo-
sants en fonction des contraintes (dispo-
sitions constructives, entretien ultrieur,
remplacement de filtres, trappes de
visite...) ;
rception et mise en conformit de lins-
tallation ;
rdaction dune consigne dutilisation
tenant compte de la notice dinstruction
fournie par le matre douvrage, qui
permettra le suivi des performances de
linstallation dans le temps.
1. POSTE DE TRAVAIL
La mise en place dun systme de venti-
lation ou de captage de la pollution est
rendue ncessaire lorsque le poste de
travail met des polluants en quantit
incompatible avec les conditions nor-
males requises de salubrit, dhygine,
de sant ou de scurit vis--vis des
oprateurs.
1.1. Diminution de la pollution par
action sur le processus polluant
Avant daborder toute tude dune solu-
tion dassainissement de latmosphre
par un dispositif de ventilation, il convient
de rechercher sil nexiste pas un moyen
simple de supprimer la cause de pollution
ou sinon den rduire les missions
par une modification du procd de
fabrication ou de la conception de linstal-
lation industrielle. Le dispositif de ventila-
tion nest quun remde pour limiter la
propagation des polluants dans latmo-
sphre, un traitement curatif des causes
dmission de ces polluants est toujours
prfrable.
1.2. Analyse du poste de travail
Il est essentiel deffectuer une enqute
pralable pour avoir une connaissance
complte du poste, de faon choisir une
solution bien adapte au problme
rsoudre (hygine du travail), mais gale-
ment bien accepte par lutilisateur :
respect des impratifs de production et
du confort du personnel. On peut ainsi
constater que la connaissance de la
seule temprature de lair est insuffi-
sante pour valuer la qualit dun envi-
ronnement thermique. Linconfort local
peut tre d la prsence de courants
dair, un gradient vertical de tempra-
ture excessif, une temprature de sol
trop leve ou trop basse, lexistence
dun champ radiatif asymtrique par rap-
port lindividu (fentres froides, sources
de chaleur dun ct du corps...), ou au
taux dhumidit relative.
Cette enqute tentera de dfinir avec
prcision le poste (zone dvolution du
personnel) et le travail effectu, la nature
du polluant et son mode dmission
(poussire, gaz, fume ou brouillard,
mission avec une vitesse initiale ou une
temprature leve, etc.), ltendue de la
zone pollue et la frquence des mis-
sions, les mouvements dair autour du
poste, etc.
Il est important de retenir, ds sa concep-
tion, une solution de captage ou de
ventilation qui ne gne pas loprateur
dans son travail par sa disposition, son
encombrement, son niveau sonore, les
courants dair induits, etc. Un systme de
captage de polluants est dautant plus
efficace quil est bien intgr et adapt au
poste de travail.
2. POLLUTION
2.1. Rglementation
Les rgles gnrales en matire dara-
tion, dassainissement et de renouvelle-
ment de lair des locaux de travail sont
fixes par dcrets et figurent au Code
du travail. Une circulaire et des arrts
compltent les textes de base [1].
2.2. Risque
La mise en uvre, par lindustrie, de
matriaux de base (matires premires)
ou de produits chimiques les plus divers
entrane gnralement une dispersion
dune partie de ceux-ci dans latmo-
sphre environnant les postes de tra-
vail. La situation ainsi cre peut
conduire des maladies dorigine pro-
fessionnelle ou lintoxication des per-
sonnes exposes, si lon a affaire des
produits toxiques ou nocifs, ou tre
lorigine dincendies ou dexplosions,
lorsque les produits sont inflammables.
De mme, la prsence de sources de
chaleur telles que fours et tuves, ou de
sources de froid (chambre rfrigre),
peut crer, si lon ne prend pas de
prcautions particulires, des situations
inconfortables, voire dangereuses, et lon
parle juste titre dans ce domaine de pol-
lution thermique.
2.2.1. Risque d'intoxication
Les substances utilises ou fabriques
dans lindustrie peuvent avoir divers
effets nfastes pour lorganisme. Nous
classerons sparment les particules et
les gaz pour la commodit de lexpos,
mais il faut savoir quil y a en gnral plu-
sieurs polluants prsents simultanment
et parfois sous plusieurs formes phy-
siques diffrentes (exemples : peintures,
fumes de soudage...).
Les particules (poussires ou arosols
solides et liquides)
Elles ont toujours un effet nfaste sur
lorganisme, soit par leur nature si elles
sont irritantes, corrosives, fibrosantes,
toxiques, allergisantes ou pathognes,
soit par le seul effet de surcharge pulmo-
naire si elles nont pas de caractre nocif
particulier.
Les gaz
Ils sont agressifs pour la sant sils
sont toxiques, irritants ou corrosifs. Par
ailleurs, quils soient agressifs ou non,
ils prsentent toujours un risque das-
phyxie lorsquils remplacent loxygne
de lair respir pour tout ou partie.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 4
5
Les valeurs limites dexposition
Lobjectif minimal atteindre est de
maintenir la salubrit de latmosphre
ncessaire pour prserver la sant des
personnes. Un systme de rfrence
consiste utiliser les valeurs limites pour
les concentrations des substances
dangereuses. Dune manire gnrale,
une valeur limite dexposition est une rf-
rence chiffre dont le respect, dans ltat
actuel des connaissances, assure la
protection de la majorit des personnes
exposes des agents chimiques, phy-
siques ou biologiques, contre des
atteintes pathologiques pouvant en rsul-
ter. Le systme franais prend en compte
deux types de valeurs limites [2] :
des valeurs limites dexposition de court
terme (VLCT) ;
des valeurs limites dexposition sur 8
heures (VL8h).
Rappels sur le comportement des
polluants dans latmosphre
a) Polluants gazeux
Il est rarement vrai quun polluant gazeux
lourd, mis dans un atelier, descende
vers le sol, comme on le prtend parfois.
Ainsi, pour le capter, il ne sera pas
ncessaire de prvoir des dispositifs de
captage aspirant lair vers le bas ou
mme placs au niveau du sol. Cette
situation extrme ne pourra se rencon-
trer que dans une atmosphre parfaite-
ment calme (lieu de stockage, atelier
ferm en repos, fosse...).
En fait, les mlanges air-polluants
gazeux rencontrs dans lambiance des
ateliers industriels ont une densit trs
peu diffrente de celle de lair. Les
vitesses de chute vers le sol, trs faibles,
sont ngligeables par rapport la diffu-
sion turbulente et aux courants dair qui
existent mme dans les espaces les
mieux protgs.
Le polluant na pas la latitude de se mou-
voir par lui-mme et il sera contrl ds
lors que lon captera lair avec lequel il est
mlang.
Au contraire, les diffrences de densit
induites par une lvation de la tempra-
ture de lair, par exemple au contact dune
surface chaude, peuvent avoir des effets
importants sur les mouvements de lair [3].
b) Poussires
Les fines particules (de diamtre infrieur
50 m environ) en sdimentation en air
calme atteignent rapidement une vitesse
limite de chute, du fait de la rsistance de
lair.
Le tableau I donne les vitesses Iimites de
sdimentation en air calme pour des
sphres de densit 1. Ce tableau montre
que les vitesses atteintes par les trs
fines particules (de diamtre arodyna-
mique infrieur 10 m) sont trs faibles
et ngligeables devant les courants dair
qui, mme dans les atmosphres trs
calmes, ont une vitesse suprieure 0,1
ou 0,2 m/s.
Dans certains procds, comme par
exemple le meulage, des particules sont
projetes dans lair avec une vitesse ini-
tiale leve. Le tableau Il donne, titre
dexemple, les valeurs des distances
darrt de particules de densit 2,5
mises avec une vitesse initiale de 50
m/s. Les distances darrt en air calme
varient fortement avec la taille des parti-
cules : de 55 m pour les particules de 2
mm, 1 mm pour des particules de 2 m.
Ces deux tableaux montrent que les
poussires peuvent tre, en premire
approximation, classes en deux cat-
gories :
a) les grosses particules qui, grce
leur nergie cintique leve, peuvent
parcourir, lorsquelles sont projetes
avec une vitesse initiale, des distances
importantes. Ces grosses particules ne
peuvent tre matrises que par des
dispositifs de captage disposs sur leur
trajectoire ;
b) les fines particules qui nont pas la
latitude de se mouvoir par elles-mmes
dans lair, mme avec une vitesse ini-
tiale, mais dont une partie peut tre
entrane dans le sillage cr par de
grosses particules lances grande
vitesse.
Les fines particules ayant une significa-
tion en hygine industrielle nont donc
pas de mouvements indpendants de
ceux de lair et, pour les capter, il suffit
(sauf le cas dentranement cit ci-
dessus) de capter lair dans lequel elles
sont en suspension.
2.2.2. Risque dexplosion
Latmosphre dun lieu de travail est
explosive lorsque les proportions de
gaz, de vapeurs, de brouillards ou de
poussires dans lair y sont telles quune
flamme, une tincelle, une temprature
excessive produisent une explosion.
Une atmosphre peut devenir explosible
lorsque les trois lments ncessaires
la combustion sont en prsence : le
combustible (gaz, poussire, brouillard,
liquide), le comburant (oxygne de lair),
un apport dnergie ou une temprature
suffisante.
Des atmosphres explosives peuvent
se former en exploitation normale
dans les locaux ferms ou mdiocre-
ment ventils, au voisinage dlments
tels que des pompes de liquides
inflammables, des rcipients prsen-
tant des surfaces libres de liquides
inflammables (bacs de solvant), des
dmes de citernes et des orifices de
chargement ouverts, des orifices de
respiration de rservoirs, des bidons
non bouchs, des systmes de
captage, des refoulements de ventila-
teurs extrayant des polluants, des
ouvertures daration, des schoirs ou
des appareils o sont vapors des
TABLEAU I
Valeurs des vitesses limites de sdimentation en air calme
pour des particules sphriques
de masse volumique 1 000 kg/m
3
(densit = 1)
Diamtre (m) 100 50 20 10 1 0,1
Vitesse limite (m/s) 0,3 0,07 0,01 3.10
-3
3.10
-5
9.10
-7
TABLEAU II
Valeurs des distances darrt pour des particules
de masse volumique 2 500 kg/m
3
projetes la vitesse de 50,8 m/s
dans de lair calme 25 C
Diamtre (m) 2 000 1 000 500 100 50 10 5 2
Distance darrt (m/s) 54,9 23,1 9,35 0,892 0,291 19,5.10
-3
6,1.10
-3
1,2.10
-3
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 5
6
solvants inflammables (postes de pein-
ture et de schage de peinture, etc.).
Des atmosphres explosives peuvent se
former accidentellement en raison de
fuites de rcipients dans des magasins
de stockage ferms ou mal ars, de
fuites sur des canalisations de transport
de liquides, de gaz inflammables ou de
polluants, de fuites sur des installations
de combustion, etc.
Gaz et vapeurs
La plupart des gaz ou vapeurs inflamma-
bles en mlange avec lair tant suscep-
tibles dexploser en senflammant, le
domaine des concentrations explosives
de chacun dentre eux est born par les
limites infrieures et suprieures dites
dexplosivit .
La limite infrieure dexplosivit (LIE)
dun gaz ou dune vapeur dans lair est
la concentration minimale en volume
dans le mlange au-dessus de laquelle il
peut exploser.
La limite suprieure dexplosivit (LSE)
est la concentration maximale en volume
dans le mlange au-dessous de laquelle
il peut exploser.
La LIE des gaz et vapeurs dangereux
pour la sant est toujours bien sup-
rieure aux VLCT et VL8h. Cependant,
mme si lon observe des concentra-
tions faibles ou voisines des valeurs
limites dexposition, il peut exister locale-
ment des poches de mlanges gazeux
explosifs.
Pour que latmosphre dun local de tra-
vail ou dune partie dun local ne
devienne pas ou ne reste pas explosive,
on doit :
empcher lintroduction de gaz ou de
vapeurs inflammables en ralisant, autant
que possible, ltanchit des enceintes,
rservoirs, rcipients, canalisations, qui
les contiennent ; en proscrivant, en arr-
tant ou en diminuant les fuites acciden-
telles ou occasionnelles, en particulier les
ruptures denveloppes et de tuyauteries,
les fuites de joints, les fuites de presse-
toupe, les dbits de fluides combusti-
bles dans des brleurs teints ;
abaisser la concentration des gaz ou
vapeurs inflammables prsents par la
ventilation ou laration (pour les travaux
en cabines de peinture ou en espaces
confins, consulter les guides de ven-
tilation spcifiques se rapportant ces
activits).
Par ailleurs, on doit empcher la prsence
de feux nus, de matriaux ports haute
temprature et dtincelles de toute
nature l o une atmosphre explosive
peut se former. Il convient de nutiliser que
des matriels, notamment lectriques,
conformes la rglementation issue des
directives sur les atmosphres explosives
(ATEX) [4].
Poussires
Les poussires combustibles ne consti-
tuent pas ordinairement de concentra-
tions explosives dans les atmosphres
des lieux de travail, qui seraient irrespira-
bles pour bien moins que cela. Toutefois,
des oprations courantes pelletage,
chargement ou dchargement de pro-
duits pulvrulents peuvent crer des
nuages dangereux ; les poussires de
granulomtrie fine (< 200 m), dposes
en couches et mises en suspension par
courant dair, ou les poussires mises
par des appareils insuffisamment
tanches (broyeurs, tamis, schoirs, tapis
transporteurs, etc.) peuvent constituer
occasionnellement avec lair des nuages
explosifs : poussires de charbon, de
soufre, de matires organiques telles
que farine, sucre, lait, amidon, crales,
bois, matires plastiques, poussires de
mtaux. Des atmosphres explosives
dues aux poussires sont galement pos-
sibles dans des enceintes fermes
comme les dpoussireurs et les silos.
La concentration minimale explosive dune
poussire donne dpend de plusieurs
paramtres (granulomtrie, nergie de la
source dinflammation notamment).
Les concentrations minimales explosives
des poussires sont, le plus souvent, com-
prises entre 20 et 100 g/m
3
. Les concen-
trations maximales explosives, mal connues,
sont gnralement suprieures 1 kg/m
3
.
Vis--vis des poussires inflammables, on
doit sefforcer :
de raliser la meilleure tanchit possible
des appareils et machines hors desquels
elles peuvent fuir (broyeurs, tamis, vis et
tapis de transport, mlangeurs...) ;
de capter la source, par voie sche
ou par voie humide, celles qui sont pro-
duites par les machines (meuleuses,
polisseuses...) ;
de maintenir les surfaces des locaux
exemptes de dpts (une couche de
1 mm de poussires inflammables pr-
sente un danger certain en cas de mise
en suspension dans latmosphre) ;
de ne pas procder des manuten-
tions gnratrices de nuages de pous-
sires (pelletage, chargements mal
conus de foyers, de broyeurs, de silos,
de sacs...).
On nutilisera que du matriel conforme
la rglementation sur les atmosphres
explosives [4], on y interdira de fumer et
on vitera toute formation de points
chauds ou autres sources possibles
dignition.
Afin dviter la communication du risque
aux autres locaux, on maintiendra en
dpression les enceintes ou les locaux
risque dincendie ou dexplosion.
2.2.3. Risques dus lexposition au
chaud et au froid
De nombreuses tudes montrent que la
chaleur et le froid sont des facteurs
contribuant frquemment la dtrio-
ration des conditions de travail. Les
ambiances thermiques ont une influence
indniable sur ltat de sant de lhomme.
Leurs effets peuvent de plus se manifes-
ter par un accroissement de la frquence
des accidents de travail. La rduction de
cette contrainte thermique est lun des
rles prpondrants de linstallation de
ventilation.
2.3. Autres causes dinconfort
Dautres situations inconfortables, ayant
un caractre accidentel ou permanent, se
rencontrent frquemment dans les locaux
de travail ; elles peuvent bien souvent
trouver une solution par la mise en place
dun dispositif de ventilation. Nous cite-
rons par exemple :
un taux dhumidit excessif,
des odeurs dsagrables...
3. CAPTAGE
3.1. Techniques de ventilation
Les diffrentes techniques utilisables pour
la ventilation peuvent se classer en deux
grandes catgories : la ventilation locale
par aspiration la source et la ventilation
gnrale ou ventilation par dilution.
La ventilation locale consiste capter
les polluants au plus prs possible de
leur source dmission, avant quils ne
pntrent dans la zone des voies res-
piratoires des travailleurs et ne soient
disperss dans toute latmosphre du
local (fig. 2a). Les aspirations localises
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 6
7
maintiennent les substances toxiques
dans un volume aussi faible que possible
et vacuent les polluants plutt que de
les diluer. Ces systmes demandent des
dbits dair beaucoup plus faibles que
les installations de ventilation par dilu-
tion, do des gains sur les cots din-
vestissement, de fonctionnement et de
chauffage.
La ventilation gnrale opre par dilu-
tion des polluants laide dun apport
dair neuf dans le local de travail de
manire diminuer les concentrations
des substances toxiques pour les ame-
ner des valeurs aussi faibles que pos-
sible (fig. 2b). Elle permet de diminuer les
concentrations, mais ne rduit pas la
quantit totale de polluants librs dans
latelier. De par ce principe de dispersion
des polluants, la ventilation gnrale
admet donc un niveau de pollution rsi-
duelle sur les lieux de travail. Il est prfra-
ble, pour cette raison, de ne lutiliser quen
complment de la ventilation locale,
notamment pour assurer un apport mini-
mum dair neuf dans les locaux et diluer
les polluants non capts par les systmes
daspiration localise.
La ventilation locale par aspiration la
source doit tre retenue en priorit dans
tous les cas et en particulier chaque fois
que des produits toxiques sont mis en
quantit notable. La ventilation gnrale
ne peut tre envisage en tant que tech-
nique principale dassainissement de lair
que si le recours une ventilation locale
est techniquement impossible. Elle ne
peut, dautre part, tre envisage en tant
que technique principale que lorsque les
polluants sont peu toxiques, mis un
dbit trs faible, ou dans toute situation
spcifique prcise dans le guide cor-
respondant une industrie particulire.
Quelle que soit la solution choisie quant
au mode de ventilation, il est ncessaire
de compenser les sorties dair vhiculant
les polluants par des entres dair neuf
(ou partiellement recycl dun autre local
dont la pollution est de mme nature,
aprs puration dans le cas des locaux
pollution spcifique) en quantit quiva-
lente. Le dbit minimal dair neuf intro-
duire dans les locaux de travail (quils
soient pollution spcifique sil y a
mission de polluants ou pollution non
spcifique si la pollution est lie la
seule prsence humaine, et quelle que
soit la technique de ventilation retenue)
est fix de manire rglementaire [1].
Le rejet de lair pollu lextrieur des
locaux ncessite galement une tude
approfondie de la configuration gnrale
du btiment et de son environnement de
manire viter tout recyclage intempes-
tif des polluants [10].
3.2. Ventilation locale par aspiration
la source
3.2.1. Principes
I. Envelopper au maximum la zone de
production de polluants.
Il. Capter au plus prs de la zone dmis-
sion.
III. Placer le dispositif daspiration de
manire que loprateur ne soit pas entre
celui-ci et la source de pollution.
IV. Utiliser les mouvements naturels des
polluants.
V. Induire une vitesse dair suffisante.
VI. Rpartir uniformment les vitesses
dair au niveau de la zone de captage.
VII. Compenser les sorties dair par des
entres dair correspondantes.
VIII. viter les courants dair et les sensa-
tions dinconfort thermique.
IX. Rejeter lair pollu en dehors des
zones dentre dair neuf.
1. Envelopper au maximum la zone
de production de polluants
On sefforcera denfermer autant que
possible lopration polluante dans une
enceinte, une cabine ou laide de
parois, rideaux, etc., de faon , simul-
tanment, contenir au maximum les pol-
luants, diminuer la surface de la zone
par laquelle ceux-ci peuvent schapper
et rduire les effets nuisibles des cou-
rants dair. Les capotages devront tre
conus de faon ne pas apporter de
gne pour les oprateurs.
Ce principe permet daugmenter lefficacit
des dispositifs daspiration et de diminuer
les dbits mettre en jeu (fig. 3).
Fig. 2. Exemple de deux principaux types de ventilation (daprs McDermott [5]).
Fig. 3. Envelopper au maximum la zone
de production des polluants.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 7
8
II. Capter au plus prs de la zone
dmission
Lefficacit des dispositifs daspiration
diminue trs rapidement avec la distance.
Ainsi, par exemple, la vitesse dair dans
laxe dun dispositif de captage nest plus
que le dixime de la vitesse moyenne
dans louverture une distance gale au
diamtre de celle-ci.
Le positionnement au plus prs du sys-
tme daspiration permet de garder une
bonne efficacit en utilisant des dbits
daspiration plus faibles (fig. 4).
III. Placer le dispositif daspiration de
manire que loprateur ne soit pas
entre celui-ci et la source de pollution
Le mouvement de lair propre doit toujours
se faire dans le sens de loprateur vers la
source de pollution puis vers le dispositif
daspiration. Ainsi, louvrier faisant de la
peinture par pulvrisation ne doit jamais se
trouver entre la pice peindre et la face
aspirante de la cabine ; si louvrier doit se
pencher au-dessus dun processus pol-
luant, on ne doit pas utiliser de hotte en
dme, etc. (fig. 5).
IV. Utiliser les mouvements naturels
des polluants
Pour des applications mettant un jet de
particules grande vitesse initiale (meu-
lage, ponage, etc.), placer le dispositif
de captage de faon ce quil intercepte
le trajet des poussires grossires et donc
puisse capter les poussires fines entra-
nes dans le sillage cr par ces der-
nires (fig. 6).
Si cela nest pas possible, on installera
des crans pour casser le mouvement
des grosses particules et avec lui la tra-
ne qui cause la dispersion des fines
particules.
Dans le cas dmission dair pollu chaud,
les dispositifs de captage seront placs de
manire tenir compte de la force ascen-
sionnelle des gaz chauds et du dbit dair
induit en prenant soin, toutefois, de res-
pecter le principe prcdent.
V. Induire une vitesse dair suffisante
Pour que le captage des polluants soit
effectif, il est ncessaire que les vitesses
ou les dbits dair soient suffisants pour
sopposer aux effets dispersifs des cou-
rants dair et aux mouvements initiaux de
lair pollu, de faon forcer ce dernier
scouler lintrieur du rseau daspi-
ration (fig. 7). Les valeurs mettre en jeu
Fig. 4. Capter au plus prs de la zone
dmission des polluants (pour induire la
mme vitesse une distance double, il
faut multiplier le dbit par 4).
Fig. 7. Capter les polluants en induisant
une vitesse dair suffisante.
Fig. 5. La tte de loprateur ne doit jamais se trouver entre le dispositif de captage
et la source de pollution.
Fig. 6. Disposer les systmes de captage en utilisant les mouvements naturels des
polluants.
Exemple du meulage : un dispositif de captage plac sur le trajet des grosses particules peut capter
la plus grande partie des poussires mises. Si celui-ci tait dispos loppos du jet des grosses
particules, il ne pourrait pas capter les fines particules entranes dans le sillage de ces dernires.
a) Vitesse induite au point
dmission suffisante.
b) Vitesse induite au point
dmission insuffisante.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 8
9
sont notamment fonction du type dap-
plication, de la toxicit et du dbit des
polluants, des courants dair rsiduels,
de la force ascensionnelle des gaz
chauds. Cet aspect sera dtaill dans le
chapitre 3.2.2. consacr aux solutions
de ventilation locale.
VI. Rpartir uniformment les vitesses
dair au niveau de la zone de captage
Les critres de ventilation sont gnrale-
ment exprims sous forme de valeurs
minimales des vitesses moyennes daspi-
ration au niveau de la zone de captage.
Les vitesses daspiration doivent tre
rparties le plus uniformment possible
de faon viter des fuites dair pollu
par les zones de plus faible vitesse das-
piration (fig. 8).
Les principes VII, VIII et IX relatifs aux pro-
blmes de compensation, dinconfort
thermique et de rejet de lair, communs
aux dispositifs de ventilation locale et de
ventilation gnrale, seront abords aux
chapitres 6 et 7.
3.2.2. Solutions
Dans la suite, on dsignera par dispositif
de captage, toute entre dun systme de
ventilation locale par laquelle lair pollu
est entran hors de lambiance de late-
lier ; cest la partie la plus importante dun
systme de ventilation locale. Une mau-
vaise conception initiale de cet lment
peut empcher le systme de capter cor-
rectement les polluants ou peut conduire,
pour compenser ce mauvais choix initial,
des dbits et des cots de fonctionne-
ment et dinstallation excessifs.
On distingue, par ordre de prfrence
dcroissante, trois types principaux de
dispositifs de captage : enveloppants,
inducteurs et rcepteurs. Chaque type
fonctionne selon des principes propres et
il faut prendre garde de ne pas calculer
lun deux avec les critres qui sappli-
quent un autre.
a) Dispositifs de captage enveloppants
Un dispositif de captage enveloppant
est un lment qui entoure le point
dmission de telle sorte que toute lac-
tion dispersive initiale du polluant ait lieu
lintrieur de celui-ci. Il est possible
den distinguer trois types : les
enceintes, les cabines ouvertes et les
cabines fermes. Malgr tout, lenve-
loppe protectrice ainsi forme doit rester
semi-tanche : un certain nombre dou-
vertures sont ncessaires au processus
lui-mme (passage dobjets,
convoyeurs...) et au maintien dun dbit
dair de compensation. Plus laire totale
de ces ouvertures sera rduite, plus
forte sera la dpression de lenveloppe
par rapport lambiance extrieure et
plus les vitesses de captage dans les
ouvertures seront importantes pour un
mme dbit daspiration.
Enceintes
Les enceintes enferment la source pres-
que compltement avec des ouvertures
de petite taille pour le passage des pi-
ces (fig. 3a), loprateur se trouvant lex-
trieur. Une enceinte est conue
pour crer une vitesse dair au travers des
ouvertures de faon empcher que le
polluant mis lintrieur ne sen
chappe. En gnral, les enceintes
demandent des dbits dair faibles et
contrlent bien les polluants mis
lintrieur ; pour certains polluants trs
toxiques, ce sont les seuls systmes
acceptables.
Dans le cas gnral, le dbit daspiration
se calcule suivant la formule :
Q = A V
e
(1)
Q : dbit daspiration (m
3
/s) ;
A : aire totale des ouvertures (m
2
) ;
V
e
: vitesse dentre de lair au travers
des ouvertures vers lintrieur (m/s).
ce dbit daspiration, on ajoutera, le
cas chant, le dbit de gaz mis lin-
trieur de lenceinte et, en cas de source
chaude intrieure, le dbit induit par
convection naturelle en tenant compte
des risques de fuite au travers de fissures
ventuelles en partie suprieure [3].
La valeur de la vitesse V
e
, dpend du pro-
cd et de lenvironnement (courants
dair...). Dune faon gnrale, on admet
quune vitesse de 0,5 1 m/s est suffi-
sante si le polluant nest pas projet
directement sur les parois. Cette valeur
sera augmente en cas de forte toxicit
ou dmission abondante de polluants.
Cabines ouvertes
Les cabines ouvertes peuvent tre consi-
dres comme des enceintes dont une
paroi a t en partie ou totalement retire.
Elles doivent tre assez grandes (et en
particulier assez profondes) pour contenir
entirement la zone naturelle de pollution.
Laspiration est en gnral situe en par-
tie arrire. Loprateur peut tre plac
lintrieur ou lextrieur de la cabine,
mais jamais entre la source de pollution
et laspiration. Les cabines ouvertes de
peinture par pulvrisation et les sorbon-
nes de laboratoire en sont deux exemples.
Le dbit daspiration dans louverture est
donn par la relation :
Q = A V
f
(2)
Q : dbit daspiration (m
3
/s) ;
A : aire de la face ouverte (m
2
) ;
V
f
: vitesse moyenne de lair dans la face
ouverte (m/s).
Comme pour les enceintes, on ajoutera
ce dbit, le cas chant, les dbits de gaz
gnrs lintrieur ou les dbits dair
induits par convection naturelle.
Les valeurs des vitesses dair V
f
dpen-
dent du procd, du mode dmission et
de la toxicit des polluants, de la qualit
de la rpartition des vitesses dair dans
Fig. 8. Rpartir uniformment les vitesses
dair au niveau de la zone de captage des
polluants.
Cabine ouverte avec une bonne distribution
de lair.
Dispositifs de
rpartition
Cabine avec une mauvaise distribution
de lair (fuites du polluants dans les
angles).
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 9
10
louverture, etc. On se reportera aux
ouvrages spcialiss pour des applica-
tions spcifiques [6, 7].
Une des conditions essentielles du bon
fonctionnement des cabines ouvertes
est lexistence dune rpartition la plus
uniforme possible des vitesses dair
(fig. 8). Si la cabine est prvue pour que
loprateur se trouve lextrieur (petites
dimensions), on visera une bonne rpar-
tition dans la face ouverte. Si elle est pr-
vue pour que loprateur se trouve lin-
trieur (cette situation est prfrable), on
essayera davoir un coulement aussi
uniforme que possible au niveau de
loprateur, en particulier en vitant de
crer des zones de turbulence par des
obstacles, des bords tombs, etc.
Pour obtenir une bonne rpartition du
dbit dair, il est possible dutiliser, vers
larrire de la cabine, des tles perfo-
res, des filtres ou des fentes associes
un caisson ; plus la cabine sera pro-
fonde, meilleure sera la rpartition des
vitesses. En outre, une cabine profonde
avec la source de pollution place prs
du fond contient mieux la zone naturelle
de dispersion des polluants et vite les
retours dair pollu vers loprateur.
Cabines fermes
Loprateur et la source de pollution
sont placs dans un local clos o ont
t mnages des ouvertures pour une
introduction et une extraction contrles
de lair. Les cabines fermes de peinture
par pulvrisation [11] ou de dcapage
au jet dabrasifs en constituent deux
exemples.
Le sens de lcoulement de lair doit tre
choisi pour que loprateur ne soit
jamais plac entre la source de polluants
et laspiration. Un coulement vertical de
haut en bas sera retenu lorsque lopra-
teur doit tourner autour de la pice.
Les ouvertures dintroduction et dex-
traction dair doivent tre quipes de
caissons de dtente, de fentes, de tles
perfores ou de filtre de rpartition pour
que lcoulement de lair soit le plus uni-
forme possible dans toutes les sections
droites.
La vitesse doit tre dtermine en fonc-
tion du type dapplication ; on veillera
avoir une bonne homognit de la
vitesse de lair dans la cabine.
b) Dispositifs de captage inducteurs
Principes de fonctionnement
Au contraire des disposififs enveloppants,
qui contiennent la source de polluants et
utilisent des vitesses dair pour empcher
les polluants de schapper, les dispositifs
de captage inducteurs, placs proximit
de la source doivent gnrer des vitesses
dair dans la zone dmission pour entra-
ner lair pollu lintrieur du rseau das-
piration et de transport.
Pour des dispositifs de captage induc-
teurs, le critre respecter est la vitesse
dair induite au point dmission des
polluants. La valeur des vitesses dans
louverture du dispositif ou dans les
canalisations ne peut en aucun cas
constituer un critre de captage. Lors
de la conception dun dispositif de cap-
tage inducteur, lordre correct des op-
rations suivre est le suivant :
positionner le dispositif en respectant
les principes noncs au paragraphe
3.2.1. ;
dterminer, en fonction du procd et
du mode de gnration des polluants, la
vitesse de captage mettre en jeu au
point dmission ;
partir de cette vitesse et de la distance
entre le dispositif de captage et la source,
calculer le dbit daspiration ncessaire ;
partir de ce dbit et en fonction des cri-
tres de distribution des vitesses, de
pertes de charge, de bruit araulique et de
vitesse de transport de lair pollu, dter-
miner les dimensions des ouvertures du
dispositif de captage et des canalisations.
Les vitesses induites en direction du dis-
positif de captage doivent tre rparties
uniformment sur toute la zone dmis-
sion des polluants ou, dfaut, tre
suprieures aux valeurs minimales indi-
ques ci-dessous au point dmission le
plus loign du dispositif de captage.
Vitesse de captage
La vitesse dair induire dans la zone
dmission dpend du procd de fabri-
cation et de son environnement. Cette
vitesse doit tre suffisante pour entraner
le polluant et sopposer aux effets dis-
persifs des courants dair et aux mouve-
ments initiaux de lair pollu. Elle sera
majore en prsence de courants dair
perturbateurs importants, de polluants
trs toxiques ou mis en grande quan-
tit, dun petit dispositif de captage ou
dune aspiration trs localise.
Le tableau III donne, titre indicatif,
quelques exemples de valeurs mini-
males des vitesses de captage induire
au point dmission (le critre vitesse
dair au point dmission a t prfr
au critre vitesse dair au point nul
propos par Hemeon [3], qui semble
TABLEAU III
Exemples de valeurs minimales des vitesses de captage
mettre en jeu au point dmission (daprs [6, 8])
Conditions Vitesse
de dispersion Exemples de captage
du polluant (m/s)
mission sans vitesse initiale vaporation de rservoirs 0,25 - 0,5
en air calme Dgraissage
mission faible vitesse en Remplissage intermittent de fts 0,5 -1,0
air modrment calme Soudage
Brasage largent
Dcapage
Traitements de surface
Gnration active en zone Remplissage de fts en continu 1,0 - 2,5
agite Ensachage de sable pulvris
Mtallisation (toxicit faible)
Perage de panneaux en amiante-ciment
mission grande vitesse initiale Meulage 2,5 - 10
dans une zone mouvement Dcapage labrasif
dair trs rapide Machine surfacer le granit
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 10
11
dutilisation moins pratique). Les four-
chettes de valeurs de ce tableau ne
figurent que pour donner une ide des
ordres de grandeur des vitesses de
captage habituellement conseilles. La
valeur de la vitesse utiliser doit tre
dtermine pour chaque application
prcise lintrieur de fourchettes plus
troites.
Relations entre dbit et vitesse
La vitesse dair en un point situ proxi-
mit dun dispositif de captage inducteur
dpend du dbit daspiration, de la dis-
tance louverture, de la forme du dispo-
sitif de captage, de la prsence dcrans,
etc.
On distinguera trois types de dispositifs
de captage inducteurs diffrents :
les bouches daspiration dont louver-
ture est circulaire ou rectangulaire avec
dans ce dernier cas :
L
< 5
b
L,b : longueur et largeur du rectangle
douverture (m) ;
les fentes daspiration, longues et
troites avec :
L
> 5
b
les buses daspiration, de petite taille,
utilises pour les systmes daspiration
faible dbit et grande vitesse dair,
proximit immdiate de la source.
La figure 9 montre, daprs les rsultats
de Dallavalle [9], la forme des surfaces
dgale vitesse devant une bouche das-
piration circulaire sans collerette et avec
collerette. Les vitesses sont indiques en
pourcentage de la vitesse moyenne dans
la section dentre V
0
. Cette figure mon-
tre que la vitesse induite dcrot trs
rapidement avec la distance au dispositif
de captage, puisque, par exemple, une
distance gale au diamtre de louver-
ture, elle nest plus dans laxe que den-
viron 7 % de V
0
sans collerette et denvi-
ron 10 % de V
0
, avec collerette.
Pour assurer un captage efficace, les
dimensions dun dispositif de captage
inducteur doivent tre en rapport avec
ltendue de la zone dmission des pol-
luants et lair aspir doit tre rparti uni-
formment dans louverture (voir le para-
graphe suivant). Cependant, si la zone
dmission nest pas trop grande ou est
ponctuelle, on pourra, au lieu dutiliser
des rseaux de courbes comme ceux de
la figure 9, se contenter de formules dun
emploi plus facile donnant la vitesse
induite dans laxe du dispositif de cap-
tage en fonction de la distance.
Les relations empiriques liant dbit
daspiration, distance X entre le dispo-
sitif de captage et le point considr et
vitesse dair induite dans laxe du dis-
positif sont indiques dans le tableau IV.
Elles permettent de retrouver la
dcroissance trs rapide de la vitesse
induite avec la distance au dispositif de
captage. Ainsi, par exemple, la relation (3)
permet de rendre compte du cas de la
TABLEAU IV
Relations entre dbit daspiration et vitesses dair induites
devant un dispositif de captage inducteur (daprs [3, 6, 8])
a) Cas des bouches daspiration (L/b < 5)
Fig. 9. Surfaces dgale vitesse devant
une bouche daspiration circulaire
(daprs Dallavalle [9])
a) sans collerette
b) avec collerette
%
d
u
d
i
a
m
t
r
e
%
d
u
d
i
a
m
t
r
e
Dbit dair
Q = (10 X
2
+ A) V
Bouche isole sans collerette ex : Q = 4 570 m
3
/h
Q = 0,75 (10 X
2
+ A) V
Bouche isole avec collerette ex : Q = 3 430 m
3
/h
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 11
12
Q = (5 X
2
+ A) V
Bouche sans collerette reposant sur un plan ex : Q = 2 320 m
3
/h
Q = 0,75 (5 X
2
+ A) V
Bouche avec collerette reposant sur un plan
Pour X assez grand
(1)
Q = 314 X
2
V
ex : Q = 1 740 m
3
/h
4 cts ouverts
Q = 1,4 PHV
Hotte en dme 2 cts ouverts
b et L
Q = (b + L) HV
(1)
Les surfaces dgale vitesse sont alors des quarts de sphre (selon Hemeon [6]).
b, L (m) : largeur et longueur de la bouche ;
A = bL (m
2
) : section de la face ouverte de la bouche ;
V (m/s) : vitesse dair induite la distance X (m) ;
P (m) : primtre de la source.
Formules valables pour X petit devant les dimensions de la bouche et pour une zone situe prs de laxe de celle-ci ( au moins 2X des bords de la bouche).
b, L (m) : largeur et longueur de la fente ;
V (m/s) : vitesse dair induite la distance X (m) ;
Formules valables pour X > 0,4 b.
Dbit dair
Fente isole sans collerette Q = 3,7 LXV
Fente isole avec collerette Q = 2,8 LXV
Fente sans collerette appuye sur un plan Q = 2,8 LXV
Fente aspirant dans un volume
Q = 1,6 LXV
limit par deux plans
a) Cas des fentes daspiration (L/b > 5)
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:34 Page 12
13
bouche isole sans collerette reprsen-
te sur la figure 9a :
Q = (10 X
2
+ A) V (3)
Q : dbit dair aspir par le dispositif de
captage (m
3
/s) ;
X : distance entre la face ouverte et le
point considr sur laxe (m) ;
V : vitesse dair induite (m/s).
Selon certains auteurs (Hemeon [3]),
pour des distances assez grandes, on
peut admettre que les surfaces dgale
vitesse sont uniquement dtermines
par des considrations de rvolution ou
de symtrie. Ainsi, selon Hemeon, dans
le cas dune bouche avec collerette
reposant sur un plan, distance suffi-
sante, les surfaces dgale vitesse sont
des quarts de sphre (fig. 10) et le dbit
daspiration et la vitesse induite sont lis
par :
Q = X
2
V (4)
On notera, dans la troisime colonne du
tableau IV, les rductions de dbit trs
importantes qui peuvent tre obtenues en
ajoutant des parois, des crans, des col-
lerettes, en prenant titre dexemple, les
valeurs suivantes :
b = 0,16 m, L = 0,25 m, A = 4 x 10
-2
m
2
et
V = 0,5 m/s X = 0,5 m
Cependant, dans de nombreuses appli-
cations, les relations entre la vitesse dair
induite et le dbit daspiration ne sont
pas connues. Cest, par exemple, le cas
des buses de captage intgres aux
outils portatifs, ou encore lorsque Ies
dispositifs de captage ont une forme
gomtrique complique ou semi-enve-
loppante (tourets de meulage, machines
bois, etc.). Les critres de ventilation
sont alors exprims directement en
valeurs du dbit daspiration en fonction
de paramtres comme la largeur de
bande, le diamtre de la meule, etc.
Systmes de rpartition des vitesses
dair
Plusieurs dispositifs peuvent tre utili-
ss pour rpartir les vitesses dair
lentre des dispositifs daspiration :
convergent, fentes linaires, fentes de
largeur variable, aubes directrices,
grilles perfores faible taux de perfo-
ration, filtres associs un caisson de
rpartition, etc. Ces dispositifs sont
dcrits en dtail dans le manuel
de lACGIH [6]. Deux rgles empiriques
peuvent tre retenues : dans le cas de
la rpartition par convergent, langle
intrieur optimum est de 60 et ne doit,
en aucun cas, dpasser 90 ; dans le
cas de fentes associes un caisson
de rpartition, la vitesse dair dans les
fentes (souvent fixe aux environs de 5
10 m/s) doit tre au moins gale
deux fois la vitesse dair moyenne dans
le caisson (fig. 11).
Exemple de calcul
Sur le captage des fumes dune
opration de soudage, la solution
retenue, compte tenu des
contraintes du poste, est une table
aspiration par une fente arrire (fig.
12). Comme indiqu au dbut de ce
paragraphe en b, lordre des opra-
tions est le suivant :
Fig. 10. Bouche daspiration avec large
collerette reposant sur un plan. Pour
des distances la bouche assez
grandes, les surfaces dgale vitesse
peuvent tre assimiles des quarts
de sphre (daprs Hemeon [3]).
Fig. 12. Table aspirante avec fente
daspiration arrire.
Fig. 11. Rpartition
des vitesses
lentre dune
bouche daspiration.
conduit
dextraction
crans
latraux
plan de
soudage
fente
daspiration
caisson de
rpartition
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 13
14
application des principes de venti-
lation locale : la table a t munie de
parois larrire et sur les cts, le
soudage doit tre fait au plus prs de
la fente daspiration, on utilise un
caisson pour rpartir uniformment
les vitesses sur la longueur de la
fente ;
choix de la vitesse de captage au
point dmission en fonction de la
nature de lopration : V
c
= 0,5 m/s ;
calcul du dbit daspiration : la
vitesse de captage doit tre induite
jusquau point le plus loign de la
fente daspiration, cest--dire
jusqu une distance gale la lar-
geur de la table. Les surfaces dgale
vitesse tant dans le cas considr
des quarts de cylindre, le dbit se
calcule en utilisant les notations de la
figure 12 par la formule :
Q
lL V
c
(5)
2
ce qui, pour la table considre
(650 x 12 x 10
-4
m
2
), conduit :
Q = 0,61 m
3
/s = 2 200 m
3
/h
calcul de la largeur de la fente b :
le choix de la vitesse dans la fente
est fait en fonction des critres de
distribution des vitesses, des pertes
de charge, des bruits arauliques ;
dans un atelier assez peu bruyant,
on peut se fixer une vitesse dair
lentre de la fente V
e
= 6 m/s ; do
le calcul de b :
b =
Q
(6)
LV
e
cest--dire b = 85 x 10
-3
m
calcul de la largeur du caisson : la
vitesse dair dans le caisson doit tre
au maximum gale la moiti de la
vitesse aux fentes ; le caisson doit
donc avoir une largeur minimale de
2b, soit 170 mm ;
calcul du diamtre de dpart de
la canalisation : si lon choisit une
vitesse de transport de lair pollu
V
t
= 10 m/s (cf. plus loin le tableau
VI), le diamtre des canalisations d
doit tre gal :
d =
4 Q
(7)
V
t
cest--dire d = 0,28 m = 280 mm.
Utilisation dun coulement dair secondaire
Un procd de captage original
consiste associer un dispositif de
captage inducteur un coulement
secondaire engendr par un jet dair ou
par une deuxime aspiration [12]. Il se
cre une paroi immatrielle sparant
lcoulement dair pollu allant vers la
fente inductrice et lcoulement dair
secondaire propre.
Ce procd, quil ne faut pas confondre
avec certains types de dispositifs de
captage rcepteurs utilisant des jets
dair (systmes push-pull ), permet,
efficacit gale, de mettre en uvre des
dbits daspiration rduits, do des
gains en cots dinstallation, dpura-
tion, de chauffage de lair neuf, etc.
c) Dispositifs de captage rcepteurs
Les dispositifs de captage rcepteurs,
comme les dispositifs inducteurs, ne
contiennent pas la source de pollution
mais sont placs proximit.
Toutefois, ils ne sont utilisables que dans
le cas o les polluants sont entrans
spontanment vers le dispositif de cap-
tage par le processus de travail, le rle
du ventilateur se limitant vacuer lair
pollu au fur et mesure. Ils se distin-
guent donc sur ce point des dispositifs
inducteurs, et les notions de vitesse de
captage et de surfaces dgale vitesse
ne jouent aucun rle.
Lair pollu peut tre entran :
par convection : cas des processus
chauds, on utilisera alors une hotte en
dme dans la mesure o les oprateurs
nont pas intervenir au-dessus de la
source ;
par induction dans le sillage de particules :
dversement de matriaux pulvrulents ;
par des jets dair : cas des systmes
push-pull installs sur des cuves de
traitement de surface [13] ;
par la force centrifuge : poussires de
meulage, etc. (dans ce cas, un dispositif
de captage rcepteur ne peut servir qu
contrler les grosses particules et ne peut
pas capter les particules respirables qui
ont des distances darrt trs faibles
(tableau II) et ne parviennent pas jusqu
lui).
Dune faon gnrale, les dispositifs de
captage rcepteurs sont dun emploi et
dun calcul plus dlicat que les disposi-
tifs de captage inducteurs et ils sont
beaucoup plus sensibles aux courants
dair (en particulier lorsque les polluants
sont entrans par convection naturelle).
4. TRANSPORT DES POLLUANTS
Lair pollu capt sur les lieux de travail
doit tre vacu vers lextrieur et, selon
les cas, pur conformment la rgle-
mentation des installations classes.
Les mthodes de calcul des tuyauteries
et du ventilateur sont fondes sur la
dtermination de la rsistance lcou-
lement de lair dans les canalisations qui,
combine avec le dbit dair requis, dfi-
nit les conditions de fonctionnement du
ventilateur.
Dune faon gnrale, le dimension-
nement des tuyauteries rsulte dun
compromis entre les contraintes co-
nomiques (investissement fonction-
nement), les diamtres disponibles de
tuyauteries, les pertes de charge admis-
sibles, les vitesses minimales de trans-
port, les phnomnes dabrasion, de
bruit, etc. Dautres paramtres peuvent
intervenir comme les pentes des tuyau-
teries, des problmes de rglage, des
variations de dbits dans le temps, lhu-
midit des poussires et de lair, la pr-
sence de gaz corrosifs, la prsence de
trappes de visite ou dvents de
dcharge, etc.
4.1. coulement de lair dans les
canalisations
4.1.1. Pression statique et pression
dynamique
La pression (relative) en un point dun
fluide en coulement est la somme de
deux termes :
une pression toujours positive et exer-
ce dans le sens de lcoulement appele
pression dynamique P
d
qui est gale :
P
d
=
1
v
2
(8)
2
P
d
: pression dynamique (Pa) ;
: masse volumique du fluide (kg/m
3
) ;
v : vitesse locale du fluide (m/s) ;
une pression exerce par ce fluide, que
celui-ci soit en mouvement ou non, per-
pendiculairement aux parois de len-
ceinte ou de la canalisation, pression
que lon appelle pression statique p
s
et
qui peut tre ngative ou positive.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 14
15
La pression totale p
t
est donc la somme
algbrique des pressions statique et
dynamique :
p
t
= p
s
+ p
d
(9)
Les diffrents termes peuvent tre mesu-
rs sparment laide dun tube de Pitot
double (fig. 13).
En gnral, compte tenu des valeurs des
pressions ou dpressions mises en jeu
dans les systmes de ventilation, on
admet que lair se comporte tout au
long des canalisations comme un fluide
incompressible. Sa masse volumique
dpend de la pression baromtrique, de
la temprature et de lhumidit de lair.
On pourra retenir que, sous la pression
atmosphrique normale 20 C, la
masse volumique de lair est voisine de
1,20 kg/m
3
.
Le tableau V donne quelques valeurs de
correspondance entre pression dyna-
mique et vitesse dair. Lunit lgale de
pression est le pascal (Pa) ; 1 Pa g 0,10
mm de colonne deau (0,10 mm CE).
TABLEAU V
Correspondance entre
vitesse dair
et pression dynamique
(pour de lair = 1,2 kg/m
3
)
la vitesse moyenne V dans une
section droite de canalisation, dfinie
comme le quotient du dbit Q par laire
de la section droite A, V = Q/A,
on fait correspondre une pression
dynamique : P
d
=
1
V
2
qui sert de
base pour le calcul des pertes de
charges (voir plus loin).
4.1.2. Vitesse de lair
Les vitesses de lair dans les canali-
sations doivent tre choisies pour cha-
que installation en fonction de la nature
et des proprits des polluants.
La vitesse de transport est un facteur
essentiel pour les rseaux dvacuation
de lair contenant des poussires :
elle doit tre suprieure une valeur
minimale de faon viter une
sdimentation des poussires et un bou-
chage des canalisations. Elle est dau-
tant plus grande que les particules sont
de masse volumique et de dimensions
leves.
Si les polluants sont uniquement des gaz
ou des vapeurs, la vitesse de transport
sera choisie de faon raliser un quili-
bre entre les cots dinstallation et de
fonctionnement.
Le tableau VI tabli par lACGIH [6]
donne, titre indicatif, des vitesses de
transport minimales pour diffrents cas
dair pollu.
4.1.3. Pertes de charge
Lair scoulant dans une canalisation
subit une chute de pression totale p (Pa)
appele perte de charge.
Vitesse dair
(m/s)
Pression dynamique
(Pa) (mm CE)
5
10
13
15
18
20
22
25
15
60
101
135
194
240
290
375
1,5
6,1
10,3
13,8
19,8
24,5
29,6
38,2
2
Fig. 13. Mesure de la pression statique, de la pression dynamique et de la pression
totale (cas dune gaine en dpression).
TABLEAU VI
Gamme des valeurs minimales
des vitesses de transport dair pollu dans les canalisations [6]
Exemples de polluants
Vitesse minimale
(m/s)
Fumes Fumes doxydes de zinc et daluminium 7 10
Poussires trs Peluches trs fines de coton 10 13
fines et lgres
Poussires sches Poussires fines de caoutchouc, de 13 18
et poudres moulage de baklite ; peluches de jute ;
poussires de coton, de savon
Poussires Abrasif de ponage sec ; poussires de 18 20
industrielles meulage ; poussires de jute, de granit ;
moyennes coupage de briques, poussires dargile,
de calcaire
Poussires lourdes Poussires de tonneaux de dsablage ou 20 23
de dcochage, de sablage, dalsage de fonte
Poussires lourdes Poussires de ciment humide, de > 23
ou humides dcoupe de tuyaux en fibres-ciment, ou transport
chaux vive pneumatique
humide
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 15
16
Celle-ci reprsente lnergie dgage
sous forme de chaleur dans lunit de
volume sous leffet des frottements
dus la viscosit de lair ; elle est direc-
tement lie la vitesse de lcoulement
et donc la pression dynamique. On
distingue deux types de pertes de
charge.
a) Pertes de charge par frottement
Les pertes de charge dues des frotte-
ments le long des parois de conduits
rectilignes section constante sont
proportionnelles la longueur du
conduit. Elles peuvent se mettre sous la
forme :
p =
L
pd =
L
V
2
(10)
D D 2
L et D : longueur et diamtre du
conduit (m).
Le coefficient sans dimension dpend
en particulier de la rugosit des parois.
Pour les calculs, on se sert gnralement
dabaques qui donnent la perte de charge
par unit de longueur, p/L, connaissant
le diamtre D et le dbit Q (m
3
/s) ou la
vitesse moyenne de lair V (m/s).
Les pertes de charge par frottement sont
proportionnelles au carr de la vitesse
dcoulement. Le tableau VII donne des
exemples pour un dbit de 1 m
3
/s.
TABLEAU VIl
Valeurs des pertes de charge
en fonction de la vitesse
dcoulement
De la mme manire, le frottement
est trs dpendant des matriaux
constitutifs du conduit et de son aspect
de surface (tableau VIII).
b) Pertes de charge singulires (fig. 14)
Ces pertes de charge sont dues
lentre de lair dans les canalisations, au
rejet de lair hors des canalisations et aux
singularits de parcours (coudes, raccor-
dements, largissements, contractions
TABLEAU VIlI
Valeurs des pertes de charge
en fonction des matriaux
constitutifs des conduits
grilles, batteries et filtres en tenant
compte de leur seuil dencrassement
admissible en service, changeurs et
rcuprateurs thermiques, silencieux,
etc.).
4.2. Conception du rseau
La conception dun rseau doit dbuter
par la recherche dun compromis
entre les diffrents critres suivants
qui feront que les dbits mettre
en uvre, qui sont imposs, seront
respects la fois dans chaque
tronon et globalement dans toute
linstallation :
Diamtre Vitesse Perte
de de
tuyauterie charge
(mm) (m/s) (Pa/m) (mm CE/m)
400 8 1,8 0,2
200 32 55 5,6
Matriau constitutif
de la gaine Perte de charge
(diamtre 400 mm, (Pa/m)
dbit 1 m
3
/s)
Matire plastique ............. 1,46
Acier galvanis ................ 1,60
Bton ordinaire................. 2,33
Bton grossier, briques .... 3,28
Gaine souple annele ...... 10,15
Fig. 14. Exemples de valeurs du coefficient de pertes de charge singulires k [12].
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 16
17
choix des vitesses dair induire en
chaque point, compatibles avec lappli-
cation envisage ;
prdimensionnement des lments du
rseau : la figure 15 illustre quelques
rgles simples de construction des
tuyauteries destines limiter les
pertes de charge. Dune faon gn-
rale, les changements de direction de
lcoulement ne devront pas tre
brusques, mais adoucis (coudes,
piquages, changement de section, etc.).
Dans la mesure du possible, on vitera de
raccorder au mme ventilateur des
branches de diamtres trs diffrents, et
on essayera de raccorder les branches
de plus petit diamtre proximit du
ventilateur ;
quilibre du rseau : lorsquen un
point dun circuit, deux tuyauteries se
rejoignent (fig. 16), lair se rpartira entre
les deux branches de faon que les
pertes de charge des deux portions en
amont, jusquau point de jonction M,
soient gales.
Les tronons de rseaux pouvant tre
de longueurs trs diffrentes dans une
installation, il sensuit que, pour obtenir
les dbits dsirs chaque bouche ou
dans chaque tronon, un calcul rigoureux
des pertes de charge doit tre tabli.
Il y a donc intrt garder, pour chaque
tronon, le mme principe de calcul des
pertes de charge pour simplifier ultrieu-
rement les oprations dquilibrage.
Bien que ces calculs soient laffaire
du spcialiste, il est bon de noter quil
existe deux grandes mthodes de
calcul [16, 17] qui sont :
les pertes de charge linaires constantes ;
les gains de pression statique.
Pertes de charge linaires constantes
On choisit la vitesse
soit dans le tronon de raccordement
au ventilateur,
soit dans le piquage le plus loign et
on dtermine la perte de charge linaire
correspondante.
Pour chaque tronon, connaissant le dbit
requis et la perte de charge linaire
admise, on en dduira le diamtre quiva-
lent puis les dimensions de la gaine.
Cette mthode de dtermination
entrane une rduction automatique de
la vitesse dair dans le sens de lcou-
lement.
Gains de pression statique
Le principe de cette mthode consiste
dimensionner chaque tronon de telle
manire que laugmentation de pres-
sion statique due la diminution de la
vitesse aprs chaque piquage com-
pense exactement sa perte de charge.
Ainsi, la pression statique reste la mme
chaque piquage ou diffuseur, et le
mme dbit traversera tous les
piquages de mme section.
La mthode des pertes de charge
lineaires constantes conduit des
cots dinstallation plus faibles et sap-
plique surtout aux installations basse
vitesse (V < 10 m/s). Elle ncessite la
mise en uvre de dispositifs dqui-
librage, la pression ntant pas
constante dans les gaines, mais les cal-
culs sont assez simples. Fig. 15. Dimensionnement des gaines.
Fig. 16. Raccordement des deux rseaux.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 17
18
La mthode des gains de pression statique
conduit des cots dexploitation plus
faibles et est surtout rserve aux instal-
lations haute vitesse (V > 20 m/s). Les
installations sont plus faciles quilibrer
du fait de la pression quasi-constante
dans les gaines, mais les calculs sont
assez ardus et ncessitent parfois lutili-
sation dun ordinateur pour des rseaux
complexes.
4.3. quilibrage de linstallation
Pour obtenir la distribution souhaite des
dbits dair dans les diffrents tronons
de linstallation, on pourra complter
lquilibrage de la pression statique
ralis la conception par un rglage de
registres ou de volets.
Cette fois, ce sont des registres ou des
volets qui permettent dajuster, sur
chaque point de captage, les dbits dair
dsirs.
On prtera alors une attention particulire
aux points suivants :
il est ncessaire de mettre en place des
dispositifs de blocage ne pouvant tre
manuvrs quau moyen dun outil ou
toute autre disposition pour viter un
drglage ultrieur des volets ;
le circuit offre une assez grande sou-
plesse pour des modifications ou des
extensions ultrieures et pour la correc-
tion de dbits mal estims au dpart ;
les calculs thoriques sont relativement
simples mais lopration dquilibrage
peut tre assez longue ;
si le conduit rsistance maximale a
t mal choisi, le ou les conduits rsis-
tance suprieure fonctionneront dbit
trop faible ;
des volets en position semi-ferme peu-
vent provoquer une usure anormale ou un
engorgement local dun circuit (dans le
cas du transport de poussires).
4.4. Ambiances explosives
4.4.1. Extraction des gaz et vapeurs
inflammables
Lextraction de gaz et vapeurs inflamma-
bles se fait au moyen de ventilateurs
dextraction qui ne doivent pas tre sus-
ceptibles dallumer un mlange inflam-
mable : les matires constitutives des
pales et de lenveloppe doivent tre
choisies et le montage ralis, pour
viter les tincelles par choc accidentel.
Les moteurs lectriques doivent tre
placs ds la conception de linstalla-
tion hors de latmosphre ventuelle-
ment inflammable ou tre de sret
en atmosphre explosive (cf. arrt
industrie du 9-8-78 dfinissant les
rgles de construction de ces matriels
lectriques).
4.4.2. Extraction des poussires
inflammables
Les ventilateurs dextraction des pous-
sires inflammables doivent tre situs,
autant que possible, en air propre (en
aval des organes de sparation pous-
sires-air). Leur construction (matire
des pales et des coques, quilibrage)
doit empcher des chocs accidentels
entre parties fixe et mobile pouvant pro-
duire des tincelles.
Les conduits dvacuation et de trans-
port pneumatique des poussires inflam-
mables doivent tre aussi courts que
possible.
Il est souhaitable, pour y viter la forma-
tion dlectricit statique, quils soient en
matire conductrice ou semi-conduc-
trice (rsistivit infrieure 10
8
.cm
-1
)
ou que leur continuit lectrique soit
assure par des lments conducteurs
(fibres incorpores, gainage, revte-
ment). Pour viter les dpts intrieurs,
les coudes et les variations de laire et de
la forme de la section doivent tre aussi
rduits que possible ; la vitesse de
circuIation souhaitable est dau moins
15 m/s, et dau moins 20 m/s pour le
transport de poussires mtalliques.
Ces conduits doivent comporter des
vents de dcharge pour librer la pres-
sion des explosions ventuelles le plus
souvent de 2 10 bars selon les pous-
sires transportes.
La vrification et le nettoyage des
conduits doivent tre effectus priodi-
quement pour viter la formation de
dpts inflammables dangereux.
4.5. Bruit
Un point important ne pas ngliger est
le problme du bruit engendr par les ins-
tallations de ventilation. Elle ne doit pas
conduire lmission de bruit pouvant
dpasser la cote dalerte de 85 dB(A).
Linstallation ne doit pas augmenter de
plus de 2 dBA le niveau sonore ambiant
mesur aux postes de travail, sauf si elle
nengendre pas un niveau suprieur
50 dBA.
La qualit acoustique dune installation
de ventilation dpend ventuellement
des bruits provoqus par les lments
suivants :
la vitesse de lair dans le rseau de
gaines,
les ponts phoniques,
les vibrations des matriels,
lmission propre des ventilateurs.
Elle dpend du matriel, du choix dim-
plantation des lments et du calcul de
linstallation, du soin apport la ralisa-
tion de celle-ci.
Les variations de vitesse et les turbu-
lences provoques par les changements
de direction et de gomtrie des
rseaux de transport, ainsi que lexci-
tation des parois des conduits quand la
vitesse est trop leve, vont conduire
un niveau sonore non ngligeable.
Une formule approche permet dvaluer
le niveau de puissance acoustique dans
une gaine droite [15] :
Lw (dB) = 10 + 50 log V + 10 log A
V : vitesse dair (m/s) ;
A : section (m
2
).
Par exemple, avec V = 10 m/s et A =
0,1 m
2
, Lw = 50 dB.
Limplantation dlments souples ou de
silencieux en certains points du circuit de
ventilation (fig. 17) et lemploi de vitesses
adaptes (tableau IX) permettent de
rduire lmission sonore globale.
Fig. 17. Emplacement pour un silencieux
[15].
a) Emplacement du silencieux proscrire :
le bruit de la centrale de conditionnement,
en traversant le conduit laval du silencieux,
court-circuite ce dernier ;
le silencieux nest pas prcd dune
longueur droite dau moins 5 D.
b) Emplacement du silencieux conseiller.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 18
19
TABLEAU IX
Vitesses limites recommandes
pour les installations
type basse vitesse
pour viter les bruits
dans les rseaux [15]
(cas des locaux industriels
installations dair
non charg de particules)
5. VENTILATEURS
5.1. Gnralits
Le ventilateur est une turbomachine
rceptrice qui fournit lnergie nces-
saire pour entretenir lcoulement de lair
dans le circuit de ventilation. Il doit tre
choisi pour dbiter un certain volume
dair sous une certaine pression (qui
dpend de la rsistance du circuit).
Le dbit dlivr par un ventilateur est la
fois fonction de ses caractristiques pro-
pres et de la perte de charge rencontre
sur le circuit. On choisira un ventilateur
en rapport avec la perte de charge maxi-
male pouvant exister dans linstallation.
une vitesse de rotation N donne, un
ventilateur peut tre caractris par qua-
tre courbes reprsentant les variations,
en fonction du dbit volume Q (m
3
/s) tra-
versant le ventilateur, de :
la pression totale du ventilateur P
t
(Pa),
dfinie comme la diffrence algbrique
entre les pressions totales la bride de
refoulement et la bride daspiration ;
la puissance absorbe ou puissance
larbre P
a
(W), puissance mcanique
fournie larbre dentranement du
ventilateur ;
le rendement du ventilateur
v
, dfini
comme le rapport de la puissance utile P
u
sur la puissance absorbe :
v
=
P
u
=
Qp
t
(11)
P
a
P
a
la puissance acoustique, exprime en
dB.
Si la vitesse de rotation N varie, le dbit
varie proportionnellement N, la pression
engendre 3 N
2
et la puissance absor-
be N
3
.
Le ventilateur est entran par un moteur
gnralement lectrique ou pneumatique.
Des conditions de construction spciales
peuvent tre imposes en cas datmo-
sphres explosives. Pour certaines appli-
cations particulires, le ventilateur peut tre
remplac par un injecteur aliment en air
comprim.
5.2. Point de fonctionnement dun
ventilateur
Soit un ventilateur ayant une courbe
dbit-pression connue, que lon introduit
dans un circuit dont on a calcul la para-
bole dbit perte de charge. Le dbit
mis en jeu sera tel que la pression four-
nie par le ventilateur gale la perte de
charge du circuit. Le point de fonction-
nement sera donc lintersection des
deux courbes (fig. 18).
Le rendement du ventilateur
v
peut
varier de 0,3 pour les plus mdiocres
0,85 environ selon le modle et le point
de fonctionnement. On ne peut donc
pas adapter nimporte quel ventilateur
nimporte quel rseau.
5.3. Choix
Il existe deux grandes catgories de ven-
tilateurs : les ventilateurs centrifuges
(fig. 19a) et les ventilateurs hlicodes
(fig. 19b).
Q V Diamtre
(m
3
/h) (m/s) thorique (mm)
144 4 113
288 4,5 150
540 5 195
1 800 6 325
2 700 6,5 380
4 700 7 486
7 200 7,5 580
9 000 8 630
12 600 8,5 724
18 000 9 840
25 200 9,5 970
32 400 10 1 070
54 000 11 1 320
90 000 12 1 630
144 000 13 1 980
a) Exemple de courbes dbit-pression et
dbit-puissance absorbe par un ventilateur
centrifuge fonctionnant pression atmosph-
rique normale dans de lair 20 C (masse
volumique de 1,2 kg/m
3
).
b) Point de fonctionnement dun ventilateur
(centrifuge dans lexemple) plac dans un
circuit de ventilation.
Dbit
Point de
fonctionnement
Pression totale
du ventilateur
Perte de charge
du circuit
P
r
e
s
s
i
o
n
P
t
P
u
i
s
s
a
n
c
e
a
b
s
o
r
b
e
P
a
P
u
i
s
s
a
n
c
e
a
b
s
o
r
b
e
P
a
P
r
e
s
s
i
o
n
t
o
t
a
l
e
P
t
(
P
a
)
Fig. 18.
Fig. 19.
a) Ventilateur
centrifuge.
b) Ventilateur
hlicode.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 19
20
Dans les ventilateurs centrifuges (ou
radiaux), lair est aspir paralllement
laxe de rotation dune roue aubes tour-
nant dans une volute et est rejet la pri-
phrie par la force centrifuge suivant un
plan perpendiculaire laxe de rotation.
Les ventilateurs centrifuges permettent
dobtenir des dbits moyens importants
avec des pressions leves (jusqu
25 000 Pa et plus). Ils sont bien adapts
au transport de lair dans des rseaux
Iongs ou ramifis.
Dans les ventilateurs hlicodes (ou
axiaux), lair entre et sort paralllement
laxe de rotation de la roue (fig. 20). Les
ventilateurs hlicodes simples, comme
celui prsent la figure 20a, peuvent
mettre en jeu des dbits trs importants,
mais sont limits des pressions faibles
(gnralement infrieures 250 Pa), ce
qui restreint leur utilisation des circuits
de faible longueur ou linsertion dans
une paroi (par exemple, ventilation gn-
rale dateliers).
Les ventilateurs hlicodes existent ga-
lement dans une version amliore,
comportant des pales plus paisses et
profiles, un moyeu large et carn et
des aubes stationnaires (redresseurs)
neutralisant les mouvements de giration
de lair (fig. 20b). Les ventilateurs de ce
type ont un rendement qui se rapproche
de celui des centrifuges, pour un
encombrement plus rduit, et des pres-
sions totales pouvant aller jusqu 600
1 500 P
a
environ.
Les ventilateurs hlicodes et centrifuges
peuvent tre soit accoupls directement
larbre moteur, soit relis celui-ci par
lintermdiaire dune transmission par
poulies et courroies. Ce dernier montage
permet de modifier le dbit du ventilateur
dans la limite dfinie par le constructeur,
modification facilite par la mise en
uvre de poulies variables.
En gnral, par rapport aux ventilateurs
centrifuges, les ventilateurs hlicodes
sont plus bruyants, ont des rendements
plus faibles, mais sont moins encom-
brants et moins chers.
En cas de transport dair poussireux, le
ventilateur est gnralement plac aprs
le dpoussireur, ce qui lui permet de
travailler en air propre, avec un bon ren-
dement et des conduites en dpression
dans latelier (vitant ainsi les fuites dair
pollu). Quelquefois, en particulier dans
lindustrie du bois, on utilise un ventila-
teur radial plac en amont dun dpous-
sireur qui filtre lair charg de pous-
sires et de copeaux.
On veillera, lors de linstallation du venti-
lateur, ne pas dpasser la vitesse de
rotation maximale, viter les singulari-
ts (et en particulier les coudes) proxi-
mit de la bride daspiration (fig. 21),
limiter la propagation du bruit et des
vibrations par des connexions flexibles et
des montages antivibratoires.
5.4. Bruit
Le bruit engendr par un ventilateur est
fonction de son implantation dans linstal-
lation. Dune manire gnrale, les ventila-
teurs seront placs lextrieur du bti-
ment. Plus la puissance fournie au venti-
lateur est leve, plus sa puissance
acoustique est grande. Le ventilateur doit
toujours tre slectionn pour fonctionner
au point de rendement maximum.
Le dimensionnement correct du ventila-
teur est un des facteurs les plus impor-
tants pour diminuer le bruit dune instal-
lation. Les constructeurs de ventilateurs
connaissent pour la plupart les caractris-
tiques de ceux-ci en matire de bruit
(dans certaines conditions dessais bien
dfinies).
6. REJET
Le rejet de lair pollu lextrieur du
btiment mrite lui aussi une tude
srieuse (hauteur des chemines,
emplacement des sorties des gaines
dextraction selon la configuration du
btiment et de son environnement).
Afin dviter de recycler une partie des
pollluants, lair pollu devra tre rejet en
dehors des zones de prise dair neuf.
Pour cela, on utilisera des chemines de
hauteur suffisante (correctement hau-
bannes), en tenant compte de la force
et de la direction du vent, du relief, etc.
(fig. 22).
Il faut noter quil est possible de rcup-
rer une partie de la chaleur contenue
dans le flux dair de rejet soit par la mise
en place dun changeur dont le rle
sera de transfrer lair neuf une partie
de la chaleur de lair rejet, soit par recy-
clage dans les locaux dune fraction de
lair de rejet pralablement trait et
pur. Comme cette opration de traite-
ment est toujours dlicate et que la qua-
lit de lair recycl en dpendra, on car-
tera cette technique dans tous les cas
o lon se trouvera en prsence de pol-
luants particulirement toxiques.
Fig. 20. Ventilateurs hlicodes. Fig. 21. Refoulement des ventilateurs [15].
a) Ventilateur simple.
b) Ventilateur amlior.
viter recommand
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 20
21
Lintrt conomique dun changeur
classique sapprcie au moyen :
de la puissance transfre instantane.
Elle est dtermine par le calcul de la
perte de chaleur de lair extrait ou du gain
de chaleur de lair introduit ;
de son efficacit qui se dfinit comme le
rapport de la puissance transfre la
puissance thoriquement transfrable
dans les mmes conditions de fonction-
nement.
Dun point de vue pratique, lefficacit
dun changeur, qui crot avec sa taille,
est limite une valeur qui correspond
lamortissement le plus rapide de
linvestissement [10].
Dans tous les cas, le rejet devra se faire
en conformit avec la rglementation rela-
tive aux problmes denvironnement.
7. AIR DE COMPENSATION
7.1. Rle de la compensation
Un atelier tant un volume ferm, il sta-
blit ncessairement un quilibre entre les
quantits dair entrantes et sortantes.
Ceci veut dire que, lorsquune extraction
est en service dans un local, il doit obliga-
toirement sy introduire un dbit dair
quivalent au dbit dair extrait.
Cette compensation peut avoir lieu :
de manire sauvage par les dfauts
dtanchit du btiment (interstices
laisss par les portes, tles de bardage
non jointives, etc.),
de manire organise , soit naturelle
(grilles de ventilation simples), soit mca-
nique (ventilateur).
Lintroduction de cet air de compensa-
tion doit tre tudie de manire :
a) assurer lefficacit des systmes de
ventilation : un manque dair de com-
pensation produit une mise en dpres-
sion des btiments, qui cre une rsis-
tance supplmentaire pour les ventila-
teurs. Il en rsulte une diminution des
dbits, particulirement sensible dans le
cas de certains ventilateurs hlicodes,
qui amne finalement une perte deffica-
cit (fig. 23) ;
b) liminer lune des causes de courants
dair grande vitesse provenant des
ouvertures (portes, fentres, fissures,
etc.), qui peuvent :
provoquer un inconfort thermique pour
le personnel,
diminuer lefficacit des dispositifs de
captage et disperser les polluants dans
tout latelier,
remettre en suspension des pous-
sires dposes (par exemple sur les
structures) ;
c) viter que lair, provenant de zones
adjacentes pollues, soit entran dans
les zones propres (aires de station-
nement o dmarrent des camions,
routes grande circulation, zone rejet
dair vici...) ;
d) diminuer les efforts douverture des
portes ;
e) assurer le fonctionnement correct
des appareils combustion et des che-
mines.
Si, pour une raison quelconque il inter-
vient une modification du dbit dair
introduit dans le local, lquilibre entre les
introductions dair et les extractions sera
dplac et les quantits dair extraites
seront diffrentes, le point de fonction-
nement de chaque ventilateur stablis-
sant une nouvelle valeur (cf. 5.2.).
Des disproportions plus ou moins
grandes peuvent exister entre les capaci-
ts des appareils et, dans ce cas, lqui-
libre peut tre obtenu en laissant subsis-
ter soit une dpression, soit une surpres-
sion dans les btiments. Il convient de
sen proccuper afin dviter les trans-
missions de polluants entre locaux.
Pour cela, les locaux o se dgagent
des produits toxiques ou asphyxiants
sont volontairement maintenus en lgre
dpression.
Dans le cas de locaux adjacents pollu-
tion spcifique diffrente, on recherchera
de plus lindpendance de leur ventila-
tion par exemple en disposant entre eux
des sas maintenus en surpression dair
neuf.
Lorsque pour les raisons spcifiques au
processus industriel, le local doit tre
maintenu en surpression, les sas seront
maintenus en dpression.
Une introduction mcanique de lair est
recommande ; si cette solution est rete-
nue, on veillera ce que ces systmes
dintroduction dair napportent pas de
bruits supplmentaires dans le local (dis-
position des ventilateurs lextrieur du
btiment neutralisation des vibrations).
Fig. 22. Rejeter lair pollu en dehors
des zones dentre dair neuf (daprs
lACGIH [6]).
Fig. 23. Perte defficacit des systmes
de ventilation par non-compensation de
lair extrait.
a) Recyclage des polluants d une hauteur
de chemine insuffisante et une entre
dair dans un mur.
a) Sans flux dair de compensation, le ventila-
teur tourne, met en dpression le local et
nextrait pas les polluants.
b) Avec un flux dair de compensation, le
ventilateur tourne et cre un mouvement
dextraction des polluants.
b) Hauteur de chemine suffisante (cas de
btiments bas sans obstacle environnant et
un terrain approximativement plat).
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 21
22
Lair neuf devra tre chauff en priode
froide ; il devra tre distribu laide de
diffuseurs et, si possible, de faon tra-
verser dabord la zone occupe par les
travailleurs puis les zones pollues.
Pour viter les courants dair, il est
ncessaire dassurer un dbit dair de
compensation correct, de le distribuer
rgulirement dans les locaux laide
de diffuseurs et de protger les sys-
tmes de captage laide de parois,
dcrans, de rideaux dair, etc. (fig. 24).
De plus, afin dempcher les sensations
dinconfort thermique, on placera lop-
rateur hors des zones de vitesses dair
trop leves et on assurera un chauf-
fage correct des locaux, surtout en
hiver.
Si lon se trouve en prsence dun
poste quip dun dispositif de captage
(ventilation locale), il est possible def-
fectuer une compensation locale par
apport dair neuf directement sur le
poste.
Il faut veiller dans ce cas ce que ni
loprateur ni son travail ne soient pertur-
bs par ce courant dair ; cette solution
ne peut sadapter qu certains types
de sources de pollution trs localises,
mais elle prsente le double avantage
de pouvoir diriger le flux des polluants
vers la bouche de captage et de ne pas
ncessiter dapport complmentaire de
chaleur.
7.2. Compensation et confort ther-
mique
La ventilation locale ou gnrale des
locaux industriels, mme avec recyclage
partiel de lair pur, ncessite un apport
dair neuf pour compenser les quantits
dair extrait. Les courants dair induits
constituent un facteur dinconfort impor-
tant qui conduit frquemment larrt
des installations de ventilation au dtri-
ment de la qualit de lair. Ce phno-
mne se manifeste principalement la
priphrie des btiments.
Il est ncessaire de prvoir un dispositif de
prchauffage de lair ; le contrle de ce dis-
positif sera plus dlicat dans le cas dune
introduction naturelle que dans celui dune
introduction mcanique de lair.
Lintroduction mcanique de lair lint-
rieur des btiments est donc recomman-
de, elle permet de traiter lair de faon
que celui-ci soit propre et temprature
optimale et de le distribuer aux endroits
opportuns.
8. VENTILATION GNRALE
8.1. Principes
La conception dune installation de venti-
lation gnrale reste, dans ltat actuel
des connaissances, une opration difficile
qui fait appel une large part dempirisme
et dintuition. Seuls quelques principes
dune porte trs gnrale peuvent tre
noncs.
a) Sassurer au pralable que le recours
une ventilation locale est bien techni-
quement impossible. On ne pourra faire
appel la ventilation gnrale en tant
que technique principale que pour la-
ration des locaux pollution non spci-
fique. Dans le cas dassainissement de
locaux pollution spcifique, on recher-
chera toujours une solution de ventilation
locale.
b) Compenser les sorties dair par des
entres correspondantes (voir chap. 7).
c) Positionner convenablement les ouver-
tures dentre et de sortie de lair de
faon :
tendre vers un coulement gnral des
zones propres vers les zones pollues ;
essayer de faire passer le maximum
dair dans les zones pollues ;
viter les zones de fluide mort ;
viter que les travailleurs soient placs
entre les sources et lextraction ;
utiliser les mouvements naturels des
polluants, en particulier, leffet ascension-
nel des gaz chauds.
La mise en application pratique de ces
dernires recommandations est dlicate.
La ventilation gnrale procde par dilu-
tion et mlange du polluant avec latmo-
sphre de latelier avant vacuation et il
faut viter de se reprsenter le polluant
comme suivant un trajet imaginaire entre
la source et lextraction (fig. 25). Il faut
tre trs prudent dans la prvision des
mouvements de lair dans un atelier muni
dune ventilation gnrale : les flches
que lon peut dessiner sur les plans sont
trs souvent sans fondement rel.
d) Utiliser de prfrence une introduction
et une sortie dair mcaniques. Les
avantages et inconvnients des diff-
rents types de ventilation (naturelle,
mcanique, mixte) sont rsums au
tableau X. Une sortie dair naturelle
convient mieux dans le cas dateliers
hauts et troits avec de grosses sources
de chaleur.
e) viter les courants dair et les sensa-
tions dinconfort thermique.
f) Rejeter lair pollu en dehors des zones
dentre dair neuf (voir chap. 6).
Fig. 24. Exemple dutilisation dcrans
pour lutter contre un mauvais captage
d des courants dair latraux.
courant dair
courant dair
Fig. 25. Visualisation schmatique du
fonctionnement de la ventilation gn-
rale (daprs McDermott [5]).
entre
dair
entre
dair
b) Ralit
a) Croyance errone
ventilateur
dextraction
ventilateur
dextraction
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 22
23
8.2. Solutions
En thorie, le dbit dair mettre en jeu
dans une installation de ventilation gn-
rale peut tre estim par la formule :
Q =
K D
(12)
C C
0
Q : dbit de ventilation gnrale (m
3
/s) ;
D : dbit dmission de polluant, suppo-
se rgulire dans le temps (kg/s) ;
C : concentration en polluant tolr dans
lambiance du local (kg /m
3
).
C
0
: concentration en polluant dans lair
neuf (souvent, C
0
= 0) (kg/m
3
) ;
K (sans dimension) : facteur de scurit
prenant en compte luniformit de rpar-
tition du dbit dair, la position des
ouvriers par rapport aux sources, le
degr de toxicit des polluants, la non-
uniformit du dbit des polluants.
Lvaluation du coefficient K est difficile ;
sa valeur peut varier en fonction des fac-
teurs ci-dessus de 3 10 [6].
Lapplication de cette formule demande
que soit connu le dbit dmission de pol-
luants D.
On notera que le taux de renouvellement
horaire R (h
-1
) :
R = 3 600
Q
(13)
V
V : volume du local (m
3
),
nintervient pas dans le calcul du dbit
de ventilation gnrale (en rgime
permanent). Lutilisation dune valeur de
taux de renouvellement comme critre
de ventilation est donc sans justifica-
tion et peut mme tre dangereuse
puisquelle conduit pour une mme
source de pollution des dbits de
ventilation diffrents selon le volume du
local et donc des niveaux de concen-
tration en polluants diffrents.
On peut, dans certains cas, coupler le
systme de ventilation gnrale avec un
rseau de soufflage complmenaire :
des buses de soufflage sont disposes
de manire induire un flux dair neuf,
repris par les extracteurs, sur les princi-
pales sources de pollution [14].
Remarque
La ventilation gnrale ninterfre pas
avec les procds industriels et laisse
une certaine flexibilit lors de la
conception.
Toutefois, compte tenu des inconv-
nients dtaills ci-dessous :
niveau de pollution rsiduelle tou-
jours prsent,
mauvaise protection des travailleurs
situs proximit des sources dmis-
sion, difficults de prvision et de
contrle des mouvements de lair,
difficults de calcul de K et D et
donc du dbit dair mettre en jeu,
gros dbits dair mis en jeu,
TABLEAU X
Comparaison des diffrents systmes de ventilation gnrale
Ventilation
Ventilation mixte Ventilation mixte
Ventilation
naturelle
entre naturelle entre mcanique
mcanique
sortie mcanique sortie naturelle
Domaine dapplication Utilisation des forces Utilisation courante Utilisation Utilisation
convectives pour des btiments de forces convectives gnrale
existantes relativement existantes
Ateliers hauts bas
et troits
Possibilit de contrle de la non non oui oui
distribution spatiale de lair
introduit
Possibilit de contrle de la qualit non non oui oui
(temprature, humidit, puret)
de lair introduit
Possibilit de contrle de la pression non non Effet thermique : oui
lintrieur du btiment (surpression (dpression) (dpression) oui (dpression (surpression
ou dpression) surpression) ou dpression)
Sans effet thermique :
non (surpression)
Possibilit de rcupration de chaleur non oui non oui
sur lair extrait
Indpendance vis--vis du vent
des entres dair non non oui oui
des sorties dair non oui non oui
Problmes particuliers Existence Existence Solution onreuse
de courants dair de courants dair pour les gros dbits
dair
Caractristiques
principales
Systme
de ventilation
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 23
24
difficults dabsorber les pointes
dmission de polluants,
il est prfrable de limiter lapplication
ventuelle de la ventilation gnrale
aux cas suivants :
en complment de la ventilation
locale ;
lorsque les polluants sont peu
toxiques, mis un dbit faible et
rgulier dans le temps, que les tra-
vailleurs sont suffisamment loigns
des sources et que le recours une
ventilation locale est techniquement
impossible.
9. IMPLANTATION
DU MATRIEL
Souvent nglige, la dtermination de
limplantation du matriel conditionne le
maintien de lefficacit des installations de
ventilation.
En effet, seuls des emplacements judi-
cieusement choisis permettront laccs
ais du matriel et son entretien, sans
gner le processus de fabrication ou la
circulation des personnes et des produits
et sans compromettre lefficacit des ins-
tallations elles-mmes.
La solution idale consiste crer un
local technique, isol des ateliers, dans
lequel sera regroup lessentiel des instal-
lations de ventilation.
dfaut les mesures suivantes seront
prises :
Pour tout matriel tournant ou ncessi-
tant un contrle et un entretien rgulier,
prvoir une implantation au sol en amna-
geant lespace ncessaire au dmontage
de tous les composants, ou en lvation
avec mise en uvre dune passerelle de
service munie de garde-corps. Si lim-
plantation est ralise en toiture, les che-
minements seront matrialiss et les sur-
charges admissibles, tant pour le matriel
que pour la zone dvolution, calcules en
consquence.
Les implantations en lvation seront
ralises de prfrence au-dessus des
alles principales, et en dehors des zones
daccs ou dintercommunication entre
les ateliers.
Les organes dquilibrage des rseaux
de gaines seront placs hors de la por-
te des utilisateurs, munis de dispositifs
de blocage et de reprage. Les organes
de rglage prvus seront par contre faci-
lement accessibles et facilement mau-
vrables par les utilisateurs.
Les ensembles de filtration et dpura-
tion seront implants de telle sorte que le
dmontage des filtres colmats ou des
dispositifs daspiration ne dgage ni
poussires ni polluants dans latelier.
10. CONTRLES
ET ENTRETIEN
DUNE INSTALLATION
DE VENTILATION
Le contrle dune installation lors de sa
mise en route permet :
de comparer ses performances celles
prvues lors de sa conception et consi-
gnes dans le cahier des charges et dans
la notice dinstruction prpare par le
matre douvrage ;
Les caractristiques arauliques et
dimensionnelles mesures et calcules
sont consignes dans le dossier dinstal-
lation et permettent ainsi de sassurer
ultrieurement du bon fonctionnement
de linstallation par comparaison aux
valeurs de rfrence issues de la notice
dinstruction (voir tableau XI).
Les contrles dune installation en cours
de fonctionnement permettent :
de vrifier le bon tat des diffrents l-
ments de linstallation (systmes de cap-
tage conduites, purateurs, appareils
dprimognes...) ;
de mettre, ventuellement, en vi-
dence les variations de paramtres indi-
quant la ncessit deffectuer des opra-
tions dentretien et de rparation.
10.1. Paramtres contrler
La rglementation [1] prvoit que le chef
dtablissement mette en place des
contrles priodques de linstallation
de ventilation. Les dates et les rsultats
de ces contrles, ainsi que les rglages
et modifications apportes, doivent
tre reports dans la consigne dutilisa-
tion du dossier dinstallation. La nature
des contrles et leur frquence dpen-
dent du type de local et figurent au
tableau XII.
10.2. Contrle dune installation sur
site
Les techniques mettre en uvre sont
diffrentes selon que lon rceptionne
une installation ou que lon effectue le
contrle en cours de fonctionnement.
Elles peuvent tre quantitatives ou qua-
litatives.
Lors de la rception, les techniques
doivent tre suffisamment prcises pour
que les rsultats de mesure puissent
tre compars aux valeurs thoriques
prvues lors de la conception de lins-
tallation.
Lors du contrle en cours de fonctionne-
ment, les techniques doivent tre de
mise en uvre facile (on doit privilgier
les mesures en continu avec indications
visuelles et alarmes) et mettre en vi-
dence les variations ventuelles des
paramtres significatifs mesurs lors de
la rception de linstallation (valeurs de
rfrence).
Le tableau XIII donne, selon le contrle
effectuer, la mthodologie et les moyens
mettre en uvre.
10.3. Techniques de contrle
quantitatives
Elles permettent de :
dterminer les vitesses et les dbits
dair mis en jeu en diffrents points
dune installation, et les pressions rela-
tives entre les diverses parties de
linstallation ;
contrler le fonctionnement dune
installation et faire procder ventuel-
lement des oprations de mainte-
nance.
La figure 26 reprsente le schma
dune installation de ventilation sur
lequel sont reprs les points o les
contrles peuvent tre effectus.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 24
25
TABLEAU XI
Dossier des valeurs de rfrence
TABLEAU XII
Contrles priodiques
Installations nouvelles ou installations ayant subi
Autres installations
des modifications notables
dossier de valeurs de rfrence et caractrisation de linstallation
slection de points de contrle reprsentatifs une premire srie de valeurs servira
(1 mois aprs la premire mise en service) : de rfrence pour les contrles
Locaux pollution non spcifique Locaux pollution spcifique
dbit global minimal dair neuf polluants reprsentatifs de la pollution
dbit minimal dair neuf par local dbits, pressions statiques et vitesses
pressions statiques et vitesses dair dair pour chaque dispositif de captage
associes ces dbits dbit global dair extrait
caractristiques des filtres (classe efficacit de captage des systmes
defficacit, perte de charge initiale daspiration (par mesure ou par
et maximale admissible) conformit des normes, compte tenu
des dbits et de la gomtrie des capteurs)
caractristiques des sytmes de
surveillance et moyens de contrle
Sil y a un systme de recyclage :
dbit global dair neuf introduit
efficacit des sytmes dpuration et
de dpoussirage (par tranches
granulomtriques pour les poussires
et notamment pour les poussires
alvolaires et les poussires totales) ;
ces valeurs peuvent tre fournies
par le constructeur
concentration en polluants en des
points caractristiques de la pollution
de latelier et dans les gaines de
recyclage
systmes de surveillance du systme
de recyclage
Locaux pollution non spcifique Locaux pollution spcifique
Tous les ans : Tous les ans :
dbit global minimal dair neuf dbit global dair extrait
examen de ltat des lments de linstallation pressions statiques et vitesses dair
conformit des filtres de rechange la fourniture initiale examen de ltat de tous les lements de linstallation
dimensions, perte de charge des filtres
examen de ltat des sytmes de traitement de lair Tous les six mois (sil y a un systme de recyclage) :
(humidificateurs-changeurs) concentrations en poussires dans les gaines de recyclage
pressions statiques et vitesses dair ou leur sortie dans un coulement canalis
contrle de tous les systmes de surveillance
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 25
26
TABLEAU XIII
Contrle dune installation : mthodologie et appareillage
Contrle effectuer
Points de mesure
Mthodologie Appareillage
Dbit daspiration DEFGH Dtermination du champ de Tube de Pitot
vitesse dans les conduites (NF X 10-112)
Anmomtre
Dtermination du champ de Anmomtre
vitesse aux bouches daspiration
Technique de traage Selon gaz traceur
Contrles
Vitesse de captage ABC Mesure directe par anmomtre Anmomtre
quantitatifs
Concentration en poussire en sortie Mthode pondrale ou comptage Appareil de prlvement
de gaine de recyclage direct Appareil de mesure directe
Variation du dbit daspiration Variation de la pression statique Prise de pression statique
DEFIJKL et manomtre
Paramtres de fonction du ventilateur Vitesse de rotation Tachymtre
Puissance consomme Ampremtre
Efficacit du captage Technique de traage Appareil de mesure selon
le type de traceur utilis
Contrles Efficacit, courants dair Observation par fumigne Fumigne
qualitatifs
Fig. 26. Points de contrle
dune installation de ven-
tilation sans systme de
recyclage.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 26
27
10.3.1. Dtermination des dbits
dair par exploration des champs de
vitesse dair dans une conduite
ferme
Dans une conduite ferme ou scoule de
lair, le dbit est dtermin partir de la
relation :
Q = A V
m
Q : dbit dair (m
3
/s) ;
A : section o seffectuent les mesures
(m
2
) ;
V
m
: vitesse moyenne de lair dans cette
section (m/s).
La vitesse moyenne est calcule partir
des vitesses locales mesures en un cer-
tain nombre de points de la section de
conduite.
Le nombre et la position des points
de mesure, dfinis dans la norme NF X
10-112, varient en fonction de la forme de
la conduite et de ses dimensions.
La vitesse moyenne peut tre calcule
selon plusieurs mthodes. Lune dentre
elles consiste faire la moyenne arith-
mtique des vitesses mesures locale-
ment.
La vitesse moyenne est fournie par la
relation :
V
i
i = 1 n
V
moy
= (14)
n
Les vitesses dair sont soit dtermines
en utilisant un tube de Pitot double soit
mesures directement laide dun an-
nomtre ( 10.5).
Les vitesses dair peuvent tre obtenues
de faon dautant plus satisfaisante que
les conditions numres ci-dessous
sont respectes :
longueur au-dessus du point de
mesure sans singularit suprieure
20 D (D : diamtre de la conduite au
niveau de la section de mesure) ;
longueur en dessous du point de
mesure sans singularit suprieure
5 D ;
bord des trous dans la conduite net et
sans bavure ;
coulement peu fluctuant et sans
giration ;
diamtre du tube de Pitot ou de
la sonde de lanmomtre infrieur
D/50 ;
antenne de tube de Pitot parallle
laxe de la conduite.
Pour la mesure de la vitesse laide
du tube de Pitot, il est souhaitable que la
vitesse moyenne soit suprieure 4 m/s.
En dessous, la valeur de la pression
dynamique (p
d
) devient trop faible et
lerreur sur la mesure trop importante.
10.3.2. Dtermination des dbits
dair par exploration du champ de
vitesse au niveau des bouches
dextraction ou dintroduction dair
Lorsque la mthode dcrite dans le para-
graphe 10.3.1. ne sapplique pas (lon-
gueurs droites trop faibles, inaccessibi-
lit...), le dbit peut tre dtermin en fai-
sant un champ de vitesse dair au niveau
des bouches dextraction ou dintroduc-
tion dair laide dun annomtre. La
vitesse moyenne sera obtenue en calcu-
lant la moyenne arithmtique des
vitesses locales mesures aux points
dfinis par quadrillage. Afin de ne pas
commettre derreurs sur le dbit (pouvant
atteindre plus de 50 % de la vraie valeur),
certaines prcautions doivent tre prises
lors des mesures. En particulier, on doit
tenir compte du type de bouche (extrac-
tion ou introduction), de la prsence ou
de labsence de grilles ou de fentes, du
type danmomtre, de la distance entre
la bouche et lanmomtre...
10.3.3. Dtermination du dbit dair
et contrle dune installation par
mesure de la pression statique en
un point [6]
Cette mthode consiste mesurer la
pression statique en diffrents points
dun circuit de ventilation, soit pour en
dduire les dbits dair mis en jeu, soit
pour contrler le fonctionnement de
linstallation.
Le contrle consiste dterminer le
dbit dair mis en jeu par une mthode
prcise (exploration du champ de
vitesse, traage) et noter simultan-
ment les valeurs de la pression statique
aux diffrents points de mesure (fig. 26
et 27).
10.3.4. Estimation du dbit dair
partir de la mesure de la vitesse de
rotation du ventilateur et de la puis-
sance consomme par le moteur
lectrique [5]
Cette mthode consiste calculer la
puissance consomme par le moteur
pour en dduire la puissance absorbe
par le ventilateur et dterminer le point
de fonctionnement du ventilateur en uti-
lisant des courbes caractristiques
(dbit-pression, dbit-puissance) four-
nies par les constructeurs.
La dtermination du point de fonctionne-
ment du ventilateur permettra de conna-
tre le dbit dair mis en jeu sur le circuit de
ventilation. Ce point est obtenu en repor-
tant la valeur calcule de la puissance
absorbe sur la courbe caractristique
dbit-puissance du ventilateur.
10.4. Techniques de contrle quali-
tatives [5]
Une estimation qualitative de lefficacit
de captage dune installation de ventila-
tion peut se faire par la visualisation des
coulements laide de fumignes.
Cette mthode, trs simple mettre en
uvre, peut tre utilise de manire
systmatique pour :
mettre en vidence la dispersion des
polluants, le sens des coulements, le
refoulement ventuel des hottes en
dme ;
dfinir la zone partir de laquelle lins-
tallation a perdu toute son efficacit ;
mettre en vidence lexistence des
courants dair et visualiser les phno-
mnes de turbulence proximit dobs-
tacles (oprateurs, pices) ;
rechercher des fuites.
Fig. 27. Implantation de la prise de
pression statique proximit dun sys-
tme de captage.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 27
28
10.5. Appareils de mesure de
vitesse dair
Les principales familles dappareils les
plus frquemment utiliss pour la
mesure des vitesses dair sont les sui-
vantes :
tube Pitot double,
anmomtres,
anmomtres thermiques,
anmomtres mcaniques,
anmomtres dflexion palettes,
anmomtres moulinets.
Les principales caractristiques des
appareils de mesure de vitesse dair
sont rsumes dans le tableau XIV.
10.6. Appareils de mesure de
pression
Les appareils de mesure de pression,
gnralement appels manomtres, uti-
liss en ventilation, peuvent tre classs
en deux catgories suivant leur principe
de fonctionnement :
manomtres hydrostatiques, tube
en U, tube inclin ;
manomtres membranes.
Le tableau XV donne les principales
caractristiques (principe de fonction-
nement, plage de mesure) des appa-
reils de mesure de pression.
10.7. Registre de contrle dune
installation de ventilation
Tous les renseignements concernant
une installation de ventilation doivent
tre consigns dans le dossier dins-
tallation. La personne effectuant le
contrle de linstallation de ventilation
doit pouvoir y trouver :
les plans de linstallation avec les
points de mesures ;
les calculs thoriques fournis par
linstallateur ;
les valeurs de rfrence, mesures
lors de la rception : dbits dair, vitesse
dair (captage, transport), pressions ;
les valeurs mesures lors des
contrles en cours de fonctionnement ;
le calendrier de maintenance ;
les oprations de maintenance effec-
tues et leurs dates ;
les modifications effectues.
10.8. Causes possibles de mauvais
fonctionnements dcels lors du
contrle dune installation
La variation (positive ou ngative) de la
pression statique en un ou plusieurs
points de mesure permet de diagnosti-
quer et de dterminer les causes de
dysfonctionnement dune installation de
ventilation.
Une diminution de la pression statique
peut avoir pour origine :
une rduction des performances du
ventilateur : rduction de la vitesse de
TABLEAU XIV
Caractristiques des appareils de mesure des vitesses dair
Prcision
Dimensions Temp-
Utilisation
Gamme
(valeurs
trous rature
en air
talon- Utilisation gnrale
Appareils Principe
mesure
fournisseurs)
en gaine dutili-
pollu
nage
Robustesse
Observations
(mm) sation
Tube > 4 m/s 3 10 tendue Oui Aucun Bonne Utilisation normalise NF X 10-112.
Pitot avec Pas utilisable en basse vitesse
manomtre
inclin
Anmomtres thermiques
Fil chaud Refroidissement dun 0,05 2 5 % = 10 0 80 C Non Frquent Moyenne Utilisation standard
fil chauff lectrique- 50 m/s pleine certains sont compenss en
ment chelle temprature
certains permettent deffectuer
des mesures de temprature, de
pression statique
Thermo- 0,05 3 % = 10 < 60 C Non Frquent Moyenne
couple 30 m/s pleine
chelle
Anmomtres mcaniques
Vlomtre Dflexion 0,2 2 3 % Dimensions troite Oui Frquent Bonne Utilisation standard
de palettes 40 pleine chelle spciales Permet de faire des mesures de
pression statique
Micro- 0,3 1,5 2 % < 60 C Non Moyen Moyenne Utilisation standard
moulinet 50 pleine chelle
10 30
Moulinet 0,3 1,5 5 % < 60 C Non Moyen Moyenne Utilisation standard
100 50 pleine chelle
150
Pas
utilisable
en gaine
Rotor muni
dailettes mis
en rotation
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 28
29
rotation, usure de la roue, colmatage de
la roue ;
une rduction des sections de pas-
sage due des dpts dans les
conduites avant le point de mesure
(vitesse de transport trop faible) ;
la mise en place de nouveaux points
daspiration ;
des changements de position des
registres dquilibrage ;
une augmentation excessive des
pertes de charge de lpurateur.
Une augmentation de la pression sta-
tique est principalement due un col-
matage du circuit derrire le point de
mesure.
Bibliographie
1. Aration et assainissement des lieux de
travail. Aide-mmoire juridique. Paris, INRS,
TJ 5, 2004.
2. Valeurs limites dexposition professionnelle
aux agents chimiques en France.
Paris, INRS, ED 984, 2012.
3. HEMEON W.C.L. Plant and process
ventilation, 2
e
d. New York, Industrial Press,
1963.
4. ATEX. Mise en uvre de la rglementation
relative aux atmosphres explosives. Guide
mthodologique. Paris, INRS, ED 945, 2011.
5. MCDERMOTT H.J. Handbook of
ventilation for contaminant control,
1
re
d. Ann Arbor, Ann Arbor Science, 1976.
6. ACGIH. Industrial ventilation. A manual
of recommended practice, 25
e
d.
Lansing, American Conference of
Governmental Industrial Hygienists, 2004.
7. HAGOPIAN J.H., BASTRESS E.K.
Recommended industrial ventilation
guidelines. Cincinnati, DHEW, publication
n NIOSH 76-162, 1976.
8. Norme ANSI Z9.2-1979 Fundamentals
governing the design and operation of local
exhaust systems.
New York, American National Standards
Institute, 1979.
9. DALLAVALLE J.M. Exhaust hoods, 2
e
d.
New York, Industrial Press, 1952.
10. Guide pratique de ventilation n 1.
Lassainissement de lair des locaux de
travail. Paris, INRS, ED 657, 1989.
11. Guide pratique de ventilation n 9.1.
Cabines dapplication par pulvrisation de
produits liquides. Paris, INRS,
ED 839, 2008.
12. La ventilation. Travail et scurit,
numro spcial 1-2, 1983.
13. Guide pratique de ventilation n 2.
Ventilation des cuves et bains de
traitement de surface. Paris, INRS,
ED 651, 2001.
14. Guide pratique de ventilation n 3.
Mise en uvre manuelle des polyesters
stratifis. Paris, INRS, ED 665, 1989.
15. CLAIN F. Le bruit des quipements. Paris,
Sedit, 1974, 126 p.
16. REGKNAGEL, SPRENGER Manuel pratique de
gnie climatique. Paris, Pyc Edition, 1980,
1495 p.
17. Manuel Carrier. 2
e
partie : distribution
de lair. New York, Carrier International Ltd,
1960.
TABLEAU XV
Caractristiques des appareils de mesure des pressions
Appareils Principe chelles Prcision talonnage Observations
(Pa) (mm CE)
liquide
Tube en U vertical Variation de niveau Jusque 5.10
4
Pa 10 1 Non Portable
dun liquide (en fonction du liquide)
tube inclin idem Jusque 2.10
3
Pa 5 0,5 Non Portable,
(en fonction du liquide) doit tre positionn
mini 1 100 Pa
Micromanomtre idem 0 5.10
3
Pa 0,5 5,10
2
Non Non portable
de laboratoire
Mcanique
membrane Mouvement dune Jusqu plusieurs bars 5 0,5 Oui Portable,
mtallique membrane mtallique mini 0 100 Pa absence de liquide,
lecture facile
Micromanomtre idem Jusqu 10
4
Pa 0,01 10
3
Oui Portable trs sensible
lectronique mini 0 10 Pa
(transducteur)
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 29
30
On se propose de calculer les pertes
de charge et les diverses nergies mises
en jeu lors du fonctionnement dune instal-
lation de captage dans deux confiturations
diffrentes.
Linstallation consiste en un rseau sur
lequel sont raccordes huit pices de cap-
tage, dun dbit unitaire de 300 m
3
/h, desti-
nes extraire des fumes de soudage. On
tudie ce rseau qui comporte un certain nom-
bre de dfauts induisant des pertes de charge
singulires et lon compare ses caractris-
tiques celles du mme rseau ayant subi les
quelques modifications suivantes :
augmentation du diamtre de raccorde-
ment des buses de captage ;
raccourcissement des flexibles de raccor-
dement ;
augmentation du rayon des courbures des
coudes ;
transformation des piquages droits en
piquages 45 ;
mise en place dun divergent en sortie du
ventilateur (rcupration de la pression dyna-
mique) ;
colmatage des dfauts dtanchit (sup-
poss rpartis uniformment dans le premier
cas).
On estime que les pertes de charges dues
aux changements de section le long dun
ANNEXE 1
tude comparative de deux rseaux dextraction
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 30
31
mme rseau sont ngligeables et lon cal-
cule les pertes de charge statiques. Les
pertes de charge totales incluant les pres-
sions dynamiques sont reprises ensuite dans
le bilan dexploitation.
Bilan dexploitation
Caractristiques communes aux deux
rseaux
Le ventilateur est suppos avoir un rende-
ment arodynamique de 50 %.
Les pertes par la transmission et le moteur
sont supposes gales 20 % de la puis-
sance absorbe.
Le temps de fonctionnement est de
10 heures par jour soit 2 250 heures par an.
Rseau n 1
Le dbit thorique de 2 400 m
3
/h conduit :
pertes de charge statiques = 1 058 Pa
pression dynamique = 212 Pa
pression totale ncessaire = 1 270 Pa
Il est suppos que les fuites reprsentant
20 % du dbit prennent naissance tout
au long du rseau. Dans ces conditions les
caractristiques utiles du ventilateur seront
approximativement :
Q= 2 400 1,2 = 2 880 m
3
/h soit 0,80 m
3
/s
p
t
= 1 270 (1,2)
2
= 1 829 Pa
La puissance absorbe larbre du ventila-
teur est :
P
a
= Q. p
t
= 0,80 1 829 = 2 926 W
0,5
La puissance absorbe par le moteur P
m
est :
P
m
= 2 926 12 = 3 511 W
ou 3,51 kW
Soit une consommation annuelle de :
2 250 X 3,51 = 7 900 kWh
RSEAU N 1 : TABLEAU DE CALCUL DES PERTES DE CHARGE
Rappel : 1 Pa g 0,10 mm CE
Dsignation du tronon de rseau V (m/s) P
dyn (
1
)
P
sta
(Pa) (Pa)
Entre pice de captage 2,78 4,5 0,4 1,8
Changement de section 300 100 en 100 10,6 66,1 1,07 65,9
Registre de rglage papillon, ouverture 15, 100 10,6 66,1 0,6 39,7
Flexible mtallique 100, l = 5 m, p
lin
= 22 Pa/m 10,6 66,1 110
Conduit mtallique 100, l = 5 m, p
lin
= 15,5 Pa/m 10,6 66,1 77,5
Coude 90, 3 sections, 100, R/D = 1,0 10,6 66,1 0,5 33,0
Conduit mtallique 100, l = 5 m, p
lin
= 15,5 Pa/m 10,6 66,1 77,5
Changement de section 100 en 150 4,75 13,3
Confluence rseau principal 90 V2 V1 V1 = 9,5 9,50 53 1 53
V2 = 4,75
V3 V3 = 10,6
Conduit mtallique 150, l = 5 m, p
lin
= 8 Pa/m 9,50 53 40
Changement de section 150 en 200 5,30 16,5
Confluence rseau principal 90 V2 V1 V1 = 8 8,0 37,6 0,9 33,8
V2 = 5,3
V3 V3 = 10,6
Conduit mtallique 200, l = 5 m, p
lin
= 4 Pa/m 8,0 37,6 20
Confluence piquage 90 V2 V1 V1 = 10,2 8,0 37,6 1,4 52,6
V2 = 10,6
V3 V3 = 8,0
Conduit mtallique 200, l = 10 m, p
lin
= 6,5 Pa/m 10,2 61,1 65
Confluence piquage 90 V2 V1 V1 = 14 10,2 61,1 1,2 73,3
V2 = 10,2
V3 V3 = 10,2
Conduit mtallique 250, l = 20 m, p
lin
= 8,5 Pa/m 14 115,2 170
Coude 90, 3 sections, 250, R/D = 1,0 14 115,2 0,5 57,6
Conduit mtallique 200 , eq 20, 1 = 5 m, p
lin
= 17,5 Pa/m 19 212,3 87,5
Total pertes de charge statique 1 058,2
(1) Coefficient de perte de charge accidentelle (sans dimension) permettant le calcul de p
sta
= p
dyn
.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 31
32
Rseau n 2
Le dbit rel puisquil ny a pas de fuite est
Q = 2 400 m
3
/h :
pertes de charge statiques = 599 Pa
pression dynamique = 53 Pa
pression totale ncessaire = 652 Pa
Q = 2 400 m
3
/h = 0,67 m
3
/s
p
t
= 652 Pa
La puissance absorbe larbre du ventila-
teur est :
P
a
Q. p
t
0,67 652
874 W
0,5
La puissance absorbe par le moteur P
m
est :
P
m
= 874 1,2 =
1 048 W
ou 1,05 kW
Soit une consommation annuelle de :
2 250 X 1,05 = 2 359 kWh
Conclusion
On peut donc constater que pour une mme
efficacit de captage, le rseau le moins tu-
di engendre une consommation annuelle
3,35 fois plus leve.
RSEAU N 2 : TABLEAU DE CALCUL DES PERTES DE CHARGE
Rappel : 1 Pa g 0,10 mm CE
Dsignation du tronon de rseau V (m/s) P
dyn (
1
)
P
sta
(Pa) (Pa)
Entre pice de captage 2,78 4,5 0,4 1,8
Changement de section 300 100 en 125 7,00 28,8 1,07 26,0
Registre de rglage papillon, ouverture 15, 125 7,00 28,8 0,6 17,3
Flexible mtallique 125, l = 2 m, p
lin
= 10 Pa/m 7,00 28,8 20
Conduit mtallique 125, l = 8 m, p
lin
= 5,7 Pa/m 7,00 28,8 45,6
Coude 90, 5 sections, 125, R/D = 2 7,00 28,8 0,2 5,7
Conduit mtallique 125, l = 5 m, p
lin
= 5,7 Pa/m 7,00 28,8 28,5
Changement de section 125 en 150 4,75 13,3
Confluence rseau principal 45 V2 V1 V1 = 9,5 9,5 53 0,3 15,9
V2 = 5,3
V3 V3 = 7,0
Conduit mtallique 150, l = 5 m, p
lin
= 8 Pa/m 9,5 53 40
Changement de section 150 en 200 5,3 16,5
Confluence rseau principal 45 V2 V1 V1 = 8,0 8,0 37,6 0,45 16,9
V2 = 5,8
V3 V3 = 7,0
Conduit mtallique 200, l = 5 m, p
lin
= 4 Pa/m 8,0 37,6 20
Coude 45, 200, R/D = 2 8,0 37,6 0,1 3,8
Confluence piquage 45 V2 V1 V1 = 10,2 8,0 37,6 0,6 22,6
V2 = 7,0
V3 V3 = 8,0
Conduit mtallique 200, l = 10 m, p
lin
= 6,5 Pa/m 10,2 61,1 65
Coude 45, 200, R/D = 2 10,2 61,1 0,1 6,1
Confluence piquage 45 V2 V1 V1 = 14 10,2 61,1 0,6 36,7
V2 = 10,2
V3 V3 = 7,0
Conduit mtallique 250, l = 20 m, p
lin
= 8,5 Pa/m 14,0 115,2 170
Coude 90, 5 sections, 250, R/D = 2 14,0 115,2 0,2 23
Conduit divergent 220 en 300 14,0 115,2 0,15 17,3
Conduit mtallique 300, l = 5 m, p
lin
= 3,4 Pa/m 9,5 53 17
Total pertes de charge statique 599,2
(1) Coefficient de perte de charge accidentelle (sans dimension) permettant le calcul de p
sta
= p
dyn
.
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 32
33
ANNEXE 2
Informations utiles
I. Donnes techniques gnrales
1.1. Convention de quelques units utiles en ventilation
1.1.1. Units de pression
Pa mbar atm
mm Hg mm eau
kgf/cm
2
inch H
2
O
inch Hg
psi (ou
(ou Torr) (ou mmCE) (ou wg) Ibf/in
2
)
1 Pa = 1 0,01 9,869.10
6
7,501.10
3
0,1020 1,020.10
5
4,015.10
3
2,953.10
4
1,450.10
4
1 mbar = 100 1 9,869.10
4
0,7501 10,20 1,020.10
3
0,4015 2,953.10
2
1,450.10
2
1 atm = 1,013.10
5
1013 1 760 1,033.10
4
1,033 406,8 29,92 14,70
1 mm Hg = 133,3 1,333 1,316.10
3
1 13,60 1,360.10
3
0,5352 3,937.10
2
1,934.10
2
1 mm eau = 9,807 9,807.10
2
9,678.10
2
7,356.10
2
1 10
4
3,937.10
2
2,896.10
3
1,422.10
3
1 kgf/cm
2
9,807.10
4
980,7 0,9678 735,6 10 000 1 393,7 28,96 14,22
1 inch H
2
O= 249,1 2,491 2,458.10
3
1,868 25,40 2,540.10
3
1 7,356.10
2
3,613.10
2
1 inch Hg = 3386 33,86 3,342.10
2
25,40 345,3 3,453.10
2
13,60 1 0,4911
1 psi = 6885 68,95 6,805.10
2
51,71 703,1 7,031.10
2
27,68 2,036 1
Exemple dapplication : 1 atm = 1,033 kgf/cm
2
1.1.2. Units de dbit et de vitesse dair
1 fpm = 1 ft/min = 5,080.10
3
m/s =
1 cfm/sq.ft = 18,29 m
3
/h.m
2
1 m/s = 196,9 fpm
1 cfm/ft = 1,548.10
3
m
2
/s = 5,574 m
3
/h.m
1.1.3. Autres units
Puissance
1 ch = 735,5 W
1 hp = 745,7 W
Concentration :
1 gr/cu ft = 1 grain/ft
3
= 2,288 g/m
3
masse volumique :
1 lb/cu ft = 16,02 kg/m
3
1.1.4. Exemple dapplication
La puissance absorbe par un ventilateur
sexprime par la formule :
P =
Q . p
t
Q (m
3
/s) dbit dair traversant le ventilateur
p
t
(Pa) pression totale fournie par le ventilateur
P (W) puissance absorbe
(sans dimension) rendement du ventilateur
Compte tenu des donnes ci-dessus, cette
formule scrit si on exprime Q en m
3
/h, p
t
en
mm CE, P en ch et en % ;
1.2. Donnes physiques
a) Masse volumique de lair : elle est
donne (selon la norme NF X 10-200) par la
formule :
(kg/m
3
) : masse volumique de lair
p (Pa) : pression absolue de lair
T (K) : temprature absolue
p
v
(Pa) : pression partielle de la vapeur deau
= 3,485.10
3
p pv
3
8
T
P = 3,7.10
4
=
Qp
t
1
2700
Qp
t
735,5 P = ou
Q
3600
9,807 p
t
100
Ainsi, par exemple, pour de lair 20 C sous
la pression atmosphrique normale (101 325
Pa) et 65 % dhumidit relative, la masse
volumique de lair est de :
= 1,20 kg/m
3
(la pression de vapeur saturante de leau
cette temprature est de 2 338 Pa). Si la
valeur de la pression partielle de vapeur
deau ne peut pas tre mesure, on pourra
en premire approximation utiliser la formule
donnant la masse volumique de lair sec :
(kg/m
3
) : masse volumique de lair sec
o
(kg/m
3
) : valeur de la pression atmosph-
rique normale et 0 C (
o
= 1,293 kg/m
3
)
p (Pa) : pression absolue de lair
T (K) : temprature absolue
p
o
(Pa) : pression atmosphrique normale
(
o
= 101 325 Pa)
T
o
(K) : temprature absolue correspondant
0 C (T
o
= 273,15 K)
b) Proprits physiques de lair sec 20 C
sous 760 mm Hg :
viscosit dynamique
= 18,2.10
6
kg/m.s
viscosit cinmatique
= 15,1.10
6
m
2
/s
chaleur massique pression constante
c
p
= 1 006 J/kg.K
c) Nombre de Reynolds : nombre sans
dimension caractrisant lcoulement dun
fluide dans une conduite :
Re
VD
V (m/s) : vitesse moyenne du fluide
D (m) : diamtre hydraulique de la conduite
(m
2
/s) : viscosit cinmatique du fluide
m
3
/s m
3
/h l/min
cfm
(ou ft
3
min)
1 m
3
/s = 1 3 600 60 000 2 119
1 m
3
/h = 2.778.10
4
1 16,67 0,5886
1 l/min = 1,667.10
5
0,060 1 3,531.10
2
1 cfm = 4,720.10
4
1,699 28,32 1
=
o
p
p
o
T
o
T
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 33
34
II. Adresses utiles
2.1. Syndicats professionnels
UNICLIMA (Union intersyndicale des
constructeurs de matriel araulique,
thermique et frigorifique)
39/41, rue Louis-Blanc -
92400 COURBEVOIE
Tl. : 01 47 17 62 92
2.2. Centres de recherches et de
documentation, organismes
CETIAT (Centre technique des indus-
tries arauliques et thermiques)
23, avenue des Arts - B.P. 2042
69603 VILLEURBANNE Cedex
Tl. : 04 72 44 49 00
COSTIC (Comit scientifique et tech-
nique de lindustrie du chauffage, de la
ventilation et du conditionnement dair)
Domaine de Saint-Paul
78470 SAINT-RMY-LS-CHEVREUSE
Tl. : 01 30 85 20 10
INERIS (Institut national de lenvironne-
ment industriel et des risques)
B.P. 2 - 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE
Tl. : 03 44 55 66 77
CITEPA (Comit interprofessionnel
technique dtudes de la pollution atmo-
sphrique)
7, cit Paradis
75010 PARIS
Tl. : 01 44 83 68 83
Conseil franais de lnergie
3, rue Treilhard
75008 PARIS
Tl. : 01 42 89 52 17
ADEME (Agence de lenvironnement et
de la matrise de lnergie)
2, square La Fayette - B.P. 406
49004 ANGERS Cedex
Tl. : 02 41 20 41 20
CFDE (Centre de formation et de docu-
mentation sur lenvironnement industriel)
18, rue Jean-Giraudoux
75016 PARIS
Tl. : 01 53 57 17 53
INRS ED 695 V4:Mise en page 1 6/06/08 12:35 Page 34
SOMMAIRE
LEXIQUE ............................................................................................................................................................ 2
COMMENT ABORDER LTUDE DUN SYSTME DE VENTILATION .............................................................. 3
1. POSTE DE TRAVAIL .................................................................................................................................... 4
1.1. Diminution de la pollution par action sur le processus polluant ......................................................... 4
1.2. Analyse du poste de travail ................................................................................................................. 4
2. POLLUTION ................................................................................................................................................. 4
2.1. Rglementation .................................................................................................................................... 4
2.2. Risque .................................................................................................................................................. 4
2.2.1. Risque dintoxication ............................................................................................................... 4
2.2.2. Risque dexplosion ................................................................................................................... 5
2.2.3. Risques dus lexposition au chaud et au froid ..................................................................... 6
2.3. Autres causes dinconfort ................................................................................................................... 6
3. CAPTAGE ..................................................................................................................................................... 6
3.1. Techniques de ventilation .................................................................................................................... 6
3.2. Ventilation locale .................................................................................................................................. 7
3.2.1. Principes .................................................................................................................................. 7
3.2.2. Solutions .................................................................................................................................. 9
4. TRANSPORT DES POLLUANTS ............................................................................................................... 14
4.1. coulement de lair dans les canalisations ....................................................................................... 14
4.1.1. Pression statique et pression dynamique .............................................................................. 14
4.1.2. Vitesse de lair ........................................................................................................................ 15
4.1.3. Pertes de charge .................................................................................................................... 15
4.2. Conception du rseau ....................................................................................................................... 16
4.3. quilibrage de linstallation ............................................................................................................... 18
4.4. Ambiances explosives ....................................................................................................................... 18
4.4.1. Extraction des gaz et vapeurs inflammables ......................................................................... 18
4.4.2. Extraction des poussires inflammables ............................................................................... 18
4.5 Bruit .................................................................................................................................................... 18
5. VENTILATEURS ......................................................................................................................................... 19
5.1. Gnralits ......................................................................................................................................... 19
5.2. Point de fonctionnement dun ventilateur ......................................................................................... 19
5.3. Choix ................................................................................................................................................. 19
5.4. Bruit ................................................................................................................................................... 20
6. REJET ........................................................................................................................................................ 20
7. AIR DE COMPENSATION .......................................................................................................................... 21
7.1. Rle de la compensation .................................................................................................................. 21
7.2. Compensation et confort thermique ................................................................................................. 22
8. VENTILATION GNRALE ....................................................................................................................... 22
8.1. Principes ............................................................................................................................................ 22
8.2. Solutions ............................................................................................................................................ 23
9. IMPLANTATION DU MATRIEL ................................................................................................................. 24
10. CONTRLES ET ENTRETIEN DUNE INSTALLATION DE VENTILATION ................................................. 24
10.1. Paramtres contrler .................................................................................................................... 24
10.2. Contrle dune installation sur site .................................................................................................. 24
10.3. Techniques de contrles quantitatives ............................................................................................ 24
10.3.1. Dtermination des dbits dair par exploration des champs de vitesse dair
dans une conduite ferme .................................................................................................. 27
10.3.2. Dtermination des dbits dair par exploration du champ de vitesse au niveau
des bouches dextraction ou dintroduction dair .............................................................. 27
10.3.3. Dtermination du dbit dair et de contrle dune installation par mesure de
la pression statique en un point ......................................................................................... 27
10.3.4. Estimation du dbit dair partir de la mesure de la vitesse de rotation du
ventilateur et de la puissance consomme par le moteur lectrique ................................ 27
10.4. Techniques de contrle qualitatives ................................................................................................ 27
10.5. Appareils de mesure de vitesse dair .............................................................................................. 28
10.6. Appareils de mesure de pression .................................................................................................... 28
10.7. Registre de contrle dune installation de ventilation ..................................................................... 28
10.8. Causes possibles de mauvais fonctionnements dcels lors du contrle dune
installation ........................................................................................................................................ 28
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 29
ANNEXE 1. tude comparative de deux rseaux dextraction .................................................................... 30
ANNEXE 2. Informations utiles ..................................................................................................................... 33
Pour obtenir en prt les audiovisuels et multimdias et pour commander les brochures et les aches
de lINRS, adressez-vous au service Prvention de votre Carsat, Cram ou CGSS.
Carsat ALSACE-MOSELLE
(67 Bas-Rhin)
14 rue Adolphe-Seyboth
CS 10392
67010 Strasbourg cedex
tl. 03 88 14 33 00
fax 03 88 23 54 13
prevention.documentation@carsat-am.fr
www.carsat-alsacemoselle.fr
(57 Moselle)
3 place du Roi-George
BP 31062
57036 Metz cedex 1
tl. 03 87 66 86 22
fax 03 87 55 98 65
www.carsat-alsacemoselle.fr
(68 Haut-Rhin)
11 avenue De-Lattre-de-Tassigny
BP 70488
68018 Colmar cedex
tl. 03 88 14 33 02
fax 03 89 21 62 21
www.carsat-alsacemoselle.fr
Carsat AQUITAINE
(24 Dordogne, 33 Gironde,
40 Landes, 47 Lot-et-Garonne,
64 Pyrnes-Atlantiques)
80 avenue de la Jallre
33053 Bordeaux cedex
tl. 05 56 11 64 36
fax 05 57 57 70 04
documentation.prevention@carsat-
aquitaine.fr
www.carsat.aquitaine.fr
Carsat AUVERGNE
(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire,
63 Puy-de-Dme)
48-50 boulevard Lafayette
63058 Clermont-Ferrand cedex 1
tl. 04 73 42 70 76
fax 04 73 42 70 15
preven.carsat@orange.fr
www.carsat-auvergne.fr
Carsat BOURGOGNE
et FRANCHE-COMT
(21 Cte-dOr, 25 Doubs, 39 Jura,
58 Nivre, 70 Haute-Sane,
71 Sane-et-Loire, 89 Yonne,
90 Territoire de Belfort)
ZAE Cap-Nord, 38 rue de Cracovie
21044 Dijon cedex
tl. 08 21 10 21 21
fax 03 80 70 52 89
prevention@carsat-bfc.fr
www.carsat-bfc.fr
Carsat BRETAGNE
(22 Ctes-dArmor, 29 Finistre,
35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)
236 rue de Chteaugiron
35030 Rennes cedex
tl. 02 99 26 74 63
fax 02 99 26 70 48
drpcdi@carsat-bretagne.fr
www.carsat-bretagne.fr
Carsat CENTRE
(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre,
37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)
36 rue Xaintrailles
45033 Orlans cedex 1
tl. 02 38 81 50 00
fax 02 38 79 70 29
prev@carsat-centre.fr
www.carsat-centre.fr
Carsat CENTRE-OUEST
(16 Charente, 17 Charente-Maritime,
19 Corrze, 23 Creuse, 79 Deux-Svres,
86 Vienne, 87 Haute-Vienne)
37 avenue du prsident Ren-Coty
87048 Limoges cedex
tl. 05 55 45 39 04
fax 05 55 45 71 45
cirp@carsat-centreouest.fr
www.carsat-centreouest.fr
Cram LE-DE-FRANCE
(75 Paris, 77 Seine-et-Marne,
78 Yvelines, 91 Essonne,
92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis,
94 Val-de-Marne, 95 Val-dOise)
17-19 place de lArgonne
75019 Paris
tl. 01 40 05 32 64
fax 01 40 05 38 84
prevention.atmp@cramif.cnamts.fr
www.cramif.fr
Carsat LANGUEDOC-ROUSSILLON
(11 Aude, 30 Gard, 34 Hrault,
48 Lozre, 66 Pyrnes-Orientales)
29 cours Gambetta
34068 Montpellier cedex 2
tl. 04 67 12 95 55
fax 04 67 12 95 56
prevdoc@carsat-lr.fr
www.carsat-lr.fr
Carsat MIDI-PYRNES
(09 Arige, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrnes,
81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)
2 rue Georges-Vivent
31065 Toulouse cedex 9
tl. 0820 904 231 (0,118 /min)
fax 05 62 14 88 24
doc.prev@carsat-mp.fr
www.carsat-mp.fr
Carsat NORD-EST
(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne,
52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle,
55 Meuse, 88 Vosges)
81 85 rue de Metz
54073 Nancy cedex
tl. 03 83 34 49 02
fax 03 83 34 48 70
documentation.prevention@carsat-nordest.fr
www.carsat-nordest.fr
Carsat NORD-PICARDIE
(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise,
62 Pas-de-Calais, 80 Somme)
11 alle Vauban
59662 Villeneuve-dAscq cedex
tl. 03 20 05 60 28
fax 03 20 05 79 30
bedprevention@carsat-nordpicardie.fr
www.carsat-nordpicardie.fr
Carsat NORMANDIE
(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche,
61 Orne, 76 Seine-Maritime)
Avenue du Grand-Cours, 2022 X
76028 Rouen cedex
tl. 02 35 03 58 22
fax 02 35 03 60 76
prevention@carsat-normandie.fr
www.carsat-normandie.fr
Carsat PAYS DE LA LOIRE
(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire,
53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vende)
2 place de Bretagne
44932 Nantes cedex 9
tl. 02 51 72 84 08
fax 02 51 82 31 62
documentation.rp@carsat-pl.fr
www.carsat-pl.fr
Carsat RHNE-ALPES
(01 Ain, 07 Ardche, 26 Drme, 38 Isre,
42 Loire, 69 Rhne, 73 Savoie,
74 Haute-Savoie)
26 rue dAubigny
69436 Lyon cedex 3
tl. 04 72 91 96 96
fax 04 72 91 97 09
preventionrp@carsat-ra.fr
www.carsat-ra.fr
Carsat SUD-EST
(04 Alpes-de-Haute-Provence,
05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes,
13 Bouches-du-Rhne, 2A Corse-du-Sud,
2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)
35 rue George
13386 Marseille cedex 5
tl. 04 91 85 85 36
fax 04 91 85 75 66
documentation.prevention@carsat-sudest.fr
www.carsat-sudest.fr
Services Prvention des CGSS
CGSS GUADELOUPE
Immeuble CGRR, Rue Paul-Lacav, 97110 Pointe--Pitre
tl. 05 90 21 46 00 fax 05 90 21 46 13
lina.palmont@cgss-guadeloupe.fr
CGSS GUYANE
Espace Turenne Radamonthe, route de Raban,
BP 7015, 97307 Cayenne cedex
tl. 05 94 29 83 04 fax 05 94 29 83 01
CGSS LA RUNION
4 boulevard Doret, 97704 Saint-Denis Messag cedex 9
tl. 02 62 90 47 00 fax 02 62 90 47 01
prevention@cgss-reunion.fr
CGSS MARTINIQUE
Quartier Place-dArmes, 97210 Le Lamentin cedex 2
tl. 05 96 66 51 31 et 05 96 66 51 32 fax 05 96 51 81 54
prevention972@cgss-martinique.fr
www.cgss-martinique.fr
Services Prvention des Carsat et des Cram
Principes gnraux de ventilation
GUIDE PRATIQUE DE VENTILATION
COLLECTION DES GUIDES PRATIQUES DE VENTILATION
0. Principes gnraux de ventilation ED 695
1. Lassainissement de lair des locaux de travail ED 657
2. Cuves et bains de traitement de surface ED 651
3. Mise en uvre manuelle des polyesters stratifis ED 665
4. Postes de dcochage en fonderie ED 662
5. Ateliers dencollage de petits objets ED 672
(chaussures)
6. Captage et traitement des arosols de fluides de coupe ED 972
7. Oprations de soudage larc et de coupage ED 668
8. Espaces confins ED 703
9. 1. Cabines dapplication par pulvrisation ED 839
de produits liquides
9. 2. Cabines d'application par projection ED 928
de peintures en poudre
9. 3. Pulvrisation de produits liquides. ED 906
Objets lourds ou encombrants
10. Le dossier dinstallation de ventilation ED 6008
11. Srigraphie ED 6001
12. Seconde transformation du bois ED 750
13. Fabrication des accumulateurs au plomb ED 746
14. Dcapage, dessablage, dpolissage au jet libre en cabine ED 768
15. Rparation des radiateurs automobiles ED 752
16. Ateliers de fabrication de prothses dentaires ED 760
17. Emploi des matriaux pulvrulents ED 767
18. Sorbonnes de laboratoire ED 795
19. Usines de dpollution des eaux rsiduaires ED 820
et ouvrages dassainissement
20. Postes dutilisation manuelle de solvants ED 6049
21. Ateliers de plasturgie ED 6146
0
Institut national de recherche et de scurit
pour la prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles
65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris
G
Tl. 01 40 44 30 00
www.inrs.fr
G
e-mail : info@inrs.fr
dition INRS ED 695
3
e
dition (1989)
G
rimpression juillet 2013
G
2 000 ex.
G
ISBN 978-2-7389-1649-5
Vous aimerez peut-être aussi
- 100 Fiches Pratiques de Menuiserie, Agencement Et B Nisterie... Wawacity - BooDocument224 pages100 Fiches Pratiques de Menuiserie, Agencement Et B Nisterie... Wawacity - BooGildas EyiPas encore d'évaluation
- Henri Renaud Charpentes Et CouverturesDocument81 pagesHenri Renaud Charpentes Et CouverturesMohamed Iziki100% (3)
- Traité d'économétrie financière: Modélisation financièreD'EverandTraité d'économétrie financière: Modélisation financièrePas encore d'évaluation
- Renaud, Henri - Fenêtres de Toit Et Lucarnes - Combles Aménagés (2013, Eyrolles) - Libgen - LiDocument82 pagesRenaud, Henri - Fenêtres de Toit Et Lucarnes - Combles Aménagés (2013, Eyrolles) - Libgen - LiMakenson MuscadinPas encore d'évaluation
- Guide RE2020 Jan2023Document80 pagesGuide RE2020 Jan2023Bogdan MihaiPas encore d'évaluation
- 2 Guide On FRDocument40 pages2 Guide On FRLa Vie JesusGodPas encore d'évaluation
- (Henri Renaud) Fenêtres de Toit Et Lucarnes ComDocument82 pages(Henri Renaud) Fenêtres de Toit Et Lucarnes ComFAHASOAVANA Percis RakotovaoPas encore d'évaluation
- Rapport-Infrastructures Hydro AgricolesDocument18 pagesRapport-Infrastructures Hydro AgricolesRami OUERGHIPas encore d'évaluation
- 7 BTC StabiliséDocument37 pages7 BTC StabiliséLEIS DJIFACK100% (1)
- SéchageDocument93 pagesSéchageWafa MersniPas encore d'évaluation
- IT PIP STDF127 Tomatecerise FRDocument41 pagesIT PIP STDF127 Tomatecerise FRJérôme Niamien100% (3)
- ZAC Bouchayer Viallet 38 - EI PréalableDocument171 pagesZAC Bouchayer Viallet 38 - EI PréalablesusCities100% (5)
- Chlore SoudeDocument14 pagesChlore SoudejojoPas encore d'évaluation
- Ed873 Conception Des StepDocument64 pagesEd873 Conception Des Steperic partratPas encore d'évaluation
- T.flow Hygro T.flow Nano Notice D InstallationDocument140 pagesT.flow Hygro T.flow Nano Notice D InstallationNorbert Alves100% (1)
- Mode D'emploi ADRIA WINDocument66 pagesMode D'emploi ADRIA WINBenoît Vergnes100% (1)
- P539Document31 pagesP539ABDERRAFIA BOUKHALIFIPas encore d'évaluation
- Lycee Jean Jaures - CCTPDocument46 pagesLycee Jean Jaures - CCTPMahdi FekiPas encore d'évaluation
- Nanterre Joffre Lot 07 Cloisons Doublages Isolation Juin 2022Document31 pagesNanterre Joffre Lot 07 Cloisons Doublages Isolation Juin 2022MFR ArchitectesPas encore d'évaluation
- Nanterre Joffre Lot 06 Menuiseries Exterieures Bois Juin 2022Document26 pagesNanterre Joffre Lot 06 Menuiseries Exterieures Bois Juin 2022MFR ArchitectesPas encore d'évaluation
- 1846 - Uniqlo Rivoli Dce CCTP CVC - 20-06-12Document63 pages1846 - Uniqlo Rivoli Dce CCTP CVC - 20-06-12BIM EEPas encore d'évaluation
- Extract j3580 TechniquesDeLIngenieurDocument6 pagesExtract j3580 TechniquesDeLIngenieurAisaoua BuobouPas encore d'évaluation
- Stage TechnicienDocument25 pagesStage TechnicienKhaled Ben YoussefPas encore d'évaluation
- Nanterre Joffre Lot 05 Etancheite Juin 2022Document33 pagesNanterre Joffre Lot 05 Etancheite Juin 2022MFR ArchitectesPas encore d'évaluation
- GCAlgerie.com(188)Document81 pagesGCAlgerie.com(188)Wence DegboePas encore d'évaluation
- IF000001 Ee 74Document34 pagesIF000001 Ee 74pqnamwPas encore d'évaluation
- 01 - CCTP Lot 01 VRDDocument79 pages01 - CCTP Lot 01 VRDde la Fayolle GrégoirePas encore d'évaluation
- ACi - DCE - CCTP Lot 01 Travaux Second OeuvreDocument27 pagesACi - DCE - CCTP Lot 01 Travaux Second OeuvreAmel RPas encore d'évaluation
- Top Escaliers Manuel ComeplanDocument34 pagesTop Escaliers Manuel ComeplanRndvan FérusPas encore d'évaluation
- KERHELLEC (SCEA) StConan (22) DAEDocument180 pagesKERHELLEC (SCEA) StConan (22) DAEبلقاسم لافيPas encore d'évaluation
- 02 Fondations Gros OeuvreDocument22 pages02 Fondations Gros OeuvreJunior MekavingPas encore d'évaluation
- Planchers Bois - Vibrations - Données EN12871Document80 pagesPlanchers Bois - Vibrations - Données EN12871GuissetPas encore d'évaluation
- CCTP LOT 01 Cma31 V003Document44 pagesCCTP LOT 01 Cma31 V003Nirina ArimananaPas encore d'évaluation
- 0000-Rapport de Presentation CMC Agadir Et AnnexeDocument175 pages0000-Rapport de Presentation CMC Agadir Et AnnexeNourdine ElbounjimiPas encore d'évaluation
- GMR 1000 Condens: Chaudières Murales Gaz À CondensationDocument68 pagesGMR 1000 Condens: Chaudières Murales Gaz À CondensationMarius IliePas encore d'évaluation
- Chaudières Murales À Gaz À Condensation: Notice D'emploi Et D'installation Destinée À L'usager Et À L'installateurDocument28 pagesChaudières Murales À Gaz À Condensation: Notice D'emploi Et D'installation Destinée À L'usager Et À L'installateurDoroPas encore d'évaluation
- Extrait Du Plan Général de CoordinationDocument7 pagesExtrait Du Plan Général de CoordinationLydie OrtegaPas encore d'évaluation
- CCTP Lot Plomberie ASN07Document119 pagesCCTP Lot Plomberie ASN07Mourad AdelPas encore d'évaluation
- Rapport Apd GDTDocument257 pagesRapport Apd GDTArij Naily Ep Hammami100% (1)
- 83265504Document128 pages83265504Azzeddine LabrichiPas encore d'évaluation
- Chaudiere Eta Pellets Unit 7 15 KW MontageDocument68 pagesChaudiere Eta Pellets Unit 7 15 KW MontageLAMBERT PierrePas encore d'évaluation
- CCTP 1 Teras VRD Esp Verts Dce IndDocument39 pagesCCTP 1 Teras VRD Esp Verts Dce IndImad Jijel100% (1)
- Upload 00069897 1653552548342Document48 pagesUpload 00069897 1653552548342Toto FollyPas encore d'évaluation
- Diris A20: Notice D'utilisationDocument68 pagesDiris A20: Notice D'utilisationEdmar BataquePas encore d'évaluation
- Rapport Veille Salon Pollutec 2009 Traitement Des PollutionsDocument58 pagesRapport Veille Salon Pollutec 2009 Traitement Des PollutionsEURL VIEDOCPas encore d'évaluation
- DG VRD CCTP VRD IndADocument85 pagesDG VRD CCTP VRD IndAbensbihPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges Habitat ERP V1Document57 pagesCahier Des Charges Habitat ERP V1nucci.modaitaliaPas encore d'évaluation
- Notice de Dietrich Elidens DTG v1300 Eco NoxDocument84 pagesNotice de Dietrich Elidens DTG v1300 Eco Noxnefeffeny-4352Pas encore d'évaluation
- Série Traitement Des GasDocument29 pagesSérie Traitement Des Gasnadjib62Pas encore d'évaluation
- CPK18EDocument49 pagesCPK18ERichard NúñezPas encore d'évaluation
- Manuel Chaudiere - de Dietrich - CityDocument44 pagesManuel Chaudiere - de Dietrich - CityBucur IliePas encore d'évaluation
- Aldes T Flow Hygro Notice FRDocument32 pagesAldes T Flow Hygro Notice FRThomas DietzPas encore d'évaluation
- Fatslfra 6 Nap 374Document97 pagesFatslfra 6 Nap 374Houda El AziziPas encore d'évaluation
- CCTP Ascenseurs DuplexDocument17 pagesCCTP Ascenseurs DuplexDavid ToledanoPas encore d'évaluation
- Man - Travaux - Amélioration Urbaine - Version Finale 22 PDFDocument150 pagesMan - Travaux - Amélioration Urbaine - Version Finale 22 PDFmezouedPas encore d'évaluation
- SX 22 - 3.4.442.5 - 400V50Hz - Fra-Spa-PorDocument114 pagesSX 22 - 3.4.442.5 - 400V50Hz - Fra-Spa-PorMarcos MendesPas encore d'évaluation
- 1392 PRO CCTP 01 B Plomberie Chauffage VentilationDocument35 pages1392 PRO CCTP 01 B Plomberie Chauffage VentilationSABER HM2EPas encore d'évaluation
- Impact Aghbala DefinitifDocument76 pagesImpact Aghbala DefinitifYOU NAMEZPas encore d'évaluation
- CCTP Marché Public BUSSYDocument34 pagesCCTP Marché Public BUSSYcelined1611Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2 GSCMDocument33 pagesChapitre 2 GSCMWafa MersniPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Introduction Au SCMDocument29 pagesChapitre 1 Introduction Au SCMWafa MersniPas encore d'évaluation
- Beet Sugar Crystallization Application Note B211932FRDocument4 pagesBeet Sugar Crystallization Application Note B211932FRWafa MersniPas encore d'évaluation
- 20403f de La Bettrave Au Sucre 2015 YUMPUDocument11 pages20403f de La Bettrave Au Sucre 2015 YUMPUWafa MersniPas encore d'évaluation
- 8 Maguin Four À Chaux 15112017Document2 pages8 Maguin Four À Chaux 15112017Wafa MersniPas encore d'évaluation
- Dimensionnement Chauffage2Document10 pagesDimensionnement Chauffage2Wafa MersniPas encore d'évaluation
- Dimensionnement Chauffage1Document11 pagesDimensionnement Chauffage1Wafa MersniPas encore d'évaluation
- SA3-Analyse Temporelle Des Systemes LineairesDocument8 pagesSA3-Analyse Temporelle Des Systemes LineairesWafa MersniPas encore d'évaluation
- Etude Experimentale D Un Transfo 2007-2Document4 pagesEtude Experimentale D Un Transfo 2007-2Wafa MersniPas encore d'évaluation
- Www.9ra - Info Wncqadvdirbeqbsaksdehvudn M 19 TSGC Proc D S de ClimatisationDocument58 pagesWww.9ra - Info Wncqadvdirbeqbsaksdehvudn M 19 TSGC Proc D S de ClimatisationWafa MersniPas encore d'évaluation
- FR Projets MDP TunisieDocument20 pagesFR Projets MDP TunisieWafa MersniPas encore d'évaluation
- Normes EnvironnementalesetproceduredinspectionaucamerounDocument121 pagesNormes EnvironnementalesetproceduredinspectionaucamerounWafa MersniPas encore d'évaluation
- Cours3 Vapeurd EauDocument15 pagesCours3 Vapeurd EauWafa MersniPas encore d'évaluation