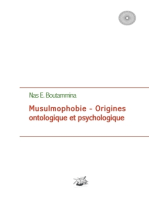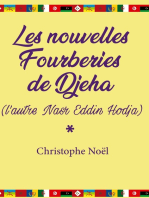Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Mohammed Dans La Bible Et Jesus Dans Le Coran A Alem
Mohammed Dans La Bible Et Jesus Dans Le Coran A Alem
Transféré par
Réda RizkyTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Mohammed Dans La Bible Et Jesus Dans Le Coran A Alem
Mohammed Dans La Bible Et Jesus Dans Le Coran A Alem
Transféré par
Réda RizkyDroits d'auteur :
Formats disponibles
MOHAMMAD DANS LA BIBLE ET
JESUS DANS LE CORAN
Auteur : A. ALEM
Ce livre fut rdig en 1986, et a t dit Paris en 1989 dans les ditions DAZ. Dans cette publication sur Internet nous avons essay de corriger les fautes de frappe avec quelques additions explicatives ; mais sans faire aucune modification fondamentale. Nous tenons ici signaler que tout genre de publication de ce livre est permise quiconque le voudrait, condition qu il n y fasse aucun changement. L auteur ne demande aucune rmunration.
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS INTRODUCTION LA BIBLE I. L Ancien Testament II. Le Nouveau Testament LE CORAN
PREMIERE PARTIE
CONTRADICTIONS, DIVERGENCES ET INEXACTITUDES DANS LA BIBLE
CHAPITRE I :
CONTRADICTIONS ET DIVERGENCES DANS LA BIBLE I. Dans L Ancien Testament II. Dans le Nouveau Testament
CHAPITRE II :
LES INEXACTITUDES DANS LA BIBLE I. Dans l Ancien Testament II. Dans le Nouveau Testament
DEUXIEME PARTIE
MOHAMMAD DANS LABIBLE
CHAPITRE I :
MOHAMMAD DANS L ANCIEN TESTAMENT I. Le Prophte Le Prophte attendu du Pentateuque Qui est Schilo ? Le Prophte des Psaumes
Le Serviteur lu Le Prophte des Manuscrits de la Mer Morte II. La Nation et la Religion L Alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance Quelle est la Nation insense Le Cantique nouveau c est l Islam Mohammad est le Prophte de Parn Le dsert fcond III. La Ville et le Sanctuaire La Ville du Prophte attendu La gloire de la Mecque et les uvres de ses habitants La gloire de la Mecque et celle de la Ste Ka ba IV. Les visions du Livre de Daniel
CHAPITRE II :
MOHAMMAD DANS LE NOUVEAU TESTAMENT I. II. Le Royaume de Dieu ou des cieux La transmission du Message divin une Nation fidle
III. Parabole des ouvriers et de la vigne IV. Le Fils de l homme V. Le Grand Messie n est pas un fils de David
VI. Le Prophte attendu VII. Le Prophte est plus puissant que Jean-Baptiste VIII. Le Vainqueur de l Apocalypse IX. Le Paraclet de l Evangile de Jean
TROISIEME PARTIE
JESUS DANS LE CORAN
INTRODUCTION La part de la culture hellnistique dans la formation du Christianisme et de l autorit politique dans son triomphe
CHAPITRE I :
JESUS, SA VIE ET SON OEUVRE I. Marie, mre de Jsus
II. La naissance de Jsus III. La mission et les miracles de Jsus IV. Jsus et les Juifs V. Jsus reviendra-t-il sur terre avant la fin du monde ? VI. Jsus a-t-il t rellement crucifi et tu ? VII. La Rdemption entre l Ecriture et la Raison
CHAPITRE II :
LA SERVITUDE DE JESUS A DIEU ENTRE LE TEXTE ET LA RAISON
I. L Ecriture Termes expliquer : Dieu, Fils, Pre II. Les preuves rationnelles du Coran concernant La servitude de Jsus Dieu
III. Discussion rationnelle concernant le Fils
CHAPITRE III :
ESPRIT SAINT DANS LA BIBLE ET LE CORAN
CHAPITRE IV :
LES ARGUMENTS RATIONNELS ANNULANT LE DOGME DE LA TRINITE
CONCLUSION
*************************
Avant-propos
Nombreux sont les savants musulmans qui ont compos des livres o ils exposent les contradictions, les divergences et les erreurs des textes bibliques. Dans leurs ouvrages ils montrent galement que la Bible renferme des allusions, plus ou moins claires, la prdication du Prophte Mohammad, et ils rfutent les croyances selon lesquelles Jsus serait le fils de Dieu ou Dieu fait homme.
Les plus importants ouvrages sont ceux d al-Ghazali, La Rfutation excellente de la divinit de Jsus-Christ d aprs les Evangiles , d al-Qortobi, al-I lam bima fi dini-n-Nassara mina-l-Awham Publication des erreurs que renferme le Christianisme , d Ibn Taimiya, La Rponse parfaite ceux qui ont altr la vritable religion du Christ , de Rahmat allah al-Hindi, Izhar al-Haqq , faire triompher la Vrit ( ou La vrit faire triompher ) et d autres.
L ouvrage de Rahmat allah al-Hindi donne des notices trs importants et s arrte sur de nombreux points qui intressent notre travail.
Son livre a le mrite de regrouper les thmes de controverses entre Chrtiens et Musulmans. Cependant, il s est trop attard sur des dtails, qui sont parfois insignifiants ; ce qui a rendu son livre volumineux et quelquefois ennuyeux.
Par ailleurs, il a nglig ou n a pas remarqu quelques textes bibliques qui se rapportent la question du Prophte annonc par les textes saints. En outre son poque ( XIXe sicle) des documents, comme ceux de Qumran (dcouverts entre 1947-1968), n taient pas encore dcouverts.
Notre tche est d viter les dtails moins importants, d inclure d autres textes concernant le Prophte attendu, aussi bien ceux que contient la Bible ou ceux faisant partie des documents de Qumran, d examiner ces textes d une manire plus systmatique, plus dtalle et plus documente, d ajouter des thmes trs importants, comme notre tude historique sur l volution du Christianisme et les influences extrieures qu il a subies.
Cette tude a le mrite, nous semble-t-il, de donner une explication ; si elle n est pas nouvelle non pour les conclusions, mais pour l analyse qu elle propose des faits et la dmarche suivie. C est ainsi que la question de l Esprit Saint en comparant Coran et Bible. Le rsultat auquel nous sommes parvenu, nous semble tout fait nouveau.
Nous avons compos le vritable portrait de Jsus partir des Evangiles. Ses qualits sont tires des textes eux-mmes. Cette image concorde avec celle esquisse par le Coran qui a le mrite de fournir deux critres en traitant de la personnalit de Jsus : Celui du texte et celui de la raison. Nous-mmes, nous avions suivi la mme dmarche qui nous a amen conclure que Jsus, selon les Evangiles, et selon la raison saine, n est qu un tre humain, un prophte et messager de Dieu.
Le dogme de la Trinit et d autres, furent rfuts de la mme manire en employant les mmes critres.
Certains n hsiteront pas juger que la partie du livre consacre aux contradictions, divergences et inexactitudes de la Bible ne prsente pas de rapport avec le titre choisi : Mohammad dans la Bible et Jsus dans le Coran .
Ainsi, devons-nous prciser que cette partie a t crite pour montrer au lecteur que les textes bibliques n ont pas une authenticit absolue et certaine, qu ils ont subi des remaniements et des altrations, volontairement ou non, et que par consquent les prophties concernant le dernier Prophte et les notices relatives la vie de Jsus et sa mission, ont connu le mme sort. Cependant, des prophties ont pu conserver leur clart et leur signification bien qu elles aient t sujettes des interprtations ternissant cette clart et dsorientant le chercheur. Mais en nous basant sur les donnes bibliques d une part, et les faits historiques de l autre, nous avons pu conserver aux textes, nous semble-t-il, leurs vritables interprtations.
A vrai dire, ce livre veut engager un dialogue avec diffrentes catgories de gens de diffrentes confessions.
Toutefois, il est noter que les rvisions des conceptions tablies et des dogmes traditionnels ne concernent que la doctrine du Christianisme. On a pu voir et entendre des savants et mme des thologiens qui nient la nature ou la filiation divine de Jsus, qui relvent des contradictions et des invraisemblances dans la Bible, etc. Par ailleurs, ces faits ont conduit d autres penseurs et prtres tudier les autres religions, notamment l Islam, o ils ont trouv des rponses leurs aspirations et leurs questions, ce qui les a conduit en fin de compte l embrasser.
Le Coran dialoguant avec les autres religions, avance des principes pour aboutir la concordance, comme dans ce verset : Dis : O gens du livre, venez-en un dire qui soit commun entre nous et vous : que nous n adorions que Dieu, sans rien Lui associer, et que parmi nous nul n en prenne d autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Coran, 3 :64.
Ce que demande le Coran c est de lire attentivement les Ecritures saintes, de comparer et de suivre le rsultat de la recherche sincre : Et ne cours pas aprs ce dont tu n as science aucune. L ouie, la vue et le c ur : sur tout cela, en vrit, on sera interrog. (Coran, 17 :36). Dis : Oui, je ne vous exhorte qu une chose : que pour Dieu vous vous mettiez debout, par deux aussi bien que tout seul, et qu ensuite vous rflchissiez. (34 :46).
Ainsi on doit rejeter les traditions de la socit, ses contraintes et ses influences au cours de notre chemin vers la connaissance vritable et la vrit immuable, pour savourer des bienfaits de ce monde : foi, certitude, tranquillit et bonheur, et de l autre, agrment de Dieu et Paradis.
Cependant, deux catgories de gens ne s intressent pas ce genre de recherche et refusent le dialogue : l indiffrent menant une vie bestiale et le fanatique obtus et ignorant : Ils ont des c urs avec lesquels ils ne comprennent pas, ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, ils ont des oreilles avec lesquelles ils n entendent pas : voil ceux qui sont semblables des bestiaux ou plus gars encore. Tels sont les inattentifs. (Coran, 7 :179). Or il y en a qui disputent au sujet de Dieu sans savoir, sans direction, sans livre qui claire ; ployant de la hanche pour garer du sentier de Dieu. ( 22 :8).
Pour ceux-ci le livre n a aucune valeur et ne mrite pas qu on s y attarde, alors que pour les autres auxquels, en effet, cet ouvrage est destin, il sera un monument prcieux. Ils l accueilleront et le liront attentivement, puis ils donneront leurs points de vue ; critiques et remarques, approbations et dsapprobations.
Le dialogue avec ceux-ci produira, vraiment, des fruits dlicieux, et c est ce que nous souhaitons pour ce livre. Enfin nous tenons remercier tous les amis qui nous ont aids achever ce travail, surtout notre intime ami Tajeddine Kedeha, qui a pris la peine de rviser ce livre et de donner ses critiques et ses remarques fructueuses.
Paris, Juin 1986
Avertissement
Nous signalons ici aux lecteurs musulmans que des textes bibliques, qu ils trouveront dans ce livre, renferment des dclarations indignes de Dieu, de ses anges, de Jsus et des autres prophtes. Ils sont reproduits pour convaincre, montrer les erreurs et claircir des thmes obscurs. Croire en ces textes est chose alors aberrante. *************************
Introduction
Les Ecritures saintes
Cette introduction mettra l accent sur des questions gnrales.
C est une tude historique et textuelle succincte visant donner une vue d ensemble sur les facteurs qui ont contribu rendre la Bible telle qu elle est actuellement. Cette tude porte sur l origine de la Bible, ses auteurs, ses collections, les poques de composition de ses livres et les modes de transmission de ses textes travers le temps.
Nous essayons d en rsumer les points essentiels en nous rfrant aux observations, remarques et critiques faites par des thologiens chrtiens. Tels qu Edmond Jacob, dans son livre l Ancien Testament [1], et Oscar Cullmann, dans le Nouveau Testament [2].
Ces deux ouvrages font l objet d une tude condense traitant diverses questions relatives aux deux Ecritures saintes.
Cependant, ces remarques et critiques gnrales seront illustres, dans la premire partie de ce livre, par des exemples voquant les contradictions et soulignant les erreurs et les invraisemblances. Ces exemples visent fournir une image claire, reluisante de dtails, en enregistrant, quand il est ncessaire, dans deux colonnes parallles, les versets concerns ; ceci pour faciliter au lecteur la comparaison entre les textes et lui pargner le recours itratif la Bible, moins qu il veuille s assurer de l exactitude de la citation.
En ce qui concerne les erreurs scientifiques de la Bible, nous renvoyons le lecteur l tude labore par Maurice Bucaille, dans son livre : La Bible, le Coran et la Science [3].
De mme, nous donnerons une vue brve sur l histoire de la rdaction du Coran et sa transmission. ************************* La Bible
La Bible est constitue de deux collections appeles : Ancien Testament et Nouveau Testament. La premire est un hritage commun aux Juifs et aux Chrtiens. Cependant, le Judasme a pour livre saint la Bible hbraque qui comprend 39 livres. Celle-ci diffre de l Ancien Testament Chrtien. Cette divergence n apporte gure de changements la doctrine. Mais le Judasme n accepte aucune rvlation postrieure la Sienne.
Le Christianisme a repris son compte la Bible hbraque en y ajoutant quelques autres livres. Mais les crits publis relatant la vie et la mission de Jsus n avaient pas tous obtenu la faveur de l Eglise. Cette dernire a effectu des coupes extrmement importantes ; et de la multitude de ces livres elle n a conserv pour le Nouveau Testament q un nombre limit d crits dont les principaux sont les quatre Evangiles canoniques.
L Ancien Testament
1. Le Canon
Le Canon de l Ancien Testament ne s est pas fait en un acte unique, mais il est pass par plusieurs tapes. En effet, sa division tripartite dans la tradition juive : Lois Prophtes Ecrits, rend assez exactement compte du processus et des progrs de la canonisation.
Le Pentateuque ou La Torah , cet ensemble de lois et d histoires qui est l expression la fois historique et typique de l action de Dieu l gard du peuple isralite est le premier groupe de livres qui ait t constitu en recueil.
Si les lois ( la Torah) ont pu tre ramenes Mose et les traditions diverses du Pentateuque harmonises parce qu elles traitent d un sujet commun ; il tait cependant difficile de trouver pour les prophtes un principe d unification. Chacun avait son individualit bien marque ; ils ne s attachaient pas tous aux mmes traditions, n annonaient pas le mme message, se contredisaient parfois. Ces messages trs diffrents pouvaient se trouver dans un mme livre ; cet ensemble taient apparemment trop disparate pour former une unit qui put prtendre tre normative.
Il semble que ce soit seulement la catastrophe de l Exil qui ait permis de reconnatre l autorit des prophtes. Dsormais on reconnut que toutes les annonces de chtiment que les contemporains des prophtes avaient coutes d un c ur en gnral lger et indiffrent s taient accomplies : les prophtes, donc, avaient dit vrai.
Les livres du troisime groupe, les Ketoubim, les Ecrits, n ont reu la conscration canonique que grce leur fonction liturgique comme les Psaumes, le livre des Lamentations et le livre d Esther ; ou grce leur attribution un personnage minent, comme les crits de sagesse attribus Salomon ; ou enfin grce leur fonction historique, comme les livres de Josu, des Juges, de Samuel, des Chronique et des Rois.
Le Judasme palestinien n a fix dfinitivement son canon q au synode de Jamnia ( 98 ap. J.-C.).
2. Qui est l auteur de l Ancien Testament ?
Un nombre important de lecteurs de l Ancien Testament, rpondant cette question, vont vous affirmer, en rptant ce qui est crit dans l introduction de leur Bible, que ces livres ont tous Dieu pour auteur. Mais lorsqu on se rfre des ouvrages crits par les religieux, qui ne sont pas destins la grande vulgarisation, on s aperoit que la question de l authenticit des livres de la Bible est beaucoup plus complexe qu on avait pu le penser a priori.
Des auteurs minents, en effet, n ont pas cach la ralit et ont dclar que l auteur vritable de l Ancien Testament, c est le peuple qui y exprime la ralit de son histoire ; il le fait au moyen de toutes les ressources de la parole. ( E.Jacob, p. 18).
Et si l on consulte, par exemple, la publication moderne, en fascicules spars, de la Bible traduite en franais sous la direction de l cole biblique de Jrusalem, le ton apparat trs diffrent et l on se rend compte que l Ancien Testament, comme le Nouveau, soulve des problmes dont les exgtes n ont pas cach, pour beaucoup, les lments qui suscitent la controverse.(Cf. Maurice Bucaille, pp. 15-16).
3.
L origine de l Ancien Testament
a)
Pluralit des textes
L Ancien Testament que nous possdons aujourd hui, est une collection d ouvrages de longueur trs ingales et de genres divers ; crits pendant plus de neuf sicles en plusieurs langues, partir de traditions orales. Ils ont t crits en hbreu et en aramen ; mais les plus anciens manuscrits bibliques ne peuvent pas tre considrs comme l expression absolument authentique de la langue des auteurs mmes des livres, encore que la transmission des textes ait t faite avec une remarquable fidlit . Par ailleurs, l hbreu reste la langue sacre, mais seule une lite tait capable de la comprendre (Cf. Nhmie : 13/24). (E.Jacob, p.8).
Il y avait l origine une pluralit de textes et non un texte unique ; vers le IIIe sicle av. J.-C. il y avait au moins trois formes du texte hbreu de la Bible ; le texte massortique, celui qui a servi, en partie du moins, la traduction grecque, et le texte du Pentateuque Samaritain. Mais, ds le premier sicle av. J.-C., nous constatons une tendance trs nette mettre fin la pluralit des traditions textuelles par l tablissement d un texte normatif, mais il faudra attendre un sicle aprs J.-C. pour que le texte biblique soit fix.
Les scribes, qui ont commenc ce travail, ont fait des corrections aux textes en les signalant par des indications marginales ; mais parfois, ils ont introduit des changements sans prendre la peine de les signaler. (E. Jacob. p. 11).
Les massortes, c'est--dire, les hommes de la tradition, ont poursuivi le travail des scribes en vue de fixer un texte clair et intangible.
Mais les plus anciens manuscrits ne donnent que les consonnes du texte, la prononciation des voyelles tant tablie par une tradition orale. Dans ce dlicat travail de vocalisation, les massortes se rfraient la tradition et essayrent de retrouver la manire primitive dont l hbreu avait t prononc. Cependant, on ne peut que s tonner que ce travail des massortes ait pu tre jug dfinitif, infaillible et inspir et que dans la synagogue aussi bien que dans l glise on traita d hrtiques ceux qui osaient mettre en doute l inspiration ou l origine trs ancienne des points et des voyelles. (E.Jacob, p. 12).
b) Les manuscrits hbreux
Les trois formes du texte de l Ancien Testament, vues plus haut, n existaient pas ; si l on possdait ces manuscrits, des comparaisons seraient possibles et l on arriverait peut-tre se faire une opinion de ce qu avait pu tre l original, mais le malheur veut qu on en ait pas la moindre ide. Mis part des rouleaux de la grotte de Qumran, datant de l poque prchrtienne proche de Jsus, un papyrus du Dcalogue du IIe sicle aprs J.-C., prsentant des variantes avec le texte classique, et quelques fragments du Ve sicle aprs J.-C. ( Gniza du Caire) le texte hbreu le plus ancien de la Bible est du IXe sicle aprs J.-C.
c) Les anciennes versions
En Langue grecque, le dbut d une premire traduction de l Ancien Testament datant du IIIe sicle avant J.-C. , serait appel la Septante ; elle fut entreprise par les juifs d Alexandrie. C est sur son texte que s appuieront les auteurs du Nouveau Testament. Elle fera autorit jusqu au VIIe sicle aprs J.-C.
En latin, saint Jrme aurait fait un texte partir de documents hbreux dans les premires annes du Ve sicle aprs J.-C. C est l dition appele plus tard Vulgate en raison de sa diffusion universelle aprs le VIIe sicle de l re chrtienne.
Toutes ces versions ont permis aux spcialistes d aboutir la confection d un texte qu on appelle moyen , sorte de compromis entre des versions diffrentes.
ainsi apparat considrable la part humaine dans le texte de l Ancien Testament. On ralise sans peine comment, de version en version, de traduction en traduction, avec toutes les corrections qui en rsultent fatalement, le texte original a pu tre transform en plus de deux millnaires. (M. Bucaille, p.17).
4. Les livres de l Ancien Testament
a) Le Pentateuque, la Torah
Les cinq premiers livres de l Ancien Testament sont appels la Torah, c'est--dire, la loi ; ce sont : la Gense o sont relates les origines du monde et des peuples, les patriarches et les dbuts de l histoire d Isral. L Exode , qui relate le sjour d Isral en Egypte , la sortie et le sjour au Sina. Le Lvitique relatant aussi le sjour au Sina et l instauration du code sacerdotale. Les nombres , la fin du sjour au Sina et le dbut de la marche d Isral de
Sina. Le Deutronome o l on relate l entre la terre promise.
L authenticit mosaque du Pentateuque n a pas de base srieuse dans le Pentateuque lui-mme qui tmoigne que ce ne sont que des morceaux bien dlimits qui sont attribus Mose : Ex. 17/14, 20/24, 23/33 ; Nbrs 33/2 ; Deut. 31/9. ce n est qu partir du Ier sicle avant J.-C. qu on rencontre la thse que le Pentateuque a t crit par Mose ; L veil du sens critique qui se manifeste d abord chez les Juifs et, sous leur influence ensuite, chez les Chrtiens, opposa de srieux arguments une mosacit globale du Pentateuque. C est ainsi qu on reconnut qu il tait impossible d attribuer Mose la notice sur les rois rgnant sur Edom avant que rgnt un roi sur Isral ( Gen. 36/31) et fortiori le rcit de sa propre mort (Deut. 34, vv. 5-12). (E. Jacob, pp. 29-30).
On a essay de dcouvrir les sources des textes juxtaposs dans le Pentateuque, et aprs une minutieuse recherche, les savants, en 1854, ont admis quatre sources auxquelles on a donn les noms de : document Yahviste, document lohiste, deutronome, code sacerdotal.
Le texte dit Yahviste du Pentateuque qui va former l ossature des cinq premiers livres, aurait t rdig au cours du Xe sicle avant J.-C. Plus tard on ajoutera ce texte la version dite lohiste et la version dite sacerdotale .
On a russi attribuer ces quatre documents, des ges approximatifs :
1.Le document Yahviste est situ au IXe sicle avant J.-C. ( rdig en pays de Juda). 2. Le document lohiste serait un peu plus rcent (rdig en Isral).
Ces deux documents donnent parfois deux versions diffrentes pour un mme vnement. La juxtaposition de ces deux traditions diffrentes avait abouti des textes quelquefois contradictoires.
3. Le Deutronome est du VIIIe sicle avant J.-C. pour les uns (E.Jacob), de l poque de Josias (VIIe sicle av. J.-C.) pour d autres (R.P. de Vaux).
4.Le Code sacerdotal est de l poque de l Exil ou de celle d aprs l exil (VIe sicle av. J.-C.).
Ainsi l arrangement du texte du Pentateuque s tale sur une priode minimum de trois sicles.
Mais le problme est encore plus complexe. En 1941, A. Lods distingue trois sources dans le document Yahviste, quatre dans l Elohiste, six dans le Deutronome, neuf dans le code Sacerdotal, sans compter les additions rparties entre huit rdacteurs.
Bien que la loi ait eu une considration majeure chez les Juifs, elle a subi des variations ; elle est transmise dans l Ancien Testament selon deux versions : Exode (20 : 1-21) et Deutronome (5 : 1-30).
Il est probable, crit E. Jacob, que ce que l Ancien Testament raconte au sujet de Mose et des patriarches ne correspond qu assez approximativement au droulement historique des faits, mais les narrateurs ont su, dj au stade de la transmission orale, mettre en uvre tant de grce et d imagination pour relier entre eux des pisodes trs divers qu ils ont russi prsenter comme une histoire. (p. 24).
D autre part, sur le plan de la critique textuelle, le Pentateuque offre l exemple le plus vident des remaniements effectus par les hommes, diffrentes priodes de l histoire du peuple juif.
Par ailleurs, sous l angle de la logique on peut relever dans la Bible un nombre considrable de contradictions et d invraisemblances.
L existence de sources diffrentes qui est l origine de la narration d un mme fait sous deux prsentations, les remaniements divers, les additions ultrieures au texte lui-mme comme les commentaires inclus plus tard dans le rcit lors d une nouvelle copie, sont tous souligns par certains spcialistes de la critique textuelle.
Nous ne possdons aujourd hui que ce qu ont bien voulu nous laisser les hommes qui ont manipul les textes leur guise, en fonction des vnements ou en fonction des ncessits particulires, des poque parfois trs loignes les uns des autres.
Ainsi le Pentateuque apparat form de traditions diverses, runies plus ou moins adroitement par des rdacteurs, ayant tantt juxtapos leurs compilations, tantt transform les rcits dans un but de synthse, mais en laissant cependant apparatre les invraisemblances et les discordances qui ont conduit les spcialistes modernes la recherche objective des sources (Cf. M. Bucaille).
b) Les grandes uvres historiques
La constitution dfinitive du Pentateuque est postrieure la rdaction des livres qui vont de Josu aux Rois. La tradition juive qui fait des personnages connus comme Samuel, Josu et Jrmie, les auteurs de ces livres ne rsiste gure aux arguments d une critique lmentaire. En effet c est un homme ou une cole fortement pntr de l esprit des prophtes qui a donn ces livres leur forme actuelle. On l appelle trs souvent le deutronomiste ; vivant pendant l Exil, probablement en Palestine, son uvre a consist dans la runion des anciennes traditions nationales aprs la conqute de Canaan en les mettant sous le couvert du Deutronome. (E. Jacob, p.44).
1.
Josu
Ce livre raconte la conqute du pays de Canaan sous la conduite de Josu et la division du pays entre les diverses tribus. Cependant ce livre contient deux lments distincts : une partie centrale (chap. 13 21) qui reflte une situation bien postrieure au temps de Josu. Et des histoires relates dans la premire partie et o l on y trouve quelques lgendes tiologiques, expliquant tel usage ou tel rite. En outre, il y a des contradictions entre les donnes archologiques et quelques textes relatant la destruction de Jricho et Ay.
2.
Juges
Ce livre contient principalement le rcit des faits et gestes de ceux qu on appelle les juges dont la fonction consistait beaucoup moins rendre la justice qu dlivrer le peuple des ennemis qui le menaaient ses frontires.
L histoire des Juges (2 : 6 16 : 31) est prcde d une double introduction ; la premire (1 :1 - 2 :5) qui prsente en partie les mmes vnements que ceux du livre de Josu, vise faire le point avec ce dernier livre, mme s il le contredit sur certains points. La seconde prface (2 : 6 3 : 6) introduit l histoire des juges ; c est un des morceaux les plus caractristiques de la thologie deutronomiste ; on y trouve ce qu on a appel le pragmatisme quatre temps : dsobissance, chtiment, appel Yahweh, envoi d un juge. Voil le schma qui domine toute l historiographie de cet ensemble.
Les traditions concernant les Juges taient parfois contradictoires entre elles, ainsi qu il ressort du rle diffrent jou par Gdon dans Juges (6-7) d une part, et dans (8 : 4-21) d autre part.
3.
Samuel
Ce recueil est divis en deux livres par le fait de la traduction grecque. Le souci biographique est dominant, et les personnages importants sont tour tour Samuel, Saul et David. Le problme le plus pineux dans ce livre c est qu il y a au moins trois versions qui racontent de manire assez diffrente l accession de Saul la royaut (cf. 1 Sam. 9 : 1-10 :16 ; 1 Sam. 10 : 17-27 et chap. 11). La diversit de ces rcits s explique par leur diverse origine.
4.
Les Rois
Le live des Rois peut tre divis, selon la matire traite, en trois parties d ingales longueurs : 1) 1 Rois 1-11 ; 2) 1Rois 12- 2 Rois 17 ; 3) 2 Rois 18 25. Dans les deux dernires parties les textes sont disposs selon un schma qui ne correspond que partiellement au droulement des faits. 1) L histoire du rgne de Salomon ; 2) L histoire synchronique des deux royaumes jusqu la chute de Samarie en 722 av. J.-C. ; 3) L histoire du royaume de Juda l Exil.
5.
Chroniques, Esdras, Nhmie
Ces livres embrassent la priode la plus vaste, puisqu elle va d Adam jusqu aux environs de l an 300 av. J.-C.
Ces uvres historiques de synthse sont celles du Chroniste. Ce dernier mentionne 14 sources auxquelles il affirme tre redevable de son information. Mais le livre de Samuel et des rois constituent la source la plus utilise par le Chroniste.
c) Les Prophtes
*Les prophtes du VIIIe sicle av. J.-C.
1.Amos surgit un moment o le danger n est pas encore imminent sur Isral. Farouche dfenseur de l alliance ancestrale avec ses coutumes et ses exigences ; ses attaques et ses paroles de condamnations sont contre la corruption du culte et contre le mpris des rgles lmentaires du droit.
2.Ose , contemporain d Amos, dnonce les mmes iniquits mais il insiste plus particulirement sur la corruption religieuse.
3. Esaie (chap. 1-39) a eu une activit trs longue. son livre reflte les diverses phases de son activit. Il a t ml de trs prs l avance de la puissance assyrienne qui aboutira l amputation, puis l annexion du royaume du Nord, et enfin la mise en tutelle de territoire de Juda.
4. Miche, contemporain d Esaie, a en commun avec ce dernier, la dnonciation du scandale de la richesse, la critique du syncrtisme et da la fausse scurit religieuse.
*Les prophtes de la fin du royaume de Juda
1. Sophonie (vers 640 av. J.-C.), annonce la catastrophe inluctable cause par la corruption sociale et religieuse.
2. Jrmie domine cette priode tragique, caractrise au point de vue national par l avance des armes babyloniennes et au point de vue religieux par l indiffrence et le formalisme. Jrmie annonce la perte du Temple et de la terre au profit de Babylone.
3. Nahum et Habacuc, taient probablement des contemporains de Jrmie, mais ils ne ragissent pas de la mme manire devant les mmes vnements.
4. Jol ; le livre de Jol est une liturgie clbre lors d une crmonie de pnitence.
*Les prophtes de l Exil
1. Ezchiel a fait partie du convoi des premiers dports Babylone en 597 av. J.-C. Il annonce, dans une premire phase, le jugement de Dieu (sur le peuple). Mais aprs avoir reu confirmation de la chute dfinitive de Jrusalem, il se sent appeler consoler ses frres d exil et il les prpare la glorieuse restauration. Ezchiel a eu des visions grce auxquelles il est devenu l homme de la mystique et du lgalisme.
2. Le Second Esaie ou Deutro-Esaie ( chap. 40-55), surgit la fin de l exil. Comme Ezchiel il se doit de donner une explication de l exil et annonce le salut incarn dans l avnement du rgne de Dieu.
3. Le livre d Abdias, reflte la situation de Jrusalem aprs 586 av. J.-C. o Edom, le peuple frre, s est livr des actes odieux sur la ville conquise.
*Les prophtes aprs l Exil
1. Agge et Zacharie (en l an 520 av. J.-C.) exhortaient le peuple reconstruire le Temple.
2. Malachie Ce prophte est en ralit un anonyme, car Malachie est un nom artificiel signifiant mon messager . C tait l poque de la domination perse. Par ses discussions, il arrivait convaincre ses compatriotes de leur infidlit. Et il annonait que la rtribution divine viendrait d une manire aussi soudaine que certaine. .
3. Le livre de Jonas ; il relate la vie du prophte Jonas fils d Amittai, dont l activit prophtique tait en dehors d Isral.
4. L Apocalypse de Daniel : celui-ci annonce la dlivrance proche, pour que leur foi ne dfaille point dans l ultime preuve. Ce message, il le donne dans des rcits et des visions.
Une remarque s impose aprs avoir donn une vue brve sur les livres des prophtes ; une fois constitu, le recueil, ou plutt le rouleau du prophte, ne constituait pas une grandeur fixe ; il arriva qu on ajouta aux paroles authentiques des prophtes des oracles auxquels on voulait confrer une plus grande autorit en les mettant sous le patronage d un nom illustre. (E. Jacob, p.66).
d) La Posie
1.
Les Psaumes
Les Psaumes sont une collection de chants s talant sur une longue priode allant de David jusque vers l poque maccabenne. Les suscriptions en tte des Psaumes attestent leur manire la pluralit des poques et des auteurs. Les auteurs des Psaumes sont probablement des prtres et des lvites de Jrusalem qui les ont composs en vue de la vie liturgique de la communaut, et cela ds les dbuts du culte du temple. Mais un grand nombre de Psaumes se prsentent comme composs par le roi David.
2.
Le livre de Job
Le livre de Job est avec les Psaumes celui des crits de l Ancien Testament o la pit apparat sous sa forme la plus pure. L poque de la composition de ce livre est tellement dbattue par les savants, qu il est difficile de donner une prcision l-dessus. Certains parlent de 500 av. J.-C., d autres de 400 av. J.-C.
3.
Les lamentations
Attribu Jrmie, ce livre reflte les malheurs lis la chute de Jrusalem. Mais le nom de Jrmie n y est jamais cit, et la thologie qui s en dgage est trs diffrente de celle de Jrmie. Les lamentations sont l cho de la situation malheureuse o vivaient les Isralites rests dans le pays, en ruine aprs la chute de Jrusalem en 587 av. J.-C. Enfin l attitude qui se dgage de ces chants est plutt celle de la repentance.
4.
Le Cantique des Cantiques
L attribution de ce livre Salomon vient de ce qu il y est expressment nomm : 1 : 5 ; 3 : 7 ; 8 : 11. Cependant, le Cantique est assez loign de l poque salomonienne.
e) La littrature de Sagesse
1.
Le livre des Proverbes
Recueil ouvert pendant longtemps, les Proverbes se sont enrichis de diverses productions, qui, grce un thme gnral, ont pu s abriter dans un livre unique. Ce livre se prsente comme une composition salomonienne, mais, bien qu l origine une collection de paroles puisse tre celle de Salomon, il est difficile, voire vain d essayer de retrouver ce qui est authentiquement salomonien.
2.
L Ecclsiaste
Ce livre a t et reste l objet de contestation. Les Juifs ont discut sur sa lgitimit dans le Canon, car ce livre paraissait contredire tout l enseignement traditionnel de la loi, des prophtes et mmes des sages. Aujourd hui encore s affrontent ceux qui y voient les rflexions d un sceptique, plus ou moins apparent aux Epicuriens ou aux Stociens, et ceux qui y lisent le tmoignage d un authentique croyant. (E. Jacob, p. 102).
3.
Esther : un roman historique
Ce livre est d une historicit douteuse. Beaucoup de donnes concernant les personnages de ce livre ne concordent pas avec celles de l histoire. Ainsi, le roi Perse n avait pas d pouse appele Vasthi ou Esther ; Mardoche le cousin d Esther ne devait pas tre vivant l poque de ce roi, etc.
4.
Ruth
Afin de susciter une descendance son mari dfunt, Ruth pousa un proche parent de son mari, Booz, et devint ainsi l arrire-grand-mre de David. La pointe du livre rside dans le lien de Ruth la Moabite avec David. Cette ouverture des Juifs sur les trangers, qui n eut lieu qu l poque salomonienne, pourrait tre la cause de la composition du livre de Ruth donnant ainsi cette communaut vocation universelle.
Aprs cette vue d ensemble des livres de l Ancien testament nous concluons par cette remarque intressante d Edmond Jacob : Les laborieuses discussions autour de la constitution du canon nous invitent ne pas envisager l autorit de la Bible sous l angle de son inspiration littrale. (p. 121).
En effet , cet assemblage, extrmement disparate par le contenu, s talant sur une priode de sept sicles au moins, provenant de sources varies et amalgames l intrieur d un mme ouvrage, va parvenir constituer le livre de la Rvlation judo-chrtienne. A vrai dire, l amalgame ne date pas du Christianisme, mais du Judasme lui-mme.
Pourtant, pendant longtemps on n osa pas mettre en doute l authenticit de ces livres malgr leurs discordances, leurs contradictions et leurs inexactitudes, et il a fallu attendre l poque moderne pour qu un examen critique de ces textes soit entrepris. *************************
II- Le Nouveau Testament
1.
Le Canon
Dans tout le Nouveau Testament, vingt-sept livres ont pris une place privilgie. A l poque o ils ont t composs, ils n taient pas encore considrs comme critures saintes. L criture sainte, pour les auteurs du Nouveau Testament, tait l Ancien Testament. Lorsqu il introduisent des citations par la formule : Afin que ft accompli ce qui a t crit , ils ne se rfrent qu l Ancien Testament.
Ces livres ont t imposs aux premires gnrations chrtiennes et ont t peu peu runi, classs en un recueil et considrs comme criture sainte. (Oscar Cullmann, le Nouveau Testament, P.U.F. Que sais-je ? p.6).
Vers le milieu du IIe sicle, les quatre Evangiles n taient pas encore les seuls faire autorit. D autres Evangiles que l on appela plus tard apocryphes , s taient dj rpandus, et leur nombre allait croissant. Peu peu, les quatre Evangiles furent retenus et revtus d une autorit normative avant tous les autres crits du Nouveau Testament.
Quant aux ptres de Paul, la premire citation d un passage paulinien, considr comme Ecriture sainte, se trouve vers 150 dans l ptre de Polycarpe XII, 1. Vers 170, les premiers recueils pauliniens comptent tantt 10 ptres tantt 13.
Peu peu, d autres crits, les Actes des Aptres, les ptres catholiques et l Apocalypse sont parvenus la dignit canonique.
Il semble que le Canon du Nouveau Testament ait t form par addition en mme temps que par limination. L laboration du Canon du Nouveau Testament a donc t le fruit d un processus qui s est chelonn sur plusieurs sicles.
Il est noter, toutefois, que le concept de Canon est issu directement de celui d aptre ; car dans certains cas, pour faire entrer dans le Canon un livre n ayant pas pour auteur un aptre, on a d tablir, aprs coup, une relation entre lui et un aptre.
Cependant, le premier Canon a t l uvre de Marcion vers 150 ; ce dernier n a reconnu comme Ecriture sainte que l Evangile de Luc et 10 ptres pauliniennes.
Aprs des tapes o l on a fait des liminations et des additions, le Canon du Nouveau Testament, vers l an 200, se rapproche dj beaucoup du Canon actuel. Cependant les discussions continurent encore longtemps propos de la canonicit de l ptre aux Hbreux et propos de l Apocalypse.
2. Les documents de Base
Le lecteur qui feuillette les pages du Nouveau testament dans une des ditions modernes de la Bible y trouve un texte clair, tant du point de vue de la typographie que du point de vue du style. Sans doute il lui sera difficile de se rendre compte de la diversit et de la complexit des documents qui sont la base du texte imprim, et de mesurer les normes difficults que l on a rencontres dans la mise jour, le dchiffrage et l apprciation de ces documents de base.
Nous n avons pas de document original du Nouveau testament , crit O. Cullmann, mais seulement des copies. Les manuscrits complets les plus anciens que nous possdions ne remontant pas au-del du IVe sicle : des fragments plus anciens mis part, trois cents ans environ sparent donc la rdaction originale du texte sacr. Un tel laps de temps pourrait nous faire douter de la stricte authenticit de ces textes. En effet de copie en copie, des dformations ont pu s introduire et des erreurs s imposer. (Op. cit. p.7).
a) Les manuscrits
Les manuscrits sont des papyri ou des parchemins. Un papyrus est constitu par des tranches de moelle de papyrus. Un parchemin est une peau trait et dcoupe en feuillets.
Les papyri sont pour la plupart du IIIe sicle. Par contre les parchemins portant des textes du Nouveau Testament ne datent que du IVe sicle au plus tt.
Tous ces documents sont crits en grec, mais dans un grec qui n est plus le grec classique.
Cependant, tous ces manuscrits sont assez difficiles lire. Aucun espace n existe entre les mots, les phrases et les paragraphes ; et nous n y trouvons ni accent ni signe de ponctuation.
Ces textes prsentent entre eux des variantes. Celles-ci rsultent tantt de fautes involontaires, tantt de corrections volontaires : ou bien le copiste s est permis de corriger le texte selon ses ides personnelles, ou bien il cherche
harmoniser le texte qu il copie avec un texte parallle pour en rduire, plus ou moins adroitement les divergences. (O. Cullmann, op. cit. p. 9).
Enfin, il est souligner qu un copiste postrieur remarquant une note la marge, crite par son prdcesseur, croit ncessaire de rintroduire cette annotation marginale au sein du texte pensant qu elle avait t oublie au passage. Et c est ainsi que le nouveau texte devient parfois encore plus obscur.
b) Les traductions
Vient ensuite un second groupe de documents, constitu par les anciennes traductions. Elles prsentent le grand intrt d tre plus anciennes que les manuscrits grecs que nous possdons. Certaines, qui datent du IIe sicle, ont t faites sur des manuscrits aujourd hui perdus et plus anciens que ceux que nous venons de mentionner. Il est tout fait plausible que les textes des manuscrits sauvegards du IVe sicle sont faits partir de ces traductions. Si cette hypothse est exacte, l apprciation de la valeur scientifique de ces traductions, qui seraient les documents de base du Nouveau Testament, serait exclue ; en effet, la comptence de ceux qui auraient pu entreprendre ce travail et leur sincrit nous sont inconnues.
c) Les citations
Un troisime groupe de documents est form par les citations du texte du Nouveau Testament que l on trouve parses dans les crits des Pres de l Eglise.
3. Les Ecrits du Nouveau Testament
Les ptres pauliniennes ont t rdiges avant les Evangiles. Ceci renforce l hypothse selon laquelle une influence importante de Paul fut exerce sur les auteurs des Evangiles.
Mais puisque les Evangiles sont mis la tte du Nouveau Testament, nous sommes appels suivre cet ordre.
Les quatre Evangiles, qui ont t retenus, posent quant leur pluralit un double problme :
a) Un problme d ordre thologique, ressenti ds l Antiquit : pourquoi faut-il quatre tmoignages sur les mmes faits ? Ne peut-on pas harmoniser les quatre rcits sur la vie de Jsus pour les fondre en un seul ? En effet, ces tentatives furent faites, ds les origines du Christianisme, pour rduire cette pluralit. Nous citons comme exemple la tentative de Talien et celle de Marcion. Mais l Eglise a refus ces tentatives d unification artificielle en gardant les quatre Evangiles cte cte.
b) Cette pluralit pose galement un problme littraire. Les trois premiers Evangiles, Matthieu, Marc, et Luc, prsentent entre eux une certaine unit par rapport au quatrime de Jean, bien qu il existe entre eux des divergences patentes.
La cause de cette discordance entre les trois synoptiques (les trois premiers) provient du fait que Chaque vangliste n avait sa disposition que des rcits et des paroles isols de Jsus qui furent transmis par la tradition orale ; il pouvait donc btir le plan qu il voulait. (O. Cullmann, p.18).
Pour rsoudre le problme de ces divergences figurant au sein de ces trois vangiles, on a donn plusieurs hypothses :
1. Hypothse de l utilisation : elle consiste supposer que le premier vangile crit serait celui de Matthieu, Marc aurait rsum Matthieu, et Luc se serait servi de l un et de l autre.
2. Hypothse de l Evangile primitif Selon cette hypothse, les trois premiers vangiles remonteraient une source commune d origine aramenne que nous n avons plus, et chacun des trois aurait utilis cette source sa faon.
3. Hypothse des rcits crits sparment De petits morceaux auraient t composs tout d abord : rcits de miracles, recueils de paroles de Jsus etc. Chacun des vanglistes aurait, plus tard, combin sa faon ces divers lments.
4. Hypothse de la tradition Orale La tradition orale se serait fixe de bonne heure, et les vanglistes se seraient borns puiser dans cette tradition commune. Ce qu ils auraient fait, chacun sa manire.
5. Hypothse des deux sources C est une combinaison de l hypothse de l utilisation et de celle de l Evangile primitif perdu : Matthieu et Luc auraient utilis, indpendamment, Marc qui serait donc le plus ancien des trois, et une source commune, aujourd hui perdue. Mais l vangile de Marc, utilis par les deux autres, tait-il celui d aujourd hui ? D autre part, la source commune a-t-elle t vraiment unique ?
Mais il faut tenir compte du fait que l Evangile a exist pendant des dizaines d annes presque exclusivement sous forme orale. Les Evangiles synoptiques ne sont donc que les porte-paroles de la communaut chrtienne primitive qui a fix la tradition orale.
La tradition orale a transmis des rcits isols et des paroles plus ou moins authentiques. Les vanglistes ont donc tiss des liens entre ces paroles et ces rcits ; mais chacun sa faon, chacun avec sa personnalit propre et ses proccupations thologiques particulires. (O. Cullmann, p. 20).
1. L Evangile selon Matthieu
L auteur du premier vangile est un Juif, converti au Christianisme, et il vit dans une communaut judo-chrtienne. Mais o situer cette communaut ? Faute de tmoignages et de preuves dcisifs, on a propos Jrusalem, la Galile, Antioche, Alexandrie, ou une des grandes villes du littoral phnicien de Syrie, ou encore une cit aux confins de la Palestine du Nord et de la Syrie comme Csare de Philippe ou Damas. Il est actuellement impossible de se prononcer.
De mme, la date de la composition de cet vangile est imprcise. On la situe en gnral entre les annes 70 et 80.
Mais qui est l auteur de cet vangile ?
La tradition, et non le texte lui-mme qui n en souffle mot, a attribu cet vangile Matthieu, le percepteur dont la conversion est raconte IX, 9 et qui devient l un des 12 aptres Mais rien ne permet de confirmer cette tradition qui soulve des difficults, surtout si nous admettons que l auteur a utilis l Evangile de Marc, qui n tait pas disciple de Jsus. (O. Cullmann, pp. 23-24).
2. L Evangile selon Marc
Nous ne savons pas qui est exactement Marc. Etait-il juif ou non ? La tradition voulait qu il soit l auteur du second vangile.
Cependant, on reconnat aisment dans cet vangile une profonde influence de la pense de l aptre Paul suggre galement par le livre des Actes des Aptres qui fait de Marc le collaborateur de Paul dans ses tournes missionnaires.
La date de la rdaction de cet vangile n est pas galement prcise.
3. L Evangile selon Luc
Le texte du troisime vangile ne dit pas le nom de son auteur. Cependant, il est attribu, partir du IIe sicle, un certain Luc. Nous connaissons un Luc qui a t compagnon de Paul. Toutefois, il est impossible d infirmer ou de confirmer cette tradition par la langue ou le style de l vangile.
L auteur a utilis trois sources : plusieurs rcits composs avant lui, des renseignements recueillis auprs des tmoins oculaires, et la tradition orale des prdications apostoliques.
4. L Evangile selon Jean
L auteur du quatrime vangile n est pas forcment Jean fils de Zbde, l un des 12 aptres. Certains critiques ont attribu le quatrime vangile Jean l Ancien qui serait distinct du fils de Zbde.
Par ailleurs, l identification de l auteur partir du texte lui-mme est absolument difficile. Cependant, il est noter que ds la fin du IIe sicle, l authenticit johannique de cet vangile a t mise en doute.
On attribue habituellement une date assez tardive la rdaction de cet vangile. On la situe dans les dernires annes du Ier sicle. Son origine pouvait tre soit d Ephse, soit d Antioche, soit encore de transjordanie. Son style et sa langue portent la marque d une double influence, hellnistique et judaque. (O. Cullmann, p. 40).
Par ailleurs, l Evangile johannique diverge d avec les synoptiques, non seulement par le cadre chronologique et le cadre gographique qu il donne au rcit de la vie de Jsus, mais d une manire gnrale par des traditions particulires et surtout par des perspectives thologiques diffrentes.
5. Les Actes des Aptres
Le contenu de ce livre ne correspond pas son titre, car il ne s agit pas de tous les aptres, mais seulement de Pierre et de Paul.
Dans son intention comme dans sa forme littraire, cet crit n est pas diffrent des vangiles.
Son auteur est le mme que celui de l vangile selon Luc. Le vocabulaire, la langue, le style et les ides thologiques sont les mmes.
Il existe quelques divergences entre cet crit et ceux de Paul. Quant la date de la rdaction de ce livre, elle est situe entre 80 et 90.
6. Les Eptres de Paul
On a attribu Paul 13 ptres. Mais l authenticit paulinienne des ptres pastorales (1 Timothe, 2 Timothe, et l ptre Tite) a t mise en doute. (Cf. O. Cullmann, p. 78).
Bien qu il existt dj du vivant de Paul des lettres qui lui taient faussement attribues, l authenticit de la plupart de ses lettres n a pas, quelques exceptions prs, t conteste.
7. Les Eptres catholiques
On englobe sous ce titre sept crits : l ptre de Jacques, la premire et la deuxime ptres de Pierre, la premire, la deuxime et le troisime ptres de Jean et l ptre de Jude.
L ensemble du texte de l ptre de Jacques apparat moralisant, judasant et sans aucune note chrtienne. On suppose qu elle a t adopte par un Chrtien qui l aurait christianise en y insrant par deux fois le nom de Jsus. Mais l auteur est probablement judo-chrtien. L identification de son auteur est difficile. L ptre de Pierre pose beaucoup de problmes quant son auteur. Cette ptre est rdige dans un trs bon grec. On constate une grande parent entre les ides de cette ptre et la thologie paulinienne. On relve l absence de souvenirs personnels concernant Jsus, ce qui est surprenant chez cet homme qui a vcu dans l intimit de Jsus. On cherche, en vain, dans cette ptre des notions centrales de l enseignement de Jsus.
L identification de l auteur de l ptre de Jude est difficile. Cependant, cette ptre a une particularit qu il faut noter. Elle cite, plusieurs reprises, des livres apocryphes du Judasme et surtout le livre d Enoch .
La date de la rdaction de la deuxime ptre de Pierre est situe aprs 90. il est donc impossible qu elle ait pour auteur Pierre qui, selon la tradition, serait mort vers 64 ou 67 Rome.
Les trois ptres de Jean sont exprimes dans un style liturgique. La majorit des critiques pense que ces trois ptres sont du mme auteur et que, si celui-ci n est pas l auteur du quatrime vangile, il appartient en tout cas au mme milieu spirituel.
8. L Apocalypse de Jean
La prsence lgitime de l Apocalypse dans le Canon a t conteste pour la premire fois vers la fin du IIe sicle, et elle le sera surtout en Orient partir du milieu du IIIe sicle. L Apocalypse fut considre comme un livre inspir vers 150.
L auteur de cet crit n est pas Jean l Aptre, fils de Zbde. Quant la date, l ptre a t crite en 96 d aprs le tmoignage d Irne au IIe sicle.
Conclusion
Bien que cette tude sur le Nouveau Testament fut brve et succincte, elle a pu, nanmoins, esquisser les trais gnraux concernant les problmes fondamentaux relatifs la rvlation chrtienne. Les crits du Nouveau Testament nous renseignent, avant tout, en parlant de Jsus, sur la mentalit des auteurs, porte-parole de la tradition des communauts chrtiennes auxquelles ils appartenaient, en particulier sur les luttes entre judo-chrtiens et Paul. Les travaux des exgtes chrtiens trs minents le prouvent. Cependant, les dfauts que contiennent les crits du Nouveau Testament ne mettent pas en doute l existence de la mission de Jsus : les doutes planent seulement sur son droulement.
*************************
LE CORAN[4]
Le Coran (en arabe al-Qur n, lecture, la lecture par excellence) est le livre saint des musulmans, qui le considrent comme la parole incre de Dieu . C est le Seigneur des mondes qui la rvle son envoy de choix, au Prophte Mohammad, afin que celui-ci la communique son peuple. Mohammad n est qu un simple agent de transmission, qui n y ajoute rien de sa part, n en supprime non plus quoi que soit, de son gr.
Le Coran ne fut pas rvl tout la fois, mais en fragments pendant vingt-trois ans (609-632). Chaque rvlation l occasion mme o l on en avait besoin, et pour toucher un problme concret.
Le Coran se divise en 114 chapitres de dimensions trs varies. Les chapitres eux-mmes n taient pas toujours rvls en entier, parfois plusieurs sourates (chapitres) furent la fois objet de rvlations fragmentaires, on les codifiait selon les directives du Prophte lui-mme. Ce travail de compilation dura toute la vie missionnaire du Prophte, et le tout date de l poque du Prophte lui-mme : aprs sa mort la rvlation cesse, et la communaut n avait aucun droit d ajouter ou de supprimer.
Le Coran ne ressemble ni l Evangile, ni aucun des livres de l Ancien Testament. A tout dtour de la vie du Prophte, la rvlation surgit, s impose, il faut sur-le champ la communiquer, car c est l heure voulue par Dieu, pour la promulgation de telle loi, pour le rappel de telle histoire ancienne, pour telle exhortation, telle prire, et le Prophte ne doit ni devancer ni retarder cette heure, ni prendre le temps de revoir le message reu pour en faire une uvre littraire.
Les versets se terminent par la rime ou l assonance. C est pourquoi il ne faut pas songer lire le Coran comme on lit la Gense, ni mme comme on pourrait lire Isae ou Jrmie. Chaque parole dite vous concerne au moment mme o vous la lisez. Il faut l entendre, avec l oue, et s arrter au bout de la phrase, ou de la proposition, l o le chant liturgique s allonge et s attarde sur la dernire syllabe, afin de laisser la pense prendre le tournant de la proposition suivante.
Le Coran ne fut pas rdig tout la fois, pour tre prsent ensuite au peuple. Il est une collection de messages reus intervalles. Il y a des passages dont le Prophte devait se servir pour haranguer l auditoire, afin de l inviter rflchir et reconsidrer son attitude religieuse. Il y en a d autres qui furent destins trancher des problmes concrets, ou des litiges prcis. Le Coran est un guide l homme dans la totalit de sa vie, temporelle aussi bien que spirituelle, individuelle et collective, toutes les catgories d hommes, dans tous les pays, et pour toujours ! Depuis le chef du gouvernement et le commandant jusqu au simple citoyen et l homme de la rue, tout y trouve ce qui le concerne.
Il convient de souligner que le Coran ne demande pas que l on croie pour croire, mais il rpte sans cesse : rflchissez, mditez, raisonnez, pensez, cherchez, et cela, mme en matire de foi comme l existence de Dieu transcendant et inconnaissable, l Au-del et la Rsurrection.
Le thme central est videmment le monothisme pur : la foi en un Dieu sans associs, ni icne, ni autres reprsentations matrielles de la Divinit.
Histoire de la rdaction du Coran
La toute premire rvlation, comportant les cinq premiers versets de la sourate 95, eut pour thme l loge de la plume comme moyen de connaissance humaine. De l le souci du Prophte pour la conservation du Coran par crit.
Et, en effet, la sourate 80 parle, aux versets 11-16, des copies crits du Coran. Les sources sont d accord pour dire que toutes les fois qu un fragment du Coran tait rvl, le Prophte appelait un de ses compagnons lettrs, et le lui dictait, tout en prcisant la place exacte du nouveau fragment dans l ensemble dj reu. Les rcits prcisent qu aprs la dicte, Mohammad demandait au scribe de lui dire ce qu il avait not, pour pouvoir corriger les dficiences s il y en avait.
Un autre clbre rcit nous dit que le Prophte rcitait chaque anne au mois de Ramadan, devant Gabriel, tout le Coran (rvl jusqu alors), que le Ramadan qui prcda sa mort Gabriel le lui fit rciter par deux foix. Ce rcit implique tout au moins que lors du saint mois du jene, le Prophte s occupait chaque anne de la rvision du texte tout entier. On sait que ds l poque du Prophte, les Musulmans prirent l habitude de veiller, le mois de Ramadan, par des offices surrogatoires, en rcitant le Coran tout entier.
Les Musulmans de la Mecque pr-hgirienne, puis ceux de Mdine se servaient de diffrents objets pour copier pour eux le texte du Coran : morceaux du parchemin et de cuir tann, tablettes de bois, omoplates de chameaux, espces de pierres blanches assez tendres pour que l on y puisse graver facilement le texte, nervures mdianes des dattiers, morceaux de poteries brises, et ainsi de suite. On pense que l emploi d os et de pierres tait motiv par le souci de la conservation : une chose grave risquait moins l effacement qu une chose crite. De mme le parchemin et le cuir tait plus solides que le papyrus, on la notait provisoirement sur de menus objets, en attendant l achvement de la sourate, pour la copier ensuite sur des matriaux plus convenables.
Mais simultanment Mohammad insistait pour que l on apprt par c ur le texte, afin de pouvoir le rciter lors des offices liturgiques. L aussi il n tait pas obligatoire de se remmorer le texte tout entier : les uns apprenaient certaines sourates, d autres certaines autres, mais quelques-uns la totalit des sourates.
C est par cette double mthode que Mohammad voulut assurer la conservation de l intgrit du texte du Coran : par crit et par mmoire. Les fautes de graphie pouvaient tre rectifies par le texte appris par c ur, et les dficiences de la mmoire par rfrence au texte crit. Cette lecture ou rcitation pieuse se pratiquait toute la vie ; elle se perptua de
gnration en gnration, jusqu nos jours. Peu de temps aprs la mort du Prophte (632), son successeur Abu Bakr, premier calife de l Islam, demanda l ancien premier scribe de Mohammad, Zaid ibn Thabit de prparer une copie, ce qu il fait.
Les sources sont unanimes pour dire qu Abu Bakr ordonna Zaid de ne point se fier uniquement la mmoire, mais de chercher pour chaque verset deux tmoins, copies crites chez deux personnes.
A la lecture des divers crits, on a cette impression que ce que Zaid cherchait ce n tait pas seulement des fragments crits du Coran, mais des rdactions de premire main, sous la dicte personnelle du Prophte. Le 2e calife, Omar (634), conserva la copie qu il donna sa mort sa fille Hafsa, veuve du Prophte.
Le troisime calife de l Islam, Uthman, qui exera son califat de 644 655, chargea une commission d experts de pratiquer la grande recension qui porte son nom. Les membres de la commission taient quatre parmi lesquels Zaid ibn Thabit. La commission consulta des Musulmans qui connaissaient le texte par c ur. La critique de l authenticit du texte s opra d une manire extrmement rigoureuse. Aprs la ralisation de cette nouvelle dition, le calife Uthman la collationna avec celle faite au temps d Abu Bakr, mais n y trouva aucune diffrence.
La transmission et la conservation du texte
Contrairement certaines autres communauts de l antiquit, qui restreignaient la connaissance du livre religieux une classe, un clan, Mohammad prfra, en suivant les directives coraniques, de rpandre cette connaissance dans toutes les couches de la communaut. Nous avons vu qu il employa la double mthode crit-mmoire. En outre, lui et ses successeurs du pouvoir attachaient la plus grande importance la connaissance coranique pour tout emploi public et administratif, et prirent les dispositions ncessaires pour son enseignement.
Ds l poque du Prophte, on ajouta une mthode additionnelle pour conserver l intgrit du texte : savoir lire et possder une copie du Coran ne suffisait pas ; par contre il fallait l tudier auprs des matres attitrs et obtenir un certificat de l authenticit de la copie, tout comme de la connaissance de la part de l lve. Cette mthode a subsist jusqu nos jours.
Il est mouvant de constater que du Maroc la Malaisie, de Tachkent Ceylan, des millions d exemplaires manuscrits ou imprims existent qui n offrent d autres variantes que des fautes de copistes. Il y a galement des centaines de milliers de Hafiz (sachant le Coran par c ur) toujours identiques, entre eux et avec le texte crit.
Il est signaler que le Coran n est pas en vers, mais qu il possde mlodie, rythme et mme rimes comme les pomes. Il n est pas en vers : ses lignes (versets) comportent parfois un seul mot, parfois plusieurs et jusqu toute une page. Il est d un genre qui n est ni prose ni pome, mais qui runit les avantages des deux.
Le Prophte a insist qu on abandonne pas la lecture du Coran, non plus qu on le lise machinalement sans mditer ou rflchir sur les points qui y sont traits. Ainsi qu il a dit qu il faut complter la lecture du Coran au moins une fois par mois.
Ainsi, une authenticit indiscutable donne au texte coranique une place part parmi les livres de la rvlation, place qu il ne partage ni avec l Ancien ni avec le Nouveau Testament. Les remaniements, qui sont parmi les causes de leurs erreurs et de leurs contradictions, qu avaient subies les livres de la Rvlation Judo-chrtienne, avant de nous parvenir dans l tat o ils se trouvent aujourd hui, ne furent pas connus par le Coran pour la simple raison qu il a t fix du temps mme du Prophte, comme nous l avons vu, par les deux mthodes possibles : l criture et la mmoire.
*************************
PREMIERE PARTIE
CONTRADICTIONS, DIVERGENCES
ET INEXACTITUDES DANS LA BIBLE
Nous allons dans cette premire partie, renforcer, par des exemples, les donnes que nous avons prsents sommairement dans l introduction.
Rappelons, cependant, que les exemples nous offrent un large choix, ce qui nous oblige n en citer que quelques-uns.
Par ailleurs, il nous a sembl utile de citer tous les textes Compars et pris en exemple lorsqu ils ne sont pas assez longs, afin de faciliter la tche au lecteur.
*************************
CHAPITRE PREMIER
CONTRADICTIONS ET DIVERGENCES DANS LA BIBLE
Pour pouvoir comparer les citations nous devons rappeler d abord un Principe : Lorsqu il y a deux affirmations contradictoires ou divergentes sur un mme sujet, notamment les chiffres, les dates et la succession des vnements, il est alors impossible de les prendre toutes les deux pour vraies ; ce qui veut dire qu il y a au moins une affirmation fausse.
I. Dans l'Ancien Testament
1. En comparant le verset 9 du chapitre 24 du 2e livre de Samuel avec le verset 5 du chapitre 21 du 1er livre des Chroniques nous trouverons des divergences dans le recensement du peuple :
2 Samuel, 24 : 9 Joab remit au roi le chiffre du dnombrement du peuple: il y avait en Isral 800 000 hommes vaillants tirant l'pe, et les hommes de Juda taient 500 000.
avec
1 Chroniques, 21 : 5 Joab remit David le chiffre du dnombrement du peuple: il y avait dans tout Isral 1 100 000 hommes tirant l'pe, et en Juda 470 000 hommes tirant l'pe.
Nous signalons que ce recensement a t ordonn par le mme chef en un mme temps. Dans cet exemple les contradictions sont flagrantes, et la prtention d'une inspiration totale et littrale de la Bible n'a aucun fondement.
2. Comparons : 2 Rois, 8 : 26 avec 2 Chroniques, 22 : 2 Ahazia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi Ahazia avait quarante-deux ans lorsqu'il et il rgna un an Jrusalem. devint roi et il rgna un an Jrusalem. Le 2e livre des Chroniques dit qu'Ahazia a succd au trne de Juda l'ge de 42 ans, or son pre (qui tait son prdcesseur) est mort l'ge de 40 ans (voir 2 Rois, 8: 17 et 2 Chr. 21: 20). Ce qui fait qu'Ahazia tait plus g que son pre!! Il est certain donc que ce texte est inexact et que l'hypothse de l'autre texte est plus raisonnable.
3. Comparons :
2 Rois, 24 : 8 Yehoyakn avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi et il rgna trois mois Jrusalem.
avec
2 Chroniques, 36 : 9 Yehoyakn avait huit ans lorsqu'il devint roi et il rgna trois mois et dix jours Jrusalem.
Dix ans de diffrence!
4. Comparons :
2 Chroniques, 24 : 13 Gad arriva chez David et lui rapporta ceci: Est-ce qu'il t'arrivera sept annes de famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes adversaires qui te poursuivront, ou sera-ce trois jours de peste dans ton pays?
avec
1, Chroniques, 21 : 12 ... Accepte: ou bien trois annes de famine, ou trois mois de dfaite devant tes adversaires, o l'pe de tes ennemis pourra t'atteindre, ou trois jours avec l'pe de l'ternel et la peste dans le pays...
5. Comparons : 2 Samuel, 23 : 8 Voici les noms des vaillants hommes de David: Yocheb-Bachbeth le Tahkemonite, chef de division. C'est lui qui brandit sa lance sur huit cents hommes, qu'il transpera en une seule fois. avec 1 Chroniques, 11 : 11 Voici, d'aprs leur nombre les vaillants hommes de David. Yachobeam, fils de Hakmoni, chef de division. C'est lui qui brandit sa lance sur trois cents hommes, qu'il transpera en une seule fois.
6. Dans le chapitre 8 de la Gense le verset 4 dit que l'arche de No s'arrta sur les montagnes d'Ararat le 7e mois. Alors que le verset 5 du mme chapitre nous apprend que ce n'est qu'au 10e mois que les sommets des montagnes sont apparus.
7. Comparons : 2 Samuel, 8 : 4, 11-13, 18 David lui prit 1 700 cavaliers et 20,000 fantassins. Le roi David les consacra l'ternel, comme il avait dj consacr l'argent et l'or pris toutes les nations qu'il avait vaincues, la Syrie, Moab, aux Ammonites, aux Philistins, Amalec, et sur le butin de Hadadzer, fils de Rehob, roi de Tsoba... Seraya tait secrtaire. avec 1 Chroniques, 4, 11, 16 David lui prit mille chars, 7 000 cavaliers, et 20 000 fantassins ; Le roi David les consacra l'ternel avec l'argent et l'or qu'il avait enlevs, Edom, Moab, aux Ammonites, aux Philistins et Amalec Chavoha tait secrtaire.
Il est vident que le Syrie est au nord d'Isral alors qu' Edom est au Sud. 8.Comparons : 2 Samuel, 10 : 18 Les Syriens s'enfuirent devant Isral, et David leur tua ... 700 chars et 40 000 cavaliers. avec 1 Chroniques, 19 : 18 Les Syriens s'enfuirent devant Isral, et David leur tua ... 7 000 chars et 40000 hommes de pied...
9.comparons : 1 Rois, 4 : 26 (dition de Genve 1979) Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destins ses chars, et 12 000 cavaliers. 10. Comparons ces textes pris du 2e livre des Rois : 16: 2 Ahaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et rgna 16 ans sur Jrusalem. Ahaz fut donc roi jusqu' ses 36 ans. 17: 1 La douzime anne du rgne d'Ahaz (c est--dire lorsqu'Ahaz avait 32 ans) Ose rgna sur Isral Samarie . 18: 1-2: La troisime anne du rgne d'Ose (elle correspond la 15e anne du rgne d'Ahaz donc l'ge de 35 ans) zchias fils d'Ahaz rgne sur Juda (c est--dire Jrusalem) ; il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Nous concluons que le pre (Ahaz) avait 35 ans quand son fils zchias lui succda, mais l'ge de 25 ans. L'anomalie est qu'zchias est n alors que son pre n'avait que 10 ans! avec 2 Chroniques, 9 : 25 (dition de Genve 1979) Salomon avait 4 000 stalles pour les chevaux destins ses chars, et 12000 cavaliers...
11. Comparons : Gense, 46 : 21 Fils de Benjamin: Bla, Beker, Achbel, Gura, Naaman, Ehi, Roch, Mouppim, Houppim et Ard. avec 1 Chroniques, 8 : 1-2 Benjamin engendra Bla, son premier-n, Achbel, le second, Ahrah le troisime, Noha le quatrime et Rapha le cinquime.
12. Comparons les textes suivants : 1 Rois, 15 : 33 avec 2 Chroniques, 16 : 1 La troisime anne d'Asa, roi de Juda ; Bacha, fils La trente-sixime anne du rgne d'Asa, d'Ahiya, rgna sur tout Isral Tirsta (il rgna) Bacha, roi d'Isral, monta contre Juda. Il btit vingt-quatre ans (c--d jusqu' la 27e anne de Rama, pour empcher ceux d'Asa, roi de Juda, rgne d'Asa). de sortir et d'entrer. Si la 36e anne du rgne d'Asa, Bacha tait vivant, il serait roi d'Isral depuis 33 ans et non 24 ans (car il a rgn la 3e anne du rgne d'Asa)!?
13.comparons : 1 Rois, 5 : 29-30 avec 2 Chroniques, 2 : 1
Salomon avait encore 70 000 manoeuvres et 80 Salomon compta 70 000 hommes pour porter 000 tailleurs de pierre dans la montagne, sans les fardeaux, 80 000 tailleurs de pierre dans la compter les chefs des prfets de Salomon montagne, et 3600 pour les surveiller. (prposs) aux travaux : 3 300 qui exeraient leur autorit sur ceux qui excutaient les travaux. Il y a une diffrence de 300 surveillants. Nous admettons l'authenticit du fait en considrant, nanmoins que ce genre d'erreur est commun dans les tmoignages des historiens mais qu'il ne peut pas dcouler d'une inspiration divine.
14. Celui qui veut prendre la peine de faire un petit calcul qu'il se rfre aux deux premiers chapitres du livre d'Esdras et au chapitre 7 du livre de Nhmie. Premirement, il y a des contradictions dans les nombres des tribus et de leurs membres et deuximement, le total qu'avaient donn les deux livres est inexact. En calculant les chiffres donns on trouve chez Esdras 29 818 au lieu de 42 360 qu'il a donn ; et dans Nhmie 31 089 au lieu de 42 360 avanc par lui. De mme en comparant les versets 69 et 70 d'Esdras avec les versets 69 71 de Nhmie on trouve beaucoup de divergences.
15. Le verset 3 du chapitre 6 de la Gense qui dit: Alors l'ternel dit: Mon Esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans est en contradiction avec le vieil ge des hommes de l'antiquit, comme il est crit dans la Gense elle-mme: No a vcu 950 ans (Gen. 10: 28) Sam 600 ans (Gen. 11: 10-26) Arpackchad 338 ans, etc.
16. Dans les chapitres 5 et 6 du 2e livre de Samuel il est dit que David a fait monter (de Baal-Juda) l'Arche de Dieu aprs la guerre contre les Philistins ; alors que dans les chapitres 13 et 14 du 1er livre des Chroniques on a racont que David l'a fait monter avant de mener la guerre contre les Philistins. L'vnement est le mme mais l'ordre chronologique est diffrent.
17. En comparant les versets 12-13 du chapitre 3 de Deutronome avec les versets 24-28 du chapitre 13 du livre de Josu en ce qui concerne l'hritage des Gadites nous trouvons de grandes divergences.
18. Du chapitre 31 (vv. 7 18) du livre des Nombres nous apprenons que les Isralites avaient tu tous les mles de Madian, toutes les femmes ainsi que les enfants ; seules les filles vierges taient pargnes par les soldats. Donc le peuple Madianite fut extermin. Mais du chapitre 6 du livre des Juges nous apprenons que les Madianites l'poque des Juges (cest--dire juste aprs la mort de Josu successeur de Mose) avaient une grande puissance de sorte que les Isralites ont t domins, vaincus et battus par les Madianites!? Comment les Madianites aprs avoir t extermins, puisqu' aucun mle n'a survcu au massacre, avaient-ils pu rapparatre, former une grande puissance et dominer pendant sept ans les Isralites?
II. Dans le Nouveau Testament 1. En comparant la gnalogie de Jsus fixe dans l'vangile de Matthieu (chap. 1) avec la gnalogie cite dans l'vangile de Luc (chap. 3) nous trouverons six points diffrents : a) Chez Matthieu nous apprenons que Joseph (l'poux de Marie selon les vanglistes) est fils de Jacob, alors que selon Luc il serait le fils de Hli (ou Hal). b) Selon Matthieu, Jsus est un descendant de Salomon fils de David (vv. 6-7); par contre d'aprs Luc il est descendant de Nathan fils de David (vv. 31-32). c) De Matthieu on apprend que les anctres de Jsus, du rgne de David la dportation Babylone, taient tous des rois. Alors que pour Luc seuls David et Nathan taient des rois. d) Matthieu attribue la paternit de Chaltiel (v. 12) Ykonia (cf. 1 Chr. 3: 17) alors que Luc considre que Nri (v. 27) est le pre de Chaltiel. e) Matthieu nomme le fils de Zorobabel par "Abioud" (v. 13) et Luc l'appelle Rhsa. Mais les noms des fils de Zorobabel sont tous inscrits dans le chapitre 3 du 1er livre des Chroniques (3: 19-20) o ne figurent ni le nom cit par Matthieu ni celui cit par Luc. f) De David Jsus il y a 26 gnrations selon Matthieu et 41 selon Luc. Ce qui est frappant encore c'est que les deux vanglistes aient donn la gnalogie de Joseph. Pourtant nous savons qu' la naissance de Jsus, Joseph n'tait que le fianc de la Vierge Marie. Donc nous avons le tableau gnalogique de Joseph qui n'est pas le pre de Jsus alors que la gnalogie de sa mre -la plus importante- fut nglige! Nous nous interrogeons sur le fondement de ces hallucinations qui ne sont en aucune faon des inspirations divines! Les vanglistes, en effet, n'avaient fourni la gnalogie de Joseph que pour dmontrer que Jsus est un descendant de David d'o natra le Messie attendu. Alors que Joseph n'tait pas son pre. Par ailleurs, nous dmontrerons plus loin que Marie n'tait pas descendante de David.
2. Le rcit de la conversion de Paul diffre d'un chapitre l'autre du livre des Actes des Aptres : a) Dans le chapitre 9 verset 7: Les hommes qui voyageaient avec lui s'taient arrts, muets de stupeur, ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Alors que dans le chapitre 22 verset 9: Ceux qui taient avec moi virent la lumire, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. b) Dans le chapitre 9 verset 6 il est crit: lve-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. La mme parole est dite dans le chapitre 22 verset 10. Par contre dans le chapitre 26 versets 16-18: Mais lve-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car voici pourquoi je te suis apparu: je te destine tre serviteur et tmoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparatrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des paens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des tnbres vers la lumire et du pouvoir de Satan vers Dieu.... Dans les deux premiers versets Paul devrait aller Damas pour se charger d'une mission; alors que dans les versets du chapitre 26 Jsus a lui-mme charg Paul d'une mission apostolique sans l'envoyer Damas.
3. Dans le chapitre 9 verset 7: Les gens qui taient avec Paul s'arrtent muets de stupeur; alors que dans le chapitre 26 verset 14 ils tombrent par terre avec Paul. Tandis que le chapitre 22 ne signale pas cet incident.
4. De la rponse de Jean-Baptiste, dans le chapitre 1 (vv. 19-23) de l'vangile de Jean, la question qu'on lui a pose, nous apprenons que Jean-Baptiste n'tait pas lie; alors que selon Matthieu (chap. 11 vv. 11-15 et chap. 17 vv. 10-13) Jsus aurait dclar que Jean-Baptiste serait lie.
5. Dans le verset 31 du chapitre 5 de l'vangile de Jean, Jsus a dit: Si c'est moi qui rends tmoignage de moi-mme, mon tmoignage n'est pas vrai.; alors que dans le verset 14 du chapitre 8 du mme vangile, Jsus aurait dit: Quoique je rende tmoignage de moi-mme mon tmoignage est vrai.
6. Dans le chapitre 26 de Matthieu (vv. 20-25) Jsus aurait adress aux Aptres cette parole: ...Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera...; alors que dans le chapitre 13 (vv. 21-26) de l'vangile de Jean, Jsus aurait dit: ... C'est celui pour qui je tremperai le morceau et qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna Judas, fils de Simon l'Iscariot . 7. Matthieu a dcrit dans le chapitre 26 (vv. 47-50) la faon par laquelle les gardes arrtrent Jsus ; Juda avait convenu avec eux d'un signal : l'homme auquel il donnera un baiser sera celui qu'il faudra arrter! C'est ce que fit Juda et on a arrt Jsus. Par contre dans le chapitre 18 (vv. 2-8) de l'vangile de Jean nous trouvons une version tout fait diffrente de cet vnement.
8. Les quatre vanglistes en rapportant le Reniement de Pierre se contredisent sur 2 points : a) Ceux qui avaient dclar que Pierre est un disciple de Jsus taient :
- Une servante et des gens prsents, selon Matthieu (14: 66-70).
- Deux servantes et des gens prsents, selon Matthieu (26: 69-73). - Une servante et deux hommes, selon Luc (22: 56). b) La rponse de Pierre la premire servante diffre avec chaque vangliste. Nous avons dcouvert d'autres diffrences mais nous avons prfr ne pas nous y attarder.
9. Dans Luc, chapitre 23 verset 26 il est dit: Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrne qui revenait des champs, et ils le chargrent de la croix, pour qu'il la porte derrire Jsus; alors que chez Jean il est crit : Jsus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appel : le crne... 19: 17-18.
10. Selon les 3 premiers vanglistes, Jsus la sixime heure, tait sur la croix (Luc, 23: 44; Marc, 15: 25-33 ; Matthieu, 27: 45). Par contre dans l'vangile de Jean cette 6e heure il tait encore chez Pilate (19: 14).
11. Marc et Matthieu racontent que les deux brigands crucifis avec Jsus l'insultaient (Marc, 15: 32; Mat, 27: 44), Luc (23: 39-43) affirme quant lui que l'un d'eux l'insultait et l'autre le dfendait, et celui-ci que Jsus promit le Paradis. 12. Marc a crit dans le chapitre 15 verset 25 que Jsus a t crucifi la 3e heure. Pour Jean, dans le chapitre 19 verset 14 Jsus tait encore chez Pilate la 6e heure.
13. Dans Marc (15: 23) ils donnrent boire Jsus un vin ml de myrrhe, mais il ne le prit pas. Alors que dans Matthieu (27: 48) on lui donna boire du vinaigre (voir aussi Luc 23: 36 et Jean 19: 29-30). Le plus important noter c'est que selon Marc il a bu cette boisson, et selon d'autres, il n'a rien bu.
14. Des quatre vangiles nous apprenons que Jsus avait ressuscit trois morts : - La fille de Jarus, le chef (Matthieu. 9: 18; Marc 5: 22; Luc 8: 41) - Le fils de la veuve (rapport par Luc, seul, 7: 11).
- Et enfin Lazare (rapport seulement par Jean 11). Mais Paul dclare dans les textes suivants : - Actes des Aptres, 26 : 23: ... C'est--dire que le Christ souffrirait et que ressuscit le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumire au peuple et aux paens. Dans 1 Corinthiens, 15: 2-23: ... Mais maintenant, Christ est ressuscit d'entre les morts il est les prmices de ceux qui sont dcds (voir aussi Colossiens 1: 18). Ces rcits attribus Paul nient la rsurrection d'un mort avant Jsus; sinon Jsus ne serait pas le premier-n d'entre les morts ni les prmices de ceux qui sont dcds. Comment peut-on donc rendre compatibles les prtentions de Paul avec les rcits des autres vanglistes concernant les trois ressuscits? D'autre part quels rcits devrait-on croire si l'on confronte les rcits de Paul, celui de Jean (dans l'Apocalypse 1: 5), ceux des vanglistes et les textes du livre de Job (7: 9-10) o il est crit: la nue s'vanouit ; elle s'en va, ainsi celui qui descend au sjour des morts ne remontera pas ; il ne reviendra plus dans sa maison, et son domicile ne le reconnatra plus, et (14: 12 du mme livre): Ainsi l'homme se couche et ne se relvera plus, il ne se rveillera pas avant que les cieux disparaissent, il ne sortira pas de son sommeil ?
15. Les quatre vanglistes se contredisent sur les circonstances de la dcouverte de la rsurrection de Jsus.
- Matthieu, 28: 1-7 - Marc, 16 : 1-8 - Luc, 24 : 1-6 - Jean, 20 : 1-15 a) Matthieu prtend qu'il y avait au tombeau deux femmes, Marie et Marie-Madeleine ; Marc ajoute ce nombre une certaine Salom ; et Jean cite Marie-Madeleine, seule. b) L'ange selon Matthieu descendit du ciel, roula la pierre du tombeau et s'assit dessus sous les yeux des deux femmes. Pour Marc les trois femmes ont trouv la pierre dplace et dcouvrirent un jeune assis l'intrieur du tombeau, droite. Quant Luc, il nous apprend que les femmes trouvrent que la pierre avait t roule, elles entrrent mais ne trouvrent pas le corps de Jsus, par contre deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Alors que pour Jean, Marie-Madeleine n'a rien trouv du tout, et les anges ne sont apparus qu'aprs l'arrive des disciples: Pierre et un autre. c) D'aprs Matthieu (28 : 9-10) aprs l'information obtenue de l'ange, les deux femmes, retournrent promptement pour informer les disciples ; en chemin Jsus vint leur rencontre, les salua et leur demanda d'informer ses frres de se rendre en Galile o ils le verront. Par contre, selon Luc (24: 9-11) les femmes aprs avoir cout les deux hommes, retournrent et annoncrent la nouvelle aux 11 aptres et tous les autres disciples sans avoir rencontr Jsus. Alors que selon Jean (20: 14) Marie-Madeleine a rencontr Jsus ct du tombeau aprs le dpart de Pierre et des disciples.
16. L'inscription place au-dessus de la tte du crucifi est diffrente d'un vangliste l'autre : - Matthieu (27: 37): Celui-ci est Jsus, le roi des Juifs - Marc (15 : 26): Le roi des Juifs - Luc (23 : 38): Celui-ci est le roi des Juifs - Jean (19 : 19): Jsus de Nazareth, le roi des Juifs Nous nous demandons comment une phrase si courte et si importante n'a-t-elle pu tre retenue et rapporte fidlement par les quatre vanglistes que l'on prtend tre des tmoins oculaires ? Pourtant de simples coliers auraient retenu facilement une telle phrase dans son intgralit. Comment alors faire confiance aux vanglistes dont la mmoire ne semble pas sre lorsqu'il s'agit des propos et des discours, beaucoup plus longs, rapports dans les rcits ?
17. Dans le chapitre 2 (vv. 1-2) de la premire Eptre de Jean il est dit que Jsus est victime expiatoire pour les pchs du monde entier. Et dans le chapitre 21, verset 18 du livre des Proverbes : on trouve: Le mchant sert de ranon pour le juste.
18. Matthieu a rapport la mort de Judas l'Iscariot dans le chapitre 27. Luc dans les Actes chapitre 1er a rapport le mme vnement racont par Pierre. Les deux rcits divergent en deux points : a) Matthieu a dit que Judas s'est pendu (v. 5) or selon les Actes (v. 18) Judas est mort d'une autre faon: il est tomb en avant, s'est bris par le milieu, et toutes ses entrailles se sont rpandues. b) Dans Matthieu, les principaux sacrificateurs avaient ramass les 30 pices d'argent que Judas a jet dans le temple. Ils ont achet le champ du potier avec cet argent. Par contre dans les Actes (v. 18) Judas lui-mme avait achet un champ avec le salaire du crime.
19. Celui qui examine le rcit concernant la femme qui a vers un vase de parfum sur Jsus dans le chapitre 26 (vv. 6-13) de l'vangile de Matthieu, 14: 1-9 de Marc et 12 : 1-8 de Jean, trouvera quatre divergences : a) Marc (v. 1) et Matthieu (v. 2) disent que cela est arriv deux jours avant la fte de Pques ; Jean (v. 1) rapporte que l'vnement eut lieu 6 jours avant la fte de Pques. b) Marc et Matthieu prcisent que l'vnement est arriv dans la maison de Simon le lpreux. Par contre Jean ne mentionne pas Simon le lpreux, mais il parle de Marthe qui servait. c) Matthieu (v. 7) et Marc (v. 3) disent que la femme a rpandu le parfum sur la tte de Jsus, par contre Jean rapporte qu'elle l'avait rpandu sur les pieds de Jsus. d) Marc (v. 4) crit que les objections provenaient de quelques-uns des prsents, Matthieu (v. 8) crit que c'taient les disciples qui objectaient, et Jean (v. 4) dit que seul Judas l'Iscariot a object.
20. En comparant le chapitre 22 de Luc avec le chapitre 26 de Matthieu et le chapitre 14 de Marc concernant la Sainte Cne, nous trouverons deux divergences : a) Luc rapporte que l'on fit usage de deux coupes : la premire lorsqu'ils taient en train de manger (v. 17), la deuxime aprs le repas (v. 20). Alors que Matthieu et Marc ne parlaient que d'une seule coupe. b) Le rcit de Luc nous informe que le corps de Jsus est donn pour les disciples (v. 19) ; celui de Marc nous informe que son sang est rpandu pour beaucoup, Matthieu dit autant sans parler du Corps. Mais Jean ne mentionne pas cet pisode qui revt aux yeux des Chrtiens une importance capitale et figure parmi les principes du dogme chrtien. Cependant il rapporte parfois des incidents insignifiants.
21. En comparant le chapitre 2 de l'vangile de Matthieu avec le chapitre 2 de l'vangile de Luc nous constatons d'normes diffrences : Tous les deux racontent la naissance de Jsus. Mais selon Matthieu, Joseph inform par un ange qu'Hrode cherche l'enfant pour le tuer, aurait fui avec Marie et Jsus en gypte. Or, selon Luc, Joseph et Marie se seraient rendus Jrusalem aprs le huitime jour de la naissance de l'enfant afin de le consacrer au Seigneur et que Jsus fut reconnu par Simon et par la prophtesse Anne. Celle-ci n'avait cess de parler de Jsus toute la population, (v. 38). Donc d'une part Hrode ne devait pas ignorer l'arrive de Jsus Jrusalem, d'autre part Joseph, Marie et son fils ne seraient pas alls en gypte puisqu'ils revinrent en Galile Nazareth (v. 39), et chaque anne ils allaient Jrusalem, pour la fte de Pques (v. 41).
Comment donc peut-on concilier les informations donnes par Simon et Anne aux habitants de Jrusalem o rgnait Hrode avec l'hostilit que ce dernier avait manifeste contre Jsus, et sa dcision de le tuer (comme le prtend Matthieu) ?
22. Dans Matthieu (3 : 13-14), Jsus vint vers Jean-Baptiste pour tre baptis ; mais Jean s'y opposait en disant : C'est moi qui ai besoin d'tre baptis par toi et c'est toi qui viens moi Ensuite Jsus fut baptis par Jean et sortit de l'eau ; Jean alors vit l'Esprit de Dieu descendre sur Jsus comme une colombe. Pourtant dans le chapitre 1 de l'vangile de Jean : Jean-Baptiste a dclar qu'il ne connaissait pas Jsus et en voyant l'Esprit de Dieu descendre sur lui il l'a reconnu. Par contre dans Matthieu (11: 2-4), Jean-Baptiste aprs avoir entendu parler des uvres de Jsus, lui envoya dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? . Puisque nous savons que Jean-Baptiste a baptis Jsus nous nous demandons : en quelle priode l a-t-il reconnu comme tant le Messie ? Est-ce avant le baptme ? Est-ce aprs le baptme ? Ou l aurait-il reconnu alors qu il tait en prison et que Jsus avait dj commenc son ministre ?
23. Marc dans le chapitre 1 rapporte que Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage (v. 6) alors que Matthieu (11 : 18) dit qu il ne mangeait pas ni ne buvait.
24. Selon Jean (3 : 24), Jean-Baptiste n tait pas encore en prison lorsque Jsus commena son ministre ; selon Marc, au contraire, Jsus se mit prcher seulement aprs l emprisonnement de Jean-Baptiste (Marc, 1 : 14).
25. En comparant Matthieu (4 : 5-13) avec Luc (4 : 5-16)nous trouverons plusieurs divergences ; elles concernent aussi bien les villes et les lieux cits que l ordre chronologique des vnements.
26. En comparant le rcit de Marc (1 : 14-20) avec celui de Matthieu (4 : 12-22) et de Jean (1 : 35-45) nous constatons deux divergences concernant la conversion des Aptres : a) Matthieu et Marc crivent que Jsus a rencontr Simon (Pierre), Andr, Jacques et Jean, le long de la mer de Galile, il les invita le suivre et ils le suivirent. Par contre l vangliste Jean ne mentionne pas Jaques. b) Matthieu et Marc crivent que Jsus a rencontr d abord Simon et Andr, et ensuite Jaques et Jean (disciples). Le quatrime vangliste (Jean) soutient qu Andr et un autre disciple de Jean-Baptiste suivirent les premiers Jsus ; qu aprs cela Andr a amen son frre Simon. Et que le lendemain Jsus a appel Philippe ; ce dernier a pu convaincre Nathanael de se joindre aux disciples. Mais Jaques n est nullement mentionn.
27. Selon Matthieu (10 : 9-10), Jsus a dfendu aux Aptres de prendre un bton. Par contre dans le chapitre 6 verset 8 de Marc, Il leur a permis de prendre un bton.
28. Matthieu (9 : 18-26) et Marc (5 : 21-42) rapportent la rsurrection de la fille de Jairus. Selon le premier le chef arriva et dit Jsus que sa fille tait morte juste avant son arrive. Mais selon Marc le chef dit Jsus : ma fillette est toute extrmit (c est--dire qu elle n est pas encore morte), et Jsus alla avec lui. En route des gens de la maison de Jairus vinrent leur dire que la fille venait de mourir.
29. Dans Matthieu (8 : 5-13) le centenier est venu lui-mme Jsus et le supplia de gurir son serviteur. Le serviteur fut guri l instant. Tandis que dans Luc (7 : 2-5) ce n est pas le centenier qui est venu voir Jsus mais il envoya des anciens pour demander Jsus de venir sauver son serviteur.
30. selon Matthieu (8 : 28-34), Jsus a guri deux dmoniaques dans le pays des Gadarniens. Par contre Marc ( 5 : 1-17) et Luc ( 8 : 26-37) dclarent que Jsus n a guri qu un seul dmoniaque.
31. selon Marc (7 : 31-34), Jsus a guri un sourd-muet alors que Matthieu (15 : 29-30) se distingue en dclarant que Jsus a guri de grandes foules, parmi elles des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropis et beaucoup d autres malades. Par contre, Jean (21 : 25) exagre en disant : Jsus a fait encore beaucoup d autres choses ; si on les crivait en dtail, je ne pense pas que le monde mme pourrait contenir les livres qu on crirait. . Je pense personnellement qu une petite tagre suffit pour cela !!
32. Selon Matthieu (21 : 1-3, 6-7), Jsus a envoy deux disciples pour lui amener une nesse et un non. Ils le firent et Jsus monta les deux. Or les trois autres vanglistes prtendent que Jsus a demand ses disciples de lui amener un non, qu il a mont, mais ils ne mentionnent pas l nesse (Marc, 11 : 1-7 ; Luc, 19 : 29-35 ; Jean, 12 : 12-14).
33. Matthieu (20 : 29) rapporte que Jsus aprs avoir quitt la ville de Jricho, a rencontr sur son chemin deux aveugles qui lui demandrent de les gurir et il le fit. Par contre Marc (10 : 46-52) nous rapporte qu il n y avait qu un seul aveugle au lieu de deux.
34. Selon Marc 4 , nous apprenons que Jsus, aprs avoir prch en paraboles ( parabole du semeur )il aurait le jour mme apais une tempte alors qu il se trouvait dans une des barques qui rejoignaient la rive. Par contre Matthieu dans le chapitre 8 nous apprend que Jsus aurait apais une tempte en pleine mer aprs tre descendu de la montagne et bien avant la prdication en paraboles (parabole du semeur, parabole de la lampe et parabole du grain de moutarde). Nous constatons que la narration des vnements n a pas le mme ordre. Or pour un simple historien l ordre chronologique des faits est recherch avec une extrme attention ; comment donc peut-on expliquer l erreur de l un des deux vanglistes ? Et lequel se trompe ?
35. Si l on considre les nonciations des faits qui concernent l entre de Jsus Jrusalem on constate que Matthieu ( chap. 21) et Marc ( chap.11 du v.27 et chap.12) attribuent des jours diffrents au mme vnement. Ainsi la discussion qui eut lieu entre Jsus et les scribes, pour Marc elle a eu lieu le 3e jour aprs l entre de Jsus Jrusalem alors qu elle se situe le 2e jour pour Matthieu. Par ailleurs, Marc fait prcder la maldiction du figuier par Jsus par la chasse des vendeurs du temple (par Jsus). Matthieu expose les vnements dans l ordre inverse.
36. Comparons ces deux textes : Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appels fils de Dieu. Matthieu (5 : 9). Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l pe. (Matthieu 10 : 34). Ces deux rcits exposent une contradiction ; on fait dire Jsus, que sera heureux celui qui procurera la paix et qu on l appellera fils de Dieu, donc si l on se rfre au second texte, Jsus ne serait pas heureux puisqu il n apporte pas la paix et il ne serait pas fils de Dieu( ?).
37. Selon Luc (9 : 51-56), Jean et Jaques avaient demand Jsus, s il voulait qu ils chtient d un feu cleste les habitants d un village dans la Samaritaine ; Jsus leur avait rpondu : Vous ne savez de quel esprit vous tes anims. Car le Fils de l homme est venu non pour perdre les mes des hommes mais pour les sauver. Par contre dans le chapitre 12 : 49-51 du mme vangile, Jsus a dit : Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu ai-je dsirer, s il est dj allum ? Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. .
38. Matthieu rapporte (21 : 18-20) que le figuier maudit par Jsus, parce qu il n y trouva pas de fruit, devint immdiatement sec. Mais selon Marc (11 : 13-21), les Aptres et Jsus n ont constat le desschement du figuier maudit que le lendemain. D autre part, Jsus n avait pas le droit de manger d un figuier qui ne lui appartenait pas qu la condition de demander la permission au propritaire. Par ailleurs, il serait draisonnable qu un prophte maudisse un figuier, pour la simple raison qu il ne porte pas de fruit, puisque ce n tait pas la saison. La maldiction, dans ce cas, ne pouvait nuire qu au propritaire. Mais ce qui serait plutt admirable aux yeux des gens senss c est que Jsus ait invoqu Dieu pour que le figuier donne des figues, ce qui aurait t un miracle agrable. De cette faon, Jsus, ses disciples et le propritaire du figuier auraient bnfici des fruits. Nous pouvons conclure d aprs ces textes que Jsus n tait pas un dieu ou un fils de Dieu comme on prtend. Car connaisseur des mondes, Dieu sait tout, alors que Jsus selon ces textes ignore que le figuier ne porte pas de fruits en cette saison. Il nous parait que ce miracle est invent de toutes pices et il ne convient pas de l attribuer Jsus.
39. Dans Matthieu (21 : 40-41), Jsus, aprs avoir cit la parabole des vignerons, a dit : Maintenant, lorsque le matre de la vigne viendra, que fera-t-il ces vignerons ? Les scribes et les sacrificateurs lui rpondirent : il fera prir misrablement ces misrables et il louera la vigne d autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. . Par contre selon Luc (20 : 15-16), Jsus a dit : Maintenant que leur fera le matre de la vigne ? il viendra, fera prir ces vignerons et donnera la vigne d autres. Les sacrificateurs et les scribes, lorsqu ils eurent entendu cela, ils dirent : Qu il n en soit pas ainsi ! .
40. Dans l Eptre aux Hbreux (7 : 18-19 et 8 : 7) Paul dit que la loi de Mose est faible, inutile et n avait pas amen la perfection. Par contre dans le Psaume (19 : 8), la loi de Dieu est parfaite, elle restaure l me, et le tmoignage de l Eternel est vridique. Comment peut-on oser mettre en cause la valeur de la loi divine en la considrant comme inutile, faible et imparfaite, surtout lorsque cette conception mane de l Aptre Paul ?
41. Dans les Actes (7 : 14) les membres de la famille de Jacob taient 75 personnes sans compter Joseph et ses deux fils. Par contre, la Gense rapporte (46 : 27) que leur nombre est de 70 personnes, en comptant Joseph et ses deux fils.
42. Comparons 1 Corinthiens (10 : 8) : Ne nous livrons pas l inconduite, comme certains d entre eux s y livrrent, de sorte qu il en tomba 23000 en un seul jour. avec Nombres (25 : 9) Il y en eut 24000 qui moururent de la plaie. .
43. comparons Matthieu (11 : 10) , Marc (1 : 2), Luc (7 : 27) : Voici, j envoie mon messager devant ta face, pour prparer ton chemin devant toi. Avec Malachie (3 : 1) : Voici que j enverrai mon messager ; il ouvrira un chemin devant moi. . a) L expression devant ta face ne figure pas dans le livre de Malachie. b) Le rcit de Malachie est la premire personne du singulier, or les trois vanglistes l avaient crit la 2e personne du singulier. Ces modifications et ces additions altrent certainement le texte primitif. *************************
CHAPITRE II
LES INEXACTITUDES DANS LA BIBLE
I- Les inexactitudes dans l'Ancien Testament
Les inexactitudes et les invraisemblances sont par dizaines, mais nous nous contenterons de citer quelques-unes titre d'exemples. 1. Le texte du Deutronome (23: 3) dclare: Un btard n'entrera pas dans l'assemble de l'ternel ; mme sa dixime gnration n'entrera pas dans l'assemble de l'ternel . Ce verset est sans doute inexact sinon le roi David et ses ascendants jusqu' Prets, n'entreront pas dans l'assemble de l'ternel ; car Prets est un btard comme il est crit dans la Gense (38: 15-30), et David selon la gnalogie donne par Matthieu est le dixime petit-fils de Prets (voir Matthieu, 1). Alors que David est le premier-n de Dieu, selon le Psaume (89: 21-28), et par consquent membre de l'assemble de l'ternel.
2. Dans 1 Samuel (6: 19), cinquante mille soixante-dix hommes sont frapps de mort (voir la traduction de la socit biblique de Genve 1979) ; dans quelques traductions on a supprim et, et on a mis sur entre parenthses sa place pour corriger l'erreur (voir par ex. l'dition de l'alliance biblique universelle, Paris 1978). Car dans le village o eut lieu la catastrophe ne pouvait avoir un grand nombre d'habitants. La population de Jrusalem, la capitale, ne dpassait pas 70000 habitants comme l'ont signal certains exgtes de la Bible[5]. 3. Le nombre de l'arme d'Abiya (2 Chr, 13: 3 et 17) semble tre exagr.
4. Dans 2 Chroniques (28: 19) il est crit: Car l'ternel humilia Juda, cause d'Ahaz roi d'Isral. C'est inexact car Ahaz est cens tre roi de Juda et non d'Isral (voir 2 Chr. 28: 1).
5. Dans la Gense (17: 8), il est crit: Je te (Abraham) donnerai et tes descendants, aprs toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perptuelle, et je serai leur Dieu . Abraham n'a pas possd Canaan. En outre ses descendants n'ont pas possd ce pays perptuellement. Seulement cette promesse pourrait tre exacte si nous l'interprtons d'une faon plus raliste et diffrente des interprtations des Juifs. Nous savons bien qu'Abraham avait deux fils : Ismal et Isaac. Jacob fils d'Isaac est l'anctre des Isralites et Ismal est l'anctre des Arabes. Le pays de Canaan fut donn premirement aux Isralites ; mais aprs leur chute les Romains prirent cette rgion. Ils en furent plus tard dpossds par les Arabes avec l'Islam. Ce qui implique que la promesse accorde Abraham ne concerne pas seulement les Isralites mais tous les descendants d'Abraham, c'est--dire les Arabes galement.
6. Dans zchiel, chapitre 26, on y trouve des prdictions dcrivant l'envahissement de Tyr et dans lesquelles Dieu a menac Tyr de l'Invasion de Nabukodonosor roi de Babylone, de la destruction de la ville et de la mort de ses habitants. Nabukodonosor a , en effet, encercl Tyr pendant 13 ans mais il n'y a jamais pu la conqurir et retourna du de son expdition. Ces prdictions ne sont donc pas authentiques et il ne convient pas de les attribuer Dieu, l'omniscient et le Puissant.
7. Dans 2 Samuel (7: 12-16), une promesse fut faite David, selon laquelle la descendance de David rgnera pour toujours. Selon l'interprtation des exgtes, cette promesse concerne en premier lieu Salomon ainsi que la dynastie des rois de Juda. Or ce rgne n'a pas t assur pour toujours car le rgne des Isralites fut dtruit par les romains et ensuite la possession de la Palestine passa aux mains des Arabes (les Musulmans).
II- Les inexactitudes dans le Nouveau Testament
I. La gnalogie de Jsus rapporte par Matthieu comporte plusieurs erreurs : 1. Dans 1: 17, Matthieu a dit: Il y a donc en tout quatorze gnrations depuis Abraham jusqu' David, quatorze gnrations depuis David jusqu' la dportation Babylone, et quatorze gnrations de la dportation Babylone jusqu'au Christ . Mais quand nous comptons les gnrations de chaque priode, nous trouvons que les deux premires sries comportent 14 gnrations chacune. Par contre il n'y a que 13 gnrations dans la troisime. Soit 41 gnrations au total et non 42.
2. Dans 1: 11 (Matthieu) il crit: Josias engendra Ykonia et ses frres au temps de la dportation Babylone. De ce verset nous comprenons que Ykonia et ses frres sont ns au temps de la dportation ce qui implique que Josias tait encore vivant. Or ceci est une erreur si l'on se rfre d'autres versets de la Bible. a) 2 Rois ( 23 : 29-30), o il est dit que Josias est mort 12 ans avant la dportation Babylone. Son fils Yoahaz lui succda et rgna 3 mois (2 R. 23 : 31). Yehoyaqin, frre de Yoahaz, succda ce dernier et rgna 11 ans (v. 36). Enfin Yhoyaqin, fils de Yehoyaqim, devint roi, durant 3 mois, au bout desquels il a t fait prisonnier par le roi de Babylone puis dport (24 : 12-16). b) Ykonia n'tait pas le fils de Josias mais le fils de Yehoyaqim (Ykonia tait lui-mme Yhoyakn ; voir 1 Chroniques 3: 16-17). c) Ykonia (Yhoyaqin) n'avait pas de frres, comme le prtend Matthieu. Mais pourquoi Matthieu a-t-il supprim Yehoyaqim pre de Ykonia de la gnalogie de Jsus ?
C'est peut-tre pour conserver le principe que Jsus est roi d'Isral . Parce que si on le met dans la chane gnalogique, Jsus ne sera pas le Christ et n'aura pas le droit d'avoir le trne de David (voir Luc, 1: 32). La raison est que Yehoyaqm fils de Josias avait brl le rouleau crit par Baruch sous la dicte de Jrmie. Alors la parole de Dieu fut adresse Jrmie ainsi: C'est pourquoi ainsi parle l'ternel contre Yehoyaqim, roi de Juda: Aucun des siens ne sigera sur le trne de David... (Jrmie, 36 : 30). Jsus est un descendant de David selon les vanglistes ; par consquent il ne rgnera jamais sur le trne de David cause de cette maldiction.
3. Le nombre de gnrations dans la 2e partie de la gnalogie de Jsus est, selon Matthieu, de 14 ; mais il est de 18 gnrations dans 1 Chroniques 3 : 10-16.
4. Selon Matthieu, (1: 8): Yoram engendra Ozias. Mais selon le 2e livre des Rois, il y aurait 3 gnrations entre Yoram et Ozias. - Ozias (qui est aussi Azaria) n'est pas le fils de Yoram ; mais le fils d'Amatsia (voir 2 Rois, 15: 1 ; 2 Chroniques 26 : 1 ). - Amatsia est le fils de Joas (voir 2 Rois, 14: 1 et 12: 1). - Joas fils d Achazia (voir 2 Rois, 11: 2) - Achazia (ou Ahazia) fils de Yoram (voir 2 Rois, 8: 25). L'vangliste a d oublier 3 gnrations.
5. De Matthieu, (1: 2) nous apprenons que Chaltiel fut pre de Zorobabel Mais le livre 1 des Chroniques (3 : 17-19) nous dit que Zorobabel est le fils de Pedaya, que Pedaya est fils de Yekonia et frre de Chaltiel. Donc Chaltiel n'est que l'oncle de Zorobabel.
6. Matthieu, (1: 13) rapporte que Zorobabel est pre de Abioud. Mais ce nom ne figure pas dans 1 Chroniques (3 : 19-20). La gnalogie de Jsus selon Matthieu comporte normment de divergences avec l'Ancien Testament.
II. Matthieu (1: 22-23) a crit: Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dclar par le Prophte : "Voici que la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel", ce qui se traduit: "Dieu avec nous" . Matthieu par cette citation voulait dmontrer que l'enfant et la jeune fille du texte d'Esae (7: 10-20) d'o il l'a extraite, s'appliquent Jsus et Marie. Mais ceci est inexact pour plusieurs raisons :
1. Le mot vierge du texte de Matthieu ne correspond pas la jeune fille[6], car le texte hbreu n'emploie pas le terme qui dsigne une vierge mais celui qui dsigne toujours une jeune fille, vierge ou non. 2. Jsus n'a jamais t appel Emmanuel. Mais au contraire sa mre, conformment aux ordres de l'ange, dans le songe de Joseph (Matthieu, 1: 21) et dans la vision (Luc, 1: 31), lui a donn le nom de Jsus. D'autre part, Jsus lui-mme n'a jamais prtendu avoir le nom d'Emmanuel. 3. Les versets d'Esae (7: 10-20) parlent d'une prophtie qui ne correspond ni par le temps, ni par le lieu, ni mme par les circonstances ( l'invasion de Juda par le roi d'Assyrie!) avec la naissance de Jsus.
III. Matthieu (2: 15) a crit: Il y resta (Joseph pre adoptif de Jsus) jusqu' la mort d'Hrode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dclar par le Prophte : j'ai appel mon fils hors d'gypte . Le Prophte auquel Matthieu fait allusion est Ose. Il s'agit, en ralit, dans le texte d'Ose (11: 1-11) d'Isral et de ses descendants qui se trouvaient en gypte et qui quittrent ce pays, guids par Mose. En effet, dans les anciennes traductions il y a : Et j'ai appel ses fils hors d'gypte . C'est--dire les fils d'Isral cit dans le verset 1 d Ose. On a manipul ce verset ce qui rend son sens incompatible avec les autres versets qui parlent de l'ingratitude des Isralites envers Dieu et leur attachement aux idoles. Mais leur retour Jrusalem, aprs leur dportation en Babylone, les Isralites n'ont plus ador que Dieu seul, dlaissant toute offrande aux idoles.
IV. Matthieu (2: 16-17) a crit: Alors s'accomplit ce qui avait t annonc par le Prophte Jrmie : Une voix s'est fait entendre Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations : "C'est Rachel qui pleure ses enfants ; elle n'a pas voulu tre console, parce qu'ils ne sont plus". Matthieu se rfre Jrmie (31: 15-17). Mais le texte de Jrmie n'a aucun rapport avec l'vnement d'Hrode (le massacre des enfants, de moins de deux ans de Bethlehem). Car les lamentations cites dans le texte de Jrmie avaient pour cause le massacre de milliers d'Isralites par les Babyloniens, six sicles avant Hrode. D'autre part, Bethlehem tait un petit village proche de Jrusalem sous le gouvernement d'Hrode ; il tait facile pour lui de mener une enqute pour connatre la maison visite par les mages, ou de faire suivre ces derniers, sans se livrer cet acte abominable. En outre, pourquoi aurait-il ordonn de massacrer les enfants de deux ans et au-dessous alors que Jsus n'avait pas plus d'un mois? N'tait-il pas facile de distinguer les bbs d'un an ou de deux ?
V. La citation de Matthieu (2: 23) : ...et vint demeurer (Jsus) dans une ville appele Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait t annonc par les prophtes : il sera appel Nazaren , ne se trouve en aucun livre des prophtes.
VI. Matthieu a crit (3: 1): En ce temps-l parut Jean-Baptiste, il prchait dans le dsert de Jude . L'expression: En ce temps-l, d'aprs le contexte, veut dire aprs la mort d'Hrode et le retour de Joseph d'gypte ; ce qui est compltement invraisemblable car Jean-Baptiste, qui n'avait que six mois de plus que Jsus (voir Luc 1), n'avait en ce temps-l que trois ans ou un peu moins. Il ne s'est mis prcher qu' l'ge de 28 ans ou 29 ans. Et
Jsus lui-mme fut baptis par Jean-Baptiste alors qu'il avait presque 30 ans.
VII. Dans Matthieu (27: 9-10) il est crit: Alors s'accomplit la parole du Prophte Jrmie : ils ont pris les trente pices d'argent, la valeur de celui qui a t estim par les fils d'Isral ; et ils les ont donnes pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonn . Cette citation n'existe pas dans le livre de Jrmie. En outre ce texte ne se trouve nulle part dans l'Ancien Testament. Pourtant certains exgtes ont essay de rectifier l'erreur de Matthieu en prtendant qu il ne s agissait pas de Jrmie mais du livre de Zacharie (11 : 12-13). Mais ceux-l ont galement tort car le rcit de Zacharie apparat dans un contexte tout fait diffrent de celui o Matthieu voulait l'insrer.
VIII. Matthieu (27: 50-53) a crit : Jsus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici : le voile du temple se dchira en deux de haut en bas, la terre trembla, les roches se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui taient dcds ressuscitrent. Ils sortirent des tombeaux, entrrent dans la ville saint, aprs la rsurrection (de Jsus) et apparurent un grand nombre de personnes. Ce rcit est inexact pour plusieurs raisons : 1. Les Juifs taient alls chez Pilate, le gouverneur romain, le deuxime jour aprs le crucifiement en disant : Le lendemain... les principaux sacrificateurs et les Pharisiens allrent ensemble trouver Pilate et dire : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore : Aprs trois jours je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du spulcre jusqu'au troisime jour, afin que ses disciples ne viennent pas drober le corps et dire au peuple : il est ressuscit des morts (Matthieu, 27: 62-63). Et en plus Matthieu (27: 17-20) a crit que Pilate et sa femme n'taient pas d'accord avec les Juifs pour tuer Jsus. Si ce miracle s'tait rellement droul, les Juifs n'auraient pas dcid d'aller chez Pilate, car les signes de la vracit de la mission de Jsus auraient t confirms par ce miracle. S'ils avaient os, malgr tout, demander Pilate de surveiller le spulcre, alors que lui-mme tait contre le crucifiement, ils auraient provoqu sa colre. D'autre part, les gens voyant les signes prodigieux auraient accus les principaux sacrificateurs et les Pharisiens de crime. 2. Ce prtendu miracle aurait t un grand signe de la vracit de Jsus, par consquent un grand nombre de Juifs et de Romains auraient d croire en lui comme cela a t le cas avec les Aptres lorsqu'ils furent remplis d'Esprit Saint (Actes, 2 et 14). Or ce miracle est plus frappant que celui attribu aux Aptres! 3. Ce miracle n'a t rapport par aucun historien de l'poque. D'autre part, les trois autres vanglistes n'en avaient rien dit. Marc avait signal que le voile s'est dchir mais sans mentionner le reste. Un grand miracle comme celui-ci ne devrait pas tre oubli par un vangliste, tmoin oculaire, comme on prtendait, alors que les vanglistes rapportent des choses insignifiantes. 4. Je ne sais pas pourquoi le temple ne s'est pas fendu alors que les tombeaux s'ouvrirent, les rochers se fendirent comme disait Matthieu ? 5. La rsurrection des corps de plusieurs saints est en contradiction avec le discours de Paul qui dit que Jsus est le premier-n et le premier ressuscit. (Actes, 26: 23; 1 Corinthiens, 15: 20-23).
IX. Dans Matthieu (12: 40), Jsus a dit : ... Car, de mme que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de mme le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre . Le chapitre 27: 62-63, reprend la mme dclaration. Faisons un calcul : Selon les vanglistes, Jsus fut crucifi le vendredi Midi (Jean, 19: 14), il ne mourut qu' la 9e heure du jour, c'est--dire l'aprs-midi. La nuit mme Joseph d'Arimathe l'ensevelit et le mit dans le tombeau (Jean, 19: 38 ; Marc, 15: 42). Et le dimanche avant le lever du soleil il fut enlev et on ne trouva personne dans le spulcre (Marc, 16 : 12; Matthieu, 28: 1; Luc, 23: 56, 24 : 1; Jean, 20: 1). Donc Jsus n'aurait demeur dans la tombe que deux nuits et un jour (la nuit qui prcde le Samedi, la nuit qui prcde le Dimanche et la journe de Samedi) et non pas trois nuits et trois jours.
X. Matthieu (16: 27-28) fait dire Jsus : Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Pre avec ses anges, et alors il rendra chacun selon sa manire d'agir. En vrit je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son rgne. Tous ceux qui taient avec Jsus alors qu'il prchait et prophtisait sont morts et n'ont pas vu Jsus venir dans son rgne !
XI. D'aprs Matthieu (chapitre 24), Jsus aurait dcrit les vnements qui devaient suivre la destruction du temple. En effet, il aurait affirm qu'immdiatement aprs la destruction du temple et sans dlai, il reviendrait et ce serai la fin du monde (v. 34). Pourtant la destruction du temple eut lieu en l'an 70 mais aucun vnement racont par Matthieu ne s'est produit.
XII. Dans Matthieu (19: 28), Jsus aurait attest que les douze Aptres seront sauvs et seront parmi les heureux. Cette attestation mise dans la bouche de Jsus est fausse car Judas l'Iscariot avait livr Jsus aux Juifs, il s'tait donc apostasi et mourut ainsi ; la Ghenne sera son sjour (voir Matthieu, 26: 24).
XIII. Selon Jean (3: 13), Jsus aurait dit : Personne n'est mont au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme [qui est dans le ciel]. Cela semble inexact car Hnoch fut enlev au ciel (d'aprs la Gense, 5: 24 et l'ptre aux Hbreux, 11: 5) ainsi que le Prophte lie (selon 2 Rois, 20).
XIV. Selon Marc (11: 23 et 16: 17-18) et Jean (14 : 12), ceux qui ont la foi en Jsus feront des miracles ; parfois mme plus grands que ceux de Jsus lui-mme. Ces miracles ne sont pas rservs pour les Chrtiens du premier sicle mais ceci est une caractristique de n'importe quel Chrtien croyant en Jsus.
En effet, les consquences de cette conception sont graves car celui qui, malgr sa foi, ne ralisera pas de miracles risque d'tre expos au doute. Ainsi, selon cette conception, la majorit des Chrtiens qui ne ralisent pas de miracles ne sont pas des vrais Chrtiens. D'autre part, comment concilier deux citations de Jsus, selon les vanglistes, o il dclare que celui qui croit en lui fera de plus grands uvres (ou miracles), avec l'autre dclaration selon laquelle le disciple ne serait pas plus grand que le Matre? (Jean, 14: 12).
XV. Selon Marc (2 : 25-26) et Luc (6: 34) Jsus, s'est rfr un acte de David pour justifier sa conduite, or la citation n'est pas tout fait exacte car si l'on tient compte de 1 Samuel (21: 1-7) on dcouvre que David tait seul, et aucune personne n'tait avec lui dans la maison de Dieu. Donc les expressions : lui et ses gens et en donna mme ses gens sont ajoutes par les deux vanglistes ou bien retranches de l'Ancien Testament. D'autre part, le Souverain sacrificateur n'tait pas Abiathar (comme disaient les deux vanglistes) mais Achimlek (1 Samuel, 22: 9-17 et 21: 3).
XVI. Dans le chapitre 15: 5 de la 1re ptre aux Corinthiens, il est dit: et il a t vu (Jsus) par Cphas (Pierre), puis par les douze. Pourtant dans Marc, 16: 14, il n'y a que 11 aptres puisque, selon les vanglistes, Judas l'Iscariot s'est suicid juste aprs le crucifiement.
XVII. Selon Matthieu (10: 19-20), Marc (13: 11) et Luc (12: 11-12) Jsus aurait promis ses disciples et ses adeptes qu'au moment de comparatre devant les autorits et les synagogues, ils rpondraient alors grce l'inspiration de l'Esprit Saint. Mais si l'on se rfre aux Actes (23: 1-5) nous trouverons que Paul a comparu devant le Sanhdrin mais il a insult le souverain sacrificateur parce qu'il ne le connaissait pas. Ensuite, aprs avoir su que c'tait le souverain sacrificateur, il s'est excus de sa faute. Cet incident ne pouvait donc tre une inspiration de l'Esprit Saint. Et la promesse ne s'est donc pas ralise.
XVIII. Selon Luc (4: 25) et l'ptre de Jacques (5: 17), il est dit que la pluie tomba trois ans et six mois l'poque du prophte lie. Or si l'on consulte 1Rois (18: 1) nous apprendrons que la pluie est tombe la 3e anne ; c'est--dire avant que les 3 ans ne soient rvolus. Les deux textes de Luc et de Jacques prtendent qu'il a plu au cours de la quatrime anne.
XIX. Dans Luc (1: 32-33) il est dit : Il sera grand (Jsus) et sera appel Fils du Trs-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trne de David, son pre. Il rgnera sur la maison de Jacob ternellement et son rgne n'aura pas de fin. Il y a trois remarques : 1. Jsus est un descendant de Yhoyaqim ; et nul descendant de ce roi ne pourrait siger sur le trne de David (voir Jrmie, 36 : 30). 2. Jsus n'avait jamais sig sur le trne de David. Il n'a jamais eu pouvoir sur les Juifs ; mais au contraire, il est jug, condamn, battu et enfin crucifi comme prtendent les vanglistes.
3. Jsus n'a jamais voulu tre un roi dans ce monde d'ici-bas (voir Jean, 18: 36). Il s'enfuit de ceux qui voulaient le proclamer roi des Juifs. Donc si cette prtention du texte de Luc est vraie, Jsus n'aurait pas rejet une responsabilit que Dieu lui ordonna d'assumer. Il serait gravement reprochable un prophte de manquer une telle obligation !
XX. Dans l'ptre aux Hbreux (9: 19-21) il y a des divergences avec l'Exode (24: 3-8).
En ralit les inexactitudes sont trs nombreuses ; cependant nous nous limitons ici renvoyer le lecteur dsirant continuer sa recherche aux versets o ce genre d'altrations apparat. Comparer par exemple : - 2 Samuel 24: 9 avec 1 Rois 21: 5 - 1 Chroniques, 7: 6 avec 1 Chroniques, 8: 1-2 et avec Gense, 46: 26. - Quelques phrases ne peuvent pas tre des paroles de Mose comme dans : Gense, 36: 31; Deutronome, 3: 14; Nombres, 21: 14 o l'auteur a puis d'un livre qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. Josu, 4: 9; 10: 13, o on a tir un texte d'un livre appel le livre du Juste qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. D'autre part l'auteur qui a dit cela n'est pas Josu. - Josu, 13: 25 avec Deutronome 2: 19, etc.
Conclusion gnrale Nous tenons rappeler au lecteur que nous n'avons prsent qu'un chantillon d'exemples o les contradictions, les divergences et les inexactitudes sont patentes. Ces diffrences, banales soient-elles, revtent une importance extrme ; car la valeur de la Bible est mise en cause et de ce fait la question de l'inspiration se pose. Nous nous demandons, ce propos, s'il y a inspiration ou non, notamment lorsque deux affirmations s'opposent. Ce que nous pouvons conclure, pour notre part, c'est que la Bible a sans aucun doute subi partiellement des additions, des suppressions et des modifications. ************************* DEUXIEME PARTIE
MOHAMMAD DANS LA BIBLE
Plusieurs prophties aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau voquent un personnage, qu'attendent les nations. Cet homme guidera son peuple, et par le truchement de ce dernier mettra toute l'humanit sur la voie de la droiture, de la justice et de la prosprit. Ce personnage n'est pas mentionn par son nom dans la Bible canonique[7] ; mais on s'est content de lui attribuer des qualits et des caractristiques le distinguant des autres prophtes. On a mis l'accent sur sa grandeur, ses oeuvres et sa prdication qui changeront la face du monde et qui aboutiront la restauration du royaume de Dieu. Cependant, les prophties figurant dans l'Ancien Testament se rapportent selon les Chrtiens au Christ ; celles du Nouveau Testament, sont interprtes de faon ce qu'elles ne concernent aucune autre personne que Jsus ; ou dfaut, on les applique l'Esprit Saint.
CHAPITRE PREMIER
MOHAMMAD DANS L'ANCIEN TESTAMENT
I. - Le Prophte
Le Prophte attendu du Pentateuque En ouvrant la Bible, nous rencontrons la plus importante prophtie du Pentateuque, concernant ce personnage, dans le Deutronome 18: 15-22: 15. L'ternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frres, un prophte comme moi : vous l'couterez. 16. C'est l tout ce que tu as demand l'ternel, ton Dieu, Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais : Que je ne continue pas entendre la voix de l'Eternel, mon Dieu, et que ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 17. L'ternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frres un prophte comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19. Et si quelqu'un n'coute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. 20. Mais le prophte qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas command de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophte-l sera mis mort. 21. Peut-tre diras-tu dans ton c ur : Comment reconnatrons-nous la parole que l'ternel n'aura pas dite ? 22. Quand le prophte parlera au nom de l'ternel, et que sa parole ne se ralisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'ternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophte l'aura dite : Tu n'en auras pas peur .
Quand nous examinons attentivement les phrases de ce texte nous constatons qu'il ne s'agit pas de Jsus comme le prtendaient les Chrtiens. Les raisons de cette conviction pourront tre rsumes dans les constatations et les remarques suivantes : 1. Bien que Jsus ft parmi les Juifs et et commenc sa mission, il ne fut pas reconnu comme tant le Prophte dont parle la prophtie prcite du Deutronome. Mais les Juifs le distingurent du Prophte attendu. Cette remarque nous la tirerons du questionnaire fait par les sacrificateurs et les lvites, envoys par les Juifs, Jean-Baptiste. Ils avaient, nanmoins la certitude que Jean est un prophte, mais ils voulaient l'identifier. On lui a mentionn trois personnages : le Christ, Elie et le Prophte. Mais lui, a dclar n'tre aucun de ces trois : Voici le tmoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyrent de Jrusalem des sacrificateurs et des Lvites pour lui demander : Toi, qui es-tu ? Il confessa sans le nier, il confessa : Moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandrent: Quoi donc? Es-tu Elie ? Et il dit: je ne le suis pas. Es-tu le Prophte ? Et il rpondit : Non... Ceux qui avaient t envoys taient des pharisiens. Ils l'interrogrent et lui dirent : Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Elie, ni le Prophte ? ... Jean, 1 : 19-25. De ce texte nous apprenons qu'il y a trois personnages : Le Christ qui est trs probablement Jsus ; Elie qui pourrait tre Jean-Baptiste (selon les dires attribus Jsus dans Matthieu, 11 : 7-15) ; et enfin le Prophte. L'identification des personnages nous importe peu, pour l'instant ; mais ce que nous devons retenir de ce tmoignage c'est leur nombre et notamment la distinction faite entre le Christ et le Prophte. Qui est donc ce Prophte ? Son image a sans doute pour fond la prophtie du Deutronome cite plus haut. Par ailleurs, pour mettre l'accent sur la distinction que faisaient les Juifs cette poque entre le Christ et le Prophte nous reproduisons un autre texte de l'vangile de Jean, 7 : 40-41 : Des gens de la foule, aprs avoir entendu ces paroles, disaient : Celui-ci est vraiment le Prophte. D'autres disaient : Celui-ci est le Christ... Le Prophte est donc un autre personnage, mis en parallle avec le Christ et dont on attendait la venue comme celle du Christ. Ces deux versets corroborent notre point de vue et appuient la dmonstration que nous venons d'laborer. Cependant, pour donner un autre appui cette ralit biblique nous citerons quelques versets des documents dcouverts dans la grotte de Qumrn (proche de la Mer Morte) qui mettent clairement l'accent sur la venue de trois personnages : deux messies et un Prophte. Dans le document appel Manuel de Discipline , il est crit[8] : Seuls les fils d'Aaron dcideront des questions de droit et de biens... Et qu'eux-mmes ne s'loignent d'aucun conseil de la loi pour marcher dans l'obstination de leur c ur ; mais qu'ils jugent d'aprs les premiers prceptes par lesquels les hommes de la communaut ont t d'abord disciplins jusqu' ce que viennent un Prophte et les Messies d'Aaron et d'Isral. Les sectaires de Qumrn, attendaient donc deux messies ; mais ils attendaient aussi un prophte, comme faisaient les autres Juifs.
2. Dans la prophtie du Deutronome que nous avons reproduite ; il y a cette formule :
Un prophte comme toi .
Au dbut des versets, lorsque c'tait Mose qui parlait il disait : Un Prophte comme moi , mais dans les versets suivants il rpte les paroles de Dieu qui lui taient adresses, et c'est alors qu'il dit : Un prophte comme toi , c'est--dire comme Mose. Cette caractristique ne saurait tre applique Jsus pour les raisons suivantes : 1. Jsus est un Isralite ; c'est une cause pour qu'il ne puisse pas tre plus grand que Mose ou l'galer ; car dans le Deutronome, 34 : 10-11, on constate qu'aucune personne parmi les Isralites ne saurait susciter l'ide d'tre plus grande que Mose : Il ne s'est plus lev en Isral de prophte comme Mose que l'ternel connaissait face face. Nul ne peut lui tre compar pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'gypte contre Pharaon... . Donc si quelqu'un prtend que parmi les Isralites apparatrait un prophte plus grand que Mose on devrait le dmentir.
2. Selon, les principes thologiques des Catholiques et des Protestants, concernant Jsus, il n'y aura aucune ressemblance entre Jsus et Mose. Nous lucidons cette ide par les constatations suivantes : a) Pour les Protestants et les Catholiques qui voient en Jsus la deuxime personne de la Trinit et le Fils de Dieu, Mose serait son serviteur ; par consquent il serait inadmissible de les mettre en quivalence et d'tablir entre eux des ressemblance[9]. b) Jsus - comme prtendait Paul - tait devenu maudit pour les Chrtiens : Christ nous a rachets de la maldiction de la loi, tant devenu maldiction pour nous - car il est crit : Maudit soit quiconque est pendu au bois Galates, 3 : 13 ; mais Mose n'a ni t maudit ni crucifi alors que Jsus l'a t comme le croient les Chrtiens. c) La loi de Mose contient diverses directives et rgles concernant la vie pratique : les interdictions et les devoirs, individuels et collectifs, portant sur la morale, la famille, l conomie, le droit etc. Alors que la loi ou les directives que renferment les vangiles ne concernent que quelques questions de ce genre. d) Mose tait un homme obi et avait autorit sur son peuple par contre Jsus ne l'tait pas.
3. Dans cette prophtie du Deutronome il y a cette formule : Je leur susciterai du milieu de leurs frres...
Au moment de l'vocation de cette prophtie, les douze tribus d'Isral taient toutes prsentes. Le contexte, en effet, montre que la parole fut adresse tout Isral. Donc il est inadmissible de prtendre que l'expression : leurs frres se rapporte aux tribus d'Isral ou l'une d'elles. Leurs frres sont donc les Ismalites, c'est--dire les Arabes ; car Ismal est le frre d'Isaac pre d'Isral ; comme le dit le verset 12 du chapitre 16 de la Gense : Il (Ismal) sera comme un ne sauvage[10], sa main sera contre tous , et la main de tous sera contre lui ; il demeurera face tous ses frres. ; et dans le verset 18 chapitre 25 : Ismal s'tablit en face de tous ses frres[11].
4. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai . C'est une allusion faite d'une part, la rvlation que ce prophte recevra et d'autre part son analphabtisme. Jsus ne pourrait pas tre concern par cette prophtie car, selon les Chrtiens, Jsus est un Dieu; ce qui implique qu'il n'a pas
besoin qu'on mette les paroles de Dieu dans sa bouche et qu'il n'a pas besoin de recevoir les ordres ; puisque c'est lui le Dieu qui commande toutes choses !
5. Et si quelqu'un n'coute pas mes paroles qu'il dira en mon nom c'est moi qui en demanderai compte. Ici c'est une allusion la grandeur de ce prophte. Mais il est difficile d'appliquer cette caractristique Jsus car d'une part, il ne serait qu'un simple porte-parole de Dieu et d'autre part ce ne sera pas lui qui jugerait ceux qui ne l'couteront pas mais ce sera Dieu ; ce qui est incompatible avec les dogmes chrtiens. Mais lorsque nous essayons d'appliquer les caractristiques cites dans la prophtie du Deutronome, au Prophte Mohammad nous trouvons une parfaite concordance : Il est comme Mose dans les caractristiques suivantes :
* Il est un serviteur de Dieu et son Messager comme Mose, et non pas un Dieu.
* Il a un pre et une mre (Jsus n'a que la mre). * Il s'est mari et avait des enfants, comme Mose (Jsus, non). * La rvlation qu'il a reue contient des directives et des rgles qui rgissent la vie entire des hommes : individuelle et collective ; morale, politique, conomique, juridique et religieuse. Pour claircir cette question nous citons quelques faits : Dans les deux religions : islamique et juive, il y a les ablutions lgales pour faire les prires ; la purification lgale des femmes aprs les rgles, l'accouchement et aprs l'acte sexuel entre la femme et son mari (dans ce cas la purification est galement obligatoire pour l'homme). L'interdiction de manger la viande d'animaux non gorgs et la chair du porc. La punition concernant l'adultre (de l'homme et de la femme). La loi du Talion. L'interdiction des sacrifices pour les idoles. L'interdiction de la pratique de l'usure. Et enfin le pur monothisme.
* D'autre part, Mohammad est mort naturellement comme Mose ; par contre Jsus, selon les chrtiens, fut crucifi et tu. * Mohammad a t enseveli et enterr et ne fut pas ressuscit (comme Mose) alors que Jsus, selon les Chrtiens, a t ressuscit et lev au ciel. * Il n'tait pas maudit pour sa communaut (tel Mose) ; par contre Jsus l'tait comme prtendait Paul. * Le Coran a soulign cette ressemblance aussi bien entre Mohammad et Mose qu'entre le Coran et la Torah : Dieu dit dans le Coran, 73 : 15 : Oui, nous vous avons envoy un Prophte qui porte tmoignage contre vous, comme nous avions envoy un Prophte Pharaon. Et il dit propos du Coran et de la Torah, 21 : 48-50 : Nous avons donn la Loi Mose et Aaron, comme une Lumire et un Rappel pour ceux qui craignent Dieu ; pour ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne le voient pas et qui sont mus en pensant l'Heure. Et ceci (c est--dire le Coran) est un Rappel bni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le mconnatre ?.
* Mohammad tait illettr, la parole de Dieu tait dans sa bouche comme dit le Coran son propos : Par l'toile lorsqu'elle disparat. Votre compagnon (Mohammad) n'est pas dans l'erreur; il ne parle pas sous l'empire de la passion
: Ce n'est l qu'une rvlation qui lui a t inspire. (53: 1-4).
6. Dans cette prophtie il est dit : Mais le prophte qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas command de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophte-l sera mis mort., La phrase ...sera mis mort est une promesse et pas un ordre. Si alors le Prophte Mohammad avait t imposteur il aurait du tre tu comme le souligne ce verset ; mais Il ne l'a pas t ; par consquent il n'tait pas un imposteur, et c'est ce que dit le Coran : S'il (Mohammad) nous avait attribu quelques paroles mensongres, nous l'aurions pris par la main droite, puis nous lui aurions tranch l'aorte, nul d'entre vous n'aurait t capable de s'y opposer. (69 : 44-47). Dans un autre verset le Coran dit : Prophte ! Fais connatre ce qui t'a t rvl par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas fait connatre son message. Dieu te protgera des gens. (5 : 75). Cette promesse du Coran de protger le Prophte a t accomplie, et personne n'a russi le tuer bien qu'il et de nombreux ennemis. Or les Chrtiens prtendaient et prtendent encore que Jsus a t tu ; donc en nous basant sur cette prophtie du Deutronome nous pourrons conclure que : soit Jsus tait un imposteur et non pas un vrai prophte (?) puisqu'il fut tu, comme on le prtend ; soit alors, Jsus a t tu tout en tant un vrai prophte ce qui nous mne conclure en revanche que ces versets du Deutronome ne sont pas authentiques et qu'ils ne sont pas l'oeuvre d'une inspiration ; par consquent ces versets ne concernent pas Jsus. Mais tout ceci est grave pour la foi des Chrtiens ! Certes cela est un dilemme. Cependant, le Coran donne une explication qui rsout cette controverse : Jsus n'a pas t tu mais lev au ciel, un autre fut crucifi sa place (Voir le Coran, 4 : 157). Selon les faits coraniques le problme est donc rsolu : le texte du Deutronome est authentique, Jsus ne fut pas tu et n'tait pas un imposteur.
7. - Dans cette prophtie du Deutronome, Dieu a donn des signes pour distinguer le prophte imposteur du prophte vridique : Peut-tre diras-tu dans ton coeur : Comment reconnatrons-nous la parole que l'Eternel n'aura pas dite ? Quand le prophte parlera au nom de l'ternel, et que sa parole ne se ralisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'ternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophte l'aura dite : tu n'en auras pas peur.
Plusieurs prdictions et prophties ont t mises dans le Coran ainsi que par le Prophte Mohammad (dans ses propos). Nous citons quelques-unes tout en soulignant que ces prdictions sont nombreuses et qu'elles se sont toutes ralises :
1. Dans le Coran a) Alif. Lam. Mim. Les Romains ont t vaincus dans le pays voisin ; mais aprs leur dfaite, ils seront vainqueurs dans quelques annes. 30 : 1- 4. La guerre sculaire entre les Byzantins et les sassanides de Perse clatait de temps autre. En 614 les forces sassanides s emparrent de Jrusalem, et la Croix fut emporte en Perse. De 616 619, des armes perses s emparrent de toute l Egypte. En 617 une autre arme perse s empara de l Asie mineure et de Chalcdoine, qui n est spare de Constantinople, la capitale Byzantine, que par le dtroit du Bosphore. Mais aprs quelques annes Hraclius a pu vaincre les Perses en 624 et a profan leur lieu sacr. Entre 624 et 628, date de l assassinat de Khosru II, par son fils Sheroye, il vainquit plusieurs armes.
Il est signaler que la sourate o se trouvent les versets prcits est une sourate mecquoise ; c'est--dire rvle avant l Hgire ; donc avant 622 ap. J. C. b) Dieu, trs certainement, ralisera par la vrit la vision de son messager : trs certainement vous entrerez dans la Sainte Mosque, si Dieu veut, en scurit, ayant ras vos ttes et coup les cheveux, n ayant point de crainte. Il sait, donc, ce que vous ne savez pas ! Puis il a prvu, au pralable, une victoire prochaine. 48 : 27. Ces versets visent la conqute de la Mecque, deux ans aprs la Trve entre Musulmans et polythistes mecquois. La vision du Prophte de l entre prochaine la Mecque est ici confirme. Ce qui est arriv effectivement. L expression Ras vos ttes et coup signifie que pour se dsacraliser et revenir la vie civile, le plerin doit se raser la tte, tout au moins se couper les cheveux, la femme coupe symboliquement une petite mche de ses cheveux. L expression Puis il a prvu vise la conqute de Khaybar. c) C est lui qui a envoy son Prophte avec la direction et la religion vraie pour la faire prvaloir sur toute autre religion. 48 : 28. Dieu a effectivement fait triompher l Islam dans une grande surface de la terre. Pour d autres prdictions voir le Coran, 22 : 41 ; 24 : 55 ; 41 : 53 ; 54 : 44-45 ; 62 : 3 et d autres.
2. Dans les propos du Prophte Mohammad Il suffit de lire les recueils de la tradition prophtique (comme Bukhari, Muslim, Tirmidi, Abu Dawoud, Ibn Maja, Ahmad et d autres) et de comparer les prdictions du Prophte avec les faits historiques pour trouver leur parfaite concordance. Par exemple le Prophte a prdit un feu immense qui sortira du Hijaz, rgion de la Mecque et de Mdine en Arabie, qui fera voir les cous des chamelles se trouvant trs loin de cet endroit. En effet en 654 de l hgire (1256 ap. J. C.) le Feu prdit depuis des sicles a jailli d une montagne au Hijaz.( De la description des historiens de l poque il ressort que ce Feu tait une sorte de Volcan trs immense.). En outre le Prophte a prdit que les Musulmans s empareront de Constantinople. Ce qui est arriv effectivement en 1453 ap. J. C. Les exemples sont nombreux ; celui qui veut tudier cette question en dtail peut consulter des livres de la tradition prophtique et des uvres historiques comme celui d Ibn Katir par exemple (al-Bidaya wan-Nihaya).
8. Les rabbins juifs l'poque du Prophte Mohammad avaient reconnu qu'il tait le Prophte attendu. Quelques uns d'entre eux s'taient convertis l'Islam ; d'autres avaient prfr s'obstiner dans leur incrdulit comme l'avait fait Caphe, le Souverain sacrificateur des Juifs vis--vis de Jsus bien qu'il et reconnu que ce dernier tait un prophte (Voir Jean, 11 : 49-52).
Cependant, une petite objection pourrait tre souleve ; elle est suggre par la proposition : Du milieu de toi (v.15). Cette formule, au contraire, corrobore ce que nous voulons tablir ; car le Prophte Mohammad, aprs avoir pass une dizaine d'annes La Mecque o il prchait, quitta cette ville pour s'installer Mdine. Dans celle-ci, il y avait trois
grandes tribus juives, qui avaient migr en Arabie, peut-tre aprs les perscutions romaines ; c'taient les Ban-n-Nadr, les Ban Quraza et les Bnu Qanuq, en outre dans la rgion de Mdine il y avait les Juifs de Khaybar, plus loin ceux de Tam.
Par ailleurs nous tenons rappeler ici que dans les documents de la Mer Morte, les critures incitent les sectaires de Qumrn s'installer au dsert pour prparer le chemin du Seigneur. Il nous semble que l'migration des Juifs en Arabie, ou du moins d'une partie d'entre elle, se serait ralise dans ce but.
Les Juifs, en effet, avaient contribu la conversion des habitants arabes paens de Mdine en leur parlant d'un prophte qui apparatra bientt.
D'autre part, il est signaler que cette expression (du milieu de toi) pourrait tre une addition ultrieure pour mettre la confusion dans le texte, ou alors c'est une note explicative introduite postrieurement dans le texte par un scribe. Les raisons que nous pouvons fournir pour cette explication sont : 1. Pierre avait mentionn cette prophtie sans rapporter cette expression (voir Actes, 3 : 22-23) ainsi que Etienne (Actes, 7 : 37). 2. Mose, quand il a rapport ce que Dieu lui a dit, n'a pas mentionn cette expression (voir Deutronome, 18 : 17). 3. Dieu avait promis Abraham de bnir Ismal et sa postrit[12] (voir Gense, 17 : 20). Si la venue du Prophte Mohammad n'tait pas la ralisation de cette promesse et de cette bndiction quand alors se raliseront-elles ?
Qui est Schilo ? Dans la Gense, 49 : 10 il est crit :
Le bton (de commandement) ne s'cartera pas de Juda, ni l'insigne du lgislateur d'entre ses pieds, jusqu' ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obissent.
D autres traduisent : ni l insigne du lgislateur par ni le bton souverain ce qui a le mme sens. Dans cette prophtie, l image est celle du chef assis sur son trne, tenant en main et entre les jambes les insignes de son pouvoir. A la venue de cette personne attendue par toutes les nations, le pouvoir, c'est--dire le pouvoir politique, et la lgislation seront transmis de Juda cet homme : c'est--dire des Isralites lui et bien sr son peuple. Le verset mentionne deux choses : la venue de Schilo et ses consquences qui sont : la transmission du bton de commandement et de lgislation de Juda cette personne et l obissance des peuples. Or ces deux caractristiques ne s appliquent pas Jsus.
Car celui-ci tait descendant de Juda (voir la gnalogie de Jsus dans Matthieu, 1 : 2 et Luc, 3 : 33) ce qui implique que sa venue ne serait pas une cause pour que le bton de commandement et de lgislation soient transmis de Juda ; mais au contraire le pouvoir politique et lgislatif demeurerait dans les mains de Juda ; puisque sa venue ne serait qu une continuit et non pas une rupture ou un loignement du pouvoir de Juda, comme le dit le texte. D autre part, Jsus, en faisant des Aptres, selon les Evangiles, des Juges chargs des douze tribus d Isral, maintenait le pouvoir dans le peuple de Juda. En outre, l obissance des peuples Jsus n est pas arrive de son vivant ; puisqu il fut crucifi et tu selon les Chrtiens. En revanche, ces donnes s appliquent parfaitement au Prophte Mohammad. Mohammad, lui ; n est pas un descendant de Juda. En outre de son vivant et aprs sa mort des peuples lui ont obi et lui obissent encore. Par ailleurs, quand nous examinons les interprtations donnes par les savants au terme Schilo nous constatons qu elles s appliquent parfaitement au Prophte Mohammad. Dans une note rserve ce terme, dans la nouvelle version Segond, dition Alliance biblique universelle , Paris 1978, p. 54, il est crit : Chilo : Le sens de ce mot reste mystrieux, comme on peut en juger par les versions et les interprtations modernes : Celui qui appartient le bton de commandement ; Celui qui doit tre envoy ; le pacifique ; le dominateur ; un cadeau pour lui ; ou encore, toute la phrase tant lue : jusqu ce que le tribut lui soit apport. On considre en gnral que cette prdiction a un sens messianique. . Nous essayons de voir qui ces interprtations s appliquent parfaitement ; Jsus ou Mohammad. 1. Schilo : Celui qui appartient le bton de commandement.
Nous avons dmontr plus haut que le bton de commandement ne saurait concern Jsus pour la simple raison que Jsus est un descendant de Juda. Par contre la contradiction disparat lorsqu on l applique Mohammad.
2.
Schilo : Celui qui doit tre envoy .
Cette interprtation s applique aussi bien Jsus qu Mohammad. Mais elle suggre que ce Prophte sera le grand envoy de Dieu.
3.
Schilo : Le Pacifique .
On ne peut apprcier la valeur et les capacits d un pacifique que si, en dpit de sa puissance militaire, il continue prfrer la paix. Quand on considre la vie de Mohammad on se rend compte qu il prfrait toujours la paix, et qu il ne recourait la guerre que lorsqu il y tait contraint. Cependant, on ne peut pas qualifier de non pacifique celui qui luttera pour la cause de Dieu et pour la restauration de la paix. Jsus, par exemple, reviendra pour dtruire les rgimes politiques de la terre, et Mohammad a combattu l ignorance et le mal en recourant la force.
4. Schilo : Le dominateur .
C est une caractristique du Prophte Mohammad ; car lui-mme et par le truchement de ses disciples il a domin presque le monde entier de son poque. Par contre, Jsus n avait pas pour mission de dominer le monde.
5. Schilo : Un cadeau pour lui . Cette interprtation est une allusion manifeste la ralit historique qu avait connue l Arabie. Les prsents et les cadeaux ont t envoys de toutes parts au Prophte Mohammad : d Hraclius, l empereur romain, du gouverneur de l Egypte, du roi d Abyssinie ainsi que d autres rois. Par contre, Jsus n a pas reu de cadeaux des rois.
6. Schilo : Jusqu ce que le tribut lui soit apport .
Cette donne s applique parfaitement au Prophte Mohammad car le Coran dit : Combattez : ceux qui ne croient pas en Dieu et au Jour dernier ; ceux qui ne dclarent pas illicite ce que Dieu et son Prophte ont dclar illicite ; ceux qui, parmi les gens du Livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu ce qu ils payent directement le tribut aprs s tre humilis. 9 : 29.
Le tribut est impos aux Juifs, aux Chrtiens, aux Persans et d autres ; qui ont t des non convertis et vivants dans l tat musulman.
Dans n importe quel livre de la lgislation islamique on trouve un chapitre consacr aux directives et rgles explicitant cette loi. Jsus, par contre, n a peru aucun tribut.
Le Prophte des Psaumes a) Dans le Psaume 45 : 2-18, il est crit :
Mon coeur bouillonne de belles paroles. Je dis : Mes oeuvres sont pour le roi! Que ma langue soit comme la plume d'un habile crivain !
3. Tu es le plus beau des fils d'homme, la grce est rpandue sur tes lvres : c'est pourquoi Dieu t'a bni pour toujours. Ceins ton pe ton ct,
4. Vaillant guerrier, ton clat et ta splendeur,
5. Oui, ta splendeur ! Elance-toi, monte sur ton char, pour la cause de la vrit, de l'humilit et de la justice, que ta droite te montre des exploits formidables!
6. Tes flches sont aigus, des peuples tomberont sous toi ; elles perceront le coeur des ennemis du roi.
7. Ton trne, Dieu subsiste toujours et perptuit ; le sceptre de ton rgne est un sceptre de. droiture.
8. Tu aimes la justice, et tu hais la mchancet : c'est pourquoi, Dieu[13] , ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilge sur tes compagnons.
9. La myrrhe, l'alos et la casse parfument tous tes vtements ; depuis les palais d'ivoire les instruments cordes te rjouissent.
10. Des filles de rois sont parmi tes favorites ; la reine est ta droite, pare d'or d'Ophir.
11. Ecoute, ma fille, vois et prte l'oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton pre.
12. Le roi porte ses dsirs sur ta beaut ; puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages.
13. Et, avec des prsents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur.
14. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intrieur du palais ; son vtement est fait de broderies d'or.
15. Elle est conduite au roi, vtue de ses habits de couleurs, et derrire elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenes auprs de toi.
16. On les conduit au milieu des rjouissances et de l'allgresse ; elles entrent dans le palais du roi.
17. Tes fils prendront la place de tes pres ; tu les tabliras princes dans tout le pays.
18. Je rappellerai le souvenir de ton nom de gnration en gnration, aussi les peuples te clbreront ternellement et perptuit. .
Ce texte dcrit un personnage et illustre ses qualits physiques et morales. De mme il mentionne ses exploits et les consquences de sa mission salvatrice. Nous essayons donc de regrouper toutes ces caractristiques en diffrents
points :
1. Tu es le plus beau des fils d'homme ton clat et ta splendeur, Oui, ta splendeur !
Cette caractristique est nettement celle du Prophte Mohammad. Comme il est crit dans les divers recueils de la tradition prophtique, ses compagnons, en le dcrivant, soulignaient sa beaut[14]. D ailleurs, ils illustraient cette beaut par des images telles que : On aurait cru en le regardant que le soleil resplendissait dans son visage ou Son visage brillait comme un vaisseau dor ou encore : Nous n avons jamais vu quelqu un de plus beau que le Prophte. . Le grand pote Hassan Ibn Thabit, compagnon du Prophte, a compos des vers dans lesquels il voulait manifester son admiration pour ses hautes qualits morales et physiques : De plus splendide que toi, Mes yeux n ont jamais vu ; De plus sublime que toi , Les mres n en ont point eu ; Pur et sans vice, Ton Dieu t a cre, Comme si de ta volont, cela dpendait.
Mais si on essaye d appliquer cette qualit physique Jsus en nous basant sur le chapitre 53 du livre d Esaie, comme l ont fait les Chrtiens, nous constatons que dans le verset 2 il est crit : Il n avait ni apparence, ni clat pour que nous le regardions, et son aspect n avait rien pour nous attirer. .
2. la grce est rpandue sur tes lvres .
C est une autre caractristique reconnue par tout le monde et mme par ses ennemis. Les tribus arabes avaient reconnu son loquence, et la tribu de Quraych avait dfendu ses membres d couter le Prophte de peur qu ils soient sduits par son loquence.
Cependant, cette loquence extraordinaire et cette grce rpandue sur ses lvres , n ont pas t reconnues Jsus bien que l on ait t convaincu de sa sagesse et de la valeur de ses paraboles. On ne trouve point de textes qui rapportent que les ennemis de Jsus aient dfendu aux gens de l couter de peur qu ils soient ravis par son
loquence. La plupart des gens qui suivaient Jsus se sont attachs lui, grce aux miracles qu il produisait. D ailleurs, lui-mme a ressenti ce fait. Il est toutefois vrai que l enseignement de Jsus tait frappant ; mais on n a jamais soulign que cela tait du son loquence.
3. C est pourquoi Dieu t'a bni pour toujours. [15].
Cette caractristique peut tre applique aux deux prophtes ; cependant nous soulignons que tout musulman dans ses cinq prires obligatoires et lorsqu il entend prononcer le nom du Prophte, doit implorer la bndiction et le salut divins sur lui, conformment au verset coranique : Oui, Dieu et ses anges bnissent le Prophte. O vous, les croyants, priez pour lui et appelez sur lui le salut. 33 : 56. Par contre Jsus est un dieu, selon les Chrtiens, et par consquent il n a pas besoin d tre bni ni par Dieu ni par ses serviteurs.
4. C est un Vaillant guerrier, ton ct, ton pe
Cette qualit est manifeste dans la vie du Prophte Mohammad. Il a men des guerres contre ses perscuteurs et a russi presque dans toutes ses expditions. Il tait un fin connaisseur des stratgies militaires. Aussi n a-t-il jamais pris la fuite bien qu un grand nombre de ses compagnons aient fui au cours de quelques batailles (celle d Uhud et celle de Hunayne). Par contre Jsus n a jamais fait de guerres et n a jamais port l pe.
5. monte sur ton char, pour la cause de la vrit, de l'humilit et de la justice.
C est une allusion aux batailles qu avaient menes le Prophte Mohammad. En effet, ces batailles n avaient pas un but personnel, ni tribal ni mme racial, et ne recherchaient aucune domination. Au contraire, elles devaient faire triompher la vrit et la justice et librer les masses opprimes par leurs despotes tout en leur laissant le choix de se convertir l Islam ou de conserver leur religion. D autre part, parmi les surnoms que lui avaient donn ses compatriotes avant qu il commence sa mission et qu il ne reoive la rvlation il y a : Le Fidle et le Vridique . Ce qui confirme cette interprtation. Donc avant mme sa mission Mohammad cherchait la justice. Par contre, Jsus n avait pas men de guerre pour faire triompher la justice et la vrit ; mais au contraire il a t mpris, crucifi et tu comme prtendent les Chrtiens.
6. Que ta droite te montre des exploits formidables.
A la bataille de Badr, le Prophte Mohammad a lanc une poigne de poussire sur l arme ennemi. La poussire a atteint les yeux de chaque combattant et tous proccups par leurs yeux n avaient pas pu se dfendre contre l attaque des Musulmans et ce fut la droute de l arme ennemie(mecquoise). Le Coran dit propos de ce fait prodigieux : Et lorsque tu lanais, ce n est pas toi qui lanait : mais c est Dieu qui lana. 8 : 17.
7. Tes flches sont aigus, des peuples tomberont sous toi ; elles perceront le coeur des ennemis du roi.
Les fils d Ismal (les Arabes) taient d excellents tireurs l arc, comme leur anctre ; dans la Gense il est dit : Dieu fut avec le garon (Ismal), qui grandit, habita dans le dsert et devint tireur l arc. Il habita le dsert de Parn.12-02 : 12 Par ailleurs, la prophtie prcise que des peuples tomberont sous la main de cette personne ; ce qui veut dire qu il y aurait des guerres. En effet, des peuples d Asie, d Afrique et d Europe sont tombs sous les mains des musulmans ; Une grande partie de ces peuples s est convertie l Islam ; la religion du Prophte Mohammad. Ces deux caractristiques, parfaitement applicables Mohammad, sont inapplicables Jsus. 8. le sceptre de ton rgne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice, et tu hais la mchancet.
Ces qualits sont reconnues, mme par les ennemis de l Islam, au Prophte Mohammad et au rgime qu il a instaur dans le monde. En effet, celui qui tudie sa vie sera sans peine convaincu de l existence de ces nobles qualits en la personne du Prophte. Par ailleurs, on ne peut pas concevoir un tel amour pour la justice et une telle aversion de la mchancet si la personne considre n est pas expose des situations qui prouvent ces qualits morales. La meilleure preuve pour dcouvrir l enracinement de ces qualits dans la conscience et dans le c ur de cette personne, c est de gouverner les gens, de trancher leurs diffrends, d tre juge Les actes de justice ou d injustice permettront alors de connatre son trfonds. Le Prophte Mohammad tait juge, gouverneur, homme d Etat, chef d arme etc. Dans toutes ces fonctions, il tait le bel exemple de la justice et de la misricorde, de la rpulsion de la mchancet aussi bien envers ses amis qu l gard de ses ennemis. Aprs sa mort, l poque des Califes bien guids , le monde a connu un rgne de justice et de bont qu il n a jamais vu auparavant ni mme aprs. D autre part, les peuples presque partout ont accueilli les conqurants musulmans comme librateurs, notamment en Egypte, en Palestine, en Msopotamie, en Espagne, etc. Cela ne veut pas dire que Jsus ne possda pas cette qualit ; mais nous voulons dire que son manifestation chez lui n avait pas t confirme par les faits rels dans toutes les domaines de la vie comme tait le cas du Prophte Mohammad. Donc la conviction que Jsus tant ainsi, est base seulement sur un principe dogmatique, mais non pas effectif.
9. Des filles de rois sont parmi tes favorites Ecoute, ma fille, vois et prte l'oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton pre. Le roi porte ses dsirs sur ta beaut ; puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages.
La reine dont il est question ici est trs probablement Safiyya, fille de Huyayy Ibn Akhtab, le chef des Juifs Nadirites qui ont t expulss de Mdine et s taient installs Khaybar (170 km de Mdine). La jeune femme Safiyya tait l pouse de Kinana Ibn ar-Rabi , le chef de Khaybar. Aprs la dfaite des Juifs dans la guerre de Khaybar le Prophte pousa Safiyya. Il apparat dans ces versets qu on aurait conseill cette jeune femme juive d oublier son peuple et de se soumettre au Prophte ; en effet, c est ce qui est arriv ; Safiyya a embrass l Islam et est devenu ainsi la mre des croyants comme les autres pouses du Prophte (voir le Coran, 33 : 6).
10. Et, avec des prsents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur . Le Prophte Mohammad a reu des prsents, comme nous l avons vu plus haut, de plusieurs rois. Par contre Jsus n en a jamais reu.
11. Tes fils prendront la place de tes pres ..
Les descendants du Prophte sont tablis Califes et rois dans divers pays du monde musulman ( en Arabie, au Ymen, en Jordanie, en Iraq, en Syrie, en Egypte, au Maroc, en Inde et en Iran). Les pres du Prophte, surtout hchim et abdul-Muttalib, ses grands-pres, taient des chefs de l oligarchie de la Mecque, et taient vnrs par tous les Arabes. Quant Jsus on sait qu il n a pas eu d enfant.
12. Aussi les peuples te clbreront ternellement et perptuit. .
Cette ralit est incontestable parce que premirement, en appelant la prire, le muezzin, clbre le nom du Prophte cinq fois par jour dans les diverses contres du monde ; et deuximement, les savants, les historiens et les autres crivains reconnaissent les qualits du Prophte et le placent la tte des grands hommes de l histoire humaine.
b) Dans le Psaume 72 : 1-17, il est crit : 1. O Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. 2. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux selon le droit. 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l effet de ta justice.
4. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les fils du pauvre et il crasera l oppresseur. 5. On te craindra, tant que subsistera le soleil, tant que paratra la lune, de gnration en gnration. 6.Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauch, comme des ondes qui arrosent la campagne. 7. En ses jours, le juste fleurira, et la paix abondera jusqu ce qu il n y ait plus de lune. 8. Il dominera d une mer l autre ; et du fleuve aux extrmits de la terre. 9. devant lui, les habitant du dsert flchiront le genou, et ses ennemis lcheront la poussire. 10. Les rois de Tharsis et des les paieront des tributs (ou apporteront des offrandes), les rois de Saba et de Sba offriront des prsents. 11. Tous les rois se prosterneront devant lui ( lui obiront), toutes les nations le serviront. 12. Car il dlivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n a point d aide. 13. Il aura piti du faible et du pauvre, il sauvera la vie des pauvres ; 14. Il les affranchira de l oppression et de la violence, et leur sang aura du prix ses yeux. 15. Ils vivront, et lui donneront de l or de Saba ; ils prieront pour lui sans cesse, ils le bniront chaque jour. 16. Les bls abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs pis s agiteront comme les arbres du Liban. les hommes fleuriront en ville comme l herbe de la terre. 17. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perptuera. Par lui on se bnira mutuellement, toutes les nations le diront heureux.
Ces caractristiques et les diffrentes uvres que cette personne accomplira se rapportent parfaitement au Prophte Mohammad ; son jugement avec la justice, sa misricorde pour les pauvres et les opprims et son combat contre les oppresseurs sont des faits historiques reconnus mme par ses ennemis. Il a affranchi les esclaves, aid les pauvres, cras l oppresseur, tabli la paix et il a reu des prsents de diffrentes contres. Le texte en effet nomme quelques unes comme Tarsis (selon les exgtes de la Bible Tarsis est la Tunisie) Saba ( c est le Ymen) et Sba ( l Ethiopie selon des exgtes). Dans le texte, par ailleurs, il y a une allusion aux habitants du dsert qui flchiront devant cette personne. Dans les textes hbreux, quand on voque le dsert, on se rapporte toujours au dsert de l Arabie qui commence au cours moyen du Jourdain et s enfonce dans le dsert mridional. Ce fait signal dans le texte est une ralit incontestable que connat n importe quelle personne qui possde le minimum d une connaissance historique. Aussi, dans le texte, y a-t-il une allusion la prosprit que connaitra le monde musulman aprs la restauration de l Etat islamique, qui est une ralit fulgurante. Nous ne nous attardons pas sur d autres allusions dans ce texte, car on a dj vu leurs semblables dans le texte prcdent.
Le Serviteur lu
Dans Esae, 42 : 1-8, il est crit:
1- Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon lu, en qui mon me prend plaisir. J'ai mis mon Esprit sur lui ; il annoncera la justice aux nations.
2. Il ne criera pas, il n'lvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues.
3. Il ne brisera pas le roseau broy et il n'teindra pas la mche qui brle encore ; il annoncera la justice selon la vrit.
4. Il ne faiblira pas ni ne s'esquivera, jusqu' ce qu'il ait tabli la justice sur la terre, et que les les esprent en sa loi.
5. Ainsi parle Dieu, l'ternel, qui a cr les cieux et qui les dploie, qui tend la terre et ses productions, qui donnent la respiration ceux qui la peuplent et le souffle ceux qui la parcourent.
6. Moi, l'ternel, je t'ai appel pour la justice et je te prends par la main, je te protge et je t'tablis pour faire alliance avec le peuple, pour tre la lumire des nations.
7. pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des tnbres.
8. Je suis l'ternel, c'est l mon nom ; et ne donnerai pas ma gloire un autre ni mon honneur aux idoles. .
Ce serviteur ne saurait tre Jsus car selon les Chrtiens le Christ est un Dieu ; or celui qui est un Dieu ne sera pas un serviteur ; mais au contraire les hommes seront ses serviteurs. Nous allons voir en dtail les caractristiques de ce serviteur :
1. C'est un lu de Dieu ; nous signalons ici que le Prophte Mohammad est appel l'lu (al-Mustaph et al-Mukhtr; qui ont le mme sens).
2. Il recevra l Esprit ; c'est--dire il aura une rvlation divine. Il a en effet reu le Coran par l'intermdiaire de Gabriel.
3. Il rvlera le droit et la justice aux nations
Cela s est accompli avec le temps ; l histoire en tmoigne.
4. Dans les versets 2 et 3, on dcrit ses caractristiques morales. 5. Il ne faiblira pas et que les les esprent en sa loi. A la fin de sa mission, le Prophte Mohammad avait unifi toute la pninsule arabique sous la bannire de l Islam ; et par le truchement de ses disciples, une grande partie de la terre a accueilli cette religion.
Par contre, Jsus, selon les Chrtiens, fut tu et n a pas tabli la justice sur la terre avant sa mort.
D autre part, les les attendent la loi de ce Serviteur ; vrai dire le Prophte de l Islam a instaur toute une lgislation qui a enrichi la lgislation mondiale. Cette loi fut applique dans tous les territoires du monde musulman durant 13 sicles.
Mais Jsus, selon les Chrtiens, n a pas de loi. Il a apport la foi la place de la loi de Mose. Tandis que Mohammad a apport les deux ; la foi et la loi.
6. Moi, l'ternel, je t'ai appel pour la justice ni mon honneur aux idoles. vv.6-8.
Il ne s agit pas dans ces versets de l alliance avec le peuple juif car il aurait t dit : une alliance nouvelle avec le peuple, puisqu il y avait dj eu une ancienne. Mais il est dit simplement une alliance ; ce qui montre que cette alliance-l (avec le peuple) n est pas prcde d une autre. D autre part, le verset 6 souligne que ce serviteur sera protg par Dieu, tabli par lui ; or d aprs les Evangiles Jsus fut tu, ce qui contredit la promesse de ce verset. Par contre le Coran a promis que le Prophte Mohammad sera protg de ses ennemis ; la promesse fut remplie, ce qui est en concordance avec cette promesse biblique en faveur du serviteur de Dieu.
7. Le verset 7 qui parle de l uvre de ce serviteur concorde avec la mission du Prophte Mohammad, notamment parmi les Arabes adorateurs d idoles, qui vivaient dans les tnbres de l ignorance et de l incrdulit.
Les versets qui suivront (du 10 au 17), que nous tudierons ensuite, dmontrent que le serviteur dont il est question dans les versets prcits ne saurait tre Jsus ; parce que dans ce passage que nous verrons on parle du peuple de ce serviteur ; les Ismalites.
Le Prophte des Manuscrits de la Mer Morte
Dans les manuscrits de la Mer Morte (de la grotte de Qumrn) il est crit dans le Manuel de Discipline : Seuls les fils d'Aaron dcideront des questions de droit et de biens et leurs ordres fixeront le sort qui dterminera les rgles des hommes de la communaut. Quant aux biens des hommes saints dont la conduite est parfaite, qu'on ne les mle point aux biens des hommes de fraude qui n'ont pas purifi leur conduite en se sparant de l'erreur et en agissant sans commettre de faute. Et qu'eux-mmes ne s'loignent d'aucun conseil de la loi pour marcher dans l'obstination de leur c ur ; mais qu'ils jugent d'aprs les premiers prceptes par lesquels les hommes de la communaut ont t d'abord disciplins jusqu' ce que viennent un prophte et les messies d'Aaron et d'Isral. (Les Manuscrits de la Mer Morte, p. 345).
Les sectaires de Qumrn[16] attendaient donc deux messies, et ils attendaient aussi un prophte.
Le Manuel de Discipline prescrit que les fils d Aaron gouverneront la communaut selon les premiers commandements jusqu la venue d un prophte et des messies d Aaron et d Isral . L expression les premiers commandements (ou prceptes) suggre un ensemble inaltrable de rgles, peut-tre les lois de Mose elles-mmes, qui devront servir de constitution au gouvernement de la communaut jusqu la fin des temps. Les versets du Manuel de Discipline, suggrent, en effet, que la venue des messies d Aaron et d Isral et du Prophte auraient des consquences importantes ; des modifications auront lieu, des lois nouvelles s imposeront, d autres anciennes seront abroges ou abolies etc. Quant au terme messie cit dans ces documents et dans les Ecritures saintes, en gnral, c est une forme occidentalise du mot hbreu qui signifie oint . Il est gnralement appliqu au roi qui est l oint du seigneur et c est de cet usage que vient l emploi du terme Messie pour dsigner le futur, promis par les prophtes. Pourtant, dans d autres passages, le mot oint ou Messie est videmment employ pour dsigner celui qui viendra la fin des temps. Ce terme, peut dsigner plusieurs personnages mais il s applique plus troitement un Messie plus grand que les autres. Cependant, le Manuel de Discipline parle, non d un, mais de deux Messies venir. On peut prsenter, crit Millar Burrows, que les deux Messies reprsentent le roi et le grand prtre de l avenir. Dans ce cas il parait trange que le Messie royal doive tre issu d Isral et non de Juda ; il se peut cependant qu Isral soit employ dans un sens gnral pour dsigner le peuple entier et que le Messie d Isral soit, si l on peut dire, le Messie laque, tandis que le Messie d Aaron serait le Messie prtre. La conception d un Messie issu de la tribu Sacerdotale de Lvi apparat dans les testaments apocryphes des Douze Patriarches et dans la littrature rabbinique, parfois en combinaison bien singulire avec d autres ides. ( Les Manuscrits de la Mer Morte, p. 239). Mais pour notre part, nous pouvons prsumer que le Messie d Aaron signifie que ce dernier serait issu d Aaron et que le Messie d Isral signifie que ce Messie serait considr comme le reprsentant d Isral, tout entier, en parallle un autre personnage envoy une autre nation, qui est le Prophte voqu dans ce texte. En d autres termes, ce Messie serait le grand Messie d Isral par rapport un autre Messie d une autre nation dsign par le terme
Prophte [17]. Pourrions-nous par ces suggestions considrer que Jean-Baptiste est le Messie d Aaron, car il en est le descendant, et que Jsus est le Messie d Isral ? Ce qui prouve que Jean-Baptiste est un descendant d Aaron est le texte suivant de l Evangile de Luc (1 : 5) : Du temps d Hrode, roi de Jude, il y avait un sacrificateur, nomm Zacharie, de la classe d Abia ; sa femme tait d entre les filles d Aaron, et s appelait Elisabeth. . Il est signaler qu Aaron fut le premier souverain sacrificateur, et que ses descendants hritrent le sacerdoce[18] ; ce qui signifie que Zacharie, pre de Jean-Baptiste, qui tait un sacrificateur, est un descendant d Aaron. Et ce qui appuie que Jsus fut le Messie de tout le peuple isralite est le texte suivant : Je n ai t envoy qu aux brebis perdues de la maison d Isral. . Matthieu, 15 : 24. Quant au troisime personnage il est appel Prophte pour faire valoir la grandeur de sa mission et de sa personnalit et pour le mettre en parallle avec les deux Messies d Aaron et d Isral. Nous signalons quand mme que la venue de ces trois personnages n est pas prcise dans le temps ; mais que leurs apparitions se succderont et ne seront interrompues par la venue d aucun prophte. A ce propos il n y a pas eu de prophte ou messie entre Jean-Baptiste, Jsus et Mohammad.
Dans le Manuel de Discipline il y a aussi un texte auquel nous donnons l interprtation qui nous semble plus admissible : Quand ces choses arriveront la communaut d Isral, ces rgles les spareront de l assemble des hommes de l erreur et ils iront dans le dsert prparer la voie du Seigneur, comme il est crit : Dans le dsert, prparez la voie du Seigneur, dans la steppe aplanissez un chemin pour Dieu. p. 344. Selon ce document, les sectaires de Qumran devaient aller s installer dans le dsert pour prparer le chemin du Seigneur. De quel dsert s agit-il ? Il est peu probable qu il s agisse du dsert o se trouvaient les Sectaires de Qumran ; tout simplement parce qu ils y habitaient et qu ils devaient le quitter pour s installer dans le Dsert afin de prparer le chemin du Seigneur. Ceci signifie que c est un autre dsert. Il nous semble trs plausible de voir dans cette prophtie une allusion aux Juifs qui s taient installs dans le dsert d Arabie, surtout Mdine qui sera l asile du Prophte attendu. En effet, comme en tmoigne l histoire, les Juifs de l poque du Prophte Mohammad avaient contribu prparer les Arabes paens de Mdine se convertir l Islam parce qu ils leur parlaient sans cesse d un prophte qui allait bientt apparatre et qu ils allaient suivre. (voir la biographie du Prophte, Ibn Hichm, 1 : 195-197). D'autre part, un certain nombre de rabbins s'taient convertis l'Islam. Ils avaient reconnu en Mohammad le Prophte dont parle l'criture.
En outre, il est signaler que les Juifs de Mdine surtout les Ban-n-Nadir et les Ban Quraza sont des fils d'Aaron ; ils jouissaient d'un grand prestige parmi leur peuple.
Il est raisonnable de voir dans ces deux tribus et dans les autres, les descendants des Sectaires de Qumrn
auxquels il a t demand de partir vers le dsert pour prparer le chemin du Seigneur (voir Ibn Hichm, 1 : 18 o il y a la gnalogie des Nadirites et des Qurazites). Par ailleurs, il est inadmissible de croire que ces sectaires iraient au dsert pour prparer la voie Jsus ; car au lieu d aller au dsert ils auraient d aller en Palestine, surtout Jrusalem pour prparer les gens sa mission. Dans le Psaume final du Manuel de Discipline, il y a la triple fonction du serviteur de Dieu : Tmoignage prophtique, rparation sacerdotale et jugement royal. Ces trois fonctions reoivent une explication ou du moins s approchent des caractristiques donnes par Jsus au Paraclet promis : Et quand il sera venu, il convaincra le monde de pch, de justice et de jugement. Jean, 16 : 8. Nous nous contentons pour l instant de mettre ces trois fonctions en parallle avec ces quelques versets coraniques concernant le Prophte Mohammad : 1. Tmoignage prophtique : Nous avons fait de vous une Communaut loigne des extrmes pour que vous soyez tmoins contre les hommes, et que le Prophte soit tmoin contre vous. (2 : 143 et voir 22 : 78). 2. Rparation Sacerdotale : Voici ce que disait Dieu Mose et ses compagnons, qui taient 70 personnes, aprs qu ils sollicitaient le pardon et la misricorde divines envers le peuple isralite aprs leur culte de Veau : Le Seigneur dit : Mon chtiment atteindra qui je veux ; Ma misricorde s tend toute chose ; Je l inscris pour ceux qui me craignent pour ceux qui croient en nos signes, pour ceux qui suivent l envoy : le Prophte gentil (ou illettr) que ces gens-l trouvent mentionn chez eux dans la Torah et l Evangile. Il leur ordonne ce qui est convenable ; il leur interdit ce qui est blmable ; il dclare licite, pour eux, les choses excellentes, il dclare illicite, pour eux, ce qui est dtestable ; il te les liens et les carcans qui pesaient sur eux (c'est--dire sur les Juifs), 7 : 156-57. 3. Jugement royal :
Dis il m a t ordonn d tre quitable entre vous. 42 : 15. juge entre ces gens d aprs ce que Dieu a rvl. 5 : 48. Lorsque Dieu et son Prophte ont pris une dcision, il ne convient ni un croyant, ni une croyante de maintenir son choix sur cette affaire. 33 : 36.
Dans le Psaume final du Manuel de Discipline il y a un texte nigmatique. Il a suggr aux exgtes plusieurs interprtations : A la venue des saisons aux jours de la nouvelle lune pendant leurs cours et de passage de l un l autre. Lorsqu elles se renouvellent, l M est grand pour le saint des saints, et la lettre N est la cl de son amour ternel et inbranlable. p. 347.
Ces quelques lignes[19] contiennent trois lettres mystrieuses dans lesquelles Brownlee discerne un acrostiche des trois consonnes du mot hbreu Amen ( / M N), l aleph (/ ) est attach au manuscrit la fin du verbe dcrta ( si c est un verbe) ; cependant Brownlee prend cette lettre comme tant la consonne initiale du mot hbreu signifiant Dieu, / Elohim, quoi qu il mentionne d autres explications possibles. La lettre M apparat dans la phrase obscure la lettre M est grande , le N dans la phrase est non moins mystrieux : la lettre N est la clef de ses misricordes ternelles . Faisant observer que la forme de la lettre N dans ce manuscrit ressemble celle d une clef ancienne, Brownlee distingue dans ce passage une rfrence probable au Messie qui, avec la clef de David , rvlera les grces certaines . Dupont-Sommer rejette l interprtation de Brownlee et demande ce qu une rfrence au Messie viendrait faire au milieu d une numration de temps consacrs. Pour lui, l aleph dans l acrostiche de Brownlee est une forme aramenne de la terminaison fminine d un substantif qui signifie dcret . Pour la lettre N , Dupont-Sommer offre une explication originale et tentante qui lui est particulire. Les lettres de l alphabet hbreu comme celles de l alphabet grec servaient reprsenter les nombres, et la lettre N reprsentait le nombre 50. Dans ce passage du Manuel de Discipline, Dupont-Sommer rattache la lettre N aux mots qui la prcdent, le Saint des saints , et il lit : Le Saint des saints et la lettre N . L expression Le Saint des saints et la lettre N signifie par consquent le caractre suprmement sacr du nombre 50 . Brownlee construit le saint des saint avec les mots prcdents et suppose qu un nouveau membre de phrase commence avec les mots et la lettre N . Pour l expression la clef de ses misricordes ternelles , Dupont-Sommer trouve encore une explication dans le fait que le nombre 50 est l expression parfaite du triangle rectangle, symbole de suprme principe qui a produit le monde . Peut-tre y a-t-il quelque vrit dans les ides de Brownlee et de Dupont-Sommer concernant ce passage. Barthlemy fait remarquer que les trois lettres dans l acrostiche de Brownlee ont une valeur numrique de 91 ( 1+ 40 + 50). Quant nous, les deux interprtations, celle de Brownlee et celle de Dupont-Sommer, nous semblent, toutes les deux , plausibles. Notre point de vue va dans le mme sens que les deux prcdentes interprtations et appuie nos prcdentes explications. Les smitiques en gnral et les Juifs en particulier avaient l habitude de donner aux lettres des valeurs numriques. Ils profitent de cet usage frquent pour cacher une certaine croyance ou un certain mystre. Parmi ces mystres cachs il y a celui concernant le dernier prophte. Selon ce point de vue nous donnons les valeurs numriques de ces lettres : Aleph = 1 ; N = 50 ; M = 40. Le total est 91 .
Suivant le raisonnement de Brownlee nous donnons une explication corroborant notre point de vue et rsolvant, peut-tre, ce problme de controverse entre les spcialistes des Ecritures saintes. Nous disons comme Brownlee que la lettre aleph est l initiale d un nom. Ce nom est celui du Prophte Mohammad qui a un autre nom initi par l aleph ; c est : Ahmad ( voir le Coran, 61 : 6). Ce nom a presque le mme sens que Mohammad. Ou bien, l aleph est l initiale du mot Amine , qui signifie en arabe comme en hbreu : fidle, vridique . Ce nom est un surnom du Prophte Mohammad que les arabes paens de la Mecque , compatriotes du Prophte, lui donnaient avant mme qu il ret la rvlation de Dieu, vu ses vertus et son irrprochable conduite tellement apprcies par ses contemporains. Quant la lettre M , elle est l initiale du nom connu du Prophte qui est Mohammad .
La lettre N , qui est la clef des misricordes ternelles, comme dit le Manuel, est l initiale du mot Nabi qui signifie en hbreu : prophte ( pluriel : Nebiim). En effet la prophtie est la clef des misricordes divines et ternelles. Les phrases qui rsultent de cette analyse sont donc les suivantes : * Ou bien : Ahmad, appel aussi Mohammad, est le Nabi (le prophte) attendu. * Ou bien : l Amine (le Fidle) Mohammad est le Nabi attendu. Donc si aleph est la lettre initiale de Ahmad on aura : Ahmad >>> Mohammad >>> Nabi >>> Total = aleph = 01. M N = 40. = 50. 91.
Si elle est l initiale de Amine on aura le mme rsultat. Dans les deux cas ce total est gal la somme des trois lettres prcites.
Et si aleph est l initiale des deux noms ( Ahmad et Amine ) on aura au total 92. Dans ce dernier cas le nombre 92 est gal au total des valeurs numriques des lettres constituant le nom Mohammad . Son nom en arabe s crit : ; il comprend quatre lettres : (M) = 40 (H) = 08 (M) = 40 (D) = 04 Total 92 Sachant que les voyelles ne sont pas comptes dans ce genre de calcul. Ainsi nous rejoignons la mthode explicative de ce mystre avance par Dupont-Sommer. Et il en rsulte, donc, que ces lettres, selon les deux possibilits, s appliquent au Prophte Mohammad.
II.- La Nation et la Religion
L'Alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance
Dans la Gense, 17: 1-14, 20, il est crit :
Lorsqu' Abraham fut g de 99 ans, l'ternel lui dit : je suis le Dieu Tout Puissant... j'tablirai mon alliance avec toi et ta descendance aprs toi, dans toutes leurs gnrations : ce sera une alliance perptuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendances aprs toi. Je te donnerai, et tes descendants aprs toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer tous le pays de Canaan, en possession perptuelle, et je serai leur Dieu.
Dieu dit Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants aprs toi, dans toutes leurs gnrations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance aprs toi : tout mle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance, entre vous et moi... un mle incirconcis... sera retranch du milieu de son peuple : il aura rompu mon alliance .
A l'gard d'Ismal, je t'ai entendu : je le bnirai, je le rendrai fcond et je le multiplierai l'extrme ; il engendra douze princes, et je ferai de lui une grande nation. (et voir Gense, 21 : 18).
Ces versets montrent clairement que l'alliance a t tablie avec Abraham et avec sa descendance. Cette alliance a t marque par le signe de la circoncision. Obissant l'ordre divin, Abraham appliqua la circoncision tous ses mles, le premier tant Ismal. D'autre part, Dieu fait deux promesses Abraham : lui donner et sa descendance le pays de Canaan, et de bnir Ismal. Donc il y a en somme trois dispositions : alliance avec Abraham et tous ses descendants, promesse d'installer sa descendance Canaan perptuellement et enfin la bndiction d'Ismal. Il va de soi que le pays de Canaan, c'est--dire la Palestine, tait occup par les Isralites un certain temps ; mais la suite de leur iniquit ils en furent dpossds au profit des Arabes, descendants d Ismal ; que Dieu a promis de bnir et de faire hriter du pays de Canaan. Donc les versets suivants ( 21-22) qui prtendent que l alliance concerne seulement Isaac sont en contradiction ; d une part, avec les premiers versets qui montrent que l alliance a t tablie avec toute la descendance d Abraham et que le signe de cette alliance est la circoncision, qu Ismal a subie le premier. D autre part avec la promesse d hriter de Canaan perptuellement. Cependant, en reconnaissant que l alliance concerne deux descendants d Abraham (Isaac et Ismal), la contradiction avec les faits historiques et avec les autres versets de ce passage disparat. D autre part, examinons un autre texte de la Gense. Il parle du sacrifice de l enfant d Abraham. On s aperoit que celui qui a t offert comme holocauste n tait pas Isaac mais Ismal. Pour illustrer cette ralit cache et altre, nous reproduisons le texte de la Gense tout en lui donnant la vritable interprtation qui a t travestie : Dieu dit : Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac... 22 : 2.
Ce texte nous montre que Dieu a ordonn Abraham de prendre son fils unique ; or Isaac n'tait pas le fils unique parce qu'Ismal naquit avant lui. Il tait l'an et il fut circoncis avant la naissance mme d'Isaac (voir Gense, 17 : 23). Donc le fils unique c'est Ismal et non Isaac ; par consquent le nom Isaac figurant dans ce verset a t ajout pour faire croire que l'alliance tait seulement avec Isaac et sa postrit.
Quelle est la Nation insense ? Dans le Deutronome, 32: 21, il est crit :
Ils ont excit ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont irrit par leurs vaines idoles ; et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peule, je les irriterai par une nation insense. .
La nation insense dont il est question dans ce verset est la nation arabe. Car les Arabes, avant la venue du Prophte Mohammad, taient dans un obscurantisme, notamment en matire de religion, et dans un garement tels qu'on qualifie l'poque pr-Islamique par la Jhilliyya . C'est--dire toute conduite draisonnable, absurde et extravagante ; toute insoumission l'ordre et aux pouvoirs ; toute ngligence de la science religieuse et profane. En Arabie, aussi bien au dbut du VIIe sicle que dans les sicles antrieurs, la multiplicit des croyances religieuses des tribus nomades et sdentaires, rendait prcaire tout quilibre entre elles. Parmi les religions autochtones, les diverses formes de polythisme prolifraient, avec des esprits ou des dieux invisibles, comme les Djinns du dsert, des divinits forme animale ou humaine. Des idoles de pierre ou des sites sacrs, constituaient des lieux de plerinage. Se superposant ce polythisme, s exprimait pourtant une aspiration assez gnrale un dieu sinon unique du moins suprieur aux autres ; au Hijaz, les trois desses principales taient tenues pour filles d un mme dieu : Allah. (Roger Garaudy, Promesses de l Islam, le Seuil, Paris, 1981, p.27). Cinq sixime de la population taient des Bdouins nomades, des bergers qui se dplaaient d un pturage un autre avec leurs troupeaux selon la saison et les pluies d hiver. Sur le plan humain et moral il y avait l adultre, le meurtre etc. Dans quelques tribus arabes le pre, s il le dsirait, enterrait sa fille ds sa naissance ; dans le meilleur cas il dplorait sa naissance et cachait son visage ses compagnons (voir le Coran, 16 : 58-59, dcrivant ces attitudes). L Arabe pr-Islamique tait gnralement illettr. Il n y avait ni savants ni historiens, mais les Arabes possdaient une enivrante passion pour l loquence, le langage beau et correct et les vers biens cisels. Ces Arabes, adorateurs d idoles mpriss par les isralites parce qu ils sont les descendants d Agar, la servante de Sara dont le petit fils est Isral (Jacob) vont tre favoriss par Dieu : lorsqu il leur a envoy un prophte pris parmi eux qui leur rcite ses versets, qui les purifie, qui leur enseigne le Livre et la sagesse, mme s ils avaient t auparavant dans une erreur manifeste. (Coran, 3 : 164). Dans cette pninsule au trois quarts dsertiques, peupl de tribus nomades dont la richesse est insignifiante face aux richesses des deux empires de l poque (Byzantin et Perse), apparat la religion qui changera et bouleversera le monde. Personne alors n aurait pens qu en moins d un sicle ces nomades conqurraient le monde, de l Espagne la Chine.
Ainsi, le milieu du VIIe prsente, en Asie et en Afrique un changement de dcor aussi soudain que dconcertant ; deux grands empires rivaux, Byzance et la Perse, s effondrent et sont remplacs par une domination inconnue la veille. C est donc un des phnomnes les plus importants de l histoire universelle ! ( Histoire universelle des origines l Islam, sous la direction de R. Grousset et G. Lonard. 1956, Gallimard, p. 63). C est alors que les sciences, les arts, le droit, l conomie, la morale et d autres domaines de la vie, vont connatre sous le rgne des Arabes musulmans un progrs fulgurant. Dans le verset du Deutronome cit plus haut, les Juifs ont accouru la colre divine parce qu ils avaient ador des dieux autres que lui ; en revanche Dieu excita leur jalousie par l lection d un peuple insens et sujet de leur mpris. Dieu a accompli sa promesse en choisissant le Prophte Mohammad parmi les Arabes. Des exgtes prtendirent que la nation insense est le peuple grec. Cette interprtation ne saurait tre acceptable parce que la Grce tait l une des nations les plus civilises du monde. En matire de religion ils avaient sous la main la traduction de l Ancien Testament, trois sicles avant J.C. Comment donc peut-on rapporter cette prophtie cette nation ou une autre semblable en ngligeant la nation arabe, laquelle possdait les caractristiques d un peuple insens qui allait tre guid vers l intelligence, la connaissance et la gloire ? D'autre part, comme nous l'avons vu, Dieu a promis Abraham de bnir Ismal ; or la ralisation de cette bndiction n'tait-ce pas celle produite grce la prdication du Prophte Mohammad ?
Le Cantique Nouveau c'est I'Islam
Dans Esaie, 42 : 10-17, il est crit :
10. Chantez l Eternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrmits de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, les et habitants des les ! 11. Que le dsert et ses villes lvent la voix ! Que les villages occups par Qdar lvent la voix ! Que les habitants de Sla clatent en acclamations ! Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie ! 12. Qu on rende gloire l Eternel et que dans les les on publie ses louanges ! 13. L Eternel sort comme un hros, il excite son zle comme un homme de guerre ; il lance la clameur, il jette des cris, il triomphe de ses ennemis. 14. J ai longtemps gard le silence, je me tais, je me contiens ; je gmis comme une femme en travail, je suis haletant et je souffre tout la fois. 15. Je dvasterai montagnes et collines et j en desscherai toute la verdure ; je changerai les fleuves en terre ferme et je desscherai les tangs. 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu ils ignoraient ; je changerai devant eux les tnbres en lumire et les endroits tortueux en terrain plat ; voil ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. 17. Ils reculeront, ils seront confondus de honte, ceux qui se confient aux idoles tailles, ceux qui disent au mtal fondu : vous tes nos dieux. .
De ces versets on dduit qu il se produira un changement trs important. Ce changement est dsign par le Cantique nouveau . Ce phnomne nouveau se rpandra partout jusqu aux extrmits de la terre. Plus spcialement, les habitants du dsert, et les villages o habite Qdar bnficieront plus que les autres de ce nouveau message ; tout simplement parce qu ils sont mentionns, particulirement, dans ces versets. Le paragraphe qui commence par L Eternel sort comme un hro est une allusion aux guerres contre les ennemis de Dieu ; ces ennemis sont des adorateurs d idoles comme il est expliqu dans le dernier verset de ce passage. Ce peuple qui sera l instrument de ce changement est un peuple aveugle (ignorant.) Toutes ces caractristiques s appliquent au peuple arabe. Le Cantique nouveau c est la nouvelle religion de l Islam. Le dsert c est l Arabie. Qdar est un fils d Ismal, anctre des Arabes et du Prophte Mohammad. Un exgte du livre d Esaie au Ve sicle ap. J.C. (c'est--dire avant l islam) a crit expliquant ce verset : Il appelle Kdar les descendants des Ismalites . (Thodoret de Cyr, II, 441 ; commentaire sur Isae, Introd. Traduction, note de Jean-Nol Guinot, les ditions du cerf, Paris 1982). Un texte de la Gense, 25 : 12-16 et un autre du livre d Ezchiel, 27 : 21 montrent que Qdar est un fils d Ismal et que ce nom dsigne les Arabes. Le nom Sla (v. 11) est identifi par Thodoret Ptra, la capitale de l Idume, au nord de l Arabie ; il se peut cependant que Sla dsigne la montagne Sla de Mdine (la ville du Prophte Mohammad). A vrai dire, ce passage parle des Arabes ; pour confirmer cette interprtation nous reproduisons ce texte du commentaire prcit de Thodoret, qui date du Ve sicle ap. J.C. : Par ces mots galement le texte prophtique a montr que la connaissance de Dieu s est rpandue sur toute la terre. Or nous voyons, nous aussi, l accomplissement de la prdiction, car, outre le monde habit, ce sont aussi les lieux sans habitations et toutes les les qui ont joui des flots de la vrit. Quant moi (Thodoret), je voudrais apprendre d un Juif, quelle espce de joie le texte prophtique annonce aux Ismalites et aux Idumens et comment les les chantent dans des hymnes le Dieu de l univers . (pp. 441-43). Quant nous, nous dclarons que l Arabie a toujours t le lieu du polythisme, et que le Christianisme n en a jamais supplant l idoltrie. Par contre lorsque le Prophte Mohammad est venu, avec le Cantique nouveau , il a tout chang et a renvers toutes les mauvaises coutumes et toutes les religions autochtones, pour instaurer la vraie religion de Dieu. Et depuis l poque du Prophte jusqu nos jours, jamais le culte des idoles n a pu resurgir en Arabie. En outre, le Christianisme, l exception de quelques lieux et pendant un certain temps, n a jamais pu s y installer. Ce qui montre que le Cantique nouveau qui changera la vie des Ismalites c est l Islam et non pas le Christianisme. Le paragraphe qui dcrit la joie et qui invite les Arabes lever la voix partout, surtout du sommet des montagnes, est une allusion l appel la prire par le muezzin et au culte spcial du plerinage la Mecque pendant lequel les plerins lvent la voix en proclamant la gloire divine. Le verset 15 fait allusion aux guerres menes par le Prophte, et ses disciples aprs lui, contre l idoltrie et l injustice dans leurs diverses formes. Les versets 16 et 17 dcrivent le changement radical qui aura pour consquence : la destruction des sanctuaires des idoles et la conduite du peuple insens et ignorant sur le chemin de la vrit et de la lumire. C est galement une
allusion au fait que les Musulmans domineront facilement le monde.
Mohammad est le Prophte de Parn
Dans le Deutronome, 33 : 1-3, il est crit :
1. Voici la bndiction par laquelle Mose, homme de Dieu, bnit les enfants d Isral, avant sa mort.
2. Il dit : L Eternel est venu du Sina, il s est lev sur eux de Sir, il a resplendi de la montagne de Parn, et il est sorti du milieu des saintes myriades : il leur a de sa droite envoy le feu de la loi.
3. Oui, il aime les peuples ; tous ses saints dans ta main. Ils se sont tenus tes pieds, ils ont reu tes paroles. .
Les expressions : l Eternel est venu, s est lev, a resplendi , sont une manire d illustrer la grce divine en rvlant aux hommes Ses paroles et Sa loi.
Dans le deuxime verset, trois lieux sont voqus o la rvlation divine fut confie un prophte.
Le nom Sina est une allusion la rvlation de la Thora Mose ; le mont Sir dsigne la montagne de Sir prs de Jrusalem (voir Josu, 15 : 8-10) ; c est une allusion aux rvlations postrieures Mose surtout celle de Jsus. Mais le terme Parn renferme une allusion manifeste la rvlation du Coran ; car Parn est en Arabie. Ismal habitait dans le dsert de Parn, c'est--dire en Arabie d o est venue la rvlation islamique (voir Gense 21 : 21 o il est dit qu Ismal habitait le dsert de Parn).
En effet, le verset 2 montre que cette troisime rvlation a d importantes consquences. Elles se manifestent dans la multitude des saints qui suivront le Prophte de cette rvlation. Ils recevront aussi la loi comme les Isralites. En outre le verset 3 montre qu il s agit d un homme qui aime les peuples, ce qui implique qu il leur rvle la parole divine, et dont les saints sont dans la main de Dieu, ils recevront, eux aussi, la parole de Dieu comme les Isralites.
Un verset dans le livre de Habaquq confirme cette interprtation (3 : 2-3) :
2. Eternel, j ai entendu ce que tu as annonc, j ai de la crainte, Eternel, devant ton uvre, accomplis-la dans le cours des annes ! Dans le cours des annes, fais-la connatre ! Mais dans ta colre, souviens de ta compassion. 3. Dieu vient de Tmn, le Saint vient de la montagne de Parn.
Tmn est en Arabie et Parn aussi. Tout ceci montre que la prophtie du Deutronome, et celle-ci, font allusion la rvlation du Coran.
Le dsert fcond
Dans Esaie, 32 : 9-17, il est crit :
9. Femmes trop tranquilles, levez-vous, coutez ma voix ! Filles sres de vous, prtez l oreille ma parole !
10. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, femmes sres de vous ; car c en est fait de la vendange, la rcolte n arrivera pas.
11. soyez dans l effroi, insouciantes ! Tremblez, femmes sres de vous ! Dshabillez-vous, mette-vous nu et mettez une ceinture vos reins !
12. En se frappant les seins, on mne le deuil sur la beaut des champs et la fcondit des vignes.
13. Sur la terre de mon peuple croissent les pines et les ronces, mme dans toutes les maisons heureuses de la cit qui s amuse.
14. Le palais est abandonn, la ville bruyante est dlaisse ; la colline et la tour serviront jamais de cavernes pour le bonheur des nes sauvages et la pture des troupeaux,
15. Jusqu ce que l Esprit soit rpandu d en haut sur nous, que le dsert se change en verger, et que le verger soit considr comme une fort.
16. Alors le droit demeurera dans le dsert et la justice habitera dans le verger,
17. l
uvre de la justice sera la paix, et l ouvrage de la justice la scurit et la confiance pour toujours.
Et dans le chapitre 35 (du mme livre) il est crit :
1. Le dsert et le pays aride s gayeront ; la steppe tressaillera d allgresse et fleurira comme un narcisse ;
2. Elle se couvrira de fleurs, et tressaillera de joie, avec chants d allgresse et cris de triomphe ; la gloire de Liban lui sera donne, la magnificence de Carmel et de Sron. Ils verront la gloire de l Eternel, la magnificence de notre Dieu.
3. Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent ;
4. dites ceux qui ont le c ur troubl : Prenez courage, ne craignait point ; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rtribution de Dieu ; il viendra lui-mme et vous sauvera.
5. Alors s ouvriront les yeux des aveugles, s ouvriront les oreilles des sourds ;
6. alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet clatera de joie. Car des eaux jailliront dans le dsert et des torrents dans la Araba.
7. Le mirage se changera en tang et la terre dessche en sources d eaux ; dans le repaire o se couchaient les chacals, il y aura un emplacement pour les roseaux et les joncs.
8. Il y aura l un chemin fray, une route qu on appellera la voie sainte ; nul impur n y passera ; elle sera pour eux seuls ; ceux qui la suivront, mme les insenss, ne pourront s garer ;
9. et l il n y aura pas de lion ; nulle bte froce ne la prendra, nulle ne s y rencontrera ; et l marcheront des affranchis,
10. ainsi ceux que l Eternel a librs retourneront, ils arriveront dans Sion avec chants de triomphe, et une joie ternelle couronnera leur tte ; l allgresse et la joie s approcheront, la douleur et les gmissements s enfuiront.
Dans le premier texte les termes : femmes, filles sont les cits. Cette interprtation est celle de Thodoret de Cyr (II,299) et J.N. Guinot ( le traducteur) souligne dans la note (p. 298-299) que les anciens exgtes (comme Chrysostome et Cyrille) comprenaient que c est une habitude dans l Ecriture d appeler femmes les cits qui jouent le rle de mtropoles et filles celles qui en dpendent ; il cite pour le prouver le verset 8 du Psaume 97 (Sion et les filles de Juda). Le prophte Esaie dans ces versets (du ch. 32) dcrit la situation triste des villes de Juda aprs le bonheur du pass. Cette situation est due la dvastation par les armes des peuples voisins comme les Assyriens et les Babyloniens.
Des bourgs et des maisons seront dlaisss ; Thodoret dans son commentaire du livre d Esaie souligne que ces bourgs jusqu aujourd hui (c'est--dire au Ve sicle ap. J.C.) sont rests dserts. Nous trouvons les noms de quelques uns dans l Ecriture, mais seules leurs traces sont vues par quelques hommes. (II, 301).
Cependant, cette situation sera change aprs que l Esprit sera rpandu sur les hommes et plus spcialement sur les hommes du dsert qui peut tre celui de l Arabie ; (en effet le chap. 35 que nous expliquerons plus tard, montre que le dsert voqu dans le chap. 32 est celui de l Arabie).
En effet, Thodoret, bien qu il ait interprt ce verset (v.15) mtaphoriquement, a soulign, toutefois, que le dsert, voqu ici, est relatif aux nations et non Juda ; il dit : A la suite de ce prsent, le dsert de Jadis c'est--dire les nations,- qui n avait pas bnfici de la charrue prophtique, bnficia de la fcondit du Carmel Il y avait jadis chez les Juifs floraison de prophtes, de justes et de prtres, tandis qu ils ont imit aujourd hui la strilit des forts. (II, 301). Mais en ralit le mot dsert, dans ce verset, a un sens propre et non pas un sens figur ; car le verset 16 montre que le droit demeurera dans le dsert ; ce qui signifie que c est une allusion un endroit prcis.
Par ailleurs, le chapitre 35 claircit ces ralits.
Le premier verset de ce chapitre est une allusion claire au dsert aride. A part le dsert d Arabie, il n existe pas un dsert d o apparut une religion.
D autre part, le verset 2 montre que le Liban sera donn ce dsert, ce qui est tout fait compatible la ralit historique ; le Liban est un territoire islamique depuis 14 sicles.
En outre, le verset 2 souligne que la renomme du Carmel et celle de Sron lui seront aussi donnes ; Carmel, c est la Jude (Palestine), car jadis elle tait remplie de fruits prophtiques ( Thodoret dans son commentaire signale que Carmel dsigne la Jude, II, 339).
Les versets 3 7 dcrivent les bienfaits de cette nouvelle prdication, surtout aux peuples non Juifs qui ne connaissaient rien en matire de religion monothiste.
Le verset 6 se rapporte intgralement l Arabie d o jaillira cette prdication. Pour dcrire sa fcondit on l a compare aux eaux et aux torrents qui jaillissent ; l eau est le symbole de la continuit de la vie et du fait qu elle dsaltre. Et l Arabie ne dsaltra-elle- pas le monde par son eau-de-vie ?
Le mot Araba , voqu dans ce verset, confirme cette interprtation ( dans le Glossaire de la Bible, version Segond, dition Paris 1978, voici la dfinition du nom Araba : La profonde dpression qui commence au cours moyen du Jourdain, se poursuit par la Mer Morte et s enfonce dans le dsert mridional. ).
Dans les versets suivants il y a une description de la scurit et la prosprit qui se rpandront dans ces lieux, notamment, en Arabie. En outre, dans ce territoire (celui de Mdine et de la Mecque) nul impur, c'est--dire nul impie, n y passera.
Dans le verset 9 on a soulign que les lions et les btes ne s empareront pas de ces lieux. Les lions et les btes sont les symboles des rois et des royaumes. Donc c est une allusion au fait que ces lieux ne seront jamais occups par les rois des autres nations et religions.
L histoire prouve cette ralit. Tous les pays musulmans ont t occups par les Europens l exception de l Arabie o se trouvent les lieux saints. Par contre la Palestine o se situe Jrusalem (Sion) fut occupe plus de deux mille ans.
Quant au verset 10, il fait allusion la domination des Musulmans sur la Palestine. Les Juifs convertis l Islam et les autres Musulmans avaient vcu la joie du triomphe, dcrit dans ce verset.
III.- La ville et le sanctuaire
La ville du Prophte attendu
Dans Esaie, 66 : 7-9 et 15-21, il est crit :
7. Avant d prouver les douleurs, elle a enfant ; avant que les souffrances lui viennent, elle a donn naissance un fils.
8. Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? un pays peut-il natre en un jour ? une nation est-elle enfante d un seul coup ? A peine en travail, Sion a enfant ses fils !
9. est-ce moi qui ouvrirais le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter ? Dit l Eternel ; Moi qui fait enfanter, empcherais-je de natre ? Dit ton Dieu. 15. Car voici l Eternel ! Il arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon, il convertit sa colre en un brasier, et ses menaces en flammes de feu.
16. C est par le feu que l Eternel exerce ses jugements, c est par son pe qu il chtie toute chair ; et ceux que tuera l Eternel seront en grand nombre.
17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un un, qui mangent de la viande de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-l priront, dit l Eternel.
18. Je connais leurs uvres et leurs penses. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues ; elles viendront et verront ma gloire.
19. Et j enverrai de leurs rescaps vers les nations, Tarsis, Poul et Loud les tireurs l arc Toubal et Yavn, aux les lointaines, qui jamais n ont entendu parler de moi, et qui n ont pas vu ma gloire ; et ils annonceront ma gloire parmi les nations.
20. Ils amneront tous vos frres du milieu de toutes les nations en offrande l Eternel, sur des chevaux, des chars et des litires, sur des mulets et des dromadaires, ma montagne sainte, Jrusalem, dit l Eternel, comme les fils d Isral apportent leur offrande, dans un vase pur, la maison de l Eternel.
21. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lvites, dit l Eternel. (Et voir Esaie, 65 : 1-7)
Dans les versets 3 et 4 du chapitre (65) on remarque que le texte parle des Juifs ainsi que des Chrtiens ; car les premires caractristiques s appliquent aux Juifs, tandis que le fait de rpandre le sang du porc est une spcificit des Chrtiens. En outre l adoration des idoles est une de leurs caractristiques car ils adorent les Icnes de Marie, de Jsus et des saints.
Les versets du passage que nous avons reproduits (66 : 7-9) font allusion une ville d o sortira (natra) un Prophte, dsign dans le texte par le fils (c'est--dire de cette ville). La naissance de cette personne produira un grand miracle. Il consiste former un Etat et faire natre un pays et une nation qui n existaient pas auparavant. C est pour cela que l auteur du texte s tonne et s merveille devant ce fait qui n a pas d exemple dans l histoire ; mme Sion (c'est--dire Jrusalem et le peuple Juif), bien qu il ait beaucoup travaill, n a pas pu enfanter un prophte semblable celui-l qui orientera un pays et une nation vers la droiture.
D ailleurs, il est noter que cette ville, qui donnera naissance ce prophte, comme le souligne le texte, n a pas connu auparavant d enfantement ; c'est--dire qu elle n a pas produit de prophte avant la venue de ce fils. Par contre Sion a beaucoup travaill et donn naissance un grand nombre de fils ; mais tous n ont pas pu faire ce que fera cet homme.
Il est net que cette ville et ce fils sont mis dans le texte en parallle avec Sion ; ce qui montre que cet homme n est pas un Juif.
D autre part, il est souligner que les traducteurs de la Bible pour montrer la diffrence entre cette ville et Jrusalem, ont mis la tte de ce passage ce titre : La nouvelle Jrusalem .
Donc le terme Jrusalem voqu dans ce passage ne se rapporte pas l ancienne Jrusalem mais la nouvelle. Or dans l histoire universelle on n a pas connu un peuple et une nation qui se sont forms de rien grce une prdication religieuse comme l ont t les Arabes par la prdication de Mohammad. De mme on ne connat pas dans le monde entier une ville qui ait donn naissance un seul prophte et qui ait une gloire dpassant celle de Jrusalem, comme la Mecque.
Dans les versets 15 17, il y a une description du chtiment qui sera exerc sur les transgresseurs, par l intermdiaire de ce Prophte et de sa nation. Les transgresseurs sont aussi bien parmi les Juifs que parmi les Chrtiens dsigns dans le texte par le fait de manger la viande du porc.
D autre part, les versets 18 et 19 montrent que le salut est rserv galement aux diverses nations par le truchement de ce Prophte et de son peuple.
L expression : les tireurs l arc est une allusion manifeste aux Arabes ( leur anctre Ismal tait un tireur l arc ; voir Gense, 21 : 20).
Dans le verset 20 il y a une comparaison entre ce que feront ces nouveaux adorateurs de Dieu vis--vis des nations, en les conduisant vers Jrusalem (c'est--dire la Mecque), et ce que faisaient les Isralites en apportant leur offrande.
En effet, des milliers et des milliers de gens vont chaque anne la Mecque pour faire le plerinage ; c est une consquence de la prdication des premiers Musulmans.
Dans les versets 20 et 21, il est fait allusion une caractristique de cette communaut ; car parmi les Musulmans on trouve ceux qui apprennent le Coran par c ur et l enseignent aux autres comme faisaient les Lvites parmi les Isralites. Or parmi les Chrtiens il n y a pas de sacrificateurs ; selon eux Jsus s est sacrifi pour les librer du pch ; donc ils n ont pas besoin de sacrificateurs.
La gloire de la Mecque et Les uvres de ses habitants
Dans Esaie, 54 : 1-17, il est crit :
Rjouis-toi, strile, toi qui n a pas enfant ! Eclate en cris d allgresse et de joie, toi qui n a pas connu les douleurs ! Car les fils de la dlaisse seront plus nombreux que les fils de celle qui est marie, dit l Eternel.
2. Elargis l espace de ta tente ; qu on dploie les toiles de tes demeures : Ne les mnage pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes piquets !
3. Car tu te rpandras droite et gauche ; ta descendance envahira des nations et peuplera des villes dsertes.
4. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse ; ne sois pas confuse, car tu ne seras pas dshonore ; mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du dshonneur de ton veuvage.
5. Car ton Crateur est ton poux : l Eternel des armes est ton nom ; et ton rdempteur est le Saint d Isral. Il se nomme Dieu de toute la terre ;
4. car l Eternel le rappelle comme une femme abandonne dont l esprit est afflig, comme une pouse de la jeunesse qui a t rpudie, dit ton Dieu.
5.
Quelques instants je t avais abandonne, mais avec une grande affection je t accueillerai ;
6. dans un instant de colre, je t avais un moment drob ma face, mais avec un amour ternel j aurai compassion de toi, dit ton rdempteur l Eternel
10. Quand les montagnes s branleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas branle, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l Eternel qui a compassion de toi.
11. Malheureuse, battue par la tempte, et que nul ne console ! Voici : je garnirai tes pierres de stuc, et je te donnerai des fondements de saphir ;
12.
je ferai tes crneaux des rubis, tes portes d escarboucles et toute ton enceinte de pierres prcieuses.
13.
Tous tes fils seront disciples de l Eternel, et grande sera la prosprit de tes fils.
14. Tu seras affermie par la justice ; tiens-toi loigne de l oppression, car tu n as rien craindre, et de la terreur, car elle n approchera pas de toi.
15.
Si l on t attaque, cela ne viendra pas de moi ; quiconque t attaquera tombera cause de toi
17. Tout instrument de guerre fabriqu contre toi sera sans effet ; et toute langue qui s lvera en justice contre toi, tu la convaincras de mchancet. Tel est l hritage des serviteurs de l Eternel, telle est la justice qui leur vient de moi, dit l Eternel.
Dans le verset 1 nous avons quatre expressions : strile qui suggre qu il y a une autre fconde, la dlaisse et celle qui est marie.
Deux interprtations sont possibles donner ces expressions. La premire consiste voir dans le mot dlaisse et dans l expression : celle qui a un mari , deux femmes qui sont, selon notre interprtation, Agar (la dlaisse) et Sara (celle qui est marie) et dans les mots strile et fconde deux villes.
La seconde opte pour l expression allgorique et suggre que ces quatre mots : strile, fconde, la dlaisse et celle qui est marie, se rapportent tous deux villes.
Cependant, lire attentivement ce premier verset, nous constatons que la strile et la dlaisse sont deux ralits diffrentes. Sinon, le texte aurait dit : Rjouis-toi strile car tes fils seront plus nombreux ; mais le texte dit : car les fils de la dlaisse.
Si la strile correspond la ville, alors la dlaisse dsignera une femme abandonne. En fait Agar a t abandonne dans le dsert d Arabie avec son fils Ismal comme le rapporte la Gense, (21 : 8-21) : Abraham se leva de bon matin ; il prit du pain et une outre d eau qu il donna Agar et plaa sur son paule ; il lui remit aussi l enfant et il la renvoya. Elle s en alla et s gara dans le dsert de Ber-Chba Dieu fut avec le garon, qui grandit, habita dans le dsert et devin tireur l arc. Il habita dans le dsert de Parn . Et par consquent celle qui est marie serait Sara.
Le contexte montre que la demande de manifester sa joie est adresse la ville strile parce que les fils de la dlaisse (Agar) seront plus nombreux que les fils de celle qui est marie (Sara).
Cette ville strile c est la Mecque ; car avant Mohammad, elle n a jamais enfant de prophtes, mais elle restait assidment au service des idoles.
La ville fconde est Jrusalem ; car elle a enfant de nombreux prophtes.
D autre part, il est certain que la relation entre une ville et ses habitants est indniable. Les fils de la dlaisse (Agar) habitent l Arabie et notamment la Mecque o natra le Prophte Mohammad et d o se propagera l Islam. Ils sont plus nombreux que les fils de Sara. Bien que ce soit un truisme, nous rappelons qu actuellement il n y a pas vingt millions de Juifs sur terre, tandis que les Musulmans frlent le milliard dont plus de deux cents millions d Arabes.
Les caractristiques donnes dans le verset 2 : Elargis l espace de ta tente montrent que le mot strile voqu dans le premier se rapporte une ville qui n a pas connu l enfantement d un prophte.
Les phrases du verset 3 sont une cause et en mme temps une consquence du verset 2. D une part, la descendance de cette ville prendra possession des nations, et d autre part, leur expansion s effectuera droite et gauche ; c'est--dire l Est et l Ouest.
Cette prophtie s est ralise concrtement ; puisque l Islam s est rpandu droite (l Est) jusqu la Chine et gauche ( l Ouest) jusqu en Espagne.
Le veuvage et le mariage voqus dans les versets 4-6 sont deux allgories, dcrivant deux ralits : celle de la priode pr-islamique et celle de l Islam. Dans la priode islamique combien de villes ont t peuples par les Musulmans ! Cette prdiction fut ralise au cours de l histoire de l Islam.
L enceinte de cette ville cite dans le verset 12, est la sainte Ka ba autour de laquelle les plerins font leurs sept tours en implorant Dieu.
Le verset 13 souligne que tous les fils de cette ville seront des disciples de Dieu ; ceci s est rellement produit ; les Arabes, surtout les habitants de la Mecque sont devenus musulmans et ont abandonn le service des idoles. Et ce sont eux qui ont gouvern le monde Islamique de longs sicles durant.
Les versets 14 17 qui parlent de la scurit rpandue dans cette ville est une caractristique de la Mecque depuis plus de 14 sicles. Elle n a jamais connu une quelconque agression trangre. Abraha l Ethiopien avait voulu dmolir la Ka ba (sanctuaire de la Mecque) avant l Islam ; mais son offensive fut stoppe et il prit avec son arme grce un miracle divin (voir le Coran, 105). Personne n a os s en emparer, mme l poque coloniale ; la domination anglaise n a pas pu tendre son empire jusqu la Mecque, alors qu elle occupait tous les territoires voisins (la Palestine, la Jordanie, l Egypte, le Soudan, le Ymen, le Golf, le Kowet et l Iraq).
Il est donc invraisemblable de croire que ces versets s adressent l Eglise, comme l on cru les exgtes chrtiens ; car les caractristiques effectives se rapportent une ville prcise et ses fils.
La gloire de la Mecque et celle de la Ste Ka ba
Dans Esaie, 60 : 1-22, il est crit :
1. Lve-toi, brille, car ta lumire parait, et la gloire de l Eternel se lve sur toi.
2. Car voici que les tnbres couvrent la terre et l obscurit les peuples ; mais sur toi l Eternel se lve, sur toi sa gloire apparat.
3. Des nations marcheront ta lumire et des rois la clart de ton aurore.
4. Porte tes yeux alentour et regarde : tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portes sur les bras.
5. A cette vue tu seras radieuse, ton c ur bondira et se dilatera, quand les richesses seront dtournes de la mer vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi.
6. tu seras couverte d une foule de chameaux, ainsi que de dromadaires de Madian et d Epha ; Ils viendront tous de Saba ; Ils porteront de l or et de l encens et annonceront les louanges de l Eternel.
7. Les Troupeaux de Qdar se runiront tous chez toi ; les bliers de Nbayoth seront ton service ; ils seront offerts en holocauste sur mon autel et me seront agrables, et je ferai resplendir la maison de ma gloire.
8. Qui sont ceux-l qui volent comme des nues, comme des colombes vers leur colombier ?
9. Car les les esprent en moi, et les navires de Tarsis sont en tte, pour ramener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, cause du nom de l Eternel, ton Dieu, du Saint d Isral qui te fait resplendir.
10. Les fils de l tranger rebtiront tes murailles, et leurs rois seront ton service ; car dans mon indignation je t ai frappe, mais dans ma faveur j ai compassion de toi.
11. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermes ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les trsors des nations et leurs rois avec leur suite.
12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas priront, ces nations-l seront entirement ruines.
13. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprs, l orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai le lieu o reposent mes pieds.
14. Les fils de tes oppresseurs viendront s humilier devant toi, et tous ceux qui t outrageaient se prosterneront tes pieds, ils t appelleront ville de l Eternel, Sion du Saint d Isral.
15. Alors que tu tais dlaisse et hae, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un objet de fiert pour toujours, un sujet de rjouissance de gnration en gnration.
16. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois ; et tu sauras que je suis l Eternel, ton sauveur, ton rdempteur, le puissant de Jacob.
17. Au lieu du bronze je ferai venir de l or, au lieu du fer je ferai venir de l argent, au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, du fer ; je ferai rgner sur toi la paix, et dominer la justice.
18. On n entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage ni de ruines dans ton territoire ; tu donneras tes murailles le nom du salut et tes portes celui de louange.
19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumire pendant le jour, ni la lune qui t clairera de sa lueur ; mais l Eternel sera ta lumire toujours, ton Dieu sera ta gloire.
20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus ; car l Eternel sera ta lumire toujours, et les jours de ton deuil seront termins.
21. Il n y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils possderont toujours le pays ; c est le rejeton que j ai plant, l uvre de mes mains, pour servir ma gloire.
22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l Eternel, je hterai ces choses en leur temps.
Il est clair qu il s agit, dans ces versets, d une ville religieuse et d un sanctuaire. Par ailleurs, cette prdiction comporte des caractristiques qu on ne pourrait appliquer ni Jrusalem ni l Eglise.
Mais si on mdite srieusement sur le vritable sens de ces phrases on constatera qu elles s appliquent parfaitement une autre ville et un autre sanctuaire.
L expression : La gloire de l Eternel se lve sur toi se rapporte la rvlation nouvelle que va recevoir le Prophte qui apparatra dans cette ville. Grce cette rvlation et cette prdication cette ville brillera, et ainsi elle dissipera les tnbres rpandues sur les peuples.
Les caractristiques que nous essayons d analyser montrent qu il s agit de La Mecque , la ville principale de l Islam, et de la Ka ba, son sanctuaire.
Les versets 3 et 4 renferment une ralit justifie par l histoire ; car La Mecque est la seule ville religieuse qui a toujours t visite par les fidles et servie par les rois, sans interruption aucune.
Le verset 5 voque une autre ralit. A vrai dire, celui qui peut avoir un simple aperu de l histoire de La Mecque pour connatre la vnration, les services rendus cette ville et les sortes de richesses qui y affluaient et affluent, sera convaincu que cette prdiction ne peut concerner que La Mecque. Pensons au ptrole, pour le temps prsentpar exemple.
Les versets 6 et 7 o on a voqu des noms de villes, de pays et de tribus (Madian, Epha, Saba, Qdar et Nebayoth) constituent une preuve vidente que dans cette prdiction il s agit de La Mecque. Ces noms ne peuvent, en aucune faon, se rapporter Jrusalem ou l Eglise.
Madian est au nord de La Mecque, Saba au sud (c est le Ymen) ; ce sont des lieux o ne vivaient et ne vivent que des tribus arabes.
Qdar et Nebayoth sont les anctres des tribus arabes et ce sont deux fils d Ismal (Gense, 25 : 13 : Voici les noms des fils d Ismal : Nebayoth, premier-n d Ismal, Qdar.
Thodore de Cyr, au Ve sicle, a crit propos de ces versets en disant :
Madian, Kdar et Gpha ( Epha) sont des nations de barbares nomades qui font descendre leur race d Ismal ,or sont appels Arabes les gens de kdar, ceux de Madian, de Gepha et de Nabeoth ( Nebayoth), qui habitent les dserts de l Arabie : ce sont des gens qui se dplacent dos de chameaux et de dromadaires. (Op.cit, pp.246-51).
Dans cette prdiction il est dit que les tribus de Qdar et de Nebayoth, les habitants de Madian, de Saba et d Epha se rendent cette ville, et que les troupeaux des deux premires tribus seront offerts en holocauste sur son autel. Il est certain, donc, que la ralisation de cette prdiction, la suite de la conversion des Arabes l Islam, est manifestement illustre par la priode de plerinage.
En effet, depuis des sicles et des sicles, les Arabes et toutes les autres nations musulmanes se rendent la Mecque pour faire leur plerinage ; pendant lequel on immole des chameaux, des bliers et on formule des louanges Dieu.
Mais qui parmi les Arabes et surtout les fils de Qdar et Nebayoth, tait parti pour offrir des holocaustes Jrusalem o l Eglise ?
Il va de soi que l Eglise ne possde pas d autel. Les Chrtiens prtendent qu ils n ont plus besoin d holocaustes puisque Jsus, selon eux, les avait librs du pch cause duquel on a t auparavant oblig d offrir des sacrifices expiatoires. Cependant, le texte signale que les tribus arabes (de Qdar, de Nebayoth, de Madian et de Saba) offrent quant elles, des bliers en holocaustes sur un autel. Il convient, toutefois, de s interroger sur l endroit o ont lieu ces sacrifices ?
Il est vident que ce n est pas Jrusalem, parce qu il n y a plus de Temple (dtruit en l an 70 ap.J.C. par les Romains) et ce n est pas l Eglise parce qu il n y a pas d holocauste dans le Christianisme. Ce ne pourrait tre donc qu la Mecque o les arabes et les autres Musulmans ont offert, offrent et offriront des holocaustes au cours du plerinage la Mecque o se trouve la Ka ba, sanctuaire et maison de Dieu dont parle le verset 13 ; pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire.
Les versets 8 et 9 : qui sont ceux-l qui volent font allusion aux plerins qui viennent de toutes parts pour clbrer la grande fte du plerinage la Mecque. Ces peuples qui accourent vers elle sont semblables des colombes qui volent vers leur colombier. Si l on veut, toutefois, comprendre exactement ce passage, que l on contemple ce qui se passe la Mecque au cours des 11e et 12e mois de l anne lunaire.
Cette similitude entre plerins et colombes est plus remarquable actuellement grce aux avions qui convergent aux aroports de l Arabie Saoudite, surtout Jadda (ville proche de la Mecque), au moment du plerinage. On y voit se dverser en flots des foules d hommes, femmes et enfants.
Le mot Tarsis dans le verset 9 dsigne Carthage(la Tunisie actuelle) selon Thodoret de Cyr (cf., III, 253), selon d autres c est l Inde. En tout cas les deux contres sont des contres islamiques d o viennent une multitude de gens pour accomplir le plerinage (majeur ou mineur).
Dans le verset 10 il y a une caractristique qui ne peut s appliquer ni Jrusalem ni l Eglise : les fils de l Etranger rebtiront tes murailles.
Comme nous l avons dit, le Temple de Jrusalem fut dtruit en l an 70 ap.J.C., et jusqu nos jours il n a pas t reconstruit. Par contre la Ka ba est toujours servie par les rois musulmans, arabes ou non arabes. La mosque sacre qui entoure la Ka ba fut largie maintes fois par les diffrents rois diffrentes poques. Par exemple des rois Sljoukites, Ayyoubides (de Saladin), Mamalik et les rois Ottomans, qui ne sont pas des Arabes, ont servi cette mosque ; et chaque roi est appel serviteur des lieux sacrs ; titre glorieux pour lui.
En outre, comme dit le verset 10 (selon une traduction), les rois se soumettent la loi qui a jailli de cette ville. Cette loi ne peut tre que celle rvle au Prophte Mohammad. Pour les Chrtiens il n y a aucune loi laquelle ils puissent s en remettre ; mais les Musulmans possdent une loi qui rgit leur vie toute entire ; et mme actuellement o les gouvernements des Etats musulmans se sont loigns de l Islam, nous remarquons que chaque gouverneur dclare son peuple qu il est soumis la loi islamique, qu il la reconnat et qu il a l intention de l appliquer.
En plus le verset 10 voque une ralit historique lorsqu il a dit : Car dans mon indignation . Avant l Islam, la ville de la Mecque tait comme frappe par la colre divine, puisqu elle ne bnficiait pas de la sollicitude divine. Mais qui en a joui par la suite de sa bont.
Le verset 11 voque une autre ralit : Tes portes seront toujours ouvertes , constate par celui qui a visit la Mecque et vu la Mosque sacre dont les portes sont ouvertes jours et nuits. Et les rois s y soumettent et y font les rites du culte Dieu en considrant cela comme un titre de gloire.
Le verset 12 : Car la nation et le royaume dnoncent clairement les prtentions juives et chrtiennes en considrant que cette prdiction concerne le Temple de Jrusalem ou l Eglise.
Quant aux Juifs, il n y a pas eu de Nations ou de Rois qui aient t serviteurs du Temple de Jrusalem aprs l exil et videmment aprs sa destruction en l an 70 ap.J.C.
Quant aux Chrtiens, ils n ont pas de temple sacr et fixe.
Par contre les rois musulmans accourent pour recevoir le titre de Serviteur des lieux sacrs (jusqu prsent le roi Saoudien est appel serviteur des lieux sacrs).
Le verset 13 confirme toujours qu il s agit d un lieu fixe et prcis, rfutant ainsi les prtentions des Chrtiens ; ce lieu ne peut que dsigner le Temple de la Mecque parce que celui de Jrusalem n existe plus depuis plus de 19 sicles.
D autre part, le verset indique que la gloire du Liban sera transmise cette ville ; ce qui est arriv effectivement.
Le verset 14 : Les fils de tes oppresseurs , montre qu il s agit d une ville et d un temple prcis. Et puisque les caractristiques donnes plus haut ne s accordent pas avec celles du Temple de Jrusalem ni avec celles de l Eglise, il est donc clair que le mot Sion figurant dans ce verset ne dsigne pas ncessairement Sion en Palestine bien que la mosque de Jrusalem soit, pour les Musulmans, le troisime lieu sacr, (aprs ceux de la Mecque et de Mdine). Il est vident qu avant que ce texte soit mis, le nom Sion dsigne Jrusalem. Cependant, le texte affirme que cette appellation sera effectue dans les temps qui viendront, ce qui implique qu il ne s agit pas de Jrusalem, mais d une autre ville o se trouve un temple analogue celui de Jrusalem et qui sera considr comme lieu sacr.
En effet, les faits historiques confirment ce que nous venons d avancer ; car le texte voque que les fils de tes oppresseurs viendront s humilier devant toi ce qui est incompatible avec les faits historiques si on considre que Sion c est Jrusalem ; les Babyloniens par exemple n taient pas venus pour s humilier devant ce lieu sacr, et les Romains avaient dtruit le Temple.
Par contre, les fils de ceux qui avaient essay d attaquer la Mecque et son Temple, comme par exemple Abraha du Ymen et les Perses, sont devenus des Musulmans.
D autre part, cette ville, comme le souligne le verset, sera appele la ville de Dieu ; or Jrusalem fut appele par les empereurs romains Aelia (cf., Thodoret, III, 259). Comment donc peut-on montrer le caractre vridique de la prophtie, moins de voir Sion dans un sens spirituel et renfermant une analogie ?
En outre les versets 15 et 16 confirment qu il s agit d un lieu sacr fixe et prcis.
Les versets 17 et 18 voquent une ralit historique qui s applique parfaitement la Mecque et son temple. Dans le monde entier il n existe pas un lieu sacr qui ait connu la paix comme la Mecque et son temple.
D autre part, le verset 18 prcise une ralit existant jusqu nos jours ; les murailles et les portes du temple et de la ville portent les noms de salut et de louange. Celui qui a rendu visite la Mecque et son temple a sans doute constat cette ralit (par ex. bb assalam.)
Les versets 19 et 20 renferment une allgorie qui fait allusion la rvlation divine grce laquelle la Mecque s est resplendie spirituellement.
Le verset 21 souligne que les habitants de ce lieu sacr possderont toujours le pays. Il est clair que les Arabes sont toujours les possesseurs de l Arabie. En outre ils ont possd la Palestine pendant 13 sicles o se trouve Jrusalem. Par contre les Juifs n ont pas possd la Palestine et Jrusalem depuis plus de 20 sicles.
Quant aux Chrtiens ; nous disons que le verset prcise qu il s agit d une ville, mais laquelle ?
S il s agit de l Arabie et de la Mecque comme nous l avons dmontr, les Chrtiens ne l ont jamais possd. S il s agit de la Palestine et de Jrusalem ils en ont t dpossds depuis l an 637 ap.J.C.
Le verset 22 confirme ce que nous avons vu plus haut.
IV.
Les visions du livre de Daniel
Le livre de Daniel
Le livre de Daniel, conserv en hbreu et en aramen, se compose de deux parties nettement distinctes. La premire (du 1er au 6e chapitre) comprend des rcits dont Daniel est le hros, et la deuxime (du 7 au 12e chap.) concerne les visions dont Daniel est lui-mme le bnficiaire.
La place qu a le livre dans le Canon a une importance en raison des indications, mmes gnrales, qu il fournit la fois pour le genre littraire du livre et pour sa date de sa composition.
Les visions mises au compte de Daniel, se prsentent du point de vue littraire, comme de vraies paraboles ou allgories dont il faut faire l exgse ; celle-ci revenant normalement l ange interprte (7 12). Le langage symbolique est emprunt le plus souvent l Ancien Testament.
Le thme commun aux deux parties du livre est : Dieu matre de l histoire qu il conduit son terme . Cette doctrine est d ailleurs mise en relief dans le chapitre 7 qui est situ la charnire des deux parties et relie ainsi les rcits aux visions apocalyptiques.
Chapitre II de Daniel
Ce chapitre comprend trois parties. Dans la premire, le roi Nabucadnetsar[20], qui a eu un songe, demande ses devins de le lui raconter et de le lui interprter. Le roi prononce une sentence de mort contre tous les sages de Babylone incapables de satisfaire ses exigences (vv. 1-13). La deuxime partie (vv. 14-45) raconte l intervention de Daniel qui expose au roi le songe et en donne une interprtation. La fin du chapitre (vv. 46-49) rapporte la profession de foi du roi et la rcompense accorde Daniel et ses compagnons.
Le songe est qualifi de mystre ( raz en hbreu, en arabe : lurz, luraz). Cette qualification est due sans doute la nature mme du songe, que le caractre symbolique contribue rendre mystrieux.
Mais comme le contenu du songe concerne des rvlations divines sur le sort du royaume de Nabucadnetsar et des royaumes qui viendront aprs lui et en fin de compte, des desseins divins, il n est pas impossible que dj le mot raz revte ici le sens de mystre, de salut que l on trouve souvent dans les textes de Qumran et en particulier dans les hymnes.
Le verset 30 souligne que Daniel n est qu un mdiateur de la rvlation divine qu il va faire au roi. Alors Daniel raconte le rve que le roi a vu, et en donne l explication en disant (2 : 31- 45) :
31. roi, tu as eu une vision, celle d une grande statue. Cette statue tait immense et d une splendeur extraordinaire, elle tait debout devant toi, et son aspect tait terrible.
32. La tte de cette statue tait d or pur ; sa poitrine et ses bras taient d argent ; son ventre et ses cuisses taient de bronze ;
33. ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d argile.
34. Tu regardais, lorsqu une pierre se dtacha sans le secours d aucune main, frappa les pieds de fer et d argile de la statue, et les mit en pices.
35. Alors le fers, l argile, le bronze, l argent et l or, furent briss ensemble, et devinrent comme la balle qui s chappe d une aire en t ; le vent les emporta, et nulle trace n en fut retrouve. Mais la pierre qui avait frapp la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre.
36. Voil le rve. Nous en donnerons l explication devant le roi.
37. roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t a donn le royaume, la puissance, la force et la gloire ;
38. il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu ils habitent, les fils des hommes, les btes des champs et les oiseaux du ciel, et il t a fait dominer sur eux tous ; c est toi qui est la tte d or.
39. Aprs toi s lvera un autre royaume, moindre que le tien ; puis un troisime royaume, qui sera de bronze, et qui dominera sur toute la terre.
40. Il y aura un quatrime royaume, solide comme du fer ; de mme que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer brise tout.
41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divis ; mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer ml avec l argile.
42. Et comme les doigts des pieds taient en partie de fer et en partie d argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile.
43. Tu as vu le fer ml avec l argile, parce qu ils ne s attacheront pas l un l autre, de mme que le fer ne se mlange pas avec l argile.
44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais dtruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d un autre peuple ; il brisera et dtruira tous ces royaumes-l, et lui-mme subsistera ternellement.
45. Ainsi, tu as vu la pierre se dtacher de la montagne sans le secours d aucune main, et elle a bris le fer, le bronze, l argile, l argent et l or. Le grand Dieu a fait connatre au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rve est vritable, et son explication digne de confiance . (Daniel, 2 : 31-45).
Dans les versets 31-33, le roi a vu une statue colossale, mais faite de mtaux divers et mme d argile ou de terre cuite. Ces mtaux au nombre de quatre sont prsents dans un ordre dcroissant depuis la tte qui est en or jusqu aux pieds qui sont en fer et en terre. Les mtaux les plus prcieux tant rservs aux parties les plus nobles du corps. Ces sortes de statues colossales taient connues des Anciens (Memphis, Rhodes, Athnes, Rome). La diversit des mtaux ne semblait pas trange aux orientaux qui connaissaient des statues chryslphantines faites d or et d ivoire[21]. Cet tat de choses cessera, dit Mathias Delcor auteur du commentaire du livre de Daniel, car le quatrime empire sera remplac par le royaume de Dieu, sans doute un royaume terrestre aux desseins universels.(Le livre de Daniel, Paris 1971, J. Gabalda et Cie, p. 85).
Pour mieux signifier que la statue de la vision reprsente le monde, sa tte touche le ciel et ses pieds la terre.
Les versets 34 et 35 dcrivent la destruction de la statue sous l effet d une pierre dtache de la montagne (cf. v. 45) par on ne sait qui (litt. Sans le secours d aucune main) ; mais sa puissance est telle que les mtaux sont rduits en pices que le vent emporte. La pierre qui a frapp la statue devient une grande montagne qui remplira toute la terre.
Ce songe se prsente au fond comme une allgorie qu il faut dchiffrer. Aprs l expos du songe, on donne partir du verset 37 son interprtation.
La tte d or est Nabucadnetsar le Roi des rois , ou plus exactement le seigneur des roi . Le premier titre tait normal pour les rois perses et exceptionnellement pour les roi babyloniens.
A Nabucadnetsar, Dieu livre tous les hommes et toutes les btes et il a domination sur eux tous, ce qui est une reprise de Jrmie (27 : 5-6) o il est galement question de sa souverainet universelle.
Les verses 39-43.
Du second empire symbolis par la poitrine et les bras en argent, nous savons seulement qu il sera infrieur au premier, celui de Nabucadnetsar ; mais plus vaste.
Des exgtes contemporains, parmi lesquels l auteur du livre de Daniel prcit, ont cru que le deuxime empire est celui des Mdes, le troisime tant celui des Perses. Leur argument est que d aprs le verset 39, cet empire est moins important que le prcdent ; ce qui ne serait pas exact si l on avait affaire l immense empire Mdo-perse. Mais cette exgse se fondant sur cet argument peut se heurter la mme difficult lorsqu on identifie le quatrime empire celui d Alexandre Le Grand ; car dans ce cas il serait infrieur au prcdent ( c est--dire l empire Mdo-perse) ce qui est invraisemblable, parce que le monde conquis par Alexandre le Grand est plus vaste que celui de l empire Mdo-perse, il s tendait sur trois continents (l Europe, l Afrique, et l Asie) et il est plus rapide et plus dtruisant. En ralit l expression qui dominera toute la terre (v.39) convient Alexandre le Grand plutt qu l empire Mdo-perse.
D autre part, il est remarquer que le deuxime empire symbolis par la poitrine et les bras convient proportionnellement celui des Mdo-perse ; Les bras associs la poitrine symbolisent les deux nations, qui constituaient l empire, leur unit et leur force. Par ailleurs, ce symbole montre que l unit des deux nations est une affaire postrieure ; elle est reprsente par la poitrine o s effectuera la fusion totale. De mme le symbole du troisime empire convient dans son tendue celui d Alexandre ; les cuisses du troisime symbole viennent aprs le ventre ce qui prdit la division au sein de cet empire[22].
Il faut spcifier que dans l interprtation qui bloque l empire des Mdes et des Perses, le troisime empire est alors celui d Alexandre et des Diadoques (aprs lui)[23], ce qui s accorde avec les donnes du verset 39.
Mais le quatrime empire ne pouvait pas tre celui des Sleucides et des Ptolmes pour la simple raison que les caractristiques du quatrime empire dcrites dans le verset 40( c est--dire qu il brise tout et crase tout comme le fer) ne concordent pas avec les donnes historiques de ces deux royaumes qui ne sont que les successeurs d Alexandre. Ces royaumes diviss ne faisaient que continuer la domination grecque sur le monde oriental et occidental.
En revanche , les caractristiques s accordent bien avec ce que l on sait de la puissance romaine et sa domination sur le monde en pulvrisant et en crasant tout, depuis l Atlantique jusqu la Msopotamie et du c ur de l Europe jusqu en Ethiopie. Le texte prcise, en effet, que le quatrime empire cartera le troisime aussi bien en orient qu en occident . Or les successeurs d Alexandre n avait pas cart leur propre empire ; mais ils l avaient conserv. Par contre, les romains avaient cras, pulvris le reste du troisime royaume[24].
Le point culminant de la vision est aux versets 44-45. La pierre qui tombe de la montagne ne symbolise pas un personnage mais un royaume qui anantira tous les royaumes et qui ne sera jamais dtruit. La date o se situera l vnement est prcise par l expression, qui est un peu vague, Aux jours de ces rois (v.44).
Cette expression ne vise fort probablement que les rois du quatrime empire. Le symbolisme de la pierre qui se dtache sans l aide d aucune intervention humaine se laisse deviner lui-mme : il signifie la toute puissance divine qui intervient de faon imprvisible, mais malgr tout, efficacement. Par ailleurs, puisque la pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre (v. 45), elle symbolise l universalisme du royaume de Dieu.
Chapitre 7
1. la premire anne de Belschatsar , roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se prsentrent son esprit , pendant qu il tait sur sa couche. Ensuite il crivit le songe, et raconta les principales choses. 2.Daniel commena et dit : je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer.
3. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, diffrents les uns des autres.
4. Le premier tait semblable un lion, et avait des ailes d aigle ; je regardais jusqu au moment o ses ailes furent arraches ; il fut enlev de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un c ur d homme lui fut donn.
5. Et voici un second animal tait semblable un ours, et se tenait sur un ct ; il avait trois cotes dans la gueule entre les dents, et on lui disait : lve-toi , mange beaucoup de chair.
6.Aprs cela je regardai, et voici un autre tait semblable un lopard, et avait sur le dot quatre ailes comme un oiseau ; cet animal avait quatre ttes, et la domination lui fut donne.
7. Aprs cela je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrime animal : terrible, pouvantable, et extraordinairement fort ; il avait de grands dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait ; il tait diffrent de tous les animaux prcdents, et il avait dix cornes.
8. Je considrais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d elles, et trois de premires cornes furent arraches devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux d homme et une bouche qui parlait avec arrogance.
9. Je regardais, pendant que l on plaait des trnes. Et l Ancien des jours s assit. Son vtement tait blanc comme la neige, et les cheveux de sa tte taient comme de la laine pure ; son trne tait comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
10.Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa prsence. Les juges s assirent, et les livres furent ouverts.
11. Je regardai alors, cause des paroles arrogantes que prononait la corne ; et tandis que je regardais l animal fut tu, et son corps fut dtruit, livr au feu pour tre brl.
12. Les autres animaux furent dpouills de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accorde pour un certain temps. 13. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nues des cieux arriva quelqu un de semblable un fils de l homme ; il s avana vers l ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
14. On lui donna la domination, la gloire et le rgne ; et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination ternelle qui ne passera point, et son rgne ne sera jamais dtruit.
15. Moi, Daniel, j eus l esprit troubl au-dedans de moi, et les visions de ma tte m effrayrent.
16. Je m approchai de l un de ceux qui tait l, et je lui demandai de me rvler la vrit sur toutes ces choses. Il me rpondit et m en fournit l explication.
17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s lveront de la terre ;
18. mais les saints du Trs-Haut recevront le royaume ternellement, d ternit en ternit.
19. Ensuite je dsirai savoir la vrit sur le quatrime animal, qui tait diffrent de tous les autres, extrmement terrible , qui avait des dents de fer et des ongles d airain, qui mangeait, brisait , et foulait aux pieds ce qui restait ;
20. et sur les dix cornes qu il avait la tte, et sur l autre qu il tait sortie et devant laquelle trois tait tombes, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres.
21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l emporter sur eux ;
22. jusqu au moment o l Ancien des jours vint donner droit aux saints du Trs-Haut, et le temps arriva o les saints furent en possession du royaume.
23. Il me parla ainsi : le quatrime animal, c est un quatrime royaume qui existera sur la terre, diffrent de tous les royaumes, et qui dvorera toute la terre, la foulera et la brisera.
24. les dix cornes, ce sont dix rois qui s lveront de ce royaume. Un autre s lvera aprs eux, il sera diffrent des premiers, et il abaissera trois rois.
25. Il prononcera des paroles contre les Trs-Haut, il opprimera les saints du Trs-Haut ; et il esprera changer les temps et la loi ; et les saints seront livrs entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moiti d un temps.
26. Puis viendra le jugement, et on lui tera sa domination, qui sera dtruite et anantie pour jamais.
27. Le rgne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donns au peuple des saints du Trs-Haut. Son rgne est un rgne ternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obiront.
28. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrmement troubl par mes penses, je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon c ur.
Le Chapitre 7 comprend deux parties bien distinctes mais qui se compltent l une l autre : d une part la description de la vision (vv. 1-14) et d autre part son interprtation (vv. 15 la fin).
Cette fois, c est Daniel lui-mme qui fait un rve et a des visions.
Le rcit de Chaque scne est ponctu par : je voyais.)31,11,9 : 7(
Les quatre vents du ciel qui soufflent sur la mer dsignent les quatre de la cosmogonie babylonienne, dans l ordre suivant : le vent du Sud, le vent du Nord, le vent de l Est et le vent de l Ouest. Aprs l Exil, cette expression servit dsigner les quatre points cardinaux.
Les quatre btes dsignent les quatre grands empires situs dans les quatre parties du monde.
Les grandes btes montent de la mer agite par les vents (v.3). La mer reprsente la puissance hostile Dieu et gnratrice de monstres.
La premire bte, qui est un lion ail, se rencontre effectivement dans maintes reproductions de l art assyro-babylonien. Aussi, cet animal fantastique tait-il tout fait dsign pour symboliser l empire babylonien. Les ailes arraches marquent probablement que la puissance de l empire babylonien a t amoindrie puisque la bte ne peut plus se mouvoir aisment.
La deuxime bte (v.5) dsigne l empire des Mdes et des Perses. La phrase elle se dressait sur un ct peut faire allusion au fait que ce sont les Perses qui ont pris le pouvoir aprs l union avec les Mdes.
Cette bte (l ours) a dans la gueule trois cotes, ce qui semble indiquer les restes d un grand repas. L invitation manger beaucoup de viande se rfre l agressivit du deuxime empire.
La panthre (v.6) est le symbole du troisime empire : celui d Alexandre le Grand. Les quatre ailes dont elle est pourvue symbolisent son extraordinaire rapidit (ceci appuie notre interprtation du 3e empire du chapitre 2 par celui d Alexandre le Grand).
Cette rapide extension (la panthre est le symbole de la rapidit et de la frocit.) ne peut concorder qu avec celle d Alexandre le Grand. En peu de temps, ( peu prs 12 ans) Alexandre a pu dominer un espace assez large de la terre.
Quant aux quatre ttes, elles dsignent les quatre importants royaumes des diadoques. L Expression Et la domination lui fut donne est rapprocher de ce qui est dit dans la description de la statue au chap.2 (v.39), o le troisime empire dominera la terre toute entire.
La quatrime bte (v.7) est la plus effrayante. Elle correspond au quatrime empire de fer du chapitre 2 (v.40). Ici, on signale seulement les dents de fer de cette bte ; celle-ci n est pas dcrite et ne porte pas de nom.
Les dix cornes dsignent des rois. La corne est proprement un symbole de puissance (cf. Esaie, 2 : 10 ; Ezchiel, 29 : 21). Ces rois ne se succderont pas ncessairement, mais ils devraient tre de puissants rois.
Au milieu des dix cornes, poussa une autre corne plus petite (v.8). La signification du symbole de la corne est suffisamment clarifie par la prcision que cette dernire tait munie d une bouche et d yeux. Il s agit donc d un homme et plus prcisment, d un roi, ennemi de Dieu.
La locution Ancien des Jours (v.9) est applique Dieu. L apparence humaine donne Dieu est une caractristique de l esprit juif et chrtien ( cf., Ezchiel, chap. 4).
Le jugement est exerc par l Ancien des jours , sur les quatre empires issus de la Mer, dpossds de leur puissance.
A ct de L Ancien, se tient toute une cour anglique pour le servir. En vue de jugement, on consulte les livres clestes o sont consignes les actions des hommes et en particulier celles des quatre empires prcdemment crits.
Sans qu il y ait rquisitoire et sans qu aucune sentence ne soit promulgue, la bte reprsentant le quatrime empire est tue et son corps livr au feu en vue de sa destruction (vv.11-12).
La domination est aussi enleve aux autres btes, mais une certaine survie leur est laisse, sans doute en raison de leur impuissance actuelle l gard du peuple de Dieu. Car, si les empires perdent leur puissance, les nations demeurent.
Avec le verset 13 commence la vision du fils d Homme rapporte sous une forme potique. Le fils d Homme s oppose la fois aux quatre animaux et l Ancien qui vient d exercer le jugement.
Le fils d Homme vient avec les nues du ciel , expression qui doit tre prfre celle traduite par la Septante qui a compris que le fils d Homme venait sur les nues du ciel. Cette dernire version (sur les nues )est suivie par Matthieu, 24 : 30 ;26 ;64 ; Apocalypse, 14 : 16. Mais, dans Marc, 14 : 62 et Apocalypse, 1 : 7, on a : avec les nues (cf. ., Mathias Delcor, op. cit. p.154).
Mais d o vient le fils d Homme ? Est-ce du ct du ciel ou est-il transfr de la terre au ciel ? La rponse cette question est capitale pour l identification mme du fils d homme.
Mathias Delcor affirme que l expression prcite ne renferme pas une sorte de manifestation visible de Dieu invisible (thophanie), en avanant que dans le livre d Enoch thiopien, la nue est un moyen de transport de la terre au ciel (Enoch, 14 : 8). Dans ces perspectives, la nue s lve de la terre au ciel et un fils d Homme avec elle. Il s agit donc de la vritable ascension d un tre apparence humaine introduit dans la cour cleste pour y recevoir, la place du quatrime empire, une investiture. Le fils d Homme est un symbole, comme les quatre btes. Ce n est donc pas un tre divin, semi-divin ou une figure anglique descendant du ciel sur la terre pour y apporter le salut, mais un tre ressemblance humaine montant de la terre vers le ciel[25].
L investiture du royaume est confre au Fils d Homme par l Ancien, ce royaume est universel et ternel ; parce qu il n y aura pas entre ce royaume et le Jour dernier (la fin du monde) un autre royaume de Dieu ou un royaume quelconque qui le dtruirait. En effet, le texte lui-mme donne cette impression en disant : Il ne passera pas et ne sera pas dtruit , comme il a t arriv aux prcdents empires.
Les saints du Trs-Haut, qui recevront le royaume, sont les disciples du Fils d Homme.
Les perscutions, signales dans le texte, qu avaient subies les saints pourraient tre une allusion aux diffrentes perscutions qu avaient subies les sectes juives fidles la loi (avant J. C.) et qu avaient subies les disciples de Jsus. Aprs le triomphe du paganisme grec sur la vraie religion du Christ, la perscution s est abattue sur les sectes monothistes comme les ariens et les piscilliens jusqu la venue de l Islam qui a libr ces opprims et a fait triompher la vritable religion.
Les thologiens chrtiens et les exgtes de la Bible ont tent d appliquer ces prophties Jsus bien que ce dernier, selon eux, ft condamn mort par ordre d un fonctionnaire du quatrime empire - alors au znith de sa puissance et que la destruction de ce quatrime empire, dcrite dans la vision, ne ft pas produite sa venue.
Ils ont prtendu que cette destruction se raliserait la seconde venue de Jsus en travestissant ainsi la ralit historique qu on ne peut plus cacher. Tout simplement parce que l empire romain s est effondr plus tard non par Jsus mais par les Musulmans.
Pour bien comprendre ces deux visions ( des chapitres 2 et 7) nous donnerons un aperu historique sur l empire romain jusqu sa destruction finale.
A l poque de Jsus l empire romain dominait une grande partie de la terre ; en Asie, en Europe et en Afrique. Cette domination fut d une duret et d une solidit telles que les deux visions, la fait ressembler justement la duret du fer. Toutes les insurrections et les rvoltes, en Palestine ou ailleurs, furent combattues violemment et sans merci.
L empire a connu durant les trois premiers sicles ap. J. C. une apoge considrable. Mais malgr cette apparente puissance, la faiblesse, due divers facteurs, commenait l atteindre.
Au quatrime sicle les indices d une division, notamment aprs la mort de Constantin, commenaient apparatre[26].
Le dluge barbare, les Huns des plaines de la Mongolie, les Goths et les Vandales de Russie, avaient caus la chute de Rome et l croulement de l empire d occident en 476. Mais cette destruction a favoris l unification de l empire divis. Cependant, cette unification tait fragile ce qui correspond la fragilit de l unit entre fer et argile dcrite dans la vision.
Cet empire, qui est Byzance, s est renforc et a eu sous sa domination la Palestine, l Asie Mineure, la Syrie, la Msopotamie, l Egypte et l Afrique du Nord durant des sicles, et cela jusqu la venue de l Islam.
Le dbut de la rvlation du Coran au Prophte Mohammad eut lieu en 610, aprs des annes de persvrance le Prophte russit fonder un tat Mdine et par la suite la pninsule arabique s unifia sous sa bannire. Aprs sa mort, l expansion de l Islam a connu une allure trs rapide. Nous nous bornons ici donner quelques dtails : Au milieu du VIIe sicle, l empire byzantin avait perdu en Orient la Msopotamie, la Syrie, la Palestine et l Egypte, conquises par les Arabes .
Les conqutes et l hgmonie arabes, qui firent rayonner l Islam sur une vaste zone allant de l Atlantique aux frontires de la Chine et l Insulinde, portrent le coup de grce ce qui restait de l empire romain mditerranen, boulevers par les grandes invasions barbares. L empire romain d Orient, son tour, fut branl par les Arabes du VIIe sicle, il ne les arrta qu aux prix d abord, de ses territoires les plus riches et les plus peupls, la Syrie et l Egypte, puis de ses dernires possessions en Mditerrane occidentale, l Afrique et la Sicile.
Quand, en 1453, les Turcs entrrent Constantinople, une nouvelle religion et un nouvel tat prirent la place de l empire chrtien d Orient. (Histoire universelle, II, 271).
Et ainsi l empire romain connut sa chute et sa destruction finale par la force de l Islam, rvlation qui a fond le royaume de Dieu voqu dans les visions du livre de Daniel.
L expansion de l Islam ne ressemble aucune autre, ni celles qui la prcdent (migration des masses innombrables des nomades de l Asie lointaine) ni celles qui l ont suivie (grandes invasions des Europens jouissant, pour s imposer, en Amrique et en Afrique, d une supriorit militaire absolue).
L Arabie n tait gure peuple et les Arabes ne possdaient mme pas les armes et les techniques militaires de la Perse ou de Byzance. L empire arabe donc ne se fonda pas sur un rapport de forces lui assurant une crasante suprmatie (cf. R. Garaudy, Promesses de l Islam, p.23).
La leve du Prophte, sa victoire en Arabie, la progression fulgurante de ses successeurs rgnant, moins d un sicle aprs sa mort, sur la quasi-totalit du monde alors connu, l exception d une partie de l Europe vgtante et d une Chine montant vers son apoge, ne peuvent se comprendre sans reconnatre une place premire au message spcifique de l Islam (Ibid, p. 24). R. Garaudy souligne deux aspects fondamentaux expliquant ce phnomne extraordinaire dans l histoire humaine : transcendance de Dieu et communaut. Donc les raisons profondes de cette expansion fulgurante furent des raisons internes, lies l essence mme de l Islam.
L affirmation radicale de la transcendance de Dieu, en relativisant tous les pouvoirs, postulait une galit de principe entre tous, et devenait donc un ferment de libration de toutes les oppressions politiques, conomiques ou religieuses. C est ce qui explique pourquoi une seule victoire militaire sur chacun des despotes rgnants fait effondrer les empires.
Dans chaque cas, aprs la dfaite de la caste dominante dteste du peuple, les Arabes sont accueillis en librateurs par ceux qui taient victimes d une oppression sociale ou politique ou d une perscution religieuse (Id. p. 35-36).
L ouverture de l Islam et sa tolrance envers toutes les sectes religieuses expliquent sa rapide pntration.
Cet aperu historique, bien que bref, sur l empire romain et sa destruction partielle puis finale en 1453 par les forces de l Islam, dmontre clairement que le royaume de Dieu voqu dans les visions s appliquent parfaitement celui de l Islam. D une part, du point de vue des faits : l empire musulman, constitu au VIIe sicle, est un empire ayant pour principe de fondation une rvlation qui lui permet d tre appel royaume de Dieu . D autre part, la destruction des empires de l poque, notamment l empire romain d Orient, concorde avec les explications donnes dans le livre de Daniel ; c'est--dire que l croulement du quatrime empire (l empire romain) ne s effectuera qu aprs la division et ne se fera que par un royaume de Dieu.
Le texte, en effet, prcise que lorsque l empire romain se divisera, en une partie solide (l empire d Orient) et une partie fragile (l empire d Occident), Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais dtruit. Ce royaume ne passera pas sous la domination d un autre peuple ; il pulvrisera et anantira tous ces royaumes-l.
1. Au temps de ces rois, Dieu suscitera , implique qu aprs la division et la faiblesse d une partie de l empire, le royaume de Dieu sera suscit.
2. Ce royaume dtruira tous les royaumes de l poque surtout les plus grands et notamment celui qui domine la Palestine. Ce qui est arriv.
3. Il subsistera ternellement.
Il est signaler que malgr les invasions successives des Croiss, des Mongols-Tartares et des Europens l poque moderne, ce royaume existe toujours et absorbe tous les autres peuples (comme les Mongols qui se convertissaient), ou les rejette (comme les Croiss et les colonisateurs).
Le texte donne encore une image qui explique la progression et la croissance de ce royaume (comme le faisait Jsus en le comparant au grain de moutarde qui devenait un grand arbre). Le royaume de Dieu c est cette pierre qui devenait une grande montagne qui remplit toute la terre aprs avoir dtruit tous les royaumes qui le prcdaient.
*************************
CHAPITRE II
MOHAMMAD DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Dans le Nouveau Testament on y trouve des prophties concernant le royaume de Dieu, la nation qui l instaurera et le prophte qui en sera la fois prcurseur et fondateur.
I.
Le Royaume de Dieu ou des cieux
En ce temps-l parut Jean-Baptiste, il prchait dans le dsert de Jude. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. (Matthieu, 3 : 1-2).
Ds lors Jsus commena prcher, et dire : Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. (Id. 4 : 17, voir 4 : 23 et Marc, 1 : 15).
Jsus a ordonn aux douze Aptres ceci : N allez pas vers les paens, et n entrez pas dans les villes des Samaritains ; allez plutt vers les brebis perdues de la maison d Isral. En chemin, prchez que le royaume des cieux est proche. (Matthieu, 10 : 6-7, et voir Luc, 9 : 1-2).
Aprs cela, le Seigneur en dsigna encore 70 autres et les envoya devant lui, deux deux, dans toute ville et tout endroit o lui-mme devait aller. Il leur disait Dans quelque ville que vous entriez, et o l on vous recevra, mangez ce qu on vous prsentera, gurissez les malades qui s y trouveront, et dites-leur : le royaume de Dieu s est approch de vous. (Luc, 10 : 1, 8-9).
Jsus par plusieurs paraboles illustra ses disciples et aux gens qui coutaient son enseignement, la grandeur, la gloire et les fruits que produira ce royaume.
Les thologiens chrtiens sont d accord sur le fait que le royaume de Dieu prch tour tour par Jean-Baptiste, Jsus et ses disciples, est celui voqu dans la vision des chapitres 2 et 7 du livre de Daniel.
Nous avons vu que ce royaume devait apparatre aprs la division du quatrime empire en deux : empire d Occident, qui tait fragile, et d Orient qui tait solide. Et l apparition de ce royaume, se produirait la destruction du quatrime empire ainsi que celle des autres.
Ce royaume de Dieu commena petit puis il s tendit sur toute la terre.
Par diverses paraboles, Jsus a donc confirm les visions du livre de Daniel. (voir Matthieu, 13 : 24-41 ; 22 : 2-14 ; 25 : 1-30 ; Marc, 4 : 26-32 ; Luc, 13 : 18-21).
II.
La transmission du Message divin une Nation fidle
Parabole de la Pierre
Dans Matthieu, 21 : 33-44, Jsus a dit :
Ecoutez une autre parabole. Il y avait un matre de maison qui planta une vigne. Il l entoura d une haie, y creusa un pressoir et y btit une tour, puis il la loua des vignerons et partit en voyage. A l approche des vendanges il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frapprent l un, turent l autre et lapidrent le troisime. Il envoya encore d autres serviteurs en plus grands nombre que les premiers ; et les vignerons les traitrent de la mme manire. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant : ils respecteront mon fils. Mais, quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux : c est lui l hritier, venez, tuons-le, et nous aurons son hritage. Ils le prirent, le jetrent hors de la vigne et le turent. Maintenant, lorsque le matre de la vigne viendra, que fera-t-il ces vignerons ? ils lui rpondirent : il fera prir misrablement ces misrables et il louera la vigne d autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. Jsus leur dit : N avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu ont rejete ceux qui btissaient est devenue la principale, celle de l angle ; c est du Seigneur que cela est venu, et c est une merveille nos yeux. (Psaume, 118 : 22). C est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlev et sera donn une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l crasera. (Et voir Marc, 12 : 1-12 ; Luc, 20 : 9-18).
Dans cette parabole Jsus a montr l incrdulit des Juifs envers les prophtes et a annonc que le message divin serait transmis une autre nation, tout en appuyant sa parabole par des versets de l Ancien Testament.
Dans cette parabole, le matre de la maison c est Dieu. La maison c est le monde. Les vignerons sont ceux qui avaient reu de Dieu une loi et une Ecriture ; c est une allusion aux Juifs.
Les serviteurs sont les prophtes de Dieu auprs des Juifs.
Le dernier que Dieu a envoy aux Isralites est Jsus, dsign dans la parabole par le fils . Ce terme peut tre appliqu Jsus, vu qu il est le dernier prophte aux Juifs et, un de leurs grands prophtes. Cependant, ce terme a pu tre mis dans la bouche de Jsus pour dire qu il est le fils de Dieu. C'est--dire que la communaut chrtienne l a employ pour dsigner Jsus, en le croyant ainsi.
Aprs la rbellion des Juifs et leurs crimes envers sa rvlation et ses serviteurs Dieu donne le royaume une autre nation.
La pierre cite dans le texte peut tre rapproche de celle de la vision de Daniel, qui est devenue une grande montagne. Jsus, dans une autre parabole, a employ le grain de moutarde, qui crot et devient un grand arbre, pour illustrer l expansion du royaume de Dieu.
Le texte souligne que la vigne c'est--dire la parole de Dieu ou sa loi seront donnes une autre nation.
Jsus a donn des caractristiques la pierre qui symbolise la nation :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Elle a t rejete auparavant. Elle deviendra la principale, celle de l angle. L lection de cette pierre provient de Dieu. Cette lection est une merveille aux yeux des Isralites. Quiconque attaquera cette pierre s y brisera et celui sur qui elle tombera, elle l crasera. Elle produira les fruits du royaume de Dieu.
Celui qui mdite sur ces versets constatera que le fils cit dans le texte n est pas la pierre . Car aprs avoir tu le fils[27] comme dit le texte, la vigne sera donne une autre nation qui est symbolise par la pierre.
Donc les caractristiques da la pierre se rapportent la nation et non au fils. Il est dit, en effet, dans le texte que le royaume sera donn une autre nation. Puis le texte souligne que celui qui tombera sur cette pierre s y brisera; ce qui confirme que la pierre est le symbole de la nation prcite.
Vrifions maintenant les caractristiques de cette pierre c'est--dire de cette nation :
1. Elle a t rejete auparavant.
Cette nation a t rejete et mprise par les Juifs. En effet, la nation mprise par les Juifs est celle des Ismalites (c'est--dire les Arabes). Cette attitude des Juifs a t hrite, probablement, de Sara qui avait mpris sa servante Agar et son fils Ismal et avait demand Abraham de les chasser (voir la Gense, 21 : 8-13).
Dieu, pour provoquer la jalousie des Juifs qui ont transgress ses commandements et sa loi, suscita cette nation mprise pour produire les fruits du royaume (Dans le Deutronome, 32 : 21, Dieu promet de provoquer la jalousie des Juifs par une nation insense, comme nous l avons vu).
2. Elle deviendra la principale, celle de l angle.
C'est--dire aprs que cette nation ait t mprise et rejete, elle deviendra la nation la plus importante.
3. L lection de cette nation provient de Dieu.
La rvlation donne cette nation, le prophte qui lui a t envoy sont des grces de Dieu envers elle. Le Coran souligne ces grces et cette lection dans ces versets : Dieu a accord une grce aux croyants lorsqu il leur a envoy un prophte pris parmi eux qui leur rcite ses versets ; qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu ils avaient t auparavant dans une erreur manifeste. (3 : 164), Vous formez la meilleure communaut suscite pour les hommes : vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez ce qui est blmable, vous croyez en Dieu. (3 : 110).
4. Cette lection est une merveille aux yeux des Isralites.
Il ne serait pas raisonnable de dire que cette prophtie s applique Jsus, tout simplement parce qu il est Juif ; par consquent lui-mme s merveillera de ce qui arrivera.
En effet, l lection de cette nation est une merveille ou un prodige aux yeux des Juifs, surtout pour leurs prophtes. Ceci pour deux raisons, la premire consiste dans le fait d lire une nation mprise des Juifs ( l exception des justes), la seconde rside dans les fruits que produira cette nation bien qu elle soit insense, ignorante et aveugle comme la qualifie la prophtie du Deutronome dj vue.
5. Quiconque attaquera cette nation s y brisera et celui sur qui elle tombera sera cras.
Cette nation triomphera de ses ennemis. Par contre les ennemis qui voudraient l attaquer s y briseront.
6. Elle produira les fruits du royaume de Dieu.
Toutes ces caractristiques s appliquent parfaitement la nation arabe. Elle a t mprise et rejete par les Juifs, ensuite elle est devenue une importante nation grce la rvlation coranique communique au Prophte Mohammad. Cette nation laquelle a t donn le royaume de Dieu, en a produit les fruits ; le tmoignage de l histoire est suffisant, et tout le monde apprcie les fruits de la civilisation islamique dans tous les domaines de la vie. Les nations et les peuples qui ont attaqu les musulmans depuis 14 sicles furent vaincus (les Croiss, les Mongols, les Tartares et les Europens). Alors que les musulmans se sont fondus sur les divers empires et les ont battus (Romains, Perse, Wisigoth, etc.).
III. Parabole des ouvriers et de la vigne : Les derniers seront les premiers
Dans une autre parabole Jsus a dit (Matthieu, 20 : 1-16) :
Car le royaume des cieux est semblable un matre de maison qui sortit ds le matin, afin d embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisime heure, en vit d autres qui taient sur la place sans rien faire et leur dit : Allez, vous aussi ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y allrent. Il sortit de nouveau vers la sixime, puis vers la neuvime heure, et il fit de mme. Vers la onzime heure il sortit encore, en trouva d autres qui se tenaient encore l et leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journe sans rien faire ? Ils lui rpondirent : c est que personne ne nous a embauchs. Allez, vous aussi, dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le matre de la vigne dit son intendant : Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzime heure vinrent et reurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurrent contre le matre de la maison, et dirent : ces derniers venus n ont fait qu une heure, et tu les traites l gal de nous, qui avons support le poids du jour et la chaleur. Il rpondit l un d eux : Mon ami ! Je ne te fais pas tort, n as-tu pas t d accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est toi et va-t-en. Je veux donner celui qui est le dernier autant qu toi. Ne m est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais il que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers.
Il est noter que ce passage parle de trois groupes, vu leur attitude et le comportement du matre leur gard. Le premier groupe est dsign dans le texte par les premiers , le troisime est dsign par les derniers et le deuxime, est celui qui forme le bloc de tous les ouvriers qui sont entre les premiers et les derniers ; nous avons mis tous ces ouvriers dans un mme groupe parce qu ils avaient la mme attitude qui tait la soumission au matre, sans avoir object ou revendiqu.
Il est clair que le Matre de la maison est Dieu, la vigne est la loi reue ou le monde o on pratique les ordres de Dieu. Les divers ouvriers sont les divers peuples et nations qui ont reu une rvlation
Les premiers ouvriers sont les Juifs parce qu ils furent le premier peuple recevoir une loi divine.
Le deuxime groupe d ouvriers qui n a pas manifest d objections rassemble les divers peuples qui ont reu une rvlation divine. On peut insrer les Chrtiens dans le premier groupe parce que les premiers Chrtiens taient des Juifs, mais on peut aussi les insrer parmi le deuxime groupe parce qu il y avait parmi eux des non-Juifs[28]. Les derniers qui ont reu une rvlation divine sont les Musulmans. L objection des Juifs leur gard est tout fait confirme par les autres textes que nous avons vus comme celui du Deutronome (32 : 21), et Matthieu (21 : 33-44 ; la pierre, la nation).
IV. Le fils de l Homme
Dans Matthieu, 24 : 30-35, Jsus a dit :
Immdiatement aprs ces jours de dtresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clart, les toiles tomberont du ciel, les puissances clestes seront branles. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparatra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nues du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler, au son des trompettes clatantes, ses lus des quatre coins du monde, d'un bout l'autre de l'univers. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement : quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l't est proche. De mme, quand vous verrez tous ces vnements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette gnration-ci ne passera pas avant que tout cela ne se ralise. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il leur dit encore : en vrit, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goteront point la mort avant d avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. (Marc, 9 : 1).
Nous avons dmontr dans l interprtation de la vision de Daniel que le terme Fils de l Homme ne se rapporte pas Jsus et nous avons appuy notre interprtation par le verset de Marc (8 : 38) : En effet quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette gnration adultre et pcheresse, le Fils de l Homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son pre avec les saints anges ; de mme nous l avons appuye par le tmoignage des thologiens : O. Cullmann et Mathias Delcor.
Nous avons aussi dmontr, suivant l interprtation de M. Delcor, que l expression sur les nues a t traduite aussi par avec les nues , (comme dans Marc, 14 : 62 et Apocalypse, 1 : 7).
D autre part, les changements que subirait des lments de la nature (soleil, lune, toile) ne sont que des images potiques, commodes l imagination des smitiques en gnral, et des Juifs en particulier. Il se peut que ces images aient t mises dans la bouche de Jsus par la communaut primitive des Chrtiens. Ce qui confirme cette explication c est que, bien que ces choses se soient produites les habitants de la terre sont encore vivants. Donc l emploi de ces images souligne simplement la grandeur et la gloire du Fils de l Homme.
Le Fils de l Homme est le fondateur du royaume de Dieu, comme il apparat de ce texte. D ailleurs nous avons vu que le royaume de Dieu, instaur par ce personnage, dtruit le 4e empire. Et Jsus dans ce passage-l souligne que le Fils apparatra bientt, mme avant la fin de la gnration existante son poque. Ce qui signifie que cette personne qui instaurera le royaume de Dieu apparatra l poque du quatrime empire. Et c tait pour cela que les Chrtiens de cette gnration croyaient que le royaume viendrait vers la fin du premier sicle. Oscar Cullmann le souligne dans son livre, le Nouveau Testament, p. 124 : il est vrai qu au dbut du Christianisme, cette fin a t attendue pour un avenir trs proche Les premiers Chrtiens, en effet, et Paul lui-mme attendaient le retour du Christ pour leur gnration. p. 52 ( voir aussi, Will Durant, Histoire de la civilisation, IX, p. 253).
Donc nous sommes face deux hypothses : ou bien ce texte est faussement attribu Jsus. Ou bien, tout simplement, le texte veut affirmer que le temps de l instauration du royaume de Dieu et l avnement du Fils de l Homme sont trs proches parce qu ils se produiront l poque mme du quatrime empire qui existait dj.
La dernire hypothse est inluctable mme pour les Chrtiens bien qu ils aient essay de l interprter autrement.
Le texte, en effet, affirme que cet avnement est trs proche, en donnant des exemples pour l expliquer. D ailleurs les autres textes que nous avons vus parlent de l avnement du royaume de Dieu et montrent qu il est trs proche[29].
En conclusion, nous nous posons la question : si les visions de Daniel montrent que le royaume de Dieu dtruira le 4e empire, et si les rcits du Nouveau Testament affirment que le royaume de Dieu est proche, ces textes ne visent-ils donc pas le royaume instaur par le Prophte Mohammad ?
V. Le grand Messie n est pas un fils de David
Dans Matthieu, 22 : 41-44, il est dit :
Comme les Pharisiens taient assembls, Jsus leur posa cette question : Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ? ils lui rpondirent : de David. Et Jsus leur dit : comment donc David, anim par l Esprit, l appelle-t-il Seigneur, lorsqu il dit : Le Seigneur a dit mon Seigneur : Assieds-toi ma droite, jusqu ce que je mette tes ennemis sous tes pieds ? (Psaume 110 : 1). Si donc David l appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne put lui rpondre un mot. (voir aussi : Marc, 12 : 35-37 ; Luc, 20 : 41-44).
Jsus a dmontr aux Juifs que celui qu on appelait Christ (c'est--dire Messie = Oint de Dieu) n est pas un descendant de David comme ils le prtendaient. Et pour les convaincre il cite le verset 1 du Psaume 110 o David appelle Le Christ , mon Seigneur . Or s il tait son fils il ne l aurait pas appel mon Seigneur ; car le pre est plus grand que son fils.
Cette affirmation de Jsus nous suggre deux hypothses :
1- La premire hypothse : si le Christ est Jsus, alors Jsus ne serait pas le fils de David, et les versets qui se trouvent soit dans l Ancien Testament, soit dans le Nouveau, considrant le Christ comme descendant de David seront faux ( comme dans Matthieu, 1 : 6 ; 9 : 27 ; Luc, 1 : 31-32 ; 3 : 32 ; Jean, 7 : 42, etc.).
Il est souligner que Jsus n a jamais dit en parlant de David : Mon pre David (ex : Marc, : 25-26).
Si cette hypothse se confirme, Jsus n aurait pas le trne de David et ne serait pas le Grand Christ qu on attendait.
En effet, cette dduction est confirme par d autres faits bibliques :
Nous savons bien que Zacharie, pre de Jean-Baptiste, tait le sacrificateur (voir Luc, 1 : 5) ce qui implique qu il est de la descendance d Aaron. Le verset de Luc rapporte qu il est de la classe d Abia (ou Abija). Abia, comme le montre le verset 10 du chapitre 24 du premier livre des Chroniques, est un descendant d Aaron. En outre la femme de Zacharie est aussi de la descendance d Aaron comme le rapporte le verset 5 du chapitre 1 de Luc. Et du verset 36 du mme chapitre, nous apprenons que Marie, mre de Jsus, est parente d Elisabeth, femme de Zacharie. Il est donc trs probable que Marie, elle-mme, fut une descendante d Aaron, ce qui nous amne conclure que Jsus qui n a que la mre est un descendant d Aaron et non de David.
2- La deuxime hypothse : si Jsus est le fils de David comme le soulignent les vanglistes, le Christ dont il est question dans les versets prcits (de Matthieu et du Psaume) ne serait pas Jsus mais un autre qui n est pas descendant de David.
Dans ce cas le titre Christ ne dsigne pas forcment Jsus mais peut tre port par n importe quel autre prophte. Cependant, le Christ dont parlent ces versets ne peut tre que le grand Messie[30].
Ce dernier ne serait pas un descendant de David[31].
VI.
Le Prophte attendu
Dans Jean, 1 : 19-25, il est dit :
Voici le tmoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyrent de Jrusalem des sacrificateurs et des Lvites pour lui demander : Toi, qui es-tu ? Il confessa sans le nier, il confessa : Moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandrent : Quoi donc ? es-tu Elie ? Et il dit : Je ne le suis pas. Es-tu le Prophte ? et il rpondit : Non. Ils l interrogrent et lui dirent : Pourquoi donc baptises-tu, si tu n es pas le Christ, ni Elie, ni le Prophte ? .
Et dans 7 : 40-41, il est crit :
Des gens de la foule, aprs avoir entendu ces paroles, disaient : celui-ci est vraiment le Prophte. D autres disaient : celui-ci est le Christ.
De ces deux textes nous constatons qu il y a une distinction nette entre le Christ et le Prophte (dont parle la prdiction du Deutronome, 18 : 15, dj vue), et ce Prophte, jusqu l poque de Jsus, n tait pas encore apparu. Qui est-il donc ? (voir la 1e prophtie de l Ancien Testament).
VII.- Le Prophte est plus puissant que Jean-Baptiste
Dans Matthieu, 3 : 1, 7-12, il est dit :
En ce temps-l, parut Jean-Baptiste. Il se mit prcher dans le dsert de Jude. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche
Comme il voyait venir au baptme beaucoup de pharisiens et de sadducens, il leur dit : Espces de vipres ! Qui vous a enseign fuir la colre de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutt par vos actes que vous avez chang de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de rpter en vous-mmes : Nous sommes les descendants d'Abraham. Car, regardez ces pierres : je vous dclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention : la hache est dj sur le point d'attaquer les arbres la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coup et jet au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient aprs moi : il est bien plus puissant que moi et je ne suis mme pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera d Esprit Saint et de feu. Il tient en main sa pelle vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le bl dans son grenier. Quant la paille, il la brlera dans un feu qui ne s'teindra jamais. (voir aussi, Luc, 3 : 7-9 et 15-17).
Jean-Baptiste dans ce texte a dclar aux Pharisiens et aux Sadducens qui prtendaient tre de la descendance d Abraham mais sans accomplir ses uvres, que Dieu pourrait susciter, des pierres, des enfants Abraham. Cela suggre que les autres fils d Abraham, notamment les descendants d Ismal, pouvaient recevoir la lumire divine.
D autre part, Jean-Baptiste, a assimil les Juifs qui ne pratiquaient pas les bonnes uvres un arbre qui ne produit pas de fruits. Cette expression ressemble la parabole de Jsus o il dit que le royaume de Dieu sera donn une autre nation qui en produira les fruits.
Ensuite, Jean-Baptiste voque la personne qui doit venir aprs lui et qui sera le prince du royaume qui est proche. Cette personne est plus grande que Jean, et baptisera les Juifs de deux choses : par l Esprit Saint et par le feu. C'est--dire qu elle baptisera ceux des Juifs qui croiront en lui d Esprit saint, et par le feu ceux qui ne croiront pas en lui.
Ces deux caractristiques ne s appliquent pas Jsus, car selon les vanglistes, Jsus a t livr par les Juifs au gouverneur romain pour le crucifier. Il ne les avait donc pas baptiss par le feu.
Par contre le prophte Mohammad a baptis ceux des Juifs qui ont cru en lui par l Esprit Saint ; c'est--dire la rvlation coranique. Et a baptis ceux parmi eux qui n ont pas cru en lui de feu ; c'est--dire il les a tus et par consquent ils taient entrs en Enfer. La parabole de Jean-Baptiste montre que l arbre qui ne produit pas de fruit on le jette au feu ; ce qui est arriv effectivement par le truchement du prophte Mohammad et non par Jsus.
VIII.
Le Vainqueur de l Apocalypse
Dans l Apocalypse, 2 : 26, Jsus a dit :
Au vainqueur, celui qui garde mes uvres jusqu la fin, je donnerai autorit sur les nations. Avec un sceptre de fer il les fera patre, comme on brise les vases d argile, ainsi que j en ai reu moi-mme le pouvoir de mon pre. Et je lui donnerai l toile du matin.
Qui est ce vainqueur qui aura autorit sur les nations aprs Jsus ? Et qui recevra l toile du matin ? (l toile du matin dsigne trs probablement la rvlation).
Il n existait personne d autre qui ait t vainqueur de ses ennemis, qui ait eu l autorit sur les nations et qui ait reu une lumire divine (la rvlation) que le prophte Mohammad.
Dans l Apocalypse, 6 : 1-2, il est crit :
Je regardai, quand l Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j entendis l un des quatre tres vivants dire comme d une voix de tonnerre : Viens. Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc ; une couronne lui fut donne, et il partit en vainqueur et pour vaincre.
Selon les exgtes l Agneau est Jsus, donc celui qui montait le cheval blanc ne serait pas lui, c est la mme personne vue plus haut, appele vainqueur et qui aura une autorit sur les nations.
Voir aussi l Apocalypse, 19 : 11-21 et 20 : 1-8 ; o on dcrit une personne tout en lui donnant les surnoms : Fidle et Vritable .
Nous signalons que ces deux surnoms donns cette personne sont ceux du prophte Mohammad ; on les lui avait donns par ses compatriotes mecquois, vu ses qualits vertueuses, avant mme qu il reoive la rvlation et la prophtie.
Quant au terme Christ , cit dans ce texte, il ne s agit pas forcment de Jsus, comme nous l avons dmontr auparavant.
Le terme bte , quant lui, dsigne l empire romain selon les exgtes chrtiens. Le texte souligne que le Fidle et Vritable a vaincu la bte et l a tue. En effet l empire romain fut dtruit par les Musulmans.
Le rgne de mille ans, est celui de la civilisation islamique du VIIe sicle au XVIIe sicle o les Europens ont commenc tendre leur rgne sur le monde. Le texte signale qu aprs les mille ans, Satan sera relch de sa prison ; ce qui s applique avec l hgmonie des Europens qui ont vulgaris l athisme et l incrdulit dans le monde soit par leurs philosophies, soit par leurs crimes, vis--vis des autres peuples. Mais ce rgne ne durera pas comme le souligne le texte.
IX. Le Paraclet de l Evangile de Jean[32]
Jean est le seul vangliste rapporter, la fin du dernier repas de Jsus, l pisode des ultimes entretiens avec les Aptres, qui se termine par un trs long discours : quatre chapitres de l Evangile de Jean (14 17) sont consacrs cette narration, dont on ne trouve aucune relation dans les autres vangiles. Et, pourtant, ces chapitres de Jean traitent des questions primordiales, de perspectives d avenir d une importance fondamentale, exposes avec toute la grandeur et la solennit qui caractrisent cette scne des adieux du Matre ses disciples.
Comment peut-on expliquer que fasse entirement dfaut chez Matthieu, Marc et Luc le rcit d adieux si touchants qui contiennent le testament spirituel de Jsus ? On peut se poser la question suivante : le texte existait-il initialement chez les trois premiers vanglistes ? N a-t-il pas t supprim par la suite ? Et pourquoi ? Disons tout de suite qu aucune rponse ne peut tre apporte ; le mystre reste entier sur cette norme lacune dans le rcit des trois premiers vanglistes.
Ce qui domine le rcit est la perspective de l avenir des hommes voque par Jsus et le souci du Matre d adresser ses disciples et, par eux, l humanit entire, ses recommandations et ses commandements et de dfinir quel sera en dfinitive le guide que les hommes devront suivrent aprs sa disparition. Le texte de l Evangile de Jean et lui seul dsigne explicitement sous le nom grec de Parakletos, devenu Paraclet en franais. En voici, selon la traduction cumnique de la Bible, Nouveau Testament, les passages essentiels :
Si vous m aimez, vous vous appliquerez observer mes commandements ; moi je prierai le Pre : il vous donnera un autre Paraclet. (14 : 15-16).
Que signifie Paraclet ? Le texte que nous possdons actuellement de l vangile de Jean explique son sens en ces termes :
Le Paraclet, l Esprit Saint que le Pre enverra en mon nom, vous communiquera toutes choses, et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit (14 : 26).
Il rendra lui-mme tmoignage de moi (15 : 26). C est votre avantage que je m en aille ; en effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vous ; si au contraire je pars, je vous l enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matire de pch, de justice et de jugement.)8-7 : 61(
Lorsque viendra l Esprit de vrit, il vous fera accder la vrit toute entire, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera.)41-31 : 61(
( A noter que les passages non cits ici des chapitres 14 17 de l Evangile de Jean ne modifient aucunement le sens gnral de ces citations).
Si l on en fait une lecture rapide, le texte franais qui tablit l identit du mot grec Paraclet avec l Esprit Saint n arrte pas le plus souvent l attention. D autant plus que les sous-titres du texte gnralement employs dans les traductions et les termes des commentaires prsents dans les ouvrages de vulgarisation orientent le lecteur vers le sens que l orthodoxie veut donner ces passages.
Il semble curieux que l on puisse attribuer l Esprit Saint le dernier paragraphe cit plus haut : il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir . Il parait inconcevable qu on puisse prter l Esprit Saint les pouvoirs de parler et de dire ce qu il entend.
Pour avoir une ide exacte du problme, il est ncessaire de se reporter au texte grec de base, ce qui est d autant plus important que l on reconnat l vangliste Jean d avoir crit en grec et non en une autre langue. Ce texte grec consult fut celui de Novum testamentum Greace (Nestl et Aland, 1971).
Toute critique textuelle srieuse commence par la recherche des variantes. Il apparat ici que, dans l ensemble des manuscrits connus de l Evangile de Jean, il n existe pas d autre variante susceptible d altrer le sens de la phrase que celle du passage 14 : 26 de la fameuse version en langue syriaque appele Palimpseste (crit au IVe ou Ve sicle et dcouvert au mont Sina, en 1812 par Agns S. Lewis). Ici, on ne mentionne pas l Esprit Saint, mais l Esprit tout court. Le scribe a-t-il fait un simple oubli ? Ou bien plac en face d un texte recopier qui prtendait faire entendre et parler l Esprit Saint, n a-t-il pas os crire ce qui lui paraissait tre une absurdit ?
L essentiel est que ce qui est expos ici sur la signification prcise des verbes entendre et parler vaille pour tous les manuscrits de l Evangile de Jean et c est le cas.
Le verbe entendre de la traduction franaise est le verbe grec akou, qui signifie percevoir des sons. Il a donn, par exemple, en franais le mot acoustique, en anglais acoustics, qui est la science des sons.
Le verbe parler de la traduction franaise est le verbe grec lale, qui a le sens gnral d mettre des sons et le sens particulier de parler. Ce verbe revient trs souvent dans le texte grec des Evangiles pour dsigner une dclaration solennelle de Jsus au cours de sa prdication. Il apparat donc que la communication aux hommes dont il est fait tat ici ne consiste nullement en une inspiration qui serait l actif de l Esprit Saint, mais elle a un caractre matriel vident en raison de la notion d mission de son, attache au mot grec qui la dfinit.
Les deux verbes grecs akou et lale dfinissent donc des actions concrtes qui ne peuvent concerner qu un tre dou d un organe de l audition et d un organe de la parole. Les appliquer par consquent l Esprit Saint n est pas possible.
Ainsi, tel qu il nous est livr par les manuscrits grecs, le texte de ce passage de l Evangile de Jean est parfaitement incomprhensible si on l accepte dans son intgrit avec les mots Esprit Saint de la phrase (14 : 26) : le Paraclet, l Esprit Saint que le Pre enverra en mon nom , etc., seule phrase qui, dans l Evangile de Jean, tablit l identit entre Paraclet et Esprit saint.
Mais si l on supprime les mots Esprit Saint de cette phrase, tout le texte de Jean prsente une signification extrmement claire. Elle est d ailleurs concrtise par un autre texte de l Evangliste, celui de la premire ptre o Jean utilise le mme mot pour dsigner tout simplement Jsus en tant qu intercesseur auprs de Dieu. Et quand Jsus dit, selon Jean (14 : 16) : Je prierai le Pre : il vous enverra un autre Paraclet , il veut bien dire qu il sera envoy aux hommes un autre intercesseur, comme il l a t lui-mme, auprs de Dieu en leur faveur lors de sa vie terrestre.
On est alors conduit en toute logique voir dans le Paraclet de Jean un tre humain comme Jsus, dou de facult d audition et de parole, facults que le texte grec de Jean implique de faon formelle. Jsus annonce donc que Dieu enverra plus tard un tre humain sur cette terre pour y avoir le rle dfini par Jean qui, soit dit en un mot, celui d un prophte entendant la voix de Dieu et rptant aux hommes son message. Telle est l interprtation logique du texte de Jean si l on donne aux mots leur sens rel.
La prsence des mots Esprit Saint dans le texte que nous possdons aujourd hui pourrait fort bien relever d une addition ultrieure tout fait volontaire, destine modifier le sens primitif d un passage qui, en annonant la venue d un prophte aprs Jsus, tait en contradiction avec l enseignement des Eglises chrtiennes naissantes, voulant que Jsus ft le dernier des prophtes. (Fin de citation).
D autre part, ce Paraclet rendra tmoignage de Jsus, mais l Esprit saint auquel on identifie le Paraclet n avait tmoign pour personne. Les Aptres n avaient pas besoin de ce tmoignage parce qu ils croyaient en Jsus avant la venue de cet Esprit. D ailleurs, les Aptres rendront aussi tmoignage de Jsus parce qu ils taient avec lui depuis le dbut de son ministre. Cette similitude entre ces deux tmoignages confirme que ce Paraclet est un tre humain comme les Aptres. Eux ils taient avec Jsus, lui il ne l tait pas, mais Dieu lui communiquera ce qu il dira de Jsus. Or si le Paraclet est l Esprit Saint il en rsultera une contradiction car l Esprit Saint est avec Jsus depuis qu il est dans le sein de sa mre. Aprs son baptme, fut par Jean-Baptiste, l Esprit a descendu sur lui comme une colombe. Nous citons quelques versets qui montrent ces faits : Luc, 1 : 35 : Le Saint Esprit viendra sur toi (Marie), et la puissance du Trs-Haut te couvrira de son ombre Luc, 3 : 22 : Et l Esprit saint descendit sur lui comme une
colombe. (voir aussi Luc, 4 : 1, 14, 18 ; Marc, 1 : 10-12 ; Matthieu, 1 : 18 ; 3 : 16 ; 4 : 1 ; et d autres).
En outre le tmoignage que rendra le Paraclet est indpendant de celui des Aptres ; ce qui implique qu il n est pas l Esprit Saint. Ce dernier n avait pas de tmoignage indpendant lorsqu il a t descendu sur les Aptres. C taient eux qui parlaient et non lui.
Par ailleurs, le dpart de Jsus tait une condition pour que le Paraclet vienne. Or comme nous l avons vu l Esprit Saint est toujours avec Jsus, le fortifiant, l animant, et par lui il chasse les dmons ( voir Matthieu, 12 : 22 ; Marc, 3 : 20-30 ; Luc, 10 : 21).
D autre part, d autres caractristiques donnes au Paraclet ne peuvent tre celles de l Esprit Saint : Et quand il sera venu, il confondra le monde en matire de pch, de justice et de jugement. (16 : 7-8).
L Esprit Saint qui a t descendu sur les Aptres ( Actes, 2 : 1-4) le jour de la Pentecte, n avait point reproch ou confondu quelqu un, mme par l intermdiaire des Aptres ; car leur rle tait d annoncer la bonne nouvelle et non de juger ou de confondre.
de pch parce qu ils ne croient pas en moi (16 :9).
Ceci implique que ce Paraclet sera vainqueur de ceux qui ne croyaient pas en Jsus et les confondra ( la majorit des Juifs ne croyaient pas en lui). Mais l Esprit Saint n tait point vainqueur du monde et n avait reproch personne sa mcrance en Jsus.
En outre Jsus a dit aux Aptres : j ai beaucoup de choses vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l Esprit de vrit, il vous conduira dans toute la vrit ; car ses paroles ne viendront pas de lui-mme, mais il parlera de ce qu il aura entendu et vous annoncera les choses venir. (16 : 12-13).
A la descente de l Esprit Saint, les Aptres n avaient pas compris de nouvelles choses qu ils ne pouvaient comprendre auparavant.
Par ailleurs, il est noter que dans les premiers sicles du Christianisme plusieurs personnes ont prtendu tre le Paraclet promis par Jsus : Montan lui-mme prophtisait avec une extase si loquente que ses disciples phrygiens, cdant au mme enthousiasme religieux qui avait autrefois engendr Dionysos salurent en lui le Paraclet promis par Jsus. (Wille Durant, Histoire de la civilisation, IX ; 255).
Donc ce Paraclet est un tre humain. Il entend la parole divine et la transmet aux hommes, il rend tmoignage propos de Jsus, comme les Aptres. Il n arrivera qu aprs Jsus, et sa venue il confondra le monde en matire de pch, de justice et de jugement. Ce Paraclet ne peut-il pas tre le Prophte Mohamad qui a rendu tmoignage au sujet de Jsus et qui a confondu le monde ?
Conclusion
Toutes les prophties que nous avons vu parlent d un prophte comme Mose, suscit d entre les frres des Isralites. Il ne parle pas de son propre chef (Deutronome,18 : 15-22).
Attendu par les juifs, et jusqu l poque de Jsus il n tait pas encore apparu (Jean,1 : 19,25). Il n est pas le fils de David (Matthieu, 22 : 41-44). Il rendra tmoignage de Jsus, viendra aprs lui et confondra le monde en matire de pch, de Justice et de jugement (Jean, 15 : 26 ; 16 : 7-8). Attendu des Sectaires de Qumran avec deux messies, auquel le bton de commandement et l insigne du lgislateur seront donns et par consquent loigns de Juda (Gense, 49 : 10), c est un vaillant guerrier, il combat pour la cause de la vrit et de la justice. Il est le plus beau des hommes. Il sera obi par des peuples et il vaincra de nombreuses nations. Les filles de rois seront parmi ses favorites ( des pouses), les rois lui enverront des prsents et des cadeaux, ses fils rgneront aprs lui ( psaumes,45 : 2-18 ; 72 : 1-17 ; Esaie, 42 : 1-9).
Il fait natre une nation d une manire extraordinaire qui bouleversera le monde (Esaie, 66 : 7-9).
Cette nation est mprise par les Juifs, elle est insense( Deutronome, 32 : 21). Le royaume lui sera transmis pour en produire les fruits( Matthieu, 21 : 33-44).
Une nouvelle religion ( le Cantique nouveau) s tablira parmi les fils de Qdar et de Nebayoth ( fils d Ismal) (Esaie,42 : 9-17 ; 60 : 15-16). Les fils d Ismal et tous les Arabes se rassembleront dans une ville sacre pour offrir des holocaustes sur l autel de Dieu et pour servir la maison de Dieu (Esaie,60 : 15-16). Cette maison sera servi par les rois. Les habitants de cette ville se rpandront droit (Est) et gauche (Ouest), vaincront les nations et hriteront
d elles (Esaie, 54 : 9-17). Ils taient auparavant dans les tnbres et adoraient les idoles (Esaie,54 : 17). Ils seront plus nombreux que les Isralites (Esaie, 54 : 1).
La rvlation divine apparatra Tmn et la montagne de Pran en Arabie (Deutronome, 33 : 1-3, Esaie 35 ; Habaqup 3 : 1-3). La paix se rtablira en cet endroit (Esaie, 60).
Ce prophte mobilisera sa nation et instaurera le royaume de Dieu qui dtruira le quatrime empire (Romain) ainsi que les autres (Daniel, 2 : 31-45 ; 7 : 1-28). A l poque de Jsus l avnement de ce royaume tait proche (Matthieu, 3 :1-2 ; 4 : 17 ; Marc, 1 : 15 ; Luc, 9 : 1-2).
Toutes ces caractristiques, ne sont-elles pas celles du Prophte Mohammad, de la nation arabe, de la Mecque, de l Arabie et de la civilisation islamique ?
*************************
TROISIEME PARTIE
JESUS DANS LE CORAN
CHAPITRE I :
JESUS, SA VIE ET SON UVRE
CHAPITRE II :
LA SERVITUDE DE JESUS A DIEU ENTRE LE TEXTE ET LA RAISON
CHAPITRE III :
L ESPRIT SAINT DANS LA BIBLE ET LE CORAN
CHAPITRE IV :
LES ARGUMENTS RATIONNELS ANNULANT LE DOGME DE LA TRINITE
Introduction
I. La part de la culture hellnistique Dans la formation du Christianisme
II. Le rle de l autorit politique romaine Dans le triomphe du Christianisme
Beaucoup de gens ignorent les causes principales qui avaient favoris la dformation de la vraie religion du Christ. Elles sont, en effet, d ordre culturel, politique et psychologique[33].
Ici nous nous bornons claircir les deux premiers facteurs dont l un, d ordre culturel, se ramifie en plusieurs branches que nous avons regroupes en deux grandes. Il s ensuit donc, de cette dichotomie, que les facteurs essentiels qui avaient contribu la formation de la doctrine chrtienne et la faire triompher, sont trois :
I. Le premier tait l influence de la culture grecque.
II. Le deuxime facteur, aussi d ordre culturel, tait l influence de la philosophie noplatonicienne.
III. Le troisime facteur, tait le rle de l autorit politique.
Ces trois facteurs essentiels ont contribu former une doctrine chrtienne et la faire triompher :
I. Le premier facteur est l influence de la culture grecque, avec ces deux facettes : philosophique et mythologique, dans l laboration de deux thmes ; celui de la divinit de Jsus et de sa filiation Dieu et celui de la rdemption. Les prcurseurs de ces thmes taient St Paul et l auteur du quatrime Evangile. Aprs eux, les philosophes convertis au Christianisme avaient essay de donner cette doctrine une base philosophique et un appui intellectuel, puiss dans la philosophie grecque.
II. Le deuxime facteur est l influence de la philosophie noplatonicienne et en particulier celle de Plotin. Celle-ci avait donn une forme dfinitive la doctrine chrtienne, qui sera proclame solennellement par le Concile de Constantinople (en 381 ap.J.-C).
III. Le troisime facteur tait le rle de l autorit politique romaine dans le premier et le dernier quart du quatrime sicle aprs Jsus. Cette autorit a favoris et mme fait triompher la doctrine prne par l auteur du quatrime Evangile et celle prche par St Paul, tout en condamnant les autres doctrines, surtout celle prche par Arius et ses partisans.
I. L influence de la culture grecque
De cette perspective il nous parait que le Christianisme n a pas t form et labor une fois pour toutes, mais il tait pass par des tapes, et avait connu des transformations importantes pour arriver enfin la forme actuelle.
En premier lieu, les quatre Evangiles appels canoniques avaient subi une influence plus ou moins grande de la culture hellnistique. Celle-ci s infiltra dans les Evangiles par l intermdiaire de Paul et d autres.
A. Son influence par l intermdiaire de St- Paul
et de Jean l Evangliste
L influence de Paul dans la composition et le contenu des Evangiles tait grande. Ses points de vue thologiques taient on ne peut plus manifestes dans ces recueils, et l on peut dire que nous n y trouvons pas de thses qui s opposent celles de Paul, l exception de quelques unes, recueillies dans d autres milieux. Et l on veut pour preuve, son influence sur le 3e e le 4e Evangile qui est certainement plus importante.
Par ailleurs, en esquissant une image de Paul et en cherchant les lments qui avaient constitu et form sa pense thologique, nous allons mettre le doigt sur les causes relles qui constituent le fondement des principaux dogmes du Christianisme.
Paul est Pharisien[34], d origine palestinienne qui tait fabricant des tentes Tarse l ancienne ville universitaire des Sleucides[35] o fleurissaient depuis trois sicles les coles pripatticiennes[36] et stocienne[37].
Paul avait reu la fois l ducation rabbinique Jrusalem et hellnique Tarse. (Histoire de l Antiquit des origines au VIIe sicle, p. 377. Voir aussi Will durant, Histoire de la civilisation, IX, 215-216, traduction de Jaques Marty, Editions Rencontre, 1963).
Cette culture acquise, avait contribu former la pense de Paul ; unifiant, ainsi, dans un mme courant, deux tendances distinctes en plusieurs points importants.
D une part, l ducation rabbinique, vaste et profonde, lui a permis de connatre largement l Ancien Testament et d y puiser volont.
D autre part, la culture hellnistique lui a fourni des principes et des instruments ncessaires pour interprter, sa guise, les textes sacrs, et qui allaient lui servir dans ses points de vue thologiques.
La preuve c est que l on constate dans les rcits des Actes des Aptres, que la prdication de Paul relie volontiers le message chrtien aux croyances supposes de l auditoire paen. La meilleure illustration de ce procd est offerte par le clbre discours d Athnes (Actes, 17 : 16-34).
L impression gnrale qui en ressort, comme le soulignait Jean Ppin, est que Paul, aprs s tre entretenu avec des philosophes stociens et picuriens hors du fracas de l Agora, prsente la Bonne Nouvelle, non pas comme une
rupture, mais comme un complment et un achvement de la thologie grecque. ( Histoire de la philosophie, sous la direction de F. Chtelet, II, 26).
Les autres points du Judasme et du Christianisme qui ne sont pas conformes cette doctrine, seront l objet de l interprtation, du camouflage et du jeu de mots. L ingniosit de Paul, son hardiesse donner aux textes sacrs des sens trop lointains, son loquence et sa duplicit vont l imposer la communaut chrtienne naissante et le consacrer comme interprte par excellence des textes sacrs de l Ancien Testament. Ainsi il attira sa cause un public (les juifs convertis) mal enseign sur les donnes de l Ancien Testament et un autre public parmi les paens qui trouve dans la prdication de Paul une continuit sa pense religieuse.
Le quatrime Evangile et les ptres de Paul sont, en effet, des exemples parfaits offrant une image claire de cette influence.
Premirement, le milieu o avait t labor le 4e Evangile, les caractristiques de son auteur et le but de la composition sont des lments intressants qui marquent cette uvre par une spcificit souligne par de nombreux thologiens chrtiens.
Cullmann dans son livre le Nouveau Testament (p.45) rsume les caractristiques de l auteur du quatrime Evangile dans ces points :
1. Il provient d un Judasme marginal et appartient un milieu thologique diffrent de celui des autres vanglistes, peut-tre celui des hellnistes de Palestine ou de Syrie.
2. Il ne fait pas ncessairement partie du groupe des Douze qui, comme tel, ne joue pas de rle dans cet vangile, alors que celui-ci mentionne d autres disciples intimes de Jsus.
3. Il ne semble pas appartenir au milieu social que les autres disciples de Jsus.
4. Il est probablement originaire de Jrusalem.
Deuximement, l influence de la philosophie religieuse grecque sur le Christianisme est souligne par certains penseurs europens et amricains. Nous citons parmi eux Reitzenstein ; son terrain favori, pour illustrer cette influence, fut l tude des mystres hellnistiques, auxquels Paul aurait t redevable en ce qui concerne la doctrine et le vocabulaire. Jean Ppin reprend les constatations de Reitzenstein en soulignant que l essentiel des mystres
d Attis, de Zagreus, d Adonis et de Mithra, consistait, pour le nophyte, dans une mort symbolique l instar du dieu et dans une rgnration par participation l esprit du dieu, garantissant le partage de son immortalit ; de mme que le myste tait assimil au dieu mourant et ressuscitant, de mme le baptme chrtien ensevelissait le fidle avec le Christ et le faisait ressusciter en mme temps que lui. (Id. II, 40).
D autre part, il est bon de choisir un terrain d investigation plus limit, d examiner par exemple ce que suggre la comparaison de la doctrine paulinienne avec celle des Stociens de l poque impriale (Snque, Epitectte, Marc-Aurne)[38].
On ne peut mconnatre, chez ces Stociens et chez Paul, la prsence de nombreux thmes communs. Ainsi, l ide d une parent de l homme avec Dieu, que l on a dj rencontre dans le discours d Athnes (Actes, 17 : 28-29), est souvent, prsente sous l aspect de l habitation divine dans l homme.
En plus de ces analogies considrables dans l architecture gnrale de la doctrine, il n est pas sans importance de souligner qu il y a une analogie, entre le langage technique des mystres et celui de Paul l instar de celle avance plus haut concernant les deux doctrines.
La philosophie de l poque hellnistique s exprimait volontiers dans une forme rhtorique particulire, comme sous le nom de diatribe cyno-stocienne . De cette diatribe, on a rapproch le style de la prdication notestamentaire ; en particulier celui de la prdication paulinienne. Sur ce dernier point l minent savant Rudolf Bultmann, exgse clbre du Nouveau Testament, a effectu ce travail intressant.
Parmi les procds qu il a repr aussi bien dans la diatribe que les Eptres de Paul, il y a ceux qui concernent la faon de citer librement les textes, en modifiant, pour les accommoder aux doctrines que l on veut tablir, ou encore, en bloquant certains d entre eux la manire d un centon.
En outre, l observation qui s impose au chercheur, touche la part considrable d expression symbolique laquelle le Christianisme et l hellnisme recourent galement pour rendre plus assimilables, au grand nombre des gens leurs croyances.
Ainsi l exgse allgorique tait l un des moyens favoris de Paul[39] et des Chrtiens qui vinrent aprs lui. Cette exgse s attache, dans tous les cas dgager dans les textes bibliques un sens symbolique, par-del le sens littral qui rebute le lecteur, et le bouleverse.
C est ainsi, notamment, que cette interprtation apparat requise chaque fois que le texte, entendu dans son sens littral, contiendrait une absurdit logique, une impossibilit matrielle, ou une dclaration indigne de Dieu. (J. Ppin, Id. II, 57)[40].
Le thme principal et le pivot de la prdication de Paul autour duquel gravitent les autres lments secondaires, est la personne de Jsus ; son rle par rapport l humanit et sa relation avec Dieu. Mais la formulation nette et sans ambigut de la thse de la divinit de Jsus fait dfaut dans les Eptres de Paul.
Les trois premiers Evangiles, les synoptiques, n en soufflent aucun mot ; mais ils donnent des aspects tendant considrer Jsus comme un homme parfait. Le seul Evangile qui en donne une impression nette et claire est celui de Jean.
Donc, les problmes et les questions qui affronteront les diverses tendances religieuses dans ces quatre sicles seront : la divinit ou la non divinit de Jsus, sa filiation spirituelle ou sa non filiation Dieu.
Mais, une dclaration manifeste sur la divinit de l Esprit Saint ou une conception prcise dterminant ses caractristiques et sa relation avec Dieu, n taient pas encore formules en cette poque. En effet, les quatre Evangiles ne font aucune allusion claire cette thse.
La lutte entre les deux courants, signals plus haut, s accentuait jusqu au moment o l autorit politique romaine (encore paenne) fit triompher, dans le 1er concile de Nice (en 325 ap. J. C.) la tendance reprsente par le 4e Evangile et qui tait soutenue par les philosophes convertis au Christianisme.
Dans ce concile, il n tait pas question de l Esprit Saint, et on y a gure fait allusion la Trinit. Il fallait attendre le deuxime concile appel 1er concile de Constantinople en 381 qui instaura la divinit de l Esprit saint pour former dfinitivement la Trinit, qui est la base du Christianisme actuel.
B. Son influence par l intermdiaire de Philon d Alexandrie
La mme mthode, dans plusieurs cas, fut, en effet, employe par Philon d Alexandrie, en interprtant les textes du Pentateuque, et en particulier de la Gense.
Dans ces entrefaites, il est important de souligner l influence directe ou indirecte de Philon d Alexandrie dans les principes doctrinaux prchs par Paul et les autres religieux aprs lui.
Philon tait un juif fervent. Son activit philosophique tait presque consacre l explication de la loi mosaque. Mais le lien de l allgorie est le seul qui lie ses ides au texte de la loi.
La mthode d interprtation allgorique tait employe l poque de Philon, et avant lui, dans le monde grecque (elle sera reprise par Paul). Bien avant les Stociens, qui avaient influenc Philon, ainsi que Paul, le procd avait t appliqu la mythologie grecque et aux pomes homriques. Mais c tait l cole stocienne qui, ds son dbut, dans l intention de retrouver sa doctrine dans la mythologie populaire, l employa avec le plus de dveloppement.
La conception de Philon du monde, de Dieu et des tres intermdiaires (Ides et intelligences) nous apparat un effort de combinaison et de conciliation entre les conceptions platoniciennes, celles des Stociens pour les fondre en fin de compte dans la tradition juive.
Chez Philon, les Ides et les intelligences pures sont engendres par Dieu sans le mdium mre , c'est--dire sans matire. En outre il a une tendance attribuer la filiation divine aux tres idaux, l exclusion des tres sensibles. Mais seules les choses, les meilleures, peuvent natre la fois par Dieu et par son Intermdiaire. Les autres naissent non pas par lui, mais par des intermdiaires infrieurs.
L action divine sur les tres imparfaits n aura donc lieu que par des intermdiaires plus parfaits. L ide que Philon introduisait dans la philosophie n est pas celle de cration ex nihil, mais celle de cration divers degrs, et par des tres intermdiaires.
Il existe, par ailleurs antrieurement Philon, des concepts analogues ; le Logos[41] stocien, la Sophia juive des Proverbes et des sagesses, la parole de l Ecriture. Chercher dterminer la part de ces diffrents concepts dans la doctrine de Philon, est une uvre dterminante et utile, qui nous aide connatre les influences de ce dernier et de la philosophie grecque dans la pense de l auteur du quatrime Evangile.
Le concept de logos chez Philon
Si le concept de logos tait usuel et rpandu, quelle tait donc l origine et la nature de ce concept ?
Le logos est, chez les Stociens, un des noms que prend la divinit suprme : il est la raison commune de toutes les parties de l univers : cette conception est prsente et vivante dans les uvres de Philon.
D autre part, ce logos, avec les mmes attributs qu il a chez les Stociens, n y est cependant plus la divinit suprme, mais un intermdiaire entre Dieu et le monde.
Cette conception est issue, pour l essentiel, de la philosophie stocienne, laquelle cependant, il faudra ajouter l influence d Hraclite et de Platon.
Les stociens, crit E. Brhier, admettaient un logos de la nature, suivant lequel arrivaient tous les vnements de l univers. Ce logos universel n est pas pour eux diffrent du principe suprme, qu ils appellent nature commune, destin, providence et Zeus. (E. Brhier, Les ides philosophiques et religieuses de Philon d Alexandrie, 3e d. Librairie philosophique, Paris 1950, p. 84).
Philon a accept cette notion du logos, sans la transformer. Parfois mme le logos garde les proprits matrielles qu il avait chez les stociens. Philon, en effet, dit : Rien de matriel n est assez puissant pour avoir la force de porter le fardeau du monde, mais c est un logos du Dieu ternel qui est l appui le plus rsistant et le plus solide de l univers . (Id. P. 85).
Ici le logos est mis en parallle avec les cercles de l ther.
Cependant, en attaquant et transformant les ides d Hraclite concernant le logos[42], Philon montre que le logos est le principe des contraires existant dans le monde et non pas les contraires eux-mmes. Il leur est suprieur et il est indivisible.
Remarquons, cependant, qu en mme temps, la fonction de mdiateur et arbitre du logos, nous fait pressentir le rle d intermdiaire qu il jouera entre Dieu et le monde.
Par ailleurs, le logos, comme principe du monde intelligible est, chez Philon, identique l Un. Il est principe de l Union dans les tres et en soi, il est unit.
D autre part, le logos est conu, chez Philon, comme un principe de la vertu. Il s identifie au droit logos des Stociens conu sur un point de vue uniquement moral et interprt, d une faon platonicienne, comme le modle idal des vertus.
Remarquons d abord, crit E. Brhier, que le droit logos, principe des vertus, est conu tantt comme un guide moral, cr, terrestre, oppos au logos divin intelligible qui est son modle, tantt au contraire, et mme le plus souvent, cette distinction n est pas faite, mais c est le logos divin lui-mme (monde intelligible ou principe de ce monde) qui guide l me humaine. (Id. p. 95).
Ici, nous devons souligner que les caractristiques que donne Philon ce logos ressemblent, dans une certaine mesure, quelques prdicats de l Esprit Saint des Chrtiens ; le logos est le pilote et le guide, il est le mari de l me qui par lui devient fconde en vertus ; tout ce qui est sans logos est honteux ; tout ce qui est avec lui, est ordonn ; le mchant a retranch de lui le droit logos, il s en est dtourn, il agit contre lui. Celui qui peut user du logos est raisonnable ; qui ne le peut pas ou ne le veut pas est sans raison et malheureux. Le logos est chef et guide du compos humain, il avertit, il instruit et il conseille Il pose des lois et il est lui-mme une loi incorruptible, il blme aussi. (Id. pp. 93-94).
Par ailleurs, dans d autres caractristiques il ressemble l image de Jsus cre par Paul, par l auteur du 4e Evangile et par les autres religieux chrtiens.
Il est , chez Philon, un intermdiaire entre Dieu et le monde, mais d un degr infrieur l tre suprme. Cependant, Philon spare en thorie Dieu et le logos et aboutit souvent donner les mmes attributions chacun des deux comme c est le cas chez les chrtiens lorsqu ils dfinissent la 2e personne de la Trinit (c'est--dire le Fils).
Chez Philon, le logos, lui-mme comme tre parfait, rend le culte Dieu comme les autres tres parfaits, arrivs au niveau des logois (plur. de logos). En effet, Jsus, chez les chrtiens, rend le culte Dieu.
Chez Philon, le logos, comme force cosmique, organe de la cration, et la parole divine concident, chez Philon, dans la reprsentation d un tre personnalit peu dfinie, qu il appelle le fils an de Dieu ; ce logos est combl des dons divins ; il est le messager de Dieu auprs des hommes, et il porte Dieu leurs supplications ; il apparat sous forme humaine, et parle aux hommes. (cf. E. Brhier, p. 107). Ces caractristiques se conforment parfaitement celles attribues Jsus.
D autre part, la thorie allgorique des Stociens s approche ou mme influence celle de Philon, au moins sur quelques traits. Le plus important des traits communs entre les deux thories c est que, chez les Stociens, Herms a t engendr par Zeus (l Etre suprme) et chez Philon le logos est fils de Dieu[43].
De mme, la mythologie allgorique du trait de Plutarque sur Isis et Osiris, nous rapproche de l poque et du milieu o vivait Philon.
Ces mythes gyptiens, altrs et influencs, par les mythes grecs, et l allgorie (employe par Plutarque dans l interprtation de ces mythes) qui imprgne, directement ou par une autre voie, les conceptions philosophiques de traits facilement reconnaissables influencent ou tout au moins reprsentent une certaine ressemblance avec les conceptions philoniennes.
Lorsque, par exemple, chez Philon, le logos comme fils an de Dieu est distingu du monde (qui est, chez lui, le jeune fils de Dieu), cette notion trouve ressemblance parfaite dans la distinction des deux Horos, fils du dieu suprme Osiris, dont l an symbolise le monde intelligible, et le plus jeune, le monde sensible.
Nous en dirons autant de la conception d un double logos, celui du monde intelligible tourn vers Dieu et celui qui descend au-devant de l homme dans la rgion des sensibles. D aprs le trait de Plutarque Osiris est logos du ciel et du Hads (du monde)[44].
Cette perspective religieuse et philosophique qui se dgage des uvres de Philon influenait et orientait, directement (ou indirectement) la pense chrtienne dans divers milieux. Elle s illustrait par diverses personnes religieuses depuis Paul et l auteur du 4e Evangile jusqu aux prtres d Alexandrie du IVe sicle.
La diffrence existant entre Philon et Paul rside dans le fait que le premier prchait une doctrine dont la personne relle qui l incarne n existait pas (tout en se basant clairement sur les conceptions de la philosophie grecque, ce qui fait qu il tait plus spculatif et plus attach l allgorie), alors que le second semblait trouver un appui rel et une incarnation parfaite de cette doctrine dans la personne de Jsus, tout en ngligeant la trs profonde spculation philosophique.
C. Le rle des Pres apologistes
Un nombre important de pres apologistes qui taient d anciens philosophes convertis au christianisme, avaient maintenu et avaient continu de soutenir et de thoriser les principes doctrinaux du Christianisme.
Il est signaler que l volution parallle (au Christianisme) de la philosophie hellnique fut loin d tre acheve l poque o naissait le Christianisme. Les IIIe et IVe sicles taient pour la pense paenne, aussi bien Rome qu Athnes, une priode extrmement brillante. Mais c est Alexandrie que les diffrents courants philosophiques et religieux s influenaient rciproquement.
Les philosophes convertis au Christianisme donnaient l exemple parfait de cette fusion tellement importante dans la constitution et le maintien de la doctrine chrtienne. A titre d exemple nous citons : Justin au IIe sicle, Clment d Alexandrie et son disciple Origne, la fin du IIe sicle et jusqu la moiti du IIIe sicle.
Les Pres, des trois premiers sicles, se rfrent Platon, et prirent contact avec le moyen platonisme. Par exemple Origne, disciple aussi bien de Clment que d Ammonius Saccas, auprs de qui il s tait trouv le condisciple de Plotin, avait une pense au sujet de laquelle J. Ppin a dit : La vision du monde d Origne est audacieuse, en particulier pour le monde spirituel : comme le Verbe est engendr par le Pre, il engendre lui-mme d autres verbes,
c'est--dire des natures raisonnables, spirituelles et libres ; cres gales entre elles, ces natures, usant de leur libert devinrent diffrentes dans la mesure o elles s attachrent plus ou moins Dieu ou se dtournrent plus ou moins de Lui. (Id. II, 75).
En revanche, nous ne nions pas l influence de certaines conceptions chrtiennes sur la philosophie rpandue l poque. Mais c est Alexandrie, sige d une cole de thologie chrtienne particulirement ouverte l hellnisme, que les philosophes paens se montrrent de leur ct, les plus ouverts la faon de vivre et de penser des Chrtiens.
D autre part, il ne faut pas oublier que le Christianisme jusqu au dbut du IIIe sicle, fut un mouvement proscrit et clandestin, avec une alternance de rpressions sanglantes et de rmissions passagres, il est clair que, dans les moments o la perscution svissait avec le plus d intensit, les Chrtiens n taient gure ports prsenter ou mme concevoir leur religion comme le prolongement et l accomplissement de la culture paenne. Mais lorsque la perscution se relchait pour quelques temps, ou dans les rgions qui s en trouvaient par bonheur prserves, ou enfin quand la paix de l Eglise fut instaure par l Edit de Milan (en 313), les Chrtiens se montrrent naturellement plus enclins se dfinir comme les dbiteurs des philosophes grecs et s ouvrir leur influence. (J. Ppin, op. cit., II, p. 32).
II. Le rle de l autorit politique
(L influence de l empereur romain sur les rsultats du concile de Nice).
Sous le rgne de Constantin, le Christianisme devint le culte de l empereur. Le paganisme ne fut cependant pas proscrit. La parit, au contraire, fut rigoureusement maintenue entre le culte chrtien et le culte paen. L empereur, protecteur de l Eglise, continua, en portant le titre de Grand Pontife, s affirmer comme le chef du clerg paen.
L adoption du Christianisme, comme le souligne plusieurs historiens, n amena aucune rupture dans la conception du pouvoir. L empereur cessa d tre considre comme un dieu, mais son autorit n en resta pas moins divine et les rites d adoration, en son honneur, ne furent pas modifis.
Sans doute, l influence du Christianisme sur la population fut remarque par Constantin ; il se peut qu il ait voulu en profiter, d une part pour maintenir son pouvoir, et d autre part pour concilier entre les conceptions philosophiques et religieuses paennes patrimoine qui lui tait trs cher et les principes dogmatiques du Christianisme qui ne diffrent pas radicalement de ce patrimoine.
L influence de Constantin sur le concile de Nice
Ainsi, cette approche historique nous incite parler du 1er concile de Nice en 325 o Constantin a jou un rle prpondrant dans le triomphe de la doctrine qui proclame la divinit de Jsus.
Dans son livre condens, Ren Metz, a donn un portrait prcis de ces conciles. Ce qui nous intresse ce sont les deux premiers conciles.
Le concile de Nice, 325 C est la doctrine arienne, ainsi dnomme en raison de son promoteur Arius, qui est l origine de la runion du premier concile oeucumnique. Au dbut du IVe sicle, Arius, qui tait un prtre de l Eglise d Alexandrie, professait que la seconde personne de la Trinit n tait pas de la mme nature que Dieu le Pre, mais qu elle tait une crature de Dieu. Le zl prdicateur fait de nombreux adeptes en Egypte. Alors Alexandre vque d Alexandrie se leva contre lui et essaya de l exclure de l Eglise ; mais les conceptions prnes par le prtre alexandrin (Arius) trouvrent un cho favorable au-del des frontires de l Egypte dans diverses provinces de l Orient ; mme l vque de Nicomdie, la capitale provisoire de l empire, ne cacha pas l intrt qu il portait Arius[45] .
Constantin, qui venait d unifier l empire en vinant son rival Licinius, fut inform des dissensions que la prdication d Arius avait occasionnes en Egypte.
Aprs qu Ossius, conseiller ecclsiastique de l empereur, choua dans sa mission de rconciliation entre les deux prtres adversaires d Alexandrie, Constantin dcida de runir l piscopat de tout l empire.
Prvu d abord pour Ancyre, l actuel Ankara, le concile fut finalement convoqu Nice en Bithynie.
Au printemps de 325 les vques se rendirent Nice. La premire sance solennelle eut lieu dans le palais imprial ; Constantin y assista, l ouvrit par un discours et probablement en assura la prsidence. Tout permet de croire que l empereur assista d autres sances et intervint mme dans les discussions.
Par sa prsence, Constantin a apport aux dbats le poids de son autorit et a fait triompher la cause du parti anti-arien ; les vques de l opposition, favorables Arius, se rallirent au symbole de foi adopt par la majorit (peut-tre par peur des sanctions et des condamnations qui furent prvues). Deux vques seulement refusrent d y souscrire ; ils seront exils, par ordre de l empereur, de mme qu Arius. (Histoire des conciles, 2e d. Que sais-je ? P.U.F. pp. 20-21).
Les annes postrieures vont montrer que ceux qui s taient rallis au symbole de la foi adopt par le concile, ne le firent que par peur ; car les partisans d Arius vont avoir un succs considrable dans diverses provinces, aprs la mort de Constantin.
D autre part, nous soulignons une autre fois que ce concile n avait point discut ni mme signal la divinit de l Esprit saint.
Le rle de l autorit politique dans l tablissement dfinitif de la doctrine chrtienne fut prpondrant. Nous en parlerons en dtail dans les pages suivantes.
III. L influence du Noplatonisme
L influence de la philosophie grecque, signale plus haut, ne fut pas acheve. Le rle du noplatonisme et en particulier de la philosophie de Plotin, nous amne parler du troisime facteur qui avait influenc le Christianisme et avait contribu son tablissement dfinitif.
Sur ce dernier facteur nous allons donner quelques claircissements qui illustrent la part de la philosophie de Plotin dans la formulation dfinitive du Christianisme.
Plotin naquit en Egypte en 205 ou 204 aprs J. C., lve Alexandrie du platonicien Ammonius Saccas , qui certains attribuent une origine indienne, il eut, au dire de son disciple et biographe Porphyre, le got et l occasion de prendre une connaissance directe de la philosophie qui se pratique chez les Perses et de celle qui est en honneur chez les Indiens.
Plotin, sans fonder proprement parler une cole, devait dvelopper ses doctrines devant un cercle de disciples, et c est au milieu d eux qu il mourut en 270.
Une lecture de Plotin montre qu il n emprunte pas seulement sa terminologie, mais aussi ses problmatiques, aux grandes philosophies de la Grce antique : platonisme, aristotlisme, stocisme, etc.
Il s est, effectivement, rattach cette philosophie de tout son amour et de toute sa volont. Mais les problmes qu il se pose sont transforms chez lui en des problmes proprement religieux ; de l naissait un effort pour adapter la philosophie grecque des points de vue diffrents. Par ailleurs, l influence des doctrines religieuses antrieures, comme celle du Judasme, ou en cours de formation, comme celle du Christianisme dans la pense de Plotin, peut
tre remarque dans quelques parties de sa doctrine. Parmi ses disciples il y avait des Chrtiens. Certains disciples comme Amlius, avaient accueilli une doctrine du Logos comme Verbe enfant par Dieu. L ide principale, qui constitue le trait commun entre ces diffrents courants, fut la gense ou plus prcisment la naissance d un tre universel du premier Principe, ou du Bien comme l appelait Platon.
Cette ide fut adopte par les Chrtiens en l appliquant Jsus dans une poque antrieure Plotin. Mais Plotin a problmatis toutes ces doctrines et philosophies rpandues, tout en se rattachant, cependant, la philosophie grecque en lui donnant le souffle religieux et mystique qui lui manquait.
Les disciples de Saccas, matre de Plotin, aussi bien que ceux qui taient parmi les disciples de Plotin, en se convertissant au Christianisme avaient adopt le systme de Plotin qui explique le mystre chrtien et lui donne un bien-fond philosophique.
Cette adoption fut faite par les philosophes alexandrins convertis au Christianisme et devenus vques sans renoncer tout fait leurs ides premires. Ils avaient constitu un courant parmi tant d autres de la Chrtient. Leur triomphe final n eut lieu rellement qu aprs le IIe concile en 381. Il est noter que les vques qui luttrent sans merci contre l arianisme, soit dans le 1er concile soit dans le IIe, sont tous des vques d Alexandrie.
Par ailleurs, une comparaison entre le systme de Plotin concernant la procession et la Trinit chrtienne tablie en 381, offre des traits refltant la similitude et la ressemblance parfaites entre les deux doctrines. Mais avant d exposer la doctrine plotinienne, nous donnerons une vue d ensemble de la Trinit chrtienne pour que la comparaison et la remarque des concordances soient plus faciles.
Un interprte d une dition de la Bible[46] crit les notes suivantes, concernant la Trinit (note, Matthieu, 28 : 19).
Dans la rvlation progressive du Nouveau Testament, se manifeste le seul vrai Dieu, existant en trois personnes divines, appeles ici : Le Pre , Le Fils et Le saint-Esprit .
1. Caractristiques : Chacune des trois Personnes de la divinit possde ses caractristiques propres et se distingue nettement des Autres. Cependant, toutes trois sont gales quant leur essence, leur puissance, et leur gloire : Chacune porte le nom de Dieu ; chacune possde tous les attributs divins ; Chacune accomplit des uvres divines ; Chacune est digne de recevoir les honneurs ds Dieu.
2. Activits : Un ordre s tablit dans leur manifestation : le Pre vient d abord, le Fils ensuite, et, en troisime lieu, le Saint-Esprit ; Le Pre est celui de qui viennent toutes choses ; le Fils, celui par qui tout est accompli ; le saint-Esprit, celui par qui tout est ralis ; et tout est pour Dieu. Malgr tout, aucune des Personnes de la Trinit n agit indpendamment des autres. Mais leur accord est permanent.
3. Rvlation : Le Nouveau Testament, par la rvlation qui lui est propre, ne dment pas le monothisme absolu de l Ancien Testament : Dieu unique en trois personnes. Les personnes de la Trinit sont un seul Dieu, non trois Dieux[47]. Dans l Ancien Testament il tait ncessaire de mettre l accent en premier lieu sur la rvlation du Dieu Unique pour viter toute quivoque avec les tendances polythistes. Cependant, la pluralit de Personnes du seul vrai Dieu apparat mme dans l Ancien Testament s il est lu la lumire du Nouveau Testament.
4. Mystre : Il faut confesser que la Trinit est un grand mystre chappant la possibilit d une explication complte.
Le 2e concile de 381 appel 1er concile de Constantinople tait le terme des efforts soutenir et faire triompher cette doctrine dtaille plus haut. Ren Metz nous donne une vue d ensemble sur ce concile : la condamnation de l arianisme, crit-il, prononce en 325 par le concile de Nice, ne mit pas fin ce courant d ides. Bien au contraire, dans la seconde moiti du IVe sicle, l arianisme domine, pour diverses raisons, dans tout l Orient et plus particulirement, dans la rgion de Bosphore ; Constantinople mme, la nouvelle rsidence impriale, toutes les glises sont aux mains des Ariens. C est alors que Thodose, qui depuis 379 se trouve la tte de la partie orientale de l Empire, dcide de convoquer un concile Constantinople ; Son but est de rtablir la paix et l unit religieuses sur la base de la foi de Nice. L vque d Antioche, Mlce, qui avait la confiance de Thodose, a prsid tout d abord le concile ; aprs sa mort survenue durant le concile, ce fut Grgoire de Naziaze, en sa qualit d vque de Constantinople, et aprs la dmission et le dpart de Grgoire[48], par son successeur, Nectaire.
L assemble raffirme les principes doctrinaux de Nice en insistant sur le Saint-Esprit[49], plus qu on l avait fait en 325 Elle proclame l gale divinit du Pre, du Fils et du Saint-Esprit et condamna l arianisme sous ses diverses formes. (Id. pp. 22-24).
Ainsi l autorit politique exerait son influence et posait son poids pour faire triompher une doctrine sur une autre sans laisser la raison son libre arbitre, ni mme se soucier de la libert du culte ou de la pense.
Le rle de l autorit politique dans l tablissement de plusieurs cultes ou doctrines est prpondrant dans plusieurs conciles, notamment les sept premiers. Le livre de Ren Metz donne une image d ensemble sur ces conciles et souligne l influence politique, sociale ou mme gographique[50] sur leurs rsultats.
Donc, une doctrine qui ne gagne pas la faveur d un appui imprial fut sujette la condamnation, la destruction de ses glises, l interdiction de culte et la chasse de tous ses reprsentants ou leur condamnation mort.
Aprs cette vue brve de la doctrine de la Trinit et son laboration au cours des sicles, revenons aux principes philosophiques ou au systme de Plotin pour constater l influence mutuelle entre ce dernier et le Christianisme.
Le principe fondamental de la philosophie de Plotin est la thorie de l manation ou, mieux, de la procession qui s appliquent au cheminement par lequel les choses, et d abord les intelligibles, naissent de l Un.
Le clbre systme des trois hypostases labors par Plotin fut expliqu dans les Ennades, uvre de Plotin dite par son disciple Porphyre.
Ici nous allons extraire quelques passages de l tude faite par E. Brhier sur la philosophie de Plotin et de l tude faite par J. Trouillard sur la procession plotinienne.
Au sommet, l Un, d o procde l Intelligence, de l Intelligence, son tour, procde l Ame, intermdiaire actif et mobile entre l Un et la matire. (E. Brhier, la philosophie de Plotin, librairie philosophique, Paris, 1961, p.38).
Sujet pur, l Un ; sujet spar idalement de son objet, l Intelligence ; enfin, sujet qui s parpille et se disperse dans un monde d objets, l Ame. Ce sont partout des sujets actifs, diffrents degrs d activit. (J. Trouillard, la Procession plotinienne, P.U.F. 1955, p. 182).
Le progrs selon lequel une hypostase nat d une autre a un caractre permanent, fixe, ternel ; la succession dans laquelle on considre les hypostases n est qu un ordre d exposition, un ordre logique, non pas un ordre temporel. (E. Brhier, p. 39).
La notion de l Intelligence, chez Plotin, est toute pntre de naturalisme. L Intelligence est un dieu, un dieu multiple qui contient tous les autres. Mais pourquoi ? C est parce qu elle est le modle du monde sensible. (E. Brhier, p.91).
Plotin a dit dans les Ennades (V, 3, 12) :
L tre qui vient de l Un ne se spare pas de lui, bien qu il ne soit pas identique lui. (voir E. Brhier, p. 164).
L me[51], c est l esprit considr en tant que puissance de crer et d organiser la nature entire
En dehors de cette rfrence, il n y a d autre diffrence entre l me et l esprit qu un degr infrieur d involution pour l me : celle-ci nat de l esprit comme le plus divis du moins divis : l me universelle est l unit de ces forces organisatrices. (J. Trouillard, op. cit., p. 80).
Ce systme ainsi dfini est marqu par sa ressemblance avec celui du Christianisme dans sa conception gnrale. Mais la pense religieuse, qui veut se traduire dans la langue universelle des Grecs, ne se contente plus d affirmer l Union du croyant son Dieu ; elle s adjoint une explication intgrale des choses, un ensemble de dogmes, comme c est le cas chez le thologien du quatrime Evangile.
C tait un tat d esprit dj ancien dans le monde grec : le stocisme en est le premier exemple, puisque, surtout sous ses dernires formes, il repose sur l Union intime de l me humaine une raison qui est en mme temps le principe de toute ralit. Un autre exemple, extrmement net, est celui de Philon d Alexandrie ; chez lui, comme chez Plotin, le culte spirituel, la prophtie, l extase se mlangent entirement une thorie rationnelle du dveloppement des formes de la ralit entre Dieu et le monde sensible.
Ce qui est absent dans le systme de Plotin c est l ide d un mdiateur ou d un sauveur destin mettre l homme en relation avec Dieu. Cette ide qui manque dans ce systme est prsente dans le Christianisme. Mais puisque ce systme explique en partie le dogme chrtien et lui donne un renfort philosophique, le Christianisme va subir une certaine influence l amenant adopter le dogme de la Trinit qui n tait pas encore formul dfinitivement. La fin du IIIe et la moiti du IVe sicles vont tre les priodes qui favoriseront l expansion de ce systme ainsi modifi. Toutefois, seuls les termes vont tre changs. Cela, afin que le dogme soit d une part, acceptable aux yeux des Chrtiens qui proclamaient dj la divinit de Jsus et d autre part, pour se rapprocher de la philosophie grecque, et en particulier du noplatonisme.
Et c est que les trois termes du systmes de Plotin correspondent parfaitement aux trois personnes de la Trinit chrtienne.
L Un : le Pre
L Intelligence : le Fils
L Ame universelle : le Saint-Esprit.
Il est noter que l engendrement chez les Chrtiens et la procession qui lui correspond chez Plotin, ne sont pas une naissance dans le temps mais une gense avant le temps lui-mme.
A travers cette approche historique et un peu philosophique, nous avons pu connatre les facteurs qui avaient contribu la formation du dogme chrtien depuis Paul jusqu au quatrime sicle ; nous avons pu voir le rle de la culture grecque au cours de trois sicles aussi bien que celui de l autorit romaine, dans le 4e sicle, dans la constitution et le triomphe du Christianisme existant actuellement[52].
*************************
CHAPITRE PREMIER
Jsus, sa vie et son uvre
I. Marie (Mariam) mre de Jsus
Depuis sa naissance et jusqu sa pubert, Marie a vcu dans un milieu o rgnait une ambiance de pit et de dvouement dans la soumission Dieu.
Avant sa naissance, sa mre a fait un v u. Il consistait consacrer le nouveau-n au service de la maison de Dieu et au culte dans les lieux saints (dans le Temple de Jrusalem). Elle esprait avoir un garon ; mais elle eut une fille. Malgr ce contre- espoir , elle persista vouloir consacrer cette fille au service de la maison de Dieu. Cette initiative et cette persistance dans la soumission bnvole taient des signes de sa sincrit et de sa dvotion dans le chemin de la pit :
La femme d Imrn dit : Mon Seigneur ! Je te consacre ce qui est dans mon sein ; accepte-le de ma part. Tu es en vrit, celui qui entend et qui sait . (Coran, 3 : 34).
Aprs avoir mis sa fille au monde elle dit : Mon Seigneur ! J ai mis au monde une fille. - Dieu savait ce qu elle avait enfant. Un garon n est pas semblable une fille ![53] . Oui, je l appelle Marie, je la mets sous ta protection, elle et sa descendance, contre Satan, le rprouv . (Coran, 3 : 35-36).
Marie a t leve par un prophte juste et agrable aux yeux de Dieu. Ce prophte, qui n tait que Zacharie pre de Jean-Baptiste, l avait duqu et l avait dirige dans les stades de la dvotion :
Son Seigneur accueillit la petite fille en lui faisant une belle rception ; il la fit crotre d une belle croissance et il la confia Zacharie. (3 : 37).
Marie a purifi son c ur de tout pch et de tout mal. Dieu la rcompensa, dans ce monde avant l autre, en lui offrant miraculeusement de la nourriture.
Quand Zacharie constata ce qu elle avait reu de grce, son espoir s veilla et souhaita avoir un enfant aussi pieux et dvou que cette jeune fille, mme si les conditions naturelles taient contre son espoir[54] :
Chaque fois que Zacharie allait la voir, dans le Temple, il trouvait auprs d elle la nourriture ncessaire, et il lui demandait : O Marie ! D o cela te vient-il ? Elle rpondit : Cela vient de Dieu, Dieu donne, sans compter, sa subsistance qui il veut . Alors Zacharie invoqua son Seigneur ; il dit : Mon Seigneur ! Accorde-moi, venant de toi une excellente descendance. Tu es, en vrit, celui qui exauce la prire (3 : 37-38).
Zacharie eut, miraculeusement, un chaste garon : Jean. Ces faits et ces prodiges qui se droulaient devant Marie n taient que des prmisses pour un vnement plus prodigieux encore et plus grave :
Les anges dirent : Marie ! Dieu t a choisie, en vrit ; il t a purifie ; il t a choisie de prfrence toutes les femmes de l univers. Marie ! Sois pieuse envers ton Seigneur ; prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s inclinent Les anges dirent : O Marie ! Dieu t annonce la bonne nouvelle d un Verbe manant de lui : Son nom est : le Messie, Jsus, fils de Marie ; illustre en ce monde et dans la vie future ; il est au nombre de ceux qui sont proches de Dieu. Ds le berceau, il parlera aux hommes tout comme en son ge mr ; il sera au nombre des justes. (3 : 42-46).
Lorsque Marie entendit cette nouvelle, elle fut bouleverse bien qu elle et constat et vcu beaucoup de miracles et de prodiges : comment, elle, qui n a pas de mari peut-elle avoir un enfant ? :
Elle dit : Mon Seigneur ! Comment aurais-je un fils ? Nul homme ne m a jamais touche . Il dit : Dieu cre ainsi ce qu il veut : lorsqu il a dcrt une chose, il lui dit : Sois ! , et elle est . (3 : 47).
II. La naissance de Jsus
Marie devenait enceinte de Jsus par le fait du souffle de l ange Gabriel, l Esprit de saintet :
Il dit (Gabriel) : Je ne suis que l envoy de ton Seigneur pour te donner un garon pur. (19 : 19).
et Marie, fille de Imrn, qui garda sa virginit. Nous lui avons insuffl de notre Esprit. (66 : 12).
L accouchement fut douloureux ; mais il fut accompagn de miracles qui avaient soulag la jeune mre qui devait faire face un monde hostile :
Elle devint enceinte de l enfant, puis elle se retira avec lui dans un lieu loign. Les douleurs la surprirent auprs du tronc du palmier. Elle dit : Malheur moi ! Que ne suis-je dj morte, totalement oublie ! . Puis on l appela[55], de dessous d elle : Ne t attriste pas ! Ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier ; il fera tomber sur toi des dattes fraches et mres. Mange, bois et cesse de pleurer. Lorsque tu verras quelque mortel, dit : J ai vou un jene au Misricordieux ; je ne parlerai personne aujourd hui. (19 : 22-26).
D ailleurs, cette conception miraculeuse ne pouvait tre conue que lorsqu on acquitterait la jeune mre par le truchement d un autre miracle.
Aprs son rtablissement, Marie quitta le lieu de l accouchement, et se rendit auprs de ses compatriotes avec son enfant. Tout le monde fut surpris ; aussi bien ceux qui connaissaient sa pit et sa dvotion que ceux qui l ignoraient. Comment une vierge, sans mari, pourrait avoir un enfant sans se livrer l adultre ? Et comment une telle pieuse a pu tre sduite ?
Elle se rendit auprs de son peuple, en portant l enfant. Ils dirent : Marie ! Tu as fait quelque chose de monstrueux ! s ur d Aaron[56] ! Ton pre n tait pas un homme mauvais et ta mre n tait pas une prostitue. (19 : 27-28).
Mais Dieu lui a fait clmence et lui a accord misricorde en transformant la preuve de l accusation en une preuve de l innocence ; c est alors le petit, lui-mme, qui va innocenter sa mre ; tout surpris les accusateurs entendaient la dclaration de Jsus :
Elle fit signe au nouveau-n. Ils dirent alors : Comment parlerions-nous un petit enfant au berceau ? . Celui-ci dit : Je suis, en vrit, le serviteur de Dieu. Il m a donn le Livre ; il a fait de moi un Prophte ; il m a bni, o que je sois. Il m a recommand la prire et l aumne tant que je vivrai et la bont envers ma mre. Il ne m a fait ni violent, ni malheureux. Que la Paix soit sur moi, le jour o je mourrai ; le jour o je serai ressuscit ( 19 : 29-33).
Par cette dclaration Jsus balaya tous les doutes et toutes les accusations qui planaient autour de Marie.
D autre part, sa dclaration, alors qu il tait dans le berceau, renferme une proclamation solennelle de sa soumission et de sa servitude Dieu, son Crateur, tout en reconnaissant les bienfaits divins.
Mais pourquoi Jsus est-il n sans pre ?
Le Coran donne la raison de cette extraordinaire et surnaturelle naissance : Nous ferons de lui un Signe pour les hommes ; une misricorde venue de nous. Le dcret est irrvocable. (19 : 21).
En cherchant le Signe dans la naissance de Jsus sans pre, nous pourrions constater trois choses claires :
1. La naissance de Jsus sans pre est une preuve vidente de la puissance divine d une part, et de sa libre volont d autre part.
Ces faits miraculeux prouvent que les lois de la nature, que Dieu lui-mme a cres, sont sous sa volont et sa puissance ; et par consquent, elles ne peuvent l empcher de crer quelque chose en dehors d elles.
Les lois de la nature qui rgissent l homme et l univers sont imposes par Dieu ; il est donc parfaitement concevable que celui qui impose les lois peut les annuler dans n importe quel moment, notamment quand il est libre et puissant.
Il est noter aussi que Dieu ne ressemble en aucune faon aux hommes. Si ces derniers sont rgis par les lois de la nature, lui, qui en est libre, peut crer d autres.
En effet, cet vnement est un Signe ; mais pour qui ? Pour tous les hommes possdant un esprit matrialiste ; et qui considrent l univers comme ternel, ou non cre. C est donc, pour ces gens, une preuve que Dieu a cr l univers par sa puissance absolue et sa volont libre de toute contrainte ou ncessit.
2. La naissance de Jsus sans pre est une dclaration manifeste que le monde des esprits existe. C est une preuve pour les gens qui niaient l existence de l esprit en croyant que l homme tait un corps matriel sans esprit. A cette ralit s ajoute celle de l incrdulit envers la rsurrection des morts. Ces deux croyances se trouvaient, en effet, chez les Sadducens (parti juif).
3. La naissance de Jsus sans pre est l accomplissement des modes selon lesquels Dieu a cr l humanit :
Il a cr Adam sans pre ni mre. Il a cr Eve sans mre. Il a cr toute l humanit de pre et mre. Et enfin il a cr Jsus sans pre.
Et c tait ainsi que se sont achevs les modes de la cration de l humanit.
III. La mission et les miracles de Jsus
Dieu a envoy Jsus au peuple Isralite pour le dlivrer de l adoration des plaisirs de la vie matrielle, pour lui annoncer la bonne nouvelle et pour diriger les gens vers la vie spirituelle de l autre monde. Il continua l uvre des prophtes prcdents et comme eux, il prcha aux juifs seuls :
et le voil prophte, envoy aux fils d Isral : Me voici, confirmant ce qui existait avant moi de la Torah et dclarant licite pour vous, une partie de ce qui vous tait interdit. (Coran, 3 : 49-50) ; (cf. Matthieu, 10 : 5 ; 8 : 4 ; 15 : 24 ; 23 : 1 ; Marc, 7 : 27).
En suggrant des modifications et des attnuations la loi juive, Jsus, ne pensait pas qu il la renversait ; je ne suis pas venu pour abolir la loi de Mose mais pour l accomplir (Matthieu, 5 : 17). (cf. Mathieu, 5 : 18 ; Luc, 16 : 17).
Nanmoins, il transformait tout par la force de son caractre et de ses sentiments. Il ajoutait la loi l injonction de se prparer pour le royaume par une vie juste, bonne et simple. Il annonce la bonne nouvelle concernant un Prophte aprs lui s appelant Ahmad (le trs-glorieux)[57] :
Jsus, fils de Marie, dit : O fils d Isral ! Je suis, en vrit, le Prophte de Dieu envoy vers vous pour confirmer ce qui, de la Torah, existait avant moi ; pour vous annoncer la bonne nouvelle d un Prophte qui viendra aprs moi et dont le nom sera : Ahmad (61 : 6).
Jsus renforait la loi par quelques explications et interprtations, tout en adoucissant quelques prescriptions. Il laissait parfois l impression que la loi juive serait abroge par la venue du royaume de Dieu (cf., Luc, 16 : 16 ; Matthieu, 5 : 18).
Dieu l avait renforc d un nombre important de miracles, comme preuve de la vracit de sa mission prophtique :
Dieu lui enseignera le Livre, la Sagesse, la Torah et l Evangile ; et le voil prophte, envoy aux fils d Israel : Je suis venu vous avec un Signe de votre Seigneur : je vais, pour vous, crer d argile, comme une forme d oiseau. Je souffle en lui, et il est : oiseau , - avec la permission de Dieu Je guris l aveugle et le lpreux ; je ressuscite les morts avec la permission de Dieu Je vous dis ce que vous mangez et ce que vous cachez dans vos demeures. Il y a vraiment l un Signe pour vous, si vous tes croyants. (3 : 48-49).
Jsus, fils de Marie, dit : Dieu, notre Seigneur ! Du ciel, fais descendre sur nous une Table servie ! Ce sera pour nous une fte, - pour le premier et le dernier d entre nous et un signe venu de toi. ( 5 : 114).
Pourquoi les miracles de Jsus taient-ils de ce genre[58] ?
A l poque de Jsus les ides matrialistes pullulaient parmi les Juifs. La croyance en l autre monde tait faible chez certains, inexistante chez d autres. Pour guider les gens vers une meilleure conduite il fallait d une part qu ils renonassent aux plaisirs de ce monde et d autre part qu ils crrent vritablement la vie ultrieure. Pour les convaincre de sa mission, afin qu ils le suivent, Jsus exposait ces miracles, preuves matrielles.
IV. Jsus et les Juifs
A l poque de Jsus les Juifs taient sous la domination romaine. Avides d or et d argent les religieux tiraient profit de toute personne se rendant au Temple pour l excution d un acte religieux, quand mme tait-il pauvre. Se croyant hritiers des prophtes, ils exigeaient l obissance du peuple, et formaient partir de ces deux moyens une sorte d aristocratie religieuse :
Ceux qui, parmi les fils d Isral, ont t incrdules, ont t maudits par la bouche de David et par celle de Jsus, fils de Marie ; parce qu ils ont t rebelles, parce qu ils ont t transgresseurs. Ils ne s interdisaient pas mutuellement les actions blmables qu ils commettaient Tu verras un grand nombre d entre eux s allier avec les impies. (Coran, 5 : 78-80).
Toutes les sectes juives, except les essniens, s opposaient la mission de Jsus. Les prtres du Temple et les membres du Sanhdrin surveillaient son activit. Ils y voyaient un danger. Ils craignaient, peut-tre, une rvolution politique dont ils seraient responsables devant le procureur romain.
Jsus son tour stigmatisait leur conduite, non conforme la loi, et leur hypocrisie qui voulait substituer la pit extrieure la grce interne. Il les accusait d avoir donn une grande importance des actes qui ne figurent pas dans la loi ; mais qui ne sont que des traditions et des coutumes qui ne formaient en aucune manire l essence de la religion.
En voyant le nombre de ses disciples s accrotre et sa rputation prendre de l ampleur, les Juifs complotrent contre lui.
Premirement, ils ont essay de le harceler par des questions dconcertantes afin de le mettre dans l embarras et causer, par la suite, la dispersion de ses disciples.
Deuximement, au moyen de questions-piges, les Juifs essayaient de dmontrer travers les rponses de Jsus, que ce dernier tait contre le gouvernement romain.
Mais Jsus, par la sagesse qu il a reue, savait se tirer de toute intrigue. Il rpondait d une manire correcte tout en vitant de provoquer la colre du gouvernement romain contre lui et ses disciples.
Cependant, ils voulaient lui rgler son compte par n importe quel moyen. Le grand prtre et la majorit du Sanhdrin se mirent d accord pour l arrestation de Jsus en l accusant de former une opposition et mme inciter une insurrection contre le gouvernement. Ils avaient l intention de le mettre mort ; mais les fils d Isral rusrent (contre lui). Dieu ruse aussi ; Dieu est le meilleur de ceux qui rusent. (Coran, 3 : 54).
Dieu, alors, a mis la ressemblance de Jsus sur un autre[59]. Ce dernier fut arrt, ensuite condamn et crucifi. Les juifs croyaient qu ils avaient crucifi Jsus alors qu il fut lev au ciel :
Nous les avons punis parce qu ils n ont pas cru, parce qu ils ont profr une horrible calomnie contre Marie et parce qu ils ont dit : Oui, nous avons tu le Messie, Jsus, fils de Marie, le Prophte de Dieu . Mais ils ne l ont pas tu ; ils ne l ont pas crucifi, son sosie a t substitu leurs yeux mais Dieu l a lev vers lui. Dieu est puissant et juste. (Coran, 4 : 157).
V. Jsus reviendra-t-il sur terre Avant la fin du monde ?
La majorit des exgtes du Coran, en interprtant deux versets coraniques qui font allusion cette question, sont d accord sur le retour de Jsus.
Ces deux versets sont :
Il n y a personne, parmi les gens du Livre, qui ne croie en lui (c'est--dire en Jsus), avant sa mort et il sera un tmoin contre eux, le Jour de la Rsurrection. (3 : 159).
Jsus est, en vrit, l annonce de l Heure (43 : 61).
En effet, les propos (Hadith) du prophte Mohammad confirment cette interprtation. On en trouve un nombre assez important, disperss a et l dans les diffrents recueils de la tradition prophtique. En supprimant les Hadith qui sont plus ou moins solides en ce qui concerne leurs chanes de rapporteurs, il reste, quand mme, une quantit considrable de Hadith authentiques, que l on peut avec certitude attribuer au Prophte.
De ces Hadith nous pouvons dgager des traits se rapportant notre question.
Quand la terre sera remplie d injustice et de mcrance, un homme appel Addajjl (l Imposteur), (l Antchrist et l Antichrist), point culminant de l erreur, sortira de l Est pour sduire les hommes. Il prtendra tre Dieu lui-mme et oprera un certain nombre de miracles pour prouver aux gens la vracit de sa prtention. Il parcoura le monde entier, l exception de la Mecque, Mdine et Jrusalem, et entrera dans chaque ville et dans chaque village, appelant son mensonge et contraignant les croyants l adorer. Une grande part de son arme sera compose de Juifs. Il combattra prement les Musulmans. Mais quand il arrivera la Palestine et plus exactement la banlieue de Jrusalem, Jsus descendra du ciel, port par des anges. Il tuera l Antchrist. Avec lui, les Musulmans sous la direction d Al Mahdi, calife de l poque, combattront l arme de l Antchrist. Aprs la dfaite de cette arme, Jsus en collaborant avec le calife musulman rpandra la religion islamique dans le monde entier. Aprs sa mort, le monde retombera dans la mcrance, et alors arrivera la fin du monde.
VI. Jsus a-t-il t rellement crucifi et tu ?
Le Coran affirme que Jsus n a t ni crucifi ni tu. Ce fait coranique est tout fait contradictoire avec l enseignement de l Eglise. Celle-ci donne une grande valeur cette question parce qu elle constitue le bien-fond et
le sens mme de la doctrine chrtienne.
Par ailleurs, ce principe de crucifiement peut-il rsister la critique textuelle ? Peut-il tre un fait historique et une ralit compatible la religion ?
Quant au principe de la rdemption, nous en parlerons dans les pages suivantes ; Ici nous nous bornons examiner la principale doctrine : le crucifiement.
Ce crucifiement a t rapport par les vanglistes ainsi que par les auteurs des ptres. Dans l introduction et dans la premire partie nous avons constat les contradictions, les divergences et les invraisemblances que renferme le Nouveau testament. De mme nous avons pu voir la valeur de la transmission des textes. Nous avons aussi soulign avec les thologiens chrtiens que ces textes ne reprsentent que l cho de la communaut chrtienne primitive.
D autre part dans un autre endroit nous avons vu que la lutte entre les diffrents courants au sein du Christianisme tait ardente, et que la doctrine de la Trinit n a pas t forme ds le dbut une fois pour toutes ; mais elle a t labore durant trois sicles. En outre nous avons dmontr quels taient les facteurs qui ont pu dformer, modifier et influencer la religion du Christ. Et nous avons enfin illustr le rle des conciles et du pouvoir politique dans le triomphe de la doctrine chrtienne actuelle.
Tous ces faits nous ont ramens scruter les textes du Nouveau Testament d une part, pour estimer leur valeur historique, et d autre part, pour valuer leur compatibilit avec les principes mme du Christianisme.
Aprs cet examen, nous sommes convaincus que la personne qui a t crucifie n tait pas Jsus. Diverses preuves confirment alors le fait coranique :
1. Aucun tmoin oculaire ne pouvait nous affirmer ce qui c tait pass rellement au moment de l interrogatoire de l homme qui devait tre crucifi, soit devant le Sanhdrin des Juifs, soit devant Pilate, le gouverneur romain.
Pierre tait dans la cour, comme l avaient rapport les vanglistes, ce qui affirme que personne parmi les compagnons de Jsus n avait vraiment assist au questionnaire pour pouvoir identifier la personne condamne. La simple ressemblance remarque de loin n est pas suffisante. Ajoutons cette critique partielle, les autres qui montrent la relativit de la transmission des faits rels concernant la vie et la mission de Jsus, mis en doute mme par les spcialistes chrtiens des Ecritures saintes.
2. Les rcits concernant plusieurs actes et vnements qui se sont drouls avant ou aprs le crucifiement, prouvent que l authenticit de ces rcits perd de sa valeur :
a) Ce qu on a donn boire l homme crucifi, diffre selon les rcits des vanglistes. D autre part certains ont rapport qu il a bu, d autres ont rapport qu il ne l a pas bu.
b) Ce qui est inscrit sur l criteau n est pas retenu exactement.
c) Les vanglistes ne sont pas d accord sur l heure de sa mort.
d) Et sur les consquences de sa mort.
e) Ni sur les paroles qu il a dit avant de rendre l me.
f) Ils sont en dsaccord sur ce que lui avaient dit les deux brigands crucifis avec lui.
g) Ils sont en dsaccord sur le jour de la mort, de la rsurrection et sur la dure du corps dans la tombe.
h) La faon de la rsurrection diffre d un vangliste l autre. Aussi le moment de la rsurrection et les personnes qui y ont assist.
i) Les apparitions de ce ressuscit dans un tel endroit, diffrent d un vangliste l autre.
j) La dure de ce Ressuscit sur terre diffre d un vangliste l autre.
3. La parole qu avait prononce l homme crucifi prouve que cette personne n tait pas Jsus.
Mathieu (27 : 46) et Marc (15 : 34) rapportent que cet homme avant de mourir a cri en disant :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m as-tu abandonn ?
Cette expression suggre trois hypothses[60] :
a) La premire consiste faire croire que Dieu a promis cet homme de le dlivrer de ses ennemis mais que Dieu a manqu son engagement et a laiss son serviteur subir les tortures et enfin la mort.
b) La seconde consiste faire croire que Dieu ne lui a donn aucune promesse ; mais c est seulement par duret qu il l a abandonn ses ennemis.
c) La troisime donne l impression que cet homme, en demandant Dieu pourquoi il l a abandonn, a mrit vraiment cet abandon et a subi les consquences de sa mchancet.
La personne qui avait prononc cette phrase ne pourrait tre Jsus, et cela dans aucune de ces trois hypothses ; car ce sont des paroles d impit qui montrent que celui qui les avait formules blasphmait contre Dieu et ne voulait pas se rsigner sa volont.
Un simple croyant, parmi les Chrtiens ou autres, ne prononce pas ce genre de blasphmes ; comment peut-on croire que cela tait un acte de pit formul par un prophte, sinon par le fils de Dieu comme disent les Chrtiens ?
Dans toute l histoire des religions, nous ne connaissons pas un croyant, notamment de prophtes, qui aurait reproch Dieu de l avoir abandonn parce que ses ennemis l avaient condamn mort.
Et si ce genre de croyants existe, c est qu alors leur foi est pratiquement inexistante.
Pour notre part cela nous persuade que l homme crucifi ne pouvait tre Jsus.
4. Le tmoignage de Barnabas (ou Barnab) dans son Evangile (dclar apocryphe par l Eglise) dit que c est Judas Iscariote qui a t crucifi, car Dieu l a revtu de la ressemblance Jsus. Barnabas prcise que les Aptres et les disciples ont cru que le crucifi tait effectivement Jsus. Il affirme cependant que sans la descente de Jsus du ciel pour leur rvler la ralit de ce qui s est pass, ils seraient demeur dans l erreur. En effet, des sectes chrtiennes croyaient que Jsus n a pas t crucifi, comme les Modalistes et les Gnostiques.
VII. La Rdemption entre l Ecriture et la raison
Le Coran, dans plusieurs passages, en racontant la vie d Adam, montre que Dieu lui a pardonn sa faute et a accept sa repentance.
Adam dsobit son Seigneur, il tait dans l erreur. Son Seigneur l a ensuite lu ; il est revenu vers lui et il l a dirig. (Coran, 20 : 121-122 ; voir aussi, 2 : 37).
Donc, selon le Coran, le pch originel, sur lequel se base tout le Christianisme, n existe pas. Il tait une fois, puis aprs la repentance d Adam tout est effac.
1. La Rdemption ; doctrine paulinienne
Le pivot de la doctrine paulinienne, autour duquel gravitent les lments secondaires, est le principe de la rdemption, cause du pch originel.
Le but, comme il en sort des crits de Paul, tait de justifier d une part, la pseudo-mort de Jsus et d autre part la rupture avec la loi de Mose.
Paul, s est efforc de justifier la rdemption, et pour convaincre il dut user de plusieurs moyens.
Il a tent, en premier lieu, d interprter quelques passages de l Ancien Testament de faon ce qu ils s appliquent Jsus ; bien que ces passages contiennent des notions vagues qui peuvent tre appliques plusieurs autres personnes.
En second lieu, il a dploy sa capacit intellectuelle et son ingniosit pour prtendre que la rdemption est, d une part, une ncessit pour l humanit entire cause du pch originel, et elle est d autre part, une manifestation de la misricorde divine.
Pour dcouvrir les origines de cette doctrine nous renvoyons le lecteur l introduction de cette partie o nous avons esquiss Paul un portrait tir des faits historiques et non de ses ptres elles-mmes, l exception bien sr de quelques ides.
A prsent, nous allons nous rfrer aux ptres de Paul afin de mieux connatre ce personnage.
2. La personnalit de Paul selon ses ptres
a) L enseignement des Aptres avait-il influenc la doctrine paulinienne ou non ?
Paul, qui a prtendu tre l aptre des paens, n a rencontr, trois ans aprs sa conversion, que deux Aptres ; avec l un d eux, Pierre, il n est rest que quinze jours. (Galates, 1 : 17-19).
Quatorze ans plus tard il a essay d exposer son Evangile aux Aptres pour avoir leur faveur. Seul son tmoignage montre qu il a reu leur approbation. (Galates, 2 : 1-10 ; 1 : 11-12 ; Romains, 2 : 16 ; 2Timothe, 2 : 8 ; Thessaloniciens, 1 : 4-5 ).
En outre, il a crit que c est par rvlation qu il avait eu connaissance du mystre du Christ (Ephsiens, 3 : 3-13).
A partir de ces faits, nous soulignons que l enseignement des Aptres n a pas eu de grandes influences sur les doctrines avances par Paul.
Dj qu il a prtendu avoir reu par rvlation un Evangile propre lui d o il puisait ses doctrines. Mais relativement cette thse, des questions se posent :
* Pourquoi Paul a-t-il essay d exposer son Evangile aux Aptres (Galates, 1 : 2) ?
Si cet Evangile est vraiment une rvlation de Jsus (Galates, 1 : 12) pourquoi l avait-t-il mis en doute en l exposant aux hommes ? Pourquoi avait-t-il cherch ce que les hommes apprcient la valeur de son Evangile ?
Paul, semblait tre incertain et peu confiant en cette rvlation. Ou alors est-ce simplement une pure prtention pour donner sa doctrine une force comparable celle des doctrines des Aptres ?
* Cet Evangile diffre-t-il des autres ?
Nous n en savons rien ; mais ce qui est certain, selon les ptres de Paul, c est que ce dernier s y rfre lorsqu il prche une doctrine qui peut choquer les autres ou tre en contradiction avec l enseignement des Evangiles prchs par d autres. Maintes fois il dit : selon mon Evangile (Romains, 2 : 16 ; Galates, 1 : 11-12 ; 2 Timothe, 2 : 8).
b) Paul attaque les prdications adverses
Dans ses ptres il s acharne attaquer les prdicateurs qui dtruisaient sa prdication. Il les accuse d tre de faux aptres. Le plus plausible, c est que ces prdicateurs auraient t des Judo-chrtiens qui s attachaient aussi bien la loi de Mose qu la prdication de Jsus. Les ptres de Paul offrent cette impression et laissent croire qu il y et un conflit ardent entre ces deux courants : (Galates, 1 : 6-9 ; 2 Corinthiens, 11 : 1-6 ; 12 :11 ; 1 Timothe, 1 : 3-11).
Pour barrer le chemin ces prdicateurs et pour convaincre ses nouveaux convertis dans diverses provinces, Paul prtendit tre suprieur ces aptres qui prchaient une doctrine contraire la sienne (Philippiens, 3 : 2-3).
Il a mme prtendu livrer Satan ceux qui ont abandonn sa doctrine pour d autres (1 Timothe, 1 : 19-20). Est-il un Dieu pour pouvoir le faire ?
Dans d autre cas, il menace les convertis, influencs par les autres prdicateurs, d un chtiment terrible s ils persistent dans leur attachement leur prdication tout en tournant le dos la sienne.
c) Paul a-t-il t sincre ?
La duplicit de Paul, son mensonge mme, qu il a confess dans ses ptres, suggrent-ils qu il aurait t un imposteur ?
Quelques incidents, en effet, peuvent tre retenus comme un appui cette suggestion ; mais, en revanche, les sacrifices de Paul peuvent soutenir la thse contraire.
Cependant, quand il y a un but raliser contre une religion, bien qu on n y adhre pas on dploie de trs importants sacrifices. L histoire ancienne et moderne offre de multiples exemples de ce genre d hommes.
Dans cette dernire perspective, Paul serait sincre avec soi-mme, vu le but raliser.
Mais quel est ce but ?
Peut-tre tait-ce de combattre les prdicateurs qui voulaient montrer une vrit cache, et d interprter les textes sacrs de faon ce qu ils aident cacher cette vrit[61].
Dans une autre perspective, celui qui croit fermement en ce qu il prche, mme s il est dans l erreur, sacrifiera tout pour sa prdication. Peut-on, selon ce point de vue, placer Paul dans ce cadre ?
A vrai dire, Paul est un personnage ambigu, sujet des jugements contradictoires.
Mais les incidents qui dvoilent, selon nous, sa contradiction, sa duplicit, et mme son hypocrisie sont :
* Il accusa Pierre (et d autres disciples de Jsus) de l hypocrisie, lorsque ce dernier se retira de la table des paens de peur d tre critiqu par les Judo-chrtiens (Galates, 2 : 11-14). Cependant, cette grave accusation peut, en effet, revenir sur Paul lui-mme, car dans plusieurs situations, surtout si nous tenons compte de sa confession, il s tait comport de la mme manire.
D aprs les Actes des Aptres (21 : 17-26), il a accept et a mme jug bon de se comporter selon les coutumes des Juifs Jrusalem afin de ne pas les choquer et pour leur montrer qu il n tait pas contre la loi.
* Dans la 1e ptre aux Corinthiens il avoue qu avec les Juifs, j ai t comme juif ; afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi et portant je ne suis pas moi-mme sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi ; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi et pourtant je ne suis pas moi-mme sans la loi de Dieu, sans tant sous la loi du Christ afin de gagner les faibles. Je me suis fait tous tous, afin d en sauver de toute manire quelques-uns. (9 : 20-22).
Donc ou bien Paul dans son accusation contre Pierre tait sincre ; par consquent il aurait condamn sa propre conduite Jrusalem. Ou bien il ne l tait pas ; et ceci laisserait croire qu il se comportait comme un hypocrite pour des intrts tout au moins propres lui.
Ou bien encore, son tmoignage contre Pierre, tait tout simplement un mensonge afin de montrer ses disciples son hardiesse en s attaquant aux Juifs et en contrariant leurs coutumes. Et tout ceci pour obtenir la faveur des paens et garantir leur persistance dans la prdication et les doctrines qu il leur avait prches.
d) Pourquoi Paul avait-il attaqu la loi de Mose ?
Comme nous l avons dit, Paul usa de cette doctrine pour rompre avec la loi de Mose bien que Jsus dans plusieurs situations dclart qu il n tait pas venu pour abolir la loi ou les prophtes (c'est--dire l Ancien Testament) mais pour les accomplir. Il ordonna aux Juifs de s adapter la loi de Mose et de la pratiquer tout en avanant quelques allgements ou restrictions : Matthieu, 5 : 17-20 ; 27-28 ; 6 : 1-6 ; 7 : 12 ; 19 : 18 ; 23 : 2-3.
En effet, le chapitre 23 de l Evangile de Matthieu, contenant des attaques contre les scribes et les pharisiens montre que Jsus est venu pour rformer la religion voile et dforme par ses reprsentants.
Par ailleurs, Jsus naquit sous la loi, se plia au rite du baptme, impliquant la confession des pchs et la repentance (Matthieu, 3 : 6-11) vcut dans une parfaite obissance la loi, l enseigna aux Juifs, la faisant respecter par ceux qui prtendaient lui obir. Il n y a donc aucune contradiction entre la foi en Jsus et la soumission la loi, tout en suivant les interprtations et les restrictions qu il a avances.
Jsus raffirme que la loi de Mose, concernant le royaume promis dans l Ancien Testament, sera la code rgissant le royaume venir sur la terre[62] (Matthieu, 5 : 17). Aussi, l attitude des hommes l gard de la loi de Mose dterminera-t-elle leur position dans le royaume (Matthieu, 5 : 19).
Mais Paul prtendit que la justification par la foi qui est la nouvelle alliance est plus glorieuse que la loi de Mose. Alors que cette dernire est faible, inutile et entrane le pch. Cependant, l intervalle entre la disparition de Jsus et son retour pour tablir le royaume sur la terre, serait-il rgi par un principe meilleur que celui qui rgira le royaume ?
Cette loi faible et inutile serait-elle alors le code du royaume au sein duquel il n y aura que les justes ? Et cette loi, dans le royaume, entranera-t-elle, alors, le pch ? Il apparat donc que, pour convaincre ses convertis, Paul tomba dans des erreurs l opposant l enseignement de Jsus lui-mme.
3. La thse de Paul sur la Rdemption est-elle solide ?
Les pseudo preuves que Paul a essayes d taler ne peuvent tre acceptables lorsque l on dmontre son incompatibilit soit avec la raison soit avec l Ecriture laquelle Paul se rfre souvent pour appuyer sa thse.
En premier lieu, celui qui ne croit pas en un seul prophte ou en un seul livre de l Ancien Testament, est considr une personne incrdule. De mme, pour celui qui ne croit pas en Jsus. Donc il n y a aucune distinction entre Jsus et les autres prophtes et entre le Nouveau Testament et l Ancien ; puisque la foi, dans les deux cas, est la base de la justification. Alors que les bonnes uvres sont relgues au second plan.
D autre part, des hommes justes, avant Jsus, sont sauvs par leur foi ferme, comme Abraham et les autres prophtes, sans qu ils soient sauvs par Jsus. Tout ceci implique que la cause de la justification et du pardon du pch n est pas la mort de Jsus mais la foi.
Suivant cette dduction pourquoi n a-t-on pas ordonn de croire en Jsus comme prophte (ce que lui-mme, en effet, a demand) et non comme tu, puisqu en fin de compte c est la foi qui a la valeur et qui compte et non pas sa mort. En ralit, Jsus a montr que la foi en lui comme prophte de Dieu avec les bonnes uvres sont les bases du salut et du pardon et non pas la foi en sa pseudo mort.
Mais qu est-ce que le pch ?
N est-ce pas la transgression des commandements et des prescriptions divins ?
Quiconque, avant ou aprs Jsus, transgresse les commandements et les prescriptions divins, est considr comme pcheur et sous le rgne du pch. En revanche, quiconque se soumet et obit Dieu est considr comme juste et libr du pch.
La colre divine se manifestant contre les gens, avant et aprs Jsus, ce n est que parce qu ils commettent des uvres mauvaises. Ceux des Chrtiens qui font les pchs sont eux-mmes exposs la colre divine et n hriteront pas dans le royaume de Dieu comme disait Paul lui-mme (Ephsiens, 5 : 4-7).
Donc, aucune diffrence entre les deux poques, antrieure ou postrieure Jsus ; car la mme justice est applique sur les gens des deux poques. Selon leur foi ou leur incrdulit et selon leurs uvres bonnes ou mauvaises, ils recevront, respectivement, les rcompenses ou les chtiments[63].
D autre part, l esclavage au pch duquel parle Paul (Romains, 7 : 14-25), peut arriver selon cette perspective, et arrive certainement sous le rgne de la foi. Et la foi seule, selon Paul, ne peut pas sauver sans uvres bonnes (Galates, 5 : 19-21 ; Colossiens, 3 : 5-11).
Paul prtend que le pch sous la loi conduit la mort et que la loi est un provocateur du pch (Romains, 7 :7-13).
Cette conception peut tre applique aussi la foi ; car celui qui a la foi et commet des uvres mauvaises n hritera pas, comme dit Paul, dans le royaume de Dieu. Les gnrations qui pchent sous le rgne de la foi ne se distinguent pas de celles qui pchaient sous la loi. Les deux perdront et sont conduits la mort.
D autre part, sous le rgne de la foi, qui a provoqu les hommes faire ces pchs ?
Un chrtien ne peut dire que la foi l a provoqu se livrer aux pchs ; en effet la mme chose pour celui qui est sous la loi ; il ne peut dire que c est la loi qui l a pouss pcher.
Par ailleurs, Paul avait prtendu que les interdictions figurant dans la loi sont les provocateurs du pch (Romains, 7 : 7) ; mais en revanche peut-on prtendre qu il n y a pas d interdiction dans le Christianisme ?
En ralit, elles sont nombreuses, et Paul en cite plusieurs. Peut-on dire alors que ces interdictions provoquent le pch sous le rgne de la foi ?
Un vrai chrtien ne peut le prtendre. Donc puisqu il n existe pas de diffrence entre les deux genres d interdictions, que la manire de les prsenter est la mme, qu ils aboutissent aux mmes rsultats, pourquoi a-t-on fait cette distinction entre les deux ?
Cependant, Paul avoua que la loi est bonne et juste (Romains, 7 : 7-8) ; mais elle conduit la mort ; Paul a oubli que ce qui est bon et juste conduit la bont et la justice et non pas la mchancet et l injustice.
Dans une autre perspective, la foi en Jsus va-t-elle supprimer et extirper dfinitivement le pch du c ur de l homme ou non ?
La rponse est facile ; la conduite des Chrtiens dmentit, dment et dmentira cette prtention.
Si on envisage, autrement, les faits religieux, on peut dire que tous les prophtes sont venus pour le salut et la rdemption de leurs peuples. Jsus, en effet, est venu pour le salut du peuple juif. De son vivant, Jsus ne demandait des gens que la foi et les bonnes uvres et proclamait que telle ou telle personne avait reu le pardon de ses pchs sans qu il exige de lui ce que Paul prtendit plus tard.
En ce qui concerne la pseudo mort de Jsus considre par Paul comme moyen du salut de l humanit, peut-on mettre au mme niveau et pour le mme but la mort de plusieurs prophtes avant Jsus ?
Cependant, ce pch originel dans sa perspective paulinienne n existe pas. Il y avait, en effet, un pch : mais il n engage pas toute l humanit dans une voie sombre et n impose pas aux hommes ce qu ils n avaient pas fait. L Ancien Testament lui-mme tranche ce problme et montre clairement que les fils n ont pas de responsabilit dans les pchs des parents et vice-versa ; dans Ezchiel, il est crit :
Vous dites : Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l iniquit de son pre ? C est que le fils a agit selon la droiture et la justice ; Il vivra. L me qui pche, c est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l iniquit de son pre et le pre ne portera pas l iniquit de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la mchancet du mchant sera sur lui. Si le mchant revient de tous les pchs qu il a commis, s il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu il a commises seront oublies ; il vivra, cause de la justice qu il a pratique. (Ezchiel, 18 : 19-22).
Et dans les proverbes, 21 : 18 Le mchant sert de ranon pour le juste et non pas le juste pour le mchant comme voulait prtendre Paul.
En outre, Jsus qui est descendant d Adam hritera ncessairement de sa mre Marie, du pch originel. Donc lui-mme, sous le rgne du pch, n est pas l homme parfait qui sauvera l humanit et la librera du pch.
Ce qui confirme ce raisonnement s est la dclaration de Jsus lui-mme en disant qu un seul est bon ; c'est--dire Dieu (Matthieu, 19 : 17).
Mais Dieu a-t-il vraiment besoin de livrer son fils pour tre tu afin de sauver l humanit ?
Pourquoi n a-t-il pas pardonn aux pcheurs, lui qui est le Misricordieux, sans qu il livre son fils la mort ?
Et, serait-il juste lorsqu il avait livr une personne qui n avait rien fait pour porter le fardeau des autres ?
Et pourquoi n a-t-il pas envoy Jsus au dbut des temps afin de sauver les gnrations passes ? S il l avait fait il serait plus indulgent et plus compatissant ?
*************************
CHAPITRE II
La servitude de Jsus Dieu Entre le texte et la raison
I. L Ecriture
Le Coran, pour persuader les gens, notamment les Chrtiens, s est bas sur deux principes lmentaires de la recherche scientifique moderne ; le texte transmis et la raison.
Le Coran a us de ces deux procds pour convaincre et dmontrer ceux qui ont l esprit ouvert et non influenc par les interprtations errones et traditionnelles, que Jsus n est qu un simple tre humain, un prophte comme les autres.
D ailleurs, une autre mthode fut propose aux Chrtiens qui ne voulaient pas se servir des deux principes prcits. On a ordonn, dans le Coran, au Prophte Mohammad d appeler ces gens pour faire une excration rciproque en appelant une maldiction de Dieu sur les menteurs[64].
La servitude de Jsus Dieu D aprs les paroles de Jsus
Le Coran, en transmettant les dires de Jsus et en exposant les discours que Jsus a prononcs, veut affirmer et illustrer que Jsus n a jamais appel les gens l adorer ou leur a impos de l appeler Dieu :
Je suis venu vous avec un Signe de votre Seigneur ; - craignez-le et obissez moi Dieu est , en vrit mon Seigneur et votre Seigneur : servez-le : c est l le chemin droit. (3 : 51) voir aussi 19 : 30, 36 ; 5 : 116.
Cette dclaration du Coran propos de Jsus est, en effet, une ralit qu on peut tirer du Nouveau Testament mme.
Quand on examine attentivement le Nouveau Testament pour connatre la personnalit de Jsus on constate qu il tait effectivement un tre humain, obissant Dieu, soumis sa volont, le prie, l adore et demande aux gens d en faire autant.
Pourtant nous citons les textes qui montrent que Jsus tait tout simplement un serviteur de Dieu, envoy par lui comme les autres prophtes :
Jsus est un envoy de Dieu
Or, la vie ternelle, c est qu ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoy, Jsus-Christ[65]. (Jean, 17 : 3).
Jsus, avait montr, selon ce verset que la vie ternelle consiste reconnatre Dieu comme tant le seul vrai Dieu et que Jsus est son envoy. Il n avait point dit que la vie ternelle consiste reconnatre que Jsus est un Dieu ou qu il est un homme et en mme temps un Dieu ou qu il y a trois personnes qui sont Dieu. Ce qui implique que celui qui confesse le contraire de ce qui est dit dans ce verset est dans la perdition ternelle.
Jsus est rempli de l Esprit Saint comme les autres prophtes :
Jsus, rempli d Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l Esprit dans le dsert( Luc, 4 : 1).
Son enseignement vient de Dieu et non pas de lui-mme
Jsus leur rpondit : Mon enseignement n est pas de moi, mais de celui qui m a envoy. Si quelqu un veut faire sa volont, il reconnatra si cet enseignement vient de Dieu, ou si mes paroles viennent de moi-mme. Celui dont les paroles viennent de lui-mme cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l a envoy est vrai, et il n y a pas d injustice en lui. (Jean, 7 : 16-18).
Il fait la volont de Dieu
Jsus leur dit : Ma nourriture est de faire la volont de celui qui m a envoy et d accomplir son uvre. (Jean, 4 : 34)/
Moi, je ne peut rien faire par moi-mme : selon ce que j entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volont, mais la volont de celui qui m a envoy. (Jean, 5 : 30 ; cf., Jean, 8 : 28-29 ; 12 : 49-50 ; 14 : 28, 31 ; 15 : 10).
Dieu lui a donn la vie
En effet comme le Pre a la vie en lui-mme, ainsi il a donn au Fils d avoir la vie en lui-mme. (Jean, 5 : 26).
Le pouvoir de Juger est un don divin
et il lui a donn le pouvoir d exercer le jugement, parce qu il est le Fils de l homme. (Jean, 5 : 27).
C est par la puissance de Dieu que Jsus chasse les dmons
Mais, si c est par le doigt de Dieu que moi je chasse les dmons, le royaume de Dieu est parvenu donc jusqu vous. (Luc, 11 : 20).
La grce qu il a, vient de Dieu
Or le petit enfant (Jsus) grandissait et se fortifiait ; il tait rempli de sagesse, et la grce de Dieu tait sur lui. (Luc, 2 : 40).
Jsus n est qu un serviteur de Dieu
Satan a tent Jsus mais celui-ci a russi sortir vainqueur de cette tentation ; la question qui se pose : un Dieu peut-il tre tent par Satan (simple crature de Dieu) ?
Le diable l emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit : je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes ; car elle m a t remise, et je la donne qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute toi. Jsus lui rpondit : Il est crit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et, lui seul, tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore Jrusalem, le plaa sur le haut du temple et lui dit : si tu es Fils de Dieu, jette-toi d ici en bas, car il est crit : il donnera pour toi des ordres ses anges afin qu ils te gardent ; Jsus lui rpondit : Il est dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. (Luc, 4 : 5-12).
Les rponses de Jsus montrent qu il n tait qu un tre humain obissant la volont divine.
Jsus n est pas omniscient
Pour ce qui est du Jour ou de l Heure, personne ne les connat, pas mme les anges dans le ciel, pas mme le Fils, mais le Pre seul. (Marc, 13 : 32).
Jsus est comme les autres prophtes
Il leur dit encore : En vrit, je vous le dis, aucun prophte n est bien reu dans sa patrie. (Luc, 4 : 24). Il parle de lui-mme, ensuite il donne des exemples en citant le prophte Elie et Elise.
Jsus, comme les autres Juifs, adore Dieu
Femme, lui dit Jsus, crois-moi, l heure vient o ce ne sera ni sur cette montagne, ni Jrusalem que vous adorerez le Pre. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. (Jean, 4 : 21-22).
Jsus prie Dieu et ordonne ses disciples d en faire autant
En ce temps-l, Jsus se rendit la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prire Dieu. (Luc, 6 :12).
En ce moment mme, Jsus tressaillit de joie par le Saint Esprit et dit : Je te loue, Pre, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cach ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les a rvles aux enfants( Luc, 10 : 21).
En ce qui concerne son ordre aux disciples pour prier Dieu voir : Luc, 11 : 1-4 ; Matthieu, 6 : 9-13.
Il va de soi que la prire enseigne par Jsus aux disciples ne renferme aucunement d allusion l adoration de Jsus avec Dieu ; le texte rapport ordonne d invoquer Dieu seul.
Jsus prie Dieu de ne pas mourir crucifi, et manifeste sa soumission totale Dieu
Arriv cet endroit, il leur dit : Priez, afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s carta d eux d environ un jet de pierre, se mit genoux et pria, en disant : Pre, si tu le veux, loigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas
ma volont, mais la tienne, qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. En proie l angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient terre. (Luc, 22 : 40-44).
Jsus ici est un serviteur de Dieu, fortifi par une simple crature (l ange), un homme angoiss et triste, qui ne veut pas mourir.
Jsus est venus pour accomplir la loi et les prophtes non pour les abolir
Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophtes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. (Matthieu, 5 :17).
Dieu est plus grand que Jsus
Si vous m aimiez, vous vous rjouiriez de ce que je vais vers le Pre, car le Pre est plus grand que moi. (Jean, 14 : 28).
Et la parole que vous entendez n est pas de moi, mais du Pre qui m a envoy. (Jean, 14 : 24).
Ici Jsus est un simple envoy, un porte-parole de Dieu.
Et n appelez personne sur la terre pre, car un seul est votre pre, celui qui est dans les cieux. (Matthieu, 23 : 9).
Je veux cependant que vous le sachiez : Christ est le chef de tout homme, l homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. (1 Corinthiens, 11 : 3).
Les disciples peuvent devenir comme Jsus
Jsus a dit : Le disciple n est pas plus que le matre ; mais tout disciple accompli sera comme son matre. (Luc, 6 : 40).
Jsus, devant Dieu, est gal ses disciples
Jsus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore mont vers mon Pre. Mais va vers mes frres et dis-leur que je monte vers mon Pre et votre Pre, vers mon Dieu et votre Dieu. (Jean, 20 : 17).
Il est clair que le terme Pre est employ pour Jsus et pour les disciples pour montrer que ce mot a ici un sens figur. Et pour bien montrer qu il ne renferme pas le sens propre il a ajout que Dieu est Son Dieu et celui des disciples. Donc il n y a aucune particularit distinguant Jsus des disciples.
Jsus n est qu un mdiateur entre Dieu et les hommes
Voir 1 Timothe, 2 : 5-6.
C est Dieu qui dcide et qui donne et non pas Jsus
Alors la mre des fils des Zbde s approcha de Jsus avec ses fils, et se prosterna, pour lui faire une demande. Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis, dans ton royaume, l un ta droite et l autre ta gauche. Jsus rpondit : Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur rpondit : Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d tre assis ma droite et ma gauche, cela n est pas moi de le donner, sinon ceux pour qui cela est prpar par mon Pre. (Matthieu, 20 : 20-23 ; voir Jean, 17 : 6-7 : O il est dit que c est Dieu qui a donn Jsus les disciples. Et 19 : 11 : O il est dit que c est Dieu qui a le pouvoir et non pas Jsus).
Un seul qui est bon, c est Dieu
Alors, un hommedit Jsus il lui rpondit : Pourquoi m interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. (Matthieu, 19 : 16-17).
Le crucifi accuse son Dieu
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m as-tu abandonn ?... Il rendit l esprit (Matthieu, 27 : 46, 50).
Le crucifi est faible, comme il apparat de Luc, 23 : 46. Il a besoin d aide extrieure ; de Dieu. Ce qui implique que lui n est pas un Dieu.
Alors que dans Jrmie (44 : 6) Dieu est fort et chtie les incrdules. Et dans Jrmie (10 : 6- 10) : Nul n est semblable toi, Eternel ! Tu es grand, et grand est ton nom puissant. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C est toi que la crainte est due ; car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes nul n est semblable toi Mais l Eternel est Dieu en vrit, lui le Dieu vivant et le roi ternel. La terre tremble devant sa colre, et les nations ne supportent pas sa fureur.
Dieu est immortel et invisible alors que Jsus a t vu par les gens et a t tu selon les Chrtiens :
Au roi des sicles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire aux sicles des sicles. (1 Timothe, 1 : 17).
* Termes expliquer : Dieu, fils, Pre
Aprs avoir donn les traits caractrisant Jsus, qui montrent qu il n tait qu un simple tre humain, un serviteur de Dieu, un Prophte comme ses prdcesseurs, nous sommes amens ici donner l explication de quelques termes qui renferment une certaine ambigut et qui, peut-tre, ont suggr aux Chrtiens que Jsus est un Dieu. Ces termes sont : fils, Dieu et Pre.
Cependant, avant de traiter de ces thmes dans le Nouveau Testament, nous trouvons utile d en donner une vue tire de l Ancien Testament.
1. Dieu dans l Ancien Testament est Eternel, Puissant, Misricordieux, invisible, n a point de ressemblance avec ses cratures aussi bien en Essence qu en attributs. Il est Un. Il est le premier et le Dernier
2. Il est formellement interdit d adorer quelqu un autre que Dieu ; cette interdiction est explicite ; on la trouve partout dans l Ancien Testament, (par exemple dans les chapitres 20 et 34 de l Exode). Dans le chapitre 13 du Deutronome il est crit : S il se lve au milieu de toi un prophte ou un visionnaire qui t annonce un signe ou un prodige, et qu il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t a parl en disant : Rallions-nous d autres dieux et rendons-leur un culte ! Tu n couteras pas les paroles de ce prophte ou de ce visionnaire( vv. 2-6) et voir (17 : 2-7).
3. Cependant, dans une grande quantit de textes dans l Ancien Testament on constate l anthropomorphisme, c'est--dire qu on attribue Dieu une forme humaine ou des attributs relatifs l homme. Nous citons quelques exemples :
Dieu a fait l homme son image, selon sa ressemblance (Gense, 1 : 26-27 et voir Gen., 9 :7). Dieu a une main, une oreille, une tte (Esaie, 59 : 1, 17). Il a la tte et les cheveux (Daniel, 7 : 9), l Oreille et les yeux (9 : 18). Il a l il (1 Rois, 8 : 29, 52 ; Jrmie, 16 : 17, 32 : 19 ; Job, 34 : 21 ; Proverbes, 5 : 21 ; 15 : 3). Il a le visage et la main (Psaumes, 44 : 4), la face et le derrire (Exode, 33 : 21-33). Il a les lvres et la langue (Esaie, 30 : 27). Il a le doit (Jrmie, 31 : 18). Il rit (Psaumes, 2 : 4). Il a le sang (Actes, 20 : 28). Il a les narines, etc.
D autres versets situent Dieu dans un espace :
Voir Exode, 25 : 8 ; 29 : 45-46 ; Nombres, 5 : 3 ; 34 ; 35 ; Deutronome, 26 :15 ; 2 Samuel, 7 : 5-6 ; 1 Rois, 8 : 30, 32, 34 ,36, 39, 45, 49 ; Psaumes, 9 : 11 ; 10 :4 ; 25 : 8 ; 67 : 16 ; 73 : 2 ; 75 : 2 ; 98 : 1 ; 134 : 21.
(Dans Mathieu, 5 : 45, 48 ; 6 : 1, 9, 14, 26 ; 7 : 6 , 11, 21 ; 10 : 32, 33 ; 2 : 50 ; 15 : 13 ; 16 : 17 ; 18 : 10,14,19,35 ; 23 : 19,22).
Les versets qui cartent l anthropomorphisme et le lieu sont peu nombreux. Voir : Deutronome, 33 : 26-33 ; 4 : 12, 15-19 ; Esaie, 45 : 5-9, 12 ; 46 : 9 ; 66 : 1-2 ; Actes, 7 : 49-50.
Il es signaler que la grande quantit de textes suggrant l anthropomorphisme est interprte, par les Juifs et par les Chrtiens, de manire ce q elle soit compatible avec le peu de versets qui affirment la transcendance de Dieu.
Pourquoi les exgtes sont amens effectuer cette dmarche ? La rponse est facile ; c est que les textes suggrant l anthropomorphisme sont incompatibles avec la raison, alors que le peu de versets affirmant la transcendance divine l est. Peut-on faire la mme chose avec des termes comme : Pre, fils, et Dieu appliqus Dieu et aux hommes ?
Certainement, cette dmarche, si on la fait, est tout fait compatible avec la raison ainsi qu avec les textes de l Ecriture.
L emploi du Terme Dieu dans l Ancien Testament
Dans la Bible, l on a nomm Dieu plusieurs cratures de Dieu. Il est parfaitement admissible et mme ncessaire de voir en ce terme un sens figur et de l interprter mtaphoriquement, surtout lorsqu il y a des indices liminant son sens propre. Sinon on aura un nombre considrable de Dieux.
Dans l Exode, 23 : 20-23, l ange qui a conduit les Isralites, hors de l Egypte, est nomm Dieu.
Dans la Gense, 18, l ange qui tait avec les autres anges est appel Dieu.
Dans la Gense, 28 : 10-22, celui qui a parl Jacob est appel Dieu, l Eternel. Alors qu il n est qu un ange ; la preuve c est que Jacob a eu un autre songe o l on a nomm Dieu l ange de Dieu. Il est tout fait clair que l Ange est le porte-parole de Dieu ; c est ainsi que lorsqu il disait qu il est Dieu, il ne faisait autre chose que transmettre le message divin. Ce qui marque ce message de la grandeur et de la solennit. (Voir Gense, 33 : 9-12 ; 35 : 1-3 ; 48 : 3-4).
Dans la Gense, 32 : 25-31, Jacob a lutt contre un homme considr comme Dieu. Il est ncessaire de comprendre le terme Dieu, dans ce texte, dans un sens figur, sinon Jacob aurait t plus fort que Dieu. D autre part, l homme de cette vision est un ange car dans le livre d Ose, 12 : 4-5, on a montr que celui qui a lutt contre Jacob est un ange ; cet ange est nomm Dieu.
Dans l Exode, 7 : 1 : L Eternel dit Mose : vois, je te fais Dieu pour le Pharaon ; et ton frre Aaron sera ton prophte. Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. (Exode, 4 : 16).
Bien que ces versets existent dans l Ancien Testament les Juifs n ont jamais os appeler Mose Dieu ou le considrer ainsi un Dieu. Ils ont compris que ce terme a ici un sens figur et non pas un sens propre.
Dans le chapitre 13 : 21-22, de l Exode, on a dit que c est l Eternel lui-mme qui tait dans la nue pendant le jour et dans le feu pendant la nuit pour conduire les Isralites, alors que dans 14 : 19, c tait l ange de Dieu qui tait dans la nue et qui les guidait. (Voir aussi Deutronome, 1 : 30-33).
Dans le livre des Juges, 13 : 3-22, Gdon et sa femme avait vu l Ange de Dieu, cependant ils avaient dclar (dans le verset 22) qu ils ont vu Dieu face face, bien que ce ft un ange.
Dans les Psaumes, 82 : 6, il est dit : J avais dit : Vous tes des dieux, vous tes tous des fils du Trs-Haut. .
Dans 2 Corinthiens, 4 : 3-4 on a appliqu le terme Dieu Satan.
Dans l Eptre aux Philippiens, 3 : 19, on a employ le mot Dieu pour dsigner le ventre.
D autre part on a employ le terme Seigneur pour des personnes qu on sert.
On peut dgager de tout ces versets que le terme Dieu peut tre employ pour dsigner des cratures. En effet, les Juifs n avaient pas pris ces emplois dans leurs sens propres parce qu ils savaient que Dieu est un, qu il est invisible, etc., alors que les Chrtiens n avaient pas fait autant. Ils sont alors tombs dans une double contradiction ; avec la raison d une part et l Ecriture d autre part.
L emploi du terme fils dans l Ancien Testament
Le terme fils est aussi employ dans l Ancien Testament ; cependant, aucun exgte juif n a prtendu que ce terme, employ dans ces endroits, a un sens propre. Nous citons quelques exemples :
Tu diras au Pharaon : Ainsi parle l Eternel : Isral est mon fils, mon premier-n. Exode, 4 : 22.
Dieu dit propos de David : Lui, il m invoquera en disant : tu es mon pre ! Mon Dieu est le rocher de mon salut ! Et moi, je ferai de lui le premier-n. Psaumes, 89 : 27-28.
Dans Jrmie, 31 : 9 : il est dit : Car je suis un Pre pour Isral, et Ephram est mon premier-n .
Dans Samuel, 7 : 14 Dieu, propos de Salomon, a dit qu il est son fils.
Dans Deutronome, 14 : 1, les Isralites sont des fils de Dieu. ( Et voir Deutronome, 32 : 19 ; Esae, 63 : 8 ; Ose, 2 : 1). Il est leur Pre (Esae, 63 : 16 ; 64 : 7 ; Psaumes, 68 : 6).
Dans Job, 38 : 7, on a employ les fils de Dieu pour les croyants.
Conclusion :
Il est donc clair que ces termes (Dieu, Pre et fils) employs, dans l Ancien Testament, pour des tres mortels, ne renferment point un sens propre. Personne n eut l audace de prtendre qu ils sont conus littralement.
L emploi des termes : Fils et Pre dans le Nouveau Testament
Le terme fils dans tous les langues, dans son sens propre, dsigne celui qui est form du sperme et de l ovule. Par consquent si on veut l employer dans d autres domaines, on doit le transposer au sens mtaphorique.
Mais les Chrtiens ont dduit de la formule fils de Dieu , applique Jsus, que ce dernier est rellement un fils de Dieu. Cette formule se heurte deux autres, que les Chrtiens emploient pour Jsus : Le Fils de l homme et le fils de David .
En effet, ce terme aussi bien que les deux autres, est employ dans un sens figur. Le Nouveau Testament fournit des attestations incontestables confirmant ce point de vue :
Dans Marc, 15 : 39, il est crit : Le centurion, qui se tenait en face de Jsus, voyant qu il avait expir de la sorte dit : cet homme tait vraiment le Fils de Dieu. .
Luc, avait rapport dans 23 : 47, la mme parole mais en substituant le terme juste fils de Dieu ; ce qui implique que cette formule a simplement un sens figur qui signifie que Jsus tait juste, obissant la volont de Dieu.
D autre part, cette formule est employe pour des personnes justes, autres que Jsus : Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appels fils de Dieu (Matthieu, 5 : 9, et voir 5 : 45).
En revanche, Jsus a employ la formule fils de Satan pour des dsobissants Dieu, qui suivent la voie de Satan :
Vous faites les uvres de votre pre. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illgitimes, nous avons un seul Pre, Dieu. Jsus leur dit : Si Dieu tait votre pre, vous m aimeriez Vous avez pour pre le diable, et vous voulez accomplir les dsirs de votre pre. (Jean, 8 : 41-44).
Il est vident que Dieu et Satan ne sont pas des pres au sens propre de ce mot ; mais pre est employ mtaphoriquement.
Dans la 1e ptre de Jean, (3 : 9-10), il est dit : Quiconque est n de Dieu ne commet pas le pch, parce que la semence de Dieu demeure en lui C est par l que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n est pas de Dieu( Voir aussi : 1Jean, 4 : 7 ; 5 : 1-2).
Les disciples sont considrs, comme Jsus, pouvant natre de Dieu. (Voir aussi : Romains, 14-16 ; Philippiens, 2 : 14-15).
Luc dans la gnalogie de Jsus, chapitre 3, avait crit que Adam est fils de Dieu. Il est vident qu Adam n est pas rellement un fils de Dieu mais du fait qu il ft cr directement par Dieu, sans pre ni mre, l vangliste lui a donn cette filiation mtaphorique.
Par ailleurs, dans plusieurs endroits du N.T. Jsus sur le mme pied d galit a employ les expressions votre pre et mon pre , dans ses paroles adresses ses disciples :
Jsus a dit : mais vers mes frres et dis-leur que je monte vers mon Pre et votre Pre, vers mon Dieu et votre Dieu. (Jean, 20 : 17).
En outre, il est signaler que les termes , fils et pre , sont aussi employs pour deux choses entre lesquelles existe une certaine convenance ; comme par exemple : le pre du mensonge pour Satan (Jean, 8 : 44), les fils de Jrusalem et les fils de la Ghenne pour les Juifs incrdules (Matthieu, 23 : 15, 37), les fils du temps pour les hommes d ici-bas, les fils de Dieu et les fils de la rsurrection (Luc, 20 : 36), les fils de la lumire et les fils du jour pour les Thssaloniciens ( 2Thssaloniciens, 5 : 5).
Jusque-l les textes sont clairs. Aucune relle difficult n est intervenue pour ternir la comprhension vritable de l emploi de ces termes. Cependant, quelques textes posent des petits problmes et font des obstacles notre dmarche explicative. Mais avant de rsoudre ces problmes et d carter ces obstacles il vaut mieux citer des textes de la Bible, qui sont assez nombreux, renfermant des images mtaphoriques ou des hyperboles :
1. Gense, 13 : 16 ; 22 : 17, Dieu a promis Abraham de multiplier sa descendance. Elle sera comme la poussire de la terre, comme les toiles du ciel et comme le sable de la mer.
2. Dans l Exode, 3 : 8 , Canaan coule du miel et du lait.
3. Dans les Psaumes, 78 : 65-66 ; 104 : 2-3, on a employ des mtaphores en parlant de Dieu.
4. Le pain et le vin se transforment en corps et sang de Jsus comme dans Matthieu (26 : 26-28)[66].
L Evangile de Jean, ses ptres et l Apocalypse contiennent un nombre important d images et d expressions mtaphoriques.
En outre, il est remarquer que les discours de Jsus renferment parfois des ambiguts. Ses contemporains, mme ses disciples, n avaient pas compris des questions qu il venait d aborder. En effet, il avait donn l explication une partie. Cependant, une autre partie reste incomprhensible. Nous citons quelques exemples :
Les Juifs ainsi que les disciples n avaient pas compris ce que Jsus a dit propos de son corps (Jean, 2 : 19-22).
Nicodme n a pas compris la parole de Jsus (Jean, 3 : 1-10).
Les Juifs et ses disciples n ont pas compris l expression de Jsus je suis le pain de vie (Jean, 6 : 35-66).
Voir aussi : Jean 8 : 21-22 ; 51-52. Jean, 11 : 11-14.
Dans Matthieu, 16 : 6-12, et Luc, 9 : 44-45, les disciples n ont pas compris.
Dans Luc, 8 : 52-53, tout le monde n avait pas compris et riait de lui.
Voir aussi : Luc : 18 : 31-34.
De mme les disciples de Jsus croyaient que l Aptre Jean ne mourra pas jusqu la fin du monde et que cette fin serait en leur poque.
Rcapitulons les questions tudies
La Bible contient une quantit considrable d hyperboles et d images mtaphoriques.
Elle contient un nombre important de versets o on a relev l anthropomorphisme. On les a interprts mtaphoriquement afin qu ils soient compatibles avec les textes affirmant la transcendance de Dieu.
Dans la Bible, on a employ les termes : Pre, fils, Dieu, en des sens figurs.
Les discours de Jsus taient dans plusieurs cas incomprhensibles, mme aux Aptres.
Ces points rcapituls contribuent claircir les textes ambigus qui renferment des allusions quivoques la divinit de Jsus ou sa filiation Dieu. Si on n essaie pas de gnraliser la mthode laquelle on a eu recours plus haut, savoir l interprtation, on risque de se contredire.
Textes ambigus
Nous essayons, maintenant, de donner des exemples renfermant ces ambiguts :
1. Jsus a dit dans Jean, 8 : 23 : Vous tes d en bas ; moi, je suis d en haut. Vous tes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. .
Ce verset, dans son vritable sens ne renferme pas de preuve que Jsus est Dieu ou un fils de Dieu ; car la mme expression a t employe par Jsus en parlant de ses disciples :
Si vous tiez du monde, le monde aimerait ce qui est lui ; mais parce que vous n tes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, cause de cela, le monde a de la haine pour vous. (Jean, 15 : 19).
Je leur ai donn ta parole, et le monde les a has, parce qu ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde( Jean, 17 : 14, 16).
Jsus dans ce dernier verset avait employ cette expression pour lui et pour ses disciples ; ce qui implique que si l emploi de ce genre d expressions est un prtexte pour attribuer la divinit Jsus tous ses disciples seraient alors des Dieux ou des fils de Dieu !
Le vritable sens du verset 23 (Jean 8) est ceci : vous tes de ce monde parce que votre but est de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde parce que mon but est l agrment de Dieu.
Ces expressions mtaphoriques sont employes dans les diffrentes langues, lorsqu on veut qualifier une personne mprisant ce monde et s intressant l autre.
2. On a attribu Jsus ceci : Moi et le Pre nous sommes un (Jean, 10 : 30). Mais cette expression a t aussi employe par Jsus propos de ses disciples : afin que tous soient un ; comme toi, Pre, Tu es en moi, et moi en toi, qu eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m as envoy. (Jean, 17 : 21).
Il est vident, d aprs ces expressions, que les disciples ne sont unis, proprement parler, ni Jsus ni Dieu, mais c est une union mtaphorique, comme celle entre Jsus et Dieu. Elle signifie l obissance parfaite et totale Dieu et la soumission sa volont. C est dans cette perspective qu il faut comprendre l union o les disciples ne se distinguent pas de Jsus, si ce n est la distinction par le degr d obissance et la soumission la volont divine. La preuve de cette interprtation est ce qu avait crit Jean (1Jean, 1 : 6-7) : Dieu est lumire Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les tnbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vrit. Mais si nous marchons dans la lumire, comme il est lui-mme dans la lumire, nous sommes en communion les uns avec les autres.
3. Dans Jean, 14 : 9-10, Jsus a dit : Jsus lui dit : il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m as pas connu, Philippe ! Celui qui m a vu, a vu le Pre. Comment dis-tu : Montre-nous le Pre ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Pre et que le pre est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-mme ; le Pre qui demeure en moi, accomplit les uvres. .
On a prtendu que ces versets font allusion la divinit de Jsus. Mais cette dduction n est pas exacte pour deux raisons :
a) La vision de Dieu en ce monde est impossible :
Personne n a jamais vu Dieu Jean, 1 : 18.
qui seul possde l immortalit, qui habite une lumire inaccessible, que nul homme n a vu, ni ne peut voir 1Timothe, 6 : 16.
Personne n a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous 1 Jean, 4 : 12.
Puisqu on a pas vu Dieu, et Jsus a t vu de tout le monde, surtout les Aptres et les disciples, il en rsulte que Jsus n est pas un Dieu.
b) Jsus se sert de la mme expression en parlant de ses disciples :
En ce jour-l, vous connaissez que moi, je suis en mon Pre, vous en moi, et moi en vous. Jean, 14 : 20.
Si on comprend que la communion de Jsus avec Dieu, dont il avait parl dans les versets plus haut, implique qu il est un Dieu, ces versets concernant ses disciples impliqueront ncessairement qu ils sont des Dieux ; ce qui est inacceptable, mme par les Chrtiens. (Voir aussi : 1 Corinthiens, 6 : 19 ; 2 Corinthiens, 6 : 16, 4 : 16 ; Ephsiens, 4 : 6).
En outre, si on dit que ce verset : Dieu est Pre de tous, qui est parmi tous et en tous , (comme le souligne le verset de l ptre aux Ephsiens, 4 : 6), signifie que tous les Chrtiens sont des Dieux ou des fils de Dieu, on aura tort. Ici l interprtation est ncessaire pour ne pas rendre le monde entier des Dieux. Cette mthode doit tre aussi applique aux expressions de ce genre concernant Jsus.
En effet, la relation existant entre Jsus et ses disciples ainsi que celle entre lui et Dieu est semblable la relation existant entre un matre et son serviteur ; celui qui respecte le serviteur et l aime, respectera le matre et l aimera, celui qui le mprise mprise aussi le matre. Cette notion est bien expliqu dans le Nouveau Testament : (voir : Matthieu, 10 : 40 ; Luc, 9 : 48 ; 10 : 16 ; 25 : 35-46).
Par ailleurs, les Chrtiens se basent sur l expression fils unique pour attribuer la divinit Jsus alors que ce dernier n a jamais employ cette expression. Toutefois, cette formule ne peut tre comprise dans son sens littral ; parce qu on a employ pour d autres le premier-n, le fils, etc., ce qui entrane dire que Jsus a des frres dans cette filiation. En revanche, il est tout fait compatible avec la raison et avec les donnes bibliques d interprter cette expression de la mme manire vue plus haut. Cependant, il est souligner que la distinction entre les autres expressions (fils, premier-n, etc.) et celle-ci ne peut tre comprise que sur le plan du degr de la perfection ; c'est--dire qu on a employ cette expression pour Jsus afin de montrer qu il est plus parfait que les autres prophtes, mais sans qu il soit un Dieu ou un fils de Dieu.
Par ailleurs ils disent que Jsus est cr sans pre ; nous parlerons, plus tard, en dtail de cette question parce qu il renferme un point rationnel.
En outre, les Chrtiens s appuient sur le fait que Jsus a ralis des miracles, surtout la rsurrection des morts. Ce fait n est pas en ralit une preuve pour voir en Jsus un Dieu. Jsus qui n avait ressuscit que trois morts selon les rcits du N.V. fut surpass par Ezchiel qui en avait ressuscit des milliers (Ezchiel, 37 : 1-10). Si ce miracle lve Jsus au rang de la divinit, Ezchiel l aurait mrit plus que lui. (Un autre prophte qui est Elise a ressuscit un mort ; 2Rois, 4 : 17-37, il a guri un lpreux ; 2Rois,5).
Conclusion :
Les traits que nous avons esquisss de Jsus, tirs du Nouveau Testament, montrent sans ambigut que ce qu a rapport le Coran propos de Jsus, bien qu il soit succinct, est tout fait authentique. Par contre les exagrations des Chrtiens propos de Jsus sont le rsultat de leurs interprtations ( des termes ambigus) qui ne sont pas compatibles ni avec la raison ni avec les autres textes de la Bible.
II. Les preuves rationnelles du Coran concernant la servitude de Jsus Dieu
La raison est le second volet d un diptyque dont le Coran se sert pour tablir ses principes et convaincre les gens des donnes qu il avance. Ainsi, nous exposons des arguments bass sur la raison tirs du Coran aprs avoir exposs ceux bass sur l Ecriture, pour rfuter la thse des Chrtiens propos de Jsus.
Ici, nous essayons de regrouper ces arguments et d en dduire d autres analogues confirmant ce fait :
1. Jsus et Adam
Le Coran dit : Oui, au regard de Dieu, il en est de Jsus comme d Adam qu il cra de poussire, puis qui il dit : Sois : et il fut. 3 : 59.
Le Coran dit : Le Messie, fils de Marie, n est qu un prophte ; les prophtes sont passs avant lui. 5 : 75.
Ils ont imagin, dans leur ignorance, que Dieu a des fils et des filles[67]. Gloire lui ! Il est trs lev au-dessus de ce qu ils imaginent ! Crateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant, alors qu il n a pas de compagne, qu il a cr toute chose et qu il connat tout ? Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n y a de Dieu que lui, le crateur de toute chose. Adorez-le ! Il veille sur tout. Les regards des hommes ne l atteignent pas, mais il scrute les regards. Il est le Subtil, il est le Bien-inform. 6 : 100-103.
En nous procurant cet argument convaincant, le Coran ne nous empche pas de chercher d autres exemples analogues. Au fait nous pourrions citer quelques uns :
a) Melchisdek : Melchisdek tait roi de Salem, sacrificateur de Dieu, Trs-haut ; il alla la rencontre d Abraham qui revenait de la dfaite des rois, et il le bnit ; c est lui q Abraham donna la dme de tout. Et, en interprtant son nom, il est tout d abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c est- - dire roi de paix. Il est sans pre, sans mre, sans gnalogie ; il n a ni de commencement de jours, ni fin de vie. Hbreux, 7 : 1-3.
Mais lui, qui ne figure pas dans la gnalogie des fils de Lvi[68], il prleva la dme sur Abraham ! Il bnit celui qui avait reu des promesses ! Or, c est sans contredit l infrieur qui est bni par le suprieur. Hbreux, 7 : 5-7.
Selon Paul, cette personne est suprieure Abraham, elle n a ni pre, ni mre, ni gnalogie, elle n a ni commencement de jours, ni fin de vie. Cependant, personne n a os la considrer comme tant un fils de Dieu ou un Dieu. Par contre Jsus, dont on connat le commencement et la fin, a t lev un rang suprieur celui de Melchisdek, bien qu il ne possde pas les caractristiques de ce dernier.
b) Les anges, n ont ni pre ni mre. Mais jamais on ne les a considrs comme des fils de Dieu ou des Dieux avec Dieu.
c) Eve est sans mre.
d) Satan, n a ni mre, ni pre.
e) Les cieux et la terre, n ont ni mre, ni pre ; cependant on a pas os dire qu ils sont des fils de Dieu.
2. La soumission de Jsus Dieu
Le Coran dit : Ils ont dit : Dieu s est donn un fils ! Mais gloire lui ! Ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre lui appartient en totalit : tous lui adressent leurs prires. Crateur des cieux et de la terre, lorsqu il dcide une chose, il lui dit seulement : Sois ! et elle est 2 : 116-117.
Dieu est unique ! Gloire lui ! Comment aurait-il un fils ? A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et quelle suffisante garantie que Dieu ! Jamais le Messie ne ddaignera d tre Esclave Dieu, non plus que les anges rapprochs de Dieu. (4 : 171-172).
Ces versets coraniques nous rvlent cinq vrits. Ce sont des preuves rationnelles convaincantes :
1. L essence divine est tout fait diffrente de l essence humaine, voire de toute autre essence. C est ainsi que parmi ses caractristiques et ses attributs on trouve celui de l unicit. Cette Unicit exige que Dieu n ait pas de semblable, et qu aucun ne possde une partie de sa substance ; ni Adam, ni Jsus ni autre.
2. Dieu est le Crateur de toute chose ; parmi ses cratures, Jsus, Adam, les anges, etc. Il est certain qu une crature ne saurait tre da la mme nature que son Crateur. Donc, Jsus (ou autre) ne saurait tre son fils, ni avoir la mme substance que lui.
3. Puisque Dieu est le Crateur, toute chose alors lui appartient. Parmi les choses cres, et qui lui appartiennent, est Jsus. Donc, il n est pas son fils. La preuve que Jsus appartient Dieu et qu il est son serviteur, c est qu il adore et prie Dieu comme les autres.
4. Puisque Dieu est le Crateur et toute chose lui appartient, toutes les cratures sont alors soumises sa volont. Elles sont toutes rgies par ses lois immuables qui incarnent sa volont. Jsus ne peut se librer de ces lois, ni se rvolter contre elles. Il est crature soumise comme les autres. En effet, les Evangiles rapportent que Jsus obissait totalement la volont divine.
5. La naissance de Jsus sans pre n est pas une preuve pour le considrer comme tant un fils de Dieu ; car Dieu est capable de crer ce qu il veut quand il veut.
3. Jsus et les lois de la nature
L exemple le plus parfait de la soumission de Jsus aux lois divines : (lois de la nature) est le fait de se nourrir :
Le Messie, fils de Marie, n est qu un prophte ; des prophtes certes avant lui ont pass. Sa mre tait parfaitement juste. Tous deux se nourrissaient de mets. Vois comment nous leur expliquons les Signes. Vois, ensuite, comment ils s en dtournent. (4 : 75).
4. Distinction entre Essence et attributs divins et ceux des cratures
Le Coran en outre met l accent sur la distinction nette entre Dieu et sa crature, aussi bien en essence qu en attributs :
Il ne convient pas que Dieu se donne un fils ; mais Gloire lui ! ( 19 : 35).
Ils ont dit : Le Misricordieux s est donn un fils ! Vous avancez l une chose abominable ! Peu s en faut que les cieux ne se fendent, que la terre ne s entrouvre et que les montagnes ne s croulent, de ce qu ils attribuent un fils au Misricordieux. Alors qu il ne convient nullement au Misricordieux de se donner un fils ! (19 : 88-92).
L essence de la divinit n est pas semblable celui de ses cratures, mme les hommes. Ces derniers se marient et engendrent. Ils ont besoin de prolonger leur vie par l intermdiaire de leurs enfants. Par contre Dieu, le Vivant, qui n a pas de corps, qui n a pas besoin d une femme, le Crateur, n est pas comme nous. Au fait, mme les esprits les plus purs ne sauraient tre comme Dieu. Comment alors les hommes, simples mortels ?
Qu on mdite sur ce verset o sont exposs les attributs divins afin de constater la diffrence entre l essence divine et l essence humaine :
Dieu ! Point de Dieu que lui, le Vivant, celui qui subsiste par lui-mme ! Ni l assoupissement, ni le sommeil n ont de prise sur lui ! Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient ! Qui intercdera auprs de lui, sans sa permission ? Il sait ce qui se trouve devant les hommes et derrire eux, alors que ceux-ci n embrassent, de sa Science, que ce qu il veut. Son trne s tend sur les cieux et sur la terre : leur maintien dans l existence ne lui est pas une charge. Il est le Trs-haut, l Inaccessible. (2 : 255).
Les attributs de Dieu cits dans ce verset montrent la distinction nette entre lui et sa crature. Jsus ne possde aucun de ces attributs :
Il a t cr par Dieu. Il ne subsiste pas par lui-mme. Il se fatigue, il dort, et il se repose. Ce qui est dans les cieux et la terre ne lui appartient pas. Il n intercdera auprs de Dieu qu aprs avoir eu la permission. Sa science n embrasse pas tout ce qu il y a dans l univers. Le Trne ne lui appartient pas, il n est ni le Trs-haut ni l Inaccessible.
Voil un autre texte coranique sur le mme fait :
Dis : Qui donc vous procure la nourriture du ciel et de la terre ? qui est matre de l ouie et la vue ? Qui fait sortir le vivant du mort ? qui fait sortir le mort du vivant ? Qui dirige toute chose avec attention ? Ils rpondront : C est Dieu ! . Dis leur : Ne le craindrez-vous pas ? Tel est Dieu, votre vrai Seigneur ! Qu y a-t-il en dehors de la Vrit, sinon l erreur ? Comment, alors, pouvez-vous vous dtourner ? (10 : 31-32).
En effet, ils ont dit : Dieu s est donn un fils ! Mais gloire lui ! Il se suffit lui-mme. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre lui appartient. Avez-vous quelque autorit pour parler ainsi ? Dites-vous sur Dieu ce que
vous ne savez pas ? (10 : 68).
En effet, Jsus lui-mme quand il a enseign ses disciples la prire, leur a recommand de demander le Pre c'est--dire Dieu. Parmi ces demandes, le pain quotidien. Il en rsulte que Jsus ne donne pas la subsistance ni la nourriture. En ralit lui-mme prie Dieu pour les recevoir.
Dieu a-t-il besoin d un fils ? Vraiment non ! Car Dieu se suffit lui-mme. En effet, Jsus n a pas enseign aux disciples d adorer et de prier ni l Esprit Saint ni lui-mme avec Dieu ; mais il leur a enseign de ne prier que Dieu seul parce que c est lui qui donne et qui fait prir :
Ceux qui disent : Dieu est, en vrit, le Messie, fils de Marie , sont impies. Dis : Qui donc pourrait s opposer Dieu, s il veut faire prir le Messie, fils de Marie, ainsi que sa Mre, et tous ceux qui sont sur la terre ? La royaut des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux appartient Dieu. Il cre ce qu il veut, il est puissant sur toute chose. (Coran, 5 : 17).
Par contre Jsus ne peut ni faire prir ni crer. Il ne peut aussi ni nuire, ni faire du bien sans la permission de Dieu :
Dis : Allez-vous adorer, en dehors de Dieu, quelqu un qui n est matre pour vous ni de mal ni de bien ? Or c est Dieu qui entend et qui sait tout. (Coran, 5 : 76).
5. Les miracles que Jsus a oprs sont par la permission de Dieu. (Voir Coran, 3 : 49 ; 5 : 110).
6. Jsus a t fortifi par l Esprit saint (Gabriel) (Coran, 2 : 87, 253). Il a besoin donc de l assistance de Dieu, par consquent il est comme les autres prophtes.
7. La sagesse et la science que Jsus a acquises ne viennent pas de lui-mme mais de Dieu : Et Dieu lui enseigne le Livre et la sagesse et la Torah et l Evangile. . Si on compare cette ralit avec les versets du Nouveau Testament on constatera que cette affirmation du Coran est parfaitement juste (voir Jean, 7 : 16-18 ; Luc, 2 : 40).
Jsus quand il tait petit ne savait rien ; mais en grandissant, il a pu avoir la sagesse et la science. D o donc cela lui est-il venu ? Certainement de Dieu. Par consquent, celui qui a besoin de Dieu, qui n a pas la science ne saurait tre un Dieu :
Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mres, sans que vous sachiez rien ; il vous a donn l ouie, la vue et des c urs. Peut-tre serez-vous reconnaissants ! (Coran, 16 : 78).
8. S il y a plusieurs Dieux et cratures ils devront se distinguer par leurs attributs et leurs activits :
Dieu ne s est pas donn de fils ; il n y a pas de divinit ct de lui, sinon chaque divinit s attribuerait ce qu elle aurait cr ; certains d entre elles seraient suprieurs aux autres. Mais, gloire Dieu, trs loign de ce qu ils inventent. (Coran, 23 : 91).
III. Discussion rationnelle concernant le Fils[69]
Aprs avoir expos les arguments du Coran dmontrant la servitude de Jsus Dieu, nous allons discuter quelques questions relatives ce thme.
1. La prtention selon laquelle Jsus unit en lui l essence divine et l essence humaine.
Nous nous demandons pralablement : Cette union tait de quelle nature ?
Si c est une incarnation, on aurait l infini qui deviendrait fini, l immatriel et l invisible qui deviendrait matriel et visible.
Ou bien, est-ce du genre de l eau des roses dans les roses, de l huile dans les olives, du feu dans le charbon ?
Si c est comme cela, il est inconcevable car le fils chez les Chrtiens n est pas un corps.
Ou bien encore est-ce du genre de la couleur que porte un corps ?
Si oui, la couleur ne peut apparatre que dans une substance, et n aura de valeur que par le corps ; si le corps disparat la couleur disparatra ncessairement avec lui.
Une autre question se pose :
Qui a assign au fils le corps ? D aprs les Evangiles Jsus fut cr par la puissance de Dieu ; donc il s ensuit deux consquences :
Le fils spirituel aprs l union avec Jsus s est-il dtach de l Etre divin ou bien non ? Dans le premier cas, le fils ne serait pas uni avec Dieu puisque le fils est dans Jsus. Et ceci implique la disparition de Dieu parce qu une partie de son essence fut dtache de lui.
Dans le deuxime cas, le fils existe dans deux lieux !
Si cette union n est pas une incarnation, le fils spirituel et Jsus font deux tres et non un, donc il n existe pas d union. S ils se sont transforms en un (et les deux autres disparaissent), ce ne serait pas une union mais on aura un troisime tre. Si l un d entre les deux prit il n y aurait pas d union puisqu il n y aurait pas d union entre quelque chose qui existe et quelque chose qui n existe pas.
2. Dieu est un Etre qui existe sans avoir besoin d un autre qui le cre ; il est le Ncessaire . Il n est pas un corps, ni dans un lieu, ni accidentel. Par contre Jsus, comme nous l avons vu, est un tre humain, ayant un corps, cr par la puissance de Dieu, n existait pas avant sa naissance, tu comme le croient les Chrtiens. Il mangeait, buvait, grandissait, se fatiguait, dormait et se rveillait. Toutes ces caractristiques sont d un tre humain, mortel comme les autres.
3. Les Chrtiens croient que les Juifs l avaient pris, l avaient crucifi et enfin l avaient tu. Si ce Jsus tait vraiment un Dieu, ou une partie de Dieu demeurait en lui, pourquoi n avait-il pas pu les repousser ? Et pourquoi demandait-il Dieu d loigner de lui la coupe de la mort ? Pourquoi avait-il manifest l impatience, l angoisse et la tristesse ?
Si Jsus est le Dieu pourquoi appelait-il celui qui est dans les cieux ? Il devrait s appeler soi-mme ! Si Dieu se trouvait dans le ciel, il n tait pas alors en Jsus.
Ainsi, apparat l absurdit, et l aberration dans le dogme des Chrtiens. Celui qui a une raison et rflchit, lorsqu il lit attentivement le Nouveau Testament se convaincra que Jsus n est qu un tre humain, un prophte parmi les prophtes. En plus, il sera persuad que les arguments avancs par le Coran, soit ceux qui se basent sur les dires de Jsus, soit ceux qui se basent sur la raison sont clairs, convaincants et dirigeants vers le juste milieu, vers la vrit.
************************* CHAPITRE III
ESPRIT SAINT DANS LA BIBLE ET LE CORAN
Le terme Esprit est souvent et vulgairement oppos Matire en tant que principe pensant. Or la dfinition n est pas si simple. On a employ le terme esprit pour dsigner un gnie ou un comportement psychique ou autre.
Mais dans la Bible ce terme a t utilis pour dsigner le souffle de la vie (l esprit humain) ou alors une entit cleste ou enfin, il est li Dieu : l Esprit de Dieu.
Le dterminatif Saint n est employ qu ultrieurement dans quelques versets de l Ancien Testament. Par contre dans le Nouveau Testament il est employ abondamment.
En Hbreu aussi bien qu en Arabe, le terme Esprit est appel Rh (en Hbreu Rah ).
Nous commenons cependant, par tudier l tymologie du terme Rh ou Rah avant de prsenter ses divers emplois dans les Ecritures saintes.
Etymologie du terme Rh
Les drivs du terme hbreu Rah , comme la racine verbale, permettent de conclure que le sens fondamental est celui de l air en mouvement dans l espace. En un certain sens, nous pourrions penser que nous sommes pas trs loin de la signification premire de Nphsh (en Arabe : Nafs).
A. Vacant, note que nphsh, neshmah et rah ont tymologiquement le sens de souffle (la mme chose en arabe), et que les termes qui dsignent l me signifient respiration ou vent en mme temps que principe de vie et de pense (en arabe aussi). (cf., Daniel Lys, Rah le souffle dans l Ancien testament, note 1, p. 384 ; d. P.U.F. 1962).
Mais, s il s agit bien parfois de respiration, le point de dpart est tout de mme diffrent de celui de nphsh qui dsignait l organe mme par lequel s accomplit la respiration ; tandis que la racine r, w, h insiste davantage sur l espace extrieur dans lequel l air en mouvement tablit des relations.
L ide relationnelle est la base du terme rah exprimant la prcarit de la condition humaine, lie la respiration toujours en cause.
Rah dans l Ancien Testament
Dans l Ancien Testament ce terme a connu une diversit de signification aussi bien dans son aspect matriel que dans son aspect spirituel. Il est employ dans trois domaines : Vent, Dieu et Homme.
Il a sans doute connu une particulire volution due une certaine transposition.
Par ailleurs, dans la mentalit primitive dont l cho est dans les textes anciens de l Ancien Testament on pourrait parler des esprits du dsert, de la mer, de l orage, etc.
Mais chose curieuse jamais les dmons ne sont dsigns par le terme rah.
1. L emploi du terme Rah dans le domaine vent
Il y a toutefois une force da la nature qui est dsign par ce terme, tel point que ce terme est son nom mme : c est le vent. Peut-tre pensera-t-on que le terme a d abord dsign le vent, puis, cause de ses caractres de mobilits, de puissance, on aurait utilis ce nom dans ses acceptions diverses (voir Exode, 15 : 8,10 ; Job, 4 : 9 ; 15 : 30 ; 26 : 13 ; 32 : 8 ; 33 : 4 ; 34 : 14. Ose, 13 : 15. Psaumes, 18 : 16 ; 104 : 30. Esaie, 11 : 15 ; 30 : 28 ; 40 : 7).
Cependant, il est remarquable que le vent n est pas un Dieu, et n est pas divin, mme dans les plus vieux textes, et encore moins dans les plus rcents . (Daniel Lys, p. 338).
On doit, d autre part, constater que le vent est associ l action de Dieu (dans la dlivrance travers la Mer Rouge : 2Samuel, 22 : 16) mais en mme temps il est mis au second plan, quoique cette action, accomplie, directement par Dieu lui-mme, soit le rsultat d un agent dsign par le terme rah. Mais refusant au vent (Exode, 14 : 21) tout caractre divin et n en faisant qu un lment naturel dont Dieu se sert son gr comme d un instrument pour incarner son action distance.
Le vent, instrument de Dieu pour faire l histoire, avait deux rles, le premier d une porte salutaire pour le peuple de Dieu, le second est associ au chtiment en portant un caractre destructeur et dispersif.
Mais lorsque le vent n est pas symbole d anantissement au service de Dieu, il devint symbole du nant, du fait, de sa nature insaisissable.
Cependant, durant l exil des Juifs, il n a plus qu un rle comparatif ; il garde un sens rel, non pas en tant que vent ; mais en tant que dsignation des diverses directions gographiques.
Aprs l Exil, le vent retrouve une action relle et naturelle mais toujours sous la main de Dieu, et avec une porte destructive montrant que l homme ne peut subsister que par la grce divine ; le vent garde, par ailleurs, sa valeur de signe d anantissement ou de nant dans des comparaisons.
Paralllement cette volution, crit Daniel Lys, les Psaumes prsentent le vent comme distinct de Dieu. Le vent n est qu une crature, dont Dieu reste le matre, et qui lui doit obissance et louange ; son rle est sans doute particulier, du fait que le vent est rah avec les caractristiques qu voque ce terme ; il permet d affirmer la prsence active de Dieu tout en respectant sa transcendance (p. 340).
D autre part, bien que le terme rah ait pu dsigner le vent l exclusion de toute force naturelle, parce qu il le dsignait ds l origine, il est aussi utilis au sens d esprit personnel en sorte que rah au sens du vent, ne pourrait qu avoir un sens spirituel (et pas simplement matriel). Cet unique terme, dsignant si tt le vent et un esprit, laisse entendre qu l origine vent et esprit ne faisaient qu un.
Ceci nous amne parler de l autre domaine o s est employ le terme Rah qui est celui de l homme.
2. L emploi du terme Rah dans le domaine homme
Comme exemple nous vous renvoyons au passage de la Gense (6 : 3) o on a voqu le mot Rah dans sa perspective humaine. Ce passage s enchane avec le rcit du dluge qui va aboutir la limitation de la vie humaine. On peut donc penser que le rah dsigne le souffle de la vie.
Or rah n est pas ainsi une entit divine habitant en l homme, ni plus forte raison devenue sa proprit ; c est simplement l affirmation que la vie de l homme est prcaire et dpend de Dieu, et tout particulirement que cette vie prcaire et dpendante s exprime sous la forme de la respiration (Daniel Lys, p. 42).
( Les textes consulter : Gense, 45 : 27 ; 6 : 17 ; 7 : 15. Exode, 6 : 9 ; 35 : 21. Nombres, 5 : 14, 30 ; 14 : 24 ; 16 : 22 ; 27 : 16. Deutronome, 2 : 30. Josu, 2 : 11 ; 5 : 1. 1Rois, 10 : 5 ; 21 : 5 ; 2 : 9,15 ; 22 : 24. 2Rois, 2 : 16 ; 19 : 17. Job, 27 : 3 ; 32 : 8 ; 33 : 4 ; 34 : 14. Esaie, 31 : 3 ; 26 : 35 ; 1 : 15 ; 28 : 6 ; 29 : 10 ; 11 : 4 ; 52 : 5 ; 45 : 6. Jrmie, 51 : 17 ; 10 : 14. Ezchiel, 3 : 14 ; 11 : 15,19 ; 13 : 3 ; 18 : 31 ; 20 : 32 ; 21 : 12 ; 37 : 1, 9, 10. Ose, 4 : 12 ; 5 : 4. Habaquq, 2 : 19. Malachie, 2 : 15, et d autres).
Donc, en l voquant dans une situation concernant la cration, rah n est rien d autre qu un lment de cette cration.
Il est noter que l esprit et le souffle (tous les deux tant dsigns par le terme rah) sont le rsultat du souffle du Crateur qui sauve chaque instant sa crature de la prcarit et de l inertie, de la mort la fois physique et spirituelle.
3. Rah de Dieu
Quand on dit Esprit de Dieu, on comprend que la prposition de implique :
1.
que l Esprit est une partie de Dieu,
2.
ou un de ses attributs,
3.
ou encore l Esprit est l essence de Dieu lui-mme,
4. ou enfin la prposition suggre que l Esprit est une proprit de Dieu, et par consquent c est une crature que Dieu possde et par laquelle il accomplit diverses actions.
Dans la premire interprtation on est en face d une conception qui suggre que Dieu est compos. En effet, cette conception est rejete aussi bien par les Chrtiens que par les Musulmans.
Dans la deuxime, on se trouve devant une conception plus ou moins acceptable, du moins par les Musulmans ; car Dieu par ses attributs se manifeste aux hommes. Les diverses manifestations ne sont que les effets de ses attributs. Dans ce cas-l l Esprit de Dieu s identifie Dieu lui-mme de sorte qu on ne peut prtendre sparer Dieu de son Esprit pour le considrer comme un Dieu distinct de lui.
La troisime interprtation ne diffre pas de la deuxime ; car attributs et essence conduisent aux mmes consquences.
Alors que dans la quatrime interprtation l Esprit serait une crature de Dieu. On l a attribu Dieu pour lui confrer une certaine honorabilit et pour montrer que l Esprit possde des caractristiques le spcifiant des autres cratures.
Dans cette interprtation l Esprit peut s identifier un ange minent et sublime que l on peut considrer comme tant le principal des anges.
Aprs ce prambule, nous revenons la Bible pour retracer un schma cette notion biblique, dgage des textes.
Nous pouvons remarquer que primitivement Rah de Dieu a eu surtout un rle d inspiration, faisant de tel ou tel homme un librateur, et reprenant au fond sur le plan de l histoire ce que le souffle du texte de 2Samuel, 22 : 16 ralisait dans la nature.
Il s agit d interventions en des hommes pour que ceux-ci fassent l histoire comme Dieu la veut (voir : Exode, 28 : 3 ; 31 : 3. Nombres, 11 : 17, 25, 26, 29 ; 27 : 18. Deutronome, 34 : 9. Juges, 3 : 10 ; 6 : 34 ; 11 : 29 ; 14 : 6, 19 ; 15 : 14. 1 Samuel, 10 : 6, 10 ; 11 : 6 ; 16 : 13-14, 23 ; 19 : 20, 23. 2 Samuel, 23 : 2. 1Chroniques, 12 : 19. 2Chroniques, 15 : 1 ; 20 : 14 ; 24 : 20. Nhmie, 9 : 20, 30. Psaumes, 51 : 13 ; 139 : 7 ; 143 : 10. Proverbes, 1 : 23. Esaie, 11 : 2 ; 30 : 1 ; 32 : 15 ; 34 : 16 ; 40 : 13 ; 42 : 1 ; 44 : 3 ; 48 : 16 ; 59 : 16, 21 ; 61 : 1).
Ainsi, l Esprit Saint conduit le peuple en inspirant son chef, et le monde en inspirant son peuple. L uvre de Rah de Dieu en l homme est toujours une uvre de libration, sans contraindre l homme mais veillant son esprit, faisant tmoignage intrieur et message et insufflant la sagesse l homme.
D autre part, avoir le Saint-Esprit c est tre inspir par Dieu et non par soi. Le terme souffle rsume, selon Daniel Lys, la notion de relation existant entre Dieu et l homme par l intermdiaire du Rah qui n est pas une entit mais la relation elle-mme, c est une relation qui met l homme sous la dpendance de Dieu, mais sans qu il ait pour autant confusion. (cf., p. 353).
En outre, Daniel Lys souligne que Rah n est pas un Dieu ct de Dieu, mme quand il s agit du Rah de Dieu ; on pourra dire qu avant tout Rah c est Dieu en relation (pas un autre Dieu ni une autre entit que Dieu). Quand Rah concerne Dieu c est alors Dieu lui-mme en relation ; quand elle concerne la cration elle n est rien d autre qu un lment de cette cration (cf., p. 32). En d autres termes, Dieu manifestant ses attributs ; car les effets des attributs de Dieu dans la cration sont les manifestations de Dieu, l gard de l homme, dans cette cration.
D autre part, de mme que l homme ne peut vivre que si Dieu renouvelle son souffle, de mme il ne peut agir efficacement que si Dieu l inspire.
Par cette approche nous sommes amens aborder un thme dlicat et en mme temps important, vu les conclusions qui en rsultent.
Ce thme concerne les emplois parallles de : l Esprit de Dieu , la parole de Dieu , l Ange de Dieu et l Esprit venant de Dieu (entit cleste), qu on trouve dans des passages de la Bible.
En premier lieu, le mot Rah est employ pour dsigner une entit cleste (1Rois, 22 : 21 ; Juges, 9 : 23). Cette entit peut tre rapproch de la signification du mot ange.
Il est remarquer que cette Rah est envoye par Dieu comme on envoie un serviteur, qui se retire et revient[70](1Samuel, 16 : 23) et qui tourmente ou pouvante sa victime (1Samuel, 16 : 14) ou qui spare et brouille diffrentes personnes (Juges, 9 : 23).
En second lieu, lorsqu on constate un lien entre souffle et menace, c'est--dire entre esprit et parole, qui marque la fois la prsence et la transcendance de Dieu, on rejoint la 2e et la 3e interprtations de l expression Rah de Dieu . C'est--dire, Rah de Dieu s identifie un attribut divin ou bien elle est quivalente tous les attributs divins lorsqu ils se manifestent au moyen du souffle et de la parole ; dans ce cas l Esprit de Dieu est quivalent l expression : Essence divine .
Nous trouvons, en effet, des passages qui mettent en parallle l Esprit et la parole de Dieu dans (Esaie, 59 : 21) : Voici mon alliance avec eux, dit l Eternel : Mon Esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, que j ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. , et ( 61 : 1) L Esprit du Seigneur, l Eternel, est sur moi, car l Eternel m a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; non pas la faon de Esaie, 34 : 16 : Consultez le livre de l Eternel, et lisez ! Aucun d eux ne fera dfaut, ni l un ni l autre ne manqueront ; car sa bouche l a ordonn. C est son Esprit qui les rassemblera. ; mais plutt la faon de 2Samuel, 23 : 2 : L Esprit de l Eternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue .
Dans Esaie, 32 : 15 et 36 : 27 o il s agit moins d Esprit que de parole , l intervention de l Esprit et de la parole de Dieu dans son prophte, non par une action contraignante mais par un message bouleversant, prparant les temps venir.
Par ailleurs, en Esaie, 63 : 11, 12 et 13 il y a une allusion la victoire sur les eaux travers lesquelles Dieu a sauv son peuple, dont il avait confi la conduite Mose, en faisant un parallle entre Rah et l Ange de Dieu.
En Psaumes, 35 : 5 on parle d un mal akh (ange) en parallle avec le vent. En fait il s agit de l Ange de Dieu pourchassant les ennemis du juste. Et le verset 6 forme un autre souhait de mort qui aussi en parallle avec l intervention de l Ange de Dieu.
En Esaie, 17 : 13 c est l image du vannage propos de la destruction d un peuple. Ici le vent n est pas un lment destructeur (comme par ex. dans Job, 1 : 19 et Jonas, 1 : 4 et 4 : 8), accomplissant un rle de jugement mais il n est que comparatif pour le problme de la justice sur le plan des relations humaines : ici, celui qui interviendra, c est l Ange de Dieu.
Le mal akh du verset 5 (Psaume, 35), malgr la conjonction, pourrait la rigueur tre prsent comme apposition vent . En ralit, les activits du Rah de Dieu dcrites dans divers passages (1Samuel, 16 : 23 ; 16 : 14, 15 ; Juges, 9 : 23 et d autres) ressemblent celles de l Ange de Dieu :
* La Gense, 41 : 38, le pharaon disait en parlant de Joseph : Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant l Esprit de Dieu ?
* Les Nombres, 24 : 2 : Balaam leva les yeux et vit Isral camp selon ses tribus. Alors l Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam pronona sa sentence et dit : oracle de Balaam oracle de celui qui entend les paroles de Dieu .
* 1Rois, 18 : 12 : Puis, lorsque je t aurai quitt, l Esprit de l Eternel te transportera je ne sais o .
* 2Rois, 2 : 16 : peut tre que l Esprit de l Eternel l a emport et l a jet sur quelque montagne ou dans quelque valle .
* Esaie, 63 : 10-14 : Ils ont attrist son Esprit Saint ; et il se changea pour eux (les Isralites) en ennemi, c est lui qui a combattu contre eux O est celui qui mettait au milieu d eux son Esprit Saint ? Il fit mouvoir, la droite de Mose, son bras resplendissant, il fendit les eaux devant eux l Esprit de l Eternel les a mens au repos .
* Dans Esaie, 48 : 16, l Esprit est un envoy comme le prophte lui-mme. Dans Ezchiel, 3 : 12 l Esprit m enleva, et j entendis derrire moi le bruit d une grande rumeur un esprit qui m enleva et m emporta .
* Dans Ezchiel, 3 : 24 et 2 : 2 l Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds . Ici l Esprit est compltement distinct de Dieu.
* Dans Ezchiel, 8 : 3 : Il tendit une forme de main et me saisit par une mche de ma chevelure. L Esprit m enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans les visions divines( voir aussi Ezchiel, 11 : 1,8,24 ; Agge, 2 : 5).
* Dans Zacharie, 7 : 12 : Ils rendirent leur c ur dur comme le diamant pour ne pas couter la loi et les paroles que l Eternel des armes leur avait envoy par son Esprit, par l intermdiaire des premiers prophtes .
Il est clair, dans ce texte, que l Esprit est considr comme un envoy au prophte au mme niveau que les prophtes ; envoys de Dieu au peuple. L Esprit peut tre considr ici comme un ange ; agent qui transmet la parole divine aux prophtes.
* D autre part, dans Ezchiel, 11 : 5, il est dit : Alors, l Esprit de l Eternel tomba sur moi, il me dit : Ainsi parle l Eternel.
Cette formule est semblable celle utilise aussi bien par l Ange de l Eternel que par les prophtes. L Esprit ici se comporte comme un ange envoy de Dieu.
* Par ailleurs, dans Ezchiel, 37 : 9-10, il est dit : Il me dit : prophtise et parle l Esprit Tu diras l Esprit : Ainsi parle le Seigneur, l Eternel ; Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu ils revivent ! . L Esprit ici est une entit, il souffle ; il parait qu il a le mme sens qu un ange.
En ce qui concerne l expression l Ange de Dieu ou de l Eternel , on constate que dans quelques passages de la Bible on confond l Ange de Dieu avec Dieu lui-mme et dans d autres, l Ange ou l Envoy de Dieu se prsentent comme tant Dieu :
1. Dans Zacharie, 6 : 8, l Ange parle Zacharie et se prsente comme tant Dieu. Dans Juges, 2 : : 1,4, l Envoy s est prsent comme tant Dieu lui-mme. 2. Dans Gense, 22 : 11, Exode, 3 : 2 et Juges, 6 : 11-24 on confond l Ange avec Dieu.
L explication que nous pourrions avancer est la suivante : l Ange de Dieu, ou l Envoy de Dieu se comportaient de la sorte parce qu ils sont les portes paroles de Dieu.
En ce qui concerne les activits de l Ange de Dieu nous citons les passages qui les dcrivent :
1.
Dans la Gense, 16 : 9, l Ange dlivre et annonce des nouvelles.
2. Dans la Gense, 21 : 17, l Ange n est pas confondu avec Dieu ; car Dieu a entendu la prire et l Ange a rpondu l appel ; comme s il avait reu un ordre divin pour l exaucer. 3. Dans l Exode, 14 : 19 l Ange est en parallle l Esprit. Alors que dans les Nombres, 22 : 22-35, l Ange de Dieu s est prsent comme un simple ange.
Par ailleurs, dans Juges, 2 : 1,4 l Envoy de l Eternel est comparable l Ange et l Esprit.
Il est noter que dans divers passages on rapporte que la conduite et la dlivrance des Isralites furent faites une fois par l Esprit Saint et une autre fois par l Ange de Dieu. Dans le passage ci-dessus (Juges, 2 : 1,4), cet Envoy peut tre identifi aux deux ; mais plus forte raison l Ange, parce qu il parlait et on entendait sa parole. En outre cet Envoy s est prsent comme Dieu lui-mme qui a conclu l alliance avec les Isralites ; l Envoy se comportait ainsi parce qu il est le porte parole de Dieu.
Mais dans 2Rois, 19 : 35, l Ange frappa dans le camp des Assyriens 18500 hommes et dans 1 : 3,15 l Ange parle et ne se prsente pas comme Dieu lui-mme. Dans Zacharie, 1 : 12, l Ange adresse la parole Dieu et se prsente comme tant une crature qui dpend de la volont divine. Et dans 3 : 1-8, et 12 (du mme livre), l Ange a une relation immdiate avec Dieu qui mettait ses paroles dans sa bouche. Il entend se prsenter comme un messager venant directement de Dieu, et il emploie mme la formule ordinaire Ainsi parle l Eternel signe de la transmission d un ordre divin, employe par les prophtes.
Donc les deux dlivrent (comme le fait de refouler la Mer Rouge), annoncent des nouvelles, combattent l ennemi et tous les deux sont confondus avec Dieu ; en raison du message qu ils transmettent ou des actes qu ils oprent. Les deux sont des envoys et des intermdiaires qui transmettent la parole divine aux prophtes.
En fait, les deux expressions sont employes (en apparence) pour deux agents ralisant les mmes actes (comme le fait de refouler les eaux de la Mer Rouge qui est attribu Dieu lui-mme, son Esprit et son Ange) et parfois l un se substitue l autre.
D autre part, l Esprit est en parallle la face divine dans Psaumes, 51 : 13 et 139 : 7. De mme l Ange est devant la face de Dieu dans Esaie, 63 : 9.
Toutes ces donnes nous convainquent que l Esprit saint dans une de ses acceptions est l Ange de l Eternel lui-mme. Ils sont deux expressions d une mme ralit : l aspect qui peut se matrialiser dans l Ange et l aspect spirituel dans l Esprit Saint ; le premier annonce et dlivre en prenant une forme et l autre dans les textes rcents de la Bible, agit de l intrieur de l homme.
Nous concluons que l Ange et l Esprit sont une seule personne, rvle sous deux formes, excutants les ordres divins. C est ainsi que nous arrivons la quatrime interprtation. Ce cas est en effet analogue l expression qui fait de l esprit humain un esprit de Dieu bien qu il soit sa crature.
Cette interprtation est compatible avec les sens du terme Esprit Saint employ dans le Coran et qui est rserv pour dsigner l archange Gabriel. Ce point de vue peut tre confirm par le passage d Esaie que nous avons vu ( 63 : 9-14), o l Ange qui est devant la face de Dieu (V. 9) est celui qui a sauv les Isralites de Pharaon. Cet Ange, que nous avons dmontr qu il est l Esprit Saint, peut tre Gabriel ; car dans Luc, 1 : 19, Gabriel a dit Zacharie : Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu . Dans le verset 10 d Esaie, il est dit : Ils (les Isralites) ont attrist son Esprit Saint ; le pronom possessif son revient l Ange cit dans le verset 9 ; c'est--dire les Isralites ont attrist l Esprit (Saint) de l Ange ; ce qui signifie que l Ange a un Esprit et que cet Esprit est radicalement diffrent de celui des autres, du moins des hommes, que l on a qualifi de Saint . Ou bien l adjectif possessif revient Dieu ; ce qui identifie, dans les deux cas, l Esprit l Ange[71].
Rcapitulons les diverses conceptions ou les diverses notions qui renferment le terme Esprit employ dans la Bible.
1. l Esprit a la signification de l esprit humain. Cet esprit est un don divin ; il n est pas un Dieu et ne revt pas un caractre divin.
2.
L Esprit a la signification de la parole divine (la rvlation).
3. La troisime notion est en parallle avec celle de l Ange de l Eternel, et, nous y avons montr qu en une certaine conception de l Esprit, c est l Ange lui-mme et que cet Ange est l Ange Gabriel.
L Esprit saint dans le Coran
Les trois conceptions ci-dessus sont en parfaite concordance avec les notions coraniques que nous allons tudier et exposer :
1. La notion d un esprit humain : dans le Coran (15 : 28-29) il est dit : Lorsque ton Seigneur dit aux Anges : Je vais crer un mortel d une argile extrait d une boue mallable. Aprs que je l aurai harmonieusement form, et que j aurai insuffl en lui de mon Esprit[72] : tombez prosterns devant lui (et voir 32 : 6-9).
2. La signification de la parole divine (la rvlation) : dans le Coran (16 : 2) il est dit : Il fait descendre les Anges avec l Esprit qui provient de son commandement sur qui il veut parmi ses serviteurs( voir aussi 40 : 15 et 42 : 52).
3.
L Esprit[73] est quivalent Gabriel.
L archange Gabriel est dsign parfois par l expression : Esprit Saint et parfois par l Esprit ou Notre Esprit tout simplement. Mais dans d autres cas par ses attributs ou ses qualits.
Le Coran (2 : 87) dit : Nous avons accord des preuves incontestables Jsus, fils de Marie et nous l avons fortifi par l Esprit de saintet . (Et voir : 2 : 253).
En parlant du Coran il dit : Dis : l Esprit de Saintet l a fait descendre avec la vrit de la part de ton Seigneur comme une direction et une bonne nouvelle pour les soumis, afin d affermir les croyants 16 : 102.
En parlant de Marie mre de Jsus il dit : Elle plaa un voile entre elle et les siens. Nous lui avons envoy notre Esprit : Il se prsenta devant elle sous la forme d un homme parfait 91-71 : 91 et voir : 66 : 12.
En parlant du Jour Dernier il dit : Les Anges et l Esprit montent vers lui (Dieu) en un jour dont la dure est cinquante mille ans 70 : 4. Et il dit : Le jour o l Esprit et les Anges se tiendront debout sur une range, ils ne parleront pas. Sauf celui qui le Misricordieux l aura permis et qui prononcera une parole juste (78 : 38).
En parlant de la Nuit Sacre du mois de Ramadan il dit : Les Anges et l Esprit descendent durant cette nuit, avec la permission de leur Seigneur.4 : 79
De ces versets nous comprenons que l Esprit de Saintet (ou l Esprit ) dsigne l archange Gabriel ; car dans d autres versets le Coran montre que celui qui a communiqu le Coran au prophte Mohammad est Gabriel, comme ce verset : Dis : Quiconque est ennemi de Gabriel. C est lui qui a fait descendre sur ton c ur avec la permission de Dieu le Livre qui confirme ce qui tait avant lui : Direction et nouvelle pour les croyants[74] (2 : 97). (Voir aussi : 26 : 192-194 et 16 : 102).
Il est appel messager noble comme dans : 81 : 19-21 : Ceci est la parole d un noble messager, dou de force auprs du Matre du trne inbranlable, obi autant que fidle . C'est--dire non la parole d un dmon comme prtendaient les ennemis du prophte Mohammad.
Ce dernier verset fournit des qualificatifs et des caractristiques Gabriel. Ce qui attire notre attention c est l expression : dou de force . Car, en ralit, le sens du mot Gabriel en hbreu est : Dieu est ma force ou ma force est de Dieu .
Gabr = ma force ( = ma , Gabr = force , El = Dieu).
Ces deux termes ont les mmes sens en arabe :
La racine : J, B, R est employ dans des acceptions qui se rapprochent les unes des autres :
- Jabara (un os) : remettre un os cass, consolider.
- Jabara (quelqu un) : l assister dans la misre, le rtablir, le mettre sur pied.
- Jabara (quelqu un) : le rconforter, lui faire plaisir.
- Jabara ( et Ajbara) qq. A faire qqch. : le forcer, le contraindre la faire.
- Jabran : par force.
- Jabr : le fatalisme.
- La science al-Jabr : l Algbre.
EL = Dieu en arabe.
Il est noter que dans la Bible, les Anges envoys aux hommes sont, jusqu au livre de Daniel, anonymes. Mais partir de ce dernier livre ils portent des noms en relation avec les devoirs ou les responsabilits que Dieu leur assigne ; comme dans l annonce faite Zacharie (Luc, 1 : 19) et Marie (Luc, 1 : 26), l Ange Gabriel instruit les hommes auxquels il est envoy, des merveilles de la puissance divine. Et dans des visions o les rvlations divines s expriment sous des formes symboliques qui exigent un exgte, l ange interprte, qui est Gabriel dans le livre de Daniel, joue ce rle important. Il parait que l identification des anges, surtout les principaux, a t rvle progressivement jusqu l identification finale de l Esprit Saint, qui est Gabriel, par la rvlation qu a reue le prophte Mohammad.
Le Coran, donc, a enlev l ambigut de cette formule, qui a amen les Chrtiens considrer l Esprit Saint comme un Dieu distinct de Dieu, alors qu il est simple crature.
*************************
CHAPITRE IV
Les arguments rationnels annulant
le dogme de la Trinit
Le Coran dclare : Oui, ceux qui disent : Dieu est en vrit, le troisime de trois sont impies 5 : 73.
Avant d aborder cette question nous soulignons quelques remarques :
1. Le dogme de la Trinit n existait pas avant les Chrtiens depuis Adam jusqu l poque de la formation de ce dogme.
2. Jean-Baptiste avait dout en Jsus lorsqu il s tait demand si c est Jsus qu on attendait ou non : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?... (Matthieu, 11 : 2).
Selon ce texte Jean-Baptiste n avait pas connu son Dieu qui est Jsus. Et de cette constatation, il en droule plusieurs consquences : en premier lieu, Jean-Baptiste serait mcrant. En second lieu, cette mcrance est en contradiction avec sa fonction de prophte, sinon du plus grand prophte ! D autre part, un prophte ignore-t-il son Dieu ? Et si cela proviendrait d une personne qui avait baptis Jsus, qu aurait t alors l attitude des autres prophtes avant lui, et celle des simples croyants ?
3. Si le dogme de la Trinit est une vrit il aurait t expliqu clairement par les prophtes, depuis No jusqu Jsus, notamment Mose aux Isralites. Et il aurait t indispensable qu un dogme considr comme le salut de l humanit, soit parfaitement explicit dans l Ancien Testament. Or quand on le vrifie, on constate que Mose avait, maintes fois, rpt les principes de la loi, notamment les dix commandements, sans qu il fit allusion la Trinit. Toutefois il avait rpt le dogme de l unit de Dieu en plusieurs formules d affirmations. Par ailleurs, on avait rapport dans l Ancien Testament des rcits insignifiants tout en ngligeant le dogme de la Trinit ; ancre du salut.
D autre part, mme l Evangile, o sont rapports les dires, plus ou moins authentiques, attribus Jsus, on ne retrouve pas de dclarations claires et sans ambigut, que Dieu est : le Pre, le Fils et le Saint-Esprit, que la Trinit, en laquelle il faut croire, est incomprhensible, que Jsus est Dieu lui-mme !
Aprs ces remarques nous essayons d exposer les arguments rationnels qui montrent que la Trinit et la raison sont des choses inconciliables. Et c est la raison pour laquelle les Chrtiens qualifient ce dogme de mystre ; et lorsqu on leur montre sa contradiction avec la raison, ils vous demandent de croire aveuglment sans essayer de comprendre ou de discuter.
Cependant, avant d en discuter les dtails et le fondement nous reproduisons le texte, que nous avons vu plus haut, d un commentaire de la Bible, qui explique le dogme de la Trinit :
Le dogme de la Trinit expliqu par un thologien chrtien :
Dans la rvlation progressive du Nouveau Testament, se manifeste le seul vrai Dieu, existant en trois personnes divines, appeles ici : Le Pre , Le Fils et Le saint-Esprit .
1. Caractristiques : Chacune des trois Personnes de la divinit possde ses caractristiques propres et se distingue nettement des Autres. Cependant, toutes trois sont gales quant leur essence, leur puissance, et leur gloire : Chacune porte le nom de Dieu ; chacune possde tous les attributs divins ; Chacune accomplit des uvres divines ; Chacune est digne de recevoir les honneurs dus Dieu.
2. Activits : Un ordre s tablit dans leur manifestation : le Pre vient d abord, le Fils ensuite, et, en troisime lieu, le Saint-Esprit ; Le Pre est celui de qui viennent toutes choses ; le Fils, celui par qui tout est accompli ; le saint-Esprit, celui par qui tout est ralis ; et tout est pour Dieu. Malgr tout, aucune des Personnes de la Trinit n agit indpendamment des autres. Mais leur accord est permanent.
3. Rvlation : Le Nouveau Testament, par la rvlation qui lui est propre, ne dment pas le monothisme absolu de l Ancien Testament : Dieu unique en trois personnes. Les personnes de la Trinit sont un seul Dieu, non trois Dieux[75]. Dans l Ancien Testament il tait ncessaire de mettre l accent en premier lieu sur la rvlation du Dieu Unique pour viter toute quivoque avec les tendances polythistes. Cependant, la pluralit de Personnes du seul vrai Dieu apparat mme dans l Ancien Testament s il est lu la lumire du Nouveau Testament.
4. Mystre : Il faut confesser que la Trinit est un grand mystre chappant la possibilit d une explication complte. (Note, Matthieu, 28 : 19. la nouvelle dition de la Bible, L. Segond, d. La Socit biblique de Genve 1975).
Critique de ce texte
Lorsqu on essaie d analyser ce commentaire on trouve d normes contradictions, absurdits et invraisemblances.
Le texte dit : Chacune des trois Personnes de la divinit possde ses caractristiques propres et se distingue nettement des Autres .
Quand on dit trois personnes, on conoit qu elles se distinguent. Si ces personnes se distinguent elles ne seront pas gales quant leur essence, leur puissance, leurs qualits. Pourtant le texte dit qu elles sont trois, qu elles se distinguent et que chacune porte le nom de Dieu ; donc ce sont trois Dieux et non pas un ; ce qui est en contradiction avec les donnes de la phrase d en dessous qui dit : Les personnes de la Trinit sont un seul Dieu, non trois Dieux .
Le texte dit : chacune possde tous les attributs divins , ceci implique deux choses : la premire consiste montrer que chacune est indpendante des autres. Ce qui entrane dire qu elles sont trois Dieux qui se distinguent par leurs attributs. La seconde montre qu elles sont identiques et qu aucune distinction entre eux aussi bien en leur essence qu en leurs attributs ne peut tre releve ; ce qui entrane dire que cette Trinit est imaginaire et non pas un fait rel.
En ce qui concerne leurs activits, le texte montre que le Pre est le premier, le Fils le second et le Saint-Esprit le troisime ; ceci implique d une part que l un se distingue des deux autres et que d autre part, aucune galit n existe entre eux. Cependant, selon le texte, c est le Pre qui dcide ce qu Il veut et le ralise par le truchement du Fils et de l Esprit Saint. Dans ce cas, le Fils et l Esprit Saint sont des instruments dans la main du Pre ; Ils ont le mme rang que les Anges. Jsus, comme nous l avons vu, affirmait qu il est venu pour accomplir la volont de Dieu et non sa propre volont.
Le commentaire prtend que la Trinit ne dment pas le monothisme absolu de l Ancien Testament. Mais en ralit quand on dit Trinit on conoit polythisme et non monothisme ; parce que polythisme = pluralit de dieux que le commentaire lui-mme a souligne.
En fin le commentaire reconnat que cette croyance est un mystre qui chappe l explication ; c'est--dire incomprhensible.
Critique rationnelle du dogme de la Trinit[76]
Par ailleurs, quand on se rfre la raison pour essayer de comprendre cette croyance on se heurte de multiples contradictions :
1. Lorsqu on dit qu il y a trois personnes divines, et que chacune se distingue des autres, on aura deux consquences : ou bien elles se distinguent par des attributs nobles ou bien non.
Si elles se distinguent par des attributs nobles, cela amne dire que chacune possde ce que les autres ne possdent pas. Donc, chacune est en mme temps parfaite et imparfaite. Et si elles se distinguent par des attributs qui ne sont pas nobles, celle qualifie de ces attributs n est pas un Dieu.
2. Lorsqu on dit qu il y a trois personnes divines, et que chacune se distingue des deux autres par sa propre existence, ceci ncessite qu il n existe pas rellement un seul Dieu ; mais une composition imaginaire entre ces trois. La composition rellement conue est celle o on peut concevoir un besoin rciproque entre les lments composants de cette chose. Or, le besoin est une caractristique des tres cres et non de Dieu.
3. On dit que 3 personnes = 1 Dieu. Cette thorie est en contradiction avec les simples donnes lmentaires de la raison et de la logique.
Le Un rel n a pas de tiers entier, car le tiers c est 1/3 ; mais le Trois a un tiers entier qui est le un .
Trois est une somme de trois units : 1+1+1. Le Un qui est rellement Un n est pas une somme de 1+1+1 ; mais de 1/3 + 1/3 + 1/3.
Si on dit que 3 = 1 et 1 = 3 nous arrivons dire que la partie = le tout ; c est comme on dit : le mur d une salle = la salle elle-mme, un tiroir = son bureau et un pneu = la voiture.
Anecdote : On racontait qu un prtre a enseign la religion chrtienne trois personnes qui venaient de se convertir, surtout le dogme de la Trinit. Un ami de ce prtre vint le voir. Il lui demanda s il y eut des nouvelles. Le prtre l informa de la conversion de ces trois hommes. Alors l ami voulait couter et savoir si ces trois hommes connaissaient bien le dogme de la Trinit. Le prtre appela le premier et lui posa une question concernant la Trinit. Cet homme rpondit : vous m avez enseign qu il y a trois dieux. Le premier est dans le ciel, le deuxime est n de la vierge Marie et le troisime est celui qui tait descendu comme une colombe sur le deuxime dieu l ge de 30 ans. Le prtre s irrita et le chassa. Il appela ensuite le deuxime : celui-ci dit : Vous m avez enseign que les dieux sont trois, l un des trois a t crucifi, il reste maintenant deux. Le prtre le chassa galement.
Enfin, le troisime qui tait trs intelligent et qui a bien appris ses leons, en rpondant la question du prtre, dit : Mon seigneur, j ai appris parfaitement ce que vous m aviez enseign et j ai compris, grce mon Seigneur Jsus, que le Un est Trois et que les Trois est Un et qu il y a union entre eux. Un des trois a t crucifi et tu, donc cause de l union entre les trois, ils ont t tous morts. Maintenant il n existe pas de Dieu, sinon nous devons renier l union entre les trois.
************************* Conclusion
L esprit critique de beaucoup de thologiens et penseurs occidentaux, par lequel furent tudis les textes bibliques, encourage beaucoup de gens rviser, voire repenser leurs convictions traditionnelles hrites de leur milieu social.
Cet esprit se fera sentir le plus, chez ceux la fois dpourvus de prjugs et sincres dans la recherche ; quant la mise en question des convictions tablies et des conceptions enracines.
L ordre tabli par exgtes et thologiens des sicles passs, concernant les interprtations des textes sacrs, fut branl. Actuellement cette attitude embrasse un large public. Et c est dans ce milieu, dnu d ides prconues, que se recrutent des penseurs ouverts au dialogue constructif et fructueux.
Notre ouvrage est un essai modeste pour ce genre de dialogue. Il a vis exposer le point de vue islamique sur d importantes thses, qui sont des sujets de controverse entre les trois religions monothistes .
Aprs un long voyage travers les textes sacrs des trois religions, nous souhaitons, dans cette conclusion, que les rsultats de ce travail poussent rflchir, lire les textes avec circonspection.
Nous avons essay de montrer dans une partie de ce livre, par des exemples l appui, les erreurs et les contradictions que renferment la Bible. Ceci confirme l opinion, selon laquelle la Bible fut sujette des remaniements humains. Ces remaniements intentionnels ou non, avaient un impact sur les textes concernant l annonciation et l avnement du dernier Prophte.
Toutefois, il n est pas sans importance de souligner que, malgr ces remaniements, quelques dtails subsistent dans ces mmes textes bibliques. Ils dcrivent le lieu gographique, la nation et les tribus au sein desquelles le dernier Prophte apparatra, l poque de son apparition ainsi que les uvres qu il accomplira.
Par ailleurs, il nous faut signaler que les exgtes Chrtiens ont essay d interprter ces textes d une faon toute indique, en ne reconnaissant cet aspect messianique qu au seul Jsus.
Or le texte de Jean (1 : 19, 25) insiste, d une faon, on ne peut plus claire, que les Juifs attendaient trois personnages : Elie, le Messie et le Prophte. Le Prophte en question, est dcrit la fois dans le Deutronome (18 : 15-22) et dsign par le Paraclet dans le discours de Jsus (Jean, 14 : 16).
D autre part, des textes de l Ancien et du Nouveau Testament sont formels quant au transfert de l hritage religieux (de la Prophtie) une autre nation. Dans d autres textes on a t jusqu mentionner les noms des tribus, la ville et le sanctuaire o se passeront les rites du sacrifice.
En outre, on a signal que la nation de ce Prophte dominera la terre, surtout de l Est l Ouest (Esaie, 54 : 9-17).
Aussi est-il besoin de signaler que les textes de la grotte de Qumran, rcemment dcouverts, confirment la thse que nous avons avanc : Nous avons essay de dchiffrer les lettres (I M N) auxquelles nous avons fourni une explication que nous croyons juste. Elle s applique d une part, aux habitudes des Juifs qui occultent certaines vrits, surtout celles concernant le dernier Prophte, par le truchement des lettres alphabtiques et leurs valeurs numriques. Et d autre part, aux premiers lettres des noms et qualificatifs du Prophte. Il en va de mme, d autres interprtations, non cabalistiques, cette fois-ci, de ces lettres, fournies par les exgtes et les thologiens Chrtiens et Juifs.
Quant la troisime partie, nous l avons consacre l tude du Prophte Jsus dans le Coran. Celle-ci prend appui sur les propos de Jsus lui-mme et sur les donnes lmentaires de la raison.
En effet, lorsque l on examine de plus prs, cette image du Christ la lumire de l Ecriture Saint chrtienne, nous constatons des concordances manifestes entre les deux textes sacrs.
En revanche, la religion authentique professe dans sa totalit par le Christ, a subi, au cours des temps, maintes mtamorphoses, dues aux diffrents facteurs : (la culture hellnistique, les conciles et l autorit politique) ; ce qui a fauss l image du Christ.
En partant des thses que nous avons avances jusqu ici, nous avons dmontr, la fois, par les textes du Nouveau Testament, et par le raisonnement rationnel, la fausset du dogme de la Trinit et de la divinit de Jsus.
Et dans la mme suite d ides, nous avons consacr des chapitres entiers aux questions fondamentales de la Rdemption, de la crucifixion et du Saint-Esprit, tout en les analysant en profondeur dans leurs sources bibliques, paralllement celles du Coran.
Il rsulte de ce parcours, en fin de compte, que Jsus prparait le peuple Juif une prdication plus universelle et plus profonde ; celle du Prophte Mohammad dont la mission est de marier le temporel et le spirituel en une unit solide, monolithique qui exclut toute dissociation.
Il nous reste ajouter en dernier lieu, que si notre nouvelle approche a russi, tel est notre v u le plus pieux, dans le cas contraire, elle aura, au moins le mrite d attirer les attentions sur ces sujets et de les remettre en actualit
permanente.
[1] Que sais-je ? PUF- Paris 1967. [2] Que sais-je ? PUF- Paris 1981. [3] Editions Seghers, Paris 1979. [4] Pour plus de dtails nous renvoyons le lecteur l introduction de la traduction du Coran faite par M. Hamidullah, laquelle nous nous rfrons. [5] Voici la note crite sur ce verset dans la traduction biblique de Genve 1979 : Nombre incertain : peut-tre une faute de copiste. [6] Dans l dition Louis Segond on a employ jeune fille qui est compatible avec le terme hbreu, cependant d autres ditions ont chang cette traduction par le mot vierge, peut-tre, afin qu il soit compatible avec le texte cit par Matthieu. [7] Mais il est mentionn dans les documents dcouverts ultrieurement : comme quelques fragments d'un Evangile perdu trouvs au Ymen, qui mentionnent le nom Ahmad (c'est--dire Mohammad) comme nom du prophte attendu. Ainsi que l'vangile de Barnab dcouvert au 17e sicle en Prusse (actuelle Allemagne), rdig en italienne. Il fut traduit en anglais puis en d'autres langues parmi lesquelles l'arabe en 1930 par un Egyptien chrtien. Il fut rdit par Dar al-Qalam au Koweit.
[8] Les manuscrits de la Mer Morte, Millar Burrows ; traduit de l'amricain par M. Glotz et M.T..Frank. Ed. Robert Laffont, Paris 1970, p. 345.
[9] Quant aux Tmoins de Jhovah, qui prtendent que Jsus est le Fils de Dieu (mais sans le proclamer un Dieu), il parait impossible d'tablir une comparaison entre les deux, car entre un Fils de Dieu et un simple tre humain il n'y a aucune ressemblance, soit dans leur essence, soit dans les consquences qui s'ensuivent : comme les pchs pour Mose (selon la croyance des Chrtiens) et l'impeccabilit, pour Jsus. [10] La vraie traduction du mot Para est nombreuse . Les Chrtiens l'ont traduit par un ne sauvage; ce qui est indigne d'un juste homme comme Ismal. Donc la phrase authentique est la suivante: Sa postrit sera nombreuse . [11] Cette prophtie ne concerne pas les Edomites, les frres des Isralites, parce que selon la Bible: Gense, 27: 1-40, Isaac a bni Jacob et a priv Esa, qui sera le pre des Edomites ; donc le Prophte attendu ne sera pas un descendant d'Esa. [12] Nous en parlerons plus tard en dtails. [13] Voici une note de la traduction Segond, concernant le terme Dieu (Paris 1978) p.584 : L'Ancien testament applique parfois le terme dieu des hommes (Psaumes 92 : 6 ; Exode, 4 : 16 ; comp. Jean, 10 : 34-35); Ici il s'applique au roi. Une autre traduction pourrait dire : C'est pourquoi, ton Dieu t'a oint. . [14] Voir Tirmidi, Chama il ; Baladzuri, 1831-832 ; Ibn Sa d, I : 2, p.120-131.
[15] Voir galement la phrase du texte suivant (Psaume, 72 : 15) : On priera pour lui sans cesse, on le bnira tout le jour. . Il faut mditer sur l expression on priera pour lui qui convient parfaitement au Prophte Mohammad ; alors que pour Jsus le texte aurait du dire : On le priera puisqu il est un Dieu selon la croyance chrtienne. [16] Nombreux sont les chercheurs qui tablissent des liens entre le groupe assdien ( les Hassidim c'est--dire les pieux) du IIe sicle av J.-C., les Essniens qui leur succdrent et qui reprsentaient leur ligne fidle la loi de Mose, et les sectaires de Qumrn. En effet, il est peu prs unanimement admis que le mouvement essnien auquel ces manuscrits (de Qumrn) appartiennent plonge ses racines dans le mouvement assiden. Un certain nombre de rapprochement s'imposent... Les Assidens sont dvous La loi... ils sont organiss en une sorte de congrgation (comme les sectaires de Qumrn) ... Les Hassidim sont enfin attachs aux fils d'Aaron qui avaient une grande place Qumrn. (Mathias Delcor. le Livre de Daniel. p. 17 ; J. Gabalda et Cie. paris 1971) ; en outre, l'auteur note des rapprochements de vocabulaire entre le Livre de Daniel, suppos assiden par lui, et les documents de Qumrn. Il est noter, en plus, que deux tribus des juifs de Mdine ( les Nadirites et les Qurazites) en Arabie, sont des fils d'Aaron (voir la biographie du Prophte Mohammad : La Sira d'Ibn Hichm. 3 : 118 o le pote Abbas Ibn Mirdas, dans les vers 1 et 5, voque cette ralit ; et voir aussi Ibn Hichm, 1 : 18, dition de 4 tomes). Ces deux tribus attendaient un Prophte qui devait sortir d'Arabie. [17] Selon la signification du terme Messie , le Prophte, voqu dans ce texte ou dans d autres, est aussi un Messie ; tout en tant le Grand Messie. Par contre le Messie d Isral serait le grand Messie d Isral seulement. [18] Pour s assurer que les sacrificateurs taient tous descendants d Aaron , voir : ( Exode,40 : 15 ; Nombres, 18 : 7 ) et pour se renseigner sur leurs fonctions, voir : ( Lvitique, 9 : 8-21 ; Nombres, 16 : 40 ; 2 Chroniques 15 : 3 ; Ezchiel, 7 : 26 ; 1 Samuel , 22 : 10 ). [19] Voir les Manuscrits de la Mer Morte, p. 219-20. [20] Ou Nabucodonosor. [21] Mathias Delcor souligne qu il faut exclure toute interprtation pessimiste de la succession des empires, prsente selon le schma des mtaux. Le chapitre 2 n enseigne pas que l humanit dgnre du fait de la valeur dcroissante des mtaux qui, dans la statue, servent composer les diverses parties du corps humain. Aucun jugement moral n est port dans le texte sur chacun des empires et la succession des mtaux marque uniquement le droulement du temps . [22] En effet les vv. 20-26 du chap. 8 donnent le dtail sur ce qui est dit sommairement dans le chap.2. Le blier du chap.8 deux cornes symbolise le pouvoir combin des rois Perses et Mdes. Ils sont donc considrs comme une unit politique ; dans le chap.2 cette unit est symbolise par la poitrine qui s associe aux bras. . [23] Aprs la mort d Alexandre en 323 av. J. -C. son empire fut divis entre ses gnraux. Sleucus fonda l empire sleucide, (en Syrie, Perse, Msopotamie, Armnie, Palestine), Ptolme celui des Ptolmes(en Egypte), Antipater eut la Macdoine et la Grce et Lysimaque la Thrace. [24] Les exgtes de la Bible donnent la mme interprtation que nous venons de donner ; par exemple C.I. Scofield, dans la note rserve ce chapitre (2) crit : Les quatre mtaux de la statue symbolisent quatre empires qui n exercrent pas ncessairement leur pouvoir sur toute la terre habite, : ce sont les empires, babylonien, mdo-perse, grec (d Alexandre) et romain. Cette dernire puissance se partage d abord en deux (les jambes), les empires romains d Orient et d Occident, puis en dix (les orteils). Dans son ensemble, la statue donne une ide impressionnante de la grandeur et de la splendeur des grandes puissances terrestres. La Pierre (Christ) dtruit l difice international (dans sa forme final) de faon subite et irrmdiable, et non pas par une suite de changements et de transformations graduelles Or une telle destruction de l organisation politique mondiale ne s est pas produite la premire venue du Christ. Au contraire, le Seigneur fut condamn mort par ordre
d un fonctionnaire du quatrime empire, alors au znith de sa puissance. Aprs la mort du Christ, cet empire s croula : en 476, sa partie occidentale, sa partie orientale en 1453. ( Segond, nouvelle dition de la Bible, d. Socit biblique de Genve 1975). [25] Le Fils de l Homme dans les Evangiles. Outre les synoptiques, le Fils de l Homme est mentionn dans le IVe Evangile, dans les Actes et l Apocalypse. L emploi de cette expression mise dans la bouche de Jsus par les vanglistes est contest par l exgse contemporaine qui a tendance mettre au compte de la communaut cette manire de dsigner Jsus. C'est--dire ceux qui ont vu en Jsus le Prophte attendu et le Prcurseur du royaume de Dieu, empruntrent ce terme Fils d homme du livre de Daniel et l appliqurent Jsus. A propos de ce terme appliqu Jsus, O. Cullmann, N.T. p. 29-30, crit : Deux questions se posent ici. La premire est de savoir si le titre de fils de l homme a t rellement revendiqu par Jsus ou s il lui a t dcern seulement par la communaut chrtienne primitive. La seconde est de connatre le sens de ce titre. Son application Jsus n est pas du tout courante dans le Christianisme primitif. Nous la rencontrons chez Marc et les autres vanglistes seulement quand ils font parler Jsus ; jamais lorsqu un interlocuteur de Jsus s adresse lui ; jamais non plus, les vanglistes ne le nomment eux-mmes ainsi. Ils ont donc gard le souvenir prcis que seul Jsus se dsignait comme Fils de l Homme. Mais nous faisons valoir qu en Marc 8 : 38, non seulement Jsus ne s appelle pas Fils de l Homme mais se distingue de lui : celui qui aura honte de moi et de mes paroles le Fils de l Homme aura honte de lui lorsqu il viendra dans la gloire de son Pre avec les saints anges , et Luc, 12 : 8-9. [26] En effet, la mort de l empereur romain Thodore le Grand en 395, l empire fut scind entre ces deux fils : l Orient pour Arcadius, l Occident pour Honorius. [27] En fait que les Juifs avaient l intention criminelle de tuer Jsus, la parabole souligne cette culpabilit en illustrant l intention volontaire excuter l acte criminel. [28] En effet, cette interprtation est confirme par les faits historiques : une grande majorit des Chrtiens, notamment d Orient, s tait convertie l Islam. Par contre il n y eut qu une minorit infime de Juifs embrasser l Islam. [29] Les anges du Fils de l Homme, cits dans le texte, sont ses disciples. La trompette c est la rvlation annonce aux nations. [30] Le mot oint = Messie = Christ, s applique soit au roi, soit au prtre (cf. Lvitique, 4 : 3 ; Esaie, 12 : 3). Ce titre peut mme tre port par un roi tranger, nommment Cyrus roi de Perse (cf. Esaie, 45 : 1). Ce titre est donn soit un chef isralite, soit un chef tranger. Les Juifs ont voulu cacher cette ralit biblique en prtendant que le Grand Messie est un descendant de David ; mais Jsus est venu pour leur dmontrer que la ralit est tout fait le contraire. C est pour cela que lorsque Jsus (Luc, 20 : 16) a dclar que le royaume de Dieu sera transfr une autre nation, ils avaient dit : Qu il n en soit pas ainsi !. C est la raison pour laquelle ils avaient essay de l arrter chaque occasion. Et n oublions pas que ce Grand Messie sera issu de la nation qu ils mprisaient ; ce qui est tout fait abominable leurs yeux.
[31] Si Jsus est un descendant de David il n aura pas son trne ; des versets de l Ancien Testament confirment cette dduction : dans Jrmie (36 : 30-31), aprs que le roi de Juda, Yehoyaqim, avait brl le rouleau qui contenait les paroles que Baruch avait crites, sous la dicte de Jrmie, la rvlation fut alors adresse Jrmie : et contre Yehoyaqim, roi de Juda, tu diras : Ainsi parle l Eternel : c est toi qui a brl le rouleau c est pourquoi ainsi parle l Eternel contre Yehoyaqim, roi de Juda : Aucun des siens ne sigera sur le trne de David . Jsus est un descendant
de Yehoyaqim ; selon Matthieu, (1 : 11) Jsus est descendant de Ykonia (qui est Yehoyaqin) et Yekonia est le fils de Yehoyaqim et petit-fils de Josias (voir 2Rois, 23 : 29-36). [32] Voir : M. Bucaille, la Bible, le Coran et la Science pp. 105-109. [33] Nous entendons par cause psychologique : 1Le rle de l imagination des rapporteurs dans la dformation des faits, concernant la vie et les dires du Christ, sous l empire de l exaltation. 2L effet de la moralit des rapporteurs dans la valeur des textes rapports. C'est--dire ces rapporteurs taient-ils vridiques ou non ? Ce facteur, nous l avions trait dans la premire partie lorsque nous avions expos les contradictions, les erreurs et les divergences figurant dans le N.T. [34] Les pharisiens est un parti juif observant les traditions et croyant la rsurrection des morts et au monde invisible. L autre parti, les Sadducens, n y croyait pas. [35] Un des quatre empires constituant le grand empire d Alexandre le Grand, divis aprs sa mort en quatre royaumes. Celui-ci se situait dans la Syrie, Palestine et Msopotamie. [36] Pripatticien. Le pripattisme est une philosophie sociale qui affirme la valeur des biens externes et corporels et de la vie pratique et politique = l Aristotlisme. [37] Les stociens. Ecole philosophique oriente vers la morale, le stocisme professe que le bonheur est dans la vertu. Les principes doctrinaux vont tre dtaills plus loin. [38] C taient des empereurs philosophes romains. [39] Dans un telle exgse le lien entre le texte et son interprtation paratra toujours arbitraire. On sera port accuser Paul de chercher intentionnellement introduire dans les textes les doctrines qu il voulait prouver. Cette mthode allgorique, souvent hardie, modifie catgoriquement les significations et les portes relles des versets de l Ecriture. [40] Malheureusement, les exgtes n avaient pas gnralis cette interprtation pour expliquer des termes renfermant des concepts mtaphoriques ; comme ceux du Fils et du Pre, sur lesquels le Christianisme fonde ses bases dogmatiques. [41] C est un mot grec qui signifie parole , raison . [42] Les ides d Hraclite concernant le logos sont diffrents de celles des Stociens vues plus haut. [43] L ide du logos-formule ou parole tait intimement lie l ide du logos principe physique et moral, c est, en effet, par cette mythologie grecque que nous pouvons tablir l unit entre les lments divers que prsente la thorie du logos. [44] Nous soulignons ici la ressemblance entre les proprits et les attributs de Jsus, chez les chrtiens, et ceux des mythes gyptiens. [45] Cette expansion de l arianisme, vaste et rapide, montre qu Arius n tait que plus zl et plus courageux que les autres. Les vques et la population des autres provinces partageaient avec lui la mme doctrine ; mais ils n osaient pas la montrer jusqu ce que ce dernier la proclamt au milieu de la population gyptienne, et trouva le soutien des autres provinces. [46] Edition : La socit Biblique de Genve, 1975. Notes et commentaires de C.I. SCOFIELD.
A noter qu il est facile de relever les contradictions dans ce commentaire. [47] Remarquons qu il a dit plus haut que chaque personne est appele Dieu. [48] Grgoire tait un arien et, c tait la cause pour laquelle il a t oblig de dmissionner et de partir, par peur peut-tre de l autorit politique. [49] En ralit on n a pas voqu sinon discut le terme Saint-Esprit dans le 1er concile. [50] Par exemple, le choix des villes avait une influence importante sur les rsultats du concile, surtout si cette ville est celle de l empereur comme c tait le cas dans les deux premiers conciles (de 325 et de 381). [51] L me ici est l Ame universelle de Brhier. C'est--dire la 3e personne de cette Trinit ; l esprit chez J. Trouillard est quivalent l intelligence de Brhier (c'est--dire la 2e personne). La terminologie diffre d un auteur l autre. [52] Voici ce qu on a crit propos du terme hypostase dans le dictionnaire : Ides et mthodes : Hypostase. - Ce mot, qui joue un si grand rle dans les coles d'Alexandrie et d'Athnes, depuis Plotin jusqu' Proclus, est l'indication d'une doctrine qui suppose un Dieu qui, sans sortir de lui-mme, se transforme ternellement en une essence d'un ordre infrieur, pour ne pas tomber dans le mouvement ncessaire au Dieu crateur. Plotin, pour expliquer Dieu et le monde, s'appuie sur la ncessit d'un intermdiaire entre l'absolu et le mobile. Il admet donc en Dieu : 1 une hypostase suprieure qui possde la perfection infinie sans mlange d'action ni de multiplicit; 2 une hypostase infrieure la premire, l'intelligence en soi; 3 une hypostase capable de produire le monde, mais mobile et infrieure la prcdente. Tels sont les trois principes en un seul tre, reconnus par toute l'cole noplatonicienne, l'Un, ou le Bien, qui est le Pre; l'Intelligence, qui est le fils; l'me, qui est le principe universel de la vie. Dans l'glise catholique, le mot hypostase fut employ avant celui de personne, en parlant de la Trinit. Pour exprimer la distinction de la divinit et les attributs des trois personnes, on disait qu'il y avait en Dieu trois hypostases en une seule essence. Le mot est grec (upostasis), les Latins firent prvaloir le mot personne.
[53] La mre de Marie regrette de n avoir pas eu un garon, qui et pu servir dans le Temple, o les filles ne sont pas admises. [54] Zacharie tait vieux et sa femme tait strile. [55] Littr. Il l appela (c est dire un ange qui l appelle). [56] Littr. S ur Aaronide. Les mots s ur et frre s emploient couramment en arabe pour membre de la tribu . Rappelons que Marie fut adopte par Zacharie, que lui et sa femme taient descendants d Aaron (Luc, 1 : 5), et que Marie tait parente de la femme de Zacharie (Luc, 1 : 36). Elle a t donc descendante d Aaron par ses deux parents ou au moins par l un d eux. [57] Le trs glorieux ou Ahmad en Arabe. Le Prophte Mohammad disait : Je m appelle Mohammad sur la terre, mais Ahmad dans le ciel. Le sens des deux noms est presque identique. Cette prdiction que le Coran met dans la bouche de Jsus rejoint celle que Jean rapporte (Jean, 14 : 16) : Je prierai le Pre, et il vous donnera un autre Directeur . Le mot Parakltos, que les Chrtiens traduisent par Consolateur,
signifie galement Directeur (Imam) et plus proprement dans le contexte de Jean (16 : 13) : Quand le Directeur sera venu, l Esprit de vrit, il vous dirigera car il ne parlera pas de lui-mme . Signalons qu un auteur du VIIIe sicle, Ibn Is-haq cite le passage de Jean (14 : 16) pour dire que Biri-Klutus , en langue des Roum signifie Mohammad . Qui sait si dans les Evangiles de son poque il ne lisait pas Periklytos au lieu de Parakltos ? (note de M. Hamidullah sur le verset 6 de la sourate 61 de sa traduction du Coran). [58] Pour rpondre cette question les thologiens musulmans avancent les raisons suivantes : A chaque poque on trouve la prpondrance et la perfection, chez un peuple, de certaines sciences, superstitions ou certains arts littraires. Dieu envoya un prophte chaque peuple. Et, par l intermdiaire de son messager, il leur exposa des miracles qui dpassaient de loin leur propre science ou superstition. Par exemple l poque de Mose les magiciens de l Egypte formaient la caste des dirigeants religieux, scientifiques et intellectuels du peuple Egyptien. Dieu donna Mose un miracle qui convenait ce qui tait rpandu en l occurrence ; mais qui surpassa toutes les jongleries des magiciens, pour prouver la vracit de sa mission (cf., Coran, 7 : 111-112 ; 20 : 60-70). A l poque de Jsus il y avait des ides matrialistes et de grands mdecins et philosophes etc. Il est donc convenable d avancer des miracles qui dfiaient les sages de l poque et confirmaient la vracit de son message. Les mdecins, incapables de gurir un lpreux, de rendre la vue un aveugle-n, de ressusciter les morts etc., en voyant ces prodiges se raliser sous leurs yeux, ils concluraient que ces actes miraculeux taient hors des capacits humaines et ne provenaient pas de la puissance terrestre ; par consquent ils reconnatraient la vracit de celui qui les effectuait. Enfin l poque de Mohammad, les Arabes se vantaient de leur loquence et de leur subtilit dans l art littraire, surtout en posie. Alors Dieu rvla au prophte Mohammad le Coran comme preuve de sa vracit. Dieu dans le Coran dfie tous les hommes, surtout les Arabes et notamment les potes et les lettrs de composer un livre comparable au Coran, ou seulement dix chapitres, ou mme un seul (voir Coran, 2 : 23 ; 10 : 38 ; 11 : 13 ; 52 : 34 ). Aucun pote ni lettr n a pu soulever ce dfi. Convaincus de leur incapacit, ils s abstiennent de la comptition et recourent premirement aux accusations mensongres et finalement aux armes pour touffer la religion naissante. En fait, ils s taient abstenus de concurrencer le Coran bien que cette concurrence, s ils gagnaient, leur pargnerait corps et biens et rvlerait que Mohammad tait un imposteur. Cette incapacit de composer un livre semblable au Coran est un signe de la vracit de Mohammad. [59] Barnab, dans son Evangile, rapporte que la ressemblance de Jsus fut mise sur Judas Iscariot, son dnonciateur (voir Evangile de Barnab chapitre 220). [60] Cet homme qui appelait Dieu ne pouvait pas tre un Dieu, sinon il se serait dlivr lui-mme sans l aide d aucun. Quel faible Dieu ! [61] Il parait que les Juifs ne voulaient pas que l alliance et la loi soient donnes une autre nation, notamment celle sujette leur mpris et hostilit, savoir les Arabes, descendants d Agar la servante de Sara. Cette transmission de l alliance et de la loi une autre nation, entranera, d une part la perte de leur prestige ancestral et de leur privilge sur les nations, et mnera une nation insense sujette leur mpris avoir un prestige plus sublime que le leur. Les Juifs, par orgueil et rancune, et sans s attacher aux prescriptions divines, voulaient prserver ce privilge entre leurs mains. Mais la prdication de Jean-Baptiste et celle de Jsus qui avaient montr que la grce sera donne une autre nation, ont t considres comme un danger pour leur prestige (Matthieu, 3 : 7-12 ; Luc, 20 :16). De ces versets on dduit que le privilge devait tre t aux Juifs afin de le donner une autre nation ; mais eux ne voulaient pas que cela se ralise. Alors ils n avaient pas cru en Jean-Baptiste, et ils avaient tent de tuer Jsus. Aprs la disparition de Jsus, ils ont perscut ses disciples ; mais constatant que la perscution n empchait pas la prdication d embrasser un large public, ils s taient rsolu d user d un autre procd : quelques uns d entre eux se sont, en apparence, convertis au Christianisme et ont essay par ce moyen de dmontrer que Jsus tait le dernier prophte, en interprtant les textes bibliques leur guise afin de barrer le chemin la prdication qui rvlait la vrit. Peut-on classer Paul parmi ces perscuteurs convertis ?
[62] Nous avons dmontr que le royaume promis (celui de Dieu) est le royaume de l Islam tabli par le prophte Mohammad. En ralit, le Coran contient une grande partie de la loi de Mose. [63] La prdication de Jsus est, en effet, compose de ces deux parties : appel la repentance et la foi. La repentance consiste abandonner les uvres mauvaises et pratiquer les bonnes, la foi est la base des uvres bonnes. Les prophtes de l Ancien Testament faisaient autant. Aucune diffrence n apparat entre Jsus et ces prophtes au sujet de ces deux principes. [64] Coran, 3 : 61. A la suite de cet ultimatum expos dans le Coran, le Prophte Mohammad s est prt pour l appliquer alors que la dlgation chrtienne laquelle le dfi a t lanc, dcida de ne pas recourir la grave mthode propose ; mais de conclure une paix moyennant soumission politique. [65] Etre envoy implique qu on obit celui qui a envoy ; donc il y a une distinction nette entre les deux ; celui qui a t envoy ne peut tre un Dieu avec le Dieu qui l a envoy. [66] Pour ceux qui prtendent que ces phrases renferment un sens propre et le pain et le vin se transforment rellement en corps et sang du Christ, nous disons : 1. Nous voyons toujours le pain qui reste pain, il n est devenu ni os ni muscles, l instant.
2. Combien de Christ nous allons avoir si des prtres dans plusieurs endroits du monde et en mme temps font la Ste Cne ? Ces Jsus seraient-ils les mmes ou non ? S ils sont les mmes la matire du pain est diffrente. S ils ne sont pas les mmes il y aurait plusieurs Christ. 3. Le pain que le prtre a coup en plusieurs morceaux, pour qu on les mange : ou bien se transforme tout entier en un seul Christ, ou bien en plusieurs. Dans le premier cas on aura un Christ coup en morceaux ; alors celui qui a mang un morceau n aurait pas mang le Christ dans sa totalit. Dans le deuxime cas, on se demande d o sont venus ces Christs alors que le pain n a t que pour un seul Christ ? 4. Selon cette croyance le Christ est toujours sujet la douleur ; car chaque anne on coupe son corps et on verse son sang ; les Chrtiens alors sont plus mchants que les Juifs qui ne l ont tu, selon les vanglistes, q une seule fois, sans qu il mange son corps. Comment peut-on qualifier celui qui tue et mange Jsus chaque anne ? D autre part, si Dieu n est pas sauv de leurs mains, comment pourrait-il tre sauv de quelqu un autre ?! [67] Les Arabes paens croyaient que les anges sont les filles de Dieu. [68] Lvi est un fils de Jacob. Ce dernier est le petit-fils d Abraham. Donc c est bizarre de parler de la gnalogie des fils de Lvi puisque Melchisdek est contemporain d Abraham ! [69] Extraite d Izhar al-Haqq de Rahmat Allah al Hindi. [70] Alors que l expression Esprit Saint , comme nous l avons soulign, n est employ que dans les passages suivants de l Ancien Testament : Esaie, 63 : 10-11 ; Psaumes, 51 : 13. [71] On a jamais constat dans la Bible, que l Esprit de Dieu (ou l Esprit Saint) gale Dieu ou fait de lui un instrument ; mais au contraire, on constate toujours que c est Dieu qui envoie son Esprit quelqu un ou pour accomplir quelque chose. [72] L Esprit dans ce verset et dans les autres concernant la cration d Adam peut tre aussi identifi Gabriel ; car le Coran en parlant de la conception de Jsus, c est de Gabriel que Dieu a dit : Notre Esprit (19 : 17 et 66 : 12).
[73] Bien que le terme Esprit apparaisse dans ces diverses acceptions, il est noter que le Coran les prcise en donnant chaque notion une expression spciale forme du terme Esprit et d un dterminatif. Gabriel = Esprit Saint ou Esprit simplement, par contre la rvlation est dsigne par l Esprit de commandement . Cet emploi est justifi par le fait que la Parole divine est un Esprit vivifiant l esprit de l homme. Et celui qui la transmet est aussi un Esprit ; pour que ce soit convenance et harmonie entre l agent et la Parole transmise. Mais cet agent est une crature, alors que la parole est un attribut divin. D autre part, l homme qui reoit cette parole (le prophte) est lui-mme dou de capacits suprieures celles des tres humains afin de leur transmettre la parole qui puisse revivifier leur esprit. Donc tous ces trois esprits viennent de Dieu mais ils sont conus diffremment. [74] Ce verset est adress aux Juifs, de l poque du prophte Mohammad, qui disaient qu ils dtestaient Gabriel et aimaient Michel. En parallle, il est signaler que les Juifs de l poque de Jsus blasphmrent contre l Esprit Saint (voir Marc, 3 : 29) ce qui nous confirme que l Esprit Saint et Gabriel dans la conception juive reprsente une seule ralit [75] Remarquons qu il a dit plus haut que chaque personne est appele Dieu. [76] Extraite de Izhar al-Haqq.
Vous aimerez peut-être aussi
- Coran Une Lecture JuiveDocument72 pagesCoran Une Lecture JuiveneferisaPas encore d'évaluation
- Monde Des Djinns Et DemonsDocument216 pagesMonde Des Djinns Et Demonsfattianna100% (19)
- 33 Citations Inspirantes Des Nos Pieux PrédécesseursDocument13 pages33 Citations Inspirantes Des Nos Pieux PrédécesseursMaurice GomisPas encore d'évaluation
- Les Voies Dacces A La Realite Dans Le SoDocument30 pagesLes Voies Dacces A La Realite Dans Le SoabdescheikhPas encore d'évaluation
- Dieu est-il 1 ou 3الوهية المسيحDocument247 pagesDieu est-il 1 ou 3الوهية المسيحعبد العزيز تقيةPas encore d'évaluation
- Modele de TestamentDocument6 pagesModele de TestamentnabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Jews of MenemenDocument4 pagesJews of Menemenjsanders14Pas encore d'évaluation
- Le TabernacleDocument121 pagesLe Tabernaclemvengue100% (1)
- L'échec de Saint Paul: Comment les Pères Apostoliques défigurèrent le projet juif de Jésus.D'EverandL'échec de Saint Paul: Comment les Pères Apostoliques défigurèrent le projet juif de Jésus.Pas encore d'évaluation
- (Tome 3) "De Moïse À Mohammed, L'islam Entreprise Juive" Par Le Père Gabriel Théry (Hanna Zakarias)Document345 pages(Tome 3) "De Moïse À Mohammed, L'islam Entreprise Juive" Par Le Père Gabriel Théry (Hanna Zakarias)vbeziau100% (2)
- Jésus (PSL), La Vérité RévéléeDocument56 pagesJésus (PSL), La Vérité RévéléeAbdallah ibn aliPas encore d'évaluation
- Bacca Dans La Bible Et Dans Le CoranDocument2 pagesBacca Dans La Bible Et Dans Le CoranfusukuPas encore d'évaluation
- Interrogez-Moi Avant Que Vous Me Perdiez PDFDocument343 pagesInterrogez-Moi Avant Que Vous Me Perdiez PDFMarc Al Al-Mahdi100% (2)
- Histoire de La Ka'Ba Depuis L'aube Des Temps À Nos JoursDocument68 pagesHistoire de La Ka'Ba Depuis L'aube Des Temps À Nos JoursAbdallah ibn ali100% (2)
- Voyage NocturneDocument15 pagesVoyage NocturneSamar CandePas encore d'évaluation
- (Tome 2) "De Moïse À Mohammed, L'islam Entreprise Juive" Par Le Père Gabriel Théry (Hanna Zakarias)Document330 pages(Tome 2) "De Moïse À Mohammed, L'islam Entreprise Juive" Par Le Père Gabriel Théry (Hanna Zakarias)vbeziau100% (1)
- Le Jour Du JeudiDocument11 pagesLe Jour Du JeudiIsmael100% (1)
- (Nouveau) de La Polémique Dans Le Coran Au Contre-Discours Coranique (Tronqué) PDFDocument73 pages(Nouveau) de La Polémique Dans Le Coran Au Contre-Discours Coranique (Tronqué) PDFnajah69Pas encore d'évaluation
- (Tome 1) "De Moïse À Mohammed, L'islam Entreprise Juive" Par Le Père Gabriel Théry (Hanna Zakarias)Document351 pages(Tome 1) "De Moïse À Mohammed, L'islam Entreprise Juive" Par Le Père Gabriel Théry (Hanna Zakarias)vbeziau100% (6)
- Les Versets SataniquesDocument3 pagesLes Versets SataniquesMarc PedroPas encore d'évaluation
- Cheikh Anta Diop - Djibril SambDocument6 pagesCheikh Anta Diop - Djibril SambMarcio Goldman100% (4)
- Gens Du LivreDocument276 pagesGens Du LivreTawfiq MansourPas encore d'évaluation
- Le Califat A5Document132 pagesLe Califat A5Hassan MoussaouiPas encore d'évaluation
- Crucifiction Complet (Boys)Document79 pagesCrucifiction Complet (Boys)Abdallah ibn ali100% (1)
- Les Croyances Des Chiites DuodecimainsDocument322 pagesLes Croyances Des Chiites DuodecimainsAbdallah ibn ali0% (1)
- Mondher Sfar - Le Coran, La Bible Et L'orient Ancien (Islam, Arabes, Sumer, Babylone Mahomet, Muhammad Allah, Plagiat Musulman Nergal Marduk)Document457 pagesMondher Sfar - Le Coran, La Bible Et L'orient Ancien (Islam, Arabes, Sumer, Babylone Mahomet, Muhammad Allah, Plagiat Musulman Nergal Marduk)Andrés Santiago100% (1)
- Notes Sur L'islam Maghribin Marabouts PDFDocument128 pagesNotes Sur L'islam Maghribin Marabouts PDFSididris Youcef Dit Joseph100% (3)
- Les Valeurs Civilisationnelles Dans Le Message Du Meilleur Des HommesDocument230 pagesLes Valeurs Civilisationnelles Dans Le Message Du Meilleur Des HommesIslamHousePas encore d'évaluation
- La Marque Antichrist 666 Dérive D'un Symbole Islamique, Bismi AllahDocument23 pagesLa Marque Antichrist 666 Dérive D'un Symbole Islamique, Bismi AllahmiftahdinePas encore d'évaluation
- Kem - AUX ORIGINES KAMITES DES RELIGIONS DU LIVREDocument6 pagesKem - AUX ORIGINES KAMITES DES RELIGIONS DU LIVREBabacar Latgrand DioufPas encore d'évaluation
- Islam-Vérités Et MensongesDocument214 pagesIslam-Vérités Et MensongesJean DroitChemin100% (2)
- Le Mahdi DEPUIS LES ORIGINES DE L'ISLAM-1885Document100 pagesLe Mahdi DEPUIS LES ORIGINES DE L'ISLAM-1885Belhamissi100% (1)
- 4-La Recension Du CoranDocument14 pages4-La Recension Du CoranDaaray Cheikhoul XadimPas encore d'évaluation
- Lhomme Face Aux Prophetes 22Document284 pagesLhomme Face Aux Prophetes 22Cheick DoumbiaPas encore d'évaluation
- La Falsification Du Coran Selon Les ChiitesDocument4 pagesLa Falsification Du Coran Selon Les ChiitesAbdallah ibn ali100% (1)
- L'islam Et La Critique Historique by Théry Gabriel PDFDocument92 pagesL'islam Et La Critique Historique by Théry Gabriel PDFrayane ouzmihPas encore d'évaluation
- Altérer La Parole de Dieu Deux Faux Versets Retirés Du CoranDocument20 pagesAltérer La Parole de Dieu Deux Faux Versets Retirés Du CoranmidokabamaruPas encore d'évaluation
- JÉSUS Reviendra Prochainement, Pour Sauver Les MusulmansDocument104 pagesJÉSUS Reviendra Prochainement, Pour Sauver Les MusulmansNoman BAALI100% (1)
- Les Origines Du Christianisme (Zaltissi)Document250 pagesLes Origines Du Christianisme (Zaltissi)Zaltissi Mohamed100% (1)
- Signes Avant Le Jour Du JugementDocument4 pagesSignes Avant Le Jour Du Jugementabouno3manPas encore d'évaluation
- Un Grand Saint de L'islam AbdelKadir Gillani Par Mehmed Ali AiniDocument262 pagesUn Grand Saint de L'islam AbdelKadir Gillani Par Mehmed Ali AiniachlihiPas encore d'évaluation
- Bakari II Christophe Colomb: À La Rencontre de Tarana Ou L'amériqueDocument1 pageBakari II Christophe Colomb: À La Rencontre de Tarana Ou L'amériqueSaikou Oumar BangouraPas encore d'évaluation
- Muhammad Mentionne Dans La Bible - Discours Du 10 Mai 2014 Prononce Par Salik Alhanif PDFDocument13 pagesMuhammad Mentionne Dans La Bible - Discours Du 10 Mai 2014 Prononce Par Salik Alhanif PDFsalik93100% (1)
- Mensonge 04 PDFDocument201 pagesMensonge 04 PDFkarpov604604Pas encore d'évaluation
- Invocation Du Nom Divin ALLAHDocument90 pagesInvocation Du Nom Divin ALLAHFifou MerletPas encore d'évaluation
- La Foi Et La VieDocument442 pagesLa Foi Et La Vieamr khalidPas encore d'évaluation
- Diacritisme Absent Dans Le Coran, Pourquoi?Document3 pagesDiacritisme Absent Dans Le Coran, Pourquoi?Linux Ubuntu50% (2)
- Abbasi Hassan - Les Secrets de L IslamDocument47 pagesAbbasi Hassan - Les Secrets de L IslamGrigoras Alexandru Nicolae100% (2)
- Decrypt Age Duc or AnDocument512 pagesDecrypt Age Duc or AnnecimPas encore d'évaluation
- La Chute de L'homme À La Lumière Des Textes Fondateurs de L'islam PDFDocument52 pagesLa Chute de L'homme À La Lumière Des Textes Fondateurs de L'islam PDFSalomon AlexandrePas encore d'évaluation
- BILÂL D'afriqueDocument112 pagesBILÂL D'afriquedazedPas encore d'évaluation
- Qu'est-Ce Que Le ThikrDocument37 pagesQu'est-Ce Que Le ThikrdazedPas encore d'évaluation
- F 038021Document336 pagesF 038021SouleyPas encore d'évaluation
- Islam Et ChristianismeDocument98 pagesIslam Et ChristianismeAbdoul JalilPas encore d'évaluation
- Musulmophobie - Origines ontologique et psychologiqueD'EverandMusulmophobie - Origines ontologique et psychologiquePas encore d'évaluation
- Mahomet et le Coran: Précédé d'une introduction sur les devoirs mutuels de la Philosophie et de la ReligionD'EverandMahomet et le Coran: Précédé d'une introduction sur les devoirs mutuels de la Philosophie et de la ReligionPas encore d'évaluation
- L'islam dans tous ses états: de Mahomet aux dérives islamistesD'EverandL'islam dans tous ses états: de Mahomet aux dérives islamistesPas encore d'évaluation
- Les nouvelles Fourberies de Djeha: (l'autre Nasr Eddin Hodja)D'EverandLes nouvelles Fourberies de Djeha: (l'autre Nasr Eddin Hodja)Pas encore d'évaluation
- Nasr Eddin Hodja rencontre Diogène: Très-Mirifiques et Très-Edifiantes Aventures du Hodja Nasr EddinD'EverandNasr Eddin Hodja rencontre Diogène: Très-Mirifiques et Très-Edifiantes Aventures du Hodja Nasr EddinPas encore d'évaluation
- Le livre descendu: Essai d'exégèse coranique, Volume 2D'EverandLe livre descendu: Essai d'exégèse coranique, Volume 2Pas encore d'évaluation
- L'obligation D'aimer Le Messager D'allâh - Extrait de Kitâb ShifâDocument25 pagesL'obligation D'aimer Le Messager D'allâh - Extrait de Kitâb ShifânabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Lettre À Mon FilsDocument15 pagesLettre À Mon Fils'AbdAllâhPas encore d'évaluation
- Les Méditations - (Par Ibn Qayim Al Jawziyya)Document36 pagesLes Méditations - (Par Ibn Qayim Al Jawziyya)AhadouneAahade100% (2)
- Les Caractéristiques D'un Croyant de Ahlus Sunnah Wal-Jamaa'ahDocument4 pagesLes Caractéristiques D'un Croyant de Ahlus Sunnah Wal-Jamaa'ah'AbdAllâhPas encore d'évaluation
- Le Comportement Des Salafs Envers Les Gens de L'innovationDocument6 pagesLe Comportement Des Salafs Envers Les Gens de L'innovationnabsthetoonsPas encore d'évaluation
- La Prédestination Et Le Libre ArbitreDocument12 pagesLa Prédestination Et Le Libre ArbitrenabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Les Principes de La Sunna Ousoul As-SunnaDocument7 pagesLes Principes de La Sunna Ousoul As-SunnanabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Explication de Six Points Du Parcours Du ProphèteDocument8 pagesExplication de Six Points Du Parcours Du ProphètenabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Les Moyens Utiles Pour Une Vie HeureuseDocument43 pagesLes Moyens Utiles Pour Une Vie HeureusetakkiddinePas encore d'évaluation
- La Sounnah Source de Civilisation Sheikh Yusuf Al QardawiDocument176 pagesLa Sounnah Source de Civilisation Sheikh Yusuf Al QardawinabsthetoonsPas encore d'évaluation
- La Foi Correcte Et Ce Qui L'opposeDocument62 pagesLa Foi Correcte Et Ce Qui L'opposeabouno3man100% (2)
- Tafsir Du Verset Du Trone (Cheikh Min Sa'Di, Fawzan, Ibn Taymiya Et Ibn Al-Qayyim JawziyahDocument6 pagesTafsir Du Verset Du Trone (Cheikh Min Sa'Di, Fawzan, Ibn Taymiya Et Ibn Al-Qayyim Jawziyahnabsthetoons100% (1)
- Les Fatawa Du Comite PermanentDocument385 pagesLes Fatawa Du Comite Permanentnabsthetoons100% (1)
- Résumé Du Dogme Islamique Tiré Du Coran Et de La Sounna Authentique (Cheikh Mohammed Ibn Jamil Zaynou)Document46 pagesRésumé Du Dogme Islamique Tiré Du Coran Et de La Sounna Authentique (Cheikh Mohammed Ibn Jamil Zaynou)nabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Fatawa IbnBaz Volume 29Document217 pagesFatawa IbnBaz Volume 29nabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Traitement Par La Hijama - Entre La Médecine Et La Religion (Mohammad Nabih)Document166 pagesTraitement Par La Hijama - Entre La Médecine Et La Religion (Mohammad Nabih)nabsthetoons100% (1)
- Remuer L'index Pendant Le Tachaoud (Extr. IslamQA)Document3 pagesRemuer L'index Pendant Le Tachaoud (Extr. IslamQA)nabsthetoonsPas encore d'évaluation
- VocajudaicaDocument10 pagesVocajudaicaAmara VenamiPas encore d'évaluation
- Delivrance Et Combat Spirituel Manuel Un Guide Complet Pour VivreDocument309 pagesDelivrance Et Combat Spirituel Manuel Un Guide Complet Pour Vivrestephane limangaPas encore d'évaluation
- Halter, Marek-Le Kabbaliste de PragueDocument226 pagesHalter, Marek-Le Kabbaliste de Pragueafakatow100% (3)
- JacobDocument57 pagesJacobtifus1410Pas encore d'évaluation
- AttachmentDocument44 pagesAttachmentHillah100% (3)
- Chronologie-Du-Nouveau TestamentDocument9 pagesChronologie-Du-Nouveau TestamentYvesPas encore d'évaluation
- Alterations Et Codicologie Coraniques PDFDocument22 pagesAlterations Et Codicologie Coraniques PDFAsis Kay AlidrissiPas encore d'évaluation
- Le Symbolisme Du Chiffre 6Document5 pagesLe Symbolisme Du Chiffre 6davidapota665Pas encore d'évaluation
- 2019YearEndConfOutline FRADocument12 pages2019YearEndConfOutline FRAJean Emmanuel LouisPas encore d'évaluation
- Tous Les Verset Sur Les ScribesDocument5 pagesTous Les Verset Sur Les ScribesMelPas encore d'évaluation
- ABRAHAMDocument9 pagesABRAHAMPato DarcoPas encore d'évaluation
- Lettre À César, Roi de RomeDocument5 pagesLettre À César, Roi de RomeYoussef StitiPas encore d'évaluation
- Qui Etait Allah Avant Lislam PDFDocument18 pagesQui Etait Allah Avant Lislam PDFJenani Mustapha100% (1)
- Guide Des Grands Sites Sacrés en France - Jean-François BlondelDocument20 pagesGuide Des Grands Sites Sacrés en France - Jean-François BlondelAndre Medigue100% (1)
- ANGEOLOGIEDocument57 pagesANGEOLOGIEconventdudragondelouestPas encore d'évaluation
- 03.bibliographie Hebrew LanguageDocument2 pages03.bibliographie Hebrew Languagescribdi2010Pas encore d'évaluation
- La Fin HeureuseDocument12 pagesLa Fin Heureuseabouno3manPas encore d'évaluation
- Litanies de La Vierge MarieDocument3 pagesLitanies de La Vierge Mariemariel909Pas encore d'évaluation
- (Tome 3) "L'Islam, Ses Véritables Origines", Par L'abbé Joseph BertuelDocument145 pages(Tome 3) "L'Islam, Ses Véritables Origines", Par L'abbé Joseph Bertuelvbeziau100% (4)
- Le Tikoun HatsotDocument38 pagesLe Tikoun Hatsotsaingainy100% (1)
- Le Grimoire de Turiel en FrançaisDocument31 pagesLe Grimoire de Turiel en FrançaisStephen Murtaugh100% (1)
- Saint Augustin - Discours Sur Les Psaumes - Ps 50 La PénitenceDocument18 pagesSaint Augustin - Discours Sur Les Psaumes - Ps 50 La PénitenceVan KarpoPas encore d'évaluation
- Baruch SpinozaDocument19 pagesBaruch SpinozaJorge Luis BorgesPas encore d'évaluation
- Histoire de L AlgerieDocument30 pagesHistoire de L Algeriebeginnerscribd0% (1)
- Conditions Des Juifs Comté de Toulouse Saige, GustaveDocument150 pagesConditions Des Juifs Comté de Toulouse Saige, GustaveClaude Bertin100% (1)
- La Roumanie Et Les JuifsDocument410 pagesLa Roumanie Et Les JuifsDaramus_Lucian_9478100% (1)