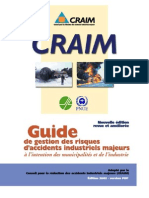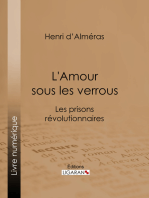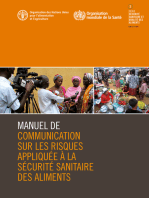Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Guide Du Responsable de La Sécurité 2006
Transféré par
Deanna BarrettCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Guide Du Responsable de La Sécurité 2006
Transféré par
Deanna BarrettDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le guide
du responsable
de la scurit
CNPP ENTREPRISE - Dcembre 2006
Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle, faite sans le consentement de
lauteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite (article L.122-4 du Code de la
proprit intellectuelle).
Cette reprsentation ou reproduction, par quelque procd que ce soit constituerait une
contrefaon sanctionne dans les conditions prvues aux articles L.335-2 et suivants du
Code de la proprit intellectuelle.
Le Code de la proprit intellectuelle nautorise, aux termes des alinas 2 et 3 de larticle
L.122-5, dune part que les copies ou reproductions strictement rserves lusage priv
et, dautre part, que le analyses et les courtes citations dans un but dexemple et
dillustration.
CNPP ENTREPRISE SARL Service Editions
Route de la Chapelle Ranville CD 64 BP 2265 F 27950 SAINT-MARCEL
Tl. : 33 (0)2 32 53 64 34 Fax : 33 (0)2 32 53 64 80
www.cnpp.com
PME-PMI
PARTIE 1
SALARIS ET RISQUES DACCIDENT
Partie 1 - Salaris et risques daccident
1 LES PRINCIPES GNRAUX EN MATIRE DE SCURIT
DANS L'ENTREPRISE
1.1 Les entreprises assujetties et les sources du droit
1.2 Les lments viss par la rglementation en matire de scurit
1.3 La mission du chef dtablissement
2 LES MESURES DE SCURIT RELATIVES AUX QUIPEMENTS
2.1 Les quipements de travail
2.2 Les machines
2.3 Les quipements de travail faisant lobjet de rgles particulires
2.3.1 Les quipements et accessoires de levage
2.3.2 Formation
2.3.3 Les ascenseurs et ascenseurs de charge
2.3.4 Les quipements sous pression
2.4 Les quipements de protection individuelle (EPI)
2.4.1 Les trois catgories d'EPI
2.4.2 Le choix des EPI
2.4.3 L'utilisation des EPI
2.4.4 La fiche de poste
2.4.5 Les risques lis aux interventions en hauteur
2.4.6 Le risque lectrique
2.4.7 Travail sur cran
2.4.8 Le risque amiante
2.4.9 Le bruit
3 LES INTERLOCUTEURS EN MATIRE DE SANT ET DE SCURIT
AU TRAVAIL
3.1 Le responsable scurit
3.2 Le CHSCT
3.3 L'inspection du travail
3.4 La CRAM
3.5 Le mdecin du travail
Partie 1 - Salaris et risques daccidents
4 L'VALUATION DES RISQUES
4.1 Gnralits
4.1.1 Quelques dfinitions sur lvaluation des risques
4.1.2 Pourquoi procder une valuation des risques ?
4.1.3 Qui doit procder lvaluation des risques ?
4.1.4 Comment procder lvaluation des risques ?
4.1.5 La rglementation
4.2 Lanalyse prliminaire de risques (APR)
4.2.1 Dfinition
4.2.2 Objectif
4.2.3 Dans quel contexte ?
4.2.4 Droulement de lanalyse
4.3 Lanalyse des modes de dfaillances, de leurs effets et de leur
criticit (AMDEC)
4.3.1 Dfinition
4.3.2 Objectifs
4.3.3 Dans quel contexte ?
4.3.4 Droulement de lanalyse
42 La mthode HAZOP
4.4.1 Dfinition
4.4.2 Objectif
4.4.3 Contexte
4.4.4 Principes
4.4.5 Droulement de lanalyse
4.5 Les arbres de dfaillances
4.5.1 Dfinition
4.5.2 Objectifs
4.5.3 Contexte
4.5.4 Principes
4.5.5 Droulement de lanalyse
4.6 La mthode DIDERO
4.6.1 Le dcoupage en units de travail
4.6.2 Le dcoupage en oprations ou tches ralises
4.6.3 Lidentification des sources de danger
4.6.4 Lvaluation des risques
4.6.5 La hirarchisation des risques
4.6.6 Le seuil de significativit de la mthode DIDERO
4.7 La scurit au travail : de la mthodologie la pratique
4.8 Llaboration du document unique relatif lvaluation
des risques professionnels
4.8.1 L valuation des risques et la situation relle
4.8.2 Qui est concern par la rglementation gnrale ?
4.8.3 Points de repre : la directive-cadre et sa transposition en droit franais
4.8.4 Le dcret du 5 novembre 2001: lments juridiques
4.8.5 La circulaire du 18 avril 2002
4.8.6 Aide la rdaction du document unique relatif lvaluation des risques professionnels
4.8.7 Quelle est ltendue de cette obligation ?
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.8.8 Modle de document unique dvaluation des risques professionnels
4.8.9 La fiche dvaluation des risques professionnels dans les PMI
4.8.10 Modle de fiche pour un poste de travail
4.8.11 Modle de plan dactions
4.9 Check-list des points-clefs pour lvaluation et la prvention des
risques
4.9.1 clairage
4.9.2 Prvention des risques dus au bruit
4.9.3 Ambiance thermique
4.9.4 Substances dangereuses
4.9.5 Risques cancrognes
4.9.6 Aration - Ventilation
4.9.7 Machines, engins mobiles, engins de levage
4.9.8 Manutention manuelle
4.9.9 Circulation
4.9.10 crans de visualisation
4.9.11 Ergonomie du poste de travail
4.9.12 Amnagement des locaux de travail
4.9.13 Incendie - explosion
4.9.14 lectricit
4.9.15 Risques lis au recours des entreprises extrieures
4.9.16 Opration de maintenance
Partie 1 - Salaris et risques daccident
1 LES PRINCIPES GNRAUX EN MATIRE
DE SCURIT DANS L'ENTREPRISE
1.1 Les entreprises assujetties et les sources du droit
Les rgles en matire dhygine, de scurit et de conditions de travail dans les entreprises
visent essentiellement protger les travailleurs contre les risques auxquels ils sont exposs
durant ou loccasion de leur travail.
Elles sappliquent aux :
tablissements industriels, commerciaux et agricoles ;
offices publics ou ministriels, professions librales, socits civiles, syndicats
professionnels, associations et groupements ;
tablissements hospitaliers publics et tablissements de soins privs ;
entreprises de transport (en dehors de toute rglementation particulire) ;
EPIC ou tablissements mixtes lorsquils emploient du personnel dans les conditions du
droit priv.
En revanche, elles ne sappliquent pas aux :
mines et carrires ;
entreprises de transport (par fer, par route, par air et par eau) assujetties une
rglementation particulire.
Toutefois, certaines dispositions peuvent leur tre rendues applicables.
Ces rgles sont inscrites au titre III du livre II du Code du travail et dans les textes non
codifis pris pour son application :
les principes gnraux sont fixs par les lois (articles L.230-1 L.236-13) ;
les principales modalits techniques sont fixes par les dcrets (articles R. 231-12
R.238-56 pour les dcrets en Conseil dtat, et articles D pour les dcrets simples) ;
plusieurs dcrets, arrts et circulaires prcisent certaines dispositions du Code. Tel est
le cas, par exemple, pour les installations lectriques (dcret 88-1056 du 14 novembre
1988) ou le btiment et les travaux publics (dcret 65-48 du 8 janvier 1965).
Lharmonisation europenne a entran de nombreuses modifications du Code du travail par
la transposition en droit franais de directives, par exemple :
la directive cadre relative la mise en uvre de mesures visant promouvoir
lamlioration de la scurit et de la sant des travailleurs au travail, CEE n89-391 du
12 juin 1989 ;
les directives du 30 novembre 1989 (CEE n 89-654, n89-655, n89-656) concernant
les prescriptions minimales de scurit et de sant pour les lieux de travail et pour
lutilisation des quipements de travail.
Dautres rgles sajoutent ce dispositif, telles que :
les dispositions gnrales de prvention et les recommandations dictes par les
caisses rgionales dassurance maladie ;
les normes rendues obligatoires par arrts ministriels ;
les conventions collectives ;
les rglements intrieurs des entreprises.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
1.2 Les lments viss par la rglementation
en matire de scurit
Le principe de base est que toutes les mesures ncessaires doivent tre prises pour
assurer la scurit et protger la sant des travailleurs, y compris les travailleurs
temporaires. Ce principe sapplique tant en ce qui concerne lamnagement des locaux,
que lorganisation du travail, le choix des quipements et des procds, la formation du
personnel, la prise en compte de lvolution des techniques, etc.
Des prcisions sont apportes sur certains points particuliers comme :
la prvention des risques chimique, biologique ;
la manutention des charges ;
la signalisation des zones dangereuses, les rgles de circulation ;
laration, lclairage, la prvention des risques dus aux bruits ;
la prvention des incendies, lvacuation ;
lutilisation des quipements de travail et des quipements de protection individuelle ;
lintervention dentreprises extrieures ;
les oprations de btiment ou de gnie civil ;
Cependant, toutes les situations ne font pas lobjet de dispositions spcifiques. Le chef
dtablissement se doit de prvenir aussi les risques non explicits dans les rglements.
1.3 La mission du chef dtablissement
La mission du chef dtablissement se caractrise principalement par lamlioration des
conditions de scurit et de travail sur le site et leur maintien.
Les principes de prvention fixs larticle L 230-2 du Code du Travail fournissent au
chef dtablissement le canevas des dmarches quil doit accomplir pour assurer la
scurit des personnes sur les lieux de travail et au cours du travail.
Ces mesures comprennent :
des actions de prvention des risques professionnels ;
des actions dinformation et de formation ;
la mise en place dune organisation et de moyens adapts ;
ladaptation des mesures de prvention pour tenir compte du changement de
circonstances et tendre lamlioration des situations existantes ;
la coopration entre les employeurs lorsque plusieurs sont prsents dans un mme lieu
de travail.
Les principes suivants doivent guider en permanence laction du chef dtablissement :
viter les risques ;
valuer les risques qui ne peuvent pas tre vits ;
combattre les risques la source ;
adapter le travail lhomme ;
tenir compte de ltat dvolution de la technique ;
remplacer ce qui est dangereux par ce qui nest pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
planifier la prvention en y intgrant, dans un ensemble cohrent, la technique,
lorganisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et linfluence
des facteurs ambiants ;
Partie 1 - Salaris et risques daccident
prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorit sur les mesures
de protection individuelles ;
donner les instructions appropries aux travailleurs.
Enfin, le chef dtablissement doit, lorsquil confie des tches un travailleur, prendre
en considration les capacits de lintress mettre en uvre les prcautions
ncessaires pour la scurit et la sant .
En outre, compte tenu de la nature des activits de ltablissement, le chef
dtablissement doit :
valuer les risques pour la scurit et la sant des travailleurs, y compris dans le choix
des procds de fabrication, des quipements de travail,
des substances ou prparations chimiques, dans lamnagement ou le ramnagement
des lieux de travail ou des installations et dans la dfinition des postes de travail ; la
suite de cette valuation et en tant que de besoin, les actions de prvention ainsi que les
mthodes de travail et de production mises en uvre par lemployeur doivent garantir un
meilleur niveau de protection de la scurit et de la sant des travailleurs et tre intgres
dans lensemble des activits de ltablissement et tous les niveaux de lencadrement .
Le dcret 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris en application de larticle, L 230-2 impose
que les rsultats de lvaluation des risques soient
transcrits dans un document unique, mis jour rgulirement et au moins une fois par an.
Cette valuation comporte un inventaire des risques identifis dans chaque unit de travail de
lentreprise ou de ltablissement.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
2 LES MESURES DE SCURIT
RELATIVES AUX QUIPEMENTS
2.1 Les quipements de travail
Sur les sites, certains quipements font courir leurs utilisateurs des risques mcaniques
(par entranement, chute, projections, coupures, crasements) mais galement des
risques lectriques, dincendie, dintoxication, de brlures
Il nest pas exig que tous les quipements en service atteignent un niveau similaire
celui dun matriel neuf sur lequel la scurit a t intgre ds lorigine.
Toutefois, il sagit de mettre en place des moyens de protection rapports et deffectuer
les modifications ncessaires pour rduire, voire supprimer, les principaux risques.
Les obligations gnrales de scurit des quipements de travail sont dfinies au
paragraphe I de larticle L.233-5 du Code du travail qui stipule que les machines,
appareils, outils, engins, matriels et installations ci-aprs dsigns par les termes
dquipements de travail [...] doivent tre conus et construits de faon que leur mise
en place, leur utilisation, leur rglage, leur maintenance, dans des conditions
conformes leur destination, nexposent pas les personnes un risque datteinte leur
scurit ou leur sant .
Sont galement viss les protecteurs et dispositifs de protection.
Les quipements soumis ces obligations de conformit sont dfinis larticle R.233-
83. Il sagit des catgories suivantes :
machines ;
tracteurs agricoles et forestiers roues ;
accessoires de levage ;
composants daccessoires de levage ;
chanes, cbles et sangles de levage ;
appareils de radiographie industrielle ;
cabines de peinture ;
lectrificateurs de cltures.
En sont exclus les quipements numrs larticle R.233-83-1, entre autres :
les machines mues par la force humaine autres que celles utilises pour le levage de charges ;
les machines qui exposent davantage aux risques dorigine lectrique quaux risques
mcaniques ;
certains moyens de transport ;
les ascenseurs,
qui sont soumis des rglementations particulires.
Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les quipements de travail en
service dans les entreprises ou vendus doccasion sont fixes au chapitre 3 du titre 3 du
livre 2 du Code du travail.
2.2 Les machines
Le Code du travail donne la dfinition suivante : Une machine est un ensemble de pices ou
dorganes lis entre eux dont au moins un est mobile et, le cas chant, dactionneurs, de
circuits de commande et de puissance runis de faon solidaire en vue dune application
dfinie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de
matriaux et le dplacement de charges avec ou sans changement de niveau .
Sont galement considrs comme machines : certains vhicules et leurs remorques.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Prcautions particulires
Avant lachat de toute machine, il est ncessaire que le chef dtablissement sassure
que celle-ci a bien fait lobjet de la procdure de certification de conformit applicable
sa catgorie.
Cette procdure sapplique galement aux composants de scurit. Cette conformit est
matrialise par le marquage CE.
Lorsque les quipements comportent des lments mobiles prsentant des risques de
contact mcanique et que ceux-ci ne peuvent tre rendus inaccessibles, des protecteurs
ou dispositifs de protection doivent tre rapports.
Ces dispositifs, appels composants de scurit , sont galement viss par les
obligations dfinies au I de larticle L.233-5 et soumis une procdure de certification
de conformit.
Selon la dfinition donne larticle R.233.83 -2, on entend par composant de
scurit un composant destin assurer, par son utilisation, une fonction de scurit et
dont la dfaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la scurit ou la
sant des personnes exposes, ou mettrait en pril une fonction de scurit de la
machine .
Les composants de scurit sont mis isolment sur le march en vue de leur installation
sur une machine maintenue en service ou sur une machine doccasion.
Parmi les composants de scurit, on compte notamment:
les dispositifs darrt durgence ;
les protecteurs ;
les dispositifs de protection ;
les ceintures de scurit ou dispositifs quivalents ;
les structures de protection contre le retournement ;
les structures de protection contre les chutes dobjet ;
les dispositifs de contrle et charge ;
les dispositifs homme mort ;
les dispositifs lectrosensibles conus pour la dtection des personnes, notamment
barrages immatriels, tapis sensibles, dtecteurs lectromagntiques ;
les blocs logiques assurant des fonctions de scurit pour commandes bimanuelles,
les crans mobiles automatiques pour la protection de certaines machines (presses,
machines de moulage).
En matire de rgles techniques et dattestation de conformit, la rglementation distingue les
matriels neufs ou considrs comme neufs et ceux doccasion :
Dfinition
Matriel neuf ou considr comme neuf Matriel d'occasion
Est considr comme mis pour la
premire fois sur le march, ou ltat
neuf , tout quipement de travail ou
moyen de protection nayant pas t
effectivement utilis dans un tat membre
de lUnion Europenne.
Est considr comme doccasion tout
quipement de travail ou moyen de
protection ayant dj effectivement t
utilis dans lUnion Europenne.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
lments vrifier lors de l'acquisition d'une machine
Matriel neuf Matriel doccasion
Le matriel neuf doit comporter le
marquage de conformit CE et tre
accompagn de :
- la dclaration CE de conformit ;
- la documentation technique relative
aux moyens mis en uvre pour
assurer la conformit de lquipement
de travail ou du moyen de protection
aux rgles techniques applicables.
- Le vendeur doit remettre au preneur
un certificat de conformit par
lequel il atteste que lquipement de
travail ou le moyen de protection
concern est conforme aux rgles
techniques qui lui sont applicables
(soit les mmes que pour un
matriel neuf, soit des rgles
prcisant les modifications
apporter, soit les rgles qui taient
applicables au moment de leur mise
sur le march, conformment
lobligation de maintien en tat de
conformit laquelle ils sont
soumis).
- Une mesure complmentaire de
contrle, opre par un organisme
agr, peut tre demande par
linspection du travail.
Formation
Le chef dtablissement doit sassurer que les salaris affects des tches comportant,
pour tout ou partie, lemploi de machines (y compris leur maintenance) ont reu une
formation la scurit les informant des risques auxquels ils sont exposs.
Cette formation implique lenseignement des comportements et gestes les plus srs,
laide de dmonstrations, lexplication des modes opratoires, le fonctionnement des
dispositifs de protection et les motifs de leur emploi.
La formation doit tre renouvele et complte aussi souvent que ncessaire pour
prendre en compte les volutions des quipements.
Les autres salaris de ltablissement doivent galement tre informs des risques les
concernant dus aux quipements de travail situs dans leur environnement immdiat de travail.
Il doit, en outre, informer ses collaborateurs des conditions dutilisation et de
maintenance du matriel, des consignes respecter, de la conduite tenir face aux
situations anormales prvisibles, et des conclusions tires de lexprience acquise
permettant de supprimer certains risques.
La vrification du matriel
Le chef dtablissement doit sassurer du maintien en tat de conformit du matriel
utilis, avec les rgles de conception et de construction.
Il doit notamment :
faire procder aux vrifications gnrales priodiques des machines qui y sont
soumises rglementairement (presses, compacteurs dchets) ;
faire procder la vrification des autres matriels suivant une priodicit approprie,
selon les indications du constructeur et en fonction des conditions dutilisation ;
consigner les rsultats sur le registre de scurit.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Le montage et le dmontage des quipements de travail doivent tre raliss de faon sre,
notamment en respectant les instructions du fabricant. Si les dispositifs de protection ont d
tre dmonts, la machine ne peut tre remise en service quaprs un essai permettant de
vrifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
Les vrifications doivent tre effectues par des personnes comptentes appartenant ou non
lentreprise et mentionnes au registre de scurit. Dans le cas des machines soumises
vrifications gnrales priodiques, ces personnes doivent connatre les dispositions
rglementaires affrentes.
2.3 Les quipements de travail faisant lobjet
de rgles particulires
2.3.1 Les quipements et accessoires de levage
Un appareil de levage est un engin, un dispositif ou une installation dont la fonction essentielle
consiste soulever ou descendre une charge, avec ou sans dplacement.
En combinant ces mouvements, on trouve toutes sortes dappareils de levage, plus ou moins
complexes, qui vont par exemple, des simples crics ou vrins aux grues tour.
Outre les obligations de scurit applicables aux machines , les appareils de levage font
lobjet de mesures particulires, en raison des risques que prsente leur utilisation
Ces mesures sont fixes aux articles R.233-13-1 R.233-13-15 du Code du travail et aux
arrts pris pour leur application.
Ces mesures visent notamment prvenir les risques tels que :
la retombe de la charge (linguage mal conu, mauvais accrochage, rupture dorgane de
prhension, dfection dun organe mcanique, absence ou dfaillance dun dispositif de
freinage, etc.) ;
le renversement de la charge, de lappareil (tableau de charge non respect, dfaillance
dun organe mcanique, non prise en compte des vnements atmosphriques, etc.) ;
le heurt de lappareil ou de sa charge avec le personnel ou des obstacles fixes ou mobiles
(mauvaise utilisation de lappareil, dplacement dans des endroits encombrs, mauvaise
visibilit de la zone dvolution de la charge, etc.) ;
les risques apports par la prsence dnergie motrice sur lappareil (clatement de
conduites sous pression, mise en mouvement intempestive des urgences).
Afin de prserver la scurit des travailleurs, plusieurs catgories de vrifications sont prvues
pour les appareils de levage :
vrification initiale ( la mise en service) en vue de sassurer quils sont installs
conformment aux spcifications prvues et quils peuvent tre utiliss en scurit ;
vrifications gnrales priodiques (trimestrielles, semestrielles ou annuelles, selon le type de
matriel) ;
vrification lors de la remise en service aprs toute opration de dmontage et remontage
ou modification, en vue de sassurer de labsence de toute dfectuosit.
Lintervention dun organisme agr pour effectuer ces vrifications est obligatoire dans
certains cas particuliers.
Les quipements de travail mobiles
Outre les rgles applicables aux machines et, le cas chant, celles fixes pour les appareils
de levage, ces quipements font lobjet des prescriptions particulires fixes aux articles R.233-
13-16 R.233-13-18 du Code du travail.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Le chef dtablissement devra particulirement veiller :
amnager des voies de circulation dune largeur et dun profil appropris au
matriel ;
maintenir la vacuit des voies de circulation ;
tablir des rgles de circulation pour les quipements qui voluent dans une zone de
travail ;
arer convenablement les locaux dans lesquels sont employs des quipements munis
dun moteur combustion ;
limiter la vitesse de circulation en fonction des travaux effectus.
2.3.2 Formation
La conduite des quipements de travail mobiles automoteurs et des quipements servant au
levage est rserve aux travailleurs qui ont reu une formation dont la dure et le contenu
doivent tre adapts lquipement concern.
Cette formation doit tre complte et ractualise chaque fois que ncessaire. Elle peut
tre dispense au sein de ltablissement ou assure par un organisme spcialis.
La conduite de certains quipements est subordonne lobtention dune autorisation
de conduite, dlivre par le chef dtablissement, sur la base dune valuation. Cette
autorisation est requise pour :
les grues tour ;
les grues mobiles ;
les chariots automoteurs de manutention conducteur port ;
les plates-formes lvatrices mobiles de personnes ;
les engins de chantiers tlcommands ou conducteur port.
2.3.3 Les ascenseurs et ascenseurs de charge
Les ascenseurs exclus du champ dapplication de larticle L.233-5 du Code du travail
sont ceux qui sont dfinis comme des appareils qui desservent des niveaux dfinis
laide dune cabine qui se dplace le long de guides rigides et dont linclinaison sur
lhorizontale est suprieure 15 degrs ; la cabine est destine au transport :
de personnes, ;
ou de personnes et dobjets, ;
ou dobjets uniquement.
La cabine doit tre accessible, cest--dire telle quune personne puisse y pntrer sans
difficult, et tre quipe dlments de commande situs lintrieur de ladite cabine
ou porte dune personne qui sy trouve .
Les appareils doivent tre conus de telle sorte que les utilisateurs ne soient pas exposs
aux chutes dans le vide, ni heurts par des objets. La mise sur le march des ascenseurs
et composants de scurit est rglemente par le dcret n 2000-810 du 24 aot 2000.
Les rgles de scurit relatives leur utilisation sont dfinies par un dcret du 10 juillet 1913
modifi. Elles concernent, dune part les personnels qui se trouvent proximit ou utilisent
lascenseur ou encore procdent aux oprations de chargement, et, dautre part ceux chargs
de lentretien des appareils.
La vrification des matriels
Le chef dtablissement est tenu de faire procder aux contrles et oprations suivants :
un examen quotidien de ltat des dispositifs de scurit et vrification du bon
fonctionnement des appareils. Suivant les rsultats de cet examen quotidien, il prescrira
ventuellement la suspension du service jusqu la remise en tat de marche ;
Partie 1 - Salaris et risques daccident
un examen semestriel des organes de suspension et en particulier les cbles et les
chanes de levage ;
un examen annuel des organes de scurit, tels que serrures, parachute, etc. ;
le graissage et l'entretien rgulier des appareils.
Cet entretien et ces vrifications seront effectus par un personnel spcialis et dment
qualifi, appartenant soit ltablissement lui-mme, soit une entreprise exerant
rgulirement cette activit particulire.
Le nom et la qualit des personnes charges de cet entretien, les dates des vrifications
et les observations auxquelles celles-ci auront donn lieu seront consigns sur le registre
de scurit.
Les prcautions particulires pour les travaux
Les travaux de vrification, dentretien, de rparation ou de transformation ne peuvent tre
effectus que sur des appareils ayant fait lobjet, depuis moins de 5 ans, dune tude de
scurit spcifique par lentreprise charge de ces travaux.
Les prescriptions particulires de scurit sont exposes dans un dcret du 30 juin 1995.
Elles simposent aux responsables des tablissements dans lesquels sont utiliss les
ascenseurs ou quipements similaires aussi bien quaux entreprises charges de la
vrification, de la maintenance, et de la rparation de ces appareils.
2.3.4 Les quipements sous pression
Ces quipements prsentent des risques dexplosion lis :
la corrosion de leur enveloppe ;
leur dtrioration mcanique lors de chocs ;
leur utilisation une pression laquelle ils ne sont pas destins.
Cest pourquoi, bien que la construction de ces appareils soit soumise une
rglementation rigoureuse, des prcautions particulires doivent tre prises pour leur
utilisation.
Le stockage et la manutention
Les bouteilles de gaz sous pression seront stockes de prfrence lextrieur, labri
du soleil.
Elles seront maintenues par un rtelier fix un lment stable de la maonnerie.
Elles ne seront dplaces, ou utilises, par exemple sur un poste mobile de soudure,
quavec un chariot adapt.
Lutilisation
Lors de la ralisation de montages sous pression, les appareillages seront protgs par
des crous pleins ou des enveloppes mtalliques mailles fixes.
Des masques respiratoires adapts devront tre disposs dans les locaux o sont
dtenus des gaz toxiques.
Sur site, la prvention repose sur deux principes :
matriser en permanence la pression effective rgnant dans lappareil utilis pour rendre
improbables les risques dexplosion, en limitant cette pression aux conditions normales
dutilisation ;
protger lquipement contre les chocs, la corrosion ou une lvation anormale de la
temprature.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
La vrification des matriels et les contrles
Un arrt du 15 mars 2000 modifi, pris en application du dcret du 13 dcembre 1999,
fixe les dispositions applicables lexploitation des appareils pression. Certains
quipements spcifiques sont viss par dautres textes.
Ces appareils doivent tre vrifis aussi souvent que ncessaire , de faon tre
constamment maintenus en bon tat.
Un examen visuel sera effectu avant toute utilisation afin de sassurer de labsence :
de corrosion ;
dun chauffement anormal ;
de fuite en tout point dun appareil, dune installation (joint, raccord, manodtendeur,
soupape,etc.).
Il convient galement de vrifier que lon utilise un matriel dorigine garanti par le
constructeur. Clef, joints de verrouillage du manomtre et de la soupape ne doivent pas
permettre la diffusion dun gaz toxique dans la pice de travail (valuation matrise de
gaz dangereux sur lextrieur).
La rglementation impose notamment :
des oprations dentretien et de surveillance ;
des inspections priodiques qui comprennent gnralement un examen visuel extrieur
et intrieur et un examen des accessoires de scurit ;
des requalifications priodiques (anciennement appeles r-preuves), le plus souvent
hydrauliques, qui permettent de sassurer de la tenue des matriaux et des
assemblages sous pression.
Pour la vrification de certains appareils, il y a lieu de faire appel un organisme habilit et
spcifiquement dlgu cet effet.
La formation
Le personnel charg de la conduite dquipements sous pression doit tre inform et
comptent pour surveiller et prendre toute initiative ncessaire leur exploitation sans
danger. Pour certains appareils, le personnel doit tre reconnu apte cette conduite par
lexploitant et priodiquement confirm dans cette fonction.
Le personnel charg des inspections priodiques doit tre comptent et apte
reconnatre les dfauts susceptibles dtre rencontrs et en apprcier la gravit .
Le rle essentiel de la DRIRE
Les missions des DRIRE (Direction Rgionale de lIndustrie de la Recherche et de
lEnvironnement) en matire dappareils pression sinscrivent dans le cadre :
de la vrification de la conformit la rglementation des appareils neufs, ds lors que ces
appareils prsentent certaines caractristiques en terme de pression et de volume ;
de la surveillance des organismes de contrle qui ont t habilits cet effet ;
de la surveillance du march pour les appareils fabriqus selon les dispositions des
directives europennes applicables.
2.4 Les quipements de protection individuelle (EPI)
La rgle gnrale veut que lon utilise un quipement de protection individuelle lorsque
les risques ne peuvent pas tre vits ou suffisamment limits par des moyens techniques
de protection collective.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Le Code du travail prcise, en son article R.233-1-3 que les quipements de protection
individuelle doivent tre appropris aux risques prvenir et aux conditions dans
lesquelles le travail est effectu. Ces quipements ne doivent pas tre eux-mmes
lorigine de risques supplmentaires.
[]
En cas de risques multiples exigeant le port simultan de plusieurs quipements de
protection individuelle, ces quipements doivent tre compatibles entre eux et maintenir
leur efficacit par rapport aux risques correspondants .
Les EPI auxquels sappliquent les exigences de scurit dfinies au I de larticle L.233-5
sont des dispositifs ou moyens destins tre ports ou tenus par une personne en vue
de la protger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa scurit ainsi
que sa sant .
2.4.1 Les trois catgories d'EPI
En fonction des risques contre lesquels les EPI sont destins protger, la directive
89/686/CEE du 21 dcembre 1989, relative la conception des EPI distingue, :
Les EPI de catgorie 1 Risques mineurs
Il s'agit par exemple d'EPI protgeant contre les dangers faibles consquences :
agressions mcaniques dont les effets sont superficiels ;
produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement rversibles ;
manipulation de pices chaudes nexposant pas une temprature suprieure 50
C ni des chocs dangereux ;
conditions atmosphriques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrmes ;
petits chocs et vibrations naffectant pas les parties vitales du corps et qui ne peuvent
pas provoquer de lsions irrversibles ;
rayonnement solaire.
Ces EPI sont des quipements pour lesquels le fabricant tablit, sous sa responsabilit,
une dclaration CE de conformit (procdure dautocertification CE).
Il s'agit en effet d'EPI de conception simple dont le concepteur prsume que
l'utilisateur peut juger par lui-mme de l'efficacit contre des risques minimes dont
les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent tre perus en temps opportun et sans
danger pour l'utilisateur.
Les EPI de catgorie II Risques graves ou spcifiques
Ce sont les EPI non viss ci-dessus, ni ci-aprs. Ils sont soumis la procdure dite
examen CE de type qui est la procdure par laquelle un organisme habilit constate
et atteste quun modle dEPI satisfait aux rgles techniques le concernant, et, dans
laffirmative, donne lieu dlivre une attestation dexamen CE de type . Le fabricant
doit alors tablir une dclaration CE de conformit .
Les EPI de catgorie III Risques importants
Il s'agit des EPI suivants :
appareils respiratoires filtrants qui protgent contre les arosols solides ou liquides ou
les gaz dangereux ou radio-toxiques ;
appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de latmosphre
dintervention et appareils de plonge ;
quipements de protection individuelle offrant une protection limite dans le temps
contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
Partie 1 - Salaris et risques daccident
quipements dintervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont
comparables ceux dune temprature dair gale ou suprieure 100C, avec ou
sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matires en fusion ;
quipements dintervention dans des ambiances froides dont les effets sont
comparables ceux dune temprature dair infrieure ou gale
- 50 C ;
quipements de protection individuelle destins protger contre les chutes de
hauteur ;
quipements de protection individuelle destins protger des risques lectriques pour
les travaux sous tension dangereuse ou quipements utiliss comme isolants contre
une haute tension.
Outre la procdure applicable aux EPI de la catgorie II, ils sont, au choix du fabricant,
soumis soit la procdure dite systme de garantie de qualit CE , soit la
procdure dite systme dassurance qualit CE de la production avec surveillance .
2.4.2 Le choix des EPI
Le chef dtablissement est soumis plusieurs obligations:
lobligation gnrale de fournir des EPI quand les mesures de prvention prioritaire
(rduction du risque la source, protection collective) savrent insuffisantes ;
lobligation de fournir des EPI accompagns dun certificat de conformit aux rgles
techniques qui lui sont applicables et portant le marquage CE ;
lobligation de procder une valuation des risques et des contraintes du poste de
travail avant de faire le choix dun EPI. (voir la grille dinventaire des risques)
2.4.3 L'utilisation des EPI
Les mesures dorganisation et les conditions dutilisation des quipements de protection
individuelle sont fixes aux articles R.233-42 R.233-44. Le chef dtablissement doit, lors de
la mise disposition dEPI :
prciser les conditions dans lesquelles les EPI doivent tre utiliss (dure du port,
usages rservs) ;
dispenser les instructions ou consignes dutilisation ;
faire bnficier les travailleurs dune formation approprie, comportant, si ncessaire,
un entranement au port de cet EPI ;
renouveler cette formation aussi souvent que ncessaire pour que lquipement soit
utilis conformment la consigne.
Il doit en outre :
assurer le bon fonctionnement des quipements et leur tat hyginique satisfaisant par
les entretiens, rparations et remplacements ncessaires.
sassurer du port effectif de lquipement.
La fiche de poste est lun des moyens pour le salari de vrifier quel quipement il doit
utiliser.
Le bon tat des EPI doit tre vrifi avant chaque utilisation.
De plus, certains EPI, en service ou en stock, sont soumis des vrifications gnrales
priodiques destines dceler en temps utile toute dfectuosit susceptible dtre
lorigine de situations dangereuses ou tout dfaut daccessibilit.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Il sagit :
des appareils de protection respiratoire autonomes destins lvacuation ;
des appareils de protection respiratoire et quipements complets destins des
interventions accidentelles en milieu hostile ;
des gilets de sauvetage gonflables ;
des systmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;
des stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.
Quant aux collaborateurs, on peut attendre de leur part :
la volont de se protger ;
le respect des instructions ;,
une complte attention lors des formations ;
la ncessit de signaler toutes anomalies ou dfectuosit constate.
Grille d'inventaire des risques
La grille d'inventaire est prsente page suivante.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
GRILLE D'INVENTAIRE DES RISQUES
Parties du corps
Tte
Crne Oue Yeux
Voies
respiratoires
Visage
Tte
entire
Chutes
de hauteur
Chocs, coups,
impacts,
compressions
Piqres,
coupures,
abrasions
Vibrations
Mcanique
Glissades,
chutes niveau
Chaleur,
flammes
Thermique
Froid
lectrique
Non-ionisantes Radiation
Ionisantes
Physique
Bruit
Poussires,
fibres
Fumes
Arosols
Brouillards
Immersions Liquides
claboussement,
projections
Chimique
Gaz, vapeurs
Bactries pathognes
Virus pathognes
Champignons producteurs
de mycoses
Risque
Biologique
Antignes biologiques non-
microbiens
Partie 1 - Salaris et risques daccident
GRILLE D'INVENTAIRE DES RISQUES
Parties du corps
Membre suprieur Membre infrieur Divers
Main
Bras
(parties)
Pied
Jambe
(parties)
Peau
Tronc
Abdomen
Voie
parentrale
Corps
entier
Partie 1 - Salaris et risques daccident
2.4.4 Les risques lis aux interventions en hauteur
Lanalyse des risques de chute se dcline au regard de chacun des postes de travail en hauteur.
On considre quil y a risque de chute de hauteur lorsquil nexiste pas dobstacle suffisamment
efficace en bordure dun vide.
Lorsque lun de vos collaborateurs travaille ou circule une hauteur de plus de 3 mtres en se
trouvant expos un risque de chute dans le vide, il est ncessaire dinstaller un dispositif de
protection collective capable darrter une personne. Le dcret n65-48 du 8 janvier 1965 fixe
les conditions dans lesquelles il y a recours aux quipements individuels.
Les tableaux suivants donnent une indication des causes daccidents les plus frquentes au
chef dtablissement.
Trois grands risques
chafaudage volant
et roulant, plate-
forme lvatrice
- Dfaut de conception / rsistance / gabarits.
- Installation dfectueuse.
- Dfaut de fixation en toiture ou dans les baies.
- Matriaux, quipements inappropris (cbles, cordages, ancrage).
- Non-respect des charges et des limites et rpartition des poids.
- Dfaut de manuvre.
- Dfaut de srets.
- Dfaut de maintenance.
chelles - Non stabilises au sol.
- Non arrimes en haut.
- En appui sur une surface glissante, fragile.
- Hauteur inadquate.
- Absence de crochet darrte.
- Matriel vtuste dfectueux.
Toitures
Terrasses
Verrires
- Matriaux fragiles.
- Toits inclins.
- Rives de terrasse.
- Moyens daccs chelle.
- Dfaut de rsistance.
- Activit non autorise.
- Dfaut de srets.
Scurit collective Scurit individuelle
- Garde-corps.
- Surface de recueil : auvent, filet.
- Ceinture.
- Baudrier.
- Harnais de scurit (muni dun absorbeur dnergie).
Lorsque la dure dexcution des travaux nexcde pas une journe , lobservation des
positions de scurit intgre ou collective nest pas obligatoire sous rserve que des
ceintures ou baudriers de scurit soient mis la disposition des travailleurs.
Le meilleur quipement ne peut rien contre la faiblesse du point dattache ; do la ncessit de
crer des points dancrage en toiture ou en faade de btiment.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
2.4.5 Le risque amiante
Lexposition diffuse aux fibres damiante persiste aujourdhui dans un trs large ventail
dactivits et, tout particulirement, loccasion doprations de maintenance ou
dentretien de btiments ou dinstallations industrielles renfermant de lamiante.
Trois types dactivits sont concerns :
fabrication et de transformation de matriaux contenant de lamiante ;
confinement et de retrait de lamiante ou de matriaux en contenant ;
interventions sur des matriaux ou des appareils susceptibles de librer des fibres
damiante.
Le chef dtablissement (celui qui emploie les salaris qui sont susceptibles dtre exposs
lamiante par les travaux quils vont raliser) doit prendre toutes mesures visant rduire
les niveaux dexposition et le nombre de personnes exposes.
Le propritaire dun immeuble bti ( lexception de ceux ne comportant quun seul logement
usage dhabitation) doit rechercher :
la prsence de flocage contenant de lamiante dans les immeubles construits avant le 1
er
janvier
1980 ;
la prsence de calorifugeages contenant de lamiante dans les immeubles construits avant le 29
juillet 1996 ;
la prsence de faux plafonds contenant de lamiante dans les immeubles construits avant le 1
er
juillet 1997.
Le responsable doit procder lvaluation des risques (nature, dure et niveau
dexposition collective et individuelle), pour ensuite informer les travailleurs sur ces risques
(une notice doit tre tablie pour chaque poste exposant un risque).
Il doit les former la prvention et la scurit, et mettre en uvre les mesures de
protection collectives, ou, dfaut, individuelles adaptes, de manire que lexposition des
travailleurs soit maintenue au niveau le plus bas quil est techniquement possible
datteindre et toujours infrieure aux valeurs limites dexposition.
Cette recherche est obligatoirement effectue par un contrleur technique ou un technicien de la
construction. Si la prsence damiante est confirme par des analyses, celui-ci doit valuer ltat
de conservation des lments concerns.
En fonction du diagnostic, des mesures dempoussirement sont ralises.
Si le niveau dempoussirement est :
infrieur ou gal 5 fibres/litre : contrle priodique est institu dans un dlai maximal
de 3 ans ;
suprieur 5 fibres/litre : travaux de confinement ou de retrait de lamiante qui doivent
tre achevs dans un dlai de 36 mois, des mesures conservatoires devant tre prises
pendant la priode prcdant les travaux.
Le propritaire constitue, conserve et actualise un dossier technique regroupant les
informations relatives la recherche et lidentification (date, nature, localisation, rsultat
des contrles priodiques, des mesures dempoussirement et le cas chant, des travaux
effectus). Il consigne galement dans ce dossier les rsultats du reprage damiante quils
doivent faire effectuer sur un certain nombre dlments de construction accessibles sans
travaux destructifs.
Depuis le 1
er
janvier 2002, les propritaires sont tenus, pralablement la dmolition de tout
immeuble construit avant le 1er juillet 1997, deffectuer des reprages de matriaux et produits et
den informer toute personne physique ou morale appele concevoir ou raliser les travaux.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
2.4.6 Le bruit
Mme faible, le bruit peut provoquer linconfort : il entrave la communication, gne
lexcution des tches dlicates, peut aller jusqu provoquer la surdit irrversible.
valuer les risques
La nuisance engendre par les ondes sonores est communment appele bruit. Celui-ci est
plus ou moins gnant selon la source qui est son origine et selon la sensibilit de celui
qui le reoit (critre de tolrance).
Les ondes sonores sont caractrises par leur amplitude (ou au niveau de pression sonore)
et leur frquence. Lamplitude sexprime en dcibels (dB) selon une chelle logarithmique
et la frquence en hertz (Hz). Les frquences en-dessous de 20 Hz sappellent les infrasons,
au-del de 20 000 Hz les ultrasons et entre ces deux valeurs les frquentes audibles (par
loreille humaine).
Loreille ayant une sensibilit variable selon les frquences, une unit particulire damplitude
pour la physiologie humaine a t introduite : le dcibel A ou dB (A).
Il est important dtre vigilant vis--vis des risques lis au bruit, car les consquences
physiologiques de ces nuisances (surdit partielle ou totale) sont irrversibles.
Quelques valeurs rglementaires
Exposition sonore moyenne Pression acoustique de crte
85 dB (A) Seuil au-del duquel des
quipements individuels de protection
doivent obligatoirement tre fournis
par lemployeur.
135 dB (A) seuil au-del duquel des
quipements individuels de protection
doivent obligatoirement tre fournis
par lemployeur.
90 dB (A) Seuil au-del duquel des
quipements individuels de protection
doivent obligatoirement tre ports.
140 dB (A) seuil au-del duquel des
quipements individuels de protection
doivent obligatoirement tre ports.
Bruits de rfrence :
0 dB (A) : seuil daudition
15 dB (A) : fort
40 dB (A) : bibliothque
60 dB (A) : conversation de quatre ou cinq personnes
85 dB (A) : circulation automobile normale en milieu urbain
100 dB (A) : marteau- piqueur
110 dB (A) : concert dun groupe de rock
125 dB (A) : avion au dcollage ( 100m)
140 dB (A) : racteur davion ( 25m), seuil de douleur
Si les installations de machines entranent un niveau dexposition sonore quotidienne
suprieure 85 dB (A), le local doit tre construit de faon rduire la rverbration du bruit
sur les parvis et limiter la propagation du bruit.
Puisquil sagit dune chelle logarithmique, les valeurs des bruits exprims en dB (A) ne
sadditionnent pas :
1 machine = 80 dB (A) 5 machines= 80 + 7 = 87 dB (A)
2 machines = 80 + 3 = 83 dB (A) 10 machines = 80 + 10 = 90 dB (A)
3 machines = 80 + 5 =85 dB (A)
Quand deux sources de bruit provoquent des niveaux dont la diffrence est suprieure 10 dB,
cest la plus forte des sources qui impose son niveau lorsquelles fonctionnent ensemble.
Machine 1 = 70 dB (A) + Machine 2 = 82 dB (A) 82 dB (A)
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Les mesures prventives
Les mesures prventives doivent tre collectives et/ou individuelles.
La prvention intgre
Cette dmarche vise rduire le bruit la source, cest--dire que lon essaie, ds la
conception des quipements, de supprimer les sources de bruit par changement de
techniques, ou alors, en modifiant des quipements dj existants dans lesquels on a pu
reprer lorigine du bruit.
Les gains possibles peuvent tre importants ; on ne peut pas les chiffrer car ils dpendent
beaucoup du type de source de bruit.
La protection collective
La protection collective vise rduire le bruit au cours de sa propagation pour protger
collectivement les salaris.
Autour des machines bruyantes, on peut installer des encoffrements , sorte de coffrages
prsentant un isolement phonique lev grce la prsence, lintrieur, dun matriau
absorbant (de type laine de verre). Ils permettent des rductions de niveaux de bruit de
lordre de 15 20 dB (A).
On peut galement placer des crans acoustiques qui ont la mme structure que
lencoffrement, avec lavantage de la mobilit.
Dans les locaux, on peut raliser un traitement acoustique (les parois intrieures sont revtues
de matriaux absorbants : laine de verre, panneaux de pltre alvol, matriaux fibreux)
ainsi quune isolation anti-vibratile des machines.
Les quipements individuels de protection
On peut proposer des casques anti-bruit, rservs la protection contre le bruit trs
intense, parfois quips dcouteurs pour liaison radio.
On peut galement proposer des serre-ttes ou serre-nuques, adapts pour un usage
intermittent, ou des bouchons doreilles, qui sont en gnral mieux supports en port continu.
Un protecteur individuel contre le bruit permet un affaiblissement global de 20 dB (A) environ.
Signalisation
Lexposition des bruits de niveaux suprieur 85 dB (A) En continu ou 135 dB en
crte, l'exposition des bruits doit tre signale aux lieux et postes concerns.
Concernant lexposition sonore quotidienne suprieure 105 dB (A), il y a lieu de baliser
la zone et dapposer un signal dinterdiction dy pntrer sans motif de service.
La rduction du temps dexposition
Elle nest efficace que si elle est importante. Par exemple, diviser le temps dexposition par deux
conduit un diminution de 3 dB (A) du niveau dexposition sonore quotidienne, alors que le
diviser par dix conduit une diminution de 10 dB (A).
Le suivi mdical
Le personnel effectuant de faon habituelle des travaux exposant un niveau de bruit doit subir
une consultation mdicale et des audiogrammes rgulirement.
Exposition Frquence
des examens mdicaux
85 dB (A) ou pression acoustique de crte > 135 dB 3 ans
90 dB (A) ou pression acoustique de crte >140 dB 2 ans
Si exposition quotidienne 100 dB (A) Tous les ans
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Les actions possibles lors d'un projet
Avant toute nouvelle installation datelier, il convient dtudier le poste de travail et son
environnement.
En quelques points :
dterminer les caractristiques gomtriques et acoustiques initiales du local
(dimensions, mesures de la dure de rverbration et de la dcroissance spatiale ou
non) ;
inventorier les emplacements des diffrentes machines implanter et dfinir leurs
puissances acoustiques respectives ;
dterminer les emplacements de travail et les itinraires de circulation des personnes et
des produits ;
tablir une carte prvisionnelle du bruit dans les espaces de travail bruyant ;
effectuer une tude dimpact sur lenvironnement.
2.5 Le risque lectrique
Llectricit est un fluide invisible dont lutilisation mal contrle entrane des accidents graves
pour les personnes et pour les installations. On sait que l'lectricit peut tre la cause d'incendies,
on sait moins que les tensions utilises quotidiennement peuvent provoquer des lectrisations ou
des lectrocutions.
Les mesures de scurit respecter sont dfinies par le dcret modifi n 88-1056 du 14
novembre 1988 pris pour lexcution des dispositions du livre II du Code du travail en ce qui
concerne la protection des travailleurs dans les tablissements qui mettent en uvre des courants
lectriques.
valuer les risques
Llectrisation peut tre provoque par un :
contact direct, cest--dire en touchant un des conducteurs normalement sous tension ;
contact indirect, cest--dire au contact dune masse mtallique quelconque
accidentellement mise sous tension ;
amorage darc ou dtincelles ;
foudroiement.
Laccident dorigine lectrique a des effets directs ou indirects trs variables pour le corps
humain. Ses consquences dpendent des caractristiques du courant lectrique : intensit
(ampre), tension (volt), frquence (hertz), de la rsistance du corps humain (ohm), du
trajet parcouru et du temps de contact (seconde ou fraction de seconde).
Les effets physiologiques directs ou immdiats
llectrisation dsigne les diffrentes manifestations physiologiques et physiopathologiques dues
au passage du courant lectrique travers le corps humain ;
llectrocution est une lectrisation mortelle ;
les brlures par arc sont provoques par la chaleur intense dgage lors de la
production dun arc lectrique ;
le foudroiement est un lectro-traumatisme mortel d la foudre (effet darc).
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Effets physiologiques immdiats en fonction
de lintensit du courant traversant lorganisme
Intensit du courant Effet sur le corps humain
1 mA Perception cutane
5 mA Secousse lectrique
10 mA Contracture entranant une incapacit de lcher prise
25 mA pendant 3 min Ttanisation des muscles
40 mA pendant 5 s ou 80 mA pendant 1 s Fibrillation ventriculaire
2000 mA Inhibition des centres nerveux
(mA : milliampre, s : seconde, min. : minute)
Lintensit du courant (I) exprime en ampres (A) est gale la tension (U) exprime en
volts (V) divise par la rsistance au passage du courant (R) exprime en ohms (W).
La rsistance du corps humain peut varier considrablement selon les caractristiques
individuelles et les conditions denvironnement (humidit, isolement). En pratique, au-
del de 25 volts, il y a toujours un danger potentiel (surtout en prsence dhumidit).
Les effets physiologiques indirects ou diffrs
Ce sont les troubles, les complications et les squelles qui peuvent apparatre avec un
temps de latence plus ou moins long, pouvant atteindre le corps humain pendant des
annes : complications cardiovasculaires, neurologiques, rnales
Les risques pour les installations
Lchauffement non contrl dun matriel sous tension peut provoquer des incendies ou
des explosions.
Les mesures techniques
Les mesures techniques concernent le matriel et les dispositifs de protection. Ces derniers
constituent une chane continue depuis la production du courant lectrique jusqu son
utilisation. Lensemble des dispositifs de cette chane doit tre calcul, vrifi, contrl et
entretenu.
Les matriels utiliss doivent tre de la classe I, cest--dire quips dun conducteur de
protection (de couleur vert/jaune, dit conducteur de terre ).
Ils peuvent ventuellement tre de classe II, cest--dire possder un double isolement. Dans ce
cas, ils ne doivent pas tre relis la terre.
Les matriels de classe III fonctionnent sous une tension alternative de 48 volts dite trs basse
tension de scurit.
Lusage des matriels de classe 0, cest--dire ne comportant pas de conducteur de protection ou
ntant pas reprs par le symbole classe II, est formellement interdit sur les lieux de travail.
Les tensions alternatives (50 Hz) 50 volts sont dangereuses pour lhomme.
L'quipotentialit
Pour prvenir llectrisation, toutes les masses mtalliques accessibles doivent tre relies
entre elles par des conducteurs adapts de faon ce quelles soient au mme potentiel.
Sil nexiste pas de diffrence de potentiel entre deux masses mtalliques, llectrisation
devient impossible car aucun courant ne peut circuler entre ces masses.
Les disjoncteurs
Un disjoncteur diffrentiel est un dispositif de protection situ en amont dun appareil ou
dun groupe dappareils. Son rle est de limiter la quantit du courant (ampres) dans le
Partie 1 - Salaris et risques daccident
circuit et de couper le courant en cas de prsence dun courant de dfaut la terre.
La vapeur du courant de dfaut au-del de laquelle le disjoncteur ouvre le circuit est de
30 mA dans le cas o le circuit alimente un appareil mobile.
Les installations lectriques de ltablissement doivent tre contrles par un organisme
agr lors de leur mise en service et aprs toute modification de structure (modification du
schma des liaisons la terre, augmentation de la puissance de court-circuit de la source,
modification ou adjonction de circuits de distribution autres que circuits terminaux, cration
ou ramnagement dinstallation).
Elles doivent ensuite faire lobjet dune vrification annuelle (cette priodicit peut tre
porte deux ans si les installations sont conformes) effectue par des personnes
appartenant ou non ltablissement et possdant une connaissance approfondie de
la prvention des risques et des dispositions rglementaires affrentes. Les modalits de
ces vrifications sont fixes par larrt du 10 octobre 2000.
L'intervention et l'habilitation lectrique
Pour intervenir sur une installation lectrique quelle qu'elle soit, il est ncessaire de
possder une habilitation dlivre par le chef dtablissement.
Cette habilitation lgitime la capacit dune personne effectuer des oprations en toute
scurit et connatre la conduite tenir en cas daccident.
Il existe plusieurs niveaux dhabilitation en fonction :
de la nature des interventions (dpannage, raccordement, essais, vrifications,
consignations, travaux sous tension, nettoyages sous tension, travail au voisinage) ;
des travaux (dordre non lectrique, dordre lectrique) ;
de la tension des installations (trs basse tension de scurit : 50 volts - basse tension A :
entre 50 et 500 volts - basse tension B : entre 500 et 1000 volts - haute tension A : entre
1000 et 50.00 volts - haute tension B : 50.00 volts).
Il faut utiliser un matriel :
conu pour lutilisation qui en est faite ;
quip du bon cble de raccordement ;
dot de la bonne fiche de prise de courant ;
raccord sur le bon socle de prise de courant ;
comportant une notice demploi relative aux conditions de son utilisation conformment
sa destination et sans danger ;
nayant pas subi de rparation incorrecte.
Il est interdit de travailler seul.
Pour intervenir sur une installation lectrique quelle quelle soit, il est ncessaire :
de procder des consignations destines mettre les installations hors tension au moment de
lintervention (cas des oprations de maintenance) ;
de respecter des protocoles particuliers pour effectuer les diagnostics des pannes ainsi
que les essais et les rglages sous tension.
La formation et le titre d'habilitation lectrique
La formation a pour but de donner au personnel concern en plus de ses
connaissances professionnelles dj acquises, la connaissance des risques inhrents
lexcution des oprations au voisinage ou sur les ouvrages lectriques et des
moyens de les prvenir.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Tableau des habilitations lectriques
Oprations
Travaux Habilitation du personnel
Hors tension Sous tension
Interventions du
domaine BT
Non-lectricien BO ou HO
Excutant lectricien B1 ou H1 B1T ou H1T
Charg dintervention
BR
Charg de travaux B2 ou H2 B2T ou H2T
Charg de consignation BC ou HC BC
Agent de nettoyage sous tension BN ouHN
Note : Pour les personnes habilites travailler au voisinage des ouvrages sous tension du mme
domaine de tension, il y a lieu dadjoindre la lettre V aux symboles BO, B1, B2, HO, H1, H2
(il ny a pas lieu de ladjoindre aux symboles T, R et N).
Les programmes de formation comportent 2 parties :
formation thorique aux risques lectriques et leur prvention ;
formation pratique dans le cadre du domaine dactivit attribue lintress.
Cette formation relve de la responsabilit de lemployeur qui peut soit lassurer avec ses
moyens propres, soit la confier un organisme spcialis.
Modle de titre d'habilitation lectrique
Le document crit transmis par le chef dtablissement peut tre tabli suivant le modle ci-
dessous.
Titre dhabilitation
Nom :
Prnom :
Fonction :
Employeur :
Affectation :
Champ dapplication Personnel Symbole
dhabilitation Domaine de tension Ouvrages concerns
Nom lectricien habilit
lectricien
Charg de travaux ou
dinterventions
Charg de consignation
Habilits spciaux
Le titulaire
Signature :
Pour lemployeur
Nom et prnom :
Fonction :
Date :
Validit
Maintien ou renouvellement de l'habilitation
Lhabilitation doit tre rvise chaque fois que cela savre ncessaire en fonction de
lvolution des aptitudes de lintress.
En cas d'accident
Se mfier du sur-accident ! Toute intervention imprudente du sauveteur/secouriste du travail
peut le conduire un accident identique , il faut :
soustraire la victime le plus rapidement possible laction du courant lectrique en
utilisant le dispositif de coupure le plus proche (interrupteur, arrt durgence, disjoncteur,
prise de courant) ;
si le courant ne peut tre coup, sisoler pour dgager la victime. Pour cela, utiliser
gants isolants, btons de bois, toffes
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Suivi mdical
Toute personne ayant t lectrise doit tre examine par un mdecin et faire lobjet dun
suivi mdical. Lincident devra tre consign sur le registre des accidents.
2.6 Travail sur cran
Lamnagement des espaces de travail est une occasion pour le chef dtablissement de
repositionner son organisation et ses modes de fonctionnement.
Voici, quelques recommandations inscrites dans la rglementation :
Informer et former aux conditions correctes dutilisation des quipements ;
Pas de reflet dans lcran ;
Disposer son poste dordinateur de faon ne pas tre en face dune fentre ;
Baisser les stores en cas densoleillement ;
Rgler son fauteuil (hauteur-inclinaison) ;
Utiliser un repose-pied ;
Nettoyer et rgler le contraste de son cran ;
Utiliser un porte-documents latral ;
Porter des lunettes adaptes lorsque les dfauts visuels sont corriger ;
Raliser des pauses de quelques minutes (5 minutes doivent tre introduites aprs
environ 45 minutes de travail) ;
Assurer une surveillance mdicale adquate.
Lapplication de ces recommandations permet de rduire les astreintes visuelles et
musculo-squelettiques des oprateurs.
2.7 La fiche de poste
Exemple de fiche de poste page suivante : Industrie chimique - Oprateur de mlange
Il peut tre intressant de personnaliser chaque fiche de poste avec, non seulement le
pictogramme, mais aussi la photo du modle d'EPI effectivement utilis sur le poste. Les
photos peuvent tre demandes au fabricant/fournisseur.
D'autre part, il est aussi possible d'illustrer les cases Risques avec des photos de
l'oprateur en situation sur son poste de travail.
Les pictogrammes utiliser
Dans les fiches de poste des pictogrammes peuvent tre utiliss, comme les exemples
prsents ci-dessous.
Port obligatoire dquipements de protection :
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Interdictions :
Exemple de fiche de poste
Poste : oprateur de mlanges
Description : Prparer les mlanges
Surveiller les niveaux des trmies et silos
Alimenter en adjuvants les trmies
Rceptionner les matires premires
Ranger et organiser les stockes de matires premires
Veiller la propret de la plate-forme de mlanges
Risques Moyens de prvention
Chimique
(manipulation de matires
premires, d'adjuvants)
Porter les quipements individuels :
- protection du visage/lunettes,
- gants (contre les risques chimiques),
- vtements de protection
Explosion - Incendie
(utilisation de matires
inflammables, explosives)
Interdiction de fumer sur la plate-forme
Coupure
(utilisation de couteaux pour
dconditionner les sacs)
- Utiliser l'outil adquat
- Porte les gants de protection (contre les
risques mcaniques)
Bruit
(exposition des niveaux
sonores levs > 85 dBA)
Porter les protections auditives
Mcanique
(heurt, entranement avec les
quipements environnant le
poste de travail)
- tre vigilant
Mal au dos
(lors de la manipulation des
sacs de 25 kg de matires
premires)
- Lever le sac dos droit, genoux plis
- Porter le sac contre son corps
Chute de hauteur
(lors de l'accs la plate-
forme et aux mlangeurs)
- tre vigilant
- Ne pas se prcipiter
- Tenir la rampe de l'escalier
Chute de plain-pied
(sol encombr d'obstacles)
- tre vigilant
- Ne pas se prcipiter
- Garder propre, ranger le poste de
travail
Partie 1 - Salaris et risques daccident
3 LES INTERLOCUTEURS EN MATIRE DE SANT
ET DE SCURIT AU TRAVAIL
3.1 Le responsable scurit
Limportance du service scurit est adapte suivant le site. La fonction scurit deux
aspects :
aspect oprationnel ;
aspect fonctionnel.
Le responsable scurit runit toutes les informations indispensables lexcution de ses
missions (analyse des accidents, laboration de programme de prvention, suivi de la
veille rglementaire).
3.2 Le CHSCT
Le CHSCT (Comit dhygine de scurit et de conditions de travail) a pour
mission essentielle de veiller la conservation de la sant des salaris, la
prvention des dangers et lamlioration des conditions de travail. Il est aussi
consult pour les programmes de formation lis des domaines de comptences.
Il est prsid par le chef dentreprise ou son reprsentant. Il est compos de
membres du personnel lus pour deux ans par les membres du comit dentreprise
et les dlgus du personnel, de membres de droit (comme le mdecin du travail),
et de toutes personnes qualifies sur un sujet.
Ce comit se runit au moins une fois par trimestre et chacune des runions peut
tre prcde par une visite datelier. Des runions extraordinaires peuvent tre
organises sur des sujets majeurs.
La liste des membres lus est affiche sur le panneau de direction.
3.3 L'inspection du travail
Linspecteur du travail veille au respect des dispositions du droit du travail dans les
entreprises et notamment en ce qui concerne lapplication de la rglementation
relative la scurit et lhygine.
Il a un rle de contrle, de conseil et de conciliation.
En matire dhygine et de scurit du travail, linspection du travail est seule
habilite mettre en uvre les sanctions pnales prvues par la lgislation.
Les inspecteurs du travail disposent dun droit dentre de jour comme de nuit
lorsque des travaux sont effectus.
Les inspecteurs de travail, avant de dresser un procs verbal pour infraction, mettent
en demeure le chef dtablissement de prendre les mesures ncessaires et conformes
aux prescriptions rglementaires afin de faire cesser linfraction.
3.4 La CRAM
La CRAM (Caisse rgionale d'assurance maladie) dispose dingnieurs-conseils et de
contrleurs de scurit qui interviennent dans les entreprises.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Ils dveloppent une importante activit de conseil technique propre rduire les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Ils peuvent inciter lemployeur prendre des mesures
justifies pour la prvention des risques et demander lintervention de linspecteur du travail.
La CRAM nest pas tenue de faire rfrence des textes rglementaires pour demander au
chef dtablissement de satisfaire certaines mesures de scurit.
3.5 Le mdecin du travail
Chaque nouveau salari doit passer une visite mdicale dembauche.
Une visite daptitude sera renouvele au moins une fois tous les deux ans.
En revanche, dans le cadre de la surveillance mdicale renforce, la visite daptitude
doit avoir lieu au moins une fois par an :
pour les salaris affects certains travaux comportant des exigences ou des risques
dtermins par des rglements.
dans le cadre de certains accords collectifs de branche tendus prcisant les mtiers et
postes concerns ainsi que des situations relevant d'une telle surveillance en dehors
des cas prvus par la rglementation ;
Les salaris qui viennent de changer de type d'activit ou d'entrer en France, les
travailleurs handicaps, les femmes enceintes, les mres dans les six mois qui suivent
leur accouchement et pendant la dure de leur allaitement, les travailleurs gs de
moins de dix-huit ans, ainsi quaprs tout arrt de travail prolong ou de changement
de poste.
Le but premier du mdecin du travail, inter-entreprise ou salari , est d'viter au
salari toute altration de sant lie au travail. Il est aussi de suivre sa sant gnrale,
de le conseiller dans ce domaine.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4 L'VALUATION DES RISQUES
4.1 Gnralits
4.1.1 Quelques dfinitions sur lvaluation des risques
Quentend-on par danger ?
Source ou situation pouvant nuire par blessure ou atteinte la sant, dommage la
proprit, lenvironnement du lieu de travail ou une combinaison de ces lments -
OHSAS 18001.
Quentend-on par risque ?
Combinaison de la probabilit et de la (des) consquence(s) de la survenue dun
vnement dangereux spcifi - OHSAS 18001.
Quest-ce que le document unique et que doit-il contenir ?
Le document unique a pour but de formaliser le rsultat de lvaluation des risques
effectue par unit de travail.
Lvaluation des risques est-elle une fin en soi ?
Non, ce nest que la premire tape de la mise en place de mesures de prvention.
En effet, le document unique doit tre utilis selon le dcret du 5 novembre 2001 portant
cration d'un document relatif l'valuation des risques pour la sant et la scurit des
travailleurs, prvue par l'article L. 230-2 du Code du travail, pour tablir le bilan de la situation
gnrale de lhygine, de la scurit et des conditions de travail dans ltablissement (bilan
annuel) et le programme annuel de prvention des risques professionnels.
4.1.2 Pourquoi procder une valuation des risques ?
Cest au terme dune expertise que la cause dun sinistre est identifie, une fois que la
catastrophe sest produite. Ce qui aurait pu tre fait pour lviter est alors rvl.
De cette constatation, nat lvidence de pratiquer des analyses pralables. Toutes les
sources dun sinistre possibles sont recherches, la plupart des risques planant sur nos
personnes ou sur notre environnement peuvent tre dtects et souvent neutraliss par le
biais de cette anticipation.
Le but de cette recherche est donc didentifier les risques par lobservation des causes
possibles dun sinistre.
Un sinistre rsultant presque toujours dun concours de circonstances, il savre
ncessaire danticiper les enchanements qui peuvent se produire partir de plusieurs
lments matriels et humains.
Lobjectif de cette valuation est donc de dgager les lments propres maintenir
tout moment linstallation en scurit, tant lors de son fonctionnement optimal que lors
des dviations prvisibles.
4.1.3 Qui doit procder lvaluation des risques ?
Lvaluation des risques doit toujours tre effectue par un groupe de travail compos de
personnes connaissant les comportements humains, les matriels et les installations dans des
situations analogues et dans des donnes du problme.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Ce travail doit runir tous les types de comptences internes et externes si besoin. Le
groupe pourra tre constitu de techniciens reprsentants chacun les diffrents secteurs
de lentreprise concerns par linstallation : technicien de fabrication, technicien en
environnement, technicien en scurit des personnes, technicien des mthodes et
surtout un garant de mthode.
4.1.4 Comment procder lvaluation des risques ?
Lanalyse doit aboutir aux choix des mesures de prvention et de protection dans un
ensemble ou interviennent des procds, des quipements, des fluides, des interfaces
entre les quipements et les oprateurs, des facteurs humains, des facteurs
environnementaux.
La dmarche se doit dintgrer ces diffrents facteurs dans toutes les tapes de ltude :
recueil des donnes de base : physico-chimique, caractre de danger, quipements,
rglementation, sinistralit ;
dfinition des conditions sres du systme en marche normale ;
recherche systmatique des dangers : produits, procds, quipements, interfaces,
facteurs humains et extrieurs ;
classement des dangers en fonction de leur gravit et de leur probabilit doccurrence
- valuation des risques ;
choix des mesures de prvention et de protection ;
analyse des fonctionnements en mode dgrad.
4.1.5 La rglementation
Les principes gnraux de prvention sont noncs par la loi n91-1414 du 31 dcembre
1991 portant transposition de directives europennes relatives la sant et la scurit du
travail et par larticle L 230-2 du Code du travail.
I. - Le chef d'tablissement prend les mesures ncessaires pour assurer la scurit et
protger la sant physique et mentale des travailleurs de l'tablissement, y compris les
travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prvention des risques professionnels, d'information
et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adapts.
Il veille l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre l'amlioration des situations existantes.
II. - Le chef d'tablissement met en uvre les mesures prvues au I ci-dessus sur la base
des principes gnraux de prvention suivants :
a) viter les risques ;
b) valuer les risques qui ne peuvent pas tre vits ;
c) combattre les risques la source ;
d) adapter le travail l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des quipements de travail et des mthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadenc et de
rduire les effets de ceux-ci sur la sant ;
e) tenir compte de l'tat d'volution de la technique ;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
g) planifier la prvention en y intgrant dans un ensemble cohrent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques lis au harclement moral,
tel qu'il est dfini l'article L. 122-49 ;
h) prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorit sur les
Partie 1 - Salaris et risques daccident
mesures de protection individuelle ;
i) donner les instructions appropries aux travailleurs.
III. - Sans prjudice des autres dispositions du prsent code, le chef d'tablissement
doit, compte-tenu de la nature des activits de l'tablissement :
a) valuer les risques pour la scurit et la sant des travailleurs, y compris dans le
choix des procds de fabrication, des quipements de travail, des substances ou
prparations chimiques, dans l'amnagement ou le ramnagement des lieux de
travail ou des installations et dans la dfinition des postes de travail.
A la suite de cette valuation et en tant que de besoin, les actions de prvention ainsi
que les mthodes de travail et de production mises en uvre par l'employeur doivent
garantir un meilleur niveau de protection de la scurit et de la sant des travailleurs
et tre intgres dans l'ensemble des activits de l'tablissement et tous les niveaux
de l'encadrement.
b) Lorsqu'il confie des tches un travailleur, prendre en considration les capacits
de l'intress mettre en uvre les prcautions ncessaires pour la scurit et la
sant
c) Consulter les travailleurs ou leurs reprsentants sur le projet d'introduction et
l'introduction de nouvelles technologies mentionnes l'article L. 432-2, en ce qui
concerne leurs consquences sur la scurit et la sant des travailleurs.
IV. - Sans prjudice des autres dispositions du prsent code, lorsque dans un mme lieu
de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont prsents, les employeurs doivent
cooprer la mise en uvre des dispositions relatives la scurit, l'hygine et la
sant selon des conditions et des modalits dfinies par dcret en Conseil d'tat.
En outre, dans les tablissements comprenant au moins une installation figurant sur
la liste prvue au IV de l'article L. 515-8 du Code de l'environnement ou vise
l'article 3-1 du Code minier, lorsqu'un salari ou le chef d'une entreprise extrieure
ou un travailleur indpendant est appel raliser une intervention pouvant
prsenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximit de cette
installation, le chef d'tablissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de
l'entreprise extrieure dfinissent conjointement les mesures prvues aux I, II et III.
Le chef d'tablissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise
extrieure des mesures que celle-ci a la responsabilit d'appliquer, compte-tenu de la
spcificit de l'tablissement, pralablement l'excution de l'opration, durant son
droulement et son issue.
4.2 Lanalyse prliminaire de risques (APR)
4.2.1 Dfinition
Lanalyse prliminaire des risques est une mthode didentification et dvaluation des
risques. Elle permet de se pencher sur les causes des risques et sur limportance de leurs
consquences.
Elle se droule donc en deux tapes :
lanalyse prliminaire des dangers ainsi que des causes daccidents ;
lanalyse des consquences daccidents.
Elle sappuie sur des listes de dangers pr-tablies ainsi que sur des tableaux formaliss
des incompatibilits, des fiches produits rassemblant les donnes physiques, chimiques,
etc., et des fiches oprations rassemblant les donnes sur la chimie des ractions, etc.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.2.2 Objectif
Lobjectif de cette analyse est de trouver les moyens et les manires dagir pour contrer
les accidents ventuels. La mthode doit permettre :
didentifier rationnellement tous les aspects scurit en identifiant les risques ;
de prescrire les actions correctives immdiates dans les meilleures conditions
defficacit, de rapidit et de cot ;
de rpertorier les risques justifiant une tude complmentaire ;
dobtenir ds les phases de recherche, dveloppement, conception, une certaine
analyse de scurit se traduisant par des consignes dexploitation et de scurit, des
dispositifs de contrle et de rgulation, des moyens de protection, des rgles de
construction des quipements.
4.2.3 Dans quel contexte ?
Lanalyse prliminaire de risques est particulirement intressante lors de la premire
phase de conception de linstallation pour laquelle il nest pas encore possible de
sappuyer sur le retour dexprience. Elle fait donc appel des techniques courantes,
mais mal matrises et difficiles appliquer, lorsque les dtails de linstallation ne sont
pas encore dtermins.
Elle est essentiellement utilise dans les domaines de la chimie, du nuclaire, de la
maintenance et de toute production lectronique, etc.
4.2.4 Droulement de lanalyse
Lanalyse prliminaire des risques dans la conception dune installation se propose de
runir des donnes de scurit suivant les listes guides sur deux types de problme :
les risques inhrents aux produits mis en uvre : matires premires, produits
intermdiaires et finis, dchets.
les risques lis au procds retenus : ractions chimiques et/ou oprations diverses.
Elle tient galement compte des interactions possibles avec les installations existantes.
Les critres de recherche sont par exemple :
Pour la fiche produit :
- les proprits physico-chimiques du produit,
- la solubilit,
- les chaleurs spcifiques,
- les caractristiques de combustion,
- les agents extincteurs,
- corrosion,
- incompatibilits,
- stabilits,
- effets des impurets,
- hygine industrielle,
- toxicit,
- rglementation,
- stockage,
- destruction ;
Pour la fiche procd :
- quation de la raction principale et des ractions secondaires,
- conditions opratoires,
- risques,
Partie 1 - Salaris et risques daccident
- dispositifs prvus pour assurer la matrise de la raction,
- moyens de prvention de contamination par mlange intempestif,
- mesures propres parer les consquences dune panne,
- mesures propres viter les fausses manuvres,
- corrosion,
- moyens dlimination et de destruction des effluents,
- anomalies observes et incidents divers.
4.3 Lanalyse des modes de dfaillances, de leurs effets
et de leur criticit (AMDEC)
4.3.1 Dfinition
Historiquement, la mthode initiale est appele Analyse des modes de dfaillances et de leurs
effets (AMDE). Son extension logique est lanalyse des modes de dfaillance, de leurs effets et
de leur criticit.
Cette mthode prventive effectue un recensement des modes de dfaillances des diffrents
composants de lunit de manire dterminer leur probabilit doccurrence et la gravit de
leurs effets. Cette mthode danalyse de la sret de fonctionnement est base sur lanalyse
inductive destine prvenir les failles possibles dun procd, dune installation, etc. : elle
remonte de leffet sur le systme jusqu la cause de la dfaillance.
4.3.2 Objectifs
LAMDEC est une technique utilise pour faciliter lexamen critique de la conception.
Elle procure alors :
une base pour une analyse quantitative ;
une documentation historique pour une rfrence future daide en analyse de
dfaillances ;
une base pour ltablissement dactions correctives prioritaires ;
une liste de pannes menant aux vnements redouts spcifis.
4.3.3 Dans quel contexte ?
La mthode AMDEC peut tre lourde, elle est donc utilise pour des pannes simples.
Tous les composants du systme tudi sont censs tre en bon tat de fonctionnement,
lexception de celui dont on analyse la faille.
Cette mthode ne donne donc pas la possibilit de sintresser aux interactions entre
systmes.
LAMDEC est ralise pour un tat de fonctionnement du systme, ce qui ncessite de :
connatre le profil de mission du systme ;
connatre la configuration du systme dans chacune des phases de la mission ;
choisir un nombre limit dtats dimensionnant vis vis des objectifs.
4.3.4 Droulement de lanalyse
La mthode AMDEC repose sur une analyse systmatique de tous les composants du
systme, des causes possibles de dfaillances et de leurs consquences. La probabilit
et la gravit de ces dfaillances sont galement tudies.
On distingue gnralement lAMDEC produit et lAMDEC procd.
Cette mthode se pratique laide dun tableau.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.4 La mthode HAZOP
4.4.1 Dfinition
La mthode HAZOP a t cre pour rpondre aux besoins de lindustrie chimique,
mais peut tre applique toute autre industrie.
Cette mthode porte galement lappellation SCF (tude de scurit sur schma de
circulation de fluides).
Une quipe danalystes sintresse aux dviations des paramtres physiques de
fonctionnement (temprature, pression), leurs causes, leurs consquences et aux
actions mettre en place.
Il sagit donc dune mthode inductive qui part dune cause et en tudie les effets.
4.4.2 Objectif
Il sagit dune mthode logique destine analyser les causes possibles dun vnement
redout afin den limiter la probabilit par des mesures de prvention appropries.
4.4.3 Contexte
Cette mthode est utilise pour les industries de procds (raffinage, liqufaction de
gaz).
4.4.4 Principes
Cette mthode seffectue en groupes de travail, ainsi les points de vue les plus divers
et les comptences les plus varies sont confronts. Les solutions naissent de ces
changes.
Ltude sappuie sur le schma de circulation des fluides et dinstrumentation complets
avec nomenclature.
Toutes les phases du procd sont tudies les unes aprs les autres en dlimitant le
systme concern (circuit des fluides) et en dfinissant soigneusement lintention qui
prside la squence.
Ils font lobjet des mmes questions gnres par une liste de mots-clefs.
Les dysfonctionnements de linstallation apparaissent au travers des dviations des
paramtres de fonctionnement et par rapport lintention.
4.4.5 Droulement de lanalyse
Lanalyse en elle-mme se fait en plusieurs tapes.
La dfinition des objectifs
La mthode pouvant sappliquer la conception dune installation comme aux contrles
dquipements existants, il est impratif que le cadre de ltude soit dfini.
Les types de dangers pris en compte peuvent tre pour :
lenvironnement ;
le voisinage ;
le personnel ;
les quipements et le matriel ;
la qualit du produit.
Une tude HAZOP pouvant tre trs dtaille, il faut galement fixer le niveau
dinvestigation de lanalyse.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Enfin, une tude HAZOP savrant trs lourde mettre en place, le systme tudi doit
tre bien cern. Ltude peut tre limite une partie de linstallation en complment
dune analyse prliminaire de risque globale et moins dtaille.
Le choix du groupe de travail
Par la varit de sa composition, lquipe technique regroupe toutes sortes de
connaissances techniques (mcaniques, chimiques) et de lexprience dans de
nombreux domaines.
Un meneur dtude est dsign. Il doit avoir intgr les objectifs de ltude et veille la
bonne application de la mthode danalyse. Ses connaissances techniques le rendent
apte suivre les discussions et les rflexions.
Il est toutefois possible de joindre aux comptences du meneur dtude, les services dun
secrtaire charg de noter les risques dcouverts dans le courant de lanalyse.
Le travail prparatoire
De cette phase prliminaire dpend la russite de la runion de rcolte dinformations.
La prparation seffectue autour de :
linventaire des points tudier ;
lobtention de plans et des schmas (inventaires de matriel, donnes physico-
chimiques des produits mis en uvre, historiques dincidents, squences opratoire,
programmes, plans dimplantation, schmas tuyauterie instrumentation, liste de
scurit, tudes dj existantes) ;
la modlisation du systme et de la circulation des fluides ;
ltude de squences et des programmes ;
la dcomposition du systme tudi selon le niveau de linvestigation dcid : on peut
retenir une dcomposition de matriel (canalisations, cuves, quipements auxiliaires),
selon le trajet suivi parles matires, depuis la matire premire jusquau produit fini.
On dcompose le systme selon des phases opratoires squentielles. Par
largissement, on pourrait dcomposer le systme en fonctionnalits, regroupant des
matriels sous une mme intention de fonctionnement ;
ltablissement de lintention prcise associe chaque lment dtude. Cest le
fonctionnement attendu de llment. A lintention correspondent des valeurs
prcises de dbits, de temprature, de pression, de PH, de viscosit
Les runions
Il est conseill que les runions se passent le matin, quelles ne durent pas plus de trois
heures et que quinze minutes soient consacres par point abord. Le temps de runion doit
tre prioritairement consacr la mise en vidence des risques.
Le groupe de travail doit rassembler le maximum de comptences et de potentialits
cratives : les spcialistes de lentretien sont indispensables parce quils connaissent
linstallation sous un angle technique, le cadre de production peut apporter un esprit de
synthse.
Une personne de laboratoire peut donner des prcisions sur les proprits des produits.
Lagent de matrise apporte son exprience, ses connaissances de la machine
Chaque lment est tudi suivant un ordre prcis : processus opratoire, chronologie,
et la dmarche est la suivante :
Expression de lintention (fonction attendue de llment)
Le fonctionnement normal de llment dtude doit tre rappel et clarifi pour tous les
participants de la runion.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Recherche des dviations possibles avec lapplication
des mots-clefs sur les paramtres de fonctionnement.
Pour un lment donn, les mots-clefs ne sont pas tous forcment applicables. Un mot-
clef peut gnrer plusieurs dviations.
Pour chaque dviation, recherche des causes possibles
Si un systme de scurit existe et quil empche la dviation, il sagit de faire
lhypothse de son non fonctionnement. Ltude devra mettre en avant le rle de ces
systmes de scurit existants ou mettre en place.
Il sagit galement de se mfier de loprateur humain.
Recherche des consquences.
Il sagit de continuer faire abstraction des scurits du systme.
Il faut galement cerner les limites maximales des dgts des accidents.
Il ne faut pas sattarder sur la qualit du produit si elle ne fait pas partie des objectifs de
ltude fixs pralablement.
Il sagit enfin de reprer les consquences pouvant prsenter un danger et les faire
figurer dans une liste rcapitulative.
Analyse des actions dj entreprises ou entreprendre
pour les consquences prsentant un danger quelconque
Il sagit alors de faire le point sur les moyens de prvention qui diminuent
les probabilits doccurrence des vnements, sur la limitation des consquences par les
moyens de protection, sur la dtection et sur les alarmes.
Il faut vrifier le rle des actionneurs (sur quel circuit agissent-ils ?).
Il faut galement vrifier la localisation des capteurs et la validit de leurs informations.
Toutes les informations sont rassembles sous forme de tableaux
Les questions qui ne trouvent pas de solutions sont notes en vue dune discussion
extrieure. Des calculs sont galement faits ultrieurement pour vrifier si un risque
potentiel identifi est avr ou non.
Consquences des runions :
Les solutions trouves peuvent constituer un changement dans le procd, dans la mthode
opratoire. Elles peuvent galement constituer un complment pour linstallation Certaines
dcisions peuvent ncessiter une nouvelle runion.
4.5 Les arbres de dfaillances
4.5.1 Dfinition
Cette mthode est ne en 1962 aux tats-Unis dans les bureaux de la socit Bell. Elle
est galement dsigne sous dautre noms : arbre des dfauts, arbre des causes, arbre
des fautes.
Il sagit dune mthode logique destine analyser les causes possibles dun vnement
redout afin den limiter la probabilit par des mesures de prvention appropries.
Cette mthode part de lvnement redout pour remonter aux causes (do le nom
parfois darbre des causes). La construction de larbre termine, il devient possible den
faire une utilisation quantitative ou qualitative.
Cet arbre des dfaillances est donc une mthode dductive.
Cest un graphe arborescent reliant de manire logique des vnements et destin
dterminer la combinaison des causes dun vnement redout.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.5.2 Objectifs
Il sagit de reprsenter graphiquement les combinaisons dvnements qui conduisent
un fait indsirable et unique.
4.5.3 Contexte
Larbre des dfaillances est une mthode dductive particulirement bien adapte aux
systmes statiques ou assimilables. Les vnements constituant un arbre des dfaillances
(intermdiaires de base) sont indpendants entre eux. Elle est utilise, entre autres, dans les
tudes de scurit de centrales nuclaires.
4.5.4 Principes
Larbre des dfaillances est form de niveaux successifs tels que chaque vnement est
gnr partir des vnements du niveau infrieur par lintermdiaire de divers
oprateurs (ou portes) logiques.
Cette mthode peut complter loutil AMDEC en offrant la possibilit dtudier les
combinaisons de pannes.
4.5.5 Droulement de lanalyse
Les principales tapes sont les suivantes :
dfinir lvnement redout ;
tudier le systme ;
construire larbre (arborescences, rductions boolennes) ;
recueillir les donnes quantitatives susceptibles de figer les valeurs des diffrents
vnements lmentaires ;
valuer les diffrentes probabilits des vnements prsents dans larbre ;
analyser et interprter les rsultats obtenus.
4.6 La mthode DIDERO
Dveloppe par le CNPP, la mthode DIDERO (dclinaison de lIdentification des
Dangers, de lvaluation des risques et des objectifs) se compose de plusieurs tapes.
4.6.1 Le dcoupage en units de travail
La premire tape est le dcoupage du site en entits lmentaires danalyse .
Ce dcoupage peut tre ralis en fonction de critres la fois gographiques et
organisationnels (dans lesprit de lapproche processus dcoulant notamment de
lapplication de la norme ISO 9001 version 2000).
Ensuite, les oprations effectues dans chaque entit sont identifies en fonction des diffrentes
tapes du processus de fabrication, mais galement, en fonction des diffrents modes de
fonctionnement (fonctionnement normal, entretien, maintenance, mode dgrad).
Enfin, de manire permettre une dtermination aussi exhaustive que possible des
sources de danger, il est ncessaire de recueillir un ensemble de donnes permettant
dapprhender chaque opration et chaque installation dans lentit tudie (machines,
produits utiliss, mesures de prvention, moyens de protection en place).
Ces lments sont recueillis partir :
dune visite de terrain ;
dentretiens avec les responsables et personnes travaillant dans lentit ;
des sources documentaires existantes (compte-rendu daccident, fiche de donnes de
scurit, registre dinfirmerie).
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.6.2 Le dcoupage en oprations ou tches ralises
Chaque unit de travail est dcoupe en oprations ou tches ralises
4.6.3 Lidentification des sources de danger
Elle est faite pour chacune des oprations effectues dans une entit lmentaire danalyse. Le
recensement des lments source de dangers au niveau de lentit lmentaire est effectu en
distinguant les dangers de type accidentel et ceux de type chronique. Cette identification est
ralise laide dune grille (volutive et adaptable) prsentant une liste exhaustive des sources
de danger que lon peut rencontrer en entreprise.
4.6.4 Lvaluation des risques
Lapprciation des risques se fait au travers de deux paramtres que sont la probabilit
doccurrence de lvnement redout et la gravit des consquences de lvnement sur les
personnes.
Dans le but dvaluer au plus juste le risque au sein dune entreprise donne, trois
critres de pondration sont utiliss :
les facteurs pouvant exacerber la gravit ou la probabilit de lvnement (par
exemple, la faible rsistance des structures dun entrept dans lequel on stocke des
matires inflammables) ;
les mesures de prvention mises en uvre ;
les moyens de protection en place.
Pour lvaluation de chacun de ces critres, des grilles de cotation par source de danger sont
la disposition des groupes dvaluation des risques (utilisation dune chelle de 1 4).
Chaque risque valu est ensuite positionn dans une matrice 4 x 4 et une note de 1 16
est attribue chacun. Ceci permet de hirarchiser les risques les uns par rapport aux autres et
donc de dfinir des priorits dactions.
4.6.5 La hirarchisation des risques
Cette phase de hirarchisation seffectue en fonction de la note qui a t attribue
chacun des risques identifis.
Les risques sont classs en trois catgories :
Les risques non significatifs qui de par leur nature ne sont pas prioritaires. Ils
continueront faire lobjet dune attention par lentreprise mais ne donneront pas lieu
ltablissement dun plan dactions scurit ;
Les risques significatifs matriss pralablement la dmarche
dvaluation des risques. Exemple, un tour bois qui pouvait gnrer des projections
ou entraner loprateur en happant ses vtements a t protg par un carter. Ainsi, les
risques ont t ramens un niveau acceptable ;
Pour maintenir ce niveau acceptable, il faut garantir le maintien dans le temps de la
protection et la prennit de la sensibilisation de loprateur au danger.
Pour ce faire, un plan de surveillance est mis en place au travers de visites hirarchiques de
scurit (VHS) : le chef datelier devra rgulirement faire le tour des machines modifies,
sassurer quelles sont utilises convenablement et sensibiliser rgulirement le personnel.
Les risques significatifs. Ce sont ceux sur lesquels les moyens de matrise ne sont
pas considrs comme suffisants au regard des dangers prsents. Ils doivent par
consquent tre traits en priorit, soit par une rflexion de fond pour la suppression
du danger, soit par lidentification dun plan de traitement intgrant des lments de
protections collectives et individuelles, de formation (suivant les principes gnraux de
prvention dfinis dans larticle L.230-2 du Code du travail).
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.6.6 Le seuil de significativit de la mthode DIDERO
Le seuil prendre en compte nest pas fig. Il est fix en fonction du niveau actuel de scurit
dans lentreprise, mais galement, en fonction du niveau quelle souhaite atteindre (niveau
dfini en tenant compte du contexte conomique, social, rglementaire).
En rgle gnrale et dans une entreprise ayant atteint un bon niveau de scurit,
lvaluation des risques conduit identifier 20 % de risques significatifs (en application de la
loi de Pareto).
En revanche, il ne peut tre exclu, dans une entreprise ayant peu investi sur la scurit, que
la proportion des risques significatifs soit beaucoup plus importante.
07 11 13 16
04 08 12 15
02 05 09 14
01 03 06 10
Les risques situs dans les cases 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont dits risques
significatifs et sont traiter en priorit.
4.7 La scurit au travail : de la mthodologie la pratique
Lorsquil est ralisable, le dcoupage par processus effectu lors de la mise en place
dun systme de management sert de base lvaluation des risques. Ce qui vite
deffectuer diffrents dcoupages de lentreprise et permet de rester dans la mme
logique que cette dernire.
Il convient en revanche de sassurer formellement que le dcoupage organisationnel
recouvre bien tout le primtre de lentreprise. En effet, il nest pas rare, que certaines
activits ou zones de lentreprise ne soient pas (formellement) prises en compte dans la
cartographie des processus . A titre dexemple : latelier maintenance, les locaux
utilits , les zones de circulation extrieures, les espaces verts
A la suite de la parution du dcret du 5 novembre 2001 portant cration d'un document
relatif l'valuation des risques pour la sant et la scurit des travailleurs, prvue par
l'article L. 230-2 du Code du travail, lemployeur transcrit et doit mettre jour par crit les
rsultats dune valuation des risques pour la scurit et la sant des travailleurs dans son
entreprise.
Diverses rflexions menes avec des institutionnels de la scurit ont amen dresser une
liste des conditions qui leur paraissent essentielles pour raliser une bonne valuation des
risques. Ainsi, pour tre de qualit, celle-ci doit tre :
Exhaustive.
Cela signifie que tout le primtre physique de lentreprise devra tre pris en compte.
Non seulement tous les locaux mais galement les rseaux de distribution (fluides,
utilits) et les zones de circulation.
Toutes les phases de vie de lentreprise seront tudies, les phases de production, mais
galement de montage, de maintenance, de rparation
Enfin, toutes les sources de danger devront tre prises en considration, quelles soient
dorigine chronique (atteinte la sant) ou dorigine accidentelle. Dans un premier temps, les
sources de danger prsentes sur le site devront tre identifies et aucune ne devra tre carte.
A titre dexemple, certains sites industriels ont recens les dangers pour le personnel
dintervention, induits par des situations durgence : incendie, pandage de produits risques,
secours blesss.
Aprs cette tape dinventaire exhaustif, le choix entre les risques significatifs et les autres
sera ralis au moment de lvaluation.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Participative et mthodique.
Une valuation des risques ne doit pas tre mene de manire alatoire, elle doit tre
cadre par un guide ou une mthode la rendant rigoureuse.
Lobjectif premier dun chef dentreprise lors de la mise en place de lvaluation des
risques au sein de son tablissement est de se mettre en conformit avec la rglementation.
Mais cest galement pour lui lopportunit dinstaurer un dialogue scurit dans
lentreprise : runir des salaris (oprateurs et encadrement), des reprsentants du personnel,
des membres du CHSCT et des membres des organismes de prvention (mdecine du travail,
CRAM) autour dune table pour valuer la sant et la scurit au travail.
Cette dmarche amorcera la pense scurit. Plusieurs expriences ont montr lintrt
que portent les employs aux dmarches participatives en matire de scurit permettant
lidentification des dangers, la dfinition et la mise en place dactions de scurit.
Il serait donc dommageable de ne pas impliquer des salaris et membres du CHSCT
dans le groupe de travail Evaluation des risques .
Ils seront notamment dune trs grande aide lors de la dfinition des oprations (quils
effectuent), la dtermination des phases de travail et des dangers associs puis la mise
en uvre du plan de rduction des risques.
Objective et reproductible.
Lvaluation des risques devra tre reconduite tous les ans ou du moins mise jour. Il
est donc ncessaire dobtenir les mmes rsultats la fois dans la dure et ce, quelle
que soit la personne (ou le groupe de personnes) qui conduit lvaluation.
Par consquent, la mthode utilise doit tre base sur des critres purement objectifs,
linterprtation de la personne dployant la mthode doit tre rduite au minimum. De
cette manire, il suffira davoir un garant de la mthodologie au sein de lentreprise
pour que lvaluation des risques soit reconduite chaque anne dans les mmes
conditions.
volutive.
Lobjectif dune entreprise nest pas, en gnral, datteindre un niveau de scurit donn mais
plutt damliorer en permanence le niveau de scurit de ses salaris. La mthodologie
dvaluation des risques doit permettre de faire voluer le seuil partir duquel on considre
quun risque est significatif, sans pour autant que lon value diffremment un risque dune
anne sur lautre.
Entre deux valuations, des mesures seront prises pour amliorer la scurit des
travailleurs et, de fait, la cotation moyenne des risques de lentreprise se verra diminue.
En consquence, si on veut garder la mme proportion de risques considrs comme
significatifs, il faudra abaisser le seuil de significativit . De cette manire, on entre
dans une dmarche damlioration continue des conditions de scurit au sein de
lentreprise.
Lapplication de mthodes de quantification des risques permet galement de mesurer le
niveau de performance scurit obtenu par lentreprise.
4.8 Llaboration du document unique
relatif lvaluation des risques professionnels
4.8.1 L valuation des risques et la situation relle
Avant toute chose, il convient dapporter quelques prcisions quant au contenu du
document unique au regard de lvaluation des risques et de la ncessit danalyser le
travail rel.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
a) Le domaine de lvaluation des risques
Lvaluation des risques doit sentendre de manire globale et exhaustive. (voir 4.7) Les
dispositions lgislatives prcisent que lvaluation des risques doit aussi tre ralise :
lors du choix des procds de fabrication, des quipements de travail, des substances
et prparations chimiques ;
lors de lamnagement des lieux de travail et de la dfinition des postes de travail
(article L. 230-2, III, a).
lors de toute transformation importante des postes de travail dcoulant de la
modification de loutillage, dun changement de produit ou de lorganisation du
travail et toute modification des cadences et des normes de productivit (lies ou non
la rmunration du travail), une valuation des risques doit tre ralise.
Des rglementations propres certaines activits ou risques, notamment physiques,
chimiques et biologiques, peuvent conduire la ralisation de diagnostics fonds sur le
respect dindicateurs permettant destimer les conditions dexposition.
b) Lanalyse du travail rel
La pertinence de lvaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte
des situations concrtes de travail, dit travail rel , qui se diffrencie des procdures
prescrites par lentreprise.
Ainsi, lactivit exerce par le travailleur pour raliser les objectifs qui lui sont assigns
gnre des prises de risques pour grer les alas ou les dysfonctionnements qui
surviennent pendant le travail.
De ce fait, lanalyse des risques a pour objet dtudier les contraintes subies par les
travailleurs et les marges de manuvre dont ceux-ci disposent dans lexercice de leur
activit. Lassociation des travailleurs et lapport de leur connaissance des risques ainsi
que de leur exprience savrent cet gard indispensables.
Pour ces raisons, il est souhaitable que dans le document unique ne figurent pas
uniquement les rsultats de lvaluation des risques mais aussi une indication des
mthodes utilises pour y parvenir.
Cela doit permettre dapprcier la porte de lvaluation des risques au regard des
situations de travail.
4.8.2 Qui est concern par la rglementation gnrale ?
Larticle L 230-2 du Code du Travail (Loi du 31 dcembre 1991) nonce le principe
gnral dune valuation des risques professionnels dans chaque unit de travail (au sens
large) afin dtudier, si besoin, les actions prventives.
Cette valuation porte notamment sur le choix des procds de fabrication, des
quipements de travail, des substances ou prparations chimiques, dans lamnagement
ou le ramnagement des lieux de travail ou installations et dans la dfinition des postes
de travail.
Le chef dentreprise doit prendre les mesures ncessaires en vue dassurer la scurit et
de protger la sant des salaris dans tous les aspects lis au travail et dans tous les
lieux de travail. Ces mesures comprennent des actions de prvention des risques
professionnels, dinformation et de formation ainsi que la mise en place dune
organisation et de moyens adapts.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Ce principe dvaluation des risques a t rendu obligatoire depuis le 1
er
janvier 1993 par la
loi du 31 dcembre 1991, transposant la directive-cadre europenne n89/391 du 12 juin
1989. La loi du 31 dcembre 1991 a introduit dans le Code du travail larticle L.230-2.
Larticle L.231-2 (3) du Code du travail indique que des dcrets dterminent les modalits de
lvaluation des risques pour la sant et la scurit des salaris prvue larticle L.230-2 du
Code du travail.
Plusieurs textes rglementaires prcisent cette obligation et notamment pour toute
activit susceptible de prsenter un risque dexposition :
au bruit (C.trav. art.232-8 et suiv.) ;
des substances/prparations chimiques dangereuses (C.trav. art. R.231-54-1) ;
des agents cancrognes, mutagnes ou toxiques pour la reproduction (C.trav. art.
R.231-56-1) ;
un risque biologique (C.trav. art. R.231-62) ;
aux risques relatifs aux oprations de manutention manuelle (C.trav. art. R.231-68) ;
ainsi que pour lanalyse des risques pouvant rsulter de linterfrence entre les activits, les
installations et matriels, laquelle doivent procder les chefs de lentreprise utilisatrice et
des entreprises extrieures (C.trav. art. R. 237-7).
4.8.3 Points de repre : la directive-cadre
et sa transposition en droit franais
La directive-cadre
La directive n 89/391/CEE du Conseil des communauts europennes du 12 juin
1989, dite directive-cadre , dfinit les principes fondamentaux de la protection des
travailleurs. Elle a plac lvaluation des risques professionnels au sommet de la
hirarchie des principes gnraux de prvention, ds lors que les risques nont pas pu
tre vits la source.
Alors que la plupart des dispositions de la directive-cadre prexistaient en droit franais,
la dmarche dvaluation a priori des risques, qui doit contribuer fortement
lamlioration globale de la sant et de la scurit et des conditions de travail, constitue
la principale innovation de ce texte communautaire, au regard de lapproche franaise
classique.
Lvaluation en amont des risques vise connatre, de manire exhaustive et prcise, les
risques traiter auxquels les travailleurs peuvent tre exposs. Elle sattache tenir compte de
lvolution des techniques, avec le souci dassurer la mise en uvre du principe fondamental
dune adaptation du travail lhomme.
La loi du 31 dcembre 1991
La loi du 31 dcembre 1991 a permis de transposer, pour lessentiel, les dispositions
que la directive-cadre ajoutait au droit franais. Sagissant de lvaluation des risques,
cest larticle L. 230-2 du Code du travail qui traduit le droit communautaire (article 6
de la directive-cadre), au regard de trois exigences dordre gnral :
obligation pour lemployeur dassurer la sant et la scurit des travailleurs (I de
larticle L. 230-2) ;
mise en uvre des principes gnraux de prvention des risques professionnels (II de
larticle L. 230-2) ;
obligation de procder lvaluation des risques (III de larticle L. 230-2).
Partie 1 - Salaris et risques daccident
ce titre, il convient de noter les arrts de la cour de cassation du 28 fvrier 2002,
relatifs lamiante, qui imposent lemployeur une obligation de rsultat devant le
conduire une grande vigilance.
Lvaluation des risques constitue une obligation la charge de lemployeur sinscrivant
dans le cadre des principes gnraux de prvention, afin dengager des actions de
prvention des risques professionnels.
Cette obligation gnrale a t dcline en prescriptions lgislatives et
rglementaires spcifiques prises, depuis 1989, en matire dvaluation des risques.
Elles correspondent, soit un type de danger, dagents ou produits dangereux
(amiante, bruit, risque biologique, chimique, cancrogne... ), soit un type
dactivit (manutention des charges, btiment-travaux publics, co-activit...).
Outre larticle L230-2 du Code du travail qui nonce les gnralits lies lvaluation
des risques, la rglementation se rapportant au document unique est complte par
plusieurs textes.
4.8.4 Le dcret du 5 novembre 2001: lments juridiques
Le dcret du 5 novembre 2001vient concrtiser le dispositif gnral mis en place en
1991, en compltant la transposition de la directive-cadre sous un angle juridique. Il
introduit deux dispositions rglementaires dans le Code du travail.
La premire, dans larticle R. 230-1 (art. 9, 1a) de la directive) prcise le contenu de
lobligation pour lemployeur de crer et conserver un document transcrivant les
rsultats de lvaluation des risques laquelle il a procd. A cette occasion, un
chapitre prliminaire, intitul principes de prvention , a t insr dans la partie
rglementaire du titre III du livre II du Code du travail.
Il importe de noter que cette obligation porte sur les seuls rsultats de lvaluation des
risques, les conditions de ralisation de celle-ci relevant donc au choix du chef
dentreprise.
Dautre part, larticle R. 230-1 dfinit les modalits de mise disposition du document
transcrivant les rsultats de lvaluation des risques, aux acteurs externes et internes
lentreprise, parmi lesquels figurent les instances reprsentatives du personnel (art. 10,
3 a) de la directive).
La seconde disposition rglementaire est de grande porte, puisquelle introduit un
nouvel article R. 263-1-1, qui porte sur le dispositif de sanctions pnales prvu en cas
de non-respect par lemployeur des diffrentes obligations, auquel celui-ci est
dornavant soumis en matire dvaluation des risques.
4.8.5 La circulaire du 18 avril 2002
La circulaire du 18 avril 2002 relative au document unique apporte des prcisions
et des indications pour lapplication du dcret du 5 novembre 2001.
Vous trouverez le texte intgral de la circulaire du 18 avril 2002 sur le site
www.travail.gouv.fr (rubrique sant, scurit au travail). En voici quelques extraits :
CIRCULAIRE DRT N2002-06 DU 18 AVRIL 2002 prise pour lapplication du dcret n2001-
1016 portant cration dun document relatif lvaluation des risques pour la sant et la
scurit des travailleurs, prvue par larticle L. 230-2 du Code du travail et modifiant le Code
du travail. []
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Lvaluation a priori des risques constitue un des principaux leviers de progrs de la dmarche
de prvention des risques professionnels au sein de lentreprise. Elle constitue un moyen
essentiel de prserver la sant et la scurit des travailleurs, sous la forme dun diagnostic en
amont -systmatique et exhaustif - des facteurs de risques auxquels ils peuvent tre exposs.
Lapport des connaissances scientifiques et lvolution des conditions de travail ont mis en
vidence de nouveaux risques professionnels (amiante, risques effet diffr lis aux
substances dangereuses, troubles musculosquelettiques, risques psychosociaux), qui soulignent
la ncessit de renforcer lanalyse prventive des risques.
Dans cette perspective, en reposant sur une approche globale et pluridisciplinaire - cest--dire
la fois technique, mdicale et organisationnelle - la dmarche dvaluation doit permettre de
comprendre et de traiter lensemble des risques professionnels.
Introduite pour la premire fois en droit franais du travail en 1991, lvaluation des risques
connat une nouvelle avance avec la parution du dcret du 5 novembre 2001 portant cration
dun document relatif lvaluation des risques pour la sant et la scurit des travailleurs.
Ainsi, les acteurs de la prvention disposent dsormais dune base tangible pour la dfinition
de stratgies daction dans chaque entreprise.
La prsente circulaire vise fournir lensemble des services des lments de droit et de
mthode utiles pour promouvoir cet outil et en faciliter la comprhension par les acteurs
externes. []
Ce dispositif cre, en effet, un instrument juridique contraignant, dont la mise en uvre
demeure nanmoins souple puisque les modalits techniques de lvaluation des risques ne
sont pas prcises par le dcret. []
Elle sappuie sur les enseignements tirs des expriences en entreprise impulses par les
services dconcentrs du ministre depuis 1995, afin de permettre linspection du travail de
remplir ses missions dinformation, de sensibilisation et de contrle. Lobligation de transcrire
dans un document les rsultats de lvaluation des risques nest pas quune obligation
matrielle. Elle reprsente la premire tape de la dmarche gnrale de prvention qui
incombe lemployeur. Mais cette formalisation doit aussi contribuer au dialogue social au
sein de lentreprise, sur lvaluation elle-mme, et, au-del, sur la conception et la ralisation
des mesures de prvention, qui devront, en tant que de besoin, faire suite lvaluation des
risques.
4.8.6 Aide la rdaction du document unique relatif lvaluation des
risques professionnels
Quel est le champ dapplication du document unique ?
Le document unique concerne exclusivement les donnes relatives la sant et la
scurit au travail. Par consquent, il ne couvre pas le champ de la scurit des
procds ou produits, ni celui de la sant environnementale.
Bien entendu, lemployeur a pu requrir pralablement des informations et conseils
laidant procder lvaluation des risques (services de mdecine du travail,
ingnieurs et techniciens de prvention) et la participation des institutions reprsentatives
du personnel et des salaris concerns.
Mais, dans tous les cas, cest lemployeur quil appartient den valider les rsultats.
Cest pourquoi, il lui est recommand de signer et dater le document unique.
Qui est charg dlaborer le document unique ?
En matire de sant et de scurit au travail, cest lemployeur qui est responsable dans
lentreprise. Cest donc lemployeur qui conserve la responsabilit pleine et entire de la
dmarche dvaluation et qui est seul comptant pour en retranscrire les rsultats dans
le document unique.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Quest-ce quune unit de travail ?
Le chef dentreprise doit considrer quil est libre dapprhender lunit de travail comme il
le souhaite et lenvisager le plus largement possible en fonction des mthodes dvaluation
des risques, de ses contraintes, de la taille de lentreprise, de son activit, etc. En effet, il ne
sagit pas dune notion juridiquement dfinie. Elle relve dune apprciation factuelle et
objective laisse la seule apprciation du chef dentreprise selon lorganisation du travail
dans son entreprise.
Cette notion figure dj dans une circulaire du ministre de lEmploi et de la Solidarit en
date du 24 juin 1998 relative la rduction du temps de travail qui nonce que la partie
de ltablissement laquelle sapplique la rduction du temps de travail doit constituer
objectivement une unit de travail technique ou conomique cohrente (exemple : une
direction, un service, une entreprise entire) . Il pourra donc sagir dune quipe de
travail, dun atelier, dun service, dun dpartement, dun tablissement ou de la totalit
de lentreprise
Comment rdiger le document unique ?
Sur la forme, la circulaire du 18 avril 2002 ne donne pas dindications prcises. Au 4.8.8
nous vous proposons un exemple de document contenant quelques rubriques. Ce document
pourra tre adapt et personnalis en fonction des caractristiques de chaque entreprise.
Dans son premier alina, larticle R. 230-1 du Code du travail dfinit les modalits de la
transcription des rsultats de lvaluation des risques, tant sur son contenu que sur sa forme. Si
la rglementation ne prcise ni le dtail, ni le contenu, ni la forme du document unique, une
valuation des risques professionnels est un pralable indispensable la qualit attendue de
ce document.
Le contenu du document unique
En application des dispositions lgislatives du Code du travail (a) du III de larticle L. 230-2),
lemployeur doit : valuer les risques pour la scurit et la sant des travailleurs, y compris
dans le choix des procds de fabrication, des quipements de travail, des substances ou
prparations chimiques, dans lamnagement ou le ramnagement des lieux de travail ou des
installations et dans la dfinition des postes de travail .
En pratique, lvaluation des risques requiert une concertation entre le chef dentreprise,
lencadrement intermdiaire, les salaris dont lexprience sur la question sera juge utile, les
reprsentants du personnel (dlgus du personnel, CHSCT). Le mdecin du travail sera
galement associ cette analyse en tant que conseiller du chef dentreprise et des salaris.
Rappelons que dans le cadre de sa mission, le mdecin du travail a lobligation de rdiger
une fiche dentreprise synthtisant lanalyse des risques et le nombre de salaris concerns.
Le premier alina de larticle R. 230-1 indique que cette opration consiste pour lemployeur
transcrire les rsultats de lvaluation des risques sur un document unique qui comporte un
inventaire des risques dans chaque unit de travail de lentreprise ou de ltablissement. Deux
prcisions doivent tre apportes cela.
Premirement, la notion dinventaire conduit dfinir lvaluation des risques, en
deux tapes :
1. Identifier les dangers. Le danger est la proprit ou la capacit intrinsque dun
quipement, dune substance, dune mthode de travail, de causer un dommage pour la
sant des travailleurs ;
2. Analyser les risques. Cest le rsultat de ltude des conditions dexposition des
travailleurs ces dangers.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Il convient de prciser que la combinaison de facteurs lis lorganisation du travail dans
lentreprise est susceptible de porter atteinte la sant et la scurit des travailleurs, bien
quils ne puissent tre ncessairement identifis comme tant des dangers. A titre dexemple,
lassociation du rythme et de la dure du travail peut constituer un risque psychosocial,
comme le stress. Ainsi, lvaluation des risques se dfinit comme le fait dapprhender les
risques crs pour la sant et la scurit des travailleurs, dans tous les aspects lis au travail.
Par consquent, elle ne se rduit pas un relev brut de donnes, mais constitue un
vritable travail danalyse des modalits dexposition des salaris des dangers ou
des facteurs des risques.
Deuximement, la notion dunit de travail doit tre comprise au sens large,
afin de recouvrir les situations trs diverses dorganisation du travail. Son champ peut
stendre dun poste de travail, plusieurs types de postes occups par les travailleurs
ou des situations de travail prsentant les mmes caractristiques.
De mme, dun point de vue gographique, lunit de travail ne se limite pas forcment
une activit fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux diffrents (manutention,
chantiers, transports, etc.).
Le travail dvaluation men par lemployeur est facilit, en ce que les regroupements
oprs permettent de circonscrire son valuation des risques professionnels. Nanmoins,
ces regroupements ne doivent pas occulter les particularits de certaines expositions
individuelles.
Ainsi, les documents tablis par le mdecin du travail (la fiche dentreprise) ; par le
CHSCT (lanalyse des risques), par les fabricants de produits (les fiches de donnes de
scurit), par exemple, ne constituent pas en tant que tels lvaluation des risques. Ce
sont nanmoins des sources dinformations utiles lanalyse des risques ralise par
lemployeur.
La forme du document unique
Le document pourra tre crit ou numrique, le soin de choisir le moyen le plus pratique de
matrialiser les rsultats de lvaluation est laiss lemployeur.
Pour tout support comportant des informations nominatives, lemployeur devra, conformment
la loi du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, procder une
dclaration auprs de la Commission nationale de linformatique et des liberts (CNIL).
Les rsultats de lvaluation des risques devront tre transcrits sur un document unique,
cela dans le souci de rpondre trois exigences :
de cohrence, en regroupant, sur un seul support, les donnes issues de lanalyse des
risques professionnels auxquels sont exposs les travailleurs ;
de commodit, afin de runir sur un mme document les rsultats des diffrentes
analyses des risques ralises sous la responsabilit de lemployeur, facilitant ainsi le
suivi de la dmarche de prvention des risques en entreprise ;
de traabilit, avec la notion de transcription signifiant quun report systmatique
des rsultats de lvaluation des risques doit tre effectu afin que lensemble des
lments analyss figure sur un support.
Dans tous les cas, lexistence de ce support traduit un souci de transparence et de
fiabilit, de nature garantir lauthenticit de lvaluation.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.8.7 Quelle est ltendue de cette obligation ?
La mise jour du document unique
Conformment la ncessit dinscrire lvaluation des risques dans une dmarche
dynamique et donc, volutive, le dcret du 5 novembre 2001 prvoit (art. R. 230-1, second
alina) trois modalits dactualisation du document unique, prenant en compte les ventuelles
modifications de la situation du travail dans lentreprise :
pour toutes les entreprises, au moins une fois par an ;
lors toute dcision damnagement important modifiant les conditions dhygine et de
scurit ou les conditions de travail, au sens du septime alina de larticle L. 236-2.
Ce dernier prvoit la consultation pralable du CHSCT lorsquune telle dcision est
prise, dsignant notamment toute transformation importante des postes de travail
dcoulant de la modification de loutillage, dun changement de produit ou de
lorganisation du travail (et) toute modification des cadences et des normes de
productivit lies ou non la rmunration du travail ;
lorsquune information supplmentaire concernant lvaluation dun risque dans une
unit de travail est recueillie . Cette disposition, permet de tenir compte de
lapparition de risques dont lexistence peut, notamment, tre tablie par les
connaissances scientifiques et techniques (troubles musculosquelettiques, risques
biologiques, etc.), par la survenue daccidents du travail, de maladies caractre
professionnel ou par lvolution des rgles relatives la sant, la scurit et aux
conditions de travail (risques psychosociaux).
La diffusion et accessibilit du document unique
Aux quatrime et cinquime alinas de larticle R. 230-1, le dcret indique que le
document doit tre tenu la disposition dune srie dacteurs quil convient de classer
en deux catgories.
a) En interne, le document unique relatif lvaluation des risques est mis la
disposition (article R. 230-1, quatrime alina) :
en premier lieu, des instances reprsentatives du personnel (CHSCT, ou instances qui
en tiennent lieu, tels que les instances reprsentatives du personnel des tablissements
publics et dlgus du personnel).
Le document unique constitue une des sources dinformation permettant ces
instances dexercer leurs prrogatives (procder lanalyse des risques professionnels,
article L. 236-2, et, droit dobtenir de lemployeur les informations ncessaires pour
lexercice de leurs missions, article L. 236-3, alina 1) ;
dans les tablissements dpourvus dinstances reprsentatives du personnel, de rendre le
document unique accessible pour les personnes soumises un risque pour leur scurit ou
leur sant . En venant pallier labsence de reprsentants du personnel, cette disposition
participe tant dune dmarche dinformation des travailleurs que dune volont dassocier
ces derniers lapprciation des rsultats de lvaluation des risques. Cela signifie que
lemployeur doit veiller ce que ces personnes puissent accder directement aux rsultats de
lvaluation des risques, aprs les avoir, le cas chant, informes des moyens de le faire.
Ainsi, lemployeur pourra aussi bien assurer la consultation de ce document par voie
numrique que sous la forme dun support papier.
du mdecin du travail, puisquil participe la dmarche de prvention, dans lexercice
de ses missions et en qualit de conseiller des salaris et de lemployeur.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Dans les tablissements comportant un CHSCT, la transcription des rsultats de
lvaluation des risques est utilise pour ltablissement du rapport crit faisant le bilan
de la situation gnrale de lhygine, de la scurit et des conditions de travail et du
programme annuel de prvention et damlioration des conditions de travail.
b) Les acteurs externes lentreprise dsigns par le dcret (article R. 230-1,
cinquime alina) sont linspection du travail, les agents des services de prvention des
organismes de scurit sociale et les organismes mentionns au 4 de larticle L. 231-2. Ces
agents peuvent accder au document unique, ds lors quils en ont fait la demande auprs de
lemployeur.
Les agents de linspection du travail exercent leur droit de consultation, comme il est prvu
dans les articles L. 611-9 et L. 611-12 du Code du travail.
En effet, il est prvu que ces agents peuvent se faire prsenter, au cours de leurs visites,
lensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail.
Cela correspond la mission de linspection du travail en matire dvaluation des
risques et notamment la sensibilisation en amont des acteurs internes lentreprise.
La mission de sensibilisation peut suivre plusieurs modalits. Elle peut consister rappeler
lemployeur les obligations quil doit respecter, conformment au dcret.
Cette dmarche vise prsenter lintrt de lvaluation des risques, par rapport la
dmarche gnrale de prvention. Il sagit de situer les enjeux dune approche en amont des
risques dont lefficacit dpend des actions de prvention que lemployeur mettra en uvre,
suite son valuation des risques.
Les sanctions pnales
Outre la responsabilit pnale de lemployeur prvue par le Code du travail et le Code
pnal (dlits non-intentionnels), aggrave en cas de conscience du danger, le dcret du
5 novembre 2001 prvoit des sanctions spcifiques.
Ces sanctions sont applicables depuis le 8 novembre 2002.
Celles-ci concernent le dfaut de transcription ou de mise jour des rsultats de
lvaluation des risques professionnels dans les conditions prvues larticle R. 230-1
du Code du travail nouvellement cr, qui prvoit une peine damende de 1 500 et
3 000 en cas de rcidive.
Afin de renforcer leffectivit des obligations de lemployeur, le dcret prvoit un
dispositif, inscrit larticle R. 263-1-1 du Code du travail, qui prvoit des peines de
contravention de cinquime classe, conformment aux articles 131-12 et suivants du
Code pnal. Les peines peuvent tre prononces lencontre de lemployeur, selon
deux motifs possibles.
Il sagit, en premier lieu, de la violation par lemployeur de son obligation de transcrire
et de mettre jour les rsultats de son valuation des risques. Cela concerne, par
consquent, (article R. 230-1, premier alina) le non-respect par lemployeur des
obligations lies la forme du document (existence dun document unique) et au fond
(transcription des rsultats de lvaluation par un inventaire des risques dans chaque
unit de travail de ltablissement).
En second lieu, sagissant de la mise jour des rsultats de lvaluation des risques,
lemployeur devra aussi veiller au respect des modalits dactualisation du document
unique, mentionnes larticle R. 230-1, second alina.
Par ailleurs, le juge judiciaire a la possibilit de doubler la peine de contravention en cas de
rcidive intervenue dans le dlai dun an, compter de lexpiration ou de la prescription de la
prcdente peine, ce, conformment larticle 131-13 du Code pnal.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Dans chaque situation concrte, il convient de trouver un juste quilibre entre lobligation qui
pse dsormais sur lentreprise et les dlais indispensables qui lui seront ncessaires pour que
lvaluation des risques, ainsi matrialise, sinscrive dans une relle dynamique de prvention.
En effet, il serait contradictoire avec lesprit de cette importante rforme que les entreprises ne
voient dans ce dispositif quune obligation purement formelle quelles pourraient satisfaire en
remplissant des grilles, voire des formulaires pr-tablis, sans que cela soit men dans le cadre
dune dmarche effective de prvention propre lentreprise.
Le dcret ne mentionne pas la violation de lobligation de mise jour du document et
disposition des instances reprsentatives du personnel et de linspection du travail. Ces
infractions sont dj prvues par le Code du travail.
Une telle violation prsente, en ce qui concerne les reprsentants du personnel, un
caractre dlictuel prvu par larticle L. 263-2-2 du Code du travail, qui porte sur le
dlit dentrave, en ce qui concerne les CHSCT (article L. 482-1 pour les dlgus du
personnel). Un tel manquement porte en effet atteinte au fonctionnement rgulier des
instances reprsentatives du personnel.
Sagissant de linspection du travail, larticle L. 611-9 fonde les conditions de linfraction
par lemployeur lencontre de son obligation de tenir le document dvaluation des
risques sa disposition.
Larticle R. 631-1 indique, cet gard, que toute infraction cette obligation sera
passible de lamende prvue pour les contraventions de 3
e
classe. Dans le cas o
llment intentionnel est retenu, cette infraction constitue un dlit dobstacle
laccomplissement des devoirs dun inspecteur ou dun contrleur du travail.
4.8.8 Modle de document unique dvaluation
des risques professionnels
Le modle prsent dans ce chapitre est destin aux entreprises non-industrielles ne
prsentant pas de risque spcifique dans leur activit. Le document synthtique est suivi de 5
fiches explicatives du contenu des 5 colonnes.
Comme indiqu plus haut, lunit de travail peut tre lentreprise (si elle est petite et si les
fonctions sont homognes), un tablissement, une direction, un dpartement, un atelier ou
encore un service, voire un poste de travail.
Identification des dangers dans lunit de travail (1)
Dans cette colonne, lemployeur liste les dangers qui peuvent concerner les salaris
dans lunit de travail considre, par exemple :
Dangers physiques : bruit, rayonnements ionisants et non ionisants, vibrations, lectricit ;
Dangers chimiques : substances et prparations dangereuses, agents cancrognes,
mutagnes, toxiques pour la reproduction, amiante, autres produits, missions et
dchets dangereux ;
Dangers biologiques : bactries, virus, parasites, champignons microscopiques ;
Facteurs ergonomiques et organisationnels : manutention mcanique, manuelle, tat des
sols, travail en hauteur, chute dobjets, dangers lis aux circulations et aux dplacements ;
Dangers dincendie, dexplosions ;
Autres dangers.
Le danger est la proprit ou la capacit intrinsque dun quipement, dune substance, dune
mthode de travail, de causer un dommage pour la sant ou la scurit des travailleurs .
Attention, lexistence dun danger nest pas ncessairement associe un risque.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
En outre, un mme danger peut entraner des risques, plus ou moins graves selon la situation.
Par exemple, une substance peut tre dangereuse lorsquelle est manipule en systme
ouvert et ne prsenter aucun risque lorsquelle est utilise en vase clos.
Rsultats de lvaluation des risques professionnels dans lunit de
travail (2)
Il sagit didentifier et dindiquer les situations de travail au cours desquelles les risques peuvent
survenir selon les critres qui auront t retenus par le chef dentreprise pour lunit de travail
(quipe, service, atelier, poste, fonction, tche).
Le risque, probabilit quun danger se concrtise, rsulte de la combinaison du danger
(proprit intrinsque de lagent ou de la situation) par nature non modifiable, et de
lexposition du travailleur ce danger qui, elle, est matrisable.
Lvaluation des risques professionnels passe par une phase dvaluation qualitative
initiale comprenant linventaire des dangers (comme prvu dans la colonne n 1) suivie
dune apprciation qualitative de lexposition des salaris ces dangers. Pour procder
cette dmarche, il est conseill de formuler dans cette partie du document, des
indications sur la frquence, la dure et la nature de lexposition au risque.
Selon les rsultats de lvaluation initiale des risques professionnels, une phase dvaluation
approfondie des risques professionnels peut tre ncessaire dans certaines situations :
mesurage du bruit, des concentrations atmosphriques (substances dangereuses, poussires,
fibres) de lefficacit des systmes de ventilation et de captage des polluants
Matrise des risques/mesures de prvention et de protection (3).
La rglementation ne prvoit pas que le document unique prcise le choix des moyens et
des mesures de prvention. Toutefois, la circulaire n 6 DRT du 18 avril 2002 indique
que la raison dtre du document unique est de susciter des actions de prvention.
Cest pourquoi, il est conseill den faire tat en privilgiant les informations qui concernant les
mesures gnrales de prvention et de protection de la sant et de la scurit des salaris.
Exemples :
Suppression de la situation dangereuse, du phnomne dangereux (substitution du
produit).
Prvention, information et formation des salaris la sant et la scurit.
Protection collective des travailleurs.
quipements de protection individuelle (EPI).
Surveillance mdicale spciale
Date de mise jour du document unique (4)
Le dcret du 5 novembre 2001 prvoit trois modalits dactualisation du document
unique (voir 4.8.4)
La circulaire du 18 avril 2002 prcise que les actions de prvention peuvent conduire
des changements techniques et organisationnels dans les situations de travail
susceptibles de gnrer de nouveaux risques. Il convient en consquence deffectuer une
nouvelle valuation des risques lissue de la mise en uvre de ces actions, selon les
modalits fixes par le dcret.
Les sanctions pnales prvues par le dcret du 5 novembre 2001 concernent non seulement
le dfaut de rdaction du document unique mais galement la carence de sa mise jour.
Partie 1 - Salaris et risques daccident
Observations (5)
Cette colonne du tableau est rserve aux informations complmentaires que lemployeur
souhaite fournir, et qui nont pas t signales dans les colonnes prcdentes. peut tre
labor avec un calendrier de mise en uvre des mesures correctives.
Professionnels dans lunit de travail
Identification
des dangers
(1)
Rsultats
de lvaluation
des risques
professionnels
(2)
Matrise
des risques
professionnels/
mesure
de prvention
et de protection
(3)
Date de mise
jour
du document
(4)
Observations
(5)
Signature de lemployeur : Date :
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.8.9 La fiche dvaluation des risques professionnels dans les PMI
Selon ce modle, chaque fiche dvaluation des risques devra comporter par poste de travail,
puis au niveau dun groupe de postes relativement homogne ou dun atelier :
la liste des facteurs de risques valus en fonction des dangers identifis ;
les actions de prvention envisages sur chaque poste, ou groupe de postes de travail
de telle sorte quils soient plus srs pour la sant et la scurit des salaris.
A partir des fiches tablies pour chaque poste de travail, un programme dactions de
prvention pourra tre tabli.
4.8.10 Modle de fiche pour un poste de travail
Il est conseill de remplir une fiche par poste de travail, comme le modle prsent ci-
dessous.
POSTE DE TRAVAIL : (ou Groupes de postes de travail) : RDACTEUR DE LA FICHE :
ATELIER :
PERSONNES ASSOCIES A LVALUATION
DES RISQUES
-
-
Date :
IDENTIFICATION DES DANGERS VALUATION
DES RISQUES
MESURES
DJ PRISES
DISPOSITIONS
A PRENDRE
PRIORITS
A B
clairage
Bruit
Ambiance thermique
Aration, ventilation
(poussire...)
lectricit
Rayonnements ionisants et non ionisants
Agents cancrognes, mutagnes,
toxiques pour la reproduction
Substances et prparations dangereuses
Machines, engins mobiles, engins de
levage, vibrations, rseaux sous pression
Manutention manuelle
Circulation
crans de visualisation
Ergo
Amnagement des locaux de travail
Co-activit interne (ex : service
maintenance) et avec entreprises
extrieures
Infla
Autres/Lesquels ? (dangers spcifiques
votre entreprise)
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.8.11 Modle de plan dactions
Ce document est facultatif.
ATELIER : RDACTEUR DE LA FICHE
PERSONNES ASSOCIES A
LVALUATION DES RISQUES
DATE
Identification des risques inhrents aux postes de travail situs dans latelier (priorits) :
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Les mesures de prvention prvues pour
chacun des risques de 1 5
Dates dexcution
prvues
Cot approximatif
Mesures techniques
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mesures organisationnelles
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mesures concernant le personnel
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.9 Check-list des points-clefs pour lvaluation
et la prvention des risques
4.9.1 clairage
Rf. : art.R. 232-7 R.232-7-10 du Code du Travail
art. R. 235-2 R.235-2-3 du Code du Travail
art. R.233-23 du Code du Travail
viter la fatigue visuelle
priorit lclairage naturel, valeurs minimales dclairement de rfrence
dispositions contre lblouissement et pour le rendu des couleurs
accs facile des organes de commande
4.9.2 Prvention des risques dus au bruit
Rf. : art. R. 232-8-7 du Code du Travail
art. R. 235-2-11 du Code du Travail
rduire les niveaux de bruit compte-tenu des techniques
contrle priodique (3 ans) de lexposition au bruit des salaris concerns
prvention technique collective et protection individuelle
surveillance mdicale des salaris exposs au niveau sonore important
information et formation des salaris exposs un niveau sonore important
mesures de prvention en matire damnagement des locaux
4.9.3 Ambiance thermique
Rf. : art.L. 232-6 et L. 232-6-1 du Code du Travail
art. R. 235-2-9 et R. 235-2-10 du Code du Travail
temprature convenable en relation avec les conditions de travail et la destination des
locaux
adaptation des tempratures des locaux pendant le temps de travail
quipements de protection individuelle adapts
4.9.4 Substances dangereuses
Rf. : art. L.231-6 et L. 231-7 du Code du Travail
art. R. 231-51 R. 231-556-10 du Code du Travail
information obligatoire des utilisateurs par les fiches de donnes de scurit et ltiquetage
des substances et prparations dangereuses
protection collective efficace des emplacements de travail
surveillance et maintenance des protections collectives
quipements de protection individuelle adapts, mis la disposition des salaris concerns
4.9.5 Risques cancrognes
valuation (nature, degr, dure de lexposition des salaris) renouvele rgulirement et
rsultats mis la disposition du CHSCT ou DP mdecin du travail, inspection du travail et
CRAM.
utilisation, si cest techniquement possible, dune substance ou prparation non-dangereuse
ou moins dangereuse
niveau le plus bas possible
Partie 1 - Salaris et risques daccident
mesures prendre en cas dutilisation dun agent cancrogne
informations appropries la disposition de linspection du travail et de la CRAM
mesures spcifiques en cas dincident ou daccident entranant une exposition anormale
mesures spcifiques pour les oprations dentretien en liaison avec CHSCT ou DP et le
mdecin du travail renouveles priodiquement
examen mdical pralable des travailleurs exposs par le mdecin du travail
dossier mdical individuel
4.9.6 Aration - Ventilation
Rf. : art. r. 232-5 R. 232-5-14 du Code du Travail
art. R. 235-2-4 R. 235-2-10 du Code du Travail
art. R. 232-6 et R. 232-6-1 du Code du Travail
garantir une puret de lair
viter les lvations exagres de temprature, les odeurs dsagrables et les condensations
introduction dair neuf en quantit et qualit
limination des polluants
installations de ventilateurs captant les polluants au plus prs des points dmission
sassurer que linstallation de ventilation nest pas gnante (bruits, courants dair)
vrifier priodiquement les installations et en contrler lefficacit
4.9.7 Machines, engins mobiles, engins de levage
obligations gnrales de scurit, maintien en tat de conformit avec rgles techniques
applicables lors de la mise an service : art. L. 233-5-1 et R. 233-1 R. 233-1-3 du Code
du travail
mesures dorganisation et conditions de mise en uvre des quipements de travail : art. r.
233-2 R. 233-13 du Code du travail
prescriptions techniques applicables aux matriels et mise en conformit raliser selon
chancier dfini : art. R. 233-14 R. 233-31 du Code du Travail
vrifications priodiques de certains quipements (presses, appareils de levage) : art. R.
233-11 complt par art. R. 233-13-1 et suivants du Code du Travail
4.9.8 Manutention manuelle
Rf. : art. R. 231-66 R. 231-72 du Code du Travail
art. R. 234-6 du Code du Travail
viter les manutentions manuelles ou mise en place de mesures dorganisations appropries
respect des limites de ports de charges, rle du mdecin du travail
information et formation sur les gestes de posture en vue de la scurit des salaris
4.9.9 Circulation
Rf. : art. r. 232-1-9 et art. R. 232-1-2 et R. 232-1-3 du Code du Travail
art. R. 233-13-16 R. 233-13-18 du Code du Travail
assurer la scurit de la circulation des pitons et des vhicules
assurer la scurit des salaris situs proximit des voies de circulation
sassurer de la bonne implantation et du bon dimensionnement des voies de circulation
respect des rgles relatives aux portes, portails, escaliers
sassurer du bon tat des sols (non glissants) : art. R. 232-1-10 du Code du Travail
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.9.10 crans de visualisation
Rf. : dcret n 91-451 du 14 mai 1991 (J.O. du 16 mai 1991)
analyse pralable et organisation du travail sur les crans
amnagement ergonomique du poste de travail, rle du mdecin du travail
information et formation des salaris sur les conditions dutilisation du travail sur cran
4.9.11 Ergonomie du poste de travail
Rf. : art. R. 232-4 du Code du Travail
annexe lart. R. 233-84 (issue du dcret 92-767 du 29 juillet 1992 - J.O. du
7/8/1992
adapter le travail lhomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que des choix des quipements de travail et des mthodes de travail et de
production
limiter le travail monotone et le travail cadenc
respecter les normes de dimensionnement
4.9.12 Amnagement des locaux de travail
Rf. : art. R. 232-1 R. 232-1-13 du Code du Travail
art. R. 235-2-9 R. 235-2-10 du Code du Travail
art. R. 235-3 R. 235-3-21 et R. 235-5 du Code du Travail
Pour tout amnagement ou construction dun local de travail, les aspects suivants sont
analyss :
la conception des btiments abritant les lieux de travail
les objectifs et les activits concerns
lenvironnement du site et son emplacement
le processus de fabricant
les modes et moyens de stockage
les moyens de manutention, de transport et de levage
llimination des dchets
la signalisation relative la scurit et la sant des salaris
les circulations extrieures aux btiments
le personnel concern et lentretien des locaux
4.9.13 Incendie - explosion
Rf. : art. R. 232-12 R. 232-12-22 du Code du Travail
art. R. 235-4 R. 235-4-17 du Code du Travail
respect des dgagements rglementaires pour une vacuation rapide
systme dalarme sonore
moyens de 1
ers
secours et affichage des consignes dincendie
essais et visites priodiques du matriel
signalisation de prvention
clairage de scurit
Partie 1 - Salaris et risques daccident
4.9.14 lectricit
Rf. : dcret du 14 novembre 1988 et ses arrts dapplication
protection contre les contacts directs et indirects
identifier les risques dincendie et dexplosion lis au courant lectrique et moyens de
prvention
identifier les oprations autorises suivant le niveau dhabilitation
consignes 1
ers
soins aux victimes daccidents lectriques
4.9.15 Risques lis au recours des entreprises extrieures
Rf. : art. R. 237-1 R. 237-28 du Code du Travail
Lintervention ponctuelle et permanente dune entreprise extrieure (nettoyage, gardiennage,
maintenance, transport, manutention,) prsente des risques lis linterfrence des
activits, des matriels ou des installations.
Lentreprise utilisatrice et lentreprise extrieure doivent conjointement arrter un plan de
prvention dterminant les mesures qui doivent tre prises par chaque entreprise.
4.9.16 Opration de maintenance
mise disposition des salaris de maintenance dun dossier dinstructions et technique des
quipements de travail
linstallation des quipements de travail doit assurer un niveau de scurit optimal des
oprateurs
modes opratoires prservant la scurit des travailleurs de maintenance.
PARTIE 2
PRVENIR LES RISQUES DINCENDIE
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
1 LES RGLEMENTATIONS APPLICABLES EN MATIRE
DE SCURIT INCENDIE
1.1 Les rglementations gnrales
1.2 Les rglementations particulires
1.2.1 Les habitations
1.2.2 Les lieux de travail
1.2.3 Les installations classes pour la protection de lenvironnement (ICPE)
1.2.4 Les immeubles de grande hauteur (IGH)
1.2.5 Les tablissements recevant du public (ERP)
2 AMNAGER LES LOCAUX DANS LE RESPECT DES RGLES
LMENTAIRES DE SCURIT
2.1 L'implantation des btiments
2.3 Le compartimentage et le cloisonnement
2.2 Le comportement au feu des matriaux de construction
2.2.1 La raction au feu des matriaux de construction
2.2.2 La rsistance au feu des lments de construction
2.4 L'vacuation
2.4.1 Les dgagements et issues
2.4.2 La signalisation
2.4.3 L'clairage de scurit
3 CHOISIR LES MOYENS DE PROTECTION
3.1 Comment faire les bons choix ?
3.1.1 Les moyens de premier secours
3.1.2 Les moyens complmentaires aux moyens de premier secours
3.2 Choisir les agents extincteurs
3.2.1 Les diffrentes classes de feux
3.2.2 L'eau : un agent extincteur
3.2.3 Les mousses
3.2.4 Les poudres
3.2.5 Le dioxyde de carbone
3.2.6 Les autres gaz
3.2.7 Quels agents extincteurs pour quels feux ?
3.3 Choisir le matriel de lutte contre l'incendie
3.3.1 Les extincteurs portatifs
3.3.2 Les extincteurs sur roues
3.3.3 Les robinets d'incendie arms (RIA)
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
3.4 Les installations d'extinction automatique
3.4.1 Les installations d'extinction automatique eau type sprinkleurs
3.4.2 Les installations d'extinction automatique CO2
3.4.3 Les installations d'extinction automatique gaz inertes et inhibiteurs
4 ORGANISER LES SECOURS
4.1 Lalarme
4.2 Lalerte
4.3 Les principes de l'vacuation
4.4 Lorganisation interne des secours
4.4.1 Le cadre rglementaire et technique
4.4.2 Les rgles techniques des assurances
4.4.3 Labonnement prvention et conseil incendie (APCI)
4.5 Le service de scurit incendie
4.5.1 Les missions du service de scurit incendie
4.5.2 L'quipe de scurit incendie dans les tablissements industriels ou commerciaux
4.5.3 L'quipe de scurit incendie dans ERP : obligations
4.5.4 L'quipe de scurit incendie dans les IGH : obligations
4.5.5 Modle de liste d'inspections raliser par le service de scurit incendie
5 RDIGER LES CONSIGNES DE SCURIT
5.1 Les consignes gnrales et particulires relatives la scurit
incendie
5.2 Les normes applicables
5.3 Les autres consignes de scurit
6 ORGANISER DES EXERCICES DE SCURIT INCENDIE POUR LES
SALARIS
6.1 Informer et sensibiliser
6.2 Former et entraner
6.3 Les exercices et procdures d'vacuation
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
7 CONTRLER SES INSTALLATIONS
7.1 Contrles du respect des mesures de prvention
7.2 La surveillance
7.3 Maintenance et prvention incendie
8 LE REGISTRE DE SCURIT
8.1 Les registres dans les btiments usage dhabitation
8.2 Les registres dans les tablissements assujettis au code du Travail
8.2.1 Le registre relatif aux vrifications et contrles
8.2.2 Registre spcial
8.2.3 Registre pour les Questions dhygine, de scurit, de mdecine du travail et de
prvention des risques
8.2.4 Le dossier de maintenance
8.3 Registre spcifique aux ERP
8.4 Registre spcifique aux immeubles de grande hauteur
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
1 LES RGLEMENTATIONS APPLICABLES
EN MATIRE DE SCURIT INCENDIE
1.1 Les rglementations gnrales
Les textes lgislatifs (lois) et rglementaires (dcrets et arrts) relatifs la protection contre
lincendie comportent deux aspects principaux :
la prvention, traduite surtout par des mesures relatives la construction ;
la prvision, qui groupe des mesures relatives lorganisation et aux premiers moyens
dintervention.
Plusieurs ministres dfinissent les exigences rglementaires selon la destination des btiments :
ministre de lquipement et du logement pour les btiments dhabitation ;
ministre du Travail pour les lieux de travail ;
ministre de lcologie et du dveloppement durable pour les installations classes et dune
manire gnrale tout ce qui concerne la protection de lenvironnement ;
ministre de lIntrieur pour les tablissements recevant du public (ERP) et les immeubles de
grande hauteur (IGH) ;
ministre de lAgriculture pour les activits agricoles.
Le Code de la construction et de lhabitation (CCH) regroupe les dfinitions, les principes
essentiels et les exigences gnrales en matire de construction des btiments dhabitation, des
tablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. En application du
code, plusieurs arrts spcifiques donnent les rgles prcises de construction et dexploitation
selon le mode doccupation.
Tous ces textes sont complmentaires et sappliquent selon la destination des lieux :
habitation, accueil du public, lieux de travail.
Lorsque des lieux de travail sont situs dans un immeuble de grande hauteur, seul le
rglement IGH sapplique. Lorsque des lieux de travail sont situs dans des btiments
dhabitation ou dans des tablissements recevant du public (cas des magasins par exemple),
les dispositions les plus contraignantes sappliquent.
Illustration
Une salle de runion dans un immeuble de bureaux, qui reoit, mme occasionnellement,
des personnes nappartenant pas ltablissement, doit tre considre comme un
tablissement recevant du public.
Un restaurant inter-entreprises est un ERP, ce qui nest pas le cas dun restaurant dentreprise,
auquel nont accs que les employs de ltablissement.
Certaines situations exceptionnelles (arbre de Nol, opration portes ouvertes, etc.) doivent
faire lobjet de mesures adaptes chaque cas, le cas chant avec laccord du maire.
1.2 Les rglementations particulires
1.2.1 Les habitations
Le Code de la construction et de lhabitation dfinit les btiments dhabitation comme
des btiments ou parties de btiments abritant un ou plusieurs logements, y compris les
foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes ges,
lexclusion des locaux destins la vie professionnelle lorsque celle-ci ne sexerce pas au
moins partiellement dans le mme ensemble de pices que la vie familiale et des locaux
auxquels sappliquent les articles R 123-1 R 123-55, R 152-4 et R 152-5 .
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les logements destins au personnel compris dans les tablissements recevant du public
ne sont pas considrs, sur le plan de la protection contre lincendie, comme habitation.
Le rglement de scurit incendie des ERP leur est donc applicable bien quun statut
spcial leur soit attribu.
Classification des habitations
Les habitations sont classes en quatre familles principales.
Les critres principaux de classement sont :
la hauteur des immeubles, laquelle correspond en fait celle des chelles dont
disposent les sapeurs pompiers : 8 m, 30 m, 45 m ;
et laccessibilit des engins de secours.
CLASSIFICATION DES HABITATIONS (art. 3 de larrt du 31 janvier 1986)
Familles
Types dhabitations
1
re
2
e
3A 3B 4
e
Habitations individuelles
- isoles ou jumeles
R + 1 au plus X
R + 1 et plus X
- en bande
R X
R + 1 avec structures indpendantes X
R + 1 sans structures indpendantes X
R + 1 et plus X
Habitations collectives
R + 3 au plus X
R + 7 au plus X
R + 7 et plus X
R + 7 et plus si 28m < H 50m X
Les immeubles dhabitation dont le niveau du plancher bas de ltage le plus haut est
suprieur 50 m sont soumis la rglementation particulire aux immeubles de grande
hauteur (IGH). Y sont soumis galement les immeubles de la 4
e
famille qui contiennent
des locaux usage autre que dhabitation, lexception de quatre cas, dans des
conditions dtailles larticle 3 du rglement IGH.
Sil existe, dans les btiments dhabitation collectifs, des locaux collectifs rsidentiels de
plus de 50 m
2
, ces derniers sont soumis la rglementation propre aux tablissements
recevant du public.
1.2.2 Les lieux de travail
Dans le livre II du code du Travail, le titre III est consacr lhygine, la scurit et aux
conditions de travail. La scurit incendie est lobjet des chapitres 2 et 5 lintrieur du titre III.
Tout tablissement o travaille une personne sous la dpendance hirarchique dune
autre, quil y ait ou non salaire, quil sagisse dun tablissement public ou priv, et
quelle que soit lactivit qui y est exerce est assujetti ces dispositions relatives
l'hygine et la scurit.
Larticle R. 232-1 dfinit comme lieux de travail, les lieux destins recevoir des postes de
travail, situs ou non dans des btiments de ltablissement, ainsi que tout endroit compris
dans laire de ltablissement auquel le travailleur a accs dans le cadre de son travail.
Le seul objet des principes de prvention et de scurit sur les lieux de travail est la
scurit du personnel.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
La responsabilit du chef dtablissement
Le premier de ces principes est la responsabilit du chef dtablissement. Celui-ci doit,
cest une obligation de rsultat, assurer par tout moyen la scurit de son personnel, y
compris intrimaire.
La consquence de ce principe est que lors dun incendie ayant entran une ou
plusieurs victimes, le chef dtablissement sera poursuivi en premier lieu.
La dlgation de pouvoir, donc de responsabilit, dans ce domaine est reconnue dans
certains cas, mais le dlgataire doit avoir, les moyens, lautorit, la comptence
ncessaires pour assumer cette responsabilit. Si ces conditions au minimum sont
remplies, le charg de scurit peut alors tre rellement responsable de
scurit .
Il faut noter aussi que chaque travailleur est tenu de prendre soin, en fonction de sa formation,
de son niveau hirarchique et de ses moyens, de sa propre scurit et de celle des personnes
concernes par son activit.
Cependant, cela ne remet pas en cause le principe de la responsabilit du chef
dtablissement.
Le chef dtablissement doit (article L 230-2-II) :
viter les risques ;
valuer les risques qui ne peuvent pas tre vits ;
combattre les risques la source ;
adapter le travail l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des quipements de travail et des mthodes de
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadenc et de rduire les effets de ceux-ci sur la sant ;
tenir compte de l'tat d'volution de la technique ;
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
planifier la prvention en y intgrant, dans un ensemble cohrent, la technique,
l'organisation du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorit sur les mesures
de protection individuelle ;
donner les instructions appropries aux travailleurs.
Chaque travailleur doit avoir reu une formation pratique la scurit au moment de
son embauche, sil change de poste de travail ou de technique, mme sil a un contrat
de travail temporaire. Cette obligation vise la formation la scurit du travail dans son
ensemble, mais englobe une formation minimum la scurit incendie, en fonction de
lactivit et des risques de lentreprise.
1.2.3 Les installations classes pour la protection
de lenvironnement (ICPE)
La lgislation relative aux installations classes pour la protection de lenvironnement est
codifie au titre 1
er
(articles L.511-1 L.517-2) du livre V du Code de lenvironnement qui
traite de la Prvention des pollutions, des risques et des nuisances . De nombreux textes
rglementaires en dcoulent, notamment :
le dcret n 77-1133 du 21 septembre 1977, modifi plusieurs fois, qui prcise en
particulier les procdures suivre ;
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
des arrts qui fixent les prescriptions applicables certaines installations soumises
autorisation ou dclaration ;
des arrts de prescriptions gnrales (remplaant progressivement les arrts-
types ) qui sappliquent aux installations soumises dclaration, en fonction du
classement dtermin daprs la nomenclature ;
de nombreuses circulaires et instructions ministrielles qui donnent aux prfets les
prescriptions quils doivent imposer dans leurs arrts dautorisation pour certaines
installations particulires.
Les prescriptions relatives la protection autre qu'incendie sont spcifies en fonction du
risque inhrent l'activit exerce. Trois principes se dgagent de la lgislation et de ses
textes dapplication :
la prvention des risques lenvironnement ;
la protection de lenvironnement, par le jeu de solutions techniques ;
le principe pollueur-payeur.
Le domaine dapplication de la lgislation des installations classes, dfini larticle
L.511-1 du Code de lenvironnement, est trs large :
dune part, la notion denvironnement recouvre les lments relatifs la commodit
du voisinage, la sant, la scurit et la salubrit publiques, lagriculture, la protection
de la nature et de lenvironnement, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que le patrimoine archologique ;
dautre part, sont vises toutes les exploitations gres ou dtenues par des
personnes physiques ou morales, publiques ou prives.
Contrairement la loi de 1917, abroge et remplace par la loi de 1976 dsormais
codifie, qui visait les tablissements caractre industriel, toute installation, ds lors
quelle figure la nomenclature, peut tre classable, mme si elle na pas de caractre
commercial.
Depuis la loi n 93-3 du 4 janvier 1993, la lgislation des installations classes est
galement applicable aux exploitations de carrires.
Un tablissement peut comporter plusieurs installations classables.
La notion dinstallation est lie la fixit : un dpt en rservoir de liquides inflammables
est classable, alors quun camion-citerne de mme capacit contenant les mmes
liquides inflammables, stationn momentanment sur un site, ne lest pas. Cette notion a
aliment une vaste jurisprudence.
Chaque installation fait lobjet de prescriptions particulires. Mais, si plusieurs installations
classes doivent tre exploites par le mme exploitant sur le mme site, une seule demande
peut tre prsente pour lensemble (article 12 du dcret n 77-1133 du 21 septembre 1977
modifi).
Cette globalisation permet en effet de mieux apprcier si les diffrentes installations constituent
une source de nuisances aggrave par synergie ( effet domino ). Sur le fondement de cet
article, larrt du 10 mai 2000 (transposant la directive Seveso II ) a introduit la notion
dtablissement, dfinie comme un groupement dinstallations relevant dun mme exploitant,
situes sur un mme site, y compris leurs quipements et activits connexes.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
1.2.4 Les immeubles de grande hauteur (IGH)
Un immeuble de grande hauteur (IGH) constitue, selon le code de la construction
et de lhabitation, tout corps de btiment dont le plancher bas du dernier niveau
est situ, par rapport au niveau du sol le plus utilisable pour les engins des services
publics de secours et de lutte contre lincendie :
plus de 50 m pour les immeubles usage dhabitation ;
plus de 28 m pour tous les autres immeubles .
En fonction des situations conditions les btiments contigus un immeuble de grande
hauteur et les parcs de stationnement situs sous celui-ci sont ou ne sont pas considrs
comme faisant partie de lIGH et sont soumis ou non aux mmes rgles de scurit.
Les dispositions destines assurer la scurit des occupants des immeubles de
grande hauteur sont contenues dans le Code de la construction et de lhabitation
qui fixe entre autres :
lemplacement par rapport aux centres de secours les plus proches ;
les conditions dutilisation (pas dinstallations classes, pas de liquides
inflammables, nombre moyen doccupants au mtre carr) ;
les principes de scurit (division en compartiments tanches au feu et aux
fumes, etc.) ;
les responsabilits des constructeurs et installateurs dquipements ;
les obligations relatives loccupation des locaux ;
les mesures de contrle.
Ces dispositions sont compltes par le rglement de scurit pour la construction
des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et
de panique pris par l'arrt du 18 octobre 1977 modifi.
La classification des IGH
Les IGH sont classs en :
GHA : immeubles usage dhabitation ;
GHO : immeubles usage dhtel ;
GHR : immeubles usage denseignement ;
GHS : immeubles usage de dpt darchives ;
GHU : immeubles usage sanitaire ;
GHW: immeubles usage de bureaux ;
GHZ : immeubles usage mixte.
1.2.5 Les tablissements recevant du public (ERP)
Constituent des tablissements recevant du public tous btiments, locaux et
enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant
une rtribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des
runions ouvertes tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considres comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
ltablissement quelque titre que ce soit en plus du personnel. (CCH)
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les dispositions destines assurer la scurit des occupants des tablissements
recevant du public sont contenues dans le Code de la construction et de lhabitation
(articles R 123-1 123-55 et R 152-4 et 5) et concernent :
la dfinition et l'application des rgles de scurit ;
le classement des tablissements ;
l'autorisation de construire, d'amnager ou de modifier un tablissement ;
les mesures d'excution et de contrle ;
les sanctions administratives ;
les dispositions diverses.
Ces dispositions sont prcises dans le rglement de scurit pris par l'arrt du 25
juin 1980 modifi en application de l'article R 123-12 du CCH.
Le rglement de scurit contre l'incendie relatif aux ERP comprend :
des dispositions applicables tous les tablissements (livre 1
er
) ;
des dispositions gnrales applicables aux tablissements de 1
re
4
e
catgorie
(livre II, titre 1
er
) ;
des dispositions particulires applicables aux tablissements de 1
re
4
e
catgorie
(livre II, titre 2) ;
des dispositions applicables aux tablissements de 5
e
catgorie (livre III).
Les types et catgories d'ERP
Les ERP sont classs par types et par catgories.
Types
Le type correspond au mode doccupation. Chaque type est dsign par une, deux ou
trois lettres.
J Structures d'accueil pour personnes ges et personnes handicapes
L Salles usage daudition, de confrences, de runions, de spectacles
ou usages multiples
M Magasins de vente, centres commerciaux
N Restaurants et dbits de boissons
O Htels et pensions de famille
P Salles de danse et salles de jeux
R tablissements denseignement, colonies de vacances
S Bibliothques, centres de documentation et de consultation darchives
T Salles dexposition
U tablissements de soins
V tablissements de culte
W Administrations, banques, bureaux
X tablissements sportifs couverts
Y Muses
Les tablissements suivants sont dits tablissements spciaux .
PA tablissements de plein air
CTS Chapiteaux et tentes
GA Gares
SG Structures gonflables
OA Htels-restaurants daltitude
REF Refuges de montagne
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Il existe aussi le type PS (parcs de stationnement), mais les dispositions correspondantes
nont pas t publies.
Les tablissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur
les eaux intrieures recevant du public font lobjet dun rglement part (dcret 90-43 et
arrt du 9 janvier 1990) et constituent le type EF.
Les catgories
Selon leur capacit, les ERP sont soumis des exigences diffrentes. Ils sont rpartis en
cinq catgories.
1
re
catgorie au-dessus de 1500 personnes
2
e
catgorie de 701 1500 personnes
3
e
catgorie de 301 700 personnes
4
e
catgorie 300 personnes et au-dessous, lexception des tablissements
compris dans la 5
e
catgorie
5
e
catgorie tablissements faisant lobjet de larticle R 123-14 du CCH
dans lesquels leffectif du public natteint pas le chiffre
minimum fix par le rglement de scurit pour chaque type
dexploitation
La catgorie sobtient en additionnant leffectif du public et du personnel, leffectif du
public tant calcul suivant des rgles diffrentes selon le type de ltablissement.
Pour la dtermination de la 5
e
catgorie, en revanche, il nest pas tenu compte de
leffectif du personnel.
Les tablissements comportant des locaux rservs au sommeil font lobjet de rgles
complmentaires (structures, dgagements, dtection automatique dincendie, signalisations
et affichages, registre de scurit et consignes).
En raison du grand nombre dincendies meurtriers qui se sont produits dans de petits htels
amnags dans danciens immeubles dhabitation par le pass, les htels de 5
e
catgorie
doivent respecter des rgles plus strictes que celles des autres tablissements.
Cela concerne les escaliers, le systme dalarme, le dsenfumage, lutilisation du gaz dans les
chambres, la dtection automatique dincendie, la formation du personnel la scurit
incendie.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
2 AMNAGER LES LOCAUX DANS LE RESPECT
DES RGLES LMENTAIRES DE SCURIT
2.1 L'implantation des btiments
Lloignement des btiments les uns par rapport aux autres est un moyen de prvention
efficace, mme si cette mesure peut tre incompatible avec les contraintes conomiques :
cot du terrain, notamment en zone urbaine ;
cot dexploitation augmentant avec les distances qui spareront des activits
complmentaires telles que les manutentions ;
dure de transport ;
dplacements ;
transport et distribution des fluides, etc.
Dans la mesure o la sparation de certaines activits savre possible, une premire approche
peut tre faite qui consisterait, lors des tudes dimplantation sur le terrain, concevoir des
btiments distincts suivant les activits, en maintenant entre chaque construction, un espace
libre.
Le choix de l'implantation des btiments, tant du point de vue du lgislateur que de celui de
lassureur, constitue un lment majeur de prvention. Dans certains cas, l'implantation du
btiment conduira des exigences supplmentaires sur le choix des matriaux et lments de
construction en fonction de leur comportement au feu.
Sparer les risques
La mesure la plus simple pour viter quun incendie se propage est de lisoler dans lespace.
Lidal est de sparer les risques. A cette fin, les facteurs prendre en considration sont
essentiellement dordre mtorologique (sens et la force des vents dominants, frquence des
impacts de foudre), et environnemental (voisinage de forts, broussailles, dpts de dtritus,
autres constructions, lignes ariennes haute tension, le relief).
Si des stockages de produits inflammables ou de matriaux combustibles sont prvus sur des
zones lair libre, ils doivent tre placs en aval des btiments par rapport au vent dominant.
En cas de sinistre, le feu se cantonne alors lextrieur et les gaz et fumes gnrs par
lincendie schappent de prfrence vers des zones libres.
Contre la propagation de feux liquides, il est toujours prfrable de prvoir le plus tt possible
lemplacement des cuvettes de rtention.
Afin de protger les btiments des incendies susceptibles de provenir de lextrieur et dviter la
propagation aux immeubles voisins de sinistres venant de lintrieur, la rglementation prvoit
des mesures disolement pour chaque type de construction : btiments d'habitation ; locaux de
travail ; installations classes pour la protection de l'environnement ; tablissements recevant du
public ; immeubles de grande hauteur.
Avant toute tude technique ou dcision, on examinera les prescriptions rglementaires lies
la nature et lactivit du btiment. Elles peuvent avoir une incidence sur le choix du terrain
et limplantation des btiments (mesures disolement, accs pompiers, nombre dissues de
secours...).
Dautres facteurs, comme les ressources en eau, les vents dominants... sont prendre en
considration afin dviter la propagation du feu et de permettre la mise en place des
moyens de sauvetage et dintervention.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
2.2 Le comportement au feu des matriaux de construction
La rglementation relative la protection des btiments contre lincendie tablit, pour chaque
type de construction, des prescriptions concernant la qualit des matriaux et lments au
regard de lincendie. Le degr de contrainte dpend du danger reprsent par le type de
construction et lactivit exerce (habitations, tablissements recevant du public, immeubles de
grande hauteur, locaux de travail, parcs de stationnement couverts, installations classes) et du
rle que llment de construction considr est appel tenir.
La rglementation vise dfinir le comportement au feu des matriaux et lments de
construction.
Par matriau, on entend toute matire ou produit qui permet de prparer des lments de
construction ou qui entre directement dans la construction : pierre, brique, bois, fer, bton,
matires synthtiques, tissu, papier, etc.
Par lment de construction, on entend tous les composants de caractristiques
physiques gnrales comparables dans une mme famille (lments porteurs, plafonds,
cloisons, fermetures, conduits, clapets, ventilateurs, etc.) issus de sries semblables ou
similaires et dont lassemblage participe ldification dun immeuble.
Le CECMI (Comit dtude et de classification des matriaux et lments de construction par
rapport au danger dincendie), cr par le ministre de l'Intrieur, a pour objet de proposer
une rglementation des mthodes et des appareils dessais, une classification des
diffrents matriaux en usage dans la construction en fonction de leur comportement en
prsence dun incendie, et lagrment des laboratoires dessais . Ce comit comprend des
reprsentants des ministres, sapeurs-pompiers, et des laboratoires agrs.
Le comportement au feu en cas dincendie est apprci daprs deux critres :
la raction au feu, cest--dire laliment qui peut tre apport au feu et au
dveloppement de lincendie ;
la rsistance au feu, cest--dire le temps pendant lequel les lments de construction
peuvent jouer le rle qui leur est dvolu malgr laction dun incendie (art. R.121-2 du
CCH).
Le critre de raction au feu sapplique aux matriaux et celui de rsistance au feu, aux
lments de construction.
Pour certains lments la rglementation impose une double condition :
dune part un classement dfini au regard de la raction au feu du matriau qui le
constitue ;
dautre part un certain degr de rsistance au feu, suivant le rle que llment est
appel jouer.
En effet, il ne suffit pas ddifier une cloison en matriau rput incombustible par nature,
encore faut-il que cette cloison ne se brise pas sous leffet du choc thermique. Pour cela, il
faut quelle ait une certaine paisseur et quelle soit ventuellement revtue dun enduit de
protection, lui-mme dune certaine paisseur, en fonction du critre et de la dure requis.
Pour certains immeubles dhabitation, tablissements recevant du public, immeubles de
grande hauteur et certains lieux de travail, la lgislation impose des mesures relatives au
comportement au feu des structures, des couvertures, des faades, des cloisonnements,
des escaliers, des conduits et gaines, ainsi que des amnagements intrieurs.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
2.2.1 La raction au feu des matriaux de construction
La raction au feu correspond l'aptitude d'un produit s'enflammer et donc alimenter
l'incendie et contribuer sa propagation.
Les Euroclasses forment un systme harmonis d'essais et de classement dans les tats
membres. Elles vont remplacer progressivement les diffrents classements nationaux, en
France, le classement M.
En France, les dtails et les dates d'application des Euroclasses seront fixs pour chaque
famille de produits par la parution des normes et arrts correspondants. Conditions et
dlais d'application du marquage CE seront fixs par arrts pour chaque famille.
Larrt du 30 juin 1983 modifi permettait de classer en fonction des rsultats des essais, les
matriaux en classes M1, M2, M3, M4 ou non classs et en catgorie M0 suivant des
dispositions particulires. Il a t abrog par larrt du 21 novembre 2002 relatif la
raction au feu des produits de construction et d'amnagement qui fixe les mthodes d'essais
et les catgories de classification en ce qui concerne la raction au feu de ces produits.
Le fonctionnement du classement M
Le classement M prend en compte deux caractristiques essentielles dune part, la quantit
de chaleur dgage au cours de la combustion et, dautre part la prsence ou labsence
de gaz inflammables . Lopacit et la toxicit des produits de combustion ne sont pas prises
en compte.
Le schma suivant rsume les classements franais M obtenus lissue des essais de
raction au feu.
Schma des classements M de raction au feu
Les produits de construction sont distincts de ceux d'amnagement, il s'agit :
des produits pour les murs ou plafonds, y compris les produits de finition ;
les lments de construction ;
les produits intgrs aux lments de construction ;
les produits des faades et murs extrieurs, y compris les couches d'isolation ;
les sols et les revtements de sols.
Les produits d'amnagement ne sont pas fabriqus pour tre incorpors durablement dans les
ouvrages de construction. Leur classement conserve les catgories M franaises. Les fabricants
peuvent cependant choisir de faire valuer leurs produits selon le systme des Euroclasses.
Les produits classs d'office : certains produits et matriaux, dont le comportement au feu
est bien connu et stable, ne sont pas soumis aux essais et le classement leur appliquer
est fix de faon conventionnelle.
Essais de combustibilit
et dinflammabilit
Conditions requises
pour M1
Mesure PCS
PCS
2,5 MJ/kg
PCS
> 2,5 MJ/kg
M0 M1
M2 M3 M4 Non class
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
L'usage des Euroclasses avant l'chance
Aucune correspondance n'existe entre le classement M et les Euroclasses. Cependant,
l'arrt de novembre 2002 comporte deux tableaux qui fixent les classes dtermines
selon le classement europen admissibles au regard du classement M utilis dans les
rglements de scurit contre l'incendie jusqu' la modification de ces derniers. Ces
tableaux permettent galement la mise en uvre de produits rpondant aux Euroclasses
avant que celles-ci ne soient rendues obligatoires (voir page suivante).
Euroclasses admissibles dans le classement M :
Produits de construction autres que les sols
Classes selon NF EN 13501-1
Combustibilit
Production
de fumes
Production de
gouttes enflammes
Correspondance
Exigence de la
rglementation franaise
A1 - - Incombustible
A2 s1 d0 M0
A2 s1 d1
(1)
A2
s2
s3
d0
d1
(1)
B
s1
s2
s3
d0
d1
(1)
M1
C
(3)
s1
(2) (3)
s2
(3)
s3
(3)
d0
d1
(1)
M2
D
s1
(2)
s2
s3
d0
d1
(1)
M3
(non gouttant)
Toutes classes
(2)
autres que E-d2 et F M4
(1)
Le niveau de performance d1 est accept seulement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l'essai.
(2)
Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prvues par l'arrt du 4/11/1975 modifi portant rglementation
de l'utilisation de certains matriaux et produits dans les ERP et l'instruction du 1
er
dcembre s'y rapportant.
(3)
Admissible pour M1 si non-substantiel au sens de la dfinition de l'annexe 1.
Euroclasses admissibles dans le classement M : Sols
Classes selon NF EN 13501-1
Combustibilit Production de fumes
Correspondance
Exigence de la
rglementation franaise
A1 fl
-
Incombustible
A2 fl
s1
M0
A2 fl
S2
B fl
C fl
s1
s2
M3
D fl
s1
(1)
s2
M4
(1)
Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prvues par l'arrt du 4/11/1975 modifi portant rglementation
de l'utilisation de certains matriaux et produits dans les ERP et l'instruction du 1
er
dcembre s'y rapportant.
Le fonctionnement des Euroclasses
Les performances de raction au feu prises en compte par les Euroclasses sont la
combustibilit, la production de fumes et la production de gouttes enflammes.
La classification de base, correspondant la combustibilit, est divise en sept classes de
A F (voir tableaux ci-dessus). Une distinction est faite entre les produits de construction
en gnral et les sols nots "FL" (flour) :
A1, A2, B, C, D, E, F ;
A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL, FFL .
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
A cela s'ajoutent les classifications lies :
au dgagement de fumes, not de s1 s3 (s = smoke) ;
la production de gouttes enflammes d0 et d2 (d = drop).
Les classes sont ranges dans le sens croissant selon le scnario de sollicitation.
Ainsi A correspond une moindre combustibilit que F, s1 correspond une plus faible
production de fume que s3.
Les classes A1 et A1fl sont attribues sans essais et correspondent aux produits trs peu
combustibles, tels que : argile, perlite, laine minrale, verre cellulaire, bton, cramique,
chaux, verre
Les essais
Les essais peuvent tre raliss soit par des laboratoires franais agrs par le
ministre de lIntrieur, soit par des laboratoires dtats membres de la
Communaut europenne ou de pays de l'Association conomique de libre-
change, parties contractantes de l'accord relatif l'Espace conomique europen,
prsentant l'indpendance et la comptence des laboratoires d'essais fixes par les
normes de la srie EN 45 000 ou NF EN ISO/CEI 17025, ou des garanties
quivalentes, et reconnus comptents par le ministre de l'intrieur, de la scurit
intrieure et des liberts locales,
Pour aboutir au classement dcrit un produit doit tre soumis trois niveaux de
sollicitation thermique, qui se ralisent grce 5 types d'essais. On n'effectue un
essai d'un niveau donn que lorsqu'un produit a russi l'essai du niveau infrieur.
L'amlioration du classement par l'ignifugation
On peut, dans certains cas, amliorer la raction au feu dun matriau combustible
par lignifugation. Celle-ci peut tre partielle (en surface) ou totale (dans la masse),
plus ou moins durable suivant le procd utilis et les conditions de service.
Lignifugation permet de diminuer ou de retarder linflammabilit du matriau trait
et peut diminuer la vitesse de propagation de la flamme. Mais, en aucun cas, elle
ne peut diminuer le pouvoir calorifique propre au matriau.
Les traitements dignifugation concernent essentiellement : les tissus (textiles
naturels ou synthtiques), le bois et ses drivs (panneaux de particules,
contreplaqus), les matires plastiques, les charpentes mtalliques.
2.2.2 La rsistance au feu des lments de construction
La rsistance au feu des lments de construction est dfinie comme le temps pendant
lequel les lments de construction peuvent jouer le rle qui leur est dvolu malgr
laction dun incendie (CCH).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Lvaluation de la rsistance au feu des produits, lments de construction et douvrages est ralise,
soit au moyen dessais, soit partir de calculs, soit par dautres modes de justification. Elle est dfinie
par larrt interministriel du 22 mars 2004 et ses cinq annexes.
Cet arrt fixe les mthodes et les conditions dvaluation des performances de rsistance au feu des
produits, lments de construction et douvrages, auxquelles se rfrent les rglements de scurit
contre lincendie.
Ainsi, larrt du 22 mars 2004 annule et remplace larrt du 3 aot 1999. Il met en application les
mthodes dessais et de classement europennes et abroge les mthodes franaises.
Les lments de construction concerns par larrt du 22 mars 2004 sont :
les lments porteurs sans fonction de compartimentage (murs planchers,
toitures, poutres, balcons, escaliers, passerelles ;
les lments porteurs avec fonction de compartimentage (murs, planchers et
toitures) ;
les produits et systmes destins protger des lments ou des parties des
ouvrages (plafonds nayant pas de rsistance propre au feu, enduits, panneaux,
protection projetes, revtements et crans de protection contre le feu) ;
les lments non porteurs ou parties douvrages (cloisons, y compris comportant
des parties isoles, plafonds possdant une rsistance au feu intrinsque, faades et
murs extrieurs y compris lments vitrs, planchers surlevs, calfeutrements de
pntration et joints dtanchit linaire, portes et fermetures rsistant au feu et leurs
dispositifs de fermeture, portes tanches aux fumes, fermetures des passages mnags
pour les systmes de convoyage, sauf les systmes de transport sur rail, conduites et
gaines pour installations techniques, chemines) ;
les produits destins tre utiliss dans les systmes de ventilation, sauf les
systmes dextraction de chaleur et de fumes (conduits de ventilation, clapets) ;
les produits destins tre utiliss dans les systmes de contrle des fumes et
de la chaleur (conduits dextraction des fumes pour compartiment unique, conduits
dextraction des fumes rsistants aux feu multicompartiments).
2.2.2.1 Les critres dvaluation
Les performances de rsistance au feu values au moyen dactions thermiques
prdtermines sont exprimes en degrs ou classes. Ces degrs, ou classes, sont
directement lis aux dures pendant lesquelles les produits, lments de construction et
d'ouvrages satisfont aux critres de performance retenus, en fonction du rle qui leur est
dvolu du point de vue de la scurit.
(article 4 de larrt de 2004).
La classification des caractristiques essentielles
La classification est tablie en fonction de trois caractristiques essentielles
symbolises par une lettre :
R : capacit portante. Capacit supporter lexposition au feu sans perte de
stabilit (R correspond donc lancien degr stabilit au feu SF).
E : tanchit au feu. tanchit au feu sur le ct expos sans transmission de
flammes et de gaz chauds pouvant senflammer sur la face non expose (E
correspond donc lancien degr pare-flamme PF).
I : isolation thermique. Isolation thermique imposant des tempratures maximales
sur le ct non expos (I correspond donc lancien degr coupe-feu CF.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Dautres critres compltent cette classification
W : rayonnement. Llment test ne laisse pas passer ou nmet pas de rayonnement
suprieur 15 kW/m
2
;
M : rsistance limpact mcanique ;
C : capacit de fermeture automatique ;
S : tanchit aux fumes ;
G : rsistance la combustion de la suie (chemines).
Des classifications spcifiques propres des lments particuliers sont
galement prvues
K : capacit de protection contre lincendie (revtements, parements de murs et
plafonds) ;
D : dure de stabilit temprature constante ;
DH : dure de stabilit sous la courbe standard temprature/temps (crans de
cantonnement) ;
F : fonctionnalit des ventilateurs extracteurs de fumes et de chaleur ;
B : fonctionnalit des exutoires de fume et de chaleur naturels.
Les classifications sont exprimes, sauf indications contraires, en minutes et non plus en
heure ou fraction dheure comme ctait le cas dans lancienne rglementation.
2.2.2.2 Le systme europen de classification
Larrt du 22 mars 2004 modifie le classement de la rsistance au feu des produits, lments de
construction et douvrages. Celui-ci tait auparavant assur par larrt du 3 aot 1999.
Les rglements de scurit continuent de se rfrer ce texte. Avec le nouvel arrt, les termes
coupe-feu pare-flamme et stabilit au feu nont pas disparu des rglements de scurit.
Cependant, ces rglements doivent se conformer aux nouvelles prescriptions. Cest ainsi que
lannexe 5 de larrt du 22 mars 2004 a t conu.
Cette annexe permet de convertir les anciens degrs de rsistance au feu en nouveaux degrs
europens de rsistance au feu nous reproduisons lannexe 5 page suivante.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
2.3 Le compartimentage et le cloisonnement
Le compartimentage est lensemble des mesures constructives prendre pour lutter
contre la propagation de lincendie en crant des obstacles cette propagation. En
empchant ou en ralentissant lincendie, ces obstacles, verticaux ou horizontaux,
permettent :
dassurer ou au moins de faciliter lvacuation rapide des personnes vers lextrieur ou
vers les lieux de recueil par des zones ou passages protgs ;
de limiter le plus possible le volume des zones prsentant des risques particuliers pour
les personnes ou pour les biens ;
de faciliter lintervention des secours extrieurs en leur permettant daccder au sige
du sinistre ;
de limiter lampleur des dgts sur les biens.
Cet objectif sapplique dun btiment lautre et lintrieur dun mme btiment.
Dans la mesure du possible, le compartimentage, comme la plupart des mesures de protection
contre lincendie, doit tre conu ds lavant-projet de construction, afin quil concide avec des
dcoupages logiques de lactivit et des services et que les quipements et les amnagements
sy intgrent judicieusement.
Le compartimentage sapplique :
un local, dont toutes les parois et issues doivent satisfaire des critres dfinis de rsistance
au feu ;
un ensemble de locaux dont les frontires seules doivent satisfaire ces critres,
lensemble formant un compartiment dans lequel les exigences de rsistance au feu des
parois verticales ne seront pas imposes. La surface dun compartiment est limite, par la
rglementation, selon le type doccupation ;
aux circulations ou dgagements , qui devront prsenter des parois et des issues ayant un
certain niveau de rsistance au feu (dgagements encloisonns), et tre limits par des
recoupements au moyen de portes rsistant au feu ;
aux cages descaliers et dascenseurs, dont les parois et les blocs-portes rsistants au feu
contribueront les encloisonner ;
aux combles vides, qui devront tre recoups par des lments rsistant au feu ;
aux gaines et conduits traversant les parois, les planchers et plafonds, afin que leur passage
naltre pas lefficacit de la protection, laide de calfeutrements, volets et clapets restituant
le degr de rsistance au feu des lments traverss ;
aux parois sparant deux btiments contigus ou deux parties de btiments.
Le compartimentage a ses points faibles. Ce sont toutes les ouvertures qui y sont pratiques
et les solutions de continuit : portes, baies, passages de gaines techniques, faux-plafonds,
jonctions entre murs et lments de toiture, partie basse des cloisons...
Ces lments peuvent loigner le compartimentage du modle idal qui vise limiter le feu
dans la zone o il a pris naissance.
La rglementation associe toujours les mesures relatives aux parois, plafonds, planchers des
mesures complmentaires concernant les ouvertures.
Les mesures de cloisonnement ou de compartimentage imposes par le lgislateur diffrent
suivant limportance du btiment, le type doccupation, la nature de lactivit La notion
mme de compartimentage est diffrente suivant quil sagit dun IGH ou dun ERP.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les exigences rglementaires relatives compartimentage sont trs nombreuses et concernent :
les btiments d'habitation ;
les lieux de travail ;
les tablissements recevant du public ;
les immeubles de grande hauteur ;
les parcs de stationnement couverts ;
les installations classes pour la protection de l'environnement, avec par exemple
certaines prescriptions svres pour :
- les entrepts couverts stockant des matires combustibles,
- les installations o sont manipuls des liquides inflammables.
2.4 L'vacuation
2.4.1 Les dgagements et issues
La vocation des dgagements et des issues est de permettre la communication
interne entre les diffrentes parties dun btiment et la communication avec
lextrieur, en situation normale comme en cas de danger immdiat.
Les mesures constructives imposes par la rglementation incendie privilgient la
continuit de la vie dans un btiment plutt que son vacuation.
Quand l'vacuation savre ncessaire, elle se pose en terme de temps et despace.
Le facteur temps tant difficilement contrlable (prise de dcision de lvacuation,
dlai de mise en mouvement et de canalisation dune foule), cest essentiellement
en terme despace que se situent les prescriptions rglementaires : nombre et
largeur des dgagements et des issues, distances parcourir.
Par dgagement , on entend, quelle que soit la nature du btiment, toute partie
de la construction permettant le cheminement dvacuation des occupants :
circulation horizontale, zone de circulation, escalier, ascenseur, couloir, rampe,
porte, sortie, issue
Les dgagements sont dits protgs lorsque les personnes sy trouvent labri
des flammes et de la fume, soit parce que les parois offrent un degr minimum de
rsistance au feu (dgagements encloisonns), soit parce quils sont exposs lair
libre.
2.4.1 La signalisation
Le balisage des dgagements vise permettre au public ou aux salaris dun
tablissement de trouver ou de reprer rapidement la sortie, en situation normale
comme en cas durgence.
En tous lieux, les indications balisant les cheminements doivent tre :
assures par des lettres ou signaux blancs sur fond vert, au moyen
de panneaux opaques ou transparents lumineux, lisibles de jour et de nuit ;
places de manire tre visibles et suffisamment diffrencies des autres
indications.
Les panneaux indiquant une sortie peuvent tre complts par la mention Sortie
ou Sortie de secours . Cette mention est obligatoire lorsquelle signale des issues
utilisables uniquement en cas de sinistre.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Dans les ERP et les IGH, les panneaux doivent tre conformes aux normes
franaises en vigueur , notamment la norme NF X 08-003 Couleurs et signaux de
scurit .
Dans tous les locaux de travail, la signalisation doit tre conforme aux prescriptions
de larrt du 4 novembre 1993 relatif la signalisation de scurit et de sant
au travail .
La norme NF X 08-003 est rpute satisfaire aux prescriptions de larrt.
2.4.2 L'clairage de scurit
Le principal objectif de lclairage de scurit est de permettre dassurer lvacuation des
personnes en cas dinterruption accidentelle de lclairage normal (R.232-12-7, EC 2,
GH 47). Cet clairage peut tre assur par les foyers lumineux des panneaux de
balisage. Il doit tre conforme la rglementation sy rapportant.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
3 CHOISIR LES MOYENS DE PROTECTION
3.1 Comment faire les bons choix ?
Les moyens de protection contre lincendie sont trs diversifis. En gnral, on distingue les
moyens de premier secours, souvent lis une intervention humaine et les moyens
automatiques. Les uns et les autres pouvant parfois tre exigs par la rglementation laquelle
est assujetti ltablissement.
Le choix dun moyen ou dun ensemble de moyens dpend de facteurs divers :
nature de lactivit exerce (commerciale, industrielle, tertiaire, etc.) ;
risques encourus (prsence de public, prsence de machines ou dinstallations vulnrables,
stockage ou manipulation de matires dangereuses, etc.) ;
prsence de personnel permanent (jour, nuit, week-ends, jours fris) ;
obligations rglementaires ;
loignement du centre de secours ;
moyens financiers de lentreprise ;
exigences de la socit dassurances.
3.1.1 Les moyens de premier secours
Sont considrs comme des moyens de premier secours adapts toutes les catgories
dactivits, les extincteurs mobiles, les robinets dincendie arms, le service de scurit incendie.
Ces moyens peuvent sassocier dautres moyens.
3.1.2 Les moyens complmentaires aux moyens de premier secours
3.1.2.1 Linstallation de dtection automatique dincendie
Une installation de dtection automatique dincendie est un dispositif destin dceler et
signaler, dans un minimum de temps, lclosion dun incendie. En pratique, un systme de
surveillance donne la possibilit de desservir un nombre lev de points de surveillance, de
signaler les incidents susceptibles de conduire des dfaillances dans la dtection et la
signalisation dun dbut dincendie et labsence de fonctionnement intempestif.
Les phnomnes dtectables sont dans lordre :
lmission de gaz de combustion ;
lmission de fumes ;
le rayonnement de la flamme ;
le dgagement de la chaleur.
Il existe plusieurs types de dtecteurs :
le dtecteur ionique de gaz de combustion ;
le dtecteur optique de fume ;
le dtecteur optique linaire de fume ;
le dtecteur optique de flammes ;
le dtecteur thermique.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
3.1.2.2 Linstallation dextinction automatique
Les installations dextinction automatique eau de type sprinkleurs, systmes trs
complets de protection contre lincendie se dclenchent automatiquement ds la
naissance du feu, donnent lalarme et arrosent le foyer, ce qui a pour effet dteindre
lincendie ou de le contenir jusqu larrive des secours.
Les autres installations dextinction automatique gaz, mousse ou poudre sont
destines la protection de locaux ou de risques particuliers sur lesquels leau nest pas
recommande.
Le choix des moyens de protection rsulte dune analyse des risques et dune bonne
connaissance des produits (agents extincteurs), des matriels et techniques de protection,
des dispositions rglementaires et des rgles prives. Les bonnes dcisions sont prises en
concertation avec lassureur et le professionnel de la scurit.
Les professionnels installateurs de matriels et de systmes de protection contre lincendie
peuvent tre titulaires dune certification APSAD. Il sagit dune certification volontaire
dentreprise ou de service spcifique la scurit. Les titulaires de la certification ont fait valider
leur comptence pour concevoir et installer des moyens de protection adapts aux risques de
leurs clients.
Par ailleurs, elles sont rfrences par la plupart des socits dassurances pour la ralisation
des installations conformes leurs rgles : les rfrentiels APSAD.
3.1.2.3 Linstallation de dsenfumage
Le dsenfumage a pour objet, en dbut dincendie, dextraire des locaux une partie des
fumes et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les voies dvacuation du
public. Ce dsenfumage permet de limiter la propagation de lincendie et de faciliter
lintervention des secours.
Les principes du dsenfumage
Les fumes doivent tre vacues le plus tt possible et le plus prs possible de la source
afin de diminuer les volumes extraire et les risques de propagation.
Deux grands types de contrle des fumes satisfont aux objectifs viss :
le premier consiste assurer un balayage de l'espace protger par de l'air frais et
extraire les fumes, afin que, dans la zone d'occupation, la dilution des gaz soit telle
qu'elle rduise au minimum leurs effets nocifs ;
le second consiste tablir une hirarchie des pressions entre le local sinistr et les
locaux adjacents, de faon raliser un quilibre s'opposant la propagation des
fumes.
Les mthodes de dsenfumage
L'analyse des besoins dpend du btiment, de son quipement et de sa destination. Dans
le mme type de btiment, des mesures constructives, des quipements complmentaires
ou des prescriptions concernant la combustibilit et le pouvoir fumigne des matriaux
vont entraner une vitesse d'enfumage et un temps d'vacuation diffrents.
Suivant la configuration des locaux traiter, les techniques de balayage seront
diffrentes en fonction de la nature des entres d'air et de celle des vacuations
(naturelles ou mcaniques).
Le dsenfumage naturel est ralis par des amenes d'air et des vacuations de
fumes communiquant avec l'extrieur, directement ou au moyen de conduits disposs
de manire assurer un balayage satisfaisant du local.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Le dsenfumage par tirage mcanique est assur par des extracteurs
mcaniques de fumes et des amenes d'air naturelles ou mcaniques, l'ensemble
tant command par un systme manuel ou automatique. Les ventilateurs doivent tre
conus pour assurer leur fonction avec des fumes 400C pendant 1 ou 2 heures et
bnficier d'une alimentation lectrique autonome. Les canalisations alimentant ces
ventilateurs doivent tre, soit protges, soit ralises en matriaux rsistant au feu.
La rgle APSAD R17 Exutoires de fumes et de chaleur concerne les systmes de
dsenfumage naturel installs dans les toitures des btiments usage commercial ou industriel.
Elle dfinit les exigences relatives la conception et linstallation des exutoires de fumes et
de chaleur, de leurs dispositifs de commande et des cantons de dsenfumage. La rgle prcise
les conditions dans lesquelles l'installation pourra tre prise en considration par l'assureur.
3.2 Choisir les agents extincteurs
3.2.1 Les diffrentes classes de feux
Classes de feux Exemples
Classe A : Feux de solides braisants Bois, cartons
Classe B : Feux de liquides ou de solides liqufiables Hydrocarbures, alcool
Classe C : Feux de gaz Gaz
Classe D : Feux de mtaux Sodium, magnsium
Classe F : Huiles et graisses vgtales et animales Huile de friture
3.2.2 L'eau : un agent extincteur
Les moyens de mise en uvre de leau sont trs varis : extincteurs mobiles, RIA, lances
incendie, installations automatiques (sprinkleurs), etc. Son action de refroidissement la destine
principalement lextinction des feux de classe A, mais en y intgrant des additifs, sa capacit
dextinction stend aux feux de classe B.
Leau reste inefficace, voire dangereuse, sur certains feux. Sur les feux de mtaux, la molcule
deau se brise , librant ainsi de lhydrogne et de loxygne.
Quand leau est projete sur le foyer, elle est porte bullition et se vaporise, c'est ce
moment que labsorption calorifique agit au maximum. On distingue :
l'eau naturelle, utilise en jet plein (jet bton) ou en jet pulvris ;
l'eau avec additif qui est utilise en pulvrisation.
Les caractristiques de base de l'eau
L'eau bnficie d'un pouvoir d'absorption calorifique trs lev, ce qui fait delle un agent
extincteur privilgi des feux de classe A.
Cependant, l'eau craint le gel. On peut y remdier par l'emploi d'antigel, surtout dans les
extincteurs. Elle peut galement provoquer des corrosions, surtout l'interface eau-air.
Mais, il existe des remdes tels que revtements, peintures, aciers inoxydables, produits
spciaux...
Par ailleurs, elle peut causer des dgts des eaux, elle conduit l'lectricit, notamment en
jet plein (attention galement au jet pulvris) et elle gnre des effluents porteurs
d'agents toxiques pouvant engendrer des pollutions.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
L'eau pulvrise avec additif
Afin dtendre lefficacit de leau aux feux de classe B, il est ncessaire dutiliser des additifs
tels que lAFFF (Agent formant un film flottant). Cet additif produit, la surface du liquide en
feu, un film qui isole les vapeurs du combustible de loxygne de lair. Ce film persiste mme
aprs lextinction.
Il faut noter que la prsence d'additif peut accentuer les problmes de corrosion et augmente
aussi la conductibilit lectrique de l'eau.
3.2.3 Les mousses
Les mousses sont formes partir deau, dmulseur et dair. Elles stalent la surface du
liquide en feu et isolent les vapeurs combustibles du comburant.
Elles sont efficaces principalement sur les feux de classe B.
Les mulseurs sont plus ou moins corrosifs, ce qui ncessite un rinage du matriel aprs
usage.
Lutilisateur doit vrifier et respecter les recommandations du constructeur quant aux
incompatibilits, par exemple :
le mlange dmulseurs de familles diffrentes peut les rendre inefficaces ;
lusage simultan deau et de mousse engendre une destruction celle-ci ;
lutilisation de poudres dtruit massivement le tapis de mousse forme.
Le foisonnement
Selon le volume dair apport, on obtient diffrents types de foisonnements.
Bas foisonnement < 20 ; en moyenne 8
Moyen foisonnement 20 MF 200 ; en moyenne 100
Haut foisonnement > 200 ; en moyenne 500
Les trois gammes de foisonnement correspondent en fait trois densits de mousse
obtenues par diffrents gnrateurs.
Un foisonnement de 8 signifie qu'avec 1 litre de solution moussante, on obtient 8 litres
de mousse.
Foisonnement = Volume de mousse
Volume de solution moussante
Les mulseurs
On distingue diffrentes familles dmulseurs en fonction de leurs constituants :
les protiniques, de couleur marron trs fonc, fabriqus partir de protines animales
(ongles, cornes, etc.).
les synthtiques, de couleur claire dont la base moussante est un tensioactif
hydrocarbon.
Les mulseurs pour feux d'hydrocarbures
mulseurs standards :
A base protinique ou synthtique, ils sont efficaces sur les hydrocarbures lourds. En
revanche, leur mousse se laisse contaminer par les hydrocarbures lgers (essence).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
mulseurs fluors :
Pour amliorer la qualit des mulseurs standards, des produits tensioactifs fluors sont
ajouts aux bases moussantes. On obtient ainsi les mulseurs fluoroprotiniques ou
fluorosynthtiques qui rsistent bien la contamination et peuvent tre projets sur les
hydrocarbures lgers.
mulseurs AFFF :
Certains produits tensioactifs perfluors abaissent la tension superficielle des solutions de
telle manire que le liquide de dcantation forme un mince film qui flotte en surface. Ce
film permet de cicatriser la couche de mousse s'opposant ainsi la r-inflammation. Ces
mulseurs, de base protinique ou synthtique, rsistent particulirement bien la
contamination.
Les mulseurs pour feux de liquides polaires
Il est ncessaire d'utiliser des mulseurs spciaux dits polyvalents ou anti-alcool.
mulseurs polyvalents base protinique :
Ils peuvent tre standards, fluors, et AFFF.
mulseurs polyvalents base synthtique :
Des polymres spciaux sont mis en solution dans l'mulseur de base (standard, fluor ou
AFFF). Au contact des solvants polaires, les polymres forment un gel.
3.2.4 Les poudres
Les poudres extinctrices sont des produits chimiques finement broys destins tre
projets sur les feux pour les teindre. Leur mode daction fait intervenir des phnomnes
dinhibition de flamme (feux de classe B et C) mais aussi des possibilits disolement des
gaz de distillation par rapport loxygne de lair (feux de classe A et D).
Dans les locaux, lutilisation des poudres cre une diminution de la visibilit pouvant
entraner des effets de panique et gner lvacuation.
Les matriels fragiles doivent tre soigneusement nettoys aprs une extinction la
poudre.
Les poudres BC
Les poudres BC agissent exclusivement par inhibition de flamme.
Leurs qualits : Les poudres BC permettent d'teindre trs rapidement les feux
d'hydrocarbures ou de gaz (efficaces sur les feux des classes B et C). Elles ne
conduisent pas llectricit, ne sont pas toxiques et ne craignent pas le gel.
Leurs inconvnients : Les poudres BC n'agissent pas sur les braises (feux de classe A) et
ne sont pas efficaces sur les feux de mtaux (classe D). La visibilit est fortement diminue
pendant la projection, surtout l'intrieur des locaux. Aprs la projection, les poudres se
dposent partout (machine, lectronique, vtement...) pouvant provoquer des salissures.
Les poudres ABC
Les poudres ABC (appeles parfois polyvalentes) agissent par inhibition de flamme
(feux des classes B et C) mais en plus, elles forment une laque la surface des
combustibles solides chauds qui empche l'mission de gaz inflammables
(isolement des braises pour feux de classe A).
Cependant, pour tre efficace, il est primordial de dposer une quantit de poudre
en excs important pour parfaire ce vernissage, ce qui implique une grande
dextrit de lintervenant.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Leurs qualits : Les poudres ABC sont efficaces sur les flammes et sur les braises
(feux des classes A, B et C). Elles ne conduisent pas l'lectricit, ne sont pas toxiques et
ne craignent pas le gel.
Leurs inconvnients : Ils sont identiques ceux des poudres BC mais leur
sensibilit l'humidit est plus nette. Elles sont lgrement irritantes pour les
muqueuses nasales.
Les poudres D (pour feux de mtaux)
Trs avides d'oxygne, les mtaux peuvent brler en prenant l'oxygne de l'eau et du gaz
carbonique. En outre, le dgagement thermique de la combustion de certains mtaux est
tellement important que les agents extincteurs classiques sont dtruits avant de pouvoir
agir. Par consquent, les produits extincteurs courants sont inefficaces, voire dangereux.
Il nexiste pas de poudre D efficace sur tous les mtaux, cest pourquoi, il est ncessaire
de prciser le ou les mtaux quelle est capable dteindre.
Le mode daction des diffrentes poudres D rside dans lisolement du mtal en
combustion par rapport lair ambiant.
Il ne faut pas mlanger les poudres, en particulier les poudres BC et ABC. Une raction
chimique entranerait une dcomposition avec une formation deau et un dgagement de gaz.
Ceci provoquerait la formation de grumeaux et une monte en pression importante de
lextincteur.
3.2.5 Le dioxyde de carbone
Le CO
2
est essentiellement efficace sur les feux dorigine lectrique et les feux de
classe B. Sur ces derniers, le rsultat de lextinction est binaire, cest--dire, tout
ou rien . Cest un agent extincteur propre, utilis en extincteur mobile et en
installation dextinction. Le dioxyde de carbone (CO
2
) agit par touffement car il
permet de diminuer la teneur en oxygne de l'air.
Il permet dteindre les feux de classe B. Cependant, utilis dans un extincteur, sa
porte est trs faible, ce qui limite son efficacit aux petits feux d'hydrocarbures.
En sortie de buse, la temprature du CO
2
est de lordre de - 78C. Il a donc un
effet accessoire de refroidissement.
Ses qualits : Le dioxyde de carbone ne salit pas les locaux ou les appareils sur
lesquels il est projet. Il ne conduit pas l'lectricit. Il ne craint pas le gel. Il n'est pas
corrosif.
Ses inconvnients : La projection du CO
2
est sensible lenvironnement (vent,
dilution rapide) do une porte faible.
L'abaissement de la teneur en oxygne rend l'atmosphre incompatible avec la vie dans les
locaux o il est utilis en noyage total.
3.2.6 Les autres gaz
Linergen
Cet agent gazeux est un mlange de trois gaz inertes : azote pour 52 % ; argon pour
40 % et CO
2
pour 8 %.
Linergen agit par touffement.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Largonite
Cest un mlange de gaz inertes (50 % dazote et 50 % dargon) agissant par
touffement.
Ces nouveaux gaz inertes sont propres et ne conduisent pas llectricit.
La quantit dagent mettre est importante et le temps dmission est de lordre dune deux
minutes.
Le FM 200
Il sagit dun hydrocarbure halogn agissant par inhibition. Il ne contient ni brome, ni
chlore. Son potentiel de destruction de la couche dozone (ODP) est de 0.
3.2.7 Quels agents extincteurs pour quels feux ?
Classes de feux Exemples Agents extincteurs
Classe A
Feux de solides braisants
Bois
Cartons
- eau pulvrise ou jet plein
- eau + additif (AFFF)
- mousse (B.F.)
- poudre ABC
Classe B
Feux de liquides ou de
solides liqufiables
Hydrocarbures
Alcool
- poudres BC et ABC
- CO
2
- Eau + additif (AFFF)
- Mousse
Classe C
Feux de gaz
Gaz Poudres BC et ABC
Classe D
Feux de mtaux
Sodium
Magnsium
Poudre spciale
Classe F
Huiles et graisses vgtales
ou animales
Huile de friture
-
Les caractristiques des diffrents agents extincteurs
Agent extincteur Action sur le feu
Conduction
lectrique BT
Toxicit
Eau
Eau + additif (AFFF)
- refroidissement
- isolement
Conducteur
(danger)
Nulle
Mousse physique - isolement
- effet secondaire de refroidissement
(bas foisonnement uniquement)
Conducteur
(danger)
Nulle
Poudre BC - inhibition (classes B et C)
- n'teint pas les braises
Non
Poudre ABC
polyvalente
- inhibition (classes B et C)
- isolement des braises (classe A)
Non
Non toxique
Irritation des muqueuses
Port d'un masque anti-poussires lors des
rechargements frquents
Dioxyde de carbone
(CO
2
)
- touffement
- n'teint pas les braises
- effet secondaire de refroidissement
Non Nulle faible dose dans l'air gaz neutre
inerte
Risque d'asphyxie en local clos
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
3.3 Choisir le matriel de lutte contre l'incendie
La ncessit dattaquer le feu dans les plus brefs dlais et le fait de mettre disposition des
quipes de secours des moyens adapts aux btiments conduit installer du matriel de
protection incendie. Ce matriel regroupe, entre autres, les extincteurs portatifs et sur roues, les
RIA (robinets dincendie arms), les hydrants (bouches et poteaux incendie) et les colonnes
sches et humides.
On peut galement recourir des installations dextinction automatique (eau ou gaz) afin de
contenir, voire teindre, un incendie sans intervention humaine.
Les critres de choix de ces moyens dextinction dpendent de :
la rglementation applicable ;
lactivit exerce ;
lloignement de ltablissement par rapport aux services de secours ;
lorganisation du service de scurit incendie lintrieur de ltablissement.
3.3.1 Les extincteurs portatifs
Un extincteur est un appareil qui permet de projeter et de diriger un agent extincteur sur un
foyer dincendie. Les extincteurs sont conus pour permettre une action rapide et efficace sur
les feux pris leur dbut. Nanmoins, de part leur taille, leur temps dusage et leur capacit
dextinction sont limits. Cest pourquoi, afin quils jouent un rle dcisif, il convient de
connatre leur fonctionnement et de sentraner rgulirement leur maniement.
Les agents extincteurs
L'extincteur peut tre :
eau pulvrise ou jet plein ;
eau avec additif (AFFF) ;
poudre ;
dioxyde de carbone (CO
2
) ;
mousse.
Masse
Un extincteur portatif a une masse infrieure ou gale 20 kg (en tat de
fonctionnement).
Porte moyenne
La porte moyenne par convention est la projection horizontale de la distance comprise
entre l'orifice et la partie de l'aire de projection.
Dure totale de fonctionnement
Cette dure est le temps pendant lequel a lieu la projection de l'agent extincteur, sans
interruption pendant la projection et vanne totalement ouverte. La dure minimale de
fonctionnement des extincteurs, suivant la norme NF EN 3 est de :
Charge dagent extincteur
(kg ou l)
Dure minimale
de fonctionnement (s)
x 3 6
3 < x 6 9
6 < x 10 12
10 < x 15
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
En pratique, un extincteur 6 l eau pulvrise a un temps de vidange denviron
30 secondes, un extincteur poudre 6 kg denviron 15 secondes et un extincteur CO
2
de 2 kg denviron 7 secondes.
Les principes de fonctionnement d'un extincteur
Les appareils comportent un corps et une tte sur laquelle sont disposs la robinetterie et le
diffuseur (ou un flexible). La pression, permettant la projection de lagent extincteur, est obtenue
selon deux principes de fonctionnement :
Les appareils pression permanente dont le corps contient lagent extincteur et le gaz
de propulsion.
La manuvre est simple : retirer le systme de scurit ;
diffuser lagent extincteur en appuyant sur la poigne.
Les extincteurs pression auxiliaire.
Ils sont mis sous pression au moment de leur utilisation. Il sagit de librer un gaz contenu dans
une bouteille auxiliaire.
Voici la manuvre : retirer le systme de scurit ;
percuter la cartouche auxiliaire ;
diffuser lagent extincteur en appuyant sur la poigne.
Si, avec les appareils pression permanente, la mise en uvre est simple, les oprations de
maintenance, en particulier les vrifications internes, sont rendues plus difficiles.
En revanche, pour les appareils pression auxiliaire, les utilisateurs prouvent souvent des
difficults percuter la cartouche.
Rappelons que la russite dune intervention est assure par la formation et lentranement du
personnel.
L'implantation des extincteurs
Selon le Code du Travail : article R 232 12 17
Les chefs d'tablissement doivent prendre les mesures ncessaires pour que tout
commencement d'incendie puisse tre rapidement et efficacement combattu dans l'intrt
du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assur par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon
tat de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur eau pulvrise de 6 litres au minimum pour 200 m de
plancher, avec un minimum dun appareil par niveau.
Lorsque les locaux prsentent des risques dincendie particuliers, notamment des risques
lectriques, ils doivent tre dots dextincteurs dont le nombre et le type sont appropris
aux risques.
Selon le Code du Travail : article R 232 12 17
Les tablissements sont quips, si cela est jug ncessaire, de robinets d'incendie arms, de
colonnes sches, de colonnes humides, d'installations d'extinction automatique d'incendie ou
d'installations de dtection automatique d'incendie.
[] Toutes ces installations doivent faire lobjet dune signalisation durable, appose aux
endroits appropris.
Selon les rglements ERP - IGH :
Un appareil 6 l pour 200 m avec un par niveau voire plus pour certains types.
Selon la rgle APSAD R4 (installation des extincteurs mobiles)
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Dans les cas o il y a un engagement contractuel entre un assur et son assureur afin
dappliquer la rgle dinstallation APSAD R4, il conviendra dappliquer la mthodologie
dcrite ici.
Pour la protection gnrale
Dfinir des zones de base en fonction de 3 critres :
- diffrencier leurs activits : industrielle ou tertiaire ;
- diffrencier la classe de feux prdominante : A, B ou C ;
- diffrencier les zones communicantes des zones non-communicantes.
Une zone de base est dfinie comme une zone lintrieur de laquelle est exerce la
mme activit, il existe la mme classe de feu et o toutes les parties sont en
communication.
Dterminer la dotation de base pour chaque zone en respectant les ratios suivants :
- activit tertiaire : 1 extincteur 6 l ou 6 kg / 200 m
2
;
- activit industrielle : 1 extincteur 9 l ou 9 kg / 200 m
2
.
Pour la protection complmentaire
Dans les zones comportant des risques spcifiques (dangers localiss, stockages intrieurs de
liquides inflammables, stockages en hauteur, zones destines aux travaux de peintures), il est
ncessaire de complter la protection gnrale.
Pour la protection dactivits particulires
Il sagit de stockages extrieurs de liquides ou de gaz inflammables, stockages extrieurs
divers (palettes, bennes ordures, etc.), stations de distribution de carburant, chambres
froides.
Les extincteurs sont rpartis de manire uniforme lintrieur de chaque zone de
faon ce que la distance parcourir pour atteindre un appareil nexcde pas
15 m. Ils doivent tre visibles ou signals, fixs sur des supports solides, mis en
place dans les dgagements et voies daccs.
Il est recommand de ne pas placer les poignes de portage plus de 1,5 m du sol.
Les extincteurs doivent imprativement tre adapts la nature des combustibles et aux risques
encourus, ainsi dailleurs que lexige la rglementation.
Hormis cette rgle essentielle, il y a lieu de tenir compte de certaines limitations demploi, du
type de local, des conditions environnementales et ventuellement des inconvnients pour les
personnes ou le matriel.
En outre, sagissant de la charge, le choix tiendra compte du type de personnes appeles les
manipuler.
3.3.2 Les extincteurs sur roues
Au-del dune masse suprieure 20 kg, un extincteur doit tre mont sur roues ou sur
un chssis remorquable.
Un extincteur sur roues est muni dun tuyau dau moins 5 m de longueur quip dune
lance. Il doit tre utilis par deux quipiers et ne peut se dplacer que sur un sol plat : il
faut pouvoir le tracter facilement.
En raison de leur capacit et de leur porte, les extincteurs sur roues sont utiliss contre
des feux plus importants ou difficilement accessibles : zones risques disperss
susceptibles de prendre rapidement une grande ampleur, stockages en hauteur, stations
de distribution de carburant, parkings, entrepts, etc.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Agent extincteur
On retrouve les mmes agents extincteurs que dans les appareils portatifs : eau, eau
avec additif, mousse, poudre, dioxyde de carbone.
Capacit :
Les capacits nominales les plus courantes sont de 45 litres et 50 kg de, sauf pour le
CO
2
o l'on rencontre des chariots portant une ou deux bouteilles de 20 ou 30 kg.
Dure de fonctionnement
Elle est en moyenne de 70 secondes pour les extincteurs poudre et 90 secondes pour
les extincteurs eau.
3.3.3 Les robinets d'incendie arms (RIA)
Une installation de RIA est constitue de diffrents postes de RIA rpartis dans le risque
protger. Un RIA doit permettre une premire intervention durgence en attendant des
moyens plus puissants.
tant aliments en permanence et prts tre utiliss sur tout dbut dincendie, ces
robinets dincendie sont dits arms .
Un robinet d'incendie arm, considr comme un moyen de premire intervention, est un
ensemble comportant :
un robinet d'arrt de lalimentation en eau ;
un dvidoir tournant ;
un tuyau semi-rigide dune longueur de 30 m maximum, avec un diamtre nominal de
19, 25 ou 33 mm, qui permet leau de circuler dans le tuyau mme partiellement
droul ;
une lance avec un robinet diffuseur : position ferme, jet diffus (conique ou nappe) ou
jet plein.
La rgles APSAD R5 permet une entreprise de concevoir et de raliser une installation de
robinets dincendie arms, y compris son alimentation en eau. Pour tre prise en considration
par lassureur, linstallation doit faire lobjet dun certificat de conformit (N5) tabli par une
entreprise titulaire de la certification APSAD de service dans ce domaine. Les oprations de
maintenance font lobjet dexigences particulires.
Implantation des RIA
Suivant la norme NF S 62-201, le nombre de RIA et le choix de leur emplacement
doivent tre tels que toute la surface des locaux protgs puisse tre efficacement
atteinte.
En parallle avec la norme, la rgle APSAD R5 permet une entreprise de concevoir et
de raliser une installation de robinets dincendie arms, y compris son alimentation en
eau dans des btiments des secteurs industriel, commercial, agricole ou tertiaire.
Les oprations de surveillance et de maintenance font lobjet dexigences particulires
tablies sur la base de des normes NF EN 671-3 et NF S 62-201, notamment le
classement des activits et stockages selon le document technique D9 Guide pratique
pour le dimensionnement des besoins en eau. La rgle prcise les conditions dans
lesquelles l'installation pourra tre prise en considration par l'assureur.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les critres suivants doivent tre pris en compte :
lagencement, la destination du local et la prsence ventuelle dobstacles ;
la longueur du tuyau (30 m maximum) ;
la porte du jet (la porte minimale est celle du jet diffus conique, soit 3 m) ;
tout point de la surface des locaux protgs par des RIA dun diamtre nominal 25 ou
33, doit tre couvert par au moins 2 jets en position diffuse.
Les RIA doivent tre placs lintrieur des btiments, proximit des accs.
Ils doivent tre signals, daccs et de mise en uvre faciles, laxe du dvidoir tant situ
entre 1,20 m et 1,80 m du sol.
L'alimentation des RIA
Lalimentation en eau des RIA est assure par une source dont la nature peut varier :
rseau deau public, rservoirs deau charge gravitaire, rservoirs sous pression,
rseau sprinkleurs, aspiration dans un cours deau.
Quel que soit leur type, ces sources doivent tre capables dalimenter simultanment
pendant 20 mn, un nombre de RIA minimal dfini en fonction du nombre de RIA de
linstallation (voir tableau ci-dessous).
Ce nombre comprend les RIA qui possdent les diamtres nominaux les plus importants
et le RIA le plus dfavoris .
Nombre de RIA de linstallation Nombre de RIA pour le calcul
2 4 2
5 ou 6 3
7 et plus 4
En tout tat de cause, la source doit avoir une capacit de 10 m
3
au moins.
3.4 Les installations d'extinction automatique
On entend par installation dextinction automatique tout systme capable de contenir, voire
d'teindre, un foyer d'incendie sans intervention humaine.
Ces installations prsentent les avantages suivants :
elles limitent les risques encourus pendant les priodes de non-activit dans les locaux ;
elles permettent une intervention rapide, quel que soit le dlai d'intervention des secours ;
elles agissent mme si la fume occulte le foyer ou gne l'action du personnel de scurit ;
elles autorisent l'action simultane des phases de dtection et d'extinction.
Elles sont composes :
dune rserve de produit extincteur ;
dun rseau de distribution et de vannes ;
de diffuseurs ;
dun dispositif de dclenchement automatique ;
dun dispositif d'alarme.
Elles sont employes pour diffrents types de protection :
totale ou d'ambiance (volume compltement clos) ;
partielle ou ponctuelle (pour objets ou secteurs non dlimits par des parois verticales
sur la totalit de leur primtre) ;
particulire (peinture ou tremp).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
3.4.1 Les installations d'extinction automatique eau type sprinkleurs
Le rle de l'installation
A l'origine, il s'agissait de rseaux de distribution quips de pommes d'arrosoir rparties sur le
risque. L'eau tait distribue manuellement en ouvrant les vannes principales.
Ce systme prsentait deux inconvnients majeurs : il ncessitait la prsence d'un homme en
permanence et l'arrosage se faisait galement sur les parties non concernes par l'incendie.
C'est en 1883 que Frdric Grinnell invente le premier sprinkleur automatique (de
l'anglais to sprinkle : asperger, arroser) tel qu'on le connat aujourd'hui. Si la
technique de fabrication et les matriaux ont beaucoup volu, les principes ont peu
chang.
Un systme d'extinction automatique eau type sprinkleur doit :
dceler un dbut d'incendie ;
donner l'alarme ;
contenir lincendie afin que l'extinction puisse tre mene bien par les moyens
internes de l'tablissement protg ou par les sapeurs pompiers, voire lteindre
directement.
Le principe de fonctionnement
L'installation se prsente sous la forme d'un rseau de canalisations sur lequel se situent
des sprinkleurs qui jouent le rle de dtecteurs thermostatiques et qui s'ouvrent une
temprature prdtermine.
Le rseau de canalisations est maintenu sous pression et est aliment par une ou deux
sources d'eau qui doivent tre capables tout moment de fournir le dbit et la pression
ncessaires aux sprinkleurs ouverts pour assurer le bon fonctionnement de linstallation.
Le dbit d'eau, le type de pulvrisation et la surface d'arrosage de chaque sprinkleur
dpendent du type de feu teindre.
Si un incendie se dclare, la temprature augmente et les sprinkleurs, aprs avoir atteint
le seuil de temprature, s'ouvrent et permettent un arrosage en pluie trs efficace.
Dans le mme temps, une alarme se dclenche permettant un appel sans dlai des secours
internes ou externes par lintermdiaire dun gong hydraulique.
L'installation agit ds les premires minutes l'endroit mme o le feu a pris naissance et en
cas d'extension du feu, de nouveaux sprinkleurs souvrent. Larrosage permet galement de
refroidir la structure du btiment sinistr.
Caractristiques du systme sprinkleurs :
veille permanente 24 h /24 h ;
surveillance en tous points protgs.
Efficacit :
dans 70 % des cas, 4 ttes de sprinkleurs permettent de matriser le sinistre avant
mme l'arrive des secours organiss ;
sauvegarde de la construction ;
dgts des eaux rduits (dversement limit aux abords immdiats du foyer).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les diffrents types d'installations sprinkleurs
Les types d'installation pris en compte par la rgle APSAD R1 sont :
les installations sous eau o les canalisations du rseau de protection sont remplies en
permanence d'eau sous pression (8 9 bars environ) ;
les installations sous air o les canalisations du rseau de protection sont remplies en
permanence d'air sous pression (2.5 bars environ) en aval du poste de contrle et d'eau sous
pression en amont du poste. Ces installations sont places dans les locaux o il existe un
risque de gel ou dans lesquels la temprature peut excder 100C (un schoir par exemple) ;
les installations alternatives o les canalisations du rseau de protection sont remplies
d'air comprim pendant les priodes o le gel est craindre et d'eau pendant les
autres priodes ;
les installations praction qui fonctionnent en deux temps. Tout dabord, lors de la
confirmation dalarme par une dtection automatique dincendie, il y a lenvahissement par
leau dans le rseau, puis le fonctionnement est identique celui d'une installation sous eau ;
les installations dluge o les canalisations du rseau de protection sont quipes de
sprinkleurs ouverts. Ces installations sont destines la protection de risques spciaux
o des incendies vitesse rapide sont probables.
Les sprinkleurs
Ce sont des organes sensibles la chaleur (ampoule ou fusible) qui dclenchent la fois
une alarme et un arrosage intensif, lorsque la temprature laquelle ils sont soumis, par
l'action d'un foyer naissant proximit, atteint un certain degr fix l'avance.
La destruction de l'obturateur sous l'effet de la chaleur laisse le passage l'eau sous pression
dont le jet vient se briser sur le diffuseur.
Elle se dploie alors en pluie uniformment rpartie autour du sprinkleur et arrose le foyer.
Les tempratures de fonctionnement
Elles sont comprises entre 57 C et 343 C. Afin de distinguer les sprinkleurs de tempratures
nominales de fonctionnement diffrentes, des couleurs conventionnelles ont t adoptes.
Sprinkleurs fusible Sprinkleurs ampoule
Temprature de
dclenchement
Couleur des triers Temprature de
dclenchement
Couleur des ampoules
57 77C
80 107C
121 149C
163 191C
204 246C
260 302C
320 343C
non color
blanc
bleu
rouge
vert
orange
noir
57C
68C
79C
93/100C
121/141C
163/182C
204/227/260/286/343C
orange
rouge
jaune
vert
bleu
mauve
noir
Tableau T15.1.5 de la Rgle APSAD R1 :
Couleurs conventionnelles en fonction de la temprature de dclenchement des sprinkleurs
Les sources d'eau
Elles doivent assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation aux pressions et
dbits requis. De plus, l'eau ne doit contenir aucune matire en suspension susceptible
de former des dpts dans le rseau. Il est recommand de placer des filtres.
Les sources d'eau admises sont classes en deux types :
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
la source A, dite limite
Elle est conue pour alimenter 5 sprinkleurs pendant 30 minutes.
Les principales sources A sont les rseaux d'eau publics (pression et dbit suffisants
24 h/24 h), les rserves d'eau charge gravitaire (chteau deau par exemple), les
pompes puisant dans une rserve intgrale et les rservoirs sous pression.
la source B, dite inpuisable
Elles est conue pour alimenter la totalit de la surface implique la densit d'eau requise par
la rgle APSAD R1 pendant une dure fixe (60 mn pour les Risques Courants et 90 mn
pour les Risques Trs Dangereux ).
Les principales sources B sont les rseaux d'eau publics, les rserves d'eau charge
gravitaire, les pompes puisant dans une rserve intgrale.
Les sprinkleurs ESFR et grosses gouttes
Les sprinkleurs ESFR et grosses gouttes se distinguent de systmes classiques par leurs
modes de fonctionnement diffrents et leurs destinations spcifiques certains cas de
figures. Leurs mises en uvre est dveloppe dans la rgle APSAD R1.
ESFR signifie Early suppression/Fast response (extinction prcoce/rponse rapide). Les
sprinkleurs ESFR ont t conus pour lutter contre les feux dveloppement rapide et de
svrit trs leve. Ils ont comme objectif l'extinction du feu ; les sprinkleurs traditionnels
tant conus pour le contenir. Leur mode de fonctionnement est donc diffrent. Les
sprinkleurs ESFR prsentent la particularit d'avoir un temps de rponse plus court face
l'lvation de la temprature ; ils procdent l'attaque directe du feu en projetant trs
rapidement une grande quantit d'eau avec une distribution amliore. Les surfaces en
feu et les surfaces impliques sont donc moins importantes. Les ESFR peuvent tre de
type pendant ou debout.
Les sprinkleurs grosses gouttes sont conus pour contenir le feu. Ils ont t dvelopps
pour lutter contre les feux haute intensit dans les endroits o sont stockes des
marchandises forte charge calorifique. En effet, dans le cas de ces feux, les gouttes
d'eau de taille normale sont emportes dans le flux gazeux sans que leur vaporisation
refroidisse le foyer. Grce au systme grosses gouttes, l'extinction se fait au moyen de
gouttes de 2 mm qui vont atteindre le foyer, et de fines gouttelettes qui vont abaisser la
temprature sous toiture.
Les avantages du systme sont notamment la possibilit d'liminer les rseaux
intermdiaires dans le rayonnage et une plus grande absorption des calories.
La protection par des sprinkleurs grosses gouttes se dfinit sur la base dun nombre de
sprinkleurs (15 20 ; 20 25 ; 25 33 ; 30 40) une pression minimum (1,7 ; 3,4
ou 5,2 bars) en fonction de la catgorie de risque, du mode et de la hauteur de
stockage.
3.4.2 Les installations d'extinction automatique CO
2
Ces installations sont destines une protection dambiance, cest--dire d'enceintes
closes relativement tanches (salles informatiques, par exemple) ou une protection
ponctuelle (machines...).
L'extinction sera obtenue par l'afflux du CO
2
provoquant la rduction du taux d'oxygne
dans l'air (touffement), l'effet de refroidissement cr par la dtente du gaz ne sera
valable qu'accessoirement.
Le rle de l'installation est d'teindre un incendie un stade encore prcoce de son
dveloppement, et de maintenir la concentration de CO
2
ncessaire pendant une dure
suffisante pour liminer tout risque de r-inflammation.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
La rgle APSAD R3 dfinit les exigences minimales de conception, dinstallation et de maintenance des
systmes dextinction automatique CO
2
, ainsi que les exigences relatives la scurit des personnes,
lextension ou la modification dinstallations existantes. Les oprations de maintenance et les
vrifications priodiques font lobjet dexigences particulires. La rgle prcise les conditions dans
lesquelles l'installation pourra tre prise en considration par l'assureur.
Proprits
Le dioxyde de carbone est un agent extincteur propre, occasionnant peu de dgts, pas
de dpts ni de produits de dcomposition.
Propuls nergiquement l'tat liquide, il engendre par frottement contre les parois, de
l'lectricit statique pouvant atteindre des tensions de l'ordre de 10 000 volts, d'o
l'obligation de mettre la terre les installations.
Lors d'une mission de CO
2
, il s'ensuit une diminution de temprature, d'o condensation
de la vapeur d'eau contenue dans l'air crant un brouillard gnant la visibilit.
Le stockage du CO
2
En rservoirs haute pression
Le dioxyde de carbone est stock dans des bouteilles, temprature ambiante, une pression
denviron 60 bar et montes sur un chssis.
Chaque bouteille est raccorde au rseau de tuyauteries par l'intermdiaire d'une vanne, d'une
tuyauterie flexible, d'un clapet anti-retour et du collecteur principal, et doit tre quipe :
d'un opercule de scurit dont le rle est de limiter toute augmentation excessive de la
pression dans la bouteille, due la temprature par exemple. C'est pourquoi, les
bouteilles devront tre situes dans des ambiances dont la temprature est comprise
entre -10 C et +35 C
d'un dispositif de contrle du poids de la bouteille, automatique et lecture
permanente.
Les oprations de montage et/ou de dmontage de chacune des bouteilles ne doivent
pas compromettre le fonctionnement de l'installation d'extinction automatique.
En rservoirs basse pression
Le CO
2
est stock dans un rservoir rfrigr dont la temprature est maintenue - 20C au
moyen d'un systme rfrigrant, une pression de 18 bars.
Le rservoir est raccord aux rseaux de tuyauteries par l'intermdiaire du collecteur
principal quip, notamment, d'une vanne manuelle (verrouille en position ouverte).
Le rservoir doit tre quip d'un dispositif de contrle de son poids, automatique et
lecture permanente.
Fonctionnement
Un dispositif de dclenchement, mcanique, lectrique ou pneumatique est actionn par
un systme de dtection automatique d'incendie utilisant le principe de la double
dtection (confirmation dalarme).
Il doit exister galement un systme de dclenchement manuel.
Le systme d'alarme
Il est obligatoire et doit comporter une alarme sonore et lumineuse.
Il faut aussi prvoir un retardateur d'mission lorsque du personnel peut tre prsent dans
un local protg, cette temporisation est de 30 secondes.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les diffuseurs
Ils doivent tre disposs de telle sorte que les locaux ou objets protger soient rapidement
noys par le CO
2
, et que les matires enflammes ne puissent, sous l'action du jet de CO
2
, ni
tourbillonner, ni se rpandre dans le local.
La surface maximale protge par diffuseur ne doit pas excder 30 m.
Le temps d'mission
Dans le cas des systmes de protection d'ambiance, la dure normale maximale
d'mission ne doit pas excder 60 secondes.
Toutefois, pour les installations comportant plus de 3 tonnes de CO
2
stocke et
protgeant des zones o des feux dveloppement lent sont prvisibles, la dure
d'mission peut tre de 120 secondes maximum.
L'obturation des ouvertures
Les locaux protgs par CO
2
doivent tre amnags de faon ce que le produit
extincteur ne puisse pas s'chapper. Les ouvertures doivent se fermer automatiquement
ds le dbut de la temporisation mais doivent pouvoir souvrir de lintrieur vers
lextrieur en cas dvacuation.
Toutes les installations de ventilation, climatisation, chauffage par ventilation, etc. doivent
tre arrtes automatiquement la mise en action de l'extinction.
La scurit du personnel
Dans tous les cas d'installation crant une mise en danger des personnes, des mesures de
sauvegarde appropries doivent tre prvues afin de garantir une vacuation rapide de la
zone, d'en interdire l'accs aprs l'mission et de fournir les moyens de secours rapide du
personnel ventuellement pig.
Les aspects de scurit, tels que la formation du personnel, les panneaux avertisseurs, la
temporisation, les alarmes et les appareils respiratoires doivent tre envisags.
La concentration de CO
2
ncessaire pour produire un effet d'extinction suffisant met en danger
la vie des personnes dans la zone de noyage.
Les exigences suivantes doivent tre satisfaites :
une zone de noyage ne doit pas constituer un itinraire d'vacuation unique pour d'autres
zones ;
prvoir des portes battantes fermeture automatique ouvrant uniquement vers l'extrieur
qui puissent tre ouvertes de l'intrieur mme si elles sont verrouilles de l'extrieur ;
prvoir des alarmes d'vacuation distinctes de tous les autres signaux d'alarme process et
qui fonctionneront au plus tard la confirmation de la dtection ;
prvoir de parfumer le CO
2
par un produit odorant ininflammable et non toxique qui
permettra de reconnatre les atmosphres dangereuses ;
prvoir des panneaux avertisseurs signaltiques aux accs et issues indiquant : En cas
d'alarme ou de dgagement de CO
2
, quitter immdiatement le local .
Les exigences suivantes devraient galement tre satisfaites, il sagit de prvoir :
des itinraires d'vacuation qui doivent tre laisss libres en permanence ainsi que des
flchages signaltiques ;
un matriel respiratoire autonome et du personnel form l'utiliser ;
des moyens de ventilation des locaux aprs l'mission de CO
2
(ceux des sapeurs-
pompiers peuvent tre pris en considration).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
3.4.3 Les installations d'extinction automatique
gaz inertes et inhibiteurs
Les installations dextinction automatique gaz inertes et inhibiteur concernent la
protection des locaux prsentant des risques dincendie importants dans lesquels du
matriel de grande valeur est stock ou dans lesquels leau ne peut tre utilise
comme moyen dextinction. Leur rle est dteindre un incendie un stade de
dveloppement prcoce.
Une analyse pralable du risque incendie est ncessaire pour dterminer linstallation et
lagent extincteur les mieux adapts.
La rgle APSAD R13 sapplique aux agents extincteurs gazeux proposs pour rpondre aux
problmes environnementaux crs par les halons. Elle dfinit les exigences minimales de
conception, dinstallation et de maintenance des systmes dextinction automatique utilisant des
gaz inertes ou des gaz inhibiteurs, ainsi que les exigences relatives lextension ou la
modification dinstallations existantes. Les oprations de maintenance et les vrifications
priodiques font lobjet dexigences particulires. La rgle prcise les conditions dans lesquelles
l'installation pourra tre prise en considration par l'assureur, notamment, linstallation doit faire
lobjet dun document attestant de sa conformit la rgle (modle N13) tabli par
linstallateur, titulaire de la certification APSAD de service, aprs rception des installations.
Les agents extincteurs gazeux sont adapts lextinction des matires et matriels suivants :
gaz combustibles, condition de garantir par des dispositions spcifiques que le
mlange combustible/air ne peut tre reconstitu lissue dune extinction russie ;
installations lectriques et lectroniques ;
liquides inflammables ;
matires combustibles base de bois, papier, textiles, sauf dans le cas o elles
pourraient tre lorigine de feux profonds.
Illustration
Exemples de cas o ces installations peuvent tre installes :
atelier de peinture ;
installations de tlcommunications ;
salle informatique ;
locaux de stockage de liquides inflammables.
Lextinction par gaz est inadapte pour les feux incluant des produits tels que :
matires solides dans lesquelles les feux peuvent rapidement devenir profonds ;
Les gaz inhibiteurs ne doivent pas tre utiliss sur des feux impliquant les produits suivants :
produits chimiques contenant de loxygne tels que le nitrate de cellulose ;
mlanges contenant des agents oxydants tels que le chlorate de sodium ou le nitrate
de sodium ;
produits chimiques susceptibles de connatre une dcomposition exothermique tels que
certains peroxydes organiques ;
mtaux ractifs (sodium, potassium, magnsium, titane, zirconium et alliages lgers),
hydrures ractifs ou amides mtalliques dont certains peuvent ragir violemment au
contact de certains agents gazeux.
Cependant, largon ou lazote pur (gaz neutre ou mlange de gaz neutres) restent
souvent utilisables sur les feux de mtaux.
Pour viter la dcomposition de lagent extincteur, il nest pas envisageable de les utiliser
dans les zones comportant des lments forte temprature.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
La scurit des occupants du local
Des mesures de scurit doivent tre prises pour raliser une vacuation rapide des
occupants de la zone et leur interdire laccs en cas dmission de gaz.
En effet, outre les risques dmanation de gaz de combustion dangereux,
labaissement de la concentration en oxygne (pour les gaz inertes), le niveau sonore
lev, leffet de souffle lors de lmission du gaz et leur concentration peuvent mettre
en danger la sant des occupants.
Une formation du personnel est ncessaire pour lui faire connatre la conduite tenir
en cas de dclenchement de linstallation.
Deux valeurs de concentration, importantes dans le cadre de la protection des
personnes qui seraient amenes tre exposes au gaz, doivent tre examines lors de
ltude de linstallation :
LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) : concentration la plus faible
laquelle un effet toxicologique ou physiologique a t observ chez lhomme,
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) : concentration la plus leve laquelle
aucun effet toxicologique ou physiologique nest observ chez lhomme.
Bien que les agents gazeux ne soient normalement pas toxiques aux concentrations
recommandes, des prcautions seront prises pour que toute exposition de personnel non
ncessaire dans la zone protge soit vite.
Certains locaux tels que les locaux techniques peuvent ncessiter des concentrations
plus leves. Dans ce cas, il est ncessaire de pouvoir de mettre hors-service
linstallation sous certaines conditions.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
4 ORGANISER LES SECOURS
Si un incendie se dclare, tout doit tre prvu pour permettre le sauvetage des occupants
et limiter les dgts matriels au minimum.
Ceci implique un ensemble dactions qui consistent, dans tous les cas, :
donner lalarme ;
alerter les secours extrieurs ;
assurer lvacuation si ncessaire et intervenir dans la mesure du possible pour limiter
le sinistre.
4.1 Lalarme
Lalarme a pour but de prvenir les occupants de loccurrence dun sinistre, de signifier au
personnel dsign quil doit donner lalerte et dordonner lvacuation. Elle peut tre de deux
sortes :
lalarme restreinte, qui prvient de la naissance dun feu et de sa localisation le poste de
scurit de ltablissement ou la direction ou le gardien ou le personnel dsign cet effet.
L'alarme restreinte permet de sassurer de la ralit du sinistre et, si ncessaire, de prparer
lvacuation ;
lalarme gnrale, qui prvient les occupants qu'ils doivent vacuer les lieux. Elle peut tre
immdiate ou temporise. Elle peut aussi tre limite linformation de certaines catgories
de personnel dun tablissement (par exemple, dans les hpitaux).
Lalarme peut tre donne :
automatiquement, suite lactivation dun dtecteur automatique dincendie ;
par lintermdiaire dun dclencheur manuel (botier bris de glace ou autre systme) ou par
tlphone (dot dun numro simple, facile retenir, clairement affich sur lappareil) par
toute personne, personnel ou public, apercevant un dbut dincendie, une fuite de gaz, de
liquide dltre, par exemple.
Linformation dalarme arrive un point fixe : poste de scurit, standard, accueil,
etc. Il faut alors sassurer que le poste est occup en permanence ou que la
personne charge dappliquer les consignes en cas dalarme est joignable sans
dlai en permanence.
Des consignes particulires destines la personne situe au point fixe dfinissent
ce quil convient de faire (lever de doute, appel du chef dtablissement, alerte des
secours extrieurs, dclenchement de lalarme gnrale). Elle pourra, sur ordre du
chef dtablissement, dclencher lvacuation et, dans tous les cas, avertir les
quipiers de seconde intervention.
Les exigences rglementaires
Habitations : larrt du 31 janvier 1986 relatif la protection contre l'incendie des
btiments d'habitation exige un quipement dalarme :
- dans les logements-foyers, chaque niveau dans les circulations communes, dans chaque
unit de vie si le nombre de leurs occupants est suprieur dix et dans les services collectifs
assujettis au rglement des ERP ;
- dans les parcs de stationnement couverts comportant plus de quatre niveaux au-dessus du
niveau de rfrence ou plus de deux niveaux au-dessous (art. 95).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Lieux de travail : selon le Code du travail, une alarme sonore doit quiper les
tablissements o peuvent se trouver occupes ou runies habituellement plus de 50
personnes, ainsi que ceux o sont manipules des matires inflammables. Lalarme
gnrale doit tre donne par btiment si ltablissement comporte plusieurs btiments isols
entre eux. Le signal sonore dalarme gnrale ne doit pas permettre la confusion avec
dautres signalisations utilises dans ltablissement. Il doit tre audible de tout point du
btiment pendant le temps ncessaire lvacuation, avec une autonomie minimale de cinq
minutes (R.232-12-18). Les modalits en sont prcises dans larrt du 4 novembre 1993
relatif la signalisation.
ERP : tous les tablissements recevant du public, toutes catgories et destinations
confondues, doivent disposer dun quipement dalarme. Pour les tablissements du 1
er
groupe, les quipements dalarme font lobjet des articles MS61 MS67 du rglement de
scurit. Les dispositions applicables aux tablissements du 2
e
groupe sont exposes
larticle PE27. Pour ces derniers, le choix du matriel est laiss linitiative du chef
dtablissement, sauf dans les tablissements sommeil, (htels, tablissements de soins, les
maisons de retraite). Pour les tablissements du 1
er
groupe, les dispositions particulires
fixent les types d'quipements d'alarme qui doivent tre utiliss suivant l'activit.
IGH : les immeubles de grande hauteur doivent tre pourvus de dispositifs sonores
conformes aux normes ou de dispositifs reconnus quivalents par la commission de scurit.
Ces systmes doivent exclusivement donner lalarme aux personnes occupant les locaux du
compartiment sinistr. Ils doivent tre asservis au systme de dtection et pouvoir tre
dclenchs par une commande manuelle partir du poste central de scurit (GH49).
Des conditions particulires sont fixes pour chaque classe dIGH :
dans les immeubles usage dhabitation, les dispositifs sonores doivent tre installs au
moins dans chaque appartement et dans les circulations horizontales des niveaux non
rservs lhabitation ;
dans les htels, ils doivent tre installs au moins dans chaque chambre, dans les locaux
recevant plus de 20 personnes et dans les circulations horizontales ;
dans les immeubles usage denseignement et de bureaux, ils doivent tre installs au moins
dans les locaux recevant plus de 20 personnes et dans les circulations horizontales ;
dans les immeubles usage sanitaire, par drogation larticle GH49, des dispositifs
dalarme doivent tre prvus dans chaque compartiment ou sous-compartiment, afin que le
personnel de surveillance soit inform en mme temps que le service central de scurit.
4.2 Lalerte
Lalerte des secours publics est donne immdiatement sur le tmoignage dun employ que le
dbut de feu ne peut tre matris par les extincteurs ou aprs le lever de doute en cas de
dclenchement par un systme automatique.
Dans tous les cas, le message dalerte doit tre donn clairement et compltement, dans
lordre des prcisions croissantes : ville, rue, numro, tage, local, sans oublier, le cas chant,
le code dentre de la porte de limmeuble. La personne dsigne pour donner lalerte doit
avoir affich en permanence au-dessus de son poste le numro dappel des sapeurs-pompiers.
La liaison avec les sapeurs-pompiers peut, en gnral, tre assure par le tlphone
urbain, mais, dans certains tablissements, des moyens trs prcis sont prescrits pour
assurer cette liaison. Cest le cas dans certains ERP du 1
er
groupe (MS 71), notamment :
ligne tlphonique directe dans les tablissements de soins de 1
re
et 2
e
catgorie et,
suivant le cas, de la 3
e
catgorie (U 46) ;
ligne tlphonique directe dans les magasins de vente et centres commerciaux de la 1
re
catgorie (M 33) ;
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
avertisseur dincendie priv ou ligne tlphonique directe dans les salles dexposition
de 1
re
catgorie de plus de 3000 personnes (T 51) ;
avertisseur dincendie priv ou ligne tlphonique directe dans les salles de runions et
de spectacles de premire catgorie et les tablissements comportant un service public
de scurit incendie (L 17).
Dans les IGH, des dispositifs phoniques (tlphone sans cadran, interphone, etc.) permettant
de donner lalerte au poste central de scurit pour provoquer lappel des sapeurs-pompiers
doivent tre installs tous les niveaux, dans les circulations horizontales communes (GH 50).
Une liaison tlphonique dintervention pour les sapeurs-pompiers doit tre prvue sur les
dispositifs daccs aux escaliers et aux compartiments (avec trois postes tlphoniques portatifs
par escalier, mis disposition en cas de sinistre) reliant entre eux tous les dispositifs daccs
correspondant au mme escalier et le poste central de scurit. La ligne et les appareils
tlphoniques peuvent tre remplacs par quatre postes radiotlphoniques (GH 56).
4.3 Les principes de l'vacuation
Lvacuation, que ce soit vers lextrieur ou vers une zone de refuge, nest pas toujours
indispensable ou possible. Lorsque les couloirs ou les escaliers sont enfums, il peut tre
beaucoup plus dangereux de chercher fuir que de rester dans son bureau en attendant
larrive des secours.
Plusieurs paramtres sont de nature prolonger le dlai pendant lequel les occupants dun
btiment peuvent y rester sans danger : la dtection prcoce du feu, larrive rapide des
secours, la prsence dquipements permettant de limiter limpact du sinistre (lments
coupe-feu, dsenfumage, extinction automatique, etc.), la lutte immdiate contre le feu
Dans les tablissements de soins, compte tenu des dlais qui seraient ncessaires pour
vacuer les malades ou les handicaps, des mesures compensatoires sont prises pour
limiter les effets de lincendie.
Dans les immeubles de grande hauteur, seuls le compartiment sinistr et ceux situs au-
dessus et en-dessous sont vacus.
Lvacuation des occupants dun btiment vers lextrieur ou vers une zone protge
simpose gnralement en cas :
de risque dexplosion (gaz, alerte la bombe) ;
dincendie gnralis, lorsque les locaux sont envahis par les fumes si le feu se dveloppe
rapidement, ou bien lorsque certains matriels ou quipements de lutte contre un incendie
naissant se rvlent dfaillants ou insuffisants.
Lvacuation spontane ou vacuation organise.
Dans le premier cas, elle a lieu lorsque les occupants dun local peroivent eux-mmes un
danger proche. Elle peut se drouler correctement sinon calmement ou engendrer des
mouvements dsordonns pouvant aller jusqu la panique.
Dans le second cas, elle rsulte de lentranement des quipes de scurit attaches
limmeuble ou ltablissement et son efficacit dpendra de la qualit de cet
entranement.
La rglementation
La rapidit dvacuation des personnes avec le maximum de scurit vers une zone
protge ou vers lextrieur pour fuir une zone sinistre est une proccupation majeure
des pouvoirs publics, que reflte la rglementation.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Pour atteindre lobjectif vis, les prescriptions portent essentiellement sur :
le nombre minimal de dgagements et la largeur minimale de chacun ;
la facilit de cheminement (conception des escaliers et circulations, sens de louverture
des blocs-portes, signalisation, clairage) ;
la longueur du cheminement pour atteindre une zone protge ;
la protection des dgagements vis--vis de la propagation du feu et des fumes (rsistance au
feu des parois et des portes, ferme-portes, dsenfumage...).
Ces dispositions sont dfinies pour les locaux de travail, les tablissements recevant du
public, les immeubles de grande hauteur et les btiments dhabitation.
Les facteurs dfavorables l'vacuation
Certains types doccupation ou certaines configurations de btiment constituent des
lments dfavorables qui ncessitent des dispositions particulires, notamment :
les locaux sommeil, la prsence dhandicaps, de personnes ges, de malades,
denfants ;
laccumulation de personnes (salles de spectacles, magasins) ;
la mconnaissance des lieux ;
lobscurit (salles de spectacles, dancings) ;
lencombrement par du matriel (tables, chaises, chariots, prsentoirs) ;
les travaux en cours ;
les multiples exploitants ou la destination unique du btiment ;
la profondeur et la hauteur de limmeuble ;
la sortie commune avec des tiers ;
labsence de systme de dtection incendie ;
le dlai pour joindre un dcideur.
Les exercices dvacuation
La programmation des exercices dvacuation est faite par le chef du service de
scurit incendie ou le chef dtablissement, en liaison, le cas chant, avec le
CHSCT. Tout doit tre minutieusement conu pour rpartir les tches, et
coordonner les actions afin dviter, en cas de sinistre, la prcipitation et les actions
contraires au but poursuivi.
L'vacuation impose en premier lieu une analyse de la population et du flux des diffrentes
personnes amenes sjourner dans ltablissement et un recensement des facteurs propres
influencer le droulement dune vacuation. Suivant limportance de ltablissement et la
configuration des locaux, on procdera un dcoupage en plusieurs zones, en prvoyant,
pour chaque zone, un ou des itinraires de rechange et/ou des refuges pour le cas o
litinraire principal ou tous itinraires seraient inutilisables.
Lorganisation de lvacuation
Pour chaque zone, des personnes seront dsignes pour remplir les rles de guides ou de
serre-files. On dfinira lavance quels collaborateurs seront chargs daider quels collgues
handicaps.
Le plan dvacuation doit prvoir un point de rassemblement situ dans une zone extrieure,
isole des risques. Il doit tre choisi de manire ne gner ni laccessibilit aux faades ni
lengagement des moyens de secours des services publics. Le rle du lieu de rassemblement est
de permettre de sassurer de la prsence de la totalit du personnel.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Il importe galement de prvoir un point de regroupement destin accueillir les
ventuelles victimes. Ce lieu doit tre facilement accessible pour faciliter leur arrive et
leur vacuation vers un centre de soins et, bien entendu, labri de lvolution dun
sinistre.
Dans les locaux rassemblant un grand nombre de personnes, et notamment dans les
tablissements recevant du public non form lidentification des signaux dalarme, le rle
des guides pourra tre facilit par la diffusion de messages sonores dynamiques, moins
traumatisants. Ces tablissements sont gnralement quips dun systme de sonorisation
destin diffuser de la musique dambiance, des messages commerciaux, etc. Ce systme
pourra tre utilis pour diffuser un message prenregistr et ventuellement des messages
directs destins informer les occupants sur la situation, en fonction du risque et du type
dvacuation choisi (source du sinistre, son volution, la formation de groupes organiss,
les issues possibles, la prsence et la marche des secours,..). Le pr-enregistrement et la
prparation de messages-types doivent tre soigneusement labors.
Les dlais d'vacuation des btiments
Le temps prvoir pour lvacuation dpend du nombre de personnes, de leur mobilit,
ainsi que de la conception architecturale du btiment en gnral et des cheminements en
particulier. Il dpend aussi des mesures et moyens de protection en place et de
lorganisation de la scurit.
Les dlais sont donc propres chaque tablissement, mais la vitesse du feu tant, elle,
incontrlable, et, le plus souvent, extrmement leve, il est indispensable que ces dlais
soient le plus rduits possible.
Le temps disponible pour vacuer doit tre suprieur au temps rigoureusement ncessaire pour
rejoindre une sortie de secours, une zone refuge, compte tenu :
du dlai possible entre lclosion du feu et sa dtection (dtection automatique ou
visuelle) ;
du dlai d la transmission intrieure de lalerte ;
du dlai correspondant la prise de dcision ;
du temps de mise en mouvement.
Le dlai total est limit par le temps au bout duquel les conditions auront atteint un niveau
critique (fumes opaques/toxiques, baisse du taux doxygne, chaleur).
Des essais ont montr que les conditions intenables dues la fume apparaissent 3 7
minutes aprs lclosion dun foyer. Cest donc dans ce laps de temps que doivent tre traites
paralllement les oprations dextinction et dvacuation.
Le dbit est maximum lorsque la densit se situe entre 1 et 5 personnes par m. Au-del, il se
produit un embouteillage et le dbit diminue inversement la densit. Le temps net
dvacuation dpend du nombre dissues, de leur largeur et de la longueur des chemins
dvacuation. La fluidit est amliore par la largeur des dgagements et est ralentie par les
amnagements tels que les portes, escaliers, changements de direction, rtrcissements, et
surtout, par la rencontre de deux mouvements de personnes un confluent ou laccs un
escalier. Un phnomne de vote peut apparatre, en cas de bousculade au niveau des sorties,
il se produit lorsque la largeur des portes et des dgagements qui y mnent est insuffisante et il
se traduit par le blocage de lissue.
Lorganisation de lvacuation a galement une grande influence sur ce temps.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
4.4 Lorganisation interne des secours
Les actions qui consistent donner lalarme, alerter les secours extrieurs, assurer
lvacuation si ncessaire et intervenir dans la mesure du possible pour limiter le
sinistre, supposent une organisation pralable par :
la dsignation des personnes charges de les assumer ;
leur formation et leur entranement ;
llaboration de consignes et de plans de secours.
Cette organisation dpend des spcificits de ltablissement (effectif et nature des
occupants, configuration des locaux, moyens matriels) et de sa situation gographique par
rapport aux centres de secours extrieurs dont il dpend qui dtermine le dlai probable
dintervention. Elle devra, bien entendu, prendre en compte les prescriptions minimales
imposes par la rglementation tant en ce qui concerne les moyens humains que matriels.
4.4.1 Le cadre rglementaire et technique
La rglementation impose des mesures plus ou moins explicites suivant la nature de
ltablissement. Les plus prcises et dtailles concernent les tablissements dans lesquels
il y a lieu dassurer la protection du public.
Les btiments d'habitation
Les propritaires des immeubles dhabitation collective des familles 2 4 sont tenus de
respecter certaines obligations daffichage, dentretien et de vrification de toutes les
installations concourant la scurit et de pouvoir en justifier.
Les lieux de travail
Les moyens de prvention et de lutte contre lincendie qui sappliquent aux lieux de
travail sont cits dans le Code du travail.
Les chefs dtablissement sont surtout tenus une obligation de rsultat, puisquils doivent
prendre les mesures ncessaires pour que tout commencement dincendie puisse tre
rapidement et efficacement combattu dans lintrt du sauvetage du personnel , ce qui
implique videmment des moyens matriels et des moyens humains.
Sagissant des moyens dextinction, seuls des extincteurs portatifs sont nommment exigs. Les
autres moyens ncessaires sont laisss lapprciation du chef dtablissement, leur
localisation devant tre signale.
Certains tablissements doivent tre quips dun systme dalarme sonore et sont tenus
dafficher une consigne en cas dincendie dsignant notamment les personnes charges de
lalarme, de lalerte, de lintervention et des mesures dvacuation, ainsi que les essais et
visites priodiques du matriel et les exercices dentranement.
Certaines dispositions peuvent faire lobjet de prcisions par arrts ministriels. Cest le
cas des dispositions relatives la signalisation de scurit et de sant au travail, tant en
ce qui concerne les signaux visuels que les signaux acoustiques dalarme (arrt du 4
novembre 1993).
La circulaire du 14 avril 1995 exige que les matriels requis par la rglementation ou en
mesures compensatoires, soient conformes aux normes en vigueur. Lentretien doit en tre
assur suivant une priodicit approprie et de faon remdier dans les plus brefs dlais
toute dfectuosit.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Outre leurs obligations lies au Code du travail, certaines installations sont soumises la
lgislation relative aux ICPE. Dans ce cadre, certaines installations, notamment celles soumises
autorisation, peuvent tre obliges dtablir un Plan dopration interne (POI) en cas de
sinistre. Ce plan dfinit les mesures dorganisation, mthodes dintervention et moyens
ncessaires que lexploitant doit mettre en uvre pour protger personnel, populations et
environnement.
Enfin, certains tablissements dsigns sont tenus dassurer eux-mmes leur protection.
Les tablissements recevant du public
A larticle R.123-11, le CCH que Ltablissement doit tre dot de dispositifs dalarme et
davertissement, dun service de surveillance et de moyens de secours contre lincendie
appropris aux risques .
Le rglement ERP du 25 juin 1980 modifi en prcise les modalits.
Pour les tablissements des quatre premires catgories :
aux articles MS 45 MS 52, la composition et les missions du service de scurit
incendie, les prescriptions respecter pour les consignes et le poste de scurit. Un
arrt du 2 mai 2005 dfinit la qualification du personnel permanent des services de
scurit incendie des ERP ;
aux articles MS 70 MS 74, les rgles gnrales relatives aux liaisons avec les sapeurs-
pompiers et les prescriptions concernant lentretien, les vrifications et les contrles des
appareils ou dispositifs dextinction et dalerte ;
aux chapitres concernant les 4 catgories au Titre II du Livre II du rglement, pour les
dispositions particulires qui s'appliquent aux diffrents types d'ERP.
Pour les tablissements de la 5
e
catgorie : aux articles PE 27 (alarme, alerte, consignes), PE
33 et 35 pour les tablissements comportant des locaux sommeil, et PO 3 pour les htels.
Les immeubles de grande hauteur
Le Code de la construction et de lhabitation impose, dans les principes de scurit, que
limmeuble comporte un systme dalarme efficace ainsi que des moyens de lutte la
disposition des services publics de secours et de lutte contre lincendie et, sil y a lieu, la
disposition des occupants (art. R.122-9).
Parmi les obligations relatives loccupation des locaux, les propritaires doivent
entretenir correctement les installations (R.122-16), organiser un service de scurit
(R.122-17) et tenir un registre de scurit (R.122-29).
Le rglement de scurit du 18 octobre 1977 modifi prcise :
au titre I, chapitre II, section 9, les moyens dalarme, dalerte et de lutte contre
lincendie (articles GH49 GH57). Au chapitre III, les dispositions touchant aux
obligations des propritaires et occupants, notamment pour les vrifications
priodiques du matriel (GH59), le service de scurit (GH60, 62 et 63). La
qualification du personnel de scurit est fixe par larrt du 21 fvrier 1995 ;
au titre II, les dispositions particulires aux diverses classes dimmeubles :
- usage dhabitation (GHA 5 et 6),
- usage dhtel (GHO 3, 4, 5, 7, 8),
- usage denseignement (GHR 4 qui renvoie aux dispositions du rglement des ERP
pour les locaux concerns, GHR 11 et 12),
- usage sanitaire (GHU 2 qui renvoie aux dispositions du rglement des ERP pour les
locaux concerns, et GHU 16 20),
- usage de bureaux (GHW 5 et 6),
- usage mixte (GHZ 4 et 5, GHZ 6 8 pour ceux recevant du public).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
4.4.2 Les rgles techniques des assurances
Au-del des dispositions rglementaires qui visent essentiellement la sauvegarde des
personnes, il faut aussi mettre en uvre les mesures pour de garantir la sauvegarde des biens,
cest--dire, gnralement, de loutil de travail.
Un certain nombre de prescriptions ou rgles techniques dinstallation et dutilisation sont
destines amliorer lefficacit des moyens de lutte contre le feu, ainsi que des rgles
dorganisation destines assurer la surveillance des lieux et lintervention dquipes en cas de
sinistre. Il s'agit des documents APSAD.
Les documents APSAD
Rgle APSAD R1 Extinction automatique eau de type sprinkleurs
Rgle APSAD R3 Extinction automatique CO2
Rgle APSAD R4 Extincteurs mobiles
Rgle APSAD R5 Robinets d'incendie arms
Rgle APSAD R6 Service de scurit incendie
Rgle APSAD R7 Dtection automatique d'incendie
Rgle APSAD R8 Surveillance des risques d'une entreprise
Rgle APSAD R11 Abonnement prvention et conseil incendie
Rgle APSAD R12 Extinction automatique mousse
Rgle APSAD R13 Extinction automatique gaz
Document technique D14 Construction - Comportement au feu
Document technique D14-A Panneaux sandwich - Comportement au feu - Guide pour la mise en uvre
Rgles techniques T14-A Panneaux sandwich - Comportement au feu - Guide pour la mise en uvre
Rgle APSAD R15 Ouvrages sparatifs coupe-feu
Rgle APSAD R16 Fermetures coupe-feu
Rgle APSAD R17 Exutoires de fumes et de chaleur
Document technique D19 Thermographie infrarouge
Rgle APSAD R31 Tlsurveillance Vol-incendie
Rgle APSAD R41 Tlscurit Habitations Risques standard
4.5 Le service de scurit incendie
Chaque tablissement ayant ses caractristiques propres, on ne peut dfinir une quipe
de scurit-type. L'quipe sera dfinie en fonction de :
de leffectif et de la composition du personnel de ltablissement et ventuellement du
public admis ;
de la nature du risque ;
de limportance des moyens de protection fixes et mobiles ;
des secours extrieurs ;
des obligations rglementaires prcises pour les IGH et certains ERP.
Il existe des rgles d'organisation APSAD sur ce domaine :
la rgle APSAD R6 Service de scurit incendie pour lorganisation dun service de
scurit incendie ;
la rgle APSAD R8 Surveillance des risques d'une entreprise pour lorganisation dun service
incendie de gardiennage et surveillance.
4.5.1 Les missions du service de scurit incendie
Selon la taille de lentreprise et son activit, le service de scurit incendie est plac sous
lautorit dun chef de service la mission plus ou moins large. Le rle de ce chef de service,
charg de la scurit, comprend gnralement les missions suivantes :
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
tude et conseil auprs de la direction de lentreprise. Il doit tre en mesure
danalyser les risques propres ltablissement. Cela implique une bonne
connaissance des activits de lentreprise, des processus de fabrication, du
matriel, des installations, etc.
Cette fonction suppose galement une connaissance approfondie de la
rglementation, notamment en matire dhygine, scurit et prvention des
incendies, autant pour la construction et les amnagements que lexploitation, ainsi
que, le cas chant, la rglementation applicable aux installations classes ;
dfinition et mise en uvre dune politique de prvention, sous lautorit du chef
dtablissement ou dans le cadre dune dlgation lui en attribuant les moyens
matriels et financiers ( condition quil soit pourvu de la comptence et de
lautorit ncessaires).
Cette politique sera labore en liaison avec les services concerns pour le choix
des installations ou du matriel de scurit, les assureurs et, le cas chant, avec
les services techniques de maintenance, dans le respect de la rglementation, des
normes, des rgles des assurances, des agrments, etc. ;
accueil, information et formation du personnel nouvellement embauch, suivi de
la formation, constitution et entranement des quipes dintervention et
dvacuation ;
mise en place des procdures et des consignes dincendie ; laboration et mise
jour des plans de secours internes et des plans dvacuation en liaison avec les
services dincendie et de secours ;
organisation de la maintenance prventive, curative et corrective des installations
de scurit ; contrle de la vrification des matriels conformment la
rglementation et aux rgles des assurances ;
vrification de lapplication des mesures de prvention dans le cadre de travaux
raliss par des entreprises extrieures (plan de prvention, permis de travail), de
chargement et dchargement de marchandises, de travaux par point chaud (permis
de feu), audits de scurit, tenue des registres de scurit ;
liaison avec linspection du travail, la CRAM, et, le cas chant, avec linspecteur
des installations classes et les commissions de scurit ;
participation au Comit dhygine, de scurit et des conditions de travail, dont il
est membre consultatif (art. R.236-6 du Code du travail) ;
intervention en cas dincendie, daccidents ou dincidents.
La fonction de chef du service de scurit suppose que son titulaire possde lautorit
utile pour dialoguer avec les autres chefs de services de lentreprise : technique,
recherche et dveloppement, gestion, ressources humaines, etc.
Dans les entreprises importantes, ces missions peuvent tre rparties entre diffrents chefs
de service sous lautorit du chef dentreprise ou dun risk manager qui assure la
gestion globale des risques.
Dans les tablissements dont la taille ne justifie pas lemploi plein temps dun
spcialiste de la scurit, cette fonction pourra tre assure de manire ponctuelle par
des consultants extrieurs pour rsoudre des problmes spcifiques, la gestion courante
devant tre assure par une personne dsigne.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les missions du service de scurit incendie dans les ERP
Pour les ERP des quatre premires catgories, le rglement de scurit prcise,
larticle MS46, que les missions du service de scurit incendie, charg de
lorganisation gnrale de la scurit dans ltablissement, sont notamment :
dassurer la vacuit et la permanence des cheminements dvacuation jusqu la
voie publique ;
dassurer laccs tous les locaux communs ou recevant du public aux membres
de la commission de scurit lors des visites de scurit ;
dorganiser des rondes pour prvenir et dtecter les risques dincendie, y compris
dans les locaux non occups ;
de faire appliquer les consignes en cas dincendie ;
de diriger les secours en attendant larrive des sapeurs-pompiers, puis se mettre
la disposition du chef de dtachement dintervention des sapeurs-pompiers ;
de veiller au bon fonctionnement de tout le matriel de protection contre
lincendie, den effectuer ou den faire effectuer lentretien (extincteurs, quipements
hydrauliques, dispositifs dalarme et de dtection, de fermeture des portes, de
dsenfumage, dclairage de scurit, etc.) ;
de tenir jour le registre de scurit.
Les missions du service de scurit incendie dans les IGH
En IGH, le rle du service de scurit incendie est notamment (art. GH62) :
dassurer une permanence au poste de scurit mentionn larticle GH 50 ;
dassurer laccs tous les locaux communs ou recevant du public aux membres
de la commission de scurit ;
dorganiser des rondes pour prvenir et dtecter les risques dincendie, y compris
dans les locaux non occups ;
de faire appliquer les consignes en cas dincendie ;
de diriger les secours en attendant larrive des sapeurs-pompiers ; le chef de
service ou son remplaant se met ensuite aux ordres du chef de dtachement
dintervention des sapeurs-pompiers ;
de veiller au bon fonctionnement de tout le matriel de protection contre
lincendie, den effectuer ou den faire effectuer lentretien (extincteurs, quipements
hydrauliques, dispositifs dalarme et de dtection, de fermeture des portes, de
dsenfumage, etc.) et de tenir jour le registre de scurit ;
dinstruire, dentraner et de diriger le personnel charg dans certaines classes
dimmeubles de lapplication des consignes dvacuation et de lutilisation des
moyens de premiers secours dans chaque compartiment ;
de surveiller les travaux de transformation, dentretien et de nettoyage
susceptibles dentraner une gne dans lvacuation des personnes ou de crer des
dangers dincendie.
Dans certaines classes dimmeubles, le service central ou le service local peuvent
tre investis de missions particulires en raison de la nature de ltablissement.
Cest le cas notamment des immeubles usage sanitaire (GHU 20) et des
immeubles usage de bureaux (GHW 6).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
4.5.2 L'quipe de scurit incendie dans les tablissements
industriels ou commerciaux
Le risque incendie nest pas seulement li aux priodes dactivit de ltablissement.
En prsence du personnel, la dcouverte rapide du feu permettra une intervention
rapide, limitant les consquences du sinistre. En revanche, lors doprations de
nettoyage ou dentretien et en priode dinactivit, les consquences de lclosion
dun incendie seront gnralement trs graves.
Le chef dentreprise adoptera, pour son quipe de scurit incendie, une organisation
articule selon trois modes dintervention :
- la protection localise ;
- la protection tendue pendant les heures de travail ;
- la protection gnrale en dehors des heures de travail.
Pour tre efficace, lintervention, devra tre rapide et prcise. Le chef de service de
scurit incendie devra donc dterminer exactement les rles dvolus aux divers
participants.
4.5.2.1 quipiers de premire intervention
La toute premire intervention pourra tre effectue par le personnel dont le poste
de travail se trouve le plus proche de lendroit o se produit le dbut dincendie.
Dans ce but, on choisit les quipiers de premire intervention (EPI) parmi le
personnel des diffrents ateliers, magasins, etc. Ils ont pour rle de donner lalarme
au poste de surveillance et dintervenir immdiatement dans leur zone de travail,
avec les moyens disponibles (extincteurs mobiles et RIA) sur place pour limiter le
dbut dincendie.
La rgle APSAD R6 recommande au minimum un EPI sur 10 employs, rpartis
gographiquement de manire quil soit possible de runir en tout point de
ltablissement leffectif minimum de 2 personnes en moins de 1 minute.
Lalarme donne, les quipiers de seconde intervention (ESI) doivent intervenir dans
les dlais les plus courts afin de complter laction des quipiers de premire
intervention, dans lattente de larrive des secours extrieurs, en apportant et en
utilisant des moyens complmentaires.
4.5.2.2 quipiers de seconde intervention
Selon la rgle APSAD R6, le nombre des quipiers de seconde intervention, en
priode dactivit de lentreprise, est calcul partir dun effectif de base de trois
hommes, augment si ncessaire pour pouvoir mettre en uvre dans le cas o il
existerait :
une installation de RIA : 2 lances de 40 mm en moins de 3 minutes ;
un rseau dincendie hors gel : 3 lances de 40 mm en moins de 5 mn.
Si le dlai dintervention des secours extrieurs est compris entre 10 et 20 minutes,
leffectif ainsi dtermin doit tre doubl.
Dans les tablissements pour lesquels le dlai dintervention du centre de secours
principal est suprieur 20 minutes, il y aura lieu de disposer de moyens
complmentaires permettant de mettre en uvre 2 lances de 70 mm susceptibles
dassurer un dbit de 60 m
3
/h pendant une heure.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
En priode de repos ou de travail partiel, le nombre minimum dESI prsents dans
ltablissement devra tre gal leffectif minimum voqu ci-dessus, sans
appliquer le coefficient multiplicateur relatif au dlai dintervention.
Pendant les priodes de travail partiel, chaque fois que cela est possible, les effectifs des
EPI doivent tre maintenus (rgle APSAD R6).
4.5.2.3 Les agents de surveillance
Le nombre dagents de surveillance sera dtermin en fonction de ltendue de
lentreprise et de la gravit du risque. Leffectif doit tre suffisant pour pouvoir
permettre la permanence dun gardien, au moins, au poste de surveillance et le
droulement des rondes dans les conditions suivantes (rgle APSAD R8) :
immdiatement aprs la cessation du travail ou la fin du nettoyage si cette
opration suit larrt de travail. Dans le cas contraire, prvoir une ronde
immdiatement aprs la cessation du travail et une autre la fin du nettoyage ;
une heure aprs le dpart de tout le personnel ;
toutes les trois heures ensuite. Cette dernire condition peut ne pas tre exige
par les socits dassurances si ltablissement est quip dune installation de
dtection automatique conforme la rgle APSAD R7 Dtection automatique
dincendie et si leffectif de surveillance comprend au minimum 2 personnes en
permanence.
Le service de gardiennage et de surveillance, tel quil est dfini par la rgle
APSAD R8, assure deux missions, en tous lieux et pendant toutes priodes
dabsence dactivit totale ou partielle du personnel travaillant dans lentreprise :
une mission de prvention, qui consiste surveiller les locaux et installations,
appliquer les consignes de gardiennage, et chercher viter les sinistres dus la
malveillance ;
une mission consistant donner lalarme et lalerte, afin de prvenir les secours
intrieurs et/ou extrieurs en cas daccident ou de sinistre.
Lvacuation des occupants doit tre organise pour le cas o lordre en serait
donn. Les personnes dsignes pour encadrer le personnel et le public prsents
sont diffrentes de celles des quipes de premire et deuxime intervention.
4.5.2.4 Les responsables de lvacuation
Les responsables de lvacuation sont de deux types :
les chefs de file, ou guides, chargs de diriger un groupe de personnes vers la
sortie ou le lieu de rassemblement ;
les serre-files (ou derniers de la file), chargs de fermer la marche derrire le
groupe, dempcher tout retour en arrire et de vrifier quil ne reste personne
dans leur secteur dvacuation.
Une entreprise qui compte parmi ses employs des sapeurs-pompiers volontaires possde
videmment un avantage en cas de sinistre.
Cet avantage est reconnu par les pouvoirs publics qui permet aux socits dassurances
daccorder une rduction des primes dassurance incendie aux entreprises employant des
sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le prvoit larticle 9 de la loi du 3 mai 1996
relative au dveloppement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
4.5.3 L'quipe de scurit incendie dans ERP : obligations
Dans les ERP des quatre premires catgories, pendant la prsence du public :
une surveillance doit tre assure (MS 45) ;
un reprsentant de la direction doit tre prsent pour prendre, ventuellement, les
premires mesures de scurit (MS 52).
Suivant le type, la catgorie et les caractristiques des tablissements, le service de
scurit incendie doit tre assur soit par :
des employs dsigns par le chef dtablissement et entrans manuvrer les moyens de
secours contre lincendie et lvacuation du public ;
des agents de scurit incendie ;
des sapeurs-pompiers dun service public de secours et de lutte contre lincendie.
Lorsque le service de scurit incendie est assur par des agents de scurit incendie, ils
sont au moins au nombre de trois, dont un chef dquipe et, si des dispositions
particulires le prvoient, le service est plac sous la direction dun chef de service
spcifiquement affect cette tche (MS 46).
Une qualification spcifique est requise pour chacun de ces trois niveaux (agent de
scurit, chef dquipe et chef de service). Elle est dlivre dans les conditions spcifies
par un arrt 2 mai 2005.
En principe, la prsence dun chef de service de scurit incendie spcifiquement affect cette tche
nest obligatoire que pour les tablissements de soins de 1
re
catgorie ou lorsque ltablissement de
soins comprend plusieurs btiments et reoit plus de 1500 personnes au total (art.U 43).
Une quipe compose de personnels justifiant des deux premiers degrs de
qualification est requise dans les tablissements de 1
re
catgorie des types L (salles
de runions et de spectacles, art. L 14), M (magasins de vente et centres
commerciaux, art. M 29), T (salles dexposition, art. T5, T 48), S (bibliothques, art.
S 18), CTS (chapiteaux, tentes et structures itinrantes, art. CTS 27).
Dans dautres tablissements de 1
re
catgorie, de types P (salles de danse ou de
jeux) ou Y (muses) par exemple, des agents de scurit peuvent tre imposs par
la commission de scurit (art. P 21, Y 19).
Dans les ERP dispenss de lobligation demployer des agents qualifis, les
personnes dsignes pour assurer la scurit doivent tre instruites linitiative et
sous la responsabilit du chef dtablissement (MS 48). Ces employs doivent tre
entrans la mise en oeuvre des moyens de secours (articles P 21, O 20, N 17, W
13...).
Pour les tablissements de la 5
e
catgorie, un membre du personnel ou un
responsable au moins doit tre prsent en permanence lorsque ltablissement est
ouvert au public (PE 27). Sil sagit dun htel, cette permanence doit tre assure
dans un local dot soit du tableau de signalisation, soit dun report dalarme (PO
3).
Les services de scurit incendie assurs par les sapeurs-pompiers dans certains
tablissements (MS 49) rsultent en gnral, soit de lapplication de dispositions
rglementaires, soit de la dcision de lautorit administrative aprs avis de la
commission de scurit.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
4.5.4 L'quipe de scurit incendie dans les IGH : obligations
Le propritaire est tenu dorganiser un service de scurit unique pour lensemble
des locaux de limmeuble (art. R.122-17 du CCH). Le rglement prcise que le
service de scurit incendie doit tre mis en place ds le dbut des travaux de
second uvre, avec des moyens de secours appropris aux risques combattre
(art. GH 60).
Le chef ainsi que les agents permanents de ce service ne doivent jamais tre
distraits de leur fonction spcifique de scurit incendie et de maintenance
technique. Ils doivent tre relis en permanence avec le poste central de scurit et
pouvoir tre rassembls dans les meilleurs dlais. Ces postes ncessitent lune des
trois qualifications suivantes : agent de scurit incendie option IGH, chef dquipe
de scurit incendie option IGH ou chef de service de scurit incendie IGH, ces
qualifications tant dlivres aux conditions prcises par un arrt du 21 fvrier
1995.
La composition de lquipe de scurit incendie est prcise dans les dispositions
particulires chaque type dimmeuble aux articles :
GHA 6 pour les IGH usage dhabitation dans lesquels le service peut,
certaines conditions, tre commun plusieurs immeubles ;
GHO 7 pour les immeubles usage dhtel, o la composition du service est
dtermine en fonction de la capacit daccueil de limmeuble ;
GHR 12 pour les immeubles usage denseignement ;
GHU 20 pour les immeubles usage sanitaire ;
GHW 6 pour les immeubles usage de bureaux, la composition du service
dpend de la classe de limmeuble et de la surface des compartiments ;
GHZ 5 pour les IGH usage mixte, o les dispositions retenir sont les plus
exigeantes de celles prescrites pour les diverses activits quils abritent.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Rcapitulatif des recommandations des assurances
selon les rgles APSAD R6 et R8
S
e
r
v
i
c
e
d
e
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
c
o
n
f
o
r
m
e
l
a
r
g
l
e
A
P
S
A
D
R
8
S
e
r
v
i
c
e
d
e
s
c
u
r
i
t
i
n
c
e
n
d
i
e
r
g
l
e
A
P
S
A
D
R
6
A
g
e
n
t
s
d
e
s
c
u
r
i
t
E
S
I
S
e
c
o
n
d
e
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
E
P
I
P
r
e
m
i
r
e
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
P
r
i
o
d
e
T
y
p
e
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
O
u
i
S
u
r
a
c
c
o
r
d
e
t
f
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
l
'
a
s
s
u
r
e
u
r
,
l
a
c
e
n
t
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
m
o
y
e
n
s
d
'
a
l
a
r
m
e
p
e
u
t
t
r
e
r
a
l
i
s
e
v
e
r
s
u
n
p
o
s
t
e
o
c
c
u
p
e
n
p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
.
N
o
n
e
x
i
g
s
L
e
s
m
i
s
s
i
o
n
s
d
e
s
E
S
I
p
e
u
v
e
n
t
t
r
e
a
s
s
u
r
e
s
p
a
r
d
e
s
a
g
e
n
t
s
d
e
s
c
u
r
i
t
-
3
h
o
m
m
e
s
p
a
r
s
q
u
e
n
c
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
p
o
u
r
m
i
s
e
e
n
u
v
r
e
d
e
2
R
I
A
e
n
m
o
i
n
s
d
e
3
m
i
n
u
t
e
s
-
6
h
o
m
m
e
s
s
i
d
l
a
i
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
u
p
r
i
e
u
r
1
0
m
i
n
u
t
e
s
-
n
o
m
b
r
e
a
u
g
m
e
n
t
s
i
m
o
y
e
n
s
d
e
s
e
c
o
u
r
s
s
u
p
p
l
m
e
n
t
a
i
r
e
s
e
x
i
g
s
1
0
%
d
e
l
'
e
f
f
e
c
t
i
f
p
a
r
s
e
c
t
e
u
r
d
e
f
a
o
n
p
o
u
v
o
i
r
r
u
n
i
r
2
E
P
I
e
n
m
o
i
n
s
d
'
1
m
i
n
u
t
e
d
a
n
s
u
n
s
e
c
t
e
u
r
A
c
t
i
v
i
t
O
u
i
U
n
e
d
r
o
g
a
t
i
o
n
s
u
r
l
a
p
r
s
e
n
c
e
d
'
u
n
a
g
e
n
t
d
e
s
c
u
r
i
t
p
e
u
t
t
r
e
a
c
c
o
r
d
e
e
t
f
o
r
m
a
l
i
s
e
p
a
r
l
'
a
s
s
u
r
e
u
r
s
i
l
e
s
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
u
r
i
t
i
n
c
e
n
d
i
e
s
o
n
t
r
e
l
i
e
s
u
n
e
s
t
a
t
i
o
n
d
e
t
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
e
t
s
i
u
n
e
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
e
s
t
p
r
v
u
e
.
N
o
n
e
x
i
g
s
N
o
n
e
x
i
g
s
N
o
n
e
x
i
g
s
I
n
a
c
t
i
v
i
t
T
y
p
e
1
L
e
s
e
r
v
i
c
e
d
e
s
c
u
r
i
t
i
n
c
e
n
d
i
e
e
s
t
a
s
s
u
r
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
p
r
i
o
d
e
s
d
'
a
c
t
i
v
i
t
d
e
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
O
u
i
I
d
e
m
T
y
p
e
1
a
c
t
i
v
i
t
O
u
i
L
a
m
i
s
s
i
o
n
d
e
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
p
e
u
t
t
r
e
a
s
s
u
r
e
p
a
r
u
n
a
g
e
n
t
d
e
s
c
u
r
i
t
i
n
c
e
n
d
i
e
A
u
m
o
i
n
s
3
N
o
n
e
x
i
g
s
N
o
n
e
x
i
g
s
I
n
a
c
t
i
v
i
t
T
y
p
e
2
L
e
s
e
r
v
i
c
e
d
e
s
c
u
r
i
t
i
n
c
e
n
d
i
e
e
s
t
a
s
s
u
r
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
p
r
i
o
d
e
s
d
'
a
c
t
i
v
i
t
e
t
d
'
i
n
a
c
t
i
v
i
t
d
e
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
4.5.5 Modle de liste d'inspections raliser
par le service de scurit incendie
Ce modle peut servir de base l'tablissement d'une liste d'inspection qui doit tre ralise en
fonction des risques existants et tre adapte chaque tablissement (extrait de la rgle
APSAD R6).
Extrieurs :
accessibilit des secours ;
absence de palettes ou stockages moins de 10 mtres des faades ;
bennes dchets et rgularit de leur enlvement ;
accessibilit et tat des poteaux incendie ;
bassins de rtention des eaux d'incendie ;
rserves d'eau ;
dbroussaillage priphrique aux btiments, etc.
Consignes gnrales :
propret gnrale ;
affichage des consignes de scurit ;
respect de l'interdiction de fumer ;
prsence de cendriers dans les zones fumeurs ;
poubelles ;
respect de la procdure de permis de feu, etc.
Protection contre l'incendie :
manuvre des portes de sorties de secours ;
test des sirnes d'vacuation ;
contrle du service de gardiennage ;
tat des portes coupe-feu ;
colmatage dans les parois coupe-feu (dont faux plafonds et faux planchers) ;
extincteurs mobiles ;
robinets d'incendie arms ;
installation de dtection incendie ;
tat des systmes d'alarme et d'alerte ;
extinction automatique eau ;
extinction automatique gaz, etc.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Locaux particuliers :
locaux techniques ;
stockage de produits dangereux ou inflammables ;
implantation des chargeurs de batteries ;
armoires lectriques ;
chaufferie ;
local sprinkleurs ;
lieu de stockage des bouteilles de gaz, etc.
Divers :
mises la terre ;
tat des installations lectriques ;
tat des canalisations et raccords des fluides du process ;
points de contrle du process ;
ventilation de locaux spcifiques, etc.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
5 RDIGER LES CONSIGNES DE SCURIT
5.1 Les consignes gnrales et particulires
relatives la scurit incendie
Il importe, lorsquun incendie se dclare, que chacun sache ce quil doit faire. En tous lieux, y
compris dans les btiments dhabitation, la rglementation impose llaboration de consignes
en cas dincendie.
Les btiments d'habitation
Obligation est faite aux propritaires des btiments dhabitation dafficher dans les halls
dentre, prs des accs aux escaliers et aux ascenseurs :
les consignes respecter en cas dincendie ;
les plans des sous-sols et du rez-de-chausse.
Les consignes particulires chaque type dimmeuble doivent tre galement affiches
dans les parcs de stationnement, proximit des accs aux escaliers et aux ascenseurs ;
Les lieux de travail
Llaboration dune consigne en cas dincendie est obligatoire pour les tablissements
o peuvent se trouver occupes ou runies habituellement plus de 50 personnes, ainsi
que ceux, quelle que soit leur importance, o sont manipules et mises en uvre des
matires inflammables cites larticle R.232-12-14 (substances ou prparations
classes explosives, comburantes ou extrmement inflammables, ainsi que des matires
dans un tat physique susceptible dengendrer des risques dexplosion ou dinflammation
instantane).
Cette consigne gnrale qui concerne la totalit de ltablissement est applicable
lensemble du personnel, y compris les stagiaires et les intrimaires, ainsi quaux visiteurs. Elle
doit contenir au minimum les informations suivantes :
Toute personne apercevant un dbut dincendie doit donner lalarme et mettre en
uvre les moyens de premiers secours, sans attendre larrive du personnel
spcialement dsign ;
la nature et lemplacement des moyens dextinction et de secours situs dans le local ou
ses abords, ainsi que le personnel charg de le mettre en action ;
pour chaque local, la liste des personnes charges de diriger lvacuation du
personnel et ventuellement du public et, le cas chant, les mesures spcifiques lies
la prsence de handicaps,
les moyens dalerte, ladresse et le numro dappel tlphonique des sapeurs-pompiers
et les personnes charges de les aviser.
La consigne doit, en outre, prvoir les essais et visites priodiques du matriel et les
exercices dentranement du personnel (art. R.232-12-21). Elle doit tre communique
linspecteur du travail.
Dans la majorit des cas, on tablira paralllement des :
consignes particulires dincendie spcifiques certains travaux ou
certains locaux. Elles nintressent quun personnel spcialis et dsign : personnel
effectuant des travaux par point chaud, laboratoires, ateliers et entrepts contenant des
matires inflammables, chaufferie, etc. ;
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
consignes spciales destines des personnes dtermines et auprs
desquelles elles doivent tre diffuses nommment, leur indiquant prcisment les modalits
dexcution des missions qui leur incombent en cas dincendie : quipiers de premire et de
seconde intervention, membres du service de surveillance et de gardiennage, standardistes,
personnes charges de lorientation des sapeurs-pompiers, charges de lvacuation,
secouristes, personnes devant assurer des manuvres particulires (fermeture de vannes,
coupures de circuits, mise en scurit dinstallations, etc.) ;
La rgle APSAD R6 Service de scurit incendie, fournit les lments ncessaires
lorganisation dun service de scurit incendie. Deux types dorganisation sont prvus, selon
que lintervention peut avoir lieu en permanence ou seulement pendant les priodes dactivit.
Un service de scurit organis selon la rgle APSAD R6 doit notamment effectuer des exercices
dextinction de feux rels laide de matriels analogues ceux dont dispose ltablissement.
Pour tre pris en considration par lassureur , le service de scurit de scurit doit tre
organis conformment cette rgle et mis en place paralllement un service de surveillance
des risques dfini par la rgle APSAD R8.
Les ERP
Dans les ERP des consignes prcises conformes la norme NF S 60-303 relative aux
plans et consignes de protection contre l'incendie, destines au personnel de
l'tablissement, constamment mises jour, affiches sur supports fixes et inaltrables
doivent indiquer :
- les modalits dalerte des sapeurs-pompiers,
- les dispositions prendre pour assurer la scurit du public et du personnel,
- la mise en oeuvre des moyens de secours de ltablissement,
- laccueil et le guidage des sapeurs-pompiers.
Les IGH
Les propritaires des IGH doivent tablir et afficher les consignes dincendie dans les
circulations horizontales communes prs des accs aux escaliers et aux ascenseurs .
Dans certaines classes dimmeubles, certaines dispositions destines aux ERP
sappliquent, notamment dans les IGH usage denseignement (GHR 4), dans les IGH
usage sanitaire (GHU 2), dans les IGH usage dhtel (GHO 3), dans les IGH
recevant du public (GHZ 6).
Modle de consigne gnrale de scurit incendie
La consigne gnrale de scurit incendie doit comporter :
la dsignation du matriel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou
ses abords ;
la dsignation du personnel charg de mettre ce matriel en action ;
pour chaque local la dsignation des personnes charges de diriger l'vacuation du
personnel et ventuellement du public, ainsi que des prcisions sur les mesures
spcifiques lies la prsence de handicaps ;
l'indication des moyens d'alerte ;
la dsignation des personnes charges d'aviser les sapeurs-pompiers ds le dbut de
l'incendie ;
l'adresse et le numro tlphonique d'appel du service de secours du premier appel (en
gros caractre) ;
l'indication suivante : toute personne apercevant un dbut d'incendie doit donner
l'alarme et mettre en uvre les moyens de premiers secours, sans attendre l'arrive du
personnel spcialement dsign .
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Exemple de consignes de scurit
Secours extrieurs les plus proches : - 18
Gardez votre calme, dclenchez
l'alarme et tlphoner au :
- Numro interne
Lors de votre appel, indiquez l'endroit
o vous vous trouvez :
Adresse, tage, local
Fume, odeur suspecte, tlphonez
au :
Numro interne
Quelques principes : - Conservez libres les dgagements
- N'encombrez pas les extincteurs
- Fermez les portes ou fentres en quittant votre lieu de travail
En cas d'incendie :
- Toute personne apercevant un dbut d'incendie doit donner l'alarme
et mettre en uvre les moyens de premiers secours, sans attendre
l'arrive du personnel spcialement dsign
- Attaquez le foyer au moyen d'extincteurs, sans prendre de risques
- Si vous tes bloqu dans la fume, baissez-vous, l'air est prs du sol
- N'utilisez pas les ascenseurs ou monte-charges pour vacuer
- Fermez les portes ou fentres en quittant votre lieu de travail
Personnels de premire intervention : M. xxx
M
me
xxx
Guides d'vacuation : M. xxx
M
me
xxx
vacuation
vacuez, ds l'ordre d'vacuation ou
l'audition du signal :
Signalisation (sirne, message enregistr)
Consignes : - Suivez les indications du guide d'vacuation
- N'utilisez pas les ascenseurs ou les monte-charges
- Ne revenez jamais en arrire sauf si vous y tes invit par les secours
Zone de rassemblement Adresse, indication du lieu de rassemblement prvu
5.2 Les normes applicables
La norme NF S 60-303 ( Plans et consignes affichs ) dfinit les principales
caractristiques auxquelles doivent rpondre les consignes et plans de scurit incendie
affichs. Elle sapplique quels que soient les types de locaux et la destination des
tablissements (habitations, locaux de travail, ERP, IGH, parcs de stationnement
couverts).
Cette norme indique notamment :
les caractristiques des plans de scurit-incendie affichs (plans d'vacuation et plans
d'intervention) ;
les consignes gnrales en cas dincendie pour les habitations ;
les consignes afficher dans les htels (non IGH) ;
les consignes destines au public dans les ERP ;
les lments devant figurer sur les plans dvacuation ;
les lments devant figurer sur les plans dintervention ;
les caractristiques graphiques et les procds de reproduction recommands et interdits ;
les emplacements respecter pour laffichage des consignes et des plans.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les symboles graphiques employer pour indiquer lemplacement et rpertorier les
quipements de protection et de lutte contre lincendie et les moyens dvacuation font lobjet
de la norme NF ISO 6790.
Le plan dvacuation indique les cheminements vers la sortie, lemplacement des issues de
secours et du matriel de premire intervention contre lincendie (alarme, extincteurs, robinets
dincendie arms, commandes de dsenfumage...). Il doit tre appos chaque niveau,
proximit des portes, escaliers et ascenseurs. On veillera ce quil soit bien orient par rapport
au lecteur.
Les lments devant figurer sur le plan dintervention, destin aux quipes de secours,
dpendent essentiellement de la nature des locaux et devront, si ncessaire, tre tudis en
liaison avec les services dincendie et de secours.
Consigne gnrale et plan dintervention peuvent figurer sur le mme panneau.
5.3 Les autres consignes de scurit
Les consignes de scurit relatives la conduite tenir en cas dincendie sont
obligatoires. Il existe galement des consignes destines rappeler les mesures prventives.
Celles-ci seront plus ou moins svres suivant lactivit de ltablissement. Leur rdaction doit
tre tudie avec soin tant sur le fond que sur la forme.
Parmi les consignes de scurit propres ltablissement, certaines sappliquent
lensemble du personnel, dautres sont spcifiques certains locaux ou certaines
tapes de lexploitation (manutention, stockages, fabrication, gestion des dchets,
entretien...).
La consigne sappliquant lensemble de ltablissement porte notamment sur :
linterdiction de fumer, de porter des feux nus ou des outillages pouvant constituer des
sources dinflammation ;
les conditions dans lesquelles les travaux peuvent tre autoriss et excuts ;
linterdiction de transporter certaines substances dangereuses dans certaines zones ;
lobligation de maintenir un parfait tat dordre et de propret ;
lobligation de dposer les dchets dans des rcipients prvus cet effet,
lobligation de porter des vtements de protection ;
lobligation de maintenir fermes des portes coupe-feu ou de ne pas les bloquer ;
linterdiction dobstruer les alles de circulations ;
les mesures observer pour la circulation et le stationnement des vhicules lintrieur
de ltablissement
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
6 ORGANISER DES EXERCICES DE SCURIT
INCENDIE POUR LES SALARIS
6.1 Informer et sensibiliser
Pour assurer lefficacit des consignes et des procdures, il est indispensable de les
complter par des informations prcises. La conduite tenir en cas dincendie doit tre
largement expose au personnel et aux occupants permanents dun tablissement ou
dun immeuble et assortie dexercices dvacuation. Linformation et la formation doivent
permettre au personnel dagir avec calme, prcision et rapidit.
Les obligations sont les suivantes dans les lieux de travail :
le code du Travail impose de donner tout salari, ds son arrive dans
ltablissement, les informations, enseignements et instructions ncessaires en ce qui
concerne les conditions de circulation dans lentreprise, lexcution de son travail et les
dispositions quil doit prendre en cas daccident ou de sinistre.
En fonction des risques prvenir, lutilit des mesures de scurit prescrites doit lui
tre explique.
Il y a lieu galement de lui prciser les issues et dgagements de secours et de lui
donner, si la nature des activits le justifie, des instructions dvacuation pour les cas
dexplosion ou de dgagement de gaz ou liquides inflammables ou toxiques (L.2313-1
et R.231-32 R.231-45). Une partie de cette information peut tre dispense par
lintermdiaire du livret daccueil ;
La rgle APSAD R6, sur lorganisation dun service de scurit incendie, prcise que
lensemble du personnel doit recevoir une information concernant :
- les risques de son entreprise ;
- la connaissance des consignes (alarme, intervention, vacuation) ;
- le matriel de premire intervention.
Il est souhaitable de complter ces informations par des lments de connaissance des
mcanismes du feu et du mode daction des agents extincteurs.
Dans certains ERP, notamment les tablissements de soins, le personnel doit tre
particulirement
mis en garde des risques et tre inform des consignes trs prcises.
Dans les IGH, obligation est faite au propritaire dinformer les occupants des
conditions dans lesquelles est assure la protection contre lincendie de limmeuble et de
leur rappeler limportance du respect des diverses dispositions de scurit . Le
propritaire doit notamment informer les occupants quils ne doivent ni entreposer ni
manipuler des matires inflammables du premier groupe dfinies larticle R.233-14 du
Code du travail, sauf exceptions prvues par le rglement de scurit (R.122-7 du CCH).
Il doit galement leur rappeler quils ne peuvent apporter aux lieux lous aucune
modification contraire aux dispositions du rglement et quils doivent sassurer que le
potentiel calorifique des lments mobiliers introduits dans les locaux qui leur sont
affects nexcde pas les limites dfinies (R.122-18 et GH 61).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
6.2 Former et entraner
Suivant le rle qu'ils sont appels jouer en cas d'incendie, personnel et occupants
doivent recevoir une formation et participer des exercices destins limiter le sinistre et
faciliter le sauvetage.
La formation minimale consiste comprendre les consignes, savoir donner lalarme,
reconnatre lalarme, tre capable dutiliser un extincteur et connatre les procdures
dvacuation.
La formation complmentaire sera adapte au rle dvolu chacun, un programme trs
prcis tant prvu dans certains cas, soit par la rglementation, soit par les assureurs.
Les exercices sont le seul moyen de vrifier si les plans dalarme, dvacuation et dintervention
sont bien adapts aux particularits du lieu et aux personnes charges de les appliquer.
Dans les tablissements assujettis au Code du travail, le chef dtablissement est tenu
dorganiser une formation pratique et approprie en matire de scurit. Ltendue de
cette obligation dpend de la taille de ltablissement, de la nature de son activit, du
caractre des risques qui y sont constats et du type des emplois occups par les salaris.
Les modalits de la formation la scurit incendie sont prcises dans le code du
Travail l'article R. 232-12-21.
Des exercices sont obligatoires pour lensemble du personnel dans le but dapprendre
reconnatre les caractristiques du signal sonore dalarme gnrale, se servir des
moyens de premiers secours et excuter les diverses manuvres ncessaires. Ces
exercices et essais priodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Si lexercice
dvacuation prsente des risques pour la scurit des personnels ou pose des problmes
sur la voie publique (milieu urbain, personnel bancaire), il est admis quil ne soit pas
men chaque fois son terme.
Dans chaque atelier o sont effectus des travaux dangereux et dans chaque chantier
occupant au moins 20 personnes pendant plus de 15 jours o sont effectus des travaux
dangereux, un des membres du personnel doit avoir reu linstruction ncessaire pour
donner les premiers secours en cas durgence.
Dans les tablissements recevant du public
Pour lensemble du personnel, des exercices dinstruction doivent tre organiss sous
la responsabilit de lexploitant .
Cette instruction sur la conduite tenir ainsi que lentranement la manuvre des
moyens de secours est galement requise pour les tablissements de 5
e
catgorie.
Dans certains types dtablissement, des exercices pratiques doivent avoir lieu tous les
trimestres, notamment dans les tablissements de soins et denseignement, les lves y
tant associs dans ce dernier cas.
Les personnes dsignes pour assurer la scurit doivent tre entranes la manuvre
des moyens de secours contre lincendie et lvacuation du public. Cette instruction
doit tre conduite linitiative et sous la responsabilit du chef dtablissement.
Les personnels permanents du service de scurit incendie doivent, pour justifier de leur
qualification, tre titulaire du diplme requis pour exercer l'emploi, tel que dfini dans larrt
du 2 mai 2005 relatif la qualification du personnel permanent des services de scurit
incendie des tablissements recevant du public .
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Ces diplmes sont les suivants :
pour l'agent de service de scurit incendie, le diplme d'agent de scurit incendie et
d'assistance personnes (SSIAP 1) ;
pour le chef d'quipe de service de scurit incendie, le diplme de chef d'quipe de scurit
incendie et d'assistance personnes (SSIAP 2) ;
pour le chef de service de scurit incendie, le diplme de chef de service de scurit incendie
et d'assistance personnes (SSIAP 3).
La formation ces diplmes ne peut tre effectue que par des organismes agrs par le
ministre de lIntrieur comme cest le cas pour le CNPP.
Dans les IGH
Pour lensemble des locaux de limmeuble, le propritaire est tenu dorganiser, au moins une
fois par an, un exercice dvacuation de chaque compartiment, en y associant les
compartiments suprieur et infrieur, ainsi que des sances destines familiariser les
occupants avec lemploi des moyens de secours.
Dans les immeubles usage sanitaire, des exercices dvacuation doivent tre
pratiqus chaque trimestre .
Les personnels permanents de lquipe de scurit incendie doivent, pour justifier de leur
qualification, tre titulaire du diplme requis pour exercer l'emploi, tel que dfini dans larrt
du 2 mai 2005 relatif la qualification du personnel permanent des services de scurit
incendie des immeubles de grande hauteur auprs dun organisme agr.
6.3 Les exercices et procdures d'vacuation
Les exercices dvacuation prvus ou inopins permettront, soit de confirmer le bien-fond des
mesures et des consignes labores, soit de les radapter en fonction des problmes
dcouverts (audibilit de lalarme en tous lieux, rapidit de lalerte, choix et balisage des
cheminements, clart et validit des consignes). Ils pourront tre mens avec le concours des
sapeurs-pompiers.
Les exercices d'vacuation sont indispensables, que ce soit pour entraner le personnel
vacuer aprs avoir effectu ventuellement les oprations pralables ncessaires ou pour
lentraner diriger correctement et calmement le public dune salle de spectacle, dun
magasin ou de tout autre lieu vers les sorties.
En cas de sinistre dclar, la dcision dvacuation revient au responsable de
ltablissement ou, en son absence, la personne qui a t dlgue pour le faire.
Lorsque lalarme gnrale a t dclenche grce un systme automatique, si celui-ci
dispose dune temporisation, il est possible de confirmer ou non la ncessit dvacuer ;
dans le cas contraire, le processus peut tre arrt par le personnel de scurit charg de
faire la reconnaissance.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
7 CONTRLER SES INSTALLATIONS
7.1 Contrles du respect des mesures de prvention
Les contrles ont un double but, sassurer de lefficacit des mesures prises et maintenir le
systme de rfrence tabli. Il faut ainsi associer chaque barrire mise en place le contrle
ncessaire son respect permanent.
Les contrles doivent sexercer tant au niveau matriel qu celui des comportements.
On constate que, mme dans les activits trs haut risque, si aucun accident na eu
lieu, le personnel a naturellement tendance, au bout dun certain temps, ne plus
respecter les procdures, partant du principe tout fait inconscient que si le danger ne
sest pas ralis, il ne se produira pas (accoutumance au danger, perte de perception
de sa gravit...).
Lencadrement doit aider chacun lutter contre sa tendance naturelle au relchement, le
seul moyen de conserver un bon niveau de scurit tant de ne tolrer aucune drive.
Le niveau de rfrence dfini lissue de lanalyse des risques doit donner lieu ltablissement
dune check-list ou liste de contrle dfinissant une procdure de visite systmatique de
toutes les surfaces de ltablissement, en une priode dtermine et renouvelable plusieurs fois
dans lanne, ltablissement tant dcoup en secteurs quotidiens de contrles.
Le contrle implique la vrification des principaux lments suivants (le dtail de chaque
lment est adapter chaque secteur. La tche est dautant plus aise que la liste prpare
est complte) :
propret des sols et de toutes les surfaces de travail et de manutention, niveau
dempoussirement de lensemble, y compris des lments de charpente, vacuation
des dchets ;
ordre (chaque chose sa place, rien qui ne soit absolument ncessaire) ;
matires dangereuses : respect des quantits, tat des rcipients, rtention,
incompatibilits, atmosphre, sources de chaleur ;
quipements lectriques et de chauffage ;
contrles de la validit des consignes et procdures, de leur parfaite connaissance
(questions inopines) par le personnel, y compris les nouveaux travailleurs, et de leur
bon tat de lisibilit ;
contrle de lapplication des mesures lgales.
Le contrle ne doit surtout pas tre assimil une tche administrative. La liste est un outil de
base, un support qui ne dispense pas douvrir lil et dtre lcoute pour recueillir des
informations : anomalies, tat du matriel, modifications apporter En dehors de ces visites
systmatiques, le service charg de la scurit doit avoir constamment un rflexe de contrle,
en tous moments et en tous lieux.
Chaque contrle doit donner lieu un rapport succinct ( laide de la liste prtablie,
sans oublier les commentaires sur les lments non prvus dans la liste) qui servira doutil
de dcision pour les mesures prendre, le cas chant. Il sera ensuite conserv par le
Service de scurit et utilis lors de la visite suivante de ces mmes surfaces.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
7.2 La surveillance
L'exprience montre quune grande majorit des sinistres nat au cours des heures de
fermeture, particulirement au dbut de cette priode.
Des instructions prcises doivent tre donnes au personnel charg de la surveillance en
dehors des heures douverture de lentreprise. Une liste de contrles spcifique doit leur
tre remise et ils sont tenus informs des vnements occasionnels devant donner lieu
surveillance particulire (travaux par point chaud, anomalie dcele en attente de
traitement).
Des instructions prcises sont galement donnes pour la surveillance des entrepts,
particulirement vulnrables en raison du nombre rduit de personnes y travaillant, de la
circulation des engins de manutention, et de la tentation que certains peuvent avoir dy
fumer
Cette surveillance permet de dtecter temps les ventuelles fuites provoques par un dfaut
demballage ou une faute de manutention, les fermentations susceptibles daboutir une
inflammation, les chauffements
Il est galement ncessaire de surveiller les stockages demballages vides souvent
constitus de matriaux minemment inflammables (cartons, papiers, paille, matires
plastiques).
La liste des produits et les plans de stockage doivent tre fournis au personnel charg de
la surveillance des entrepts, avec les prescriptions relatives aux mesures prendre en
fonction de la nature des produits en cas de fuite ou de dbut dincendie. Un feu
pouvant couver pendant des heures, cet aspect de la prvention est trs important.
7.3 Maintenance et prvention incendie
Les contrles rvlent invitablement des dfaillances de divers ordres par rapport au
niveau de rfrence quil sagit de conserver. Ils doivent tre suivis d'actions correctives.
Des modifications ont pu donner lieu la naissance de nouveaux risques ncessitant des
actions prventives.
Cest un rle de coordination que doit jouer le service de scurit, entre la direction et
les diffrentes units oprationnelles concernes, notamment le service charg de la
maintenance, pour engager des actions destines maintenir le niveau de scurit
requis :
sur les quipements et le matriel ;
sur les procds de fabrication ;
sur les oprations dentretien ;
sur les affichages et moyens de signalisation dfrachis ou obsoltes, etc.
Lorsque les fonctions sont spares, linterface entre la fonction scurit et la fonction
maintenance doit tre soigneusement dfinie afin que le programme de prvention
puisse sappuyer sur lune et sur lautre.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
7.4 Labonnement prvention et conseil incendie (APCI)
Labonnement prvention et conseil incendie (APCI) est une prestation ayant pour objet
de dvelopper la prvention et la protection dans les tablissements et/ou entreprises
industriels et commerciaux en sensibilisant leurs responsables la prise en compte des
risques dincendie et dexplosion.
Ces missions ont pour but d'offrir aux exploitants des tablissements industriels et commerciaux
un service visant renforcer le niveau de prvention et de protection de leurs entreprises contre
les risques d'incendie et d'explosion.
La mission consiste en des visites annuelles effectues par des ingnieurs et techniciens de
lorganisme dont la mission est de procder lanalyse de vulnrabilit face aux risques
prcits, de proposer des mesures adaptes, puis de vrifier priodiquement que la
prconisation des mesures a t suivie deffets.
La rgle dorganisation APSAD R11 dfinit les recommandations pour la ralisation des missions
de prvention et de conseil en incendie ralises par un organisme de prvention incendie.
Cette rgle dapplication volontaire est destines tous les usagers, organismes consultants ou
assureurs qui souhaitent sassurer de la qualit des missions APCI.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
8 LE REGISTRE DE SCURIT
La tenue de registres de scurit constitue une obligation gnrale. Les registres constituent la
mmoire de la scurit et le carnet de sant des moyens de prvention et de protection.
Suivant la nature de ltablissement, plusieurs registres se rapportant la scurit peuvent
coexister. Dans tous les cas, ils doivent comporter un minimum de renseignements obligatoires.
8.1 Les registres dans les btiments usage dhabitation
Parmi les obligations incombant aux propritaires des immeubles usage dhabitation,
figure la tenue dun registre attestant de lentretien rgulier et de la vrification annuelle
des installations, amnagements et dispositifs mcaniques mis en place pour permettre la
protection des habitants (art. R. 111-13 du Code de la construction et de lhabitation et
art. 101 de larrt du 31 janvier 1986 modifi).
8.2 Les registres dans les tablissements
assujettis au code du Travail
Les registres obligatoires ayant trait, directement ou indirectement, la scurit incendie
sont tenus sous la responsabilit du chef.
8.2.1 Le registre relatif aux vrifications et contrles
Les attestations, consignes, rsultats et rapports relatifs aux vrifications et contrles mis
la charge des employeurs au titre de lhygine et de la scurit doivent tre conservs.
Les inspecteurs du travail et les agents de la CRAM peuvent se faire prsenter ces
documents au cours de leurs visites. Cette mesure concerne notamment :
les essais et visites priodiques du matriel de scurit incendie qui doivent tre
consigns sur un registre sur lequel sont galement reports les exercices
dentranement du personnel (reconnaissance de lalarme, utilisation des moyens de
premier secours et diverses manuvres ncessaires). Doivent figurer sur ce registre, les
dates des essais et exercices, ainsi que les observations auxquelles ils peuvent avoir
donn lieu (R.232-12-21).
De leur ct, les socits dassurances demandent que soit consign sur ce registre le
compte rendu des sances dentranement des EPI et des ESI (rgle APSAD R6), quy soit
intgr ou annex le registre dinstallation de dtection automatique dincendie (rgle
APSAD R7) ;
le rsultat des vrifications priodiques auxquelles sont soumis certains quipements de
travail et destines dceler en temps utile toute dtrioration susceptible de crer des
dangers (R.233-11).
Pour certains quipements de travail, la tenue dun carnet de maintenance est galement
requise (R.233-12) :
le rsultat des vrifications priodiques auxquelles sont soumis certains quipements de
protections individuels (R.233-42-2) ;
les contrles priodiques et les interventions relatifs aux installations et dispositifs techniques et
de scurit des lieux de travail prvu larticle R.232-1-12.
Ce dossier regroupe galement la consigne dutilisation et les documents relatifs au
contrle des installations de ventilation, au contrle de lexposition au bruit et les rgles
dentretien priodique du matriel dclairage. Il est, le cas chant, annex au dossier
de maintenance.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Les installations lectriques, qui doivent, ainsi que le prvoit larticle 55 du dcret n 88-1056
du 14 novembre 1988 modifi relatif la protection des travailleurs dans les tablissements
qui mettent en uvre des courants lectriques, faire lobjet dun dossier comportant, outre des
plans de situation, le plan des canalisations lectriques enterres, un registre consignant les
dates et nature des vrifications ou contrles ainsi que lidentit des intervenants, les rapports
des vrifications et les justifications des travaux et modifications.
Tous ces documents sont prsents au CHSCT au cours de la runion qui suit leur
rception par lemployeur (R.236-13). Cette prsentation est en fait une analyse dtaille
partir de laquelle peut sinstaurer un change .
Dans certains cas, dans des conditions et limites fixes par dcrets, certains registres peuvent
tre tenus en ayant recours dautres moyens, notamment informatiques, aprs consultation
des dlgus du personnel ou du CHSCT sils sont concerns (L.620-7, D.620-1).
Le registre unique
En ce qui concerne les informations relatives au vrifications et contrles mis la charge des
employeurs au titre de lhygine et de la scurit qui doivent figurer dans des registres distincts,
les employeurs sont de plein droit autoriss runir ces informations dans un registre unique
lorsque cette mesure est de nature faciliter la conservation et la consultation de ces
informations .
Les modes de regroupement qui ne prsenteraient aucune cohrence thmatique et surtout
chronologique ne rpondront pas lexigence damlioration de la conservation et de la
consultation des informations ncessaire pour l'adoption d'un registre unique .
8.2.2 Registre spcial
Un registre spcial cot doit tre ouvert au timbre du Comit dhygine, de scurit et
des conditions de travail, sur lequel doivent tre consigns les avis relatifs aux causes de
danger grave et imminent.
Ce dossier doit tre tenu sous la responsabilit du chef dtablissement, en son bureau
ou au bureau de la personne quil dsigne, la disposition des reprsentants du Comit
(art. L.231-9 et R.236-9).
Ce registre ne doit pas tre intgr au registre unique.
8.2.3 Registre pour les Questions dhygine, de scurit, de mdecine
du travail et de prvention des risques
Les chefs des tablissements doivent tenir un registre dans lequel sont portes (ou annexes si
elles ont fait lobjet dun courrier) les observations et mises en demeure formules par
linspecteur du travail et relatives des questions dhygine, de scurit, de mdecine du travail
et de prvention des risques .
Tenu constamment la disposition des inspecteurs du travail, il doit tre prsent, sur leur
demande, aux agents de la CRAM et peut tre consult par les membres du CHSCT ou,
dfaut, par les dlgus du personnel (L.620-4).
8.2.4 Le dossier de maintenance
Le dossier de maintenance exig par l'article R. 235-5 est destin permettre le suivi des
mesures de scurit tout au long de la vie dun btiment. Cette disposition s'applique aux
btiments construits ou modifis aprs le 1
er
janvier 1993.
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
Il doit tre labor par le matre douvrage qui le transmet lutilisateur au moment de
la prise de possession des lieux, dans le but de lui prsenter les dispositions prises pour
faciliter la maintenance.
Ce dossier contient les documents, notices, dossiers techniques relatifs :
aux quipements dclairage, de ventilation, dassainissement ;
aux installations lectriques ;
lentretien de tous les quipements.
Il contient aussi les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitres en lvation
et en toiture, pour laccs en couverture, lentretien des faades, et pour faciliter les
travaux dentretien intrieur.
Lorsque lentreprise quitte les locaux, le chef dtablissement doit restituer ce document
au propritaire ou le transmettre loccupant suivant.
8.3 Registre spcifique aux ERP
Dans les tablissements recevant du public, un registre de scurit doit tre tenu sur
lequel sont reports les renseignements indispensables la bonne marche du service de
scurit et, en particulier :
- ltat du personnel charg du service dincendie ;
- les diverses consignes, gnrales et particulires, tablies en cas dincendie ;
- les dates des divers contrles et vrifications ainsi que les observations auxquelles ceux-
ci ont donn lieu ;
- les dates des travaux damnagement et de transformation, leur nature, les noms du ou
des entrepreneurs et, sil y a lieu, de larchitecte ou du technicien charg de surveiller les
travaux .
Le rglement de scurit requiert, en outre, que soient ports sur le registre de scurit
ou annexs celui-ci certaines informations et documents, notamment :
la date des exercices dinstruction organiss pour lensemble du personnel (MS 51) ;
le contrat dentretien et la notice descriptive des conditions dentretien et de
fonctionnement du systme de dtection dincendie (MS 58) ;
la preuve de lexistence du contrat dentretien ou des consignes crites concernant les
systmes de scurit incendie des catgories A et B (MS 68) ;
le livret dentretien des installations de gaz, avec mention des dates des vrifications et
oprations dentretien des appareils et des accessoires (GZ 30) ;
le livret dentretien de linstallation de filtration dair, avec mention des visites, mesures,
nettoyages ou rangements de filtres (CH 39) ;
le certificat de conformit de linstallation de panneaux et tubes radiants combustible
gazeux (art. CH 55) ;
le registre sur lequel sont ports les rsultats des vrifications inhrentes aux
installations lectriques, tel que celui prvu par larticle 55 du dcret du 14 novembre
1988 concernant la protection des travailleurs dans les tablissements qui mettent en
uvre des courants lectriques (EL 14) ;
le registre technique relatif aux ascenseurs, escaliers mcaniques et trottoirs roulants, qui
comprend un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ainsi
que tous documents, rapports et attestations concernant les examens ou interventions sur
ces appareils (AS 11).
Partie 2 Prvenir le risque dincendie
8.4 Registre spcifique aux immeubles de grande hauteur
Larticle R.122-29 du CCH impose aux propritaires dIGH la tenue dun registre de
scurit sur lequel sont ports les renseignements indispensables au contrle de la
scurit, en particulier :
les diverses consignes tablies en cas dincendie ;
ltat nominatif et hirarchique des personnes appartenant au service de scurit de
limmeuble ;
ltat et les plans de situation des moyens mis la disposition de ce service ;
les dates des exercices de scurit ;
les dates des diverses vrifications et contrles ainsi que les observations ou rapports
auxquels ils ont donn lieu .
Ce registre doit tre prsent lors des contrles administratifs et soumis chaque anne au visa
du maire, accompagn des deux derniers rapports de vrifications techniques des
installations, quipements et dispositifs viss larticle GH 59, notamment : les ascenseurs et
monte-charge, les moyens de secours, les portes et volets rsistant au feu, les systmes de
dtection, les quipements de dsenfumage, les installations lectriques, les paratonnerres,
etc. (GH 4).
PARTIE 3
LUTTER CONTRE LA MALVEILLANCE
Partie 3 Lutter contre la malveillance
1 ANALYSER LES RISQUES RELLEMENT ENCOURUS PAR
L'ENTREPRISE
1.1 Politique de sret
1.2 Planification
1.3 Mise en uvre et fonctionnement
1.3.1 Structure et responsabilit
1.3.2 Formation, sensibilisation et comptence
1.3.3 Communication
1.3.4 Documentation
1.3.5 Matrise des documents, de l'information et des donnes
1.3.6 Matrise oprationnelle
1.3.7 Capacit ragir face une situation d'urgence
1.4 Vrification et action corrective
1.4.1 Surveillance du niveau de performance
1.4.2 Les incidents sret, actions correctives et actions prventives
1.4.3 Matrise des enregistrements
1.4.4 Audit
1.5 Revue de direction
2 METTRE EN PLACE UN CONTRLE D'ACCS AUTOMATIQUE
DANS L'ENTREPRISE
2.1 Mise en uvre
2.1.1 tude conceptuelle
2.1.2 Niveaux de scurit
2.2 Installation
2.2.1 Lecteurs
2.2.2 Traitement et commandes
2.2.3 Verrouillage
2.3 Formation des utilisateurs
2.4 Rception de linstallation
2.5 Maintenance
3 METTRE EN PLACE LA SURVEILLANCE LECTRONIQUE D'UN SITE
3.1 Le rle de la surveillance lectronique
3.2 Les solutions techniques
3.2.1 Linstallation de dtection dintrusion
3.2.2 La station de tlsurveillance
Partie 3 Lutter contre la malveillance
3.3 Faire appel un installateur
3.3.1 La comptence de linstallateur
3.3.2 Faire tablir un devis
3.3.3 La rception de l'installation
4 ORGANISER LA SURVEILLANCE ET LE GARDIENNAGE
DES LOCAUX
4.1 La surveillance humaine
4.2 Les consignes
4.3 L'intervention
4.4 L'entranement
5 LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
5.1 Les principes de la protection des informations
5.1.1 Que protger ?
5.1.2 Qui doit prendre la responsabilit ?
5.1.3 Sous quelle forme se prsentent les informations protger ?
5.1.4 Les communications crites peuvent-elles tre protges ?
5.1.5 Les communications orales peuvent-elles tre protges ?
5.1.6 Quelles sont les rgles fondamentales de la protection des informations ?
5.2 La mise en place d'un systme d'information protger
5.2.1 L'argumentaire
5.2.2 L'habilitation des personnes
5.2.3 Les procdures respecter
5.2.4 La gestion des documents protger
5.2.5 Les protections particulires la communication par moyens lectroniques
5.2.6 La scurit informatique
6 LES DISPOSITIONS RELATIVES L'ATTENTAT LA BOMBE
6.1 Plan de crise en cas d'attentat ou d'alerte la bombe
6.2 Conseils lors de la rception d'un message d'alerte la bombe
Partie 3 Lutter contre la malveillance
1 ANALYSER LES RISQUES RELLEMENT ENCOURUS
PAR L'ENTREPRISE
La prise en compte de la sret dans une entreprise doit reposer sur une approche
globale de ses vulnrabilits. Cette approche doit s'intgrer dans le management de
l'entreprise et reposer sur une approche structure d'analyse de risque.
Cette approche est notamment dveloppe dans le rfrentiel CNPP n1302 Lutte contre la
malveillance et prvention des menaces Mise en place dun systme de management destin
assister les organismes dans leur mise en uvre dune organisation structure, partie
intgrante du management global de l'entreprise, permettant la matrise des enjeux en matire
de sret et permettre la dmonstration par ces organismes de cette matrise.
Le terme sret doit tre prfr celui de malveillance . Le management de la
sret regroupe l'ensemble des dispositifs dfinis et mis en uvre pour prvenir et lutter
la fois contre les menaces d'origine intentionnelle et contre les menaces du fait des
personnes, l'encontre de l'organisme et ceci sans intention de nuire (par exemple une
ngligence, de non-respect du besoin de rserve, etc.).
La malveillance, elle, correspond lintention de nuire par une action pouvant porter
atteinte lorganisme.
La mise en place dun Systme de management de la sret doit permettre aux
organismes de structurer leur organisation afin notamment :
de dmontrer l'identification de toutes les menaces potentielles pour les biens matriels
et immatriels (dont la protection du savoir-faire et de l'information), le personnel
(agression, chantage) et ses partenaires (clients, fournisseurs) ;
d'argumenter le niveau de matrise suffisant mis en uvre face ces menaces et de
viser une amlioration et une adaptation constante du niveau de scurisation des biens
matriels et immatriels sensibles ;
de dmontrer l'implication dans le systme de management de la sret du personnel
tous les niveaux de l'organisation ;
de garantir, aux diverses parties prenantes, le fonctionnement efficace d'une
organisation structure permettant une matrise des risques de malveillance portant sur
les personnes, les biens matriels et immatriels.
La mise en place du systme de management de la sret dcoulera d'une action volontaire de
l'entreprise lui permettant une amlioration globale et continue de son management. Il peut
servir de rfrence et tre mis en uvre par tout organisme ayant concevoir, fabriquer,
dtenir, utiliser, stocker, commercialiser et acheminer tous biens et informations sensibles.
Un systme de management de la sret repose sur la dfinition dune politique de
scurit appuye sur une planification dont dcoulent la mise en uvre et le
fonctionnement, lensemble fait lobjet de vrifications et dactions correctives qui sont
passes en revue par la direction pour aboutir un amlioration continue du systme.
L ide est de faire vivre linstallation pour la faire voluer en parallle avec la ralit du terrain.
1.1 Politique de sret
La Direction de l'organisme doit dfinir, son plus haut niveau, une politique de sret.
Cette politique doit indiquer clairement les objectifs gnraux, dsigner le responsable
du systme de management de la scurit et tre consigne par crit et communique
tout le personnel.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
En outre, elle doit :
rpondre aux exigences de sret du site ;
identifier les populations accdant au site ;
satisfaire aux contraintes de fonctionnement ;
sadapter aux situations exceptionnelles.
1.2 Planification
La planification de la sret doit comporter plusieurs aspects :
lorganisme doit raliser un diagnostic initial ;
lidentification des menaces.
Sur la base du diagnostic initial, l'organisme doit tablir et tenir jour des procdures
permettant d'identifier de faon rgulire les menaces, dvaluer les vulnrabilits et de
mettre en uvre des mesures de matrise adaptes.
La menace est constitue par llment dclencheur dune vulnrabilit dont le mode
daction peut tre :
intentionnel, dont lorigine est un agresseur visant atteindre un point prcis de
lorganisme (cible) ;
non-intentionnel et dont lorigine est une personne ou une fonction ralisant une action
nfaste lorganisme et ceci sans intention de nuire.
Lorigine de la menace peut tre interne (par les membres de lorganisme).
Lidentification des menaces passe par lidentification des objectifs, des agresseurs et des
moyens et des mthodes daction.
Les agresseurs et leur motivations
Il existe une gradation dans la typologie des agresseurs :
populations standards ;
vandales ;
baluchonneurs et malfaiteurs occasionnels ;
cambrioleurs organiss et escrocs ;
grand banditisme ;
terroristes et saboteurs.
En fonction de cette typologie une croissance dans les moyens de protection (niveau de
dissuasion) doit tre tablie.
Les motivations des agresseurs sont de divers ordres :
intrt personnel : matriels (besoins vitaux), motif (vengeance, gloriole) ;
intrt conomique : concurrence, fraude lassurance ;
idologie : politique, religieuse ;
drglement psychique : kleptomanie, trouble du caractre.
La cible qui doit faire lobjet des mesures de sret : est llment matriel ou immatriel,
lhomme-clef dont latteinte directe ou indirecte, par une menace, va nuire lorganisme vis.
Lvaluation des vulnrabilits
La vulnrabilit est le rsultat de lvaluation des consquences, pour lorganisme, de latteinte
dune cible sret par une menace.
Lvaluation des vulnrabilits de lorganisme correspond au processus dvaluation des
risques.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
La dmarche dvaluation des vulnrabilits sappuie gnralement sur une valuation de la
frquence de concrtisation des menaces et de la gravit datteinte de la cible . Il sagit de
quantifier les vulnrabilits et de les hirarchiser.
Le couple menace-vulnrabilit en sret est le pendant du couple danger-risque en
hygine et scurit et du couple aspect-impact en environnement.
le plan de traitement
Les vulnrabilits majeures identifies doivent faire lobjet dun plan de traitement visant les
supprimer et/ou les matriser notamment par l'utilisation de moyens de surveillance, de
traabilit, de protection physique et/ou logique
L'organisme doit s'assurer que les rsultats de ces valuations sont pris en compte lors de
la dtermination des objectifs de sret. Ces informations sont tenues jour et
consignes par crit.
1.3 Mise en uvre et fonctionnement
1.3.1 Structure et responsabilit
Pour faciliter le management de la sret, les rles, les responsabilits et l'autorit du
personnel, doivent tre dfinis, consigns par crit et communiqus.
1.3.2 Formation, sensibilisation et comptence
Le personnel doit tre comptent pour raliser les tches qui pourraient avoir une
incidence sur la sret. Les comptences doivent tre dfinies en terme de formation
initiale et/ou continue et/ou d'exprience.
Lorganisme doit tablir et tenir jour des procdures lui permettant de sassurer que,
quel que soit le niveau et la fonction des personnes concernes, celles-ci soient
sensibilises la sret.
1.3.3 Communication
L'organisme doit tablir des procdures lui permettant de s'assurer que les informations
pertinentes sur la sret sont communiques au personnel, aux fournisseurs et sous-
traitants et aux autres parties prenantes, si ncessaire.
Plan de communication interne doit prendre en compte ce qui est ncessaire prvoir
pour viter, comme en chirurgie opratoire, le rejet par exemple du badge ou de la
biomtrie.
Grer la peur du filtrage, de la surveillance auprs du personnel est du ressort de la
communication interne.
Ce plan de communication interne doit tre issu de la concertation de la direction
gnrale, de la direction des ressources humaines, de la direction de la communication,
de la direction des services gnraux
1.3.4 Documentation
L'organisme doit tablir et maintenir linformation, sur un support adquat tel que sur papier ou
informatique, ncessaire pour :
dcrire les lments essentiels du systme de management et leurs interactions ;
indiquer o trouver la documentation correspondante.
Les responsabilits des diffrents acteurs de l'organisme en charge de la classification des
informations et leur diffusion sont dfinies et portes la connaissance du personnel.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
1.3.5 Matrise des documents, de l'information et des donnes
L'organisme doit tablir et tenir jour des procdures pour matriser tous les documents
et donnes requis.
1.3.6 Matrise oprationnelle
L'organisme doit dfinir celles de ses activits associes aux vulnrabilits identifies
devant faire l'objet de mesure de matrise. Ces activits doivent tre planifies, y compris
leur maintenance et leur surveillance, afin d'assurer qu'elles sont ralises dans des
conditions requises.
Les moyens de protection et de dtection des vulnrabilits mis en place doivent tre cohrents
avec le niveau de vulnrabilit. Ces moyens font l'objet d'une surveillance par du personnel
dsign et comptent.
L'organisme identifie les lments de son patrimoine informationnel et de ses innovations
devant faire l'objet d'une protection juridique particulire par l'utilisation de droit et titre de
proprit intellectuelle.
1.3.7 Capacit ragir face une situation d'urgence
A partir de la description de sa sensibilit sret et de son analyse de vulnrabilit,
l'organisme doit :
tablir et tenir jour des procdures pour identifier les situations d'urgence et tre capable de
ragir de faon prvenir, dtecter et rduire les atteintes aux personnes, aux biens et
aux informations pouvant y tre associes ;
revoir ses procdures de prvention et de dtection des situations d'urgence et de capacit
ragir, en particulier aprs la survenue d'un incident ou d'une situation d'urgence ;
mettre priodiquement ces procdures l'essai lorsque cela est ralisable.
Ces procdures doivent inclure la conduite tenir en cas d'atteinte aux personnes, de
perte ou de vol de biens, documents ou d'informations sensibles pour l'organisme.
1.4 Vrification et action corrective
Il faut redynamiser le systme rgulirement et il faut la participation de tout le monde.
1.4.1 Surveillance du niveau de performance
L'organisme doit tablir et tenir jour des procdures :
pour contrler, surveiller et mesurer rgulirement les performances relatives la sret
malveillance et au systme de management mis en place ;
d'talonnage et de maintenance des quipements de surveillance, dont les enregistrements
devront tre conservs en respectant les rglementations.
La surveillance de la conformit aux rglementations et aux autres exigences applicables se
traduira notamment, indpendamment de la ralisation des contrles et vrifications imposs
par la rglementation, par la ralisation d'une valuation priodique de cette conformit.
1.4.2 Les incidents sret, actions correctives et actions prventives
Lorganisme doit tablir et tenir jour des procdures permettant de dfinir les
responsabilits et l'autorit pour :
l'identification des incidents sret (presqu'acte de malveillance ou signes avant-
coureurs des actes de malveillance), des actes de malveillance et des non-conformits ;
Partie 3 Lutter contre la malveillance
le traitement et l'enqute concernant les incidents sret, les actes de malveillance et
les non-conformits identifies.
Les incidents sret et les actes de malveillance identifis (vol de matriels et/ou d'information,
agressions) font systmatiquement l'objet d'un enregistrement, d'une enqute et d'une
analyse.
1.4.3 Matrise des enregistrements
L'organisme doit tablir et tenir jour des procdures d'identification, de conservation et
de destruction des enregistrements relatifs la sret, y compris ceux relatifs aux rsultats
des audits et des revues de direction.
1.4.4 Audit
L'organisme doit tablir et tenir jour un programme et des procdures pour la
ralisation priodique d'audits.
Les procdures d'audit doivent couvrir le domaine d'application, la frquence, les
mthodologies et les comptences, ainsi que les responsabilits et les exigences relatives
la conduite des audits et aux comptes rendus des rsultats.
1.5 Revue de direction
Au minimum, annuellement, la Direction de l'organisme au plus haut niveau, en
prsence des dlgataires concerns, doit revoir le Systme de Management de la Sret
pour assurer qu'il demeure pertinent, adquat et efficace. Le processus de revue de
direction doit assurer que les informations ncessaires sont recueillies pour permettre la
direction d'effectuer son valuation. Cette revue doit tre consigne par crit.
La revue de direction doit aborder les ventuels besoins de changement au niveau de la
politique, des objectifs et d'autres lments du Systme de Management de la Sret.
Cela doit tre fait la lumire des rsultats des audits et dans le cadre de l'engagement
damlioration continue.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
2 METTRE EN PLACE UN CONTRLE D'ACCS
AUTOMATIQUE DANS L'ENTREPRISE
Les moyens de protection mcanique ou la dtection lectronique utiliss en priode d'inactivit
ne peuvent remplir pleinement leur rle de protection d'accs aux locaux pendant les priodes
dactivit.
Par ailleurs, pour son activit, un site usage professionnel doit ncessairement laisser pntrer
des personnes et/ou des vhicules.
Un systme automatique de contrle d'accs permet de conserver une scurit adapte aux
menaces potentielles durant cette priode d'activit.
Un systme automatique de contrle daccs a pour objectif de contrler de faon
automatique les flux de circulation de personnes et parfois de vhicules, qui souhaitent pntrer
l'intrieur d'un site, d'un btiment ou d'un local.
Par contrler, il faut entendre filtrer, et donc accepter ou refuser les passages aux diffrentes
entres, aprs contrle de l'identit et du droit d'accs des demandeurs.
Le systme automatique de contrle d'accs doit signaler, et dans certains cas, assurer la
traabilit des vnements, et ventuellement communiquer (change d'informations) avec
d'autres installations de scurit.
Pour tout projet, il est indispensable d'tudier le site en se rendant sur les lieux ou partir de
plans lorsquil sagit dune construction.
2.1 Mise en uvre
2.1.1 tude conceptuelle
Dans le cadre du traitement du risque, une tude pralable doit mettre en vidence la
ncessit de mise en uvre d'un systme automatique de contrle daccs l'intrieur du
primtre de proprit d'un site.
L'tude pralable doit :
identifier les points nvralgiques d'un site et les zones
contrler.
Le filtrage s'effectue aux diffrents points d'accs sur l'enceinte de la zone
sous contrle. Le filtrage peut tre progressif selon la localisation des points nvralgiques ;
recenser les flux d'individus et/ou de vhicules aux points d'accs
contrler.
Une analyse des flux de circulations doit tre mene pour chaque point d'accs
contrler, afin d'apporter les rponses aux questions de base : QUI ? QUAND ?
COMMENT ? COMBIEN ?
aboutir un choix des niveaux de scurit de filtrage mettre en uvre
dans les zones sous contrle.
En principe, l'accs un point nvralgique l'intrieur d'une zone sous contrle d'un site doit
faire l'objet d'un filtrage. En fonction de l'tude, plusieurs filtrages conscutifs peuvent tre
prconiss sur le chemin de progression vers ce point ;
adapter les niveaux de rsistances mcaniques des enceintes.
La rsistance de lenceinte doit tre en adquation avec le risque concernant le local et
cohrente avec la rsistance des systmes de fermeture.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
2.1.2 Niveaux de scurit
Un niveau de scurit est affect tous les points d'accs d'une zone sous contrle. La zone
sous contrle est caractrise par le niveau de scurit du plus faible de ses points d'accs.
Le rfrentiel CNPP n 5083 Guide de conception dune installation automatique de contrle
daccs propose une aide au choix du niveau de scurit afin daider un futur utilisateur ou
prescripteur d'un systme de contrle d'accs pour dfinir son besoin en fonction du niveau de
scurit souhait pour ses zones sous contrle
Un niveau de scurit dfinit la rsistance au franchissement d'une zone sous contrle par un
individu (avec ou sans vhicule ou colis), ainsi que la ncessit de connatre les vnements du
pass des fins d'investigations.
Le niveau de scurit fait appel diffrentes classifications d'identification pour le filtrage
d'accs pour la traabilit et de rsistance des actes agressifs.
2.1.2.1 Classification d'identification
La classification d'identification des utilisateurs est caractrise par la prcision
de l'identification des utilisateurs autoriss pntrer dans la zone sous contrle.
La norme NF EN 50133-1 dfinit quatre classes d'identification croissantes :
Classe 0 - aucune identification (exemple, laccs un parking) ;
Classe 1 - reconnaissance de l'identification personnalise d'un individu par
composition d'un code personnel ou d'un mot de passe mmoris (clavier) : facilement
contournable et facile obtenir par simple observation (exemple, laccs un
stockage) ;
Classe 2 - Identifiant personnalis (carte magntique, carte de proximit, carte puce
ou autre, implant)ou caractristique biomtrique (exemple, autour dun stockage
dangereux) ;
Classe 3 - Combinaison de l'identifiant personnalis ou caractristique biomtrique +
confirmation par un code personnel ou mot de passe mmoris exemple, pour
laccs un point nvralgique, il limite le nombre de personnes autorises ainsi
que les horaires daccs).
2.1.2.2 Classification d'accs
Les systmes automatiques de contrle d'accs sont classs en fonction de la ncessit d'utiliser
une grille horaire, pour dfinir les droits d'accs aux diffrentes catgories d'utilisateurs, et
d'enregistrer les transactions d'accs.
La norme NF EN 50133-1 dfinit trois classes d'accs :
Classe A Pas de grille horaire, ni d'enregistrement des transactions ;
Classe B Grille horaire et enregistrement des transactions. Cette classe de systme
ncessite une dclaration auprs de la Cnil (voir ci-contre).
Classe Ba Grille horaire, mais sans enregistrement des transactions.
2.1.2.3 Classification de la rsistance la malveillance.
Les composants et les liaisons quipant les points d'accs d'un systme automatique de
contrle d'accs sont classs selon des critres de rsistance la malveillance (fraude +
effraction).
Partie 3 Lutter contre la malveillance
Le traitement d'informations nominatives doit tre dclar auprs de la Cnil La dclaration peut se faire
directement en remplissant le formulaire en ligne sur le site de la Cnil ou grce formulaire tlchargeable
(ci-dessous)sur le mme site.
Il existe une dlibration CNIL (n 02-001) concernant les traitements automatiss d'informations
nominatives mis en uvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrles d'accs aux locaux, des
horaires et de la restauration.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
Cette rsistance est dfinie pour chaque point d'accs de la zone sous contrle. Elle comporte
obligatoirement une rsistance minimale la pousse mcanique et la fraude. Elle peut tre
complte par une rsistance l'effraction selon les paramtres tablis pour les serrures de
btiment (l'annexe 6 des rgles techniques T61 Spcifications et mthodes d'essais Serrures
de btiment et le Rglement particulier de la marque A2P H61 - CNPP) :
Classe E0 Rsistance minimale la pousse.
Classe E1 Rsistance l'effraction correspondant la catgorie .
Classe E2 Rsistance l'effraction correspondant la catgorie .
Classe E3 Rsistance l'effraction correspondant la catgorie .
2.2 Installation
Le prestataire de service doit dfinir dans son offre les moyens pour apporter une
rponse adquate aux besoins exprims par l'tude conceptuelle en terme de : flux,
contraintes, et niveaux de scurit.
Une installation de systme automatique de contrle d'accs doit possder les
qualits essentielles de fiabilit et de disponibilit. Une telle installation est sre
lorsqu'elle remplit son rle de faon durable, non erratique, dans les conditions et
circonstances dfinies par les constructeurs des matriels constitutifs de
l'installation.
Fonctions fondamentales
Une installation de contrle d'accs peut tre dcompose en fonctions
fondamentales pour un ou plusieurs points d'accs, et qui assurent : l'identification
des utilisateurs, le traitement des donnes et les commandes, et le verrouillage des
points accs.
Le choix du type de matriel dpend des niveaux de scurit du site. Les matriels
doivent comporter, de faon apparente ou non, des indications suffisantes pour tre
identifis sans risque d'erreur (nom du fabricant, modle, type, etc.). Les matriels
slectionns doivent tre porteurs de certification NF et A2P de 1 3 boubcliers
2.2.1 Lecteurs
Un lecteur permet de raliser la lecture des donnes introduites dans le systme par la
composition d'un code sur un clavier et/ou la prsentation d'un support identifiant (code, carte,
clef, etc.) ou dun lment biomtrique.
Le dispositif est install proximit du point d'accs contrler. Le lecteur doit tre
facilement accessible par l'utilisateur pour permettre les manipulations d'identification.
Aucun code ou identifiant ne doit tre laiss proximit du lecteur.
Une signalisation sur le lecteur ou proximit doit informer l'utilisateur de l'accord et du
refus de passage lors dune demande d'accs.
2.2.2 Traitement et commandes
Lunit de traitement et de commande centralise assure la gestion de toutes les
demandes d'accs, les compare ses bases de donnes, et dlivre les commandes de
librations des verrouillages.
L'accs au paramtrage des bases de donnes doit tre limit aux seuls responsables de
l'exploitation et protg par un mot de passe. Ce mot de passe doit tre chang rgulirement.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
2.2.3 Verrouillage
Le dispositif de verrouillage ralise le blocage mcanique du point d'accs, pour
empcher le passage de personnes non autorises.
Ce dispositif doit offrir une rsistance mcanique minimale aux tentatives de
pntrations. Selon les exigences particulires, le dispositif de verrouillage peut ncessiter
une rsistance la malveillance plus leve.
2.3 Formation des utilisateurs
Les systmes de contrle d'accs utilisent des bases de donnes informatiques pour affecter les
droits d'accs chaque utilisateur. Les logiciels employs peuvent tre trs complexes et
ncessitent donc une bonne formation des exploitants des systmes, la fois initiale et
continue.
La formation est spcifique selon la nature des interventions des exploitants :
administrateurs ; oprateurs ; utilisateurs internes l'entreprise ; utilisateurs externes
l'entreprise.
Pour que le systme de filtrage fonctionne correctement il est primordial dobtenir la motivation
du personnel.
Sauvegardes
Un dossier du paramtrage du systme de contrle d'accs doit mettre en vidence
toutes les grilles temporelles cres, avec la raison de leurs crations et les catgories
d'utilisateurs associes.
Les bases de donnes informatiques voluent sans cesse. Il est indispensable de prvoir une
procdure de sauvegarde des donnes avec, au minimum, une sauvegarde par trimestre.
2.4 Rception de linstallation
La rception est une remise officielle de linstallation entre les mains de lutilisateur, aprs
que linstallateur ait effectu une vrification de conformit et remis un dossier technique.
La vrification de conformit a lieu la mise disposition ou aprs la modification d'une
installation. La vrification de conformit a pour but de s'assurer que l'installation remplit
effectivement les fonctions pour lesquelles elle est prvue.
Constitution du dossier technique
Linstallateur tablit un dossier technique en deux exemplaires. Lun est conserv par
linstallateur, et le second est remis l'utilisateur.
Vrification de Conformit
La rception de l'installation est prononce, l'issue des oprations de :
vrifications gnrales ;
vrification fonctionnelle de linstallation ;
Linstallateur remet alors l'utilisateur le dossier technique. Les rsultats de la vrification
de conformit doivent tre conservs par l'installateur.
Au terme de ces vrifications, l'installateur doit prsenter linstallation lutilisateur,
effectuer devant lui les manuvres d'utilisation et sassurer qu'elles ont bien t
assimiles.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
2.5 Maintenance
Aprs la mise disposition, une installation de contrle d'accs est soumise des
vrifications rgulires afin de conserver dans le mme tat de fonctionnement les
matriels susceptibles de se dgrader ou dfaillants.
Entretien permanent
Certaines oprations de vrifications et d'entretien doivent tre prises en charge
directement par les services d'entretien de l'utilisateur. L'utilisateur doit disposer d'une rserve
de pices dtaches pour assurer la continuit de fonctionnement du contrle.
Vrifications priodiques
D'autres vrifications priodiques ou interventions correctives en cas de panne ou de
drangement seront ralises par un installateur. Pour ce faire, l'utilisateur doit souscrire auprs
d'un installateur un contrat de maintenance reconductible, pour effectuer un contrle complet
de l'installation. Le contrat doit prciser la frquence des visites de vrification priodique, la
nature des oprations effectues et un dlai maximal d'intervention en cas de panne ou de
drangement.
Les visites priodiques ont pour objectif, au titre de la maintenance prventive, de vrifier et
dinformer sur le bon fonctionnement de linstallation.
Maintenance corrective
Ces interventions ont pour objectif de remettre en tat de fonctionnement linstallation
suite une panne ou une dfaillance.
Les interventions sont effectuer dans des conditions clairement dfinies dans le contrat :
dlais, heures et jours dintervention, cots des prestations. Le dlai imparti ne devrait pas tre
suprieur 48 heures ouvrables.
Registre de maintenance
La mention des oprations effectues, tant en interne que par un installateur et les
incidents constats sont ports sur un registre de maintenance dtenu par l'utilisateur. Il
doit faire clairement apparatre la traabilit entre les vrifications anciennes et nouvelles.
Modifications apportes une installations
Les modifications apportes une installation de contrle d'accs doivent entraner
obligatoirement une mise jour du dossier technique de l'installation.
Une modification importante ncessite une nouvelle rception, partielle ou totale, de
l'installation.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
3 METTRE EN PLACE LA SURVEILLANCE
LECTRONIQUE D'UN SITE
3.1 Le rle de la surveillance lectronique
Le niveau de protection mettre en uvre est dtermin partir dune analyse dtaille
qui tient compte de la situation et de la nature des locaux, mais aussi de limportance du
risque (montants des valeurs assurer). Elle conduit au choix des matriels utiliser, des
interconnexions ncessaires et du traitement des informations recueillies. La synthse de
ces diffrents lments aboutit un systme de surveillance lectronique.
La nature du bien dtermine le choix du type de protection : sur lensemble des locaux, une
partie de ceux-ci, un point ou un objet prcis dans certains cas.
Le cot de la protection (protection mcanique et surveillance lectronique) doit galement tre
proportionn la valeur des biens ou des informations protger.
De mme, on prendra en compte :
le type de btiment et son accessibilit ;
la protection mcanique existante, et notamment les ventuels points faibles du contour du btiment ;
lemplacement et la nature des ouvertures ;
limportance des valeurs protger et leurs localisations ;
les scnarios possibles de pntration et de dplacement dun intrus lintrieur des locaux ;
le mode doccupation des lieux ;
lenvironnement de ltablissement (isolement, voisinage, sinistralit) ;
dventuels lments physiques susceptibles de perturber linstallation (temprature, humidit,
vibrations, foudre, lectromagntisme, animaux).
Le but de la surveillance lectronique est dexercer une dissuasion contre le vol et le vandalisme
et, si ncessaire, de dclencher une intervention, en dtectant et en signalant la pntration
et/ou le dplacement dun intrus lintrieur de ltablissement. Accessoirement, elle constitue
un lment scurisant vis vis dune agression ventuelle des occupants du btiment.
Le dclenchement dun dispositif de signalisation dalarme sonore ou lumineux veille
lattention dventuels occupants et a un effet psychologique immdiat sur lintrus pntrant
lintrieur dun tablissement, dautant plus quil aura dj pass un certain temps franchir
lobstacle du systme de protection mcanique. La plupart du temps, il nosera pas rester sur
les lieux pendant le dclenchement de lalarme.
Pour assurer son rle, un systme de surveillance lectronique contre lintrusion est constitu :
dune installation de dtection dintrusion ;
dune station centrale de tlsurveillance ;
dun dispositif de contrle daccs (chapitre 2 ).
3.2 Les solutions techniques
3.2.1 Linstallation de dtection dintrusion
Une installation de dtection dintrusion comprend :
des dtecteurs ;
une centrale dalarme ;
un contrleur enregistreur ;
un dispositif dalarme, par le biais de dispositifs de signalisation sonore et lumineuse
ou de transmission.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
En vue de garantir une efficacit minimale des matriels utiliss dans les installations de
dtection d'intrusion, le CNPP a tabli des procdures de certification des lments constitutifs
de ces installations. Seuls les matriels certifis NF&A2P apportent lassurance de rpondre
des normes (franaises ou europennes transposes) ou des rfrentiels techniques
spcifiques qui dfinissent leur aptitude lemploi. Les fabricants contrlent en permanence
leur production et font eux-mmes lobjet dune validation de ces contrles par un organisme
tierce partie.
Selon leur destination et limportance des valeurs protger, les matriels certifis NF&A2P
sont adapts au niveau de risque identifi. Leur niveau est reprsent par des boucliers (de
1 3).
Chaque matriel certifi doit imprativement port le logo NF&A2P de faon apparente et
comporter les informations minimales qui garantissent sa traabilit (constructeur, modle,
site de construction)
La liste complte de matriels certifis NF&A2P et de leurs fabricants est consultable sur
le www.cnpp.com
D'autre part, il existe des certifications conjointes NF service & APSAD de service
d'installation de ces matriels, telle que celle relative au service dinstallation et de maintenance
des systmes de dtection d'intrusion dans les risques professionnels.(rglement NF 367-I81,
norme NF X 50-785 et la nouvelle rgle APSAD R81)
3.2.1.1 Les dtecteurs
Lors de l'tude d'une installation de surveillance lectronique, on dterminera le chemin
de pntration, dans le sens de la progression de l'intrus. En particulier, les diffrents
dtecteurs devront tre choisis et placs de faon signaler la prsence de l'intrus dans
le laps de temps le plus court possible. Plus la dtection est prcoce, plus elle est
efficace.
A cet effet, il pourra tre mis en place :
une dtection priphrique (dtecteurs extrieurs placs dans la zone situe entre
la clture et le btiment) ;
une dtection primtrique (dtecteurs placs sur les parois dlimitant le btiment :
murs de faible rsistance mcanique, ouvertures, toitures) ;
une dtection intrieure (dtecteurs de prsence ou de dplacement placs l'intrieur
du btiment) tenant compte du cheminement possible de l'intrus vers les valeurs protger.
Elle peut, dans certains cas, assurer la surveillance ponctuelle dun objet particulier (porte
intrieure, coffre-fort, objets de valeur).
Pour chacune des dtections numres ci-dessus, il existe des dtecteurs de types
particuliers :
dtecteurs douverture ;
dtecteurs de choc, de vibration et de bris de glace ;
dtecteurs de passage ;
dtecteurs volumtriques.
3.2.1.2 La centrale d'alarme
Elle est llment central de l'installation de dtection, son rle est :
de recevoir et d'analyser les signaux en provenance des diffrents dtecteurs ;
de dclencher le cas chant une alarme locale et/ou une alarme distance ;
d'assurer la rsistance la fraude de la totalit de l'installation par un contrle
permanent du circuit d'autosurveillance (matriels et liaisons) ;
d'alimenter en nergie les systmes filaires (dtecteurs et dispositifs de signalisation
d'alarme), mme en cas de dfaillance de l'alimentation par le secteur.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
L'organisation en zones de surveillance distinctes permet de mettre en service la totalit ou une
partie seulement de l'installation, par exemple : la totalit en cas d'absence de l'occupant du
btiment, et uniquement certains dtecteurs lorsqu'il est prsent dans les locaux et qu'il dsire se
dplacer dans certaines pices.
Le contrleur-enregistreur
La fonction de contleur-enregistreur peut tre assure par la centrale dalarme elle-mme ou
par un contrleur-enregistreur lectronique spcifique.
Il sagit denregistrer de faon horodate :
les mises en service et hors service de la totalit de la dtection de l'installation ;
les dclenchements d'alarme ;
dans certains cas, les tentatives de prise de ligne du transmetteur tlphonique reli
une station centrale de tlsurveillance.
Le contrleur enregistreur est plomb et, en cas de sinistre, il peut tre dplomb par
l'installateur, en prsence d'un reprsentant ou d'un expert de la socit d'assurance
concerne.
Il doit tre totalement autonome et assurer un fonctionnement ininterrompu de
quatre mois au minimum. Pour les matriels comportant les bandes
d'enregistrement, celles-ci sont remplaces au cours des visites d'entretien de
l'installation et conserves par l'utilisateur. Elles sont dates et signes par
l'installateur, chaque visite.
3.2.1.3 Les dispositifs de signalisation dalarme
Le dclenchement d'une alarme locale et distance permet de dissuader
l'agresseur, par l'mission de signaux sonores de forte puissance et de signaux
lumineux particulirement visibles, et dattirer l'attention d'ventuels intervenants
(voisins, gardiens, services spcialiss).
Les dispositifs d'alarme sonore sont soumis des rglementations et normes sur les conditions
d'usage en fonction de l'usage intrieur ou extrieur aux locaux. La circulaire du ministre de
l'Intrieur n NOR/INT/D/98/00227/C relative aux systmes d'alarme sonore audibles sur la
voie publique a confi la dlivrance de l'autorisation de pose dalarmes sonores aux
municipalits.
Par ailleurs, un dcret du ministre de l'Environnement n 95-79 du 23 janvier 1995, relatif la
lutte contre le bruit, prcise que les dispositifs d'alarme sonores doivent fonctionner dans des
limites d'intensit sonore dfinies par un arrt interministriel. Cet arrt n'est pas encore paru.
Il existe galement un projet de norme europenne PR NF EN 50131-4 (Janvier 2000)
Systmes d'alarme - Systmes d'intrusion - Partie 4 : Dispositifs d'avertissement.
La signalisation dalarme est constitue :
d'un dispositif d'alarme locale qui comporte un dispositif dalarme sonore (sirne) plac
l'intrieur du btiment, et ventuellement :
- un dispositif dalarme sonore (sirne) extrieur,
- un dispositif lumineux intrieur ou extrieur ;
d'un dispositif d'alarme distance (liaison tlphonique).
Le dclenchement d'une alarme permet d'veiller l'attention d'ventuels intervenants et
peut dissuader l'intrus par les effets physiologiques et psychologiques des signaux sonores
de grande puissance mis par les sirnes intrieures et extrieures.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
3.2.2 La station de tlsurveillance
On constate que la dissuasion que constituent les alarmes sonores n'est pas toujours suffisante
si l'tablissement est isol, les voisins absents ou encore si l'intrus est un malfaiteur confirm.
C'est ainsi qu'apparat le besoin d'une surveillance complmentaire consistant doubler le
dispositif d'alarme d'une surveillance distance du btiment concern, c'est--dire une
tlsurveillance.
La tlsurveillance ne doit pas tre confondue avec la tlscurit qui est un ensemble de
services comprenant la dtection d'intrusion, la tlsurveillance et l'intervention d'un personnel
spcialis en cas d'alarme.
Un rseau de tlsurveillance contre l'intrusion comporte :
une station centrale qui reoit les informations dlivres par le transmetteur
tlphonique de l'installation de dtection situ au niveau local du risque ;
un parc de transmetteurs tlphoniques, chacun d'entre eux tant raccord une
installation locale de dtection.
Pour bnficier des services du rseau de tlsurveillance, il est ncessaire de souscrire
un contrat d'abonnement. Les oprateurs de la station centrale appliquent les consignes
contractuelles dfinies avec l'utilisateur et peuvent prvenir les services d'intervention si un
contrat spcifique couvrant cette prestation a galement t souscrit.
La station centrale assure la surveillance des installations 24h/24. Parmi les
consignes contractuelles, peut figurer la mission de prvenir les forces de police
aprs leve de doute, mais aussi les services spcialiss comme ceux offerts par les
socits de tlscurit qui envoient du personnel spcialis sur les lieux o a t
signale l'intrusion.
L'abonnement un rseau de tlsurveillance peut tre rentabilis par la surveillance
d'autres catgories de dfauts, telles que baisse de tension, coupures du secteur, alarme
incendie, anomalies de fonctionnement de certains appareils domestiques...
Il existe une certification APSAD de service qui concerne les tablissements de
tlsurveillance des installations de scurit incendie et de dtection dintrusion utilisant
linfrastructure filaire du rseau tlphonique public commut.
Elle est attribue aux stations centrales qui rpondent aux exigences du rglement de
certification I31 et aux prescriptions de la rgle APSAD R31 : qualit des moyens
matriels et humains mis en uvre, comptence des oprateurs et informatisation de la
gestion des informations reues et rpercutes dans le respect des consignes
contractuelles.
Ces stations centrales font lobjet de contrles priodiques sur site afin de vrifier, en
particulier, que les conditions requises pour la certification APSAD de service continuent.
3.3 Faire appel un installateur
3.3.1 La comptence de linstallateur
Compte tenu de l'exprience ncessaire pour concevoir une installation de surveillance
lectronique efficace et assurer une maintenance de bonne qualit, il est vivement conseill de
faire appel des professionnels.
Les installateurs de systmes de dtection d'intrusion sont reprsents par des syndicats
professionnels qui veillent au respect des rgles de dontologie.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
Si l'installation doit tre prise en compte par les socits d'assurances, il peut tre demand de
faire appel un installateur certifi APSAD de service.
Si l'installateur est titulaire de la certification APSAD de service, ses capacits commerciales et
techniques ont t contrles. Dans le cas contraire, les installateurs consults doivent pouvoir
justifier d'une exprience professionnelle confirme. Il peut tre intressant de disposer d'une
liste de leurs rfrences.
Un installateur comptent doit :
Procder l'analyse du risque
Elle consiste, mettre en vidence laccessibilit des locaux, la surveillance des
ouvertures, les passages obligs et les localisations des biens et/ou objets de valeur, afin
de conseiller le client sur le niveau de surveillance et les moyens mettre en uvre ;
Raliser une installation efficace et sre
L'efficacit dpend des matriels et techniques mis en uvre et de leur emplacement
dans le local protger. Le systme de surveillance lectronique doit remplir son rle de
faon durable, sans erreur ni dfaillance, dans les conditions d'exploitation dfinies par
l'installateur ;
Assurer une maintenance rgulire et srieuse de l'installation
La maintenance permet de vrifier que l'installation est toujours en mesure de remplir sa
fonction. Les conditions de maintenance sont dfinies dans le contrat de maintenance que
l'installateur propose au client, cette maintenance peut tre priodique ou globale, incluant les
dpannages. L'installateur doit disposer d'un service aprs-vente capable d'intervenir dans un
dlai maximal de 48 heures.
Un registre de maintenance ou un spcimen de fiche de contrle numrote doit faire foi
quant la date et la dure des interventions et la nature des travaux raliss. Ils doivent
tre conservs par l'utilisateur comme preuve d'un entretien correct de l'installation.
Lors de la mise en service ou au plus tard la rception de l'installation, l'installateur doit
remettre l'utilisateur les documents suivants :
la notice d'exploitation ;
le contrat de maintenance ;
le registre de maintenance.
les consignes en cas de panne.
3.3.2 Faire tablir un devis
Il est ncessaire de comparer les devis de plusieurs socits. Des diffrences importantes de
prix ne sont admissibles que si elles correspondent des matriels et des prestations
diffrents en nombre et (ou) en qualit. Les devis doivent tre suffisamment dtaills pour
permettre de comparer les cots.
Il est galement important d'obtenir de l'installateur la proposition de contrat de maintenance
en mme temps que le devis de l'installation.
Le devis doit, en principe, tre remis en deux exemplaires et comporter les parties
suivantes :
Spcifications particulires de l'installation
Les indications donnes doivent permettre de vrifier que l'installation est effectivement
prvue pour rpondre aux besoins en tenant compte de l'analyse du risque, des rgles et
des normes en vigueur. Elle doit indiquer les drogations ventuelles, avec les solutions
de substitution, qui ne peuvent tre que d'ordre technique.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
Documentation technique
Les installateurs consults doivent remettre une documentation technique et commerciale sur
les matriels proposs (marques et rfrences, types), indiquant les ventuelles certifications, et,
prcisant leurs quantits et leurs implantations.
Prestation fournie
Le descriptif technique doit dresser la liste exhaustive des matriels et des ventuels travaux
annexes ncessaires lors du montage de l'installation. Le cas chant, les matriels ou services
non inclus dans le devis doivent tre prciss.
Conditions commerciales
Cette partie doit indiquer : le montant de la fourniture, les conditions de livraison, le dlai, la
rvision de prix, les conditions de paiement, les garanties.
3.3.3 La rception de l'installation
La rception est une phase importante de la ralisation de l'installation laquelle peut
tre associ l'assureur. Il est souhaitable qu'elle ne soit prononce qu'aprs l'expiration
d'un dlai dobservation partir de la mise en service (de l'ordre de une trois
semaines).
Ce dlai est destin vrifier le bon fonctionnement du systme et permettre
l'installateur d'liminer les ventuels dclenchements intempestifs. Cette opration peut
tre concrtise par la signature d'un procs-verbal de rception.
Il est en revanche dconseill de dresser un constat d'efficacit (rglage des dtecteurs
par exemple), ce point tant de la responsabilit de l'installateur.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
4 ORGANISER LA SURVEILLANCE
ET LE GARDIENNAGE DES LOCAUX
4.1 La surveillance humaine
Les activits de surveillance effectues par des socits prives autant que par des services
internes de scurit sont rgies par la loi 83-629 du 12 juillet 1983 rglementant les activits
prives de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifie notamment par la loi
2003-239 du 18 mars 2003 pour la scurit intrieure.
La surveillance humaine doit s'intgrer dans la surveillance de scurit classique de
l'tablissement (comprenant notamment la scurit incendie). Souvent le PC est commun,
le personnel est voisin sinon polyvalent, les consignes sont interdpendantes, les rondes
sont utiles aux deux missions.
La surveillance humaine consiste essentiellement assurer une prsence, que ce soit
sous forme d'une permanence dans un poste central de protection ou sous forme de
rondes dans l'tablissement.
Le poste central de scurit (PCS) est destin centraliser les informations de scurit d'un
tablissement. C'est un local o se tiennent les agents de surveillance et d'o sont dclenches
les mesures prendre en cas d'vnement.
Les rondes ont pour but de complter les dispositifs de dtection en essayant de dcouvrir,
de faon alatoire, les prmices d'actes de malveillance. Il existe plusieurs catgories de
rondes suivant le but prcis recherch :
ronde de clture ;
ronde de site ;
ronde de btiment ;
ronde de (contrle de) poste ;
ronde de fermeture de locaux, etc.
Toutes ont besoin d'un support technique appropri : moyen de locomotion, moyen de
transmission, moyen de dfense. C'est ainsi que lon parlera de ronde motorise, ronde
canine, etc.
Les responsables de l'entreprise attachent un tel intrt aux rondes qu'ils s'efforcent de bien les
contrler. D'o la floraison des systmes de contrle de ronde de plus en plus labors o
l'attention finit par se focaliser sur le contrle en oubliant l'essentiel : l'objectif de la ronde.
PCS et rondes s'appuient sur du personnel, l ressurgissent les questions bien connues du
recrutement, de la qualification, des effectifs, du rgime de travail, des avantages et
inconvnients du personnel contractuel.
L'valuation de la surveillance est bien dlicate. Ce qui est recherch, c'est avant tout une
certaine dissuasion par la prsence d'agents de surveillance. Ce que l'on demande ce
personnel, c'est une vigilance de tous les instants, et tout propos. Les questions se poser
sont celles de la confiance, de la comptence, de l'effectif suffisant, des moyens suffisants, de la
comprhension et du respect des consignes.
L'valuation cherchera savoir si lon n'a pas l'illusion de scurit dans un tablissement confi
une grande part du temps (heures non ouvrables) une quipe restreinte de prposs
subalternes disposant de toutes les opportunits... bienveillantes, laxistes ou malveillantes.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
L'agent de surveillance
Prsent 24 heures sur 24 sur un site, il filtre et contrle le personnel et les vhicules des
diverses entreprises entrant sur le site, ainsi que les visiteurs de toutes sortes, souvent
inconnus du personnel. Il assure la fonction d'accueil du personnel, parfois associe la
fonction de standard et veille l'application des consignes de scurit du poste qui lui est
confi.
L'agent de surveillance doit avant tout faire preuve de discrtion, avoir le sens du contact,
avoir une tenue irrprochable. Il existe un trop grand nombre d'agents de surveillance qui
ne portent que le nom d'agent de surveillance . N'oublions pas que l'entreprise est
aussi juge sur sa scurit, et que son image de marque peut en dpendre.
Enfin, puisquil a accs une grande partie des locaux en dehors des heures ouvrables, l'agent
de surveillance doit avant tout tre d'une parfaite intgrit. Il sera capable de voir ou de
dcouvrir certaines choses qui demandent une grande discrtion.
Une formation en matire de scurit incendie devrait tre obligatoire, dans la mesure
o l'agent doit tre en mesure, dans certains cas, d'intervenir le premier en cas
daccident.
4.2 Les consignes
Le support indispensable de la surveillance est la consigne dont on s'accorde dire qu'elle
doit tre crite, ne traiter qu'un sujet la fois, tre brve et simple (quand, qui, o,
comment ?). Encore faut-il s'assurer qu'elle est comprise.
Parmi les multiples sujets de consignes, citons :
le rglement intrieur de l'tablissement (consigne de discipline gnrale) ;
la consigne de ronde (propre chaque catgorie de ronde) ;
la consigne d'exploitation du PCS qui en est le guide d'emploi ;
la conduite tenir en cas d'acte de malveillance (une fiche par menace, une fiche par
point nvralgique) ;
la consigne des vrifications priodiques effectuer ;
les consignes de contrle des accs ;
les consignes de postes (emploi du temps, relves, tenue... ).
4.3 L'intervention
En cas de dcouverte dun acte de malveillance il faut alerter et intervenir.
L'alerte a pour objet la mise en uvre des moyens d'intervention. L'alerte initiale,
immdiate et laconique, n'indique que le lieu et la nature de la menace. Elle
permet la mise en uvre des premires procdures d'intervention. Le message de
confirmation tabli aprs l'valuation de l'vnement et transmis grce aux moyens
de liaison, permet de donner les renseignements complmentaires destins
organiser l'intervention.
Enfin, l'alarme peut tre lance dans l'tablissement dans des cas de gravit
exceptionnelle, pour avertir le personnel et l'inciter prendre les mesures de
scurit immdiates.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
L'intervention a pour objet :
de faire cesser la menace et de porter secours aux victimes ou aux personnes
menaces ;
de limiter les consquences de la tentative ou de l'acte de malveillance, notamment en
protgeant les points nvralgiques ;
de apprhender le ou les auteur des faits et, si possible, devoir de tout citoyen, prvu
par le code pnal, soit de les remettre la police en cas d'acte dlictueux, soit de les
faire sanctionner par la direction de l'entreprise (s'il s'agit de son personnel).
4.4 L'entranement
L'entranement a pour but de crer et de maintenir un tat d'esprit dans l'entreprise. La
direction doit tre sensibilise aux risques qui la menacent et aux faons de s'en
prmunir.
L'encadrement et le personnel doivent tre motivs, ce qui implique information,
rcompense et sanction. Le personnel de surveillance doit tre instruit et bien entran
dans sa profession.
Enfin, les pouvoirs publics ne doivent pas tre tenus l'cart des efforts accomplis dans
l'entreprise.
Les mthodes d'entranement sont diverses suivant qu'il s'agit de sensibilisation, d'information,
de formation. Cependant, on s'attachera aux suggestions provenant du sein de l'entreprise,
par exemple, l'occasion des exercices.
Le rle des exercices est de s'assurer que les consignes sont bien assimiles, que les
instructions sont bien ralistes et applicables, que les rflexes de scurit ont t bien
acquis. Il est courant de dcouvrir des failles l'issue d'un exercice et d'tre oblig de
revoir certaines dispositions.
Un exercice annonc est un moment favorable la malveillance et un exercice impromptu peut
avoir des rpercussions dangereuses.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
5 LA PROTECTION DES INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES
5.1 Les principes de la protection des informations
Voici, pour les responsables soucieux de protger les informations confidentielles, une
procdure aussi souple que possible qui permet d'accder un premier niveau de
protection ; elle est dfinie sous le sigle SIP (Systme d'Information Protger). Le
systme d'information protger peut se dfinir partir des cinq questions qui suivent.
5.1.1 Que protger ?
Toute information dont la diffusion prmature et non-contrle peut porter prjudice
l'entreprise ou l'un de ses collaborateurs.
5.1.2 Qui doit prendre la responsabilit ?
Il appartient l'auteur de l'information de juger si celle-ci doit ou non entrer dans le SIP.
5.1.3 Sous quelle forme se prsentent les informations protger ?
Ces informations peuvent tre :
crites ou sur support magntique : courrier, tlcopie, bureau d'tude, bureautique et
messagerie lectronique crite, reprographie, etc. ;
orales : directes, par tlphone, par messagerie lectronique vocale, par
tlconfrence.
5.1.4 Les communications crites peuvent-elles tre protges ?
Seuls les documents crits et leurs annexes, la reprographie, ainsi que les supports
magntiques d'information peuvent tre l'objet d'une organisation permettant de
renforcer la sret.
5.1.5 Les communications orales peuvent-elles tre protges ?
Il est possible, avant une runion trs importante, de contrler l'absence de dispositifs
clandestins d'coute.
Il est galement faisable d'quiper en permanence un nombre trs limit de bureaux pour
que l'on soit certain que les conversations ne sont pas l'objet de dtournement.
Il existe un rseau tlphonique protg qui, s'il est srieusement contrl et entretenu,
peut permettre de s'assurer, dans de trs nombreux cas, que les lignes reliant deux postes
ne sont pas l'objet d'une agression extrieure.
Le rseau tlphonique non protg et la messagerie lectronique vocale peuvent tre
tout moment l'objet d'un dtournement d'informations.
5.1.6 Quelles sont les rgles fondamentales de la protection
des informations ?
La protection des informations tant contraignante, il importe que la slection faite la
diligence de l'auteur soit particulirement rigoureuse.
Toute information protger doit tre connue des seules personnes qui en ont
expressment besoin.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
L'entourage immdiat de ces personnes (assistants, secrtaires) se trouve obligatoirement
au courant. Ces dernires personnes, dont la moralit doit tre indiscutable, occupent
des postes de confiance ; il convient d'attirer leur attention sur lobligation de
discrtion qui leur incombe dans l'exercice de leurs fonctions. Ces postes ne doivent en
aucun cas tre occups titre temporaire par des intrimaires ou des stagiaires. Lobligation
de discrtion doit tre formalise par une dclaration d'habilitation.
Toute information protger, transcrite sur un support quelconque (notes, lettres, plans,
bandes magntiques, etc. ), doit tre soumise des rgles strictes d'mission, de
reproduction, de dtention, de transmission, de stockage et de destruction qui font l'objet
d'une directive particulire.
5.2 La mise en place d'un systme d'information protger
5.2.1 L'argumentaire
Cet argumentaire est destin expliquer au personnel les motivations de la mise en
place d'un systme d'information protger (SIP).
La protection des membres du personnel et du patrimoine commun, donc de l'outil
collectif de travail, rend importante, voire vitale dans quelques cas, la mise en place
d'une organisation destine protger certaines informations contre toute indiscrtion
pendant un dlai plus ou moins long.
Avoir accs de telles informations est une responsabilit dont il faut avoir conscience,
ce qui implique un devoir de discrtion.
Tout systme d'information protge entrane certaines contraintes. Il n'est instaur que
pour faciliter ce devoir collectif et individuel de discrtion. Il n'est dirig contre personne
mais pour la scurit des individus et de la collectivit qui les rassemble.
Il est normal de ne diffuser les informations protger qu'aux personnes qui ont les
traiter et de leur demander, ainsi qu leurs collaborateurs directs, de manifester leur
adhsion en signant une dclaration d'habilitation.
Cette habilitation est lie la fonction et non la personne ; elle cesse en cas de
changement de fonction.
5.2.2 L'habilitation des personnes
Toute personne dtentrice d'une information confidentielle orale ou crite ncessaire sa
fonction a un devoir de discrtion :
lors de ses conversations avec des collaborateurs non concerns ;
dans les lieux publics, mme avec des collaborateurs concerns (moyens de transports,
restaurants, etc.) ;
au cours des confrences, symposiums ou autres manifestations pendant lesquelles elle
peut prendre la parole.
Les documents quelle aura elle-mme classs dans le Systme d'information protger (SIP)
ou quelle aura reus dans l'exercice de ses fonctions seront soumis la procdure de
gestion des documents protger.
Ils devront faire l'objet d'une vigilance particulire si, pour les besoins du service, ils
doivent tre transports l'extrieur de l'entreprise.
En cas de changement de fonction ou de dpart de l'entreprise, ces documents devront
tre, soit transmis personnellement au responsable hirarchique direct, soit au successeur
si celui-ci a t dsign et habilit par ce responsable hirarchique.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
5.2.3 Les procdures respecter
L'auteur et le destinataire d'une information confidentielle classe dans le systme d'information
protger doivent s'engager respecter les rgles de discrtion. Il est ncessaire de formaliser
cette disposition par une dclaration d'habilitation.
Outre l'auteur et le destinataire, un nombre aussi restreint que possible d'autres personnes
peuvent avoir accs aux informations protger. Ce sont gnralement des assistants ou des
secrtaires. Ces collaborateurs doivent tre sensibiliss et responsabiliss ; une dclaration
d'habilitation doit galement leur tre demande.
Ces habilitations sont lies la fonction de chacun. Elles sont conserves par le responsable
hirarchique qui, en cas de mutation, les transmet son successeur.
5.2.4 La gestion des documents protger
Lorsquun document est considr par son auteur ou par son lecteur comme devant tre
protg, il doit tre soumis la procdure du SIP que ce soit l'mission, la
reproduction, la dtention, la transmission, au stockage ou la destruction.
mission des documents
Le document doit tre matriellement ralis par une personne habilite. Il doit
comporter au minimum les mentions suivantes :
les mentions habituelles : service metteur, date, numro d'ordre ;
SIP ( l'exclusion de toute autre mention, par exemple confidentiel , secret , etc.). Ce
sigle indique que la reproduction, la dtention, la transmission, le stockage et la destruction
doivent tre contrls par des personnes habilites ;
la liste nominative des destinataires ;
la mention aucune reproduction ne peut tre faite sans l'autorisation expresse du
destinataire qui, le cas chant, voudra bien mentionner de sa main sur son exemplaire et
avant reproduction, le nom du ou des destinataires secondaires . (Cette mention peut tre
ralise l'aide d'un tampon adapt.).
Les carbones, stencils, rubans, disquettes et supports numriques, tirages dfectueux seront
dtruits ou effacs dans les plus brefs dlais par les personnes habilites ayant ralis
l'dition.
Reproduction
La reproduction de documents classs SIP ne pourra s'effectuer que par des personnes
habilites qui noteront sur un cahier spcial le numro du document, la date, le nombre
d'exemplaires et les destinataires, de faon qu'un contrle puisse tre fait si une dviation dans
la diffusion tait dcele.
Dtention
Les documents SIP devront tre conservs en lieu sr : tiroir ou armoire ferms clef, armoire
forte ou coffre. Ils ne devront pas rester sur les tables de travail lors des absences mme
momentanes.
Transmission
La transmission des documents SIP sera faite sous double enveloppe :
la premire contenant le document sur laquelle sera porte la mention (ou le tampon)
suivante : M. X Pli confidentiel remettre ferm son destinataire .
la seconde contenant la premire portant la mention : M. X ou Secrtariat de M. X.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
Aucune autre marque, notamment l'origine, ne devra tre porte sur lenveloppe
extrieure qui devra tre aussi neutre que possible.
Destruction
Les documents SIP devront tre dtruits par les soins d'une personne habilite ds qu'ils
ne prsenteront plus d'intrt pour leur destinataire.
L'auteur du document jugera s'il y a intrt dtruire ou archiver son exemplaire et, dans
ce cas, l'archivage devra tre ralis soit sous clef par une personne habilite, soit par le
service spcialis de l'tablissement.
Les secrtariats ou bureaux devront s'quiper, s'ils ne le sont dj, de corbeilles papier
destructrices de documents (broyeurs).
5.2.5 Les protections particulires la communication
par moyens lectroniques
Tlphone et tlcopie
Aucune information ou dcision classe ne doit tre communique par tlphone ou par
tlcopie.
Le courriel
Outre les solutions techniques du type antivirus, anti-spam, pare-feu, la protection des
messageries internet passe galement par des solutions dorganisation.
Il est ncessaire dtablir une charte dutilisation des messageries, valide par les
reprsentants du personnel, diffuse et signe par tous les utilisateurs. Ce
document indique les rgles dusages et les mesures de prcaution prendre pour
la scurit des messageries, les limitations dusage et les ventuels contrles dont
peut faire lobjet la messagerie.
Les pratiques de prudence mettre en uvre par les usagers sont de divers ordres. Le
Clusif prconise entre autres, de ne pas utiliser son adresse professionnelle pour un usage
priv, de crer un mot de passe personnel pour protger laccs sa messagerie, ne pas
ouvrir les messages dexpditeurs inconnus, sauvegarder les messages importants, utiliser
la fonction denvoi en copie cache lorsquun message a plusieurs destinataires
Par ailleurs, la gestion de la messageries doit tre confie un administrateur charg de
veiller au respect des rgles fixes
La destruction des documents confidentiels
Il est important de faire effectuer la destruction de les notes confidentielles ainsi que de
tous autres documents moins confidentiels mais qui peuvent, dans une certaine mesure,
porter prjudice l'entreprise d'o l'importance de recenser et classer les risques par
dpartement dans la socit.
Chaque colis renfermant des notes confidentielles dtruire devra tre scell par les
principaux intresss ou leurs proches collaborateurs.
Le ramassage se fera par un agent de surveillance qui notera sur un cahier le nombre de colis,
la provenance des colis, la date, qu'ils sont bien scells et fera signer les intresss sur un cahier
ad hoc attestant leur prise en charge.
Ces colis seront prsents au responsable scurit qui vrifiera leur nombre et la bonne
marche de la procdure. Les colis dtruits en sa prsence, il paraphera lui-mme ce cahier.
Un trop grand nombre de notes confidentielles sont actuellement jetes dans de simples
corbeilles papier qui deviennent alors une source de renseignements.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
5.2.6 La scurit informatique
La scurit des systmes dinformation (SSI) est aujourdhui essentielle :
dune part linformatique a envahi non seulement la gestion des entreprises mais
aussi les moyens de production et/ou de rgulation, maintenant pilots par des
ordinateurs standards ;
dautre part, lactivit conomique est de plus en plus dpendante des donnes
numriques. Leur indisponibilit peut compromettre le paramtrage dune machine, la
connaissance des quantits produire ou acheminer.
La SSI
Dans le pass, on parlait de systme informatique pour dcrire le parc des ordinateurs.
Dsormais, on parle de systme dinformation car le cadre demploi de ces machines a
largement volu : messagerie (lectronique) interne ou externe ; gestion centralise des
donnes sur la clientle ; communication via le web.
L'architecture informatique c'est complexifie : les ordinateurs centraux ont t complts
par une myriade de serveurs, de taille plus petite. Paralllement, la capacit de stockage
des donnes sur les PC de bureau et sur les ordinateurs portables a considrablement
augment.
Quest-ce que la scurit des donnes ?
Elle peut se rsumer un triple objectif : assurer la disponibilit, lintgrit et la confidentialit
des donnes. En d'autres termes, il s'agit de prendre toute disposition pour que linformation
soit accessible, ne soit pas modifie accidentellement ou de faon malveillante et en prserver
le secret si besoin est.
On rajoute mme une quatrime caractristique, limputabilit ou auditabilit qui dfinit la
possibilit de suivre son emploi ou ses modifications.
Notre information rpartie est aujourdhui nomade, non seulement via des ordinateurs
portables mais aussi via des organiseurs personnels, ces derniers pouvant maintenant stocker
des centaines de mga-octets de fichiers : feuilles de calculs, documents et contrats, bases de
donnes, fichiers clients Il faut donc en assurer la sauvegarde et la confidentialit. Face
une architecture informatique aussi complexe (rseau local ou distant), htrogne , il faut de
la mthode si on veut optimiser lemploi des moyens de scurit et ne rien oublier.
Les types de risques
Il faut trs rapidement classer les risques auxquels on est expos et, si possible, identifier
leurs impacts financiers.
Il faut insister sur le fait que cette dpendance critique est trop souvent sous-estime,
voire ignore. Son apprciation ncessite un dialogue entre les diffrents services de
lentreprise : informatique, gestion, production, acheminement, etc.
La typologie des risques repose sur un triptyque traditionnel :
Accident : incendies, dgts des eaux, explosions, pollutions corrosives pour les
quipements informatiques, etc.
Erreur : actions humaines accidentelles dexploitation de linformatique et les erreurs
de programmations, les fameux bugs.
Malveillance : le problme majeur est celui de la malveillance, par des employs ou
des personnes extrieures, qui ont un intrt, parfois lucratif, dtruire ou modifier ces
donnes informatiques.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
La scurisation du systme
Contre tout cela, la dmarche SSI doit idalement commencer par un audit de scurit.
Celui-ci aura pour objet didentifier les risques auxquels lentit est expose, apprcier
les vulnrabilits existantes ou les parades relatives et en dduire un plan daction.
Dans la pratique, lactivit informatique a souvent dbut sans que la dimension scuritaire soit
correctement prise en compte. Laudit aura alors pour objet de raliser un tat des lieux afin
dordonnancer de faon optimale le dploiement des plans de scurit.
Les plans de scurit, dtermineront ensuite les moyens et procdures mettre en oeuvre
en fonction des risques envisags.
Il existe de nombreux plans :
sauvegarde des donnes ;
redondance des moyens informatiques ;
activation des moyens de substitution ;
gestion des droits et des privilges sur les ressources informatiques ;
lutte antivirus ;
sensibilisation et formation du personnel ;
communication de crise, etc.
Tous les plans concourent la ralisation de trois objectifs majeurs : prvention
(rduction de loccurrence), protection (rduction de limpact) et raction (gestion de
lvnement).
Il existe heureusement une littrature et une offre de services trs varies, adaptes aux
environnements techniques et aux contraintes organisationnelles de chacun. La mise en
ligne sur le web, facilite dsormais laccs de telles informations mais il est fortement
conseill de se faire assister par un cabinet conseil, au moins dans la phase de dmarrage.
Limites
Du fait de la possibilit des ngligences, des oublis, de l'aspect volutif des organisations
on ne peux pas considrer une solution comme acquise et dfinitive :
- les cycles de sauvegardes initialement quotidiens deviennent mensuels ;
- les mots de passe sont reconduits lidentique ;
- les procdures de gestion des incidents ne sont pas adaptes en fonction des
volutions, etc.
Il est donc impratif de mettre en place des procdures de tests et/ou de contrles pour
dtecter au plus tt linadquation des mesures de scurit face aux menaces ou aux
besoins de continuit de lactivit conomique.
Insistons sur le facteur humain, facteur dchec ou clef de la russite de votre scurit. La
vritable problmatique est la prise de conscience du risque et la volont de sen prserver. Les
solutions mettre en uvre ne sont pas forcment coteuses car, dans tous les cas, la seule r-
organisation du mode de travail avec les moyens existants permettant damliorer le niveau de
scurit : conservation des donnes en dehors du btiment, mot de passe difficilement
devinable, anticipation des plans de raction sur incident, etc.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
6 LES DISPOSITIONS RELATIVES
L'ATTENTAT LA BOMBE
L'attentat la bombe, individuel ou collectif, dirig contre un objectif prcis ou
aveugle , est malheureusement devenu l'un des moyens couramment employ dans
les guerres conomiques ou idologiques auxquelles sont confrontes les nations
occidentales.
L'attentat ou la menace d'attentat sont aussi utiliss par des individus et des
organisations sans scrupule, pour mettre en difficult des entreprises industrielles ou
mme les dtruire si les actions menes sont suffisamment rptitives.
Il est donc indispensable, au sein de toute entreprise, de se proccuper l'avance de ce
problme et de prvoir la conduite tenir en cas d'alerte ou d'attentat.
Les mesures prventives doivent tre prises sans attendre une conjoncture alertante, ce
type d'vnement tant, par nature, imprvisible.
Il faut :
tablir un plan de protection fond sur une analyse rigoureuse des risques ;
crer un tat d'esprit sans instaurer un climat de psychose ;
dfinir les procdures et les consignes qui entreront en vigueur en cas d'alerte ou d'attentat
(en particulier, les dispositions concernant lvacuation du public et du personnel doivent
tre parfaitement dfinies) ;
instituer une cellule de crise qui peut, ventuellement, voir ses missions largies tous les
problmes graves en matire de scurit/sret.
6.1 Plan de crise en cas d'attentat ou d'alerte la bombe
Mme si certaines entreprises sont plus menaces que d'autres en raison, par
exemple, de la nature de leur fabrications ou de l'origine de leurs capitaux, aucune
n'est l'abri.
Cependant, rappelons que sensibiliser son personnel aux risques d'attentat en
certaines priodes, dans certaines industries plus particulirement menaces, ne
signifie aucunement instaurer un climat de psychose.
6.1.1.1 Mesures prventives
tablir un plan de protection : prvenir, protger, intervenir.
tude des risques : menaces relles, menaces potentielles, liste des points nvralgiques
de l'entreprise, mise en place de parades.
tude des objectifs : effet de dissuasion, Information, Action.
Crer un tat d'esprit
Moyens : des notes de service, des confrences de sensibilisation, des articles dans la
presse d'entreprise.
Dfinir les procdures et les consignes
Contrler les entres l'aide de badges, de laisser-passer ou tous autres moyens,
aussi bien pour le personnel que pour les visiteurs et pour les vhicules.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
tablir un plan des lieux, jour, avec l'emplacement des points sensibles et les
endroits les plus appropris pour le dpt des engins explosifs.
Interdire d'abandonner des colis, sacoches ou valises dans les locaux communs
(vestiaires, toilettes, couloirs, salles de lecture...).
Limiter les voies d'accs.
Organiser un plan d'vacuation avec plusieurs itinraires de sortie.
Surtout ne jamais toucher un colis suspect, prvenir les autorits et vacuer les lieux dans le
calme.
Instituer une cellule de crise
Missions : la cellule de crise est un lment moteur de la dcision assurant le
commandement, l'organisation et la gestion de l'tat d'alerte.
Choix des personnels :
- le dcideur n'est pas forcment le chef d'tablissement, il peut y avoir dlgation ;
- la dcision peut tre prise collgialement ;
- le nombre est fonction de l'importance de la socit, mais nous pouvons y trouver
d'une faon gnrale : le chef d'tablissement, le chef du personnel, le chef de la
scurit.
Il est important ne pas dpasser 4 6 personnes compte tenu des intervenants extrieurs
(police, gendarmerie, etc.) sinon les dcisions sont rapidement bloques.
Moyens matriels :
- un bureau PC ;
- moyens de communication ;
- dossier technique (plans) ;
- tresse de balisage ;
- clairage de secours, etc.
Objectifs. Un programme devrait donner les orientations pour les activits suivantes :
- contrle de l'opration ;
- vacuation ;
- recherche de l'engin ;
- moyens de recherche ;
- dcouverte de l'engin ;
- explosion ;
- contrle des dgts ;
- victimes/local de tri ;
- intervention sanitaire ;
- relations avec l'extrieur/mdia ;
- rapport.
La cellule de crise, si on lui affecte les techniciens ncessaires, peut devenir l'outil de
dcision pour tous les problmes graves relatifs la scurit/sret dans l'entreprise :
l'explosion (pas forcment une bombe) ;
la prise d'otage ;
les cataclysmes naturels ;
les problmes sociaux graves, etc.
Partie 3 Lutter contre la malveillance
6.1.1.2 vacuation du public et du personnel
Modalits
vacuation avec vestiaires en service : les vestiaires peuvent rester ouverts et gards ;
chacun reprend ses affaires personnelles avant de sortir.
vacuation avec vestiaires ferms : chacun rejoint les sorties de secours d'urgence, sans
reprendre ses affaires
Consignes
Mise en alerte PC scurit ;
alarme (sono-diffusion la voix sur le rseau gnral ou sirnes) ;
dblocage des issues de secours ;
information des diffrents organismes extrieurs : police, pompiers, etc. ;
rassemblement au PC scurit des diffrents corps de mtier de la maintenance :
lectriciens, plombiers, etc. ;
information de la Direction du droulement de l'vacuation et des mesures mises en
place ;
attente de l'intervention de services spcialiss avant rintgration dans la socit,
aprs annonce la direction gnrale par voix sur rseau gnral intrieur et
extrieur ;
compte rendu d'vacuation la Direction ;
attente pour rouverture ventuelle.
Messages d'vacuation puis, en fin d'alerte, de radmission du public et
du personnel
Ils sont diffuss au moyen de haut-parleurs, dans et l'extrieur des btiments par la direction.
6.2 Conseils lors de la rception d'un message
d'alerte la bombe
Consignes aux standardistes :
1. Gardez votre calme.
2. Essayez de faire parler l'individu : faire traner la conversation ; faire rpter ; discuter.
3. Notez le maximum de renseignements : homme ou femme ; accent ; tonalit de la
voix ; dbit calme ou hach ; le texte.
4. Prvenez immdiatement le responsable sret/scurit, plus diffrentes personnes
(liste joindre avec les consignes).
Partie 3 Lutter contre la malveillance
Modle de fiche d'appel tlphonique concernant les menaces diverses. A
l'usage des standardistes, centres d'accueil et postes de scurit
Vous pouvez dans le cadre de votre activit, tre confront (e) un appel tlphonique
soit d'alerte la bombe, soit de menaces diverses.
Il est important, quel que soit votre sentiment sur le srieux de cet appel, de pouvoir rpondre
aux questions listes ci-dessous dans la mesure du possible notamment en faisant parler votre
interlocuteur.
Date:
.....
Heure :
.
Lieu :
.....
- Communication reue par : .
- Texte exact de la communication :
Questions auxquelles vous devez tenter d'obtenir une rponse :
1. QUAND explosera l'engin ?
2. O est-il ?
3. De QUEL engin s'agit-il ?
4. POURQUOI agissez-vous ainsi ?
("Vous ne donnez pas l'impression d'tre quelqu'un qui souhaite faire du mal...")
5. QUI tes-vous ?
Partie 3 Lutter contre la malveillance
Votre raction immdiate, aprs avoir complt la premire partie de la fiche dappel
tlphonique ci-dessus, doit tre davertir linterlocuteur dsign cet effet et de remplir la
seconde partie de la fiche correspondant aux indices que vous aurez pu percevoir pendant
la conversation.
AVERTIR
Pendant les heures de service n : ..
En dehors des heures de service n : ..
VOIX DU CORRESPONDANT :
Homme, Femme, Enfant (ge) : ..
Langue employe : ...
Prononciation et dfauts :
Dbit (rapide, lent, hach, essouffl, etc.) :
Accent : .
BRUITS DE FOND PERUS PENDANT LA COMMUNICATION :
Musique : ..
Conversation : ..
Frappe de machine crire : ..
Enfants :
Trafic urbain (sirne de police ou ambiance) : ..
Avions : .
Autre : ..
PARTIE 4
UTILISER DES PRODUITS DANGEREUX
EN LIMITANT LES RISQUES
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
1 LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX
1.1 Dfinition
1.2 Classements des produits dangereux
1.2.1 La classification europenne harmonise
1.2.2 Les autres classements
2 LES FICHES DE DONNES DE SCURIT
2.1 Les rubriques de la fiche de donnes de scurit (FDS)
2.2 Exemple de fiche de donnes de scurit
3 TIQUETER ET EMBALLER LES PRODUITS DANGEREUX
3.1 tiquetage
3.2 Nature des risques particuliers
3.2.1 Phrases R
3.2.2 Combinaisons de phrases R
3.3 Conseils de prudence
3.3.1 Phrases S
3.3.2 Combinaisons de phrases S
4 COMMENT STOCKER LES PRODUITS DANGEREUX
4.1 La responsabilit de lentrepositaire
4.2 La connaissance des produits stocks
4.3 La conception du stockage
4.3.1 La compatibilit des produits dangereux
4.3.2 Les conditions de stockage
4.4 La configuration des btiments de stockage
5 COMMENT UTILISER LES PRODUITS DANGEREUX
5.1 Les produits de substitution
5.2 Les risques lis aux proprits physico-chimiques
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
5.3 L'utilisation des moyens de protection collective
5.4 Le port des quipements de protection individuelle
5.5 La manipulation de produits dangereux
5.5.1 Formation et information du personnel
5.5.2 Protection du personnel
5.5.3 Propret des locaux
5.5.4 Les produits dangereux usags
6 CHARGEMENT/DCHARGEMENT DES PRODUITS DANGEREUX
6.1 Les aires de chargement/dchargement
6.2 Le protocole de chargement/dchargement
6.3 Le transvasement et le reconditionnement
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
1 LA CLASSIFICATION
DES PRODUITS DANGEREUX
1.1 Dfinition
Les produits dangereux sont classs en substances et en prparations dont les dfinitions sont
donnes par le Code du travail (article R231-51) :
Substances : lments chimiques et leurs composs tels qu'ils se prsentent l'tat
naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procd de production contenant
ventuellement tout additif ncessaire pour prserver la stabilit du produit et toute
impuret rsultant du procd, l'exclusion de tout solvant pouvant tre spar sans
affecter la stabilit de la substance ni modifier sa composition.
Prparations : mlanges ou solutions composs de deux substances ou plus.
Les substances et prparations dangereuses sont celle correspondant l'une ou plusieurs
des catgories suivantes (Code du travail article R231-51) :
a) explosibles - substances et prparations solides, liquides, pteuses ou glatineuses
qui, mme sans intervention d'oxygne atmosphrique, peuvent prsenter une raction
exothermique avec dveloppement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais
dtermines, dtonent, dflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en
cas de confinement partiel ;
b) comburantes - substances et prparations qui, au contact d'autres substances,
notamment inflammables, prsentent une raction fortement exothermique ;
c) extrmement inflammables - substances et prparations liquides dont le point d'clair
est extrmement bas et le point d'bullition bas, ainsi que substances et prparations gazeuses
qui, temprature et pression ambiantes, sont inflammables l'air ;
d) facilement inflammables - substances et prparations :
qui peuvent s'chauffer au point de s'enflammer l'air temprature ambiante sans apport
d'nergie ;
l'tat solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brve action d'une source
d'inflammation et continuer brler ou se consumer aprs l'loignement de cette source ;
l'tat liquide, dont le point d'clair est trs bas ;
ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrmement inflammables
en quantits dangereuses ;
e) inflammables - substances et prparations liquides, dont le point d'clair est bas ;
f) trs toxiques - substances et prparations qui, par inhalation, ingestion ou
pntration cutane en trs petites quantits, entranent la mort ou nuisent la sant de
manire aigu ou chronique ;
g) toxiques - substances et prparations qui, par inhalation, ingestion ou pntration
cutane en petites quantits, entranent la mort ou nuisent la sant de manire aigu
ou chronique ;
h) nocives - substances et prparations qui, par inhalation, ingestion ou pntration
cutane, peuvent entraner la mort ou nuire la sant de manire aigu ou chronique;
i) corrosives - substances et prparations qui, en contact avec des tissus vivants,
peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
j) irritantes - substances et prparations non corrosives qui, par contact immdiat, prolong
ou rpt avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une raction inflammatoire ;
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
k) sensibilisantes - substances et prparations qui, par inhalation ou pntration
cutane, peuvent donner lieu une raction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition
ultrieure la substance ou la prparation produit des effets nfastes caractristiques ;
l) cancrognes - substances et prparations qui, par inhalation, ingestion ou pntration
cutane, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la frquence.
Cancrognes de catgorie 1 : substances et prparations que l'on sait tre cancrognes
pour l'homme ;
Cancrognes de catgorie 2 : substances et prparations pour lesquelles il existe une forte
prsomption que l'exposition de l'homme de telles substances et prparations peut
provoquer un cancer ou en augmenter la frquence ;
Cancrognes de catgorie 3 : substances et prparations proccupantes pour l'homme en
raison d'effets cancrognes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont
insuffisantes pour classer ces substances et prparations dans la catgorie 2 ;
m) mutagnes - substances et prparations qui, par inhalation, ingestion ou pntration
cutane, peuvent produire des dfauts gntiques hrditaires ou en augmenter la frquence.
Mutagnes de catgorie 1 : substances et prparations que l'on sait tre mutagnes pour
l'homme ;
Mutagnes de catgorie 2 : substances et prparations pour lesquelles il existe une forte
prsomption que l'exposition de l'homme de telles substances et prparations peut produire
des dfauts gntiques hrditaires ou en augmenter la frquence ;
Mutagnes de catgorie 3 : substances et prparations proccupantes pour l'homme en
raison d'effets mutagnes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont
insuffisantes pour classer ces substances et prparations dans la catgorie 2 ;
n) toxiques pour la reproduction - substances et prparations qui, par inhalation,
ingestion ou pntration cutane, peuvent produire ou augmenter la frquence d'effets nocifs
non-hrditaires dans la progniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacits
reproductives.
Toxiques pour la reproduction de catgorie 1 : substances et prparations que l'on sait tre
toxiques pour la reproduction de l'homme ;
Toxiques pour la reproduction de catgorie 2 : substances et prparations pour lesquelles il
existe une forte prsomption que l'exposition de l'homme de telles substances et
prparations peut produire ou augmenter la frquence d'effets nocifs non hrditaires dans la
progniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacits reproductives ;
Toxiques pour la reproduction de catgorie 3 : substances et prparations proccupantes en
raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les informations
disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et prparations en catgorie 2 ;
o) dangereuses pour l'environnement - substances et prparations qui, si elles
entraient dans l'environnement, prsenteraient ou pourraient prsenter un risque immdiat ou
diffr pour une ou plusieurs de ses composantes.
1.2 Classements des produits dangereux
1.2.1 La classification europenne harmonise
Dans la lgislation actuelle, les substances dangereuses sont rpertories l'annexe I de la
directive CEE n 67-548 modifie par la directive 2001/59/CE concernant le rapprochement
des dispositions lgislatives, rglementaires et administratives des tats membres, relatives la
classification, l'emballage et l'tiquetage des substances dangereuses. Cette lgislation repose
sur une distinction conventionnelle entre les substances chimiques mises sur le march avant
1981 et celles nouvelles mises sur le march aprs cette date. Seules les substances
nouvelles doivent tre notifies et testes.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Dans la classification actuelle, chaque substance y est rpertorie avec diffrentes entres
pour lui permettre d'tre retrouve facilement. Ces entres correspondent des numros et
une identification.
Le programme Reach
Cependant, la Commission Europenne a constat que ce systme a eu pour effet de favoriser
lusage quasi exclusif des produits connus avant 1981, cest--dire non tests, et de freiner
linnovation. Par ailleurs, ce systme apparat comme mal adapt lidentification et la gestion
des risques de nombreux produits.
Pour ces raisons, lUnion Europenne travaille llaboration du systme Reach, un systme
unique denregistrement et dautorisation des substances chimiques, et la cration dune
Agence europenne des produits chimiques.
Une proposition concernant Reach et cette agence a t adopte le 29 octobre 2003.
Ladoption dfinitive du texte devrait avoir lieu dans le courant du premier semestre 2006.
Cette proposition ne contient pas de prescriptions quant la classification, ltiquetage et
lemballage des substances. De ce fait les lments correspondants de la directive 67-548
resteront en vigueur.
Avec le systme Reach, la charge de la preuve sera renverse et passera des autorits
publiques lindustrie. Il reviendra aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs de veiller
fabriquer, mettre sur le march, importer ou utiliser des substances qui ne risquent pas
davoir deffets nocifs pour la sant humaine et lenvironnement.
Le maillon central de ce systme sera lenregistrement des produits chimiques. Pour ce faire, les
dclarants devront fournir un dossier technique comportant lidentit du dclarant, celle de la
substance et ses proprits. Un rapport de scurit chimique devra tre tabli pour les produits
dont la production annuelle est de plus de 10 tonnes. Ce rapport sappuiera sur lvaluation
de scurit chimique et lidentification des mesures appropries en vue de matriser
valablement les risques. L'enregistrement et l'valuation des substances passeront ainsi sous la
responsabilit des producteurs et des importateurs.
La fiche de donnes de scurit destine aux utilisateurs devra incorporer toutes ces mesures.
L'utilisateur, quant lui, devra en principe informer par crit son fournisseur de l'usage qu'il
projette de faire des substances afin que celui-ci value la scurit chimique de chaque
utilisation identifie.
Par ailleurs, lutilisateur aura obligation de respecter les mesures de rduction des risques
prvues par les FDS.
1.2.1.1 Les numros de classement des substances dangereuses
Le numro Index
Le numro index de chaque substance se prsente sous la forme d'une squence de 9 chiffres
du type ABC-RST-VW-Y (dans l'annexe I, les substances sont classes par ordre croissant de
numro croissant de numro Index), o :
ABC reprsente soit le numro atomique de l'lment chimique le plus caractristique
(prcd d'un ou de deux zros pour complter la sous-squence), soit le numro
conventionnel de la classification des substances organiques ;
RST reprsente le numro progressif des substances considres dans les squences ABC ;
VW reprsente la forme sous laquelle la substance est produite ou mise sur le march ;
Y reprsente le chiffre de contrle (check digit) calcul selon la mthode utilise par l'ISBN.
Illustration
Le numro index du chlorate de sodium est le 017-005-00-9.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Liste des lments chimiques classs selon leur numro atomique
N Symbole
N Symbole
N Symbole
1 H Hydrogne 36 Kr Krypton 71 Lu Luttium
2 He Hlium 37 Rb Rubidium 72 Hf Hafnium
3 LI Lithium 38 Sr Strontium 73 Ta Tantale
4 Be Bryllium (Glucinium) 39 Y Yttrium 74 W Tungstne
5 B Bore 40 Zr Zirconium 75 Re Rhnium
6 C Carbone 41 Nb Niobium 76 Os Osmium
7 N Azote 42 Mo Molybdne 77 Ir Iridium
8 O Oxygne 43 Tc Technetium 78 Pt Platine
9 F Fluor 44 Ru Ruthnium 79 Au Or
10 Ne Non 45 Rh Rhodium 80 Hg Mercure
11 Na Sodium 46 Pd Palladium 81 Tl Thalium
12 Mg Magnsium 47 Ag Argent 82 Pb Plomb
13 Al Aluminium 48 Cd Cadmium 83 Bi Bismuth
14 Si Silicium 49 In Indium 84 Po Polonium
15 P Phosphore 50 Sn tain 85 At Astate
16 S Soufre 51 Sb Antimoine 86 Rn Radon
17 Cl Chlore 52 Te Tellure 87 Fr Francium
18 A Argon 53 I Iode 88 Ra Radium
19 K Potassium 54 Xe Xnon 89 Ac Actinium
20 Ca Calcium 55 Cs Csium 90 Th Thorium
21 Sc Scandium 56 Ba Baryum 91 Pa Protactinium
22 Ti Titane 57 La Lanthane 92 U Uranium
23 V Vanadium 58 Ce Crium 93 Np Neptunium
24 Cr Chrome 59 Pr Prasodyme 94 Pu Plutonium
25 Mn Manganse 60 Nd Nodyme 95 Am Amricium
26 Fe Fer 61 Pm Promthium 96 Cm Curium
27 Co Cobalt 62 Sm Samarium 97 Bk Berklium
28 Ni Nickel 63 Eu Europium 98 Cf Californium
29 Cu Cuivre 64 Gd Gandolinium 99 Es Einsteinium
30 Zn Zinc 65 Tb Terbium 100 Fm Fermium
31 Ga Gallium 66 Dy Dysprosium 101 Md Mendlvium
32 Ge Germanium 67 Ho Holmium 102 No Noblium
33 As Arsenic 68 Er Erbium 103 Lw Lawrentium
34 Se Slnium 69 Tm Thulium
35 Br Brome
70 Yt Ytterbium
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Le numro CE (Einecs ou Elincs)
Les substances chimiques produites, utilises, mises sur le march en Europe ont fait l'objet d'un
inventaire qui a t clos le 18 septembre 1981.
Cet inventaire est dsign sous le sigle EINECS (European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances).
Les substances inscrites dans l'Einecs portent un numro se prsentant sous la forme
d'une suite de 7 chiffres du type XXX-XXX-X. Par consquent, toute substance chimique
rpertorie aprs cette date est qualifie de nouvelle et doit faire l'objet d'une dclaration
de mise sur le march.
Les substances dclares aprs le 18 septembre 1981 sont donc inscrites dans une liste dite
des substances notifies, ELINCS (European List of Notified Chemical Substances), mise jour
chaque anne et publie au JOCE.
Leurs numros se prsentent galement sous la forme d'une srie de sept chiffres du type
XXX-XXX-X.
1.2.1.2 L'identification
A ct des numros, les substances chimiques sont en gnral inscrites sous la dnomination
utilise dans l'Einecs ou l'Elincs. Elles peuvent aussi tre inscrites sous leur nom chimique selon
la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et applique (UICPA).
Le numro CAS
Le numro CAS (Chemical Abstract Service) est aussi mentionn dans la classification
europenne harmonise pour faciliter l'identification de l'entre. Compos de 3
squences du type XXX-XX-X ou XXXXXX-XX-X, il permet d'identifier les espces chimiques
sans aucune ambigut.
L'index alphabtique
Pour aider les utilisateurs, l'INRS publie une liste alphabtique et par numro CAS de
chaque substance qui permet de retrouver facilement le numro Index correspondant
la substance.
1.2.2 Les autres classements
1.2.2.1 Le classement du Comit europen des assurances (CEA)
Le CEA a mis au point un systme de classification des produits et des
marchandises destin donner des informations rapides et simples sur les risques
qu'ils prsentent.
Ce systme attribue aux produits et marchandises une combinaison de lettres et de
chiffres correspondant leurs proprits combustibles et explosibles ainsi qu' leurs
effets sur l'environnement et l'tre humain.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Proprits combustibles et explosibles
Une lettre dfinissant la catgorie de danger :
F matires combustibles et incombustibles n'ayant pas d'action oxydante, non susceptibles d'auto-
inflammation et ne dgageant aucun gaz combustible au contact de l'eau
AF matires auto-inflammables
HF matires dgageant des gaz combustibles au contact du feu,
O oxydants, matires favorisant la combustion et l'entretenant mme en l'absence d'air et pouvant
enflammer des matires combustibles ou former avec elles des mlanges explosibles
E matires explosibles, mme en absence d'air
Un chiffre, indiquant le degr de danger
En ordre dcroissant, de 1 6, dans la catgorie de danger dfinie ;
Une lettre reprsentant l'tat physique 20 C et 1 bar :
s
l
g
solide
liquide
gazeux
S'il y a lieu, les indications suivantes sont ajoutes :
Co matires qui, sous l'effet du feu, dgagent des gaz ou vapeurs fortement corrosifs,
Ex matires explosibles dans certaines conditions ou raction spontane dont les autres proprits
de combustibilit priment sur le danger d'explosion et non comprises dans la catgorie E
Fu matires qui, en cas d'incendie, dgagent une quantit de fume trs suprieure la moyenne,
susceptible d'entraver le sauvetage et d'occasionner des dommages par dpt de suies,
Ra matires radioactives.
cotoxicit
Pour l'eau, les lettres PN auxquelles sont ajoutes un chiffre de 1 4 reprsentant :
PN1
forte mise en danger de l'eau, phrase R 50
PN2 mise en danger de l'eau, phrase R 51
PN3 faible mise en danger de l'eau, phrase R 52
PN4 n gnral, aucune mise en danger de l'eau
Pour l'air, la lettre Z avec une chiffre de 1 2 :
Z1 gaz toxiques comprims reprsentant une menace directe et compromettant une action d'extinction, ou
matires susceptibles, en cas d'incendie, de librer des quantits importantes de substances toxiques
difficilement dgradables, exigeant la mise en oeuvre de mesures de dcontamination trs importantes
Z2 matires qui, en cas d'incendie, librent des quantits importantes de substances toxiques
causant ainsi une contamination de l'environnement et requrant la mise en oeuvre de mesures
de dcontamination simples et limites.
Proprits anthropotoxiques
T matires trs toxiques et toxiques, correspondant aux phrases de danger de la classification officielle
R 23 28, 39, 40 et 45 49,
HT matires dgageant des gaz toxiques, caustiques/corrosifs ou fortement nausabonds au contact de
l'eau (R 29) pouvant en cas d'incendie prsenter un rel danger ou engendrer une inquitude
srieuse dans le voisinage,
C matires causant en peu de temps des lsions graves (phrases R 34 et R 35).
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
1.2.2.2 Le classement de la NFPA
Le classement de la NFPA, National Fire Protection Association (tats-Unis), est intressant
connatre pour les produits qui sont imports.
En effet, la NFPA publie un certain nombre de standards ayant trait la prvention et la
protection contre l'incendie, qui servent de rfrence aux tats-Unis et dans de nombreux pays.
Parmi ces standards, le NFPA 704 Standard System for the Identification of the Fire Hazards of
Materials, dtermine trois classes de risques de toxicit, inflammabilit et ractivit, qu'il
quantifie en ordre dcroissant de 4 0 selon la gravit des dangers et dont la signification est
la suivante :
Toxicit
4 : une trs courte exposition ces matires peut provoquer la mort ou des lsions
majeures irrversibles,
3 : une courte exposition ces matires peut causer de graves lsions temporaires
ou irrversibles,
2 : une exposition intense ou continue mais non chronique ces matires peut
causer une incapacit temporaire ou une lsion irrversible possible,
1 : une exposition ces matires peut causer une irritation mais seulement une
lsion irrversible mineure,
0 : sous l'effet d'un incendie ces matires ne prsentent pas plus de risques qu'un
matriau ordinaire combustible ;
Inflammabilit
4 : matires se vaporisant rapidement ou compltement la pression
atmosphrique et temprature ambiante normale ou qui sont facilement
disperses dans l'air et brlent facilement,
3 : liquides et solides pouvant tre enflamms dans presque toutes les conditions
de temprature,
2 : matires qui doivent tre modrment chauffes ou exposes une temprature
ambiante relativement leve avant de s'enflammer,
1 : matires devant tre chauffes pour s'enflammer,
0 : matires incombustibles ;
Ractivit
4 : matires susceptibles par elles-mmes de facilement dtoner, se dcomposer
ou ragir d'une faon explosive tempratures et pressions normales,
3 : matires susceptibles de dtoner ou de ragir d'elles-mmes de faon explosive
mais avec l'aide d'une nergie d'activation ou sous l'effet de chauffage ou de
confinement,
2 : matires qui subissent facilement de violents changements chimiques des
tempratures et pressions leves ou qui ragissent violemment avec l'eau ou qui
peuvent former avec l'eau des mlanges explosifs,
1 : matires normalement stables par elles-mmes mais pouvant devenir instables
tempratures et pressions leves,
0 : matires normalement stables par elles-mmes mme exposes l'incendie et
qui ne ragissent pas avec l'eau.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
La signalisation
Cette classification sert de base la signalisation des rservoirs et rcipients contenant
les produits et parfois mme aux btiments de stockage.
Son marquage consiste en un losange comportant quatre cases dans lesquelles sont
inscrits :
sur fond bleu le chiffre correspondant la toxicit ;
sur fond rouge le chiffre correspondant l'inflammabilit ;
sur fond jaune le chiffre correspondant la ractivit.
La quatrime case est utilise pour des remarques ventuelles telles que par exemple :
emploi d'eau sur le produit proscrit.
Illustration
Signalisation
de l'actaldhyde
selon la NFPA
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
2 LES FICHES DE DONNES DE SCURIT
Les fabricants, importateurs, fournisseurs sont tenus de fournir leurs clients une fiche de
donnes de scurit contenant les renseignements ncessaires la prvention du risque
chimique et la scurit des travailleurs (Code du travail, article R231-53). Elle doit
ensuite tre transmise par le chef d'tablissement au mdecin du travail.
Larrt du 9 novembre 2004 dfinissant les critres de classification et les conditions
d'tiquetage et d'emballage des prparations dangereuses et transposant la directive
1999/45/CE du Parlement europen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le
rapprochement des dispositions lgislatives, rglementaires et administratives relatives la
classification, l'emballage et l'tiquetage des prparations dangereuses rend obligatoire la
FDS :
pour les substances et prparation dangereuses ;
mais galement pour les prparations non classes comme dangereuses mais qui contiennent
des produits dangereux pour la sant et lenvironnement, des produits prsentant des valeurs
limites dexposition professionnelles, un minimum de 1% en concentration ou 0,2 % en
volume.
La fiche de donnes de scurit doit tre ralise suivant les indications du guide annex
l'arrt du 5 janvier 1993 fixant les modalits d'laboration
et de transmission des fiches de donnes de scurit modifi pas l'arrt du 9 novembre 2004.
Cet arrt du 9 novembre 2004 transpose la directive 2001/58/CE de la Commission du 27
juillet 2001.
Cette fiche doit contenir les renseignements suivants :
l'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale,
responsable de sa mise sur le march ;
les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de
concentration, ncessaires l'apprciation des risques ;
l'identification des dangers ;
la description des premiers secours porter en cas d'urgence ;
les mesures de lutte contre l'incendie ;
les mesures prendre en cas de dispersion accidentelle ;
les prcautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
les procdures de contrle de l'exposition des travailleurs et les caractristiques des
quipements de protection individuelle adquats ;
les proprits physico-chimiques ;
la stabilit du produit et sa ractivit ;
les informations toxicologiques ;
les informations cotoxicologiques ;
des informations sur les possibilits d'limination des dchets ;
les informations relatives au transport ;
les informations rglementaires relatives en particulier au classement et
l'tiquetage du produit ;
toutes autres informations disponibles pouvant contribuer la scurit ou la sant des
travailleurs.
L'article R231-53 du Code du Travail prcise que cette fiche doit tre actualise,
date, fournie gratuitement au moment de la premire livraison et que toute fiche
actualise doit tre galement fournie gratuitement tout client ayant reu dans les
douze mois prcdant la rvision le produit ou la substance concerne.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
D'aprs la jurisprudence, la fourniture de fiches sur support informatique ne
dispense pas de la fourniture de la fiche sur papier. En revanche, une fiche fournie
par tlcopie est valable si l'envoi est sign par un responsable.
Si le fournisseur ne fournit pas la fiche de donnes de scurit, il engage sa
responsabilit en cas d'accident.
Il existe aussi une norme : la norme NF ISO 11014-1 (novembre 1994) Fiches de
donnes de scurit pour les produits chimiques Partie 1 : contenu et plant type (indice
de classement : T 01-102).
2.1 Les rubriques de la fiche de donnes de scurit (FDS)
Il nexiste pas de modle type obligatoire, mais la fiche doit comporter les 16
rubriques obligatoires dans lordre prcis requis par le code du travail, tre rdige
en franais de manire claire et concise.
La quantit ainsi que la nature des informations qui doivent tre fournis sont
illimits, le rdacteur peut ajouter toute information utile pour la scurit dusage
du produit.
Modle tabli selon l'arrt du 5 janvier 1993 modifi fixant les modalits
d'laboration et de transmission des fiches de donnes de scurit (directive
2001/58/CE).
1. Identification de la substance/prparation et de la personne physique
ou morale responsable de la mise sur le march
1.1. Identification de la substance/prparation.
Dnomination utilise pour l'identification identique celle figurant sur l'tiquette
Si d'autres moyens d'identification existent, ils peuvent tre indiqus
1.2. Utilisation de la substance/prparation.
Utilisations rvues ou recommandes dans la mesure o elles sont connues.
Si multiples utilisations possibles, mentionner les plus importantes ou les plus courantes.
Description sommaire de l'effet rel (ex : retardateur de flamme, antioxydant, etc.)
1.3 Identification de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le march.
Identification du responsable (fabricant, importateur, distributeur).
Adresse complte et n de tlphone
Si le responsable est hors de France, adresse complte et n de tlphone du responsable en France,
si possible.
1.4. N de tlphone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organisme agr par le code du travail
2. Composition/informations sur les composants
Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnatre aisment les dangers prsents par
les composants de la prparation.
Les dangers de la prparation elle-mme doivent tre mentionns au point 3
2.1 Il n'est pas ncessaire d'indiquer la composition complte, mme si une description gnrale des
composants et de leur concentration est utile.
2.2. Pour les prparations classes comme dangereuses, mentionner les substances qui suivent ainsi que leur
concentration ou gamme de concentration :
a) substances prsentant un danger pour la sant ou l'environnement, lorsqu'elles sont prsentes en
concentrations gales ou suprieures celles prvues l'article 8 de l'arrt du 9 novembre 2004 ;
b) substances pour lesquelles il existe des limites d'exposition professionnelle non couvertes par a).
2.3. Pour les prparations non classes comme dangereuses, prsentes en concentration individuelle 1 %
en masse pour les prparations autres que gazeuses et 0,2 % en volume pour les prparations
gazeuses, mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration :
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
- les substances prsentant un danger pour la sant ou l'environnement
- les substances pour lesquelles il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle
2.4. La classification des substances vises ci-dessus est mentionne, y compris les lettres des symboles et les
phrases R qui leur sont assignes selon leurs dangers physico-chimiques, pour la sant et pour
l'environnement.
2.5. Le nom et le n EINECS ou ELINCS de ces substances doivent tre mentionns.
2.6. Si l'identit de certaines substances doit tre garde confidentielle, la nature chimique doit tre dcrite
afin d'assurer la scurit d'emploi. Le nom utiliser doit tre le mme que celui drivant de l'application
des dispositions mentionnes ci-dessus
3. Identification des dangers
Indiquer la classification de la substance ou prparation.
Indiquer clairement et brivement les principaux dangers pour l'homme et pour l'environnement.
Distinguer clairement les prparations sont classes comme dangereuses et celles non classes
comme dangereuses.
Dcrire les principaux effets nfastes : physico-chimiques, pour la sant de l'homme et pour
l'environnement et les symptmes lis l'utilisation et aux mauvais usages raisonnablement prvisibles.
Si ncessaire, mentionner d'autres dangers (formation de poussires, asphyxie, apparition d'engelures)
ou les effets sur l'environnement (dangers pour les organismes du sol, etc.), qui n'entranent pas la
classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers gnraux du matriau.
Les informations qui figurent sur l'tiquette sont donner sous la rubrique 15.
4. Premiers secours
Dcrire brivement et clairement les premiers secours donner.
Spcifier d'abord si un examen mdical immdiat est requis.
Les informations concernant les premiers secours doivent tre brves et faciles comprendre par la
victime, les personnes prsentes et les secouristes.
Les symptmes et les effets doivent tre brivement dcrits et les instructions doivent indiquer ce qui
doit tre fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets retardement sont craindre aprs une
exposition.
Prvoir une sous-rubrique par voie d'exposition
Prciser si l'intervention d'un mdecin est ncessaire ou souhaitable.
Pour certaines substances ou prparations, souligner que des moyens spciaux doivent tre mis
disposition sur le lieu de travail pour un traitement spcifique et immdiat.
5. Mesures de lutte contre l'incendie
moyen d'extinction appropri ;
moyen d'extinction ne pas utiliser pour des raisons de scurit ;
risque particulier rsultant de l'exposition la substance/prparation en tant que telle, aux produits de
la combustion, aux gaz produits ;
quipement de protection spcial pour le personnel prpos la lutte contre le feu.
6. Mesures prendre en cas de dispersion accidentelle
Selon la substance ou la prparation en cause, des informations doivent ventuellement tre donnes
concernant :
les prcautions individuelles ;
les prcautions pour la protection de l'environnement ;
les mthodes de nettoyage.
7. Manipulation et stockage
Les informations prvues sous cette rubrique concernent la protection de la sant, la scurit
et la protection de l'environnement. Elles doivent aider l'employeur concevoir les
procdures de travail et les mesures d'organisation adquates en application du code du
travail.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
7.1. Manipulation.
Envisager les prcautions prendre pour garantir une manipulation sans danger, (mesures
d'ordre technique , les mesures destines empcher la production de particules en
suspension et de poussires ou prvenir les incendies, les mesures requises pour protger
l'environnement ainsi que toutes exigences ou rgles spcifiques ayant trait la
substance/prparation)
7.2. Stockage.
tudier les conditions ncessaires pour garantir la scurit du stockage (conception
particulire des locaux de stockage ou des rservoirs, matires incompatibles, conditions de
stockage, quipement lectrique spcial et prvention de l'accumulation d'lectricit
statique.
Le cas chant, les quantits limites pouvant tre stockes.
Toute indication particulire : type de matriau d'emballage/conteneur
7.3. Utilisation(s) particulire(s).
Pour les produits finis destins une ou plusieurs utilisations particulires, les
recommandations doivent se rfrer l'utilisation ou aux utilisations prvues et tre
dtailles et fonctionnelles.
8. Contrle de l'exposition des travailleurs et caractristiques des
quipements de protection individuelle
8.1. Valeurs limites d'exposition.
Paramtres de contrle spcifique actuellement en vigueur tels que valeurs limites
d'exposition professionnelle contraignantes ou indicatives et indicateurs biologiques
d'exposition.
Informations sur les procdures de surveillance actuellement recommandes.
Pour les prparations, donner des valeurs pour les composants devant figurer sur la fiche de
donnes de scurit conformment au point 2.
8.2. Contrles de l'exposition.
Toutes les mesures spcifiques de protection et de prvention prendre durant l'utilisation
pour rduire au minimum l'exposition des travailleurs et assurer la protection de
l'environnement.
8.2.1.
8.2.1.1
8.2.1.2.
8.2.1.3.
8.2.1.4.
Contrle de l'exposition professionnelle. Cette information est ncessaire l'employeur pour
valuer les risques pour la sant et la scurit des travailleurs que prsente la
substance/prparation.
Il convient de disposer d'informations appropries et adquates sur ces mesures pour
valuer srieusement les risques. Cette information est complmentaire celle dj donne
au point 7.1.
Lorsqu'une protection individuelle est ncessaire, spcifier le type d'quipement propre
assurer une protection adquate.
Protection respiratoire. En cas de gaz, vapeurs ou poussires dangereux, prciser le type
d'quipement de protection utiliser
Protection des mains. Spcifier le type de gants porter lors de la manipulation.
Si ncessaire, indiquer toute mesure supplmentaire de protection des mains.
Protection des yeux. Spcifier le type de protection oculaire requis
Protection de la peau. Spcifier le type et la qualit de l'quipement de protection requis. Si
ncessaire, indiquer toute mesure supplmentaire de protection de la peau ainsi que toute
mesure d'hygine particulire.
8.2.2. Contrle d'exposition li la protection de l'environnement.
Spcifier l'information requise par l'employeur pour remplir ses engagements au titre de la
lgislation relative la protection de l'environnement.
9. Proprits physiques et chimiques
9.1 Informations gnrales : aspect ; odeur
9.2 Informations importantes relatives la sant, la scurit et l'environnement
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
- pH
- Point/intervalle d'bullition.
- Point d'clair.
- Inflammabilit (solide, gaz).
- Dangers d'explosion.
- Proprits comburantes.
- Pression de vapeur.
- Densit relative.
- Solubilit :hydrosolubilit ;liposolubilit
- Coefficient de partage : n-octanol/eau.
- Viscosit.
- Densit de vapeur.
- Taux d'vaporation.
9.3. Autres donnes
Indiquer les autres paramtres importants pour la scurit, tels que la miscibilit, la
conductivit, le point/intervalle de fusion, le groupe de gaz, la temprature d'auto-
inflammabilit, etc.
10. Stabilit et ractivit
10.1. Conditions viter : temprature, pression, lumire, chocs, etc.,
10.2. Matires viter : eau, air, acides, bases, oxydants , etc.
10.3. Produits de dcomposition dangereux.
11. Informations toxicologiques
Cette rubrique rpond la ncessit d'une description concise et nanmoins complte et
comprhensible des divers effets toxiques pouvant tre observs lorsque l'utilisateur entre en
contact avec la substance ou la prparation
Effets dangereux pour la sant d'une exposition la substance ou la prparation, que
ces effets soient connus par l'exprience ou par les conclusions d'exprimentations
scientifiques
Informations sur les diffrentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la
peau et les yeux), et dcrire les symptmes
Indiquer les effets diffrs et immdiats connus ainsi que les effets chroniques induits par
une exposition court et long termes
12. Informations cologiques
Effets, comportement et devenir cologique de la substance ou prparation dans l'air,
l'eau et/ou
le sol.
Principales caractristiques susceptibles d'avoir un effet sur l'environnement, du fait de la
nature de
la substance ou prparation et des mthodes probables d'utilisation.
Mmes renseignements sur les produits dangereux provenant de la dgradation des
substances et prparations.
12.1. cotoxicit.
12.2. Mobilit. Le potentiel de transport de la substance ou des composants appropris d'une
prparation, rejets dans l'environnement, vers les eaux souterraines ou loin du site de rejet.
12.3. Persistance et dgradabilit. Le potentiel de dgradation de la substance ou des composants
appropris d'une prparation dans un environnement pertinent, par biodgradation ou
d'autres processus tels que l'oxydation ou l'hydrolyse.
12.4. Potentiel de bioaccumulation. Le potentiel de bioaccumulation et de passage dans la chane
alimentaire de la substance ou des composants appropris d'une prparation
12.5. Effets nocifs divers..
13. Considrations relatives l'limination
Si l'limination de la substance ou de la prparation prsente un danger :
fournir une description de ces rsidus ainsi que des informations sur la faon de les manipuler sans
danger ;
indiquer les mthodes appropries d'limination
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
14. Informations relatives au transport
Prcautions spciales connatre ou prendre pour le transport l'intrieur ou l'extrieur des
installations.
15. Informations rglementaires
Informations relatives la sant, la scurit et la protection de l'environnement figurant
sur l'tiquette conformment aux arrts du 20 avril 1994 modifi et du 9 novembre 2004.
Si la substance ou la prparation vise par cette fiche de donnes de scurit fait l'objet de
dispositions particulires en matire de protection de l'homme et de l'environnement sur le
plan communautaire, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, tre prcises.
Lorsque c'est possible, mentionner les dispositions lgislatives ou rglementaires nationales
mettant ces dispositions en application ainsi que toute autre mesure nationale applicable en la
matire.
16. Autres informations
Indiquer tout autre renseignement que le fournisseur juge important pour la scurit et la sant de
l'utilisateur et la protection de l'environnement,
2.2 Exemple de fiche de donnes de scurit
(Voir ci-contre. Source : Eau & Feu)
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Page 1 sur 4
POLYPETROFILM 6/6 Version : P 36 1
Date de cration /Rvision : 26/08/04
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
PRESENTATION ET REGLES DE REDACTION CONFORMES
A LA DIRECTIVE 91/155/CEE modifie par la directive 2001/58/CE
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE
1.1 Identification du produit : POLYPETROFILM 6/6
1.2 Utilisation (pour plus de dtails, : Extinction de feux de produits chimiques polaires et
se reporter la notice technique) d'hydrocarbures
1.3 Identification de la Socit : EAU & FEU
82 rue Lesage
51054 REIMS Cdex
03 26 50 64 10 Fax 03 26 09 64 38
Service contacter : Dpartement Emulseurs
1.4 Numro durgence : ORFILA 01 45 42 59 59
2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
2.1 Nature chimique : Prparation base dhydrolysat de protines, de tensio-actifs fluors
filmognes et hydrocarbons, glycols, polymre, eau
2.2 Composs prsentant un danger
Nom EINECS Symboles Phrases R Concentration
Hexylne Glycol 203-489-0 Xi 36/38 < 5%
Ethylne Glycol 203-473-3 Xn 22 < 15%
1-2 Benzisothiazoline-3(2H)-one 220-120-9 Xn, N 22-38/41-43-50 < 0,2%
3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classification CE : Non class
Principaux dangers : Peut entraner une sensibilisation par
contact avec la peau
4. PREMIERS SECOURS
* Contact avec la peau : Laver l'eau
* Contact avec les yeux : Rincer abondement l'eau pendant 15 minutes minimum
En cas dirritation persistante consulter un spcialiste
* Ingestion : Rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter ventuellement un mdecin
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
5.1 Moyens d'extinction appropri : Non spcifiquement concern
5.2 Moyen dextinction ne pas utiliser : Non combustible
5.3 Risques particuliers : Tous les agents dextinctions proximit sont
utilisables
5.4 quipement pour la protection des intervenants : Non spcifiquement concern
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Page 1 sur 4
POLYPETROFILM 6/6 Version : P 36 1
Date de cration /Rvision : 26/08/04
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Prcaution individuelle : Eviter le contact avec la peau et les yeux
Protection de lenvironnement : Limiter autant que possible les rejets dans l'environnement.
Mthode de nettoyage : Rcuprer le produit pour limination ultrieure, puis laver
le sol grande eau
7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1 Manipulation : Travailler dans un lieu bien ventil
Conserver les rcipients ferms en dehors de leur emploi
7.2 Stockage : Tempratures de stockage : - 15C + 50C ( lcart des
matires incompatibles)
7.3.1 Matriaux demballage * Recommands Acier ordinaires et inoxydables
plastiques
Joints recommands : Tflon - Viton
8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE
Ethylne Glycol : Vle = 125 mg/m
3
(50 ppm)
Hexylne Glycol : Vle = 125 mg/m
3
(25 ppm)
8.1 Mesures individuelles de prvention
* Protection des mains : Porter des gants rsistant la pntration des produits chimiques
* Protection des yeux : Porter des lunettes tanches
8.2 Mesures spciales de protection : Ne ncessite pas de mesures spcifiques
Respecter les rgles gnrales de protection applicable pour la
manipulation des produits chimiques
8.3 Moyens collectifs durgence : Fontaine oculaire
8.4 Mesures dhygine : Ne pas manger, boire et fumer pendant lutilisation
Se laver les mains aprs le travail
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1 Informations gnrales
Etat physique : liquide pseudoplastique 20C
Odeur : caractristique
9.2 Informations importantes
pH : 7,5
TC initiale d'bullition : 100C
Point d'clair : > 100C
Point de conglation : < -15C
Solubilit : soluble dans l'eau en toutes proportions
Pression de vapeur :
Masse volumique : 1,090 g/cm 20C
Temprature d'auto-inflammation : non applicable
Viscosit dynamique 20C : 1100 mPa.s
Tension Superficielle 6% : 16,5 mN/m 20C
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Page 3 sur 1
POLYPETROFILM 6/6 Version : P 36 1
Date de cration /Rvision : 26/08/04
10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1 Stabilit : Produit stable temprature ambiante dans les conditions
normales de stockage et de manipulation
10 .2 Matires viter :
10.3 Produits de dcomposition dangereux : A hautes tempratures, dcomposition thermique possible en
produits fluors (HF)
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Effets ltaux aigus : DL50 orale : > 2000 mg/kg (rat)
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1 Ecotoxicit
Effets sur organismes aquatiques :
CE 50 48 h (Daphnies) : 0,29% = 3190 mg/l
12 .2 Effets sur les installations de traitement des eaux rsiduaires
Demande Chimique en Oxygne (DCO) : 576 mg/g
Demande Biochimique en Oxygne (DBO
5
) : 113 mg/g
12.3 Mobilit
Tension superficielle : Se reporter la section 9 pour la donne chiffre
12.4 Persistance et Biodgradabilit
Produit fortement moussant en cas de rejet dans leau
Biodgradabilit arobie ultime (suivant NFT 90312) : 80% en 28 jours
12.5 Bioaccumulation
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Produit pur : Ne pas rejeter dans lenvironnement
Incinrer en installation autorise
Le produit ne pertube pas le fonctionnement des stations
dpuration aprs dilution
Produit aprs utilisation : Confiner les rsidus et les solutions une entreprise de
traitement physico-chimique autorise ou incinrer en installation
autorise
Emballages souills : Confier les emballages vids un rcuprateur autoris ou
dtruire en installation autorise ou recycler aprs nettoyage
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Page 4 sur 1
POLYPETROFILM 6/6 Version : P 36 1
Date de cration /Rvision : 26/08/04
14. TRANSPORT ONU N
R.T.M.D RID/ADR IMDG OACI
maritime arien
--------------------------------------------------------------------------------------------
Classe................................... :
Groupe, chiffre ou page.... :
Page IMDG......................... :
Etiquette(s)......................... :
Code danger....................... : Non rglement
Code matire (n ONU)..... :
N fiche de scurit........... :
N table GSMU.................. :
Avion passagers :
Avion cargo :
__
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Etiquetage CE
Symbole : Pas dtiquetage
Phrases R : R 43 Peut entraner une sensibilisation par contact
avec la peau
Phrases S : S 24 Eviter le contact avec la peau
S 37 Porter des gants appropris
Phrases complmentaires Contient du 1-2 Benzisothiazol-3(2H)-one
Rglementations Nationales Tableau des maladies professionnelles N84
16. AUTRES INFORMATIONS
Restriction demploi :
Sources des principales donnes : Fiches toxicologiques de lINRS
Fiches de donnes de scurit des fournisseurs
___________________________________________________________________________________________
Cette fiche complte la notice technique dutilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont bass sur
l'tat de nos connaissances relatives au produit concern, la date de mise jour. Ils sont donns de bonne foi. Une liste de rappel
des principaux textes lgislatifs, rglementaires et administratifs peut tre jointe, titre indicatif, cette fiche. L'attention des
utilisateurs est en outre attire sur les risques ventuellement encourus lorsqu'un produit est utilis d'autres usages que ceux pour
lequel il est conu.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
3 TIQUETER ET EMBALLER
LES PRODUITS DANGEREUX
Toutes les rglementations concernant les substances et prparations dangereuses en imposent
leur tiquetage et renvoient pour sa mise en uvre aux prescriptions de deux arrts :
celui du 20 avril 1994 modifi relatif la liste et aux conditions d'tiquetage et d'emballage
de substances, arrt issu de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 ;
et celui du 9 novembre 2004 dfinissant les critres de classification et les conditions
d'tiquetage et d'emballage des prparations dangereuses et transposant la directive
1999/45/CE du 31 mai 1999.
Il est donc fait obligation aux vendeurs ou distributeurs de substances ou de prparations dangereuses
ainsi qu'aux chefs des tablissements o il en est fait usage, d'apposer sur tout rcipient, sac ou
enveloppe contenant ces substances ou prparations une tiquette ou une inscription indiquant le nom
et l'origine de ces substances ou prparations et les dangers que prsente leur emploi.
Les rcipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou prparations dangereuses
doivent tre solides et tanches et de nature compatible avec le produit contenu.
3.1 tiquetage
Tout emballage renfermant une substance ou une prparation contenant au moins une
substance dangereuse dans une concentration dfinie par les deux arrts doit tre muni d'une
tiquette apparente et lisible, d'une dimension en rapport avec l'importance de son volume
(annexe VI de l'arrt du 20 avril 1994)
Les dimensions sont de lordre de :
52 x 74 mm si possible pour un volume infrieur ou gal 3 l ;
74 x 105 mm pour un volume suprieur 3 litres et infrieur ou gal 50 l;
105 x 148 mm pour un volume suprieur 50 litres, mais gal ou infrieur 500 l ;
148 x 210 mm pour un volume suprieur 500 litres.
Ltiquette doit tre solidement fixe sur une ou plusieurs faces de lemballage se trouvant
directement en contact avec la prparation.
Les informations devant figurer sur ltiquette doivent se dtacher nettement du fond, tre de
taille suffisante et prsenter un espacement suffisant pour tre aisment lisibles.
Par ailleurs, l'tiquette doit obligatoirement tre rdige en franais, une traduction en langue
trangre est admise.
L'tiquette doit comporter en caractres trs apparents et indlbiles :
a) pour les prparations, le nom commercial ou la dsignation ;
b) pour les substances, le nom de la substance, et pour les prparations, les noms des
substances prsentes dans la prparation ;
c) les nom, adresse complte et n de tlphone du responsable de la mise sur le march de la
substance ou prparation ;
d) le(s) symbole(s) et indication(s) de danger ;
e) les phrases indiquant les risques particuliers (phrases R) ;
f) les phrases indiquant les conseils de prudence (phrases S) ;
g) pour les substances, le numro CE accompagn, dans le cas des substances figurant
lannexe I, de la mention tiquetage CE ;
h) pour les prparations offertes ou vendues au public, la quantit nominale du contenu, sauf si
elle est spcifie ailleurs sur lemballage.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Les indications telles que non toxique , non nocif , non polluant , cologique ou toutes
autres indications analogues ne doivent pas figurer sur ltiquette ou sur lemballage des substances ou
des prparations
Le nom de la substance doit tre conforme au nom utilis dans l'Inventaire europen des
produits chimiques commercialiss (EINECS).
Symboles et indications des dangers
E : Explosif
F : Facilement
inflammable T : Toxique Xi : Irritant C : Corrosif
2
O : Comburant
F+ : Extrmement
inflammable T+ : Trs toxique Xn : Nocif
N :Dangereux pour
l'environnement
Chaque symbole doit occuper au moins un dixime de la surface de ltiquette et avoir
une superficie dau moins 1 cm
2
.
Exemple dtiquette
source : Eau & Feu
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
3.2 Nature des risques particuliers
3.2.1 Phrases R
R1 Explosif l'tat sec.
R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu
ou d'autres sources d'ignition.
R3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction,
le feu ou d'autres sources d'ignition.
R4 Forme des composs mtalliques explosifs trs
sensibles.
R5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R6 Danger d'explosion en contact ou sans contact
avec l'air.
R7 Peut provoquer un incendie.
R8 Favorise l'inflammation des matires
combustibles.
R9 Peut exploser en mlange avec des matires
combustibles.
R10 Inflammable.
R11 Facilement inflammable.
R12 Extrmement inflammable.
R14 Ragit violemment au contact de l'eau.
R15 Au contact de l'eau, dgage des gaz
extrmement inflammables.
R16 Peut exploser en mlange avec des substances
comburantes.
R17 Spontanment inflammable l'air.
R18 Lors de l'utilisation, formation possible de
mlange vapeur-air inflammable/explosif.
R19 Peut former des peroxydes explosifs.
R20 Nocif par inhalation.
R21 Nocif par contact avec la peau.
R22 Nocif en cas d'ingestion.
R23 Toxique par inhalation.
R24 Toxique par contact avec la peau.
R25 Toxique en cas d'ingestion.
R26 Trs toxique par inhalation.
R27 Trs toxique par contact avec la peau.
R28 Trs toxique en cas d'ingestion.
R29 Au contact de l'eau, dgage des gaz toxiques.
R30 Peut devenir facilement inflammable pendant
l'utilisation.
R31 Au contact d'un acide, dgage un gaz toxique.
R32 Au contact d'un acide, dgage un gaz trs
toxique.
R33 Danger d'effets cumulatifs.
R34 Provoque des brlures.
R35 Provoque de graves brlures.
R36 Irritant pour les yeux.
R37 Irritant pour les voies respiratoires.
R38 Irritant pour la peau.
R39 Danger d'effets irrversibles trs graves.
R40 Effet cancrogne suspect ; preuves
insuffisantes.
R41 Risque de lsions oculaires graves.
R42 Peut entraner une sensibilisation par inhalation.
R43 Peut entraner une sensibilisation par contact
avec la peau.
R44 Risque d'explosion si chauff en ambiance
confine.
R45 Peut provoquer le cancer.
R46 Peut provoquer des altrations gntiques
hrditaires.
R48 Risque d'effets graves pour la sant en cas
d'exposition prolonge.
R49 Peut provoquer le cancer par inhalation.
R50 Trs toxique pour les organismes aquatiques.
R51 Toxique pour les organismes aquatiques.
R52 Nocif pour les organismes aquatiques.
R53 Peut entraner des effets nfastes long terme
pour l'environnement aquatique
R54 Toxique pour la flore.
R55 Toxique pour la faune.
R56 Toxique pour les organismes du sol.
R57 Toxique pour les abeilles.
R58 Peut entraner des effets nfastes long terme
pour l'environnement.
R59 Dangereux pour la couche d'ozone.
R60 Peut altrer la fertilit.
R61 Risque pendant la grossesse d'effets nfastes
pour l'enfant.
R62 Risque possible d'altration de la fertilit.
R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets
nfastes pour l'enfant.
R64 Risque possible pour les bbs nourris au lait
maternel.
R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des
poumons en cas d'ingestion.
R66 L'exposition rpte peut provoquer
desschement ou gerures de la peau.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer
somnolence et vertiges.
R68 Possibilit d'effets irrversibles.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
3.2.2 Combinaisons de phrases R
R14/15 Ragit violemment au contact de l'eau en dgageant des gaz extrmement inflammables.
R15/29 Au contact de l'eau, dgage des gaz toxiques et extrmement inflammables.
R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R23/24 Toxique par inhalation et par contact avec la peau.
R23/25 Toxique par inhalation et par ingestion.
R23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion.
R26/27 Trs toxique par inhalation et par contact avec la peau.
R26/28 Trs toxique par inhalation et par ingestion.
R26/27/28 Trs toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R27/28 Trs toxique par contact avec la peau et par ingestion.
R36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
R39/23 Toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par inhalation.
R39/24 Toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par contact avec la peau.
R39/25 Toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par ingestion.
R39/23/24 Toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par inhalation et par contact avec la peau.
R39/23/25 Toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par inhalation et par ingestion.
R39/24/25 Toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par contact avec la peau et par ingestion.
R39/23/24/25 Toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par inhalation, par contact avec la peau et
par ingestion.
R39/26 Trs toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par inhalation.
R39/27 Trs toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par contact avec la peau.
R39/28 Trs toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par ingestion.
R39/26/27 Trs toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par inhalation et par contact avec
la peau.
R39/26/28 Trs toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par inhalation et par ingestion.
R39/27/28 Trs toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par contact avec la peau et par ingestion.
R39/26/27/28 Trs toxique : danger d'effets irrversibles trs graves par inhalation, par contact avec la peau
et par ingestion.
R42/43 Peut entraner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R48/20 Nocif : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par inhalation.
R48/21 Nocif : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par contact avec
la peau.
R48/22 Nocif : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par ingestion.
R48/20/21 Nocif : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par inhalation et par
contact avec la peau.
R48/20/22 Nocif : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par inhalation et par
ingestion.
R48/21/22 Nocif : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par contact avec la
peau et par ingestion.
R48/20/21/22 Nocif : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par inhalation,
contact avec la peau et ingestion.
R48/23 Toxique : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par inhalation.
R48/24 Toxique : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par contact
avec la peau.
R48/25 Toxique : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par ingestion.
R48/23/24 Toxique : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par inhalation et
par contact avec la peau.
R48/23/25 Toxique : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par inhalation et
par ingestion.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
R48/24/25 Toxique : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par contact
avec la peau et par ingestion.
R48/23/24/25 Toxique : risque d'effets graves pour la sant en cas d'exposition prolonge par inhalation,
par contact avec la peau et par ingestion.
R50/53 Trs toxique pour les organismes aquatiques, peut entraner des effets nfastes long terme
pour l'environnement aquatique.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraner des effets nfastes long terme
pour l'environnement aquatique.
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraner des effets nfastes long terme
pour l'environnement aquatique.
R68/20 Nocif : possibilit d'effets irrversibles par inhalation.
R68/21 Nocif : possibilit d'effets irrversibles par contact avec la peau.
R68/22 Nocif : possibilit d'effets irrversibles par ingestion.
R68/20/21 Nocif : possibilit d'effets irrversibles par inhalation et par contact avec la peau.
R68/20/22 Nocif : possibilit d'effets irrversibles par inhalation et par ingestion.
R68/21/22 Nocif : possibilit d'effets irrversibles par contact avec la peau et par ingestion.
R68/20/21/22 Nocif : possibilit d'effets irrversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
3.3 Conseils de prudence
3.3.1 Phrases S
S1 Conserver sous cl.
S2 Conserver hors de la porte des enfants.
S3 Conserver dans un endroit frais.
S4 Conserver l'cart de tout local d'habitation.
S5 Conserver sous... (liquide appropri spcifier par le
fabricant).
S6 Conserver sous... (gaz inerte spcifier par le
fabricant).
S7 Conserver le rcipient bien ferm.
S8 Conserver le rcipient l'abri de l'humidit.
S9 Conserver le rcipient dans un endroit bien ventil.
S12 Ne pas fermer hermtiquement le rcipient.
S13 Conserver l'cart des aliments et boissons y compris
ceux pour animaux.
S14 Conserver l'cart des... (matire(s) incompatible(s)
indiquer par le fabricant).
S15 Conserver l'cart de la chaleur.
S16 Conserver l'cart de toute flamme ou source
d'tincelles - Ne pas fumer.
S17 Tenir l'cart des matires combustibles.
S18 Manipuler et ouvrir le rcipient avec prudence.
S20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
S21 Ne pas fumer pendant l'utilisation.
S22 Ne pas respirer les poussires.
S23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/ fumes/arosols
(terme(s) appropri(s) indiquer par le fabricant).
S24 viter le contact avec la peau.
S25 viter le contact avec les yeux.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immdiatement
et abondamment avec de l'eau et consulter un
spcialiste.
S27 Enlever immdiatement tout vtement souill ou
clabouss.
S28 Aprs contact avec la peau, se laver immdiatement
et abondamment avec... (produits appropris
indiquer par le fabricant).
S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
S40 Pour nettoyer le sol ou les objets souills par ce
produit, utiliser... ( prciser par le fabricant).
S41 En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les
fumes.
S42 Pendant les fumigations/pulvrisations porter un
appareil respiratoire appropri (terme(s) appropri(s)
indiquer par le fabricant).
S43 En cas d'incendie utiliser... (moyens d'extinction
prciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques,
ajouter "Ne jamais utiliser d'eau ").
S45 En cas d'accident ou de malaise consulter
immdiatement un mdecin (si possible lui montrer l
'tiquette) .
S46 En cas d'ingestion consulter immdiatement un
mdecin et lui montrer l'emballage ou l'tiquette.
S47 Conserver une temprature ne dpassant pas... C
( prciser par le fabricant).
S48 Maintenir humide avec... (moyen appropri prciser
par le fabricant).
S49 Conserver uniquement dans le rcipient d'origine.
S50 Ne pas mlanger avec... ( spcifier par le fabricant).
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventiles.
S52 Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux
habits.
S53 viter l'exposition, se procurer des instructions
spciales avant l'utilisation.
S56 liminer ce produit et son rcipient dans un centre de
collecte des dchets dangereux ou spciaux.
S57 Utiliser un rcipient appropri pour viter toute
contamination du milieu ambiant.
S59 Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des
informations relatives la rcupration ou au
recyclage.
S60 liminer le produit et son rcipient comme un dchet
dangereux.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
S29 Ne pas jeter les rsidus l'gout.
S30 Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.
S33 viter l'accumulation de charges lectrostatiques.
S35 Ne se dbarrasser de ce produit et de son rcipient
qu'en prenant toutes prcautions d'usage.
S36 Porter un vtement de protection appropri.
S37 Porter des gants appropris.
S38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil
respiratoire appropri.
S61 viter le rejet dans l'environnement. Consulter les
instructions spciales / la fiche de donnes de
scurit.
S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter
immdiatement un mdecin et lui montrer l'emballage
ou l'tiquette.
S63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime
hors de la zone contamine et la garder au repos.
S64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau
(seulement si la personne est consciente).
3.3.2 Combinaisons de phrases S
S1/2 Conserver sous cl et hors de porte des enfants.
S3/7 Conserver le rcipient bien ferm dans un endroit frais.
S3/9/14 Conserver dans un endroit frais et bien ventil l'cart des...
(matires incompatibles indiquer par le fabricant).
S3/9/14/49 Conserver uniquement dans le rcipient d'origine dans un endroit frais et bien ventil l'cart
de... (matires incompatibles indiquer par le fabricant).
S3/9/49 Conserver uniquement dans le rcipient d'origine dans un endroit frais et bien ventil.
S3/14 Conserver dans un endroit frais l'cart des...
(matires incompatibles indiquer par le fabricant).
S7/8 Conserver le rcipient bien ferm et l'abri de l'humidit.
S7/9 Conserver le rcipient bien ferm et dans un endroit bien ventil.
S7/47 Conserver le rcipient bien ferm et une temprature ne dpassant pas ...C
( prciser par le fabricant).
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
S24/25 viter le contact avec la peau et les yeux.
S27/28 Aprs contact avec la peau, enlever immdiatement tout vtement souill ou clabouss et se laver
immdiatement et abondamment avec... (produits appropris indiquer par le fabricant).
S29/35 Ne pas jeter les rsidus l'gout ; ne se dbarrasser de ce produit et de son rcipient qu'en prenant
toutes les prcautions d'usage.
S29/56 Ne pas jeter les rsidus l'gout, liminer ce produit et son rcipient dans un centre de collecte
des dchets dangereux ou spciaux.
S36/37 Porter un vtement de protection et des gants appropris.
S36/37/39 Porter un vtement de protection appropri, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S36/39 Porter un vtement de protection appropri et un appareil de protection des yeux / du visage.
S37/39 Porter des gants appropris et un appareil de protection des yeux/du visage.
S47/49 Conserver uniquement dans le rcipient d'origine temprature ne dpassant pas... C
( prciser par le fabricant).
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
4 COMMENT STOCKER
LES PRODUITS DANGEREUX
Le stockage des matires dangereuses est essentiellement concern par les
rglementations suivantes :
la lgislation sur les installations classes pour la protection de l'environnement ;
le Code de la construction et de l'habitation ;
le Code de lurbanisme ;
le Code des communes ;
le Code du travail ;
le rglement sanitaire dpartemental.
Lensemble des textes et mesures applicables aux stockages de matires dangereuses vise
assurer dans toutes les circonstances de lexploitation (normale ou dgrade) :
la protection des personnes (les tiers ou le personnel) ;
la protection des biens ;
la protection de lenvironnement.
4.1 La responsabilit de lentrepositaire
Il lui appartient de mettre en place :
un dispositif de prvention des accidents (par exemple pour l'organisation des
stockages) ;
un dispositif de protection efficace contre tout sinistre corporel ou matriel en liaison
avec les services de secours extrieurs.
4.2 La connaissance des produits stocks
La connaissance du produit stock est une donne fondamentale dans ltude de ralisation
dun stockage de produit dangereux.
Les paramtres suivants doivent tre connus :
la dsignation usuelle ;
la dsignation commerciale ;
lventuelle utilisation dans le process ;
ltat : solide ; en blocs ; pulvrulent ; granuleux ; liquide ; gazeux ; comprim ; liqufi
comprim ; liqufi rfrigr ; chaud ou froid ;
le(s) danger(s) : explosif ; inflammable ; comburant ; toxique ; nocif ; irritant ;
radioactif ;dangereux pour lenvironnement ;
les incompatibilits avec dautres produits ;
les quantits stockes ;
le mode de stockage envisag (si projet) : en cuves, en fts, en colis.
Pour un produit identique, les dangers peuvent diffrer suivant le mode de stockage et ltat.
4.3 La conception du stockage
Certains produits peuvent ragir violemment les uns avec les autres. Ils ne doivent donc pas
tre stocks au mme endroit.
En effet, en cas de fuite ou dincendie, les emballages peuvent tre endommags ; des produits
peuvent alors se mlanger les uns avec les autres en provoquant des ractions dangereuses :
dgagement dun produit gazeux toxique, projections, inflammation, explosion.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Plusieurs types de mesures permettent dassurer la scurit :
stockage lextrieur dans un emplacement ventil ;
stockages des distances loignes les uns des autres ;
stockages en locaux diffrents ou en boxes ferms ou spars par des murs coupe-feu ;
armoires spciales pour produits inflammables ;
accs limit au personnel autoris.
Pour les produits en petits conditionnements, lutilisation des symboles de risques de
ltiquetage permet de raliser un premier tri parmi les produits incompatibles.
4.3.1 La compatibilit des produits dangereux
Produit
inflammable
Comburant
Produit
toxique
Produit nocif
ou irritant
Produit
inflammable
+ - - +
Comburant - + - 0
Produit
toxique
- - + +
Produit nocif
ou irritant
+ 0 + +
- ne doivent pas tre stocks ensemble
0 ne doivent tre stocks ensemble que si certaines dispositions sont appliques
+ peuvent tre stocks ensemble Source : Doc. ED 753 - INRS
4.3.2 Les conditions de stockage
Les conditions de stockage des produits dangereux sont rglementes en fonction de l'tat ou
de la nature du produit considr. Il existe ainsi des rgles pour les dpts de liquides
inflammables, de gaz inflammables, de produits toxiques, comburants, etc., ainsi que des
rgles pour des produits particuliers : actylne, chlore, peroxydes organiques, lessive de
soude, etc., par exemple.
Selon la quantit susceptible d'tre prsente, les installations de stockage peuvent tre
soumises la lgislation des ICPE, sous le rgime de la dclaration ou de l'autorisation.
Des arrts prfectoraux fixent les prescriptions relatives l'amnagement, l'exploitation,
la prvention des risques, les rejets, la remise en tat en fin d'exploitation.
Pour les installations soumises dclaration, ces arrts sont tablis sur la base des arrts de
prescriptions gnrales (anciens arrts-types).
Pour les installations soumises autorisation, ils sont particuliers l'installation ou
l'tablissement et tiennent compte, le cas chant, des prescriptions ministrielles
existantes pour le type de produit considr. Lorsque des matires, produits ou
substances combustibles sont stocks en quantit suprieure 500 tonnes, l'entrept ou
l'ensemble des btiments ou zones usage d'entrepts) est class ds lors que le volume
total atteint 5000 m
3
. Les stockages des produits appartenant des catgories
spcifiques (par exemple : toxiques, comburantes, inflammables) sont viss par d'autres
rubriques. Si les seuils de chaque rubrique sont dpasss, l'installation est classe sous
toutes ces rubriques simultanment.
Si les prescriptions varient selon les produits, on peut toutefois dgager un certain
nombre de conditions communes que le simple bon sens peut imposer dans tous les cas.
Ces conditions sont dcrites ci-dessous, sans que cette liste soit limitative.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Dpts sous abri :
cuvette de rtention tanche ;
parois coupe-feu ;
portes pare-flammes donnant sur l'extrieur du btiment, coupe-feu l'intrieur ;
appareillage et clairage lectriques anti-dflagrants ou tanches aux gaz dans les locaux ou
des gaz ou vapeurs inflammables ou explosibles sont susceptibles de se dgager ;
paroi jectable lorsqu'il y a risque d'explosion ;
possibilit d'vacuation rapide des rcipients en cas d'incendie ;
exutoires de fume, etc. ;
signalisation des produits dangereux stocks sur la porte d'accs au local, etc.
Dpts ariens :
recul par rapport aux immeubles occups par des tiers, aux limites de proprit, aux
ERP, la voie publique, etc. ;
cuvette de rtention tanche ;
protection contre la malveillance (clture) ;
double enveloppe ou fosse tanche pour les rservoirs enterrs ;
appareillage et clairage lectriques anti-dflagrant ou tanche aux gaz proximit
des rservoirs pouvant dgager des gaz ou vapeurs inflammables ;
moyens d'extinction et rserve d'mulseurs ncessaires ;
poste de dpotage tanche.
Certains textes, comme les instructions techniques du 9 novembre 1989 sur les stockages de
gaz et de liquides inflammables donnent des formules permettant de calculer les zones de
danger autour des stockages.
Les bassins de rtention des eaux d'incendie
Depuis les incendies de Sandoz et de Protex, la ralisation d'un bassin de confinement
des eaux d'extinction est obligatoire pour les stockages de certains produits dans les
installations soumises autorisation.
Sont notamment concerns, les produits trs toxiques ou les produits toxiques particuliers
lorsque les stockages dpassent 20 t ainsi qu'un certain nombre de substances si les stockages
dpasse 200 t (annexe II, arrt du 2 fvrier 1998) ou les produits agro-pharmaceutiques en
quantit suprieure 500 t.
La capacit du bassin est calculer et justifier dans le cadre de l'tude de dangers obligatoire
pour les installations soumises autorisation. dfaut elle sera gale 5 m
3
par tonne de
produit stock.
4.4 La configuration des btiments de stockage
Le stockage doit tre conu et construit en fonction de :
la nature des matires entreposes (danger, produits incompatibles, quantit) ;
laccessibilit des secours ;
prescriptions : des assureurs et de larrt prfectoral, le cas chant ;
laccessibilit des transporteurs.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
La conception des btiments
Voici les principales prescriptions qui peuvent tre mises par l'administration ou les
socits dassurance :
la rsistance au feu des lments utiliss dans la construction doit rpondre aux critres
de stabilit des structures (ossature, charpente, murs porteurs) et de compartimentage
imposs par la rglementation ou exigs par les assureurs (rgles APSAD) ;
les stockages doivent tre dcoups en compartiments o seront stocks les produits
compatibles entre eux et doivent tre isols des bureaux par des distances suprieures
10 mtres ;
les communications (porte, ouverture dans les murs, convoyeur, gaine) entre
compartiments doivent tre sectionnables par des moyens coupe-feu ;
des systmes de rtention doivent tre mis en place sur les sols des compartiments
recevant des produits liquides.
Ces rtentions seront conues de telle sorte quelles ne permettent pas :
la rencontre de produits incompatibles,
lcoulement direct vers un rseau extrieur (cration dun volume tampon).
Pour cela, la qualit des sols devra tre compatible avec la nature des produits stocks,
et, en prsence de risque dexplosion, les toitures devront tre quipes dvents ou de
points de rupture permettant de contrler la surpression exerce sur les murs du
stockage.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
5 COMMENT UTILISER
LES PRODUITS DANGEREUX
Plus on agit en amont du risque, plus la prvention est efficace.
Autant que possible, laction du chef dtablissement sinscrit dans la logique suivante :
il doit intervenir ds le choix des produits.
Les rgles gnrales de prvention du risque fixes par le Code du travail (article R231-
54) sont les suivantes :
limiter l'utilisation des substances ou des prparations chimiques dangereuses ;
valuer les risques ;
mettre en place des moyens efficaces assurant l'vacuation des vapeurs, des gaz des
arosols ou des poussires ;
assurer la vrification et la maintenance des appareils de protection collective ;
mettre disposition des appareils de protection individuelle ;
informer chaque poste de travail des risques auxquels peut tre expos le travailleur ;
contrler les valeurs limites ;
limiter l'accs des locaux de travail ;
adopte une signalisation de scurit approprie ;
effectus les prlvements et analyses obligatoires.
5.1 Les produits de substitution
La mesure de prvention la plus efficace est le remplacement d'un produit dangereux par
un quivalent ne prsentant pas ou peu de risques. Une tude pralable approfondie est
souvent ncessaire.
5.2 Les risques lis aux proprits physico-chimiques
Quelques caractristiques sont utiles connatre :
Le point dclair
Il sagit de la temprature minimale laquelle il faut porter un liquide pour que les
vapeurs mises senflamment en prsence dune flamme, dans des conditions
normalises. Cette constante a t retenue comme critre de classement rglementaire
des liquides inflammables en trois catgories (extrmement inflammable, trs
inflammable, inflammable). Plus le point dclair est bas, plus le risque dinflammabilit
est grand (par exemple, pour lther thylique ou oxyde de dithyle, le point dclair est
45 C) ;
Le point dauto-inflammation
Il sagit de la temprature partir de laquelle les vapeurs senflamment spontanment
sans apport de flammes. Plus cette temprature est basse, plus le risque dinflammation
spontane est important (par exemple, pour le sulfure de carbone, le point dauto-
inflammation est de + 100 C) ;
Les limites d'inflammabilit
Les gaz et vapeurs peuvent s'enflammer ou exploser si le rapport vapeur/air est compris
entre deux valeurs limites, la limite infrieure dinflammabilit (LII) et la limite suprieure
dinflammabilit (LSI). Elles sont exprimes en pourcentage dans lair ;
Les valeurs limites dexposition
Les valeurs limites dexposition correspondent des concentrations dans latmosphre ne
pas dpasser. Ce ne sont pas des valeurs dfinitives elles font lobjet de rvisions au regard
de lvolutiion des connaissances .
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
La transposition de la directive 200/39/Ce par larrt du 30 juin 2004 a fourni une liste de
63 VLE rglementaires indicatives, des VLE indicatives quivalentes sont tablies par plusieurs
circulaires ministrielles.
Par ailleurs des VLE contraignantes existent pour une certains nombre de produits, ces valeurs
sont fixes par dcrets amiante, benzne, chlorure de vinyle monomre, plomb, silice
cristalline, gaz de fumigation, poussire
Ces VLE sont dfinies de la faon suivante :
la valeur limite de moyennes dexposition (ou VME) : pour un produit donn, est
la concentration dans lair laquelle un travailleur en bonne sant peut tre expos pendant
8 heures par jour sans dommage pour sa sant ;
la valeur limite dexposition (ou VLE) : est la valeur limite ne dpasser en aucun
cas lors dune exposition de 15 minutes par inhalation.
Ces valeurs renseignent sur les effets ventuels de lexposition dun homme sain un produit
unique, mais elles ne prennent en compte ni la sensibilit individuelle, ni les effets cumuls de
plusieurs produits sur un mme individu.
5.3 L'utilisation des moyens de protection collective
Les quipements de protection collective doivent tre utiliss en priorit.
D'aprs le code du travail (article R231-54-3), les installations et les appareils de
protection collective doivent tre rgulirement vrifis et maintenus en parfait tat
de fonctionnement. Les rsultats des vrifications sont tenus la disposition de
l'inspecteur du travail, des agents des services de prvention des organismes de
scurit sociale, du mdecin du travail et des membres du comit d'hygine, de
scurit et de conditions de travail (CHSCT) ou, dfaut, des dlgus du
personnel.
En outre, une notice tablie par l'employeur aprs avis du comit d'hygine, de
scurit et des conditions de travail ou, dfaut, des dlgus du personnel, fixe
les procdures mettre en uvre pour assurer la surveillance et la maintenance
des installations de protection collective.
Ces moyens de protection collective sont par exemple :
les sorbonnes, qui sont des enceintes ventiles en dpression, raccordes par un
extracteur lextrieur ;
les hottes chimiques mobiles, qui aspirent lair et le rejettent dans le laboratoire
aprs passage sur un filtre charbon actif (en gnral spcifique une famille de
composs volatils). Elles doivent faire lobjet dune surveillance constante
(saturation du filtre),
les crans de protection, qui doivent tre en matriau rsistant et placs devant
chaque manipulation de produits chimiques prsentant un risque de projection ou
dexplosion.
5.4 Le port des quipements de protection individuelle
Le port des quipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire.
Des appareils de protection individuels adapts aux risques encourus sont mis la
disposition des travailleurs susceptibles d'tre exposs l'action des substances ou des
prparations chimiques dangereuses. Le personnel d'intervention ou de secours dont la
prsence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de
substances ou de prparations chimiques dangereuses doit tre quip de moyens de
protection corporelle adapts aux risques encourus et, s'il y a lieu d'appareils de
protection respiratoire isolants. (Code du travail).
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Les EPI utiliser sont au minimum :
une blouse en coton (ferme) ;
des lunettes de protection coques latrales ;
des gants rsistants aux produits manipuls (suivant les cas : gants en vinyle, latex,
noprne, nitrile ou coton pour les poudre fines).
Le responsable doit sassurer que ces quipements sont ports.
La protection respiratoire est, le cas chant, assure par des masques cartouches filtrantes
ou cartouches absorbantes adaptes aux produits utiliss. Les masques autonomes peuvent
tre utiliss lors dinterventions ponctuelles.
Les masques anti-poussire ne protgent jamais des vapeurs de produits chimiques.
5.5 La manipulation de produits dangereux
5.5.1 Formation et information du personnel
Le personnel de lentreprise, y compris les caristes, doit recevoir une formation
approprie sur les risques lis aux produits manipuls et stocks ainsi que les moyens de
prvention.
Les informations portent sur les points suivants :
risques lis la manipulation des produits dangereux (lecture de ltiquetage) ;
mesures prventives ;
limination des dchets dangereux ;
consignes en cas daccident, dincendie ou de fuite de produits ;
lutte contre lincendie ;
premiers secours ;
vacuation.
Le marquage et laffichage sur les lieux de travail compltent ces informations.
5.5.2 Protection du personnel
Des installations sanitaires doivent tre mises la disposition des travailleurs pour leur
hygine personnelle.
Des consignes indiquant de se laver les mains avant de manger et de boire sont
recommandes.
Les vestiaires doivent permettre au personnel de ranger ses vtements de travail et ses
vtements de ville sparment, lorsque le travail comporte un risque de contamination
par des produits dangereux.
Des consignes doivent indiquer de ne pas porter de vtements sales imprgns de
produits dangereux.
5.5.3 Propret des locaux
Lorsque la quantit de produit renvers est faible, on peut utiliser un produit absorbant.
Les dchets doivent tre rcuprs et limins.
Il faut prvoir des consignes pour quen cas de fuite importante un responsable soit
inform sans dlai.
Tout dversement lgout doit tre vit.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Le magasin doit tre nettoy par des moyens appropris (par aspiration, par lavage
leau, etc.).
Le balayage est viter car il disperse les poussires dans lair.
5.5.4 Les produits dangereux usags
Les produits dangereux usags sont considrs comme des dchets industriels spciaux
(DIS) ou des dchets toxiques en quantits disperses (DTQD) en fonction des quantits
gnres.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
6 CHARGEMENT/DCHARGEMENT
DES PRODUITS DANGEREUX
6.1 Les aires de chargement/dchargement
Laire de dchargement doit possder, certaines caractristiques dont :
Sol
Il doit rsister aux charges des vhicules et aux produits chimiques, et permettre, en cas de
renversement accidentel, lvacuation des produits sils sont liquides vers une fosse de rtention.
Balisage
La zone rserve au chargement/dchargement des produits doit tre balise et avoir des
dimensions adaptes aux vhicules.
Circulation
Lentre sur laire de chargement/dchargement et la sortie des vhicules doit pouvoir
seffectuer en marche avant dans la mesure du possible. En dehors des oprations de
dchargement, les alles de circulation doivent tre dgages. Les installations fixes doivent tre
protges contre le risque de choc par les vhicules.
Point deau
Pour entraner les produits liquides rpandus vers une fosse de rtention, il est conseill
dinstaller un point deau (sil ny a pas dincompatibilit entre leau et le produit).
Douches de scurit, lave-il
Une douche de scurit et un lave-il permettent de secourir le personnel en cas
dclaboussures par des produits corrosifs. Les circuits deau sont protger du gel.
6.2 Le protocole de chargement/dchargement
L'arrt du 26 avril 1996 sur les travaux effectus par une entreprise extrieure
impose notamment l'tablissement d'un protocole de scurit crit. Ce protocole
doit tre tabli pour chaque opration de chargement ou de dchargement entre
l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport, pralablement la ralisation de
l'opration. Il contient des indications concernant lentreprise daccueil et le
transporteur.
Pour l'entreprise d'accueil :
Les consignes de scurit, particulirement celles relatives l'opration de chargement
ou de dchargement ;
le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalits d'accs et de stationnement
aux postes de chargement ou de dchargement accompagnes d'un plan et des
consignes de circulation ;
les matriels ou engins spcifiques utiliss pour le chargement ou le dchargement ;
les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
l'identit du responsable dsign par l'entreprise d'accueil auquel l'employeur dlgue
ses attributions ;
Pour le transporteur :
les caractristiques du vhicule, son amnagement et ses quipements ;
la nature et le conditionnement de la marchandise ;
les prcautions ou sujtions particulires rsultant de la nature des substances ou produits
transports, notamment celles qui sont imposes par la rglementation relative au transport
des matires dangereuses.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Modle de protocole de chargement/dchargement
(Voir page suivante)
6.3 Le transvasement et le reconditionnement
Il s'agit d'oprations de transfert ou transvasement de produits dun rservoir ou dun conteneur
dans un autre, habituellement plus petit. Ces oprations peuvent provoquer des missions de
vapeurs ou de poussires, donner lieu des claboussures et des renversements accidentels.
Elles doivent tre effectues un poste de travail spcialement amnag, le cas chant,
suivant les prescriptions applicables l'installation au titre de la lgislation sur les ICPE.
Ventilation
Il est ncessaire dassurer une ventilation efficace pour supprimer la fois les risques
dexplosion et dintoxication :
en plein air (sous auvent). Si la ventilation naturelle savre insuffisante, un dispositif de
captage la source des vapeurs ou poussires doit tre install ;
lintrieur dun local. Un systme de ventilation mcanique est ncessaire, par exemple un
dispositif de captage localis des vapeurs ou des poussires (complt ventuellement par
une ventilation gnrale). La seule ventilation gnrale du local par un systme mcanique
nest acceptable que si le captage localis nest techniquement pas ralisable.
Protection de la peau et des yeux
Il faut utiliser des appareils vitant tout contact cutan avec les produits, par exemple des
pompes ou des vide-tourie.
Il faut porter des gants, crans faciaux ou dfaut lunettes, vtements, chaussures ou bottes.
Protection contre les incendies et les explosions
(cas des liquides et gaz inflammables)
Il faut :
mettre la terre les rcipients mtalliques ;
utiliser du matriel lectrique et dclairage appropri aux atmosphres explosives et
corrosives ;
ne pas employer dair comprim pour transfrer un liquide inflammable ;
viter le remplissage en pluie qui favorise laccumulation de charges dlectricit statique.
Protection contre le risque de confusion entre produits
Les rcipients secondaires dans lesquels ont t transvass les rcipients primaires doivent avoir
la mme tiquette que ce dernier.
Partie 4 Utiliser des produits dangereux en limitant les risques
Modle de protocole de chargement/dchargement
Entreprises Entreprise d'accueil :
- Nom, adresse, tlphone
- Service destinataire
- Nom du responsable concern
Entreprise de transport :
- Nom, adresse, tlphone
- Nom de l'interlocuteur
Horaires d'ouverture
aux transporteurs
Informations sur la scurit du site / Procdure
d'alerte
- Nom du responsable de la scurit
- Numros de tlphone :
. Premier secours
. Pompiers
. Problmes techniques
- Indication des points pharmacie
- Indication du point phone, disponible pour les chauffeurs
Indications portes sur le plan de masse - Les lieux de chargement et dchargement
- Les parkings d'attente
- Les aires de bchage/dbchage
- Le plan de circulation et les limitations de vitesse
- Les bascules
- Les bureaux administratifs pour les documents
- Les sanitaires
- Le local de repos disposition des chauffeurs
- Les conteneurs ordures
- Les tlphones
- Les zones interdites aux chauffeurs
- Les lignes lectriques ariennes
quipements fixes entreprises d'accueil - Quai
- Pont roulant avec pontier
- Passerelle de bchage
quipement mobile disponible chez l'entreprise
d'accueil
- Chariot lvateur avec cariste
- Tire-palette lectrique
quipement mobile sur le camion - Grue auxiliaire
- Tire-palette main
- Diable
- Hayon lvateur
Type de chargement ncessitant des prcautions
ou des amnagements particuliers
- Bobines
- Conteneurs
- Tourets
- Produits dangereux
- Autres :
Type de matriel souhait par l'entreprise
d'accueil
- Savoyarde avec chelle
- Bchage coulissant toit fixe
- Bchage coulissant toit mobile
- Plateau
- Citerne avec rambarde
- Frigorifique
- Benne
- Autres :
Consignes gnrales
Consignes particulires
Date :
Entreprise d'accueil (nom, fonction, signature)
Entreprise de transport (nom fonction, signature)
PARTIE 5
PRVENIR LES RISQUES
POUR L'ENVIRONNEMENT
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
1 IDENTIFIER LES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT
2 LES INSTALLATIONS CLASSES
2.1 ICPE : la lgislation
2.2 ICPE : les textes de base
2.3 La nomenclature
2.4 La cration d'une installation classe
2.4.1 La notion d'installation
2.4.1 Larticulation avec le permis de construire
2.5 La procdure d'autorisation
2.5.1 Quand, par qui, o, comment ?
2.5.2 L'tude d'impact
2.5.3 L'tude de dangers
2.5.4 Le recours la tierce expertise
2.5.5 L'enqute publique
2.5.6 L'arrt d'autorisation
2.5.7 La procdure d'autorisation et le secret
2.5.8 Les servitudes d'utilit publique
2.6 La dclaration
2.7 Les recours et sanctions
2.7.1 Les recours
2.7.2 Les sanctions
2.8 La vie d'une installation classe
2.8.1 Le systme de management environnemental
2.8.2 Les contrles
2.8.3 Le secret industriel
2.8.4 Le rle du CHSCT
2.8.5 Les plans de secours
2.8.6 Les obligations priodiques des exploitants
2.8.7 Les modifications ou extensions d'installations
2.8.8 Le rgime fiscal des installations classes
2.8.9 La cessation d'activit
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
3 LA GESTION DES REJETS ET DES DCHETS
3.1 Les rgles respecter en matire de rejets
3.1.1 La pollution atmosphrique
3.1.1 La pollution de l'eau
3.1 La gestion des dchets
3.1.1 Les dispositions lgislatives
3.1.2 Les dfinitions
3.1.3 Les contrle des circuits dlimination de dchets
3.1.4 limination des dchets
3.2 La gestion des dversements accidentels et des dchets dincendie
3.2.1 Les dversements accidentels
3.2.2 Les dchets d'incendie
4 LA RESPONSABILIT EN MATIRE D'ENVIRONNEMENT
4.1 La responsabilit civile
4.2 La responsabilit pnale
4.2.1 La responsabilit de la personne morale
4.2.2 La responsabilit de la personne physique
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
1 IDENTIFIER LES RISQUES
POUR L'ENVIRONNEMENT
Il existe deux manires dapprhender la gestion des risques pour lenvironnement : une
manire slective, par type de risque et une manire globale.
La premire fait lobjet de mesures spcifiques par grands thmes (air, eau, dchets,
protection de la nature). La seconde considre les effets nuisibles des substances et
activits sur tous les milieux.
Des lois dictent les principes pour lune et lautre : loi sur lair, loi sur leau, loi dchets,
loi sur les installations classes. Ces lois ont t partiellement ou entirement codifies et
lessentiel des dispositions se trouve dsormais rassembl dans le Code de
lenvironnement.
Le Code de lenvironnement dfinit des principes gnraux pour la protection des
espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, la qualit de lair, les
espces animales et vgtales, la diversit et les quilibres biologiques. Il sagit :
du principe de prcaution,
du principe daction prventive et de correction, par priorit la source, des atteintes
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles un cot
conomiquement acceptable,
du principe pollueur-payeur,
du principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accs aux informations
relatives lenvironnement, y compris celles relatives aux substances et activits
dangereuses.
Le livre 1
er
du code rassemble les dispositions communes : principes gnraux,
information et participation des citoyens (tudes dimpact, enqutes publiques,
institutions environnementales et associations pour la protection de lenvironnement).
Le livre II, Milieux physiques recouvre le titre Eau et le titre Air et atmosphre .
Les livres III et IV concernent la protection de la nature (respectivement les espaces
naturels et la flore et de la faune).
Le livre V traite de la Prvention des pollutions, des risques et des nuisances. Il codifie
plusieurs grandes lois sur les installations classes pour la protection de lenvironnement,
le contrle des produits chimiques, les organismes gntiquement modifis, llimination
des dchets, la gestion des dchets radioactifs, la scurit civile et les risques majeurs (en
partie) et la lutte contre le bruit.
Le livre VI runit les dispositions applicables la Nouvelle-Caldonie, aux territoires
doutre-mer et Mayotte.
Les proccupations du responsable dtablissement sont les risques qui peuvent tre
engendrs par ses activits. Il lui appartient de les valuer, du point du vue de la scurit
des travailleurs comme de celui de la protection de lenvironnement.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
2 LES INSTALLATIONS CLASSES
2.1 ICPE : la lgislation
La lgislation des installations classes a pour but de protger contre des dangers ou des
inconvnients soit pour la commodit du voisinage, soit pour la sant, la scurit, la salubrit
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des lments du patrimoine
archologique (L.511-1 Code de lenvironnement).
Cette approche intgre permet la prise en compte de tous les impacts sur
lenvironnement : sont ainsi viss les risques d'incendie et d'explosion, le bruit, la
pollution de l'air et de l'eau, celles rsultant des dchets, de la radioactivit, et
aussi les atteintes la beaut des sites.
Toutes les activits sont concernes, si elles sont gnratrices de nuisances : agriculture,
industrie, artisanat, commerces, services qu'elles soient exerces par des personnes
physiques ou morales, par des collectivits, par des organismes privs ou publics.
Cette lgislation permet de prvenir les pollutions et les risques de l'installation elle-
mme, mais aussi ceux qui sont lis son exploitation, comme les inconvnients
rsultant de la circulation engendre par l'installation.
Ce trs large domaine d'application a cependant ses limites :
seules sont comprises dans le champ d'application les installations fixes, c'est--dire les
sources fixes de nuisances, btiments, ateliers, usines, chantiers, entrepts, ce qui exclut les
installations qui ne sont pas fixes, dont vhicules de toute nature (L.511-1);
les installations soumises cette lgislation sont celles inscrites sur une liste arrte
par dcret en Conseil d'tat, la nomenclature des installations classes (L.511-2).
2.2 ICPE : les textes de base
La lgislation des installations classes est fonde sur la loi n 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classes pour la protection de l'environnement, dsormais codifie
au titre 1
er
du livre V du Code de lenvironnement. Cette loi avait succd celle du 19
dcembre 1917 sur les tablissements dangereux, insalubres et incommodes.
De nombreux textes, vocation gnrale ou particulire, compltent le dispositif
lgislatif.
Des textes spcifiques fixent des mesures appliques une catgorie
dactivits ou des catgories dactivits voisines :
le dcret n53-578 du 20 mai 1953, modifi, fixe la liste des activits concernes
(nomenclature),
le dcret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifi prcise les procdures suivre
par toute personne qui se propose de mettre en service une installation.
Des textes transversaux existent galement, tels que :
larrt du 31 mars 1980 portant rglementation des installations lectriques des
ICPE susceptibles de prsenter des risques dexplosion ;
larrt du 28 janvier 1993, concernant la protection contre la foudre de certaines
ICPE ;
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
larrt du 23 janvier 1997 relatif aux bruits ariens mis dans lenvironnement
par les ICPE ;
larrt du 2 fvrier 1998 modifi, relatif aux prlvements et
la consommation deau ainsi quaux missions de toute nature des installations
soumises autorisation ;
larrt du 10 mai 2000 modifi, relatif la prvention des accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses dans certaines catgories dinstallations
classes pour la protection de lenvironnement soumises autorisation
(transposition de la directive dite Seveso II ).
Pour les textes spcifiques une activit :
des arrts de prescriptions gnrales (remplaant progressivement les
arrts-types ), sappliquent aux installations classes soumises dclaration.
Prpars par le ministre de l'Environnement, ils peuvent tre adapts par le prfet
aux conditions locales.
des arrts spcifiques certaines activits soumises autorisation
fixent des prescriptions minimales que les prfets doivent prendre en compte dans
leurs arrts dautorisation pour certaines installations particulires. On peut citer
larrt du 16 juillet 1997 relatif aux installations de rfrigration employant de
lammoniac comme fluide frigorigne ou larrt du 29 juillet 1998 modifi relatif
aux silos et aux installations de stockage de crales, de graines, de produits
alimentaires et de tous autres produits organiques dgageant des poussires
inflammables, ou encore larrt du 5 aot 2002 relatif la prvention des sinistres
dans les entrepts couverts soumis autorisation sous la rubrique 1510
De nombreuses circulaires et instructions ministrielles apportent des
prcisions ou des complments sur la prvention de certains risques, le contrle des
installations, etc. linstar des circulaire et instruction du 9 novembre 1989
relatives aux dpts anciens de liquides inflammables ou de la circulaire du 6 mai
1999 relative lextinction des feux de liquides inflammables.
Les installations classes sont galement vises par dautres textes dintrt gnral comme le
Code de lurbanisme, le Code rural, le Code minier et les textes communautaires qui
sappliquent directement sans que leur transposition soit ncessaire (rglements, dcisions).
Par ailleurs, il est vident que l'application de la lgislation sur les installations classes ne
dispense pas de respecter les autres textes qui peuvent sappliquer concomitamment,
notamment ceux concernant la prvention des incendies (tablissements recevant du public) et
la lgislation relative l'hygine et la scurit des travailleurs.
2.3 La nomenclature
Les installations classes pour la protection de lenvironnement sont dfinies dans la
nomenclature prvue l'article L.511-2 du Code de lenvironnement (ex-article 2 de la
loi n 76-663 du 19 juillet 1976 sur les ICPE) et tablie par le dcret du 20 mai 1953
modifi.
Jusquen juillet 1992, la nomenclature comprenait plus de quatre cents rubriques
classes alphabtiquement, associes une numrotation devenue disparate.
Une refonte de cette nomenclature a t mise en uvre. La nouvelle nomenclature,
fonde sur un classement numrique, divise les rubriques en deux grandes parties : un
classement par les substances et un autre par les branches dactivits.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Dans le premier classement (rubriques de la srie 1000),
les installations sont classes en fonction des substances quelles stockent, traitent ou
transforment, et donc des risques quelles prsentent :
substances et prparations toxiques et trs toxiques (1110 1190) ;
substances et prparations comburantes (1200 1220) ;
explosifs et substances et prparations explosibles (1310 1331) ;
gaz, liquides et solides inflammables (1410 1455) ;
produits combustibles (1510 1531) ;
substances et prparations corrosives (1610 1631) ;
substances radioactives (1700 1721) ;
substances ou prparations ragissant violemment au contact de leau (1810 1820).
La dfinition et la classification des substances et prparations sont donnes la rubrique
1000.
Dans le second (rubriques de la srie 2000), les activits sont classes par
grands secteurs :
activits agricoles, animaux (2101 2180) ;
agroalimentaire (2210 2275) ;
textiles, cuirs et peaux (2310 2360) ;
bois, papier, carton, imprimerie (2410 2450) ;
matriaux, minerais et mtaux (2510 2575) ;
chimie, parachimie, caoutchouc (2610 2690) ;
dchets (2710 2799) ;
divers (2910 2950).
Au regard de chaque rubrique, la nomenclature indique le rgime dont relvent les
installations : dclaration (D), autorisation (A), autorisation avec servitudes (AS). Elle indique
galement le primtre daffichage de lavis denqute publique pour les installations A et AS.
Pour les substances, le rgime de classement dpend gnralement de la quantit susceptible
dtre prsente dans linstallation.
Pour les activits, il correspond un ou plusieurs critres comme la capacit de production, la
puissance installe des machines, le volume stock, le mode opratoire
La diversit des installations classables est telle que vous pouvez, sans le savoir, en avoir
une ou plusieurs sur votre site ! Par exemple : un atelier de charge daccumulateurs
(rubrique 2925), une installation de rfrigration ou de compression (2920)
2.4 La cration d'une installation classe
2.4.1 La notion d'installation
Le lgislateur ne donne pas de dfinition prcise dune installation.
Une installation qui correspond une rubrique de la nomenclature ds lors que le
premier seuil est atteint est coup sr classable.
Par exemple, un dpt de dchets mtalliques sur un terrain sans autre affectation
(soumis autorisation si la surface utilise est suprieure 50 m) ou une installation
temporaire peuvent tre une installation classable ds lors qu'elle figure la
nomenclature.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Un mme tablissement peut comporter plusieurs installations classables.
Sil sagit dinstallations relevant toutes du rgime de la dclaration, elles pourront tre
considres distinctement. Si lune delle au moins relve de lautorisation, l'exploitant peut ne
prsenter qu'une seule demande pour lensemble et le dossier sera trait de manire globale
afin de prendre en compte les risques supplmentaires dus la proximit ou la connexit.
Dans le cadre de la transposition de la directive dite Seveso II , larrt du 10 mai
2000 a introduit la notion dtablissement , soit : lensemble des installations
classes relevant dun mme exploitant sur un mme site [...] y compris leurs
quipements et activits connexes ds lors que lune au moins des installations est
soumise au prsent arrt (soumise autorisation dans laquelle sont prsentes des
substances ou prparations dangereuses).
2.4.2 Larticulation avec le permis de construire
Selon l'article L.421-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire est ncessaire pour
toute construction, modification ou changement de destination de btiments existants.
Lorsque limplantation dune installation ncessite lobtention dun permis de construire,
la demande de permis de construire doit tre accompagne du justificatif du dpt de la
demande d'autorisation ou de la dclaration (Code de lurbanisme, art. R.421-3-2).
Rciproquement, pour une installation soumise autorisation, la demande
dautorisation devra tre accompagne ou complte dans les dix jours suivant sa
prsentation par la justification du dpt de la demande du permis de construire.
Loctroi du permis de construire ne vaut pas lautorisation .
En outre, dans les meilleurs dlais, le permis de construire ne peut tre accord avant la
clture de l'enqute publique et ne peut tre rput accord avant lexpiration dun dlai
dun mois suivant la date de clture.
En pratique, il convient de dposer pralablement la demande dautorisation puis celle du
permis de construire accompagne du rcpiss de la demande dautorisation. La justification
du dpt de la demande de permis de construire devra ensuite tre fournie dans les 10 jours
pour tre jointe la demande dautorisation.
Les deux dmarches sont distinctes, l'une des deux autorisations peut tre accorde et l'autre
refuse, les critres tant diffrents. L'existence ou non d'un PLU (plan local durbanisme) joue
un rle dans la dlivrance du permis de construire.
2.5 La procdure d'autorisation
2.5.1 Quand, par qui, o, comment ?
Quand ?
Lorsque sur la nomenclature le seuil de classement correspond la lettre A ou AS , une
demande d'autorisation doit tre dpose avant tout commencement d'exploitation. Cela
signifie thoriquement que la construction des btiments peut tre entreprise, les quipements
peuvent tre mis en place, mais le fonctionnement de l'installation ne peut commencer qu'aprs
rception de l'arrt d'autorisation. Toutefois, la plus grande prudence cet gard simpose,
certaines conditions damnagement pouvant tre imposes par larrt dautorisation.
tant donne la dure de la procdure (huit douze mois), l'exploitant a tout intrt
prsenter sa demande au stade du projet, et consulter l'inspection des installations
classes avant de commencer des travaux.
La mise en service d'une installation avant que l'autorisation ait t accorde constitue un
dlit particulirement grave et svrement rprim.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Une installation temporaire peut aussi tre soumise autorisation. Le prfet peut, dans
certaines conditions accorder une autorisation pour une dure limite, dans le cadre dune
procdure exceptionnelle plus courte.
Par qui ?
C'est la personne, physique ou morale, qui se propose de mettre en service l'installation
qui doit dposer la demande d'autorisation, donc l'exploitant, qu'il soit ou non
propritaire des lments matriels de l'installation.
O ?
La demande doit tre adresse la prfecture du dpartement concern, au service des
installations classes. A Paris elle sera adresse la Prfecture de police.
Si l'installation est situe cheval sur plusieurs dpartements, la demande doit tre
adresse chaque prfecture concerne.
Comment ?
La forme de la demande est fixe par le dcret du 21 septembre 1977. Si plusieurs
installations classes doivent tre exploites par le mme exploitant sur le mme site, une
seule demande dautorisation peut tre prsente pour lensemble de ces installations.
Des prescriptions additionnelles peuvent tre fixes pour les autres installations ou quipements
exploits par le demandeur qui, mentionns ou non la nomenclature, sont de nature, par leur
proximit ou leur connexit avec une installation soumise autorisation, modifier les dangers
ou inconvnients de cette installation (article 19 du dcret).
Il faut donc que les tudes ou documents accompagnant la demande d'autorisation portent sur
l'ensemble des installations et quipements projets.
La demande, remise en sept exemplaires, doit mentionner :
le nom, le prnom, le domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ; sa
dnomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son sige, le nom, le
prnom et la qualit du signataire, s'il s'agit d'une personne morale. Les numros SIREN
(n d'entreprise), SIRET (n d'tablissement) et NAF (n du code de l'activit principale
exerce selon la nomenclature de l'INSEE) doivent tre prciss ;
l'emplacement prcis sur lequel l'installation est projete ;
la nature, le volume des activits envisages et la ou les rubriques correspondantes de
la nomenclature ;
le primtre et les rgles souhaites, si linstallation requiert linstitution de servitudes
dutilit publique ;
les procds de fabrication, matires utilises, produits fabriqus ;
les capacits techniques et financires de lexploitant ;
lorsque linstallation est destine llimination des dchets, lorigine gographique prvue
des dchets et la manire dont le projet est compatible avec les plans dpartementaux,
rgionaux et nationaux ;
pour les installations de stockage de dchets, les carrires et les installations susceptibles
de donner lieu servitudes dutilit publique, les modalits des garanties financires,
destines assurer la surveillance du site, son maintien en scurit, les interventions
ventuelles en cas daccident et la remise en tat aprs fermeture.
Des cartes et plans doivent tre joints chaque exemplaire :
une carte au 1/25 000 ou dfaut au 1/ 50 000 sur laquelle sera indiqu
l'emplacement de l'installation projete,
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
un plan l'chelle de 1/ 2 500 au minimum des abords de l'installation, sur lequel seront
indiqus les btiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, voies publiques,
points d'eau, canaux et cours d'eau,
un plan d'ensemble l'chelle 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetes
de l'installation, l'affectation des terrains avoisinants et le trac des gouts existants.
Doivent galement tre joints au dossier :
ltude dimpact prvue par les articles L.122-1, 2 et 3 du Code de lenvironnement et
dont le contenu est dfini par le dcret du 21 septembre 1977 ;
une tude de dangers ;
une notice relative la conformit de l'installation projete avec les prescriptions
lgislatives et rglementaires relatives l'hygine et la scurit du personnel ;
pour les carrires et les installations de stockage de dchets, un document attestant
que le demandeur est le propritaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de
lexploiter.
Une circulaire du 25 septembre 2001, destine aux prfets, rappelle les principes qui
doivent tre respects au cours de linstruction des dossiers de demande dautorisation.
Elle prcise notamment la responsabilit du demandeur auquel il appartient :
de fournir ladministration un dossier complet, faute de quoi la procdure ne peut
tre lance,
de dmontrer la compatibilit de son projet avec la rglementation en vigueur qui
repose notamment sur la prise en compte des performances correspondant aux
meilleures techniques disponibles conomiquement acceptables et sur le respect de la
sensibilit de lenvironnement et du voisinage.
2.5.2 L'tude d'impact
Le but de ltude dimpact est de caractriser l'tat initial du site, de faire ressortir les effets
prvisibles de l'installation sur son environnement, et dindiquer les mesures envisages pour
les supprimer, les limiter ou les compenser. Elle prsente successivement :
une analyse de ltat initial du site (richesses naturelles, espaces agricoles, forestiers,
maritimes ou de loisirs, biens matriels et patrimoine culturel) ;
une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de linstallation sur
lenvironnement : paysages, faune, flore, milieux naturels, commodit du voisinage (bruits,
vibrations, odeurs, missions lumineuses), agriculture, hygine, sant, salubrit et scurit
publiques, protection des biens matriels et du patrimoine culturel ; des prcisions doivent
tre donnes sur lorigine des nuisances et leur niveau ;
les raisons pour lesquelles le projet a t retenu, du point de vue des proccupations
denvironnement ;
les mesures envisages pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvnients de
linstallation, avec une estimation des dpenses correspondantes et les caractristiques
techniques dtailles ;
les conditions de remise en tat du site aprs exploitation ;
pour certaines catgories, une analyse des mthodes utilises pour valuer les effets de
linstallation sur lenvironnement ;
un rsum non-technique de cette tude dimpact destin faciliter linformation du public.
2.5.3 L'tude de dangers
Ltude de dangers exige par le dcret du 21 septembre 1977 doit porter sur
lensemble des installations ou quipements exploits ou projets qui, par leur
proximit ou leur connexit avec linstallation soumise autorisation, sont de nature
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
en modifier les dangers ou inconvnients.
Elle doit exposer les dangers que peut prsenter l'installation en cas d'accident (explosion,
incendie, fuite d'effluents liquides ou gazeux), que leur cause soit dorigine interne ou
externe. Elle doit, en outre, justifier les mesures envisages pour en rduire la probabilit et les
effets. Cette tude prcisera, compte tenu des moyens de secours publics existants, la nature et
l'organisation des moyens de secours privs dont le demandeur dispose ou qu'il a prvus. Le
contenu de ltude de dangers doit tre en relation avec les dangers avec limportance des
dangers de linstallation et de leurs consquences prvisibles.
Pour certaines catgories dinstallations impliquant lutilisation, la fabrication ou le
stockage de substances dangereuses, la transposition de la directive Seveso II , travers
la modification du dcret du 21 septembre et larrt du 10 mai 2000 modifi (explicit
par une circulaire de mme date), a renforc les obligations relatives aux tudes de
dangers et la politique de prvention de ceux-ci.
Elle doit systmatiquement comporter un rsum non-technique explicitant la probabilit,
la cintique et les zones deffets des accidents potentiels, ainsi quune cartographie des
zones risques significatifs.
Ces exigences sont encore plus strictes pour les tablissements classs AS, dont les
tudes doivent :
rendre compte de lexamen qua effectu lexploitant pour :
- identifier et analyser les risques (analyse qui ncessite lutilisation de mthodes systmiques
(HAZOP, AMDEC, arbre de dfaillances),
- valuer ltendue et la gravit des consquences des accidents majeurs identifis,
- justifier les paramtres techniques et les quipements installs ou mettre en place pour la
scurit des installations ;
exposer les ventuelles perspectives damlioration en matire de prvention des
accidents majeurs ;
contribuer linformation du public et du personnel ;
fournir les lments ncessaires la prparation des plans particuliers dintervention (POI)
et des plans particuliers dintervention (PPI) ;
permettre une concertation ultrieure entre acteurs locaux en vue dune dfinition des zones
dans lesquelles une matrise de lurbanisation autour de ltablissement est ncessaire pour
limiter les consquences des accidents.
Ces tudes doivent intgrer un document dcrivant la politique de prvention des accidents
majeurs et un document dcrivant de manire synthtique le systme de gestion de la scurit.
Ce dernier devra tre suffisamment prcis pour que lon puisse :
comprendre lorganisation mise en place,
constater que des moyens et des ressources ont t dfinis pour la mise en uvre de la
politique,
sassurer que les procdures mettre en uvre dans le cadre du systme de gestion
de la scurit ont t prises en compte.
L'absence ou l'insuffisance, de l'tude de dangers peut justifier un rejet de la demande
d'autorisation.
Pour les installations qui prsentent les dangers ou inconvnients les plus importants, l'exploitant
peut tre invit produire une analyse critique de lensemble de l'tude de dangers, ralise
aux frais du demandeur par un organisme extrieur, expert choisi en accord avec
l'administration.
Les risques majeurs identifis dans ltude de dangers doivent tre ports la connaissance des
exploitants dinstallations classes voisines ds lors que les consquences de ces accidents
majeurs sont susceptibles daffecter leurs installations. Cette information est transmise au prfet.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
2.5.4 Le recours la tierce expertise
Pour les installations qui prsentent les dangers ou inconvnients les plus importants, le prfet
peut, tout moment de la procdure dcider davoir recours un organisme extrieur expert.
Cette procdure nest pas limite lanalyse critique de lensemble de ltude de dangers et
peut tre utilise pour lanalyse dautres pices du dossier. Lorsquelle est produite avant la
clture de lenqute publique, elle est jointe au dossier mis la disposition du public.
2.5.5 L'enqute publique
Lorsque le prfet, aprs rception du dossier de demande d'autorisation, le juge complet, il
saisit le prsident du tribunal administratif, qui, dans un dlai de quinze jours, dsigne un
commissaire enquteur, ou les membres d'une commission d'enqute. Le prfet dcide de
louverture de l'enqute publique par arrt.
L'enqute a pour but une large information du public concern par l'installation projete,
et l'enregistrement des observations que le projet suscite. L'enqute dure en principe un
mois. Sa publicit est assure par des affiches, apposes dans les mairies et dans le
voisinage sur l'ensemble des communes concernes par les risques et les inconvnients
de l'installation (au minimum le primtre correspond au rayon daffichage dfini dans la
rubrique de la nomenclature dont relve linstallation objet du dossier), par des avis dans
la presse locale, et par tous moyens prescrits par l'arrt d'enqute publique et ce, au
minimum 15 jours avant la date douverture effective de lenqute publique.
Le commissaire enquteur peut :
visiter les lieux concerns ;
faire complter le dossier ;
proposer l'organisation de runions publiques avec la participation de l'exploitant.
Le commissaire enquteur formule un avis, aprs avoir ventuellement prolong
l'enqute de quinze jours au maximum.
Ds l'ouverture de l'enqute publique, le prfet transmet tous les services administratifs
intresss un exemplaire de la demande d'autorisation. Ces services ont quarante-cinq jours
pour se prononcer. Un exemplaire du dossier est galement adress aux autorits de ltat
voisin, lorsque le primtre comprend une commune frontalire.
Le rsultat de l'enqute publique peut amener l'exploitant modifier son projet. Si les
modifications sont importantes, la procdure doit tre reprise entirement.
2.5.6 L'arrt d'autorisation
Dans les trois mois compter du jour o il a reu le dossier du commissaire enquteur, le
prfet doit prendre sa dcision d'autorisation ou de refus. La prolongation du dlai, si elle est
ncessaire, doit faire l'objet d'un arrt.
Pour accorder son autorisation, le prfet tient compte des avis qu'il a recueillis, mais
aussi de tous lments qui permettent d'valuer la possibilit de limiter les risques pour
l'environnement. Si par exemple aucun procd connu ne permet de juguler ces risques
ou si la nature mme de l'installation exclut la possibilit de respecter les prescriptions
techniques, le prfet doit rejeter la demande d'autorisation. En revanche, les
circonstances sociales ou conomiques ne peuvent servir de base au refus d'autorisation.
La dcision prfectorale est prise aprs consultation du conseil dpartemental d'hygine,
runissant des reprsentants des administrations, du conseil gnral, des chambres de
commerce et d'industrie et des associations. Cette consultation est ouverte et contradictoire,
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
lexploitant a la possibilit d'y assister et d'y dfendre son dossier. En effet, c'est au cours de
cette sance que sont discuts contradictoirement le projet d'autorisation tabli par la DRIRE et
ventuellement les contre-propositions de l'exploitant.
L'arrt d'autorisation dfinit les conditions d'installation et d'exploitation de nature
prserver l'environnement, les moyens d'analyse et de mesure ncessaires au contrle de
l'installation et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Ces prescriptions tiennent
compte, notamment, d'une part, de l'efficacit des techniques disponibles et de leur
conomie, d'autre part, de la qualit, de la vocation et de l'utilisation des milieux
environnants.
L'arrt peut prvoir, aprs consultation des services dpartementaux d'incendie et de
secours, l'obligation d'tablir un plan d'opration interne (POI) en cas de sinistre. Ce plan,
obligatoire pour les tablissements AS, dfinit les mesures d'organisation, les mthodes
d'intervention et les moyens ncessaires que l'exploitant doit mettre en uvre pour protger le
personnel, les populations et l'environnement.
L'arrt fixe galement les mesures d'urgence que doit prendre l'exploitant en matire
d'information des personnes susceptibles d'tre touches par un accident sur les dangers
potentiels, les mesures de scurit et le comportement adopter dans ce cas.
Si les risques peuvent concerner plusieurs dpartements ou rgions, c'est le ministre qui
accorde l'autorisation, aprs consultation des conseils rgionaux et gnraux. De mme
si l'installation est projete dans une commune comportant une aire de production de vin
appellation d'origine contrle ou dans une commune limitrophe, LInstitut national des
appellations dorigine doit tre consult.
Il arrive quelques fois quune seule autorisation soit dlivre pour le site. Dans ce cas,
elle englobe toutes les activits et traite de toutes les nuisances possibles (risques, rejets
liquides, gazeux, dchets).
L'arrt d'autorisation est publi de la manire suivante :
une copie de l'arrt dautorisation, et, le cas chant, des arrts complmentaires,
est dpose la mairie ( Paris, au commissariat de police) et peut y tre consulte ;
des extraits en sont affichs,
le mme extrait est affich dans l'installation et chaque conseil municipal, gnral ou
rgional concern en reoit copie, ainsi que, le cas chant, les autorits de ltat
voisin,
un avis est publi dans deux journaux locaux ou rgionaux diffuss dans la rgion ou
le dpartement.
2.5.7 La procdure d'autorisation et le secret
Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli spar les informations
dont la diffusion lui apparatrait de nature entraner la divulgation de secrets de
fabrication.
Lors de l'enqute publique, ces lments pourront tre disjoints du dossier, et les
dispositions correspondantes de l'arrt d'autorisation pourront tre exclues de la
publicit.
2.5.8 Les servitudes d'utilit publique
Linstauration de servitudes d'utilit publique , si elle nest pas demande par lexploitant
conjointement lautorisation dinstallation, peut ltre par le maire de la commune
dimplantation ou linitiative du prfet.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Ces servitudes peuvent comporter :
la limitation ou linterdiction du droit dimplanter des constructions ou des ouvrages et
damnager des terrains de camping ;
la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques
tendant limiter le danger dexposition aux explosions ou concernant lisolation des
btiments au regard des manations toxiques ;
la limitation des effectifs employs dans les installations industrielles et commerciales
qui seraient cres ultrieurement.
Elles seront annexes au plan local durbanisme.
Ces servitudes concernent uniquement les installations implantes sur un site nouveau. Elles
sont assorties d'indemnits la charge de l'exploitant.
2.6 La dclaration
Sont soumises une simple dclaration les installations qui ne prsentent pas de graves
dangers ou inconvnients pour l'environnement, mais qui doivent cependant respecter
des prescriptions gnrales dictes par le prfet en vue dassurer, dans le dpartement,
la protection des intrts relatifs lenvironnement. Ce sont, dans la rubrique considre,
les installations dont le seuil de classement correspond la lettre D .
Quand, comment ?
La dclaration doit tre adresse, avant la mise en service de l'installation, au prfet du
dpartement dans lequel celle-ci doit tre implante.
Le dossier de dclaration comprend :
le nom, le prnom et le domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une personne physique, la
dnomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du sige social et la
qualit du signataire, s'il s'agit d'une personne morale ;
l'emplacement o l'installation sera ralise ;
la nature et le volume des activits que le dclarant se propose d'exercer ainsi que la
ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit tre range.
A cette description doivent tre joints un plan de situation du cadastre dans un rayon de
100 m et un plan d'ensemble l'chelle de 1/200 au minimum, une description de
l'installation et des constructions et terrains avoisinants, ainsi que des points d'eau,
canaux, cours d'eau, gouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'puration et
d'vacuation des eaux rsiduaires et des manations de toute nature, ainsi que
d'limination des dchets doivent y tre prciss. La dclaration mentionne galement les
dispositions prvues en cas de sinistre.
La dclaration et ses annexes sont remises en triple exemplaire.
Le prfet donne rcpiss de la dclaration et communique au dclarant une copie des
prescriptions gnrales applicables la catgorie dactivits concerne.
Ces prescriptions sont fixes soit sous forme dun arrt ministriel de prescriptions
gnrales, ventuellement adaptes aux circonstances locales, soit, dfaut, sont bases
sur les arrts-types pris sur le fondement de lancienne nomenclature.
Tandis que les installations soumises autorisation ne peuvent tre mises en
fonctionnement qu'aprs rception de l'arrt d'autorisation, les installations soumises
dclaration peuvent entrer en fonctionnement ds que le rcpiss a t dlivr.
Toute modification apporte linstallation, son mode dexploitation ou son
voisinage, entranant un changement notable des conditions initiales, doit tre porte
la connaissance du prfet qui peut exiger une nouvelle dclaration.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
2.7 Les recours et sanctions
2.7.1 Les recours
Lexploitant
Il est toujours possible un exploitant de contester une dcision de classement ou les
prescriptions techniques qui accompagnent l'autorisation. Le tribunal comptent est le tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve l'installation faisant l'objet du litige. Il n'est pas
oblig de prendre un avocat, ni de comparatre. La procdure est crite. L'exploitant a deux
mois aprs la notification qui lui est faite de l'autorisation ou du refus pour lever un recours.
Les tiers
Une commune ou un groupement de communes peut aussi redouter l'installation
autorise ou, au contraire, souhaiter l'installation refuse.
De mme, toute personne peut protester contre la cration d'une installation juge
dangereuse, ou estimer insuffisantes les prescriptions imposes l'exploitant.
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut
engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant
une atteinte aux objectifs qu'elle dfend.
Les tiers (municipalits, voisins ou associations) ont quatre ans pour agir compter de
la publication de l'acte contest. Toutefois, pour les dcisions concernant les
autorisations dexploitation de carrires, le dlai de recours est fix six mois.
Les tiers installs postrieurement la publication de l'autorisation n'ont pas de recours contre
l'installation mais ils peuvent toujours ultrieurement demander l'aggravation des prescriptions
d'exploitation.
Le tribunal peut confirmer purement et simplement la dcision du prfet, annuler l'autorisation,
annuler le rcpiss de dclaration parce qu'en ralit l'installation est soumise autorisation
(l'exploitant devra alors entamer la procdure ncessaire) ou encore annuler le refus
d'autorisation et renvoyer l'affaire au prfet, ou modifier les prescriptions imposes ou mettre
l'exploitant en demeure de rgulariser sa situation le cas chant.
2.7.2 Les sanctions pnales
Il existe des sanctions administratives, pour dfaut d'autorisation ou de dclaration, et
des sanctions pnales, la suite d'infractions.
Si une installation classable est exploite sans autorisation ou sans dclaration, le prfet
met en demeure l'exploitant de rgulariser sa situation et peut dans certains cas faire
suspendre le fonctionnement de l'exploitation. L'installation peut dans des cas
exceptionnels tre purement et simplement ferme.
2.8 La vie d'une installation classe
Les prescriptions imposes l'exploitant d'une installation classe sont les conditions
fixes son ouverture. Elles lui resteront applicables, pendant toute la dure de son
fonctionnement, et une nouvelle tude sera effectue en cas de modification du site.
Le respect de ces prescriptions ne dispense pas de l'application d'autres rglementations,
telles que les rgles d'urbanisme ou le code du travail ou dautres lgislations relatives
lenvironnement pour la protection de lair ou de leau.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
En revanche, les dispositions municipales ( lexception de celles concernant les dchets) ou
le rglement sanitaire dpartemental ne sont pas applicables aux installations classes.
Les prescriptions fixent l'exploitant un but atteindre, mais ne dterminent pas les techniques
ou moyens d'y parvenir. Elles doivent tre techniquement ralisables en fonction des
connaissances disponibles et des impratifs conomiques raisonnables.
Cependant, un exploitant ne peut se dispenser d'appliquer des prescriptions en invoquant le
cot trop lev des mesures ncessaires.
Par ailleurs, mme si les nuisances ne sont pas encore effectives, les prescriptions doivent tre
appliques immdiatement.
2.8.1 Le systme de management environnemental
La mise en uvre par lexploitant dun systme de management environnemental est un
moyen efficace pour assurer le suivi des prescriptions rglementaires qui lui incombent et
amliorer ses performances environnementales.
Deux systmes lui sont proposs pour entreprendre cette dmarche : la certification sur la base
de la norme internationale ISO 14001 et la procdure denregistrement EMAS, systme
communautaire de management environnemental et daudit. Dans les deux cas, il sagit dune
dmarche qui na aucun caractre obligatoire.
Le nouveau rglement EMAS du 19 mars 2001 sapplique toutes les organisations qui ont
des impacts environnementaux (le prcdent ne concernait que le secteur industriel) et se
rfre la norme ISO 14001 pour dfinir les exigences du systme. Lobjectif pour les
organisations qui participent lEMAS est den obtenir une valeur ajoute en terme de
contrle rglementaire, de rduction des cots et dimage publique. Afin de renforcer leur
crdibilit, les entreprises peuvent faire examiner et valider la conformit de leur systme, de
leur programme daudit et de leur dclaration environnementale par des vrificateurs
environnementaux agrs.
Le Ministre de lenvironnement encourage les entreprises utiliser ces mcanismes qui
sont de nature permettre lallgement et la simplification des contrles.
Les exploitants dtablissements classs AS doivent veiller ce que leur systme de
management environnemental soit cohrent avec le systme de gestion de la scurit quils
ont lobligation de mettre en place.
2.8.2 Les contrles
Lorganisation de linspection des installations classes est confie, sous lautorit du
prfet, au directeur rgional de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement. Les
inspecteurs sont dsigns par le prfet, sur proposition dudit directeur. Ils relvent, soit :
de la direction rgionale de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement (DRIRE) ;
de la direction dpartementale des services vtrinaires (DDSV), notamment pour les
activits agricoles, levages ;
de la direction dpartementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), notamment
pour les dchets ;
du service technique des installations classes de la Prfecture de police de Paris
(STIIC), pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Mission des inspecteurs des installations classes
Les inspecteurs des installations classes ont pour mission :
d'identifier les installations classables non dclares ni autorises ;
de prparer les prescriptions qui seront proposes au prfet pour tre imposes
l'exploitant ;
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
de visiter priodiquement les installations classes pour vrifier l'application des
prescriptions ;
dinstruire les plaintes et les accidents sil sen produit et, le cas chant, de proposer
au prfet toutes les mesures ncessaires ;
de relever les infractions commises et d'en dresser procs-verbal.
Leur rle se limite donc l'application des textes relatifs la protection de l'environnement.
Ils n'ont pas autorit dans les domaines de la scurit du personnel, par exemple.
Si les vrifications exigent des analyses ou d'autres contrles techniques, il peut tre
impos l'exploitant de les faire effectuer, ses frais, par des laboratoires agrs.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ont droit d'entre dans les
tablissements dont ils ont assurer le contrle tout moment, mme la nuit et en
priode d'inactivit, et justifient de leur qualit en produisant leur carte de service
bande tricolore dlivre par le ministre de l'Environnement. L'exploitant qui mettrait
obstacle, de quelque manire que ce soit, leur contrle, encourrait une peine
correctionnelle.
LInspection des installations classes dfinit des priorits afin de consacrer
lessentiel de ses efforts sur les tablissements haut risques technologiques ou
dont les potentiels de pollution ou de nuisances sont levs.
Les DRIRE doivent notamment contrler prioritairement :
les tablissements Seveso seuil haut ;
les installations de stockage ou dlimination de dchets ;
les installations rejets importants dans latmosphre ;
les installations dont les rejets dans le milieu naturel dpassent certaines valeurs ;
ainsi que les tablissements ncessitant une surveillance particulire selon des critres lis au
profil industriel local et la sensibilit du milieu sans prjudice des missions mener dans le
cadre des actions prioritaires.
2.8.3 Le secret industriel
Les inspecteurs ne doivent ni divulguer ni utiliser les secrets de fabrication dont ils ont
connaissance. Avant de prendre leurs fonctions, ils prtent serment devant le tribunal de
Grande Instance de leur domicile.
2.8.4 Le rle du CHSCT
L'article L.236-2 du Code du Travail dispose que dans les tablissements comportant une
ou plusieurs installations soumises autorisation les documents tablis l'intention des
autorits publiques charges de la protection de l'environnement sont ports la
connaissance du comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail par le chef
d'tablissement (CHSCT) avant leur envoi l'autorit comptente.
Le CHSCT est consult sur le dossier tabli par le chef d'tablissement l'appui de sa
demande. Il est, en outre, inform par le chef d'tablissement sur les prescriptions
imposes par les autorits publiques charges de la protection de l'environnement.
Le comit est consult par le chef d'tablissement sur la dfinition et les modifications
ultrieures du plan d'urgence interne. Il peut proposer des modifications de ce plan au
chef d'tablissement qui justifie auprs du comit les suites qu'il donne ces propositions.
Dans les tablissements comportant une ou plusieurs installations nuclaires de base et
dans les installations figurant sur la liste des catgories, et ventuellement des seuils de
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
capacit, des installations dans le voisinage desquelles certaines servitudes peuvent tre
institues (liste fixe par dcret en Conseil d'tat, art L.515-8-IV code de l'environnement)
le comit est consult :
avant toute dcision de sous-traiter une activit, jusqu'alors ralise par les salaris de
l'tablissement, une entreprise extrieure appele raliser une intervention pouvant
prsenter des risques particuliers ;
sur la liste des postes de travail lis la scurit de l'installation prcisant les postes qui
ne peuvent tre confis des salaris sous CDD ou sous contrat de travail temporaire,
ceux qui doivent tre occups par les salaris de l'tablissement et ceux dont les tches
exigent la prsence d'au moins deux personnes qualifies.
Larticle L.236-2-1 stipule que dans ces deux types dtablissements le CHSCT est largi
lorsque sa runion a pour objet de contribuer :
la dfinition des rgles communes de scurit dans l'tablissement ;
l'observation des mesures de prvention ;
une reprsentation des chefs d'entreprises extrieures et de leurs salaris selon des
conditions dtermines.
Il se runit au moins une fois par an, ainsi que lorsque la victime dun accident est une
personne extrieure intervenant dans l'tablissement.
Le comit est galement inform la suite de tout incident qui aurait pu entraner des
consquences graves. Il peut procder l'analyse de l'incident et proposer toute action
visant prvenir son renouvellement.
Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la runion qui se
tient au moins une fois par an (art. L. 236-4) lors de laquelle le chef d'tablissement
prsente au CHSCT :
le bilan crit de la situation gnrale de l'hygine, de la scurit et des conditions de
travail dans son tablissement et des actions qui ont t menes au cours de l'anne ;
un programme annuel de prvention des risques professionnels et d'amlioration des
conditions de travail.
Le CHSCT met un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de
priorit et l'adoption de mesures supplmentaires. Cet avis est transmis pour information
l'inspecteur du travail.
Le procs-verbal de la runion du CHSCT consacre l'examen du rapport et du
programme est obligatoirement joint toute demande prsente par le chef
d'tablissement en vue d'obtenir des marchs publics, des participations publiques, des
subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
2.8.5 Les plans de secours
Les installations classes qui prsentent les risques les plus importants pour les personnes
et lenvironnement peuvent se voir imposer par le prfet, aprs consultation du Service
dpartemental dincendie et de secours, ltablissement dun plan dopration
interne (POI).
Par ailleurs, la loi du 13 aot 2004 de modernisation de la scurit civile prvoit la
planification des secours en matire de risque technologique, sous la forme de plans
durgence qui comprennent :
les plans particuliers dintervention (PPI),
les plans de secours spcialiss lis un risque dfini (PSS).
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Les plans doprations internes (POI)
Lobligation dlaborer un POI est dfinie dans larrt dautorisation ou par un arrt
complmentaire. Elle concerne :
les installations qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention et, sans distinction, les
installations classes AS ;
les installations qui par la nature de leurs activits ou celles du voisinage prsentent
des risques particuliers.
Le plan dopration interne dfinit les mesures dorganisation, les mthodes
dintervention et les moyens ncessaires que lexploitant doit mettre en uvre pour
protger le personnel, les populations et lenvironnement .
Il reproduit galement les mesures durgence qui incombent lexploitant sous le
contrle de lautorit de police, notamment en matire dalerte. Il est tabli par
lexploitant, sous sa responsabilit, sur la base de ltude de dangers, mais en troite
liaison avec les pouvoirs publics. Pour les installations soumises servitudes dutilit
publique, il doit tre tabli avant la mise en service de linstallation. Lavis du CHSCT sur
le POI doit tre recueilli et transmis au prfet. Des exercices d'application doivent tre
raliss, pour vrifier la fiabilit du plan et en combler les lacunes ventuelles, de
prfrence une fois par an. Pour les installations classes AS , le POI est mis jour et
test des intervalles nexcdant pas trois ans .
Une circulaire du 30 dcembre 1991 dcrit l'articulation entre le plan d'opration interne et les
plans d'urgence visant les installations classes.
Les plans particuliers dintervention (PPI)
Ces plans sont tablis dans les conditions prvues par le dcret 2005-1158 du 13
septembre 2005 pris en application de la loi du 13 aot 2004.
Les PPI sont prpars par le prfet et ont pour but de prvoir les mesures prendre et les
moyens engager en cas de sinistre dpassant les limites de l'installation.
Ils concernent obligatoirement les installations dont l'emprise est localise et fixe,
rpondant aux caractristiques suivantes :
les sites comportant au moins une installation nuclaire de base, qu'elle soit ou non secrte ;
les installations classes susceptibles de donner lieu servitudes dutilit publique
(installations soumises autorisation prsentant des dangers dexplosion ou dmanations
de produits nocifs);
les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liqufis ou gazeux, ou
de produits chimiques destination industrielle ;
certains amnagements hydrauliques ;
les ouvrages d'infrastructure lie au transport des matires dangereuses ;
les tablissements utilisant des micro-organismes hautement pathognes dont l'emploi
serait de nature prsenter un risque pour la sant publique ainsi que les produits qui en
contiennent
Par ailleurs le prfet peut prescrire l'laboration d'un PPI pour :
dautres ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localise et fixe.
des risques de nature particulire, identifis, susceptibles de porter atteinte la vie ou
l'intgrit des personnes, prsents par des installations ou ouvrages fixes.
Et ceci, aprs avis, d'une part, du conseil dpartemental comptent en matire de
scurit des populations sur le rapport et la proposition de l'autorit de contrle dont
relve l'activit et, d'autre part, de l'exploitant.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Attention, le prfet peut dcider qu'un PPI n'est pas ncessaire pour :
- des installations susceptibles de donner lieu servitudes dutilit publique ;
- des stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liqufis ou gazeux, ou de
produits chimiques destination industrielle ,
en se basant sur l'tude de danger dmontrant l'absence de danger grave pour la sant de
l'homme ou pour l'environnement l'extrieur de l'tablissement, et du rapport de l'autorit de
contrle dans le cadre de la procdure d'autorisation.
Ce plan dcrit notamment les dispositions particulires, les mesures prendre et les moyens
de secours pour faire face aux risques particuliers considrs :
la description des scnarios d'accident et des effets pris en compte par le plan avec la
description gnrale de l'installation ou de l'ouvrage ;
la zone d'application et le primtre du plan, et la liste des communes sur le territoire
couvertes par le plan ;
les mesures d'information et de protection prvues pour les populations et, le cas chant, les
schmas d'vacuation ventuelle ;
Les mesures qui incombent l'exploitant pour la diffusion immdiate de l'alerte auprs des
autorits comptentes et l'information de celles-ci sur la situation et son volution, ainsi que, le
cas chant, la mise la disposition de l'tat d'un poste de commandement amnag sur le
site ou au voisinage de celui-ci.
les mesures incombant l'exploitant l'gard des populations voisines et notamment, en cas
de danger immdiat, les mesures d'urgence qu'il est appel prendre avant l'intervention de
l'autorit de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
a) la diffusion de l'alerte auprs des populations voisines ;
b) l'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'loignement des
personnes au voisinage du site ;
c) l'interruption des rseaux et canalisations publics au voisinage du site.
les missions particulires, dans le plan, des services de l'tat, de ses tablissements publics,
des collectivits territoriales et de leurs tablissements publics et les modalits de concours des
organismes privs appels intervenir ;
les modalits d'alerte et d'information des autorits d'un tat voisin ;
les dispositions gnrales relatives la remise en tat et au nettoyage de l'environnement
long terme aprs un accident l'ayant gravement endommag survenu.
Les plans de secours spcialiss (PSS)
Les plans de secours spcialiss sont tablis pour faire face aux risques technologiques qui
n'ont pas fait l'objet d'un plan particulier d'intervention ou aux risques lis un accident ou un
sinistre de nature porter atteinte la vie ou l'intgrit des personnes, aux biens ou
l'environnement.
Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spcialis est prpar par le
prfet en liaison avec les services et les organismes dont les moyens peuvent tre mis en
uvre.
2.8.6 Les obligations priodiques des exploitants
Le dcret du 21 septembre 1977 modifi prvoit, pour certaines installations,
ltablissement de documents permettant un suivi rgulier, dans lobjectif de maintenir les
prescriptions en adquation avec les risques encourus.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Le recensement des produits dangereux
Les exploitants dtablissements dont lune au moins des installations figure dans la liste
annexe larrt modifi du 10 mai 2000 doivent adresser au prfet un tat recensant les
substances et prparations dangereuses susceptibles dtre prsentes dans ltablissement
(nature, tat physique et quantit) avant le 31 dcembre 2005 puis, tous les trois ans, avant le
31 dcembre de l'anne concerne. "
Le systme de gestion de la scurit
Dans le cadre de la mise en uvre du systme de gestion de la scurit applicable
lexploitant dun tablissement comportant au moins une installation AS, celui-ci adresse
chaque anne au prfet une note synthtique prsentant les rsultats de la revue de
direction. Il tablit, par ailleurs, rgulirement, des bilans sur les dfaillances survenues et
les actions correctives entreprises (arrt du 10 mai 2000).
Ltude de danger
Lexploitant dun tablissement class AS, doit rexaminer ltude de dangers et, si
ncessaire, la mettre jour au moins tous les cinq ans, puis la transmettre au prfet. Le
cas chant, le POI sera rvis en consquence (dcret du 21 septembre 1977).
L'exploitant doit tenir les exploitants d'installations classes voisines informs des risques
d'accidents majeurs identifis dans l'tude de dangers ds lors que les consquences de
ces accidents sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette
information au prfet (arrt du 29 septembre 2005).
Le bilan de fonctionnement
Certaines installations doivent tablir, tous les dix ans, un bilan de fonctionnement en
vue de permettre au prfet de rexaminer et, si ncessaire, dactualiser les conditions de
lautorisation. Les installations vises par cette obligation et le contenu du document sont
fixs par un arrt du 17 juillet 2000.
2.8.7 Les modifications ou extensions d'installations
En cas de modification ou d'extension notable de ses installations, l'exploitant doit renouveler sa
demande d'autorisation ou sa dclaration.
Il en va de mme en cas de changement dans les procds de fabrication ou de
transformation des installations.
Si l'extension a pour consquence de faire passer une installation de la classe D (dclaration)
la classe A (autorisation), une demande d'autorisation devra tre dpose. Avant d'engager
toute formalit, il est conseill de prendre contact avec l'inspection des installations classes.
En cas de changement dexploitant, le nouvel exploitant doit en faire dclaration auprs du
prfet dans le mois suivant afin que ladministration soit en tenue informe en permanence
de lidentit de lexploitant dune ICPE. De plus, le changement dexploitant est soumis
autorisation prfectorale pour certaines catgories dexploitations (dcret 77-1133 du 21
septembre 1977).
La dclaration dincidents/accidents dans les meilleurs dlais auprs de linspection des
installations classes est une obligation pour lexploitant dune installations soumise
dclaration ou autorisation (dcret 77-1133 du 21 septembre 1977).
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
2.8.8 Le rgime fiscal des installations classes
Les installations classes sont soumises la taxe gnrale sur les activits polluantes .
La TGAP regroupe plusieurs contributions, dfinies aux articles 266 sexies 266
duodecies du code des douanes : taxe initiale la dlivrance de lautorisation, taxe
annuelle assise sur lexploitation, taxes spcifiques certaines activits (extraction de
granulats, dchets...).
La taxe initiale
La taxe initiale est due par les installations soumises autorisation et exploites dans des
tablissements industriels, commerciaux ou artisanaux ou des tablissements publics
caractre industriel ou commercial.
Elle est applicable lors de la cration de l'installation ou lors de toute nouvelle
autorisation. Le taux est rduit pour les artisans inscrits au rpertoire des mtiers et ceux
n'employant pas plus de deux salaris.
La taxe annuelle
La taxe annuelle s'applique aux tablissements privs ou publics industriels et commerciaux,
lexception des entreprises inscrites au Rpertoire des mtiers, qui exercent l'une des activits
numres au dcret modifi n 2000-1349 du 26 dcembre 2000, activits qui font courir,
par leur nature ou leur volume, des risques particuliers lenvironnement.
2.8.9 La cessation d'activit
L'exploitant d'une installation classe qui cesse son activit doit en informer le prfet dans
le mois qui suit la cessation. Pour les installations de stockage de dchets et les carrires,
le pravis est de six mois. Le dcret du 21 septembre 1977 prvoit les conditions dans
lesquelles lexploitant peut arrter dfinitivement son activit dans le cadre du rgime de
la dclaration et de celui de lautorisation et, notamment, celles dans lesquelles le site
doit ventuellement tre remis en tat. Parfois, les mesures de remise en tat du site sont
dfinies ds l'autorisation d'ouverture.
Des garanties financires peuvent tre exiges cette fin. Ces garanties sont destines
assurer, suivant la nature des dangers ou inconvnients de chaque catgorie
d'installations, la surveillance du site et le maintien en scurit de l'installation, les
interventions ventuelles en cas d'accident avant ou aprs fermeture, et la remise en tat
aprs fermeture. Elles ne couvrent pas, cependant, les indemnisations dues par
l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un prjudice par fait de pollution ou d'accident
causs par l'installation.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
3 LA GESTION DES REJETS ET DES DCHETS
3.1 Les rgles respecter en matire de rejets
3.1.1 La pollution atmosphrique
La pollution atmosphrique provient principalement des installations de combustion, tant
industrielles que domestiques, de la circulation automobile et de la production
industrielle. En ce qui concerne la lutte contre la pollution atmosphrique, la lgislation
vise essentiellement :
la limitation des missions ;
la nature des combustibles utiliss ;
le traitement des rejets provenant des installations de production.
En application des articles L.221-1 et L.221-2 du Code de l'environnement, le
dcret modifi du 6 mai 1998 fixe des objectifs de qualit, de seuils d'alerte et de
valeur limite des polluants, notamment pour les produits suivants, qui doivent faire
l'objet d'une surveillance :
dioxyde dazote ;
les particules fixes et les particules en suspension ;
le plomb ;
le dioxyde de soufre (SO
2
) ;
l'ozone ;
le monoxyde carbone (CO) ;
le benzne,
Pour la surveillance de la qualit de l'air une distinction est faite entre :
les agglomrations de plus de 100 000 habitants dans lesquelles le dioxyde
d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et
l'ozone sont surveills par mesures en station fixe;
l'extrieur de ces agglomrations dans lesquelles, le dioxyde d'azote, les
particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont
surveills soit par mesures en station fixe, soit par modlisation;
Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est ralise
dans les zones o la pollution est prsume la plus forte, o la sant ou
l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulire ou qui sont prsumes
donner une reprsentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
Les installations sont aussi soumises un certain nombre d'obligations, outre la
lgislation sur les ICPE, en vertu de la loi 61-842 du 2 aot 1961 relative la lutte
contre la pollution et les odeurs et du dcret d'application et des arrts qui en
fixent les modalits.
Les installations de chauffage et de combustion
Les chaudires, chaufferies, installations de combustion sont l'objet de nombreuses
dispositions rglementaires qui rgissent :
leur rendement ;
les valeurs limites de rejet qui leur sont applicables ;
leurs contrles priodiques.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Citons titre dexemple :
le dcret n 2005-1195 du 22/09/05 relatif aux mesures de protection de l'environnement
contre les missions polluantes des moteurs combustion interne destins quiper les
engins mobiles non routiers ;
le dcret n 98-833 du 16/09/98 relatif aux contrles priodiques des installations
consommant de l'nergie thermique ;
le dcret n 98-817 du 11/09/98 relatif aux rendements et l'quipement des chaudires de
puissance comprise entre 400 kW et 50 MW ;
le dcret n 74-415 du 13/05/74 relatif au contrle des missions polluantes dans
l'atmosphre et certaines utilisations de l'nergie thermique ;
l'arrt du 11/08/99 relatif la rduction des missions polluantes des moteurs et turbines
combustion ainsi que les chaudires utilises en post-combustion soumis autorisation sous
la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classes pour la protection de
l'environnement ;
l'arrt du 25/07/97 relatif aux prescriptions gnrales applicables aux installations classes
soumises dclaration sous la rubrique 2910 (combustion) ;
l'arrt du 27/01/93 relatif l'utilisation de combustibles minraux solides dans les petites
installations de combustion ;
l'arrt du 27/06/90 relatif la limitation des rejets atmosphriques des grandes installations
de combustions et aux conditions d'vacuation des rejets des installations de combustion.
3.1.2 La pollution de l'eau
Le titre 1
er
du livre II du Cde de l'environnement (art.L.210-1 L.218-20) rgit la gestion des
ressources en eau, les cours d'eau, la police des eux, la qualit de l'eau d'alimentation, sa
distribution, les prlvements et rejets en mer, en eau douce, superficielles, souterraines
Seules certaines dispositions sont applicables aux installations classes pour la protection
de l'environnement. Elles sont notamment dispenses de la procdure d'autorisation ou
de dclaration.
N'est traite dans ce chapitre que l'incidence que peut avoir l'utilisation de produits
dangereux sur les problmes de rejets d'eaux rsiduaires industrielles.
Lautorisation de dversement
Les articles L.214-1 L.214-3 du Code de l'environnement soumettent autorisation ou
dclaration (suivant la procdure tablie par le dcret n 93-742 du 29 mars 1993) les
dversements, coulements, rejets ou dpts directs ou indirects, chroniques ou pisodiques,
mme non polluants non domestiques, suivant les dangers qu'ils prsentent et la gravit de
leurs effets sur la ressource en eau et les cosystmes aquatiques. Les oprations concernes
font l'objet d'une nomenclature (dcret n 93-743 du 29 mars 1993 modifi).
Les rejets en milieu naturel, nappes d'eaux souterraines ou eaux superficielles, sont
soumis autorisation ou dclaration suivant :
l'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activit doivent tre raliss ;
la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux
ou de l'activit envisags, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans
lesquelles ils doivent tre rangs ;
les variations saisonnires et climatiques, des incidences de l'opration sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l'coulement, le niveau et la qualit des eaux, y compris de
ruissellement ;
les moyens de surveillance prvus et, si l'opration prsente un danger, les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Les procdures de demande d'autorisation et dclaration sont similaires celles
concernant les installations classes : dossier sur les incidences du projet sur
l'environnement, enqute publique, etc.
Lorsque le rejet est fait dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'une
dclaration relevant de la lgislation sur les installations classes il n'y a qu'une
procdure, celle des installations classes.
3.2 La gestion des dchets
3.2.1 Les dispositions lgislatives
Les dispositions lgislatives relatives aux dchets font lobjet du titre IV du livre V du
Cde de lenvironnement divis en deux chapitres :
limination des dchets et rcupration des matriaux (art. L.541-1 L.541-
50) ;
Dispositions particulires aux dchets radioactifs (art. L.542-1 L.542-14) ;
Ces dispositions sont issues de la loi du 15 juillet 1975 relative llimination des
dchets et la rcupration des matriaux et de la loi du 30 dcembre 1991
relative aux recherches sur la gestion des dchets radioactifs, elles-mmes issues du
droit communautaire.
Paralllement, les activits ayant trait aux dchets (dpts, stations de transit et
units de traitement ou dincinration de dchets) sont soumises la lgislation sur
les installations classes pour la protection de lenvironnement (voir chapitre 2 ),
ainsi que le stipule notamment larticle L.541-25 du Code de lenvironnement :
Les installations dlimination des dchets sont soumises, quel quen soit
lexploitant, aux dispositions du titre 1
er
du prsent livre. [...] . Par limination , il
faut comprendre aussi bien le stockage ou le tri que le traitement lui-mme).
De nombreux dcrets, arrts et circulaires compltent le dispositif lgislatif, auxquels
viennent sajouter les textes europens applicables sans quune transposition soit
ncessaire (rglements et dcisions).
3.2.1.1 Les grands principes en matire de dchets
Quatre grands principes constituent le fondement de la rglementation :
prvenir ou rduire la production et la nocivit des dchets, notamment en agissant sur
la fabrication et sur la distribution des produits ;
organiser le transport des dchets et le limiter en distance et en volume ;
valoriser les dchets par remploi, recyclage ou toute autre action visant obtenir
partir des dchets des matriaux rutilisables ou de l'nergie ;
assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la sant publique
des oprations de production et d'limination des dchets, sous rserve des rgles de
confidentialit prvues par la loi, ainsi que sur les mesures destines en prvenir ou
en compenser les effets prjudiciables.
3.2.1.2 Les principales obligations qui en dcoulent
Toute personne qui produit ou dtient des dchets doit en assurer ou en faire
assurer llimination, conformment aux dispositions rglementaires, dans des
conditions propres viter des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, la
dgradation des sites ou des paysages, la pollution de lair ou des eaux, la
production de bruits et dodeurs et, dune faon gnrale, les atteintes la sant
de lhomme et lenvironnement.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Au cas o des dchets seraient abandonns, dposs ou traits contrairement aux prescriptions
rglementaires, les pouvoirs publics peuvent en assurer doffice llimination aux frais du
responsable.
Les entreprises qui produisent, importent, exportent, liminent ou qui transportent,
se livrent des oprations de courtage ou de ngoce de certaines catgories de
dchets (dfinies par dcrets) sont tenues de fournir ladministration toutes
informations concernant lorigine, la nature, les caractristiques, les quantits, la
destination et les modalits dlimination, des dchets quelles produisent,
remettent un tiers ou prennent en charge.
Certains producteurs, importateurs ou distributeurs de produits gnrateurs de dchets peuvent
se voir imposer lobligation de pourvoir ou de contribuer llimination des dchets qui en sont
issus.
Les communes assurent llimination des dchets mnagers et assimils dans le cadre de
plans dpartementaux ou interdpartementaux.
Chaque rgion doit tre couverte par un plan rgional ou interrgional dlimination des
dchets industriels spciaux. Le ministre de lenvironnement tablit des plans nationaux
pour certaines catgories de dchets.
Les exploitants dinstallations dlimination de dchets soumises autorisation au titre de
la lgislation sur les installations classes pour la protection de lenvironnement, les
communes et les groupements de communes, les prfets tablissent et tiennent jour des
documents destins linformation du public.
Des Commissions locales dinformation et de surveillance (CLIS) peuvent ou sont
obligatoirement dans certains cas, cres afin de promouvoir linformation du public sur
les problmes poss par la gestion des dchets dans leur zone gographique de
comptence.
3.2.1.3 Les autres rglementations
La collecte, le dpt, llimination des dchets font galement l'objet de
prescriptions dans dautres textes, et notamment dans les codes suivants et les
textes pris ventuellement pour leur application :
le Code gnral des collectivits territoriales (obligations des communes pour la
collecte et limination des dchets mnagers et assimils) ;
le Code de la sant publique (dchets dactivits de soins, rglements sanitaires
dpartementaux et rgles gnrales dhygine prises par dcrets en application
de ce code et qui se substituent peu peu aux rglements sanitaires
dpartementaux) ;
le Code rural (quarrissage) ;
le Code minier (haldes et terrils des mines) ;
le Code de la route (vhicules abandonns) ;
le Code de lurbanisme, le code pnal, le code des impts
3.2.2 Les dfinitions
3.2.2.1 Le dchet
Dans son article L.541-1, Le Code de lenvironnement dfinit le dchet comme
tout rsidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matriau, produit ou plus gnralement tout bien meuble abandonn ou
que son dtenteur destine l'abandon .
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
3.2.2.2 Les dchets ultimes
Dans ce mme article est ultime un dchet, rsultant ou non du traitement d'un dchet,
qui n'est plus susceptible d'tre trait dans les conditions techniques et conomiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par rduction de son
caractre polluant ou dangereux .
Rappelons quau terme de larticle L.541-24, depuis le 1
er
juillet 2002, les installations
dlimination des dchets par stockage ne seront autorises accueillir que des dchets ultimes.
3.2.2.3 Les dchets dangereux
Les dchets dangereux sont dfinis par le dcret n 2002-540 du 18 avril 2002 relatif
la classification des dchets. Les dchets dangereux sont dfinis l'article 2.
Dune part les dchets considrs comme dangereux sont ceux qui prsentent une
ou plusieurs des proprits numres dans le tableau de la page suivante (et
signals par un astrisque dans la liste des dchets de l'annexe II du dcret).
H 1 Explosif
H 2 Comburant
H 3-A Facilement inflammable
H 3-B Inflammable
H 4 Irritant
H 5 Nocif
H 6 Toxique
H 7 Cancrogne
H 8 Corrosif
H 9 Infectieux
H 10 Toxique pour la reproduction
H 11 Mutagne
H 12 Substances et prparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dgagent un gaz
toxique ou trs toxique
H 13 Substances et prparations susceptibles, aprs limination, de donner naissance, par quelque
moyen que ce soit, une autre substance, qui possde l'une des caractristiques numres
ci-avant
H 14 cotoxique
Dautre part, les dchets industriels dangereux (art. L.541-24 du Code de
l'environnement) qui sont les dchets dangereux autres que les dchets d'emballages
municipaux et les dchets municipaux. ;
Le dcret n 2005-635 (30 mai 2005) relatif au contrle des circuits de traitement des dchets
a abrog et remplac le dcret n 77-974 (19 aot 1977) qui donnait la liste des dchets
considrs comme gnrateurs de nuisances .
Llimination de ces dchets (collecte, transport, stockage, tri, traitement) fait lobjet de
prescriptions rglementaires complmentaires. De plus, ces catgories de dchets ne
peuvent tre traites que dans les installations pour lesquelles lexploitant est titulaire
dun agrment de ladministration (art. L.541-22).
3.2.2.4 Les dchets mnagers et assimils
Les dchets mnagers sont constitus par les ordures mnagres comprenant
gnralement des matires vgtales et animales, des papiers, cartons, mtaux,
plastiques, textiles, verres, etc.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Les dchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu gard leurs caractristiques et
aux quantits produites, peuvent tre limins sans sujtions particulires et sans risque
pour les personnes ou lenvironnement sont limins dans les mmes conditions que les
dchets des mnages (article R.2224-28 du Code gnral des collectivits territoriales).
Le sort de ce quil est convenu dappeler les dchets industriels banals fait lobjet
dune circulaire du 1
er
mars 1994. Sont considrs comme tels les dchets issus des
entreprises qui, par leur nature, peuvent tre traits ou stocks dans les mmes
installations que les dchets mnagers . Ils leur sont de ce fait assimils , mme sils
sont collects sparment.
3.2.2.5 Les dchets demballages
En application de larticle L.541-10 du code de lenvironnement, le dcret du 1
er
avril
1992 modifi fixe les conditions dlimination des emballages dont les dtenteurs sont
les mnages. Les producteurs, importateurs ou les responsables de la premire mise sur
le march des produits emballs doivent pourvoir leur limination ou les faire prendre
en charge par un organisme agr (Eco-emballage, Adelphe...).
Un autre dcret, dat du 13 juillet 1994, fixe les conditions dlimination des dchets
rsultant de labandon des emballages dun produit tous les stades de la fabrication ou
de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de lutilisation par les
mnages. Ces dchets doivent obligatoirement tre valoriss par remploi, recyclage ou
toute autre action visant obtenir des matriaux rutilisables ou de lnergie. Les
dtenteurs doivent soit procder eux-mmes leur valorisation (dans une installation
classe), soit les cder par contrat lexploitant dune installation agre dans les mme
conditions.
3.2.3 Les contrle des circuits dlimination de dchets
Par limination, le Code de lenvironnement entend les oprations de collecte,
transport, stockage, tri et traitement ncessaires la rcupration des lments et
matriaux rutilisables ou de l'nergie, ainsi qu'au dpt ou au rejet dans le milieu
naturel de tous autres produits dans des conditions propres viter les nuisances .
Dcret n 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrle des circuits de traitement des dchets
dfinit les formalits administratives qui incombent aux entreprises intervenant sur ces dchets.
3.2.3.1 Le registre
En application de larticle L.541-7 du Code de lenvironnement un registre
chronologique de la production, de l'expdition, de la rception et du traitement
des dchets doit tre tenu par les exploitants des tablissements produisant ou
expdiant des dchets dangereux et radioactifs ;
Ainsi que par :
les transporteurs ;
les ngociants ;
les exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou
de traitement ;
les personnes collectant de petites quantits ;
de ces mmes dchets.
Il en va de mme pour les exploitants d'installations destinataires de dchets autres que
dangereux et radioactifs, l'exception de celles qui ralisent une opration de
valorisation de dchets inertes.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Ces registres doivent tre conservs pendant 5 ans au moins.
3.2.3.2 Le bordereau de suivi
Le producteur, le collecteur, toute personne ayant reconditionn ou transform des
dchets dangereux ou radioactif et toute personne en possession de dchets dont
lmetteur est inconnu sont tenus dmettre un bordereau de suivi lors de la remise de
ces dchets un tiers (art. 4, dcret du 30 mai 2005).
Ce document doit tre conserv par la personne qui lmet, le reoit ou le
complte pendant :
3 ans pour les transporteurs ;
5 ans pour les autres.
Larrt du 29 juillet 2005 fixe ce formulaire du bordereau de suivi des dchets
dangereux. Les personnes soumises cette obligation doivent utiliser le formulaire
CERFA n 12571-01 sauf pour les dchets amiants.
De plus, les collecteurs prenant en charge de petites quantits des dchets dangereux
joignent au bordereau qu'ils mettent l'annexe 1 du formulaire.
Toute personne ayant transform des dchets ou ralis un traitement des dchets
aboutissant d'autres dchets joint l'annexe 2 du formulaire dment remplie au
bordereau qu'elle met lors de la rexpdition de ces dchets vers une autre installation.
Chaque intervenant successif doit remplir le bordereau aux endroits les concernant et en
conserver copie
3.2.3.3 La dclaration
Le dcret du 30 mai 2005 stipule que les exploitants dinstallations classes
produisant des dchets dangereux et des installations de traitement de ces dchets
doivent fournir l'administration une dclaration annuelle sur la nature, les
quantits et la destination ou l'origine de ces dchets.
Les installations recevant des dchets non dangereux, sauf celles valorisant des
dchets inertes, sont galement soumises lobligation de dclaration.
3.2.4 limination des dchets
3.2.4.1 Les filires
L'limination par stockage tant limite aux dchets ultimes depuis 1
er
juillet 2002, la
valorisation est une tape obligatoire pour la grande majorit des dchets. Plusieurs filires sont
possibles, notamment :
Le recyclage ou la rcupration.
Cette solution est videmment la meilleure mthode dlimination des dchets,
conditions que le cot en soit conomiquement acceptable. Elle est impose pour certains
dchets tels que par exemple les dchets constitus par les emballages, les piles et
accumulateurs, les dchets dquipement lectrique et lectroniques
L'incinration.
L'incinration peut tre avec ou sans rcupration d'nergie, elle peut tre effectue l'extrieur
ou dans l'entreprise, dans le cadre de la lgislation sur les installations classes. Cependant
certains dchets doivent obligatoirement tre incinrs par des entreprises agres.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Au cas o des dchets seraient abandonns, dposs ou traits contrairement aux prescriptions
rglementaires, les pouvoirs publics peuvent en assurer doffice llimination aux frais du
responsable.
Les entreprises qui produisent, importent, exportent, liminent ou qui transportent,
se livrent des oprations de courtage ou de ngoce de certaines catgories de
dchets (dfinies par dcrets) sont tenues de fournir ladministration toutes
informations concernant lorigine, la nature, les caractristiques, les quantits, la
destination et les modalits dlimination, des dchets quelles produisent,
remettent un tiers ou prennent en charge.
Certains producteurs, importateurs ou distributeurs de produits gnrateurs de dchets peuvent
se voir imposer lobligation de pourvoir ou de contribuer llimination des dchets qui en sont
issus.
Les communes assurent llimination des dchets mnagers et assimils dans le cadre de
plans dpartementaux ou interdpartementaux.
Chaque rgion doit tre couverte par un plan rgional ou interrgional dlimination des
dchets industriels spciaux. Le ministre de lenvironnement tablit des plans nationaux
pour certaines catgories de dchets.
Les exploitants dinstallations dlimination de dchets soumises autorisation au titre de
la lgislation sur les installations classes pour la protection de lenvironnement, les
communes et les groupements de communes, les prfets tablissent et tiennent jour des
documents destins linformation du public.
Des Commissions locales dinformation et de surveillance (CLIS) peuvent ou sont
obligatoirement dans certains cas, cres afin de promouvoir linformation du public sur
les problmes poss par la gestion des dchets dans leur zone gographique de
comptence.
3.1.1.3 Les autres rglementations
La collecte, le dpt, llimination des dchets font galement l'objet de
prescriptions dans dautres textes, et notamment dans les codes suivants et les
textes pris ventuellement pour leur application :
le Code gnral des collectivits territoriales (obligations des communes pour la
collecte et limination des dchets mnagers et assimils) ;
le Code de la sant publique (dchets dactivits de soins, rglements sanitaires
dpartementaux et rgles gnrales dhygine prises par dcrets en application
de ce code et qui se substituent peu peu aux rglements sanitaires
dpartementaux) ;
le Code rural (quarrissage) ;
le Code minier (haldes et terrils des mines) ;
le Code de la route (vhicules abandonns) ;
le Code de lurbanisme, le code pnal, le code des impts
3.1.2 Les dfinitions
3.1.2.1 Le dchet
Dans son article L.541-1, Le Code de lenvironnement dfinit le dchet comme
tout rsidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matriau, produit ou plus gnralement tout bien meuble abandonn ou
que son dtenteur destine l'abandon .
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
3.3.2 Les dchets d'incendie
La situation est ici toute diffrente, encore que, nombre de remarques faites
prcdemment puissent encore s'appliquer ici.
3.3.2.1 Les rsidus de produits
Ces rsidus seront en quantits plus importantes, ils auront t mlangs, lors de la
lutte contre l'incendie ou lors de leur rcupration, et ils auront t dnaturs, par
le feu ou par l'eau, ou par raction entre eux.
Ici encore, il sera hautement souhaitable d'agir rapidement pour rpertorier les
produits en cause, de les vacuer pratiquement toujours en centre de traitement
spcialis et de procder au nettoyage du site, ne serait-ce que pour viter un
lessivage ultrieur par les eaux de pluie et les pollutions consquentes possibles.
3.3.2.2 Les eaux d'extinction
Elles constituent souvent un problme majeur de par leur volume et les produits qu'elles
contiennent, qu'il s'agisse des rsidus des produits impliqus dans l'incendie ou des
rsidus des agents extincteurs (poudres alcalines, mulseurs des mousses d'extinction).
Leur traitement sur place, dans le bassin de rtention, sera l'affaire de socits
spcialises. Ici encore, si l'entreprise sinistre est raccorde une importante station
d'puration urbaine, le traitement de ces volumes de liquides trs important sera
grandement facilit.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
4 LA RESPONSABILIT EN MATIRE
D'ENVIRONNEMENT
4.1 La responsabilit civile
Le Code de lenvironnement prvoit la protection des tiers travers deux articles :
larticle L.514-19, qui stipule que Les autorisations sont accordes sous rserve des
droits des tiers . Ce qui signifie que lobtention dune autorisation dexploiter un
tablissement gnrateur de nuisances nexonre pas lexploitant de sa responsabilit
vis--vis des tiers ;
larticle L.514-20, qui prvoit que le vendeur dun terrain sur lequel a t implante une
installation soumise autorisation doit en informer par crit lacheteur, en prcisant,
pour autant quil les connaisse, les dangers et inconvnients importants qui rsultent de
lexploitation.
Il n'existe pas, actuellement, en droit franais, de rgime de responsabilit spcifique
l'environnement et ce sont les principes gnraux de la responsabilit civile qui sappliquent,
bien quils se rvlent dans certaines circonstances peu adapts la rparation des atteintes
l'environnement.
Ces principes sont dicts par les art. 1382, 1383 et 1384 du Code civil :
Article 1382 : Tout fait quelconque de lhomme, qui cause autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arriv, le rparer ;
Article 1383 : Chacun est responsable du dommage quil a caus non seulement par son
fait, mais encore par sa ngligence ou par son imprudence ;
Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que lon cause par
son propre fait, mais encore de celui qui est caus par le fait des personnes dont on
doit rpondre, ou des choses que lon a sous sa garde [...] .
Et aussi, pour ce qui concerne les troubles anormaux de voisinage, par larticle 544 du Code
civil : La proprit est le droit de jouir et disposer des choses de la manire la plus absolue,
pourvu quon nen fasse pas un usage prohib par les lois ou par les rglements .
La directive 2004-35 du 21 avril 2004 sur la responsabilite environnementale en ce qui
concerne la prvision et la rpartition des dommages environnementaux tablit un cadre de
responsabilit environnementale, cest la premire lgislation communautaire compter parmi
ses objectifs principaux l'application du principe du pollueur-payeur.
Elle devra avoir t transpose par les Etats membres au plus tard le 30 avril 2007.
Les fondements actuels de la responsabilit
La mise en jeu de la responsabilit civile suppose la runion de trois conditions :
une faute (non codifie) ;
un dommage (moral, physique ou concernant les biens) ;
un lien de causalit entre la faute et le dommage.
Un dommage caus par une entreprise lair, leau ou au paysage est susceptible de
porter prjudice un individu, une entreprise ou une collectivit.
Illustration
Des fumes peuvent porter atteinte la sant dune ou plusieurs personnes, la pollution dune rivire
rendre celle-ci impropre lusage quen fait une entreprise voisine, des vibrations intempestives faire
rgulirement voler en clats les vitres dun village
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
4.1.1 La faute
Responsabilit civile dlictuelle
La faute, qui est l'vnement l'origine du dommage, peut ou non rsulter dune faute.
En matire dlictuelle, la responsabilit pour faute est fonde sur les articles prcits du
Code civil :
la faute volontaire, vise larticle 1382 ;
la faute involontaire, vise larticle 1383.
La violation d'une rgle n'est pas seule constitutive d'une faute et le juge peut tendre la
faute l'abus de droit, notamment en matire de troubles anormaux de voisinage.
La responsabilit sans faute relve de l'article 1384 du Code civil qui est la responsabilit
du fait des personnes dont on doit rpondre ou des choses que lon a sous sa garde.
Dans ce cas, la victime n'a pas apporter la preuve d'une faute et la responsabilit de
celui qui en a la garde est automatiquement prsume, ds lors quil y a un lien de
cause effet. L'exploitant ne pourra s'exonrer de sa responsabilit qu'en prouvant la
force majeure, le fait d'un tiers ayant concouru la ralisation du dommage, ou l'tat de
ncessit, face un pril grave.
Responsabilit civile contractuelle
La responsabilit civile peut aussi tre engage sur une base contractuelle. Ainsi, sur le
fondement de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu la garantie des vices cachs et
la responsabilit contractuelle du cdant peut tre engage par l'acqureur d'un terrain qui se
rvle contamin. Larticle L.514-20 prcit du Code de lenvironnement prvoit l'obligation
pour le vendeur dinformer par crit lacheteur d'un terrain sur lequel a t exploite une
installation soumise autorisation, quil subsiste ou non des nuisances. A dfaut, l'acheteur
peut demander la rsolution de la vente, se faire restituer une partie du prix ou demander la
remise en tat du site aux frais du vendeur, pour autant que le cot ne parat pas
disproportionn par rapport au prix de vente .
4.1.2 Le dommage
Les dommages dordre environnemental peuvent tre commis au prjudice des
personnes, des biens ou de lenvironnement. Ils peuvent tre de nature matrielle ou
immatrielle.
Si lon visualise facilement les dommages matriels (vibrations prjudiciables la sant
et aux constructions, pollution dune rivire piscicole), les dommages immatriels sont
plus difficiles apprhender. On peut considrer quils ne sont pas susceptibles
d'valuation pcuniaire, mais quils portent atteinte la qualit de la vie : bruits, odeurs,
vibrations, fumes Ces dommages relvent gnralement de la notion de troubles
anormaux du voisinage et les conditions d'anormalit se dfiniront au cas par cas en
fonction du lieu de situation de l'immeuble et, ventuellement, de lantriorit de ceux-ci
par rapport celle de linstallation.
En ce qui concerne lenvironnement lui-mme, ce sont les milieux naturels qui vont subir le
dommage, principalement de manire diffuse et chronique. Souvent, les effets ne sont perus
que longtemps aprs que la pollution ait commenc se produire (appauvrissement de la
couche dozone, effet de serre, pollution des eaux par les nitrates).
Le droit franais n'a pas de rgles spcifiques en matire de responsabilit pour
dommages cologiques, mais lamlioration des connaissances techniques contribue
faire voluer le droit, en particulier au niveau communautaire.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
4.1.3 Le lien de causalit
L'tablissement du lien de causalit, et par l mme, la dtermination du responsable
pose des difficults en matire d'environnement en raison des diffrents types de pollution
pouvant tre incrimins.
Les pollutions sont diverses en fonction de leur origine (pollution de l'eau, de l'air, du sol) et de
leur dure (pollution accidentelle ou rsiduelle).
La pollution accidentelle ou instantane est le rsultat d'une dfaillance du processus
industriel, dune erreur de manutention, non prolonge dans le temps. Pour ce type de
pollution, le lien de causalit sera facile tablir.
La pollution rsiduelle ou continue est une succession dans le temps de petites missions
polluantes qui entranent des dommages rels l'environnement. C'est un tat permanent qui
n'est pas en lui-mme anormal, mais, du fait de sa rptition doit tre rpar. La
dtermination du responsable est souvent plus difficile dans ce type de pollution.
Illustration
Quelques exemples de difficults dans la dtermination du responsable :
Quel sera l'exploitant juridiquement responsable en cas de pluralit de pollueurs, de rvlation
d'une pollution par les travaux d'une personne autre que l'exploitant, ou en l'absence de
responsable ?
Le juge pourra, en cas de multiplicit de pollueurs, appliquer une obligation in solidum c'est--dire
que l'un des responsables aura la charge de la totalit de la rparation sans avoir rechercher le
partage de responsabilit.
En cas de succession d'exploitants sur un mme site, si une pollution inhrente l'activit se rvle
postrieurement la cession, quel sera l'exploitant responsable, l'ancien exploitant ou le nouveau ?
4.2 La responsabilit pnale
La responsabilit pnale correspond aux fautes commises lencontre de la socit.
Des sanctions pnales pour atteintes lenvironnement sont prvues pour un certain
nombre dinfractions fixes par le Code de lenvironnement, le Code rural, le Code de la
sant publique, ou les rglements pris pour leur application. Les lments de ces
infractions sont dfinis de manire prcise, tout comme les peines encourues.
Illustration
Par exemple, larticle L.216-6 du Code de lenvironnement stipule que Le fait de jeter,
dverser ou laisser s'couler [] une ou des substances quelconques dont l'action ou les
ractions entranent [] des effets nuisibles sur la sant ou des dommages la flore ou la
faune [] est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
Autre exemple, la suite de larticle L.216-6 nonce que lorsque lopration de rejet est autorise par
arrt, les dispositions de cet alina ne sappliquent que si les prescriptions de cet arrt ne sont pas
respectes .
Les infractions et les peines encourues par les personnes morales, comme par les personnes
physiques sont fixes de manire prcise.
Ainsi, les lois et rglements dterminent la nature des infractions et leurs limites, les peines
applicables et renvoient au Code pnal pour leurs conditions dapplication, la dtermination
du degr de responsabilit Le Code pnal fixe les principes selon lesquels les
responsabilits sont tablies et les sanctions appliques, et notamment :
Nul ne peut tre puni pour un crime ou pour un dlit dont les lments ne sont pas dfinis par
la loi, ou pour une contravention dont les lments ne sont pas dfinis par le rglement.
Nul ne peut tre puni dune peine qui nest pas prvue par la loi, si linfraction est un
crime ou un dlit, ou par le rglement, si linfraction est une contravention .
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
Trois types dinfractions pnales existent :
les contraventions sont du ressort du tribunal de police ;
les dlits sont sanctionns par le tribunal correctionnel ;
les crimes sont du ressort de la cour dassises.
Une ouverture vers lharmonisation europenne de la rpression pnale des atteintes
lenvironnement a t entame avec la Convention sur la protection de lenvironnement
par le droit pnal du 4 novembre 1998, signe par quelques pays, dont la France,
mais non encore ratifie.
4.2.1 La responsabilit de la personne morale
Le principe de la personnalit des peines : seul lauteur de linfraction peut se voir
condamn pour les problmes lis lenvironnement, il sagit soit dune personne
physique soit dune personne morale.
Article 121-2 du nouveau Code pnal :
Les personnes morales l'exclusion de l'tat sont responsables pnalement selon les
distinctions des articles 121-4 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou reprsentants.
Toutefois, les collectivits territoriales et leurs groupements ne sont responsables pnalement
que des infractions commises dans lexercice dactivits susceptibles de faire lobjet de
conventions de dlgation de service public [].
Les articles 121-4 121-7 dfinissent respectivement : lauteur de linfraction, la tentative
dinfraction, le complice dune infraction.
Les personnes morales peuvent tre poursuivies lorsque les lois et rglements particuliers
ou le Code pnal le prvoient. Les sanctions encourues sont galement spcifiques.
Ces dispositions sont ainsi exprimes :
Les personnes morales peuvent tre dclares pnalement responsables dans les
conditions prvues par larticle 121-2 du Code pnal des infractions dfinies [...] .
Illustration
Par exemple, larticle L.514-18 du Code de lenvironnement : []des infractions dfinies aux
articles L.514-9 et L.514-11.
Et, au mme article : Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 Lamende,
suivant les modalits prvues par larticle 131-18 du code pnal ; 2 Les peines mentionnes au
2 et 9 de larticle 131-39 du mme code .
Les situations suivantes engagent, par exemple, la responsabilit de la personne morale :
lexploitation dune installation classe sans autorisation, en infraction une mesure de
fermeture, de suppression, de suspension ou dinterdiction (L.514-18 et 514-11 du
Code de lenvironnement) ;
le fait de navoir pas pris les mesures ncessaires pour mettre fin la cause datteinte
au milieu aquatique aprs un accident (L.216-12 et 211-5 du Code de
lenvironnement) ;
le fait de dposer, dans des conditions contraires aux dispositions lgislatives, des
dchets gnrateurs de nuisances (L.541-47 et 541-46 du Code de lenvironnement).
Le domaine de responsabilit de la personne morale couvre les infractions aux personnes
et aux biens. Les peines encourues vont de lamende linterruption de lactivit.
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
4.2.2 La responsabilit de la personne physique
Dans les diffrents textes, les infractions susceptibles dtre retenues lencontre
des personnes physiques ne sont pas spcifiquement diffrencies. Toutes les
infractions punissables peuvent leur tre imputes. Le lgislateur prcise, dailleurs,
dans larticle 121-2 du Code pnal que : La responsabilit pnale des personnes
morales nexclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des
mmes faits, sous rserve des dispositions du quatrime alina de larticle 121-3 .
En outre, la personne physique peut tre responsable double titre, dune part, de
son propre fait, et, en sa qualit de dirigeant ou de prpos ayant reu dlgation
de pouvoirs, pour le fait d'autrui.
Par exemple, dans le cas dernirement voqu du dpt de dchets en infraction
aux dispositions lgislatives, larticle L.541-48 du Code de lenvironnement
stipule que larticle L.541-6 est applicable tous ceux qui, chargs un titre
quelconque de la direction, de la gestion ou de ladministration de toute entreprise
ou tablissement, ont sciemment laiss mconnatre par toute personne relevant de
leur autorit ou de leur contrle les dispositions mentionnes audit article .
D'une manire gnrale, on pourra reprocher au dirigeant, un dfaut
dorganisation ou un dfaut de surveillance, gnrateur du dlit de droit commun
(imprudence, ngligence, inattention, maladresse), un manque de formation et/ou
d'information de son personnel, un relchement dans l'exercice de son devoir de
surveillance des hommes et des machines, un dysfonctionnement dans
l'organisation du travail ou l'entretien des dispositifs de scurit.
La responsabilit de la personne physique peut aussi, tre engage sur le
fondement de l'article 121-7 du Code pnal :
Est complice dun crime ou dun dlit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilit la prparation ou la consommation.
Est galement complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
dautorit ou de pouvoir aura particip une infraction ou donn des instructions
pour la commettre .
Illustration
Par exemple, larticle L.581-35 du Code de lenvironnement prvoit : Est puni des mmes
peines que lauteur de linfraction, celui pour le compte duquel la publicit est ralise .
Peuvent galement tre sanctionns les auteurs de dlits ou de contravention non-
intentionnels commis par imprudence ou ngligence, ou encore de manire
indirecte, aux termes de larticle 121-3 du Code pnal (et de l'article R.610-2) :
Il n'y a point de crime ou de dlit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prvoit, il y a dlit en cas de mise en danger dlibre de
la personne d'autrui.
Il y a galement dlit, lorsque la loi le prvoit, en cas de faute dimprudence, de
ngligence ou de manquement une obligation de prudence ou de scurit prvue
par la loi ou le rglement, sil est tabli que lauteur des faits na pas accompli les
diligences normales, compte tenu, le cas chant, de la nature de ses missions ou
de ses fonctions, de ses comptences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prvu par lalina qui prcde, les personnes physiques qui nont pas
caus directement le dommage, mais qui ont cr ou contribu crer la situation
qui a permis la ralisation du dommage ou qui nont pas pris les mesures
permettant de lviter, sont responsables pnalement sil est tabli quelles ont,
Partie 5 Prvenir les risques pour lenvironnement
soit viol de faon manifestement dlibre une obligation particulire de prudence
ou de scurit prvue par la loi ou le rglement, soit commis une faute caractrise
et qui exposait autrui un risque dune particulire gravit quelles ne pouvaient
ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure .
L'article R.610-2 prcise que les dispositions des troisime et quatrime alinas de
l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le rglement
exige une faute d'imprudence ou de ngligence[] .
PARTIE 6
PRVENIR LES RISQUES
SUR UN CHANTIER
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
1 QUI FAIT QUOI SUR UN CHANTIER ?
1.1 Missions et responsabilits des diffrents intervenants
1.1.1 Le matre de l'ouvrage
1.1.2 Matre d'uvre
1.1.3 L'entrepreneur
1.1.4 Les fournisseurs de matriaux
1.1.5 Le coordonnateur scurit
1.1.6 Le contrleur technique
1.2 Le permis de construire
1.3 Les contrles de scurit
1.4 Lassurance dun chantier
1.5 Marchs privs/marchs publics et documents types
2 CHANTIERS DE BTIMENT ET DE GNIE CIVIL :
ORGANISATION ET COORDINATION DE SCURIT
2.1 La dclaration pralable
2.2 La coordination de scurit
2.2.1 Trois catgories de chantiers
2.2.2 Le contrat avec le coordonnateur de scurit
2.2.3 Les missions du coordonnateur de scurit
2.3 Les diffrents plans
2.3.1 Le plan gnral de coordination de la scurit
2.3.1 Le Plan particulier de scurit
2.4 Les autres documents
2.4.1 Le dossier d'intervention ultrieure sur l'ouvrage (DIUO)
2.4.1 Le registre journal
3 LES INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTRIEURES
3.1 Dfinitions
3.2 Obligations de l'entreprise utilisatrice
3.3 Obligations de l'entreprise extrieure
3.4 Les obligations communes et le plan de prvention
3.4.1 L'inspection pralable
3.4.2 L'analyse des risques et le plan de prvention
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
3.5 Les travaux dangereux
3.6 Le permis de feu
3.7 Le travail de nuit ou dans un lieu isol
4 LES MESURES DE SCURIT
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
1 QUI FAIT QUOI SUR UN CHANTIER ?
1.1 Missions et responsabilits
des diffrents intervenants
1.1.1 Le matre de l'ouvrage
La norme NF P 03-001 (marchs privs) dfinit le matre de louvrage comme la
personne physique ou morale pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont
excuts .
La loi 85-704 du 12 Juillet 1985 (modifie) relative la matrise d'ouvrage publique et
ses rapports avec la matrise duvre prive (loi MOP) dfinit le matre de louvrage
public comme : la personne morale pour laquelle louvrage est construit .
Le matre de louvrage peut donc tre :
le simple particulier faisant construire pour son propre compte ;
une socit faisant construire un btiment pour son activit industrielle ou
commerciale ;
une socit de professionnels investissant dans une construction destine la location
ou la revente ultrieure ;
ltat ou une collectivit publique ;
un organisme priv caractre public (Caisse dassurance maladie, Allocations
familiales) ;
un organisme priv dhabitation loyer modr, etc.
Le matre de louvrage est donc le client, celui qui conclut des contrats de louage
douvrage avec les ralisateurs de la construction, tant en ce qui concerne la conception
que lexcution, en dfinissant les fonctions quelle doit remplir (habitation, usine, salle
de spectacle, magasin...) et aprs stre assur de la faisabilit du projet, quil
sagisse dune implantation nouvelle ou dun programme de rhabilitation.
Obligations du matre de l'ouvrage
Le matre de louvrage a l'obligation de fournir les renseignements ncessaires
ltablissement du projet (donnes juridiques, administratives, techniques, financires...). Il
est aussi lhomme-clef des oprations de btiment ou de gnie civil. Il est pnalement
responsable dobligations spcifiquement mises sa charge et qui dpendent
essentiellement du caractre (ouvrage public ou priv), de la nature et de limportance du
chantier. Toutefois, le matre douvrage nengage sa responsabilit que sil est lui-mme
comptent et que cette comptence est notoirement reconnue.
Illustration
Ainsi, quand le matre douvrage est un particulier ou une petite commune ne disposant pas
de services techniques comptents et ne pouvant, de ce fait, faire face ses obligations,
celles-ci peuvent tre dlgues un mandataire, ce dernier tant alors soumis, pour la
passation des contrats avec les divers intervenants la construction, aux rgles qui
simposent au matre de louvrage. Ce dernier nendosse, en ralit, que les responsabilits
le concernant personnellement.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
1.1.2 Matre d'uvre
Le matre duvre est, selon la norme NF P 03-001 (marchs privs), pour la partie
relative au march de travaux, la personne physique ou morale, qui, pour sa
comptence, peut tre charge par le matre de louvrage :
- de lassister pour la consultation des entreprises et pour la conclusion du ou des
marchs avec le ou les entrepreneurs ;
- de diriger lexcution du ou des marchs de travaux ;
- dassister le matre de louvrage pour la rception des ouvrages et le rglement des
comptes avec les entrepreneurs .
La loi MOP (marchs publics) dfinit la matrise duvre comme : une rponse
architecturale, technique et conomique au programme du matre de louvrage .
Le matre duvre est celui qui, gnralement depuis sa conception, mne bonne
fin lexcution de la construction qui doit remplir les fonctions dfinies par le matre de
louvrage.
Mission
La mission minimale du matre duvre, quil sagisse dun ouvrage public ou priv,
dune construction neuve ou dune opration de rhabilitation, est de concevoir et de
raliser la synthse architecturale des objectifs et contraintes du programme et de
sassurer du respect, lors de lexcution de louvrage, des tudes quil a effectues.
Lassistance apporte au matre de louvrage stend la priode de garantie de parfait
achvement. Le matre duvre a donc une obligation de rsultat quant la bonne
ralisation de louvrage.
Le matre duvre se doit, en outre, dinformer son client de toutes les consquences que
telle ou telle instruction pourrait avoir sur la stabilit des ouvrages, leur prennit et leur
scurit. Le matre duvre tant prsum comptent, il ne doit rien ignorer des rgles
de son art et donc, en matire de scurit, de tous les rglements en vigueur. Dune
manire gnrale, il doit contrler le respect des dispositions lgislatives civiles ainsi que
des rgles administratives dans leur acception la plus svre. Il prend en charge les
procdures administratives, notamment celles ncessaires lobtention du permis de
construire, et assiste le matre douvrage au cours de leur instruction.
Qui est le matre duvre ?
Le matre duvre est gnralement un architecte, une socit dingnierie ou un bureau
dtudes. Le recours un architecte nest obligatoire que dans le cadre de la mission lie
au dpt du permis de construire (Loi n 77-2 du 3 janvier 1977), soit llaboration du
projet architectural et la vrification du respect des dispositions de ce projet. Larchitecte
nassure pas obligatoirement la direction des travaux. Pour les oprations prives, le
choix du matre duvre nest assujetti aucun formalisme rglementaire particulier. En
revanche, pour les oprations publiques, la dsignation du matre duvre est
rglemente par le Code des marchs publics pour les matres douvrage qui y sont
soumis et par la loi MOP (et le dcret n 93-1269 du 29 novembre 1993 pris pour son
application) pour les autres.
Responsabilit du matre duvre
Les interventions du matre duvre dans lacte de construire entranent pour lui des
responsabilits diffrentes et distinctes souvent partages solidairement avec les autres
intervenants.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Lexigence de scurit telle que dfinie aux articles 319 et 320 du Code pnal implique
lengagement de la responsabilit du matre duvre en cas daccident, mme aprs
lachvement de la construction. Cette exigence dordre gnral fait lobjet de prcisions
sur divers points particuliers dans les textes relatifs aux rgles de scurit contre les
risques dincendie et de panique. En cas daccident, cest le juge pnal qui dtermine
qui incombe la faute ou la responsabilit.
Par ailleurs, dans le cadre des contrats conclus pour la construction, le matre
duvre est soumis au rgime de la responsabilit contractuelle de droit commun
(article 1147 du Code civil). Cette responsabilit lengage pendant tout le dlai de
garantie de parfait achvement des travaux, et au-del, en cas de faute, notamment
pour les dommages intermdiaires non couverts par les garanties biennale et
dcennale.
En cas de violation des lois et rglements, de ngligence ou dimprudence, la
responsabilit dlictuelle du matre duvre peut tre recherche au titre des articles
1382 et 1383 du Code civil, pendant dix ans, compter de la manifestation du
dommage ou de son aggravation.
1.1.3 L'entrepreneur
Suivant la norme NF P 03-001 relative aux marchs privs, lentrepreneur est la
personne physique ou morale, dsigne par ce terme dans les documents du march, qui
a la charge de raliser les travaux ou ouvrages aux conditions dfinies par ce march .
Dans les documents rglementaires relatifs aux marchs publics, il nexiste aucune
dfinition de lentrepreneur.
Pour les marchs privs, que les contractants soient ou non lis aux termes de la
norme prcite, les entreprises sont libres de contracter individuellement ou de se
grouper pour contracter solidairement un mme march. Le matre douvrage priv
peut galement faire appel un entrepreneur gnral , titulaire dun march
unique qui a pour objet lensemble des travaux concourant la ralisation dun mme
ouvrage .
Aux termes du Cahier des clauses administratives gnrales (CCAG) applicable aux
marchs publics de travaux , les entrepreneurs peuvent se grouper, soit solidairement,
soit conjointement. Dans le premier cas, un mandataire est dsign pour reprsenter
lensemble des entrepreneurs, mais chacun dentre eux sengage pallier une ventuelle
dfaillance de ses partenaires. Dans le second cas, la responsabilit de chacun nest
engage que pour le lot qui lui est assign, le mandataire ou reprsentant tant, lui,
solidaire de chacun lgard du matre de louvrage jusqu une date donne et charg
de la coordination des tches.
Obligations de l'entrepreneur
Outre une obligation de rsultat, lentrepreneur se doit dattirer lattention du matre
duvre sur les consquences ventuelles que sa conception pourrait avoir sur la
stabilit et la scurit de louvrage.
Lentrepreneur est lui-mme garant des manquements et violations aux rgles de scurit
dans la mesure o il sagit de la mise en uvre du matriau lui-mme.
Responsabilit de l'entrepreneur
Comme celle du matre duvre, la responsabilit de lentrepreneur sapprcie, dune
part sur le plan de la responsabilit dcennale (articles 1792 et 2270 du Code civil) et,
dautre part, sur le plan de la responsabilit gnrale contractuelle dont la prescription
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
est de 30 ans. Enfin, il peut tre poursuivi titre pnal pour navoir pas signal des
violations ou manquements aux rgles de scurit dont il aurait pu avoir connaissance.
Afin de se couvrir pour la responsabilit qui lui incombe dans les oprations de btiment
sur le fondement des articles prcits du Code civil, lentrepreneur doit obligatoirement
souscrire un contrat dassurance dit de responsabilit dcennale . Comme pour le
matre duvre, cette obligation comporte une clause dexclusion en cas
dinobservation inexcusable des rgles de lart (Code des assurances, art. A.243-1).
1.1.4 Les fournisseurs de matriaux
Les fournisseurs de matriaux, aux termes des articles 1641 et suivants du Code Civil,
sont responsables des vices cachs des matriaux quils fournissent.
Ils sont tenus responsables des consquences dommageables que lemploi de ces
matriaux, mme correctement fabriqus, peut entraner, notamment sur le plan de la
scurit incendie, dans la mesure o les limites demploi de ces matriaux nont pas t
clairement signifies sur les notices publicitaires, particulirement pour ce qui concerne
leur utilisation dans les IGH (Immeubles de grande hauteur) ou les ERP (tablissements
recevant du public).
La responsabilit dun fabricant peut galement tre engage sil a prconis lemploi
dun produit dtermin en connaissant lusage qui allait en tre fait, alors que ce produit
savre inadapt cet usage.
Sont assimils aux fabricants les importateurs et les revendeurs qui apposent leur propre
marque sur les matriaux ou lments dquipement.
Les lments de construction conformes une norme ou bnficiant dune certification
peuvent dgager le fabricant de cette responsabilit.
Une obligation dinformation incombe galement au revendeur de
matriaux.
Les produits susceptibles dentraner la responsabilit solidaire des fabricants, dans
certaines conditions, sont essentiellement les biens conus et produits pour satisfaire, en
tat de service, des exigences prcises et dtermines lavance . Ceux-ci, dsigns
sous le terme EPERS (lments Pouvant Entraner la Responsabilit Solidaire des
fabricants et importateurs douvrages ou parties douvrages) engagent le fabricant ou
limportateur aux mmes responsabilit dcennale et garantie biennale de bon
fonctionnement que le constructeur, dans la mesure o la mise en uvre de la fourniture
a t faite sans modification par lentrepreneur et conformment aux rgles dictes par
le fabricant.
1.1.5 Le coordonnateur scurit
Dans certains cas, le matre douvrage a lobligation de sadjoindre le concours de
partenaires chargs de tches prcisment dfinies par la rglementation.
Cest le cas du coordonnateur scurit dont la mission est de prvenir les risques lis
la co-activit entre les diffrentes entreprises intervenant sur le chantier afin dassurer la
scurit de tous (voir chapitre 2.2 ).
Lobligation de dsigner un coordinateur de scurit est rglemente par les dcrets du
20 fvrier 1992 et du 26 dcembre 1994.
La dsignation dun coordonnateur est obligatoire ds lors quun chantier est soumis
dclaration pralable (plus de 30 jours ouvrs et plus de 20 travailleurs simultanment
ou non ou lorsque le volume des travaux excde 500 hommes-jours) ou quil fait
intervenir au moins deux entreprises ou travailleurs indpendants.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Ces obligations sont rsumes dans le tableau suivant :
La coordination en cas dintervention
dentreprises extrieures sur un chantier
Btiment et gnie civil Autres activits
Conditions : 20 travailleurs et 30 jours ouvrs
ou 500 hommes/jours
1 ou plusieurs entreprises
Conditions non remplies Conditions remplies
1 seule entreprise
Plus de 1 entreprise
ou
Travaux risques
particuliers
Dcret de 1992 Dcret de 1994 Dcret de 1994
Le coordinateur
na pas besoin
de comptences
particulires
Le coordinateur doit
tre diplm.
Plan de prvention
obligatoire
Le coordinateur doit
tre diplm
Obligation de
dclaration pralable
PGCSPS obligatoire
PPSPS obligatoire
Le coordinateur
na pas besoin
de comptences
particulires
Plan de prvention
obligatoire
PGCSPS : plan gnral de coordination en matire de scurit et de protection de la sant
PPSPS : plan particulier de scurit et de protection de sant
Le coordonnateur opre sous la responsabilit du matre de louvrage. Il ne participe pas
lopration de construction proprement dite.
Son rle est de :
viter les risques ;
raliser lvaluation des risques invitables ;
lutter contre les risques leur origine ;
prendre en compte des volutions techniques ;
substituer ce qui nest pas ou ce qui est moins dangereux ce qui est dangereux ;
organiser la prvention de telle sorte quelle intgre la technique, lorganisation du
travail, les conditions de travail, les relations de travail et linfluence des facteurs
ambiants ;
adopter des mesures de scurit collective en leur donnant la priorit sur les mesures
de protection individuelles.
Le coordinateur de scurit doit effectuer la vrification personnelle du respect et de
lapplication des dispositions destines la scurit et la protection de la sant. Il doit
garantir que les dispositions prises fonctionnent bien.
1.1.6 Le contrleur technique
Le recours un contrleur technique est obligatoire pour les tablissements recevant du
public des 1
re
, 2
e
et 3
e
catgories, les immeubles de grande hauteur et certains btiments
autres quindustriels prsentant une difficult technique (dcret n 78-1146 du 7
dcembre 1978).
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Dans le cadre dune opration de btiment et de gnie civil, ce doit tre une personne
distincte du coordinateur.
Pour les marchs privs, sa dsignation nest soumise aucun formalisme ; pour les
marchs publics, la procdure de dsignation est fixe par la rglementation.
Mission du contrleur technique
Le contrleur technique a pour mission de prvenir les alas de la construction ;
il donne au matre de louvrage son avis sur les problmes dordre technique,
notamment sur les problmes concernant la solidit de louvrage et la scurit des
personnes quant lapplication des dispositions rglementaires applicables aux
ouvrages et quipements pendant leur phase de construction et jusqu la rception
des travaux. A ce titre, il est soumis la prsomption de responsabilit
dcennale, mais seulement dans la limite de la mission lui confie par le matre
de louvrage (article L.111.24 du CCH). Le matre douvrage qui ne tiendrait pas
compte des avis mis par un contrleur technique risquerait de voir sa
responsabilit engage avec celle des constructeurs.
1.2 Le permis de construire
Tout projet de construction, exception faite de certains travaux de nature particulire ou
de faible importance, ncessite lobtention dun permis de construire (article L.421-1 du
Code de lUrbanisme).
La demande doit en tre faite auprs du maire de la commune sur laquelle les travaux
doivent tre raliss.
Dune manire gnrale, le permis de construire est lacte administratif par lequel
les pouvoirs publics sassurent que le projet de construction sinscrit dans le cadre
des rgles durbanisme et obit aux rgles damnagement de la zone dans
laquelle il doit tre ralis (essentiellement les dispositions du Plan dOccupation
des Sols ou POS). Ainsi, lobtention pralable dun certificat durbanisme peut tre
rendue obligatoire, notamment en cas de division parcellaire. Le permis de
construire ne sanctionne pas les rgles de construction et ne constitue pas un
laisser-passer pour ce qui concerne les rgles de scurit. Toutefois, dans certains
cas, la demande de permis de construire doit tre accompagne de documents
complmentaires destins un contrle a priori du respect de la rglementation.
Les cas particuliers
Les IGH et les ERP
Dans les cas des immeubles de grande hauteur (IGH) et des tablissements
recevant du public autres que ceux de la 5
e
catgorie (ERP), la dlivrance du permis
de construire ou de toute autorisation de modification dun immeuble existant
ncessite a priori un contrle du respect des rgles de scurit. Ce contrle est
effectu par les Commissions de scurit existant dans le cadre de la Commission
Consultative Dpartementale de Scurit et dAccessibilit (CCDSA, dont le rle est
dfini par le dcret n 95-260 du 8 mars 1995). Les plans et documents
ncessaires au contrle sont joints la demande de permis de construire. La
Commission met un avis, favorable ou dfavorable, auprs de lautorit de police
(prfet ou maire). Dans ce cas particulier, comme dans le cas dune demande de
drogation au rglement de scurit, cet avis lie lautorit dlivrant le permis de
construire (art. 2 du dcret et art. L.421-3 du code de lurbanisme et L.123-1 du
CCH).
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Les ICPE
Dans le cas des installations classes pour la protection de lenvironnement (ICPE), la
demande dautorisation ou la dclaration doit tre adresse par lexploitant en mme
temps que sa demande de permis de construire, les deux dmarches tant toutefois
distinctes, lune des deux autorisations pouvant tre accorde et lautre refuse. La
demande de permis de construire, adresse au maire de la commune, doit tre
accompagne du justificatif du dpt de la demande dautorisation ou de la dclaration.
La demande dautorisation ou la dclaration sadresse la prfecture du dpartement
concern, au service des installations classes. Si linstallation est soumise autorisation,
lexploitant doit fournir un justificatif de sa demande de permis de construire. Celui-ci ne
peut tre accord avant la fin de lenqute publique lorsquil doit y en avoir une.
Des formalits complmentaires sont galement demandes dans des cas particuliers,
notamment : constructions commerciales importantes, logements collectifs, lieux de
travail, locaux spcifiques en rgion le-de-France, travaux ncessitant la dmolition dun
btiment ou labattage darbres...
La demande de permis de construire est toujours adresse au maire de la commune dans
laquelle la construction est envisage, mais donne lieu, si ncessaire, consultations auprs
des services ou commissions intresses par le projet pour accords ou avis prvus par la
rglementation. Suivant les cas, le permis est dlivr par le maire ou le prfet.
1.3 Les contrles de scurit
Cas des ERP
En cours de travaux, les tablissements recevant du public doivent faire lobjet de
vrifications prvues au Rglement de scurit pour ce qui concerne les installations
techniques (sauf ERP de 5
e
catgorie ne comportant pas de locaux sommeil). Des
contrles administratifs peuvent tre galement effectus sur le chantier par la
Commission de scurit la demande du maire ou du prfet. A lachvement des
travaux, lors du dpt en mairie de la demande douverture, la commission de scurit
procde une visite de rception (sauf ERP 5 catgorie).
Cas des IGH
Pour les immeubles de grande hauteur, une vrification aura lieu avant occupation, au niveau
national par une commission technique interministrielle des IGH, ou bien au niveau local par
la Commission Consultative Dpartementale de Scurit et dAccessibilit (CCDSA). Le service
instructeur sassure que les travaux ont t raliss conformment au permis de construire.
Dans certains cas, pour les ERP et les IGH, le contrle est effectu en liaison avec le directeur
dpartemental des services dincendie et de secours (DDSIS).
Les contrles exercs par les commissions de scurit ne dgagent pas les constructeurs
et installateurs des responsabilits qui leur incombent personnellement.
1.4 Lassurance dun chantier
Lassurance dommage-ouvrage du matre douvrage
Avant louverture du chantier, le matre de louvrage a lobligation (CCH, art. L.111-30),
sauf cas particuliers, de souscrire ou de faire souscrire, une assurance dite de
dommage-ouvrage garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilits, le
paiement des travaux de rparation des dommages (au sens de larticle 1792-1 du
Code civil, cest--dire les dsordres de nature dcennale ).
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Cette assurance permet que les dommages soient immdiatement rpars, avant que
lon ait se proccuper de recherches de responsabilits.
Les cas particuliers dexemption concernent les personnes morales de droit public et les
personnes morales prives justifiant dune surface financire (art. L 111-6 du Code des
Assurances) lorsque ces personnes font raliser pour leur compte des travaux de
btiments autres que dhabitation.
Le matre douvrage a la facult de souscrire une police unique de chantier qui couvre, par
le biais dun contrat unique, lassurance de dommage-ouvrage et la responsabilit de
lensemble des constructeurs.
Lassurance de responsabilit dcennale du matre duvre
Pour couvrir une partie de ces responsabilits, et afin de garantir le remboursement des
travaux de rparation, le matre duvre a lobligation de souscrire une assurance de
responsabilit, celle-ci tant communment dsigne sous le terme de responsabilit
civile dcennale (Art. L. 111-28 du CCH).
Cette couverture implique lobligation du respect des rgles de lart, telles quelles sont
dfinies par les rglementations en vigueur, les documents techniques unifis ou les
normes tablies par les organismes comptents (Art. A.243-1 du Code des assurances).
1.5 Marchs privs/marchs publics et documents types
Le matre de louvrage priv relevant du secteur libre nest soumis quau rgime du droit
commun. En labsence de rglementation spcifique, le matre de louvrage de droit
priv dispose dun cahier des clauses types , objet de la norme NF P 03-001
Marchs privs Cahiers types - Cahier des clauses administratives gnrales
applicable aux travaux de btiment faisant lobjet de marchs privs . Il peut galement
se rfrer, sil le souhaite aux documents types mis la disposition des matres
douvrages publics.
Sil appartient au secteur priv rglement (cas, notamment, des organismes dHLM du
secteur priv, des organismes de scurit sociale et des socits dconomie mixte), le
matre de louvrage peut tre soumis des rgles de passation de marchs ou la loi
MOP pour des oprations qui font appel des fonds dorigine publique.
Sont soumis au Code des marchs publics et la loi MOP pratiquement tous les
tablissements et organismes caractre public, notamment : ltat et ses tablissements
publics autres que ceux caractre industriel et commercial, les collectivits territoriales
et leurs tablissements publics, les groupements de collectivits locales, les syndicats
mixtes...
Pour les marchs publics, la rglementation propose aux matres douvrage divers
documents types permettant de constituer les dossiers de consultation dentreprises. Elle
propose, en particulier, en en conseillant fortement lutilisation, des cahiers des
charges dterminant les conditions dans lesquelles les marchs sont excuts. Il existe
ainsi :
des documents gnraux qui sont les Cahiers des clauses administratives gnrales
(CCAG) applicables aux marchs publics (concernant respectivement les travaux, les
fournitures courantes et services, les marchs industriels et les prestations
intellectuelles) ;
les Cahiers des clauses techniques gnrales ;
et des documents particuliers qui sont les Cahiers des clauses administratives
particulires et les Cahiers des clauses techniques particulires .
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Ces documents sappliquent aussi bien aux marchs de ltat qu ceux des collectivits
locales et de leurs tablissements publics qui sy rfrent (ils sont dits par lImprimerie
Nationale).
Pour les oprations confies par un matre douvrage public une personne ou un
groupement de personnes de droit priv, la mission de matrise duvre est dfinie par le
dcret n 93-1268 du 29 novembre 1993, complt par larrt du 21 dcembre 1993
(dcret pris pour application des articles 7, 8, 9 et 10 de la loi MOP). Suivant la nature
de louvrage, cette mission sera plus ou moins complexe et assortie ou non de missions
complmentaires ou spcifiques. Des procdures particulires sappliquent lorsque le
matre douvrage est soumis de surcrot au Code des marchs publics.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
2 ORGANISATION ET COORDINATION DE SCURIT
DANS LE BTIMENT ET LE GNIE CIVIL
Le lgislateur distingue deux types de chantiers rgis par des dispositions rglementaires
diffrentes. Schmatiquement, on distingue :
les chantiers de travaux effectus dans un tablissement par une ou plusieurs entreprise(s)
extrieure(s) (sujet trait dans le chapitre 3 ) ;
les chantiers ou oprations de btiment ou de gnie civil qui constituent dans la pratique des
chantiers clos et indpendants (objets de ce chapitre).
Les oprations de btiments et de gnie civil sont soumises aux dispositions du code du Travail,
Livre II, Titre 3, Chapitre 8 (articles R. 238) : "Dispositions particulires relatives la
coordination pour certaines oprations de btiment ou de gnie civil".
2.1 La dclaration pralable
Le matre d'ouvrage doit dclarer pralablement ses oprations de btiment ou de gnie civil
l'inspection du travail, l'OPPBTP et la Cram, si :
sa dure est suprieure 30 jours et l'effectif suprieur 20 salaris un moment
quelconque ;
ou le volume est suprieur 500 hommes-jours.
Le calcul des hommes-jours
Il s'agit de multiplier d'effectif moyen des salaris du chantier, tous lots confondus, par le
nombre de jour de travail sur un mois et par le nombre de mois de chantiers :
effectif/jour x nombre de jours x nombre de mois
2.2 La coordination de scurit
Si plusieurs travailleurs indpendants ou entreprises interviennent sur le chantier, dans sa
conception et sa ralisation, alors, il doit tre prvu une coordination pour :
prvenir les risques engendrs par la co-activit des intervenants et leur succession ;
mettre en commun les moyens.
Le matre d'ouvrage qui dsigne le coordonnateur en matire de scurit et de protection de la
sant.
Le coordonnateur de scurit n'est pas un contrleur technique.
La coordination en cas dintervention dentreprises extrieures sur un chantier
Btiment et gnie civil Autres activits
Conditions : 20 travailleurs et 30 jours ouvrs ou 500 hommes/jours 1 ou plusieurs entreprises
Conditions non remplies Conditions remplies
1 seule entreprise
Plus de 1 entreprise ou
Travaux risques particuliers
Dcret de 1992 Dcret de 1994 Dcret de 1994
Le coordinateur
na pas besoin de
comptences
particulires
Le coordinateur doit tre
diplm.
Plan de prvention
obligatoire
Le coordinateur doit tre diplm
Obligation de dclaration
pralable
PGCSPS obligatoire
PPSPS obligatoire
Le coordinateur na pas
besoin de comptences
particulires
Plan de prvention
obligatoire
PGCSPS : plan gnral de coordination en matire de scurit et de protection de la sant
PPSPS : plan particulier de scurit et de protection de sant
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Dbut de l'opration
Plan de prvention crit
obligatoire
Information par crit l'inspection du travail de
l'ouverture des travaux
Information des salaris
Inspection pralable commune et analyse
des risques
- Travaux dangereux ?
- Opration > 400h ?
Projet d'intervention d'une ou
plusieurs EE
- Chantier clos et indpendant ?
- Rparation navale ?
tablissement d'un plan de prvention
(selon les articles R.237-1 R.237-28
du Code du travail)
Donnes pralables l'opration :
- information de lEU par EE
- par crit
Convocation l'inspection pralable par lEU des reprsentants :
- de lEE
- des entreprises sous-traitantes
Invitation des membres du CHSCT de lEE et de lEU
Non concern par les articles
R.237-1 R.237-28 du
Code du travail
NON
OUI
NON
OUI
Plan de prvention
simplifi
(1)
Existence de risques
interfrents
NON
Dbut de l'opration
Dfinition des mesures de
prvention
OUI
- Travaux dangereux ?
- Opration > 400h ?
NON
OUI
PV relatif
linspection
pralable
(1)
La mise en uvre dun plan de prvention simplifi pour les oprations de moins de 400 h ou ne comportant pas de travaux dangereux
nest pas une obligation rglementaire
Logigramme rsumant les tapes pralables au dbut de lopration
Source : CNPP
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
2.2.1 Trois catgories de chantiers
Les oprations de btiment et de gnie civil sont classes en trois catgories (article R. 238-8) :
1
re
catgorie : oprations soumises l'obligation de constituer un collge interentreprises
de scurit, de sant et des conditions de travail ;
2
e
catgorie : oprations soumises l'obligation d'tablir un plan gnral de coordination
en matire de scurit et de protection de la sant ;
3
e
catgorie : autres oprations.
Les coordonnateurs n'ont pas les mmes niveaux de comptence. C'est l'organisme de
formation qui dlivre une attestation de comptence permettant au coordonnateur
d'intervenir sur des oprations de catgorie 1, 2 ou 3 :
Les trois niveaux de comptence du coordonnateur sont (art. R. 238-9) :
niveau 1 : aptitude coordonner toutes oprations ;
niveau 2 : aptitude coordonner les oprations des 2
e
et 3
e
catgories ;
niveau 3 : aptitude coordonner les oprations de la 3
e
catgorie.
Pour ce qui concerne les oprations de la 1
re
et de la 2
e
catgorie, l'aptitude
coordonner est distincte pour la phase de conception, d'tude et d'laboration du
projet et pour la phase de ralisation de l'ouvrage.
2.2.2 Le contrat avec le coordonnateur de scurit
Le contrat doit prciser :
le contenu de la mission ;
les moyens, notamment financiers ;
l'autorit vis--vis des intervenants ;
les modalits de prsence sur le chantier, et aux runions.
2.2.3 Les missions du coordonnateur de scurit
Les missions du coordonnateur en matire de scurit et de protection
de la sant sont fixes l'article R. 238-16.
Sous la responsabilit du matre d'ouvrage, le coordonnateur :
veille ce que les principes gnraux de prvention (L230.2 ) soient mis en uvre ;
coordonne la conception, l'tude et l'laboration du projet ;
coordonne la ralisation ;
tient compte des interfrences avec les activits d'exploitation sur le site ;
prside le CISSCT (collge interentreprises de la scurit, de la sant et des conditions de
travail) ;
prend les dispositions pour que seules les personnes autorises puissent accder au chantier.
Les missions de conception
laboration du plan gnral de coordination ;
constitution du dossier d'intervention ultrieure sur l'ouvrage ;
ouverture du registre-journal de la coordination ;
dfinition des sujtions affrentes la mise en place et l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accs, des installations gnrales et
mentionne dans les pices crites leur rpartition entre les entreprises ;
passage des consignes au coordonnateur de ralisation.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Les missions de ralisation
organiser entre les entreprises :
- la coordination de leurs activits simultanes ou successives ;
- les modalits d'utilisation en commun des installations, matriels et circulations ;
- leur information mutuelle, ainsi que l'change entre elles de consignes ;
procder avec chaque entreprise, avant remise du Plan particulier (PPSPS) une
inspection commune du chantier ;
veiller l'application des mesures de coordination ;
tenir jour le plan gnral de coordination ;
complter le dossier d'intervention ultrieure sur l'ouvrage.
Le collge interentreprises de scurit
Il s'agit du CISSCT, collge interentreprises de la scurit, de la sant et des conditions
de travail.
Il est constitu au plus tard 21 jours avant le dbut des travaux par le matre d'ouvrage si
le volume de travaux est suprieur 10.00 hommes-jours et si plus de 10 entreprises en
btiment ou plus de 5 entreprises en gnie civil interviennent (article R. 238-46).
Il est prsid par le coordonnateur ralisation .
2.3 Les diffrents plans
2.3.1 Le plan gnral de coordination de la scurit
Il s'agit du PGCSPS, plan gnral de coordination de la scurit et de la protection de la
sant.
Il est obligatoire et tabli par le coordonnateur si :
il y a eu dclaration pralable au chantier ;
il existe des risques particuliers.
Le plan gnral de coordination est remis par le matre d'ouvrage aux entrepreneurs. Il
nonce :
les renseignements administratifs ;
les mesures d'organisation gnrale arrte par le matre d'uvre ;
les mesures de coordination prises par le coordonnateur :
- les voies ou zones de circulation,
- les conditions de manutention des matriaux et matriels (limitation du recours aux
manutentions manuelles),
- les zones de stockage (dlimitation, amnagement),
- le stockage, l'limination, l'vacuation des dchets et dcombres,
- l'enlvement des matriaux dangereux utiliss,
- l'utilisation des protections collectives, des accs provisoires, des nergies,
- les dispositions en matire d'interactions sur le site.
les sujtions dues l'exploitation du site,
les mesures prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en tat de
salubrit,
les renseignements pratiques concernant les secours,
les modalits de coopration entre les entrepreneurs,
les missions du CISSCT.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
2.3.2 Le plan particulier de scurit
L'entrepreneur (sous-traitant inclus) dispose de 30 jours ds la rception du contrat pour tablir
le plan. Il conservera ce plan pendant 5 ans.
Il s'agit du PPSPS, Plan particulier de scurit et de protection de la sant dfini aux
articles L235-6 et L235-7. Il est ralis par l'entrepreneur. Un exemplaire est en
permanence sur le chantier.
Lentrepreneur doit obligatoirement le fournir :
au coordonnateur, si plusieurs entreprises interviennent et si elles interviennent
plus de 30 jours avec un effectif suprieur 20 un moment quelconque ou
dans le cas d'un volume suprieur 500 hommes-jours ;
au matre d'ouvrage si une seule entreprise intervient pour une dure de travaux
suprieure 1 an et 50 salaris pendant plus de 10 jours.
Le plan mentionne les mesures prises pour prvenir les risques :
gnrs par le chantier et son environnement ;
gnrs par les autres entreprises ;
gnrs par l'activit de l'entreprise sur les salaris et sur les salaris des autres
intervenants.
Les mesures prises pour prvenir les risques incluent :
l'analyse dtaille des procds de construction et les modes opratoires ;
les risques prvisibles lis :
- aux modes opratoires,
- aux matriels,
- aux dispositifs et installations,
- l'utilisation de substances ou prparations,
- aux dplacements du personnel,
- l'organisation du chantier ;
les conditions du contrle de l'application des mesures ;
les mesures prises pour assurer la continuit des solutions de protection collective.
Le PPSPS du gros-uvre ou du lot principal, ainsi que ceux correspondant des
travaux prsentant des risques particuliers sont adresss (avec les avis du mdecin du
travail, du CHSCT et des dlgus du personnel) :
par l'entrepreneur l'Inspection du travail la Cram et l'OPPBTP ;
par le coordonnateur aux autres entreprises.
Modle de plan particulier de scurit (PPSPS)
Nous prsentons un exemple de PPSPS la page suivante.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Modle de Plan particulier de scurit (PPSPS)
Opration :
Adresse du chantier :
Renseignements gnraux
Nom de l'entreprise :
Adresse :
Tlphone et fax :
Dsignation lot et n :
Conducteur de travaux :
Responsable de chantier :
Dbut des travaux :
Fin des travaux :
Effectifs du chantier :
Horaires du chantier :
Installations du chantier
Les locaux suivants sont mis disposition par :
et sont quips par :
Vestiaires :
Rfectoire :
Sanitaires :
Stockage :
Protection incendie :
Nature des travaux
Lot n :
Descriptif des travaux :
Sous-traitance (entreprises et travaux) :
Installation lectrique provisoire du chantier
- Installations lectriques provisoires effectues par le lot :
- clairage du chantier effectu par le lot :
Vrification des installations effectue par organisme agr et procs-verbal laiss sur place.
Mode opratoire
Phases
Droulement des tches
Moyens de
construction
Risques propres Risques exports
Moyens de
prvention
(aussi long que ncessaire)
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Protections individuelles des salaris
Fournies par l'entreprise :
(citer les quipements)
Dplacements du personnel
(indiquer le moyen de transport utilis par votre personnel et le cheminement suivre pour atteindre le site de
l'opration)
Liste des documents conservs sur le chantier
- Registres des contrles
- Registres de l'inspection du travail
- Registre d'observations
- Dcret du 8 janvier 1965
Liste des documents afficher dans les vestiaires
- Horaires de travail
- Consignes En cas d'accident
- Rglement intrieur de l'entreprise
- Avis de consultation des conventions collectives,
- Nom et coordonnes des membres du CHSCT
Premiers secours
Bote pharmacie sur le chantier
Secouristes : prvoir dans l'quipe de travail
Consignes en cas d'accident
- Ne pas toucher au bless, selon la nature des blessures ventuelles.
- Aviser le service des pompiers ou de secours implant sur le chantier.
- Rassembler les effets personnels.
- Baliser la zone conduisant l'endroit o se trouve le bless.
- Attendre les services de secours l'entre du chantier et les conduire l'endroit o se trouve le bless.
- Aviser l'entreprise.
- Accompagner le bless l'hpital.
Intervention/secours/prvention
- Hpital :
- Pompiers : 18
- Police : 17
- Samu : 15
Organismes de prvention
Inspection du travail :
Cram :
OPPBTP :
Mdecine du travail :
Intervenants
Matrise d'ouvrage :
Matrise d'uvre :
Coordonnateur scurit/sant :
Fait :
Le :
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
2.3 Les autres documents
2.3.1 Le dossier d'intervention ultrieure sur l'ouvrage (DIUO)
Il s'agit d'un document ayant pour objectif essentiel de faciliter l'entretien et la
maintenance d'un ouvrage.
Prvu l'article L 235-15, il rassemble, sous bordereau, tous les documents tels que les
plans et notes techniques de nature faciliter l'intervention ultrieure sur l'ouvrage
(R. 238-37).
Il est constitu ds la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la
responsabilit et transmis au coordonnateur charg de la phase de ralisation des travaux
lorsque celui-ci est diffrent.
Le DIUO doit ainsi contenir :
une notice descriptive des oprations de maintenance faisant la synthse des principes
retenus par les concepteurs ;
la liste de tous les documents jour, disponibles dans le dossier des ouvrages
excuts ;
des documents de synthse tablis spcialement pour la maintenance courante (plan
de masse avec indication des risques lis l'environnement, schma des installations
techniques, plans des verrires, faux-plafonds, plans de circulation des engins et des
personnes, etc.) ;
les procdures de travail classes par localisation ou corps de mtiers.
2.3.2 Le registre journal
Dans de registre, le coordonnateur doit consigner (article R. 238-19) :
les comptes rendus des inspections communes, les consignes transmettre et les
observations particulires ;
les observations ou notifications qu'il peut juger ncessaire de faire au matre
d'ouvrage, au matre d'uvre ou tout autre intervenant sur
le chantier, qu'il faut faire viser dans chaque cas par le ou les intresss avec leur
rponse ventuelle ;
ds qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de
chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prvisible des travailleurs
affects au chantier et la dure d'intervention sur le chantier tenue jour ;
le procs-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appel lui
succder.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
3 LES INTERVENTIONS
DES ENTREPRISES EXTRIEURES
Le lgislateur distingue deux types de chantiers rgis par des dispositions
rglementaires diffrentes. Schmatiquement, on distingue :
les chantiers ou oprations de btiment ou de gnie civil qui constituent dans la
pratique des chantiers clos et indpendants (objets du chapitre 9.2 ) ;
les chantiers de travaux effectus dans un tablissement par une ou plusieurs
entreprise extrieure(s) (objets de ce chapitre).
Le chapitre 7 du Titre 3 du Livre II du code du Travail concerne les prescriptions
particulires d'hygine et de scurit applicables aux travaux effectus dans un
tablissement par une entreprise extrieure (articles R. 237).
Les dispositions du chapitre 7 ne s'appliquent pas aux chantiers de btiments et de
gnie civil ni aux chantiers cols et indpendants (chapitre 8 du code du Travail).
La circulaire du 10 avril 1996 relative la coordination sur les chantiers de
btiment et de gnie civil rappelle les champs d'application du chapitre 7
Prescriptions particulires d'hygine et de scurit applicables aux travaux
effectus dans tablissement par une entreprise extrieure d'une part et du
chapitre 8 Dispositions particulires relatives la coordination pour certaines
oprations de btiment ou de gnie civil d'autre part.
3.1 Dfinitions
L'entreprise extrieure
Il s'agit d'une entreprise faisant intervenir son personnel aux fins d'excuter une opration
ou de participer l'excution d'une opration, quelle que soit sa nature, industrielle ou
non, dans un tablissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dpendances
ou chantiers.
Cette entreprise est juridiquement indpendante de l'entreprise utilisatrice.
L'entreprise extrieure est l'entreprise intervenante laquelle l'entreprise utilisatrice a fait
appel directement et aussi son ou ses sous-traitants.
L'entreprise utilisatrice
Il s'agit de l'entreprise d'accueil o une opration est effectue par du personnel
appartenant d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas compltement sous sa
direction, qu'il y ait ou non une relation contractuelle avec les entreprises extrieures
intervenantes ou sous-traitantes.
Opration
Daprs la circulaires DRT n96-5 du 10 avril 1996, une oppration est constitue par
un ensemble de travaux assurs par plusieurs entreprises en vue de concourir un mme
objet. Elle suppose donc une suite ordonne dactes prparatoires antrieurs la
ralisation de louvrage .
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
3.2 Obligations de l'entreprise utilisatrice
Selon l'article R. 237-2, le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination
gnrale des mesures de prvention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des
chefs des entreprises intervenant dans son tablissement. Chaque chef d'entreprise est
responsable de l'application des mesures de prvention ncessaires la protection de
son personnel.
Cette coordination gnrale a pour objet de prvenir les risques lis l'interfrence entre
les activits, les installations et matriels des diffrentes entreprises prsentes sur un
mme lieu de travail.
Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu
d'alerter le chef de l'entreprise extrieure concerne lorsqu'il est inform d'un danger
grave concernant un des salaris de cette entreprise, mme s'il estime que la cause du
danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prvention
ncessaires puissent tre prises par le ou les employeurs concerns .
3.3 Obligations de l'entreprise extrieure
Ces entreprises ont des obligations d'information (art. R. 237-4) :
Les chefs d'entreprises extrieures doivent faire connatre par crit l'entreprise utilisatrice :
- la date de leur arrive,
- la dure prvisible de leur intervention,
- le nombre prvisible de salaris affects,
- le nom et la qualification de la personne charge de diriger l'intervention.
Ils sont galement tenus de lui faire connatre les noms et rfrences de leurs sous-
traitants, le plus tt possible et en tout tat de cause avant le dbut des travaux dvolus
ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traits .
Ces informations seront tenues la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du
service de prvention de la caisse rgionale d'assurance maladie ou des caisses de
mutualit sociale agricoles, des mdecins du travail comptents, du comit d'hygine, de
scurit et des conditions de travail comptent et, le cas chant, des agents de
l'organisme professionnel de prvention du btiment et des travaux publics.
Les chefs des entreprises intervenantes sont responsables de l'application des mesures de
prvention ncessaires la protection de leur personnel. Ils sont aussi responsables en
matire de coordination : ils ont le devoir d'interpeller le chef de l'entreprise utilisatrice
sur l'tablissement d'un plan de coordination et de circulation.
3.4 Les obligations communes et le plan de prvention
3.4.1 L'inspection pralable
Les obligations communes des chefs des entreprises intervenantes et utilisatrices
concernent des mesures pralables l'excution de l'opration et, notamment,
l'inspection commune des lieux de travail.
Au cours de cette inspection (article R. 237-6), le chef de l'entreprise utilisatrice dlimite
le secteur de l'intervention des entreprises extrieures, matrialise les zones de ce secteur
qui peuvent prsenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation
que pourront emprunter ce personnel ainsi que les vhicules et engins de toute nature
appartenant aux entreprises extrieures. Les voies d'accs du personnel de ces entreprises
aux locaux et installations sont galement dfinies.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Il [le chef de l'entreprise utilisatrice] communique aux chefs des entreprises
extrieures ses consignes de scurit applicables l'opration qui concerneront les
salaris de leurs entreprises l'occasion de leur travail ou de leurs dplacements
(article R. 237-6).
Ces consignes doivent attirer l'attention sur les risques inhrents l'activit de l'entreprise
utilisatrice.
Ces risques dpendent :
des conditions d'exploitation et des procds de fabrication,
des sources d'nergie,
des matires premires ou finies,
des conditions d'ambiance,
des machines,
de l'outillage,
des engins de levage et de manutention,
des zones risques particuliers.
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations ncessaires la prvention,
notamment la description des travaux effectuer, des matriels utiliss et des modes opratoires
ds lors qu'ils ont une incidence sur l'hygine et la scurit (article R. 237-6).
3.4.2 L'analyse des risques et le plan de prvention
3.4.2.1 De lanalyse des risques la dfinition du plan
L'analyse des risques est faite en commun par les employeurs aprs l'inspection commune
des lieux de travail. Elle concerne les risques pouvant rsulter de l'interfrence entre les
activits, les installations et matriels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrtent d'un commun accord, avant le dbut
des travaux, le plan de prvention dfinissant les mesures qui doivent tre prises par
chaque entreprise en vue de prvenir ces risques (article R. 237-7).
3.4.2.2 Le plan de prvention crit obligatoire
L'article R. 237-8 impose l'obligation d'tablir par crit un plan de prvention dans deux
cas avant le commencement des travaux :
ds lors que l'opration effectuer par la ou les entreprises extrieures, y compris les
entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, reprsente un
nombre total d'heures de travail prvisible gal au moins 400 heures de travail sur
une priode gale au plus 12 mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il
en est de mme ds l'instant o, en cours d'excution des travaux, il apparat que le
nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
quelle que soit la dure prvisible de l'opration, lorsque les travaux effectuer pour
raliser l'opration sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixe,
respectivement, par arrt du ministre charg du travail et par arrt du ministre
charg de l'agriculture (voir chapitre 3.5 ).
3.4.2.3 Le contenu du plan de prvention
Les mesures prvues par le plan de prvention comportent au moins des dispositions
dans les domaines suivants :
1. La dfinition des phases d'activit dangereuses et des moyens de prvention spcifiques
correspondants ;
2. L'adaptation des matriels, installations et dispositifs la nature des oprations effectuer
ainsi que la dfinition de leurs conditions d'entretien ;
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
3. Les instructions donner aux salaris ;
4. L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la
description du dispositif mis en place cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5. Les conditions de la participation des salaris d'une entreprise aux travaux raliss par une
autre en vue d'assurer la coordination ncessaire au maintien de la scurit et, notamment,
de l'organisation du commandement.
Le plan de prvention prvoit aussi la liste des postes occups par les salaris
susceptibles de relever de la surveillance mdicale particulire et fixe la rpartition des
charges d'entretien entre les entreprises dont les salaris utilisent les installations dfinies
l'article R. 237-16 et mises disposition par l'entreprise utilisatrice.
3.4.2.4 Modle de plan de prvention
PLAN DE PRVENTION
I Renseignements relatifs l'opration et aux entreprises
Nature de l'opration :
Lieu de l'opration :
Date prvue de dbut et de fin des travaux :
ENTREPRISE UTILISATRICE
Raison sociale :
Adresse :
Tlphone : Fax :
Nom du coordonnateur :
ENTREPRISE EXTRIEURE (EE)
(si plusieurs EE participent l'opration, cette partie est reproduire)
Raison sociale :
Adresse :
Tlphone : Fax :
Nom et qualification du chef dtablissement :
Effectif sur le site :
Noms et rfrences des sous-traitants qui interviennent sur le site :
DSIGNATION DES TRAVAUX A EFFECTUER PAR L'EE
Commande n : du :
Nature des travaux :
Lieu d'intervention (secteur, btiment) :
Date prvue du dbut des travaux :
Date prvue de fin des travaux :
II Risques d'interfrence et mesures de prvention
Risques d'interfrence lors des diffrentes
phases de l'opration
Mesures de prvention
Liste des postes relavant de la surveillance mdicale particulire :
Organisation des premiers secours :
N de tlphone intrieur :
N de tlphone extrieur (y compris code d'accs) :
Consignes respecter sur le site de l'opration :
Modalits d'information des salaris :
Entreprise utilisatrice Entreprise(s) extrieure(s)
Date :
Nom et signature :
Date :
Nom et signature :
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
3.5 Les travaux dangereux
La liste des travaux dangereux pour lesquels il est tabli par crit un plan de prvention
est fixe dans l'arrt du 19 mars 1993, pris en application de l'article R. 237-8 du code
du Travail.
Ces travaux dangereux sont les suivants :
1 Travaux exposant des rayonnements ionisants ;
2 Travaux exposant des substances et prparations explosives, comburantes,
extrmement inflammables, facilement inflammables, trs toxiques, toxiques, nocives,
cancrognes, mutagnes, toxiques vis--vis de la reproduction, au sens de l'article
R. 231-51 du code du travail ;
3 Travaux exposant des agents biologiques pathognes ;
4 Travaux effectus sur une installation classe faisant l'objet d'un plan d'opration
interne en application de l'article 17 du dcret n 77-1133 du 21 septembre 1977
modifi ;
5 Travaux de maintenance sur les quipements de travail, autres que les appareils et
accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vrifications priodiques prvues
l'article R. 233-11 du code du travail, ainsi que les quipements suivants :
vhicules benne basculante ou cabine basculante,
machines cylindre,
machines prsentant les risques dfinis aux deuxime et troisime alinas de
l'article R. 233-29 du code du travail ;
6 Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs,
monte-charge, escaliers mcaniques, trottoirs roulants et installations de parcage
automatique de voitures ;
7 Travaux de maintenance sur installations trs haute ou trs basse temprature ;
8 Travaux comportant le recours des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs ;
9 Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimils mus la main,
installs temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation ;
10 Travaux exposant au contact avec des pices nues sous tension suprieure la TBT ;
11 Travaux ncessitant l'utilisation d'quipements de travail auxquels est applicable
l'article A. 233-9 du code du travail ;
12 Travaux du btiment et des travaux publics exposant 1es travailleurs des risques de
chute de hauteur de plus de 3 mtres, au sens de l'article 5 du dcret n 65-48 du 8
janvier 1965 ;
13 Travaux exposant un niveau d'exposition sonore quotidienne suprieure 90 dB
(A) ou un niveau de pression acoustique de crte suprieure 140 dB ;
14 Travaux exposant des risques de noyade ;
15 Travaux exposant un risque d'ensevelissement ;
16 Travaux de montage, dmontage d'lments prfabriqus lourds, viss l'article 170
du dcret n 65-48 du 8 janvier 1965 ;
17 Travaux de dmolition ;
18 Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matire ou en atmosphre
confine ;
19 Travaux en milieu hyperbare ;
20 Travaux ncessitant l'utilisation d'un appareil laser d'une classe suprieure la
classe 33 A selon la norme NF EN 60825 ;
21 Travaux de soudage oxyacthylnique exigeant le recours un permis de feu .
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
3.6 Le permis de feu
Le permis de feu est tabli dans un but de prvention contre les dangers d'incendie et
d'explosion occasionns par des travaux par points chauds (chalumeaux et arc lectrique).
Aucun travail avec appareil thermique ou produisant des tincelles ne peut tre
entrepris sans l'accord pralable du chef d'entreprise ou de son dlgataire habilit.
Il se prsente sous la forme d'un imprim spcial comportant trois exemplaires, l'un
destin le plus souvent au donneur d'ordre, le deuxime au dirigeant de l'entreprise
charge des travaux, le troisime l'agent veillant la scurit de l'opration. Il
doit pouvoir tre prsent toute rquisition.
Le Permis de feu est un imprim triplicata autocopiant (modle dpos l'INPI - N
933943). Il est vendu au CNPP - Service ditions. Un fac-simil du permis feu est prsent
dans les 2 pages suivantes.
Qui le remplit ?
Le chef d'tablissement ayant la responsabilit de la scurit incendie ou son
reprsentant dment habilit (le responsable de la scurit s'il existe).
Sa signature l'engage : il ne s'agit pas d'une couverture , mais d'un document qui
atteste que toutes les mesures de scurit ont bien t prises.
Le CNPP considre qu'il est ncessaire, mme si les travaux sont effectus par les quipes
de l'entreprise elle-mme et non pas uniquement par celles d'une entreprise extrieure.
Est-il obligatoire ?
Il a t rendu obligatoire par l'arrt du 19 mars 1993 pris pour application de larticle
R237-8 du code du Travail, pour les travaux de soudage oxyacthylnique effectus par
une entreprise extrieure.
Pour Paris et les dpartements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne,
des mesures de scurit quivalentes sont obligatoires, sans que le document soit
mentionn, depuis l'ordonnance prfectorale du 10 fvrier 1970.
Les prescriptions applicables aux installations classes pour la protection de
lenvironnement prvoient frquemment ltablissement dun permis de feu. Pour les
installations soumises dclaration, cette obligation est, le cas chant, fixe aux points
4.5 et 4.6 (du 4 Risques ) des arrts de prescription gnrale tablis suivant le
canevas-type. Elle sapplique au travaux de rparation ou damnagement conduisant
une augmentation des risques (emploi dune flamme ou dun source chaude par
exemple).
Les mmes prescriptions sont imposes aux installations soumises autorisation
prsentant les mmes types de risques, comme cest le cas par exemple pour les silos
(art. 20 arrt du 29 juillet 1998) ou les entrepts couverts (art.22 arrt du 5 aot
2002).
Par ailleurs, il fait partie des exigences de base d'un nombre croissant d'assureurs.
Si un incendie se dclare par suite de travaux par points chauds et si aucun permis de feu n'a
t tabli, l'indemnisation pourra tre rduite.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
Combien de temps est-il valable ?
Sa validit demeure tant qu'aucun de ses lments (lieu, nature des travaux,
intervenants) n'a chang. C'est rarement le cas au-del de quelques jours.
La dure prvisible des travaux est dans tous les cas une mention obligatoire lors de son
tablissement.
Combien de temps doit-on le conserver ?
Quelle que soit la situation, il doit tre conserv tant que les travaux ne sont pas termins
et que l'inspection finale n'a pas t faite, donc au moins 48 heures.
Mais, il est conseill de l'archiver pour servir l'historique des travaux.
3.7 Le travail de nuit ou dans un lieu isol
Le cas des oprations excutes de nuit ou dans un lieu isol est prvu par le code
du Travail. L'article R. 237-10 impose les mesures suivantes :
Lorsque l'opration est excute de nuit ou dans un lieu isol ou un moment o
l'activit de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extrieure
concern doit prendre les mesures ncessaires pour qu'aucun salari ne travaille
isolment en un point o il ne pourrait tre secouru bref dlai en cas d'accident.
S'il s'agit de travaux effectus dans un tablissement agricole, ne sont viss par les
dispositions de l'alina prcdent que les travaux raliss dans les locaux de
l'exploitation, de l'entreprise ou de l'tablissement ou proximit de ceux-ci.
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
4 LES MESURES DE SCURIT
Les chefs d'tablissement et notamment ceux du btiment et des travaux publics sont
tenus de prendre les mesures spciales de protection et de salubrit nonces dans le
dcret 65-48 du 08 janvier 1965, lorsque le personnel effectue, mme titre
occasionnel :
des travaux de terrassement ;
de construction ;
d'installation ;
de dmolition ;
d'entretien ;
de rfection ;
de nettoyage ;
toutes oprations annexes et tous autres travaux prvus par le dcret, portant sur des
immeubles par nature ou par destination ;
Il s'agit des mesures de protection et de salubrit applicables aux tablissements dont le
personnel excute des travaux de btiment, des travaux publics et tous autres travaux
portant sur des immeubles par nature ou par destination.
En sont exclus les travaux portant sur les immeubles par destination, ds lors qu'ils sont
soumis, en ce qui concerne leur dmontage, leur entretien ou leur maintenance, aux
dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail qui spcifie que :
- les quipements de travail doivent tre installs, disposs et utiliss de manire
rduire les risques pour les utilisateurs de ces quipements et pour les autres travailleurs.
Doit notamment tre prvu un espace libre suffisant entre les lments mobiles des
quipements de travail et les lments fixes ou mobiles de leur environnement.
L'organisation de l'environnement de travail doit tre telle que toute nergie ou substance
utilise ou produite puisse tre amene et vacue en toute scurit.
- Les quipements de travail et leurs lments doivent tre installs de faon permettre
aux travailleurs d'effectuer les oprations de production et de maintenance dans les
meilleures conditions de scurit possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer
l'emploi des outils, accessoires, quipements et engins ncessaires pour excuter les
oprations de mise en oeuvre, y compris de rglage relevant de l'oprateur, ou les
oprations de maintenance en toute scurit.
- Ils doivent tre installs et, en fonction des besoins, quips de manire telle que les
travailleurs puissent accder et se maintenir en scurit et sans fatigue excessive tous
les emplacements ncessaires pour la mise en oeuvre, le rglage et la maintenance
desdits quipements et de leurs lments.
- Les passages et les alles de circulation du personnel entre les quipements de travail
doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimtres. Leur sol doit prsenter un profil et
tre dans un tat permettant le dplacement en scurit.
Ces mesures sont des mesures gnrales de scurit relatives :
la rsistance et stabilit : les installations, dispositifs, matriels et engins doivent tre
appropris au travail effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposs. Ils
doivent en particulier prsenter une rsistance suffisante pour supporter les charges et
les efforts auxquels ils sont soumis ;
la protection collective destine empcher les chutes de personnes ;
la protection destine empcher les chutes d'objets et de matriaux et les accidents
dus aux planches munies de pointes saillantes ;
la protection individuelle ;
Partie 6 Prvenir les risques sur un chantier
aux travaux excuts par grand vent ;
aux dispositions concernant la circulation des vhicules, appareils et engins de
chantier ;
aux examens, vrifications, registres ;
ainsi que des mesures particulires relatives :
aux appareils de levage :
- appareils de levage mus mcaniquement,
- appareils de levage mus la main ;
aux cbles, chanes, cordages et crochets ;
aux travaux de terrassement a ciel ouvert ;
aux travaux souterrains :
- mesures prendre pour viter les boulements et les chutes de bloc,
- ventilation,
- circulation,
- signalisation, clairage ;
aux travaux de dmolition ;
aux chafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers ;
aux chelles ;
aux travaux sur les toitures,
aux travaux de montage, de dmontage et de levage de charpentes et ossatures ;
aux travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'lments prfabriqus
lourds ;
aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations lectriques ;
aux mesures gnrales d'hygine ;
au logement provisoire des travailleurs :
- dispositions concernant les travailleurs dplacs ou vivant en collectivit,
- dispositions concernant les travailleurs autres que ceux qui sont dplacs ou qui vivent en
collectivit.
Le dcret prvoit aussi des dispositions particulires pour des travaux particuliers ou
risques (taiements d'une hauteur de plus de 6 mtres, mise en tension des armatures du
bton prcontraint, enlvement des cintres et des coffrages et enlvement des charpentes
soutenant ces installations, travaux de soudage, de rivetage et de sablage, travaux
exposant des risques de noyade, par exemple).
PARTIE 7
LIMITER LE RISQUE
CIRCULATION ROUTIRE
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
1 MTHODE POUR TABLIR UNE POLITIQUE
DE SCURIT ROUTIRE
2 LE DIAGNOSTIC PRALABLE
2.1 tablir un diagnostic
2.2 Modle de diagnostic flash
2.3 Analyser spcifiquement le risque trajet
2.4 Modle de questionnaire sur les risques des trajets
3 IMPLIQUER LA DIRECTION ET L'ENCADREMENT
3.1 L'action de la direction
3.2 Modles de chartes qualit / scurit
3.3 Le rle de l'encadrement
4 COMMENT RALISER UN GUIDE DU CONDUCTEUR ?
4.1 Qu'est-ce qu'un Guide du conducteur ?
4.2 Comment utiliser le Guide du conducteur ?
4.3 Modle de Guide du conducteur
5 IMPLANTER UNE STRUCTURE DE SCURIT
5.1 L'quipe scurit
5.2 Le test d'embauche
5.3 Modle de test
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
6 COMMENT ANALYSER LES ACCIDENTS ?
6.1 Les objectifs de l'analyse
6.2 L'entretien avec le conducteur accident
6.3 L'utilisation de fiches d'analyse d'accident
6.4 Modle de fiche d'analyse d'un accident routier
7 TABLEAUX DE BORD POUR SUIVRE LES ACCIDENTS
7.1 La centralisation des fiches d'analyse
7.2 Les tableaux de bord
7.3 Exemples de tableaux de bord
7.4 Faire voluer sa politique de prvention
8 LA GESTION GLOBALE DU RISQUE CIRCULATION
DANS L'ENTREPRISE
8.1 Rappel des points essentiels
8.2 Prendre en compte tous les risques
8.3 Liste des actions de prvention possibles
9 LA CIRCULATION : FICHES D'INFORMATION
9.1 L'alcool et la conduite
9.2 La circulation sur les chantiers
9.3 Les rfrences des articles de loi qui concernent les accidents
de la route dans le cadre professionnel
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
1 MTHODE POUR TABLIR UNE POLITIQUE
DE SCURIT ROUTIRE
Si l'amlioration de la scurit routire dans l'entreprise fait partie des proccupations du
chef d'entreprise, il nest pas facile de mettre en place une politique de prvention dans
de ce domaine. D'autant que seule une action globale et suivie dans le temps peut
aboutir des rsultats mesurables.
La Prvention Routire a mis au point une mthode pour aider, par des moyens concrets,
chaque entreprise mieux comprendre le risque circulation qu'elle encoure afin de lui
permettre de trouver les solutions qui lui correspondent. Cette mthode, appele Cristal
(Connatre les Risques pour Identifier des Solutions dans le Travail qui Anticipent
Laccident) comprend sept volets :
1 Le diagnostic pralable
2 Le rle de la direction et de l'encadrement
3 Limplication des conducteurs
4 La mise en place d'une structure scurit
5 La connaissance des risques et des solutions
6 Les tableaux de bord et la communication
7 La gestion globale des risques.
C'est cette mthode qui est dcrite dans cette partie.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
2 LE DIAGNOSTIC PRALABLE
La premire tape dun plan de prvention du risque circulation consiste tablir
un diagnostic qui value le degr dimplication de lentreprise dans ce domaine.
Des cabinets de consultants spcialiss proposent de raliser ce type dtude et
remettent gnralement un rapport dune cinquantaine de pages. La mthode
danalyse propose ici nentend pas se substituer aux interventions dune socit de
conseil mais permet plutt de brosser un rapide tableau de la situation. Cest la
raison pour laquelle la grille danalyse qui sert de support est appele diagnostic
flash .
2.1 tablir un diagnostic
Le modle de diagnostic flash propos ci-aprs permet de passer en revue, sous
une forme pratique, les diffrents thmes professionnels en relation avec le risque
routier.
Ce document est une adaptation dun imprim conu lorigine par la Caisse
Rgional dAlsace Moselle en 2004. Il se compose de quatre feuilles qui sont
prvues pour tre photocopies sur un format A3, les feuilles 1 et 4 doivent tre
photocopies dun ct et les feuilles 2 et 3 de lautre. Il suffit ensuite de plier le
tout en deux pour obtenir un double feuillet en format A4 dont la partie centrales
est compose des pages 2 et 3.
La premire partie (page 1) permet de rassembler les informations disponibles dans les
diffrents services de lentreprise et qui concerne les accidents de la route, on peut y
noter les donnes suivantes :
Prsentation gnrales : le diagnostic concerne-t-il toute lentreprise ou seulement un
service ou un site gographique ? Quelle est la date de ralisation et la personne charge
de le faire ?
Inventaire des vhicules utiliss en mission : quel est le nombre des vhicules et
comment sont-ils rpartis en fonction du type et de leur mode dutilisation ?
Trajet domicile - travail : quels sont les moyens de dplacements utiliss par le plus
grand nombre de personnes ?
Accidents en missions et en trajets : durant les trois dernires annes, quel est le
nombre daccidents dclars dans le cadre dun dplacement automobile ?
volution des cots : durant les trois dernires annes, quelles est le montant des
dpenses provoqus par les sinistres automobiles ?
Les pages 2 et 3 sont plus faciles remplir car il suffit de cocher les cases rondes
qui correspondent le mieux la ralit. Six thmes sont abords : la
communication, lorganisation, la formation, les vhicules, la circulation interne et
les trajets domicile - travail. Pour chacun deux, diffrentes situations sont
proposes et classes en quatre niveaux numrots de zro trois. Plus le niveau
est important, plus la situation est favorable une bonne prvention du risque
routier. La dernire partie de la page 3 permet de faire un bilan des actions
menes par le pass afin dviter de rpter des checs ou afin de renouveler des
oprations juges utiles.
Enfin la page 4 sert noter les projets mettre en uvre en priorit suite
lidentification des points amliorables. Ces derniers correspondent aux situations
coches dans les niveaux 0 ou 1. Si le rdacteur du diagnostic manque dides
pour dfinir son plan dactions, il peut se reporter au document intitul Pistes pour
un plan dactions et prsent dans la 7
me
partie.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
2.2 Modle de diagnostic flash
1
1) Prsentation gnrale
tablissement concern :
Adresse :
Activit :
Ce diagnostic est ralis par : Fonction :
Date de ralisation :
Autres informati ons :
2) Inventaire des vhicules utiliss en mission
Deux roues
Vhicul es lgers
Vhicul es utilitai res
Poids lourds
Total
Vhicul es
personnels
Vhicul es
du parc
Vhicul es
en locati on
Km parcourus
annuellement
3) Trajets domicile travail
En vhicule lger
En deux roues
Avec les transports en commun
Avec le service de ramassage
A pied ou en roll ers
Total
Nbre de
personnes
Moyen habituel pour
venir travailler
%
%
%
%
%
%
100 %
5) volution des cots
Des pri mes dassurance automobil e
Des franchises dassurance
Des frais de restituti ons (si LLD)
Des rparations pour l es accidents non dclars
Des remorquages et des vhicul es de remplacement
Total de lanne
Montant total
4) Accidents : missions, trajets
de constats
dclars
de jours
d A.T.
de dcs
Annes
Nombre
Annes
Vhicul es
Type
Gestion : indemnits
kilomtriques
amortissement
sur ans
location
sur ans
Prvention du risque routier :
diagnostic flash
Mesure du niveau de prvention et prparation dun plan dactions
1
1) Prsentation gnrale
tablissement concern :
Adresse :
Activit :
Ce diagnostic est ralis par : Fonction :
Date de ralisation :
Autres informati ons :
2) Inventaire des vhicules utiliss en mission
Deux roues
Vhicul es lgers
Vhicul es utilitai res
Poids lourds
Total
Vhicul es
personnels
Vhicul es
du parc
Vhicul es
en locati on
Km parcourus
annuellement
3) Trajets domicile travail
En vhicule lger
En deux roues
Avec les transports en commun
Avec le service de ramassage
A pied ou en roll ers
Total
Nbre de
personnes
Moyen habituel pour
venir travailler
%
%
%
%
%
%
100 %
5) volution des cots
Des pri mes dassurance automobil e
Des franchises dassurance
Des frais de restituti ons (si LLD)
Des rparations pour l es accidents non dclars
Des remorquages et des vhicul es de remplacement
Total de lanne
Montant total
4) Accidents : missions, trajets
de constats
dclars
de jours
d A.T.
de dcs
Annes
Nombre
Annes
Vhicul es
Type
Gestion : indemnits
kilomtriques
amortissement
sur ans
location
sur ans
1
1) Prsentation gnrale
tablissement concern :
Adresse :
Activit :
Ce diagnostic est ralis par : Fonction :
Date de ralisation :
Autres informati ons :
2) Inventaire des vhicules utiliss en mission
Deux roues
Vhicul es lgers
Vhicul es utilitai res
Poids lourds
Total
Vhicul es
personnels
Vhicul es
du parc
Vhicul es
en locati on
Km parcourus
annuellement
3) Trajets domicile travail
En vhicule lger
En deux roues
Avec les transports en commun
Avec le service de ramassage
A pied ou en roll ers
Total
Nbre de
personnes
Moyen habituel pour
venir travailler
%
%
%
%
%
%
100 %
5) volution des cots
Des pri mes dassurance automobil e
Des franchises dassurance
Des frais de restituti ons (si LLD)
Des rparations pour l es accidents non dclars
Des remorquages et des vhicul es de remplacement
Total de lanne
Montant total
4) Accidents : missions, trajets
de constats
dclars
de jours
d A.T.
de dcs
Annes
Nombre
Annes
Vhicul es
Type
Gestion : indemnits
kilomtriques
amortissement
sur ans
location
sur ans
1) Prsentation gnrale
tablissement concern :
Adresse :
Activit :
Ce diagnostic est ralis par : Fonction :
Date de ralisation :
Autres informati ons :
2) Inventaire des vhicules utiliss en mission
Deux roues
Vhicul es lgers
Vhicul es utilitai res
Poids lourds
Total
Vhicul es
personnels
Vhicul es
du parc
Vhicul es
en locati on
Km parcourus
annuellement
3) Trajets domicile travail
En vhicule lger
En deux roues
Avec les transports en commun
Avec le service de ramassage
A pied ou en roll ers
Total
Nbre de
personnes
Moyen habituel pour
venir travailler
%
%
%
%
%
%
100 %
5) volution des cots
Des pri mes dassurance automobil e
Des franchises dassurance
Des frais de restituti ons (si LLD)
Des rparations pour l es accidents non dclars
Des remorquages et des vhicul es de remplacement
Total de lanne
Montant total
4) Accidents : missions, trajets
de constats
dclars
de jours
d A.T.
de dcs
Annes
Nombre
Annes
Vhicul es
Type
Gestion : indemnits
kilomtriques
amortissement
sur ans
location
sur ans
Prvention du risque routier :
diagnostic flash
Mesure du niveau de prvention et prparation dun plan dactions
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N
0
niveau 1 niveau 2 niveau 3
Des affiches de prvention ou
des dpliants dinformation sont
parfois installs.
Diffrentes notes de service
concernent lutilisation des vhicules
(entretien, conduite, restitution )
Un guide du conducteur
de lentreprise regroupe toutes
les consignes de scurit.
L assureur ou le loueur transmet
des informations relatives aux circonstances
des accidents.
Le risque routier est tudi et pris
en compte dans le document unique
dvaluation des risques.
Un diagnostic du risque circulation rdig
par une socit de conseil
se conclu par un plan dactions.
Des initiatives personnelles font
que les accidents de la route sont
parfois voqus.
Les accidents de la route sont
systmatiquement voqus en
C.H.S.C.T.
La Direction est fortement implique,
montre lexemple et a sign une charte
qualit /scurit.
Les consquences corporelles des accidents
de la route sont connues
(nombre d AT, de jours d arrt).
L volution de la frquence des
accidents de la route en mission
et en trajet est suivie par un service.
Des indicateurs de scurit permettent
de suivre les circonstances des
accidents et de dfinir des solutions
Des sances de sensibilisation
du personnel sont organises,
participation facultative.
Des sances de sensibilisation du
personnel sont organises, partici-
pation obligatoire pour les itinrants.
Des sances de sensibilisation
du personnel sont organises avec
un prestataire extrieur.
Des annonces dvnements
majeurs (tempte, neige, blocage
des routes) sont reprises en interne.
Des informations relatives aux
conditions de circulation sont envoyes
aux conducteurs concerns.
Des informations sur les conditions
de circulation et la mtorologie sont
disponibles par tous en temps rel.
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
F
O
R
M
A
T
I
O
N
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
Ceux qui le souhaite peuvent utiliser
un CD-ROM dinformation sur
les risques de la conduite.
Des stages de conduite sont
organiss pour certaines catgories
de conducteurs.
Des stages post-permis sont
prvus dans le plan de formation
de l entreprise.
Il existe un livret d accueil qui
contient une rubrique sur
le risque routier.
Le nouvel embauch rencontre
systmatiquement un correspondant
prvention propos du risque routier
La procdure d intgration comporte
une sensibilisation au risque anime
par un intervenant extrieur.
Chaque conducteur a fourni une
copie de son permis de conduire.
Un contrle annuel de la validit
du permis est effectu (copie,
attestation sur l honneur )
Lentreprise participe au financement
de stages de rcupration de points.
L examen mdical annuel de tous
les salaris est normal .
L examen mdical est plus pouss
que la moyenne. La conduite auto-
mobile figure sur la fiche d aptitude.
Lentreprise finance des contrles
chez l ophtalmologiste et des tests
daptitude pour les conducteurs.
Les dplacements sont laisss
linitiative de chacun, pas de rflexion
globale sur les dplacements
Des actions pour limiter les dpla-
cements et pour choisir le meilleur
moyen de transport sont menes.
Un politique trs claire concernant
lusage des moyens de dplacement
et des htels existe.
Le respect de lheures darrive
est une contrainte gre par le
conducteur.
Le temps de conduite est calcul et
prcis dans lordre de mission du
conducteur.
La procdure en cas de retard est
formalise et connue de tous.
Les nouveaux vhicules sont remis
avec le guide dutilisation fourni
par le constructeur.
Lattribution dun nouveau vhicule
donne lieu une explication par le
garagiste ou le loueur.
La prise en main dun vhicule
comprend un test de conduite et
dutilisation des accessoires.
Lors de la procdure dembauche,
le temps de conduite li au
poste est prcis au candidat.
Le sujet des risques de la conduite
est abord verbalement lors de
lentretien dembauche.
Un test dvaluation du comportement
au volant est pass par les candidats
des postes itinrants.
Un suivi permet de connatre
les kilomtres parcourus.
Un suivi permet de connatre
les kilomtres parcourus et la
frquence des rvisions.
Un suivi permet de connatre les km
parcourus, la frquence des rvisions,
la consommation carburant.
Les accidents de la route mortels
sont analyss par le CHSCT.
Les accidents de la route corporels
et les accidents dclars
lassurance sont analyss.
Tous les accidents de la route,
mme non dclars lassurance,
sont analyss.
2
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N
0
niveau 1 niveau 2 niveau 3
Des affiches de prvention ou
des dpliants dinformation sont
parfois installs.
Diffrentes notes de service
concernent lutilisation des vhicules
(entretien, conduite, restitution )
Un guide du conducteur
de lentreprise regroupe toutes
les consignes de scurit.
L assureur ou le loueur transmet
des informations relatives aux circonstances
des accidents.
Le risque routier est tudi et pris
en compte dans le document unique
dvaluation des risques.
Un diagnostic du risque circulation rdig
par une socit de conseil
se conclu par un plan dactions.
Des initiatives personnelles font
que les accidents de la route sont
parfois voqus.
Les accidents de la route sont
systmatiquement voqus en
C.H.S.C.T.
La Direction est fortement implique,
montre lexemple et a sign une charte
qualit /scurit.
Les consquences corporelles des accidents
de la route sont connues
(nombre d AT, de jours d arrt).
L volution de la frquence des
accidents de la route en mission
et en trajet est suivie par un service.
Des indicateurs de scurit permettent
de suivre les circonstances des
accidents et de dfinir des solutions
Des sances de sensibilisation
du personnel sont organises,
participation facultative.
Des sances de sensibilisation du
personnel sont organises, partici-
pation obligatoire pour les itinrants.
Des sances de sensibilisation
du personnel sont organises avec
un prestataire extrieur.
Des annonces dvnements
majeurs (tempte, neige, blocage
des routes) sont reprises en interne.
Des informations relatives aux
conditions de circulation sont envoyes
aux conducteurs concerns.
Des informations sur les conditions
de circulation et la mtorologie sont
disponibles par tous en temps rel.
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
F
O
R
M
A
T
I
O
N
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
Ceux qui le souhaite peuvent utiliser
un CD-ROM dinformation sur
les risques de la conduite.
Des stages de conduite sont
organiss pour certaines catgories
de conducteurs.
Des stages post-permis sont
prvus dans le plan de formation
de l entreprise.
Il existe un livret d accueil qui
contient une rubrique sur
le risque routier.
Le nouvel embauch rencontre
systmatiquement un correspondant
prvention propos du risque routier
La procdure d intgration comporte
une sensibilisation au risque anime
par un intervenant extrieur.
Chaque conducteur a fourni une
copie de son permis de conduire.
Un contrle annuel de la validit
du permis est effectu (copie,
attestation sur l honneur )
Lentreprise participe au financement
de stages de rcupration de points.
L examen mdical annuel de tous
les salaris est normal .
L examen mdical est plus pouss
que la moyenne. La conduite auto-
mobile figure sur la fiche d aptitude.
Lentreprise finance des contrles
chez l ophtalmologiste et des tests
daptitude pour les conducteurs.
Les dplacements sont laisss
linitiative de chacun, pas de rflexion
globale sur les dplacements
Des actions pour limiter les dpla-
cements et pour choisir le meilleur
moyen de transport sont menes.
Un politique trs claire concernant
lusage des moyens de dplacement
et des htels existe.
Le respect de lheures darrive
est une contrainte gre par le
conducteur.
Le temps de conduite est calcul et
prcis dans lordre de mission du
conducteur.
La procdure en cas de retard est
formalise et connue de tous.
Les nouveaux vhicules sont remis
avec le guide dutilisation fourni
par le constructeur.
Lattribution dun nouveau vhicule
donne lieu une explication par le
garagiste ou le loueur.
La prise en main dun vhicule
comprend un test de conduite et
dutilisation des accessoires.
Lors de la procdure dembauche,
le temps de conduite li au
poste est prcis au candidat.
Le sujet des risques de la conduite
est abord verbalement lors de
lentretien dembauche.
Un test dvaluation du comportement
au volant est pass par les candidats
des postes itinrants.
Un suivi permet de connatre
les kilomtres parcourus.
Un suivi permet de connatre
les kilomtres parcourus et la
frquence des rvisions.
Un suivi permet de connatre les km
parcourus, la frquence des rvisions,
la consommation carburant.
Les accidents de la route mortels
sont analyss par le CHSCT.
Les accidents de la route corporels
et les accidents dclars
lassurance sont analyss.
Tous les accidents de la route,
mme non dclars lassurance,
sont analyss.
2
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
APPRECIATION DES RESULTATS
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
ACTIONS ET ANNEES DE MISE EN UVRE :
Diagnostic du risque routi er en _ _ _ _
Confrence ou vido en _ _ _ _
Communicati on (affiches ou brochure) en _ _ _ _
Challenge scurit en _ _ _ _
Systme de pri me / sanction li aux accidents en _ _ _ _
Journes de formation pour _ _ conducteurs en _ _ _ _
Journes de conseil pour lencadrement en _ _ _ _
Autre acti on : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _
C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
I
N
T
E
R
N
E
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
T
R
A
J
E
T
S
D
O
M
I
C
I
L
E
-
T
R
A
V
A
I
L
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
Une salle manger et un micro-
onde sont mis disposition.
Possibilit de se f aire livrer des
repas ou des fournisseurs se
trouvent moins de 500 m.
Le restaurant dentreprise (cuisine
sur place) est frquent par plus de
50 % du personnel.
Des informations concernant les
transports collectifs existants
sont mises jour dans l entreprise.
Une intervention suivie deffet a t
faite auprs des collectivits pour
amliorer les dessertes de transports
Une incitation financire engage
utiliser les transports collectifs et/ou
le co-voiturage.
Un ramassage dune petite partie
du personnel (moins de 20%)
fonctionne.
Un ramassage dune partie du
personnel (moins de 50%)
fonctionne.
Un ramassage du personnel est en
place et concerne pl us de 50% de
l effectif.
La majorit des salaris doivent
respecter des horaires fixes. Il y a
pnalisation en cas de retar d.
Les horaires sont flexibles,
lorganisation permet le
rattrapage des retar ds.
Les horaires sont libres et la
gestion du temps de travail est
personnalise.
V
E
H
I
C
U
L
E
S
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
Actions de prvention menes dans le pass
3
Tous les vhicules sont des
modles de base, il y a peu dexi-
gence dquipements de scurit
Selon les besoins, certains vhicu-
les sont quips d ABS, de pneus
contacts, dair-bag, de climatisation
Tous les vhicules possdent des
quipements de scurit passive,
voire dun GPS.
Une note de service rappelle l a
ncessit dadapter l a vitesse la
signalisation et aux circonstances.
Quelques vhicules haut de
gamme sont dots de rgul ateur-
limiteur de vitesse.
Tous les vhicules sont dots de
rgulateur-limiteur de vitesse.
Chaque conducteur connat ses
missions dentretien du vhicule
et leur frquence.
Un contrat dentretien est pris avec
un garage. Un carnet d entretien
existe dans chaque vhicule.
Un service ou un prestataire extrieur
ralise le suivi du parc et f ait des
contrles priodiques.
Chaque conducteur signale par
crit les pannes et les anomalies
des vhicules quil utilise.
Chaque conducteur sait o aller
pour faire gonfler, f aire laver ou
faire vrifier son vhi cule.
L entreprise organise rgulire-
ment des contrles grat uits de
ltat des vhi cules.
Les sens de circulation ne sont
pas cl airement dfi nis, les flux
de cir culation se croisent
Entre et sortie sont spares
pour les vhicules et laccs des
pitons est distincte.
Aucun vhicule na besoin de
manuvrer et tous les croisements
de flux sont i ndiqus au sol.
Le plan de circulation est implicite,
chacun fait au mieux pour cir culer.
Un plan de circulation a t
Dfini et des consignes de pru-
dence sont af fiches sur le site.
Le plan de circulation est af fich
lentre avec des informations
mises jour.
Les places de par king sont peu ou
pas matrialises. Le stationne-
ment est parfois sauvage .
Il y a suffisamment de places
de parking et elles sont
matrialises.
Les places de par king sont toutes
claires et matrialises, cert aines
sont prvues pour les handicaps.
Le flchage au sol est dgrad,
le sens de circulation nest pas
toujours vident.
Le flchage au sol est bien
visible, il y a quelques panneaux
de signalisation.
La signalisation verticale et horizon-
tale sont trs claires, le sens uni que
de cir culation est privilgi.
APPRECIATION DES RESULTATS
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
non satisfai sant insuffisant
ACTIONS ET ANNEES DE MISE EN UVRE :
Diagnostic du risque routi er en _ _ _ _
Confrence ou vido en _ _ _ _
Communicati on (affiches ou brochure) en _ _ _ _
Challenge scurit en _ _ _ _
Systme de pri me / sanction li aux accidents en _ _ _ _
Journes de formation pour _ _ conducteurs en _ _ _ _
Journes de conseil pour lencadrement en _ _ _ _
Autre acti on : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _
C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
I
N
T
E
R
N
E
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
T
R
A
J
E
T
S
D
O
M
I
C
I
L
E
-
T
R
A
V
A
I
L
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
Une salle manger et un micro-
onde sont mis disposition.
Possibilit de se f aire livrer des
repas ou des fournisseurs se
trouvent moins de 500 m.
Le restaurant dentreprise (cuisine
sur place) est frquent par plus de
50 % du personnel.
Des informations concernant les
transports collectifs existants
sont mises jour dans l entreprise.
Une intervention suivie deffet a t
faite auprs des collectivits pour
amliorer les dessertes de transports
Une incitation financire engage
utiliser les transports collectifs et/ou
le co-voiturage.
Un ramassage dune petite partie
du personnel (moins de 20%)
fonctionne.
Un ramassage dune partie du
personnel (moins de 50%)
fonctionne.
Un ramassage du personnel est en
place et concerne pl us de 50% de
l effectif.
La majorit des salaris doivent
respecter des horaires fixes. Il y a
pnalisation en cas de retar d.
Les horaires sont flexibles,
lorganisation permet le
rattrapage des retar ds.
Les horaires sont libres et la
gestion du temps de travail est
personnalise.
V
E
H
I
C
U
L
E
S
0 niveau 1 niveau 2 niveau 3
Actions de prvention menes dans le pass
3
Tous les vhicules sont des
modles de base, il y a peu dexi-
gence dquipements de scurit
Selon les besoins, certains vhicu-
les sont quips d ABS, de pneus
contacts, dair-bag, de climatisation
Tous les vhicules possdent des
quipements de scurit passive,
voire dun GPS.
Une note de service rappelle l a
ncessit dadapter l a vitesse la
signalisation et aux circonstances.
Quelques vhicules haut de
gamme sont dots de rgul ateur-
limiteur de vitesse.
Tous les vhicules sont dots de
rgulateur-limiteur de vitesse.
Chaque conducteur connat ses
missions dentretien du vhicule
et leur frquence.
Un contrat dentretien est pris avec
un garage. Un carnet d entretien
existe dans chaque vhicule.
Un service ou un prestataire extrieur
ralise le suivi du parc et f ait des
contrles priodiques.
Chaque conducteur signale par
crit les pannes et les anomalies
des vhicules quil utilise.
Chaque conducteur sait o aller
pour faire gonfler, f aire laver ou
faire vrifier son vhi cule.
L entreprise organise rgulire-
ment des contrles grat uits de
ltat des vhi cules.
Les sens de circulation ne sont
pas cl airement dfi nis, les flux
de cir culation se croisent
Entre et sortie sont spares
pour les vhicules et laccs des
pitons est distincte.
Aucun vhicule na besoin de
manuvrer et tous les croisements
de flux sont i ndiqus au sol.
Le plan de circulation est implicite,
chacun fait au mieux pour cir culer.
Un plan de circulation a t
Dfini et des consignes de pru-
dence sont af fiches sur le site.
Le plan de circulation est af fich
lentre avec des informations
mises jour.
Les places de par king sont peu ou
pas matrialises. Le stationne-
ment est parfois sauvage .
Il y a suffisamment de places
de parking et elles sont
matrialises.
Les places de par king sont toutes
claires et matrialises, cert aines
sont prvues pour les handicaps.
Le flchage au sol est dgrad,
le sens de circulation nest pas
toujours vident.
Le flchage au sol est bien
visible, il y a quelques panneaux
de signalisation.
La signalisation verticale et horizon-
tale sont trs claires, le sens uni que
de cir culation est privilgi.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
CONCLUSION ET PROPOSITIONS DACTIONS
PROJET DACTION SUIVI PAR CALENDRIER COUT ESTIME
4
Prvention du risque routier :
diagnotic flash
CONCLUSION ET PROPOSITIONS DACTIONS
PROJET DACTION SUIVI PAR CALENDRIER COUT ESTIME
4
Prvention du risque routier :
diagnotic flash
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
2.3 Analyser spcifiquement le risque trajet
Les entreprises qui ne possdent aucun parc automobile voudront recueillir des donnes
plus dtailles sur les risques lis lutilisation des vhicules personnels lors des trajets
domicile travail.
A ce sujet, les sources dinformations demeurent trs limites car seuls les accidents
de trajet avec arrt de travail font lobjet dune dclaration. Il apparat donc
ncessaire davoir recours un questionnaire qui peut tre propos lensemble du
personnel de lentreprise. A titre dexemple, le document prsent ci-aprs comporte
11 questions qui abordent diffrents sujets.
Les questions 1 5 permettent de se faire une ide des habitudes prises par les salaris
pour se rendre au travail.
La question 6 permet de mesurer la frquence des sinistres.
Les questions 7 et 8 permettent dvaluer quelques points de connaissance (les bonnes
rponses sont 7 : C et 8 : C).
La question 9 cherchent identifier le message de scurit qui ne sera pas ncessaire
daborder car il est dj mis en uvre.
La question 10 cherche au contraire identifier le point de scurit qui doit tre abord
en priorit car non pris en compte par les conducteurs.
Enfin la question 11 permet aux personnes qui remplissent ce questionnaire de faire part
de leurs souhaits.
2.4 Modle de questionnaire sur les risques des trajets
(voir page suivante)
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
Analyse anonyme des risques
Merci de choisir une seule rponse par question
Questionnaire retourner .. ,
avant le ..
1) Quel moyen utilisez vous habituell ement pour venir au travail ?
A la marche pi ed, D la moto
B le roll ers E la voiture
C le vlo, l e cyclomoteur F les transports en commun
4) Rentrez-vous chez vous pour djeuner ?
A oui B non
5) Votre heure darrive dans votre service est :
A fixe B variable
7) Selon vous, on dpasse le taux dalcool mi e lgal en consommant :
A deux verres de vin C trois demi de bi re
B deux verres de whisky D un apriti f et un digestif
8) Selon vous, quell e est la distance de scurit avec l e vhicul e de devant ?
A 10 mtres C 2 secondes de dplacement
B 20 mtres D la longueur de 2 vhicules
3) Quel est la longueur de votre traj et domicil e - travail (laller uniquement) ?
A moins 10 kil omtres C de 20 30 kil omtres
B de 10 20 kil omtres D plus de 30 kil omtres
6) Depui s deux ans, avez vous eu des chocs, mme l gers, lors des traj ets domicil e - travail ?
A aucun choc C 2 chocs
B 1 choc D plus de 2 chocs
9) Quel est votre comportement prventif l e plus frquent (une seul e rponse) ?
A je laisse passer les pitons qui attendent sur le bord du trottoir
B jallume l es feux de dtresse en cas de ral entissement brutal
C je vrifi e la pressi on des pneumatiques une fois par mois
D jindique systmatiquement mes changements de directi on avec le clignotant
E je fais toujours une pause aprs deux heures de conduite
10) Quel risque prenez vous l e plus souvent (une seul e rponse) ?
A je ne porte pas systmatiquement la ceinture de scurit
B je respecte plus ou moins les li mitations de vitesse
C je passe quel ques fois au feu orange
D il m arrive de faire plusi eurs choses en conduisant (tl phoner, manger, cri re )
E je stati onne parfois sur des endroi ts non prvus pour cela (double file, trottoirs ...)
11) Selon vous, quelle serai t lacti on de prvention raliser en priori t ?
A lancer une campagne dinformati on interne (affiches, vido, confrence)
B organiser une formati on compl mentaire des conducteurs (stages)
C faire un contrle technique des vhicul es
D demander un nouvel amnagement pour certains endroits dangereux
E modi fier l es heures darrive et de dpart
2) Quel moyen utilisez vous occasionnell ement pour venir au travail ?
A la marche pi ed, D la moto
B le roll ers E la voiture
C le vlo, l e cyclomoteur F les transports en commun
Analyse anonyme des risques
Merci de choisir une seule rponse par question
Questionnaire retourner .. ,
avant le ..
1) Quel moyen utilisez vous habituell ement pour venir au travail ?
A la marche pi ed, D la moto
B le roll ers E la voiture
C le vlo, l e cyclomoteur F les transports en commun
4) Rentrez-vous chez vous pour djeuner ?
A oui B non
5) Votre heure darrive dans votre service est :
A fixe B variable
7) Selon vous, on dpasse le taux dalcool mi e lgal en consommant :
A deux verres de vin C trois demi de bi re
B deux verres de whisky D un apriti f et un digestif
8) Selon vous, quell e est la distance de scurit avec l e vhicul e de devant ?
A 10 mtres C 2 secondes de dplacement
B 20 mtres D la longueur de 2 vhicules
3) Quel est la longueur de votre traj et domicil e - travail (laller uniquement) ?
A moins 10 kil omtres C de 20 30 kil omtres
B de 10 20 kil omtres D plus de 30 kil omtres
6) Depui s deux ans, avez vous eu des chocs, mme l gers, lors des traj ets domicil e - travail ?
A aucun choc C 2 chocs
B 1 choc D plus de 2 chocs
9) Quel est votre comportement prventif l e plus frquent (une seul e rponse) ?
A je laisse passer les pitons qui attendent sur le bord du trottoir
B jallume l es feux de dtresse en cas de ral entissement brutal
C je vrifi e la pressi on des pneumatiques une fois par mois
D jindique systmatiquement mes changements de directi on avec le clignotant
E je fais toujours une pause aprs deux heures de conduite
10) Quel risque prenez vous l e plus souvent (une seul e rponse) ?
A je ne porte pas systmatiquement la ceinture de scurit
B je respecte plus ou moins les li mitations de vitesse
C je passe quel ques fois au feu orange
D il m arrive de faire plusi eurs choses en conduisant (tl phoner, manger, cri re )
E je stati onne parfois sur des endroi ts non prvus pour cela (double file, trottoirs ...)
11) Selon vous, quelle serai t lacti on de prvention raliser en priori t ?
A lancer une campagne dinformati on interne (affiches, vido, confrence)
B organiser une formati on compl mentaire des conducteurs (stages)
C faire un contrle technique des vhicul es
D demander un nouvel amnagement pour certains endroits dangereux
E modi fier l es heures darrive et de dpart
2) Quel moyen utilisez vous occasionnell ement pour venir au travail ?
A la marche pi ed, D la moto
B le roll ers E la voiture
C le vlo, l e cyclomoteur F les transports en commun
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
3 IMPLIQUER LA DIRECTION ET L'ENCADREMENT
laborer une stratgie de prvention du risque circulation impose de respecter une
chronologie prcise. Pralable indispensable, le diagnostic est cens faire prendre conscience
aux responsables d'entreprise de limportance de ce risque. Ce qui, en bonne logique, devrait
les conduire envisager des mesures de prvention.
Toutefois, avant de mettre celles-ci en uvre, une premire tape simpose. Elle
consiste officialiser le rle de la direction et de lencadrement dans la politique de
gestion des risques.
3.1 L'action de la direction
Lentreprise ne peut se concrtiser quavec le soutien des dcideurs. En bref, pour que la
prvention entre dans les proccupations du personnel, elle doit dcouler, en droite ligne,
d'une volont affiche de la direction. Le personnel ne simpliquera que dans un projet qu'il
sait suivi et valoris.
Comment, concrtement, parvenir recueillir l'adhsion du personnel ?
En intgrant la prvention dans les valeurs internes de l'entreprise.
Le moyen le plus simple d'y parvenir est de rdiger, en comit de direction, une charte officielle
dont la vocation sera de rendre ce point explicite.
La charte exprimera les valeurs permanentes qui dfinissent le cadre dans lequel s'exercent
toutes les activits professionnelles. Elle doit concerner la qualit et la scurit en gnral sans
sattacher spcifiquement au risque circulation. En fait, ce document prcise la philosophie de
lentreprise, la ncessit de la mobilisation de tous ainsi que les moyens ncessaires pour y
parvenir. Un slogan en guise de conclusion savre galement utile.
Une fois rdig, ce texte sera largement diffus et rgulirement rappel dans les supports de
communication traditionnels : affiches, notes, publication interne, dossier dintgration des
nouveaux embauchs.
3.2 Modles de chartes qualit / scurit
Modle n1
Dans lentreprise ......... la scurit est une priorit pour tous.
Chacun est responsable de sa propre scurit et de celle de ceux qui lentourent.
Notre attachement la qualit et la scurit dtermine notre niveau de professionnalisme.
Tout accident quel quil soit peut tre vit.
Modle n2
Notre politique est de satisfaire nos clients par une qualit de service irrprochable tout en
respectant les rgles strictes de scurit.
Limplication de tous et tous les niveaux est une ncessit pour atteindre ces objectifs.
Je mengage ce que cette politique soit connue de tous, ractualise et mise en uvre
efficacement.
Modle n 3
NOS BUTS :
- Exercer nos responsabilits en bons professionnels.
- Entretenir nos connaissances et nous perfectionner, donner le bon exemple.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
- Bien prparer notre travail et organiser avec soin notre activit.
- Utiliser le matriel ou loutillage adapt.
- Connatre les modes demploi, entretenir, ranger, avoir un esprit innovant.
- changer nos expriences.
- Matriser les risques.
- tre vigilant au travail, en trajet ou chez soi.
Modle n 4
Rduire dune faon significative notre exposition aux dangers de notre mtier est un
enjeu majeur pour notre groupe : les consquences humaines, conomiques et sociales
des accidents affectent nos familles et notre activit.
Le plan daction .. (nom du plan dactions), en engageant lensemble des salaris de
lentreprise, a pour objectif de dvelopper de faon durable, un vritable tat desprit
prvention .
Pour y parvenir, chacun dentre nous doit rechercher des solutions pour amliorer son
organisation et son comportement. Protger lensemble de nos collaborateurs, cest
lambition de .. (nom du plan dactions).
Dans tous les domaines de la scurit, nous devons devenir une entreprise exemplaire.
La prvention est luvre de chacun dentre nous.
3.3 Le rle de l'encadrement
Les principes formaliss par la charte nentreront dans les faits que sils sont relays par la
ligne hirarchique. Le moyen le plus classique pour impliquer les cadres dans cette politique
consiste dfinir avec eux des objectifs. Mais il s'agit l de faire preuve de discernement. En
vitant, en particulier, tout objectif quantitatif matrialis par des formules du type : Votre
service a enregistr 20 accidents lan dernier, vous devez, cette anne, rduire ce nombre
10 . Puisquil sagit du but qu'en somme, on lui assigne, le chef du service concern risque
d'tre tent de s'arranger pour dclarer exactement 10 accidents pour la priode !
Inconvnient de cette situation, le nombre rel des accidents restera inconnu : les dgts
mineurs ne seront pas comptabiliss, les vnements de dcembre inscrits en janvier Il
est, de toute faon, maladroit dutiliser le terme "objectif" en matire daccidents car cela
sous-entend quil sagit dune barre atteindre.
Comment exprimer les directives dont lencadrement a cependant besoin ?
Par le biais de deux procdures :
1. L'encadrement doit s'assurer que tous les chocs sont dclars, quelle que soit la
gravit des dommages. Cest en comptabilisant tous les accidents que l'on peut en
connatre toutes les causes. Une cause qui a provoqu un sinistre bnin gnrera, en
effet, tt ou tard un vnement grave si elle nest pas traite.
2. Pour chaque choc dclar, lencadrement doit faire raliser une analyse. Elle doit
permettre didentifier les solutions pour que ce type daccident ne se reproduise pas. Cette
procdure essentielle pour la russite de lopration sera dtaille dans le chapitre 6.5.
Outre ces procdures, rien n'empche de dterminer une prvision chiffre du nombre
des accidents ; elle servira de repre pour valuer, mois aprs mois, lefficacit de la
politique de prvention. A noter que cette prvision n'est pas destine servir de
fondement d'ventuelles sanctions. En effet, si, un moment donn, le nombre effectif
des accidents dpasse le chiffre prvu, cela doit normalement se corriger l'avenir
grce au respect des procdures prcites. Et s'il doit y avoir sanction, c'est donc au
regard de labsence ou de la mauvaise excution de celles-ci.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
4 COMMENT RALISER UN GUIDE DU
CONDUCTEUR ?
Comment motiver l'ensemble du personnel pour l'adoption d'un comportement de
scurit au volant ?
Car si chaque salari, lorsqu'on l'interroge individuellement, se dclare prt accomplir
des efforts en ce sens, encore faut-il qu'il sache prcisment en quoi cela consiste.
En tout premier lieu, il convient de se souvenir de ce prcepte de base des spcialistes
de prvention : conduire, c'est aussi un acte de travail.
Or, il n'existe pas un outil concourant l'activit d'une entreprise qui ne possde sa procdure
d'utilisation. Les vhicules ne doivent pas faire exception la rgle. C'est pourquoi un guide du
conducteur s'avre indispensable.
4.1 Qu'est-ce qu'un guide du conducteur ?
Ce document, peu coteux raliser, prcise aux conducteurs ce que l'entreprise attend
d'eux. Le guide du conducteur est d'abord un vecteur de communication : il sert faire
comprendre que la tche de conduite est bien partie intgrante de l'activit
professionnelle. Il apporte ensuite aux salaris des solutions simples pour prvenir le
risque et viter des accidents. Enfin, il sert d'lment de rfrence lors de l'analyse des
accidents.
4.2 Comment utiliser le guide du conducteur ?
Rserv un usage interne l'entreprise, le guide ne doit pas tre la reproduction d'une
brochure, comme il en existe souvent excellentes, au demeurant chez les diteurs de livrets
pdagogiques pour la formation des conducteurs.
Il faut, au contraire, en dfinir le contenu en fonction de la nature du parc et de l'activit
de l'entreprise. Sa prsentation sera ainsi diffrente selon que l'on gre une flotte de
voitures particulires confies des reprsentants qui sillonnent l'ensemble des rgions
franaises, ou bien des camionnettes de dpannage qui ne dpassent jamais les
frontires de l'agglomration ou encore des poids lourds de fret international.
Comme le modle ci-dessous le montre bien, le guide ne se limite pas une simple
check-list d'avant le dpart, comme il peut en exister dans des entreprises de
transport routier. Sur le plan de la forme, il importe d'y faire figurer le logo de
l'entreprise ainsi que ses slogans habituels.
Pour que le document ne soit pas reu comme une paperasse de plus , chaque responsable
hirarchique s'attachera le remettre lui-mme ses destinataires. Il les informera, cette
occasion, qu'il veille personnellement au bon respect des procdures contenues dans le guide.
Bien sr, le document a toute sa place dans le dossier des nouveaux embauchs et des
intrimaires.
Le modle qui suit peut vous aider laborer votre propre guide du conducteur.
4.3 Modle de guide du conducteur
Voir page suivante
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
GUIDE DU CONDUCTEUR DE LENTREPRISE : ____________________
PROCDURES AVANT DE PARTIR
Que savoir ?
Le temps perdu au dpart ne se rattrape pas en
conduisant plus vite. Ainsi, sur autoroute, si vous
effectuez un trajet de 100 km 130 km/h ou 150
km/h, le gain de temps sera seulement de 6 minutes.
La non-propret de vos phares peut diminuer
votre clairage de 60 %.
Le sous-gonflage chauffe anormalement le
pneu et provoque la dtrioration de sa structure.
La surface de contact de vos quatre pneus avec
le sol est gale en tout la taille dune feuille de
papier (format A4).
Lors dun choc, la ceinture de scurit sallonge
pour vous retenir progressivement. Les appuis-
tte ne sont pas des accessoires de confort mais
des quipements de scurit qui retiennent la tte
lors des chocs arrire.
Les 2/3 des accidents surviennent moins de 15
km du domicile. La vigilance du conducteur est
diminue par de nombreux facteurs : habitude,
soucis, absorption dalcool ou de mdicaments..
Que faire ?
tudier son itinraire. Tlphoner pour avertir
dun retard et prendre le temps ncessaire.
Nettoyer rgulirement les surfaces vitres et les
feux.
Vrifier ltat et la pression des pneumatiques
une fois par mois. Respecter les pressions de
gonflage prescrites en fonction de lutilisation du
vhicule.
Porter la ceinture de scurit pour se rendre
solidaire du vhicule. Changer la ceinture aprs
un choc.
Rgler lappui-tte selon votre taille.
tre conscient de ses limites et de ses
habitudes.
Adapter sa conduite son tat.
PROCDURES EN CONDUITE
Que savoir ?
A larrt, votre champ de vision est un arc de
180 degrs. La vitesse le rduit considrablement
en raison du dfilement latral du paysage.
Ce qui se trouve sur les cts du vhicule nest pas
toujours visible dans les rtroviseurs. En outre, ce qui
est visible dans les rtroviseurs est plus proche quil
ny parat.
Le temps de raction thorique dune personne
en pleine forme et attentive est environ dune
seconde. En fait, il est plus souvent proche de 2
secondes. A 90 km/h, en 2 secondes, vous
parcourez 50 mtres.
Chaque conducteur analyse diffremment une
mme situation de conduite. Les autres ne nous
voient pas ou ne vous comprennent pas toujours.
Lors dun arrt en circulation, une distance trop
courte avec le vhicule prcdent vous empche de
vous dgager en cas de ncessit (collision arrire,
vhicule prcdent en panne, agression).
Le fait de faire plusieurs choses en mme temps
constitue une cause majeure daccidents
Que faire ?
Balayer frquemment la route du regard pour
capter le plus dinformations utiles.
Tourner la tte pour regarder sur le ct lors
des changements de file ou des dpassements.
A lapproche des zones risque (intersection,
cole...), placer le pied au-dessus de la pdale
de frein.
Intervalle de scurit = deux secondes.
En cas dincertitude, envisager toujours le
scnario le plus dfavorable. Assurez-vous dtre
vu et compris par les autres.
Sarrter de manire pouvoir voir les roues
arrire du vhicule qui vous prcde.
teindre son tlphone et consulter sa
messagerie lors des pauses.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
PROCDURES EN RETOUR DE DPLACEMENT
Que savoir ?
Votre prochain dpart sera une manuvre
sans visibilit si vous ne leffectuez pas en
marche avant. La majorit des accidents sur
un parking surviennent lors de la sortie de
lemplacement.
Durant le stationnement, dautres risques
existent : le vol, la descente du vhicule, la
manutention du chargement, laccrochage
avec des tiers.
Les vhicules sont partags par plusieurs
conducteurs qui apprcient de les emprunter
dans le meilleur tat possible.
Chaque incident ou accident est
loccasion dune rflexion sur son propre
comportement et sur les solutions qui
auraient permis de lviter. Un accident
est toujours une suite dvnements,
jamais une fatalit.
Que faire ?
Stationner le plus souvent possible en marche arrire
pour prparer son dpart.
Rechercher le meilleur stationnement pour ne gner
personne. Ne rien laisser dapparent lintrieur du
vhicule.
Faire le plein dessence avant de rentrer. Signaler par
crit toute anomalie.
Raliser une reconstitution de laccident et identifier les
facteurs sur lesquels il sera possible dagir lavenir
pour en viter dautres.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
5 IMPLANTER UNE STRUCTURE DE SCURIT
Pour impliquer les services fonctionnels, il faut constituer une quipe pour mettre en uvre la
politique de prvention, avec l'indispensable soutien de la hirarchie.
5.1 L'quipe scurit
Tout vnement, rappelons-le, est gnr par des causes. Laccident de circulation
galement. Par consquent, la manire la plus efficace de prvenir les sinistres cest
d'agir en amont, sur lorigine des causes. Mais pour traiter un facteur de risque, encore
faut-il connatre sa nature. Cela exige l'intervention dun membre du personnel aprs
chaque choc.
Mission de cette personne : rencontrer laccident et identifier avec lui les raisons du
choc. Comme cette tche sajoute ses fonctions habituelles, elle doit lui prendre peu
de temps. L'idal est de constituer une quipe de scurit ce qui permet de rpartir le
travail entre plusieurs personnes.
Si l'activit de l'entreprise se droule sur plusieurs sites, un membre au moins de cette quipe
scurit devra se trouver sur chaque site. Ainsi tous les membres du personnel sauront,
qu'aprs chaque accident, un de leurs collgues proche d'eux, viendra les rencontrer pour
trouver les moyens dviter quil ne se reproduise. La prvention sera, par consquent,
perue comme une ralit et non comme une ide abstraite voire une lubie du sige
social.
5.2 Le test d'embauche
A ct de cette quipe directement oprationnelle pour la matrise du risque, les services
fonctionnels, au premier rang desquels les ressources humaines, ont aussi un rle
jouer.
Et, au premier chef : appliquer des procdures cohrentes avec les principes noncs
dans la charte scurit dont l'entreprise s'est dote. En particulier, l'occasion de
chaque recrutement, les candidats doivent tre valus aussi au regard de la scurit.
Le modle suivant est un exemple de test que l'entreprise peut faire passer lors de lentretien
dembauche dun salari appel conduire rgulirement.
Voici les rponses :
1-B, 2-B, 3-A, 4-A, 5-C, 6-C, 7-C, 8-B, 9-C, 10-C.
On compte 1 point par bonne rponse. Une personne qui obtiendrait moins de 8 points
devrait tre suivie avec attention si un vhicule lui est confi. L'avantage principal de ce
type de test est de faire prendre conscience au nouvel arrivant que la prvention
reprsente une des proccupations majeures de son employeur. Son comportement au
volant en sera chang.
En conclusion de ce quatrime chapitre, il convient de souligner, encore une fois, qu'en
matire de matrise du risque circulation, rien ne se fera sans le soutien de la hirarchie.
Celle-ci a la responsabilit dorganiser, dans les plus brefs dlais, l'analyse de chaque
accident. Pour autant, il n'est pas ncessaire quelle y participe concrtement.
5.3 Modle de test
Voir page suivante
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
Nom/Prnom Lieu du test Date du test
Le risque circulation
/ / 20
Cochez une seule rponse par question
1) Si le vhicul e devant moi freine brutal ement, j e pourrai viter laccident :
A car ses feux stop me prviendront quil sarrte
B
C
en roulant l oin derrire lui
grce mes rfl exes de bon conducteur
2) Un pi ton traverse la chausse devant moi en dehors dun passage rserv aux pitons :
A
je diminue mon allure et j e mainti ens ma traj ectoire
B
je lui facilite le passage et je passe aprs lui
C je klaxonne pour quil traverse un autre endroit
3) Sur une route ou une autoroute, par temps de brouillard, je conduis :
A
de mani re pouvoir m arrter dans ma zone de visibilit
B
60 km/h maximum
C 80 km/h maximum si je connais bi en litinraire
4) Lorsque japproche dun endroit qui me parat dangereux :
A j imagine tous les dangers possibles cet endroit
B je compte sur le bon sens des autres conducteurs
C
je compte sur mes bonnes comptences aux volants
5) A mon avis, les accidents sont provoqus le plus souvent par :
A
des mauvaises conditions mtorologi ques (plui e, neige, verglas )
B
une dfaillance mcanique
C
les dcisi ons du conducteur
6) A un carrefour, un vhicule qui vi ent de la gauche ne ral enti t pas pour me laisser passer :
A
je ne doi s pas en tenir compte car en cas daccident c est lui qui serait responsabl e
B je passe avant quil ne s engage dans l e carrefour car jai la priorit
C
je ralentis pour l e laisser passer
7) Lors dun long dplacement, je me sens fatigu :
A je marrte souvent pour prendre un caf et je continue mon voyage
B
jaugmente ma concentration pour tre plus vigilant et je monte le chauffage.
C
je marrte pour m assoupir l e temps ncessaire
8) Si mes pneumatiques sont sous-gonfls, quell e peut tre la consquence ?
A
aucune consquence : c est le sur-gonflage qui est dangereux
B
une consquence ngative : l cl atement du pneumatique
C
une consquence positive : une meilleure adhrence sur sol glissant
9) Si j e suis conducteur et que les passagers l arri re ne mettent pas la ceinture
A
seuls les passagers peuvent tre verbaliss et risquent de payer une amende.
B je peux tre verbalis si les passagers ont moins de 13 ans
C
je peux tre verbali s si l es passagers ont moins de 18 ans
10) Si jai un accident de la route pendant mon traj et domicil e - travail
A cet accident ne sera pas considr comme un accident du travail
B
cet accident sera considr comme un accident du travail si j e suis responsable
C
cet accident sera considr comme un accident du travail si j e suis bless( e)
Nom/Prnom Lieu du test Date du test
Le risque circulation
/ / 20
Cochez une seule rponse par question
1) Si le vhicul e devant moi freine brutal ement, j e pourrai viter laccident :
A car ses feux stop me prviendront quil sarrte
B
C
en roulant l oin derrire lui
grce mes rfl exes de bon conducteur
en roulant l oin derrire lui
grce mes rfl exes de bon conducteur
2) Un pi ton traverse la chausse devant moi en dehors dun passage rserv aux pitons :
A
je diminue mon allure et j e mainti ens ma traj ectoire
B
je lui facilite le passage et je passe aprs lui
C je klaxonne pour quil traverse un autre endroit
3) Sur une route ou une autoroute, par temps de brouillard, je conduis :
A
de mani re pouvoir m arrter dans ma zone de visibilit
B
60 km/h maximum
C 80 km/h maximum si je connais bi en litinraire
4) Lorsque japproche dun endroit qui me parat dangereux :
A j imagine tous les dangers possibles cet endroit
B je compte sur le bon sens des autres conducteurs
C
je compte sur mes bonnes comptences aux volants
5) A mon avis, les accidents sont provoqus le plus souvent par :
A
des mauvaises conditions mtorologi ques (plui e, neige, verglas )
B
une dfaillance mcanique
C
les dcisi ons du conducteur
6) A un carrefour, un vhicule qui vi ent de la gauche ne ral enti t pas pour me laisser passer :
A
je ne doi s pas en tenir compte car en cas daccident c est lui qui serait responsabl e
B je passe avant quil ne s engage dans l e carrefour car jai la priorit
C
je ralentis pour l e laisser passer
7) Lors dun long dplacement, je me sens fatigu :
A je marrte souvent pour prendre un caf et je continue mon voyage
B
jaugmente ma concentration pour tre plus vigilant et je monte le chauffage.
C
je marrte pour m assoupir l e temps ncessaire
8) Si mes pneumatiques sont sous-gonfls, quell e peut tre la consquence ?
A
aucune consquence : c est le sur-gonflage qui est dangereux
B
une consquence ngative : l cl atement du pneumatique
C
une consquence positive : une meilleure adhrence sur sol glissant
9) Si j e suis conducteur et que les passagers l arri re ne mettent pas la ceinture
A
seuls les passagers peuvent tre verbaliss et risquent de payer une amende.
B je peux tre verbalis si les passagers ont moins de 13 ans
C
je peux tre verbali s si l es passagers ont moins de 18 ans
10) Si jai un accident de la route pendant mon traj et domicil e - travail
A cet accident ne sera pas considr comme un accident du travail
B
cet accident sera considr comme un accident du travail si j e suis responsable
C
cet accident sera considr comme un accident du travail si j e suis bless( e)
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
6 COMMENT ANALYSER LES ACCIDENTS ?
Compose d'un ou plusieurs salaris dsigns par la direction, l'quipe scurit de l'entreprise
va s'attaquer sa tche premire : l'analyse des accidents. Les membres de l'quipe devront se
rendre disponibles environ six heures par mois, en moyenne, le temps ncessaire pour
rencontrer chaque conducteur impliqu et dcortiquer avec lui les circonstances de
l'accident.
6.1 Les objectifs de l'analyse
tudier chaque accident rpond plusieurs objectifs :
Tout dabord, faire prendre conscience tous que lentreprise ne considre plus un
accrochage comme un incident banal mais, au contraire, comme un problme
traiter systmatiquement.
Ensuite, dboucher sur une comprhension relle de laccident bien prfrable aux
versions fantaisistes qu'avancent parfois les accidents qui ne seraient pas tenus de
fournir dexplications dtailles.
Enfin, apporter une rponse un problme vcu et prouver lintrt que porte
lentreprise la scurit de son personnel.
Rappelons que ce travail vise identifier des solutions et non dsigner des coupables.
Les notions de faute et de culpabilit, en particulier, ne sont ici daucune utilit. En
revanche, savoir comment viter, lavenir, des dpenses inutiles constitue une
information de choix.
6.2 L'entretien avec le conducteur accident
Il importe que le conducteur impliqu rencontre un membre de l'quipe scurit dans un dlai
de sept jours maximum pour viter des pertes de mmoire. En principe, personne d'autre ne
participe lentretien mais une copie de la fiche rdige cette occasion devra revenir un
responsable hirarchique.
Comment conduire l'entretien ? Avancer une mthode dtaille serait fastidieux. En revanche,
ces quelques principes de bon sens devraient en faciliter la tenue :
accueillir l'interview sans familiarit ni formalit excessives,
choisir un lieu de rencontre neutre (exemple : viter le bureau du directeur !),
souligner que cette procdure concerne tout le personnel et ne constitue en rien une
forme de brimade personnelle,
rappeler que le but est de trouver des solutions,
utiliser un document adapt comme les fiches d'analyse ci-dessous.
6.3 L'utilisation de fiches d'analyse d'accident
La logique des fiches est simple : aprs une premire partie consacre aux circonstances
de l'accident, on passe en revue avec le conducteur - mieux plac que quiconque pour
ce faire - les solutions pour viter le risque lavenir, et on note s'il estime ou non
l'accident vitable. Il est recommand de remettre au conducteur impliqu une copie de
la fiche ainsi remplie.
Le document se compose de quatre feuilles, prvues pour tre photocopies sur un format A3.
Les feuilles 1 et 4 doivent tre photocopies dun ct et les feuilles 2 et 3 de lautre. Il suffit
ensuite de plier le tout en deux pour obtenir un double feuillet en format A4 dont la partie
centrales est compose des pages 2 et 3.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
6.4 Modle de fiche d'analyse d'un accident routier
5. NATURE DE LVENEMENT
Matriel seul
Corporel seul
Matriel et corporel
Bris de glace
Vol du vhi cule
Vandalisme
Dgt marchandises
Vol marchandises
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Situation dangereuse
6. PREMI ER IMPACT
Lavant du vhi cule
Larrire du vhicule
Le ct droit
Le ct gauche
Le chssis, les roues
Le toit, le capot
Le pare brise, vitres
A lintrieur du vhi cule
Grue, nacelle, br as
Engin transport
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Aucun impact
7. CONTACT AVEC
Point fixe, portail , quai
Vhicule stationn
Deux roues
Vhicule lger , utilitaire
Poids lourd, bus
Engin de manutention
Piton
Animal
Gravillon, projection
Tiers non identifi
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Aucun contact
8. CIRCONSTANCES
Avec un tiers prcdent
Avec un tiers suivant
Avec un tiers venant de ct
Avec un tiers venant de face
En dpassant , en t ant dpass
En manuvrant , en reculant
En sortant de l a route
En tant en stationnement
En per dant un chargement
En ouvrant une porte
En cir culant (autres cas)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. CONSEQUENCE EXTERNE
Aucune consquence
Dgt au domaine public
Dgt matriel aux tiers
Dgt corporel aux tiers
Dcs du tiers
Pollution
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. CONSEQUENCES INTERNES
Aucune rparation effect ue
Vhicule remorqu
Vhicule immobilis pour rparation
Vhicule mis en pave
Arrt de tr avail
Corporel grave, mortel
Retard dans l'activit
Intervention de collgues
Location dun autre vhicule
Dgts aux mar chandises
Tiers rembours sans dclaration
Autres dgts internes
11. ENVIRONNEMENT EXTERNE
Rien de particulier
Embouteillage
Dviation, travaux
Sol glissant
Sol en mauvais tat
Monte ou descente i mportante
Passage trs troit
Mauvaise luminosit, blouissement
Pluie, nei ge
Brouillard
Nuit
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. EXPERI ENCE - FORMATION
Pas de formation (0 2 ans conduite)
Pas de formation (3 5 ans conduite)
Pas de formation (+5 ans conduite)
Formation faite en interne
Formation faite en externe
FIMO
FCOS
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Si croquis, rendez vous
en dernire page
1.CONTEXTE
En mission habituelle
En mission occasionnelle
En mission intrimaire
En trajet domi cile - tr avail
En dplacement inter-sites
En activit personnelle
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
2. MATERIEL UTILISE
Vlo, cyclomoteur
Moto
Vhicule lger
Vhicule utilitaire
Porteur
Tracteur
Semi-remorque
Remorque seule
Camion + remorque
Engin de T.P.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. LIEU
Rue, avenue, boulevard
Voie communale
Route, RD, RN
Voie express, rocade
Autoroute
Voie prive, chemin
Aire de stationnement
Sur le site de l'entreprise
Chez un client , fournisseur
Chantier, zone de tr avail
Tout terrain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. CONFIGURATION
Ligne droite
Intersection
Rond point
Courbe
Bretelle d'accs
En pis
Place, cour , esplanade
Quai de chargement
Pont, tunnel
Entre, sortie
Impasse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circonstances - Solutions - Actions
Fonction du conducteur
Date de l vnement : / / 20
Heure :
Nom/prnom du correspondant prvention
Nom/Prnom du conducteur
Identification du matriel
Agence du conducteur
Date de l analyse
Fiche n :
/ / 20
1
Ici,
plusieurs
slections
possibles
5. NATURE DE LVENEMENT
Matriel seul
Corporel seul
Matriel et corporel
Bris de glace
Vol du vhi cule
Vandalisme
Dgt marchandises
Vol marchandises
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Situation dangereuse
6. PREMI ER IMPACT
Lavant du vhi cule
Larrire du vhicule
Le ct droit
Le ct gauche
Le chssis, les roues
Le toit, le capot
Le pare brise, vitres
A lintrieur du vhi cule
Grue, nacelle, br as
Engin transport
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Aucun impact
7. CONTACT AVEC
Point fixe, portail , quai
Vhicule stationn
Deux roues
Vhicule lger , utilitaire
Poids lourd, bus
Engin de manutention
Piton
Animal
Gravillon, projection
Tiers non identifi
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Aucun contact
8. CIRCONSTANCES
Avec un tiers prcdent
Avec un tiers suivant
Avec un tiers venant de ct
Avec un tiers venant de face
En dpassant , en t ant dpass
En manuvrant , en reculant
En sortant de l a route
En tant en stationnement
En per dant un chargement
En ouvrant une porte
En cir culant (autres cas)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. CONSEQUENCE EXTERNE
Aucune consquence
Dgt au domaine public
Dgt matriel aux tiers
Dgt corporel aux tiers
Dcs du tiers
Pollution
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. CONSEQUENCES INTERNES
Aucune rparation effect ue
Vhicule remorqu
Vhicule immobilis pour rparation
Vhicule mis en pave
Arrt de tr avail
Corporel grave, mortel
Retard dans l'activit
Intervention de collgues
Location dun autre vhicule
Dgts aux mar chandises
Tiers rembours sans dclaration
Autres dgts internes
11. ENVIRONNEMENT EXTERNE
Rien de particulier
Embouteillage
Dviation, travaux
Sol glissant
Sol en mauvais tat
Monte ou descente i mportante
Passage trs troit
Mauvaise luminosit, blouissement
Pluie, nei ge
Brouillard
Nuit
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. EXPERI ENCE - FORMATION
Pas de formation (0 2 ans conduite)
Pas de formation (3 5 ans conduite)
Pas de formation (+5 ans conduite)
Formation faite en interne
Formation faite en externe
FIMO
FCOS
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Si croquis, rendez vous
en dernire page
1.CONTEXTE
En mission habituelle
En mission occasionnelle
En mission intrimaire
En trajet domi cile - tr avail
En dplacement inter-sites
En activit personnelle
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
2. MATERIEL UTILISE
Vlo, cyclomoteur
Moto
Vhicule lger
Vhicule utilitaire
Porteur
Tracteur
Semi-remorque
Remorque seule
Camion + remorque
Engin de T.P.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. LIEU
Rue, avenue, boulevard
Voie communale
Route, RD, RN
Voie express, rocade
Autoroute
Voie prive, chemin
Aire de stationnement
Sur le site de l'entreprise
Chez un client , fournisseur
Chantier, zone de tr avail
Tout terrain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. CONFIGURATION
Ligne droite
Intersection
Rond point
Courbe
Bretelle d'accs
En pis
Place, cour , esplanade
Quai de chargement
Pont, tunnel
Entre, sortie
Impasse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circonstances - Solutions - Actions
Fonction du conducteur
Date de l vnement : / / 20
Heure :
Nom/prnom du correspondant prvention
Nom/Prnom du conducteur
Identification du matriel
Agence du conducteur
Date de l analyse
Fiche n :
/ / 20
1
Ici,
plusieurs
slections
possibles
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
Ltat du matriel a-t-il favoris lvnement ?
La conception du matriel ou des quipements a-t-elle
favoris lvnement ?
Autre .................................................................
Raliser l'entretien prventif temps
Raliser lentretien courant
(niveaux, pression des pneus, propret ...)
Ranger le poste de conduite
Rgler le poste de conduite selon la taille
Vrifier les attaches des portes et du chargement
Signaler par crit toute anomalie
Prendre en compte les anomalies signales
Revoir les critres d'achat des vhicules
Mieux quiper le vhicule
.............................
Amliorer l'clairage des voies et des parkings
Amliorer la signalisation (verticale et horizontale)
Amliorer ltat du sol
Rendre le risque plus perceptible
Modifier le plan de circulation
Amnager la configuration du lieu
Installer des protections collectives
Prendre en compte les risques signals
..........................
L'environnement interne dissimulait - il le risque ?
La configuration du lieu a-t-elle favoris
lvnement ?
Un risque signal avant lvnement a-t-il
t nglig ?
Autre .........................................................
Existait-il une alternative moins risque ?
La prparation de la tche pouvait-elle viter
lvnement ?
Un retard dans l'organisation ou une prcipitation ont-ils
favoriss l'vnement ?
Autre .....................................
Le matriel
Lenvironnement interne
Lorganisation
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
2
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Remplacer le dplacement par une autre action qui
aboutirait au mme rsultat
Passer par un itinraire moins risqu
Partir une heure moins risque, ou plus tt
Utiliser un vhicule mieux adapt la mission
Choisir un autre conducteur plus apte
Communiquer le guide du conducteur
Raliser une prise en main du vhicule
Connatre et prparer litinraire
viter toute surcharge du vhicule
Porter la ceinture de scurit, le casque
S'arrter pour prvenir du retard et prendre le temps
ncessaire
.....................................
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
Le comportement
2 secondes avant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 secondes avant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 secondes avant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utiliser tous les rtroviseurs (gauche et droit)
Balayer frquemment du regard
Regarder par dessus l'paule (changements de file)
Lancer le regard loin devant
Descendre / se retourner pour manuvrer
Se faire guider
Dsembuer, dgivrer, dgager les vitres
tre attentif aux avertisseurs (radar)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Prserer son espace de scurit :
A l'arrt (voir les roues du vhicule de devant)
A l'avant (2 secondes d'cart minimum)
A l'arrire du vhicule (porte faux)
Au dessus du vhicule (gabarit)
Au dessous (ralentir ou viter)
Sur les cts (l'espace d'une portire)
Au dmarrage (attendre 2 secondes)
Conserver toute partie du corps l intrieur
Mieux positionner le vhicule sur la chausse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
viter le cumul de tches
S'assurer d'tre vu et compris des tiers
Adapter l'allure aux circonstances
Imaginer le scnario le plus dfavorable
Prparer le pied face au frein l'approche dun risque
Tenir compte de la signalisation, du code de la route
Prvoir et regarder lchappatoire
Stationner pour repartir en marche avant
Stationner en scurit (frein, cale, lieu sr)
Fermer le vhicule clef
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Connatre le guide du conducteur
Connatre la mthode darrimage, de bchage
Connatre le type de carburant
Connatre le gabarit
Connatre la signalisation
Connatre les conditions de circulation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
viter la consommation d'alcool
viter les mdicaments signals (vigilance)
Respecter le temps de sommeil
Respecter les temps de pause
Prendre conscience de son stress, le signaler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
La personne prsente a -t-elle t surprise par un
risque quelle pouvait DETECTER ?
La personne prsente pouvait - elle PRESERVER
UN ESPACE suffisant entre elle et le risque ?
La personne prsente pouvait - elle ANTICIPER
le risque pour elle et pour les autres ?
La personne prsente pouvait - elle mieux
CONNAITRE LE RISQUE ?
La personne prsente pouvait - elle mieux tenir
compte de son ETAT PHYSIQUE OU
PSYCHOLOGIQUE ?
Notez ce qui sest pass avant (remontez lvnement dans le tem ps).
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
3
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Le comportement
2 secondes avant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 secondes avant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 secondes avant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utiliser tous les rtroviseurs (gauche et droit)
Balayer frquemment du regard
Regarder par dessus l'paule (changements de file)
Lancer le regard loin devant
Descendre / se retourner pour manuvrer
Se faire guider
Dsembuer, dgivrer, dgager les vitres
tre attentif aux avertisseurs (radar)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Prserer son espace de scurit :
A l'arrt (voir les roues du vhicule de devant)
A l'avant (2 secondes d'cart minimum)
A l'arrire du vhicule (porte faux)
Au dessus du vhicule (gabarit)
Au dessous (ralentir ou viter)
Sur les cts (l'espace d'une portire)
Au dmarrage (attendre 2 secondes)
Conserver toute partie du corps l intrieur
Mieux positionner le vhicule sur la chausse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
viter le cumul de tches
S'assurer d'tre vu et compris des tiers
Adapter l'allure aux circonstances
Imaginer le scnario le plus dfavorable
Prparer le pied face au frein l'approche dun risque
Tenir compte de la signalisation, du code de la route
Prvoir et regarder lchappatoire
Stationner pour repartir en marche avant
Stationner en scurit (frein, cale, lieu sr)
Fermer le vhicule clef
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Connatre le guide du conducteur
Connatre la mthode darrimage, de bchage
Connatre le type de carburant
Connatre le gabarit
Connatre la signalisation
Connatre les conditions de circulation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
viter la consommation d'alcool
viter les mdicaments signals (vigilance)
Respecter le temps de sommeil
Respecter les temps de pause
Prendre conscience de son stress, le signaler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
La personne prsente a -t-elle t surprise par un
risque quelle pouvait DETECTER ?
La personne prsente pouvait - elle PRESERVER
UN ESPACE suffisant entre elle et le risque ?
La personne prsente pouvait - elle ANTICIPER
le risque pour elle et pour les autres ?
La personne prsente pouvait - elle mieux
CONNAITRE LE RISQUE ?
La personne prsente pouvait - elle mieux tenir
compte de son ETAT PHYSIQUE OU
PSYCHOLOGIQUE ?
Notez ce qui sest pass avant (remontez lvnement dans le tem ps).
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
3
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Si oui,
cochez
la ou les
solutions
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
Solution(s) trouve(s) et propose(s)
Dans quels dlais ?
A quel cot ?
Qui peut mettre
en uvre
cette solution ?
F. P.
Schma de lvnement, notes complmentaires
Estimez vous que cet vnement est vitable lavenir ?
NON, il ny a pas de solution parce que : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUI, il existe une ou plusieurs solutions ( noter dans le table au ci dessous).
Dcision du chef
d tablissement
(accepte ou refuse)
Conclusion
Solution(s) trouve(s) et propose(s)
Dans quels dlais ?
A quel cot ?
Qui peut mettre
en uvre
cette solution ?
F. P.
Schma de lvnement, notes complmentaires
Estimez vous que cet vnement est vitable lavenir ?
NON, il ny a pas de solution parce que : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUI, il existe une ou plusieurs solutions ( noter dans le table au ci dessous).
Dcision du chef
d tablissement
(accepte ou refuse)
Conclusion
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
7 TABLEAUX DE BORD POUR SUIVRE LES ACCIDENTS
Les mmes causes produisent les mmes effets ! Les accidents qui ont impliqu des conducteurs
de l'entreprise risquent d'arriver de la mme manire leurs collgues de travail qui, par
dfinition, circulent dans des conditions semblables. D'o l'intrt des informations recueillies au
travers d'analyses du risque circulation comme celles prsentes dans notre prcdent chapitre.
Permettant didentifier les solutions aux accidents de circulation, elles serviront ainsi
prvenir les chocs futurs. Encore faut-il faire connatre les conclusions de ces analyses
grce un circuit dinformation interne l'entreprise.
7.1 La centralisation des fiches d'analyse
Premire tape de cette nouvelle tche : tablir une synthse des donnes recueillies dans les
analyses daccident. Pour cela, un Correspondant Prvention fait systmatiquement parvenir une
copie de la fiche danalyse un service fonctionnel de l'entreprise charg de les centraliser. Ce
service accomplit deux missions. Tout dabord, il sassure de la qualit des analyses : il doit, par
exemple, ragir si un accident est estim non vitable alors quune solution parat vidente.
Ensuite, il relve les circonstances et les solutions qui ont t le plus souvent identifies.
S'il y a moins de 30 fiches danalyse par an, leur tude seffectue par simple lecture. Pour des
quantits suprieures, un traitement informatique sur tableur voire, dans les grandes
entreprises, linstallation dun logiciel spcifique savre utile.
7.2 Les tableaux de bord
Impliquer le personnel et la hirarchie dans la scurit passe par l'laboration de
tableaux de bord qui doivent faire l'objet d'une large communication.
La figure ci-dessous constitue un exemple de tableau de bord synthtique. Sa mise
jour s'effectue sur un rythme mensuel. Dans sa version destine l'affichage pour
lensemble du personnel, le responsable de son laboration fait figurer les donnes
relatives tous les accidents de circulation. En revanche, lorsqu'il est communiqu au
responsable d'un service particulier, ny apparaissent que les donnes relatives ce seul
service.
Pour en tirer le meilleur profit, le lecteur de ce tableau de bord sintressera dabord la courbe
du nombre cumul des accidents. Si le dernier point de cette courbe se situe en dessous de la
prvision, il classera le document sans y prter une attention particulire. Si, au contraire, le
nombre des accidents est suprieur aux prvisions, le lecteur prendra connaissance avec
attention des solutions qui doivent tre mises en uvre en priorit et qui seront ajoutes sous le
graphique.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
7.3 Exemples de tableaux de bord
Circonstances
Solutions
8. CIRCONSTANCES
Avec un tiers prcdent 10 20%
Avec un tiers suivant 2 4%
Avec un tiers venant de ct 2 4%
Avec un tiers venant de face 1 2%
En dpassant, en tant
dpass 6 12%
En manuvrant, en reculant 21 42%
En sortant de la route 4 8%
En tant en stationnement 3 6%
En perdant un chargement
En ouvrant une porte 1 2%
En circulant (autres cas)
1. CONTEXTE
En mission habituelle 30 60%
En mission occasionnelle 12 24%
En mission intrimaire 8 16%
En trajet domicile - travail 0 0%
En activit personnelle 0 0%
4. CONFIGURATION
Ligne droite 25 50%
Intersection 6 12%
Rond point 1 2%
Courbe 2 4%
Bretelle d'accs 1 2%
En pis 0 0%
Place, cour, esplanade 0 0%
Quai de chargement 10 20%
Pont, tunnel 0 0%
Entre, sortie 5 10%
Impasse 0 0%
2. MATERIEL UTILISE
Vlo, cyclomoteur 0 0%
Moto 2 4%
Vhicule lger 35 70%
Vhicule utilitaire 5 10%
Porteur 0 0%
Tracteur 0 0%
Semi - remorque 6 12%
Remorque seule 2 4%
3. LIEU
Rue, avenue, boulevard1 8 36%
Voie communale 3 6%
Route, RD, RN 15 30%
Voie expresse, rocade 0 0%
Autoroute 2 4%
Voie prive, chemin 0 0%
Aire de stationnement 9 18%
Dans l'entreprise 0 0%
Chez un client, fournisseur 3 6%
Chantier, zone de travail 0 0%
Tout terrain 0 0%
HEURES, JOURS etc..
8. CIRCONSTANCES
Avec un tiers prcdent 10 20%
Avec un tiers suivant 2 4%
Avec un tiers venant de ct 2 4%
Avec un tiers venant de face 1 2%
En dpassant, en tant
dpass 6 12%
En manuvrant, en reculant 21 42%
En sortant de la route 4 8%
En tant en stationnement 3 6%
En perdant un chargement
En ouvrant une porte 1 2%
En circulant (autres cas)
1. CONTEXTE
En mission habituelle 30 60%
En mission occasionnelle 12 24%
En mission intrimaire 8 16%
En trajet domicile - travail 0 0%
En activit personnelle 0 0%
4. CONFIGURATION
Ligne droite 25 50%
Intersection 6 12%
Rond point 1 2%
Courbe 2 4%
Bretelle d'accs 1 2%
En pis 0 0%
Place, cour, esplanade 0 0%
Quai de chargement 10 20%
Pont, tunnel 0 0%
Entre, sortie 5 10%
Impasse 0 0%
2. MATERIEL UTILISE
Vlo, cyclomoteur 0 0%
Moto 2 4%
Vhicule lger 35 70%
Vhicule utilitaire 5 10%
Porteur 0 0%
Tracteur 0 0%
Semi - remorque 6 12%
Remorque seule 2 4%
3. LIEU
Rue, avenue, boulevard1 8 36%
Voie communale 3 6%
Route, RD, RN 15 30%
Voie expresse, rocade 0 0%
Autoroute 2 4%
Voie prive, chemin 0 0%
Aire de stationnement 9 18%
Dans l'entreprise 0 0%
Chez un client, fournisseur 3 6%
Chantier, zone de travail 0 0%
Tout terrain 0 0%
HEURES, JOURS etc..
Utiliser tous les rtroviseurs (gauche et droit)
Balayer frquemment du regard
Regarder par dessus l'paule (changements de file)
Lancer le regard loin devant
Descendre / se retourner pour manuvrer62 %
Se faire guider
Dsembuer, dgivrer, dgager les vitres
Prserver son espace de scurit :
A l'arrt (voir les roues du vhicule de devant)
A l'avant (2 secondes d'cart minimum)48%
A l'arrire du vhicule (porte faux)
Au dessus du vhicule (gabarit)
Au dessous (ralentir ou viter)
Sur les cts (l'espace d'une portire)
Au dmarrage (attendre 2 secondes)
Conserver toute partie du corps l intrieur
Mieux positionner le vhicule sur la chausse
viter le cumul de tches
Prvoir et regarder lchappatoire
Adapter l'allure aux circonstances
Imaginer le scnario le plus dfavorable
Prparer le pied face au frein l'approche dun risque
Tenir compte de la signalisation, du code de la route
S'assurer d'tre vu et compris des tiers
Stationner en prparant le dpart14%
Stationner en scurit (frein, cale, lieu sr)
Fermer le vhicule clef
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
7.4 Faire voluer sa politique de prvention
Dfinir alors la stratgie de l'entreprise au regard du risque circulation dpendra, en fait,
des solutions qui reviennent le plus souvent dans les fiches danalyse.
Ces solutions sont de quatre ordres :
le matriel,
l'environnement interne l'entreprise,
son organisation,
et le comportement (voir fiche danalyse daccident).
Si elles concernent principalement le chapitre matriel, c'est le signe que lachat
dquipements ou un nouveau cahier des charges pour les vhicules sont
vraisemblablement ncessaires.
Si elles relvent de lenvironnement interne, des amnagements ou une meilleure
signalisation simposent.
Si les solutions sont lies lorganisation, un changement des procdures doit prvaloir.
Enfin, si le comportement est rgulirement identifi comme une solution, des consignes
ou une information cible permettent d'y remdier.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
8 LA GESTION GLOBALE
DU RISQUE CIRCULATION DANS L'ENTREPRISE
8.1 Rappel des points essentiels
Appliquer les procdures dcrites dans les chapitres prcdents revient, en fait,
apporter une rponse deux questions : Quels sont les risques ? Et, quelles solutions
mettre en uvre en priorit pour en rduire le nombre ?
En ajoutant l'difice ainsi construit les quelques points, le plus souvent de bon sens,
contenus dans ce dernier chapitre, l'entreprise disposera d'une stratgie d'action efficace
contre l'inscurit routire. Bien qu'elle require des comptences multiples, la mission du
gestionnaire de risques peut tre dfinie, sur le papier, de faon trs simple : minimiser le
poste de charges que constitue le risque.
Rappelons, que le cot total du risque (CTR) se calcule, gnralement pour 12 mois selon la
formule qui suit :
CTR = Total des dommages transfrs + Total des dommages internes + Total des dpenses
de protection + Total des dpenses de prvention.
Les dpenses de protection correspondent aux achats d'quipement qui, certes n'empchent
pas l'accident, mais en limitent les consquences (air-bag, barrires, casques...). Les dpenses
de prvention correspondent aux investissements raliss pour viter la survenance des
accidents (information, formation, salaire du gestionnaire de risques...). Selon la taille de
l'entreprise, le CTR peut se chiffrer en millions deuro. La responsabilit premire du
gestionnaire de risques est donc de prsenter, la fin de lanne, un CTR infrieur celui de
la prcdente.
8.2 Prendre en compte tous les risques
l'vidence, le gestionnaire de risques ne va pas s'attacher qu'aux seuls accidents de
circulation. D'autres activits de l'entreprise gnrent galement des risques. Ainsi
convient-il de traiter, de la mme faon, les accidents de manutention, les chutes, les
litiges marchandises, les accidents lectriques, le risque chimique et bien d'autres.
L'avantage de la mthode Cristal est qu'elle s'adapte facilement tous les types de
risques. En effet, pour chacun, on retrouve un schma de prvention identique avec des
solutions lies au matriel, l'environnement interne, l'organisation et, enfin, au
comportement.
Comprendre la gense de toutes ces catgories de dommages dcoule de la mme logique
d'analyse. Seules les rubriques de leur fiche d'analyse changent. Enfin, il convient de calculer
chaque anne, selon le mme principe, le CTR spcifique chaque risque puis le cot global
de l'ensemble.
Conue comme un aide-mmoire des thmes abords au fil des chapitres prcdents, la fiche
pratique du modle suivant peut s'utiliser comme une check-list des diffrentes actions
possibles pour grer au mieux son risque circulation.
8.3 Liste des actions de prvention possibles
Voir les quatre pages suivantes
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
Aide la dfinition du plan dactions
1) Prsentation gnrale
tablissement concern : .
Adresse : ..
Activit :
Ce plan daction est tudi par : ...Foncti on : .. Date de ralisation :
Autres informati ons : ..
2) Mes notes
Approche pluridisciplinaire :
Technique Humaine Organisationnelle
1
Prvention du risque routier :
pistes pour un plan dactions
Aide la dfinition du plan dactions
1) Prsentation gnrale
tablissement concern : .
Adresse : ..
Activit :
Ce plan daction est tudi par : ...Foncti on : .. Date de ralisation :
Autres informati ons : ..
2) Mes notes
Approche pluridisciplinaire :
Technique Humaine Organisationnelle
1
Prvention du risque routier :
pistes pour un plan dactions
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
MANAGEMENT - COMMUNICATION
Implicati on de la Directi on
- Officialisation dune charte qualit / scurit qui englobe tous les risques dont le risque routier.
- Engagement de la Direction par la diffusion dune directive scurit spcifique (valeurs essentielles de prvention).
Mise en pl ace dindi cateurs et doutils d analyse
- Affichage des rsultats scurit routire, suivi des i ndicateurs , information du personnel sur les causes dacci dents.
- Procdure de dclaration et de recueil d information pour tout accident de la route, mme le plus bnin.
- Analyse des acci dents, suivie de mesures de prvention ci blant les facteurs de risques.
- Les accidents de la route sont tudis par le CHSCT.
Sensi bilisati on du personnel
- Elaboration et diffusion d un guide du conducteur de l entreprise.
- Messages de scurit diffuss rgulirement par affi ches, journal inter ne, vido, ou I ntranet .
- Sances de sensibilisation du personnel par un prestat aire externe.
- Test dvaluation des connaissances du risque routier ou confrences sur le mme thme.
- Procdures de sensibilisation aux risques routier : nouveaux embauchs, intrimaires, visiteurs.
Informati ons sur l es condi tions de circul ation
- Transmission au personnel des informations relatives la mto, au trafi c, aux travaux
- Accs Internet pour la prparation des missions : itinraires, pl an d accs, dure du dpl acement .
- Affichage dune carte rgionale des tr ajets domicile - tr avail, identification de secteurs dangereux.
- Plan d accs pour tous les visiteurs, stagiaires, clients, livreurs.
ORGANISATION DU TRAVAIL, DES HORAIRES
Initi atives pour rduire lexposi tion aux ri sques
- Mise en place dun systme de visio-confrence.
- Dfinition et respect de critres dopportunit propos des dplacements.
- Regroupement gographique des dplacements (dplacements en tourne et non en marguerite)
Choix de mode de dplacement plus srs
- Lentreprise fait le choix et dcide pour son personnel des moyens de dplacement les plus srs.
- Incit ation utiliser en priorit les transports collectifs, le train, l avion.
- Utilisation prfrentielle des autoroutes.
Planification des dplacements
- Lattitude l aisse chacun dans l a planifi cation de ses dplacements ou de ses rendez-vous.
- Reconnaissance relle du temps de conduite comme un temps de travail.
- Souplesse pour l a prise en char ge des frais d hber gement en vue du respect des temps de conduite.
Gestion des relati ons cli ent - fournisseur - sige
- Clause spcifi que de prvention dans les contr ats client / fournisseurs comportant des dplacements routiers.
- Dfinition et respect par les itinrants des consignes qui concernent lusage du tlphone.
- Existence dune procdure connue en cas di mprvu, de retard, de panne ou dacci dent .
2
Prvention du risque routier :
pistes pour un plan dactions
MANAGEMENT - COMMUNICATION
Implicati on de la Directi on
- Officialisation dune charte qualit / scurit qui englobe tous les risques dont le risque routier.
- Engagement de la Direction par la diffusion dune directive scurit spcifique (valeurs essentielles de prvention).
Mise en pl ace dindi cateurs et doutils d analyse
- Affichage des rsultats scurit routire, suivi des i ndicateurs , information du personnel sur les causes dacci dents.
- Procdure de dclaration et de recueil d information pour tout accident de la route, mme le plus bnin.
- Analyse des acci dents, suivie de mesures de prvention ci blant les facteurs de risques.
- Les accidents de la route sont tudis par le CHSCT.
Sensi bilisati on du personnel
- Elaboration et diffusion d un guide du conducteur de l entreprise.
- Messages de scurit diffuss rgulirement par affi ches, journal inter ne, vido, ou I ntranet .
- Sances de sensibilisation du personnel par un prestat aire externe.
- Test dvaluation des connaissances du risque routier ou confrences sur le mme thme.
- Procdures de sensibilisation aux risques routier : nouveaux embauchs, intrimaires, visiteurs.
Informati ons sur l es condi tions de circul ation
- Transmission au personnel des informations relatives la mto, au trafi c, aux travaux
- Accs Internet pour la prparation des missions : itinraires, pl an d accs, dure du dpl acement .
- Affichage dune carte rgionale des tr ajets domicile - tr avail, identification de secteurs dangereux.
- Plan d accs pour tous les visiteurs, stagiaires, clients, livreurs.
ORGANISATION DU TRAVAIL, DES HORAIRES
Initi atives pour rduire lexposi tion aux ri sques
- Mise en place dun systme de visio-confrence.
- Dfinition et respect de critres dopportunit propos des dplacements.
- Regroupement gographique des dplacements (dplacements en tourne et non en marguerite)
Choix de mode de dplacement plus srs
- Lentreprise fait le choix et dcide pour son personnel des moyens de dplacement les plus srs.
- Incit ation utiliser en priorit les transports collectifs, le train, l avion.
- Utilisation prfrentielle des autoroutes.
Planification des dplacements
- Lattitude l aisse chacun dans l a planifi cation de ses dplacements ou de ses rendez-vous.
- Reconnaissance relle du temps de conduite comme un temps de travail.
- Souplesse pour l a prise en char ge des frais d hber gement en vue du respect des temps de conduite.
Gestion des relati ons cli ent - fournisseur - sige
- Clause spcifi que de prvention dans les contr ats client / fournisseurs comportant des dplacements routiers.
- Dfinition et respect par les itinrants des consignes qui concernent lusage du tlphone.
- Existence dune procdure connue en cas di mprvu, de retard, de panne ou dacci dent .
2
MANAGEMENT - COMMUNICATION
Implicati on de la Directi on
- Officialisation dune charte qualit / scurit qui englobe tous les risques dont le risque routier.
- Engagement de la Direction par la diffusion dune directive scurit spcifique (valeurs essentielles de prvention).
Mise en pl ace dindi cateurs et doutils d analyse
- Affichage des rsultats scurit routire, suivi des i ndicateurs , information du personnel sur les causes dacci dents.
- Procdure de dclaration et de recueil d information pour tout accident de la route, mme le plus bnin.
- Analyse des acci dents, suivie de mesures de prvention ci blant les facteurs de risques.
- Les accidents de la route sont tudis par le CHSCT.
Sensi bilisati on du personnel
- Elaboration et diffusion d un guide du conducteur de l entreprise.
- Messages de scurit diffuss rgulirement par affi ches, journal inter ne, vido, ou I ntranet .
- Sances de sensibilisation du personnel par un prestat aire externe.
- Test dvaluation des connaissances du risque routier ou confrences sur le mme thme.
- Procdures de sensibilisation aux risques routier : nouveaux embauchs, intrimaires, visiteurs.
Informati ons sur l es condi tions de circul ation
- Transmission au personnel des informations relatives la mto, au trafi c, aux travaux
- Accs Internet pour la prparation des missions : itinraires, pl an d accs, dure du dpl acement .
- Affichage dune carte rgionale des tr ajets domicile - tr avail, identification de secteurs dangereux.
- Plan d accs pour tous les visiteurs, stagiaires, clients, livreurs.
ORGANISATION DU TRAVAIL, DES HORAIRES
Initi atives pour rduire lexposi tion aux ri sques
- Mise en place dun systme de visio-confrence.
- Dfinition et respect de critres dopportunit propos des dplacements.
- Regroupement gographique des dplacements (dplacements en tourne et non en marguerite)
Choix de mode de dplacement plus srs
- Lentreprise fait le choix et dcide pour son personnel des moyens de dplacement les plus srs.
- Incit ation utiliser en priorit les transports collectifs, le train, l avion.
- Utilisation prfrentielle des autoroutes.
Planification des dplacements
- Lattitude l aisse chacun dans l a planifi cation de ses dplacements ou de ses rendez-vous.
- Reconnaissance relle du temps de conduite comme un temps de travail.
- Souplesse pour l a prise en char ge des frais d hber gement en vue du respect des temps de conduite.
Gestion des relati ons cli ent - fournisseur - sige
- Clause spcifi que de prvention dans les contr ats client / fournisseurs comportant des dplacements routiers.
- Dfinition et respect par les itinrants des consignes qui concernent lusage du tlphone.
- Existence dune procdure connue en cas di mprvu, de retard, de panne ou dacci dent .
2
Prvention du risque routier :
pistes pour un plan dactions
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
VEHICULES
Critres de choix des vhicul es de lentreprise
- Tous les vhicules qui ps d ABS, dair-bag, de climatisation, de commande radio au volant .
- Prise en compte des charges transportes, grille de spar ation avec lhabit acle, systme d attache ...
- Consultation des utilisateurs avant l achat ou la location de nouveaux vhi cules.
Modrati on de la vitesse
- Tous les vhicules qui ps de rgul ateur / limiteur de vitesse.
- Utilisation de vhi cules de puissance conventionnelle.
- Rappel des sanctions encourues en cas d infraction.
Etat des vhicules du parc
- Rvisions et entretien prventif trs suivi.
- Vhicules en location longue dure incluant un contrat d entretien avec un contrle priodique.
- Carnet de suivi de l entretien du vhicule et procdure crite pour signaler les anomalies.
Vhicul es du personnel
- Aide financire au contrle techni que des vhi cules personnels.
- Organisation de journes diagnostic - scurit par un professionnel.
- Mise disposition dune station de gonfl age, de nettoyage, de liqui de l ave glace et dhuile moteur.
CONDUCTEURS
Perfecti onnement la condui te
- Formation et mise en place de formateurs internes l entreprise.
- Stage de perfectionnement la conduite. Audits de conduite.
- Formations spcifi ques : 2 roues, vhi cules utilitaires, conduite de nuit
- Sances de sensibilisation aux risques routiers.
Risque routier et nouveaux embauchs
- Dur ant l a priode dintgration : information sur li mportance du risque routier en mission et en trajets.
- Rubrique risque routier dans le livret d accueil .
- Mise en relation avec le correspondant prvention charg de l information sur le risque routier.
Apti tude la condui te
- Test d valuation des candidats l embauche pour des postes itinrants.
- Examen mdi cal approfondi.
- Prise en compte, par le mdeci n du tr avail , du risque routier dans l a fi che d aptitude.
Permis de condui re
- Aide financire pour partici per des stages de rcupr ation de points.
- Contrle priodique de l a validit du per mis, ou des per mis.
- Contrle des connaissances du code de l a route.
3
Prvention du risque routier :
pistes pour un plan dactions
VEHICULES
Critres de choix des vhicul es de lentreprise
- Tous les vhicules qui ps d ABS, dair-bag, de climatisation, de commande radio au volant .
- Prise en compte des charges transportes, grille de spar ation avec lhabit acle, systme d attache ...
- Consultation des utilisateurs avant l achat ou la location de nouveaux vhi cules.
Modrati on de la vitesse
- Tous les vhicules qui ps de rgul ateur / limiteur de vitesse.
- Utilisation de vhi cules de puissance conventionnelle.
- Rappel des sanctions encourues en cas d infraction.
Etat des vhicules du parc
- Rvisions et entretien prventif trs suivi.
- Vhicules en location longue dure incluant un contrat d entretien avec un contrle priodique.
- Carnet de suivi de l entretien du vhicule et procdure crite pour signaler les anomalies.
Vhicul es du personnel
- Aide financire au contrle techni que des vhi cules personnels.
- Organisation de journes diagnostic - scurit par un professionnel.
- Mise disposition dune station de gonfl age, de nettoyage, de liqui de l ave glace et dhuile moteur.
CONDUCTEURS
Perfecti onnement la condui te
- Formation et mise en place de formateurs internes l entreprise.
- Stage de perfectionnement la conduite. Audits de conduite.
- Formations spcifi ques : 2 roues, vhi cules utilitaires, conduite de nuit
- Sances de sensibilisation aux risques routiers.
Risque routier et nouveaux embauchs
- Dur ant l a priode dintgration : information sur li mportance du risque routier en mission et en trajets.
- Rubrique risque routier dans le livret d accueil .
- Mise en relation avec le correspondant prvention charg de l information sur le risque routier.
Apti tude la condui te
- Test d valuation des candidats l embauche pour des postes itinrants.
- Examen mdi cal approfondi.
- Prise en compte, par le mdeci n du tr avail , du risque routier dans l a fi che d aptitude.
Permis de condui re
- Aide financire pour partici per des stages de rcupr ation de points.
- Contrle priodique de l a validit du per mis, ou des per mis.
- Contrle des connaissances du code de l a route.
3
VEHICULES
Critres de choix des vhicul es de lentreprise
- Tous les vhicules qui ps d ABS, dair-bag, de climatisation, de commande radio au volant .
- Prise en compte des charges transportes, grille de spar ation avec lhabit acle, systme d attache ...
- Consultation des utilisateurs avant l achat ou la location de nouveaux vhi cules.
Modrati on de la vitesse
- Tous les vhicules qui ps de rgul ateur / limiteur de vitesse.
- Utilisation de vhi cules de puissance conventionnelle.
- Rappel des sanctions encourues en cas d infraction.
Etat des vhicules du parc
- Rvisions et entretien prventif trs suivi.
- Vhicules en location longue dure incluant un contrat d entretien avec un contrle priodique.
- Carnet de suivi de l entretien du vhicule et procdure crite pour signaler les anomalies.
Vhicul es du personnel
- Aide financire au contrle techni que des vhi cules personnels.
- Organisation de journes diagnostic - scurit par un professionnel.
- Mise disposition dune station de gonfl age, de nettoyage, de liqui de l ave glace et dhuile moteur.
CONDUCTEURS
Perfecti onnement la condui te
- Formation et mise en place de formateurs internes l entreprise.
- Stage de perfectionnement la conduite. Audits de conduite.
- Formations spcifi ques : 2 roues, vhi cules utilitaires, conduite de nuit
- Sances de sensibilisation aux risques routiers.
Risque routier et nouveaux embauchs
- Dur ant l a priode dintgration : information sur li mportance du risque routier en mission et en trajets.
- Rubrique risque routier dans le livret d accueil .
- Mise en relation avec le correspondant prvention charg de l information sur le risque routier.
Apti tude la condui te
- Test d valuation des candidats l embauche pour des postes itinrants.
- Examen mdi cal approfondi.
- Prise en compte, par le mdeci n du tr avail , du risque routier dans l a fi che d aptitude.
Permis de condui re
- Aide financire pour partici per des stages de rcupr ation de points.
- Contrle priodique de l a validit du per mis, ou des per mis.
- Contrle des connaissances du code de l a route.
3
Prvention du risque routier :
pistes pour un plan dactions
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
INFRASTRUCTURES
Les accs l entreprise
- Entres et sortie des vhicules spares.
- Accs distincts piton/vhicules.
- Accs distincts vhicules personnels /vhicules de livraison.
- Zone trs large pour la circul ation et les manuvres des poids lourds.
Le plan de circulation
- Plan af fich lentre de l entreprise.
- Limitation au maximum des croisements de flux : pitons, vhicules, chariots lvateurs.
- Instaur ation de sens uni ques de la cir culation lorsque cest possible.
- Mise en vi dence des croisements de flux lorsquils ne peuvent pas tre limins (peint ure ausol, panneaux ).
- Voies pitonnes rserves et couvertes.
- Mise jour rgulirement de consignes de scurit crites.
Les parkings
- Emplacements matri aliss des places de stationnement avec butoir pour les roues arrires.
- Instaur ation du stationnement en marche arrire (pour repartir en marche avant).
- Nombre suffisant de places, abri 2 roues, places visiteurs .
- cl airage satisfaisant, bonne visibilit.
- Revtement du sol en bon t at.
- Signalisation horizontale et verti cale bien adapte, panneaux dorientation cl airs.
- Entretien correspondant aux conditions mto (vacuation d eau, dnei gement, protection contre le vent )
TRAJET DOMICILE - TRAVAIL
Restauration d entrepri se
- Le restaur ant d entreprise est utilis par l a majorit du personnel.
- Plusieurs autres possibilits de restauration sur pl ace (coin cuisine, micro-onde, distributeurs automati ques).
- Partenariat ngoci avec un restaurant proche.
Moyens de transport
- Service de r amassage du personnel organis par l entreprise.
- Mesures favorisant l utilisation effective des transports en commun au lieu des moyens personnels.
- Mesures pour ne pas encourager lutilisation des deux roues.
- Partenaires sociaux impliqus dans une rflexion visant rduire l exposition aux risques (mairies, DDE ).
Gestion des horaires
- Horaires flexibles, gestion personnalise du temps de travail.
- Mesures organisationnelles pour viter les flux massifs dentre et de sortie aux mmes horaires.
- Concertation avec les entreprises voisines si ncessaire.
- Clarification de l a procdure en cas de retard : prvenir et prendre le temps ncessaire.
4
Prvention du risque routier :
pistes pour un plan dactions
INFRASTRUCTURES
Les accs l entreprise
- Entres et sortie des vhicules spares.
- Accs distincts piton/vhicules.
- Accs distincts vhicules personnels /vhicules de livraison.
- Zone trs large pour la circul ation et les manuvres des poids lourds.
Le plan de circulation
- Plan af fich lentre de l entreprise.
- Limitation au maximum des croisements de flux : pitons, vhicules, chariots lvateurs.
- Instaur ation de sens uni ques de la cir culation lorsque cest possible.
- Mise en vi dence des croisements de flux lorsquils ne peuvent pas tre limins (peint ure ausol, panneaux ).
- Voies pitonnes rserves et couvertes.
- Mise jour rgulirement de consignes de scurit crites.
Les parkings
- Emplacements matri aliss des places de stationnement avec butoir pour les roues arrires.
- Instaur ation du stationnement en marche arrire (pour repartir en marche avant).
- Nombre suffisant de places, abri 2 roues, places visiteurs .
- cl airage satisfaisant, bonne visibilit.
- Revtement du sol en bon t at.
- Signalisation horizontale et verti cale bien adapte, panneaux dorientation cl airs.
- Entretien correspondant aux conditions mto (vacuation d eau, dnei gement, protection contre le vent )
TRAJET DOMICILE - TRAVAIL
Restauration d entrepri se
- Le restaur ant d entreprise est utilis par l a majorit du personnel.
- Plusieurs autres possibilits de restauration sur pl ace (coin cuisine, micro-onde, distributeurs automati ques).
- Partenariat ngoci avec un restaurant proche.
Moyens de transport
- Service de r amassage du personnel organis par l entreprise.
- Mesures favorisant l utilisation effective des transports en commun au lieu des moyens personnels.
- Mesures pour ne pas encourager lutilisation des deux roues.
- Partenaires sociaux impliqus dans une rflexion visant rduire l exposition aux risques (mairies, DDE ).
Gestion des horaires
- Horaires flexibles, gestion personnalise du temps de travail.
- Mesures organisationnelles pour viter les flux massifs dentre et de sortie aux mmes horaires.
- Concertation avec les entreprises voisines si ncessaire.
- Clarification de l a procdure en cas de retard : prvenir et prendre le temps ncessaire.
4
INFRASTRUCTURES
Les accs l entreprise
- Entres et sortie des vhicules spares.
- Accs distincts piton/vhicules.
- Accs distincts vhicules personnels /vhicules de livraison.
- Zone trs large pour la circul ation et les manuvres des poids lourds.
Le plan de circulation
- Plan af fich lentre de l entreprise.
- Limitation au maximum des croisements de flux : pitons, vhicules, chariots lvateurs.
- Instaur ation de sens uni ques de la cir culation lorsque cest possible.
- Mise en vi dence des croisements de flux lorsquils ne peuvent pas tre limins (peint ure ausol, panneaux ).
- Voies pitonnes rserves et couvertes.
- Mise jour rgulirement de consignes de scurit crites.
Les parkings
- Emplacements matri aliss des places de stationnement avec butoir pour les roues arrires.
- Instaur ation du stationnement en marche arrire (pour repartir en marche avant).
- Nombre suffisant de places, abri 2 roues, places visiteurs .
- cl airage satisfaisant, bonne visibilit.
- Revtement du sol en bon t at.
- Signalisation horizontale et verti cale bien adapte, panneaux dorientation cl airs.
- Entretien correspondant aux conditions mto (vacuation d eau, dnei gement, protection contre le vent )
TRAJET DOMICILE - TRAVAIL
Restauration d entrepri se
- Le restaur ant d entreprise est utilis par l a majorit du personnel.
- Plusieurs autres possibilits de restauration sur pl ace (coin cuisine, micro-onde, distributeurs automati ques).
- Partenariat ngoci avec un restaurant proche.
Moyens de transport
- Service de r amassage du personnel organis par l entreprise.
- Mesures favorisant l utilisation effective des transports en commun au lieu des moyens personnels.
- Mesures pour ne pas encourager lutilisation des deux roues.
- Partenaires sociaux impliqus dans une rflexion visant rduire l exposition aux risques (mairies, DDE ).
Gestion des horaires
- Horaires flexibles, gestion personnalise du temps de travail.
- Mesures organisationnelles pour viter les flux massifs dentre et de sortie aux mmes horaires.
- Concertation avec les entreprises voisines si ncessaire.
- Clarification de l a procdure en cas de retard : prvenir et prendre le temps ncessaire.
4
Prvention du risque routier :
pistes pour un plan dactions
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
9 LA CIRCULATION : FICHES D'INFORMATION
9.1 L'alcool et la conduite
Selon la loi du 12 juin 2003 et plus spcifiquement le dcret de 11 juillet 2003, tout
conducteur contrl avec un taux suprieur 0,5 g dalcool par litre de sang (ou 0,25
mg par litre dair expir), est passible dun retrait de 6 points sur son permis. En juillet
2004, ce seuil a mme tait rduit 0,2 g dalcool par litre de sang pour les
conducteurs de transport en commun.
Les faits Comment faire changer les choses ?
Seulement 3% des conducteurs circulent
avec un taux dalcoolmie suprieur 0,8 g
par litre de sang, mais ils sont impliqus
dans 40 % des accidents de la route
mortels.
Tout le monde est concern. Au restaurant
vous pouvez commander des demi-
bouteilles de vin contenant 37 ml, ce qui
correspond une consommation correcte
pour deux convives.
Aprs avoir bu, un conducteur se sent
toujours en parfait tat pour prendre le
volant. Lalcool, mme en petite quantit,
provoque une sensation de bien tre et de
confiance en soi.
Aprs avoir bu mme en faible quantit,
mfiez-vous de vos sensations et prenez en
compte lavis des autres. Passez le volant
quelquun qui naura pas bu.
Le taux lgal dalcoolmie est de 0,5 g/l. Ce
taux est atteint aprs deux consommations
au bar. Par exemple : 2 verres de vins ou 1
apritif et 1 verre de vin.
Comptez le nombre de verres que vous
consommez. Attention, les doses prises chez
soit correspondent souvent au doubles des
doses servies dans un bar.
Lalcool slimine lentement. Lorganisme
limine environ 0,15 g dalcool par heure.
Aprs 6 verres dalcool pris le soir, un
conducteur possde un taux dalcoolmie
rprhensible lorsquil prend la route le
lendemain matin.
quipez vos vhicules de dthylotests
chimiques jetables. Tous ces appareils ne
sont pas obligatoirement certifis. Ceux qui
le sont doivent tre conformes la norme
NF X 20-702.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
9.2 La circulation sur les chantiers
Les faits Comment faire changer les choses ?
Les voies tablies sur les chantiers pour une
dure dutilisation suprieure ou gale
deux ans sont considres comme des
routes. Elles doivent rpondre aux conditions
de circulation exiges par le code de la
route.
tablir une signalisation pour indiquer les
croisements, les points dangereux, le sens
de circulation, les limitations de vitesse et les
interdictions diverses.
Dfinir des voies principales prioritaires et
des voies secondaires comportant des
panneaux STOP.
Les pistes tablies sur les chantiers pour une
dure suprieure deux semaines doivent
tre prpares supporter un trafic de poids
lourds.
tablir les pistes sur une bande de terrain
nivele et compacte quipe dun systme
dvacuation des eaux dans les points bas.
Arroser frquemment les pistes par temps
sec afin dabattre la poussire.
Le conducteur se considre sur une voie de
circulation si celle-ci conserve les mmes
caractristiques tout le long du trajet (mme
largeur, mme aspect...).
Adapter la largeur des voies en fonction de
la taille des engins et conserver cette
largeur pour les ponts provisoires.
Ne pas dpasser des pentes de 10 %.
La nuit, la vision du conducteur se porte
essentiellement au niveau du sol. Toute la
signalisation verticale est invisible la nuit.
clairer les intersections la nuit.
clairer les lignes lectriques ariennes.
Placer des gabarits sur la voie de part et
dautre de leur traverse.
Toute perturbation du trafic augmente le
risque daccident.
Privilgier le sens unique de circulation et
interdire la circulation en marche arrire sur
toutes les voies.
Interdire le stationnement en dehors des
zones prvues cet effet.
Les accidents mortels impliquent le plus
souvent un piton. En raison du bruit sur le
chantier, les pitons peroivent mal les
avertisseurs sonores des vhicules ou ny
prtent plus attention avec le temps.
Interdire la circulation des pitons sur les
voies servant aux engins.
Equiper si possible les engins dun panier de
recueil lavant et larrire.
Partie 7 Limiter le risque circulation routire
9.3 Les rfrences des articles de loi qui concernent
les accidents de la route dans le cadre professionnel
Dans le code du travail :
Obligation de protection des risques professionnels : art. L.230.2
Obligation dvaluation des risque (document unique) : art. R.263.1.1
Dans le code pnal :
Atteinte involontaire la vie dautrui : art. 221-6
Exposition un risque : art. 223-1
Dans le code de la scurit sociale (source INRS):
Prvention du risque routier au travail : texte du 05-11-03
Prvenir les accidents routiers de trajet : texte du 28-01-04
Les valeurs essentielles et bonnes pratiques : document de fvrier 03
Dans le code de la route :
En plus de la responsabilit pcuniaire du conducteur, il peut y avoir une responsabilit
pcuniaire de lemployeur, en tant que commettant du conducteur (art. L.121-1) ou en
tant que titulaire du certificat dimmatriculation du vhicule (art. L.121-2).
PARTIE 8
DIMINUER LES COTS GRCE
UNE MEILLEURE SCURIT
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
1 LES COTS DE SCURIT
2 EN LIMITANT LES RISQUES
2.1 Identifier ses risques
2.1.1 tudier la documentation
2.1.2 Mener des entretiens
2.2 Estimer ses risques
2.3 Classer ses risques
2.4 Mettre en place des mesures de prvention
2.5 Mettre en place des moyens de protection
2.5.1 Moyens de protection les plus courants
2.5.2 Deux outils particuliers
3 EN MATRISANT LES DPENSES DE SCURIT
4 EN NGOCIANT LES ASSURANCES
4.1 Les contrats
4.2 La dclaration
5 EN CONTRLANT LE MONTANT OU EN NGOCIANT UNE
BAISSE DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL
5.1 Accident du travail/accident de trajet : dfinitions
5.2 Les cotisations
5.3 Les ristournes et minorations et les majorations
6 EXEMPLE DE DIMINUTION DES COTS GRCE UNE
MEILLEURE SCURIT
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
1 LES COTS DE SCURIT
Toute organisation (entreprise industrielle ou commerciale, association, socit de
service, communaut urbaine) est une combinaison dynamique de ressources
humaines, techniques, commerciales et financires organises pour atteindre ou
maintenir un objectif.
Cette organisation doit faire face de nombreux risques susceptibles de rduire ou
dendommager ses ressources et de lempcher datteindre ses objectifs. La
dtrioration ou la destruction des composantes essentielles de lorganisation peut
mme avoir pour consquence sa disparition.
La fonction de la politique de scurit est de garantir la prennit de lorganisation,
quels que soient les vnements qui la touchent et les pertes qui en dcoulent, dans les
meilleures conditions de cot.
Les risques taient traditionnellement classs en :
risques dentreprise, risques volontairement pris par lentreprise dans lespoir dun
gain, mais pouvant entraner des pertes ;
risques accidentels, risques subis ne pouvant occasionner que des pertes.
Limbrication de plus en plus forte entre ces deux types de risques (flux tendus, externalisation,
concentration, grves, pollutions) conduit aujourdhui privilgier une rpartition en quatre
classes de risques :
les risques de personne (lis aux ressources humaines) ;
les risques de dommages aux biens (lis aux ressources matrielles) ;
les risques de responsabilit (lis aux ressources commerciales) ;
et les risques de pertes de revenu (lis aux ressources financires).
En rsum, une bonne scurit est une scurit qui se proccupe de tous les risques de
lorganisation dans le cadre dune approche globale et transversale qui prend en
compte la stratgie de lorganisation (ses objectifs) et qui est adapte ses moyens
financiers.
Les cots supports pour la scurit sont les cots :
de fonctionnement du service scurit et des consultants externes ;
de rduction du risque (investissements et frais dexploitation) ;
dassurance ;
et des sinistres non indemniss par lassurance (volontairement ou involontairement).
Une bonne politique de scurit va permettre de rduire les cots supports par
lorganisation en intervenant sur les risques eux-mmes, sur les dpenses de scurit, sur les
contrats dassurance et sur les cotisations accident du travail.
Il ne faut jamais oublier que la meilleure scurit est la scurit globale adapte la stratgie
de l'organisation et compatible avec ses moyens financiers.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
2 EN LIMITANT LES RISQUES
Cest dabord sur ce point que la politique de scurit va permettre dagir.
Pour limiter les risques auxquels une organisation est expose, il faut mettre en place un
processus damlioration permanente qui comporte une succession dtapes dvaluation, de
traitement, de financement et de contrle.
Ce processus est itratif. En effet, la dernire tape (contrle) conduit reprendre la
premire tape (valuation) car certaines mesures ou certains moyens mis en place ne
permettent pas datteindre les objectifs que lon stait fixs initialement, lenvironnement
rglementaire et juridique a volu, les cots de certains quipements et services ont
chang et lorganisation a progress dans la connaissance de son mtier, de sa raison
dtre et de ses objectifs.
2.1 Identifier ses risques
La premire tape dune bonne politique de scurit est lidentification des risques. Cest
la plus importante, car la valeur du travail effectu par la suite est conditionne par la
qualit de lidentification.
En effet, le risque le plus catastrophique pour une organisation est le risque non identifi
et, par consquent, non trait et non financ.
Pour mener bien cette premire tape, il faut disposer dune bonne connaissance de
lorganisation, de son mtier, de ses objectifs, de ses mthodes de travail, de ses flux et
de ses moyens financiers.
Illustration
Par exemple, un btiment abritant une ligne de production qui fabrique des
produits en fin de vie ne prsente pas la mme importance quun btiment
identique abritant une ligne de production similaire, mais dont les produits
sont innovants et reprsentent lavenir de lentreprise. Une bonne scurit
investira beaucoup plus pour la protection du second btiment
Il est galement trs important de connatre lenvironnement juridique et culturel de
lorganisation (par exemple, les rglementations des diffrents pays dans lesquels elle
opre).
2.1.1 tudier la documentation
Afin didentifier les risques qui menacent une organisation, il va falloir tudier de nombreux
documents, dorigine interne ou externe, contenant des informations avant ou aprs sinistre,
concernant des donnes ou des comportements.
Sans que cette liste soit exhaustive, on peut citer :
des documents financiers (bilans, comptes de rsultat, plans de trsorerie, budgets) ;
des documents techniques, administratifs et commerciaux (documentation, contrats,
compte rendus, tracts) ;
des documents dexploitation (programmes de production, schmas de flux) ;
des documents concernant le personnel (bilan social) ;
des documents dassurance (contrats, sinistres) ;
des documents concernant la scurit (registres de scurit, contrles de la CRAM,
visites des pompiers ou des commissions de scurit).
Ces documents internes peuvent tre complts par des statistiques fournies par les branches
professionnelles, les rgions ou les compagnies dassurance.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
2.1.2 Mener des entretiens
A ce travail documentaire, il faut ajouter les entretiens avec diffrents responsables et
acteurs internes et externes, les check-lists , lutilisation des instruments de sret de
fonctionnement (arbre de dfaillance, diagramme cause-effet, mthode AMDEC,
Analyse des modes de dfaillance, de leurs effets et de leur criticit, mthode HAZOP,
mthode THERP), les visites de site et les simulations.
Lidentification va ainsi mettre en vidence les biens matriels et immatriels qui risquent dtre
endommags lors de la survenance des prils traditionnels que sont les risques naturels
(inondation, tempte, glissement de terrain, tremblement de terre, ouragan), lincendie,
lexplosion, le vol, les attaques sur les systmes dinformation, le bris de machine ou le dgt
des eaux.
Elle va galement permettre dtablir la liste des engagements rglementaires et
contractuels pris par lorganisation et dont le non-respect reprsente des risques de
responsabilit.
Il ne faudrait surtout pas ngliger des risques comme la perte de personnel (surtout
lorsquil sagit dhommes cls), la perte de savoir-faire, la perte de clients, les
dfaillances de fournisseurs, lespionnage industriel, le sabotage et latteinte limage
de marque.
2.2 Estimer ses risques
Lorsque les risques ont t identifis, il va falloir les estimer (on utilise parfois le terme
quantifier ), cest--dire leur attribuer une valeur. Il est courant de dire que la valeur dun
risque est le produit de sa frquence (probabilit que le risque se ralise) par sa gravit
(effets de la ralisation du risque).
valeur = frquence x gravit
Si les effets potentiels de la ralisation dun risque ne sont pas trop difficiles estimer
(en faisant appel aux experts internes et externes), il en est tout autrement de la
frquence. Lestimation de la frquence ncessite lutilisation du calcul des probabilits
ou des statistiques. Dans ce dernier cas, cela suppose un grand nombre de donnes
cohrentes, ce qui est rarement le cas au sein dune organisation.
Cest pourquoi, lapproche la plus courante consistera en lestimation dterministe des
consquences potentielles.
Dans ce cadre, le comit europen des assurances a donn une dfinition du sinistre
maximum possible (SMP) et du sinistre raisonnablement escomptable (SRE).
Le SMP est le sinistre qui peut survenir lorsque, les circonstances les plus dfavorables se
trouvant plus ou moins exceptionnellement runies, le sinistre nest arrt que par un
obstacle infranchissable ou faute daliment .
Le SRE est le sinistre qui rsulte dun vnement unique, dont ltendue est apprcie en
tenant compte de tous les facteurs, propres ou extrieurs ltablissement considr,
susceptibles daggraver ou de rduire le montant des dommages, mais en excluant les
circonstances ou concours de circonstances exceptionnelles ou catastrophiques possibles mais
peu probables .
Ces dfinitions parfaitement adaptes lincendie ou lexplosion, ne sappliquent pas
toujours aisment dautres risques comme, par exemple, le risque de responsabilit.
Pour estimer les risques de lentreprise, pralable indispensable lvaluation des
risques, il faudra procder en deux temps.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Dans un premier temps, lestimation portera sur la valeur de la ressource qui risque dtre
touche, cot de reconstruction dun btiment, montant des charges que lorganisation
devra supporter en cas darrt dactivit, valeur de remplacement dun bien, valeur des
stocks Cette estimation ne doit surtout pas tre purement comptable mais reposer
sur le cot de remplacement ou de restauration des ressources.
Dans un deuxime temps, lestimation portera sur la part des ressources qui peut tre
affecte par un sinistre.
2.3 Classer ses risques
Les risques, une fois estims, vont tre classs, hirarchiss, valus pour dterminer les
priorits de traitement. En effet, il nest jamais possible de traiter simultanment tous les
risques auxquels une organisation est expose car les ressources financires disponibles
ne sont pas illimites.
Toute organisation prsente un certain niveau dacceptabilit du risque. Tous les risques
qui se trouvent au-del de ce seuil doivent tre traits avant ceux qui sont en-de et les
risques les plus graves pour la prennit de lentreprise sont videmment prioritaires.
Pour des raisons defficacit, on classera les risques en cinq catgories depuis les moins
graves jusquaux risques catastrophiques.
Dans la premire catgorie, on mettra les risques nuls , dans la seconde, les risques
faibles (ils ne ncessitent pas de mesures coteuses ou contraignantes), dans la troisime,
les risques moyens (ils fragilisent lorganisation et ncessitent un traitement).
Les risques forts, quatrime catgorie, compromettent les prvisions de lentreprise et
doivent absolument faire lobjet dun traitement important.
Enfin, les risques catastrophiques de la cinquime catgorie entraneraient la disparition de
lentreprise et reprsentent les risques traiter prioritairement avec des outils lourds comme
les plans de survie ou la gestion de crise.
Le traitement du risque, sa rduction, peut concerner les deux composantes du risque, la
frquence et la gravit. Il faut dabord sefforcer dempcher la survenance du sinistre
(diminution de la frquence) puis, si le sinistre survient, en limiter les consquences
(diminution de la gravit).
2.4 Mettre en place des mesures de prvention
Les mesures de prvention sont toutes les mesures qui contribuent diminuer la probabilit de
survenance du sinistre ou de laccident. La prvention rduit la frquence. Pour chaque risque,
il existe des mesures de prvention appropries qui peuvent concerner les personnes, les
matriels ou lorganisation.
La multiplicit des mesures la disposition des organisations ne permet pas den faire
une liste exhaustive mais on citera nanmoins certaines mesures indispensables ou
certains principes de prvention.
Le capital humain
Latout le plus important dune organisation est son capital humain. Pour les risques quil
encourt, les mesures de prvention indispensables sont linformation sur les risques et la
formation sur les mesures prendre pour viter leur survenance ainsi que la rdaction de
procdures dexploitation sres. Les autres mesures de prvention classiques sont les
formations aux gestes et postures pour les personnes qui manipulent des objets lourds ou
encombrants, la vaccination du personnel, la conception ou ladaptation ergonomique des
postes de travail, la modification des processus dangereux, le remplacement de certains
matriaux, la ventilation, lentretien et la protection des matriels, lutilisation dEPI
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Illustration
Pour les organisations qui disposent dun parc automobile, les actions de prvention
porteront sur les vhicules (choix adapt au besoin, quipements de scurit, vrification
avant chaque voyage, remplacement avant usure), les chauffeurs (slection sur
comptence, comportement et exprience, formation continue), le chargement
(adaptation au vhicule, arrimage, adaptation litinraire), les itinraires (circulation
peu intense, courts, avec possibilits de dtournement en cas de blocage), les plannings
(temps suffisant pour le trajet et le repos ncessaire) et lentretien prventif des vhicules.
Pour le risque incendie
Pour le risque incendie, le principe est llimination dun des trois lments du triangle
du feu (combustible, comburant, source dinflammation). Cest ainsi que linterdiction de
fumer dans un local de stockage de produits combustibles a pour objectif de supprimer
la source dinflammation. Si on ne peut supprimer un des lments, une autre mesure
est la mise en place dune barrire entre les trois lments.
Les pertes dues la responsabilit
Les pertes dues la responsabilit sont les sommes dargent quune organisation paye lorsque
lon porte plainte contre elle. Le principe de la prvention sera dviter le dpt de plainte en
mettant au point un systme de gestion de la conformit et de la qualit, en tudiant avec un
conseiller juridique les moyens de dgager lorganisation de ses obligations vis--vis dautrui,
en proposant des compensations en cas de prjudice port autrui.
Les risques environnementaux
Les risques environnementaux sont de deux types, les risques lis la responsabilit
(pollution et contamination) et les risques lis la dtrioration effective de
lenvironnement (dversements, fuites, dchets). La prvention portera sur la conformit
la rglementation et sur lamlioration des processus de production.
Le risque de malveillance
Le risque de malveillance prsente une particularit. Les dommages rsultent dune
volont humaine de dtruire ou sapproprier les biens de tiers. La prvention va
sattaquer aux deux conditions initiales de toute activit criminelle, un motif et
lopportunit de raliser lacte. Les procdures de recrutement, les conditions de travail
correctes et quilibres rduisent le potentiel dactes hostiles lgard de lorganisation.
Ltablissement de barrires physiques et de procdures rduiront les opportunits.
Les pertes de revenu
Les pertes de revenu peuvent correspondre soit une diminution de recettes, soit une
augmentation de dpenses. Ces pertes sont la consquence dvnements qui ont
occasionn des sinistres lis aux biens, la responsabilit et au personnel, ces vnements
pouvant survenir au sein de lorganisation, dans son environnement direct (clients,
fournisseurs) ou indirect (vacuation de la zone o elle est implante, par exemple).
La prvention visera essentiellement viter laccident lorigine de la perte et on
retrouvera toutes les mesures dj cites prcdemment.
Dans certains cas, la prvention permettra dliminer compltement la possibilit dune
perte. Ce sera le cas lorsque lorganisation dcidera de renoncer un projet qui
prsenterait des risques trop importants (on parlera alors dvitement) ou la poursuite
dune activit dangereuse (on parlera alors dabandon). Ce sera galement le cas,
beaucoup plus courant, du transfert la sous-traitance. Il sagit dun transfert
contractuel de la responsabilit lgale et financire dun risque, ne pas confondre
avec le transfert du financement dun risque quest lassurance.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
2.5 Mettre en place des moyens de protection
Les moyens de protection sont tous les moyens qui contribuent diminuer les consquences
dun sinistre ou dun accident. La protection rduit la gravit. Comme pour la prvention, il
existe des moyens de protection adapts chaque risque et qui peuvent concerner les
personnes, les matriels ou lorganisation. Les moyens de protection agissent aprs la
survenance dun pril, mais doivent tre mis en place avant. L encore, les organisations
disposent dune trs grande varit de moyens. Comme pour la prvention, un parcours des
moyens de protection les plus courants illustrera notre propos.
2.5.1 Moyens de protection les plus courants
La protection du personnel
Pour protger le personnel, les moyens de protection indispensables sont lutilisation
dquipements de protection individuelle. Pour limiter la gravit des accidents de travail,
lorganisation mettra en place des sauveteurs secouristes du travail (SST), des quipements
adapts aux risques (couvertures, douches, masques, trousses de premiers soins, lave-ils).
Pour acclrer le retour au travail, laccent sera mis sur ladaptation du poste de travail.
Certaines organisations vont plus loin dans le traitement du risque en participant la
rducation du personnel ou de tiers.
Le risque incendie
Pour le risque incendie, les moyens de protection reposent sur une intervention la plus
prcoce possible, afin dviter la propagation du feu ou sur des dispositions, gnralement
constructives, qui auront le mme effet. A cette deuxime catgorie appartiennent le
compartimentage, le dsenfumage ou lloignement entre les diffrents btiments.
La premire catgorie comprendra la mise en place dquipes dintervention, dextincteurs
de diffrents types (eau, poudre, CO
2
), de robinets dincendie arms, de systmes
dextinction automatique (sprinkleurs ou gaz).
Pour pouvoir intervenir, il faut avoir connaissance le plus rapidement possible de la
naissance dun incendie. Cest le rle des dtecteurs dont la varit permet de rpondre
toutes les configurations (dtecteurs thermostatiques, thermovlocimtriques, de
fume, de flamme).
Pour garantir la scurit du personnel et des visiteurs, la mise en place de procdures
dvacuation et la formation des guides et serre-files est une ncessit.
Devant limportance du risque et la qualit des programmes de protection mis en place,
est apparue une nouvelle notion, celle de risque hautement protg ou RHP qui suppose
une bonne construction des btiments, une protection par sprinkleurs, une protection
externe satisfaisante (pompiers).
Pertes dues la responsabilit
Pour limiter la gravit des pertes dues la responsabilit, le principe sera la ngociation. Cette
ngociation portera sur le rglement, sur une solution autre que le procs (mdiation,
arbitrage) ou sur le choix de la juridiction (certaines sont plus favorables que dautres).
La meilleure mesure consiste rduire la gravit du prjudice par exemple en se chargeant de
la protection ou du sauvetage des biens endommags ou des soins dispenss aux personnes
qui ont subi des dommages corporels dans le cadre dun rglement ngoci.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Les risques environnementaux
Face des risques environnementaux, la protection portera sur la rduction la source
(rduire la production de polluants ou de dchets), la rutilisation ou le recyclage (avec
ou sans traitement physique ou chimique), la rcupration (pigeage des polluants
avant leur dversement ou leur dgagement dans lenvironnement), la valorisation ou
llimination.
La malveillance
La protection contre les risques de malveillance repose sur une action vigoureuse lencontre
des criminels pour les dtecter et les poursuivre. Cette stratgie sapplique tous les actes de
malveillance et tout particulirement en ce qui concerne linformatique (quipements, logiciels,
informations).
Les personnes qui commettent une malveillance partent du principe quelles ne seront
pas prises. Elles croient quelles peuvent agir en toute impunit parce que leur forfait ne
sera pas dcouvert ou quelles ne seront pas identifies, ni poursuivies.
Les deux faons de changer la perception de lorganisation comme une cible facile et toute
prte sont de renforcer les capacits de dtection et didentification des malfaiteurs (gardiens,
alarmes, chiens, projecteurs, camras) et de cooprer dans la poursuite des suspects avec les
autorits judiciaires.
Les pertes de revenu
La gravit des pertes de revenu dpend des facteurs suivants :
dure pendant laquelle lorganisation ne peut fonctionner normalement ;
volume dactivit au moment de laccident ;
degr dempchement ;
montant des dpenses extraordinaires, des frais dacclration ou des frais encourus
en raison de lempchement ;
temps ncessaire pour revenir au niveau habituel.
Pour diminuer cette gravit, il faudra donc diminuer la dure darrt en faisant appel aux
heures supplmentaires, au travail temporaire ou des back-up qui auront du tre prvus
avant la survenance dun sinistre.
Certaines mesures peuvent avoir un effet de rduction de la frquence (prvention) et de
rduction de la gravit (protection). Dautres peuvent rduire la gravit mais augmenter
la frquence.
Illustration
Ainsi, la limitation de vitesse diminue les risques daccident de la route
(perte de contrle du vhicule, freinage durgence ) mais aussi la
gravit des accidents (sortie de route, collision). La formation du
personnel a galement un effet de prvention et de protection.
En revanche, la rpartition dun stockage de matires premires sur
plusieurs sites au lieu dun seul aura pour effet de diminuer la gravit
dun sinistre potentiel mais daugmenter sa probabilit. Toutes les
mesures de sparation du risque, avec ou sans redondance, diminuent
la gravit et augmentent la frquence.
Certaines mesures peuvent modifier la nature du risque et cest pourquoi il est
important davoir toujours une vision globale. Par exemple, une protection par
systme dextinction automatique eau peut crer un risque de dgt des eaux, la
sous-traitance un risque de perte de revenu du fait dune interruption conscutive
un accident survenu chez le sous-traitant.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
2.5.2 Deux outils particuliers
On peut ajouter la liste des moyens de protection mis en place deux outils
particuliers que lon utilise dans les cas de forte gravit : le plan de continuit des
activits (on utilise encore les termes plan de survie mais la connotation est plus
ngative) et la gestion de crise.
2.5.2.1 Le plan de continuit des activits
Le plan de continuit des activits est un ensemble de mesures et de moyens mis en
place pour permettre lorganisation de continuer produire des biens ou des services
dans les meilleures conditions conomiques possibles.
Il est labor avant la ralisation dun sinistre avec la participation de toutes les
fonctions de lentreprise.
Il se compose :
dun plan de secours (sauvetage des personnes et des biens) ;
dun plan de communication (information du public, du personnel, des partenaires
sociaux, des fournisseurs, des clients) ;
dun plan marketing bis (rflexion sur les activits, les produits, la clientle, les
marchs, la distribution afin de dterminer ce que lon conserve et ce que lon
abandonne en cas de sinistre) ;
dun plan de redmarrage et dun plan de financement.
Lorganisation qui existera aprs le sinistre ne sera pas identique celle qui existait
avant le sinistre.
2.5.2.2 La gestion de crise
Lorsquun sinistre important survient, il reste rarement interne lorganisation et, au-del
du plan de continuit des activits, il convient alors denvisager une gestion de crise.
Tout comme le plan de continuit des activits, la mise en place dune gestion de crise
se prvoit avant le sinistre.
La dfinition de la crise varie selon les auteurs, mais certaines de ses caractristiques
sont reconnues par tous. Les situations de crise sont complexes, le thtre des
oprations est fragment, les repres habituels sont inoprants et les mdias amplifient
les problmes et obligent ragir en temps rel.
Les deux aspects fondamentaux de la gestion de crise sont la constitution de la cellule
de crise, structure de commandement de substitution, et la communication de crise.
La communication de crise devient un facteur stratgique de premire importance.
Elle est prcde par une communication froid en fonctionnement normal
(rencontres avec les mdias locaux, journes portes ouvertes) et par la ralisation
dun dossier de presse contenant des plans, schmas, argumentaires, rpertoires
tlphoniques
Les crises sont heureusement peu frquentes lchelle dune organisation. Il est donc
ncessaire de prvoir rgulirement des exercices de mise en situation (simulation) suivis
dune valuation. Les personnes pouvant communiquer avec les mdias doivent tre
clairement dsignes et tre entranes aux techniques de linterview filme.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
En rsum, la meilleure scurit est celle qui permet :
- de dtecter les risques par une bonne identification et donc de rduire les cots lis aux
risques non ou mal identifis ;
- de limiter la survenance des risques par une bonne prvention et donc de rduire les cots
lis la frquence des risques ;
- de limiter les effets sur les hommes, les biens et les finances de lorganisation par une bonne
protection et donc de rduire les cots lis la gravit des risques.
Il ne faut jamais oublier :
que le risque le plus grave pour une organisation est le risque non identifi ;
que les mesures de prvention sont plus faciles et plus rapides mettre en uvre et
cotent moins cher que les moyens de protection ;
mais, que ces derniers sont nanmoins indispensables pour limiter les consquences
des sinistres.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
3 EN MATRISANT LES DPENSES DE SCURIT
Les mesures de prvention et les moyens de protection reprsentent des charges et ncessitent
parfois des investissements importants. A ces dpenses, viennent sajouter tous les frais de
fonctionnement du service scurit et les factures mises par les consultants et les experts
auxquels lorganisation fait appel pour laider dans ltablissement de sa politique de scurit.
Le choix entre les diffrentes dpenses de scurit va tre fait en fonction de plusieurs critres :
efficacit par rapport aux objectifs atteindre ;
moindre cot pour atteindre le rsultat ;
dlai de mise en uvre.
Les mesures et les moyens qui seront retenus sont ceux qui minimisent le cot global du
risque ou qui optimisent le rendement des investissements.
Le principe retenir est de travailler le plus en amont possible. Par exemple, les mesures
constructives cotent beaucoup moins cher lors de la conception dun ouvrage que
quelques annes aprs son achvement.
Par ailleurs, lorsque lon met en place des mesures de scurit, les premires mesures
que lon prend ont un cot faible pour une grande efficacit, les suivantes sont un peu
plus coteuses et ont une efficacit moindre jusquau moment o les mesures
additionnelles auront un cot suprieur lconomie quelles permettraient de faire sur
les sinistres. Arriv cet optimum, ce sont les changements survenus au niveau de la
stratgie de lentreprise, de la rglementation ou des cots des instruments de traitement
(des quipements plus puissants et moins coteux apparaissent rgulirement sur le
march) qui guideront les modifications apporter la politique de scurit de
lorganisation. De plus, lusure de certains quipements mis en place conduit des
cots dentretien beaucoup trop importants.
Il faut privilgier les dpenses de scurit peu coteuses correspondant une mise en place
facile et rapide. Cest le cas de la plupart des mesures de prvention comme la formation du
personnel en gnral, et, des services de scurit en particulier (chefs de service, agents de
prvention et de surveillance, quipiers dintervention) ; la mise en place de panneaux
dinterdiction de fumer dans les locaux risque ; la rdaction de procdures
Ce nest quensuite que lon tudiera, en fonction des ressources financires disponibles,
les moyens plus lourds de la protection comme la mise en place de systmes dextinction
automatiques ; de systmes de scurit incendie ; de systmes de gestion centralise des
alarmes
Pour aller plus loin dans loptimisation des choix, il va falloir faire appel aux techniques
statistiques et financires. Les premires vont permettre dtablir des prvisions sur la
sinistralit de lorganisation, les secondes vont permettre de faire lanalyse des flux de
trsorerie actualiss.
Pour prvoir les charges lies aux sinistres futurs, plusieurs oprations savrent
ncessaires. Elles consistent rassembler et organiser les donnes concernant
lhistorique des sinistres, appliquer de faon intuitive en usant de son bon sens lanalyse
statistique et lanalyse de tendance (ces deux outils ne sont pas utilisables dans toutes les
situations, le premier correspond un schma de stabilit, le second un schma
dvolution). En particulier, la cohrence (par exemple, les valeurs doivent tre ajustes
pour tenir compte de linflation) et la pertinence des donnes utilises sont
fondamentales pour la validit des prvisions. Il ne faut pas hsiter remettre en cause
les conclusions tires si de nouvelles donnes (de nouveaux sinistres) viennent les
contredire.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
La plupart des organisations assoient leurs dcisions dinvestissement sur la maximisation de la
valeur actuelle des flux de trsorerie long terme. Lutilisation de ce critre permet de dfendre
les projets dinvestissement de scurit avec la mme logique que celle qui sert de base
toutes les dcisions de lentreprise. Lanalyse des flux de trsorerie permet de montrer limpact
de tout projet sur les flux entrants et sortants, de calculer leur valeur actuelle et dvaluer les
diffrentes solutions en terme de rendement interne.
En supposant identifis les risques de lentreprise et recenss les instruments de
traitement disponibles applicables ces risques, il sagit de rpondre la question :
quels instruments mettre en uvre dans la situation donne ?
La dmarche suivre est simple dans son esprit, beaucoup plus dlicate dans sa
ralisation.
Le premier calcul faire est lvaluation des flux sans la prise en compte des risques.
Un second calcul va introduire les risques de pertes conscutives la survenance des
prils redouts (incendie, vol, sabotage, bris de machine, inondation) sans prendre en
compte limpact des mesures envisages pour traiter le risque.
Il existe plusieurs instruments de traitement des risques la disposition de lorganisation
(prvention, protection, sparation des risques, transfert contractuel en mettant les
risques la charge dun tiers). Pour chacun de ces instruments et pour une combinaison
dinstruments, si cette solution est envisageable, un nouveau calcul des flux permettra de
mesurer leur impact et donc de choisir la solution la plus efficace conomiquement.
La meilleure scurit est celle qui permet :
- de choisir les instruments de traitement adapts la stratgie de lorganisation et donc de
rduire les cots lis linadquation des mesures et des moyens ;
- de mettre en place les instruments les plus efficaces le plus rapidement possible et donc de
rduire les cots de sur-scurit .
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
4 EN NGOCIANT LES ASSURANCES
Pour les assureurs, le risque assurable est un vnement futur dommageable de ralisation
incertaine ou, si elle est certaine, de date inconnue (cas de lassurance vie). Sa rpartition
alatoire dans le temps et dans lespace permet la mutualisation, cest--dire la rpartition
de lindemnisation des sinistrs sur une masse de cotisants non sinistrs. Pour reprendre la
devise des Lloydss, lassurance est la contribution de tous aux revers de fortune de
quelques-uns .
Lassurance est destine rparer, le plus souvent financirement, les effets de la ralisation
individuelle du risque commun un groupe dindividus, les assurs.
Le rle de lassurance sest progressivement largi et les compagnies interviennent de plus
en plus dans la prvention des risques, soit directement, soit par lintermdiaire
dorganismes spcialiss comme la Prvention routire, l'Association prvention sant (APS)
ou le CNPP.
Tous les risques ne sont pas assurables et, en particulier, sont formellement exclus la responsabilit
pnale, les amendes fiscales et les sinistres provenant dune faute intentionnelle de lassur mais
ce qui serait considr comme inassurable aujourdhui peut trs bien devenir assurable dans le
futur parce que les assureurs auront progress dans la connaissance du risque.
Les assurances de personne
Les assurances de personne ont pour objet le versement dune prestation dclenche par la
ralisation dun risque affectant la personne de lassur (dcs, accident, maladie).
En France, lassurance des accidents du travail est confie la caisse dassurance maladie.
Toute personne (hors rgimes spciaux), quelle que soit la forme ou la nature du contrat de
travail, y est assujettie.
Il reste nanmoins les assurances complmentaires, les contrats de prvoyance, les rgimes de
retraite supplmentaires et lpargne dentreprise.
Les assurances de dommages
Les assurances de dommages sont fondes sur le principe indemnitaire. Le bnficiaire sera
remis, financirement, dans ltat dans lequel il se serait trouv en labsence de sinistre,
mais sans en tirer un profit quelconque.
Lassurance de choses est la forme la plus ancienne dassurance. Le propritaire dun bien
sassure contre la destruction totale ou partielle de ce bien par un pril (incendie, bris,
vol). Il est donc possible de sassurer contre lincendie et les risques annexes (foudre,
explosion, lectricit, accidents de mnage, tempte, grle), contre le bris de machines
(machines en exploitation, systmes informatiques) ou contre le vol.
Lassurance des dommages dus des vnements naturels est un systme de couverture
particulier dfini par la lgislation franaise (calamits agricoles, catastrophes naturelles,
temptes).
Les assurances de responsabilit civile
Les assurances de responsabilit civile (il nest pas possible dassurer la responsabilit
pnale) protgent la valeur du patrimoine contre les consquences pcuniaires exposes
par la rparation due autrui des dommages causs par lassur, par les personnes dont il
rpond (enfants, employs) ou par les choses quil a sous sa garde.
Depuis 1970, de nombreuses obligations dassurance de responsabilit ont t instaures.
Elles concernent pour la plupart lassurance responsabilit civile professionnelle . Les
dommages causs lenvironnement font lobjet dune assurance de responsabilit civile.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Lassurance construction
Cest un terme gnral qui recouvre une assurance obligatoire de choses en
prfinancement pour le matre douvrage (dommages ouvrages) ; des assurances
obligatoires de responsabilit pour les participants lacte de construire (responsabilit
dcennale) ; dautres assurances non obligatoires comme la tous risques chantiers .
Lassurance pertes dexploitation
Elle couvre la marge brute pendant la priode comprise entre le sinistre et le moment o
lorganisation retrouve les rsultats quelle aurait connus sans sinistre.
En rsum :
- lassureur de dommages verse, en cas de sinistre garanti, une indemnit visant rtablir la
valeur dun patrimoine et donc dpendant du dommage ;
- lassureur de personnes verse, en cas de ralisation du risque couvert, une allocation forfaitaire
indpendante du prjudice subi.
Lassurance est, sans doute, linstrument de financement des risques le plus souvent
utilis et la principale source financire pour la remise en tat aprs des sinistres
accidentels. Pour un grand nombre dorganisations (surtout celles de petite taille),
lachat de couverture dassurance est la faon la plus fiable de disposer des fonds
ncessaires au moment voulu, surtout pour les risques dont la gravit est importante par
rapport leurs ressources propres.
Pour une organisation, lassurance est un mcanisme de transformation de dpenses futures
incertaines (en nombre et en montant) en un flux certain de sommes payes
priodiquement avec une possibilit de remboursement (indemnisation) quand le sinistre
survient.
Lassurance, en rduisant lincertitude, permet le dveloppement dactivits qui, sans elle,
seraient trop risques et contribue donc un accroissement de la productivit de la socit
en gnral.
Cependant lassurance ne fournit les moyens ncessaires pour se remettre dun sinistre que
si ce sinistre est bien dans le cadre de la garantie du contrat et dans les limites de cette
garantie.
Lassurance prsente des bnfices et des cots. Les bnfices comprennent
lindemnisation, la rduction de lincertitude, la disposition de fonds pour les
investissements, les actions de rduction des risques et, pour les petites entreprises,
une assistance. Les cots encourus en contre-partie sont lis aux frais de
fonctionnement de lassurance, aux salaires, aux frais de marketing, aux frais de
gestion et dexpertise des sinistres, aux frais de gestion de lentreprise et aux
bnfices.
4.1 Les contrats
Les engagements entre assureur et assur sont formaliss dans le cadre dun contrat crit. Tous les
contrats ont un certain nombre de points communs.
Un contrat dassurance crit est un document physique qui rassemble sous une mme
couverture un certain nombre de documents pr-imprims (conditions gnrales) ou qui est
tabli spcifiquement (intercalaire).
En sus des contrats dassurance de base, dautres documents crits, questionnaires de
souscription, conventions et avenants, spcifications de lassurance sont ajouts au
contrat et le font voluer pour quil rponde aux besoins spcifiques de lassur.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Bien quil y ait des diffrences significatives entre les diffrents contrats dassurance, les
contenus peuvent tre dcoups en cinq catgories :
les dclarations ou conditions particulires permettent de personnaliser le contrat en
identifiant lassur et en dcrivant lensemble des biens et vulnrabilits assurer (numro de
contrat, nombre de documents rattachs, montant des garanties par risque, montant des
franchises, date de prise deffet, montant de cotisation et condition de sa dtermination, assurs
additionnels ou ayant droit) ;
laccord dassurance ou tendue de la garantie dfinit ce que lassureur
accepte de couvrir en prcisant si la garantie sapplique aux dommages matriels et
immatriels conscutifs ou non. Les termes sont gnraux et lensemble des autres
documents est indispensable pour connatre ltendue exacte dune couverture ;
les exclusions liminent de la couverture des conditions ou un risque que lassureur na pas
lintention de couvrir. Lobjectif est de clarifier ltendue exacte de la couverture accorde par
lassureur et, pour viter des dconvenues ultrieures, il est particulirement important que tout
assur lise attentivement lensemble des exclusions (explicites ou implicites). Ces exclusions
permettent dliminer certaines couvertures inutiles pour un assur donn et de limiter le
montant des cotisations un niveau conomiquement raisonnable ;
les conditions indiquent les actions que lassur doit entreprendre ou veiller ce que
dautres entreprennent sil souhaite pouvoir obtenir de lassureur quil remplisse les
obligations dfinies par le contrat. On trouve entre autres, le paiement des cotisations, la
dclaration rapide des sinistres, la fourniture lassureur des documents ncessaires pour
tablir la ralit de la perte et son montant ;
les dispositions diverses traitent, en gnral, des relations entre lassureur et lassur
sans avoir la force, sur le plan juridique, des conditions. On trouvera les conditions de
rsiliation, des options de rglement de sinistre
La couverture offerte par un contrat dassurance doit tre analyse de faon dterminer les
vnements couverts, le montant maximum que lassureur payera lors de la survenance de
lvnement assur, les procdures que lassur doit respecter pour tre effectivement indemnis.
Un vnement nest couvert que si le pril, le bien ou lorigine de responsabilit, les personnes
morales ou physiques, les pertes engendres par le sinistre, la priode de garantie et le lieu de
lvnement sont couverts.
4.2 La dclaration
Lassurance est tablie sur la base des valeurs dclares par lassur. Cette dclaration
permet de dterminer le taux et le montant de la cotisation ou prime. Laccumulation des
valeurs exposes un mme sinistre est un facteur aggravant du risque et les taux appliqus
sont progressifs. La prime est le produit dun taux par un montant de capitaux assurs. Les
capitaux dclars interviennent donc doublement dans ce calcul et sont donc un lment
contractuel fondamental du contrat.
Une dclaration inexacte est sanctionne financirement par le code des assurances sous la
forme des rgles proportionnelles qui laissent une partie des consquences financires dun
sinistre la charge de lentreprise.
Lassur est indemnis dune part dans la proportion existante entre les capitaux dclars et
les capitaux existants au moment du sinistre (rgle proportionnelle de capitaux), dautre
part, sil y a lieu, dans la proportion existante entre la prime effectivement paye et celle
rsultant du taux qui aurait d tre retenu pour son calcul, sur la base de ces mmes
capitaux (rgle proportionnelle de prime), les deux rgles sappliquant en cascade.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Ceci concerne la sous-assurance de bonne foi. Si lassureur peut prouver une intention
dolosive ou frauduleuse de lassur, il y a nullit du contrat.
En cas de sur-assurance lindemnit est ajuste en fonction de la valeur relle des biens.
La valorisation des btiments et du matriel doit se faire sur la base de la valeur de
remplacement au jour du sinistre et non sur une valeur comptable qui nenregistre quune
valeur historique.
La solution rside dans lestimation par voie dexpertise pralable. Elle doit tre confie un expert
agr et tre actualise chaque anne par la mme voie. Cest le seul moyen de nature
viter toute contestation en cas de sinistre.
Pour la valorisation des stocks, lorganisation sappuiera sur ses lments comptables et
commerciaux en faisant appel son expert comptable. En cas de sinistre, lassureur
demandera des justifications et cest pourquoi il est recommand de prciser dans le contrat
les modalits retenues.
Pour ce qui concerne les assurances pertes dexploitation, la rduction de prime est lie au
raccourcissement de la priode dindemnisation. Pour viter que les assurs ne sous-
estiment la dure ncessaire au rtablissement de lentreprise, la priode dindemnisation
ne peut tre infrieure un an pour la garantie de bnfice brut.
Indpendamment des avantages dj cits au niveau du risque, la prvention et la protection
permettent dobtenir des rductions ou de ne pas subir daugmentation au niveau du montant de
la cotisation.
Peuvent ainsi avoir une influence sur le montant de la cotisation les choix au niveau des btiments
(nature de la construction, sparation entre les btiments pour rendre les risques distincts ,
compartimentage), laccumulation de valeurs, les stockages de grande hauteur, les procds
de chauffage, les installations lectriques (vrificateur agr), les moyens de premier secours
(extincteurs, RIA, service de scurit), les installations dextinction automatique (sprinkleur, CO
2
), labonnement prvention conseil auprs dun organisme agr, la prsence dun charg de
scurit ayant obtenu un agrment dlivr par le CNPP (INSSI pour lincendie, CERIC pour la
malveillance).
Un dernier lment peut faire lobjet dune ngociation entre assureur et assur, il sagit de
la franchise.
Lassurance permet le partage financier du risque entre lassureur et lassur travers la dfinition
du niveau de franchise qui fixe la part de financement conserve par lassur lors de la survenance
dun sinistre. Plus la franchise est importante, plus la prime est faible. En revanche, plus la
franchise est importante, plus la part de financement des sinistres la charge de lorganisation est
leve. Il faut donc trouver le niveau de franchise optimum pour lorganisation compte-tenu de ses
ressources financires. La dfinition du type et du niveau de franchise est un exercice difficile qui
repose sur une bonne connaissance de la sinistralit passe de lentreprise.
La meilleure scurit est celle qui permet :
- dviter la sous ou la sur-assurance par une mauvaise valuation des capitaux assurer et donc
de diminuer les cots lis aux taux et la part de sinistre restant la charge de lassur ;
- dobtenir une rduction ou dviter une majoration et donc de diminuer les cots lis au montant
de la cotisation ;
- davoir le niveau optimum de franchise et donc de diminuer les cots lis lquilibre entre le
montant de la cotisation et le montant des sinistres non indemniss.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
5 EN CONTRLANT LE MONTANT
OU EN NGOCIANT UNE BAISSE
DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL
La dfinition donne laccident dont est victime un salari a des consquences,
aussi bien pour le salari que pour lemployeur.
Sont en jeu le montant des cotisations la charge de lemployeur, les conditions
dindemnisation des salaris, les possibilits de recours contre lemployeur et
linterdiction de licencier le salari pendant larrt de travail.
5.1 Accident du travail/accident de trajet : dfinitions
Laccident de travail est, quelle quen soit la cause, un accident survenu par le fait
ou loccasion du travail, toute personne salarie ou travaillant quelque titre
que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs dentreprise (article L 411-1
du code de la scurit sociale). Il suppose que la victime est sous lautorit de
lemployeur et que les trois critres du caractre professionnel, lieu de travail,
temps de travail et existence dun lien de subordination, sont runis.
Laccident de trajet est un accident survenu un travailleur pendant le trajet aller
et retour entre ; dune part la rsidence principale, une rsidence secondaire
prsentant un caractre de stabilit ou tout autre lieu o le travailleur se rend de
faon habituelle pour des motifs dordre familial et de lieu de travail ; et dautre
part, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, dune manire plus gnrale,
le lieu o le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure o le
parcours na pas t interrompu ou dtourn pour un motif dict par lintrt
personnel et tranger aux ncessits essentielles de la vie courante ou indpendant
de lemploi (article L 411-2 du code de la scurit sociale). Les accidents de trajet
sont assimils aux accidents de travail du point de vue de la rparation.
La frontire entre accident de trajet et accident de travail nest pas toujours facile tablir,
comme dans le cas des salaris en mission, mission ponctuelle qui les loigne de leur lieu
habituel de travail ou mission des salaris non sdentaires appels se dplacer
continuellement (VRP par exemple).
La jurisprudence se base sur le critre dautorit. Lors dun accident de trajet, le salari
nest pas sous la subordination de son employeur, il nest pas encore ou il nest plus
soumis aux instructions de lemployeur.
Alors que la maladie non professionnelle entrane une simple suspension du contrat de
travail et la prise en charge du salari par la scurit sociale, les accidents de travail et
les accidents de trajet (ainsi que la maladie professionnelle) relvent des risques qui sont
globalement la charge de lentreprise.
Les cots supports par lorganisation sont fonction du risque rel, cest--dire des
cots enregistrs et pays par la caisse rgionale dassurance maladie. Les
cotisations daccidents de travail proprement dits sont calcules partir du montant
des prestations servies, donc du nombre daccidents. Les cotisations daccidents de
trajet font lobjet dune cotisation forfaitaire indpendante du nombre daccidents.
Cela sexplique par le fait que laccident sest produit hors de lentreprise, un
moment o le salari ntait pas sous lautorit de son employeur.
Il y a donc un intrt vident pour les employeurs contester, le cas chant, la
qualification daccident du travail au profit de celle daccident de trajet.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
5.2 Les cotisations
Chaque anne la CRAM dtermine le taux de cotisation d au titre des accidents de travail et
des maladies professionnelles pour chaque catgorie de risque.
Ces taux voluent en fonction des rsultats financiers obtenus au niveau national (pour
le taux collectif) et par les tablissements (pour les taux individuel et mixte). Les risques
professionnels sont la charge de lentreprise. Les cotisations sont exclusivement
patronales et le pourcentage varie en fonction de la taille de lentreprise et de
limportance du risque professionnel.
Les dpenses affrentes aux accidents de trajet font lobjet dune majoration forfaitaire
fixe chaque anne par arrt ministriel. La CRAM attribue une notion de risque
lentreprise ou ltablissement. Le classement seffectue selon la nomenclature
dactivits franaise (dcret 92-1129 du 02/10/92) et en fonction des risques
professionnels prsents par lactivit principale de ltablissement concern (activit
exerce par le plus grand nombre de salaris). Sauf cas particulier, la tarification est
base sur la notion dtablissement.
Le mode de tarification est fonction de leffectif de ltablissement sil est unique
(moyenne du nombre de salaris prsents au dernier jour ouvr de chaque trimestre civil
de la dernire anne connue) ou de lentreprise dont il relve (somme des salaris de
chaque tablissement). Si leffectif est infrieur dix salaris, la tarification est collective et
forfaitaire (tarification de branche professionnelle), sil est compris entre 10 et 199 salaris, la
tarification est mixte (une partie collective et une partie individuelle proportionnelle leffectif),
au-del de 200 salaris, la tarification est individuelle et reprsentative de tous les accidents
survenus dans ltablissement.
Le taux national moyen est de lordre de 3,5 4% de la masse salariale. A ces cots
directs, il convient dajouter les cots indirects lis labsence de laccident, aux
formalits Selon certaines tudes, ils peuvent tre valus 1,5 3 fois les cots
directs.
Pour chaque tablissement, la CRAM tient un relev appel compte employeur sur
lequel sont portes toutes les prestations verses par la Scurit sociale au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les employeurs non soumis
la tarification collective, la liste des accidents de travail (avec arrt) pour lesquels les
sommes ont t dbites au compte collectif ou individuel, le montant des salaires
annuels entrant dans le taux.
Le compte employeur prcde la notification du taux de cotisation. Il permet
deffectuer le calcul prvisionnel du taux ainsi que celui de la cotisation. Il constitue
la premire indication sur le cot des accidents et intervient dans toute dmarche de
prvention.
La qualit des mesures de scurit mises en place peut tre value laide de diffrents
types dindicateurs. Adapts lorganisation, ces outils dinformation et daide la
dcision vont permettre dapprcier le niveau de scurit et dorienter le traitement
appliquer.
Les principaux indicateurs pour les accidents corporels sont :
le taux de frquence (nombre daccidents dans le temps calcul en multipliant par
1 000 000 le nombre daccidents avec arrt et en divisant par le nombre dheures
travailles) ;
le taux de gravit (relation entre le temps perdu du fait des accidents et la dure
dexposition en risque calcule en multipliant par 1000 le nombre de jours darrt de
travail et en divisant par le nombre dheures travailles) ;
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
et lindice de gravit (traduction de limportance des squelles physiques calcule en
multipliant par 1000 000 le total des taux dincapacit permanente et en divisant par
le nombre dheures travailles).
Il est possible de mesurer galement la frquence et la gravit des accidents matriels et
les presque accidents.
Enfin, lentreprise peut mettre en place des indicateurs de prise en compte de la
scurit qui permettent dapprcier la dtermination de lencadrement dans
lapplication de la politique scurit et le comportement du personnel lgard des
mesures de scurit prescrites.
Il sagit de mesurer le nombre de suggestions scurit (nombre reu, retenu, ralis), le
nombre de secouristes du travail, la connaissance et le respect des consignes et modes
opratoires, dvaluer lattitude du personnel lors des actions de scurit, la position de
la direction par rapport la scurit (priorit), les paramtres de la fonction scurit
(autonomie, rattachement hirarchique, moyens).
On peut ajouter le nombre dexercices de scurit (nombre programm et ralis), le
nombre de sances de formation la scurit (nombre programm et effectu), le
budget consacr la scurit, le nombre de runions du CHSCT
5.3 Les ristournes et minorations et les majorations
Toute organisation qui mne une politique de prvention des accidents de travail et de
trajet peut obtenir une ristourne ou une minoration du taux de cotisation. Les
tablissements qui peuvent bnficier de ces mesures sont ceux soumis la tarification
collective ou la tarification mixte. Elles peuvent concerner la cotisation des accidents
de travail et la majoration des accidents de trajet.
Lorganisation bnficiaire doit tre jour de ses cotisations, les avoir acquittes
rgulirement au cours de la dernire anne, avoir accompli un effort de prvention
soutenu (pour la cotisation accidents du travail), avoir pris des mesures susceptibles de
diminuer la frquence et la gravit des accidents du travail proprement dits ou des
accidents de trajet.
En outre, la ristourne sur la majoration trajet ne pourra tre accorde que si, au cours
de la dernire anne, aucun risque exceptionnel na t rvl dans ltablissement par
un procs-verbal de linspecteur du travail (infraction la rglementation dhygine et
de scurit) ou par linobservation des mesures de prvention prescrites par la CRAM.
Les ristournes sont accordes, sur linitiative de la CRAM ou la demande de
lemployeur sur prsentation dun rapport motiv du service prvention de la caisse,
aprs avis du CHSCT ou, dfaut, des dlgus du personnel, aprs avis favorable du
directeur rgional du travail et du comit technique rgional comptent.
En revanche, le dfaut dexcution de mesures de prvention peut entraner des
majorations de taux, les cotisations supplmentaires, qui prennent en compte les risques
exceptionnels prsents par lexploitation.
Il ne faut pas les confondre avec la cotisation complmentaire qui est impose une
entreprise pour rcuprer la majoration de rente alloue la victime dun accident de
travail la suite dune faute inexcusable.
Il ne peut y avoir imposition dune cotisation supplmentaire sans une injonction
pralable faite lemployeur par la CRAM davoir prendre des mesures (justifies)
de prvention. Cette injonction est faite aprs enqute sur place dun ingnieur-
conseil ou dun contrleur de scurit de la CRAM. Elle est adresse lemployeur
par lettre recommande avec demande davis de rception.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Elle doit indiquer avec prcision les mesures prendre, les possibilits techniques de
ralisation, le dlai dexcution et prciser quau-del de ce dlai, lemployeur est
passible de lapplication de la cotisation supplmentaire.
Le montant en est fix par la CRAM, aprs avis du comit technique rgional, en
pourcentage du taux de la cotisation accident du travail de ltablissement concern
dans la limite de 25 % (ce maximum peut tre port 50 % voire 200 % en cas de
rcidive ou de refus dexcution).
La cotisation supplmentaire est due partir de la constatation du risque exceptionnel,
procs-verbal de linspecteur du travail constatant une infraction, expiration du dlai
dexcution des mesures de prvention ayant fait lobjet dune injonction pralable ou
constatation de linexcution de mesures de prvention.
Au-del des mesures de prvention et de protection classiques comme la formation
du personnel, lentranement la lutte contre le feu, les exercices dvacuation, le port
des quipements de protection individuels, les capots de protection certaines
organisations ont mis en place de vritables politiques de sant en offrant au personnel
la possibilit dentretenir leur condition physique (salle de gymnastique), damliorer leur
alimentation (conseils en dittique) et, pour les personnes ayant subi un accident,
modification du poste de travail et cration de centres de rducation pour acclrer le
retour une vie active normale .
Toutes ces actions permettent de rduire les cots directs mais aussi les cots indirects
supports par lorganisation.
La meilleure scurit est celle qui permet :
- dobtenir une diminution du taux de cotisation et donc de diminuer les cots lis aux
accidents de travail et de trajet ;
- dviter les cotisations supplmentaires et donc de diminuer les cots lis une insuffisance
de prvention.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
6 EXEMPLE DE DIMINUTION DES COTS
GRCE UNE MEILLEURE SCURIT
Un exemple simplifi sur les cots lis la scurit pour un centre de traitement
informatique va permettre de visualiser les effets de diffrents choix sur les cots .
Nous allons considrer que le budget annuel de scurit de ce centre comprend :
des installations de scurit pour une valeur locative de 38 000 euros ;
des dpenses de fonctionnement (scurit des installations) de 25 000 euros ;
une quote-part du salaire pour le gardiennage de 16 000 euros ;
un budget pour les assurances de 33 000 euros ;
des pertes moyennes conserves du fait des franchises de 8 000 euros ;
Soit un total de 120 000 euros.
La variabilit se compose des postes suivants :
des pertes en dommages directs (vtust sur les installations assures en valeur
dusage et matriel non assur) pour 300 000 euros ;
des pertes dexploitation conscutives et frais supplmentaires (non assurs) pour
3 800 000 euros ;
des pertes indirectes (pertes de march, de clientle, de notorit) pour 2 800 000 euros ;
Soit un total de 6 900 000 euros.
Lorganisation estime quelle ne peut supporter, sans que les consquences ne soient
irrversibles, des pertes accidentelles suprieures 1 500 000 euros (limite de
solvabilit).
Les conomies du fait de lautomatisation des procdures de traitement de linformation ont
t estimes 300 000 euros par an (limite de rentabilit).
Le risque est donc supportable au niveau du budget annuel (les 120 000 euros de
budget annuel sont bien infrieurs aux 300 000 euros de la limite de rentabilit) mais ne
lest pas par sa variabilit (les 6 900 000 euros de variabilit sont trs nettement
suprieurs aux 1 500 000 euros de la limite de solvabilit).
Il est donc absolument ncessaire, pour la prennit de lorganisation, de traiter le
risque afin de le ramener dans des limites compatibles avec les possibilits financires
de lentreprise.
La premire srie dactions que nous allons prendre en compte sont les
mesures prventives suivantes :
protection du centre de traitement informatique contre les sinistres dorigines
extrieures ;
protection du centre contre les intrusions ;
diminution des charges calorifiques lintrieur du local informatique ;
suppression des appareils et des canalisations deau lintrieur du local
informatique.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Ces traitements ont modifi les caractristiques du risque de la faon
suivante :
la variabilit na pas chang car, en cas de sinistre, les consquences restent
potentiellement les mmes que prcdemment (la prvention na, en gnral, pas
deffet sur la gravit) ;
le budget annuel est rduit essentiellement par la diminution de la probabilit des
sinistres (effet de la prvention) comme le montre la dcomposition suivante
(augmentation du poste dpenses de fonctionnement et diminution des deux derniers
postes) :
- des installations de scurit pour une valeur locative de 38 000 euros,
- des dpenses de fonctionnement (scurit des installations) de 29 000 euros (au lieu
de 25 000 euros),
- une quote-part du salaire pour le gardiennage de 16 000 euros,
- un budget pour les assurances de 19 000 euros (au lieu de 33 000 euros),
- des pertes moyennes conserves du fait des franchises de 3 000 euros (au lieu de
8 000 euros).
Soit un total de 105 000 euros (au lieu de120 000 euros).
Le budget annuel a donc diminu de 15 000 euros (120 000 euros - 105 000 euros).
Les traitements prventifs ont transform le risque initial R0 en un risque R1, plus faible en
budget annuel, mais na pas permis de le rendre acceptable (variabilit non modifie et donc
toujours trop importante).
Lorganisation va donc envisager une deuxime srie de traitements, la mise
en place de procdures ou de dispositions permettant la poursuite de lactivit
(applications informatiques) en dpit de la disparition de tout ou partie des chanes de
traitement.
En termes informatiques, ces dispositions sont dsignes sous le vocable de back-up .
Loptimisation du recours au back-up comporte cinq phases bien distinctes qui sont,
pour mmoire :
le choix du centre de back-up ;
la slection des applications vitales ;
lvaluation des besoins en ressources informatiques ;
le choix des modes dexploitation ;
la prparation effective du back-up.
Les effets du traitement de back-up (une forme de protection) sont valus, la fois en
budget annuel et en variabilit, comme suit :
Effets sur la variabilit :
des pertes en dommages directs (vtust sur les installations assures en valeur
dusage et matriel non assur) pour 300 000 euros ;
des frais supplmentaires (non assurs) pour 3 000 000 euros (au lieu des
3 800 000 euros de pertes dexploitation conscutives et frais supplmentaires et des
2 800 000 euros de pertes indirectes),
Soit un total de 3 300 000 euros (au lieu de 6 900 000 euros).
La variabilit a donc diminu de 3 600 000 euros (6 900 000 euros 3 300 000 euros).
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Effets sur le budget annuel :
abonnement pour le back-up de 120 000 euros,
des installations de scurit pour une valeur locative de 38 000 euros,
des dpenses de fonctionnement (scurit des installations) de 29 000 euros,
une quote-part du salaire pour le gardiennage de 16 000 euros,
un budget pour les assurances de 19 000 euros (au lieu de 33 000 euros),
des pertes moyennes conserves du fait des franchises de 1 500 euros (au lieu de
3 000 euros),
Soit un total de 223 500 euros (au lieu de 105 000 euros).
Le budget annuel a donc augment de 118 500 euros (223 500 euros -
105 000 euros).
Le traitement par mise en place dun back-up a transform le risque R1 en un risque R2 mais
la variabilit de 3 600 000 euros excde encore les possibilits financires de lorganisation.
Celle-ci va envisager le recours un abonnement salle blanche qui permet un
accs prioritaire un local quip pour recevoir un ordinateur. Lutilisation du centre de
back-up sera alors limit au dlai de livraison de lordinateur et non plus au dlai de
reconstruction du local informatique. Labonnement salle blanche va avoir pour effet de
rduire les frais supplmentaires potentiels dus au back-up de plusieurs semaines.
Les variations de variabilit et de budget annuel la suite du traitement par
labonnement salle blanche (en plus de labonnement de back-up) sont les suivantes :
Effets sur la variabilit :
des pertes en dommages directs (vtust sur les installations assures en valeur
dusage et matriel non assur) pour 300 000 euros,
des frais supplmentaires (non assurs) pour 500 000 euros (au lieu de 3 000 000 euros),
Soit un total de 800 000 euros (au lieu de 3 300 000 euros).
La variabilit a donc diminu de 2 500 000 euros (3 300 000 euros 800 000 euros).
Effets sur le budget annuel :
abonnement pour le back-up de 95 000 euros (au lieu de 120 000 euros),
abonnement pour la salle blanche de 28 000 euros,
des installations de scurit pour une valeur locative de 38 000 euros,
des dpenses de fonctionnement (scurit des installations) de 29 000 euros,
une quote-part du salaire pour le gardiennage de 16 000 euros
un budget pour les assurances de 19 000 euros
des pertes moyennes conserves du fait des franchises de 1 500 euros,
Soit un total de 226 500 euros (au lieu de 223 500 euros).
Le budget annuel a donc augment de 3 000 euros (226 500 euros 223 500 euros).
Ce traitement transforme le risque R2 en risque R3. Malgr les augmentations de budget,
celui-ci reste infrieur la limite de rentabilit de 300 000 euros. Grce la forte diminution
de la variabilit, celle-ci est devenue infrieure la limite de solvabilit de 1 500 000 euros.
Le risque R3 est donc acceptable financirement par lorganisation.
Partie 8 Diminuer les cots grce une meilleure scurit
Lorganisation dcide nanmoins de modifier son contrat dassurance en
assurant le matriel et les frais supplmentaires.
La variabilit est donc ramene zro, le budget tant major de 6 000 euros ce qui le
porte 232 500 euros (toujours infrieur la limite de rentabilit de 300 000 euros).
Le risque R3 est transform en risque R4.
La combinaison des diffrents traitements envisags a ainsi permis de transformer un risque
inacceptable R0 en un risque supportable (R3 ou R4).
PARTIE 9
LA RESPONSABILIT PNALE ET CIVILE
EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
1 LE RISQUE DE SANCTIONS PNALES EN MATIRE DHYGINE
ET DE SCURIT
1.1 Les infractions et les sanctions
1.1.1 Les atteintes involontaires lintgrit physique des salaris (nouveau code pnal)
1.1.2 Les infractions aux rgles dhygine et de scurit prvues au code du travail
1.2 Les personnes physiques pnalement responsables
1.2.1 La personne physique responsable dans lentreprise
1.2.2 Le chef dentreprise responsable en cas dintervention de plusieurs entreprises
1.3 La responsabilit pnale de lentreprise en tant que personne
morale
1.3.1 La condamnation payer pour les fautes dun prpos
1.3.2 La condamnation un plan dhygine et de scurit
1.3.3 La responsabilit pnale propre de lentreprise
2 LE RISQUE DE SANCTIONS CIVILES
2.1 Lindemnisation complmentaire de la victime
2.1.1 La faute inexcusable de lemployeur ou de son prpos
2.1.2 La faute intentionnelle de lemployeur ou de son prpos
2.2 Lindemnisation des proches de la victime
3 SEXONRER DE SA RESPONSABILIT PNALE EN CAS
DACCIDENT
3.1 Invoquer la force majeure
3.2 Soulever lerreur de droit ou lerreur de ladministration
3.3 Invoquer le fait dun tiers ou de la victime
3.4 Prouver leffectivit de la dlgation de pouvoirs
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
1 LE RISQUE DE SANCTIONS PNALES
EN MATIRE DHYGINE ET DE SCURIT
Alors que la responsabilit civile vise rparer les dommages causs un individu,
la responsabilit pnale contraint lauteur dune infraction rpondre de ses actes
devant la socit dans son ensemble.
Le droit pnal vise rprimer les infractions, cest--dire les actions ou les
omissions dfinies et punies par la loi, imputables leur auteur et ne se justifiant
pas par lexercice dun droit.
1.1 Les infractions et les sanctions
Les rgles dhygine et de scurit visent protger les salaris contre les risques
lis lexcution du travail. Le non-respect de ces rgles est sanctionn en tant que
tel (infractions prvues par le Code du travail).
En outre, ds lors quil sest produit un accident du travail dans lentreprise, on
recherche la responsabilit du chef dentreprise pour atteinte involontaire
lintgrit physique des personnes (infractions prvues par le Code pnal).
Ainsi, le chef dentreprise peut commettre deux sortes dinfractions en matire
dhygine et de scurit :
les atteintes involontaires lintgrit physique des personnes, sanctionnes par
le Code pnal ;
les manquements aux rgles dhygine et de scurit dictes par le Code du
travail.
Pour les infractions en matire de sant et de scurit au travail, la responsabilit pnale
peut tre engage sur le fondement du Code du travail ou sur celui du Code pnal.
Souvent, les infractions aux rgles dhygine et de scurit entranent un accident du
travail et sont donc sanctionnes sur le terrain du Code du travail et du Code pnal.
1.1.1 Les atteintes involontaires lintgrit physique
des salaris (nouveau code pnal)
Le Code pnal permet de poursuivre le ou les auteurs des infractions, quil sagisse
de personnes physiques ou de personnes morales.
Un certain nombre dinfractions qui constituent des atteintes involontaires la vie et
lintgrit physique sont qualifies de dlits.
On peut citer lhomicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention,
ngligence ou manquement une obligation de scurit ou de prudence impose
par la loi ou les rglements (article 221-6), ou encore les blessures involontaires
quand lincapacit totale de travail qui en rsulte est suprieure trois mois (article
221-19).
Avec le nouveau Code pnal, le dlit de mise en danger dautrui (article 223-1) a
t introduit dans le but de prvenir les accidents du travail, en rprimant les
manquements graves mme en labsence de dommages.
Cette infraction est une violation manifestement dlibre dune obligation
particulire de scurit ou de prudence, impose par la loi ou le rglement, qui
expose directement autrui un risque de mort ou de blessures pouvant entraner
une mutilation ou une infirmit permanente.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Linfraction est constitue lorsque son auteur a pleinement conscience du risque et
lorsque plusieurs conditions sont runies : le risque vis est immdiat (risque
daccident du travail ou de maladies professionnelles), lexposition au risque est
directe et invitable pour le salari, enfin il y a la violation dune obligation
particulire de scurit.
1.1.1.1 La liste des infractions
Il y a une gradation des infractions (de la contravention auu dlit) selon les consquences
(atteinte lintgrit nayant pas entran dincapacit totale de travail, incapacit totale
pendant moins de 3 mois, incapacit totale de travail pendant plus de 3 mois, dcs) et les
circonstances de latteinte (imprudence ou manquement dlibr une obligation de scurit
ou de prudence).
Mise en danger dautrui
Le fait dexposer directement autrui un risque immdiat de mort ou de blessures graves de
nature entraner une mutilation ou une infirmit permanente par la violation manifestement
dlibre dune obligation particulire de scurit ou de prudence impose par la loi ou le
rglement constitue un dlit de mise en danger dautrui
En labsence de dommage, lart. 223-1 rprime le dlit de mise en danger dlibre
dautrui par 1 an demprisonnement et 15 000 Euros damende.
Le dlit de mise en danger dautrui qui peut tre galement un facteur aggravant de
certaines infractions dhomicide et de blessures involontaires, car lauteur a conscience du
danger.
Blessures involontaires
Sil ny a pas dincapacit temporaire de travail
La maladresse, limprudence, linattention, la ngligence ou le manquement une obligation
de scurit ou de prudence impose par des textes qui porte atteinte lintgrit dautrui sans
entraner dincapacit totale de travail donne lieu une amende contraventionnelle de
deuxime classe (150 Euros. R. 622-1) ;
En cas de manquement dlibr une obligation de scurit ou de prudence impose par une
loi ou des rglements, la sanction est une amende contraventionnelle de cinquime classe (1
500 Euros). (R. 625-3).
En cas dincapacit temporaire de travail de moins de 3 mois
La maladresse, limprudence, linattention, la ngligence ou le manquement une obligation
de scurit ou de prudence impose par des textes, qui entrane une incapacit totale de travail
pour une dure infrieure ou gale 3 mois donne lieu une amende contraventionnelle de
cinquime classe (1 500 Euros).(R. 625-2) ;
En cas de manquement dlibr une obligation de scurit ou de prudence impose par une
loi ou des rglements, la sanction, qui devient correctionnelle, est porte 1 an de prison et 15
000 Euros damende (Art 222-20).
En cas dincapacit temporaire de travail de plus de 3 mois
La maladresse, limprudence, linattention, la ngligence ou le manquement une obligation
de scurit ou de prudence impose par des textes ayant entran une incapacit totale de
travail pendant plus de 3 mois donne lieu une peine de 2 ans de prison et 30 000 Euros
damende (Art 222-19) ;
En cas de manquement dlibr une obligation de scurit ou de prudence impose par une
loi ou un rglement, les peines encourues sont portes 3 ans de prison et 45 000 Euros
damende.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Homicide involontaire
La maladresse, limprudence, linattention, la ngligence ou le manquement une obligation
de scurit ou de prudence impose par des textes, ayant entran la mort donne lieu une
peine de 3 ans de prison et 45 000 Euros damende.
En cas de manquement dlibr une obligation de scurit ou de prudence impose par une
loi ou un rglement, les peines encourues sont portes 5 ans de prison et 75 000 Euros
damende (Art 221-6 Ncp).
1.1.1.2 Les peines
Lorsque le dlit est puni dune peine demprisonnement, le tribunal peut prononcer une
peine de jours-amende (contribution quotidienne verser au Trsor). Cette peine peut se
cumuler avec la peine demprisonnement mais pas avec lamende.
De mme, la peine demprisonnement et lamende peuvent tre remplaces par la
condamnation un travail dintrt gnral (TIG) non-rmunr.
Enfin, des peines privatives ou restrictives de droits peuvent tre prononces, telles que la
suspension ou lannulation du permis de conduire, la confiscation dobjets, linterdiction
dexercer une activit professionnelle ou une fonction etc.
Ces peines sont alternatives lamende ou lemprisonnement.
Le tribunal peut tre aussi amen prononcer des peines complmentaires. Il faut que cette
peine soit expressment prvue pour chaque infraction en cause.
Certaines peines complmentaires doivent obligatoirement tre prononces. Larticle L 263-
3 prvoit, par exemple, que le tribunal fixe le dlai dans lequel les travaux de scurit doivent
tre excuts. Cet article prvoit galement quen cas de condamnation sur le fondement des
articles L 263-2 et L 263-4, le tribunal ordonne laffichage du jugement aux portes de
ltablissement ainsi que sa publication dans les journaux quil dsigne.
Certaines peines complmentaires peuvent tre prononces, notamment en cas de rcidive
aprs une condamnation sur le fondement de larticle L 263-3. Le tribunal peut prononcer la
fermeture temporaire ou dfinitive de ltablissement.
En cas de rcidive, linterdiction dexercer une activit professionnelle pendant une dure
maximale de 5 ans peut tre galement prononce. La violation de cette interdiction
entrane une amende de 9 000 Euros et une peine de prison de 2 ans ou lune de ces
deux peines.
Lorsque lentreprise a commis plusieurs infractions en matire dhygine et de scurit,
lamende laquelle elle est condamne est applique autant de fois quil y a de salaris
concerns. Sil y a quatre infractions, mais si deux salaris seulement sont concerns, il y
aura deux amendes et non quatre.
Le cumul de peines contraventionnelles est toujours possible. Il en est ainsi en cas cumul
de peines encourues pour inobservation des rgles dhygine et de scurit et de peines
au titre de la contravention pour blessures involontaires.
Le cumul de peine est possible lorsquil y a contravention pour blessures involontaires et
dlit de manquement aux rgles de scurit.
En revanche le cumul est impossible lorsquil y a contravention aux rgles dhygine et
de scurit et dlit de manquement aux rgles de scurit, dans la mesure o les peines
prvues larticle L 263-4 ne se cumulent pas avec celles prvues au Code pnal.
Le cumul sapplique aux amendes mais pas aux peines complmentaires.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
En matire de crimes et de dlits, lorsque plusieurs peines de mme nature sont en concours, il
ne peut tre prononc quune seule peine de cette nature dans la limite du maximum le plus
lev. Il sensuit que le juge peut prononcer la fois une peine demprisonnement et une peine
damende puisque ce ne sont pas des peines de mme nature.
1.1.1.3 Les lments de linfraction
Les infractions en matire dhygine et de scurit sont toujours des infractions non-
intentionnelles. Une graduation des fautes non-intentionnelles est faite entre les simples
fautes de ngligence ou dimprudence et la mise en danger dlibre dautrui.
La responsabilit du chef dentreprise est engage, non seulement en cas dinobservation
des rgles dhygine et de scurit mais galement en cas de manquement son
obligation gnrale de scurit sans quaucun texte prcis nait t viol.
Le chef dentreprise a, en effet, une obligation gnrale de scurit, qui vise le
contraindre prendre les mesures ncessaires commandes par les circonstances, en
vue de faire disparatre toute situation dangereuse pour la scurit des travailleurs
(obligation danticiper les risques mme sans texte prcis ou aucune obligation prcise).
Limprudence, la ngligence
Lorsquun accident sest produit, alors mme que les rgles dhygine et de scurit ont
t respectes, la responsabilit de lemployeur peut, malgr tout, tre mise en cause sil
a commis une faute dimprudence.
La loi du 13 mai 1996 sur la responsabilit pnale pour des faits dimprudence ou de
ngligence modifie larticle 121-3 du Code pnal : il y a galement dlit [] en cas
dimprudence, de ngligence ou de manquement une obligation de prudence ou de scurit
prvue par la loi ou les rglements, sauf si lauteur des faits a accompli les diligences normales
compte-tenu, le cas chant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
comptences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait .
Lemployeur dgagera sa responsabilit sil a tout mis en uvre, compte-tenu de ses
possibilits, pour sopposer, vainement, la ralisation du dommage.
Il appartient au ministre public de faire la preuve que lemployeur na pas accompli les
diligences normales.
Ne constitue pas une diligence normale le fait davoir fait vrifier un appareil en mauvais
tat par un organisme agr ; de mme, le fait davoir conclu un contrat dentretien sur
une machine en mauvais fonctionnement ne suffit pas ; de mme, le fait davoir rappel
les consignes de scurit aux ouvriers sans avoir fait des modifications techniques sur un
matriel la suite dun premier accident sans gravit.
Les zones dangereuses de travail exigent un balisage particulier pour que les diligences
normales soient accomplies.
En gnral, limprudence se manifeste sous la forme dune mauvaise organisation de
lentreprise :
pas de dfinition prcise des tches de chacun, rpartition inadapte des rles de
surveillance, notamment lorsque la surveillance de plusieurs chantiers loigns les uns des
autres est laisse un seul et mme agent ;
dfaut de surveillance des ouvriers alors quils effectuent des oprations dlicates ou
dfaut de surveillance des lieux lorsque des lments dangereux sont laisss
proximit des travailleurs ;
dfaut de formation du personnel, surtout lorsquil sagit deffectuer des travaux dangereux,
la formation devant concerner lensemble du personnel et non pas seulement les ouvriers en
relation directe avec les appareils prsentant des risques, dans la mesure o il peut arriver,
en cas durgence, que des travailleurs affects dautres tches soient amens les utiliser.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Il ne tient quau chef dentreprise de parer aux dfauts dorganisation qui pourraient tre
lorigine daccidents dont il serait alors responsable.
Illustration
Un employeur a t condamn pour avoir laiss son personnel utiliser un
matriel dont le caractre dangereux avait t signal par linspecteur du
travail, aux motifs que ce chef dentreprise ne pouvait se contenter de
demander au constructeur dtudier un dispositif de scurit complmentaire
et aurait du prendre immdiatement toutes dispositions utiles.
La mauvaise organisation, qui cause limprudence, peut rsulter galement du fait que le chef
dentreprise na pas fait de dlgation de pouvoirs pour assurer la scurit dans lentreprise. Il
est donc ncessaire de prvoir une dlgation de pouvoirs effective .
Linobservation des rglements
Linobservation des rglements suffit engager la responsabilit de lemployeur, sans
quil soit besoin de dmontrer sa ngligence ou son imprudence. Dans ce cas, il y a
infraction au Code du travail puisquil y a manquement une prescription rglementaire,
la faute de lagent est alors prsume, et infraction au Code pnal puisque le
manquement a eu une consquence dommageable.
Il en est ainsi lorsque lemployeur fait travailler des salaris sur des machines dangereuses
dpourvues de dispositif de scurit (machine-outils instruments tranchants tournant
grande vitesse), ou lorsque les ouvriers travaillent sur des plates-formes dpourvues de
garde-corps, lorsque lemployeur manque lobligation lgale de former le personnel (L
231-3-1).
En effet, lemployeur doit former les salaris tout au long de la relation contractuelle (lors de
lembauche, dun changement daffectation de poste de travail, dun changement de
technique de travail) ou prvoit cette obligation pour les travailleurs sous CDD ou
intrimaires. Larticle R 231-36 prcise le contenu de cette formation, qui doit tre la fois
thorique et pratique.
Illustration
Il a t reproch un employeur de navoir pas donn au salari la
formation souhaite en ne lui enseignant pas les comportements et les
gestes les plus srs en fonction des risques auxquels il serait expos.
Le cas particulier des infractions de mise en danger
En cas de mise en danger dautrui, le comportement est plus grave quune simple
ngligence sans quil y ait, toutefois, volont de produire un rsultat dommageable.
Infraction autonome
La mise en danger est une infraction autonome prvue larticle 223-1. Le fait dexposer
directement autrui un risque immdiat de mort ou de blessures graves, de nature
entraner une mutilation ou une infirmit permanente, par la violation manifestement
dlibre dune obligation particulire de scurit ou de prudence impose par la loi ou
le rglement est punie dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende.
Il nest pas ncessaire quun dommage se soit produit. Cest la mise en danger qui est
sanctionne. Le risque cr par le comportement fautif doit tre immdiat et doit
ncessairement rsulter de la violation manifestement dlibre dune obligation de scurit.
LInspecteur du Travail constate lexistence dune situation de mise en danger dautrui dans un
procs verbal quil adresse au Ministre Public afin que des poursuites puissent tre engages.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Circonstance aggravante dune autre infraction
La circonstance aggravante de mise en danger est encourue lorsque le dommage sest
ralis. Il sagit de la circonstance aggravante dune infraction dhomicide ou de
blessure involontaire.
Le comportement dangereux est caractris par la violation particulire dune obligation
de scurit ou de prudence prvue par la loi ou le rglement (dcret ou arrt pris en
application de la loi) ou par un manquement lobligation gnrale de scurit mise
la charge de lemployeur. Il faut que cette violation ait t manifestement dlibre et
que, selon la jurisprudence, elle ait t la cause directe et immdiate du risque auquel
a t expos autrui .
Le lien de causalit entre le comportement fautif et le dommage doit tre certain. Si la relation
de causalit est douteuse, lagent poursuivi est relax.
Comme dans le cas de la mise en danger en tant quinfraction autonome, la preuve de la mise
en danger rsulte du constat de lInspection du Travail
La mise en danger avant la loi du 10 juillet 2000
Avant la loi du 10 juillet 2000, la faute commise par le prvenu suffisait entraner la
condamnation, alors mme, quelle navait pas t la cause directe et exclusive de
laccident.
Illustration
Dans une espce o le dcs de la victime tait survenu la suite de
complications lors du traitement, et, alors mme que le rapport dexpertise
concluait que le dcs tait d une embolie pulmonaire sans relation
directe avec le traumatisme subi lors de la chute, lemployeur a t
condamn aux motifs que limmobilisation de la victime avait t
conscutive la chute.
Il suffisait que le comportement fautif ait jou un rle dans la ralisation du
dommage, mme si le lien entre la faute et le dommage tait indirect.
La mise en danger et la loi du 10 juillet 2000
La loi du 10 juillet 2000 a pour objectif de prciser la notion de dlit involontaire et
doprer une distinction selon que la faute commise est la cause directe ou indirecte du
dommage. Il sagit de limiter la responsabilit pnale pour les causes de responsabilit
en matire dinfractions non-intentionnelles.
Cette loi, qui sapplique aux causes de responsabilit de tous les dcideurs, et
particulirement des lus locaux, prsente un intrt particulier pour les chefs dentreprise
dont la responsabilit pnale est le plus souvent recherche pour des infractions non-
intentionnelles.
La nouvelle dfinition de linfraction involontaire (Art. L 121-3)
La faute du dcideur est la cause directe du dommage.
Larticle L 121-3-3 rprime linfraction involontaire qui a t la cause directe dun
dommage : la faute dimprudence ou de ngligence ou le manquement une obligation
de prudence ou de scurit prvue par la loi est la cause directe du dommage. Ainsi,
toute faute, mme lgre, est susceptible dengager la responsabilit de son auteur.
La responsabilit est engage si lauteur de linfraction na pas accompli les diligences
normales permettant dviter le dommage. On tient compte de la nature de sa mission,
de ses fonctions de ses comptences ainsi que du pouvoir dont il tait investi et des
moyens dont il disposait. Lauteur de la faute dgage sa responsabilit sil peut prouver
quil a accompli les diligences normales.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
La faute du dcideur est la cause indirecte du dommage.
Larticle 121-3 alina 4 rprime linfraction involontaire qui a t la cause indirecte dun
dommage. Cet article vise les personnes qui nont pas caus directement un dommage
mais qui soit :
ont cr ou ont contribu crer la situation qui a entran la ralisation du
dommage ;
nont pas pris les mesures qui auraient pu viter que le dommage ne se ralise.
Lobjectif de la loi est de faire en sorte que la responsabilit du dcideur soit plus difficile
mettre en uvre lorsque la faute est la cause indirecte du dommage (121-3 al 4). Il
faut alors que la faute soit suffisamment caractrise. La faute lgre ne suffit pas. Il doit
sagir soit :
de la violation manifestement dlibre dune obligation particulire de prudence ou
de scurit prvue par la loi ou le rglement ; cest la mise en danger dlibre
dautrui ;
dune faute caractrise ayant expos autrui un risque dune particulire gravit que
la personne ne pouvait ignorer.
La mise en danger dlibre dautrui
La mise en danger doit tre dlibre. Il faut au pralable lexistence dune obligation
particulire de scurit, prvue par la loi ou le rglement, et que la personne, qui
connaissait cette rglementation, ait choisi, dlibrment, de ne pas la respecter.
La faute caractrise
En labsence de mise en danger dlibre, la faute doit alors tre caractrise :
elle expose autrui un risque dune particulire gravit, cest--dire un risque de
mort ou de blessures graves. Cela exclu les fautes bnignes, les fautes ordinaires ;
lauteur de la faute ne pouvait ignorer le danger, cest--dire quil faut quil ait t en
mesure den connatre lexistence. Cet lment permet de tenir compte dvnements
antrieurs.
Illustration
Un employeur a laiss une salarie utiliser une presse dfectueuse, alors
quil ne pouvait ignorer que la machine tait affecte dun
dysfonctionnement rvl par plusieurs incidents antrieurs. (ITT de plus de
3 mois. application art. 121-3 et 222-19).
La jurisprudence volue. La nouvelle loi, dont lobjectif tait de limiter les causes de
responsabilit pnale des dcideurs, particulirement en matire dinfractions non-
intentionnelles, na eu que peu deffet sur la jurisprudence relative aux accidents du travail. La
jurisprudence ne fait pas toujours la distinction, en effet, entre les articles 121-3 alina 3 et
121-3 alina 4 du Nouveau Code Pnal.
La faute, mme quand elle est la cause indirecte du dommage, est considre comme la
cause directe du dommage.
Dune faon gnrale, les manquements de lemployeur aux dispositions du dcret du 8
janvier 1965 sont pratiquement toujours considrs comme la cause directe de
laccident.
Le degr de la faute, (faute dlibre, faute caractrise) importe peu, puisquil est fait
application de larticle 121-3 al. 3 et non de larticle 121-3 al. 4. Il semble que la faute
simple du dcideur suffise.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Illustration
Un employeur a t condamn pour navoir pas accompli
les diligences normales ds lors quil tait tabli que le salari
intrimaire navait pas eu de formation pratique en matire
de scurit. La mconnaissance par le dcideur de prescriptions
lgales ou rglementaires, (en lespce art. L 231-3-1 Code
du Travail) a t considre comme la cause directe du dommage.
1.1.1.4 Les solutions jurisprudentielles applicables
Lorsque le juge fait application de larticle 121-3 al 4, il constate systmatiquement
lexistence dune mise en danger dlibre dautrui ou dune faute caractrise.
La mise en danger est toujours dlibre
Pour la jurisprudence, la violation dune obligation particulire de scurit par un
dcideur est de plein droit considre comme manifestement dlibre
lorsquelle reconnat que cette violation na eu quun rle indirect dans la
ralisation du dommage.
Illustration
Dans le cas du dcs dun salari caus par leffondrement dune
tranche insuffisamment taye, en violation des dispositions du dcret
du 8 janvier 1965, la violation dlibre du grant au sens de larticle
121-3 al 4 a t retenue car il lui incombait dassurer le respect de la
rglementation, alors que le matriel de blindage ncessaire avait t
laiss au dpt par le cogrant.
Autre exemple : la faute dlibre du chef dentreprise a t retenue,
suite llectrocution dun salari qui travaillait proximit dune ligne
lectrique, aux motifs quil devait informer la victime des rgles
respecter dans de telles circonstances, comme lexige larticle 172 du
dcret du 8 janvier 1965.
La faute caractrise
Pour condamner sur le fondement de la faute caractrise , le juge ne fait pas
toujours la distinction tablie par le lgislateur entre mise en danger dlibre
applicable en cas de manquement une rglementation particulire et faute
caractrise applicable en cas de manquement une obligation gnrale de
scurit ou de prudence. Le juge a, du reste, tendance recourir quasi
systmatiquement la notion de faute caractrise.
Comme pour la mise en danger dlibre dautrui, le manquement une obligation
rglementaire de scurit constitue de plein droit la faute caractrise.
Il en est ainsi lorsque le prvenu na pas pris les dispositifs de scurit ncessaires
lorsque :
il na pas tabli un plan de scurit en accord avec le responsable dune entreprise
extrieur, alors quun tel plan aurait permis dviter laccident ;
il a omis dafficher les prescriptions de scurit et quil na pas mis en place un
dispositif de fermeture interdisant laccs aux endroits dangereux ;
il a fait travailler des salaris proximit dun danger sans scurit ;
la victime ne portait pas dquipement de scurit ;
lemployeur a failli son obligation de formation.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Illustration
Particulirement dans une espce o un salari stait sectionn lindex
avec une scie lectrique au rayon boucherie dun hypermarch, le
directeur de ltablissement a t condamn pour blessures involontaires
aux motifs que tout chef dtablissement est tenu dorganiser une
formation pratique et approprie en matire de scurit .
Le manquement une obligation gnrale de scurit peut tre constitutif de la faute
caractrise. La rpression, cet gard, se fera sur le fondement de larticle R 233-
1, lequel dispose quen cas dinsuffisance des quipements prescrits par dcrets, le
chef dentreprise doit prendre toutes autres mesures ncessaires leffet dassurer la
scurit et de prserver la sant des travailleurs.
La responsabilit de lemployeur sera donc engage lorsquil naura pas palli
linsuffisance dquipement dans son entreprise.
Enfin, tout manquement une obligation lgale de scurit constitue une faute
caractrise,. la rpression se fait alors sur le fondement des articles L 230-2 et L 233-1
et suivants du Code du travail.
Larticle L 230-2 dispose que le chef dtablissement prend les mesures ncessaires
pour assurer la scurit et la sant des travailleurs de ltablissement . Larticle L
233-1 prvoit que les tablissements [] doivent tre amnags de manire
garantir la scurit des travailleurs .
Illustration
Dans une espce o il tait reproch aux dirigeants de deux
socits de navoir pris les mesures qui auraient permis de dviter
le dommage, commettant, les juges ont retenu une faute
caractrise distincte de linfraction la rglementation du travail
dont ils taient relaxs.
La responsabilit de principe du chef dentreprise (en cas dinobservation des rglements) nest
mise en jeu que sil y a un lien de causalit entre le manquement de lemployeur et le
dommage.
Si ce lien nest pas dmontr, la responsabilit de lemployeur ne peut tre engage sur le
fondement du Code pnal. Elle reste toutefois possible sur le fondement du code du travail.
La jurisprudence adopte une conception large de la causalit : un comportement est
considr comme causal sil a jou un rle, mme indirect, dans la ralisation du
dommage. La faute de la victime nest en gnral pas prise en considration car les
juges estiment quelle est, dans la plupart des cas, rendue possible par la ngligence
du chef dentreprise.
Illustration
Dans une espce o le salari avait travaill du mauvais ct de la
machine ; ds lors quil navait reu aucune consigne lui interdisant de
procder ainsi, le chef dentreprise a t dclar responsable du dfaut
de surveillance.
Dans une autre espce, lemployeur a t condamn alors que
laccident stait produit dans lexcution dune tche non-prvue
par lui, effectue sur la seule initiative de la victime et en son
absence aux motifs quen omettant de mettre la disposition de la
victime les moyens de scurit ncessaires, lemployeur, qui navait
pas dlgu ses pouvoirs, avait commis une faute caractrise. On
retiendra cette occasion que le fait de navoir pas dlgu ses
pouvoirs est en soit une faute.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Toute le personne ayant particip de prs ou de loin limprudence peut tre sanctionne
(responsabilit cumulative) et ce quelle que soit sa qualit, sa fonction dans lentreprise.
Toutefois, la responsabilit de lun des auteurs ne peut tre engage que sil lui est reproch
une faute distincte par rapport celle des autres auteurs.
On tient compte de la place hirarchique occupe par chacun dans lentreprise et des
tches et fonctions qui leur sont propres, pour analyser leur part de responsabilit dans
la ralisation du dommage.
Illustration
Dans le cas dun accident caus la suite du non-respect des
dispositions de larticle 15 du dcret du 8 janvier 1965 (en lespce
chute dun ouvrier qui travaillait sans dispositif de scurit), le prsident-
directeur gnral de la socit et le chef de chantier ont t condamns
en appel pour homicide involontaire, nayant pas veill au respect de la
rglementation.
Cet arrt a t cass par la chambre criminelle au motif quune mme
infraction ne pouvait servir de fondement la condamnation la fois du
prsident-directeur gnral de la socit et du chef de chantier. Il fallait
choisir entre lun ou lautre des auteurs, ou alors trouver pour chacun
une faute distincte en reprochant par exemple lemployeur de navoir
pas pris les mesures de scurit ncessaires et au chef de chantier de
navoir pas surveill les travaux.
Cest la solution qui a t retenue, dans le cas dun accident caus par
une dcharge lectrique ayant caus la mort dun ouvrier qui effectuait
des travaux de peinture sur un transformateur lectrique.
Le prsident-directeur gnral et le directeur gnral adjoint de la
socit ont t condamns pour homicide involontaire au motif quils
navaient pas pris les mesures de scurit obligatoires pour les travaux
effectus proximit dun ligne de haute tension sur le fondement des
articles 179 et 181 du dcret du 8 janvier 1965. Le chef de chantier a
t condamn, quant lui, en raison du dfaut de surveillance.
Dans une autre espce, suite la chute mortelle dun ouvrier qui se
trouvait dans la nacelle fixe au crochet dune grue, le grutier et le chef
de chantier ont t condamns pour fautes caractrises et le prsident
du Conseil dadministration pour infraction aux rgles de scurit car il
avait omis de confier un collaborateur expriment en matire de
scurit la responsabilit du chantier.
Ainsi, les imprudences commises diffrents niveaux de la hirarchie engagent la
responsabilit de leurs auteurs.
Toutefois, cest malgr tout sur lemployeur que la jurisprudence fait peser une obligation
gnrale de prudence et de scurit dans la mesure o il appartient au chef dentreprise
de prendre les dispositions ncessaires quexigent les circonstances.
Lemployeur doit aller au-del de lapplication de la loi et des rglements et anticiper sur les
risques daccident pour les prvenir. Il importe peu que ni la CRAM ni linspection du travail
naient relev lanomalie et nait sollicit de mise en conformit loccasion de leur inspection.
Le chef dentreprise manque son obligation gnrale de scurit lorsquil :
nglige de prendre les mesures utiles pour assurer la coordination entre diffrents
services ;
ne met pas en uvre un programme dentretien rgulier des machines ;
nintgre pas dans son entreprise tous les progrs lis lvolution et la technique.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Enfin, le chef dentreprise na la responsabilit que des accidents que les conditions de travail
rendaient prvisibles. La responsabilit de lemployeur est dgage lorsque laccident a eu un
caractre imprvisible et exceptionnel.
1.1.2 Les infractions aux rgles dhygine et de scurit
prvues au code du travail
La responsabilit pnale repose sur une seule personne, gnralement le chef
dentreprise. Il doit veiller personnellement au respect strict et constant, dans son
entreprise, des rgles dictes par le Code du travail.
En pratique, il ne peut pourtant pas tre prsent partout. Pour pallier cette difficult, la
jurisprudence lautorise transfrer ses pouvoirs et ainsi ses responsabilits un prpos
dot dune dlgation de pouvoir.
Aucun texte rglementaire ne prvoit ni norganise la dlgation de pouvoir qui est une
construction issue de la jurisprudence de la Cour de cassation en 1902.
Le juge apprcie, pour chaque cas, la ralit matrielle de la dlgation invoque en
fonction, notamment, de la comptence, de lautorit et des moyens dont dispose le
dlgataire. Si aucun formalisme particulier nest exig pour tablir une dlgation,
lcrit peut tre conseill.
En cas dintervention dune entreprise extrieure, le chef de lentreprise utilisatrice doit
assurer la coordination des mesures de prvention. Toutefois, chaque chef dentreprise
(utilisatrice et intervenante) reste responsable de lapplication des rgles son propre
personnel.
Illustration
Ainsi, le responsable dune entreprise utilisatrice a t condamn pour
navoir pas respect les mesures de scurit qui lui incombaient et
navoir pas inform lentreprise intervenante des risques encourus par
son personnel et de la ncessit de lui faire porter une protection
individuelle (arrt de la Cour de cassation du 3 avril 1997).
La responsabilit du chef dentreprise (ou de son dlgataire) sera recherche quand, par sa
faute personnelle, il commet une infraction aux rgles dhygine et de scurit.
Ainsi, les chefs d'tablissement, directeurs, grants ou prposs qui par leur faute
personnelle, ont enfreint les dispositions du Code du travail et des rglements pris pour
leur application sont punis d'une amende de 3 800 Euros.
Lemployeur (ou son dlgataire) ne peut sexonrer de sa responsabilit en invoquant
son absence au moment des faits, ou une faute commise par la victime moins que
celle-ci ne constitue la cause exclusive et imprvisible de laccident.
Les infractions sont constates par les inspecteurs du travail ou des officiers de police
judiciaire.
1.1.2.1 Les principes applicables
Les infractions sont graduelles (du dlit la contravention) selon la nature des textes non-
respects.
En matire dinfractions aux rgles dhygine et de scurit, labstention et en elle-
mme punissable, mme si elle na eu aucune consquence dommageable. La
responsabilit du chef dentreprise est de principe.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Il importe peu que le chef dentreprise ait pris toutes les prcautions (affichage des
consignes dutilisation des appareils) et il importe peu que lemployeur nait pas t sur
les lieux au moment de laccident. Sa responsabilit est nanmoins engage aux motifs
quil appartient lemployeur de veiller personnellement la stricte application des
prescriptions lgales et rglementaires.
.
Le chef dentreprise peut sexonrer de sa responsabilit au moyen de la dlgation de pouvoir.
Labsence de dlgation est, dailleurs, en elle-mme fautive.
La responsabilit du chef dentreprise est carte, galement, en cas dimprudence
particulirement grave commise par le personnel dexcution.
La responsabilit du chef dentreprise ne peut tre mise en cause quen cas de violation
dune prescription prcise en matire dhygine et de scurit.
La responsabilit du chef dentreprise en cas de manquement une obligation gnrale
de scurit (notamment en cas de violation des articles L 232-1 et L 233-1 du Code du
travail qui fixent des obligations gnrales concernant lhygine et la scurit : tat de
propret des locaux et amnagement de nature garantir la scurit) ne saurait tre
mise en jeu sur le fondement des dispositions du code du travail.
Illustration
Dans une espce o aucune disposition prcise du code du travail
navait t viole, mais o le travail avait t effectu dans des
conditions dangereuses (accompli ct dune machine qui naurait pas
d tre en marche), la cour de cassation a fait valoir quun tel
comportement pouvait justifier une condamnation sur le fondement du
code pnal mais pas sur celui de larticle L 263-2 du Code du travail.
Les infractions aux rgles dhygine et de scurit prvues dans le Code du travail, sont
le plus souvent des infractions continues, le comportement dlictueux consistant ne pas
prendre les mesures exiges par la rglementation aprs mise en demeure de
linspecteur du travail dans le dlai imparti.
Lorsque la situation dangereuse ne fait pas lobjet de disposition particulire (art. L 232-
1, L 233-2 du code du Travail), elle doit faire lobjet dune mise en demeure du directeur
dpartemental du travail au vu du rapport de linspection du travail. A lexpiration du
dlai imparti, linspecteur du travail qui constate que linfraction na pas cess dresse un
procs verbal.
Lorsquun risque srieux datteinte lintgrit physique dun travailleur rsulte de
linobservation des rgles en matire dhygine et de scurit, linspecteur du travail peut
saisir le juge des rfrs pour ordonner les mesures conservatoires destines faire
cesser le risque (art. L 263-1 du code du travail). Des mesures conservatoires telles que
mise hors service dinstallations, immobilisation, saisie de matriels, machines, produits
ou autres peuvent tre ordonnes. Il peut ordonner galement la fermeture temporaire
dun atelier ou dun chantier.
1.1.2.2 Les dlits en matire dhygine et de scurit
Art. L 263-2 du Code du travail : cet article prvoit que des condamnations pnales
peuvent tre prononces en cas dinfraction aux chapitres I,II,III du titre III du livre II du
Code du travail (relatif lhygine et la scurit du travail) et des article L 231-6, L
231-7, L 3232-2, L 233 -5 et L 233-7 du Code du travail et des rglements pris en
excution de ces dispositions.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Larticle L.263-2 C.T punit dune amende de 3 750 euros les infractions aux
prescriptions relatives lhygine et la scurit. Cette amende est applique autant de
fois quil y a de salaris de lentreprise concerns par linfraction.
En cas de rcidive, le chef dentreprise peut se voir condamner une peine de prison
dun an et/ou une amende de 9 000 Euros.
Le Tribunal peut en outre ordonner la fermeture temporaire dun atelier ou dun chantier,
dcision qui peut tre assortie dune astreinte au profit du trsor. La mesure ne devant
pas porter atteinte aux droits des travailleurs, elle ne doit entraner ni rupture, ni
suspension des contrats de travail, ni retenues ou rduction de salaires. Le juge peut faire
interdiction lauteur de linfraction dexercer certaines fonctions dans lentreprise.
1.1.2.3 Les contraventions en matire dhygine et de scurit
Ce sont des contraventions de 5
e
classe, passibles dune amende de 375 Euros 750 Euros. Il
sagit des infractions aux prescriptions des articles L 234-1 et L 234-5, concernant le travail des
femmes et des jeunes travailleurs.
Ces contraventions sont galement encourues quand il na pas t satisfait une mise
en demeure la suite dinfraction aux rgles dhygine et de scurit, notamment aux
rglements dadministration publique destins lamlioration des conditions de travail,
des conditions gnrales dhygine et de scurit et de la protection de la sant des
travailleurs (prvus larticle L 231-2).
Parmi les dcrets pris en application de larticle L 231-2, on peut citer ceux qui suivent :
dcret du 23 aot 1947, concernant linstallation, lutilisation et lentretien des
appareils de levage ;
dcret du 8 janvier 1965 concernant les mesures gnrales de scurit sur les
chantiers de btiment et de travaux publics ;
dcret du 18 avril 1975 concernant les mesures dhygine et de scurit dans les
installations nuclaires ;
dcret du 20 fvrier 1992, concernant les travaux excuts par une entreprise
extrieure ;
dcret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs en contact avec
le courant lectrique ;
dcret du 7 fvrier 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques lis
la poussire damiante ;
dcrets concernant la prvention des maladies professionnelles, le dcret du 31
dcembre 1947 ayant dress un tableau des maladies professionnelles.
1.1.2.4 Les solutions jurisprudentielles applicables
en fonction des risques particuliers
Risques dlectrocution
Il a t jug que ds lors quil est constat que la distance minimale entre le plan de
travail et la ligne lectrique na pas t respecte, la faute personnelle du chef
dentreprise et le lien de causalit entre cette faute et le dcs de la victime sont tablis et
ce malgr limprudence de la victime.
La faute rsulte, selon la dcision, du fait que le chef dentreprise na pas demand la mise
hors tension de la ligne et ne peut justifier dune information effective du personnel par le
moyen dune consigne.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Risque dincendie
Il a t jug que la responsabilit pnale du directeur technique est engage ds lors que
les diverses fautes et ngligences (en lespce omission de laffichage de linterdiction de
fumer dans latelier, droulement des faits dans un local muni dune installation
lectrique non-antidflagrante proximit dun stockage dhydrocarbure, local dpourvu
dune aration adquate) sont lorigine de laccident.
En lespce, laccident stait produit alors que la victime nettoyait une machine laide
dessence qui lavait clabouss et stait brusquement enflamme.
Risques dirradiation
Un employeur a t condamn une amende et des rparations civiles, pour avoir laiss
utiliser des appareils gnrateurs de rayons ionisants, en omettant de procder la dsignation
dune personne charge de la surveillance et en omettant de remettre lintresse un
dosimtre.
Dautres ngligences avaient t constates comme le dfaut de visite mdicale avant
lentre en fonction, de contrle de ltat de sant de lintresse aprs une absence
maladie, de dfaut dtablissement de dossier sur ses antcdents mdicaux.
Risques de chute
Une jurisprudence abondante est relative au travail en hauteur. La responsabilit pnale de
lemployeur est engage lorsque, la suite de la chute dun salari, il est constat que
lchafaudage ntait pas muni des dispositifs de protection rglementaires ; lorsque les
dispositifs collectifs de scurit nont pas t pris mais seulement des dispositifs individuels de
scurit ; lorsque lemployeur na pas remis au coordonnateur des travaux le plan de scurit.
Lorsquil sagit de travaux sur toiture, la faute personnelle de lemployeur est retenue lorsque le
filet de protection, tendu au-dessus du lieu de travail avait t interrompu lendroit de
laccident ; lorsque le prvenu navait pas donn des consignes dutilisation des baudriers de
scurit.
Puits et trappes
La responsabilit pnale de lemployeur est engage en cas daccident lorsque le salari est
tomb dans une fosse dascenseur insuffisamment clture ; lorsque, aprs enlvement des
trappes, aucun systme de protection na t mis en place en particulier la pose de grilles sur
louverture ; lorsque les puisatiers navaient pas eu le dispositif de protection ncessaire,
comme par exemple une nacelle, lors de leur intervention dans le puits.
Cuves, bassins et rservoirs
La responsabilit pnale du chef dentreprise est engage lorsque le salari victime sest
asphyxi aprs stre enfonc dans un silo grains, ds lors quil navait pas mis en place un
plancher autour et lextrieur de la cellule qui aurait permis la victime de faire son travail
lextrieur de la cuve.
Matriels dangereux ou dfectueux
Il y a violation des rgles de scurit lorsque la presse lorigine de laccident ntait protge
que par un grillage dont lagencement nempchait pas laccs la partie mobile ; ou quand
le systme de scurit de la presse avait t enlev et non-remis en place par louvrier charg
de la maintenance.
Il y a galement violation des dispositions rglementaires lorsque des travaux dentretien ou de
rparation ont t faits sans la prsence dun surveillant qualifi charg dassurer la scurit,
alors que le dispositif de scurit avait t neutralis pour la ralisation des travaux.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
1.2 Les personnes physiques pnalement responsables
En principe, chacun nest responsable que de son fait personnel et cest donc lauteur de
la faute qui est sanctionn.
En cas datteinte lintgrit physique dun salari (infraction prvue au Code pnal), ce
principe est parfaitement respect puisque tous ceux qui ont particip de prs ou de loin
linfraction peuvent tre sanctionns (principe de la responsabilit cumulative).
En revanche, concernant linobservation des rgles dhygine et de scurit dictes par le
Code du travail, cest en principe le chef dentreprise (ou ventuellement son dlgataire) qui
est sanctionn mme si linfraction est matriellement ralise par lun de ses prposs dans
lentreprise.
1.2.1 La personne physique responsable dans lentreprise
Dans les entreprises individuelles, le chef dentreprise responsable est la personne (en
gnral le propritaire ou le grant) qui assume la direction effective de lentreprise.
Toutefois, en labsence de contrat de travail entre le grant et la victime les rgles
relatives lhygine et la scurit sont inapplicables.
Dans les socits, le chef dentreprise responsable est celui qui dtient le pouvoir de
direction sur le personnel de lentreprise. En principe, ce pouvoir appartient lensemble
des associs. Mais, dans les faits, il en est autrement :
dans les SA avec Conseil dAdministration : cest le Prsident qui est responsable ;
dans les SA avec Directoire : cest le directoire collgial qui est responsable ou le Directeur
gnral unique ou ventuellement celui des membres qui les autres membres ont dlgu
la tche de direction du personnel ;
Le prsident du Directoire nest pas plus responsable que les autres membres du Directoire, sil
na pas reu une dlgation particulire dans le cadre dune rpartition des tches de gestion
de lentreprise.
dans les SARL, sil y a un grant unique, cest lui qui est responsable. Sil y a plusieurs
grants, la responsabilit est collective, moins que lun dentre eux ait t investi par
les autres du pouvoir de grer le personnel et notamment de faire appliquer les rgles
dhygine et de scurit ;
dans les SNC, sil y a un grant unique, cest lui qui est responsable. Sil y a plusieurs
grants, la responsabilit est collective moins que lun dentre eux ait t investi par
les autres du pouvoir de grer le personnel et notamment de faire appliquer les rgles
dhygine et de scurit ;
dans les entreprises en difficult (en redressement ou en liquidation judiciaire)
ladministrateur judiciaire est responsable des accidents qui surviennent aprs la mise
en redressement.
Dans certaines entreprises, un des associs (en gnral celui qui est majoritaire) prend de fait le
pouvoir de direction. Selon la thorie de lapparence, cest lui qui est responsable des
accidents ou du non-respect de la rglementation en matire dhygine et de scurit.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
1.2.2 Le chef dentreprise responsable
en cas dintervention de plusieurs entreprises
Quand lentreprise fait appel la sous-traitance, cest en principe lentreprise de sous-traitance
(qui recrute la main duvre) qui est responsable des accidents ou du non-respect de certaines
rgles dhygine et de scurit.
Lentreprise qui fait appel la sous-traitance peut tre mise en cause dans certains cas,
notamment si elle na pris aucune mesure pour viter certains risques ou si elle na pas t
vigilante quant au choix du sous-traitant et ses qualits particulires pour le travail demand.
Illustration
Une socit avait sous-trait pour lexcution de travaux de construction dun
ouvrage, avec une entreprise de construction. Un effondrement a eu lieu
pendant lexcution des travaux lequel occasionna des blessures graves et un
accident mortel.
La responsabilit du directeur de lentreprise de construction a t retenue,
faute de surveillance suffisante du chantier, mais galement la responsabilit
de la socit principale qui ne stait pas renseigne sur la qualification de
lentreprise de sous-traitance et qui navait pas averti darchitecte de
lintervention de cette entreprise.
Quand lentreprise fait appel des travailleurs temporaires, le Code du travail (L.124-4-6)
prvoit que pendant la dure de la mission, lentreprise utilisatrice est responsable des
conditions dexcution du travail telles quelles sont dtermines par les mesures lgislatives,
rglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En outre, selon le principe dgalit entre les salaris, lentreprise utilisatrice doit faire bnficier
aux travailleurs intrimaires, des mmes rgles protectrices que celles appliques aux autres
salaris de lentreprise.
Dans certains cas, la responsabilit de lentreprise de travail temporaire peut tre mise en cause
sil savre quelle a commis une faute lorigine de laccident (par exemple si elle slectionne
des travailleurs qui nont pas la formation adquate pour le travail demand et qui commettent
une erreur causant ainsi un accident).
Quand plusieurs entreprises travaillent en commun sur un chantier, le chef dentreprise
responsable est en principe celui qui emploie la victime de laccident.
Toutefois, lorsque le chantier a t plac, de fait ou de droit, sous la responsabilit dun
chef de travaux charg de veiller lapplication des rgles dhygine et de scurit, cest
lui qui est responsable des infractions.
Le chef dentreprise peut, ainsi, carter sa responsabilit lgard de ses salaris pour ce
qui est de lhygine et de la scurit, en plaant les travaux sous une direction unique
autre que la sienne. Les juges sont tenus de prendre en compte la rpartition des
responsabilits tablies entre les intervenants.
Illustration
Dans une espce notamment, le directeur dune entreprise de raffinerie avait charg une socit de
faire la rparation dune soupape de scurit. Un ouvrier de cette socit, qui ne portait de masque,
avait t mortellement intoxiqu par lmanation dun gaz toxique.
La cour dappel a dclar le directeur de la raffinerie coupable dhomicide involontaire pour navoir
pas fourni un quipement de protection louvrier. Cet arrt a t cass par la chambre criminelle de
la cour de cassation car il existait une convention entre les deux socits qui prcisait que
lorganisation de la scurit incombait la socit intervenante pour la rparation de la soupape.
Cest donc au directeur de cette entreprise que la violation du dcret du 8 janvier 1965 devait tre
impute.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Cependant, malgr ce transfert de responsabilit, la responsabilit du chef dentreprise
dont dpend la victime peut malgr tout tre recherche.
Par ailleurs, la responsabilit de chaque intervenant peut tre retenue de faon cumulative. Il
en est ainsi pour nimporte quel intervenant, ds lors quil sest vu confier un rle dans
lorganisation ou la surveillance du chantier.
Mais les responsabilits de chacun doivent tre distinctes pour que plusieurs personnes
soient condamnes loccasion dun mme accident.
Illustration
Ainsi, la responsabilit cumulative a pu tre retenue, dans le cas de la chute
mortelle dun ouvrier qui effectuait des travaux dans un immeuble en construction,
pour le compte dune entreprise de plomberie, laquelle avait charg une
entreprise tierce de la scurit des travaux. Le directeur de cette entreprise a vu sa
responsabilit engage pour navoir pas organis un systme de scurit
suffisamment efficace, et le chef de chantier de lentreprise de plomberie a t
galement jug responsable pour navoir pas surveill son propre chantier et
vrifi ltat du dispositif de scurit.
Dans une autre espce, o des ouvriers avaient t tus par une explosion
occasionne par une tincelle de soudure au cours de travaux
dimpermabilisation dune cuve, ltincelle ayant t en contact avec des
vapeurs de peinture, le chef de lentreprise de soudure et le chef de
lentreprise de peinture ont t dclars responsables le, leurs activits
conjugues ayant t la cause du dommage.
Une autre espce a vu engages les responsabilits dun ingnieur, dun agent
technique et dun chauffeur dune socit fournisseur de gaz propane, lorigine
dune explosion ayant entran la mort de plusieurs personnes, et la responsabilit
du directeur rgional de la socit utilisatrice, car il ne stait jamais proccup de
la faon dont la socit tait alimente en gaz.
Lorsque dans un mme lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont prsents
(passage de travailleurs dun chantier lautre ou prt de matriel), les employeurs doivent
cooprer la mise en uvre des dispositions relatives la scurit, lhygine et la sant
selon des conditions et des modalits dfinies par dcret en Conseil dEtat. L.230-2
Un dcret du 20 fvrier 1992 (R.237-1 R.237-28) fixe les prescriptions particulires
applicables aux travaux effectus dans un tablissement par une entreprise extrieure.
Une circulaire dapplication du 18 mars 1993 prcise les modalits dapplication de ce
dcret.
Ainsi, quand lopration effectuer par lentreprise intervenante reprsente un nombre
total dheures de travail prvisible gal au moins 400 heures, un plan de prvention
doit tre tabli par crit.
Le chef de lentreprise extrieure doit, avant le dbut des travaux, faire connatre aux
salaris quil affecte ces travaux, les dangers auxquels ils sont exposs et les mesures
pour les prvenir.
Un plan de scurit doit galement tre tabli lorsque le travail effectuer est un travail
dangereux.
En toute logique si le plan de scurit est dfini en commun, la responsabilit est collective,
sauf dmontrer que lun des chefs dentreprise a t investi du pouvoir effectif de direction.
Lorsque les travaux impliquent lintervention de nombreuses entreprises, linspection commune
des lieux de travail doit tre effectue par toutes les entreprises intervenantes.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
1.3 La responsabilit pnale de lentreprise
en tant que personne morale
La personne morale reconnue responsable est, soit amene payer pour les fautes dun
prpos, soit responsable en tant quauteur de linfraction.
1.3.1 La condamnation payer pour les fautes dun prpos
Lentreprise peut tre condamne payer, en totalit ou en partie, lamende (et
ventuellement les frais de justice) prononce lencontre du prpos qui a commis une
infraction aux rgles dhygine et de scurit ayant entrane un accident corporel
(L.263-2-1 C.T).
Le Tribunal tient compte des circonstances de laccident : il condamnera plus facilement une
entreprise dans laquelle rgne une certaine inorganisation ou dans laquelle il y a une
insuffisance de moyens, matriels ou financiers.
1.3.2 La condamnation un plan dhygine et de scurit
Lentreprise peut galement tre condamne mettre en place un plan de scurit.
Art. 263-3-1 du Code du Travail : en cas daccident du travail survenu dans une entreprise
o ont t relevs des manquements graves ou rpts aux rgles dhygine et de scurit du
travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prvention la ou les
personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du Code pnal cites
larticle L 263-2-1, faire obligation lentreprise de prendre toutes mesures pour rtablir des
conditions normales dhygine et de scurit du travail .
Lentreprise ne peut donc tre condamne mettre en place un plan dhygine et de scurit
(L.263-3-1 C.T) que si :
elle a commis des manquements graves ou rpts aux rgles dhygine et de scurit ; ces
manquements sont ceux qui, sans quil soit besoin quune procdure judiciaire ait t
engage leur propos, ont pu tre relevs par linspection du travail avant linstance en
cours ;
il y a eu un accident du travail (dcs ou blessures involontaires), des poursuites sur le seul
fondement du Code du travail seraient insuffisantes ;
le juge ne peut retenir la responsabilit pnale daucune personne physique en particulier
(quand les causes de laccident se diluent sur plusieurs personnes). Ou alors, le juge a
dcid de ne pas prononcer contre le prvenu une peine demprisonnement.
Cest le cas o une relaxe est prononce parce que les causes de laccident sont multiples et
la condamnation serait trop svre lgard dune seule personne physique. Dans ce cas, la
relaxe pure et simple serait trop injuste. Do la possibilit de condamner lentreprise un
plan de scurit.
La condamnation un plan de scurit a un caractre obligatoire lorsque toutes les conditions
dapplication de larticle L 263-3-1 sont runies.
Concrtement, seul le tribunal qui a prononc la relaxe est comptent pour condamner
lentreprise un plan de scurit. Le juge dinstruction qui rend une ordonnance de non-lieu
na pas comptence pour ordonner la mise en place dun plan de scurit.
Le Tribunal enjoint lentreprise de lui prsenter un plan tendant rtablir les conditions
normales dhygine et scurit , ce plan devant tre accompagn de lavis motiv du CE et du
CHSCT (ou, dfaut, des dlgus du personnel).
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Le mme Tribunal doit ensuite accepter ou refuser le plan aprs avis du Directeur
dpartemental du travail. En cas de refus ou si lentreprise a prsent son plan hors dlai, le
Tribunal impose son propre plan.
La dure dexcution du plan ne peut aller au-del de 5 ans et son cot annuel ne peut
dpasser le montant annuel moyen (sur 5 ans) des cotisations accidents du travail pour les
tablissements.
Le contenu du plan est vari : il peut prvoir lachat de nouvelles machines, lamnagement
des lieux de travail, lorganisation dune formation du personnel aux rgles dhygine et de
scurit, la mise en place de systme de scurit etc.
Un contrle est effectu par linspecteur du travail, qui peut ventuellement saisir le juge des
rfrs pour une fermeture totale ou partielle de ltablissement.
En cas de non-application du plan ou de non-prsentation dun plan dans les dlais prvus, le
chef dentreprise peut tre condamn une amende de 300 1 800 Euros, laffichage et la
publication du jugement. En cas de rcidive, lemployeur peut faire lobjet dune interdiction
dexercer pendant une dure maximale de 5 ans.
1.3.3 La responsabilit pnale propre de lentreprise
Le Nouveau Code pnal de 1992 a introduit la notion de responsabilit pnale des
personnes morales.
La responsabilit pnale des personnes morales ne peut tre engage que dans les
cas o leur mise en cause a t spcialement prvue par un texte lgal ou
rglementaire. Le Code pnal le prvoit en matire dhomicide involontaire (221-
7), de blessures involontaires (222-21), de mise en danger (223-2) et lorsque cette
mise en danger est la circonstance aggravante dune autre infraction.
La loi du 10 juillet 2000 nest pas applicable aux personnes morales, si bien quen cas
dhomicide ou de blessures involontaires, la faute dont lentreprise est rendue responsable,
entranera sa responsabilit, mme sil sagit dune faute lgre, ayant t la cause indirecte du
dommage, puisque larticle 121-3 alina 4 du code pnal ne sapplique quaux personnes
physiques.
La responsabilit pnale de lentreprise ne peut tre recherche en cas de
manquement aux rgles dhygine et de scurit nayant pas caus daccident,
puisque seule la responsabilit des personnes physiques peut tre recherche dans
ce cas.
Il ny a mise en jeu de la responsabilit de la personne morale, en cas de violation
dune rgle du Code du Travail, que si linfraction a t la cause dun accident du
travail ou sil y a eu mise en danger dautrui.
La responsabilit pnale de lentreprise ne peut tre recherche que si linfraction a
t commise par un de ses organes ou de ses reprsentants. Le dlgataire est
considr comme un organe de lentreprise pour les actes accomplis dans le cadre
de la dlgation.
Linfraction doit avoir t commise pour le compte de la personne morale. Il faut
que lentreprise en ait retir (ou espr retirer) un profit quelconque (ou mme une
conomie, par exemple lorsquelle ne renouvelle pas ses installations en raison du
cot de lopration).
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Les dcisions jurisprudentielles
Les dcisions jurisprudentielles sont rares.
Illustration
Avant la loi du 10 juillet 2000 dans le cas dun homicide involontaire d
leffondrement dun chafaudage, la socit employeur a t condamne pour
avoir laiss travailler le salari sans vrifier la solidit de lchafaudage et la
socit sous-traitante ( qui avait t confi linstallation de lchafaudage) a t
condamne pour navoir pas contrl ltat de son matriel : 4 500 Euros pour
la socit employeur et 7 500 Euros pour la socit sous-traitante, outre
laffichage et la publication du jugement.
Depuis la loi du 10 juillet 2000. Une circulaire du 11 octobre 2000 invite les
juges poursuivre les personnes morales en lieu et place des personnes
physiques, en cas de relaxe de ces derniers.
Appliquant ces principes, la Cour de cassation a fait grief aux juges du fond
davoir relax la socit, alors que les personnes morales sont responsables
pnalement de toute faute non-intentionnelle de leurs organes ou reprsentants
ayant entran une atteinte lintgrit physique, mme lorsque la responsabilit
pnale des personnes physiques ne peut tre recherche (le chef dentreprise
avait t relax car les circonstances de laccident taient inconnues).
En lespce, la personne morale tait relaxe alors mme que les juges
avaient relev un manquement aux prescriptions du dcret du 8 janvier 1965,
alors, que ce manquement tait susceptible de justifier des poursuites pnales
lencontre de la socit, sur le fondement, non pas de larticle 121-3 alina 4,
mais sur le fondement de larticle 121-3 alina 3.
La responsabilit pnale de l entreprise n exclut pascelle despersonnesphysiquesauteursou
complicesdesmmesfaits.
En gnral, la personne morale est condamne payer une amende (dont le taux
maximum est gal au quintuple de celui prvu, pour les personnes physiques, par la loi
qui rprime linfraction).
Conditions
Deux conditions principales doivent tre respectes pour que lamende soit mise la
charge de lentreprise :
la responsabilit du prpos doit tre engage pour une des infractions numres
lalina 1 de larticle L 263-2 ; cest--dire pour ne pas avoir respect les rgles
gnrales et particulires relatives lhygine et la scurit du travail. Le prpos ne
peut tre quun salari disposant dun pouvoir hirarchique ;
il faut que le manquement soit lorigine dun prjudice corporel, quil ait provoqu la
mort ou des blessures.
Mise en uvre
Elle nest pas automatique. Le tribunal tient compte des circonstances de fait et des
conditions de travail de lintress : manque de moyens la disposition du prpos de
telle sorte quil ntait plus en mesure dappliquer les rgles dhygine et de scurit.
La substitution conduit dcharger le prpos des amendes correctionnelles prononces
contre lui, mais la sanction reste inscrite son casier judiciaire. Le juge peut en cas de
partage de responsabilit ne mettre quune partie de lamende la charge de
lentreprise.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Mais, elle peut tre condamne dautres peines (131-39 du nouveau Code pnal) :
la dissolution (pour les infractions volontaires les plus graves, punies de plus de 5 ans
demprisonnement) ;
linterdiction, titre dfinitif ou pour une dure de 5 ans au plus, dexercer directement
ou indirectement une ou plusieurs activits professionnelles et sociales ;
le placement sous surveillance judiciaire (pour une dure ventuellement suprieure
5 ans) : contrle de lactivit de lentreprise par un mandataire de justice ;
la fermeture dfinitive ou pour une dure de 5 ans au plus des tablissements, ou de
lun, ou de plusieurs tablissements de lentreprise ayant servi commettre les faits
incrimins ;
lexclusion des marchs publics titre dfinitif ou pour une dure de 5 ans au plus ;
linterdiction, titre dfinitif ou pour une dure de 5 ans au plus, dmettre des chques (sauf
chques certifis) ou dutiliser des cartes de paiements ;
linterdiction, titre dfinitif ou pour une dure de 5 ans au plus, de faire appel public
lpargne ;
la confiscation de la chose qui a servi ou tait destine commettre linfraction ou de
la chose qui en est le produit ;
laffichage de la dcision prononce ou la diffusion de celle-ci.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
2 LE RISQUE DE SANCTIONS CIVILES
En cas daccident du travail ou de maladie professionnelle, la responsabilit de lemployeur est
de plein droit.
La victime obtient, sans avoir prouver la faute de lemployeur, une indemnisation forfaitaire
de la scurit sociale visant compenser la perte de sa rmunration. Cette indemnisation
exclut en principe toute autre indemnisation sur le terrain de la responsabilit civile de droit
commun.
Lindemnisation forfaitaire de la victime est limite au prjudice professionnel. Le salari peroit
pendant larrt de travail le remboursement intgral de ses soins mdicaux, de rducation ou
de radaptation, de ses frais hospitaliers, pharmaceutiques et peroit une rente en cas
dincapacit dfinitive de travail.
Lindemnisation forfaitaire est finance par une cotisation exclusivement patronale lassurance
des risques professionnels gre par les caisses de scurit sociale.
En consquence de la responsabilit de plein droit de lemployeur, le salari, victime dun
accident du travail, ne dispose contre lui ou contre ses prposs, daucune action en
responsabilit civile de droit commun, que ce soit devant les juridictions civiles ou pnales.
En cas de faute inexcusable ou intentionnelle de la victime, si elle a t dterminante dans la
ralisation du dommage, il peut y avoir rduction, voire suppression de lindemnit forfaitaire
de la scurit sociale.
Mais, lemployeur peut tre amen, dans certaines conditions bien prcises, payer en
plus une indemnit la victime ou ses ayants droit
Dune manire gnrale, la responsabilit civile trouve sa base lgale dans le Code civil
(articles 1134, 1382 et suivants). Une personne physique ou morale voit sa
responsabilit civile engage ds lors quelle a caus un dommage autrui par sa faute
ou par la faute des personnes dont elle rpond.
Ainsi, lemployeur est civilement responsable des fautes commises par ses salaris, dans
les fonctions auxquelles il les a employs.
2.1 Lindemnisation complmentaire de la victime
Le salari peut obtenir une indemnisation complmentaire la charge de lemployeur en
cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de lemployeur ou de son prpos.
Une action en responsabilit contractuelle reste possible quand la prise en charge est
impossible.
Cest ainsi que le salari, qui attribue son tat de sant aux mauvaises conditions de travail
imposes par lemployeur, peut demander rparation de son prjudice sur le terrain de la
responsabilit contractuelle lorsque son affection ne peut tre prise en charge au titre des
maladies professionnelles (Bull. 94 n269).
Si laccident du travail ou la maladie professionnelle est due lintervention dun tiers
responsable.
Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, les bases lgales de la rparation
civile sont prvues, de manire spcifique, par une loi du 9 avril 1898. Ce systme
dindemnisation prvoit une rparation, non-intgrale, forfaitaire et automatique, ds lors quun
accident du travail ou une maladie professionnelle sont reconnus.
En complment, la victime peut invoquer lexistence dune faute inexcusable de lemployeur lui
permettant dobtenir en cas de succs une majoration de son indemnisation.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Alors que les victimes daccidents (de la route, thrapeutiques, de produits dfectueux, etc.) sont
intgralement et mieux indemnises sans avoir prouver la faute de lauteur de leurs dommages, les
victimes du travail doivent prouver une faute dune exceptionnelle gravit de leur employeur dcoulant
dun manquement une rgle de scurit ou de prudence : la faute inexcusable.
Dernirement, les procs des travailleurs de lamiante ont conduit la remise en cause
par la Cour de cassation de ce systme dindemnisation. Dans toutes ces affaires, des
salaris qui ont longuement travaill au contact de lamiante ont contract une maladie
professionnelle.
La Cour de cassation a jug que lobligation de scurit de lemployeur est rattache au
contrat de travail le liant son salari, et non plus seulement au rgime lgal de 1898.
Cette obligation contractuelle de scurit est une obligation de rsultat. Le manquement
cette obligation a le caractre dune faute inexcusable lorsque lemployeur avait ou
aurait d avoir conscience du danger auquel tait expos le salari, et quil na pas pris
les mesures pour len prserver.
La faute inexcusable cesse donc dtre une faute dune exceptionnelle gravit (arrt de la
Cour de cassation du 28 fvrier 2002).
Ce revirement de jurisprudence applicable aux maladies professionnelles a galement
t tendu aux accidents du travail.
Illustration
Ainsi, un salari habitu travailler sur son poste de travail avait t retrouv
mourant ce mme poste. Dans un premier temps, la Cour dappel avait
considr que lemployeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il
exposait son salari en laffectant une machine sur laquelle il tait habitu
travailler.
La Cour de cassation a cass cet arrt en ayant le raisonnement suivant : en
vertu du contrat de travail le liant son salari, lemployeur est tenu envers ce
dernier par une obligation de scurit de rsultat, notamment en ce qui
concerne les accidents du travail.
Le manquement cette obligation a le caractre dune faute inexcusable
lorsque lemployeur avait ou aurait d avoir conscience du danger auquel
tait expos le salari et quil na pas pris les mesures ncessaires pour len
prserver (arrt de la Cour de cassation du 11 avril 2002).
En outre, lexistence de faute inexcusable de lemployeur est galement admise dans le cas
daccidents de salaris particulirement expriments. Ces salaris, mme lorsquils sont
hautement qualifis, doivent recevoir une formation renforce la scurit et une information
sur leurs conditions de travail (arrt de la Cour de cassation du 27 juin 2002).
2.1.1 La faute inexcusable de lemployeur ou de son prpos
La faute inexcusable est une faute dune gravit exceptionnelle drivant dun acte ou dune
omission volontaire, commise en connaissance du danger couru par la victime et en labsence
de tout fait justificatif. Le litige sur la faute inexcusable est du ressort du Tribunal des affaires de
scurit sociale (TASS).
Illustration
Exemples : utilisation dun matriel dfectueux connu comme tel
par lemployeur, exposition sans protection aux poussires
damiante alors mme que les risques taient connus de
lemployeur ; non-respect de certaines rgles de scurit (selon les
circonstances de lespce), travail dangereux confi un seul
ouvrier alors quune quipe tait ncessaire ; travaux confis des
salaris dont la formation nest pas suffisante.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
La faute peut rsulter dune mauvaise organisation du chantier.
Illustration
La faute dune gravit exceptionnelle a t retenue dans le cas dun
salari mortellement bless par la chute dun parpaing chapp des
mains dun camarade de travail qui oprait un tage suprieur et
cela malgr limprudence dun tiers, la cause de laccident rsidant
dans la mauvaise organisation du chantier imputable
lemployeur.
Lemployeur doit avoir eu conscience du danger. En ralit, la jurisprudence se contente
dtablir que lemployeur aurait d normalement avoir conscience du danger pour
le dclarer responsable.
Un chef de chantier qui donne lordre deffectuer un travail sur une ligne lectrique,
sans sassurer quelle avait t maintenue hors tension a conscience du danger, de
mme que celui qui ne sest pas assur qu son dploiement maximum, la grue sur
laquelle travaillait la victime, ne risquait pas de toucher une ligne de haute tension
de telle sorte quil ne peut, aprs laccident caus par le dploiement imprvisible
de celle-ci, se retrancher derrire le dfaut de fabrication de la grue.
La conscience du danger nest pas retenue lorsque laccident est exclusivement d
une initiative du salari en labsence de lemployeur ou de ses dlgus.
Toutefois, il faut que limprudence de la victime ait t la cause dterminante de
laccident. Il nen est pas ainsi lorsque la victime a mconnu les consignes de
scurit et a utilis un appareil quil savait dfectueux sans protection, alors mme
quil tait hautement qualifi. Le fait que lappareil ait t dfectueux suffit
justifier la condamnation de lemployeur.
La faute inexcusable nest pas retenue si les circonstances de laccident sont
inconnues ou sil est impossible dtablir le lien de causalit entre la faute de
lemployeur et la ralisation du dommage.
La faute dterminante de la victime nexonre lemployeur de sa responsabilit, que
lorsque celui-ci a veill la stricte excution des prescriptions lgales, lorsque la
faute suppose de lemployeur na pas t la cause dterminante du dommage. Il
en est ainsi lorsque la victime contrevient aux ordres formels de lemployeur,
lorsquelle a nglig dutiliser le matriel de scurit mis sa disposition. Dans tous
les cas, il faut que lemployeur ait mis en place des mesures de contrle et quil ait
vrifi que ses instructions ont t excutes.
Illustration
La faute de la victime na pu exonrer lemployeur de sa responsabilit
suite la chute mortelle dun ouvrier qui procdait linstallation dun
garde-corps sur un chafaudage 12 mtres au-dessus du sol alors
mme quune affiche sur le chantier rappelait le caractre obligatoire du
port de la ceinture de scurit et alors mme que la victime et les autres
ouvriers ne voulaient pas mettre de protections ; il appartenait
lemployeur de faire respecter les prescriptions du dcret du 8 janvier
1965, au besoin sous menace de sanctions.
Lexprience de la victime est sans consquence sur lapprciation de la faute de
lemployeur si ce dernier tait sur les lieux.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Illustration
Dans une espce o les victimes taient des ouvriers hautement
qualifis, qui avaient commis limprudence de faire reposer
lchafaudage sur des lments en quilibre instable, la faute
inexcusable de lemployeur na pas, pour autant, t carte, aux motifs
que, prsent sur les lieux, il avait omis dassurer de manire efficace la
stabilit de louvrage. On en dduira que lemployeur ne peut se
contenter dune prsence passive sur le chantier mme lorsque lquipe
au travail est chevronne.
Lemployeur peut invoquer la force majeure pour sexonrer de sa faute. Mais, elle est trs
rarement admise par les juges. Il ny a force majeure que lorsque la cause de laccident tait
la fois imprvisible, irrsistible et insurmontable.
Illustration
Elle a t retenue dans une espce o la mort dun grutier avait t
cause par une rafale de vent qui avait provoqu la chute de la grue. En
revanche, il ny a pas force majeure quand la tempte svissait depuis
plusieurs jours avant laccident. Dans ce cas, le caractre imprvisible
fait dfaut.
Il existe des cas o la faute inexcusable est de droit (pas besoin dtre prouve par la
victime ou ses ayants droit) :
quand le risque (qui sest matrialis) avait t signal par la victime ou un membre du
CHSCT (L.231-8 C.T) ;
pour les salaris en CDD ou les travailleurs temporaires victimes dun accident ou dune
maladie professionnels, alors quils ont t affects des postes de travail prsentant des
risques particuliers sans avoir bnfici de la formation la scurit prvue larticle L.231-
3-1 C.T (L.231-8).
La victime et de ses ayants droits ont deux ans pour agir en responsabilit civile. Ce dlai
court compter du jour de laccident (ou de la clture de lenqute ou de la cessation
du paiement de lindemnit journalire ou, en cas de rechute, de la date de sa
constatation par le mdecin). En cas de maladie professionnelle, la cessation de travail
constitue un point de dpart supplmentaire de la prescription (L 461-5 CSS)
Consquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable peut donner lieu, soit une majoration de la rente attribue la
victime, soit une indemnisation complmentaire :
la majoration de rente ne peut dpasser, soit la fraction du salaire annuel
correspondant la rduction de capacit de travail subie par la victime, soit le montant
de ce salaire annuel (L.452-2 CSS).
La rente majore alloue la victime en cas dincapacit totale ne peut excder le montant de
son salaire annuel (L 452-2 CSS). Si la victime dun accident caus par la faute inexcusable de
lemployeur se voit allouer une rente 50% alors quelle bnficie dj dune rente gale son
salaire annuel, elle ne pourra bnficier de la majoration sauf en cas de rduction future de
son taux dincapacit permanente totale.
Lorsque lincapacit permanente de travail est infrieure 10 % et que le salari touche une
indemnit en capital, la majoration ne peut dpasser le montant de cette indemnit.
La majoration de rente est lie la gravit de la faute commise et non ltat de la
victime. Il est ventuellement tenu compte du comportement de la victime. Si les juges
retiennent lerreur professionnelle de la victime, ils ne peuvent fixer la majoration de la
rente son maximum.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
La majoration est en fait paye par la scurit sociale mais rcupre par le biais dune
cotisation supplmentaire sur lemployeur. Le taux et la dure de cette cotisation sont
fixs par la CRAM. Elle ne peut durer plus de 20 ans, ni excder 50 % de la cotisation
normale de l'employeur ou 3 % des salaires servant de base de calcul cette cotisation.
lindemnisation complmentaire sert rparer le prjudice personnel de la victime
(au del du prjudice professionnel) : prjudice caus par les souffrances, prjudice
esthtique, prjudice dagrment, prjudice moral, prjudice de perte de chance de
promotion professionnelle
Lindemnisation complmentaire est en fait paye par la scurit sociale mais rcupre, par
le biais dune cotisation supplmentaire, sur lemployeur. La dure et le montant de cette
cotisation sont fixs par la CRAM sur proposition de la CPAM. En cas de partage de
responsabilits, lemployeur (ou son assureur) peut rcuprer une partie de la cotisation
supplmentaire.
La relaxe prononce par la juridiction rpressive sur le fondement dune infraction
dhomicide ou de blessures involontaires ne fait pas obstacle loctroi dune rparation
sur le fondement de larticle 1383 du Code civil (article 4-1 du Code de procdure
pnale).
De la mme faon, labsence de faute pnale non-intentionnelle ne fait pas obstacle
lexercice dune action civile fonde sur larticle L 452-1 du Code de la scurit sociale,
si lexistence de la faute inexcusable prvue par cet article est tablie (cest une
nouveaut de la loi du 10 juillet 2000).
Pareillement, la condamnation pnale pour faute dimprudence nemporte pas
automatiquement reconnaissance dune faute inexcusable. Lorsque limprudence de la
victime a t la cause dterminante du dommage, la faute inexcusable de lemployeur ne
peut tre retenue, malgr la condamnation pnale de ce dernier.
En revanche Le TASS doit respecter, lautorit de la chose juge au pnal quant :
lexistence des faits incrimins, la constatation des faits par le juge pnal simposant
au juge civil ;
la qualification des faits ;
au lien de causalit : le TASS ne peut invoquer lincertitude quant la cause de laccident
pour carter la faute inexcusable si lemployeur a t condamn au pnal pour blessures
involontaires et infractions au rglement ;
limputabilit des faits : si le juge pnal impute le dommage la faute de lemployeur, le
juge civil ne peut limputer un vice indcelable du matriel.
Lexercice de laction pnale interrompt la prescription de 2 ans relative la
reconnaissance de la faute inexcusable de lemployeur.
Lemployeur peut sassurer contre les consquences de la faute inexcusable de ses prposs
(substitus dans la direction du travail) et contre les consquences de ses propres fautes
inexcusables (L.452-4 CSS).
2.1.2 La faute intentionnelle de lemployeur ou de son prpos
La faute intentionnelle de lemployeur ou de son prpos suppose, quant elle, un acte
volontaire accompli dans lintention de causer des lsions corporelles et ne rsulte pas
dune simple imprudence, si grave soit-elle (dfinition jurisprudentielle).
Il y a faute intentionnelle ds lors que laccident trouve sa source dans un acte volontaire de
violence mme si, la base, il sagit dune plaisanterie (de mauvais got !) ou si la personne
vise nest pas celle qui a t touche. Il ne peut y avoir de faute intentionnelle en cas de
condamnation pour coups et blessures involontaires.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
En cas de faute intentionnelle, la victime et ses ayants droit peuvent rechercher la
responsabilit civile de lemployeur ou de son prpos sur le terrain du droit commun
(article 1382 Code civil), en rparation de la totalit de leur prjudice. Ils peuvent
exercer laction civile devant les juridictions civiles ou rpressives.
Les rentes lgales restent dues par les CPAM qui ont la possibilit de se retourner contre
lauteur de la faute intentionnelle. En cas de faute intentionnelle dun prpos, la victime
peut engager la responsabilit civile de lemployeur sur le fondement de larticle 1384
alina 5 du Code civil. La CPAM ne peut agir, quant elle, que contre lauteur de
laccident.
Lemployeur peut sassurer contre les fautes intentionnelles de ses prposs (mais pas contre ses
propres fautes intentionnelles).
2.2 Lindemnisation des proches de la victime
En principe, les proches qui touchent les prestations de la scurit sociale ne peuvent
rechercher lemployeur sur le terrain de la responsabilit civile. Cest le cas notamment
des proches dune victime dcde la suite dun accident du travail ou dune maladie
professionnelle.
En revanche, lpouse (ou la concubine) de la victime non-dcde, qui na reu
personnellement aucune prestation de la scurit sociale, peut agir contre lemployeur pour
obtenir rparation de ses prjudices personnels.
En outre, les petits-enfants et collatraux de le victime dcde, ne recevant aucune
prestation de la part de la scurit sociale, peuvent galement agir contre lemployeur en
rparation de leurs prjudices personnels.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
3 SEXONRER DE SA RESPONSABILIT PNALE
EN CAS DACCIDENT
De manire gnrale, pour tre ventuellement exonr de sa responsabilit, lauteur des
faits pourra prouver quil a accompli les diligences normales (cest--dire quil a fait
tout ce qui tait en son pouvoir de faire pour viter les manquements) compte-tenu, le
cas chant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses comptences, ainsi
que des pouvoirs et des moyens dont il disposait. Les juges sont assez svres sur la
diligence normale.
Illustration
Par exemple, pour eux, le simple rappel des consignes de scurit ne
constitue pas une cause exonratoire de responsabilit pnale.
En dehors de ce cas gnral, lemployeur peut aussi :
invoquer la force majeure ;
soulever lerreur de droit ou lerreur de ladministration ;
invoquer le fait dun tiers ou de la victime ;
prouver leffectivit de la dlgation de pouvoirs.
3.1 Invoquer la force majeure
La force majeure ou contrainte abolit compltement la volont du prvenu qui,
malgr lui, a commis une infraction. Cette contrainte, qui doit tre totalement
imprvisible et irrsistible, est trs rarement retenue par les tribunaux (il sagit en
gnral de contraintes climatiques graves)
Ainsi, le desserrage intempestif dun crou rendant inefficace le dispositif de
scurit dune presse nest pas imprvisible ; pas plus que leffondrement dune
dalle provoqu par des lments comme un surcharge ponctuelle de bton un
endroit donn. Un chef de chantier qui na pas dlgu ses pouvoirs ne peut
invoquer limpossibilit de surveiller plusieurs chantiers en mme temps.
3.2 Soulever lerreur de droit ou
lerreur de ladministration
La personne qui justifie avoir cru, par une erreur de droit quelle ntait pas en mesure
dviter, pouvoir lgitimement accomplir lacte nest pas pnalement responsable (122-3
CP).
Lerreur doit porter sur le droit et non sur le fait. Le grant qui sest tromp sur la porte
des clauses dun accord professionnel commet une erreur de fait et non une erreur de
droit.
Lerreur doit tre insurmontable. La jurisprudence apprcie ce critre de faon subjective
en fonction de la situation personnelle de lintress. Si, notamment, ladministration du
travail induit en erreur le chef dentreprise, ce dernier ne sera exonr de sa
responsabilit que si lerreur tait insurmontable pour lui.
La simple tolrance ou lautorisation implicite de ladministration nexonre pas le chef
dentreprise de sa responsabilit en cas dinfraction.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Illustration
Ainsi, lavis du ministre qui dclare quune autorisation pour une extension de
surface de vente nest pas ncessaire, ne saurait justifier lerreur commise par une
grande surface, ds lors quelle disposait, lvidence, de juristes qualifis pour
lclairer sur le choix de la stratgie commerciale.
3.3 Invoquer le fait dun tiers ou de la victime
La loi du 6 dcembre 1976 a introduit la ncessit dune faute personnelle du chef
dentreprise. Cette exigence, qui ne change rien sur la responsabilit de principe du chef
dentreprise a permis la jurisprudence dadmettre plus facilement son exonration
quand il na commis aucune faute en relation avec le dommage.
Il en est ainsi lorsque toutes les mesures de scurit prvues par la rglementation ont t
respectes et que laccident se produit la suite dune manuvre dangereuse et non-
indispensable de la victime.
La faute de la victime nexonre lemployeur de sa responsabilit que si elle a t la
cause unique et exclusive du dommage. Comme pour lemployeur, il doit sagir dune
faute dune gravit exceptionnelle, commise avec la conscience du danger encouru.
Lemployeur ne peut se borner invoquer un manquement larticle L 230-3 du Code
du travail qui prvoit que chaque travailleur est tenu de prendre soin de sa scurit et de
sa sant. Pour apprcier la conscience du danger encouru, on tient compte de la
formation et de lexprience du salari.
Illustration
Cest ainsi que la responsabilit de lemployeur a t carte dans une espce
o la comptence et la qualification du salari (en lespce un mcanicien
hautement qualifi) a t juge telle que lon ne pouvait reprocher
lemployeur de ne pas lui avoir donn de consignes de scurit et de ne pas
avoir dfini de procdures quand aux modes opratoires.
Si la faute de la victime saccompagne dune faute, mme lgre de lemployeur, il ny a
pas dexonration, mais partage de responsabilit selon la thorie de lquivalence des
conditions qui permet de retenir la responsabilit de tous ceux qui ont jou un rle dans
le ralisation du dommage.
Illustration
La responsabilit de lemployeur a t exclue notamment :
dans un cas o il tait en cong au moment o avait eu lieu laccident qui
stait produit dans lexcution dune tche non-prvue dans le programme
de travail arrt avant le dpart de lemployeur ;
dans une espce o la victime avait fait des travaux de rparation dune
pice dans une armoire lectrique et avait nglig de mettre linstallation hors
tension, alors quil sagissait dun technicien expriment et que les rgles
fondamentales de scurit avaient t portes la connaissance du
personnel dans des conditions normales ;
dans une espce o une formation la scurit avait t organise dans
lentreprise ;
dans un cas o il avait t fait interdiction formelle la victime
dutiliser un matriel en raison de son jeune ge et o elle avait
contrevenu linterdiction en chappant toute surveillance.
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
Illustration
La responsabilit de lemployeur a t retenue malgr la faute de la
victime alors que:
la victime avait dtach le harnais de scurit aux motifs quil ne
stait pas assur que les rgles de scurit taient respectes ;
la victime a eu une initiative intempestive et aberrante aux motifs que
le salari tait un intrimaire en poste depuis seulement huit jours et
quil navait pas reu de formation la scurit ;
la victime, qui avait reu une formation suffisante en matire de scurit,
stait blesse en voulant nettoyer une machine sans en avoir au
pralable arrt le fonctionnement aux motifs que cette pratique
consistant intervenir sur des machines en fonctionnement tait une
pratique habituelle dans lentreprise que lemployeur avait laiss se
dvelopper.
Consquences de la faute inexcusable de la victime
Cette faute justifie la minoration de la rente (L 453-1 CSS). La diminution est gradue en
fonction de la gravit de la faute. Les juges se bornent constater la faute inexcusable
de la victime mais nont pas comptence pour valuer la diminution de la rente,
valuation qui appartient la commission comptente.
3.4 Prouver leffectivit de la dlgation de pouvoirs
Le chef dentreprise est normalement dgag de toute responsabilit pnale lorsque la faute
est constate dans un des secteurs quil nadministre pas directement et dont il a dlgu la
direction des agents investis expressment par lui .
La dlgation doit tre certaine et exempte dambigut et le dlgataire doit tre pourvu de
lautorit ncessaire. La dlgation doit tre prcise et non-gnrale. Il ne peut y avoir cumul
de dlgations pour exonrer le chef d'entreprise en matire de scurit, le cumul de plusieurs
dlgations pour un mme travail tant, au surplus, de nature restreindre l'autorit et
entraver les initiatives de chacun des prtendus dlgataires (arrt de la Cour de Cassation du
28 juin 1990).
Ainsi, lemployeur ne peut dlguer ses pouvoirs plusieurs personnes pour lexcution dun
mme travail car un tel cumul est de nature restreindre lautorit et entraver les initiatives de
chacun des prtendus dlgataires.
Nanmoins, lemployeur peut tre amen prouver la ralit, leffectivit de la dlgation. Sil
savre en outre quil a commis une erreur qui a caus linfraction, il ne sera pas exonr
totalement de sa responsabilit (cumul des responsabilits du dlgataire et du chef
dentreprise). Il peut mme tre entirement responsable dun accident sil savre quil a
commis une faute indpendante de la dlgation (par exemple : erreur dapprciation dans le
choix dune technique de ralisation).
La possibilit pour le chef d'entreprise de se dcharger de sa responsabilit pnale a
t affirme par la Cour de Cassation dans les conditions fixes par des arrts en
date du 11 mars 1993. Sauf dans les cas o la loi en dcide autrement, le chef
d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part la ralisation de l'infraction, peut
s'exonrer de sa responsabilit pnale s'il rapporte la preuve qu'il a dlgu ses
pouvoirs une personne pourvue de la comptence, de l'autorit et des moyens
ncessaires.
Le dirigeant concern doit prouver par tous moyens l'existence et le contenu de cette
dlgation et les juges n'ont pas en rechercher l'existence (arrt de la Cour de cassation
du 20 novembre 1974).
Une dlgation orale est valable mais elle doit tre prouve par des tmoignages et
Partie 9 La responsabilit pnale et civile en cas daccident du travail
indices concordants. La Cour de Cassation a soulign dans un des arrts en date du 11
mars 1993 quune telle dlgation n'est soumise aucune forme particulire, la preuve
de celle-ci incombe au prvenu.
Ces exigences de preuve rendent un crit prfrable de faon fixer nettement le
domaine de dlgation. C'est le dlgataire qui sera poursuivi et il est donc ncessaire
de prouver qu'il a accept la dlgation. Une subdlgation pourra ensuite tre
ventuellement tablie (arrt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1996).
La possibilit de dlgation n'est pas reconnue dans les domaines qui sont considrs comme
de la responsabilit ultime du chef d'entreprise.
D'autre part, elle n'est valable que si le dlgataire est un prpos. Il doit avoir l'autorit
ncessaire et s'il ne peut donner les ordres au service concern, la dlgation sera sans valeur
(arrt de la Cour de Cassation du 6 mai 1996).
PARTIE 10
COMMENT LIMITER
LES RISQUES DE SANCTION ?
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
1 LES CONSIGNES
1.1 Les consignes relatives lamnagement des locaux
1.1.1 Aration des locaux
1.1.2 Ascenseur
1.1.3 Dossier de maintenance des lieux de travail
1.1.4 clairage des lieux de travail
1.2 Les consignes relatives au secteur du btiment
1.2.1 Btiments et travaux publics : dcret du 8 janvier 1965
1.2.2 Oprations de btiment et de gnie civil
1.2.3 I mmeubles de grande hauteur
1.2.4 Btiments dhabitation
1.2.5 Bruit
1.3 Consignes en matire dincendie
1.4 Machines, matriels, appareils, quipements
1.4.1 Accumulateur de matire
1.4.2 Appareils de levage (autres que ascenseurs et monte-charge)
1.4.3 Ascenseurs et monte-charge
1.4.4 Centrifugeuse
1.4.5 Chariots automoteurs
1.4.6 Machines meules
1.4.7 Plans inclins
1.4.8 Presses mouler par injection
1.4.9 Ponts lvateurs pour vhicules
1.4.10 Transporteurs bandes
1.4.11 quipements
1.5 Les consignes de scurit relatives aux matires dangereuses
1.5.1 Agents et procds cancrognes
1.5.2 Amiante
1.5.3 Locaux o sont entreposes des substances explosives
1.5.4 Fours combustibles liquides ou gazeux
1.5.5 Produits chimiques
1.6 Consignes en matire de transports
1.6.1 Vhicules de transport de marchandises
1.6.2 Voies ferres dans les entreprises
1.6.3 Transports de matires dangereuses
1.7 Consignes en matire de travaux dangereux
1.7.1 Locaux et emplacements de travail risque particulier de choc lectrique
1.7.2 Installations lectriques
1.7.3 Peinture et vernis par pulvrisation
1.7.4 Radiations ionisantes
1.8 Dispositions applicables toutes les entreprises
1.8.1 Accidents du travail
1.8.2 CHSCT
1.8.3 Travail sur crans de visualisation
1.8.4 Entreprises extrieures intervenantes
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
1.8.5 Heures de travail
1.8.6 Instructions en matire de sant et de scurit
1.8.7 Prvention des maladies professionnelles
1.9 Divers
1.9.1 Blanchisseries
1.9.2 gouts
1.10 Consignes en matire de prvention des risques
2 PRVOIR LES RGLES D'HYGINE ET DE SCURIT DANS LE
RGLEMENT INTRIEUR
2.1 Lhygine et la scurit dans le rglement intrieur
2.2 Modle dun chapitre Hygine et scurit dans le rglement
intrieur
2.3 Modle de la lettre de convocation du CHSCT pour avis sur le
rglement intrieur
2.4 Modle de P.V de runion du CHSCT sur le rglement intrieur
2.5 Modle de la lettre de convocation du CE
2.6 Modle de P.V. de runion du CE sur le rglement intrieur
2.7 Modle de la lettre de convocation des dlgus du personnel (en
labsence de CHSCT et de CE)
2.8 Modle de P.V. de runion des dlgus du personnel sur le
rglement intrieur
2.9 Modle de notification du rglement intrieur linspecteur du
travail
3 ASSOCIER LE COMITE D'ENTREPRISE, LE CHSCT ET LE MDECIN
DU TRAVAIL
4 SANCTIONNER LES SALARIS QUI NE RESPECTENT PAS LES
CONSIGNES D'HYGINE ET DE SCURIT
4.1 Lexercice du pouvoir disciplinaire pour faire respecter les rgles
dhygine et de scurit
4.2 Modle de lettre davertissement
4.3 Modle de lettre de convocation toute autre sanction
4.4 Modle de lettre de convocation un entretien avec mise pied
conservatoire
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
4.5 Modle de lettre de notification dune mise pied disciplinaire
5 RESPECTER LES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE
FORMATION DES SALARIS
6 RESPECTER ET FACILITER LE DROIT DE RETRAIT DES SALARIES
7 TENIR COMPTE DE L'AVIS DES CAISSES RGIONALES
D'ASSURANCES MALADIE
8 TENIR COMPTE DE L'AVIS DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL
9 DLGUER SES POUVOIRS EN MATIRE D'HYGINE ET DE
SCURIT
9.1 La dlgation de pouvoir
9.1.1 Les conditions de la dlgation
9.1.2 Les conditions relatives au dlgant
9.1.3 Les conditions relatives au dlgataire
9.2 Modle de dlgation de pouvoirs
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
1 LES CONSIGNES
1.1 Les consignes relatives lamnagement des locaux
1.1.1 Aration des locaux
Le chef dtablissement doit indiquer dans une consigne dutilisation les dispositions
prises pour la ventilation des locaux et doit fixer les mesures prendre en cas de panne
des installations. Les consignes doivent tenir compte, sil y a lieu, des indications de la
notice dinstruction fournie par le matre de louvrage, ce dernier tant tenu dadresser
une notice dutilisation au chef dentreprise avec les dispositions prises pour la ventilation
et lassainissement des locaux.
La consigne est soumise lavis du mdecin du travail, des membres du CHSCT ou
dfaut des dlgus du personnel.
1.1.2 Ascenseur
Dans chaque ascenseur de personne sont affichs la charge nominale en kilos et le
nombre maximal de personnes.
Chaque ascenseur de personne doit avoir une machine qui lui est propre. Une notice
dinstruction est tablie par linstallateur au sujet du montage, branchements, rglage,
maintenance. La notice contient les schmas ncessaires lutilisation courante.
1.1.3 Dossier de maintenance des lieux de travail
Le matre douvrage transmet aux utilisateurs au moment de la prise de possession de
locaux un dossier dentretien des lieux de travail. Ce dossier est transmis au plus tard dans
le mois qui suit cette prise de possession des lieux.
1.1.4 clairage des lieux de travail
Le chef dentreprise fixe les rgles dentretien priodique du matriel. Ces rgles sont
consignes dans un document communiqu au CHSCT dfaut aux dlgus du
personnel.
Elles sont tablies en fonction du document que lui transmet le matre douvrage, lequel
document contient des lments dinformation sur lentretien du matriel ainsi que sur les
niveaux minimum dclairement des locaux pendant les priodes de travail.
1.2 Les consignes relatives au secteur du btiment
1.2.1 Btiments et travaux publics : dcret du 8 janvier 1965
1.2.1.1 Appareils de levage mus mcaniquement
Il doit tre appos en permanence, sur tout appareil de levage actionn
mcaniquement, auprs du conducteur, ainsi que sur la partie infrieure de
lappareil de levage, une plaque indiquant les limites demploi de
lappareil, compte-tenu, notamment de limportance et de la position des
contrepoids, de lorientation et de linclinaison de la flche, de la charge leve en
fonction de la porte et de la vitesse du vent compatible avec la stabilit.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Une consigne doit prciser les conditions dapplication des prescriptions en cas de
transport ou dlvation du personnel par des appareils de levage mus la
main.
1.2.1.2 Planchers dchafaudage
Un registre spcial doit tre tenu et un affichage doit indiquer les restrictions dusage.
1.2.1.3 Travaux Publics : consignes et affichage
Instructions
Le chef dtablissement doit, avant le dbut des travaux publics porter la
connaissance du personnel, au moyen de consignes crites, les mesures de
protection qui devront tre mises en uvre lors de lexcution des travaux ainsi que
les mesures de scurit qui seront prises lorsque les travaux sont effectus
proximit dune installation lectrique sous tension.
Il est interdit demployer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans des travaux
en hauteur de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude ces travaux ne
soit mdicalement constate. Une consigne crite dtermine les conditions demploi
et de surveillance des intresss.
Affichage
Quand le chantier dpasse une semaine, le chef dentreprise doit indiquer ladresse
et le numro de tlphone du service durgence auquel il convient de sadresser en
cas daccident. Les consignes prises en application du dcret du 8 janvier 1965
doivent tre affiches une place aisment accessible.
1.2.1.4 Portes et portails automatiques
Pour toute porte ne rpondant pas aux normes, le matre douvrage doit joindre au
dossier une note technique justifiant la conformit larrt.
1.2.2 Oprations de btiment et de gnie civil
Quand plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, le matre douvrage fait tablir
par le coordonnateur un plan gnral de coordination en matire de scurit.
Un plan particulier est adress au coordonnateur par chaque entreprise intervenante et
au matre douvrage si le volume de travail confi une seule entreprise dpasse un
certain volume fix en CE.
Un collge interentreprises de scurit dfinit les rgles communes pour que les mesures
de scurits sur le chantier soient respectes.
1.2.3 Immeubles de grande hauteur
Plan et dispositifs de scurit
Les dispositifs daccs aux escaliers et aux compartiments doivent comporter :
1 le numro de ltage inscrit sur la porte de chaque escalier, chaque niveau ;
2 un plan du niveau o le plan est affich qui doit permettre le reprage :
- du dispositif daccs et la distribution gnrale du niveau,
- de lemplacement des ouvrants et de leur commande douverture,
- de lemplacement des dispositifs dvacuation deau,
- de lemplacement des moyens de secours et du tlphone dalerte.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Chaque dispositif daccs comporte une ligne tlphonique fixe qui relie au poste central
de scurit tous les dispositifs daccs correspondant au mme escalier.
Le service de scurit dispose en outre de 3 postes de tlphones portatifs par escalier
pouvant tre mis la disposition des sapeurs-pompiers et quil est possible de brancher
sur la ligne tlphonique de chacun des dispositifs daccs.
Les dispositifs de scurit sont la charge du propritaire de limmeuble.
Exercices dvacuation et affichage
En cas de travaux, le propritaire doit mettre sur pied un service permanent de scurit et doit
organiser au moins une fois par an un exercice dvacuation de chaque compartiment (en
associant les compartiments infrieurs et suprieurs) tout en prvoyant la possibilit
dvacuation de limmeuble dans sa totalit en procdant (ventuellement) des exercices
cette fin.
Le propritaire doit tablir et afficher les consignes dincendie prs des accs aux
escaliers et aux ascenseurs et doit donner aux habitants des informations sur les moyens
de protection contre lincendie mis en place dans limmeuble.
1.2.4 Btiments dhabitation
Le propritaire ou, le cas chant, la personne responsable quil dsigne, doit afficher
dans les halls dentre, prs des accs aux escaliers et aux ascenseurs les consignes en
cas dincendie :
les plans des sous-sols et du rez-de-chausse ;
les consignes particulires selon le type dimmeuble en cas dincendie.
Les consignes sont affiches galement dans les parcs de stationnement.
1.2.5 Bruit
Lemployeur doit procder une estimation et, si besoin, un mesurage du bruit
subi pendant le travail.
Ce mesurage doit tre prvu dans un document tabli par lemployeur et soumis, pour
avis, au CHSCT ( dfaut aux dlgus du personnel) et au mdecin du travail.
Ce document doit tre rexamin et radapt chaque fois quil y a modification des conditions
de travail, ou sur proposition du mdecin du travail.
1.3 Consignes en matire dincendie
Les consignes en matire dincendie sont des lments de la formation la scurit
des entreprises et sont soumises lavis du CHSCT et de lInspection du travail.
Affichage
Les chefs et exploitants dtablissement runissant plus de 50 personnes doivent tablir et
afficher des consignes sur les mesures prendre en cas dincendie, de manire
apparente indiquant :
les matriels dextinction et de secours qui se trouvent dans le local et aux abords, le
personnel charg de mettre ce matriel en action, les personnes charges de diriger
lvacuation du personnel et ventuellement du public, en prcisant le cas chant, les
mesure spcifiques lies la prsence de personnes handicapes ;
le numro dappel tlphonique du service de secours de 1
er
appel de manire apparente ;
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
que toute personne apercevant un dbut dincendie doit donner lalarme et mettre en
uvre les moyens de 1
er
secours.
La consigne doit prvoir des essais lors des visites priodiques du matriel et des exercices, au
moins tous les 6 mois, au cours desquels le personnel apprend reconnatre les
caractristiques du signal sonore dalarme gnrale, se servir des moyens de 1
er
secours et
excuter les diverses manuvres ncessaires.
Plan
Il est souhaitable de complter les consignes incendie par des plans indiquant :
lemplacement des moyens de secours et des risques particuliers ;
les moyens daccs des locaux et les cheminements pour lvacuation.
Des plans dintervention pourront tre tablis pour les pompiers ou les services de
secours publics.
Une signalisation doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapproche.
1.4 Machines, matriels, appareils, quipements
1.4.1 Accumulateur de matire
Organisation
Arrt du 24 mai 1956 relatif la prvention des accidents susceptibles dtre provoqus
par des accumulateurs de matires : lorsque la descente de personnel lintrieur des
accumulateurs de matires savre ncessaire, cela nest possible que sur ordre du chef
dentreprise ou de son prpos. La descente se fait sous la surveillance dun agent de
matrise qualifi prsent lextrieur de laccumulateur pendant toute la dure de
lopration.
quipement
Les travailleurs sont obligs de porter une ceinture ou un harnais de scurit. Le chef
dtablissement tablit les consignes sur les prcautions prendre et le matriel utiliser.
1.4.2 Appareils de levage (autres que ascenseurs et monte-charge)
Organisation du travail
Le chef dtablissement a lobligation de prendre toutes mesures pour que les appareils de
levage ne soient pas en contact avec les installations lectriques.
Interdiction
Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf ncessit. Dans ce
cas des mesures spciales doivent tre prises pour prvenir tout danger.
quipements
La loi autorise exceptionnellement le levage de personne condition que soient utiliss
les quipements de travail et les accessoires prvus cette fin. Le levage de personne
avec des quipements de travail non prvus pour le levage peut tre utilis en cas
durgence.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
1.4.3 Ascenseurs et monte-charge
Sagissant de lentretien des appareils de levage, une fiche descriptive
rcapitulant lensemble des risques sera tablie conformment larticle 5 du
dcret du 30 juin 1995.
1.4.3.1 Appareils destins tous transports
Organisation du travail
Seul un personnel qualifi peut avoir accs au systme de fonctionnement des
ascenseurs (moteurs, organes de transmission, dispositifs de verrouillage et de scurit).
Lemployeur doit veiller ce que le travail de ce personnel soit facilit : laccs au
systme de fonctionnement des ascenseurs et monte charges ne doit pas tre entrav ni
rendu dangereux par une difficult daccs (le travailleur qualifi ne doit pas tre un
acrobate pour avoir accs au systme de fonctionnement) ou par un manque de place
(le travailleur doit tre libre de ses mouvements quand il intervient sur le systme de
fonctionnement).
Les usagers, quant eux, ne doivent pouvoir utiliser que les organes strictement
ncessaires pour actionner les appareils.
Consignes crites
Les instructions lattention des usagers, affiches ct de ces organes, devront en
prciser le mode dutilisation et donner le nom, sil y a lieu, des personnes charges de
lentretien.
Dispositions techniques
Des dispositions particulires (non prcises) doivent tre prises lorsque des personnes
utilisent les appareils lvateurs afin de prvenir les risques demballement de lappareil
(drive et excs de vitesse) et les risques de dfaillance, afin dassurer la prcision des
arrts et de rendre possible larrt autrement que par lutilisation du systme habituel de
manuvre.
1.4.3.2 Appareils destins au seul transport dobjets
Si lappareil est exclusivement destin au transport dobjets, un affichage rappellera au
personnel linterdiction de lutiliser pour un autre usage.
Par ailleurs, les appareils de commande extrieure seront disposs de telle sorte
quil ne sera pas possible de les actionner depuis lappareil de levage.
1.4.4 Centrifugeuse
Affichage
Le fabricant doit munir chaque centrifugeuse dune plaque trs visible, solidement fixe sur la
cuirasse de lappareil. Cette plaque doit, au minimum indiquer :
le numro de marque de fabrication et de lanne de fabrication ;
le nom du fabricant ;
la vitesse maximum tours/mn ;
la charge maximum en kg.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Les indications figurant sur la plaque des appareils et les instructions donnes aux
oprateurs doivent, en cas de ncessit, tre rappeles dans des avis placs prs des
machines et des postes de commande.
Formation
Les oprateurs des centrifugeuses doivent, quant eux, tre pralablement informs des
dangers encourus et tre informs des mthodes sres employer pour la conduite, le
chargement ou le dchargement de lappareil, aussi bien en rgime normal quen cas de
danger ou de panne.
1.4.5 Chariots automoteurs
Dispositions techniques
Des dispositifs de scurit doivent tre mis en place afin :
dempcher la mise en marche par des personnes non habilites ;
de garantir le freinage par un dispositif de freinage de secours ;
damliorer la visibilit du conducteur.
Formation des conducteurs et aptitudes particulires
La conduite des quipements de travail mobiles automoteurs est rserve un
personnel ayant reu une formation adquate, complte et ractualise chaque
fois que ncessaire. Une autorisation de conduite est ncessaire pour la conduite
de certains quipements prsentant des risques particuliers. Cette autorisation est
tenue par lemployeur la disposition de lInspecteur du Travail et des agents des
services comptents de la scurit sociale. Des arrts ministriels dterminent les
conditions dans lesquels lemployeur sassure de laptitude du travailleur.
Affichage
Certaines informations doivent figurer sur les chariots (norme FD H96-301-1).
1.4.6 Machines meules
Affichage
Chaque machine meule doit tre munie dune plaque bien visible sur le bti, indiquant
:
la vitesse maximale de rotation ;
la nature des meules pouvant tre utilises, et leurs diamtres maximal et minimal.
Le rglement datelier, qui reprend toutes les consignes de scurit applicables au travail
sur les meules, doit tre affich dans tout local o est manipule une meule ou machine
meule, de telle sorte que le personnel puisse en prendre aisment connaissance.
quipement
Lorsque la nature du travail de l'ouvrier l'exige, celui-ci doit porter des gants de
protection appropris son travail. Cette consigne est reproduite dans le rglement
datelier.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
1.4.7 Plans inclins
Le chef dentreprise doit tablir des consignes dutilisation avant toute mise
en service, en tenant compte du site de linstallation et aprs avis du CHSCT (ou
dfaut des dlgus du personnel).
Ces consignes doivent :
indiquer le nom du ou des machinistes de linstallation ;
interdire au machiniste de quitter son poste pendant le fonctionnement de linstallation,
sauf verrouiller pralablement les commandes ;
interdire de laisser une personne, autre que celle dsigne cette effet, manuvrer les
appareils ;
interdire dutiliser le plan inclin pour les transports de personnes ;
interdire de se tenir et de circuler sur les voies et leurs abords pendant le
fonctionnement de linstallation ;
indiquer les conditions dans lesquelles malades ou blesss peuvent tre transports
titre exceptionnel ;
indiquer dans quelles conditions exceptionnelles la circulation pied sur le plan inclin
et la traverse de celui-ci peuvent tre autorises ;
interdire de se tenir au pied du plan inclin pendant la circulation du ou des vhicules ;
faire obligation au machiniste de linstallation de se concerter avec le receveur afin de
convenir dun signal et faire obligation au machiniste et au receveur de sassurer que
personne nest sur la voie ;
faire obligation au machiniste et au receveur de prendre toutes mesures pour quun
vhicule accident ne puisse se mettre en mouvement de lui-mme ;
prvoir les mesures de scurit prendre en cas de dfaillance notamment de
draillement ou en cas dincendie ;
prvoir les conditions de transport des matires inflammables, explosives,
dangereuses ;
faire obligation au personnel de porter le casque et autres accessoires de protection
individuelle.
1.4.8 Presses mouler par injection
Les dispositions relatives aux mesures de prvention prendre doivent tre affiches dans
tous les ateliers o se trouvent des presses mouler les matires thermoplastiques par
injection.
1.4.9 Ponts lvateurs pour vhicules
Instructions
Les chemins de roulement des ponts lvateurs plate-forme doivent tre maintenus en
parfait tat de propret. La zone de dplacement de la plate forme doit tre nettement
dlimite sur le sol et maintenue dgage en permanence, ds lors que le pont lvateur
est susceptible de tourner autour dun axe vertical.
Affichage
La charge maximale dutilisation et la pression de service ne pas dpasser pour les
ponts comportant des vrins doivent tre inscrites dans un endroit parfaitement visible du
pont.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Par ailleurs, le chef dentreprise porte la connaissance du personnel, par voie daffiche
ou par tout autre moyen appropri la consigne suivante :
Il est interdit de stationner sous un pont lvateur en mouvement, que ce pont soit
charg ou non, et galement sous un pont lvateur larrt lorsque les conditions du
travail effectuer ne limposent pas .
Personnel qualifi
Les ponts lvateurs ne peuvent tre manuvrs ou contrls que par des personnes
comptentes, dsignes par le chef dtablissement.
1.4.10 Transporteurs bandes
Les utilisateurs de transporteurs bandes mus mcaniquement ou dinstallations compltes
doivent sassurer que le matriel comporte de faon visible : le nom du constructeur ou du
fournisseur, lanne et le n de fabrication.
1.4.11 quipements
1.4.11.1 quipements de protection individuelle
Marquage
Formalits obligatoires pralables la mise sur le march des quipements de travail et
moyens de protection neufs ou considrs comme neufs. Ces formalits concernent les
fabricants, responsables de la mise sur le march dquipements de travail. Un
marquage de conformit doit tre appos de manire distincte et indlbile.
Instructions
A certains travailleurs
Lemployeur doit informer de manire approprie les travailleurs chargs de la maintenance
des quipements de travail : des conditions dutilisation et de maintenance de ces
quipements, des instructions et consignes les concernant, de la conduite tenir en cas
danomalies, des conclusions tirer des expriences afin de supprimer certains risques.
A tous les travailleurs
Lemployeur informe de manire approprie les travailleurs des risques contre lesquels
les quipements de scurit les protgent et des conditions dutilisation concernant ces
quipements.
Par ailleurs, tous les travailleurs sont informs des risques les concernant provenant des
quipements de travail, mme sils ne les utilisent pas, lorsque ces quipements sont
dans leur environnement de travail immdiat
Les instructions et conditions dutilisation sont mentionnes dans une consigne labore
par le chef dtablissement que celui-ci tient la disposition des membres du CHSCT (ou
dfaut D.P.).
Linspection du travail peut procder la vrification des quipements de travail et
moyens de protection.
1.4.11.2 quipements de travail mobiles
Les voies de circulation des quipements de travail mobiles doivent tre maintenues libres
de tout obstacle. Si une quipe de travail volue dans la zone de circulation, le chef
dtablissement doit tablir des rgles de circulation adquates et veiller leur
application.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
1.4.11.3 quipements sous pression
Ces quipements doivent porter des marquages permettant didentifier le fabricant ou
ses mandataires tablis dans la C.E.
Ils sont accompagns des instructions dutilisation qui doivent tenir compte de
celles du fabricant relatives leurs conditions dinstallation, de mise en service,
dutilisation ou de maintenance.
1.5 Les consignes de scurit relatives
aux matires dangereuses
1.5.1 Agents et procds cancrognes
En cas dutilisation dun agent cancrogne, lemployeur applique les mesures
suivantes :
limitation des quantits dun agent cancrogne sur le lieu de travail ;
limitation des travailleurs exposs ou susceptibles de ltre ;
mise au point de modalits de travail ;
vacuation des agents cancrognes.
1.5.2 Amiante
Le chef dtablissement tablit, pour chacun des travailleurs concerns, une fiche
dexposition prcisant la nature et la dure des travaux effectus, les procdures de
travail, les quipements de protection utiliss et, sil est connu, le niveau
dexposition. La fiche est transmise aux intresss et lInspection du travail.
1.5.3 Locaux o sont entreposes des substances explosives
Ces locaux ne doivent contenir aucune source dignition : flamme ou
substance susceptible de senflammer et doivent disposer dun systme de ventilation
appropri.
Des consignes particulires de scurit concernent les locaux o sont entreposs
des liquides particulirement inflammables.
Une affiche indique linterdiction de fumer.
1.5.4 Fours combustibles liquides ou gazeux
Instructions au personnel spcialis
Des consignes simples et prcises sont portes la connaissance du personnel qualifi
qui est confi la conduite des fours. Ces consignes sont tablies partir des instructions
du constructeur. Elles sont affiches de faon visible et permanente, soit dans la zone du
four, soit, sil y en a un, son poste de commande.
Vrifications avant usage
Le rglement conseille de procder une inspection soigne de linstallation chaque
dmarrage froid aprs un arrt prolong du four, notamment lorsque des travaux de
rparation ou dentretien, ont t faits sur linstallation.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Pour ce faire, il est indiqu de sassurer de labsence de personnes ou de corps trangers
dans la chambre de combustion, de fermer convenablement toutes les trappes daccs
linstallation, de procder un positionnement convenable des brleurs et allumeurs, de
sassurer de ltat de fonctionnement des registres de fumes.
1.5.5 Produits chimiques
Les installations et appareils de protection collective doivent tre rgulirement vrifis et
maintenus en parfait tat de fonctionnement ; une notice est tablie par lemployeur
aprs avis du CHSCT.
Lemployeur doit tablir une notice pour chaque poste de travail exposant les
travailleurs des substances ou prparations chimiques dangereuses. Cette notice est
destine les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des
conditions prises pour les viter.
Les fabricants, vendeurs tablissent des fiches de donnes concernant les substances
ou prparations dangereuses destines aux utilisateurs. Le chef dentreprise transmet ces
fiches au mdecin du travail.
1.6 Consignes en matire de transports
1.6.1 Vhicules de transport de marchandises
Doivent tre affichs :
dans la cabine de conduite, la vitesse maximum autorise, le nombre maximum
de places autorises, et le rappel de linterdiction de parler au conducteur sans
ncessit ;
dans le compartiment rserv aux voyageurs : linterdiction de voyager
debout, de sasseoir sur les bords et sur les ridelles du vhicule, de monter ou de
descendre avant larrt complet et en dehors des endroits prvus cet effet.
1.6.2 Voies ferres dans les entreprises
Les dispositions en matire de scurit sur les voies ferres dans les entreprises (signal
darrt ou de ralentissement placs en avant des parties de voies o la circulation est
arrte ou ralentie ; lutilisation dun dispositif de commande distance pour le
ralentissement et larrt des wagons), ne sont pas applicables pour les parties de voies
situes lintrieur des ateliers, magasins ou btiments.
Le rglement intrieur ou des consignes de scurit doivent fixer les mesures particulires
de protections relatives ces portions de voies.
1.6.3 Transports de matires dangereuses
Pour faire transporter des matires dangereuses, lemployeur doit donner au conducteur
des consignes crites.
Ces consignes doivent mentionner le nom, ladresse, le tlphone de lexpditeur des matires
dangereuses ou du service de scurit alerter si ncessaire.
Les consignes prcisent :
la nature du danger et les mesures prconises pour y faire face, (les mesures prendre en
cas dincendie et les moyens employer pour lextinction) ;
les mesures prendre en cas de bris des emballages, notamment lorsque des matires
gazeuses se sont rpandues sur la chausse.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Ces consignes sont affiches dans la cabine du conducteur.
1.7 Consignes en matire de travaux dangereux
1.7.1 Locaux et emplacements de travail
risque particulier de choc lectrique
Laccs aux locaux et emplacements de travail risques particuliers de choc lectrique nest
autoris quaux personnes appeles y travailler et averties des risques lectriques.
Cette autorisation est donne par le chef dtablissement.
1.7.2 Installations lectriques
Les prescriptions suivantes doivent tre observes dans les domaines BTB, HTA et HTB :
des pancartes sur tous les obstacles doivent rappeler linterdiction de faire
cesser la protection par les obstacles ;
les obstacles dmontables ou dplaables seulement avec des outils doivent porter le
symbole de danger lectrique.
Le personnel utilisant une installation lectrique ou travaillant dans son voisinage, doit
tre inform des prescriptions de scurit respecter, par affichage de
consignes ou dordres de services ou remise contre dcharge dun carnet de
scurit .
Lemployeur doit assurer une formation suffisante aux travailleurs concerns et doit
sassurer que les prescriptions de scurit sont respectes et les rappeler rgulirement.
Le salari doit, en particulier, signaler toute dfectuosit ou anomalie constate dans
ltat apparent dans le fonctionnement du matriel lectrique utilis.
Les travailleurs doivent disposer du matriel ncessaire afin dintervenir en cas
daccident, lequel matriel doit tre adapt la tension de service et tre en parfait tat.
Le personnel de surveillance
Une personne comptente dont le nom est port la connaissance de lensemble du
personnel doit tre charge de la surveillance des installations lectriques. Cette
personne doit veiller supprimer ou faire supprimer les causes de dfectuosit et les
anomalies constates.
Elle doit en outre veiller :
au maintien hors de porte des pices normalement sous tension ;
au bon tat des conducteurs de protection ;
au bon tat des conducteurs souples raccords aux appareils amovibles ;
au calibrage des fusibles et au rglage des disjoncteurs ;
au contrle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant diffrentiel rsiduel ;
au contrle des dfauts disolement ;
au contrle de lloignement des matires combustibles par rapport certains
matriels lectriques ;
au contrle de la propret de certains matriels lectriques, les risques dchauffement
pouvant tre rendus dangereux par laccumulation de poussire ;
au contrles de scurit des installations utilises dans les locaux risques dexplosion ;
aux prcautions prises pour pallier les consquences dventuelles missions de gaz,
vapeur ou poussires toxiques dues lutilisation de certaines matires isolantes.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Le personnel qualifi
Les travaux ou oprations sur les installations lectriques (ou proximit) ne peuvent tre
confis qu des personnes qualifies et habilites, appartenant ltablissement ou
une entreprise qualifie en matire lectrique. Lemployeur doit remettre chaque
travailleur, contre reu, un recueil des prescriptions quil complte, le cas chant,
par des instructions particulires relatives certains travaux.
Pour les installations HTA et HTB, la mise hors tension doit toujours tre
effectue avant tout dplacement ou enlvement dobstacles, mme si ces oprations ne
peuvent se faire sans outils. Une affiche sur lobstacle ou proximit immdiate donne le
dtail des oprations effectuer pour la mise hors tension.
En cas de travaux effectus sous tension, une procdure exceptionnelle doit tre suivie,
le personnel doit :
tre instruit des prcautions prendre ;
avoir reu une instruction de service indiquant les prescriptions respecter, les conditions
dexcution des travaux, les appareils et outillages utiliser.
Pour les travaux sous tension, le personnel doit, en outre disposer du matriel
ncessaire pour assurer sa scurit (outils isolants, gants isolants, tabouret ou
tapis isolant etc.) et disposer des moyens ncessaires pour dlimiter la zone de
travail (pancartes, bandes souples plastifies blanches et rouges, ou noires et jaunes
etc.).
Consignes en cas daccidents
Les consignes des premiers soins donner aux victimes daccidents lectriques (dcret du 14
fvrier 1992) doivent tre portes la connaissance du personnel.
Les numros des services dintervention durgence (SAMU, Pompiers) doivent faire lobjet
dun affichage apparent.
1.7.3 Peinture et vernis par pulvrisation
Le chef dentreprise doit afficher dans un endroit apparent de latelier :
le texte du dcret du 23 aot 1947 ;
le nom, ladresse du mdecin charg de procder aux examens mdicaux.
1.7.4 Radiations ionisantes
Instructions
Lemployeur doit remettre une notice crite tout travailleur destin travailler dans la
zone contrle ou appel y pntrer occasionnellement.
Cette notice les informe :
des dangers que reprsente lexposition aux rayonnements ionisants et que comporte
son poste de travail ;
des moyens mis en uvre pour les viter ;
des mthodes de travail garantissant la meilleure scurit ;
des garanties que reprsentent pour lui les examens mdicaux.
Le mdecin du travail ritre ces informations auprs des femmes dont la grossesse lui a
t dclare.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Lemployeur est tenu de faire connatre aux travailleurs intresss :
le nom et ladresse du mdecin charg de procder aux examens mdicaux
obligatoires et le lieu o se droulent ces examens ;
le nom de la personne comptente pour la manipulation et lutilisation des sources
radioactives.
Lemployeur informe, en outre, les travailleurs intresss sur les dispositions spcifiques
du rglement intrieur relatives aux conditions dhygine et de scurit dans les zones
contrles.
Des dispositions du rglement intrieur rappellent aux travailleurs quils doivent respecter
les consignes de scurit et porter les quipements individuels de protection et, pour une
certaine catgorie de travailleurs (catgorie A), quils doivent se munir de dosimtres
individuels.
Affichage
Consignes relatives aux gnrateurs poste fixe : une signalisation permanente doit avertir du
fonctionnement du gnrateur et interdire laccs du local par la mise en place dun dispositif
qui ne peut tre franchi par inadvertance.
Consignes relatives aux gnrateurs poste mobile.
En cas dutilisation de gnrateur poste mobile, lemployeur labore une notice de service
dans laquelle il fixe les mesures de scurit qui doivent tre prises pour assurer la protection des
tous les travailleurs exposs.
Les consignes doivent prescrire notamment lloignement des objets superflus situs au
voisinage du gnrateur de rayon X, prvoir la matrialisation et la signalisation de la
zone o le personnel tranger lopration ne doit pas avoir accs.
Mesures durgence
Lemployeur doit prvoir les mesures durgence appliquer en cas dincendie proximit
de la source, en cas de perte de la source ou de rupture de la capsule ou de lenveloppe
de la source. Les mesures doivent tre portes la connaissance des travailleurs
concerns.
Lemployeur doit prvoir les mesures durgence appliquer en cas de disparition
accidentelle des sources non scelles sur les lieux de travail et porter ces mesures la
connaissance du personnel affect la manipulation des sources.
Dispositions du rglement intrieur sur les sources non scelles
Lemployeur doit mettre disposition des travailleurs les moyens ncessaires pour que, en
aucune circonstance, des sources non scelles ne soient manipules mains nues, que des
solutions radioactives ne soient pipetes la bouche. Une disposition du rglement intrieur
rappele en permanence aux postes de travail concerns, doit prescrire aux travailleurs de faire
usage de ces moyens.
Une disposition du rglement intrieur doit interdire dintroduire lintrieur dun local
o sont prpares ou utilises des sources non scelles de substances radioactives : de la
nourriture, des boissons, articles fumeurs, sacs main, cosmtiques, mouchoirs, lesquels
sont dposs aprs usage dans un rcipient prvu cet effet. Le rcipient est vid chaque
jour et les mouchoirs doivent tre considrs comme des dchets radioactifs.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
1.8 Dispositions applicables toutes les entreprises
1.8.1 Accidents du travail
Les chefs dtablissement sont tenus dafficher, dans des locaux normalement
accessibles aux salaris, ladresse et le numro dappel des services de secours
durgence (pompiers, SAMU)
1.8.2 CHSCT
La liste nominative des membres du CHSCT et l'emplacement de leurs lieux de travail
habituels doivent tre affichs dans les locaux affects au travail.
Lorsqu'une entreprise extrieure met du personnel disposition de l'entreprise
utilisatrice, un affichage de la liste nominative des membres du CHSCT de l'entreprise
extrieure et de l'entreprise utilisatrice est fait aux lieux d'entre et de sortie du
personnel.
1.8.3 Travail sur crans de visualisation
Organisation du travail
Lemployeur doit procder lanalyse des conditions de travail sur les postes
comportant un cran de visualisation. Il doit organiser lactivit des salaris afin de
permettre une interruption priodique du temps de travail quotidien, par des pauses et
des changements dactivit.
Formation
Lemployeur doit en outre assurer au salari une formation sur tout ce qui concerne la
sant et la scurit lie son poste de travail.
Surveillance mdicale
Par ailleurs, les salaris doivent faire lobjet dune surveillance mdicale et doivent
bnficier dun examen des yeux et de la vue pralablement une affectation des
travaux sur cran.
1.8.4 Entreprises extrieures intervenantes
Pralablement toute opration, une inspection commune des lieux, des installations
et des matriels mis la disposition de lentreprise extrieure doit avoir lieu. Le chef de
lentreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extrieures les consignes
de scurit qui concerneront leurs salaris. Les chefs dentreprises doivent se
communiquer toutes les informations ncessaires la prvention des risques ;
notamment un descriptif des travaux effectuer, des matriels utiliss et des modes
opratoires.
Au vu de ces informations, les chefs dentreprises procdent en commun une analyse
des risques pouvant rsulter de linterfrence entre les activits, les installations, les
matriels. Quand les risques existent, ils arrtent en commun un plan de prvention
comportant :
une dfinition des phases dactivit dangereuse et des moyens de prvention
spcifiques ;
ladaptation des matriels, linstallation dun dispositif adapt la nature des
oprations effectuer ;
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
linstruction donner aux salaris ;
lorganisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas durgence ;
les conditions de la participation des salaris dune entreprise aux travaux
raliss par une autre en vue dassurer la coordination ncessaire en matire
de scurit et notamment de lorganisation du commandement.
Le plan de prvention, tabli par crit, est tenu, pendant toute la dure des travaux,
la disposition de lInspection du travail, des services de prvention des caisses de
scurit sociale, des mdecins du travail.
Le CHSCT de lentreprise utilisatrice et de lentreprise extrieure sont informs des
dates des inspections et des runions communes de coordination entre leurs entreprises
respectives.
1.8.5 Heures de travail
Les chefs dtablissement doivent afficher les heures auxquelles commence et finit le
travail ainsi que les heures et la dure des repos.
En cas de rpartition de lhoraire par cycles, laffichage doit comprendre la rpartition de la
dure du travail dans le cycle ou le programme de modulation.
1.8.6 Instructions en matire de sant et de scurit
Instructions
Conformment aux instructions qui lui sont donnes par lemployeur, le travailleur
doit prendre soin de sa sant et de sa scurit (L230-3 Code du Travail).
Plan damnagement
Linterdiction de fumer : sapplique dans tous les lieux ferms et couverts qui
constituent des lieux de travail. Lemployeur tablit, aprs consultation du mdecin du
travail, du CHSCT et dfaut du dlgu du personnel, un plan damnagement des
espaces spcialement rservs aux fumeurs.
1.8.7 Prvention des maladies professionnelles
Visites mdicales
La prvention des maladies professionnelles les plus graves consiste en un examen
pralable des salaris aux fins de vrifier si lorganisme du salari prsente une
prdisposition une affection rendant lemploi du salari impossible au poste
concern (si le poste est expos des risques dintoxication : silicose, intoxication
saturnine, intoxication benzolique ou intoxication par le bromure de mthyle etc.). Des
examens mdicaux de surveillance ont lieu par la suite, en gnral, tous les trois mois.
quipements
Selon limportance des risques, des vtements spciaux, masques, appareils
respiratoires peuvent tre exigs.
Affichage
Un affichage attire lattention du salari sur les dangers de lintoxication et les
prcautions prendre.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
1.9 Divers
1.9.1 Blanchisseries
Les chefs dindustrie, directeurs ou grants doivent afficher dans un endroit visible des locaux
professionnels le dcret du 1
er
octobre 1913 ainsi que des consignes :
pour imposer lemploi de vtements de travail au personnel ;
pour obliger le personnel prendre des soins au niveau de la propret chaque
sortie de latelier ;
pour interdire de consommer des aliments ou boissons dans les ateliers o est
manipul le linge sale.
1.9.2 gouts
Le chef dentreprise est tenu dafficher dans un endroit trs apparent, dans les lieux o
se font la paye des ouvriers ainsi que lembauchage, ainsi que dans les vestiaires, le
nom et ladresse du mdecin charg de procder aux examens.
1.10 Consignes en matire de prvention des risques
Les principales mesures prvues par la loi du 30 juillet 2003, sur la prvention des risques
technologiques et naturels concernant plus particulirement le volet risques technologiques,
touchent les domaines suivants :
Information du public sur les risques technologiques
Lorsque lenqute publique porte sur une demande dautorisation concernant une
installation classe, une runion publique devra obligatoirement tre organise si le
maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise linstallation dangereuse en
fait la demande.
Un comit local dinformation et de concertation sur les risques est cr par le prfet
pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations risques. Il peut
faire appel aux comptences dexperts reconnus et doit tre tenu inform de tout
incident ou accident touchant la scurit desdites installations.
Cration de plans de prvention des risques technologiques
Une tude de dangers qui prcise les risques que linstallation peut engendrer donne
lieu une analyse de ceux-ci qui dfinit et justifie les mesures propres rduire la
probabilit et les effets de ces accidents.
Des plans de prvention des risques technologiques (PPRT) sont labors et mis
en uvre par ltat dans le but de limiter les effets daccidents susceptibles de
survenir dans les tablissements hauts risques et pouvant entraner des effets sur
la salubrit, la sant et la scurit publiques.
Ces plans dlimitent un primtre dexposition aux risques en tenant compte de la
nature et de lintensit des risques technologiques dcrits dans les tudes de dangers et
des mesures de prvention mises en uvre.
Intensification de la scurit du personnel des tablissements
risques
En cas de sous-traitance dans les tablissements comprenant au moins une
installation classe, les employeurs cooprent la mise en uvre des dispositions
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
relatives la scurit, lhygine et la sant. Le chef dtablissement de
lentreprise utilisatrice veille au respect par lentreprise extrieure des mesures
que celle-ci a la responsabilit dappliquer.
Le chef dtablissement est tenu de dfinir et de mettre en uvre au bnfice des chefs
dentreprises extrieures et de leurs salaris, avant le dbut de leur premire
intervention sur le site, une formation pratique et approprie aux risques particuliers
que leur intervention peut prsenter en raison de sa nature ou de la proximit de
linstallation.
Par ailleurs, de faon gnrale : le chef dtablissement informe, ds quil en a connaissance,
linspecteur du travail, le service de prvention des organismes de scurit sociale et, selon le
cas, linspection des installations classes ou lingnieur charg de lexercice de la police des
installations, de lavis rendu par le CHSCT quant lexistence dune cause de danger grave
et imminent.
Des moyens appropris, humains et matriels, de prvention, de lutte conte lincendie
et de secours doivent tre prvus afin de veiller en permanence la scurit des
personnes occupes dans lenceinte de ltablissement.
Renforcement du rle du CHSCT dans les tablissements risques
Le CHSCT est consult avant toute dcision de sous-traiter une activit pouvant
prsenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximit de
linstallation dangereuse. Il est galement consult sur la liste des postes de travail lis
la scurit de linstallation et est inform la suite de tout incident qui aurait pu
entraner des consquences graves.
Le chef dtablissement doit consulter le CHSCT sur la dfinition et la modification des
moyens appropris, humains et matriels, de prvention, de lutte contre lincendie et
de secours devant tre prvus dans ce type dtablissement.
Le nombre de membres de la dlgation du personnel au CHSCT, dont le temps laiss
pour exercer leurs fonctions dans un tablissement risques est major de 30 %, est
augment par voie de convention collective ou daccord entre le chef dentreprise et
les organisations syndicales reprsentatives.
Le CHSCT est largi lorsque sa runion a pour objet de contribuer la dfinition des
rgles communes de scurit dans ltablissement et lobservation des mesures de
prvention.
Assurant la concertation entre les CHSCT des tablissements comprenant au moins une
installation dangereuse, un comit interentreprises de sant et de scurit au travail est
mis en place par lautorit administrative afin de contribuer la prvention des risques
professionnels susceptibles de rsulter des interfrences entre les activits et les
installations des diffrents tablissements.
Le CHSCT peut faire appel un expert en risques technologiques, les reprsentants du
personnel au CHSCT bnficient dune formation spcifique correspondant des
risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec lactivit de lentreprise.
Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
Ltat de catastrophe technologique est constat par une dcision de lautorit
administrative, en cas de survenance dun accident dans une installation ou
daccidents lis au transport de matires dangereuses.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
2 PRVOIR LES RGLES D'HYGINE ET DE SCURIT
DANS LE RGLEMENT INTRIEUR
2.1 Lhygine et la scurit dans le rglement intrieur
Le rglement intrieur est obligatoire dans les entreprises dau moins 20 salaris. Il doit
contenir, entre autres, les mesures dapplication de la rglementation en matire dhygine et
de scurit. Ces dispositions obligatoires peuvent tre compltes par des dispositions propres
lentreprise.
Il doit contenir les instructions permettant aux salaris de lentreprise de prendre
soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilits, de leur scurit, de
leur sant, ainsi que celles des autres personnes concernes du fait de leurs actes
ou de leurs omissions au travail.
Ces instructions, adaptes la nature des tches accomplir, doivent prciser
galement, sil y a lieu, les conditions dutilisation des quipements de travail, des
quipements de protection individuelle, des substances et prparations
dangereuses.
Il doit prciser les consignes gnrales de scurit et les conditions dans lesquelles
les salaris peuvent tre appels participer, la demande de lemployeur, au
rtablissement des conditions de travail protectrices de la scurit et de la sant des
salaris ds lors quelles ont t compromises.
Lemployeur nest pas tenu de reproduire dans le rglement intrieur toutes les dispositions
relatives lhygine et la scurit, ni dy dresser une liste exhaustive de toutes les prescriptions
particulires qui pourraient sappliquer dans lentreprise.
Toutefois, il ne peut prendre que des dispositions relatives lhygine, la scurit et la
discipline. Seules les matires fixes limitativement par le lgislateur peuvent faire lobjet
de dispositions dans le rglement intrieur. Lemployeur, par exemple, ne peut prendre
de clauses par lesquelles il dclinerait toute responsabilit en cas de vol ou de clauses
relatives lutilisation de crdits dheures.
Les clauses doivent fixer des prescriptions permanentes et gnrales ; il nest donc pas
possible de fixer dans une clause du rglement intrieur lordre de passage dans les
douches.
Le rglement intrieur ne doit pas tre contraire aux lois et aux rglements. Ainsi, il nest pas
possible de faire figurer au titre de sanction la mise pied si celle-ci nest pas prvue dans la
convention collective applicable lentreprise.
Il ne peut restreindre les droits des salaris, si cette restriction nest pas justifie par la
nature de la tche accomplir. Lemployeur ne peut pas, par exemple introduire dans le
rglement intrieur une clause interdisant toute conversation trangre au service, ou
autorisant la direction se faire ouvrir tout moment les vestiaires, ou imposant le port
dune blouse blanche quand cette tenue nest pas justifie par la nature de la tche
accomplir.
Le rglement intrieur n'entre en vigueur qu'aprs les formalits de dpt et de publicit. En
mme temps que les mesures de publicit, il est transmis l'inspecteur du travail et affich dans
un endroit accessible, sur les lieux de travail.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
L'inspecteur peut tout moment faire retirer ou modifier certaines dispositions non
conformes. Il notifie sa dcision l'employeur (avec copie aux reprsentants du
personnel et au CHSCT).
Si, loccasion dun litige entre lemployeur et un salari, le conseil de prudhommes carte
lapplication dune clause en raison de son illgalit, une copie du jugement est adresse par
le secrtariat-greffe linspection du travail.
Le rglement intrieur est un document unilatral de lemployeur. En revanche, il doit
tre soumis lavis du Comit dentreprise (ou, dfaut, des dlgus du personnel) et
du CHSCT.
Toutefois, en cas durgence, les prescriptions en matire dhygine et scurit peuvent tre
appliques immdiatement aprs information des secrtaires du CE et du CHSCT ainsi que de
linspecteur du travail (L.122-39 C.T).
Le rglement intrieur doit tre transmis lInspecteur du travail et affich dans un
endroit accessible, sur les lieux du travail. Linspecteur du travail peut tout moment
faire retirer ou modifier certaines dispositions non conformes. Il notifie sa dcision
lemployeur (avec copie aux reprsentants du personnel et au CHSCT). Lemployeur peut
exercer un recours contre cette dcision, dans les deux mois, auprs de la Direction
rgionale du travail. La dcision du Direction rgionale du travail est alors notifie
lemployeur et communique au CE et CHSCT. Un recours hirarchique est possible
dans les deux mois, auprs du Ministre du travail.
Les salaris qui refusent dappliquer les consignes du rglement intrieur commettent une
faute susceptible dtre sanctionne (ventuellement par un licenciement).
Le rglement intrieur ntant pas limitatif, lemployeur peut sanctionner le salari, mme si
linfraction et la sanction ne sont pas prvues au rglement intrieur.
Prvention des incendies
Les consignes de scurit incendie doivent tre dtailles dans des documents distincts du
rglement intrieur. Dans les tablissements de plus de 50 salaris o sont manipules
des matires inflammables, un exemplaire des consignes de scurit incendie doit tre
affiche dans chaque local de travail (et communique linspecteur du travail).
Alcoolmie et tabagisme
Le rglement intrieur peut prvoir la soumission de certains salaris au test de lalcootest. Mais
cette mesure nest permise que si elle a pour objet de prvenir ou de faire cesser une situation
dangereuse.
Le rglement intrieur peut galement comporter des mesures relatives linterdiction de fumer
sur les lieux de travail. Mais, cette interdiction doit tre affiche et doit tenir compte de lactivit
accomplir. Cest le Dcret du 29 mai 1992 qui fixe les conditions dapplication de
linterdiction de fumer dans les lieux usage collectif. Il sapplique tous les lieux ferms et
couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. Lemployeur doit tablir,
aprs consultation du Mdecin du travail, du CHSCT ou des DP, un plan damnagement des
espaces rservs aux fumeurs (le cas chant) et un plan dorganisation ou damnagement
destin assurer la protection des non-fumeurs (dans les locaux o il nest pas interdit de
fumer).
Nettoyage des armoires individuelles
Le rglement intrieur doit contenir une disposition sur les conditions de nettoyage des
armoires individuelles des salaris (R.232-24C.T).
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
Visites mdicales obligatoires
Le rglement intrieur peut rappeler le caractre obligatoire des visites mdicales
dembauche, de reprise et priodiques et prciser les sanctions du non-respect par les
salaris de cette obligation.
2.2 Modle dun chapitre Hygine et scurit
dans le rglement intrieur
Article 1 - Hygine
a. Il est interdit dintroduire ou de distribuer des boissons alcoolises ou de la drogue sur le lieu
de travail. Il est galement interdit de pntrer dans lenceinte de ltablissement en tat
dbrit ou sous lemprise de la drogue.
Pour les entreprises qui justifient dune activit particulirement dlicate (manipulation de
produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, conduite de vhicules) : un
alcootest sera mis la disposition des salaris qui contestent leur tat divresse.
b. Il est interdit de consommer des boissons alcoolises sur le lieu du travail. Nanmoins,
dans certaines circonstances et avec lautorisation de la Direction, les salaris pourront
tre autoriss consommer sur le lieu de travail, des boissons faible teneur en alcool
(ex : vin, cidre, bire).
c. Il est interdit de prendre ses repas sur le lieu du travail.
d. Les salaris disposent dune armoire ferme cl. Elles doivent tre maintenues dans
un tat constant de propret et doivent tre vides au moins une fois par an pour
permettre leur nettoyage.
e. Le refus du salari de se soumettre aux obligations en matire dhygine peut entraner
des sanctions.
Article 2 - Scurit
a. Chaque salari doit avoir pris connaissance des consignes de scurit affiches. Cette
disposition doit tre complte par les prescriptions particulires lies aux activits de
certaines entreprises.
b. Les quipements de travail, les quipements de protection individuelle, les substances
et les machines dangereuses doivent tre utiliss dans les conditions dcrites ci-dessous :
( complter par chaque entreprise en fonction de son activit)
c. Chaque salari doit prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilits,
de sa scurit et de sa sant et de celles des autres membres du personnel.
d. Il est interdit de fumer dans les locaux suivants :
A prciser ventuellement, les lieux o il nest pas interdit de fumer.
e. Il est interdit de gner ou de neutraliser de quelque manire que ce soit le dispositif de
scurit.
f. Sauf impossibilit absolue ou motif lgitime, tout accident du travail ou du trajet doit
donner lieu dans les plus brefs dlais une information du suprieur hirarchique de
lintress.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
g. Lorsque la sant et la scurit paraissent compromises, les salaris peuvent tre
appels participer au rtablissement des conditions de travail protgeant la scurit et
la sant, dans les conditions suivantes :
h. Le personnel est tenu de se soumettre aux visites mdicales obligatoires lors de
lembauche, lors de la reprise de travail et lors de lexcution du contrat de travail.
i. Le refus du salari de se soumettre aux prescriptions relatives la scurit et aux visites
mdicales peut lexposer une sanction disciplinaire.
2.3 Modle de la lettre de convocation du CHSCT
pour avis sur le rglement intrieur
A envoyer 15 jours au moins avant la date de la runion.
Objet : Convocation
Nous vous prions de bien vouloir assister la runion du CHSCT qui aura lieu le ../../..
. heures dans la salle
Cette runion sera consacre lexamen, pour avis, des dispositions du rglement
intrieur relatives lhygine et la scurit.
Cette consultation peut avoir lieu dans le cadre dune runion ordinaire du CHSCT. Il faut alors
intgrer cette phrase dans lordre du jour complet.
Le secrtaire Le prsident
Signature Signature
Destinataires :
Membres lus du CHSCT
Reprsentants syndicaux du CHSCT
Inspecteur du travail
Et certains membres du CHSCT ( voix consultative) :
Responsable du service scurit (membre du CHSCT)
Agent de prvention de la CRAM
Personne qualifie de ltablissement
Mdecin du travail
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
2.4 Modle de P.V de runion du CHSCT
sur le rglement intrieur
Objet : Procs-verbal de la runion du
Noms et qualits des personnes prsentes la runion :
Avis du CHSCT sur le rglement intrieur (clauses relatives lhygine et la scurit) :
Le prsident du CHSCT, M. a procd la lecture des dispositions du rglement
intrieur relatives lhygine, le scurit et les conditions de travail. Aprs un change de
vues, auquel M. .., mdecin du travail ainsi que M. .. , responsable du service de
scurit, ont apport les prcisions et modifications suivantes : .
Il a t procd au vote.
Ont mis un vote favorable :
Noms
Ont mis un vote dfavorable :
Noms
Se sont abstenus :
Noms
Le secrtaire
Signature
2.5 Modle de la lettre de convocation du CE
La runion doit avoir lieu aprs celle du CHSCT
La convocation doit tre envoye 3 jours au moins avant la date de la runion.
Objet : Convocation
Nous vous prions de bien vouloir assister la runion du CE qui aura lieu le ../../..
heures dans la salle ..
Cette runion sera consacre lexamen pour avis du projet de rglement intrieur.
Le secrtaire Le prsident
Signature Signature
Destinataires :
Membres lus du CE
Reprsentants syndicaux du CE
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
2.6 Modle de P.V. de runion du CE
sur le rglement intrieur
Objet : Procs-verbal de la runion du
Noms et qualits des personnes prsentes la runion :
Avis du CE sur le projet de rglement intrieur :
Le prsident du CE, M. a procd la lecture des dispositions du projet de rglement
intrieur. Aprs un change de vues, au cours duquel le prsident a apport les
prcisions suivantes : .., il a t procd au vote.
Ont mis un vote favorable :
Noms
Ont mis un vote dfavorable :
Noms
Se sont abstenus :
Noms
Le secrtaire
Signature
2.7 Modle de la lettre de convocation des dlgus
du personnel (en labsence de CHSCT et de CE)
A envoyer au moins 15 jours avant la date de la runion
Objet : Convocation
Nous vous prions de bien vouloir assister la runion des dlgus du personnel (investis
des missions du CHSCT) qui aura lieu le ../../.. heures dans la salle
Cette runion sera consacre lexamen pour avis du projet de rglement intrieur et
notamment des clauses relatives lhygine et la scurit.
Quand les DP sont juste investis de la mission du CHSCT, lavis est demand uniquement sur
les clauses relatives lhygine et la scurit.
Le secrtaire Le prsident
Signature Signature
Destinataires :
Dlgus du personnel
Mdecin du travail
Inspecteur du travail
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
2.8 Modle de P.V. de runion des dlgus
du personnel sur le rglement intrieur
Objet : Procs-verbal de la runion du
Noms et qualits des personnes prsentes la runion :
Avis des DP sur le projet de rglement intrieur :
Quand les DP sont juste investis de la mission du CHSCT, lavis est rendu uniquement sur les
clauses relatives lhygine et la scurit.
Le prsident du CE, M. a procd la lecture du projet de rglement intrieur (ou des
clauses relatives lhygine et la scurit). Aprs un change de vues, au cours duquel le
prsident a apport les prcisions suivantes : .., il a t procd au vote.
Ont mis un vote favorable :
Noms
Ont mis un vote dfavorable :
Noms
Se sont abstenus :
Noms
Les dlgus Le prsident
Signature Signature
2.9 Modle de notification du rglement intrieur
linspecteur du travail
A envoyer dans les 6 mois
Monsieur lInspecteur,
Je vous adresse, en deux exemplaires, le rglement intrieur de lentreprise (ou
ltablissement) simultanment dpos au greffe du Conseil de Prudhommes de
Ce rglement a t soumis pour avis le ../../.. aux membres du CHSCT (pour les clauses
relevant de sa comptence) et le ../../.. aux membres du CE.
Vous trouverez ci-joint les avis formuls par ces instances.
Veuillez agrer, Monsieur linspecteur, lexpression de ma considration distingue.
Le Directeur
Signature
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
3 ASSOCIER LE COMITE D'ENTREPRISE,
LE CHSCT ET LE MDECIN DU TRAVAIL
En dehors de leur rle consultatif sur le rglement intrieur, les instances reprsentatives
du personnel ainsi que le mdecin du travail jouent un rle en matire dhygine et de
scurit :
le Comit dentreprise peut formuler toute proposition de nature amliorer les
conditions de travail, demploi et de formation professionnelle des salaris, leurs
conditions de vie dans lentreprise. En outre, il doit tre inform et consult sur les
problmes gnraux concernant les conditions de travail, ainsi que sur les mesures
prises en faveur des accidents du travail ;
le CHSCT a pour mission de contribuer la protection de la sant et de la scurit des
salaris de ltablissement (et de ceux mis disposition par une entreprise extrieure, y
compris les travailleurs temporaires), ainsi qu lamlioration des conditions de travail.
Il doit en outre veiller lobservation des prescriptions lgislatives et rglementaires
prises en ces matires.
Ds lors quelles occupent habituellement au moins 50 salaris, toutes les entreprises tenues de
respecter les rgles dhygine et de scurit doivent constituer un CHSCT.
A noter que dans les tablissements o il ny a pas de CE et/ou pas de CHSCT, les
dlgus du personnel sont investis de leurs missions en matire dhygine et de scurit.
Le mdecin du travail a un rle prventif. Il doit viter toute altration de la sant des
travailleurs du fait de leur travail et surveiller les conditions dhygine du travail, les
risques de contagion et ltat de sant des travailleurs.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
4 SANCTIONNER LES SALARIS QUI NE RESPECTENT
PAS LES CONSIGNES D'HYGINE ET DE SCURIT
4.1 Lexercice du pouvoir disciplinaire
pour faire respecter les rgles dhygine et de scurit
La vigilance du chef dentreprise se dmontre aussi par sa volont et son pouvoir de
mettre fin aux anomalies qui pourraient causer un accident.
Le fait de sanctionner un salari qui se met en danger ou met en danger ses collgues en
matire dhygine et de scurit nexonre pas forcment le chef dentreprise de sa
responsabilit, mais cela plaide en sa faveur pour prouver la diligence normale ou la faute de
la victime. Les sanctions au manquement aux rgles dhygine et de scurit sont prvues dans
le rglement intrieur (au chapitre droit disciplinaire ).
Il peut sagir selon la gravit du manquement :
dun avertissement (observation crite destine attirer lattention du salari dans un
premier temps) ;
dune mise pied disciplinaire (suspension temporaire du contrat sans rmunration) ;
dune mutation disciplinaire (changement de poste titre de sanction) ;
dune rtrogradation (affectation une fonction de niveau infrieur) ;
dun licenciement disciplinaire, avec ou sans pravis, avec ou sans indemnits, selon le
degr de gravit de la faute.
Toute sanction doit tre motive et notifie par crit au salari dans les deux mois. Elle
doit respecter les procdures lgales en vigueur (pour celles du moins qui ont une
incidence sur la prsence dans lentreprise, la fonction, la carrire ou la rmunration du
salari).
Illustration
Exemples dinfractions la scurit :
le fait, pour un responsable de chantier ou un ingnieur, de ne pas
respecter les prescriptions de scurit lmentaire en prsence des
ouvriers ;
le fait pour un salari charg de la surveillance des locaux de fumer
dans lusine pourtant classe tablissement dangereux de premire
catgorie, malgr linterdiction de fumer dicte par le rglement
intrieur ;
le refus pour un ouvrier de ne pas porter son casque pourtant
obligatoire sur le chantier ;
le fait de se prsenter sur le lieu de travail en tat dbrit avance
et de prodiguer des injures lencontre du personnel et de la
Direction
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
4.2 Modle de lettre davertissement
LRAR
Monsieur,
A la suite de plusieurs observations dont vous navez pas cru devoir tenir compte, nous
avons eu regretter un nouvel incident :
Dcrire les faits objectivement et prcisment, par exemple le refus dutiliser le matriel de
protection, le refus de se conformer aux prescriptions de scurit pour lutilisation dune
machine etc.
Ces faits constituent une infraction aux dispositions du rglement intrieur concernant les rgles
dhygine et de scurit (ou une faute contractuelle, si la faute nest pas prvue au rglement
intrieur), ce qui nous conduit vous notifier par la prsente un avertissement qui sera vers
votre dossier personnel.
Si de tels agissements devaient se reproduire, nous serions amens prononcer votre
encontre une sanction plus importante.
Dans ces conditions, nous attendons de vous que vous fassiez votre possible pour
remdier cette situation le plus rapidement et le plus durablement possible.
Veuillez agrer, Monsieur, lexpression de nos sentiments distingus.
Le Directeur
Signature
4.3 Modle de lettre de convocation toute autre sanction
LRAR
Monsieur,
Suite (dcrire lincident), nous envisageons votre gard une sanction.
Nous vous demandons en consquence de bien vouloir vous prsenter le ../../..
heures (environ 3 jours aprs la rception du courrier), (prciser le lieu) pour un
entretien avec M au cours duquel vous serez invit fournir toutes les explications
ncessaires sur la faute qui vous est reproche.
Vous avez la possibilit, si vous le souhaitez, de vous faire assister par un des membres
du personnel de lentreprise.
Veuillez agrer, Monsieur, lexpression de nos sentiments distingus.
Le Directeur
Signature
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
4.4 Modle de lettre de convocation un entretien
avec mise pied conservatoire
Nous envisageons de prendre une sanction votre gard.
A cet effet et dans le but de nous fournir les explications sur les faits qui vous sont reprochs,
vous tes invit vous prsenter le ../../.. .. heures (3 jours aprs notification en gnral)
pour un entretien avec M
Etant donn la gravit des fautes que nous avons releves votre encontre, nous vous notifions
par la prsente une mise pied conservatoire, dans lattente dune sanction dfinitive qui
devrait tre prononce sous jours (en gnral, le dlai raisonnable est de 5 jours ouvrs
partir de la date de la lettre de convocation).
Vous avez la possibilit, si vous le souhaitez, de vous faire assister par un des membres du
personnel de lentreprise.
Veuillez agrer, Monsieur, lexpression de nos sentiments distingus.
Le Directeur
Signature
4.5 Modle de lettre de notification
dune mise pied disciplinaire
Monsieur,
Nous avons regretter de votre part un manquement aux obligations dhygine et de scurit
prvues dans le rglement intrieur (ou une infraction contractuelle).
Vous avez en effet, le ../../..
Au cours de lentretien qui a eu lieu le ../../.., vous navez pas t en mesure de nous apporter
des lments qui auraient pu modifier notre apprciation des faits.
Nous vous notifions donc par la prsente une sanction de mise pied de jours (dure
maximale prvue au rglement intrieur) avec retenue sur salaire correspondant la dure de
la suspension de votre contrat de travail.
Cette mise pied prend effet compter du ../../ Vous reprendrez votre poste de travail le
../../..
Si le salari a dj fait lobjet dune mise pied conservatoire, il faut retirer le nombre de jours
de suspension dj effectus.
Si de tels comportements fautifs devaient se renouveler, nous serions amens envisager une
autre sanction (de degr suprieur sil y en a une) ou un licenciement votre encontre. Nous
comptons sur vous pour tout mettre en uvre afin dviter que ces faits ne se reproduisent.
Veuillez agrer, Monsieur, lexpression de nos sentiments distingus.
Le Directeur
Signature
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
5 RESPECTER LES OBLIGATIONS D'INFORMATION
ET DE FORMATION DES SALARIS
Le chef dentreprise est tenu dorganiser et de dispenser une information des salaris sur
les risques pour la sant et la scurit et les mesures prises pour y remdier. Les
conditions de cette information sont fixes par dcret.
En outre, le chef dtablissement est tenu dorganiser une formation pratique et
approprie (tenant compte de la qualification, de lexprience professionnelle) en
matire de scurit. Cette formation bnficie aux salaris :
nouvellement embauchs ;
qui changent de poste de travail, de technique ou qui sont exposs des risques
nouveaux ;
qui reprennent leur activit aprs un arrt de travail dau moins 21 jours (sur demande
du mdecin de travail) ;
La formation doit galement tre dispense aux travailleurs temporaires et ceux qui sont
embauchs des tches comportant lemploi de machines.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
6 RESPECTER ET FACILITER
LE DROIT DE RETRAIT DES SALARIES
Tout salari ou groupe de salari a le droit de se retirer dune situation de travail dont il
a un motif raisonnable de penser quelle prsente un danger grave et imminent pour sa
vie ou sa sant, sans encourir aucune retenue de salaire ni aucune sanction de la part de
lemployeur.
Si toutefois lexercice du droit de retrait par le salari tait dpourvu de fondement, son
licenciement aurait alors une cause relle et srieuse.
Par ailleurs, lorsque le risque, signal par un membre du personnel ou le CHSCT, sest
matrialis par un accident, la faute inexcusable (art. 468 Code scurit sociale) de
lemployeur est avre envers le salari victime.
Tout salari doit signaler toute dfectuosit quil constate dans les systmes de protection
(il peut tre sanctionn sil ne le fait pas).
En outre, le chef dtablissement prend les mesures et donne les instructions ncessaires
pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et invitable, darrter
leur activit et de se mettre en scurit en quittant immdiatement le lieu de travail. En
fait, il sagit dorganiser les conditions du retrait collectif des salaris, afin dviter que
des retraits individuels dsordonns ne mettent en danger la scurit dautres travailleurs.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
7 TENIR COMPTE DE L'AVIS DES CAISSES
RGIONALES D'ASSURANCES MALADIE
La Scurit Sociale joue un rle trs important en matire dhygine et de scurit dans
lentreprise, dabord en assumant la rparation des accidents du travail, ensuite en
soutenant la prvention de ces accidents :
Les caisses rgionales (CRAM) peuvent :
inviter tout employeur prendre des mesures de prvention ;
demander lintervention de linspecteur du travail ;
faire adopter des mesures gnrales de prvention aux employeurs de leur
circonscription ;
imposer des cotisations supplmentaires en cas de risques exceptionnels prsents par
lexploitation ;
accorder des ristournes sur cotisations aux employeurs ayant mis en uvre une
prvention efficace ;
consentir aux entreprises des avances taux rduits pour leur faciliter la ralisation
damnagements destins assurer une meilleure protection des travailleurs.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
8 TENIR COMPTE DE L'AVIS
DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL
En principe, lorsque linspecteur du travail constate une infraction la rglementation
relative lhygine et la scurit dans lentreprise, il peut dresser immdiatement un
procs verbal. Il peut aussi procder (quand la loi le prvoit expressment) une mise en
demeure, ce qui laisse lemployeur un certain dlai pour remdier la situation
dfectueuse (L.231-4). Cest alors seulement, si rien na t fait lissue de ce dlai, que
linspecteur dresse le procs verbal.
Larticle R.233-47 indique les articles du Code relatifs la scurit pour lesquels la mise
en demeure est prvue ainsi que le dlai minimum dexcution.
Les inspecteurs du travail sont autoriss dresser immdiatement un PV, alors mme que la
mise en demeure est prvue par les textes, lorsque les faits constats prsentent un danger
grave ou imminent pour lintgrit physique des travailleurs (L.231-4 al. 2).
Lorsque linspecteur du travail constate le danger de certaines situations, alors mme
quaucune rglementation nest spcifiquement viole, il peut faire un rapport au
directeur dpartemental du travail qui mettra lui-mme en demeure le chef
dtablissement.
Le chef dtablissement peut exercer un recours (suspensif) dans les 15 jours devant le
directeur rgional du travail, qui dispose de 21 jours pour rpondre (R.231-13-1). Au-
del de ce dlai, son silence vaut acceptation de la rclamation.
En cas de risque srieux datteinte lintgrit physique dun travailleur d
linobservation des dispositions rglementaires, linspecteur du travail peut saisir le juge
des rfrs pour faire cesser le risque. Le juge pourra procder la mise hors service,
limmobilisation, la saisie du matriel, des machines, des produits incrimins
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
9 DLGUER SES POUVOIRS
EN MATIRE D'HYGINE ET DE SCURIT
9.1 La dlgation de pouvoir
9.1.1 Les conditions de la dlgation
Le chef dentreprise ne peut pas physiquement tre partout la fois pour vrifier
que les rgles dhygine et de scurit sont bien respectes par lensemble des
salaris. tant donnes les responsabilits encourues en la matire, il est prfrable
de dlguer ses pouvoirs en la matire, par exemple au conducteur des travaux, au
chef de chantier, au chef dquipe
Mais, pour tre rellement exonratoire de responsabilit, la dlgation de
pouvoirs doit tre :
Expresse
Elle ne saurait rsulter de la nature mme des travaux. En labsence dcrit ou dans
lhypothse o lcrit est jug insuffisant par les juges parce quils estiment que le
chef dentreprise a, en ralit, conserv ses pouvoirs prtendument dlgus, il
faudra que la dlgation ait un caractre public. Les ouvriers qui travaillent sous les
ordres du dlgu doivent avoir connaissance de cette dlgation ;
Prcise
Le chef dentreprise ne saurait transfrer lensemble de ses pouvoirs. Ainsi,
lorsquun chef dentreprise consent plusieurs dlgations de pouvoirs pour
lexcution dun mme travail, les juges refusent de leur donner effet.
De la mme faon la dlgation doit avoir un objet limit. Le contrat qui confre
un salari une mission gnrale de surveillance et dorganisation des mesures de
scurit sur les chantiers ne vaut pas dlgation du chef dentreprise en labsence
dinstructions prcises de ce dernier.
Effective
Une lettre demployeur dlguant ses pouvoirs ntablit pas par elle-mme
lexistence dun transfert de pouvoirs. En effet, la dlgation nest effective que si le
chef dentreprise a pris toutes les mesures ncessaires permettant au dlgataire
dexercer rellement les attributions qui lui sont confies.
En outre, pour tre effective, la dlgation doit avoir un caractre permanent. Sa
validit nest reconnue qui si elle a t suffisamment longue. Il nest est pas ainsi si
elle na pas un minimum de dure ou de stabilit ou si la mission du dlgataire est
frquemment interrompue.
En cas de changement de direction, la responsabilit du dlgataire dsign par
lancienne direction est dgage. La nouvelle direction doit renouveler la
dlgation.
Accepte
La dlgation entrane des obligations nouvelles pour le salari : elle doit avoir t
accepte (sous forme dun avenant au contrat de travail ou dune disposition
indpendante).
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
La dlgation de pouvoirs peut tre valable mme si elle nest pas crite. Mais pour des
raisons videntes de preuve, il est primordial de faire un crit prcis (soit une lettre portant
dlgation de pouvoirs, soit une clause au contrat de travail).
La condition deffectivit est trs importante. Elle fait lobjet dun contrle trs affin de la part
des juges. Il est ncessaire de donner tous les moyens au dlgataire dexercer sa fonction de
surveillance en matire dhygine et de scurit.
9.1.2 Les conditions relatives au dlgant
Le chef dentreprise est, en principe, seul pouvoir dlguer ses pouvoirs. Le
dlgataire peut toutefois recourir de son ct la subdlgation. Ce recours nest
possible que si le chef dentreprise a consenti cette subdlgation de faon claire
et prcise.
Sagissant de la dlgation, celle-ci nest possible que dans les grandes entreprises
que le dlguant ne peut contrler personnellement cause de sa taille. Les juges
considrent que les chefs dentreprise de taille modeste peuvent tre en mesure de
veiller eux-mmes la rglementation. Les dlgations quils peuvent consentir sont
alors inoprantes car les juges estiment que la dlgation nest donne que dans le
but dchapper toute responsabilit.
9.1.3 Les conditions relatives au dlgataire
Le dlgataire doit appartenir lentreprise. Il doit tre apte tre dlgataire. Les
simples salaris qui nappartiennent pas la hirarchie ne peuvent pas tre
dlgataires.
Il ne sera reconnu au prpos sa qualit de dlgataire qu certaines conditions.
Le dlgataire doit tre investi dune autorit suffisante pour pouvoir accomplir sa
mission. Il doit pouvoir prendre ses dcisions en toute indpendance. Ce nest pas
le cas, si le dlgataire ne peut, mme en cas durgence, prendre que des mesures
conservatoires en attendant la dcision du chef dentreprise.
Par ailleurs, le dlgataire doit, disposer dun pouvoir disciplinaire minimum. A cet
effet, lemployeur doit avoir transfr au dlgataire les pouvoirs de
commandement et de discipline ncessaires pour lui permettre de donner ses
instructions et de les faire respecter. Le dlgataire doit, pour cela, pouvoir prendre
certaines sanctions.
Le dlgataire doit tre comptent. Ceci suppose que lemployeur ait choisi un
dlgataire qui, par ses capacits et sa formation, soit capable de mettre en uvre
les rgles de scurit. Il doit, par ailleurs, avoir les connaissance techniques
requises pour lexcution des travaux.
Le dlgataire doit avoir, enfin, les moyens ncessaires pour assurer sa mission.
Labsence de moyens conduit une dlgation formelle. La dlgation peut tre
considre comme inexistante si le dlgataire, responsable de chantier ne reoit
pas le matriel adapt lexcution des travaux.
Partie 10 Comment limiter les risques de sanction ?
9.2 Modle de dlgation de pouvoirs
Socit A le
Adresse
Le prsident directeur-gnral
M.
Directeur (fonctions exactes de lintress)
Monsieur,
Nous avons dcid de vous confier la responsabilit de(description de la mission
confie).
Nous sommes ainsi amens procder une dlgation de pouvoirs en matire
dhygine et de scurit, dune dure de . (si elle na pas une dure indtermine).
Ce mandat exprs vous est donn par la prsente en raison de vos comptences
techniques et professionnelles, pour assurer (prciser lobjet : ex. lorganisation et la
surveillance du travail sur tel chantier).
Pour laccomplissement de cette mission nous mettons votre disposition les moyens
suivant.. (ou : vous disposez des pouvoirs les plus larges et de tous les moyens matriels,
humains, techniques et financiers ncessaires). Il vous appartient de prendre toutes les
mesures en consquence et de vous assurer quelles sont effectivement respectes. A cet effet
vous disposez dun pouvoir de sanctions disciplinaires (prciser : avertissements, mises pied
).
Nous vous signalons que, compte-tenu de cette dlgation, en cas dinfraction aux rgles
dhygine et de scurit ou en cas daccident, votre responsabilit personnelle serait
engage sur le plan pnal.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous tes responsable de lorganisation du travail
dans (lusine, lagence, le chantier) et que vous avez donc la possibilit de dlguer vos
pouvoirs dans les domaines mentionns ci-dessus vos cadres et agents de matrise, selon
leur comptence et en leur donnant les moyens ncessaires pour exercer ces pouvoirs.
Vous voudrez bien, pour la bonne forme, nous retourner la prsente, revtue de la
mention manuscrite Bon pour acceptation de pouvoir , suivie de la date et de votre
signature.
En vous renouvelant notre confiance, nous vous prions de croire, Monsieur, nos
sentiments distingus.
Chef dentreprise Pour acceptation : le dlgataire
Signature Signature
Vous aimerez peut-être aussi
- Reglement General HSE Pour Entreprises Exterieures Applicable Chez UCB Sur Site Braine L Alleud Et AnderlechtDocument22 pagesReglement General HSE Pour Entreprises Exterieures Applicable Chez UCB Sur Site Braine L Alleud Et AnderlechtMohamed OmarPas encore d'évaluation
- 1.support de Cours HseDocument3 pages1.support de Cours HseSaidi Abdelillah100% (1)
- Fiches Securite PDFDocument38 pagesFiches Securite PDFAbderrahmaneNajidPas encore d'évaluation
- Guide PPI Etablissement SEVESO Seuil Haut PDFDocument128 pagesGuide PPI Etablissement SEVESO Seuil Haut PDFpopPas encore d'évaluation
- Aide Memoire Incendie POSDocument2 pagesAide Memoire Incendie POSsalamPas encore d'évaluation
- Guide Du CRAIMDocument402 pagesGuide Du CRAIMmiclea simona100% (1)
- Formation en Evacuation Des LocauxDocument6 pagesFormation en Evacuation Des LocauxmahamoudouPas encore d'évaluation
- (CDG72) Travail en HauteurDocument9 pages(CDG72) Travail en Hauteurf.BPas encore d'évaluation
- Formation EpiDocument9 pagesFormation EpiAdnen GuedriaPas encore d'évaluation
- 2.audit Des Conditions de Travail en Alg+®rie - Etat Des LieuxDocument10 pages2.audit Des Conditions de Travail en Alg+®rie - Etat Des LieuxlenoirmccPas encore d'évaluation
- Dotation Des Extincteurs PDFDocument2 pagesDotation Des Extincteurs PDFismailinesPas encore d'évaluation
- QHSSE Project SécuritéDocument20 pagesQHSSE Project SécuritéZineb AssafianiPas encore d'évaluation
- CoupageDocument24 pagesCoupageRP WinnerPas encore d'évaluation
- Livret GrueChargementDocument28 pagesLivret GrueChargementFrancois Matong100% (1)
- Boite À Outils FinaleDocument40 pagesBoite À Outils FinaleHajar ElouazzaniPas encore d'évaluation
- Binome Incendie Isere 2007Document39 pagesBinome Incendie Isere 2007omar benounaPas encore d'évaluation
- Introduction GénéraleDocument1 pageIntroduction GénéraleMohamed OmarPas encore d'évaluation
- Guide Autodiag Hotel RestDocument52 pagesGuide Autodiag Hotel RestNANA TCHIDIO KEVINEPas encore d'évaluation
- Atex 2Document5 pagesAtex 2Hakim Yahiaoui100% (2)
- Implanter Des Extincteurs - 3 PDFDocument2 pagesImplanter Des Extincteurs - 3 PDFAbdelaly JabbadPas encore d'évaluation
- 2007-10-25, Prevention Des Risques HSE Des EntreprisesDocument41 pages2007-10-25, Prevention Des Risques HSE Des EntreprisesJonathan Kacou100% (1)
- Ademe - INRS Hygiène Et Sécurité Sur Les Chantiers de Réhabilitation de Sites Pollués (1995)Document66 pagesAdeme - INRS Hygiène Et Sécurité Sur Les Chantiers de Réhabilitation de Sites Pollués (1995)jpvuillePas encore d'évaluation
- Fiche Technique Lutte Anti IncendieDocument3 pagesFiche Technique Lutte Anti IncendieMalek SiguerPas encore d'évaluation
- Comment Bien Réaliser Sa Veille Reglementaire HSEDocument18 pagesComment Bien Réaliser Sa Veille Reglementaire HSEAmin HATIMIPas encore d'évaluation
- Plateforme Qs +: Offre de FormationDocument16 pagesPlateforme Qs +: Offre de FormationM'hammed HamdaouiPas encore d'évaluation
- Permis de Pénétré 2Document2 pagesPermis de Pénétré 2Abdelilah BouazzaPas encore d'évaluation
- Les Risques Incendie Dans Les ERP (Guide Pratique À L'usage Du Maire) PDFDocument54 pagesLes Risques Incendie Dans Les ERP (Guide Pratique À L'usage Du Maire) PDFAbderrahmen SellamiPas encore d'évaluation
- Permis de FeuDocument37 pagesPermis de FeuNicolas Nascimento BideauPas encore d'évaluation
- Présentation INSAT HSEDocument31 pagesPrésentation INSAT HSETunENSTABPas encore d'évaluation
- EDD Module 6 AMDEC (Mode de Compatibilité)Document20 pagesEDD Module 6 AMDEC (Mode de Compatibilité)Othmani ChokriPas encore d'évaluation
- Guide ALARPDocument71 pagesGuide ALARPKamelMezianiPas encore d'évaluation
- HSE MONITOR GESTION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT. 8 Modules de Management Intégrés.Document11 pagesHSE MONITOR GESTION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT. 8 Modules de Management Intégrés.Benouna Fert100% (1)
- Flash de Sensibilisation Hygiene - R CHIMDocument2 pagesFlash de Sensibilisation Hygiene - R CHIMMohamed Omar100% (2)
- Guide SST SodexoDocument24 pagesGuide SST SodexoSchmidt DanielPas encore d'évaluation
- Nomenclature ICPEDocument79 pagesNomenclature ICPEmartinjibPas encore d'évaluation
- Permis de FeuDocument8 pagesPermis de Feuelmahjoub100% (1)
- Intégrer le genre dans la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des programmes de transferts en espèces et de travaux publics: Guide technique 3 de la FAOD'EverandIntégrer le genre dans la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des programmes de transferts en espèces et de travaux publics: Guide technique 3 de la FAOPas encore d'évaluation
- Systeme Permis de Travail HMD Version 1 Approuvé Par DRDocument120 pagesSysteme Permis de Travail HMD Version 1 Approuvé Par DRAhmed Chahine100% (2)
- Etude de Danger Zakraria RACHCHADDocument65 pagesEtude de Danger Zakraria RACHCHADRochdy ZoghlamiPas encore d'évaluation
- Acfci Guige PME SSTDocument100 pagesAcfci Guige PME SSTMelle J.100% (1)
- SSE5.4-Procedure Equipement Protection Individuels-120824Document5 pagesSSE5.4-Procedure Equipement Protection Individuels-120824TOSSOUPas encore d'évaluation
- Hygiène Et SécuritéDocument63 pagesHygiène Et Sécuritésaito36Pas encore d'évaluation
- Textes Réglementaires HSEDocument13 pagesTextes Réglementaires HSEbellahcenePas encore d'évaluation
- Guide de Preparation Aux Situations D'urgenceDocument11 pagesGuide de Preparation Aux Situations D'urgenceHD49100% (1)
- HSE Matériels Mobiles de Lutte Contre L'incendieDocument4 pagesHSE Matériels Mobiles de Lutte Contre L'incendieMadeleine BassoumataPas encore d'évaluation
- Plan HSE - FRDocument146 pagesPlan HSE - FRAhmed AtefPas encore d'évaluation
- CHSCTDocument2 pagesCHSCTAnna MatrasPas encore d'évaluation
- Permis de Feu - FicheDocument3 pagesPermis de Feu - Ficheamal118Pas encore d'évaluation
- EL7P1 16 253 v2 Cle2d9e88Document35 pagesEL7P1 16 253 v2 Cle2d9e88Khabtane AbdelhamidPas encore d'évaluation
- Hygiène Et Sécurité en EntrepriseDocument220 pagesHygiène Et Sécurité en EntrepriseBA BIa100% (2)
- L'Amour sous les verrous: Les prisons révolutionnaires - Mme Roland et Buzot. Lucile et Camille Desmoulins. André Chénier et la Jeune Captive. Notre-Dame de Thermidor. Geôles et salonsD'EverandL'Amour sous les verrous: Les prisons révolutionnaires - Mme Roland et Buzot. Lucile et Camille Desmoulins. André Chénier et la Jeune Captive. Notre-Dame de Thermidor. Geôles et salonsPas encore d'évaluation
- CP MOD Permis de FeuDocument4 pagesCP MOD Permis de Feumazen fakhfakhPas encore d'évaluation
- 4-Securite GazDocument12 pages4-Securite GazAfef NejiPas encore d'évaluation
- Regles Generales de Securite Et Surete FR PDFDocument16 pagesRegles Generales de Securite Et Surete FR PDFKhalil DridiPas encore d'évaluation
- Manuel de communication sur les risques appliquée à la sécurité sanitaire des alimentsD'EverandManuel de communication sur les risques appliquée à la sécurité sanitaire des alimentsPas encore d'évaluation
- Création et certification de votre formation professionnelle: Qualiopi, Datadoc, RNCP, RS, certification européenneD'EverandCréation et certification de votre formation professionnelle: Qualiopi, Datadoc, RNCP, RS, certification européennePas encore d'évaluation
- L' interaction entre les problèmes de gestion des ressources humaines et de santé et de sécurité au travail: Études de casD'EverandL' interaction entre les problèmes de gestion des ressources humaines et de santé et de sécurité au travail: Études de casPas encore d'évaluation
- Exemple PPSPS1Document27 pagesExemple PPSPS1Mominé VePas encore d'évaluation
- Securite Industrielle Plan D Operation Interne PDFDocument126 pagesSecurite Industrielle Plan D Operation Interne PDFDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Scan Echangeur Caterpillar 3304Document1 pageScan Echangeur Caterpillar 3304Deanna BarrettPas encore d'évaluation
- 3 C2 Etude de DangersDocument129 pages3 C2 Etude de DangersDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Notion de BioaccumulationDocument2 pagesNotion de BioaccumulationDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Types de Remorqueurs PDFDocument19 pagesTypes de Remorqueurs PDFDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Ecotox 2018 2019 PDFDocument133 pagesEcotox 2018 2019 PDFDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Dahir1 90 107Document4 pagesDahir1 90 107Deanna BarrettPas encore d'évaluation
- Liste ConvensionsDocument1 pageListe ConvensionsDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Psiu IiiDocument59 pagesPsiu IiiDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Decret 2-61-161Document82 pagesDecret 2-61-161Deanna BarrettPas encore d'évaluation
- PMDocument52 pagesPMDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Circulaire 2012Document3 pagesCirculaire 2012Deanna BarrettPas encore d'évaluation
- Maintenance 8 ReglesDocument12 pagesMaintenance 8 Reglesفدوى غاني100% (1)
- CV Belghiti 2012Document4 pagesCV Belghiti 2012Yassine KandoussiPas encore d'évaluation
- Referentiel Secretaire Medico Sociale PDFDocument4 pagesReferentiel Secretaire Medico Sociale PDFStéphaniePas encore d'évaluation
- Bureau ChefDocument1 pageBureau ChefMonaf13 MonafPas encore d'évaluation
- MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009Document33 pagesMG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009isabelle_christodoulPas encore d'évaluation
- CDP 121035Document30 pagesCDP 121035Mina KDPas encore d'évaluation
- Le TableauDocument1 pageLe Tableaukalamine dassPas encore d'évaluation
- Bro Al-267 FR Es WebDocument4 pagesBro Al-267 FR Es WebEnrique TiscorniaPas encore d'évaluation
- Liste Des SiglesDocument4 pagesListe Des SiglesVero VdvPas encore d'évaluation
- Complémentaire Santé: 3 Clés Pour Bien ChoisirDocument2 pagesComplémentaire Santé: 3 Clés Pour Bien ChoisirCentre technique des institutions de prévoyance (CTIP)Pas encore d'évaluation
- Securite Equipier 2nd InterventionDocument2 pagesSecurite Equipier 2nd Interventionf.BPas encore d'évaluation
- Scandale Du Mediator: Pourquoi Servier Est PoursuiviDocument28 pagesScandale Du Mediator: Pourquoi Servier Est PoursuiviLe magazine "Marianne"Pas encore d'évaluation
- Inscription Le Guide Du Titulaire D OfficineDocument23 pagesInscription Le Guide Du Titulaire D OfficineAmr RabahPas encore d'évaluation
- La Santé - ExercicesDocument4 pagesLa Santé - ExercicesGisela AlvesPas encore d'évaluation
- Monde 2 en 1 Du Jeudi 02 Avril 2015Document36 pagesMonde 2 en 1 Du Jeudi 02 Avril 2015rafimanePas encore d'évaluation
- (CDG72) Travail IsoleDocument3 pages(CDG72) Travail IsoleM'hammed AbouzianePas encore d'évaluation
- Tarification Et Mesure de L'antisélection en Assurance Santé Collective - Ozlem KARATEKINDocument152 pagesTarification Et Mesure de L'antisélection en Assurance Santé Collective - Ozlem KARATEKINJeezPas encore d'évaluation
- Powerpoint Ssi 20alex 20en 20PW2000Document16 pagesPowerpoint Ssi 20alex 20en 20PW2000radhouanePas encore d'évaluation
- GNR Sauvetage Et DéblaiementDocument88 pagesGNR Sauvetage Et DéblaiementZeBlackTiger100% (2)
- Guide Des Frontaliers Be FRDocument30 pagesGuide Des Frontaliers Be FRdops_2004Pas encore d'évaluation
- Confirmation PDFDocument8 pagesConfirmation PDFAnonymous yjhsFTT5Pas encore d'évaluation
- Circulaire Interministérielle N° 2006-20 Du 29 Mars 2006 Relative À La Sécurité Des Tunnels Routi PDFDocument10 pagesCirculaire Interministérielle N° 2006-20 Du 29 Mars 2006 Relative À La Sécurité Des Tunnels Routi PDFKöksal PatanPas encore d'évaluation
- Synphonat Protocoles Detoxication MetauxDocument2 pagesSynphonat Protocoles Detoxication MetauxKharnak MiraPas encore d'évaluation
- Evaluation Food DefenseDocument14 pagesEvaluation Food DefenseHabib Tabeti100% (1)
- (Sample) Kanji in 60 de TexteDocument10 pages(Sample) Kanji in 60 de Textemiha_loves_zaf100% (3)
- Harnais FR PDFDocument16 pagesHarnais FR PDFBoualam BouPas encore d'évaluation
- AM Document 20170420 103749 0Document1 pageAM Document 20170420 103749 0Bich NgocPas encore d'évaluation
- R446Document8 pagesR446Sebastien Cabot100% (1)
- Dépliant Allianz Chifaa PDFDocument2 pagesDépliant Allianz Chifaa PDFyassinemajPas encore d'évaluation
- Lijst Gereglementeerde Beroepen 200536CEDocument13 pagesLijst Gereglementeerde Beroepen 200536CELigia TiclosPas encore d'évaluation