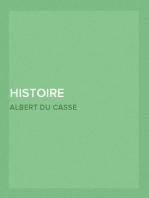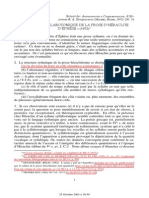Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rabatel PDF
Transféré par
Omar JanmohamedTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rabatel PDF
Transféré par
Omar JanmohamedDroits d'auteur :
Formats disponibles
ANALYSE NONCIATIVE DU POINT DE VUE, NARRATION
ET ANALYSE DE DISCOURS
Alain Rabatel*
RSUM
RSUM: Cet article montre que lanalyse nonciative du point de vue (PDV), en rupture avec
la typologie des focalisations de Genette, peut renouveler partiellement la narratologie, la
condition de substituter lapproche immanentiste du rcit une analyse interactionnelle de la
narration. Larticle prsente dabord lapproche nonciative du PDV, en appui des thories de
Ducrot, et, sur cette base, propose diverses modalits de PDV (reprsent, racont, assert)
qui donnent corps au point de vue des personnages ou du narrateur en modifiant sensiblement
les analyses de Genette. Dans une deuxime partie, larticle envisage le rle des PDV dans la
narration, notamment dans la rvaluation des dimensions cognitive et pragmatique de la
mimsis, puis dans les mcanismes infrentiels-interprtatifs, proches du systme de sympathie
de Jouve, enfin, dans la revalorisation du rle du narrateur puisque ce dernier se construit
dans le mme temps quil construit ses personnages.
MOTSCLS
MOTS-CLS
CLS: Approche nonciative du point de vue; analyse interactionnelle de la narration;
dimensions cognitive et pragmatique de la mimesis; mcanismes infrentiels-interprtatifs.
yse interactionnelle de la narration; dimensions cognitive et pragmatique de la mimesis ;
mcanismes infrentiels-interprtatifspApproche nonciative du point de vue, Analyse
interactionnelle de la narration; dimensions cognitive et pragmatique de la mimesis;.
et article entend prsenter brivement comment lanalyse
nonciative du point de vue (PDV), en rupture avec la
typologie des focalisations de Genette, peut renouveler
partiellement la narratologie. Pour ce faire, il propose de
considrer un certain nombre doutils (schma actantiel, schma
quinaire du rcit, isotopie etc.) non plus seulement comme des
IUFM de Lyon, ICAR, UMR 5191, CNRS, Universit Lumire-Lyon 2, France.
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
organisateurs de la digse, mais aussi comme des indicateurs de
points de vue sur lhistoire comme sur sa narration, et donc comme
des moyens de connaissance par lesquels scripteur et lecteur
construisent leur tre au monde travers leur rapport au monde,
dans une posture rflexive qui sait faire leur place aux motions (cf.
les phnomnes empathiques) comme aux sensations esthtiques.
Un tel choix thorique suppose de dpasser lapproche immanentiste
du rcit pour sappuyer sur une analyse interactionnelle de la narration,
inscrite elle-mme dans le cadre de lanalyse de discours, du moins
telle quelle a t dveloppe par Maingueneau (2004), propos de
lanalyse des textes littraires, et par Amossy (2006), notamment
pour lanalyse de la dimension argumentative indirecte luvre
dans les rcits.1
La rupture avec les approches du rcit qui font de la surface
du discours la manifestation de structures profonde immanentes
nimplique pas labandon des outils que reprsentent le schma
actantiel, les parcours smiotiques ents sur le carr smiotique,
les schmas ternaire ou quinaire du rcit, les isotopies. Elle invite
au contraire les reconsidrer, dans des cadres thoriques qui
permettent dapprhender plus finement le jeu interactionnel des
personnages (cf. les thories de laction, les thories de faces) ainsi
que les enjeux de la narration (analyses pragmatiques des actes de
discours, de leffacement nonciatif, de largumentation directe ou
indirecte). Un des biais mme doprer le dcentrement thorique
en cours du rcit vers la narration parat tre lapproche nonciative
et interactionnelle du/des points de vue.
Cette prsentation est loin dpuiser la question, du point de vue de lanalyse de
discours pour le texte littraire. Notamment, il manque ici larticulation des textes,
des auteurs, avec les configurations discursives qui les ont vu natre. De telles analyses
peuvent difficilement tre conduites de conserve dans le cadre dun article, surtout
lorsquon prsente des exemples varis. Le lecteur trouvera toutefois des pistes
intressantes dans Delormas 2006, et, bien sr, dans louvrage de rfrence dAmossy
et Maingueneau 2003, qui dvoile la diversit des approches sinscrivant plus ou
moins fortement dans le paradigme de lAD.
346
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
Dans sa critique serre des travaux structuralistes sur le rcit,
Bres (1994) souligne que le rcit ne se rduit pas un ensemble
monologique de structures dcontextualises et de cltures internes renvoyant un sens immanent, une structure profonde
(refusant toute dimension psychologisante et/ou sociologisante,
sous sa version autotlique dure). En rfrence aux travaux de
Bakhtine et de Labov, Bres met en relief la dimension sociohistoriquement construite du sens qui dcoule des rapports pratiques des hommes entre eux et avec le monde:
On natteint jamais le sens des choses, mais le sens donn aux choses. Le
sens advient au langage du rapport de lhomme au monde; mais,
paralllement, les rapports de lhomme au monde passent par le langage.
La relation entre langage et monde nest donc pas mcaniste mais
dialectique. Le langage ne dcalque pas le monde: il le dcoupe selon le
travail de lhomme. (Bres, 1994, p. 33)
Dans cette conception matrialiste2 du rcit, il ny a pas de
signifi prexistant, 3 par consquent toute conception de
lantriorit de la narrativit (en tant que structure profonde
immanente) sur la manifestation du rcit fait limpasse sur la
dimension dialogique de la construction du rcit, dimension
dialogique qui merge certes fortement dans le cadre du rcit oral en
situation dialogale, mais qui opre aussi dans le cadre de rcits littraires
crits. Il sensuit que le narr nest pas logiquement antrieur
au narrant; il est bien plutt le produit de la fonction rfrentielle
du langage dans son interaction avec la praxis (ibid., p. 34). Dans
la perspective interactionnelle des rcits, lanthropomorphisation des
2
Cf. encore: Nous dirons que la conception smiotique qui drive le faire du rcit des
transformations de la structure profonde est idaliste. Lorganisation de la signification
procde de et non prcde laction de lhomme sur le monde. Cest par/pour son agir
que lhomme donne du sens au monde. La signification nest pas toujours-dj l.
(ibid., p. 35)
Les notions domniscience ou de restriction de champ ne perdurent que par rapport
cette reprsentation immanente encore dominante du rcit. quoi sajoute la force des
vidences de lexprience commune (en tant quindividu, je ne peux pas tout savoir ;
le narrateur sait tout puisquil invente tout ou puisquil raconte une histoire qui sest dj
passe, en narration ultrieure).
347
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
rcits est la mise en spectacle par laquelle lhomme se reprsente les
rapports praxis transformatrice/praxis linguistique (ibid., p. 36).
Dans cette optique, les relations nonciatives luvre dans
le rcit ne sont donc pas seulement la mise en scne dun texte prtabli ou la manifestation de lintentionnalit toute puissante de
lcrivain. Elles fonctionnent comme des didascalies, des indications
scniques de nature procdurale, indiquant au destinataire comment
sapproprier le texte, partir de quels centres de perspective (tel
ou tel acteur, actant ou narrateur), comment penser leurs relations,
afin de faire merger une signification co-construite par le lecteur,
sur la base des instructions du texte et des choix dempathisation
effectus par le lecteur (Rabatel, 2004b, 2005a). On opre ainsi un
dcentrement majeur: lunit du rcit nest plus du ct du racont,
de lnonc, de ses structures, mais du ct de son nonciation, et
de sa cononciation pour ce qui relve de la part du lecteur.
Mais, avant dexaminer quelques apports de lanalyse du PDV
la narration, il est indispensable de prsenter, ft-ce rapidement,
les grandes lignes dune approche nonciative qui prend ses
distances avec la narratologie dessence structuraliste propose par
Genette.
1. LAPPROCHE NONCIATIVE DU POINT DE VUE
Sous sa forme la plus gnrale, le PDV se dfinit par les moyens
linguistiques par lesquels un sujet4 envisage un objet,5 tous les
sens du terme envisager,6 que le sujet soit singulier ou collectif et
lobjet, concret ou langagier. Le sujet, responsable de la rfrencia4
Ou focalisateur (Genette, 1972, 1983), nonciateur (Ducrot, 1984), sujet de conscience
(Banfield, 1995), sujet modal (Bally, 1965), foyer dempathisation (Forest, 2003), centre
de perspective (Lintvelt, 1981) etc.
Ou focalis (Bal, 1977).
Allant de la perception la reprsentation mentale, telles quelles sexpriment dans et
par le discours.
348
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
tion de lobjet, exprime son PDV tantt directement, par des
commentaires explicites, tantt indirectement, par la rfrenciation, cest--dire travers les choix de slection, de combinaison,
dactualisation du matriau linguistique.7 Ces phnomnes oprent
dans tous les cas de figure, depuis les choix les plus subjectifs aux
choix apparemment les plus objectivants, depuis les marques les
plus explicites aux indices les plus implicites.
1.1. Les instances du point de vue
Dans mon approche du PDV (librement inspire de Ducrot
1984), le locuteur est linstance qui profre un nonc, selon un
reprage dictique ou anaphorique, tandis que lnonciateur,8 proche
du sujet modal de Bally, assume lnonc dans la mesure o les
valuations, qualifications, modalisations et jugements sur les objets
du discours sont donns travers sa subjectivit et sont valids/
validables par ce dernier.9 Souvent, les noncs reposent sur un
syncrtisme locuteur/nonciateur, comme chaque fois que le
locuteur pense ce quil dit et dit ce quil pense ou feint de dire ce
quil pense.
Traiter du PDV partir de marques linguistiques permet davancer dans la discussion
des arguments opposables, mais prsente aussi linconvnient, en premire analyse
du moins, de paratre ne valoir que pour le franais, en raison des spcificits de
chaque systme linguistique. En ralit, il nen est rien, vu la similitude des
phnomnes cognitifs et des marques qui jouent un rle identique dans de
nombreuses langues. La thorie du PDV ici prsente peut donc prtendre une
certaine gnralit condition de prendre les plus extrmes prcautions pour ne
pas transposer telles quelles des analyses et des marques qui nauraient pas leur
quivalent tel ou tel systme car, au-del de leurs diffrences, les langues sont
toutes traverses un degr ou un autre par lhtrognit nonciative, cest-dire par lintrication des voix des autres dans son propre discours, phnomne
fondamental pour la thorie du PDV.
Charaudeau et Maingueneau, 2002, p. 220-4 et 226.
Il y a intrt distinguer thoriquement ces deux actualisations, mme si elles vont
souvent de pair: cf. Rabatel, 2005d.
349
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
Mais le locuteur/nonciateur primaire peut aussi dvelopper
dans son discours des PDV10 quil ne partage pas ncessairement,
comme dans lironie, les hypothses, le discours indirect libre, ou
encore dans les noncs dlocuts qui expriment un PDV, dans les
narrations htrodigtiques au pass, comme dans
17, 41
(1) 17
Le Philistin regarda et, quand il aperut David, il le mprisa: ctait
un gamin, au teint clair et la jolie figure. (Premier Livre de Samuel, 17, 41.
TOB, p. 542)
Le texte installe Goliath en sujet de la perception (il regarda),
qui prcise la nature de cette perception intentionnelle (il le
mprisa): le quand quivaut un ds que, indiquant que Goliath
a sciemment regard David pour dterminer si cet individu allait
tre un adversaire redoutable. Le texte ne fait pas que prdiquer la
perception dans le premier plan (dont le temps prototypique est le
pass simple), en la rapportant sous une vise globale. Avec le
passage limparfait,11 du fait de la vise scante de cette forme de
second plan, le lecteur se trouve au cur de la perception: le texte
dploie ce moment les dtails ou parties de la perception (aspect
gnral, teint, visage).12 Le lecteur comprend en effet, sans que le
Philistin dise un mot, que le terme gamin, la mention de la jolie
figure, la grce quasi fminine, tout comme celle du teint clair,
qui caractrise davantage les femmes que les hommes, connotent
le mpris du mle viril en son ge mr pour un jeunot qui ne fait
pas partie du monde des hommes virils, et nest donc pas un
adversaire digne de sa force.
10
Rfrs un nonciateur intra-textuel.
11
Limparfait est le temps prototypique du second plan (Combettes, 1992). Parler de temps
prototypique revient dire que cest le temps le plus frquemment rencontr, mais
que dautres temps peuvent jouer ce rle, comme un participe prsent linstar de
celui qui figure dans le texte hbraque.
12
Tels sont, rapidement prsents, les mcanismes sur lesquels repose le PDV reprsent,
consistant en un dveloppement des perceptions (et des penses qui leur sont associes)
dans le deuxime plan du texte. On se reportera Rabatel, 1998, chapitre 1, pour une
analyse linguistique plus dtaille.
350
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
Ainsi, cet nonc, crit par le narrateur, qui correspond au
locuteur/nonciateur premier, met-il en scne un nonciateur intratextuel, Goliath, qui est la source nonciative dun PDV, sans que ce
PDV corresponde un discours de Goliath, puisque ce dernier na
littralement rien dit. Autrement dit, le PDV reprsent est un
fragment descriptif qui pourrait tre paraphras par une sorte de
monologue intrieur implicite, du type: Ce mignon jeune homme,
je vais nen faire quune bouche! Le locuteur/nonciateur premier
rapporte ce PDV, sans reprendre son compte sa connotation
mprisante, 13 mme sil entrine la dnotation du contenu
propositionnel, savoir la jeunesse et la beaut de David, en
labsence de distanciation pistmique.
Quelles conclusions dordre narratologique tirer de cette
analyse nonciative? Si les sources du PDV sont les nonciateurs,
ds lors, il ne peut y avoir de catgories de PDV, en lien avec une
source nonciative, que rapportes un substrat linguistique. Cette
ralit nonciative explique quil existe bien un authentique PDV
du narrateur, lorsque les objets du discours sont rfrencis sans
passer par le prisme perspectif dun personnage saillant. Ce serait
le cas en (2) si David tait dcrit avec les mmes expressions, sans
quelles soient rfres Goliath:
(2) David apparut. Ctait un gamin, au teint clair et la jolie figure, un
adversaire qui ne mritait pas le respect.
Lide dune focalisation zro (que Genette glose comme
absence de focalisation, comme point de vue du narrateur ou comme
focalisation variable rsultante de toutes les focalisations gloses
contradictoires, incompatibles pour une dfinition scientifique )
13
La distanciation axiologique est discrte, mais elle existe travers le contraste entre
le verbe mprisa et la qualification de David: les attributs, orients positivement,
nappellent en principe pas le mpris, sauf tre interprts travers le prisme
sadique de lhomme sr de sa force, qui ramne les relations humaines au choc des
corps corps mort. Cette distanciation indique une dissonance entre le narrateur
et le personnage percevant. Dans le cas contraire, on parle de consonance: cf. Cohn,
1981; Rabatel, 1998, chapitre 4, et 2001.
351
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
ne rsiste pas lanalyse. Et pas davantage la focalisation externe,
contrairement ce que prtend Rivara (2000).14 Bal (1977), voil
longtemps, a bien soulign cette confusion entre focalisation par
(un sujet focalisateur/une instance) et focalisation sur (un objet
focalis), reversant la focalisation externe du ct de la description
objective du focalis. Lapproche anglo-amricaine qui distingue
seulement entre point de vue externe (le narrateur) et point de vue
interne (le personnage) va dans le mme sens que mes propositions,
quand bien mme on peut discuter du bien fond linguistique de la
dnomination externe. L est le point fondamental, nonciatif,
du diffrend avec Genette. Je nai pas la place ici de reprendre la
dmonstration de 1997 (jamais dmentie depuis): les exemples
allgus comme focalisation externe relvent soit dun PDV du
personnage soit dun PDV du narrateur en vision externe, cest-dire limite la description dun aspect externe dun objet,15 telle
la description dun habillement, dun objet, et exprime dans des
noncs objectivants, avec nonciation historique, et surtout, sans
traces manifestes de subjectivit.
Outre le diffrend fondamental avec Genette sur le nombre et
la nature des instances du PDV, il existe un dsaccord srieux sur
lattribution dun volume du savoir intangible accol chaque
perspective, depuis lomniscience narratoriale la rtention
dinformation maximale en focalisation externe.16 Or lomniscience
est une donne qui ne se vrifie pas toujours dans les textes, selon
les genres, les types de narrateur, les stratgies dexposition etc.;
au demeurant, pour autant quelle est manifeste, elle nest pas non
plus rserve aux seuls narrateurs, puisquil existe des personnages
14
Voir Rabatel 2007b pour une discussion dtaille.
15
Ainsi la description physique (externe) de David comporte des traces de la subjectivit
(interne) de Goliath, cest pourquoi jai abandonn cette dichotomie (Rabatel, 1997)
sans fondement linguistique.
16
Outre quil ny a pas de foyer ou de source nonciative pour la FE, les fragments qui
relvent dune vision externe dun objet de discours apprhend par un focalisateur
personnage ou narrateur peuvent comporter beaucoup dinformations, comme le constate nimporte quel lecteur de Balzac
352
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
savants (Rabatel, 2000) et que, dune faon gnrale, la thse selon
laquelle les personnages auraient un point de vue limit ( la vision
externe, selon Vitoux, 1982), parce quils ne pourraient pas accder
aux penses des autres personnages, ne rsiste pas un examen
linguistique minutieux, comme le montrent les exemples analyss
dans le chapitre 12 de mon ouvrage de 1997. Le fait quun
personnage puisse voquer notamment par le discours rapport
des penses est lindice le plus sr de ce que les personnages, en
tant que centre de perspective narrative, peuvent accder
lintriorit des personnages, ou, du moins, la reprsenter, comme
le narrateur, avec les mmes marges de certitude et derreur. Certes,
ce savoir actorial ncessite la caution du narrateur: en ce sens, il y a
bien une diffrence entre les instances auctoriale et actoriale,17 mais
elle concerne la fiducie. Bref, lintrospection dautrui est possible
un personnage, contrairement ce qucrit J. Lintvelt: adoptant la
perspective dun acteur, le narrateur est limit lextrospection de
cet acteur-percepteur, de sorte quil ne pourra donner quune
prsentation externe des autres acteurs (Lintvelt, 1981, p. 44).
1.2. Les diffrentes modalits du point de vue: dialogisme des points de vue
reprsents, raconts et asserts
Le PDV correspond donc ce qui, dans la rfrenciation
linguistique des objets (du discours) rvle, dun point de vue cognitif
et axiologique, une source nonciative particulire et indique,
explicitement ou implicitement, ses reprsentations, et, ventuellement, ses jugements sur les rfrents. Cette dfinition permet de
rendre compte des parents entre PDV et discours rapport dune
17
On pourrait objecter que le savoir des personnages tient leur statut de narrateurpersonnage, auteur de rcits enchsss. Lobjection se retourne contre ses auteurs:
le fait quun personnage puisse jouer un rle de narrateur second dmontre linanit
des arguments qui cantonnent les personnages un savoir limit. Cela ne conduit
pas minorer les diffrences de fonction et de statut: la supriorit cognitive du
personnage-narrateur, suprieure celle de tout autre personnage, est moindre que
celle du narrateur premier.
353
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
part, PDV et assertion dautre part, sans restreindre le PDV aux
perceptions ou au seul genre narratif: il y a PDV lorsque la rfrenciation de lobjet renvoie en sus la reprsentation dun nonciateur,
mme en labsence de jugement explicite (mme si sa prsence
favorise bien videmment le reprage du PDV), que lobjet du
discours soit une opinion ou une perception, que ces dernires
paraissent dans une description, une narration, une information,
une explication ou une argumentation.
Cela signifie que le PDV ne se limite pas lexpression des
perceptions reprsentes, telles que je les ai analyses dans Rabatel
(1998), mme si je ne renie pas ces analyses ; tout simplement,
elles ne sont pas, nont jamais prtendu tre le tout du PDV. En ce
sens, discours rapports (Rosier, 1999) et PDV sont des sousensembles de la problmatique gnrale du dialogisme. Paroles,
penses et perceptions peuvent tre rapportes/reprsentes selon
des schmas syntaxiques et nonciatifs identiques, empruntant le
rapport direct (3), indirect (4), indirect libre (5),18 ou dans une
perception narrativise analogue au discours narrativis (6):
(3) Le Philistin regarda et, quand il aperut David, il le mprisa: cest un
gamin, au teint clair et la jolie figure.
(4) Le Philistin regarda et vit que David tait un gamin, au teint clair et la
jolie figure. Il le mprisa.
(5) Le Philistin regarda et, quand il aperut David, il le mprisa: ctait un
gamin, au teint clair et la jolie figure. (Premier Livre de Samuel, 17, 41. TOB,
p. 542)
(6) Le Philistin regarda et vit David, un gamin gracile, mprisable.
Ces formes de comptes rendus de perception peuvent tre
regroupes dans un continuum, en fonction de leur plus ou moins
18
En labsence de verbe de parole ou de pense, beaucoup de cas limites de DIL peuvent
sinterprter comme PDV reprsent.
354
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
grand degr de visibilit et leur plus ou moins grande aptitude
exprimer lintriorit, la subjectivit et la rflexivit des nonciateurs:
yonnair
e ou racont (Rabatel, 2000, 2001,
Le PDV embr
embryonnair
yonnaire
2004b) correspond aux PDV perceptifs limits des traces
dans le premier plan, comme en (6).
Le PDV reprsent (Rabatel, 1998, p. 54, 2001, 2003) exprime les comptes rendus de perception (ventuellement
associs des paroles ou des penses) dvelopps dans le
second plan, comme dans les italiques de (1), (5).
Le PDV assert (Rabatel, 2003) correspond aux PDV sexprimant
par des paroles ou des penses, linstar des formes conventionnelles du
DR (3), (4) ou dans des assertions (en dehors du contexte du DR)
compltes voire mme embryonnaires: voquer la police en parlant
de gardiens de la paix ou de forces de lordre ne dit pas la mme
chose relativement au rle de la police et la conception des rapports
sociaux.
En ce sens, le PDV embryonnaire nest pas une absence de
PDV, cest un PDV minimal, moins rflexif et subjectivant quun PDV
assert, mais cest dj un PDV du personnage ou du narrateur,
selon lnonciateur (Rabatel, 2003).
La question des marques internes et externes du PDV nest
pas aborde longuement ici, faute de place: cf. Rabatel 1998, 2003.
Disons simplement que plus la rfrenciation compte de
subjectivmes (Kerbrat-Orecchioni, 1981),19 plus le PDV est sensible,
mais cela ne doit pas conduire faire conclure que labsence de
marques subjectives quivaudrait une absence de PDV ou une
objectivit du narrateur ou un degr zro de la narration du
19
Ainsi, au plan de la cohsion nominale, des dnominations lexicales comportant des
jugements de valeur apprciatifs ou dprciatifs ou certaines marques dactualisation
du nom, les prsentatifs, les connecteurs, sans compter le rle des formes verbales.
(7) Le Philistin regarda et, quand il aperut David, il le mprisa: mais ctait un gamin,
cet phbe au teint clair et la jolie figure.
355
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
narrateur. Leur prise en compte montre que tous les PDV peuvent
tre objectivants ou subjectivants et quil ny a donc pas lieu de
simplifier outrageusement les choses en disant que le PDV du narrateur
htrodigtique serait, par dfinition, un PDV objectif, tandis que le
PDV du personnage serait par dfinition subjectif. Ce genre de
confusion entre origine et expression linguistique de la subjectivit
accorde une confiance trop nave en lide que la narration serait si
objectivante que personne ne parle ici, les vnements semblent
se raconter deux-mmes, affirmation de Benveniste contredite par
la prsence de marqueurs de subjectivit de toute nature, y compris
dans les textes crits avec une nonciation historique, parce que les
reprages anaphoriques nempchent pas quaffleurent des traces du
sujet modal (cf. Rabatel, 2004a et 2005d, p. 117-20).
2. LES POINTS DE VUE DANS LA NARRATION
Cette nonciation narrative en acte, que Labov (1972/1978)
met au jour partir des rcits oraux, est videmment trs marque
dans les interactions orales. Mais la dimension interactionnelle existe
aussi, ft-ce sous une forme mdiatise, dans les rcits crits,
littraires ou non.20
Ces marques peuvent se cumuler avec un nombre infini de marques syntaxiques exprimant
le dialogisme (question rhtorique, concession, rfutation, rectification, confirmation,
renchrissement, ngation, focalisation etc.) et, plus elles sont nombreuses, plus elles
contribuent lexpression subjectivante et rflexive des PDV. Pour une bibliographie plus
complte, cf. http://icar.univ-lyon2.fr/membres/arabatel
20
Que luvre littraire soit affaire dexpression, certes, mais de communication, cest,
pour daucuns, plus discutable. Cette thse anti-communicationnelle a pu recevoir le
soutien de certains travaux de linguistes mettant en avant le fait que lnonciation de
type rcit, dconnecte des paramtres de la situation dnonciation, renvoyant une
attitude de locution distancie, sans proccupation dinfluer sur le destinataire, reposant
sur un texte quasiment sans nonciateur (personne ne parle ici, le rcit semble se raconter
de lui-mme). Ces reprsentations, alimentes par les travaux parfois contradictoires de
Benveniste (et des lectures rductrices), ont t justement rectifies (cf. Rabatel, 2004a,
2005d).
356
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
2.1. Reconception de la mimesis: la dimension cognitive et pragmatique de la reprsentation
Prendre au srieux cette dimension pragmatique entrane une
reconception du mimtisme, qui dpasse lapproche vriste qui se
dploie sans limites dans les reprsentations idalistes du rcit.
La construction textuelle du mimtisme na rien voir avec avec
la conception idaliste du mimtisme vriste, car elle rsulte dune
interaction dialectique entre le monde et les sujets parlants (et
interprtants), dune re configuration de lexprience, ainsi que le dit
Ricur dans Temps et rcit, cette dimension configurante tant une
sorte dinterface entre mimsis 1 (la dimension prfigurante) et
mimsis 3 (la dimension refigurante par laquelle le lecteur sapproprie
le texte sur la base des interactions entre mimsis 1 et 2).21
Le PDV permet en tant quactivit cognitive de concevoir le
mimtisme comme une re-prsentation, et cette activit
configurante qui rend lnonciateur lorigine de la rfrenciation
dautant plus crdible quelle est globale, intgrant non seulement
les actions ou les paroles des personnages, mais encore le prisme
perceptif/cognitif travers lequel des scnes, des pauses, des
sommaires sont apprhends. Les centres de perspective
(personnage ou narrateur) sont ainsi la rsultante dune double
mimsis (Rabatel, 2004b) qui construit et garantit le personnage
partir dune re-prsentation de lobjet opre par le travail
perceptuel et cognitif du sujet. Le mimtisme ainsi conu est travers
par la question de la rflexivit, puisquil correspond aux efforts du
sujet pour sapprocher au plus prs de la ralit de lobjet,
conformment lusage quil veut faire de sa reprsentation, mais
aussi conformment lusage de celle-ci, dans linteraction o il se
trouve pris.
Cette dimension pragmatique explique que le rcit alimente
une dimension argumentative indirecte (Amossy, 2006), cest--dire
qui ne repose pas sur lappareil logique de la dmonstration et de la
21
Voir Ricur, 1983, p. 87-117.
357
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
logique naturelle, mais sur des topo, des reprsentations doxiques
qui alimentent une stratgie infrentielle certes moins contrainte que
largumentation logique base syllogistique (Grize, 1990), mais
nanmoins dirige par les instructions du texte, notamment la rfrenciation, en sorte que les re-prsentations orientent linterprtation
du destinataire, quil sagisse du lecteur, et, en amont, des interactants.
Ces formes dargumentation indirectes bases sur les infrences sont
particulirement efficaces, dans la mesure o elles reposent sur des
manires de voir qui ne sexpriment pas dans des jugements explicites,
reposent sur une forte connivence ; au surplus, comme elles ne se
prsentent pas comme des argumentations, elles nalimentent pas
de contre argumentation (Plantin, 2002, p. 240-1, Rabatel, 2004a).
De tels mcanismes fonctionnent dans tous les rcits, et pas
seulement dans les textes littraires. On a ainsi montr que certains
articles de presse schma narratif souple pouvaient reposer sur
ces stratgies, par exemple les articles qui font le bilan dune priode,
dun cycle vnementiel, linstar dune lgislature, dune campagne
lectorale etc. La campagne du rfrendum pour la constitution
europenne de mai 2005 a fait lobjet dune sorte de rcit, avec hros,
anti-hros, adjuvants et opposants, pisodes rebondissement et jeux
de rles rassembls dans la structure souple dun parcours narratif
(de la victoire annonce du oui sa dfaite), cependant que les
deux journalistes jouant le rle de narrateur taient particulirement
discrets, en rduisant le rcit premier au strict minimum,
lexception de la titraille,22 du chapeau, des lgendes des photos et
des verbes de parole qui soulignent le jeu des responsables (Rabatel,
2006, p. 78-83). Mais cet effacement du narrateur nempchait pas
ce dernier de peser sur la lecture de lvnement, en reprsentant
ce dernier sous la forme de lternel affrontement de grands fauves
politiques (Chirac, Hollande, Fabius etc.), selon une thtralisation
22
Larticle tait intitul La campagne a dchan les passions franaises (Le Monde, 29
mai 2005).
358
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
qui flatte les strotypes23 les plus culs de la vie politique, rduite
une lute de place (pour les politiques) et une gesticulation
passionnelle (pour le peuple hostile au trait). Reprsentation bien
videmment non assume dans des noncs explicites des
journalistes, que leur dontologie astreint une certaine objectivit
(que Koren 1996 invite ne pas prendre pour argent comptant),
mais qui sourd nanmoins de lensemble de la scnographie
nonciative et de la mise en rcit, comme du choix des photos.
Lactivit de narration apparat ainsi comme une stratgie
intressante de gestion des conflits, lcrit comme dans les
interactions orales. Dans Rabatel (2005b), jai essay de montrer
comment, face une interaction dissensuelle portant sur la rdaction
dun texte argumentatif rdig deux, mergent dans la rdaction
collective du texte (et par rapport llaboration collective du plan)
des processus dcriture qui narrativisent les arguments. Ces
processus sont en effet prsents, noncs, organiss sous la forme de scnarios fictifs qui sont un des biais par lesquels le locuteur
fait passer des arguments qui ne recueillent pas lassentiment du
co-locuteur. En quelque sorte, largument dtre prsent comme
une possible histoire, dans un possible univers de discours (ou espace mental) dconnect de lespace mental de linterlocuteur,
permet la poursuite de la rdaction cooprative. En dautres termes,
les arguments sont recatgoriss, dans le cadre dune argumentation
indirecte, selon un processus dempathisation qui peut se rsumer
ainsi: si a arrive dautres, a peut tarriver toi aussi. Ici encore,
on constate que la dimension cognitive de la reprsentation du relle
opre des fins argumentatives particulirement efficaces, dans la
mesure o elles reposent sur des vidences partages
23
Les strotypes ont eux aussi une dimension cognitive, au risque de surprendre
ceux qui ont une approche, elle-mme conventionnelle, de la dimension pistmique,
base sur linvention et loriginalit
359
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
2.2. Centres de perspective et dynamique interprtative
Multiplier les centres de perspective, montrer leur rle dans
la construction des parcours interprtatifs, cest multiplier, enrichir,
complexifier les voies daccs aux textes.
Lanalyse nonciative interactionnelle (ou pragmatique) des
rcits, base sur lapproche nonciative/rfrentielle des diffrents
PDV, permet ainsi au lecteur de pntrer au plus prs des enjeux
dramatiques, des conflits thiques et des beauts esthtiques de
luvre en pousant toutes les perspectives (celles des diffrents
personnages comme celle du narrateur) et en tant au plus prs des
sources nonciatives et des enjeux qui rsultent de ces manires de
sentir, de parler, dagir ou de raconter. Cela signifie que lidentification
est loin de reposer seulement sur lidentification du lecteur celui
qui agit, au premier chef au personnage principal. Autrement dit,
pour paraphraser Barthes, je suis celui qui a la mme place que
moi:
Point de vue reprsent: Je suis celui qui peroit/pense la mme place
que moi;
Point de vue assert: Je suis celui qui parle/pense la mme place que
moi.
Point de vue racont: Je suis celui qui raconte la mme place que moi24;
Ces mcanismes infrentiels-interprtatifs (proches du systme
de sympathie de Jouve (1992, p. 124-32) ; cf. Rabatel, 1997, p. 22833) sont intressants parce quils installent le lecteur au cur des
personnages et du drame, et aussi au cur de la machine narrative,
en sorte que cette identification ne fait pas que ramener le lecteur
la situation du lu (Picard, 1986) ou du lisant ; elle lui permet, du
cur du drame quil reconstruit en se mettant la place de chacun,
de jouer un rle de lectant lisant et interprtant (Jouve), tant la fois
dedans et dehors, avec tous les personnages dont le lecteur est
capable de reconstruire le PDV et au-dessus deux par sa mobilit,
24
Cf. Jouve, 1992, p. 129: Je suis celui qui en sait autant que moi, qui dcouvre lhistoire
par les mmes voies que moi.
360
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
ce qui lui permet ainsi de dgager du sens depuis le cur de luvre
et darticuler lintentio operis avec lintentio auctoris.
La multiplication et la diversification des PDV est donc un
phnomne crucial: non pas parce quelles invitent se mettre la
place de tel ou tel personnage ou du narrateur, comme on vient de
le dire, mais encore parce reposent sur des modalits diverses et
somme toute complmentaires de PDV, incitant le lecteur tirer
partie de toutes les informations du texte, y compris les plus
apparemment banales, les plus platement mimtiques, dans la
mesure o elles donnent des indications sur les personnages et sur
le drame.
Je nai pas la place de dvelopper longuement cette dimension,
qui demanderait des exemplifications minutieuses, mais je
mappuierai sur un exemple universellement connu, le combat de
David contre Goliath, dans le chapitre 17 du Premier Livre de Samuel25
et, renvoie le lecteur une publication rcente pour un examen
dtaill de lensemble. Il nest pas sans signification de remarquer
que le texte commence par prsenter le peuple dIsral en butte
un champion philistin menaant qui inspire une terreur telle que la
dfaite des lignes dIsral est annonce, tandis que David nmerge
que progressivement dans le rcit. Comme si ce texte, fondateur de
ce que les thologiens appellent la monte de David (vers la
royaut), manifestait par le jeu des PDV que David, lorigine en
position subalterne (cest le cadet de Jess, un berger), mrite de
devenir le roi dIsral la place de Sal dont la carence est patente.
Cette image dun homme qui slve vers Dieu par ses mrites
propres est constamment manifeste par le fait que le lecteur voit
dabord David agir (cest un bon berger, un bon fils, un bon serviteur),
avant de le voir venir aider ses frres, censs combattre. Or, ds que
David arrive au camp, lantithse entre les Isralites dun ct et les
Philistins de lautre est relativise par la monte en puissance
25
Voir lAncien Testament et, pour notre analyse, nous renvoyons le lecteur Rabatel,
2007a.
361
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
dramatique dune forte dichotomie entre les Isralites et David. Ce
dernier parle peu, mais manifeste quil est inspir par le Seigneur,
et cest cette foi qui le pousse affronter Goliath, avec ses propres
armes, et non avec celles de Sal lui propose. Le jeu des PDV repose
sur quelques PDV reprsents (cf. supra, exemple 1), et sur des PDV
asserts plus nombreux, dans les dialogues. Mais le PDV dominant
est le PDV racont qui empathise avec David: nous le voyons agir (il
parle relativement peu, et ses paroles prparent laction) tandis
que Goliath plastronne mais est vaincu. La prgnance de ce PDV fait
sens.
Se construit ainsi une thologie narrative, en acte, qui privilgie
la thse dun homme qui, par ses actions (par ses uvres, pas
seulement par sa foi), slve jusqu Dieu: lecture dautant plus
intressante que le familier de lAncien Testament sait que le chapitre
antrieur voque une autre version de la monte de David, qui
bnficie de loint du Seigneur, et donc qui est choisi par Dieu pour
tre le futur roi dIsral en raison de sa foi. Le Premier livre de Samuel
porte ainsi la trace de deux traditions diffrentes qui coexistent, au
cur du processus scriptural, et qui gagnent tre interprtes
moins comme une contradiction mettre au compte des maladresses
des auteurs de lantiquit quau crdit dune confrontation de PDV
au cur mme de la foi hbraque et, en fait, au cur de tout
croyant, tant il est vrai que les thologies mettent plus ou moins
laccent sur la foi et/ou sur les uvres, linstar de la thologie
protestante, qui rserva cette question un statut minent.
Quoi quil en soit, on voit o je veux en venir. Contrairement
la thse dominante selon laquelle les actions reprsenteraient le
degr infrieur de la caractrisation des personnages (nautorisant
que des infrences), suivies par les donnes sur lapparence
extrieure, les gestes, les attitudes, laccoutrement, puis un niveau
au-dessus, par la manire dont ils portent jugement sur les autres
(et rciproquement), enfin leurs paroles, dans le discours direct,
puis les penses (quelles quen soient les formes, depuis le discours
narrativis au monologue intrieur) et, last but not least, les
362
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
commentaires du narrateur sur les personnages (Alter, 1999, p. 160),
il me semble que laction est riche denseignements. Sans rejeter le
moins du monde lide que les paroles et penses donnent de riches
moyens daccs lintriorit, force est de reconnatre que lon ne
doit pas hirarchiser ces sources dinformation, sauf verser dans
un positivisme normatif et naf. Car aprs tout, on peut objecter
que certaines paroles sont trompeuses, que certaines penses disent
plus la force des illusions et des fantasmes sans quelles ne rvlent
toujours la vrit des sujets: sur ces plans, les philosophies tiennent
des discours parfaitement antinomiques. Sans trancher dans ce dbat
o chacun fait jouer ses propres reprsentations, reconnaissons
simplement que la hirarchisation tablie par Alter (1999), un des
plus minents spcialistes de la Bible, est sape la base par
limpossibilit linguistique dtablir une coupure radicale entre
lextrieur (les actes, les gestes, les vtements) et lintrieur (la
pense), surtout au plan linguistique. Cest au fond la leon narratologique des PDV, dans le chapitre 17 du Premier Samuel, que de
souligner limportance des actes, comme critrium dune vrit qui
nest pas que de bouche, et qui engage ltre tout entier. Je nai
gure la place de dvelopper, mais le lecteur aura compris, du moins
veut-on lesprer, que les techniques narratives et nonciatives du
PDV sont de nature clairer les analyses traditionnelles du rcit,
de sa structure, en mettant ces structures en perspective avec lagir
et le ptir humain, comme avec la capacit du narrateur jouer
avec les motions et lintellect, travers les reprsentations des
rapports de lhomme avec ses semblables ou avec Dieu, si lon
croit en dieu. Cette analyse fait cho cette profonde remarque de
Bres cite dans la note 2, selon laquelle lorganisation de la
signification procde de et non prcde laction de lhomme sur le
monde.
363
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
2.3. Revaloriser le rle du narrateur, y compris (et surtout) lorsquil est discret, et de
son discret (mais actif) lecteur cononciateur
On laura compris la lumire de lexemple prcdent, une
telle approche entrane galement une rvaluation du rle du
narrateur. Il sagit dune part de lexistence dune authentique
perspective narratoriale, dautre part de la prsence du narrateur,
et de son PDV, jusque et y compris au cur du PDV des personnages,
ainsi quen rendent compte maintes analyses de la scnographie
nonciative (Rabatel, 1998, p. 137-8, 172-88), dautres analyses
encore (Rabatel, 2001, 2004a, 2005a). Sil est vrai que le narrateur
est une instance, et que celle-ci sapprhende partir de ses actes,
alors force est de constater que le narrateur est la fois une
abstraction commode qui repose au demeurant sur une ralit
nonciative fondamentale dtre lnonciateur primaire et dans le
mme temps un syncrtisme qui ne doit pas masquer les positions
diverses occupes par le narrateur dans la scnographie nonciative
dont il est lorganisateur. Au demeurant, une telle rflexion est de
nature enrichir la rflexion sur la complexit de la fonction-auteur,
dans la ligne des travaux de Barthes 1970 et de Foucault 1969
(Rabatel et Grossmann, 2007).
Comprendre de lintrieur les ressorts et mcanismes dune
criture, les stratgies du narrateur est de nature laisser des traces profondes, surtout si cette approche nonciative est vivifie par
le contact dune histoire littraire qui dpasse les ressassements du
nolansonisme et qui sattache la matrialit des logiques qui
structurent le champ littraire (Bourdieu, 1992; Viala, 1985, 1999;
Rosier et al 2000; Maingueneau, 2004) ainsi quaux rgles qui
rgissent la scne dnonciation (scne englobante, constituante
de Maingueneau). En dfinitive, cette approche nonciative prend
au srieux larticulation de la forme et du fond, rebours du
formalisme qui estime si peu la forme quil la dtache du
sens (Merleau-Ponty, 2001 [1960], p. 124-5).26
26
Une telle dmarche ne peut tre pleinement signifiante que si elle sarticule avec
deux autres activits qui doivent aussi tre au cur de la pratique des textes littraires
364
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
Au terme de ce parcours, on mesure que les effets
pragmatiques du PDV ne se limitent pas quaux textes littraires et
que la saisie de leurs mcanismes nonciatifs est minemment utile,
puisquelle aide lire des discours constituants (Maingueneau et
Cossutta, 1995) comme la Bible, mais aussi des discours quotidiens
(comme la presse), des interactions orales etc. De plus, ces
mcanismes offrent maintes passerelles pour ltude des PDV
argumentatifs et pour une comprhension en tension des relations
entre rcit et argumentation (Danblon, 2002; Rabatel, 2004b, 2005b)
tout en invitant dvelopper la dimension argumentative indirecte
qui dcoule des phnomnes deffacement nonciatif frquents dans
les PDV en apparence objectivants. Cest en tout cas ce dont tentent
de rendre compte les dplacements daccent, ds mon ouvrage de
1998 celui de 2004, de la construction textuelle DU point de vue
la construction interactionnelle DES points de vue.
La thorie du PDV offre ainsi au lecteur des outils privilgis
pour lui permettre de (re)tisser, son tour, les fils du texte ou de
faire, son tour, la synthse de lhtrogne synthse qui ne
seffectue pas seulement dans le rcit lui-mme, comme le disait
Ricur, mais aussi dans lacte mme de lecture, dans lacte de
reconfiguration du rcit. Dans cette perspective, le PDV ne prtend
pas substituer une structure nouvelle lancienne tripartition des
focalisations mme si cest en fin de compte toujours possible
(Rabatel, 1997, p. 289-90) : il entend dgager une mthode de
lecture pragmatique des textes (littraires et non littraires) qui fasse
du lecteur le troisime dans le dialogue, selon la belle formule de
Bakhtine (1984, p. 332), qui lui permette de prendre toute sa part
dans la co-construction des interprtations sur la base des
instructions du texte.
lcole, je veux parler de larticulation lecture/criture et du travail sur tout ce qui
fait le contexte de luvre littraire. Je ne mentionne cette question quen passant,
faute de place, mais elle est dcisive sur un plan didactique (Rabatel, 2004b, 2005b).
365
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
BIBLIOGRAPHIE
ALTER, R. (1999) Lart du rcit biblique. Bruxelles: Lessius.
AMOSSY, R. (2006) Largumentation dans le discours. 2e d. Paris: Armand Colin.
AMOSSY, R.; MAINGUENEAU, D. (ds) (2003) Lanalyse du discours dans les tudes littraires.
Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.
BAKHTINE, M. ([1979] 1984) Esthtique de la cration verbale. Paris: Gallimard.
BAL, M. (1997) Narratologie. Paris: Klincksieck.
BANFIELD, A. ([1982] 1995) Phrases sans parole. Thorie du rcit et du style indirect libre.
Paris: Seuil.
BALLY, C. (1965) Linguistique gnrale et linguistique franaise. 4e d. Berne: Francke.
BARTHES, R. (1970) Lancienne rhtorique. Communications, 16, p. 172-229.
BOURDIEU, P. (1992) Les rgles de lart. Paris: Seuil.
BRES, J. (1994) La narrativit. Louvain-La-Neuve: Duculot.
CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. (2002) Dictionnaire danalyse du discours. Paris: Seuil.
COHN, D. ([1978] 1981) La transparence intrieure. Paris: Seuil.
COMBETTES, B. (1992) Lorganisation du texte. Metz: Celted, Universit de Metz.
DANBLON, E. (2002) Rhtorique et rationalit. Essai sur lmergence de la critique et de la
persuasion. Bruxelles: Editions de lUniversit de Bruxelles.
DELORMAS, P. (2006) Genres de la mise en scne de soi. Les autographies de Jean-Jacques
Rousseau. Thse (Doctorat) - Universit de Paris 12-Val de Marne.
DUCROT, O. (1984) Le dire et le dit. Paris: ditions de Minuit.
FOUCAULT, M. ([1969] 2001) Quest-ce quun auteur? In: Dits et crits. Paris: Gallimard, t.
1, p. 817-49.
FOREST, R. (2003) Empathie linguistique et point de vue. Cahiers de Praxmatique, 41, p.
85-104.
GENETTE, G. (1983) Nouveau discours sur le rcit. Paris: Seuil.
_____. (1972) Figures III. Paris: Seuil.
GRIZE, J.-B. (1990) Logique et langage. Gap, Paris: Ophrys.
JOUVE, V. (1992) Leffet-personnage dans le roman. Paris: Presses Universitaires de France.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1981) Lnonciation. La subjectivit dans le langage. Paris: Armand
Colin.
KOREN, R. (1996) Les enjeux thiques de lcriture de presse et la mise en mots du terrorisme.
Paris: LHarmattan.
LABOV, W. ([1972] 1978) La transformation du vcu travers la syntaxe narrative. In: Le
parler ordinaire. Paris: Minuit.
LINTVELT, J. ([1981] 1989) Essai de typologie narrative. Paris: Jos Corti.
MAINGUENEAU, D. (2004) Le discours littraire. Paris: Armand Colin.
366
Filol. lingst. port., n. 9, p. 345-368, 2007.
MAINGUENEAU, D.; COSSUTTA, F. (1995) Lanalyse des discours constituants. Langages,
117, p.112-25.
MERLEAU-PONTY, M. ([1960] 2001) Signes. Paris: Gallimard.
PICARD, M. (1986) La lecture comme jeu. Paris: Minuit.
PLANTIN, C. (2002) Analyse et critique du discours argumentatif. In: KOREN, R.; AMOSSY,
R. (ds). Aprs Perelman. Quelles politiques pour les nouvelles rhtoriques? Paris: LHarmattan,
p. 229-63.
RABATEL, A. (2007a) Points de vue et reprsentations du divin dans 1 Samuel 17, 4-51: le
rcit de la Parole dans le combat de David contre Goliath. In: ASURMENDI, J.; BURNET,
R.; COMBET-GALLAND, C.; FLICHY, O. (ds). Le point de vue dans la Bible. Paris: Cerf.
_____. (2007b) Pour une narratologie nonciative ou pour une approche nonciative
des phnomnes narratifs ? In: SCHAEFFER, J.-M.; BERTHELOT, F.; PIER, J. (ds). La
narratologie aujourdhui. Paris: ditions de lEHESS/CNRS.
_____. (2005a) Analyse nonciative et interactionnelle de la confidence. A partir de
Maupassant. Potique, 141, p. 93-113.
_____. (2005b) La narrativisation dun texte argumentatif: rsolution des conflits et
argumentation propositive indirecte. In: BOUCHARD, R.; MONDADA, L. (ds). Les processus
de la rdaction collaborative. Paris: LHarmattan, p. 227-55.
_____. (2005c) La vise des nonciateurs au service du lexique: points de vue,
(connaissance et) images du monde, strotypie. In: GROSSMANN, F.; PAVEAU, M.-A.;
PETIT, G. (ds). Didactique du lexique: langue, cognition, discours. Grenoble: ELLUG, p.
229-45.
_____. (2005d) La part de lnonciateur dans la construction interactionnelle des points
de vue. Marges linguistiques , 9, p.115-36. Disponible en <http://www.margeslinguistiques.com>.
_____. (2004a) Effacement argumentatif et effets argumentatifs indirects dans lincipit
du Mort quil faut de Semprun. Semen, 17, p. 111-32.
_____. (2004b) Argumenter en racontant. Bruxelles: De Boeck.
_____. (2003) Le dialogisme du point de vue dans les comptes rendus de perception.
Cahiers de Praxmatique, 41, p.131-55.
_____. (2001) Fondus enchans nonciatifs. Scnographie nonciative et points de vue.
Potique, 126, p. 151-73.
_____. (2000) Un, deux, trois points de vue ? Pour une approche unifiante des points de
vue narratifs et discursif. La Lecture Littraire, 4, p. 195-254.
_____. (1998) La construction textuelle du point de vue. Lausanne/Paris: Delachaux et Niestl.
_____. (1997) Une histoire du point de vue. Paris: Klincksieck; Metz: CELTED.
RABATEL, A.; GROSSMANN, F. (2007) Figure de lauteur et hirarchisation nonciative.
Lidil, 35, p. 9-23.
RICUR, P. (1983) Temps et rcit 1. Paris: Seuil.
367
RABATEL, Alain. Analyse nonciative du point de vue, narration et analyse de discours
RIVARA, R. (2000) La langue du rcit. Introduction la narratologie nonciative. Paris:
LHarmattan.
ROSIER, L. (1999) Le discours rapport. Bruxelles: Duculot.
ROSIER, J.-M.; DUPONT, D.; REUTER Y. (2000) Sapproprier le champ littraire. Bruxelles: De
Boeck.
VIALA, A. (1999) Lloquence galante, une problmatique. In: AMOSSY, R. (d.). Images de
soi dans le discours. Lausanne/Paris: Delachaux et Niestl, p. 179-95.
_____. (1985) Naissance de lcrivain. Paris: Editions de Minuit.
VITOUX, P. (1982) Le jeu de la focalisation. Potique, 51, p. 359-68.
RESUMO
RESUMO:: Este artigo mostra que a anlise enunciativa do ponto de vista (PDV), em ruptura
com a tipologia das focalizaes de Genette, pode renovar parcialmente a narratologia, sob
a condio de substituir a abordagem imanentista da narrativa por uma anlise interacional
da narrao. O artigo apresenta, em primeiro lugar, a abordagem enunciativa do PDV, em
apoio s teorias ducrotianas, e, sobre esta base, prope diversas modalidades de PDV (representado, recontado, assertado) que do corpo ao ponto de vista das personagens ou do
narrador modificando sensivelmente as anlises de Genette. Em uma segunda parte, o artigo
focaliza o papel dos PDV na narrao, notadamente na reavaliao das dimenses cognitivas
e pragmtica da mimesis, depois nos mecanismos inferenciais-interpretativo, prximos ao
sistema de simpatia de Jouve, enfim na revalorizao do papel do narrador uma vez que
este ltimo se constri ao mesmo tempo que constri suas personagens.
PAL
AVRASCHA
VE
ALA
VRAS-CHA
CHAVE
VE: Abordagem enunciativa do ponto de vista; anlise interacional da narrao; dimenses cognitiva e pragmtica da mimesis; mecanismos inferenciais-interpretativos.
Approche nonciative du point de vue, Analyse interactionnelle de la narration; dimensions
cognitive et pragmatique de la mimesis ; mcanismes infrentiels-interprtatifsApproche
nonciative du point de vue, Analyse interactionnelle de la narration; dimensions cognitive
et pragmatique de la mimesis ; mcanismes infrentiels-interprtatifs.
368
Vous aimerez peut-être aussi
- Histoire anecdotique de l'Ancien Théâtre en France, Tome Premier Théâtre-Français, Opéra, Opéra-Comique, Théâtre-Italien, Vaudeville, Théâtres forains, etc...D'EverandHistoire anecdotique de l'Ancien Théâtre en France, Tome Premier Théâtre-Français, Opéra, Opéra-Comique, Théâtre-Italien, Vaudeville, Théâtres forains, etc...Pas encore d'évaluation
- Conferencia Grize Lógica NaturalDocument34 pagesConferencia Grize Lógica NaturalShinobu MoriPas encore d'évaluation
- Dilthey - 06 Die Geistige Welt Einleitung in Die Philosophie Des LebensDocument338 pagesDilthey - 06 Die Geistige Welt Einleitung in Die Philosophie Des Lebensivalex000Pas encore d'évaluation
- BÜRGER - Crítica de La Estética Idealista (ENTERO)Document133 pagesBÜRGER - Crítica de La Estética Idealista (ENTERO)Victoria Andrades100% (2)
- Benjamin, Walter - Sur Le Concept D'histoireDocument115 pagesBenjamin, Walter - Sur Le Concept D'histoireValentin AbbatePas encore d'évaluation
- Tertulian - Aliénation Et Désaliénation Une Confrontation Lukács-HeideggerDocument26 pagesTertulian - Aliénation Et Désaliénation Une Confrontation Lukács-Heideggergyorgy85Pas encore d'évaluation
- SCHLEGEL-Cours de Littérature Dramatique PDFDocument430 pagesSCHLEGEL-Cours de Littérature Dramatique PDFAnonymous uWo9lMaPas encore d'évaluation
- PDF Nietzsche Schopenhauer StanekDocument16 pagesPDF Nietzsche Schopenhauer StanekmoustaphaPas encore d'évaluation
- De La Grammatologie - VicipaediaDocument2 pagesDe La Grammatologie - Vicipaediajacquesderrida1930Pas encore d'évaluation
- Qu'Est Ce Que La LittératureDocument2 pagesQu'Est Ce Que La Littératurecover guitar by ilyas100% (1)
- Joseph Moreau - Approche de HegelDocument31 pagesJoseph Moreau - Approche de HegelduckbannyPas encore d'évaluation
- Julio Premat Sobre El Entenado de SaerDocument21 pagesJulio Premat Sobre El Entenado de SaerMaría Fernanda SpadaPas encore d'évaluation
- L Attitude Ludique de Jacques HenriotDocument13 pagesL Attitude Ludique de Jacques HenriotKameleon.c100% (1)
- Bajtín - Hacia Una Filosofía Del Acto Ético PDFDocument40 pagesBajtín - Hacia Una Filosofía Del Acto Ético PDFMartín RosanaPas encore d'évaluation
- De L'actualité Du Temps Présent - Pieter LagrouDocument8 pagesDe L'actualité Du Temps Présent - Pieter LagrouGabriela JaquetPas encore d'évaluation
- Les Troubles Du Récit (Jean-Marie Schaeffer (Schaeffer, Jean-Marie) ) (Z-Library)Document209 pagesLes Troubles Du Récit (Jean-Marie Schaeffer (Schaeffer, Jean-Marie) ) (Z-Library)mfoutouserge83Pas encore d'évaluation
- Derrida Lecteur de HusserlDocument11 pagesDerrida Lecteur de HusserlYvan KalievPas encore d'évaluation
- Victor Henry - Antinomies LinguistiquesDocument81 pagesVictor Henry - Antinomies Linguistiquesbphq123100% (1)
- Pomian, Krzysztof - Sur Les Rapports de La Mémoire Et de L'histoire (2002)Document10 pagesPomian, Krzysztof - Sur Les Rapports de La Mémoire Et de L'histoire (2002)Sami Bouallègue100% (1)
- Judith Schlanger Metaforas TextoDocument14 pagesJudith Schlanger Metaforas TextotleninePas encore d'évaluation
- MANDRESSI, R. Métamorphoses Du Commentaire. Projets Éditoriaux Et Formation Du Savoir Anatomique Au XVI SiècleDocument21 pagesMANDRESSI, R. Métamorphoses Du Commentaire. Projets Éditoriaux Et Formation Du Savoir Anatomique Au XVI SiècleFábio MartinsPas encore d'évaluation
- Pêcheux Michel. Sur Les Contextes Épistémologiques de L'analyse de Discours. in Mots, Octobre 1984, N°9. Pp. 7-17.Document12 pagesPêcheux Michel. Sur Les Contextes Épistémologiques de L'analyse de Discours. in Mots, Octobre 1984, N°9. Pp. 7-17.nestored1974Pas encore d'évaluation
- Kremer-Marietti, Angèle - Repenser FoucaultDocument8 pagesKremer-Marietti, Angèle - Repenser Foucaultmau100_2Pas encore d'évaluation
- CarnavalesqueDocument7 pagesCarnavalesqueغشام بومعزةPas encore d'évaluation
- Les Nouvelles Voies Du Comparatisme PDFDocument183 pagesLes Nouvelles Voies Du Comparatisme PDFZoraRosaPas encore d'évaluation
- Jaran-Duquette Francois 2006 These PDFDocument337 pagesJaran-Duquette Francois 2006 These PDFjoaofernendesPas encore d'évaluation
- 1932 6 Revue de Philologie Litterature Et D'histoire Anciennes PDFDocument6 pages1932 6 Revue de Philologie Litterature Et D'histoire Anciennes PDFAndrea MarottiPas encore d'évaluation
- Tarby-De L'art-Du-RéelDocument14 pagesTarby-De L'art-Du-RéelkudretaraserdemPas encore d'évaluation
- L'UNITÉ DU VOLONTAIRE ET DE L'INVOLONTAIRE COMME - RicoeurDocument22 pagesL'UNITÉ DU VOLONTAIRE ET DE L'INVOLONTAIRE COMME - RicoeurkinderpatPas encore d'évaluation
- Dies Auguste La Transposition PlatonicienneDocument45 pagesDies Auguste La Transposition PlatonicienneaoaddiePas encore d'évaluation
- Le Drame Émancipé - ImpersonnageDocument8 pagesLe Drame Émancipé - ImpersonnageAnge Aristide DjedjePas encore d'évaluation
- Balibar - Le Structuralisme Une Destitution Du SujetDocument19 pagesBalibar - Le Structuralisme Une Destitution Du SujetPatrícia NettoPas encore d'évaluation
- Mouraviev, Serge N. - Le Rythme Syllabotonique de La Prose D' Héraclite D'éphèse - 1972 - (236-251 Abrev.)Document16 pagesMouraviev, Serge N. - Le Rythme Syllabotonique de La Prose D' Héraclite D'éphèse - 1972 - (236-251 Abrev.)the gatheringPas encore d'évaluation
- Vie Des Martyrs - Georges DuhamelDocument65 pagesVie Des Martyrs - Georges DuhamelJeanLoupAlainPas encore d'évaluation
- Rgi 1278 14 La Symbolique de Friedrich Creuzer Philologie Mythologie PhilosophieDocument18 pagesRgi 1278 14 La Symbolique de Friedrich Creuzer Philologie Mythologie PhilosophieEliana López Rossi100% (1)
- Aspects Divers de La Mémoire Chez BergsonDocument4 pagesAspects Divers de La Mémoire Chez BergsonTomás PadillaPas encore d'évaluation
- L Archéologie Du Savoir Foucault Michel 1968 L Du Annas ArchiveDocument255 pagesL Archéologie Du Savoir Foucault Michel 1968 L Du Annas ArchiveSarah Castel100% (1)
- Shared HistoriesDocument901 pagesShared HistoriesRui Guimarães Lima100% (1)
- MARCOS DIAZ - El Surgimiento de La Phantasía en La Grecia Clásica (Cap 2 y 3)Document32 pagesMARCOS DIAZ - El Surgimiento de La Phantasía en La Grecia Clásica (Cap 2 y 3)Hado NavarroPas encore d'évaluation
- Mimofonías. en La Masmédula de Girondo o La Ficción de La LenguaDocument28 pagesMimofonías. en La Masmédula de Girondo o La Ficción de La LenguaDavid Benavídez100% (2)
- Alain Michel Le Vocabulaire Esthétique À Rome Rhétorique Et Création ArtistiqueDocument21 pagesAlain Michel Le Vocabulaire Esthétique À Rome Rhétorique Et Création Artistiqueze_n6574Pas encore d'évaluation
- Bildung Et Bildungsroman PDFDocument10 pagesBildung Et Bildungsroman PDFclaugtzp-1Pas encore d'évaluation
- Rosse-Autofiction Et AutopoietiqueDocument9 pagesRosse-Autofiction Et AutopoietiqueA Guzmán MazaPas encore d'évaluation
- La Madriguera Franz KafkaDocument12 pagesLa Madriguera Franz KafkamiguelfernandezsolerPas encore d'évaluation
- Premier Discours Sur La Condition Des Grands. Pascal PDFDocument8 pagesPremier Discours Sur La Condition Des Grands. Pascal PDFBbaggi BkPas encore d'évaluation
- La Dialectique D'aristote DénaturéeDocument19 pagesLa Dialectique D'aristote DénaturéeThierrytrade100% (1)
- A. Solignac, "Doxographies Et Manuels Dans La Formation de Augustin'Document36 pagesA. Solignac, "Doxographies Et Manuels Dans La Formation de Augustin'mattteostettler100% (1)
- Bibliografia M.blanchotDocument19 pagesBibliografia M.blanchotRobertoPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze Nietzsche Et La Philosophie PDFDocument236 pagesGilles Deleuze Nietzsche Et La Philosophie PDFDavid HernándezPas encore d'évaluation
- Le Récit Et Ses Miroirs PDFDocument13 pagesLe Récit Et Ses Miroirs PDFScaramouche FiorelliPas encore d'évaluation
- Antonin Artaud - Pour en Finir Avec Le Jugement de Dieu (1947)Document34 pagesAntonin Artaud - Pour en Finir Avec Le Jugement de Dieu (1947)marcelojanuario9813Pas encore d'évaluation
- Aes 510 2 Les Relations Locuteur Enonciateur Au Prisme de La Notion de VoixDocument16 pagesAes 510 2 Les Relations Locuteur Enonciateur Au Prisme de La Notion de VoixMarcela Laura DebiazziPas encore d'évaluation
- Etudes Et Recherches en Linguistique Et Littérature Amazighes La Mesure Du Sens Et Le Sens de La MesureDocument8 pagesEtudes Et Recherches en Linguistique Et Littérature Amazighes La Mesure Du Sens Et Le Sens de La MesureDriss OuhatnaPas encore d'évaluation
- Foi Raison Hegel J-L.Poirier PDFDocument9 pagesFoi Raison Hegel J-L.Poirier PDFHoang HongPas encore d'évaluation
- Georg Von Lukacs Vienne Au Crépuscule (Der Weg Ins Freie)Document8 pagesGeorg Von Lukacs Vienne Au Crépuscule (Der Weg Ins Freie)Jean-Pierre MorboisPas encore d'évaluation
- Le Sociogramme de La Guerre (Claude Duchet) PDFDocument24 pagesLe Sociogramme de La Guerre (Claude Duchet) PDFSanou Jean carmelPas encore d'évaluation
- Benveniste BibliografíaDocument10 pagesBenveniste BibliografíaJuan Manuel MuñozPas encore d'évaluation
- Alphabet PhontiqueDocument3 pagesAlphabet Phontiquebeebac2009Pas encore d'évaluation
- Ruth Amossy, Apologie de La Polémique, 240 PagesDocument4 pagesRuth Amossy, Apologie de La Polémique, 240 PagesvalesoldaPas encore d'évaluation
- Vies MinusculesDocument100 pagesVies MinusculesOmar Janmohamed100% (3)
- Le Pas-Tout de La Comédie HumaineDocument11 pagesLe Pas-Tout de La Comédie HumaineOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- La Littérature Panoramique Dans La Genèse de LaDocument29 pagesLa Littérature Panoramique Dans La Genèse de LaOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- Critica LiterariaDocument21 pagesCritica LiterariaOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- Signes, Traces, PistesDocument32 pagesSignes, Traces, PistesOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- Yves Bozec EkphrasisDocument15 pagesYves Bozec EkphrasisOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- ZolaDocument9 pagesZolaOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- Deleuze PliDocument16 pagesDeleuze PliOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- Le Demon de La Tautologie Clement RossetDocument93 pagesLe Demon de La Tautologie Clement RossetOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- Le Demon de La Tautologie Clement RossetDocument93 pagesLe Demon de La Tautologie Clement RossetOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- Le Demon de La Tautologie Clement RossetDocument93 pagesLe Demon de La Tautologie Clement RossetOmar Janmohamed100% (3)
- Anne Marie LecoqDocument33 pagesAnne Marie LecoqOmar JanmohamedPas encore d'évaluation
- Schenck Intecont Plus Weighfeeder Manual PDFDocument87 pagesSchenck Intecont Plus Weighfeeder Manual PDFANDREY79% (19)
- Fip 200 R00 AqhseDocument2 pagesFip 200 R00 AqhseBitsindouPas encore d'évaluation
- 2843612136Document8 pages2843612136Hanina mamiPas encore d'évaluation
- Leica Geo Offi Ce Logiciel de TraitementDocument4 pagesLeica Geo Offi Ce Logiciel de TraitementFares BelkalemPas encore d'évaluation
- Autocad 2016 Tips and Tricks FR PDFDocument23 pagesAutocad 2016 Tips and Tricks FR PDFHamza ChelabiPas encore d'évaluation
- Francais Texte RestaurantDocument1 pageFrancais Texte RestaurantJosefina García OsorioPas encore d'évaluation
- Adresse IPv4Document12 pagesAdresse IPv4Fifi FifitaPas encore d'évaluation
- Travaux Pratiques !Document12 pagesTravaux Pratiques !Kaoutar SalamPas encore d'évaluation
- Manga FrenchDocument23 pagesManga FrenchLaurent Ferry SiégniPas encore d'évaluation
- Analyse 3Document25 pagesAnalyse 3Kenny GayakpaPas encore d'évaluation
- Cours BetonDocument8 pagesCours BetonMērâbtï Râ MzïPas encore d'évaluation
- Systèmes Ongrid Pour Les Industriels Raccordés en Moyenne Tension - 2Document111 pagesSystèmes Ongrid Pour Les Industriels Raccordés en Moyenne Tension - 2nabil basbousPas encore d'évaluation
- L'air Et L'aerauliqueDocument24 pagesL'air Et L'aerauliqueCHAKIB SACIPas encore d'évaluation
- Prèsentation Du SFEDocument30 pagesPrèsentation Du SFEMohamed EL HATTABPas encore d'évaluation
- Chapitre 1-Cours de Java PDFDocument22 pagesChapitre 1-Cours de Java PDFmrcutPas encore d'évaluation
- 2.fungi Cours JPM 2006 JpegDocument39 pages2.fungi Cours JPM 2006 JpegNoor GhPas encore d'évaluation
- Depistage TrisomieDocument4 pagesDepistage TrisomieLoubere TaubiraPas encore d'évaluation
- Phèdre (PDFDrive)Document383 pagesPhèdre (PDFDrive)Ange Miguel0% (1)
- Item 334 - Angor Chronique StableDocument5 pagesItem 334 - Angor Chronique Stableabdele.adelPas encore d'évaluation
- Controle 1 4sc 2023 2024vfDocument3 pagesControle 1 4sc 2023 2024vfytube.channel49Pas encore d'évaluation
- Berger Du Peuple de Dieu - 122700Document116 pagesBerger Du Peuple de Dieu - 122700ngafgabadawePas encore d'évaluation
- Tisser Des Liens L Entrevue Caroline DoyonDocument23 pagesTisser Des Liens L Entrevue Caroline DoyonKaroline TruchonPas encore d'évaluation
- Transistors BipolairesDocument17 pagesTransistors Bipolaireskouassinehemie320Pas encore d'évaluation
- Bus M 2016 Brahimi Aghilas PDFDocument207 pagesBus M 2016 Brahimi Aghilas PDFhana tiPas encore d'évaluation
- Trévisan-Le Songe VerdDocument5 pagesTrévisan-Le Songe VerdbertosamPas encore d'évaluation
- Clinique SSR Bellefontaine NancyDocument2 pagesClinique SSR Bellefontaine NancySonia GonzalezPas encore d'évaluation
- Info - Express N°04Document2 pagesInfo - Express N°04Walid Ben AmirPas encore d'évaluation
- Freies Handbuch CH Retail FRDocument36 pagesFreies Handbuch CH Retail FRHyacinthe DahoPas encore d'évaluation
- TP2 Filtrage NumeriqueDocument25 pagesTP2 Filtrage NumeriqueG POWERPas encore d'évaluation