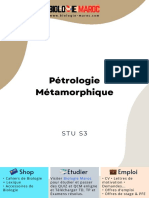Les structures
dans les roches sdimentaires
La gosphre et les systmes de la Terre
Cours
Ides importantes : Les roches sdimentaires montrent des structures diverses qui
dpendent de leur histoire. On peut identifier ces structures et les utiliser pour
reconstituer les conditions de formation dun ensemble sdimentaire : conditions du
milieu de sdimentation, conditions de la dformation aprs consolidation.
Capacit IESO : capacit didentifier des structures comme : stratification,
granoclassement, stratification entrecroise (cross bedding), ripplemarks, plans de
discontinuit (joints et plans de faille).
- capacit didentifier sur le terrain plis et failles et de remonter au champ de
contraintes qui ont affect les roches (directions de compression et dextension).
Dans les roches sdimentaires, on peut observer une disposition des lments
sdiments en strates, qui ne sont pas toujours planes, horizontales, parallles,
composition homogne. Les couches sont alors perturbes par des structures ou figures.
Or la sdimentation des fragments de roches, minraux, fossiles se produit dans un
milieu de sdimentation o rgnent des conditions qui le caractrisent, en particulier
des conditions hydrodynamiques, susceptibles dinfluencer les dpts. Quelles sont les
figures observables ? Comment les reconnatre, les identifier ? Comment les interprter
et donc les utiliser pour reconstituer les conditions du milieu de sdimentation ?
Par ailleurs, aprs le dpt et la consolidation des sdiments, les roches peuvent tre
soumises un champ de contraintes qui dforme les strates. Quelles sont les
dformations obtenues ? Comment les identifier, les caractriser ? En les analysant,
peut-on remonter au champ de contraintes qui les a affectes ?
I-Structures acquises avant la consolidation des roches sdimentaires
Le dpt des particules au sein dun fluide (air ou eau) est conditionn par :
- la gravit qui conduit la sdimentation
- les mouvements du fluide qui, par son nergie cintique, favorise leur dplacement
(voir diagramme dHjulstrm, fiche Origine des roches sdimentaires ).
A- Stratification et joints de stratification
Les roches sdimentaires prsentent une stratification, ce qui signifie quelles sont
composes de strates/couches. La stratification est dautant plus visible que les strates
sont de nature lithologique diffrente. Une strate correspond une unit de
sdimentation, dpose dans des conditions physiques relativement stables. Elle est
spare des couches sus et sous-jacentes par des surfaces limites, discontinuits qui
marquent soit des changements des conditions de dpt, soit des surfaces drosion, soit
des lacunes (absence) de sdimentation. Ces joints de stratification, au contraire des
failles (voir plus loin), ne sont pas des contacts anormaux avec dplacement. Ils
soulignent la stratification, et ne sont pas forcment plans et horizontaux, ni parallles.
�Strates
Grs ocre compact
Argile noire
schisteux
Joints de
stratification
Joints de stratification dans des flyschs ordoviciens
Site pdagogique ac-Montpellier / nappe de Montpeyroux
B- Dynamique des fluides et formation de rides la surface des strates
(ripple-marks)
Sur les surfaces de sdiments dtritiques non consolids, parcourues par un coulement
fluide (courant deau ou vent), sobservent des constructions de type rides ou
dunes . Les observations sur le terrain (rides de plages, fonds sous-marins, rivires,
dserts) ou les expriences de laboratoire (avec chenaux hydrauliques, souffleries)
montrent que ces constructions sont souvent transverses par rapport au courant, et
concernent surtout les sables.
La taille et la forme de ces
structures dpend de la taille
des particules et de la force
du courant. Par exemple, un
courant de moins de 10 cm/s,
avec des particules infrieures
1 mm, ne peut donner
naissance des rides.
La formation des rides
dpend de la vitesse du
courant et de la taille des
grains
2
Formation de lits plans
Formation de rides
Pas de dplacement des grains
�Sens du courant
Ride de courant asymtrique
Sens du courant
La surface de la strate a conserv la trace de rides de
courant (grs des Alpes)
Dautre part, les rides, de quelques cm de haut, peuvent tre asymtriques ou
symtriques selon lorientation du courant :
Morphologie dune ride :
Si L1=L2 , la ride est symtrique le courant est oscillatoire
Si L1>L2, la ride est asymtrique le courant est unidirectionnel
-
avec un courant unidirectionnel, les rides sont asymtriques, les grains
entrains sur le flanc long, peu pentu, amont par le courant, dvalent le flanc
court pentu et aval en formant des petits lits obliques (lamines).
Avec un courant oscillatoire, comme celui cr en profondeur ( 20 ou 30 m au
maximum) par la houle de surface, les grains ont un mouvement de va-et-vient,
les rides sont symtriques.
�Diffrents types de rides peuvent tre associs.
Mer
basse
Petites rides
symtriques
Grandes rides
asymtriques
Oscillations
de mare
Sens du courant
Deux types de rides associs
En appliquant le principe de lactualisme, on peut utiliser la prsence des rides la
surface des couches, en associant aussi la granulomtrie et la forme des grains, pour
reconstituer les caractristiques du milieu de sdimentation : dpt olien ou aquatique,
sens de dplacement des fluides, vitesse des courants, paisseur de la couche deau. Il
sagit toujours dune interprtation dlicate.
C- Dynamique des fluides et stratification oblique (en anglais cross-bedding)
Lintrieur des strates peut prsenter une organisation lite avec des fines couches
obliques par rapport aux joints de stratification, planes ou incurves.
Stratification oblique :
laffleurement
prsente deux
directions obliques des
strates successives.
�Lobliquit est bien visible dans un plan perpendiculaire la direction des lits. Cette
disposition peut tre due laction dun courant (eau ou vent) et associe la formation
de rides asymtriques. Si la direction du courant est constante, loblicit est la mme.
Ride rectiligne
Stratification parallle
Stratification oblique
Relation entre formation de rides rectilignes et stratification oblique
Interprtation de la stratification oblique par dplacement des grains entrains
par un courant sur une pente par exemple au niveau dun delta
�Sur certaines coupes, plusieurs obliquits, de pendages diffrents, sont visibles. Les
couches les plus jeunes recoupent les plus anciennes, qui sont tronques, les couches
sont arques. Cette stratification entrecroise apparat dans des zones o les
conditions hydrauliques varient, comme les rivires (alternance de crues et dcrues), les
deltas, et les milieux marins littoraux o divaguent des chenaux.
Comme prcdemment, avec ltude granulomtrique et ltude de la forme des grains,
lanalyse de la stratification permet de reconstituer les conditions du milieu de
sdimentation.
Par ailleurs, en utilisant le principe de recoupement (toute couche qui en recoupe une
autre est plus rcente), la stratification entrecroise est un critre de polarit : elle
permet de dterminer le haut (rcent) et le bas (ancien) des couches.
T4
Recoupement des strates
plus anciennes par les plus jeunes
T3
T2
Formation dun
nouveau chenal scant
T1
Creusement puis
comblement dun chenal
Formation de stratification entrecroise par divagation de chenaux
Ride
ondulante
Stratification
entrecroise
Stratification
oblique
Formation de stratification entrecroise par des rides non rectilignes
�D- Granoclassement
Les grains dtritiques peuvent prsenter un classement de taille progressivement
croissant ou dcroissant (les plus frquents).
Dans le granoclassement latral, on observe une diminution progressive de la taille
des grains de lamont vers laval du courant de transport. Or le dpt des particules (cf.
courbes exprimentales dHjulstrm) dpend de la taille des particules et de la vitesse du
courant. Si la vitesse du courant diminue, les sdiments se dposent des plus grossiers
aux plus fins, le granoclassement est dcroissant.
Dans le granoclassement vertical (en anglais : graded bedding) normal, les grains les
plus grossiers se dposent en premier puis progressivement des grains de plus en plus
fins (dcroissant). Ce granoclassement peut servir de critre de polarit.
On trouve, par exemple, ce granoclassement vertical associ la stratification
entrecroise au niveau de chenaux de rivire. Dans un premier temps, le chenal est
creus par la rivire en crue dans les sdiments prcdents (force rosive du courant
grande vitesse). Progressivement, en chaque point du cours deau, lhydrodynamisme
baisse, et des particules de plus en plus petites se dposent, comblant peu peu le
chenal. Ce granoclassement vertical, local, se combine le long du cours deau avec le
granoclassement latral, qui dpend en particulier du profil (pente) du cours deau.
Le granoclassement caractrise aussi les courants de turbidit. Ces coulements
gravitaires de masses deau charge de matriaux dtritiques, et donc de plus forte
densit que leau environnante, se produisent sur les pentes marines ou lacustres. Ils
caractrisent en particulier les talus continentaux qui bordent la plate-forme
continentale. Sur ces pentes de 5, de 3000m de dnivel, laccumulation des sdiments
est instable, les microsismes frquents. Il se forme alors une avalanche, mlange des
sdiments avec leau, qui dvale la pente au niveau de canyons sous-marins, puis ralentit
en arrivant sur la plaine abyssale pente nulle. Les sdiments (turbidites) y sont
grossirement granoclasss. Comme ces avalanches se rptent, les squences
granoclasses aussi. On retrouve dans les Alpes des roches (les flyschs), issus de ces
empilements de turbidites.
Grains grossiers
(minraux, fragments
de roches)
Ordre des dpts
Grs grain fin
Photographie E.Bonhoure
Granoclassement vertical dans un flysch turbiditique
(rgion de Biarritz)voir localisation ci-dessous
�Zone correspondant la
photo prcdente
Granoclassement vertical dans une squence de turbidites
E- Empreintes de surface
1- Les fentes de dessiccation :
Une surface de sdiment boueux (eau et argile) qui se dessche (dessiccation) se
rtracte et se fend. Les fentes de retrait qui dessinent des polygones de dessiccation. Ces
figures caractrisent des milieux continentaux soumis des variations saisonnires ou
climatiques qui provoquent des asschements de lacs, lagunes
Fentes
polygonales
remplies de
sdiments
Fentes de dessiccation actuelles
dans la valle de la Mort
Fentes de dessiccation fossiles
dans le permien de Lodve
�2- Figures drosion
Le courant peut creuser des marques allonges dans son sens dcoulement.
3- Empreintes dobjets ;
Des objets divers (galets, coquilles, morceaux de bois) peuvent imprimer une surface de
banc l o ils se trouvent, ou tre emports et laisser une traine sur la surface.
F- Perturbations lies aux tres vivants
Par leur activit, les tres vivants peuvent perturber la surface du sdiment, et ces traces
peuvent tre fossilises (indures, recouvertes dun sdiment qui en fait moulage
Moulages de pistes de reptation sur une base de banc de grs
ordoviciens( Camaret) Photo issue du site planet-terre
Il sagit par exemple dempreintes de pas (dinosaures), de terriers de vers
Lidentification des tres vivants responsables de ces traces participe la reconstitution
des paloenvironnements (voir la fiche du mme nom).
II- Dformations acquises aprs la consolidation des roches
Dans les roches dformes, il est difficile de connatre ltat initial qui permettrait
dvaluer la dformation. Les dformations ne sont pas spcifiques des roches
sdimentaires, mais la stratification qui les caractrise est un marqueur qui permet de
les mettre facilement en vidence, voire de les quantifier.
�A- Dformations continues et discontinues
La dformation est continue si deux points contigus le restent, mais sont relativement
dplacs. Elle est discontinue si deux points contigus sont spars dans la dformation
par une cassure.
1- Les plis, des dformations continues
Ils rsultent de la torsion ou de la flexion des couches de roches. Les joints de
stratification initialement peu dforms acquirent une suite de concavits. Le
plissement correspond un raccourcissement des terrains.
Raccourcissement
Direction axiale du pli
Strate calcaire
Charnire =
zone de
courbure
maximale
Joint
stratigraphique
limitant une strate
Flanc
Trace du plan axial,
qui passe par toutes
les charnires
Pli dans les Alpes : un indice de raccourcissement
La direction des contraintes ne peut tre reconstitue
Si la convexit du pli est vers le haut, et que les couches les plus anciennes sont au cur
du pli, il sagit dun anticlinal. Si la courbure est concave vers le haut, avec les terrains
les plus jeunes au cur, il sagit dun synclinal.
2- Les failles, des dformations discontinues cassantes
La roche est casse au niveau dune surface de discontinuit et les deux compartiments
ainsi spars sont dplacs lun par rapport lautre. La stratification permet de
danalyser le dcalage (rejet) cr par le dplacement et de visualiser un
raccourcissement, un allongement ou un coulissage.
Failles normales dans
lHimalaya : une faille a
t souligne, cherchez en
dautres Quel est le sens
de dplacement des
compartiments ? Y-a-t-il
extension ou
raccourcissement ?
10
�B- Les contraintes lorigine des dformations
La dformation est due des forces appliques sur les surfaces au sein des roches. Ces
forces sont responsables de pressions ou contraintes en chaque point (cest le rapport
de la force sur la surface sur laquelle elle sapplique, F/S quand S tend vers zro). Les
forces dpendent du contexte godynamique global (mouvement des plaques
lithosphriques).
1- Un champ de contrainte anisotrope
Pour quil y ait dformation, il faut que les diffrentes contraintes qui sappliquent la
roche soient ingales dans lespace, sinon la roche est simplement comprime sans
dformation. On peut les quantifier dans lespace autour dun point par lenveloppe que
dessinent tous les vecteurs contrainte normaux, pour tous les plans passant par ce
point : cest lellipsode des contraintes. Nous ne nous intresserons ici qu la contrainte
maximale ou minimale de lellipsode.
2- Remonter des dformations aux contraintes
Il est rarement possible de reconstituer le champ des contraintes partir des
dformations finalement observes. Des tudes en laboratoire sur des carotte de
roches permettent de prciser les relations entre dformation et contraintes.
Contrainte maximale
raccourcissement
Carotte de roche place
exprimentalement dans une presse
2 systmes de failles conjugues
symtriques
Contrainte minimale
longation
Etude de leffet de
lapplication de contraintes
Dans le cas des plis, le raccourcissement rsulte dune compression complexe avec
des rotations, et ne permet pas de dterminer de direction principale de contrainte.
Dans le cas des failles, on peut dterminer les axes principaux de dformation et de
contrainte.
Les failles normales apparaissent dans un contexte dextension, par exemple li
lcartement de deux plaques lithosphriques. Dans les roches tires, la pression
interne est diminue, elles ont un comportement cassant et la distension se manifeste
par un rejet horizontal dans la direction de cette contrainte minimale, qui est donc
possible dterminer.
11
�Direction de
contrainte
minimale
Une faible pression permettant
une extension latrale (= la
dformation)
Failles normales conjugues en Limagne (Gandaillat)
Photographie issue du site planet-terre
Surface de faille
(miroir si elle est polie)
Rejet vertical
Strate qui permet davoir
un repre du dplacement
Rejet horizontal :
extension lie la faille
Interprtation de la photographie
Les failles inverses apparaissent dans un contexte de compression, par exemple dans
le rapprochement des plaques lithosphriques. Dans la direction de la compression, la
pression interne est augmente, et correspond dans lespace la contrainte maximale.
Le raccourcissement apparat dans cette direction et permet donc de reconstituer la
direction de cette contrainte maximale.
Direction de contrainte maximale
Une forte pression qui conduit un
raccourcissement latral (= la dformation)
R = rejet horizontal transversal
Une faille inverse dans le trias de Lodve :
Photographie site planet-terre
La faille inverse conduit un chevauchement
des deux compartiments.
Rejet horizontal transversal
raccourcissement
12
�Les failles peuvent tre associes des figures qui permettent de prciser les
contraintes, ce sont, particulirement dans les calcaires, les joints stylolitiques et les
fentes de distension.
Dans les calcaires soumis des contraintes compressives, la roche tend se dissoudre
au niveau des joints. Cette dissolution sous pression forme des joints hrisss de petites
pointes, nomms joints stylolitiques, souligns par les impurets qui ne se sont pas
dissoutes. Les pointes des joints donnent la direction de la contrainte maximale.
Joints
stylolitiques
Utilisation des joints stylolitiques dans la dtermination de la contrainte maximale:
Les pointes des joints stylolitiques donnent la direction de la contrainte maximale.
13
�Relation entre joints stylolitiques
et joints de tension
Schma issu du site pdagogie.acMontpellier sur le petit Pic St Loup
Il existe dautres types de failles, comme les dcrochements, failles verticales, au niveau
desquelles les compartiments coulissent paralllement la faille (voir la fiche
Failles ).
Les roches sdimentaires enregistrent donc au cours de leur formation des
structures et des dformations qui sont autant dindices pour reconstituer les
tapes de leur histoire, aussi bien sdimentaire que tectonique.
Bibliographie :
- Cojan I., Renard M . (1997)-Sdimentologie, Masson, collection Enseignement des
Sciences de la Terre- p.91-130
14