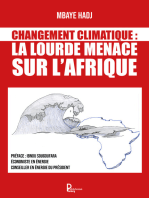Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ecole Hassania Des Travaux Publics Direc PDF
Ecole Hassania Des Travaux Publics Direc PDF
Transféré par
Hicham GisTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ecole Hassania Des Travaux Publics Direc PDF
Ecole Hassania Des Travaux Publics Direc PDF
Transféré par
Hicham GisDroits d'auteur :
Formats disponibles
ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE
Manuel du cours de
CLIMATOLOGIE
1AS mto
Version : 2003
par : Said EL KHATRI
Direction de la Mtorologie Nationale
Centre National de Recherches Mtorologiques
Service Etudes Climatiques
B.P. 8106; Casa-Oasis; Casablanca
Tl: +212.0.22.91.36.99
Fax: +212.0.22.90.48.98
E-Mail: elkhatri@mail.com
Table des matires
Chapitre 1: Concepts fondamentaux de la CLIMATOLOGIE ............................................... 5
I. Dfinitions:................................................................................................................................ 5
I.1. La climatologie: .............................................................................................................................. 5
I.2. Le temps et le climat: ...................................................................................................................... 5
I.3. Elments et Facteurs du climat:....................................................................................................... 5
I.4. Le systme climatique:.................................................................................................................... 6
I.5. Notions dchelle despace et de temps: ......................................................................................... 6
II. Buts de la climatologie et dmarche climatologique: ............................................................ 9
III. Mission de la climatologie: ................................................................................................ 10
IV. Problmes rencontrs en climatologie: ............................................................................ 10
Chapitre 2: Les facteurs du climat: ........................................................................................ 11
I. Composition de l'air:.............................................................................................................. 11
II. La latitude et l'nergie solaire:.............................................................................................. 11
III. Le bilan gnral de la radiation solaire : ......................................................................... 13
IV. La nature de la surface du sol et de son revtement :..................................................... 14
V. Le facteur "volution de l'eau dans l'atmosphre" : .......................................................... 14
VI. Le facteur "relief" : ........................................................................................................... 15
VII. Le facteur "circulation gnrale atmosphrique" :........................................................ 15
Chapitre 3: Les lments du climat: ....................................................................................... 16
I. Le rayonnement solaire: ........................................................................................................ 16
II. La nbulosit:.......................................................................................................................... 16
III. La temprature de l'air: .................................................................................................... 16
IV. Les prcipitations:.............................................................................................................. 17
V. Evaporation: ........................................................................................................................... 17
VI. L'humidit de l'air: ............................................................................................................ 18
VII. La pression atmosphrique:.............................................................................................. 18
VIII. Le vent: ............................................................................................................................... 18
IX. La transparence de l'air (ou la visibilit horizontale): ................................................... 18
Chapitre 4: Observation mtorologique: .............................................................................. 19
I. Buts et qualit d'une observation: ........................................................................................ 19
II. Contraintes dans l'implantation d'un rseau mtorologique: .......................................... 19
III. Les observations mtorologiques - rseau du Maroc associ: ...................................... 21
III.1. Observation en surface:................................................................................................................. 21
III.2. Observation en altitude: ................................................................................................................ 21
III.3. Observation satellitaire:................................................................................................................. 22
III.4. Observation radar:......................................................................................................................... 22
III.5. Observation marine: ...................................................................................................................... 22
IV. La veille mtorologique la Direction de la mtorologie nationale du Maroc ........ 24
IV.1. Etat du rseau national du Maroc: ( la date 2001) ....................................................................... 25
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 2/43
IV.2. Plan de dveloppement : ............................................................................................................... 26
V. Rgionalisation de la DMN :.................................................................................................. 27
V.1. Actions entames : ........................................................................................................................ 28
V.2. Actions futures : ............................................................................................................................ 28
Chapitre 5 : Les Donnes Climatologiques ............................................................................ 29
I. Calcul des moyennes: ............................................................................................................. 29
II. Calcul des totaux: ................................................................................................................... 30
II.1. Prcipitation: ................................................................................................................................. 30
II.2. L'insolation:................................................................................................................................... 30
III. Calcul des frquences: ....................................................................................................... 30
IV. Classement:......................................................................................................................... 31
V. Les normales climatiques: ..................................................................................................... 31
VI. Homognit des observations :........................................................................................ 31
Chapitre 6 : La Banque de Donnes Mtorologiques .......................................................... 32
I. Analyse de lexistant............................................................................................................... 32
I.1. Organisation et attributions du service banque de donnes climatologiques ................................ 32
I.2. Les procdures dalimentation de la base actuelle ........................................................................ 32
II. Evaluation de la situation actuelle de la BDC...................................................................... 34
II.1. La gestion...................................................................................................................................... 34
II.2. Techniques .................................................................................................................................... 35
III. Dfinition et conception du futur systme ....................................................................... 35
III.1. Scnario de mise en uvre............................................................................................................ 35
III.2. Etapes de ralisation du projet....................................................................................................... 38
Chapitre 7 : Recettes Climatologiques classiques .................................................................. 40
I. Les tracs graphiques: ........................................................................................................... 40
I.1. Diagramme polaire:....................................................................................................................... 40
I.2. Diagramme en bton: .................................................................................................................... 41
I.3. Histogramme:................................................................................................................................ 41
I.4. Polygone et polygone cumulatif:................................................................................................... 41
I.5. Courbe........................................................................................................................................... 41
I.6. Climatogramme:............................................................................................................................ 41
I.7. Nuage de points d'observation: ..................................................................................................... 41
I.8. Cartogrammes: .............................................................................................................................. 41
II. Erreurs viter: ..................................................................................................................... 41
Annexe I: Le Systme Mondial de Tlcommunication (SMT) ........................................... 42
I. Les fonctions assignes au systme mondial de tlcommunications mtorologiques.... 42
II. Le rseau du SMT .................................................................................................................. 42
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 3/43
Remarques importantes:
1) Le prsent manuel du cours de Climatologie est le mariage entre la
premire partie du cours de Climatologie de lENM de Mto-France
ralis par Mme Maryse DESROSIERS et Mme Victorine PERARNAUD et
des informations dveloppes dans d'autres publications sur la
climatologie (voir rfrences la dernire page). Par ailleurs, il adapte le
reste du cours au contexte du Maroc avec la participation dautres
collgues notamment :
- Mr. B. BOURHIM pour la partie rseau marocain d'observation
- Mlle H. KAMILE pour la partie banque de donnes
2) La version actuelle nest pas dfinitive. Des amliorations seront
introduites prochainement. Nhsitez donc pas de transmettre vos
remarques et suggestions afin damliorer le prsent manuel.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 4/43
CHAPITRE 1: CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA
CLIMATOLOGIE
I. Dfinitions:
I.1 . L a c l i m a to l o g i e :
La climatologie est la science du climat. Mais son domaine dapplication nest pas
restreint au climat. Il sagit dune discipline beaucoup plus vaste. Elle emprunte dautres
sciences des notions ou des rsultats dont elle a besoin en faisant appel des moyens
techniques de plus en plus sophistiqus... On peut en citer quelques unes: toutes les
sciences concernant latmosphre comme la physique, la chimie, mais galement la biologie,
lagronomie, lhydrologie, lconomie, linformatique .. et surtout les statistiques pour le
traitement et lutilisation rationnelle des donnes.
I.2 . L e te m p s e t l e c l i m a t:
Le TEMPS est considr comme ltat physique de latmosphre en un lieu donn et
un moment donn. Il se dcrit en fonction de divers lments mtorologiques exprims
en valeurs instantanes (pression, temprature, ...) ou en valeurs moyennes ou cumules
sur des courtes priodes (vent: moyen du vent sur 10 minutes, dure dinsolation au cours
dune journe, etc.).
Le CLIMAT est laspect du temps sur une longue priode en un domaine spatial
dtermin. Cest un ensemble ordonn des tats de latmosphre et de leurs interactions
avec la surface sur une priode donne et sur une tendue dtermine.
LOrganisation Mtorologique Mondiale (OMM) dfinit le climat comme:
un ensemble dlments mtorologiques
pris sur une priode donne qui concourent donner caractre et individualit
mtorologiques
un domaine spatial dtermin.
Le climat sera donc caractris par diffrents critres statistiques des paramtres
mtorologiques. Ces paramtres sont appels lments du climat.
I.3 . Elments et Facteurs du climat:
Les lments du climat: des paramtres physiques et des observations visuelles qui
caractrisent le climat: ils rsultent :
soit directement de la lecture ou de lenregistrement dun appareil de mesure:
thermomtre, pluviomtre, ...
soit des observations visuelles codifies directement par lobservateur: on peut citer par
exemple la dtermination de la couverture nuageuse ou de la morphologie du type de
nuages.
Dautres lments interviennent dans la caractrisation climatique mais ne font pas
lobjet de relevs systmatiques dans les stations mtorologiques: champ lectrique de
latmosphre, radioactivit de lair, sa composition chimique, sa teneur en micro-organismes,
etc.
Les facteurs du climat: ceux sont des facteurs qui agissent sur la variabilit des lments
du climat. On distingue:
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 5/43
les facteurs astronomiques : qui font intervenir la rotation de la Terre sur elle mme et
autour du soleil, entranant une variation de la quantit dnergie solaire reue au niveau de
la surface Terrestre au cours dune journe et au cours de lanne.
les facteurs mtorologiques : qui tiennent compte de la circulation gnrale, de leffet
des masses dair, etc.
les facteurs gographiques : qui regroupent leffet daltitude, de la position par rapport
la mer, etc.
les facteurs anthropogniques : parmi lesquels le rejet de gaz carbonique dans
latmosphre tient un rle important.
Remarques:
La distinction entre les lments du climat et les facteurs du climat est assez artificielle.
Elle nest dailleurs pas toujours bien nette.
Ceux sont les facteurs climatiques relativement constants qui permettent de dterminer
la partie prvisible des variations atmosphriques.
I.4 . Le systme climatique:
Le systme climatique comprend:
latmosphre: constitu par lenveloppe gazeuse (air sec, vapeur deau, impuret et
autres gaz: gaz carbonique, ozone, etc.)
lhydrosphre: comprend lensemble de toutes les tendues liquides (ocans, mers,
cours deau, tendues lacustres, fleuves, ..)
la cryosphre: constitue par lenveloppe glaciaire ou neigeuse (calottes glaciaires,
polaires ou montagneuses, banquises et glaces de mer, tendues neigeuses,..).
la lithosphre: comprend les lments de lenveloppe corticale rocheuse (masses
continentales) et les arosols.
la biosphre: constitue par lensemble des tres vivants (couvert vgtal, monde
animal, activits humaines ...)
Remarque: Ces diffrents lments du systme climatique ont t rangs par ordre
dimportance dcroissante sur le climat chelle globale de la plante. Mais, chelle plus
rduite, chacun de ces lments peut tenir un rle dterminant.
I.5 . Notions dchelle despace et de temps:
Il est ncessaire en climatologie de bien prciser lchelle despace et lchelle de temps
choisi. Les valeurs reprsentatives des lments du climat sont fonction de la priode et du
domaine spatial tudis.
Il est dusage en climatologie de dfinir quatre chelles spatio-temporelle principales,
associes quatre termes dsignant le climat:
Lchelle globale ou plantaire: associe au terme climat global :
Echelle de temps: 1 semaine et plus.
Echelle despace: 10 000 kilomtres tout le globe.
Pour indiquer les processus et les phnomnes qui stendent sur toute latmosphre, on dit
que ce sont des phnomnes lchelle hmisphrique ou lchelle globale. On peut citer
comme exemple les changements saisonniers qui se produisent simultanment sur tout le
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 6/43
globe, la circulation gnrale, lchange dnergie par rayonnement entre la Terre et lespace
qui lentoure, etc.
La grande chelle ou chelle synoptique: associe au terme climat rgional :
Echelle de temps: 12 heures une semaine.
Echelle despace: 100 10 000 kilomtres.
Les phnomnes synoptiques ou grande chelle sont, par exemple, des dpressions
qui se dplacent avec leurs systmes frontaux.
Lextension de chaque climat rgional est variable: elle dpend de la disposition du relief,
de la proximit dune zone ocanique, etc.
La moyenne chelle ou mso-chelle: associe au terme topo climat ou climat
local :
Echelle de temps: 1 12 heures.
Echelle despace: 1 100 kilomtres.
A cette chelle, le climat subit linfluence de la disposition gographique du relief ou
topographie.
Les processus chelle moyenne engendrent des orages et des tornades ainsi que des
phnomnes tels que la brise de Terre et la brise de mer ou encore la formation de nuages
lenticulaires au sommet des pics montagneux.
La petite chelle ou micro chelle: associe au terme microclimat :
Echelle de temps: 1 seconde 1 heure.
Echelle despace: infrieure un kilomtre.
Les phnomnes qui peuvent tre observs en un lieu donn sont des phnomnes
petite chelle: chauffement ou refroidissement sur la paroi dun btiment, vaporation au-
dessus dun bassin qui modifie les caractristiques de la masse dair sus adjacente,
refroidissement au dessous dun arbre le jour quand lair est calme, turbulence mcanique
engendre par un bosquet, etc.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 7/43
ECHELLE
PLANETAIR
Anne
CIRCULATION
ATMOSPHERIQ
Mois
ONDES
LONGUES
PERTURBATION
Jour
VENTS
REGIONAUX
BRISES
NUAGES ECHELLE
D'ONDE
SYNOPTIQU
Heure
TORNADES
Minut
TOURBILLONS
e DE POUSSIERE
TOURBILLONS
RAFALES
TURBULENTS
(C.L.A.)
Secon
de
1 101 102 103 104 105 106 107 m
Espace
CLASSIFICATION DES ECHELLES DE PHENOMENES METEOROLOGIQUES
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 8/43
Remarques:
a) Les limites temporelles et spatiales des diverses chelles sont approximatives. Il nest
pas possible de fixer des limites rigoureuses pour chaque type dchelle. Mais, il est
important de retenir quil se produit dans latmosphre des processus, des phnomnes
et des vnements qui ne peuvent tre discerns quen se rfrant des chelles
appropries de temps et despace. Ainsi, ce qui est perceptible une chelle ne lest pas
toujours une autre: par exemple, leffet de brise nest pas perceptible lchelle
globale. Do lintrt en climatologie de prciser quelle chelle on veut travailler et de
se rfrer des donnes reprsentatives de cette chelle.
b) On peut indiquer quune station mtorologique satisfaisant aux rgles internationales
relatives son environnement est reprsentative de son propre topo climat, cest dire
dans un rayon dune dizaine de kilomtres autour du site de mesures. Mais il est exclu
dextrapoler les rsultats au niveau station pour fournir des renseignements micro
chelle pour un usager de la rgion. Lintress doit installer sur son site, pendant une
priode dtermine, une station dobservation effectuant des mesures au pas de temps
adquat.
c) Lors dune tude climatologique, on doit avoir conscience que les effets des processus
une certaine chelle peuvent tre modifis par une activit marque dont lchelle est
plus grande: par exemple, une brise de mer chelle moyenne ne peut pas se
dvelopper lors du passage dune perturbation chelle synoptique.
II. Buts de la climatologie et dmarche climatologique:
La climatologie a essentiellement pour but:
a) lanalyse des lments mtorologiques qui constituent le climat,
b) la recherche des causes qui expliquent les diffrents climats et les fluctuations qui les
accompagnent,
c) ltude de linteraction du climat et des sols, des matriaux, des tres vivants, des
techniques et de lactivit conomique et mme sociale.
Dans la dmarche climatologique, on distingue plusieurs phases associes ces diffrents
buts:
1) la climatologie descriptive (ou analytique): cest ltude gographique des conditions
mtorologiques caractrisant chaque rgion. Elle permet, partir dobservation, la
description des volutions de latmosphre aux diffrents points du globe,
2) la climatologie explicative (ou synthtique): elle consiste tudier les proprits et
lorigine des fluctuations ou des vnements climatiques avec une interprtation
physique ou dynamique. Elle englobe ainsi:
la climatologie physique: qui tente mettre en vidence des mcanismes physiques du
comportement atmosphrique, partir dun jeux de donnes dobservation,
la climatologie dynamique: qui consiste retrouver ce que rvle lobservation par tous
les moyens appropris et en particulier par la modlisation numrique. Cest une branche
thorique de la climatologie base sur nos connaissances de la mcanique des fluides,
de la turbulence, des transferts nergtiques, des conditions rgissant les changes
entre milieux diffrents ... et sur les rsultats des statistiques. Le but de la climatologie
dynamique est de mieux connatre les mcanismes de la circulation gnrale
atmosphrique et les changes nergtiques au niveau du systme Terre
atmosphre afin de mieux comprendre les variabilits ainsi que les changements du
climat longue chance. La climatologie dynamique est un moyen de base pour
llaboration de prvision moyen et long terme (principalement la prvision
saisonnire),
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 9/43
3) la climatologie applique: cest lapplication de la climatologie des domaines autres
que latmosphre elle mme puisque le climat agit constamment sur diverses sortes
dactivits. A partir des donnes climatologiques, il est possible de raliser des travaux
permettant dapporter une aide lamlioration des activits humaines varies tributaires
du climat. Ainsi existe: lagroclimatologie, lhydroclimatologie, la bioclimatologie, la
climatologie aronautique, la climatologie marine ...
III. Mission de la climatologie:
Pour accder ses diffrents buts, un service climatologique a plusieurs missions
remplir:
1) Collecter des donnes: rassembler, contrler et conserver toutes les informations
mtorologiques disponibles,
2) Archiver: transfrer ces informations sur supports traitables informatiquement. Constituer
une banque de donnes. Contrler, grer, conserver et mettre jour cette banque,
3) Traiter les donnes: excuter, ventuellement la demande, des travaux statistiques ou
dtudes gnrales de synthse destines affiner les connaissances acquises sur le
climat,
4) Communiquer linformation: mettre les archives et les diffrents travaux la disposition
des usagers. Publier, priodiquement ou en cas de besoin, les informations sous forme
de rapports
5) Grer les rseaux climatologiques,
6) Participer diffrents programmes internationaux de recherche en climatologie.
IV. Problmes rencontrs en climatologie:
Parmi les problmes rencontrs en climatologie:
1) des travaux doivent tre mens partir de donnes imparfaites (srie trop courtes, ou
non homognes, valeurs manquantes, ...)
2) certaines tudes climatologiques ncessitent lanalyse de paramtres qui ne font pas
lobjet de relevs systmatiques ou qui ne sont pas archivs sur support traitable,
3) les paramtres relevs en station et le pas de temps des mesures ne sont pas toujours
pertinents pour lensemble des utilisations potentielles et pour des tudes diffrentes
chelles spatio-temporelles,
4) il est souvent difficile de cerner les besoins climatologiques des diffrents usagers. Ceci
demande une connaissance approfondie du domaine concern par lassistance.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 10/43
CHAPITRE 2: LES FACTEURS DU CLIMAT:
Les phnomnes qui intressent le temps (et donc le climat) d'une manire directe
sigent dans les 10 premiers kilomtres de l'atmosphre partir du niveau sol. L'ensemble
des phnomnes qui influencent le climat directement ou indirectement se manifeste dans
les 40 premiers kilomtres.
A cause de l'effet de la pesanteur, 50% du poids de l'atmosphre se trouve dans les
5 premiers kilomtres qui englobent 90% de la vapeur d'eau existante dans l'atmosphre.
Ainsi les facteurs du climat sont essentiellement la composition de l'air, la rotation de la
Terre.
I. Composition de l'air:
a) l'air sec:
L'air sec est compos essentiellement d'Azote (78,09%) et d'Oxygne (20.95%). Le
un pour cent restant comporte d'autres gaz, tel que : Argon, Anhydride carbonique,
Non, Hlium, Krypton, Hydrogne, Xnon, Ozone et le Radon.
La composition de l'air sec est pratiquement constante en terme de proportion jusqu'
une altitude de 80 kilomtre. Cependant on note que:
la teneur de l'air en gaz carbonique est trs variable, elle dpend de l'activit
industrielle dans les basses couches,
la proportion d'Ozone au voisinage de la mer est trs faible, elle devient plus
importante en altitude dans la couche d'Ozone qui s'tend en moyenne entre 15
et 40 kilomtres
b) la vapeur d'eau:
Le pourcentage de la vapeur d'eau dans l'air est trs variable dans le temps et dans
l'espace. Il dpend de plusieurs conditions. Mai le volume occup par la vapeur d'eau
ne peut dpasser 4 5%.
On note par ailleurs que l'eau existe dans l'air sous ses autres formes: tat solide et
liquide constituant ainsi les divers types de nuages.
c) Les impurets (pollution atmosphrique):
Les impurets dans l'atmosphre sont de deux sortes:
Les arosols: les causes sont soit naturelles (vents de sable, poussire
volcanique, pollen, ..) soit dues aux activits humaines (fums d'usines, ...)
Les gaz polluants: anhydride sulfureux, oxyde de carbone, hydrocarbure, les
Chloro-Fluoro-Carbones (CFCs), les Hydro-Fluoro-Carbones (HFCs), ...
II. La latitude et l'nergie solaire:
La radiation solaire est la premire source d'nergie pour le systme Terre - atmosphre.
L'nergie solaire reue sur un point de la Terre change en fonction de l'espace et du
temps cause:
du mouvement de la Terre autour de son axe,
et du mouvement de la Terre autour du soleil.
Ces deux mouvements engendrent:
a) une dure ingale des jours et des nuits:
Le vecteur directeur de l'axe de rotation de la Terre est fixe et forme avec le plan
cliptique (plan de l'orbite de la Terre autour du soleil) un angle constant de 6633'.
Ce qui donne que:
l'quateur: la dure du jour est gale la dure de la nuit toute l'anne,
dans les autres rgions, la dure du jour est diffrente de celle de la nuit, sauf aux
quinoxes (21 Mars et 23 Septembre). Cependant on note que:
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 11/43
- sur la zone tropicale (entre les tropiques du Cancer [2327'Sud] et du
Capricorne [2327'Nord]), il y a peu de variation entre la dure du jour et celle
de nuit,
- sur les zones tempres (entre 2327' et 6633'): l'ingalit entre la dure du
jour et celle de la nuit augmente en fonction de la latitude
- sur les zones glaciales (arctique: pole nord, et antarctique: pole sud): on parle
du jour polaire et de nuit polaire qui durent aux ples 6 mois chacun.
b) une incidence variable des rayons solaires: i
Soit i: l'angle d'incidence et w: la quantit
d'nergie reue sur le sol horizontal
w est proportionnel cosinus(i),
la masse de l'atmosphre traverse est Znith
proportionnelle l'angle i,
midi on a: i
- l'quateur: i=0 aux quinoxes et
i 2327' au cours de l'anne,
- au pole nord: i=90 (w est donc nul) aux
quinoxes, il descend 6633' pendant
l't. Pendant l'hiver w est ngatif. Sol
c) une distance Terre - Soleil variable: ( cause
de la forme elliptique de l'orbite de la Terre autour
du soleil). On note que:
La Terre reoit 7% moins d'nergie en Juillet qu'en Janvier,
La dure de l'hiver boral (i.e. t austral) dpasse de 7.5 jours celle de l't
boral (i.e. hiver austral)
Terre
Soleil
Aphlie Prihlie
(apoge) (prige)
Juillet Janvier
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 12/43
III. Le bilan gnral de la radiation solaire :
La radiation solaire est l'nergie transmise, par rayonnement solaire, au globe Terrestre et
son atmosphre.
On distingue:
a) le bilan radiatif global : qui est nul
Ce qui explique que le systme "Terre - Atmosphre" est en quilibre nergtique et donc le
climat global de la Terre est stable vis vis des changes nergtiques entre le systme
"Terre - Atmosphre" et son extrieur.
S + R + T =0
Avec :
S: rayonnement solaire incident reu sur la surface sommet de l'atmosphre
S=175 milliard de Mgawatts, = 343 Watts/m2 )
R: rayonnement solaire rflchi, diffus vers l'espace
R=-53 milliard de Mgawatts =30% de S
T: rayonnement infrarouge Terrestre (rayonnement propre au globe Terrestre)
T=-122 milliard de Mgawatts =70% S )
Remarques:
le bilan radiatif un instant donn en un point donn du globe n'est pas nul. En effet:
S: dpend de l'angle d'incidence des rayons solaires (i) qui varie en fonction de la
latitude, la saison et l'heure du jour. i peut tre calcul mathmatiquement.
R: dpend de la couverture vgtale, de la composition de l'atmosphre et de la
rflectivit du sol (mesure par l'albdo)
T: dpend de la matire
En moyenne annuelle, le bilan radiatif est positif aux basses latitudes [40 Sud, 40 Nord]
et ngatif prs des ples.
b) la radiation solaire totale: (S)
La radiation solaire total reue par le systme "Terre - Atmosphre" est rpartie en
- Radiation solaire absorbe par la Terre: cette radiation est forme d'une
partie du rayonnement solaire direct (34%) et d'une partie du rayonnement
diffus par l'atmosphre (17%)
- Radiation solaire absorbe par l'atmosphre (14% de S)
- Radiation solaire diffuse vers l'espace (35% de S dont 27% dus aux
nuages, 6% dus aux rayonnement diffus par l'atmosphre vers l'espace et
2% dus l'albdo)
S S=100
27% 6%
35%S 2%
14%
14%S 17% 34%
51%S
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 13/43
c) Le rayonnement global (qui intresse le sol) = le rayonnement solaire direct +
rayonnement diffus par l'atmosphre.
N.B. Le rayonnement global n'est pas entirement absorb par le sol, mais partiellement
rflchi et diffus.
d) L'albdo: le rapport, exprim en pourcentage, entre le flux d'nergie non absorbe par le
sol sur le flux d'nergie incident.
L'albdo dpend en premier lieu des caractristiques de la surface du sol et du
rayonnement (intensit et angle). Il est de l'ordre de 80 90% pour la neige frache, 13
18% pour le sable et 7 9% pour un sol cultiv et vgtation.
IV. La nature de la surface du sol et de son revtement :
Comme facteur du climat, la surface du sol se caractrise par: son albdo, sa
capacit calorifique, son degr d'humidit et de permabilit, sa couleur, son revtement
vgtal, son exposition, son orientation et sa forme. Ces lments interviennent dans les
changes d'nergie calorifique et d'humidit entre l'atmosphre et la Terre.
Il est noter que:
Le sol prsente une faible conductivit thermique: seule la couche superficielle qui
s'chauffe puis cde sa chaleur l'atmosphre (par contact, par conductivit et par
rayonnement).
La temprature au voisinage du sol est commande essentiellement par les changes
d'nergie entre le sol et l'atmosphre.
La vgtation qui recouvre le sol rduit l'chauffement (le jour) ainsi que le
refroidissement du sol (la nuit). Ce qui donne une amplitude diurne de temprature
moins importante pour un sol couvert que pour un sol nu.
La temprature des mers s'lve et s'abaisse plus lentement que celle du sol, ce qui
donne naissance au phnomnes de brise de mer et de brise de terre et fait que les
mers jouent un rle de rgulateur du climat pour les zones voisines (brassage de l'air
entre la terre et la mer), mais aussi l'chelle globale: on rappelle que la surface du
globe est constitue de 71% de mer et de 29% de terre. Cette rpartition devient
(respectivement) 60% et 40% pour l'hmisphre nord et 82% et 18% pour l'hmisphre
sud.
L'amplitude thermique Tx - Tn est plus faible prs des mers que loin d'elles.
V. Le facteur "volution de l'eau dans l'atmosphre" :
Il est bien connu que l'eau suit un cycle de vie en passant par ses diffrentes phases
(tat gazeux, liquide, solide). La transformation de l'eau d'un tat un autre est
accompagne d'un change d'nergie entre l'air et l'eau dans l'atmosphre. On cite par
exemple:
Le processus d'vaporation permet l'air de perdre sa chaleur reue par
rayonnement. Ce processus fait que les zones tropicales seraient moins chaudes que
s'il n'y a pas de mers.
Le processus de condensation permet l'air de gagner de la chaleur. Ce processus
fait que les zones de haute latitude seraient moins froides que si la vapeur d'eau ne
leur arrive pas (grce la circulation atmosphrique gnrale)
Par analogie, les autres processus d'volution de l'eau dans l'atmosphre permettent
des changes nergtiques entre l'eau et l'atmosphre: fusion, solidification,
sublimation, ...
La vapeur d'eau transporte l'nergie calorifique et absorbe le rayonnement solaire et le
rayonnement Terrestre.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 14/43
VI. Le facteur "relief" :
A un accroissement d'altitude correspond une diminution de pression et de temprature et
une modification des prcipitations. Par ailleurs, les courants ariens sont perturbs par le
relief cause du frottement et gnrent des actions thermiques (effet des turbulences sur la
temprature, ..) et des actions dynamiques qui dpendent de la forme du relief, la vitesse et
la direction du courant ainsi que la stabilit de l'air.
On note au passage :
le phnomne bien connu sous le nom: effet de Fhn:
un mouvement ascendant provoqu par la pente
entrane la condensation de la vapeur d'eau ...
Air
Air
l'augmentation de la vitesse du vent dans le cas de valle de plus en plus troite dans le
sens de la direction du vent.
VII. Le facteur "circulation gnrale atmosphrique" :
La circulation gnrale atmosphrique a pour effets:
la modification de la rpartition des masses nuageuses et des constituants de
l'atmosphre (essentiellement la vapeur d'eau)
le rtablissement de l'quilibre thermique entre les diffrents points de la Terre grce au
mouvement de l'air et au transport de l'nergie par la vapeur d'eau.
Les causes principales qui provoquent et maintiennent la circulation gnrale atmosphrique
sont:
la rotation de la Terre
l'ingalit du bilan thermique la surface Terrestre
(+ la distribution des mers et des continents, + les influences gographiques, ...)
N.B. En allant vers des altitudes plus leves, la circulation devient de plus en plus rgulire,
rapide et zonale
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 15/43
CHAPITRE 3: LES ELEMENTS DU CLIMAT:
I. Le rayonnement solaire:
Le rayonnement solaire est caractris par la dure d'insolation et l'intensit de la
radiation globale.
La dure d'insolation pour un jour donne est fonction de la latitude du lieu de mesure et du
jour de l'anne. Elle peut tre rduite par le relief, la nbulosit, la brume, le brouillard, la
fume dense, ...
II. La nbulosit:
Au cour de la journe et en contact avec une masse nuageuse, le rayonnement
solaire (S) est rparti en rayonnement rflchi (R), rayonnement diffus (D) et rayonnement
absorb (A) et donc seule une partie le l'nergie solaire atteint la surface du sol. Ainsi, au
cour de la journe, un ciel nuageux permet la diminution du rchauffement de la surface
Terrestre.
S
R
A nuage A nuage
D
D
Surface du
Le jour La nuit
Au cours de la nuit, un ciel nuageux permet la rduction de la perte d'nergie de la Terre par
rayonnement infra - rouge et donc diminution du refroidissement de la Terre.
III. La temprature de l'air:
La temprature de l'air usuelle est la temprature de l'air mesure l'ombre, dans un
abri mtorologique, une altitude de 1m50. Le choix de ce niveau d'altitude revient au fait
que l'air s'chauffe en contact direct avec le sol. Ainsi, la temprature de l'air est maximale
prs du sol; elle s'affaiblie en altitude avec un gradient fort prs du sol. Ce gradient devient
nul prs de 1m50.
Dans les premires couches d'air au dessus du sol, la temprature du sol est
suprieure celle de l'air pendant le jour et infrieure pendant la nuit.
Remarques:
Si la mesure de T est faite au soleil, on risque de mesurer la 90
temprature du matriel thermomtre.
La Tmin se produit vers le lever du soleil (ou peu aprs le 60 Leningrad
lever du soleil [une demi heure]).
La Tmax se produit deux heures aprs le mridien (le midi-
49 Paris (16)
soleil). 37 Alger (13)
La temprature de l'air sous abri ne correspond pas
troitement aux sensations de chaleur (ou du froid) par les
tres vivants (l'homme par exemple). Cette sensation est,
EQ
certes, lie la temprature, mais aussi l'humidit, vent, ... 6S Djakarta
(i.e. indice de confort)
Nombreux facteurs agissent sur la variation diurne de la Amplitude thermique
temprature; on peut citer la nbulosit, l'altitude, la latitude,
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 16/43
la saison, la nature du sol, le relief avec toutes ses caractristiques (forme, exposition,
orientation), le degr de continentalit, l'tat de l'atmosphre.
L'amplitude thermique annuelle augmente en fonction de la latitude.
IV. Les prcipitations:
Les prcipitations constituent avec la temprature les lments les plus importants
qui dfinissent le climat d'un lieu donn. Ils ont une grande influence sur la vie de l'homme et
des animaux ainsi que sur les conomies des pays.
D'aprs certains auteurs, rien qu'avec le cumul annuel des prcipitations on peut
classer les climats en:
- climat dsertique : RR < 120 mm
- climat aride : 120 mm < RR < 250 mm
- climat semi aride : 250 mm < RR < 500 mm
- climat modrment humide : 500 mm < RR < 1000 mm
- climat humide : 1000 mm < RR < 2000 mm
- climat excessivement humide: RR > 2000 mm
Mais les prcipitations sont caractrises non seulement par leur quantit, mais aussi
par: leur nature physique (pluie, neige, grle, grsil), leur frquence (une fois par ans ou 100
fois par an ?!), leur dure de chute (dix minute ou 24 heures?!), leur intensit (10mm/heure
ou 100mm/heure?!), leur rpartition dans le temps (exp. jours successifs) et dans l'espace
(chelle locale ou synoptique?!). Cet ensemble de caractristiques influence sur l'absorption
du sol, le drainage, les crues des cours d'eau, l'utilit agricole, la scurit humaine, etc.
Remarques: (en gnral)
Les quantits des prcipitations augmentent en se rapprochant de la mer ( latitude
gale)
Elles augmentent avec l'altitude: les cartes des prcipitations concident avec celles
hypsomtriques (cartes d'altitude).
Au relief, les versants "au vent" sont plus arross que les versants "sous le vent" (pour
des pentes assez leves. Bien entendu, pour des vents apportant de l'air humide.
La distribution des prcipitations la surface du globe est caractrise par:
- entre 20S et 20N : fortes prcipitations (1500 mm - 3000 mm)
- entre 20 et 30 latitude : zones sches (< 200 mm) avec quelques rgions pluvieuses.
- entre 30 et 40 latitude : entre 400 et 800 mm
- aux hautes latitudes > 70: faibles prcipitations (< 200 mm)
V. Evaporation:
L'vaporation concerne aussi bien les prcipitations qui arrivent au sol que l'eau
contenu dans le sol. Elle a un rle biologique puisqu'elle influence la respiration et la
transpiration. Elle est lie diffrents facteurs tel que: la temprature (mme sens de
variation), humidit relative, pression, mouvement de l'air (vent, turbulence), forme et
dimension de la surface d'vaporation, paisseur de la lame d'eau.
L'vaporation peut tre estime partir de la vitesse du vent, la radiation solaire, la tension
de vapeur d'eau, etc. ...
Remarques:
L'vaporation augmente si l'air est peu humide et plus agit.
L'vaporation provoque la formation du brouillard et des nuages,
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 17/43
VI. L'humidit de l'air:
Elle s'exprime par la tension de la vapeur d'eau (e) et par l'humidit relative (U:
exprime en pourcentage [degr hygromtrique])
La variation de U et de e en fonction du temps et de l'espace est trs complexe, mais en
gnral:
e et U ont une distribution zonale,
e= 20 mm de mercure dans les zones quatoriales; e< 5mm dans les zones polaires.
U est de l'ordre de 85% sur les zones quatoriales, trs faible sur les zones subtropicales
(notamment sur les zones continentales) et leve dans les moyennes latitudes et
dpend de la saison.
VII. La pression atmosphrique:
La pression est le poids de la colonne d'air qui surmonte l'unit de surface sur
laquelle elle s'exerce. Sa variation temporelle est lie celle de la temprature et son
gradient gnre le vent (force et direction).
VIII. Le vent:
Le vent est le rsultat de la diffrence de pression entre deux zones voisines. Il
provoque le dplacement des masses d'air et transporte ainsi les caractres climatiques. On
rappelle par exemple les moussons indiennes qui sont de deux sortes: les moussons
humides et pluvieuses dont l'air circule de l'ocan vers le continent et les moussons sches
dont l'air circule du continent vers l'ocan.
Remarque:
Un vent fort, en contact avec la surface de l'eau ou du corps humain favorise le
phnomne de l'vaporation (l'nergie cintique est perdue en chaleur).
IX. La transparence de l'air (ou la visibilit horizontale):
Elle change en fonction de l'humidit de l'air, sa puret et sa stabilit. Ainsi une
diminution de la visibilit est produite par l'absorption et la diffusion de la lumire (par les
constituant de l'atmosphre).
On mtorologie, on parle de brouillard lorsque la visibilit est infrieure 1000 m et
de brume lorsqu'elle est comprise entre 1000m et 5000m.
La stabilit de l'atmosphre, en prsence d'un air humide ou impure, favorise une mauvaise
visibilit.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 18/43
CHAPITRE 4: OBSERVATION METEOROLOGIQUE:
I. Buts et qualit d'une observation:
L'observation mtorologique a pour buts:
1) l'tude du temps prsent: les observations effectues un instant donn par le rseau
global d'observation permet de dcrire l'tat physique de l'atmosphre,
2) la prvision du temps: partir des observations et, bien sur, d'outils numriques ou
statistiques, on peut prvoir le temps futur,
3) l'tude climatologique: partir de l'tude des donnes historiques d'observation pendant
une priode suffisamment longue...
II. Contraintes dans l'implantation d'un rseau mtorologique:
La cration d'une nouvelle station d'observation ou la modification dans l'exploitation
d'une station existante est confronte plusieurs contraintes:
la contrainte conomique:
L'implantation d'une nouvelle station d'observation est tributaire de budget allou la
Direction de la Mtorologie Nationale. D'autre part, certaines observations, ne peuvent
tre effectues dans toutes les stations en raison de leur coups: exemple de l'appareil
de mesure du rayonnement direct, le pyrhliomtre ..
la contrainte technologique:
L'quipement en appareil de mesure spcial doit tre adapt la demande. Il est
inutile d'quiper deux stations voisines de radars ou de radiosondage ! Par ailleurs, plus
l'erreur d'estimation d'un appareil de mesure est grande (exemple capteur d'humidit)
plus la distance entre les stations (effectuant sa mesure) doit tre grande.
les caractristiques gographiques de la rgion:
Le rseau de station mtorologique doit couvrir tous les types de relief et de terrain.
Ainsi l'existence de plusieurs stations sur un site ayant un horizon dgag constitue un
facteur important de point de vue synoptique et climatologique, mais un tel rseau doit
tre complt par des stations auxiliaires situes dans des sites moins dgags (valles,
forets, ..).
Dans les rgions o les conditions gographiques sont assez uniformes, une station par
1000 km2 est largement suffisante pour satisfaire la plupart des besoins climatologiques.
Cependant un tel rseau ne permettra pas de prendre en compte des phnomnes
locaux, comme les averses, les orages.. Il sera donc ncessaire de crer des postes
pluviomtriques.
la variabilit spatio-temporelle des lments:
Tant que le nombre de stations qui effectuent la mesure d'un paramtre est grand tant
que l'analyse de la rpartition spatiale dudit paramtre est plus complte. Mais la densit
idale d'un rseau dpend dans une large mesure de l'lment tudier et de sa
variabilit dans l'espace et dans le temps. Ainsi un rseau peu dense peut suffire
l'tude des pressions atmosphriques, tandis que l'tude des rgimes de vent ou des
prcipitation exige un rseau plus dense... De plus les frquences de mesure des
paramtres doivent tenir compte de leurs variabilits temporelles. Par exemple, la
temprature de l'air varie plus remarquablement au sol qu' 500hpa.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 19/43
les besoins climatologiques de la rgion:
Pour satisfaire au mieux l'usager, il est ncessaire de connatre, priori, ces besoins
en donnes mtorologiques avant l'tablissement du rseau d'observation.
En agro mtorologie, la temprature au niveau du couvert vgtal a plus d'intrt que
la temprature sous abri.
On peut, galement envisager la prise de mesures "spcifiques" dans des stations
exprimentales avec un chantillonnage dans le temps trs fin et durant une priode
assez limite. C'est l'exemple de mesure de pollution urbaine dans le but d'tudier les
indices de confort en fonction de l'tat atmosphrique et la teneur de l'air en gaz et
particules polluants Casablanca.
les contraintes sur l'exploitation des donnes:
Mme si les moyens techniques concernant l'acquisition des donnes se dveloppent
de plus en plus, les problmes concernant toute la chane de traitement limiteront le
nombre de paramtres saisis, augmentent le pas de temps entre l'observation et
l'archivage. Le problme est encore plus marqu quand il s'agit des donnes du rseau
auxiliaire. De mme pour les stations automatiques, mme si elles peuvent tre
interroges tout moment, les donnes archives ne sont archives qu'au mieux
chaque demi-heure.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 20/43
III. Les observations mtorologiques - rseau du Maroc associ:
III.1 . Observation en surface:
Les principaux paramtres mtorologiques observs en surface sont:
Paramtre Unit de mesure Moyen de mesure + remarques
La pression: Hectopascal (hpa) baromtre
Le vent direction : 0-360 Girouette
vitesse m/s anmomtre
Temprature de l'air sous abri 1/10 C Thermomtre
+ Tmin Sonde thermique
+Tmax Thermomtre mouill
+Temprature du point de (psychromtre)
ros (Td)
+ventuellement: T10cm et T => agriculture
dans le sol
Humidit de l'air 0-100% (T et Td) Hygromtre
Sonde d'humidit
Prcipitation 1/10 mm pluviomtre
Visibilit horizontale 10m
Les nuages Identification
Nbulosit (en 1/8)
Hauteur (en 100m) Altimtre
Temps pass- temps prsent Caractre gnral
Evaporation 1/1000+1/10.000 Evaporomtre (Piche)
mmd'eau
Insolation En heures +1/10 heure Hliographe
Rayonnement solaire global Pyranomtre (global = direct +diffus)
'' " direct Pyrhliomtre
" " diffus Pyranomtre
" total Pyrradiomtre
(total=solaire+terrestre+atmos)
Les paramtre observs peuvent tre classs en :
1. lments mesurables: P, T , H, V, ...
2. lments estims: nbulosit, VISI, ...
3. lments rsultant d'une totalisation: vaporation, insolation, neige , RR, ...
III.2 . Observation en altitude:
Elle se fait par :
Le radiosondage ( 00TU et 12TU): la radiosonde permet de mesurer la temprature, la
pression, l'humidit et le vent
Le radio-vent ( 06TU et 18TU) mesure le vent
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 21/43
III.3 . Observation satellitaire:
Deux types de satellites sont utiliss:
Satellites gostationnaires
Satellites dfilent
Les "images" envoyes par les
satellites nous informent sur :
- la couverture nuageuse
- la temprature de surface
- les mouvements
atmosphriques
- les tempratures de surface de
la mer
- le vent
III.4 . Observation radar:
Les radars permettent de faire des mesures estimatives des
prcipitations (quantit et intensit) d'une manire quasi instantane. Ils
permettent surtout de suivre l'volution spatiale des systmes pluvieux et
orageux (via l'analyse de la distribution spatiale des masses nuageuses
prcipitants) et ils jouent un grand rle dans la prvision mtorologique
immdiate (une heure 6 heures) qui aidera , lassistance aux
gestionnaires de leau et des rseaux urbains dassainissement et la
protection civile.
III.5 .Observation marine:
En dehors des observations en surface et des observations en altitude classiques, les
observations en mer comportent d'autres lments:
- des mesures bathythermiques sont effectues en certains points des mers et
ocans jusqu' une profondeur de 450 mtres (le plus souvent)
- l'tat de la mer (hauteur, direction, priode de la mer du vent et de la houle)
- des enregistrements de houle sont galement effectus (boues
acclromtriques )
Le rseau d'observation en mer se comporte de:
a) Navires mtorologiques stationnaires: NMS
De plus des observations marines dcrites plus haut, les NMS effectuent des
observations horaires de surface et des observations en altitude.
b) Bateaux feux
Les bateaux feux sont des units qui excutent presque toutes les observations
synoptiques de surface et occupent en permanence des points fixes en zones littorales ou
proches du littoral o les conditions mtorologiques diffrent de celles rgnant la cote ou
au large.
c) Navires slectionns
Ce sont des navires de la marine marchande ou des navires de pche. Ils font au cours
de leurs voyages sur toutes les mers des observations mtorologiques aux heures
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 22/43
synoptiques qu'ils consignent dans un carnet et quils transmettent aprs codage par
voies radiolectriques.
d) Boues fixes ou drivantes
Les boues sont munies de stations mtorologiques automatiques et interroges par
satellite. Elles fournissent les valeurs des paramtres courants : V, P, T, houle et,
ventuellement pour celle qui se dplacent, une ides des courants superficiels
Remarques:
1. Rpartition des donnes marines:
La majorit des donnes des observations marines provient de stations sur navire mobiles
(en dplacement: voyage, marchandise, ..). Ce qui fait que la distribution de ces
observations dans le temps et dans l'espace est assez irrgulires: elles sont concentres le
long des routes maritimes. Il existe, ainsi, de vastes espaces ocaniques qui ne sont jamais
traverss par des navires et les donnes de s boues drivantes sont trop peu nombreuses
2. Calcul des donnes climatologiques:
On note tout d'abord que dans les rgions mal desservies, il faut interprter les paramtres
statistiques dcrivant les caractristiques climatiques avec une grande prudence. On a,
souvent, recours l'exploitation des donnes satellitaires pour combler ces nombreuses
lacunes.
Rappelons que l'tude du climat ncessite d'avoir une longue srie d'observation en un point
donn. Mais il est trs rare d'avoir plus d'une observation pour exactement la mme position.
Pour remdier ce problme, on travaille par "carrs" dlimits par des parallles et des
mridiens. Ainsi le carr correspond une station "fixe" bien que les observations qui y sont
effectues sont ralises par des observateurs diffrents sur des stations mobiles diffrentes
et en des intervalles de temps irrguliers.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 23/43
IV. La veille mtorologique la Direction de la mtorologie nationale
du Maroc
La veille sur lvolution de ltat de latmosphre, la protection de lenvironnement, la
scurit des personnes et des biens, lefficacit et la rentabilit de nombreuses activits
sensibles aux conditions mtorologiques, exigent toutes une gamme de services
mtorologiques. Pour pouvoir fournir ces services, la DMN est oblige de disposer des
donnes dobservation ncessaires, ainsi que danalyses et de prvisions pour diverses
chelles (de lchelle locale lchelle globale) et diffrentes chances (de la prvision
pour limmdiat la prvision longue chance). Le programme de la Veille
Mtorologique Mondiale (VMM) est une entreprise internationale concerte conue pour
rassembler et diffuser, lchelle du globe, cette information mtorologique indispensable
laquelle tous les pays peuvent avoir accs.
Le systme mondial dobservation (SMO) a pour but de fournir des donnes
dobservation normalises et de qualit, en provenance de toutes les parties du monde, pour
la prparation danalyses, de prvisions et davis mtorologiques et dapporter un appui
dautres programmes de lOMM (Organisation Mondiale de la Mtorologie) et aux
programmes pertinents dautres organisations internationales. Il sagit dun systme
composite regroupant divers moyens pour lobservation en mer, sur terre et dans
latmosphre des lments mtorologiques et dautres paramtres relatifs
lenvironnement.
Par ailleurs, de par ses caractristiques gographiques, le climat du Maroc a
plusieurs composantes. Sa caractrisation nen est que plus complexe. Si au Sud quelques
stations peuvent suffire, tant donne luniformit orographique, il en va autrement pour le
nord. Les chanes montagneuses impriment aux diffrents paramtres mtorologiques, une
importante variabilit spatiale.
Rseau dobservation
mondial
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 24/43
IV.1. Etat du rseau national du Maroc: ( la date 2001)
Le rseau se compose dun rseau de base principal (rseau synoptique) et dun
rseau de soutien auxiliaire (rseau climatologique). Le rseau synoptique se distingue du
rseau climatologique par sa gestion directe par la DMN, aussi bien en terme de ressources
humaines que financires, par le nombre dinstruments de mesure et par la frquence de la
mesure.
Le rseau synoptique se
compose de 44 stations dont
* 5 quipes de radars, Rseau des
* 5 quipes de stations stations
automatiques, d'observation
* 4 font la mesure en altitude, 5
effectuent des mesures maritimes,
* 12 des mesures radiomtriques,
* 2 dotes des moyens de mesure de
pollution de fond
* et une pour la mesure dozone.
41 Stations Synoptiques
4 Stations Maritimes
3 Stations radiosondage
5 Stations Radar
2 Stations pollution de Fond
Le rseau climatologique est compos de 528 postes:
* 432 pluviomtres,
* 44 de type C1 (pluviomtre et mesure des tempratures minimale et maximale),
* 20 de type C2 (C1+relevs de lhumidit 07 heures et 18 heures),
* 24 de type C3 (C2+relev de lhumidit 13 heures)
* et 8 de type C4 (C3+enregistreurs et instruments spciaux).
La DMN y contribue par linstrumentation et le contrle a posteriori des donnes. La gestion
est assure par dautres organismes: Ministre de l'Agriculture, Ministre de l'Intrieur,
Ministre de l'Equipement, etc...
La constitution, la gestion et la consistance spatiale du rseau dobservation
appellent quelques remarques:
Si au nord dEl Jadida le rseau est relativement dense, au sud de celle ci, dans la
montagne et lest du pays, il est peu reprsentatif, voire inexistant.
Lusage des stations automatiques est peu dvelopp, il pourrait rsoudre le problme
de couverture des rgions accs difficile et rpondre aux besoins dusagers exigeant
des informations relatives ces zones.
Quelques stations synoptiques sont envahies par lurbanisme, ce qui influence leurs
conditions de servitude qui doivent rpondre aux normes de lOMM.
Manuel du cours de Climatologie . par : Said EL KHATRI 25/43
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours AeroportsDocument57 pagesCours AeroportsalbanPas encore d'évaluation
- Design Patterns Design PatternsDocument44 pagesDesign Patterns Design PatternsABDELHAK BENTOUISPas encore d'évaluation
- Météorologie Et Climatologie - CoursDocument16 pagesMétéorologie Et Climatologie - CoursOLAHANMI Charafa67% (3)
- 00017381Document865 pages00017381pdfal100% (1)
- Sans TitreDocument52 pagesSans TitreHamathPas encore d'évaluation
- ClimatologieDocument105 pagesClimatologieBen Marzoug Faouzi100% (2)
- Chapitre 2 Sur Les Plaques TechtoniquesDocument4 pagesChapitre 2 Sur Les Plaques TechtoniquesAbbyRondinPas encore d'évaluation
- Introduction À La Climatologie GénéraleDocument30 pagesIntroduction À La Climatologie Généraleremacin1Pas encore d'évaluation
- La Télédétection Radar À Haute Résolution SpatialeDocument36 pagesLa Télédétection Radar À Haute Résolution SpatialeSedar Dech100% (1)
- Projet Sig Et Télédetection District D'el HammamDocument23 pagesProjet Sig Et Télédetection District D'el Hammamoussama najibPas encore d'évaluation
- Géomorpho3 Séances 2Document9 pagesGéomorpho3 Séances 2YiiiPas encore d'évaluation
- Chap 4 - Cours Machinerie Thermique-2Document2 pagesChap 4 - Cours Machinerie Thermique-2Ayadi Boushila100% (1)
- Présentation GéologieDocument9 pagesPrésentation GéologieAnia Brg100% (1)
- Cours - Tecto - Globale (Mode de Compatibilité)Document59 pagesCours - Tecto - Globale (Mode de Compatibilité)Abdelilah Ait IchouPas encore d'évaluation
- Exemple Phenomenes ClimatiquesDocument34 pagesExemple Phenomenes ClimatiquesAsmaa KasmiPas encore d'évaluation
- Geodynamique Interne Cours 07Document41 pagesGeodynamique Interne Cours 07Ebou Mo7amedPas encore d'évaluation
- Volume 7Document106 pagesVolume 7Youssef EnnajmyPas encore d'évaluation
- Guide Des Projets DNH Mali v14Document185 pagesGuide Des Projets DNH Mali v14sosi2020Pas encore d'évaluation
- Livre LittoralCoteIvoire POTTIER-ANOH PDFDocument328 pagesLivre LittoralCoteIvoire POTTIER-ANOH PDFYao Monou Constant Kodjo0% (1)
- Les Formations Superficielles Et Les Risque AnthropiquesDocument19 pagesLes Formations Superficielles Et Les Risque Anthropiquesislem.naitsaidiPas encore d'évaluation
- Teledetection PrincipesetapplicationsDocument81 pagesTeledetection Principesetapplicationsoumar traorePas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document6 pagesChapitre 1Mohamed MahmoudPas encore d'évaluation
- Memoire - M - Kesse - V31 (1) 2Document70 pagesMemoire - M - Kesse - V31 (1) 2WabdanPas encore d'évaluation
- Géomorpho 0'Document25 pagesGéomorpho 0'NBPas encore d'évaluation
- Plan de Cours de Notions de GeologieDocument5 pagesPlan de Cours de Notions de GeologiePierrot LongaPas encore d'évaluation
- Érosion PDFDocument94 pagesÉrosion PDFbali100% (2)
- Initiation A La Climatologie Et A LDocument29 pagesInitiation A La Climatologie Et A LJordan AzédiéPas encore d'évaluation
- Elément de GéologieDocument48 pagesElément de GéologieChota ChrifPas encore d'évaluation
- Petro Magm FinalDocument42 pagesPetro Magm FinalEmmanuel KomboziPas encore d'évaluation
- (CoursSNA3 Géomorphologie (Compatibility Mode) )Document39 pages(CoursSNA3 Géomorphologie (Compatibility Mode) )Myr IdaasPas encore d'évaluation
- La GeophysiqueDocument5 pagesLa GeophysiqueDaanouni RaniaPas encore d'évaluation
- 2014 FrancaisDocument3 pages2014 FrancaisKatcha nanklan enock hiliPas encore d'évaluation
- 2007-2008 Corrige Examen Session de RattrapageDocument2 pages2007-2008 Corrige Examen Session de Rattrapagesumalee100% (1)
- Rapport TalemboteDocument12 pagesRapport TalembotejoefmPas encore d'évaluation
- These Samir Kamel 2007Document230 pagesThese Samir Kamel 2007Mohamed NasrPas encore d'évaluation
- Chapitre3 - Les PrécipitationsDocument24 pagesChapitre3 - Les PrécipitationsNOUSIMPas encore d'évaluation
- Les Temps Geologiques PDFDocument13 pagesLes Temps Geologiques PDFMustafa Mostafa100% (1)
- ManuelRuddyLelouche 1Document90 pagesManuelRuddyLelouche 1Benjamin Taïki TenonePas encore d'évaluation
- Rapport de Stage de Mvouti - Pour Fusion 001Document24 pagesRapport de Stage de Mvouti - Pour Fusion 001Maxinho Janvier DushimePas encore d'évaluation
- Economie Des Ressources NaturellesDocument48 pagesEconomie Des Ressources NaturellesEsaie MwanzaPas encore d'évaluation
- Cours Geologie Du Quaternaire St3b 2015Document88 pagesCours Geologie Du Quaternaire St3b 2015Kamel RegayaPas encore d'évaluation
- TP HydrologieDocument14 pagesTP HydrologieMerlin NgouaraPas encore d'évaluation
- Cours de ClimatologieDocument15 pagesCours de Climatologiekanoukone4Pas encore d'évaluation
- Bioclimatologie USTHB PDFDocument57 pagesBioclimatologie USTHB PDFKhaled NaasPas encore d'évaluation
- Cours l2 Issgea Teledetection - 014138Document42 pagesCours l2 Issgea Teledetection - 014138Geril Christ HOUMBAPas encore d'évaluation
- 3 Géomorphologie Dynamique 2021 2022 1erpartieDocument32 pages3 Géomorphologie Dynamique 2021 2022 1erpartieNouhayla El KcPas encore d'évaluation
- Cours Géodynamique ExterneDocument100 pagesCours Géodynamique ExterneJoe AbdPas encore d'évaluation
- Faille de GafsaDocument228 pagesFaille de GafsaABDERRAOUF BEN MILEDPas encore d'évaluation
- Fin Memoir 1Document33 pagesFin Memoir 1Bounoumar Dia100% (1)
- Les VolcansDocument3 pagesLes VolcansYahi asma100% (1)
- Géographie de La PopulationDocument10 pagesGéographie de La Populationabdoulaye cissePas encore d'évaluation
- Gravimetrie Terrestre SBonvalotDocument145 pagesGravimetrie Terrestre SBonvalotFranck BitaPas encore d'évaluation
- StratigraphieDocument35 pagesStratigraphieMAX KAYLE50% (2)
- Programme ArcgisDocument2 pagesProgramme ArcgisGhislainPas encore d'évaluation
- Module Geologie Pour L - IngénieurDocument135 pagesModule Geologie Pour L - IngénieurjustinoPas encore d'évaluation
- ClimatologieDocument105 pagesClimatologieilias2003Pas encore d'évaluation
- 4-5-Domaines Dapplication de La TélédétectionDocument3 pages4-5-Domaines Dapplication de La TélédétectioncoulibalyPas encore d'évaluation
- La Terre, sa formation et sa constitution actuelleD'EverandLa Terre, sa formation et sa constitution actuellePas encore d'évaluation
- La terre et la lune forme extérieure et structure interneD'EverandLa terre et la lune forme extérieure et structure internePas encore d'évaluation
- Des risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscamingueD'EverandDes risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscaminguePas encore d'évaluation
- Études sur la géologie, la paléontologie et l'ancienneté de l'homme: Le département de Lot-et-GaronneD'EverandÉtudes sur la géologie, la paléontologie et l'ancienneté de l'homme: Le département de Lot-et-GaronnePas encore d'évaluation
- Denver CR 718 FrenchDocument9 pagesDenver CR 718 FrenchPrankPas encore d'évaluation
- Objectifs: A. Formateurs Et CoordinationDocument2 pagesObjectifs: A. Formateurs Et Coordinationi.assoumani09Pas encore d'évaluation
- Tempète 99 Influence Stat Ventvortrag - Christian - SacreDocument9 pagesTempète 99 Influence Stat Ventvortrag - Christian - SacrecoedhilPas encore d'évaluation
- Sujet ProjetDocument8 pagesSujet ProjetAmine IsaadPas encore d'évaluation
- Interface MatlabDocument32 pagesInterface MatlabMoh Abd BenPas encore d'évaluation
- Recherche Dht11Document4 pagesRecherche Dht11Selma AttabaPas encore d'évaluation
- Etude Et Exploitation Du Gisement Eolien Pour Le Pompage D Eau en Milieu SteppiqueDocument13 pagesEtude Et Exploitation Du Gisement Eolien Pour Le Pompage D Eau en Milieu SteppiquemauricetappaPas encore d'évaluation
- Composantes Pour Mesurer Les Paramètres MétéorologiquesDocument12 pagesComposantes Pour Mesurer Les Paramètres MétéorologiquesOmar Ben SmailPas encore d'évaluation
- Mémoire-2022 Compressed CompressedDocument62 pagesMémoire-2022 Compressed CompressedMirana LalatianaPas encore d'évaluation
- Dimensionnement D'un Reseau de Station MeteorologiqueDocument3 pagesDimensionnement D'un Reseau de Station Meteorologiquehenripaolo65Pas encore d'évaluation
- Contrôle de La Salinité PDFDocument9 pagesContrôle de La Salinité PDFAnonymous M0tjyWPas encore d'évaluation
- Mode Demploi 672633 Station Meteo Radiopilotee Numerique Techno Line Ws 9032 ItDocument16 pagesMode Demploi 672633 Station Meteo Radiopilotee Numerique Techno Line Ws 9032 ItStaff Health ICRC AmePas encore d'évaluation
- Guidelines Data Management FRDocument66 pagesGuidelines Data Management FRhbouaouliPas encore d'évaluation
- Mode D'emploi Station MétéoDocument3 pagesMode D'emploi Station MétéoMomocheTrouadec100% (1)
- TDR Etudes de Faisabilite Parc Solaire Burkina Faso MaliDocument75 pagesTDR Etudes de Faisabilite Parc Solaire Burkina Faso MaliEric DondebzangaPas encore d'évaluation
- FR WS900Document138 pagesFR WS900Yu ZhangPas encore d'évaluation
- Cours SmoDocument63 pagesCours SmoBoumediene NawelPas encore d'évaluation
- Eijelkamp Gestion de L'irrigationDocument12 pagesEijelkamp Gestion de L'irrigationAnonymous M0tjyWPas encore d'évaluation
- CatalogueDocument15 pagesCatalogueFlorent DesobriPas encore d'évaluation
- 04-StationMeteo-Partie 1Document12 pages04-StationMeteo-Partie 1karaPas encore d'évaluation
- Libble EuDocument45 pagesLibble EuMichel GiustinaPas encore d'évaluation
- Generalites Sur Les CapteursDocument37 pagesGeneralites Sur Les Capteurskpea chris dylanPas encore d'évaluation
- Cours CSPDocument281 pagesCours CSPAyoub HaijPas encore d'évaluation
- Station MeteoDocument123 pagesStation Meteolaurent13013Pas encore d'évaluation
- La Crosse WS7394 Manual FRDocument7 pagesLa Crosse WS7394 Manual FRJose ArrozalesPas encore d'évaluation
- Chacon 54230 Weather StationDocument2 pagesChacon 54230 Weather Stationmanuel querolPas encore d'évaluation
- MasterielDocument1 pageMasterielYoucef BonyPas encore d'évaluation
- Plaquette Capteur Meteo EmbarqueDocument1 pagePlaquette Capteur Meteo Embarquekirian.meyerPas encore d'évaluation