Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Averroès
Averroès
Transféré par
Nadia Pitura RjibaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Averroès
Averroès
Transféré par
Nadia Pitura RjibaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Averroès
Ibn Rushd est né en 1126, alors que l’empire Almoravide était en passe de disparaître.
Avant l’avènement des Almohades en 1147, l’empire Almoravide était en proie à des conflits
de sectes qui ont marqué la jeunesse du philosophe. Le retour de la paix avec l’avènement
des Almohades a marqué profondément le philosophe. Dans son commentaire des Lois de
Platon, qu’il a rédigé à la fin de sa vie, il a adressé des louanges au régime almohade, qui, à
la différence de celui des almoravides, avait su sauvegarder la paix. En 1153 environ, alors
qu’il est à Marrakech, il est présenté par Ibn Tufayl au sultan almohade. Celui-ci lui demande
d’entreprendre un commentaire de l’ensemble de l'œuvre d’Aristote. C’est à partir de ce
moment que Ibn Rushd commence sa carrière intellectuelle et se lie de façon très étroite à
l’autorité almohade. En effet, il a exercé des fonctions de cadi presque toute sa vie.
Le Discours décisif n’est pas un texte philosophique à proprement parler. Ibn Rushd
s’adresse à son lectorat en tant que cadi. Il veut les convaincre de l’innocuité de la
philosophie. Ibn Rushd distingue trois types de discours : 1/ le discours rhétorique, qui
emploie des figures de style comme la métaphore, pour faciliter l’édification de la foule ; 2/ le
discours dialectique, qui est le domaine privilégié des théologiens, qui vont au-delà du sens
littéral du texte coranique et s’efforcent de percer le sens caché ; 3/ le discours démonstratif,
qui est le propre des philosophes péripatéticiens, qui maîtrisent l’art du syllogisme. Chaque
type de discours est donc associé à un type de personne.
Pour Ibn Rushd, le discours démonstratif jouit d’une autonomie vis-à-vis du Coran. À la
différence de la dialectique théologienne, le discours rationnel et démonstratif ne s’appuie
pas sur la Révélation. Celle-ci sert d’aiguillon à la recherche démonstrative, en tant que le
Coran encourage la quête du savoir scientifique, mais elle ne contribue pas à la construction
du savoir à proprement parler. Tout comme le discours démonstratif, le discours dialectique
jouit lui aussi d’une certaine autonomie. En fait, aucun des trois types de discours n’a le droit
d’empiéter sur le domaine des autres. Les théologiens n’ont pas le droit de récuser les
thèses philosophiques, comme a prétendu le faire Al-Ghazali, puisqu’ils ne maîtrisent pas
l’art du syllogisme (la syllogistique).
Cette délimitation des domaines est réciproque, c’est-à-dire que les philosophes eux aussi
n’ont pas le droit d’empiéter sur le domaine des théologiens. En effet, cela répondrait le
scepticisme parmi les théologiens et ceux-ci le répandraient à leur tour dans la foule. Les
théologiens n’ont pas le droit d’exposer publiquement leurs thèses, puisque la foule ne
saisirait que la réfutation du sens obvie du Coran, sans pour autant en saisir le sens caché
qui est dévoilé par la dialectique. Ibn Rushd s’oppose donc à la fois aux malikites
almoravides (théologiens) qui souhaitent imposer leurs thèses à tous qu’à Ibn Tamut, le
fondateur de l’Almohadisme, qui souhaitait imposer à tous un régime de connaissance
rationnelle (ce à quoi ne peut atteindre la foule).
Le Discours décisif a donc été rédigé par Ibn Rushd pour deux raisons : 1/ établir
l’autonomie de la philosophie vis-à-vis de tous les autres types de discours, en montrant
qu’elle ne présente aucun danger à l’ordre établi et 2/ proposer une solution aux conflits
inhérents entre les sectes en montrant que chaque type de discours jouit de sa propre
sphère d’autonomie sur laquelle personne n’a le droit d’empiéter.
Vous aimerez peut-être aussi
- Dictionnaire de la Théologie chrétienne: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire de la Théologie chrétienne: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Soufisme D' Ibn Khaldun PDFDocument287 pagesLe Soufisme D' Ibn Khaldun PDFAboumyriam Abdelrahmane100% (2)
- Le Livre D'or de L'alchimieDocument319 pagesLe Livre D'or de L'alchimieSiehi Toh Servais85% (13)
- Al Hujwiri - Somme Spirituelle (Kashf Al-Mahjub) Éd. Sinbad (1988) 2 PDFDocument479 pagesAl Hujwiri - Somme Spirituelle (Kashf Al-Mahjub) Éd. Sinbad (1988) 2 PDFKeba Jamdong75% (4)
- 177 Rumi Contes SoufisDocument244 pages177 Rumi Contes SoufisPatrickLeCosmologiste100% (3)
- Les Derviches Tourneurs Chap1 RUMIDocument66 pagesLes Derviches Tourneurs Chap1 RUMIbenzaky100% (1)
- Averroès Et L'averroïsmeDocument292 pagesAverroès Et L'averroïsmekaouthar chebbiPas encore d'évaluation
- La Cosmogonie D'urantia (Livre Entier) Traduction Version 1961 J.WeissDocument2 200 pagesLa Cosmogonie D'urantia (Livre Entier) Traduction Version 1961 J.WeissPierre Girard94% (18)
- Associe Martiniste Premier PasDocument56 pagesAssocie Martiniste Premier PasKalvaster René100% (11)
- Commun, P (Ed.) - L'ordolibéralisme Allemand - Aux Sources de L'économie Sociale de Marché PDFDocument275 pagesCommun, P (Ed.) - L'ordolibéralisme Allemand - Aux Sources de L'économie Sociale de Marché PDFSimón RamírezPas encore d'évaluation
- Le Stoicisme, Le Bonheur Et La LibertéDocument4 pagesLe Stoicisme, Le Bonheur Et La LibertéClara Vergoz100% (3)
- Razi - Lawami' (Traité Sur Les Noms Divins)Document671 pagesRazi - Lawami' (Traité Sur Les Noms Divins)iskandar1984100% (3)
- Averroès (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandAverroès (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de la Philosophie médiévale: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire de la Philosophie médiévale: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La TerminologieDocument200 pagesLa TerminologieAndrei100% (1)
- Kardec Allan Recueil de Prières Et D'instructions Sprites MjysDocument42 pagesKardec Allan Recueil de Prières Et D'instructions Sprites Mjysledrogo100% (1)
- Abou Hamid Al-Ghazali - Le Tabernacle Des LumièresDocument52 pagesAbou Hamid Al-Ghazali - Le Tabernacle Des LumièresismaelPas encore d'évaluation
- Wahdat Al-Wujud Vs Wahdat-Al-Shuhud Debate PDFDocument35 pagesWahdat Al-Wujud Vs Wahdat-Al-Shuhud Debate PDFAnonymous MnbKE367% (3)
- La Révolte Des Masses by José Ortega y Gasset, José-Luis Goyena, Louis ParrotDocument316 pagesLa Révolte Des Masses by José Ortega y Gasset, José-Luis Goyena, Louis ParrotldlmffslmqPas encore d'évaluation
- Chefs-'oeuvre de la Civilisation Islamique LE DÉVOILEMENT DES IGNOMINIES GRECOUES ET LES ASPERSIONS PAR DE PIEUX CONSEILS: Par Shihab al-Din' Umar Ibn Muhammad al SuhrawardiD'EverandChefs-'oeuvre de la Civilisation Islamique LE DÉVOILEMENT DES IGNOMINIES GRECOUES ET LES ASPERSIONS PAR DE PIEUX CONSEILS: Par Shihab al-Din' Umar Ibn Muhammad al SuhrawardiPas encore d'évaluation
- (Etudes Traditionnelles - Islam FR) - Pierre Lory - Qu'est-Ce Qu'une Langue SacréeDocument8 pages(Etudes Traditionnelles - Islam FR) - Pierre Lory - Qu'est-Ce Qu'une Langue SacréeRoger MayenPas encore d'évaluation
- Histoire de La Philosophique Is Inconnue PDFDocument223 pagesHistoire de La Philosophique Is Inconnue PDFBaptiste verrey100% (1)
- Alain de Libera = Averrأ²es, le trouble-fأھteDocument17 pagesAlain de Libera = Averrأ²es, le trouble-fأھteMadjid PhiloPas encore d'évaluation
- Des Noms DivinsDocument5 pagesDes Noms Divinsmariane_romaoPas encore d'évaluation
- Titus Burckhardt - Introduction Aux Doctrines Ésotériques de L'islamDocument193 pagesTitus Burckhardt - Introduction Aux Doctrines Ésotériques de L'islamDIALLO AMADOU100% (1)
- F AngéologieDocument29 pagesF AngéologieBernard Djino100% (2)
- Titus Burckhardt - Introduction Aux Doctrines Ésotériques de L'islamDocument193 pagesTitus Burckhardt - Introduction Aux Doctrines Ésotériques de L'islamDIALLO AMADOUPas encore d'évaluation
- Ibn 'Atâ' Allâh. La Sagesse Des Maîtres SoufisDocument4 pagesIbn 'Atâ' Allâh. La Sagesse Des Maîtres SoufisJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Biographie de VoltaireDocument3 pagesBiographie de VoltaireOuazzani Khalid100% (1)
- Denis GRIL Esoterisme Contre Heresie Abd Al Rahman Al Bistami Un Representant de La Science Des Lettres A Bursa PDFDocument14 pagesDenis GRIL Esoterisme Contre Heresie Abd Al Rahman Al Bistami Un Representant de La Science Des Lettres A Bursa PDFludovic1970100% (3)
- Premices de La Theologie Musulmane (Josef Van Ess) (Z-Library)Document171 pagesPremices de La Theologie Musulmane (Josef Van Ess) (Z-Library)trofouPas encore d'évaluation
- Catalogue 2021 Nouveauté WebDocument58 pagesCatalogue 2021 Nouveauté WebJack NapierPas encore d'évaluation
- Le Chemin UniverselDocument59 pagesLe Chemin Universelkabballerodelagruta100% (2)
- Al GhazaliDocument10 pagesAl GhazaliArou N'a100% (2)
- Averroes 20oct09 PDFDocument55 pagesAverroes 20oct09 PDFMorpheus OuattPas encore d'évaluation
- Liste Des 100 Logiciens Majeurs Du Patrimoine Islamique, Leurs Contributions, Leurs Œuvres - EkDocument40 pagesListe Des 100 Logiciens Majeurs Du Patrimoine Islamique, Leurs Contributions, Leurs Œuvres - EkCryptopher KPas encore d'évaluation
- Dictionnaire du Moyen Âge, littérature et philosophie: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire du Moyen Âge, littérature et philosophie: Les Dictionnaires d'UniversalisÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La Discrimination À L'embauche: La Situation Actuelle en BelgiqueDocument88 pagesLa Discrimination À L'embauche: La Situation Actuelle en Belgiquelawman69Pas encore d'évaluation
- SoufismeDocument8 pagesSoufismeJuliette Beaudequin-ScholtenPas encore d'évaluation
- Denis GRIL, Esotérisme Contre Hérésie Abd Al-Rahmân Al-Bistâmî Un Représentant de La Science Des Lettres À Bursa.Document14 pagesDenis GRIL, Esotérisme Contre Hérésie Abd Al-Rahmân Al-Bistâmî Un Représentant de La Science Des Lettres À Bursa.Hassan Turini100% (1)
- RicoeurDocument74 pagesRicoeurBreak Focus100% (1)
- La Philosophie en AfriqueDocument5 pagesLa Philosophie en AfriqueDavePas encore d'évaluation
- Les Miroirs Des Princes Islamiques: Une Modernité Sourde ?Document18 pagesLes Miroirs Des Princes Islamiques: Une Modernité Sourde ?lukasesanePas encore d'évaluation
- Discours Islam PDFDocument41 pagesDiscours Islam PDFSalahddin KhalilPas encore d'évaluation
- Giorgio Agamben, Joël Gayraud Lusage Des Corps Homo Sacer, IV, 2Document395 pagesGiorgio Agamben, Joël Gayraud Lusage Des Corps Homo Sacer, IV, 2John O'sheaPas encore d'évaluation
- Fabrizio PREGADIO, Liu Yiming - Superior Virtue, Inferior VirtueDocument39 pagesFabrizio PREGADIO, Liu Yiming - Superior Virtue, Inferior VirtueyieldsPas encore d'évaluation
- Apologie Du Soufisme Par Un Philosophe S PDFDocument34 pagesApologie Du Soufisme Par Un Philosophe S PDFOuiza AghrivPas encore d'évaluation
- Article - Les Soufis Et Le Soufisme Selon Ibn Taymiyya 11-02Document46 pagesArticle - Les Soufis Et Le Soufisme Selon Ibn Taymiyya 11-02Arou N'aPas encore d'évaluation
- Ibn Rochd Averroes Lhomme de Tous Les SaDocument28 pagesIbn Rochd Averroes Lhomme de Tous Les SaAhmed KabilPas encore d'évaluation
- ZZZ 4Document3 pagesZZZ 4Karl ZinsouPas encore d'évaluation
- Ibnkhaldoun 2 PDFDocument11 pagesIbnkhaldoun 2 PDFzbimboPas encore d'évaluation
- ZZZ 4Document2 pagesZZZ 4Karl ZinsouPas encore d'évaluation
- Exposé Guillaume D'ockham. LakaseDocument13 pagesExposé Guillaume D'ockham. LakaseDei VerbumPas encore d'évaluation
- Averroes Discours DecisifDocument3 pagesAverroes Discours DecisifPierre-AlexandrePas encore d'évaluation
- L'Influence Mu Tazilite Sur La Naissance Et Le Développement de La Rhétorique ArabeDocument23 pagesL'Influence Mu Tazilite Sur La Naissance Et Le Développement de La Rhétorique ArabeSo BouPas encore d'évaluation
- Grandes Figures Islam (57 - 776)Document4 pagesGrandes Figures Islam (57 - 776)tozzi.monicaPas encore d'évaluation
- Islam - Coran - Averroès Et L'occident PDFDocument5 pagesIslam - Coran - Averroès Et L'occident PDFIsmaelPas encore d'évaluation
- Qayyim La Médecine PhoniqueDocument7 pagesQayyim La Médecine Phoniquebabagang03Pas encore d'évaluation
- Ibn AbbadDocument13 pagesIbn Abbadbenyeah100% (1)
- MA Thode Contra Le Souffle PDFDocument7 pagesMA Thode Contra Le Souffle PDFArt Fang ArifPas encore d'évaluation
- CORBIN - Islamisme Et Religion Arabie - 1964 - Num - 77 - 73 - 18209Document9 pagesCORBIN - Islamisme Et Religion Arabie - 1964 - Num - 77 - 73 - 18209Ulisse SantusPas encore d'évaluation
- Dialnet LlullEtLalteriteCulturelle 174908Document8 pagesDialnet LlullEtLalteriteCulturelle 174908yahya23morePas encore d'évaluation
- Al-Ghazali - WikipédiaDocument28 pagesAl-Ghazali - WikipédiaAbrahamPas encore d'évaluation
- Projet OLIF CNRS Abd El Kader Ecrits SPDocument4 pagesProjet OLIF CNRS Abd El Kader Ecrits SPyann nguessanPas encore d'évaluation
- 1.les Lumières - 1ère AnnéeDocument5 pages1.les Lumières - 1ère AnnéeTamara Taska ZajicPas encore d'évaluation
- Philosophie Lumieres Islam I QueDocument26 pagesPhilosophie Lumieres Islam I QueRabo Magagi AboubacarPas encore d'évaluation
- Livre Methode PDFDocument5 pagesLivre Methode PDFAli KhaledPas encore d'évaluation
- Meftah - Unicité Du Tempignage Et de L'existenceDocument28 pagesMeftah - Unicité Du Tempignage Et de L'existenceTur111100% (1)
- Raymond LULLE, Le Livre Du Gentil Et Des Trois SagesDocument6 pagesRaymond LULLE, Le Livre Du Gentil Et Des Trois SageslakborgeniePas encore d'évaluation
- Lévi Jean - L'art de La PersuasionDocument42 pagesLévi Jean - L'art de La PersuasionzhoulyhuiPas encore d'évaluation
- Lislam A Livre Ouvert Penser Les Divisio PDFDocument18 pagesLislam A Livre Ouvert Penser Les Divisio PDFNadir IrmcPas encore d'évaluation
- Naples BOUCHIBA Farid Ibadism Napoli 1Document32 pagesNaples BOUCHIBA Farid Ibadism Napoli 1Ayman UchihaPas encore d'évaluation
- ITA Texspi 01Document0 pageITA Texspi 01arbahimPas encore d'évaluation
- Le Soufisme Et Les Soufis Selon Ibn Taymiyya 28-06-2011Document47 pagesLe Soufisme Et Les Soufis Selon Ibn Taymiyya 28-06-2011aboufirdaws aboufirdawsPas encore d'évaluation
- Lunyu [LOUEN-YU] (Entretiens de Confucius) (anonyme): Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLunyu [LOUEN-YU] (Entretiens de Confucius) (anonyme): Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Philosophie Et Sciences Sociales, Qu'est-Ce Que La Sociologie Et À Quoi Peut-Elle Bien Servir ?Document7 pagesPhilosophie Et Sciences Sociales, Qu'est-Ce Que La Sociologie Et À Quoi Peut-Elle Bien Servir ?Cassandra PAYETPas encore d'évaluation
- Philo InhumainDocument2 pagesPhilo InhumainLouison ConanPas encore d'évaluation
- Les Traités Alchymiques - Feuille 1Document3 pagesLes Traités Alchymiques - Feuille 1Muet D'hiversPas encore d'évaluation
- Argument Cosmologique KalamDocument56 pagesArgument Cosmologique KalamMoustapha SYPas encore d'évaluation
- Culture Commune Versus Émancipation Les Effets Pervers de La Canonisation Des Auteurs PhilosophiquesDocument17 pagesCulture Commune Versus Émancipation Les Effets Pervers de La Canonisation Des Auteurs PhilosophiquesTérence PELLEGRINIPas encore d'évaluation
- Les Voyages - Rêves Et Réalités - Vers Une Philoso - 230213 - 070945Document24 pagesLes Voyages - Rêves Et Réalités - Vers Une Philoso - 230213 - 070945Jonas Magalhães LopesPas encore d'évaluation
- Respeth 52 DiaDocument26 pagesRespeth 52 DiaAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Hadji Charles LEvaluation Regles Du JeuDocument5 pagesHadji Charles LEvaluation Regles Du Jeumav4tarPas encore d'évaluation
- Fiche N°1: Sujet: Correction: Problématique: PlanDocument3 pagesFiche N°1: Sujet: Correction: Problématique: PlanAHMAT Hassan GorimiPas encore d'évaluation
- Transposition DidactiqueDocument2 pagesTransposition DidactiqueAchraf BennaniPas encore d'évaluation
- Naturalité BienDocument32 pagesNaturalité BienLe Comte de BronzePas encore d'évaluation
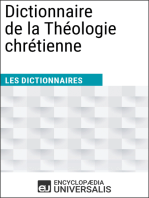









































































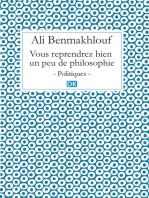
![Lunyu [LOUEN-YU] (Entretiens de Confucius) (anonyme): Les Fiches de Lecture d'Universalis](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/503686000/149x198/cf36ef99b2/1677012145?v=1)










