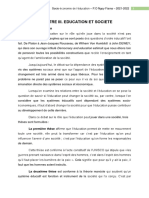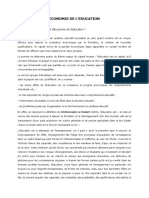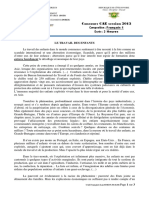Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Monde Vendredi 17 Février Article 1
Transféré par
paloma morenoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Monde Vendredi 17 Février Article 1
Transféré par
paloma morenoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Monde 17/02/2023 10(08
Le déclassement des profs vu par six ex-ministres de
l’éducation
De gauche à droite : Jack Lang, reçoit des enfants au ministère pour la
Fête de la musique, le 21 juin 2000. Luc Ferry visite le lycée professionnel
Gaspard-Monge, à Savigny-sur-Orge (Essonne), le 15 novembre 2002.
Najat Vallaud-Belkacem dans une classe de l’école Emile-Charcot, à Blois,
le 9 octobre 2015. JACK GUEZ/AFP ; PIERRE VERDY/AFP ; GUILLAUME SOUVANT/AFP
Sylvie Lecherbonnier et Violaine Morin
Lang, Ferry, de Robien, Peillon, Hamon, Vallaud-Belkacem… Des
anciens locataires de la Rue de Grenelle analysent le décrochage du
métier d’enseignant alors qu’en quelques décennies leur
rémunération a plongé
A
u début des années 1980, un enseignant débutant gagnait l’équivalent de 2,3 fois le
smic. Cette rémunération est tombée à 1,2 fois le salaire minimum début 2022. Cette
statistique révèle, à elle seule, le déclassement subi par les enseignants. Comment
expliquer ce décrochage salarial et symbolique ? Pourquoi les professeurs ont-ils
dégringolé dans la hiérarchie sociale et comment expliquer qu’aucune action
publique d’envergure n’ait été engagée pour enrayer le phénomène ?
Pour le comprendre – alors que Pap Ndiaye travaille sur une revalorisation « historique »
promise par le chef de l’Etat que beaucoup jugent déjà décevante –, Le Monde a posé la
question à tous les anciens ministres de l’éducation nationale depuis trois décennies. Six ont
accepté de nous faire part de leur expérience : Jack Lang (avril 1992-mars 1993, sous François
Mitterrand et mars 2000-mai 2002, sous Jacques Chirac), Luc Ferry (mai 2002-mars 2004, sous
Jacques Chirac), Gilles de Robien (juin 2005-mai 2007, sous Jacques Chirac), Vincent Peillon
(mai 2012-avril 2014, sous François Hollande), Benoît Hamon (avril-août 2014, sous François
https://journal.lemonde.fr/data/2723/reader/reader.html?t=1676623552436#!preferred/0/package/2723/pub/3806/page/10/alb/158590 Page 1 sur 5
Le Monde 17/02/2023 10(08
Hollande) et Najat Vallaud-Belkacem (août 2014 -mai 2017, sous François Hollande). Aucun des
ministres de Nicolas Sarkozy n’a souhaité répondre, pas plus que Jean-Michel Blanquer,
ministre du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.
Des mesures, d’ampleur différente, ont été prises par les différents locataires de l’Hôtel de
Rochechouart. Mais elles n’ont jamais permis de rattraper le décrochage salarial qui s’est
installé, et avec lui, la perte d’attractivité du métier. Pour ces anciens ministres, la nécessité
d’une revalorisation salariale apparaît aujourd’hui comme une « évidence ». « La
revalorisation sociale et symbolique reviendrait si la dévalorisation financière n’était pas
aussi dévastatrice », juge ainsi Luc Ferry. Et le jeu, pointent les anciens ministres, en vaut la
chandelle. « Une école qui fonctionne constitue une vraie dépense d’investissement pour un
pays : sa compétitivité réside tout de même dans la formation des citoyens », estime Vincent
Peillon.
Benoît Hamon met en avant une sorte de double peine pour les enseignants. Ils voient leurs
revenus s’effriter en même temps que leur rôle leur apparaît plus étriqué. Selon lui, c’est
d’abord parce que la réduction des inégalités n’est plus le sujet central, et que « le métier s’en
trouve dévitalisé ». « Si les enseignants n’ont plus l’impression de contribuer à changer le
destin, à quoi bon se lever le matin ? », explique-t-il.
Entre les salaires et les postes, il faut choisir
Comment en est-on arrivé là ? La dernière grande revalorisation a été mise en place par Lionel
Jospin en 1989, pour accompagner la transformation du corps des instituteurs en celui de
professeurs des écoles. Ensuite, la question salariale est passée au second plan car les
enseignants du premier degré ont gagné, dans cette réforme, de forts acquis salariaux. Jack
Lang s’en souvient : « Au début des années 2000, la question des salaires ne se posait pas. Le
dossier important, c’était les emplois. » Il propose alors la mise en œuvre d’un plan
pluriannuel de recrutement de 185 000 enseignants, qui s’arrêtera avec la réélection de
Jacques Chirac en 2002. Le sujet reprend progressivement de l’importance dans les années
2000, et surtout après 2010, alors que le métier d’enseignant, désormais accessible à bac +5,
entre en concurrence avec d’autres emplois de niveau cadre.
Le choix cornélien entre création de postes – quand il ne s’agit pas d’en supprimer – et
augmentation des salaires est particulièrement criant au cours de la mandature de François
Hollande. Lors de la campagne électorale, le socialiste avait promis 60 000 emplois
d’enseignants supplémentaires.
« Je suis arrivé après le quinquennat Sarkozy, pendant lequel près de 80 000 postes avaient
été supprimés, une demi-journée de travail enlevée aux élèves et la formation des
enseignants tronquée, rappelle Vincent Peillon, devenu en 2012 le premier ministre de
l’éducation du quinquennat Hollande. Le chantier auquel je devais m’atteler, dans une France
relativement indifférente, était d’une ampleur inouïe. » Mais « la politique définit toujours la
hiérarchie des urgences », ajoute l’ancien ministre, et la création des 60 000 postes promis
par le président Hollande « grévait » l’argent disponible pour augmenter les salaires. Vincent
Peillon reconnaît s’être enlisé dans la réforme des rythmes scolaires, toujours primordiale à
ses yeux. Afin de donner « du temps scolaire de qualité » aux élèves, elle prévoyait le retour à
la semaine de quatre jours et demi. « Il aurait certainement fallu donner un peu d’argent aux
enseignants en contrepartie », estime le philosophe aujourd’hui.
Le gouvernement socialiste a payé le prix de l’impopularité de cette réforme : « On m’a donné
des moyens, mais beaucoup ont considéré que les réformes que je mettais en œuvre
déstabilisaient le pays. Que se sont dit les responsables à ce moment-là ? Que l’école était un
puits sans fond. Qu’on avait voulu bien faire, qu’on avait mis un type compétent, qu’on lui
avait donné beaucoup d’argent et que malgré tout, ça n’allait pas. Il y a eu une espèce de
découragement, qui nous a coûté très cher politiquement. »
A d’autres époques, il a surtout fallu supprimer des postes. Luc Ferry, aux manettes entre 2002
et 2004, le concède. « On m’a demandé, pour des raisons d’affichage libéral de droite, de
https://journal.lemonde.fr/data/2723/reader/reader.html?t=1676623552436#!preferred/0/package/2723/pub/3806/page/10/alb/158590 Page 2 sur 5
Le Monde 17/02/2023 10(08
supprimer des postes sans faire de réformes structurelles au préalable. Ce qui était
parfaitement absurde. » Najat Vallaud-Belkacem tempère cependant ce dilemme entre
créations de postes et revalorisation salariale, car la qualité de vie au travail est également un
facteur majeur d’attractivité : « Il faut aussi un nombre suffisant d’adultes dans
l’établissement scolaire, pour permettre par exemple de ne pas monter au-dessus de 35 élèves
par classe. »
Les professeurs victimes de leur impopularité
Les ministres de l’éducation nationale que nous avons interrogés racontent la difficulté de
faire du statut et de la rémunération des professeurs une priorité. Dans les équilibres
gouvernementaux, d’une part, mais aussi au sein d’un ministère où l’attention se focalise sur
les savoirs et les apprentissages. Gilles de Robien dit ainsi n’avoir eu que très peu de marge
d’action sur ce sujet, absorbé qu’il était par la mise en œuvre de la loi Fillon et de son socle
commun de connaissances et de compétences, en 2005. L’ancien ministre l’a assumé dans son
discours de passation de pouvoir avec Xavier Darcos en 2007, en offrant cette perspective : « Je
crois à une amélioration qualitative du statut des enseignants et en particulier de leur
rémunération. C’est ce que j’ai commencé à faire, modestement. Il faudra poursuivre. »
Tous rapportent le combat permanent pour faire exister cette priorité. « Il faudrait augmenter
la rémunération des enseignants, c’est une évidence absolue, reconnaît Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de 2014 à 2017. Mais dans les faits, je vous assure que ce n’est pas si simple.
A l’égard de Bercy, des parlementaires, comme de l’opinion publique. » L’ancienne ministre se
souvient ainsi du poids de l’opinion dans les arbitrages, alors que celle-ci n’est pas toujours
favorable aux professeurs, loin s’en faut.
« L’idée s’était installée que les enseignants ne faisaient pas ce qu’on attendait d’eux, ou qu’ils
n’en faisaient pas assez », rapporte-t-elle, en rappelant l’importance du « prof-bashing », cette
« dynamique quasi sociétale », qui ne se cantonne pas à « quelques esprits chagrins
conservateurs ». Les parents d’élèves, plus éduqués qu’autrefois, sont « tendus par les enjeux
de la réussite scolaire et du poids des diplômes » et reportent leurs angoisses sur les
professeurs avec un moindre respect. « L’opinion publique n’a jamais été convaincue
qu’augmenter les enseignants était une priorité », conclut Najat Vallaud-Belkacem.
Elle se souvient avoir « rapidement fait l’objet de critiques » quand il s’est agi de négocier le
protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), un
dispositif visant à mieux gérer la carrière des fonctionnaires, doté de près d’un milliard
d’euros pour l’éducation nationale – et reporté d’un an à l’arrivée d’Emmanuel Macron au
pouvoir, en 2017. « Apparemment, je faisaisune fleur au corps professoral », s’agace-t-elle
aujourd’hui. « Mais on ne peut pas se plaindre que les professeurs sont mal payés par rapport
à la moyenne de l’OCDE et en même temps nous reprocher de faire des cadeaux », s’énerve-t-
elle.
Des « batailles homériques » avec Bercy
Dans le rapport de force visant à donner la priorité aux enseignants, les anciens ministres
décrivent tous des « batailles homériques », selon les mots de Najat Vallaud-Belkacem, avec le
ministère de l’économie. Défendre le premier budget de la nation se révèle une mission à
plein temps, car augmenter – même très peu – près d’un million de fonctionnaires représente
des budgets colossaux. « L’éducation nationale est un ministère d’emplois, confirme Jack
Lang. Trop souvent, on n’a pas donné aux ministres les crédits à la hauteur de ce qu’il fallait. »
L’ancien ministre dit avoir pu compter sur ses conseillers budgétaires, Richard Descoings et
Frédéric Mion – devenus tous les deux directeurs de Sciences Po après – pour « se bagarrer »
avec Bercy et avoir l’appui de Matignon et de l’Elysée.
« Peu de monde défendait les priorités de l’éducation nationale », confirme Benoît Hamon,
éphémère locataire de la Rue de Grenelle qui se souvient d’un Emmanuel Macron, alors
secrétaire général adjoint de l’Elysée, demandant sans cesse des réductions de budget. « La
https://journal.lemonde.fr/data/2723/reader/reader.html?t=1676623552436#!preferred/0/package/2723/pub/3806/page/10/alb/158590 Page 3 sur 5
Le Monde 17/02/2023 10(08
doxa budgétaire était omniprésente, dénonce l’ancien ministre. On nous répondait que les
enseignants étaient trop nombreux, ou on nous reprochait d’ouvrir la boîte de Pandore : si on
augmentait les profs, tous les autres allaient réclamer… » Najat Vallaud-Belkacem se souvient
d’avoir réussi à « arracher » au premier ministre, au cours d’un voyage en avion, la création de
l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE), toujours versée aujourd’hui aux
professeurs du premier degré. « Construire son budget est un exercice de proactivité, mais
c’est aussi un exercice de défense, ajoute-t-elle. Bercy revient très régulièrement à la charge, de
toutes les façons possibles, pour essayer de vous reprendre de l’argent. »
Les contreparties, un point sensible
Alors qu’Emmanuel Macron propose un « pacte » aux enseignants – qui doit permettre aux
volontaires de gagner davantage en échange de missions supplémentaires –, la question des
contreparties ne fait pas consensus chez les anciens ministres. Il faut dire que la bataille pour
la revalorisation de 1989 a laissé des traces : à cette époque, Lionel Jospin a reculé sur les
contreparties un temps proposées pour « travailler autrement » et a signé un accord sans ce
donnant-donnant. Une évidence, selon Jack Lang : « Faire le lien entre les salaires et
l’organisation de l’école et de la pédagogie est ressenti de manière négative, et à juste titre, par
les enseignants. »
Gilles de Robien, lui, a organisé des voyages d’études avec les syndicats en Suède, en Belgique
et en Autriche, pour « voir comment les maîtres étaient formés, combien d’heures ils
faisaient, combien d’élèves il y avait par classe, comment les professeurs étaient rémunérés ».
Il évoque alors l’idée de se baser sur la moyenne européenne pour améliorer ces différents
indicateurs. Si l’idée a fait long feu, il assume avoir plaidé pour que la hausse des
rémunérations s’accompagne d’un temps de présence plus important dans les
établissements. « Les enseignants peuvent alors plus facilement avoir des discussions
informelles avec les élèves et comprendre leur situation et leurs difficultés », estime-t-il, en
nuançant toutefois : cette proposition n’est « plus entendable » dans le contexte actuel, où le
salaire des enseignants a fortement décroché.
Luc Ferry aussi a pensé à différencier les rémunérations sans pouvoir réaliser son projet,
« coincé entre un président qui n’avait qu’un objectif, surtout pas de vagues, et une gauche
qui n’avait pas digéré d’avoir été obligée de voter pour lui pour éviter Jean-Marie Le Pen » . Le
philosophe aurait aimé « régionaliser le capes » et proposer à la sortie du concours un double
statut : les uns auraient conservé l’horaire et le salaire de base, les autres auraient connu « une
augmentation substantielle » contre un temps de travail rallongé de quelques heures. « Les
jeunes professeurs auraient eu le choix en fonction de leur vie familiale, de leurs aspirations
et de leurs besoins », détaille Luc Ferry.
L’impossible consensus autour de la formation des maîtres
Autre levier : la formation des enseignants. Les anciens ministres reviennent sur cet enjeu
majeur pour l’attractivité, source d’inépuisables réformes et d’un consensus impossible. Les
instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), créés en 1990 par Lionel Jospin, ont
été maintes fois réformés. Sous François Fillon, en 2005, ils intègrent les universités. La
mastérisation, décidée en 2008 par Nicolas Sarkozy et mise en place en 2010, vient supprimer
l’année de stage. En 2013, Vincent Peillon ferme les IUFM pour créer les écoles supérieures du
professorat et de l’éducation (ESPE), qui deviendront les instituts nationaux supérieurs du
professorat et de l’éducation (Inspé) sous Jean-Michel Blanquer. A chaque fois, la place du
concours et la part donnée à la formation didactique – par opposition à l’académique – font
débat.
Les effets de la mastérisation – l’entrée dans le métier à bac +5 après un master –, même si elle
n’est pas remise en cause, sont largement décriés. « Donner à penser qu’on améliorerait le
système en recrutant les profs au niveau master est une formidable escroquerie », commente
Jack Lang. Pour lui, c’est une certitude : pour changer l’école, « il faut transformer le système
de formation des maîtres ». « Mon plus grand regret ? Les difficultés qu’ont connues les
https://journal.lemonde.fr/data/2723/reader/reader.html?t=1676623552436#!preferred/0/package/2723/pub/3806/page/10/alb/158590 Page 4 sur 5
Le Monde 17/02/2023 10(08
ESPE », confie Vincent Peillon, persuadé lui aussi que « l’effet maître » est primordial. « Toutes
les études le montrent, insiste-t-il. Un système qui réussit est un système où le maître est bien
dans sa peau, heureux de faire ce métier, avec les outils institutionnels, pédagogiques, pour
bien agir. » Pour l’ancien ministre, « avec une véritable formation professionnelle des
enseignants du premier degré, on peut faire beaucoup pour les enseignants et pour les
élèves ».
Pour travailler sur l’attractivité du métier, l’ancien socialiste a expérimenté les « emplois
d’avenir professeur » pour les étudiants boursiers. Ce programme permettait à des jeunes de
deuxième et troisième années de licence et de première année de master d’occuper un emploi
à temps partiel dans une école, douze heures par semaine en moyenne, afin d’intégrer le
métier en douceur. Avec un succès mitigé : moins de 8 000 contrats signés. « La réalisation
n’a pas été à la hauteur des ambitions, en raison de salaires trop bas et d’un accueil compliqué
au sein des établissements scolaires », reconnaît Vincent Peillon. « Mais construire ce type de
pré-recrutement permet d’attirer des jeunes qui n’ont pas toujours les moyens de faire des
études, surtout depuis l’obligation d’un bac +5 pour entrer dans la carrière », met-il en avant.
Une boussole politique qui a le tournis
L’histoire de l’éducation nationale est jalonnée de ces ordres et contre-ordres, et bien sûr
d’alternances. A l’exception de Jean-Michel Blanquer, resté tout un quinquennat Rue de
Grenelle, la longévité moyenne d’un ministre de l’éducation depuis le début des années 2000
est d’environ deux ans. « Le temps politique n’est pas le temps de l’éducation nationale et c’est
un gros handicap, estime Gilles de Robien. Le ministre, parce qu’il change souvent, est peu
considéré, écouté ou suivi. Dans la tête des enseignants, il fait des réformes mais peut-être
que le suivant prônera l’inverse… alors ne nous y mettons pas tout de suite ! »
Des phases où la priorité est de « restaurer la confiance » succèdent à des périodes de tension,
souvent en lien avec des suppressions de postes. « J’ai été confronté à une certaine colère, plus
ou moins justifiée et légitime, témoigne Jack Lang, arrivé après le passage fracassant de
Claude Allègre à l’éducation nationale. On m’a demandé d’être celui qui redonnerait aux
professeurs et aux élèves de la considération. Il m’a fallu dans un premier temps redonner de
la confiance. » Il en a tiré une certaine philosophie : « Les bonnes idées peuvent tomber dans
les limbes si on ne trouve pas le chemin pour atteindre le cœur des principaux intéressés,
explique-t-il. Le ministre doit payer de sa personne, donner des gages. Les rapports humains
comptent beaucoup. »
Redonner confiance, c’est aussi la mission confiée à Pap Ndiaye après un quinquennat où la
colère des enseignants s’est cristallisée sur la personne de Jean-Michel Blanquer. Mais les
alternances en elles-mêmes provoquent souvent un changement de cap, y compris quand les
ministres qui se succèdent sont du même bord. En son temps, et dès son arrivée Rue de
Grenelle, Xavier Darcos avait abrogé un décret très contesté sur le temps de service des
enseignants, pris par son prédécesseur Gilles de Robien.
Pour ce dernier, aujourd’hui président du conseil d’orientation de l’Ileri, une école supérieure
privée, l’école devrait faire l’objet d’un consensus politique, qui lui fait cruellement défaut
aujourd’hui. « Il faudrait redéfinir ses missions, ses moyens, mettre d’accord l’ensemble de la
classe politique et les grands spécialistes. Et ensuite, laisser au moins dix ans pour la mise en
œuvre et la mesure des résultats. »
https://journal.lemonde.fr/data/2723/reader/reader.html?t=1676623552436#!preferred/0/package/2723/pub/3806/page/10/alb/158590 Page 5 sur 5
Vous aimerez peut-être aussi
- Guide pratique de l'école primaire et maternelle en Belgique: Guide pratique à l'usage des parentsD'EverandGuide pratique de l'école primaire et maternelle en Belgique: Guide pratique à l'usage des parentsPas encore d'évaluation
- Nouvelle gouvernance scolaire: Impacts sur l'agir des professionnels de l'enseignementD'EverandNouvelle gouvernance scolaire: Impacts sur l'agir des professionnels de l'enseignementPas encore d'évaluation
- Le Monde Vendredi 17 Février Article 2 PDFDocument2 pagesLe Monde Vendredi 17 Février Article 2 PDFpaloma morenoPas encore d'évaluation
- Dossier Sur La Démission Des Enseignant.e.sDocument24 pagesDossier Sur La Démission Des Enseignant.e.sAudio TeamPas encore d'évaluation
- Frank Kangwande Mbale Capital Humain Et La CroissanceDocument61 pagesFrank Kangwande Mbale Capital Humain Et La Croissancembale kangwandePas encore d'évaluation
- Impact de Formation Sur Rendement C3a9ducatifDocument109 pagesImpact de Formation Sur Rendement C3a9ducatifعبداللهبنزنوPas encore d'évaluation
- Formation Des Enseignants - Un Projet de Réforme Hors Sol Et Inquiétant - Le ClubDocument3 pagesFormation Des Enseignants - Un Projet de Réforme Hors Sol Et Inquiétant - Le ClubbenjaminlpePas encore d'évaluation
- Dissertation SociologieDocument5 pagesDissertation SociologieRobinPas encore d'évaluation
- Histoire Du Sport :CM-1989-2005-T.BELIERDocument12 pagesHistoire Du Sport :CM-1989-2005-T.BELIERcolombierPas encore d'évaluation
- Thème 122 - L'ascenseur SocialDocument20 pagesThème 122 - L'ascenseur SocialMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Ries 4527Document197 pagesRies 4527Melehe SiluePas encore d'évaluation
- Chapitre 4. La JeunesseDocument10 pagesChapitre 4. La JeunesseFaustine LeclercqPas encore d'évaluation
- Antoine BoulangéDocument28 pagesAntoine BoulangélesempecheursdenseignerenrangPas encore d'évaluation
- E SES SpécialitéDocument10 pagesE SES SpécialitéLetudiant.fr100% (1)
- Thème2 - L'ascenseur SocialDocument20 pagesThème2 - L'ascenseur SocialMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- M2R Sarah Gustin2008 PDFDocument130 pagesM2R Sarah Gustin2008 PDFIl Principio CarinoPas encore d'évaluation
- SOcio-économie de L'education. PO Ngoy FyamaDocument12 pagesSOcio-économie de L'education. PO Ngoy FyamaFlay Parker KimbaPas encore d'évaluation
- Vol10N2 Art4Document20 pagesVol10N2 Art4Israël BaraPas encore d'évaluation
- Exposé Sur L - Échec ScolaireDocument7 pagesExposé Sur L - Échec ScolaireMahama GbanePas encore d'évaluation
- Chapitre 6. Term Élève 2021 Quelle Est L'action de L'école Sur Les Destins Individuels Et Sur L'évolution de La SociétéDocument28 pagesChapitre 6. Term Élève 2021 Quelle Est L'action de L'école Sur Les Destins Individuels Et Sur L'évolution de La SociétéAzhar ElachkariPas encore d'évaluation
- 10.TTU, L01, S01, TD 10. Savoir Relever Les Mots Clés (II), 2023 2024Document1 page10.TTU, L01, S01, TD 10. Savoir Relever Les Mots Clés (II), 2023 2024Mãnãl MembPas encore d'évaluation
- Capes de Maths Niveau QCM de Collège Les Raisons Du SinistreDocument1 pageCapes de Maths Niveau QCM de Collège Les Raisons Du SinistreGuillaume Prigent100% (1)
- Gestion de L'education 14 OctobreDocument14 pagesGestion de L'education 14 OctobreJosée WorrallPas encore d'évaluation
- Réforme de La Voie ProfessionnelleDocument1 pageRéforme de La Voie ProfessionnellevlahopoulosPas encore d'évaluation
- Pourquoi Nos Enfants Sortent-Ils de L'ec - Patrick MoreauDocument154 pagesPourquoi Nos Enfants Sortent-Ils de L'ec - Patrick Moreauche_valier100% (1)
- Baccalaureat ES SES Obligatoire CompletDocument7 pagesBaccalaureat ES SES Obligatoire Completdaoudadem558Pas encore d'évaluation
- L'insertion Des Jeunes Sans DiplômeDocument113 pagesL'insertion Des Jeunes Sans DiplômeCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- FDL2 - Einstein Avait Raison, Il Faut Réduire Le Temps de Travail - Ghislaine Sanchez-MartinDocument14 pagesFDL2 - Einstein Avait Raison, Il Faut Réduire Le Temps de Travail - Ghislaine Sanchez-Martinboumaazajamal829Pas encore d'évaluation
- Etude Marché - EcolededevoirsDocument81 pagesEtude Marché - EcolededevoirsHugues BocquetPas encore d'évaluation
- SES Chapitre 3 - SociologieDocument13 pagesSES Chapitre 3 - Sociologiehoussen dzoPas encore d'évaluation
- 2014 FrancaisDocument3 pages2014 FrancaisKatcha nanklan enock hiliPas encore d'évaluation
- DS 2h Structure Soc Sujet ADocument3 pagesDS 2h Structure Soc Sujet AAsli BostanciPas encore d'évaluation
- Bac 2019 SES ObligatoireDocument8 pagesBac 2019 SES ObligatoireLETUDIANTPas encore d'évaluation
- Ch08 p218 Textes-ConvertiDocument14 pagesCh08 p218 Textes-ConvertiGødwìn ÅmouzouPas encore d'évaluation
- Le Monde - PacteDocument3 pagesLe Monde - Pactefalza ratorPas encore d'évaluation
- Expose de FrançaisDocument10 pagesExpose de FrançaisGONTOH CampbelPas encore d'évaluation
- SpeechDocument6 pagesSpeechRejeton AnathPas encore d'évaluation
- Macron Met Les Lycées Professionnels Au Service Des Entreprises MediapartDocument3 pagesMacron Met Les Lycées Professionnels Au Service Des Entreprises MediapartProut HihiPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 Comment Est Structurée La Société Française ActuelleDocument8 pagesChapitre 6 Comment Est Structurée La Société Française Actuellewhhvtytb85Pas encore d'évaluation
- Enseignement Supérieur, Capital Humain Et Croissance Économique: Une Approche Par L'analyse CausaleDocument26 pagesEnseignement Supérieur, Capital Humain Et Croissance Économique: Une Approche Par L'analyse CausaleBennaceur ThamiPas encore d'évaluation
- Chap 3.1Document12 pagesChap 3.1Jeanne-AurorePas encore d'évaluation
- ECONOMIE DE L - (Enregistré Automatiquement) - CopieDocument18 pagesECONOMIE DE L - (Enregistré Automatiquement) - CopieRakotoarimino SantatraPas encore d'évaluation
- Métiers D'avenir Au BéninDocument36 pagesMétiers D'avenir Au Bénincedric GOHOUEDEPas encore d'évaluation
- Journal ScolaireDocument19 pagesJournal ScolaireRami Khalid0% (2)
- 1 - PEDER Guide Pratique Education de Base Non Formelle Et Insertion Economique Des JeunesDocument32 pages1 - PEDER Guide Pratique Education de Base Non Formelle Et Insertion Economique Des Jeunessaid etebbaiPas encore d'évaluation
- Support 06Document12 pagesSupport 06Chahine BergaouiPas encore d'évaluation
- Cours Magistral JLDocument81 pagesCours Magistral JLAssiaaPas encore d'évaluation
- Cours de PPEDocument12 pagesCours de PPEFOTSING TACUNE LEONEL DUTROCHETPas encore d'évaluation
- ZDDocument5 pagesZDhiiamchiPas encore d'évaluation
- Les Inégalités en Classes Préparatoires, Par Jean-Marie VouembaDocument17 pagesLes Inégalités en Classes Préparatoires, Par Jean-Marie VouembaTelecomParisTechPas encore d'évaluation
- Le Capital Humain - Comment Le Savoir Détermine Notre Vie (Les Essentiels de l'OCDE) (PDFDrive)Document164 pagesLe Capital Humain - Comment Le Savoir Détermine Notre Vie (Les Essentiels de l'OCDE) (PDFDrive)hamzajou66Pas encore d'évaluation
- 2013 Francais PDFDocument3 pages2013 Francais PDFKatcha nanklan enock hiliPas encore d'évaluation
- Ibrahim Ben Khajjou - Seance 04Document2 pagesIbrahim Ben Khajjou - Seance 04صناع المحتوى - Makers Content Team.Pas encore d'évaluation
- Égalité Professionnelle Entre Les Femmes Et Les HommesDocument20 pagesÉgalité Professionnelle Entre Les Femmes Et Les HommesTheLookinesisPas encore d'évaluation
- Qu'apprend-On À L'ena?: La Fabrique de Nos Élites A 60 AnsDocument10 pagesQu'apprend-On À L'ena?: La Fabrique de Nos Élites A 60 AnsФранц КафкаPas encore d'évaluation
- Choc Des Savoirs Le Collège AbaisséDocument4 pagesChoc Des Savoirs Le Collège AbaissébenjaminlpePas encore d'évaluation
- MéthodologieDocument7 pagesMéthodologieYahia AchourPas encore d'évaluation
- La gestion des ressources humaines pour la réussite scolaire, 2e éditionD'EverandLa gestion des ressources humaines pour la réussite scolaire, 2e éditionÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Instruire, corriger, guérir?: Les orthopédagogues, l'adaptation scolaire et les difficultés d'apprentissage au Québec, 1950-2017D'EverandInstruire, corriger, guérir?: Les orthopédagogues, l'adaptation scolaire et les difficultés d'apprentissage au Québec, 1950-2017Pas encore d'évaluation
- Enseigner aujourd'hui: Du choix de la carrière aux premières années dans le métierD'EverandEnseigner aujourd'hui: Du choix de la carrière aux premières années dans le métierPas encore d'évaluation