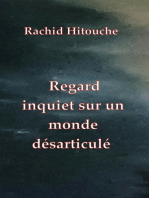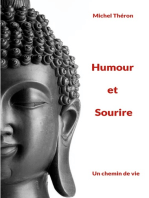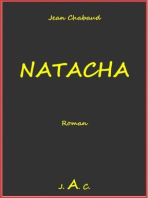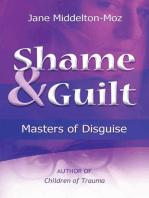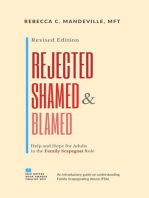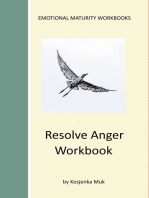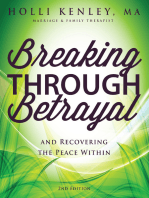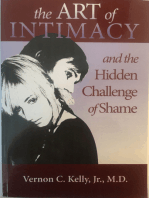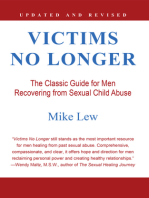Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sartre, La Honte, Plus Tournier Tout Seul
Transféré par
bhardhamu0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues1 pageTitre original
Sartre, la honte, plus Tournier tout seul
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues1 pageSartre, La Honte, Plus Tournier Tout Seul
Transféré par
bhardhamuDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 1
J’ai honte de ce que je suis.
La honte réalise donc une relation intime de moi avec
moi : j’ai découvert par la honte un aspect de mon être. Et pourtant, bien que certaines formes
complexes et dérivées de la honte puissent apparaître sur le plan réflexif, la honte n’est pas
originellement un phénomène de réflexion. En effet, quels que soient les résultats que l’on
puisse obtenir dans la solitude par la pratique religieuse de la honte, la honte dans sa structure
première est honte devant quelqu’un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire : ce
geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement. Mais voici tout à coup que
je lève la tête : quelqu’un était là et m’a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et
j’ai honte. Il est certain que ma honte n’est pas réflexive, car la présence d’autrui à ma
conscience, fût-ce à la manière d’un catalyseur, est incompatible avec l’attitude réflexive :
dans le champ de ma réflexion, je ne puis jamais rencontrer que la conscience qui est mienne.
Or autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même : j’ai honte de moi tel que
j’apparais à autrui. Et, par l’apparition même d’autrui, je suis mis en mesure de porter un
jugement sur moi-même comme sur un objet, car c’est comme objet que j’apparais à autrui.
Mais pourtant cet objet apparu à autrui, ce n’est pas une vaine image dans l’esprit d’un autre.
Cette image en effet serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me « toucher ». Je
pourrais ressentir de l’agacement, de la colère en face d’elle, comme devant un mauvais
portrait de moi, qui me prête une laideur ou une bassesse d’expression que je n’ai pas ; mais je
ne saurais être atteint jusqu’aux moelles : la honte est, par nature, reconnaissance. Je
reconnais que je suis comme autrui me voit.
Sartre, L’Être et le Néant, Gallimard, Tel, pp. 265-266.
A Speranza, il n’y a qu’un point de vue, le mien, dépouillé de toute virtualité. Et ce
dépouillement ne s’est pas fait en un jour. Au début, par un automatisme inconscient, je
projetais des observateurs possibles – des paramètres – au sommet des collines, derrière tel
rocher ou dans les branches de tel arbre. L’île se trouvait ainsi quadrillée par un réseau
d’interpolations et d’extrapolations qui la différenciait et la douait d’intelligibilité. Ainsi fait
tout homme normal dans une situation normale. Je n’ai pris conscience de cette fonction –
comme de bien d’autres – qu’à mesure qu’elle se dégradait en moi. Aujourd’hui, c’est chose
faite. Ma vision de l’île est réduite à elle-même. Ce que je n’en vois pas est un inconnu
absolu. Partout où je ne suis pas actuellement règne une nuit insondable. Je constate d’ailleurs
en écrivant ces lignes que l’expérience qu’elles tentent de restituer non seulement est sans
précédent, mais contrarie dans leur essence même les mots que j’emploie. Le langage relève
en effet d’une façon fondamentale de cet univers peuplé où les autres sont comme autant de
phares créant autour d’eux un îlot lumineux à l’intérieur duquel tout est – sinon connu – du
moins connaissable. Les phares ont disparu de mon champ. Nourrie par ma fantaisie, leur
lumière est encore longtemps parvenue jusqu’à moi. Maintenant, c’en est fait, les ténèbres
m’environnent.
Et ma solitude n’attaque pas que l’intelligibilité des choses. Elle mine jusqu’au
fondement même de leur existence. De plus en plus, je suis assailli de doutes sur la véracité
du témoignage de mes sens. Je sais maintenant que la terre sur laquelle mes deux pieds
appuient aurait besoin pour ne pas vaciller que d’autres que moi la foulent. Contre l’illusion
d’optique, le miracle, l’hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de
l’audition... le rempart le plus sûr, c’est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi,
mais quelqu’un, grands dieux, quelqu’un !
Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique (1967), Gallimard, « Folio », p.
53-55.
Vous aimerez peut-être aussi
- Cause Libre CorpusDocument4 pagesCause Libre CorpusNana VérifPas encore d'évaluation
- Itinéraires d'un enfant perdu: Ou comment j'ai traversé le siècleD'EverandItinéraires d'un enfant perdu: Ou comment j'ai traversé le sièclePas encore d'évaluation
- C. G. Jung Souvenirs, Rêves Et PenséesDocument544 pagesC. G. Jung Souvenirs, Rêves Et Penséeszordzema100% (6)
- Ecce Homo 1888 de NietzscheDocument69 pagesEcce Homo 1888 de Nietzscheali boucettaPas encore d'évaluation
- Stephen Jourdain - Cette Vie M'aime - Postface de Jean Paulhan (1962)Document42 pagesStephen Jourdain - Cette Vie M'aime - Postface de Jean Paulhan (1962)Holomun100% (2)
- Le Paysan de Paris - Préface À Une Mythologie Moderne Et Passage de L'opéraDocument22 pagesLe Paysan de Paris - Préface À Une Mythologie Moderne Et Passage de L'opéraJérémy Grenier-SpéroniPas encore d'évaluation
- Pierre Simon Ballanche - La Ville Des Expiations - Livre VIIDocument45 pagesPierre Simon Ballanche - La Ville Des Expiations - Livre VIIlapointe gabrielPas encore d'évaluation
- Cioran - de L'inconvenient D'etre NeDocument22 pagesCioran - de L'inconvenient D'etre NeCheval LaomaPas encore d'évaluation
- L'Experience Interieure - Georges BatailleDocument160 pagesL'Experience Interieure - Georges Batailletchouang_zu86% (7)
- Résumé en 250 MotsDocument2 pagesRésumé en 250 MotsIbrahim TaPas encore d'évaluation
- De L'âmeDocument76 pagesDe L'âmeHelmutVonKartoffelPas encore d'évaluation
- VALÉRY, Paul. Introduction à La Méthode de Léonard Da Vinci.Document148 pagesVALÉRY, Paul. Introduction à La Méthode de Léonard Da Vinci.Walisson OliveiraPas encore d'évaluation
- Philolog: La Conscience de Soi Est-Elle Une Connaissance de Soi?Document18 pagesPhilolog: La Conscience de Soi Est-Elle Une Connaissance de Soi?Love BabaPas encore d'évaluation
- Munier Roger Le Visiteur Qui Jamais Ne VientDocument37 pagesMunier Roger Le Visiteur Qui Jamais Ne VientJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Blanchot - L'Espace Littéraire - AnnexesDocument19 pagesBlanchot - L'Espace Littéraire - Annexesruttiger57Pas encore d'évaluation
- La Recherche de Soi Diaporama Les Métamorphoses Du MoiDocument20 pagesLa Recherche de Soi Diaporama Les Métamorphoses Du MoilyblancPas encore d'évaluation
- Emmanuelle Prie - Le Duc EsoDocument138 pagesEmmanuelle Prie - Le Duc EsoDispo Optimo100% (1)
- Caresse Erotisme FémininDocument2 pagesCaresse Erotisme FémininStéphane ChampiéPas encore d'évaluation
- Miller Jacques Alain Un Début Dans La VieDocument156 pagesMiller Jacques Alain Un Début Dans La Viespring_into_dadaPas encore d'évaluation
- Contes de l'homme-cauchemar - Tome 1: Recueil de contesD'EverandContes de l'homme-cauchemar - Tome 1: Recueil de contesPas encore d'évaluation
- Ex StasisDocument32 pagesEx StasisMarko TasićPas encore d'évaluation
- La Conscience - Cours TerminaleDocument16 pagesLa Conscience - Cours TerminaleMilkyWayPas encore d'évaluation
- Pouvoirs de L'horreur Essai SurDocument240 pagesPouvoirs de L'horreur Essai SurCésar Andrés Paredes100% (1)
- Assumer L AbductionDocument21 pagesAssumer L AbductionFuzzywuzzyxPas encore d'évaluation
- L Énergie DivineDocument274 pagesL Énergie DivinesantseteshPas encore d'évaluation
- Georges Bataille SacrificesDocument11 pagesGeorges Bataille SacrificesDidi4lifePas encore d'évaluation
- Voyages de L'espritDocument75 pagesVoyages de L'espritphilippe.zanottiPas encore d'évaluation
- Raison UnivDocument251 pagesRaison Univvictor bigoy100% (1)
- Suis Je Ce Que J Ai Conscience D EtreDocument6 pagesSuis Je Ce Que J Ai Conscience D EtreJPas encore d'évaluation
- Husserl I Levy BruhlDocument15 pagesHusserl I Levy BruhltwerkterPas encore d'évaluation
- Comment Antonin Artaud Me RésonneDocument32 pagesComment Antonin Artaud Me RésonneL. SiLPas encore d'évaluation
- DescartesDocument31 pagesDescartesNaïm BoudjemaPas encore d'évaluation
- Experience Music 4th Edition Charlton Solutions ManualDocument23 pagesExperience Music 4th Edition Charlton Solutions ManualKimberlySerranocrpo100% (50)
- Merleau Ponty - Loeil Et Lesprit - Extraits PDFDocument12 pagesMerleau Ponty - Loeil Et Lesprit - Extraits PDFIla FornaPas encore d'évaluation
- Merleau-Ponty - Extrait de L'Œil Et L'espritDocument57 pagesMerleau-Ponty - Extrait de L'Œil Et L'espritkairotic100% (3)
- Foucault Le Corps UtopiqueDocument5 pagesFoucault Le Corps UtopiqueBruntnobrzucha Miłośniczka RosyPas encore d'évaluation
- Testament de L'egoDocument36 pagesTestament de L'egoLucien RakotonPas encore d'évaluation
- Cixous, H. La Venue A L'ecritureDocument32 pagesCixous, H. La Venue A L'ecritureGustavo Bustos Gajardo100% (3)
- In-Former Ruth NahoumDocument4 pagesIn-Former Ruth NahoumJ RPas encore d'évaluation
- Epictète, Trouver Le Sens Des MotsDocument1 pageEpictète, Trouver Le Sens Des MotsbhardhamuPas encore d'évaluation
- Je Suis Conduit À Regarder La Parure Comme Un Des Signes de La Noblesse Primitive de LDocument1 pageJe Suis Conduit À Regarder La Parure Comme Un Des Signes de La Noblesse Primitive de LbhardhamuPas encore d'évaluation
- Epictète, Trouver Le Sens Des Mots 2Document1 pageEpictète, Trouver Le Sens Des Mots 2bhardhamuPas encore d'évaluation
- Calendrier Nature BRDocument23 pagesCalendrier Nature BRbhardhamuPas encore d'évaluation
- Mon Jardin Au NaturelDocument17 pagesMon Jardin Au NaturelbhardhamuPas encore d'évaluation
- Fiche Rousseau Contrat SocialDocument10 pagesFiche Rousseau Contrat SocialbhardhamuPas encore d'évaluation
- 2016 11 22 AAB Guide EbenisterieDocument23 pages2016 11 22 AAB Guide EbenisteriebhardhamuPas encore d'évaluation
- Guide JardinDocument16 pagesGuide JardinbhardhamuPas encore d'évaluation
- Fiche Platon PhèdreDocument4 pagesFiche Platon Phèdrebhardhamu100% (1)
- Guide Entretien Ecologique PelouseDocument2 pagesGuide Entretien Ecologique PelousebhardhamuPas encore d'évaluation
- Fiche Platon RépubliqueDocument20 pagesFiche Platon RépubliquebhardhamuPas encore d'évaluation
- Vidal Rosset IntuitionismeDocument5 pagesVidal Rosset IntuitionismebhardhamuPas encore d'évaluation
- Les Multinationales, Des Pouvoirs Souverains Privés. Le Cas de Total - Observatoire Des MultinationalesDocument11 pagesLes Multinationales, Des Pouvoirs Souverains Privés. Le Cas de Total - Observatoire Des MultinationalesbhardhamuPas encore d'évaluation
- Fiche Platon SophisteDocument5 pagesFiche Platon SophistebhardhamuPas encore d'évaluation
- Bibliothèque IdéaleDocument1 pageBibliothèque IdéalebhardhamuPas encore d'évaluation
- Pascal Chabot Arche Des PhenomenologuesDocument12 pagesPascal Chabot Arche Des PhenomenologuesbhardhamuPas encore d'évaluation
- Systeme de Logique 1Document145 pagesSysteme de Logique 1bhardhamuPas encore d'évaluation
- Grille D'Évaluation de Stage 2 AnnéeDocument1 pageGrille D'Évaluation de Stage 2 Annéelouise marnetPas encore d'évaluation
- Resume MTUDocument3 pagesResume MTUSARAH LADJEMILPas encore d'évaluation
- De La Ruptura La AwarenessDocument36 pagesDe La Ruptura La Awarenessdragos - valentin tataPas encore d'évaluation
- Définition de Situation D'intégrationDocument3 pagesDéfinition de Situation D'intégrationYesguer Samah100% (4)
- NotesDocument32 pagesNotesHas NahPas encore d'évaluation
- Jean-Louis Baudry, Dispositif Cineì MatographiqueDocument27 pagesJean-Louis Baudry, Dispositif Cineì MatographiqueOn DinePas encore d'évaluation
- Techniques Pour Prendre Des NotesDocument217 pagesTechniques Pour Prendre Des NotesArabicuser Youcef100% (2)
- 4 5920112857004903586Document169 pages4 5920112857004903586bernice nenkamPas encore d'évaluation
- Exposé Psychologie AujourdhuiDocument74 pagesExposé Psychologie AujourdhuiMourad lahmarPas encore d'évaluation
- La VéritéDocument4 pagesLa VéritéLouise SolelhacPas encore d'évaluation
- Chapitre IV Les compétences clés du LeadershipDocument3 pagesChapitre IV Les compétences clés du Leadershiprafik.rajhiPas encore d'évaluation
- Créativité Et Ingénierie Territoriale Lahmadi Et Sanquirgo V2Document23 pagesCréativité Et Ingénierie Territoriale Lahmadi Et Sanquirgo V2bahcinePas encore d'évaluation
- Coaching en EntrepriseDocument33 pagesCoaching en EntrepriseService Informatique M100% (1)
- Vos 3 Types D'hypersensibilitesDocument32 pagesVos 3 Types D'hypersensibilitesalaouikadiri8279Pas encore d'évaluation
- Aleluya - Trompeta BB I (Arreglo) PDFDocument2 pagesAleluya - Trompeta BB I (Arreglo) PDFUlisesGonzalezPas encore d'évaluation
- L'Atelier A1Document170 pagesL'Atelier A1QINLU YANGPas encore d'évaluation
- Comment Fédérer Une ÉquipeDocument6 pagesComment Fédérer Une Équipeitss.rinooPas encore d'évaluation
- LestravauxduMardi (Selonhaziel) - L'AntreCieletTerre 1688410169584Document8 pagesLestravauxduMardi (Selonhaziel) - L'AntreCieletTerre 1688410169584Rigo SikinaPas encore d'évaluation
- Comment Détecter Les MensongesDocument33 pagesComment Détecter Les MensongespapePas encore d'évaluation
- Discours Du Bien-Aimé HarmonyDocument5 pagesDiscours Du Bien-Aimé HarmonyEudrick AlexisPas encore d'évaluation
- Lacan 1971 - FRDocument331 pagesLacan 1971 - FRcristianPas encore d'évaluation
- The MindBody Code: How to Change the Beliefs that Limit Your Health, Longevity, and SuccessD'EverandThe MindBody Code: How to Change the Beliefs that Limit Your Health, Longevity, and SuccessÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Letting Go of Shame: Understanding How Shame Affects Your LifeD'EverandLetting Go of Shame: Understanding How Shame Affects Your LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (18)
- Understanding Codependency: How to Overcome Abuse, Addiction, Trauma and Shaming to Live a Peaceful LifeD'EverandUnderstanding Codependency: How to Overcome Abuse, Addiction, Trauma and Shaming to Live a Peaceful LifeÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Brené Brown's Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead SummaryD'EverandBrené Brown's Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead SummaryÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9)
- Conquering Shame and Codependency: 8 Steps to Freeing the True YouD'EverandConquering Shame and Codependency: 8 Steps to Freeing the True YouÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (11)
- From Shame to Beauty (Women of the Word Bible Study Series)D'EverandFrom Shame to Beauty (Women of the Word Bible Study Series)Pas encore d'évaluation
- Discover Your True Self: How to Silence the Lies of Your Past and Actually Experience Who God Says You AreD'EverandDiscover Your True Self: How to Silence the Lies of Your Past and Actually Experience Who God Says You AreÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Rejected, Shamed, and Blamed: Help and Hope for Adults in the Family Scapegoat RoleD'EverandRejected, Shamed, and Blamed: Help and Hope for Adults in the Family Scapegoat RoleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (17)
- Unmasking the Spirit of Shame: Breaking Free from the PastD'EverandUnmasking the Spirit of Shame: Breaking Free from the PastÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- Unashamed: Healing Our Brokenness and Finding Freedom from ShameD'EverandUnashamed: Healing Our Brokenness and Finding Freedom from ShameÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Emotional Intimacy: A Comprehensive Guide for Connecting with the Power of Your EmotionsD'EverandEmotional Intimacy: A Comprehensive Guide for Connecting with the Power of Your EmotionsÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (3)
- To Have and to Hold: Motherhood, Marriage, and the Modern DilemmaD'EverandTo Have and to Hold: Motherhood, Marriage, and the Modern DilemmaÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6)
- Breaking Through Betrayal: And Recovering the Peace WithinD'EverandBreaking Through Betrayal: And Recovering the Peace WithinÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- Crianza Responsiva: Principios para criar hijos conectados y saludablesD'EverandCrianza Responsiva: Principios para criar hijos conectados y saludablesPas encore d'évaluation
- Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the LawD'EverandHiding from Humanity: Disgust, Shame, and the LawÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9)
- Sex, Food and God. The Struggle for the Heart: Breaking Free from Temptations, Compulsions, & AddictionsD'EverandSex, Food and God. The Struggle for the Heart: Breaking Free from Temptations, Compulsions, & AddictionsPas encore d'évaluation
- A Framework for Extraordinary Relationships Without Guilt, Shame or FearD'EverandA Framework for Extraordinary Relationships Without Guilt, Shame or FearPas encore d'évaluation
- Victims No Longer: The Classic Guide for Men Recovering from Sexual Child AbuseD'EverandVictims No Longer: The Classic Guide for Men Recovering from Sexual Child AbuseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5)
- Intimate Deception: Healing the Wounds of Sexual BetrayalD'EverandIntimate Deception: Healing the Wounds of Sexual BetrayalÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (5)
- Beads of Healing: Prayer, Trauma, and Spiritual WholenessD'EverandBeads of Healing: Prayer, Trauma, and Spiritual WholenessPas encore d'évaluation