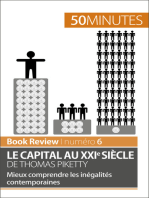Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Comment Expliquer Les Cycles Économiques - Removed
Transféré par
khaled khaledTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Comment Expliquer Les Cycles Économiques - Removed
Transféré par
khaled khaledDroits d'auteur :
Formats disponibles
lOMoARcPSD|20856753
Comment expliquer les cycles
économiques ?
« Le cycle décennal semble être révolu » affirme F. ENGELS en 1882
lorsque les pays qui s’industrialisent subissent une récession de plus long terme
que celle anticipée sur la base des travaux de C. JUGLAR. Vingt ans plus tôt en
effet, en 1862, celui-ci avait mis en évidence des cycles de court terme, d’une
durée de 8 à 10 ans, qui caractériseraient l’activité en faisant se succéder de
moments de croissance, de crise (point haut de basculement du cycle), de
récession (voire de dépression) et de reprise (point bas du cycle). L’affirmation de
F. ENGELS fait écho des interrogations – A. PARVUS, J. VAN GELDEREN à la fin
du 19ème siècle, A.A. SPIETHOFF en 1920 – que suscite une période (1873-1896)
que l’on qualifiera par la suite de Grande Dépression. La postérité retiendra
surtout KONDRATIEFF qui, en 1926, met en évidence des cycles d’une durée
plus proche de 40 à 60 ans, qu’auraient connus les pays (Royaume Uni, France,
Etats-Unis, Allemagne) dont l’industrialisation a marqué le 19ème siècle. Que
penser de l’affirmation de F. ENGELS un siècle plus tard ? La crise déclenchée en
2008 et la profonde récession débutée en 2009 touche-t-elle à sa fin et s’inscrit-
elle dans une dynamique purement cyclique ? Fait-elle partie d’une longue
fluctuation, qui aurait débuté avec la fin des Trente Glorieuses ? Les cycles
peuvent être définis, comme le font A.F. BURNS et W.C. MITCHELL en 1944,
comme « des fluctuations caractéristiques de la vie économique et des nations
qui organisent principalement leurs activités dans le cadre d’entreprises privées
». La crise étant le point de retournement du cycle finalisant une phase de
croissance, provoquant une phase de récession jusqu’à un point bas, qualifié de
reprise. Cette définition généralise la notion de cycles, leur assigne un profil
récurrent de fluctuations et relègue au second plan leur amplitude et leur durée :
même si la distinction entre cycles de court, de moyen ou de long terme est
essentielle, elle permet d’insister sur le caractère supposément inévitable d’une
succession de phases et de moments, pouvant d’ailleurs se superposer sur des
périodes de 3 à 4 ans (J. KITCHIN), de 8 à 10 ans (C. JUGLAR) ou de plus de 40
ans (N. KONDRATIEFF).
De telles fluctuations sont-elles inévitables ? Serions-nous aujourd'hui dans
une phase particulière d’un cycle long ? Assisterions-nous, dans des économies
de plus en plus financiarisées, à des cycles de plus en plus courts ?
I) Les cycles, longs notamment, peuvent être expliqués par
des innovations, et sont caractérisés par des faits stylisés
reliant croissance, prix et emploi.
A) L’observation de la conjoncture plaide en faveur d’une
dynamique cyclique caractéristique
1. La crise, moment inessentiel ou trop essentiel ?
Chez des auteurs néoclassiques s’interrogeant respectivement sur la
valeur (W.S. JEVONS, C. MENGER), l’équilibre (L. WALRAS) et l’optimum (V.
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
PARETO), à la veille de la Grande Dépression, les notions de croissance et de
cycle sont tout à fait secondaires : « longtemps après la tempête l’océan
redevient plat » affirmait ainsi L. WALRAS, comme pour signifier que malgré
l’importance des crises et de leurs conséquences sociales, il importait de
privilégier les conditions de réalisation d’un équilibre, fut-il seulement de long
terme seulement. Le célèbre « à long terme nous serons tous morts » prononcé
par J.M. KEYNES quelque cinquante ans plus tard lui fait écho, pour lui opposer
l’importance d’agir vite afin d’éviter les conséquences politiques – le
communisme et le nazisme, soit des systèmes économiques planifiés et coercitifs
– qui pourraient résulter d’une trop grande confiance en une autorégulation
rapide par les prix. Mais lorsqu’il écrit la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt
et de la monnaie dans un contexte de crise déflationniste teintée de forts taux de
chômage, J.M. KEYNES se soucie pas ou peu de la problématique des cycles.
Ainsi la crise peut-elle paraître trop inessentielle à une réflexion qui se préoccupe
plus d’équilibre que de dynamique de croissance pour les uns, trop essentielle
pour n’être analysée que sous l’angle de la cyclicité pour les autres, trop
préoccupés des conséquences dramatiques du court terme pour laisser à une
reprise de l’activité le temps de se produire. Côté néoclassique, l’équilibre peut
ainsi cohabiter avec une forte comme une faible croissance, fluctuante ou non. Si
les prix sont parfaitement flexibles sur l’ensemble des marchés, si les facteurs de
production sont parfaitement mobiles entre les marchés, si ces marchés sont
libres d’entrée et de sortie, et si l’information est transparente (rapide et
gratuite), alors on doit pouvoir éviter toute forme de déséquilibre durable, et
finalement il n’est pas de crise économique que les marchés – par la variation
des prix relatifs - ne seraient pas susceptibles d’absorber en réallouant
efficacement les ressources en terre, capital, travail, entre les branches. Côté
keynésien, l’équilibre peut coïncider avec un sous-emploi des capacités
productives et un chômage involontaire tels que le relance doit vite être
entreprise sans attendre une reprise spontanée, incertaine voire improbable si les
entrepreneurs ne trouvaient pas de raisons de redevenir optimistes et
investisseurs.
2. Si crise il y a, cycle il y a
Il est cependant possible de voir dans la crise autre chose qu’un
phénomène secondaire vis-à-vis de la notion d’équilibre. J. BOUVIER qualifiait de
crise d’ancien régime celles qui ponctuaient l’activité économique jusqu’au
19ème siècle. Ces crises ont mis fin à des périodes d’expansion comme par
exemple celle qu’aurait connue la France entre 1799 et 1844. Survenant à la
suite d’une mauvaise récolte, la hausse des prix, diminuant les achats non
alimentaires, affecterait par contagion l’activité productive dans le secteur
industriel, par une baisse de la demande tout au long de la chaine de production.
L’insuffisance de moyens de transports terrestres de l’époque pré-industrielle
empêcherait des échanges entre régions excédentaires ou déficitaires qui
auraient pu atténuer ce choc, ce qui aggraverait ainsi les variations de prix. La
baisse de cette activité réduit la main d’œuvre employée, ce qui freine la
production de biens agricoles, avec pour conséquence de faire durer la récession
(ralentissement de la croissance) ou la dépression (croissance négative). Ainsi les
cycles de l’activité globale pourraient-ils sembler inévitables dès lors que seraient
elles-mêmes inévitables de mauvaises récoltes, du fait de variables climatiques
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
que l’homme ne maîtrise pas. Si certaines mauvaises conditions climatiques
peuvent être « absorbées », atténuées et résorbées dans l’activité globale parce
que ne générant pas de fortes variations de prix, de contraction de la demande
et de l’emploi, d’autres au contraire dégénéreraient en crise véritable, mettant
fin à une phase de croissance.
La prédominance du secteur agricole sur le secteur industriel est remise en
question au 19ème siècle avec l’industrialisation. L’expression crises mixtes
décrit ainsi le fait qu’un choc dans le domaine agricole pourrait conduire à des
processus cumulatifs industriels et financiers : à la baisse de la demande de
biens de production s’ajoute un processus cumulatif financier du fait qu’un pays
affecté par une mauvaise récolte va importer les biens alimentaires qui lui font
défaut de l’extérieur. Ces importations conduisent l’encaisse-or dans la nation et
plus précisément dans le secteur bancaire à diminuer. Les Banques centrales
sont conduites à élever le taux de réescompte (le taux auquel elles acceptent de
réescompter les effets de commerce) de sauvegarder la valeur interne comme
externe de la monnaie nationale, et les banques commerciales et d’affaires leur
taux d’escompte. Le renchérissement du crédit voire son rationnement
ralentissent les investissements et freinent encore le dynamisme de l’activité
économique. Une telle crise peut être identifiée en 1847 en France, qui sonne la
fin d’une phase d’expansion de la production industrielle de dix ans entre 1836 et
1847. La crise économique de 1847 n’est évidemment pas pour rien dans la crise
sociale, révolutionnaire, qui secoue la quasi-totalité de l’Europe en 1848. Elle
aurait fait au moins 100 000 chômeurs supplémentaires en France (si tant est
que l’on puisse bien mesurer l’ampleur du phénomène dans les provinces), et
conduit ainsi à la création des ateliers nationaux, qui, si on en croît LAMARTINE,
auraient eu plus de retentissement dans les rues de Paris que la proclamation de
la nouvelle République. Elle s’avère aussi déflationniste pour les prix industriels
comme en atteste par exemple la baisse de 50% du prix de la fonte ou de 30%
du prix du fer, matières premières essentielles au développement de nombreuses
industries.
3. Court ou long, tout est bon
Cette crise a sans doute constitué un événement marquant pour ceux qui
vont vouloir analyser le(s) rythme(s) de l’activité économique et des cycles,
malgré les difficultés statistiques de l’époque pour fonder empiriquement, avec
une grande validité scientifique, les théories. C. JUGLAR en 1860 défend
l’existence de cycles de 8 à 10 ans, en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, en
Allemagne, jalonnés de crises comme point de retournement explicables par un
retournement du crédit. Essentiels au développement d’un commerce « au loin »,
international, depuis longtemps dynamique, les crédits commerciaux, dont une
grande partie sont déjà internationaux participent à une diffusion des récessions
entre les nations. A.H. HANSEN considère ex post sur la base de statistiques
plus fiables dont on disposera au 20ème siècle que l’observation donne raison à C.
JUGLAR : une douzaine de cycles d’une dizaine d’années se seraient succédés
entre 1837 et 1937, ce que A.F. BURNS et W.C. MITCHELL confirment eux
aussi, identifiant des cycles JUGLAR au nombre de 7 aux EU entre 1867 et 1938
notamment. C. JUGLAR n’a fait qu’évoquer la possibilité de cycles de plus longue
durée. C’est à sa suite que des économistes comme HYDE CLARK et A.A.
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
SPIETHOFF notamment, mais surtout N.D. KONDRATIEFF en 1926 vont
s’atteler à les mettre en évidence. N.D. KONDRATIEFF croît ainsi identifier des
cycles d’une durée de 50 à 60 ans dont les phases d’expansion dureraient une
vingtaine d’années environ, suivies d’une récession primaire d’environ une
quinzaine d’années et d’une récession secondaire d’une vingtaine d’années. La
Grande dépression de 1873-1896, qui a fait suite à une phase d’expansion après
les révolutions de 1848, qui s’est accélérée entre 1866 et 1873, en France
notamment, est bien sûr au fondement de l’analyse de N.D. KONDRATIEFF.
Apparaît au cours de cette période ce qu’à la suite de N. KALDOR, on appellera
par la suite un fait stylisé, soit une corrélation régulière et assez établies entre de
grandes variables macroéconomiques : ainsi l’inflation serait-elle associée à la
croissance, la déflation à la récession, ou encore les taux d’intérêt réels faibles
avec l’expansion tandis que la déflation récessioniste les élèveraient… Imbert
(1959) puis F.J. SIMIAND confirment l’analyse de N.D. KONDRATIEFF et de tels
liens établis entre activité et prix, vérifiés à 75%. Avec le recul de l’histoire, il
serait possible, selon G. ABRAHAM-FROIS, d’identifier la succession de cinq
vagues dites KONDRATIEFF : - une première entre 1730 et 1790 avec un pic aux
alentours de 1770, - une deuxième de 1790-1849 avec un pic en 1814, - une
troisième entre 1849-1896 avec un pic en 1873 - une quatrième entre 1896-1945
avec un pic dans les années 1920 (soit au tout début en 1921, soit avec la crise
de 1929) - une cinquième entre 1945 et les années 1990 avec un pic en 1973.
Ceci soulève quatre questions :
Quels seraient les facteurs pouvant expliquer l’existence de tels cycles ?
Comment s’articulent les facteurs technologiques, monétaires et financiers
dans les cycles ?
Comment expliquer les cycles des affaires qui semblent de plus en plus
courts et fréquents
Serions-nous depuis les années 1990 dans un nouveau cycle long, avec
une croissance mondiale qui, avec l’intégration internationale des
émergents, les prémisses d’une croissance plus durable sur le continent
africain dont la population active croît, se serait interrompue en 2008 ? Ou
sommes-nous promis à une stagnation séculaire ?
4. L’innovation ferait le cycle
A la première question, il serait possible de répondre en reliant croissance
et progrès technique. En effet, J.A. SCHUMPETER, dès 1912 dans sa Théorie de
l’évolution économique, puis en 1939 avec Business Cycles, ou en 1942 dans
Capitalisme, socialisme et démocratie, considère comme fondamental le rôle joué
par les innovations (à distinguer des inventions) qui, de cinq types – produits,
procédés, débouchés, matières premières, organisation (entendue surtout chez
J.A. SCHUMPETER en tant que structuration d’un marché) – apparaissent
fondamentales pour expliquer les fluctuations de la croissance. Ainsi serait-il
possible de croiser différentes caractéristiques observées ex post pour conclure à
une succession d’ordres productifs (P. DOCKES) issus des sorties de phases B
par le biais de grappes d’innovations : ‐ phases de type A (1789-1816, 1848-
1873, 1896-1929, 1945-1973, 1993-2008), ‐ phases de type B (1816-1848, 1873-
1896, 1929-1945, 1973-1993, 2008- ?).
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
Entre 1770 et 1789, l’industrialisation du textile, des mines, le
développement de la machine à vapeur aurait fait émerger un premier ordre
productif : le capitalisme manufacturier. Après une phase A entre 1800 et
1816, l’essor du chemin de fer aurait mis fin à une phase B à partir de 1848 et
préparé l’avènement d’un capitalisme concurrentiel, avant que l’électricité, la
chimie, la métallurgie, le moteur à explosion et l’organisation scientifique du
travail ne fasse émerger, après la grande récession débutée en 1873, un
capitalisme de type monopoliste de 1896 à 1920 ou 1929. Entre les Années
Folles et le premier choc pétrolier, biens de consommation durable,
audiovisuel, nucléaire auraient conditionné le développement d’un capitalisme
fordiste à partir de 1945 conjuguant gains de productivité, essor d’Etats-
providence et cercle vertueux entre partage de la valeur ajoutée, offre et
demande. A celui-ci aurait enfin succédé depuis les années 1990, un
néocapitalisme se constituerait sur la base des innovations (TIC) devant mettre
fin aux Vingt piteuses, et faisant émerger un ordre productif pouvant être
qualifié de post-industriel. Mais comment expliquer la survenance de telles
innovations et changements à ces moments-là ?
B) Les déterminants de l’innovation et de leurs impacts
1. En quête de profit
Dans Business Cycles en 1939, J.A. SCHUMPETER évoque « la chasse au
profit des hommes d’affaires » comme élément déterminant. Si la beauté du
geste peut conduire à l’invention, la motivation financière est le prélude aux
innovations, c’est-à-dire à leur commercialisation, leur diffusion à grande échelle,
leur capacité ne plus être seulement signe d’ingéniosité mais source d’ingénierie,
de bouleversement de méthodes de production, de modes de production,
d’ouverture de nouveaux marchés dont d’impact véritable sur la croissance.
Intuition confirmée empiriquement. J. SCHMOOKLER s’attache en 1966 à la
valider sur 4 secteurs industriels et plus d’un millier d’entreprises : l’anticipation
des profits et donc le rendement anticipé du capital investi constituent bien des
déterminants des choix d’innovations d’entrepreneurs qui ne se jettent pas dans
l’inconnu mais bien, comme l’avait considéré F.H. KNIGHT dès 1921, en
transformant l’environnement incertain en un environnement risqué, c’est-à-dire
dont les éventualités, les chances de réussir ou les risques d’échouer – les «
états de la nature » en microéconomie – sont probabilisés.
Ce sont donc justement les innovations et les effets d’entraînement
qu’elles génèrent, les grappes qu’elles peuvent susciter, qui, selon J.A.
SCHUMPETER et F.J. SIMIAND relanceraient l’activité économique, la
croissance, à la fin d’une phase de type B, de récession voire de dépression. Mais
à quel moment et pourquoi ? Parce que les innovations elles-mêmes pourraient
suivre une évolution cyclique, fondée sur une loi de Poisson, comme l’ont
montré P. AGHION et P. HOWITT. Lorsqu’il y a beaucoup d’innovations en une
période t, l’incitation à innover s’affaiblit car l’on peut craindre que tout
innovation supplémentaire soit comme « noyée » au milieu de beaucoup
d’autres, et sa rentabilité attendue peut risquer d’être faible. C’est lorsqu’il y a
peu d’innovations qu’au contraire la rentabilité d’une innovation peut paraître
élevée, être le « big fish » : l’incitation à innover est alors forte car la rente
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
monopolistique à attendre d’une innovation supplémentaire a toutes les chances
d’être, elle aussi, élevée. L’innovateur peut espérer acquérir grâce à elle un fort
pouvoir de marché, c'est à dire une capacité à être price maker, à profiter d’un
prix largement supérieur au coût marginal, à générer des profits. Sur cette base,
il y aurait donc toutes les chances de connaître des cycles d’innovation, des
phases de peu d’innovations alterneraient avec des phases de nombreuses
innovations. Et si les innovations sont elles-mêmes cycliques et qu’elles font le
cycle, alors toute économie au sein desquelles les innovations sont permises et
souhaitées ont toutes les chances de connaître des fluctuations au rythme peut
être incertain, mais au profil régulier.
2. Des profits nés de contraintes
Les prix relatifs, en particulier en ce qui concerne les ressources naturelles,
l’énergie, peuvent dans ce cadre, jouer un grand rôle. Dès lors qu’il existe
différentes matières premières disponibles pour produire de l’énergie ou pour
produire un bien quelconque, la raréfaction d’une ressource fait s’élever son prix
sur le marché ; son prix absolu mais aussi son prix relatif par rapport à une autre
ressource, dite de substitution. C’est justement cette élévation du prix relatif qui
va rendre rentable l’usage d’une ressource nouvelle, de substitution. En 1865
déjà, W.S. JEVONS craignait la raréfaction du charbon, dans The Coal Question.
Que ce soit chez des historiens (WRIGLEY…) ou des économistes comme G.
MENSCH, N. ROSENBERG ou R.B. FREEMAN (école dite néo technologique,
néo schumpetérienne), trois critères conditionnent une révolution technologique
qui s’explique par l’apparition, soudaine ou progressive, d’une contrainte : ‐ un
usage identifié de la ressource de l’input de substitution, ‐ la disponibilité ou
abondance de cette ressource, ‐ de fait un prix relatif qui diminue pour cette
ressource nouvelle relativement à une ressource traditionnelle qui voit son prix
s’élever au fur et à mesure de sa raréfaction.
Ceci pourrait expliquer en quoi l’Angleterre, faiblement dotée en source
d’énergie dite traditionnelle (bois à partir du milieu du 18ème siècle, force
hydraulique du fait de faibles dénivelés), aurait été conduite à privilégier le
charbon de terre, qui a pu s’avérer déterminant pour la première révolution
industrielle. Une chance était offerte naturellement à l’Angleterre, comme le
rappelle K. POMERANZ dans Une grande divergence (2010) : une forte dotation
en charbon de terre qui permettait de pallier l’absence de torrents et la
raréfaction du bois – au contraire d’une France faiblement dotée en charbon et
qui n’était que peu incitée à l’utiliser, le bois y étant resté abondant et les fleuves
puissants (Alpes) – s’est conjuguée à un état d’esprit favorable à l’innovation et à
une transition démographique qui suscitait à la fois des besoins et de la main
d’œuvre pour lancer la révolution industrielle. C’est aussi au moment où en
Angleterre, le coton est devenu moins cher que la laine, grâce à la colonisation
de l’Inde puis des Etats-Unis, que l’industrie a connu son essor en permettant de
s’approvisionner en coton moins cher et en substituant une industrie « moderne
» à une industrie traditionnelle. Des chocs exogènes, déterminés par des facteurs
géopolitiques autant qu’économiques, peuvent ainsi contribuer à expliquer des
accélérations de la croissance. Bien plus tard, c’est de la même manière au
moment des chocs pétroliers (causes géopolitiques prédominantes qu’ont été la
guerre de Kippour en 1973 puis la révolution iranienne en 1979) que
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
l’impératif nucléaire est devenu de plus en plus évident : l’augmentation du prix
de pétrole aura rentabilisé les lourds investissements en coûts fixes des centrales
françaises notamment.
3. Reste à comprendre comment ces innovations impactent la croissance
a) L’impact peut être particulièrement long
Des chocs, qualifiés de réels (par opposition au monétaire et au financier),
liés à des changements dans le rythme de la productivité ou des changements
politiques ou institutionnels durables peuvent donc expliquer les fluctuations de
croissance. Mais l’incidence des innovations ou chocs technologiques peut
s’avérer particulièrement longue dans les temps. Chez J.A. SCHUMPETER, le fait
que l’on observe des cycles plutôt courts (C. JUGLAR) ou longs (N.D.
KONDRATIEFF) tiennent à la durée de mise en œuvre, qu’on ne pourrait
connaître a priori, des innovations. Comme B. BUNCH et A. HELLEMANS et en
1993, puis P. DOCKES ou G. ABRAHAM-FROIS, il est alors possible de contester
l’idée de vagues successives d’innovation. Deux grands moments pourraient être
distingués : l’un rassemblant les changements induits par les révolutions du
textile (machinisation, passage du putting-out system au factory system…) et de
la vapeur (induisant hausse des coûts fixes, investissements lourds,
développement du crédit, fortes externalités…) ; puis depuis la deuxième moitié
du 19ème siècle, 5 grandes grappes d’innovation se seraient succédées sur un
temps long, jusqu’à aujourd'hui :
L’électricité qui, finalement, a permis de décliner une multitude de produits
(matériel domestique électrique, les produits blancs de la société de
consommation etc.).
Le moteur à explosion qui a permis toute une déclinaison d’innovations
(comme l’automobile, mais aussi les infrastructures routières, l’usage du
pétrole, le développement particulier des villes etc.).
La chimie et tout ce qui va se décliner avec les matières plastiques.
La communication, qui débute dès 1844 avec les télégraphes avec un
grand nombre d’innovations concentrées à la fin du 19ème siècle
(photographie, cinéma, téléphone) mais se déroulant jusqu’à aujourd'hui
(avec internet).
La physique, avec les particules, les physiques quantique (infiniment petit)
et relativiste (l’infiniment grand), qui déclinent d’activités dans le domaine
du nucléaire, dans la communication, dans la fission nucléaire mais aussi
potentiellement dans la fusion.
Trois exemples des impacts de long terme. Bien que le pétrole ait vu son
exploitation pensée dès 1859 en Pennsylvanie, il n’a induit de véritables
changements qu’à partir de la première guerre mondiale : G. CLEMENCEAU
voyait dans le pétrole une ressource aussi importante pour le futur « que le sang
sur le champ de bataille », A. HITLER a investi des milliards dans le pétrole de
synthèse pour éviter des ruptures d’approvisionnement de ses armées. Le
pétrole, dont la production devait connaître un pic (peak oil) annoncé dès le
début des années 1970, reste aujourd’hui encore fondamental – si ce n’est très
écologique – à nos modes de vie. Le transistor, apparu en 1947, permet
aujourd’hui des procédés de miniaturisation qui autorisent des capacités dans un
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
même espace 50 millions de fois plus élevées qu’à sa création. Il est
indispensable entre autres à toutes les technologies de l’information et de la
communication (TIC). Le laser, pensé dès les années 1950, est inventé en
pratique en 1960 et donne depuis et jusqu’aujourd’hui encore lieu à une «
galaxie d’application », ludiques et médicales… Les exemples sont légion.
b) Leur survenance peut être imprévisible mais cependant conduire à
ces cycles
E.E. SLUTSKY a soutenu dès 1927 que des chocs, même aléatoires,
pouvaient tout à fait générer des fluctuations régulières. Un peu comme une
pierre jetée dans l’eau induirait des vagues dont les caractéristiques seraient
prévisibles des physiciens. Mais il faut, selon R. FRISCH en 1929, distinguer
l’impulsion initiale des mécanismes de propagation : ceux-ci peuvent conduire à
estomper ou amplifier les fluctuations induites.
Ces travaux seront d’une grande portée, tant pour ceux de P.A.
SAMUELSON sur l’investissement et les oscillations (cf. infra) que pour la théorie
des cycles réels (F.E. KYDLAND et E.C. PRESCOTT, 1977, et par la suite J.B.
LONG et C. PLOSSER, 1984), qui se fonde sur une idée simple : à l’origine des
fluctuations du PIB ou de la croissance, il y a des chocs purement réels, qui vont
du tremblement de terre, du tsunami ou du cyclone à des évènements politiques
et sociaux, révoltes, révolutions, en passant par des chocs technologiques, dits
de productivité. Ces chocs surviendraient de manière aléatoire, imprévisible. Trois
principaux principes méthodologiques sous-tendent cette thèse :
Le passage d’un choc technologique à de l’investissement dans des inputs
susceptibles d’augmenter l’offre de biens et de services et de susciter une
demande requiert du temps (« Time to build »).
Des anticipations rationnelles.
Un agent représentatif, c’est-à-dire dont le comportement est supposé
résumer le comportement de tous.
Relation entre élasticité de l’offre de travail au salaire et croissance
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
À partir de là, il serait possible de montrer que l’élasticité de l’offre de travail au
salaire dépendrait en grande partie de la durée anticipée par un agent
représentatif du choc de productivité, ou réel. Ainsi les conséquences des chocs
sur la croissance dépendraient-ils des réactions des offreurs et des demandeurs
de travail à ce choc. Plus le choc serait anticipé comme étant de court terme,
plus l’offre de travail serait élastique, et donc l’impact en termes d’emploi et de
croissance augmenterait. Tandis que si ce choc devait être anticipé comme de
long terme, l’impact serait plus faible. Ainsi les fluctuations dépendraient-elles
moins du choc en lui-même que des comportements induits par ce choc. En grec,
Krisis signifie aussi bien séparation, distinction, que choix. Ce dernier sens
interpelle : la crise est le moment du choix. N’est-ce pas la réaction à l’oracle qui
mène ŒDIPE à ignorer qui sont ses père et mère véritables ? Ce n’est pas tant
qu’il n’échappe pas à sa destinée supposée mais qu’une fois la prévision établie,
les réactions, les comportements peuvent tout à fait se conjuguer pour en faire
une réalité. Ici, la réalité est le profil du cycle, inconnaissable ex ante mais
constatable ex post. Elle mettrait en évidence qu’il n’existerait aucun trend de
croissance véritable mais qu’au contraire les changements conjoncturels ne
seraient que le produit de réactions au déclenchement, tout à aléatoire ou en
tout cas imprévisible, de chocs. La croissance serait ainsi par nature aléatoire et
non régulière, les fluctuations de l’activité économique ne seraient rien d’autre
que des réponses optimales à des chocs réels aléatoires mais « naturels » de la
vie économique. Et ces réponses aux chocs peuvent réserver bien des surprises
que l’individu représentatif ne permet pas toujours d’entrevoir.
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
D’autant que d’autres facteurs que la durée anticipée du choc peuvent être
déterminants pour les incidences d’un choc : le taux de chômage, déterminant
pour l’élasticité de l’offre de travail, en l’instant et l’endroit où se produit le choc,
le matching ou appariement entre compétences effectives et requises pour que
les innovations donnent lieu à des investissements… Car lorsque ces innovations
surviennent, il faut encore qu’elles se traduisent en investissements de la part
des firmes pour avoir un impact en termes de croissance, d’emploi, de revenu...
Et si l’investissement lui-même était sujet à des fluctuations endogènes ?
II) L’investissement joue un rôle fondamental dans la
dynamique cyclique, et les politiques économiques en
général et l’Etat en particulier cherchent à influer sur lui.
A) Des cycles de l’investissement : l’introduction du problème du
temps
1. Accélérateur et surréaction
D’après l’accélérateur (J.B. CLARK, A. AFTALION), il y aurait
surréaction des investisseurs, donc des entreprises, aux variations de la demande
de biens de consommation, et donc indirectement aux variations du revenu des
ménages. L’investissement varierait de manière plus que proportionnelle aux
variations du revenu : I = v∆Y, v étant le coefficient d’accélération. Au
contraire de l’effet PIGOU, soutenant que les variations du niveau général des
prix pouvaient être de nature à réguler la consommation des ménages et
finalement éviter des fluctuations trop marquées, l’accélérateur permet de
soutenir que les fluctuations peuvent être très importantes du fait des réactions
plus que proportionnelles des entrepreneurs aux changements de la
consommation induits par ceux du revenu. Des risques de sous-investissement
risquent ainsi toujours d’alterner avec des phases de surinvestissement, l’une
justifiant l’autre, ce que N. KALDOR résume par une formule : « L’investissement
avance par bonds ». Si, dans la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la
monnaie, l’investissement génère inévitablement le revenu qui lui-même génère
une épargne équivalente à l’investissement par le biais du multiplicateur, le
modèle dit néo-keynésien de R. HARROD et E.D. DOMAR s’interroge au
contraire sur les conditions d’une telle équivalence – assurant elle-même
l’équilibre sur le marché des biens puisque Y = C + S (utilisation du revenu
global) et Y = C + I (production globale à l’origine du revenu), et implicitement
sur le temps nécessaire à ce que l’investissement ait généré une épargne
équivalente. Si I = v∆Y, avec I une variation du capital disponible (investir =
augmenter le K dont on peut disposer), il y a équilibre si S = I, S étant égale à la
propension marginale à épargne x revenu. Pour qu’un tel équilibre soit réalisé, il
faut que sY soit égal à v∆Y, soit ∆Y/Y = s/v. Si, de surcroît, la population active
croît à un certain taux, ce taux de croissance doit être par ailleurs tel qu’il assure
l’absorption de la population active supplémentaire pour assurer l’équilibre sur le
marché du travail. ∆Y/Y = s/v = gn.
Il faut donc un certain taux de croissance (∆Y/Y) pour qu’il y ait équilibre
sur le marché des biens et services et sur le marché du travail. Or, rien ne
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
garantirait un tel équilibre, ‐ si l’on s’écarte des hypothèses néoclassiques
d’ajustement parfait et simultané des marchés par la flexibilité des taux d’intérêt,
des salaires et des prix, c’est-à-dire si les décisions sont indépendantes les unes
des autres et non interdépendantes comme dans le modèle walrasien, si le temps
n’est plus l’abstraction du principe du multiplicateur keynésien. La croissance
est donc sur le fil du rasoir, faisant encourir un risque permanent de
déséquilibre, et pouvant donc potentiellement dégénérer en une expansion
cumulative (inflationniste et de « surchauffe ») ou une dépression cumulative
(déflationniste et de sous-emploi).
En marge de ce résultat essentiel pour l’interprétation des cycles, un autre
est tout aussi important pour la dynamique même d’une économie de marché
décentralisée : la notion d’équilibre devient une notion dynamique. Le
mouvement, c’est-à-dire la croissance, est nécessaire à l’équilibre comme il l‘est
pour une bicyclette. Les marchés ne peuvent être en équilibre, face aux
changements toujours possibles des comportements des ménages (natalité,
consommation…) et aux réactions des entreprises, qu’avec la croissance.
L’équilibre n’est pas synonyme de stabilité mais de mouvement.
On peut également le montrer en raisonnant sur l’investissement : celui-ci
produit à la fois un effet de demande et un effet d’offre. L’effet de demande est
∆Y = k∆I, tandis que l’effet d’offre est μ.I avec μ = Kt/Yt, soit le coefficient de
capital. L’impact d’un investissement sur la capacité de production dépend du
capital déjà investi dans le passé et de l’état de la technologie à un moment
donné. L’effet d’offre et l’effet de demande sont parfaitement compatibles pour
le marché des biens et augmentent offre et demande au même rythme si : k∆I =
μ/I soit ∆I/I = μ/k = μ.s (k= 1/1-c). Si les variations de demande ne sont pas
parfaitement compatibles avec les choix d’investissement conditionnant l’offre, il
est possible qu’il y ait sur ou sous-investissement en permanence. Si l’on ajoute
qu’un investissement n’est pas homogène, ou que l’investissement peut
impacter différemment les marchés selon qu’ils sont de remplacement, de
substitution du capital au travail ou dans des innovations, l’incertitude est encore
plus grande. Elle est encore aggravée si de surcroît les investisseurs se fondent
sur des variations anticipées et sont constatées…
L’accélérateur est dit flexible (KOYCK) si les entreprises réagissent non
aux variations observées mais aux variations anticipées de revenu ou de la
demande de biens de consommation. Deux manières de concevoir le déséquilibre
sont alors possibles. Les anticipations erronées risquent d’induire une
déconnexion de l’investissement et des choix effectifs des ménages ; les choix
d’investissement, en influant sur la dépense et les revenus futurs, auto-réalisent
ou auto-invalident les anticipations. Dans les deux cas, l’investissement ne
pourrait garantir en tout instant une compatibilité des choix des ménages et des
entreprises et les « erreurs » seraient d’une certaine façon toujours
recommencées. L’équilibre est possible mais jamais garanti.
2. Cycles de l’investissement et partage de la valeur ajoutée
Le modèle de GOODWIN
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
D’autant plus si le partage de la valeur ajoutée donc la répartition
salaires/profits intervient non seulement en aval de l’investissement mais aussi
en amont. Si on considère, comme R. M. GOODWIN, qu’il existe un certain taux
de chômage U* ‐ en dessous duquel les salaires ont tendance à augmenter et ‐
au-dessus duquel les salaires ont tendance à baisser (Courbe de PHLLIPS, U*
pouvant être assimilé au NAWRU), et qu’il existe un certain niveau de profit π* ‐
en dessous duquel les entreprises freinent leur investissement et ‐ au-dessus
duquel les entreprises sont au contraire incitées à investir, alors on devrait
observer une succession de phases d’investissement selon que le partage de la
VA s’effectue tantôt en faveur des salaires, tantôt en faveur des profits. Lorsque
que le chômage est élevé, les salaires diminuent, ce qui va élever les profits,
donc l’investissement. La demande de travail qui en découle va réduire le taux
de chômage jusqu’au moment où, en dessous du NAWRU, les salaires
recommencent à augmenter, réduisant les profits et donc l’incitation à investir. Le
chômage augmente alors à nouveau jusqu’à ce que l’investissement reprenne
après la baisse des salaires. Et ainsi de suite… Si les salaires sont rigides à la
baisse, une situation de chômage et de faible investissement peut perdurer. Plus
les salaires sont rigides (à la hausse comme à la baisse) et plus les variations
d’investissement et de chômage sont marquées, éloignant de la situation
d’équilibre (au centre) correspondant au NAWRU et à un taux de profit stable.
3. Des profils complexes de croissance
Le modèle de SAMUELSON
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
En fait, dès 1939, P.A. SAMUELSON avait montré que la combinaison de
l’accélérateur et du multiplicateur avec l’introduction d’effets-retards peuvent
ainsi être à l’origine de différents profils de croissance bien identifiables (c’est le
sens du modèle) mais bien difficiles à anticiper. Si on considère que la
consommation en une période t dépend du revenu de la période précédente (Ct
= c(Yt-1)) tandis que l’investissement des entreprises serait fonction de la
variation de la consommation entre la période précédente et la période présente
(It = v∆ (Ct –Ct -1) alors l’investissement serait fonction de variations de revenu
entre t-2 et t-1… À partir de là P.A. SAMUELSON fait apparaître une fonction de
type c = 4v / (1+v)2, qui admet un extremum en (1.1) en dessous de laquelle on
observera des oscillations, tandis que la fonction c.v = 1 détermine si la
croissance ou les oscillations s’atténuent ou deviennent explosives.
4. Le jeu des stocks et les cycles de court terme
Une des variables importantes à prendre en considération sont les stocks.
Comme le montre l’équilibre emplois-ressources au niveau macroéconomique Y =
C + I + G + ∆S, (Y + M = C + I + G + ∆S + X en économie ouverte), une partie
de ce qui est produit (Y) peut conduire à une constitution de stocks (∆S > 0) ; ou
une partie de ce qui n’est pas produit en une période t être tout de même
vendue, car déstockée (∆S < 0). Ces stocks peuvent être volontaires,
stratégiques de la part des firmes et constituer un moyen de faire face à une
augmentation soudaine de la demande future, ou un moyen de limiter ou d’éviter
une baisse des prix, si les entreprises préfèrent vendre moins à un prix stable
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
(garantie de signal de qualité) que vendre plus à un prix moins élevé. Dans ce
cas, les variations de stocks sont subies par les entreprises, dès lors que la
demande serait insuffisante au prix qu’elles exigent. Ces stocks pourront alors
être utilisés au cours d’une période suivante pour satisfaire la demande, ce qui
va donc freiner la production au cours de cette période de déstockage. A court
terme, comme l’avait montré J. KITCHIN, les stocks ont un rôle fondamental. Ils
peuvent être la conséquence de changements inattendus dans la demande, mais
en même temps sont la cause de fluctuations de l’offre plus importantes. La
possibilité de stockage peut amplifier les cycles de production tandis que les
difficultés de stockage peuvent, comme dans le cas de biens agricoles
périssables, amplifier les variations de prix et expliquer leur forte volatilité. Ceci
est caractéristique de biens dont l’élasticité de la demande aux prix est faible
(matières premières, produits agricoles, conformément à la loi de KING). Dès
lors que l’offre d’une période t serait fonction des prix constatés dans le passé O
= f (Pt-1), convergence ou divergence vis-à-vis de prix d’équilibre dépendent des
élasticités relatives de l’offre et de la demande aux variations de prix (Cobweb
initié par T.W. SCHULTZ, RICCI, J. TINBERGEN, cf. cours 1A). Mais dans tous les
cas, les variations de l’offre de biens risquent de se produire pour les secteurs
concernés.
5. L’économie de marché fait de tout investissement un risque
Comme tout membre d’un couple tombe dans les bras d’un amant, tout
investisseur échange des certitudes présentes contre une incertitude future.
Qu’il se fonde sur la VAN ou le TRI, ou même simplement sur la durée de retour
sur investissement et sans même être exhaustif, un investisseur est confronté à
trois difficultés dans l’évaluation des profits futurs qui seront les siens et qui est
indispensable à la transformation de l’incertitude en risque :
a) S’il n’est pas taille atomistique, l’impact de son propre investissement sur le
prix du marché, dès lors qu’il ne pourrait parfaitement anticiper l’adéquation de
son offre future (après investissement) avec la demande future (qu’il cherche à
connaître et anticiper mais avec risque d’erreur).
b) Si son investissement répond à une variation de prix, une hausse qui
rentabilise son investissement dans de nouvelles unités de production pour
satisfaire une demande en hausse, cette hausse de prix peut également être
l’occasion pour d’autres investisseurs d’investir dans l’offre d’un bien de
substitution, ce qui aura un impact sur le prix futur du bien considéré.
c) Son investissement peut susciter chez des concurrents un investissement dans
la même branche ou la nouvelle branche du produit de substitution, et la théorie
des jeux, initiée en 1944 par J. VON NEUMANN et O. MORGENSTERN a permis
de montrer en quoi une situation de dilemme du prisonnier était envisageable en
l’absence de coordination des choix. Ici, un surinvestissement apparaît toujours
possible dans une économie décentralisée où un gosplan ne déterminerait pas de
manière centralisée les offres et les besoins.
Le marché de l’énergie est à cet égard exemplaire à plusieurs égards. Il est
d’abord déterminant : même s’il ne représente pas une part prépondérante de la
production nationale d’un pays développé (moins de 10% le plus souvent), il
conditionne l’activité de l’ensemble des secteurs d’activité. Ainsi l’exploitation
des ressources charbonnières a-t-elle été déterminante au 19ème siècle, ainsi le
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
choc pétrolier a-t-il eu une influence majeure sur le ralentissement de la
croissance des pays consommateurs de pétrole qui, devant subitement le payer 3
fois puis onze fois plus cher, n’ont pu faire autrement que de subir un frein à la
croissance, faute de pouvoir financer rapidement des déficits commerciaux par
des entrées de capitaux ou un surcroît d’exportations (cf. cours sur la contrainte
extérieure et sur la mobilité des capitaux).
L’augmentation du prix du pétrole incite à l’exploitation par des
producteurs « historiques » de gisements aux coûts jusque-là prohibitifs et de
nouveaux concurrents (les NOPEP comme la Norvège, la Russie etc) à
développer leur propre production, ce qui a évidemment un impact sur les prix.
Dans le même temps, elle incite des pays consommateurs à substituer d’autres
formes d’énergie au pétrole pour réduire la « contrainte pétrolière », comme l’a
fait la France avec le renforcement du développement du nucléaire dans les
années 1970, ou de nombreux pays dans l’éolien... L’impact sur les prix peut être
durable et surtout rendre très incertain la rentabilité des investissements,
décidés sur la base de prix courants et anticipés, mais dont l’anticipation parfaite
supposerait de connaître précisément ce que vont faire les autres. Ainsi est-il
difficile d’éviter des successions de surinvestissement suite à des hausses de
prix, qui expliquent elles-mêmes des baisses de prix risquant d’être à l’origine de
sous-investissement. Plus les coûts fixes d’un investissement sont importants et
plus ces investissements requièrent du temps pour se traduire en un supplément
d’offre, et plus la volatilité des prix risque d’être importantes. On ne s’étonne
ainsi pas du caractère hautement spéculatif de tels biens, la spéculation pouvant
elle-même accentuer (sans que cela soit une fatalité) la volatilité.
B) Une cyclicité de la croissance sous influence (ici synthétisé, cf.
politiques de régulation conjoncturelles)
1. Agir sur l’investissement ou sur l’épargne permettrait d’influer sur le cycle
Dans le prolongement de l’analyse keynésienne, le modèle HARROD
conduit à défendre l’idée d’une intervention conjoncturelle pour faire rester ou
ramener la croissance sur le fil du rasoir. Par sa politique monétaire, une Banque
centrale peut influer sur l’investissement, le stimulant avec une baisse des taux
d’intérêt lorsqu’il est insuffisant, le freinant par une hausse lorsqu’il est excessif
et se traduit par un surcroît d’inflation. Par sa politique budgétaire, l’Etat peut
être cet investisseur à contre-courant qui investit quand l’état d’esprit des
milieux d’affaires est trop morose pour soutenir l’investissement privé, ou au
contraire réduit ses dépenses quand l’investissement privé est excessif. A l’action
sur l’investissement, N. KALDOR privilégie une action sur l’épargne. Il considère
que tout déséquilibre entre épargne et investissement risque d’être cumulatif :
1. Un excès d’épargne sur l’investissement global risque de freiner
l’investissement des industries de biens de consommation ; clientes des
industries de biens de production, ces dernières n’investiront pas elles non plus
et le sous-investissement demeure.
2. Un excès d’investissement sur l’épargne accroît la demande de biens de
production donc les revenus versés dans ces secteurs, ce qui risque d’augmenter
la demande de biens de consommation et l’investissement dans les deux
secteurs.
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
N. KALDOR identifie quatre raisons possibles à la fin du plein-emploi et
d’une phase de croissance. Une hausse des taux d’intérêt de la part des banques
qui voudraient freiner le crédit, une hausse des taux de la part d’une Banque
centrale qui voudrait freiner l’inflation, une demande de biens de consommation
qui ne peut pas suivre le rythme de l’investissement qui avance par bonds, une
pénurie de main d’œuvre. Les deuxième et troisième raisons justifieraient une
politique de redistribution des revenus entre salaires et profits. Si on considère en
effet que les salariés ont une propension marginale à consommer supérieure à
celle des détenteurs de profits (hypothèse forte mais raisonnable), il faut, dans le
deuxième cas, en situation d’inflation (I > S), augmenter l’épargne par une
redistribution en faveur des profits, et dans le troisième cas (S > I), diminuer
l’épargne donc agir sur la répartition de la valeur ajoutée à l’avantage des
salaires Pour N. KALDOR autant un boom doit finir par s’arrêter de lui-même,
autant une récession ou une dépression peut devenir durable. Il faut donc
chercher à en sortir par des politiques actives.
2. « Réguler » le cycle
De telles actions contra-cycliques ne sont cependant pas à associer
précisément à J.M. KEYNES, qui évoquait la possibilité d’un « boom permanent
», mais au keynésianisme pour lesquels une grande partie des gouvernements
ont implicitement pris fait et cause au lendemain de la seconde guerre mondiale,
sans doute inspirés par la réussite des New Deals. Elles s’inscrivent plutôt dans
la perspective de la critique, adressée à J.M. KEYNES dès la publication de la
Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, par son collègue D.H.
ROBERTSON, véritable instigateur des politiques de réglage fin de la conjoncture
– fine tuning – et de stop and go en Angleterre. Avant eux, G. MYRDAL en
1933 avait déjà défendu l’idée d’une politique budgétaire qui, sur le court terme,
pouvait se fonder sur des déficits budgétaires, tout en visant sur le long terme un
équilibre des finances publiques (cf. sujet sur les politiques d’austérité). Ainsi
R.A. MUSGRAVE en 1959 considère-t-il qu’au côté de l’allocation de ressources
utiles non prodiguées par l’initiatives privée, de la redistribution de ressources, la
régulation de l’activité relève d’une des trois justifications de l’intervention
publique En dehors de la problématique de la cyclicité, le cas d’une pénurie de
main d’œuvre pour des entreprises voulant investir ne saurait être résolu par
aucune politique économique. Le « cruel dilemme » entre inflation et chômage
fondé sur la courbe de PHILLIPS révisée par R.G. LIPSEY et P.A. SAMUELSON
pourrait implicitement être compris dans le prolongement des politiques contra-
cycliques : si dilemme il y a dans la conduite de la politique économique, il
pourrait y avoir dilemme, dans le temps, entre des phases de croissance
inflationnistes éradicatrices de chômage et de récession déflationniste
génératrice de chômage, qu’il serait inévitable d’observer et de connaître.
Pourtant, d’autres arguments pourraient plaider en faveur d’une inaction de l’Etat
en matière conjoncturelle.
3. Ne peut-on compter sur…
a) Des bornes aux fluctuations de l’investissement ?
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
L’investissement ne devrait en effet pouvoir descendre en dessous d’un
certain seuil : un investissement « autonome » d’un investissement minimal de
remplacement s’impose aux entreprises dans le cadre de la poursuite de leur
activité, comme le montre J.R. HICKS. Une demande de biens de production et
les effets multiplicateurs des revenus ainsi générés assurent un minimum de
croissance et un inévitable « rebond ». On ne pouvait que remonter du fond de
l’eau. Une fois la dynamique de l’investissement lancée, on peut compter sur elle
pour soutenir a minima l’activité après un temps plus ou moins long.
Inversement, l’investissement ne peut excéder celui qui serait borné par les
capacités de production des biens de production eux-mêmes. Rapidement, la
hausse des prix vient stopper l’investissement affecté par des perspectives de
rentabilité plus faibles voire nulles. Mais il est bien des manières de remonter du
fonde de l’eau : d’un faible mouvement de cheville ou par une forte poussée,
avec aisance ou en manquant de souffle. Ou mort. La question de l’action
demeure. Notamment celle de l’Etat.
b) Des stabilisateurs automatiques ?
Sans avoir à modifier sa politique budgétaire, un Etat subit lors d’une
récession une baisse de ses recettes fiscales, la baisse du revenu global
produisant moins d’impôt sur le revenu, celle des profits moins d’impôt sur les
sociétés, celle des prix moins de recettes de TVA… Même à supposer que les
dépenses publiques seraient inchangées, une récession peut donc être de nature
à faire apparaître ou aggraver un déficit public. Celui-ci, par le jeu du
multiplicateur de dépenses publiques, pourrait suffire à limiter la récession. Si on
ajoute que la récession peut être de nature à élever les dépenses, si par exemple
le chômage augmente (allocations-chômage supplémentaires à verser), le déficit
plus aggravé jouerait un rôle contracyclique plus important encore. C’est ce que
l’on appelle « le jeu des stabilisateurs automatiques ». Les fluctuations seraient
rendues moins importantes qu’elles ne pourraient l’être, atténuées par l’Etat, par
son mode de financement même et par son rôle dans la protection sociale, sans
même qu’il ait la volonté de « relancer ». Un déficit budgétaire subi, non
volontairement pratiqué, peut suffire. Rien n’interdit cependant de penser que
cela puisse être l’inverse.
4. Le risque d’affecter les chances de reprise
L’effet dit « RICARDO-BARRO » est supposé le montrer. Si un Etat devait
en effet échouer à relancer l’activité et ne parvenait qu’à limiter la récession
dans son importance (amplitude du cycle), il risquerait de devoir supporter des
déficits budgétaires récurrents. L’accumulation de l’endettement public qui
s’ensuivrait pourrait faire envisager aux ménages des augmentations futures
d’impôts (pratiquées par l’Etat afin d’assurer le remboursement de la dette). Ce
faisant, les ménages élèveraient leur épargne par précaution, réduisant la
contribution de la consommation à la croissance. Ainsi une reprise « spontanée »
pourrait-elle en être affectée. Si cette dette publique devait, au moins en partie
être « financée » par des créanciers étrangers, c’est une hausse des taux
d’intérêt (primes de risque) qui, là aussi, pourrait freiner la reprise future. Dans
les cas où l’effet RICARDO-BARRO jouerait, il se pourrait donc que l’action
contracyclique de l’Etat ne soit qu’atténuation des récessions mais aussi risque
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
d’obérer la phase de croissance du cycle. La théorie doit être confrontée aux faits
pour révéler ou non le caractère effectif de l’effet… qui peut jouer ou pas. C’est
une des raisons pour laquelle cet effet est si sujet à débats entre économistes qui
révèlent souvent à ce propos leur obédience. Il associe un raisonnement dit d’«
équivalence ricardienne » (qui date du début du 19ème siècle, qui signifie
simplement qu’il est plusieurs manières de financer une dépense publique (à
l’origine à des fins militaires) selon que l’on choisit l’impôt ou la dette, cette
dernière sur des durées plus ou moins longues et la thèse de R.J. BARRO (1974)
selon laquelle des agents rationnels devraient anticiper que toute dette a pour
contrepartie un remboursement futur que seuls des impôts futurs permettront
d’assurer. L’association des deux auteurs écrivant de près de deux siècles
d’intervalle n’est pas innocente : elle a été faite par J.M. BUCHANAN, chef de
file de l’école dite du Public Choice (qualifiée d’ultra-libérale) qui cherche à
montrer en quoi l’Etat serait immanquablement capturé par des intérêts privés et
de fait incapable de poursuivre des objectifs d’intérêt général. Dans le domaine
de l’action conjoncturelle, non content d’obérer les chances de reprise
spontanée, l’Etat pourrait même accentuer les fluctuations, en exagérer
l’amplitude en voulant les réduire.
5. Le risque d’amplifier les cycles
D’abord du fait d’un problème de temporalité. Plus les fluctuations sont de
court terme, plus le risque est grand. En effet, le temps qu’une récession
(expansion) soit constatée, qu’une politique soit décidée et votée, puis mise en
œuvre et appliquée, du temps s’est déjà écoulé : au moment où la relance (le
frein) de l’activité se ressentira, la reprise (le ralentissement) aura peut-être déjà
eu lieu. L’action contra-cyclique n’aura fait qu’accentuer les fluctuations en
voulant les atténuer et les politiques qui vont suivre risquent d’être encore plus
marquées, disproportionnées eu égard à ce qu’aurait nécessité une croissance
sujette à de faibles et courtes fluctuations. C’est ce qui a pu être constaté à partir
du milieu des années 1950 jusqu’en 1965 et qui a commencé à faire douter du
bien-fondé des politiques contra-cycliques. Il ne fallait plus que le début de la
stagflation et la coexistence d’inflation et de chômage avec la récession
consécutive au premier choc pétrolier pour aboutir à jeter le discrédit sur ces
politiques. Ensuite parce que ce problème de temporalité s’articule avec des
considérations politiques liées au rythme des élections des régimes
démocratiques.
6. Le risque de cycles politico-économiques
Dans le prolongement des thèses dites du Public Choice de J.M.
BUCHANAN ou G. TULLOCK, F.E. KYDLAND et E.C. PRESCOTT (1977) puis
W.D. NORDHAUS (1984) ont développé l’idée de cycles dont l’origine ou au
moins l’amplitude pourrait être trouvée dans l’intervention de l’Etat elle-même.
Un risque d’incohérence temporelle caractériserait les politiques monétaires et
fiscales notamment. Des promesses fiscales attractives pour des entreprises
pourraient être tenues avant que des changements fiscaux ne rendent des
entreprises ayant investi dans des coûts fixes élevés sur un territoire moins
profitables qu’elles ne s’y attendaient… Dans des régimes démocratiques,
l’élection ou la réélection d’un gouvernement (d’une « administration » aux Etats-
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
Unis) serait fondée sur des promesses d’action à la veille des élections, fondées
sur le phénomène prioritaire du moment (lutte contre l’inflation par exemple),
suivies de mise en application (ou non) dans une première phase de
gouvernement, corrigée potentiellement à la veille de nouvelles élections afin de
s’assurer la victoire.
On le voit, la question du financement de l’action publique s’invite
insidieusement dans la réflexion sur les cycles. Au-delà de la question d’une
incohérence des politiques de gestion des cycles, l’Etat et les Banques centrales,
en intervenant par des politiques budgétaires et monétaires, pourraient-ils être à
l’origine même des cycles ? C’est en fait la question du financement en général
de l’investissement et des innovations qui se profile, et qui avançait jusqu’ici
masquée derrière le réel.
III) Au cœur du financement des innovations et de
l’investissement, monnaie et comportements sur les marchés
financiers interagissent pour rendre instable la croissance
économique.
A) Variations de l’offre de monnaie et cycles
1. Post hoc ergo propter hoc
En 1963, dans un ouvrage retraçant l’histoire monétaire des États-Unis de
1867 à 1960, M. FRIEDMAN et A.J. SCHWARTZ mettent en évidence un lien
entre les variations de la masse monétaire et les variations de prix. Sur le long
terme, ils observent que les variations de la masse monétaire se traduisent par
des variations de prix (du niveau général des prix, avec des décalages de
plusieurs mois, de 6 à 8 en moyenne), et en déduisent – sur la base d’une
méthodologie résumée par J. TOBIN comme « après cela donc à cause de cela »
(post hoc ergo propter hoc) – que les variations de la masse monétaire sont la
cause des variations de prix. À partir du moment où l’offre est considérée comme
exogène, car « l’offre de monnaie est ce que les autorités monétaires décident
qu’elle sera », « l’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire », ce
qui serait un truisme s’il ne fallait comprendre qu’il ne peut y avoir de hausse du
niveau général des prix qu’à la condition qu’une offre de monnaie
supplémentaire l’ait permise, autorisée pourrait-on dire. Des politiques
monétaires inadéquates de la part des Banques centrales peuvent tout à fait
conduire à influer sur le niveau général des prix et indirectement sur la
croissance. Une déflation peut ainsi s’expliquer par une contraction subite et
malencontreuse de la masse monétaire et c’est ainsi un « crime » qui selon M.
FRIEDMAN aurait été commis avec le Coinage Act de 1873 qui démonétise
subitement l’argent et se trouve être à l’origine de la déflation. M. FRIEDMAN
aurait pu relever que, dès 1890, le Silver Purchase Act est venu comme son
nom l’indique faciliter la création de liquidités en échange d’argent, assouplissant
la politique monétaire et limitant le caractère déflationniste du Coinage Act. Mais
cela peut aussi donner du crédit à sa thèse si cet assouplissement est survenu
tardivement au cœur d’une phase déjà déflationniste et pour y mettre fin.
Récessions et pressions déflationnistes – comme celles survenues entre 1873 et
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
1879, 1893 et 1896, 1920 et 1921 ou encore 1929 et 1933 – seraient ainsi la
conséquence de contractions de la masse monétaire que la Fed n’aurait pas su
éviter. Les Banques centrales pourraient être rendues responsables du fait de ne
pas maitriser ou de mal maitriser les évolutions de la masse monétaire et la
spéculation au cours de certaines périodes, et de réagir de manière inappropriée
au terme de ces périodes par des politiques (de hausse des taux de réserves
obligatoires) trop brutales. De surcroît, elles auraient choisi d’agir au moyen de
variations de taux d’intérêt (moyen seulement incitatif) et non d’un contrôle
suffisamment strict (coercitif) de l’évolution de la masse monétaire : ainsi M.
FRIEDMAN regrette-t-il en 1980, que « la FED ait donné son cœur à la maitrise
des taux d’intérêt plutôt qu’au contrôle quantitatif de la masse monétaire ».
2. La surprise monétaire
R.E. LUCAS franchit un pas supplémentaire en 1972 puis en 1987 en
voulant réintégrer la microéconomie dans l’analyse des cycles, procéder comme
il l’affirme « à une réintroduction dans le cadre général de la théorie micro
économique de problèmes agrégés comme l’inflation et les fluctuations cycliques
». R.E. LUCAS considère que les cycles sont le résultat de chocs d’offre de
monnaie qui, lorsqu’ils ne sont pas anticipés par les agents (entreprises,
ménages), placent face à un problème dit d’extraction du signal. Les entreprises
feraient mal la distinction entre une pression à la hausse sur les prix de vente
résultant d’une demande à la firme – à elles-mêmes –, qui les inciterait à produire
davantage, et une hausse qui ne serait que le produit d’une élévation du niveau
général de prix elle-même due à une création soudaine de monnaie. Affectées
par une fonction de surprise quant aux prix, les prix effectifs (P) étant plus élevés
que ceux qui avaient été anticipés (Pa), elles vont élever leur niveau de
production Y par rapport à la production correspondant au sentier de croissance
naturel (Yn) : Y - Yn = α (P –Pa).
Ces problèmes d’information interviennent également sur le marché du
travail puisque la variation du niveau général des prix va avoir des conséquences
sur le salaire réel, entrepreneurs et salariés risquant de faire dévier le niveau
effectif de l’emploi du niveau naturel et donc du taux de chômage naturel : en
produisant davantage, la demande de travail augmente, faisant pression à la
hausse des salaires nominaux, ce qui peut conduire à une hausse de l’offre de
travail. Mais l’inflation dont auront rapidement conscience les deux types
d’agents viendra les rappeler à l’ordre, les ramener à la réalité : la production
supplémentaire non désirée et vendue réduira la demande de travail à son
niveau naturel tandis que l’inflation et la baisse du salaire réel réduiront l’offre de
travail. C’est donc un problème d’information quant au choc d’offre initial qui
explique cette déviation du sentier de croissance. Mais s’il est possible de
tromper 1000 fois une personne, il n’est pas possible de tromper une personne
1000 fois. La Banque centrale risque de perdre sa crédibilité. Ainsi doit-elle selon
R.E. LUCAS, afin d’éviter ces fluctuations inutiles, doit être tenue à des
engagements stricts, et en particulier à une parfaite transparence quant à la
régularité de l’accroissement de la masse monétaire prévue dans ses statuts. A
l’heure où l’on s’interroge sur une éventuelle publication des minutes de
délibération des conseils de politique monétaire et où le forward guidance a
pris une place considérable dans la conduite des politiques monétaires pour
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
ancrer les anticipations des agents, on peut s’étonner de la capacité, dépeinte
par R.E. LUCAS, d’une Banque centrale à pouvoir agir dans le secret. On peut
cependant se souvenir qu’au début des années 1960 en France, l’expression « le
plafond est crevé » pouvait être utilisé pour décrire un dépassement imprévu
d’évolution de la masse monétaire eu égard aux objectifs fixés par les autorités
monétaires elles-mêmes. L’inquiétude de R.E. LUCAS n’est donc pas dénuée de
fondement. Mais cela ne signifierait-il pas qu’il faille abandonner l’hypothèse
d’une offre exogène de monnaie ? Et l’idée d’une détermination des cycles par
des chocs monétaires au profit de l’idée inverse ?
3. Et si l’offre de monnaie était endogène, et plutôt rarement exogène ?
C’est la conclusion défendue par la théorie des cycles réels de F.E.
KYDLAND et E.C. PRESCOTT avec l’idée de « Rules rather than discretion : The
inconsistency of optimal plans », in Journal of Political Economy (1977). L’offre de
monnaie y est considérée comme parfaitement endogène et donc « superneutre
» et ses variations sont une conséquence – et non une cause – des cycles dont la
nature est « réelle » (cf. supra). A la place d’un multiplicateur de crédit, c’est
un diviseur de crédit qui est ici privilégié, car la fonction de prêteur en dernier
ressort de la Banque centrale la conduit le plus souvent à « valider » les choix
des banques de second rang en matière de prêts, lorsque la situation est telle
qu’il y a à craindre l’illiquidité voire l’insolvabilité de nombreuses banques. Les
variations du crédit bancaire sont ici les conséquences de variations de la
demande de crédit de la part d’investisseurs qui ont pris leurs décisions en
fonction de chocs réels de productivité. Plus que la politique monétaire, c’est la
politique d’octroi de crédit qu’il s’agit alors d’observer pour expliquer les cycles,
ce que les Banques centrales semblent pouvoir influencer mais non parfaitement
maîtriser.
4. Cycles et « art difficile des banquiers centraux »
Bien avant M. FRIEDMAN et R.E. LUCAS, R.G. HAWTREY, avait montré
à quelles difficultés se heurtaient les Banques centrales dans les cycles
économiques. Son analyse peut être résumée par la succession de titres de ses
ouvrages : The Trade Cycle (1926), Trade and Credit (1928) et The Art of Central
Banking (1932). Les cycles des affaires sont reliés au crédit et l’action des
Banques centrales en la matière relève d’un art difficile. Fondant son analyse au
début des années 1930 sur le régime d’étalon-or, il montre en quoi la défense
de l’encaisse-or par la Banque centrale et son taux d’escompte, (au fondement
du régime de l’étalon-or), était un principe stabilisant pour la valeur des
monnaies, mais pouvait aussi s’avérer déstabilisant et à l’origine de fluctuations
de l’activité économique. Monnaie et crédit sont imbriqués : lorsque la Banque
centrale abaisse son taux d’escompte (prix que paient les banques pour avoir
accès aux liquidités en échange de créances commerciales), elle stimule le crédit
et le commerce, et in fine, les prix vont tendre à augmenter lorsque sont
rencontrées les capacités de production. La Banque centrale n’a alors d’autre
possibilité que d’élever le taux d’escompte donc de freiner le crédit. Les cycles
auraient une origine monétaire, de par la difficulté des Banques centrales à éviter
les variations du taux d’escompte en fonction de l’activité commerciale.
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
A. GREENSPAN, l’ancien gouverneur de la FED, affirmait lui-même qu’« il
est très difficile à une banque centrale de se substituer au jugement de milliers
d’investisseurs et de s’y opposer ». Cela pouvait sonner comme un aveu
d’impuissance : en tant que gouverneur de la FED, il pouvait tenter d’ancrer les
anticipations inflationnistes en régulant les évolutions de la masse monétaire,
mais il admettait ainsi en filigrane ne pas pouvoir maitriser la spéculation,
l’inflation des prix d’actifs, l’évolution de l’endettement global, en particulier
lorsqu’ils sont liés à une vague d’euphorie concernant des innovations comme
celles de la fin des années 1990 lorsque s’est formée une bulle financière sur les
valeurs des NTIC du Nasdaq, ou au début des années 2000 sur les titres
subprimes. Plus tôt, le gouverneur de la Banque du Japon s’était lui aussi heurté
à la difficulté d’éviter une bulle immobilière et financière par une hausse des taux
directeurs, puisqu’il était dans le même temps tenu d’éviter l’appréciation du yen
conformément aux accords du Louvre de 1987. L’éclatement de la bulle
japonaise en 1990 et 1991 fut le point de départ d’une longue récession
déflationniste que seules des politiques de taux très faibles et négatifs et de
multiples plans de relance ont limitée. De la même manière, l’éclatement de la
bulle des subprimes a précipité l’économie mondiale dans la récession de 2009,
élevé les taux de chômage et fait craindre la déflation que seules des politiques
non conventionnelles de quantitative easing et de taux négatifs ont pu
éviter.
B) Des cycles financiers plus que monétaires.
Peut-être est-ce ainsi vers le secteur financier qu’il faut se tourner pour
bien expliquer les cycles. Dès 1898, K. WICKSELL avait mis en évidence que «
l’offre de monnaie est en théorie illimitée mais en pratique contenue dans
certaines limites ». Une manière de dire qu’à présent qu’il est désormais
communément – c’est-à-dire socialement et psychologiquement – admis que la
monnaie puisse être émancipée de contraintes de production matérielles dans
son émission – il est aisé techniquement de créer de la monnaie fiduciaire et plus
encore scripturale –, mais qu’il faut de fait pouvoir compter pour que sa fonction
de réserve de valeur soit assurée pourvoir compter sur des règles d’émission. La
monnaie peut être créée à partir de rien mais elle ne saurait l’être en
contrepartie de rien. A partir du moment où il revient à un système bancaire,
constitué autour d’une Banque centrale et de banques privées de second rang,
de créer la monnaie par le crédit – « les crédits font les dépôts » selon
l’expression de WHITERS en 1901, est « créateur de monnaie ad hoc » selon
celle de J.A. SCHUMPETER –, le taux d’intérêt effectif pouvait devenir
inférieur à un taux d’intérêt naturel, c’est-à-dire un taux d’équilibre égal à la
productivité marginale du capital, ou encore un taux qui devrait équilibrer
parfaitement le marché du capital si l’investissement ne devait dépendre que
d’une épargne préalable.
Cette divergence de taux et l’investissement supplémentaire autorisé par
la création monétaire et un taux d’intérêt effectif plus faible pourraient avoir des
conséquences inflationnistes s’inquiétait K. WICKSELL. Mais une autre
inquiétude se fait jour, non seulement du côté des prix, relatifs ou absolus, mais
du côté de l’accumulation du capital. En 1931, F.A. HAYEK s’inquiète ainsi de ce
que le crédit bancaire risque d’être à l’origine d’une surcapitalisation. En
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
économie de marché, la catallaxie ou jeu des prix relatifs constitue le
mécanisme essentiel d’information et d’allocation (et réallocation) de ressources
productives., c’est-à-dire qu’ils déterminent les choix d’investissement de la part
des entreprises en influant sur les profits relatifs. Cependant, un « nouvel
élément déterminant » est venu s’ajouter qui, en influant sur les prix relatifs,
influe sur les cycles : le crédit qui, facilité par la création monétaire, permet en
effet de dissocier l’investissement d’une épargne préalablement constituée,
éloignant du taux d’intérêt naturel d’une part mais contribuant d’autre part à
financer des investissements, des « méthodes de plus en plus détournées de
production » qui, selon F.A. HAYEK, n’auraient pas dû l’être. Un « triangle de
valeur » s’étirerait ainsi, « offrant » une place à un trop grand nombre
d’entreprises et de secteurs offrant des biens de production : ainsi observerait-on
un accroissement du capital investi entre les secteurs les en amont du système
productif (les matières premières) et les secteurs les plus en aval (les biens de
consommation). Le surinvestissement induit par le crédit générateur d’offre de
monnaie supplémentaire aurait hypertrophié le système productif eu égard à
celui qui aurait dû être si l’on avait seulement pu compter sur l’épargne préalable
des ménages, qui exprimeraient par ce comportement ce qu’ils attendent en
termes d’investissement. D’une certaine manière, le crédit bancaire créateur de
monnaie est acte de désobéissance à l’endroit des ménages, ce qui vient fausser
les choix et l’efficience de la catallaxie. Un retournement de politique monétaire
serait alors inévitable pour freiner le crédit et la surcapitalisation, se traduisant
par une hausse des taux d’intérêt. Celle-ci viendrait sonner le glas d’un grand
nombre d’entreprises entrant en situation d’insolvabilité et, les faillites des uns
entrainant celle des autres, serait à l’origine de la crise et du retournement du
cycle. Dans cette vision, la crise n’apparaît que comme le moment rationnel d’un
retour à une capitalisation respectueuse du taux d’intérêt naturel et d’équilibre.
2. La gueule de bois et on remet ça
Dès 1935, M. KALECKI avait montré en quoi la dynamique du capital
reposait sur un profit global des entreprises, engendré lui-même par
l’investissement. D’une certaine manière, les entreprises, considérées
globalement, collectivement, font leur propre profit par l’investissement :
l’investissement des unes est la condition d’existence du profit des autres.
Prolongeant une interrogation du Traité de la monnaie de J.M. KEYNES en 1930
sur l’existence d’un profit macroéconomique, la conclusion de M. KALECKI
anticipe sur un point la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la
monnaie : c’est l’optimisme quant aux profits futurs qui justifie l’investissement
qui lui-même fait le profit, entretient la croissance, et ainsi l’emploi. Encore faut-il
pouvoir financer ces investissements et donc trouver cet optimisme chez les
investisseurs en actions et les créanciers potentiels. Faute d’optimisme partagé
chez les apporteurs de capitaux, de manière intermédiée (crédit bancaire) ou non
(actions et obligations), il n’est pas d’investissement possible. Lorsque
l’optimisme n’est plus de mise, tant pour des causes monétaires (hausse des
taux d’intérêt) que pour des causes financières (crédit crunch, cf. cours sur la
finance et rôle des scandales financiers dans le retournement des tendances), la
baisse de l’investissement précipite la baisse des profits en même temps que la
baisse des prix. A l’endettement pour financer de nouveaux projets, une majorité
d’entreprises préfère le désendettement, qui contracte la masse monétaire et fait
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
pression à la baisse sur les prix. Alors peut s’enclencher le processus de déflation
par la dette de I. FISHER, où les débiteurs voient la valeur réelle de leur dette
s’élever tandis qu’ils tentent, dans un mouvement collectif, de réduire leur
endettement nominal. Le processus déflationniste enclenché fait passer de
l’euphorie au marasme les investisseurs et précipite la Grande Dépression.
3. L’instabilité financière du capitalisme
Ainsi serait-il peut-être inévitable de connaître des phases de financement
sain auxquelles succèderaient des phases d’euphorie où le financement
deviendrait de plus en plus spéculatif, c’est-à-dire plus risqué quant aux
perspectives de profit futurs. Jusqu’à ce que, confrontées aux premières
difficultés, des entreprises ne réussissent à contracter de nouveaux emprunts
que pour honorer leurs dettes contractées dans le passé. Un financement de type
PONZI s’établirait jusqu’au déclenchement d’une crise inévitable de
financement, révélant une interaction entre politique monétaire et conditions de
financement intrinsèquement instable. Tel est le paradoxe de la tranquillité et
l’instabilité financière intrinsèque du capitalisme décrite par H.P. MINSKY en
1982. Tout optimisme quant à des profits futurs à anticiper d’innovations peut
évoluer vers une dynamique spéculative : bien liée au réel en son fondement, la
finance finirait toujours par risquer d’en devenir déconnectée au point d’agir sur
la dynamique de croissance. L’optimisme peut se muer en euphorie quand les
innovations du moment laissent espérer des profits futurs élevés. « Vaincre les
forces du présent et percer le mystère qui entoure le futur » disait J.M. KEYNES
de la finance. Parfois le mystère est grand. Et lorsque le crédit s’est à ce point
développé qu’il s’est éloigné des profits raisonnables à espérer des innovations,
survient le moment où se retournent à la fois les anticipations, les conditions de
crédit et les tendances de la croissance. Surtout lorsque les innovations «
industrielles » (dont font partie les servicielles d’aujourd’hui) interagissent avec
des innovations financières. Comme C.D. ROMER l’observait, deux phases
devraient être distinguées au sein de la phase de croissance de type A qui suit la
reprise des innovations : ‐ une première plus financière, dont le caractère
potentiellement euphorique peut conduire à un ralentissement de croissance
lorsqu’éclate une bulle, une seconde plus « réelle », une fois les innovations
monopolisées par un plus petit nombre de firmes plus « solides » financièrement
et mieux à même de porter ces innovations. Peut-être parce qu’entre les deux, «
tel levier peut mieux que tel autre vaincre la résistance de la matière inerte. Mais
tous existent du fait que la résistance demeure » comme le rappelait K. MARX.
4. Windhandel : retour aux innovations, trop souvent oubliées
« Commerce du vent » (C.P. KINDLEBERGER). La première grande crise
spéculative de l’histoire financière a sans doute eu lieu en Hollande en 1636 et
1637. À Amsterdam avaient vu le jour des innovations que même la typologie de
J.A. SCHUMPTER semble laisser de côté – l’innovation financière – alors que la
définition même du capitalisme de J.A. SCHUMPETER insiste sur ce trait
caractéristique du « phénomène additionnel du crédit, c’est-à-dire de la création
monétaire ad hoc ». À Amsterdam déjà, des innovations financières comme les
options d’achat et de vente apparaissent alors que le marché d’options parisien
ne sera institutionnalisé qu’en 1986 avec la création du MONEP (marché
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
lOMoARcPSD|20856753
d’options négociables de Paris). Les options permettent d’acheter ou de vendre
ce qu’on appelle un sous-jacent, un actif qui, lui, est bien réel, mais sans avoir à
le détenir. Des droits d’acheter ou de vendre à des prix fixés à l’avance des actifs
ou des titres, dans le but de se couvrir de variations futures de prix, de procéder
à des arbitrages, ou de spéculer, conformément à la définition donnée par M.
KALDOR en 1954 : « L’achat ou la vente d’actif dans le seul but de réaliser un
profit à la revente de ce titre, indépendamment de son usage ». En 1929 ce sont
les procédures d’achat sur marge, c'est à dire la possibilité pour des brokers
d’acheter sur la base d’un effet de levier en avançant que 10% par exemple du
prix d’une action et donc en empruntant 90% de ce prix (en particulier auprès
d’entreprises à la trésorerie excédentaire) ont alimenté la bulle spéculative à la
bourse de New-York. En 2008, la crise a révélé que les dérivés de crédit pouvaient
désormais être des dérivés de dérivés de dérivés, des dérivés puissance n en
quelque sorte, représentant plusieurs milliers de fois les PIB de nations
industrialisées. Utiles comme toute innovation schumpetérienne, ingénieuses
comme des inventions Léonardiennes, elles n’en sont pas moins risquées.
A peine sortis d’une crise financière à l’origine d’une récession profonde
que même les plus libéraux des Etats ont cherché à limiter, nous observons que
des voix se font déjà entendre pour craindre une nouvelle bulle spéculative, une
nouvelle survalorisation des entreprises de la frontière technologique.
Innovations financières et innovations industrielles s’articulent pour susciter des
investissements qui eux-mêmes interagissent dans des dynamiques de
croissance instable, au sein d’économies de marché où les risques sont
probabilisés mais bien réels. Les profits en sont anticipés et jamais certains, car
chocs exogènes comme processus endogènes conditionnent leur caractère
effectif. L’économie de marché est ainsi faite qu’elle autorise des progrès
technologiques mais jamais avec certitude quant à leur survenance, leurs
impacts, les fluctuations qu’elles induisent. Leur amplitude et leur durée
resteront sans doute des mystères imprévisibles. L’effet d’hystérèse que fait
courir une crise grave sur le capital humain (baisse de l’employabilité) comme
physique (baisse des investissements en recherche-développement) réduit la
croissance future. C’est selon A.K. SEN ce qui rend la démocratie plus désirable,
car plus « efficace » qu’un pouvoir autoritaire, c’est qu’elle enjoint par principe
(alors qu’une dictature ne l’est que par choix) les gouvernements à des politiques
contracycliques, à renoncer au do nothing au profit d’une gestion publique et
volontariste des surprises conjoncturelles qui risquent d’affecter le long terme. Et
l’équilibre social et politique. Pouvoir distinguer les fluctuations pouvant être
laissées à elles-mêmes de celles dont les conséquences risqueraient d’être
irréversibles serait idéal. Utopique plutôt. Les crises sont autant révélatrices
d’abus passés que d’erreurs possibles dans les choix qu’elles nécessitent.
Téléchargé par Rida EN-NACHAF (ennachaf.rida@gmail.com)
Vous aimerez peut-être aussi
- 42 Sujets de Productions Écrites 1 BacDocument6 pages42 Sujets de Productions Écrites 1 Backhaled khaled80% (10)
- Etude de Marche Des FromagesDocument3 pagesEtude de Marche Des FromagesMeryem Nejma100% (2)
- Friedman KeynesDocument12 pagesFriedman KeynesSalutÇaVaMeknesPas encore d'évaluation
- L'illusion ÉconomiqueDocument418 pagesL'illusion Économiquesephirot2010100% (10)
- Les Théories Des Crises Économiques, FicheDocument11 pagesLes Théories Des Crises Économiques, FicheYousra Amakhtari El BouabdellatiPas encore d'évaluation
- Sujet 16 Corrige-CompletDocument11 pagesSujet 16 Corrige-CompletMohamed BaiyaPas encore d'évaluation
- Croissance ÉconomiqueDocument21 pagesCroissance Économiquemaroine ikhmim80% (5)
- Crises ÉconomiquesDocument43 pagesCrises Économiqueshamza1996Pas encore d'évaluation
- TP Doctrines PropreDocument46 pagesTP Doctrines Proprewilsonmaka010Pas encore d'évaluation
- Cours de Théorie Des CyclesDocument45 pagesCours de Théorie Des Cycleshmdniltfi100% (1)
- Les Fluctuations de La CroissanceDocument11 pagesLes Fluctuations de La CroissanceSewsen Charmati100% (1)
- First Prépa MeknesDocument11 pagesFirst Prépa Meknesmehdi benmassoudPas encore d'évaluation
- Problèmes Économiques - Comprendre Les Crises ÉconomiquesDocument132 pagesProblèmes Économiques - Comprendre Les Crises Économiqueskarim karim100% (2)
- 2135 Cycles Crises Et Guerres D Eacute Velopper La Finance en Attendant La ProchaineDocument6 pages2135 Cycles Crises Et Guerres D Eacute Velopper La Finance en Attendant La Prochainesababikarim7Pas encore d'évaluation
- La Face Cachée de La Crise Financière MondialeDocument151 pagesLa Face Cachée de La Crise Financière MondialeAl-amin MohammadPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Croissance Et DéveloppemmentDocument11 pagesChapitre 2 - Croissance Et DéveloppemmentjhnipmfsPas encore d'évaluation
- Chap 9 - La Croissance ÉconomiqueDocument4 pagesChap 9 - La Croissance Économiquetom renPas encore d'évaluation
- Vive La Crise Et L - InflationDocument252 pagesVive La Crise Et L - InflationCoucou ScofieldPas encore d'évaluation
- Unia Crises FinDocument75 pagesUnia Crises FinAbdo EłPas encore d'évaluation
- Synthèse Élève 3Document34 pagesSynthèse Élève 3Alpha FopaPas encore d'évaluation
- Thème: L'université A. MIRA de Bejaia Faculté SEGC Département SEGC Première Année - A2Document22 pagesThème: L'université A. MIRA de Bejaia Faculté SEGC Département SEGC Première Année - A2Saad GhoummidPas encore d'évaluation
- Croissance Et Développement Du XIXème Siècle À Nos JoursDocument11 pagesCroissance Et Développement Du XIXème Siècle À Nos Joursmohamed chekkelPas encore d'évaluation
- Le Cycle Kondratiev Mythe Ou Realite FuturiblesDocument16 pagesLe Cycle Kondratiev Mythe Ou Realite FuturiblesAlain TournebisePas encore d'évaluation
- L'Existence de La Révolution IndustrielleDocument2 pagesL'Existence de La Révolution IndustrielleRédha BelhachemiPas encore d'évaluation
- WP2013 14Document46 pagesWP2013 14tshimangakams46Pas encore d'évaluation
- La Crise Financière InternationaleDocument47 pagesLa Crise Financière InternationaleAsmahane TahiriPas encore d'évaluation
- La Crise de 1929Document119 pagesLa Crise de 1929bhtkimPas encore d'évaluation
- La Crise Des Subprimes Et La Crise FinancièreDocument28 pagesLa Crise Des Subprimes Et La Crise Financièreoussama el100% (1)
- Les Cycles: 2 Partie Du Cours de MacrodynamiqueDocument16 pagesLes Cycles: 2 Partie Du Cours de MacrodynamiqueISMAEL NJIKAMPas encore d'évaluation
- Cours Revolutions Industrielles1Document19 pagesCours Revolutions Industrielles1Andreea DulghieruPas encore d'évaluation
- Dle 1995 eDocument64 pagesDle 1995 exczq5gqwwhPas encore d'évaluation
- Les Cycles Économiques.Document9 pagesLes Cycles Économiques.Imane EL ALAOUIPas encore d'évaluation
- L. Desmedt, de L'hyperinflation Au Miracle Monétaire - L'expérience Hongroise de 1945-1946 Cairn - InfoDocument49 pagesL. Desmedt, de L'hyperinflation Au Miracle Monétaire - L'expérience Hongroise de 1945-1946 Cairn - Infosimplice tene penkaPas encore d'évaluation
- Crise de 1929, Cours 2023Document7 pagesCrise de 1929, Cours 2023hasdibaiPas encore d'évaluation
- I. L'inflation, Définition, Mesure, Et ÉvolutionDocument6 pagesI. L'inflation, Définition, Mesure, Et ÉvolutionDiallyn NoelPas encore d'évaluation
- Toute Sortie de Crise Est-Elle KeynesienneDocument9 pagesToute Sortie de Crise Est-Elle KeynesienneCamille GARATEPas encore d'évaluation
- Les Grandes Crises de L'histoire ÉconomiqueDocument5 pagesLes Grandes Crises de L'histoire Économiquetom renPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitSewsen CharmatiPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Croissance ÉconomiqueDocument10 pagesChapitre 1 Croissance ÉconomiqueChaimae BouzaganePas encore d'évaluation
- L'Analyse Des Cycles EconomiquesDocument34 pagesL'Analyse Des Cycles EconomiquesCorinne Sammut100% (2)
- Melissa Rezgui Et Sabri FerielDocument23 pagesMelissa Rezgui Et Sabri Ferielmelissa rezguiPas encore d'évaluation
- Pes 1Document4 pagesPes 1Maoukil TachPas encore d'évaluation
- PARETO Vilfredo Crises ÉconomiquesDocument16 pagesPARETO Vilfredo Crises ÉconomiquesIsmail El YakoubiPas encore d'évaluation
- La Croissance Économique ADocument5 pagesLa Croissance Économique AOmayma Es-saddikiPas encore d'évaluation
- Document 2 Pbs Eco Et SociauxDocument48 pagesDocument 2 Pbs Eco Et Sociauxلايف المشاهيرPas encore d'évaluation
- Crise CoDocument107 pagesCrise CoabderrrassoulPas encore d'évaluation
- L'InflationDocument21 pagesL'Inflationloubina020250% (2)
- Echanges Internationaux Et Organisation Mondiale Du CommerceDocument23 pagesEchanges Internationaux Et Organisation Mondiale Du CommerceAbdo EłPas encore d'évaluation
- Fiche - 1929 La Crise EconomiqueDocument2 pagesFiche - 1929 La Crise Economiquegiancarlo de cesarePas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - L - Instabilité FinancièreDocument32 pagesChapitre 3 - L - Instabilité FinancièreAmihaf IcamerPas encore d'évaluation
- Synthèse Chap 10Document5 pagesSynthèse Chap 10tom renPas encore d'évaluation
- Dominique Sarciaux Histoire Du XXe SiècDocument14 pagesDominique Sarciaux Histoire Du XXe SiècferkesPas encore d'évaluation
- Finances Publiques en Tunisie: Comment Financer Le Fardeau Croissant Des Dépenses Publiques en Période de Faible Croissance Économique ?Document21 pagesFinances Publiques en Tunisie: Comment Financer Le Fardeau Croissant Des Dépenses Publiques en Période de Faible Croissance Économique ?Yosr TliliPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Bachet FlocoDocument24 pagesChapitre 1 Bachet FlocoHàjàgh J'aPas encore d'évaluation
- Citations, Elements Factuels CrisesDocument6 pagesCitations, Elements Factuels CrisesClémentine BRUGUEROLLEPas encore d'évaluation
- La Croissance ÉconomiqueDocument14 pagesLa Croissance ÉconomiqueHicham AtroniPas encore d'évaluation
- Exemples D'usageDocument9 pagesExemples D'usagemsambihafilsPas encore d'évaluation
- Le capital au XXIe siècle de Thomas Piketty: Mieux comprendre les inégalités contemporainesD'EverandLe capital au XXIe siècle de Thomas Piketty: Mieux comprendre les inégalités contemporainesPas encore d'évaluation
- L'écologie contre le capitalisme: Ce qu'il faut sauver, ce qu'il faut stopperD'EverandL'écologie contre le capitalisme: Ce qu'il faut sauver, ce qu'il faut stopperPas encore d'évaluation
- Book review : Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie: Résumé et analyse du livre de John M. KeynesD'EverandBook review : Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie: Résumé et analyse du livre de John M. KeynesPas encore d'évaluation
- Soulèvements et recompositions politiques dans le monde arabeD'EverandSoulèvements et recompositions politiques dans le monde arabePas encore d'évaluation
- Mai 68, la France paralysée: De la révolte étudiante à la crise nationaleD'EverandMai 68, la France paralysée: De la révolte étudiante à la crise nationalePas encore d'évaluation
- Texte SupportDocument4 pagesTexte Supportkhaled khaled100% (1)
- Chapitre PremierDocument2 pagesChapitre Premierkhaled khaledPas encore d'évaluation
- ObjectifsDocument3 pagesObjectifskhaled khaledPas encore d'évaluation
- Faut-Il Chercher La DécroissanceDocument4 pagesFaut-Il Chercher La Décroissancekhaled khaledPas encore d'évaluation
- Rapport DSSMPIF 2021Document110 pagesRapport DSSMPIF 2021khaled khaledPas encore d'évaluation
- Les 100 Mots de La Géopolitique - PUF-1Document65 pagesLes 100 Mots de La Géopolitique - PUF-1khaled khaledPas encore d'évaluation
- (WWW - Al7ibre - Com) Devoir 1 Semestre 1 Francais TCS-BIOF Exemple 4Document3 pages(WWW - Al7ibre - Com) Devoir 1 Semestre 1 Francais TCS-BIOF Exemple 4khaled khaledPas encore d'évaluation
- Des Examens La Bîte À MerveillesDocument61 pagesDes Examens La Bîte À Merveilleskhaled khaled67% (3)
- 212-Article Text-725-1-10-20210617Document24 pages212-Article Text-725-1-10-20210617khaled khaledPas encore d'évaluation
- Bi Grammaire Chapitre 3Document30 pagesBi Grammaire Chapitre 3Oumar SaadouPas encore d'évaluation
- CA Peut Pas Rater Epub - 6Document1 pageCA Peut Pas Rater Epub - 6vebokebPas encore d'évaluation
- Mithra Et Le MithriacismeDocument25 pagesMithra Et Le MithriacismeSamuel Vincent Béranger BiteauPas encore d'évaluation
- G120 CU250S2 BA13 0414 FraDocument414 pagesG120 CU250S2 BA13 0414 Frafernando NOGUEIRAPas encore d'évaluation
- Samu Lyon ProtocolesDocument102 pagesSamu Lyon Protocolesjk0% (1)
- AntidotesDocument9 pagesAntidotesStradin Bien-aimePas encore d'évaluation
- Etude Ethnobotanique Dans Le Sud-Est de Chlef (Algerie Occidentale)Document18 pagesEtude Ethnobotanique Dans Le Sud-Est de Chlef (Algerie Occidentale)Akrem ZouabiPas encore d'évaluation
- Déclartations Global IS, Acompte IS État Honoraires, AcomptesDocument18 pagesDéclartations Global IS, Acompte IS État Honoraires, AcomptesItto MohaPas encore d'évaluation
- 013 Les Paraboles de Jesus en Saint LucDocument4 pages013 Les Paraboles de Jesus en Saint LucDr. Prevot Chirac BATSINDILAPas encore d'évaluation
- Chap 6 - Diag de ClassesDocument16 pagesChap 6 - Diag de ClassesalaesahbouPas encore d'évaluation
- PP Complet BoucettaDocument354 pagesPP Complet BoucettaRakia BenPas encore d'évaluation
- Maquette Du Master Génie Civil - Master PDFDocument4 pagesMaquette Du Master Génie Civil - Master PDFMohammed Mammar KouadriPas encore d'évaluation
- Le Seigneur Et Ephraïm - Jacob LorberDocument5 pagesLe Seigneur Et Ephraïm - Jacob Lorberestaran0% (3)
- Sur Un Air D'offenbachDocument12 pagesSur Un Air D'offenbachscribdPas encore d'évaluation
- PDF Programme Scf-2Document7 pagesPDF Programme Scf-2Kaddouri KaddaPas encore d'évaluation
- L'essence Double Du Langage Selon Gilbert HottoisDocument6 pagesL'essence Double Du Langage Selon Gilbert HottoisRui MascarenhasPas encore d'évaluation
- Exercices Synchrones 25487Document13 pagesExercices Synchrones 25487lukaPas encore d'évaluation
- Annexe Archeologie Projet Fevrier 2011Document126 pagesAnnexe Archeologie Projet Fevrier 2011Pierre KinyockPas encore d'évaluation
- Le Logement FLE Copie Professeur-5Document54 pagesLe Logement FLE Copie Professeur-5nelisnoemiePas encore d'évaluation
- Introduction XMLDocument9 pagesIntroduction XMLayoubkhPas encore d'évaluation
- La Revolution FrancaiseDocument5 pagesLa Revolution Francaisealehandro ozarPas encore d'évaluation
- Presentation Generale Du Programme en HebergementDocument3 pagesPresentation Generale Du Programme en HebergementMohamed Kandra CamaraPas encore d'évaluation
- Horaires Aleop 312 1-9-2023 Au 28-6-2024 PDFDocument7 pagesHoraires Aleop 312 1-9-2023 Au 28-6-2024 PDFtitouanmacheferPas encore d'évaluation
- Introduction A La Science PolitiqueDocument5 pagesIntroduction A La Science PolitiqueHürrem KIPIRTIPas encore d'évaluation
- 0 Guide-Maison-Ind - Neuve - Archi150413 PDFDocument40 pages0 Guide-Maison-Ind - Neuve - Archi150413 PDFABELWALIDPas encore d'évaluation
- Circulaire DGS 3A 667 Bis Du 10 Octobre 1985Document3 pagesCirculaire DGS 3A 667 Bis Du 10 Octobre 1985mourad laatatPas encore d'évaluation
- Organisation & Gestion Des Entreprises: Chapitre 2Document17 pagesOrganisation & Gestion Des Entreprises: Chapitre 2bouzianePas encore d'évaluation
- Mission 2004 Comment Accroitre Les Performances Par Un Meilleur ManagementDocument336 pagesMission 2004 Comment Accroitre Les Performances Par Un Meilleur Managementludtch3321Pas encore d'évaluation
- Compte Rendu - at CAO Elec S2Document36 pagesCompte Rendu - at CAO Elec S2boukariPas encore d'évaluation