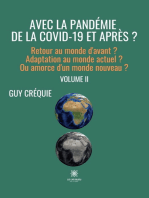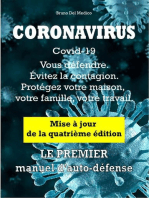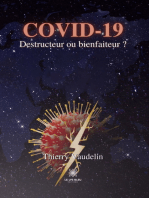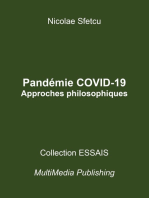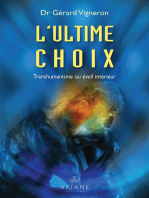Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Capitalisme Genetique
Transféré par
discomolinoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Capitalisme Genetique
Transféré par
discomolinoDroits d'auteur :
Formats disponibles
lundi
06.04.20
Analyse
Covid-19 et capitalisme
génétique
Par Thierry Bardini
Les formes actuelles de la viralité, qu’elle soit
biologique, informatique ou informationnelle,
organique ou numérique, caractérisent notre entrée
dans une nouvelle phase du capitalisme, le
capitalisme génétique. Loin de simplement exploiter
une réalité matérielle donnée, le nouveau capitalisme
produit cette réalité en l’augmentant.
I just need to have access to the pure virus, that’s all ! For
the future !
Terry Gilliam, Twelve Monkeys, 1995.
Extension du domaine du
confinement
Nous vivons actuellement la première pandémie virale
globale. Aujourd’hui, donc, nous sommes confiné·es,
comme tout le monde, ou presque. Aujourd’hui, nous
pratiquons la « distanciation sociale » et la
« quarantaine » plus ou moins auto-imposée. Aujourd’hui,
des drones peuvent nous interpeller dans la rue pour nous
enjoindre à rentrer dans l’ordre, à deux mètres de notre
prochain·e. Aujourd’hui, le signal GPS de nos téléphones
cellulaires sert au contrôle biopolitique d’un État plus ou
moins soudainement (selon les régimes, mais
globalement) revenu à s’intéresser à notre bien-être, à
notre santé. Aujourd’hui, les seuls travailleur·es qui
restent sont celleux qui n’ont pas le choix, dans la mesure
où leur travail est considéré comme « essentiel », où
celleux qui peuvent travailler depuis leur domicile. Les
premièr·es ont l’honneur insigne de pouvoir
éventuellement mourir pour les autres, tandis que les
second·es ont l’avantage de continuer à produire quand
même.
Aujourd’hui, chacun·e est libre de se sentir comme un·e
réfugié·e parqué·e dans son camp personnel, comme un·e
dissident·e, assigné·e à résidence, ou comme un·e
criminel·le en prison. Aujourd’hui, les plus optimistes
relisent La Chartreuse de Parme, pour y retrouver la
recette d’un allusif bonheur certes agrémenté de
panoptique numérique, version YouTube ou Netfix, 100%
garanti par les influenceur·es de l’heure. Aujourd’hui, les
plus pessimistes sentent la fin du meilleur des mondes
possibles, l’effondrement à venir, l’apocalypse.
Chacun·e, frappé·e d’une sorte de stupeur débilitante, fait
une autre expérience du temps, se réinvente peut-être des
routines pour tenir, passe quand même de son pyjama de
nuit à son pyjama de jour à huit heures tapantes, fait sa
journée comme ille peut, prend son apéro sur Skype ou
Zoom, et évite si possible de frapper les autres membres
du foyer encore présent·es—la presse rapporte cependant
qu’à Montréal la ligne SOS violence conjugale a enregistré
une hausse des appels de l’ordre de 15% depuis le début
du confinement, pendant qu’à Gatineau elle se demande si
c’est parce que les victimes sont confinées avec leurs
tortionnaires que les appels baissent.
Demain peut-être nous serons à l’hôpital, en attente
d’éventuels soins intensifs.
Soit ça manque d’air (c’est confiné), soit ça manque de
respirateur.
Soit ça manque de corps en présence (c’est confiné), soit
ça manque de soin.
Ça manque de personnel hospitalier.
Ça manque de tests, d’antiviraux, de lits, de masques,
d’alcool à friction, de thermomètres, de papier toilette,
de…
Ça manque ou ça risque de manquer : ON ouvre quand
même, ou pas, les écoles et les universités, les stades et
les arénas, les bars, les succursales de la société des
alcools ou du cannabis, les cavistes, les coffee-shops, les
centres commerciaux, les clubs échangistes, les musées,
les salons de coiffure et les officines dentaires. De petites
ruées précèdent les fermetures. Ça manque déjà, avant
même de manquer vraiment. Ça nous manque. Alors en
attendant, nous soignons nos angoisses du mieux que nous
pouvons.
Entrée en scène de virus
And you may ask yourself
How do I work this?[1]
Alors oui, nous nous la posons, cette question : que faire
(quand même)? Günther Anders nous indique une voie de
réponse : « S’il existe la moindre chance, aussi infime soit-
elle, de pouvoir contribuer à quelque chose en intervenant
dans cette situation épouvantable, dans laquelle nous nous
sommes mis, alors il faut le faire. » Mais quelle
intervention est-elle maintenant possible? Pour ma part, je
n’en connais hélas qu’une seule : chercher à faire des
liens pour prendre la mesure de cette situation
épouvantable, traquer l’évidence non réfléchie, instruire
par le verbe le procès du monde – participer à donner les
moyens d’émettre un jugement à son égard pour mieux
pouvoir y agir. Or il me semble justement que la situation
actuelle peut donner matière à un tel travail, une sorte
d’arraisonnement en retour des discours techniques et
politiques au sujet du virus, pour inaugurer une certaine
manière de vivre en poète avec virus. En bref, apprendre
de cette situation épouvantable, pour peut-être moins
nous épouvanter la prochaine fois, et idéalement,
« changer le monde » au passage. Penser avec virus.
Le mot « virus » existe certes depuis longtemps, mais les
virus biologiques seulement depuis le début du vingtième
siècle, les virus informatiques seulement depuis son
dernier quart[2], alors que la viralité sur les réseaux
sociaux, quant à elle, est une invention du vingt-et-unième
siècle, une sorte de bouche-à-oreille 2.0. « Virus » vient du
latin, où il signifiait « suc, jus, bave, humeur ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection », mais aussi,
chez Pline, « semence animale ». En français, il semble
qu’une des premières utilisations du mot au sens d’agent
infectieux, « substance capable de transmettre la
maladie », date de 1478.[3] En anglais, au début du même
siècle, il apparaît au sens de « pus suintant d’une
blessure » dans une traduction d’un traité du grand
chirurgien milanais Lanfranc. Dans cette même langue,
son usage au sens d’agent infectieux est bien établi dès
1785, en référence aux maladies vénériennes. En français,
un autre chirurgien de renom, Ambroise Paré, avait déjà
fait ce lien dès le seizième siècle dans ses traités où il
évoque le virus verollique, ou celui de la rage.[4]
Cependant, en parallèle à ce que nous considérons
maintenant comme l’évolution de son sens « propre »
(même si toujours utilisé pour qualifier quelque chose de
« sale » ou de dangereux), un autre sens, maintenant
considéré comme figuré, travaille en sous-terrain dans nos
langues : celui d’un agent de contagion morale. Ce sens
est déjà bien établi durant la Révolution française,
lorsqu’un chroniqueur évoquait « les communes les plus
infectées de ce virus », en parlant de « l’alliage du
fanatisme, de l’intolérance avec l’amour de la liberté. »[5]
Dans un autre document de la même année, un autre
chroniqueur parlait de « purifier du limon de
l’aristocratie » les sociétés populaires qui en étaient
infectées, démontrant ainsi que cette métaphore de la
contagion morale était déjà fort commune.
Dès 1925, le mot prenait encore un autre sens figuré,
cette fois-ci sans connotation péjorative : « goût très vif ou
même excessif pour quelque chose, passion. » ON dira
alors qu’ON a attrapé le virus de quelque chose, comme,
dans une métaphore connexe qui évoque son contraire, le
vaccin, ON pourrait dire qu’ON « en a la piqure ». La
généalogie de virus – depuis ses sens hérités du Moyen
Âge et des discussions théologico-politiques de
l’excommunication et de la contagion des pêchés, jusqu’à
ceux, modernes, d’une science médicale triomphante sous
couvert du paradigme de la biologie moléculaire et de la
thérapie génique, sans cesse annoncée comme remède à
tous les maux, ou des virus de l’esprit et autres memes –
est donc extrêmement équivoque.
Cependant, malgré cette profusion de sens, s’il fallait
rajouter un qualificatif à l’action des virus, il est fort
probable que la plupart s’accorderaient sur
« infectieuse ». Les virus, comme chacun·e sait, sont des
agents infectieux. Pour peu que vous toussiez un peu, vous
vous écrierez certainement, « j’ai encore attrapé un
mauvais virus ». Ce en quoi vous vous tromperez
certainement ! D’abord parce que les mêmes symptômes
pourraient provenir d’une infection bactérienne, et
ensuite, et surtout, parce qu’ON n’attrape jamais UN
virus. Les virus viennent en meutes, en bandes, en hordes,
bref, toujours au pluriel. Ce sont des véritables colonies
virales que vous avez attrapées, si jamais.
Certains virus (mais pas le SARS-CoV 2 de la COVID-19)
peuvent en outre se transmettre eux-mêmes comme gène
et passer ainsi dans le patrimoine génétique d’une autre
espèce, non sans emporter des « informations
génétiques » venues de leur hôte initial, dans un
processus généralement appelé transduction par les
biologistes. Des résultats récents de la virologie
considèrent la transduction à la fois comme le processus
élémentaire de l’individuation du vivant et comme un
moteur de l’évolution des espèces. La transduction virale
décrit donc effectivement une sorte de résonance interne
minimale du vivant, dans la mesure exacte où l’existence
virale consiste en cette perpétuelle mise en relation du
milieu intérieur et du milieu extérieur. Comme un virus
transducteur n’a jamais absolument de code propre – son
code est toujours à la fois son code et celui d’un autre, il
n’a pas systématiquement de milieu intérieur propre – son
milieu intérieur est alternativement le sien et celui de son
hôte.
Claude Bernard disait déjà que la vie est le résultat du
contact de l’organisme et du milieu ; nous ne pouvons pas
la comprendre avec l’organisme seul, pas plus qu’avec le
milieu seul. Le virus, comme forme de vie la plus
élémentaire, n’est ni intrinsèquement autonome, ni
intrinsèquement dépendant, mais bien alternativement les
deux. Son corps est transitoire et relatif, pure relation,
pure immanence. Plus encore, ce qui vaut pour la relation
au milieu vaut aussi pour la relation à l’un et au multiple.
Le virus, conçu comme entité, n’est ni un, ni multiple, ni
individuel, ni population de codes variables, colonie ou
meute, mais alternativement les deux. Le virus décrit donc
cette limite inférieure de la vie où l’individu est pure
relation : il existe entre deux colonies, ne s’intégrant à
aucune, et son activité est une activité d’amplification de
l’être. Le virus transducteur nous fournit bien ce
paradigme élémentaire du vivre ensemble qui caractérise
le devenir du vivant, où ce « deux » est toujours déjà n.[6]
Capitalisme génétique
Ils sont légion et toutes les bases leur appartiennent,
comme le dit le meme sur l’Internet. Ils sont les passeurs
de bases, les producteurs de séquences de bases, les
transducteurs de bases. Toutes les bases, potentiellement,
sont déjà à eux. Ils forment, in-forment et trans-forment
les séquences de bases. Ils sont bases ; comme on dit
« bases arrières », « bases de données », « bases
militaires », et « camps de base ». À la base, vous les
trouverez assez systématiquement : assise, support, socle,
origine, fondement et principe, ce sur quoi et ce à quoi
tient maintenant la vie.
Ils sont virus. Ils n’existent qu’au pluriel, et font fi des
oppositions auxquelles nous semblons tenir avec autant de
rancœur, nous les petits humains toujours au singulier. Ils
sont légion et multitudes, flux de code, toujours déjà
décodés et surcodés. Nous, les humains, croyons avoir
tout compris en les réduisant à leur code, à leurs
séquences, leurs chiffres et leurs lettres. Comme
d’habitude, nous avons tout compris et rien compris, bien
sûr : nous commençons à peine à explorer leur réalité. Les
bases ne sont que les noms que nous donnons à leur
matérialité moléculaire la plus élémentaire, que nous nous
plaisons à égrener comme un alphabet à quatre lettres : A,
T, C, G. A, adénine ; T, thymine ; C, cytosine ; G, guanine.
Quelle simplicité, quelle économie!
Nous, les humains, croyons connaître leurs formules
chimiques et leurs affinités électives. Bases puriques et
pyrimidiques, spécifiquement couplées une à une par des
liaisons hydrogène : A:T/C:G. Une structure possédant des
caractères nouveaux d’un intérêt biologique considérable,
comme le disaient avec une fausse candeur les deux
individus qui se sont accaparé tout le crédit disponible
pour cette « découverte » qui fait époque : il n’a pas
échappé à notre attention que l’appariement spécifique
que nous avons postulé suggère un possible mécanisme de
copie du matériel génétique, écrivaient-ils.[7]
Intérêt = crédit = mécanisme. Ah la belle équation !
Nous, les humains, croyons dur comme matière en nos
fictions (surtout quand elles rapportent). Un gène, une
protéine. De nos fictions, nous inférons un monde que
nous arraisonnons par notre technique, pour mieux nous
l’approprier séance tenante et en faire notre monde,
construit sur et par nos fictions. Nous, les humains,
croyons connaître le normal et le pathologique, et divisons
le monde en conséquence. Nous, les humains, ne doutons
de nos fictions que pour mieux leur inventer de nouveaux
ressorts causaux. « Efficience » est le nom de notre
errance, que nous aimons considérer comme seule
logique.
Devenus industrieux, nous avons capitalisé sur nos
instruments, et rebaptisé notre logique en conséquence :
instrumentale. Au passage, les virus sont éventuellement
devenus nos instruments les plus élémentaires, les
vecteurs de nos errances, de notre manie d’appropriation.
En fait, ils sont la base même du développement d’une
nouvelle phase du capitalisme mondial. Le patrimoine
génétique est ainsi devenu le fonds de commerce d’un
nouvel eldorado, et les virus leurs nouveaux agents –
comme dans « agents de change » ou « agents
d’immeuble ».
Aujourd’hui en effet le vivant, quelle que soit notre
incapacité à le définir encore, quelles que soient ses
frontières floues, représente le potentiel de
développement le plus fantastique pour le marché,
un formidable réservoir d’opportunités de business,
comme on dit en franglais international. Deux ans avant la
fin du dernier siècle, un gourou de la prospective avait
déjà qualifié notre siècle, le vingt-et-unième, de « siècle
biotech ». Peut-être ne faudrait-il pas trop le prendre au
sérieux – il avait aussi naguère promis la fin du travail,
l’âge de l’accès, et plus récemment la civilisation de
l’empathie et la troisième révolution industrielle – mais
quand même…
Quand même, l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE), véritable fer de
lance de l’idéologie libérale des pays les plus riches de la
planète, définissait dès 1982 les biotechnologies
comme « l’application des principes scientifiques et de
l’ingénierie à la transformation de matériaux par des
agents biologiques pour produire des biens et services ».
La même Organisation considérait que la résolution des
problèmes mondiaux de l’alimentation, de la santé et de
l’environnement dépendrait dans une grande mesure du
développement des industries qui les emploieraient. Rien
de moins.
Trente-huit ans plus tard, les mêmes problèmes
continuent d’accabler la planète – et surtout ses
habitant·es les plus pauvres, relativement de plus en plus
nombreux – mais les biotechnologies sont toujours là, et
elles se portent bien, elles. Le 25 mars 2015, la Grande
chambre des recours de l’Office Européen des Brevets
(OEB) a officiellement conclu (pour un temps ?) une
polémique qui aura duré près de quarante ans et ouvert la
voie au brevetage du vivant en Europe (pourtant
longtemps réfractaire à cette possibilité) en décrétant
qu’un produit obtenu par un procédé essentiellement
biologique est [dorénavant] brevetable. Les grands
acteurs universitaro-industriels des biotechnologies
n’avaient certes pas attendu cette conclusion : selon des
travaux publiés au mois d’octobre de la même année dans
la prestigieuse revue Science, environ 20% des gènes
humains font déjà l’objet de brevets. Sans parler de ceux
déposés et acceptés pour rendre propriétaires les
séquences en provenance d’autres formes de vie –
animales, végétales, bactériennes, ou virales, bien sûr.
À la définition originelle et quelque peu abstraite de
l’OCDE se sont substitués de nouveaux vocables, au fur et
à mesure du développement de la science et des stratégies
de relations publiques des grandes industries
biotechnologiques de ce monde : génie génétique hier,
biologie de synthèse aujourd’hui. Un crabe, sous n’importe
quel nom, n’oublierait pas la mer, écrivait naguère Paul
Éluard (avec l’aide de Benjamin Perret). Aujourd’hui,
Wikipedia, cette encyclopédique base de connaissances au
goût du jour, regrette l’abus de langage qui consiste à
restreindre les biotechnologies au seul génie génétique –
et plus précisément aux technologies issues de la
transgénèse, cette capacité à implanter une séquence d’un
être vivant dans un autre, faisant ainsi de ce dernier un
être vivant transgénique, aussi appelé organisme
génétiquement modifié (ou OGM). Wikipedia date un peu,
cependant : le vrai goût du jour, c’est maintenant la
synthèse d’un organisme entier, et non plus sa « simple »
modification. Les OGM, c’est déjà du passé, dépassé. Nous
entrons dans l’ère de l’ingénierie de la créature.
L’heure est en effet à la biologie de synthèse, et le rêve
démiurgique de la production artificielle du vivant semble
(enfin ?) à la portée des ambitions humaines – qui, comme
chacun sait, sont sans limites. Ce rêve-là n’est certes pas
nouveau. Il suffit pour s’en convaincre de citer, comme
tout le monde qui s’intéresse à cet apparent destin des
savoirs et pratiques biologiques, la fameuse injonction du
professeur Stéphane Leduc, dès 1912 : La biologie est une
science comme les autres, soumise aux mêmes lois, aux
mêmes règles, à la même évolution ; les mêmes méthodes
lui sont applicables. Comme les autres sciences, elle doit
être successivement descriptive, analytique et
synthétique.
En notant qu’en ce début de siècle, seule la chimie
organique synthétique était déjà constituée, reconnue, et
admise, Leduc se demandait non seulement pourquoi les
autres parties de la biologie synthétique n’existaient pas
encore, mais surtout pourquoi leur étude n’était même pas
admise. S’il ne se hasarda pas à donner une réponse à sa
propre question, il en proposa une autre (rhétorique ?) en
lieu et place : en quoi est-il moins admissible, se demanda-
t-il, de chercher à faire une cellule que de chercher à faire
une molécule ? Aujourd’hui, c’est chose faite : dès 2003,
Craig Venter et son équipe annonçaient la création du
premier virus de synthèse, le phage ϕX174.
Depuis les années soixante, « virus » s’est en fait imposé
tranquillement comme la signature d’une nouvelle forme
du capitalisme, que j’appelle capitalisme génétique.
Comment, en quelques décennies, ce qui paraissait
antérieurement comme le germe du mal, l’ennemi
invisible et redoutable de tous les accros de l’hygiène
physique ou psychique, a-t-il pu devenir ainsi la mesure
même du succès, le parangon de la réussite numérique ?
Aujourd’hui en effet, il semble que nous pouvons tout
autant craindre être contaminés par un virus que rêver
d’en devenir un, et contaminer les autres (sur Facebook
ou Instagram).
D’aucun·es ne manqueront pas de penser que tout ceci
n’est guère que métaphore, que ce n’est que par les
hasards d’une culture de plus en plus globale, et donc de
plus en plus aliénante, que le même mot, virus, peut
désigner à la fois un coronavirus, une infection de votre
disque dur, ou vous-même sur Twitter – autant de
manifestations étrangères les unes aux autres, qu’aucune
causalité certaine ne paraît lier entre elles. Celleux-là
diront que ce n’est que par la malchance résultante d’une
pauvreté lexicale affligeante que le même mot, virus, en
vint, au début des années quatre-vingt, à passer à la fois
pour la cause du mal de cette fin de siècle, le terrible
Syndrome d’Immuno-Déficience Acquis, et des infections
qui affecteraient dès lors nos ordinateurs en nombre
proliférant.[8]
À ceci je rétorque[9] que le virus est le moteur de notre
subjectivation à venir, sous le régime rénové des
dispositifs des sociétés génétiques, qui feront bientôt
passer ceux des sociétés disciplinaires et des sociétés de
contrôle pour de grossiers jeux d’enfants. Non plus : je
peux te mater, te contrôler, te surveiller ou te punir. Mais
bien : je peux te faire (et te défaire). We can build you,
comme l’écrivait un visionnaire (Philip K. Dick) dès 1972.
Ultime avatar de la honte prométhéenne jadis
diagnostiquée par Günther Anders comme le symptôme le
plus clair de l’obsolescence de l’homme, transformée
aujourd’hui en vecteur de l’angoisse terminale des sujets
désaffecté·es des sociétés post-post-industrielles, le virus
s’impose comme la forme à venir de notre condition, son
actualisation fatale et prolifique. Baudrillard l’avait
compris dès la fin du siècle dernier[10]. Et il avait raison :
ceci n’est pas une métaphore.
Machine du quatrième
type et subjectivation
virale
Ma thèse, brièvement énoncée, est la suivante : les formes
actuelles de la viralité, qu’elle soit biologique,
informatique ou informationnelle, organique ou
numérique, caractérisent notre entrée dans une nouvelle
phase du capitalisme, le capitalisme génétique. Dans cette
nouvelle phase, les dispositifs de subjectivation
s’articulent sur des machines cybernétiques maintenant
capables d’effectuer concrètement la convergence des
codes, du code binaire des ordinateurs au code génétique
du vivant, et vice-versa, du « vrai monde » de la matière à
une couche d’information qu’elles lui surimposent, et vice-
versa. Loin de simplement exploiter une réalité matérielle
donnée, le nouveau capitalisme produit cette réalité en
l’augmentant.
Ceci est particulièrement vrai dans le domaine du vivant.
Dans ce domaine, le capitalisme génétique dépasse toute
forme d’amélioration antérieure (domestication, dressage,
élevage, croisement, sélection génétique), en ouvrant la
voie vers la synthèse d’êtres vivants ou de parties d’êtres
vivants augmentés par des moyens issus de la maîtrise de
ces nouvelles machines cybernétiques (de l’ADN
recombinant à CRISPR-Cas9). L’espèce humaine apparaît
donc en mesure de devenir le designer du vivant, du fait
du développement de ces technologies. Alors que jusqu’à
présent l’humain transformait les performances du vivant,
il peut maintenant en modifier les compétences mêmes,
inaugurant ainsi l’ère de l’ingénierie de la créature : par-
delà le phantasme de « la production de l’homme par
l’homme » (sic), se profile la machine du quatrième type et
sa production de matériau vivant partiellement ou
totalement synthétique.
Quelle est donc cette machine, qui reconfigure maintenant
le vivant comme potentiel produit, comme marchandise
manufacturée ? Après les machines archaïques des
sociétés de souveraineté (I), après les machines
motorisées des sociétés disciplinaires (II), après les
machines informatiques des sociétés de contrôle (III),
l’humanité fait maintenant face à l’émergence de ses
machines bio-informatiques (IV). La dernière phase en
date de la série souveraineté/discipline/contrôle, théorisée
par Michel Foucault[11] et Gilles Deleuze[12] au siècle
dernier, est l’encodage/décodage cybernétique du vivant
même, ADN et bits.
Le prototype de la machine de troisième espèce, le
régulateur à boules de James Watt, est advenu avec la
première machine motorisée fonctionnelle, le moteur à
vapeur. De la même manière, la machine génétique est
advenue avec le premier ordinateur pleinement
fonctionnel, la machine informatique personnelle et
distribuée. Le chiasme de la modernité tardive est donc le
suivant : la machine génétique est à la machine
cybernétique ce que le régulateur à boule était au moteur
à vapeur. Ce n’est qu’une fois que le monde a été
enveloppé dans un réseau global d’ordinateurs personnels
gonflés à bloc que le vivant a pu être réduit à une banque
de données génétiques.
Le génome décrypté est le nouvel étalon, remplaçant la
monnaie en un nouvel équivalent général, et la banque de
données génétiques est l’institution financière du futur. La
théorie de la valeur rapidement esquissée ici se conçoit
comme suit. Comme le voulait l’économie politique
marxiste, le temps de travail aurait dû être à l’ère
industrielle le référent de la valeur d’usage, traduit en
salaire par le medium de la monnaie. Mais sous la forme
du capital fixe, le référent ultime devint plutôt la machine,
moteur d’une économie entièrement tournée vers la
valeur d’échange. Lorsque le capitalisme est devenu
essentiellement financier, la monnaie s’est affranchie de
son rôle d’intermédiaire et de son ancrage dans la
matérialité du travail pour devenir sa propre cause, son
propre medium : la monnaie sert alors avant tout à
produire de la monnaie, dans une spirale de virtualisation
hors contrôle, où la monnaie devient essentiellement
information.
Or voici qu’apparaît un type d’information qui change à
nouveau la donne : l’information génétique, comme en
témoigne l’usage de la notion de « patrimoine génétique ».
La dernière frontière du capital, c’est la monnaie vivante,
et lorsque la matérialité revient dans l’équation, ce n’est
plus en tant que cause première, mais bien cette fois sous
la forme de la conséquence. D’organe reproducteur de la
machine, l’humain en devient le produit. Virus est le stade
élémentaire de la monnaie vivante.
L’ère des biotechnologies informatisées inaugure ainsi de
nouvelles formes de subjectivation. Les êtres humains ont
d’abord été asservi·es aux machines de premier type,
lorsqu’illes apparaissaient à toutes fins pratiques en être
des pièces constituantes. Illes devinrent ensuite
assujetti·es aux machines de deuxième type, en
apparaissant non plus comme une de leurs composantes
mais comme leur opérateur, leur ouvrier. La machine
cybernétique, ou machine du troisième type, construit à
son tour un mode subjectivation généralisé, qui agrège
dans un mode de contrôle étendu l’asservissement
machinique et l’assujettissement social comme ses pôles
extrêmes : quarante heures par semaine devant un clavier,
le cyber-prolo, chauffeure d’Uber ou Turc mécanique
d’Amazon se détend le reste du temps en consultant
Facebook.
Mais qu’arrive-t-il au sujet lorsque le code même du vivant
devient l’objet de son travail productif, et ses gènes
brevetés ? C’est ce que j’appellerai ici subjectivation
génétique. Le virus – en tant qu’unité minimale du vivant
et moyen essentiel du transfert d’information génétique –
est la forme élémentaire de cette subjectivation, à la fois
le message et son medium.
Le vivre ensemble qui caractérise le devenir du vivant
apparaît finalement comme un enchâssement de
processus transductifs, où chaque phase redouble et
complexifie la transduction virale originelle. Il culmine
dans la suzugia, cette relation si solide et pourtant muette
de la sympathie, la communauté de joug.[13] Le joug, ici,
rappelle la machine du premier type, propre aux sociétés
archaïques. Mais, depuis ces sociétés de souveraineté, le
joug s’est déphasé dans les machines motorisées des
sociétés disciplinaires, puis les machines informatiques
des sociétés de contrôle, pour maintenant faire place à
l’émergence des machines génétiques.
À l’heure du Venter-capitalism, nous assistons à un
nouveau déphasage de la transduction, qui boucle la
boucle de la transduction vitale originelle : une nouvelle
transduction virale, à ceci près que le virus peut
maintenant autant référer à une forme de vie organique, à
base de carbone, qu’à une forme de vie à base de silicone
ou à un message encrypté sur des réseaux dits
« sociaux ». Que devient le joug, lorsque nous avons passé
le seuil de la convergence des codes, analogique et
numérique, naturel et artificiel ?
Nous en avons une expérience directe avec ce
confinement. Comme beaucoup, je pense qu’il faudrait
remplacer l’expression « distanciation sociale » par
« distanciation physique et solidarité sociale », et
anticiper la sortie de « la panique virale » (et pas
seulement de la pandémie) pour penser la suite avec des
égards renouvelés[14].
Je prends donc le pari qu’il nous faut donc désormais
produire une ontologie et une politique virales, où les
termes d’individu et de population (ou d’espèce), comme
d’unité et de multiplicité, ne peuvent absolument plus être
réifiés, et n’existent qu’en fonction (et même après) les
relations qui les lient, plutôt maillage que réseau. Une
ontologie et une politique relationnelles pour qui les
termes sont seconds, et procèdent de la relation ; une
ontologie qui commence entre, et se fonde sur, la
médiation transductive. Une sorte de démocratie
participative où TOUT aurait droit de cité, y compris les
virus.
Dans ce sens, le virus apparaîtra comme l’entité modèle
pour comprendre les modes de subjectivation propre au
capitalisme génétique, et ce confinement nous permettra
de commencer à faire l’expérience d’une subjectivation
qu’il nous appartient maintenant d’infléchir.
[1] Talking Heads, « Once in a lifetime », 1980.
[2] À ce sujet, la référence est le livre de Jussi Parikka,
Digital Contagions : A Media Archeology of Computer
Viruses (Peter Lang, 2007).
[3] Le Guidon en françois d’après Sigurs.
[4] Dans ses Œuvres complètes, aux éditions Malgaigne,
en 1575.
[5] Documents du 23 avril 1793, Recueil des Actes du
Comité de Salut Public, édité par F. A. Aulard, t. 3, p. 418
[6] Ces deux derniers paragraphes reprennent et
synthétisent un développement bien plus long paru sous le
titre « Devenir animal et vie aérienne. Prolégomènes à une
biologie transcendantale » dans la revue Chimère (73 :
109-125, 2010).
[7] Francis H. C. Crick, James D. Watson, « Molecular
Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose
Nucleic Acid », Nature, vol. 171, nº 4356, 25 avril 1953,
p. 737. Voir mon papier intitulé « Variations sur
l’insignifiant génétique : les métaphores du (non)code »
(Intermédialités, 3: 163-186, 2004) pour un
développement de ce point.
[8] Voir mon papier intitulé « Hypervirus : A Clinical
Report » dans la revue en ligne CTheory,
(http://www.ctheory.net) Février 2006.
[9] Plus en détails dans le chapitre 4 de mon livre
Junkware (Presses de l’Université du Minnesota en 2011)
et en français dans mon article intitulé « Vade Retro Virus.
Numéricité et Vitalité », paru dans la revue Terrain (63 :
103-121, 2015).
[10] « Ce n’est donc plus l’Humain qui pense le monde.
Aujourd’hui, c’est l’Inhumain qui nous pense. Et pas du
tout métaphoriquement, mais par une sorte d’homologie
virale, par infiltration directe d’une pensée virale,
contaminatrice, virtuelle, inhumaine. » Jean Baudrillard,
« Vue imprenable » (1986) dans Cahiers de l’Herne.
Baudrillard, dirigé par François L’Yonnet. Paris, Éditions
de l’Herne, 2004, p. 176.
[11] À partir de Surveiller et punir (Paris : Gallimard,
1975)
[12] En particulier dans son « Post-scriptum sur les
sociétés de contrôle » (paru dans le premier numéro de
L’Autre Journal, en 1990).
[13] Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des
notions de forme et d’information. Grenoble, Jérôme
Millon, 2005, p. 249.
[14] Voir le texte d’Yves Citton paru dans AOC à ce sujet.
Thierry Bardini
Sociologue et agronome, Professeur titulaire et directeur du département de
communication de l’université de Montréal
Vous aimerez peut-être aussi
- Comité Invisible - Maintenant-La Fabrique (2017) PDFDocument160 pagesComité Invisible - Maintenant-La Fabrique (2017) PDFoperariusPas encore d'évaluation
- Quiz 1-2 e 3 - VictimologieDocument14 pagesQuiz 1-2 e 3 - VictimologieSandro AlvesPas encore d'évaluation
- Simon Sylvie - Vaccins, Mensonges Et PropagandeDocument128 pagesSimon Sylvie - Vaccins, Mensonges Et PropagandeCloJoDa100% (4)
- Carnets de Guerre Covid-19 - Didier RaoultDocument415 pagesCarnets de Guerre Covid-19 - Didier Raoultsimplice tene penkaPas encore d'évaluation
- Electrical Energy Meter Design and Realization Guy Rostand KougangDocument49 pagesElectrical Energy Meter Design and Realization Guy Rostand KougangGuy_Rostand_KOUGANGPas encore d'évaluation
- Audit Opérationnel Historique Objectifs DémarcheDocument32 pagesAudit Opérationnel Historique Objectifs DémarcheSamyChemala100% (1)
- Sans peur et sans reproche: Méditation biblique sur la peurD'EverandSans peur et sans reproche: Méditation biblique sur la peurPas encore d'évaluation
- Sur La Situation Épidémique Par Alain BadiouDocument6 pagesSur La Situation Épidémique Par Alain BadiousebastienjeanquebecPas encore d'évaluation
- Big Reset PDFDocument5 pagesBig Reset PDFVincent de MarsPas encore d'évaluation
- Avec la pandémie de la Covid-19 et après ? - Volume 2: Retour au monde d’avant ? Adaptation au monde actuel ? Ou amorce d’un monde nouveau ?D'EverandAvec la pandémie de la Covid-19 et après ? - Volume 2: Retour au monde d’avant ? Adaptation au monde actuel ? Ou amorce d’un monde nouveau ?Pas encore d'évaluation
- Dupuy Illich2021Document28 pagesDupuy Illich2021gil peoPas encore d'évaluation
- La Révolution Numérique Met ElleDocument54 pagesLa Révolution Numérique Met Ellefranç lequPas encore d'évaluation
- Alors C'est Quoi La COVID-19 ?: Disease 2019Document4 pagesAlors C'est Quoi La COVID-19 ?: Disease 2019Sana SarkisPas encore d'évaluation
- TVL - Alexandra Henrion-Claude - COVID 19Document21 pagesTVL - Alexandra Henrion-Claude - COVID 19Guy Dugas de BaudanPas encore d'évaluation
- La Gestion Par La PeurDocument3 pagesLa Gestion Par La PeurMarie Jeanne VogelPas encore d'évaluation
- Palimpseste No5 (2021)Document60 pagesPalimpseste No5 (2021)Eleni KarafylliPas encore d'évaluation
- Covid-19 - Une Histoire À Rebondissements en Quatre SaisonsDocument16 pagesCovid-19 - Une Histoire À Rebondissements en Quatre SaisonslopiousPas encore d'évaluation
- Coronavirus Covid-19. Vous défendre. Évitez la contagion. Protégez votre maison, votre famille, votre travail. Mise à jour de la quatrième édition.D'EverandCoronavirus Covid-19. Vous défendre. Évitez la contagion. Protégez votre maison, votre famille, votre travail. Mise à jour de la quatrième édition.Pas encore d'évaluation
- Laurent Toubiana Covid 19 Une Autre Vision de Lepidemie 2022Document271 pagesLaurent Toubiana Covid 19 Une Autre Vision de Lepidemie 2022Cédric Christophe100% (1)
- Au Meilleur de L'immonde-Le Crime ParfaitDocument38 pagesAu Meilleur de L'immonde-Le Crime ParfaitMarius boko-kokouPas encore d'évaluation
- 2020 Un Trop Humain Virus OcredDocument57 pages2020 Un Trop Humain Virus OcredPierre ChanPas encore d'évaluation
- Les nouvelles menaces mondiales: La grande pandémie du déniD'EverandLes nouvelles menaces mondiales: La grande pandémie du déniPas encore d'évaluation
- Voyages en effondrement: Un pire à éviter ou une période à vivre?D'EverandVoyages en effondrement: Un pire à éviter ou une période à vivre?Pas encore d'évaluation
- Coronavirus tsunami. Quand reviendrons-nous à la normale?D'EverandCoronavirus tsunami. Quand reviendrons-nous à la normale?Pas encore d'évaluation
- Contribution À La Critique Anthropologique D'une Pandémie.Document3 pagesContribution À La Critique Anthropologique D'une Pandémie.Chatellier MarcPas encore d'évaluation
- Byung-Chul Han La Pandémie de La FatigueDocument5 pagesByung-Chul Han La Pandémie de La FatiguebritocostaPas encore d'évaluation
- Coronavirus Le Coup D'état Mondial Des Rothschild Et Son Lien Avec La 5G & Les Armes SilencieusesDocument16 pagesCoronavirus Le Coup D'état Mondial Des Rothschild Et Son Lien Avec La 5G & Les Armes SilencieusesDanick MetalunaPas encore d'évaluation
- FDGVDocument147 pagesFDGVLoan SassePas encore d'évaluation
- Joyeux Confinement Joyeuse Métamorphose. Par D.K. Printemps 2020 2Document67 pagesJoyeux Confinement Joyeuse Métamorphose. Par D.K. Printemps 2020 2MBleuet52Pas encore d'évaluation
- La Nouvelle Dictatute Médico-Scientifique - Sylvie Simon - Don Organe, Pollution Et Mensonges, Vaccins, Santé, Médecine, Pesticide, EtcDocument256 pagesLa Nouvelle Dictatute Médico-Scientifique - Sylvie Simon - Don Organe, Pollution Et Mensonges, Vaccins, Santé, Médecine, Pesticide, EtcGeoffroy Coutellier - Chanvrier100% (2)
- Un Festival D'incertitudes - Edgar MorinDocument19 pagesUn Festival D'incertitudes - Edgar MorinselaPas encore d'évaluation
- ACISSE - Rester Chez Soi - 20200331VF PDFDocument5 pagesACISSE - Rester Chez Soi - 20200331VF PDFibrahima gueyePas encore d'évaluation
- Nexus DeconfinementDocument148 pagesNexus DeconfinementcianPas encore d'évaluation
- Nexus 55Document93 pagesNexus 55ustensilPas encore d'évaluation
- Il fait si bon, je reste encore un peu...: Comment une maladie sur le point de m'ôter la vie, me l'a en fait sauvé.D'EverandIl fait si bon, je reste encore un peu...: Comment une maladie sur le point de m'ôter la vie, me l'a en fait sauvé.Pas encore d'évaluation
- ¿Debemos Aprender A Vivir Con Los Microbios?Document4 pages¿Debemos Aprender A Vivir Con Los Microbios?infoLibrePas encore d'évaluation
- Article Plan Mondial Vaccination Nexus No121 - Mars Avril 2019 CompressedDocument17 pagesArticle Plan Mondial Vaccination Nexus No121 - Mars Avril 2019 CompressedAgustin BarrientosPas encore d'évaluation
- Ebook Du DR Luc Bodin Les VirusDocument23 pagesEbook Du DR Luc Bodin Les VirusSTEFAN100% (1)
- Le Professeur PERRONNE Sur Les VaccinsDocument2 pagesLe Professeur PERRONNE Sur Les VaccinsRăzvan Vâlcu100% (1)
- Pandémie COVID-19: Approches philosophiquesD'EverandPandémie COVID-19: Approches philosophiquesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Elysee Module 16405 FRDocument7 pagesElysee Module 16405 FRJohnnyPas encore d'évaluation
- Roland Gori-La Fabrique de Nos Servitudes-JerichoDocument227 pagesRoland Gori-La Fabrique de Nos Servitudes-JerichoAMINEPas encore d'évaluation
- Koyre. La Fonction Politique de La Mensonge ModerneDocument15 pagesKoyre. La Fonction Politique de La Mensonge ModernePS82100% (1)
- BilheranDocument13 pagesBilheranIoan PopescuPas encore d'évaluation
- Prêts pour l'effondrement ?: Guide pratique vers le monde d'aprèsD'EverandPrêts pour l'effondrement ?: Guide pratique vers le monde d'aprèsPas encore d'évaluation
- Covid Et CapitalismeDocument16 pagesCovid Et CapitalismerebuberPas encore d'évaluation
- Covid-19 Et Détresse PsychologiqueDocument219 pagesCovid-19 Et Détresse PsychologiquesheymaPas encore d'évaluation
- Nouveaux Cahiers Pour La Folie # 2Document66 pagesNouveaux Cahiers Pour La Folie # 2sdufauPas encore d'évaluation
- Une Autre Vision de La CovidDocument118 pagesUne Autre Vision de La CovidBombinette GideonPas encore d'évaluation
- "Corruption" (Seuil, 2014)Document249 pages"Corruption" (Seuil, 2014)Antoine Peillon100% (2)
- Le Sacrifice Au Cœur de La CultureDocument5 pagesLe Sacrifice Au Cœur de La CultureanabasethPas encore d'évaluation
- Des interdits impossibles vers un désir d'ordre ?: Après le coronavirus ?D'EverandDes interdits impossibles vers un désir d'ordre ?: Après le coronavirus ?Pas encore d'évaluation
- Formes Apocalyptiques Du Pouvoir-1Document502 pagesFormes Apocalyptiques Du Pouvoir-1ffevcoxijmhjbatydlPas encore d'évaluation
- Étude de La Qualité Physico-Chimique Des Eaux Et Des Sols de La Région Souss MassaDocument10 pagesÉtude de La Qualité Physico-Chimique Des Eaux Et Des Sols de La Région Souss MassaAhmed BougheraraPas encore d'évaluation
- IIIsouDocument4 pagesIIIsouIssam MellaliPas encore d'évaluation
- La Place Du Crowdfunding Dans Le Financement Des Tpme Cas Du MarocDocument22 pagesLa Place Du Crowdfunding Dans Le Financement Des Tpme Cas Du MarocHamza ChPas encore d'évaluation
- TP3 IngSIDocument5 pagesTP3 IngSITEDx UniversitéCentralePas encore d'évaluation
- Np27vMyKEeixVgrdmPgCQg INFORMATIONS-IMPORTANTES FRDocument2 pagesNp27vMyKEeixVgrdmPgCQg INFORMATIONS-IMPORTANTES FRGUEU Fabrice SAIPas encore d'évaluation
- Analyser Étape Par ÉtapeDocument2 pagesAnalyser Étape Par ÉtapeGhostoo GoPas encore d'évaluation
- Seq 2 La BamDocument13 pagesSeq 2 La Bammanar100% (2)
- Rapport de StageDocument14 pagesRapport de StageIbtissam ANOIRPas encore d'évaluation
- Alimentation D'un Moteur Asynchrone À Partir D'un Générateur PhotovoltaïqueDocument75 pagesAlimentation D'un Moteur Asynchrone À Partir D'un Générateur PhotovoltaïquesarlasotecPas encore d'évaluation
- Corrige Detaille Sm2 Td2Document11 pagesCorrige Detaille Sm2 Td2Tchonbe Albert TchonbePas encore d'évaluation
- Zone CritiqueDocument7 pagesZone CritiqueHedil Ben Haj KalboussiPas encore d'évaluation
- Cours 03 Le Sol Vivant 1.0 PDFDocument31 pagesCours 03 Le Sol Vivant 1.0 PDFkarina46Pas encore d'évaluation
- APS D'un IncinerateurDocument117 pagesAPS D'un IncinerateurFIGADEPas encore d'évaluation
- Poly Cours - PsDocument32 pagesPoly Cours - PsKhawlaManaaPas encore d'évaluation
- Un Exemple de Cahier Des Charges Pour Une Tude de FaisabilitDocument4 pagesUn Exemple de Cahier Des Charges Pour Une Tude de Faisabilitimane benssalihPas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2023-11-08 À 22.22.21Document1 pageCapture D'écran . 2023-11-08 À 22.22.21q6wqb66hxqPas encore d'évaluation
- Parametres Lignes ElectriquesDocument114 pagesParametres Lignes ElectriquesDadi Aziz100% (1)
- Etude de L'activité AntifongiqueDocument10 pagesEtude de L'activité Antifongiquemekaek100% (1)
- L'Audit Interne (Code DeontologieDocument3 pagesL'Audit Interne (Code DeontologieTawfiq BarhroujPas encore d'évaluation
- Lettre de Proposition de Service PDF - Recherche GoogleDocument1 pageLettre de Proposition de Service PDF - Recherche Googleelvicktayeye00Pas encore d'évaluation
- 1 SMDocument13 pages1 SMAziz OualidPas encore d'évaluation
- Les Progrès de L'esprit Humain Selon CondorcetDocument2 pagesLes Progrès de L'esprit Humain Selon Condorcetranya.shaamsPas encore d'évaluation
- Guide Technique - Comité Français Pour Les Techniques Routières PDFDocument1 pageGuide Technique - Comité Français Pour Les Techniques Routières PDFhamza3660Pas encore d'évaluation
- Erdogan PDFDocument4 pagesErdogan PDFsheckyna86Pas encore d'évaluation
- Le Fonctionnement Des Microprocesseurs ResumeDocument2 pagesLe Fonctionnement Des Microprocesseurs ResumeAlaa Ben MabroukPas encore d'évaluation
- Je Parle Grec en 20 Leçons Amusantes Flash MaraboutDocument82 pagesJe Parle Grec en 20 Leçons Amusantes Flash Maraboutlolamaratou7596100% (1)
- Histoire de La Medecine Arabe 2 PDFDocument25 pagesHistoire de La Medecine Arabe 2 PDFTETY FREJUS BEUGREPas encore d'évaluation
- Dzexams 3as Francais As - E2 20201 551001Document3 pagesDzexams 3as Francais As - E2 20201 551001Don Selo Madrïdìstö100% (2)