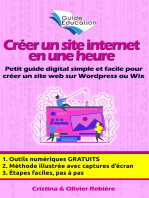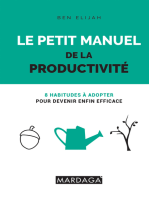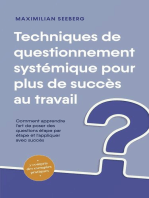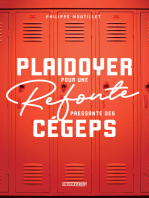Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
REM1
REM1
Transféré par
Bobby0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues1 pageCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues1 pageREM1
REM1
Transféré par
BobbyDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 1
C’est dans l’institution de cette éducation pédagogique pratique que réside la vraie réforme
de l’École ; les conférences et discussions du Musée pédagogique peuvent être une
excellente préparation à cette tâche nouvelle que nous allons avoir à accomplir ensemble ;
voilà pourquoi j’ai beaucoup tenu à y participer, malgré une hésitation bien naturelle à traiter
des questions d’enseignement secondaire sans autre expérience personnelle de cet
enseignement que celle qui peut résulter des examens auxquels j’ai pris part. À la réflexion,
d’ailleurs, cette hésitation ne m’a pas paru justifiée ; la conférence devant être suivie d’une
discussion, les exagérations révolutionnaires auxquelles pourrait me conduire le manque
d’expérience ne peuvent pas avoir d’inconvénient ; vous saurez, quand il sera nécessaire, me
ramener au contact des réalités. J’entre maintenant dans mon sujet, que nous diviserons, si
vous le voulez bien, en deux parties, pour la clarté de la discussion. Nous parlerons d’abord
de ce que l’on peut tenter de faire sans rien changer aux programmes ni à l’organisation de
l’enseignement, de ce que l’on peut faire dès demain ; nous rechercherons ensuite ce qui
pourrait se faire si, au lieu de nous trouver en face de programmes, d’examens, de concours,
de budgets déterminés, nous nous trouvions devant une table rase. Il est clair que cette
seconde partie devra être surtout regardée comme l’occasion d’échanges de vues et ne
pourra guère avoir de sanctions pratiques immédiates. I Les exercices pratiques de
Mathématiques dans l’enseignement secondaire, tel qu’il est actuellement organisé,
consistent à peu près exclusivement : 1° en calculs numériques ; 2° en dessin géométrique
(dit aussi dessin graphique). Les calculs numériques sont fort peu estimés, en général, des
élèves de l’enseignement secondaire ; ils sont regardés par presque tous comme une corvée
aussi ennuyeuse qu’inutile. Un élève dira très couramment : « J’ai très bien réussi mon
problème ; mon raisonnement est juste ; je me suis simplement trompé dans le calcul, à la
fin ; mais c’est une simple erreur de virgule ; j’ai trouvé 34 fr. 50 au lieu de 345 francs. En
somme, je suis très satisfait ! » On étonnerait beaucoup cet élève en lui demandant s’il serait
aussi satisfait si ses parents, après lui avoir promis 345 francs pour s’acheter une bicyclette
neuve, lui donnaient seulement 34 fr. 50. Il n’a, en effet, nullement l’idée que l’on puisse
songer à établir un rapport quelconque entre les nombres qu’il manie dans ses problèmes et
des francs réels, servant vraiment à acheter des choses. Les nombres des problèmes ne sont
pas pour de bon ; une erreur de virgule n’y a pas d’importance. C’est enfoncer une porte
ouverte que d’insister sur les inconvénients et les dangers de cet état d’esprit. Mais, s’il est
aussi répandu chez les élèves, l’éducation qu’ils reçoivent n’y est-elle pas pour une part ? et
ne serait-il pas facile aux professeurs de le modifier, sans beaucoup de peines ni d’efforts,
simplement en portant sur ce point toute l’attention qu’il mérite. Il ne s’agit pas là de
réformes ni de changements profonds, mais simplement d’un ensemble de petits détails, sur
lesquels je vous demande la permission de m’étendre un peu. Tout d’abord, il paraît
nécessaire que, dans la correction des devoirs et des compositions, il soit tenu le plus grand
compte des erreurs de calcul dans les applications numériques, même si le raisonnement est
juste et l’élève intelligent. Sans doute, il peut être pénible de classer assez loin, pour une
faute de calcul, un élève qu’on regarde comme l’un des plus intelligents de la classe ; mais on
ne doit pas hésiter à le faire, dans l’intérêt de cet élève même et aussi dans l’intérêt général
de la classe. On peut même, sans paradoxe, soutenir que, plus un élève est capable de
raisonner juste, plus une faute de calcul doit être regardée comme grave dans son devoir ;
car la confiance même qu’il a légitimement dans l’exactitude de ses raisonnements
entraînera des inconvénients pratiquement plus graves que si, se méfiant de lui-même, il
n’utilisait son résultat pour un but réel qu’après l’avoir vérifié par une autre méthode ou
recouru aux lumières d’un conseiller plus habile. Dans le même ordre d’idées, tant que le
Concours général subsistera et aura, par suite, une influence sur le travail de certains élèves
Vous aimerez peut-être aussi
- 27 Techniques simples de gestion du temps [Comment réaliser plus en moins de temps]D'Everand27 Techniques simples de gestion du temps [Comment réaliser plus en moins de temps]Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (50)
- La gestion du temps: Augmentez votre productivité et passez à l’actionD'EverandLa gestion du temps: Augmentez votre productivité et passez à l’actionÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (3)
- Créer un site Internet gratuit en une heure: Petit guide digital simple et facile pour créer un site web sur Wordpress ou WixD'EverandCréer un site Internet gratuit en une heure: Petit guide digital simple et facile pour créer un site web sur Wordpress ou WixÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Le petit manuel de la productivité: 8 habitudes à adopter pour devenir enfin efficaceD'EverandLe petit manuel de la productivité: 8 habitudes à adopter pour devenir enfin efficacePas encore d'évaluation
- Mathématiques Classiques Condeveaux 04 (CM1-CM2) J'apprends À RaisonnerDocument354 pagesMathématiques Classiques Condeveaux 04 (CM1-CM2) J'apprends À RaisonnerSaurinYanick100% (9)
- Introduction À La Microéconomie - Hal Varian PDFDocument98 pagesIntroduction À La Microéconomie - Hal Varian PDFMohamed Laaroussi67% (9)
- Premiers Pas Vers Les MathsDocument96 pagesPremiers Pas Vers Les MathsDrelin100% (1)
- Succes Facile: Comment réussir ses études en comptabilitéD'EverandSucces Facile: Comment réussir ses études en comptabilitéPas encore d'évaluation
- Entretien Campus FranceDocument5 pagesEntretien Campus FranceMylene Yo78% (9)
- Ebook Les 8 Conseils Pour Apprendre InformatiqueDocument25 pagesEbook Les 8 Conseils Pour Apprendre InformatiqueMoussaPas encore d'évaluation
- Enseigner À L'universitéDocument199 pagesEnseigner À L'universitéMounir Ait MansourPas encore d'évaluation
- Cahiers Pédagogiques-Neurosciences Et PédagogieDocument254 pagesCahiers Pédagogiques-Neurosciences Et Pédagogiezakaria salhiPas encore d'évaluation
- Je Vais Vous Apprendre À Intégrer L'X - IntroductionDocument8 pagesJe Vais Vous Apprendre À Intégrer L'X - IntroductionEditions du 4675% (4)
- Analysecours Ecole Des Ponts - CorrigeDocument139 pagesAnalysecours Ecole Des Ponts - CorrigeWijdane Ait AhmedPas encore d'évaluation
- Rapport Autoreflexif Cyril DENIS C1Document19 pagesRapport Autoreflexif Cyril DENIS C1Monsieur DENIS100% (1)
- Méthode de Travail PDFDocument3 pagesMéthode de Travail PDFgreat manPas encore d'évaluation
- Rem 2Document1 pageRem 2BobbyPas encore d'évaluation
- La MP en BrefDocument13 pagesLa MP en BrefKenny ZoukouPas encore d'évaluation
- Rdoc 2 - Utilite Et Interet de La DidactiqueDocument22 pagesRdoc 2 - Utilite Et Interet de La Didactiquejeanpierrekawamahomy5Pas encore d'évaluation
- ReussirDocument8 pagesReussirBopePas encore d'évaluation
- 19. ĐỀDocument4 pages19. ĐỀiamquynh0204Pas encore d'évaluation
- Méthode Dissert Ses TleDocument30 pagesMéthode Dissert Ses Tlemarie-pierre AnceyPas encore d'évaluation
- Les Punitions À L'école Primaire: Haute Ecole Pédagogique BEJUNEDocument58 pagesLes Punitions À L'école Primaire: Haute Ecole Pédagogique BEJUNEgervaisg2012Pas encore d'évaluation
- Conseils AbdoDocument6 pagesConseils AbdoCBYPas encore d'évaluation
- PFM Dauphine - Quelques Erreurs À Éviter - V2Document2 pagesPFM Dauphine - Quelques Erreurs À Éviter - V2pro.succesmaniaPas encore d'évaluation
- SyllabusDocument405 pagesSyllabusgbovynPas encore d'évaluation
- Ebook Droit 9 AstucesDocument20 pagesEbook Droit 9 Astucesmdhnfmdj5yPas encore d'évaluation
- B2 - Introduction Modele - EssaiDocument5 pagesB2 - Introduction Modele - EssaiTuyen DoanPas encore d'évaluation
- Actes Maths PrimaireDocument191 pagesActes Maths Primairesjaubert100% (1)
- 4 Conseils Pour Devenir Bon en MathsDocument1 page4 Conseils Pour Devenir Bon en Mathsjonathanekfuma7Pas encore d'évaluation
- Guide Pedagogie D Integration Final Au MarocDocument57 pagesGuide Pedagogie D Integration Final Au Marocاركيك88% (16)
- L'érreur Un Échec Ou Une Progession)Document39 pagesL'érreur Un Échec Ou Une Progession)imad imad0% (1)
- Campus Toutes Les Questions PossiblesDocument14 pagesCampus Toutes Les Questions PossiblesFARES DZPas encore d'évaluation
- Document 2Document6 pagesDocument 2Mouhammad Moukhtar Ndongo NDIAYEPas encore d'évaluation
- EntretienDocument5 pagesEntretienFARES DZPas encore d'évaluation
- Approche CompetencesDocument214 pagesApproche Competencesاركيك100% (11)
- PPP Rapport Detonnement-Desercy-Mathys-Td5Document3 pagesPPP Rapport Detonnement-Desercy-Mathys-Td5api-673794140Pas encore d'évaluation
- Dethi-HSGQG-TiengPhap12-2011-đã Chuyển ĐổiDocument10 pagesDethi-HSGQG-TiengPhap12-2011-đã Chuyển ĐổiNguyễn Tùng QuânPas encore d'évaluation
- Analyse Critique Filipe Monteiro Up202204446Document4 pagesAnalyse Critique Filipe Monteiro Up202204446Filipe MonteiroPas encore d'évaluation
- Les Questions freÃÅquentes Dans L'entretien CampusfranceDocument5 pagesLes Questions freÃÅquentes Dans L'entretien CampusfranceBoulos BoulosPas encore d'évaluation
- JVSP - Ii.2 PDFDocument4 pagesJVSP - Ii.2 PDFEditions du 460% (1)
- Rapport D'étonnementDocument2 pagesRapport D'étonnementapi-596693386Pas encore d'évaluation
- Quatre ScenariosDocument35 pagesQuatre ScenariosJanvier OctobrePas encore d'évaluation
- PETIT GUIDE Stage Memoire HEC 2022Document34 pagesPETIT GUIDE Stage Memoire HEC 2022Amina MalekPas encore d'évaluation
- ModelisationDocument6 pagesModelisationPremium CertificatsPas encore d'évaluation
- Exos Terminale3 3 Avecdessin 2 1Document186 pagesExos Terminale3 3 Avecdessin 2 1douae azlPas encore d'évaluation
- Les Questions FréquentesDocument7 pagesLes Questions Fréquentes6ktxyrwcs4Pas encore d'évaluation
- Les Questions Campus FrancedocxDocument4 pagesLes Questions Campus FrancedocxkajbkjPas encore d'évaluation
- Reflexions Sur Les Activites Concernant La Resolution de Problemes A L'Ecole PrimaireDocument10 pagesReflexions Sur Les Activites Concernant La Resolution de Problemes A L'Ecole Primairedoriane.mzt17Pas encore d'évaluation
- Les Questions Campus FranceDocument5 pagesLes Questions Campus FranceEasy Study AbroadPas encore d'évaluation
- TD 2018 - 2019 - SocietesDocument14 pagesTD 2018 - 2019 - SocietesMarwan GuediriPas encore d'évaluation
- 100questionsLesplusPosées 1Document24 pages100questionsLesplusPosées 1Omar GueyePas encore d'évaluation
- Varian-Microeconomie CopieDocument98 pagesVarian-Microeconomie CopieLuzincourt Jean GardyPas encore d'évaluation
- Compétence 4: Praticien RéflexifDocument4 pagesCompétence 4: Praticien Réflexifapi-752828228Pas encore d'évaluation
- 0-Réussir Mon ExamenDocument177 pages0-Réussir Mon ExamenHalas MaitPas encore d'évaluation
- TPE - Entrepreuneuriat 2Document2 pagesTPE - Entrepreuneuriat 2Daniel MoukouriPas encore d'évaluation
- Techniques de questionnement systémique pour plus de succès au travail Comment apprendre l'art de poser des questions étape par étape et l'appliquer avec succès - y compris des exemples pratiquesD'EverandTechniques de questionnement systémique pour plus de succès au travail Comment apprendre l'art de poser des questions étape par étape et l'appliquer avec succès - y compris des exemples pratiquesPas encore d'évaluation
- Matériel DidactiqueDocument4 pagesMatériel DidactiquePat MerveillesPas encore d'évaluation
- Liste Professeurs D Allemand DataDocument2 pagesListe Professeurs D Allemand DataKamano GnoumaPas encore d'évaluation
- Didactique Des Sciences Et Formation Des EnseignantsDocument25 pagesDidactique Des Sciences Et Formation Des EnseignantsWardi MollPas encore d'évaluation
- Frédéric Anciaux - AMC Dans Les IDDocument340 pagesFrédéric Anciaux - AMC Dans Les IDPaquchaPas encore d'évaluation
- Support Theorie Des Ados - Psychologie de LeducationDocument13 pagesSupport Theorie Des Ados - Psychologie de LeducationitaudPas encore d'évaluation
- Rapport FinalDocument158 pagesRapport FinalMeryem ElPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 1Document18 pagesRapport de Stage 1yxt6srqjdcPas encore d'évaluation
- DIDAQTIQUEDocument2 pagesDIDAQTIQUEMoncef BARZANEPas encore d'évaluation
- Personnalisation Des Apprentissages en FAD Pancanadienne Francophone 20181Document199 pagesPersonnalisation Des Apprentissages en FAD Pancanadienne Francophone 20181Ghazal zarePas encore d'évaluation
- Université Frères Mentouri Constantine 1Document94 pagesUniversité Frères Mentouri Constantine 1Flash FacebookPas encore d'évaluation
- Albero 2Document31 pagesAlbero 2Go Laurie100% (1)
- MODELE de RAPPORT Techniques D'electricité KaoucheDocument13 pagesMODELE de RAPPORT Techniques D'electricité Kaoucheahmedkaouche10Pas encore d'évaluation
- Programme Géographie 5e 065907Document31 pagesProgramme Géographie 5e 065907kambodedieudonnelarePas encore d'évaluation
- Messahli Fifi-AlgérieDocument12 pagesMessahli Fifi-AlgériefifimessahliPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage - FinalDocument16 pagesRapport de Stage - Finalototgamer111100% (1)
- Sciences Générales: 3 DegréDocument140 pagesSciences Générales: 3 DegréJérémy FranchePas encore d'évaluation
- Gouvernements ScolairesDocument24 pagesGouvernements Scolairesbabafaye655Pas encore d'évaluation
![27 Techniques simples de gestion du temps [Comment réaliser plus en moins de temps]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/195544866/149x198/549125ee58/1697144989?v=1)