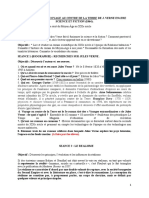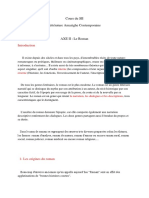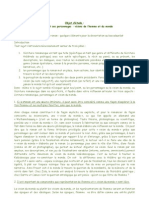Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Roman
Le Roman
Transféré par
style.liiffe980 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues12 pagesTitre original
Le roman
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues12 pagesLe Roman
Le Roman
Transféré par
style.liiffe98Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 12
le roman
Le roman est un genre littéraire narratif. C’est-à-dire
qu’il raconte une histoire de la manière ordonnée et
précise que choisit son auteur.
Le roman peut être défini comme une fiction (une œuvre
imaginaire) en prose (sans versification), écrite par un auteur
— voire plusieurs —, même si celui-ci est parfois anonyme. Il
est en général plus long qu’un conte et qu’une nouvelle, bien
qu’il existe des romans courts. Il diffère du récit, qui est
généralement plus simple du point de vue de la narration.
Sous le nom de roman se regroupent des œuvres très
diverses. On les classe en de nombreuses sous-catégories,
selon leurs thèmes, leur forme, leur but ou les différents
genres romanesques.
L’ORIGINE DU MOT « ROMAN »
Au Moyen Âge, le roman (ou langue romane) est la langue
vulgaire (celle que le peuple utilise, par opposition au latin, la
langue savante). À l’origine, on utilise donc le terme
« roman » pour désigner une œuvre traduite ou adaptée plus
ou moins librement en roman, à partir d’une œuvre
composée en latin. Au XIIe siècle apparaissent ainsi les
premiers textes qui portent le nom de « roman », tels le
Roman de Thèbes (vers 1150). Ce ne sont pas des romans
au sens moderne, mais de longs récits en vers sur des sujets
tirés de l’Antiquité.
Le mot « roman » désigne ensuite des récits en prose
d’origine populaire, romane ou celtique, comme le Roman de
Renart et le Roman de Tristan (XIIe–XIIIe siècles). Peu à peu le
sens s’élargit et désigne toutes sortes de récits d’aventures
imaginaires, merveilleuses ou incroyables. Enfin, à partir du
XVIIesiècle, le « roman » devient un genre narratif, et prend
son sens moderne. L’adjectif « romanesque », qui signifie
« ce qui a trait au roman », apparaît à cette époque.
UNE FORME EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Les premiers récits en prose qui se rapprochent du roman
moderne datent de l’époque romaine et s’inspirent de
l’épopée, notamment de l’Odyssée d’Homère, mais aussi de
la comédie. Parmi les « romans » antiques grecs, citons les
Éthiopiques d’Héliodore (IIIe siècle après J.-C.), et dans le
domaine latin, le Satiricon de Pétrone (Ier siècle après J.-C.)
et les Métamorphoses (ou l’Âne d’or) d’Apulée (IIe siècle).
Du Moyen Âge à l’époque moderne, le roman prend de
multiples formes et ne cesse d’évoluer. Il est longtemps
considéré comme un genre mineur. À partir du XIXe siècle, il
devient la forme littéraire la plus utilisée par les écrivains, et
la plus populaire.
LES GENRES ROMANESQUES AU FIL DES
SIÈCLES
Les romans du Moyen Âge
→ Le roman de chevalerie est un genre de roman dont les
héros sont des chevaliers. Les romans du cycle arthurien, qui
apparaissent au XIIe siècle, sont des romans de chevalerie qui
situent leur action à la cour du roi Arthur. Ils sont d’abord
écrits en vers, puis en prose à partir du XIIe siècle. Chrétien
de Troyes en est l’auteur le plus réputé, avec notamment
Lancelot (1177) et Perceval (1181-1185). Don Quichotte
(1605), de Miguel de Cervantès, est une satire burlesque des
romans de chevalerie.
→ Le roman courtois est une variété du roman médiéval des
XIIe et XIIIe siècles, dont les personnages et l’intrigue
amoureuse sont marqués par l’idéal de la courtoisie. Les
romans arthuriens sont également des romans courtois.
Les romans des XVIe et XVIIe siècles
→ Le roman picaresque raconte l’apprentissage d’un jeune
héros naïf, inexpérimenté et misérable. C’est un mélange de
roman d’aventures et de roman d’apprentissage. Il apparaît
en Espagne en 1554 avec Lazarillo de Tormes (anonyme),
suivi de l’Histoire comique de Francion (1623) de Charles
Sorel.
→ Le roman pastoral, à l’époque baroque, met en scène des
bergers et des bergères dans un espace idyllique, et raconte
leurs amours contrariées. Le modèle du genre est l’Astrée
(1607-1619) d’Honoré d’Urfé.
→ Le roman précieux se développe au XVIIe siècle. Il a pour
thème l’amour, et traite des préoccupations galantes de
l’époque, dans un langage très raffiné. Madeleine de Scudéry
excelle dans ce genre avec Clélie, histoire romaine (1654-
1660).
Les romans du XVIIIe siècle
→ À travers l’intrigue du roman philosophique, l’auteur
exprime ses idées philosophiques. Ce type de roman apparaît
au siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, avec des auteurs tels
Voltaire (Candide, 1759) et Denis Diderot (Jacques le
Fataliste, 1778-1796).
→ Le roman épistolaire, ou roman par lettres, est entièrement
constitué par les lettres échangées entre les personnages. Au
XVIIIe siècle, il est très à la mode et devient célèbre grâce à
des chefs-d’œuvre comme Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761)
de Jean-Jacques Rousseau et les Liaisons dangereuses
(1782) de Choderlos de Laclos.
Les romans du XIXe siècle
L’action du roman historique, inauguré par l’Anglais Walter
Scott, auteur d’Ivanhoé (1819), se déroule dans le passé et
tente de faire revivre une époque particulière de l’histoire.
Les romantiques affectionnent ce genre, notamment Alfred
de Vigny (Cinq-Mars, 1826), Victor Hugo (Quatrevingt-treize,
1874) et Alexandre Dumas père, avec les Trois
Mousquetaires (1844), roman de cape et d’épée.
Le roman réaliste se développe au XIXe siècle avec Stendhal,
Honoré de Balzac et sa Comédie humaine, puis avec Gustave
Flaubert, les frères Goncourt et enfin Émile Zola. Le roman
réaliste est ancré dans la réalité politique et sociale. Le
physique des personnages et le milieu social dans lequel ils
vivent sont décrits avec minutie.
Le roman naturaliste se situe dans la lignée du roman
réaliste, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Il est représenté
surtout par Émile Zola, auteur du cycle des Rougon-Macquart
(1871-1893), qui tente d’appliquer à l’écriture du roman une
méthode analogue à celle des sciences. Il étudie notamment
les comportements humains, les milieux sociaux et l’influence
de l’hérédité.
Le roman d’aventures connaît son apogée dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Riches en aventures, en épreuves et
rebondissements, ces romans très populaires comptent
notamment les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas
(1844) et Michel Strogoff (1876) de Jules Verne.
Le roman fantastique naît avec le Diable amoureux (1792) de
Jacques Cazotte. Mais le genre s’épanouit en France au
XIXe siècle, surtout sous la forme de nouvelles (le Horla de
Guy de Maupassant, 1887). Le roman fantastique décrit un
monde familier dans lequel se produisent des événements
que la raison ne permet pas d’expliquer et qui ont une cause
surnaturelle. Le héros, et aussi le lecteur, est amené à
hésiter entre une explication rationnelle et une explication
surnaturelle.
Le roman gothique apparaît en Grande Bretagne au tournant
des XVIIIe et XIXe siècles, et associe généralement horreur et
mystères fantastiques. Frankenstein (1818) de Mary Shelley
est sans doute le roman gothique le plus célèbre, avec le
Moine de Matthew Gregory Lewis.
Au XIXe siècle, beaucoup de romans sont publiés pour la
première fois en feuilletons dans la presse. On parle alors de
romans-feuilletons. Honoré de Balzac, Alexandre Dumas
père, Georges Sand ou Émile Zola publient ainsi la plus
grande partie de leurs romans. Les Mystères de Paris (1842-
1843) d’Eugène Sue connaissent à l’époque un très grand
succès.
LES ROMANS DU XXE SIÈCLE
Le roman policier, dont l’intrigue tourne le plus souvent
autour d’une enquête policière, naît véritablement avec
Arthur Conan Doyle, qui crée en 1887 le personnage du
détective Sherlock Holmes. Il est suivi par Gaston Leroux,
Agatha Christie, Maurice Leblanc, Georges Simenon. Le
roman noir, le thriller, le roman à suspense, le roman
d’espionnage sont des genres apparentés.
Le roman de science-fiction a comme précurseur Jules Verne,
auteur de romans d’anticipation (qui projettent l’avenir de
l’humanité) comme Vingt Mille lieues sous les mers (1870).
La science-fiction transpose la science et la culture en
d’autres temps (notamment dans le futur) ou d’autres
espaces (sur d’autres planètes). La Guerre des mondes
(1898) d’H. G. Wells, le Meilleur des mondes (1932) d’Aldous
Huxley et 1984 (1949) de George Orwell sont des grands
classiques du genre.
Le roman engagé est un roman dans lequel l’auteur exprime
des convictions politiques ou philosophiques. Il apparaît dans
les années 1930-1940, avec des auteurs comme André
Malraux (la Condition humaine, 1933), Louis Aragon (les
Beaux Quartiers, 1934), Albert Camus (l’Étranger, 1942) et
Jean-Paul Sartre (la Nausée, 1938).
Le Nouveau Roman n’est pas un genre romanesque mais un
courant littéraire né en France dans les années 1950-1960. Il
regroupe des écrivains comme Nathalie Sarraute, Claude
Simon, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet, qui cherchent à
renouveler le genre du roman en rompant avec le roman
traditionnel, notamment en refusant les notions de
personnage, d’intrigue, de réalisme.
Du théâtre antique grec à la création contemporaine, l’histoire du
théâtre s’étend sur plus de 2 500 ans et concerne tous les continents.
DE LA TRAGÉDIE GRECQUE À LA COMÉDIE ROMAINE
Le théâtre antique apparaît en Grèce au VIe siècle avant J.-C. Les
représentations dramatiques naissent avec le culte de Dionysos. La
tragédie grecque, qui tire son origine du dithyrambe, hymne à
Dionysos, est un spectacle en plein air. Le chœur joue une place
prépondérante dans le théâtre antique. Il chante, danse et commente
l’action. Le théâtre grec prend place autour de l’autel dédié à
Dionysos sur une scène circulaire. Des gradins sont disposés autour,
en arc de cercle.
Le théâtre romain ne se développe qu’à partir du IIIe siècle avant J.-C.
Les représentations sont d’abord associées aux fêtes religieuses puis
le théâtre devient un divertissement à part entière. La comédie est
le genre le plus apprécié des Romains. Le théâtre est généralement
situé près de la place du marché. Il est formé de gradins soutenus par
des arcades disposées en étages. La scène en demi-cercle est beaucoup
plus grande que dans la construction grecque.
LE THÉÂTRE MÉDIÉVAL : DES MIRACLES À LA FARCE
Le théâtre du Moyen Âge est avant tout un théâtre religieux. Dès le
Xe siècle, la liturgie est mise en scène dans le but de renforcer la foi
des ignorants. Plus qu’un simple divertissement, c’est un véritable
moyen d’éducation. Toutes les classes sociales y participent.
Les premiers textes extraits de la Bible sont interprétés dans l’enceinte
des églises lors des principales fêtes religieuses comme Pâques. À
partir du XIIIe siècle, les sujets des pièces reprennent la vie des saints.
Ce sont des miracles.
Au XVe siècle, ces représentations prennent le nom de mystères et
sont alors inspirées de la Passion du Christ. Les mystères font appel à
un grand nombre de participants. Ils ont lieu à l’extérieur, d’abord sur
les parvis des églises, puis sur les places des villages.
Au milieu du XIIIe siècle, le théâtre comique s’affirme. Les genres se
diversifient. La sotie est une satire souvent politique. La moralité
enseigne la morale chrétienne par le biais de figures allégoriques (la
Gourmandise, la Paresse, etc.). La farce est une critique grossière des
grands de ce monde. Elle est très populaire jusqu’au XVIIe siècle.
LA COMEDIA ET L’AUTO-SACRAMENTAL ESPAGNOLS
Le Siècle d’or, c’est-à-dire le XVIe siècle, voit naître la comedia
espagnole qui prend plusieurs formes : comédie bourgeoise, comédie
populaire, comédie de cape et d’épée, drames de l’honneur et de la
passion. La comedia reflète les intrigues de cour et la vie politique,
militaire et sociale. Elle se termine généralement par une danse. On
joue d’abord ces pièces dans les cours intérieures des maisons
appelées corrales puis, dès la fin du XVIe siècle, dans de véritables
théâtres. Lope de Vega, Tirso de Molina et Pedro Calderón de la
Barca en sont les plus grands représentants.
Pour contrecarrer l’engouement des Espagnols pour le théâtre profane,
l’Église invente un nouveau genre, l’auto-sacramental, une pièce
donnée le jour de la Fête-Dieu et contrôlée par le pouvoir religieux et
royal. Vraie force de propagande, ces pièces allégoriques parlent tout
aussi bien de la mythologie, d’histoire ou de légendes que de textes
bibliques. Ce genre de théâtre met en scène les faiblesses de l’homme
et Pedro Calderón de la Barca en est le plus grand maître. L’auto-
sacramental est finalement interdit par décret royal au XVIIIe siècle.
LE THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN EN ANGLETERRE
La grande époque du théâtre anglais commence vers 1580 et se
poursuit après le règne d’Élisabeth Ire (1558-1603). Le théâtre
élisabéthain tire son origine du théâtre médiéval populaire. Les thèmes
sont d’une part la folie, la destruction, le crime et le sang et d’autre
part le doute et l’individualisme. William Shakespeare est le
dramaturge le plus fécond et le plus important de cette période. Il
aborde tous les genres, de la comédie et de la féerie au drame et à la
tragédie la plus noire.
Les premières représentations ont lieu dans les cours d’auberge dont
l’agencement influence la forme architecturale du théâtre élisabéthain.
La scène ronde à ciel ouvert est entourée de loges et de galeries
couvertes. Le public bruyant suit l’action et attend les différentes
péripéties : duels, scènes violentes. Les acteurs sont exclusivement
masculins et se travestissent pour interpréter les rôles de femmes. En
1642, le Parlement décrète la fermeture des théâtres, ce qui met un
terme à l’essor du théâtre élisabéthain.
LA COMMEDIA DELL’ARTE ITALIENNE
La commedia dell’arte est une forme de comédie populaire née en
Italie dans la seconde moitié du XVIe siècle. Elle doit sa naissance, et
son nom, à une nouvelle catégorie d’artistes : les comédiens dell’arte,
ou acteurs de métier. La commedia dell’arte ne repose sur aucun
texte écrit. Le canevas de la pièce se contente d’une description
sommaire de l’action et des différentes entrées et sorties des acteurs
sur scène.
Les troupes, composées de six à douze acteurs, improvisent des
comédies mêlées de chants, de danses, de mimes, d’acrobaties et de
pitreries. Les acteurs portent tous des masques à l’exception des
femmes.
Les personnages de la commedia dell’arte sont très stéréotypés
(serviteurs comiques, vieillards, avocats, amants, docteurs ridicules,
etc.). À l’origine, les troupes jouent dans la rue, mais grâce à leur
succès, elles commencent à se produire devant les courtisans. La
commedia dell’arte a exercé une grande influence sur diverses formes
de théâtre, notamment sur les comédies de Carlo Goldini ou celles de
Molière.
LE THÉÂTRE CLASSIQUE FRANÇAIS : LA TRAGÉDIE ET LA
COMÉDIE
Le théâtre classique s’impose en France au XVIIe siècle avec la
renaissance des deux principaux genres antiques : la tragédie et la
comédie.
La tragédie classique tire ses sujets de la Bible et de l’Antiquité. Elle
est soumise à la règle des trois unités : d’action, de lieu et de temps.
Pierre Corneille et Jean Racine en sont les deux grands représentants.
La comédie classique emprunte ses thèmes aux tracas de la vie
quotidienne. Le sujet préféré reste l’amour contrarié de jeunes gens
par les pères ou les maris. Molière est considéré comme le maître de
la comédie classique.
LE THÉÂTRE DES LUMIÈRES : LE DRAME BOURGEOIS ET LA
COMÉDIE SPIRITUELLE
Le théâtre des Lumières correspond au théâtre du XVIIIe siècle. Le
goût pour la tragédie classique du XVIIe siècle commence à
s’essouffler et les auteurs tentent de renouveler cet art.
Un genre nouveau apparaît, intermédiaire entre la tragédie et la
comédie : le drame bourgeois. Il met en scène un événement
dramatique dans la vie quotidienne d’une famille bourgeoise. Le
personnage ridicule n’est plus le bourgeois gentilhomme mais le noble
hautain et futile. Le drame est la première revanche de la
bourgeoisie, alors en plein essor, sur la scène théâtrale.
La comédie évolue également. Le rire franc propre à Molière laisse la
place à des comédies plus spirituelles, moralisantes, satiriques ou
psychologiques. Voltaire, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
et Pierre Augustin Caron de Beaumarchais en sont les principaux
représentants.
LE MÉLODRAME
Dans la lignée du drame bourgeois, le mélodrame se développe au
XIXe siècle. Ce genre obtient vite les faveurs du public populaire car il
accorde la première place à l’intrigue et au spectacle.
L’action est conçue autour d’une succession de péripéties et de
rebondissements (batailles, poursuites à cheval, inondations,
tremblements de terre, etc). L’intrigue repose sur un conflit entre un
« bon » et un « méchant ». Le mélodrame inspire des émotions fortes
comme la crainte et les larmes. Il se déroule en trois actes (au lieu de
cinq comme dans le théâtre classique).
LE THÉÂTRE ROMANTIQUE
Le théâtre romantique naît en Allemagne avec Johann Wolfgang von
Goethe et Friedrich von Schiller puis se répand dans toute l’Europe
au XIXe siècle. Le romantisme exalte l’émotion plutôt que la raison, se
libérant des règles classiques. Il prône avant tout la liberté et la
révolte.
En France, Victor Hugo ouvre la voie au romantisme et proclame la
liberté de la forme théâtrale. Il remet en question la règle des trois
unités, mêle le vers et la prose, multiplie les personnages et mélange
les genres. Alfred Vigny et Alfred de Musset font partie de la
génération romantique.
LE THÉÂTRE DE BOULEVARD : LA COMÉDIE ET LE
VAUDEVILLE
Le théâtre de boulevard tire son nom des Grands Boulevards parisiens
sur lesquels se trouvent de nombreux théâtres. Il prend tous les
visages de la comédie : sentimentale, dramatique, légère ou satirique.
Les personnages du théâtre de boulevard appartiennent généralement
au monde de la noblesse ou de la richesse. Ils sont par définition
oisifs et n’ont pas d’autre souci que leurs plaisirs. L’amour constitue
la principale préoccupation de ces protagonistes. Les problèmes du
mariage, du divorce, de l’inégalité des deux sexes devant l’adultère
sont largement évoqués dans ces pièces. Le théâtre de boulevard est
très populaire jusqu’en 1914.
Le vaudeville est l’une des formes du théâtre de boulevard. Il s’agit
d’un genre très ancien né au XVe siècle qui mêle, à l’origine, chansons
et comédie légère. Au XIXe siècle, le vaudeville désigne toutes les
comédies de boulevard dans lesquelles l’intrigue tourne autour d’une
infidélité conjugale. Eugène Labiche, Georges Courteline et
Georges Feydeau en sont les plus célèbres représentants.
LE RENOUVEAU DU THÉÂTRE AU XXE SIÈCLE
Après la Seconde Guerre mondiale apparaissent plusieurs formes de
théâtre : le théâtre populaire, le théâtre engagé et le théâtre absurde.
– Le théâtre devient populaire grâce à la décentralisation
théâtrale. Les pièces ne sont plus jouées uniquement dans les théâtres
parisiens. La création du Festival d’Avignon et du Théâtre National
Populaire (TNP) par Jean Vilar en sont la plus belle illustration. Le
théâtre s’ouvre à de nouveaux publics.
– Le théâtre engagé ou philosophique est issu directement des
épreuves de la guerre. Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou Georges
Bernanos se lancent dans cette voie et offrent un théâtre politique ou
humaniste.
– Le théâtre de l’absurde est un théâtre d’avant-garde qui suit les
traces des dadaïstes, des surréalistes et des existentialistes. Il connaît
son apogée dans les années 1950. Le néant est le thème principal des
œuvres d’Eugène Ionesco ou de Samuel Beckett qui mettent en scène
le vide des personnages, des lieux, de l’intrigue et du langage, donc
l’absurde.
À partir des années 1970, le théâtre est confronté à une pénurie de
nouveaux textes dramatiques. Les metteurs en scène travaillent alors
de plus en plus à l’adaptation de textes littéraires. Par ailleurs, les
frontières entre le théâtre et les arts voisins se réduisent, ce qui permet
d’opérer des croisements avec la danse, le cirque, les arts plastiques,
l’opéra, le cinéma, etc.
On voit émerger d’un côté un théâtre intimiste, de l’autre un théâtre de
mise en scène, c’est-à-dire un théâtre dans lequel le metteur en scène
et son travail sont privilégiés et deviennent plus importants que le
texte ou le jeu des comédies .
e
e
Vous aimerez peut-être aussi
- Fiche Bilan Roman 2Document3 pagesFiche Bilan Roman 2Fouzia Badi50% (2)
- Sous L'orageDocument11 pagesSous L'orageSteve LAMARCK100% (1)
- Personnages Et Analyse Du RomanDocument39 pagesPersonnages Et Analyse Du RomanAndreea P-b100% (1)
- Le RomanDocument4 pagesLe Romanmiloud rouabhiPas encore d'évaluation
- Littérature FrançaiseDocument8 pagesLittérature FrançaiseJonny SvenssonPas encore d'évaluation
- Les genres littéraires - Le roman, la poésie et le théâtre (Bac de français)): Réussir le bac de françaisD'EverandLes genres littéraires - Le roman, la poésie et le théâtre (Bac de français)): Réussir le bac de françaisÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Les Mouvements LitterairesDocument11 pagesLes Mouvements LitterairesbuciumeniPas encore d'évaluation
- Typologie Textuelle Semaine 4Document83 pagesTypologie Textuelle Semaine 4sayouri houdaPas encore d'évaluation
- Bilan Sur L'histoire LittéraireDocument11 pagesBilan Sur L'histoire LittéraireCherif ChokeirPas encore d'évaluation
- Victor Hugo 2013Document25 pagesVictor Hugo 2013Mohamed100% (1)
- Résumé Mouvement LittéraireDocument5 pagesRésumé Mouvement Littéraireantohol88Pas encore d'évaluation
- Etude de L'oeuvre Integrale 1Document9 pagesEtude de L'oeuvre Integrale 1ealainfl100% (1)
- Le Roman RomantiqueDocument2 pagesLe Roman RomantiqueM2723Pas encore d'évaluation
- Liste Des Mouvements LittérairesDocument2 pagesListe Des Mouvements Littérairesscribdophilia50% (2)
- Le Roman: XemplesDocument3 pagesLe Roman: XemplesNouhaila Sdoud100% (1)
- Le Romantisme Francais RésuméDocument31 pagesLe Romantisme Francais RésuméJustine Martin100% (2)
- Le RomantismeDocument44 pagesLe RomantismeNour Bouker100% (1)
- Histoire Du Roman ResuméDocument10 pagesHistoire Du Roman ResuméHicham IKHABBARNPas encore d'évaluation
- Le Genre RomanesqueDocument6 pagesLe Genre RomanesqueSerge Irie0% (1)
- ZolaDocument27 pagesZolaLucreziaBonaventuraPas encore d'évaluation
- AL4FR51TEWB1116 Lecture LitteratureDocument50 pagesAL4FR51TEWB1116 Lecture LitteratureElena Voicu100% (1)
- Les Genres RomanesqueDocument2 pagesLes Genres RomanesqueitfcinfoPas encore d'évaluation
- Littérature Française Du Xviie SiècleDocument34 pagesLittérature Française Du Xviie SiècleHuseyin Dincer100% (2)
- Cours HugoDocument5 pagesCours HugoMagdalena ChiticPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire La Peau de Chagrin PacteDocument6 pagesAnalyse Linéaire La Peau de Chagrin PactePetitpo 09Pas encore d'évaluation
- DISSERTATION Le Roman Doit-Il Accorder La Priorité À La Représentation Du Réel Ou Tout Au Contraire Privilégier L'invention ImaginaireDocument5 pagesDISSERTATION Le Roman Doit-Il Accorder La Priorité À La Représentation Du Réel Ou Tout Au Contraire Privilégier L'invention ImaginaireAme AngéliquePas encore d'évaluation
- Couturier M. Postface A La Figure de L'auteur 2008Document10 pagesCouturier M. Postface A La Figure de L'auteur 2008anon_750073837100% (1)
- Les Misérables de Victor Hugo (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frD'EverandLes Misérables de Victor Hugo (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frPas encore d'évaluation
- Ecrire un roman historique ou régionaliste: Guide pratiqueD'EverandEcrire un roman historique ou régionaliste: Guide pratiquePas encore d'évaluation
- LICENTADocument85 pagesLICENTARaluca Mădălina VoiculețPas encore d'évaluation
- 400 Histoire Du RomanDocument4 pages400 Histoire Du RomanSarah SlimaniPas encore d'évaluation
- Sequence Roman Revisitee 1Document12 pagesSequence Roman Revisitee 1Vã NõuPas encore d'évaluation
- RomanDocument5 pagesRomannajhabibPas encore d'évaluation
- LLE Cours BoutaghaneDocument15 pagesLLE Cours Boutaghanefohej55867Pas encore d'évaluation
- ExposerDocument3 pagesExposerz4snmd5m8nPas encore d'évaluation
- Personnage en MargeDocument5 pagesPersonnage en Margep45268qdffPas encore d'évaluation
- Re Introduction Zola VR VRDocument10 pagesRe Introduction Zola VR VRomaridaabou123Pas encore d'évaluation
- Cours Du SII PDFDocument9 pagesCours Du SII PDFLynda DidaPas encore d'évaluation
- Lhistoire de LetterateureDocument5 pagesLhistoire de Letterateuremiloud rouabhiPas encore d'évaluation
- Qu'est Que La Littérature Française ?Document3 pagesQu'est Que La Littérature Française ?omarPas encore d'évaluation
- Littérature 19Document10 pagesLittérature 19AlbertaMozzarelliPas encore d'évaluation
- Introduction Aux Grandes Th+®ories Du RomanDocument6 pagesIntroduction Aux Grandes Th+®ories Du RomanmayaguerrandPas encore d'évaluation
- Les Mouvements LittérairesDocument6 pagesLes Mouvements LittérairesmoskitokitokitoPas encore d'évaluation
- Appui 2Document2 pagesAppui 2Zakariae BenaliPas encore d'évaluation
- Synthèse RomantismeDocument5 pagesSynthèse RomantismenoaPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitogmios_94Pas encore d'évaluation
- Histoire Des Idee de Moyen AgeDocument8 pagesHistoire Des Idee de Moyen Agegaddaoui anasPas encore d'évaluation
- Le RomantismeDocument3 pagesLe RomantismeLily SaimonPas encore d'évaluation
- La Littérature Française Du Xixe Siècle SDocument2 pagesLa Littérature Française Du Xixe Siècle SDai AriasPas encore d'évaluation
- Anthologie du roman historique: En Belgique francophoneD'EverandAnthologie du roman historique: En Belgique francophonePas encore d'évaluation
- Le RomantismeDocument5 pagesLe RomantismeYoussoufa TinePas encore d'évaluation
- Historique Du RomanDocument3 pagesHistorique Du RomanBerkal WahibaPas encore d'évaluation
- COURS 2 Eme Année Licence Culture Et CivilisationDocument3 pagesCOURS 2 Eme Année Licence Culture Et Civilisationboukhemis manel100% (1)
- L e RomantismeDocument3 pagesL e RomantismeFama GueyePas encore d'évaluation
- Synthèse - Le RomantismeDocument4 pagesSynthèse - Le Romantismesara.hmdi75Pas encore d'évaluation
- Literatura FrancesaDocument6 pagesLiteratura FrancesaARUME BAJO GARCÍAPas encore d'évaluation
- Littérature(s) Contemporaine 1Document9 pagesLittérature(s) Contemporaine 1greyminouPas encore d'évaluation
- Le Nouveau Roman 3Document7 pagesLe Nouveau Roman 3afilal23Pas encore d'évaluation
- Le RomanDocument8 pagesLe Romanfatoudionesenegal99Pas encore d'évaluation
- La TresseDocument23 pagesLa TresseamandyneedouardPas encore d'évaluation
- Le RomantismeDocument3 pagesLe RomantismeLidia QuesadaPas encore d'évaluation
- La Prose Du XX Siècle, Marcel Proust, MadelaineDocument6 pagesLa Prose Du XX Siècle, Marcel Proust, MadelaineElena MarinoniPas encore d'évaluation
- Littérature Française Du Moyen ÂgeDocument12 pagesLittérature Française Du Moyen ÂgeMickel HaddadPas encore d'évaluation
- Victor HugoDocument12 pagesVictor Hugogiulia CellerinoPas encore d'évaluation
- PortfolioDocument20 pagesPortfolioArthur ZhangPas encore d'évaluation
- Pierre Michel, Les Romans de Mirbeau Vus Par L'opus DeiDocument3 pagesPierre Michel, Les Romans de Mirbeau Vus Par L'opus DeiAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Andrée Chedid: Femme Multiple, Écrivaine MultipleDocument24 pagesAndrée Chedid: Femme Multiple, Écrivaine MultipleDaniela K.Pas encore d'évaluation
- Des Écrits Je M'entraîne: CompréhensionDocument10 pagesDes Écrits Je M'entraîne: CompréhensionMaria Ginevra GalloPas encore d'évaluation
- 1cahier de Textes AMEF 2019Document14 pages1cahier de Textes AMEF 2019dorinePas encore d'évaluation
- Le Roman CatholiqueDocument3 pagesLe Roman CatholiqueKalou6100% (1)
- Assia Djebbar La SoifDocument2 pagesAssia Djebbar La Soifchemseddine chihebPas encore d'évaluation
- Silo - Tips - Livre Prof fr5 Chap02Document10 pagesSilo - Tips - Livre Prof fr5 Chap02taffach57Pas encore d'évaluation
- قصّة الأمير و الفقيرDocument11 pagesقصّة الأمير و الفقيرanon_921187Pas encore d'évaluation
- Le Grand Meaulnes SequenceDocument15 pagesLe Grand Meaulnes SequenceSylvie COLYPas encore d'évaluation
- 1830 4927 1 SMDocument20 pages1830 4927 1 SMYounes El ManzPas encore d'évaluation
- Don QuichotteDocument3 pagesDon QuichotteMa LiaPas encore d'évaluation
- Crise de L'histoire Réécriture PostmoderneDocument92 pagesCrise de L'histoire Réécriture Postmodernemervett78Pas encore d'évaluation
- 310507065339chapitre 8 Voltaire 2Document22 pages310507065339chapitre 8 Voltaire 2mohaPas encore d'évaluation
- Comment Rediger Une CritiqueDocument1 pageComment Rediger Une Critiquecarlos 2211100% (1)
- Structure Narrative Et Organisation Textuelle Chez: Assia DJEBAR, Dans L'Amour, La FantasiaDocument67 pagesStructure Narrative Et Organisation Textuelle Chez: Assia DJEBAR, Dans L'Amour, La FantasiaSãb RïnãPas encore d'évaluation
- L'enfant, Prétexte Littéraire Du Roman Maghrébin, Des Années 1950 Aux Années 1980Document25 pagesL'enfant, Prétexte Littéraire Du Roman Maghrébin, Des Années 1950 Aux Années 1980Nadia BenPas encore d'évaluation
- LA14 Madame de LafayetteDocument4 pagesLA14 Madame de LafayetteLola Gonzalez-GalopinPas encore d'évaluation
- Résumé Du Livre "Corniche Kennedy" de Maylis de KerangalDocument5 pagesRésumé Du Livre "Corniche Kennedy" de Maylis de Kerangalsembat69200Pas encore d'évaluation
- Sellam HodaDocument56 pagesSellam HodaSai SoumiaPas encore d'évaluation
- Revista Amerika - Opera Do Malandro PDFDocument23 pagesRevista Amerika - Opera Do Malandro PDFAndre AguiarPas encore d'évaluation
- Marta Teixeira Anacleto - Infiltrations D'images - de La Reecriture de La Fiction Pastorale Iberique en France (XVIe-XVIIIe Siecles) - (2009)Document398 pagesMarta Teixeira Anacleto - Infiltrations D'images - de La Reecriture de La Fiction Pastorale Iberique en France (XVIe-XVIIIe Siecles) - (2009)ZoraRosaPas encore d'évaluation
- Fiche Synthèse RomanDocument3 pagesFiche Synthèse Romanpivoine42Pas encore d'évaluation
- Marcandier Littérature Et Écologie Ciclic 2019 CopieDocument6 pagesMarcandier Littérature Et Écologie Ciclic 2019 CopieDr-Hicham BédeirPas encore d'évaluation
- Fiche Pédagogique-Réquisitoire OralDocument1 pageFiche Pédagogique-Réquisitoire OralEsprit PurPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitNermine NasrPas encore d'évaluation