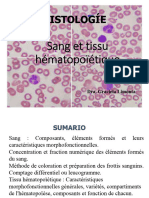Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Mononucléose infectieuse infection à EBV fièvre glandulaire
Mononucléose infectieuse infection à EBV fièvre glandulaire
Transféré par
Nabyl BektacheCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Mononucléose infectieuse infection à EBV fièvre glandulaire
Mononucléose infectieuse infection à EBV fièvre glandulaire
Transféré par
Nabyl BektacheDroits d'auteur :
Formats disponibles
Mononucléose infectieuse
Point de vue Hématologie (Infection à VEB, «Fièvre glandulaire») MQZH 2012-02
Introduction
Virus Epstein-Barr – Transmission La mononucléose infectieuse (également appelée «Fièvre glandulaire») est une infection provo-
et persistance dans les cellules B quée par le virus Epstein-Barr (VEB). Près de 95% des adultes ont subi une infection à VEB. Une
grande majorité des infections à VEB évolue de manière asymptomatique. En présence d’infec-
Après une infection, une partie tions cliniquement manifestes, les patients souffrent entre autres, de maux de tête, fatigue, fièvre,
gonflement des ganglions lymphatiques, pharyngite (inflammation de la gorge), splénomégalie
des virus EB persistent de manière
(augmentation du volume de la rate) et hépatomégalie mineure (augmentation du volume du
latente dans les lymphocytes B foie). L’examen hématologique montre une lymphocytose accompagnée généralement d’un
(«memory cells»). En présence nombre élevé de leucocytes et de modifications réactives des lymphocytes. Sur le plan purement
d’un système immunitaire intact, morphologique, la différenciation de ces cellules par rapport aux lymphocytes néoplasiques asso-
ils sont toutefois contrôlés à vie ciés à des proliférations lymphocytaires malignes peut parfois s’avérer difficile. Le diagnostic dé-
par les cellules T. Une réactivation finitif repose sur la recherche sérologique d’anticorps dirigés contre le VEB ou sur une méthode
peut se manifester par exemple en de génétique moléculaire via le dépistage de l’ADN viral par PCR. Les préparations de l’essai
cas d’immunosuppression. interlaboratoire actuel proviennent d’une patiente âgée de 21 ans présentant une infection à VEB.
La transmission du virus Epstein- Physiopathologie
Barr passe par la salive de per- Le virus Epstein-Barr (VEB) appartient à la famille des virus herpès. Il est transmis par la salive
sonnes infectées, raison pour la- et infecte les cellules épithéliales de la gorge ainsi que les lymphocytes B. L’infection entraîne
quelle cette infection est désignée une réaction des cellules T cytotoxiques. Les lymphocytes B colonisés se transforment, sous
également de «Maladie du baiser». l’influence du virus, en cellules lymphoblastoïdes, qui produisent des anticorps hétérophiles. Les
La contamination touche souvent lymphocytes réactifs dont la présence sur l’hémogramme est caractéristique d’une infection à
VEB, sont des lymphocytes T activés et des cellules NK (natural killer cells). En outre, on retrouve
les enfants, les adolescents et les
un plus petit nombre de cellules modifiées aux aspects blastiques, qui sont généralement des
jeunes adultes. lymphocytes B.
Le virus est largement répan- Résultats de laboratoire
du et près de 95% des plus de
30 ans sont infectés par le VEB. Résultat Fréquence Observation
L’infection évoluant souvent aussi
Lymphocytose abs./rel. 99% > 60% de lymphocytes (généralement 10 –15
de manière asymptomatique, de G/l)
nombreuses personnes ignorent
qu’elles avaient été infectées. Des Lymphocytes atypiques 99% modifications réactives
tests sérologiques, qui dépistent la Neutropénie 60-80% favorise des surinfections bact.
présence d’anticorps dirigés con- Thrombopénie, mineure 25-50%
tre l’IgG-EBNA, permettent cepen-
Anémie, sévère rare autoimmunohémolytique (auto-Ac)
dant de diagnostiquer l’infection.
Anticorps anti-VEB dans le 100% VCA-IgM, VCA-IgG et IgG-EBNA*
sérum (se manifestent dans cet ordre au cours de
l’infection)
Différenciation monocytes / lym- Hétérophile Ac anti-IgM dans le 80-100% mononucléose test rapide («Monospot»)
phocytes réactifs sérum
ADN du VEB (PCR) 100%
Les monocytes présentent un Taux hépatiques path. 80-100% ALT, AST
cytoplasme gris bleu («gris tourte-
Agglutinines froides 10-50%
relle»). Il peut être basophile plus
foncé lorsqu’il jouxte un érythro- Hyperbilirubinémie 30-50%
cyte. Toutefois cette basophilie * VCA = Virus capsid Antigen (enveloppe du virus), EBNA= antigènes associés au noyau
est limitée à une fine zone au
Source: «Diagnostische Hämatologie» H.Huber, H.Löffler, D. Pastner
bord. Le plasma des monocytes
contient souvent des vacuoles.
Différenciation monocytes / lymphocytes réactifs
En revanche les lymphocytes réac-
tifs montrent une basophilie du cy-
toplasme plus prononcée, qui est
particulièrement impressionnante
Monocytes
aux bords, mais diffuse vers le
noyau où elle devient de plus en
plus claire. Ce «dégradé de cou-
leur» vers le noyau est typique des
lymphocytes réactifs.
Lymphocytes
réactifs
Point de vue Hématologie Morphologie des lymphocytes
Les lymphocytes réactifs se placent, du point de vue morphologique, entre les lymphocytes, les
plasmocytes et les monocytes. Les cellules présentent une taille variable (8 –25µm) et des ano-
Variabilité des lymphocytes réac- malies au niveau de la forme et de la structure du noyau ainsi que des divergences en termes de
tifs largeur et de coloration du cytoplasme (polymorphie de taille et de noyau).
Les termes utilisés pour ces cellules sont également divers et varient d’un laboratoire à un autre
(lymphocytes réactifs, formes réactives lymphatiques, virocytes, lymphomonocytes, lymphocytes
La variabilité morphologique au transformés).
sein de la population des lym-
phocytes est importante («image
multicolore»). Elle peut varier Cellule Taille Noyau Cytoplasme
considérablement à la fois d’un 8 –10 µm rond, chromatine étroit, basophile
Lymphocyte
patient à un autre et à l’intérieur dense en mottes
des différents stades.
normal
La variabilité de la taille des
cellules est impressionnante.
Outre des lymphocytes présen- 10 –12 µm légèrement ovale, largeur moyenne, baso-
LGL – large granular
tant seulement un grossissement chromatine dense phile clair avec granulati-
négligeable allant jusqu’à env. 15 on grossière azurophile
µm, il existe également de très
(cellule NK)
lympocyte
grandes cellules avec un diamètre
cellulaire allant jusqu’à 25 µm.
Tandis que les lymphocytes
10 –15 µm sinué ou irrégulier, largeur moyenne, légère-
réactifs d’un diamètre cellulaire
chromatine dense ment basophile au bord,
jusqu’à env. 20 µm sont retrouvés zone plus claire autour du
dans diverses infections virales noyau.
(rubéole, rougeole, hépatites
virales), les éléments fortement
agrandis d’un diamètre cellulaire
de >20 µm sont typiquement as- 10 –15 µm rond à faiblement largeur moyenne, légère-
sociés au VEB (virus Epstein-Barr), sinué, excentrique, ment basophile au bord,
chromatine dense zone plus claire autour
au CMV (cytomégalovirus), à une
du noyau
infection primaire à VIH et une
toxoplasmose.
Lymphocytes réactifs
15 –20 µm sinué, irrégulier, largeur moyenne,
chromatine disper- bords év. entourés
sée, év. nucléoles d’érythrocytes, bord
basophilie foncé avec
zone plus claire autour
du noyau
20 –25 µm irrégulier, encoché, large, bords év. entourés
chromatine fine, sou- d’érythrocytes, basophi-
vent un à plusieurs lie large, intense au bord
nucléoles avec zone plus claire
autour du noyau
12 –20 µm allongé, en forme de largeur moyenne, gris-
haricot, sinué, chro- basophile, souvent avec
Monocyte
matine à structure vacuoles, granulation fine
fine, «spongieuse», azurophile.
absence de nucléoles
8 –14 µm excentrique, rond, basophile foncé avec
chromatine grossière zone périnucléaire
Plasmocyte
Impressum en mottes marquée. Absence de
Auteur Annette Steiger nucléoles.
Photos Dr. Roman Fried
Conseil professionnel:
K. Schreiber, Dr. J. Goede
Clinique d‘Hématologie
Hôpital Universitaire Zürich
© 2012 Verein für medizinische
Qualitätskontrolle www.mqzh.ch
Vous aimerez peut-être aussi
- Cahier Des Charges - Solution Monétique BBCI PDFDocument18 pagesCahier Des Charges - Solution Monétique BBCI PDFMathPas encore d'évaluation
- Custo PMDocument68 pagesCusto PMfaycel045Pas encore d'évaluation
- Lymphocytose réactiveDocument2 pagesLymphocytose réactiveNabyl BektachePas encore d'évaluation
- LymphocytesDocument2 pagesLymphocytesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- EBVDocument4 pagesEBVabdelouahabmekahliaPas encore d'évaluation
- Virologie 3 PDFDocument43 pagesVirologie 3 PDFMajed HarrabiPas encore d'évaluation
- Morphologie HématologiqueDocument2 pagesMorphologie HématologiqueNabyl BektachePas encore d'évaluation
- La Leucémie Aiguë Au Cabinet MédicalDocument2 pagesLa Leucémie Aiguë Au Cabinet MédicalNabyl BektachePas encore d'évaluation
- III-334-Syndrome MononucléosiqueDocument5 pagesIII-334-Syndrome MononucléosiqueNemo Lu100% (1)
- Variétés Anatomo-Pathologiques Du Granulome Aspects PathologiquesDocument48 pagesVariétés Anatomo-Pathologiques Du Granulome Aspects Pathologiquesmaroua aouadiPas encore d'évaluation
- L'hépatite Auto-ImmuneDocument22 pagesL'hépatite Auto-ImmuneElena CerneiPas encore d'évaluation
- 48 Syndrome MononucleosiqueDocument5 pages48 Syndrome Mononucleosiqueaudekouakou458Pas encore d'évaluation
- 22 Les LymphomesDocument7 pages22 Les Lymphomesdanger inflammablePas encore d'évaluation
- La Lignee GranuleuseDocument17 pagesLa Lignee Granuleuseyaya camaraPas encore d'évaluation
- 12 - Les Leucémies AiguesDocument10 pages12 - Les Leucémies AigueshoudaPas encore d'évaluation
- Leucémie Aiguë Lymphoblastique - Hématologie Et Oncologie - Édition Professionnelle Du Manuel MSD PDFDocument1 pageLeucémie Aiguë Lymphoblastique - Hématologie Et Oncologie - Édition Professionnelle Du Manuel MSD PDFLotfi LahlouPas encore d'évaluation
- Résumé Ayoub YaiciDocument4 pagesRésumé Ayoub YaiciZiad BenamanePas encore d'évaluation
- 5-Syndrome Mononucléosique DR NazihDocument44 pages5-Syndrome Mononucléosique DR Nazihhanane elPas encore d'évaluation
- 5) Formule LeucocytaireDocument43 pages5) Formule LeucocytaireFarida SirimaPas encore d'évaluation
- CoursDocument7 pagesCourschamo chaimaPas encore d'évaluation
- HEMOGRAMME Anomalies Des Leucocytes 2022-2023 (Compatibility Mode)Document46 pagesHEMOGRAMME Anomalies Des Leucocytes 2022-2023 (Compatibility Mode)Jlizi MalekPas encore d'évaluation
- Cocci À Gram Négatif by TOUATIDocument11 pagesCocci À Gram Négatif by TOUATIfellah aminaPas encore d'évaluation
- HématologieDocument58 pagesHématologieOUMAIMA EL CHAALPas encore d'évaluation
- Hémopathies MalignesDocument49 pagesHémopathies MalignesSalam SawadogoPas encore d'évaluation
- O31920 InflammationviraleDocument16 pagesO31920 InflammationviralePrincia FITIAVANAPas encore d'évaluation
- Sepsis À BGNDocument6 pagesSepsis À BGNAhmed ZiyadPas encore d'évaluation
- Hemato05-Leucemies ChroniquesDocument18 pagesHemato05-Leucemies ChroniquesAmine BekkiPas encore d'évaluation
- 5.semiologie HematologiqueDocument6 pages5.semiologie Hematologiqueachraf benameurPas encore d'évaluation
- Les Globules Blancs Lymphocytes Et MonocytesDocument22 pagesLes Globules Blancs Lymphocytes Et Monocytesbenjaminmanca10Pas encore d'évaluation
- 1685079Document22 pages1685079Joel AmefiamPas encore d'évaluation
- Hematologie Fascicule 2010 Hyperlymphocytose Syndrome MononucleosidiqueDocument2 pagesHematologie Fascicule 2010 Hyperlymphocytose Syndrome Mononucleosidiquerseng_19894794Pas encore d'évaluation
- Le Diagnostic de La Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) en 2012Document8 pagesLe Diagnostic de La Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) en 2012ALIOUNE91Pas encore d'évaluation
- Cellule CancéreuseDocument49 pagesCellule CancéreuseSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Syndrome MyéloproliferatifDocument74 pagesSyndrome MyéloproliferatifAli MoudPas encore d'évaluation
- 43-Focus-Immunophenotypage-BiomnisDocument3 pages43-Focus-Immunophenotypage-BiomnisRougani DijaPas encore d'évaluation
- Study of Antigenic Profile of Blasts in Acute LympDocument10 pagesStudy of Antigenic Profile of Blasts in Acute Lympnazimmesbah402Pas encore d'évaluation
- Éosinophilie Avec Systèmes D Hématologie À Différeciation en Trois PopulationDocument2 pagesÉosinophilie Avec Systèmes D Hématologie À Différeciation en Trois PopulationNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Néoplasies PlasmocytairesDocument2 pagesNéoplasies PlasmocytairesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- 08-01 10h30-11h30 Bacterio MycoplasmesDocument6 pages08-01 10h30-11h30 Bacterio Mycoplasmeslibrairie MarhabaPas encore d'évaluation
- HematoDocument88 pagesHematoYounes Abid100% (1)
- 11 - Inflammation Virale, Parasitaire Et MycotiqueDocument3 pages11 - Inflammation Virale, Parasitaire Et MycotiqueNesrine DibPas encore d'évaluation
- Chapitre VII - L'INFLAMMATION VIRALEDocument52 pagesChapitre VII - L'INFLAMMATION VIRALEalmnaouarPas encore d'évaluation
- LLC 4pharDocument2 pagesLLC 4phardjassa djassaPas encore d'évaluation
- 15-Leucemies AiguesDocument4 pages15-Leucemies AiguesNoureddine BoulaouedPas encore d'évaluation
- Moy Ended Fense 2Document27 pagesMoy Ended Fense 2Salam SawadogoPas encore d'évaluation
- 321.3 Examen Cyto Bactériologique Du Liquide CéphalorachidieDocument8 pages321.3 Examen Cyto Bactériologique Du Liquide CéphalorachidieAlexandra Ascorra100% (2)
- 4 Frottis Sanguin PDFDocument35 pages4 Frottis Sanguin PDFabdellah abdelkhalek100% (1)
- Fichier Produit 1916Document11 pagesFichier Produit 1916Hakim SabirPas encore d'évaluation
- 18-Inf Herpétiques - 2017Document4 pages18-Inf Herpétiques - 2017Sebbar SebbardPas encore d'évaluation
- 0506 Reanimation Vol14 N4 p245 - 247Document3 pages0506 Reanimation Vol14 N4 p245 - 247amos kagonePas encore d'évaluation
- Leucémie AigueDocument5 pagesLeucémie Aiguewassim hamdikenePas encore d'évaluation
- NéoplasieDocument32 pagesNéoplasieAthmani Nabil100% (1)
- Mecanisme LeucemogeneseDocument8 pagesMecanisme LeucemogeneseAyoub HajjarPas encore d'évaluation
- HVP Et Cancer Classification Des LésionsDocument8 pagesHVP Et Cancer Classification Des LésionsMezouar AbdennacerPas encore d'évaluation
- 4-les cellules de l'immunié innée 2ème méd 2023.24.).pptDocument47 pages4-les cellules de l'immunié innée 2ème méd 2023.24.).pptpc lenovoPas encore d'évaluation
- Lymphomes Intracraniens Du Sujet ImmunocompétentsDocument14 pagesLymphomes Intracraniens Du Sujet ImmunocompétentsyaalaPas encore d'évaluation
- Physiopathologie Des Maladies InfectieussDocument4 pagesPhysiopathologie Des Maladies InfectieussAuguste SueliePas encore d'évaluation
- Tumeurs Benignes Malignes v2Document3 pagesTumeurs Benignes Malignes v2Andra VasilePas encore d'évaluation
- Pathologie Hepatique - Doc2Document16 pagesPathologie Hepatique - Doc2Siaka YodaPas encore d'évaluation
- VIRO 4 Diagnostic VirologiqueDocument16 pagesVIRO 4 Diagnostic VirologiquefsxnsstoaehkbhlzygPas encore d'évaluation
- Sangre y Hematopoyético Haiti 1Document50 pagesSangre y Hematopoyético Haiti 1tntanime00Pas encore d'évaluation
- Système immunitaire: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandSystème immunitaire: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Érythrocytes MicrocytairesDocument2 pagesÉrythrocytes MicrocytairesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- DrépanocytesDocument2 pagesDrépanocytesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- ThrombocytesDocument2 pagesThrombocytesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Aspects Morphologiques de La LeucémieDocument2 pagesAspects Morphologiques de La LeucémieNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Néoplasies PlasmocytairesDocument2 pagesNéoplasies PlasmocytairesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- PancytopénieDocument2 pagesPancytopénieNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Leucémie À TricholeucocytesDocument2 pagesLeucémie À TricholeucocytesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- MonocytesDocument2 pagesMonocytesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Évaluation de L'hémogramme RougeDocument2 pagesÉvaluation de L'hémogramme RougeNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Effets de La Durée Et de La Température de Stockage Sur Les Paramètres HématologiquesDocument2 pagesEffets de La Durée Et de La Température de Stockage Sur Les Paramètres HématologiquesNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Le RéfrégirateurDocument134 pagesLe RéfrégirateurNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Atelier Les Anomalies de La Formule Sanguine Docteur Joffrec AllardDocument60 pagesAtelier Les Anomalies de La Formule Sanguine Docteur Joffrec AllardNabyl BektachePas encore d'évaluation
- 00-Anatomie PathologiqueDocument108 pages00-Anatomie PathologiqueNabyl BektachePas encore d'évaluation
- Hybride F1 - Wikipédia PDFDocument24 pagesHybride F1 - Wikipédia PDFMaman BachirPas encore d'évaluation
- TP 2 Déformation D - Un PortiqueDocument4 pagesTP 2 Déformation D - Un PortiqueAber Gěstort50% (2)
- Pompe A Eau 914 LiebherrDocument18 pagesPompe A Eau 914 LiebherrLiebherrPas encore d'évaluation
- Sentinel Aerien DRR Poste h61Document6 pagesSentinel Aerien DRR Poste h61zatara100% (1)
- VW - Catalogue AmarokDocument12 pagesVW - Catalogue AmarokSerge Gostoli-GeorgesPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage ONEEP SETTATDocument22 pagesRapport de Stage ONEEP SETTATIbtissam Anoir100% (2)
- Parcours 4: Le Texte Explicatif Lecture Approfondie: Pourquoi Le Ciel Est-Il Bleu ?Document2 pagesParcours 4: Le Texte Explicatif Lecture Approfondie: Pourquoi Le Ciel Est-Il Bleu ?Nguyễn Tuệ PhươngPas encore d'évaluation
- B4d - Fiche TechniqueDocument2 pagesB4d - Fiche TechniqueYann RouvroyPas encore d'évaluation
- Abb E MAXDocument135 pagesAbb E MAXmarvin2008Pas encore d'évaluation
- Cours5 SuiteDocument13 pagesCours5 SuiteHammadi GharsPas encore d'évaluation
- Poly MDF 05 12 2020Document263 pagesPoly MDF 05 12 2020chamso chamsoPas encore d'évaluation
- Introduction La Min RalogieDocument40 pagesIntroduction La Min RalogieYassinElhasnaouiPas encore d'évaluation
- Responsabilité Sociale de L'entrepriseDocument12 pagesResponsabilité Sociale de L'entreprisemajo1234567Pas encore d'évaluation
- LMDDocument12 pagesLMDoussama lifePas encore d'évaluation
- TD1 MO de RO NGDocument2 pagesTD1 MO de RO NGVerelle Yoma MponoPas encore d'évaluation
- Cours Proprieěteěs Viscoeělastiques 2021Document53 pagesCours Proprieěteěs Viscoeělastiques 2021MOHAMED EL BACHIR BERRIOUAPas encore d'évaluation
- Dic Banda (Africa Central) FrancésDocument118 pagesDic Banda (Africa Central) FrancésEnrique GarcíaPas encore d'évaluation
- Cours StatistiqueDocument47 pagesCours StatistiqueGreat Ideas in 5 Minutes افكارعظيمة في 5 دقائقPas encore d'évaluation
- Cargos - Part1 - Chap1 2 3 4 5Document76 pagesCargos - Part1 - Chap1 2 3 4 5cramix drlPas encore d'évaluation
- Exercices 3 Noyaux-Masse Et ÉnergieDocument2 pagesExercices 3 Noyaux-Masse Et Énergieabdelfattah elmottakyPas encore d'évaluation
- Chapitre2 TD OscillateursDocument4 pagesChapitre2 TD OscillateursFatima EzzahraPas encore d'évaluation
- La TSF Moderne - N°33, Mars 1923Document84 pagesLa TSF Moderne - N°33, Mars 1923didier madelgairePas encore d'évaluation
- 14 PDFDocument1 page14 PDFApopii CatalinPas encore d'évaluation
- La Contention Et La RécidiveDocument10 pagesLa Contention Et La RécidiveAimen FeknousPas encore d'évaluation
- Terreal Guide de Pose CanalDocument16 pagesTerreal Guide de Pose CanalbastophePas encore d'évaluation
- THÉORIE DDDDocument134 pagesTHÉORIE DDDayissi jeanPas encore d'évaluation
- Catalogue Electrovanne Proportionnelle Series 610 Asco FR 4275154Document34 pagesCatalogue Electrovanne Proportionnelle Series 610 Asco FR 4275154Houcine BelhaskaPas encore d'évaluation
- Carnet Du ScorpionDocument35 pagesCarnet Du ScorpionSaikou Oumar BangouraPas encore d'évaluation