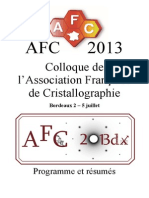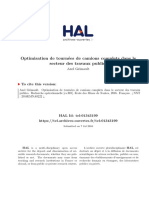Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
#Manual Técnico Da Escola Francesa
#Manual Técnico Da Escola Francesa
Transféré par
TheDoctorFeelGoodTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
#Manual Técnico Da Escola Francesa
#Manual Técnico Da Escola Francesa
Transféré par
TheDoctorFeelGoodDroits d'auteur :
Formats disponibles
Manuel technique de l'Ecole Franaise de Splologie
INITIATEUR
Mise jour du document : mai 1996
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Un Manuel Technique de splologie...
"Enfin !" diront les uns, " A quoi bon? " diront les autres... Quelles que soient les ractions suscites par la parution de ce MANUEL TECHNIQUE, il est bel et bien paru ! Et cela constitue dj un vnement, car s'il est au sein de l'E.F.S un projet qui aura connu une longue gestation, c'est bien celui-l. L'ampleur du travail a longtemps mis mal les meilleures volonts politiques, car la recherche de la perfection et de l'exhaustivit formaient des objectifs trop ambitieux. Par consquent, le document que vous avez sous les yeux n'est pas une encyclopdie. Vous n'y trouverez donc pas tout ce qui touche au matriel et la technique, et cela procde d'un choix mrement rflchi : nous avons prfr duquer plutt qu'instruire ; transmettre des savoirs utiles plutt que des savoirs savants. Il s'agit d'une slection de mthodes, de manipulations, reconnues majoritairement comme techniquement simples et efficaces. Majoritairement, car il est des cas o l'unanimit a t impossible obtenir parmi l'quipe de cadres fdraux charge de la conception du Manuel, preuve que rien n'est dfinitivement arrt dans notre discipline Ces pages constituent le chapitre INITIATEUR du Manuel Technique. Elles prsentent donc les techniques lmentaires, les principes de base que doit connatre un initiateur dans le cadre de sa fonction : initier les autres. Les techniques de pointe ou d'exception (matriel ultra lger, techniques cordelette...) seront dveloppes ultrieurement, dans un futur chapitre MONITEUR par exemple. D'ailleurs, comme tout volue, que nul n'est l'abri d'une nouvelle ide gniale (!) ou d'une critique constructive, ce manuel est conu pour tre ractualisable page par page. Si une modification, une amlioration, intervient sur un thme, la ou les pages concernes seront rdites, et l'information diffuse par l'intermdiaire de Spelunca et d'Info-EFS. S'agissant d'un Manuel Technique, on ne s'tonnera pas que les disciplines dites connexes (karstologie, biologie souterraine...) en soient absentes ou juste effleures; on se reportera utilement aux autres publications de l'E.F.S telles que les Dossiers-Instruction ou les Cahiers de l'E.F.S. Maintenant, aux lecteurs-utilisateurs de juger. Soyez convaincus que chaque remarque et proposition sur le contenu de ce Manuel Technique sera prise en compte et tudie avec toute l'attention qu'elle mrite. Merci Rmy LIMAGNE, Prsident EFS.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 2
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
une Entreprise ne de la Passion de la Splologie
De l'empirisme d'explorateurs passionns qui bricolaient les nouveaux ustensiles destins vaincre les obstacles rencontrs sous terre, la fabrication industrielle -depuis 1970- du matriel de progression sur corde... L'histoire de l'volution des techniques en splologie est troitement lie au nom de Petzl. Aujourd'hui, la socit, toujours anime par l'esprit d'innovation et soucieuse de la qualit de sa production, a une envergure mondiale. Artisan et splologue Splologue et artisan, Fernand Petzl rejoint dans les annes 30 I'quipe conduite par Pierre Chevalier dont l'objectif tait l'exploration du fameux rseau de la Dent de Crolles. En 1947, le record du monde du dveloppement souterrain et de la profondeur est largement mrit. Outre la performance, la splologie vivait alors l'volution des moyens artificiels et humains mis en uvre pour russir. A l'poque, tout tait encore inventer en matire de techniques de progression pour explorer toujours plus loin et surmonter les difficults. Fernand Petzl, trs actif sur les nombreuses expditions, bricole et ralise des prototypes adapts aux objectifs ambitieux : remonte de puits par la base, dsobstruction, passage de cascades etc... Il s'agissait d'inventer, d'essayer, de tester, d'y croire, et d' adapter toutes les innovations pour avancer. Avec son compagnon Brenot "kiki", auquel on doit les premires griffes mtalliques nommes singes ce seront les mises au point des amarrages scells au plomb, des premiers mts, etc. Ds 1942. Fernand Petzl s'intresse aux tests des premires cordes en nylon. Puis il se lance dans la fabrication en nombre des chelles. Splologue passionn. il participera activement au nouvel exploit que fut l'exploration du gouffre Berger (record du monde -1122 m, en 1956). La naissance d'une entreprise L'entreprise prend forme dans les annes 7()... Imaginez un atelier artisanal de 75 m2 situ au pied de la dent de Crolles. prs de Grenoble. Au dbut. l'atelier tait un lieu de rencontre on y apprenait les nouvelles dcouvertes du milieu souterrain, on y fabriquait les articles et on les vendait. Fernand Petzl ralise des outillages pour la fonderie et cre sans cesse. avec ses amis, ses fils. En 1968, Bruno Dressler lui prsente trois produits : les anctres du descendeur (systme de poulie flasque fixe) et du bloqueur sur corde. Il s'inspire du procd, dessine, puis met au point les nouveaux produits. Bientt les premiers outils de la rvolution des techniques de descente et de remonte sur corde sont au point. Le splologue dcouvre son autonomie et les nouvelles perspectives d'exploration qu'elle offre. Les produits furent crs dans les premires annes par intuition, un peu au hasard des demandes et des dfis techniques. La lampe frontale en est un bon exemple : il restait quantit de pices plastiques utilises pour l'clairage splo et les stocker devenait un casse-tte chinois. La "famille" inventa alors la lampe frontale. Chaque produit tait ralis avec ce qui tait conomiquement facile trouver : les premiers lastiques des lampes Zoom ont t dcoups dans des lastiques de soutien-gorge, les botes d'emballage rcupres dans les commerces pour faire les colis des commandes... A l'actif de Petzl. on peut citer entre autres, la mise au point de l'clairage splo avec piezo lectrique, le shunt, les plaquettes, les premiers harnais, etc... L'innovation et la qualit Depuis 1957, Petzl possde son laboratoire d'essais. En relation permanente avec le "milieu", la socit garde l'esprit artisanal indispensable l'innovation. L'entreprise est forte de son propre bureau d'tude, son atout est la matrise totale du produit depuis sa conception jusqu' sa ralisation industrielle avant sa commercialisation.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 3
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Les produits connaissent actuellement un nouvel lan avec les nouvelles activits professionnelles que sont les travaux en hauteur. 80% de la production est exporte. Dans la prsentation du catalogue, Paul PetzI s'exprime en ces termes "Derrire chaque produit, il y a plusieurs dizaines d'inventions. Nous en sommes fiers parce qu elles ont chang la pratique des sports engags que sont la splologie, l'escalade, le canyoning.
l'atelier, hiver 52
Tout en nous faisant plaisir, nous exigeons de nous-mme la qualit. Il en va de la satisfaction de nos clients, nos fournisseurs et mme du personnel de l'entreprise. Mais construire prend du temps. Trouver et former les hommes dans un esprit enthousiaste. honnte et cratif ne peut se faire du jour au lendemain. L'humilit, nous l'apprenons face notre responsabilit dans nos units de production en France et aux USA". Une collaboration enrichissante Si Petzl accompagne de fait chaque splologue sous terre par le port et l'utilisation de son matriel, des collaborations constantes ont lieu : test de prototypes sur le terrain, suggestions d'amliorations bases sur l'exprience des explorateurs, prsence de techniciens sur les stands aux congrs... Dans cet esprit d'change et de communication directe, Petzl prsente dans notre revue fdrale ses produits avec les explications illustres sur l'utilisation de son matriel. De plus, l'Ecole Franaise de Splologie a mis en place depuis deux ans un Groupe d'Etudes Techniques. L'quipe est charge de raliser des recherches sur les techniques splologiques. Elle diffuse les rsultats de ces tudes rgulirement dans Spelunca et Info-EFS. Accueillis plusieurs reprises dans le laboratoire de tests de la Socit Petzl et soutenus dans leurs recherches par les professionnels du bureau d'tude, les techniciens de l'E.F.S. tudient, dcortiquent, testent. dcrivent et informent les Splologues sur l'utilisation du matriel dans de bonnes conditions. Soucieux d'une pratique en toute scurit de la splologie, avec le matriel fiable, performant et conu pour l'exploration du milieu souterrain et adapt aux conditions de progression, Petzl s'est associ bien volontiers la parution de ce manuel technique destin aux initiateurs. Pour Petzl et l'EFS, une splologue.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 4
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
SOMMAIRE
PRESENTATION ........................................................................................................................ 8 1.1 1.2 LA FDRATION FRANAISE DE SPLOLOGIE ........................................................... 8 L'COLE FRANAISE DE SPLOLOGIE......................................................................... 8 L'QUIPEMENT INDIVIDUEL............................................................................................ 15 Le casque ................................................................................................................... 15 L'clairage................................................................................................................... 15 La combinaison ........................................................................................................... 16 Les sous-vtements .................................................................................................... 16 Les bottes ................................................................................................................... 17 Les gants .................................................................................................................... 17 La couverture de survie ............................................................................................... 17 Le cuissard.................................................................................................................. 17 Le baudrier de torse .................................................................................................... 18 Les longes................................................................................................................... 18 Le descendeur ............................................................................................................ 20 Le bloqueur ventral...................................................................................................... 20 Le bloqueur de poigne............................................................................................... 20 La pdale .................................................................................................................... 21 La liaison longe-poigne.............................................................................................. 21 Le bloqueur de pied..................................................................................................... 21 La montre.................................................................................................................... 22 La cl de 13mm........................................................................................................... 22 La cordelette pour nud autobloquant ........................................................................ 22 La gestion du matriel sur soi ...................................................................................... 22 Les cordes .................................................................................................................. 23 Les mousquetons........................................................................................................ 24 Les maillons rapides.................................................................................................... 25 Les plaquettes............................................................................................................. 26 Les anneaux de sangles, de corde, de cordelette ........................................................ 27 Le matriel pour spiter................................................................................................. 28 Les chevilles autoforeuses .......................................................................................... 28 Se longer..................................................................................................................... 30 Les mains-courantes ................................................................................................... 30 La descente ................................................................................................................ 30 La mise en place du descendeur .......................................................................... 30 Le passage de fractionnement.............................................................................. 31 Le passage d'une dviation .................................................................................. 31
LINITIATEUR........................................................................................................................... 15 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 2.1.16 2.1.17 2.1.18 2.1.19 2.1.20 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3
LE MATRIEL COLLECTIF............................................................................................... 23
LA PROGRESSION SUR CORDE ..................................................................................... 30
2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 5
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.3.3.4 2.3.3.5 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.4.3 2.3.4.4 2.3.4.5 2.3.4.6
Le passage de nud............................................................................................ 31 Les utilisations particulires .................................................................................. 32 La mise en place des appareils............................................................................. 33 La technique de progression................................................................................. 33 Le passage d'un fractionnement ........................................................................... 34 Le passage d'une dviation .................................................................................. 35 Le passage de nud............................................................................................ 35 La sortie de puits .................................................................................................. 35
La monte................................................................................................................... 33
2.3.4.7 L'escalade assure au bloqueur ........................................................................... 36 2.4 LA PROGRESSION SUR ECHELLE ................................................................................. 37 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 La progression ............................................................................................................ 37 L'assurance................................................................................................................. 38 Les rgles impratives................................................................................................. 39 La corde simple........................................................................................................... 39 Le choix du passage.................................................................................................... 42 Le nettoyage du passage ............................................................................................ 42 Les nuds conseills.................................................................................................. 42 Les amarrages ............................................................................................................ 43 Les amarrages naturels........................................................................................ 43 Les amarrages artificiels....................................................................................... 44
L'EQUIPEMENT AVEC CORDE ........................................................................................ 38
2.5.6.1 2.5.6.2 2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.5.10 2.5.11 2.5.12 2.6 2.7 2.8
La main-courante ........................................................................................................ 45 La tte de puits............................................................................................................ 45 La dviation................................................................................................................. 46 Le fractionnement........................................................................................................ 46 Les nuds de jonction ................................................................................................ 47 Le sac matriel ......................................................................................................... 48 Le transport du sac............................................................................................... 48
2.5.12.1
L'QUIPEMENT L'CHELLE......................................................................................... 49 DES EXEMPLES D'QUIPEMENT .................................................................................... 50 LA PROGRESSION EN EQUIPANT .................................................................................. 56 S'assurer en quipant.................................................................................................. 56 S'assurer en dsquipant ............................................................................................ 57 Situations en initiation.................................................................................................. 58 La descente ................................................................................................................ 58 La monte................................................................................................................... 59 La progression sans matriel....................................................................................... 60 La marche ................................................................................................................... 60 Le souci d'conomie.................................................................................................... 60 Les diaclases et mandres .......................................................................................... 60
2.8.1 2.8.2 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4
LES SITUATIONS D'INITIATION....................................................................................... 58
LA PROGRESSION SANS MATERIEL.............................................................................. 60
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 6
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.10.5 2.10.6 2.11 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.11.5 2.11.6 2.11.7 2.11.8 2.12 2.12.1 2.12.2 2.13 2.13.1 2.13.2 2.14 2.14.1 2.14.2 2.15 2.15.1 2.15.2 2.16 2.16.1 2.16.2 2.16.3
Les troitures .............................................................................................................. 61 Les troitures verticales............................................................................................... 61 Prsentation................................................................................................................ 62 La confection d'un poulie-bloqueur .............................................................................. 62 Le dgagement du bas vers le bas .............................................................................. 62 Le dgagement vers le haut ........................................................................................ 64 La descente sur corde tendue ..................................................................................... 65 La descente sans descendeur ..................................................................................... 65 La monte sans bloqueur ............................................................................................ 65 L'auto-dgagement lors d'une monte l'chelle......................................................... 66 L'entretien ................................................................................................................... 67 Le stockage................................................................................................................. 67 La nourriture et l'eau.................................................................................................... 68 Le carbure................................................................................................................... 68 Conseils gnraux....................................................................................................... 69 Mtorologie et splologie......................................................................................... 69 La mise en attente du bless ....................................................................................... 71 Le dclenchement de l'alerte ....................................................................................... 71 Les propritaires de cavits ou entres........................................................................ 72 L'accs aux cavits ..................................................................................................... 72 Les interdictions ou rglementations............................................................................ 72 Celles du propritaire ........................................................................................... 72 Celles induites par une activit anthropique .......................................................... 72 Celles dcrtes par une mesure de protection .................................................... 73 Le rle des splologues dans la protection et la valorisation des sites karstiques 73
LES TECHNIQUES DE RECHAPPE.................................................................................. 62
L'ENTRETIEN ET LE STOCKAGE DU MATRIEL............................................................ 67
LE MATRIEL CONSOMMABLE ...................................................................................... 68
LA PRVENTION .............................................................................................................. 69
LE SECOURISME.............................................................................................................. 71
LA LGISLATION ............................................................................................................. 72
2.16.3.1 2.16.3.2 2.16.3.3 2.16.3.4 2.16.4 2.16.5 2.16.6 2.16.7 2.17 2.18 2.17.1
Les responsabilits...................................................................................................... 74 Les assurances ........................................................................................................... 74 Le certificat mdical..................................................................................................... 74 Splologie et scurit ................................................................................................ 74 Le gisement ................................................................................................................ 75
L'ARCHOLOGIE ............................................................................................................. 75 BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................... 77
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 7
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
1 PRESENTATION
1.1 LA FDRATION FRANAISE DE SPLOLOGIE
En 1888, Edouard Alfred Martel ralisait la traverse de la grotte de Bramabiau, inventant une nouvelle activit : la splologie. En 1963 tait cre la Fdration Franaise de Splologie ( F.F.S.). En 1996, le gouffre le plus profond du monde se trouve toujours en France (le gouffre Jean Bernard, profond de 1602 mtres, en Haute-Savoie). La F.F.S. rassemble tous ceux que passionne le monde souterrain. Elle a pour but la promotion de la splologie et son enseignement, l'tude du milieu souterrain sous tous ses aspects et la protection de son environnement. Elle est dirige par un Comit Directeur (C.D.) et un Bureau. Elle est organise en Comits Rgionaux - C.S.R.(ou ligues) et Dpartementaux - C.D.S.- qui regroupent les splologues fdrs, individuels ou membres de clubs. Pour couvrir les multiples aspects de la pratique splologique, la F.F.S. a cr 14 commissions spcialises: Assurances Audio-visuel Canyon Documentation Enseignement ( E.F.S.) Environnement Mdicale (Comed) Plonge Professionnelle Publications Relations Internationales (C.R.E.I.) Scientifique Secours (S.S.F.) Statuts et Rglements intrieurs
Chaque anne se tient un rassemblement splologique national, lieu d'change o se confrontent les expriences de chacun, scientifiques, sportives ou culturelles. La F.F.S. est affilie la Fdration Splologique de la Communaut Europenne F.S.C.E.) et l'Union Internationale de Splologie (U.l.S.). Elle conserve depuis l'origine une place de leader mondial.
1.2
L'COLE FRANAISE DE SPLOLOGIE
L'cole Franaise de Splologie ( E.F.S.), Commission d'enseignement de la Fdration Franaise de Splologie, regroupe en 1996 plus de 1200 brevets membres de la F.F.S. Ces cadres fdraux, initiateurs, moniteurs, ou instructeurs, sont l'origine de la plupart des actions d'enseignement de la splologie se droulant au sein de la F.F.S ou en dehors. L'organisation et l'encadrement de stages fdraux constituent l'activit habituelle de l'E.F.S.: chaque anne une centaine de stages se droulent en France, accueillant au total plus d'un millier de stagiaires.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 8
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Ces stages se dcomposent en trois grandes catgories: Stages de formation personnelle, de la dcouverte du milieu au perfectionnement technique. Stages de formation de cadres, dlivrant trois niveaux de brevets (initiateur, moniteur, instructeur ) aux splologues qui se destinent l'enseignement. Stages spcialiss, axs sur des thmes spcifiques tels que la photographie souterraine, la topographie, la dsobstruction, etc.
Une procdure d'agrment permet de garantir pour chaque type de stage un contenu conforme aux rfrentiels de l'E.F.S. Leur dure varie de quatre quatorze jours. Notons le dveloppement rcent des actions d'enseignement vis vis d'autres pays, par l'accueil en France de stagiaires trangers, ou l'envoi l'tranger de cadres franais (Liban, Roumanie, Chine, etc.). Ces stages de haut niveau sont l'occasion de mener des tudes sur le matriel et les techniques, qui peuvent encore se perfectionner. L'E.F.S ralise aussi pour ses stages une documentation pdagogique importante. Il s'agit notamment des "Dossiers d'instruction", simples fascicules de quelques pages sur des thmes tels que la karstologie , la biosplologie, accessibles tout le monde. Ces dossiers sont complts et ractualiss rgulirement. Les Cahiers de l'E.F.S. dveloppent des sujets importants de faon plus exhaustive ; c'est l que sont gnralement publis les travaux de recherche des instructeurs. L'E.F.S gre galement une bibliothque de plusieurs milliers d'ouvrages et revues splologiques franais et trangers, ainsi qu'une vidothque et une diapothque. L'E.F.S. participe aux travaux et aux jurys du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif option Splologie. En 1996 la presque totalit des titulaires de ce Brevet d'Etat sont aussi des brevets fdraux. Afin de valoriser les acquis fdraux dans la ralisation de projets de formation professionnelle, un certain nombre d'allgements et de dispenses on t fixs pour les titulaires de Brevets Fdraux dans le cursus du BE. Ainsi, les Instructeurs sont allgs du stage de prformation sauf la partie lie la vie professionnelle des UF "Pdagogie et public particulier"(UF1), "Technique, technologie et scurit"(UF2), "Milieu"(UF3). du stage de prformation sauf la partie lie la vie professionnelle des UF2 et 3.
Les Moniteurs sont allgs -
De plus, les Qualifis et les Initiateurs prsentant une liste de courses sont dispenss des tests de slection.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 9
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Rfrentiel de l'Initiateur Fdral
En texte normal : les "pr-requis" pour l'inscription au stage ( = niveau technique "formation l'quipement") En italique : les lments enseigns au stage pdagogique Initiateur
MATERIEL ET TECHNIQUE Connaissance du matriel - Je connais le fonctionnement de la lampe actylne et sais procder aux petites rparations - Je possde un clairage mixte en bon tat et fiable - Je sais choisir des vtements adapts la cavit - Je possde un quipement complet de progression sur corde simple - Je connais les impratifs de rglage du harnais, des longes, des pdales - Je connais les diffrences entre cordes statiques et dynamiques et leur usage respectif - Je sais o trouver les caractristiques des cordes, connecteurs, chelles souples, ancrages Equipement des verticales - Je sais enkiter cordes et amarrages - Je sais choisir le matriel partir d'une fiche d'quipement - Je connais et applique le principe du double amarrage - Je sais quiper une main courante au descendeur - Je sais quiper une main courante long sur poigne - Je sais comment localiser la verticale d'un puits - Je sais tester la roche et slectionner l'emplacement d'un spit - Je sais planter un spit - Je sais choisir le type de plaquette adapt - Je sais anticiper le trajet de la corde et placer un fractionnement utile - Je sais faire un nud en huit, un cabestan, un chaise, un chaise double, et connais leurs avantages - Je sais raliser et rgler un amarrage en Y - Je sais installer une dviation et connais ses avantages - Je sais raliser un nud de raccordement - Je sais installer une chelle - Je sais lover une chelle Autonomie de progression - Je sais descendre au descendeur et m'arrter en scurit - Je sais monter aux bloqueurs en scurit - Je sais franchir un fractionnement et une dviation la descente - Je sais franchir un fractionnement et une dviation la monte - Je sais franchir un nud de raccordement - Je sais porter un kit en puits, en troiture, en mandre - Je sais franchir une troiture - Je sais progresser en opposition - Je sais franchir une main courante fractionne - Je sais monter l'chelle en auto assurance
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 10
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Auto secours - Je sais faire une conversion bloqueurs - descendeur, et descendeur - bloqueurs - Je sais descendre sur corde au nud italien - Je sais descendre aux bloqueurs - Je sais monter avec un nud autobloquant - Je sais dgager un quipier vers le bas Techniques d'assurance - Je sais faire une assurance depuis le haut au descendeur - Je sais monter et o installer un poulie-bloqueur - Je sais installer judicieusement une poulie de renvoi - Je sais dbloquer un poulie-bloqueur sous charge et redescendre un quipier VIE FEDERALE Connatre le fonctionnement d'une association - J'ai pris connaissance des statuts de mon club - Je connais le rglement intrieur de mon club - Je sais comment se droulent les lections dans un club - Je connais la procdure de dclaration d'une association en Prfecture - Je sais quelles instances peuvent attribuer des subventions au club - Je connais les obligations du prsident de club en matire d'assurance - Je connais la responsabilit du prsident de club en matire de scurit - Je connais le cadre juridique qui rgit l'encadrement des activits sportives Connatre la FFS, ses structures dcentralises, et ses commissions - Je connais les grandes lignes de l'histoire de la fdration - Je connais l'organisation de la FFS et de ses diffrentes structures - Je sais comment sont dsigns les responsables fdraux (prsident, bureau, comit directeur) - Je sais comment est constitue l'Assemble Gnrale FFS - Je connais les sources de financement de la FFS - Je sais comment contacter un responsable fdral. - Je connais les principales publications fdrales, Spelunca et Karstologia - Je connais la politique gnrale de la FFS Connatre l'EFS et ses stages - Je connais l'organigramme des stages fdraux - Je connais la composition du conseil technique de l'EFS - Je connais le rle du correspondant rgional de l'EFS - Je connais la documentation publie par l'EFS - Je connais les conditions de validit des brevets fdraux Avoir les connaissances ncessaires pour organiser un stage de Dcouverte - Je sais o trouver le calendrier des stages fdraux - Je sais ce qu'est une demande d'agrment - Je sais ce qu'est un compte-rendu normalis - Je connais les moyens d'assurer un stagiaire - Je sais tablir un budget de stage - Je connais le programme type d'un stage dcouverte
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 11
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
TOPOGRAPHIE - Je connais les diffrents usages d'une topographie de cavit - Je sais raliser une fiche d'quipement partir d'une topographie Le relev topographique - Je connais l'utilisation des outils de mesure des longueurs (dcamtre, topofil) - Je connais les avantages et inconvnients de chacun - Je connais l'utilisation des outils de mesure des directions (boussole, compas) - Je connais les avantages et inconvnients de chacun - Je connais l'utilisation des outils de mesure des pentes (clinomtre, rapporteur/fil plomb) - Je connais les avantages et inconvnients de chacun - Je sais talonner mon matriel de relev - Je suis capable de dterminer les points de vises dans une galerie simple - Je sais ce qu'est une srie et une station - Je sais prendre toutes les mesures ncessaires chaque station Le report topographique - Je sais dfinir les notions de plan, de coupe projete, de coupe dveloppe - Je sais choisir une chelle sur un plan - Je sais raliser le squelette d'un plan par mthode graphique - Je sais en extraire une coupe projete - Je sais raliser une coupe dveloppe - Je sais o trouver les signes conventionnels pour l'habillage - Je sais quels sont les renseignements complmentaires mentionner sur la topographie - Je sais dfinir (et discuter) les notions de largeur, dnivellation, profondeur, dveloppement CARTOGRAPHIE - ORIENTATION Savoir lire et utiliser une carte topographique - Je connais la dfinition d'une carte topographique - Je sais mesurer des distances grce l'chelle - Je connais la signification des couleurs de la carte - Je sais utiliser les courbes de niveau pour calculer une altitude - Je comprends la totalit des informations de la lgende - Je sais dterminer les limites d'une commune Connatre la dfinition des trois nords utiliss en France - Je sais ce qu'est le nord gographique - Je sais ce qu'est le nord magntique - Je sais ce qu'est la dclinaison magntique - Je sais ce qu'est le nord Lambert Savoir orienter une carte avec ou sans boussole - Je sais reconnatre les lments de la carte sur le terrain - Je sais aligner le nord de ma boussole sur la carte - Je sais faire une triangulation pour pointer une cavit sur la carte - Je sais pointer une cavit sur la carte en utilisant les lments caractristiques du paysage Savoir positionner un point sur une carte d'aprs ses coordonnes Lambert - Je sais ce qu'est le quadrillage Lambert - Je sais reprer ce quadrillage sur la carte
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 12
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Je sais calculer les coordonnes Lambert d'un point sur la carte Je sais trouver un point sur la carte partir de ses coordonnes Lambert
GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE - Je connais le processus de la sdimentation marine - Je peux citer diffrents types de roches sdimentaires - Je connais les caractristiques principales du calcaire (soluble, homogne, fissur) - Je peux situer les principaux affleurements calcaires en France - Je sais comment reprer les couches sur une carte gologique, valuer leur ge, dcrire leur facis - Je sais dfinir les notions de stratigraphie et de tectonique - Je connais les diffrences entre joints de strates, diaclases, failles, et peux les identifier sous terre - Je peux dfinir les notions de bassin versant, perte, rsurgence, niveau de base - Je peux dcrire le cycle de l'eau KARSTOLOGIE - Je sais reconnatre les principales formes karstiques de surface - Je connais le principe de la corrosion du calcaire - Je sais situer la zone d'absorption, la zone de transfert et la zone noye dans un karst - Je connais les principales formes de galeries souterraines et leur gense - Je connais les principales formes de remplissages souterrains - Je connais le processus du concrtionnement sous terre - Je peux localiser les principaux massifs karstiques franais - Je peux localiser les principaux rseaux splologiques franais BIOSPELEOLOGIE - Je connais les caractristiques du milieu souterrain et leur influence sur la faune cavernicole - Je connais les trois grands types de faune cavernicole - Je connais les caractres originaux des chauves-souris PREVENTION - Je connais le texte des recommandations fdrales de scurit - Je connais les rgles inhrentes l'organisation d'une exploration - Je connais les rgles de scurit particulires l'organisation d'une sortie d'initiation - Je sais prvoir le matriel d'auto-secours adapt la cavit - Je sais me renseigner et tenir compte des conditions mto avant une exploration - Je sais adapter la dure de l'exploration au niveau des participants et ventuellement renoncer SECOURISME, SECOURS - Je connais les statistiques sur les principales causes d'accidents sous terre - Je sais reconnatre les signes d'puisement, de fatigue, et ragir en consquence - Je sais reconnatre les signes d'hypothermie et ragir en consquence - Je suis capable d'appliquer les principaux gestes de survie - Je connais la conduite tenir en cas d'accident - Je connais le processus de dclenchement d'une alerte - Je connais le rle et l'organisation du SSF
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 13
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
PEDAGOGIE - Je suis capable de communiquer efficacement dans un groupe - Je suis capable de comprendre, d'assimiler, de transmettre un message - Je sais adapter ma mthode d'enseignement aux caractristiques de l'lve ou du groupe - Je suis capable d'valuer les phases d'apprentissage de l'lve ou du groupe - Je sais laborer un projet pdagogique dans le cadre d'un stage, et dfinir des objectifs un lve - Je suis capable d'valuer mon action - Je sais me situer dans une quipe d'encadrement - Je connais la ncessit d'adopter une attitude scurisante avec un dbutant - Je sais mener un bilan pdagogique avec l'lve ou le groupe - Je sais laborer et utiliser une grille d'valuation AUTRES DOMAINES - Je connais les grands principes de la physiologie sportive - Je suis conscient de la ncessit de boire sous terre - Je connais les mcanismes d'adaptation l'effort et la ncessit de l'entranement en splo - Je sais appliquer des notions de dittique dans la prparation d'une exploration - Je sais o chercher de la documentation et suis convaincu de l'importance de publier tous les travaux - J'observe et fais observer un comportement responsable vis vis du milieu et des propritaires - Je connais la politique fdrale en matire de protection de l'environnement - Je connais la conduite tenir en cas de dcouverte archologique
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 14
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2 LINITIATEUR
2.1 L'QUIPEMENT INDIVIDUEL
de
L'quipement individuel est l'adaptation l'individu au milieu naturel de la cavit.
Ce milieu n'est pas un environnement hostile, mais n'est pas exempt d'agressions. L'quipement individuel ne doit pas tre un bricolage de vtements et d'outils, mais il doit protger l'individu de toutes les agressions physiques et thermiques de la cavit. Il ne doit pas tre source de problme pour le splologue. Au contraire il doit lui permettre d'voluer facilement et d'exprimer toutes ses possibilits physiques. Cet quipement doit avoir la confiance du splologue, on ne peut pas avoir de doute sur sa rsistance et sa fiabilit. L'quipement individuel est un outil qui permet au splologue de progresser correctement sous terre. En ce sens il doit faciliter l'volution et ne doit pas gner, contraindre, ou proccuper. il doit tre confortable, adapt aux risques naturels, et aux difficults techniques. 2.1.1 Le casque
Prsentation : Il est compos d'une calotte avec trous d'aration, d'une coiffe rglable et d'une jugulaire en V. Utilisation : Il protge la tte des chutes de pierres ou d'autres objets, mais galement des chocs contre les parois (lors de chutes, dans les troitures, etc.). Except dans les troitures verticales, la jugulaire doit imprativement tre ferme pour viter de perdre le casque en cas de chutes de pierres successives, de mouvements brusques de la tte ou de chutes au sol. Le casque permet la fixation de l'clairage (clairage frontal et botier de pile). Important : le dpassement des vis de fixation de l'clairage doit se faire vers l'extrieur du casque. L'espace entre la calotte et la coiffe permet le logement d'une couverture de survie, l'exclusion de tout autre objet pouvant occasionner des blessures. Entretien : Il est important de contrler l'usure du casque, toute fissure de la calotte ou altration de la coiffe (sangle dtriore ou rivet arrach) remet en cause la scurit. Il faut donc y remdier en remplaant le casque. 2.1.2 L'clairage
Prsentation : L'clairage mixte mont sur le casque est compos de deux sources de lumire : Un clairage principal ( actylne), compos d'un collecteur de gaz (tuyau, pipe), d'un bec, d'un rflecteur, d'un dbouche bec et d'un allume gaz qui sont fixs sur le casque, et d'un gnrateur d'actylne. Un clairage d'appoint compos d'une source lumineuse lectrique.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 15
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Utilisation : Il faut connatre l'autonomie de son gnrateur d'actylne pour grer correctement une exploration. Prvoir le complment de carbure ncessaire l'exploration, plus la marge de scurit (voir secourisme), prvoir galement une ou plusieurs piles de rechange suivant le type d'exploration, ainsi qu'un sac poubelle pour ressortir la chaux de la cavit. Entretien : Eclairage principal Il faut vrifier rgulirement le bon tat des principaux lments (gnrateur, tuyau, bec, joint torique). Il est impratif d'avoir sur soi un ncessaire de rechange (bec et joint torique). Eclairage d'appoint Il faut vrifier rgulirement son bon tat (cosses, fils lectriques, interrupteur, ampoule, contact), et avoir imprativement une ampoule de rechange. 2.1.3 La combinaison
Prsentation : La combinaison est un lment essentiel de l'quipement individuel, puisque c'est elle qui est en contact direct avec l'environnement (humidit, froid, agression du rocher,...), et qu'elle doit nous en protger. La combinaison est en une seule partie, sans cordelette ou sangle superflue, ceci pour viter divers problmes d'accrochage. Elle ne doit pas prsenter de tissus flottants pouvant s'introduire dans les appareils de progression. Elle doit tre la bonne taille ce qui vite lors des passages troits qu'elle se boudine ou s accroche, et bloque la progression. De plus, trop grande ou trop petite, elle entrave les mouvements et se dtriore plus rapidement. Utilisation : Il faut adapter le type de combinaison la cavit et au type d'exploration Coton pour les rseaux trs chauds. Nylon enduit pour les rseaux temprs. P.V.C. enduit pour les rseaux humides. Les sous-vtements
2.1.4
Prsentation : Les sous-vtements doivent tre en tissu hydrofuge (ne retenant pas l'eau et schant rapidement), ils doivent tre simples (pas de boutons) et bien ajusts (boudinage). La sous-combinaison Tout comme la combinaison, la sous-combinaison doit tre d'une seule pice. Pour viter le boudinage, pour un meilleur confort, les reins ne doivent pas tre nu. Elle doit avoir un minimum de coutures et de replis de tissu au niveau du baudrier. Pour les cavits froides, on peut rajouter des polos en tissu hydrofuge. Les chaussettes En laine paisse, il est agrable d'en mettre deux paires pour le confort dans les bottes. On peut aussi utiliser des chaussons en noprne. Utilisation : Il faut adapter l'habillement la temprature de la cavit : lger pour les cavits tempres ou chaudes, polaire ou plusieurs paisseurs pour les cavits froides. On peut prendre des vtements de rechange pour les cavits aquatiques.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 16
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.1.5 Les bottes En caoutchouc, non toil de prfrence (schage rapide, pas d'odeur...). Elles ont une semelle suffisamment crante pour permettre une adhrence maximum. 2.1.6 Les gants C'est un lment de scurit Pour les nophytes, les gants sont gnants dans la manipulation des appareils. Mais il faut rapidement trouver le modle adapt sa main (souple et rsistant), afin d'viter les petites blessures ou coupures qui perturbent l'habilet manuelle. Dans les cavits humides et froides, il faut choisir des gants en PVC manchettes longues, pour viter un refroidissement important. 2.1.7 La couverture de survie Elle doit faire partie intgrante de l'quipement individuel du splologue. Elle doit tre systmatiquement emporte sous terre, le splologue doit la porter sur lui et non dans un sac et elle doit tre en bon tat. Prsentation : Il existe deux modles de couverture de survie : lgre (facile loger dans le casque, mais trs fragile), et renforce (modle rutilisable). Utilisation : Permet de supporter des attentes imprvues et vite de se refroidir (position de la tortue), permet aussi de loger dans son emballage du papier et un crayon. Sert en cas d'immobilisation force conditionner le bless (voir chap 2.1 5.1). Se dtriore au contact prolong avec l'eau, surtout non dplie. 2.1.8 Le cuissard
Prsentation : Il est compos d'une sangle de ceinture, des sangles de tour de cuisses, d'un systme d'accrochage (boucles mtalliques, boucles en sangle ou anneau soud), des systmes de rglage de la ceinture, des tours de cuisses et ventuellement de sangles sous fessires. Il est important d'utiliser un cuissard confortable. Utilisation : Le rglage du cuissard se ralise sur soi avec les vtements communment utiliss pour aller sous terre. Il faut que le cuissard soit parfaitement ajust de faon ce que le splologue soit en scurit (bon maintien). Respecter les notices des fabricants concernant le passage des sangles dans les passants prvus cet effet. Il ne faut pas que le splologue, au cours d'une manuvre, quelle qu'elle soit, puisse perdre son cuissard. Une fois le rglage effectu, couper l'excs de sangle, en conservant une marge de scurit (8 cm minimum). Toute retouche est susceptible d'entraner l'annulation de la garantie du fabricant. La fermeture du cuissard se fait l'aide d'un M.A.V.C (Maillon A Vis de Ceinture). Il existe deux formes : demi-rond et triangulaire. Le demi-rond permet un meilleur positionnement des appareils et des boucles du harnais.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 17
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Ces deux modles existent en acier et en zicral. il est important que le sens de vissage se fasse de droite gauche (vu par le splologue, matriel sur lui), cela vite que le frottement de la corde ne dvisse la virole lors de la monte. On ne doit pas fermer le cuissard avec un mousqueton traditionnel car les forces produites par les appareils de progression (descendeur, bloqueur ventral et longes), font qu'il travaille de travers, or il n'est pas prvu pour cela. Certains fabricants commercialisent actuellement des mousquetons spcifiques destins cet usage. On peut les employer en respectant les consignes du constructeur. Entretien : Surveiller l'tat des coutures, il faut imprativement changer de cuissard si les sangles sont uses ou dchires. Ne rien coudre ou riveter directement sur le cuissard. 2.1.9 Le baudrier de torse
Prsentation : Le baudrier de torse est compos d'un anneau de sangle ; on distingue le baudrier de torse en huit ou le baudrier de torse rglable. Le huit Avantage : simplicit. Inconvnients : rglage unique, gne la respiration car il comprime la cage thoracique dans certains passages, comme les plans inclins ou troitures, il n'est pas adapt aux petits gabarits, et douloureux pour les dames. Le rglable Avantages : modle plus adapt que le prcdent car il limine les inconvnients du huit rglage unique. Il permet d'adapter la tension du bloqueur ventral dans les plans inclins, dans les puits troits ou les grandes verticales. Il permet d'optimiser le rendement lors de la monte. Utilisation : Il permet de maintenir le bloqueur ventral sur la poitrine du splologue dans une position verticale. Torse en huit : mousquetonner la sangle du torse dans le trou suprieur du bloqueur ventral au moment de la monte. Torse rglable: la sangle du torse est installe dans le trou suprieur du bloqueur ventral au moment de la descente, mais sans tension. Au moment de la monte, tendre le torse (ranger le bout de sangle de tension afin qu'il ne s'introduise pas dans le bloqueur ventral). Entretien : Surveiller l'usure de la sangle, de la boucle de rglage et des coutures. 2.1.10 Les longes
Prsentation : Deux longes suffisent pour raliser toutes les manuvres de la splologie moderne en toute scurit. Le systme de longe double en corde dynamique (diamtre minimum 9 mm) est prconis. Il se prsente sous la forme d'un nud de huit double dont les bouts
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 18
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
se terminent chacun par un nud de huit double avec mousqueton. Le terme de longe comprend la corde dynamique plus le mousqueton. Il ne faut en aucun cas raliser de longes en corde statique ou en sangle, car elles ne jouent pas leur rle d'amortisseur en cas de chute. Certains fabricants proposent des longes en sangle avec un procd les rendant dynamiques. Ces longes sont adaptes la splologie, mais il faut vrifier les coutures aprs une chute (elles ont un inconvnient : leur taille unique). Les mousquetons de longes sont sans vis, de prfrence asymtriques, en alliage d'une rsistance suprieure ou gale 2200kg. En outre ils doivent pouvoir s ouvrir sous charge. Ne pas utiliser de mousquetons ultra lgers spcifiques l'escalade, car leur domaine d'utilisation est diffrent. Ne pas utiliser de mousquetons doigts couds car ceux-ci peuvent s'ouvrir et s chapper de la corde intempestivement, par exemple si la main courante peu tendue fait une boucle. Les mousquetons sont rendus imperdables de diffrentes manires: - A l'aide d'une barrette inox, monte d'origine sur le mousqueton. Mais ce systme prsentant quelques risques ne sera bientt plus commercialis. A l'aide d'un lastique de chambre a air. Ces montages sont fortement recommands, ils facilitent l'utilisation de la longe, car le mousqueton est toujours dans le bon sens.
Dans les deux cas, les ganses des nuds doivent tre les plus courtes possible pour viter qu'elles ne s'chappent des mousquetons lors d'une fausse manuvre.
Confection des longes : On distingue la longe courte et la longe longue. La longe courte doit tre suffisamment longue pour pouvoir se longer au fractionnement lors de la monte (cette longueur est dicte par la dimension des appareils) : 41 cm du M.A.V.C l'ouverture du doigt du mousqueton (voir dessin). Une longe trs courte n est pas plus sre et est gnante dans les manuvres. La longe longue : sa longueur maximum est fonction de la morphologie du splologue. C'est dire qu'en tension sur le bloqueur de poigne (reli au bout de la grande longe) le splologue doit pouvoir atteindre celui-ci.
La longueur minimum est dicte par la technique de remonte sur corde : elle ne doit pas limiter vers le haut l'amplitude des mouvements. Utilisation : Leur utilisation est indispensable lors de la pratique sur agrs. Elles se relient au M.A.V.C. par l'intermdiaire du nud de huit double (voir positionnement du matriel). Remarque : Une troisime longe reliant en permanence le bloqueur de poigne au M.A.V.C est superflue et n'apporte aucune scurit supplmentaire. Elle ne peut qu'ajouter de la confusion dans les manuvres.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 19
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.1.11
Le descendeur
Prsentation : Il existe diffrents types de descendeurs en splologie, nous citons ici deux modles : le modle simple et le modle poigne. Ils sont poulies fixes et ont une flasque mobile avec cliquet pour pouvoir les ouvrir sans les dsolidariser du mousqueton. Utilisation : Il convient de connatre l'utilisation et les limites des deux modles. Les descendeurs sont solidaires du M.A.V.C par l'intermdiaire d'un mousqueton vis et s'utilisent imprativement avec un mousqueton de renvoi (de prfrence en acier). Au niveau de l'apprentissage, le descendeur simple doit tre prfr au modle poigne, car ce dernier mobilise les deux mains et sa manipulation est plus complexe. Une erreur de manuvre peut entraner la chute (crispation sur la poigne). L'utilisation de la poigne comme frein est proscrire car elle altre les cordes (vitrification, ovalisation) ; elle est uniquement utilise pour s'immobiliser sur la corde. Pour un arrt prolong ou dlicat (plant de spit ou pendule), il faut faire une cl d'arrt, quel que soit le modle. Le descendeur simple est facile utiliser en toutes situations. Le descendeur poigne est rserv des splologues autonomes conscients des limites de l'appareil. Entretien : Surveiller l'usure des poulies qui peuvent tre tournes une premire fois, ensuite elles doivent tre changes (ne pas attendre de voir la vis de fixation de la poulie pour la tourner ou la changer). Surveiller galement l'usure gnrale (flasques, cliquet, vis). 2.1.12 Le bloqueur ventral
Utilisation : Le bloqueur ventral est utilis pour la remonte, il est fix sur le M.A.V.C. Mme s'il ne sert pas pendant la descente, il doit rester la mme place pour permettre d'ventuels changements de progression ou d'ventuelles interventions sur un quipier. La pratique qui consiste placer le bloqueur ventral dans le sac la descente est stupide et dangereuse. Entretien : Vrifier l'usure des picots qui permettent le blocage sur la corde. Vrifier l'usure du corps qui peut devenir tranchant au point de sortie de la corde. Vrifier l'usure de la gchette et de l'axe. Vrifier l'usure du trou de fixation au M.A.V.C. Le refermer hors utilisation. 2.1.13 Le bloqueur de poigne Il existe les bloqueurs simples et les bloqueurs poigne. Si les premiers ont l'avantage de leur faible encombrement, les seconds ont celui d'une meilleure prise en main. Les deux prsentent les mmes garanties de scurit. Il faut viter de choisir des modles exotiques proposs par certains fabricants o le blocage sur la corde se fait par un jeu de biellettes et de cames.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 20
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Utilisation : Il est solidaire de la pdale par l'intermdiaire d'un mousqueton a vis. Entretien : Vrifier l'usure des picots qui permettent le blocage sur la corde. Vrifier l'usure du corps qui peut devenir tranchant. Vrifier l'usure de la gchette et de l'axe. Le refermer hors utilisation. Remarque : Il existe des bloqueurs poigne pour gaucher. 2.1.14 La pdale
Prsentation : Il s'agit d'une cordelette statique d'un diamtre minimum de 5,5 mm avec un nud une extrmit permettant de l'accrocher au mousqueton vis du bloqueur de poigne ; l'autre extrmit deux boucles (nud en Y) permettant de positionner les pieds. Il ne faut pas qu'il y ait de nud intermdiaire car cela empche de l'utiliser pour le dgagement d'quipier. La longueur de la pdale doit tre telle que, jambe tendue, le bloqueur de poigne se positionne juste au dessus du bloqueur ventral. Les pdales en sangle peuvent se coincer dans le croll ; dans ce cas, mettre son poids sur la pdale et tirer vigoureusement la sangle vers l'extrieur. Utilisation : Sert la pousse des pieds lors de la monte et dans une mthode de dgagement d'quipier sur corde. Peut aider dans certains passages ariens de fractionnement et de main courante. Entretien : Surveiller l'usure, surtout la ou les boucles infrieures (frottement de la corde de progression). 2.1.15 La liaison longe-poigne
Prsentation : La liaison se fait avec la longe longue, dans le mousqueton vis du bloqueur de poigne. 2.1.16 Le bloqueur de pied
Utilisation : Appareil facultatif, sur le principe d'un bloqueur ventral ou de poigne, le bloqueur de pied va aider considrablement lors de la monte (conomie d'nergie, rapidit), et aux passages d'troitures verticales ou en sorties de puits troites. Entretien : Surveiller l'usure gnrale (sangles, gchette, corps). Remarque : Il ne remplace pas l'utilisation des bloqueurs de poigne et de poitrine.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 21
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.1.17 La montre La splologie est une activit de pleine nature, de loisirs. Mme si cette notion de plaisir, de vacances, est souvent oppose la notion de contrainte de temps et d'horaire, il est important de prendre une montre sous terre car c'est la seule indication en absence de soleil pour se reprer dans le temps. Ce reprage est indispensable pour organiser la sortie, prvoir le retour en fonction de l'aller, grer l'clairage, les rserves de carbure, l'alimentation, la fatigue et ventuellement les secours. Elle permet aussi d'viter des retards gnrateurs d'inquitude. La montre est un lment de scurit. 2.1.18 La cl de 13mm Cl de 13 plate ( fourche ou il) servant visser et dvisser les amarrages. Important: un amarrage bien viss est un amarrage dont la vis est serre modrment. 2.1.19 La cordelette pour nud autobloquant Anneau de cordelette d'un diamtre minimum de 5,5 mm servant raliser un nud autobloquant (Machard par exemple). Il sert remplacer un des bloqueurs en cas de perte de celui-ci. Voir dessin ou chapitre 2.11.7. 2.1.20 La gestion du matriel sur soi
Principe : Le matriel est dispos sur soi de faon ce que l'on puisse tout moment l'utiliser: pas de descendeur dans le kit la monte, on le met sur le ct. Idem pour les bloqueurs : la descente, le bloqueur ventral reste sur le M.A.V.C., bloqueur de poigne et pdale la ceinture. Pour le positionnement du matriel sur le M.A.V.C, se rfrer ou dessin (positionnement du matriel), ce principe vite d'emprisonner dans le bloqueur ventral les longes et les mousquetons. Pour le reste du matriel, chacun fait un peu ce qu'il veut, tout en gardant l'esprit que les passages troits puisent les splologues qui laissent traner leurs longes et pdale. Le nettoyage du matriel aprs choque sortie est un principe de scurit. On ne peut vrifier l'tat du matriel que s'il est propre. Un splologue doit avoir un clairage performant (efficace, bien rgl), pour bien visualiser la cavit, les passages, les prises. La faiblesse de l'clairage entrane une fatigue visuelle et physique. Il ne faut donc pas rduire volontairement sa flamme pour soi-disant conomiser le carbure, c'est un principe saugrenu la limite du raisonnable, sauf situation exceptionnelle imposant une attente prolonge (accident, crue,...).
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 22
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.2
LE MATRIEL COLLECTIF
2.2.1 Les cordes Nous utilisons des cordes de diamtre 9 et 10 mm pour une pratique classique de la splologie. Toutes les techniques dcrites sont utiliser avec des cordes de ce diamtre. Les cordes de diamtre infrieur ont une rsistance qui implique des techniques spcifiques. Gnralits Les cordes de splologie, sont des cordes statiques utilises pour la descente au descendeur et la remonte aux bloqueurs. Les cordes de splologie sont rsistantes l'abrasion, et possdent des proprits semi-dynamiques pour assurer la scurit en cas de chute de facteur infrieur ou gal un. Les cordes statiques de splologie sont de couleur dominante blanche. La corde en polyamide (nylon) est constitue de l'me protge par la gaine. L'me reprsente presque les 2/3 de la rsistance de la corde. La gaine rsistante l'abrasion assure le tiers restant. La corde possde l'intrieur de l'me un fil tmoin de couleur. Chaque couleur correspond l'anne de fabrication, quel que soit le fabricant : 1984 : rouge 1985 : vert 1986 : bleu 1987 : noir 1988 : jaune 1989 : rose 1990 : violet 1991 : rouge 1992 : bleu 1993 : orange 1994 : vert 1995 : noir
Avant la premire utilisation, il faut laisser tremper la corde dans l'eau pendant 24 heures pour liminer les lubrifiants de fabrication. La faire scher lentement. La corde se rtractera d'environ 5%, ce qui rduira le risque de glissement de la gaine sur l'me (l'effet chaussette). Attention l'usage de certaines marques dont les cordes peuvent rtrcir de 10 15%. Les cordes de 10 mm et 9 mm se vrifient, s'entretiennent, se nettoient et se stockent de la mme manire. Il faut tre aussi consciencieux avec une corde de 10 mm qu'avec une corde de 9 mm. Le marquage des cordes Un marquage complet comprend la longueur de la corde, l'anne d'achat, la proprit. Il s'effectue aprs la premire utilisation. On indiquera l'une des extrmits le marquage complet, et seulement la longueur l'autre bout. Le marquage doit tre clair, insensible au milieu souterrain : on enroule sur la corde un ruban adhsif, qui forme un support o l'on colle les bandes autocollantes chiffres et lettres. On recouvre l'ensemble de gaine thermortractable transparente. On fait chauffer la gaine (rchaud gaz ou sche cheveux) pour qu'elle se rtracte sur le marquage sans se dchirer. Le nettoyage des cordes Une corde doit tre lave aprs chaque utilisation pour permettre une bonne vrification de son tat. Les cordes peuvent tre nettoyes l'eau claire (sans dtergent) l'aide de lave cordes commercialiss ou bricols, mais aussi la machine laver le linge, sans lessive, une temprature de 30 degrs maximum.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 23
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Les nettoyeurs haute pression sont proscrire car ils font pntrer les cristaux de calcite et les argiles dans la corde, ce qui contribue couper les fibres. Suspendre la corde love en cheveaux, l'ombre, pour la faire scher. La vrification des cordes Les techniques de splologie sur corde simple sont labores autour d'un axiome de base: La corde que j'utilise est solide. Je lui fais confiance et j'utilise des techniques qui ne vont pas la fragiliser. Pour cela le ne dois pas avoir de doute sur sa rsistance. Une corde doit tre contrle aprs chaque utilisation, afin de dceler le moindre indice de fragilisation cr par frottement, chute de pierres, pitinement... Vrifier que la corde n'est ni brle ni dtriore. Vrifier que le diamtre de la corde est bien uniforme. Le contrle de la corde est double : la vue et au toucher. On fait glisser la corde entre ses doigts tout en cherchant visuellement le moindre dfaut. il est bon de vrifier l'angle de courbure de la corde: il doit tre le mme sur toute la longueur. Quand une corde prsente un dfaut (brlure ou coupure), il faut la couper immdiatement car elle est devenue dangereuse. Une corde prsentant un vieil aspect (brlure sur plusieurs mtres provoque par le descendeur, peluche rpte) doit tre mise au rebut. Le stockage Une corde se stocke l'abri de la lumire. La corde ne doit pas tre en contact avec une substance chimique : batteries au plomb (utilises pour l'clairage et les perforateurs) qui contiennent de l'acide sulfurique, hydrocarbures (essence, huiles), le carbure, les piles usages... Attention au transport des cordes et de tout le matriel textile en polyamide (harnais, sangles,...) dans les vhicules. 2.2.2 Les mousquetons
Gnralits Pour l'quipement des verticales, on utilise des mousquetons de scurit vis en zicral. Les modles asymtriques s'ouvrant sous charge facilitent l'quipement. Le nettoyage des mousquetons Les mousquetons doivent tre nettoys aprs chaque utilisation pour permettre une bonne vrification : les brosser l'eau et les suspendre pour les faire scher. Attention la lubrification : on peut mettre une goutte d'huile au niveau de la virole et de l'articulation du doigt, mais il faut essuyer le trop plein d'huile afin d'viter qu'il ne coule sur la corde la prochaine utilisation. Le stockage des mousquetons Il faut les ranger goutts et schs, de prfrence suspendus dans un local non humide. La vrification des mousquetons Un mousqueton se vrifie aprs chaque utilisation : vrification de l'absence de fissure sur l'axe du doigt : elles se crent cause d'une diffrence de dilatation entre l'axe en acier et le corps en aluminium.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 24
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
vrification de la corrosion interne du mousqueton due au milieu, et aux phnomnes d'lectrolyse existant entre l'aluminium et l'acier. il y a destruction interne des molcules d'aluminium, imperceptibles l'il au dbut. Puis le mousqueton prend par la suite des aspects de lpre en surface. vrification de l'usure mcanique : cette usure est provoque par les frottements : mousqueton de renvoi, mousqueton de longe, porte lampe...
A la moindre anomalie, le mousqueton doit tre imprativement retir de la circulation pour ne plus jamais tre employ. Il ne doit pas tre affect un rle dit secondaire : porte matriel, porte kit, dsobstruction... L'exprience montre que dans des situations particulires (carence de matriel ou multiplicit des intervenants), on retrouve ces mousquetons dangereux dans des fonctions de scurit. 2.2.3 Les maillons rapides
Gnralits Il existe une multitude de maillons rapides. Pour les amarrages, on utilise le maillon de 7mm grande ouverture en acier (rupture 2500 kg) ou en zicral (rupture 1000 kg). Le nettoyage des maillons rapides Les maillons rapides doivent tre lavs l'eau aprs chaque utilisation, l'aide d'une brosse. Les suspendre pour les faire scher. Attention la lubrification de la virole du maillon : ne pas oublier d'essuyer le maillon rapide pour viter que l'huile ne coule sur les cordes la prochaine utilisation. Le stockage des maillons rapides Il faut les ranger goutts et schs, de prfrence suspendus, dans un local non humide. La vrification des maillons rapides Un maillon rapide se contrle aprs chaque utilisation vrification de bon fonctionnement de la virole: un maillon rapide doit toujours tre utilis avec la virole compltement ferme. vrification de l'oxydation : corrosion du maillon due au milieu agressif. vrification de l'usure mcanique ; cette usure est provoque par frottements : quipement en fixe, porte lampe...
A la moindre anomalie, le maillon rapide doit tre retir de la circulation pour ne plus jamais tre employ quelle qu'en soit son utilisation : porte matriel, dsobstruction...
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 25
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.2.4
Les plaquettes
Gnralits Les plaquettes utilises en splologie sont quipes de vis de 8 mm. La vis a une longueur de 16 mm pour les plaquettes et de 20 mm pour les anneaux aciers. Attention ne pas intervertir les vis. Les plaquettes sont en dural, en acier, en inox, selon les marques et modles. L'utilisation des plaquettes Chaque plaquette a une ou plusieurs utilisations spcifiques. Dans tous les cas, le serrage de la vis doit rester modr sinon on fragilise l'amarrage. On les classe en diffrents modles. La plaquette coude s'utilise avec un mousqueton reposant sur le rocher. Ne s'emploie donc pas avec des maillons rapides. La plaquette coude loigne le nud et la corde de la paroi, vitant le frottement. La plaquette coude se place de manire ce que la traction exerce soit parallle la paroi. Les nouvelles plaquettes coudes trou ovale, en forme de tuile, sont conues pour tre utilises avec tous types de maillons et de mousquetons. La plaquette vrille s'utilise avec un mousqueton ou un maillon rapide. Par sa forme, la plaquette vrille n'carte pas le nud et la corde de la paroi. Elle s'utilise donc lorsque la roche prsente une cavit sous la cheville. La plaquette vrille se place de manire ce que la traction exerce soit parallle la paroi. Pour loigner la corde du rocher avec une plaquette vrille, il suffit d'utiliser deux mousquetons ou deux maillons.
La plaquette cur s'utilise avec un mousqueton ou un maillon rapide. La plaquette cur accepte de multiples axes de traction, on peut la placer en plafond. Elle est en acier inox et doit tre utilise avec des mousquetons ou maillons en acier pour les quipements en fixe.
La plaquette clown s'utilise sans mousqueton, et dans toutes les positions. Comme elle est peu pratique pour se longer et surtout se dlonger, il est dconseill de l'utiliser avec des quipiers dbutants ou peu autonomes.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 26
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
L'anneau acier s'utilise seul ou avec un mousqueton ou un maillon rapide. Dans le cas o il est employ seul (pass directement dans la corde), on ralise un nud de Y avant de le fixer sur la cheville ou on enfile les anneaux sur la corde et on fait un huit. Pas de tte d'alouette. L'anneau acier accepte de multiples axes de traction, on peut le placer en plafond. Attention au positionnement de l'anneau avant d'y exercer une traction.
Le nettoyage des plaquettes Les plaquettes doivent tre nettoyes aprs chaque utilisation, les brosser l'eau en insistant sur la vis pour rendre le filetage impeccable. Les suspendre pour les faire scher. Le stockage des plaquettes Il faut les ranger gouttes et sches, de prfrence suspendues, dans un local non humide. La vrification des plaquettes Une plaquette se contrle aprs chaque utilisation vrification de l'il (trou permettant le passage du mousqueton), il doit tre intact et non us par frottements. vrification de la forme initiale : plaquette dforme cause d'une mauvaise utilisation. vrification de la vis et de son joint torique : le filetage vieillit et s'abme avec le temps, rendant impossible son vissage dans la cheville. Le joint torique permet de rendre la vis imperdable. il faut vrifier son tat. Dans le cas d'une vis dtriore, la remplacer par une vis identique, mme diamtre, mme longueur, mme rsistance. Les anneaux de sangles, de corde, de cordelette
Une plaquette prsentant ces dfauts ne doit plus tre utilise.
2.2.5
Les anneaux de sangle Les sangles se prsentent en version plate ou tubulaire. Les fabricants proposent plusieurs largeurs de sangle. La sangle utilise couramment pour l'quipement des verticales possdent une largeur de 20 30 mm environ. Il faut choisir imprativement de la sangle plate, car la sangle tubulaire est fragile: elle se dtricote aux accrocs ou l'usure. Deux sortes d'anneaux de sangle: L'anneau ferm l'aide d'un nud de sangle.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 27
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
L'anneau cousu par le fabricant, il existe en plusieurs largeurs et longueurs.
A noter que le nud de sangle diminue la rsistance de l'anneau d'environ 50%, contrairement la couture de l'anneau cousu. Les anneaux de corde Un anneau de corde est constitu d'un bout de corde, ferm l'aide d'un nud de huit tress. Les anneaux de cordelette L'anneau de cordelette est constitu d'un bout de cordelette de diamtre suprieur ou gal 5 mm, et infrieur 8 mm. il est ferm l'aide d'un nud de huit tress. La vrification des anneaux de sangle, de corde, de cordelette Les anneaux de sangle, de corde, de cordelette, doivent tre vrifis aprs chaque utilisation. On vrifie que les anneaux ne sont pas brls, ou abms par un frottement, une chute de pierre, des pitinements... Changer tout anneau prsentant une usure.
2.2.6 Le matriel pour spiter Le matriel pour spiter comprend au minimum un tamponnoir pour cheville 8 mm, un marteau, des chevilles autoforeuses de 8 mm avec cnes, et une pochette pour ranger le tout. Le tamponnoir Tous les tamponnoirs de 8 mm dragonne proposs par les diffrents fabricants conviennent au plant de chevilles autoforeuses en milieu souterrain. On trouve des tamponnoirs de splologie, et des tamponnoirs poigne un peu plus volumineux. Le marteau Il est important de choisir un modle muni d'une tte imperdable et quip d'une cordelette de scurit, de prfrence d'une masse suffisante pour tre efficace La pochette On choisira une pochette spcialement conue pour contenir tout le matriel spiter. 2.2.7 Les chevilles autoforeuses Les chevilles autoforeuses utilises en splologie ont un diamtre extrieur de 12 mm et sont en acier. Elles s'utilisent avec des vis de 8 mm en acier "8.8" (certains fabricants fournissent des vis en acier inoxydable). Ce modle est amplement suffisant pour la splologie. 20 ans d'utilisation nous ont donn entire satisfaction. D'autres activits de plein air prconisent l'emploi d'un diamtre suprieur, mais pour des utilisations diffrentes. Des dent acres sont tailles une extrmit, l'autre bout est taraud. Visse un tamponnoir chaque cheville fore son trou Le coin conique (le cne) introduit l'extrmit dente de la cheville, prend appui sur le fond du trou et provoque l'expansion de la cheville sous les coups de marteau, comprime la roche et immobilise la cheville. On trouve couramment deux modles de chevilles autoforeuses de 8 mm: les chevilles SPIT sont anneles et de couleur or. les chevilles HILTI sont lisses, et de couleur argent.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 28
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Attention ne pas intervertir les chevilles et cnes de marques diffrentes. En effet les formes de cnes sont diffrentes et l'expansion de la cheville ne sera pas optimale. On associe donc imprativement les chevilles et cnes de mme marque. Le plant de la cheville autoforeuse au tamponnoir L'emplacement : on sonde le rocher au marteau. La roche doit mettre un son clair. Il faut viter la proximit de fissures, de lames, de chevilles dj en place. Ne pas placer la cheville sur une protubrance de faible volume. Le dcapage pour prparer une surface propre et plane : frapper la roche au marteau de faon enlever la couche superficielle corrode, ainsi que les cailles, picots, qui peuvent gner la mise en place de la plaquette sur la cheville. Le forage : tenir le tamponnoir perpendiculaire la paroi, et le frapper petits coups rapprochs (tout en le tournant) l'aide du marteau. Lorsque la cheville est enfonce de 5 mm, on peut frapper plus vigoureusement en tournant le tamponnoir chaque coup de marteau pour dgager les dbris de roche. Sortir la cheville de temps en temps, et en nettoyer l'intrieur. Souffler dans le trou de manire dgager la poussire de roche. Le trou est termin lorsque la cheville s'y loge entirement. L'expansion de la cheville : nettoyer le trou et la cheville. Placer le cne l'extrmit de la cheville l'aide d'un petit coup de marteau. Introduire l'ensemble dans le trou. Frapper sur le tamponnoir, sans le tourner, jusqu' l'enfoncement total de la cheville. Dvisser le tamponnoir. Une cheville autoforeuse correctement plante affleure la roche, est perpendiculaire la paroi, son trou n'est pas vas, elle ne bouge pas.
Si on utilise une perforatrice, il faut tester l'emplacement de l'amarrage au marteau (voir le dbut du paragraphe), et il faut nanmoins terminer le trou au tamponnoir avec une cheville. En effet, la pointe du foret perce un trou fond conique. Le cne du spit aura tendance s'enfoncer dans le fond de ce trou et l'expansion de la cheville ne sera pas optimale.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 29
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.3
2.3.1
LA PROGRESSION SUR CORDE
Se longer
Principe Quand le splologue se longe, il se met en scurit pour progresser sur un passage ncessitant une assurance (main courante, fractionnement, vire,... Utilisation Les longes permettent donc de s'assurer ; les fractionnements se passent avec la petite longe, tandis que les mains courantes et les vires se passent avec les deux longes. Bien vrifier que le mousqueton emprisonne la corde lors des passages de main courante et de vire sans se laisser tromper par le simple bruit du mousqueton qui se ferme. 2.3.2 Les mains-courantes
Progression La progression sur une main-courante se fait trs simplement en utilisant ses deux longes l'une aprs l'autre, c'est--dire que l'on se longe avec une des deux longes sur le premier tronon de main courante puis on progresse jusqu'au deuxime tronon dans lequel on se longe avec la deuxime longe. En fin de main-courante on enlve sa dernire longe uniquement lorsque l'on est protg par un autre appareil (descendeur, bloqueur), ou lorsque l'on se trouve dans une zone non expose. Cette technique permet au splologue d'tre en permanence en scurit. 2.3.3 La descente
2.3.3.1 La mise en place du descendeur La mise en place du descendeur s'effectue comme indiqu sur la notice du fabricant, c'est--dire ouvrir la flasque cliquet du descendeur, introduire la corde qui arrive de l'amarrage dans la gorge infrieure de la poulie infrieure en dcrivant un S, puis installer la corde dans le mousqueton de renvoi. Utilisation Une fois le descendeur install, il faut avaler le surplus de corde avant de se mettre en appui sur le descendeur, vrifier que le descendeur ne s'est pas coinc dans le mousqueton de renvoi, le splologue est prt descendre. Pour cela il doit saisir la corde en aval du mousqueton de renvoi et prendre dans la mme main la corde en amont, ceci afin de bloquer le descendeur. A ce stade il doit se dlonger de la main courante ou du fractionnement prcdent. Il peut alors entamer sa descente en abaissant la main vers la cuisse et doser la vitesse par la pression de la main sur la corde, le fait de monter la main permet de rguler la descente et aussi de se bloquer. Main haute, le me bloque. Main basse je descends. Au stade o le splologue est arrt sur la corde main haute, il peut effectuer une clef d'arrt, et seulement ce moment l.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 30
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.3.3.2 Le passage de fractionnement Le splologue arrive au niveau du fractionnement, il ne doit pas descendre trop bas sinon il ne pourra pas se longer. il se longe avec sa longe courte dans l'amarrage et finit de descendre pour se mettre en poids sur sa longe, il peut alors dfaire son descendeur pour le positionner sur le tronon de corde suivant, quand cela est fait il enlve son mousqueton de renvoi et le place en aval du descendeur. A ce stade le splologue se trouve dans la situation de dpart de puits avec un peu moins de confort (pour certains fractionnements) pour se dlonger. il suffit pour cela de saisir le nud de l'amarrage avec la main qui tient dj la corde de descente, de se hisser avec le pied ou le genou dans la boucle de corde du fractionnement, et de se dlonger avec l'autre main, tout en gardant la corde de descente main haute.
2.3.3.3 Le passage d'une dviation Une dviation n'est pas un obstacle que l'on franchit, c'est un obstacle que l'on te de la corde pour le remettre en place au dessus de soi ( la descente). On ne se suspend pas sur une dviation. Le splologue arrive au niveau de la dviation, il monte la main qui rgule la descente vers la tte du descendeur, dmousquetonne la dviation avec l'autre main et la place en amont du descendeur.
2.3.3.4 Le passage de nud Le splologue arrive au niveau du nud : il enlve la corde du mousqueton de renvoi et descend jusqu' ce que le nud l'arrte. Il se longe avec sa grande longe dans la boucle de corde prvue cet effet dans le nud. Il place son bloqueur de poigne et sa pdale au dessus du descendeur, la distance le sparant du bloqueur de poigne doit tre suprieure de 10 cm environ celle de la longe courte. En prenant appui sur la pdale, il se longe sur la corde au dessus du bloqueur de poigne ou dans le bloqueur de poigne. Le descendeur ne doit plus tre en tension (si ncessaire placer le bloqueur de poigne plus haut). Le splologue enlve le descendeur et le place sous le nud, il tient la corde comme pour passer un fractionnement. Enlever sa longe courte en prenant appui sur la pdale afin de se retrouver en poids sur le descendeur. il peut donc retirer son bloqueur de poigne, ainsi que sa longe longue de la boucle et entamer la descente.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 31
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.3.3.5
Les utilisations particulires
La cl d'arrt C'est une technique qui permet de s immobiliser sur la corde afin de librer ses mains pour quiper, planter un spit, placer une dviation, effectuer un pendule, se reposer. Celle technique ne doit pas tre utilise pour s'assurer lors du passage d'un fractionnement ou de l'quipement d'une main courante, car en cas de chute il y a risque de dformation ou de rupture du descendeur.
Les puits troits Dans les puits troits, le descendeur fonctionne trs mal, voire pas du tout, sa place habituelle. On le met en bout de longe, dans la boucle, ct du mousqueton de longe ou sa place. Cette mthode permet d'avoir le descendeur plus haut que la tte, il est donc libre et peut fonctionner normalement. Par contre dans celle position il peut happer trs facilement cheveux, barbe, jugulaire, bijoux: il faut tre trs attentif. Il convient tout de mme d'tre raliste et de ne pas s'engager dans un passage qui peut prsenter de srieux problmes lors de la monte.
Descente en C La progression sur des cordes de fort diamtre ou gonfles par l'argile (quipement fixe) pose problme. La corde gonfle freine, voire bloque la descente. Pour pouvoir descendre convenablement, il suffit de placer la corde dans le descendeur comme indiqu par le dessin. Toutefois il convient de bien connatre les limites de cette technique. il ne faut aucun moment qu'une traction (violente chute d'un quipier s'exerce en aval du descendeur plac en C. Toute traction en aval du descendeur provoque la destruction de celui-ci et la chute du splologue. Cela implique que lors de la descente, les splologues doivent progresser en laissant deux amarrages entre eux (deux fractionnements ou fractionnement doubl). Le non respect de cette consigne entrane un risque mortel.
Descente sur cordes glaiseuses Pour les cordes glaiseuses qui ne permettent pas de grer facilement la descente, il faut rajouter la technique de descente normale deux tours morts de la corde dans le mousqueton de renvoi.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 32
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.3.4
La monte
2.3.4.1 La mise en place des appareils Au moment de la monte, le splologue a dj le matriel sur lui tel qu'il l'a positionn avant d'entrer dans la cavit. C'est dire: Bloqueur ventral reli directement au M.A.V.C. Longes relies directement au M.A.V.C. et gauche ( gauche vu par le splologue lui mme) du bloqueur ventral. Le descendeur et le mousqueton de renvoi sont mis sur le porte matriel. Le torse prrgl (type huit) est reli au bloqueur ventral par un mousqueton (micro). Le torse rglable peut tre pass directement dans le bloqueur ventral. Si le splologue utilise un bloqueur de pied, celui-ci sera positionn au moment de la monte.
La mise en place sur la corde Relier le torse au bloqueur ventral par le trou suprieur, rgler le torse. Ouvrir la gchette du bloqueur ventral, introduire la corde et fermer la gchette. La grande longe est relie la poigne ainsi que la pdale. Ouvrir la gchette du bloqueur de poigne, introduire la corde et fermer la gchette. La pdale est positionne dans l'un des pieds avant le dpart. S'il y a utilisation d'un bloqueur de pied, ouvrir la gchette de celui-ci, introduire la corde et fermer la gchette.
A ce stade des oprations, la mise en place est effectue. 2.3.4.2 Principe La monte se fait par un mouvement alternatif (assis, debout), c'est dire que le splologue utilise les bloqueurs (ventral et de poigne) en transfrant alternativement son poids de l'un l'autre. Le bloqueur qui n'est pas sollicit est alors hiss vers le haut. Utilisation Concrtement, le splologue hisse le bloqueur de poigne puis pousse sur la pdale, ceci a pour premier effet de pomper le mou qui est aval par le bloqueur ventral (tenir la corde sous le bloqueur ventral au dpart). Suivant la hauteur de corde il faut plus ou moins de mouvements pour que la corde se mette en tension par son propre poids. Le splologue est alors en poids total sur l'amarrage suprieur, il peut mettre en uvre le mouvement alternatif et engager la monte: 1- Hisser le bloqueur de poigne. 2- Pousser sur la pdale, bien dans l'axe de la corde. 3- Le bloqueur ventral se hisse automatiquement, si la corde est : suffisamment leste par son propre poids, maintenue par un coquipier, coince entre les pieds ou sur le cou de pied de la botte au moment de la pousse sur la pdale, La technique de progression
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 33
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
maintenue par le splologue lui-mme la sortie du bloqueur ventral.
4- Se reposer en poids sur le bloqueur ventral afin de pouvoir re-hisser le bloqueur de poigne. 5- Rpter les oprations jusqu' l'arrive au prochain amarrage. Remarque Lors de la monte le splologue ressent un phnomne de yo-yo qu'il peut exploiter son avantage (il suffit pour cela de rentrer dans le tempo : amorcer la pousse sur la pdale dans la phase ascendante du yo-yo). Afin d'viter de se fatiguer, ne pas tirer sur les bras mais pousser sur les jambes. L'efficacit et le rendement sont optimiss s'il n'y a pas de jeu entre le torse, le bloqueur ventral et le baudrier. Il est donc trs important de bien rgler son torse ainsi que le baudrier, pour supprimer le jeu du bloqueur ventral, pour amliorer la respiration et conomiser ses bras. il faut que le torse permette au bloqueur ventral de suivre la monte du bassin. Utilisation d'un bloqueur de pied Cette utilisation ncessite imprativement l'emploi des bloqueurs ventral et de poigne, seule la pdale peut ventuellement tre supprime. La technique reste la mme, le bloqueur de pied remplaant la pdale lors de la pousse. Le bloqueur de pied prsente plusieurs avantages: meilleur rendement de la monte (principalement d une pousse efficace et directe dans l'axe de la corde), maintien de la corde sous le bloqueur ventral, facilit se longer dans l'amarrage de fractionnement, efficacit dans les troitures verticales.
2.3.4.3 Le passage d'un fractionnement Le fractionnement est un obstacle qui se franchit par une manipulation des bloqueurs et de la longe courte. Arriv au niveau du fractionnement, ne pas monter le bloqueur de poigne en bute sur le nud mais laisser une marge de manuvre pour pouvoir enlever la poigne (1 2 cm). Faire une dernire pousse pour hisser le bloqueur ventral. Lors de cette dernire pousse, se longer avec la longe courte dans l'amarrage (mousqueton ou anneau), ouvrir la gchette du bloqueur ventral et librer la corde. Se pendre sur sa longe courte, se reposer et mettre en place dans le bloqueur ventral la corde du tronon de puits suivant, fermer la gchette. Ouvrir la gchette du bloqueur de poigne, librer la corde, mettre en place dans le bloqueur de poigne la corde du tronon de puits suivant, fermer la gchette. Attention de ne pas croiser la grande longe avec les cordes de progression. A ce stade, reprendre les oprations dcrites dans le paragraphe "Technique de progression", pour mettre en tension la corde du tronon de puits suivant, une fois la tension effectue, se dlonger, vrifier le bon positionnement de l'amarrage, signaler que la corde est libre si le puits ne comporte pas de risque prononc de chute de pierres, poursuivre la monte. La mthode malheureusement trop rpandue qui consiste une fois long passer le bloqueur de poigne en premier, se mettre debout sur la pdale et passer ensuite le bloqueur ventral, sous une apparente rapidit, demande une nergie considrable et provoque une fatigue supplmentaire. Cette mthode est inefficace pour les fractionnements avec pendule ou ceux dont la longueur de corde suprieure est telle qu'il faut "avaler" beaucoup de mou pour s'loigner du fractionnement.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 34
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Fractionnement avec pendule Procder comme prcdemment, mais il faut penser avant de se dlonger, passer une cuisse par dessus la corde, pour viter que le bloqueur ventral ne travaille mal en bout de pendule.
Passage de fractionnement avec bloqueur de pied Pour passer un fractionnement avec un bloqueur de pied, il faut procder comme pour la mthode classique, mais il faut, en plus, retirer le bloqueur de pied aprs avoir remis le bloqueur de poigne sur le tronon de corde suivant. Il faut alors monter un peu, afin d'avoir suffisamment de corde pour l'utiliser, d'o l'intrt de conserver sa pdale pour limiter les efforts. 2.3.4.4 Le passage d'une dviation La dviation est un obstacle que l'on ne franchit pas, mais que l'on enlve et que l'on remet. Il n'y a donc pas de manipulation de bloqueurs et de longe dans le passage d'une dviation. Il faut monter suffisamment haut pour forcer le moins possible : si la configuration du puits n'est pas vidente (manque de prise pour pousser) il ne faut pas que l'angle de dviation soit trop important. Pour passer, il faut pousser sur des appuis de pieds et dmousquetonner la dviation, ensuite la remousquetonner sous le bloqueur ventral, et poursuivre la monte. 2.3.4.5 Le passage de nud Un passage de nud est un obstacle qu'il faut franchir avec manipulation des bloqueurs et des longes. Comme pour le passage d'un fractionnement, il ne faut pas mettre le bloqueur de poigne en bute sous le nud, mais 1 ou 2 cm en dessous. Ensuite il faut se longer court dans la boucle du nud prvue cet effet, ouvrir la gchette du bloqueur de poigne, librer la corde, positionner le bloqueur au dessus du nud et fermer la gchette. Faire la mme chose avec le bloqueur ventral, se dlonger et poursuivre la monte. Passage de nud avec bloqueur de pied Le principe est le mme que dans la mthode classique, il suffit en plus de librer la corde du bloqueur de pied quand celui-ci peut se positionner au dessus du nud. 2.3.4.6 La sortie de puits La sortie de puits est un franchissement d'obstacle avec manipulation des bloqueurs et des longes. Ne pas mettre le bloqueur de poigne en bute sous le nud de l'amarrage. A ce stade on peut rencontrer deux types de mains-courantes en sortie de puits (main-courante aise ou plein vide). Main courante aise Hisser le bloqueur ventral suffisamment haut et se longer avec la longe courte sur la main courante, prendre de bons appuis et enlever les bloqueurs. Progresser sur la main courante l'aide des longes.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 35
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Main courante plein vide La technique est la mme que pour la main courante aise, mais au lieu de prendre des appuis naturels, on utilise la pdale pour retirer les bloqueurs. Le splologue se trouve alors pendu sur sa petite longe la main-courante (cela ncessite un quipement de la main- courante sans frottement). La suite de la progression s'effectue en se longeant sur le tronon de corde suivant, et ainsi de suite. Pour progresser plus facilement, il est judicieux de raccourcir sa longe longue en la mousquetonnant dans le M.A.V.C., et de rajouter un mousqueton sur la boucle ainsi forme.
2.3.4.7 L'escalade assure au bloqueur Installer le bloqueur ventral sur la corde, escalader l'obstacle. Ou bien mettre le bloqueur de poigne, en bout de longe longue, sur la corde (en prenant soin de passer la corde dans le mousqueton de longe); passer le bloqueur de poigne sur l'paule et mettre la corde dans le dos.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 36
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.4
2.4.1
LA PROGRESSION SUR ECHELLE
La progression
Important : l'chelle est un moyen de progression et non d'assurance. Il faut toujours associer une chelle une corde d'assurance.
La monte Sauf exception il ne faut pas monter sur une chelle souple comme sur une rigide, les mains et les pieds du mme ct de l'chelle. Pour quilibrer le corps, le garder le plus vertical possible et conomiser les bras. On passe un, ou les deux pieds si ncessaire, par derrire l'chelle en crochetant le barreau par le talon. On crochte l'chelle avec les mains par derrire, le cble passant entre le pouce et l'index. Contre paroi on utilise un coude et un genou comme levier pour dcoller l'chelle de la paroi, ou la placer perpendiculairement celle-ci.
La descente C'est une pratique peu utilise, car fatigante voire dangereuse. Il faut la rserver des hauteurs de quelques mtres et lui prfrer la descente au descendeur.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 37
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.4.2
L'assurance
La monte La corde d'assurance qui sert la descente est amarre correctement afin qu' la monte, on puisse s'assurer l'aide du bloqueur de poigne plac en bout de longe longue pos sur l'paule, corde d'assurance dans le dos. Pour se reposer on se longe au cble et non aux barreaux de l'chelle. En aucun cas il ne faut mettre le bloqueur de poigne la ceinture, car lors d'une chute le cble de l'chelle peut ouvrir la gchette du bloqueur, et de plus l'autodgagement est dlicat.
La descente l'chelle L'quipier est assur du haut par un autre quipier avec une corde supplmentaire (ce peut tre la corde de descente du cadre) que l'on freine avec un descendeur ou un nud "italien". Voir chapitre 2.11.6.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 38
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.5
L'EQUIPEMENT AVEC CORDE
2.5.1 Les rgles impratives Lors de le prparation des sacs, il faut faire systmatiquement un nud en huit 1 mtre de l'extrmit de la corde. Il est possible que malgr toutes les prcautions prises, la corde soit plus courte que la verticale. Il ne faut jamais laisser un bout de corde inutilise, libre. Donc systmatiquement faire un nud ou le rattacher un amarrage; ou s'il est long le lover en cheveaux serrs (toujours avec un nud 1mtre de l'extrmit), pour viter qu'un quipier l'utilise comme corde de progression ou d'assurance. Cohrence, clart, confort Cohrence: On quipe en fonction d'une ncessit (risque, niveau des quipiers). Un quipement cohrent tient compte de tous ces paramtres tout au long de la cavit. On ne prend pas plus de risques l'entre qu'au fond, on ne msestime pas les capacits d'volution des quipiers. De mme l'absence du matriel appropri un moment de l'exploration ne doit pas tre l'excuse pour outrepasser les principes de base de scurit. Par exemple si en dbut de main courante il n'y a qu'un spit, on le double avec un amarrage naturel et en l'absence de celui ci on prend le temps de planter un autre spit. La clart, la simplicit d'un quipement sont des facteurs de scurit. Un quipement brouillon dont les cordes se croisent inutilement, o le surplus de corde n'est pas lov, o l'on passe sans raison d'une paroi l'autre, o l'on ne discerne pas au premier coup d'oeil l'utilit de chaque chose, engendre des risques supplmentaires. Le confort d'un quipement n'est pas une valeur pantouflarde: c'est une notion de scurit et de pdagogie. Rendre un quipement confortable (rglage des boucles, position des amarrages), c'est diminuer la fatigue, amliorer l'aisance, optimiser l'apprentissage. 2.5.2 La corde simple
Principes Les obstacles d'une cavit sont quips d'une corde simple qui permet la progression et assure la scurit du splologue. On n'utilise pas en splologie de corde d'assurance supplmentaire (sauf exceptions initiation, secours,...). L'quipement doit permettre au splologue de franchir des obstacles en scurit sans que sa progression n'altre la solidit des diffrents lments : cordes, amarrages. Les rles de la corde La corde d'assurance. Elle sert uniquement d'assurance pour le franchissement d'une difficult. Le splologue progresse sans se tracter dessus, en libre sur le rocher ou avec un autre agrs (chelle, fil clair, corde fixe). Elle ne sera sollicite qu'exceptionnellement en cas de chute (exemple: main courante).
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 39
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
La corde de progression
Elle sert de moyen de progression et d'assurance. Elle est sollicite en permanence pour le franchissement de l'obstacle. L'quipement doit tre adapt l'utilisation de la corde. 1) Il faut fixer la corde de manire irrprochable avant d'tre expos (amarrage naturel fiable ou double amarrage) dans une zone o l'on est en scurit. 2) Le dpart de la corde install, on utilise celle ci pour s'assurer et continuer quiper. 3) Une corde d'assurance, une main courante, ne sont sollicites qu'exceptionnellement, elles doivent tre places judicieusement pour assurer leur rle.
Installation L'installation d'une corde de progression doit faire l'objet d'une attention particulire. Elle ne doit en aucun cas frotter, ni au niveau de l'amarrage ni sur toute sa longueur pendant l'utilisation quand elle est tendue par le poids du splologue.
Logique L'quipement d'une difficult doit protger le splologue sur toute la longueur de la difficult. il doit dmarrer d'un lieu o il est hors de danger et se terminer identiquement en un lieu o il est en scurit. Il ne doit pas tre interrompu. Un quipement doit prsenter la mme logique de rsistance sur toute sa longueur. il ne doit pas avoir de point faible (d un matriel mal adapt ou mal utilis). Le premier amarrage Il doit tre irrprochable ; c'est le socle, la base de l'quipement. Si c'est un amarrage naturel il doit tre de dimension suffisante ou alors tre doubl. Si c'est un amarrage artificiel (cheville, scellement, piton), il doit tre systmatiquement doubl car il faut suspecter une mauvaise installation (invisible au premier abord) rocher mal sond, fissur, collage mal ralis. (voir chapitre amarrage, 2.5.6) Distinction du rle de l'amarrage L'amarrage de traction Il est sollicit en permanence pendant la progression : il doit tre plac judicieusement pour que la corde ne frotte pas. L'amarrage d'assurance Il n'est sollicit qu'exceptionnellement: en cas de chute du splologue ou en cas de rupture de l'amarrage de traction.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 40
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Son emplacement a de l'importance: il ne faut pas que, dans la position o il est sollicit, il guide la corde ou le splologue vers une situation o il y a risque immdiat (arte tranchante, trmie...).
Le facteur de chute Le matriel de splologie est conu pour tre utilis en facteur de chute gal ou infrieur 1. Equiper avec des facteurs de chute suprieurs est dangereux, voire mortel. Dfinition du facteur de chute: Le facteur de chute est le rapport de la hauteur de la chute par la longueur de corde sollicite (qui amortit la chute). Les cordes d'escalade dynamiques sont prvues pour cela. En splologie cette situation n'existe que dans le cas o le splologue est long dans un amarrage et se trouve au dessus de celui ci. Les longes sont en cordes dynamiques.
Les cordes statiques de splologie ne sont prvues que pour accepter des chocs de facteur 1. En aucun cas l'quipement ne doit impliquer des situations o la corde risque d'tre sollicite par des chocs de facteur suprieur 1. Il faut toujours veiller ce que dans le cas o un amarrage cderait, la corde ne soit pas soumise un choc d'un facteur suprieur 1. Il est prfrable d'quiper avec un facteur de chute le plus faible possible. Dans les puits, en cas de rupture de fractionnement, le facteur de chute est souvent faible. Il ne faut pas confondre prise de risque et difficult. Un passage peut tre trs difficile et peu
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 41
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
expos. Exemple caricatural : un pas d'escalade long de un mtre, boueux et situ un mtre du sol. Il n'est pas ncessaire de le protger par une corde. Par contre une vire de un mtre de large, plate, o l'on marche facilement, mais situe dix mtres du sol, devra tre quipe par une main courante car une chute, mme peu probable, aurait des consquences graves... 2.5.3 Le choix du passage Lors d'une progression souterraine, on doit toujours tre conscient du danger, et donc choisir son itinraire en consquence. Il faut, dans la mesure du possible, viter les trmies, les troitures svres, les puits bouleux... Pour l'quipement d'un puits, on doit anticiper sur la continuit de celui-ci, et donc choisir les amarrages les mieux placs: pour un plein vide, pour le confort (amarrages hauts). De plus on doit vrifier un amarrage avant d'y fixer la corde (tat de la cheville, de l'amarrage naturel...). 2.5.4 Le nettoyage du passage Avant d'quiper un puits, le premier rflexe doit tre de nettoyer celui-ci. Tout en tant en scurit (sur la corde), on pousse tout ce qui risque de tomber (cailloux, branches...) dans le puits. Au fur et mesure de la descente, on vrifie que les margelles soient propres. Si ce n'est pas le cas, les nettoyer. Attention, il faut nettoyer un puits avant que la corde ne soit en bas, Si l'on veut nettoyer au cours de la descente, alors que le puits est quip, il faut remettre la corde dans le sac. C'est la personne qui quipe qui effectue ce nettoyage, afin d'viter que les coquipiers ne fassent ensuite tomber ces lments dans le puits, alors que la corde est installe. Attention, la corde de progression du splologue qui quipe doit tre dans le sac qui est accroch lui, et se librer durant la descente. En aucun cas il ne faut mettre la corde en place et nettoyer ensuite. Les cailloux tombant dans le puits risquent de l'endommager. 2.5.5 Les nuds conseills Pour l'quipement, un nud simple passe partout est connatre: le nud de huit : il s'utilise sur les amarrages, les longes, en bout de corde... On le fait sur des cordes de diamtre suprieur ou gal 9 mm.
Le nud de neuf, s'utilise comme le nud de huit. Dans certains cas il est plus facile dfaire.
Le Y utilise deux amarrages, et les fait travailler en mme temps. il permet de positionner la corde o l'on veut et diminue notablement le facteur de chute.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 42
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.5.6 Les amarrages On distingue deux catgories d'amarrages: les amarrages naturels et les amarrages artificiels. 2.5.6.1 Les amarrages naturels
Les arbres: en entre de cavits. N'utiliser que les arbres vivants de taille raisonnable (d'un diamtre d'un ordre de grandeur d'une quinzaine de centimtres) Il faut vrifier qu'ils sont solidement ancrs dans le sol : se mfier des arbres poussant sur les rebords terreux. Les protubrances rocheuses (lucarne, lame, caille...). Il faut les choisir de dimensions suffisantes, d'un ordre de grandeur d'une vingtaine de centimtres. Le rocher doit tre compact, exempt de fissures et solidaire du socle. Il faut tester leur solidit en les sondant au marteau et elles doivent mettre un son clair: un son creux, sourd, permet de suspecter des fissures. Il ne faut pas hsiter attnuer le tranchant des artes au marteau. Les concrtions. Il est difficile de donner des critres de solidit pour les concrtions : ceux ci varient en fonction du massif, de la cavit, de l'ge des concrtions... Nanmoins les concrtions actives et rcentes sont en gnral plus solides que les vieilles. Il faut vrifier qu'elles ne se sont pas formes sur de l'argile et qu'elles sont solidaires de la roche. Dans tous les cas il faut doubler un amarrage naturel si l'on a le moindre doute sur sa rsistance. Amarrage naturel d'assurance. On attache directement la corde autour de celui ci avec un nud appropri. Amarrage naturel de traction. On place une sangle ou un anneau de corde sur l'amarrage et on y relie la corde par un mousqueton ou un maillon. C'est l'anneau de sangle ou de corde qui subit l'usure due au frottement: la corde garde son intgrit. Ce type d'amarrage est doubl en fonction de son rle (tte de puits, fractionnement, extrmit de main courante). On peut le doubler par un amarrage diffrent ou par la corde sur le mme support si celui-ci est irrprochable.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 43
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Les amarrages artificiels Les plaquettes utilises en splologie sont quipes de vis de 8 mm, compatibles avec les chevilles auto foreuses de 8 mm. La vis a une longueur de 16 mm pour les plaquettes et de 20 mm pour les anneaux acier. Les diffrents modles et leurs utilisations Chaque amarrage a une ou plusieurs utilisations spcifiques. Dans tous les cas, le serrage de a vis doit rester modr, sinon on fragilise l'amarrage.
La plaquette coude La plaquette coude s'utilise avec un mousqueton s'appuyant sur le rocher. Ne s'emploie donc pas avec un maillon rapide. La plaquette coude loigne le nud et la corde de la paroi, vitant le frottement. La plaquette coude se place de manire ce que la traction exerce soit parallle la paroi. Elle ne peut pas travailler en plafond.
La plaquette vrille La plaquette vrille s'utilise avec un mousqueton ou un maillon rapide. Par sa forme, la plaquette vrille n'carte pas le nud et la corde de la paroi. Elle s'utilise donc lorsque la roche prsente une cavit sous la cheville. La plaquette vrille se place de manire ce que la traction exerce soit parallle la paroi. Elle ne peut pas travailler en plafond.
La plaquette cur ou plafond La plaquette cur s'utilise avec un mousqueton ou un maillon rapide. La plaquette cur accepte de multiples axes de traction on peut la placer en plafond La plaquette cur employe comme une plaquette vrille possde les mmes limites elle n'loigne pas le nud et la corde de la paroi.
Pour loigner la corde du rocher avec une plaquette vrille, il suffit d'utiliser deux mousquetons ou deux maillons.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 44
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
L'anneau acier L'anneau acier s'utilise seul, avec un mousqueton, avec un maillon. Dans le cas o il est employ seul (pass directement dans la corde), on ralise un nud Y ("Mickey") avant de le fixer sur la cheville. On ne fait pas de tte d'alouette, car le diamtre de l'anneau tant faible, ce nud endommage la corde. L'anneau acier accepte de multiples axes on peut le placer en plafond.
Mauvais emplacement de l'amarrage Si l'amarrage fait frotter la corde juste sous celui-ci, on peut le rallonger avec quelques mousquetons ou un anneau de sangle ou de corde. Mauvais emplacement de l'amarrage
2.5.7 La main-courante Une main courante est une corde subhorizontale, mise en place afin d'enrayer la chute du splologue lors de l'approche d'un puits, d'une progression en mandre large... Pour le confort, la main-courante ne doit pas tre au ras du sol (cela entrave la progression, abme la corde..), mais hauteur d'homme. Elle doit tre tendue. Les amarrages d'extrmits de main courante doivent tre irrprochables, soit amarrages naturels de bonne dimension, soit deux spits.
2.5.8 La tte de puits Pour le confort de l'quipement, en tte de puits, il est essentiel de choisir des amarrages assez hauts. Lorsqu'on est debout devant le puits, les amarrages sont au minimum hauteur des yeux. Lors de la remonte, on pourra directement poser les pieds sur le bord du puits, et sortir sur la main-courante moindre effort. En tte de puits les amarrages doivent tre irrprochables. A une tte de puits, les deux amarrages (progression et scurit) ne doivent pas tre trop distants, afin d'viter un pendule trop important en cas de rupture de l'amarrage principal.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 45
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.5.9 La dviation Afin d'viter un frottement, on peut placer une dviation. Celle-ci dvie la corde de la verticale, l'aide d'un mousqueton sans vis et d'une cordelette fixe sur la paroi oppose au frottement. Son point d' amarrage doit tre suffisamment solide pour ne pas cder lors de la progression, et donc faire frotter la corde. Afin d'viter une force trop importante sur la dviation, l'angle cr entre la corde et la verticale ne doit pas dpasser 20, ceci afin de mnager l'amarrage, permettre un certain confort pour passer la dviation, et modrer le pendule en cas de rupture de celle-ci. La cordelette est accroche sur un amarrage naturel, ou artificiel.
2.5.10 Le fractionnement Afin d'viter un frottement, on peut placer un fractionnement. Celui-ci stoppe la descente, qui est reprise sur ce nouvel amarrage. Ce fractionnement est plac l'endroit du frottement. Aprs avoir laiss suffisamment de mou dans la boucle de corde, on fixe la corde sur l'amarrage et on continue descendre.
Le nud Pour fixer la corde sur l'amarrage, on fait un nud de huit.
La ganse La ganse doit tre la plus courte possible, afin de se longer facilement dans l'amarrage.
La boucle Lors de la mise en place du fractionnement, on doit tre attentif laisser une boucle suffisamment importante pour que les coquipiers puissent installer leur descendeur et se dlonger aisment. Si la hauteur du tronon prcdent est importante, il faut tenir compte de l'lasticit de la corde. Pour bien rgler le mou de la boucle, se longer court dans l'amarrage, laisser filer la corde dans le descendeur afin d'obtenir la longueur de boucle voulue, confectionner le nud d'attache et le mettre dans le mousqueton d'amarrage (mousqueton s'ouvrant sous charge obligatoire). Il est faux de dire que la dimension de la boucle influe gravement sur le facteur de chute en cas de rupture du fractionnement. Rduire au maximum la boucle n'augmente pas la scurit. Elle doit tre suffisamment grande pour ne pas gner la progression. Si on utilise des maillons rapides pour les fractionnements, il est prfrable d'en mettre deux, l'un au dessus de l'autre. La corde se place sur celui du bas, et on se longe sur celui du haut. Cela vite d'craser la corde avec son mousqueton de longe.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 46
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Doubler un fractionnement Dans certains cas de figure, le fractionnement doit tre doubl. En cas de rupture d'amarrage, il y a danger: lorsque le pendule est important et que le splologue risque de se blesser contre la paroi d'en face. si la corde se retrouve sur un lment l'endommageant fortement (lame d'rosion, trmie, boulis, cascade,...). si la hauteur du tronon prcdent est importante, et que le fractionnement est quelques mtres du sol, il y a chute au sol.
Jonction de corde au fractionnement Pour viter un passage de nud, on peut profiter du fractionnement pour changer de corde. Pour cela, on love proprement et solidement le reste de la corde suprieure au niveau de l'amarrage, tout en conservant le nud d'arrt au bout de celle-ci. On fixe la nouvelle corde de descente dans l'amarrage sans oublier de la jonctionner avec la prcdente, ganse dans ganse. il faut que la ganse de traction soit en appui direct sur le mousqueton, et n'crase pas la ganse de la corde prcdente. 2.5.11 Les nuds de jonction Pour jonctionner deux bouts de corde, le nud de huit est essentiel. en main-courante, on tresse un nud de huit avec les deux bouts de corde. Dans un puits, on fait un triple huit. On fait un double huit avec sa boucle sur la corde amont, et on retresse un huit simple sur le huit initial avec la corde aval. Ce nud est facile dfaire. De plus avec deux cordes de diamtres diffrents, le nud ne glisse pas, et il y a toujours une boucle pour se longer comprise dans le nud. Pour un anneau de sangle, on fait un nud simple avec un bout de la sangle, que l'on retresse avec l'autre bout. Pour un anneau de corde, ou de cordelette, on fait un nud en huit avec un bout, que l'on retresse avec l'autre bout.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 47
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Prparation du sac de portage Lors de la prparation du sac, on doit tre sr que la corde a un nud serr 1 mtre du bout (celui qui est au fond du sac), car la longueur de la corde peut tre plus courte que la hauteur du puits. 2.5.12 Le sac matriel Pour progresser sous terre, on a besoin d'un certain volume de matriel, de nourriture... Tout ceci est conditionn dans des sacs, qui suivront le splologue tout au long de son parcours. Le sac doit avoir un gabarit cohrent avec celui de la cavit (il vaut mieux souvent 3 petits sacs qu'un norme). De plus, ce sac doit prsenter le moins possible de boucles, de sangles, de cordelettes, qui s accrochent en permanence aux asprits de la cavit. La longe de portage doit tre en bon tat, ainsi que son point d'attache (pour viter les chutes de sac) Son systme de fermeture doit tre efficace et rsistant.
2.5.12.1 Le transport du sac - Lors de la marche, le sac doit tre port sur le dos le plus possible. Cela permet d'avoir les mains libres (utile pour la progression), et d'conomiser au maximum les bras. Dans les diaclases ou mandres, il est aussi au maximum sur le dos (pour les mmes raisons d'conomie). Lorsque le passage se rtrcit, il faut chapper une bretelle, afin d'avoir le sac de ct, dans le prolongement de l'paule du splologue. Pour les passages bas, on le garde sur le dos, mais en le dsaxant sur le ct, afin de pouvoir se relever au maximum, et garder les mains libres. Pour les troitures, il est prfrable de les passer seul, avec un minimum de matriel, et de se faire passer le sac par le coquipier. Si cela n'est pas possible, on positionne le sac, de faon pouvoir faire marche arrire tout moment, donc avec le sac devant soi. Dans les boyaux ou rampings, on accroche le sac soi par sa longe, et on le tire. On guide le sac avec les pieds, afin qu'il ne s'accroche pas. il vaut mieux qu'un quipier suive pour librer le sac des coincements ventuels. Si on est seul (ou le dernier du groupe) pousser le sac devant soi.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 48
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.6
L'QUIPEMENT L'CHELLE
Mise en place des chelles L'quipement est le mme que pour les corde. Il suffit d'adapter la longueur d'chelle la hauteur du puits. Toutes les approches de puits doivent tre scurises par des mains courantes. La descente et la monte l'chelle doivent toujours tre protges par une corde d'assurance. La jonction d'chelles s'effectue l'aide des anneaux italiens prvus cet effet (voir photo). Le surplus d'chelle au bas de puits est roul de faon ce qu'il soit l'abri de chutes de pierres qui pourraient l'endommager.
Entretien Il faut vrifier rgulirement le bon tat des anneaux italiens, des cbles, des sertissages, des barreaux et des frettages des barreaux sur les cbles. Les chelles sont plies correctement, par exemple la Lyonnaise, et ranges dans le mme local que les cordes. L'quipement en fixe avec les chelles communment utilises en splologie (modle en galva) est proscrire car elles subissent une dtrioration rapide (oxydation des cbles et lectrolyse alu-acier). Il faut utiliser des chelles en acier inoxydable.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 49
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.7
DES EXEMPLES D'QUIPEMENT
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 50
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 51
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 52
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 53
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 54
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 55
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.8
LA PROGRESSION EN EQUIPANT
2.8.1 S'assurer en quipant Les mains courantes L'assurance en quipant s'effectue avec le descendeur positionn normalement sur la corde de progression qui est amarre solidement. On effectue un nud en aval du descendeur en laissant une longueur suffisante pour accder aux amarrages suivants Si il y a chute, le splologue est arrt par le nud. Il ne faut pas faire de cl sur le descendeur, car en cas de chute avec du mou sur la corde, le mousqueton peut se positionner en travers dans le trou du descendeur; il y a alors risque de rupture du descendeur ou du mousqueton. On peut aussi quiper long sur son bloqueur de poigne en prenant soin : de mousquetonner le mousqueton de sa longe longue sur la corde, d'tre au maximum en tension sur le bloqueur de poigne (longe longue tendue). pas de nud effectuer en aval, rglage de la longueur de corde entre 2 amarrages immdiat.
Avantages:
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 56
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Les puits Il faut imprativement qu'il y ait un nud l'extrmit de la corde qui est au fond du sac. Le splologue est en poids sur le descendeur, il arrive au niveau du fractionnement, s'immobilise sur la corde l'aide d'une cl d'arrt. Il peut alors calculer la longueur de corde ncessaire la boucle du fractionnement (suffisamment longue) pour pouvoir se longer avec la longe courte, il sufft de placer la corde dans l'amarrage avec un nud de huit double. Le splologue se longe avec sa longe courte dans l'amarrage, il peut alors dfaire la clef d'arrt et se mettre en poids sur sa longe, il passe le fractionnement et continue la descente jusqu' l'obstacle suivant. Cette mthode systmatique est irrprochable. Mais il faut obligatoirement tenir compte de l'lasticit de la corde et anticiper (surtout dans les grands puits). Il faut donc prvoir le surplus de corde, ncessaire pour compenser cette lasticit, entre le descendeur et le fractionnement. Une autre mthode est plus rapide : Arriv au niveau du fractionnement, placer l'amarrage, se longer dessus, se pendre dessus.~ ATTENTION : Ne pas enlever la corde du descendeur. Pour s'assurer faire un nud 3 mtres environ en aval du descendeur, laisser filer la corde dans le descendeur. Tirer du mou en amont du descendeur, jusqu' ce que la corde ne soit plus en tension. Evaluer la longueur ncessaire de la boucle et mettre la corde en place sur le fractionnement. Cette mthode ncessite l'emploi de mousquetons d'amarrage s'ouvrant sous charge. 2.8.2 S'assurer en dsquipant
Les mains courantes faciles Il faut que le splologue soit sur sa poigne (mousqueton de longe de poigne crochet dans la corde de main courante). Les mains courantes ariennes Il faut s'assurer l'aide du bloqueur de poigne, en passant systmatiquement la corde dans le mousqueton de la longe longue. Les fractionnements Il faut passer le fractionnement, puis dfaire l'amarrage.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 57
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.9
LES SITUATIONS D'INITIATION
2.9.1
Situations en initiation
Attention, ce chapitre ne dcrit pas une dmarche, une mthode, un contenu, une attitude pdagogique. Ce chapitre liste les techniques que l'initiateur doit connatre pour encadrer. C'est par ses objectifs, ses connaissances pdagogiques, sa personnalit qu'il adaptera son enseignement ses lves. Prvention Avant la descente il faut vrifier : la fermeture du M.A.V.C, les boucles du baudrier, la fixation des appareils (descendeur, longes, bloqueurs) sur le M.A.V.C et le baudrier. Il faut vrifier que rien ne puisse se glisser intempestivement dans le descendeur ou le bloqueur ventral : jugulaire de casque trop longue, cheveux ,vtements amples, bijoux, cordelettes, etc. 2.9.2 La descente
La corde d'intervention C'est une corde qui mesure la longueur du plus grand puits. A une extrmit on prpare deux nuds avec deux mousquetons et l'autre un nud d'arrt. Le cadre l'a en permanence avec lui, love dans son sac et accessible rapidement. En cas de problme, il suffit de l'accrocher sur les amarrages de la corde de progression et de descendre jusqu' la personne en difficult. Si c'est ncessaire on peut facilement faire un balancier pour dgager le splologue (voir chapitre dgagement). Assurer un dbutant la descente Une seule mthode rassemble tous les avantages L'assurance du bas par le haut. Impratif: il faut que la corde de progression fasse le double de la longueur de la verticale. Le splologue tient la corde en dessous du dbutant en faisant une boucle vers le haut. Avantages Le cadre est long en haut du puits, il contrle l'approche en main courante, la mise en place du descendeur et le dpart. S'il doit intervenir, il place naturellement la corde aval du descendeur en position haute, main haute = position d'arrt. Le dbutant n'a qu' suivre le mouvement pour acqurir le bon geste.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 58
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Dans le cas o la cavit comporte plusieurs verticales, on peut viter de prvoir des cordes du double des verticales en raboutant une corde supplmentaire au bas de la corde de progression et en la faisant suivre chaque puits. Pour l'apprentissage du passage d'un fractionnement, l'lve doit matriser la descente simple et tre autonome dans cet exercice. Le passage du fractionnement doit se faire vue du cadre. Il ne faut pas hsiter se placer proximit avec la corde d'intervention. Le cadre peut alors contrler la descente de la deuxime longueur comme prcdemment. Pour l'apprentissage de la descente il est important d'adapter le diamtre de la corde au poids de l'lve pour viter une glisse trop rapide, ou l'absence de glisse (dbutants de petits gabarits).
2.9.3
La monte de la monte est
Assurance l'chelle
La mthode la plus sre l'utilisation du poulie bloqueur.
On emploie la corde de descente, comme corde d'assurance, relie au M.A.V.C. de l'lve par un nud en huit et un mousqueton vis. Le seul risque contrler est que la corde ne passe pas entre deux barreaux de l'chelle quand on la renvoie. En cas de problme on peut transformer le poulie bloqueur en balancier ou en palan.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 59
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.10 LA PROGRESSION SANS MATERIEL
2.10.1 La progression sans matriel Lors d'une exploration, on ne progresse pas exclusivement la verticale sur des cordes. C'est pour cela que l'on va dcrire certaines techniques de progression sans matriel, permettant de franchir les obstacles efficacement, sans trop se fatiguer, et sans danger. Pour cela le matriel de progression sur agrs doit tre rang afin qu'il n'entrave pas le dplacement. 2.10.2 La marche Lors de la progression, on doit autant que possible se tenir debout. On est beaucoup plus efficace, on s'conomise. L'quilibre est fondamental, ainsi que le positionnement du pied. 2.10.3 Le souci d'conomie Pour rester efficace tout au long de l'exploration, et ressortir de la cavit en forme, on doit avoir le souci permanent de progresser moindre effort. On choisit un itinraire rgulier, on vite les variations d'altitude (il est prfrable d'enjamber un bloc, plutt que de monter dessus et d'en redescendre). Pour cela, on doit observer le milieu, et choisir son parcours en consquence. il faut anticiper le franchissement d'un obstacle, et mme anticiper chaque dplacement. 2.10.4 Les diaclases et mandres Lorsque le passage est plus large en hauteur, on quitte le sol pour progresser entre deux parois verticales. S'il n'y a pas de prises pour les pieds, on se verrouille, pour se tenir en opposition et ne pas glisser au fond du conduit (bras, genoux, etc...). On adopte une position, permettant de se maintenir par coincement. On se positionne comme si on voulait carter les parois.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 60
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Dans certaines positions on ne force pas, on peut en profiter pour se reposer, et observer la suite du passage.
2.10.5
Les troitures Pour le franchissement d'une troiture, ne pas hsiter retirer le matriel pouvant entraver la progression (descendeur, baudrier, casque...). On franchit l'troiture avec un bras tendu devant (poussant le matriel et/ou le sac) et l'autre bras le long du corps. On dgrafe la jugulaire du casque afin d'viter l'tranglement si celui-ci se coince.
2.10.6 Les troitures verticales Pour franchir une troiture verticale, on s'y glisse les pieds en premier (ttant le volume et les prises). Cela permet de pouvoir remonter en cas de problme.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 61
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.11 LES TECHNIQUES DE RECHAPPE
2.11.1 Prsentation Les techniques de rchappe regroupent diffrentes mthodes pour subvenir un manque de matriel, ou venir en aide un coquipier.
2.11.2 La confection d'un poulie-bloqueur Il est possible de confectionner un poulie bloqueur avec son bloqueur de poigne et un mousqueton. On peut galement effectuer un palan en rajoutant son bloqueur ventral et un ou deux mousquetons en aval du bloqueur de poigne.
2.11.3 Le dgagement du bas vers le bas Il existe plusieurs mthodes pour venir en aide un quipier bloqu sur corde.
Technique balancier avec grande longe du sauveteur Je monte jusqu'au bless. En me hissant sur mes pdales, j'attache ma longe courte dans le bas du M.A.V.C. du bless (doigt du mousqueton contre le bless). Je vrifie son bloqueur de poigne et sa pdale. S'ils sont utilisables le les laisse en place sinon je les remplace par les miens (il est impratif que le mousqueton qui relie la pdale au bloqueur puisse s'ouvrir sous charge). Je mousquetonne ma grande longe dans le M.A.V.C. du bless ou mieux dans le trou du haut du bloqueur ventral.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 62
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Je dplace le bloqueur de poigne du bless de telle sorte que la distance mousqueton de poigne M.A.V.C. du bless soit peine plus courte que ma grande longe. Je me hisse sur la pdale : j'enlve mon bloqueur ventral puis je passe la corde de ma grande longe dans le mousqueton du bloqueur de poigne. Je me pends et je profite du balancier pour soulever le bless. Je dcroche le bloqueur ventral de la corde. Les deux splologues sont pendus sur le seul bloqueur de poigne du bless. C'est admis car c'est une situation exceptionnelle de secours. La rsistance du bloqueur et de la corde est amplement suffisante pour supporter une charge statique d'un poids doubl. Je place mon descendeur sur le M.A.V.C. du bless (il est ncessaire de faire un tour mort ou un nud italien sur le mousqueton de freinage pour mieux contrler la descente). Je fais une demi cl et une cl sur le descendeur. Je vrifie que le bless n'est plus reli au bloqueur de poigne par sa grande longe. Je me hisse sur la pdale, l'enlve ma grande longe du mousqueton du bloqueur de poigne. Je me pends sur ma petite longe (au M.A.V.C. du bless). Je dfais la cl et demi cl et le descends en faisant attention de ne pas aggraver l'tat du bless par mes manipulations et le dpose au sol doucement. On peut profiter du fait que le sauveteur touche le sol en premier pour arrter la descente avant que le bless ne touche terre. Il est alors possible de dplacer le bless horizontalement en pendule et le dposer l'cart de la base du puits. Avantages Effort de traction limit et applicable par tout splologue. Applicable partout, mme sous un amarrage. A aucun moment le sauveteur ne se trouve en facteur suprieur 1. Le descendeur se trouve toujours en bonne position. Le sauveteur descend sous le bless et peut donc le rceptionner facilement. Inconvnients Le mousqueton de balancier doit pouvoir s'ouvrir sous charge. Le balancier est difficile a rgler, s'il est trop bas le nud de longe vient buter avant que le balancier ne soit efficace.
Technique balancier sur pdale avec bloqueur ventral Monter jusqu'au bless. Enlever les pieds du bless de sa pdale. Le sauveteur crochte sa petite longe sous le M.A.V.C du bless, doigt du mousqueton contre le ventre du bless. Le sauveteur enlve ses bloqueurs et se pend sur sa petite longe. Le sauveteur installe un descendeur sur le M.A.V.C du bless, droite du bloqueur ventral du bless et cliquet face au sauveteur. Il installe la corde dans le descendeur, met un mousqueton de renvoi, fait une demi-cl et une cl d'arrt. Oter la grande longe du bless de sa poigne.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 63
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Rcuprer un mousqueton et accrocher la pdale du sauveteur sur la partie suprieure du M.A.V.C du bless. Faire passer la pdale dans le mousqueton du balancier. Calculer le dbattement du balancier en laissant approximativement 5 10 cm au dessus du nud de la pdale. Le sauveteur se hisse sur la pdale du bless (pdale passant l'extrieur des jambes du bless), dans la foule il place son bloqueur ventral le plus bas possible sur la pdale servant de balancier. Balancer le bless, ouvrir son bloqueur ventral. Le sauveteur se hisse nouveau sur la pdale du bless, le balancier joue dans l'autre sens, le bless se trouve alors sur son descendeur. Le sauveteur enlve dans la foule la pdale balancier de son bloqueur ventral, il dsolidarise cette mme pdale du systme balancier et se remet en tension sur sa petite longe. Il dfait la cl d'arrt et descend le bless. Avantages Elimine le problme de rflexion pour le calcul de la longueur de balancier. Le balancier s'effectue dans l'axe. Mthode relativement simple. La longueur des longes du sauveteur n'est pas dterminante bien qu'il faille mettre sa petite longe dans le M.A.V.C du bless. Inconvnients Ncessite l'utilisation de la pdale du bless. Ne fonctionne que pour un diamtre de pdale de 5,5 mm minimum. Risque de perte de ses pdales. Attention la remise en poids sur le descendeur, avec la cl d'arrt. Lger coincement de la gchette du bloqueur ventral sur les pdales trop souples. 2.11.4 Le dgagement vers le haut Lorsqu'un quipier est en difficult sur la corde sous soi, et que l'on veut le remonter jusqu'au fractionnement, on fait un balancier "espagnol". Pour cela, placer une chane de 2 ou 3 mousquetons dans le mousqueton d'amarrage (ou dans la ganse du nud en cas d'amarrage naturel ou en Y). Je fixe le dernier mousqueton de la chane sur la corde qui descend (on peut mettre 2 mousquetons cte cte, ce qui diminue l'angle de la corde lors du balancier). Je me longe long sur la corde au dessus de l'amarrage. Je me longe court sur la corde qui descend, entre l'amarrage et le(s) dernier(s) mousqueton(s) de la chane. Je place mon bloqueur de poigne l'envers, sur la corde qui descend, et je passe ma pdale dans mon M.A.V.C (faire attention au sens, de faon ne pas dvisser le M.A.V.C quand je me hisse sur la pdale). Je suis en poids sur la longe courte et tire du mou en poussant sur la pdale. Quand le mou est suffisant, le retire mon bloqueur de poigne de la corde pour le placer entre mon mousqueton de longe et le dernier de la chane, puis je me hisse pour positionner le bloqueur ventral sous le bloqueur de poigne. Le balancier est en place, je remonte la victime.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 64
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Quand la victime arrive sous l'amarrage, le la soulve par contrepoids, et la longe sur la main courante. Je me soulve de faon la mettre en poids sur sa longe et en profite pour me longer l'amarrage. il ne reste plus qu' retirer la corde de progression. 2.11.5 La descente sur corde tendue Pour descendre sur une corde tendue (corde coince, quipier en poids...), on utilise ses bloqueurs. Les bloqueurs sont en place sur la corde identiquement la monte. On se met debout sur la pdale, ce qui soulage le bloqueur ventral. On peut donc, en appuyant sur le dessus de la gchette, permettre la corde de coulisser vers le haut. On fait une flexion de la jambe, en appui dans la pdale, pour permettre au bloqueur ventral de descendre. Puis on relche la pression du doigt sur la gchette, pour se mettre en poids sur le bloqueur ventral. On peut donc baisser le bloqueur de poigne, en appuyant sur le dessus de la gchette, et renouveler la manuvre afin de continuer la descente. En aucun cas, on ne libre un bloqueur de la corde. D'autres techniques existent pour descendre sur corde tendue, mais elles sont complexes. Celle-ci est la plus simple et la plus sre. Pour descendre une grande longueur, cela peut tre long et fatigant, on utilisera donc la corde d'intervention. 2.11.6 La descente sans descendeur Si on perd son descendeur, on peut le remplacer en faisant un nud italien (demi cabestan) sur un mousqueton vis, fix sur le M.A.V.C. Faire attention ce que la corde ne travaille pas sur le doigt du mousqueton, Si le cas se prsente, retourner le mousqueton. Ce nud a l'avantage de travailler dans les deux sens, ce qui permet de vrifier sa ralisation, mais prsente l'inconvnient de beaucoup vriller les cordes.
2.11.7 La monte sans bloqueur Si on n'a plus de bloqueur ventral, on peut le remplacer par le nud de cur. Celui-ci est effectu sur deux mousquetons identiques vis, fixs cte cte sur le M.A.V.C. Si on n'a pas de bloqueur de poigne, on peut le remplacer par un nud Machard. Il s'effectue avec un anneau de cordelette d'un diamtre infrieur celui de la corde (de 6 8 mm).
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 65
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.11.8 L'auto-dgagement lors d'une monte l'chelle Dans le cas le plus dfavorable, le splologue se trouve pendu par son bloqueur de poigne sur la corde d'assurance. Il doit alors installer son descendeur au bout de la petite longe et faire une cl d'arrt sur celui-ci. Il fait ensuite des tours morts avec la corde autour d'un pied pour pouvoir se soulever et dfaire le bloqueur de poigne qu'il laisse coulisser sur la corde, il peut alors se mettre en poids sur son descendeur, dfaire la cl d'arrt et descendre.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 66
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.12 L'ENTRETIEN ET LE STOCKAGE DU MATRIEL
2.12.1 L'entretien Les cordes, les cuissards, les longes, les anneaux de sangle et de corde, les cordelettes, doivent tre nettoys l'eau claire d'une temprature maximum de 30. Pendant le nettoyage il faut vrifier le bon tat du matriel. Une corde qui prsente un point d'usure doit tre coupe sur celui-ci et la longueur marque nouveau. Les coutures et les sangles des baudriers doivent tre minutieusement inspectes, et il ne faut pas hsiter dclasser un baudrier dont certains lments sont cisaills. Les anneaux de sangle, les longes, les cordelettes doivent tre jets ds qu'ils sont uss. Les mousquetons rforms (doigt fissur, usure anormale, chute dans un grand puits, etc....) doivent tre JETS. il ne faut surtout pas, par souci d'conomie, les garder comme porte sac ou porte gnrateur d'actylne. C'est trs dangereux, et systmatiquement dans les rassemblements de splologues, stages, exercices secours, o beaucoup de matriel est engag, on retrouve ce genre de mousquetons sur des quipements de scurit (quel que soit son marquage et l'attention du propritaire). 2.12.2 Le stockage Le stockage du matriel doit tre fait l'abri de la lumire et de la chaleur, et sans contact direct avec des hydrocarbures et produits chimiques (qui attaquent la structure de la corde sans que cela soit visible). Attention dans les garages aux bidons d'essence, d'huile, batteries, etc. Si l'on veut dclasser une corde mais la conserver pour un usage diffrent (dsobstruction, corde de dpannage de voiture, etc), il faut la marquer de manire trs voyante pour viter que, sur un malentendu au sein du club, la corde ayant tract la 4 L du prsident serve quiper la main courante du puits. La seule manire efficace est le marquage la peinture tous les 2 mtres, c'est facile raliser en trempant le bas de l'cheveau de la corde dans un pot de peinture.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 67
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.13 LE MATRIEL CONSOMMABLE
2.13.1 La nourriture et l'eau La splologie est une activit qui demande beaucoup d'nergie, du fait de l'effort, du milieu (froid, obscurit, humidit...). C'est pour cela que l'on prend toujours de la nourriture, afin de subvenir aux besoins de l'organisme et prvenir la fatigue, la faim, le froid... La nourriture apporte doit tre adapte au milieu et son transport. Son arrive intacte sur le lieu du ou des repas est primordiale, et donc le conditionnement est important. Elle doit tre varie (sucr, sal), et apprcie de tous. On s'arrte pour manger des heures rgulires et habituelles. Il ne faut pas hsiter en prendre en plus, ce peut tre utile. On ressort de la cavit le reste de nourriture ou les dchets, car sous terre, il n'y a pas suffisamment d'animaux pour consommer ce surplus, et l'absence de cycle biologique (jour, nuit, chaud, froid, pluie,...) ne permet pas une dcomposition normale. De plus, il est trs bon de prendre un rchaud, avec des boissons chaudes (caf, th, soupes), car mme si on n'a pas spcialement soif, les besoins en eau sont importants. il est indispensable de boire sous terre, et ceci avant d'avoir soif (cf article du Dr. Ballereau dans Spelunca n 19 page 30), en thorie, boire quelques gorges toutes les 1/2 heures. Si la cavit est fossile, n'oubliez pas de prendre de l'eau. 2.13.2 Le carbure Sous terre, l'clairage c'est la vie (lumire et chaleur). C'est pourquoi on doit en prvoir plus que pour la dure de l'exploration (un retard de plusieurs heures est si vite arriv). Son conditionnement est primordial, et son emballage doit tre tanche (air et eau) et robuste. On utilise la bite carbure qui est un bout de chambre air correctement ferm aux extrmits. Une fois le carbure consomm, la chaux est mise dans un sac poubelle et ressortie de la cavit, car elle ne se dcompose pas. En cas d'impossibilit, le pis aller est de "dchauler" dans l'eau courante, et non sur les margelles. Ne pas oublier de prvoir de l'eau pour le gnrateur actylne.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 68
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.14 LA PRVENTION
2.14.1 Conseils gnraux Afin d'viter un maximum de problmes, et donc augmenter la scurit, une sortie souterraine doit tre bien prpare. On doit s'informer sur la cavit: accs, difficult, nature de la cavit, temprature, hydrologie. Se renseigner auprs des structures fdrales : tlphoner au Conseiller Technique Dpartemental du SSF. De plus, on doit estimer la dure de l'exploration, afin de prvoir l'clairage et la nourriture en gardant une marge de scurit. Tous les membres de l'quipe doivent savoir o sont caches les cls du ou des vhicules. Le matriel est nettoy et vrifi aprs chaque sortie. il doit tre stock correctement. La prparation du matriel est primordiale. Lors du remplissage du sac de portage, on fait un nud de huit double au bout de la corde, ainsi qu'un nud de huit un mtre plus haut. Car si elle est trop courte, le splologue s'arrtera sur le nud... La mthode des deux nuds prsente un double intrt si la corde s'avre trop courte: pas de surprise, car l'arrive sur le premier nud laisse une marge de scurit, qui n'oblige pas remonter; fonctionnel, car le nud du bas en double huit est dj prt avec sa ganse, il suffit de tricoter la corde suivante.
Sous terre plusieurs choses sont indispensables pour la scurit ne pas stationner au bas des puits, nettoyer les abords des puits et les margelles, connatre ses limites, savoir renoncer, reprer dans le milieu les signes annonciateurs de crue, savoir s'orienter en se retournant chaque carrefour.
2.14.2
Mtorologie et splologie
Sous terre Les lments mtorologiques prendre en compte par le splologue sont lis aux risques encourus. Pour le parcours souterrain, il s'agit avant tout des crues qui se traduisent par des galeries noyes (parfois brutalement), des puits arross, des dplacements de rochers, l'augmentation du courant des rivires et le charriage de boue et d'objets divers (branches, ...). C'est donc ce qui touche l'eau qui doit attirer l'attention. La mtorologie apporte dans ce domaine des informations indispensables au splologue consciencieux : tat des sols (couverture neigeuse, tat hydrique
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 69
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
dpendant des prcipitations passes, quantits de pluie ou de neige tombes rcemment ou prvues pendant les cinq prochains jours, volution de la temprature (pour la fonte de la neige par exemple). Finalement, en ajoutant les informations cites ci-dessus une connaissance suffisante du lieu d'exploration, on parvient se mettre dans des conditions de scurit optimales. Le splologue doit donc, en plus de ses connaissances gnrales du milieu karstique, disposer d'une bonne description du site o se trouve la cavit. Citons plus particulirement : les variations saisonnires (temprature, dbits des cours d'eau, ...), l'importance du couvert vgtal, la capacit de rtention d'eau en surface (par l'humus, les mares, le rseau hydrologique, la forme et l'tendue du bassin versant, les caractristiques de la cavit. Selon les situations, certains de ces paramtres pourront revtir une importance cruciale. Ainsi, un bassin versant tendu et pentu collectera trs rapidement de grandes quantits d'eaux de ruissellement, ce qui pourra occasionner une monte soudaine de l'eau dans toute cavit situe dans la partie basse de ce bassin versant. Dans ces conditions, les averses ou les orages, phnomnes en gnral de courte dure et intenses la fois, sont particulirement dangereux. Sur le chemin d'approche Il ne faut cependant pas oublier que le splologue peut rencontrer les mmes difficults que n'importe quel autre randonneur de moyenne ou haute montagne pour rejoindre l'entre d'une cavit. Une mauvaise mto peut rendre la progression difficile (brouillard, vent, orage, pluie, neige, ...) et le terrain incertain (avalanches, glissements de terrain, ...). De mme, un soleil de plomb peut aussi tre un facteur aggravant. Il faut galement prendre garde aux conditions rencontres au moment du retour qui se fera aprs que chacun ait accumul une fatigue certaine pendant la progression souterraine. Un calendrier recommander Les jours prcdant l'exploration, il est utile de suivre la situation sur le site d'exploration, mme distance. En mme temps, avoir une ide de l'volution dans les jours qui suivent peut s'avrer profitable : dcider de maintenir ou d'annuler une opration est plus facile deux ou trois jours avant la date prvue que le jour mme une fois sur place. Il faut insister sur le fait que la dception cause par le report d'une opration prvue de longue date est sans commune mesure avec les consquences d'un grave accident d la ngligence de risques prvisibles. Le jour de l'exploration, le point doit tre fait aprs avoir contact le service mtorologique dpartemental (ou le service adquat l'tranger; tous les pays disposent au moins d'un service mtorologique national qui vous fournira des informations plus ou moins prcises, mais utiles dans tous les cas). L'volution des conditions mtorologiques pendant une priode couvrant largement la dure prvue de l'exploration sera dterminante. Ceci peut tre avantageusement complt (mais pas remplac) par un examen du ciel par le splologue: inspecter le ciel est un exercice de sciences naturelles utile et agrable et on peut parfois y trouver des signes d'volution court terme : dveloppements orageux importants, pluie prochaine signale par une couverture nuageuse de plus en plus basse et sombre... En conjuguant ces informations avec celles qui concernent la cavit (obtenues dans la littrature, auprs des splologues locaux ...), l'quipe pourra estimer s'il y a un risque descendre sous terre.
Comment s'informer ? Consulter la mtorologie est un gage de scurit. En splologie, le risque de crue est rel. Si vous manquez d'informations gnrales sur le systme hydrologique de la cavit que vous dsirez explorer, si les conditions mtorologiques sont mauvaises, le plus sage est de s'abstenir ou de modifier son programme. Dans tous les cas, rassembler l'avance toutes les informations ncessaires a une exploration rduit les risques et accrot le plaisir de pratiquer la splologie.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 70
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.15 LE SECOURISME
La mise en attente du bless Lors d'un accident, la premire chose faire est de protger la victime du sur-accident. On la met donc en lieu sr, l'abri de l'eau ,du froid, des pierres, des courants d'air, etc... On ne doit dplacer un bless qu'en connaissant tous les impratifs du secourisme de base (cf. brevet de secourisme, et manuel technique du S.S.F). En l'isolant du sol avec du matriel que l'on a avec soi (corde, sac, combinaison, couverture de survie), on confectionne ensuite une tente avec une ou plusieurs couvertures de survie. On y place un ou plusieurs casques allums avec leur clairage principal, qui vont librer assez de chaleur pour maintenir le bless une bonne temprature (afin d'viter une hypothermie). Technique de la "Tortue" Ce procd peut tre utilis par tout splologue et tout moment (fatigu, ayant froid, devant attendre). Dans ce cas il suffit de s' asseoir sur son casque ou sur un sac avec la couverture de survie par dessus soi (en conservant la flamme du casque sous celle-ci). 2.15.1 Le dclenchement de l'alerte Lorsque l'on est tmoin d'un accident, aprs avoir mis en attente le bless, il faut faire le bilan (les 5 questions). Rpond-il aux questions? Petit-il bouger de partout? A-t-il du mal respirer? A-t-il un pouls au poignet? A-t-il une lsion vidente? Toutes les informations recueillies doivent tre notes pour viter les oublis. Ces informations comprenant en plus du bilan, le lieu et les circonstances de l'accident, l'horaire, le nom du bless, son sexe, son ge, le type de cavit, le nombre de personnes sur place et leurs comptences, seront utiles pour l'organisation du sauvetage. Quand vous possdez ces renseignements, vous pouvez sortir sans prcipitation de la cavit pour alerter les secours. Dans la mesure du possible, sortir deux, en s'attendant. Vous devez alerter le Service d'incendie et de secours (Tel = 18 qui est gratuit) et le conseiller technique secours du dpartement concern, puisque vous vous tes inform au pralable auprs des structures fdrales. Il est impratif de doubler l'appel. Ds que l'on a le contact tlphonique, on dclare l'accident en fournissant les renseignements collects, il faut aussi donner les coordonnes, le nom de la cavit et son itinraire d'accs, son identit, le numro de tlphone d'o on appelle, pour se faire rappeler en cas de besoin. Important : vous devez rester auprs de ce tlphone jusqu' l'arrive des secours pour pouvoir rpondre toute demande de renseignements supplmentaires.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 71
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.16 LA LGISLATION
Les propritaires de cavits ou entres On distingue 3 catgories de domaine de proprit. Le domaine priv des personnes prives: ce sont des particuliers, des associations, des entreprises, etc. Le domaine priv de I'Etat. Dans ce domaine, le Maire, le Prsident du Conseil Gnral ou le Prfet reprsentant l'Etat ou des administrations comme l'ONF, jouissent des mmes prrogatives qu'un propritaire priv. Le domaine public. Il s'agit de biens appartenant l'Etat, aux collectivits publiques et aux tablissements publics qui sont affects l'usage du public (routes, fleuves, etc..) ou des services publics (centrales lectriques, voies ferres, etc...).
2.16.1 L'accs aux cavits En dehors des zones publiques compltement libres, l'accs aux cavits est toujours subordonn au droit et au consentement du propritaire. Dans certains cas, aucune dmarche n'est ncessaire, soit parce que localement les splologues savent qu'il y a accord tacite de la part du propritaire, soit parce que les limites de proprits sont mal connues. Il est donc indispensable de se renseigner auprs des splologues locaux et d'obtenir 1'accord du propritaire avant d'entamer une exploration et plus encore une dsobstruction qui peut tre considre comme une dgradation sur la proprit d'autrui. Il est donc indispensable de respecter les cltures, les indications portes sur les panneaux installs sur le site, de se rendre la mairie afin de prendre connaissance des rglementations locales (exemple : vhicules motoriss interdits sur les chemins communaux). Il faut viter d'tre bruyant l'abord des habitations. 2.16.2 Les interdictions ou rglementations
2.16.2.1 Celles du propritaire Il est matre chez lui et le droit de circuler dpend de son bon vouloir. Le maire peut aussi rglementer l'accs sur un terrain communal en prenant un arrt municipal. il doit alors, contrairement au particulier, justifier cette dcision par des raisons de scurit, de pollution, de gne. 2.16.2.2 Celles induites par une activit anthropique Pour des raisons de scurit ou pour protger l'outil de travail, le site peut tre interdit ou soumis rglementation les installations de l'EDF, les zones de barrages, les grottes amnages pour le tourisme, les terrains militaires, les zones de chasse autorise, les pistes forestires, les carrires.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 72
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Les conditions d'accs sont souvent indiques sur des panneaux rgulirement installs sur le pourtour du site. il est souvent possible d'obtenir l'autorisation de rentrer des priodes non prjudiciables pour l'activit pratique : entre deux lchers d'eau pour un barrage, en dehors des priodes de tirs sur les terrains militaires et dans les carrires, aprs les heures de visites pour les sites amnags... 2.16.2.3 Celles dcrtes par une mesure de protection Les mesures de protection dictes par un texte administratif peuvent entraner une rglementation d'accs, mais ce n'est pas systmatique. Cela dpend du degr de vulnrabilit de l'objet protger et surtout de l'apprciation des responsables de la protection, ce qui est parfois trs subjectif et pas toujours bas sur une argumentation scientifique. les sites inscrits et classs (loi de 1930), pour leur intrt pittoresque entre autres, les monuments inscrits et classs (loi de 1913); la prsence de vestiges archologiques, historiques ou prhistoriques entrane parfois le classement d'une grotte ce titre. les rserves naturelles par dcret ou par agrment (loi de 1976); essentiellement pour leur intrt floristique, faunistique ou gologique. les arrts de biotope; il sont pris par simple arrt prfectoral, ce qui rend la procdure rapide. Ils protgent le biotope, c'est dire l'environnement naturel, d'une espce animale ou vgtale ellemme protge au titre de la loi sur les espces protges. Les arrts de biotope ne concernent que des zones restes sauvages car il n'est pas possible de restreindre des activits anthropiques traditionnelles. les primtres rapprochs des captages.
Extrait de la loi de 1941 sur la rglementation des fouilles archologiques: ARTICLE 1 : Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant autrui des fouilles ou des sondages l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intresser la Prhistoire(...) sans avoir au pralable obtenu l'autorisation. 2.16.2.4 Le rle des splologues dans la protection et la valorisation des sites karstiques Les splologues sont des spcialistes dans le domaine de l'exploration du monde souterrain. A ce titre, il est leur devoir de s'intresser aux cavits dans leur globalit. Il est possible de participer aux tudes scientifiques en accompagnant les spcialistes sur le terrain. Les diffrentes tches accomplir pour conduire une tude peuvent se rpartir en fonction des comptences de chacun. Le rapport final et les suites donner aux tudes sont tablis en commun. Les procdures de protection ne doivent pas tre subies. On doit participer leur mise en place, prendre une part active dans les mesures qu' il faut ventuellement prendre pour la conservation. Pour les cavits sensibles, on peut viter les interdictions totales d'accs en prvoyant des balisages, des panneaux d'information, des modalits de visite. Si les mesures de protection sont imposes et semblent injustifies, elles doivent tre dnonces dans les dlais rglementaires. Pour tre efficaces dans toutes ces dmarches, il est bon d'instaurer des relations de confiance avec les propritaires et les maires des communes. Il faut les associer en les tenant informs de l'tat des dcouvertes, en leur faisant connatre le patrimoine souterrain local au moyen de publications, d'expositions ou de confrences. Il vous exprimeront leur reconnaissance en signalant leurs observations de surface. Ils participent parfois en proposant gratuitement les moyens techniques dont ils disposent. Les municipalits n'hsitent pas subventionner des actions exceptionnelles qui renforcent leur image de marque. Au niveau prfectoral, il faut se tenir au courant des diffrentes commissions mises en place sur le dpartement (sites, carrires ...), informer le Prfet et le Prsident du Conseil Gnral que nos comptences peuvent tre mises profit pour les dossiers qui concernent le karst. Il est indispensable d'instaurer les conditions ncessaire pour maintenir le libre acces viter les sources de conflits. Un splologue ne doit pas agir seul. Pour tout projet, il doit avoir l'accord du CDS avant d'entreprendre des ngociations.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 73
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Nous devons participer l'co-citoyennet: signaler les rejets de toutes sortes qui sont interdits dans les gouffres, les rivires ou tout endroit partir duquel ils peuvent atteindre l'eau sans tre filtrs, mener des actions de dpollution, mener des tudes et notamment des traages afin de dmontrer les liaisons souterraines, organiser des actions de sensibilisation la protection de l'eau.
Nous devons participer une valorisation douce du karst en proposant des solutions alternatives aux grands chantiers d'amnagement de cavits. Les sentiers karstiques de surface et souterrains dj raliss en sont de bons exemples 2.16.3 Les responsabilits Tout organisme (club ou instance fdrale), ou bnvole ou professionnel qui organise ou encadre la splologie contracte une obligation de scurit. Il doit donc tout mettre en uvre pour ramener sain et sauf le groupe encadr, mais n'est pas responsable des faits imprvisibles et de force majeure qu'il peut rencontrer. D'o la ncessit de contracter une assurance en responsabilit civile. 2.16.4 Les assurances Il est indispensable de vrifier lors d'une sortie ou d'un stage que toutes les personnes sont bien couvertes par une assurance pour la pratique de l'activit. Tout manquement cette obligation rend l'association ou la personne organisatrice responsable en cas d'accident. Elle devra alors verser la victime des dommages et intrts correspondant l'indemnisation que celle-ci aurait obtenue si elle avait souscrit un contrat d'assurance. 2.16.5 Le certificat mdical L encore la responsabilit du cadre peut tre recherche s'il ne s'est pas assur avant la sortie ou le stage que les personnes qu'il encadrait taient aptes physiquement pratiquer la splologie. Il faut donc systmatiquement rclamer un certificat mdical pour la pratique de la splologie. 2.16.6 Splologie et scurit Deux textes essentiels consulter sur ce site : Les recommandations de la FFS "splologie et scurit" L'arrt Jeunesse et Sports du 8/12/95 relatif l'encadrement en centre de vacances
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 74
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.17 L'ARCHOLOGIE
Le gisement Le gisement archologique reprsente une grande varit de situations, il fait partie de notre patrimoine culturel commun. Il peut tre antquaternaire, car les roches sdimentaires dans lesquelles nous voluons ont pu garder des traces anciennes remises jour par l'rosion. Des splologues ont dj trouv des empreintes de dinosaures sous terre. Il peut tre palontologique, c'est--dire concerner les restes des anciens animaux. Ce sont souvent des ossements, mais l'on peut trouver des bauges ou des griffades d'ours ou d'autres animaux. Il peut tre prhistorique. Ce sont les gisements les plus clbres. On trouve des traces et empreintes, des vestiges mobiliers, de l'art parital, des foyers et des amnagements, etc. Il peut tre historique et mme rcent. Toujours msestime, l'archologie historique est pourtant ncessaire la connaissance des socits mme modernes. Les vestiges et les traces sont encore plus nombreux, mais on peut citer les encoches dans les parois servant soutenir des planchers, les vestiges mobiliers et culinaires, les signatures anciennes dessines sur les parois. Mme un petit mur de pierre, tout boul, peut avoir son importance. O et quand suspecter la prsence d'un gisement archologique? Il peut se situer sur toute la surface d'une cavit, sur les parois, au sol ou dans les remplissages. Il peut tre situ l'entre de la cavit ou dans la zone obscure. L'utilisation des entres est bien connue, mais loin sous terre on peut trouver de remarquables traces et vestiges. Soit parce qu'ils ont t dplacs (par l'eau, ou par la gravit) aprs leur dpt, soit parce que les hommes pntrent profondment sous terre depuis qu'ils possdent la premire source de lumire, le feu. Mais aussi parce que les animaux, ont toujours pntr sous terre. N'oubliez pas que l'on peut donc trouver des traces plusieurs kilomtres de l'entre. Il peut tre situ dans des grottes, mais aussi au fond de gouffres. Soit parce que les vestiges ont t dplacs, soit parce que l'homme n'a pas attendu Martel pour descendre ou monter des verticales de plusieurs dizaines de mtres l'aide d'chelles en bois, soit enfin parce que nos prdcesseurs accdaient au site par un autre accs plus ais aujourd'hui ferm. Le milieu souterrain a toujours constitu une rserve importante de matires premires comme le fer, les phosphates, ou plus simplement l'eau. En somme, un gisement archologique peut exister presque partout, y compris dans des cavits dj connues. Mais de cette liste on pourrait exclure les cavits de montagne, sauf exception. En haute Arige un gouffre vers 1700 mtres d'altitude contient bien des crnes humains, peut-tre vestiges d'une histoire de passeurs de la dernire guerre. Si l'on peut exclure (mais seulement pour la prhistoire !) les zones profondes des gouffres d'altitude, on doit tre attentif presque partout. Mais il est des rgions, bien connues des splologues o les cavits requirent encore plus d'attention. La difficult est d'arriver reconnatre un gisement ou une trace. Pour cela, il est ncessaire d'avancer lentement en prenant particulirement soin des endroits o l'on pose les pieds et les mains, o l'on rampe. Il faut aussi tre particulirement mfiant quand on creuse dans des remplissages. Un morceau d'os, une anomalie topographique du sol, une rayure, un trait, ou un point sur une paroi, un morceau de charbon ou de cramique dans le sol, peuvent tre suspects. Il vaut mieux se sentir ridicule d'avoir cru trouver un vestige que de dtruire un gisement.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 75
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Que faire en cas de dcouverte ? La premire rgle est de ne pas modifier l'aspect ou l'emplacement des vestiges, donc de ne toucher rien, d'viter de pitiner le sol, mme si a priori, il ne recle aucune trace et en cas de dsobstruction d'arrter les travaux. Un rgle bien connue consiste paralllement et malgr l'euphorie de la dcouverte, ne pas bruiter la nouvelle, par exemple par voie de presse, sous peine de voir le site dtruit par des chercheurs de trsor moins respectueux. Il faut alerter les services archologiques rgionaux, ou dfaut leur correspondant local. On peut aussi s'adresser en priorit un correspondant "archo" splologue, s'il existe au niveau dpartemental ou rgional. En tout cas il faut prvenir une personne comptente. La loi oblige en cas de dcouverte fortuite une dclaration au maire de la commune. Ce n'est pas toujours la bonne solution, surtout pour les petites communes, car le maire peut diffuser la nouvelle et le site tre pill. On prfrera prvenir un service archologique professionnel. Pour cela il suffit de chercher dans l'annuaire de France Tlcom au chef-lieu rgional, la Direction Rgionale des Affaires Culturelles ou bien demander au sige de la F.F.S ou de l'E.F.S (des adresses sont rgulirement publies dans les revues fdrales). Pour pouvoir tayer les explications relatives la dcouverte on peut, sans abmer le site ni les vestiges, raliser une topographie ou un croquis et des photographies des traces et vestiges. Surtout n'oubliez pas qu'un vestige archologique ne vous appartient pas, mais qu'il fait partie du patrimoine commun. Sa perte, sa confiscation par une seule personne, ou sa destruction ampute les connaissances de tous.
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 76
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
2.18 BIBLIOGRAPHIE
Cette liste bibliographique fournit quelques complments aux chapitres techniques abords dans l'ouvrage. Elle ne se veut pas exhaustive, et se cantonne des rfrences correspondant aux critres suivants : publications postrieures 1980, date de parution de "Techniques de la splologie alpine" (G. Marbach et J.L. Rocourt), qui constitue une excellente synthse des matriels et des techniques connus l'poque. sujets techniques limits ceux abords dans cet ouvrage. Sont notamment exclues la prospection, la dsobstruction, la topographie, la plonge, etc. ouvrages ou priodiques franais diffusion nationale, faciles se procurer. Pour les revues, les rfrences se limitent Spelunca, Splo et Info-EFS.
1. Anonyme (1993): Usage du descendeur en "0" (ou en "C"). - Info-EFS, n24, p.59-60 2. AUDRA Philippe (1990): Vie, mort et rsurrection d'un tamponnoir. - Spelunca, bull. F.F.S., n38, p.44 3. BALLEREAU Andr (1983): Le Pasabloq, un palan ingnieux. - Spelunca, bull. F.F.S., n11, p.4041 4. CAVAILLES Daniel ; CAZES Grard; FULCRAND Serge (1991): Initiation la descente au descendeur. - Info-EFS, n22, p.40-42 5. CAVAILLES Daniel ; CAZES Grard; FULCRAND Serge (1991): Rappels sur l'quipement individuel. - Info-EFS, n22, p.43 6. COURBIS Robert (1980): Remarques sur les essais de matriel. - Spelunca, bull. F.F.S., n4, p.l7l172 7. COURBIS1 Robert (1982): Test matriel cordes et descendeurs autobloquants. - Spelunca, bull. F.F.S., n5, p.42-44 8. COURBIS Robert (1984): Commission tude du matriel. - Spelunca, bull. F.F.S., n13, p.VII ) 9. COURBIS Robert (1984): Essais de nuds en position anormale. - Spelunca, bull. F.F.S., n15, p.43 10. COURBIS Robert (1984): Quelques prcisions sur les essais de matriel splologique. Spelunca, Mmoires F.F.S., n13, p.23-24 11. GENUITE Pat (1991): Toute la lumire sur les dudules. - Splo, n3, p.7 12. Groupe d'Etude Techniques (1994): L'chelle, et son utilisation en splo. -Info-EFS, n25, p.3539 13. Groupe d'Etude Techniques (1994): L'quipement personnel du splologue. -Spelunca, bull. F.F.S., n54, p.43-44 14. Groupe d'Etude Techniques (1994): La pompe. - Spelunca, bull. F.F.S., n55, p.34-38 15. Groupe d'Etude Techniques (1994): Le kit. - Spelunca, bull. F.F.S., n56, p.41-45 16. Groupe d'Etude Techniques (1995): L'assurance des dbutants en verticale. -Info-EFS, n27, p.37-39
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 77
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
17. Groupe d'Etude Techniques (1995): Les cordes. - Spelunca, bull. F.F.S., n57, p.23-28 18. Groupe d'Etude Techniques (1995): Les nuds de jonction. - Spelunca, bull. F.F.S., n59, p.22-37 19. HOURTAL Aude; BOUILHOL Christian (1995): propos du dgagement d'quipier... suite. - InfoEFS, n28, p.l4-l5 20. Instructeurs EFS (1992): Equipements fixes en cavits. - Info-EFS, n23, p.74-75 21. LANGUILLE Andr (1986): Perforateur batterie. - Spelunca, bull. F.F.S., n20, p.36-37 22. LIMAGNE Rmy (1994): propos du dgagement d'quipier. - Info-EFS, n26, p.36-37 23. MACIEJEWSKI Nathalie (1995): La prparation du kit. - Info-EFS, n27, p.40- 41 24. MARBACH Georges (1982): Cordes statiques et scurit. - Spelunca, bull. F.F.S., n7, p.40-41 25. MARBACH Georges (1990): Comment improviser une lampe actylne. - Splo, n1, p.7 26. MARBACH Georges (1990): la recherche des dviationnistes. - Splo, n2, p.7 27. MARBACH Georges (1991): Bien rgler ses bloqueurs pour avaler les verticales. - Splo, n5, p.7 28. MARBACH Georges (1993): Appel aux combinards: ruses de Sioux. - Splo, n11, p.7 29. MARBACH Georges (1993): Macromolcule et grains de sable : bien faire vieillir ses cordes. Splo, n12, p.7 30. MARBACH Georges (1994): Du nouveau dans les bloqueurs : la pompe anti coup de pompe. Splo, n15, p.7 31. MARBACH Georges (1995): La preuve par huit. - Splo, n20, p.7 32. MARBACH Georges; ROCOURT Jean-Louis (1980): Techniques de la splologie alpine. - 350p. 33. MEREDITH Mike ; MARTINEZ Dan (1986): Guide de la splologie verticale.- Ed. S.A. Petzl, 84p., (2me d.) 34. MISERY Ren (1982): Pour la remonte aux bloqueurs. - Spelunca, bull. F.F.S., n5, p.45 35. Stage moniteur 1990 (1992): Dgagements d'quipier sur main-courante ou tyrolienne. - Info-EFS, n23, p.73
Manuel Technique Initiateur
Mai 1996
page 78
Vous aimerez peut-être aussi
- OphtalmologieDocument166 pagesOphtalmologieHo Nhat Quang100% (2)
- Apprentissage Artificiel - Concepts Et Algorithmes by Antoine Cornuéjols, Laurent Miclet, Jean-Paul HatonDocument834 pagesApprentissage Artificiel - Concepts Et Algorithmes by Antoine Cornuéjols, Laurent Miclet, Jean-Paul Hatonnacer zidiPas encore d'évaluation
- L' Environnement traductionnel: La station de travail du traducteur de l'an 2001D'EverandL' Environnement traductionnel: La station de travail du traducteur de l'an 2001Pas encore d'évaluation
- PourLaScience-443-Septembre2014 - Energie Et Matiere SombreDocument100 pagesPourLaScience-443-Septembre2014 - Energie Et Matiere SombrenickPas encore d'évaluation
- L InflammationDocument6 pagesL InflammationAmine Dido100% (1)
- TP1 Bus CAN-2Document7 pagesTP1 Bus CAN-2samsoum1Pas encore d'évaluation
- Baudry - Ecriture Fiction Idéologie - Tel QuelDocument11 pagesBaudry - Ecriture Fiction Idéologie - Tel Queltomgun11Pas encore d'évaluation
- Cours - FondationsDocument101 pagesCours - Fondationstarekhocine100% (1)
- HP Manip Mesures S 01 02 I OcrDocument63 pagesHP Manip Mesures S 01 02 I OcrorauxPas encore d'évaluation
- Confort ThermiqueDocument21 pagesConfort Thermiquetennich fatma100% (4)
- AFC 2013 Programme Et RésumésDocument232 pagesAFC 2013 Programme Et RésumésadautantPas encore d'évaluation
- Optical Properties of Point Defects in Hexagonal BDocument139 pagesOptical Properties of Point Defects in Hexagonal BAhamed Al ArifinPas encore d'évaluation
- 2007 - Depaepe - Matieres Premières - Le Paléolithique Moyen de La ValléeDocument150 pages2007 - Depaepe - Matieres Premières - Le Paléolithique Moyen de La ValléeOsiris GruñonaPas encore d'évaluation
- Memoire de Titres Et TravauxDocument54 pagesMemoire de Titres Et TravauxgayetPas encore d'évaluation
- A Study On Hydrogen Storage Through Adsorption inDocument243 pagesA Study On Hydrogen Storage Through Adsorption inNordin SuhadatPas encore d'évaluation
- Manuscrit These KGDocument370 pagesManuscrit These KGDiopPas encore d'évaluation
- Différentes Contributions Aux Lasers, À L'optique Non Linéaire, Et À L'optique InstrumentaleDocument67 pagesDifférentes Contributions Aux Lasers, À L'optique Non Linéaire, Et À L'optique InstrumentaleJunior WandjiPas encore d'évaluation
- JDC243Document44 pagesJDC243ramopavel0% (1)
- Monuments and Sites 15 ISCS Glossary Stone - Stone DecayDocument86 pagesMonuments and Sites 15 ISCS Glossary Stone - Stone DecayCatalin PopoviciPas encore d'évaluation
- These N VeyratDocument420 pagesThese N VeyratFe DwāPas encore d'évaluation
- Monnayage Et Fausse MonnaieDocument780 pagesMonnayage Et Fausse MonnaieelracalPas encore d'évaluation
- TH2016PESC1110Document204 pagesTH2016PESC1110MoezPas encore d'évaluation
- L AMBLYOPIE. Cahiers de Sensorio-Motricité. XXXIIe Colloque (2 007) Collaboration - F Oger-Lavenant, D Lassalle & A CorbinDocument218 pagesL AMBLYOPIE. Cahiers de Sensorio-Motricité. XXXIIe Colloque (2 007) Collaboration - F Oger-Lavenant, D Lassalle & A CorbinFanny HazizaPas encore d'évaluation
- 7jours 190405 Toureiffel b1 ProfDocument4 pages7jours 190405 Toureiffel b1 ProfCoformation intergenerationnellePas encore d'évaluation
- Novembre 1954Document4 pagesNovembre 1954avatarchange2Pas encore d'évaluation
- Les Sujets de La Recherche: Questions Didactiques: To Cite This VersionDocument145 pagesLes Sujets de La Recherche: Questions Didactiques: To Cite This VersiontidjanigourdinPas encore d'évaluation
- These BervillerDocument102 pagesThese BervillerYoucef MimouniPas encore d'évaluation
- Optimisation de Tournées de Camions Complets Dans Le Secteur Des Travaux PublicsDocument171 pagesOptimisation de Tournées de Camions Complets Dans Le Secteur Des Travaux PublicsCoulibaly KhalilPas encore d'évaluation
- Panda 3Document226 pagesPanda 3Dwight AndersonPas encore d'évaluation
- Techniques Light v2.0Document46 pagesTechniques Light v2.0jmvictoria6870100% (1)
- Rapport 1Document422 pagesRapport 1adel.aissiou01Pas encore d'évaluation
- Caractérisation Du Comportement Au Feu Des Matériaux These - ChloeVincent - 15112016Document229 pagesCaractérisation Du Comportement Au Feu Des Matériaux These - ChloeVincent - 15112016moustafa hadj-doulaPas encore d'évaluation
- Athena 245 PDFDocument52 pagesAthena 245 PDFGeogrios GladitisPas encore d'évaluation
- Analyse de La Performance Hydraulique Dun NouveauDocument270 pagesAnalyse de La Performance Hydraulique Dun NouveaukadaPas encore d'évaluation
- 7jours 190405 Toureiffel A2 ProfDocument4 pages7jours 190405 Toureiffel A2 ProfCoformation intergenerationnellePas encore d'évaluation
- Experimental and Numerical Study of The StabilityDocument305 pagesExperimental and Numerical Study of The StabilityFaissal El KhazantiPas encore d'évaluation
- Mmoire de Thse PUIGDocument206 pagesMmoire de Thse PUIGlili loulouPas encore d'évaluation
- These GuimbretiereDocument140 pagesThese Guimbretierebobmahamba488Pas encore d'évaluation
- These - Évaluation Du Potentiel Éolien Offshore Et Imagerie SatellitaleDocument128 pagesThese - Évaluation Du Potentiel Éolien Offshore Et Imagerie SatellitaleBreardPas encore d'évaluation
- Coppolani Marie-Laure VavdDocument349 pagesCoppolani Marie-Laure VavdAshok PavelPas encore d'évaluation
- LLB 2022 0110Document2 pagesLLB 2022 0110Sebastian SerafinPas encore d'évaluation
- Cours Fondations Des Ouvrages PH Reiffsteck 2009-2010 PDFDocument80 pagesCours Fondations Des Ouvrages PH Reiffsteck 2009-2010 PDFmathy_martin0% (1)
- Letravailintelle00payo BWDocument296 pagesLetravailintelle00payo BWfisico gamerPas encore d'évaluation
- Guide de La Recherche en Logique Methodologie en FranceDocument216 pagesGuide de La Recherche en Logique Methodologie en Francelukasesane100% (1)
- Pras Olivier 2011 VFDocument261 pagesPras Olivier 2011 VFATTAH Régis Patrick AusséPas encore d'évaluation
- Fragments de Science - Volume 2 - Corinne Labat Carlos de MatosDocument83 pagesFragments de Science - Volume 2 - Corinne Labat Carlos de Matoslulucf11Pas encore d'évaluation
- LAMPEA-Doc 2009 - Numéro 30 / Vendredi 11 Septembre 2009Document24 pagesLAMPEA-Doc 2009 - Numéro 30 / Vendredi 11 Septembre 2009LampeaDocPas encore d'évaluation
- Développement D'éléments Finis de Coque Pour Le Calcul Des Ouvrages D'artDocument193 pagesDéveloppement D'éléments Finis de Coque Pour Le Calcul Des Ouvrages D'artPierre BICABAPas encore d'évaluation
- Memoire S.jegouDocument188 pagesMemoire S.jegouMohsaidBouamrenePas encore d'évaluation
- Sengele Armelle 2015 ED222Document227 pagesSengele Armelle 2015 ED222kaltoumPas encore d'évaluation
- Rebreather Diving Introduction, FrenchDocument41 pagesRebreather Diving Introduction, FrenchSusan Coleman100% (1)
- VD Siecinska JoannaDocument637 pagesVD Siecinska JoannaAdam NowakPas encore d'évaluation
- These Julien PayenDocument258 pagesThese Julien Payenyounes zekkourPas encore d'évaluation
- These JDRollierDocument246 pagesThese JDRollierRamsPas encore d'évaluation
- Études Sur L'histoire de La (.) Terson Albert Bpt6k5623494cDocument54 pagesÉtudes Sur L'histoire de La (.) Terson Albert Bpt6k5623494cnasserPas encore d'évaluation
- Thèse Complète SC2Document855 pagesThèse Complète SC2kabam5734Pas encore d'évaluation
- CNESMAG50Document76 pagesCNESMAG50hagamokPas encore d'évaluation
- Leçon Inaugurale de Ian HackingDocument11 pagesLeçon Inaugurale de Ian HackingSimone AvilaPas encore d'évaluation
- ThA Se KoutiriDocument244 pagesThA Se KoutiriHarb KamalPas encore d'évaluation
- Les Zolithes Un Nanomonde Au Service de La Catalyse PDFDocument278 pagesLes Zolithes Un Nanomonde Au Service de La Catalyse PDFRamsPas encore d'évaluation
- Le Bahers Tangui - TheseDocument222 pagesLe Bahers Tangui - Theselyes TargantPas encore d'évaluation
- 28576.preview FileDocument20 pages28576.preview FileChebbah MahmoudPas encore d'évaluation
- La Science au présent 2018: Une année d'actualité scientifique et techniqueD'EverandLa Science au présent 2018: Une année d'actualité scientifique et techniquePas encore d'évaluation
- Optimal Control of Differential Equations With - oDocument158 pagesOptimal Control of Differential Equations With - oนนฐ์ทกร บุญรักชาติPas encore d'évaluation
- HHHHJHDocument9 pagesHHHHJHJihane BenhaddouPas encore d'évaluation
- Solution Serie 3Document12 pagesSolution Serie 3Chaoune MedPas encore d'évaluation
- Conseil Des ImpotsDocument397 pagesConseil Des ImpotsBODRICK MABELAPas encore d'évaluation
- La Chine Ses Symboles Et Ses Fêtes NationalesDocument9 pagesLa Chine Ses Symboles Et Ses Fêtes NationalesViktoriia RybiakPas encore d'évaluation
- 4 - Roues de FrictionDocument8 pages4 - Roues de Frictionesloch100% (3)
- TestsDocument2 pagesTestsMohammed BoumlikPas encore d'évaluation
- PH 3 - Energie CinitiqueDocument8 pagesPH 3 - Energie Cinitiqueayoub hannatPas encore d'évaluation
- Snitem Synthese MDR 2018 ReglementationDocument13 pagesSnitem Synthese MDR 2018 ReglementationGgggggggggPas encore d'évaluation
- Radware IG Feb 2011Document196 pagesRadware IG Feb 2011Diego Germán Domínguez HurtadoPas encore d'évaluation
- Hortense CVDocument2 pagesHortense CVHortiis bb AgbassanPas encore d'évaluation
- Diaporama CCF-LV Partie1Document17 pagesDiaporama CCF-LV Partie1LorisPas encore d'évaluation
- A3 GénéralitéIntroDocument3 pagesA3 GénéralitéIntroDany Defossez-anceauxPas encore d'évaluation
- CPHY-221 Loi de Boyle-Mariotte Fiche ProfesseurDocument8 pagesCPHY-221 Loi de Boyle-Mariotte Fiche ProfesseurEl YassirPas encore d'évaluation
- Latin TechniqueDocument16 pagesLatin TechniquebougetPas encore d'évaluation
- ModesteDocument41 pagesModesteFrançois DemanoPas encore d'évaluation
- Etude de Linfrastructure RadierDocument14 pagesEtude de Linfrastructure RadierChawki ChawkiPas encore d'évaluation
- Isoupdate Oct2012Document23 pagesIsoupdate Oct2012BILELCFAPas encore d'évaluation
- Les DividendesDocument3 pagesLes DividendesmouniaPas encore d'évaluation
- Referências - GréciaDocument12 pagesReferências - GréciaMilena TarziaPas encore d'évaluation
- Ethique Et Soins Infirmiers: Novembre-Décembre 1993, Paraît 6 Fois Par An, 103e AnnéeDocument24 pagesEthique Et Soins Infirmiers: Novembre-Décembre 1993, Paraît 6 Fois Par An, 103e AnnéeBalemboyPas encore d'évaluation
- Diaporama Après La 3eDocument25 pagesDiaporama Après La 3eAymeric PochonPas encore d'évaluation
- X - 4 (Avec Bruitage)Document245 pagesX - 4 (Avec Bruitage)eauregalePas encore d'évaluation
- La Sécurité Humaine en Afrique de L'ouest: D: Éfis, Synergies Et Actions Pour Un Agenda RégionalDocument56 pagesLa Sécurité Humaine en Afrique de L'ouest: D: Éfis, Synergies Et Actions Pour Un Agenda RégionalKoutoua SamsonPas encore d'évaluation
- Corr 01Document4 pagesCorr 01vexin2170Pas encore d'évaluation