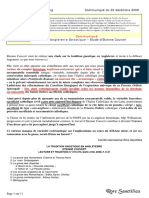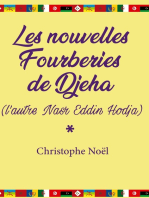Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Abel-Rémusat - Foe Koue Ki
Abel-Rémusat - Foe Koue Ki
Transféré par
ingmar_boerCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Abel-Rémusat - Foe Koue Ki
Abel-Rémusat - Foe Koue Ki
Transféré par
ingmar_boerDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chi Fa Hian.
@ - Fo Kou Ki, ou Relation des royaumes bouddhiques, voyage dans la Tartarie, dans l'Afghanistan et dans l'Inde, excut, la fin du IVe sicle par Chy F Hian. Traduit du chinois et comment par M. Abe.... 1836.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet 1978 : *La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits labors ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accder aux tarifs et la licence
2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss, sauf dans le cadre de la copie prive, sans l'autorisation pralable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservs dans les bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signals par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de rutilisation.
4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est le producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du code de la proprit intellectuelle. 5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue dans un autre pays, il appartient chaque utilisateur de vrifier la conformit de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en matire de proprit intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition, contacter reutilisation@bnf.fr.
I9S3
PS
FOKOUK ' 6 AU RELATION DES ROYAUMES BOUDDHIQUES
PAR
CHY
HIAN.
INTRODUCTION.
Tant aux
de
considrations qui ont
de l'ordre donn lieu
le plus
lev-
se rattachent premire unes obscures, discutes et et
croyances du
la composition les
originale les autres
FO KOU KI ; tant fait nouvelles,
de questions, ont qui t
tout dans
souleves,
claircies qui y sont
le Commentaire
y est joint;
les particularits
touchent aux subtilits d'une rapportes mtaphysique si abstruse, aux rveries d'un mysticisme si raffin ; elles expliquent tant de contradictions, rectifient tant d'erreurs, que lorsque, par des circonstances aussi funestes un esprit ordinaire qu'imprvues, s'est une mme trouv sphre l'ont appel aussi les rsumer, inopinment des ides transport dans
leve
au-dessus
communes,
ses efforts et de son comme quand, de soi ! et t lui-
ramen : fatale
tout
le sentiment qui dont on jette de s'est
de sa faiblesse empare
insuffisance cette d'une espce hauteur ne
impression,
de lui
d'blouissement considrable, serait pas la
on ne peut les yeux
se dfendre au-dessous s'il lui et d'en
Telle permis mme
la position dernire main
M. Rmusat ce livre
de mettre l'introduction. traiter
crire
Habitu d'une esprit
des sujets
qui
demandent de la plus embrasser
toutes rare dans
les ressources sagacit, leur son
rflexion avait
puissante assez d'tendue
et l'emploi pour
ensemble
ii les opinions dans indiennes leurs tempre raisonne, et par d'une ne peut
INTRODUCTION. et assez de force Son pour les faire apprcier vive, la critique dans que toutes mais la
jusque cependant mieux les
moindres par tait des
rsultats. un jugement
imagination et par chercher
svre pour
assez
patiente aussi qui
sources,
procds
ingnieux
l'interprtation gence humaine
doctrine atteindre.
a tent
de s'lever
multiplis, o l'intelli-
Et soit que, la considrant dans ce qu'elle a de purement il et cherch pntrer dans spculatif, ce sanctuaire tout de mystres et de symboles o elle a comme enferm il l'et la religion considre ; soit dans que, se plaant avec son que, sur un presque influence s'attachant sparer dans terrain tous sur plus solide,
ses rapports et dans
les systmes la civilisa en sonder l'absurde et faits
de la philosophie tion des peuples
orientale, de la haute en peser rationnel, soit enfin
Asie ; soit le fort il l'et que,
les profondeurs, de dans qui tion ce qui tait
et le faible, observe
sa sublimit des
ses carts; ont
se bornant
l'exposition
ses progrs accompagn des causes il faut auxquelles depuis bords l'Hindoustan du grand
et sa dcadence les attribuer, o elle Ocan
et l'apprciail l'et suivie dans et o elle s'est Japon o elle
sa propagation, teinte, a t on et jusqu'aux adopte; retrouv des faits
est ne
et jusqu'au
de quelque manire son sujet, qu'il et envisag dans le rsum offert cette critique qu'il aurait gnraux, cette tous n'auraient t sans sans mystres. et eu consciencieuse rudition ces pour sans ces les les dans des faits
leve de dtail de la
qui distinguent
ses crits. eu rien
Philosophe, de cach
antiquits lui; les
mtaphysique auraient
dogmes
extravagances, Historien, celle rien plus des de
les allgories l'origine peuples vague; de qui dans
voiles, opinions
les initiations converties brasses, plus en
croyances plus
ont
em-
n'auraient dans
traditions les vne-
de fables,
les dates
d'incertitude,
INTRODUCTION. ments rgions auxquels l'rudition, rassemblent plus de confusion. Comment oser s'lever conduire toutes moins les
m ces jusqu' ! Les points de parties de l'Asie, la
inaccessibles il faudrait intressent
o lui seul s'arrter
et pu nous embrassent les
les peuples les plus grossier
connus
les notions
contradictoires et l'idalisme de que
et touchent
fois au polythisme Que l'on parcoure
le plus le que
le plus sublime. sur tendre le FO bien
Commentaire cet aperu, on dans un intrt ici, un
M. Rmusat j'aurais pu toute tant
KOU KI, on verra davantage, de runir pars quelle n'a rien
d'exagr;
comprendra seul cadre
la difficult de documents
et de rapprocher s'attache
auxquels rserve
si vari, au lieu
et l'on des que
apprciera pages sa plume qu'
par
on ne trouve de de l'histoire simples est venue
dune
les plus aurait deux
intressantes trace, reprises Mais, que
de la philosophie dtails sur une
publication
la mort
auparavant,
interrompre. qu'il me soit permis
de jeter prsent
un
coup claircir doctrines
d'oeil un et y
sur les efforts des points des peuples. a prise, rcents peut et
qui ont t tents jusqu' rests les plus obscurs dans Quoique celle qu'il des de l'on connaisse
pour des
l'histoire
et la part assigner
que M. Rmusat dans les progrs
convient livres propos faon
de lui
de l'tude hors
et des traditions
bouddhiques, travaux
il ne ont
paratre
prcd KI. En
et en quelque de telles matires,
ici quels de rappeler la composition prpar
du FO KOU il ne suffit
le mrite, pour bien juger a produit, il faut surtout pas de savoir ce que le mrite et les obstacles les facilits d'aprs qu'il a pu rencontrer fallu vaincre.
le mesurer qu'il lui a
Il y a vingt Bouddhisme,
ans,
quand
M. Rmusat aucun modle
commena suivre;
s'occuper ni conseil,
du ni
il n'avait
iv secours esprer. Cette
INTRODUCTION. religion clbre n'avait encore t l'objet
dont les rsultats se bornaient d'essais, que d'un petit nombre des rapprochements On hasards ou des conjectures tmraires. s'tait peu occup de ses abstractions morales et mtaphysiques, ou ceux qui avaient t tents d'y jeter les yeux avaient, les uns renonc, souvent dent rente les autres elles aucune et qui sont mal rendues russi par qui nous des les faire connatre. Trop
expressions
qui ne correspond'une manire diff-
des ntres, sont autant
se groupent
de mtaphores
prises
d'objets
matriels
notre langage que ceux qui ont servi former figur. Le vide pour Yesprit, Yignorance pour la matire, Iapparence les cinq pouspour le corps, les cinq racines pour nos organes, sires pour nos sens, les cinq amas pour nos facults, et une infinit d'autres termes si loigne du mme du cercle genre, ordinaire doivent tre pris dans que des une longtextes.
ou sensibles
autres
acception temps Ce n'est
de nos ides, la plus exacte
elle a pu rien,
chapper
l'intelligence
en pareil les radicaux, il cas, que d'entendre quand savoir quel sens abstrait reste encore ou dtourn on a attach, soit par convention, tel ou tel driv. soit par caprice, Pour absurde ciation tout tait ne s'tre arrt qu' la signification on n'a pas l'ide littrale et souvent dans l'apprcause Bouddha le nant qu'une de
de ces expressions, du systme
su dmler, d'une que c'est comme la
bouddhique,
double loi de
ce qui existe, et l'on a prononc une loi de nant, que s'y conformer, principe illusoire. tait de l'tre, et les tres
admettre n'ayant
comme existence qu'il
Un tel nonc, un avertissement
et la rigueur qui
des consquences d engager plus de ce lanpresque mais
entrane,
aurait
autre moins directe, quelque interprtation On aurait raisonnable. t conduit alors faire sortir gage nigmatique un ensemble rationnel d'ides oppos
chercher
INTRODUCTION. en tout point au nihilisme systmatique que l'on avait reconnu
v de
prime-abord. Cependant, Indiens que dont d'une A vrai ceptions nuer l'on elle il faut en convenir, dans par l'objet. d'autant bizarres, qui les toute une l cette antique tellement plus sagesse des
est comme a pu tre
ensevelie dtourn d'tre
idoltrie de l'examen
trange, approfondi esprer
mritait
Quels
enseignements et de
doctrine dire, les
entache rcits
d'extravagance inventions taient qu'on s'en digne sans
draison? les conpour attAussi
ridicules, peu tait faits
fantastiques l'opinion qui
y abondent,
en rien
dfavorable ne la jugrent presque malice
forme.
les missionnaires, srieuse, dclare temps l'ont-ils le comble des
d'aucune L'un
rfutation d'eux En prix, mme dans les les de la
rejete de la
examen.
rduite
en quintessence. trouver des armes tout
philosophes, annales ses
qui voulaient humain, ou qui
premires bases de
du genre
croyances, qui
appartenaient
pour renverser cette classe que peuple par
littrateurs rerie source grand plusieurs l'Asie, fut
ne se sauvent y voir les le culte
de l'insignifiance d'un des qui, prtendu deux depuis zls qui dans
la bizaret la tout compte de de le ce
, pensaient de toutes systme
primitif Ainsi ans,
religions
continents. deux mille
de philosophie de sectateurs et par ceux que
millions mconnu
diffrentes
parties faute
ceux qui les
le condamnaient sans le
comprendre, mieux, par dont vaient poser M. aux un mais travers
et par parce d'esprit
l'admiraient, autres commun, pour l'avaient on
comprendre Alors, une qui vrit lui serim-
condamn. abandonna
assez
la recherche de voile aucun Rmusat causes et
tait et qui,
difficile, en
les mensonges ne semblaient
apparence,
devoir
effort sut
l'intelligence. le remonter il sut des effets
en France premier ]a mtaphysique; de l'idoltrie
distinguer
vi la doctrine de la extrieure,
INTRODUCTION. qui n'est qui de Dieu, des vagues des qu'un consiste l'esprit phnomnes polythisme dans oppos allgorique, dogmes et d-
doctrine tels que
intrieure, l'unit physique notions
quelques
simples, dans
la matire, il sut et
l'explication dans mille mler, l'exagration
naturels;
et incohrentes, un enchanement bonnes
travers d'ides
et l'obscurit dont d'arrter en fussent De bonne avait preuve
termes,
et de propositions, mritaient que les au sens philosophie de l'admettre tude seules noncs commun. chinoise sans des
les consquences, l'attention souvent heure, son de la des plus
ou mauvaises, clairs, et indienne encore contraires sur loign la pale conl'avait fait la
des hommes draisonnables l'influence attention. rejeter
attir ou
Egalement sans examen, svres, qu'on ne
tiente duisirent encore, moins pour
faits,
l'habitude avec qui
dductions
approfondir, ces doctrines
de succs
semblaient et
impntrables. aux crmonies
Il accorda du leur qu'on l'tendue les peuples ; adoptes, Siamois, les culte, impory redes du
d'attention
la mythologie des carts
davantage s'occuper non sur les tance, plus marque, rgions monde avec mais qu'elles les plus quelques relativement se sont intolrants, modifications, au que
opinions, ou les
et il mesura singularits et chez
leur soumises.
antiquit Tolres
les Chinois chez Tibet, celle les
et les Japonais Birmans, les les
Anamites; orientale, qui elles
naturalises il n'y soient les plus a plus
de toutes qui leur ont
nations
de l'Asie chez de six
a donn fait, depuis
naissance prs
mconnues; grands adouci presque rendu progrs leurs
elles chez
sicles, elles de tarie, gations ont leurs
les peuples et, fixant tribus
de race dans
mongole; les limites de la Taragret,
chang, steppes ont
moeurs, les
toutes
nomades ces
elles qui,
jamais de la Chine,
impossibles
formidables de tous cts,
du nord
se rpandaient
INTRODUCTION. se grossissant et menaaient pays grands bien des peuples l'Europe. ni d'aucune vnements, examins pour comment ne s'est et vaincus, Etrange poque d'aussi en dtail; de faisaient rvolution, n'offrent tonnantes c'est trembler dont l'Asie les
vu entire annales Certes, mrisujet philo-
d'aucun d'aussi taient de
d'exemple! vicissitudes l un assez pour
d'tre
vaste le
recherches voyons
l'historien,
mditations
sophe;
il a t compris. occup des tartares. de la religion faits qui la Une mais les ides fois trop de Bouddha concernent seulement systmatique, qu'incidans les
Deguignes demment, annales soumettre tait dhistes heureuse. les des propre, , et l'on
l'occasion
des principauts l'analyse les
il a voulu qui lui des Boudd'avoir dans t
scrutatrice, et cette
traditions que
particulires est loin
sait
louable autres,
tentative
Georgi
et quelques qu'une gloses
qui ne voyaient du christianisme, que/Bouddha rfuts divinit Pallas, par
toutes
mythologies textes et des
corruption pour prouver
entassaient tait le fonde tout
dateur
du manichisme, qui, Scandinave. lui,
et ils taient en faisait une
le P. Paulin ou
S.-Barthlemi au moins
grecque, ou plutt
Le P. de la Penna, le judicieux que choses
Joerig,
son interprte, n'ont gure
Bergmann, vu du Bouddhisme
lui-mme, Deshauterayes et l encore ses fictions; on a au srieux; des romans des mythes mytholo-
eu le tort ridicules giques fanatiques mot, gine pntrer figure. grossiret on n'a d'une
de prendre ont pass pour
les
trop
des articles
de foi,
pour
les rcits pour pas fable les t ou
de l'histoire, enseignements plus d'un relle que habile
et les conceptions de toute une pour remonter qu'on allgorie ne qu'au peut lieu ne ou
de quelques en un secte; oripour
la vritable l'avait d'une t
symbole d'une la raison
la C'est
valeur parce
expression de Ja
s'accommoder de prter
de pareilles
inventions,
aux nom-
vin breuses folie on qu'il devait populations ne convient n'y voir mme ou pour d'offrir des cette du sujets cause,
INTRODUCTION. chez qui elles sont en faveur un degr de
pas d'attribuer que des crations mais
lgrement d'une faites
ses semblables, imagination bizarre, pour voiler
dsordonne un dogme avantage templatifs C'est
si l'on enrichir
veut, une
dessein et qui avaient et aux
lgende,
le double esprits con-
merveilleux de mditations. jusqu'ici
au vulgaire,
peu et rapide
remarque extension C'est
je crois, dans
que
le les
Bouddhisme contres loir daire, nale,
a d
sa grande
toutes
o le proslytisme chez en mme temps comme et chez le sont ceux
l'a port. des
les tribus
peuples turbulentes
l ce qui l'a fait prvad'une civilisation seconde l'Asie septentrio-
les Chinois, se sont levs, qui, comme par la culture des lettres et la pratique des arts, au rang des nations les Mais c'est l aussi ce qui l'a fait proscrire des lieux plus polices. mmes de son origine, ce qui lui a attir les perscutions d'une secte, cette d'offrir folies son ane patrie seule, idoltriques et sa rivale, de tant jalouse d'ides de rgner sans partage dans cts toutes refusaient et les
primitive des
rpandues et
de tous dchues,
populations ftichisme
nerves que
d'un
les Bouddhistes
de reconnatre. pour le fond des aux par
La diffrence deux
qui en est rsulte, mais encore
non-seulement pour tout culte, qu'il ce qui n'a pas a condans
doctrines,
se rapporte t aperue
particularits Deguignes, indienne,
de l'un dans les
et de l'autre trois mmoires
sacrs
la religion d'erreurs
et cette
confusion l'a trop avant sur
l'a entran souvent suivi. re, de de sur divisa l'une toutes
un ddale Ce Indiens, divinits autres; sur
o M. de Bohlen qui, un sicle
schisme ne de
fameux repose la pas
notre
les des les la
uniquement primitive, accorde
l'adoption
religion
l'exclusion Bouddha
la prfrence
Brahma,
INTRODUCTION. doctrine lition relatives formes duction distinctions conues des nous n'avons autorits seurs sociale rarchie, s'taient Gange dirent les s'est des de Shkya : elle sur celle des Vdas; aussi sur sur une le maintien suite
ix ou l'abo-
castes l'me,
se fonde facults,
de distinctions aux
ses
sa destine,
sa runion
corporelles des tres, si
et leur
dsunion,
l'manation des mrites de force
et la pro; ont sur pour nous et des dfenla vie de hiceux rives : ils les livres qui du
aux consquences que gare rflexion difficiles les tudier
et des dmrites ceux qui les
subtiles,
l'imagination la premire est saisir,
souvent o plus la
de mditer distinctions longtemps
matires d'autant
impuissante; que pendant que
eu, pour
et les juger,
des documents autant avantages une de sorte que de
brahmaniques. intresss d'une sont, les depuis Brahmes d'eux
Partisans thocratie trois ne mille
fanatiques, o ans, tous les
soumis pas caste, aux
se contentrent
forcer les
spars pour leur aller haine
quitter leur leur croyance porter
fuir trangers sur exposs,
teno
intolrante
et toute-puissante nouvelle dans taient lequel ces originales des
principes jusque
mme
de la religion sur l'idiome de elles ces n'ont ont
et peut-tre taient chapp crits. la
livres ont savants
Si quelques-unes proscription, qui, les
compositions pas t pris connues
de Calcutta institutions et
premiers, Le docteur autres, rendre
tche
d'interprter
les
indiennes. plusieurs bon droit
Buchanan,
M. Colebrooke, que leur
M. Hodgson origine hors pouvait
rduits suspectes, pu
des notions ou furent
entrans dfinitivement
de la route sur des ides avaient
de la vrit, qu'ils intrt accumul aux Indiens ne
ou n'ont
prononcer que Le que par le
connaissaient dfigurer. d'erreurs qu'il
rapport Wilford,
de
ceux par
qui
les tant
capitaine pour et avoir qui,
accord par une
n'a exemple, trop de confiance pieusement
consultait
fraude
x complaisante, ce qui y tait,
INTRODUCTION. lui faisaient que ce trouver qu'il de des dans dsirait nous les textes y mettre voir. en sanscrits, M. Rmusat garde contre a fait entremoins n'a le
nglig tmoignage voir enfin toire nous les
aucune des
occasion ennemis
Bouddhistes, ce
et il nous qu'il Mais rendre
la possibilit dans
de distinguer les ne deux doivent labeur, doctrines. pas
y a de
contradicque envers notre un but
et d'oppos avons hommes
les richesses ingrats fonder vers
acquises qui, par reste
nous ont
leur
contribu diriges
fortune; qu'il
il leur
l'honneur d'eux ont avaient
de tentatives d'atteindre plus modifier ont de
n'a pas
dpendu qui qu'ils
compltement, quelques
et les gards constat ont moins clairer exig rare. de le aclopLow, ont infades sicle,
renseignements les rsultats
permis
de
obtenus premire
suffisamment travaux qui non venus
d'ailleurs des
l'intrt
et l'utilit peu
connaissances Sir Alex.
communes et M.
et une Schmidt tout
sagacit sont n'tait
Johnstone ce sujet
quelques premier tive MM. de
lueurs en la
o nagure dans l'le une et le plus
qu'obscurit, cette patrie
dcouvrant secte et
de Ceylan, mine que
perscute, Mahony,
le
capitaine M. Upham, avec une
Joinville sans
rcemment en Rappliquant
exploite tigable Mongols se sont naire
l'puiser;
second
persvrance tout ce qui
extraire tient aux ides
des
monuments qui,
littraires au xme
religieuses La
rpandues mongols du dont, mme
parmi
les Tartares.
grammaire
et le dictionles sur
en outre, genre sont que dans que des
on est redevable M. Csoma services
M. Schmidt, a publis ne
ouvrages la langue
de Krs dont qu'on l'utilit
tibtaine, il est vrai, tre
repose qui
encore, ne rale celle saurait
l'application aujourd'hui
en fera,
mais
douteuse, qui et par unit la
surtout
confraternit de Paris,
la
Socit
par la libque, de Calcutta asiatique M. de Schilling, nous
munificence
de
INTRODUCTION. sommes livres devenus tibtains Les au style ceux commenc surmontes; de le Tibet, le matriaux l'Inde au possesseurs et mongols difficults de des ces du qui qui deux Gandjour ne nous et d'une laisse rien collection envier la
xr de aux gramsorte
trangers. maire, devenus avait comme ensemble golie, d'o
tiennent idiomes, ces
l'criture, qui sont
en quelque que
Bouddhistes, lever, et, peuvent comme auquel del du
difficults tre
M. Rmusat considres comble cet la Moncontres
dsormais mettre le
pour
contribuent Gange striles offrir M.
la Chine, et Ceylan, pendant une les
Bouddhisme elles-mmes faits dans dans les
a t devoir
banni, nous
longtemps, moisde d-
semblent son de
abondante vient
documents et qui trouv sont une crits a dj anglais aux au
que tels
Hodgson
couvrir poser
que
le Npal, l'on a enfin Bouddhistes tendue rsident accessibles
qu'ils
permettent
de supdes livres dont la lipartie Socit a conquelque d'esjour des idiome sur quesont De con-
portion en sanskrit.
considrable Ces
originaux une bralit du moins,
des
ouvrages, par en la
collection du
envoye seront
Londres bientt, puisque M. Hodgson, Mais de
Npal,
savants des copie de
franais, offres ces de
asiatique sacr ct prer les tions t des qu'on que origines les rdigs
de
Paris,
profitant pour la
fonds
textes.
en obtienne l'tude du plus les qu'on
l'explication, en fera et celle originaux jaillit de sur et certains, doit esprer que,
on ne peut ne jette notamment savoir dans le plus sur
s'empcher grand une quel
Bouddhisme, curieuses, livres
toutes jectures nous plter un
parts
la lumire
lesquels les secours
repose arrivent;
ce culte. des
plausibles, sont offerts, tendre, aussi
des faits et l'on
des documents beaucoup, dans a fait
authentiques pour les com-
et les esprit
des progrs
ces dernires faire en
annes, France
judicieux
qu'habile
XII l'tude dans du sanskrit,
INTRODUCTION. en le rapprochant des pris tous autres naissance dialectes dans qui, l'Inde s'apla-
ont successivement l'antiquit, et dans les contres voisines. Sur nissent, Mais il ne si les s'agit plus que les seul
les points
les routes
de les parcourir. taient sacrs, pour crits jamais dans sa taries, l'idiome doctrine sortir des
sources plus un
s'il ne restait mme aux que hommes,
plus pures de ces livres choisi
la divinit
avait
pour
transmettre encore
ou s'ils ne de la Chine
devaient et du Tibet
de longtemps o ils sont dans ceux-ci
monastres rcusait manes
conservs; des
si l'on Brahmatres
absolument postrieurement dans
les textes
rdigs o
la langue sont rests
l'poque l'Inde; si l'on pas
de la religion singhalaises mologie n'tait nant natre comme des plus aux la
se plaignait de remonter la langue les hros, racines de
de ce que l'origine de des manire la
les versions ou l'tys'il
ne permettent termes possible dieux, aux qui d'y
constituent retrouver aux
religion; apparte-
noms en
saints,
recon-
signification; offrant quelques et trop en ceux
si l'on
les livres des Tibtains rejetait diffrences dans les classifications cosMongols et des cause lgendes prtendait mlange primitive ces plus de leur date qui la y comont docni de dans imles
mogoniques, parativement t trine introduites;
des
rcente un tout mot,
nationales retrouver de et
si l'on sans
de Bouddha trangres, originale, sur d'tre
entire, dans
formules presque faites
traditions sa langue mdiatement mots, nances avant
sa puret encore saints les sont
il resterait les livres
traductions authentiques, par des
interprts, presque toujours sont t tout
reproduits
conson-
analogues
reconnaissables, conserves, par et les qui,
o les formes ds la Pour elles plus la sup-
grammaticales haute antiquit,
elles-mmes nous exacte ont de
transmises le systme
Chinois.
connaissance
bouddhique,
INTRODUCTION. plent comme avec avantage de une de l'absence ce qu'on srie peut des meilleures en autorits, ce genre,
xm et on
exemple
y dcouvrir trop collections que, et de
a de M. Rmusat D'un des pour auteurs se sont YHistoire ressants dates les autre et ct,
de travaux
tt interrompus. historiques dans leur la gographie, ou qu'ils fixent ddain les ne Dj d'int-
nombreuses des la
dterminent de ont trop
positions
procds indiens
chronologie souvent nglig
d'exprimer, de supprimer savante
pas
fait
scrupule avait
de dnaturer, montr l'Europe
mme. combien
des Huns souvenirs
et quels
prcieux dans
dbris
des traditions chinoises. boulevers
primitives On avait les ementre sicles que des leur plus
de la haute pu y prendre pires, la mer avant mers dplac
Asie sont une
conservs
les annales qui ont
ide
des rvolutions et mlang oriental.
les populations et l'Ocan les Chinois, opposent Jaxartes que par
les races On
d'hommes deux
Caspienne notre de sable re,
y voyait, la
franchissant du et, l'Oxus. ct de
barrire
leur
l'ouest, de J. C,
tendre n'tre s'est
domination spars raconter Les
jusqu'au de la Perse les principales
au temps Mais
Deguignes
born
circonstances et fut les tour
de ce grand longues tour
fait historique. la et les suite
expditions cette toute
nombreuses extension son
guerres, forme a entrevu
desquelles absorbrent compris
dtruite, causes,
attention,
et s'il en
les consquences, d'une ou il les a nonces ses recherches rigoureuse d'autres tails lui sont personne Dans son plus et dans faits, neufs, ainsi avant un
il n'a pas su les distinguer manire trop vague. avec
clairement, poussa plus
M. Rmusat une mthode
et les appliqua,
esprit moins systmatique, de sujets qu' la discussion qu'ils sont puiss des
la dcouverte dont sources tous les d-
parce
qu'avant
n'avait ouvrage
explores. sur les Langues iartares, il ne se contente pas
xiv de soumettre dont Ce sujet, tendu;
INTRODUCTION. d'ingnieuses aucun quelque il s'en secours, vaste empare les rsultats, les des par pour thories en Europe, et difficile fortement, parties, fait les lments n'avait qu'il soit, pu constitutifs lui donner
d'idiomes la clef. pas trop
il ne le juge calcule toutes les du
il en succder avec
les ressources, aperus, savoir geurs celle ment. encore ce qu'il et
en lie toutes les
aux faits les armes des
aux aperus de la raison
et renverse
observations
superficielles L'histoire
voyatient facilecritique :
et les prjugs des peuples
philosophes. des les liens dont
des langues chappe plus de
la tnuit faut-il que
Peut-tre, que faut
dbrouiller, plus de rflexion porte remplacer
d'rudition, surtout, qualit de dnouer. important des les qui calculs
d'imagination et sans de jugement laquelle on
c'est ne
une peut
d'esprit et
qu'aucune tranche et non
autre au lieu moins de rois,
Il y a l, saisir de que
en effet, des
un fil plus d'clipss, dans du mais
difficile des l'tude temps elles re-
sries Comme
suites
gnrations.
de l'histoire, et de l'espace doublent le hasard des usages
difficults nous quand avoir
augmentent loignent il s'agt des d'idiomes de part
en proportion vnements;
encore semble
la formation que le raisonnement souvent du
desquels ; o ne lois
eu des
plus habitudes
variables,
locales qui
inconnues, ct en objet des
supplent de l'analogie guant,
qu'imparfaitement et de la rgularit des qui
ce des
manque
drivations. a prises des
C'est pour lments
distinde ses
dans
chacune le fond que
langues lui est
qu'il propre,
recherches, qu'on dance les les avec
trangers et la descen-
y a mls, des tribus
M. Rmusat
a su tracer Asie;
l'origine c'est en
nomades
de la haute de
rapprochant causes les de ces qui unes rap-
diverses produisent, les
natures qu'il et
d'altrations, suit qu'il les nations dtermine
la diversit dans mme leurs
des rapports
autres,
le genre
INTRODUCTION. ports. montre royaumes comme nent, yeux, parlent, primitif modifi Pour lui, les mots des par sont des faits au moyen de desquels presque
xv il nous tous les
l'histoire de l'Asie celle par le leurs gnie et le les de
Tartares
lie
celle
les doctrines d'autres et le
philosophiques peuples de celui dtourn reconnatre Sous sont dire pour de leurs des
et religieuses, l'ancien armes. hommes l'une de celles son qui contiA ses qui la tat on! le
beaucoup
migrations d'une langue
succs
constate qui ont pour autres. tropes, ainsi soit
rvolutions sur
mettent
la voie des les pour confiance, ou au
la situation
sociale
ce point des annales
de vue, secrtes
vocabulaire, que quelles cunes dcouvrir leurs pour sion les
la grammaire, peuples conservent avec
leur
insu,
et auxaux soit lapour de enfin
il des
recourt souvenirs la nature
suppler
silence
des des de
traditions, hommes, leur ou esprit; de leur
des
penchants la marche de leurs
l'tendue soit
moyens retrouver
intellectuels, les traces
conqutes et religieuse. religieuse, plus grand attacher
soumis-
morale, politique, Cette dernire cause, qu'aucune voyons-nous autre
littraire l'influence et sur un
agit nombre
plus
puissam;
ment aussi
d'individus dans
M. Pimusat des part, le
s'y
de prfrence, idiomes de moyens
l'examen Le
et la comparaison d'une poques et les plus
diffrents
de la Tartarie. l'autre, opposs, con Les
Bouddhisme des les ides durent
Musulmanisme et par des des
coururent, modifier Mahomtans et du tisme cap ne
diverses institutions
de conversions pieds la guerre rpandus parler venaient de
peuples au glaive
asiatiques. qu' leur Les au de
la parole, proslydu des de l'Asie.
de Racca s'tendit au Mongols, conqurants
jusqu'aux que par
de l'Himalaya, et le pillage. en foule
aptres milieu devoirs,
Bouddhisme, camps justice des aux
contraire, osaient qui
morale,
d'envahir,
de dvaster
xvi Dans nations lrant le principe, de race ne fit que tandis des autres une turque
INTRODUCTION. gale frocit se faisait : le fanatisme des unes et les place remarquer d'un chez culte les intoet turde
et mongole les les
renforcer que
dispositions sauvages faire
au carnage habitudes
la rapine, bulentes
moeurs pour
s'effaaient
l'uniformit nervante
la vie pastorale du climat que dans double
et contemplative, se ft paisible sur L'action peuples l'alphabet la conversion adopter leurs qui
comme
si l'influence elles
de l'Hindoustan la religion les
communique de cette tartares
en mme Il faut de re-
temps suivre cette
originaire les langues du lui jusqu' des
contre. les
Recherches
progrs fut
rvolution. H y a des depuis avant fait
Samanisme doivent la toute
surtout leur
marquable. intellectuelle, sieurs hindous toute tropole religieux, chercher Histoire naissance tres lorsqu'il sicles
culture Plu-
mtaphysique. les missionnaires croyances comme des la
Mongols, et leurs tait avec plus alors
avaient la Tartarie du
lettres
dans m-
mridionale. ; elle
Khotan entretenait des pays
Bouddhisme et les
l'Inde
rapports y
Samanens sacrs
orientaux
venaient En crivant de recon-
des livres de Khotan, et
et de pieux
enseignements. un en point
M. Rmusat qui lui
se prpare servira
de ralliement, s'occupera
dterminer que les
d'audoctrines
de reconnatre en se propageant. o avec tout la est secte
la route
indiennes A la tions
ont Chine
suivie mme,
immuable, nouvelle;
de elles
graves
innova
s'introduisirent
attaqurent Cette langue,
la fois les moeurs, faite uniquement et des
la philosophie pour voyelles ; cette aux les yeux, pour
et jusqu' dt
la langue. se plier les toute
reprsenter sons rationnelle n'en de
des
consonnes formules icius, aucune,
exprimer
certaines de Conenseignait ces
consacres indiffrente fut force
philosophie parce de
croyances
qu'elle
de s'occuper
dogmes
et de symboles;
INTRODUCTION. moeurs le fondes est furent par que sur en ordre nous, dont dont par n'ont l'introduction tant de preuves le dogme d'harmonie plus paratre le modle l'exemple est dans est dans Les par l'univers, les
xvn dont
principe
traditions sur les
antiques, incarnations, de Lao musat avait de tire, ne d
corrompues exemple, depuis sur
la superstition. t adoptes du son
ides les
sectateurs et M. R-
tseu
Bouddhisme, opinion que
a appuy recevoir
la
Chine
de l'occident du souffle ne peut en tat d'en en par plus
platonique qui unit
de la Raison, l'esprit qu' la maceux qui
l'Unit-trine, etc., quelle
paradoxale
seraient-pas Des
suivre
l'examen. inapprciables, ce qu'elles servi qu'on expliquer n'avait pas ont enregistres de positif certains souponnes, tablies. et rap-
particularits, soin et ramenes lui ont
apparence l'analyse d'une fois
avec
d'essentiel, ports, et qu'on Peut-tre, dernires les problmes dans les
constater regarde s'il lui
des concidences aujourd'hui avait comme
incontestablement suivre
t permis lui
de les
consquences, qui
auraient-elles aux causes
dans leurs jusque donn la clef de tous de et la migration de des l'Asie
se rattachent de des l'ancien
peuples avant
le nord
continent Ces pas en
l'tat que les
conqutes en le voit,
Musulmans. n'tait-on
esprances droit l'usage, de
la mort concevoir sous
a changes lorsqu'on le nom dhistes; tires leurs de
regrets,
successivement, Fan, la part d'un que
dcouvrir dialecte les sanskrit
la Chine,
de langue montrer leur
particulier prise, loin aux
aux Bouddes rcits dans fronde l'Asie
Chinois
ont
patrie,
des
vnements dans la Tartarie;
antrieurs constater, qui
premires
excursions
centrale, n'existent au milieu s'avancer,
l'tablissement plus, mme et tout
de cela,
colonies presque
hindoues son dbut
aujourd'hui la carrire, qui cherche
dans
des ttonnements les tnbres,
d'une sur
intelligence une route
travers
inconnue? c
xviii Un crit de en sept
INTRODUCTION. chapitres Alors qu'il avant sur la religion de Bouddha taient depuis. suffisamment loin fut d'avoir un le il sa on y derniers si avait ne que et le lui tre la gloire
ses premiers de
essais.
ses recherches leur a donn les avoir
degr explique pense reconnat temps
prcision les faits souvent
Quelquefois tablis;
de
y est dj
confuse, de toutes devaient
embarrasse, les ides recevoir qui, des
et cependant dans les
le germe
de sa vie surtout, Au reste, d'un point encore, pour ignor, nom
dveloppements de ce qu'il et qu'il
considrables. fait, pouvait l'on occup
M. Rmusat, de perfection jugea les son premiers un
mcontent qu'il travail fruits temps o qui
apercevait avec une
atteindre rarement rester
svrit
a trop
de ses tudes, il pouvait aurait fait
condamna utile d'un
dans une
d'attacher autre, mais sorte
son qui
production pas plutt dire de
ne suffisait ou rien
la sienne. de rserve, cette ne rien moindres son attention omettre de sur qui sont est mieux de ceux la si
Cette presque de certain,
de
timidit ne retrouve
religieuse qu'on
hasard, les
jusque remarquer dans Le tous terrain
dans
notices
M. Rmusat,
se fait surtout que
dans ceux sur les Averti
Commentaire ouvrages il s'avance que, l'exemple pour
le FO KOU KI , ainsi relatifs ingal assurer qui l'ont au Bouddhisme. et se drobe ses pas, prcd, d'tre dans juger,
de ses lequel pieds, par sur
si facilement calcule
sous tous.
il les
il est
continuellement comme eux, ou
ses gardes, leur mme n'est
dans suite. quand pas d'un
crainte Hardi il faut ignore que sante attendre
entran
de s'garer timide ce
ses vues,
mais
observateur s'il ne dit
exact, pas des tout,
quelquefois, pas assidues fcondes; plus mettre
qu'il jour puiset fera dans
; il ne veut des tudes
en avant pas son
connaissances qu'une sera
n'ont et plus il se croira
mries, autorit
rflexion respecte
n'a pas
de lui,
oblig
d'tre
consciencieux
INTRODUCTION. ses doutes, Jamais svre dans ses dductions, sacrifier rserv dans
xix ses jugeaux circonil les a du
ments. stances, tous nom aussi vrages plutt dans la
il ne consentira
ni sa raison car et
ni sa conscience dans s'est les progrs
ses intrts, de la science Avec qu'il peine?
ses intrts, dans
placs qu'il
la dignit
acquis
en la cultivant. s'tonner conus
rigoureux, bauchs, de tous
comment d'autres ceux qu'il qu'il
des principes littraires ait laiss plusieurs ouQue l'on s'tonne bien
a termins, lui a t donn l'infatigable les impressions
ou
seulement ; que de
entrepris, l'on ce admire gnie
le court courageuse
espace
de vivre
persvrance, toutes les
activit sans
habile par des
recevoir
se laisser
dominer par ! Qui dpo-
aucune, ides
et dont riches
moindres autant
productions que grandes
se distinguent et fcondes quel
et brillantes ? quel
a recueilli sitaire ou
son hritage
confident
de ses tudes, au but ajout
de ses penses nous conduira tout ce qu'il aurait nous rvlera se ft prolonge au moment avait les acquises les
qu'il allait atteindre, nos connaissances encore? profiter enfin Il a t un de avenir M. Pitoutes qu'il quasavoir, lier le en
si sa carrire musat
quelques de nous
annes faire
a succomb qu'il sur ans, talent, en
les richesses avait tabli
et de raliser plus solides. de
bases
rante-quatre de son
dans se
toute mettant
la force
son
ge,
frapp de son pour
peine tant
l'oeuvre de travaux
faisceau silence, Un tredit Khian Bouddha idiomes 1812. Il
de ses recherches et qui des ce plus recueil, o sont rests
et excuter ou indits
mdits
ou inachevs. ces derniers, les relatifs les cinq est yeux au sans mme culte conde de
regrettables, compos les mots
parmi par ordre et les
et sous phrases dans
loung, sont de se
transcrits orientale.
et interprts Il nous en avait faire
l'Asie
achev connatre
principaux la traduction en alors c* par une
contenta
de
xx simple pntrer tives, notice le figures le haut sens des
INTRODUCTION. intrt termes d'une synonymie des qui permettait de
mystiques, que l'usage en de vaines
de concilier, contenues Tartares. prochements des diffrences entre qui tions sens, pres,
ou techniques sans se perdre les livres rendre plus que
collecexpressions a consacr," et religieux conjectures, ceux des plus les notions Chinois utile et des rap-
dans Pour
indiens,
dans
et cette
concordance tait sur
et les
faciles, l'on
son dessein remarque, dans livres
de rechercher points pentaglotle, d'tudier subir, enfin des soit aux ides sur le les
la cause essentiels, et celle altraleur pro-
plusieurs
la classification est que soit en usage les dans
suivie dans les
le Vocabulaire sanscrits; avaient pu
termes leur
originaux orthographe;
dans noms
de joindre mots exprimant des aux qu'il par la trait
et chacun et uns du
des
autres
morales, le rle Tel avec et de de
mythologiques aux assign tait l'objet M. Eugne leurs efforts,
philosophiques, dans l'histoire,
explications dans de de leur de
autres prparait runion complet
dogme. concert savoir
commentaire et qui, devenu
Burnouf, serait
un
la religion
Bouddha. Encore grand lents tations, mettre de tous stant l'Inde Bouddha les Tartares; et et n'et-ce t l de qu'un des moindres rsultats de ce
travail. qui lui
Obligs taient
mot rapprocher chaque de confronter toutes attribus, compte des plus lgres
des 'quivales interpret de
de se rendre continuellement les pays, rigoureux, appartiennent ont t les
diffrences
en prsence auteurs constater, les textes
les traditions par part,
des Bouddhistes conde de chez les orileur
arrivaient, d'une d'aprs
un paralllisme quel les dialecte livres
lesquels la Chine,
rdigs
ou traduits, si tous de l'ont ces
au Tibet, sur
de l'autre, si quelques-uns
directement perdus
ginaux,
derniers,
dans
INTRODUCTION. forme sur des authentique copies et primitive, trangres, sans altration Fan, et ni n'ont existent mlange. qui fait pas t refaits purs et du t aprs de facile
xxi coup toute de
encore, Il la base
interpolation, dcider pentaglotte, ou seulement alors
si la langue tait commune
dictionnaire
aux Brahmanes M. Rmusat qu'il
et aux Bouddhistes, inclinait vers souleve, les Chinois diffrences quelques semblent rgulire, une le pli, langue et que partout doute systce
propre
ceux-ci. question
dernier dans (1811), que son
sentiment, Mmoire a exerc Fan
et cette sur l'tude
a le premier trangres chez Les dans et qui
des langues reprises dans
plusieurs prsentent avec
les mots mme,
sa sagacit. certaines formes, ancien,
racines tre lui
le sanscrit de
le plus
soumises avaient autre l cet fait
aux
lois
l'analogie que ces Vdas,
et une mots
marche
supposer que celle sacr lors ne sont est de
constituaient
part, c'tait o ces ils
des
probablement
idiome
que les Bouddhistes leur grande
propagrent
s'tablirent
diffrences
pas de
toutes dmler
Sans migration. dues une intention les modifications de celles palis, les
matique; doit ment guent mais dans chinoise auraient livres mire crits de
la difficult comme
considrer accidentelles. suffisamment on les comprend
caractristiques, les originaux
Dans
que l'on qui sont puremots se distin;
de ceux que
en sanscrit qui leur correspondent cette distinction soit souvent insensible ou moins altres de langue le sanscrit t du que Fan, la langue
transcriptions permet donc pu de faire. entendre
plus Sous
le nom
les Chinois ; les pre-
qui leur sont venus de ces langues, et ceux dans la seconde. Aucune Telle
galement par le nord
et le pli dans midi la
auraient
ont tirs qu'ils en dernire tait, n'infirme quelques
seraient l'opinion le qui
analyse,
M. Rmusat.
tradition renferme
cette
hypothse;
FO KOU KI, au contraire,
particularits
xxii la rendent une encore discours plausible, plus
INTRODUCTION. sans grande cependant prcision, fournir et ce sujet les moyens d'atlong-
teindre temps Un dmie
rclamera
de nouveaux sur
claircissements. lamaque, notice lu en 1821\ l'Acapremiers seuls fragrecom-
a Hirarchie et une
des Inscriptions, de la religion restent
sur les trente-trois sont les deux
patriarches ments mand Le
de Bouddha, d'un du travail sujet que qu'il
qui nous
son tendue tait destin la fois
aurait
indpendamment de ces deux
claircir. le plan et le
premier
morceaux
est tout
rsum dont tion. monde, qualit stante se i
de l'ouvrage, le second est un chantillon il aurait t trait; l'un est la thorie, l'autre La succession pour de dieux et rgulire, y de tous perptuer les personnages la doctrine ramene par qui secrte, une M. Rmusat et Shkya au ont
de la manire est l'applica-
paru dans le avec la double consries : la de qui
et de pontifes, est distribue d'poques des la
chronologie en trois
rapportant les anciens du
autant patriarches de sige
principales, Indes depuis la
comprenant jusqu' Ve sicle sicles
translation notre suivirent re;
religion
Chine, dans
20 les Matres : priode de et de ces
de la Doctrine, confusion hritiers
les huit pendant
et d'obscurit de l'me ne
laquelle ne fut pas
la suprmatie moins 3 enfin, cette prcaire
de Bouddha l'tait qui leur fut
dpendante lamas, sicle, fait qui de ont depuis
que
existence; revtu de
les grands au xme pas un
le premier nos jours.
dignit, avait
jusqu' quelque converti sa place
Il n'y de terre ces
importance l'Asie dans aprs ce cadre
pour avoir
l'histoire fui leur et de ta-
rformateurs natale, qui ne
trouvt
la sagacit, lieux, blissait
combinant
et apprciant que l'rudition des dates
les indications avait recueillies
si simple, de temps, et classes,
de personnes,
chronologiquement
et des successions
auxquelles
INTRODUCTION. il ne ment manquait reconnues. de cette indiens, des l'incertitude La dissertation de la de ou que ce Les degr historiens de certitude chinois, supplaient par leur pour qui tre faisaient
xxni dfinitivela base
principale ments
chronologie, contrlaient, de ces
au silence exactitude
des monuminutieuse,
l'exagration ciations, rcits.
calculs
derniers, souvenirs cite sur
de leurs que religion faits, (ressortir j'ai
le vague de leurs nonet la contrarit de leurs les trente-trois premiers un
patriarches petit propres nombre
de Bouddha, privs eux-mmes
quoique des
restreinte dveloppements donner une
en faire que les en point
la valeur, aurait que concerne
pourrait suivie,
ide pour
de la mthode la mieux juger,
M. Rmusat discussions ce qui
si l'on
n'avait,
le FO KOU KI a fait l're bouddhique, si incertain,
natre. pour de la
principalement claircir chronologie Au reste, conue, histoire en de ce
fondamental,
et jusqu'ici
asiatique. il serait faire difficile, apprcier pour tout autre et et les plus faits que celui qui l'avait de que cette l'on nos pour d'tre prcises du Boudle
l'tendue
l'importance deux pour Ils qui, Ces au extraits
de la religion sont, pour cet
samanenne, gard, notre un
connat que auquel est
augmenter veillent moment notions
regrets sujet
diminuer
curiosit. intrt suspendu.
satisfait, sur
ils s'appliquent rest indfiniment et le lieu exacts o des
l'poque ces des
principaux sur ce la culte
vnements et
dhisme, ancienne avait
dtails contres
chronologie a fleuri,
la gographie
rassembls, pour
il faudra les runir
une
succession
et d'efforts naissance l'Asie, tion pour
de nouveau; langues
que M. Pimusat considrable de temps sa vaste conil faudra des nations sa pntrade
de l'histoire interroger pour
et des toutes suppler
de la plupart
les traditions; l'insuffisance
il faudra des
ingnieuse,
tmoignages,.et
xxiv son jugement enfin le ferme, une
INTRODUCTION. pour ne s'carter aussi jamais leve que des la faits sienne tablies rels; pour entre il
faudra tracer tous
philosophie des
tableau
communications Asie et de
religieuses l'Hindoustan,
les peuples
de la haute
modifiant avec En des ides attendant, singulire seules connue diverses de cette par o
les moeurs, nouvelles, ses recherches
perfectionnant de nouveaux sur
les langues signes pour sur qu'elle
et apportant, les exprimer. l'poque a subies, qui, bien de
le Lamisme,
cette
institution une plus
et sur
les variations neuve, empch
constituent et t sur
particularit tt, aurait du
importante, de hasarder
si elle des sur
ides
questions thocratie, les
Bouddhisme, l'influence immdiats sa source, systme avec leurs
et en particulier des sectes
l'origine
due
chrtiennes aux
et fonde lieux mmes du
successeurs prend de
de Gengis-khan, dans s'est ces hautes
le Gange d'o miers Les l'esprit
montagnes descendre et leurs dont
Tibet, les pre-
imagin
de faire leurs barrires voisins jamais du dynastie sortirent guerre arts
hommes Tibtains,
idiomes, par que les
croyances. les a boule-
protgs moins
la nature aux
environns, versements aux
furent de
leurs
exposs une part a t Tang leurs
l'Asie, dont
et ne cette
prirent partie de la ils une
trs-active le (du thtre. vne au en
rvolutions pendant
globe des de
Toutefois, commencement conqurants, et,
le rgne du Xe sicle), la Chine au sud-est, vers golfe un l'Inde, du grand
limites continuelle, valles,
firent qui, route au alors
presque de leurs de de
les fleuves une donner
s'chappent ils s'tendirent Bengale le nom
leur
ouvrant venir
ce ct mer qui les sait de du
jusqu' Tibet.
Ils formaient toute s'taient que la petite
et puissant Leur influence
empire sur on
comprenait pays qu'ils
Boukharie. nous
soumis au
est presque de
inconnue; cette priode
seulement et
ce fut
commencement
splendeur
INTRODUCTION. de gloire que le Bouddhisme de la par la masse une autorit s'introduisit nation, qui alla il finit parmi par eux. prvaloir, jusqu'
xxv Repouss et les
d'abord Lamas
prirent
en croissant se changea plus
de l'envahissement nation que devenu avaient Cette tion absolue. celles du Ds
des Mongols, lors
o elle
l'poque en une domiconqutes pays est qu'ils Tartares. l'attenen trente comme civise
ils ne tentrent et en par les la
d'autres dont leur
proslytisme, a perptu, autrefois tait trop
religion
le centre acquise influence
l'augmentant, armes sur pour ont pour les les ptres les
l'influence autres attirer
remarquable
ne pas montr
de M. Rmusat, des on faits tait de arriv
et ses recherches six cents ans
comment, de Tibet antique l'honneur,
prenant sicles, les plus
traditions du Cette
considrer du dont peuple on
proches
hritiers
primitif. leur
lisation rduit,
si perfectionne, tout bien examin, qui leur et assez
a attribu les plus
aux notions ont t
simples
de morale histohin-
et de littrature, riquement dous En prcise romanesque fait ct natre; l'accs leurs mme des connues premiers
portes, par
des des
poques
rcentes,
missionnaires
instituteurs. qu'il un des intrt rveries temps substituait solide plus qu'il ainsi, et durable ou moins par la cet ingnieuses pour toujours connaissance intrt tout avaient de ce
temps faits, que en aux
mme opinions
fermait
les notions dionales, religieuses, Tantt tendue livres existent il
les plus dans
systmatiques, caractriser propres les Tibtains demi-civilisation ce faut qu'il Bouddhistes connatre dont une ont
M. Rmusat ces
rassemblait mriides fruit.
superstitions avec en de leurs le
lesquelles de l'espce
puis, qui
a t la
recherchera attribue par nous ou
penser
prodigieuse leurs qui
les fera
sacrs,
et
quelques-uns de ceux de ces ouvrages imagination
rellement,
ceux
dsordonne
XXVJ a seulement criptives de traits de suppos des qualits qui, runis,
INTRODUCTION. l'existence. corporelles lui offriront Tantt, quelques pithtes desautant
de Bouddha l'ensemble
deviendront de
la physionomie que la varit
ce personnage
et lui permettront
de dterminer
de l'espce humaine avec laquelle elle a le plus de rapports est la race indienne. Combinaison aussi simple qu'ingnieuse, qui a renvers de fond en comble des hypothses chafaudes sur une futile en elle-mme, mais d'o question fait dpendre de la civilisation l'origine que Bouddha que qu'ils arts tait ces un deux avaient ngre venu pendant orientale, de t l'Ethiopie peupls par un moment on a
en prtendant dans les l'Hinmmes les
doustan; hommes, mmes de
avaient pays suivi les le mme pensait de faits
mmes Ennemi n'y ne par
usages, de en
cultiv toute
et pratiqu M. Rmusat ni non
culte. qu'il qu'il
espce de
routine,
a pas
histoire d'claircir
vrits et de
indiffrentes, discuter,
soit une
prudent
pour des fixer
rvoquer, sicles
orgueilleuse des hommes,
prmais
somption, pour des rgler prjugs,
l'exprience ses ides, afin de
et le savoir
sa persuasion,
se soustraire l'hritage
l'empire de ses pour-
transmettre de toutes
la postrit les richesses que
prdcesseurs, rait y ajouter. En l'illustre points de soumettant auteur la
accru
lui-mme
une de
discussion des
nouvelle Huns il n'a plus
les
explications de but
que
Histoire
a donnes d'autre solides perptuer tort de
quelques que de les
doctrine leur du
samanenne, prter savant des ne appuis
de complter, que la clbrit qu'il l'poque vaient a mises. o tre les
et d'empcher les de erreurs devancer pouavait se pro-
contribue
Deguignes questions
a eu qu'il
l'honorable s'tait propos Les avec
traiter qu'il qu'il
compltement n'tant pas
claircies. en rapport
moyens le but
sa disposition
INTRODUCTION. posait, tifie, fallu il a t entran indcises progrs des rapprochements des que difficults des rien qu'il
xxvn ne jusaurait et comdepuis ont chou. Un pourra auto-
et il a laiss rsoudre.
la plupart de l'tude plus
Les une
compare approfondie
langues et plus
des institutions, plte des traditions
connaissance
quelques permis C'est jour tre rits; ront jamais une sur
tant de dcouvertes asiatiques, dans le champ des antiquits annes, M. Rmusat de russir o Deguignes se perfectionnent que les sciences la valeur des renseignements qu'il balance, d'autres dtruite dcouvertes, mme par
faites, indiennes, avait
ainsi aussi
en s'tendant. a recueillis de meilleures
diminue, un jour
modifier changer de tels
progrs pourcertains rsultats de ses recherches, sans pouvoir l'opinion que tous ceux qui ont le droit d'en avoir sujets se sont avec tant forme, d'un ensemble de travaux et
de nouveaux
si pnibles, de talent. Au une points de cette reste, rfutation
accomplis
d'application,
de persvrance
l'crit des
il
a consign de Deguignes
ses observations qu'une
est
moins des
ides
explication
fondamentaux triade
de la religion de'cette
samanenne unit-trine,
suprme,
et en particulier qui est la base de Bouddha, provient, Ce sont la Loi, auxquelles trois tre, Etres le
la croyance de tous les peuples bouddhistes. voil les trois causes desquelles tout Clerg, tout retourne, sur tout s'appuie. lesquelles trois reprsentations d'un
prcieux, gence Cette aux riels moral peut
ou plutt
mme
YIntelli-
absolue, double abstractions fait voir
se manifestant interprtation les plus
et dans la Multiplicit. par la Parole, des mmes mots appliqus la fois leves en et des objets purement philosophique l'enveloppent, que prsente matet on la
comment, article rsoudre
dgageant des les
le sens voiles qui difficults
de chaque parvenir
de foi toutes
xxvm distinction telligence esprits degr ment sur des de deux
INTRODUCTION. doctrines. C'est un et pas figur, important invent dans par avec l'indes le
ce langage
contemplatifs, d'abstraction du corps matires par o
mystique comme tant tous les
le plus saints
en harmonie aspirent, s'garant ternellement
auquel l'exaltation la
l'anantisse mditer con-
de la pense humaine est
des
raison
damne Cette pour en
l'ignorance premire
et la confusion. donne de n'a pas du seulement systme de l'importance elle et par voir, entre par les
l'apprciation acquiert encore
l'ensemble
bouddhique; qu'elle Elle essentielle rpand fait
par les notions auxquels aucune du Npal, de la
nouvelles elle conduit.
les rsultats exemple, opinions ment conclure Dieu aux
inattendus qu'il n'existe
diffrence du Tibet
des sectaires principes que
et de la Chine, et l'on
relativepeut en d'un distinct ; en un nombre par la
doctrine samanenne
sotrique, reconnat la fois; qu'il auquel
la religion unique a form
l'existence d'un tre
suprme, qu'il
et trine
tout
du monde mot, d'tres d'un
et de la matire principe, s'assimiler
a produite un certain car,
Bouddha ont
premier pu
sanctifis
compltement,
des vertus, la prire et l'extase, on rentre dans le sein pratique de la divinit, dont tous les tres sont sortis par manation, et l'on s'identifie de nouveau avec elle. H y a loin de l cette doctrine du vide et du nant sur aux laquelle sont dirigs Cette les reproches notion par de d'exl'esprit
travagance distinct suprieure, en de serpents, d'aucun force
adresss de la matire, qui
Bouddhistes. oppos dans mme presque
la matire toutes des qui de
sa nature tant et des
a remplac, du un
les contres dragons
del qu'au constitue autre sous
Gange, systme
la superstition religieux de l'lvation pour le concevoir.
n'est l'esprit Les
au-dessous et de la
le rapport qu'il faut
intellectuelle
Bouddhistes
INTRODUCTION. ne sorte aussi se sparrent davantage peu des Brahmanes ou, possible. que si l'on pour veut, unifier pour en
xxix quelque l'ide
la divinit, que
en rendre
complexe les autres
Ils la distingurent ou pures ou ne purifies, devait
absolument d'origine voir en elle
de toutes divine que tions, ou
intelligences et pour
humaine, par
montrer sans
qu'on
la substance ils lui
excellence, le nom comme sauraient d'entraner
donnrent imparfaite, qui ne
comme sans relaqualits de vide, de nant : dnomination toutes recevoir la celles de nom, ngation que l'on applique qui avait mat-
insuffisante, des leurs riels bout causes yeux tels que
mais
l'avantage la corporit
d'attributs
et l'tendue. hommes mais de
On viendrait renoncer, aux leur avec existence plaisirs faire les
difficilement non-seulement du coeur et de l'uni-
de persuader
aux
aux jouissances l'esprit, vers comme Avec pense mer qui siste une si l'on comme autant pareille un
des sens, ne parvenait nant, d'illusions,
mme
d'abord rapports et notre on
envisager objets comme cartant ide, aucun Leur atteindre Mais pour
nos
extrieurs un rve. de sa
croyance, toute de
conoit
qu'en toute
toute dans la
distraction, contemplation prtendre tout, n'est ou plutt leurs qu'aux Bouddha, seuls
sensation, Dieu, Dieu faire,
s'ab-
il n'y
ait
quitisle vie con-
ne puisse faire
devenir ne rien yeux
lui-mme. pour
ce but, l'ternit tre le
et la mort n'est est attribue devenu des
qu'une
apothose. et quand pas qui le qu'il
Bouddhas, non
on dit qu'un est all grossir les saintet
on entend, fantastiques qu'il nouveau M. Rmusat a atteint
nombre tages saire dont Shkya rel
puissances mais de
remplissent de
divers ncesinfinie que type crs,
clestes, pour tout tre mane. mouni,
degr avec
confondu n'tait de
l'Intelligence de penser est le seul ont t
pas l'ge
loign actuel,
ou lequel
le Bouddha des
d'aprs
personnages
imaginaires
xxx pour frentes duire tre reports, priodes reconnatre manifestations du trouve
INTRODUCTION. dans cette mme qualit de Bouddhas, pourrait des au Bouddhas mme de le difconet de
mythologiques. si le dogme successives
Cette
conjecture
de la pluralit remonte
de leurs
temps
la fondation nit saints. Tous moins les s'est
Bouddhisme, peu peu
et comment presque
l'adoration efface par
la divides
culte
tres
se trouvent de l'tre
donc
placs
des
distances plus ou
plus
ou
grandes
primitif,
de l'absolu, ou, de pour
avec parler
moins des pour fleuve, de cet
de disposition Bouddhistes, gagner l'me tat
s'en
rapprocher, le fleuve En ce qui
le langage
traverser oppos. de et
la vie de
et de la mort ct elle modifie variation, les nature, est qui par l'en du sort de la
le rivage est affranchie
passant altrait o
l'autre
sa nature; l'illusion, la
secondaire avait
accidentel la rapports
mille dure, les
manires, l'individualit, sentiments, est d'y sont le but arriver.
produit et les
dpendance, qui
en dcoulent, de sa
penses, l'extinction
Indestructible passions. elle doit tendre; auquel Les diffrents dans et de degrs
les
la mditation
le moyen sparent tages de verra
d'loignement extrieure, ainsi
dsigns,
la doctrine
diffrents par les
superposs, les brutes la transmigration, depuis dans le FO KOU KI, que les hommes que les incarnations du premier non retenue le mais dans tablie et plus du sens
de mondes
cieux
que
phases On
jusqu'aux purifis, du que culte second les
gnies. tels que ordre,
lesrhans, nommes d'tres ne sont dans les et Cette n'est
Bouddhas que
et Bodhisattwas, ont
Dvas,
classe
les Bouddhistes des dieux,
nullement
suivant
brahmanique, attach ce mot des de la mes
de l'Occident, mythologies ou moins avances plus distinction, jusqu'ici mal
seulement la route ou
engages
perfection. entrevue,
confusment
INTRODUCTION. pas la particularit : elle la moins lie curieuse ni la moins importante
xxxi du
Bouddhisme et dans il est
la doctrine que l'on perdre
secrte veut faire de vue,
l'apprciation essentiel de sont leurs ne
la croyance de l'une ou que les de natre Ils leur sont
vulgaire; de l'autre, qu'elles
pas
dieux
reconnaissent et perdre grande longue viennent rendent
astreints avantages et cependant la dure
la ncessit par pch. limits dans vie, des le
et de mourir dous d'une quelque dcadence les
puissance, que soit
pouvoir; de
de
leur enfin
signes
en marquer
le terme; aux hommes,
des facults ceux-ci par
surnaturelles peuvent
suprieurs les surpasser mme religion soumis Des liards, terre indique, tous ceux
mais
les galer, que restent la
en s'affranchissant, des qui conditions habitent
divers
moyens
d'existence l'enceinte des
auxquelles trois par peut mondes. millions embrasser superposs
sont groupes, puissances imaginaires dans l'espace que la vue de l'homme au ciel, et dans les divers tages
et milde la dont
d'univers
la perception le nombre. sont morale leur
de la pense La place par qu'elles des
la plus
puissante
ne saurait le rle qu'elles de
concevoir y jouent, perfection
y occupent, degrs
dtermins
correspondants de leur
et intellectuelle, rang dans sur la
et la dure hirarchie cette
vie est proportionne Les est tablie et on conceptions ne man-
mythologique. hirarchie
fantastiques quent y parfois
lesquelles
ni de grandeur, au fond,
ni de magnificence, l'ide, bien de dtermine, la production
ne peut
mconnatre, et vivement par un tre
fortement de toutes mondes du ne se
conue choses jaillissent sein lassent encore
recommande,
en tous
et absolu. D'innombrables primordial sens et dans un espace incommensurable, divine, les plus Toujours et les folles auteurs exagrations de des lgendes pour l'infini et
de cette pas cette
substance d'entasser ide.
rehausser toujours
proccups
xxxn renouvelant lui donner dfinis les une plus
INTRODUCTION. vains efforts pour le saisir, en employant absurde d'essayer qui ils ont tent de
apparence des matires
de prcision, o Pour la il est supputer
des nombres un mode
dans
quelconque les parties qui
d'valuation. de leur l'univers,
les distances d'tres dans qui les
sparent la se un
quantit
habitent, elles
dure forment, systme dans
est assigne,
les priodes
lesquelles
subsistent de numration
et se dtruisent, o dcuple, pour les
on sait
qu'ils
ont invent
nombres, finissent d'une millions n'est
se multipliant par former une
toujours somme et
une
progression indicible, suivie
indiciblement o l'unit
me servir ou cinq rien
de leurs de zros
expressions, n'est encore que genre aident
de quatre
qu'un appareil
chiffre
modeste.
Certes, mais les
plus d'un
extravagant certain
cet sont
numrique; des faits
absurdits en qui
elles-mmes natre d'esprit Bouddhistes mtiques, de l'infini l'on rentes sur
assez
curieux,
ce qu'elles
con-
l'imagination de ceux n'aient soit pour qui
des hommes les adoptent.
les inventent On succs ne saurait ces dans
et la tournure nier que les
appliqu soutenir
avec leur
garements
arith-
pense soit pour des cosmogonie tout
la contemplation les ides que appa-
en temps d'aprs
et en espace, le tmoignage Toute seul tre leur
carter des repose est ramen savoir:
se forme,
sens,
limites
de la cration. d'un
videmment par l'action
la doctrine
auquel deux
successive suprme la matire. musat, c'est
et rciproque-de et l'ignorance Mais que, ce qui dans
principes, en d'autres t
l'intelligence l'esprit par parties, et
ou l'erreur; n'a encore
termes, que et ses
remarqu
M. Rune et leur par une de
ce dualisme, prennent
l'univers leur
fois forms, configuration, sorte la part d'action du
se dveloppent, se maintiennent, interne premier
accroissement
s'altrent sans erreurs,
et se dtruisent, aucune
et spontane, principe. Les
intervention
les passions
et les vices
INTRODUCTION. circonscrivent, phnomnal; des tres bornent sa dure vivants, finalement dans un des laquelle et tendent les oprations du des
xxxm monde actions ou
est subordonne prolonge leur
la moralit existence
individuelle Tous les mondes,
les runit est-il dit
la substance livres
universelle.
les plus clbres, tous bouddhiques les mondes sont forms de la force et par la vertu des actes des tres vivants. ils se dtruisent; ils se reforment; Forms, dtruits, leur Cela commencement est inimaginable et leur ! pensent de de la formation, l'univers; ils ont les voulu de l'tendue, procds tout numet qu' manire et fin se succdent sans interruption.
Ce que les des vicissitudes riques dont aux
Bouddhistes et
de la dure desquels moins
proportions est
rduire,
l'normit enfin, soit relative par
propre
satisfaire
l'imagination leur
l'accabler; d'envisager, la position apprci cosmogonie juger proch, que qui des
ce qu'il y a d'essentiel dans la nature matrielle en elle-mme, de ses parties, dans son se trouve Essai expos,
tout
soit l'ordre comment,
M. Rmusat, des Bouddhistes; par
travail
l'importance avec autant
l'tendue, que
sur la cosmographie et la dont il ne faut pas prcieux, et dans lequel l'auteur a rapde profondeur, du systme de prcision
de finesse
de lucidit, y est li, livres Cet de tel
l'idoltrie que
bouddhique
le lui avait dont
fait concevoir nous possdons
philosophique une tude assidue des versions chidont
cette est
religion
noises.
crit
le dernier les sans pour de
qu'il
ait publi. et
Si la manire les carts les ide
il a interprt, l'abus Bouddha, de ses tesse aussi de
analys
abstractions objet a pu la plus de
auxquels de
mditations est faite
conduire haute
disciples de l'tendue
donner
connaissances, de son pineux esprit, nous
la porte qui avec
son jugement, traiter intrt pour
de la jusun sujet
la cause inspire,
l'a dtermin un nouvel
sa per-
xxxiv sonne, plus de vnration dans la plus
INTRODUCTION. pour chre sa mmoire. de de le contre tranges, nigmatique, son intrt, ses Frapp par la mort de se
de sa mre soustraire ment travail dhisme hrente
affections, choses, en
il essaya
ce dcouragement qu'entrane un ses son pour pour de refuge mythes langage aiguiser
toutes
ce dprissedans du un
intellectuel obstin et et de de
chagrin, la douleur. de
cherchant L'tude mtaphysique
Boudincoassez ou
sa lui
parut
offrir sa pense,
de difficults du la moins tche
enchaner de ses regrets. ces avait
la dtourner des par aprs la
de l'objet noncs vie
Il s'imposa ides produit dont un
ramener exalt et esprit d'un
rationnels
mysticisme l'exagration; homme d'un
contemplative si admirablement raison
toute cet
l'avoir
accomplie, d'une mmoire plus
si sage, savoir
d'une
si saine,
si heureuse, d'impuissantes comba, avait faits
si vari aux fois
et si exact, sentiments de sa douleur
n'opposant qui l'accablaient, et des
que sucqu'il
distractions tout la
victime pour
efforts
en triompher.
Le Commentaire le complment On y
sur de tous trouve
le FO KOU KI peut les runis, travaux que
tre
considr d'essayer seul
comme de rsur des dans l'on
je viens en et un la
sumer. les
rapprochs sur une de l'histoire foule nouveaux de
corps,
croyances o
bouddhiques, elles ont il fleuri, ajoute
gographie pars que
contres les livres
documents faits ceux
chinois; dj, des tre
connaissait et soulve pu
il en rectifie questions qui,
quelques-uns, discutes
en claircit pour la premire dont
d'autres, fois, le plus pole
n'ont grand sitive.
toutes
suffisamment avoir de dont
approfondies, t rsolues
mais d'une en l'a
nombre S'il tait des
paraissent intressant langes
manire sorte
dbarrasser
quelque envelopp,
Bouddhisme
la superstition
et de
INTRODUCTION. ramener ses tait de leur sens ses les moral, mtaphysique, ses expressions religion des cosmogonique figures clbre, peuples important qu'elle Asie ans en a suivie ont eu qui de sous l'ont
xxxv mme, ; s'il imporle rapport adopte, son dans
symboles, d'tudier son
allgories, fastes sur
de cette l'tat social
influence ni moins
il n'tait itinraire, lequel Ne elle qui, les dans
curieux,
niJmoins la route
marquer
de reconnatre habitants le nord pendant fini sans par castes, les nations, les chez de de
et l'ordre
la
haute mille
connaissance. notre re,
l'Inde, plusieurs
environ ct la pays secte natal, idoltrie
avant du
y rgna ayant
sicles anantit de leur
Brahmanisme, Alors ces
prvaloir, expulss
rivale.
Hindous dans chez fiant,
se dispersrent contemplative les autres, modi-
toutes vingt
directions, civilisant moeurs, quelques-unes
portant les les unes,
leur
pacifiant
altrant
institutions, le
les langues
de toutes, des fa-
et arrtant cults qui
dveloppement vertus mles
entier
humaines, l'amnent, le
en substituant dogme nervants. remarquables, de
aux l'inaction
et vigoureuses dans ses
philosophique
principes
les plus phases
Il y a trois l'histoire grandes
trois Aprs dans
poques
principales
dans quatre de
de cette missions
propagation. se rpandent
la mort les
de Bouddha, limitrophes
contres orientale;
l'Hindoustan; des royaumes
la foi s'tablit de Geylan Kachemir : c'est comme les pompes zls de du
dans et de
la Perse Kandahar
les habitants et l'indoctrines croyances des prdiles Bir
la reoivent L les ; les
troduisent saintes sont cations uns mans; la Chine,
la premire une nouvelle du vont culte, les
poque. rvlation par
obtiennent ravives ; des par
la ferveur sur le
aptres en
porter Ava, dans
continent, chez les
dans les
l'Inde autres
Gange,
Siam, la petite
dans
la Baetriane, Japon;
Boukharie, de monuments F."
en Core
et jusqu'au
ils couvrent
xxxvi religieux de leur les contres en
INTRODUCTION. qu'ils parcourent, laissant partout indiennes Lamisme, le pntr ans les plus ou et consacrent sur leur passage' le souvenir la foi, poque. rform. est sans le la La Au Boudpu do-
mission les est
langue, troisime
institutions celle du du
: c'est d
l seconde Bouddhisme qui
commencement dhisme s'y primitif,
ve sicle, dj
Samanisme, dans tard,
avait deux
le Tibet, il y tait incursions le du Bleue
avoir
maintenir; Ds
cents
la religion ds
minante. dans des
ce moment, septentrionale de race
frquentes de la Chine,
Tartares armes Tibet
la partie peuples tous
succs Chen si,
des au
tongouse qui
l'occident la mer que d'adresse bouddhiques, la M.
et dans deviennent dha La prsente riode. faire temps n'taient
les pays un moyen
avoisinent
jusqu'
Khotan, de Boud-
de propagation avec alitant
les sectateurs que qui de succs. est d la
mettent
profit des
Description publication, Dans voir
royaumes se rapporte autres
l'objet seconde
de
la p
moiti Rmusat
plusieurs
crits,
s'tait
attach
qui ont su faire le tour de l'Asie longque les Chinois, le cap de Bonne-Esprance, avant que nous eussions doubl pas aussi dispos ignorants en gographie Des textes qu'ils et au positive nombreux ont prise, qu'on prouvent, deux cents est
gnralement d'une ans manire avant notre
le croire.
incontestable, re, aux lors ou ces
la part vnements ils ne
commerce d'entretenir politiques,
de l'Asie des avec au le
occidentale. relations les habitants
Depuis amicales de
cessrent commerciales de villes
plus ou qui
hostiles, deux lignes
semblent la Perse.
tracer, Dans
travers sicle tracter derniers par les
de la Tartarie, qui prcda avec
le chemin la naissance les rois de des
de la Chine de J. C, la
ils cherchaient et plus renverss de
contard, les
alliance membres Arabes,
Bactriane, Sassanides, auprs
de la famille venaient se
en Perse Ta
rfugier
l'empereur
INTRODUCTION. tsoung. acqurir c'est tenues plus Les Chinois profitrent des lieux de qui tous ces vnements t le thtre; tablies et
xxxvn pour mais entreles Jamais ont con-
la connaissance aux
en ont
surtout par prcieux
communications qu'ils recueillis
religieuses doivent les
le Bouddhisme qu'ils des des ont
renseignements trangers. ne les
sur les peuples ni, l'appt loignes pas du gain
ni l'ambition duits dans
conqutes; aussi contres
proslytisme d'tonnement et les et des gager, vaincu pandre pour donn actes La ait dent, avoir mers
a pntr, qu'on qui voit
et ce n'est d'humbles arrt lesquels des
o le zle du que celles sans une admiration mle traverser franchir les des fleuves dserts os s'en-
religieux armes,
avaient dans des prils,
montagnes braver la volont au loin en aller
aucune
;earavane des obstacles
n'avait qui
surmonter
avaient pour r-
toute-puissante la croyance
des empereurs, ils taient les contres lieux religion. religieuses de Lao que
les uns attachs,
laquelle dans les
d'autres
vrifier
les principes et pour visiter
qui lui avaient consacraient les
naissance, de la vie plus du
fondateur de ces est avant
de leur entreprises du re.
ancienne le souvenir
dont tseu, qu'on que
l'histoire en Occipuisse les cirgale
gard
celle notre de
voyage Quelque tradition, mritent qu'il y
au VIe sicle sur l'authenticit qu'elle il est une dogmes des
opinion et pas a eu, bien toutes
cette ne doute
constances confiance, trs-recules, Chine, ce pays, sages du des
rapporte hors sorte de de
une
des
poques la hors de pas-
rciprocit et dans tseu.
dans
l'importation,
de Bouddha, de que pour Lao
la propagation, de plusieurs qui
prceptes
Il rsulte philosophique tait,
FO KOU KI, personnage ve sicle contres
la secte son re,
reconnat
ce dernier ment dans du les
fondateur
au. commencerpandue dj de la Chine et
de notre situes
trs-anciennement et au. sud-ouest
l'ouest
xxxviii jusque existe dans entre l'Inde. les On
INTRODUCTION. ne des qui porte saurait docteurs nier de d'ailleurs la Raison l'analogie et celles qui des
opinions
Bouddhistes; sur ce les dtails cercle de
analogie
sur le fond populaire, qui qu'on deux
des doctrines, et qui s'carte constamment croire qu'elle
comme trop de les se soit de
de la croyance vrits et point, dans ou nomm qui de d'erreurs pour les
ramne puisse pays,
hommes forme toute
au mme spontanment communication,
indpendamment traditionnelle. tre le premier occidentales dans qui le Chen
Un Samanen, sionnaire la l'an avoir Chine 217 t bouddhiste pour avant
quelque Che li fang, soit venu
influence parat des
mis si
contres Il arriva province
y rpandre notre du l'on
sa religion. cette des de celle
re ; ainsi, gouvernement a des fut raisons aussi
passe
pour de
le sige et a pris o
premiers que
souverains la civilisation
la Chine, chinoise
croire qui,
naissance, Che li fang livres anne
la premire, de dix-huit
connut religieux des C),
le Bouddhisme. et avait Il an, d'autres et vers la avec lui
tait sacrs. youan
accompagn Sous cheou par de I tsun A ti, (deux keou,
des
de la dynastie ans avant des un J.
premire livres furent
apports le roi
envoy ordonna
Gtes; savant
le mme
temps,
ce pays
nomm de la secte de Bouddha, disciple dans l'Inde les prceptes. pour y tudier les historiens partout pire, tion sur mais chinois, nos on les sectateurs leur pas. qu'une manifest plusieurs sur dessiner
King
lou,
de se rendre poque, disent rpandus dans son plus l'emadoptard.
A cette
de Bouddha doctrine tait peut
taient connue appeler d'annes
frontires; n'y n'eut croyait lieu s'tant chargea informations d'en
Ce qu'on soixantaine dans lettrs la les
officielle
Bouddha Ming
lui-mme
un
songe
l'empereur recueillir dans d'en Ils
ti, ce prince des prceptes,
d'aller
ITlindoustan copier les
religion temples
bouddhique, et les images.
INTRODUCTION. revinrent royaume leur culte accompagns du Milieu ft de commena deux religieux. des Des Ce fut alors
xxxix que le
possder
Samanens,
et que fr-
profess
publiquement. tablies les nations de pieux depuis sicle venus
communications l'Inde,
quentes chez
et rgulires, presque par envoyaient o on toutes
de la Chine de l'Asie zls plerins
le portrent Les unes le
intrieure.
recevaient d^autrs contres Avant nens
l'entremise de
missionnaires, pour le chercher en honneur. re, beaucoup du pays
tandis
que dans les
le savait du second taient former leurs un
longtemps de notre de Bokhara, des et
la fin
de Samades Gtes religieux langues de Bouet
trangers
de l'Hindoustan, o ils prchaient L'an 267,
la Chine doctrines
tablissements les
enseignaient parcourait recueilli de livres que
l'Inde. kharie,
Bouddhiste un Gte, qui
chinois avait
la petite dans saints, les
et en 2 65, une
contres tait venu
occidentales les 'Fo traduire thou
nombreuse La
collection notice
la Chine. tchhing, que ce dans
M. Rmusat universelle, de le
a consacre fait connatre exera, l'occident autour accouraient de ses religieuse comme miet celle de
la Biographie venu sicle, qu'il dans
l'influence au de lui pour racles;
Samanen, du ive
l'Hindoustan, nord en et foule
commencement l'empire. portrent profiter beaucoup et Les au de
disciples loin ses de on sa
runissait les pour tre
renomme;
peuples tmoins la vie poque
prdications, personnes peut
embrassrent cette
contemplative, des plus grands Fo
regarder de la religion
progrs tho ye
bouddhique ye ho, et surtout les route autres
la Chine. Kieou ma
Sangadeva, lo chi, doustan, tchhing tendre
ho,
Tan
ma
originaires, continurent avait fraye,
le premier
de la Cophne, dans la s'avancer lui contriburent nouvelle.
de l'HinFo thou
que
et comme de la religion
puissamment
l'influence
XL Le prtre bouddhiste cette nom cole
INTRODUCTION. auquel samanenrie nous dont devons Kieou le ma FO KOU KI le
appartient chef. naires Son
io chi est
de famille yang,
de Ping
sesanctres.taient taitKoung; origidans le Chn si. Consacre ds sa naissance l'ge de trois ans, un ds avec le degr
la vie monastique, de Cha mi, de religion c'est--dire, dont
il reut
de disciple est ide lequel
ou d'aspirant, de ou connu, celle
de ces noms noms indiens
la forme quelque sous
imite morale il soit qui
et qui prit plus
dsignent le seul
alors,
Celui asctique." qu'il est CHY FA HIAN, bu Manifestation n cessaient grand concours son les de la loi. d'attirer de re-
simplement
FA HIAN, ce
signifie ma fou, lo chi un
Le savoir Tchhng ligieux; thologique, la doctrine
et la saintet 'an, ce fut et aujourd'hui l que
de Kieo Si 'an
FA HIAN vint avoir il reut Cependant t
complter tous
instruction mystres et de obtint de la tibdu les s'teiindiff-
qu'aprs
initi
sotrique, de Samanen. impriale la diviser avaient sacrs ngligs manquant
les prceptes les guerres
suffisants qui
la qualit la dynastie Chine, taine
enlevrent
presque entre t
toute plusieurs fatales
la partie petits au
septentrionale princes de race
pour
et tartare,
Bouddhisme. mutils toute
A la fin ou disperss, ferveur devenait
TVe sicle, prceptes gnait, rente.
les textes taient
se trouvaient ou abandonns,
et la foi,
de lumires de cet les tat
et d'appui, de choses,
Profondment ; il se dirige plusieurs leur petite toute de
afflig vers ses troupe
sa patrie saintes; l'an Ils 399
contres
FA HIAN quitte les rivires qu'arrosent se joignent lui, chinoises. montagnes et
coreligionnaires tait hors des
frontires dans les
traversent
la Tartarie, les plus et de hautes ponts
s'engagent chanes volants, mille du des
du Tibet, l'aide de
o sont cordes
globe, valles
franchissent, inaccessibles deux fois
et des prcipices
profonds
de huit
pieds,
passent
INTRODUCTION. l'Indus L, et suivent les bords du Gange ceux aprs Indes fait par jusqu' qui avoir et relch environ mer. taient navigu Java, douze son embouchure. partis avec
XLI
FA HIAN, rest pour mois 'an,
seul Ceylan, mer ,4i4, de deux tous
de tous d'o, des ayant mille lieux eu qu'
lui, prs
s'embarque de trois Tchhang par terre
pendant il revient cents
sui\la l'an
lieues trente et la
et plus visit dit-il,
Il avait par les
parcouru les traditions,
royaumes, partout, conduite Des Depuis liore; nord un
les
consacrs admirer
il n'avait des moins
vertus,
la pit,
rgulire spectacles son dpart, une violente
religieux. difiants des l'attendaient Bouddhistes se prparait vers le milieu du ne dans s'tait sa pas eux patrie. amle
la cause perscution Elle leurs clata progrs.
contre
dans
de la Chine. temps arrta et leurs
Ve sicle, de fuir flammes. tenter populariser l'autorit
et pour ou Mais de se ds
Ils furent la proie suivant,
obligs des
cacher
livres annes
devinrent du sicle
les premires efforts, croyance ginaux. de
on les voit pour sur
d'autres leur des ori-
recommencer et rtablir L'an 5o2,
de nouvelles la tradition Spung l'Oudyna, l'empereur yunet le
courses religieuse Hoe Kandahar seng
parcouraient et la Perse
le pays orientale. le pour tait de
Badakkhan, ans aprs, Fa
Quinze Samanen, y tudier retour ployes toutes loin
Ming dans
ti envoyait les contres En 65o, de prs
Yun,
surnomm
li et d'autres,
occidentales, thsang
les livres
de Bouddha. aprs une absence
Hiuan
en Chine, visiter les parties
le Tokharestan, de l'Hindoustan. le rcit
l'Afghanistan, C'est lui
de vingt annes emle Sind et presque qui a port qui le plus la
ses pas;
ou du moins,
de son voyage, est-il que
contient
de cent quarante description pays diffrents, le plus tendu et le plus dtaill de tous ceux sons. Vers le mme temps, le souverain
de beaucoup nous connais-
du royaume
de Kaschgar
XLH envoyait l'empereur relations sicles dans qui trois cueillir de le manteau Kao crites que dura
INTRODUCTION. de Shkya, On a, comme en deux religieux Tang, une prcieuse le relique, des
tsoung. par
livres, qui, entreprirent
catalogue
cinquante-six des
pendant des
les trois voyages est Ta celle tsou, d'y re-
la dynastie Mais 964.
l'Occident. eut lieu l'an
l'expdition D'aprs partirent de Bouddha parmi eux (celles Wang un
la plus dcret pour
considrable de l'empereur
cents des
Samanens reliques Il y avait des trois
l'Hindoustan, livres crits vers
afin sur dans de Lao de Hoe n'est mrite pour des
et des un
feuilles la contseu tcheou; pas trset
atanier.
homme de Confucius,
naissance de Bouddha) ce fut lui
doctrines
; il se nommait qui mais rdigea ce qu'on qu'elle notions
et tait du voyage.
natif
la relation y lit sur
Elle pays poque l'tat
d taille; plus on
diffrents une sur beaucoup
d'autant laquelle royaumes
d'attention, n'a que des
se rapporte trs-imparfaites et que
situs dont
l'occident on n'a que
de la Chine, peu de
de particularits, s'y trouvent
connaissance
d'ailleurs,
mentionnes. Je ne puis bls dans des cette la hte son plus indiquer que quelques que dans savoir, et dnue traits principaux aurait offert et rassemcomplet et revtu style. Mais avoir N'est-ce reet la
de ce tableau achev du ple
M. Rmusat ses moindres de l'esprit
ensemble, riches
dtails et du
couleurs quoique rien
esquisse,
de formes, qu'il que a par de voir
ne saurait lui-mme. des
fait perdre pas un
au sujet
de l'intrt spectacle
grand o
et tonnant la morale sont des
doctrines
ligieuses psychologie ptuer
et la mtaphysique, confondues, sont nes et
la cosmogonie s'tablir hors
continuellement rgions o elles
et se per-
loin
de l'influence philo-
des causes sophique
qui les ont le plus
produites;
runissant, placs
par aux
le systme deux
abstrait,
des peuples
extrmits
INTRODUCTION. de la civilisation, spars, difficiles rence digne que de moins comme encore que et par par de ils le sont des distances la disparit leurs aux deux aussi de bouts de l'Asie,
XLIII et que la diffde plus
considrables climat, a-t-il notre
franchir, leurs
leur Qu'y de
moeurs dans la marche que
idiomes? intellectuelle voyageur? ides
d'attention, d suivre
l'histoire
espce,
de ce culte les mmes de l'me
Qu'y sur
a-t-il de plus unide
remarquable verselle, sa nature avec sacrent, valles Et dans important l'histoire connatre de la haute les rapports sur
de voir
l'manation sr l'identit
la perfectibilit celle qui
humaine,
avec
de la divinit, leur est propre
propages, et les
il y a des lgendes qui des d la a-t-il qui
sicles, les con-
le langage de l'Inde de
la Chine, jusqu'au
du Bengale milieu des
au Tibet, neiges qu'y
profondes Sibrie? de plus
l'Himalaya
le domaine que des
de la littrature la profonde la conqute
orientale, obscurit des
de pntrer Indes avant
enveloppe que de re-
Musulmans; politique poque; que des que
la situation Asie, qui
sociale
et la division cette eux ces
royaumes marquer com-
antrieurement liaient dans entre
de
peuples d'isolement
l'opinion
mune des toire,
reprsente autres?Et tant tant de faits
un tat habituel renseignements ngligs
les uns l'gard et d'hisaltrs par
d'utiles prcieux,
de gographie par les Indiens,
les Persans,
conqu'y a-t-il de plus curieux que de les dcouvrir avec la plus minutieuse dans des relations exactitude, signs, la Chine, crites et d'apprendre chinois par des voyageurs des lieux auxquels dans l'Inde, s'attache, quel tait l'emplacement la plus grande clbrit ? religieuse Cet genres vrages, soudre aperu, d'intrt pourra tous dont et faire le but d'utilit pressentir obscurs est qui de donner une ide ces des diffrents d'oude r-
recommandent aussi l'extrme
sortes
difficult
les points
qu'ils
prsentent.
Il y a l beaucoup
XLIV de questions de nos actuel sinon dont Hiuan blier travail, nieuses qu'on gretter rsolues,, quelques thsang, pour les dont faire faits auxquelles
INTRODUCTION; nous ne et que srie saurions atteindre?, dans l'tat
connaissances, dans autres devaient suite au cette
M, Rmusatauraitclaircies; et de commentaires; Soung se proposait mrite de les ce vues de yunjet de
de mmoires tels l'objet que ceux-de
voyages, tre Fol qui les
et qu'il
::de pudernier ing-
KOU KI. Le y sont
nouveaux
exposs,
il estrempli,
observations tout
pleines nous
sagacit resi
y remarque,,montrent dans cette tche
assez
ce que
avons
si heureusement interrompue. et Hiuan un des thsang sicle poques
commence,
mais
inopinment,
si cruellement yun contres, pour souvent discuts,
FA -.HIAN., Soung; couru Leurs mines, qui, les mmes
ont
tous
les l'un et
trois
par-
de distance diverses et quelquefois points sur
de l'autre. bien dter-
rcits des compars
offrent, dtails, et
semblables fixent des
diffrents, de
trs-importants
chronologie phie
religieuse,
et fournissent aux
l'histoire
et la gograde rencelui de accorder, qu'elle l'Inde partout ne semo au tait elle sur de de ce
de l'Hindoustan, prcieux. au temps
ve, vie et vne sicles, l'tat FA du
beaucoup et relation fait
seignements l'Asie dernier sur doit blait, le les pas entire
Mais de
Bouddhisme la
HIAN rendent
particulirement deux autres, par son dire, avait secte influence au rapport
recommandable, M. Rmusat, antriorit. de ses et encore, sicles. une
et lui ont prfrence en effet, Elle en les
seulement ainsi
Alors, limites. toutefois, dans
pour
sortie pntr,
tait
Bouddhisme cette son
se rpandant lieux o elle
loin, ne, n'avait, le
conservait de quatorze
Dans perdu
l'Inde
centrale,
de FA HIAN, rien si, emport, dans quelques la pratique
de sa supriorit les partisans
Brahmanisme; l'avaient
contres,
celui-ci
et les crmonies
du Boud-
INTRODUCTION; dhisme; ' cela une cess antique les avantages assurs et Bnars, ses adeptes, n'avaient de nos jours tait pas
XLV pour
d'existery
si)renomme
comme de
Samanens. constatent,; fini'par pondante dentale hors ration, elle et
cole de la sagesse ds Brahmanes, ' de = La ' lationf Soung y un et celle au contraire; la suprmatie 6 vi^etvn sicles, dans ls que les
peuple
d Hiuan premiers
thsang avaient corresoccisitus l'altAinsi, avant
conqurir de leurs
aux
et l dcadence rgions Dans moyenne, les pays
opposantsde causes
septentrionale d'autres
l'Hindoustan. avaient
de l'Inde, les avait autres perdu
contribu,
les unes
i'anantissement un grand nombre
de la foi bouddhique. de ses sectateurs, mme
la conqute de la religion Hiuan altr Tsoung pays thsang,
de la Perse
par les Arabes, par suite de f introduction de Zoroastre dans la Boukharie. Ainsi, au dire de la domination et dplac des les Turcs avait dj, de son des runion Turcs; temps, monts des devait,
les moeurs
populations des la Tartares dfaite encore
l'ouest etla des d'autres
ring ; ainsi, occidentaux annes galement
la soumission l'empire aprs amener
quelques ments
plus
tard,
bouleverse...:;:.".:..".-...
fcheux. des moins Gtes, qui modifia sur tout les ces que les
La ruine n'eut du pas
de la puissance une influence Depuis tant sur de la
en Asie, destines peuples dans doctrines chantrileurs auquel introdans la
remarquable
Bouddhisme. soumis, occidentale
s'taient partie
les pays longtemps, que les deux rives de l'Indus, Chine, en reconnaissaient changeant disperss qu'avaient
bouddhiques; grent bus, pres, ils duit aussi rduits
mais de
la plupart, et les la vie dans
de matres, par petites mene le culte ils l'avaient plus
religion,
Gtes, errante
de nouveau partout,
portrent
leurs comme
migrations, partout
taient dans
demeurs leurs
fidles,
envahissements.
Si on
ne le retrouvait
XLVI les lieux o ils avaient o d'eux ils
INTRODUCTION. rgn, il tait un dans tous ceux, Les bien plus le venus en sorte de o il
nombreux, reurent grossir qu'on son est qu'il
avaient
cherch hordes eu
refuge.
Tibtains taient lors,
; quelques semblent en avoir pourrait les dans considrer toutes
tartares
qu'ils ds la cause nord part
connaissance comme tant du tout
premire de l'Asie
extension aujourd'hui pt
les
contres
dominant,
quoique
s'opposer
ce
Pour d'tablir presque jours nastres saints et les curiosit
y pntrer jamais. aux pays nous en tenir quelle teint tait dans des sa situation, les provinces religieux tombaient et les valles n'offraient thsang,
et l'poque o il nous importe nous le trouvons, au vne sicle, orientales y diminuait; en ruine; qu'habitent de la Perse. les tours Tous et les les mo-
le nombre abandonns se perdait, Bloutches de Hiuan
l'intelligence prsent
des livres les Afghans et la pieuse de la religion vue tra-
plus que de
la vnration faibles vestiges
avait t autrefois qui'y si florissante. L'Ouclyna ditions thsang qu'un tant ont que petit pour t des nombre le but tirer, racontes souvenirs
transplante,
et que FA HIAN y avait et le Kandahar, o tant de saintes F presque croyants. que HIAN, ne fournissent ; il n'y
Hiuan compte donc que que plus plac, nous son
effacs
de vrais de son dans
II se trouvait pour l'instruction
voyage,
en pouvons prdcesseur; bien y trouve lixit dont que dans ils sont pour des
des
circonstances quoique
moins plus que
favorables tendue,
aussi gards,
sa relation, moins
a-t-elle,
d'importance on y remarque, de ne peut qui
celle avec
de F HIAN. On une dans grande pro-
plus les
de lgendes, dtails,
beaucoup et elle
prtention plus ne les gure pas
la manire d'intrt dans le double le
prsents, regarde ce
offrir dcrits sous
ce qui
les pays qui
sont
FO KOU KI. Tout
concerne
autres,
INTRODUCTION. rapport trois de sicles la gographie entre nous et les de l'histoire, voyages, l'occasion peut Enfin rsum tre dans ayant l'intervalle t,
XLVII des dans le
couls que et
deux
Commentaire multiplis comme volume,
publions, tendus, connu. un
de rapprochements considr qui dsormais termine thsang ce
d'extraits
suffisamment et qui contient des jusqu'
l'appendice de l'itinraire
de Hiuan
et le sommaire tion, pourra, que toujours
particularits un certain devait les
les plus point, tenir
essentielles lieu tout
de sa rela-
de la traduction en laissant dont nan-
complte moins
M. Rmusat regretter
en donner, claircissements
il l'aurait
accompagne. Le voyage pour religieuse travers de des de FA HIAN n'offre la gographie des contres qui, pas positive des que avantages pour Mais ont moins l'histoire la marche disparu conpolidu dans
sidrables tique plerin l'espace qu'il est et
orientales. pour tait la plupart, aussi Ces ces tours
pays
quatorze
sicles
difficile difices votives dont
reconnatre il dcrit rencontre par leurs qu'ils d'autres ruines occummes, une faire verra reque les
important ces ont
de la constater. monastres, fait place des culte. du
magnificences, chaque peuples, eussent paient, effacs tche vivre pas,
qu'il
monuments Avant sol, mme
levs que
consacrs disparu les noms du souvenir d'une aprs
un autre de la surface qu'ils des avaient hommeji,
l'emplacement taient,
port,
sur les lieux pas entreprendre de les On
N'tait-ce que milieu
redoutable tant n'est de pas
difficile, sicles au gp restjlu-dessous
d'essayer de nous? de tout
M. Rmusat de son ruclit. dres habilet Il suit
ce qu'elle
exigeait comme des moinmieux
et de ses connaissances cjftique pas, afin de tenir note l'itinraire^as comme relatives la position des villes,
particularits les signes
et pour
observer
caractristiques
de chaque
localit;
il suppute
XLVIII les distances, ceux les qui chant de ceux ou qui calcule
INTRODUCTION. les positions, tudie rvolutions les compare les noms produits et avec par cette d' prsent le temps, sagacit rapprochinois, indiens,
d'autrefois, les
changements de tout genre;
guerres, dmle les
le certain, renseignements
le probable, transmis en trop
le douteux par petit d'autres nombre,
et le faux, crivains des livres
qui
ont
t tirs,
appartiennent sans interruption leur
des
voyageurs
occidentaux, visits noms par
il parvient
tracer
la srie
des points leurs
FA HIAN, traforme chidans parties lesprind'un apprpravant par s'est ras-
dterminer vers les
position,
retrouver modernes,
anciens leur
transformations ces noms d'origine
rtablir que Les les
dans
primitive noises quelles cipales Mmoire cis sents de les
indienne
transcriptions
avaient il est de son
rendus entr
mconnaissables. cet gard et faits veulent d'une constituent forment
discussions une des
Commentaire Les saisis, rsums ou mettre tablir. un seul dans leur
en
outre tre
le sujet bien soin,
particulier.
de ce genre, tre
pour
et facilement avec suite,
coordonns spciale. procder les moyens de M.
avec
manire
Il faut, par analyse, dont on en
gnraliser et les dans
de les appliquer, au Tel grand a t jour
dductions servi pour
le but les jointes tant et de mis
Rmusat
semblant phiques prsentant rflexion ments, dmontrer l'Acadmie pas tre
cadre les
tous notes
claircissements sa traduction, propositions en resserr Ce ordre les
gograet en dont divers pour a t une len lu
dissmins dans
ensemble avait pes svre les
scrupuleuse dont un jugement d'avance
avait
la chane qui
tous
rsultats.
Mmoire, i83o,
des Inscriptions imprim dans
la fin de l'anne le recueil par des travaux de les la
ne tardera savante ac-
de cette publication
compagnie. tuelle, il y
Indpendant, appartient par
sa forme, fond, et
le
conclusions
dduites
INTRODUCTION. des nral, questions doivent qui y sont agites, ici. le rsum des principaux faits Rappliquant l'ouvrage
XLIX en g-
trouver
place
J'offrirai, rsultent avant lopps de
dit M. Rmusat, l'examen auquel ou du
qui
le travail d'obscurit, des
FO KOU KI, et qui me semblaient, il a donn ou incertains, ou envelieu, inconnus. leur une exactitude prcision Le caractre en matire parde rapour peut
entirement chinois,
ti ticulier chronologie,
crivains permet travaux
d'atteindre les plus dont
qu'obtiennent quand ils ont
rement sujet toujours ayant les
les
approfondis, la date
livres suspecter
indiens,
est ignore donc au
et qu'on regarder
d'interpolation. constants points tait aux tous
On doit la Chine,
comme du
ve sicle, i l'ouest Ougours, malaya. clbrait et cette noms On Le du
rputs les huit
commencement
suivants. tabli
dans du petits la Tartarie lac tats de au centrale, Lob, nord chez les
Bouddhisme grand dsert,
environs les
Khotan, y voyait crmonies y tait
dans des
de l'Hion Fan, des y
monastres indiennes,
peupls
de religieux, la langue naissance
des langue
on y cultivait pour donner
assez
connue
de localits. mme dans religion tout tait encore qui plus florissante l'ouest alors les de mon-
2 La l'Indus, tagnes tasira, culte,
les tats
indiens
occupaient
de l'Afghanistan, etc. Les
Oudyna,
Gandhra, port dans ces
Beloutcha, les pompes contres
Tchyoude leur
Bouddhistes locales
y avaient placent
et des traditions vnements des et des textes
le thtre la des encore en des
de plusieurs rdaction langues que fait
relatifs sacrs. Une
Bouddha, extension dans
ses voyages, si remarquable n'tait incontestable, l'rudition
docLrines
de l'Inde rend
l'occident
souponne. connatre
F HIAN en l'poque et
l'existence et fournit
l'origine,
L matriaux combinaison 3 LTnde du et tort Gange, Gogra, qui lui
INTRODUCTION. manquaient pour expliquer orientales. le pays du du Npal, qui est situ les rivires qu'on mouni pre lequel sur le bord le mlange et la
de plusieurs centrale, entre est la les
doctrines c'est--dire
montagnes patrie
Djoumna avait est tait n un
vritable dans
Bouddhisme, Shkya Son
transporte aux de
le Behar d'Aoude
mridional. et deLucknow. du roi
Kapila, prince
environs
ce pays,
tributaire
de Magadha, s'est accomplie
rsidait du
Pt'alipoutra. Gange, dans les
Toute"
sa prdication d'Aoude,
au nord
provinces
de Bnars au nord
et dans dans
le Behar le voi-
septentrional; sinage 4 serv, rit tion des Form en politique jusqu'au
il a fini montagnes dans
sa carrire du Npal. centrale,
de Patna,
l'Inde avec traditions
le
Bouddhisme une remonter Des sorte
y avait
con-
opposition : des
le Brahmanisme, la faisaient notre dont de ces re.
de supriointerrupdont en ruine,
sans monuments, taient
xe sicle
avant
plusieurs confirmaient 5 aux Le
subsistaient
encore,
quelques-uns traditions. jusque dans
le tmoignage Bouddhisme du que dans des la avait Gange.
pntr
le Bengale,
et
embouchures 6 On assurait
la mme
religion et il
avait
aussi ds lors,
pntr dans on qu'on
trscette faisait les
anciennement contre, remonter comprenait 7 de
le Dcan, en
existait de
excavations construction dans les temps tait
forme
temples,
dont
des
poques
si recules
mythologiques. dominant avec Ceylan, et les crmonies On y trouvait du voyage des de de MM. E.
Le Bouddhisme
ce culte
s'y clbraient On 1497e s'y
magnificence. dans le tre le moment nirvana ajouts
livres
religieux.
croyait, depuis
FA HIAN, la Shkya mouni.
anne
(l'extinction) ceux que
Ces faits
doivent
INTRODUCTION. Burnouf l'introduction 8 dans faciliter un On toutes et Lassen du cherchait les parties ont si bien discuts Ceylan. des langues sacres, la On d'Aoude, il n'est entre en entreprise pour fixer l'poque
LI de
Bouddhisme par de des dans l'tude
l'Inde, textes
complter religieux.
collection avait Patna,
et
l'intelligence nombre
recueilli Bmende ces
trs-grand
la province ; et toutefois
nars, tion textes, La lesquels faits les de
au Bengale, la diffrence selon recherche ils taient contenaient, du riche et les qu'il autant long qu'ils
Ceylan qui taient
fait aucune le dialecte
devait crits
exister
en sanscrit l'tude des
ou en pli. diffrents des idiomes doctrines des lieux dans et des saints, H dides vo-
de ces livres, rdigs, tels plerinage
la connaissance taient, avec
qu'ils motifs
la visite par
entrepris thologiques,
notre de
voyageur. souvenirs
revenait fiants, lumes choisie
d'enseignements dtails qu'il procurs nombreuse. donne
sur
le titre que
et le sujet la collection
s'tait que
montrent
en tait
son premier soin A peine arriv, est de faire des richesses les Samanens profiter qu'il rapporte et du savoir il ne a acquis. Il ne reverra qu'il pas sa patrie, devoir ne soit rempli. Au prendra pas de repos que ce dernier Tchhang Nanking, o avec le conlieu d'aller 'an, il vient cours travail religieux avoir de fut d'un docteur indien, et nomm Pa lo thsan, relatif sans il entreprend doute aux un traits
de critique et aux
de rdaction,
donn
et qui pourrait prceptes qu'il avait rassembls, traduction des livres du lgislateur lieu la grande en ou cent quatre quatre-vingt-douze ans aprs (vers mille 4-i8 versets, qui
la haute excute
Asie, trois
), et laquelle
c'est qu'il FA HIAN a probablement Ce qui est certain, pris part. des Soung, n'crivit la relation de son voyage que sous la dynastie et l'anne 419. Elle fut revue par consquent postrieurement
LU publie thsin. la de nouveau Cette dition
INTRODUCTION. sous est roi sur les celle [Fourm. diffrents Ming, qui par nous Hou a servi; et fait tchin elle partie heng et Mao
appartient d'une collec-
du Bibliothque tion de dissertations et de littrature, acadmies, et que et
cccrv), sujets
que
M. Rmusat avait
de philosophie, d'histoire aux mmoires de nos compare pour est aucun par mise la un recueil rputation de traits dont de science quelquefois ligne des dans le
Fourmont l'art
prise Telle n'est
sur
la magie
divinatoire. qu'il
FO KOU RI jouit et d'rudition mme les o
en Chine, il ne Son soit
rpertoire fragments,
reproduit est
en totalit.
autorit
en qui
premire traitent
ouvrages
de gographie et on tous les la trouve articles
et d'histoire invoque sont dans
peuples de Khang
trangers, hi, aux dont
le Dictionnaire de citations
remplis
empruntes
meilleurs Le style de
crivains. F HL\N est appliqu simple et faire concis; perdre plus M. rien Rmusat s'est a
particulirement d'original gante que , pour l'on
ne lui une
de ce qu'il qu'l-
et de naf. ne pas
Il fallait altrer jusque
traduction
littrale
ce caractre dans dire
de bonne
foi et de vracit expressions, et que :
remarque mot porte
les moindres avec lui. J'en
chaque
pour
ainsi
citerai
un exemple quand du que, pros'il
la locution il parle nom s'agit a telle Kieou confrres, dinaires scrupuleux qu'il mle d'un
de F HIAN est pays
: de tel lieu on vient se servant se dsigner pas all, pour et pour presque lui-mme; il dira satisfaire cder
tel autre, toujours tandis
o il a t, pour
personnel d'un ville. ma pays
indfini
o il ne soit
: telle
distance
il y de ses
Il crivit lo chi, de
sa relation son matre,
la demande aux voeux de
jaloux
conserver
le souvenir Mais invent conduit
d'aventures observateur une dans seule ses
si extraornon des moins fables
et de travaux que crdule,
si mritoires. il n'a pas
sa narration.
Il tait
explorations
INTRODUCTION. par un sentiment cieuse superstition; cune bellir lit circonstance, qui n'admet aussi il n'a mme dans Ce qu'il ce qu'on grand Si l'on et les de pas l'inexactitude, aucun pouvait fait, avoir une
LUI conscienaud'emfidce
embelli ce qu'il a vu, lui soin
dissimul intrt la mme
ou de dissimuler. qu'il rapporte cas, tout
il le dit avec a cont; de
seulement, qu'il
dans ne
dernier que autres aprs raisons portait, de voir les sur
il a toujours d'autrui. chinois parcouru persuad pieux choses Tout motifs comme entier tout, certains ce
prvenir ses rcits qui, on devait
parle des
la foi voyageurs
rapproche occidentaux
de ceux
plusieurs
sicles
lui,
ont
mmes sa
contres, Il
a de nouvelles l'habit qu'il
d'tre aux les
sincrit.
dans son entreprise, qui le soutenaient il les a vues, et de les dire comme obligations les les prodiges reliques de son dont qu'on apostolat,
il
a dites.
aux sont lieux,
l'occupe perptu crmonies y a levs habitent il n'est perfection o est
avant clans
ce qui le souvenir s'est y conserve, les qu'on et qui culte, de
qu'on
y pratique,
les temples qui attach
et les monastres desservent qu'il soit les uns son
et le nombre les autres. encore o l'on
des religieux Mais quelque
pas
parvenu considre qualit
ce point le repos
d'idalisme, comme
ce degr
la demeure
de l'me, L'inaction son unique
l'absence loin d'tre Il est
de toute toute
est le propre et tre
de la raison.
sa morale sans
la contemplation fanatique. les sentiments, les faiblesses nous pour Chez
vertu.
superstitieux n'a pu teindre faire le font
le religieux, commander de l'homme, inspirent ses actions plus et
l'exaltation toutes
tous taire aimer
les impressions, nous
toutes
et ces faiblesses
davantage, plus d'intrt
de sympathie pour sa personne, il dit Quand pour ses paroles. n'exagre tre basse. rien; En elle est modeste
ce qu'il sans
a souffert, tre humble
expression sans et humble dit-il, mon coeur
son
rcapitulant
ce que j'ai
prouv,
LIV s'meut prils involontairement. ne sont par fait les
INTRODUCTION. Les sueurs qui ont coul dans a t but pas l'objet auxquels Caucase inau mes conqui sr de
pas le sujet sentiments ma vie,
de cette qui dans
motion.
Ce corps C'est o l'on mon n'est tait
serve m'a
m'animaient. des pays
hasarder
de sa conservation, mon espoir, tout
pour risque. les
parvenir jusqu' La description dfils son
ce qui des
dangers du
il chappe dien, milieu les des
en traversant larmes neiges un pendant des traits qu'il
impraticables compagnon qu'il le rcit quelques de candeur
donne
succombant prouve
de l'Himalaya,
l'motion
Ceylan
en rencontrant ses core craintes , offrent
de ses compatriotes, la tempte,
de sa navigation, passages ensen-
autres et
touchants
de vritable
sibilit. Le FO KOU KI, dit phique, par est crit dans M. Rmusat un style dans son Mmoire et qui le sujet connu. et imbus. et des indiqus le livres de par souvenir sacrs. qui gogra-
trs-simple ; mais fort peu
ne prsenteque le voyaparle
rait is geur
lui-mme
aucune nous est
difficult encore est
affectionne homme
Il en s'adresse Les
en
qui qui traits
ce
sujet
familier
d'autres
hommes les
en sont
pareillement
reliques, saints un seul secnous nous
les prodiges, de la mme mot, taires qui et qui ne
de la vie de Bouddha sont pour le plus en souvent
autres par
religion, suffit nourris
ce mot sont
rappeler des
des Pour qui
de la lecture que des lambeaux et ont laissent
possdons de peuples indications Un liturgie,
lgendes, diffrents
viennent de telles
divers nous grand de
pass
idiomes, beaucoup de habi-
ncessairement d'expressions qui
d'obscurits. termes tudes ouvrage de
nombre tours
de phrases rendre cela sera
asctiques, attestent des
monastiques, embarrassante.
contribuent Tout
la lecture expliqu
de ce petit ailleurs, et la
INTRODUCTION. seule lative tendre de observation la nature d'un voyageur des que des j'aie prsenter dans qu'on Ayant ce moment est pour en objet droit est
LV red'at-
renseignements de cette espce. de
principal nglig de
s'instruire
traditions
sa religion, pas, les par
il aura directement chapelles, les reliques
s'informer rectement. rendus
de ce qui Les clbres
ne s'y rapportait les monastres, ou
ou indiles lieux que l'on
temples, par des
prodiges,
ou parce y conservait, que de saints personnages s'y taient arrts ou y avaient laiss des traces de leur passage, voil ce se proposait de voir, et c'est aussi ce le qu'il qui est devenu sujet habituel de ses remarques. Partout o il est conduit, ce qu'il voit avant les de tout, c'est le nombre des moines bouddhistes qu'il pr-
qui peuplent a recueillies dilection grossir mme celui de
monastres prfrence
; voil toutes
les notions autres; ici son
statistiques une
et comme effet ordinaire, manire
exclusive le nombre raison des
a d produire des Samanens, que Juifs Benjamin
de la mme de Tudle a t
il a pu et par d'exaLa
la
accus voyages.
grer
course de tout cela des sont mais sur l'Inde,
avait trouvs dans qu'il F HIAN est un plerinage entrepris intresser le culte consulter. des auquel Des
ses pour
s'instruire vou, absurdes, la son liturgie livre ; et
ce qui pouvait le rend
il tait fables sur
mme traditions surtout cela les
intressant
mythologiques, ce dont il
observations et voulu
a rempli n'ait relative laquelle
remplir
n'empche noms et la
pas qu'il position pour
occasionnellement des on ne tats et des pas
recueilli, villes d'autres de
une
poque
possde chercherait dans
renseignements, les crits
des indications des occidentaux, Sa relation que pour est
que l'on
vainement ceux des pour orientales. Inla
dans diens
et peut-tre donc aussi
eux-mmes. compare,
prcieuse
gographie
l'histoire
des rgions
I.VI Il faut mires pour seulement que tracer l'histoire un si long
INTRODUCTION. s'entourer, de l'Inde itinraire pour peut l'entendre, fournir, de toutes et user des les lu-
de critique encore
travers
contres
si peu Dans doit celles tient tre,
connues. les en
ouvrages effet,
de
la
nature par
de des
celui-ci, concordances
le
premier analogues tout
soin
d'claircir de base
qui
servent
la gographie des localits. t plus
ancienne, Celles-ci bien
ce qui
la dtermination dont elles
reconnues, et s'exou le
les vnements pliquent plus voyage mieux,
ont
le thtre facilement,
se conoivent et deviennent avions,
se vrifient ou moins thsang,
certains
vraisemblables. les mmes manquerait des re.
Si nous moyens peu
pour
de Hiuan
le FO KOU KI, il nous pour sept un geur la gographie premiers ouvrage sicles inutile, sans
de critique que pour de notions importantes de l'Inde, dans les
et l'histoire de que notre
royaumes Mais
ce serait
entreprendre ce voya notre des re-
de se borner les
traduire qu'il
ce que peut avoir exige
a racont, et
examiner
titres cette
confiance; cherches sances mis que d'esprer
malheureusement elle
entreprise une runion qu'il On pourra
si considrables, si peu
suppose possdent, de sitt. a t
de connaisgure par perles
de personnes tenter
n'est
de la voir
juger,
rsultats pensable Des pays
auxquels dans cette
M. Rmusat occasion qui
conduit, nglig connus
si le travail sans
indis-
peut n'taient
tre
inconvnient.
et des
villes,
taient leur
compltement
ignors,
reprennent, mesure;
que de nom ou qui au centre de l'Asie, d'autres, leur de ou qui n'avaient ralit Kapila, gode
place
d'existence graphique. Kous'inagara dans
n'a jamais que le compas que dans la mythologie, La et position d'autres de
recouvrent de tous primitif, Vais'li, plus
Ks'ala,
royaumes,
moins
fameux pour la
les annales
du Bouddhisme
est dtermine
INTRODUCTION. premire tout canton fois avec prcision; et un par royaume, particulier. empires,
LVII F HIAN entend o L'poque comme et l'Inde, princien a
il voyageait la Tartarie, pauts
ou petit pays ayant n'tait pas celle des se trouvait morcele qu'il et ceux-ci
nom
grands
en beaucoup des
de petites Il nous
indpendantes transmis les noms, cueillir, nations des lutions forme qu'ils musulmanes villes qui soit
appelle sont
royaumes.
galement territoires soit des ont
intressants
re-
correspondent les ont
des remplacs, ou
o les dnomiappartiennent dont fois les rvochang la
qu'ils tats cent sont
aujourd'hui ont boulevers
dtruites,
le sol de l'Inde Mais les ces noms
et dplac
les limites. ce qui
orthographis de les rendre
la manire souvent retrouver fort
chinoise, difficiles
dfigure
au point
reconnatre
; nanmoins et
M. Rmusat tablir sa
a su
les
dnominations en n'employant svre puisse
originales que avouer. moins des
synoymie que la cri
gographique, la plus tique appuyer qui plet ses
combinaisons
Il a gnralement sur des que
cherch
peuvent des
rapprochements, induire facilement relatives
en erreur, la situation
de sons rapports sur l'accord comdes lieux. par Quelque l'auteur
indications
frappante chinois
du nom que soit la ressemblance avec un nom indien reconnu pour circonstances dans
recueilli ancien,
il ne l'admet qui d'une peuvent concimanire fondatous
avoir discut les qu'aprs la confirmer ou la dtruire, dence qu'une mental, fortuite premire a, d'erreur des
historiques la crainte de tirer errones, au
consquences mprise, en erreur, dont les
de la mme sujet d'un point
commise conduit Chinois
Deguignes ont dans eu
dplacer connaissance. dj
les pays occidentaux On ne doit pas, se reprsenter cette poque,
dit M. Rmusat, d'un si elle
le Mmoire qui sortait
cit, de
la marche comme
voyageur avait lieu
de Chine dans H
maintenant,
Lvm vastes tats dont les
INTRODUCTION. limites sur nos sont cartes. bien fixes et peuvent alors tre rde tait princidonn Le et lieux m-
gulirement petits royaumes sujette
traces dont
Il existait mal
beaucoup
la circonscription,
dtermine, des pas
encore pauts
varier lieux
en des
chaque instant. Il y avait n'ont nos gographes auxquels l o ils ont donne sur que marqu des des
de noms, voyageur quelquefois qu'il
et des chinois
villes ne
dserts gnrales des et cette
indications et la position le rhomb, fait
trs-vagues,
l'tendue marquer est tout chaque milieu d'en
a parcourus. dpourvue corrige une
Il se borne de prcision pas les route impossible de rsultats au
thode on n'en
insuffisante Si l'on absolument position clbres, m'ont des trace
quand devait incerdes fourni ne
instant. pays aucune fleuves nom,
tracer connu, Laine. villes
pareille
d'un
il serait Des dont
dduire des le vritable
chanes j'ai points russi fixes
montagnes,
retrouver entre beaucoup d'une
quelques saurait L'histoire,
lesquels de
l'itinraire la ligne est aux
plerins sur
s'tre en
cart plus
la carte. des
occasion, Quant
venue
au
secours
combinaisons trois marche roule mers manires en qu'il des
gographiques. de Tartarie, a faites Indes les indiquer. dans par les eau,
distances, par les
F HIAN a journes parties soit dans de de la les mais qu'en sont mesure
II les dserts, soit sur
value et dans le Gange, est laisse
et de la Chine.
Ce mode ne
trs-imparfait, de les regrets distances
l'incertitude deux ou
qui en est insparable trois endroits de l'itinraire. le voyageur surtout quand estime plus noncer les il est la exprime question 260e
Quand en
trs^petites,
li de la Chine, des contres degr,
variable, et qui mme s'en
trangres, peut-tre l'auteur ne
peut une
tre fraction
partie Au reste,
d'un
petite.
comme de
sert
que
pour
floigneinent
certains
monu-
INTRODUCTION. ments entre eux, et qu'en il n'y a lieu la mesure son voyage, sera ces occasions ici
. mme, dans il fait
ux souvent
usage des ce sujet. plus l'Inde,
pas, Enfin
d'entrer qu'il est
aucune dans yan,
discussion la de
emploie le yeou dans
intressante dont
de
la portion ou yodjna
la longueur des
value
les
notes. rapportes par
Quelques-unes F HIAN ou jusqu'ici explications sentent 1re d'avec prouve, gine erreurs sont faits tantt qui en Mais tine ainsi sacrs. acception ture ne une rait du pouvait des plus les ou
particularits
historiques
il fait allusion, des vnements auxquelles ignors dont la scne avait t dplace, ont ncessit des dont l'tendue varie en raison de l'intrt que prpoints discuter. et la Les distinction (Shkya); de notes du relatives Bouddha celles dans la fixation mythologique lesquelles de rectifie de -Shkya, des on l'oriles de
bouddhique le Bouddha contre
historique les hypothses indienne; au sujet du
Bentley, encore de
l'antiquit o l'on
de la civilisation commises de vritables est tablie, d'aprs ont
celles lieu dans leurs
la naissance
dissertations tantt leurs d'aprs consquences le souvenir. la plus des
lesquelles causes et
la probabilit circonstances, tmoignages
et leurs des
la valeur
conserv
la partie l'exposition
considrable rites des et de la
du
Commentaire du
est
des-
morale l'usage
Bouddhisme, a conde que leur la na-
qu'
l'interprtation sortes ordinaire, sujet ramne faciliter grandes une de
termes en forges et
que partie
religieux
Ces
d'expressions, en partie souvent l'intelligence, difficults celles
dtournes
arbitrairement, aucun secours pour vaincre, plus o le
dont
europen traducteur, et on pour suront ou
taient, qu'il et
ajouter, Dans
monter. des
l'apprciation merveilleuses,
avait le qu'il d'une doctrine un mot
d'intrt les mal syllabes reconnu
proprits
nglig,
ix mai nes. dialecte tient les traduit Les peut
INTRODUCTION. entraner dans rpandus sorte de langue les consquences l'Asie d'association, et qui : c'est tre est celle les plus orientale qui commune que les elle pour toutes ont erroun
Bouddhistes part, une nation de F<m la et
dans
aucune peuples
en particulier, croyance croit
n'appar tous Chinois n'tait lesquels les dnoil ne
mme que l'on
appellent pas moins
le pah\
Comme
familire il ne
il crivait, minations trouvait tion de
F HIAN qu'aux s'est pas fait scrupule qui lui convenaient
Samanens d'en tirer
mystiques pas mots
et pour Il a ainsi
lesquelles rempli
d'quivalents d'une
en chinois. souvent
sa narraet quel-
signification moiti chinois, grce les dans
embarrassante indiens,
quefois plus
douteuse,
moiti
ni indiens, d'une les
ni chinois, langue o
l'altration
et qui ne sont en qu'ils ont subie suffisent entireque, dans
passant toutes ment
lments une pour autre
orthographiques langue presque On sait
intonations, de moyens
dpourvue
les exprimer.
ces transcriptions, disparat destines qui doivent le totalement, veiller frapper mot avec
le caractre et que la pense, l'oreille. indien certitude et l'on ces manque Fan est ne ainsi les
symbolique signes, ne sont
de l'criture au lieu d'tre des des
chinoise images
plus quand
que
articulations du son ne le est peut sens
Mme
l'analogie ou dfigur connat que
vidente, tre qui restitu
reprsent que
qu'autant doit pas
l'on
lui est affect, faciliter 11 ne des mots
se dissimuler ne soient
les secours encore trs-
propres insuffisants. la valeur une
rapprochements pas de
nomenclatures mais elles
indique, pour
o thologiques sont loin d'offrir pour les
synonymie : non dans
complte
le nombre, qui de
satisfaisante on les doit sacr; leurs
explications trs-verss qu'ils
que les crivains la connaissance souvent
ne paraissent mais parce
l'idiome dans
semblent
avoir
consult,
interprtations,
INTRODUCTION. moins qui mitifs, mme en l'analyse a t des de exacte faite dans drivs jeux des termes secte; de la langue, donnant et des de mots le prs, mode que ainsi, des l'application comme allusions usuelles.
LXI
leur et de
priou
sens vritables
mtaphoriques, mots, comme
formes de cette
La comparaison a permis plus
d'un
trs-grand d'en
nombre reconnatre exceptions
espce le qu'il a
M. Rmusat
d'altration
habituel, sont plutt
et* quelques dus une qu' de des
les rsultats et d'une
obtenus gnrale, La
mthode
rgulire
application et partielles. orthoon doit
combinaisons termes prcise dans du
diffrentes leur dans
restitution
quelques
vritable lequel
graphe,
et la dtermination ont ncessit
sens
les entendre, lieu son des travail
des recherches tendus. Dans
considrables toute approfondie lumires dans de cette cette des celui carrire.
et donn partie langues de tous L'aucelles et il de
dveloppements qui M. qui M. exigeait Rmusat s'est une s'est avanc Burnouf la
connaissance aid le plus tait du ; il lui des loin
de l'Inde, nos torit dont aurait savants de il
Eug.
trs-petit aimait
nombre
de
reconnt
comptence qu'elle seraient m'tre suprieur, elle
parl
ici de l'appui conoit s'il et qui pouvait mrite
a prt,
l'invoquer, dans des termes de mes les
que
ma pense personnels, naturel t d'un Les sion de
l'expression permis de
sentiments Juge et
manifester. sa bouche la mienne. fait
tout
la louange serait auxquels dplace notre notes les
dans dans
prix lgendes
inestimable,
et les prodiges l'occasion s'est born sans aucune sont de
voyageur tendues,
alludans
ont
t on
plusieurs
assez
lesquelles de ces
raconter chercher consquence.
principales expliquer, Les
circonstances et encore historcits, qui sont
vnements, en tirer fables aux
les
moins
explications mais ces
des riques se rapportent
rarement
heureuses; prdications du
premires
Bouddhisme,
LXII l'expression pour absurdes mmes, qu'aux et au peine qu'on d'une puisse
INTRODUCTION. pense se thologique en Si, attention font au droit lieu qu'aux encore de de les les usages trop peu. connue quelque en eux-
croire
ngliger, considrer qu'ils
paraissent. qu'ils on veut ne faire habitudes degr des qu'ils
rappellent,
revivre,
qu'au
genre on y
d'intelligence dmlera lieu sans des
d'imagination enseignements intressantes.
qu'ils utiles Il faut qui
supposent, qui pourront en dire autant servent En ne nous qu'on content laissant et
donner de
remarques de ces
conceptions
tranges bouddhiques.
de base nous
quelques-unes la mythologie pas tirer l'asune
et la cosmogonie pect qu'elles prsentent bien toujours leur le
arrtant
en apparence, de celle s'est sens,
en pourrons a eu de chacun une de dessein les
instruction Presque prtendre conjectures, pour oblig des quels tiques, ligieuse tion, les les de
diffrente M. Rmusat trouver vague un des Dans choix, ou svres
d'offrir. sans des
exposer la libert
hypothses
latitude tout
immense claircir, de combiner les traits, et
applications. faire un
l'impossibilit on le voit moins opposs, ou que
occup
termes qu'ils qui du discut ides
quivalents soient, concourent Bouddhisme. avec thoriques des ont Mais poques le plus
de rassembler mais tous
grotesques, le tableau a observ
caractrisred'attencomment
former Ce qu'il de soin lesquelles diverses
de la philosophie avec le plus c'est cette
et de profondeur, se et par fonde
sur
philosophie, influences doctrine doc-
conues diffrentes, identique. trinaux
soumises
des qu'une
fini nanmoins en examinant il s'est bien
ne composer de tous
les
rapports d'riger
les points
entre
eux,
gard
ces rapprochements Avant des de juger, vi-
en systmes il compare, dentes,
et leurs
consquences ses
en principes. que sparant sur
et il n'appuie authentiques,
remarques
preuves
incontestables;
scrupuleusement
INTRODUCTION. ce qu'il distinction conduit ment, ses sait avec certitude de de ce qu'il la science avec l'aveu ne fait positive ce que supposer. l'opinion conoit
LXIII Cette le
rigoureuse toujours
d'avec qu'il
exposer avec candeur
nettet de
claire-
faire doutes qu'il corriger, si pineuse, vu, tout sur
ce qu'il ne
ignore, pas
proposer dire que ce
ce qu'il
souponne.
On
veut
travail, rien sion tout ies
n'a
eu le temps rien dsirer.
ni d'achever, Dans si les ou ces
ni de revoir, questions il ne qu'il heureuses, aplanir travail, voudront, t le germe d'une
ne laisse discusavoir poul-
d'une
solution parmi de plus Toutes ouverte,
difficile, tentatives moins
saurait a faites
approfondi; il y en aura d'inutiles. d'avoir de dont et
rsoudre, pas
il ne s'en la route sernou-
trouvera qu'il viront velles le texte, La a paru dont pour
contribueront et son qui
a la gloire longtemps rflexions continuer
sa mthode par de
guides les
ceux
siennes
auront ses essais. sans en
et comme
complter
narration convenable il ne la peut
de F HIAN se suit de rsulter la distribuer
aucune chapitres. quant
division, Cette
mais forme,
il
aucun
inconvnient d'une rendaient les renvois.
l'original, que les pour du
a, dvefavoFO
traduction, du citations
l'avantage Commentaire et faciliter en entier dans les
classification indispensable La sauf
loppements riser les
traduction quelques et qui
KOU KI appartient qu'il assez avant avait du de laisses soin le
M. Rmusat, derniers apportait chapitres
lacunes
LmoiguenL passage vingtlivre. de Dix s'arde
minutieux commenter. ; c'est M. charg n'avait existaient pu
qu'il
revoir son travail
chaque jusqu'au du forc
Il a conduit un peu plus tait,
et-unime chapitres rter. revoir sements
chapitre ensuite,
de la moiti son ce qui tour, restait
Kiaprolh de
11 s'tait ce qui qui
complter qu'bauch, tous ceux
inachev, aux claircis-
tre dj,
d'ajouter qui pouvaient
tre
nces-
LXIV saires ne encore; rien et cet perdre l'excution on bien M. peut
INTRODUCTION. ouvrage, en entrepris dans au qu'il l'orthographe trace; dans et tre hxvariables. tre faite le les crire, notes qui plus ni d'un par les plan ait des mains si habiles, Il s'est t conadopt
devait pour
passant gnrale,
siennes. qui cru des par lui avait devoir
form, d'abord; sans telle au lieu ces
mais raisons que
regretter
modifier, chinois, Foe
plausibles, l'avait
mots
Rmusat
exemple, appartiennent que
de Fo,
et introduire bizarres paraissent
prononciations qui ni de ne
difficiles, rsultat Cette pour
russes
franrguimporque
aises, lier, tante l'on viter raient
systme peu anomalies mots, disparates
principes devait dans
observation, les
au fond, remarquera les
expliquer de que
la transcription et les mprises
certains ces
et pour pour-
confusions
occasionner. tout la en ne ngligeant intelligence les traditions rien de du ce qui texte, tait en essence qui
M. Klaproth, tiel pour assurer
parfaite et du en
concerne accord M.
la philosophie cette ne la partie lui nature
religieuses, moins Le lui des pas genre a
a peut-tre que esprit, fait
Commentaire donn. tudes,
d'extension de son
Rmusat que son
aurait de ses
autant diriger Au reste,
principalement gographiques.
attention toutes les
sur notes
la discussion qui de ne sont
points
de M. Rmusat longtemps de que chacun j'y que sur
tant ces dans ai prise j'ai con-
signes, dtails, cette
il serait et l'on
superflu distinguera Je pour n'ai
s'appesantir facilement la de
plus part celle
publication. que en cette
rien
dire les M.
moi-mme tractes ment mais cours,
reconnatre envers
obligations Eug. Burnouf. ses soins de
occasion voulu auprs
Non-seule l'ouvrage, tous les se-
il a bien j'ai trouv
continuer de livre, lui le
donner plus
celui
qu'aucun
aucune
prcieux science ne
pouvaient
m'of-
INTRODUCTION. frir la les des zle triaux quelque d'un malgr prmuni avoir qu' plus et les gard : des conseils et des des de encouragements. langues et de la M. Chine Jacquet, qui et de l'Inde
LXV runit toutes
connaissance conditions doctrines que
critique
d'rudition et qui
qu'exige
l'intelligence avec autant des de madans plus Et mal bien
indo-chinoises,
a recueilli, que voir m'a de
de modestie, qu'il grand serait
de persvrance dsirer M. utile de Jacquet et des lui
courage, en de
mettre fourni
oeuvre ct
travail,
son
renseignement tant de secours, les
rapprochements encore, critique. que
ingnieux. je le crains, Si l'on j'avais peut-tre je n'ai pas veut
je me svrits
prsente de des t les la
contre plutt
la nature dont elles pardonner je n'ai pu ont
difficults surmontes, erreurs
vaincre sera-t-on vites
la manire dispos lacunes
me que
que
remplir.
Ce livre qu'on comme orientales pit aussitt le cite
tait
attendu
depuis
longtemps, indit. du
et il y a un Il avait des t
an
dj
en Allemagne, paratre aux
quoique frais
annonc
devant
Comit
traductions romholui pu-
de Londres. les
A la mort qui pas
de M. Rmusat, avaient sacrifier la France enviaient. l'ouvrage t les pris
sa veuve avec cette qui d'une
engagements n'hsitant pour les conserver
norable taient blication gea alors
Socit, offerts, que de
avantages
l'honneur M. Klaproth et d'en
trangers de bien
nous continuer voulu
se charsurveiller et lorsque
revoir, Il avait
l'impression. la mort vint nous parti
m'associer seul pour sans que trop
ce travail; supporter doute, chacun os en
le frapper, bien
je restai ingalement des
le poids tait
que r-
partagions, dans
puisqu'il de nous entreprenant
la proportion Si l'on la tche m'accuse qu'il
forces d'avoir
pouvait de
apporter. continuer
s'tait
propos
d'achever,
je n'excuserai
LXVI ma moins qui prsomption par m'honore ma que bonne
INTRODUCTION. par volont je le dsir et par ne pour dont me que mes j'avais efforts, de rpondre, confiance titre que au
une d'autre de
et laquelle que je conserve
reconnais la mmoire anim me
l'attachement Heureux des lits si les
M. Rmusat. auprs des quapas !
sentiments dont
je suis l'estime,
pouvaient, tenir que C. lieu je n'ai
personnes qui me
j'ambitionne et suppler
manquent
au savoir
LANDRESSE.
Dans un ouvrage rempli comme celui-ci cle mots dont la transcription incertaine et difficile, il tait presque impossible est variable, l'orthographe fautes n'chappassent point la lecture la plus attentive. que quelques Voici celles qu'une dernire rvision, faite avec le soin le plus minutieux, a permis de reconnatre. P. i,l. 12, i g, 21, 59, 60, 67, 70, 78, 110, 12Q, 131, 135, 1I12, 148, 5. Au lieu de Hoe ing.. lisez Hoeying. 2 5. ltihsa. Ityoukta. . en chinois Sang en chinois Seug. i!xles Lah des Tibtains. 8. les Lha des Tibtains. . la foule des dieux et des 11. la troupe des hommes clestes. hommes. 15. 1 li. 34. uit. 16. antpen, 10. tipnait. 29. 2 3. uit. Pi thsiu. Khasolang onge Chy lifoe Rdjagrika. Para adhi moksha jjj ^a i?e iu tha Protapanna Soung y an Naga krochouna Karkoutchanda . Pi tsou. Khasalang ouge. Che lifo. Rdjagrlia. Pratimksha. J^N ' ^v?. Foyu tha. Srotpanna. Soung y un. Naga kchouna. Krakoutchhanda. Shkya. Yuan kian loui chou. Kia ch. Keou chen mi.
15g, 160, 5. 200, Skkya Yuan kian houi chou. . . 201, note d. 1 7, et partout dans ce chapitre, Kia se. . 272, . 1o, et p. 3 1 3,1. 1, Kou than mi 3o5,
fc
Sj
$>
FO
KOU
Kl
OU
'JpLATION
DES
ROYAUMES
BOUDDHIQUES.
CHAPITRE Dpart de Tchhang 'an.
I.
Monts Loung. Thsin d'occident. Liang du midi. Liang du nord. Thun houang. Dsert de sable.
Anciennement les
.Fa hian (1), tant
Tchhang
et les livres thologiques prceptes altrs Par ce motif, par des lacunes.
des caractres marque cycliques Tao tching, Hoe ing, Hoe'we (5) et plusieurs concert avec eux, chercher dans l'Inde les la religion. Ils partirent ils vinrent Ce sjour
et dj la seconde anne Houng chi (4), Ki ha, il partit avec Hoe hing, autres, lois et pour aller, les prceptes de de
'an (2), fut afflig (3) prs de se perdre
de voir
le (mont) Loung (6), et, ayant travers au royaume un sjour (8). de Khian houe (7), o ils firent au royaume ils allrent en avant et parvinrent termin, 1
de Tchhang'an,
2 de Neou ihan
FO
KOU les monts
KI. Yang leou (10), et arrivrent
(g). Ils passrent au commandement militaire
Le pays de Tchang y tait rendaient les routes impraticables. par affection pour eux, les retint Ce fut Pao alors qu'ils rencontrrent
de Tchang y (n). alors le thtre de grands Le roi de Tchang et se rendit leur
qui et y, par intrt bienfaiteur (12).
troubles
ymi, Seng king (i3) et plusieurs dans runis une mme intention ensemble; en route
Tchi y an, LIoe kian, Seng chao, autres. Charms de se trouver , ils continurent fut venu, (i4). L sjour ils se remirent sont des retranli leur
et quand le terme de ce sjour Thun houang et ils arrivrent s'tendre qui peuvent au nord. Ils s'arrtrent 80 un mois
chements du sud
li de l'est
l'ouest,
et ko
et quelques Ensuite jours. la suite de quelques F hian et cinq autres devant, partirent et se sparrent de nouveau de Pao yun et des autres. ambassadeurs, de Thun Li hao, leur Le gouverneur fournit les choses houang, le Fleuve de sable (i5). pour traverser Il y a dans ce fleuve de sable des mauvais et des vents si gnies, les rencontrer, on vient on meurt, et que brlants, que, quand n'en rchappe. On ne voit ni oiseaux en haut, voler ni personne marcher en bas. De tous cts, et jusqu'o la vue peut quadrupdes dont ils avaient besoin s'tendre, d'autre si l'on cherche le lieu propre traverser, signe pour le faire reconnatre, que et qui seuls peuvent servir d'indices. qui y ont pri, Ils voyagrent et l'on peut valuer pendant dix-sept jours, li le chemin i5oo firent atteindre le royaume qu'ils pour Chen chen. n'aperoit les ossements de ceux on
de
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
I.
( 1) Cliyf hian. ] C'est un de ces noms que les Bouddhistes de la Chine adoptent en entrant dans la vie religieuse, et qui indiquent ou des dispositions morales, ou une aptitude particulire de certaines observances de la vie monastique : c'est quel-
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
I.
que chose d'analogue ce qu'on appelait autrefois chez les peuples catholiques nom de religion (nomenprofessionismonasticoe), comme la mre des Anges, la soeur de la Rdemption, le pre de la Misricorde, etc. L'objet des moines chinois, en changeant de nom, est, comme autrefois chez nous, d'annoncer l'intention de renouveler leur vie et de renoncer leur famille. Ces noms, traduits ou imits du sanscrit, sont tous significatifs et dsignent des ides morales ou asctiques : le religieux de la quitude {'An tsing), le repos de la loi ( Tao 'an), la svrit de la prudence ( Tchi mang)*, etc. Le nom de Chyf hian signifie manifestation de la loi de Chy (Sbakya). On l'abrge dans la suite du discours, conformment l'usage observ pour les noms propres, et l'on dit simplement F hian; c'est de cette manire que le voyageur, qui parle toujours de lui-mme la troisime personne, crit le plus souvent son nom. (2) Tchhang 'an, ] repos perptuel, est le nom qu'a port la ville, ou, pour parler d'une manire plus exacte, le dpartement qu'on nomme prsent Si 'an ( Si ngan dans le Chen si. C'est maintenant le nom d'une ville du troisime ordre, au fou) sud de cette mtropole, et qui passe pour en avoir t l'ancien emplacement sous les Thsin et les Han. Lorsque la capitale a chang de nom, on l'a longtemps encore appele Tchhang 'an, par imitation de l'antiquit. (3) Les prceptes et les livres thologicjues.] Dans l'original, Li. Tsang lia signifie prcepte; Tsang veut dire collection. L'ensemble des livres religieux se nomme communment San tsang, les trois collections, proprement les trois contenants ( en sanscrit, les trois Pitaka) ; et cette expression s'applique aussi la doctrine qui y est renferme , la religion elle-mme. Les trois parties de la triple collection sont les King, ou livres sacrs, les Prceptes, et les discours, Lun. On les nomme en sanscrit Sotra, Vinaya, Ahhidharmah. Les San tsang sont nomms en mongol Gorban amak sabac. (Il) Houng chi.] C'est le nom des annes du rgne de Yao heng, prince de la petite dynastie des Thsin postrieurs, qui rgna dans le Chen si la fin du ive et au commencement du v sicle de notre red. La premire anne Houng chi rpond l'anne cyclique Ki ha, 399. Il y a donc une sorte de contradiction dans le rcit de F hian, qui marque la fin de l'anne cyclique Ki heu et la deuxime anne Houng chi comme poque de son dpart. Mais si ce n'est pas simplement une faute dans son texte, on peut supposer que ces petits princes de race tibtaine qui rgnaient, dans un temps de trouble et de confusion, l'une des extrmits de l'empire, n'observaient pas trs-exactement les rgles du calendrier chinois, et ne marquaient pas l'ouverture de l'anne politique prcisment au premier jour de l'anne astronoVoyezWen hian thonng hhao, livre CCXXVI, pao-./, et suiv. b Fanyming ming i, livre IV, ouvragequi est 0 cit dansle San tsang f sou, ivre VIII, pag. 28 v. c Geschichte lier Ost-Mongolen, pag. 4o. d HistoiredesHuns, tom. I, pag. 162. 1.
FOE
KOUE
KL
mique. Il faudrait alors que Fa hian et quitt Tchang 'an dans les derniers jours de l'an 399, quand on y avait dj renouvel le nom d'annes Houng chi, bien que l'on y comptt encore l'anne cyclique Ki ha. Cette supposition ne manque pas de vraisemblance. (5) Hoe king, Tao tching, Hoe ying, Hoe ive et les autres. ] F hian ne dit nulle part le nombre prcis de ses compagnons de voyage; il en nomme ici quatre, et l'on verra plus bas que plusieurs autres encore se joignirent -ceux-l. C'tait alors un usage assez ordinaire parmi les religieux bouddhistes, de se runir en troupes et des plerinages communs, de temple en temple et de ville en Avilie, d'entreprendre de l'Inde la Chine et de la Chine dans l'Inde. Les quatre noms qu'on voit ici sont des noms de religion. (Voyez note 1.) Leur signification est : Hoe king, clat d'intelligence ; Tao tching, ornement de doctrine ; Hoe ing, correspondance cit, minence de perspicacit. de perspica-
(6) La montagne Loung.] Montagnes dans la partie occidentale du Chen si, au N. E. du district de Thsin'an, l'E. de la rivire Thsing. On distingue le grand et le petit Loung. Le nom de cette montagne se trouve sur les cartes chinoises rcentes, 35 de lat. et 1o l'O. du mridien de Pe king. (7) L royaume de Khian koue] tait au del de la montagne de Loung. On serait tent de prendre Khian koue pour un nom de pays. C'est celui d'un prince de la race des Sian pi, appartenant la petite dynastie des Thsin occidentaux, ou de Loung si (occident du mont Loung), laquelle rgna dans la partie occidentale du Chen si, la fin du ivc et au commencement du ve sicle \ Khian koue tait mont sur le trne en 388. [Khy fou Kou jin fonda, en 385 de J. C, avait fortifi Young sse tchhing, et y avait tabli nom honorifique de Yuan tchhouan. Elle tait Kin hian, dpartement de Lan tcheou fou du la dynastie des Thsin occidentaux; il sa rsidence. Cette ville reut alors le situe au N. E. de la ville actuelle de Kan su. Quand, en 388, Khian koue
succda son frre an Kou jin, il transporta sa cour Kin tchhing, qui est le Kin hian de nos jours. Voyez Thoung kian liang mou sous les annes indiques, et Ta ung tchi, dition de 17/1/1, sect. CLVIII,f. 18 v. KLAPROTH. thsing y il10 ] (8) Sjour. ] Dans le texte, Ma tso (s'asseoir en t). Cette expression doit tre prise dans un sens gnral, et ne signifie nullement qu'on s'arrte en t ou qu'on passe l't; elle revient frquemment dans le rcit de F hian. est vraisemblablement employ pour ~K cause de l'identit de prononciation. Histoire desHuns, loin. I, pag. 200. Li ta hi sse, liv. XLIV,pag. 18 v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
I.
(9) Le royaume de Neou than.] Ce nom n'est pas non plus , comme on pourrait le croire, le nom d'un pays, mais celui d'un homme. Neou than, que Deguignes appelle Jo than ", appartenait la race des Sian pi et la petite dynastie des Liang mridionaux qui rgnait dans le Ho si, l'occident du fleuve Jaune, et qu'on fait commencer en 397. Neou than ne monta sur le trne que l'anne Jinyin du cycle (4o2); ce qui prouve que F hian et ses compagnons s'taient longtemps arrts en route avant de parvenir un point si peu loign. Au reste, il crit mal la premire syllabe du nom de ce prince, -|JL au lieu de *&; mais on peut aisment faire cette faute quand on crit de mmoire, parce que ces deux caractres se prononcent galement neou. Peut-tre aussi avait-il entendu prononcer le nom de ce prince sans jamais l'avoir vu crit. Rien n'est plus commun que les mprises de cette espce. [Les princes de la petite dynastie des Liang mridionaux avaient pris le titre de rois de Siphing, d'aprs le nom de leur rsidence, qui tait Siphing, ville situe dans le voisinage ou peut-tre sur l'emplacement de Si ningfou, dans le Kan su. Voyez Tlioung kiang kang mou, sous l'anne 62 avant J. G., et le Ta thsing y thoung tchi, dition de 17/1/1, sect. CLXVI, f. 8v. KL.] (10) [Comme F hian se rendit de Si ning Kan icheou, il devait ncessairement passer la grande chane de monts couverts de neiges perptuelles, et qui spare les dpartements de Kan tcheou et de Liang tcheou, de la grande valle dans laquelle coule la rivire appele par les Mongols Oulan mouran, et par les Chinois Houang choui ou Ta thoung ho. Cette haute chane fut appele par les anciens Hioung nou, Khi lian chan. A prsent sa cime la plus leve, qui forme un glacier colossal, porte chez les Mongols du voisinage le nom tibtain de Amiyc gang g ai- oola, c'est--dire, montagne du KL.] grand-pre, blanche de neige. (11) Tchang y, ] maintenant Kan tcheou, se trouvait, au moment du voyage de F hian, sous la domination des princes de la dynastie des Liang septentrionaux. Les troubles dont parle F hian en cet endroit, et qui l'arrtrent dans sa route, provenaient des guerres que toutes ces petites dynasties se faisaient les unes aux autres, et qui amenrent la destruction de tous ces petits tats. Le roi de Kan tcheou alors rgnant tait ou Touan nie, qui mourut en koi, ou son successeur Meng san, qui lui succda en koi, et occupa le trne jusqu'en 433 \ F hian ne le nomme pas, et cela est fcheux, parce que cette circonstance sage Kan tcheou. et fix l'poque prcise de son pas-
(12) Bienfaiteur.] Dans le texte, tan youi. C'est un mot chinois d'origine sanscrite, comme les Bouddhistes en ont introduit beaucoup. Celui-ci est driv Aufan ' Hist.des h Huns,tom. I, p. 198. Cf.li ta hisse, liv. XLIV,pag. i3 r. Ilisl. desHuns, l. I, p. ->.',.
FO
KOU
KI.
(sanscrit) tan ou tan na (dna), don, aumnes ou largesses faites dans une vue religieuse, ce qui compte au nombre des dix moyens de salut (pramita); il s'y est joint une syllabe chinoise, youe (franchir, aller au del, passer par-dessus), et le compos exprime que celui qui sait pratiquer la bienfaisance, franchit la mer de la pauvret a. (i3) Tchiyan, Hoe kian, Sengchao, Pao yun, Seng king et autres.] Voil cinq nouveaux compagnons qui grossissent la suite de F hian. Sa troupe se composait en ce moment de plus de dix religieux; mais ils se sparrent plusieurs fois dans le cours du voyage, se runirent ensuite, et finirent par se disperser tout fait. Ces cinq nouveaux 7107715 de religion (voyez note 1) sont significatifs comme les autres; en voici la valeur : Tchiyan, majest de la prudence; Hoe kian, rserve de perspicacit; Seng chao, connexion de religieux; Paoyun, nuages prcieux (divins); Seng king, clat des religieux. ( 1 ) [ Thun houang fut une place militaire de grande importance depuis le temps des Han jusqu'aux Thang. Sous les cinq petites dynasties qui ont rgn aprs les Thang, elle porta le nom de Cha tcheou ou ville de sables, qu'elle a conserv jusque sous les Ming. La ville nomme actuellement Cha tcheou est situe cinq six lieues plus l'orient, sur la rive droite du Sirgaldzin gol. Il parat que l'ancien Thun houang a t galement dplac plusieurs fois. KL. ] Li hao enleva ce pays la petite dynastie des Liang septentrionaux, et y forma lui-mme une principaut sous le nom de Liang d'occident. Il ne prit pas le titre de roi, mais simplement celui de Koung (prince). La premire anne de son rgne est Kencj tseu du cycle (Aoo) ''. Au reste, F hian, qui ne lui donne avec raison que le titre de gouverneur (ta cheou) de Thun houang, se trompe en crivant la deuxime syllabe de son nom, comme il s'tait galement tromp au sujet de la premire syllabe de celui de neou than : il l'crit "t/i- au lieu de ~|K L'analogie des prononciations rend compte de cette mprise comme de la prcdente. Voyez note 9. (15) Le Fleuve de sable, ] dans le texte, Cha ho. On dit ordinairement Cha m. La description que le voyageur fait ici du grand dsert est fort exacte; elle ressemble beaucoup celle de Marc-Polc; seulement F hian en exagre la largeur, qui ne saurait tre value, entre Cha tcheou et le lac de Lob, plus de 11 o lieues, 1 100 li, au lieu de i5oo. Peut-tre les tablissements du peuple que les plerins allaient visiter, n'taient-ils pas alors immdiatement sur le lac de Lob, mais un peu plus l'ouest, sur les rivires de Khadouet de Yarkand daria. 1 Sun son, liv. XXXIII,pag. 2b v. et alibi. '' Hist.des Huns,t. II, p. ix, 267. Li ta Msse, tsangf Inc.cit. '' Liv.I, chap. xxxv,d. dp Marsden,p. Sg.
CHAPITRE
IL
Ou hou. - Kao Royaumes de Chen chen. tchhang.
Le royaume de Chen chen (1) est un pays montueux et trs-ingal. La terre y est maigre et strile. Les moeurs des habitants, leurs habillements et semblables sont grossiers ceux de la terre de Han (2) : la seule Le roi diffrence est dans l'usage du feutre et des toiles. y avoir dans ses tats l'tude de la petite aussi bien royaumes, de l'Inde (7), avec des de ce pays honore la loi (3). Il peut mille environ tous attachs religieux, quatre translation (4). Les laques (5), dans tous ces que les Cha men (6), pratiquent diffrences plus qui tiennent nement. A partir l'occident royaume de ce point, ressemblent a une tous tous la loi ou moins
de grossiret
ou de raffi-
langue tous gieux s'appliquent de l'Inde (9). F hian et les autres
les royaumes qu'on trouve en voyageant plus ou moins celui-ci : seulement chaque barbare (8) ; mais les reliqui est diffrente l'tude des livres de l'Inde et de la langue
ici un mois et quelques sjournrent jours; en route, et voyageant puis ils se remirent quinze jours du ct du ils parvinrent au royaume de Ou i (10). Les religieux du nord-ouest, de Ou i sont aussi au nombre d'environ tous royaume quatre mille, del petite translation. Ils sont, quant la loi, exacts et bien rgls. Les Cha men de la terre de Thsin (n) qui arrivent dans cette contre ne sont aux usages de ces religieux. F hian, pas prpars muni d'une se rendit au campement o Koung patente, alors, le retint deux mois et quelques rgnait jours. Ensuite de Pao yun et des autres. Tous ensemble trouvrent auprs qui tait sun, qui il revint que les
8 habitants
FO
KOU
KI.
du royaume de Ou i n'taient de la pratique point occups des rites et de la justice, et qu'ils exeraient envers peu l'hospitalit les voyageurs. C'est pourquoi Tchi yan, Hoe kian et Hoe 'we retournrent le dessein autres immdiatement de demander reu une dans des secours patente donc se le pays pour ; Koung mettre de leur sun en Kao tchhang (12), dans F hian et les voyage. leur avait tout donn de suite des et
avaient
provisions s'avancer Le pays une vie
: ils purent du ct du sud-ouest. qu'ils extrme traversrent pour
route
est
dsert
et sans Il
habitations. n'y l'on a rien
On dans
a la Ils
aux fatigues comparer que puisse furent en route un mois et cinq jours, aprs quoi Yu ihian. atteindre
peine que l'on
passer
les rivires.
a endurer. ils russirent
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
IL
(1) Le royaume de Chen chen.] Ce pays, d'abord nomm Leou lan, tait situ aux environs du lac de Lob. C'est une contre sablonneuse et strile, et cet tat n'a jamais t puissant. Il fut connu du temps des Han, et confinait alors, du ct du sud-est, avec la peuplade tibtaine appele Eul kiang, et du ct du nord-ouest, avec les Ougours Tchhe sse. Le nom de Leou lan fut chang en celui de Chen chen dans le premier sicle avant J. C. Ma touan lin donne une courte notice sur ce paysa. Voyez aussi Deguignes, Histoire des Huns h.
(2) La terre de Han.] La Chine, ainsi nomme depuis la dynastie de Han, dont la puissance a laiss de longs souvenirs. On dit encore prsent Han jin, les Chinois, Han in, la langue chinoise , quoique les Han aient cess de rgner depuis seize cents ans. (3) Le roi honore la loi.] Il s'agit de la loi par excellence, c'est--dire Fo ou du Bouddhisme. de la loi de
(lx) Quatre mille religieux, tous de la petite translation.] Les religieux sont appels ici du nom qu'on leur donne le plus souvent, Seng, du sanscrit Sang a (unis, joints par un lien commun). J'ai donn l'explication de cette expression, qui s'est introduite "" ' Wenhian khao,liv. CGCXXXVI, (houng pag. g. Ibid.tom. II, pag. xj.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
II.
9 elle revient
dans la langue chinoise, et qui sert dsigner les prtres bouddhistesa; celle de fidles ou ecclsiastiques.
On partage, sous le point de vue moral, les Sangas en quatre classes : i ceux qui accomplissent lajustice; ce sont les Bouddhas, les Lokadjyeshthah (honorables du sicle), ainsi que les Bodhisattwas, les Pratyeka-Bouddhas, les Shrwakas, etc., dont la vertu est au-dessus des lois mmes, et qui, surmontant tous les obstacles, ont obtenu leur propre dlivrance (moukti). 2Les Sangas ordinaires dusicle; ce sont les hommes qui rasent leur barbe et leurs cheveux, qui se revtent du kia cha, qui ont embrass la vie religieuse et ses obligations, et savent observer les prceptes et les dfenses de Bouddha. 3 Les Yayangseng, Sangas moutons muets; ce sont les hommes stupides et ignorants qui ne savent pas comprendre la diffrence qu'il y a entre l'action de commettre ou de ne pas commettre les pchs fondamentaux (tuer, voler, forniquer, mentir), et qui, tant tombs en des pchs moins normes, ne sont point capables de faire clater leur repentir. 4 Enfin les Sangas honts qui, ayant embrass la vie religieuse, ne se font pas scrupule d'enfreindre les prceptes et observances qui leur ont t imposs, et qui, affranchis de toute honte et de toute pudeur, ne craignent pas mme les fruits amers qui leur en reviendront dans les sicles futurs h. La petite translation, la grande translation, sont deux expressions qui reviendront souvent dans le rcit de F hian : il faut les expliquer une fois pour toutes. Deguignes en a fait imparfaitement connatre le sens c, et n'a pu en retrouver l'origine. On dit en chinois ta tching, la grande rvolution; siao tching, la petite rvolution. Tching est un mot qui dsigne la translation, le passage d'an lieu un autre, la rvolution, le tour, et aussi un moyen quelconque de transport, comme un char, une monture. Il est l'quivalent parfait du sanscrityna, qui a les mmes significations" 1. Mais l'un et l'autre acquirent dans la doctrine bouddhique une valeur toute particulire. Ce n'est pas, comme l'a cru M. Schmidt, celle de tradition (Ueberlieferung)" : c'est une expression mystique pour dsigner l'action que l'me individuelle peut et doit exercer sur elle-mme, afin de se transporter une condition suprieure. Comme cette action et ses rsultats ont plusieurs degrs, on distingue deux, trois, ou mme un plus grand nombre eynas, en chinois tching, en mongol kulgun 1; et suivant qu'on dirige ses efforts vers une perfection plus ou moins leve, on appartient la petite, la moyenne, la grande translation ou rvolution. Voici, cet gard, les distinctions les plus gnralement tablies. Le vhicule qui est commun toutes les translations, c'est la contemplation des a sur Journalasiatique,cit Voy.Journ.asiat.t. VII, p. 267. Observ. points,etc., dansle Nouveau etc. p. 20. samanenne, quelques pointsdela doctrine prcdemment, p. 25g. h Ti d Wilson, Sanscrit h. v. tsangchi lan king, liv. V, cit dans le San Diclionary, " im Gebieteder oelleren tsang f sou, liv. XVI, pag. 8. Forschungen rcligioesen " Mm.de Acadmie der des inscript, etbelles-lettres, lddungsgcschichie VoelkerMiltelasiens, pag. 241 lom.XL,p. 200.Voyez lesObservations surquelques Schmidt, loc.cil.
10
FOE
KOUE
KI.
quatre vrits : la douleur, la runion, la mort et la doctrine a, et celle des douze enchanements 1. Par ce moyen, les hommes sont transports hors de l'enceinte des trois mondes et du cercle de la naissance et de la mort 0. Il n'y a, proprement parler, qu'une translation, c'est celle de Bouddha. Il est enjoint tous les tres vivants de la mettre en pratique, et de sortir de l'ocan des peines de la naissance et de la mort, en dbarquant sur l'autre rive, qui est celle de l'absolu 11.Bouddha et dsir rpandre immdiatement la connaissance de la loi et enseigner tous les hommes la translation unique; mais il dut proportionner son enseignement aux facults de ceux qui le recevaient, et de l vint la diffrence des Yncts ou moyens de transport. On distingue d'abord la translation des disciples ou auditeurs ( Ching ven, en sanscrit Shrwaka) et celle des intelligences distinctes" (Youan ki, en sanscrit Pratyeka-Bouddha){. On en ajoute une troisime, celle des Bodhisattwas, qui sont des tres bien plus voisins encore de la perfection absolue 5. Enfin, on fait une autre classification encore sous cinq chefs, savoir : i la translation des hommes; 2 celle des dieux (Deva); 3 celle des Shrwakas ou auditeurs; lx celle des Prafyeka-Bouddhas ou intelligences distinctes; 5 celle des Bodhisathvas h; ou un peu diffremment : i ou la translation des hommes et des dieux; 2 celle des Shraivakas; Pratyeka - Bouddhas ; " celle des Bodhisathvas ; 5 celle des Bouddhas ' translation, Mah yna : mais la division en trois est la plus usuelle on trouve la mention la plus frquente dans les livres ordinaires. le petit Yna 3 celle des ou la grande et celle dont
C'est au Tri yna que s'applique la double mtaphore des trois chars et des trois animaux qui passent un fleuve la nage. Le char est pris ici comme emblme de ce qui s'avance en roulant, de ce qui sert de vhicule; et cette ide est en rapport avec celle qui s'attache au mot yna, et aux moyens par lesquels les hommes parviennent sortir de l'enceinte des trois mondes pour entrer dans le nirvana. Le premier char est attel d'un mouton; cet animal, quand il prend la fuite, court sans regarder derrire lui s'il est suivi du reste du troupeau. Il en est ainsi des Shraivakas, qui, par l'observation des quatre ralits, cherchent sortir des trois mondes, mais ne s'occupent que de leur propre salut, sans regarder les autres hommes. C'est ce qui est dsign dans les livres classiques par ce passage : Ces disciples, en cher chant le char aux moutons, sortent de l'habitation du feu. Le second char est tran par des cerfs, sorte d'animaux a On qui, tout en courant, peuvent regarder der-
expliquede plus d'une manirecesquatre vritsou ralits.Voyezci-aprsles notessur le cliap.xxn. '' Nouv. Journalasiai.lom. VII, pag. 291. Voyez c Hoa yan king sou, liv. II, cit dans le San tsang f sou, liv.VII, pag. 2 v. '' F honaking, liv. I, cit dans le San tsang f liv. sou, IV, pag. /|. " Journalasiatique,t. VII, p. 260. VoyezNouv.
Hoa yan kinq sou, liv. I. Thianta ssekiao yi isi lehu, cit dans le San tsang f sou, liv. VII, pag. 3. Voyez ci-dessous, xm, i3. S F hoaking,liv. II, cil dans le San tsangf sou, liv.XI, pag. g v. ' Yulan sou,citdansle 5atsang pan king f sou, liv. XXII,pag. 171;. Hoayan, Ki tchingkiao i, cit dans le San tsang f sou, liv.XXII, pag. 16.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
IL
11
rire eux le troupeau qui les suit. C'est la figure des Pratyeka-Bouddlias qui, par la connaissance des douze Nidnas*, parviennent sortir de l'enceinte des trois mondes, et ont la pense du salut des autres hommes. Le troisime char est celui que trane un boeuf, qui reprsente les hommes Bodhisattwas de la doctrine des trois Pitakas (chap. XVI, 22 ), pratiquant les six moyens de salut, et ne songeant qu' faire sortir les autres de l'enceinte des trois mondes, sans y penser pour eux-mmes, comme le boeuf qui supporte avec patience tous les fardeaux qu'on lui impose 11. Les trois animaux qui traversent un fleuve la nage, sont l'lphant, le cheval et le livre. Le fleuve est la raison pure, 3-Wj?', les Shrwakas , les Pratyeka-Bouddhas et les Bodhisattwas sortent galement des trois mondes et rendent tmoignage la raison pure : mais leurs facults et leurs moyens varient d'tendue; leur conduite et leur dignit sont plus ou moins considrables. C'est ainsi que quand un lphant, un cheval et un livre traversent ensemble une rivire, ils y entrent plus ou moins profondment. L'lphant, qui touche le fond du fleuve, reprsente l'homme Bodhisallwa, pratiquant les six moyens de salut, et, par dix mille actions vertueuses, apportant du profit tous les tres, supprimant les erreurs de la vue et de la pense, les effets de l'habitude et des passions, et manifestant le bodhi (la sans toucher le lit du fleuve, est doctrine). Le cheval, qui enfonce profondment mis pour l'homme Pratyeka, qui, par les moyens dj expliqus, supprime les erreurs de la vue et de la pense, ainsi que les effets de l'habitude et des passions, et vide, sans toutefois pouvoir atteindre le terme de toute puret. Le livre enfin, qui flotte la surface de l'eau sans pouvoir enfoncer, figure le Shrwaka, pratiquant les quatre ralits, supprimant les erreurs de la vue et de la pense, mais sans pouvoir se dlivrer tout fait des effets de l'habitude et des passions, bien qu'il manifeste la nature du vritable vide c. Une exposition dtaille de tout ce qui est entendu par l'action de ces diffrentes classes d'tres, serait en quelque sorte un trait du Bouddhisme; et si je voulais mme en abrg, elle m'entranerait bien au del des bornes d'une l'entreprendre, simple note. Il suffira de dire que ces modes de translation sont autant de nuances et de degrs qui s'tablissent dans la mditation, et dont les effets conduisent l'homme des grades plus ou moins levs dans la hirarchie psychologique et psychogonipetite translation, que qui s'tend depuis les tres infrieurs jusqu' l'absolu. Dans 1& on s'attache la pratique des prceptes et des rites religieux. Les cinq prceptes et les dix vertus sont le vhicule dont se servent les hommes et les dieux pour ce genre de translation qui est la moindre de toutes. Par l on chappe seulement aux quatre mauvais pas, qui sont : la condition d'Asoura, celle de dmons, celle cle brutes, et les enfers. A cela prs, on reste enferm dans le cercle de la transmi'' Observations sur quelques etc. p. 58. points, 11 F honaking, liv. II, cit dans le San tsang f son, liv. XI, pag. 8 v. c Thianta sse kiao i et Fa honahiuanyl, cils dansle .Santsang f sou, liv. XI, pag. i ?.. manifeste la nature du vritable
12
FOE
KOUE
KI.
gration. Dans la translation moyenne, trois ordres de personnages parviennent sortir de l'enceinte des trois mondes, en s'aidant ou des instructions orales de Bouddha (les Shrivakas), ou de mditations sur les vicissitudes individuelles et le vritable vide de l'me (les Pratyeka-Bouddhas), ou enfin des dix moyens de salut appliqus tous les tres vivants qu'on entrane avec soi hors de l'enceinte des trois mondes (les Bodhisathvas). Enfin, dans la grande translation, l'intelligence, parvenue son point de perfection absolue, fait parvenir tous les tres vivants la condition de Bouddha ". Pour traduire tout cela en langage europen, on pourrait dire que la petite translation consiste dans la morale et le culte extrieur; que la translation moyenne s'excute par des combinaisons psychologiques spontanes ou et que la grande translation a pour base une thologie abstruse, une traditionnelles; ontologie raffine, le mysticisme le plus exalt. . On conoit que diffrents peuples bouddhistes, selon leurs dispositions plus ou moins contemplatives et le degr de leur culture intellectuelle, ont d s'arrter plus ou moins haut dans l'chelle des translations. Les peuples du nord, au tmoignage des Chinois, ont toujours prfr la petite translation, c'est--dire la morale et la mythologie, qui seules pouvaient s'accorder avec des habitudes nomades et des inclinations belliqueuses. Les nations du midi, soumises l'influence du climat et plus portes aux rveries savantes, ont ordinairement aspir la grande translation, et ont cherch la rpandre chez leurs voisins h. On voit pourquoi les religieux d'un monastre tion nent leur neuf pouvaient cultiver l'une ou l'autre. On comprend aussi la distincque les Bouddhistes tablissent entre leurs livres sacrs, selon qu'ils contienl'exposition des dogmes les plus relevs de leur thologie , ou les principes de morale et des mythes de leur symbolique. Voil pourquoi ils partagent ces sortes de livres (Sotra, Geya, Gth, Ityoukta, Djtaka, Adbhoutadharma, Ou-
dna, Fapoulia, Vykrana) en deux familles, appartenant les uns la grande, et les autres la petite translation*. Enfin, cette classification donne une notion prcise au sujet des distinctions indiques vaguement par plusieurs auteurs sur l'existence d'une doctrine populaire et d'une doctrine sotrique dans le Bouddhisme, l'une et l'autre attribues Shkya-mouni lui-mme d. Cette longue note ne sera pas trop tendue si elle claircit compltement un sujet qui n'avait pas encore t trait fond. J'y renverrai dans le cours de la relation de F hian, quand il sera question de monastres de la grande ou de la petite translation. (5) Les laques,] en chinois Sou jin, * Hoa les hommes d vulgaires. Cette expression se
yan, chapitre sur la Rvolution unique, cit dansle Santsang f sou,liv.XXII, pag. 16. h Tchi tou lun, livre XXXIII, cit dans le San 20. tsang f sou, 1.XXXIII,p. 26, 1.XXXIV, c L'histoire tibtaine en fournit un p. exemple : mars i83i,p. i53. comparezle JournaldesSavants,
du royaume de Tunquin, VoyezMarini, Relation tibetan. pag. 197.Georgi, Jlphabetum pag. 223, der Ost-Mongolen, 2^2, etc. Geschichte p. 16, 356. Histoire desHuns, tom. II, p. 224.Hodgson, dans les Transactions t. II, ofiheroyalasiaticSociety, pag. 254.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
II.
15
trouve dj deux lignes auparavant; mais ici elle est dtermine dans son sens relatif la religion, par son opposition avec le mot Cha men, Samanen. Voyez la note suivante. (6) Les Cha men.] pi Vv C'est ainsi que les Chinois transcrivent le mot sanscrit Sramana, sous sa forme pli Smana. Ils l'crivent aussi quelquefois 1^ _J| Sang men. Ils ajoutent que le sens de ce mot est : celai qui resh'eint ses penses, ou celui qui s'efforce et se restreinta. D'autres ajoutent que c'est le nom commun des religieux bouddhistes ou hrtiques \ Les anciens ont connu ce nom et l'ont transcrit avec exactitude c. Il a pass de proche en proche chez diffrents peuples tartares et jusque dans la Sibrie, o il est descendu des jongleurs ou sorciers de la plus grande ignorance. Nos voyageurs l'y ont recueilli sous la forme Schamane, et dans un temps o l'on manquait encore des moyens ncessaires pour constater les rapports et les diffrences des mots qui tiennent aux croyances des Asiatiques. Ce nom de Chamane, et celui de Chamanisme, qui en est driv, ont t appliqus un systme religieux qu'on supposait originaire du plateau de la grande Tartarie, et qu'on regardait comme la base des religions de la Bactriane, de l'Inde et de l'Egypte. Langls a parl en plusieurs endroits, avec une rserve mystrieuse, de prtendues dcouvertes faites ce sujetd : les progrs de la critique historique ont fait justice de ses hypothses. On est surpris d'en retrouver encore quelque trace dans les recherches de M. Schmidte, qui ne parat pas avoir reconnu l'identit des Samanas* et des Chamanes, soit entre eux, soit avec les Samanens. On distingue quatre sortes de Cha men caractriss par les dnominations suivantes : i Ching tao Cha men, ceux qui accomplissent la doctrine, c'est--dire qui, en vue de Bouddha, embrassent la vie religieuse et parviennent teindre la et par consquent cupidit, dissiper l'ignorance et les autres imperfections, effectuer les principes de la doctrine; 2 Chou tao Cha men, ceux qui, ayant obtenu pour eux les avantages qu'on vient de dire, sont en tat de promulguer la vraie loi, et d'engager les autres hommes entrer dans la voie de Bouddha; 3 Hoa tao Clia men, ceux qui renversent la loi en en enfreignant les prceptes, pratiquant toutes sortes de mauvaises actions, et se vantant d'a</ir brahmaniquement (Fan long) 4 Ho tao Cha men, ceux qui font revivre la quand ils font tout le contraire; doctrine ou qui sont la doctrine vivante, parce qu'ayant teint la cupidit, dissip l'ignorance, et mis en pratique toutes sortes de bonnes actions, ils agrandissent les Journal, New sries, Klaproth, dans VAsiatic vol.VI, p. a63. Santsang f sou, 1.XVI, p. 7 v., 1. XXXIII,p. ilxetpass. h Youan kianlouhan, liv. CCCXVII, pag. 25. c Strabon, 1. XV, pag. 712, d. Saf. Strom. liv.III. Porphyr.deAbstin. p. 168 sqq., d.Cant. " Mm.de l'Jcad desinscr.et b. I. t. XXVI-XXXI. d Consultezles notessur le de Thnnberq, Voyage tom. III, pag. 2/18. Notice surleritueldesMandans les Notices dchous, et Extraits, tom.VII, 2/18. " Geschichte der Ost-Mongolen, pag. 353, 416. f Fin derI,ehreBuddhas, Anhnger pag.3oy.
14 bonnes lois qu'ils trouvent (prdjii)a.
FO tablies,
KOUE
KI. aux sens par la science
et ils commandent
(7) La loi de l'Inde, ] Thian tch f. Thian tch est le nom le plus ordinaire de l'Inde dans les livres chinois. La seconde syllabe s'crit avec un caractre *L qui passe pour tre ici l'abrviation de w= th; il faudrait donc lire Thian tou, et ce mot serait une forme de plus du nom de Chin tou, Hian teou, Sin theou, Youan tou, Yin tou, toutes transcriptions plus ou moins altres de celui de Sin theou, Sind, Hincl, Indou, lequel signifie lune, suivant les Chinois c. On trouve un pays de dans le Chan ha king; et Kou Thian tou avec une orthographe peu diffrente, pou prtend qu'il s'agit de Thian tch ou de l'Inde J; mais cela est douteux, parce que Tchao sian ou la Core est nomme en mme temps. On sait, au reste, que l'Inde n'a t connue des Chinois qu'au temps de l'expdition de Tchang khian chez les Dahee, 126 ans avant J. C. Quant au nom mme de Thian tch, il n'a t employ, pour la premire fois, que la 20 anne fang lu, 1 5g de J. C. Thian tch, pour dsigner l'Inde, est cit pour la premire [Le nom de "^"^^ fois clans les annales chinoises, la 8e anne du rgne de l'empereur Ming ti, des Han (65 ans avant J. C). Ce nom ne se trouve ni dans les King, ni dans aucun ouvrage antrieur la dynastie des Han. Le dictionnaire Chou wen, rdig par Hiu tchin, en 121 de notre re, ne contient pas mme encore le caractre tch, qui est le second dans le mot Thian tch. KL.] (8) Langue barbare,] dans le texte, hou y a. Cette expression dsigne habituellement les langues des Tartares et des autres peuples peu civiliss. La remarque de F hian donnerait lieu de croire que les peuplades qui habitaient l'ouest du lac de Lob, en tuant du ct de Khotan, appartenaient toutes des races particulires et avaient des idiomes diffrents, sans parler mme de celui des Hindous que la religion avait introduit dans ces contres. Les langues dont il s'agit devaient tre le tangutain ou tibtain, le turc, quelques dialectes gtiques, et d'autres idiomes inconnus. Il est douteux qu' cette poque aucune nation mongole se ft avance dans cette direction. (g) Les livres de l'Inde, la langue de l'Inde,] le sanscrit, selon toute probabilit. On ignore si les livres bouddhiques taient ds lors crits en pli. Au reste, les diffrences qui caractrisent ce dernier idiome, en distinguent les mots de ceux qui leur correspondent en sanscrit. Les Chinois n'ont pas fait cette distinction, et elle disparatrait entirement dans les transcriptions trs-altres que la 1 111 kiasseti lun, citdansle San tsanq de Tliang. Cf.Pian i tian, 1. LVIII,s. 2 , p. 1. f sou, liv.XVI, pag. 7 v. Wen hian thoungkhao,liv.CCCXXXVI, p. i4. '' '' Yanssekou, cil dans Conter Khanghi Tseutian, vocab.Tchu, rad. l'Encycl. jap. LXIV, i5. 0 Dr despaysde l'occident, dans l'Histoire CXVIII,tr. 2 svription
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
IL
15
nature de leur langue leur permet de faire des mots sanscrits. Sous le nom de langue fan a, ils ont donc entendu galement le sanscrit et le pli. H y a lieu de croire que les livres qui leur sont venus par le nord taient dans la premire de ces langues, et que ceux qu'ils ont tirs du midi taient crits dans la seconde. F hian, qui visita les monastres du nord et ceux de Ceylan, qui tudia la langue des livres sacrs pour se mettre en tat de les copier et de les expliquer ses compatriotes, ne nous fournit aucune lumire sur un point de critique qu'on est surpris de voir chapper son attention. (10) Ou i] ou les barbares de Ou. Ce nom, comme il est crit ici, ne se trouve nulle part ailleurs ; mais il est facile de le reconnatre l'aide d'une correction trs-simple. Au lieu de a|> i, barbare, il faut lire "SH hou, qui a la mme valeur. C'est vraisemblablement l'effet d'une simple inadvertance de l'diteur chinois, qui a mis un mot pour l'autre, cause de l'analogie des significations; ces sortes de substitutions arrivent frquemment. La correction que je propose est si simple, qu'il y a un autre diteur qui l'a adopte sans croire ncessaire d'en avertir, en transcrivant un passage du Fo kou kih. Ou hou serait alors le nom des Ougours. Il y a parmi les tribus dont se forme la nation Hoe h, des Ou hou, dont le nom a la mme prononciation, quoiqu'il soit crit un peu diffremment 0. (ii) La terre de Thsin.] On dsigne par ce nom la Chine entire, et c'est, comme on sait, celui d'une dynastie du troisime sicle avant notre re, laquelle a, la premire,, t connue des peuples occidentaux, et a t pour eux l'origine des dnominations de 5m, Qivai, Tchina, Tchinistan, Chine. Mais au temps o crivait F hian, plusieurs petites dynasties tablies dans le Chen si avaient fait revivre le nom Thsin dans cette contre o il avait autrefois pris naissance. Le voyageur qui tait parti de ce pays, fait sans doute allusion ces dynasties en donnant aux religieux chinois le nom de religieux de Thsin.
(12) Kao tchhang.] C'est le nom que commena porter sous les 'Wed, c'est-dire au m0 sicle, le pays des Ougours antrieurs ou mridionaux, rpondant peu prs l'emplacement de la ville actuelle de Tourfan. Les voyageurs s'taient avancs plus l'ouest, par consquent, du ct de Kharachar. Trois d'entre eux retournent, pour obtenu des pi'ovisions, dans le Kao tchhang; c'tait en effet se rapprocher du point d'o ils taient partis, le lac de Lob. Les autres vont directement au S. 0. pour se rendre Khotan. route avec un plus haut degr de prcision. a Pian i tian, loc.cit. pag. 2. * Pian i tian, l. LV; Noticesurlu thian, pag. 5. Voy.Hist.de la villede Khotan,p. 1 . Les dtails manquent pour fixer leur
c "=| 1L Vovezle liv. CCCXLVII du Wenhian khao,pag. 6. thoung d Wenhian khao,liv. CCCXXXVI, thoung p. i3 v.
CHAPITRE
III.
Royaume
d'Yu thian.
dTu thian (i) est heureux et florissant. Le peuple royaume y vit dans une grande abondance. Tous les habitants, sans exception, la loi, et c'est la loi qui leur procure la flicit dont ils y honorent On compte eux plusieurs fois dix mille jouissent. parmi religieux, la grande rvolution sont adonns (2). Tous lesquels beaucoup leurs repas en commun. Les gens du pays fixent leur deprennent meure les toiles. Devant la porte de toutes les maisons, on d'aprs parmi lve deux carre, tout tours petites toises de hauteur. o les religieux de (3). Les On plus petites peuvent a construit des monastres reoivent l'hospitalit avoir environ
Le
(h) de forme et trouvent
trangers
ce qui leur est ncessaire. Le roi du pays fit reposer Fa hian et ses compagnons dans un Seng kia lan (5) ; ce Seng kia lan se nommait Kin ma ti (6). C'est un temple de la grande translation Ils prennent (7), o il y a trois mille religieux. un signal son le rfectoire, chacun avec leurs donne en frappant (8). qu'on ils ont une contenance grave avec ordre et en silence. rang, et autres vases. Ces hommes quand ils
en commun, repas ils entrent dans Quand leurs et pose. Ils s'asseyent Ils ne font pas de bruit purs ne se permettent
bassins
les uns les autres pas de s'appeler mais ils se font des signes avec les doigts. mangent, Hoe king, Tao tching et Hoe tha (9) partirent devant grent du ct royaume observer la du de Kie tchha (10). Fa hian
et se diri-
et les autres,
qui dsiraient trois mois et quelques Seng kia lan} et l'on
des Images (11), s'arrtrent procession H y a dans ce royaume jours. quatorze grands ne saurait le nombre des petits. Le compter
CHAPITRE
III. toutes et les rues
17 de
ier jour de la l\e lune (12), on balaye et l'on arrose la ville ; on orne et l'on met en tat les chemins tend de
et des tentures devant grandes tapisseries ville. Tout est par et arrang Le roi, magnifiquement. et des femmes sont tous placs en cet endroit. lgantes gieux ceux du Km ma li tant livrs l'tude le plus; que le roi honore miers la procession des Images. construit un char quatre roues de trois des toises (i3) environ, dans
les places. On la porte de la la reine Les reli-
de la grande translalion, sont aussi ce sont eux qui font les preA trois ou quatre li de la ville, on les images ; il est haut
pour y placer la forme d'un
avec des sept choses prcieuses, au milieu; couvertures de soie. L'Image (i4) est place sa (i5) sont ses cts; autour et par derrire sont les dieux. Toutes sont
orn mobile, pavillon des rideaux et des tentures, deux images Phon des
prcieuses la porte, nouveaux, des parfums au-devant
en or et en argent, avec des pierres sculptes en l'air. est cent pas de Quand l'Image suspendues de sa tiare, se revt le roi se dpouille d'habillements et s'avance ; il sort de tenant nus, pieds de la ville, accompagn la main des fleurs et de sa suite,
ses pieds Il se prosterne et l'Image. des parfums. des fleurs et en brlant Au moment rpandant entre dans la ville, les dames et les jeunes filles qui l'Image au-dessus de la porte, de toutes sur le pavillon jettent parts de toutes profusion tout couvert. Il sortes de fleurs, de manire que le char
pour aller l'adore en o sont une en est
diffrents et chaque crmonie, chaque y a des chars pour un jour des Images Seng kia lan fait la procession particulier. et la procession Cette crmonie commence le ier jour de la ke lune, des Images est termine le 11\ : alors le roi et ses femmes retournent au palais. A sept il y a un Seng kia lan qu'on nomme le nouveau temple du roi. On a mis quatre-vingts ans le et il a fallu le rgne de trois rois pour l'achever. Il jDeut avoir btir, 3 ou huit li l'ouest de la ville,
18
FO
KOU
KI.
de sculptures toises (i6) de hauteur. On y voit beaucoup vingt-cinq Tout ce qu'il sur des lames d'or et d'argent. et d'ornements gravs de la tour. la construction a t runi dans y a de plus prcieux de Fo, admirablement une chapelle dcore; On a lev ensuite les poutres, fentres, sont les les piliers, tout couverts battants de lames des des les treillis portes, construit d'or. On a aussi
et si les religieux, des cellules pour qui sont si belles sparment les dcrire. bien dcores, qui puissent qu'il n'y a pas de paroles de la chane des six royaumes Les princes qui sont situs l'orient tout ce qu'ils en offrande des montagnes (17), y envoient peuvent dont une petite et y font de riches avoir de plus prcieux, aumnes, seulement est mise en usage. partie
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
III.
(1) Le royaume de Yu thian.] C'est la ville de Khotan, l'une de celles de la Tartarie o le Bouddhisme parat avoir t tabli plus tt et pratiqu avec le plus de magnificence. Le nom de cette ville ne vient pas du mot mongol j--^=-^ ( ville), comme on l'a cru longtemps "; mais il drive, ainsi que je l'ai fait voir, de deux mots sanscrits, Kou stana, lesquels signifient mamelle de la terre. On commence voir dans ce pays beaucoup de noms et d'expressions emprunts l'idiome sacr que la religion parat y avoir comme naturalis. Au reste, je n'aurai pas besoin de joindre des notes tendues ce chapitre, parce que j'ai rassembl et publi sparment toutes les traditions relatives Khotan que contiennent les livres chinois 11; il me suffira d'y renvoyer. Le passage de la relation de F hian qui concerne Khotan , s'y trouve rapport c avec quelques lgres diffrences. La version prsente est plus exacte. (2) La grande translation.] 1 Voyez chap. II, note A.
fortifie,commeKhoteu mongol, car une ville en [Le mot p^J2-vt Khotan,ou, commeon crit sansn plonastique la fin, L..OA gnrals'appelle danscettelangue. KL.] ordinairement Balghasoun h JFist. Khot, n'est pas d'originemongole, mais est un de la villede Khotan, etc. Paris, 1820, des nombreuxtermessanscritsqui sesontintroduits i vol.in-8. c en mongol.C'estcfJTfKotta, qui signifieune place Pag. 11 i 5.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
III.
19
(3) Petites tours. ] Le mot chinois que je rends ici par tour, est $%. Th. Il rpond au terme sanscrit Sthopa", qui signifie iumulus; mais dans le langage des Bouddhistes, ces deux mots dsignent les constructions sept, neuf, et mme treize tages, que l'on lve pour recouvrir les lieux o l'on a dpos certaines reliques de saints ou des dieux, et qu'on nomme vulgairement pagodes. On en verra plusieurs mentions dans la suite du rcit de F hian. Les autres relations, les itinraires et les lgendes parlent chaque instant de tours de cette espce. La dimension des tours varie beaucoup. Celles dont il est question ici n'avaient que deux toises chinoises, ou 6m, 120. On en cite de beaucoup plus petites encore qui sont des simulacres de tours, ou comme des bornes riges pour la dvotion des particuliers. D'un autre ct, il est parl d'une tour situe dans le pays des Gandhra, qui avait 700 pieds chinois d'lvation, ou environ 21 G mtres, plus de deux fois la hauteur de la flche des Invalides Paris. (h) Des monastres.] Dans le texte, Seng fang, maison de religieux. On emploie ordinairement d'autres expressions. Voyez la note suivante. kia lan.] Ce mot, emprunt au sanscrit, parat ici pour la premire (5) 5e7i<ji fois; il a besoin d'tre expliqu. Les auteurs chinois qui l'emploient disent qu'il signifie jardins ou jardin de plusieurs, ou jardin de commwiaut \%A~jfc h- Jardin se dit beaucoup pour habitation dans le langage des Bouddhistes. On trouve aussi en chinois Kia lan, par abrviation ; mais, quoi qu'en dise le dictionnaire de Khang hic, Kia lan seul ne peut signifier jardin de plusieurs. J'ai soumis ces transcriptions et ces interprtations chinoises M. Eugne Burnouf, qui propose de restituer Seng kia lan en Sanggram, maison de la runion ou des (prtres) unis. Sur le sens du mot Sanga, en chinois Sang, on peut voir ci-dessus, chap. II, note 4. Je n'hsite pas regarder Seng kia lan comme l'quivalent sanscrit du chinois Seng fang, maison des religieux, employ quelques lignes auparavant. Voyez note kQuoi qu'il en soit, le Seng Ida lan est la demeure des Feou thou d, c'est--dire de Bouddha et des Sangas; c'est tout la fois un temple et un monastre, c'est ce qu'on nomme en sanscrit ordinaire Vihra; et la partie de l'difice o sont les objets livrs l'adoration des fidles, est un Tchatya. Les Tibtains nomment les monastres dGan pa, et les Mongols Kit. On peut voir la description de ces temples bouddhiques dans l'ouvrage de Georgie, et leur reprsentation dans les planches jointes au mmoire de M. Hodgson f, et dans la collection de Parlas 8. Khanghi Tseutian, au mot Th, rad. xxxn, tr. 10. On peut voirp. 53i, tom. I, part, i du Morrison's une.vignettereprsentantun Th. Dictionary, Santsang hiTseutian.Voy. f sou,passim, Khang Lan, rad. CXL, tr. i4; id., voy.Kia, rad. ix, tr. 5. c Loc.cit. d hi Tseutian.Voy. Kia. ' Rang libet. Alphab. pag. /107. f Transactions tom.II, of the royalasialicSociety, pag. 2/15,257, pi. irr, v, vi, vu. S Sammlung historischerNachrichlenbcr die t. II, pag. 1/13, pi. x, xi. Mongolischen Flkerschuften, 3.
20
FOE
KOUE
KI.
(6) Kiu ma ti. ] Ce nom est videmment sanscrit. Peut-tre faut-il le restituer Gmati, de go, vache, btail. Telle est l'origine du nom de la rivire Gmati (Goomty) dans la province d'Aoude \ (7) La grande tiwislation.] Voyez chap. II, note ti(8) Un signal qu'on donne en frappant. ] Il y a dans le texte Khian tchhou i,'A 4j On appelle ainsi une plaque de mtal, de pierre ou de bois, qui rsonne quand on la frappe, et qui sert donner le signal d'une assemble h. (9) Hoe th] est un des compagnons de F hian, que celui-ci n'a pas nomm Son nom signifie pntration clans l'numration qu'il a faite au commencement. intelligente. Voyez chap. I, note 1. (10) Sur le pays de Ki tcha, voyez la note 6 du chapitre V. (11) La procession des Images.] Cette manire de promener les images des dieux sur un char magnifiquement dcor, est commune aux Brahmanes et aux Bouddhistes c. 1' (12) Le 1e jour de la li" lune.] Si, comme cela est vraisemblable, compte ici la manire chinoise, la crmonie qu'il dcrit devait vers le k juin et se continuer jusqu'au 18. le voyageur commencer
(i3) Trois toises, ] environ 9,180. Les chars qui servent aux processions l'Inde, ont au moins cette lvation, au tmoignage de nos voyageurs.
dans
(ili) L'Image.] F hian ne dit pas quelle est cette image de la divinit princicelle d'un Bouddha; mais pale que l'on promenait : c'tait vraisemblablement nous n'avons pas assez de renseignements sur l'tat du Bouddhisme Khotan, dans le v sicle, pour dterminer si leur principal objet d'adoration tait un Bouddha terrestre comme Slikya-mouni, ou un Bouddha divin comme Amitabha, ou enfin le Bouddha par excellence. La circonstance dont il sera parl dans la note suivante, rendrait cette dernire supposition d'autant plus probable, que le Kiu ma ti tait un monastre de la grande rvolution. (i5) Deux Phou sa.] L'image principale avait ses cts celles de deux Photi sa ou Bodhisathvas. A prendre ce rcit au pied de la lettre, il semblerait que le * Wilson, Sanscr. Diclionaiy, pag. 278. 1 Outchhe Kian. yunfon. Voy. 0 Sonnerat, pag. 226. aux Indesorientales,tom. I, Voyage
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
III.
21
dieu tait accompagn de deux divinits infrieures, peut-tre de deux Bodhisattwas. Il est plus vraisemblable que Bouddha avait ses cts ses deux acolytes de la triade suprme, Dharma et Sanga". On pourrait encore supposer qu'il s'agissait des autres triades qui abondent dans le Bouddhisme, comme les trois Bodhisattwas, Mandjousri, f adjra-pni et Padma-pni h, ou bien Amitabha, Avalokiteshwara et Shkya, ou bien Amitabha, Shkya-mouni et Matreya, etc. Les dieux dont les images taient places plus loin sont nomms Thian dans le texte : ce sont. les Dvas des Indiens, les Lha des Tibtains, les Toegri des Mongols, tels qu'Indra, fort infrieures, dans Brahm, et les autres divinits du panthon brahmanique, le systme des Bouddhistes, aux Bodhisattivas, etc. aux Intelligences pures ou purifies, aux Bouddhas,
(16) Vingt-cinq toises.] Environ Panthon Paris.
y6m,5oo,
un peu moins que le sommet
du
(17) La chane des montagnes.] On veut parler ici des monts Tsoung ling, les montagnes de l'Oignon 0, l'ouest de Khotan, chane qui va, dans la direction du nord au sud, rejoindre le massif de l'Himalaya. On verra plus bas que F hian donne un nom quivalent celui <YHimalaya, diverses chanes qui portent habituellement d'autres dnominations. Quant aux six royaumes situs l'orient de la chane, et dont les princes envoyrent au nouveau temple du roi des offrandes magnifiques, F hian ne les dsigne pas d'une manire prcise. Il faut sans doute compter les pays qu'il avait traverss et o il avait trouv le Bouddhisme tabli, Clien chen, Ou hou, Kao tchhang; les trois autres devaient sans doute tre compris entre le dsert et les montagnes de l'Oignon d. Voyezles planches jointes au mmoire de M.Hodgson,Transactions t. II, qfthe asialicSociety, n 2 , etle Nouv. Journ.asiatique, tom.VII,pag.270. h tibet.pag. 279. Alphabet, 0 c Hist. de Khotan, prface, pag. VI; Mmoires l'Asie,tom.II, /120. relatifs a Cf. Wen hian pag.2g5, thoungkhao, liv. CCCXXXVI, pag. 6.
CHAPITRE
IV. de Yu hoe.
Royaume
de Tseu h. Monts Tsoung ling. Royaume
Aprs termine, se rendait le royaume
la 4e lune,
la crmonie
vingt-cinq pendant dans ce royaume. Le roi est fermeaprs quoi ils arrivrent jours, attach la religion mille ment (4). H y a dans ce pays environ la grande translation. On y religieux, appartenant pour la plupart sjourna et, aprs quinze avoir ling au midi, Les voyageurs se dirigrent ensuite jours. march ils entrrent clans les monts quatre jours, au royaume de Yu hoe (6), o ils se (5), et parvinrent s'tre reposs, ils reprirent leur de Ki route, et, en ils ils atteignirent king le royaume et les autres. tcha (7), o
Seng chao partit dans le Ki pin de Tseu h (3). Ils
de la procession des Images tant seul la suite d'un prtre barbare (i) qui vers se dirigrent (2). Fa hian et les autres furent en route
Tsoung reposrent. vingt-cinq rejoignirent
Aprs jours, Hoe
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
IV.
(1) lin prtre barbare.] Le mot du texte que je rends par celui de prtre est Tao homme de la raison. jin, littralement, nom qu'on donne aux sec[ ,/v jtTao /"l est un synonyme de -j^jj&Taosse*, tateurs de Lao tseu et de la doctrine du Tao ou de la Raison suprme. Je ne vois pas pourquoi M. Abel-Rmusat a traduit ce terme par prtre barbare. KL. ] (2) Ki pin, ] la Cophne ou le pays arros par le Cophs h. Rennell a cru que b Slrab. liv. le dictionnairechinoisOutchheyun soui XV, trad. fr., tom. V, pag. 33. [Voyez de Lingi toung, sect.XVI, fol.liverso,et le dictionPlin. liv.VI, d. Hard., pag. 3i7, 3ai, 32/1, 325; nairejaponais-chinois Wosctsysilsliaidmzen,diEmend. pag. 355.Stephan. de Urb.pag. 98. KL. tionde 1826, fol.32 verso. Fest. Avienus, v. i35/|. ]
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
IV.
23
celui des affluents de l'Inclus qui est ainsi nomm par les anciens, tait le Cowmull*; Sainte-Croix pense que c'est plutt le Merham-hirh. Le nom de Cow est probablement un reste de l'antique dnomination. Le Ki pin, que quelques auteurs c, et que Deguignes a pris pour Samarcande, parce qu'il avait pris Samarcande pour le Kaptchaki, rpondait la contre o se trouvent les villes de Ghizneh et de Kandahar. Il est assez clbre clans les gographies chinoises e, et le Bouddhisme parat y avoir t trs-florissant. [Le Gmal, et non pas Cmvmull, prend son origine Dourtchelly, clans le pays de Ghizneh, au sud de Sirefza, et coule d'abord au sud-ouest; bientt il tourne vers le sud, et continue de suivre cette direction jusqu' Domandi, o il reoit la rivire de Mammye et le Kondour, qui a sa source dans le voisinage de Tirwa. D'ici le cours du Gmal se dirige l'est sur Sirmgha, o il est joint par le Zhobi. C'est une rivire presque aussi considrable que le Gmal mme : elle sort des montagnes de Kend l'est de Berchori, et coule dans un canton auquel elle donne son nom. Un peu l'est de Sirmgha, le Gmal traverse la chane de montagnes de Soliman, passe devant Raghzi, et fertilise le pays habit par les tribus de DauUt khal et de Gandehpour. Il se dessche au dfil de Pezou, et son lit ne se remplit plus d'eau que dans la saison des pluies; alors seulement il rejoint la droite de l'Indus, au sud-est du bourg de Paharpour. KL. ] (3) Tseu h.] Ce pays est plac par F hian vingt-cinq jours de marche de Khotan, mais il n'indique pas la direction. C'est en considrant la route que les suivre, et les points connus o ils arrivrent plus voyageurs ont d naturellement tard, que j'ai trac cette partie de l'itinraire au S. 0. de Khotan. Les gographes de la Chine identifient le nom de Tseu h, qui semble signifier union des fis, avec ceux de Tchu kiu pho ou Tchu kiu phan, qui paraissent emprunts du sanscrit. A dfaut d'autres renseignements, je transcrirai ici les dtails qui se trouvent ce sujet dans les collections chinoises f. Le pays de Tseu h a t connu dans le temps des Han postrieurs (au m0 si cle). Il formait autrefois un seul royaume avec celui de Si ye (nuit occidentale). <(Les deux tats ont maintenant des rois particuliers. La demeure de celui de Tseu h s'appelle la valle de Kian; elle est 1000 li (100 lieues) de Son le (Khachgar). On y compte 35o familles et 4ooo soldats s. Sous les 'We du nord, la 3 anne King ming (5o2), la 12 lune, il vint un tribut du pays de Tchu kiu phan. Ce pays est l'ouest de lu thian (Khotan). Descr.de l'Hindoustan, trad. franc., tom. II, pag. 219-20. Examen deshistoriens d'Alexandre, pag. 7^0. c Pian i tian, liv. LUI, Hist.desHuns,tom. II, pag. Ixxxix. Voyezla notice sur ce pays, traduite du Wen asiahianthoung khao,dans mesNouveaux Mlanges tom.I, pag. 2o5. tiques, f Piani tian, liv.LX. de l'occident, cite l S Noticesur les contres mme, pag.1. chinois ont confondu avec le Kachemire
24
FO
KOU
KI.
Ses habitants vivent au milieu des montagnes. Il y a du bl et beaucoup de fruits sauvages. Tout le monde y pratique la loi de Fo. La langue est la mme que celle de Khotan. Cet tat est soumis aux Ye tha (Gtes). Il vint un nouveau tribut la l\e anne Young phing ( 511 ), la 9e lune a. (( Le Tchu kiu pho, aussi nomm Tchu kiu phan, envoya payer le tribut dans les annes Wou t (618-626); c'est le pays qu'on nommait Tseu h sous les Han. Il y a quatre pays (connus du temps des Han) qui sont runis celui-l : Si ye, Phou li, Y na, Te jo. Il est 1000 li prcisment l'ouest de Khotan, et 300 li au nord des monts Tsoung ling. A l'ouest, il touche au pays de Klw phan tho; au nord, goo li, il est frontire du Sou le (Khachgar). Au midi, 3ooo li, est le royaume des Femmes ; il renferme 2000 soldats. La loi de Feou thou y est honore. Les caractres sont ceux des Brahmanes13. Tou chi ajoute ces dtails que le roi de Tchu kiu pho tait originaire de Khachgar, qu'il paya le tribut dans les annes Young phing de Siouan ti; que la langue de ce peuple ressemble celle de Khotan, avec quelques lgres diffrences ; que la figure des habitants ressemble celle des Chinois, et aussi celle des habitants de Sou le. Ils ont pay le tribut sans interruption au temps de la grande dynastie Thangc. On trouve ailleurs' 1 cpie les diffrentes sortes de grains sont en abondance dans le pays de Tchu kiu pho; qu'on n'y mange que du bl, qu'on n'y voit pas de boucheries; que ceux qui se nourrissent de chair, ne mangent que de celle des animaux morts naturellement; que les moeurs des habitants ainsi que leur langue sont analogues celles de Khotan ; que les lettres sont les mmes que celles des Brahmanes ; qu'enfin, le pays peut avoir cinq journes de chemin de circonfrence. On voit que ces diffrents rapports placeraient le pays de Tseu h l'ouest de Khotan, une distance de cent lieues, par consquent 370 de latitude et 710 de longitude orientale du mridien de Paris, vers le point qu'occupe sur les cartes modernes la ville de Yerkiyang". Il faut remarquer que cette position est assigne au pays nomm Tchu kiu pho, et que l'identit de celui-ci avec le Tseu h de la gographie des Han et de F hian ne repose que sur l'autorit de la gographie des Thang. D'ailleurs le pays de Yerkiyang est dcrit par les gographes de toutes les poques, et ne saurait tre confondu avec Tseu h. Une autre raison qui m'a empch d'admettre sans restriction celte position, c'est qu'elle amenait Tseu h trop loin l'ouest. De ce point, quatre jours de route au midi, vingt-cinq jours l'empereurSiouan wou ti, citedansle LXlivredu Piani tian, pag. 1 verso. '' des contres de l'occident Voyezla Description annexe l'Histoiredes Thang, cite l mme, pag. 2. e tian, citl mme,pag. 2 v. Thoung * Hist.des'Wedunord,viede 11 Hist.du Kia lan (monastre) de Loyang, cite l mme. 0 d'au[M. Abel-Rmusat, n'ayant sa disposition tres cartesque celles en Europe, qui ont t publies ne pouvaitsavoir que la vritablelatitudede Yerkiyangest de 38 20', et sa longitude E. de Paris, de 73056'] KL.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
IV.
25
de plus dans une direction cpii n'est pas dtermine, un mois de chemin l'ouest au travers des montagnes de l'Oignon, quinze jours encore vers le sud-ouest pour atteindre le haut Indus, sont une srie de distances qu'il est difficile de compter en prenant Yerkiyang pour point de dpart. [La position du royaume de -y-^f~ Tseu h se trouve dtermine dans la dernire dition du Ta thsing y thoung tchi (sect. 419). C'est le canton actuel de Kouke yar (rivage escarp bleu), situ au sud de Yerkiyang par 700 ko' E. de Paris, et 370 3o' lat. N. sur la droite de la rivire Kar sou, qui coule au nord et se runit au Tiz b ou Tingsa b osteng, affluent de droite du Yerkiyang daria. Ce canton se trouvant presque 5 de longitude ouest de Khotan, et les routes qui y conduisent n'tant pas directes , il n'est pas tonnant que F hian ait mis vingt-cinq journes pour y arriver. Le royaume de Tchu kiu pho s'tendait depuis Ingachar ou Yanghi hissar, dans le territoire actuel de Kachghar, jusqu' Yoal arik, dans celui de Yerkiyang. Il n'est donc pas identique avec le royaume de Tseu h. KL. ] () Fermement attach la religion. ] L'auteur emploie une expression particulire et prise dans le vocabulaire asctique de sa religion : c'est jt|t ;f pi' tsing tsin, qui signifie proprement efforts vers la puret, progrs dans les choses subtiles (saintes), en sanscrit vrya. C'est un des dix moyens d'arriver la perfection absolue, ou, comme disent les Bouddhistes, d'atteindre l'autre rive. J'ai dj eu bien des occasions de parler de ce moyen ou pramit \ On trouvera de nouveaux dtails ce sujet dans le Commentaire sur le Vocabulaire pentaglotte, que nous prparons, M. E. Burnouf et moi, sect. xn, n. A. (5) Les monts Tsoung ling.] On a dj vu (chap. III, note 17) que cette chane de montagnes, dtache du massif de l'Himalaya, court, selon les Chinois, dans une direction peu prs septentrionale. Il s'agit sans doute ici de quelque rameau dtach de la chane du ct de l'orient. Les voyageurs, partant de Tseu h, le rencontrrent aprs s'tre dirigs Arers le midi pendant quatre jours; ils furent cinquante-cinq jours le traverser; sur ce nombre, il y eut trente journes de marche vers l'ouest, et au milieu mme de ces montagnes se trouve, ainsi qu'on le verra plus bas, un royaume appel Ki tchha. (6) Royaume de Yu hoe. ] Ce mot parat offrir la transcription de quelque nom local ; mais il est tout fait ignor d'ailleurs h, et le pays o les voyageurs se trouvent est encore trop peu connu pour nous fournir des moyens de comparaison. (7) Royaume de Ki tchha,] autre pays sur lequel les gographes chinois ne nous fournissent non plus aucun renseignement 0. Voyez ci-dessous, chap. V, note 7. " en particulierle Nouveau tom.VII, pag. 200. Cf.Pian i tian, liv. LXIII, Journalasiatique, Voyez sect. 2; liv. LIV,articlesOutchhaet Kiaanyu mo. Cf.Pian i tian, liv. LXIII, sect. 3. 4-
CHAPITRE
V.
Royaume de Ki tchha.
Le
roi
cle Kie
tchha
clbre
en chinois signifie grande cette assemble, on invite nent tous et s'assemblent o
le pan the yue sse (i). Pan tche yue sse assemble cjuincjiiennale. Au temps fix pour de tous les cts les Samanens. Ils viendes nuages, sance, avec pompe et gravit.
comme prennent On dresse
Au lieu
les religieux des bannires, des dais. pha en or et en argent,
on suspend des tentures, un trne garni de fleurs de nymet d'toffes de soie; et dans le fond on diset ses officiers Cela dure faire leurs y viennent un mois, ou deux, ou (2). Quand leur tour trois le roi
pose des siges lgants. dvotions conformment trois
Le roi
la loi.
: gnralement la crmonie a lieu dans le printemps le roi a lev l'assemble, il exhorte ses officiers faire leurs ou dvotions. Les uns y mettent tout le monde un
cinq fait une bride; et les
Quand jours. distribution (3) du cheval des chevaux qu'ont monts
les autres deux, jour, a termin ses dvotions, de sa selle officiers
qu'il a mont, les principaux
et de sa
ainsi que de distinction, personnages et de toutes d'toffes de laine et d'objets les choses prcieux, les Samanens avoir besoin. Tous les officiers s'engagent peuvent on rachte des religieux des voeux et font des aumnes ; ensuite autres ces objets. Ce pays que le bl. et montagneux. Il n'y mrit ont reu que les religieux
du royaume de toutes sortes dont par tous
est
froid
Aussitt
pas leur
d'autre
l'anne,
le temps, de serein qu'il tait, devient neigeux ne reoivent a-t-il coutume d'ordonner leur que les religieux est parvenu sa maturit. vision annuelle qu'aprs que le grain
grain de provision : aussi le roi pro-
CHAPITRE
V.
21 il est de pierre aussi une dent pays ont lev l'tude de la
Il y a dans ce royaume un vase o Fo a crach ; et de la mme couleur que le pot de Fo (4). II y a de Fo (5); et, en l'honneur de cette dent, les gens du une tour. H y a plus de mille religieux, tous attachs petite rvolution. A l'orient de grossiers diffrence formment roues qui des ces
montagnes, ressemblent ceux toffes loi, tre de font laine usage
le peuple de la terre et du de feutre. roues
s'habille de Thsin, Les
de vtements sauf la seule conde ces
Samanens,
la
(6), et l'efficacit
ne saurait
Ce royaume on s'avance au deviennent le grenadier la Chine. tout
rapporte. est au milieu des midi de ces
montagnes
montagnes, a que qui
diffrents
: il n'y sucre,
ling f]). Quand les plantes et les fruits trois vgtaux, le bambou, Tsoung semblables ceux de
et la canne
soient
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
V.
(i) Pan tche yu sse.] Ce mot est videmment d'origine sanscrite, et conformment l'interprtation qu'en donne l'auteur, grande assemble quinquennale, il se compose du radical pantcha, cinq [et de youktih, runion, assemble. KL.] ~~ ^ *"** (2) [Dans l'original : ~ % % % flf^j fy ^^ J( A' qu'il faut traduire ce passage de la manire suivante : Ou le premier mois, ou le second, ou le troisime, mais gnralement au printemps. KL.] (3) Distribution, aumne.] Le voyageur emploie ici le terme consacr, "ij/tL^T pou chi, l'quivalent du sanscrit dna. C'est le premier des dix pramit ou moyens de salut. Voyez ci-dessus, chap. I, note i 2 , et chap. IV, note . de la profes(Il) Le pot de Fo. ] Le pot est l'un des ustensiles caractristiques sion du religieux mendiant. Celui dont s'tait servi Shkya mouni durant son existence terrestre, est devenu une relique trs-prcieuse. Il en sera question plus tard. Voyez chap. XII. 4.
28
FO
KOUE
KL
(5) Une dent de Fo.] Les dents de Fo sont au nombre des reliques les plus clbres du Bouddhisme. L'histoire de cette religion prsente beaucoup de faits relatifs ces restes prcieux du corps de Shkya mouni. (6) Roues.] H y a dans le texte $. tchhouan, objet circulaire et tournant, et non pas J?A. lun, roue (en sanscrit tchakra, en tibtain hGor-loe, en mongol entendre ce passage diffremment; mais il s'agit kurdou). On pourrait peut-tre ici des roues prires ou cylindres sur lesquels on colle des priprobablement res , et qu'on fait tourner ensuite avec autant de rapidit que cela est possible, pour obtenir et procurer aux assistants, chaque tour de roue, le mme mrite que si la prire avait effectivement t rcite. On peut voir la description de cet usage dans les relations des Aroyageurs qui ont visit la Tartarie a. Au reste, l'ide de roue, de rvolution circulaire, est une de celles qui reviennent le plus souvent dans le langage mtaphorique des Bouddhistes. On a dj vu cpie c'tait le sens propre de l'expression mystique de yna (chap. II, note li). La roue est au nombre des huit symboles (les huit vtargas; naman takil en mongol) qu'on voit dans les temples bouddhiques b. Elle est le signe de la puissance suprme entre les mains des monarques qui sont censs avoir exerc une domination universelle, et qu'on nomme par cette raison tchakravarti, tourneurs de rouec; elle est l'emblme de la transmigration des mes, qui est comme un cercle sans commencement ni fin. Elle est aussi l'emblme de la prdication; et pour due qu'un Bouddha a commenc prcher sa doctrine, on dit qu'il a une premire fois fait tourner la roue de la loi. Cette expression, qu'on rencontrera dans le rcit de F hian, tient vraisemblablement l'emploi des roues prires. Enfin, les diverses branches d'une doctrine, ou les systmes diffrents qu'embrassent ceux qui l'ont adopte, reoivent aussi le nom de roue, et l'on dit les prceptes de la roue de la loi suprieure, de la roue de la loi moyenne, de la loi infrieure d. Au reste, les roues prires paraissent tre maintenant particulires aux Bouddhistes des contres du nord, et je n'ai pas trouv de mention de cet usage dans les extraits des livres indiens qui sont venus ma connaissance. C'est ce qui justifierait la remarque cette note. " faite par F hian dans le passage qui a t l'occasion de
Pallas, trad. fr., tom.I, pag. 568. B. Bergu. s. w., tom. III, mann, Nomadische Streifereien, Reisein denKaukasus, tom.I, pag.125.'Klaprotli, pag. 181.Descr.de hLassa, dansles Nouv.Ann. 2srie, tom. XIV,pag. 265.Alphab. des Voyages, Tibet, pag. 5o8, 5i i et planche.Descr.de Soungnum, extraitedu Journalde Calcutta(Journal asiatique) , tom.I, pag. 352.
h Pallas , hisioriseher Nachrichten, Sammlnngen u.s. w., t. II, pag. 158.Asiat.Research, tom.XVI, pag. /]6o. c Alphab.Tibet,pag. 21g.Geschichteder OstMongolen, passim. d orientaux, Sanang sctsen, Hist. des Mongols textemongol,pag. 16.Voyez JournaldesSavants, janvier 1831,pag.3g.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
V.
29
tchha, ou selon la prononciation (7) [La position du royaume de jt^fiixjKi vulgaire Kiet tchha ou Ket tchha, est d'autant plus difficile dterminer, cpie ce nom ne se trouve dans aucun autre crivain chinois connu en Europe. M. Rmusat penchait y reconnatre le Kachemir, mais ce pays n'est pas aussi froid que l'est le Ki tchha selon F hian, et il produit, au rapport de Moorcroft, du froment, de l'orge, du bl-sarrasin, du millet, du mas, des lgumes, du panic et du riz. Cependant, comme le dernier est le plus cultiv, on peut le regarder comme la principale des crales du pays a. D'ailleurs, pour se rendre de Tseuh ou Kouke yar dans le Kachemir, F hian aurait d traverser la branche suprieure de l'Indus qui vient du Tibet, o elle porte actuellement le nom de Singh tchoii ou Sing dzing khampa, et qui est beaucoup plus considrable que celle qui, venant du nord, prend sa source au pied mridional de l'immense glacier Pouchti kher et s'appelle rivire de Khmeh. Dans les hautes montagnes de l'Asie centrale, les chemins qui conduisent travers les glaciers, ou qui les vitent par des dtours, restent presque toujours les mmes : il est donc vraisemblable que celui qu'a suivi notre voyageur, ne diffre pas de celui qui, encore aujourd'hui, conduit de Khotan et de Yerkiyang au Tibet occidental. Ce chemin remonte la partie suprieure du Tiz b jusqu' sa source, passe par le dfil de Kar koroum, au sud duquel il suit le cours du Khamdan, affluent du Cliayouk, et puis le cours de celui-ci jusqu' Leh ou Ladak. De cette ville on se rend dans le Baltistan, en restant au nord de la branche tibtaine de l'Indus; et nous verrons qu'on n'y passe le Kmeh que beaucoup plus loin. F hian, en partant de Tseu h (ou Kouke yar), a donc suivi, dans une direction mridionale, le Kar sou jusqu' ses sources, qui sont dans les monts Tsoung ling. De l il a tourn d'abord au sud-est pour atteindre et remonter le Tiz b, puis il a suivi le cours du Khamdan et du Chayouk jusqu' Ladak, qui parat tre son royaume de Yu hoe. De Yu hoe il y a vingt-cinq journes (sans doute l'ouest) pour arrivera Ki tchha. Il faut donc .chercher ce pays dans le Baltistan, qui est le petit ou premier Tibet, ou dans le voisinage. KL.] 2 Journal the tom. II, pag. 23. of royalgeographical Society of London,
CHAPITRE
VI.
Monts Tsoung ling. Neiges perptuelles. Inde du nord. Royaume de Tho ly. Colosse de Mi le Phou sa.
on alla vers l'ouest en se dirigeant du ct Du pays de Ki tchha les Tsoung de l'Inde du nord. On fut un mois en route pour traverser et en t. Il il y a de la neige en hiver ling. Sur ces montagnes, leur s'ils venimeux venin, qui vomissent y a aussi des dragons manquer la pluie. la neige, le viennent leur proie (i). Le vent, de tels obstacles aux sable volant et les cailloux rouls opposent il n'y en a pas un Voyageurs, que sur dix mille qui s'y hasardent, les habitants de ce pays hommes des On nomme qui y chappe. Montagnes Quand Au moment petit royaume de religieux, de neige (2). on a travers d'entrer nomm tous cette dans Tho on arrive de cette dans l'Inde du nord on trouve grand
chane,
(3). un
les limites
contre, un
ly (4), o il y a aussi de la petite translation. ce royaume un
nombre
dans Il y eut autrefois d'une puissance surnaturelle
(6), transporta la stature de Teou chou (7) pour y contempler Phou sa (8), et en faire, tre redescendu, aprs taille en bois. Cet artiste monta trois fois
Lo han (5) qui, par l'effet un sculpteur dans le ciel et les une de traits de Mi le
reprsentation suite pour voir
le
une statue haute de huit toises (9), et aprs il excuta personnage, de fte, cette staet dont le pied avait huit coudes (10). Les jours de lumire; tue est toujours les rois de ces pays lui resplendissante rendent l'envi les plus grands honneurs. Elle subsiste encore actuellement dans cet endroit (n).
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VI.
31
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VI.
' PassaSe CJue (i) [L'original porte : ^ tf_ Jh] ^J^^^F "M ^ |L4~ je crois plutt signifier : ail y a aussi des dragons venimeux, qui, s'ils sont m contents, vomissent du venin. Il s'agit ici vraisemblablement des vapeurs et exhalaisons vnneuses qui infectent plusieurs valles de l'Himalaya et des mon KL. ] tagnes du Tibet. (2) Hommes des Montagnes de neige. ] On reconnat clans cette dnomination celle des montagnes du grand Caucase indien, couvertes de neiges perptuelles, en sanscrit Himalaya. Au reste, la phrase chinoise est embarrasse et peut-tre corrompue ; on en jugera.
Littralement: Occurrentium his oerumnis, decies mille, non unus servatar. Istius terroe homines nomine vocantar niveorum montium homines. La difficult tombe sur le mot jin (homines), qui ne devrait pas tre rpt deux fois. Il n'y a point de variantes dans les deux textes. [Je pense que le premier caractre $%_ yu, rencontrer, appartient la phrase et se rapporte aux vents, la pluie, la neige, au sable volant et aux prcdente, cailloux rouls que les voyageurs rencontrent; alors le sens du reste serait : Ces obstacles quoique innombrables n'en forment pas un vritable pour les gens du pays ; aussi ces gens sont-ils appels gens des Montagnes de neige. KL.] (3) L'Inde du nord. ] La contre appele Inde du nord, P Thian tch, parles Bouddhistes et les gographes chinois qui les ont suivis, n'tait pas comprise dans les limites actuelles de l'Hindoustan ; mais cette dnomination s'appliquait aux pays situs au N. E. de l'Indus, au midi d'Hindou kouch, dans la partie orientale de ce qu'on appelle maintenant Afghanistan. Vlnde du nord contenait, outre le Tho ly (Darada?), seront nomms plus bas. l'Oudyna, le Gandhra et quelques autres pays qui
(Zt) Tho ly. ] Ce petit pays est compltement
inconnu
d'ailleurs.
chi(5) Lo han.] Lo han, et plus exactement A lo han, sont la transcription noise du mot sanscrit Arhan, vnrable. A b han, suivant les Chinois, signifie qui n'est plus soumis la naissance, ou cpii n'a pas besoin d'tude (wou seng,
52
FOE
KOUE.
KI.
wou Mo). V Arhan est celui qui est arriv la perfection et qui sait y conduire les autres . Il est dix millions de fois suprieur YAngm, et un milliard de fois infrieur au Pratyka Bouddha, selon le tarif des mrites acquis par les diffLes Arhan rentes classes de saints, tarif qui est attribu Shkya-mounilui-mme1'. jouent un trs-grand rle dans toutes les lgendes bouddhiques. Les Tibtains les nomment gNas-hrtan; on en compte dix-huit principaux, qui sont figurs clans les mythologies chinoises (Sanihsc thou hoe, Jin-sse, 1. IX, p. ho). On en dsigne ailleurs seize auxquels on donne l'pithte de grands, et qui vivent dans diffrentes les du monde terrestre c. L'Arhan dont il est ici parl se nommait Mo thian ti kia (en pli Madhyntika ), au rapport de Hiouan thsang. Voyez ci-aprs, VIII, i. -fo $. jfE} force suffisante des dieux. La par(6) Une puissance surnaturelle.] faite connaissance des vrits du Bouddhisme procure aux saints de cette religion dix sortes de puissance. i Ils connaissent les penses d'autrui. 2 Ils ont la vue connaissent perante et pure des yeux du ciel, c'est--dire qu'ils voient clairement, sans obscurit, sans obstacle, tout ce qui existe dans l'univers. 3 Ils connaissent le pass et le prsent, li" Us connaissent la succession non interrompue, sans et sans fin, des kalpas ou ges du monde, actuels et futurs. 5 Ils commencement ont la finesse des oreilles du ciel, c'est--dire qu'ils entendent clairement, distinctement, sans efforts et sans obstacles, tous les sons, toutes les voix qui se produisent dans les trois mondes et les dix parties de l'univers, et qu'ils en discernent l'origine sans difficult. 6 Ils ne sont point assujettis aux conditions corporelles, et peuvent, volont, former des apparences pour accomplir leurs intentions. 7 Ils distinguent les nuances des mots heureux ou malheureux, prochains ou loigns. 8 Ils ont la connaissance des formes : sachant que la forme est vide, ils peuvent revtir toutes sortes de formes; et sachant que le vide est forme, ils peuvent anantir les corps. g Ils ont la connaissance de toutes les lois. io Ils ont la science de la contemplation d. Parmi les dix grands disciples de Shkya mouni, le sixime, nomm Mo kian Les autres brillaient par lion, s'tait acquis la plus grande force surnaturelle. l'exacte observation des prceptes, par la manire dont ils prchaient la doctrine, ou dont ils expliquaient les choses spirituelles, etc. ". La puissance surnaturelle est ce cpie les Mongols appellent riddi khoubilganl. Sanang setsen en rapporte plusieurs exemples e. ,l Commentaire sur le Hoa yan king, cit dans le Santsang f sou,liv. XXXVIII,pag. 18 u. Fan y mingi, cit dans le San tsang f sou, liv. XLI, pag. 12 v.Encycl.jaj).liv. XIX, pag. 8. u. s. f, tom. II, pag. 386. Pallas, Sammlung., M. Schmidt,Notes surSanangsetsen,pag. 3i 2. s Pag. i5, 33, 43, etc. " Transactions the tom.II, of royalasiaticSociety, 2/i5. Cf. Schmidt, Notessur Sanang setsen, 3i/|. h Fochouessechicul tchangking,pag. 4 v. 5. Cf.Mcm.surla religion samanenne, danslesMcm.de l'Acad.des inscr.et belles-lettres, lom.XL, p. 25/|. c F tchu ki, cit dans le San tsangf sou, liv. XLV,pag. 17.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VI.
33
Teou sou, (7) Le ciel de Teou chou.] Ce nom, qui se transcrit ordinairement ou plus exactement Teou sou tho, reprsente le mot sanscrit Touchita, et dsigne le sjour de la joie. C'est l'un des tages superposs ou paradis placs au-dessus du monde matriel, que l'on nomme en sanscrit bhouvana. Le Touchita est le quatrime de ces tages, compris dans le monde des dsirs, selon la classification la plus rpandue a, et le troisime du Kmavatchar, selon l'arrangement des Bouddhistes du Npal h. Le P. Horace de la Penna, qui en parle sous son nom tibtain de dG Idan, le place au premier rang infrieur parmi les habitations des lia ou dieux 0, tandis qu'ailleurs il le compte comme le quatrime en montant, Le nom de ce paradis signifie parmi les stations du monde de la concupiscence 11. savoir suffisant, parce que les dieux qui y habitent savent se tenir en garde contre les cinq dsirs, ou les dsirs des cinq sens". On l'interprte aussi par joyeux, dlicieux, lieu de dlices et de satisfaction. C'est l le sens de l'expression tibtaine f et des explications tartares s, comme c'est le sens du mot sanscrit. Dans ce paradis, les dieux vivent cinq cent soixante et seize milliers de millions d'annes. Leur taille est de cinq cents donpa (mesure tibtaine de quatre coudes), et ils se reproduisent par le simple attouchement des mains \ chinoise de Matreya Bodhisattwa. Mi le est (8) Mi le Phou sa, ] transcription la prononciation trs-abrge et trs-corrompue de Matreya, mot sanscrit qui 1 c'11'-Le signifie, suivant les Chinois, fils de la bont ou de la tendresse, J^r %ie ^sei mot chi, joint au radical tseu, rend l'effet de l'inflexion sanscrite sur le radical mitra. Ce personnage, qui doit succder Shkya mouni comme Bouddha terrestre, D'autres tait, sous le nom de Ayito, au nombre des disciples de ce dernier'. assurent qu'il est n dans le ciel l'poque o Shkya embrassa la vie religieuse, c'est--dire quand la dure de la vie moyenne des hommes tait de cent ans. Depuis ce temps il rside en qualit de Bodhisattwa dans le Touchita, et il y rsidera jusqu' son avnement dans la qualit de Bouddha. Cet avnement, suivant une prdiction que Shkya fit ses disciples dans la ville de Che we, aura lieu une poque trs-recule, quand la vie des hommes, par une srie de diminutions et d'accroissements successifs, aura t porte quatre-vingt-quatre mille ans, c'est--dire dans cinq milliards six cent soixante et dix millions d'annes k. Le nom de la ville o il prendra naissance, celui du prince son pre et de la San Thiantha ssekiaoi, cit dans le San tsang tsang f sou, u. s. f c Boolan h.v. sou, liv.XLVII,pag. 26v.Focabnlaire Schroeter, Diciionarj: pentaglolle, sect.XLIX, n 4. u. s. S Vocabulaire pentaglotte, h Tibet, Hodgson, Sketch of the Buddhism,dans les Alphab. pag.483. 1 etc. tom.I, pag. 234. Ta tchi tou lun, cit dans le San tsang Transactions, f sou, Tibet, liv. XLIV,pag. 6. Alphab. pag. 182. * Ibid. 1 Encrei. liv. IV, pag.32. pag. 483. jap. 5
54
FO
KOUE
KL
princesse sa mre, ont t galement annoncs par Shkya. Son pre se nommera Sieou fan ma, sa mre Fan ma you. Ce sera la plus belle personne du monde, gale en attraits la femme d'Indra, ayant les lvres comme la fleur oubara, l'haleine comme le santal. Matreya natra, comme Shkya, par le flanc droit de sa mre. Alors les dieux, habitants du Touchita, entonneront des cantiques", etc. Matreya vivra quatre-vingt-quatre nirvana aura la mme dure. (9) Huit toises], 2/1'", ko. (10) Huit coudes], 2'", kk. (11) Elle subsiste encore.] F hian s'exprime ici en homme qui a vu le colosse dont il parle. On verra, dans le chapitre suivant, quelle poque la tradition qu'il a recueillie faisait remonter l'rection de cette statue. * Ghin i tian, liv. LXXVIII, pag. 3. mille ans, et la loi qu'il lguera aprs son pari
CHAPITRE
VIL
Fleuve Sin theou.
On
suivit
la chane
au sud-ouest,
en
marchant
pendant
quinze
Cette route est extrmement difficile et fatigante, jours. remplie d'obstacles et d'escarpements On ne voit dans ces mondangereux. de rochers d'ltagnes que des murailles qui ont huit mille pieds vation. avancer, Quand on s'en le pied Au bas est une approche, venait glisser, rivire nomme la vue se trouble; et si, en voulant il n'y a rien qui pt le retenir (i). le fleuve Sin theou (2). Les anciens
les rochers ouvrir une route, et ils ont taill des perc pour chelles on a pass ces chelles, Quand qui ont sept cents degrs. on traverse le fleuve sur (un pont de) cordes Les deux suspendues. rives du fleuve sont loignes l'une de l'autre d'au moins quatre-vingts des Han, dans leurs Tchang khian et Kan yng (3), sous la dynastie dont les secrtaires du cabinet des affaires tranvoyages, interprtes la relation gres ont donn (4), ne sont, ni l'un ni l'autre, parvenus pas. ce point. jusqu' Les religieux ont demand la loi de Fo avait commenc pondu m'ont l'rection passrent : Je assur de m'en suis inform F hian si l'on savoir quand pouvait l'orient. Hian leur a rgens ce pays, et tous ce fut aprs traditions, des Cha men de l'Inde de
ont
passer prs des
les plus anciennes que, suivant la statue de Mi le Phou sa que
avec eux les livres sacrs et la colemportant lection des prceptes. La statue fut rige trois cents ans aprs le ni houan de Fo, ce au temps qui, par le calcul des annes, rpond de Phing wang, de la famille de Tcheou on peut dire (5) : c'est pourquoi que la grande doctrine a commenc se propager et se rpandre
ce fleuve,
56
FO
KOU
Kl.
l'poque Sans le secours de ce grand ( de l'rection ) de cette statue. matre Mi le, qui et continu l'oeuvre de Chy kia et rduit ses lois en la connaissance de rpandre des trois Qui et t capable pratique? tres prcieux chez les habitants (6), et de la faire pntrer jusque de l'extrmit du monde, en leur apprenant connatre avec certitude d'une l'origine opration de la rvolution Telle (7). humaine. des Han mystrieuse? a t la cause Ce n'a du pas t l'effet ti
songe
de Ming
de la dynastie
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIL
( 1) Il n'y a rien qui pt le retenir. ] Cette description des escarpements dans les hautes chanes de l'Himalaya est d'une exactitude parfaite, et tous les voyageurs qui en ont parcouru quelques parties, s'accordent dans le rcit des difficults de toute espce qui rendent la marche travers ces montagnes aussi pnible que les prilleuse : les rochers pic, les escaliers taills dans les escarpements, chanes tendues au-dessus des valles et les ponts suspendus. (2) Le fleuve Sin theou.] Le nom du Sind est crit ici jjjfr. Ailleurs on le trouve orthographi /j^Mg ou $_E}-3Z. Ce nom signifie, suivant les Chinois, fleuve qui sert de preuve ou de tmoignage, y^Tj^- D'aprs la cosmographie bouddhique, il sort de la partie mridionale du lac A neou tha, passe par la bouche de l'lphant d'or, fait une fois (alias sept fois) le tour du lac, et va se jeter dans la mer du sud-ouest \ On sait que, selon cette cosmographie, quatre fleuves partis du mme point se dirigent en sens opposs : i Le Heng Ma ou Heng (Gange), dont le nom sanscrit signifie venu de la maison cleste, parce qu'il coule d'un lieu trs-iev. Il sort de la partie orientale du lac A neou tha, ainsi nomm d'un mot sanscrit (anawadata), qui signifie exempt de tumulte. Ce lac est au midi de la montagne des Parfums, et au nord des grandes Montagnes de neige; il a huit cents li de tour. L'or, l'argent, le verre, le cristal, le cuivre, le fer, etc. ornent ses rivages. Le Gange sort de la bouche d'un boeuf d'argent, et, faisant une fois le tour du lac, il se jette dans la mer du sud-est. 20 Le Sin tou (Sind), dont on vient de parler. * A han king(le longAgama),cit dans le Santsang Tchang f a sou, liv. XVIII, pag. 21v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIL
57
3 Le F thsou (Vatch, Oxus ou Djihoun ), dont le nom sanscrit signifie rivire pure; il sort du ct occidental du lac A neou tha, par la bouche du cheval de verre ou de saphir, fait une fois le tour du lac, et va se verser dans la mer du nord-ouest. k Le Si to, d'un mot sanscrit (s'ta) qui signifie froid, sort de la partie septentrionale du lac A neou tha, par la gueule du lion de Pho ti Ma (sphatika, cristal fait une fois le tour du lac, et va se jeter dans la mer du nord-est. Quelques-uns prtendent que ce fleuve s'enfonce sous terre et va sortir des montagnes du dsert de pierre, o il forme la source du fleuve Jaune de la Chine a. Pallash, d'aprs la cosmographie mongole Ertundjin tooli, nomme les quatre fleuves Ganga, CMlda, Baktchoa ( Wakshou, Oxus) et Aipara. B. Bergmann, citant le mme ouvrage 0, rapporte d'autres noms : Ganga, Sidda, Barkho etBaklchi ou Chida. Le P. Horace, d'aprs les Tibtains, nomme ces quatre fleuves mGan-hgis, Sindhou, Paktchhou et Sidai. [Le lac A neou tha ou Anawadata est le Rwanhrada des Hindous et le Mapam datai des cartes mandchou-chinoises faites sous Khang hi et Khian loung. Dans les dernires, les quatre bouches sont appeles les quatre portes, mais c'est d'une seule que sort une rivire qui communique l'ouest avec le lac Langga. Voici les noms de ces quatre portes: Touigochal, l'orientale; GMou ourgo, la mridionale; Arabko, l'occidentale, qui communique avec le Langga, et Dadzan loung, la septentrionale. Il ne faut cependant pas oublier que F hian n'a pas travers la branche suprieure de l'Indus, qui vient du Tibet, ou qui sort, d'aprs les ides des Bouddhistes, de la partie mridionale du lac Anaivadata. Le voyageur a seulement pass la seconde branche de l'Indus, appele Klumeh. M. E. Burnouf propose une autre explication du mot A neou tha. En pli, ce lac se nomme Anavatatta, mot qui ne peut tre autre chose que le sanscrit anavatapta, c'est--dire, cp n'est pas clair ou chauff (par les rayons du soleil). Cette explication s'accorde bien avec l'opinion qui fait de ce lac le Rvanhrada. KL.] (3) Tchang khian et Kanyng.] L'intention du voyageur est de relever le mrite des efforts qu'il a d faire pour atteindre une contre si loigne de la Chine, et il cite les deux expditions les plus lointaines qui eussent t faites jusqu' lui, par des gnraux chinois, pour montrer qu'il avait dpass le point le plus recul o fussent encore parvenus ses compatriotes. Tchang khian, que Deguignes, par erreur, a nomm Tchang kiao", est un gnral chinois qui, sous le rgne de Wou ti de la dynastie des Han, l'an 122 avant J. C, fit la premire expdition mmorable dans l'Asie centrale. On l'avait envoy en ambassade chez les Yu ti, mais il avait t retenu par les Hioung nou, et gard dk ans chez ces peuples. Il s'y tait mme mari et avait eu des a c Nomadischc tom.III, pag. 198. A hanking(le longAgama),cit dans Streifercien, Tchang d leSantsang Alphab.Tibetpag. 186. f sou, liv. XVIII,p. 21 v. ' Histoire desHuns, t. I, p. 27; t. II, p. 48. Sammlungen, u.s.f, tom.II, pag.3-j. de roche),
58 enfants. Durant
FOE
KOU
KL
ce sjour, il avait acquis une connaissance tendue des contres situes l'occident de la Chine. 11 finit par s'chapper et s'enfuit plusieurs dizaines de journes du ct de l'ouest, jusque dans le Taivan (Farghana). De l
il passa dans le Khang kiu (la Sogdiane), le pays des Yu ti et celui des Dahse. Pour viter son retour les obstacles qui l'avaient arrt, il voulut passer au milieu des montagnes, par le pays des Khiang ( le Tibet ) ; mais il ne put viter d'tre encore pris par les Hioung nou; ce qui, pour le dire en passant, fait voir qu' cette poque le Tibet tait dj expos aux incursions des nations septentrionales. Il parvint s'chapper de nouveau et revint en Chine aprs treize ans, sur cent qui avaient form sa suite son n'ayant plus que deux compagnons, dpart. Les contres qu'il avait visites en personne taient le Ta wan, le pays des grands Yu ti, celui des Ta Ma (Dahoe) et le Khang kiu ou la Sogdiane. Mais il avait en mme temps recueilli des renseignements sur cinq ou six autres grands tats, voisins de ceux-l, et son retour il fit part l'empereur de ses observations. Quand j'tais chez les Tahia, dit-il, je remarquai des cannes de bam bou de Khioung et des toiles de Ch. Je demandai comment on s'tait procur ces objets. Les Tahia me rpondirent : Nos marchands vont faire le commerce dans le pays de Chin tou (Sind). Le Chin tou est au S. E. des Ta hia, quel ques milliers de li. Les moeurs de ses habitants et leurs vtements ressemblent ceux des Tahia; mais leur pays est bas, humide et chaud. Ces gens montent sur des lphants pour faire la guerre. Leur pays touche la grande mer. Sui vant mon calcul, le pays des Ta hia est douze cents li au S. O. del Chine. Et puisque le Chin tou est quelques milliers de li au S. E. des Ta hia, et que l'on y trouve des objets venus de Ch, ce pays ne doit pas tre loign de Ch. En consquence, j'ai voulu passer par le pays des Khiang ; mais en vou tant viter les dangers qui me menaaient chez ces peuples, je me suis avanc un peu trop vers le nord, et j'ai t fait prisonnier par les Hioung nou. Cepen dant il doit tre facile de sortir par le pays de Ch, et l'on ne serait point expos aux attaques des brigands. L'empereur ayant appris que les Ta wan, les Ta hia, les An szu et autres peuples formaient des tats puissants, o l'on trouvait beaucoup de choses rares; que ces nations avaient une grande ressemblance avec le royaume du Milieu, mais qu'elles taient peu guerrires, et qu'elles estimaient beaucoup les marchandises de la Chine; sachant aussi que dans le nord, les grands Yu ti, les Khang kiu et autres peuples puissants et belliqueux pouvaient tre attirs par l'appt des richesses, et que si on parvenait leur faire goter des ides de justice, une vaste rgion de dix mille li d'tendue serait ouverte aux officiers de l'empire, et de toutes parts entre les qu'alors la vertu et les bonnes moeurs se rpandraient quatre mers, il donna son approbation au projet de Tchang khian, et ordonna diffrentes routes. qu'on fit. partir de Ch plusieurs envoys cpii prendraient
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIL
59
Ils sortirent en effet par quatre points, et firent chacun mille ou deux mille li; les routes fermes au nord par les Ti et les Tso, au sud mais ils trouvrent par les Sou et les Kouen ming. Ces peuples n'ont pas de chefs et se livrent, au brigandage. Ils firent prir plusieurs des envoys chinois, de sorte que la communication projete ne put avoir lieu. On apprit seulement qu' mille li du ct de l'occident, tait un royaume o l'on se servait d'lphants pour monture, et que l'on nommait Thian, et que c'tait l que passaient les marchandises qui venaient de Ch. Quelques-uns russirent y arriver. Ce fut ainsi qu'en cherchant communiquer avec les Dalise, les Chinois commencrent connatre le royaume de Thian. On avait dj fait bien des tentatives pour ouvrir des relations avec les barbares du sud-ouest ; mais on y et renonc sans les assurances donnes par Tchang khian sur la possibilit d'arriver chez les Dahse par ce chemin. environ, Tchang khian servit ensuite dans les guerres contre les Hioung nou; et les connaissances locales qu'il avait acquises pendant son sjour chez ces peuples, furent fort utiles aux gnraux chinois. Il fut, en 123 avant J. C, lev un poste important. Mais deux ans aprs, ayant chou dans une expdition contre les Hioung nou, il encourut la peine capitale, et fut, par grce spciale, condamn seulement la dgradation et rduit au rang du peuple. Il ne laissa pas, sur les rapports qu'aquelque temps aprs, de donner d'utiles renseignements vaient entre eux les princes des Hioung nou, des Ou sinn et des Yu ti, sur la soumission des Sa par ces derniers, et sur d'autres vnements relatifs ces nations occidentales, qui avaient de l'intrt pour les Chinois cause de la exercer alors sur l'Asie intrieure \ J'ai cru domination qu'ils prtendaient devoir entrer dans ces dtails, parce qu'ils se rapportent la premire dcouverte de l'Inde par les Chinois. Il n'est en aucune faon parl de cette contre avant cette poque, au moins dans ceux de leurs livres que nous connaissons. L'autre gnral dont parle F hian dans le passage qui a t l'occasion de cette longue note, est Kanyng, que le clbre Phan tchao, conqurant de la Tartarie pour l'empereur Ho ti, envoya, l'an 97 de J. C, jusque sur les bords de la mer occidentale, c'est--dire de la mer Caspienne, avec ordre d'aller soumettre l'empire romain. Les informations que ce gnral prit chez les Tiao tchi (Tadjiks) et de ce projet. On lui dit que la mer tait vaste, et que les An szu le dtournrent ceux qui la traversaient dans un sens ou dans un autre, mettaient trois mois quand ils taient favoriss par un bon vent; que si le temps tait contraire, il sur fallait quelquefois deux ans, et qu' raison de cela ceux qui s'embarquaient cette mer, avaient soin de se munir de provisions pour trois ans ; que sur mer, les meilleurs soldats taient dans l'impatience de revoir la terre, et qu'il en prissait " Fie de Tchangkhian, dans l'Histoiredes Han, Thsianhan chou, liv. LXI,p. i, 5.
40
FOE
KOUE
KI.
beaucoup par l'effet du regret qu'ils avaient d'avoir laiss leur pays. Kan yng se rendit ces reprsentations et s'arrtaa. On voit que Tchang khian et Kan yng sont du nombre des Chinois qui ont voyag dans les contres occidentales la plus grande distance de leur pays. Il n'est pas mme tout fait exact de due qu'ils n'ont pas t aussi loin que F hian; car le premier, en allant chez les Ta hia et en revenant du Khorasan par la route du midi et les limites du Tibet, a d passer deux fois l'Indus, et Kan yng, parvenu sur les bords de la mer Caspienne, avait atteint un point plus recul que celui auquel est parvenu le voyageur bouddhiste. Mais celui-ci n'avait probablement pas une ide trs-prcise de la situation des pays dont il parlait, ni de la vritable direction des expditions anciennes dont il rappelle ici le souvenir. (k) Les secrtaires interprtes du cabinet des affaires trangres. ] J'ai introduit dans cette phrase une lgre correction dont je dois rendre compte. On lit dans les deux textes 5C1/JT'I^^Li' ce cIm' ne ^ aucun sens. Je lis $iLn\xtSffLjKieouyi est le nom d'une sorte d'interprtes ou de secrtaires attachs au tian chou kou, ou bureau o se traitaient les affaires des peuples trangers rcemment soumis l'empire , sous la dynastie des Hanh. C'est aux rapports de ces employs qu'on est redevable de beaucoup de renseignements gographiques et ethnographiques suites contres lointaines. [Je pense que M. Abel-Rmusat s'est tromp dans la correction de ce passage, clans lequel il faut mettre un point aprs le caractre Y)\, et qu'on doit traduire : Les deux rives du fleuve sont loignes l'une de l'autre d'au moins quatre-vingts pas; il y a neuf stations (o on le passe). On ==, raconte que Tchang khian u et Kan yng ne sont, ni l'un ni l'autre, parvenus jusqu' ce point. KL. ] (5) Phing wang de la dynastie de Tcheou.] Il s'agit ici d'un fait extrmement imde l'poque o cette religion s'est rpanportant pour l'histoire du Bouddhisme, due au del de l'Indus, et dans les contres orientales de l'Asie, en Tartarie et dans ce dernier jusque dans la Chine. On a coutume de placer son introduction pays l'an 61 de J. C, et de l'attribuer un vnement dont il sera parl dans la note 7 ci-aprs. C'est en effet la date de ce que l'on peut appeler son adoption officielle , car c'est alors que le culte de Bouddha fut port avec solennit dans la capitale, et profess historiens authentiques. * Notice sur les contres publiquement pour la premire fois, au tmoignage des Mais des faits isols, et dont le souvenir s'est conserv t. XXV,p. 3o; Mm.de l'Institut,Acad.desinscr. et t. VIII, p. 116, 123. belles-lelt., 1 Thsianhan chou, liv. XIX, 1" sect., p. 7 v.; tr. i3. Khanghi Tseutian, au mot F, rad. CXLIX,
occidentales,annexe l'Histoiredes Han, Heouhan chon, 1.LXXXVIII, p. G, note Anszu.Cf.Piani tian, liv. LVI, art. 3, de VInstitut, Acad.desinscr.etbclles-lett., ; Mm. p. >.
NOTES vaguement,
SUR
LE
CHAPITRE
VIL
41
n'en attestent pas moins que le Bouddhisme avait pntr clans diverses provinces des poques antrieures, et s'tait tabli obscurment sans tre remarqu. On croit mme qu'il avait t prch trs-anciennement, que l'incendie des livres, sous Chi houang ti de la dynastie des Thsin, tait la cause qui l'avait fait oublier 3; et l'on raconte, que la vingt-neuvime ou la trentime anne du rgne de ce prince (ou 217 ans avant J. C), un Samanen, des contres occidentales, nomm Che li fang, vint Hian yang (bourgade prs de Si 'an fou du Chen si), avec dix-huit autres religieux, apportant des livrs sacrs en sanscrit. Ils s'adressrent la cour; mais l'empereur, choqu de leurs habitudes extraordinaires, les fit mettre en prison. Alors Li fang et ses compagnons se mirent rciter le Maha pradjha pramit; une vive clart remplit toute la prison, et immdiatement aprs un gnie, de couleur d'or, de la taille de seize pieds, arm d'une massue, vint enfoncer les portes et dlivrer les prisonniers. L'empereur, effray, se repentit du traitement qu'il leur avait fait subir, et les renvoya aprs leur avoir rendu de grands honneurs h. Vers l'an 122 avant J. C, l'expdition du gnral Hou khiu ping contre les Hioung nou conduisit les Chinois dans un pays nomm Hieou thou, situ au del des montagnes de Yarkand. Le roi de ce pays offrait des sacrifices une statue apporte l'empereur en 121e. Yan faite en or pour reprsenter le prince des statues de Fo actuellement en sacre, la fit placer dans le palais des sources douces. Elle avait plus d'une toise (3"', o5 ) de hauteur. On ne lui offrait pas de sacrifices, seulement on brlait des parfums en son honneurd. C'est ainsi, ajoute-t-on, qu'a commenc s'introduire la doctrine de Fo. Tchang khian, au retour de son ambassade chez les Ta hia, rendant compte de ce qu'il avait appris au.sujet des Feou thou 0. d'un envoy Chine alors, nations voisines, parla Sous 'A-ti (l'an 2 avant des Yu ti, nomm suivant l'expression de des Chin tou ou de l'Inde, et du culte de J. C), un savant nomm Thsin king reut / tsun kheou, des livres bouddhiques. La d'homme en or. Cette statue fut prise et sse kou remarque ce sujet qu'on l'avait des gnies clestes, et que c'est l'origine usage. L'empereur, la considrant comme
l'historien desWe, connut cette doctrine, du mais elle n'y crut pas f. Voil tout ce que j'ai trouv de relatif l'introduction l'an 61 de notre, re, o l'on a coutume Bouddhisme en Chine, antrieurement de placer cet vnement. On verra bientt quelques dtails sur la part qu'y prit l'empereur Ming ti. Quant la connaissance * de cette religion, que les Chinois trouvrent, ds leurs
VoyezWen hian thoungkhao, livre CCXXVI, 3Pagh pian, cit dans le Chin i tian, Fof kin thang liv. LIX, p. 5. c Thsianhan chou, Fiede Wouti.
1 'We chou,noticesur lesdeuxsectesde Chvkia et de Lao tseu. c Id. ibid. ci-dessus la note d. Voyez 1 Wen hian khao,liv. CCXXVI, thoung p. 3 ; 'We chou,utsupr; cf.Chinitian, liv. LIX, p. 7. 6
42
FO
KOU-E
KI.
premires expditions, tablie au nord du Tibet et dans la Boukharie, F hian est l'auteur qui nous a conserv la tradition la plus prcise et la plus intressante. Suivant lui, les Bouddhistes du bord de l'Indus avaient appris que leur religion s'tait rpandue au del de ce fleuve, par les soins des Samanens de l'Inde, au eut et cet vnement temps de l'rection du colosse de Matreya Bodhisattwa, lieu trois cents ans aprs le Nirvana de Shkya, l'poque du rgne de Phing l'an 770 wang de la dynastie de Tcheou. Or, Phing wang commena rgner avant J. C., et mourut l'an 720. Pour le dire en passant, cette indication reporterait la mort de Shkya, antrieure de trois cents ans, dit l'auteur, l'rection du colosse, l'an 1020 au plus tard. Or, sans entrer ici dans la discussion de toutes si les dates assignes par les Bouddhistes des diverses nations cet vnement suivi important pour eux, je dois faire observer que le calcul le plus ordinairement par les Chinois, place la naissance de Shkya l'an 1027 ou 102g, et sa mort instruits des l'an g5o a. Le calcul suivi par d'autres auteurs chinois trs-bien traditions bouddhiques1", serait encore bien plus contraire la chronologie de Chi f hian, puisqu'il place la naissance de Shkya la neuvime anne de Tchouang wang (688 avant J. C.), et qu'il ferait par consquent descendre sa mort l'an 609, plus d'un sicle aprs l'poque assigne l'rection du colosse de Matreya. Ce ce sont les expressions du texte : elles montrent que, dans qu'il faut remarquer, l'opinion de F hian, Matreya n'est pas seulement un personnage mythologique, confin dans le Touchita; mais que son action s'est exerce sur la terre, et qu'elle a contribu soutenir l'influence de l'apostolat de Shkya, et la propager jusque chez les peuples de l'extrmit du monde. Il faut comparer ce passage avec les autres traditions qui placent trois sicles aprs Shkya l'avnement d'un persond'une sorte de rformateur ou de continuateur nage de l'ordre des Bodhisattwas, des prdications bouddhiques, d'un rdacteur des livres sacrs, et qui le font agir dans la partie occidentale de l'Inde. Il sera parl du colosse de Bodhisattwa dans la relation du pays d'Oudyna par Hiouan thsang. ou de (6) La connaissance des trois (tres) prcieux], c'est--dire du Tiiratna, Bouddha, Dharma, Sanga. J'ai rassembl ailleurs beaucoup d'indications sur les noms de cette triade chez les diffrents peuples bouddhistes c. Je dois y joindre ce passage curieux d'un auteur musulman d : Quand les Tibtains prtent ser ment, ils invoquent le Kandja soum (lisez dKon mtchhog soum), c'est--dire le Dieu triple; kandja signifiant dieu, et soum, trois. Ils disent cependant qu'il n'y a qu'un * t. I, p. 115, 117. Comparez Mlanges asiatiques, b Histoire des'We,noticesur lesdeuxsectes,etc.; Histoire desSouX, partie littraire; Wenhian thoung khao, liv. CCXXVI, p. 1; Chini tian, liv. LIX, p. 1, 3. Voyez Hodgson, Sketchof the Buddhism,dans les Transactions of the royalasiaticSociety,t. II, et les auteurs cits dans mes Observations sur quelques samanenne. pointsde la doctrine Relationdun voyage dans l'Asiecentrale,par Mir Fzzet-ullah, en 1812 (Magasinasiatique de M. Klaproth, tom. II, p. i5).
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VII.
45
Dieu, et que des autres, l'un est son prophte et l'autre son verbe, et que l'union des trois dans la formule du serment se rapporte un seul Dieu. H y a aussi une grande ressemblance entre les lamas du Tibet et les moines des pays chr tiens, etc. Les voyageurs bouddhistes, pour dire qu'un peuple, un prince la religion samanenne, se bornent remarquer pratiquent qu'ils sont profondment attachs aux trois prcieux. Le dogme des trois prcieux est pour eux comme le fondement de la doctrine, un point qui, une fois admis, entrane avec lui tous les autres. Ne pas croire aux trois prcieux, est un pch irrmissible a. Il serait difficile d'entendre ces passages dans le sens troit qu'on donne communment ces trois mots, Bouddha, la loi et le clerg. On veut parler videmment d'une triade suprme o l'intelligence absolue se manifeste dans la parole et la multiplicit. Sans rentrer ici dans une discussion de mtaphysique et de thologie, qui a dj trouv place ailleurs, je rapporterai une anecdote que me fournit un livre chinois imprim au Japon. La quinzime anne du rgne d'un prince de Sin ra (Sin lo, en Core), nomm F hing wang (le roi promoteur de la loi, 528 de J. C), la religion de Fo commena s'tablir dans cette contre. Auparavant, sous le rgne de No khi wang, un Samanen nomm Me hou tseu tait arriv de Kao li (la Core proprement dite ) la ville de I chen na. Il s'tait creus une grotte pour y demeurer. L'empereur de la Chine, de la dynastie des Liang, envoya en prsent au prince de Sinra toutes sortes de parfums ; mais ni le prince ni ses sujets n'en connaissaient l'usage, ni mme le nom. Hou tseu le leur enseigna. Ces substances, leur dit-il, sont destines tre brles. L'odeur exquise qu'elles rpandent parvient jusqu'aux saints esprits; et parmi ceux qu'on nomme saints esprits, il n'y en a aucun qui soit au-dessus des trois prcieux : le premier s'ap pelle Fo tho; le second, Tha mo; le troisime, Seng kia. Si vous formez des voeux en brlant ces parfums, divine ne manquera pas d'y rpondre. l'intelligence La fille du roi se trouvait malade en ce moment. On chargea Hou tseu de brler des parfums et de prononcer des formules de prires. La princesse se rtablit Le roi, charm, rcompensa magnifiquement le Samanen 11. J'ajouterai, puisque l'occasion s'en prsente, que les images, les livres et le culte de Fo furent introduits dans la Core, la seconde anne du roi Siao cheou lin (372); que l'usage de l'criture s'introduisit dans le P tsi (autre partie de la anne du rgne de Siao kou wang (37k) ; et qu'un reliCore), la vingt-neuvime gieux tranger, nomm Ma la nan koue, vint de Tsin (la Chine) dansle mme pays, la dixime anne du roi Kieou cheou ( 3SZi) ; le roi alla au-devant de lui, le mena dans son palais et lui rendit de grands honneurs. C'est alors que le Bouddhisme s'tablit dans le P tsi. L'anne suivante, on commena l'rection d'un temple de Fo sur le mont Han, et dix personnes y embrassrent la vie religieuse. Je ne dis rien de l'tablissement du Bouddhisme au Japon. Titsingh, dans ses " b Fyuan tchulin, cit dansle San Isangfsou,1. XXIX,p. 28 v. Encyclop. japonaise,1. XIII, p. 1o. 6. immdiatement.
44
FO
KOU
KL
Annales des Daris, et M. Klaproth, dans les claircissements qu'il a joints cet ouvrage, donneront sans doute sur ce sujet toutes les explications ncessaires. (7) Le songe de Ming ti.] Ming ti, de la dynastie des Han, eut un songe : il vit un homme, de couleur d'or, d'une taille leve, la tte coiffe d'une aurole blanche lumineuse, voler dans l'air au-dessus de son palais. Il consulta quelquesuns de ses courtisans sur ce songe. On lui rpondit que, dans les contres occidentales, il y avait un esprit nomm Fo. En consquence, l'empereur chargea un grand officier, nomm Thsa yn, et un lettr, nomm Thsin king, d'aller avec plusieurs autres, dans l'Hindoustan, prendre des informations sur la doctrine de Fo , dessiner ou peindre des Feou thou (temples et idoles), et recueillir des pret revint avec deux d'entre eux, Ma ceptes. Thsa yn s'adressa aux Samanens, teng et Tchou fa lan, Lo yang. Ce fut alors que le royaume du Milieu commena possder des Samanens et observer les usages relatifs aux gnuflexions. Un prince de Tchou, nomm Yng, fut le premier embrasser la religion nouvelle. Yng s'tait aussi procur le livre de Fo en quarante-deux chapitres, et des images de Shkya. Ming ti fit peindre des reprsentations religieuses et les plaa dans la tour de la puret. Le livre sacr fut dpos dans un difice en pierre prs de la tour de Lan; et comme, en revenant Lo yang, Thsa yn avait plac ce livre sur un cheval blanc, on construisit un monastre qui fut nomm temple du cheval blanc. Ma teng et F lan passrent leur vie dans ce monastre.
CHAPITRE
VIII.
Royaume d'O tchang. Empreinte
du pied de Fo.
on a pass le fleuve, on est dans le royaume d'O tchang (i). d'O tchang forme prcisment la partie septentrionale Ce royaume de l'Inde. On y fait absolument usage de la langue de l'Inde centrale (2). Quand L'Inde lements ceux centrale est ce qu'on nomme royaume du Milieu (3). Les habildu peuple et sa manire de se nourrir sont aussi semblables Milieu. La loi de Fo o les religieux en y est extrmement taient des sencj s'arrtrent, kia lan, tous appartenant
du royaume du honneur. Tous les lieux
kia lan. H y a en tout cinq cents seng l'tude de la petite translation ou des (). S'il vient quelque tranger et on les nourrit Pi khieou (5), on les reoit avec empressement, trois jours. Aprs ces trois jours, un autre gte. Quand la tradition on les avertit de se chercher eux-mmes
dans parle du voyage de Fo qui vint jusque l'Inde du nord, c'est de ce royaume Fo y a laiss qu'il est question. de cette empreinte de son pied. La dimension varie suil'empreinte de ceux qui la contenaient vant la pense encore (6) ; elle subsiste prsent. La pierre lieu o les mauvais La pierre est haute est plate d'un ct. Trois o les habits ont t schs au soleil (7), et le ont dragons d'une toise; t convertis, elle a deux subsistent toises
galement. et elle
en carr,
Hoe king, Tao des religieux, en avant pour le royaume de Na ki, hian et les autres s'arrtrent
tching
et Hoe
o est l'ombre
partirent de Fo (8). Fa
tha,
le temps'de leur sjour .quand du midi dans le royaume de Su ho lo (9).
dans ce royaume; et pour sjourner fut termin, ils descendirent du ct
46
FOE
KOU
KI.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
(i) Le royaume rf'Ou-tchang.] Le nom de ce pays signifie jardin, en sanscrit Oudyna; et le pays tait ainsi nomm, parce que l avait t autrefois le parc d'un roi de la roue (tchakravarti radja). F hian est le premier Chinois qui en ait eL Ou tchang. Soung yun l'crit parl : il orthographie le nom de ce royaume i & % Oa tchhang > et Hiouan thsang l'crit ainsi : 5$ ^J- J|L Ou tchang na. Ce dernier voyageur rapporte aussi les deux orthographes altres }tt <j JL Ou sun tchhang, et A^ i=L Ou tchha. Celle qu'il a suivie est la transcription aussi exacte qu'on puisse la faire en chinois du mot sanscrit Oudyna, le tch ou dj se substituant presque toujours la dentale mouille dans la transcription des noms hindous. dans les lgendes bouddhiques, Le pays ! Oudyna est trs-clbre mais les voyageurs de cette religion ne sont pas les seuls qui l'aient fait connatre aux Chinois. Ceux-ci ont eu avec les princes d'Oudyna quelques rapports politiques, notamment en 5o2, en 5i i, en 518, en 52 i, en 6Zt2. L'existence historique de ce royaume ne saurait donc tre mise en doute entre l'anne 4oo ou 4oi , dans laquelle F hian le visita, et l'anne 6A2 , o son prince crivit une lettre l'empereur de la Chine. S'il fallait s'en rapporter aux lgendes, ce pays aurait dj exist sous le nom d'Oudyna au temps de Shkya mouni; mais la critique n'est pas encore en tat d'adopter'"ou mme de discuter de semblables traditions. Ma toaan lin met ce royaume l'orient du Kandahar 3, et y place l'habitation des Brahmanes, la premire entre les tribus des barbares. Ce pays ne pouvait tre loign des cantons 'Altok et de Pechawer; mais son nom ne se trouve plus parmi les dnominations gographiques de ces contres. Il n'y a Tien qui y ressemble dans la liste des noms anciens de lieux qui se rapportent aux parties septentrionales et occidentales de l'Inde, noms que Wilford a extraits des Pouran'sb, C'est une observation qui ni dans celle que Ward a tire du Mrkandeyapouran'. peut se gnraliser, et qui s'appliquera toute la suite de notre itinraire. Trop de rvolutions ont boulevers le sol de l'Inde, pour que des noms de lieux, qui remontent quatorze cents ans, puissent tre cherchs sur les cartes rcentes, particulirement quand ils tiennent un tat politique qui a vari cent fois. Les Hindous n'ont pas mme l'ide des travaux critiques par lesquels, la Chine comme dans l'Occident, on tablit les concordances qui servent de base la gographie ancienne; et parmi les savants europens, que l'tude du sanscrit et mis en tat de suppler l'absence de matriaux de cette nature, un fort petit nombre se sont sentis attirs par des recherches arides, pineuses et souvent ' Liv. CCCXXXVIII, i3. '' Asiat. Res.t. VIII. * Ward'sView, etc. 1.1, p. 11. p.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
47
ingrates. On n'a pas encore donn assez de suite la gographie des Pouranas de Wilford : il et t pourtant bien intressant d'tendre les investigations et de rectifier les erreurs de cet crivain laborieux, mais trop systmatique. La lecture de ces anciennes compositions, du Rmyana, du Mahabhrata, et de quelques autres pomes, comme le Megha douta, entreprise dans le but d'en dpouiller toute la partie gographique, serait un vritable service rendu l'rudition. On admire avec raison, dans ces ouvrages, des peintures gracieuses et d'lgantes descriptions ; mais ces beauts, quel qu'en soit le mrite, ne sauraient tre que pour des esprits superficiels l'objet d'un intrt exclusif. Des souvenirs fugitifs, propres fournir des inductions chronologiques, ou faire esquisser le tableau des anciennes divisions de l'Inde d'aprs les crivains indiens, auraient infiniment plus de prix aux yeux des savants. Il y a eu d'heureux essais en ce genre dans ces dernires annes, mais on n'a point encore embrass le sujet dans son ensemble : aussi la dtermination de tous les lieux dont parle F hian a-t-elle exig un travail considrable ; ce qui tait impossible au temps de Deguignes, tant encore aujourd'hui hriss de difficults. On voit, par la relation de F hian, que le Bouddhisme tait tabli au ive sicle dans la partie orientale de l'Afghanistan, sur la rive droite de l'Indus, et dans une contre que l'on nomme encore Kafristan ou pays des Idoltres ; car c'est ce canton que rpond incontestablement l'Oudyna, quelle qu'ait t son tendue du ct de l'occident. Nous apprenons d'ailleursa qu'au vu" sicle, la mme religion y existait encore, quoiqu'elle laisst voir quelques symptmes de dcadence; que sur quatorze cents monastres qu'on y comptait autrefois, plusieurs fussent tombs en ruine ; que beaucoup de religieux se fussent transports ailleurs , et que ceux qui restaient eussent perdu l'intelligence du vritable sens de leurs livres. Ces faits, consigns dans des ouvrages antrieurs aux invasions des Musulmans, sont d'accord avec les tmoignages que ceux-ci ont mis un peu plus tard, et peuvent mme servir les expliquer. Plusieurs faits relatifs au royaume d'Oudyna, et qui ont t nois au temps des dynasties des We septentrionaux et des Thang, la relation suivante, extraite du Kou kinthouchou, Piatiitian, liv. La troisime anne King ming, du rgne de Siuan wou ti de connus des Chise trouvent dans
'We du nord (5o2 de J. C), des ambassadeurs vinrent apporter un tribut. Ce royaume est au midi du Siu mi (Sou merou). Au nord, il a la chane des montagnes de l'Oignon ; au sud, il confine l'Inde. Les Brahmanes sont, chez les trangers, considrs comme la caste suprieure. Les Brahmanes sont verss dans la science du ciel et dans le calcul des jours heureux et malheureux. font rien sans consulter leurs dcisions. Pian i tian, liv. LXIII, descr.d'O tchang,pag. G. Les rois ne
LXIII, p. i-i5. la dynastie des du royaume de Ou tchang
48
FOE
KOU
KI.
Ce pays contient beaucoup de forts et produit des fruits. On conduit les eaux pour arroser les champs. La terre est fertile et abondante en riz et en froment. Il y a beaucoup de sectateurs de Fo. Les temples et les tours sont trs-orns et elles se soumettent magnifiques. Quand deux personnes ont une contestation, prendre mdecine. Celle'qui a tort prouve de violentes le droit pour elle ne ressent aucun mal. Dans leurs lois, les coupables ; ceux qui auraient mrit cette punition S. O. des montagnes de l'Intelligence; l est le mont Tan on a construit un temple. On leur porte des aliments douleurs, et celle qui a on ne punit pas de mort sont seulement exils au
the. Sur cette montagne l'aide de plusieurs nes. Il n'y a personne au bas de la montagne pour les diriger ou les retenir, et ils peuvent d'eux-mmes aller et venir. des monastres rapporte le voyage de deux habitants de Thun houang nomms Soung yun tse et Hoe seng, qui se rendirent dans les (Cha tcheou), contres a occidentales. Ils employrent douze mois avant d'entrer dans le royaume de Ou tchang. Ce royaume touche, au nord, aux montagnes de l'Oignon ; du ct du midi, il tient l'Inde. Le climat y est tempr. Le pays a plusieurs milliers de li d'tendue; il est bien peupl et riche en productions. Il y a un monticule isol, voisin d'une rivire dont les eaux sont noires, et de l'le des Gnies. Les champs de la plaine sont trs-fertiles. C'est le lieu de la demeure de Pi lo chi eul, o Sa tho a fait l'abandon de son corpsb. anciennement les moeurs de ce pays fussent loin d'tre trs-parfaites, cependant, l'exemple du roi, on y avait fait des progrs dans la puret, on pratiquait des jenes en se nourrissant de lgumes, on honorait Fo le matin et durant la nuit; on frappait alors sur un tambour, on sonnait de la conque, on jouait de Quoique la guitare, de la flte, d'autres instruments vent; et ce n'tait qu'aprs que la moiti du jour avait t employe de cette manire, que l'on s'occupait des affaires de l'tat. On ne punissait pas de mort les criminels, mais seulement on les exposait sur une montagne dserte, o on les laissait chercher boire et manet on ger. Quand une affaire prsentait des doutes, on prenait des mdicaments, s'en rapportait au tmoignage qu'ils rendaient sur le clair et l'obscur, le grave et le lger, ou sur le temps. La terre est bonne et fertile; les habitants vivent dans l'abondance. Toutes les crales y croissent, ainsi que les cinq principaux fruits, et beaucoup d'autres qui viennent maturit. La nuit on entend le bruit des cloches qui, de tous cts, remplissent l'air 0. La fertilit de la terre donne naissance des fleurs extraordinaires qui se succdent l't comme l'hiver. Les prtres ont coutume de les cueillir pour aller les offrir Fo. ' Tchhing (ville), est une fautedans le texte: il fautjit +5S contre. Ce passageparat altr : il est du moins peu intelligible. c Littralement, le monde. ' L'histoire
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
49
Le roi voyant arriver Soung yun, l'envoy du grand royaume de 'We, pour le saluer, et ayant reu ses lettres de crance , demanda Soung yun s'il tait un homme du pays o le soleil se lve. l'orient de notre pays, rpondit Soung yun, il y a une grande mer du sein des eaux de laquelle le soleil sort. Tel est l'ordre du Jou la (Tathagta). Le roi demanda encore : Ce pays produit-il de saints personnages? Soung yun parla alors de Tcheou koung, de Confucius, de de Lao tseu; il indiqua les vertus de chacun d'eux : puis il parla du Tchouangtseu, mont Phencj la, de la porte d'argent, de la salle d'or, des gnies et des immortels qui y habitent; il en vint aux habiles astrologues et devins, aux mdecins, aux magiciens, et traita de toutes ces choses sparment et avec ordre. Quand il eut fini, le roi lui dit : Si les choses sont comme vous le dites, c'est le royaume de Fo , et nous devons, pendant toute la dure de notre vie, respecter les habitants de ce pays. Soung yun et Hoe seng sortirent ensuite de la ville pour chercher les vestiges de la doctrine du Jou la. A l'orient de la rivire est le lieu o Fo fit scher ses habits. Autrefois, lorsque le Jou la voyageait dans le royaume de Outchang, il convertit le roi des dragons. Celui-ci, dans sa colre, avait excit une violente tempte. Le seng Ida li de Fo fat tremp en dedans comme en dehors par l'eau de la pluie. Quand elle eut cess, Fo, assis au bas du rocher du ct de l'orient, fit scher son Ma cha " au soleil. Quoiqu'il se soit, depuis ce temps, coul bien des annes , les taches et les endroits clairs sont comme s'ils taient nouveaux. Non-seulement on voit distinctement les traces, mais jusqu'aux plus menues impressions des fils. Au moment o nous allmes les voir, c'tait comme si l'on n'en et pas encore t, et il semblait qu'on et gratt ces raies. Au lieu o Fo s'est assis, ainsi que dans celui o les habits ont t schs, on a lev des tours, qui en marquent le souvenir. A l'ouest de la rivire est un tang : c'est celui o habitait le roi des dragons. A ct est un temple avec une cinquantaine de religieux. Le roi des dragons oprait souvent des merveilles. Le roi du pays, pour le conjurer, jetait clans l'tang de l'or, des pierres prcieuses, des perles. Ensuite (le roi des dragons) les fit jaillir des deset ordonna aux religieux de les recueillir. Les vtements et la nourriture servants de ce temple sont fournis par les dragons. Aussi les habitants le nomment temple du roi des dragons. Au nord de la ville royale, dix-huit li, il y a une empreinte du pied du Jou la; on a bti une tour de" pierre pour la renfermer. L'endroit du rocher o est l'empreinte est comme si l'on et imprim un pied dans la boue. La mesure n'en est pas fixe; elle est tantt plus grande et tantt plus petite. Il peut maintenant y avoir dans le temple soixante et dix religieux. [Le kia cha estune espceJe collet que les religieuxbouddhistes portent sur les paules. KL.]
50
FO
KOUE
KL
Au midi de la tour, vingt pas, il y a une source dans un rocher. Fo s'tant purifi et ayant mch une branche d'osier, la planta en terre : elle est devenue un grand arbre, que les barbares nomment Plio leou. Au nord de la ville est le temple de Tho lo, o il y a beaucoup d'adorateurs de Fo. hefeoa thou" est haut, et grand, mais les cellules des religieux sont trs-resserres. Il y a tout autour du temple soixante statues dores. Tous les ans, le roi tient une grande assemble dans ce temple; tous les Samanens du royaume s'y rassemblent comme des nuages. Soung yun et Hoe seng ont vu ces mendiants; et leur conduite rgulire, leurs pieuses austrits, leurs moeurs ont excit leur respect et leur admiration. Ils leur abandonnrent un esclave mle et un autre femelle pour faire les offrandes de vin et balayer le temple. Au sud-est de la ville royale, huit jours de marche, dans les montagnes, est le lieu o Fo fit l'abandon de son corps un tigre affam. C'est une montagne trs-escarpe, avec des prcipices, des cavernes, des pics qui entrent dans les nuages. L'arbre du bonheur kalpa darou et le champignon ling tclii y croissent en abondance. Les sources qui sont dans la fort, le mlange agrable des fleurs y charment les yeux. Soung yun et Hoe seng donnrent de l'argent pour faire une statue dans le Feou thou sur le front de la montagne, et gravrent sur le rocher une inscription en caractres li, pour rappeler les grandes actions de la dynastie 'We. Sur cette montagne est le temple de l'or conserv; il y a plus de trois cents religieux. Au sud de la ville royale, plus de cent li, est le lieu o jadis le Jou la, tant dans le pays de Maliieou, prit sa peau dtache pour papier, et un de ses os. pour pinceau. Le roi Ayeou fit btir une tour cette place; elle est haute de dix tchang. A l'endroit o l'os fut dtach, la moelle a coul sur la pierre, et l'on voit la couleur de la graisse, et la tache huileuse comme si elle tait rcente. Au sud-ouest de la ville royale, cinq cents li, est le mont Chen tclii, ou des biens; il y a des sources douces et de beaux fruits, dont il est parl dans la lgende. Les montagnes et les valles y sont agrablement diversifies. Les arbres des montagnes conservent leur verdure en hiver. Cette riche vgtation, cette douce temprature, le printemps dans sa fleur, les papillons, semblables des fleurs qui voltigent, produisent un ensemble dlicieux. Au milieu de cette scne sduisante,, Soung yun, qui se trouvait dans une contre si loigne de son pays, tait agit de mille penses diverses, et sentait natre en son coeur les motions d'autrefois. Il y passa un mois pour obtenir des Brahmanes des charmes qui le calmrent. Au sud-est de cette montagne, il y a une maison de pierre dite du prince, o se voient deux chambres. Devant la maison du Prince, dix pas, est une grande pierre carre. On dit que le prince avait coutume d'aller s'y asseoir. Le roi Feou thouest le nom [ qu'on donne aux pyramidesou oblisques qui renfermentdes s'arra, ou reliquesde Shkyaou d'autres saints personnages. On appellegalementainsi les chapelles dans les KL. ] quellessontplacesleurs images.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
51
A yeou y fit btir une tour pour en consacrer le souvenir. Au midi de la tour, un li, est le lieu o tait la cabane du prince. En descendant de la montagne, au nord-est, cinquante pas, est le lieu o le prince et la princesse firent le tour d'un arbre sans se sparer, et o les Brahmanes les flagellrent de manire faire couler le sang terre. Cet arbre subsiste encore, et conserve les gouttes de sang dont il fut arros. L est une source d'eau. A l'ouest de la maison, trois li, le roi du ciel Indra se changea en lion, et l est la place o il se tint assis sur le chemin, cachant Man yun. Les vestiges de son poil, de sa queue et de ses ongles subsistent encore prsent, ainsi que le lieu o A tcheou tho Idiou et son disciple offrirent des aliments leurs parents. Dans ces divers lieux, il y a des tours pour en conserver le souvenir. Dans les montagnes sont les lits de cinq cents anciens Arhan. Ils sont sur deux files du sud au nord, et la place o ils taient assis les uns vis--vis des autres; sur la seconde range, il y a un grand source d'eau o but le prince. Au nord nombre d'nes; personne ne les garde, sortent trois heures du matin, et gardent la tour, et c'est l'immortel W temple o vivent deux cents religieux, et la est un temple toujours entour d'un grand et ils vont d'eux-mmes o ils veulent. Ils midi ils mangent. Ce sont des gnies qui pho qui leur a donn cette commission. Il au sa la o
y avait jadis dans ce temple un Cha mi qui avait l'habitude de jeter les cendres dehors, et par la volont des huit gnies, il les attirait lui. Insensiblement peau se colla et ses os se sparrent. L'immortel W pho prit sa place dans fonction de porter les cendres au dehors. Le roi a lev un temple W pho,
est son image recouverte de feuilles d'or. Auprs d'un petit dfil, il y a le temple de Pho Man, construit par Ye tcha. On y trouve quatre-vingts religieux. On dit que le Arhan Ye tcha venait souvent y l'aire des offrandes de vin, balayer, ramasser du bois. Les mendiants vulgaires ne peuvent demeurer dans ce temple. Nous, Samanens de la grande dynastie 'We, emes la gloire de venir jusqu'ici; mais nous nous en retournmes, n'osant y faire sjour. La troisime anne Young phing (5io), la neuvime lune, le pays de Ou tchang envoya un tribut. La quatrime anne, la troisime lune et la dixime lune, il en vint un autre du mme pays. La mme chose eut lieu la septime lune intercalaire de la premire anne Chin houe de Hiao ming ti (5 18), et la cinquime lune de la seconde anne Tching kouang (621). Sous la dynastie des Thang, la seizime anne Tching houan (6/12), il vint des ambassadeurs de Ou tchang. Il n'en est pas question dans la vie de Ta tsoung; mais on lit ce qui suit dans la Notice sur les contres occidentales : Ou tchha, aussi nomm Ou tchang na et Ou tchang, est juste au midi" de l'Inde. Ce pays a cinq mille li de longueur. Il confine l'orient avec le pays de Pho lia (Pourout), Faute vidente,pour droitau nord,ainsi qu'onle voitimmdiatement aprs, 7-
52
FO
KOU
KL
six cents li. A l'ouest il est quatre cents li de Khi pin (Cophne). Les mon tagnes et les valles se tiennent et se succdent. Elles produisent de l'or, du fer, du raisin, l'herbe odorifrante y Mn. Le riz y mrit au bout, d'un an. Les habi tants sont faibles, la fort adonns aux pratiques superstitieuses, trompeurs, magie. On n'emploie pas les supplices dans ce royaume; les coupables qui au raient mrit la mort, sont exils dans les montagnes dsertes. Quand il y a des doutes sur la culpabilit, on les dissipe au moyen d'une boisson mdicinale qui fait distinguer le vrai du faux. Il y a cinq villes : le roi demeure dans celle de Chou meng pe li, aussi nomme Meng ki li. Au nord-est est le ruisseau Tha li lo : c'est l'ancien pays de Ou tchang. La seizime anne Tching kouan (6/12), le roi Tha mo in ilio ho sse envoya des ambassadeurs qui apportrent du camphre. Une lettre impriale lui marqua la satisfaction qu'on avait de cette conduite. On remarque qu'en passant les montagnes au nord de Pho lo ton lou, et faisant six cents li, on atteint la tribu de Ou tchang. Le Thse fou youan houe rapporte ainsi la lettre de Tha mo in tho ho sse : Le trs honorable souverain, dou de bonheur et de vertu, qui rgne la fois sur le milieu et sur le haut, monte le prcieux char du ciel, dissipe toutes les tnbres, et, comme le seigneur Indra, est capable de soumettre le roi des A sieou lo (Asoura). Votre esclave se repose sur la racine de vos bonts, et, comme s'il et obtenu la race d'Indra vivant, salue votre trs-honorable personne et lui offre du camphre. fut flatt d'un hommage venu de si loin, et fit sceller de son sceau L'empereur une rponse bienveillante. la Notice des pays occidentaux sous la grande dynastie des Thang, le royaume de Ou tchang n'a pas plus de cinq mille li de tour. Il est rempli de montagnes et de valles qui dpendent les unes des autres, et de courants et de lacs dont les sources se communiquent. On y sme des crales; mais, malgr le soin qu'on a de labourer la terre, elles ne produisent gure. 11 y a beaucoup de raisin et peu de cannes sucre. La terre produit du fer, de l'or; elle convient au y Mn. Les forts sont extrmement touffues; les fleurs et les fruits viennent en abondance. La chaleur et le froid se temprent; le vent et la pluie se succdent avec rgularit. Les habitants sont d'un caractre timide et astucieux; ils aiment l'tude et ne transgressent pas les lois. L'astrologie est leur occupation habituelle. La plupart sont vtus de laine blanche, et peu d'entre eux ont d'autres habillements. Quoique leur langage diffre, il approche beaucoup de celui de fin tou, ainsi que leur criture, leurs crmonies, leurs usages. Ils honorent beaucoup la loi de Fo, et leur culte appartient la grande translation. Sur le fleuve Sou, pho f son thou, il y avait autrefois quatorze cents Ma lan (monastres). Beaucoup sont dj tombs en ruine. Jadis on y trouvait dix-huit mille religieux; leur nombre est prsentement fort diminu. Tous tudient la grande translation, et se livrent la contemplation : ils se plaisent lire leurs critures, mais ils n'en entendent pas le sens Suivant
NOTES
SUR"LE
CHAPITRE
VIII.
55
la conduite est pure. Ils gardent sont en usage parmi eux. Suivant : la premire est celle de F mi (conversion de la terre); la troisime, celle de Yn houang ou Ks'yapa (lumire hue); la quatrime, celle de Chou i thsiyeou; et la cinquime, celle de Ta tchoung ou de la multitude. Dix temples au moins sont habits ple-mle par des hrtiques. Les villes sont au nombre de quatre ou cinq. Le roi habite le plus souvent dans celle de Meng Me li. La ville a seize ou dix-sept li de circonfrence. La population y est trs-nombreuse. A l'est de la ville de Meng ki li, et quatre ou cinq li, est un grand sou ton po" o se trouvent un trs-grand nombre de merveilles divines. Quand Fo tait vivant, il institua dans cet endroit l'immortel Jin jo roi de Ky li. (Ce mot, en chinois, signifie dbat, discussion. On disait prcdemment ko li: c'tait une corruption.) Pour couper les membres (Lacune dans le texte.) Au nord-est de la ville de Meng ki li, en faisant deux cent cinquante ou deux cent soixante li, on entre dans une grande montagne, et on arrive la fontaine du dragon A po lo lo, qui est la source du fleuve Sou pho f sou thou. Les eaux se partagent en coulant du ct du sud-ouest. Et comme hiver, il y fait un froid excessif; matin et soir il y tombe de la neige. Au milieu de la neige et de la pluie mles ensemble, il y a une lumire de toutes couleurs qui resplendit de tous cts. Le dragon A po lo lo naquit dans le temps que Kia ch pho Fo tait parmi les hommes. Il porta le nom de Keng khi; et profondment vers dans l'tude de la magie, il empcha, par ses formules, que les dragons ne produisissent des orages de pluie. Les gens du pays se confirent lui et lui offrirent le superflu de leurs moissons. Les habitants furent trs-touchs ; ils conservrent le souvenir de ce bienfait, et, par maison, on s'imposa un boisseau de grain pour les offrandes. Plusieurs annes aprs, il arriva qu'on manqua ce devoir. Keng khi, mcontent, souhaita de devenir un dragon venimeux. Il excita une tempte mle de vent et de pluie, qui dtruisit les moissons; et quand il eut ordonn qu'elle cesst, il fit cet tang et la source du Dragon, d'o coule une eau blanche qui dtruit les biens de la terre. Chy kia jou la, plein de bont pour les hommes et dirigeant le sicle, fut touch de compassion pour les habitants de ce pays, qui n'taient exposs qu' ce seul malheur. Il fit descendre un esprit qui vint en cet endroit pour convertir le dragon furieux. Il prit un sceptre divin de diamant, et frappa sur le ct de la montagne. Le roi des dragons pouvant sortit et vint faire sa soumission. Il couta la doctrine de Fo, purifia son coeur, et crut la loi. Jou la lui fit aussitt la dfense de nuire aux moissons. Le dragon rpondit : Tous ceux qui mangent, comptent sur les champs a lamulns, Sllwtipa, pde oj earlh. Chapelle,couvent.
profond. Les prceptes sont mis en pratique, et les observances, et les formules d'enchantement ce que la tradition enseigne, il y a cinq sectes (silence de la loi); la seconde, celle de Houa ti
54
FO
KOU
KL
des hommes. Aujourd'hui je reois votre sainte instruction, je crains de pou voir difficilement me garantir de la ncessit. Je souhaite que sur douze annes, il y ait une rcolte qui me soit abandonne. Le Jou la eut compassion de lui et le permit. C'est pourquoi il y a tous les douze ans un dsastre de l'eau blanche. Au sud-ouest de la source !A po lo lo, plus de trente li, sur nal de la rivire, sur une grande pierre, il y a une impression du mesure en varie selon le bonheur et la force des hommes. C'est du Jou la quand il quitta ce lieu aprs avoir soumis le dragon. le bord septentriopied du Jou la. La
la marque du pied Les hommes des temps postrieurs amassrent des pierres en cet endroit pour y faire un temple. De prs et de loin on y accourt pour offrir des fleurs et des parfums. En descendant la rivire, environ trente li, on vient une pierre o le Jou la lava ses habits; les raies de son Ma cha y sont empreintes comme si elles taient graves. Au midi de la ville de Meng ki li, quatre cents li, est la montagne et la valle de Hi lo. La'rivire coule vers l'ouest, et retourne ensuite vers l'orient. Des fleurs mles et des fruits rares sont entrans par le courant. Les bords sont escarps et les montagnes coupes par de profondes valles o se prcipitent des torrents. Les voyageurs y entendent quelquefois le bruit de voix ou de cris, ou le son d'instruments de musique. Les rochers sont carrs comme un lit, de mme que si on les avait travaills la main. Ils se tiennent et se prolongent en se suivant les uns les autres. Ces escarpements et ces valles sont l'endroit o Fo, ayant entendu la moiti d'un pome, fit le sacrifice de sa personne et de sa vie. (Prcdemment on disait kie : c'est un mot sanscrit abrg. On dit aussi kie tho, par altration du mot sanscrit. Maintenant, pour rendre exactement le son du mot, on dit kia tho: "|j cheou.) Au midi de la ville de Meng ki li, deux cents li environ, sur le revers d'une montagne, on trouve le Kia lan (monastre) de Ma ha fa na. (Ce mot fan, crit la chinoise, signifie la grande fort".) C'est le lieu o le Jou la pratiqua jadis les oeuvres de Phou sa et fut surnomm roi de Fo tha tha. (Mot/o?i, qui en chinois signifie don universel.) Fuyant les ennemis et abandonnant son royaume, il arriva jusqu'ici. Il rencontra un pauvre Brahmane qui demandait l'aumne. Ayant perdu son royaume et son rang, n'ayant rien donner, il ordonna qu'on le lit lui-mme et qu'on le livrt au roi de ses ennemis, pour que l'argent qu'on donnerait pour lui servt d'aumne. Au nord-ouest du monastre de Maha fana, en descendant les montagnes l'esli, on arrive au Kia lan de Mo yu. (Ce mot signifie fve en pace de trente-quatre chinois.) Il y a un Sthopa haut de plus de cent pieds. Au revers, sur une grande pierre carre, est une trace du pied du Jou la. Fo ayant foul cette pierre, en fit jaillir la lumire J3$T,|w kcou tclii, qui claira le monastre de Maha fana; il raconta les aventures de sa propre naissance en faveur des hommes et des dieux. s l'a na est le mot sanscritvana,fort. KL. ce qui en chinois signifie pome. Un pome a trente-deux vers,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
55
Au bas du mur du Sthopa, il y a une pierre entoure de jaune et de blanc. H a y toujours un suc graisseux. Dans le temps o Fo mettait en pratique les actions de Phou sa, pour que l'on entendt la droite doctrine dans cet endroit, il se rompit un os pour crire les livres sacrs. A l'ouest du monastre de Moyu, soixante ou soixante et dix li, il a un y Sthopa qui a t lev par le roi Wou yeou. C'est l que le Jou la, pratiquant jadis les actions de Phou sa, reut le titre de roi de CM pi kia. (Ce mot fan, en chinois, signifie donner. On disait autrefois, par abrviation, roi de Chi pi.) Il avait pri Fo, et c'est rellement dans cet endroit qu'il coupa son corps pour le livrer l'pervier au lieu de la colombe. (Voyez IX, .) Au nord-ouest du lieu dit pour la colombe, deux cents li au moins, on rencontre le ruisseau Chan ni bche, et on arrive au monastre de Sa so cha ti. (Ce mot signifie en chinois mdecine du serpent.) Il y a un Sthopa haut de plus de quatrevingts pieds. C'est le lieu o le Jou la, tant jadis Indra, rencontra une troupe de gens affams et pestifrs. Les mdecins n'y pouvaient rien; et, sur les routes, ceux qui mouraient de faim se succdaient sans interruption. Indra, plein de compassion, songea les dlivrer de cette calamit, et il changea son corps en celui d'un grand serpent. Il appela les cadavres dans les rivires et les vallons : en l'entendant, tous trs-joyeux se mirent fuir et courir. Il gurit les affams et les malades. Non loin, il y a le grand Sthopa de Sou ma. C'est le lieu o jadis le Jou la, tant Indra, par compassion pour des pestifrs, se changea en serpent Sou ma. De tous ceux qui en mangrent, il n'y eut personne qui ne ft consol. Sur le bord des rochers, au nord du ruisseau Chan ni lo che, il y a un Sthopa. Les malades qui y arrivent sont guris, et sont garantis de beaucoup de maladies. Le Jou la tant autrefois roi des paons, y vint avec sa troupe. Presss de la chaleur et de la soif, ils cherchaient de l'eau qui ne s'y trouvait pas. Le roi des paons, d'un seul coup de bec, frappa le rocher et en fit jaillir de l'eau qui coula et forma de suite un lac. Ceux qui en boivent sont guris de leurs maux. Sur le rocher, il y a encore l'empreinte d'une patte de paon. Au sud-ouest de la ville de Meng ki li, en faisant soixante ou soixante et dix li, l'orient du grand fleuve, il y a un Sthopa haut de soixante pieds environ, qui a t lev par le roi de la Haute arme. Anciennement le Jou la, tant sur le point d'entrer dans l'extinction, avertit ainsi tous les peuples : Aprs mon nirvana, Je roi de la Haute arme du royaume d'O tchang na doit donner une partie de mes reliques tous les princes, pour tablir une mesure gale. Quand le roi de la Haute arme fut venu, il y eut une consultation sur leur valeur. Alors les hommes clestes et la foule rptrent les paroles de la prdiction et de l'ordre du Jou la. On partagea les reliques, et chacun les emporta dans son royaume; on leva en leur honneur le Sthopa. Sur la rive du grand fleuve, il y a une
56
FOE
KOUE
KL
grosse pierre de la forme d'un lphant. Anciennement le roi de la tlaute arme fit placer les reliques sur un grand lphant blanc, et vint en s'en retournant cet endroit. Alors l'lphant se prosterna et mourut; il fut chang en pierre. A cet endroit on a construit un Sthopa. A quarante ou cinquante li de la ville de Meng ki li, en traversant le grand fleuve, on vient au Sthopa Louhi ta kia. (Ce mot signifie rouge en chinoisa.) Il est haut de plus de cinquante pieds, et a t rig par le roi Wou yeou. Anciennement le Jou la, pratiquant les actes de Phou sa, devint roi d'un grand royaume, sous le titre de Tscu li (force de bont). Dans cet endroit il se pera le corps et on disait ye cha; c'est prit son sang pour nourrir cinq yo cliah. (Prcdemment une corruption. ) Au nord-est de la ville de Meng ki li, trente li, on vient au Sthopa de pierre appel Ko pou to (ce mot signifie en chinois merveille unique) ; il est haut de quarante pieds. Anciennement le Jou la discourut sur la loi en faveur des hommes et des dieux, et leur ouvrit la voie. Aprs que le Jou la s'en fut all, la foule, qui se dsolait de son dpart, l'honora en lui offrant des parfums et des fleurs sans interruption. A l'ouest du Sthopa de pierre, trente ou quarante li, en passant le grand fleuve, dans un temple, il y a une image de A fou lou tchi ti chefa lo Phousci. (Ce mot signifie en chinois contemplant ce qui est de soi-mme. Ce sont des mots unis et des sons qui s'enchanent dans un mot sanscrit. En les sparant on y trouve afolou tchi to, qui se traduit par contemplant, et chefalo, qui se traduit par existant de soi-mme. Prcdemment on le traduisait par voix, sicle de lumire, ou par voix contemplant le sicle, ou par existant de soi-mme et contemplant le sicle. Tout cela est altr et corrompu c. ) Les secrets de sa majestueuse intelligence ont t illustrs par les vestiges de son gnie, et ses compagnons dans la loi accouraient pour lui offrir leurs hommages sans interruption. l'tre qui existe par luiAu nord-ouest de la statue de Phou sa contemplant mme, cent quarante ou cent cinquante li, on vient au mont Lan pho lou. Au sommet de ce mont est l'tang du Dragon, qui a plus de trente li de tour. Les eaux en sont pures et forment des nappes transparentes comme un miroir clair. Pi lou chy kia attaqua, devant le roi, les quatre Chy, qui s'taient Anciennement Chacun d'eux se sparant s'envola de son opposs l'arme ct. Il y eut un d'eux, nomm Chy tchoung, qui, aprs tre sorti de la capitale '' C'est le mot sanscritlhitalta, [ qui, ainsi que KL.] Inhila,signifie, romjc. h Les cha,en sontdesdmons [ jo sanscrityakcha, hindoue,sontspcialement qui, selonla mythologie attachs Kouvm, dieu de la richesse, et chargs d'avoirsoinde sesjardins et de sestrsors. KL. ] " ^ [ fou lu'c''' '' c^iefa1Phousa est la transcriptionchinoisetant soit peu corrompuedu sanscrit Avalkiles wara BodhisaUwa, c'est'-dire, leBo KL.] lematrequicontemple avecamour. dhisaltwa,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
57
du royaume, voyagea par terre et par eau; mais fatigu l'excs, il demeura moiti du chemin. Il y eut alors une oie qui vint en volant devant lui, et qui se montra si bien discipline qu'il la put monter. L'oie s'abattit cet tang. Chy tchoung, qui avait voyag par les airs et qui se trouvait dans une contre loigne et trangre, sans connatre les chemins, chercha un abri sur un arbre pour y dormir. La fille du dragon du lac, qui se promenait sur le rivage, aperut tout coup Chy tchoung, et fut trs - effraye ; elle prit la figure d'un homme et le tira avec la main. Chy tchoung s'veilla en sursaut, et lui adressant des remercments : Un pauvre tranger tel que je suis, dit-il, comment daignez-vous venir son secours? Je suis sincrement touch de ce que vous assistiez un fugitif expos dans les dserts. La jeune fille rpondit : Mes parents m'ont enseign vnrer les fidles. Mais quoique vous m'ayez honore de vos regards, je n'ai pas encore reu vos ordres. Chy tchoung reprit : Dans le fond des mon tagnes et des valles, o est votre habitation? Elle rpondit : Je suis la fille du dragon de ce lac. J'ai appris la fuite des saints et leur msaventure : heu reusement je suis venue voir ici, et j'ai pu vous offrir des consolations dans vos fatigues. Le destin a voulu que Yan sse existt ; j'ignore quelle est sa volont. D'ailleurs j'ai pour surcrot de malheur ce corps de dragon; l'loignement vous a empch de l'apprendre. Cliy tchoung dit : Veuillez en une parole me soumettre sincrement votre dsir, et il sera satisfait. La fille du dragon dit : J'coute respectueusement vos ordres, et je m'y soumets. Chy tchoung, liant son coeur par un serment, dit : Que tout ce que j'ai de force, de bonheur et de vertu fasse reprendre cette fille du dragon sa forme humaine. Par l'effet de cette vertu divine, le dragon redevint homme l'instant. Pntre de reconnaissance et de joie, elle remercia Chy tchoung et lui dit : J'tais accable de douleur, mais mes maux se sont convertis en biens. Vous avez daign employer vos forces. Ce que vous me rendez d'ge, redevenue en un matin dans ma forme, je dsire vous le consacrer pour reconnatre ce bienfait. Je m'puiserai votre service sans satisfaire ma gratitude. Je veux aller l'annoncer mes pa rents, et ensuite ils vous prpareront une rception convenable. La fille des dragons rentra dans le lac; et, s'adressant son pre, elle lui dit : En me pro menant, je viens de rencontrer Chy tchoung, qui, par sa puissance, m'a rendu la forme humaine. Le roi des dragons, joyeux de cette faveur et plein de reconnaissance pour le saint, suivit sa fille, et, pour lui faire une invitation, sortit du lac. Il remercia Chy tchoung et lui dit : Malgr la diffrence des espces, je me soumets votre respectable puissance, et je vous invite venir dans ma maison, o je vous offrirai mes hommages et mes soins. Chy tchoung accepta l'invitation du roi des dragons, et alla habiter dans le palais des dragons. On vint au-devant de lui en crmonie, et avec de la musique, en grande joie. Chy tchoung, en voyant la forme des dragons, fut frapp de crainte et de dgot, et voulut 8
58
FOE
KOUE
KL
prendre cong et sortir. Mais le roi des dragons l'arrta et lui dit : J'ai heureuse ment prs d'ici une maison ; vous y pouvez habiter. Tout le pays est vos or dres. Nous sommes vos sujets, etc. Chy tchoung remercia et dit : Je ne dsire pas ce que vous dites. Le roi des dragons plaa une riche pe dans un coffre, la recouvrit avec une merveilleusement belle toffe de laine blanche, et dit Chy tchoung : Prenez cette toffe et portez-la au roi du pays. II acceptera cer tainement le tribut d'un tranger; et, dans cet instant, vous le tuerez, et vous vous emparer de ce royaume. Ne sera-ce pas une bonne chose? Chy tchoung agra le conseil du dragon, et s'en alla faire son offrande. Le roi d'O tchang na leva lui-mme l'toffe de laine, alors Chy tchoung le prit par la manche et le tua. Les courtisans et les gardes poussrent de grands cris, et furent troubls sur les degrs. Chy tchoung, tenant l'pe la main, dit: L'pe que je tiens est celle que le dieu dragon a bien voulu me donner pour chtier. Ensuite il lui trancha la tte. Tous ceux qui ne se soumirent pas furent pouvants de ce pouvoir surhumain, et les autres honorrent son rgne. Ensuite il tablit son gouet la commisration qu'il montra pour les sages toucha la multitude. vernement, Ayant prpar la loi, il se rendit au palais du dragon, et ordonna la fille de celuici d'aller en avant pour rapporter cette tte dans la capitale. La fille du dragon s'acquitta de ce devoir. Partout o elle allait, la tte de Yan sse montrait neuf ttes de dragon. Chy tchoung, effray, ne sut comment faire; et, attendant qu'elle ft endormie, il tira son pe et les coupa. La fille du dragon se rveilla en sursaut et dit : Ceci n'est pas au profit de votre postrit. Mes ordres n'auront pas t vains. C'est une petite blessure, et tes fils et tes petits-fils en ressentiront de la douleur la tte. C'est effectivement le mal auquel on est expos dans ce pays. Chy tchoung tant mort, son fils lui succda. C'est lui qui fut Wen ta lo sy na. (Ce mot signifie en chinois arme suprieure.) Le roi de l'arme suprieure lui ayant succd, sa mre porta le deuil. Le Jou la revint de soumettre le dragon A po lo lo. Il descendit du haut de l'air dans son palais. Le roi de la Haute arme se trouvait la chasse. Le Jou la, en faveur de sa sur la loi. Rencontrant la sainte audition, elle reprit mre, prcha sommairement aussitt son clat. Le brillant Jou la demanda : Votre fils est mon parent ; o est-il maintenant? La mre rpondit : Il est parti ce matin pour aller la chasse : il va bientt revenir. Le Jou la et le peuple voulurent sortir pour l'aller chercher. La mre du roi dit : Je suis heureuse d'avoir seule rencontr le saint parent Jou la, qui veut bien nous consoler, et qui daigne descendre auprs de mon fils ; mais il va bientt revenir, et je vous prie de l'attendre un peu. L'honorable du sicle reprit : Cet homme est mon parent; il peut apprendre la loi et croire , etc. Je m'en vas. Quand il reviendra, dites-lui : Jou la s'en va d'ici; dans la ville de Keou chi, entre les arbres so lo, il entrera dans le ni pan [nirvana). Il convient de recueillir ses che li, et de l'honorer. Le Jou la et sa suite s'envolrent pourrez
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
59
par les airs. Le roi de l'arme suprieure revint de la chasse, et voyant de loin une vive lumire au-dessus de son palais, il craignit que ce ne ft un incendie. Il quitta la chasse et s'en revint. Voyant sa mre rendue son clat et toute joyeuse, il lui demanda : Aprs que j'ai t sorti, quel heureux vnement est venu et a pu rendre ma mre son ancien clat? La mre rpondit : Pendant que tu tais sorti, le Jou la est venu ici : aprs avoir entendu la loi, j'ai recouvr ma beaut. D'ici, le Jou la se rend la ville de Keouchi, et il doit, entre des arbres so lo, entrer dans le ni pan. Il t'invite venir en toute hte pour prendre part aux che li. Le roi ayant appris cette nouvelle, etc., pressa son char et arriva entre les deux arbres. Le Ni pan tait dj fini, et dans ce moment, les rois, mprisant son loignement et estimant les che li, ne voulaient pas partager les che H avec lui. Alors la troupe des hommes clestes publia la volont de Fo, et les rois, l'ayant apprise, lui donnrent sa part quitablement. Au nord-est de la ville de Meng ki li, on passe les montagnes, on franchit les est prilleux et escarp; les et obscures. On marche le long des montagnes et les valles sont trs-profondes cordes, ou sur des ponts faits de chanes de fer, ou sur des poutres volantes, ou sur des ponts forms de bois assembls. On grimpe ainsi plus de mille li, et valles, l'on arrive au ruisseau de Tha li lo. C'est l que se trouve l'ancienne capitale du royaume d'O tchang na. On en tire beaucoup d'or, du parfum y Mn. Dans le ruisseau Tha li lo, auprs d'un grand monastre, il y a une statue du Phou sa bienfaisant, sculpte en bois; elle est de couleur d'or, resplendissante, majestueuse , et haute de plus de cent pieds. Elle a t faite par l'Arahan Mo thian ti kia. [Mo thian ti est une abrviation corrompue.) Il l'acheva aprs avoir lui-mme contempl trois fois ses perfections merveilleuses. Depuis que cette statue existe, la loi l'orient. A l'orient de ce point, en traversant les s'est rpandue considrablement montagnes et franchissant les valles, remontant le fleuve Sin tou, marchant suides ponts volants, des poutres assembles, des prcipices, des terrains marcageux, en faisant cinq cents li, on vient au pays de Po lou lo (limite de l'Inde du Nord). [Ici suit, dans l'original, la figure d'un homme d'O tchang na avec un paon.) (2) L'Inde centrale.] Vraisemblablement Madhya des a ou la rgion moyenne. On peut voir, dans le mmoire gographique, quelles paraissent avoir t les limites des cinq thian tcha ou des cinq parties de l'Hindoustan et de la partie centrale en particulier. Il est remarquable que, suivant F hian, on ait fait usage dans l'Oudyna prcisment du mme langage que dans l'Inde moyenne. L'expression dont il se sert a mme quelque chose'de singulier : %% jffjTs^ 07i emploie) tout fait la langue de l'Inde centrale. T* Tp jH, on fa'L ( Pou 1' scon remonte le fleuve Sin tou. Le chemin
[Je pense qu'il faut traduire : finem fecit lingnoe Indioe medioe, ou jusqu'ici tend la langue de l'Inde moyenne. KL.] 8.
60
FOE
KOUE
KL
(3) Le royaume du Milieu,] dans le texte, Tchoung kou. Comme c'est prcisment la Chine, il faut prendre l'expression dont on se sert pour dsigner communment ne pas confondre les passages qui se garde, dans les relations bouddhiques, l'apportent la Chine avec ceux qui sont relatifs aux contres de Matoura, de Magadha, et autres royaumes situs dans l'Inde centrale. Cette confusion ne peut avoir lieu dans le livre de Chy F Man, qui, en parlant de son pays natal, le dsigne toujours par les noms de dynasties Han, Thsin, etc. Sur le mot de royaume du Milieu, voyez le chap. XVI. () Seng Ma lan l'tude de la petite translation.] Voyez II, k ; III, 5.
(5) Des Pi hhieou;] c'est la transcription du sanscrit bhikchou, mendiant. On les nomme en tibtain dGe slong a. Lorsque quatre fleuves se jettent dans la mer, ils ne reparaissent plus avec leur nom de fleuve. Lorsque les hommes des quatre castes sont devenus Samanens, ils ont le titre commun de ^g*j Chy tchoung, race de Shkya (synonyme de bhikchou). Le Tsun ching king les nomme J0t ,,?* Pi tlisiu (nom d'une herbe des monts Himalaya1'), et les autres king y |-|- Pikhieouc.)i Les religieuses mendiantes sont appeles /[L Fr )X_jP[ khieou ni [bhkchouni). Ce terme est honorable, parce qu'il ne s'applique qu'aux religieux qui mendient par un principe de dvotion et d'humilit. Ceux qui se dvouent ce genre de vie ont pratiquer douze sortes d'observances qu'on nomme theoa tho, d'un mot sanscrit qui signifie secouer, parce que ces observances servent secouer la poussire et les souillures du vice. Les mendiants doivent carter d'eux toutes les occasions de trouble, fuir les vains ornements, dtruire dans leur coeur le germe des dsirs, viter l'orgueil, et, en purifiant leur vie, chercher la suprme raison, la rectitude et la vrit. Les douze observances qui leur sont recommandes dans cette vue se rapportent aux quatre actions ou manires d'tre qu'on nomme 'weyi savoir : marcher, s'arrter, s'asseoir, [gravit, ou ce qui doit tre fait gravement), tre couch. Ce qui suit est extrait d'un livre spcialement consacr aux douze observances et qui en porte le titre CM eul theou tlw king d. i Le mendiant doit habiter dans un lieu qui soit a lanjo [ranyaka), c'est-dire , en sanscrit, lieu de repos, lieu tranquille. C'est le moyen d'loigner les troubles d'esprit, d'carter la poussire des dsirs, de dtruire jamais toutes les causes de rvolte, et d'obtenir la raison suprme , etc. 2 Il doit constamment mendier sa nourriture ( en pli pin'd'aptika), afin d'tein-
" et alibi. Alphab.Tibet,p. 212, 2/15, b Thscniji A han king, cit dans le Yuan Man louihan, liv. CCCXVII, p. 24. San tsang j sou, liv. XXII, p. g v.
Chieultheou thoking, le Livresacr des douze cit dans le San tsangf sou, 1.XLIV, observances, sect.XLV. p. 10. Cf. Vocabulaire peniaglotte,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
61
dre tous les dsirs. Le mendiant ne doit accepter d'invitation de personne. 11faut qu'il mendie la nourriture ncessaire la sustentation de son corps matriel et de ses devoirs moraux. Une doit faire aucune diffrence des alil'accomplissement ments qu'il obtient, bons ou mauvais, ni concevoir aucun ressentiment lorsqu'on lui en refuse, mais tre toujours dans une galit d'esprit parfaite. 3 En mendiant il doit prendre son rang (en pli ythpant'ari) sans tre attir par les mets savoureux, sans ddaigner les personnes, sans choisir entre les pauvres et les riches, et prendre son rang avec patience. 4 Le mendiant qui s'occupe de bonnes oeuvres doit faire cette rflexion : C'est beaucoup d'obtenir un repas ; c'est trop de faire un petit repas (djeuner ), et un second repas (aprs midi). Si je n'en retranche un, je perdrai le mrite d'une demi-journe, et mon esprit ne sera pas entirement livr la raison. En consquence, il vite la multiplicit des repas, et adopte l'habitude de n'en faire qu'un seul [ekapnika). 5 Les aliments que le mendiant a obtenus seront diviss en trois portions : une portion sera donne la personne qu'il verra souffrir de la faim ; une autre sera porte dans un lieu dsert et tranquille, et dpose sur une pierre, pour les oiseaux et les btes. Si le mendiant ne rencontre personne qui soit dans le besoin, il ne doit pas pour cela manger la totalit des aliments qu'il a reus, mais les deux tiers seulement. Par l son corps sera plus lger et plus dispos, sa digestion plus prompte et moins laborieuse. Il pourra sans peine se livrer la pratique des bonnes oeuvres. Quand on mange avec avidit, les entrailles et le ventre grossissent, la respiration est gne ; rien ne nuit davantage aux progrs de la raison. Cette cinquime observance se nomme en sanscrit khaloupas'waddhaktinka. 6 Le suc des fruits, le miel et autres choses du mme genre ne doivent jamais tre prises par le mendiant pass midi. S'il en boit, son coeur se laisse aller aux dsirs et se dgote de la pratique de la vertu. 7 Le mendiant ne doit dsirer aucun ornement; il ne recherche pas les habits somptueux, mais il prend les vieux haillons dchirs que d'autres ont rejets, il les lave et les nettoie, et s'en fait des vtements rapicets, seulement pour se garantir du froid et pour couvrir sa nudit. Les vtements neufs, les beaux: habits donnent lieu aux dsirs de renatre, ils troublent la raison; ils peuvent aussi attirer les voleurs. 8 Tratchvarika, ou seulement trois habits. (Cf. XIII, 10.) Ces mots signifient que le mendiant se contente du Ma cha de neuf, de sept ou de cinq pices. Il a peu de dsirs et il est facile satisfaire. Il ne veut avoir ni trop, ni trop peu de vtements. Il s'loigne galement des hommes vtus de blanc, qui sont pourvus de nombreux habits, et des hrtiques qui, par esprit de mortification, vont entirement nus, au mpris de toute pudeur : l'un et l'autre excs sont galement
62 contraires
FOE
KOU
KL
la raison. Les trois habits tiennent un juste milieu. Au reste, le mot de kia cha signifie de couleurs diverses, cause des pices qui forment le vtement du premier, du second et du troisime ordre. 90 S'ms'cniika, ou l'habitation au milieu des tombeaux, procure au mendiant des ides justes sur les trois choses qui sont la premire porte de la loi de Fo : l'instabilit, ou le peu de dure du corps, compos des ciTKjf amas, qui retournent leur origine et se dtruisent; la douleur, qui presse et opprime le corps entre l'poque de la naissance et celle de la mort; et le vide, puisque ce corps est d'emprunt, form par la runion des quatre lments et sujet la destruction. C'est effectivement l'observation qu'en fit Shkya mouni, qui lui ouvrit le chemin de la sagesse suprme. En demeurant au milieu des tombeaux, le mendiant voit le spectacle de la mort et des funrailles. La puanteur et la corruption, les impurets de toute espce, les bchers, les oiseaux de proie, font germer en lui les penses relatives l'instabilit, et htent ses progrs dans le bien. io Frkchamolika, ou tre assis sous un arbre. Le mendiant qui n'a pas atteint la sagesse au milieu des tombeaux, doit aller mditer sous un arbre, y chercher la raison, comme fit Bouddha, qui accomplit sous un arbre les principales circonstances de sa vie : il y naquit, il y complta la doctrine, y tourna la roue de la loi, et finalement, y excuta son pari nirvana. C'est un effet de la destine. Nous apprenons d'ailleurs que d'autres Bouddhas s'y sont galement de ces oprations soumis, ,et l'arbre est tellement inhrent l'accomplissement suprmes, que le mot bodhi dsigne galement l'arbre et la doctrine. 11 Etre assis sur la terre, bhyavakshika, est encore un avantage pour le mendiant. Assis sous un arbre, comme moiti couvert par l'ombrage, il jouit de la fracheur. Il est vrai que la pluie et l'humidit l'atteignent, que la fiente des oiseaux le souille, qu'il est expos la morsure des btes venimeuses; mais aussi il se livre la mditation. Assis terre, son esprit se rcre; la lune, en l'clairant, semble clairer son esprit, et il y gagne de pouvoir plus facilement tre en extase. 12 Nachadhika, tre assis, et non couch. La position de l'homme assis est celle qui convient le mieux au mendiant. Sa digestion, sa respiration sont galement faciles, et il peut aisment atteindre la sagesse. Les vices font irruption sur celui qui se livre la paresse, et le surprennent leur avantage. La marche, la station, mettent le coeur en mouvement et l'esprit en dfaut. Le mendiant doit prendre son repos assis, et sans que ses reins touchent terre. J'ai pens que cet extrait d'un livre consacr aux habitudes du mendiant bouddhiste , ferait mieux connatre les ides de la secte que la rptition de ce qu'on trouve sur le mme sujet dans les relations des voyageurs. On remarquera ce qui est dit sous le n 8, comme tant en opposition avec les manires de voir attribues aux digambaras ou gymnosophisles.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
VIII.
65
(6) La dimension de cette empreinte varie. ] Le texte dit : tantt longue, tantt courte, cela dpend de la pense des hommes a. On pourrait croire ce passage altr, si la mme ide bizarre n'tait reproduite, d'une manire encore plus prcise, par les autres plerins bouddhistes qui ont visit l'empreinte du pied de Fo dans le pays d'Oudyna. (7) La pierre o les habits ont t sches.] Cette aventure, arrive Bouddha, est raconte en dtail par Soung yun. La manire abrge dont F hian indique les traits de la vie des personnages de sa religion, par une simple allusion qu'il suppose bien connue de ceux qui il s'adresse, est une le plus d'obscurit dans sa relation, parce que nous sommes lgendes compltes o soient rapports tous les miracles Bouddhas, Bodhisattwas, Arhans, etc. Le sens commun n'aide en rien pour claircir ces endroits, car la plupart de ces actions fabuleuses sont un degr d'extravagance qu'il n'est pas facile de deviner. Il en serait peu prs ainsi, si, dans la vie de Mahomet, on disait simplement et sans explication, Y aventure de l'aiguire, Y affaire de la montagne, le miracle de la lune et de la manche: de telles indications seraient inintelligibles livre propre expliquer ces fables. pour celui qui ne serait aid d'aucun quelque circonstance des choses qui jettent loin de possder des attribus aux divers
(8) L'ombre de Fo.] Pour ce prodige, l'un des plus absurdes dont il soit fait mention dans les lgendes bouddhiques, voyez ci-dessous le chapitre XIII, les notes sur ce chapitre, et la partie du Si yu M relative au pays de Na ki lo ho. (g) Du pays d'Oudyna, F hian franchit, en allant vers le midi, une distance en qu'il a nglig d'noncer, mais qui ne saurait avoir t trs-considrable, juger par la suite de son rcit. On ne doit pas oublier qu'il tait rest l'ouest du Sind, en des contres que l'on comprend ordinairement dans la Perse, qui faisaient alors partie de l'Inde, et qui sont vritablement intermdiaires entre ces deux pays, et distinctes de l'un et de l'autre par la nature de leur population comme par leur situation gographique. C'est l qu'il trouva un petit tat qu'il nomme Su ho to, et qui est absolument inconnu d'ailleurs. * Ou [ plutt : cela dpend de la ferveurde l'me en priant. KL. ]
CHAPITRE
IX.
Royaume
de Su ho to.
Dans florissante.
le royaume
de Su ho to (1), la loi de Fo
est galement
trs-
cleste (2), prouva le Phou Chy, l'empereur et en colombe en pervier sa (3). II se changea (4). [Le Phou sa] dchira la colombe. la sa chair racheter Aprs que Fo eut accompli pour Anciennement, il passa par cet endroit avec ses disciples, et il leur dit : Voici ma chair la colombe. Les le lieu o j'ai jadis dchir pour racheter et ils levrent dans gens du pays apprirent par l cette aventure, loi, cet endroit une tour qui est enrichie d'ornements d'or et d'argent.
NOTES (1)
SUR
LE
CHAPITRE
IX.
Le royaume de Su ho to.] La forme de ce nom semble bien annoncer une origine indienne ; mais il est tout fait inconnu d'ailleurs. Tout ce qu'on sait de la position du pays qu'on appelle ainsi, c'est qu'il tait au midi de YOudyna, et cinq journes l'ouest du Gandhra de F hian. L'aventure fabuleuse qui y est sanscrite originale; mais il y a rapporte, pourra faire retrouver la dnomination sans doute longtemps que cette dnomination a disparu dans la contre laquelle elle a appartenu, par l'effet de l'influence persane et de celle du musulmanisme. (2) Chy, empereur cleste.] C'est Indra qu'on dsigne ainsi dans les livres bouddhiques de la Chine, quand on n'y transcrit pas son nom, In tho lo". On l'appelle aussi Ti chy, le seigneur des dieux, et Chy tlii houan in (vraisemblablement Shatamanyou ), ce qui signifie, dit-on, en sanscrit, puissant roi des dieux b. On sait Indra passe pour le seigneur du que, dans l'ordre des divinits bouddhiques, Trayastrinsha, ou du sjour des trente-trois dieux ( comparez XVII, 2), le second des Bhouvanas du monde des dsirs, en montant. On lui donne en tibtain le nom b * .S'oit isangf sou, liv. XLVI, p. n. Ibid.liv. XXXIII, p. .
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
IX.
65
de dVang po, seigneur, et beaucoup d'autres dnominations qui ne sont que des pithtesa. En mongol, on l'appelle Kliormousda; et ce nom, aussi bien que la circonstance des trente-trois dieux auxquels il sert de chef, a t, pour M. Schmidt, l'occasion d'un rapprochement curieux avec Hormuzd et les trente-deux amschaspands h. Il est difficile de contester cette analogie, et plus difficile encore de l'expliquer jusqu'ici, puisque la nomenclature mongole est la seule qui la prsente, et qu'il n'y en a pas de trace chez les Hindous, lesquels ont d, plus que tout autre peuple d'Asie, avoir occasion de faire ou de fournir des emprunts aux Persans. (3) Phou sa] ou Bodhisathva. Celui dont il s'agit ici est Shkya mouni, dans une de ses existences antrieures, o il n'tait encore parvenu qu'au rang de Bodhisattwa. (Voy. X, k-) Ces personnages sont caractriss, dans leur vie humaine, par une bont extrme, une bienveillance universelle, un dtachement qui les porte se sacrifier pour le salut de tous les autres tres, comme dans l'exemple cit ici. n'a [) Il se changea en pewier et en colombe. ] Cette double transformation rien d'impossible dans les ides bouddhiques. Les dieux et les saints peuvent revtir plusieurs corps la fois, ou crer plusieurs apparences existant simultanment : c'est ce que signifie la phrase chinoise. Voyez pag. 55. ' le Dictionnaire de Scliroeter,passim. b Forsehungen,u. s. w. Voyez
CHAPITRE
X.
Royaume
de Kian tho we.
On
descendit
de
Su
ho
to
vers
l'orient,
de chemin,
et on arriva
o rgna F Phou sa (4), il fit dans lement lev
au royaume i (2), fils du roi A yu (3). Dans
pendant cinq journes de Kian tho we (i) : c'est le lieu le temps o Fo tait
ce pays l'aumne en cet endroit une grande
de ses yeux (5). On a pareiltour avec des ornements d'or beaucoup sont livrs
et d'argent. Parmi les habitants l'tude de la petite translation.
de ce royaume,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
X.
(1) Le royaume de Kian tho we.] On serait tent de prendre ce nom pour celui du canton de Gandhava, qui a t introduit assez rcemment sur nos cartes \ Mais F hian, a visit les l'opinion d'un autre voyageur chinois, qui, postrieurement mmes contres, et qui s'est attach rectifier les erreurs commises par son prdcesseur dans l'expression des noms gographiques , nous conduit considrer Kian tho we comme une altration du nom bien connu de Kian tho lo : or, dans ce dernier se retrouve videmment celui des Gandari de Strabon h, le Gandhra des Pouranas c, le Kandahar des gographes musulmans, lequel est rest affect une ville clbre. Il ne faut pas que la position plus occidentale de cette ville soit regarde comme le sujet d'une objection contre une synonymie incontestable. Divers tmoignages, au nombre desquels il faut placer ceux des gographes chinois de la dynastie des l'invasion des Musulmans, les Gandhra Thang, font voir qu'antrieurement avaient form un tat puissant et tendu l'ouest de l'Indus. Nous en possdons, dans les collections chinoises, une description dtaille, postrieure de deux sicles celle du Fo kou Ici. Plusieurs traditions importantes pour le Bouddhisme avaient, cette poque, cours chez les Gandhra et dans les petits tats voisins. " dansle Bloutchistan, trad. fr. t. II, pag. 117. h Liv.XV. Ward, t. I, p. 11 Pottinger,Voyage
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
X.
67
Quelques-unes rappelaient les actions attribues Fo, au temps o il tait Bodhisattwa, c'est--dn'e, comme on l'a observ plus haut, dans une des priodes de son existence que la mythologie place avant l'poque de sa vie relle. de la (2) F i. ] Ce nom parat significatif: F i, avantage ou accroissement loi. Ce doit tre la traduction de quelque nom sanscrit comme Dharmavardhana, qui a appartenu plusieurs princes indiens. D'aprs cette tradition, le fils d'un roi de Mgadha aurait rgn dans le pays de Gandhra. Ce point d'histoire aurait besoin d'tre clairci par l'examen des livres sanscrits, qui, en juger d'aprs les extraits cits par M. Wiisona, peuvent fournir d'autres faits l'appui d'une runion quelconque entre Mgadha et Gandhra, des poques anciennes de l'histoire de l'Inde.
(3) Ayu.] Ce roi est plus souvent appel Wou yu. Son nom transcrit exactement est A chou Ma [asoka, sans tristesse). Il tait arrire-petit-fils du roi Ping cha ou Pinposolo [Bimbsra) , .dont il sera parl plus bas, et il vivait cent ans aprs le Nirvana de Shkya mouni. En mongol, on le nomme Khasolung ougeh, mot qui a la mme signification, mais que M. Schmidt n'a pas restitu, ni peut-tre reconnu. Comme on attribue ce roi la fondation de presque tous les difices religieux qui existaient autrefois dans les diverses parties de l'Inde, et qu'on la rapporte l'an i i 6 aprs le Nirvana de Bouddha, 9 de la rgence Koung hoc, 833 avant J. C., c'est l un synchronisme de la plus haute importance; et comme il est fond sur dans l'poque du rgne d'Asoka, et qu'il en sera fait mention trs-frquemment la suite de ces relations, nous reviendrons plus d'une fois sur l'histoire de ce monarque. Il faut surtout voir ce qu'en dit Hiouan thsang, dans sa Description de Mgadha, et les notes sur ces endroits. (4) Dans le temps o Fo tait Phou sa, ] c'est--dire, dans celle des existences, antrieures l'existence que nous reconnaissons comme historique, o Shkya mouni tait dj parvenu l'ayant-dernier degr de la perfection morale et intellectuelle ,-et avait obtenu la qualit de Bodhisattwa. Cette partie de la lgende tant peu connue , et formant, s'il est permis de parler ainsi, Yavant-scne de la vie de Bouddha, j'en vais donner un extrait, d'aprs une prdication que Shkya mouni fit, dans le royaume de Kapila, dans la chapelle de la famille Shkya, sous un arbre de l'espce appele nyagrodha [ficus religiosa), et laquelle assistrent, avec les mille deux cent cintous parvenus au rang d'Arhn, cinq cents religieuses quante grands mendiants, mendiantes, un nombre infini 'Oupsika et A'Oupsik (fidles de l'un et de l'autre sexe), de Brahmanes ; les quatre rois du ciel, le roi durayastrinsha (Indra), "Varna, les dieux du Touchita ( VI, 6 ), le dieu Nimalothi, le dieu Pholo nimi, Brahma et les " Mudra c liakshasa,prface, p. n. h Geschichle derOst-Mongolen, p. 16. Wakan kwlJ'en nen tsou.(Table chronol.comparede Y et chinoise, liv. I, p. 17 v.) Histoire gakfoun-no japonaise 9-
68
FO
KOUE
KL
dieux mmes de l'Aghanichta, avec les princes des Nagas, des Asoura, des Kia lieou etc.; et de plus le roi Pe tsing, le roi Wou lo, des Tchin tho lo, des Mahieoule, le roi Kan lou tsing nou (sans colre), le roi Wou youan (sans indignation), (puret de la rose), ainsi que neuf cent mille grands et magistrats du pays de Kapila, qui tous taient venus honorer Shkya dans sa qualit rcemment reconnue de Bouddha. Maha Mou Man lian ", un des disciples favois de Shkya , fut celui qui provoqua de sa part des explications sur sa destine passe. Shkya fit alors un discours, dont je me borne transcrire les principales circonstancesh : Ma vie actuelle a dur pendant d'innombrables kalpas. J'tais d'abord un homme ordi naire qui cherchait la doctrine de Bouddha. Mon me reut une forme mat rielle en passant par les cinq voies. Quand un corps tait dtruit, j'en recevais un autre. Le nombre de mes naissances et de mes morts ne peut se comparer qu' celui des plantes et des arbres de l'univers entier. On ne pourrait compter et les corps que j'ai eus. La priode de temps qui comprend le commencement la fin du ciel et de la terre s'appelle un kalpa, et moi-mme je ne puis noncer les renouvellements et destructions du ciel et de la terre que j'ai vus. La cause des motions pnibles, ce sont les passions mondaines. J'ai t longtemps flot tant et comme submerg dans l'ocan des dsirs, mais je n'ai souhait que de remonter leur source : tel a t le but de mes efforts, et c'est ainsi crue j'ai a russi en sortir au temps o le Bouddha Ting liouang Anciennement, (lumire du vase, Dpankara) releva le monde, il y avait un saint roi nomm Tcng ching (abondance de lampes), qui rgnait dans le pays de Thi ho 'we. Son peuple tait favoris d'une grande longvit, et vivait dans la pit et la justice. La terre tait fertile, et l'on jouissait d'une paix profonde. Ce fut alors que naquit le prince qui porta le nom de Ting kouang. Ce prince tait dou de facults sa vieillesse, <(sans pareilles. Le saint roi, qui le chrissait, sentant approcher voulut lui rsigner son royaume; mais le prince le cda son frre cadet, et, embrassant la vie religieuse, il fonda la doctrine samanenne et devint Bouddha. Il parcourut le monde la tte d'une troupe innombrable de disciples. Quand il voulut revenir au royaume de Thi ho 'we, pour convertir sa famille et les prin cipaux du pays, on craignit la multitude opposer une arme. Le Bouddha, parles [ MahaMonkianlian signifiele grandMoukian lian.Le motMouhianlianest traduitdans les livres bouddhiquesdes Chinoispar & pp] hou teou, c'est--dire, lentille (ciccr lens). C'est le sanscrit Un ermite qui a la mmesignification. Manggalyam, les lentilles, de la haute antiquit aimait beaucoup d'o lui vint son nomde familleMangjalyam, qui des dix estdevenu sonnom propre.Il estle sixime grandsdisciplesde Shkya,et celui qui avaitacquis et l'on voulut lui qui l'accompagnait, six facults surnaturelles dont il jouisla plusgrandeforcesurnaturelle; c'est pourquoion le nomme .- 3* ijs Tho? oule premier dansla sainte pntration. [Sanisangfsou, l.XLI,p. i3. ) Le mmepersonnageest ailleursappelen sanscrit lililha, ce que les Tibtains, les Mongolset les Mandchousrendent par ex gremiovelex amplexu nains.[Vocabulairepentaglolte, sect. xxi, n 3.)KL.] b D'aprsle Sieouhingpen ke king, cit dans le Chini lian, liv. LXXVII,p. 8.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
X.
69
saita, connut ce dessein, et il leva une forte et haute muraille, puis une seconde, et rendit ces deux murailles transparentes comme du verre, de sorte que l'on voyait trs - distinctement au travers six cent vingt mille Bikchou (mendiants), tous pareils des Bouddhas. Le roi reconnut son erreur. On adora le Bouddha, et l'on fit les prparatifs d'une grande fte pour le recevoir. Dans un espace de quarante li, on aplanit les chemins, on les arrosa d'eau de senteur, on leva des pavillons et des tentures avec toutes sortes d'ornements d'or, d'argent et de pierres prcieuses. Le roi vint la rencontre du Bouddha, et celui-ci ordonna aux Bikchou de rpondre aux honneurs qu'on lui rendait Sur ces entrefaites, il y avait un jeune lettr Fan tclii (Brahmatchri)1", nomm Lumire sans tache. Ds sa jeunesse, il avait donn des preuves d'une intelligence suprieure. Son me s'tait ouverte aux plus rares connaissances. Retir dans les forts et les montagnes, il y menait une vie pure, s'adonnant la contemplation, mditant sur les critures, et il n'y avait rien qu'il ne st parfaitement. Il avait converti un grand nombre d'hommes. Dans ce nombre tait un Brahmatchri nomm Pou tsi tho, qui desservait un grand temple o il clbrait toute l'anne les cr monies et les sacrifices. La foule de ses disciples s'levant quatre-vingt mille a lui avaient apport, la fin de l'anne, de Yor du Dakshin, de l'argent, des pierres des chars, des chevaux, des moutons, de riches vtements, des prcieuses, toffes, d'lgantes chaussures, des dais enrichis de perles, des btons d'tain ( l'usage des mendiants), des aiguires. Le plus habile et le plus intelligent devait possder tous ces trsors. Sept jours n'taient pas encore couls, quand le jeune Bodhisattwa entra dans cette compagnie. Il y prcha sept jours et sept nuits. Les auditeurs furent ravis, et leur chef, plus content qu'eux encore, voulut offrir au Bodhisattwa une fille vertueuse ; mais le Bodhisattwa ne l'accepta pas, et ne voulut prendre qu'un parasol, un bton, une aiguire, des chaussures et mille pices de monnaie. Il rendit tout le reste au matre, qui voulut du moins partager avec lui; mais le Bodhisattwa refusa encore, et lorsqu'il quitta ses dis ciples, il leur distribua chacun une pice d'argent. En continuant sa route, il vint dans un pays o les habitants paraissaient joyeux et o se montraient de toutes parts des prparatifs de ftes. Il s'informa du motif de ces ftes: on lui dit que Ting kouang allait venir recevoir les hommages du peuple. Le jeune * oBrhman, fromthe timeofhis investiture wilhthe ci-dessus,VI, 5. Voyez cord, tothe periodofhisbecoming a householdcr : 1 f - A?f* Fan tchi, dit le San tsanqf sou it is also appliedto aperson, whocontinues with his spiritual teacher, through life, studyirmthe (liv. XVI, pag. i5 verso), est un mot sanscritqui Vedas, and observing thedutiesofthe student;it is en chinois-^- 1/^tt, c'est--dire, la postrit signifie alsogivenasa titlc toPandits learnedin the Vedas ; des Danstoutesleslgendes to a classof ascetics;hy the Tanlras, it is assigne! purs(oudesBrahmanes). ce tenue chinoisremplacele sanscrit to personswhosechiefvirtueis the observance of bouddhiques, continence;and it is assumedhy many religions Brahmatchri, dans sondicque M.Wilsonexplique Kr,. tionnairepar : The religionsstudent; the young vagabonds. ]
70 Bodhisattwa
FOE
KOUE
KL
sauta de joie en apprenant la venue du Bouddha, et demanda quel des hommage on allait lui rendre. Rien que de lui offrir des fleurs, rpondit-on, Il entra en hte dans la ville; mais le parfums, des toffes, des banderoles. roi avait fait dfendre de vendre des fleurs pendant sept jours, afin de les rserver pour la crmonie. Le Bodhisattwa se sentit trs-mortifi de ce contre-temps ; mais le Bouddha avait pntr la pense du jeune homme. Une fille vint passer avec une cruche pleine de fleurs : le Bouddha l'claira d'un rayon de lumire; la cruche devint transparente comme du verre, et le Bodhisattwa, lui ayant achet ses fleurs, s'en alla fort content formant Le Bouddha tant arriv, une multitude immense l'accompagna, autour de lui plusieurs milliers de fois cent rangs. Le Bodhisattwa voulait appro' cher pour rpandre ses fleurs, mais il ne pouvait y russir. Le Bouddha, qui s'en aperut, fit sortir de terre un grand nombre d'hommes d'argile qui l'aidrent pntrer dans la foule. Alors le Bodhisattwa jeta cinq fleurs qui demeurrent en (( l'air, et formrent un dais large de soixante et dix li. Deux autres fleurs s'arrtrent sur les paules du Bouddha comme si elles y eussent pris racine. Le Bodhisattwa charm rpandit ses cheveux terre, et supplia le saint personnage de marcher dessus. Aprs quelques faons et de nouvelles instances, le Bouddha y consentit ; alors sa bouche souriante projeta deux rayons de lumire de diverses couleurs, qui se sparant sept pieds de distance, firent trois fois le tour de sa personne, et. dont l'un claira les trois mille grands milliers de mondes, sans que rien y chappt, et revint sur le vertex ( du saint ) ; l'autre descendit dans les dix huit rgions infernales, et suspendit un moment les tourments qu'on y endure. Les disciples demandrent au Bouddha l'explication de son sourire. Vous voyez leur rpondit-il, l'honorable du sicle vous annonce que la ce jeune homme, puret qu'il a voulu acqurir dans un nombre infini de Kalpas, en soumettant son coeur, surmontant la destine, et chassant les passions; que ce vide suprme ni fin, qui rsulte de l'amas des vertus et qui doit accom sans commencement plir ses voeux, il les a obtenus ds prsent. Puis s'adressant au jeune homme lui-mme : Dans cent Kalpas, continua le Bouddha, tu obtiendras de devenir Bouddha; tu t'appelleras Chy kia iven (ou le pieux, l'humain). Le nom du Kalpa o tu natras sera Pho tho (sage) ; le monde s'appellera Cha fou. Ton pre sera P tsing, ta mre Maye, ta femme Kieou i, ton fils Lo. Ton compagnon sera A non; ton disciple de droite, Chy lifo; ton disciple de gauche, Maha Mo kian lian. Tu instruiras les hommes des cinq mondes grossiers ; tu sauveras les dix parties, le tout exactement comme moi. L-dessus Bodhisattwa le Pieux, que cette prdiction comblait de joie, perdit la facult de penser, et tomba en extase ; mais en mme temps son corps s'leva en l'air et y demeura suspendu la distance de cinquante-six pieds de terre. Il redescendit ensuite et se prosterna aux pieds du Bouddha. Alors il se fit Samanen; et quand le Bouddha prchait la loi, Bodhi-
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
X.
71
sattwa le Pieux l'assistait. Lorsque Ting kouang parvint au Nirvana, ce Bouddha reut ses prcejites et maintint la loi dans toute sa puret. 11 ne se lassa jamais de pratiquer la bont, l'humanit, la charit et toutes sortes de vertus. Quand sa vie fut termine, il naquit dans le Touchita; mais comme il dsirait toujours sauver ceux qui taient dans l'aveuglement et l'obscurit, il descendit sous la forme de roi tourneur de roue [tchakravarti), l'empereur qui marche en volant. Il tait posses seur de sept trsors plus prcieux les uns que les autres la roue d'or, les perles divines, la femme parfaite (de jaspe), le ministre rempli de science, une arme bien discipline, la crinire enrichie de perles d'un cheval couleur de pourpre, et la queue pareillement orne de perles de l'lphant blanc. (Comparez XVII, 12.) L'ge des hommes tait alors de quatre-vingt-quatre mille ans. Il avait dans son palais quatre-vingt-quatre mille femmes. Il lui naquit mille fils, tous vertueux et braves, de telle sorte qu'un seul d'entre eux en valait mille. Le saint roi gouverna avec la plus grande sagesse, et fit fleurir la vertu. Il tablit la paix dans tout l'univers. Le vent et la pluie venaient propos pour faire mrir tous les grains. Ceux qui s'en nourrissaient, n'avaient que peu de maladies. La saveur en tait comme une douce rose, et ces aliments procuraient une sant parfaite. Il n'y avait que sept infirmits : le froid, le chaud, la faim, la soif, les deux besoins na turels et les dsirs de l'esprit. Quand le saint roi eut puis son ge, il monta au ciel de Brahma, o il devint Brahma. La dure de la vie d'un Brahma est de deux rgnrations du monde ou deux mille six cent quatre-vingt-huit millions d'annes. Au ciel, il tait Indra. La vie d'un Indra est de mille ans, dont chaque jour vaut cent de nos annes, ou trente-six millions cinq cent mille ans. Sur la terre, il tait roi saint. Ces vicissitudes eurent lieu trente-six fois; mais enfin il prouva de nouveau le dsir de sauver les hommes, et au temps convenable, il redevint Bodhisattwa. En se soumettant la douleur, il avait travers trois asankhya de Kalpas (trois cents quadrillions de fois seize millions huit cent mille ans). Au bout de cette priode, il voulut tmoigner sa commisration pour toutes les douleurs, et faire tourner la roue en faveur de tous les tres vivants. Il fit l'abandon de son corps un tigre affam a, et traversa ainsi neuf Kalpas en se livrant aux plus grands efforts. Dans les quatre-vingt-onze Kalpas restants (de puis le temps du Bouddha Ting kouang), il s'appliqua l'tude de la raison et de la vertu, s'introduisit dans les penses du Bouddha, pratiqutes six moyens de salut, et runit dans son coeur la vrit de l'aumne [dna), de l'observation des prceptes [s'la), de la confusion salutaire [kshnti), de l'activit sainte [vrya), avec l'exquise connaissance [prdjn), et la subtilit [oupya) ; il s'accoutuma [ Il naquit alors commetroisimefilsdu puissantmonarque Mahrath,et s'appelaitMahSatwa. Sesdeux frres ans taien! MahKda et Mah Diva. L'meincarnedansle premiertak cellede Mutrcya,et l'me du secondcelle de Mandjousri. -KL.]
72
FO
KOU
KL
traiter tous les tres vivants avec la tendresse qu'il aurait montre l'gard d'un enfant nouveau-n. Enfin, il amassa toutes les vertus d'un Bouddha, de sorte qu'ayant, dans le cours des Kalpas, parcouru avec effort les dix terres (ou sta tions pour l'unification a ), il se trouva dans la vie parvenu ce point qu'on nomme ekavtchika, et o l'me n'a plus qu'un seul obstacle surmonter pour atteindre la suprme intelligence. Alors ses mrites tant accomplis, et le cercle de la divine prudence tant entirement immense parcouru, il dut descendre pour devenir Bouddha. Il se donna lui-mme dans le Touchita quatre sujets d'observation : il observa le pays o il devait natre, et le pre et la mre dont il (Je dans le texte) devait recevoir la naissance, et ce qui convenait pour l'enseignement et la conversion qu'il projetait. Je savais d'avance, continue Shkya (en parlant dsormais la premire personne), que c'tait le roi P tsing qui devait tre mon pre dans le sicle. Keou li cha ti avait deux filles qui taient alors se baigner dans un tang du jardin des femmes. Le Bodhisattwa tendit la main et dit : Voici la mre qui doit m'engendrer dans le sicle. Quand le temps de ma naissance fut venu, il y eut cinq cents Fan tchi (Brahmatchri), tous jouissant de cinq facults surnatu relies (sur six), qui passrent en volant sur les murailles du palais sans pouvoir y pntrer. Frapps d'tonnement, ils se dirent les uns aux autres : Nos facults divines nous permettent de passer au travers des murailles ; pourquoi donc ne pouvons-nous pntrer ici? Le matre des Brahmatchri leur dit : Voyez-vous ces deux filles? L'une des deux doit engendrer le grand homme, possesseur des trente deux lakcliana (beauts corporelles), et l'autre doit nourrir ce mme grand <(homme. Cet tre divin et redoutable va nous priver de nos facults surnatu relies. Cette nouvelle se rpandit bientt dans tout l'univers. Le roi P tsing, transport de joie et dsirant que l'empereur qui marche en volant vnt natre dans sa maison, demanda la jeune fille en mariage, et vint la recevoir comme son pouse. Le pieux Bodhisattwa, mont sur un lphant blanc, s'approcha <(du sein de sa mre, et choisit pour natre le huitime jour de la quatrime lune. La dame s'tant baigne et parfume, prenait du repos, quand elle vit en songe un lphant blanc qui rpandait la lumire dans tout l'univers. Un concert de voix et d'instruments se faisait entendre, on rpandait des fleurs, on brlait des par fums. Quand ce cortge, qui traversait les airs, fut parvenu au-dessus d'elle, tout disparut subitement. Elle s'veilla tout effraye, et le roi lui ayant demand la cause de son pouvante, elle lui raconta le songe qu'elle venait d'avoir. Le roi, inquiet son tour, consulta les devins, qui le rassurrent. Ce songe, dirent-ils, est la marque de votre bonheur, roi ! Il annonce qu'un saint esprit est des cendu dans le sein (de la princesse). Cf. Vocabulaire sect.xi pentaglolte, Elle concevra de ce songe, et le fils qu'elle
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
X.
75
engendrera sera, dans votre maison (comme prince), empereur qui marche en volant et faisant tourner la roue ; et hors de la maison ( dans la vie religieuse ), il tudiera la loi, deviendra Bouddha, et dlivrera les dix parties du monde. Le roi fut ravi de cette assurance ; la dame en prouva de corps et d'esprit la plus salutaire influence. Les princes des petits tats voisins, apprenant que la femme du grand roi avait conu, vinrent lui rendre hommage ; chacun d'eux lui paya tribut avec de l'or, de l'argent, des perles, des habits prcieux, des fleurs et des parfums, lui exprima son respect, et lui souhaita mille bonheurs. La dame tendit la main et refusa leurs offres avec civilit. Depuis que la dame avait conu, les dieux lui prsentaient les mets les plus savoureux ; une vapeur subtile la nourrissait sans qu'elle et besoin de recourir aux cuisines du roi. A la fin du dixime mois, le corps du prince tant tout fait form, le huitime jour de la quatrime lune, la dame sortit, traversa la foule et alla se placer sous un arbre : les fleurs s'panouirent, et une brillante toile apparut cette lgende au point o commence la partie de l'existence du J'interromps saint personnage, pendant laquelle il atteignit la dignit de Bouddha. Plusieurs traits de cette dernire carrire pourront trouver place dans les notes qui suivront ; mais il faut remarquer que le nom de Bodhisattwa est encore appliqu Shkya dans plusieurs aventures de sa vie terrestre, relatives un temps o il n'tait antrieures sa trentime anne. pas encore devenu Bouddha, c'est--dire (Voyez XII, 2.) de ce trait de
(5) L'aumne de ses yeux.] II est parl dans les autres relations charit du Bodhisattwa.
10
CHAPITRE
XL
Royaume
de Tch cha chi lo. Le tigre affam.
il y a un sept journes de marche, Tch cha chi lo. Tch cha chi lo signifie en chinois nomm royaume o Fo tait Phou sa (2), il fit en ce lieu Tte coupe (i). Dans le temps ce nom au pays. on a donn l'aumne de sa tte (3), et c'est pourquoi A l'orient de Kian tho we, Plus corps grandes de ces l'orient un tigre encore, affam ornes les on vient (4). Dans de toutes grands au lieu ces deux o (Fo) endroits, a abandonn on a lev son de
tours, contres,
sortes
de choses
les dvotions et d'y brler parl plus tours (5).
et le peuple eux dans des fleurs ; on ne cesse d'y rpandre qu'ils y pratiquent Ces tours, et les deux autres dont il a t des parfums. sont appeles par les gens du pays les quatre grandes
prcieuses. rivalisent entre
Les rois
haut,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XL
tchyoutasira (tte tombe), (1) Tch cha chi lo.] Il faut lire vraisemblablement mot sanscrit qui aurait peu prs la signification indique par F hian. La sifflante remplaant la dentale la seconde syllabe, ne doit pas arrter dans une transcription chinoise. On a dj vu un exemple de cette substitution, et on enverra encore d'autres par la suite. Au reste, il n'est pas tonnant qu'une dnomination fonde sur une pareille aventure, ait compltement disparu avec le Bouddhisme dans la nous manquent pour localit laquelle on l'avait applique. Les renseignements fixer prcisment la place de ce canton sur nos cartes : il ne devait pas tre trsloign de Shoraivak et du canton actuel de Sarawan. (2) Fo tait Phou sa.] Voyez X, k. (3) L'aumne de sa tte.] Cette circonstance, ainsi que celle de l'aumne des yeux
NOTES indique prcdemment, thsang a recueillies.
SUR se trouve
LE
CHAPITRE
XL
75 que Hiouan
rapporte
dans les lgendes
(4) Abandonn son corps un tigre affam.] Voyez ci-dessus, X, k- Jadis Bouddha tant prince sous le nom de Sa tho (Sattwa), se promenait dans les montagnes ; il vit un tigre qui mourait de faim, et jeta au-devant de lui son propre corps, pour lui sauver la viea. [Dans sa Grammaire mongole, imprime Saint-Ptersbourg en 183 i, M. J. J. Schmidt a donn cette lgende bouddhique, extraite du 26e chapitre du livre intitul i~-\) 1I\{_I 1 Alton, gerel (en sanscrit Souwarna prabhsa) ou l'clat de l'or. Il l'a accompagne d'une analyse grammaticale et d'une traduction allemande.] KL. (5) Les quatre grandes tours, ] savoir : la tour du pays de Su ho to, o le Bodhisattwa avait rachet la vie des colombes aux dpens de sa propre chair ; celle du Gandhra, ou de l'aumne des yeux; et les deux qui sont indiques dans ce chapitre. " Santsangfsou, 1.XXXVIII,p. i v.
10.
CHAPITRE
XII.
Royaume
de Fo leou cha. Pot de Fo.
Du royaume de Kian tho we, en allant au midi pendant quatre on arrive au royaume de Foe leou cha (i). Anciennement, jours, ce pays avec ses disciples, s'adressa A nan (2) et lui Ki ni mon pan ni houan (3), il y aura un roi nomm kia (4), qui lvera une tour dans cet endroit. Par la suite, le roi Ni kia se mit voyager; et comme il parcourait ayant paru dans le sicle, Fo, parcourant dit : Aprs ce pays, Chy, l'empereur Il rjroduisit un jeune Le dit-il. roi lui dit : Que donna Le roi lui de celle cleste bouvier fais-tu (5), voulut lui faire natre qui, sur sa route, l? Je fais une tour loges, une pense. levait une tour. Fo, rponune tour
de grands
et il fit construire
au-dessus
de quarante et tous ceux temple, ainsi
de ce jeune Cette tour tait haute de plus berger. toises (6), orne de toutes sortes de choses prcieuses ; qui la voyaient admiraient la beaut de la tour et du laquelle rien ne pouvait tre que leur magnificence, renomme portait que cette tour tait suprieure
La compar. toutes celles du Yanfeou thi (7). Quand la tour du roi fut termine, la au midi de la grande, haute d'environ trois pieds. petite tour parut, Le pot de Foe (8) est dans ce royaume. le roi des Anciennement, Youe dsirait le roi chi (9) leva une
s'emparer des Yu
arme et vint attaquer le pays. Il puissante du pot de Fo. Quand il eut soumis le royaume, tait fermement la loi de Fo, attach ti, qui
voulut
le pot et l'emporter : c'est pourquoi il ordonna des prendre et quand il eut sacrifi aux trois (tres) sacrifices, prcieux (10), il fit un grand lphant et plaa le pot richement approcher caparaonn, sur cet lphant ; mais l'lphant tomba terre et ne put avancer.
CHAPITRE On construisit alors un char
XII.
77
quatre on y plaa le pot, et roues, huit lphants le tirrent; mais il leur fut impossible de faire un du pot (n) n'tait pas encore alors que la destine pas. Le roi reconnut : il en prouva une vive mortification arrive ; mais il fit lever en et un seng kia lan (12). Il y laissa une garnison Il peut y et y fit faire toutes sortes de crmonies. pour le garder, Un peu avant le milieu du jour, avoir environ sept cents religieux. ces religieux tirent le pot du lieu o il est enferm, et, revtus d'habits toutes sortes d'honneurs. Ils dnent ils lui rendent blancs, ensuite, retournent et, quand le soir est venu, ils brlent des et s'en parfums deux boisseaux (i3). cet endroit une tour
Le pot peut contenir environ aprs. Il est d'une couleur o le noir domine; il est bien form mlange des quatre il est pais d'environ deux lignes, luisant et bien cts; le remplir avec quelpoli. Il y a de pauvres gens qui parviennent tandis que des gens riches, des fleurs ques fleurs, qui apporteraient en offrande, mesures pourraient (i4), sans jamais en mettre cent, mille ou dix mille grandes
le remplir. parvenir Il n'y eut que Pao yun et Seng king qui firent leurs dvotions au ensuite. Hoe king, Hoe tha et Tao pot de Fo : ils s'en revinrent rendus taient en avant et s'taient dans le royaume tching partis ki pour y adorer l'ombre et la dent de Fo, ainsi que l'os de son crne. Hoe king tant tomb malade, Tao tching resta pour de Fo leou cha. le veiller, et Hoe tha revint seul dans le royaume de Na Quand king king Il n'y Hoe tha, Pao yun et Seng ses compagnons, rejoint le pays de Thsin immdiatement (i5). Hoe repartirent pour du pot de Fo. se plaisait dans le temple extraordinairement eut donc crne que le seul de Fo. Fa hian qui se rendit au lieu o tait il eut
l'os du
78
FO
KOU
KL
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XII.
(i) Royaume de Fo leou cha.] 11 n'y a gure lieu de douter qu'on n'ait ici la mention la plus ancienne du nom des Beloutches, sous une forme vraisemblablement emprunte la langue sanscrite. La ville de Pa lou cha, que Hiouan et celle de Fou leou cha, qui thsang place dans la partie sud-est du Gandhra, tait habite par les Yu 'ti (ci-dessous, note g), paraissent rappeler la mme dnomination. J'avais hsit reconnatre les Beloutches dans le pays de Fo leou cha, et je croyais d'abord que ce nom pouvait tre une altration de celui de Pars ou Fars; mais les circonstances gographiques et religieuses qui sont indiques au sujet de Fo leou cha et de Pa lou cha ne permettent pas d'admettre cette conjecture \ Il est peut-tre assez singulier de retrouver ce mot dans une relation chinoise du vc sicle, et plus encore d'apprendre, sur la religion de ce peuple, des dtails qui ne sont point connus d'ailleurs. La tour la plus magnifique qui existt alors dans tout le Djambou dwpa, c'est--dire, en style indien, dans le continent entier, avait t construite chez les Fo leou cha en l'honneur de Bouddha, et l'on y conservait sa marmite, ustensile indispensable et caractristique du solitaire bouddhiste. La possession d'un tel trsor attira dans le pays une invasion du roi des Yu ti ou Gtes, dont F hian recueillit la tradition accompagne de circonstances fabuleuses. Au reste, tous les gographes chinois sont d'accord au sujet de la domination que les Gtes ont exerce dans ces contres, et nous verrons encore leur nom ml dans une autre tradition relative la mme marmite de Fo, que le voyageur eut l'occasion de noter pendant son sjour Ceylan. A nan tho [Ananda), et dont le nom est expliqu par joie, jubilation 1, est l'un des disciples favoris de Shkya mouni, et l'un de ceux qui sont le plus frquemment cits dans les lgendes. C'tait celui qui passait pour le plus savant ( to wenc), le plus vers dans la doctrine des trois tsang [Pitaka), (2) Anan,] des livres sacrs, des prceptes et des discours. Quand Bouddha eut accompli la loi, le roi Hou fan [Amitodana), son oncle, envoya dire son frre an le roi P tsing [Shouklodana) qu'il venait de lui natre un fils. P tsing, ravi de cette nouvelle, dit aux ambassadeurs : Puisque c'est un fils, il faut lui donner le nom de Joie (Ananda). Ce prince s'attacha par la suite son cousin Shkya mouni, quand celui-ci embrassa la vie religieuse. Une notice sur la vie d'Ananda nous apprend qu'il tait Kshatrya, natif de la ville des Rois (Rdjagrika ), et fils du roi P fan. Ce dernier point est en opposition " Pian i tian, liv. c Fan i LXIII, pag. i5. ming i, cit dans le San tsangJ sou, 5aHtsang et liv.XLI, pag. i3; Encyclopdie japonaise,liv. XIX, J sou, liv. XXXI, pag. 10 verso, [Utssim. pag. S. c'est--dire souvent nomm
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XII.
79
avec le texte prcdent, qui fait Ananda fils du roi Amitodana. Aprs le Nirvana de son cousin, Ananda vint sur les bords du Gange. Cinq cents Arhn descendirent au travers des airs : dans le nombre taient Chang na ho sieou et Mo ti kia. H savait que tous ces personnages taient des vases de la grande loi, et il les appela lui. Jadis, leur dit-il, Tathgata a confi au grand Kashyapa le trsor des yeux de la droite loi. Quand celui-ci est entr dans l'extase, il me l'a remis; et moi, qui suis prt m'teindre, je vais vous le transmettre. Ecoutez les vers que voici :
Il existe une loi que je vais vous confier, Et cette loi, c'est la uon-existence (l'absolu). Il faut distinguer ces deux choses, Et comprendre la loi de ce qui n'est pas le nant. Ensuite l'Arhn s'leva en Tair, et aprs avoir subi dix-huit transformations, il se laissa emporter par le vent, et s'teignit en s'enfonant subitement dans le son mi [ l'extase ). On se pai'tagea ses sharra [ reliques ), et on leva des tours en leur honneur. Ceci se passa au temps de I wang de Tcheou (89/1-879 avant J. C.)\ Il y a un calcul chronologique faire sur ces indications. Shkya avait trente ans quand il accomplit la loi prs de la ville de Bnars ; c'est cette poque qu'Ananda vint au monde. Shkya vcut encore quarante-neuf ans : tel devait tre l'ge d'Ananda l'poque du Nirvana. Mah Kashyapa, le premier successeur de Shkya mouni, en qualit de patriarche, se retira dans le mont Koukkouta pda pour y attendre la venue de Matreya, la cinquime anne de Hiao wang des Tcheou, 905 avant J. C., quarante-cinq ans aprs le Nirvana, Ananda ayant quatrevingt-quatorze ans. On ne dit pas combien de temps il exera les fonctions de patriarche; mais pour qu'il et pu mourir au temps de I wang, quand bien mme c'et t la premire anne de ce rgne (89/1), il et fallu qu'il vct cent cinq ans. La chose n'est pas impossible ; mais elle permet d'autant plus de doutes, que les auteurs bouddhistes dont nous possdons les ouvrages nous laissent ignorer les moyens dont ils se sont servis pour tablir des synchronismes entre les dates des vnements, dans les premiers sicles de leur religion, et celles de l'ancienne histoire chinoise. Voici le rsum de celle-ci, d'aprs l'ouvrage cit prcdemment : Naissancede Shkya o H embrasse la vie religieuse... 19 Il accomplit la loi. Anandanat. 3o H entre dans le Nirvn'a 79 Mah Kashyapa meurt \ik Ananda meurt a San thsathouhoe we, liv. IX, p. 6 v. jin chinois que j'ai
Avant J. C. 1029 ike de Tchao wang 1010 4 3e 3e de Mou wang ggg 52e 95o . 5e de Hiao wang go5 Sousle rgne de I wang.. 89/1-879
80
FO
KOU
KL
D'autres livres chinois fourniraient d'autres calculs qui seraient affects de la mme incertitude. La chronologie japonaise place la mort de Kashyapa en 905, et celle d'Ananda la onzime anne de Li wang, en 868a : il aurait eu cent trente ans. (3) Pan ni liouan.] Ni liouan, ou f extinction, se reconnat sans difficult pour la transcription du sanscrit nirvana. Mais on trouve frquemment dans les livres chinois cette expression prcde de la syllabe pan : c'est toujours quand il est ou de l'extase en gnral, mais du passage de question, non de l'anantissement la vie relle et relative l'tat d'absorption, effectu par un Bouddha. Ni liouan, c'est l'tat auquel les saints aspirent; pan ni liouan, c'est l'acte qui les y fait arriver. D'aprs cette observation, M. Burnouf pense que ce mot doit tre la transcription de pari nirvana, qui s'emploie en sanscrit dans le mme sens et dans les mmes occasions. [Le texte porte % n9 fan ninoaan heou. Le mot \&.\&W%J$L pan, ou plutt pouan, signifie, selon les dictionnaires chinois, 5e transporter d'un endroit l'autre. Il ne parat donc pas tre la transcription d'un mot sanscrit dans la phrase cite, dont le sens est d'ailleurs assez clair, car elle signifie : Aprs que je me fus transport dans le ni honan [ ou nirvana ). Le San tsang f sou (liv. XXXIX, fol. 2 k verso) dit pourtant que pan ni phan est une expression sanscrite qui signifie en chinois my tou, c'est--dire, le passage l'tat d'absorption. ] KL. [) Ki ni Ma, ] et plus bas, par abrviation, Ni Ma. C'est le mme prince que iliouan thsang fait rgner dans le Gandhra, quatre cents ans aprs leNirvn'a duTathgata, et qu'il nomme Kia ni se Ma. Ce doit tre le mme que le Kanika de Sanang setsen, que cet auteur mongol place trois cents ans aprs le Nirvana de Bouddha, et qu'il dsigne comme ayant t roi de Gatchou b, avec l'pithte de y*- ^\P^}-^A. prince de misricorde, aumnier, bienfaisant. M. Schmidt a lu Gatchi au lieu J~L-Ik de Gatchou, le nom du royaume de Kanika ; mais comme il n'a pas mis de note en cet endroit, j'ignore si la faute est dans le texte ou dans la traduction.
(5) Chy, l'empereur cleste.] Indra. Voyez IX, 2. (6) Quarante toises,] environ 122 mtres. Voyez, pour l'indication d'un sthopa encore plus lev, dans la mme contre, III, 3, et la relation de Gandhra par Hiouan thsang. de Djambou dwpa, que l'on (7) Yan feou thi.] Ce mot est une corruption rend quelquefois d'une manire plus exacte par le de Clien pou. La cosmographie comme celle des Brahmanes, bouddhique, partage la terre en quatre grands dwpa ou continents (les), disposs autour du Soumerou. Ces continents sont: a Wa kankuvto nen der Ost-Mongolen, isou, p. 16. h Geschichle Jeu gakj oun-no pag. 16.
NOTES i A l'orient du Soumerou,
SUR
LE
CHAPITRE
XII.
81
le Fo yu tha ou Fo pho thi [Porvavideh?). Ce nom signifie corps qui surpasse, parce que la superficie de ce continent l'emporte sur celle du continent mridional. On le traduit aussi par origine ou commencement, parce que le soleil se lve dans ce pays. Ce continent est troit l'orient et large l'occident, ayant la forme d'une demi-lune; son diamtre est de neuf mille yodjanas. Le visage des habitants est aussi en forme de demi-lune. Leur stature est de huit coudes, chacune de huit pouces; ils vivent deux cent cinquante ans. un synonyme de vidha, oriental. KL.] [Ce mot est proprement 2 Le Yan feou thi [Djambou divpa). Yanfeou, en sanscrit Djambou. Thi [dib, divpa) signifie le. Djambou est le nom d'un arbre. Dans les contres occidentales , il y a un arbre qu'on nomme Djambou. Au pied est un fleuve, et au fond de ce fleuve, il y a du sable aurifre \ Ce continent est au midi du Soumerou ; il est troit du ct du midi, et large vers le nord, de la forme d'un coffre de char; son tendue est de sept mille yodjanas. Le visage des habitants est de la mme forme que le continent. Le plus grand nombre d'entre eux ont trois coudes et demie de haut (img2i5); et quelques-uns ont jusqu' quatre coudes (2mig6). La dure de leur vie est de cent ans, mais beaucoup n'atteignent pas cet ge. [Les auteurs chinois disent que Djambou divpa signifie le d'or du levant. KL.] 3 Le Kiu ye ni [Gdhanya). Ce mot sanscrit signifie richesse de boeufs, parce que c'est en boeufs que consiste la richesse de ce pays; il est l'ouest du Soumerou. Sa forme est comme la pleine lune ; son diamtre est de huit mille yodjanas. Le visage des habitants est aussi semblable la pleine lune. Leur taille est de seize coudes; ils vivent cinq cents ans. k" Le Y tan yu [Oaitara-Kourou). Ce mot sanscrit signifie pays des vainqueurs, parce que ses habitants ont soumis les trois autres continents. [Le texte chinois dit que Y tan yu (en sanscrit Outtara-Kourou) signifie en chinois :
*, Endroit
li^U
11
plus lev, parce que ce pays est plus lev que les trois autres tcheou ou parties du monde. La version de M. Abel-Rmusat : Pays des vainqueurs, parce que ses habitants ont soumis les trois autres continents, est inexacte. D'ailleurs outtara en sanscrit signifie ce qui est prminent ou lev, et Kourou est le nom Il est au nord du Soumerou. Ce continent est carr propre d'une tribu.KL.] comme une piscine ; sa largeur est de dix mille yodjanas. Le visage des habitants est de la mme forme que le continent. Ils ont trente-deux coudes de haut, et vivent mille ans. On ne voit pas chez eux de mort prmature y mingi, cit dans le San tsangJ sou, liv. XX, p. 8. * Fan h h.
Ahan (le long Agama), cit dansle San Tchang tsang Ja sou, liv. XVIII, p. 17. 11
82
FOE [Les noms de ces quatre continents, TIBTAIN. i. 2. 3. II. Char gi Lus pag dwp. Djambou dwp ou Djambouglincj. Noub gi Balang bdjoddwp. Bdja Gra rnisnandwp.
KOUE
KL sont :
en tibtain et en mongol,
MONGOL. Donna Oulamdzi beyetodip. Djamboudip. Ourouna Uker edlektchidip. Moh dhto dip ". KL.]
Le Djambou dwpa reprsente videmment, dans cette cosmographie, l'Inde avec ce que les Hindous ont pu connatre des autres parties de l'ancien continent. J'aurai par la suite une occasion d'expliquer ce que sont les rois de la roue [tchakravarti rdja) ou monarques universels. Dans l'intervalle de la domination que ces rois ont exerce sur une ou plusieurs des grandes les dont je viens de parler, le Djambou dwpa tait partag entre quatre seigneurs : i A l'orient, le roi des hommes; on l'appelait ainsi cause de la grande population de cette partie du monde. Les moeurs y sont raffines : on y cultive l'humanit, la justice et les sciences. Le pays est doux et agrable. 2 Au midi, le roi des lphants. Ce pays est chaud et humide; il convient aux lphants, et c'est d'o lui vient son nom. Les habitants sont froces et violents ; ils s'adonnent la magie et aux sciences occultes, mais ils peuvent aussi purifier leur coeur, et, se dgageant des liens du monde, se dispenser des vicissitudes de la vie et de la mort. 3 A l'ouest, le roi des choses prcieuses. Ce pays touche la mer qui produit beaucoup de perles et d'objets prcieux, et c'est ce qui lui a fait donner son nom. Les habitants ne connaissent ni les rites, ni les devoirs sociaux, et ils ne font cas que des richesses. ka Au nord, le roi des chevaux. La terre est froide et dure ; elle convient la nourriture des chevaux. Les habitants sont braves et cruels; ils savent endurer la mort et les dangers h. [Je crois qu'il est ici question des quatre chefs qui se partagrent l'empire de l'Inde aprs le dmembrement de l'ancienne royaut de Delhi, et que la tradition nomme Narapati [le chef des hommes), TchaGadjapati (le chef des lphants), trapati (le chef du parasol), As'vapati (le chef des chevaux). E. BURNODF. ]
(8) Le pot de Fo.] Le pot est une des six choses indispensables au religieux mendiant. C'est avec le pot que le mendiant demande l'aumne, et c'est l qu'il met sa nourriture. Sa forme est celle d'une petite marmite basse, troite par en haut et large du ventre. La matire doit en tre simple et de vil prix, comme l'argile ou le fer ; il peut contenir un boisseau et demi au moins, et trois boisseaux au plus. On peut en voir une figure dans la petite Encyclopdie * Pallas, ibidem. Comparezd'autres dnominations sanscriteset tibtaines, dans le Vocabulaire sect.XLVII tib, ainsi que dans l'Alphabet pentaglotte, tain du P. Georgi,pag.^S, 477et 478. Celles qu'on dans de trouve l'ouvrage Pallas, intitulSammlungen japonaise l-
zur Kenntniss der Mongolischen t. II, Vlkerschajlen, unter p. a5, ainsi que dans Bergmann's Streifereien denKalmiiken, t. III, p. 3i, sont dfigures. h Fyouantchulin (laFortde perlsdujardin de la loi), cit dansleSan tsang Ja sou,liv.XVI, p. 12v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XII.
85
mentaire \ Celle de la grande Encyclopdie h est trop orne et reprsente un vase d'apparat de quelque riche couvent du Japon. Le pot et les vtements de Fo sont considrs comme de prcieuses reliques, qui doivent tre conserves religieusement et passer de main en main ; de sorte que l'expression chinoise i po (vtement et pot) est devenue synonyme de ce mode de transmission". On prtend que le pot et les habits de Fo ont t apports en Chine, dans le vc sicle, par le dernier des patriarches bouddhistes ns dans l'Hindoustan d. On Bodhidharma, verra, dans la suite de ces relations, beaucoup d'autres faits relatifs au pot de Bouddha. Le mot chinois po (pot) est l'abrg du sanscrit po to lo (Ptra) : les Mandchous en ont form leur mot badiri. En barman OOCOOO e. (g) Le roi des Youe chi.] Les Yu chi, Yu tchi, ou, comme M. Klaproth pense que l'on doit lire ce nom, les Yu ti ou Youttif, sont une des nations les plus clbres de l'ancienne Tartarie. Selon les Chinois, ils nienaient primitivement une vie errante dans le pays qui est entre Thun hoang (Cha tcheou) et les monts Khi lian. Une guerre que leurs voisins septentrionaux, les Hioung nou, leur firent dans la premire moiti du if sicle avant J. C, les obligea de fuir vers l'occident. Ils allrent s'tablir dans la Transoxane, au del du Fargana; et, ayant vaincu les Ta hia, ils s'arrtrent sur la rive septentrionale du We (Oxus), soumettant aussi les An szu, qui, dans ce temps-l, n'avaient pas de chef suprme. Ils occupaient, lorsque Tchang khian alla chez eux en ambassade 8, cinq villes dont les noms ne sont pas tous faciles reconnatre, attendu la disette de renseignements gographiques relatifs cette contre et cette poque : ces villes taient Ho me, capitale del tribu de Hieou mi; Chouang mi, habite par la tribu du mme nom; Hou h tsao, soumise au prince de Koue chouang ; Po mao, habite par la tribu de Hi tun; et Kao fou (Caboul), o vivait la tribu de ce nom. La ville de Lan chi est donne comme la rsidence de leur roi. Dans le premier sicle de notre re, le prince de Koue chouang subjugua les quatre autres, devint trs-puissant, et s'empara de tout le pays des An szu, de Caboul, de Han tha (Candahar), de Ki pin (Cophne). Son successeur accrut encore cette puissance en s'emparant de l'Inde. Les rois des Yu ti continurent d'exercer l'autorit dans ces diverses contres jusque dans le ine sicle. Au commencement du ve sicle, on parle encore de leurs incursions dans l'Inde, et on indique les points o s'tendaient leurs habitations. Pho lo (Balkh), l'occident; le Gandhra, au nord ; cinq royaumes, au midi de ce dernier, reconnaissaient leur puissance. Ce furent des marchands de cette nation qui, vers ce temps, apprirent aux Chinois faire du verre avec des cailloux fondus. Une " Hiun ' Judson, Barman thoulou,liv. XI, p. 6. meng pag. 362. Dictionary, b ' Tableaux de l'Asie, p. 288. liv. XIX, p i3. japonaise, historiques Encyclopdie Voyez ci-dessus,VII, . Khanghi Tseutian, au mot Po, rad. CLXVII, h du Baslin. 5. l'Histoire Cf.Saint-Martin,Additions " Id. ibid. Empire,t. III, p. 386. 1 1.
84
FOE
KOUE
KL
habita branche des Yu ti, qui tait reste en arrire lors de leur migration, le N. E. du Tibet, sous le nom de Petits Yu ti. Une autre branche, qui porta le mme nom, mais qu'il faut bien distinguer de celle-l, se dtacha plus tard (dans le ve sicle) du gros de la nation, et habita la ville de Fo leou cha, situe au S. O. de Pho lo (Balkh), et qui doit tre le Pa lou cha de Hiouan thsang" ou le pays des Beloutches. On rapporte qu' l'orient de cette ville, dix li de distance, tait une tour de Fo, qui avait trois cent cinquante pas de circonfrence et quatre-vingts toises [ikk mtres) d'lvation. Depuis l'poque o ce monument gigantesque, nomm la tour de cent toises, avait t construit, jusqu' la huitime anne Wou ting (55o de J. C. ), on compte huit cent quarante-deux ans, ce qui en place l'rection l'an 292 avant J. C, et par consquent une poque plus ancienne que l'migration des Yu ti. On ne saurait douter que les Yu ti ne soient une de ces nations venues de la haute Asie dans la Bactriane, qui ont domin sur les provinces orientales le Boutchistan et la partie occidentale de de la Perse, l'Afghanistan moderne, l'Inde. Leur nom, dont il reste tant de traces dans toutes ces rgions, donne lieu de penser qu'ils appartenaient la race gothique, malgr leur origine orientale. Il est trs-remarquable de voir une nation de cette race aussi attache la religion de Bouddha que l'annoncent le fait cit ici par Chy fa hian, et d'autres traits qui seront relevs dans la suite de nos relations. (10) Aux trois prcieux. ] Voyez ci-dessus, VII, 6.
(11) La destine du pot.] Le mot yuan, que je rends par destine, signifie non arrt d'avance par un tre tout-puispas peut-tre ce qui a t irrvocablement sant et libre, mais l'enchanement invitable de toutes les causes et de tous les on verra ce sujet une tradition effets. Quant la destine du pot de Bouddha, curieuse dans le chapitre de la relation de F hian sur Ceylan. (12) Seng Ma lan.] Voyez ci-dessus, (i3) III, 5. contient dix livres de riz, ou cent
Deux boisseaux.] Le teou ou boisseau quatre-vingts onces de notre poids commun. (i/i) Grandes mesures.] Hou, le dcuple
du boisseau.
(i5) Le pays de Thsin. ] Les deux textes ont une variante en cet endroit; celui du Fo kou M porte : -j* -rk j^ j^. retournrent immdiatement dans la terre de Thsin, ou la Chine. L'extrait du Piani tian prsente : - ^fe jh^ jj& retournrent immdiatement pour rendre compte l'empereur. Mais cette formule officielle n'a et je n'hsite pas prfrer la premire leon. pas ici d'application, 8 VoyezXII, i.
CHAPITRE
XIII. de Fo.
Royaume de Na ki. Ville de Hi lo. Os du crne de Fo. Dent Bton de Fo. Manteau de Fo. Ombre de Fo.
de seize yeou y an (i), on l'espace du royaume de Na ki (2), et la ville de Hi lo (3). arriva la frontire la chapelle de l'os du crne de Fo. Elle est entireC'est l qu'est de toutes sortes ment dore et revtue d'ornements (4). Le prcieux a la plus grande roi du pays vnration l'os du crne; et, pour dans la crainte chefs des huit a un que quelqu'un des principales ne vienne familles l'enlever, il a fait choix de son royaume : chacun d'eux de la chapelle. De grand matin, et ils ouvrent ensuite la sceau,
En
marchant
vers
l'occident
sceau
ils vont
que l'on met la porte leur tous les huit vrifier
elle est ouverte, ils se lavent les mains avec des eaux Quand porte. de senteur, retirent l'os du crne de Fo et le portent hors de la chapelle, de toutes dessous, sur un trne de lev, choses pourvu d'une sortes la cloche La prcieuses. qui le recouvre, de pierre ronde et table de pierre qui est sont galement ornes table
de verre
de perles et de pierres fines. L'os est de couleur blanchtre; jaune il a quatre de circonfrence et une minence la partie supouces les gens de la chaprieure. Chaque jour, aprs le lever du soleil, sur un pavillon de gros tambours, lev; l ils frappent pelle montent de la conque et font retentir des cymbales sonnent de cuivre. Ds il se rend la chapelle, o il fait ses dque le roi les a entendus, en offrant des fleurs et des parfums. l'adoration votions est Quand finie, On chacun entre son par la en use ainsi par celle de l'occident. et ce n'est tous les matins, qu'aprs qu'il a fait la crmonie et accompli d'adoration, qu'il s'occupe rang porte orientale porte (la relique) et on sort sa tte (5) et s'en va.
Le roi ses
dvotions
86 des affaires cent affaires voir tout de l'tat. par Les cet
FO
KOU
KL officiers de se livrer commen leurs
de mme
et les principaux grands acte d'adoration, avant tous
particulires. n'admet aucune
Il en est ainsi diffrence
les jours, et ce premier dede zle ou de relchement. Quand
le monde
a fini ses dvotions,
H y a des tours chapelle. les unes ouvertes, hautes choses prcieuses, les autres fermes, d'enil y a constamment, viron cinq pieds. Pour les remplir, chaque matin, de fleurs et de parfums de la chades marchands devant la porte pelle, et ceux
on rapporte l'os du crne dans la de dlivrance (6), ornes de toutes sortes de
faire leurs dvotions en achtent de toute qui veulent Les rois des pays voisins ont aussi coutume des d'envoyer espce. de faire les crmonies d'adoration en leur nom. charges personnes Le lieu occup est de quarante Quand par la chapelle pas en carr. le ciel s'abmerait et que au la terre s'entrouvrirait, cet espace n'en serait branl. point De ce lieu, en allant
nord,
la distance
d'un
la capitale du royaume de Na ki. C'est Phou sa acheta, avec de la monnaie d'argent, cinq fleurs, pour en Ting kouang Foe (7). Dans cette ville, il y a une faire hommage les mmes tour leve pour une dent de Fo (8). On y pratique crarrive monies que pour l'os du de la ville, Au nord-est de Fo y pratique d'une tte (9). On crne. un yeou yan, est, l'entre a aussi lev en cet endroit crmonies. il est long de bois, d'o Ce d'une une valle,
yeou y an, on l'endroit o jadis
le bton et l'on
mont environ. hommes
des pareillement de boeuf en santal; dans un tube
chapelle, bton est sur sept et mme toises mille
de six cent
On l'a plac ne pourraient dans
le retirer. et marchant
du ct de quatre journes du seng kia li (10) de Fo, o se font on trouve la chapelle l'occident, il y a une scheresse les crmonies d'adoration. dans le Quand royaume, dorer; les habitants le ciel alors vont tous ensemble pluies. tirer le seng kia li et l'aenvoie de grandes
En entrant
la valle,
NOTES Au midi fice en pierre C'est l'endroit dre dix de la ville adoss o
SUR de Na
LE k,
CHAPITRE un demi
XIII.
87
une Fo
montagne a laiss son c'est
il y a un diyeouyan, et tourn du ct du sud-ouest. (u). si Quand l'on avec on la consi-
ombre comme
vritable
pas de distance, de Fo lui-mme, et tout
de couleur
d'or,
le corps voyait ses beauts ca-
ractristiques, plus l'ombre
reprsentation la ralit. Les rois de tous les pays ont envoy des peintres pour la mais aucun n'a pu y russir. Les gens du pays ont une dessiner, tradition suivant mille Fo doivent finir par laisser leur laquelle ombre en cet endroit. A cent o il pas tait au avec environ monde, l'ouest de l'ombre, Fo, et les dans le temps et de
resplendissant s'affaiblit. C'est une
de lumire.
Plus
on approche, toute semblable
concert huit
ses
se coupa les cheveux il construisit une disciples,
toutes (12), pour servir de modle tirait par la suite. Elle subsiste encore prsent. A ct est un modans lequel sont environ Dans ce lieu nastre, sept cents religieux. est la tour (de des Lo han et personnages). des Py tchi foe (i3), o ont demeur mille ces saints
toises
ongles; tour haute de sept les tours que l'on b-
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XIII.
(1) L'espace de seize yeou yan.] La longueur du yeouyan ou yodjana de l'Inde est estime k kros, c'est--dire k \, 5 ou mme g milles anglais. L'usage que F hian a fait de cette mesure inconnue la Chine, montre qu'il a pris des Hindous les indications des distances. Par plusieurs de celles dont il fait mention, et qui se rapportent fort bien aux distances de nos cartes, on peut croire qu'il a rendu fidlement, cet gard, les indications des gographes ou des voyageurs de l'Inde au commencement du vc sicle. Cependant, la plupart de ses mesures, exprimes soit en li, soit en journes, soit mme en yodjanas, semblent un peu trop fortes, et quelques-unes mme sont exagres. Les sinuosits des routes et la variation de la mesure itinraire dans diffrentes provinces peuvent, jusqu' un certain point, rendre
88
FOE
KOUE
KL
raison d'une trop forte valuation. Dans quelques occasions, il a t tromp par des rapports fautifs et presque fabuleux; mais c'est quand il parle de distances qu'il n'a pas t en tat de vrifier, ou de pays qu'il n'a pas visits lui-mme, et les erreurs de cette espce sont pour nous sans importance. Nous croyons pouvoir adopter, comme terme moyen de la valeur du yodjana du Fo kou ki, le plus petit de ceux dont parle M. Wilson, c'est--dire celui de k milles \ anglais ou de quinze au degr ( i lieue --)> lequel s'applique avec exactitude aux points les plus clbres, et dont la synonymie sera plus tard reconnue incontestable. Je dois encore ajouter ici quelques observations littraires ou historiques. On crit le nom de cette mesure, en chinois, yeou yan, yeou siun ou yu chen na; ce du sanscrit yodjana, et on l'interprte par mesure, qui est une triple transcription terme ou station. Le Y sou" en attribue l'origine aux stations que les monarques de la roue [tchakravarti rdja) ont faites en visitant les diverses parties de leur empire. C'est, dit un auteur chinois, comme le relais de poste de ce pays-ci. Un autre crivain l'value ko li, du temps des Tsin h. Les traducteurs des livres bouddhiques en distinguent trois d'aprs le Ta tchi tou lunc : le grand yodjana de 80 li, qui sert mesurer les pays de plaine, o les montagnes et les rivires laissent un chemin facile; le yodjana moyen, de 60 li, quand les montagnes et les rivires opposent quelques difficults aux voyageurs; et le petit yodjana, valant ko li, pour les pays o les montagnes sont trs-escarpes et les rivires trs-profondes. On peut voir, pour la longueur du yodjana valu dans l'Inde, YAyin ahberii et M. Wilson 6; et pour l'valuation d'aprs les distances rapportes par F hian, ce qui en a t dit plus haut. On doit supposer que ce voyageur a recueilli les indications qu'il donne de la bouche des naturels, ou peut-tre de quelque ouvrage gographique indien qu'il aura eu sa disposition. Dans l'un et dans l'autre cas, on ne peut esprer d'atteindre qu'une dtermination une sorte de moyenne, satisapproximative, faisante seulement pour la gographie historique d'une contre presque entirement inconnue. On doit remarquer encore que F hian commence faire usage de cette mesure itinraire dans le pays de Na ki , aprs s'tre servi jusque-l du li chinois ou de la journe de voyage. Ce fait est du nombre de ceux qui attestent la prdominance de la langue et des coutumes de l'Hindoustan cette contre, du ct du nord et du nord-ouest. hors des limites actuelles de
(2) Du royaume de Na ki.] La position de ce pays est assez difficile dterminer, tant cause du peu de points de comparaison qui nous sont offerts par les gographes occidentaux pour cette partie de l'Asie, que parce que F hian et Hiouan thsang ne sont pas entirement d'accord sur la marche que chacun d'eux a Voyezce nom cit dans le San tsangJ sou, liv. XIII, p. 5. '' Youan kianloulian, liv. CCCXVI, p. 6. '' c Fan i, cit dans le Sontsang y Ja sou,ibid. a Trad. ming t. II, angl. p. 187,349. c Sanscrit h. voc. Dictionary,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XIII.
89
suivie pour y arriver. Le premier l'atteint en faisant seize yodjanas l'ouest du pays des Beloutches. Le second y vient par Caboul, aprs avoir travers une grande rivire, qui doit tre un des affluents de l'Indus, et marche ensuite l'est jusqu'au pays des Gandhras. On ne peut nanmoins s'loigner beaucoup de la vrit, en plaant le pays de Na ki l'orient de Ghazna et du Kandahar actuel. Mais pour ne parler ici que des noms, celui de Na Me, crit Na ki lo ho par Hiouan thsang, se trouve, dans la relation des deux voyageurs chinois, Soung yun et Hoe sang, appel Na kia lo ho. On lit dans le Siyu ki une lgende qui peut en expliquer l'origine. Au reste, le royaume de Na ki lo ho envoya un tribut la Chine en 628. C'tait alors une dpendance de celui de Kia pi che. La Chine eut, sous la dynastie des Thang, des rapports politiques avec le royaume de Na ki, qui doit consquemment avoir eu une certaine dure. On apprit alors qu'il n'tait pas soumis un seul roi, mais tait partag entre plusieurs tribus qui, chacune, avaient leur chef; c'est la condition la plus ordinaire de la population du Sind, du Bloutchistan et de l'Afghanistan. Le pays est raboteux, ingal, coup par des valles, entour de hautes montagnes. Cette description s'applique galement toutes les parties de cette contre. Enfin, cinq cents li vers le sud-est nous ramnent au pays de Gandhra. Ces indications, quoique vagues, nous reportent au centre de et la ville de Hi h doit aA^oirt situe aux confins de ce pays, du l'Afghanistan, ct de la Perse. Or, au vu 0 sicle, le Bouddhisme tait encore la religion des habitants, parmi lesquels on trouvait peu d'hrtiques. Cependant le nombre des solitaires y tait diminu, et beaucoup d'difices religieux tombaient en ruine. Chy kia, en sa qualit de Bodhisattwa, avait autrefois laiss des traces de son passage clans ce royaume. (3) La ville de Hi lo.] Cette ville n'tait pas la capitale du royaume de Na ki ; mais elle tait situe trente li au sud-est de cette capitale, et parat surtout avoir t remarquable par le grand nombre de reliques de Bouddha que l'on y conservait. [k) Toutes sortes d'ornements prcieux.] Plus littralement, sept choses prcieuses. Mais le plus souvent cette expression s'emploie dans un sens indtermin, dcfiniltim pro indefinito. On varie dans la dsignation des sept choses prcieuses : en voici deux, sries avec quelques dtails qui paraissent assez curieux. 1 Sou fa lo [souvarn'a), nom sanscrit de l'or. Suivant le Ta tchi tou lan, l'or se tire des montagnes, des pierres, d sable, du cuivre rouge. Il a quatre proprits : il ne change pas de couleur; l'homme il ne s'altre jamais ; rien ne l'empche de reprendre sa forme"; il rend opulent. i A lou pa [ropya), nom sanscrit de l'argent. Selon le mme or blanc. om-rage, l'argent se tire des pierres fondues; on l'appelle communment * Cesensest douteux.On lit ~j0fkjfit'f'p jpJL dans ^ctcxtc12
90
FO
KOU
KL
Il a les quatre proprits de l'or. 3 Lieou li, nom sanscrit d'une pierre bleue. Le Kouan king sou, ou l'Explication des livres des contemplations, l'appelle aussi fe lieou liye, ce qui signifie non loin; ce nom lui vient de ce qu'on la trouve dans une montagne des contres occidentales, laquelle n'est pas loigne de Bnars. [C'est sans doute le vadorya ou lapis lazuli. Pidora, qui signifie non loin, est le nom de la E. BURNOUF. La couleur bleue ou verte de montagne o l'on trouve cette pierre. ] cette prcieuse substance ne saurait tre dtruite par aucune autre matire. Son clat, sa duret, sont uniques dans le monde. k Pho li, autrement se pho ti Ma [sphat'ika, spath), est le nom sanscrit du chouyu ou cristal de roche a. Sa transparence et son clat sont uniques dans le monde. 5 Meou pho l ki lpho; ce mot sanscrit dsigne une substance prcieuse de couleur bleue et blanche. Sa forme est celle d'une roue avec un moyeu et des rayons (je pense que c'est une espce d'ammonite) ; sa duret et la beaut de ses teintes la font rechercher dans le monde. 6 Mo lo Ma li ou l'agate, pierre mle de teintes rouges et blanches comme le cerveau d'un cheval, d'o lui vient son nom (chinois) de ma nao [equi cerebrum). On peut la polir et en faire des vases, ce qui lui donne de la valeur. 70 Po ma lo kia [padmarga 1) ; ce mot sanscrit signifie gemme rouge (plus exactement couleur du nelombo). Le Fo ti lun (Discours sur la terre de Bouddha) dit que c'est un produit d'insectes rouges. Le Ta tchi tou lun dit que cette pierre sort du ventre d'un poisson et du cerveau d'un serpent. Sa couleur rouge est extrmement brillante et clatante; KL.] c'est ce qui la fait rechercher. [Padmarga en sanscrit est le rubis. La seconde srie se compose exclusivement de pierres prcieuses. i Po lo so (en sanscrit prabla, en bengali pal), le corail. Le Ta tchi tou lun l'appelle arbre de pierre marin. On dit que dans la mer du sud-ouest, sept ou huit lic, il y a une le de corail dont le fond est une pierre sur laquelle crot cette substance. On en dtache le corail avec des filets de fer. 2 A chy ma ki pho [as'magarbha?) ou succin. Il est de couleur rouge et transparent. 3 Ma ni ou Mo ni [man'i), mot qui signifie exempt de tache, et qui dsigne la perle. Cette substance est brillante et pure, exempte de taches et de souillures. C'est pourquoi le Yuan ki tchliao (Manuel des Pratyka Bouddhas) l'appelle aussi jou i [conforme au dsir, ci l'intention) ; les richesses que l'on dsire de possder, les vtements, la nourriture, toutes choses enfin qui sont on se les procure au moyen de cet objet prcieux, conformment ses ncessaires, dsirs, et c'est d'o vient ce nom. k Tchin chou Ma; ce nom sanscrit dsigne une pierre prcieuse de couleur rouge. Selon l'histoire des contres occidentales, il y a un arbre nomm tchin chou Ma dont les fleurs sont de couleur rouge et grandes comme la main. La substance laquelle on donne aussi ce nom est de la mme couleur que ces fleurs. [C'est le Mms'ouka ou butea frondosa.] 5 Chy kia pi lingkia. Ce mot sanscrit signifie vainqueur, qui surpasse, parce que cette substance l'emporte " Cf.Hist.de Khoian, c Cettedistance p. 169. parat fautive: il faut, je crois, b Mlanges asiatiques,t. II, p, 262. lire, septouhuitmilleli.
NOTES sur toutes
SUR
LE
CHAPITRE
XIII.
91
les autres pierres prcieuses du monde. 6 Mo lo kia tho [marakata, Le Ta tclii tou lun appelle ainsi une pierre prcieuse de couleur verte. meraude). Elle sort du bec de l'oiseau aux ailes d'or, et peut garantir de toutes sortes de poisons, y0 Pa tch lo [vadjra) ou le diamant. Cette substance nat dans l'or; sa couleur est semblable celle de l'amthyste. Elle est incorruptible et infusible, extrmement dure et tranchante, et on s'en sert pour tailler le jade. On peut voir sept autres objets prcieux numrs comme appartenant monarque de la terre, X, k(5) Porte [la relique) sa tte.] Cette phrase est obscure pourrait lui donner des sens diffrents. dans le texte, au
et l'on
*Jo|S$*E<4ll Thing tha signifie porter sa tte, et ce qui se porte sur la tte, le bouton du bonnet qui sert marquer les rangs, et ceux qui ont cette distinction. Tseu ti veut dire per ordinem. (6) Tours de dlivrance.] Le mot tour, en sanscrit sthopa, ne s'entend pas seulement des grands difices religieux, mais il s'applique encore, ainsi qu'on l'a dj vu, de petites constructions qui en sont comme le diminutif, ou le simulacre, dans des dimensions rduites. On en distingue de plusieurs sortes et on leur donne comme sthopa, ta pho (minence), feou thou [acervns), sou theou pho (prcieuse tour), teou seou pho; mais plusieurs de ces dnominations paraissent drives du mme radical sanscrit sthopa, et les interprtations varies Ces petites constructions sont faites en qu'on en donne semblent arbitraires. Il y en a un, pierres ou en briques, en forme de tour, sans couronnement. diffrents, deux, trois, tages, pour les S'rvakas ou auditeurs de Bouddha des quatre premiers rangs. Les pi phao tha sont consacres des reliques de Bouddha, antrieures son entre dans le Nirvana. Celles des Pratyka Bouddhas ont onze tages; celles de Bouddha en ont treize, pour montrer qu'il a dpass les douze nidnas ou conditions de l'existence relative ; mais on ne marque point d'tages celles que l'on lve des mendiants ordinaires, des hommes vertueux". Suivant le F houa wen kiu h, on n'lve pas de tours ou de sthopa sur la tombe des religieux et des laques, mais on y place de simples pierres, qui, par leur forme, reles cinq lments : l'ther, le vent, le feu, l'eau et la terre, et consquemment le corps humain qui en est form. On les nomme aussi sthopa par analogie. La figure jointe cette explication donne une ide de la forme assigne chaque lment. prsentent 1 Chychiyao lan, cit dans l'Encyclopdie japonaise, liv.XIX, p. 1/1. Citl mme. 12 . quatre des noms
92
FOE
KOUE
KL
Le plus bas ou la terre, est sur une plaque rectangulaire ; l'eau, immdiatement au-dessus', occupe un cercle; le feu, un triangle; le vent, un croissant; et l'ther, un cercle plus petit, termin en pointe. Au lieu des noms chinois, on inscrit aussi sur ces diffrentes parties du sthopa des lettres sanscrites qui sont l'abrviation du nom sanscrit de chaque lment : kha, l'ther; ka, le vent; ra, le feu; va, l'eau; a, la terre (?).En yjoignant une sixime syllabe, ma ou sa, pour la connaissance ou la pense, on a les noms des six lments et une formule dont l'efficacit est immense. On parle encore d'une espce de tour appele sthopa vue, et d'une formule qui a la vertu de garantir jamais des trois mauvaises voies (l'enfer, la condition de brute et celle de dmon) ; beaucoup de gens la vantent; mais cette formule ne se rencontre pas dans les textes sacrs ; c'est une invention des temps postrieurs et dont on ne connat pas l'origine. Les tours de dlivrance dont F hian parle en cet endroit, paraissent tre des autels creux, destins recevoir des offrandes de fleurs et de parfums. Le mot de dfinitif de l'me, dlivrance dsigne l'affranchissement originelle , en chinois Ma thou, en sanscrit moukti. son retour la perfection
(7) Ting kouang Fo. ] L'aventure laquelle il est fait allusion ici a t raconte en dtail (X, k). On voit que le pays de Thi ho 'we, o rgnait le pre de cet antique Bouddha, devait tre situ dans la Perse orientale; ainsi, tout en conservant, pour la vie relle de Shkya mouni, les traditions locales qui se rapportent l'Inde centrale et septentrionale, les Bouddhistes ne craignent pas de transporter la scne des actions mythologiques de leurs saints fabuleux hors des limites de l'Hindoustan, dans les contres qu'ils nomment Inde du nord, et o vraisemblablement leur religion n'a pntr qu' une poque rcente, comparativement celle de son origine. (8). Une dent de Fo.] On a dj vu la mention d'une relique de cette espce dans le (chap. V), et il s'en prsentera d'autres encore par la suite, notamment voyage Ceylan. Au reste, une observation qui sera faite dans la note suivante, et qui peut s'appliquer la dent dont il s'agit, permettrait de penser que ces restes un autre personnage que le Bouddha historique, Shkya prcieux appartenaient mouni, peut-tre au Ting kouang Fo dont il est parl dans la note 7. La dent dont il est ici question avait disparu lors du voyage de Hiouan thsang, deux cent vingtsept ans aprs F hian.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XIII.
93 ), un attribut estjt M lo; tchang, china
que font les anneaux dont il est garni; en mandchou on le nomme douldouri. Il y a un Livre du bton [Sy tchang king). On y lit que Bouddha dit son disciple Ks'yapa : L' tain est ce qu'il y a de plus lger (parmi les mtaux); le bton est la fois un appui et un prservatif contre les vices, l'aide duquel on sort de l'enceinte des trois mondes. Le bton de Ks'yapa Bouddha avait une tte deux ouvertures, o taient engags six anneaux. Celui de Shkya Bouddha avait quatre ouvertures et douze anneaux". Le douldouri moderne en a neufh. Ce qui est dit ici des proportions du bton de Fo, qui avait six ou sept toises chinoises (18 2 ira), s'il n'y a pas de faute en cet endroit du texte, qu'il s'agit, non du prouverait, bton de Shkya, mais de celui de quelqu'un de ces Bouddhas ns dans les temps o la vie des hommes tait prodigieusement longue et leur taille colossale. Par exemple, Ks'yapa naquit une poque o la vie des hommes tait de vingt mille ans, et sa stature tait de seize toises (/i8m8o); Vipas'yi, n dans un temps o les hommes vivaient quatre-vingt mille ans, tait haut de soixante yodjanas, et l'aurole qui entourait sa tte en avait cent vingt. C'est quelque gant de cette espce que pouvait avoir appartenu un bton de dix-huit vingt mtres. la de ou
(g) Le bton de Fo.] Le bton est, comme le pot [ chap. XII, note 8 Le nom sanscrit de cet ustensile oblig du mendiant bouddhiste. on l'appelle en chinois sy tchang (bton d'tain), tchi tchang, t de vertu, bton voix, cause du bruit tchang, bton de prudence,
(10) Du seng kia li de Fo.] Seng kia li, et plus exactement seng kia ti, est du sanscrit sanght'i. Les religieux bouddhistes ont trois sortes transcription vtements : i Le seng Ma li, ainsi nomm d'un mot sanscrit qui signifie runi doubl, parce qu'il est fait de pices coupes et runies ensemble. Le I tching f dit que le mot sanscrit seng kia ti dsigne un habit doubl; mais le Siuan li
assure que les noms des trois sortes de vtements des religieux ne sauraient traduits trs-exactement; que le grand vtement s'appelle tsa sou i (habit de pices cause de la multitude de morceaux dont il se compose. Quant son mlanges), usage, on l'appelle habit pour entrer dans le palais des rois ou habit de place publique, parce que l'on s'en sert pour aller prcher la loi dans les palais, aussi bien que pour aller mendier dans les carrefours. Le Sa pho to lun distingue trois sortes de grand habit : l'infrieur, qui est neuf, onze ou treize pices; le moyen, qui a quinze, dix-sept ou dix-neuf pices; etle suprieur, qui en a vingt et une, vingt-trois ou vingtcinq. 20 Y to lo seng [outtarasanght'i) ; ce. mot sanscrit signifie habit de dessus, surtout : il est sept pices. Le Siuan li sse appelle habit du moyen ordre, le vtement
sse sse tre
de sept pices; et, d'aprs son usage, il le nomme habit pour aller dans l'assemble. C'est celui qu'on met pour les crmonies, les prires, les ftes et la prdication. " Chychiyao lan, cit dans l'Encyclopdie japonaise, liv. XIX, p. 9 v. Voyezen cet endroit la figuredu b bton dont il s'agit. Thsing wenkian, liv. XIX, p. 5.
9k
FOE
KOUE
KL
3 An tho hoe; ce mot sanscrit dsigne un vtement intrieur qu'on met pour dormir et qui touche au corps. Le mme ouvrage l'appelle habit de dessous, en disant qu'il est form de cinq pices; et sous le rapport de son usage, il le dfinit comme un vtement form de diverses pices, servant, dans l'intrieur de la maison, ceux qui pratiquent la loi [yuan ne hing tao tsa tso i "). [Ce vtement se nomme en sanscrit antaravsaka. ] a pareillement t vue (11) Son ombre. ] Cette relique, d'un genre particulier, Hiouan thsang. Comme on n'en saurait rvoquer en doute l'existence, on l'attribuer quelque effet de catoptrique, adroitement mnag pour tromper dont il est parl ici sont plerins superstitieux. Les beauts caractristiques par doit les les
lakchana du corps visible et transfigur de Bouddha \ Hiouan thsang trente-deux raconte c quelle occasion Tathgata a laiss son ombre en cet endroit, et confirme la prdiction qui annonce que tous les Chi tsun [ Lokadjyecht'ha, illustres du sicle , Bouddhas) del priode des sages ou de la priode actuelle, doivent imiter cet gard l'exemple de Shkya mouni. (i 2) Sept huit toises. ] 2 im 35 ou ikm ko. Des Lo han et des Py tchi fo.]On adj vu (chap.VI, notei) que Lo han, ou plus exactement A h han, tait la transcription 'Arhn, et que ce terme sanscrit dsignait l'un des degrs suprieurs dans l'chelle des saints ou intelligences puriau-dessous est celui des Py tchi fo ou Py tchi fies. Le degr qui est immdiatement (i3) ou jTli intelligence simple ou est interprt par '^jfJL complte, et reprsente le nom sanscrit de Pratyka Bouddha d, ou Bouddha spar, Bouddha distinct. Sans entrer dans les distinctions presque infinies que les Bouddhistes tablissent entre les diffrents degrs de perfection auxquels on peut parvenir par la contemplation et la pratique des vertus, je transcrirai ici un passage Ma lo, dont le nom d'un livre sacr qui fera connatre la place qu'occupent les Pratyka Bouddhas dans la hirarchie des saints bouddhistes. On appelle les cinq fruits, les fruits que tmoignent les Siu thowan, les Sse tho han, les A na han, les A lo han et les Py tchi fo, pour dire que ces cinq classes d'hommes, en traversant les sicles, n'attendent pas d'avoir totalement supprim les imper<(fections morales, pour retourner leur me vers la grande purification, et cueillir les fruits de (l'arbre) bodhi ou de la raison. i Le premier fruit est celui de l'me dont le retour dure quatre-vingt mille Kal pas ; ce sont les Siu tho wan [Srotpanna) qui l'obtiennent. Leur nom signifie qu'ils ' Fan y mingi, cit dans le San isanqf sou, liv.XIII, pag. 12verso. '' Voc. sect.III.Ml.asiat.t. I, p. 168. pentagl. Voyezci-aprs, Relation du pays de Na ki loho. Asiat. tom. XVI,pag.445. Besearches, Comparez c
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XIII.
95
sont parvenus en coulant, c'est--dire qu'ils sont sortis de l'coulement gnral ( des tres du monde) et parvenus l'coulement des saints. Ils ont coup les trois noeuds (qui rattachent le corps aux trois mondes), franchi les trois assujettissements ( ou la condition d'Asoura, de brute et de damn); et, aprs tre ns sept fois parmi les hommes ou parmi les dieux, dlivrs de toute douleur, ils entrent dans le nirvana o ils obtiennent le bodhi du premier ordre au-dessus duquel il n'y a rien. 2 Le second fruit est celui de l'me dont le retour dure soixante mille Kalpas. Il est obtenu par les Sse tho han [Sakridgm). Leur nom signifie une alle et venue, parce qu'aprs tre ns une fois parmi les hommes et une fois parmi les dieux, ils obtiennent le nirvana qui rend parfait. Ils ont supprim six classes d'erreurs atta ches l'action des sens et aux dsirs qui en naissent; et aprs tre rens une fois parmi les dieux ou parmi les hommes, ils sont dlivrs de toute douleur et passent soixante mille Kalpas dans le nirvana, pour obtenir ensuite le suprme bodhi. 3 Le troisime fruit est celui de l'me dont le retour dure quarante mille Kal pas. Il appartient aux A na han [Angmih), personnages dont le nom signifie qu'ils ne viennent plus, c'est--dire qu'ils ne renaissent pas dans le monde des dsirs. Ils sont affranchis des cinq liens infrieurs, et de qu'aprs quarante mille Kalpas, ils obtiennent le 4 Le quatrime fruit est celui de l'me dont le Il est le partage des Arhn, qui, ayant supprim qui naissent dans les trois mondes, des dsirs, l'ignorance, obtiennent, aprs vingt mille Kalpas, 5 Le cinquime fruit est celui de l'me dont le appartient aux Py tchi fo [Pratyka Bouddha), qui la ncessit de renatre, de sorte suprme bodhi. retour dure vingt mille Kalpas. pour toujours les imperfections de la colre, del haine et de le bodhi suprme.
retour dure dix mille Kalpas. 1! obtiennent, aprs dix mille Kai pas, le bodhi suprme qu'ils ont mrit en supprimant les imperfections qui rsul tent des dsirs des trois mondes, de la colre, de la haine et de l'ignorance ". Il n'y a, comme on voit, aucune diffrence exprime entre les mrites acquis par les Pratyka Bouddhas et les Arhn. Un autre passage du mme livre 1 place les Pratyka Bouddhas dans une situation intermdiaire entre les S'rvakas et les Bodhisattwas, par rapport aux progrs qu'ils ont faits dans la science qui consiste contempler la succession non interrompue des douze nidnas ou conditions de l'existence individuelle 0, reconnatre leur enchanement continu, et par consquent la non-ralit de ce qu'on appelle naissance et mort, dtruire les erreurs qui proviennent de la vue et de la pense, et remonter la vritable condition des choses qui est le vide (l'immatrialit). trouvera ci-aprs des explications plus tendues sur les Pratyka Bouddhas 11. " Livresacrdu Nirvn'a (Niphanking ), citdans le Santsang J sou, liv. XXII, pag. 3 verso. Citdansie Santsang Ja sou,liv. XI, pag. sect.XXII.OE'Alphab. Vocabulairepentaglotte, On
Tibet, pag. 4gg.Transact. ojtheroyalasialic Society, tom. I, pag. 562. Observations sur quelques points del doctrine samanenne, pag. 54. '' Comparez ci-aprs,cliap.XVIJ.
CHAPITRE
XIV.
Petites Montagnes de neige. Royaume de Lo i. Royaume Fleuve Sin theou.
de Po na.
A la seconde au midi montagnes cessif, tant hors II dit tant expira. pleura, contraire cueillit des
lune
de l'hiver
(i), F hian
et trois
autres
de neige (2). La neige petites Montagnes l't comme Du ct du nord, l'hiver. est cause
passrent s'amasse sur ces le froid y est exeut pour-
et sa violence que Hoe king d'tat d'avancer. F hian : il ne
qu'on est prescrite transi. Il n'y la rigueur et qui se vit qui ne put en supporter Il lui sortait de la bouche une cume blanche.
: II est impossible Partez l'insque j'en revienne. faut pas que nous mourions tous ici. Et l-dessus, il lui avait adress toutes que dans leur sortes projet de consolations; commun il le se trouvt
F hian et
vivement regretta la destine : mais, parvint
ses forces,
au midi
l'impuissance de la chane
il red'y remdier, (3) et arriva dans le
de Lo 1 (4). royaume Il y a dans ce pays
la grande qu' pour y sjourner; et quand ce sjour fut termin, on descendit au midi, et en dix jours de marche on atteignit le royaume de Po na (6). Dans ce royaume, il y a aussi trois mille religieux tous environ, la petite translation (7). De l, en allant l'orient appartenant pendant trois les deux journes, rives sont on passa de nouveau un pays plat et uni. le fleuve Sin theou (8), dont
prs de trois mille religieux, la petite translation (5). On s'arrta
appartenant
tant
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XIV.
(i) La seconde lune de l'hiver.] Si cette poque est marque d'aprs le calendrier chinois, le printemps commenant la nouvelle lune la plus voisine du jour o le soleil entre dans le i 5e degr du Verseau, la deuxime lune de l'hiver avait commenc deux mois auparavant, c'est--dire vers le 5 dcembre, sauf rduction. Il est assez singulier que les plerins aient entrepris clans une telle saison un voyage travers des montagnes couvertes de neiges perptuelles, et l'on n'a pas lieu de s'tonner de l'accident survenu l'un d'entre eux.
(2) Les petites Montagnes de neige.] Ces montagnes ne peuvent tre que les rameaux qui portent actuellement le nom de Souleiman kouh, dans l'Afghanistan. La de petites Montagnes de neige doit avoir eu quelque rapport avec dnomination celle 'Himalaya, attendu l'usage de la langue sanscrite, alors tabli dans ces contres. On la trouve frquemment reproduite dans la relation de Hiouan tsang. dans le canton de Gundava, o les (3) Au midi de la chane.] Vraisemblablement montagnes laissent, jusqu' l'Indus, un espace libre que doivent avoir occup les petits tats de Lo i. et de Po na, et que F hian traversa en treize journes. [k) Le royaume de Lo i.] Pays totalement inconnu d'ailleurs. F hian ne rapporte aucune circonstance qui permette de restituer cette dnomination gographique. (5) La grande et la petite translation.] Voyez chap. II, note k. que pour celui de Lo i, ci-dessus,
(6) Le royaume de Po na.] Mme observation note k-
(7) La petite translation.] Voyez chap. Il, note k(8) Le fleuve Sin theou.] Voyez par F hian, que les deux rives du s'agit du bas ou du moyen Indus. voyageurs vers Bluikor. La suite supposition. chap. VII, note 2. La circonstance remarque fleuve taient un pays plat et uni, montre qu'il On a vu que ce fleuve dut tre pass par les de leur itinraire va bientt confirmer celle
CHAPITRE
XV.
Royaume
de Pi tchha.
Quand
on a travers
le fleuve,
la loi de Fo
y est en honneur la grande que dans celui de la petite touch de voir arriver des voyageurs nous terre tint ce discours : Comment connatre peuvent-ils et comment viennent-ils donnrent formment tout ce qui
il y a un royaume et florissante, tant translation.
nomm dans
Pi tchha (i) ;
le systme de On fut extrmement de Thsin, extrmits et on de la
(2) de la terre hommes des
des
la vie religieuse au loin chercher tait ncessaire,
et la pratique de la raison, la loi de Fo? Ils nous et nous traitrent con-
nous
aux rgles
de la loi.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XV.
(1) Un royaume nomm Pi tchha.] On pourrait lire Pi thou; mais je crois devoir substituer A^. Tchha A^. Thou. Au reste, on peut aussi lire thsa, et l'on aurait alors une transcription peu altre du nom qu'il est naturel de chercher en cet endroit, soit qu'on le suppose employ ds lors sous sa forme persane dans quelque dialecte de ces contres [Pendj-b), soit qu'on le prenne sous celle qu'il a en sanscrit [Pantchla). La position du pays ne permet gure de douter que ce ne soit le nom que F hian avait recueilli, et toute discussion parat superflue ce sujet. [ Si F hian et ses compagnons ont pass l'Indus Bhukor ou Poukor, ils ne sont pas entrs dans le Pendj-b, car ce pays est beaucoup plus au nord. Il a reu son nom des cinq grandes rivires Behat ou Djylam, Tchinb, Ravi, Beyah et Setledj qui le traversent, se runissent et se jettent dans l'Indus, plus de cinquante lieues au-dessus de Bhuker. F hian entrait donc dans le Sind plutt que dans le Pendj-b.KL.] (2) Des voyageurs.] Il y a dans le texte /AV M" des hommes en chemin. Cette expression signifie ici voyageurs, et non pas prtres de Tao, comme au chap. IV, note 1.
CHAPITRE
XVI.
Royaume
de Mo theou lo. Rivire de Pou na.
De l on y an (i). lesquels dizaines On
alla
au S. E., devant des
et l'on un
fit au
moins nombre
passa vivaient
de mille
religieux (2). Aprs avoir
trs-grand dont on pass
quatre-vingts de temples,
yeou dans
pouvait compter plusieurs tous ces endroits, on vint un
se nomme ; ce royaume Mo theou lo (3). On suivit aussi la royaume rivire Pou na (4). A droite et gauche de cette rivire, il y a vingt contenir trois mille religieux. La loi de seng kia lan (5), qui peuvent Fo recommence tre en honneur (6). Ds qu'on a laiss les sables l'occident, (7) et la rivire tous les rois des diffrents de l'Inde sont fermement attachs la royaumes loi de Fo; et lorsqu'ils de leur tiare officiers, leur leur ont rendent (8). Eux prsentent aux religieux, ils se dhommage et les princes de leur famille, ainsi les aliments de leur propre main.
pouillent que leurs Quand
ils tendent un tapis par terre, et prsents, vont se placer en face sur un sige. En prsence des religieux, ils n'oseraient s'asseoir sur un lit. Cette coutume, que les rois observent leur respect, a commenc du temps o Fo tait dans pour tmoigner le monde, et elle s'est continue (9). depuis jusqu' prsent Le pays qui est au midi de celui-ci se nomme royaume du Milieu (10). Dans le royaume l'un par temprs du Milieu, le froid et le chaud sont modrs et ni neige. Le peuple vit ni registres dans l'abondance de population (11), ni magistrats, ni lois. II n'y a que ceux qui cultivent les terres du roi qui en recueillent les fruits. Quand on veut s'en aller, on s'en va; quand on veut rester, on reste. Pour gouverner, les rois l'autre n'emploient pas l'appareil des supplices. Si quelqu'un se rend i3. cou; il n'y a ni bruine et la joie. On ne connat
ils les
100 il est seulement pable, la lgret ou la gravit commet un malfaiteur droite, qui sans
FO
KOU
KL et on suit en cela
l'assistent, Les pas
un que par rcidive lui couper la main on se borne crime, du roi, et ceux Les ministres lui rien faire de plus. droite et gauche, ont tous des moluments et des habitants de ce pays et ne mangent ne tuent aucun tre vivant; ils ne pas d'ail ni d'oignons tchha lo (i3) : le nom de Tchen (12). Il ne
dans son argent, frapp de sa faute. Alors mme
pensions. boivent faut
de vin,
tchha lo dexcepter que les Tchen de celles des autres signe des hassables. Ils ont des demeures spares ils entrent dans une ville ou dans une place de marhommes. Quand ch , ils frappent sur ce signe, les autres contact. Dans un morceau habitants les de bois vitent : pour se faire reconnatre et se garantissent de leur
ce pays on ne nourrit pas de porcs ni de coqs. On ne Il n'y a, dans les marchs, ni boucheries, vend pas d'animaux vivants. ni boutiques de marchands de vin. Pour les changes, on se sert de la (i4). Il n'y a que les seuls Tchen tchha lo qui aillent coquilles et qui vendent de la viande. le pan ni houan (i5) de Fo, les rois, les grands, les chefs Depuis en faveur de famille ont lev des chapelles des religieux; ils leur ont fourni des provisions et fait donation de champs et de maisons, de et de vergers, avec les fermiers et les bestiaux jardins pour les culchasse tiver. des L'acte de ces donations vinrent Cet ensuite usage s'est tait ne trac sur le fer (16), et aucun d'y prsent ce pays porter sans ont la audes se serait
princes qui atteinte. moindre cune
permis
perptu
Les religieux interruption. qui maisons pour y loger, des lits et des matelas et manger, des vtements, boire enfin tout saire sans
jusqu' vivent dans
de quoi pour coucher, ce qui leur est nces-
religieux de vertu.
rien ; il en est de mme en tous lieux. Les qu'il y manque font leur occupation constante de bonnes oeuvres et d'actes Ils s'appliquent aussi la lecture des livres sacrs et la Quand au-devant les arrivrent, religieux trangers et les conduisirent, d'eux, portant les tour an
contemplation. ciens vinrent
CHAPITRE tour leurs habits
XVI. de une l'eau
101 pour collation ils
et leur pot (17). Ils leur apportrent se laver les pieds, de l'huile les oindre, et pour extraordinaire (18). Aprs que ceux-ci se furent reposs s'informrent pratiquer; fit reposer saire, du nombre et de l'ordre des sacrifices et quand ils se furent rendus de tout aprs les avoir pourvus conformment la rgle.
un instant, qu'ils
avaient on les
l'habitation, ce qui leur tait
nces-
o les religieux s'arrtrent sont la tour de Che lij'oe (19), les tours de Mou lian (20) et 'A nan (21), ainsi que les tours de YA pi than (22), des Prceptes sacrs (24). Aprs qu'ils y (23) et des Livres un mois, tous les gens qui eurent got le repos pendant esprent le bonheur firent rent une une (25) les exhortrent collation grande termine, sortes reprendre leurs exercices Ils pieux. extraordinaire tous les religieux tin(26) ; ensuite o l'on discourut la tour sur la loi (27). Cette li fo, faire conde Che offrande allu(28).
Les lieux
assemble
frence de toutes mes
on alla dans
: ensuite tait
Che li foe embrasser du grand hommages Yhonorable
de parfums, et la nuit entire on tint des lampes on fit faire la mme chose par d'autres personnes (29) de Fo qui vint auprs jadis un Brahmane du grand pour la plupart
la vie religieuse. Il en est de mme Kia che. Les Pi khieou ni (3o) adressent la tour 'A nan, parce aux
pour Mou lian et leurs
que ce fut A nan qui pria femmes la permission d'emdu sicle (3i) d'accorder brasser la vie religieuse (32). Il y a aussi un ordre dans lequel les Cha mi (33) remplissent Ceux qui ont un matre leurs devoirs religieux. d'A pi than, rendent leurs hommages matre en fait de prceptes, honorent il y a un service de ce genre, au Ma ho y an (34) rendent hommage Wen tchu sse li (36), Kouan l'A pi than ; ceux qui ont un les prceptes. anne, Chaque d'eux a son jour. Les dvots et chacun au Phan jo pho lo mi (35),
chi in (37), etc.
Les religieux de faire la les prsents reurent qu'il est d'usage fin de l'anne (38). Les anciens, en charge, les Brahmanes les hommes et aiii32es4eiir donnrent et d'autres des habits de diffrentes espces,
102 objets mne des qui aux sont ncessaires
FO.KOU aux
KL et ct, que qu'on firent la sainte depuis en venant offre en au-
Samanens,
Les religieux, de leur religieux. aumnes. Les rites et les crmonies ainsi succd sans
pareillement (3g) troupe le ni houan
se sont pratique, de Fo (4o). Aprs mridionale, mille qu'on
interruption
a pass
le fleuve
Sin
theou,
vers
l'Inde
la mer du Midi, et jusqu' li (4i) : ce sont partout des plaines fleuves, mais
il y a quarante ou cinquante o l'on ne voit ni grandes des rivires et des
ni grands montagnes, courants d'eau.
seulement
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVL
( i ) Quatre-vingts yeou y an. ] Du point o nos voyageurs ont pass l'Indus, jusqu' Matoura, on compte environ huit degrs d'un grand cercle. Cette indication donnerait environ dix yodjanas par degr. (2) Plusieurs dizaines de mille.] Comme F hian n'entre dans aucun dtail au sujet de ces religieux, et qu'il ne parat pas s'tre arrt pour visiter leurs monastres, on peut en infrer qu'ils n'appartenaient pas la religion samanenne, mais qu'ils taient vraisemblablement attachs au culte brahmanique; sans cela, on s'expliquerait difficilement comment ces plerins, qui parcouraient l'Inde pour visiter les temples o ils pouvaient apprendre quelques particularits relatives leur croyance, et qui, dans d'autres parties de leur voyage, dcrivent presque topographiquement les points o se prsentaient des objets propres fixer leur pieuse attention, n'en auraient rencontr aucun dans cet espace, et auraient franchi tout d'un coup une distance de cent vingt lieues. Cette observation sera confirme dans la note 6. (3) Mo theou lo,] et dans la relation de Hiouan thsang, Mo thou lo, est la transcription la plus exacte qui se puisse du nom de Mathour. [C'est encore une ville de la province d'Agra, situe par 270 3 1' lat. N. et 75 12' 4,5" long. E. de Paris, sur la rive droite du Djamnah. Elle est clbre parmi les Hindous, comme ville natale et premier sjour de Krichn'a; et pour cette raison, c'est un lieu o ils se rendent frquemment en plerinage. KL.] [k) La rivire Pou na.] Ce nom est fort altr; mais la position ne permet pas de
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
105
mconnatre la rivire Djamn ou Yamoun, sur la rive droite de laquelle est situe la ville de Mathour. [Le nom de Pou na est vraisemblablement le mot sanscrit Poun'ya, qui signifie pur, saint. KL.] (5) Seng Ma lan.] Voyez ci-dessus, chap. III, note 5.
Cette (6) Recommence tre en honneur.] H y a dans le texte Jg^ll-tyilwla plus naturelle semble cellephrase serait susceptible de plusieurs interprtations; ci : la loi de Fo refleurit; mais on peut encore l'entendre en deux sens assez diffsoit au temps, soit l'espace. On rents, en appliquant l'ide de renouvellement, peut supposer qu'aprs avoir t perscute ou nglige, la religion de Bouddha commenait, l'poque du voyage de F hian, trouver un plus grand nombre de partisans; ou bien, qu'aprs avoir parcouru des pays o le bouddhisme tait dominant, puis travers d'autres contres o le brahmanisme l'avait emport sur le culte des Samanens, le voyageur trouva de nouveau celui-ci en faveur dans le pays de Mathour, o nous le voyons parvenu. Cette dernire explication me parat la plus probable ; car F hian dit expressment que la pratique des crmonies du bouddhisme et les avantages assurs ses sectateurs n'avaient point t interrompus depuis le Pari nirvana de Shkya mouni. On a vu ci-dessus (note 2 ), qu'en effet la rgion qu'il avait parcourue aprs avoir travers l'Indus, devait avoir t habite par des Hindous attachs la secte des Brahmanes, puisque le voyageur, qui cherchait partout des objets intressants pour sa religion, n'y avait trouv matire aucune observation, et qu'il avait pass rapidement et en quelques mots sur un espace de quatre-vingts yodjanas. (7) Les sables.] Le grand dsert sal, l'est de l'Indus, et qu'il faut traverser quand on vient des bords de ce fleuve et qu'on se rend directement dans le centre de l'Inde. bonnet cleste ou divin. C'est l'orne(8) Leur tiare.] Il y a dans le texte TJ^J^ ment de la tte d'un roi, une tiare, un diadme, une couronne. il fait voir qu'au cinquime (9) Jusqu' prsent. ] Ce passage est trs-remarquable; sicle, le bouddhisme n'avait encore, dans l'Inde centrale, rien perdu de sa suet qu'il en avait joui sans interruption depuis priorit sur le culte brahmanique, le temps de Shkya mouni, c'est--dire, depuis le dixime sicle avant J. C, selon le calcul chinois. Les voyageurs postrieurs, quoique anims du mme esprit que F hian, avouent au contraire que la religion samanenne laissait voir, en plusieurs endroits, des signes de dcadence. Des temples tombaient en ruine, des reliques clbres avaient disparu, le nombre des religieux diminuait dans plusieurs
104
FOE
KOUE
KL
et ceux qui restaient vivaient mls avec les hrtiques ou Brahmanes. monastres, dans l'Inde reoit un grand jour de la comparaison de L'histoire du bouddhisme ces divers passages, qui fixent des points trs-importants de chronologie religieuse. (10) Le royaume du Milieu.] Nous avons dj rencontr t releve. Voyez chap. VIII, note 3. cette expression, qui a
(11) Registres de population.] Ces registres sont ceux qui servent en Chine fixer le rle des contribuables ; c'est pourquoi l'auteur compte, au nombre des avantages dont jouissent les Hindous, de ne pas tre soumis aux conditions du recensement. (12) D'ail ni d'oignons.] Le vin, l'ail et les oignons sont du nombre des choses dont le Bouddhiste doit s'abstenir d'aprs le cinquime prcepte. Les cinq prceptes sont": i Ne pas tuer les tres vivants. 20 Ne pas commettre de larcin. 3 Ne pas commettre d'adultre. 4 Ne pas mentir. 5 Ne pas boire de vin. Ces cinq prceptes sont en rapport avec cinq vertus correspondantes: l'humanit, la prudence, la justice, la sincrit, et l'urbanit b. On en ajoute trois, qui, joints ces cinq, comptent au nombre des huit prceptes. 6 Ne pas s'asseoir sur un grand lit ou sige large et lev. 70 Ne pas porter de fleurs et de rubans sur ses habits. 8 Ne point se livrer aux chansons, aux danses, aux comdies c. Les deux suivants sont encore noncs comme compltant le nombre de dix. 90 Ne pas porter ses mains d'ornements prcieux d'or et d'argent. 1o Ne pas manger au del de midi. Tels sont les dix prceptes que les aspirants la qualit de Samanen doivent les dix prceptes des religieux ^wL~T"-^i autre calcul qui en porte le nombre deux cent cinquante, appels qu'ils suffisent au plein et entier exercice de la vie religieuse. On la manire suivante : extrme mchancet). i Rgles contre le Pho lo i (corruption, observer. On les nomme f|i d- H- Y a un
suffisants, parce les distribue de
Quatre articles. 20 Rgles contre le Seng kia pho chi cha; ce mot sanscrit signifie ruine du Sang a, parce que celui qui enfreint ces prceptes, est comme s'il avait t assassin par ' Cf. A Diclionary oj the BurmanLanguage,by A.Judson. Calcutta, 1826, pag. 388. '' Jin wangkingsou, cit dans le Santsangf sou, liv. XXIIT,pag. 7 v. pho cha lun, cit dans le San tsang J sou, liv. VII, pag. 16. d Thianthassekiaossei tchu, citdansle San tsy tsangJ sou, liv.-VII, pag. i5 v. c Pi
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
105
un autre; son corps vit mais il n'en est pas moins perdu. Treize artoujours, ticles. 3 Rgles indtermines, deux articles. Les infractions ces articles se mesurent ou d'aprs le Pho lo i, ou d'aprs le Seng kia pho chi cha, ou d'aprs le Pho y thi (voyez ci-dessous) ; c'est ce qui fait nommer ces rgles indtermines. k" Rgles relatives au Ni sa khi et au Pho y thi, trente articles. Le mot sanscrit ni sa khi signifie abandonner; ce terme s'applique l'amour des richesses et la ngligence, qui font renoncer entrer dans le corps des Sangas. Celui de pho y thi veut dire tomber, et exprime que si l'on n'abandonne pas, on tombe dans l'enfer. 5 Rgles relatives au Pho y thi, quatre-vingt-dix articles; et 6 rgles relatives au Pho lo thi thi che ni, quatre articles. Le mot de Pho y thi vient d'tre expliqu; celui de Pho lo thi thi che ni signifie, littralement, se repentir vis--vis de quelqu'un. Selon le Seng khi li, les fautes dont il s'agit doivent tre dclares l'assemble; de l vient cette dnomination. 70 Rgles qui prescrivent aux mendiants d'tudier. Cent articles. 8 Rgles pour touffer les contestations. Sept articles. Ces deux cent cinquante prceptes sont imposs aux religieux et aux mendiants, qui doivent les observer 3. (i3) Les Tchen tchha lo.] On reconnat aisment les Tchan'dcils, nom dont la seconde syllabe est altre par la substitution d'une palatale une dentale, ce qui, comme on l'a dj observ, a lieu frquemment dans la transcription des mots sanscrits en caractres chinois. Les Bouddhistes semblent partager le mpris des Brahmanes pour les Tchan'dcils, les derniers des mortels, comme les appelle Menou h. M. Wilson explique ce mot, comme le texte du Fokou M, par hassablec. Les Chinois prtendent qu'il signifie boucher et aussi soevumsignum, parce que ces individus, qui s'avilissent par la pratique de la profession de boucher et d'autres mauvaises actions, sont tenus, quand ils marchent, d'agiter une clochette ou de tenir comme signe un morceau de bambou , pour qu'on puisse les reconnatre pour ce qu'ils sont. Il y a cinq sortes de personnes auprs desquelles les religieux doivent prendre garde de ne pas aller demander l'aumne. i Les chanteurs et comdiens, qui ne songent qu' badiner et se rjouir et qui troublent la contemplation. i Les femmes de mauvaise vie, qui ont une conduite impure et une mauvaise rputation, qui sont dvoues au libertinage et qui ferment la bonne voie. 3 Les marchands de vin, parce que le vin fait natre tous les vices, tous les excs, tous les crimes. 4 Les rois, parce que leur palais est rempli de courtisans et d'officiers qui en interdisent l'entre et qu'il faut se garder d'offenser. 5 Enfin les Tchen tho lo ou Tchen tchha lo (Tchan'dals), * Thiantha sse kiaoi tsy tchu, cit dans le San tsang J sou, liv. VII, pag. i 5 v. ComparezEssai surlepli, pag. 201. X, 11 12, 16; dit. de Haughton, tom. II, pag. 3/ia. "' Sanscr. h. v. Dictionaiy, l k Manava dharmashastra,ch.
106 c'est--dire
FOE
KOUE
KL
les bouchers, qui se plaisent tuer et tourmenter les tres vivants, et dtruisent la vertu et les bonnes inclinations". [On qui, dtruisant la sensibilit, sait que les Tclian'dls passent pour descendre du mlange des Sodras avec des femmes de la caste des Brahmes. KL. ] (i k) De coquilles.] [M. Rmusat en note : Je traduis conformment avait traduit de coquilles et de dents, et il ajoute la correction du Pian i tian. Le texte du Fo
kou M porte j^ @ , ce qui n'a pas de sens. Les coquilles dont il s'agit ici sont les cmvries [cyproea moneta), qui servent de monnaie courante dans l'Inde. Cependant il n'y a pas de diffrence entre le texte du Pian i tian et celui du Fo kou ki; tous les deux portent : c'est--dire n. n m f-
: pour faire le commerce, ils se servent aussi de coquilles. Le terme |S} l Pe tchhi, est consacr pour dsigner les petites coquilles ou cowries dont on se sert en place de monnaie. La grande Encyclopdie japonaise donne pour raison de cette dnomination, que la cyproea moneta porte des empreintes & k* M
denteles,
qui ressemblent
aux dents des poissons b. KL.]
(i 5) Le pan ni liouan de Fo.] On a dj vu (chap. XII, note 3 ) l'explication de cette expression. Au reste, ce passage, ainsi que le prcdent (voyez note g), fait voir que, selon les traditions recueillies par F hian, le bouddhisme n'avait pas encore prouv , dans l'Inde centrale, les effets de la rivalit des Brahmanes, quatorze sicles aprs son institution. (16) Trac sur le fer.] Les actes portant donation de terres [Grantha) des sont la matire la plus ordinaire des inscriptions temples bouddhiques, qu'on a releves dans l'Inde. Telles sont en particulier celles qui ont t traduites par M. Wilkins \ celle que M. Burnouf a fait connatred, et beaucoup de celles qui font partie de la collection du colonel Mackensie. Ces donations taient graves sur des plaques de cuivre ou d'autre mtal. (i 7) Leurs habits et leur pot, ] c'est--dire Hianyangchingkiaolun, cit dansle San tsang f sou,liv. XXII, pag. u. h [Penthsaokangmou,lom. XLVI, pag. 20v. Yuankian lo ni han, sect. CCCLXIV, pag. 23. La ' leur bagage. Voyez chap. XII, note 8. grande Encyclopdie japonaise, tom. XLVII, p. 12. Nouv. Journalasiat.tom. XIII, pag. 154-i ] c Asiat. Pies.trad.fr. tom. I, pag. 62. d Journal asiatique,tom. VIII, pag. 110.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
107
(i8) Une collation extraordinaire.] Il y a dans le texte %& Vff";jfe., littralement du bouillon contre-temps. Ce qu'on appelle temps en fait de repas, s'entend ainsi chez les religieux bouddhistes. Le temps des dieux, c'est le grand matin, qui est le moment o les dieux prennent leur repas. Le temps de la loi, c'est midi, qui est l'heure choisie parles Bouddhas passs, prsents et venir pour leur rfection. Le temps des brutes est le soir o les animaux mangent. Le temps des gnies est la nuit, pendant laquelle mangent les bons et les mauvais espritsa. Ainsi, tout repas pris aprs midi est contre-temps pour les religieux, et ceux qui observent rigoureusement les prceptes s'en abstiennent. Ceux qui sont malades ne tiennent pas compte de ces distinctions, et mangent quand il leur plat 11.Le djeuner s'appelle chez les religieux Tcha, abstinence, et le souper Fe chi, Bouddha contre-temps. a recommand tous ses disciples d'observer le temps Kia lo, c'est--dire vritable , et de fuir le San mo ye ou faux ( Fe chi )c. Quant Tsiang, ce mot signifie sauce, jus, bouillon, bouillie, toute espce d'aliments liquides. Il est ici, sans doute par synecdoche, pour dsigner la collation tout entire, comme quand on dit en chinois inviter au vin, pour inviter un repas, et dans l'usage vulgaire en franais, manger la soupe, au lieu de dner. On conoit qu' raison des fatigues que les voyageurs avaient endures, on ait drog la stricte rigueur des rgles, en leur offrant une collation contre-temps; mais la mme expression se retrouve un peu plus bas, dans un autre passage o elle semble plus difficile expliquer. ( 19) Che Hfo, ] que l'on nomme aussi Che li tseu; sous cette forme, la dernire syllabe chinoise est la traduction de la terminaison indienne du nom original, Sr poutra. Ce nom signifie fils de la grue de l'Inde, parce que sa mre avait des yeux semblables ceux de cet oiseaud. C'tait l'un des principaux disciples de Shkya, et celui qui excellait dans le Pradjn, la science divine, dans laquelle il avait t instruit par Avalokites'wara. Le Pian i tian, ici et plus loin, crit le nom de ce personnage 1^^'J /w au ^eu ^e 7K ^'J ^t" ^ette ortno8'raPne Parat fautive.
(20) Mou lian.] Il s'agit d'un autre disciple de Shkya, galement rang parmi les dix plus considrables ; aussi lui donne-t-on habituellement l'pithte de Grand. H a le titre de Tsun tche, qui quivaut celui d'Aiya. Voyez ci-dessus, pag. 68, note a. (21) J nan.] C'est--dire Ananda. Voyez ci-dessus, chap. XII, note 2.
'' Fa yuantckulin, cit dans le SontsangJ sou, liv. XIX, pag. k v. b Pi lo santchu jaking, cit dans l'Encyclopdie ponaise, liv. CV,pag. i5.
c Ta tchi tou lan, cit dans le San tsangf sou, liv. VIII, pag. i3. d Fan i mingy, cit dans le San tsang J sou, liv. XLI, pag. i3. l.
108
FOE
KOUE
KL
(22) L'A pi than, ] et plus correctement A pi tha mo [ Abhidharma), est le nom qu'on donne la dernire des trois classes sous lesquelles on range les livres sacrs, celle qui contient les discours ou entretiens. Ces trois classes sont appeles les trois contenants, en chinois San tsang, en mongol Gorban amak saba*, en tibtain sDe snod gso.um. Les mots de ces diverses langues qu'on emploie en cette occasion et sont l'quivalent du sanscrit Pit'adsignent un vase, un contenant quelconque, kah ou Kiu che [Kocha)"; on leur donne ce nom parce que chacune d'elles contient, renferme, embrasse les diffrents crits religieux qui se rapportent aux trois genres suivants. i Sieou to lo [Sotra). Ce sont les principes ou aphorismes qui font la base de la doctrine, les textes authentiques et invariables (en chinois King) : en tibtain ce sens d'immobilit se rend par hGyour. Ces textes renferment, en haut, la doctrine des Bouddhas, et en bas, les devoirs ou les facults de tous les tres vivants. 2 Pi naye [Vinaya). Ce mot dsigne les prceptes, les rgles, les lois ou ordonnances , ou littralement le bon gouvernement, ce qui doit rgler les mauvaises qualits des tres vivants , comme les lois du monde servent redresser les fautes soit graves, soit lgres. Le mot tibtain bKh exprime cette signification, et joint au titre tibtain des livres sacrs, il forme le compos bKh-liGyour qui est le titre d'une collection trs-clbre communment appele Gandjourd. On appelle aussi dans la mme langue les prceptes hDoul-ba, livres pour convertir, pour changer du mal en bien ; en mandchou Wemboure nomoun, et en mongol Dzina. 3 A pi thamo [Abhidharma). Ce mot signifie discours, entretiens; ce sont, suivant un ouvrage bouddhique (le lu Ma lun), des traits o, par le moyen de demandes et de rponses, on fait un choix arrt entre les divers procds indiqus parla loi. Les Abhidharmas se nomment en tibtain Tsios mdon pa ou loi manifeste, en mandchou Ilctou nomoun e. On distingue les ouvrages de ces trois classes en deux espces, selon qu'ils appartiennent la grande ou la petite translation!. Parmi les Sotras de la grande translation, on cite le Iloayan et d'autres textes sacrs qui, ne traitant que de la doctrine du Bodhi ou de l'Intelligence conue dans le monde de la loi, enseignent et montrent les bonnes actions des Bodhisattwas du Mah yan, et rendent manifestes les fruits de leur conduite morale. Les Vinayas appartenant la mme translation, sont, comme le Fan kang [Bramadjla, filet de Brahma), des livres o sont rapportes les rgles qui ont t observes et gardes par les Bodhisattwas de la grande translation. Enfin, " Gcschicte der Ost-Mongolen, pag. Ai, 355. h Vocab. sect. XLIII, n i. pentaglolle, c San tsang f sou, liv. VIII, pag. 29 v. d On voit des que ce titre ne signifiepastraduction parolesoudes ordres, commel'a cru M. Schmidt. de SanangSetscn,pag. I118 Notessur l'histoire Voyez Journalasiatique, tom. X, pag. 138. et suivantes. 0 Fan i mingy, cit dans le San tsangJ son, sect.XLIII, liv.VIII, pag. 28 v. Vocab. pentaglotte, n g et 10. f ci-dessus,chap.II, note k. Voyez
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
109
parmi les Abhidharmas du mme ordre, on cite le Khi sin lun [Discours pour faire natre la foi) et d'autres ouvrages de discussion sur la conduite suivie par les Bodhisattwas du Mah yanci \ On cite parmi les Soutins de la petite translation, l'Agama et d'autres livres sacrs o il n'est parl que de la nature du vritable vide (l'esprit) et du repos ou de l'anantissement (extase), pour faire voir les procds suivis par les Shrcivakas et les Pratyekas, et les fruits qu'ils en ont retirs. Agama est un mot sanscrit qu'on rend par sans pair. Au nombre des Vinayas, on dsigne les rgles pour les quatre sections [Sse fen liu), c'est--dire pour la conduite des mendiants, pour celle des mendiantes, pour l'observation des prceptes et pour l'extinction des querellesh. Les discours intituls Kiu che [Kcha, ce qui embrasse, ce qui comprend; en chinois Tsang) sont cits comme appartenant la classe des Abliidharmas de la petite translation; on y discourt sur la conduite et les mrites des Shrvakas et des Pratyka Bouddhas \ Un autre ouvrage, aprs une dfinition du mot Tsang [qui contient ou renferme une loi et un sens immenses), en distingue cinq. i Les Sou ta lan [Sotram) ou Sieou to lo, doctrine immuable laquelle tout se conforme la fois dans les dix mondes, et de laquelle rien ne change dans les trois temps. 2 Les Pi naye [Finaya) ou rgles. 3 Les Api tha mo [Abhidharma) ou discours, k" Panjo pho lo mi to [Pracljn pcramita) ; ces deux mots signifient l'arrive l'autre rive pour la science. Les hommes gars loin de la science et retenus dans le cercle de la vie et de la mort, sont dsigns comme tant sur cette rive; les Bodhisattwas qui pratiquent le Pracljn et parviennent au Nirvana, sont sur l'autre rive. Suivant les livres sacrs, l'tre dou de sensibilit qui s'applique la vraie et solide science du Mah yan, s'loigne de la condition du moi, et les distinctions qui lui servent cet objet constituent le Pracljn pramita. 5 Tho lo ni [Dhran'), c'est--dire ce qu'on prend, invocation, formule mystrieuse. On dsigne ainsi, suivant les livres sacrs, ce qui, quand on ne peut observer ou comprendre les Sotras, sert rgler et peut diminuer la gravit des pchs commis , procurer tt ou tard la dlivrance, et conduire au Nirvana l'homme sans lumires aussi bien que l'homme clair d. on ne compte pas les Pracljn pcramita et les Dhran' parmi les Gnralement, collections des livres sacrs dont on dsigne l'ensemble par les mots de San tsang, les trois collections. Cette expression revient frquemment et se retrouve dans le titre de l'un des ouvrages o sont puiss la plupart de ces claircissements, le San les nombres de la loi des trois contenants, parce que la tsang f sou, littralement substance des livres sacrs y est distribue d'aprs le nombre des subdivisions attribues chaque notion psychologique, religieuse ou mythologique. Ce titre pourrait yan king,Sousouyn i tchao, cit dans le Santsang J sou, liv. VIII, pag. 29. surles prceptes lanote12 Voyez, bouddhiques, du chapitreXVI. " Hoa c Thianthassekiaoi tsy tchu, cit dans le San tsang f sou, liv. VIII, pag. 29. d Livresacrdes six Pho lo mi [Pramita), cit dansle Santsang J sou, liv.XX, pag. 19v.
.110
FOE
KOLE
KL
tre en sanscrit Tri pit'aka dharmci sankhya. Au reste, on verra beaucoup d'autres classifications plus spciales des livres religieux, dans les notes relatives aux passages o les voyageurs bouddhistes parlent de ceux qu'ils ont recueillis dans leurs courses. L'usage d'lever des tours pour y renfermer l'original d'un livre sacr, aussi bien que pour y dposer une relique, ou pour conserver le souvenir d'un prodige, est constat par le passage qui a donn lieu cette note. 11 y avait Mathour la tour des Abdhidharmas, celle des Vinayas, celle des Sotras. des Pinayas. Voyez la note prcdente. On (20) Des prceptes.] C'est--dire comple trois sortes de prceptes. 1 Pi ni [Vinaya); ce mot signifie bonum regimen. Il s'applique ce qui est capable de rgler les dsirs, la colre, l'ignorance et les autres imperfections. Il exprime l'ide de temprer et de soumettre, parce qu'avec le secours de ces prceptes on peut temprer et contenir les trois actes, c'est--dire ceux du corps, de la bouche et de l'intention, et gouverner ou subjuguer les mauvaises dispositions. 20 Chi lo [Shla), ce qui arrte ou restreint (le mal) et rend capable (du bien), ou simplement dfense, obstacle qui arrte les actes vicieux du corps, de la bouche et de l'intention. 3 Pho lo thi mou tcha [Para adhi moksha) ou dlivrance, parce que ces prceptes cartent les liens des mauvaises inclinations et rendent l'homme matre de lui . (2 A) Des livres sacrs.] Le mot King en chinois dsigne ce qui est invariable; on s'en sert pour rendre l'ide d'une doctrine constante, d'un texte rvl. Chacune des sectes qui se sont introduites la Chine a emprunt ce terme l'cole des lettrs, qui le rservent aux seuls livres rdigs par Confucius. Les Bouddhistes aux Soutins (voyez la note 22 ), parce que, selon l'exl'appliquent particulirement plication donne dans un de ces livres mmes, ils font loi et sont invariables. On s'y conforme dans les dix mondes, et les trois temps n'y changent rien. Les dix mondes sont les mondes des Bouddhas, des Bodhisattwas, des Pratyka Bouddhas, des Shravakas, des dieux, des hommes, des Asouras, des dmons de la faim (Prth), des brutes et des rgions infernales. Les trois temps sont le pass, le prsent et l'avenir. (2 5) [ M. Rmusat avait laiss cette phrase en blanc dans son manuscrit. Le texte /fci p$> ce cllu' signifie toutes les familles, ou tous les gens qui porte 0k^^Jf$ esprent le bonheur. Cette expression parat dsigner ceux qui suivent la loi de Bouddha. KL.] (26) Une collation extraordinaire.] On a vu (note 18) l'explication de cette manire de parler; mais ici elle semble moins bien sa place. On ne conoit pas aisa Ta sur le lloa yanking,citsdansle Santsang Isangy lan, et Commentaire J sou, liv.IX, pag. J 5.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
III
ment pourquoi les voyageurs , invits par des personnes dvotes reprendre leurs exercices pieux, se seraient prpars une sorte de confrence thologique ou de prdication , par une infraction aux observances de leur profession, telle que serait l'acte de faire une collation hors des heures fixes pour les repas monastiques. Le passage a peut-tre besoin de correction, mais il est le mme dans les deux textes que j'ai sous les yeux. On nomme ainsi les (27) On discourut sur la loi.] Dans l'original, il y a Y^)Lassembles que tiennent les Sangas, et dans lesquelles on explique les livres sacrs, en dveloppant les principes de la religion et en rpondant aux difficults dont ils peuvent devenir l'objet. Les Samanens chinois devaient assister avec beaucoup d'intrt ces confrences, eux qui avaient entrepris un si long A*oyage et tant de travaux pnibles pour s'instruire fond de la doctrine intrieure du bouddhisme. On emploie la mme expression pour dsigner les prdications de Shkya, et l'on dit qu'il parla de kl loi en faveur de sa mre, ou des peuples, ou des dieux. Voyez ci-dessous. (28) Par d'autres personnes.] C'est encore un passage difficile; il y a dans le texte y .Ab.^$ T$L- n ne vort Pas a quoi se rapporte cette phrase, qui ne se lie ni avec ce qui prcde, ni avec ce qui suit, mais qui est sans diffrence dans les deux ditions. (29) Qui vint auprs de Fo.] Peut-tre faudrait-il lire =|g qui demanda la permission, au lieu de "=g^ qui vint auprs. Cette phrase serait mieux en rapport avec ce qui suit. (30) Les Pi khieou ni. ] Pi khieou ni est le fminin de Pi khieou [Bhikshou, Bhikshouni), religieux mendiant (voyez chap. VIII, note 5). Aprs que Shkya eut accompli la loi, sa tante Maha pho che pho thi [Mahpradjpal) Ta'a tao (l'amie de la religion ) demanda la permission d'embrasser la vie religieuse et d'tudier la doctrine. Shkya n'y voulait pas consentir ; ce fut Ananda qui insista auprs de lui pour l'obtenir. Bouddha rpondit: Prenez-y garde; ne faites pas entrer les femmes dans ma loi pour y devenu- samanennes. Quand dans une famille il y a beau coup de filles et peu de garons, vous savez qu'elle tombe en ruine et ne peut recouvrer sa splendeur. Ananda renouvela ses instances, alors Bouddha exposa ce qu'on appelle les huit procds respectueux. Si elles peuvent les garder, ajoutait t-il, je consens ce qu'elles deviennent religieuses. L'amie de la religion porta la main sa tte (en signe de respect), et les reut avec confiance. Elle fut convertie et devint religieuse. Voici les huit procds respectueux imposs aux femmes par Bouddha :
112
FO
KOU
KL
i Une religieuse, et-elle cent ans, doit le respect un religieux, celui-ci ft-il au premier t de sa profession. 2" Une religieuse doit montrer son respect aux mendiants, ne jamais les insulter ni les calomnier. 3 Si un religieux vient pcher, la religieuse ne doit pas lui donner d'loges; mais si une religieuse pche et qu'elle entende les loges d'un religieux, elle doit faire un retour sur elle-mme et s'examiner. k Elle doit recevoir les prceptes d'un Sanga, ou de quelque mendiant haute vertu auquel elle se sera adresse pour les obtenir. d'une
5 Si une religieuse a pch et qu'elle se sente indigne de rsider dans l'assemble des mendiants, elle doit s'humilier et confesser sa faute, afin d'loigner d'elle et la ngligence. l'orgueil o Do 6" Elle doit recevoir, durant la moiti d'un mois, les instructions des Sang as, et s'adresser deux fois par mois un mendiant une instruction qui la mette en tat de faire 70 Elle doit, durant les trois mois d't, mendiants, sans les quitter ni jour ni nuit; de grande vertu, afin d'obtenir de lui des progrs dans la doctrine. s'interdire le repos et s'attacher aux les interroger sur le sens de la loi, et
augmenter son instruction pour la mettre en pratique. 8 Quand les trois mois d't sont couls, depuis le 15 de la ke lune jusqu'au i5 de la 7e, elle doit suivre les mendiants pour s'exercer par les exemples des autres, et si elle commet des fautes, s'en repentir et les confesser tous a. Bouddha avait annonc Ananda, qu'attendu l'admission des femmes dans la vie religieuse, la loi des tmoignages (c'est--dire, la premire priode de la loi durant laquelle elle devait porter tous ses fruits) qui devait durer mille ans, serait rduite de cinq cents ans. Mais quand il eut expliqu les huit procds respectueux aux religieuses et qu'elles les eurent accepts, la dure de mille ans fut rtablie pour la loi des tmoignages h. Il y a huit pchs par lesquels les religieuses montrent qu'elles ont abandonn les prceptes et qu'elles mritent elles-mmes d'tre abandonnes de tout le monde, parce qu'elles sont hors del toi de Bouddha; ce sont : i Oter la vie un tre sensible qui, comme tous les existence ; le faire souffrir et le 20 Drober ce qui appartient de donner. 3 Commettre des par les rites et se garder par les tres de cette espce, tient son corps et son tourmenter au lieu de lui montrer de la compassion. autrui, s'abandonner la cupidit, prendre au lieu impurets. La religieuse qui ne sait pas se dfendre prceptes, conoit des dsirs et souille la puret qui
doit prsider sa conduite. k Mentir, cacher la vrit, et tromper autrui par des paroles artificieuses. 5 Souffrir le contact; cela se dit d'une religieuse qui se laisse toucher par le corps d'un homme, et qui par l fait natre des dsirs impurs. 6 Les " Fan i '' TSan tsousse mingy,In hoe tchinghi, citsdansle San y f yuan wen, cit dansle San j sou, liv.XXXII,pag. 17. tsang tsang J sou,liv.XIII, pag. 1.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
113
huit. Il s'agit des huit actions suivantes : prendre les mains d'un homme par l'effet d'un dsir dshonnte, toucher ses vtements, entrer avec lui dans milieu retir, s'y asseoir ensemble, y faire la conversation, y marcher ensemble, s'appuyer l'un sur l'autre , s'y donner des rendez-vous criminels. 70 Couvrir ou cacher : c'est quand, dans l'assemble o l'on discourt sur les prceptes et o l'on pratique la loi, la religieuse cache les pchs des autres ( ^]b -]tf ) et ne veut pas rvler les siens l'assemble. 8 Suivre ou s'appuyer, c'est--dire, dans les grandes assembles des Sangas, ne pas faire l'office en commun et suivre quelque socit particulire
(3 1) L'honorable du sicle.] C'est l'un des dix surnoms que l'on donne aux Bouddhas humains, et par consquent Shkya mouni comme aux autres. Un Bouddha, par la science sublime [pracljn) et par les autres perfections qu'il a acquises, dtruit les dsirs, la colre, l'ignorance et les autres imperfections; il teint les douleurs de la vie et de la mort; il obtient une intelligence suprieure tout. Les dieux et les hommes, tous les saints, dans le monde comme hors du monde, le comme vnrable. C'est le sens de ce surnom, dont la forme originale en sanscrit est Lokadjyeslitlia. La traduction tibtaine est nDjig rten gyi gtso bo h. Deguignes a commis, sur le sens du mot chi (sicle), une mprise trs-extraordinaire c : il a cru que le sicle ou le temps tait pour les Bouddhistes un objet d'adoration; que Chitsan, l'honorable du sicle, signifiait honorer le sicle, et que ces ides avaient du rapport avec les opinions attribues aux Persans et aux autres peuples orientaux sur le culte du Zerouan et des Aons. J'ai eu occasion de relever cette erreur ll. (32) [Selon la Chronologie japonaise intitule Wa kan kw tfen nen gakf oun-no tsou, conserve la Bibliothque du Roi, Che lifo et Mou lian embrassrent la vie monastique l'an gg5 avant J. C. D'aprs le mme ouvrage, A nan ou Ananda fut instruit par Shkya mouni, et se fit moine l'an 976 avant la mme poque, et en 970 il pria son matre de permettre aux femmes de se faire religieuses. KL.] (33) Les Cha mi.] C'est le nom qu'on donne aux disciples ou aspirants la profession religieuse. On le rend par deux mots qui signifient calmer et compatir : calmer les passions nes des souillures du sicle; compatir aux souffrances de tous les tres Lengyan i ha, cit dans le San tsangJ sou, liv. XXXII,pag. 18t.. b Vocab. sect. i, n 11. pcntagl. Histoire des Huns,tom. II, pag. 226. Mm. a de l'Acad.des inscript, et belles-letlrcs, tom. XXVI, pag. 802. d Observations sur quelques sapointsde la doctrine manenne, pag. /i3. i5 reconnaissent et l'honorent
114
FO
KOU
KL
vivants et y porter assistance a. La forme la plus rgulire de ce mot est Che li ma li lo kiah; mais on n'emploie jamais que la forme abrge Cha mi. Les Chami doivent observer les dix prceptes (voyez ci-dessus, note 12); et c'est quand ils ont reu les prceptes suffisants, c'est--dire les deux cent cinquante prceptes, qu'ils sont rputs Bhikshoa. On donne aux Cha mi diffrents noms selon leur ge. Entre sept et douze ou treize ans, on les nomme chasseurs de corbeaux; de quatorze dix-neuf, on les appelle.cfocipfes propres la loi; vingt ans et au del, on dit qu'ils ont titre (comparez chap. I, note 1 ). Ils peuvent alors faire cesser toutes inclinations et pratiquer toutes les vertus : ils mritent donc le nom sont des Cha mi proprement ditsc. Le mot de cliabi, qui signifie disciple un nom ou un les mauvaises de Chami; ce en mandchou,
parat form du chinois Cha mi. Les femmes portent le nom de Cha mi ni ou plus exactement Che lima li kia, ce qui exprime leurs efforts pour faie des progrs dans la doctrine de Bouddha. C'est une trange mprise de la part d'un auteur qui a publi une traduction des Rgles des Cha mi, que d'avoir toujours donn ce dernier mot pour un quivalent de Cha men [S'ramana), mme sur le titre de l'ouvrage ''. (34) Ma ho y an.] C'est la transcription du terme sanscrit Mcdiyna, la grande translation (chap. II, note k). Les religieux qui s'adonnent la petite translation sont nomms Mokslia deva [ dieux dlivrs ) ; et ceux qui se livrent la grande, Mcdiyna cleva. (35) Phanjo pho lo mi.] Transcription incomplte du sanscrit Pracljn pramita, faction d'atteindre l'autre rive par la science. C'est l'un des dix moyens de dlivrance finale appele Pcramitaf. Plusieurs titres de livres religieux o cette science divine est enseigne portent le titre de Pracljn pramita. C'est Mandjousri Avalokites'wara (voyez la note suivante) qu'on en fait honneur. (36) PVen tchu sse li,] en sanscrit Mandjous'ri. Les Chinois prtendent qu'il y a trois manires d'crire et d'interprter ce nom; savoir : i Wen tchu sse li, vertu merveilleuse; l'tre qu'on dsigne ainsi tant dou dmrites admirables, subtils, infiniment varis et innombrables. 1 Man tchu chi li, tte ou chef admirable, parce ses mrites merveilleux, subtils, infinis, il est au-dessus de tous les Bodhique par sattwas. 3 Man tchu che li, admirable bndiction (formule de louange, d'adoration, d'heureux augure), parce qu' raison de ces mmes mrites, son nom est le plus heureux des augures s. Mais il est probable qu'en transcrivant avec des caractres tsangf sou, liv. VII, pag. 16v. .linwanghoukou king,Pradjnapramita, dernier chapitre, cil liv. XXIX,pag. 2/1 v. * Fan y mingi, liv. XI, pag. 1/1v. '' TheCatechism Shamans, ojlhr pag. 36 et pass. 1 San " Discours surla relation deITiua.11 tsang,cit dans lePian i tian, liv. XLIV,pag. g. ' Vocab. pentagl.sect.XII. 3 Fan y ming i, cil dans le San tsang J sou, liv. XI, pag. 3 v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
115
chinois diffrents un mme mot sanscrit, on s'est plu, comme on l'a fait souvent, chercher des allusions des sens divers, que l'tymologie autorise ou suggre titre de jeux de mots ou de rapprochements fortuits. Mandjousri signifie proprement en sanscrit l'heureux S'ri, et S'ri est l'expression par laquelle on bnit les dieux, les saints. On nomme aussi le mme personnage Mandjoughcha, l'heureux son, l'heureuse voix. Les Tibtains lui donnent le nom de hDjam clVyang. C'est, dans la mythologie, le dieu de la sagesse". Il a jadis anim la grande tortue d'or, avant le commencement de l'univers dont les fondements reposent sur cette tortue, et il doit, dans une priode future du monde, reparatre comme en tant le dominateur1'. C'est le grand Dcmiourgos, le Vis'wa karma, l'architecte qui, par les ordres du Bouddha suprme, a construit les divers lages, tant clestes qu'infernaux, dont se compose un univers c. Ce peu de mots suffirait pour tablir le rle thologique assign Mandjousri, si mon objet actuel tait de tracer une esquisse du Panthon bouddhique; mais les extraits des livres chinois qu'il s'agit surtout de faire connatre et de livrer la discussion, montreront quel point les ides philosophiques sont dnatures dans la mythologie et perdues de vue par les auteurs lgendaires. Bouddha (Shkya mouni) parcourait un jour les montagnes Khi tche khiu du pays de Lo yu khi (R'djagriha) avec une grande multitude de mendiants, forme de i25o mendiants et de 32,ooo Bodhisattwas. L'honorable du sicle tait en tour d'un nombre infini de ses adhrents, par centaines et par milliers. Dans l'assemble sigeait alors un fils des dieux (Devapoutra) nomm Tsi chan lin in [In quite obsequens proeceptorum voci, vel vox qniet proeceptis obsequens), lequel se levant de son sige, arrangeant ses vtements, faisant une longue gnuflexion et joignant les mains, s'adressa l'honorable du sicle en lui disant : O est l'habitation actuelle de Mandjousri? Toute l'assemble, tous ceux qui composaient la mul titude des quatre classes, c'est--dire les mendiants, les mendiantes, lesOupasika et les Oupayi '', aussi bien que les dieux, les nagas, les bons et les mauvais gnies, Brahma, Indra et les quatre rois des dieux, souhaitaient ardemment d'entendre les discours merveilleux du vritable matre, et de recevoir ses explications sur les livres sacrs. Bouddha dit alors que du ct de l'orient, dix mille terres bouddhiques de ce monde, c'est--dire dix mille fois l'espace du monde o s'tendent les heureuses influences de la prdication d'un Bouddha, il y avait un monde appel Pao chi (famille prcieuse, peut-tre Ralncya) et un Bouddha nomm Pao ing jou la [preliosi terminus Tathgata), intelligence pure et hors de rang, qui prchait actuellement la doctrine, et que Mandjousri tait l couter les leons du grand matre de tous les Bodhisattwas, lequel leur enseignait Schroeter, Bootan Diclionary,h. v. Alphab. Tibet,pag.279-281. '" hislonschcr .Vuc/in'c/i/. tom. II, p. 85, Sammlnng pi. IX, fig. 3. ' 0 dans les Truns. llodgson, Sketchoj Buddhism, loin.II, pag. 23/i. royalasiat.Society, oj tlic d San citsang J sou, liv. XVI, pag. 14 r. Voyez dessus,pag. 67, note /|. i5.
116
FOE
KOUE
KL
connatre leurs imperfections. Le fils des dieux s'adressa de nouveau Bouddha : a Je voudrais seulement, grand saint, que par un acte de votre bont puissante, vous fissiez venir ici Mandjousri; qu'il nous enseignt les moyens l'aide desquels il explique la doctrine des livres sacrs elles claire d'une vive lumire, quelque difficult qu'il s'y trouve, de manire dpasser tous les Sliravakas et tous les Pratyka Bouddhas. Lorsque Mandjousri prche la grande loi, tous les dmons [Mara) sont subjugus; aucune erreur ne peut plus tromper les hommes; il n'est point d'hrtique qui ne rentre clans le devoir Dj, Tathgata, tous exaltent la vrit suprme; si ce saint enseignement vient fortifier vos leons, la dure de la vraie loi en sera accrue. Jamais Tathgata n'aura t second par un auxiliaire aussi vers dans le Pracljn, dou d'aussi grandes facults, aussi capable de rpandre et de publier la doctrine, que le sera Mandjousri.' D'aprs l'invi tation du fils des dieux Tsichun lia in, l'honorable du sicle fit jaillir, du duvet qui tait entre ses sourcils, un rayon de lumire qui claira les trois mille millions d'univers et de terres bouddhiques, et fit le tour de dix mille de ces terres, rpan dant une clatante clart sur le monde Pao chi. Les Bodhisattwas de cette terre bouddhique demandrent leur Bouddha d'o provenait l'apparition de cette lumire et quelle pouvait tre la cause de ce prodige. Le Tathgata Pao ing leur rpondit : Du ct de l'ouest, aprs qu'on a pass dix mille kshma de Bouddhas, il y a un monde qui s'appelle monde de la patience (Savaloka); son Bouddha se nomme le Tathgata capable de bont (Shkya). C'est une intelligence pure, parcivenue au suprme degr de la vrit. Il prche en ce moment la loi. Un rayon s'est dtach de l'intervalle de ses sourcils, et en illuminant dix mille terres bouddhiques, est parvenu jusqu' ce kshma. Et ce Lokadjyeshlha, reprirent les Bodhisattwas, centaines de milliers et des millions quelle est son intention?-Des sans nombre de Bodhisattwas sont assembls avec ce Bouddha, rpondit le Bouddha, avec lTndra et le Brahma de ce monde et les quatre tribus, et tous dsirent ardemment que Mandjousri veuille se montrer eux et leur expliquer la loi. Ils ont fait part de leur dsir au Bouddha, qui, par ce rayon de lumire, a engag Mandjousri venir. Et toi, continua le Tathgata Pao ing en s'adressant Mandjousri, va dans cette terre o le Tathgata capable de bont t'attend, et o d'innombrables Bodhisattwas soupirent aprs ta prsence. J'avais aussi, reprit Mandjousri, reconnu la cause de ce rayon merveilleux. Et l-dessus il prsenta ses hommages au Bouddha Pao ing, et, accompagn de dix mille Bodhisattwas, il passa trois fois sa droite, puis tendant les bras comme un gnral valeureux, il disparut tout coup du kshma Pao chi. En moins de rien il se trouva dans la terre de-la patience, et se tenant dans l'espace sans se faire voir, il laissa tomber une pluie de fleurs clestes sur l'assemble, qui en eut jusqu'aux genoux. Emer veills de ce prodige, tous ceux quiformaient l'assemble demandrent Bouddha ce que prsageait cette pluie de fleurs. Bouddha avertit ses parents et ses proches
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
117
que c'tait Mandjousri avec dix mille Bodhisattwas, qui venaient d'arriver confor mment ses ordres, et qui, du haut des airs o ils taient placs, faisaient pleu voir des fleurs pour honorer sa dignit. Que nous souhaiterions, reprit l'assem ble, de voir Mandjousri et les Bodhisattwas! Quelle flicit de contempler ce vritable matre, tel qu'on ne saurait en rencontrer! Ils n'avaient pas fini de parler que Mandjousri et les Bodhisattwas se montrrent et vinrent se prosterner devant les pieds de Bouddha. Ils firent sept fois le tour droite, et par le pouvoir surnaturel dont ils taient dous, ils firent clore de grands nymphas sur les quels ils se placrent. Ensuite, le fils des dieux, Tsi chun liu in, dit Bouddha qu'il dsirait demander Mandjousri des claircissements relatifs au saint en seignement, qui fussent propres aider la marche incertaine de l'assemble. Exposez vous-mme votre pense, rpondit le Bouddha, et on satisfera vos questions. Alors le fils des dieux s'engagea dans une srie de questions auxquelles Mandjousri satisfit pleinement, sur les perfections du Bouddha que celui-ci venait de quitter, sur le principe de la vrit, sur les progrs des religieux mendiants, sur la nature de l'me, etc. Celte confrence thologique est infiniment curieuse, en ce dont l'exposilion se qu'elle touche aux dogmes les plus relevs du bouddhisme, rapporte un Bouddha exalt, et est place dans la bouche de la sagesse divine elle-mme. Mais elle embrasse des sujets trs-obscurs, huit pages, je dois la renvoyer une autre occasion. et comme elle occupe vingt-
(37) Kouan chi in.] Autre personnage de la mythologie bouddhique, non moins clbre, mais mieux connu que Mandjousri. Sous la forme qu'on lui voit ici, son nom signifierait en chinois vox contemplans soecahnn; mais c'est une traduction du terme original sanscrit Avalokiles'ivara, qui, bien que gnralement admise la Chine, repose sur une mprise signale par M. Klaproth a. Les premiers auteurs qui ont voulu faire passer ce nom dans leur langue, ont pris la finale iswara, seigneur, pour swara, son, voixb. La vritable interprtation chinoise est Kouan tseu tsa, le seigneur contemplant. On donne ce personnage mythologique une foule de noms divers. On l'appelle en sanscrit Paclma pni (porteur de nympha), en tibtain sDjan ras gZigs clVang tclihoug, en mongol Ergetou khomsim bodisatonc. Dans le systme bouddhique dont nous devons l'exposition M. Hodgson, Padma pni est le Bodhisattwa ou la production active du quatrime Bouddha cleste Amitabha, et on lui doit la cration du monde actueld, ou du moins la formation des tres anims; car la partie matrielle de l'univers passe pour l'ouvrage de Man* Nouv. Journalasiatique,tom.VII, pag. igo. Klaproth,Fragments bouddhiques, pag. 32. 11 la relationde Hiuan thsang sur le pays Voyez d'Oudyna. c Voyezune figure de ce personnagedans les histor.Nachrict. tom. II, pi. I, lig. 3, et Sammlung une description dtailledesa figuremythologique, dansVAlphab. Tibet, 176sqq. d Transactions pag. tom. II, oj theroyalasiaticSociety, pag. 238.
118
FOE
KOUE
KL
djousri (ci-dessus, note 35). Dans un autre systme, Padma pni, fils cleste du Bouddha divin du monde actuel, est, dans cette qualit, entr en fonction depuis la mort du Bouddha terrestre Shkya mouni, comme son remplaant, charg d'tre aprs lui le protecteur constant, le gardien et le propagateur de la foi bouddhique renouvele par Shkya. C'est pour cette raison qu'il ne se borne pas une apparition unique comme les Bouddhas, mais qu'il se soumet presque sans interruption de Matreya, le futur une srie de naissances qui dureront jusqu' l'avnement Bouddha. On croit aussi qu'il est incarn dans la personne du Dala-lama, et qu'il paratra en qualit de Bouddha, le millime de la priode actuelle du monde. Le et la formule il est le pre de ses habitants", Tibet est sa terre de prdilection; clbre Oui nianipaclm hom est un de ses bienfaits h. Le systme auquel appartient cette seconde explication du rle d'Avalokites'wara aurait besoin d'tre fortifi dans quelques-unes de ses bases ; et, par exemple, on ne sait si c'est dans l'ordre des ides ou dans la classe des mythes, qu'on doit placer cette supposition, philosophiques un Tathgata se cre l'instant, dans qu'en parvenant la perfection bouddhique, une sorte de reflet [Abglanz), qui est un Bouddha de le monde des manifestations, contemplation ( Bouddha dhyani ), et que de celui-ci nat un Bodhisattwa tel qu'est AvalokilesNvara. Je ne puis risquer de m'garer en ce moment dans ce ddale thologique, et suivant ma marche ordinaire, je me borne transcrire quelques fragments des lgendes chinoises au sujet du personnage dont parle ici Chy f hian. Aulrefois, il y a dix quadrillions de fois cent quadrillions de kalpas (le plus petit kalpa, comme on sait, est de seize millions huit cent mille ans, et le grand kalpa, dont il doit tre question ici, est d'un milliard trois cent quarante-quatre millions d'annes c), dans un monde appel Chan thi lan, le kalpa tant nomm bien tenu (les prceptes bien observs), il y avait un saint roi Tchakravarti nomm Wou tseng ni an, qui rgnait sur les quatre parties du monde. Ce fut alors que le Tathgata Pao tsang [Ratnagarbha) parut dans le monde. Le roi avait mille fils dont l'an se nommait Pou hiaan [non oculos movens; Animisha?) et le second Ni mo. Il'avait un ministre nomm Pao ha [Rainkara), qui tait le pre du Tathgata Pao tsang. Ce ministre exhortait le roi, ses fils, leurs parents et allis, ainsi qu'un nombre infini d'hommes et de dieux, livrer leurs penses au Bodhi (la perfection bouddhique), de manire pouvoir tous obtenir, dans les dix parties de l'univers, le rane; de pure intelligence. Ce ministre Pao ha est le Shkya Tathgata d' prsent. Alors le roi et ses mille fils rendirent hommage au Tathgata, et, s'attachant ce Bouddha, embrassrent la vie religieuse et cultivrent la doctrine. Bouddha chan gea le nom du roi en celui de Wou liang thsing tsing [immensa puritas; Amitas'oud' ibclannm,pag. 280. Alphabelum '' Lotiiseuchiutchhcou king( Livredela divineformuledes six syllabes)et autres ouvragesdu mme genre, citsdans le Chini tian, liv.XCVIII,pag. 2/i. Uebcr Grandlchren desBuddhaismus, Abhandcinige I, pag. 21, 22. lung, c et la cosmoEssaisurla cosmographie Comparez des Bouddhistes, $ 2. gonie
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
19
i dhi?), puis il lui assigna dans le monde occidental de 'An lo (le sjour de la joie <tranquille, ordinairement Ki lo, la joie suprme, en sanscrit Souk'hvati) le rang ( et la dignit de Bouddha sous le titre de Wou liang cheou (Amitabha). Alors son ( fils an Pou hiaan, s'adressant au Bouddha : Honorable du sicle, lui dit-il, mes i bonnes dispositions, mes rflexions et mes voeux tendent tous la pratique de la i doctrine du suprme Bodhi. Les maux qui affligent tous les tres, les terreurs i auxquelles ils sont en proie et qui les cartent de la droite voie, leur chute dans le i sjour des grandes tnbres, les douleurs sans fin'qui les tourmentent sans qu'ils ( aient un librateur ou un protecteur, leur font invoquer ma puissance et mon < nom. Mais leurs souffrances que mon oeil cleste me fait voir, que mon oreille c<leste me fait entendre, et auxquelles je ne puis porter remde, me troublent au ( point de m'empcher d'atteindre l'tat de pure intelligence. Honorable du sicle, i souffrez que je renouvelle un voeu que j'ai dj exprim en faveur de tous ces <tres. Le saint roi Tchakravarti est maintenant devenu Bouddha dans le monde ( de la joie tranquille, sous le titre de Wou liang cheou (Amitabha). Quand, aprs .1un nombre infini de kalpas (le nombre est dtermin, FF ou liang, c'est--dire cent <quintillions, ou selon un autre calcul, un asankhya lev la troisime puissance. <L'asankhya est de cent quadrillions), il aura accompli son oeuvre de Bouddha, il i entrera dans le pan ni liouan (chap. XII, note 3 ; chap. XV, note i 5), et la loi sera <invariablement observe. Moi, pendant ce temps, je dois exercer la condition de :< Bodhisattwa; si je pouvais accomplir l'oeuvre de Bouddha, ds la premire nuit :i o sa loi directe ( Tching f) serait teinte, la nuit suivante j'atteindrais au rang de :< Bouddha. Alors le Bouddha Pao tsang, lui assignant la fonction qu'il sollicitait, lui :i rpondit : Excellent jeune homme, tu as contempl les dieux, les hommes et les " trois conditions mauvaises (celles des brutes, des dmons et des damns), et :i touch d'une compassion parfaite, tu as dsir dtruire les souffrances et lsinait perfections de tous les tres; tu souhaites qu'ils soient tous admis dans le sjour u de la joie tranquille; c'est pourquoi je dois l'accorder le titre de Kouan chi in (Ava lokites'wara, Seigneur qui contemple). Tandis que tu exerceras la condition de Bodhisattwa, il y aura des centaines de milliers de FF ou liang (cent quintillions) Kde millions de Na yeou tha (billion) d'tres qui te devront d'tre garantis de la douleur. Tu pourras oprer la grande oeuvre de Bouddha et succder au Bouddha Wou liang cheou (Amitabha) sous le titre du Tathgata roi des montagnes, aux m. rites clatants de lumires [ Y thsy kouang ming koung t chan wang Jou la).Le se cond des princes vint devant le Bouddha et exprima le dsir de pouvoir succder Kouan in, et d'avoir le mme royaume et les mmes avantages de beaut, sans Haucune diffrence avec Kouan in. Le Bouddha lui assigna la qualit de Bouddha avec le titre de Tathgata roi des montagnes prcieuses, o l'on excelle clans l'observation (de la loi) ( Chen tchu tchin pao chan ivang Jou la). 11lui dit ensuite : Excellent jeune homme, comme tu as dsir de prendre le grand univers (sous ta protection), je
122
FOE
KOUE
KL
action une contemplation pntrante comme le diamant, une bont et une misricorde semblables celles d'un Bouddha, la puissance de secourir tous les maux, et le pouvoir de pntrer en tous lieux, sous trente-deux formes, et de sauver gnralement tous les tres. C'est ce qu'on nomme les trente-deux relations ou [Kouan chi in, san chy eul ing). Ainsi : i Quand correspondances d'Avalokites'wara les Bodhisattwas entrent dans le Samdi, et qu'ils s'exercent complter la suprme dlivrance, Avalokites'wara leur apparat sous la forme de Bouddha et leur prche la loi qui les aide accomplir cette dlivrance. 2I1 apparat comme T Mo (Praaux hommes parvenus ce rang, c'est--dire ceux qui sont ns tyeka-Bouddha) dans les temps o il n'y a pas de Bouddha, qui n'ont point eu de matre et ont appris par eux-mmes ou tout seuls (*W fgj T Mo). 3 Il se montre dans le mme but aux Yuan Mo, sous la forme d'un Yuan Mo, c'est--dire d'une Intelligence qui, par la contemplation des douze nidnas, a compris la vritable nature des choses [nidna Bouddha?), supprim ces nidnas, et triomph de la nature (mortelle). On continue la mme explication l'gard des autres conditions auxquelles le Bodhis'acsattwa, complet dans la manifestation de sa nature triomphante ({10 3/MjuJi*-), commode pour oprer leur dlivrance. Ce sont : k les Srvakas, ou ceux qui ont entendu la voix de Bouddha, obtenu par l'tude la connaissance du vide des quatre vrits, et pntr dans le nirvana par la pratique de la loi. 5 Brahma, oue seigneur du ciel de la premire contemplation du monde des dsirs , dont le Bodhisattwa prend la forme en faveur de ceux des tres qui souhaitent se maintenir dans une puret parfaite, en cartant d'eux les dsirs et leurs souillures. 6 Indra, dont le Bodhisattwa prend la forme pour dlivrer ceux qui veulent devenir rois des dieux. 70 Iswara, le cinquime transforme dieu du monde des dsirs, dans la personne duquel le Bodhisattwa se en faveur de ceux qui dsirent parcourir les dix parties du monde en qualit de seigneurs. 8 Mah-Iswara, ou le sixime dieu du monde des dsirs, auquel le Bodhisattwa s'identifie pour le salut de ceux qui veulent traverser l'espace en volant, 90 Le grand gnral des dieux, ou le gnral d'Indra, au poste duquel on aspire quand on veut commander aux gnies et prendre les royaumes sous sa protection. io Les quatre rois des dieux; savoir : celui de la partie orientale, ou le protecteur des royaumes; celui du midi, ou qui accrot la grandeur; celui de l'ouest, ou le dieu aux larges yeux; celui du nord, ou le savant, dont la fonction est de gouverner le sicle et de protger les tres vivants. 11 Les fils des quatre rois des dieux, qui naissent dans les palais clestes et se font obir des gnies. 12e Les rois des hommes. 13 Les chefs de tribu. 1 k Les lettrs ou philosophes qui se plaisent dbiter de belles maximes et pratiquer des principes de puret. 15 Les magistrats ou chefs qui administrent des portions de territoire. 16 Les Brahmanes (ou hommes qui marchent dans la puret), lesquels cultivent l'arithmtique et les * ci-apres,chap.XVII, note3i. Comparez
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVI.
123
sciences occultes, comme l'astrologie, l'art divinatoire, etc., en gardant (leur coeur) et conservant (leur personne et leur bouche), c'est--dire en se soumettant des observances morales et physiques. 170 Les mendiants (chap. VIII, note 5). i8Les mendiantes. 19e Les Yeou pho se [Oupsika) ou hommes purs, qui se plaisent dans l'observation des cinq prceptes et mnent une vie laque. 20 Les Yeou pho i ou femmes pieuses laques. 2 i Les reines ou femmes des empereurs, dont le Bodhisattwa prend la forme pour gouverner la foule des femmes et prcher celles d'entre elles qui exercent des fonctions dans les palais et sont au service des rois. 220 Les hommes qui veulent garder la continence. 2 3 Les filles qui gardent leur virginit. 2k" Les dieux. 26 Les dragons. 26 Les Y cha ou Y cha [Yaksha], ou braves. 2 70 Les Khan tha pho [Gandharvas, obscurit odorifrante )-ou gnies de la suite d'Indra. 28 Les A sieou lo [Asouras, irrguliers, imparfaits), ainsi nomms cause de la difformit de leur figure. 2g 0 Les Kin na lo [Kinnara), esprits douteux, c'est--dire monstres, qui ont la figure d'hommes et ne sont point des hommes, qui ont des cornes sur la tte, etc. 3oMa hou lo Ma [Mahoraga), les hydres ou grands serpents. 3i Les hommes. 32 Les non-hommes, c'est--dire les dmons ou les brutes, tres dous ou privs de la facult de pensera. Par la puissance corporels ou incorporels, qui lui est accorde, le Bodhisattwa s'accommode aux trente-deux conditions qu'on vient d'numrer et qui embrassent tous les tres; il en revt la forme; il prche ceux qui aspirent un tat meilleur et ceux qui, placs dans un tat dsavantageux, s'efforcent de s'en dlivrer, et il leur fournit les moyens d'y parvenir. lafin de l'anne.] Ce sont apparemment des trennes que l'on (38) Prsents donne aux religieux mendiants. Le mot chinois ~^"m signifie proprement la fin d'une anne et le renouvellement de l'autre. (3g) La sainte troupe] ou la sainte multitude, l'glise. l'assemble des fidles, le Sanga,
[ko) Le Nihouan de Fo.] Quelque opinion qu'on adopte sur l'poque de la mort de Shkya, il est toujours extrmement remarquable qu'un Bouddhiste du v sicle de notre re fasse remonter la prminence de sa religion dans l'Inde centrale huit ou neuf sicles avant J. C, et qu'il assure qu'on n'avait encore, de son temps, apport aucune interruption aux avantages que les rois du pays accordaient aux Samanens. La suprmatie des Brahmanes doit donc tre reporte en d'autres lieux. C'est l une question historique de la plus haute importance. Quarante ou cinquante mille li.] Le li employ la vague nonciation de ces longues distances tait fort petit. La longueur de la cte de Malabar, depuis les bouches de l'Indus, n'est donc pas ici trs-exagre. [ki) " Lengyan king, cil dans le San tsangf sou,liv. XLVIII,pag. 5. l6.
CHAPITRE
XVII.
Royaume de Seng kia chi.
De l, nomm
en allant
au sud-est,
dix-huit
yeouyan, aprs
Seng kia chi (i). C'est le lieu o Fo, durant de Tao li (2), et avoir, trois mois, mre il usa (3), redescendit de ses facults sur la terre. surnaturelles Quand
il y a un royaume tre mont au ciel en faveur de sa
prch Fo monta que
au ciel de Tao li,
ses disciples n'en rien. surent encore Sept jours manquaient (au temps fix pour son leurs facults divines (5). A na li (6), quand ils employrent absence) de loin Yhonorable du qui tait dou de la vue des dieux (7), aperut sicle (8), et il dit le grand Mou lian (9) : personnage, du sicle. Va t'informer de l'honorable Mou lian alla donc se prosterner et adorer le pied ( de Bouddha la question ), et il lui adressa Fo dit Mou. lian : Dans Quand il eut parl, qui lui tait suggre. d'ici je descendrai jours et son retour, les revint, sept vassaux revoir Seng le Yan feou thi (10). Mou lian s'en rois de huit leurs grands royaumes, brlaient du dsir de longtemps depuis des nuages dans ce royaume (de Yhonorable du sicle. Alors la men: Aujourd'hui les rois et l'attente de Fo; moi, qui suis dans au vnrable
(4), de sorte
et les peuples, qui comme Fo, s'assemblrent
kia chi), pour y attendre diante Yeou pho lo (11) se dit en elle-mme les peuples une femme, se servit faisant rendit sont en adoration dans comment tre
donc tourner
pourrais-je de la facult divine
la premire voir Fo? Elle en saint roi pour se transformer de beaucoup la premire de marchait qui il l'esca-
la roue (12), et elle Fo. du ciel de escalier Tao
fut
hommage Fo redescendit un triple
li. Au prcieux.
moment Fo
descendre, sur
forma
degrs
CHAPITRE lier Fan du milieu, (i4), fit aussi orn des sept un escalier choses
XVII.
125 (i3). Le roi des dieux, du ct droit, tenant
prcieuses il tait d'argent; (i5) blanc
la main seigneur
un chasse-mouche
un escalier Chy (16) forma la main tenant un parasol enrichi Une foule innombrable accompagnant (Fo). Fo tandis qu'il descendait. Quand il fut
et accompagnant Le (Fo). d'or bruni; il tait gauche, des sept choses prcieuses et de descendu, dieux les (17) suivait trois esca-
liers
et il n'en resta que sept degrs sous la terre, disparurent apparents. Dans la suite, le roi A yeou (18) dsira en voir la base; il enbas (de l'escalier). On parvint jusqu'au voya des gens pour creuser une source jaune, sans pouvoir atteindre la base. Le roi sentit s'accrotre sa foi et sa vnration. et sur le degr haute de six toises de pierre, haute Dans l'intrieur Il fit donc lever du milieu (19). Derrire de l'escalier, debout, colonne un lion. une chapelle il rigea une statue au-dessus (de Fo) dressa une on plaa
de trente de la
la chapelle on coudes (20) : au-dessus taient, des
colonne
et l'extrieur des images de Fo. L'intrieur taient dissants comme du cristal. Il y eut des philosophes aux Cha men le sjour de ce lieu. qui disputrent se soumirent tion. faut une condition et doit firent tre le en commun Si ce lieu,
cts, quatre polis et resplenhtrodoxes (21) Les une Cha men
conven-
dirent-ils,
tmoignage qu'un fini ce discours, quand fit entendre un grand
surnaturel le lion qui
des Cha men, il sjour le donne connatre. Ils avaient tait sur le sommet de la colonne
les hrtiques furent la nourriture Fo, ils reurent corps exhala les hommes une odeur
ce tmoignage, (22). En voyant rugissement saisis de frayeur, et se soumettant de coeur divine bien (23). Pendant diffrente ils firent une une trois mois, leur
cleste
du sicle
(24); et comme ce lieu lev
de ce qui a lieu pour l leurs ablutions, on de bains l'endroit : ce bain o la
a par la suite construit dans subsiste encore. On a aussi religieuse Dans mendiante o Yeou Fo
maison tour
dans
le temps
Fo. pho lo rendit le premier hommage on btit une tour tait au monde, dans
126 l'endroit o les o trois il avait Fo du coup
FO ses
KOU cheveux pass avait on
KL et ses ongles assis et o des o (25); dans avec l'on celui
temps qu'il partout
(26) s'taient parcourus construisit
wen (27); dans des images
les lieux des Fo;
Chy kia avait rig qui toutes
tours,
subsistent roi lev religieux en des
encore dieux
aujourd'hui. Fan descendirent Dans ces
A l'endroit la suite endroits, il
le seigneur Chy et le de Fo, on a pareillement y avoir ensemble mls mille, tant et mangent avec ceux qui
une
tour. que
compagnie, la petite. tudient Dans blanches abondant, champs, et l'endroit fut en en
religieuses, ceux de
qui tous la grande des
peut demeurent translation
du
leur
sjour bienfaiteur. tomber garantissant
faisant les
un dragon (28) oreilles religieux, C'est lui qui rend le pays fertile et propos une pluie sur les douce de toutes calamits. Il procure le
aux religieux, repos une ont construit prparent hommage. ble , trois pelle forme blanc. crme trne du aussi Les
et ceux-ci,
chapelle des aliments
reconnatre ses bienfaits, lui pour avec une estrade Ils l'y placer. pour heureux et lui rendent pour le dragon chaque prendre termin, deux jour, leur le dans repas leur dans assemla chala de
religieux
choisissent
personnes
dragon. d'un petit Quand dans un les
qu'ils envoient Leur tant sjour serpent religieux de dont l'ont cuivre. les
oreilles ils lui
dragon prend sont bordes
reconnu, Le o
bassin au bas
et vient des
de l'estrade
dragon il se promne
de la prsentent descend du haut du l'air ayant il disparat. de
avoir fait le tour, Il Aprs anne. Ce royaume est fertile et abondant fois chaque en Le peuple toutes sortes de productions. riche et y est nombreux, sans comparaison ailleurs. Des gens de tous que partout plus joyeux prendre sort une informations. pays leur manquent est ncessaire. ne pas d'y accourir, et on leur donne tout ce qui
Au nord nomm
du temple, cinquante yeou yan (29), il y a un temple Terme ou Limite du feu (3o). Limite du feu est le nom d'un
CHAPITRE mauvais gnie. Fo convertit
XVII.
127
qui sont venus en ont fait un l'eau dont
et les hommes jadis ce mauvais gnie, ont bti une chapelle en cet endroit, et ils aprs don aux A lo han. Il (Fo) se lava les mains avec de on les voit encore par terre; elles rej^araissent et toujours dans cet endroit une tour de et d'arroser, de balayer de l'oeuvre des hommes. Un roi de
tombrent gouttes quelques dans ce lieu : on a beau les balayer, ne se desschent pas. H y a en outre Fo, manire qu'un bon gnie avait coutume
qu'il n'y avait pas besoin tu peux faire de la sorte, dit : Puisque pervers je vais assembler une arme dans cet endroit; grande qui sjournera j)Otirras-tu de mme le fumier et les ordures enlever qu'elle y amassera Le gnie fit souffler a cent petites tours journe ment. ct mais sible un grand dans cet vent qui enleva mais on et purifia tout.
endroit;
les compter, qu'on n'en connatrait Si l'on veut absolument le savoir,
passerait exactepas le nombre on jlace un homme de ces hommes; qu'il six ou prenait la roue endroit est impossept cents sa nourrid'un seul char. n'en les sont
Il y toute la
on fait ensuite de chaque le conrpte tour.et il y en a tantt de sorte moins, plus et tantt d'en avoir une connaissance exacte.
Il y a un Seng kia lan (3i) qui peut contenir Pi tchi foe (32) C'est dans ce lieu qu'un religieux. ture. La terre du Ni houan (33) est grande comme cet Les autres endroits de l'herbe; produisent produit habits pas. Il en est de mme dans le lieu Les (34); il n'y crot sur la terre, marques comme autrefois. pas d'herbes. et ces traces raies
o l'on des
a fait scher vtements
subsistent
encore
prsent
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
(i) Seng Ma chi.] On ne peut gure douter que Seng kia chi ou Seng kia che ne du Samkassam ou Samkassa des livres pli". Hiouan tsang, soit la transcription qui visita le temple o l'escalier de Bouddha tait conserv, nomme Ki pi tha le pays o ce temple existait de son temps, ainsi que ceux qu'on avait levs Brahma et Indra, pour avoir accompagn Bouddha son retour du ciel : l'identit La position de Seng Ma chi et de Ki pi tha est constate par ces rapprochements. de ce pays, par rapport Mathour et Kanoudje, rsulte galement du double tmoignage de Hiouan tsang et de Chy f hian, et elle doit rpondre au district actuel de Feroukh. abcl. (2) Au ciel de Tao li.] C'est le Trayastrinsha ou ciel le lieu de l'habitation d'Indra et des trente-deux dieux pendance. Il occupe la seconde place dans le monde dsirs, et par consquent dans l'ordre des vingt-huit posent un universh. C'est donc comme si l'on disait que des trente-trois, c'est--dire qui sont placs sous sa dinfrieur, dit le monde des cieux superposs qui comBouddha monta au second
ciel. Ces trente-trois dieux sont autant d'hommes qui, dans les gnrations antrieures, ont mrit, par des actions vertueuses, de renatre en cet endroit avec la qualit divine c. La dure de leur vie est fixe mille ans dont chaque jour vaut cent de nos annes d, ce qui fait trente-six millions d'annes. Au bout de ce temps, ils meurent et renaissent en d'autres qualits, infrieures ou suprieures celles des habitants du Trayastrinsha, selon qu'ils ont acquis ou perdu sous le rapport du mrite moral. C'est ce qui fait qu'on rencontre, dans les lgendes, des personnages qui ont t Indras ou Brahmas, ou telle autre divinit, dont le nom n'indique pas un tat dfinitif et invariable, une fois acquis pour toujours au mme individu, mais une qualit passagre laquelle chacun peut parvenir son tour. Selon la cosmographie tibtaine, la ville habite par les trente-trois dieux est de forme carre; son circuit est de 10,000 clPag thsacl ou ko milles romains; les murailles , formes d'or pur, ont 2 dPag thsacl ou 10 milles de hauteur. Le palais est plac dans le milieu de la ville; il a 1000 dPag thsacl de tour. Aux quatre angles sont des jardins dlicieux dans l'un desquels est un lphant six trompes, tte rouge, et qui conduit une troupe d'un million d'animaux de la mme espce. Les dieux ont des pouses qui leur donnent des fils, lesquels sont conus , naissent et grandissent au mme instant. Leur stature est de 2 5o Dom pa ou quadruples coudes 0. Suivant un livre bouddhique, sur le sommet du mont Sou mcrou est la demeure Pallas, Sammlung. Tibet,pag. A82. u. s. f, Alphab. tom. II, pag. 46. c San tsang J sou, liv. XLVII, pag. 26 v. d u. s. tom. VIII, pag. /i/|. AlDesliauterayes, Tibet, loc. cit. phab. c Tibet,ut supra. Alphab.
' Abhidhna, sectiondes villes, si. 2-5.Prdjiha, fol. 8,1.6. Cesdeuxcitationsme sontcommuniquespar AI.E. Burnouf. 11 n 2. ComparezVocabul. prnlagl.secl. XLIX, sur la religion de Foe, Deshauterayes, Recherches dans le Journal asiatique, tom, VII, pag. 314
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
129
des dieux. L, il y a une ville nomme Glien hian ou la bonne apparence, dans laquelle demeure Indra. Cette ville a mille portes; elle est magnifique et remplie des plus riches ornements. Le palais qu'elle renferme surpasse tout ce qu'on peut imaginer de plus prcieux. Aux quatre angles de la ville, il y a quatre tours ou pavillons, les plus beaux qui se puissent voir, construits en or, en argent et en autres matires prcieuses. Hors de la ville, de chacun des cts de la muraille, il y a un jardin de forme exactement carre, dans le milieu duquel est un lac nomm Jou i [ conforme aux dsirs), et dont l'eau a huit agrables proprits : elle est pure, frache, douce, lgre, limpide, tranquille, dsaltrante et nutritive. C'est l que les dieux vont prendre le plaisir de la promenade. Le premier jardin s'appelle le jardin des chars, parce que quand Indra et les autres dieux vont s'y promener, des chars prcieux y paraissent d'eux-mmes pour leur servir. Le second est le jardin des objets grossiers et mauvais, ainsi nomm de ce que des cuirasses, des lances et d'autres armes s'y prsentent d'elles-mmes quand Indra et les dieux veulent combattre. Le troisime est le jardin des forts mlanges, parce que toutes sortes d'objets agrables et charmants, propres rcrer les dieux, y naissent et se prsentent eux quand ils s'y promnent. Le quatrime est le jardin de la fort dlicieuse, ainsi appel parce que tout ce qui peut, flatter les sens s'y trouve en foule et produit une joie parfaite laquelle ne se mle aucun ennui \ (3) En faveur de sa mre.] Mah my ou la dame, comme l'appellent les Bouddhistes, fille de Keou li cha ti et femme du roi Tsin fan [Shoudclhodana), mourut sept jours aprs la naissance de son fils Shkya. Mais en considration du mrite d'avoir port dans son sein le matre [magisler) des dieux, elle naquit de nouveau dans le Trayastrinsha, o elle l'ut reue parmi les dieux. L'un des cinq devoirs que Tathgata avait remplir, tait de prcher la loi sa mre. Ainsi donc, aprs qu'il eut accompli la doctrine, il ne songea plus qu' la bont de cette mre qui l'avait nourri (dans son sein) ; mais outre la profondeur de son affection, il avait encore pris l'engagement de retourner pour sauver son pre et sa mre. C'est pourquoi il voulut prcher pour celle-ci et lui faire obtenir la dlivrance; ce fut dans celte intention qu'il monta dans le palais du ciel au Trayastrinsha^. [k) Ses facults surnaturelles.] On a dj vu (chap. VI, note 5) quelques dtails sur la puissance surnaturelle attribue aux saints du bouddhisme. L'expression du texte (jt|}' %& pntration divine) est ici la mme que dans le trait relatif aux facults des Brahmatcharis, rapport ci-dessus (chap. X, note k) ; et au lieu de dix puissances, on compte six facults seulement. On pourra comparer ce qui a t dit prca A tha mo, Ta pi piphocha lun, cit dansle San tsang J sou,liv.XVI, pag. io v. Thseng y Ahan king, cit dansle San isang J sou,liv.XIX, pag. 23. *7 h
130 demment ce sujet,
FOE
KOUE
KL rapporte dans un autre trait
avec l'explication
suivante
religieux. Chin (spirituel, surnaturel, divin) se dit de l'me ou de la pense des dieux; Tlioung (pntration, se dit de la nature intelligente. Ce qui fait intelligence) qu'on pntre et qu'on voit la manire des dieux s'appelle Chin tlioung' 1. i L'oeil divin. On nomme ainsi la facult de voir tous les tres, vivants ou morts, aux six conditions ; savoir : celles des dieux, des hommes, des qui appartiennent Asouras, des dmons de la faim, des brutes et des enfers. De voiries signes de la douleur et de la joie de ces tres, et tous les corps, de quelque espce qu'ils soient, qui se trouvent dans tous les mondes, sans prouver ni obstacle ni empchement. 2 L'oreille divine. Quand on la possde, on entend toutes les paroles de joie ou de tristesse que prononcent les tres appartenant aux six conditions, et tous les sons et bruits, de quelque espce qu'ils soient, qui ont lieu dans le monde. 3 Connaissance de la pense des autres. C'est la facult de connatre ce que pensent, dans le fond de leur coeur, tous les tres des six conditions. k Connaissance de l'existence. On appelle ainsi la facult qui fait qu'on sait tout ce qui a rapport sa propre existence, une, deux, trois gnrations de distance, et jusqu' cent, mille, et dix mille gnrations, et tout ce qu'on a fait durant ces diverses existences; que l'on connat celles de tous et de chacun six conditions, ainsi que toutes leurs actions. des tres des
5 Le corps volont. Cela veut dire qu'on peut passer corporellement en volant sans prouver d'obstacle; disparatre dans par-dessus les mers et les montagnes, ce monde et reparatre dans un autre, ou rciproquement; de grand devenir petit, de petit devenir grand, et enfin changer de forme volont. 6 La fin du dgouttement [ "W- fyjfo stillationis finis). Cette expression singulire, le dgouttement, l'coulement par gouttes, dsigne les erreurs de la vue et de la pense dans les trois mondes. On entend par les erreurs de la vue, les divisions ou distinctions qui naissent du rapport de la racine du mens la poussire de la loi (voyez pag. i52) ; et par les erreurs de la pense, les dsirs et les affections qui naissent du rapport des cinq racines de l'oeil, de l'oreille, du nez, de la langue et du corps, avec les cinq poussires de la couleur, du son, de l'odeur, du got et de la tactilit. Les Arhan dlivrs des erreurs de la vue et de la pense obtiennent les facults surnaturelles, parce qu'ils ne reoivent plus la naissance ni la vie dans les trois mondes h. (5) Leurs facults divines.] Il y a ici j^jjW Ing lo king, cit clansle San tsang J sou, liv. XXVI,pag. 7 i.. " [force) suffisante des dieux. Com-
F kia tseuii, cit dans le San tsangJ sou, Cf. liv. XLI, pag. 11. liv. XXVI,pag. 7 verso.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
131
parez ce qui est dit de ces facults surnaturelles, prcdente.
chap. VI, note 5 , et dans la note
(6) A na liu.] L'un des dix grands disciples de Shkya et celui qui tait renomm pour sa vue perante : il avait l'oe/7divin \ Son nom s'crit plus exactement Ana liu tlioh, ce qui en sanscrit signifie inextinguible; il tait ainsi nomm, parce qu'ayant autrefois pratiqu l'aumne, il avait mrit de renatre parmi les hommes et les dieux, et d'y jouir d'un bonheur inextinguible. 11 tait cousin de Bouddha c, et second fils du roi Hou-fan; il embrassa la vie relioieuse la suite de Shkya. On explique aussi son nom par exempt de pauvret 11.On l'crit ailleurs A ni leou teou et A neou leou tho, et on le traduit par -^^'S conforme aux voeux quatre-vingt-onze kalpas avant Shkya, [anuvrata?), parce que, trs-anciennement, il tait n parmi les hommes et les dieux, avec le don d'une flicit qui comblait tous ses voeux ". (7) La vue des dieux.] Voyez ci-dessus, chap. VI, note 5, n 2; la note k sur le prsent chapitre, n 1, et la prcdente note. (8) L'honorable du sicle.] En sanscrit Lokadjyeshtha. Voyez chap. XVI, note 3i. le
en sanscrit Manggalyana, (9) Mo lian] est le mme que Mo kian lian, sixime des dix grands disciples de Shkya. Voyez chap. X, note k(10) Le Yan feou thi. ] Le Djambou dwpa. Voyez chap. XII, note 7.
Ce nom parat tre la transcription du sans(11) La mendiante Yeou pho lo.] crit outpala, et signifier lotus, nympha bleu f. Il n'est question du trait attribu cette religieuse par Chi f hian, ni clans le Si yu tchis, ni dans les autres lgendes chinoises que nous possdons sur la vie de Shkya. : c'est la Dans le texte, jEjfttfn^(12) Saint roi faisant tourner la roue.] traduction de Mah tchakravarti rclja, dnomination qui revient celle de moce titre pompeux, qui n'est complnarque universel. C'est ici le lieu d'expliquer tement dfini nulle part, pas mme dans l'Histoire de Sanang Setsen h. Le Saint Roi de la Roue est celui qui domine sur les quatre continents (compaliv.XIX, la Grande Encyclopdie japonaise, Voyez pag. 8. '' San tsang J sou, liv. XXI, pag. 23 verso. 0 San tsang J sou,liv. XLI, pag. i3 verso. d Che kiapou, citdansleSantsang J sou, 1.XVI, pag. i4. ' panking,heoujen, cit dans le Santsangf sou, liv.XV,pag. i3 verso. 1 Sanisangj sou, liv. XIX, pag. 26. BVoyez la descriptiondu paysdeKie ci-dessous pi tha. h Gesch. der Ost-Mongolen, c. i, p. 7, 3o4 et pass. 17" Ai
132
FOE
KOUE
KL
rez chap. XII, note 7 ) \ Il jouit de quatre avantages spciaux qu'on dcore du nom de vertus : 1 Il est trs-riche ; il possde une grande abondance de trsors, des champs, des habitations, des esclaves des deux sexes , des perles et des pierres prcieuses, des lphants, des chevaux. Nul homme sous le ciel ne peut l'galer. 20 II est d'une beaut sans pareille. 3 Il n'est jamais malade et jouit d'un calme parfait, k" Sa vie se prolonge au del de celle de tous les autres hommes h. Quand il sort pour se promener, il est suivi et gard par quatre sortes de troupes : des hommes monts sur des lphants, des hommes cheval, des hommes sur des chars, et des fantassins qui marchent pied et revtus de cuirasses et de casques 0. On sait que, selon les Bouddhistes, l'ge des hommes est sujet une suite d'accroissements et de diminutions, dont la rvolution complte s'appelle un petit de la vie humaine en porte la dure kalpa. Le plus grand accroissement 84,ooo ans. Quand il s'est coul cent ans, elle diminue d'un an, et dcrot dans la mme proportion d'un an tous les cent ans), jusqu' ce qu'elle (c'est--dire ait atteint la dure de dix ans : c'est ce qu'on appelle le kalpa (ou la priode) du dcroissement. Il se passe encore cent ans, aprs quoi elle augmente d'un an, ou, comme on dit, le fils vit le double de la vie de son pre; car si celui-ci a vcu dix ans, le fils en vit vingt. C'est cette priode que l'on nomme le kalpa de l'accroissement. Cet accroissement va jusqu' 84,000 ans, et c'est alors qu'il parat un roi de la roue d'or, qui nat dans une famille royale ; il obtient la dignit suprme en succdant son pre, et en se faisant baptiser avec de l'eau des quatre ocans. Pendant quinze jours il se baigne dans des eaux de senteur et garde le jene; puis il monte sur une tour leve, entour de ses ministres et de ses courtisans. Tout d'un coup une roue d'or parat du ct de l'orient, rpandant une vive et admirable clart, et vient se placer dans le lieu o est le roi. Si le roi veut aller l'orient, la roue tourne de ce ct, et le roi, accompagn de ses troupes, la suit. Devant la roue, quatre gnies lui servent de guides. L o elle s'arrte, le roi en fait autant; et la chose a lieu de la mme manire, au midi, l'ouest et au sepla roue jusqu'au point o elle parvient. Dans tentrion, o on suit pareillement les quatre continents, il invite les peuples suivre les dix bonnes voies, c'est-dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultre, ne point mentir, ne point avoir la langue double, ne pas calomnier, ne pas parler avec une lgance recherche, ne pas se livrer ses dsirs, ne point prouver de colre ni de haine, ne point avoir de vues dshonntes. On le nomme roi de la roue d'or, ou saint roi qui fait tourner la roue. Il a en sa possession sept choses prcieuses, savoir : * On trouve d'amples renseignements sur les SaintsRoisde la Roue, dansle Foepenhingtsyking, livre sacr o sont recueilliesles actionsdu Bouddha, cit dans le San tsang J son,liv.V, pag. 2 v. h Leouthan king, cit dans le San tsang J sou, liv. XVI, pag. 12 verso. c A hanking( le longAgama),citdansle Tchang Sein tsang j sou, liv. XIX, pag. 16.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
133
i Le trsor de la roue d'or, aussi nomm seigneur victorieux [72. g] jl*^-)Cette roue a mille rayons; son diamtre est d'une toise et quatre pieds (4m,27o). Le moyeu et les jantes sont sculpts et cisels avec des ornements prcieux qui jettent un grand clat; c'est l'ouvrage des artisans du ciel, et rien dans le monde n'en approche. On appelle son possesseur le saint roi quifait tourner la roue, parce que ds qu'il l'a obtenue, la roue, selon la pense du roi, tourne et parcourt successivement l'univers en roulant. 2 Le trsor de l'lphant blanc, aussi nomm la montagne bleue (h-g ) Le saint roi de la roue tant, le matin, venu son palais, il y a un lphant blanc qui parat tout d'un coup sa vue; son corps est tout entier d'un blanc uni, et sa tte de couleurs mlanges; il a dans la bouche six dents, qui sont de la couleur des sept choses prcieuses. Il est si robuste qu'il peut voler en l'air; et quand le roi l'a mont, il peut en un jour faire le tour de l'univers, partir le matin et revenir le soir, sans prouver ni peine ni lassitude. S'il passe une rivire, l'eau n'en est pas agite, et ne mouille pas mme ses pieds. (On voit ici, pour le dire en passant, pourquoi les monarques de l'Inde ultrieure mettent tant de prix avoir un lphant blanc dans leurs curies, et prennent le titre de possesseur de l'lphant blanc. Ce titre quivaut celui de souverain du monde.) 3 Le cheval pourpre, aussi nomm vent fort et rapide. Ce cheval est d'une teinte entre le rouge et le bleu. Le saint roi de la roue tant, de grand matin, venu son palais, il y a un cheval de couleur violette qui se prsente tout d'un coup sa vue. Ses crins sont passs dans des perles, qui tombent quand on le lave et qu'on l'instant, plus fraches et plus brillantes qu'aul'trille, et qui se reproduisent paravant. Quand il hennit, on l'entend la distance d'un yodjana. Il a une force suffisante pour voler. Quand le roi le monte pour parcourir le monde, il part le matin et revient le soir, sans prouver aucune lassitude. Tous les grains de poussire que touchent les pieds de ce cheval se convertissent en sable d'or. 4 Les pertes divines, aussi nommes nuages o la lumire est recele. Ces perles s'offrent subitement la vue du saint roi de la roue, comme les objets prcdents. Leur couleur et leur eau sont parfaites, sans taches et sans nuances. Suspericlues en l'ail* pendant la nuit, elles clairent de leur lumire les grands et les petits tats; et l'intrieur du jour. comme l'extrieur, elles jettent une clart pareille celle pare et et frais l'odeur
5 Le trsor de la fille de jaspe [~f~ -^ ), autrement appele la vertu admirable. Elle est doue d'une beaut exquise. Son corps est tide l'hiver l't. De tous ses pores s'chappe le parfum du santal; sa bouche exhale du lotus bleu. Ses paroles sont douces, et sa dmarche est pose. Ce qu'elle
mange se dissipe et s'vapore ; elle n'est sujette aucune des impurets des autres femmes du monde.
134 6 Le docteur des richesses
FOE
KOUE
KL
( HyTJE.), autrement les grandes richesses, ou le docteur des trsors. Quand le roi de la roue dsire possder les sept sortes de richesses, le magistrat charg des mines ou trsors se tourne vers la terre, et la terre produit les sept choses prcieuses; ou vers l'eau, les montagnes, les pierres, el l'eau, les montagnes ou les pierres produisent galement les sept choses prcieuses. Le livre intitul Agama ajoute que le fonctionnaire qui remplit cette et que ses yeux peuvent apercharge est sous l'influence d'une haute prosprit, cevoir les trsors qui sont cachs dans la terre, soit qu'ils aient ou n'aient pas de matre. S'ils en ont un, il veille leur conservation ; s'ils n'en ont pas, il s'en empare pour l'usage de son souverain. 70 Le gnral d'arme, aussi nomm l'oeil sans tache, ou officier charg de la conduite des troupes. Quand le saint roi de la roue veut avoir quatre sortes de troupes, au nombre de mille hommes, de dix mille ou mme jusqu' un asankhya sont est se il n'a qu' tourner les yeux, et dj les troupes (une quantit innombrable), ranges dans le plus bel ordre. Le livre Agama dit encore : Cet officier habile et prudent, brave et intrpide, consomm dans les ruses de guerre. Il prsente seul et revient dire au roi : Seigneur, si vous avez des ennemis
a combattre, ne vous affligez pas. Vous voulez quatre sortes de troupes, des hommes monts sur des lphants ou sur des chars de guerre, des cavaliers ou des fancitassins. Je puis les mettre votre disposition \ Lorsque Sidclarlha (Shkya mouni) vint au monde, il possdait dans sa physionomie des signes qui prsentaient une alternative des plus heureuses, au jugement des astrologues. Si le prince reste dans la maison (s'il mne une vie laque), dirent-ils, il deviendra saint roi de la roue, et possesseur des quatre continents ; car les rois de la roue ont dans leur extrieur les trente-deux beauts [Laks'apa)h, S'il sort de la maison (s'il embrasse la vie reliet le prince les possdait. gieuse), continurent-ils, qu'il ddaigne la dignit royale pour chercher la doctetr in e [bodhi), il deviendra infailliblement Bouddha, et recevra le titre de guide \fa) \ [Ift}^f^-f Le livre intitul Long Agama ne parle que du roi de la roue d'or, possesseur du mais si l'on s'en rapporte au Kiu trsor dont on vient de faire rnumration; che lan (livre qui parat tre une partie de VAbhidharma), il y a quatre rois dcors a universel du signe de la roue; ce sont : i Le roi de la roue de fer. Il parat l'poque o la vie de l'homme, aprs avoir touch au terme de sa plus grande brivet (dix ans), est revenue, par une suite d'accroissements successifs, 20,000 ans. Il ne rgne que sur les royaumes de son seul continent mridional ou Djambou dwpa. Si quelqu'un rsiste son * Sieou hingpeukhi king,cit dans le San tsangf sou, liv. XXX, pag. 11. Vocab. pentagl.sect. m. ' Foe penhingtsyking,liv. V, pag. 2.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
135
influence bienfaisante, le roi fait clater sa puissance, l'obligea se soumettre, et tablit ensuite la pratique des dix bonnes voies. 2 Le roi de la roue de cuivre. Il parat quand la dure de la vie des hommes est reporte 4o,ooo ans. Il commande deux continents : l'oriental ou Feiu tha; et le mridional, Djambou divpa. Il agit comme le prcdent; et par sa puissance et sa vertu, il convertit tous ceux qui se sont carts de la bonne voie. 3 Le roi de la roue d'argent. 11 se montre quand la vie des hommes est arrive 60,000 ans. Il commande trois continents, savoir: ceux qui ont t nomms ci-dessus, et de plus au continent occidental ou Kiuye ni. Si parmi les royaumes il en est un qui rsiste son influence, il le subjugue et y qui s'y trouvent, rtablit par la force la pratique de la vertu. 4 Le roi de la roue d'or, qui gouverne les quatre continents a, ainsi qu'on l'a vu plus haut. (1 3) Des sept choses prcieuses. ] On en a vu ci-dessus i'numration, note 4(i4) chap. XIII,
Le roi des dieux, Fan;] dans le texte, J_S^H\' ^ Y a r^n& ans cIue j'ai expliqu pour la premire fois ce mot. chinois1'. Les missionnaires n'avaient jamais interprt le Fan, que Deguignes avait toujours rendu vaguement par Indien", et auquei il parat avoir attribu la signification de preces d. Il y a donc longtemps qu'on sait que Fan est, en chinois, l'quivalent du mot sanscrit Brahma, et que l'on dsigne aussi par ce terme l'criture et la langue sanscrites, ainsi que les livres composs dans cette langue. Mais la vritable tymologie de cette expression se trouve pour la premire fois dans mes Observations sur les Mmoires de Deguignes . Elle m'a t fournie par un seul passage d'un livre bouddhique, car on n'emploie et jamais ce mot Fan que sous cette forme abrge, qui le rend mconnaissable admise. Fan est la contraction de J|t tf^'W* Fan lan ma, qui est universellement transcription de Brahma f. Le sens de ce mot est exempt de dsir ou pur s. Brahma est, dans le systme bouddhique, le premier des vingt dieux qui sont nomms comme ayant des fonctions et une protection exercer l'gard des autres tres. On lui donne le titre de roi. Son corps et son me sont galement remplis d'une majest parfaite et d'une puret exempte de toute imperfection. Il est strict observateur des prceptes, clair, et sait gouverner la troupe des BrahI San tsang J sou, liv. XVI, pag. 11. II Del'tudedes chezlesChinois, langues trangres dans le Magasinencyclopdique d'octobre1811. asiat.Paris, 1826,tom. II, pag. 2/42. ComparezML Rech.surleslangues larlares,tom. I, pag.373. c Mm.del'slcad.elesinsc.etbcll.leit.t. XL, pass. ll Aouii. Joum.asiat.tom.VII, pag. 298. ' Mpag-=991 Thiantchouan Histoiredes dieux cil dans le ( ), Santsang son, liv. )3. XIA'I, pag. f e kl. ibid.
136 mas secondaires.
FOE
KOUE
KL
C'est lui qui, dans le F houa king, est appel seigneur du Savaloka [Chi khi : ce mot signifie le vertex ou le tubercule du sommet de la tte et aussi le feu), grand Brahma qui gouverne le grand chiliocosme, c'est--dire la plus grande des trois agrgations d'univers, contenant mille millions de soleils, de Sou mcrou, de continents quadruples de ceux que nous voyons a, etc. D'autres distributions du Panthon bouddhique prsentent situation un peu moins releve. Il y occupe, soit par lui-mme, et ses ministres, les trois cieux de la premire contemplation, Brahma dans une
soit par ses sujets dans le monde des formes [Ropya valchara), c'est--dire le septime ciel, le huitime et le neuvime en montant du mont Son merou. Dans le septime est la troupe ou l'arme de Brahma [Brahmciparipaty). Les ministres de Brahma [Brahmapourohila) sont dans le huitime; et le neuvime est le sjour du grand Brahma lui-mme [Mahbrahmana). A compter de cette manire, Brahma serait bien loign d'tre le suprme seigneur du grand chiliocosme, puisque le petit chiliocosme est recouvert par les cieux de la deuxime contemplation laquelle il est rapport, et que ce petit chiliocosme est compris un million de fois sous le ciel de la quatrime contemplation, qui recouvre le grand chiliocosme. Le Savaloka a un sens encore plus vaste, toutes les parties des trois mondes; puisqu'on runit sous cette dnomination savoir : le monde des dsirs; les dix-huit cieux du monde des formes, rapports la premire, la seconde, la troisime et la quatrime contemplation; et le monde des tres sans formes. Les Bouddhistes du Nipal comptent, clans le monde des formes, treize cieux sujets Brahma, et parmi lesquels il y en a quatre dont les noms expriment plus cette dpendance ; savoir: Brahma- Kyik, Brahma- pourhta, particulirement Brahma-prashdy et Mah-Brahmanah. Un sloka du Poudja-Kanda, ouvrage moderne compos dans le Nipal, mais, ce qu'on assure, d'aprs des autorits respeca produit Brahma tables, donne penser que Padma-pani (Avalokites'wara) pour crer, Vishnou pour conserver, et Mahsa pour dtruirec. Un autre livre plus ancien porte que le soleil et la lune naquirent des yeux d'Avalokites'wara, Mahadeva de son front, Brahma de l'intervalle de ses paules, Vishnou de sa poitrine, Paras vati de ses dents, Vyou de sa bouche, Prithvi de ses pieds, et Varouna de son nombril" 1. Aprs la cration de ces divinits, est-il dit ailleurs, Avalokites'wara leur adressa la parole en ces termes : Toi, Brahma, sois le seigneur de la vertu Salya, et cre ; toi, Vishnou, sois le seigneur de la vertu Radjas, et conserve ; toi, Mahsa, sois le seigneur de la vertu Tamas, et dtruis \ Selon Sarvadjna Mitrapada, religieux du Cachemire, les trois divinits indiennes sont
" Thianichouan (Histoiredes dieux), cit dansle San tsang J sou, liv.XLVI, pag. i3. '' Transacl. tom.II, pag. 233. ofthcasiatic Society, " Id. ibid.
Kranda Vyoha,cit par M. Ilodgson dans le mmemmoire,pag. 2/12. c Gounakranda,cit le mme, par pag. 248.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
137
nes avec les mmes circonstances, mais du sein du Pracljn suprme (ou de la pense divine ) a. On reconnat aisment que l'origine assigne Brahma dans ce passage tient du Nipal, que M. Hodgson nous a expos au syncrtisme brahmanico-bouddhique le premier. Les Bouddhistes, dont nous avons les livres en chinois, ne regardent nullement Brahma comme un dieu crateur, et mme ils placent l'ide de la cration du monde par Brahma au nombre des neuf erreurs sur ce point, lesquelles, disent-ils, sont enseignes par les hrtiques. Les docteurs qui suivent les Vdas, tiennent que le dieu Nryana a pu engendrer les quatre familles (les Brahmanes, les Kshatryas, les Vesyas et les Soudras); et que sur ce nympha est le dieu que de son nombril est n un grand nympha, Brahma, surnomm Xaeul, parce qu'il est le grand-pre de tous les tres. Brahma a eu la puissance de crer tous les tres vivants et non vivants. Ils estiment donc que ce dieu est ternel, qu'il est unique, qu'il est la cause de toutes choses, et mme la cause du nirvn'ah, c'est--dire de l'tat absolu o l'on conoit la nature, la formation de l'univers, et la naissance, tant des individus que antrieurement des rapports qui les lient entre eux. On verra plus bas quelques dtails au sujet de ces opinions htrodoxes c. les dieux de la troupe de Brahma habiSuivant la cosmographie bouddhique, tant le premier ciel de la premire contemplation dans le monde des formes, ont 875 clom-pa ou quadruples coudes, et vivent la moiti d'une rvolution du monde; les ministres de Brahma, dans le ciel immdiatement suprieur au pront 1000 clom-pa et vivent les trois quarts d'une rvolution; les grands ont 1126 Brahmas, enfin, dans le troisime ciel de la premire contemplation, clom-pa, et accomplissent la dure d'une rvolution entire, c'est--dire une priode de 1,344,000,000.d'annes a, ou, suivant un autre calcul, six fois le cours entier des neuf ges de l'homme, ce qui fait un nombre d'annes bien plus considrable r, et qu'on aurait peine exprimer avec des chiffres. Ailleurs on donne Brahma cdent, une vie de 60 petits kalpas, c'est--dire de 1,008,000,000 d'annes*. Les Tibtains ont rendu, dans leur langue, le nom de Brahma par celui de Thsangs-pa, dont la composition rpond l'ide de puret que les Bouddhistes attachent au mot sanscrit. Les Tartares le remplacent par celui 'Esroun, qui semble tre form de celui d'Isnren [Is'ivara), et avoir t transport de l'une des personnes de la Triinoiirti l'autre. (i5) Un chasse-mouche.] Le chasse-mouche d ou poussetoir est un des instru-
I Sarakadlira, cit l mme. II Iloa yan king,sonsou yanyi tchhao,cil dansle Santsangf sou, liv.XXXV,pag. 3. la note 20 sur les opinionsdes ci-dessous Voyez hrtiques.
Tibet, dans Alphab. pag. /18/1.Deshaulerayes, leJourn.asiat.tom.VIII, pag. /|4 " Cf. Tibet,u. s. et pag. /171. f FoAlphab. isoutoungki, cil dans le San tsang J sou, liv. XVIII, pag. 11. l8
138
FO
KOU
KL
form d'un manche et d'une touffe de poils de la ments du culte bouddhique, les religieux livrs queue d'un cerf, de poils d'ours, ou de soie rouge. Celui que la contemplation tiennent la main, est de couleur blanche : on peut en voir une figure dans l'Encyclopdie japonaise \ (16) Le seigneur Chy.] Indra. Voyez chap. IX, note 2.
dans le bouddhisme, (17) Une foule de dieux.] Le mot de dieux est consacr, les rgions leves du pour dsigner les tres suprieurs l'homme, qui habitent monde des dsirs, ainsi que le monde des formes et celui des tres incorporels ; mais ce mot ne doit pas tre pris dans le sens que la mythologie d'Occident y a sont des tres imparfaits, limits dans leur attach. Les dieux du bouddhisme pouvoir et dans la dure de leur existence, parmi lesquels on peut esprer de renatre en pratiquant la vertu, mais que les hommes eux-mmes peuvent suret passer en atteignant le rang d'Intelligence purifie (Bouddha et Bodhisattwa), en s'affranchissant des vicissitudes de la naissance clans les trois mondes. Leur nom en sanscrit est Dva. Les Tibtains les appellent Lah. Les Chinois n'ayant pas, dans leur langue, de mot qui s'applique en particulier l'ide d'un tre incorporel et de nature divine, les dsignent par le terme qui signifie ciel, Thian. A leur exemple, les Mongols les ont nomms Tagri, et les Mandchous Abka, ce qui signifie la mme chose. On distingue quatre sortes de dieux : Les dieux du monde, ou les rois, qui, tout en habitant parmi les hommes, reoivent l'influence d'un bonheur cleste. Les dieux par naissance; ce sont les tres qui, par la pratique des prceptes et des ont mrit de renatre parmi les vertus, ou par l'exercice de la contemplation, dieux des trois mondes : c'est de ceux-l qu'il est surtout question en ce moment. Les dieux de puret, ou les hommes des deux translations, c'est--dire les Shravakas et les Prcdyeka-Boucldhas, qui, en prit) , suppriment les erreurs des de puret. Les dieux de justice, perfection morale, accompli le la contemplation du vide (de l'essens et de la pense, et atteignent un haut degr s'attachant
huit classes d'tres vivants moins levs, les Mahoragas ou dragons terrestres; les Kinnaras, gnies cornus et musiciens d'Indra; les Garoudas, oiseaux aux ailes d'or; les Asoaras, les Gandharvas, autres musiciens d'Indra; les Yakshas, les Ncgas ou dragons, et les Dvas ou dieux. Ces derniers sont des tres clestes, qui jouissent d'une haute flicit, dont le corps est pur et clatant de lumire, et qui mritent d'tre honors d'une
ou les Bodhisattwas qui ont, par dix genres de sens de toutes les lois de la dlivrance 1. Les suprieurs l'homme sont, en commenant par les
Liv.XIX, pag. 12. " Tatchi tonlun, liv. XXII, el Livre, du Nirvana,
liv. XXI, cits dans le San tsangf sou, liv. XVI, aussiliv.XI, pag. i 5. pag. 8 verso. Voyez
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
159
vnration sans gale. Ils sont les plus levs dans les cinq conditions (les dieux, les hommes, les damns, les prtas et les brutes), trs-suprieurs ( l'homme), Ils trouvent en eux-mmes les causes de leur joie; trs-grands, trs-respectables. rien ne contrarie leurs dsirs. Ces avantages sont la rcompense de la conduite pure qu'ils ont mene jadis". La couleur blanche leur est attribue, cause de la puret de leurs actions; de l vient que les mtaphores qu'on leur applique sont tires de la couleur blanche, et aussi du ct de l'occident o cette couleur est suppose dominer h. Leur nombre est trs-considrable; mais ils ont pour chefs Brahma, le seigneur du Sou merouc. du grand chiliocosme, et Indra, prince des trente-deux dieux
Anciennement on ne comptait que seize dieux principaux, dont on avait les images, et dont chacun avait son influence et sa domination particulire. Par la suite, on en a ajout quatre : le soleil, parce qu'il dissipe l'obscurit; la lune, parce qu'elle claire la nuit; So kie, roi des dragons, parce qu'il tient cach le trsor de la loi (ci-dessous, note 27); et Yan ma lo, parce qu'il rgne dans les tnbres. Il faut faire connatre par quelques mots ces dieux du Panthon bouddhique, d'aprs les mythographes chinois. i Le roi des dieux, Fan ou Fan lan ma. Voyez ci-dessus, note i 42 Le roi du ciel, Indra. Voyez ci-dessus, note 16. 3 Pi cha men ou le glorieux. Ce dieu est ainsi appel, parce que la renomme de sa gloire et de sa vertu est rpandue de toutes parts. Il est le roi des dieux de la partie du nord, habitant moiti de la hauteur du Sou merou, au quatrimesur la paroi de cristal. Il comtage de cette montagne, du ct du septentrion, mande des myriades innombrables de Yakshas ou gnies valeureux, et il a le nord sous sa protection. Les Mongols l'appellent Bisman tgri. 4 27' theou la tho ou Thi to lo tho, le protecteur des royaumes, ou le pacijicaleur des peuples. Ce dieu, dont la puissance est favorable aux royaumes terrestres , est le roi de la partie orientale du ciel. U habite moiti de la hauteur du Soumerou, au quatrime tage, du ct de l'est, sur la paroi d'or. Il commande aux Ganclharvas ou musiciens d'Indra, et aux Foiiclannas ou dmons qui et c'est lui qui prsident aux fivres. Il a le ct de l'orient sous sa domination, procure la paix et le repos aux peuples. En mongol, Ortchilong letkoiiklchi. 5 Pi leou le tcha ou Pi lieou li, dont le nom signifie grandeur accrue, pour exprimer que sa puissance, sa majest et ses vertus s'accroissent des autres. Ce dieu habite au mme tage du Sou merou Voyezi article Ou tao, ou les cuuj conditions, Tching J nian tchouliing,cit dans le San tsang j sou,liv. XXIII, pag. 20. '' Yuan kiu king li sou Ichhao,livre qui ne fait a et accroissent celles que les prcdents,
pas partie de la collectionsacre, cit dans le San tsang J sou,liv. XXIII, pag. 21 verso. c Fan i ming y, liv.II, citdansleSantsang J' sou, liv. XXXIII,pag. )3 verso. l8.
140
FOE
KOUE
KL
mais sur le ct mridional, et sur la paroi de saphir [Lieou li). Il commande aux Kheou phan tho [Kumbhnda?), et d'autres gnies et dmons en nombre infini. Il prside au ct du midi. Les Mongols l'appellent Ulumtchi treltou. 6" Pi lieou po tcha ou Pi lieou pho tcha, dont le nom se traduit de deux manires : langage ml, parce qu'il peut parler toutes sortes de langues; grands yeux, parce que ses yeux sont beaucoup plus grands que ceux des hommes. Ce dieu habite la mme rgion que les prcdents, mais sur le ct occidental du Sou merou, et sur la paroi d'argent. Il commande aux dmons nomms Pi che tche [Fisatchas), et des quantits innombrables de dragons et d'autres-dmons. Il garde le ct de l'occident. C'est le San boiisou nidoutou des Mongols. Ces quatre derniers dieux sont appels les quatre rois du ciel. Ils sont les ministres d'Indra. On les nomme aussi les protecteurs du monde, cause du rle qu'ils sont appels jouer \ 70 Kin kang mi tsi, c'est--dire en chinois, le dieu qui tient la main une massue prcieuse de diamant ( Vacljra pni), et qui connat fond toutes les actions et toutes les dmarches des Tathgatas. Il y eut, dans les anciens temps, un roi qui donna le jour mille fils et deux de plus. Les mille premiers atteignirent galement au rang de Bouddhas, et toutes leurs penses se au perfecrapportaient tionnement de la doctrine. Mais les deux plus jeunes ne la connaissaient pas. L'un des deux fit un voeu. Si mes mille frres ans accomplissent la loi, s'cria-t-il, puiss-je devenir dmon pour les attaquer et leur nuire! L'autre, au contraire, demanda d'tre un guerrier en tat de les dfendre. C'est ce dernier qui devint Kin kang ou Facljra pn'ih. Il commande cinq cents Ye cha [Yakshas) et autres gnies, qui tous sont de grands Bodhisattwas. U habite avec eux sur le sommet des monts les plus levs, et tous ensemble sont les protecteurs de la loi des mille Bouddhas du kalpa des sages, c'est--dire de la priode actuelle. 8 Ma i cheou lo [Mah Ishwara), le grand seigneur, ou comme d'autres traduisent, la majestueuse Intelligence. Quelques-uns lui donnent trois yeux, parce qu'il est le seigneur le plus vnrable des trois mondes. Le Fou hing M dit ce sujet : Le dieu du monde des formes a trois yeux et huit bras. Il est mont sur un boeuf blanc, et tient la main une poussette blanche. Il est dou de beau coup de force et de majest. Il habite dans le lieu o rsident les Bodhisattwas, et peut connatre le nombre des gouttes de pluie qui tombent dans un grand chi liocosme. Il gouverne un grand chiliocosme, et dans les trois mondes il est le plus clitme d'tre honor. 9 Le grand gnral Sa tchi ou 5a tchi sieou ma : ce nom signifie silence, repos jg. La collection des Dharanis ou formules contient un passage o il est dit que ' F houamen h Otchir-bani kia, liv.II, cit dansle Santsangfei en mongol.Voyez u. s. f. Sammlung. sou, livre XVI, pag. 9 verso.-Comparez tom. II, pag. 101. Pallas, Summl. /lui'.Xaclinchlen, loin.II, pag. 40.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
.141
la mre des dmons eut trois fils : le premier nomm We che wen, le second le gnral Sa tclii, et le plus jeune Mani pa tho, lesquels peuvent protger tous les tres dans tous les mondes de l'espace, carter d'eux tous les vices et toutes les erreurs. Ils habitent sur la terre ou dans l'air. Chacun d'eux a cinq cents officiers qui lui sont attachs, et vingt-huit classes de dmons et de gnies qui en dpendent. Partout o la doctrine sacre se rpand, ils s'y rendent pour protger ceux qui la prchent, loigner d'eux les maux, et les maintenir dans la paix. Ils les favorisent du triple repos du corps, de la bouche et de l'esprit, faisant en sorte dans leur que toutes les saveurs et les manations les plus subtiles pntrent corps par les pores; que de belles paroles et une loquence qui ne s'interrompt pas leur bouche; et que l'activit, le courage et la pntration fortifient leur esprit. Ils font aussi que ceux qui entendent prcher la loi, reoivent le bonheur qui appartient aux hommes et aux dieux, et puissent obtenir promptement le bodhi. Tels sont les bons offices qu'ils rendent en rcompensant les vertus et en ornent punissant les vices. i o Le grand discerneur, ainsi nomm cause de sa haute intelligence et de sa profonde pntration, il demeure dans les endroits les plus escarps des montagnes, ou dans les antres et au fond des forts. Dans les lieux o il habite, il a toujours la tte haute, un seul pied, huit bras et un bel extrieur. 11 tient un arc, des flches, un sabre, une lance, une longue massue, une roue de fer. Indra et les autres dieux l'honorent beaucoup et clbrent ses louanges. Il est pourvu d'un il protge le discernement que rien n'arrte ; et dans toutes les circonstances, monde, vient au secours des tres, rpand la doctrine de Bouddha, sans jamais se lasser, raison de son intelligence et de ses dons heureux. Par la lumire qu'il rpand sur les assembles religieuses, il est le plus favorable de tous les dieux. i i Le dieu des vertus ou des mrites, ainsi nomm dans le livre du Nirvana et dans la collection des Dharanis, et appel le premier en majest, promoteur des actions vertueuses, grand dieu des mrites, dans le Kouang ming king et le Sa tchiphin. C'est en lui que le Tathgata Kin chan tchao ming (lumire de la montagne d'or) a plac les semences de toutes les vertus qui ont attir sur lui toutes sortes de Sa figure et son extrieur sont admirables. Il rpand le bonheur bndictions. et les vertus sur tous les tres. 11 habite dans un magnifique jardin qu'on nomme Pavillon d'or. Il fournit tout ce qui est ncessaire ceux qui prchent la loi. et se plat les combler sans relche de tous les dons de la vertu et de la science. 12 Le gnral, dieu des FVei ou We to [ Vclas) ; ce dernier mot signifie discours de science. Le Ling we yao lio dit que ce dieu, nomm FF'e et surnomm Khuen, est l'un des gnraux soumis au roi des dieux du midi [Pi. leou le tcha, ci-dessus, n 5). Il y a ainsi trente-deux gnraux sous les ordres des quatre rois des dieux, et celui-ci est le premier de tous. Il est dou d'une
142
FOE
KOUE
KL s'affranchir
grande intelligence; il a su, de bonne heure, a adopt une conduite pure et brahmanique virginit et des actes pleins de sincrit. Au reu les instructions de Bouddha. Il dfend sa trois continents (le Djambou dwpa, le Viclha et
des dsirs des sens; il [Fan hing), et s'est consacr la lieu des volupts des dieux, il a religion au dehors, et protge les le Goyeni), au grand avantage des tres vivants qu'il convertit et qu'il secourt en foule. Aussi toutes les fois qu'on on y place sa statue que l'on adore en considration btit un kia lan (temple), de la glorieuse protection qu'il accorde la religion. i 3 Le gnie appel Terre de solidit. La solidit est la qualit de ce qui est de ce qu'on ne peut briser, comme le diamant. Le mot de terre indestructible, indique que ce gnie a des mrites profitables au monde, et que l'on peut comparer la grande terre qui soutient tout, produit les arbres, les plantes, les grains et toutes les choses prcieuses. Il garde et dfend tous les lieux o la doctrine est de la loi, fait prouver ceux Il porte sur sa tte les prdicateurs rpandue. qui l'entendent le got d'une douce rose, et accrot les forces de leur corps. Dans le Ti tsang king, Fo dit au gnie de la terre : Toutes les terres du Djambou dwpa reoivent ta protection. dance. Tu protges la doctrine mrites sont galement grands. i 4 Le gnie de l'arbre Bodhi Tout ce que la terre produit est fourni en abonde Bouddha. Dans le sicle et hors du sicle, tes
ou de l'intelligence : il est constamment veiller sur les lieux o les Tathgatas accomplissent la doctrine, et c'est de l que vient son nom. Il parle de lui-mme en ces termes dans le Sou chi in : Je songe con tinuellement Bouddha ; je jouis la vue de l'honorable du sicle. J'ai fait voeu de ne pas m'carter du soleil de Bouddha. Il montre ainsi sa puissance et son attention le suivre jusque dans ses actions les plus minutieuses et les plus subtiles ; il couvre de sa protection tous les tres vivants, et leur assure les avantages coi'porels; c'est pourquoi les livres sacrs sont remplis de ses louanges, et clbrent ses mrites immenses. 15 La desse mre des dmons. Cette desse a eu mille fils. Le plus petit, : il avait coutume nomm 'Ai non, tait celui qu'elle chrissait le plus tendrement de dvorer les enfants des hommes. Fo convertit cet A nou et le cacha sous sa marmite. La mre le chercha au ciel et parmi les hommes sans pouvoir le dcouvrir. Elle se soumit alors ( Fo), et Fo relevant sa marmite, lui rendit son plufils. Ces mille enfants sont devenus les rois des dmons, et commandent sieurs lgions de dix mille dmons. Il y en a cinq cents au ciel, toujours occups sduire et tourmenter les dieux, et cinq cents dans le monde, qui s'at sduire les peuples. Fo a donn ( la mre des dmons) tachent pareillement les cinq prceptes pour la ramener la bonne loi; elle est devenue Protapanna", et elle habite dans les chapelles de Fo. Les hommes qui n'ont pas d'enfants s:a' Voyez ci-aprs, notc3i.
NOTES dressent
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
143 font des prires et Fo, elle appela ses offenser les hommes
elle pour en obtenir. Ceux qui sont malades lui recouvrent la sant. Aprs qu'elle eut reu les prceptes de mille fils et les engagea s'y soumettre avec elle, et ne plus ni les dieux. i 6 Ma litchi, ainsi nomm d'un mot qui signifie flamme
du jour [Yangyan), parce que son corps ne peut tre ni aperu ni saisi. Ce dieu marche toujours devant le soleil et la lune. Il protge les royaumes et les peuples, et dlivre ceux-ci des fureurs de la guerre et des autres calamits. Il y a dans le livre du dieu Ma li tchi une phrase d'une extrme efficacit; c'est celle-ci : An! o grand Ma li tchi so po ho [Oml Maritchi swcih). Tout homme qui possde cette formule peut suffire tout; une force surnaturelle lui est assure, et on peut se reposer sur lui. 170 Le fils des dieux qui habite clans le palais du soleil. Ce dieu, tandis qu'il tait dans les liens des causes (dans le monde), pratiquait l'aumne, observait les prceptes, cultivait la vertu et honorait Bouddha. C'est ainsi qu'il a mrit de renatre parmi les dieux. Son palais a des murailles qui sont ornes des matires les plus prcieuses, et cinq tourbillons l'entranent, sans lui permettre de jamais s'arrter. Il tourne circulairement, moiti de la hauteur du Sou merou, et claire les quatre continents. Quand il est le milieu du jour dans celui qu'on nomme Djambou dwpa, le soleil commence se coucher clans le Videha, il se lve pour le Goyeni, et il est minuit dans YOitttara Kourou. C'est ainsi qu'un seul soleil claire quatre continents, en carte la nuit, dissipe les tnbres, favorise la maturit de toutes choses. Tels sont ses grands et rels mrites. C'est le mme dieu qui est nomm, dans le Fa hoa king, fils des dieux de la prcieuse lumire. 18 Le fils des dieux du palais de la lune. Le dieu qu'on nomme ainsi s'est acquis les mmes avantages que le prcdent, en pratiquant les mmes vertus. Son palais est pareillement orn de matires prcieuses, et entran autour du mont Sou merou par cinq tourbillons, de manire clairer les quatre continents. La pleine et la nouvelle lune ont lieu de la manire suivante. Au commencement de la lune blanche (l'apparition), le soleil est devant. Au commencement de la lune noire (la conjonction), le soleil est par derrire. Suivant que le reflet du soleil est couvert ou darde ses rayons, il y a pleine et nouvelle lune : c'est ce qu'on nomme l'approche du soleil; et quand le reflet du soleil se couvre, alors le disque de la lune est en dcours. Or, la lumire de la lune verse de douces et secrtes influences sur tous les tres ; elle claire la nuit. Les services qu'elle rend viennent aprs ceux que procure le soleil. C'est le mme dieu qu'on nomme, dans le Fa hoa king, fils des dieux de la brillante lune. i g0 So ko lo [Sgara), c'est--dire mer sale (Ocan), nom qu'on traduit aussi par roi des dragons; c'est le septime des cent soixante et dix-sept rois des dragons qui sont dans la mer sale. Il est le seul que l'on cite maintenant, parce qu'il est au
144
FOE
KOUE
KL
et qu'il habite dans les dix terres", c'estrang des plus puissants Bodhisattwas, -dire qu'il a parcouru les dix degrs qui conduisent les saints de cette classe la perfection. H se montre sous la figure d'un dragon, et il fait son sjour dans la mer sale. Quand il doit pleuvoir, c'est lui qui d'avance tend les nuages et veille ce que la pluie soit galement distribue. Il suit les assembles de Fo, protge sa loi et les peuples, et s'acquiert ainsi de grands mrites. Son palais , orn des sept choses prcieuses, ne diffre en rien de celui des dieux. dont le nom signifie roi double, ou selon d'autres, roi unique : 2 0 Yanmalo, roi double, parce que ce roi et sa soeur cadette sont les souverains des enfers; roi unique, parce qu'il est charg seul de ce qui concerne les hommes, et que sa soeur cadette a le soin de ce qui est relatif aux femmes. On traduit aussi son nom par celui qui apaise les querelles, parce qu'il met fin aux disputes des pcheurs. On prtend que c'est un Bodhisattwa qui a pris cette forme pour l'avantage des tres vivants. Le Tching f nian king contient un gatha adress aux hommes par Yan et vous ne cultivez ma lo en ces termes : Vous avez reu un corps d'homme, pas la doctrine : c'est comme si vous entriez dans un trsor et que vous en sor tissiez les mains vides. A quoi sert de pousser maintenant des cris pour les peines que vous endurez, puisque vous recevez en retour de ce que vous avez fait vous-mme ? Le Livre des rois dit : Le roi Yan [ Yan ma lo) doit, dans l'avenir, devenir Bouddha, et il s'appellera Phou wang Jou lai, le Tathgata roi universel. u Tel sera l'excellent effet de la transformation de ce Bodhisattwah. Son nom du sanscrit Yama. On nomme ce dieu actuel Yan ma ou Ye ma est la transcription en tibtain gChin otche, en mandchou Ilinoun khan, et en mongol Erlik khakan. Outre les vingt dieux qui viennent d'tre nomms, il y en a beaucoup d'autres simplement les qui n'ont pas de rle mythologique jouer, ou qui remplissent divers tages clestes. Tels sont les trente-deux compagnons d'Indra, qui habitent avec lui le sommet du Sou merou, et qui ont fait donner la rgion o ils sont le nom de Trayastrinsha ou ciel des trente-trois. Ce sont trente-trois personnes qui, ayant contribu ensemble des bonnes oeuvres, ont mrit de renatre en cet endroit. Elles occupent autant de. palais, disposs par huit chacun des quatre angles et le seigneur du ciel, Indra, a le sien dans la partie centrale. On du Soumerou; ne connat pas le nom des dieux du Trayastrinsha; mais on sait qu'Indra tait leur chef au temps de l'ancien Bouddha. On nomme encore Yema, en sanscrit Yma (diffrent du Yama des enfers), en tibtain Thab bral [celui qui est loign de la guerre, ou selon la traduction chinoise, bon temps, parce qu'il chante et se rjouit sans cesse), un dieu qui est parvenu, par la pratique de l'aumne et des prceptes, l'emporter mme sur les I l'ocab. pentagl.sect.xi. II Histoire desdieux, ouvrage qui ne fait paspartie de la collectionsacre,cit dansle Santsang J sou, liv. XLVI, pag. i3.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
145
trente-trois 11.En rcompense, il a t lev au troisime ciel du monde des dsirs. Viennent ensuite les dieux du Tous'ita ou ciel de la connaissance suffisante, et des autres cieux, en remontant jusqu' ceux des Brahmas et du grand Brahma roi, qui nat le premier au commencement de chaque kalpa, et meurt le dernier la fin de ce mme kalpa. Enfin, on donne encore le nom de dieux tous les tres qui habitent les autres tages clestes, lesquels, joints ceux dont on a dj parl, sont au nombre de vingt-huit. On peut voir ce que les Tibtains rapportent de leur taille, de la dure de leur vie, et de quelques autres particularits qui les concernent1'. Les auteurs chinois que j'ai pu consulter, fournissent beaucoup moins de dtails sur ce sujet. Quelque suprieurs que soient les dieux aux passions humaines, il en est une dont ils ne sont pas compltement exempts, au moins dans les rgions infrieures. Ceux qui habitent dans les deux tages terrestres, sur les flancs et au sommet du mont Sou merou, c'est--dire les rois des quatre points cardinaux et les trente-trois, ne sont pas trangers la distinction des sexes : aussi s'unissent-ils la manire du sicle. Les dieux du Yma se propagent par de simples embrassements; ceux du Tous'ita, par l'attouchement des mains. Ceux du ciel de la joie de la conversion ont si peu de dsirs, qu'ils se bornent des sourires qu'ils changent entre eux. Et enfin les dieux du sixime ciel, o l'on convertit autrui, n'prouvent presque aucun sentiment de concupiscence; les regards mutuels sont les seules marques de dsir qu'ils s'adressent les uns aux autresc, et ce moyen suffit leur propagation d. Dans le monde des formes, les dix-huit tages clestes sont pareillement habits par des dieux de divers rangs. A la premire contemplation sont les Brahmas, ou le peuple des Brahmas, sujets du grand Brahma roi, purs, exempts de souillures et de dsirs; les ministres de Brahma, ou ses compagnons; le grand Brahma roi, aussi nomm Sikliie. La puret est l'attribut commun de ces trois sortes de dieux. A la seconde contemplation, il y a aussi trois cieux, dont les habitants ont pour caractre la lumire, faible dans le premier, immense dans le second, et leur tenant lieu de voix dans le troisime. Les trois sortes de dieux de la troisime contemplation jouissent, selon les mmes degrs, d'une puret de pense qui leur procure une joie cleste, ineffable, immense, universelle. Tous ces dieux habitent clans l'espace, et reposent sur des nuages. Au-dessus d'eux viennent les dieux de la quatrime contemplation, rpartis dans neuf cieux diffrents. Celui d'en bas est appel sans nuage, parce que les dieux qui l'habitent n'ont plus besoin de l'appui que les nuages prtent aux dieux infrieurs. Le ciel immdiatement suprieur est " lu kia sseti lun. h Tibetanum, Giorgi,Alphabclnm Roma;, 1762, iu-.'i, pag. /|83 sqq. c Thianta ssehiaoi tsy tchu,livrequi ne fait pas partie de la collectionsacre, citdansle San tsang fa sou, liv.XXII, pag. 22. '' Tibet. loc. cit. Comparez Alphab. c note 1!\. Voyez *9
146
FO
KOUE
KL
celui des grandes rcelui de la vie heureuse. On trouve ensuite, en remontant, compenses; le ciel o il n'y a pas de rflexion, c'est--dire o les dieux, pendant toute la dure de leur vie, sont exempts du travail de la pense; le ciel sans fatigue, le ciel o les dieux ont atteint le terme de la pense, pures intelligences sans soutien, sans localit, libres, exemptes de trouble; le ciel des dieux qui voient admirablement tous les mondes rpandus dans l'espace; celui des dieux pour qui tout est prsent et manifeste, sans restriction et sans obstacle; enfin l'/lghaniclit, ou le ciel des dieux qui ont atteint le dernier terme de la tnuit de la matire. On s'est efforc, comme il est facile d'en juger, de graduer les genres de perfection de ces dix-huit classes de dieux, en entassant les ides de puret, de lumire, de pntration, de repos et de subtilit, et on n'y a crue trs-imparfaitement russi; car il se trouve, dans cette classification, des rptitions et des incohrences; elle est d'ailleurs sujette varier chez les diffrents auteurs. Quelquesuns placent, au-dessus de l'Aghanicht, le ciel du suprme seigneur, Mahs'waravasanam \ il y a encore quatre classes de dieux: Dans le monde des tres immatriels, ceux qui, fatigus des liens de la substance corporelle, rsident dans le vide ou ceux qui n'ont de lieu [substratum) que la connaissance, l'immatriel; parce que le vide est encore trop grossier pour eux; les dieux qui n'ont pas de lieu; et les derniers de tous, placs au sommet du monde des tres immatriels, qui n'ont ni les attributs des dieux non pensants et sans localit, ni ceux qui appartiennent aux dieux dont la connaissance est l'unique localit b : dfinition qui ressemble de l'claircir en cet endroit. Il trop du galimatias pour que j'entreprenne faut remarquer que cette longue classification ne comprend pas les Bodhisattwas, ni surtout les Bouddhas, dont les perfections morales et intellectuelles sont infiniment au-dessus de celles de tous les dieux des divers ordres. leur rang dans la hirarchie La dure de la vie des dieux est proportionne qui vient d'tre expose. Un Indra, roi des dieux du Sou merou, mythologique d'annes. Un grand Brahma roi gale, par sa longvit, une grande vit 36,ooo,ooo d'annes. Un dieu de lai quatrime contemrvolution du monde, i,344,000,000 plation [exempt de pense) voit se succder cinq cents rvolutions pareilles c, et un habitant du dernier ciel du monde incorporel en traverse quatre-vingt mille. Le P. Horace ll et Deshauterayes " ont fait connatre ces divers degrs de longvit, sur lesquels je crois superflu de m'arrter. Au reste, il ne faut pas croire que cette longue dure de la vie soit regarde comme un privilge qui ne soit joint aucune privation pour les dieux qui en jouissent; car, par exemple, le dieu qui vit cinq " Vocab. sect.Lin, n g. penlugl. '' Thian la sse hiao i, cit dans le San tsangJ 26. sou, liv. XLVII, pag. 0 Wemosochoue king,cit dans le San Isanu J sou, liv.XXXIII,pag.g. d Tibet. Voyez " Joum.Alphab. asiat.tom. VIII, pag. <i/i.
NOTES cents rvolutions
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
147
du monde sans penser, est clans l'inaction, comme une personne dans la glace, et durant ce temps il est priv de l'avantage de voir emprisonne des Bouddhas et d'entendre prcher la religion : aussi, beaucoup d'hrtiques qui ont pratiqu la vertu renaissent dans celte qualit a. Les dieux tant astreints la ncessit de natre et de mourir comme les autres tres, bien qu'en parcourant des priodes immenses, il y a pour eux des signes de dcadence qui leur annoncent une fin plus ou moins prochaine. Ils cessent de faire entendre des chants joyeux, la lumire dont brille leur corps s'affaiblit et s'teint. Dans leur tat ordinaire, une huile parfume, pareille celle du lotus, garantit leur poitrine du contact de l'eau : quand leur gloire est sur son dclin, l'eau commence mouiller leur corps, et ils ne sont plus secs quand ils sortent du bain. Habituellement rien n'arrte leur marche et ne retarde l'excution de leurs volonts : ils prouvent des retards et des embarras. Leur vue qui s'tendait sans obstacle tout un grand chiliocosme, s'affaiblit et leurs yeux commencent clignoter. Ce sont l les cinq petits signes de la dcadence de leurs facults 1; il y en a cinq grands qui prsagent leur mort prochaine. Les dieux sont ordinairement revtus d'une robe lgre, du poids de six tcha (le tchu est valu dix grains de millet), qu'on nomme cause de cela tchuyi; cette robe est toujours propre et brillante de l'clat de la nouveaut : quand leur bonheur s'puise, et que la dure de leur vie va se terminer, leur robe se tache d'elle-mme, et c'est un des grands symptmes de la dcadence des dieux. Ils ont sur la tte des couronnes de fleurs ou de pierres prcieuses, des plumes et des ornements de diffrentes couleurs : ces fleurs se fanent et se desschent. Leur corps, form d'une substance si subtile et si pure, commence laisser chapper de la transpiration et des humeurs. Les parfums d'une suavit inexprimable qu'il exhalait, se changent en vapeurs ftides. Ils cessent de se plaire dans le sjour qui leur appartient, malgr les dlices qui y sont runies c. Il y a cinq actions ou rgles de conduite qui procurent l'homme l'avantage de renatre parmi les dieux, et tous les tres vivants peuvent pratiquer ces actions: i avoir le coeur compatissant, ne pas tuer les tres vivants, prendre piti d'eux, leur assurer du repos; 2 suivre la sagesse, ne pas voler le bien d'autrui, faire l'aumne, se garantir de l'avarice, secourir tous les ncessiteux; 3 tre pur, ne pas se rendre coupable de volupts extrieures, garder les prceptes, observer le jene; 4 tre sincre, ne point tromper autrui, se garantir des quatre pchs de la bouche (le mensonge, l'affectation dans le langage, la duplicit, la calomnie), ne jamais flatter; 5 un homme qui honore la bonne loi, et qui marche solideh F yuantchulin, liv. cit dans le San V, tsang J sou,liv. XXII, pag. 2c l. ibid. 19.
J'Ve mosoclioue king,cliap.P nan, ou deshuit circonstances malheureuses,cit dans le San tsang J sou,liv. XXXIII,pag. 10.
148 ment clans la voie brahmanique la raison \
FOE
KOUE
KL qui enivrent et troublent
, ne boit pas de liqueurs
Il y a cinq signes qui annoncent qu'un homme va renatre parmi les dieux : i Une vive lumire recouvre son corps; et comme celui-ci est nu, l'me fait cette rflexion : Pourvu que les autres dieux ne voient pas ma nudit. Mais l'instant mme elle parat aux yeux des autres tre vtue, bien qu'en ralit elle ne le soit pas. 2 En dcouvrant les choses qui sont dans le ciel, l'homme conoit des penses exet apercevant clans les bosquets et les jardins clestes des objets qu'il traordinaires; n'a jamais vus, il les regarde et les considre de tous cts. 3 Il est frapp de confusion l'aspect des filles du ciel; et la vue de leur beaut, il n'ose les des autres dieux qu'il aperoit, il regarder en face. 4 Il est tent d'approcher rflchit, il hsite et cloute de ce qu'il doit faire. 5 Lorsqu'il veut s'lever dans l'espace, il lui vient des craintes; il ne monte pas haut, il ne s'loigne pas beaucoup ; il ctoie les murailles ou reste appuy sur la terre h. (18) Le roi A yeou.] Asoka. Voyez chap. X, note 3.
'> (19) Six toises,] environ i8m, 3o. On lit dans les deux textes : "fJLjE ~^yZ ce qui semblerait signifier plutt six statues debout, hautes d'une toise. Mais la phrase serait incorrecte et ne prsenterait qu'un sens invraisemblable. (2 o) Trente coudes. ] La mesure dont il est parl ici est le H'^j" tcheou ou coude. Sa longueur a vari : on l'estime tantt deux tclihi (om, 610), tantt un tchhi et deux tsun [ om, 4575 ). Quatre tcheou valent un koung (arc), et trois cents koung font un li. Le li, d'aprs ce calcul, serait de 549, ou mme de 732. (2 1) Des philosophes htrodoxes.] Dans le texte : ppS^jta" yv*' H est frquemment parl des philosophes htrodoxes dans les livres bouddhiques : le plus souvent on doit entendre par l les Brahmanes; quelquefois il peut tre quesde quelques autres sectes orientales. Leurs discustion, sous cette dnomination, sions avec les Samanens sont l'objet de mentions multiplies dans les rcits qui se rapportent la vie de Shkya mouni et de ses successeurs. La relation de Soung yan et celle de Hiuan thsang constatent les avantages que les Brahmanes fini par remporter sur leurs adversaires, aux vic et vne sicles, et la dcadence correspondante de la religion de Bouddha clans les rgions moyennes, occidentale et septentrionale de l'Hindoustan. Il ne sera question ici que des opinions des hrtiques en tant qu'elles paraissent se rapporter aux premiers temps du bouddhisme. tchetseuso wenking, kingou Piani tchang cil liv. XXII, pag. 18 verso. a Pian i Tching J niantchou king,liv. XXXIX,cit dans e San tsang J sou, liv. XXII, pag. 19. 1 avaient
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
149
On compte six hrsiarques principaux, dont le coeur dprav, les vues perverses et la fausse prudence, qui ne se rapportait pas la vritable doctrine, ont enfant les erreurs. Le principe de toutes les hrsies remonte . Kia pi lo (le Jaune, en sanscrit Kapila); mais elles se sont divises en branches, et leur propagation en a fait natre six principales : i Fou lan na kia che. Fou lan na tait le titre de cet hrsiarque ; on n'en donne pas la traduction. Kia che [Ks'yapa) tait le nom de sa mre, et devint son nom de famille. L'hrsie fonde joar cet homme consiste anantir toutes les lois : il ne reconnat ni prince, ni sujet; ni pre, ni fils; ni droiture de coeur, ni pit filiale. Il appelle cela forme et vide (ther). La forme, selon cet hrtique , brise tout ce qui est clans le monde des dsirs ; le vide brise tout ce qui est dans le monde des formes : le vide est donc le fate suprme, l'tre au-dessus de tous les tres. 2 Mo kia li Mu che li. Mo Ma li (en sanscrit, non viclens raiionem) est le titre de cet homme. Kiu che li, dont on ne donne pas le sens, est le nom de sa mre. Il pensait faussement que les maux et le bonheur des tres vivants ne dcoulent mais que ce bonheur et ces maux viennent pas de leurs actions antrieures, d'eux-mmes. Cette opinion sur la spontanit des choses, est une erreur qui exclut la succession des causes. 3 C/ia?i tche ye pi lo tchi 11. Chan tcheye [Sandjaya) signifie recta Victoria; c'est le titre de cet hrtique. Pi lo tchi [Vciiragi], non agens, est le nom de sa mre. Son hrsie consiste penser qu'il n'est pas ncessaire de chercher la doctrine [bodhi) dans les livres sacrs, et qu'elle s'obtient d'elle-mme quand le nombre des kalpas et de mort est puis. Il pensait aussi qu'aprs quatre-vingt mille kalpas la doctrine s'obtient naturellement. 4 A khi to hiu che khin pho lo. A khi to hiu che tait le titre de cet hrtique; on n'en donne pas la signification. Khin pho lo est son surnom : Khin pho lo [Kambala) veut dire vtements grossiers. Son. erreur tait de supposer qu'on peut forcer la destine, obtenir, par exemple, le bonheur dont la cause n'est pas dans l'existence antrieure; que la doctrine consiste porter des vtements grossiers, s'arracher les cheveux, exposer ses narines la fume, et son corps la chaleur de cinq; cts (des quatre cts du corps, et. avoir de plus du feu sur le sommet de la tte), se soumettre enfin toutes sortes de macrations, dans l'espoir que le corps ayant, dans la vie prsente, souffert toutes sortes de maux, on obtiendra, dans un corps futur, un ternel bonheur. 5 Kia lo Meou tho Ma tchin yan. Kia lo Meou tho, litre de cet hrtique, signifie encolure de boeuf. Kia tchin yan, nom de sa famille, veut dire cheveux rass. Son erreur, assez mal dfinie, consistait dire que, parmi les lois, les unes sont accessibles aux sens, et que les autres ne le sont pas. Chantouye ou Chantcheye. de naissance
150
FOE
KOUE
KL
6 Ni kian tho j thi tseu. Ni Man tho signifie exempt de liens; c'est le titre commun des religieux htrodoxes. Celui-ci tenait de sa mre le nom de J thi, dont on ne donne pas la signification. Cet hrtique disait que les pchs, le bonheur (les vertus), les maux et la flicit taient dtermins par la destine, et que selon qu'on y tait soumis, on ne pouvait viter de les recevoir; que la pratique de la doctrine ne pouvait en garantir. C'est dans cette ide que consistait son hrsie ". On nommeiKs, c'est--dire, manires de voir particulires, opinions nonces, hypothses, les ides que les hrtiques adoptent sur certaine partie de la loi. Us prennent, clans les diverses doctrines, des choses fausses pour vraies, et des vrits dans leurs explications, et s'cartent de la pour des erreurs; ils s'embrouillent droite raison. H y a sept vues de cette espce. La premire consiste calomnier la vraie loi, l'attaquer sans preuve, traiter d'erreur l'opinion sur la rtribution des bonnes et des mauvaises actions, sur la vritable origine des six sens et des six. qualits sensibles; la rapporter, par exemple, au dieu Brahma ou aux atomes. La seconde est la vue du moi, qui pose la personne comme une sorte de seigneur et matre, toujours existant par sa propre force, constituant le moi (l'individualit) ; on ignore que cette personne n'est autre chose que la vaine et fausse runion des cinq skcindha h. La vue de la dure perptuelle mconnat la variabilit de la personne et du corps, ainsi que de tous les tres extrieurs, lesquels sont tous, sans excepet retournent l'extinction. Ceux qui admettent la tion, sujets la destruction, vue de la terminaison, ne savent pas que les lois (de la nature) sont toutes rellement spirituelles, ternelles, indestructibles; ils les croient sujettes un terme, et imaginent faussement qu'aprs la mort, le corps ne sera plus renatre. La cinquime vue s'appelle proeceplorum furtam ou visionis captio natuavoir
sujet : elle consiste mconnatre les vritables prceptes fonds par les Tathgatas, et suivre quelques mauvais prceptes par lesquels on se distingue et on se spare des autres pour y faire des progrs; comme par exemple, quand, se persuadant qu'on a t, clans une existence antrieure, au rang des boeufs ou des chiens, on s'astreint ne se nourrir que d'herbes ou d'objets impurs, ce qui s'appelle suivre le prcepte du boeuf ou du chien. On acquiert vritablement ainsi quelques lgers mrites, mais on se persuade qu'ils sont suffisants. On se livre une vie des choses. Parla drgle, et l'on nglige d'observer le vritable enchanement sixime vue, appele fructuum furtam, mconnaissant ce mme enchanement, ainsi que les fruits qu'on est en droit d'attendre de ses actions, on puise d'excellentes rsolutions clans une conduite blmable, et l'on s'vertue pour obtenir les mrites de la macration, en s'exposant nu aux impressions du froid , aux ardeurs 'Tho lo ni isyking(CollectiondeDhranis). Fany mingi, cildans le San tsangJ sou, liv. XXVII, '' sect.xxxm. pag. 11. Vocab. penlagl.
NOTES de la flamme
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
151
et du soleil (ce qu'on nomme les cinq chaleurs), en se souillant avec des cendres, en couchant sur des herbes pineuses; et le faible mrite qu'on retire de toutes ces actions, on se l'exagre par une fausse persuasion cru'il n'en est point de suprieur. Enfin, la septime vue, qu'on appelle du doute, consiste tantt la non-individuaprendre dans toutes les opinions, tantt l'individualit, lit , tantt la dure ternelle , tantt la non-ternit, sans pouvoir se fixer sur ces ides ni sur les autres du mme genre a. On assure ailleurs que les opinions htrodoxes ne dpassent pas en ralit le nombre de quatre ; mais les vues sont en cet endroit nonces d'une presque nigmatique. Les partisans du systme des nombres [sankhya), n'admettent parmi les causes et les effets que l'unum, et non le diversum. systme suprieur n'y voient que le diversum. Ceux de Le so pho [Rishabna manire dit-on, Ceux du
) admettent galement l'imam, et le diversum. Ni kian tho j thi tseu repousse galement l'unum et le diversum h. Il est, faute d'claircissements, difficile de dire s'il est ici question de logique ou de cosmogonie. Les hrtiques se divisent pareillement sur l'identit du moi et des cinq [skandlia)c. Les uns croient que le moi et les cinq skandha existent galement; les autres crue ni le moi ni les cinq skandha n'existent. D'autres encore, pour viter lec deux erreurs prcdentes, assurent que le moi et les cinq skandha existent et n'existent pas, et tombent ainsi clans une contradiction manifeste. Les derniers, enfin, pour s'carter de cette contradiction, disent, par une sorte de jeu de mots, que le moi et les cinq skandha ne sont ni existants ni privs d'existence d; difficult dont le bouddhisme orthodoxe peut seul donner la solution. Les hrtiques varient encore sur la dure du moi : il en est qui pensent que le moi des gnrations prcdentes est le mme que celui de la gnration actuelle, sans aucune interruption, et ils tombent par l dans l'erreur de la perptuit. D'autres supposent que le moi d' prsent a commenc dans la gnration actuelle, et n'a point son origine dans les prcdentes; ils ne le croient donc pas ternel, et ils tombent ainsi dans l'hypothse de l'interruption. Il en est qui posent que le moi est ternel, et que le corps ne l'est pas; mais de cette manire, le corps tant mis part, il n'y a pas de moi; c'est donc encore une ide errone. Enfin, d'autres remarquent que le corps tant compos ( diversum), n'est pas ternel; et que le moi n'tant pas compos, ne peut ne pas tre ternel. Mais de cette manire encore, il ne peut y avoir de moi sans le corps e. Il est parl, dans quelques lgendes sur Shkya mouni, de controverses que ce personnage et ses disciples eurent avec les partisans de quatre-vingt-quinze mo, citdans le San tsang J Houayankoung sou, liv. XXX, pag. 2 verso. h Houayankingson, citdansleSan tsang J sou, liv.XVII,pag. 2Gverso. 1 " Cf. supr, pag. i5o. d Idem, cit dansle San tsang J sou, liv.XVIII, 1. pag. c Idem,cit l mme, pag. 1verso.
152
FO
KOUE
KL
sectes : mais nous apprenons que ce nombre se rduit onze, dont l'enseignement, les livres et les habitudes s'taient rpandus dans l'Occident. On les indique de la manire suivante. de la doctrine des nombres [Snkhya); on les appelle ainsi, ou parce qu'ils parlent en premier lieu des nombres, ou parce que le raisonnement engendre (procde par) les nombres, ou parce qu'ils traitent des nombres et en font leur tude. Ils enseignent que l'obscurit engendre l'intelligence, et qu'il y a ainsi, jusqu'au moi spirituel, vingt-cinq principes ou ralits; savoir : i l'obscurit ou la primordiale nature [natura per se); 1 le principe de la connaissance ou l'in4, 5, 6, j, 8, les cinq telligence [Bouddha); 3 la pense du moi (conscience); choses subtiles, ou la couleur, le son, l'odeur, la saveur, la tactilit; 90, io, 1 i, i2, 1 3, les cinq grands (tres), la terre, l'eau, le feu, le vent, l'ther; 1 4, 1 5, 160, 170, 180, les cinq racines de connaissance, l'oeil, l'oreille, le nez, la langue, le corps; 19, 200, 21, 220, 2 3, les cinq racines d'action, la bouche, la main, le pied, le fondement, l'urtre; 2 4 la racine coordonnante du coeur, ou le mens, comavec les dix prcdentes, le nombre de pose des cinq lments, et compltant, onze racines; 2 5 le moi spirituel ou la connaissance qui a son sige dans le huitime viscre. Les hrtiques croient que le moi spirituel a pu engendrer les lois, qu'il est ternel, indestructible, que c'est le nirvana 11. On attribue l'invention de ces vingt-cinq principes Kia pi lo [Kapila, ou le Jaune). Ceux qui suivent ses opinions se livrent la contemplation; ils prtendent avoir une intelligence divine, et parvenir la connaissance de ce qui s'est pass durant quatre-vingt mille kalpas. Quant ce qui a prcd ces kalpas, ils n'en savent rien, et c'est ce qu'ils nomment obscurit, d'o sort la nature, puis l'intelligence, jusqu'au moi intellectuel, le principe suprme. Ils classent ces vingt-cinq principes sous neuf divisions b; mais en ralit ils font natre les vingt-quatre premiers principes du vingt-cinquime, le moi spirituel, comme le seigneur, toujours intelligent et clair, ternel, qu'ils considrent embrassant et renfermant toutes les lois, unique par consquent, indestructible, cause de tous les tres et du nirvana lui-mme c. 20 Les sectateurs des FVe chi. We chi [Vashesika) est un mot sanscrit qui signifie sans suprieur (littralement sine victore). Cet homme parut clans le monde huit cents ans avant Bouddha. Les gens de ce temps se cachaient le jour dans les montagnes et les marcages, pour viter le bruit et les sductions. La nuit ils voyaient et entendaient trs-bien, et ils sortaient pour aller mendier. En cela, ils ressemblaient aux chouettes, et on les nommait ermites chouettes. We chi avait les tsangf sou,liv. XLVII, pag. 26. Comparez Colehrookc,Onthe Philosophy of the Hindus, dansles Transactions, etc.lom.I, pag.3o. Voyez 1 San aussi Nouveaux asiat. tom. Il, pag. 350. Mlanges h Ici. pag. 25. c ci-dessous, Voyez pag. 155 iLes sectateurs
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
155
cinq facults a; il composa dix fois dix mille vers pour rendre tmoignage au bodhi; puis il entra joyeux dans le nirvana. Il mit en avant les six mots gnrateurs; savoir : i la substance, qui est le corps des lois (de la nature), sur quoi s'appuient la qualit et l'action; 2"la vertu ou la qualit; 3 l'action, l'usage ou emploi; 4 le grand tre, c'est--dire ce qu'il y a de commun la substance, la considrs dans leur unit; 5 le qualit et l'action, ou ces trois prdicaments commun et le diffrent, comme par exemple : la terre considre par rapport la terre, c'est le commun; par rapport l'eau, c'est le diffrent. Il en est ainsi de l'eau, du feu, du vent, etc. 6 L'union ou l'agrgationb : on entend par l l'union de toutes les lois (de la nature). Par exemple, un oiseau vole dans l'espace : tout coup il arrive sur une branche d'arbre; il s'y arrte. Il en est de mme des lois ( de la nature ), dont l'union fait la stabilit. 3 Les sectaires qui se couvrent de cendres [Vibhoti); ceux-ci imaginent que le sixime dieu du monde des dsirs, le dieu Is'wara, a cr toutes choses. 4 Les sectateurs des Vdas imaginent que Ncryan'a (celui dont la force est comparable un cadenas, cause de la vigueur des articulations de ses membres) a cr les quatre familles ; que de sa bouche sont ns les Brahmanes ; de ses deux bras, Sotras. les Kshatryas; de ses deux cuisses, les Vesyas; et de ses pieds, les
5 Les partisans de An tchha [An d') : on ignore la signification de ce mot. Ceux-ci admettent un premier principe ou terme dans le pass. Ils croient qu' la premire origine du monde, il y avait une grande eau. Alors naquit le grand An tchha, qui avait la forme d'un oeuf de poule. Il se divisa ensuite en deux fragments : celui d'en haut produisit le ciel; et celui d'en bas, la terre. Dans l'intervalle naquit un dieu Brahma, qui eut le pouvoir d'engendrer tous les autres tres anims ou non anims, sans exception. Ils considrent ainsi Brahma comme le crateur et le seigneur. Par une autre erreur, ils le croient immorteld. 6 Les sectaires qui admettent le temps, c'est--dire qui croient que les tres sont ns du temps, remarquent que les plantes, les arbres et les autres vgtaux ont un temps pour produire des fleurs, un autre pour donner des fruits ; qu'il a un y temps pour les employer; que tantt il y a expansion et tantt resserrement ; de sorte que telle branche d'arbre, suivant le temps, se couvre de feuilles ou se dessche. Ils en concluent ment subtile et invisible. a que le temps existe, quoique ce soit une chose infini-
Voyezci-dessus,pag. 12g. On dit ici que ces : Sonpied ne foucinq facultstaientles suivantes la tait pas terre; il connaissaitla vie des autres et leur pense ; sonoeilvoyait milleli; s'il appelait,on arrivait; lesrocherset les pierres ne lui opposaient pas d'obstacles.
Col ebrooke,danslesTransactions, etc. Comparez tom.I, pag. g.4, et les Nouveaux Mlanges asiatiques, tom. II, pag. 370. 0 C'estl'oeuf dans [an d') nommIliran'yagarbha la mythologie indienne.E. B. d Santsangj sou, liv.XVII, pag. 26 verso. 20
''
154
FO
KOUE
KL
70 Les sectaires qui reconnaissent l'espace pour principe des choses. L'espace, ou l'tendue dans les quatre sens, peut, selon eux, engendrer les hommes, le ciel et la terre; et aprs leur extinction, ils rentrent dans l'espace. 8 Les Lou Ma ye [Laokika), ainsi nomms d'un mot qui signifie conforme au sicle, croient que la forme, la pense et autres lois (de la nature) sont des principes infiniment subtils. Ils pensent que ces principes naissent des quatre grands tres (les lments); que le subtil peut engendrer le grossier; que la forme, bien qu'infiniment subtile, est cependant une substance; que les tres grossiers du monde sont prissables, mais que les causes subtiles sont indestructibles. 9 Les sectaires forts de la bouche, lesquels admettent l'ther comme principe de toutes choses, croient que l'ther nat du vent, du vent le feu, du feu la chaleur. La chaleur produit l'eau; l'eau produit la glace; solidifie elle fait la terre. La terre engendre les cinq sortes de grains. Les cinq sortes de grains produisent la vie. En se dtruisant, la vie retourne l'ther. i o La secte de ceux qui croient que le bonheur ou les chtiments suivent les actes de la vie; qui admettent, pour les tres vivants, une punition ou une rcompense conformes aux actes qu'ils ont effectus durant leur vie. Si quelqu'un observe les prceptes et pratique la vertu, les maux du corps et de l'me qu'il endure effacent ses actions antrieures; et quand celles-ci sont dtruites, les souffrances cessent galement, et il arrive mme au nirvana. Les actes antrieurs sont donc, pour ces sectaires, la cause universelle. i i Les sectaires qui n'admettent pas de cause, et qui croient que tout arrive de soi-mme; qui soutiennent que les tres n'ont niyin ni youan, c'est--dire ni dpendance parte priori, ni liaison parte posteriori; que tout nat et se dtruit de soi-mme a. On a vu prcdemment ( note i 4, ci-dessus , pag. 137), que neuf opinions diffrentes sur l'origine et la naissance du monde taient dclares htrodoxes par les Bouddhistes. Les hrtiques, disent ceux-ci, ne conoivent pas que les lois et qu'elles n'aient pas de fin. (de la nature) n'aient pas eu de commencement Quand les causes et les effets sont unis et enchans, on appelle faussement cela naissance; quand les causes et les effets sont dsunis et isols, on appelle faussement cela extinction. La naissance et l'extinction suivent la destine ( sont des effets), et. ne sont point des ralits de la nature. Mais suivant leur caprice particulier, quelques-uns ont suppos que ce qui produisait la naissance tait un tre distinct, qui avait eu le pouvoir de former le monde et tous les tres. H y a, cet gard, neaf fausses vues (hypothses errones). 1 Il y a des hrtiques qui croient que tous les tres sont ns du temps ; comme les plantes et les arbres ont un temps pour porter des fleurs, et un autre pour n'en pas porter. Le temps exerce donc une action : il dilate ou il resserre. Il fait que les branches d'arbre, selon le Houa yan king,Sousou yan i tchhao,cits dansle San tsang f sou, liv. XLIII, pag. 2'i.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
155
temps, se couvrent de feuilles ou se desschent. Le temps, bien que chose trssubtile et qu'on ne peut apercevoir, manifeste son existence par l'action de ses parties sur les fleurs, les fruits et autres objets de mme genre. On a donc pris le temps pour un tre ternel, unique cause de tous les tres, et mme du nirvana. 2 Les partisans de l'espace supposent que les quatre parties de l'espace, l'orient, l'occident, au sud et au nord, peuvent produire des hommes, le ciel, la terre, et qu'aprs l'extinction, tout rentre de nouveau dans l'espace. L'ther, le inonde entier, tout est espace : l'espace est ce par quoi les hommes et tous les tres vivent et meurent; rien n'est spar de l'espace. On a donc pris l'espace pour un tre ternel, unique, etc. 3 Les atomes, c'est--dire les parcelles de poussire les plus tnues, ont t regards, par les partisans du Lou Ma ye (ce mot signifie conforme au sicle), comme engendrant la forme, la pense et les autres lois. Ils disaient que les parties les plus subtiles des quatre grands (tres), c'est--dire des quatre lments, sont ternelles, et capables d'engendrer les tres grossiers ; cpie, bien que la forme soit extrmement subtile, la substance ou matire existe; et que tandis que les tres grossiers du monde sont variables, leur cause, extrmement subtile, est indestructible. En consquence, ils soutenaient que ces lments subtils taient l'tre unique, ternel, etc. 4 L'ther, ou l'espace vide, est considr par les sectaires appels ore fortes, comme la cause de tous les tres; car ils disaient que de l'ther naissait le vent; du vent, le feu; du feu, la chaleur; la chaleur engendrait l'eau; l'eau, la glace; la glace endurcie produisait la terre; la terre produisait les cinq sortes de grains; ceux-ci produisaient la vie; et la vie, en finissant, rentrait dans l'espace vide. Pour eux donc l'ther tait l'tre ternel, unique, etc. 5 Les sectaires qui se conforment au sicle admettent la semence des lmenls, c'est--dire de la terre, de l'eau, du feu et du vent, comme ayant pu produire la cause de tous les tres; ils croient que tous les tres de l'univers sont ns des quatre lments, et qu'ils y rentrent aprs leur destruction. Par exemple, dans le corps (litt. la racine du corps), la partie solide rpond la terre; la partie humide l'eau; la partie chaude au feu; la partie mobile (ou la mobilit) au vent. On voit par l que le corps et tous les tres ne diffrent en rien des quatre lments. Ainsi donc la semence des quatre lments est pour ces sectaires l'tre ternel, unique, etc. 6 Le moi. spirituel, ou ce que les hrtiques nomment la connaissance du huitime viscre. Kia pi lo et ses sectateurs enseignent, comme on l'a dj vu, que le principe des vingt-cinq ralits", ou le principe obscur, a produit l'intelligence; que de l'intelligence est ne la pense du moi; que la pense du moi. a engendr la couleur, le son, l'odeur, le got et la tactilit, ou les cinq atomes; que des cinq atomes sont ns les cinq lments, la terre, l'eau, le feu, le vent et l'ther; que des cinq lments sont nes les onze racines, l'oeil, l'oreille, le nez, la langue, le corps, le mens, la main, le pied, la bouche, " ci-dessus,p. 162. Voyez l'orifice intestinal et l'urtre, ce qui, avec le mm 2O.
156 spirituel;
FOE
KOUE
KL
fait vingt-cinq principes, dont les vingt-quatre derniers sont ns du moi spirituel et en dpendent comme d'un matre. Ils considrent ce moi spirituel comme ternel, intelligent, clair et tranquille. En lui rsident l'ternit, l'indestructibilit; il contient et embrasse toutes les lois (de la nature). Ils le regardent donc comme l'tre unique, etc. 70 Les partisans des Vdas reconnaissent l'excellent vainqueur ou Nryan'a, le plus excellent et le plus victorieux des dieux, celui qui a engendr les quatre familles ou castes. De son nombril sortit un grand nympha, et sur ce nympha naquit le dieu Brahma, qui eut le pouvoir de crer toutes choses. Le dieu vainqueur est, dans ce systme, suprieur Brahma, et c'est, lui qu'on regarde comme l'tre unique, ternel, etc. 8 Les adorateurs du dieu seigneur [Is'ivara), ou du dominateur des trois mille mondes qui rside dans le ciel appel Aqlianisht, Ce sont les sectaires qui se frottent de cendres, et tous les Brahmanes en gnral, qui regardent ce dieu comme la cause de toutes choses. Us lui attribuent quatre vertus [gona') : la substance ou ralit substantielle, l'ubiquit, l'ternit, le pouvoir de crer toutes les lois (del nature). Ils disent encore que ce dieu-a trois corps : le corps de la loi, ce qui signifie que sa substance est ternelle, universellement rpandue et de la mme tendue que l'espace vide, ayant le pouvoir de crer toutes choses;Te corps qui dispose, parce qu'il est audessus des formes; le corps des transformations, parce qu'il convertit, dans les six conditions, tous les tres dont il prend la forme. 90 Les partisans de MahBrahma". On compte encore neuf points sur lesquels les hrtiques sont dans l'erreur, relativement la forme, aux rapports, la cause, l'effet, la vue, la nature, l'enchanement et qui ont t exposs par (destine), l'action, la conduite\ Tathgata au trs-intelligent Bodhisattwa, dans l'assemble de Lanka, pour pargner aux sicles postrieurs toute mprise ce sujet. Ils se trompent encore de vingt manires, l'gard du nirvana : i Ils appellent ainsi la mort du corps quand il se dtruit, et que la respiration s'arrte, comme une lampe qui s'teint. 20 Ceux qui croient que l'espace est le premier de tous les tres, le nomment quand l'univers dtruit revient son origine. 3 Ceux qui croient que peut produire, prolonger et dtruire la vie, et qu'il a donn la naissance choses, appellent le vent nirvana. 4 Les hrtiques partisans des Vdas nirvana, le vent toutes croient sur tous que sont des
ainsi qu'on l'a vu, que du nombril du dieu Nryan'a est sorti un nympha lequel a paru le prince et aeul des dieux, Brahma, qui a donn la naissance les tres vivants et non vivants, lesquels sont sortis de sa bouche, ainsi toutes les grandes terres, thtre du bonheur, des vertus et des prceptes; o prsentes en offrande des fleurs et des plantes, et des victimes telles que note i/i,pag. 136. Houayan ci-dessus, Voyez kinij,Sou!sou yan i tchhao,citsdansle Santsangf sou, liv. XXXV, pag. 3. ' b
Lcngkia king (ou Livre sacrde Lanka), cit dansle San tsang f sou, liv. XXXV, pag. 5 verso.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
157
porcs, des brebis, des nes, des chevaux, etc. La naissance dans une de ces terres du I che na et leurs diffrentes branches s'appelle nirvana. 5 Les'hrtiques disent que le vnrable matre I che na est invisible de corps et remplit tous les lieux, et que 'de ce qui est sans forme et sans apparence, il a pu produire les tres vivants et non vivants, et toutes choses sans exception. Us l'appellent donc nirvana. 6 Les hrtiques qui vont nu-corps estiment que la claire et distincte perception de toutes choses dans leurs diffrentes manires d'tre, est le nirvana. 70 Les partisans du Pi chi disent que de la runion et combinaison de la terre, de l'eau, du feu, du vent, de l'ther, des atomes et autres tres, nat le monde, avec les tres intelligents ou privs d'intelligence; que quand il n'y a pas runion et combinaison, il y a dispersion, et que cette dispersion est le nirvana. 8" Les hrtiques qui macrent leur corps, appellent ainsi la fin de ce corps et du bonheur dont il peut jouir, g0 Ceux qui se placent dans la dpendance de la femme, croient que le suprme seigneur Mai cheou h [Mah ls'wara) a form une femme qui a engendr les dieux, les hommes, les dragons ; les oiseaux, ainsi que l'universalit des tres qui naissent d'un oeuf, les serpents, les scorpions, les mouches, etc.; que celui qui sait cela est dans le nirvcin'a. io Les sectaires qui se livrent des macrations corporelles [tapasvi), pensent que les pchs et le bonheur ont une fin; que la vertu mme en a une, et que c'est l le nirvana. 11 Les sectaires que l'on nomme oeil pur, croient que les passions ont un ternie : hY s'attachent donc la prudence [pracljn), qui est pour eux le nirvana. 12 Les sectateurs de Ma tho lo croient que leur matre Nryan'a a dit : C'est moi qui ai fait toutes choses; je suis l'tre par excellence au milieu de tous les tres. J'ai cr tous les mondes. Les tres vivants et non vivants sont ns de moi; et cela s'appelle nirvana. i3Les quand ils retournent clans un autre lieu [paratra), partisans de Ni kian tseu disent qu'il est n en premier lieu un mle et une femelle, et que de leur union sont ns tous les tres tant anims qu'inanims; en se dtruisant, dans un autre lieu, c'est que quand ils se sparent, et retournent, le nirvana. 14 Les sectateurs du .Seng kia [Snkhya) admettent les vingt-cinq principes", comme tant la cause de la nature et ayant form tous les tres, et c'est ce qu'ils appellent nirvana. i5 Les sectateurs de Ma i cheou lo [Mahls'wara) disent que c'est en ralit le Brahma qu'a produit Nryan'a qui est la cause. Ce qu'on appelle Brahma et Nryan'a sont les souverains dieux et seigneurs, la cause de la naissance et de l'extinction; toutes choses naissent du seigneur et s'teignent par le seigneur : il est donc le nirvana. 160 Les sectaires qui n'admettent pas de cause, disent qu'il n'y a ni cause ni effet qui aient engendr tous les tres; qu'il n'y a point de cause impure ni de cause pure; que les aiguillons d'une plante pineuse et les couleurs du paon ne sont l'ouvrage de personne, qu'ils existent d'euxmmes et ne sont ns d'aucune cause. 170 Les partisans du temps disent que le ' ci-dessus, Voyez pag. ib2.
158
FOE
KOUE
KL
temps mrit tous les lments, qu'il forme tous les tres, qu'il les disperse. Il est dit dans les livres de ces sectaires, que frapp de cent flches, si le temps n'est pas venu, on ne mourra pas; et que s'il est venu, le contact de la plus petite Toutes choses naissent par le temps, mrisplante fera mourir immdiatement. sent par le temps, s'teignent l'eau est le principe de toutes anims et inanims, qu'elle i g" Les partisans du systme que le premier de tous les par le temps. 18 Les sectateurs de l'eau croient que choses, qu'elle a form le ciel, la terre, tous les tres peut faire et dtruire; ils l'appellent donc nirvana. de l'ther pensent qu'il est la cause de toutes choses;
principes est l'ther; que de l'ther est n le vent, puis successivement tous les lments, comme il a dj t dit. La terre engendre toutes les semences et herbes mdicinales selon leurs espces, au nombre desquelles sont les grains qui produisent la vie, qui, aprs s'tre alimente, rentre dans l'ther. 2 0 Les sectaires qui croient au An tchha [An d'), pensent que primitivement il n'y avait ni soleil, ni lune, ni toiles, ni terre, ni ther. Il y avait seulement une grande eau. Le grand An tchha y naquit, ayant la forme de l'oeuf d'une poule, tout entour de couleur d'or; quand il fut parvenu maturit, il se partagea en deux fragments, et Brahma naquit entre-deux, ainsi qu'on l'a vu plus haut. Quand les tres anims ou inanims se dissipent et se perdent dans l'autre lieu, cela se nomme nirvana. des opinions errones qu'ils professent sur des points de docIndpendamment trine, il y a des pratiques que les sectaires regardent comme propres leur assurer des mrites rels. On compte six sortes de macrations en usage chez les hrtiques. i Us se refusent le boire et le manger, et souffrent longtemps la faim acquirent ainsi des droits une rcomfroides. 3 Ils endurent des brlures en par le nez des vapeurs brlantes. 4 Hs bravant le froid et le chaud. 5 Ils choisissent les cimetires et les bocages funraires pour leur demeure, et s'y astreignent un silence absolu. 6 Il en est qui prtendent avoir t, dans les gnrades boeufs et des chiens, et qui gardent en consquence ce tions antrieures, qu'on appelle les prceptes du boeuf et du chien, c'est--dire qu'ils broutent l'herbe et boivent de l'eau impure, dans l'espoir de renatre au ciel\ et la soif, se persuadant vainement qu'ils pense. 2 Us se plongent dans des sources diffrents endroits du corps, ou aspirent demeurent perptuellement assis, nus et Il y a cinq sortes de doutes auxquels sont enclins les hrtiques, et que l'on nomme les cinq penses coupes [cogitationum proecisiones). i Us doutent de Fo; ils raisonnent ainsi : Fo est-il grand? Est-ce Fou lan na ou tout autre qui est et dtruire en soi les bons principes grand? Ce qui revient blasphmer (racines) des penses. Ces hrtiques croient que toutes les lois sont sans existence, " Thi Phousa, Chylengkia king, Waltaosiao pho tching,Niphan king, cilsdans le San tsangf son, liv. XLVI, pag. 20. Ta ni phanking, cit dans le San tsang J sou, liv. XXVII,pag. i 2 verso.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
159
comme le vide, et ne sont sujettes ni la naissance ni l'extinction. 2 Us doutent de la loi, se demandant si c'est la loi de Fo qui est la meilleure, ou si c'est celle des Vdas. Les Vdas ( y'fc s We tho), dont le titre signifie discours de science, sont des compositions remplies de la fausse science des hrtiques. 3 Us ont des doutes sur les Seng [Sanga), ne sachant si les disciples de Fo doivent l'emporter, ou si les disciples de Fou lan na mritent la prfrence. De cette manire ils ne croient pas aux trois (tres) prcieux, Bouddha, Dharma, Sanga, et l'on dit ailleurs" que c'est un pch irrmissible; que les hommes stupides et ignorants qui, clans leur vue perverse, ne croient pas aux trois tres prcieux, et qui sont sans droiture et sans pit filiale, ont en eux le principe de tous les crimes, qu'ils s'exposent tous les chtiments; qu' leur mort, ils sont aussi assurs de tomber dans les conditions mauvaises h, qu'on l'est de voir l'ombre suivre le corps. Ce crime est de ceux dont on ne saurait tre dlivr, quelque dsir que l'on en prouve. 4 Us doutent des prceptes : au lieu d'avoir confiance aux prceptes, ils se demandent s'il ne serait pas plus utile de s'attacher la pratique dite de la poule et du chien, et qui consiste se tenir sur un seul pied comme la poule, ou se nourrir d'aliments impurs comme le chien, ou d'autres austrits, qui les font renoncer aux lois de l'honntet. 5 Us doutent de la vrit des enseignements, c'est--dire qu'ils balancent entre les enseignements de Fo et ceux de Fou lan nac. Suivant ce que rapporte le matre de la loi Seng tchao, huit cents ans aprs que Fo fut entr dans le nirvana, les hrtiques se multiplirent; il s'leva des sectes violentes; de mauvaises doctrines opprimrent la vrit et troublrent la saine raison. Ce fut alors que Deva Bodhisattwa, disciple de Loung chou [Naga krchouna) composa le livre intitul P lan (les cent discours), pour dfendre la vrit et fermer la route l'erreur ''. Quelque longue que soit cette note, on ne la trouvera peut-tre pas trop tendue , si l'on veut considrer que les passages qui y sont rapports, en nous montrant les opinions que les Bouddhistes traitent d'htrodoxes, nous mettent sur la voie pour mieux juger celles qui constituent leurs yeux l'orthodoxie. C'est une manire dtourne, mais assez sre, de connatre fond une doctrine, que de rassembler tout ce que ses partisans jugent erron dans les doctrines qui leur sont chinois relatifs ce que les trangres. Au reste, parmi les passages des auteurs Bouddhistes nomment hrsies, je n'en ai trouv aucun qui ft plus particulirement applicable aux pyroltres de la Perse, dont il parat que certaines lgendes crites en mongol font mention sous le nom de Tarsa". j sou, yuantchu lin, citdansle San tsang liv.XXIX,pag. 28. b ci-dessus. Voyez f sou, Tchhing chy lun, citdans le San tsang liv.XXIV,pag. 9 verso. " F Santsangj sou, chapitredesSanlun,ou trois liv.IX, pag. i5 verso. discours, ' Vie leBouddha, danslesMcm. relatifs Comparez l'Asie,de M. Klaproth,tom.II, pag. 81. d
160
FOE
KOUE
KL
(22) Un grand rugissement.] Ce prodige a de la clbrit, et il y est vraisemblablement fait allusion dans un livre que j'ai trouv cit quelquefois, mais dont j'ignore la date et le sujet spcial, parce qu'il n'est pas compris dans la bibliode Ma touan lin a, non plus que dans le catalogue intitul graphie bouddhique Soa tlisou thancj chou mou \ lequel comprend les titres de mille trois cent quatrevingt-dix-huit ouvrages religieux, avec des notices littraires. Il est intitul Tafang en sanscrit, Mah kouang sse tseu lieou king, c'est--dire, selon toute apparence, vapoalya sinhandandi. U y a un Bodhisattwa dont le nom, Sinhandandi (rugissement du lionc), parat se rapporter une circonstance semblable. Le rugissement du lion sert de point de comparaison, sous onze rapports diffrents, la prdication de la loi par Bouddha d. ha nourriture des dieux ou les (23) La nourriture divine.] Dans le texte, q^^C^ aliments clestes. Cette expression asctique dsigne vraisemblablement la contemplation, ou la mditation applique aux plus sublimes perfections de l'intelligence. A l'origine du monde, les Dvas du monde des formes ne faisaient point usage des aliments grossiers dont on se nourrit prsent; mais ils se sustentaient par la pure contemplation ; c'est ce que nous apprend le passage suivant, de Sanang setsene : \> ^jx&\x JAXX^UXj.a V>&J_J.A.^ s-^ax ^ j^jx^ (-xx&i^ ojxk \^p^> Iv^Ai^ j^x
les hommes de la gnration ou du sicle. On (24) Les hommes du sicle.] ,/v-wdsigne ainsi le commun des hommes, par opposition aux saints de diffrents degrs, qui ont su se dlivrer des liens corporels, et qui sont garantis de toutes les infirmits humaines. (28) Ses cheveux et ses ongles.] Comparez la relation de Hiuan thsang, description 'Ayodhya, de Sou lou Mn na et de Kiu pi chouang na. Les cheveux, les ongles et les dents des Bouddhas, des Bodhisattwas et des autres saints sont les reliques les plus ordinairement indiques, et au-dessus desquelles on levait des sthopa. (26) Les trois Fo du temps pass.] Les trois Bouddhas qui ont prcd Shkya mouni dans l'ge actuel, sont Karkoutchanda, Kanaka mouni et Ks'yapa. et khao, liv. CCCXXVI VoyezWcnhiantlioung CCCXXXVII. h Chini tian, liv. XCV-CI. Vocab. pcnlagl.sect.ix, art. 18.-Santsang J 2bverso. liv. sou, XXIX, pag. a Voy.le LivreduNirvana, liv. XXVII, chap. du titrede roi, cit dansle San tsang J sou, liv. XLTII, pag. 20. c Geschichie derOst-Mongolen, pag. . d
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
161
(27) Chy kia wen.] On dit indiffremment Chy Ma mouni. et Chy kia wen, le Solitaire ou l'ornement de la maison de Shkya; car Shkya est le nom de la famille o naquit le dernier Bouddha, et non pas le nom individuel de celui-ci : c'est abusivement et pour abrger qu'on l'emploie en ce dernier sens. Il y a un trs-ancien Bouddha du nom de Shkya; au temps duquel notre Bouddha commena la priode de son existence que l'on nomme les trois Asanlihya" ; il s'appelait alors Ta kouang ming, le trs-lumineux. C'est un fait peu remarqu que cette application d'un mme nom deux ou plusieurs personnages du rang de Bouddha ou de Bodhisattwa. Il y a ainsi deux Amitabha, deux Shkya mouni, deux Avalokites'wara, etc.h (28) Un dragon.] Le mot chinois Loung rpond au terme indien Nga. L'ide d'un tre fabuleux, analogue aux reptiles par la forme gnrale de son corps, mais dou de la facult de voler, est bien plus ancienne la Chine que la religion de Bouddha. Il pourrait tre curieux de rechercher si cette ide avait t apporte de l'Inde ds la plus haute antiquit, et si le nom mme de cet animal fantastique, Loung, n'est pas une altration du sanscrit Nga. Il n'est pas question du rle que les dragons jouent dans la mythologie nationale des Chinois, mais de celui qui leur est assign dans les fables bouddhiques. Il y a huit classes d'tres intelligents auxquels la doctrine lgue par les Bouddhas peut devenir profitable et assurer les bienfaits de la dlivrance finale : ce sont ces huit classes que l'on dsigne comme assistant en foule (comme les arbustes d'un bocage) aux prdications et aux assembles des saints des trois translations, c'est--dire des S'rvakas, des Nidna Bouddhas et des Bodhisattwas : i" les dieux (Dvas); 2 les dragons [Loung, Ngas); 3 les Y cha (Yakshas); 4 les Kan tha pho (Gandharvas) ; 5 les A sieoulo (Asouras) ; 6 les Kia leou lo (Garouras); 70 les Kin na lo (Kinnaras) ; 8 les Ma lieou lo kia (Mahoragas). J'aurai, dans la suite de ces notes, l'occasion de revenir sur ces diffrentes classes de gnies c : je ne dois parler en ce moment que des Ngas, qui occupent, comme on voit, une place parmi les tres suprieurs l'homme et dous de raison. Ce sont, dit-on, des animaux intelligents. Dans le livre du Paon [Khoung tsi king), le livre des grands Nuages [ Ta yun king), et d'autres livres sacrs, on trouve des dragons nomms par leurs titres, et leurs rois sont dsigns comme protecteurs de la loi de Bouddha' 1. U y a dans la mer cent soixante et dix-sept rois des dragons. Le septime est nomm So ki lo, c'est--dire, mer sale [Scgara) ; il est le dix-neuvime des vingt dieux, et le plus puissant des rois des dragons. C'est lui qui, ci-dessus, Comparez chap. X, note -Voyez aussiEssaisurla Cosmologie insrdans samancnne, le JournaldesSavantsde i83i; octobre,pag. 697616;novembre,pag.G68-674; dcembre,pag.716. * 1 Mitho kingsoutchhao,liv.IV, pag.2g verso. c ci-dessus,chap.XVI, note 36, pag. 122. Voyez d Fan cil y mingi, liv. II, chap. deshuitclasses, dans le Santsang f sou, liv.XXXIII,pag. i3 verso. 11
162
FOE
KOUE
KL
quand les Bodhisattwas rsident dans les dix Terres (ou degrs d'unification), apparat avec son corps de dragon et au-dessus de l'Ocan. S'il vient pleuvoir, c'est lui qui rpand (dans le ciel) des nuages serrs, dans le but de faire en sorte que la pluie soit profitable tous. Il suit constamment les assembles de Bouddha; il est dfenseur de la loi et protge les peuples, ce qui lui procure de grands avantages. Le palais qu'il habite est orn des sept choses prcieuses, et offre la mme magnificence que ceux des dieux a. C'est dans ce palais que les dragons recueillirent le livre appel Hia peu king, ou le dernier volume, aprs les prdications faites par Mandjousri et par Ananda; et c'est l que le vit le Bodhisattwa Nga kochouna, lorsqu'il eut pntr clans le palais des dragons. Ce livre tait partag en trois parties ou volumes : le suprieur, le moyen, et l'infrieur. L'infrieur contenait cent mille gclhs, distribus en quarante-huit classes. Nga kochouna les retint dans sa mmoire, et les publia dans le monde h. L sont encore conservs des livres d'une tendue merveilleuse, puisque l'un d'entre eux contient autant de gciths qu'il y a d'atomes dans dix grands chiliocosmes, et autant de" sections qu'il y a d'atomes dans les quatre continents du monde c. Les dragons peuvent natre de quatre manires : d'un oeuf, d'une matrice, de selon qu'ils habitent l'orient, au midi, l'occil'humidit, par transformation, dent ou au nord de l'arbre Tcha che ma li (troupe de cerfs). Leurs palais sont tous orns des sept choses prcieuses* 1. Ils jouissent, comme les autres cratures suprieures l'homme, de la facult de se transformer, hormis dans cinq occasions particulires , qui ne leur permettent pas de cacher leur forme : i leur naissance ; 2 leur mort; 3 au moment de leurs bats; 4 quand ils sont anims par la colre; 5 quand ils se livrent au sommeil. On raconte ce sujet que dans le temps o Bouddha tait avec les Sangas clans le jardin Ky kou to, il y avait un roi des dragons de la mer, qui, ayant revtu la forme humaine, der embrasser la vie religieuse. Les bhikchous, ignorant qu'ils dragon, le reurent conformment sa demande. Le dragon mais les dragons sont d'un pour se livrer la contemplation; lourd : celui-ci s'assoupit, et perdit ainsi la facult de cacher tait venu demanavaient affaire un religieux se retira
temprament trssa forme naturelle, et son corps remplit toute la chambre. Les bhikchous qui demeuraient avec lui, tant venus rentrer dans la maison, furent saisis d'pouvante en l'apercevant. Ils poussrent de grands cris pour appeler leurs compagnons, et le dragon s'tant rveill, reprit la figure d'un bhikchou, et s'assit les jambes croises pour continuer ses mditations. La disparition du dragon et l'apparition du religieux renouvelrent l'effroi de l'assemble, et on alla rapporter la chose Bouddha. Ce n'est point un a Thiantchhouan oul'Histoire desdieux,citedans le San tsang J' sou,liv. XLVI,pag. 18 verso. b sou,liv.III, chap.Young tscu,cil Houayanking dansle Santsang J sou, liv. XXXVI, pag. 1/1. c Ibid. Cf.Mlanges asial.tom. I, pag. \k verso. pag. 1/18. d Khiclii ipenkeng,liv.V,chap.Outseu,cildans le Santsang J sou, liv.XVIII, pag.3 verso.
NOTES homme,
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
165
dit celui-ci, c'est un roi des dragons. Il l'appela ensuite et prcha en sa faveur, puis il lui ordonna de retourner au palais des dragons, et dfendit aux bhikchous de faire embrasser dsormais la vie religieuse aucun dragon. Ce fut pour Bouddha l'occasion d'expliquer les cinq circonstances attaches la destine de cette classe d'tres\ Les dragons sont les rois des animaux cailles et de ceux auxquels- on donne le nom d'insectes. Us peuvent se cacher ou briller d'un vif clat, prendre une taille plus grande ou plus petite; mais ils sont sujets trois flaux qui troublent leur existence. Ils redoutent les vents brlants et le sable chauff, qui consument leur peau et leur chair, et leur causent dans les os les plus vives douleurs. Ils sont exposs tomber au milieu des temptes, qui leur font perdre les ornements qui parent leurs vtements, et mettent leur corps nu, ce qui leur est infiniment dsagrable. Enfin, ils craignent crue le Garouda, tandis qu'ils sont se jouer, dans leur palais, et ne saisisse les petits dragons qui viennent de natre, et dont il fait sa nourriture h. On verra, dans la suite de ces relations, beaucoup d'aventures fabuleuses o figurent des dragons de l'un et de l'autre sexe : elles seront pour nous l'occasion n'entre de revenir sur ce sujet. de France.
(29) Cinquante yeou yan.] Environ soixante et dix lieues communes
(30) Limite du feu.] Dans le texte, $j&y\^ Ho king. La dislance considrable nonce ci-dessus, si elle n'est pas fautive, nous reporte sur les limites septentrionales de l'Inde, ou mme au Tibet, clans la direction des sources du Gange. Il y a sans doute, dans le nom du mauvais gnie, Limite du feu, une allusion quelque lgende qui a jusqu'ici chapp nos recherches, et peut-tre ou du moins de la prsence d'eaux quelque souvenir d'une ruption volcanique, thermales, comme on en trouve dans les chanes mridionales de l'Himalaya. Le P. d'Andrada raconte, sur l'lment du feu, une fable qui se rapporte une source chaude, situe presque dans les mmes contres c. Un pays nomm Agnya est compris dans l'numration des pays du nord de l'Inded. Agni dva, ou le dieu du feu, rsidant Agni poura, est mentionn (3i) parmi les divinits du Npal . Voyez chap. III, note 5.
Seng kia lan.] Sanggaram, temple bouddhique.
(32) Py tchi fo. ] On a dj vu qu'on nommait ainsi une classe de saints qui hou, J king,citdans le Santsang Ynyuanseng 23. sou, liv.XXIII, pag. b Tchou kingyao tsy, liv. XII, cit dans le San tsang J sou, liv.XII, pag. 8 verso. * c au Tibet,pag. i o. Voyages d Pourn a, citpar Ward, AView on Markandaya theHistory ojthe Hindus,tom.II, pag. 11. Asiat.Research, tom.XVI,pag. 466, note 37. 21.
164
FOE
KOUE
KL
occupe un rang trs-minent clans la hirarchie bouddhique. L'expression sanscrite est Pralyelea-bouddha*, en pli Patcheka-bouddha, en mongol Pracligabouclh. M. Schmidt n'a pas reconnu cette dernire forme, et s'est born la transcrire sans la rapporter son origine c. C'est vraisemblablement de la forme pli patcheka, que les traducteurs chinois ont tir le mot Py tchi; mais il se prsente l une difficult : ces traducteurs prtendent que le terme fan entier est Py tchi-kia lod, ce qui donnerait une forme inconnue en sanscrit, Pratyekara, et ce qui ne rpondrait plus l'analyse qu'on fait en chinois du nom sanscrit. Quoiqu'il en soit, quand les auteurs des versions chinoises, au lieu de se borner transcrire ce mot, veulent en donner l'interprtation , ils en rendent le sens de trois manires, ce qui permet de supposer quelque quivoque dans le radical sanscrit. Ils prtendent que Py tchi fo signifie ^ |iy Yuan Mo, intelligence complte; Jfep' , Yuan Mo, intelligence produite par la destine (ou l'enchanement des causes) ; et *r ywn To Mo, intelligence isole ou distincte. Cette triple traduction doit tenir quelque sens quivoque du radical sanscrit; la dernire est la seule qui s'accorde compltement avec le sens bien connu du mot Pratyka. Quoi qu'il en soit, la place que les Pratyeka-Bouddhas occupent dans la hirarchie des saints, est fixe avec prcision par les livres bouddhiques. U y a cinq fruits qui mettent ceux qui les ont recueillis, sur la voie de revenir au suprme Bodhi; et l'on donne des noms particuliers aux degrs de perfection que reprsentent ces cinq fruits. Le plus humble est celui des S'rotpanna, qui ont encore 80,000 kalpas parcourir avant d'tre compltement affranchis de l'irtffuence des erreurs et des passions. Au-dessus d'eux sont, toujours en s'levant, les Sakridgm, les Angm et les Arhan. Au-dessus de ceux-ci sont les Pratyeka-Bouddhas, qui ont recueilli le cinquime fruit. Us ont jamais renonc aux erreurs des trois mondes, aux dsirs, la colre, la haine, l'ignorance; et quand ils auront travers dix mille kalpas , ils obtiendront le premier degr au-dessus duquel il n'y a rien . Bouddha luimme a dit : Cent mchants ne valent pas un seul homme vertueux; mille <( hommes vertueux ne valent pas un seul observateur des cinq prceptesf; dix mille observateurs des cinq prceptes ne valent pas un S'rotpanna; un million de S'ro tpannas ne valent pas un Sakridgm; dix millions de Sakridgms ne valent pas un Angm; cent millions d'Angms ne valent pas un Arhn; un milliard d'Arhns ne valent pas un Pralyeka-Bouddha. Mais il ajoute : Dix milliards de Pratyeka-Bouddhas ne valent pas l'un des Bouddhas des trois temps, c'est--dire du temps pass, du prsent et de l'avenir; et cent milliards de ces Bouddhas * Asiatic Research, tom. XVI,pag. 445. I T/ocubulairc sect.xix. pcntaglolte, 0 Gcschichtc dcr Ost-Mongolen, pag. 419,k-j2. IISan tsang j sou, liv. XXXXT, pag. iSetpass. Livredu grand Nirvana, cit dans le San tsang ci-dessus, J sou, liv. XXII,pag. 3v. Comparez XIII, i3. 1 XVI, 12. Voyez
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVII.
165
ne valent pas l'tre exempt de pense, de localit, d'action et de manifestation a. Le Yuan Mo, par la contemplation des douze Yuan (Nidnas), se dlivre de l'assujettissement du moi et des autres erreurs (S^f^V^ v^ ), connat et comprend le vritable vide (la substance spirituelle) et la nature du Nirvana. C'est ainsi qu'il est port hors de l'enceinte des trois mondes : c'est son yna ou moyen de translation dans le Nirvn'aL; et comme ce sont les yuan (les douze degrs de la destine individuelle) qui lui en tiennent lieu, on le nomme pour cette raison Yuan Mo, ce qui semblerait tre la traduction de Nidna-Bouddha. Les Tou Mo paraissent aux poques o il n'y a point de Bouddhas. Us sont isols et livrs eux-mmes dans la contemplation des choses et de leurs vicissitudes, et c'est sans matre et par leur propre entendement qu'ils parviennent comprendre de l leur dnomination de To ki (Intelligence isole), apparemment Pratyeka-Bouddha. Les hommes parvenus ce degr ne peuvent oprer que leur salut personnel; il ne leur est pas donn d'atteindre ces grands mouvements de compassion qui profitent tous les tres vivants sans exception 0, et qui vide; sont le propre des Bodhisattwas. Telle est la limite pose aux efforts des To ki, et c'est ce qui fait qu'ils ne deviennent pas Bouddhas (immdiatement)d. Les To ki et les Yuan ki sont nomms concurremment dans un mme passage , ce qui semble prouver qu'au moins les Bouddhistes de la Chine ont tabli quelque distinction entre les Niclna-Bouddhas et les Pratyeka-Bouddlias, distinction qui toutefois n'est nullement justifie en cet endroit mme. On distingue deux sortes de To ki : ceux qui font classe ou troupeau, c'est--dire qui, l'exemple des cerfs, s'occupent de leurs semblables et regardent derrire eux si on les suit ; on les nomme en sanscrit Varggatchri. Les autres leur propre salut, et n'entretiennent aucune pense relative au hommes; on les compare l'animal qui n'a qu'une corne [Khi et on les nomme en consquence Khadgavis'cnkalpa, Pratyekas licorne f. La contemplation ne songent qu a salut des autres lin en chinois), semblables la le vritable
des douze Nidnas, telle que la font les Yuan ki, est un point important mais difficile claircir. Il serait intressant de dterminer comment la succession de ces douze causes et effets conduit l'esprit saisir la nature du vritable vide ou de la substance spirituelle; mais je ne trouve ce sujet qu'un passage conu en termes presque nigmatiques : le Yuan ki voit que l'Avidy (ignoSsechyeuttclmng king,pag. 4 v. Houayanytchinghiaoi,Jen tsi tchang,citdans le San tsang J sou, liv. XXII, pag. 16, 17, 18v. Sur Yna, voyezII, l\. " Kieou king y tching paosenglun, chap. III, cit dans le Santsang J sou,liv. XVIII, pag. 4 v. d Houayaukingsou, liv. I, citdans le Sontsang Jsou, liv. XX, pag. 25. lloua yan kingsouyani tchhao, liv.III, citedansleSantsang jsou, liv.XXII, 1 v. pag. Lengyan king,liv. VI, cit dans le Santsanij J sou, liv. XLVIIIpass. f Vocabulaire sect. XIX. Sy hiuanki penteiglotle, (ouvrage qui n'est point comprisdans la collection sacre), cit dans le San tsangj sou, liv. VII, pag. 2.
166
FOE
KOUE
KL
rancej parvient au Djrmaran'am (vieillesse et mort), et qu'ainsi naissent les douze Nidnas. Il voit ensuite que l'extinction de l'Avidy conduit l'extinction du Djrmaran'am, et il comprend ainsi qu'il n'y a ni naissance ni mort, ou il comprend ce qui n'est sujet ni la naissance ni la mort, c'est--dire la nature spirituelle \ La perfection laquelle les Yuan ki sont arrivs, leur exemption des vicissitudes de la vie et de la mort, la facult qu'ils ont de_devenir hommes ou dieux, les rendent clignes d'adoration ; aussi sont-ils du nombre des huit classes d'tres en l'honneur desquels on btit des tours b. Les sept autres classes sont les Bouddhas, les Bodhisattwas, les Arhan, les Angm; les Sakridgm, les S'rotpanna, et les rois Tchakravarti. Par tout ce qui prcde, on voit que le mot de Bouddha, qui entre dans le nom des Pratyeka-Bouddhas, n'en doitjpoint imposer sur la vritable condition de ces personnages, et qu'ils sont bien loigns de pouvoir tre classs parmi les absolues. C'est donc une grave inexactitude Intelligences que de dire avec M. Schmidt : a Les livres bouddhiques font une grande diffrence entre les divers Bouddhas, non sous le rapport de leur saintet, mais sous le rapport de leur activit pour le salut des tres vivants, et de comprendre dans cette classe les S'ravakas et les Pratyekasc. La confusion n'est pas sauve par les distinctions qui suivent, et l'on vient de voir qu'il en faut tablir d'autres entre les Bouddhas et les Pratyekas, sattwas qui sont infiniment infrieurs aux premiers. spars dans la hirarchie des saints par les Bodhiau-dessus des seconds, quoiqu'ils soient encore bien
dont il vient d'tre (33) La terre du Ni houan.] Le lieu o le Pratyeka-Bouddha, parl, avait pass dans le Nirvn'a, c'est--dire o il tait mort, vraisemblablement sur un bcher, comme on le verra plus bas pour Shkya mouni. (34) O l'on a fait scher les habits.] Comparez le chapitre VIII, note 7.
a F houa c Ueber Grundlehrcn desBuddhaismus, Zweit. king,liv. II, chap. des comparaisons einige tires des plantes, cit dans le San tsangj sou, Abhandl. [laie i5 septembrei83o). Mmoiresde liv. XI, pag. g v. l'Acadmie tom. I, imprialede Saint-Ptersbourg, h Fan y mingi, cit dans le San tsangj sou, pag. 241. liv. XXXII,pag. 26-
CHAPITRE
XVIII.
Ville de Ki jao i. Rivire Heng. Fort de Ho li.
F hian
s'arrta
dans
Quand que temps. et ayant fait sept yeou la rivire ville touche entirement A l'ouest consacrs de
le temple son sjour fut yan, il
(i) du fini,
et y sjourna dragon quelil se dirigea vers le sud-est;
de Ki jao i (2). Cette Hencj (3). Il y a deux seng kia lan (4) qui sont l'tude de la petite translation (5). la distance de six ou
vint
la ville
sejDt li, et sur la rive septentrionale de la rivire Heng, est un lieu o Fo prcha en faveur de ses disciples. La tradition que c'est dans cet enporte droit qu'il a discouru sur l'instabilit (6) et sur la douleur (7), sur la comparaison autres sujets encore En trois corps semblables. du avec une bulle d'eau (8), et sur une tour En ce lieu, on a lev quelques qui subsiste de l'espace y a prch o
la ville,
actuellement. passant la rivire et se dirigeant Heng, une fort nomme dans tous les lieux au midi PIo li. Fo qu'il
yeou yan, on arrive la loi. On a lev des tours il a march, o il s'est
a traverss,
assis.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVIII.
(1) Le temple.] Le mot du texte est ^>-^^" Tsing che, maison pure ou sainte. On donne ce nom aux seng kia lan (III, 5), parce que ceux qui modrent leurs penses, c'est--dire les Samanens, y font leur demeure. Il y a cinq Tsing che plus clbres que tous les autres, et dont il sera parl dans les chapitres suivants : ce sera une occasion pour revenir sur ce mot. (2) Ki jao i.] Ce nom, que les Chinois n'expliquent pas, est identique avec
168
FOE
KOUE
KL
[C'est la transcription du Kanykoubclja, qui signifie fille bossue. Cette tymologie se rapporte une lgende selon laquelle les cent filles du roi Kous'ancibha, qui y rgnait, furent toutes rendues bossues par Vyou, parce qu'elles n'avaient pas voulu se soumettre ses dsirs effrns. Kanykoubclja est la mme ville crue Ptolme (liv. VII, chap. 2 ) appelle Kavoyi^a,et qui de nos jours porte le nom de Kinnodje ou Kanoudje. Elle est situe sur la droite du Gange, par 270 4' lat. N. et 820 9' i5" long. E. de Paris. Le nom de cette ville se trouve aussi crit Kanardji dans les livres sanscrits du moyen ge. Les ouvrages bouddhiques chinois traduisent Kanykoubclja par }m^r^ fflj Khiuniu tchhing, ou ville des femmes bossues. Dans cette ville, disent-ils, il y avait autrefois l'ermite du grand arbre qui maudit quatre-vingt-dix-neuf femmes, lesquelles au mme moment devinrent toutes bossues : c'est de l que vient ce nom. Fo descendit ici du ciel Tao li (Trayastrinsha) o il avait prch la loi; c'est pourquoi on y a lev une tour, cinquime parmi les huit grandes tours de Bouddha". KL.] qui est la
celui de Kjo ki tche, dans la relation de Hiuan thsang. nom sanscrit de la ville de Kanoudje ou plutt ^^Tlcn^l
(3) La rivire Heng.] On a vu (VII, 2) que les Chinois nommaient le Gange Heng ou Heng Ma, et que le nom sanscrit, dont ces deux mots offraient la transcription, signifiait selon eux, venu de la maison cleste, parce que ce fleuve coulait d'un lieu lev, c'est--dire du sommet des Montagnes de neige 1. Nous ne rpterons pas ce qui a t dit dans cet endroit au sujet des sources du Gange c. Il y a une nymphe qui prside cette rivire et qui en porte le nom; elle n'avait pas de nez et discernait trs-bien les odeurs. Ce trait est cit pour faire voir que quand l'organe d'un sens nous manque, les autres y peuvent suppler. Il est parl de mme 'Anaroclha, qui, bien que priv des yeux, n'en voyait pas moins tout ce que contient un triple chiliocosme, comme on distingue un fruit plac dans la main; du Naga Pa nan tho (Vananda), qui entendait sans le secours des oreilles; de Kiao fan pa thi (Kavanpati), qui ruminait comme un boeuf et ne laissait pas de discerner les saveurs; du gnie de l'espace vide (S'ounyta), qui, sans corps, tait sensible aux corps extrieurs; et de Media Ks'yapa, qui n'avait pas besoin du mens pour connatre toutes les lois de l'univers d. (4) Seng kia lan.] Voyez III, 5. (5) La petite translation.] (6) L'instabilit.] " P ta Voyez II, 4clans le texte, la non-dure, la non-ternit, en
Proprement,
lingtha king,cildansle Santsang J sou, liv.XXXI, pag. G. 11Tu tsangy lan, cit dans le San tsang j sou,
liv. XXIV,p. i3 v. Lengyan king,cit1.XXVIII, c desMission, t. XIV,p. 176. p. 2. Comp.Mm. Lengyan king,cit au mmeendroit.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XVIII.
169
sanscrit anidyam, est une des conditions fondamentales de l'existence relative a, ou, comme parlent les Bouddhistes, une des quatre ralits reconnues par Shkya mouni. (Ce sujet sera trait fond dans une des notes du chapitre XXII.) (7) La douleur.] Une des quatre ralits douhkham c. Voyez la note prcdente. reconnues par Shkya, en sanscrit
(8) Avec une bulle d'eau.] Shkya reconnut que le corps de l'homme, form de la runion des quatre lments, n'avait pas plus de solidit qu'une bulle; mais cette observation fut faite par lui dans ses promenades autour de la ville de Kapilavastou (XXII). Il reprit apparemment ce sujet, ainsi que les deux prcdents, dans les prdications qu'il fit prs de la ville de Kanoudje. " sect.xxui, n 2. h lbid.n 1. VocabulairepentagloUe,
22
CHAPITRE
XIX.
Royaume de Cha tchi.
De grand
l,
en faisant
royaume
yeou yan (i) vers le sud-ouest, de Cha tchi (2). Quand on sort de la ville l'orient
dix
on
vint
au
de Cha tchi le lieu
on trouve, mridionale, par la porte o Fo mordit une branche d'alisier branche ment la hauteur poussa jusqu' ni diminu. Les Brahmanes couprent
de la route,
et la planta en terre. Cette de sept pieds et n'a jamais auganims hrtiques, par l'envie pour la jeter au loin ;
et la jalousie, la mais elle renaquit
ou l'arrachrent
en ce lieu comme auparavant. toujours Il y a aussi dans ce pays quatre stations de Fo o l'on des tours qui subsistent encore.
a lev
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XIX.
(1) Dix yeou yan.] Quatorze lieues environ. (2) Le grand royaume de Cha tchi.] [D'aprs la direction de la route de F hian, le pays de Cha tchi doit tre plac dans le territoire de Luknow et sur le cours du KL.] Goumty.
CHAPITRE
XX.
Royaume
de Kiu sa lo. Ville de Che 'we. Temple Ville de Tou we.
de Tchi houan.
De
l,
vers
le midi,
en faisant
huit
royaume de cette viron
de Kiu ville est
sa lo (2) et la ville trs-peu familles considrable, (ou On
au yeou yan (i), on arriva de Che 'we (3). La population et l'on n'y
deux
cents sa
no (4) faisait dans l'enceinte
rsidence. du
compte qu'enC'est l que le roi Pho sse maisons). la loi : aussi y est trs-affectionn lieu o tait le mur du
du puits vieillard o le mauvais gnie Yng hiue (6) obtint la doctrine, au lieu du pan ni houan (7) o fut brl le corps, les hommes des sicles postrieurs ont lev des tours qui toutes subtemple, Siu tha (5), au lieu sistent sentiment entendre foudre, encore. Les Brahmanes ont de jalousie, le bruit du de sorte mus par un (8) de la ville, hrtiques voulu les dtruire; mais le ciel a fait briller et gronder les renverser. les clairs la
au
tonnerre,
qu'ils n'ont pu parvenir En sortant de la ville par la porte douze cents pas mridionale, l'orient de la route, on trouve le temple Siu tha que le patriarche a fait btir. La porte de ce temple est tourne du ct de l'orient. Il y a deux (9) pavillons et deux colonnes de pierre. Sur la colonne du ct gauche on a excut la reprsentation d'une roue (10); et sur celle du ct droit on a plac celle d'un boeuf. Les rservoirs sont de l'eau la plus pure, et les bosquets forms d'arbres touffus; remplis les fleurs les plus rares y croissent en abondance et charment la vue par leurs vives couleurs. le temple C'est l ce qu'on appelle de Tchi houan (11). Fo dix jours tant pour mont prcher au ciel Tao li (12), s'y arrta quatre-vingtla loi en faveur de sa mre. Le roi Pho sse no 12. de
172 avait une un tte vif dsir de
FO revoir
KOU Fo ; il
KL consquence sculpter de manire reprsenter une fit en
de boeuf
en bois
de santal,
image de Fo, et il la plaa dans le lieu o Fo s'tait assis. Quand, son retour, Fo entra dans le temple, la statue sortit et vint sa rencontre. Fo lui dit : Retourne t'asseoir; aprs mon pan ni houan, tu seras le modle classes (i3). La qui sera imit par les quatre statue revint s'asseoir, et elle est et celle que les hommes ont imite. (de Fo), postrieurs dans un petit temple Ensuite Fo se transporta construit sur le ct diffrent de celui de la statue, et situ vingt pas de mridional, distance. Les rois sept tages. de divers royaumes de vnration pour ce lieu et venaient des ftes. On y suspendait des bany clbrer et des dais, on rpandait des fleurs, on brlait deroles des parfums. Les lanternes au jour, ne s'teiet, de jour mme, y supplaient primitivement taient pleins jamais. mit lanternes, et les sept et les peuples On ou crut que gnaient une des bougies des ayant pris la bouche le feu aux banderoles et aux draperies des pavillons, du temple furent entirement consums. Les rois tages Un une grande douleur prouvrent de bois de santal avait t l'image le petit temple Ce fut pour tout de cet brle; oriental le monde vnement. mais (a), quatre on vit rat Le temple et les peuples de Tchi houan avait la premire des temps de toutes les statues
en ouvrant cinq jours aprs, tout d'un coup l'ancienne image. sujet de joie. On reconstruisit le second En tage, on rtablit au temple honorable arrivant
le temple, (i5) la statue
et quand on dans son ancienne Fa hian dans et Tao ce lieu, cts
un grand eut atteint place. tching r-
de Tchi houan, du sicle avait
flchirent macrations multitude
que durant de gens divers
t,
annes vingt-cinq anims des mmes royaumes : les uns
(16). A leurs penses devaient
de occup taient une
et parcouru les autres pays, voyant ce lieu
et qui avaient voyag retourner dans leur
l'instabilit prouver o Fo n'tait plus
de la vie (17). Ce jour-l, en le coeur pntr (18), ils eurent
CHAPITRE d'une Fa vive hian douleur. et Tao Les autres religieux
XX. adressrent une
175 question venus ? leur
demandrent-ils. rent ceux-ci.
: De quel tching pays tes-vous Nous sommes venus de la terre de Han,
mirable de entre venir
Les religieux chose! ces hommes chercher : Nous la loi autres
rpondiet dirent en soupirant : L'adreprirent de l'extrmit de la terre sont capables Puis ils se parlrent le temps
eux
nous n'adirent-ils, que nous nous succdons vions pas encore vu venir ici des prtres de Han (20). Au nord-ouest du temple, quatre li, il y a un bocage qu'on Bois des yeux recouvrs. Il y eut jadis cinq cents aveugles nomme qui, se rendant au temple, en cet endroit. Fo prcha la sjournrent loi en leur faveur, et ils recouvrrent tous btons la vue. dans Ces de joie, plantrent leurs transports acte d'adoration, le visage tourn racine la terre Les aveugles, et firent un
ce lieu! jusqu'en et Ho chang matres les uns aux autres,
(19), depuis
de ce ct.
btons
et grandirent. Les gens du sicle, par respect, et ils formrent un bocage : c'est pour cette raison qu'on le couper, nomme Dois des yeux recouvrs. Les religieux du temple de Tchi houan vont souvent, leur dner, dans ce bocage s'asseoir aprs pour s'y livrer la mditation. du de Tchi houan, la distance de six ou sept temple de Pi che hhiu (21) fit btir un temple, et y invita Fo li, la mre Cet endroit est dans une troite ainsi que les religieux. dpendance du temple de Tchi houan. Le bourg a deux portes, tournes l'une du ct de l'orient, et l'autre du ct du nord. C'est l le jardin pour o Fo Siu tha fit faire patriarche est situ ter (22). Le temple arrt et avait trs-longtemps aprs avoir au centre, donn dans que le l'aches'tait Au nord-est
prirent n'osrent les
l'argent l'endroit
la loi pour le salut des hommes. prch lev des tours, Aux lieux o il a pass ou s'est assis, on a partout : tel est celui o Sun to et ces lieux ont tous des noms particuliers li accusa Quand Fo de meurtre du temple (23). de Tchi houan par la porte orientale, et on sort
174
FO
KOU
KL
au nord, la distance qu'on marche la route, on trouve le lieu o Fo de quatre-vingt-seize les magistrats grands, des sectes et le
et dix pas l'ouest de avec les partisans jadis disputa les (24). Les rois du pays, hrtiques de soixante
et occups nuages Tchen tche mo na, nomme tique, sie , rattacha qu'elle tait ses vtements et, grosse, Fo d'avoir en un sur sur
taient tous amoncels comme peuple couter. En ce moment, une fille hrpousse son ventre de jaloupar un sentiment de manire faire croire elle des vint
reprocher Chy, se changea avait terre; l'enfer. chirer attache
en prsence de toute l'assemble, enfreint la loi (25). Alors le roi rat blanc de et et vint sorte ronger
dieux,
la ceinture
ses reins, s'entrouvrit,
la terre Thiao Fo,
que ses vtements cette femme tomba vivante venimeux dans l'enfer. avait
qu'elle tombrent dans dont
tha (26), qui de ses ongles tomba vivant pareillement
voulu
Ces lieux
t reconnus
et marqus par les hommes qui sont venus aprs. Dans l'endroit o eut lieu la dispute on a aussi (avec les hrtiques), lev un temple; ce temple est haut de six toises (27) environ. Dans l'intrieur A l'orient nant face sont dernier l'appelle aux du est une statue de Fo assis. chapelle Couverte (28) des dieux apparteElle est en de la route, il y a une et qu'on nomme
hrtiques bti temple
ainsi
l'oppos est aussi haut Couvert
par l'ombre. sur le lieu de la dispute, et les deux temples l'un de l'autre des deux cts de la route. Ce de l'ombre. six toises Quand environ. le soleil Voici est pourquoi on le
mais quand le hrtiques; la chapelle se dirige au nord et ne recouvre l'orient, le temple de Fo. Les hrtiques avaient coutume jamais d'envoyer des gens pour garder la chapelle de leurs dieux, la balayer, l'arrodes parfums et y allumer ser, y brler des lanternes pour clbrer leur culte ; mais le lendemain matin toutes les lanternes se trouvaient aj>partenant l'ombre de transportes dans le temple de Fo. Les Brahmanes (3o), pleins
temple des dieux
par de Yhonorable
l'occident,
du sicle (29) couvre aux
de son ombre
la chapelle soleil est
de
CHAPITRE ressentiment, s'en nous nuit raient servent se dirent pour les : Les honneurs pas? ils virent les Fo, Cha men
XX. prennent nos Fo; donc lanternes pourquoi se mirent
175 et ne la
y opposerions-nous attendre; mais prendre de Fo
qu'ils rendent Les Brahmanes les dieux
eux-mmes et honorer
lanternes,
et les gnies qu'ils adofaire trois fois le tour du tout coup. Les de Fo et celle dans la
temple Brahmanes des
gnies,
ainsi apprirent et, abandonnant
puis connatre leurs
disparatre la grandeur
familles,
ils entrrent
religion. La tradition ment, dix-huit et qui Milieu il y
rapporte avait autour
seng kia lan, n'taient vides (3i),
voisine de cet vnequ' une poque du temple de Tchi houan quatre-vingttous pourvus de logements pour les religieux, qu'en un seul endroit. Dans le royaume sectaires qui du
il y a quatre-vingt-seize sortes de tous connaissent le monde actuel secte a ses disciples (32). Chaque qui sont nombreux; ils mendient leur nourriture, mais ils ne portent aussi le bonheur dans les dserts (33). Ils cherchent pas. de marmite et sur les routes, et ils y tablissent des maisons aux pour fournir le couvert, des lits et de quoi boire et manger. Les voyageurs la vie religieuse hommes qui ont embrass y logent pareillement en allant ainsi aussi Fo norent n'est des du et venant; pas le sectateurs pass mais mme qui le temps durant ils sont hbergs lequel les monastres). Thiao tha a (que dans encore : ils honorent subsistent les trois Chy kia wen foe (35) qu'ils n'ho-
temps
(34); il n'y a que de Che 'we,
pas. Au sud-est
de la ville
voulait plaa tour.
le royaume de attaquer sur la route, o il tait et, l'endroit
quatre li, le roi Lieou h (36) du sicle se Che i (37). Vhonorable debout, on a lev une
A cinquante li l'ouest une bourgade de la ville, on vient nomme Tou we (38); c'est le lieu de la naissance du Fo Kia che (3g). Au lieu o le pre et le fils eurent une entrevue [ko), ainsi qu'au lieu
176 pan ni houan truit une grande la (43) Kia che. du (4i), tour on
FO a lev pour les
KOU des Che
KL tours. On a pareillement li {ko.) du corps entier consdu Jou
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XX.
(1) Huit yeou yan.] Onze lieues un cinquime. se reconnat (2) Kiu sa lo.] Ce royaume, appel aussiKiusa lo par Hiuanthsang, aisment pour le pays de Ks'ala ou d'Aoude. C'est une des contres les plus clbres dans l'histoire du bouddhisme primitif. Il est important et facile d'en dterminer la situation. Ce point bien fix assurera d'autant plus les stations prcdentes, et nous fournira une base solide pour la suite de la marche des plerins au travers de reconnatre. La carte de l'Inde qui se trouve d'une rgion qu'il est trs-intressant dans la grande Encyclopdie japonaise (liv. LXIV, pag. 13 ), que M. Klaproth a reproduite en franais a, et qu'il a jointe ce volume (PL I), prsente sparment les deux noms Kiao sa h et Che 'we, faisant de l'un et de l'autre deux royaumes distincts, entre lesquels on voit celui de Kia pi lo. Cependant Fa hian runit Kiu sctlo et Che'we dans un seul royaume, en faisant de Che 'we la capitale de Kiu sa lo. Comme il avait t sur les lieux, on peut donner la prfrence son tmoignage sur celui du gographe inconnu qui a compil les matriaux de la carte que nous venons de citer. Kiu sa lo est le Ks'ala des livres sanscrits, le clbre royaume de Rama dont Ayohya fut la capitale. La position de ce pays est donc un point des plus assurs dans l'itinraire de Chy f hian, puisqu'il rsulte ]a fois d'une synonymie incontestable, et de la marche du voyageur avant et aprs, c'est--dire depuis Mathoura et Kanoudje jusr qu' Patna. On pourrait peut-tre supposer que le nom de Ks'ala s'est tendu d'autres contres de l'Inde, puisqu'on retrouve, sur la carte cite, Kiao sa lo plac l'occident de Bnars, au midi de Kaous'ambi et de Mathoura, et indiqu comme un grand royaume de six mille li de tour. En outre, un pays de Kia tse lo, dont le nom semblerait une autre transcription du mme mot sanscrit Ks'ala, se voit aussi sur la mme carte au nord-ouest d'O che yan na (Oudjan). C'est celui que Hiuan thsang place dans l'Inde occidentale et dont il nomme la capitale Pi lo ma lo b. Ce doit tre Guzarate. Ma touan lin cite une histoire de Kou sse lo, Kou sse lo tchoaan, compose en un livre par un anonyme c; mais il ne donne aucun dtail ce sujet. Il est probable
* Mmoires l'Asie,tom. II, pag. 4io. l Pianiiian, liv. LXXVI,art. 17. Wenhianthoung relatifs khao, liv.XCIX, pag. 7 v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XX.
177
qu'il ne s'agit pas l du Ks'ala, mais d'une famille Kou, tablie dans la rgion l'occident du Fleuve (le Tangout), et avec laquelle un officier chinois, nomm Lieou houan tchoung tchang, alla, par ordre de l'empereur de la Chine, nouer des rapports diplomatiques en io4i aUne difficult relative l'identit de Ks'ala et de Che 'we, admise par F hian et rejete par Hiuan thsang, sera examine dans la note suivante. (3) Che 'we. ] On rend ce nom de ville par Funcj le, vertu abondante ou florissante h, et aussi par Wen w, productions clbres, parce que, par la rputation de ses productions, celte ville l'emporte sur tous les autres pays, et qu'on en tire beaucoup de choses prcieuses c. Hiuan thsang assure que ce mot est altr, et qu'il doit se prononcer Chy lofa sy li (S'rvasti)d, La ville de Che 'we tait recommandable par quatre proprits dignes de remarque. Elle renfermait toute espce de richesses et de choses prcieuses, de sorte qu'aucun autre royaume ne pouvait l'galer. Les cinq sortes de dsirs (correspondants aux cinq sens) y taient plus vifs que partout ailleurs. Aucun autre pays n'offrait une si grande abondance. Nulle pat les habitants n'taient plus en tat de cultiver la doctrine et d'obtenir la dlivrance absolue e. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le mme Hiuan thsang dcrit sparment le Ks'ala et le S'rvasti, tandis que Chy f hian fait du second le nom de la capitale du premier. Hiuan thsang se rendit S'rvasti en partant de Pi so kia, et passa de l Kapilavastou; ce fut plus tard, aprs avoir travers le Kalinga, qu'il trouva le Ks'ala, d'o il atteignit ensuite le pays d'Andlira, qui rpond au Telinga moderne. Il est donc facile de voir que le nom de Ks'ala s'appliquait, du temps de Hiuan thsang, une partie de l'Inde que F hian n'avait pas visite, et dont il ne dit rien. Aussi les dtails que le Si iu tchi donne sur cette contre aucun rapport avec ce qu'en dit l'auteur du Fo kou ki. Ils concernent exclusivement la prdication-que fit le treizime patriarche Nga kochouna f, principalement dans les parties mridionales de l'Inde, 800 ans aprs Shkya. D'un autre ct, les scnes de la vie de Shkya que Fa hian place clans le Ks'ala et le Che 'we (car ces deux noms sont pour lui synonymes), se retrouvent indiques par Hiuan thsang dans le Chy lo f sy li. C'est donc ce dernier pays qui est le Ks'ala du Fo liou ki; mais il est permis de supposer que le souvenir de la monarchie puissante dont les crivains de la secte des Brahmanes attribuent la fondation leur Rama, s'tait perptu dans d'autres rgions de l'Inde, et notamment dans celle laquelle le Si iu tchi conserve le nom de Ks'ala. a Wen hian Ithao,liv. XCIX,pag. 17 v. ilioung 1 San Isangfsou,liv. XXV,pag. 3 v. Liv.XXXI, pag. 6. 0 Ibid.liv. XXVI, pag. a Piani iian, liv. LXXV, art. 6, pag. i. c Fan y cit mingi, liv. III, art. des royaumes, dans le SanIsangfsou, liv.XVIII,pag. i 9 v. f ci-dessus,XVII, 21, pag. i5g. Voyez n'ont-ils
178
FOE
KOUE
KL
dans les livres boud(li) Pho sse no.] C'est le nom qu'on donne habituellement, de Shkya. On traduit ce dhiques, au prince de Ks'ala qui tait contemporain nom par arme victorieuse ou triomphante ~%~)J*K- Hiuan thsang le dclare altr et le restitue P lo si na chi to, en le traduisant de la mme manire. La forme sanscrite doit tre Prasendjit. Ce prince, peu de temps aprs qu'il fut mont sur le trne, demanda en mariage, au roi de Kapila, une princesse de la race de Chy tchoiing ou Shkya soula. Une esclave de Ma ha nan ayant mis au monde une fille d'une beaut parfaite, on l'envoya au roi Prasendjit, qui en eut un prince nomm Lieou h : il en sera parl plus bas. Ma ha nan tait fils du roi Hou fan et cousin de Shkya. Sanang Setsen nomme en mongol Saltchan, le prince qui, du temps de Bouddha, rgnait Ks'ala, dans la ville de Fasli, et dit qu'il tait fils du roi Arighona oekuktchih. Je souponne quelque erreur dans ce rcit, au moins quant la ville de Was'ali, qui ne devait pas, l'poque dont il s'agit, tre renferme dans les limites du Ks'ala. On sait que le traducteur de Sanang n'offre, dans ses notes, aucun claircissement sur la partie du texte de son auteur relative l'ancienne histoire de l'Inde, et qu'il s'est born transcrire, sans les expliquer, les noms traduits en mongol des princes indiens. (5) Siu ili.] Ce nom est encore altr, selon Hiuan thsang, qui l'orthographie Sou th to et le traduit par bien donnant"; ce doit donc tre en sanscrit Soudt. Le titre de peT-pZ- tnan9 tche, qu'on lui donne, dsigne indiffremment la supde l'ge et celle du rang : c'est donc ancien, le patriarche ou le chef, le grand. Ce Soudt tait effectivement l'un des grands ou des ministres du roi Prasendjit. Pieux et clair, sachant amasser les biens et les rpandre, gnreux envers les pauvres et secourable pour les ncessiteux, les orphelins, les hommes isols, il mrita le beau surnom de Ky kou ton. (largitor erga orphahos.et dereliclos). C'est lui qui rigea pour Bouddha le temple de Tchi houan, dont il sera parl plus bas ; ce qui fit donner cet emplacement le nom de Ky koa touyouan (jardin du bienfaiteur des orphelins) d. Hiuan thsang vit, au vne sicle, les ruines du palais d ce ministre c. (6) Le mauvais gnie Yng Mue,] nomm ailleurs Yng kiu ma lo. Ce nom signifie qui montre les vlements ou la parure. On dsignait ainsi un tre malfaisant qui s'tait rendu le flau du royaume et de la ville de Chy lofa sy ti (S'rvasti). Il tuait les hommes et prenait leurs bonnets et leurs ttes pour s'en faire une parure. Hiuan thsang raconte, au sujet de ce mauvais gnie, une lgende qu'on trouve dans le Si iu tchi, chapitre consacr au pays de Chy lofa sy ti. * San d Pian i tian, u. s. tsang f sou, liv. XXXII,pag. g v. h Gcsch. c Fan lier Ost-Mongolen, i /|. p. y ming i, cit dans le San isangf sou, c Piani tian, liv. LXXV, liv. XXIV,pag. 20. pag. i v. riorit
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE minents
XX. dans le bouddhisme.
179 Voyez
(7) Pan ni houan.] Mort des personnages ci-dessus, chap. XII, note 3.
(8) Les Brahmanes hrtiaaes.] C'est--dire ceux qui sont attachs au culte.brahmanique et la doctrine des Vdas. On a vu plus haut (chap. XVII, note 2 1 ) ce que les Bouddhistes appellent hrtiques. (9) Deux pavillons.] Au lieu de ttgj ^ Liang siang, qu'on lit dans le texte, le Pian i tian porte ]*a tS^ Si siang, ce qui parat une meilleure leon. Il faut traduire le pavillon occidental a deux colonnes de pierre, etc. (10) Une roue. ] On sait que la roue (tchakra) est un emblme familier aux Bouddhistes ; il exprime le passage successif de l'me dans le cercle des divers modes d'existence, la puissance des rois Tchakravartis (voyez chap. XVII, note 12) sur toute la terre habitable, et la prdication des Bouddhas ainsi que les bons effets des prires et des invocations rptes comme l'aide d'un chapelet (voyez chap. V, note 6). Faute d'explication, on ignore quel pouvait tre le sens de la roue place sur une colonne auprs du temple de Djt. (11) Le temple de Tchi houan.] C'est un des difices les plus clbres du bouddhisme : son nom est altr par F hian, mais les autres auteurs samanens l'crivent Tchi tho, et l'interprtent par victoire j|&_ *a. Hiuan thsang, qui affecte beaudans la transcription des mots sanscrits, dclare corrompue coup d'exactitude la forme mme de Tchi tho, et crit ce nom Tchi to ou Chi to. Il confirme au reste de ses devanciers : ainsi nous avons la certitude que ce temple cl'interprtation lbre s'appelait en sanscrit 3RTTDjet, c'est--dire le temple du victorieux ou du triorn ce nom le mot lin, fort; ce qui forme l'quivalent phateur. Les Chinois.ajoutent exact du terme pli ou sanscrit Djetavana, si frquemment employ dans les livres singalais. Il parat que ce nom de victorieux tait celui du prince hritier du royaume, qui appartenait le jardin sur l'emplacement duquel fut bti le temple ; et comme ce fut Soudt qui fit les frais de cette acquisition, on appelle indiffremment cet difice sacr et le terrain qui l'entourait temple de Djt et jardin du bienfaiteur des orphelins (Ky kou ton youan) \ Voyez ci-dessus, note 5. Le temple de Djt est l'un des huit qu'on nomme Ling ili, Tours divines ou Tours des Esprits. Les sept autres sont celles du jardin de Loung mi ni ou Lan pi ni, dans la ville de Kapila; celui qui fut bti sur les bords de la rivire Ni lian, dans le pays de Magadha ; celui du Parc des cerfs, prs de Bnars ; celui de la ville de Kanoudje; celui de Rdjagriha; celui de la Belle ville; et enfin celui de la ville de a San b Isangfsou, liv. XXXI,pag. 5 v. Ibid.liv.XXIV,pag. 20.
180
FO
KOU
KL
Kouchina. Il y a un livre qui porte le titre de P ta ling 'th ming hao king ou Livre sacr des noms et titres des huit grandes tours divines. Selon cet ouvrage, si quelqu'un, par l'effet d'une grande foi et l'impulsion d'un coeur bien dirig, btit une tour ou un temple et y tablit des crmonies et un culte, il obtient de renatre parmi les dieux. H y a dans le monde humain et dans les cieux un grand nombre de tours qui ont t riges pour les s'arira de Bouddha. Mais les huit tours dont parle ce livre sont celles qui ont t leves dans les lieux o Tathgata est descendu dans et o il a accompli divers actes importants de sa vie terrestre. par la suite du rcit de F-hian de quelle importance il tait pour lui temple de Djt, l'un des plus clbres de tous ceux qui existaient enpoque. Beaucoup de passages des livres sacrs sont supposs rvls par Bouddha quand il tait clans la ville de S'rvasti (Che 'we) et dans le temple de Djt. (12) Au ciel de Tao li.] C'est--dire au Trayastrinsh. Voyez chap. XVII, note 2. (i3) Les quatre classes.] Dans le texte, Sse pou : c'est ce qu'on nomme ailleurs Ssepe, les quatre troupes; c'est--dire : i Les Pi khieoa (Bikchou), les mendiants ou religieux qui font profession de recevoir leur nourriture par aumne (voyez cha2). VIII, note 5). Ils mendient en haut pour soutenir leur vie intellectuelle, et en bas pour sustenter leur corps visible. 1 Les Pi khieou ni (Bikchouni) ou mendiantes ( voyez chap. XVI, note 3o ). 3 Les Yeou pho se (Oapsika) ; ce mot signifie les purs, et indique que, bien que ceux qui le portent restent dans leur maison, c'est--dire mnent une vie laque, ils observent les cinq prceptes et gardent une conduite pure. On rend aussi leur nom par hommes qui approchent du devoir, pour exprimer qu'en accomplissant les prceptes, ils se rendent propres recevoir la loi des Bouddhas. 4 Yeou pho i (Oupayi) ou femmes pures, c'est--dire laques a. (1 i) Le petit temple oriental.] Je traduis d'aprs la leon du Pian i tian, qui porte Tonng siao tsing che. Le Fo kou ki offre une faute en cet endroit; on y lit Toung yuo tsing che >r, au lieu de A~%, ce qui ne fait pas de sens. (1 5) On rtablit la statue. ] Il y a ici une lacune de deux caractres dans le texte du Fo kou ki. Le Pian i tian la remplit par les deux mots jjg. "W Tchounq yonan. Le premier est exact : quand on eut atteint le second tage Mais le second est videmment fautif. Il faut lire jpg^ Hoan, retourner, rtablir. (16) Vingt-cinq annes.] Cette " Fan priode de vingt-cinq annes d'preuves ne se la naissance, On verra de visiter le core cette
cit dansle Sonisangf sou, liv. XVI, pag. liv. y mingi, liv. VIT,art. des disciples,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XX.
181
trouve indique qu'en cet endroit. Shkya mouni passa cinq ans dans les dserts avant d'atteindre la perfection absolue. Il devint Bouddha trente ans, et vcut ensuite quarante-neuf ans occup prcher sa doctrine. Il s'agit apparemment de quelque temps de pnitence qu'il avait accompli dans une de ses existences antrieures en qualit de Bodhisattwa. (17) L'instabilit de la vie.] En sanscrit anityam. C'est une des conditions de l'existence relative de ne pouvoir durer, d'tre sujette au changement. Cette expression est bien pompeuse pour tre employe dans une rflexion si simple. Peut-tre est-elle emprunte de quelque passage des livres sacrs. La phrase entire a peuttre un sens diffrent; je la rapporte ici pour qu'on puisse en juger : elle est la mme dans les deux textes :
O Fo n'tait plus.] La phrase du texte a bien plus d'nergie : voyant cette place vide de Fo. ML ^TL' littralement (18)
: 'fwj Jff
(19) Ho chang.] Ce terme, trs-usit la Chine, n'a jamais t bien expliqu. Les dictionnaires vulgaires le rendent par prtre de la secte de Fo, bonze. Il est tranger la langue chinoise, et appartient la langue de Khotan, dans laquelle il reprsente le mot sanscrit Oupsika (Yeou pho se, Yeou pho chy kia, Ou pho so Ida). Les Chinois l'interprtent par fortes, robore nati, in vi viventes a, et aussi par purissimi doctores et ojficio proximi; ce qu'on dveloppe en disant que ce sont des hommes qui, par leur puret, s'approchent de l'tat o il faut tre pour recevoir la loi de Fo h. On le rend encore ailleurs par magistri doctrin donati ou magistri doctrinal proximic. Oupsika signifie simplement fidles, dans un sens religieux, et c'est le nom gnrique des Bouddhistes Ceylan et au Pgu. Mais ce mot dsigne particulirement les laques, ainsi qu'on l'a vu dans la note i3 ci-dessus. A ce qu'on y trouve sur les quatre classes des Bouddhistes, j'ajouterai qu'on en distingue aussi sept, qu'on nomme les sept multitudes ( Thsy tchoung). De ces sept, cinq sont rputes ou, comme on s'exprime dans les livres boudappartenir la vie monastique, dhiques, tre sorties de la maison; et deux sont dsignes comme restant dans la maison, c'est--dire comme menant une vie laque. Voici ce que je trouve au sujet de cette autre classification. i Les Pi khieou ou mendiants, aussi nomms Pi tsou, par allusion une plante odorifrante des monts Himalaya, laquelle ressemble aux religieux mendiants sous cinq rapports : elle est molle et flexible, et marque ainsi la simplicit de leur exth c tsangf sou, liv. XXIII, pag. 26 et pass. Ibid.liv. XXXIX,pag. 25. Ibid.liv. XXX, pag.5. Liv.XXXIII,pag. 1 v. a San
182
FOE
KOU
KL
rieur et de leur langage annonant la soumission et l'humilit; elle est tranante et s'tend latralement, et en cela elle indique leur disposition continuelle travailler au salut des autres hommes; son parfum se rpand au loin, de mme que l'odeur des prceptes qui est porte partout quand les religieux les accomplissent; elle a des proprits curatives, qui sont l'emblme du pouvoir des mendiants pour faire cesser les passions et les vices; elle ne se dtourne pas des rayons du soleil, et reprsente en cela les religieux qui ont constamment les yeux fixs sur le soleil de Bouddha. 2 Les Pi lihieou ni ou Pi tsou ni, ou mendiantes : la finale ni marque le fminin. Suivant le Ta tchi lun, les mendiantes ont pratiquer un grand nombre de devoirs : c'est pour cela qu'elles viennent aprs les mendiants. On dit aussi qu'elles ont moins d'aptitude aux devoirs de la loi, aussi les place-t-on aprs les Pi khieou. 3 Les Cha mi ou Chy li mo li lo kia, dont le nom exprime qu'ils s'abstiennent des affections qui sont la souillure du sicle, et qu'ils aiment et secourent tous les tres vivants. Comme ils commencent entrer dans la loi de Fo, ils conservent encore beaucoup d'affections dont il est ncessaire qu'ils se. dbarrassent afin de s'abstenir du mal et de pratiquer la bont. 0 Les Cha mi ni ou Chy li mo li kia, en chinois femme qui est diligente et qui s'vertue, pour marquer l'attention subtile et les efforts des femmes qui s'exercent aux bonnes actions de la loi de Fo. 5 Les Chy tcha ma na ou femmes qui tudient la loi. Le Hing sse tchhao dit : Les Chy tcha ni ont trois sortes d'tudes faire : i Elles tudient les principes oues bases (de la loi); ce sont les dfenses de tuer, de voler, de commettre des impurets , de mentir. 2 Elles tudient les six lois, ce qui consiste ne pas souiller sa pense, son corps, son tact; ne pas voler quatre deniers autrui, ne pas ter la vie aux animaux, ne pas commettre de petits mensonges, ne pas manger hors des heures fixes (chap. XVI, note 18, pag. 107), ne pas boire de vin. 3 Elles tudient la pratique, et par l on entend les prceptes que les grandes Ni (religieuses) doivent observer et pratiquer. 6 Les Yeou pho se, anciennement OH pho so kia (Onpsilm). Voyez ci-dessus. 70 Les Yeou pho i ou femmes trs-pures. Anciennement on transcrivait ce nom Ou pho sse kia, et on le traduisait par mulieres appropinquantes ad ojfwium*, etc. Voyez ci-dessus, pag. 123 et 180. On voit, par tous ces passages, que loin de dsigner les bonzes ou les prtres de Fo, le mot Ho chang, dans la langue de Khotan, et son quivalent sanscrit Oupsika, s'appliquent * Jin proprement aux Bouddhistes qui mnent la vie laque, tout en
wanghou houephanjo hing,liv. XII, au mot 'Ou. Fan y mingi, cites dans le San isangf sou, liv. XXIX, pag. 24-
NOTES observant
SUR
LE
CHAPITRE
XX.
183
les prceptes de la religion et en gardant une conduite rgulire et sans souillure. Ce titre rpond donc exactement celui de Fadjra tchrya que M. Hodgson a trouv dans les livres bouddhiques du Npala. (20) Des prtres de Han.] C'est--dire de religieux chinois. Le mot que je rends ici par prtre est le mme mot Taojin, homme de raison, qu'on a dj vu plus haut. (21) La mre de Pi che khiu.] Hiuan thsang parle en trs-peu de mots de l'invitation adresse Bouddha par la mre de Pi che khiu. Il n'ajoute ce sujet aucune particularit. (22) L'argent pour l'acheter.] Voyez ci-dessus, notes 5 et 11.
(2 3) De meurtre.] [Cette accusation appartient ce que les Bouddhistes appellent les neuf'tribulations de Fo. Fo raconta que jadis dans la ville de Pho lo na (Bnars), il y avait un comdien nomm Tlising yan et une femme dbauche appele Lou siang. Thsing yan invita cette femme sortir en char de la ville avec lui. Parvenu dans un jardin plant d'arbres, comme ils s'y rjouissaient ensemble, il y avait un Py tchi fo qui se livrait ses actes de pit et tudiait la doctrine. Thsing yan attendit que le Py tchi fo ft entr dans la ville pour mendier sa nourriture, puis il tua Lo siang et l'enterra dans la tente du Py tchi fo. Il accusa le Py tchi fo. Quand celui-ci fut parvenu au lieu du supplice, Thsing yan, en le voyant, sentit des remords et dit : Pour ce que j'ai fait je dois re cevoir la punition. Il confessa donc son crime, et le roi fit tuer Thsing yan. Ce Thsing yan d'alors, ajouta Fo, c'est ma personne; cette Lou siang d'alors, c'est Sun to li. Par une consquence de ce crime, j'ai subi des peines infinies durant un nombre infini de milliers d'annes ; et maintenant mme que je suis devenu Bouddha, il me reste encore des peines subir par l'accusation injuste porte contre moi par Sun to lih. KL. ] (2k) Quatre-vingt-seize sectes hrtiques.] Le San tsang f sou n'en compte que quatre-vingt-quinze c, encore les rduit-il onze principales sur lesquelles seules il entre dans quelques dtails. Voyez ci-dessus, chap. XVII, note 20. (2 5) D'avoir enfreint la loi.] Hiuan thsang raconte aussi cette autre aventure avec de lgres diffrences dans les dtails. La fille brahmane qui accusa Fo d'avoir pch avec elle se nommait Tchin tchha, Tchin cha ou Tchen che. Fo expliqua plus Shetch Buddhism, derived of from.theBouddha scripturcs ofNpal, dansles Transactions of theRoyal asiatic tom. II, pag. 2^5. Society, h Tatchitonlunet Hingkhihinghing,citsdansle Santsang fa sou, liv.XXXIII,pag. 22. ' Liv. XLIII, pag. 2-
184
FOE
KOUE
KL
tard ses disciples pourquoi il avait t en butte cette calomnie. Trs-ancienne ment, dit-il, il y avait un Bouddha nomm Tsin ching Jou la (le Tathgata trs victorieux). Dans l'assemble que les religieux formaient autour de lui, se trou vaient deux bhikshous, nomms l'un, Wou ching (sans victoire), houan (toujours joyeux). Il y avait alors dans la ville de Bnars Ta 'a (grand amour), dont la femme s'appelait Chenlionan (bonne deux mendiants frquentaient cette maison, o ils recevaient et l'autre Tchhang un grand nomm
trompeuse). Les d'abondantes lar gesses. Wou ching, qui avait rompu avec les souillures du monde, ne se relchait jamais des devoirs de son tat; Tchhang houan, au contraire, encore retenu dans l'erreur et les actes (mondains), ne pouvait s'empcher d'apporter quelque n gligence dans l'accomplissement du culte. Del naquit en lui un sentiment d'envie qui le porta rpandre faussement le bruit que le commerce de Wou ching avec Cloen houan n'tait pas en vue de la loi et des crmonies de la religion, mais qu'il tenait des sentiments tendres. Or, continua Fo, le Tchhang houan de ce tempscil n'tait autre que moi-mme; et cette Clien houan, dont je viens de vous parler, est la mme que Tchin tchha. La calomnie que j'ai exerce l'gard de Wou ching m'a justement fait encourir plusieurs genres de punition ; et maintenant mme que je suis parvenu la dignit de Bouddha, il me reste encore cette peine endurer. Au moment o je prchais la loi en faveur des hrtiques, des men diants, des rois et de leurs sujets, une fille vint tout coup, ayant un bassin suspendu sur son ventre, et, se plaant devant moi, m'interrompit par ses dis cours injurieux. Samanen! me dit-elle, que ne t'occupes-tu des affaires de ta maison au lieu de discourir ainsi sur les affaires des autres? Tu ne songes qu' ton plaisir et tu ne t'embarrasses pas de mes souffrances. Tu as t prcdemment avec moi et tu m'as rendue grosse. Il faut que pour le mois prochain je puisse avoir du beurre pour nourrir mon enfant, songe m'en procurer. A ces paroles, tous ceux qui taient dans l'assemble baissrent la tte et gardrent le silence. Mais Chy thi houan in (Indra) se changea en rat, passa sous les vtements de cette fille, et rongeant le cordon qui attachait le bassin, le fit tomber terre la grande satis faction de l'assemble ". Hiuan thsang vit encore la fosse par o cette vierge calomniatrice tait tombe vivante dans l'enfer h. C'est l encore un exemple des huit tribulations auxquelles Shkya mouni se vit soumis, mme aprs avoir atteint le rang de Bouddha, en et pour lesexpiation des fautes par lui commises en des existences antrieures, quelles , malgr des chtiments prolongs durant des myriades de milliards de sicles, il demeurait encore assujetti un reste de pnitence. Shkya mouni fit connatre ses tribulations ses disciples afin de les animer la pratique des bonnes actions, en leur faisant voir que mme un Tathgata, aprs avoir accompli la doctrine, fait " Ta tchi loulun, liv. IX, et sou, liv. XXXIII, pag. 25. Hing khi hingking, cits dans le San tsang f 1 Pian i tian, liv. LXXV,art. 6, pag. 5.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XX.
185
sa condition humaine et acquis dix mille cesser tous les maux qui appartenaient sortes de bonheur, ne pouvait se drober aux effets de quelques pchs qu'il avait pu commettre dans les kalpas prcdents. (26) Thiao th,] ou, d'aprs une orthographe plus rgulire, Thi pho th ton ou Thi pho th tho (Dvadatta), est un nom dont on donne la signification sanscrite de deux manires : chaleur cleste* ou don des dieux 1. Cette dernire interprtation, qui est rapporte par Hiuan thsang, est la seule vritable. Le mme auteur fait ce perD'autres crivains, qui ne semblent pas sonnage fils du roi Hou. fan (Amitodana). bien informs, cas, Dvadatta le reprsenter le font natre du roi P fan (Dhotodana). Dans l'un et dans l'autre tait le cousin germain de Shkya mouni. On s'accorde galement comme l'ennemi le plus acharn du fondateur de la religion. On
trouvera plusieurs traits de cette haine implacable dans d'autres endroits de ces relations. Hiuan thsang raconte en dtail l'aventure dont il s'agit ici, et dans laquelle Dvadatta, s'tant frott les ongles avec une substance vnneuse, vint de fort loin avec l'intention de faire mourir le Bouddha, en feignant de lui rendre hommage. (27) Six toises.] Environ i8m 3.
(28) Une chapelle des dieux.] Il y a quelque difficult pour trouver des quivalents aux divers termes chinois par lesquels on dsigne les difices consacrs au et leur destination. Le temple de culte, suivant leur tendue, leur importance Djt, dont il vient d'tre donn une si magnifique description, a le nom de Tsing che. Selon la gnalogie de Shkya c, un Tsing che est le lieu o s'arrtent ceux qui se sont rendus matres de leurs penses (les Bouddhas). Ce mot signifie sjour de la subtilit. On compte cinq difices principaux qui ont reu cette dnomination. 1 Le temple du Bienfaiteur des orphelins, bti par Soudata sur l'emplacement du jardin du prince Djt, et autrement nomm le temple de Djt. 1 Le temple de la montagne du Vautour, dont il sera parl plus bas. 3 Le temple de la rivire des Singes : il en sera galement fait mention dans un des chapitres suivants, k" Le temple de l'arbre An lo, qui fut offert Bouddha par une femme de ce nom. 5 Le temple du jardin de Bambous, dans la montagne Khi tche khiu, autrement nomm le jardin de Kia lan tho. F hian donne le mme nom beaucoup d'autres temples moins considrables, construits en des lieux o Bouddha avait fait quelque sjour. Mais le mot dont l'auteur fait usage ici pour dsigner un temple brahmanique, Sse, et il y joint le mot ^^ Thian (TJiian sse, temple des dieux), pour dsigner les Dvas objets du culte des Brahmanes, et rduits, clans le systme " San tsang f sou, liv. XXXVI,pag. 5 v. b Pian i tian, liv. LXXV,art. 6, pag. 4 v. pou, cit dans le San tsangf sou: liv. XXIV,pag. 20. * Chy kia est celui de -i"
186 samanen,
FO un rle trs-subordonn
KOU
KL
ploie toujours
(en sanscrit Devlaya). Hiuan thsang emdans le mme sens le mot -ftp*! j^^ Thian sse. Voyez ci-
(29) L'honorable du sicle.] Lokadjys'ta, un des noms de Bouddha. dessus, pag. 9, chap. II, note lx\ et pag. 9/1, chap. XIII, note 1 1.
(30) Les Brahmanes. ] 11est souvent fait mention des Brahmanes dans les lgendes qui se rapportent aux premiers temps du bouddhisme. Un livre fort ancien, le Ma leng kia king ", parle des quatre castes dans les termes suivants : On suppose faussement que nous (la famille de Bouddha) sommes ns de Brahma; c'est pour cela que l'on nous donne le surnom d'enfants de Brahma. Les Brahmanes prcitendent qu'ils sont ns de la bouche de Brahma; les Cha ti li (Kshatryas), de son nombril; les Pi che (Vais'yas), de ses bras; et les Cheou tho (Sotras), de ses pieds. D'aprs cet arrangement ils se regardent comme les premiers, et ils ne le sont vritablement pas. Le mot Pho lo men (Brahmana) signifie qui marche dans la puret. Les uns sont laques, et les autres embrassent la vie religieuse; ils se suc cdent de gnration en gnration, faisant leur occupation de l'tude de la doc<c trinc. Ils se disent les rejetons de Brahma : leur nom leur vient de ce qu'ils gardent la doctrine et conservent la puret. Le nom des Cha li li signifie seigneurs des champs. Ce sont en effet les possesseurs des grandes terres du monde, et ils <isont de race royale. Les Pi che ou Fi che sont les marchands, et les Cheou tho ou Chou tho lo forment la race des laboureurs. On voit, par l'histoire des patriarches, que la distinction des castes n'empchait pas de choisir indiffremment le principal chef de la religion dans l'une ou dans l'autre. Shkya mouni tait Kshatrya. Mah ks'yapa, son successeur, appartenait la caste des Brahmanes. Cliang na ho sieoa, troisime patriarche, qui fut revtu de cette dignit quatre-vingts ans seulement aprs le Nirvana de Bouddha, tait Vais'y a ; et Son successeur, Yeou pho kieou to, qui la reut cent quarante-quatre ans aprs cette re, tait Soutrab. Ainsi, conformment au principe du bouddhisme, on avait exclusivement en vue le mrite moral de celui qu'on choisissait pour la transmission de la doctrine, sans avoir gard aux distinctions de la naissance et la supriorit des castes. pris en mauvaise part, dans les livres bouddhiques, qu'autant qu'on y joint l'pithte de Watao, hrtique, htrodoxe; mais les accusations de jalousie et de malveillance portes contre cette caste sont trs-ordinaires, et l'on en rencontrera plus d'une encore dans la suite du rcit de Chy f hian. * Liv. I, cit, concurremmentavec le Fan y mingi, liv. I, dans le San tsangf sou, liv. XVI, occidenfamillesdescontres pag. i3, art. des quatre tales h Voyezla grande Encyclopdieintitule San tlisathouhoe, et rdigepar le docteur Wangkhi; sectiondesaffairesde l'homme, liv. IX, pag. I\ v. et suiv. Le mot Brhnan n'est dcidment
NOTES (3i)
SUR
LE
CHAPITRE
XX.
187
Le royaume du Milieu.] On a dj vu cette expression employe pour dsigner l'Inde centrale ou le Madhyads'a, comprenant les pays de Mathoura, Ks'ala, Kapila, Magadha, etc. (32) Connaissent le monde actuel] Cette phrase parat signifier que les hrtiques se bornent parler des devoirs imposs l'homme dans sa vie actuelle, sans la rattacher, par la notion de la mtempsycose, aux priodes antrieures d'existence qu'il a d traverser. (33) Pas de marmite.] C'est une diffrence essentielle l'gard des mendiants bouddhistes, dont on sait que la marmite est un attribut oblig. Voyez ci-dessus, chap. XII, note 8, pag. 82. (3/j.) Les trois Fo du temps pass.] Il s'agit des trois premiers Bouddhas de l'ge Keou na han mou actuel, dit le kalpa des sages : Keou leou sun (Krakoutchtchhanda), ni (Kanaka mouni) et Kia che (Ks'yapa). Il sera parl d'eux plus en dtail par la suite. On peut voir l'poque de leur apparition, selon la chronologie fabuleuse des Bouddhas, dans le tableau que j'en ai dress . (35) City kia wen, ] autrement Shkya mouni ( chap. XVII, note 2 6 ). Il est curieux de trouver l'indication d'une secte de Bouddhistes qui honoraient les Bouddhas des ges antrieurs, et qui refusaient de reconnatre le Bouddha de l'ge actuel, seul type rel d'aprs lequel on croit gnralement que ces personnages imaginaires ont t crs aprs coup, pour tre reports des priodes mythologiques. Il serait intressant de connatre les opinions religieuses de ce Dvadatta, cousin de Shkya, son rival et son perscuteur. Ce passage a de l'importance, parce qu'il semble autoriser penser que le dogme de la pluralit des Bouddhas et de leurs manifestations successives, remonte au temps mme de la fondation du bouddhisme. (36) Le roi Lieou li.] On sait que ce nom est la transcription d'un mot sanscrit qui dsigne une pierre transparente de couleur bleue, et par extension le verre. Hiuan thsang nomme ce prince Py lou tse kia, et rappelle comme tant une orthographe altre la forme Py lieou li. Lorsque Prasendjit fut mont sur le trne de Ks'ala, il fit demander en mariage une princesse du pays de Kapila et de la race de Shkya (Chy tchoung, Shakyoe.semen). Une des esclaves de Mahnanda, fils d'Amitodana et cousin de Shkya mouni, avait mis au monde une fille parfaitement belle. On l'offrit Prasendjit, qui l'pousa et en eut le prince Lieou li. A l'ge de huit ans, ce prince se rendit avec le brahmatchri '' Hao khou la maison n Essaisur la cosmographie et la cosmogonie des selonles auteurschinois,dans le JourBouddhistes, naldesSavants,cahierdedcembre i83i, pag.723. h Vovez pag. 69, note b. 24-
188
FOE
KOUE
KL
de Mahnanda. On venait d'lever, dans le royaume de Kapila, une salle de confrence o l'on voulait inviter le Tathgata recevoir les hommages de ses sectateurs. Le prince Lieou li entra dans la salle des confrences, et monta sur le trne du Lion (Sinhsana). A cet aspect, les enfants de Shkya s'emportrent en injures. Ce fils d'esclave, s'crirent-ils, ose entrer et s'asseoir ici ! Il sortit et dit au brahmatchri Hao khou : Les enfants de Shkya viennent de me faire un affront mortel : rappelle-moi cette insulte quand je serai mont sur le trne. En effet, quand par la suite le prince Lieou li fut devenu roi, Hao khou lui renouvela le souvenir de cette affaire. Lieou li rassembla des troupes et vint attaquer les enfants de Shkya. Shkya mouni prit part cet vnement qui menaait la tribu d'o il tait issu. Je vais transcrire ici l'explication qu'il en donna ses disciples; c'est un exemple de plus de ces destines auxquelles on est soumis en expiation des fautes commises dans des existences antrieures, et dont le Bouddha lui-mme n'tait pas exempt, ainsi qu'on l'a vu plus haut (note 2 5). Voici dans quels termes il expliqua aux bhikchous les causes de l'aventure de Licou li avec les enfants de Shkya. Fort anciennement, dit-il, il y avait prs de la ville de Loyou un village habit par des pcheurs. Il arriva une famine, et comme il y avait ct du village un tang rempli de poissons, les gens de la. ville en allaient chercher pour les manger. Dans le nombre de ces poissons, il y en avait deux, l'un nomm fou (balle de l'autre to chi (babillard, mdisant), froment), qui conurent du ressentiment (contre les pcheurs). Dans le mme temps, un petit garon qui s'amusait sur le a bord de l'tang voir frtiller les poissons, prit un bton et les frappa la tte. Or, les habitants de la ville de Lo you sont maintenant les enfants de Shkya; le poisson fou, c'est le roi Lieou li ; le poisson to chi, c'est le brahmatchri Hao khou ; et le petit garon, c'est ma propre personne. Voil par quel effet de la desa tine le roi Lieou li a fait prir la race de Shkya ", (37) Le royaume de Che i.] La suite du rcit fait voir qu'il s'agit du pays habit par les enfants de Shkya, c'est--dire par la tribu laquelle appartenait le fondateur de la religion bouddhique, surnomm lui-mme Skhya mouni (le religieux de la famille Shkya), Shkya Sinha (le lion de Shkya), etc. ; car on ne doit pas oublier que Shkya est proprement un nom de race et non point un nom d'homme, bien que nous nous en servions habituellement pour dsigner le Bouddha, fils de Shouddhodana. Au reste, il faut que le nom de Che i, qu'on donne ici au royaume des enfants de Shkya, soit une des dnominations applicables au pays de Kapila; mais l'tymologie en est jusqu'ici inconnue. (38) Ton 'we.] J'ignore la forme sanscrite de ce nom; mais la note suivante fera ' Ta tchitoulunet Hingkhihinghing,citsdansle San Isangfsou, liv.XXXIII,pag. 2k v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XX.
189
voir que ce n'est pas dans le pays de Ks'hala que le Bouddha Ks'yapa est suppos avoir pris naissance. (39) Fo Kia che,] c'est--dire Ks'yapa Bouddha; car ce mot doit tre lu Kia che et non pas Kia y, bien que le second caractre -&r ait habituellement la prononciation dey. On le trouve quelquefois crit entrais caractres, Kia chpho*. Ce nom de Ks'yapa, emprunt- aux antiquits brahmaniques, est appliqu parles Samanens un de leurs Bouddhas, celui qui est suppos le prdcesseur immdiat de Shkya 1 mouni; son nom est rendu par lucem bibens et aussi par testudo". La premire explication n'est qu'un jeu de mots, Kas'ya pa pouvant effectivement tre traduit par splendorem bibens vel absorbens, parce que l'clat qui jaillissait de son corps effaait toutes les autres lumires. C'est ce que les Mongols rendent par les mots de Gerel sakiktchi. Beaucoup de lgendes et de particularits mythologiques sont rapportes au temps du Bouddha Ks'yapa. Suivant la Srie chronologique des prdcesseurs de Bouddha'', le troisime Bouddha, Ks'yapa, parut dans le sicle au neuvime petit kalpa de l'ge actuel, dans la priode de dcroissement, quand la vie des hommes tait rduite vingt mille ans, c'est--dire, il y a maintenant ( 183 a ) de 1,992,859 annes. Suivant le long Agama{, il tait de la race des Brahmanes, la famille de Ks'yapa. Son pre se nommait Fan t (vertu de Brahma, Brahmas'la?), sa mre Tsa ichu (opulente). Il demeurait dans la ville de Bnars, et ce fut assis sous un nyagrodha (ficus indica), qu'il prcha la loi une assemble dans laquelle il convertit vingt mille hommes. Les deux esprits qui l'assistaient (genii pedes) taient Thi che et Pho lo pho; celui qui assemblait ses troupes tait Chenfan tsen. J'ignore le sens de ces deux expressions, genii pedes, exercitum colligere : il y en a de semblables dans chacune des notices relatives aux six Bouddhas antrieurs Shkya mouni. Selon le livre intitul Procds des Talhagalase, si l'on rcite convenablement les formules, Ks'yapa Bouddha se tient dans l'espace et tend sa protection sur un nombre infini d'tres vivants : il les garantit de toutes les maladies, de tous les malheurs, de l'influence des mauvais gnies. Voici ces formules divines : j'y joins autant qu'il se peut la restitution 1. Nan wou Fo tho ye, 2. Nan wou Th ma ye, 3. Nan wou Seng kia ye, * San tsang f sou, liv. XXVIII,pag. 1011. h Ibid.liv. XXXIII, pag. 22 et suiv. c Fan y mingi, cit dans le San tsangf sou, liv.LXI, pag. 12v. d Sclrmidt,Notes surSanang Setscn,pag. 3o6. sanscrite. Namo Bouddhya. Namo Dharmya. Namo Sangya. *Foctsou l (livrequi n'estpasadmisdansic toung recueilsacr), citdans leSantsang f sou,i. XVIII, 12. pag. f Citdansle Chini tian, liv. LXXVII,pag.7. e Jou luifangpian, cit l-mme.
190
FOE
KOU
KL Namo Ks'yapya. Om! Hara, hara, hara. Ho, ho, ho. Namo Ks'yapya. Arhate. Samyaksambouddhya.
4. Nan wou Kia che pho To kia to ye na, 5. An! 6. Ho lo, ho lo, ho lo, ho lo, 7. Ho, ho, ho, 8. Nan wou Kia che pho ye, 9. A lo han ti, 10. San miao San fo tho ye, 11. Sy tchu ho chi. 12. Ma to lo po tho. 13. Sou pho ho,
Swh.
Quand le Bouddha eut achev de rvler ces formules, il s'adressa au bodhisattwa Aks'agarbha et lui dit : Excellent jeune homme! ces formules sont celles qu'ont rcites un nombre de Bouddhas gal trente-trois fois les grains de sable du Gange ; tu dois les recueillir et les rciter en pratiquant de bonnes actions. 0 quelque homme vertueux ou quelque femme vertetueuse, qui, de jour et de nuit et dans les trois temps, rpte ces formules, il obtiendra de voir en songe les Bouddhas et d'tre dlivr de tous les empche ments rsultant des actes de la vie. Ks'yapa, rapporte dans les Louanges des sept Bouddhas a, est conue dans les termes suivants : J'adore Ks'yapa, le seigneur du monde, trs-excellent et trs-minent'sage, qui naquit Bnars dans une famille de Brahmanes rvrs L'invocation par les princes ; la vie de son corps illustre dura vingt mille ans, et les eaux des trois mondes furent dessches par la lampe de la sagesse divine qu'il acquit au pied de l'arbre nyagrodha. On voit que ce passage sanscrit, d'accord en quelques circonstances avec la traduction chinoise du long Agama, est contraire au tmoignage direct de Chy la hian, qui place le lieu de la naissance de Ks'yapa loin de Bnars, dans le nord de la province d'Aoude. h Le livre intitul Jou kouanfo san mi king dit que le corps de Ks'yapa Bouddha tait haut de seize toises (38m8) et que son aurole avait vingt yodjanas. Suivant un autre ouvrage c, le Bouddha Ks'yapa ayant prch sur les livres saints, il y eut, dans une seule assemble, vingt mille bhikchous qui obtinrent le titre d'Arhan. Le King ttchouan teng lou compte Ks'yapa Bouddha comme le troisime Honorable du kalpa des sages, c'est--dire le troisime Bouddha de l'ge actuel. (4o) Une entrevue.] Ceci doit tre une expression consacre, car on la retrouvera Comme Shkya mouni eut plus tard, l'occasion du Bouddha Krakoutchtchhanda. c Le Fa Stotra,danslesAsialic Ttesearches, SaptaBouddha yuan tchulin, cit l-mme. d tom. XVI, pag. /i54Citgalementdans le Chini tian, liv. LXXVII, '' Citdansle Chini tian, liv. LXXVII, pag.7 v. pag. 8. " Aks'agarbha! s'il se trouve
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XX.
191
une entrevue avec son pre Shouddhodana, on a voulu sans doute imiter cette particularit de sa vie et la reproduire dans la vie mythologique des prtendus prdcesseurs du Bouddha historique. (4i) Pan ni houan.] L'entre du Bouddha Ks'yapa clans le Nirvana. Cette expression a t explique ci-dessus (chap. XII, note 3) et releve ailleurs (chap. XVI, note i 5 ). (42) Les Che li.] C'est le mot sanscrit s'rra : les Chinois le traduisent du corps. Voyez pag. 5g, chap. VIII, note 1. par os
(43) Le Jou la,] c'est--dire le Tathgata, celui qui est rellement avenu, d'aprs le sens des termes chinois et tartares qui rpondent au mot sanscrit; et plus exaccelui tement, d'aprs l'analyse de ce dernier et d'aprs la doctrine bouddhique, qui est comme parti, qui a quitt dfinitivement l'existence relative pour entrer dans le Nirvana ou l'existence absolue. On le traduit en tibtain par De bjin gshegs pa, en mandchou par Inekou dzikhe, en mongol par Tagoutsilan iraksan*. C'est le premier des dix noms honorables que l'on assigne aux Bouddhas. On l'entend dans trois sens diffrents, selon qu'on l'applique aux trois tats du Bouddha (les trois corps), son tat de loi (Dharmakya), sa manifestation glorieuse dans le monde des ides (Sambhogakya), et sa transformation corporelle (Nirmnakya). Un Bouddha est Tathgata dans le premier sens, en tant qu'il n'est rien d'o, il vienne, et rien o il aille h, c'est--dire que la perfection absolue ne procde d'aucune chose et ne tend aucune autre chose. Il est Tathgata dans le second sens, parce que le premier principe, l'essence des choses, est similitude, identit (avec l'intelligence, ide conue par elle), et qu'il est parvenu s'assimiler l'Intelligence parfaite c. Il est Tathgata dans le troisime sens, en ce que port par la nature relle de la similitude (l'identit del nature intelligente), il est venu l'tat de parfaite Intelligence" 1. [Le mot Tathgata en sanscrit, de mme que De bjin gshegs pa en tubtain, signifie : qui a march de la mme manire que ses prdcesseurs ". KL.] le Vocabulaire sect.i. Voyez pentaglotte, Kin kangking, cit dans le San tsang f sou, liv.XXXV, pag. i8v. 0 lunlun, cit l-mme. Tchouanf d chilun, citl-mme. Tching ' Vocabulaire tom.I, pag. i v. pentaglotte,
CHAPITRE
XXL
Ville de Na pi kia. Lieu
de la naissance de Keou leou thsin fo et de Keou na han meou ni fo.
yeou yan (i) au sud-est, on vint une cit nomme Na pi kia (2). C'est le lieu de la naissance de Keou leou thsin Joe (3). Il y a galement des seng kia lan (4) dans les endroits o le pre et le fils eurent une entrevue (5), ainsi que de Che \ve, en faisant douze sur du pan ni houan (6), et on y a lev des tours. l'emplacement De L vers le nord, en faisant moins d'un yeou yan (7), on parvint une cit qui est le lieu o Keou na han meou ni j'oe (8) reut la naisOn et,
De la ville
sance.
a pareillement lev des tours dans l'endroit o .le pre le fils eurent et dans celui du pan ni houan. une entrevue,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXL
(1) Douze yeou yan.] Douze yodjanas valent environ seize lieues. (2) Na pi kia.] Ce lieu n'est point connu. (3) Keou leou thsin fo.] Nom d'un des Bouddhas antrieurs Shkya mouni. Il est quelquefois orthographi Keou leou sun; c'est une altration du sanscrit Krakoutchtchhanda : on le traduit par ce qui doit tre interrompu ou supprim, et l'on entend par l les vices et les passions qui doivent tre anantis de manire qu'il n'en reste rien. Les Mongols ont rendu ce nom par Ortchlang i ebdeklchi ". Il naquit dans le neuvime kalpa de l'ge actuel, lorsque la vie des hommes tait rduite soixante mille ans, il y a par consquent ' Sclimidt,Notes surSanangSctsen, pag. 3oti. cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXI.
193
mille huit cents ans ". Le livre intitul le long Agamab l'abaisse au temps o la vie n'tait que de quarante mille ans, et le rapproche de nous de deux millions d'annes. Suivant le mme ouvrage, c'tait un Brahmane de la famille Ks'yapa; son pre se nommait Li t et sa mre Chen tchi. Il habitait la ville de An ho (paix et concorde). Il prcha la loi assis sous l'arbre O li cha (s'ircha, acacia sirisa); et dans une seule assemble, il opra le salut de quarante mille hommes. Ses appuis spirituels'' taient Sa ni et Pi leou ; son gardien tait le suprme vainqueur Glien ki tsea ( fils de la bonne Intelligence). Le livre des Procds des Tathgalasd enseigne que quand on fait un bon usage des formules et des prires, le Bouddha Krakoutchtchhanda se tient dans l'espace. d'o il tend sa protection sur tous les tres vivants, loignant d'eux les maladies et tous les genres de maux, aussi bien que les dmons. C'est pour cela qu'il a rcit la formule suivante : i. Nan. wou Fo tho ye, 2. Nan wou Th mo ye, 3. Nan wou Seng kia ye, 4. Na mou Kia lo ki tsun ta ye, 5. To tha kia to ye , 6. A lo nanti, 7. San miao kia san fo tho ye, 8. An! g. Kia tho, kia tho, kia tho, kia tho. 10. Chi tchi, chi tchi, chi tchi kia tho ye. 11. Na mou Sa pho to tha kia ti fou. 12. Ho lo ho ta ti ye. i3. San miao san fo tho pho ye. 1 4- Sou pho ho ! Namo Bouddhya. Namo Dharmya. Namo Sangya. Namo Krakoutchtchhandya. Tathgatya. Arhate. Samyaksambouddhya. Om!
Swh!
Bouddha dit au bodhisattwa Aks'agarbha : E.tcelEnsuite Krakoutchtchhanda lent jeune homme ! ces dhran (invocations) sont celles que les Krakoutchtchhanda Bouddhas, ayant le mme nom (que moi), jusqu' un nombre gal celui des grains de sable du Gange, aussi bien que les Bouddhas des trois temps, ont en seignes et dont ils ont vant l'efficacit. Si les hommes gardaient ces divines for mules, ils pourraient, jusque dans le dernier kalpa du temps venir, tablir fera mement le culte des trois (tres) aux bhikchous, aux bhikchounis, prcieux, et faire natre la vritable foi. Quant aux Qupasikas, aux Oupayis, qui pourront r ci-dessus,pag. 189. ,l Voyez hing, citdans Jalafang pianchenkhiaotclicou le Chini tian, liv. LXXVII,pag. 4 v. 25
" Fan f mingi, liv. I(noms des Bouddhas),cit dans le Santsang f sou, liv. XXVIII,pag. 10. b Citdansle Chinitian, liv. LXXVtl, pag. !\v.
194
FOE
KOUE
KL ils carteront de leur corps
citer constamment ces formules et les observer, visible tous les genres de maladies et de maux. Voici l'invocation
Krakoutchtchhanda, telle qu'elle est rapporte dans le Sapla Bouddha Slolra" : J'adore Krakoutchtchhanda (sic), le seigneur des mounis, le sougata qui n'est point gal, la source de la perfection, qui naquit Kchemavati, d'une famille de Brahmanes rvre par les rois; la vie de ce trsor d'excellence fut de quarante mille ans, et il obtint, au pied de l'arbre s'ircha, l'tat de Djanendra, avec les armes de la science qui anantit les trois mondes. Le Jou houan fo san mi king h dit que le corps de Krakoutchtchhanda Bouddha tait haut de vingt-cinq yodjanas, que son aurole avait trente-deux yodjanas, et que la lumire mane de son corps s'tendait cinquante yodjanas. Le Fyouan tchu Unz dit que, dans une seule assemble o Krakoutchtchhanda expliqua les textes sacrs, il y eut quarante mille bhikchous qui tous atteignirent la qualit d'Arhan. Le Bouddha Krakoutchtchhanda est, suivant le King le tchouan teng lou d, le premier Honorable (Lokadjyes'ta) de l'ge actuel ou du kalpa des sages. (4) Seng kia lan.] Monastres. Voyez chap. III, note 5.
(5) Une entrevue.] Voyez chap. XX, note 4o. (6) Pan ni houan.] Voyez chap. XII, note 3. (7) Un yeou yan.] Unyodjana, une lieue un tiers environ.
(8) Keou na han meou ni Fo, ] autrement Ka na hia meou ni ou Kiu na han meou ni, en sanscrit Kanaka mouni. On interprte ce nom par aurea quietudo : kanaka signifie or, et marque ici l'clat extrieur du personnage ; et mouni, l'absence de tout obstacle au repos dans la vie solitaire 0. D'autres rendent ce mot par ermite d'or, parce que ce Bouddha avait le corps de couleur d'or f : les Mongols le nomment Altan tchidaktchiB. Il parut clans le monde et naquit dans le Djambou dwpa, l'poque o la vie humaine tait rduite quarante mille ans, c'est--dire, il y a trois millions h sept cent quatorze mille cent ans. Le long Agama place sa naissance au temps o la vie tait de trente mille ans, c'est--dire, il y a seulement deux millions sept cent quatorze mille cent ans. Ce personnage Asialic ditionde Calcutta,t. XVI, Rcsearches, pag. A53. 11 Citdansle Chini tian, liv.LXXVII,pag. 5 v. c Citl-mme. '' Citl-mme. tait Brahmane, " Fan de la famille de Ks'yapa;
y mingi, cit dans le San tsangf sou, liv. XXVIII,pag. 10D. f Ta tchitonlun, citl-mme. 5 Sclimidt, JS'olcs sur SanangSclsen,pag. 3o6. Citdans le Chini tian, liv.LXXVII,pag. 5 v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXL
195
son pre s'appelait Ta le (grande vertu) et sa mre Chen ching (bien victorieuse). 11 habitait dans la ville trs-pure, et tint, sous l'arbre appel Ou tsanpho lo men (Oudoumbara, ficus glomerala), une assemble dans laquelle il prcha la loi et convertit trente mille hommes. Ses appuis spirituels (chap. XX, note 39) taient nomms, l'un Chu phan na, et l'autre Yo lo leou. Celui qui le gardait tait le guide de la multitude, fils de la concorde tranquille .-j'ignore le sens de ces expressions mystiques. Suivant le livre des Procds des Tathgatas a, quand on rcite bien les formules, Kanaka mouni Bouddha se tient dans l'espace. Il tend sa protection sur tous les tres vivants, carte toutes les maladies, loigne tous les mauvais esprits. C'est dans cette intention qu'il a dbit les invocations suivantes : 1. Nan wou Fo tho ye, 2. Nan AVOU Th mo ye , 3. Nan wou Seng kia ye, 4- Na mou Kia na kia mou na i, 5. To tha kia to ye, 6. Alohanti, 7. San miao kia san fo tho ye , 8. An! g. Sa lo, sa lo, sa lo, sa lo, 1o. Sy lo pho ye. 1 1. Th mo , th mo, th mo, th mo , 12. Tou wou tou wou tou mo ye. 13. Na mou Kia na wou ma i, 14- To tha kia to ye , 15. A lo han ti, 16. San miao kia san fo tho ye, 17. Sv thian chy man to lo po ta. 18. Sou pho lo ! Namo Bouddhya. Namo Dharmya. Namo Sangya. Namo Kanaka mounaye. Tathgatya. Arhate. Samyaksambouddhya. Om! Sara, sara, sara, sara. Dharma, dharma, dharma, dharma. Namo Kanaka mounaye. Tathgatya. Arhate. Samyaksambouddhya. Swh!
Aprs avoir achev de prononcer ces invocations, le Bouddha Kanaka mouni s'adressa au bodhisattwa Aks'agarbha et lui dit : Excellent jeune homme! si un homme ou une femme dous de vertu peuvent rciter constamment ces dhram (invocations) et les observer, toutes les maladies seront cartes ou guries. Le Sapla Bouddha Stotra 1 contient l'invocation suivante Kanaka mouni : J'adore Kanaka mouni, sage et lgislateur, exempt de l'aveuglement des illusions mon daines, qui naquit dans la cit de Sobhanavati, d'une race de Brahmanes honors par les rois. Sa personne resplendissante exista trente mille ans. Gnreux comme la montagne des pierres prcieuses, il obtint le degr de Bouddha au pied de l'arbre oadoumbara. * Cit dansle Chini tian, liv. LXXVII,pag. G. h CitdanslesAsiat.Res.tom.XVI, pag. 45.1. r 2 O.
196
FOE
KOUE
KL
Le Jou kouanfo san mi king a assure que le corps de Kanaka mouni tait haut de vingt-cinq yodjanas, que son aurole en avait trente, et que la lumire mane de son corps s'tendait quarante yodjanas. Suivant le Fa youan tchu lin, dans une assemble ou Kanaka mouni expliqua les livres sacrs, il y eut trente mille bhikchous qui atteignirent la qualit d'Arhan. Le King t tchouan louh appelle le Bouddha Kanaka mouni le deuxime Honorable du kalpa des sages. Krakoutchtchhanda (voy. ci-dessus, note 3), Kanaka mouni et Ks'yapa (ch.XX, note 3g ) sont nomms les Bouddhas du temps pass. Us sont les trois premiers des mille Bouddhas qui doivent paratre dans le kalpa actuel, dit le kalpa des sages; Shkya mouni est le quatrime. En y joignant les trois derniers des mille Bouddhas qui ont paru clans le cours de l'ge prcdent, Vipas'yi, Sikhi et Vis'wabhou, on a nomms ensemble les sept sept personnages de ce rang qui sont habituellement Bouddhasc, sans qu'on donne de motif suffisant pour cette runion des trois derniers Bouddhas du kalpa antrieur avec les quatre premiers du kalpa prsent. M. Schmidt a cru que les trois premiers n'taient pas nomms dans les ouvrages bouddhi ques d ; cette erreur provient de ce que, dans les livres o il n'est question que de l'ge actuel, on commence la srie des Bouddhas par le premier de cet ge, , sans remonter la priode antrieure. Mais l'ouvrage mme puisque Sanang Setsen y fait que ce savant a traduit dmentait son observation, mention de Sikhi et de Vis'wabhou . M. Hodgson ne croit pas devoir rvoquer en doute l'existence historique des six Bouddhas prdcesseurs de Shkya f; et d'un autre ct, M. Wilson pense que l'on Krakoutchtchhanda peut mettre en question la ralit de l'existence de ces Bouddhas 3. A en juger d'aprs les indications toutes fabuleuses qu'on vient de lire, il n'y aurait point de question lever ce sujet. Un autre point qui doit tre relev, c'est la succession des sept Bouddhas et leur distribution dans les quatreyougas. II est trs-digne de remarque, la dit M. Hogdson1', que suivant les critures anciennes les plus authentiques, suite de ces sept Bouddhas remplit toute ia dure du temps : les deux premiers tant rapports au satya youga, les deux suivants au trila, les deux d'ensuite au dwpara; et Shkya et le Bouddha venir tant les seigneurs reconnus du kali a youga actuel. C'est l une notion brahmanique introduite dans le bouddhisme par les habitants du Npal, et qu'on ne saurait trouver dans les traits originaux, 3 Citdansle Chini tian, liv. LXXVII,pag. 6 v. h Citl-mme. Fan y mingi, cit dans le San isangf sou, liv. XXV1IT, d'Hcmatchandra. pag. g v. Vocab. Slotra(Louanges des septBouddhas), SaptaBouddha dans les Asial.Res.tom. XVI, pag. 453. Sanang der Osl-Mongolen, Selscn,Ccschichte pag. 8. d Indessfindetmanin Buddhaschen Bcbcrndie
drei ersten nicht genannt.Notessur SanangSetsen, 3o6. pag. 0 ..... Von densclbensind bereits siebenvorbergegangen, unter . weleben Sh und TViswabhu. Setsen,traductionde M. Scbmidt,p. g. Voy.Sanang f Asiat.PLCS. tom. XVI, pag. 445. e Ibid.pag. 455. b Ibid. pag. 445.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXL
197
o la succession des Bouddhas est expose dans un systme tout diffrent. Sans rpter ce sujet ce que j'ai dit ailleurs a, le tableau suivant rappellera les principaux traits de cette chronologie fantastique, qui ne parat sujette aucune diversit chez les diffrentes nations bouddhistes. KALPA DESMERVEILLES. 997 Bouddhas anonymes 1000 Bouddhas. Vipas'yi, 998" Bouddha Sikhi, 999e Vis'wabhou, ] 000e et dernier Bouddha de cette priode KALPA DES SAGES Krakoutchtchhanda, Kanaka mouni, (ge actuel). &as yaPa' 1000 Bouddhas. Shkya mouni, A venir : 1 Bouddha de cette priode. ...... 20 3e 4 , j I I \ Les sept /Bouddhas I 1 1 . ] /
5 Matreya, 995 Bouddhas venir * Essaisurla etc. cosmographie,
AVERTISSEMENT.
Ce n'est que jusqu'ici que feu M- Rmusat a pu conduire son commentaire sur le texte du Fo kou ki. Je n'ai trouv dans ses papiers que le brouillon de la traduction de la seconde moiti de ce texte; je l'ai corrige sur l'origide notes tires des mmes je l'ai divise en chapitres et accompagne sources o M. Ahel Rmusat avait puis les siennes. J'ai aussi insr, aux endroits convenables, les fragments de la lgende de la vie de Shkya mouni nal, quand il tait Bodhisattwa, de laquelle il a t question la page 7 3.
KLAPROTH.
CHAPITRE
XXII.
Ville de Kia 'we lo 'we. Champ du roi. Naissance de Fo.
d'un yeou yan (i), on arrive la ville de Kia 'we lo 'we (2). Il n'y a dans cette ville ni roi, ni peuple; comme une vaste solitude. Il n'y a que des religieux c'est absolument de gens du peuple. C'est le lieu o palais du roi Pe tsing (3), et c'est l qu'on a fait une reprsentation du prince o le prince, (h) et de sa mre, prise au moment sur un lphant entra dans le sein de sa mre (5). mont blanc, et quelques tait l'ancien Au lieu celui o, o le prince la vue d'un chemin sortit malade de la ville dans orientale; par la porte son char et lui fit (6), il fit retourner des tours. Dans les endroits dizaines de maisons
De l, en allant
l'orient,
la distance
rebrousser o
A i contempla dans l'lphant; alle une au sud-est, source d'eau
, partout le prince celui o l'on la distance
on a lev (7); o tira Nan
tho. et d'autres (8), dont
de l'arc
frapprent la flche qui tait et fit jaillir ont dispose ; dans le roi
de trente
li, entra
en terre
, que les hommes en forme de puits dont ils donnent le lieu o Fo, aprs avoir obtenu
des temps postrieurs l'eau boire aux voyageurs la doctrine (9), revint
visiter
son pre; clans celui o cinq cents fils des Shkyas (10) embrassrent leur hommage Yeou pho li.(u); la vie monastique et adressrent de six manires la place o la terre trembla o Fo (12); dans l'endroit prcha drent dans la loi en faveur les quatre l'assemble; des dieux, et dont de faon que portes, au lieu o Ta 'a tao les quatre le roi son pre fit l'aumne rois du ciel garne put d'un
pntrer seng kia
li (i3) Fo, un arbre
roi Licou
auparavant lev des tours
du ct de l'orient, sous qui tait assis le visage tourn dans l'endroit Ni keou liu (1/1), qui subsiste o le encore; li fit prir la famille des Shkyas avait obtenu (i5), laquelle le rang de Sai tho ivan (16); (dans tous ces lieux) on a qui existent encore.
CHAPITRE Au nord-est le lieu o de la ville, plusieurs sous un plac
XXII. li, est le Champ considra arbre, royal. des
199 L est labou-
reurs jardin l'tang
le prince, (17). A l'est de la ville, porte pour le nom de Lun
cinquante ce li, est le Jardin royal; ming (18). La dame (19) tant entre dans elle fit tourne terre,
vingt pas, du ct de l'orient,
se baigner, en sortit par le ct septentrional; une branche et s'tant d'arbre, prit la main elle donna rois naissance au prince. des dragons lavrent il se forma Tomb
le prince fit sept pas. Deux A l'endroit o cette ablution et c'est ce puits, aussi
eut lieu,
son corps (20). aussitt un puits; eu lieu boivent. ternellement (21); le second, celui o : le bain,
o avait qu' l'tang ont coutume de puiser l'eau qu'ils que les religieux Il y a pour tous les Fo quatre lieux dtermins le premier est celui o ils accomplissent la doctrine celui o ils font tourner la roue ils prchent les hrtiques sont leur la loi, o ils ont des confrences
bien
de la loi (22) ; le troisime,
et o ils soumettent
celui o ils redescendent (23) ; le quatrime, aprs qu'ils monts au ciel de Tao li (24), pour y prcher la loi en faveur de mre (25). Les autres lieux sont ceux des diverses manifestations les circonstances.
Le royaume de Kia 'we lo 'we est une grande le peuple Sur les routes on solitude; y est rare et en petit nombre. a redouter les lphants blancs et les lions, de sorte qu'on n'y suivant peut sans prcaution. voyager Aprs le lieu o Fo est on atteint le royaume en faisant mou. (26) vers
'
n,
cinq
yeou yan
l'orient,
de Lan
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
(1) Un yeou yan.] Une lieue et un tiers environ. (2) Kia 'we lo 'ive.] C'est certainement par une faute d'impression qu'on a supprim la troisime syllabe de ce nom dans le Wen hian Ihoung khao a, o on lit Kia 'we Wenhianthoung khao,iiv. CCXXVI, pag. i.
200
FOE
KOUE
KL
'we; cette faute s'est reproduite ailleurs \ Les Mongols crivent ^&^ Kabilik, et l'auteur persan du TarkhWialayi, attribu Abdallah Bedhawi, ^IKAJXJS'Kipilvih'. Le plus grand nombre des auteurs bouddhistes qui ont crit en chinois, rendent le mme nom par ^j* #]fcjffl^ Kia pi lo c; quelques-uns l'interprtent par bienfaisant, ce (fui est une mprise, car c'est ainsi qu'on traduit le nom de Skkya; d'autres plus exacts le rendent par Jaune. La signification du nom de Kapilavaslou ne saurait tre l'objet T d'aucun doute, puisque nous en possdons la traduction tubtaine qui est : $\T T ^ cV c\ es -v ^ f^Q^^^cf Ser s,kya gj (le sol du Jaune fonc), ou ^sj J V^JQT^^T Ser s,kya glironq (la ville du Jaune fonc). Ser s,kya (en mongol J-A-M^ J-^-V) signifie le jaune fonc, comme kapila eu sanscrit. C'tait aussi le nom du clbre ermite ^ff^J Kapila, qui donna aux fondateurs du royaume de Kapila le sol o ils btirent leur ville, comme on le verra dans la note 10 de ce chapitre. Hiuan thsang est l'auteur qui orthographie le mieux le nom de cette ville, en le rendant par "fx JmtK,^^ ]$$ y**. Kipi lo f sou lou d, ce qui exprime trs-exactement Je Kapilavaslou ou Kapilavaltha des livres pli. Les Birmans crivent ce nom Kapilavot; les Siamois, Kbinlawathoa ou Kabilapat ; les Singhalais, Kimboalval ; et les Nepaliens, Kapila-poar. Le royaume de Kapila est encore mentionn par Ma touan lin sous le nom de Kia pi li. Dans l'article Inde, il dit : Dans la 51'des annes Yuan kia, /^$&Mj& du rgne de l'empereur Wen rides Soung (Zta8 de J. C), Yu'ai, roi deKiapi li, u dans le Thian tchu, envoya une ambassade l'empereur. Elle apporta une lettre et des prsents consistant en bagues de diamant, en anneaux d'or pour freins, et en animaux rares, parmi lesquels il y avait un perroquet rouge et un blanc. Sous l'empereur Ming li, de la mme dynastie, la deuxime des annes Tlia chi (/166 de J. C), le Kia pi li. envoya encore en Chine une ambassade qui apporta un tribut. L'ambassadeur reut !e titre de gnral lev et grave ". Le Lf la ki szu, qui mentionne aussi l'ambassade du roi de Kia pi U, en 428 de notre re, ajoute que la lettre adresse l'empereur tait rdige tout fait dans le style des prdications de Bouddha f. de la grande collection gographique intitule Pian i tian, disent, en parlant de ce Kipi lofa sou lou, qu'anciennement on crivait mal ce nom, W*,^* isx Mi- Kia pi lo -we, et que ce pays tait situ la frontire de YInde du Milieu; '' YuanhianImiihan, liv. CCCX.VJI, 3, 3 v. pag. Tcbeou. cluiui Ici,cit l-innie. Essaisurles sries deShkya cldehaotseu,annex l'Histoire des 'We, citdansle Chini tian, liv.LIX, pag. i. " llislor. d.A.Mller,Jciuc,1689,in-4", Sinrnsis, a mallu ce du texte persan.Le traducteur 11a". :<) nom, linkjal'ilavi, pag. /i1. c San tsangf sou, liv. XI1J,pag. 17; liv.XXX, SanihsaIhou pag. 28 t.; liv. XXXIII,pag. 2/1. hoe,Jin \v, liv. IX, pag. ig v. '' Pian i liait,liv.LXXV, art. 6. " WenhianIhoung khao,liv.CCCXXXVIil, Voyez pag. i5; et le l'ian i tian, liv.LXVII, art. 5. Noticeduroyaume deKiapi h, pag. 1, tirede l'Histoire des/ etdess)lan,du tempsdela dynastie des Tsanij. ' hy lai kiszu, liv.XLVI, pag. 35v. Les rdacteurs
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
201
mais il parat qu'ils sont rests clans le doute sur l'identit du Kia 'we lo 'we de Chy f hian et du Kipi lo f sou tou de Hiuan thsang, de sorte qu'aprs avoir insr, la place convenable, l'extrait du Fo kou ki qui se rapporte au premier de ces nomsa, ils ont renvoy ailleurs le chapitre du Siyu tchi qui devait s'appliquer au second; puis ils ont oubli de transcrire ce chapitre, et c'est une omission qui nous est trsprjudiciable, parce qu'elle nous prive de points de comparaison trs-ncessaires pour l'claircissement de la partie du rcit de F hian que nous avons maintenant sous les yeux. Je crois tre le premier qui se soit cart de l'opinion vulgairement reue, que le Bouddha Shkya mouni a vu le jour dans le Magadha ou Bahar mridional. Dans une note que j'ai ajoute la traduction franaise de la Notice sur trois ouvrages bouddhiques, par M. H. H. Wilson, insre dans le cahier de fvrier 1831 du Nouveau Journal asiatique (pag. 100), j'ai dit : 11 n'est pas facile d'indiquer avec quelque certitude l'emplacement de Kapilapour ou Kapilawaslon. D'aprs les relations chi noises, il parat que cette ville tait situe dans le nord de l'Inde, dans le pays d'Ayodhya ou Oude.... Toutes les notions que nous avons sur la patrie de Shkya sinha nous obligent de la chercher plus au nord, dans le pays nomm prsent Oude, et qui est l'ancien Ayodhya. Selon le Kah ghyour ou la grande collection de livres bouddhiques traduits en tibtain, la ville de Kapila ou Kapilavastou tait situe dans le Ks'ala ou l'Aoude de nos jours. A l'poque de la naissance de Shkya mouni, la plus grande partie de l'Inde centrale tait sujette aux rois de Magadha; c'est pour cette raison que le pays de Ks'ala, clans lequel Kapila tait situe, fut considr comme appartenant au Magadha, dont il tait vraisemblablement tributaire. En tout cas, Magadha est la contre clans laquelle eurent lieu les premiers travaux de Shkya mouni; il n'est donc pas tonnant que plusieurs auteurs bouddhistes aient plac la naissance de ce lgislateur dans le Magadha mme L. Les auteurs tibtains disent que Kapila tait prs du mont Ka'ilas (dnomination sous laquelle il faut entendre ici la chane du Himalaya) et sur la rivire Bhgralh, qui est le Gange suprieur, ou sur le Rohini, qu'il ne faut pas confondre avec la rivire connue prsent sous le nom de Rohini, laquelle est un des affluents du Gandak. Kapila devait d'ailleurs se trouver prs de la frontire du Npal, puisque les lgendes bouddhiques disent que la famille des Shkyas, ayant t chasse de sa patrie, s'tait retire clans ce pays. La chronologie chinoise des patriarches bouddhiques le place effectivement au sud-ouest du Npal c; et, d'aprs une autre relation bouddhique, le pays de Bnars tait au sud de celui de Kia 'we lo 'we' 1. 0 Encyclopdie japonaise,liv.LXIV,pag. 27. d"Yuan hianhouihan, liv.CCXVI,pag.6. 26
" Pianilian, liv. LXIV,art. 6. '' Asia polyglolta, Voyez pag. 123. Journal of theAsialic in Bengal,tom.I, pag. 7. Society
202
FOE
KOUE
KL dans l'EncyKiao chang mi ou Kchal \ en peut juger
Le Kia pi lo est plac, dans la carte chinoise de l'Hindoustan, insre clopdie japonaise a, au nord de Bnars et du royaume d'Ayu tho, de et de Kiao sa lo. Ayu tho est la ville d'Ayodhya ; Kiao sa lo est le Ks'ala et Kiao chang mi le Kausmb des auteurs hindous. Ainsi, autant qu'on
d'aprs une carte o des notions recueillies par des voyageurs chinois sont entasses un peu confusment, Kapila serait au nord de Bnars et au nord-est de cette partie de la province d'Aoude qui constituait le royaume de Rma; c'est ce que vient conJirmer pleinement l'itinraire de Fa hian. De Kanoudje, il s'tait dirig au sud-est pour atteindre Ks'ala : il a suivi la mme direction, puis celle de l'est pour arriver Kapila. D'aprs cette indication et celle du Kah ghyour cite plus haut, cette ville devait donc tre situe sur les bords de la rivire de Rohini ou Rohen, qui vient des montagnes du Npal, se runit au Mahnda et se jette dans le Rapty, par la gauche, au-dessus de la ville actuelle de Gorak'hpour. De cette manire on peut donc regarder comme un point assur la situation du lieu de la naissance du Bouddha. Dans son Essai sur le Bouddhisme, M. Hodgson " dit que Kaplvaslou tait situ prs de Gang a sagr. Voici ce qu'on trouve sur ce dernier nom dans le Dictionnaire sanscrit de M. H. H. Wilson : Sgar dsigne l'Ocan. Sagara tait un roi d'Ayodhya, a qui avait de Kes'ini un fds nomm Asamandja et soixante mille autres fils de Soumat. Ces derniers ayant t changs en un tas de cendres par le sage Kapila, Garoud'a enseigna au roi le moyen d'accomplir les rites funraires avec l'eau du Gange, que dans ce but on devait faire venir du ciel. Ce grand ouvrage ne fut accompli que par la dvotion de Bhagrat'ha, petit-fils d'Asamandja, lequel ayant conduit le fleuve vers la mer, lui donna le nom de Sgara, et c'est pour la mme raison que l'embouchure du Gange est appele Gang Sgar. M. J. J. Schmidt s'est tromp en confondant la ville de Kapila avec celle de Rdjagrlia, situe une distance considrable au sud-est de la premire. Cette erreur vient de ce qu'il a cru que les mots mongols Khaghanou abkho balghad (ville de la rsidence royale) taient la traduction du terme sanscrit Rdjagrha' 1, qui en effet signifie rsidence du roi, mais qui est aussi le nom d'une ville situe, comme nous le verrons plus bas, au sud du Gange. KL.
(3) Le roi P tsing.] C'est le nom du roi qui fut pre de Shkya mouni. P tsing signifie en chinois blanc et pur; on le nomme galement dans cette langue Tsing fan wang, ou le roi qui mange des mets purs. C'est la traduction du sanscrit S'ouddhda.na. " Voyezla carte jointe ce volume,pi. I. '' Ks'ala,a namoof tlio city Jyod'hya =RTJ^ district. ^fEf^iJ (Aoude),or the neighbouring the countrysouthoAyod'hya,or Ayod'hya Kchal, ilsclf. (VJihonsSansciilDiclionary, 2d. pag.352.) c 'Transactions tom. Il, oflheRoyalasialicSociety, pag. !\o. ,l ini(}ebielc der Bildungsgeschichte der Forscliungen Voelker Millclasiens, etc. pag. 171. Geschichte der Ost-Mongolen, pag. 312.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
205
Je fais suivre ici la gnalogie de la maison de Shkya mouni. On a imprim en italique les noms chinois, ainsi que les noms pli; ceux-ci sont prcds d'un p. Les tibtains sont en romain, et les mongols sont prcds d'une m. Ta chensengwung. I / szumowang. I Yeoulotho ivang. .. I Khiulo wang. I Nifeou lo wang. Szutsu kiwang. kabn, (p. Sinhahna Sengglre h,ghram, m. Oghadjitouarsalan.) Tsing fan wang. [p. Souddhdana, Zas d,zzangma, m. Arighonideghelou. ) S t'h to. Nantho. Pfan wang. (p. Soukldana, Zas d,tur, m. Tsagliaideghetou. ) Thiaola. A nan. Houfan wang. Kanloafan watuj. (p. Amildana, [p. Dhtdana, BreVozas, b,Doudhr,tsi zas, m. Tangsouk ideghelou.) m. Rachiyan ideghelou.) Ma hanan. Ana lia. Phoso. Pa thi.
Si th to, en sanscrit Siddhrta (selon la traduction chinoise je. ), est le _a_||r prince qui, ayant obtenu la dignit de Bouddha, fut appel Shkya mouni". KL. (/t) Une reprsentation du prince.] Shkya mouni, avant de quitter la maison paternelle, est toujours nommjfe du roi ou prince, en chinois ~T" 4- Ta tsu, en sanscrit ^PT^ Rdjapouttra, en tibtain r,Ghialsrs, et en mongol WM^-e) L^AC Khan kubakhoun (Khan kbhn). KL. (5) Dans le sein de sa mre. ] Au moment o Shkya mouni, tant encore bodhisattwa dans le ciel Touchita , devait s'incarner clans le sein de sa mre Mah my, pouse du roi S'ouddhdana, il monta sur un lphant blanc six dfenses et entra dans le corps de sa mre sous la forme d'un rayon de lumire de est principalement extraitedu bonichousan ihsuthon partie chinoisede ce tableau gnalogique hoe,sect.Jin we, liv. IX, pag. 2. 26. 1 La
204
FO
KOUE
KL c'est-
cinq couleurs. Cet lphant blanc porte en sanscrit le nom de Aradjavartan, -dire le chemin sans tache. Voyez la planche IL KL.
" et selon les (6) A la vue d'un malade. ] D'aprs la grande Encyclopdie japonaise autres lgendes que j'ai pu consulter, ce fut en sortant, non de la porte orientale, mais de la porte mridionale que Sy th, en sanscritSiddha ouSarvrtha siddha (celui qui produit tout le salut) ", rencontra un malade. La lgende de la vie de Shkya mouni, quand il tait encore bodhisattwa c, dit la mme chose. Siddha, tant dans la maison paternelle, tait toujours triste et rveur; pour le distraire, son pre lui avait fait pouser la princesse Kieou i (Katchn) fille de Chun ki (Souva bouddha), roi de Siuphofo (Souprabouddha). Cette alliance ne fit pourtant pas renatre la tranquillit dans l'me de son fils. On lui fit donc prendre de nouvelles femmes d'une beaut admirable ; l'une appele Toute louange ( Sarvastouti), l'autre nomme Toujours joyeuse (Sadnand). Ces trois pouses de Siddha avaient chacune vingt mille filles leur service, toutes bien faites, d'une exquise beaut et pareilles aux nymphes du ciel. Le roi son pre s'adressant Kieou i et aux autres, leur dit : Le prince a maintenant soixante mille femmes pour l'amuser par leurs concerts et pour le soigner : est-il content et joyeux? Elles lui rpondirent : Le prince est du matin au soir occup de ses penses subtiles et de la doctrine; il ne songe ni aux dsirs ni la joie. Le roi, fort attrist en entendant ces paroles, appela ses ministres pour dlibrer de nouveau. Il leur dit que les soins qu'on avait pris pour le prince taient puiss; que ni les trsors, ni les beauts du monde, ne pouvaient l'arracher ses projets, et qu'il ne gotait aucune joie. Est-ce donc ce qu'a dit A i? ajouta-t-iL Les ministres rpondirent : Puisque soixante mille femmes et tous les plaisirs du sicle ne le rjouissent pas, il faut le faire sortir et qu'il voyage pour observer le gouvernement, afin de dissiper ses penses sur la doctrine. L-dessus, le roi manda au prince qu'il fallait qu'il voyaget pour faire des ' observations. Le prince se dit lui-mme : Il y a longtemps que je suis enferm dans le fond de mon palais, et j'avais le dsir de sortir pour voyager et pour m'in former de ce qui est l'objet de mes penses. Le roi fit publier une ordonnance dans a son royaume pour que tous les lieux par o le prince devait passer fussent orns, les rues et les chemins arross et balays, que l'on brlt des parfums, que l'on suspendit des tapisseries, des banderoles et des dais. On excuta cet ordre, et tout fut orn et purifi. Le prince, accompagn de mille chars et de dix mille cavaliers, commena sortir de la ville par la porte orientale. Alors un dieu de la classe des Sortiras ('/|fv r "T=l ) nomm Nan thi ho lo, pour presser le prince de se dcider embrasser la vie religieuse, et pour le secourir en le dlivrant de ses dsirs a Tom. XIX, Journalasiatique, t. XII, p. /108. h C'est le nom que Shkyamouni porp. 7. Nouveau tait danssa jeunesse. c Fopenhingisy, cit dansleSan tsang f a sou,liv. XIII, pag. 21.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
205
enflamms comme trois feux empoisonns dans les dix parties, voulut faire pleuvoir l'eau de la loi afin d'teindre ces feux empoisonns. Il se changea donc en vieillard, et s'assit sur le bord du chemin : la tte blanche , les dents tombes, la peau flasque et le visage rid ; la chair fondue, l'chin courbe et les articula tions des membres contournes ; les yeux larmoyants, le nez coulant, la respira tion haletante et embarrasse ; la peau noircie, la tte et les mains tremblantes, le corps et les membres extnus et branlants, laid et nu, il se montra assis sur son sant dans cet endroit. Le prince demanda : Qu'est-ce que cet homme ? C'est un homme vieux, rpondirent les serviteurs. Qu'est-ce que c'est que vieux? demanda-t-il encore. C'est, rpondit-on, un homme qui a vcu beaucoup d'annes, dont les organes sont uss, dont la forme est change, qui a le teint fltri, la res piration faible, et dont les forces sont puises. Il ne digre plus ce qu'il mange. Ses articulations se disloquent. S'il se couche ou s'il s'assied, il a besoin du secours des autres. Ses yeux sont obscurcis, son oreille n'entend plus. En se retournant, il oublie tout. S'il parle, c'est pour regretter et pour se plaindre. Le reste de sa vie n'est propre rien : voil ce qu'on appelle un vieillard. Le prince tourment dit: Si les hommes, en naissant dans le monde, sont exposs au malheur de vieillir ainsi, il n'y a que des insenss qui puissent le dsirer et l'aimer. Quelle douceur y trouve-t-on? Les tres qui naissent dans le printemps se desschent et se fltrissent en automne et en hiver. La vieillesse arrive mriterait-il de nous attacher ? Et il dbita teint se fltrit et perd tout son clat, la peau mort approche et presse. Dans la vieillesse, comme un clair : comment le corps le gth suivant : Par la vieillesse, le se relche et les ctes sevsoulvent; la
le corps change et peut se comparer un vieux char^Ea loi peut loigner cette amertume. Il faut employer ses forces pour tudieH moyen de commander ses dsirs. Quand les jours et les nuits sont finis, il faut tre diligent et fort. C'est une ralit du monde que l'instabilit. Si l'on n'applique toutes ses facults, on tombe dans l'obscurit. Il faut que l'tude allume la lampe de l'esprit; que de soi-mme on choisisse et qu'on cherche la science, et qu'on vite les souillures. Ne contractez aucune souillure : prenez le flambeau pour contempler la terre de la doctrine. Ensuite le prince fit retourner son char et s'en revint. Sa tristesse s'accrut encore, et la douleur qu'il avait en pensant que tous sans exception taient soumis cette grave infortune, ne lui per mit de goter aucune joie. Le roi demanda ses serviteurs pourquoi le prince, qui tait sorti pour une promenade, tait rentr si promptement. Les serviteurs : Sur la route il a rencontr un vieillard dont la vue l'a attrist, et ne pouvant goter aucun plaisir, il est revenu son palais, o il s'afflige en pensant la longvit. a Peu de temps aprs, il voulut sortir et se promener de nouveau. Le roi fit pu blier dans le royaume que le prince allait sortir, et dfendit crue rien de ftide , qu'aucune immondice se trouvt sur le bord des routes. Le prince monta donc rpondirent
206
FOE
KOUE
KL
dans son char et sortit par la porte mridionale de la ville. Le dieu se changea en malade et se tint sur le bord de la route. Son corps tait amaigri et son ventre gonfl. Sa peau tait jaune et brlante. Il toussait et sanglotait. Il avait des clou leurs dans toutes les articulations. De ses neuf ouvertures s'coulait un liquide sanieux. Ses yeux ne voyaient pas les couleurs. Ses oreilles n'entendaient pas les sons. Sa respiration tait haletante. Ses mains et ses pieds cherchaient le vide; il u appelait son pre et sa mre, et s'attachait douloureusement sa femme et son fils. Le prince demanda : Qu'est-ce que ceci? Ses serviteurs lui rpondirent : C'est un malade. Qu'est-ce qu'un malade? reprit le prince. Ils rpondirent : L'homme est form de quatre lments : la terre, l'eau, le feu et le vent. Chaque lment a cent et une maladies qui se succdent alternativement. Quand les quatre cent quatre maladies naissent ensemble, on sent un froid extrme, une chaleur ex trme, une faim extrme, une plnitude extrme, une soif extrme, une altra tion extrme; toutes les poques tant troubles, il a perdu l'instabilit de se cou cher et de se lever : c'est ainsi qu'il a gagn cette maladie. Le prince soupira et dit : Je suis dans l'tat le plus riche et le plus prospre, celui que le monde honore. Le boire et le manger abondent pour ma bouche. Je puis m'abandonner mes capri ces , donner dans les excs des cinq dsirs , et ne pouvant plus exercer mon intelli gence sur moi-mme, je deviendrais malade aussi. Quelle diffrence y aurait-il de moi celui-ci ? Alors il pronona ce gth : a Que ce corps est une chose fra gile! Il est form de quatre lments, il a neuf ouvertures impures et dgotantes. Il est soumis aux tourments de la vieillesse et de la maladie. Mme en naissant H parmi les dieux, il est soumis l'instabilit. En naissant parmi les hommes, il est afflig par les maladies. Je regarde le corps comme une goutte de pluie. Quel plai sir peut-on goter dans le monde ? Alors le prince fit retourner son char, et s'en revint son palais, pensant que tous sans exception taient soumis cette grave infortune. Le roi demanda ses serviteurs comment se trouvait le prince de la course qu'il avait faite. Ses serviteurs rpondirent : Il a rencontr un malade, et cette vue ne lui permettra de longtemps aucun plaisir. Peu de temps aprs, il voulut sortir encore. Le roi fit publier un dit dans son royaume pour que, dans le moment o le prince sortirait, on aplant la terre et. qu'on ne laisst rien d'impur approcher de la route. Il sortit parla porte occi dentale de la ville. Le dieu se changea en un homme mort qu'on portait hors de la ville. Les gens de la maison suivaient le char en sanglotant et en pleurant, adres sant au ciel des plaintes sur un abandon et une sparation ternelle. Le prince demanda : Qu'est-ce que cela? Les serviteurs lui rpondirent : C'est un mort. Qu'est-ce que,cela? demanda-t-il. La mort, rpondit-on, c'est la fin. L'me s'en est alle. Les quatre lments veulent se dissiper. L'me sensitive et l'esprit n'tant point en repos, le vent s'en va et cesse absolument, le feu s'teint et le corps se refroidit. Le vent tant parti le premier et le feu ensuite, l'me et l'intelligence dis-
NOTES paraissent.
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
207
Les membres s'allongent et se redressent. U n'y a plus rien recon natre. Au bout de dix jours, la chair se dtruit, le sang coule, le ventre se gon fie, se putrfie et devient ftide ; il n'y a rien y prendre. Le corps est rempli de vers qui le rongent. Les nerfs, les veines sont dtruits par la putrfaction. Les articulations des os se disjoignent et se dispersent. Le crne va d'un ct; l'chin, les ctes, les bras, les jambes, les pieds et les mains vont chacun d'un autre ct. Les oiseaux qui volent, les btes qui marchent, accourent pour les dvorer. Les dieux, les dragons, les dmons, les gnies, les empereurs et les rois, le peuple, les pauvres, les riches, les nobles, le vulgaire, personne n'est exempt de cette calamit. Le prince fit un long soupir et dit en vers : Quand je contemple la vieillesse, la maladie et la mort, je gmis sur la vie humaine et sur son instabilit. Il en est ainsi de ma personne. Ce corps est une chose prissable; mais l'me n'a fias de forme. Sous la fausse apparence de la mort, elle renat. Ses fautes et son bonheur ne se dispersent pas. Ce n'est pas une seule gnration qui comprend son commencement et sa fin. Sa dure se prolonge par l'ignorance et l'amour. C'est par l qu'elle reoit la douleur ou la joie. Quand le corps est mort, l'me ne prit pas. Elle n'est point ther, elle n'est pas dans la mer, elle n'entre pas dans les montagnes et les rochers. Il n'y a pas de lieu clans ce monde, ni de terre o l'on soit exempt de mourir. L-dessus, le prince fitrelourner son char et s'en revint son palais, considrant tristement que tous les tres vivants taient soumis aux tourments et aux douleurs de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Il en tait tellement attrist qu'il ne mangeait plus. Le roi demanda ses serviteurs si le prince tait plus gai depuis qu'il tait all se promener. On rpondit au roi : U a rencon tr un mort, et il est devenu d'une tristesse extrme pour plusieurs annes. Peu de temps aprs, il voulut aller encore une fois la promenade, et son beau char sortit par la porte septentrionale de la ville. Le dieu se changea de nouveau en Samanen. Il avait le costume de la loi, il tenait le pot et marchait pied, examinant tranquillement et n'cartant pas ses yeux de devant lui. Le u prince demanda: Quel est cet homme? Ses serviteurs lui rpondirent: C'est un u Samanen. Qu'est-ce qu'un Samanen ? On lui rpondit : Les Samanens sont ceux qui pratiquent la doctrine. Ils abandonnent leurs maisons, leurs femmes et o leurs enfants. Ils renoncent aux dsirs tendres, ils suppriment les six affections. Ils observent les prceptes, et, par la quitude, ayant atteint la simplicit du coeur, toutes les impurets s'teignent. Celui qui pratique la simplicit du coeur se nomme Arhan. L'Arhan est le vritable homme. Les sons et les couleurs ne pett vent le souiller. Les dignits ne peuvent le flchir. Il est immobile comme la terre. Il est dlivr de l'affliction et de la douleur. Vivant ou mort, il est matre de lui-mme. Le prince s'cria : Chose excellente! Il n'y a de joie que ceci. Et il dit un gth qui signifiait : 0 douleur! celui qui possde cette vie d'afflictions est soumis aux tourments de la vieillesse, de la maladie et de la mort. L'me relourne
208
FOE
KOU
KL
dans la route du pch, parcourt toutes sortes d'agitations douloureuses. Main tenant, elle doit teindre tous les maux; la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort sont cartes. On ne rentrera plus dans la runion des affections, et on obtiendra pour toujours le salut par l'extinction. L-dessus, le prince fit retour ner son char et s'en revint si triste, qu'il ne put manger. Le roi demanda ses serviteurs : Le prince est encore sorti : son esprit est-il gay ? Les serviteurs r pondirent : Dans son chemin, il a vu un Samanen qui a redoubl sa tristesse et ses rflexions. 11 ne songe ni boire, ni manger. A cette nouvelle, le roi entra dans une grande colre, et levant les mains, il se frappa lui-mme. Il renouvela la dfense de s'occuper de la doctrine, et prescrivit que si le prince sortait encore, tout ce cfui serait de mauvais augure ou fautif encourrait un chtiment ou la peine de mort. Ensuite il convoqua ses ministres, et leur ordonna de dlibrer et de proposer chacun le meilleur moyen pour empcher que le prince ne sortt pour tudier la doctrine". Voil ce que les Bouddhistes appellent les quatre ralits reconnues par Shkya mouni quand il voulut sortir des portes de la ville royale. Ce sont la vieillesse, la maladie, la mort, et la dissolution finale des atomes du coiys. KL. (y) Dans les endroits o A i. ] Le Tao szu, appel par les auteurs chinois H& vp A i, est nomm en sanscrit fPT^ft tapasv, ou l'ascte qui mne une vie austre. C'est sous ce nom qu'il est question de sa visite Bouddha enfant, dans une inscription fort curieuse en langue mgah, qui fut trouve dans un caveau auprs d'Islamabad ou Tchittagong. On y lit : Le lendemain matin (aprsla naissance de Shkya mouni), le bruit se rpandit qu'il tait n un enfant dans la famille du roi. Tapasvi mouni qui, demeurant dans les bois, consacrait tout son temps l'adoration de la divinit , apprit par inspiration que le Bouddha tait venu au jour dans le palais du roi. Il s'y rendit travers les airs, et l, s'asseyant sur un trne, il dit : Je suis venu pour visiter l'enfant. On apporta aussitt le Bouddha en sa prsence. Le mouni remarqua deux pieds fixs sur sa tte, et devinant quelque chose de bon et de mauvais augure, il se mit pleurer et rire alternativement. Le roi le questionna sur ce qui se passait en lui. Je ne dois pas, rpondit-il, rsider au mme lieu que le Bouddha, lorsqu'il parviendra au rang d'avatar : c'est l le sujet de mon affliction; mais je suis maintenant rempli de joie par sa prsence, attendu qu'elle m'absout de toutes mes fautes. Le mouni se retira alors; et cinq jours s'tant couls, il assembla quatre pandits, pour calculer la destine de l'enfant. Trois d'entre eux prdirent que, comme il avait sur les mains des marques qui res semblaient une roue, il finirait par devenir un roi Tchakravarti; un autre prdit qu'il parviendrait la dignit d'avatar h.
" Chini tian, liv. LXXVII, h trad. franc,tom. II, pag. 426. pag. 2/1-28. Recherches asiatiques,
NOTES A fou
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
209
Tapasv mouni est, selon le P. Georgi, appel dans les livres tubtains Trang srong tsien pb (ou le grand homme qui agit selon la doctrine). Ce vieil ermite ayant connu, dans sa solitude loigne, la venue de l'enfant, arriva en volant vers lui, l'embrassa, le serra tendrement dans ses bras, et prdit au pre, en versant des larmes, le genre de vie religieuse et contemplative qu'il devait mener dans le dsert aprs avoir quitt son pouse. A l'poque de la naissance du Bouddha, dit la l gende de sa vie, il n'y eut pas un seul des seize grands royaumes qui ne ft pou vant par des prodiges ou frapp d'tonnantes merveilles. Il avait un Tao szu, y ou docteur de la Raison, des montagnes des Parfums, nomm A i, qui, au milieu de la nuit, s'aperut de l'branlement du ciel et de la terre. Il vit un grand feu dont les flammes et l'clat s'tendaient sur les montagnes des Parfums, et dans le milieu de ce feu tait une fleur nomme Yeou than po. Cette fleur produisit d'elle mme le seigneur des Lions. Il tomba terre, fit sept pas la tte leve, et se mit rugir de telle sorte, qu' ko li, parmi les oiseaux qui volent et les btes qui marchent, les vers, les insectes ails ou les animaux qui rampent, il n'y en eut pas un qui ne se cacht. A i se dit intrieurement : Il y a dans le monde un Boud dha dont l'apparition est marque par ce prodige. Les cinq souillures ont rempli le monde de maux : comment un augure si formidable y pourrait-il avoir lieu ? Guid par cette lumire cleste, il vint au travers des airs jusqu'au royaume de Kia i 'we; mais avant d'y arriver, la distance de ko li de la ville, i descendit terre, et frapp de crainte et de joie la fois : Il y a certainement un Bouddha ici, s'cria-t-il, je n'en doute plus. Il vint pied jusqu' la porte du palais. Ceux qui la gardaient vinrent dire au roi que A i s'y trouvait. Le roi, surpris, dit : A i vient toujours en volant : pourquoi donc aujourd'hui reste-t-il la porte et de mande-t-il tre introduit ? Il sortit et vint sa rencontre en lui rendant hom mage. Il le fit baigner et lui donna des vtements neufs, aprs quoi il lui adressa cette question : Quel motif, saint vous a fait prendre la peine de respectable, venir aujourd'hui prs de nous? J'ai appris, rpondit A i, que l'pouse de votre majest avait mis au monde un prince, et je suis venu pour le voir. Le roi envoya des gens du palais pour prendre l'enfant et l'apporter dehors ; mais une des femmes qui le gardaient revint dire que le prince tait fatigu et commen ait s'assoupir. A i, tout joyeux, pronona un gth dont le sens tait : Le hros d'entre les hommes, l'intelligence qui s'exerce sur elle-mme et sur tous les tres non intelligents, a travers les sicles sans soucis et sans repos : qu'a-t-il besoin de s'assoupir? Ensuite les femmes qui gardaient le prince, l'apportrent dans leurs bras et voulurent lui faire adorer A i; mais celui-ci, tout troubl, s'empressa de les prvenir et d'adorer les pieds de l'enfant. Le roi et ses sujets, frapps de voir que le matre du royaume A i rendait de tels hommages au prince, connurent que celui-ci avait droit leurs respects, et tous, la tte incline, adorrent ses pieds. Ai tait d'une vigueur pouvoir subjuguer cent athltes; 27
210
FOE
KOUE
KL
cependant, quand il eut pris le prince dans ses bras, ses os et ses nerfs furent et embarrasss et branls. En voyant les trente-deux laits'an as (ressemblances) les quatre-vingts narakas (beauts), ce corps brillant comme le diamant, ces per fections infinies qui taient comme autant de tmoignages surnaturels et qui lui prouvaient, sans aucun doute, que cet enfant ne pouvait manquer de devenir Bouddha, il laissa couler des larmes et poussa des sanglots, touch d'une si pro fonde douleur qu'il ne put parler. Le roi, tout afflig, lui demanda si le prince portait quelque signe de mauvais augure, le priant de lui faire connatre, sans restriction, ce qu'on pouvait attendre d'heureux ou de malheureux. A i rprima sa douleur et pronona le gth suivant : Aujourd'hui est n le grand et saint homme, qui loignera tous les maux et toutes les afflictions. Je pleure sur mon infortune personnelle. Je dois mourir dans sept jours. Je ne verrai pas cette di vine conversion, cette prdication de la loi dans l'univers. C'est aujourd'hui que je me sparerai du prince : voil ce qui cause ma douleur et mes larmes. Le prince leva alors la main et dit : Les hommes des cinq conditions et des dix parti ties du monde, seront tous instruits et convertis par moi. Je remplirai, pour eux, mon premier voeu, qui est de les sauver. Si un seul homme du Sa ho sa (Sahasra, des mille mondes ) pouvait ne pas obtenir la doctrine, je ne voudrais pas en trer dans le Nirvana. Alors A i satisfait recommena d'adorer les pieds du prince. Le roi P tsing, dont la joie tait trouble par l'inquitude, pronona le gth suivant : Quelles sont les perfections extrieures du prince ? Quel en sera l'effet dans le monde ? Je voudrais que vous m'en fissiez rmunration une une, en me disant quelle heureuse influence elles auront. A i rpondit au roi par ce gth : Si je contemple le corps du prince, je le vois de couleur d'or, ce qui in dique la fermet de ses entreprises, et annonce ce pilon de diamant qui doit briser les montagnes des dsirs impudiques. L'embonpoint de ce grand person nage et la rgularit de ses formes extrieures montrent que s'il est roi, il main tiendra la paix, et qu'en embrassant la vie religieuse, il atteindra au rang de l'Intelligence parfaite ( Bouddha). Les roues empreintes sur ses pieds et sur ses mains font voir qu'il possdera les mille rayons, c'est--dire qu'il fera tourner la roue de la loi, et qu'il arrivera au rang de Bouddha, l'honorable dans les trois mondes. Ses chevilles de cerf, ses hanches de dragon, ses formes de cheval qu'on ne se lasse pas d'admirer, montrent que sa loi sera pure. Ses mains lon gus et effiles, ses bras et ses doigts dlicats, la paume de ses mains traverse pat' des filets, prsagent la dure de sa loi, qui se prolongera mille ans pour l'en seignement du monde. Ses poils dlis, doux et tourns vers la droite qu'il ne recevra aucune souillure. Ses articulations serres comme une de couleur d'or, annoncent qu'il soumettra les hrtiques. Son corps poitrine de lion, ses formes arrondies sans irrgularit, ses mains qui ses genoux, marquent l'accomplissement montrent chane et carr, sa
dpassent de tous les rites. Les sept parties de
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
211
son corps qui sont pleines, indiquent la rsistance que mille fils opposeront au Bodhisattwa, et montrent qu'en s'abstenant de toute action, il se garantira de toute colre et du mal. Sa bouche contient quarante dents carres, blanches et bien rgulires, qui annoncent la douce rose que la loi rpandra sur la multitude, et en vertu de laquelle il sera possesseur des sept choses prcieuses. Ses joues sem blables celles d'un lion, ses quatre dents, sont le signe de la vertu de Bouddha apparaissant dans l'univers sous les dix mille dnominations diffrentes dont il enrichira les trois mondes. Son got saisit toutes les saveurs, parce que le got consiste reconnatre la saveur de ce qu'on mange. Aussi, quand il aura reconnu la saveur de la loi, il en fera don tous les tres. Sa langue, large comme la fleur du lotus, peut, en sortant de sa bouche, couvrir tout son visage, et lui donner toutes les voix; celui qui les entendra, les trouvera douces comme la rose. <tLe son de sa voix efface celle du huan ; en rcitant les textes sacrs il surpas sera Brahma; et quand il prchera la loi, son corps sera tranquille et son esprit fixe (dans la Ses yeux, d'un bleu tirant sur le brun, sont la contemplation). maque d'une bont qui s'est exerce de gnration en gnration ; c'est pourquoi les hommes, les dieux et les autres tres ne se lassent jamais de contempler le Bouddha. Les tubercules qu'il a sur le front, et ses cheveux bruns avec une teinte azure, annoncent qu'il dsire tre le sauveur universel. C'est pourquoi sa loi rem plira les mondes et les protgera. Sa face lumineuse comme la pleine lune repr sente une fleur qui vient d'clore. Le duvet d'entre ses sourcils est blanc et pur comme les perles brillantes. Alors le roi ayant connu fond tout ce que prsa geaient ses traits, fit btir, pour lui, des palais pour les quatre saisons b. KL. (8) On tira de l'arc] La chronologie japonaise place ce fait dans l'anne ^ %p^ Kouei ha, qui est la 60e du xxxve cycle, ou 1018 ans avant J. C. A l'occasion du mariage de Siddhrta avec la princesse Kieou i, le roi P tsing dit Yeou tho d'avertir le prince son fils qu'il faudrait qu'il montrt ses rares talents. Yeou tho ayant reu cet ordre, alla avertir le prince que le roi, voulant l'instant faire preuve de la connaissance qu'il possdait des rites et de la musique, il convenait qu'il se rendt au thtre. Le prince sortit donc avec Yeou tho (Ou d), Nan tho (Nanda), Thiao th (Dvadatta), A nan (Ananda) et autres, au nom bre de cinq cents, tenant la main les objets ncessaires pour les arts qui se rapportent aux rites, des instruments de musique et tout ce qu'il fallait pour tirer de l'arc. Comme ils allaient sortir de la porte de la ville, ils trouvrent un lphant devant cette porte. Justement ce fut le robuste Thiao th qui sortit le premier, et voyant l'lphant qui barrait le chemin, il lui assena un coup de poing, et l'l- a Oiseau qui tient le milieu entrele paon et le faisanet qui parat tre un animalfabuleux.VoyezEncyclopdie japonaise,liv. XLIV,pag. 9. h Chini tian, liv. LXXVIII,pag. 17-19v. 27.
212
FO
KOUE
KL
phant tomba roide mort l'instant mme. Nan tho qui arriva immdiatement, le trana sur le ct de la route. Le prince, qui venait ensuite, demanda ce serviteur : Qui a tu sans motif cet lphant? On lui rpondit : C'est Thiao th qui l'a tu. Qui l'a transport l ? C'est Nan tho. Le Bodhisattwa dou d'un coeur com ptissant tira l'lphant, le dressa et le plaa hors de la ville. L'lphant ressuscita et fut rendu la vie comme auparavant. Thiao th tant arriv sur le thtre, attaqua tous' les athltes ; il n'y en eut aucun qui pt lui rsister. Tous les lutteurs les plus clbres furent renverss et confus. Le roi demanda ses serviteurs : Qui est-ce qui a t vainqueur? On lui rpondit : C'est Thiao th. Le roi dit Nan tho : Il faut que toi et Thiao th vous combattiez ensemble. Nan tho ayant reu cet ordre, attaqua Thiao th, et le mit dans un tel tat qu'il perdit entirement con naissance. On le fit revenir lui par degrs en lui jetant de l'eau. Le roi demanda de nouveau qui avait t vainqueur. On lui rpondit que c'tait Nan tho qui avait remport la victoire. Le roi dit Nan tho de lutter avec le prince ; mais Nan tho dit au roi : Mon frre an est comme le mont Sou merou, et moi Nan tho je suis comme un grain de moutarde, je ne suis pas son gal. Il se retira en s'excusant. On en vint tirer de l'arc. On plaa d'abord un tambour de fer dix li, et on mit ainsi jusqu' sept tambours. Les flches des archers les plus renomms n'eurent pas la force d'aller jusqu'au premier tambour. Thiao th ayant tir, traversa celui ci et atteignit le second; Nan tho en traversa deux et percale troisime. Les autres archers n'ayant pu arriver jusque-l, le prince rompit tous les arcs de ceux qui avaient tir avant lui ; il n'y en eut point qui allt sa main. Le roi dit ses servi teurs : Mes anctres avaient un arc qui est maintenant dans le temple des dieux : allez le prendre et apportez-le. On alla donc chercher l'arc, et il fallut deux hommes pour le porter. Il n'y eut dans l'assemble personne qui pt le soulever. Quand le prince le tendit, l'arc fit un bruit pareil celui du tonnerre. Il le remit l'as semble, mais il n'y eut personne qui pt le tendre. Le prince le fit flchir, et le bruit de la corde s'entendit quarante li. L'arc courb lana la flche de manire qu'elle traversa les sept tambours. Il tira un second coup, et aprs avoir travers les tambours, la flche pera la terre et fit jaillir une source d'eau. Au troisime coup il pera les tambours et atteignit les montagnes de l'enceinte de fer. Toute l'assemble admira ce prodige inou. Tous ceux qui taient venus prendre part ces jeux, furent vaincus et s'en retournrent pleins de confusion. Il y avait encore le Roi des Hommes forts, qui vint le dernier de tous. Sa vigueur tait extrme, et dans le monde entier, rien ne surpassait son courage et sa frocit. Il prtendit que Thiao th et Nan tho ne suffisaient pas pour combattre avec lui, et qu'il ne pouvait ses forces mesurer qu'avec le prince. Tous ceux qui avaient t vaincus cherchaient quelqu'un qui pt les venger. Ils sautrent de joie, et dirent au Roi des Hommes a forts : Prince, puisque votre vigueur est incomparable dans le monde, venez prou ver vos forces et remporter la victoire. Eux-mmes, fort satisfaits, le suivirent et
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
213
revinrent avec lui assister son combat avec le prince. Thiao th et Nan tho ani nirent le courage de celui-ci, et ils auraient voulu les premiers combattre le Roi des Hommes forts ; mais ils dirent : Ce n'est pas une force humaine, c'est celle du dmon de la mort. Si vous ne pouviez en triompher, prince, quel dshonneur pour vous ! Mais vous tes bien celui qu'il faut pour le combattre. Le roi apprenant ceci, pensa que le prince tait trop jeune et trop affect par la tristesse. Tous ceux qui vinrent pour assister au combat, parlaient du moment o le prince allait tre vaincu. Le Roi des Hommes forts frappait la terre du pied, et courageusement il relevait ses bras et tenait ses mains en l'air; il les avana pour saisir le prince ; en ce moment, celui-ci le saisit et le jeta par terre. La terre trembla. Toute l'assem ble se dispersa, encore plus confuse qu auparavant, et disparut tout coup. Le prince ayant ainsi remport une victoire complte, on sonna les cloches, on battit le tambour, on fit entendre des instruments et des chants. Il monta cheval et s'en revint au palais a. (9) O Fo, ayant obtenu la doctrine.] La chronologie japonaise intitule Wa kan kw t fen nen gakf oun-no tsou place cet vnement dans l'anne -^^C. kouexve, qui est la 2 oe du xxvmG cycle, et qui correspond la k" du rgne de Mou wang de la dynastie Tcheou, et l'an 998 avant J. C. Le Bouddha avait alors vingt-neuf ans b. L'histoire mongole de Sanang Setsen dit : Dans l'anne Ping du Singe, il (Bouddha) tait g de vingt-neuf ans, et se trouvant devant la tour vritable ment sainte, il embrassa de sa propre volont l'tat ecclsiastique c. Le F yuan tchu lin dit : Le lieu o le Tathgatha (Jou la) obtint la doctrine, est dans le royaume de Mo ki tho (Magadha), sous un arbre P7ion thi (bhodhi, Bauhinia scandens). On y a lev une tourd. KL. S'kya est le nom de la tribu ou de la (10) Cinq cents fils des Shltyas.] aj (<=fM famille de Slikya mouni; elle appartenait la caste des Kshatrias. Selon les traditions bouddhiques, elle descend de Llis'wakou, prince de la ligne solaire, et fondateur de la race royale d'Ayod'hya ou Aoude. Cependant ce nom ne figure, dans les listes gnalogiques des Hindous, ni comme nom de tribu, ni comme nom de peuple. Voici ce que'M. Csoma de Krs a extrait sur ce sujet du 26e volume de la division du Kh ghyour appele mDo : Les S'kyas, qui habitaient la ville de Kapilavstou, s'adressrent au Bouddha pour tre instruits par lui sur l'origine de leur race; celui-ci chargea son disciple Mngalyana (ou Ayousmn Mngalyana) de leur expliquer ce fait. Il le fit de la manire suivante. Aprs que la terre eut t repeuple 1 Chini tian, liv. LXXVII,pag. 21-23v. h Nouveau tom. XII, pag. il 1. Journalasiatique, c Geschichte der Ost-Mongolen, pag. i3. par des hommes, et que ceux-ci eurent d F yuan ichu lin (la Fort de perles du jardin de la loi), ouvragecitdansle San isangfsou, liv.XIII, pag. 25.
214
FOE
KOU
KL
peu peu perdu les facults suprieures dont ils taient d'abord dous, des disputes s'levrent frquemment entre eux. Us choisirent donc parmi eux un <(chef ou roi, qui fut appel Mah sammanta, c'est--dire, honor par la multitude (en tubtain, Mang-pos bkour va; en mongol, Olana ergudeksen khagan). Un de ses descendants fut Karn'a (en tubtain, rNa bha tsian), qui rsida Potala (en tubtain, Ghrou h,dzin), ou le porta. Il avait deux fils, Gotama et Bhard'hwadja (en tubtain, rNa va tchan). Le premier se fit religieux; mais ayant t injuste ment accus d'avoir tu une femme publique, il fut empal Potala, et son frre succda Karn'a. Bhard'hwadja tant mort sans enfants, les deux fils de Go' tama, qui taient ns d'une manire surnaturelle, hritrent du trne. C'est des circonstances de leur naissance qu'eux et leurs descendants sont appels de di vers noms, comme Angirasa (en tubtain, Yan lagh s,kyes), Sorya vnsa (en tub tain, Gni maki g,ngen), Gutama et Iks\vakou ( en tubtain, Bhou ram ching pa). Un u de ces deux frres mourut sans postrit; alors l'autre rgna sous le nom d'flts'wakou. Il eut pour successeur son fils, dont les descendants, au nombre de cent, occu prent le trne de Potala. Le dernier fut lks'wakou Viroud'haka (en tubtain, Bon ram ching pa hp'hgs s,kyes po). Il avait quatre fils, nomms en tubtain Kar madh tong, Lagh r,na, Long po tsie dhoul et Kang dhoub djian. Aprs la mort de sa pre mire femme, il se remaria avec la fille d'un roi, dont il obtint la main sous la condi tion de transmettre le trne au fils qu'il aurait d'elle. Press par les grands officiers de la cour, il exila ses quatre premiers fils, pour assurer la succession leur jeune frre pun. Les quatre princes emmenrent leurs propres soeurs avec eux, et ac(( compagnes d'une grande multitude, ils quittrent Potala, se dirigrentvers le Him laya et arrivrent sur les bords de la rivire Bhagralh (en tubtain, Kal dzian ching r,ta), o ils s'tablirent dans le voisinage de l'ermitage du richi Kapila, vivant dans des huttes faites de branches d'arbres. Ils se nourrissaient de leur chasse et (( visitaient quelquefois l'ermitage du richi Kapila. Celui-ci voyant qu'ils avaient trs-mauvaise mine, leur demanda pourquoi ils taient si ples : ils lui exposrent alors combien ils souffraient de la continence force dans laquelle ils vivaient. Le richi leur conseilla de prendre pour femmes celles de leurs soeurs qui n'taient pas nes de la mme mre qu'eux. O grand richi, dirent-ils alors, cela nous serait-il permis? Oui, seigneurs, leur rpondit le richi; des princes bannis peu vent agir de cette manire. Ainsi, se rglant d'aprs cette dcision du richi, ils cohabitrent avec leurs soeurs qui n'taient pas de la mme mre qu'eux, et en eurent beaucoup d'enfants. Le bruit que faisaient ces enfants interrompait le richi dans ses mditations, et il dsira d'aller habiter autre part. Cependant ils le prirent de rester o il tait, et de leur indiquer un autre emplacement pour y a vivre. Le richi leur montra alors l'endroit o ils devaient btir une ville ; et comme " L'ancienPotala est le Tatta de nos jours, l'embouchurede l'Indus.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
215
le sol leur avait t donn par Kapila, ils appelrent cette ville Kapilavastou (c'estu -dire le solde Kapila oue sol du Jaune, ce qui est la signification du nom du richi). Leur nombre ayant augment considrablement, les dieux leur indiqurent une autre place o ils btirent une ville, qu'ils appelrent H'ias b,stan (montre par un dieu). Se rappelant la cause de leur bannissement, ils firent une loi d'aprs laquelle aucun d'eux ne devait pouser une seconde femme de la mme tribu, et devait se contenter d'une seule pouse. A Potala, le roi Iks'wakou Viroud'haka se ressouvenant un jour qu'il avait quatre fils, demanda ses officiers ce qu'ils taient devenus : ils lui rpondirent que pour quelque faute sa majest les avait expulss du pays, qu'ils s'taient tablis dans le voisinage de l'Himalaya, qu'ils avaient pris leurs propres soeurs pour pouses, et qu'ils s'taient considrablement multiplis. Le roi, trs-surpris de ce rcit, s' cria plusieurs fois S'kya!S'kya! est-il possible! est-il possible! (en tubtain, phodh pa). Aprs la mort d'Ilfs'wakou Viroud'haka de Potala, son fils cadet (nomm en tubtain r,Ghyal srid d,ghah, celui qui dsire de rgner) lui succda. tant mort sans enfants, les princes bannis hritrent successivement de lui. Les trois premiers n'avaient pas de descendants. Le fils du quatrime, Kang dhoub djian, fut g,Naghh,dzogh, et le fils de celui-ci Sa ghim. Les descendants de celui-ci, au nombre de 55,ooo, ont rgn Kapilavastou". C'est d'eux que descendent les Shkyas du temps du Bouddha Shkya mouni. Nous devons M. E. Burnouf l'extrait du passage suivant du Mahvamsa, ou l'Histoire de la grande famille, ouvrage en langue pli et en plus de douze mille s'iokas, qui renferme l'histoire de la famille royale dans laquelle naquit Shkya mouni, l'exposition de sa doctrine et du culte qu'on doit lui rendre, la liste des rois hindous et singalais qui ont le plus efficacement contribu la propagation de la religion qui le reconnat pour chef. Ce passage est tout fait conforme l'extrait du K'ha ghyour que nous venons de donner et la gnalogie de Shkya mouni, extraite des livres chinois, que nous avons rapporte dans la note 3 de ce chapitre. Duo et octoginta miUiaSthassaroe rgis frlii et filiorum filii reges fuerunt; Djayasena (exercitus victoriae)ultimus fuit. IUi in Kapilavatthi S'kya-reges fuerunt; filius (fuit). Shalinuh aulem magnus rex Djayasenoe fiiia nomine erat Yas'odhar; Djayasenoeque in Devadaha (divino stagno) rex DevadhaSalska (S'kya) nomine fuit. Andjana et .... nasna fuerunt duo ejus filii; Kasnque uxor fuit rgis Shahnu. Journalof the AsiaticSociety of Bengal, 1833, tom.II, pag. 385 et suiv. Shahnou de lion, commeSzu signifiemchoire tsuMeen chinois,Sengghe gramen tuhctain, Arsalan arsalanen mongol.VoyezSan thsaiihou oghadjitou hoei;Jinw,liv.IX, pag.2.Alphabetum Tibetanum, der Ost-Mongolen, pag.19 et 220. Geschichte par M.I. J. Schmidt,pag. 12.
216
FOE
KOUE
KL
HaecYas'odliaruxor fuit Andjanoe(filii) Sakka; Andjanm filiaefuerunt My et Padjpat. Filii duo sceptrigeri Suppahuddhaet Skya; quinque filii et duo filioefuerunt rgi Shahnu: Dhotodana, Su/kodana,Amitodana, Suddhoclana, Amita et Pramit : illi quinque (quatuor?), illoeduo. e Sakka oriundi Amit uxor fuit, Suppabuddhoe ejusque duo filii fuerunt Baddha/calchnaet Dvadatta. uxores fuerunt. Maya et Padjpat Saddhodanoe E magno rege Suddhoclanaet Maya natus ille Djina. " Sic ex Mahsammatoefamilia continua srie MAHAMUNI natus est omnium Kchatriyorum princeps b. Voici la filiation de la famille des Slikyas et celle des rois de Devadha mises en tableau, selon les donnes du passage prcdent. Djayasena. Shahnu (kabana), Yas'odliar. pouseKasn. Devadha Sakka. Andjana, ...nasna. Kasn. pouse Yus'odhar.
Souddhodana, Dhotodana.S'ukkodana.Amitodana.Amit.Pramit. Suppahuddha,Maya. Padjpat. S'kya. pouse pouseAmit. " "" ~" Maya et Padjpat. "~*"*T*~ i Baddhakalchna. Dvadatta. DJINA (S'kya mouni). Le texte du Mahvamsa donne encorela liste suivantedes rois des deux dynastiesdes Shkyas.Il en dans la premiredynastie, mais il donnevingt-trois noms. comptevingt-deux IDYNASTIE. i. Malisammala. 9. Tcharaka. 10. Upatcharaka. 2. Rodja. 11. Tchetiya. 3. Vararodja. I. 12. Moutchala. 4. Kaiynika 5. Kaiynika IL i3. Mahmoutchala. (3. Ouposatha. i4- Moutchalinda. i5. Sgara. 7. Mandhta. 8. Varamandhta. 16. Bharata. Tous cesrois habitaient Kus'avati,Rdjagrihaet Mithila. 21. Mahpratpa. 17. Bhgirasa. 18. Routchi. 22. Pranda. 23. Mahpranda. g. Souroulchi. 20. Pratpa. Il y a ici interruption entre les deuxdynasties. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11eDYNASTIE. Okkkasa. Okkkamoukha. Nipouna. Tchandim. Tchandamoukha. Parisandjaya. Vessantara. 8. Dvli. g. Sinhavhana. 10. Shassara eut 82000 fils, dontle dernier tait 11. Djayasena. KL.
et Oapali en sanscrit, signifie tte 5 Mah mouni le ou Bouddha. b Mahvamsa, (ou grandpnitent) est Shkyamouni II, i4.
(11) A Yeou pho li.] Yeou pho li en chinois,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
217
suprieure, et selon d'autres, celui qui est proche et conserve. C'est le nom du neuvime des dix grands disciples de Fo. Quand celui-ci tait encore prince, Yeou pho li tait dj entirement dvou sa personne et spcialement charg de ses affaires. Ayant embrass la vie monastique, il garda les prceptes et fut le modle de tous ; c'est pourquoi on l'appela le premier observateur des prceptes \ KL. de terre qui (12) Trembla de six manires.] Il s'agit ici du grand tremblement eut lieu la naissance d Fo, et qui se fit sentir dans tous les Kchamas des trois mille grands chiliocosmes h. Les Bouddhistes admettent six moments dans un tremblement de terre : le commencement du mouvement, de son inl'augmentation des eaux, le vritable tremblement, tensit, le dbordement le bruit qu'il occasionne , et l'croulement qui en est la suite c. Les Bouddhistes prtendent qu'il y a huit causes de tremblement de terre : i Ils sont produits par l'eau, le feu et le vent. Selon les livres sacrs, le Djambou dvpa est, du sud au nord, large de 2 1,000yodjanas; de l'est l'ouest, il en a Au-dessous de la terre, il y a de l'eau 7,000 : son paisseur est de 68,000yodjanas. qui a une profondeur de 4o,ooo yodjanas. Au-dessous de l'eau, il y a du feu dont l'paisseur est de 87,000 yodjanas. Au-dessous du feu, il y a une couche de vent ou d'air, paisse de 68,000 yodjanas. Au-dessous de cet air, il y a une roue d'acier au milieu de laquelle sont les s'arra (reliques) de tous les Bouddhas passs. S'il y a un grand vent, il agite tout coup le feu, le feu remue l'eau, l'eau agite la terre; et c'est ce qu'on appelle tremblement de terre produit par l'eau, le feu et le vent. 20 Tremblement de terre produit par l'entre des Bodhisattwas dans le sein de leur mre. Quand les Bodhisattwas, qui doivent s'incarner pour devenir Bouddhas, descendent du ciel Touchita, et viennent surnaturellement habiter le sein de leur de terre. mre, il y a alors de grands tremblements 3 Tremblement de terre quand les Bodhisattwas sortent du sein de leur mre. ka' Tremblement de terre quand les Bodhisattwas ont achev la loi. Les Bodhiet ayant sattwas ayant quitt leur maison pour embrasser la vie monastique, tudi la raison, deviennent intelligence pure sans suprieure, et c'est ce qu'on nomme tre Bouddha; alors la terre tremble galement avec beaucoup de force. 5 Quand les Bouddhas entrent dans le Nirvana, il y a aussi de grands tremblements de terre. 6 Il y a des tremblements de terre quand les bhilichous ou religieux mendiants veulent se servir de leurs facults surnaturelles. Les livres sacrs disent : Il y a des bhikchous dous d'une grande puissance surnaturelle, et qui souhaitent d'oprer diff* Fan i mingy, cit dans le San tsangf sou, liv. XLI, pag. 1/1. h Terrasexies iotacontremiscit et nuiat. Georgi, Tiheianum, Alphabetum pag. 33. Houayanhingsou, cit dansle San isangfson, liv. XXVII,pag. 24. Les Bouddhistescroientaussi que les tremblementsde terre indiquentsept choses diffrentes. 28
218
FO
KOUE
KL
Ils peuvent partager un seul corps en cent mille rentes espces de mtamorphoses. autres, et faire rentrer ensuite ceux-ci en un seul; voler dans l'espace sans que les montagnes et les rochers leur apportent aucun obstacle; plonger dans l'eau ; s'enfoncer dans la terre. Dans tous ces cas, il y a aussi de grands tremblements de terre. 70 La terre tremble aussi quand les dieux quittent leur premire forme et deviennent matres du ciel ( j^^ Thian tchu). Les livres sacrs disent : Il y a des dieux qui ont de grandes facults surnaturelles et une vertu infinie. Quand leur vie est termine, ils renaissent dans un autre lieu, et par la vertu et la force de Bouddha, ils quittent leur premire ( i M* Fan tchu). forme et deviennent Indra (*M^* Ti chy) ou Brahma
8 Quand il doit y avoir une famine ou une grande guerre ; car alors la vie des tres vivants ou leur bonheur doivent finir, parce qu'ils se battent et qu'ils sont exposs au glaive a. KL. (i3) Aumne d'un seng kia li.] Seng kia li, en sanscrit sanght'i, est le manteau des religieux bouddhistes. Voyez chap. XIII, note 10, pag. 93. KL. (1 k) Sous un arbre Ni keou lia.] Ni keou lia est la transcription chinoise de J^JJTJ nyagrdha; c'est en sanscrit le nom du figuier d'Inde (ficus indica). KL. Fit prir la famille des Shkyas.] Voyez chap. XX, note 36, pag. 213.
(I5)
(16) Le rang de Sia tho wan.] Siu tho wan, en sanscrit ^|d|Mi Srtpanna, est le nom de la premire classe des S'rvakas ou auditeurs de Bouddha. II signifie, selon les auteurs bouddhistes chinois, ceux qui sont affermis contre le courant (de l'coulement des tres du monde b). Cependant il se traduit en tubtain par r,Ghioun dhoujoaghs bha (ceux qui entrent partout) . Voyez le chap. XIII, note 1 3, pag. 9/1. KL. (17) Considra des laboureurs.] Quand le prince Siddhrta fut de retour de ses promenades vers les quatre portes de la ville royale, un des ministres de son pre proposa de lui faire voir les travaux de l'agriculture, afin que ses rflexions ne se portassent pas sur la doctrine. On se pourvut donc d'instruments aratoires, de charrues et de tout ce qui tait ncessaire; et les serviteurs, accompagns d'offi ciers subalternes, vinrent dans un champ o ils firent excuter le travail. Le " Thscng y Ahan king,cit dans le San tsangf sou, liv. XXXIII,pag. i 5 et 16. h Ta tchi tou lun, cit dans le San Isangfsou, liv. XLI, pag. 26. Vocab. peut., nomsdes S'rvakas,tom. I, pag. 65.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
219
prince s'assit sous un arbre djambou et considrait ceux qui labouraient. En creu sant la terre, on en fit sortir des vers. Le dieu (Nan thi ho lo), par une nouvelle mtamorphose, fit que le boeuf qui marchait en soulevant la terre, les faisait re tomber; un corbeau vint les becqueter et les mangea. Le dieu fit aussi paratre a un crapaud qui les poursuivit et les avala; puis, un serpent replis tortueux sortit d'un trou et dvora le crapaud. Un paon s'abattit en volant, et piqua le serpent; un faucon se saisit du paon et le dvora; un vautour fondit sur le fau con, son tour, et le mangea. Le Bodhisattwa, la vue de tous ces tres divers qui s'entre-dvoraient et tour tour, sentit mouvoir son coeur compatissant, sous l'arbre o il tait plac, il atteignit le premier degr de la contemplation. La lumire du soleil tant dans toute sa splendeur, l'arbre recourba ses bran ches pour ombrager le corps du Bodhisattwa. Le roi, pensant que dans l'intrieur de son palais le prince n'avait encore prouv aucune douleur, demanda ses lui rpondit-on, serviteurs comment il se trouvait. 11 est actuellement, sous un arbre djambou, le coeur entier fix dans la contemplation. Je vais aller le voir l'instant, dit le roi, je vais troubler ses penses; car s'il se livre la contem plation, quelle diffrence y a-t-il avec son sjour dans la maison? Le roi de manda son beau char et se rendit au-devant de lui. En approchant, il vit le prince, qu'un divin clat rendait extrmement resplendissant, couvert par les branches recourbes de l'arbre. Il descendit de cheval pour faire un salut, et s'en retourna avec sa suite. Il n'avait pas encore atteint la porte de la ville, que d'innombrables milliers d'hommes ayant offert des fleurs et des par fums, les astrologues firent entendre les louanges de l'tre dont la vie devait tre immense. Le roi demanda la cause de ces acclamations; les Brahmatch ris lui rpondirent : Demain matin, au lever du soleil, les sept choses pr cieuses vous seront remises., grand roi. Le bonheur et la joie vous rendront le saint seigneur. En ce moment, le prince revint au palais, toujours unique ment occup de rflexions sur la doctrine et sur sa puret, qui exigeait que l'on abandonnt la vie laque pour se retirer dans les montagnes et les bois, approfondissant les choses subtiles et pratiquant la contemplation a. Lun ming. Dans les livres (18) Porte le nom de Lun ming.] Dans l'original, JX^ftf^ chinois qui traitent du bouddhisme, le nom de ce jardin est transcrit par jfc "jjffg i Kia tho tchhu, Loung mi ni et ^ #), J|l Lan p ni. Il y est expliqu par )^^AJ^et sans c'est--dire, lieu de celui qui existe par lui-mme, sans empchement obstacle. Je trouve aussi ce terme Kia tho expliqu par Pho lo thi mou tchha, qui est le sanscrit m | ffelMl-srlPardhimkcha, c'est--dire, extrme batitude ternelle1'. " Chini tian, liv.LXXVII, h pag. 28. Santsangf sou, liv. IX, pag. 15. 28.
220
FO
KOU
KL est aussi
Kia tho signifie proprement : aider quelqu'un viter l'infortune. Ce jardin appel f^Jjffl^ We ni \ Voyez pag. 179. KL. Pu j^n> cest (19) La dame.] Dans l'original chinois, ,/VTV donne ordinairement la mre de Bouddha. KL.
^e trtre
qu'on
(20) Deux rois des dragons lavrent son corps.] Voici comment la lgende raconte la dlivrance de Mah my et la naissance du Bouddha Shkya mouni : Mah my alla se promener ; elle passa travers des flots de peuple, et se plaa sous un arbreb. Alors les fleurs s'panouirent et une brillante toile parut dans le monde. La dame s'appuyant sur une branche d'arbre, enfanta par le flanc droit. En naissant, l'enfant tomba terre et fit sept pas ; il s'arrta ensuite et levant la main :
$=.&$*.*._
Dans le ciel et sous le ciel, dit-il, il n'y a que moi d'honorable. Tout est amertume dans les trois mondes, et c'est moi qui adoucirai cette amertume. En ce moment, le ciel et la terre tremblrent fortement, et tous les Kchmas, dans les trois grands chiliocosmes, furent clairs par une grande lumire. Indra, Brahma, les quatre rois du ciel avec toute leur suite et les dieux qui leur sont soumis, les dragons, les dmons, les gnies, les Yakchas, les Gandharvas, les Asouras, vinrent tous entourer et garder le nouveau-n. Deux rois des dragons, frres, l'un nomm Kia lo, et l'autre Y kia lo, firent pleuvoir sur lui une eau tide gauche, et frache droite. Indra et Brahma tinrent une robe cleste et l'y envelopprent. Le ciel fit tomber une pluie de fleurs odorifrantes; on en tendit le son des instruments; des parfums de toute espce, rpandus avec pro fusion, remplirent l'espace. La dame, tenant le prince dans ses bras, monta sur un char attel de dra gons et orn de banderoles et de draperies; et accompagne par des musiciens, elle s'en revint au palais. En apprenant la naissance du prince, le roi donna de grands signes de satisfaction (littralement: sauta de joie), et il sortit avec une grande suite compose de tous les magistrats, de ses sujets, de Brahmatchris, d'officiers, de grands, de ministres et de soldats, pour aller sa rencontre. Ds que les chevaux du roi touchrent la terre de leurs pieds, cinq cents trsors se mon'' P la lingth hing,cit dans le San tsang f sou, liv. XXXI, pag. 5 v. Ni phan hing, cit dans le mmeouvrage, liv. XXVIII,pag. 16v, h C'taitun arbre as'oka le [Jonesia asoha).Voyez Chykiaphou, citdansle Santsang fsou, liv.XXX, pag. 29.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
221
: trrent dcouvert, un ocan de bonnes actions se produisit, au grand avantage ; du sicle. L'assemble tant arrive, les Brahmatchris et les astrologues firent i entendre des acclamations, et tous ensemble donnrent au prince le nom de i Si tha (Siddha, bienheureux). Quand le roi aperut Indra, Brahma, les quatre rois i du ciel et tous les dieux, les dragons et les gnies qui remplissaient entirement i l'espace, son coeur fut saisi de respect, et, sans s'en apercevoir, il descendit de <cheval et rendit hommage au prince. On n'tait pas encore parvenu la porte i de la ville ; il y avait, ct de la route, le temple d'un gnie que tout le monde ( adorait : les Bi^ahmatchris et les astrologues dirent, d'une commune voix, cfu'ii ( fallait mener le prince rendre hommage la statue du gnie. On le prit donc dans ( les bras et on le porta dans le temple ; mais aussitt tous les gnies se prosteri nrent devant lui. Alors les Brahmatchris, les astrologues et toute la foule dirent i que le prince tait un gnie, un tre vritablement excellent, puisque sa majest i exerait tant d'empire sur les dieux et les gnies. Tout le monde donna au i prince le titre de dieu des dieux (Dvtidva). Ensuite on retourna au palais. Les dieux firent paratre trente-deux signes ou prsages relatifs cet vne( ment. iLa terre fut agite par un grand tremblement. Les monticules et les < collines s'aplanirent. 2 Les rues et les chemins se trouvrent nettoys d'eux( mmes, et les endroits ftides exhalrent des parfums. 3 Les arbres secs qui i taient sur les limites du royaume, se couvrirent de fleurs et de feuilles. k Les i jardins donnrent d'eux-mmes naissance des fleurs rares et des fruits savou<reux. 5 Les terrains sans eau produisirent des lotus grands comme les roues d'un < char. 6 Les trsors cachs dans la terre se montrrent spontanment. 70 Les ( pierres prcieuses et les autres rarets de ces trsors laissrent briller un clat < extraordinaire. 8 Les vtements et les garnitures de lit enferms dans les coffres ( en furent tirs et placs en vidence, g0 Les ruisseaux et tous les cours d'eau :<acquirent un plus haut degr de limpidit et de transparence. io Le vent :<cessa, les nuages et les brouillards se dissiprent, le ciel devint pur et serein. :c 11 Le ciel fit tomber de quatre cts une rose odorifrante. 120 La perle divine de la pleine lune fut suspendue sur la salle du palais. 13 Les cierges du palais ;<ne servirent plus. 1 k Le soleil, la lune, les toiles et les plantes s'arrtrent. 15 Des toiles filantes parurent et assistrent la nativit du prince. 1 6 Les dieux et Brahma tendirent un dais prcieux au-dessus du palais. 1 70 Les gnies des huit parties du monde vinrent offrir des choses prcieuses. 180 Gent sortes d'aliments clestes et savoureux vinrent se prsenter d'eux-mmes ( devant le prince ). 190 Dix mille vases prcieux se trouvrent suspendus et remplis d'une douce rose. 20e Les dieux et les gnies amenrent le char de la rose avec les sept choses prcieuses. 2 i Cinq cents lphants blancs, qui s'taient pris d'eux-mmes Kdans les filets, se trouvrent devant le palais. 220 Cinq cents lions blancs sortirent des Montagnes de neige et se trouvrent lis la porte de la ville. 2 3 Les nym-
222
FOE
KOU
KL
phes du ciel parurent au-dessus des paules des musiciennes. ika Les filles des rois des dragons se tinrent en cercle autour du palais. 2 5 Dix mille vierges c lestes parurent sur les murailles du palais, tenant la main des chasse-mouches de queue de paon. 2 6 Les vierges clestes, tenant des urnes remplies d'eaux de senteur, se tinrent ranges dans l'espace. 270 Les musiciens clestes descen dirent et commencrent ensemble un harmonieux concert. 2 8 Les tourments des enfers furent interrompus. et les 290 Les insectes venimeux se cachrent, oiseaux de bon augure chantrent en agitant leurs ailes. 3o La douceur et la bont remplacrent en un instant les sentiments durs et froces des pcheurs et des chasseurs. 3i Toutes les femmes enceintes du royaume donnrent le jour des garons. Les sourds, les aveugles, les muets, les paralytiques, les lpreux et les hommes affects de toutes sortes de maladies furent guris radica lement. 32 Les ermites des bois se montrrent, et, la tte incline, prsen trent leurs adorations \ Une inscription 11 en langue mgah, grave sur une plaque d'argent et trouve dans un caveau prs d'islm-bd ou Tchtgng (Tchiltagong), publie dans le second volume des Recherches asiatiques, raconte la naissance de Bouddha peu prs dans les mmes termes. On y lit : Quand Bouddha-avalr descendit de la rgion des mes, au mois de mgah, et entra dans le corps de Mah my, pouse de Soutah donna, roi de Kals, le sein de Mah my offrit tout coup l'apparence d'un cris tal diaphane, et l'on y voyait Bouddha beau comme une fleur, genoux et appuy sur ses mains. Lorsque dix mois et dix jours de sa grossesse furent couls, Mah my demanda au roi la permission de faire une visite son pre. En consquence, il fut donn l'ordre de rparer et de nettoyer les chemins pour son voyage. On planta des arbres fruit, on plaa sur les cts du chemin des vases d'eau, et on prpara de grandes illuminations. Mah my se mit ensuite en route, et arriva dans un jardin contigu au chemin, o son penchant l'engagea se promener et cueillir des fleurs. En ce moment, assaillie tout coup des douleurs de l'enfante ment, elle s'appuya contre les arbres pour se soutenir ; ils baissrent aussitt leurs branches afin de la cacher pendant qu'elle mettait l'enfant au monde. Brahma lui mme fut prsent, tenant la main un vase d'or. Il plaa l'enfant sur ce vase et le remit Indra, qui en chargea une femme de sa suite. L'enfant, descendant de ses bras, fit sept pas, aprs quoi Mah my le prit et le porta chez elle 0. Voyez la copie d'une image chinoise reprsentant la naissance de Bouddha, sur la planche II qui accompagne ce volume. Dans les divers ouvrages bouddhiques crits en chinois que j'ai sous les yeux, et " Chini tian, liv. LXXVII, pag.15-17. Comparezaussicestrente-deuxprsagesselonles livres Boohs pli, dans Thesacredand historical ofCeylon, publishedhy E. Upham,tom. III, pag. 46. inscription,gravepar ordre de Tchndi lh rdja, date du i4 du moisde mgah,l'an go4, 1/197 de notrere. qui correspond 0 Recherches trad. fr. tom.II, pag. 425. asiatiques, b Cette
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
223 rappor-
qui parlent de la naissance de Fo, ses premires tes. Selon le Ni pan king a, il dit :
paroles sont diversement
Parmi les dieux, les hommes et les Asoaras, moi je suis le plus vnrable. Une grande collection bouddhique, imprime la Chine sous la dynastie des Ming, et dont je ne possde que quelques fragments, donne la reprsentation de sa naissance et de son baptme, et lui fait dire : t If & <$ T * -L *
Au ciel et sous le ciel, moi je suis le seul vnrable. Le Chy kia pou rapporte ces paroles encore autrement, savoir .
Parmi tous les dieux et tous les hommes, moije suis le plus vnrable et le plus levh. Enfin, dans le Fo siang thou we, dont la dernire Japon, en 1796, on lit ces paroles : dition a t imprime au
Entre les quatre points cardinaux, le znith et le nadir, moi seul je suis le plus vn rable. Le pseudo-Abdallah Beidhawi lui fait dire : r^> j*-*-*-&. b o^bu^j ^^^ f>* XJIX? yi^.*AJ jioi (jj l Dieu m'a envoy comme prophte, jusqu'au temps o d'au trs prophtes viendront 0. L'auteur du Ayn Akbari fait dire Bouddha : c^*** ^vjj-s?.LSJ&J.(jv^l 3 ; ce qui doit signifier, ce que je crois, la dernire incarnation est la mienne d. Dans une lgende mongole, extraite par M. I. J. Schmidt, il est dit : Chagkia mouni quitta, le 22 du mois as'ivini d'une anne du tigre mle de feu, la haute rgion divine Damba tagar, sous la forme d'Ardjavardan, roi des lphants, et descendit dans le Djamboudwip, dans le royaume de Magadha, de l'Inde moyenne. L'anne suivante, qui fut celle d'un livre femelle de feu, le 1 5 du mois pourvasad (pourvas'adha), dans la rsidence royale, il entra, sous la forme d'un rayon de lumire de cinq couleurs, dans le sein de la reine Mah my, pouse de 1 CitdansleSan ja sou, 1.XXVIII,p. 16v. b CitdansleSantsang f sou, liv.XXX,pag. 29. tsang 0 Abdallse Beidavoei Historia Sinensis, Jena;,1689, pag. 3o. AynAkbari,cit par M. Langlsdans sonMmoire surle rituelmandchou, insrdansles Notices et extraitsdesmanuscrits de la Bibliothque royale, 2 tom. VII, pag. 46d
224 u Sodadani,
FOE
KOUE
KL
roi de Maghada. L'anne suivante, qui fut celle du dragon mle ter restre, le i5 du mois outlara p'halgouni, midi, dans le jardin Lompa, il vint au monde, par mtamorphose, par la cavit du bras droit de sa mre. Le chef des Esrun (Brahma) le reut sur un byssus (bus) prcieux, et Kliormoasda koachika lui administra le bain sacr. Le jeune enfant fit sept pas, et sous (Indra) chaque pas s'panouit aussitt une fleur de lotus. Il rcita alors le passage sui vant d'une ancienne hymne : Si toi, le premier des hommes, renaissant par mtamorphose et en faisant sept pas dans ce monde, tu dis : Je suis le matre de l'univers; alors, trs-illustre, je t'adorerai ". - KL. (2 1) O ils accomplissent la doctrine.] C'est--dire, o, tant Bodhisattwa, ils deviennent Bouddha Tathgata ou accomplis. Quant au Bouddha Shkya mouni, il obtint cette dignit dans un jardin du royaume Ma kia tho (Maghada), sur les bords de la rivire Ni lian (les auteurs chinois avouent ignorer la signification sanscrite de ce nom). Le saint tait alors assis entre deux arbres Po thi (ficus religiosa), et y devint Intelligence huit tours saintes b. absolue. On a lev, cette place, la seconde des
La rivire jj \J^) Ni lian, dont les bords furent pendant six ans le thtre des macrations auxquelles Shkya mouni, tant encore Bodhisattwa, se soumit pour atteindre la dignit de Bouddha, est appele, dans la relation de Hiuan thsang, Ni Han chen na; et dans les livres jjN^j jr. Ni lian chen et ^j n]L./Cj ^>i. Nrandjara, NirandzaraA et Naran dzara *.Toutes ces transcripmongols, p,1 .f 1,1 tions reprsentent le terme sanscrit Tf^T^I Nlntchana (en pli, Nirandjanam), qui signifie sulfate de cuivre et aussi clair. C'est le nom d'un torrent considrable qui est encore prsent appel Niladjan, et qui, avec un autre nomm Mohane, qui vient du sud-est, forme la rivire Falgo (P'halgou). Cependant comme le Niladjan, nomm sur nos cartes Ammnat, a un cours beaucoup plus long que le Mohane, on peut le regarder avec raison comme la partie suprieure du Falgo. Il a ses sources dans les montagnes boises du district de Tort, de la province de Ramghur, environ reoit dans le par 2 3 ko' latitude nord; il coule en gnral au nord-nord-est, Bahar les noms de Falgo et de Mohany, et se runit au Gange au-dessous du village de Roui nalln. Hiuan thsang, en se rendant du monastre Che lo p tho lo (ou de l'abstinente sagesse )f la ville de Kia ye ( Bouddha Gaya), faisait quarante cin quante li au sud-ouest et passait la rivire Ni lian chen. Tous ces dtails dterminent avec prcision la contre o Shkya mouni vcut pendant six ans dans la solitude, et o il obtint la dignit de Bouddha. KL. * I. J. Schmidt'sForsch. imGebiete, etc. pag. 171. b P la lingthhing,cit dansle San tsang f sou, liv. XXXIII,pag. 5 verso. " Piani lian, liv.LXV, pag. 25v. et 36Geschichte der Ost-Mongolen, pag. 3i3 et 333. im Gebiete, Forschungen pag. 173. *J(^Ti S'ilavrilla signifieen sanscrituneconduitesageetmorale.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXII.
225
(22) Tourner la roue de la loi.] C'est une expression allgorique employe pour indiquer qu'un Bouddha a commenc prcher la doctrine. Le F yuan tchu lin dit : Le lieu o le Tathgata (Shkya mouni) a fait tourner la roue de la loi n'est pas bien dtermin. Selon les uns, c'est l'estrade du silence (^Syjfet)' selon les autres, dans le Parc aux cerfs (prs de Bnars et au nord-est de cette ville), ou dans les cieux et d'autres lieux a. KL. (2 3) O ils soumettent les hrtiques.] On a vu, la note 21 du l'exposition des doctrines des philosophes htrodoxes du temps de C'est Vrnas ou Bnars que Shkya mouni soutint le plus avec les docteurs htrodoxes. Ces derniers, qui sont appels Ters chapitre XVTJ, Shkya mouni. de discussions
dans les livres bouddhiques des Mongols, taient ennemis jurs de la doctrine de Bouddha. A l'poque de la rformation de Shkya mouni, les sectateurs de S'iwa se sentirent trop faibles pour le combattre; alors son oncle Deivadatla se mit la tte de ses antagonistes et adopta la croyance des Ters, qu'il tcha aussi d'introduire la cour de plusieurs petits princes de l'Inde. Croyant renverser Shkya mouni, il fit venir les six principaux docteurs des Ters (comparez chap. XVII, note 21, pag. 1 Zig) pour les opposer son neveu, une grande fte o tous les princes taient assembls; mais ils choui'ent contre son intelligence suprme. Les quinze rois prsents cette fte se runirent tous les j ours, depuis le premier jusqu'au quinze du premier mois ; et les six docteurs des Ters essayrent, dans ces assembles, d'attaquer et de vaincre le Bouddha par des moyens magiques. Sans les craindre, il triompha d'eux de la manire la plus glorieuse, par la force de ses raisonnements et par sa puissance divine et surnaturelle; de sorte qu'aprs quinze jours de discussions, le chef de ses adversaires fut contraint de se prosterner devant lui et de l'adorer. Tous ceux qui taient prsents se levrent et suivirent son exemple. Par cette dernire victoire, sa gloire et sa doctrine se rpandirent clans toute l'Inde ; et en mmoire de cet vnement, ses sectateurs l'anne ''. KL. (ik) clbrent encore tous les ans les quinze premiers jours de
Monter an ciel Tao li.] Voyez chap. XVII, note 2.
(2 5) Pour y prcher la loi en faveur de leur mre.] Voyez chap. XVII, note 3, et chap. XX, pag. 171. Voici de quelle manire l'Histoire mongole de Sanang Setsen raconte que le Bouddha Shkya prcha la loi sa mre : Six jours aprs la naissance du prince royalKhamouh tousayi butughektchi (en sanscrit Sarvrthasiddha, qui produit le salut a San pag.81. h l'Asie,Viede Bouddha,dansle tomeII, tsang f sou, liv. XIII, pag. 25. Mmoires relatifs 29
226
FO
KOU
KL
de tous), sa mre Mah my entra dans le Nirvana. 11 obtint, dans l'anne Ting du tigre, la dignit de Bouddha; et six ans aprs, dans l'anne Ting du blier, re gardant un jour avec les yeux de l'inspiration divine, il dcouvrit sa mre Mah my, sous une nouvelle incarnation, dans la rgion des trente-deux tgri. Aussi tt il s'y leva pour la conduire sur le chemin de la saintet divine, et il y resta pendant quatre-vingt-dix jours pour lui prcher la loia.
(26) En faisant cinq yeou yan.] Environ
six lieues et demie.
" Geschichte der Osl-Mongolen, vonI. J. Schmidt, pag. i5.
CHAPITRE
XXIII.
Royaume de Lan m. tang du Dragon. Aventure du roi A y avec le roi des Dragons. Elphants qui font le service prescrit par la loi.
En quittant le lieu o Fo est n, et en faisant, cinq yeou yan (i) vers on arrive un royaume nomm Lan m (2). Le roi de ce l'orient, pays un fragment de che li (3) de Fo, btit une tour apayant, obtenu il y a un tang, pele la tour de Lan m (4). A ct de cette tour et dans l'tang un dragon la tour. Lorsque qui garde continuellement le roi A y (5) sortit du faire quatre-vingt-quatre et voulait roi qui en venir sicle, mille il voulut autres. briser Il avait les huit dj tours bris pour en sept tours
celle-ci,
A yi, le fit entrer dans la clbration servaient
et conduisant ]e quand le dragon parut, son palais pour lui montrer les choses du culte. Ensuite il dit au roi : Si tu pourras Le roi A y. reconnut n'taient pas de ceux sur ceci,
tu peux parvenir l'emporter par tes offrandes, dtruire (la tour), je ne t'en empcherai pas. la clbration que les objets qui servaient
a dans le sicle, et il s'en revint. qu'on Dans cet endroit strile il n'y a point et solitaire, et balayer; arroser mais on y voit continuellement
d'hommes des
pour
de l'eau avec leur trompe d'lphants qui prennent pour toutes sortes de fleurs et de parfums, font le terre, et qui, recueillant service de la tour. Il y eut des Tao sse (6) de divers pays qui vinrent faire leurs adorations cette tour. Ils rencontrrent les lpour phants, virent furent sonne dant et saisis
troupeaux arroser la
de frayeur, ils se cachrent dans les arbres, d'o ils les lphants la loi. Les Tao sse faire l'office conformment extrmement en ce lieu arros pour touchs faire de voir le service comment, quoiqu'il de la tour, l'difice donc n'y et pertait cepenleurs 29. grands
et balay.
Les Tao sse abandonnrent
228 prceptes les herbes propre fonder tenant et revinrent et les arbres, Ils
FO se faire
KOU Cha
KL ils arrachrent cet endroit
mi. Eux-mmes, la terre et rendirent le roi
aplanirent de religieux
et net. un une
s'efforcrent
de convertir ainsi
tablissement habitation
longtemps, il y a toujours lieu On o
de religieux. et la tradition nous en a t transmise des
qu'un La chose s'est
et de l'engager Il y a maintemple. passe jusqu' il n'y a pas
prsent: au (8).
De l en allant le prince y a aussi bti
Cha mi qui desservent le temple. l'orient de trois yeou yan (7), on arrive l'espace son char et quitta son cheval blanc renvoya une tour.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIII.
(1) Cinq yeou yan.] Environ
six lieues et demie de France.
(2) Un royaume nomm Lan m.] Hiuan thsang qui, dans la premire moiti du vu" sicle, visita ce pays, l'appelle Lan moa, en crivant la dernire syllabe de ce nom avec un autre caractre que celui qu'emploie F hian. Il le trouva aussi dsert, et il en raconte peu prs les mmes choses que notre voyageur. On doit chercher le Lan m au nord ou au nord-est de la ville actuelle de Gorakhpour, au pied du versant mridional des montagnes qui sparent le Npal du royaume d'Aoude. Ce dernier est clbre comme tant le pays de Rama, et il est vraisemblable que Lan m, en chinois, est la transcription du nom de ce conqurant. Nanmoins, les deux bourgs appels Rampour, situs dans le voisinage de l'endroit o la rivire Gandak entre du Npal dans l'Inde, me paraissent trop loin l'est de la rivire Rohen ou Rohini pour tre confondus avec le Lan m de F hian. KL. (3) Un fragment de che H.] Che li est le mot sanscrit s'rira, qui-signifie proprement corporel, ce qui vient du corps, puis aussi les reliques des Bouddhas et d'autres saints personnages. Les Mongols ont fait de ce mot leur s'aril. Comme le corps des Bouddhas, quand ils se montrent clans les trois mondes, n'appartient que d'une manire apparente au sansra ou la matire, les restes matriels de ce corps ne font nullement partie de l'essence immatrielle et ternelle des Bouddhas. Selon un passage du Mahyna souwarn a prabhsa (en mongol, Alton gerel), traduit par M. I. J. Schmidt\ Routchiraketou, dsirant tre instruit sur ce point, adressa * Pian iiian, liv. LXIV,art. 7. h Ueber Gnindlehren derBuddhasmus, Zweite einige Ahhandlung,dans les Mmoiresde l'Acad.de Saintsriesciences Ptersbourg, polit,etc.tom.I, pag. 23o.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIII.
229
Shkya mouni les paroles suivantes : Trs-glorieux accompli, si, d'aprs ce que ces Bouddhas (les quatre prcdents) ont enseign, le trs-glorieux accompli est dj devenu Nirvana avant qu'un s'rra soit laiss dans le monde, pourquoi donc les Sotras disent-ils : Quand Bouddha devient Nirvana, les s'rra qu'il laisse dans le monde sont vnrs par les dieux et les hommes, avec recueillement et avec une confiance religieuse? Par la vnration et la dvotion ardente que les dieux et les hommes ont pour les s'rra des Bouddhas des poques passes, d'in commensurables mrites ont t accjuis. Comment cela cadre-t-il avec l'assertion qu'il n'y a pas vritablement de s'rra? Le Bouddha trs-glorieusement accom pli voudrait-il bien expliquer cette contradiction, et claircir la vrit sur ce point? Le trs-glorieux accompli rpondit alors Routchiraketou Bodhisattwa et ceux qui taient prsents, en disant : Il faut regarder comme provisoire (c'est--dire comme destine ceux qui ne sont pas encore assez clairs) la doctrine, que le trs-glorieux accompli, en devenant Nirvana, laisse au monde un s'rra; car, fils d'illustre origine, les Bodhisattwas Mahsatlwas enseignent que les S'ra manas vritablement apparus et les Bouddhas entirement accomplis, deviennent dj indubitablement et parfaitement Nirvana par les dix qualits suivantes, etc. On voit par ces paroles de Shkya mouni, que la doctrine che li ou s'rra n'est destine que pour le peuple. KL. de la saintet des
(k) La tour de Lan m.] Cette tour n'est pas comprise parmi les huit tours divines dont il a t question dans la note 11 du chapitre XX, pag. 179. KL. (5) Lorsque le roi A y.] C'est As'oka, roi de Magadha, arrire-petit-fils de Bimbsra et petit-fils de Adjtas'atrou, dans la huitime anne du rgne duquel Siddhrta devint Bouddha. As'oka vivait cent ans aprs le Nirvana de Shkya mouni. La Wa kan kw t fen nen gakf oun-no tsou place la chronologie chinoise-japonaise des quatre-vingt-quatre mille tours par Ayi, roi de l'Inde (Ten zik), dans l'anne J&j\ du cycle xxxi, c'est--dire 833 ans avant notre re ". construction Les rois de Magadha avaient eu de longues guerres soutenir contre ceux 'Anga, pays situ du ct de Bagalpour sur le Gange infrieur. Peu de temps avant la naissance de Shkya mouni, les rois de Magadha ou Behar devinrent tributaires de ceux d'Anga, et le furent jusqu'au rgne de Mah Padma (Padma tchenb, le grand lotus, en tubtain). Bimbasra ou Vimbasra, fils de Mah Padma, lui succda. Il porta le surnom de S'renka. C'tait lui cuti avait encourag son pre ne pas payer le tribut. Dans la guerre qui s'ensuivit, il tua le roi d'Anga, et ajouta ce pays aux tats de sa propre famille. A l'poque de la naissance de Shkya mouni, sa rsidence tait Rdjagrha h. ' Nouveau Journalasiatique, tom. XII, pag. 417. h Abstract ofihe contents oj'theDul-va, jirstpart of theKuhghyour, dansleJourby M.Csomade Koro's, naloftheAsiatic i832 , t. I, p. 2. sociely of'Bengal,
230
FO
KOU
KL
L'Histoire mongole de Sanang setsen contient la liste suivante des prdcesseurs du roi As'oka de Magadha, mais leurs noms y paraissent traduits du sanscrit en mongol. Pour les reconnatre, j'ai mis leur signification en franais, et c'est par ce moyen que je suis parvenu les retrouver dans la langue originale. Ye/c Linklwa (le Grand lotus). C'est le Mah Padma pati Nanda, ou Nanda le matre du Grand lotus, du Bhgavala pourana, et le Padma tchenbo des livres tubtains. djirouken(le Coeurlev). Il fut contemporain de Shkya mouni j-O"^ V- ^-LgJ ' "** Tsoktsas-un et rsida Vrn'as(Bnars). Ce prince est omis dans la liste du Bligavata pourana. Suivant les auteurs hindous, Nanda, le Grand lotus, fut tu par le brahman Tchanakya, qui mit sur le trne Tchandragoupta,de la famille Maurya. Les livres tubtains, que M.Csoma de Krs a extraits, font succder Bhnbasra ou Vimbasra son pre Padma tchenbo (le Grand lotus). Erdenisar (la Lune prcieuse). C'est le Tchandrac/oupta(e protg par la t-^-M/VJ' ' ^ 'lune) du Bhgavata, et le Tchandagoutladu Mahvamsa. ouiledou/ctchi V>:*L:M|-\>A 'J Marcjisiriamogolang (Mrgas'ira,qui agit avectranquillit). Le Lun i 10 Lloj i i Bhgavata appelle ce roi Vrisra (Essence d'eau), et le Mahvamsalui donne le nom de Bindhousra(Essence de la goutte d'eau). Les Chinois \j_cjn3j_L-^al'appellent Phing cha ou Pin po so lo, ce qui est la transcription de Bimbsra (Essence de Bimba). LXXJ_(|A_I_I.. Arsalan (le Lion). Ce roi est appel Adjtas'atrou dans les livres sanscrits. Dans la huitime anne de son rgne, Siddhrta devint Bouddha. Adjtas'atrou rgna trente-deux ans. S^J-^-Ma- k9:i--'-L- Arban lerghetou(qui a dix siges). Je suppose que c'est le Das'aratha (dix chars) du Bhgavata. Ce livre l'indique comme second successeur d'As'oka ou As'okavardhana, et non pas comme son prdcesseur. \y^j2oe.j-LAi_i__i_y_i_y_ GhasaangoughcNom-unkhaghan(le roi de la loi, lequel est sans tristesse). LC tjeJULU-X-VJ; C'est As'oka (en chinois, A yii), qui rgna cent dix ans aprs le Nirvn'a de Shkya mouni. Hiuan thsang transcrit son nom par A choukia \ (6) Il y eut des Tao sse.] Il est trs-remarquable que, dans sa relation, F hian parle si souvent des Tao szu qui, de son temps, existaient non-seulement dans l'Asie centrale, mais aussi dans l'Inde. Il parat donc que la doctrine de cette secte philosophique tait dj trs-anciennement rpandue dans les contres situes l'ouest et au sud-ouest de la Chine. Nous avons dj vu (chap. XXII, note 7) le Tao szu A i arriver Kapila la naissance de Shkya mouni, et tirer son horoscope. Les -Jriff Ta%szu sont nomms en tubtain }3\VT de la croix mystique, Bon bb, etZTJ^UUT^rCryZ^| appele en sanscrit swaslika). religion du L J.J_O^ Lij-i-^
Yonng dhroung pa (sectateurs Leur doctrine,
nomme ^(3T^3T(X)^\JT-60"' LXV,pag. 11.
ghi tsis, tait l'ancienne
1 Piani tian, liv.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIII.
231
Tubet; elle y prvalut mme jusqu'au ixe sicle, poque de l'introduction gnrale du bouddhisme dans ce pays : encore aujourd'hui, il a un y grand nombre de ses sectateurs dans le K'ham youl ou Tubet infrieur. Ils ont plusieurs livres qui contiennent l'expos de leur doctrine, que les Mongols appellent jyii. JA p^ t-gj Bom bb-in nom. Al^f-M X ^J^J Chen roebs en a t le fondateur a.
Sanang setsen raconte, dans son Histoire mongole, que quand le premier roi du Tubet, Segher sandalitou khagan (en tubtain, Gnia thri zzan bb), vint dans ce pays et descendit dans la valle de Yarloang, il y rencontra le Debchin bon bb du ciel et le Yang bon bb de la terre, qui le proclamrent roi\ M. I. J. Schmidt n'a pas su expliquer ce titre de Bon bb autrement qu'en disant : Bon bb signifie seigneur en tubtain. Je crois qu'il s'agit ici des habitants des montagnes et des valles c. Mais on voit que le prince hindou fut reu par les grands prtres de la religion qui rgnait dans le pays, et reconnu leur instigation par tous les habitants. Dans un autre endroit des notes de son Histoire mongole, M. I. J. Schmidt dit pourtant : Il est souvent question de la doctrine du Bon dans le Bodhimr, sans qu'on voie en quoi elle pouvait consister. Il parat seulement qu'elle tait contraire au principe du boud dhisme. La doctrine du Bon ou des Bon bb tait dj rpandue clans le Tubet long temps avant Srongdzan gambb : c'tait peut-tre une secte chinoise. KL. (7) Trois yeou yan. ] Environ quatre lieues. KL.
(8) Renvoya son char et quitta son cheval blanc] L'inscription en langue mgah, cite plus haut, dit : Shkya quitta son palais, n'ayant avec lui qu'un domestique et un cheval ; il traversa le fleuve Ganga et arriva Balo kl o il posa son ar mure, aprs avoir ordonn son serviteur de le quitter et d'emmener son che vald. La circonstance que Bouddha ait travers le Gange pour arriver ce lieu, est en contradiction avec le rcit des livres bouddhiques traduits en chinois. Bouddha y arriva du palais de son pre situ dans la ville de Kapila, et ne vint qu'aprs dans le royaume de Maghada, qui tait au sud du Gange. Le lieu appel Balo kl dans cette inscription, est nomm A nou mo dans les livres des Boud)jti$^fj dhistes chinois ; dans les livres pli c'est la rivire Anoumanam . Voici comment la lgende raconte ce trait de la vie du Bodhisattwa. Siddhrta parvenu sa dix-neuvime anne, le 70jour de la 4lune, fit serment de sortir de sa maison ; et la nuit suivante, aprs minuit, une toile brillante Dictionary ofthe Tibetan language, by M. Csoma de KorSs,g4 et 36. 11Geschichte der Ost-Mongolen, pag. 23. 0 imGebiete derGeschichte vonMittel. Forschungen Asienpag. 25. * d Recherches asiatiques,trad. franaise,tom. II, pag. 427. " Thesacredand historical Boohs Voyez ofCcylan, E. publishedby Upham, tom. III, pag. 8g.
232
FOE
KOUE
KL
parut, et tous les dieux remplissant l'espace exhortrent le prince s'en aller. Dans ce mme temps, Kieou i eut cinq songes qui firent qu'elle s'veillatrs-effraye. Le prince lui demanda ce qui l'avait ainsi veille avec pouvante. Elle lui rpondit : J'ai vu en songe le mont Sou merou qui s'croulait, la pleine lune qui tombait (( terre, la lumire des perles qui s'teignait subitement ; le noeud de mes cheveux tombait, et quelqu'un me faisait violence : voil ce qui m'a fait peur et m'a r veille. Le Bodhisattwa fit en lui-mme la rflexion que ces cinq songes se rap portaient sa propre personne, et sur le pointde sortir de sa maison, il dit Kieoui: Le Sou merou ne s'croulera pas; la pleine lune continuera de nous clairer; l'clat des perles ne s'teindra pas ; le noeud de vos cheveux n'est pas tomb ; personne ne vous a fait violence: rendormez-vous donc tranquillement, et ne vous attris tez pas pour cela. Alors les dieux dirent au prince qu'il devait partir ; mais craignant qu'il ne s'arrtt ou ne ft retenu, ils appelrent Ou sou mon (l'esprit de la satit ) pour qu'il entrt dans le palais. Tandis qu'on dormait, Nan li ho lo changea toutes les parties du palais en tombeaux, Kieou i et toutes ses suivantes en cadavres dont les ossements taient disperss, les crnes transports en divers endroits, les entrailles corrompues, ftides et vertes, le sang extravas et coulant ml de sanie. Le prince voyant les salles du palais changes en tombeaux, et parmi ces tombeaux, les oiseaux de proie, les renards, les loups, les oiseaux qui volent et les btes qui marchent; Aboyant que tout ce qui existe est comme une illusion, un changement, un songe, une voix; que tout retourne au vide, et qu'il faut tre insens pour s'y attacher, il appela (tchhe ny) l'cuyer, et lui commanda de seller sur-le-champ son cheval \ L'cuyer lui reprsenta que le ciel n'tait pas encore clair : Quel si grand empressement de seller le cheval? Le prince rpondit l'cuyer par un gth o il disait : Je ne me plais pas maintenant dans le monde ; cuyer, ne me retiens pas. Laisse-moi accomplir mon voeu primitif, et m'affranchir des douleurs des trois mondes. Alors l'cuyer alla pour seller le cheval ; mais le cheval se cabrant ne voulait pas se laisser approcher. On retourna le dire au prince : Le cheval maintenant ne peut tre sell, lui dit-on. Le Bodhisattwa y alla iui" Cechevalde Shkyamouniest nommdansle la texte chinoisKhiante. C'est vraisemblablement transcriptiondu mot sanscritqui, en pli, est deLes livrestubtains appellentle venu Kaniakanam. le digne de mmechevalsNgaghs Idzian,c'est--dire louanges.Dans les livrespli il porte aussile titre de Kanta kanam Aswardja signifieroi Aswardjah. Dans des naissancesantrieures, son des chevaux. meesprantanimerun jour une monturedestine porter un Bouddha,avait, pendant un kalpa ende saintet.Cechevalnatier, pratiqu des oeuvres quit en effetle mme jour que le BouddhaShkya mouni; il parvint dix-huitcoudesde longueuret une hauteur proportionne ; il tait blanc comme une coquillepolie.Le Bouddhamonta Kantakanam attel un char superbe,dans lequel il pouvaiten quinzeheuresfaire le tourde l'univers.AyantBouddha sur son dos, Kantakanamtraversad'un saut la rivireAnoumanam, ; l, large dehuit centscoudes leBouddhavoulantentrer dansl'tat ecclsiastique, chargeason cuyerd'avoirsoinde son cheval,et le la ville. Mais l'endroitmmeo Kantarenvoya kanam Aswardja perdit le Bouddha de vue, il mourut de douleur; et sonmeentra dansla gloire ternelle, parcequ'il avaitentendules prdications du Bouddha.Voyez Upham, tom. III, pag. 53.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIII.
235
mme, et frappant doucement de sa main sur le dos du cheval, il rcita ces vers": Il y a longtemps que tu es dans la vie et la mort; prsent tu vas cesser de porter et de traner. Kian the, conduis-moi seulement afin que je sorte : quand j'aurai obtenu la loi, je ne t'oublierai pas. Alors on acheva de seller le cheval. Kian the pensa en lui-mme : il faut que je frappe maintenant la terre des pieds, de ma nire causer un bruit qui aille jusqu' ceux qui sont dehors. Mais quatre esprits lui soutenaient les pieds, afin qu'ils ne touchassent pas terre. Le cheval voulut cn suite hennir et faire entendre sa voix de prs et de loin; mais les dieux la disper srent de manire qu'elle se perdit dans l'espace. Le prince monta donc che val et se mit en route. Parvenu la porte de la ville, les dieux, les dragons, les gnies, Indra, Brahma, les quatre rois du ciel s'assemblrent pour le guider dit: Le jusqu'au dsert. Le gnie gardien des portes parut, et se prosternant, royaume de Kia 'we lo 'we est le plus florissant et le plus fortun de l'univers; le peuple y vit heureux : pourquoi l'abandonneriez-vous? Le fils du roi rpondit par ce gth: La naissance et la mort sont de longue dure; l'me parcourt les cinq voies. Si mes voeux primitifs sont accomplis, j'ouvrirai les portes du Nir vn'a. Alors les portes de la ville s'ouvrant d'elles-mmes, il sortit et s'loigna comme s'il et vol. Il marcha la vue des dieux l'espace de quatre cent quatre-vingts li, et vint au royaume d'A nou mo. L, le prince descendit de cheval, se dpouilla de ses vte ments prcieux, de ses ornements, de sa tiare, et remettant le tout sur Kian th: Ramne, dit-il ( son serviteur), mon cheval au palais; remercie pour moi le grand roi et ses officiers. Je veux vous suivre, disait Kian th, pour vous fournir ce qui vous sera ncessaire. Je ne puis m'en retourner seul; car si vous lchez votre cheval et le faites aller dans les montagnes, il y trouvera beaucoup d'ani maux dangereux, des tigres, des loups et des lions. Qui d'ailleurs pourrait vous manger et boire, de l'eau, de la bouillie et ce qu'il faut pour dormir? Comment auriez-vous tout cela? Il faut que je vous suive, que je vous accom pagne. Kian th fit une longue gnuflexion. Ses larmes coulrent, il baisa les pieds (du prince). Il ne buvait plus d'eau, il ne mangeait pas d'herbes. Il pleurait et gmissait, il hsitait quitter le prince. Celui-ci lui adressa un nouveau gth: Le corps, dit-il, est soumis la maladie. L'action vitale gne par la vieillesse arrive la dcrpitude et la mort. Le mort et le vif ne peuvent manquer de se sparer. Quelle joie y a-t-il dans le monde? Alors Kian th, trs-afflig et versant des larmes, offrit ses hommages aux pieds du prince ; ce cheval si doux prit sa rso lution et s'en retourna. Il n'tait pas encore arriv la ville royale, quand, quarante li de distance, il fit entendre un gmissement douloureux. Sa voix re tentit dans tout le royaume, et tout le monde dit : Le prince revient pour soutenir l'tat. Le peuple sortit pour aller sa rencontre; mais on vit l'cuyer qui ra menait le cheval vide. Kieou i, ce spectacle, se prcipita de son palais et vint 3o procurer
234 embrasser
FOE
KOUE
KL voyant contint
le cheval en gmissant et en pleurant une telle infortune. Le roi Kieou i qui se dsolait et les cinq officiers de l'intrieur dans l'affliction, se et leur dit : Mon fils tudie sa propre nature. Mais dans le royaume, le ayant vu la tristesse du roi et de Kieou i, il n'y eut personne qui n'prouvt
peuple la plus vive douleur. Kieou i y songeait le jour et la nuit. Le roi appela donc ses officiers (( et leur dit : J'ai un fils an qui m'a quitt pour entrer dans les montagnes ; il faut que cinq d'entre vous, tour de rle, aillent faire la garde autour du prince et veillent avec soin ce qu'il puisse revenir a. La chronologie chinoise et japonaise Wa kan kw t fen nen gakf oun no tsou place la fuite de Siddhrta, lorsqu'il se rendit de la maison paternelle Yu theou lan c'est--dire l'an 1006 avant fo, clans l'anne 7|* "^ Y liai, la i 2duxxvniccycle, notre re b. KL. Chini lian, liv. LXXVII, h Journalasiatique,tom. XII, pag. .411. pag. 28 v. et suiv. Nouveau
CHAPITRE Tour des Charbons.
XXIV.
Ville de Kiu i na ki. Rivire Hi lian.
De trouve
en
allant
l'orient
et en
faisant
(2). H y a aussi En allant de nouveau l'orient l'espace vient la ville de Kiu i na ki (4). C'est au nord deux arbres (5), sur le bord vers de la rivire le nord, Hi
la tour des Charbons
yeou yan (i), on un seng ha lan. de douze yeou yan (3), on quatre de cette ville, entre lian dans du (6), que illustre le Ni houan (8). L
sicle (7), la tte
tourne
entra
o Siu p (9), longtemps la loi, et o on adora dans son aprs, obtint d'or l'illustre du sicle pendant cercueil sept jours (10); l o le hros (n) lcha le pilon d'or, et o les huit qui porte le sceptre de diamant les che li (12); dans tous ces lieux on a lev des tours rois partagrent des seng kia lan qui tous existent encore. Dans cette ville, la population est rare et peu nombreuse. et des familles du peuple. que des religieux au sud-est et en faisant De l, en allant vingt yeou yan voit entra retenait foss le lieu dans Fo o le Ni sans tous les Li tchhe (i4) voulurent ce que Fo ne permit le laisser aller ; celui suivre Fo et on a tabli Il n'y a
(i3), on
houan, vouloir
pas; o Fo
il quand le lieu o l'on fit un grand tira un
trs-profond heureux pronostic mille pour lever (16).
l'endroit o Fo qui ne put tre travers; sa fade sa marmite (i5), et celui o il renvoya sur laquelle il y avait une de pierre une colonne
inscription
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIV.
KL. (1) Faisant quatre yeou yan-.] Environ six lieues et demie. (2) La tour des Charbons.] Selon le rcit de Hiuan thsang, cette tour tait haute 3o.
256
FOE
KOUE
KL
de plus de trente tchang ou toises chinoises. Situe dans une fort de figuiers d'Inde, elle couvrait la place o le corps de Fo avait t brl, et dont la terre tait entremle de cendres et de charbons. Dans le kia lan qui appartenait cette tour, on voyait les trnes des quatre Bouddhas passs a. -KL. (3) Douze yeou yan.] Environ KL. dix-sept lieues.
(4) La ville de Kiu i na ki.] Ce nom, transcrit en chinois par ^S Jjv B& 3*9 , parat tre fautif dans le second caractre s& i, car dans la plupart des livres boud^ll c^ 'tehhiJdhiques traduits en chinois, cette ville est nomme $LP4n Ils expliquent ce nom, qui est sanscrit dans sa premire moiti, par ville cornes ou ville triangulaire^. Hiuan thsang l'appelle plus exactement $&$% ~ffi{ ^lu chi J^f\ na ki loc ( ch^Mr^i^ Kous'inagara), ce qui signifie ville de l'herbe Kous'a (Poa cynosuroides). Cette dnomination s'accorde parfaitement avec la traduction excellente. tubtaine M. Csoma r^sa ml:cno3n 3ron3' vule de l'herbe
-~K*ScNob^T^1^
de Krs, qui cite cette dernire comme employe dans le Kah ghyour, place la ville en question dans le district de Kmaroupa de l'Assamd; mais, d'aprs les rcits de F hian et de Hiuan thsang, on ne peut lui assigner une situation aussi orientale. Kous'inagara doit au contraire avoir t peu de distance de la rive orientale du Gand'ak (le Gunduck des cartes anglaises). C'est sans doute la ville de Kousinr des livres pli. Quoique son emplacement n'y soit pas dtermin, elle ne pouvait pourtant pas tre trs-loigne du royaume de Magadha. KL. (5) Entre deux arbres. ] C'taient deux arbres appels So lo en chinois, et en sanscrit S'l (Shorea robusta). KL. tre le mot (6) La rivire Hilian.] jgt jfc Hi lian me parat indubitablement sanscrit fefTpT Hiran'ya, qui signifie or. Les anciens ouvrages bouddhiques traduits en chinois appellent cette rivire %^ J^Chi lai nafti(^^3^\Sivar/^"fx^" n'awat), et traduisent ce nom par ayant de l'or. Hiuan thsang, la vrit, nomme la mme rivire JAT^ "^ TY v*yl c^1 fo f li, ce qu'il traduit par sans pareille dans le monde entier, en assurant que l'ancienne orthographe de ce nom, ^^^^^.^lj f^j A H lo pho ti, est fautive1'. C'est, comme je l'ai dj dit, le Gand'ak ou Gunduck. Dans le Fo siang thon 'we, " Piani tian, liv.LXIV,art. 7, pag. 5. L Ni pan king,Ileoufen, citdansle San tsang f sou, liv.XXXI,pag. v. ' Piani tian, liv.LXXV,art. 7, pag. 1. i834, Dictionai'yoftheTibelanlaiiguage,GixlcuUi\, pag. 268. Journalof theAsiatic of Bengal, socieiy i83a , tom. I, pag. 5. ' Pian itian, liv. LXXV,art. 7, pag. 1. 1
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIV.
257
qui est une collection d'images relatives au bouddhisme, publie au Japon, cette rivire est appele V^J jjjffi^ Pho li ho. Voici comment Hiuan thsang dcrit le lieu o mourut le Bouddha Shkya mouni : A trois ou quatre li au nord-ouest de la ville (de Kiu chi na ki lo), on tra verse la rivire A chi to f ti. Prs de son bord occidental est une fort d'arbres So lo. Ces arbres sont une espce de hou; leur corce est d'un blanc verdtre, et leurs feuilles sont trs-luisantes. On en remarque quatre fort beaux, qui sont placs ensemble l'endroit o le Ja la (Tathgata) mourut. Dans une grande chapelle leve cette place, on voit le tableau qui reprsente le Nirvana du Ju la. Il a la tte tourne vers le nord et a l'air de dormir. A ct, il y a une tour btie par le roi A y (As'oka). Les fondations tombent en ruine, mais la tour est encore debout et haute d'environ deux cents toises chinoises. Devant la tour, on a plac une colonne de pierre en mmoire de la mort du Ju la; elle en contient le rcit. On y lit : Bouddha, g de quatre-vingts ans, entra dans le Nirvana minuit, le 15e jour de la lune Fei che khiu (Vasakh). C'est le i 5e jour du 3e mois. Il y a quelques auteurs qui disent que Bouddha entra dans le Nirvana minuit, le 8e jour de la lune Kia la ti kia (Krttik) ; ce serait donc le 8e jour de la 9e lune. Quant l'poque du Nirvana de Bouddha, les collections diffrent clans sa dter mination. Les unes le placent il y a plus de 1200 ans, d'autres plus de i3oo, et d'autres encore il y a plus de 1 5oo ans. Il y en a mme qui assurent qu'il n'y a que 900 ans, et que 1000 ans ne sont pas accomplis depuis cet vnement\ Hiuan thsang crivait vers l'an 6ko de J. C; c'est donc cette anne que se rapportent ces calculs, qui mettent la mort de Shkya mouni en 56o, 660, 860 et mme 36o avant notre re. La lgende chinoise, extraite par Deshauterayes, rapporte la mort de Fo de Ja manire suivante : Fo, g de soixante et dix-neuf ans, aprs avoir entretenu ses disciples et l'assemble de ses auditeurs, la quinzime nuit du second (?) mois, comme ferait un testateur, se coucha sur le ct droit, le dos tourn l'orient, le visage l'occident, la tte au septentrion et les pieds au midi, et il s'teignit. En mme temps plusieurs prodiges apparurent : le soleil et la lune perdirent leur lumire; les habitants des cieux s'crirent en gmissant : O douleur! par quelle fatalit le soleil de la sagesse s'est-il teint ! Faut-il que tout ce qui est se trouve priv d'un bon et vritable pre, et que les cieux perdent l'objet de leur vnration ! Toute l'assemble fondit en larmes; on mit enfin le corps de Fo au cercueil; mais quand on voulut le porter au bcher, il fut impossible de le lever; alors un d'eux s'cria en forme de prire : O Fo ! vous galisez ou identifiez toutes choses, n'admettant aucune diffrence entre elles; vous rendez galement heureux les hommes et les habitants des cieux. Cela dit, le cercueil s'levant de Ini* Piani tian, liv. art. 7, pag. 1 v. et 2. LXXV,
258
FOE
KOU
KL
mme fort haut, entra dans la ville de Kiu chi par la porte occidentale, en sortit par celle de l'orient, rentra par celle du midi, et ressortit par celle du nord; il fit ensuite sept fois le tour de la ville : la voix de Fo se fit entendre du cercueil. Tous les habitants des cieux accoururent la pompe funbre ; tous taient en pleurs ; et cette semaine ainsi passe, on porta le corps de Fo sur un lit magnifique, on le lava d'eau parfume, on l'enveloppa d'une toile et de plusieurs couvertures de prix; ensuite on le remit dans le cercueil, o l'on rpandit des huiles de senteur. On dressa un bcher fort haut de bois odorifrants, sur lequel on posa le cercueil; on mit. ensuite le feu au bcher, mais il s'teignit subitement. A ce prodige, les spectateurs s'crirent douloureusement, et il fallut attendre l'arrive d'un saint homme pour achever la crmonie. Ds qu'il fut arriv,.le cercueil s'ouvrit de lui-mme et livra en spectacle les pieds de Fo environns de mille rayons. Alors on jeta des flambeaux allums sur le bcher, mais le feu n'y prit pas encore. Ce . saint, homme leur fit entendre que ce cercueil ne pouvant tre brl par le feu des trois mondes, plus forte raison il ne pouvait l'tre par un feu matriel. A peine eut-il parl, que le feu pur de la fixe contemplation ($TkjZL,San mc, en sanscrit, Samdhi), sortant de la poitrine de Fo par le milieu du cercueil, en fiamma le bcher, qui au bout de sept jours fut entirement consum. Le feu tant teint, le cercueil parut en son entier, sans mme que la toile et les couver tures de prix dont on avait envelopp le corps eussent t endommages \ M. le docteur de Siebold a publi, clans ses Archives du Japon, la copie rduite d'une clbre image reprsentant le Nirvana (en japonais, Ne fan) de Bouddha, laquelle se conserve dans le temple de Toofk si (Toung fou szu) Miyako. Elle est peinte par le clbre peintre japonais Teo den tsou. On y A^oitShkya mouni, avec ses habits ecclsiastiques, plac sur un catafalque, entre des arbres saints, la tte pose sur une fleur de lotus ; il est entour par une troupe nombreuse d'hommes et d'animaux, parmi lesquels rgne une tristesse gnrale; on y voit la douleur exprime sur toutes les figures. Les disciples et les aptres entourent d'abord le catafalque de leur matre : on les reconnat leurs ttes rases. Les Bodhisattwas ont. des figures et des formes de femmes, et les dieux paraissent avec leurs attributs ordinaires ''. KL. (7) L'illustre du sicle.] En chinois, J- -W< Chi. tsun. Voyez chap. XVI, note 31. (8) Entra dans le Ni houan.] Il y a ici dans le texte, comme dans plusieurs autres endroits, les mots "Vj3V^Jjjl? Pan ni houan, que M. Abel Rmusat a toujours transcrits comme tant identiques avec l'expression sanscrite pari nirvana. J'ai dj fait ' Journal tom. VII, pag. 171 etsuiv. asiatique, Journ.asiatique, tom. V,pag. i4i. aussi Nouv. Yovez " Panthon vonJapon,dansle Nippon Archiv. 3elivraison,pag. 42, pi. 4.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIV.
259
observer, la page 80, que cette phrase chinoise ne signifiait qu'entrer dans le nirvana, et c'est aussi de cette manire que je l'ai traduite partout o elle se trouve dans la partie du texte du Fo kou ki que je commente. KL. (9) L o Siu po.] Ce nom se trouve aussi crit Siu p tho lo. Hiuan thsang le rend par Sou p tho lo (en sanscrit, QT^Soubhadra), et le traduit en chinois par Chen hian, c'est--dire le bon sage ; c'tait un matre des Brahmans qui atteignit d'A nan et des autres disciples de l'ge de cent vingt ans : il tait contemporain KL. Shkya mouni, dont il adopta la doctrine a. (10) Pendant sept jours.] Voyez la note 6 ci-dessus. (11) Le hros au sceptre de diamant.] C'est le Bodhisattwa Vadjrapn'i, ainsi nomm parce qu'il tient la main une espce de sceptre de diamant ou de traits de foudre, qui, dans les livres bouddhistes, est figur de la manire suivante :
est traduit en tubtain par Phyoagh na rdor rdzie ou Lagh na rdo rdzie, c'est--dire, celui qui tient le sceptre de diamant dans la main. Ptchir ban', qu'ils Les Mongols dfigurent souvent ce nom, en crivant vj^s \^ prononcent Olchir bani. Pallas et Georgi ont fait graver l'image de cette divinitb. Hiuan thsang donne au mme Bodhisattwa le titre de hros de la trace cache dn gnie au sceptre de diamant. Quand celui-ci vit que Fo venait de mourir, il s'cria dans sa douleur : Le Ja la nous quitte ; il rentre dans le grand Nirvana ; il ne nous rendra plus meilleurs, il ne nous protgera plus. La flche empoisonne est entre profondment, le feu de la tristesse lve sa flamme. Il jeta alors son sceptre de diamant (ou le pilon d'or de F hian), et dans son dsespoir extrme, il se roula longtemps par terre; puis il se leva, et plein de douleur et de compassion, il dit : Dans la vaste mer de la naissance et de la mort, qui sera notre barque et notre rame? Dans l'obscurit d'une longue nuit, qui sera notre lampe et notre mche0? Voyez aussi chap. XVII, note 17, pag. i4o. ou BodhisatVadjrapn'i est le second de la srie des cinq Dhyni Bodhisattwas twas du cield. KL. Piani tian, liv. LXXVII,art. 7, pag. 2 v. h tom. II, Pallas, Mongolische Vlkerschaften, tab. , Tibetanum, Alphabcinni pi. g, fig. 6. Georgi, fig. ad pag. 281. c Piani tian, liv. LXXVII,art. 7, pag.3 a h. 'l On trouve dans les l'imagede ce Bodhisattwa et dans les tom. XVI, pag. /1/12, siatic Researchcs, lom. fi, pi. ?.. Asialic Socicly, Proccedings of theRoyal
Le nom de ce Bodhisattwa
240
FOE
KOUE
KL
(12) O les huit rois partagrent les che li.] Voici ce qu'on lit ce sujet dans la seconde partie du Ni pan king. Quand Shkya Tathgata eut accompli son Tchha phi dans la ville de Kia chi, tous les tats levrent des troupes pour (combustion) enlever de force ses s'rra ou reliques. Il y eut alors un Brahman qui arrta les combattants et qui partagea ces reliques en huit parties, pour que les huit royaumes pussent les honorer en levant des tours. i Les braves de la ville de Kiu chi eurent une part des s'rra; ils levrent au milieu de leur pays une tour pour y faire des offrandes. 20 Les laques (en sanscrit Oupsika, en chinois Ly seng) du royaume de Pho kian lo pho obtinrent une autre part de ces reliques, avec laquelle dans leur pays, o ils levrent une tour pour les vnrer. ils retournrent 3 Les Kiu leou lo du royaume de Szu kia na pho, de mme. k Tous les Kshatryas du royaume de A le tche, de mme. 5 Tous les Brahmans du royaume de Phi neou, de mme. 6 Tous les Li tchhe du royaume de Phi li (Phi che li), de mme. 70 Tous les Shkyas du royaume de Tche lo kia lo, de mme. 8 Le roi A tche chi du royaume de Mo kia tho, de mme \ KL. (13) Vingt yeou yan. ] Environ vingt-huit lieues. KL.
( 1 k) O les Li tchhe voulurent suivre Fo quand il entra dans le Ni houan. ] Il y a dans l'original : A >i VL t \% % #il it
M. Abel Rmusat avait traduit ce passage : au lieu o Tchu tchhe li voulut suivre Fo clans son Pan ni houan; mais il s'agit ici des habitants de la ville de Phi che li (Vas'li), lesquels formaient une rpublique et s'appelaient en sanscrit Litchtchiwi, ou Li tchhe dans la transcription chinoise. Tchu Li tchhe signifie donc tous les Litchtchiwi ou la runion des Li tchhe. Cette mme expression se trouve aussi employe dans le Ai pan king, lieou fenh, propos du partage des reliques de Fo entre les huit royaumes. La ville de Vas'li y est nomme par abrg Phi li; et tous les Li tchtchiwi ( Jj J^'g-g tchu Li tchhe) de cette ville eurent leur part des reliques,
ainsi que ~4^- 7^'gis tchu Ly szu, tous les laques de Kiu chi, %]] *ffittu%!t tchu Tchh ti li, tous les Tchh li li (Kshatryas) du royaume SA le tche, et " Il *rv.^3r w ^m ^ ^ men> tous ^es Brahmans de Phi neou. On voit que dans toutes ces phrases, l'adjectif -fefe tchu (tous) ne fait pas partie des noms pro-
h Ni pan king,Ileoufen, cit dans le San tsang f sou, liv. XXXI,pag. 4-5. Citdans le San tsang J'sou, liv.XXXI,pag. liv.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIV.
241
prs. Nous verrons encore, dans le chapitre XXVI, tous les Li tchhe poursuivre A nan, au moment o il veut entrer dans le Nirvana. KL. (15) Fo tira un pronostic heureux de sa marmite.] Voyez chap. XXXI, note 3, lettre F.Dans un Abrg de la doctrine du Bouddha Gautama, crit en langue singalaise et publi par M. Upham, on lit: Il (Bouddha) tait assis prs de la ri vire Nirandjara, o il partagea le riz en quarante-neuf boules, qu'il mangea. Il jeta alors le bassin d'or dont il s'tait servi dans la rivire, en pensant que si ce bassin nageait contre le courant, il parviendrait enfin lui-mme l'tat de Bouddha. Le miracle eut lieu en effet, et il se remit en route avec une nouvelle ardeur 5. KL. (16) Pour dtailler tous ces vnements de la vie de Shkya mouni, il faudrait avoir une biographie complte de ce Bouddha, et c'est ce qui nous manque Paris. KL. ' Sacredand historical books vol. III, pag. 12/1. of Ceylon,
3i
CHAPITRE
XXV.
Tour de la moiti du corps d'A nan. Jardin de la Royaume de Phi che li. femme An pho lo. Lieu o Fo entra dans le Nirvana. Tour des arcs et des armes dposs. A nan ne prie pas Fo de demeurer dans le sicle. Recueil des actions et des prceptes de Fo.
on vient au royaume yeou yan (i) l'orient, deux fort et une chapelle de Phi che li (2). Il y a une grande une des stations de Fo, et on y voit la tour de la tages : c'tait moiti du corps d'A nan (3). Dans cette ville vivait autrefois une femme De l, en faisant cinq nomme midi encore une dans An pho lo (), qui leva une tour Fo ; et actuellement, au trois li de distance, l'ouest de la route, de la ville, on voit An pho lo donna que cette femme de ce dernier Fo fut sur (5). Quand il sortit ses disciples et se tournant droite, avec et qui est le point d'entrer de la ville de Phi che li Fo,
le jardin des stations le Ni houan,
par la porte occidentale, la ville de Phi che li, ici qu'aura lieu la
il jeta ses regards sur ses disciples : C'est et prophtisa en disant dernire de toutes mes actions (6). Les hommes
des temps postrieurs y ont lev une tour. trois h, il y a une tour nomme Au nord-ouest de la ville, arcs et des armes dposs. Ce qui a donn lieu ce nom, c'est que, les Lords d'un qui roi tait du fleuve accoucha
des sur
signe et jeter eut un
jalouse de mauvais dans roi
des femmes infrieures Hencj (7), il arriva qu'une d'une houle de chair. La premire du roi, pouse de l'autre, dit : Ce que tu as mis au monde est un de bois
On le fit mettre dans un coffre augure. le fleuve le fil de l'eau LIeng : le coffre suivit
ses regards, vit le coffre qui, en promenant il l'ouvrit de l'eau; et y aperut mille enfants extrmement petits Le roi les recueillit bien conforms. et les leva. Par la suite, tant devenus grands, ils furent forts et valeureux; et tout
(8). Il y la surface
ce qu'ils
CHAPITRE voulaient ne pouvant attaquer, Ils en vinrent mettre. attaquer ci en fut constern. Sa femme sujet de sa tristesse. trs-vaillants et sans voil vous ce Le roi leur
XXV. rsister, tait
245
de se souoblig le royaume du roi leur pre; celuiinfrieure lui demanda quel tait le
qui cause dsolez pas, mais
: Le roi de tel pays a mille fils rpondit venir attaquer mon royaume ; pairs ; ils veulent mon affliction. La jeune femme : Ne reprit faites construire un pavillon vous me Le roi lev l'orient sur ce placerez fit ce qu'elle di-
de la ville; pavillon, sait; et sur
les ennemis viendront, quand et je me fais fort de les arrter. les leur ennemis adressa furent arrivs, la parole ainsi vous
quand
le pavillon,
la jeune femme, place : Vous tes mes enfants, leur
dit-elle,
venez-vous rvolter et nous faire la pourquoi Qui tes-vous, les ennemis, vous qui dites guerre? rpondirent Alors la jeune femme dit : Si vous ne mre? que vous tes notre me croyez tous la bouche vers moi. Puis pressant avec pas, tendez ses mains cents Les ses jets ennemis, arcs deux de mamelles, lait elle fit sortir dans qui tombrent reconnaissant alors armes; l'un mamelle chaque la bouche de ses mille leur en dignit encore. dpoconsidration de Py tchi Les Honomre, de
cinq fils. srent de
leurs
et leurs
que c'tait et les deux rois, et l'autre la
cet
vnement,
obtinrent
foe (9). Les deux tours de ces Py tchi fo existent la loi, dirent leurs rables des sicles postrieurs qui ont accompli disciples que c'tait le lieu o jadis on avait dpos les arcs et les armes; les hommes ont lev une tour cet venus ensuite l'ayant appris, endroit, mille des trois dmons rer dans A trois ans aprs Fo arcs mois et c'est
de l que vient son nom. Les mille enfants sont les ct de la tour de Yge des Sages (10). Fo, se trouvant armes il faut A nan, (n). il y a une tour. Cent un mendiant de Phi 3i. dposs, que avertit j'entre A nan, dans par en lui houan. Fo disant Le : Dans roi des le Ni
et des d'ici,
troubla le sicle
et l'empcha
l de prier
de demeu-
ou quatre li l'orient de cet endroit dans le Ni houan, que Fo fut entr
244 che li recueillit ses actions
FOE
KOUE
KL
a rapport aux dix dfenses mmes de Fo. C'est ainsi des paroles de la loi, en les accompagnant une runion d'Arhans et de menque, dans un temps plus proche, les prceptes et qui taient tous docteurs, en diants, qui tenaient tout sept cents religieux, examinrent de nouveau une tour le trsor des lois (12). Les gens qui vinrent aprs prsent. elle subsiste encore levrent cet endroit;
et tout
ce qui
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXV.
(1) Cinq yeou yan.] Cinq yeou yan oayodjanas
font plus de huit lieues.
(2) Au royaume de Phi che li.] ispL/q^-^lK ^" c^e ^ es* ^a transcription chinoise du nom d'une ville jadis clbre, appele en sanscrit ^Tajlic^ Vas'li (l'Etendue), et dans les livres pli Vesli ou Vesaliya pouri". Les Tubtains ont traduit cette dYang ha djian. Les Mongols lui ont conserv son nom sanscrit et l'appellent u-y 1M i_^gv>_j_i_^a Vas'li balghasoun, la ville de Vas'li. Elle est clbre par le sjour et par les prdications que Shkya mouni y fit. Il y arriva de Maghada, sur l'invitation des Litchtchiwi, habitants de Vas'li, qui avaient un gouvernement rpublicain et taient trs-riches. Hiuan thsang a visit Vas'li; il transcrit ce nom par Fe che li, et dit que ce pays appartenait l'Inde moyenne. Il lui donne 5ooo U de tour. Le sol y est fertile, dit-il, et produit des fleurs, des fruits et des herbes. Il y crot beaucoup de fruits An mou lo et Meou nomination par ^4J '"v\] *-=J -^CH tche. C'est une contre riche; la temprature y est agrable et peu soumise aux variations. Les moeurs y sont douces, et les habitants sont contents de leur heureuse situation. Quant leur croyance, c'est un mlange de faux et de vrai. On y voit plus de cent kia lan ( couvents ) dtruits. Il en reste de trois cinq o il y a fort peu de disciples religieux; ceux-ci ont environ dix chapelles, vivent mls avec les hrtiques, et il parat qu'ils sont en effet leurs complices. La ville de Fe che li est prsent tombe en ruine. Les anciennes fondations ont 60 70 li de circonfrence, habite, et le chteau (Koung tchhing, ville du palais) etc. h KL. en avait k 5. Elle est peu
* Journal theAsiaiic of society of Bcngal,tom. I, pag. 3. Pdrdjiha (manuscritde Laite).histe de villescitesdans l'Jbidluina (communique par
M.E. Burnouf).Proceedings of the RoyalAsiatie tom.III, pag. 60. Society, b Pian itian, liv. LXIV,art. 9, pag. 3.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXV.
245 comment
(3) La moiti du corps d'A nan.] On verra, dans le chapitre suivant, les s'rra ou reliques d'A nan furent partages. KL.
(k) Une femme nomme An pho lo.] Hiuan thsang crit le nom de cette femme An mou lo. "KL. (5) Une des stations de Fo. ] C'est--dire, une place o le Bouddha la loi ses disciples et ses adhrents. KL. (6) La dernire de toutes mes actions. ] L'original chinois porte : i4i Dans son brouillon, M. Rmusat avait traduit ce passage par : c'est un lieu o je reviendrai bien longtemps aprs ceci. Cette version ne me parat pas reprsenter le sens de l'original, puisque Shkya mouni, en profrant ces paroles, allait devenir un Bouddha Tathgata, et que les Tathgatas ne reviennent pas dans le monde qu'ils ont quitt pour toujours en entrant dans le Nirvn'a. Shkya mouni, en profrant ces paroles, ne peut avoir en vue que la dernire et principale action de tous les Bouddhas, celle de mourir pour la dernire fois, et sans tre expos de nouvelles naissances. KL. (y) Le fleuve Heng.] |g Heng est la transcription chinoise du nom du Gange. Hiuan thsang appelle ce fleuve AjfoTjk Khing Ma. KL. (8) Suivit le fil de l'eau.] H y a ici, dans les deux ditions du Fo kou ki que je peux consulter, une faute d'impression, qui n'a pas t non plus corrige par les rdacteurs du Pian i tian. On y lit \f> ^, ne pas couler, au lieu de M? "P> suivre le courant. KL. (g) La dignit de Py tchi fo.] Pratyeka Bouddha. Voyez chap. XIII, pag. 8/t; et chap. XVII, note 3i, pag. i 63. note i3, \r n a enseign
(10) De l'ge des Sages.] En chinois -gfyJT- Hian ki, et en sanscrit VJ^^lT Bhadrakalpa, l'poque des Sages vertueux. Selon la cosmogonie des Bouddhistes, les systmes du monde qui se suivent dans des naissances et des destructions perptuelles, prennent leur origine au second Dhyna, dans le kalpa ou l'poque de la fondation- La formation successive des diffrentes rgions du monde occupe un kalpa intermdiaire, ou la vingtime partie du kalpa de la fondation. Ce n'est que quand toutes ces formations, depuis les rgions des dieux jusqu' la superficie de la terre
246
FOE
KOUE
KL
et jusqu'au mont Soumerou, sont acheves, qu'elles sont peuples par des tres qui sortent de la troisime rgion du second Dhyna, laquelle est la plus leve. Cette population dure pendant dix-neuf kalpas intermdiaires, jusqu' l'origine des rgions infernales et jusqu'au temps o l'ge des hommes, d'abord compos d'annes innombrables, est rduit 80,000 ans. Alors commence la seconde poque, qui est le kalpa de l'habitation ou de la stabilit. Pendant ce kalpa, mille Bouddhas doivent paratre, pour renouveler tour tour la doctrine bouddhique, et c'est pour cette raison qu'il est appel Bhadrakalpa ou le kalpa des Sages vertueux. Le premier kalpa intermdiaire dure jusqu' ce que l'ge des hommes, de 80,000 ans soit rduit la dure de 1 o ans ; alors succde le second kalpa intermdiaire, dans lequel l'ge des hommes remonte derechef 80,000 ans. Cette mme marche se succde encore pendant dix-sept kalpas intermdiaires, et alors finit le grand kalpa. Le kalpa dans lequel nous vivons, est un Bhadrakalpa ou kalpa des Sages vertueux. On a imprim la Chine une liste, en langues sanscrite, tubtaine, mandchou, mongole et chinoise, des mille Bouddhas de ce kalpa, dont quatre ont dj paru. Une liste semblable se trouve clans le Mah yna sotra Bhadra kalpngga, qui a t traduit en mongol. M. I. J. Schmidt a extrait de ces deux ouvrages la liste des mille Bouddhas en sanscrit \ KL. (11) De demeurer dans le sicle.] Voici comment Hiuan thsang rapporte cet vnement, d'aprs la lgende. A ct du jardin d'An mou lo, dit-il, est une tour leve l'endroit o Fo annona son Nirvana. Fo se trouvant autrefois ici, dit A nan : Celui qui a approfondi la cause primitive des quatre espces de proprits surnaturelles 1, ne peut rester pendant un kalpa entier dans ce monde. A prsent j'ai accompli cet ge; combien de temps dois-je rester encore dans le monde? Il rpta trois fois cette question; mais A nan ne rpondit pas, car le Mra cleste avait offusqu sa raison. A nan se leva alors de son sige, et se retira dans la fort pour y mditer en silence. Le prince des Mra se rendit auprs de Fo, et lui dit : Il y a bien longtemps que le Ju la est dans le monde ! il y a dj autant d'tres convertis et sauvs, qu'il y a de grains de sable dans la poussire. A pr sent le Bouddha est dans un ge assez avanc, de sorte qu'il serait bon qu'il entrt dans le Nirvana. Le Vnrable du sicle prit aloi's un peu de terre, la plaa sur l'ongle de son doigt, et dit au Mra : Y a-t-il plus de terre dans toute la plaine terrestre que sur mon ongle ? Le Mra rpondit : Il y a plus de terre dans toute la plaine terrestre. Alors Bouddha dit : Le nombre des tres que j'ai convertis et sauvs est comparable au peu de terre qui est sur mon ongle, tandis que le nombre de ceux qui ne sont pas convertis ressemble toute la masse de la terre. c Ueber dieTausendBuddhas,mmoirelu l'Acadmie des sciencesde Saint-Ptersbourg, le 10 octobre h i832. En sanscrit, 3df^ Rddhi.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXV.
247
Cependant, ajouta-t-il, dans trois mois d'ici j'entrerai dans le Nirvn'a. Le prince des Mra, ayant entendu ces paroles, s'en alla content, et se retira dans son sjour ordinaire. A nan tant dans la fort, rva qu'il voyait un grand arbre, dont les branches tendues taient charges d'un beau feuillage touffu, sous lequel on jouissait d'un ombrage agrable. Tout coup un vent pouvantable s'leva, dracina l'arbre et en dispersa les dbris. A nan pensa alors : Le Vnrable du sicle voudrait-il entrer dans le Nirvn'a? Mon coeur le craint. Il alla donc questionner Fo, qui lui dit : Je t'en avais averti dj, mais tu tais obscurci par le Mra. Il n'y a pas longtemps que le roi des Mra m'a quitt, et que je lui ai promis d'entrer bientt dans le Nirvn'a. Voil tout ce que t'a annonc ton rvea. Les JTR, Mra, en chinois W Mo, en tubtain ^J^A Dhoudh, en mongol s^-v Simnou ou Chimnou, et en mandchou U^-K. Ari, sont des dmons puissants, qui habitent le ciel Paranirmitavas'avartit (qui exerce un pouvoir sur les mtamorphoses au-dessous du premier ciel produites par d'autres). Ce ciel est plac immdiatement du premier Dhy na ; il est le quatrime au-dessus du Trayastrins', ou des trente-trois, habit par Indra et les gnies soumis sa direction. Les Mra rgnent donc sur tous les six cieux du monde des dsirs. Le chef des Mra est galement nomm Mra en sanscrit, et Mo ivang en chinois. C'est le Kma ou le dieu de la volupt des Hindous. Les Mra sont les plus redoutables ennemis de Bouddha et de sa doctrine, qui de chercher vaincre la sensualit par tous les moyens prescrit principalement possibles ; aussi emploient-ils une foule de moyens pernicieux pour empcher les hommes de suivre cette doctrine. Dans ce but, ils prennent souvent des formes humaines, et paraissent dans le monde comme philosophes hrtiques, sducteurs et tyrans. Shkya mouni lui-mme eut beaucoup souffrir de leurs perscutions ; et son oncle Dvadatta, qui chercha le contrarier de toutes les manires, est regard comme une manation des Mra. La dure de la vie du roi de ces dmons gale environ dix mille millions d'annes humaines ; car mille six cents de ces dernires ne font qu'un jour de sa vie; et il vit dix-huit mille de ces annes. Il porte le titre joyeux (en tubtain Rab ivang phyough ou Rab vaugtchouk, et en mongol Machi baya souktchi ergheto). Malgr toute l'opposition des Mra contre Bouddha et sa doctrine, ils n'en sont pourtant pas les vritables ennemis; et en agissant ainsi, ils en font d'autant plus clater la gloire et l'excellence. KL. du Trs-Puissant (12) Examinrent ie nouveau le trsor des lois] D'aprs l'Histoire mongole de Sanang Setsen, la premire rdaction des paroles et des doctrines du Bouddha Shkya mouni remonte au temps de Margas'ira (Bimbasr), roi de Magadha. A cette poque les " Pian i tian, descriptiondu royaumede Phi cheli, liv.LXVI, art. 9, pag. 0.
248
FOE
KOUE
KL
trois chefs du clerg, Ananda, Tchiliola Aktchi, Ks'yapa, et cinq cents Arhans, se runirent Vimaladjana-in koundi, et recueillirent les paroles du Bouddha relatives au premier principe de sa doctrine, la connaissance des quatre vrits. Cent dix ans aprs l'anne qui suivit celle du Nirvn'a de Shkya mouni, quand le roi Ghasalang oughe Nom-un khaghan (As'oka), fils du roi Arban tergheto, tait matre des dons de la religion, sept cents Arhans se runirent dans la grande ville de Vas'li, et, sous la prsidence du religieux Teglder amourliksan, recueillirent la collection des paroles relatives au principe moyen de la doctrine, la nullit de tout ce qui est. Ce Ghasalang oughe Nom-un khaghan renferma, dans la collection des paroles et des images du Glorieux, un grand nombre d'objets propres difier l'esprit. Trois cents ans aprs l'anne qui suivit celle du Nirvn'a de Shkya mouni, et quand Kanika, roi de Gatchou ( ^rj> dans le texte, et Gatchi dans la traduction), tait matre des dons de la religion, il arriva qu'une manation du Simnou (Mra), nomme Mha dvaa, se fit religieux dans le couvent de Djalandhara, dans le royaume de Gatchiin kunas'ana, et mla la khoubilghan). Ceci fut cause que cents Pan'ditas se runirent sous des paroles relatives au dernier finale 11.Cette dernire collection surnaturelles religion des mtamorphoses (Rddhi cinq cents Bodhisattwas, cinq cents Arhans et cinq la prsidence de Vichnoumitra, et firent la collection principe de la doctrine, qui en est la conclusion contient principalement les Dhrans ou formules
de conjuration, etc. Le chastir Tchirkola Kereglektchi, traduit en mongol et cit dans les notes de M. Schmidt (pag. 315), contient la notice suivante sur ces trois collections des paroles et des doctrines de Bouddha : La premire collection, dit-il, fut faite dans l't de l'anne qui suivit celle dans laquelle Bouddha tait entr dans le Nirvn'a, la source de la rivire Routa, o Ananda et cinq cents autres Arhans recueillirent les premires paroles. La collection des paroles moyennes eut lieu cent dix ans aprs l'entre de Bouddha dans le Nirvn'a, quand Ghasalang oughe Nom-un khan, du royaume d'Aghodoughar, tait matre de la religion. Elle fut faite par Amour liksan et sept cents autres Arhans, qui recueillirent les paroles moyennes de Bouddha. Trois cents ans aprs l'entre de Bouddha dans le Nirvn'a, et l'poque o Kanika tait matre des dons de la religion, cinq cents Bodhisattwas et cinq cents u Arhans, runis sous la prsidence de Vichnoumitra, dans le couvent de Djalandri du royaume de Kechmeri (Kachimir), recueillirent les dernires paroles du Bouddha. A cette poque, on distribua toutes les paroles de Bouddha dans des livres, et on * Danssa relation, Hiuan thsangrapporteque le roiKia ni se Ida,du royaumede Kiantholo (Gandhale mmeque Kara), lequel estvraisemblablement ou Gatchi,chez. M. Schmidt, nika, roi de Gatchou vivaitquatre cents ans aprsle Nirvn'ade Shkya j maisle mmeauteur ne place Mha dvaque cent ans aprscet vnement,sousle rgned'As'oka,roi Voy.Pian i tian, liv. LUI, pag. 6. de Maghada. 1 Geschichte der Ost-Mongolen, traducComparez tion de M. I. J. Schmidt, pag. 16 et 17.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXV.
249
adopta, comme sa vritable et infaillible doctrine, quatre grandes sections, qui contiennent dix-huit subdivisions. La premire grande section se compose de sept, la seconde de trois, la troisime aussi de trois, et la quatrime de cinq de ces subdivisions. Les trois collecteurs des livres, aprs la mort de Bouddha, taient Ananda, Oapali et Ks'yapa. A nan, dit le Fou f thsang ynyuan king, signifie en sanscrit jubilation, ajoie. Il tait fils du roi Ho fan wang. Il naquit le jour mme o le Bouddha atteignit le suprme degr de l'Intelligence. Comme, cette poque, tout le royaume tait dans la plus parfaite allgresse, A nan reut ce nom. Il suivit le embrassa la vie d'ermite et obtint le degr d'Arhan. Il est le preBouddha, mier parmi ceux qui ont entendu beaucoup (Voyez chap. XII, note 2, pag. 78); c'est pourquoi il fut le mieux en tat de recueillir le trsor de la loi. Aprs la mort du Tathgatha, lui et Mandjous'ri runirent une grande assemble dans la Montagne de lenceinle de fer et en d'autres endroits, o ils recueillirent le trsor des Sotras. Oupali signifie en sanscrit n par mtamorphose; mais on interprte (( aussi ce nom par tte suprieure, parce que ce fut lui qui reut le mieux les prci ceptes; et comme il connaissait le mieux les vnements, il runit, aprs la mort du Tathgata, cinq cents hommes pieux dans la caverne de Pipho lo ( de l'arbre de Photi ), et recueillit avec eux les Vinayas. Kas'ypa signifie en sanscrit splen deur bue. On dit que son corps tait resplendissant et clatant et .qu'il avait la pro pritde rflchir les autres objets; aprs la mort du Tathgata, il runit une grande assemble dans la caverne de Pipho lo et en d'autres endroits, o il recueillit les Abi dharmas ". Hiuan thsang rapporte que les sages chargs de former la collection appele San tsang, ou les Trois trsors, recueillirent d'abord les cent mille s'ikas ou doubles vers des Sotras de Shkya mouni, puis les cent mille s'ikas des Vinayas, et enfin les cent mille s'ikas des Abhidharmas; en tout trois cent mille s'ikas, contenant six millions six cent mille motsb. KL. * b Foufthsangynyuanking,citda.nsleSantsang f sou, liv. XI, pag. 7. Piani tian, liv. LUI, pag. 10.
32
CHAPITRE
XXVI.
Runion des cinq rivires. Nirvn'a d'A nan. Sa mort au milieu du fleuve.
A quatre yeou yan de l (i), on vient la Runion des cinq rivires (2). A nan se rendant du royaume de Mo ki vers Phi che li (3), dans l'intention d'entrer dans le Niphan, les dieux en avertirent le roi A tche chi (4). Celui-ci, plein ses troupes sur ses traces, du fleuve (5). Tous les Li tchhe de Phi che li (6), ayant appris la venue d'A nan, vinrent tant au fleuve, A nan rflchit aussi sa rencontre. Tous arrivs A tche chi l'atteindrait; que s'il allait en avant, que s'il resur ses pas, il aurait encore les Li tchhe sur ses traces. Dans du fleuve. son indignation, il se brla au milieu La flamme du san et pensa tournait me (7) consuma fut son corps, et il entra dans le Ni houan. Son fut porte en deux parties ; chaque sur partag partie et de cette manire les deux rois (8) eurent chacun la moiti rives, des che li du corps. Ils s'en retournrent et levrent des tours (9). corps l'une des de diligence, marcha et arriva sur les bords la tte de toutes
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVI.
(1) Quatre yeou yan.] Environ
cinq lieues et demie.
(2) La runion des cinq rivires.] F hian avait pass le Hi lian ou Gandki avant d'arriver Phi che li ou Vas'li, car cette ville tait situe quelques li l'est de la rivire. De Vas'li il suivit la gauche du Gandk jusqu' son embouchure clans le Gange. Cette embouchure est l'ouest de la ville actuelle de Hadjipour, et au nord de celle de Patna. Depuis l'entre du Sone dans la droite du Gange jusqu'audessous de Patna, plusieurs autres rivires se jettent du mme ct dans ce fleuve, de sorte qu'il est vraisemblable que tout le pays dans ce voisinage a port autrefois le nom des Cinq embouchures. KL.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVI.
251
(3) De Mo ki vers Phi che li.] A nan venait du royaume de Magadha, situ au sud du Gange ; il avait pass ce fleuve et allait se rendre Vas'li pour y entrer dans le Nirvn'a, vraisemblablement la mme place o Bouddha avait quitt ce monde. KL. (k) Avertirent le roi A. tche chi. ] -W- fin f$A tche chi, ou plutt A tcha chi, transcription d'un mot sanscrit qui, d'aprs la dernire section du Ni phan signifie celui qui n'engendre pas de haine ou ne se fait pas d'ennemisa. Hiuan thsang le nom de ce prince A tot to ch to louh, et dit que A tche chi en est l'ancienne nonciation est la king, crit pro-
C'est le sanscrit %)siIclaj=i Adjlas'alrou (qui corrompue et contracte'. n'engendre pas de haine). C'tait un roi de Magadha qui vivait vers l'an 868 avant notre re, car c'est cette anne que la chronologie japonaise et chinoise Wa han kw tfen nengakf oun-no tsou rapporte la mort d'A nan ou Ananda, c'est--dire l'anne Q^ ^CC, qui est l'a 3oe du xxxe cycle sexagnaire, et la 11 du roi Li wanq en Chine. Ananda aurait donc vcu cent trente ans, puisqu'il vint au monde dans l'anne o Shkya mouni obtint la dignit de Bouddha, c'est--dire l'an 998 avant notre re. KL. (5) Sur les bords du fleuve. ] C'est le Gange qui est nomm ici le fleuve par excellence. KL. (6) Tous les Li tchhe de Phi che li. ] Voyez l'explication note 1/1 du chapitre XXIV, pag. 2/40. de ce terme dans la
(7) La flamme du san me.] Les corps des Bouddhas, des Bodhisattwas et des autres personnes qui, selon la croyance bouddhiste, ont joui d'un haut degr de saintet, sont censs ne pas pouvoir tre consums par la flamme naturelle, mais seulement par celle du ^m Rf samdhi (ou, transcrit la chinoise, san me), c'est--dire de la plus profonde mditation religieuse, laquelle sort alors du corps du dfunt et le consume pour le reproduire dans toute la beaut chap. XXTV, note 6, pag. 238. KL. dont il tait orn pendant sa vie. Voyez
(8) Les deux rois. ] Il parat que quoique les habitants de Vas'li eussent une forme de gouvernement rpublicaine, ils avaient pourtant aussi un roi. Les deux ' Ni phanking,Heoufen,citdansleSanisangf sou,liv. XXXI,pag. 4. !l Le secondcaractrede ce nomest -Si , synotoen ",il se prononceordinairement nymede f}-3 chinois; mais dansla transcriptiondes mots sansla syllabe crits, il estsouvent employ pour exprimer tche,prononciation primitivedu groupe -TST,qui entre danssa composition. c Pian i tian, liv. LXV, pag. 53. 32.
252
FO
KOU
KL et celui qui tait le chef de
rois de notre texte sont donc A tche chi de Magadha, l'tat des Li tchhe ou Litchtchewi de Vas'li. KL.
(9) Et levrent des tours.] Il a dj t question d'une de ces tours, qui contenait la moiti des reliques d'Ananda, appartenant la ville de Vas'li. Voy. chap. XXV, note 3, pag. 2 45. KL.
CHAPITRE
XXVII.
Royaume de Mo ki thi. Ville de Pa lian fou. Mont Khi tche ki. Montagne leve par les gnies. Fte pour l'anniversaire de la naissance de Fo. Hospices. Empreinte du pied de Fo. Inscription. Ville de Ni li.
d'un yeou yan (i), on arrive au royaume de Pa lian fou (3). Cette ville tait la capitale du roi A y. Les palais du roi qui sont dans la ville, ont des murailles dont les pierres ont t rassembles par les gnies. Les gravures et les sculptures les fentres, sont qui ornent l'espace de Mo ki thi (2) et la ville ce que le sicle ne saurait faire : elles existent encore actuellement. Le frre cadet du roi A y (4), ayant obtenu le degr de doctrine vivait constamment dans les monts Khi tche ki (5), o il se d'Arhan, dans le loisir et dans le repos. Le roi, qui le vnrait, le pria plaisait de venir le culte divin dans son palais ; mais le prince, pratiquer charm du sjour des montagnes, refusa d'accepter cette tranquille invitation. Le roi dit alors son frre cadet : Acceptez seulement mon invitation, et je ferai lever pour vous une montagne dans la ville. leur vous sent. pierre finie, pierre, carres, et haute grande Le dit fit apporter : Acceptez tous pas table tous roi boire mon et manger, pour appela demain, fait invitation les gnies mais vous un et ne pr-
En traversant
le fleuve
et en allant
au midi
asseoirez
Le lendemain, qui avait il chargea et de btir
que vous les gnies
ne m'ayez
chacun
ou cinq pas quatre les gnies de construire
chacun une grosse apportrent en carr. Quand l'assemble fut une grande montagne de
au pied de la montagne, avec cinq grandes pierres de trois tchang, large de deux, une maison de pierre, longue Il y avait alors un Brahman d'un de la tchang (6) environ. nomm clair Lo tha szu pho de prudence mi, qui sjournait ; il n'y avait rien dans qu'il
translation,
cette ville ; il tait
et plein
254 ne st moignait il allait fond; toute il se tenait sorte
FO dans
KOU une
KL
le consulter,
Le roi lui tpuret parfaite. le servait comme un matre, et quand d'honneurs, n'osait s'asseoir de lui. Le roi, en signe auprs prit la main ; mais aprs qu'il la lui eut se lava. Durant ans, plus de 'cinquante levs et la confiance dans ce seul place
lui et d'amiti, de respect aussitt le Brhmn prise,
le royaume eut les yeux la loi de Fo, et rpandit Il accrut de sorte que les hrhomme. russir se faire prvaloir (7). tiques ne purent des religieux a fond, ct des tours du roi A y, des [La runion et trs-beaux. H y a aussi des Ma ko yan Seng kia lan (8) trs-levs il y habite en tout entre de la petite translation; six et sept temples On y voit aussi cls collges admirablement btis dans cents religieux. un style majestueux et grave. Les Chamen d'une haute vertu des quatre parties du monde, et les tudiants ces qui dsirent s'instruire dans la Les matres des fils des temples. Wen tchu szu li (9). Dans ce royaume, sont aussi appels haute vertu sont de la grande men d'une tous translation; se rendent tous
philosophie, Brahmans les Cha
les Pi
suivent leur exemple et leur obissent; et (mendiants) ces seng kia lan sont tous du royaume du Milieu (10). ceux qui habitent de ce royaume sont grands; Les villes et les bourgs le peuple y est mais il est compatissant et juste dans ses riche, il aime les discussions, khieou actions. Mao Tous les fait ans, des (11), on pour chars clbrer le huitime roues sur jour de la lune dresse qu'ils quatre soutenus par on lesquels de manire
cinq tages en bambou haute une colonne forment d'une peint dcore attache tour. ensuite avec On la les couvre
des lances,
de plus de deux de tapis de feutre toutes les et du verre aux quatre
tchang blanc,
et qui a l'aspect sur lesquels on clestes, qu'on En haut, on de avec
de images de l'or, de l'argent d'toffe dans debout brode; chacune
divinits de couleur. coins sont
un toit
petites chapelles, des Bodhisattwas ces chars,
desquelles ses cts. Il peut l'un de l'autre
pratiques est un Bouddha assis,
qui diffrent
tous
y avoir environ vingt de pour le faste et pour l'im-
CHAPITRE portance.
XXVII.
255
Ce jour-l toutes les rues de la ville sont couvertes d'hommes On donne des reprsentations on fait thtrales, qui s'y rassemblent. On embellit des tours de force, on joue de la musique. la fte avec des Les Brahmes viennent visiter Fo; les Bouddhas fleurs et des parfums. arrivent nuit selon leur ordre dans la ville et s'arrtent on allume de force des lanternes partout et o on donne des concerts aux reposoirs. A la dans les lieux o on pour clbrer la
tombante, tours
fait des fte.
On s'y rend de toutes des royaumes entretiennent de mdicaments les boiteux, enfin
Maison lins,
les provinces; et les dlgus que les chefs dans la ville, y ont tabli chacun une du bonheur et de la vertu. Les pauvres, les orphetous les malades tout ce dont des provinces ils ont besoin. vont dans ces Les mdecins selon contribue les
maisons, y examinent convenances,
o on leur leurs
donne maladies
; on leur
sert boire
et manger Tout
et on leur
administre
des mdicaments.
les tranquilliser; y ayant dtruit La grande de la ville. tour
ceux qui sont guris s'en vont d'eux-mmes. Le roi A mille autres. sept tours, en leva quatre-vingt-quatre est plus de trois li au sud qui fut faite la premire, cette
des pieds de Fo (12); tour] est l'empreinte on y a bti un temple dont la porte est au nord et tourne vers la tour. Au sud de la tour, il y a une colonne de pierre qui a quatre et trois tchang au moins de hauteur; sur cette cinq tchang de circuit colonne est une inscription qui porte : Le roi A y avait donn le Yan des quatre d'eux pour de cts; il l'a rachet feou thi aux religieux l'argent, et ainsi trois fois (i3). A trois ou quatre cents pas au nord autrefois la ville de Ni U (i4). Au de cette tour, le roi A y btit de pierre galement haute de plus de trois il y a une colonne est plac un lion. Sur cette colonne il y a une tchang, et sur laquelle la fondation de la ville de Nili, la raison qui rappelle inscription centre, qui la fit construire, ainsi que l'anne, le jour et le mois.
Devant
256
FOE
KOU
KI/
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVII.
(i) L'espace d'un yeou yan.] C'est--dire d'une lieue et demie. (2) On arrive au royaume de Mo ki thi.] Le nom de ce royaume est transcrit, par d'autres auteurs chinois, Mo kia tho et Mo ki tho, c'est--dire Magadha. C'est le nom du Bahar mridional, ou de la partie du Bahar situe au sud du Gange. F hian est le premier auteur chinois qui ait fait mention de ce royaume, lequel envoya, l'an 6/17 de J. C, une ambassade l'empereur Ta tsoung de la dynastie des Thang. Suivant la description des pays occidentaux, annexe l'histoire de cette dynastie, il appartient l'Inde du milieu et a cinq mille li de circonfrence. Le sol y est fertile; on y sme et on y qu'on appelle riz lo, qu'on appelle jusqu'au bord du Ce mmoire rcolte diffrentes espces de grains, entre autres une espce de riz des grands hommes. Le roi rside clans la ville de Kiu tche ki lo pou aussi Kiu sou mo phou lo et ville de Po to li tsu, qui s'tend au nord fleuve King kia (Gange).
sur les pays occidentaux sous la grande dynastie des Thang appelle ce royaume Mo ki tho, et lui donne galement cinq mille li de circuit. Il ajoute qu'il avait peu de villes, mais beaucoup de bourgs et de hameaux. L'empereur Kao tsoung de la mme dynastie, lequel rgna entre 65o et 683, envoya Wang yuan ths comme ambassadeur au royaume de Mo ki tho; celui-ci y leva, dans le temple Mo ho phou thi, un monument avec une inscription. Plus tard, l'empereur T tsoung (780-80^) fit faire une inscription pour une cloche, et la prsenta au temple Na lan tho. C'est la dernire mention du Magadha qu'on trouve dans l'histoire chinoise \ Selon la dernire section du Ni phan king, le nom de Mo kia tho ou Magadha signifie en sanscrit excs de bont b. KL. ^a aanf0^ 1 est l'ancienne transcription (3) A la ville de Pa lian fou.] 3fr jJLo* chinoise du nom de la ville de Palibothra, si clbre chez les anciens. Hiuan thsang tchhing, c'est--dire ville (tchhing) du fils de l'appelle $f ~h~ W'<t:f\']/'k Ph to a *SH (l'arbre) Pho ta li. Nous verrons plus bas l'origine de ce nom, qui en sanscrit est m<ifr>i>LMPt'alipoutra, avec la mme signification. Les Chinois ont traduit la dernire moiti de ce nom (poutra, fils) par le caractre -j- tsu, qui signifie la mme chose. Ils ont agi de mme dans d'autres transcriptions sanscrites; c'est ainsi qu'ils expriment le nom de S'rpoutra (en pli, S'riputt), fds du S aras ou S'r, par Clie li b " Pian i tian, liv. LXV, pag. 8 v. et 67. Ni phan king,Heoufen, cit dans le San isangf sou, liv. XXXI, pag. v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVII.
257
tsu, qu'ils crivent aussi Che li fou; et alors le dernier caractre, my fou, reprsente le mot sanscrit poutra et le pli poutt, de mme que dans le Pa lian fou de F hian; car, en dialecte vulgaire, la syllabe/o se prononce fout ou fots. Pa lian fou ou plutt Pa lian fol, Pa lian Quant la transcription pot, elle se d'Arrien et d'Etienne de Byzance; tandis que rapporte singulirement au naA/Ju.S'oSe^ la vritable orthographe sanscrite Pt'alipoutra, qui n'a pas de nasale aprs la syllabe li, se rapproche plus du nom de xiocAiC^ejc que Ptolme et Strabon donnent cette capitale. L'illustre Rennell" a dj suffisamment dmontr que cette ville, qu'Arrien appelle la plus grande de l'Inde, et qu'il place dans le pays des Prasiens, l'embouchure de l'Erannoboas dans le Gange, tait situe dans le voisinage de Patna, et au-dessous du confluent de la rivire S'on a avec le Gange. La rivire S'on a porte en effet les noms Iliran'yabhou (bras d'or) et de f^Iirqs) (^ Hiran'yawha def^u"<H=H<g> (qui roule de l'or). Une de ces deux dnominations a t change par les Grecs en Erannoboas. De plus, Strabon rapporte que Palibothra tait loigne de six mille stades de l'embouchure du Gange, et qu'on comptait cette distance d'aprs la navigation en remontant ce fleuve. C'est pour cette raison que dj Patroclus n'admet que cinq mille stades en ligne directe pour cette distance. Pline la suppose de six cent vingt-huit milles, qui quivalent cinq mille stades. L'ancien emplacement de Patna est un peu plus de deux cent huit lieues, de vingt-cinq au degr, de l'embouchure du Gange , en naviguant sur ce fleuve; mais en ligne droite, et en ngligeant les nombreuses courbes que le cours du Gange dcrit, il n'y a que cent soixante-sept lieues. Les recherches du savant H. H. Wilson ont appuy sur tous les points celles de Rennell. Il est donc inutile de rfuter ici l'hypothse du colonel Wilford, qui croyait que Palibothra tait le Rdjamahal de nos jours, ou d'avoir gard l'opinion de M. W. Franklin, selon lequel cette ancienne capitale de l'Inde se trouvait prs de Bhgalpour. D'ailleurs, le premier a lui-mme reconnu l'erreur de son hypothse. Il avait compos sur ce sujet un mmoire dont sa mort a empch la publication; il y prouve que Pt'alipoutra a d exister dans le voisinage de Patna1'. Le nom de Pt'alipoutra suave olens), donn cette ville, signifies de l'arbre Pt'ali (Bignonia c\ en tubtain riJ N Shya nar ghi bon, fils de (la fleur) s^ u)J\
Skya nar. Le morceau suivant (de 6do de J. C.), que j'extrais des Mmoires sur les pays occidentaux sous les Thang, raconte ainsi l'origine de cette dnomination : Au sud du fleuve Khing kia (Gange) est l'ancienne ville; elle a soixante et dix li de circuit; son emplacement est vide et couvert d'herbes ; on n'y voit que des fonda tions et des ruines. Anciennement, quand l'ge des hommes se composait encore * Memoir a of Mapof Hindoostan, g et suiv. pag. A h Sanskrit Dictionary, byH. H. Wilson, 2edition, pag. 522. Select of theThtre of theHinspcimens dus.Loodon, 1835,vol. II, pag. 136. 33
258
FO
KOUE
KL
d'annes innombrables, elle portait le nom de Kiu sou mo phou lo, c'est--dire, ville du palais des fleurs odorifrantes (c'est le sanscrit '5fytfV(TJ^Kousoumapoura, ville fleu rie"). Le palais royal tait rempli de fleurs, et c'est pour cela que la ville reut ce nom. Quand l'ge des hommes ne fut plus que de mille ans, elle fut appele P7io to li tsu, ville du fils de Photoli, et non pas, comme on crivait autrefois, Pa lian fo. Il y avait alors un Brahman dou de hautes facults et d'un savoir immense. Le nombre de ses disciples montait mille, et il les instruisait dans tout ce qui a rap port aux sciences. Ses disciples, allant un jour se promener, avaient un de leurs compagnons distrait et triste ; les autres lui demandrent pourquoi il tait si afflig. Il leur dit : La plus parfaite beaut et la force qu'on admire sont empches dans leur marche ; les arts acquis pendant des annes et des mois ne sont pas parfaits : c'est ce qui attriste mon coeur. Les autres disciples rpondirent en plaisantant -. Allons, il s'agit d'avoir bientt un fils; il faut donc tcher de te marier. Ainsi nom nions deux d'entre nous qui feront le pre et la mre du garon, et deux qui feront a le pre et la mre de la fille. Ils allrent plus loin , s'assirent sous un arbre Pho to li (msfc^ Pt'ali), et l'appelrent l'arbre du mari de la fille. Ils cueillirent des fruits mrs , puisrent de l'eau limpide, et disposrent tout pour commencer le ritnupc tial. Celui qui reprsentait le pre de la fille s'tant assur que le temps tait favo rable pour l'union, leva une branche fleurie, la prsenta l'lve , et lui dit : Le moment est propice pour le mariage; soyez heureux et ne vous quittez plus. Ces paroles remplirent le coeur de l'lve de joie, et il accepta. Vers le soir, comme il s'agissait de retourner, tout absorb dans ses penses amoureuses il voulut rester. Les autres disciples lui dirent : Ce que nous avons fait n'tait qu'une simple plaisanterie; tu feras mieux de revenir avec nous; la fort est remplie de btes froces qu'il faut craindre, et qui te dchireront. Mais l'lve les quitta et se pro mena prs de l'arbre. Quand la nuit eut rpandu ses ombres, un clat trange claira la plaine; on tendit des cordes pour dresser un beau pavillon avec des rideaux, et tout fut convenablement dispos. Tout coup il vit un vieillard A^n rable qui, appuy sur un bton , vint sa rencontre, ainsi qu'une vieille condui saut une jeune fille. Ces deux personnages vinrent en crmonie le recevoir; le chemin tait rempli de monde; tous avaient de beaux habits, on chantait et on u faisait de la musique. Le vieillard lui montra la jeune fille et lui dit : C'est la nouvelle marie de monsieur. Le banquet, les chants, la musique et les ftes joyeuses durrent pendant sept jours. Les autres disciples qui craignaient que leur camarade ne ft dchir par les btes froces, allrent sa recherche. Ils le trouvrent seul, assis l'ombre de l'arbre. Quand ils furent parvenus jusqu' lui, ils l'invitrent revenir avec eux; mais il refusa et ne les suivit pas. Plus tard il vint lui-mme la ville pour visiter ses parents, et leur raconta ce qui lui tait ' H. H. Wilson'sSanskrit 2edition, pag. 287. Dictionary,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVII.
259
arriv. Tous ceux qui entendirent son histoire en furent tonns. Il conduisit ses amis dans la fort. Ils y virent l'arbre en fleurs et un grand train d'esclaves, de domestiques et de chevaux qui allaient et venaient. Le vieillard vint les re cevoir, et leur fit servir un dner accompagn de musique. Enfin, aprs que le matre de la maison leur eut fait toutes les politesses requises, les amis retour nrent la ville, et racontrent partout ce qu'ils avaient vu. Aprs un an, il naquit ( l'lve) un fils. Il dit alors son pouse : Je dsire maintenant retourner chez moi; ne soyez pas fche de mon dpart, et ne m'empchez pas de m'en aller ; je reviendrai rester avec vous. Sa femme fit part de ce qu'elle venait d'entendre au vieillard cheveux blancs, auquel l'lve dit alors : Pour que l'homme puisse vivre heureux, il est ncessaire qu'il soit clans un lieu habit ; il faut donc l'instant construire des maisons et ne pas penser autre chose. Tous les domestiques se mirent sur-le-champ travailler, et achevrent l'ouvrage en peu de jours: ce fut l'ancienne ville des fleurs odorifrantes, qui reut de ce fils, et parce qu'elle avait t construite par les gnies, le nom de ville du fils du Pho to ti. Cette dnomination devint plus tard celle du royaume". Quoique les notions que le colonel F. Wilford a fait extraire des livres sanscrits par ses pandits, ne soient pas l'abri du soupon de falsification, je ne veux pourtant pas omettre de rapporter ici ce qu'il dit sur Ptali poutra et la signification de ce nom. Kousouma poura fut, d'aprs le Bramn'da, btie par le roi Oudasi, grandpre de Mha Bali (nomm aussi Nanda et Mhapadma). Kousouma poura signifie la ville fleurie, et elle fut encore appele Padmavati, la ville du lotus. Selon la tradition, son ancien emplacement tait Phoulwri, dont le nom a, clans les dialectes parls, la mme signification que Kousouma poura. Cependant le Gange ayant chang de lit, cette ville fut peu peu transporte de Phoulwri au Patna actuel, appel aussi Ptali poutra, d'aprs le fils d'une forme de Dvi, dont elle a pris le nom de Ptali dvi (ou la desse mince). Son fils est ordinairement nomm Ptali poutra, et la ville Ptali poutra poura. Cette tymologie de M. Wilford est cependant insoutenable, parce que le nom de la ville de Pt'ali poutra s'crit rrrjfv^T^" et non pas TTTcTfPT^Ptal poutra. Dans un autre mmoire, le mme capitaine Wilford place Pt'ali poutra ou Koude Patna 1; en quoi il peut parfaitement souma poura dix lieues l'ouest-sud-ouest avoir raison. KL. (k) Le frre cadet du roi A y.] Hiuan thsang dit qu'il c'est--dire, le grand empereur, et qu'il tait de la mme Mo hi yan tho lo est le terme sanscrit ^^Mahendra, mme chose, c'est--dire, le grand puissant ou souverain. s'appelait Mo hi yan tho lo, mre que Ay ou As'oka. qui signifie peu prs la KL.
* Pian i tian, 1. LXV, 911.et suiv. h Asiat. d.Cale. t. IX, p. 36 et 'i-j, et t. V, p. 228. Research, p. 33.
260
FOE
KOUE
KL
(5) Dans le mont Khi tche ki.] Cette montagne, situe dans le royaume de Magadha , et faisant partie de la chane qui traverse le Bahar mridional, depuis l'endroit o le S'on' tourne au nord-est, jusqu' Rdjamahal sur les bords du Gange, sera plus amplement dcrite dans le chapitre XXIX. Elle est nomme Ky ly tholo kiu ta dans la relation de Hiuan thsang. C'est la transcription du terme sanscrit 'J?^? Grdhrakot'a (pic du Vautour). Les Chinois traduisent ce nom par J} W* Tsieou tsieou fung, ou pic du Vautour surnaturel. fung; ils l'appellent aussi JL gT ^.Ling Cette montagne est un des lieux o Shkya mouni a sjourn et prch le plus dans les cartes, le nom de Giddore. Voyez sa longtemps. Elle porte actuellement, position dans l'Esquisse des environs ie Gaya, pi. III. KL. (6) Haute d'un tchang.] Le tchang ou la toise chinoise est d'environ 3m 6o. KL.
(7) Il manquait ici le feuillet 2 5, dans l'exemplaire du Fo kou ki de la Bibliothque du Roi, dont feu M. Rmusat s'est servi pour faire sa traduction; j'ai rempli cette lacune en traduisant le contenu de ce feuillet sur une autre dition du mme ouvrage que M. le professeur Fr. Neumann, Munich, a eu la bont de me KL. communiquer. Ce morceau du texte est renferm entre deux crochets. (8) Des Ma ho yan Seng kia lan.] Ce sont des monastres dont les religieux suivaient les prceptes du Mhayna ou de la grande translation. KL. (9) Sont aussi appels Wen tchu szu li.] Wen tchu szu li est une des transcriptions chinoises du nom de Mahdjous'ri, divinit bouddhique dont il a dj t question clans la note 36 du chapitre XVI. C'est un titre honorifique qu'on donnait aux Brahmans les plus savants a. KL. (10) Sont tous du royaume du Milieu, ] c'est--dire de T<^f^5J Mad'hyads'a (en pli, Madjdjadsa), ou de la rgion centrale de l'Inde. C'est sous cette dnomination qu'tait compris tout le pays situ entre Kouroukchtra au nord, Allahabd au sud, les monts Himalaya l'est, et les monts Vindhya l'ouest. Il renfermait donc les provinces actuelles d'Allahabd, d'Agra, de Dehli, l'Ouie et le Bahar, etc. KL. (11) Le huitime jour ie la lune Mao,] c'est--dire du quatrime mois, car le caractre y y mao est le quatrime des dix signes du cycle de douze. C'est le jour de la naissance du Bouddha Shkya mouni. Cet anniversaire est clbr encore aujourd'hui par tous les Bouddhistes avec la plus grande solennit; il est marqu dans ' Fou fa thsang yun yuan king, cit dans le San tsang f sou,liv. XI, pag. 7.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVII.
261
sa^ni Joar ^e "aT'5~ l'Almanach de la cour de Peking comme g|^_^ iw^^^v^r sance ie Cliy kia wen fo. Les Mongols l'appellent -^-M/(^^^L. Unis sar (la lune de la grce). Les Kalmuks clbrent cette fte depuis le huitime jusqu'au quinzime du premier mois de l't, qui est par consquent le quatrime de l'anne ( Too la, du livre), c'est--dire avant le milieu du mois de mai. KL. (12) Est Tempreinte ies pieds de Fo.] Hiuan thsang vit aussi et dcrivit ces empreintes. Elles avaient un pied huit pouces de long et six pouces de large; les empreintes des deux pieds montraient la figure d'une roue et de dix doigts. On les avait entoures de guirlandes de fleurs et de poissons tachets, qui jetaient beaucoup d'clat quand le temps tait serein et clair. Autrefois, ajoute-t-il, quand le Jou la rsolut d'entrer dans le Nirvn'a, et fut sur le point de marcher vers le nord pour se rendre la ville de Kiu chi na, il regarda encore le royaume de Mo ki tho, ayant les pieds sur cette pierre; puis il dit A nan : Je laisse pour trs-longtemps l'em preinte de ces pieds dans le royaume de Mo ki tho, car je veux m'en aller dans l'anantissement. Cent ans aprs, le roi sans tristesse (As'oka) gouverna le monde et fit construire un palais dans ce lieu. Il fut converti alors par l'assistance des trois prcieux, et devint un serviteur des divinits, ainsi que le furent les rois ses successeurs. Il y tablit sa rsidence, y fit btir une ville, et construisit un difice au-dessus de la pierre de l'empreinte qui tait prs des murs du palais, et qu'il vnrait toujours avec zle. Aprs lui, les rois des autres royaumes voulurent absolument enlever cette pierre; mais une multitude d'ouvriers qu'ils y employrent, ne purent parvenir la remuer. Il n'y a pas longtemps " que le roi Ch chang kia, qui perscuta et A^oulut extirper la loi de Bouddha, voulut aussi dtruire cette pierre et son empreinte sacre; mais aprs qu'il en eut fait effacer les traits, ils reparurent tels qu'ils taient auparavant. U fit alors jeter la pierre dans le Khing kia (Gange ), mais le courant de ce fleuve la rapporta l'ancien endroitb. KL. (I3) Et ainsi trois fois.] Hiuan thsang, qui visita ces lieux environ deux cent vingt ans plus tard, trouva les caractres de cette inscription presque effacs. U dit que son contenu tait peu prs : Le roi sans tristesse, ferme dans sa croyance, a trois fois fait don du Djambou iwpa (de l'Inde) aux prtres de la loi de Bouddha; trois fois il l'a rachet d'eux contre toutes ses perles et tous ses trsors ". KL. (1k) La ville ie Ni li.] Je n'ai trouv nulle autre mention de cette ville, qui doit tre la rsidence mentionne dans la note 12. KL. a Ceci a t crit dans la premiremoitidu vu" sicle. h Piani tian, liv.LXV, pag. i3. Ibid.loc.cit.
CHAPITRE
XXVIII.
des Na lo. Nouvelle ville de la rsidence Montagne du Rocher isol.Hameaux Les royale. cinq Montagnes. Ancienne rsidence du roi Ping cha. Jardin d'An pho lo.
De l,
en allant
au sud-est,
on fait
neuf
montagne du Rocher isol (i). Sur sa cime tourne vers le midi ; Fo s'y tant assis, du khin (3) par les musiciens clestes pincer du Bouddha. deux choses Le seigneur (5), en du dessinant dessins ciel Chy chacune
la petite yeou yan jusqu' est une maison de pierre le roi du ciel Chy (2) y fit Pan tche (k), en l'iionneur sur doigt ce lieu, les quarantesur la pierre il y a aussi on vient aux
l'interrogea avec son Dans
les vestiges de ces un seng kia lan. De l, hameaux Che houan li en allant de Nalo fo, tant
existent
encore.
au sud-ouest (6). C'est retourn dans
d'un yeou yan, l'espace cet endroit que naquit y entra encore.
(8). On y a bti une en faisant De l vers l'occident,
ce village, tour qui existe
Che li Joe (7). aussi dans le Ni
ville de la rsidence
fut construite royale (9). Cette par il y a deux seng kia lan. En sortant roi A tche chi. Au milieu de on arrive, aprs trois cents pas, une tour que porte occidentale, il eut obtenu une partie roi A tche chi leva quand des reliques Fo : elle En est haute, sortant grande, majestueuse de la ville du ct du midi et belle.
un yeou yan, nouvelle ville
on vient
la nouvelle le la le de
et en se dirigeant li quatre dans les cinq Montagnes. au sud, on entre dans une valle qui conduit forment une enceinte Ces cinq montagnes comme les murs d'une ville : c'est Yancienne ville du roi Ping cha (10). De l'est l'ouest elle au sud sept ou huit. L est le lieu peut avoir cinq six li, et du nord la premire fois O pi (n); le o Che li Joe et Mou lian virent pour de feu et servit Fo des lieu o Ni kian tse fit une fosse remplie
NOTES mets empoisonns ayant bu du vin,
SUR
LE
CHAPITRE
XXVIII.
265
(12); et celui voulut
o l'lphant noir faire du mal Fo. les anciens ont
du roi A tche chi (i3),
A l'angle nord-est de la ville, dans le jardin o An pho lo invita cette disciples pour les honorer; La ville est entirement
chapelle Fo et douze cent cinquante de ses subsiste encore. chapelle dserte et inhabite.
lev
une
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVIII.
(1) La petite montagne iu Rocher isol.] En chan. Hiuan thsang appelle cette montagne I^fSTR^T^T Iniras'ilagouh (de la caverne de a des valles profondes remplies de fleurs, de est couronne par deux pics qui s'lvent tout
chinois, jJ4 ,5 ^liL'y^ Siao kou chy Yn tho lo chi lo kiu ho, c'est--dire roches d'Indra). Il rapporte qu'elle bois et de bosquets touffus; sa cime droit". KL.
(2) Le roi iu ciel Chy.] C'est--dire 5T^TS'akra ou Indra, appel aussi j9ti(M S'akrardja ou itlsh"^" S'akradwa, nom qui coiTespond au chinois *&%jL Cliy ti ou ^^^Chythianti.-KL. (3) Fit pincer du khin.] Le khin est une espce de lyre horizontale sept cordes; il y en a de trois grandeurs. On en voit un dessin dans les Mmoires sur les Oiinois, t. VI, pi. k, fig. 2 1 ; et dans le Chou king, publi par Deguignes, pi. i, fig. i. KL. (k) Les musiciens' clestes Pan tche.] Je ne trouve nulle part d'claircissement sur le terme Pan tche. M. Abel Rmusat avait traduit ce passage : le roi du ciel Chy, avec ls musiciens clestes, y fit excuter le Pan tche et pincer du khin. KL. (5) Les quarante-deux choses.] H y a dans l'original le caractre 3f^, qui signifie plutt affaires ; mais comme Indra les dessina sur la pierre, j'ai traduit choses. Hiuan thsang n'est pas non plus clair sur ce point, en disant : Au sud du pic occidental (du mont Indras'ilagouh), dans un prcipice, est un grand difice de pierre ; il est vaste, mais il n'est pas haut. Anciennement, quand le Jou la y eut tabli son sjour, l'empereur du ciel Chy (Indra) dessina quarante-deux affaires douteuses sur la pierre, et pria Fo de les lui expliquer amplement. Ces traits d'Indra sub* Pian i tian,liv. LXV,pag. 64.
264
FOE
KOUE
KL
sistent encore a. Le Szu chy eul tchang king (ou le Livre des quarante-deux paragraphes), le premier ouvrage bouddhique qui ait t traduit du sanscrit en chinois, a reu son titre par allusion cette circonstance. KL. (6) Aux hameaux des Na lo.] On lit dans le texte vjL'S| l? $f- M. Abel Rmusat avait cru que ces quatre caractres formaient un seul nom propre, mais ils signifient hameaux runis des Na lo. Hiuan thsang appelle ce lieu Kia lo pi na kia; car c'est l qu'il place la naissance du vnrable Che li tsu. Il ajoute qu'il y entra aussi dans le Nirvn'a, corps b. KL. et qu'on y leva une tour sous laquelle est plac son
(7) Que naquit Che lifo.] Che li fo (en sanscrit, yj | f^n ^ S'ripoutra) est un des plus fameux disciples de Bouddha; il en a dj t question (chap. XVI, note 19). ^sJ S'ri-bou, fils de (l'oiseau) S'ri, et aussi Il est nomm en tubtain -M IfJ es c\ ~s 2. k-\ yX^ ^ ^ "N ^1 S'radwali-bou, fils du S'radwati. Auparavant il portait ie 4 ~3 2. nom de <j ^NJ Nid rghial, ou le roi du soleil S'ripoutra. Il tait fils d'un Brahman trs-savant. Sa mre vit en songe un homme extraordinaire, revtu d'une cuirasse et tenant la main un pilon de diamant avec lequel il dtruisait toutes les montagnes, l'exception d'une seule devant laquelle il s'humilia. Le pre prit ce songe pour un bon prsage, qui lui promettait un fils d'un grand savoir, lequel dtruirait dans le monde les fausses doctrines et ne serait que le disciple de l'homme par excellence (Bouddha). KL. (8) Entra aussi dans le Ni houan.] On lit dans le livre mongol traduit du sanscrit et intitul Uligerin dala (la Mer des Paraboles) : Quand S'ripoutra apprit que Bouddha avait rsolu d'entrer dans le Nirvn'a, il tomba dans une grande tris tesse, et se dit lui-mme : C'est bien vite et contre toute attente que le Tathgata a pris la rsolution d'entrer dans le Nirvn'a : qui, aprs lui, sera le protecteur et l'gide des mes et des tres envelopps dans les tnbres? Il dit alors Boud dha : Il m'est impossible de voir Bouddha devenir Nirvn'a. Trois fois il rpta ces mots, jusqu' ce que Bouddha lui rpondit: Si tu crois que ton temps est venu, agis selon ta volont, comme tous les khoutoukhtou (en sanscrit nirmm n'kya, incarnations) qui entrent dans le Nirvn'a de la tranquillit. S'ripoutra ayant entendu ces paroles de Bouddha, se mit arranger son habillement; et en faisant cent fois le tour de Bouddha, il rpta un grand nombre de vers en ' Pian i tian, liv. LXV, L pag. 64- Ibid.pag.i 2 v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVIII.
265
l'honneur de celui-ci. Puis il embrassa ses pieds, les posa trois fois sur sa propre tte, joignit les mains et dit : J'ai t trouv digne d'approcher le Bouddha glo rieusement accompli. Il adora alors Bouddha, et se rendit avec son serviteur, le prtre Yonti, Rdjagrha, qui tait sa ville natale. Quand il y fut arriv, il dit au prtre Yonti : Rends-toi dans la ville, dans les faubourgs, au palais du roi et dans les habitations des hauts fonctionnaires et de ceux qui font des aumnes, et dis leur : Le khoutoukhtou S'ripoutra a rsolu d'entrer dans le Nirvn'a, venez et prosternez-vous devant lui. Le prtre Yonti excuta l'ordre de son matre, alla aux lieux indiqus et y porta son message de la manire suivante : Le khou toukhtou S'ripoutra est arriv ici ; si vous voulez le visiter, venez sans dlai. Quand le roi Adjtas'atrou, les dispensateurs d'aumnes, les grands dignitaires, les chefs de l'arme, ainsi que les pres de famille, apprirent ce message, ils fu rent tous remplis de tristesse, et l'esprit accabl de douleur, ils dirent : Ah! que deviendrons-nous, quand le second chef de la loi, le conducteur de tant de cratures, le khoutoukhtou S'ripoutra sera entr dans le Nirvn'a! En grande hte ils se rendirent auprs de lui, s'inclinrent devant sa personne, et dirent: Khoutoukhtou, si tu deviens Nirvn'a, qui sera notre protecteur et celui de tant d'autres cratures? S'ripoutra leur adressa alors les paroles suivantes : Puisque tout est prissable, la fin de tout est la mort. Comme vous appartenez au monde rempli de tourments, vous-mmes vous ne durerez pas longtemps, et la mort viendra finir votre carrire. Mais comme vous tous, en consquence d'ceu vres mritoires antrieures, vous avez eu le bonheur de vous trouver ensemble dans le monde avec Bouddha et d'y reparatre sous la forme humaine, vous de vez accumuler d'autres mrites, et accomplir des oeuvres qui vous sauveront du Sansra. Quand S'ripoutra eut fini de prcher ainsi aux assistants la doctrine de la loi inpuisable, et qu'il eut rjoui leur esprit par des mdecines salutaires, ils s'inclinrent devant le khoutoukhtou, et chacun retourna chez soi. Aprs minuit, S'ripoutra s'assit en prenant une position toute droite, recueillit toutes les facults de son me, les dirigea sur un seul point, et entra dans le premier Dhyna; de l il entra dans le second, de celui-ci dans le troisime, du troisime dans le quatrime. Du quatrime il passa dans le Samdhi des naissances de l'espace cleste sans bornes, puis dans le Samdhi des naissances du nant complet. De ce Sa mdhi il entra dans celui des ni pensant ni non.pensant, puis dans celui de la limitais tion, et del enfin dans le Nirvn'a. il Quand Khourmousda, le roi des dieux, apprit le Nirvn'a de S'ripoutra, vint avec plusieurs centaines de mille personnages de sa suite, portant des fleurs, des parfums et d'autres objets propres aux sacrifices. Ils se rpandirent dans toute l'tendue du ciel; leurs pleurs tombrent comme la pluie; ils jetrent des fleurs qui couvrirent la superficie de la terre, et dirent : Oh! celui dont la sagesse tait comparable la profondeur de la mer, qui avait pass par toutes les portes 34
266
FO
KOUE
KL
du savoir, dont la parole harmonieuse coulait suavement comme une source, qui de soi tait parfait dans l'accomplissement des devoirs, dans la contemplation mme et en toute sagesse, le sublime chef de la doctrine, l'excellent khou toukhtou S'ripoutra s'est trop ht de devenir Nirvn'a. Qui succdera prsent au Bouddha glorieusement accompli et Tathgata, pour rpandre la loi ? Tous les habitants de la ville et des alentours, aussitt qu'ils eurent appris le Nir vn'a de S'ripoutra, vinrent apporter en quantit de|l'huile, des parfums, des fleurs et d'autres objets propres aux sacrifices. Ils firent entendre des lamenta tions et des accents de douleur et de deuil, en posant par terre, avec respect, les choses destines aux sacrifices. Khormousda, le prince des dieux, ordonna alors Vischnoumitra de fabriquer un char avec diffrentes espces de choses pr cieuses, pour le corps de S'ripoutra. Quand le char fut achev, on y plaa le corps de S'ripoutra, dans la position d'un homme assis, et on le transporta dans une belle plaine, pendant que les dieux, les Ngas, les Yakshas, le roi, les chefs de l'arme, les officiers et le peuple entier poussaient des cris de douleur. L, on leva un bcher de bois de tchandana (santal). Aprs l'avoir arros d'huile . et de beurre, on y plaa le corps de S'ripoutra, et on l'alluma. Alors tout le monde s'inclina et chacun se retira chez soi. Quand le feu fut entirement teint, le prtre Yonti recueillit dans les cendres les s'rra de son matre, et les porta Bouddha, ainsi que sonptra (marmite) et ses habits ecclsiastiques. Il dposa ces objets aux pieds de Bouddha, en lui annonant que son matre S'ripoutra tait devenu Nirvn'a. Quand Ananda apprit cette nouvelle de la bouche de Yonti, il s'attrista fortement et dit Bouddha : O Bouddha! le premier de notre runion est devenu Nirvn'a: qui devons-nous nous confier et qui pouvons nous regarder comme notre soleil protecteur? Bouddha lui rpondit : Ananda! quoique S'ripoutra soit devenu Nirvn'a, ni la charge de vos devoirs, ni le Sa mdhi, ni l'intelligence, ni la rdemption plnire, ni le pradjn de la rdemption plnire, ni la nature des proprits caches ne sont devenus Nirvn'a. D'ailleurs, avant un grand nombre de gnrations, S'ripoutra tait dj une fois devenu Nir vn'a avant moi, parce qu'il ne pouvait souffrir de me voir entrer dans le Nir vn'a a. KL. (9) La nouvelle ville de la rsidence royale.] C'est la nouvelle ^T^p^ Rdjagrha (en pli, Rdjagaha), ou rsidence royale. On trouve ce nom transcrit en chinois par jjj)^ ^jj :p| Lo yu khi. Ce fut le roi As'oka qui quitta cette ville et transporta sige de son empire Pt'ali poalra. KL. (10) L'ancienne ville du roi. Ping cha.] C'est l'ancienne ' I. J. SchmidtsUeberdie dritteWeltder Buddhaisten, pag. 17 et suiv. Rdjagrha, le
ou rsidence
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXVIII.
267
10 to tcae ^ '"> orthoroyale. Hiuan thsang l'appelle iZ^ ^'J j$f^ MiMl^ altre, mais dans laquelle le mot sanscrit Rdjagrha graphe vraisemblablement est galement cach, car Hiuan thsang traduit ce nom par ou rsiAs._J_maison dence royalea. Dans le Ayn Akbari, le nom de Rdjagrha est crity^j Rdj-ghir. Le roi Ping cha est Bimbsra. Voyez chap. XXIII, note 5. KL. Virent pour la premire fois Opi.] Je crois que cet O pi est le mme personnage que le bhikchou nomm par Hiuan thsang A chy pho chi (^PSfrTrT As'vdjit, qui va cheval). Il raconte que S'ripoutra rencontra ce religieux dans la ville de Rdjagrha, et que ce fut celui-ci qui l'instruisit dans la loib. KL. (11) (I 2) Servit Fo des mets empoisonns.] Voici comment Hiuan thsang raconte cet vnement : A peu de distance du lieu o Che li fo (S'ripoutra) fut instruit dans la loi, est une grande fosse profonde, ct de laquelle on a lev une tour. C'est l que Chy li khieou to (le beau cach, en sanscrit ;5u^ Srgod'ha), pour faire du mal Fo, creusa une fosse qu'il remplit de feu et servit des mets empoisonns. Ce Chy li khieou to tait attach la croyance des hrtiques et toujours prt faire le mal. 11 invita beaucoup de monde un repas dans sa maison; devant la porte il y avait une grande fosse remplie de feu et recouverte seulement par des btons de bois pourri, sur lesquels il avait jet de la terre sche ; en outre, tous les plats taient empoisonns avec diffrentes espces de poisons, afin que ceux qui viteraient la fosse feu, succombassent en mangeant de ces mets. Les habi tants de la ville, sachant que Chy li khieou to nourrissait une haine implacable contre l'Honorable du sicle, prirent celui-ci instamment de ne pas se rendre chez lui. L'Honorable du sicle leur rpondit : Ne vous attristez pas, le corps d'un Tathgata ne peut tre bless par cela. Il se recommanda eux et partit. Au moment o il mit le pied sur le seuil de la porte, la fosse remplie de feu se changea en un tang clair et limpide comme un miroir, sur lequel flottaient des fleurs de lotus. Quand Chy'li khieou to vit cela, il en fut fch et attrist; cepen dant il dit encore ses disciples : Par son art, il a bien vit la fosse de feu, mais il y a encore les mets empoisonns. Mais l'Honorable du sicle, aprs avoir fini d'en manger, exposa la loi excellente. Chy li khieou to ayant entendu son discours, lui demanda pardon, avoua ses fautes et amenda sa conduite 0. KL. L'lphant noir du roi A tche chi.] Hiuan thsang n'accuse pas le roi A tche chi (ou Adjtas'atroa) de ce forfait; mais il dit que Dvadatta, tant avec ce prince et ses parents et amis, lcha un lphant qu'il avait enivr, dans l'espoir qu'il ferait du mal au Tathgata ; mais celui-ci ne fit qu'un signe avec la main, et sur-le-champ (I3) c h ' Pian i tian, liv. LXV, pag. 56. Ibid.pag. 47- Ibid.pag. 48. 34.
268
FOE
KOUE
KL
il en sortit cinq lions devant lesquels l'lphant ivre devint tranquille et s'humilia '. Une lgende mongole de la vie de Bouddha que j'ai publie, rapporte ce miracle peu prs de la mme manire. Dvadatta, oncle de Shkya mouni, dit cette l gende, lui fit ressentir de nouveau sa haine, en conduisant dans son voisinage un lphant dompt, auquel il fit boire une si grande quantit de vin de cocos qu'il assouvit totalement sa soif. Alors il attacha aux dfenses de cet lphant deux sabres tranchants et lcha l'animal ivre contre Goodam (ou Shkya mouni), croyant que sa rage tournerait contre l'ermite; mais celui-ci ne fit que lever les cinq doigts donna lieu
de sa main, l'lphant le prit pour un lion et s'apaisa. Cet vnement la fondation de la Place sainte de l'lphant furibond et dompt h. " Pianiiian, liv. tom. IV, pag. 22. LXV,pag. 48. ]l Journalasiatique,
CHAPITRE
XXIX.
Pic de Khi tche. Le dmon Phi siun se mtamorphose en vautour. Peur d'A nan. Trne des quatre Bouddhas. Pierre jete contre Fo par Thiao th. Sacrifice de F hian.
En entrant
dans la valle,
et en allant
de quinze li vers le sud-est, on arrive A trois li avant d'avoir atteint le sommet de la montagne, il y a dans les rochers une caverne tourne vers le sud; Fo s'y assit pour y mditer. A trente pas au nord-est, il y a une grotte de pierre ; A nan s'y assit Le dmon du ciel Phi siun (2), mtamorphos en pour y mditer. vautour, s'arrta devant la caverne et lit peur A nan. Fo, surnaturelle le rocher, (3), ouvrit puissance prit A nan par avec la main, et fit cesser sa crainte. La trace de l'oiseau, et le trou par lequel Fo la dnomination existent encore. C'est de l que vient passa sa main, de mont de la caverne du Vautour. Devant la caverne (A). Tous pour les Arhans mditer. avaient par sa le bras
montagnes jusqu'aux au pic de Khi tche(i).
au del
est la place du trne des quatre Bouddhas aussi chacun leur caverne o ils s'asseyaient de ces cavernes est de plusieurs centaines. Fo, dent. tagne, existe dtruite tant Thiao devant th, plac la maison sur qui dans
Le nomhre
de pierre, l'occij)assa de l'orient les sommets escarps au nord de la monhlessa Fo l'orteil (5) : cette pierre la doctrine est qui subsiset majes-
jeta une pierre encore. La salle
; il n'y a que tent encore. Les pics ce sont les plus tueux, Fa fleurs hian ayant
Fo a enseign laquelle les fondations d'un mur en briques de cette montagne sont levs des cinq Montagnes. dans la nouvelle ville,
rguliers
achet,
et des lampes huile, loua deux anciens duire aux grottes et sur le mont Khi tche. Aprs des parfums et des fleurs, les lampes augmentrent
des parfums, des Pi khieou pour le conavoir fait l'offrande La doula clart.
270 leur Fo Cheou et l'motion avait autrefois
FO le touchrent t dans
KOU jusqu'aux cet endroit;
KL larmes que le y avait enseign se rencontrer avec Mais devant une nuit. la ca: il se disait
leng yan (6). F hian n'a pu Fo, il n'a pu que voir les traces de son sjour. verne il rcita le Cheou leng yan, et il y sjourna
qu'il de son vivant
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIX.
(i) On arrive au pic Khi tche.] Le pic Khi tche s'appelle en sanscrit Grdhrakota, c'est--dire le pic du F autour. Il a dj t question de cette montagne dans la note 5 du chapitre XXVII. C'est une de celles qui sont situes environ par 2 5 de lat. N., aux sources des rivires Dahder et Banourah". Par la relation de F hian, on apprend de montagne du Vautour. Cependant d'autres auteurs l'origine de la dnomination bouddhistes prtendent que cette montagne avait reu ce nom cause de sa forme qui reprsente celle d'un vautourb. Le Tathgata, dit Hiuan thsang, quand il eut atteint l'ge de cinquante ans, sjourna beaucoup sur cette montagne et y prcha la loi admirable. KL. (2) Le dmon du ciel Phi siun.] y] \j& Phi siun signifie, selon le Chy kiphou, le mchant, et c'est un des noms de Mra ou du roi des gnies malfaisants 0. En sanscrit, TO^R Pis'ouna. Hiuan thsang rapporte cet vnement de la manire suivante : Devant la mai son de pierre de Bouddha est une pierre plate, et c'est l qu'A nan eut peur du Mra. Le vnrable A nan y tant absorb dans la mditation, le roi des Mra prit la forme d'un vautour; et pendant une nuit qui n'tait pas claire par la lune, il fendit les rochers, tendit ses ailes et poussa des cris effroyables pour pouvanter le Vnrable, qui, en effet, fut saisi d'une peur sans bornes. Le Ta thgala s'en aperut, moyennant son omniscience; d'une manire affable il ten dit sa main, la passa travers le rocher, la posa sur la tte d'A nan, et lui dit : C'est le Mra qui s'est mtamorphos, trs-gracieusement n'ayez pas peur. A nan, en effet, reprit courage et se tranquillisa. On voit encore sur le roc les traces de l'oiseau, et dans la fente du rocher, le trou par lequel a pass (la main de Bouddha) d. KL. the course of the Map of SouthBahar including dans le Bengal Atlasincluding to Chunargur, Gangcs of war,by JamesRennell, n m. maps of thethtre London, 1781. 1 Fan i mingy, cit dans le San tsangf sou, liv.XXIV,pag. 20 v. 0 CitdansleSan sou,liv. XXX,pag. 3o. tsang f d Piani tian, liv. LXV,pag. 4g v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXIX.
271
(3) Par sa puissance surnaturelle.]
Voyez chap. VI, note 6, pag. 32.
(k) La place du trne des quatre Bouddhas, ] c'est--dire de Shkya mouni, Ks'yapa, Kanaka mouni et Krakoutchtchhanda, qui sont ceux qui ont dj paru dans le Bhadra kalpa ou l'poque actuelle du monde. KL. (5) Une pierre qui blessa Fo l'orteil.] Cet vnement est la huitime des neuf tribulations auxquelles le Bouddha Shkya mouni se trouva soumis pour expier des fautes qu'il avait commises dans des gnrations antrieures. Voici comment il raconta lui-mme la cause du coup de pierre que lui lana Thiao th ou Dvadatta : Dans le temps pass, il y avait dans la ville Lo yu khi (Rdjagrha) un grand nomm Siu than. Sa maison tait riche et opulente; son fils se nommait Siu mo thi. Le pre, Siu than, ayant termin ses jours, Siu mo thi, qui avait un frre cadet n d'une autre mre et nomm Siu ye che, ne voulut pas partager son bien avec ce frre cadet. Un jour, il prit la main de ce frre et monta avec lui sur le mont Khi tche khiu (du vautour); tant arriv sur le bord d'un prcipice, il le poussa au fond et jeta des pierres sur lui : le frre cadet termina ainsi ses jours. Fo donna l'explication suivante Che li fo : Le grand, nomm Siu than, c'tait le roi mon pre, P thsing; Siu mo thi, c'tait moi-mme, et Siu u ye che tait Thi pho th to (Dvadatta) d' prsent. C'est par la consquence de mon action antrieure que, marchant sur le bord du mont Khi tche khiu, Thi pho th to dtacha une pierre du prcipice pour me la jeter la tte. Le gnie de la mon tagne dtourna la pierre; un petit bout du bord seulement atteignit mon pied au gros orteil, le blessa et en fit sortir du sang". KL. (6) Le Cheon leng yan. ] Leng yan king est le titre d'un livre qui contient les instructions de Shkya mouni. Le Ta tchi lun dit que Leng yan ou Cheou lengyan signifie en sanscrit les choses qui sont difficiles distinguer l'une de l'autre ( JH il-jy*-^w \OE )h. KL. b f sou, liv. XXX,pag. i5 et 16. Cit Hingkhi hingking,cits dansle San tsang dansleSanisangfsou,liv. XXXIV, pag. 21. * Ta tchitoulunet
CHAPITRE
XXX.
Jardin des bambous de Kia lan tho. Chi mo che na ou le cimetire. Grotte de Pin pho lo. Maison de pierre Tchhe ti. Premire collection des paroles de Fo. Caverne de Thiao th. Pierre noire du Pi khieou.
Il sortit En allant le Jardin
ensuite au nord
de l'ancienne
ville
pour
retourner
la nouvelle.
de trois cents pas, il vit l'ouest de la route l'espace des bamhous de Kia lan tho (i), o l'on avait construit une cha-
des religieux la balayent et l'arrosent. Au nord pelle qui existe encore; de la chapelle, deux ou trois li, est le Chi mo che na. Chi mo che na signifie en chinois, champ des tombeaux o Ton place les motets (2). En traveret en allant l'occident, trois cents sant la montagne mridionale il y a un difice de pierre la grotte de Pin pho lo (3). qu'on appelle s'asseoir en ce lieu pour y Fo, aprs ses repas, venait habituellement mditer. Plus l'ouest, en faisant cinq ou six li, au nord de la monpas, il y a une maison de pierre nomombrag, me Tchhe ti (4) ; c'est le lieu o, aprs le Ni houan de Fo, cinq cents Arhans recueillirent la collection des livres sacrs. Quand ces livres tagne sacrs on dressa trois trnes vides disposs avec magnipublis, ficence : Che li fo tait gauche, et Mou lian tait droite. Parmi les cinq cents Arhans, il n'en manquait seul; c'tait A nan qui, qu'un le grand Kia se (5) monta sur le trne, resta hors de la porte quand sans entrer. On a lev dans ce lieu une tour qui subsiste pouvoir aussi. Au del des montagnes, il y a encore dans le rocher des grottes o les Arhans s'asseyaient et mditaient : elles sont en grand nombre. En sortant de l'ancienne et en descendant du ct du nordville, est durant quante autrefois chissant de pierre de Thiao th (6). A cinli, il y a la caverne Il y eut noire carre. pas de l, il y a une grande pierre un Pi khieou qui, en passant dit en rflpar-dessus, trois : Ce corps n'est pas durable, il est sujet la douleur, vide furent et dans un endroit
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXX.
275
et expos aux souillures. l'ennui et les chagrins de ce Contemplant il tira son poignard et voulut se tuer lui-mme; corps, puis, faisant une nouvelle il se dit : L'Honorable du sicle a tabli en rflexion, prcepte ne doit pas se tuer soi-mme. Il rflchit encore : qu'on en soit, dit-il, je ne veux tuer aujourd'hui Quoi qu'il que trois ennemis mortels; et il se poignarda. il commena ses blessures, il Quand devint Siu tho wan; quand il fut moiti, il devint A na han; quand il se fut tout fait achev, il devint dans Arhan, et entra rellement le Ni houan.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXX.
(i) Le Jardin des bambous de Kia lan tho.] Hiuan thsang rapporte que le Jardin des bambous de Kia lan tho tait situ un li de la porte septentrionale de la ville des Montagnes. De son temps, il y avait une chapelle btie en briques sur une fondation de pierres, et dont la porte tait tourne vers l'est. C'est un lieu o le Tathgata sjourna souvent et enseigna la doctrine, fit des miracles et conduisit tous les tres au salut. On y voyait l'image du Tathgata et celles d'un grand nombre d'autres Tathgatas. Autrefois il y avait dans cette ville un grand nomm Kia lan tho; il tait trs-riche et distribuait des largesses tous les hrtiques dans le Jardin des bambous. Cependant ayant vu le Tathgata et entendu sa doctrine, il se purifia par la foi et cessa d'avoir de la prdilection pour la foule des hrtiques qui habitaient le Jardin des bambous. Alors, avant que l'instituteur des dieux et des hommes ne vnt se servir de cette habitation, les gnies et les dmons, pour rcompenser Kia lan tho, en expulsrent les hrtiques en leur disant : Le chef Kia lan tho veut lever une chapelle pour Bouddha dans le Jardin des bambous, il faut donc vous en aller d'ici pour viter tout malheur. Les hrtiques, quoique en grande colre, furent pourtant obligs d'avaler leur chagrin, et ils quittrent le jardin. Le chef (Kia lan tho) construisit alors une chapelle; et quand elle fut acheve, il alla lui-mme prier le Tathgata de venir en prendre possession a. KL. (2) Champ des tombeaux o l'on place les morts.] Le mot Chi mo che na est la trans KL. cription du sanscrit ^HitJM' S'mas'na, qui signifie cimetire. (3) La grotte de Pin pho lo.] Je suppose que c'est la mme grotte qui est nomme aussi caverne de Pipho lo. Voyez chap. XXV, note 12 , pag. 2A9. KL. ' Pian i.tian, liv. LXV,pag. 52 et 53. 35
274
FOE
KOUE
KL
(k) Une maison de pierre nomme Tchhe ti.] Hiuan thsang ne donne pas le nom de cet difice, mais il dit qu'il tait plac cinq ou six li au sud-ouest du Jardin des bambous, sur le versant septentrional de la montagne et dans une grande fort de bambous. Aprs le Nirvn'a du Tathgata, ajoute-t-il, le vnrable Mah Ks'yapa, avec neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Arhans, y fit la collection des trois trsors a. la note 12 du Voyez, sur cette premire collection des ouvrages bouddhiques, chapitre XXV, pag. 2/17. KL. (5) Quand le grand Kia se. ] Le grand Kia se est Mah Ks'yapa. KL. (6) La caverne de pierre vu, une des orthographes grande maison de pierre, deux ou trois li l'est de de Thiao th.] Thiao th est, comme nous l'avons dj chinoises du nom de Dvadatta. Hiuan thsang place la
o ce personnage clbre se livrait la mditation, la porte septentrionale de la ville des Montagnes, gauche, dans l'ombre de la pente mridionale de la montagne. Dvadatta, qui fut pendant sa vie l'ennemi et le perscuteur du Bouddha Shkya mouni, est regard ordinairement comme une incarnation du Mra ( ou gnie malfaisant). De pareilles incarnations ne servent qu' illustrer et mettre dans tout son jour l'excellence des Bouddhas et de leur doctrine. Un ouvrage mongol ^extrait par M. I. J. Schmidt, dit sur ce sujet : Des gens dont l'esprit est obscurci, croient par erreur et soutiennent que Dvadatta tait un antagoniste, un ennemi et un perscuteur du Bouddha. Si, pendant les cinq cents gnrations durant lesquelles le Bouddha Tathgata suivit le chemin de Bodhisattwa, l'illustre Bogda Dva datta lui fit prouver toute sorte de mal et de contrarit, ce ne fut que pour fortifier l'excellence et les hautes qualits du Bodhisattwa. Aussi ces hommes obscurcis commettent un pch, quand ils soutiennent et veulent faire croire que Dvadatta a t un ennemi et un perscuteur du Bouddha Tathgata ; ils cau sent par de tels discours leur propre renaissance dans les trois rgions des condi tions abjectes (de brutes, de dmons et d'habitants des enfers).L'accumulation des vertus de l'illustre Bogda Dvadatta est trs-grande, et la racine de ses mrites immense ; il a rendu des services extraordinaires beaucoup de Bouddhas, et il a, par ce moyen, contribu au germe de la racine des oeuvres mritoires; il appar tient d'ailleurs ces Mahsattwas qui ont vritablement approfondi les moyens du salut, et il a approch de la dignit d'un Bouddha Tathgata. Ceux qui le re gardent avec haine et aversion, occasionnent par consquent leur propre malciheur et leur renaissance dans les trois rgions des conditions abjectes h. " Piani tian, liv. LXV, h der Ost-Mongolen, pag. 53 v. Geschichte pag. 3i 2.
CHAPITRE
XXXI.
Ville de Kia ye. Lieu o Fo vcut pendant six ans dans les macrations. Lieu o il accomplit la loi. Il est expos aux attaques du dmon. Autres lieux saints. Quatre grandes tours en l'honneur de Fo.
De l, en allant la ville
l'ouest
de Kiaye (2). Cette continuant au midi, et en faisant le Phou est bois. se mit ches loin dans sa vcut pendant De l en allant l'eau
pendant quatre yeou yan. (i), on arrive ville est aussi compltement dserte. En l'endroit o li, on vient vingt dans les macrations (3) : ce lieu on vient au lieu alors o Fo
six ans trois
li l'ouest,
les dieux tinrent pour se baigner; d'arbres et l'en couvrirent sa sortie de l'tang au nord, on vient au lieu o les filles des Fo une du riz au lait (5). De l au nord,
des branli plus "retires li, Fo,
(k). Deux familles deux
offrirent assis sur
sous un grand et tourn vers l'orient, arbre, pierre et la pierre ce riz : l'arbre existent encore ; la pierre mangea peut et de longueur, avoir six pieds de largeur et deux pieds de hauteur. le froid et le chaud le royaume du Milieu, il y a des arbres qui durent plusieurs prs, mme jusqu' dix mille ans. Dans De l en faisant une grotte un demi tant gaux et temmilliers d'annes et
de pierre. s'assit les jambes croises et pensa dans son coeur : Pour l'occident, la loi, il faut que j'aie un tmoignage divin. Ausque j'accomplisse de Fo; elle parut de la pierre se dessina l'ombre sitt sur la paroi tait clair et brillant. Le ciel et la haute de trois pieds, et le temps terre rent furent : Ce n'est trs-mus, et tous les dieux qui taient dans l'espace et venir accomplissent pas ici le lieu o les Fo passs d'un peu plus d'un demi yeou la loi. Au sud-ouest, la distance yan, sous un arbre Pi to (7), est le lieu o les Fo passs et venir 35.
on arrive yeou yan (6) vers le nord-est, Le Phou sa y tant entr, et se tournant vers
di-
276
FOE dieux
KOUE
KL se tinrent parl, le chemin en se retirant. ainsi deLe
la loi. Les accomplissent vant lui, chantrent et lui Phou donna sa se leva;
ayant montrrent
et quand il fut trente Yherhe d'heureux augure (8); le Phou Cinq cents oiseaux bleus et s'envolrent. Le Phou d'heureux trois belles augure filles
pas encore. tour de lui tendit dmons ver, terre
un dieu lui pas de l'arbre, sa la prit et marcha quinze trois fois au(9) vinrent voltiger sa s'avana vers l'arbre Alors Pe to, le roi des
l'herbe
l'orient
et s'assit.
envoya et il vint avec
du nord pour l'prouqui vinrent lui-mme dans ce dessein. Le Phou sa frappa alors la les doigts de ses pieds, et les troupes reculrent du dmon
et se dispersrent : les trois filles furent en vieilles (10). Il changes s'tait impos pendant six ans les plus grandes Dans tous macrations. ces lieux, les hommes des temps postrieurs et ont bti des tours dress des images qui subsistent Dans le lieu o Fo, ayant l'arbre o et obtint il passa prsent. la loi, resta sept jours accompli la joie de l'extrme batitude ternelle; Pe encore
contempler dans celui
to se promener d'occident en orient; des ayant cr l'difice servirent Fo pendant dans cesept maisons prcieuses, sept jours; lui o un dragon cailles brillantes Fo pen(n) entoura aveugle dant sept jours; dans celui o Fo, tant assis sous un arbre Ni kiu li, et sur vint une pierre carre, (12) ; dans dans celui tourn celui du ct de l'orient, rois cents o le dieu lui Brahma offrirent lui le prier du riz
sous l'arbre sept jours dans celui o les dieux,
un bassin;
o les quatre o les chefs de cinq miel (i3); dans
des dieux marchands
offrirent
Kia se et ses frres dans la loi, tous ces lieux
grill et du (i4), le matre on a aussi
celui
il convertit
et les disciples au nombre de mille; lev des tours. Au lieu o Fo obtint
il y a trois seng kia lan; sont des tablissements prs de chacun Le peuple les nourrit pour les religieux, qui y sont trs-nombreux. avec abondance sans qu'il leur manque rien. Les prceptes sont svrement la plus grande dans toutes les gards ; on observe gravit dmarches, en s'asseyant, en se levant, et en entrant dans le inonde.
NOTES Les
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
277
tours a leves en commmoration de quatre grandes qu'on les saintes toutes actions que Fo pratiqua pendant qu'il tait dans le monde, se sont conserves sans interruption dejusqu' prsent tours sont au lieu o puis le Ni houan de Fo. Ces quatre grandes Fo est n, au lieu et au lieu o il obtint o la loi, celui le Ni o il a tourn houan. la roue de la loi, il est entr dans
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
(i) Quatre yeou yan.] Environ
cinq lieues et un tiers.
(2) La ville de Kia ye.] Dans l'original, -kH^/ft. Ces deux caractres se prononcent actuellement en effet Kia ye, cependant le dernier se prononait autrefois plutt ya. Kia ye est donc la transcription du nom sanscrit Tf Gaya. Il ne faut pas confondre cette ville avec celle qui porte prsent ce nom, et qui est situe par 1 870 20' i5" long. E. et 2k" kg lat. N., sur la rive gauche de la rivire Phalgou ou Falgo. Les ruines de l'ancienne Gaya, appeles encore aujourd'hui Bouddha Gaya, sont situes dans une vaste plaine et peu de distance l'ouest de la rivire Niladjan ou Amnat, qui est la partie suprieure du Falgo. Ces ruines ne prsentent plus que des monceaux irrguliers de briques et de pierres; dans quelques endroits on reconnat encore les fondations rgulires d'anciens difices. Une immense quantit de matriaux de construction a dj t extraite de ces ruines, qui par l sont devenues de plus en plus informes. La quantit d'images de pierre qu'on trouve disperses une distance de quinze vingt milles anglais autour de la place, est vraiment tonnante; toutes paraissent cependant avoir appartenu un grand temple et ses alentours, et avoir t transportes de l diffrents autres endroits. Actuellement il n'y a plus de Bouddhistes dans tout le voisinage de Bouddha Gaya \ Hiuan thsang rapporte que cette ville tait dans une position trs-forte ; il y trouva peu d'habitants et seulement un millier de familles de Brahmans qui descendaient d'anciens saints ( ^[lt ) hLes ruines de Bouddha Gaya ont t visites tout rcemment (en fvrier i 833 ) par l'ambassadeur birman Mengy maha tchesou et sa suite, pendant son voyage dans les provinces suprieures de l'Hindoustan, o il se rendait pour trouver le gouverneur gnral. Cet ambassadeur tait accompagn du capitaine Burney. En parcourant les ruines et en les examinant " avec soin, les voyageurs dcouvrirent une ins-
k by Walter Hamilton,tom. I, pag.267. Pian ilian, liv. LXV,pag. 30 r. Description of Hindoostan,
278
FO
KOU
KL
cription ancienne en caractres pli, laquelle tait moiti sous terre, prs du Maha bodhigatch, ou figuier sacr, sur la terrasse du temple. M. Burney en prit avec soin et avec beaucoup de peine trois copies, dont deux, avec la traduction, furent remises au gouverneur gnral et l'ambassadeur birman tine la Socit asiatique de Calcutta. Cette inscription d'une haute importance, comme un des monuments les dhisme et comme servant constater la vrit des rcits ; la troisime tait desen langue birmane est
plus curieux du boudde F hian et de Hiuan b lethsang. En voici le contenu" : Ceci est une des quatre-vingt mille chapelles ves par Sri Dharm As'oka, souverain du Djambodivip, la fin de la 218 anne", aprs l'annihilation du Bouddha, sur la sainte place o Bhugawan (Bouddha) gota le lait et le miel (madhapyasa)i. tant, par le laps du temps, tombe en ruine, elle fut reconstruite par le prtre Nak mahanta. Ayant derechef t ruine, elle fut restaure par le radja Sado-mange. Aprs un long intervalle, elle fut encore dmolie; le radja Sempyou sakhen tara mengi chargea son matre spirituel, Sri dhamma Radja gouna, de diriger la btisse : celui-ci s'y rendit avec son disciple Sri Ks'yapa; mais ils ne purent l'achever, quoiqu'ils fussent aids de toutes manires par le radja. Plus tard, Varadasi nak thera demanda au radja la per mission de l'entreprendre. Le radja y consentit en effet, et chargea de cette en treprise le prince Pyoutasing, qui envoya le jeune Pyonsakheng et son ministre Ratha traverser la mer et rparer l'difice sacr. De cette manire la chapelle fut reconstruite pour la quatrime fois, et termine le vendredi 10e jour de Pyadola, dans l'anne de Sakkaradj 667 f. Le dimanche 8 du Tatchhaon moun g la 668 e, elle fut consacre avec des crmonies brillantes o l'on offrit des comestibles, avec des parfums, des bannires et des lampions, ainsi qu'avec des guirlandes (podja?) du fameux arbre Kalpa wriks'ah; et les pauvres furent traits charitablement, comme les propres enfants du radj. Ainsi fut acheve cette oeu vre mritoire, qui produira des rcompenses ternelles et des fruits vertueux. Que les fondateurs soient pour toujours renomms! puissent-ils jouir de la tranquillit du Nirbhan* et devenir Arahanta la venue d'Arya Matrikl KL. ' Journal theAsiatic of of Calcutta,1834, Society vol. III, pag. 2ii et 3oi. b II a dansla traduction y anglaiseshrines,mais ou tours boudje crois qu'il s'agit ici de sthopas dhiques; car ce fut bien 84,ooo tours que le roi As'oka fit construiredanstout son " H doit avoirici une erreur empire. dans l'originalou y dans la traduction; carAs'okane vivaitque no ou n8 ans aprs le Nirvn'ade Shkya, et non pas 218 ans.Dansla traduction, la 218eanne aprsla mort du Bouddhaest indiquecommela 326avant J. C, selon le calcul actuel des Birmans, qui placent le Nirvn'ade Shkyaen 553 avantJ. C. KL. d Voyezla note 13 de ce chapitre, pag. 288. Le roi ne peut tre,le mmeprince Sado-mang que celui que M. Crawfurd, dans la Table chrono Ava,appelle logique insre dans son Ambassade Sato-mang-bya,et qui fonda, selon lui, la ville ou Ava,seulementen l'an 726 de l're de d'Angwa Sakkaradj(i364 de J. C.).KL. f i3o5 de J. C. i3o6 de J. C. h Un des arbres fabuleux du ciel d'Indra, au on obtient tout ce qu'on dsire. KL. moyenduquel ' Nirvn'a. k C'est--dire Matreya,ou le Bouddha venir.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
279
(3) Vcut pendant six ans dans les macrations. ] La premire des neuf tribulations que le Bouddha Shkya mouni eut souffrir, fut d'tre oblig de vivre pendant six annes entires dans les macrations et les privations, avant d'obtenir le plus haut degr de saintet. Voici comment il expliqua lui-mme la cause de cette tribu-, lation : Il y avait anciennement, dans le territoire de la ville de Pho lo na (Bna rs), le fils d'un Brahman nomm Ho man et celui d'un potier nomm Hou hi; ces deux enfants taient jeunes et se portaient rciproquement beaucoup d'af fection. Hou hi dit Ho man : Allons voir Kia se Jou la (le Bouddha Tathgata Ks'yapa). Ho man rpondit : A quoi bon aller voir ce religieux tte raseP Il en fut ainsi jusqu'au troisime jour. Alors Hou hi dit encore : Nous pourrions aller un instant le voir. L'autre rpondit : Pourquoi aller visiter ce religieux ton du? Comment aurait-il la doctrine de Bouddha? L-dessus, Hou hi prit Ho man par la tte et dit : Je veux que tu viennes voir le Jou la avec moi. Ho man, tout effray, dit en lui-mme : Ceci n'est pas une petite affaire; il faut qu'il y ait quelque chose de bon l-dessous; il dit donc : Lche ma tte, je veux aller avec toi. Parvenu au lieu o tait le Bouddha, ils firent le salut aux pieds de Kia se. Hou hi dit au Bouddha que Ho man ne connaissait pas les trois Prcieux; il le pria de les lui ouvrir et de le convertir. Ho man en voyant le Bouddha l'aima et conut beaucoup de joie : il c'tait moi-mme; ce sortir de la ville pour vases fleurs qui me embrassa la vie religieuse et tudia la doctrine. Ho man, Hou hi est celui qui, quand j'tais encore prince, me fit embrasser la vie religieuse, et ce fut le fils d'un faiseur de guida. Cependant, parce que j'avais autrefois mal parl du Bouddha Kia se, j'ai d souffrir une rtribution en peines ; le reste de ces peines, je dois le subir prsent que je suis sur le point de devenir Bouddha, par six annes de macrations. Comme tout ce chapitre est rempli du rcit des aventures arrives au Bouddha, quand il tait encore Bodhisattwa, et pendant les six annes de macrations qu'il devait subir, je fais suivre ici la fin de la lgende qui a dj fourni beaucoup d'claircissements. Cette fin se joint la partie de la lgende insre dans la note 8 du chapitre XXIII, pag. 23kA. Le prince, quand il fut parvenu quitter la vie vulgaire, sauta de joie et se mit marcher paisiblement. Il entra clans la ville; les gens du pays le contem plrent avec plaisir et sans prouver aucun ennui. Le prince, en se sparant de tous les objets de son attachement et de son affection, avait loign la racine des douleurs et des passions. B. Il voulut se faire raser les cheveux; mais dans son empressement il n'avait pas pris d'instrument. Indra vint, un sabre la main ; les dieux et les gnies reurent les cheveux. Ensuite il, se remit en route et avana dans le pays. Les habitants le suivaient et le considraient. Alors il sortit du royaume, et s'tant cn core avanc un peu, il parvint au royaume de Mo ki (Magadha). Il entra par la
280
FO
KOU
KL
porte de droite et sortit par la porte de gauche. Les gens du pays, hommes et femmes, grands et petits , voyant le prince, se dirent que ce devait tre Indra, Brahma, ou un gnie du ciel, ou un roi des dragons, et ils se livrrent des transports de joie, sans savoir quel gnie ce pouvait tre. Le prince, qui connaissait leur pen se, quitta la route et s'assit sous un arbre. Le peuple l'entoura et le considra avec joie. Alors le roi du pays Phing cha (Bimbsra) demanda ses officiers : D'o vient que dans le royaume tout est si tranquille et qu'on n'entend pas le moindre son, ni la moindre voix? On lui rpondit : Il y a un docteur de la raison qui traverse le royaume et qui vient la cour. Partout o il passe, il laisse une trace de lumire, et il inspire le respect par sa majest. C'est une chose qu'on ne voit pas dans le sicle. Les gens du pays, grands et petits, sont sortis pour le voir et le contempler, et jusqu' pr sent ils ne sont pas encore revenus. Le roi sortit alors avec tous ses officiers ; et s'tant approch du docteur de la raison, il vit le prince qui rpandait un clat merveilleux. Il lui demanda donc : Quel gnie tes-vous? Je ne suis point un gnie, rpondit le prince. Si vous n'tes point un gnie, reprit le roi, de quel royaume venez-vous et quel est votre nom de famille? Le prince rpondit : Je sors de l'orient des Monts parfums, du nord des Montagnes de neige ; mon royaume se nomme Kia'we; mon pre se nomme P ilising; ma mre se nomme Moye. Le roi Bimbsra reprit : N'tes-vous donc pas Si th (Siddrtha) ? Je le suis, r pondit le prince. Frapp d'admiration, le roi se leva et adora ses pieds. Prince, dont la naissance a t signale par tant de merveilles (lui dit-il ), dont l'extrieur annonce par son clat un prince ternel, qui doit tre le saint roi faisant tourner la roue <(dans les quatre continents, le trsor des gnies qu'on attendait en levant la tte au milieu des quatre mers, pourquoi avez-vous quitt la dignit cleste (royale) pour aller vous cacher au milieu des montagnes? Sans doute vous avez quelque ad mirable vue. Je dsirerais apprendre vos projets. Le prince rpondit : A ce que j'ai vu, les hommes et les choses, dans le ciel et sur la terre, naissent pour mourir. Les souffrances cpii s'ajoutent cela sont au nombre de quatre : la vieillesse, la maladie, la mort et la douleur. Il est impossible de les viter. Le corps est un vase de douleurs. L'affliction et la crainte sont immenses. Si l'on est dans une situation glorieuse, on tombe dans l'excs de l'orgueil. Au lieu des joies que l'on souhaite et que l'on cherche, le monde est rempli de chagrins. C'est ce qui a caus mon ennui, et c'est pour cela que je souhaite d'entrer dans les montagnes. Les grands et les anciens reprirent : Cette vieillesse, cette maladie, cette mort, sont de tout temps dans le monde. Pourquoi vous en affliger seul par avance? En rejetant d'ailleurs un titre glorieux, et en allant vous retirer et vous cacher dans une pro fonde retraite pour tourmenter votre corps, n'est-ce pas aussi vous exposer un mal? Alors le prince dit les vers suivants : D'aprs ce que vous dites, seigneurs, je ne devrais pas prvoir le mal et m'en attrister; mais si j'tais roi, en vieillissant, la maladie arriverait, et, parvenu au moment de la mort, il faudrait que j'eusse un
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
281
successeur. En recevant cette calamit, c'est comme si je n'avais pas de succes seur. Comment pourrait-on m'interdire l'affliction? Il y a dans le monde un pre tendre, un fils pieux dont la tendresse pntre jusqu' la moelle des os : au moment de mourir, ils ne peuvent succder l'un l'autre. Quant ce corps illusoire, le jour o, quoique plac dans une haute dignit, la douleur l'atteint, les six parents sont ses cts, comme si pour un aveugle on prparait des flambeaux. A quoi v servent-ils ceux qui sont privs de leurs yeux ? J'ai considr que toutes les actions sans exception sont soumises l'instabilit, que tout revient l'erreur. Il y a peu de joie et beaucoup de douleurs. Le corps n'existe point de lui-mme; et le monde, qui est tout vide, ne peut tre habit longtemps. Les tres qui sont ns, meurent. Les choses qui sont acheves, se dtruisent. Dans le repos vient le danger; dans la possession vient la perte. Tous les tres sont en confusion et en tumulte, tous doi vent retourner au vide. L'me n'a pas de forme, elle se promne dans l'obscurit, et en marchant, elle arrive la calamit de la mort et de la naissance; elle ne la reoit pas une fois pour toutes, mais ses dsirs et ses affections la cachent dans le filet de l'ignorance. Elle se plonge dans le fleuve de la naissance et de la mort, et nul ne peut en avoir l'intelligence. Voil pourquoi j'ai voulu entrer dans les mon tagnes : toute ma pense est dirige vers les quatre vides, vers le salut de puret, les volupts rprimes et la colre teinte; je chercherai porter mes rflexions sur ce qu' atteint le vide et le rien, et non-seulement cela, mais je remonterai sa source et je retournerai son principe. Je commencerai sortir de la racine, et c'est ainsi que je souhaite d'obtenir le grand repos. Le roi Bimbsra et les anciens, joyeux de l'explication que leur donnait le prince, jugrent par l qu'il tait un de ces prodiges du monde destins obtenir la doctrine de Bouddha, et souhaitrent qu'il les sauvt les premiers. C. Le prince garda le silence et poursuivit son chemin; en continuant ses rflexions, il dit : Maintenant que je vais entrer dans les montagnes, quoi me servent des vtements prcieux? Ce sont l les trsors pour lesquels les hommes ignorants et stupides du monde s'exposent au danger. Il vit alors passer un chas seur revtu d'un habit conforme la loi. Le prince joyeux, se dit : Voil le vri table vtement d'un homme, l'habit de celui qui, par sa commisration, veut sauver le monde. O chasseur, pourquoi l'as-tu revtu ? Si tu veux l'changer, tu combleras mes voeux. Il donna donc son vtement orn d'or, et reut en change l'habit conforme la loi, Tchin ya; puis il passa rapidement. Le chasseur fut trs-joyeux, et le Bodhisattwa pareillement. Le prince revtit le Tchin yu au lieu de ses habits moelleux et magnifiques; et regardant d'un oeil pur le Seng kia li (son manteau de religieux ), il entra dans les montagnes. Le Bodhisattwa, charm d'avoir trouv le vtement conforme la loi, rpandit un clat qui illumina les montagnes et les forts. Parmi les Tao szu, l'un nomm A lan, l'autre nomm Kia lan, qui avaient pass des annes dans l'tude, et qui avaient suffi aux quatre 36
282
FOE
KOU
KL
contemplations et atteint cinq facults furent frapps et se demandrent : Que garder ce que c'tait; et apercevant le maintenant rellement quitt sa maison;
surnaturelles, voyant cette lumire, en signifie ce prodige? Ils sortirent pour reprince, ils dirent : C'est Siddhrta qui a Siddhrta est le bien venu. Qu'il s'asseye
sur ce lit; il aura une source frache et de bons fruits. Qu'il mange maintenant! Puis ils ajoutrent en vers : Le roi soleil a commenc se lever; il est mainte nant sur le sommet de la montagne; c'est pourquoi sa lumire intelligente claire tous les tres vivants. Si quelqu'un a vu sa face ou son image, son esprit ne connatra plus l'ennui; c'est pourquoi sa raison et sa vertu n'ont pas de pair, n'ont pas d'gal qu'on puisse lui comparer. Alors le Bodhisattwa reprit en vers : Quoique vous ayez cultiv les quatre ides fixes, votre esprit ne connat pas la raison intelligente ( Pradjna bodhi ) sans suprieure. La rectitude du coeur en est la racine ; elle ne consiste pas honorer les gnies pervers, pratiquer des cho ses vulgaires, ce qu'on peut vritablement appeler, chercher Brahma dans une longue nuit. C'est pourquoi celui qui ne connat pas la raison, tombera parie tour de la roue dans la vie et la mort. Ensuite le Bodhisattwa conut une pense de bont, et songeant que tous les tres taient soumis la vieillesse et l'igno rance, qu'ils ne pouvaient se garantir des infirmits et des il voulut oprer leur dlivrance pour rendre unique leur de ce que tous, sans exception, supportaient la faim et chaud, le gain et la perte, les douleurs du pch et d'autres douleurs pense; la soif, le froid et le afflictions, il souhaita de calmer et d'adoucir (ces maux) : afin d'un'flier leur pense, il fit natre un sen timent de joie. Il songea que dans tous les mondes, il y avait des douleurs et de la tristesse, des craintes et de la terreur, les chagrins de la socit ; il souhaita de les calmer et de conduire les hommes l'abstraction : afin d'unifier leurs pen ses, il fit natre un sentiment de protection. Il souhaita de sauver des cinq con ditions et des huit malheurs les tres qui, offusqus par l'ignorance et obscurcis par la stupidit, ne voyaient pas la droite raison. Il voulut oprer leur salut et faire en sorte qu'ils n'prouvassent pas de contradiction pour unifier leur pen se, qu'ils trouvassent le bien, ne se plussent pas dans le mal et n'eussent pas de tristesse en abandonnant les huit actions du sicle, le profit, la ruine, la destruction, l'exaltation, la louange, les injures, la douleur et la joie, de manire n'en tre ni drangs ni mus. C'est ce qui produisit la deuxime contemplation. D. Il se remit ensuite en route et vint la vallea de Jw -$}t Sse na. Cette valle tait unie et droite ; il y avait beaucoup d'arbres fruits de diffrentes sortes ; parie tout il y avait des sources vives, des lacs pour se baigner. Tout y tait pur et clair. Il n'y avait pas d'araignes, de mouches, de taons, de gupes ni de puces. Dans Il y a dans l'original le caractre1j j tchhoiian, ou qui dsignenon-seulementun torrentdes montagnes, KL. en gnral une eau coulante,mais aussi une vallearrosepar un ruisseau. de la mort, et souffrant
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
283
cette valle tait un Tao szu nomm Sse na. Il instruisait des disciples au nombre de cinq cents, et dirigeait leurs oprations. Le Bodhisattwa s'assit sous un arbre So lo", et en faveur de ses intentions, il demanda le suprme bodhi de la vrit sans suprieure. Les dieux lui prsentrent une douce rose, mais le Bodhisattwa n'en voulut pas accepter, et il se soumit ne prendre, par jour, qu'un grain de chanvre et un grain de riz pour soutenir ses forces vitales. Il demeura assis, de cette manire, durant six annes. Son corps devint excessivement maigre. Sa peau tait colle sur ses os. Sa puret originelle, son repos, son calme profond, son silence, occuprent toute son me; mais sa pense se portait avec tranquil lit sur : i le nombre, a0 la suite, 3 l'arrt, k la vue, 5 le retour, 6 la puret. Il <(exprima sa pense trois ou quatre fois. Il sortit par les douze portes, mais sans se dissminer et sans partager sa pense. Ses facults divines devinrent excellentes. Il pntra et rejeta les dsirs et le mal. Il ne rentra plus dans les cinq couvertures, il ne reut plus les cinq dsirs. Tous les maux s'teignirent d'eux-mmes. Ses rflexions considraient, distinguaient et clairaient. Ses penses voyaient sans agir. Il tait comme un hros qui a vaincu. C'est ainsi qu' force de puret, il par vint la troisime contemplation. E. En parcourant le ciel, Indra rflchit et dit : Voil six ans entiers que le Bodhisattwa est assis sous un arbre; son corps est excessivement amaigri. Il faut maintenant qu'on prsente au roi qui fait tourner la roue de quoi manger pour suppler cette abstinence de six annes. Alors il toucha les deux filles de Sse na, et fit en sorte qu'elles eurent un songe : le monde tait compltement achev, et il y avait dans l'eau une fleur qui avait l'clat des sept choses prcieuses. Tout coup elle se desscha et perdit sa premire couleur; mais un homme tant venu l'arroser, elle renaquit aussitt telle qu'elle tait auparavant. Alors toutes les fleurs qui taient clans l'eau commencrent pousser et germer, et leurs tiges recouvrirent l'eau comme si elles en sortaient. Les deux filles ayant ainsi rv, se rveillrent, et, tout tonnes de ce prodige, elles allrent le raconter leur pre. Le pre ne put l'expliquer. Il consulta tous les vieillards, et aucun ne put dire ce qu'il signifiait. Indra descendit de nouveau, et se changea en Brahmatchari pour expliquer le rve des jeunes filles. Cette fleur que vous avez vue natre dans le monde, sur l'eau, c'est le fils an du roi P thsing qui est n. Voil maintenant six annes qu'il est sous un arbre, son corps est extrme ment amaigri. La fleur qui s'est fltrie et l'homme qui la faisait revivre en l'ar rosant, signifient qu'il faut lui offrir manger. Les petites fleurs dont les tiges voulaient sortir, ce sont les hommes qui vivent ou meurent dans les cinq con dirions. Ensuite Indra pronona un gtha dans ces termes : Depuis six ans, il ne s'est point inclin ni baiss. Il n'a pas mme pens la faim et au froid. Ses " HI0 Sala,ou Hl\0 S'la ( Shorea robusla), arbre quis'appelleencoreSldansl'Inde. 36.
284
FOE
KOUE
KL
efforts n'ont encore rien atteint. Son corps est amaigri, sa peau et ses os se touchent. Armez-vous d'un esprit respectueux, et prsentez manger au Bodhi sattwa. II y aura un grand bonheur dans le sicle prsent, et le fruit et la rcom pense seront dans les sicles suivants. Les filles reprirent : Que faut-il faire pour lui prsenter de la nourriture ? Le Brahmatchari rpondit : Il faut prendre le A chaque fois lait de cinq cents vaches et le lui prsenter boire alternativement. qu'on aura trait une vache, on prendra le lait de cette vache et on s'en ser vira pour faire du riz bouilli. Quand en bouillant le riz au lait sortira du vase, il s'lvera cinquante-six pieds, en haut gauche, en bas droite, droite en haut, et gauche en bas. On remplira la marmite de ce riz avec une cuiller, pour qu'elle ne soit pas souille. F. Les deux filles prsentrent (le riz bouilli) au Bodhisattwa. Celui-ci voulut d'abord se baigner avant de prendre le riz. Il se rendit auprs de l'eau courante et se lava le corps. Quand il eut fini de se baigner, il sortit de l'eau, et les des branches d'arbres. Les deux filles lui pr dieux et les gnies rapprochrent sentrent le riz au lait". Quand il eut mang, ses forces revinrent; et, par une formule, il voua (les jeunes filles) un bonheur sans fin en disant : Puissiez-vous aux trois honorables! Ayant fini de manger, il se lava les mains, se rina la bouche et lava sa marmite. En s'en allant, il la jeta dans la rivire, o elle remonta contre le courant. Elle n'tait pas encore sept li, que les dieux for nirent un Garouda qui vint en volant, et. saisissant la marmite, l'emporta ainsi que les cheveux clans ce mme lieu o, pour les honorer, on a bti une tour. G. Le Bodhisattwa se remit ensuite en route ; et quand il fut sur le point de passer la rivire Ni lian tchhen, il fit un gtha qui signifiait : En passant le Ni lian tchhen 1, je suis mu de compassion pour tous les hommes. Les cinq conditions retourner et les trois taches envenimes, je les enlverai comme si elles taient purifies avec de l'eau. Le Bodhisattwa fit ensuite cette rflexion : Tous les tres ignorants tombent dans l'obscurit. Il faut que je prenne les huit choses droites, et par la lotion de l'eau, j'effacerai les trois taches envenimes. Alors il commena mon ter sur la rive. Des oiseaux bleus, au nombre de cinq cents, volrent autour du Bodhisattwa en faisant trois tours; et aprs avoir chant douloureusement, ils s'loignrent. H. Il se remit ensuite en route ; et comme il allait passer par le lac du dragon " Dansun destraits bouddhiques que sirAlexanon trouve dreJohnstona fait traduiredu singhalais, le passage suivant, qui est trs-curieux, parcequ'il donne,unedate assezancienne l'poque du Bouddha Shkyamouni.Le voici: Depuisl'acceptation du riz bouilli jusqu'au samedi 20 novembrede l'anne (chrtienne) i8i3, il y a eu deux mille quatre cents ans et vingtjours. CommeShkya mouniacceptaleriz au lait en questionpeu de temps avantde devenirBouddhaaccompli,et que cet vnementeut lieu quand il eut atteint sa vingt-neuvimeanne, ce calculfixesa naissance l'an 998 avantJ. C.Voy.Sacred andhistorical Books of Ceylon, publishedby E. Dpham. London, i833, vol. III, pag. 56. KL. h Voy.le chapitreXXII, note 22, pag. 22/1.
NOTES aveugle,
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
285
ce dragon sortit trs-joyeux en manifestant ses transports la vue du Bodhisattwa, et il pronona le gtha suivant : Quel bonheur! Je vois Siddhrta qui vient nous dlivrer. Comment pourrions-nous tarder lui offrir les sucs de la plus douce rose, au-dessus de laquelle il n'y a rien? Quand il marche, la terre tremble sous ses pas. Tous les instruments rendent des sons d'eux-mmes. C'est comme les Bouddhas du temps pass. Je n'ai en moi aucun doute justement ce sujet. Maintenant, il a pris le pradjna suprme, et il va soumettre tous les gnies de la mort et tous les maux. Il doit maintenant, comme le soleil de Boud dha, clairer tous les tres et les rveiller de leur sommeil. I. Ensuite il avana encore et aperut le mont %k g, Sou lin. Le pays y tait plat et rgulier. De tous cts il tait pur et agrable. Il produisait des plantes dlicates et pleines d'agrments. De douces sources coulaient en abondance. Le parfum des fleurs tait suave et pur. Au milieu il y avait un arbre haut et ad mirable, dont toutes les branches taient rgulirement les unes au-dessus des autres; toutes ses feuilles s'ajoutaient les unes aux autres, et les fleurs en taient touffues et serres comme le fard des dieux. Une banderole tait au sommet de l'arbre. C'tait le roi de toutes les forts et de la flicit originelle. Alors avan ant un peu, il vit un homme qui fauchait de l'herbe. Le Bodhisattwa lui de manda : Quel est prsent ton nom ? Mon nom est Heureux augure, et main tenant je coupe l'herbe d'heureux augure. Si tu me donnes de cette herbe, les dix parties du monde auront un heureux augure. Alors Heureux augure pronona le gtha suivant : Il a rejet la dignit de saint roi, les sept trsors, la fille de jaspe son pouse, les lits d'or et d'argent, les tapis, les toffes brodes et barioles, la voix plaintive de l'oiseau Kan than, l'harmonie des huit accords, et sa supriorit sur le dieu Brahma, et il se sert maintenant d'herbe. Le Bodhi sattwa rpondit par ce gtha: J'ai form un voeu pendant un asankya; c'est de sauver les hommes des cinq conditions. Je vais maintenant remplir ce voeu. C'est pourquoi je dsirais obtenir que l'homme l'herbe me donnt une poigne de son herbe, et que la tenant vers le roi des arbres, les penses du monde fus sent toutes confondues. Je dois redresser ces projets. Le faucheur lui prsenta alors de l'herbe et l'tendit par terre, comme il lui avait t dit : le Bodhisattwa s'y assit, et reut son prsent. Le Bodhisattwa fit les trois choses ncessaires pour s'asseoir; et arriv devant l'arbre, il dit : Si je ne pouvais obtenir la doctrine, je ne m'loignerais pas des trois serments, mes ctes se desscheraient et seraient immobiles. S'il faut que je complte la qualit de Bouddha et que j'obtienne la doctrine, chaque heure produira une pense. L-dessus, le Bodhisattwa s'tant assis, entra en extase". Il rejeta la douleur et les ides de joie; sans tristesse ni quellemanireles livres pli [Upham, vol. I, pag. 125) racontent cet pisodede la vie * Voicide de Bouddha. Aprs(avoir pass la rivireAirun djara), il vint dans une foret d'arbres sal, o
286
FOE
KOU
KL
penses de plaisir, son coeur ne s'appuya pas sur le bien et ne s'appliqua point au mal. Il tait justement dans le milieu. Comme un homme qui se baigne, pu rifi, se recouvre d'un feutre blanc, au dehors, il tait toute puret; au dedans, il tait un augure sans tache. Ananti dans le repos, il complta, sans change ment, les quatre contemplations; aprs qu'il eut fini, il obtint la pense dter mine sans perdre sa grande compassion; par sa science et ses procds, il p ntra les principales merveilles; il comprit les actions des trente-sept classes de doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle les trente-sept classes? Ce sont, premirement, les quatre stases d'ides du mens; secondement, du mens; les quatre interruptions troisimement, les quatre suffisances spirituelles; les cinq raquatrimement, cines; cinquimement, les cinq forces ; siximement, les sept mens intelligents; septimement, les huit actions droites. Aprs les avoir parcourues, il recommena le vide de la douleur. Extraordinairement sans forme, sans souhait ni moi, il pensa au monde qui, par l'avidit, l'amour, la gourmandise, les dsirs, tombe dans les douleurs de la vie et de la mort. Combien peu savent se connatre eux-mmes, tous tirant leur origine des douze Nidna" l Quels sont ces douze? ii resta pendant quatrejours. Dansla nuit, il alla a en avant, sur une route qui avait t rendue praticablepar les dieux, et il arriva un arbre bogas. En chemin il avaitrencontrun Brahmin, qui lui avait donn huit poignes de grains de kousatani. Aprsqu'il les eut rpandus autour de l'arbre, la terre se fendit, et une estrade, haute de quatorzecoudes,sortit du sol. Il s'y assitaussitt en appuyantsondos contrel'arbre, qui alorsdevint comme une colonne d'argent. Il y fut visit par l'assemblede tous les dieux, qui lui rendirent hommageet exaltrentsesactionsvertueuses. chiCetteestradeest appelepar les Bouddhistes nois \TZL -yTP^Z^Phou thi thang,ou l'estradedu Bodhi: c'estl que le Bodhisattwaparvint la dignit deBouddha.(Voy.San tsang fa sou,1.XXVIII, pag. 18, et liv. XXXIV,pag. i.) Elle tait dans le Bouddha,pour trerest longroyaumede Maghada. temps dans la fort, est aussi nommen sanscrit 3TTT(J^=f Aran'yaka, ou l'habitant du dsert. tom. II, fol. 19 r. Voy.Vocabulaire pentaglotte, a Lesdouze Nidna(l"1&|*( de ) ou consquences causesantrieures, en chinois Z%k Ey Ynyuan, sont les diffrentesphasesque l'me parcourt dans une gnration, avant et pendant laquelle elle se trouve emprisonnedans le corps. Le systme de cette doctrine est assezobscur.Je le donne ici tel qu'il se trouve expos dans le Thiantha szu hao i (cit dans le San tsangf a sou, liv. XLIV,pag. 8), en ajoutant aux nomschinoisdes douzeNidnales termessanscrits,quipeuventservir leur explication. Pour ce qui regarde le Wou ming et les autres [Ynyuan), dit l'ouvrageque je viens de citer, ce rqui se dveloppeet se suit dans une succession gulireproduit des effetsqu'on nommeYn(causes), qui, par leur enchanement mutuel, deviennent Yuan (consquences).Cela a lieu dans les trois temps (le pass, le futur et le prsent), successivement et sansinterruption. et [Nota. Dans les trois temps, successivement sans interruption : cela veut dire que le Wou ming(ou l'tat d'ignorancede l'me d'elle-mme), et le Hing (ou sa marche), dans la gnrationactuelle, ont leurs Yn (ou causes) dans la gnration passe; ils produisent le Chy (ou la connaissance), et les autresdes cinqconsquences jusqu'au en Cheou(la perception), qui sont,les effets.Des effetsde la gnrationactuelle naissentle Ngai ( le dsir amoureux), le Thsiu(l'obtention de ce qu'on cherche), et le Yeou(la possession).Ce sont les trois Ynde la gnrationactuelle; et les Ynde cette gnrationproduiront les Ynde la gnration venir, savoir: le Seng (la procration), le hao (la vieillesse),et le Szu (la mort).] i ma ^jfcJ'Vouming (sans clart, en sanscrit l'medans ^wM&MAwidya, ignorance;c'est--dire, Les dceptionsdes l'tat d'ignoranced'elle-mme).
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
287
Leur origine est l'ignorance; l'ignorance agissant, produit la connaissance; la connaissance agissant, produit le nom et le titre; le titre agissant, produit les six entres; les six entres agissant, produisent le plaisir renouvel; le plaisir re nouvel agissant, produit le dsir; le dsir agissant, produit l'amour; l'amour agissant, produit la caption; la caption agissant, produit la possession; la posses sion agissant, produit la naissance; la naissance agissant, produit la vieillesse et la mort, la douleur et la compassion, le chagrin et la souffrance, qui sont les peines du coeur et l'instrument de grandes calamits. Quand l'me est une fois tombe dans cette alternative de la vie et de la mort, si elle veut obtenir la doc trine, elle doit interrompre l'amour et teindre et supprimer les passions et les dsirs. Quand la quitude est venue, alors l'ignorance s'teint; l'ignorance tant teinte, alors l'action s'teint; l'action s'teignant, alors la connaissance s'teint; la connaissance s'teignant, alors le nom et le titre s'teignent; le nom et le titre tant teints, alors les six entres s'teignent; les six entres s'teignant, alors le plaisir renouvel s'teint; le plaisir renouvel tant teint, alors le d sir s'teint; la douleur teinte, alors l'amour s'teint; l'amour tant teint, alors vicesdes gnrationspassestant couvertes par le 4"TI ~/b~^en slmd(^a na';ureprimitive), il n'y a rien qu'on voie clairement ; c'est pourquoi on appelle cet tat sansclart. 2 A-^Hing (la marche, le progrs, en sanscrit ti^tlH Sanskra,marche en avant vers l'accomplissement).C'estainsi qu'onappelletousles actes bonsou mauvaisque le corpsou la boucheont excutsdans les gnrations passes. en sanscritX^xTr^T 3 ~fP}Chy(connaissance, Tous les actes erronsdes gnrations Widjndna). et la prentranentcette connaissance, prcdentes cipitent dans l'utrus de.la mre, o dans l'espace d'un moment elle souillel'amouret forme la semence, qui, recevanten elle la pense, forme le foetus. 4 (U V^Mi/ijc (formedu nom, en sanscrit dans le texte de la lgende, rj m^M Nmaropa; C'est l'me inJ2_ j^Ming tsu, dnomination). carne; car l'meincarne n'a rien que le nom, et n'a point de corpsni de substance.La couleur( roupa), c'est la substancecolore, ou le corps,parce que depuisle momentou il a t confi l'utrus jusqu'au septimejour du cinquime (mois de la le sige du corpsse forme, les racines grossesse?), (organes)paraissent,et les quatre membresse sparent. (les six entres, eu sanscrit b|^|<4ClT Chad'yatama). Depuisl'tat de la forme du nom [tmuropa)jusqu'au septimejour du sixime(mois?),les cheveux,les poils, les ongles, se placent.Le septimejour du septime(mois?), le nomse pourvoitde racines.Quand lessix racines (les yeux,les oreilles,le nez, la langue,le corpset la pense)sont ouverteset dployes,il y a six entres pour les sixpoussires (la vue, le son,l'odorat, le got, le tact et la conception). 6 w-gnTchhu(le tact, le toucher, en sanscrit ^tjSpars'a; dansle textede la lgende,g5 &? 5 S\^-rThoujy Kenglo,joie change).Depuisla sortie de l'utrus jusqu' l'ge de trois ou quatre ans, quoiqueles six racinescorrespondent par le tact auxsixpoussires, la joieet on ne peut encorerflchir,ni comprendre les peinesde la vie. Cheou par lessens,ensanscrit 7 <(^> (perception dans le texte de la lgende, y\ Vcdan; qTJ^TT dsir). De sixou sept ansjusqu' douzeou Thoung, sont en contactavecles six treize,lessixpoussires racines, et on peut recevoirles bonnesou les mauvaiseschoses qui se prsentent; mais quoiqu'on puisseles discerner,on ne peut encoreproduireles pensesde dsiret d'avidit. 8 'jtf'Nga (dsiramoureux,en sanscritcTrrTT Trichn').Depuisquatorze ou quinze ans jusqu'
288
FOE
KOUE
KL
la caption s'teint; la caption tant teinte, alors la possession s'teint; la pos session s'teignant, alors la naissance s'teint; la naissance s'teignant, alors la vieillesse et la mort, la tristesse, la compassion, la douleur et la souffrance, les peines du coeur et les grandes calamits ont pris fin : c'est ce qu'on appelle avoir trouv la doctrine. K. Le Bodhisattwa se dit alors en lui-mme : Je dois maintenant soumettre les officiers et les descendants du Mara. Il fit donc sortir de l'espace qui sparait ses sourcils un rayon de lumire qui alla frapper le palais du Mra. Le Mra, trs pouvant, ne put avoir le coeur tranquille, et voyant que le Bodhisattwa tait dj sous l'arbre, pur, sans dsir, occup sans relche de penses subtiles, et que, clans son coeur, les venins des passions, le boire et le manger n'avaient pas de douceur; qu'il ne songeait plus au plaisir des femmes; il pensa : Ceci est l'ac complissement de la doctrine, certainement il aura une grande victoire sur moi. Tandis qu'il n'est pas encore devenu Bouddha, je veux ruiner sa doctrine. Le fils du Mra, Siu ma thi, interrompit son pre en lui disant : Le Bodhisattwa pra tique la puret. Dans les trois mondes il n'a pas de pareil; il est parvenu par lui mme la puissance surnaturelle. Les Brahmas et tous les dieux, par centaines de millions, vont tous lui rendre hommage et le garder; ce n'est pas lui que les dieux et les hommes peuvent attaquer. En troublant sa quitude et en faisant natre le mal, qu'il dtruise lui-mme son bonheur. O roi des Mara! si vous n'coutez pas ces raisons, appelez les trois filles de jaspe, la premire nomme Amour gra cieux, la seconde Toujours joyeuse, la troisime Grande joie. Ne vous tourmentez dix-huit ou dix-neuf, les dsirs en chaque chose l'emportent sur les meilleures dispositions,et parviennentjusqu' l'tat de dsirs lascifs; mais on ne peut pas encorese les procurerlargement. 9 Jp? '/isiu(laprise, obtenirce qu'on cherche, en sanscrit3TTSI*1 Oupdna). Avingt ans les dsirs reviennentet abondent l'gard des cinq poussires (la couleur et la forme, le son, l'odorat, le got, le tact), et se prcipitentde toutes parts pour se contenter.Cela s'appellela prise. io /M Yeou(avoir,possder,en sanscrit ^e( Bliawa). Par la recherche prcipite au del de toutes les bornes, naissent tous les actes bons et mauvaisqui s'amassentet s'assemblent dans lesproduits (fruits) des trois JM Yeou de la vie. [Comme ces produits ne sont pas vains,il faut qu'il y ait trois ""f Yeou,qui sont le Yeoudu dsir, le Yeoudes formes et le Yeousansformes, c'est--dire les trois mondes.] Seng(la procration,en sanscritirTUcT Djti).D'aprs les actes bons ou mauvaisde la gnration prsente, il se forme pour les gnrations suivantesun cercle dans les six voieset les quatre dans lesquelleson est reproduit. [Les six naissances, voiessont cellesdes hommes, des Asouras,des gnies famliques,desbrutes et des enfers.Les quatre naissances se font par la matrice, par un oeuf,par l'humidit et par la transformation. ] i2 yPVi^P'Lao szu (vieillesse et mort, en sanscrit,j)|((*-NU| Djrmaran'a, et affaiblissement mort). Quand on est destin la naissance dans une gnration venir, le corps composdes cinq F/i (imperfections)tant mr, retourne sa destination par la vieillesseet la mort. [Les cinqYn sont ceux de la forme, du recevoir,de la pense, de l'action et de la connaissance.] Cetteexplicationdesdouze Nidnaservira claircir la traduction littrale donne par M. AbelR KL. musat du passageci-dessus. n /t
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
289
pas, roi mon pre. Nous irons troubler la pnitence du Bodhisattwa; cela n'est pas assez important pour vous dranger. O roi! ne vous attristez plus. Alors les trois filles, dont les charmes taient relevs par un vtement cleste, arrivrent prs du Bodhisattwa, suivies de cinq cents filles de jaspe. Les instruments de mu sique dont elles jouaient, leurs chants, leur langage lascif avaient pour but de le troubler dans l'tude de la doctrine. Toutes trois prenant la parole : Votre vertu et votre bont sont si grandes, dirent-elles, que les dieux vous respectent et veulent vous rendre un culte : c'est pour cela qu'ils nous prsentent vous. Nous sommes belles et pures; nos annes sont dans leur fleur; nous dsirons obtenir la faveur de vous servir et de vous tenir compagnie droite et gauche, en nous levant le matin et la nuit en dormant. Les attraits et les excitations de ces trois beauts ne produisirent aucun effet sur l'me du Bodhisattwa; d'un seul mot il les changea en vieilles femmes tte blanche, dont les dents taient tombes, et qui avaient les yeux teints et le dos bossu, de sorte qu elles furent obliges de se servir de btons pour retourner d'o elles taient venues. Le Mra les voyant arriver dans cet tat, entra dans une violente colre et vint, avec ses 1,800,000 dmons, l'entourer clans un espace de trente-six yodjanas. Ces dmons prirent la forme de lions, d'ours, de rhinocros, de tigres, d'lphants, de boeufs, de chevaux, de chiens, de porcs et de singes. On en voyait qui avaient des ttes d'animaux sur des corps humains, d'autres qui avaient des corps de serpents venimeux et des ttes de tortue six yeux. 11 y en avait plusieurs ttes, avec des dents et des griffes crochues ; ils portaient des montagnes sur le dos, faisaient sortir de leur bouche du feu, du tonnerre et des clairs. Ils vinrent des quatre cts attaquer le Bodhisattwa, avec des armes de toute espce ; mais rien ne put branler le courage de celui-ci, et il sortit victorieux de toutes les attaques de ses ennemis. Enfin le Bodhisattwa ayant, par sa force surnaturelle, vaincu et soumis le Mra, tous les dieux, remplis de joie, descendirent des cieux et rpandirent des fleurs. Le Bodhisattwa obtint alors la dignit de Bouddha, sous le nom de Chy kia wen jou foi', (Shkya mouni Tathgata), et les titres honorifiques de "ffiti/^^Instituteur dha vnrable du siclea. KL. des hommes et des dieux, et de Boud-
(k) L'en couvrirent sa sortie de l'tang.] Voyez la note 3, lettre F. Selon Hiuan thsang, Shkya mouni prit ce bain dans la rivire Ni lian chen; en mmoire de KL. quoi on leva dans ce lieu une tour, qui existait encore de son temps ''. (5) Offrirent Fo du riz au hit.] Voyez la note 3, lettre E. Les deux filles qui nourrirent le Bouddha de lait et de riz, aprs ses six annes de macration, sont qua* J'ai h Piani tian, liv LXV,pag.30. abrgla finde cette lgende,qui est d'une longueurdmesure. 37
290
FO
KOU
KL
lifies dans le texte de Hr* 3C jf ' ce cIlu' Je cris>ne Peut signifier autre chose que filles des familles retires (ou qui se sont loignes du monde). M. Rmusat, prenant Mi kia pour un nom propre, avait traduit : Deux li plus loin on vient au lieu o Mi kia, femme, offrit du riz au lait. Hiuan thsang appelle ces deux filles ~Jt'^ bergres". Leurs noms taient An to (joie, ^"FF^ Ananda) et PJio lo (force, 3Rj5 Bah) h. Dans les livres singhalais, il n'est question que d'une seule femme appele Soudjatawon (Soudjt?). Pendant un million de kalpas, elle avait fait un grand nombre de bonnes oeuvres, dans l'espoir de pouvoir un jour offrir du riz et du lait un Bouddha, le jour mme o il obtiendrait le plus haut degr de perfection. Son dsir fut exauc. Elle tait fille d'un Silaivno (homme riche) du pays de Senananam niangami, et devint pouse du principal Sitaivno de Barenessi (Bnars). Elle offrit une marmite d'or d'un million de masses d'or, et remplie de riz au lait, au Boudet ayant dha, le jour mme de son accomplissement; aprs cet accomplissement, elle entra dans la batitude ternelle c. KL. entendu sa prdication, (6) En faisant un demi yeou yan.] C'est deux tiers de lieue.
(7) Sous un arbre Pe to.] C'est le borassus jlabelliformis ou le palmier vin, tki, et par les Anglais dans l'Inde palmyra. D'aprs le rappel en sanscrit cTT<5 cit de la lgende, donn dans la note 3, lettre D, ce ne fut pas sous un Pe to, mais sous un So lo (ou Sala) que le Bouddha resta assis pendant six annes. La lgende mongole, extraite par M. I. J. Schmidt, en fait un figuier d'Inde (ficus religiosa), en disant : Prs du roi des arbres, d'un Bdhi lev, il tait assis les jambes croises, et clans une position immobile ; il y vainquit et soumit les chimnous (d mons), et devint le lendemain Bouddha, pour ouvrir tous la source inpuisable de la vie i. Dans la relation de Hiuan thsang, c'est galement sous un arbre Bdhi que Shkya mouni resta pendant six annes. KL. (8) Lui donna l'herbe d'heureux augure.] Voyez la note 3, lettre I. (9) Cinq cents oiseaux bleus.] Voyez la note 3, lettre G. (10) Les trois filles furent changes en vieilles.] Voyez pour le combat avec le roi des dmons et pour cette mtamorphose, la note 3, lettre K. (11) Un dragon aveugle cailles brillantes.] Voyez la note 3, lettre H. Hiuan thsang nomme le lac dans lequel ce dragon habitait, Mou tchi lin tho. KL. * Piani lian, liv.LXV, pag. 34 v. h le San tsang Voyez f sou, liv. XIII, pag. 24 v. c Voyez Upham,vol. III, pag. 56. d Geschichte der Ost-Mongolen, pag. 3i3.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXI.
291
(12) Le dieu Brahma vint le prier.] Voyez le chapitre XXXIV, not. i 2. (1 3) Lui offrirent du riz grill et du miel.] Bouddha, dit Hiuan thsang, tant assis, les jambes croises, sous l'arbre Bodhi, et ayant obtenu la joie de la batitude ternelle, sortit aprs sept jours de ses profondes mditations. Deux marchands passant alors par la fort, en furent avertis par le gnie qui l'habitait, et qui leur dit : Le prince de la race des Shkyas est ici; il a obtenu le degr de Bouddha, son esprit est absorb par la mditation, et pendant quarante-neuf jours il n'a rien mang. Alors les deux marchands se rendirent auprs du Bouddha et lui offrirent du riz grill et du miel. Le Bouddha accepta leur offrande ; mais comme il n'avait pas de vases o il pt mettre leurs prsents, les quatre rois du ciel vinrent des quatre points cardinaux, et lui apportrent chacun une marmite d'or. Le Bouddha refusa de les accepter, parce que des vases aussi prcieux n'taient pas convenables l'tat ecclsiastique qu'il avait embrass ; il refusa encore plusieurs autres marmites de matire prcieuse, et en accepta enfin une tout fait ordinaire, etc. " Voici comment cette histoire est raconte dans les livres palis : Deux mar chands, nomms Tpsdjuye et Ballakcdje, cpti taient frres et natifs de la ville de Puskereiveti nuwr dans le royaume de Raamanimandeledje, allaient trafiquer dans le pays de Maddemeprederedje. Ils taient accompagns de beaucoup de monde et de cinq cents charrettes charges. Arrivs prs du lieu o le Bouddha sjournait alors, une desse de la terre, qui, dans une vie prcdente, avait t la mre de ces deux frres, fit en sorte que leurs charrettes s'arrtassent. Les marchands pro mirent aussitt de faire un sacrifice, et la desse leur dit : O hommes fortuns, notre Bouddha est assis sous l'arbre Kiriplurake; vous qui allez trafiquer, faites lui une offrande de beurre frais et de miel, et vous obtiendrez du bonheur pour un long espace de temps. Les marchands ayant fait cette offrande, Bouddha l'accepta, et en mangea dans le vase de rubis qui lui avait t donn par le dieu Sien waran dewi radjan. Puis il leur prcha la doctrine, et cpiand ils furent con vertis, ils devinrent Vipasikis. Les marchands voulant se remettre en chemin, Bouddha prit, avec sa main droite, huit cheveux bleus de sa tte, et les leur donna comme un gage qu'ils devaient clans la suite propager sa doctrine. Les marchands, trs-contents de cette marque de bienveillance, portrent ces che veux dans une bote d'or la ville de Puskereiveti nuwr; ils la dposrent la porte orientale, et construisirent une tour au-dessus. De cette tour sortent, dans certaines saisons, des rayons bleus; ainsi elle contribue, comme le Bouddha lui-mme, la joie des dieux et des hommes. C'est la premire tour qu'on ait leve Anurahde-poura. Quelque temps aprs, ces marchands revinrent dans leur pays, et prchrent au monde la doctrine de Bouddha. C'est par leurs pr" Pian i lian, liv. LXV, pag. 36. 37.
292 dications qu'elle fut introduite dharma ". KL.
FOE
KOUE
KL dans le royaume du roi Mh-
Anurahde-poura,
(I k) O il convertit Kia che et ses frres.] Ce sont les trois frres Kia ch ( ou Ks'yapa) qui y furent convertis par Shkya mouni; savoir : Ouromvilwa Ks'yapa (Ks'yapa du cognassier), Nadi Ks'yapa (de la rivire), et Gay Ks'yapa (de la ville de Gaya). Il ne faut pas confondre ces trois personnages avec le grand Kia ch (Mh Ks'yapa ), ni avec un autre nomm en chinois Chy ly Kia ch (en sanscrit Das'awah, le dix fois fort), qui fut un des cinq premiers personnages convertis par Shkya Bouddha. Selon le Fan y ming i, le nom de Ks'yapa signifie en sanscrit famille de la grande tortue (selon d'autres auteurs, splendeur bue). Les anctres du grand Ks'yapa s'tant, de gnration en gnration, appliqus l'tude de la raison, une lortue miraculeuse, portant une table divine sur le dos, rpondit aux questions de ses anctres vertueux : de l l'origine de son nom de famille. Il tait capable de pratiquer les actes suprieurs de la propre excitation. C'est pourquoi on lui a donn le nom de premier de la Haute actionh. Confrez ce qui en a t dit plus haut, ch. XX, not. 3g, pag. 189. KL. ' Thesacrcdand hisioricalbooks of Ceylon,published by E. Upham, vol. III, pag. 110 et suiv. Danscet ouvrageles nomspropressontcritsd'une de fixer maniresi irrgulire,qu'il est impossible leur vritableorthographesansavoirles originaux devantles yeux.On peut djtapalis et singhalais destextespublispar blir que le Puskereweii nuwr Upham,doit tre, en sanscrit,Pouchkaravali nagaru; le royaumede Raamani est probablement mandeledje enfin Vipasik Rmama'nd'ala; n'est peut-trequ'une altrationdu sanscritVipas'yi. Fan i mingy, cit dans le San tsangf sou, liv. XLI, pag. un.
CHAPITRE
XXXII.
A.y devient roi de la roue de fer, et rgne sur le Yan feou thi. Il visite l'enfer ; fait construire une prison pour punir les criminels. Histoire d'un Pi khieou qui entra dans cette prison. Le roi se convertit.
Le roi Ay, tant encore petit garon sur la route; il (i), jouait en mendiant rencontra sa nourriture. Chy kia fo (2) qui marchait donna une poigne de terre Fo. Fo Le petit garon, trs-joyeux, la prit, la remit et passa son chemin. La terre, en de cela, fit (A y) roi de la roue de fer (3). Il rgna sur thi () et monta sur la roue de fer. En visitant le Yan feou (5) plac o l'on entre deux et tout entour montagnes Il demanda les criminels. d'une ses dans la boue
rcompense le Yan feou thi, enceinte ministres des
il vit l'enfer de fer,
contenait
Ils rpondirent ce que celait. que c'tait le lieu o le roi les criminels. Le roi rflchissant, Yan lo (6), retenait dmons, : Le roi moi, un enfer il leur des qui dmons suis a su faire un enfer pour les y punir ne ferais ses
se dit
criminels; je pas
prince
des hommes,
ministres, enfer pour trs-mchant ministres sur
pour y demanda
les punir homme qui puisse la recherche partout d'une rivire,
les criminels? punir : Quel est celui qui criminels? Ils rpondirent d'un mchant
pourquoi S'adressant
peut me faire un : Il n'y a qu'un le faire (7). Le roi envoya donc ses homme. Ils virent
les bords
jaunes bouche
et aux yeux de poisson. il les
aux cheveux gant au teint noir, et une verts, qui avait des crocs au lieu de pieds, et quand Il sifflait les oiseaux et les quadrupdes, un tuait sans qu'aucun coups de flches, ils revinrent eurent trouv cet homme, en secret, dans et lui l'intrieur dit : Entoure toutes sortes un pt lui le dire espace de Heurs
ils venaient,
Lorsqu'ils chapper. au roi. Le roi le fit venir carr d'un mur lev,
et place
294 et de fruits, et avec ainsi beaux avidit.
CHAPITRE
XXXII. qui soient les re-
agrables garder
et des lacs valles, que de belles voir, et qui invitent les hommes Tu feras cette prison une porte,
vient qu'un les criminels sortir; punir
y entrer, tu le saisiras tout de suite et suivant leurs sans permettre personne espces, et quand bien mme ne te relche j'y entrerais, pas les criminels : je te fais prince de l'enfer. Un pi khieou
et si queltu feras punir de de (8),
sa nourriture, entra Le gardien de qui demandait par cette porte. la porte le voyant, voulut le punir comme un criminel. Le Pi khieou, demanda ce qu'il et dn. Quelque effray, quelque rpit jusqu' il entra un homme. Le gardien de la prison le mit dans temps aprs, un mortier vu, et le pila : il en sortit se convainquit alors comme cela fut Le Pi khieou rouge. tait prissable et que ce corps une bulle d'eau (9) ou une cume, fait, ravi. le gelier mit l'cume dans Le feu desscha et l'cume, un nnuphar. Le Pi khieou une cume
l'ayant
vide sujet la souffrance, et il devint Arhan. Quand une quand s'assit marmite elle dessus, ; le Pi khieou fut refroidie,
en fut il en
sortit
et le gelier s'en alla rendre au roi des mercompte veilles dans la prison. Il voulut qui s'opraient que le roi vnt pour les voir. Le roi dit : J'ai auparavant chose d'important quelque aller prsent. Le gelier : Ce n'est faire, je n'y puis reprit il faut, roi, que vous veniez en diligence affaire; pas une petite et que vous remettiez les affaires avez. Le roi le suivit que vous donc et entra; le Pi khieou lui prcha la doctrine. Le roi obtint la foi, dtruisit et se repentit de tout le mal qu'il avait l'enfer, fait antrieurement. cieux (10). Il allait pentir ce temps, il crut Depuis habituellement sous l'arbre se chtier du Les to. roi lui-mme, demanda lui et honora Pe to (n) les trois prse repour aux huit le roi allait
de ses fautes, L'pouse
et se soumettre dans quel lieu
purifications. toujours
jours et envoya
se promener. sous l'arbre Pe des gens pour
grands La reine
rpondirent attendit que
couper
l'arbre
allait touqu'il le roi n'y ft pas, et le renverser. le roi Quand
NOTES revint
SUR
LE
CHAPITRE
XXXII.
295
il fut si troubl et qu'il s'en aperut, et si afflig qu'il tomba Les grands lui arrosrent le visage avec de l'eau; enfin, par terre. au bout d'un long temps, il revint lui. Alors il fit lever un mur de briques tout et arroser autour cruches de lait de vache. Lui-mme de ne jamais serment fut-il fini, depuis tchang ce temps (12). ment les racines de l'arbre avec cent se jeta j3ar terre, et fit le serse relever si l'arbre ne renaissait pas. A peine ce repousser des racines; et commena que l'arbre prsent, il est devenu haut d'au moins dix
jusqu'
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIL
(1) Etant encore petit garon.] Il y a dans le texte af % >b \\ % i f n
M. Abel Rmusat avait traduit cette phrase par : Le roi A yeou (lisez A y, car le caractre "n ne se prononce jamais yeou) autrefois fit un petit garon. Mais le verbe auxiliaire /j'h tlisb, qui signifie proprement faire, est aussi employ pour dsigner tre, peu prs de la mme manire qu'on dit en franais se faire vieux. D'ailleurs Hiuan thsang raconte aussi que ce fut le roi A chou kia (As'oka, le mme que A y) qui construisit la prison dont il est question dans ce chapitre. KL. (2) Rencontra Chy kia fo:] Le Bouddha
Shkya.
(3) Fit (A y) roi de la roue de fer.] Voyez chap. XVII, not. 12, pag. i3/t. Il y est dit que le roi de la roue de fer parat l'poque o la vie de l'homme, aprs avoir touch au terme de sa plus grande brivet (dix ans), est revenue, par une suite d'accroissements successifs, vingt mille ans. Cependant le texte rapport dans le San tsang f a sou, et que M. Rmusat avait sous les yeux, dit : Selon le Ta tchi tou lun, l'ge des hommes augmente et diminue dans les petits kalpas. La vie mille ans; au bout de tous les des hommes est d'abord de quatre-vingt-quatre cent ans, cette dure est abrge d'un an; elle dcrot ainsi jusqu' dix ans. Il se passe cent annes encore, aprs quoi elle augmente de nouveau d'un an, jusqu' ce qu'elle revienne vingt mille; dans ce laps de temps, parat le roi de la roue de /e/ 1, etc. Comme le Bouddha Shkya mouni, dont le roi A y ou As'oka tait
296
FOE
KOU
KL
le contemporain, naquit dans le monde l'poque o la vie humaine n'avait que cent ans de dure, on voit bien que le roi de la roue de fer n'attendait pas pour se montrer dans le monde, que cette dure ft remonte vingt mille ans. KL. (k) Il rgna sur le Yan feou thi.] C'est le Djambou not. 7, pag. 81. dwipa. Voyez chap. XII,
(5) Il vit l'enfer.] Suivant les traits bouddhiques runis dans le San tsang f a sou, prcisment au-dessous de l'extrmit mridionale du Djambou dwpa, la profondeur de plus de 5oo yodjanas, est la demeure du roi Yan lo; ce sont les enfers. On les nomme Tiyo, parce qu'ils sont au-dessous de la terre. De ces enfers, il y en a de grands et de petits. Des grands, il y en a huit chauds et huit froids; des petits, il y en a seize qui sont placs aux portes de chacun des grands, et dissoient successivement poss de manire que les tourments augments : c'est et du redoupourquoi on les nomme Yeou thseng yo (enfers de la transmigration blement). Tous les tres vivants condamns souffrir traversent ces enfers; et quand ils ont subi leur peine un tage, ils passent dans un autre. Les seize tages d'enfer o l'on passe sont : i Ile cha tiyo (l'enfer du sable noir). Un vent chaud souffle sur du sable noir; il le rend brlant, le porte sur la peau et les os des coupables, qui sont brls en prouvant des douleurs affreuses. Quand ils ont longtemps souffert de la sorte, ils passent dans l'enfer suivant. 20 Fey chi ti yo. Des boules de fer qui se remplissent d'excrments brlants s'lancent en avant et pressent les coupables, qui sont forcs de les embrasser. Elles les brlent au corps et aux mains. Ils sont ensuite forcs de les mettre dans leur bouche et de les avaler; et, depuis le gosier jusqu'au ventre, il n'y a rien qu'elles ne brlent jusqu'aux 3 Thi ting ti yo. Les ministres de cet enfer tendent les coupa'bles sur du fer chaud, et les y fixent avec des clous en leur clouant les mains, les pieds et tout le tour du corps avec cinq; cents clous. k" Ki'o tiyo (enfer de la faim). Les dmons versent pables du cuivre fondu qui, du gosier, descend jusque partout o il passe des douleurs intolrables. dans la bouche dans le ventre, des couet cause en passant. Des insectes bec de fer leur piquent os. la chair et pntrent
5 Ko li yo (enfer de la soif). Les ministres de l'enfer prennent des boules de fer chaud, les mettent dans la bouche des coupables, et leur brlent les lvres et la langue. 6 Toung hb ti yo. Les coupables sont jets dans des chaudires, o ils bouillent et o leurs corps montent, descendent et tournoient, jusqu' ce qu'ils soient dtruits.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXII.
297
70 To toung hb tiyo. Les ministres de l'enfer plongent les coupables dans des chaudires, les brlent et les dtruisent, puis les prennent avec des crocs de fer pour les jeter dans d'autres chaudires. 8 Chy mo ti yo. Les coupables sont placs sur une grosse pierre chaude; d'autres pierres brlantes leur tiennent les pieds et les mains tendus, leur crasent le corps, rduisent leurs os et leur chair en bouillie. 9 Noung hiouei tiyo. On baigne les coupables dans le sang et le pus; on leur en inonde le corps, les membres, la tte, la face, qui sont ainsi tout consums, et on leur en fait avaler. io Liang hb tiyo. Dans cet enfer, il y a de grands feux; les coupables doivent prendre un boisseau de fer pour mesurer le feu, ce qui leur brle le corps. La douleur de la brlure leur arrache des soupirs et de grands cris. i i Iloe hb ti yo. Un fleuve de cendres, qui a 5oo yeou siun de long et autant de large, exhale des vapeurs pestilentielles; ses flots se choquent et se poussent avec un bruit effroyable. Du haut en bas, il y a des pointes de fer ; sur le rivage, il y a des forts d'pes ; les branches, les feuilles, les fruits et les fleurs, sont autant d'pes. Les coupables sont entrans par le courant ; soit qu'ils montent ou qu'ils descendent, qu'ils restent la surface des flots ou qu'ils s'enfoncent, les pointes de fer leur piquent le corps et pntrent au dedans comme au dehors , en leur causant dix mille douleurs. S'ils sortent du fleuve et viennent sur le bord, le tranchant des pes les blesse, puis des panthres et des loups mangent leur chair vivante. Ils courent pour monter sur les arbres pes, mais les lames diriges vers le bas tombent sur eux; celles qui sont vers le haut leur coupent les mains. S'ils s'appuient sur leurs pieds, ils ont la peau et la chair qui tombent par terre tailles en pices ; leurs nerfs et leurs veines se tiennent. Il y a un oiseau bec de fer qui leur pique la tte et leur mange la cervelle. Ils rentrent, alors dans le fleuve de cendres et suivent le courant; mais en descendant ou en plongeant, les pointes de fer leur piquent le corps, leur dchirent la peau et la chair. Il en sort du pus et du sang, et il ne reste que les os tout blancs qui surnagent la surface. Alors il souffle un vent froid qui les ressuscite, et ils passent dans l'enfer des boules de fer. i 2 Thi wan tiyo. Les coupables sont obligs de tenir des boules de fer ardent. Leurs pieds et leurs mains sont dtruits; leur corps est debout comme enflamm. 13 Ynfoa tiyo. Les ministres de l'enfer tendent les coupables sur du fer chaud, et, avec des haches de fer chaud, ils leur coupent les mains et les pieds, les oreilles, le nez, les membres, en leur faisant endurer des douleurs inoues. i k Tchay lang ti yo. Des panthres et des loups effroyables mordent et dchirent les coupables. La chair tombe, les os sont entams, le pus et le sang coulent en rivire. i 5 Khian tchou ti yo. Un vent violent agite les feuilles de l'arbre aux pes, qui 38
298
FOE
KOUE
KL
tombent sur le corps des coupables; leur tte, leur figure, tous leurs membres sont blesss et dchirs. Un oiseau bec de fer leur crve les deux yeux. 16 Han ping ti yo. Un grand vent froid souffle sur le corps des coupables et roidit leur corps; la gele attaque leur peau et leurs os, et les fait tomber. La douleur leur arrache des cris. Or, aprs que la vie est finie, tous les tres vivants qui ont commis de mauvaises actions tombent dans ces diffrents enfers \ Ce ne sont l encore que les seize petits enfers. Les noms des huit enfers brlants et des huit enfers glacs, qui sont les grands enfers, expriment galement le genre de supplice auquel les coupables sont condamns. Les huit enfers chauds sont : i Siang tiyo. Dans cet enfer,, il vient aux vivants des ongles de fer longs et pointus. Les yeux irrits, le coeur plein de colre et de penses de haine, ils s'arrachent les uns aux autres la chair qui tombe; ils la dchirent et la broient d'une manire cruelle. Ils pensent tre dj morts; mais un vent froid souffle sur eux, leur peau et leur chair renaissent, et ils se relvent ressuscites. Dans le Cite lun cet enfer est aussi nomm Teng ho tiyo (des ressuscites). 2 Ile ching ti yo. Les dmons lient les coupables avec des chanes de fer brlantes, et ensuite ils leur coupent la tte ou les scient. Des chanes ardentes serrent leur corps, brlent leur peau, pntrent leur chair, calcinent leurs os dont ils font couler la moelle en leur causant mille douleurs : c'est pourquoi on le nomme enfer des Chanes noires h. 3 Touy ya tiyo. Cet enfer se nomme aussi Tchoung ho. Dans cet enfer, il y a de grandes montagnes de pierre; elles s'affaissent d'elles-mmes sur les coupables, dont le corps, les os et la chair sont mis en morceaux et rduits en bouillie : c'est pourquoi on le nomme enfer des Montagnes comprimes. k" Kiao iven ti yo. On jette les coupables dans de grandes chaudires, o ils bouillent en souffrant horriblement et en poussant de grands cris. 5 Ta kiao wen tiyo. Quand les dmons ont ainsi fait bouillir les coupables, un vent souffle et ils sont ressuscites; on les met alors dans des fourneaux o ils rtissent et souffrent des douleurs si cruelles, qu'ils poussent des cris effroyables : voil pourquoi on l'appelle ainsi. 6 Tchao tchy ti yo. Les murs en sont de fer. Le feu qu'on y allume produit des tourbillons de flammes qui consument les coupables au dedans et au dehors, brlent leur peau et leur chair, et en les rtissant, leur causent dix mille douleurs : c'est pourquoi on l'appelle ainsi. 7 Ta tchao tchy ti yo. Les murs de fer que la flamme a rougis en dedans et en dehors brlent les coupables. Il y a l des fosses qui sont remplies de feu et de flammes, et sur les deux bords de ces fosses sont des montagnes toutes de feu. On s San Isangfsou, liv. XLV,pag. 19-21. h Ile, noir, est pris ici dans un sens mtaphorique qui est peu prs le mme que celui de l'adjectif latin letcr.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXII.
299
saisit les coupables avec des fourches de fer, et on les prsente ce feu. Leur chair est rtie, et ils souffrent dix mille douleurs : c'est pourquoi on le nomme ainsi. 8 Wou kian ti yo. Les coupables, parvenus cet enfer, souffrent sans cesse et sans aucun repos. C'est le plus terrible de tous les enfers. L'apparence (le corps) y est sans interruption; les coupables y naissent et meurent; quand ils sont : c'est pourquoi on morts, ils renaissent; leur corps n'prouve pas d'interruption le nomme ainsi \ Les huit enfers froids sont : i L'enfer 'O feou to ou 'O pou to (en sanscrit Arbouda1). Ce mot sanscrit signifie rides, parce que les coupables, par le froid auquel leur peau et leur chair sont soumises, ont des rides et des gerures. 2 L'enfer Ny lay feou to ou Ny tseu pou to (en sanscrit Nirarbouda"). Ce mot sanscrit signifie gerure ou dchirure, parce que les coupables exposs au froid prouvent des gerures. 3 L'enfer 'O tcha tcha ou Hb hb. Ces mots ne sont pas traduits. Les coupables, cause du froid extrme, ne peuvent remuer les lvres; seulement avec leur langue ils font ce bruit. k L'enfer O po po ou Hiao hiao po. Les coupables, cause de l'excs du froid, ne peuvent remuer la langue, et seulement ce son se produit entre leurs lvres. 5 L'enfer 'Eou heou. Les coupables, cause de l'excs du froid, ne peuvent remuer ni les lvres, ni la langue; mais l'air, en passant dans leur gosier, produit ce son d. 6 L'enfer Yo po lo (en sanscrit Utpliah") ou Ming po h. Ce mot sanscrit signifie nnuphar bleu, parce que les coupables, cause de l'excs du froid, ont la peau et la chair panouies comme cette fleur. 7 L'enfer Po teou mo ou Po the mo (en sanscrit Padma, et en pli Padouma1). Ce mot sanscrit signifie nnuphar rouge, parce que les coupables, cause de l'excs du froid, ont la chair plisse et de la couleur de cette fleur. 8 L'enfer Fen to ly (en sanscrit Pou'nd'arkaB). Ce mot sanscrit signifie nnuphar blanc, parce que les coupables, cause de l'excs du froid, voient leur chair se dtacher et tomber, et que leurs os, mis nu, sont comme cette fleur. On le en place deux autres nommsl'un Koumouda, et l'autre Sugandhika. L'enfer Utphala vient ensuite. E. BUHNOUF. 0 Cet enferest mentionndans le Dharmapradipik, fol. gr v. fin. Dansle Dharmapradipik, cet enfern'est plac qu'aprsl'enferPound'arika. (Ibid. fol. grr.) Nous avonsindiqules orthographes sanscriteet pliedu motpadma,parcequ'il sembleque lesChinois aient eu connaissance de l'une et de l'autre.E.B. e Ibid.fol.gr r. init. 38. " Hian thsanglun, cit dans le San isangf sou, liv. XXXIII,pag. 5 v. L Cet enferest mentionndansle Dharmapradtiik, fol. gr v. Ibid.fol. gr v. d Acestroisenfers dansleDharmacorrespondent, nommsAbabanapradlpih,leslieuxde souffrance et Ahahanaraka. Ce dernier est raka, Alaianaraka l'enfer 'Eou heou;mais l'ordredes deux prcdents est renvers,puisqueAbabaestexactement 'O popo, et Alata, O tchatcha.Voyezfol.gr v. fin. Immdiatementaprs l'enfer Ahaha, le Dharmapradipik
300
FOE
KOUE
KL
nomme aussi Ma ha po the mo (Mahpadmaa), le grand nnuphar rouge. La peau et et semblables cette fleurh. CL. la chair sont entrouvertes La division des enfers est prsente d'une manire un peu diffrente par les Bouddhistes de Ceylan. Ils admettent huit principaux enfers connus sous le nom de Naraka ou Niraya. ( B. Clough's Singh. Diction. v Niraya, tom. II, pag. 326.) Autour de chacun de ces huit enfers sont placs quatre autres enfers plus petits : la somme totale de ces lieux de chtiment s'lve ainsi quarante. Dans le Dharmapradipik ou le Flambeau de la loi, ouvrage crit en singhalais entreml de citations d'anciens textes sanscrits et palis, on trouve un distique sanscrit dans lequel sont rsums les noms des huit enfers principaux (fol. gu v) : Samdjvam, Klasiramlcha, Samght, Ruravas tath, Mahruravatpkhy, Pralpvitchinmakh. Ces huit enfers (mentionns dans Manou, IV, 88, 89 ) se nomment Acht'a mahnrakh.--E. B.
(6) Le roi des dmons, Yan lo. ] Yan lo est le juge des enfers. Ce terme correspond $TfYama en sanscrit, iAjOri j~ gChin rdje (prince de la mort) en tubtain,
u-At LY^ 1 Erlik khan en mongol, et /-J-M A?J (_X Ilmoun khan en mandchou. On dit aussi en chinois Yan mo lo ou Yan ma lo; c'est sous ce dernier nom cpi'il en a t question plus haut. Voyez chap. XVII, not. 17, pag. kk.-KL. une prison est une (7) Il n'y a qu'un trs-mchant homme qui puisse le faire.] Garder des douze mauvaises actions que la loi rprouve et qu'on appelle O liu yi. C. L. (8) Il y avait un Pi khieou.] Un bhikchou ou prtre mendiant. (g) Vide comme une bulle d'eau.] Shkya mouni dit dans le Leng yan king : La mer est originairement immobile et claire ; mais quand les vents et les tourbillons la frappent, ils y produisent des bulles d'eau. On peut lui comparer la nature de la plus haute intelligence, qui est aussi pure, clatante et excellente, mais que les vanits du coeur meuvent, et qui rendent ainsi le monde vide et sans ralit. Ce monde vide et sans ralit est, dans la nature de la plus haute intelligence, abso lument ce que sont les bulles d'eau dans l'Ocan d. KL. (10) Les trois prcieux.] Fo, Fa, Seng (Bouddha, Dharma, Sanga), ou la triade suprme. Le Hoa yan king dit : Ce qu'on appelle Bouddha, Dharma, Sanga, bien * Cet enferestmentionndans le Dhanna-pradpih, fol.gr r. 1 Fangy mingi, citdansle Santsang f sou,liv. XXXIII,pag. 7 v. Tsa'0 py tan sinlun, cit dans le San tsang fa sou, liv. XLIV,pag. 12 v. hengyan king, cit dans le San tsang f sou, liv. IV,pag. 2I1.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXII.
501
que le nom soit en trois substances, sort d'une seule nature et est consubstantiel. Bouddha signifie intelligence, pour dire que sa nature et sa substance sont intelligentes et rationnelles, qu'il a clair les lois, qu'il n'est ni vide, ni tre. Dharnia, c'est la loi ou ce qui rgle. Cela dsigne la nature de la loi du silence et de l'extinction, qui doit servir de rgle aux vertus naturelles. Sang a, cela signifie en chinois la foule unie, pour dire que les excellentes vertus ne se sparent pas en deux modes, mais restent unies a. les trois prcieux sont distincts et diffrents. i Bouddha : quand Respectivement, il commena faire la loi sous l'arbre Po thi (bodhi), il ne montrait qu'un corps de six tchang; quand il en vint discourir sur le livre Hoajan, il parut tre le corps de l'honorable Lou clie na. 2 La loi : c'est la grande rvolution, la petite rvolution, les prceptes, les discours, les collections qui ont t rvls dans les cinq temps. (Les cinq temps sont, celui du Hoa yan, celui du Parc aux cerfs [voyez ci-aprs, chap. XXXIV], celui du Fang teng, celui du Pradjn et celui du Nirvn'a.) 3 Sanga : cela dsigne ceux qui ont reu la doctrine, qui rglent les causes, qui recueillent les fruits, ou les Cliing wen, les Youan hio et les Bodhisattwas. (Les Ching wen sont ceux qui, par les discours de Fo, ont obtenu d'entendre la doctrine; les Youan hio ont obtenu l'intelligence de la doctrine en considrant les douze enchanements ; les Bodhisaltwas sont l'intelligence avec affectionh.) [Voy. pag, 1 o.] On peut voir beaucoup d'autres dtails sur le dogme des trois prcieux, et sur son importance chez les diffrents peuples bouddhistes, dans les Observations de M. Abel Rmusat sur la doctrine samanenne, et ci-dessus, p. k.2 et 15g. G. L. (11) Sous l'arbre Pe to.] Il s'agit ici du mme arbre Pe to (lorassusJlahelliformis) sous lequel Shkya mouni obtint la perfection bouddhique. Hiuan thsang vit encore cet arbre plus de deux cents ans aprs F hian, ainsi que le mur dont le roi As'oka l'avait fait entourer. KL. (12) Haut d'au moins dix tchang.] Environ " 3om 600.
h Hoajan Hng,cit dansle Santsanij f sou, liv. VIII, pag. ai v. Chechiyao lan, cit dansle San c tsana. Journalasiatique,tom.VII, pag. 265 et suiv. f sou, liv. VIII, pag. 2/1v. Nouveau
CHAPITRE
XXXIII.
Montagne
du Pied de coq. Sjour du grand Kia ch. Demeure dans cette montagne.
des Arhan
De l au sud, me le Pied
en faisant
trois
li, on arrive
une
Il a perc
actuellement de coq (1). C'est l qu'est le pied de la montagne pour y entrer, entrt
nommontagne le grand Kia ch. et n'a pas souffert
que personne de l, rable Kia ch
A une distance endroit. considpar le mme dans lequel est le corps entier de il y a un trou latral de ce trou, est celle sur laquelle Kia en dehors ch. La terre, les gens du pays ont mal la tte, ils se lava les mains. Quand avec cette est la terre demeure et le mal des se dissipe. Dans cette Arhan (2). Les religieux y viennent montagne, de la rai-
se frottent et l'ouest,
son (3) de tous adorer dant leurs ment. touffus. voyager Kia la nuit, doutes, Les
les royaumes Ceux qui
de ces contres arrivent qui
annuellement peneux et rsoudre immdiatetrs-pais : on n'y et peut voient,
ch.
des Arhan et bois qui, qui
embarrass, l'esprit discourir avec viennent l'avoir cette fait, disparaissent sont montagne de loups
aprs couvrent
Il y a beaucoup crainte. qu'avec
de lions,
de tigres,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIII.
\^ Koukout'apda, ou suivant la transcrip(1) Le Pied de coa.] En sanscrit <=h=n<2.M tion chinoise de Hiuan thsang, Khi hhi tcha po i7to.Ce voyageur ajoute qu'on appelle aussi cette montagne Kiu lou po ilio, ou Pied du vnrable ; c'est le sanscrit <J^MI4 Gouroupda. Il dit qu'on y arrive aprs avoir fait plus de cent li dans une plaine boise, l'est de la rivire Mou ho, qui parat tre le S'on a. Il dcrit la montagne comme trs-haute et escarpe, et couronne de trois cimes. Le vn-
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIII.
505
rable grand Kia ch (Mah Ks'yapa) y habite encore, car il n'osa pas laisser voir son Nirvana. C'est pour cette raison qu'on l'appelle montagne du Pied du vnrable". Selon la chronologie chinoise et japonaise Wa khan kw tfen nen gkf oun-no tsou, Kia ch, le troisime Bouddha de l'ge actuel, se retira dans cette montagne l'anne jte f , qui est la 53e du xxixe cycle de soixante, et qui correspond l'an 905 avant notre reb. KL. [L'identit des noms produit ici une confusion de personnes et de dates. Il est important de ne pas oublier que ce nom de Kia ch ou de Ks'yapa, qui est celui du Bouddha prdcesseur immdiat de Shkya, appartient aussi plusieurs personnages des lgendes bouddhiques. C'est celui d'un des hrsiarques (pag. 1 g ); celui de trois des principaux disciples de Shkya (pag. 292 ); celui encore d'un des cinq religieux convertis par ce dernier (ci-aprs, pag. 310). Mais le passage mme que M. Klaproth vient de citer, en rapportant le fait de la retraite de Ks'yapa dans la ans environ montagne du Pied de coq l'anne go5, c'est--dire quarante-quatre aprs le Nirvana de Shkya, prouve suffisamment qu'il ne s'agit pas du Bouddha Ks'yapa , dont Fa hian a d'ailleurs dj plac les Che li ou reliques dans le royaume de Kos'ala (chap. XX, pag. 176). Le Ks'yapa dont il est question ne peut donc tre qu'un de ces disciples de Shkya auxquels on donne ordinairement l'pithte de grand. C'est le premier de ces saints personnages ou patriarches, parmi lesquels s'est perptu le secret des mystres que leur matre leur a transmis en mourantc. Ne pourrait-on pas attribuer quelque confusion du mme genre la contradiction qui existe entre le rcit de notre voyageur, qui donne Kos'ala pour la patrie de Ks'yapa Bouddha, et l'opinion de quelques autres livres qui le font natre Bnars? C. L.] (2) Est la demeure des Arhan.] Ces Arhan sont galement censs tre encore en vie, de mme que leur matre, le grand Ks'yapa. KL. (3) Les religieux de la raison.] C'est--dire des Tao sse.Voyez chap. XXIII, not. 7, pag. 23o. * Piani tian, liv. LXV, pag. 43. 1 Nouveau tom. XII, pag. /j.18. Journalasiatique, c le Mmoirede M-AbelRmusat,sur la Voyez Succession destrente-trois de la repremiers patriarches deBouddha, danslesMlanges tom.I, ligion asiatiques, pag. il8.
CHAPITRE
XXXIV.
Pietour Pa lian fo. Temple de la Vaste solitude. Ville de Pho lo na, dans le royaume de Kia chi. Parc des cerfs. Les cinq premiers hommes convertis par Fo. Royaume de Keou than mi. Temple Kiu sse lo.
le fleuve Heng (2) lianfoe (i), descendit de nomm vers l'occident. Aprs dix yeou y an (3), il vint un temple de Fo (5). Aujourd'hui la Vaste solitude {h). C'est une des stations il le cours du fleuve Heng l'ocEn suivant encore y a des religieux. la ville douze yeou y an (6), il arriva de Pho lo cident, pendant Fa hian, na (7), dans U, on vient le royaume de Kia chi (8). Au nord-est situ dans le Parc des cerfs au temple de la ville, de l'Immortel dix : ce
en retournant
Pa
la station d'un Py tchi foe ; il y a habituelparc tait primitivement des cerfs qui s'y reposent. l'Honorable du sicle fut lement Quand la loi, les dieux chantrent au milieu de sur le point d'accomplir l'espace a tudi tchi fo : Le fds du roi Pe tsing sept a embrass la vie la doctrine, et dans il va devenir jours le Ni houan; c'est plaine a accompli chapelle les des cerfs religieuse, Fo. Le pourquoi de l'Immortel. il Py on
nomme Depuis ges
entendu cela, prit ayant de la le Jardin ce lieu que l'Honorable ont du sicle construit Keou une
la loi, dans cinq
les hommes
des
postrieurs Fo dsirant
ce lieu. hommes ce Cha (9), ces men Kiu
convertir
entre se dirent cinq hommes des austrits, tan (10) pratique et un grain de riz, chanvre plus qu'on forte se livre raison son quand
lin parmi eux : Depuis
six ans, par jour encore pu le commerce
ne mangeant et il n'a pas on vit dans
qu'un grain de obtenir la loi : des hommes,
ses penses, sa bouche, comment corps, la doctrine? veilarrive, accomplir Aujourd'hui qu'il pourrait-on Fo s'tant ne pas lui parler. les cinq lons bien approch, et le vnrrent. se levrent hommes
NOTES Au nord s'assit de ce lieu,
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIV.
505
soixante
et commena
tourner
vers l'orient, pas, Fo, regardant la roue de la loi (n). Il convertit Keou
lin parmi les cinq hommes vingt pas, est le lieu o (12). Au nord, Fo raconta son histoire Mi le (i3). Au sud de l, cinquante pas, est l'endroit o le dragon / lo po demanda Fo : Dans combien de temps ces lieux pourrai-je on a lev tre dlivr de ce corps parmi du Parc lesquelles des cerfs, de des tours, Dans tous dragon? il y a deux seng kia yeou y an, il y porte le nom de ce lieu, et c'est la est il on y
lan o sont
des religieux. Au nord-ouest du temple
treize
a un royaume nomm Keou than mi {i). Son temple Jardin de Kiu sse lo (i5). Fo s'est arrt autrefois dans pour plupart le lieu a fait a lev avoir cela
de religieux, qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de la petite translation. De l l'orient, huit yeou y an, o autrefois Fo a converti les mauvais gnies. L encore, il a march et il y a des de religieux. et s'est seng assis. Dans tous ces lieux il peut des kia lan dans
des stations, tours, centaine
lesquels
une
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIV.
(1) En retournant Pa lian fo.] F hian, en quittant Pa lianfo (Pt'ali poutra), s'tait dirig d'abord au sud-est pour visiter la nouvelle et l'ancienne Rdjagrha, ou capitale des rois de Magadha, ainsi que la montagne du Vautour. De cette montagne, situe au sud de la ville actuelle de Bahar, et faisant partie de celles qui se trouvent entre les rivires Dahder et Banoura, il ah a l'ouest, traversa la rivire Ni lian (Niladjan ou Ammnat), et arriva Kiaye (Bouddha Gay). Ayant visit les merveilles et tous les lieux sacrs qui rendaient clbre cette contre, principal thtre des austrits pratiques par Shkya mouni pendant six annes il dsira retourner Pt'alipoutra pour poursuivre le but de son conscutives, voyage, qui tait de s'embarquer aux bouches du Gange pour file de Ceylan, et de retourner de l en Chine. Cependant il n'avait pas encore vu la sainte viile de Bnars et ses alentours, galement clbres dans l'histoire de Shkya mouni, comme tant le pays o l'Honorable du sicle avait commenc ses prdications. F hian, pour s'y rendre, longea donc le Gange l'ouest, et revint aprs vers l'orient Pt'alipoutra. 39
506
FOE
KOUE
KL
La trente-troisime feuille de cet ouvrage, qui contient la lgende bouddhique 1 sur l'origine de la ville de P ai alipoutra (pag. 267-259), tait dj imprime, quand j'ai eu connaissance d'une brochure intressante que M. Hermann Brockhaus a publie Leipzig en 1835, sous le titre de Fondation de la ville de Pat'alipoutra et histoire d'Oapasoka, en sanscrit et en allemand. M. Brockhaus a tir ces deux morceaux d'une collection d'historiettes de Sonia dva, dont plusieurs manuscrits se de la compagnie des Indes. Ce rcit trouvent Londres, dans la bibliothque de la fondation de Pt'alipoutra, donn, non par un Bouddhiste, mais par un sectateur de la religion brahmanique, diffre entirement de celui que j'ai extrait du voyage de Hiuan thsang. Ici, un nomm Poutraka trouve dans les monts Vindhya deux fils qui se disputent l'hritage de leur pre, consistant en un vase, un bton et des pantoufles, objets qui tous ont des vertus miraculeuses. Par un stratagme, Poutraka s'empare de ces trois objets, et s'envole par les airs. Ils lui donnent la facilit de se faire aimer de la belle P'ali, et de l'enlever du palais de son pre. Arriv avec elle sur les bords du Gange, il y tablit, la prire de son amante, et par la vertu miraculeuse de son bton, une ville qu'il appelle, d'aprs cette princesse, Pt'alipoutra. Il devient un roi puissant, se rconcilie avec son beau-pre, et gouverne toute la terre jusqu'au bord de la mer. Je n'ai pas voulu omettre ce rcit, quoiqu'il n'gale pas en intrt la lgende bouddhique porte par Hiuan thsang. KL. (2) Le jleuve Heng.] C'est le Gange. (3) Aprs dix yeou y an.] C'est--dire environ treize lieues et demie. rap-
[li) Au temple nomm la Vaste solitude.] Dans l'original, ^* $Wi; c'est la traduction d'un mot sanscrit que je ne peux restituer, peut-tre de Prntara, 'Aranya ou de Marou, dsert, plaine vaste et dserte. En tout cas, il s'agit ici du temple appel dans les livres pli Iswere patne rny, Issa patana ramaa ou Issi pattene. Ce temple tait situ dans le pays de Bnars, dans un canton trs-agrable, dix-huit yodoans (yodjanas ) au sud du Figuier d'Inde du continent du Djambou dvvpa. Tous les Bouddhas sont censs y avoir tenu leurs premires prdications. Il tait autrefois frquent par un grand nombre de mages ou sages qui avaient le pouvoir de voler dans les airs. C'est pour cette raison, ajoutent les livres pli, que ce temple a t nomm Issa patana ramaa par ceux qui ont vu cela a. KL. (5) Une des stations de Fo.] Ce sont les lieux o le Bouddha a prch la doctrine. KL. " Thesacredand historical boohs o/Ceylon,publishedby E. Uphnm.tom.III, pag. 5g, 91 et 112.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIV.
507
(6) Douze yeou y an.] Environ quatorze lieues. (7) La ville de Pho lo na.] C'est la clbre ville de Bnars, appele en sanscrit ^T^HTHt Frn'as, ^TOTff Varan as, ou =|(U(tu" Varan'as. Les deux premires dnominations sont drives, suivant les lexicographes indiens, de vara, la meilleure, et anas, eau, c'est--dire le Gange, sur les bords duquel la ville est situe. Il parat cependant que le dernier nom [Varan'as) est le primitif, quoique sa drivation soit irrgulire, de Varan , nom d'une rivire qui coule au nord-est de Bnars et se jette dans le Gange, et de Asi, qui est celui d'une autre rivire au sud de la mme ville. La Varan' est actuellement nomme Berna; son nom drive de la racine vr, choisir. Les Chinois, qui transcrivent Varan'as par -^t^JS VR[ ou V$ Ph j-^zp; lo na, expliquent ce nom de deux manires : d'abord par Parc des cerfs, puis par Entour par le fleuve : ces deux tymologies paraissent tre fautives. Hiuan thsang, qui a aussi visit cette ville, crit son nom J&- JR JS| ?0k Pho lo n sse. Il dit que c'est une vaste capitale, situe l'ouest et prs du Gange, ayant dix-huit dix-neuf li de longueur sur cinq six de largeur. Les habitations du bas peuple y sont trs-serres ; la population y est fort considrable, et le nombre des maisons monte plus de dix mille. Il y a une foule de marchands. Les moeurs y sont douces et le peuple est poli. Tout le monde y tudie avec zle. La plupart croient aux doctrines htrodoxes, et il n'y a que peu de personnes qui honorent la loi de Bouddha. Le climat y est tempr; le sol produit des grains et des fruits; les arbres y ont une croissance extraordinaire, ainsi que les herbes et les plantes. On y compte plus de trente kia lan et environ trois mille prtres et disciples, qui suivent tous les doctrines de la petite translation. Il y a environ cent temples clans lesquels dix mille hrtiques honorent le Grand Dieu existant par lui-mme [Is'vara). Ils se coupent les cheveux ou les portent en noeud sur la tte. Ils A^onttout nus et se couvrent le corps de cendres. Les plus pieux vivent dans des austrits continuelles et cherchent quitter la vie pour la mort. Au nord de la ville coule la rivire Pho lo n (Varan') ; sur son bord, dix li de la ville, est le kia lan de la Plaine des cerfs : il y viron quinze cents prtres et disciples, qui suivent tous la doctrine de la petite lation. Au milieu de la grande enceinte est un temple haut de plus de deux pieds; il est couronn par une flche dore. Les fondations sont construites a entranscents avec
une pierre appele 'An mou lo ko, et les murs des tages sont de briques. Ce temple est entour d'une centaine de chapelles; toutes ont des flches, et on y voit des images divines dores. Au milieu du temple sont des statues de Bouddha et d'un grand nombre d'autres Tathgatas, sculptes en pierre y Jf ^iC0U c'lJ " Ces images sont toutes dans la posture de tourner la roue de la loi ( de prcher)b. KL. 0 Suivantles dictionnaires danois, cettepierre se trouveen Perse; eiie ressemble l'or et ne noircitpas. '' Pian i lian, sect.LXXV, art. 8. 39.
508
FO
KOU
Kl.
(8) Le royaume de Kia chi.] C'est le nom sanscrit ^fsj Ks'i, dont on se sert encore aujourd'hui pour dsigner la ville et le pays de Bnars; il signifie KL. resplendissant. (g) Parmi les cinq hommes.] Voyez la note 12. (10) Ce Clia men Kiu tan.] Kiu tan est la transcription chinoise du sanscrit Gutama, l'un des nombreux surnoms de Bouddha, et celui qui est plus particulirement en usage dans l'Inde au del du Gange, o il a servi former le nom de la principale divinit des Siamois, Somonakodom, par l'addition de l'pithte Somona [s'rman'a), Samanen. Au reste, toutes les nations bouddhistes ont ce nom galement en honneur : au Tibet, c'est Geoutam; en mandchou et en mongol, Goodam. On est moins d'accord sur sa signification, et chacun des peuples qui adore Bouddha a, sur ce point comme sur tant d'autres, des traditions obscures et parfois si diffrentes, qu'il est presque impossible de les concilier. Quoique les livres chinois ne contiennent rien de satisfaisant cet gard, il peut cependant ne pas tre tout fait inutile d'indiquer brivement ce qu'ils en disent. Suivant eux, Chy kia est le nom honorable de Kiu tan a. Tous les hommes savent, disent-ils, que Jou lai descend d'un prince Tcha ti li (Tchatrya), mais ils ne savent pas que Kiu tan tait autrefois le nom de Chy kia. Dans le principe, il y avait cinq noms qu'on lui donnait indiffremment : Kia tan, Kan tclie ( canne sucre), Jy tchoung (descendant du et enfin celui de Chy kia, qui est aujourd'hui soleil), Che y (sjour tranquille), presque le seul qui soit rest. Kia tan est le nom de famille des rois Tcha ti li ; il signifie en sanscrit parfaitement pur, ou grand vainqueur de la terre. Au commencement de l'ge actuel, il y avait un roi nomm Ta mao thsao. Ayant abandonn son royaume un ministre, il vint auprs du sage Kiu tan pour tudier la doctrine, et prenant le nom de son matre, il s'appela le petit Kiu tanh. Le nom de Qxy kia est interprt d'une manire moins confuse. En sanscrit il signifie capable de pit. Chen yen, premire femme du roi Kan tche, eut un fils nomm Tchang cheou, et la seconde femme en eut quatre. Chen yen, pour favoriser son fils, excita le roi bannir du royaume ses quatre autres enfants. Parvenus au nord des Montagnes de neige, Pe tching, qui tait le quatrime de ces enfants, devint roi, leva une ville, et fonda un royaume que l'on nomma Che y (Sjour tranquille). Son pre s'tant repenti de l'avoir exil, le rappela, mais il ne voulut pas revenir; alors le roi, soupirant, dit : Mon fils chy kia! et c'est de l qu'est venu ce nomc. tseutoung,au mot >ffi*. b Chychyyao lan, cit dans leSantsangfsou,liv.XIX, pag. 11 v, Tching Id. ibid.pag. 22. "
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIV.
509
Il est intressant de comparer ce rcit avec la lgende relative au mme fait, extraite du Khgliyour par M. Csoma de Krs, et rapporte ci-dessus, chap. XXII, not. 1o , pag. 2 1 3. C. L. [Les Singhalais possdent, sur l'origine de la dnomination de Gatama, deux traditions qui paraissent contradictoires. Suivant Clough [Singhal. Diction. v Gutama), Shlya mouni est nomm Gatama, parce qu'en entrant dans la vie religieuse, il suivit les leons du sage Gtama, que l'on suppose tre le mme philosophe auquel on rapporte le systme appel nyya. Suivant d'autres, Gatama est le nom propre de la famille dans laquelle est n Shkya. Cette dernire opinion est, comme on voit, identique celle des Bouddhistes de la Chine. Or ces deux traditions donnent lieu aux difficults suivantes. Les vies de Slikya connues jusqu' ce jour ne disent pas d'une manire expresse que Shkya ait suivi les leons du philosophe Gtama; et quand mme il en aurait t ainsi, rien ne prouve que Slikya et d, pour cette seule raison, prendre le titre de Gatama,- lequel signifie le Gautamide. Secondement, le nom de Gatama est celui d'un descendant de la famille de GIl ne semble pas tama, famille qui est un des Gtras (ou souches) brahmaniques. que ce puisse tre celui d'un membre de la caste guerrire, car les jurisconsultes indiens affirment, d'une manire positive, que la caste des Kchatriyas n'a ni Gtras, ni saints tutlaires. Il rsulte de l qu'il n'est pas ais de comprendre comment Slikya a pu porter la fois ce nom, qui rappelle la tribu guerrire laquelle il apLa seule partient, et celui de Gatama, qui rappelle une famille brahmanique. manire de rsoudre cette dernire difficult, c'est d'admettre que le nom de Gatama a d appartenir, non pas seulement Shkyamouni seul, mais toute la famille guerrire des Shkyas, comme le pensent les Chinois. On sait en effet qu'il est permis aux Kchatriyas de prendre le nom de famille de leur prtre domestique ; d'o il suit que pour s'expliquer comment la race des Shkyas s'est appele Gautamide, il suffit de supposer qu'elle avait un descendant de Gtama pour prtre domestique ou pour directeur spirituel. Cette distinction, purement indienne, entre les Brahmanes qui possdent par eux-mmes le droit de dsigner leur famille par le nom du saint qui en est le chef, et les Kchatriyas qui empruntent ce nom de leur patron religieux, a pu tre oublie des Bouddhistes, qui n'admettent pas la sparation des castes au mme degr que les Brahmanes. L'ignorance de ces prescriptions, qui tiennent aux particularits les plus intimes de l'organisation brahmanique, a pu donner naissance aux deux traditions singhalaises. L'une aura cherch concilier le titre de Gautamide avec l'existence du philosophe clbre nomm Gtama., l'autre aura conserv la vritable tradition, mais, ce qu'il semble, sans la comprendre, ou du moins sans l'expliquer. E. B.] (11) Commena tourner la roue de la loi.] C'est--dire o il tint ses premires 2 2 5. prdications. Voyez chap. XX, not. 22 , pag.
510
FO
KOU
Kl.
(12) Il convertit Keou Un parmi les cinq hommes.] Keou lin est ordinairement nomm Keou li dans les ouvrages bouddhiques chinois. Voici les noms de ces cinq personnages clbres, selon les livres chinois et selon les lgendes mongoles, o ces noms sanscrits se trouvent traduits en tubtain. i A j Kiao tchhin ju, en tubtain Yang chi Go di ni y a. Aj, dit le Fan y ming i, est son surnom, et signifie sachant; Kiao tchhin ju est son nom de famille ; il signifie bassin feu. En pli ce nom est transcrit par Adja kondandjan. Il tait d'une famille de Brahmanes, et il avait, dans les mondes prcdents, fait le service du feu : de l lui vint son nom de famille. Il appartenait celle d'un oncle maternel du Bouddha. 20 0 pi, ou plutt As'vdjit, comme nous l'avons vu chap. XXVIII, not. 11, pag. 267. Le Fan y ming i traduit ce nom par qui monte cheval ou par matre du cheval. Il est rendu en tubtain par rTa toi, ce qui signifie un cheval dress. 0 pi tait de la famille du Bouddha. 3 P thi, dont le nom est expliqu en chinois par petit sage, est en tubtain Ngang zen ou Ming zan. Il tait galement de la famille du Bouddha. 4 Chy ly Kiay, c'est--dire Ks'yapa force dcuple (en sanscrit ^aj^i^ia^M Das'abala Ks'yapa), est aussi nomm en chinois Pho fou, en tubtain Lang ba. Il tait de la famille des oncles maternels du Bouddha. Le Fan y ming i observe qu'il ne faut pas le confondre, ni avec le Mah Ks'yapa, ni avec les trois Ks'yapas, Ourouwilv Ks'yapa, Nad Ks'yapa et Gaya Ks'yapa. 5 Keou li tha tseu ou le prince royal Keou li, appel par F hian Keou lin; en tubtain Zang den. Il tait le fils an du roi Hofan ivang, oncle maternel du Bouddha. Voyez chap. XXII, not. 3, pag. 2o3 a. Ces cinq personnages sont appels dans les livres singhalais Paswaga Mahanounansi, ou les cinq grands prtres ; c'taient des Brahmanes trs-instruits et principalement habiles dans la prdication. Ayant reconnu les marques caractristiques de la personne du dernier Bouddha, savoir, les trente-deux Assoulakounou (Cf. pag. 210) et les deux cent seize symptmes appels Magoul-lakounou, ils acquirent la cer\ tude qu'il deviendrait Bouddha. Ils embrassrent alors la vie religieuse, et le suivirent et le servirent pendant les six ans qui prcdrent le moment o il obtint la dignit de Bouddha. Aprs avoir entendu la premire prdication qu'il fit en cette qualit, ils obtinrent la gloire ternelleb. Un trait mongol intitul : Histoire de l'origine des quatre vrits de toute la loi, raconte de la manire suivante la conversion des cinq personnages en question : Le quinzime jour du dernier mois du printemps de l'anne Brouh-ah, ou du boeuf de fer femelle, pendant le crpuscule du soir, Bouddha termina ses occupations spi" Fan y mingi, citdansle Santsangf sou,liv. XXI, pag. 26 v. h Thesacredand historical boolts of Ceylon, publishedby E. Upliam,tom. III, pag. 59.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIV.
511
rituelles qui consistaient dans la soumission entire des esprits du Nisbana (PjlH^ Nichpanna, naissance) ou de la sduction de la naissance. A minuit il obtint le Dyan (^"FT D'hyna, la plus profonde mditation) ou le plus haut degr de la saintet des ermites, et au lever du soleil il avait atteint la nature d'un Bouddha vritablement accompli existant par lui-mme dans la spiritualit suprme. Le Bouddha vritablement accompli commena alors tourner la roue de la doctrine spirituelle et rpandre partout la loi, en dclarant qu'il avait remport la victoire sur les abmes de la misre inne, qu'il avait dtruit toutes les imper fections qui oppriment l'me, et qu'il tait devenu le Bouddha instituteur du monde. Plusieurs personnes parmi le peuple en furent consternes et dirent : Le fils du roi a perdu l'esprit et draisonne. D'autres prtendirent qu'il avait quitt le trne et le pays pour pouser une fille de Shkya; d'autres, enfin, proclamaient que le fils du roi tait en effet un Bouddha vritablement accompli. Le Bouddha pronona alors l'instruction suivante : A quoi bon offrir au peuple le nectar de la doctrine spirituelle, puisque l'instruction lui manque? Puisqu'il n'a pas d'oreilles pour l'entendre, il est inutile de la lui dvelopper. En consquence, il se retira derechef dans la solitude, au pays 'Archi, o il resta pendant quarante-neuf jours et autant de nuits pour obtenir un nouveau Dyan. Ds qu'il l'eut obtenu, Esroun tgri [Bvahma) se rendit auprs de lui, portant dans la main une roue d'or mille rayons, symbole de la domination spirituelle, et dit au Bouddha : Tu n'es vraisemblablement pas devenu Bouddha pour ton propre bonheur, mais pour celui de toutes les cratures du monde; daigne donc poursuivre l'oeuvre de rpandre la doctrine. Mais le Bouddha ne se rendit pas celte invitation. Les Mah rdja tegri a tenant dans leurs mains les Naman takilh, vinrent alors et lui dirent : Matre de la dcuple force, grand hros qui as vaincu toutes les sductions innes dans la crature, ne jugeras-tu pas propos de te charger du salut des cratures? Leur demande fut galement refuse. Enfin, Khourmousda tegri (Indra) lui-mme, accompagn des trente-deux autres tegri, vint auprs du Bouddha pour l'adorer, et ils lui rendirent les honneurs dus un Bouddha, en faisant le tour du lieu o il sjournait. Kliourmousda, tenant 3. OEldzailou tsoun,une figurede lignesentrelaces la grecque. e lotus. k. Badma, le parasol. 5. Chikour, le vasepour l'eaubnite. 6. Boumba, 7. lgahsoun djimili,une espced'tendardcomposslesuns sur les autres. posde sixcapuchons 8. Kurdu,ou la rouede la puissance. la flammeSrivasta Les Mongols et le remplacent des Bouddhistes Tchouri du Npal,par la ligure07.7et le Kurdu. dzaitou tsoun
* Les quatreMahrdjategri (ou grandsroisdes esprits) sont les gardiens des quatre rgions du monde. h Naman tahil ( ou les huit sacrifices ) ; c'estla dnominationmongole des huit Vitrgaou emblmesdes neuf Bodhisatwas, sur lesquelson peut consulter le Nouveau Journal asiatique, tom. VII, pag. n , not. i. Leurs noms en mongolet leur ordresont: i. Dzighasoun ( Dzsoun ), les poissons. 2. Doung ou Doungar, la conquemarine.
512
FO
KOUE
KL
la main le Doung erdenia, lui dit : 0 toi crateur du nectar de la spiritualit, qui, semblable un mdicament prcieux, purges et guris la crature du malciheur inn dans lequel elle sommeille, daigne faire entendre ta majestueuse voix spirituelle. A cette invitation taient prsents les cinq prtres et disciples du Bouddha, savoir : Yang chi Go di niya, rTa toi, Ngang zen, Lang ba et Zang den, qui jusqu'alors n'avaient pu parvenir former un jugement sur leur matre. S'en tretenant entre eux de la sagesse du Bouddha, ils dirent : Si Goodam est devenu Bouddha, il faut que nous adoptions sa doctrine spirituelle; mais s'il n'est pas encore parvenu au rang de Bouddha, pourquoi l'adorerions-no us? Dans le mme moment, Yang chi Go di niya qui se sentait prt reconnatre le Bouddha, tourna tout coup les yeux vers lui, et aperut que son corps jetait un clat d'or, et qu'il tait entour d'une aurole brillante. Entirement convaincu par ce signe, il ac complit le premier l'adoration due au Bouddha, et obtint par l le droit de lui succder un jour dans sa dignit. Les quatre autres disciples suivirent son exemple et adorrent galement le Bouddha. Ils lui dirent : Puisque tu es devenu le vritable Bouddha du monde, daigne te rendre Varan'as, car c'est l qu'a t le trne (( des mille Bouddhas de la priode passe ; c'est l que tu dois sjourner et t'occu per de l'oeuvre de tourner la roue de la doctrine. Pendant qu'ils lui adressaient cette prire, ils ne quittrent pas la position de l'adoration. Une aurole nouvelle en touraalors le Bouddha, et tout son corps jeta des rayons d'un clat inexprimable. Cdant aux pressantes instances de ses disciples, S'hkya mouni se leva et se rendit Varan'as, pour adorer et occuper le trne des mille Bouddhas; il choisit pour son sige principal celui des trois Bouddhas de la priode actuelle du monde, Ortchilong ebdektclii (Krakoutchtchanda), Altan tchidaktchi (Kanaka mouni), et Gerel zakiktchi (Ks'yapa). Dans la mme anne, le quatrime jour du mois du milieu de l't, le Boud dha agra pour ses premiers disciples les cinq prtres mentionns plus haut, et leur communiqua les principes des quatre vrits spirituelles. L'existence de la misre est la premire ; la seconde est que cette misre immense tend son em pire partout ; la dlivrance finale de cette misre est la troisime ; enfin la qua trime est le nombre infini des obstacles qui s'opposent cette dlivrance. En ajouta-t-il, vous qui tes prtres, vous tes galement soumis cette consquence, misre, mais vous en connatrez l'immensit; vous contribuerez montrer aux autres le chemin de la dlivrance, et vous devrez tout faire pour en carter les obstacles. la note 8 du cha-
(i3) Raconta son histoire Mi le.] Voyez sur ce personnage pitre VI, pag. 33. erdeni(ou la prcieusecoquille) estune Doung grande coquilleblancheet le seconddesNamallahil. a
LesBouddhistes s'en serventsouvent dansleurs crmoniesreligieuses, pour donner dessonsde cor.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIV.
515
(i/t) Un royaume nomm Keou than mi.] Hiuan thsang et la carte chinoise-japonaise de l'Inde jointe ce volume, appellent ce pays Kiao chang mi; en sanscrit ^iSJT5^! Kaus'mb. C'est le nom d'une ancienne ville situe sur le Gange, dans la partie infrieure du Doub, et dans le voisinage de Kurrah; on l'appelle aussi Vatsapattana. Le nom de Kaus'mb lui vient de son fondateur Kous'mba". Hiuan thsang donne ce royaume six mille li de circuit et le dcrit comme trs-fertile. Le climat y est froid; les habitants sont d'un caractre dur et froce; cependant ils aiment l'tude et s'occupent des sciences et des arts. Il y trouva une dizaine de kia lan, mais dans un tat de dlabrement extrme : aussi n'y avait-il qu'environ trois cents prtres et disciples; ils suivaient les doctrines de la petite translation. Il y a environ aux hrtiques, lesquels sont trs-nombreux cinquante chapelles qui appartiennent dans le pays. Dans la ville est un grand temple, haut de plus de soixante pieds, o l'on voit une image de Bouddha sculpte en bois de sandal et suspendue en haut la pierre. Ce temple a t construit par ordre du roi Ou thoyan na (dont le nom signifie amour manifest)1.KL. c [ M. Rmusat observe qu'on peut douter que F hian ait visit lui-mme ce royaume de Keou than mi. Il n'en parle, en effet, que vaguement; et au lieu de son expression ordinaire, on arrive tel pays, on trouve telle ville, il se contente simplement de dire il y a un royaume. Les circonstances qu'il rapporte sont communes un trop grand nombre de lieux, pour pouvoir servir fixer avec prcision l'emplacement de celui-ci; seulement les indications du voyageur le mettent 60 milles au N. O. de Bnars, entre les territoires d'Aoude et d'Allahabad. C. L.] (i5) Son temple porte le nom de Jardin de Kiu sse lo.] Hiuan thsang en trouva les ruines dans l'angle sud-est de la ville mme. Il dit que ce temple a reu son nom de celui d'un chef appel Kiu sse lo (Kous'ala?), qui l'a fond. Dans l'intrieur il y a une chapelle ddie Bouddha d. KL. * Wilson'sSanscrit 2' dit. pag. 255. b Piani lian, liv. LIV,pag. 3 t. ' Mmoire goDictionaiy, d le de hian. i loc.cit. sur Voyage Chy Pian lian, pag. /|. f graphique
/+0
CHAPITRE
XXXV.
Royaume
de Th thsen. Le seng kia lan Pho lo yu.
cents yeou y an (i), il y a un royaume nomm Ta thsen (2), o est un seng kia lan du Fo pass Kia che (3). On a une grande de rocliers le faire. Il a en tout montagne perc pour renferme cinq tages ; l'infrieur, qui a la forme d'un lphant, cents chambres de pierre. Le second tage, qui a la forme d'un cents chambres. contient Le troisime, quatre qui a la forme cheval, d'un forme contient boeuf, d'une trois cents deux chambres. cents contient colombe, Le quatrime, qui chambres. Le cinquime, chambres. cinq lion, d'un
De l au sud,
deux
a la forme qui a la
contient
cent
il y a une source d'eau qui suit les elle entoure les appartements, et descend, coulant, le tour de l'difice, dont infrieur, jusqu' l'tage les appartements tous les tages, laisser ment l'difice pour tites entrer claire on monter; chelles,
A l'tage suprieur du rocher; en circonvolutions en faisant elle arrose ainsi aussi
Dans les chambres de ; puis elle sort par la porte. il y a partout des fentres dans le roc pour perces la lumire, de sorte que chaque chambre est parfaiteet qu'il Aux quatre de n'y a pas d'obscurit. angles et on y avait pratiqu des escaliers prsent les hommes montent de pepar des espces l'endroit un homme o autrefois a laiss pour arriver perc de ses pieds. Voil pourquoi on appelle lo yu en indien colombe (4). Dans signifie des Arhans ce temple ce temple, le roc,
avait
l'empreinte Pho loyue.
d'un Pho
Cette colline est qui y demeurent. ce n'est qu' une distance de la trs-loigne Les habitants sont des gens pervers montagne qu'il y a des villages. les Brahmanes, qui ne connaissent pas la loi de Fo. Les Samanens, d'autres htrodoxes et tous les gens de ce pays avaient souvent vu
il y a habituellement dserte et inhabite;
NOTES des hommes de rites, volant? la Raison les arriver des
SUR en volant
LE
CHAPITRE
XXXV.
515
autres leur
habitants avons
ce temple ; quand donc les religieux voulurent venir y pratiquer les royaumes dirent : Pourquoi ne venez-vous pas en
vu des religieux en volant (5). Les reliy arriver : Nos ailes ne sont pas encore formes. gieux rpondirent Les routes du royaume de Th thsen sont dangereuses, pnibles, et difficiles connatre. Ceux qui veulent d'abord doivent y aller une certaine somme au roi du pays, alors il leur enpayer d'argent voie des gens pour les accompagner et leur montrer le chemin. A leur retour, ils s'indiquent le chemin les uns aux autres. Fa hian n'a pu y aller, et il tient des gens du pays ce qu'il en a pu dire.
Nous
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXV.
(i) A deux cents yeou yan.] Environ
deux cent soixante et dix lieues.
(2) Un royaume nomm Th thsen.] Le nom de ce royaume s'crit en chinois il diffre par consquent, sous tous les rapports, de celui de ;f|^ 4r tf|jj; Ta thsin, par lequel les Chinois dsignent l'empire romain. Nanmoins les rdacteurs de la grande collection gographique, faite par ordre de l'empereur Kang hi, et intitule Pian i tian % n'ont pas manqu de confondre le royaume indien de Th thsen avec cet empire. Le Th thsen de la relation de F hian n'est videmment que la transcription du mot sanscrit ^fsdU| Dakchin'a (le sud), dnomination qu'on applique la vaste contre appele encore aujourd'hui Deccan, ce qui n'est qu'une prononciation vulgaire de Dakchin'a. Th thsen est le pays des AcryvartJV de l'auteur du Priple de la mer Erythre, qui ajoute que Jti%tvodsignait le sud dans la langue des Indiens. KL. (3) Un seng kia lan du Fo pass Kia ch.] Il s'agit ici du Bouddha Ks'yapa, dont l'poque religieuse a prcd celle du Bouddha Shkya mouni, qui est celui de l'poque actuelle. Ks'yapa est le troisime des Tathgatas qui ont paru dans le kalpa dans lequel nous vivons; il est par consquent cens avoir vcu presque deux millions d'annes avant Shkya mouni. Voyez chap. XX, note 3g, p. 189. KL. * Piani tian, article Ta 7 thsin,liv. LX, pag. 8. 4o.
516
FOE
KOU
KL
[) Pho lo yu en indien signifie colombe.] Pho loyu n'est pas tout fait la transcription du mot sanscrit m^cT Prvata (pigeon); c'est plutt celle de niiflT Pet dans d'autres dialectes de l'Inde mridionale 11, rav, qui, enmahrattea, dsigne le pigeon gris ou pourpre. Il serait difficile de dterminer dans quel canton du Deccan ce monastre bouddhiste de la Colombe tait situ; l'indication de F hian, qui n'y avait pas t lui-mme, est trop vague pour pouvoir guider le retrouver parmi les nombreuses excavations qu'on rencontre dans les montagnes de l'Inde. Cependu ve sicle dant le fait mme de l'existence de ce monument au commencement de notre re, est dj trs-intressant; il pourra servir modifier l'opinion de quelques savants anglais qui ont visit l'Inde, et qui se croient autoriss ne pas attribuer une trs-haute antiquit aux excavations qui se trouvent dans les rochers de l'Hindoustan. Voici, par exemple, ce que le clbre H. H. Wilson dit sur ce sujet : Un aperu des rvolutions religieuses de la pninsule resterait incomplet, sans quelques notions sur ces temples fameux, pratiqus dans des cavernes, qu'on y rencontre en grand nombre, et sur ses autres monuments religieux. La collection du colonel Mackenzie n'ajoute rien ce que nous savons sur les premiers; il est mme difficile de les faire connatre autrement que par des dessins, et le peu de plans de ce genre qui se trouvent dans sa collection, n'ont presque aucune va leur. Ce dfaut est de peu d'importance, puisque ce sujet a t amplement trait dans les Recherches asiatiques et dans les Transactions de la Socit littirrire de Bom<ibay; dans ces dernires principalement, par M. Erskine, d'une manire qui ne laisse rien dsirer. Cet crivain joint des connaissances un trs-tendues, jugement sain, un esprit critique d'observation, une conception distincte, et le talent de dcrire avec clart. Sa description d'Elephanta, et ses observations'sur a les restes des monuments des Bouddhistes dans l'Inde, doivent tre tudies avec attention par tous ceux qui s'occupent de recherches sur l'histoire des Boud dhistes et des Djains. Les cavernes appartiennent en gnral ou au culte de S'iwa ou celui de Bouddha. Il n'y a que fort peu d'excavations de Djains Ellora, et il n'y en a aucune Elephanta ou Kenneri. Nous manquons d'indications suffi sants pour dterminer l'antiquit de ces excavations ; cependant il n'y a pas de raison de croire qu'aucune d'elles soit d'une haute antiquit; on ne saurait non plus dire prcisment si ce sont les sectateurs de S'iwa ou les Bouddhistes qui, les premiers, ont excut ces difices : on pourrait cependant supposer que ce furent les derniers; dans ce cas, les sectateurs de S'iwa se les seraient appropris aprs la chute des Bouddhistes ; aussi M. Erskine suppose que les cavernes d'Elephanta ne peuvent avoir plus de huit sicles de date. Selon une tradition dont j'ai dj parl plus haut, les Bouddhistes ne vinrent dans la pninsule de l'Inde, que dans aA Dictionary of theMarat'ha language,by lieut. col. Vans Kennedy.Bombay,182/1, in-fol.pag. 72. b En hindostcmi pareiwa. 'y?.f>.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXV.
517
le iif sicle aprs J. C; leurs excavations n'ont v ou vic. Les adhrents de S'iwa qui creusrent appartenaient une secte de Djoghis, comme tures, les grands pendants d'oreilles, les figures
donc pu tre faites que dans le des cavernes du mme genre, le prouvent, dans leurs sculpamaigries des pnitents, les r-
ptitions et tous les dtails du sacrifice de Dakcha, qui est une histoire favo rite des S'auva pourn'a, dont aucun n'est vraisemblablement plus ancien que le viiie sicle \ Le Fo kou ki rfute suffisamment l'hypothse de ceux qui veulent que les Bouddhistes n'aient paru dans l'Inde qu'au in 0 sicle de notre re; et une perquisition minutieuse dans les environs de Patna, de Gaya ou de Bnars, pourrait peut-tre faire retrouver quelques dbris des monuments que F hian y a vus, et qu'il a dcrits. Il est mme prsumable que le monastre de la Colombe existe encore dans le rocher du Deccan o il a t primitivement taill, et que la dcouverte en est rserve quelque savant anglais qui parcourra ce pays en scrutateur habile et en observateur exerc. KL. (5) Voyez, propos de cette facult de voler par les airs, la note k du chapitre prcdent, page 3o6. etc. collected by lient,col.Collin descriptive Catalogue ofthe orientalmanuscripts, Machenzie, by H. H. Wilson.Calcutta,1828,in-8,vol. I, introd.pag. Ixixet suiv. " Macltenzie Collection. A
CHAPITRE
XXXVI.
Livres et prceptes recueillis Prceptes
des Mo ho seng tchhi. par F hian.Prceptes des Sa pho to. Les A pi tan.
on revient de Pho lo na, en allant l'orient, Du royaume jusdemand les avait d'abord qu' la ville de Pa lian fo (i). Fa hian de l'Inde du nord les mais tous les matres des royaumes prceptes, avaient transmis de bouche, il s'avana sans un volume plus loin et parvint une collection de du Mo ho y an (3), il obtint monastre des Mo ho seng tchhi (4), des prceptes C'tait la collection prceptes. suivis par le plus qui, du temps que Fo tait dans le sicle, furent dans le temple Ce livre fut communiqu (F hian) grand nombre. c'est pourquoi L, dans un Tchhi liouan matres (5). Pour les dix-huit autres collections (6), chacune pas connatre a des Le grand conforme, tendus, F hian Koue (7) ne diffre le fait l'usage ceux qui renferment les obtint former dans qui pt tre crit (2); du milieu. dans l'Inde
qui s'y appuient. quand le petit n'est pas les plus les plus vrais, les traditions, pltement sont recueillis les
du petit ; (8). Mais
une
le plus comcollection o
sept mille kie (9); ce to (10), ceux que les religieux sont les prceptes Mais tous ces prceptes t de la terre de Thsin pratiquent. ayant transmis de matre en matre, n'avaient successive, par une tradition par crit dans des livres (n). Il eut aussi dans cette pas t consigns divers extraits des A pi tan (12), formant environ six mille collection prceptes, runis des pouvant Sa pho ki. Il eut cinq cents d'atteindre des livres sacrs (i3) en deux mille exemplaire ainsi qu'un volume du livre sacr sur les moyens he, le Pan ni houan (i4) d'environ cinq mille kie, et YA pi tan aussi hian ici trois tudiant les un
des Mo ho seng tchhi. Fa C'est pourquoi
sjourna
annes,
NOTES livres et la langue fut arriv
SUR Fan
LE et
CHAPITRE copiant les
XXXVI. prceptes. Tao
519 tchhing, vu la loi de des
(i5),
dans le royaume du Milieu, lorsqu'il qu'il eut des Cha men et tous les religieux se conduisant dcents, graves, manire tre admirs, en soupirant, pensa, que les religieux frontires saient Fo, du pays de Thsin leurs il dit devoirs; de ne manquaient que dans
aux prceptes et transgress'il pouvait devenir l'avenir,
clans le pays des frontires; pas renatre c'est pourquoi il demeura et ne revint dont le prepas. Fa hian, mier dsir tait de faire que les prceptes se rpandissent et pntrassent dans la terre de Han, revint donc seul.
il souhaitait
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVI.
(i) La ville de Pa lian fo.] C'est--dire Pt'alipoutra. Voyez sur la route suivie par F hian de Pho lo na Pa lian fo, la note i du chapitre XXXIV, pag. 3oo. (2) Sans un volume qui put tre crit.] Ceci dmontre que dans la partie du nordouest de l'Inde, qui est celle que les Chinois appellent le Thian ths septentrional, la civilisation et l'art d'crire n'taient pas aussi rpandus que dans l'Inde du milieu, situe sur le Gange et ses affluents. KL. (3) Dans un monastre du Mo ho yan.] Voyez chap. XVI, note 34, pag. 1 ikMhayna ou de la grande translation.
des religieux de la grande (4) Prceptes des Mo ho seng tchhi.] C'est--dire, runion, ou des Arhans qui ont recueilli les prceptes de Shkya. Les traditions et qu'il faut singhalaises contiennent ce sujet des particularits intressantes, d'autant moins ngliger qu'elles offrent quelques diffrences avec les lgendes mongoles, et peuvent, en plusieurs points, servir modifier et complter les extraits que nous en avons donns a. Suivant ces traditions, la huitime anne du rgne 'Ajassat (Adjtas'atrou) '', trois semaines aprs la mort de Bouddha, cinq cents religieux, partis,de la ville de Voyezci-dessus,cliap.XXV,note 12, p. 2A7. '' Sous le rgne de Margasi'ra,d'aprsles lgendes mongoles. a
520
FO
KOU
KL
Cusinanaiv, arrivrent celle de Rajagaha-nuivara (Rdjagrha). Le roi, inform de leur venue et de l'intention o ils taient de prcher la doctrine, leur fit disposer, sur le mont JVabahara-parlnvateye, une demeure orne avec magnificence. Les religieux, ayant Ks'yapa leur tte, en prirent possession, et s'assirent suivant leur degr d'anciennet, laissant vacant le sige que devait occuper Ananda. Celuici, qui venait d'obtenir la qualil d'Arhan, le fit connatre l'assemble d'une manire extraordinaire : la terre s'tant ouverte au milieu de la salle, Ananda vint, au-dessus de cette ouverture, s'asseoir la place qui lui avait t rserve \ Alors Mah Ks'yapa, s'adressant l'assemble, demanda de quelle partie de la doctrine on s'occuperait d'abord. On dcida que ce serait du Vinna pittaka (Vinayapit'aka), et Uplisthavira fut charg de l'expliquer. Le soin de commenter le Soutra pittaka, qui contient les discours prches aux hommes, fut dvolu Ananda, qui illustra tous les passages sur lesquels il fut interrog par Ks'yapa, et composa de la sorte le Dierganikaya (Drghanikya), bana-wara qui contient soixante-deux (chaque bana-wara se compose de deux cent cinquante gthas ou vers). Le Madqui est une partie du Solra pittaka, et qui contient dimenikaya (Madhyamanikya), quatre-vingt mille bana-wara, ayant t compil et mis en ordre, le premier disfut charg de le transmettre au ciple de Damseiiewiserrint-maha-Teroonwahansey souvenir des hommes. Le Saninktenikaya (Samyuktanikya), qui est une autre partie du Sotra pittaka, compose de cent bana-wara, fut compil et divis en deux parties, dont on confia la rdaction Mh Ks'yapa et ses disciples. L'Angottercontenant deux mille bana-wara, et qui fait aussi partie nikaya (Angottaranikya), des discours ou du Sotra pittaka, fut distribu en deux parties, et Anurudda, aid de son premier disciple , s'occupa de le rdiger. Ensuite Abhidharma pittaka, qui contient les discours prches aux dieux, fut compil et divis en deux parties par les cinq cents religieux, qui recueillirent aussi en deux classes les livres infrieurs, tels que le Soutternipata (Sotranipta), ainsi rassemble par Mah le Dharmapadeya, etc. Cette collection de prceptes, Ks'yapa et cinq cents principaux prtres avec lui, fut acheve en sept mois1". Cent ans aprs la mort de Bouddha, le roi Kalasoka (As'oka) invita Sabbe kamy Yasa (Sarvakmi yas'a) et d'autres Arhans, au nombre de sept cents, se runir Visalah (Was'li), dans le temple Walucaw. L, il les questionna sur Ylstewirrewade (Sthaviravda) et le Vinaya, et les chargea de les mettre en ordre, ce qui fut accompli en huit mois c. En dernier lieu, le roi Dharms'oca ayant demand Moggali-putte-Tissemahastewira et mille autres Arhans, de faire une nouvelle collection des lois de Bouddha, passageclaircitun endroitun peu obscur de la relationde Fa hian, o il estfait mentionde ce prodige, et qui n'avait pas t comment. Conf. cliap.XXX,p. 272. * Ce h Sacredandhistorical Boohsof Ceylon, by Upham, vol. I, pag. 32. c Id. ib. pag.A3.
NOTES ils se runirent
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVI.
521
Pellelup (Pt'alipoutra), dans le temple Assocarahama (As'okrma), et ils achevrent cette troisime collection dans 1%cours de neuf mois, la 2 35e anne de Bouddha, et la i 7e du rgne de Dharmsoca \ C. L. (5) Le temple Tchhi houan.] Au premier abord on pourrait induire de ce passage, que le temple dont il s'agit se trouve dans la ville de Pa lian fo, tandis qu'il est situ clans le royaume de Kos'ala. (Il en a dj t question lors de la desIl est bon de remarquer que, cription de ce pays, chap. XX, pag. 171 etsuiv.) depuis un moment, notre voyageur a interrompu le rcit de son itinraire. Il n'est pas au terme de sa course ; il a encore bien des fatigues supporter, bien des courir; mais les vues religieuses qui l'ont port entreprendre un si long plerinage sont satisfaites. Le voici parvenu dans un pays o il peut tudier la langue sacre, s'entretenir des prceptes avec des religieux clairs, les mditer et les recueillir. Aucun ne lui offrira plus de ressources; il s'y arrte donc, il s'y dangers installe en quelque sorte, et commence par rcapituler les rsultats qu'il a obtenus jusqu' ce moment. L'Inde du nord, qu'il a d'abord visite, ne lui a rien offert qui ait pu l'intresser. C'est pour lui une contre strile et presque barbare qu'il a traverse rapidement pour atteindre le pays sacr, la terre classique o les monuments et les traditions du culte auquel il est vou se conservent intacts, l'Inde du milieu. A peine y est-il entr, que partout il est accueilli avec gards, avec intrt On admire son courage et son zle, et on s'empresse de par ses coreligionnaires. satisfaire ses demandes. Les temples et les lieux saints se succdent ds lors et c'est dans le plus magnifique de tous ceux qu'il a vus, de courts intervalles, dans le temple Tchhi houan, un des difices les plus clbres du culte de Bouddha, que pour la premire fois il obtient la copie d'un recueil des Prceptes. C. L. (6) Les dix-huit collections.] Il y a deux manires de diviser les livres sacrs : ou en douze collections (J|p pou, classes), qui contiennent la fois ceux de la grande et de la petite translation; ou en dix-huit classes, qui se partagent par moiti entre ces deux doctrines. Nous donnons ci-dessous les douze classes 1. Les neuf " Sacrcdand hislorical Boohs ofCeylon, by Upbam, vol. I, p. G7. 11Selonle Tatchitonlun citdansle San ( isangf des sou, liv. XLIV,pag. 6 et suiv.), les douze classes sacrssont : livres 1 Sieoulo lo. Ce mot sanscrit [Solra) signifie doctrines attaches ou cousues. Le lien suprieurestla nature de Bouddha,l'infrieur est le mcanisme de tous les tres vivants.On appelle hing ou doctrine, la loi qui est invariable ; toutce quoi lesdixmondes se conforment,s'appelleloi; tout ce qui ne change C'estle pas dans les troistemps,s'appelleinvariable. nom gnral de tous les enseignements saints.Ce que l'on nommeSieouto lo (Sotra), ce sont les longs textes des Kingo l'ontraite simplementde la loi, en discourssuivis, longsou courts, sans que le nombredescaractres soitlimit. ( Lesdixmondes sontceuxdesBouddhas,des Bodhisallwas, desYuan ki, des Ching wen, des dieux, des hommes, des Sieou lo [Asouras],des dmonsde la faim, des brutes cl des enfers.) 2 Khiye. Ce mot sanscrit (Geya)signifiechant 4i
522
FO
KOUE
Kl.
sont : les Sotra, classes de livres appartenant spcialement la grande translation, les Geya, les Gtli, lgs Itihsa, les Djtaka, les Adbhoutadharma, les Oudna, les Vapoulya et les Vykaran'a. Les Nidna, les Avadna et les Oupades'a n'y sont pas compris, parce que, dit le Ta tchi ton lan, i dans la grande translation on nonce sans en dduire les motifs [Yin youan) [Nidna]; simplement la loi suprme, 2 on ne s'adresse qu' la raison complte, c'est pourquoi on supprime comme inutiles les discours ou instructions [Yeou pho ti che) [Oupades'a] ; 3 enfin, on ma daim, livre, dragon; quej'ai tl'oiseauaux ailes d'or, le roi dispensateurde millet, un saint roi qui faisaittourner la roue, etc. 7 A feou th mo. Ce mot sanscrit (Adbhoula ce qui n'apas dharma) signifiece qui estmcrvedleux, encoreeulieu.Commequand Bouddha, au moment de sa naissance,eut fait septpas, des nymphasnaquirent tousles endroitso il avait pos les pieds; il rpandit une vivelumirequi clairale monde, et il prononaces mots:. Je suis celui qui sauvetous les tres vivants de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Il y eut alors un grand tremblement de terre; le ciel fit pleuvoir toutes sortes de fleurs; les arbres rendirent des sonset firent entendre une musiquecleste.Comme tout celaest extrmementrare, on le nommechose qui n'a jamais t. Ce que les quatre troupes (les Pi khieou, les Pi khieou ni, les Yeoupho se et les Yeou pho yi) entendentet qui n'a jamais t entendu, ce qu'ellesvoient et qui ne s'estjamais vu, s'appelleainsi. 8 PhothoouA photho na. Cemol sanscrit (Avdana)signifiecomparaison (en chinoisPhiyu). C'est quand leTathgata, expliquantla loi, empruntedes mtaphoreset des comparaisons pour l'claircir et faire qu'elle soit entendue plus aisment; comme dans le F hoa king, la maisonde feu, les plantes mdicinales,etc. gG Yeoupho ti che. Ce mot sanscrit (Oupades'a) C'est, dans tousleslivressasignifieavis,instruction. crs, les demandeset les rponses,les discoursqui servent discuter tous les points de la loi.Comme dans le F hoa king, le chapitre Ti pho th to, o le BodhisattwaTchitsy discourt avec Wen chusseli sur la loi excellente. io Yeou thona. Cemot sanscrit(Oudna)signifie Cela s'entend quand, sanstre parler de soi-mme. interrog par personne, le Talhgala, par la prudence qui devinela pense des autres, contemple le ressortde tous lestres vivants,et, de sonpropre les instruitpar desprdications. Comme mouvement,
ou chant redoubl( en chinois Ing correspondant, soung), c'est--direqu'il rpond un texte prcdent, ou qu'il le rptepour en manifesterle sens. Il est de six, de quatre, de trois, ou de deuxphrases ( ($7 ). Tout celasenommesoung(chant). 3 Kia tho.Ce mot sanscrit (Glh) signifievers chant.C'estun discours direct et de longue haleine en vers, commele Khoung plan,dans le Kinkouang mingIting(le Livrede la splendeurdel'clat de l'or) et autres. A" Ni tho lo. Ce mot sanscrit (Nidna) signifie cause, raisonpour laquelle(en chinois In youan). Commequand, dans les King, il y a quelqu'un qui demandela cause, et qu'on Ht c'esttellechose. Commepour les prceptes, quand il y a quelqu'un qui transgressece qu'ils prescrivent, on en tire une consquence pour l'avenir. C'estainsique le Tathgata donne la raison pourquoi telle ou telle chose arrive: tout cela s'appelleYnyouan(cause, raison pourlaquelle).CommedanslelivresacrHoatchhing lacaused'un vnement ynphin, oon explique par ce qui a eu lieu dans des gnrationsantrieures, etc. 5 I li mouto.Ce mot sanscrit (Itihsa) signifie (en chinoisPen sse). Quandon raaffaireprimitive conte ce qui a rapport aux actes des disciplesdes leur sjoursurla terre, comme Bodhisattwaspendant dansle Pen ssephindu F hoa king,o il est questiondu BodbisattwaYowang,qui se rjouissaitdans la vertubrillanteet pure commele soleilet la lune, et dans la loi obtenue par Bouddha, et qui de son et se corps et de son bras pratiquait lescrmonies livrait toutes sortesd'austrits pour obtenirla suprmeintelligence. 6 TchctoMa.Cemot sanscrit (Djtaka) signifie naissances ouantrieures. C'estquand on raprimitives conteles aventuresque les Bouddhaset les Bodhisattwasont prouves l'poque de leur existence dans une autre terre (kciim).C'est ainsi qu'il est dit dans le Ni pan king: Les bikchousdoiventsa voir que dans les siclespasssj'ai t cerf, ours,
NOTES nifeste
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVI.
525
la vrit ternelle, sans avoir besoin, pour la dmontrer, de uniquement mtaphores ni de comparaisons [Pho tho) [ Vda] a. Ces trois dernires sortes de livres, au contraire, sont propres la petite translation, qui, d'un autre ct, n'a ni les Vapoulya, ni les Vykaran'a, ni les Oudna. Dans la petite translation, on ne traite que de la loi de la vie et de l'extinction ; c'est pourquoi il n'y a pas de Py fo lio (Vapoulya). Comme les hommes de la petite translation n'ont pas encore pu devenir Bouddhas, il n'y a pas de Ho kia lo (Vykaran'a), et il n'y a pas de Yeou tho na (Oudna), parce qu'ils ont besoin, pour des motifsh. Les neuf classes de livres de la petite translation parler, d'emprunter sont donc les Sotra, les Geya, les Gth, les Itihsa, les Djtaka, les Adbhoutadharma, les Avadna et les Oupades'a. Suivant les Bouddhistes du Npal, le corps original des saintes critures s'lve, mille volumes, qui sont dsigns, colquand il est complet, quatre-vingt-quatre lectivement ou sparment, par les noms de Sotra et de Dharma, ou par celui de Bouddha vatchna (paroles de Bouddha). Shkya sinha, le premier, recueillit par crit les doctrines laisses par ses prdcesseurs, auxquelles il joignit les siennes consacrs, quoique d'une propres. Les mots Tantra et Pourn'a sont ordinairement manire un peu vague, la distinction des doctrines sotrique et exotrique, et il semble qu'on pourrait leur appliquer plus particulirement ceux cYOupades'a et de Vykaran'a : les Gtha, les Djtaka et les Avadna paraissent tre plutt, suivant M. Hodgson, des subdivisions du Vykaran'a, que des classes distinctes 0. C. L. (7) Le grand Koue ne diffre pas du petit.] Les trois >^a Koue (appuis) correspondent aux trois prcieux, et compltent en quelque sorte ce dogme de la triade, qui est la base de toute la thologie samanenne. Jou la, quand il commena perfectionner la droite intelligence, s'adressant aux principaux d'entre ses disciples, leur ouvrit les prceptes des trois Koue, pour quitter le mal, revenir au bien et sur le Hoa y an king former la racine de l'entre dans la raison. Le commentaire dit : Les trois prcieux sont ce qu'il y a de meilleur augure et de plus excellent. dansle Lengyan,o devantl'assemble,il parle de ce qui a rapport aux cinquante sortesde dmons, sans attendre qu'A nan le prie et l'interroge. De mmedans le Mitho king,o il parle de lui-mme Cheli foi, sans que rien en ait donnl'occasion. 11 Pifo lio.Cemol sanscrit(Vapoulya) signifie et delaloi.Fangestla loi, kouang, en chinoisgrandeur grand. Lavritableraisonnaturelleest aussiappele fang, et envelopperdes richessesest aussi nomm Ce sontles livresde la loi de la grandetranskouang. lation,dont la doctrine et le sens est ample comme l'espacede la vacuit. 12Ho kialo.Cemot sanscrit(Vykaran'a) signifie explication. C'estquand le Talhgata,parlant aux aux Pratyekas,aux S'ravakas, Bodhisattwas, leur raconte l'histoire des Bouddhas.Commedans le F hoaking,oil dit: ToiAylo (surnomde Malreya), dansle sicle venir, tu accompliras l'Intelligence de Bouddha,et tu t'appellerasMalreya. " Cit dans le San tsangf sou, liv. XXXIII, pag. 26 v. h Ta tchi ion lun, cit l mme, liv. XXXIV, pag. 20. 0 Conf. litcraHodgson'sNotices of tlielanguages, tureand religionofthe Baudclhas of Npal,dans les Asiatic t. XVI, p. 2^1. Researches, 4i.
524
FO
KOU
Kl.
Ce sont des appuis au moyen desquels on peut distinguer les grandes affaires, produire toutes les racines des vertus, s'loigner des malheurs de la vie et de la mort, obtenir les joies du Ni pan. C'est ce qu'on appelle les trois appuis. i S'appuyer sur Bouddha. Kouei a le sens de revenir, cela signifie se rvolter contre le matre du mal et revenir au matre du bien. Quand on s'appuie sur la grande intelligence de Bouddha, on parvient sortir des trois souillures (celles de l'pe, du sang et du feu), s'affranchir de la vie et de la mort dans les trois mondes. C'est pourquoi le texte sacr dit : Quand on s'appuie sur Fo, on ne revient plus jamais aux autres esprits qu'adorent les hrtiques. a0 S'appuyer sur la loi. Cela signifie que ce que Fo a dit, enseignement ou raisonnement, qu'on peut mettre en action, tous les hommes doivent le pratiquer. Telle est la doctrine des anciennes traditions. Retourner, c'est quitter les mau vaises lois pour s'attacher la loi vritable. Quand on s'appuie sur ce que Fo a dit, on obtient de sortir des trois souillures et d'tre affranchi du mal de la naissance et de la mort dans les trois mondes. C'est poui-quoi le texte sacr dit : Celui qui s'appuie sur la loi est jamais incapable de tuer ou de nuire. 3 S'appuyer sur le Seng. Les hommes des trois rvolutions qui sortent de leur maison (qui embrassent la vie religieuse), sont unis de coeur clans la loi que Fo a rvle ; c'est pourquoi on les appelle Seng. Ceux qui se rvoltent contre les sectaires lesquels suivent la mauvaise pratique des hrsies, ceux dont le coeur se livre aux religieux des trois rvolutions, ceux qui croient aux hommes unis dans la droite pratique et qui s'appuient sur eux, ceux-l obtiennent de sortir des trois souillures et des peines de la vie et de la mort dans les trois mondes. C'est pour quoi le texte sacr dit : Celui qui revient vers les religieux, et s'appuie sur eux, ti ne change plus jamais et ne saurait s'appuyer sur les hommes adonns l'hrsie \ CL. ffl ; ce qui pourrait (8) L'usage le fait connatre.] Il y a dans le texte : ^^KE] s'interprter encore par on se sert d'une explication, ou d'un commentaire. Ces mots : dans ^eur acception littrale la plus stricte, signifient ouvrir et M^ ffl kflJ sse> fermer; ouvrir ce qui est ferm. Peut-tre est-ce le titre d'un livre, qui serait une sorte entre les traits de la grande et de la petite translation; mais de concordance dans ce cas, le San tsang f sou, si complet dans ses indications bibliographiques, n'aurait souvent un ouvrage de cette importance. pas manqu de mentionner Quoi qu'il en soit, il y a dans ce chapitre plus d'un passage obscur, et celui-ci est du nombre. C'est un de ceux que M. R_musat avait laisss en blanc dans l'bauche de sa traduction, avec l'intention d'y revenir plus tard, et d'employer, pour les son immense discuter et les claircir, toutes les ressources que lui fournissaient Fa kie tseu ti, cit dans le San tsangf sou, liv. IX, pag. 16 v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVI.
525
savoir et sa critique si judicieuse et si exerce. Qu'ajouterai-je de plus pour faire comprendre l'extrme dfiance avec laquelle j'ai os hasarder ici une interprtation? CL. (g) Pouvant former environ sept mille Kie.] Le mot kie est l'abrviation du sanscrit *{iv\[ gth, vers. KL.
chinoise
(10) Les prceptes runis des Sa pho to.] Il y a cinq classes de prceptes, qui forment le trsor des prceptes enseigns par le Tathgata. Voici comment on a divis les prceptes en cinq parties : Quand le Vnrable du sicle eut atteint l'ge de trente-huit ans et obtenu la loi, il se rendit la ville. Le roi ayant fini son repas de carme, ordonna Raholo de laver le bassin. Celui-ci le fit tomber, par mgarde, de ses mains, de sorte qu'il se cassa en cinq pices. Ce jour-l il y eut Fo : Le bassin s'est cass en beaucoup de bikchous, qui dirent unanimement cinq morceaux. Fo rpondit : Dans les cinq cents premires annes qui suivront ma mort, de mauvais bikchous diviseront le trsor des Pi ni (Vinaya) en cinq classes. Postrieurement il y eut cinq disciples du rang de Yeou. pho khieou to a, qui, chacun selon leur manire de voir, partagrent tout le grand trsor des prceptes du Tathgata en cinq classes, qui sont : i Tan won t ou Tan mo khieou to. Ce mot signifie destruction de l'obscurit (c'est vraisemblablement d*iy Tamoghna, destructeur de l'obscurit). Cette classe est aussi appele trsor de la loi et les prceptes diviss en quatre parties. Il est dit dans le Ta tsy king : Aprs mon Ni phan, tous mes disciples recueilleront les douze classes des livres sacrs; ils les copieront, les mditeront, les porteront la plus haute perfection, et en publieront les paroles, qu'on appellera pour cette raison la Destraction de l'obscurit. Cette classe sera celle des Tan wou t. Les quatre parties de ces prceptes sont : i la loi des Pi khieou; 20 la loi des Pi khieou ni; 3 la loi de ceux qui ont reu les dfenses ; et 4 la loi des trpasss. 20 Sa pho to. Ce mot sanscrit signifie la somme ou les prceptes des lectures [d'Oapasi). On appelle aussi cette classe la vritable loi des trois mondes. Il est dit dans le Ta tsy king: Aprs mon Ni phan, tous mes disciples recueilleront les douze classes des livres sacrs; ils les mditeront sans cesse, et y ajouteront des expli cations et des commentaires, au moyen desquels toutes les questions difficiles seront entirement rsolues. Cette classe sera celle des Sa pho to. 3 Kia se kouei. Ce mot sanscrit signifie contemplation du double vide; c'est la rgle de l'existence parfaite. Il est dit dans le Ta tsy king : Aprs mon Ni phan, tous mes clis ciples recueilleront les douze classes des livres sacrs; ils diront qu'il n'y a pas de a Selonlesauteurschinois,ce terme c'est peut-trele sanscrit -iM'lIT signifie protection grandeou proche; Oupagoupta.
526
FOE
KOU
Kl.
moi; et de cette manire ils rejetteront les erreurs comme des cadavres morts. 4 Mi cha se. Ce mot sanscrit signifie ce qui n'est pas manifest et ne peut tre aperu. On appelle aussi cette classe celle des prceptes diviss en cinq parties. Il est dit dans le Ta tsy king : Aprs mon Ni phan, tous mes disciples recueilleront les douze classes des livres sacrs. Les ressemblances de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, n'existeront pas; il n'y aura que l'espace vide. Cette classe sera celle des Mi cha se. Les cinq parties de ces prceptes sont : i les observances des Pi khieou; 2 celles des Pi khieou ni; 3 la loi des dfenses reues; 4 la loi des trpasss; et 5 la loi des religieux. 5 Pho thso fou lo. Ce mot sanscrit signifie veau. On dit que dans la plus haute antiquit, il y eut un immortel qui s'accoupla avec un veau; ce veau mit un fils au monde, et depuis, le nom de veau resta la famille. Dans cette classe on considre la vanit du moi ainsi que les cinq amas (ce sont la forme, la perception parles sens, la rflexion, l'action et la science). Il est dit dans le Ta tsy king : Aprs mon Ni phan, tous mes disciples recueilleront les douze classes des livres sacrs. Tous diront qu'il y a un moi, et ils n'expliqueront pas la ressemblance qu'on appellera la classe du Pho thso fou lo \ KL. (II) N'avaient pas t consigns par crit.] A Ceylan, depuis loi de Bouddha dans cette le, sous le rgne du roi Deveny aprs la mort de Shkya), jusqu'au temps du roi Valagambou ne 10 jours aprs la mme poque), les doctrines bouddhiques du vide. C'est ce
l'introduction de la Paetissa (206 ans (643 ans g mois et s'taient transmises
que par tradition et au moyen de prdications. Mais alors trente-six savants prtres, pensant que, dans les ges postrieurs, il pourrait y avoir des religieux de peu de cinq cents hommes d'une saintet et d'un savoir reconnus, capacit, runirent recueillir les livres saints et dans un lieu nomm Matoala, et commencrent les transcrire 11. G. L. (12) Divers extraits des A pi tan.] A pi tan, ou A pi tlia mo, est un mot sanscrit [abhidharma), qui signifie loi sans pair; c'est un des trois Tsang ou contenants, c'est--dire une des trois classes de livres o sont renferms le texte et le sens des lois. Voyez ce qui a t dit sur l'A pi tan et les trois contenants, chap. XVI, note 22 , page 108. D'aprs une autre classification des livres religieux, il y a huit contenants, qui les diffrentes sortes de king, les liu, les lun et les tcheou. King sicomprennent gnifie loi, chose constante et invariable. Tout ce que les saints ont rgl s'appelle loi ; ce que les hrtiques ne peuvent ni changer, ni dtruire, s'appelle constant ou
' Fan y ming i, cil dans le San tsangf sou, liv. XX, pag. 17 et suiv.
h Sacredand historical Books ofCeylon, byUphani, vol. II, pag. A3.
NOTES invariable. prvient
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVI.
527
Lia A^fjL,c'est la rgle; c'est ce qui distingue le lger et le lourd, ce qui les pchs. Lun, ce sont les discours o l'on traite du sens le plus profond voeu; cela dsigne les prires et les invocade diffrents pour la grande et la petite transet les Youan Mo (Pratyeka Bouddha). Ceux
des King, qui comprend les quatre A han (Agama). A han signifie loi sans pair, parce que la loi du sicle ne peut tre compare aucune autre. Les quatre A han sont : le long A han (drghgama), le moyen A han (madhyamgama), le A han mlang (samyuktgama), et le A han supplmentaire (angottargama), que , par erreur sans doute, le glossateur du San tsang f son cite le premier. 1 Le contenant des prceptes, o sont renferms ceux des quatre Feu (degrs), qui sont ceux des Pi khieou, des Pi khieou ni, des Cheoukia (dfenses reues) et des Miel tchang (disputes termines) ; les dix Soung (lectures) que le disciple de Fo Yeou pho li a mises au jour, et autres. 3 Le contenant des discours, c'est l'A pi tan et autres. 4 Le contenant des prires; ce sont les Dharani, pour loigner toutes les maladies et viter tous les maux. Dharani est un mot sanscrit qui signifie invocation, ou ce qui peut maintenir le bien et empcher le mal. Les quatre autres Tsang sont particuliers aux Pratyeka-Bouddhas. 5 Le contenant des King, o sont compris le Miao fa yun hoa king, le Ta fang Fo hoa yen et autres King. 6 Le contenant des prceptes, tels que le Chen kia king des Phousa, les dfenses du Fan wang et autres. 70 Le contenant des discours, tels que le Ta tchy ton lun, le Chy ty king et autres. 8 Le contenant des prires, tels que le Lingyen tcheou, le Ta pe et autres prires \ CL. (1 3) Un exemplaire des livres sacrs.] On a vu que ce mot devait particulirement s'appliquer aux Soutras (chap. XVI, note 24, page 110). L'numration que F hian vient de faire des traits qu'il avait recueillis, est un des points les plus intressants de sa relation ; et le nombre des gtha ou vers qu'il assigne chacun de ces livres, prouve que plusieurs d'entre eux taient d'une trs-grande tendue. Nous avons cru devoir entrer dans quelques dtails spciaux ce sujet; mais il de la classification plus gnrale donne par M. Rmusat dans faut les rapprocher ses notes sur le chapitre XVI. CL. (14) Livre sacr sur l'entre dans le Ni houan.] C'est le Ni phan king, qui se divise en deux volumes. KL. La langue Fan.] C'est le sanscrit.
Tcheou jj\, signifie tions. Parmi tous ces livres, il y en a lation, pour les Ching wen (Shrwaka) des Ching iven sont : i Le contenant
des lois diverses.
(I5) '
IToayen king, etc., cit dans le San tsang ja sou, liv. XXXI, pag. 6 v.
CHAPITRE
XXXVII.
Royaume
de Tchen pho. Royaume de To mo li ti. F hian s'embarque. Il arrive au royaume des Lions.
et le descendant pendant Gange l'orient, le grand royaume dix-huit yeou y an (i), il y a, sur sa rive mridionale, et dans de Fo sur notre de Tchen pho (2). Dans les chapelles route, o Fo s'est assis, on a lev des tours, endroits qui paraissent quatre En suivant le cours habites l'orient des religieux (3). De l en allant pendant prs au royaume de To mo li ti (5); de cinquante yeou y an [), on parvient il y a vingtdans la mer (6). Dans ce royaume, l est l'embouchure par seng kia quatre florissante. F hian lan, tous peupls de religieux, et la loi de Fo y est
du
A cette poque, des marchands, peindre se mettant firent route vers le sud-ouest; en mer avec de grands et au vaisseaux, de l'hiver, le vent tant favorable, commencement aprs une navide quatorze des Lions (7). Les gation est loign est grand yeou yan de jours, on arriva au royaume gens du pays (de To mo li ti) disent que celui-ci du leur d'environ sept cents yeou yan (8). Ce royaume il a de l'est l'ouest et situ dans une le; cinquante nord au sud trente et yeou yan (10). A droite au nombre d'une centaine; nuits et d'autant
y sjourna des images.
deux
ans,
occup
crire
des livres
sacrs
et
(9), et du
il y a de petites les qui sont gauche leur distance entre elles est pour les unes de dix li, pour les autres de vingt deux cents li; toutes sont dans la dpendance de la grande le. On en tire beaucoup de choses prcieuses et de perles; il y a un canton le joyau Mo ni (n), et qui peut dix li en avoir qui produit carr. Le roi envoie de dix pices des gens pour il en prend trois. le garder, et quand on en ramasse,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE vingt-quatre
XXXVII. lieues.
(i) Pendant dix-huit yeou yan.]
Environ
(2) Le grand royaume de Tchen pho.] :3FTT Tchamp, ou ^sqftrt Tchamppour, est le nom de l'ancienne capitale de Karn'a, roi du pays diAngades'a, et frre an, par sa mre, des princes Pnd'ou, puisqu'il tait le fils de Sorya et de Kounti, avant le mariage de cette dernire avec Pnd'ou. Cette ville qui, pour cette raison, portait aussi le nom de Karnapoura, tait situe sur l'emplacement du Bhgalpour actuel (890 28' i5" long. E., 2 5 11' lat. N.), ou du moins trs-prs de cette place. Nous avons vu (chap. XXIII, note 5) que les rois d'Anga avaient t pendant longtemps les suzerains des princes de Maghada, mais que ceux-ci se dlivrrent, sous le rgne de Mah padma, du tribut qu'ils taient obligs de leur payer, et que Mah padma et son fils Bimbasra conquirent mme le royaume d'Anga dont ils firent une province. Hiuan thsang quatre mille li et avait plus de est chaud. Les place le royaume de Tchen pho dans l'Inde du milieu et lui donne de tour. La grande ville capitale tait adosse au nord du Gange, quarante li de circuit, a Le pays, ajoute-t-il, est fertile, et le climat
moeurs des habitants sont douces et polies. De son temps il y avait une dizaine de kia lan, pour la plupart dlabrs ; on n'y comptait qu'environ deux cents religieux. Les htrodoxes y avaient une vingtaine de temples \ Le nom de Tchamp, qui se retrouve encore sur quelques cartes, s'est conserv dans celui de la ville de Tchampanagar. KL. (3) Qui paraissent habites par des religieux.] Cette phrase fait prsumer que F hian ne descendit pas du btiment sur lequel il faisait la route en suivant le cours du Gange.KL. (4) Prs de cinquante yeou yan.] Environ soixante-huit lieues.
(5) Au royaume de To mo li ti. ] Hiuan thsang appelle ce royaume Tan mo ly ti. Il ajjpartient, dit-il, l'Inde du milieu; il a quatorze cents li de tour, et sa capitale a a plus de dix li de circuit. Elle est situe sur le bord de la mer, et il s'y fait un grand commerce par eau et par terre. Il y trouva dix kia lan, dans lesquels habitaient plus de mille religieux. Les hrtiques y avaient environ cinquante temples. A ct de la ville il y avait une tour btie par le roi As'oka, en l'honneur d'un trne des quatre Bouddhas passs, et d'autres souvenirs de leur vie et de leurs actions, dont les traces existaient dans le voisinage de ce lieu h. To mo li ti ou Tan mo ly ti est la transcription ' Piani lian, liv. LXXV, art. 10. h Ibid.art, 18. 2 du terme sanscrit rrra"f5t
550
FO
KOU
KL
Tmralipt, qui signifie tach par le cuivre. La place qui portait autrefois ce nom est la moderne Tamlouk (900 18' 1 5""long. E., 220 18' lat. N.), situe sur la droite de la rivire Hougli, un peu au-dessus de son embouchure dans la mer, et peu de distance de Calcutta. Le Mahvamsa (XI, 38), dont M. E. Burnoufme communique un passage trs-curieux, nomme ce pays exactement comme notre voyageur, Tmalitti; ainsi F hian a recueilli et rendu avec fidlit la forme pli de ce nom. d'une ancienne renomme. A la fin du Ce pays jouissait, chez les Bouddhistes, 5e sicle avant notre re, le roi Dharms'oka, souverain de tout le Djamboudvpa, envoya au roi de Ceylan une ambassade qui partit de ce port. Par le rcit de F hian et de Hiuan thsang, on voit que cette ville tait encore d'une grande importance, tant au vc qu'au vif sicle. KL. [Il est bon de remarquer que, suivant Wilson, le nom de cette province est Tmalipt (affect de tristesse); d'o il rsulterait, si cette orthographe est bien authentique, qu'il n'est pas besoin d'inventer la forme Tmralipt, pour en tirer le pli Tmalitti. ] E. B. du Gange dans la mer. (6) L'embouchure dans la mer.] C'est--dire l'embouchure Cette circonstance ne laisse aucun doute sur l'emplacement du pays nomm ici par le voyageur, et on voit, par l'expression dont il se sert, que la rivire Hougli formait du temps de F hian une des principales branches du Gange. KL. (7) Au royaume des Lions.] En chinois )iJ ~T~ ffiu Sse tsea kon, c'est la traduction du sanscrit FT^^ Sinhala (qui a des lions). Hiuan thsang transcrit ce nom par Sp. IWTB ^eny 'lia '' et mt cIue ce royaume n'tait pas compris dans les limites de l'Inde : il lui donne sept mille li de circonfrence ; l'tendue de la ville principale est de plus de quarante li. Il ajoute que ce pays s'appelait autrefois l'Ile des Joyaux, cause de la quantit considrable de choses prcieuses qu'il produisait.a. On trouvera des dtails sur l'origine du nom de ce royaume dans les notes sur le chapitre suivant. KL. (8) Sept cents yeou yan. ] Environ neuf cent trente-cinq (g) Cinquante yeou yan.] Soixante-huit lieues. lieues.
(10) Trente yeou yan.] Environ quarante lieues. Ainsi que le remarque M. Rmusat, dans son Mmoire sur le prsent voyage, ces mesures et cette proportion sont exactes; mais F hian se trompe de la mme'manire en donqu'ratosthne, * Piani tian, liv. LXVI, art. , pag. 11v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVII.
551
nant Ceylan plus d'tendue dans le sens de la longitude, que dans celui de la latitude a. Par les petites les qu'il groupe droite et gauche, il est vident qu'il entend parler des Maldives. CL. (11) Le joyau Mo ni.] Il y a dans l'original 3-/L/j i Mo ni tchu. Le mot tchi signifie proprement perle, mais aussi en gnral un joyau, et c'est dans ce sens qu'il faut le prendre ici. Vfu\Man'i en sanscrit, est joyau, pierre prcieuse; ce terme est en quelque sorte synonyme du mot chinois tchu. Les perles s'appellent clans la mme langue ST^ff Moukt; aussi ne s'agit-il pas ici de perles, mais d'une pierre prcieuse appele le joyau deMan'i: c'est l'escarboucle, de laquelle on dit qu'elle jette des traits de lumire pendant la nuit. La description que les livres bouddhiques donnent du Man'i est fabuleuse. KL. " Conf. surla gographie des anciens,t. III, pag. 29/1. Gossellin,Recherches
fl2.
CHAPITRE
XXXVIII
Description du royaume des Lions. Empreintes des pieds de Fo. Monastre de la Montagne sans crainte. L'arbre Pe to. La dent de Fo. Crmonies pratiques en son honneur. Chapelle Po thi. - Le samanen Tha mo kiu thi.
n'tait pas habit par des hommes Ce royaume (i), primitivement, ; il n'y avait que des dmons, des gnies (2)'et des dragons qui y demeurassent. les marchands des autres royaumes le Cependant y faisaient commerce. le temps de ce commerce tait venu, les gnies Quand et les dmons choses aux ne en avant des paraissaient pas, mais ils mettaient dont ils marquaient le juste prix; s'il convenait ils l'acquittaient et prenaient la marchandise (3).
prcieuses,
marchands,
Comme
ces ngociants venaient et sjournaient, les habiallaient, tants des autres royaumes apprirent que ce pays tait fort beau ; ils y vinrent aussi et formrent par la suite un grand royaume. : on n'y connat Ce pays est tempr de l'hiver et pas la diffrence de l't. mencement point Les herbes des et les arbres y sont toujours est suivant la volont verdoyants. des gens; L'enseil n'y draa
de temps Fo vint Quand
champs pour cela. dans
gons (4). Par la force ses pieds au nord de la le sommet d'une
ce pays, de son pied ville
il voulut divin,
convertir il laissa
les mauvais
Sur le vestige qui est au nord de quinze yeou yan la ville royale, on a bti une grande tour haute de quarante tchang (7). Elle est orne d'or et d'argent, et les choses les plus prcieuses sont runies former ses parois. On a encore construit un seng Ida pour lan, qu'on nomme la Montagne sans crainte (8). Il y a cinq mille religieux.
montagne (6) l'une de l'autre.
royale, (5). Les deux
d'un de l'empreinte et l'empreinte de l'autre sur traces sont la distance de
CHAPITRE On y a lev Parmi toutes une salle Fo,
XXXVIII. avec des ciselures d'or
555
et d'argent. les choses prcieuses qu'on y voit, il y a une image de jaspe bleu, haute de deux tchang : tout son corps est form des elle est tincelante de splendeur et plus sept choses prcieuses; ne saurait Dans la main droite elle qu'on l'exprimer. d'un perle prix inestimable. anDepuis que F hian avait quitt la terre de Han (9), plusieurs nes s'taient les gens avec lesquels il avait des raiDports, coules; majestueuse tient une taient rivires, tait s'en tous les des hommes herbes, pour les lui. de contres arbres, Les montagnes, les trangres. tout ce qui avait ses yeux frapp ceux qui avaient fait route avec lui,
nouveau taient
arrts et les autres tant morts. spars, En rflchissant au pass (10), son coeur tait toujours rempli de penses et de tristesse. Tout coup, ct de cette figure de jaspe, il vit un marchand la statue d'un ventail de taffetas qui faisait hommage blanc du pays de Tsin (n). Sans qu'on s'en apert, cela lui causa une motion telle que ses larmes coulrent et remplirent ses yeux. Les anciens rois de ce pays envoyrent dans le royaume du Milieu ct tchang (12) chercher de la salle des de de l'arbre Pei to (i3). On les planta graines Fo. l'arbre fut haut d'environ Quand vingt du ct du sud-est. Le roi craignant qu'il ne huit ou neuf
De plus, les uns s'tant
(i4), il pencha le fit tayer tombt, enceinte
par en le soutenant.
puyait, poussa une Sa grandeur prit racine. quoiqu'ils dant pas une soient enlevs
une piliers qui formrent au milieu de la place o il L'arbre, s'apbranche descendit terre et qui pera un pilier, est environ
de quatre ivei (i5). Ces piliers, fendus par le milieu, et tout djets, ne sont cepenAu-dessous de l'arbre on a lev par les hommes. Les religieux de la
dans laquelle est une statue assise. chapelle Raison ont l'habitude de l'honorer sans relche. Dans de Fo. la ville on a encore fait construit avec un
difice
pour
une
dent Le Les
Il est entirement et s'abstient
roi se purifie
les sept choses prcieuses. de la pratique des rites brahmaniques.
554 habitants sont fermes. de la ville Depuis une ont
FO
KOU
KL respect, et leurs sentiments
de la foi et du
famine, leur
de disette,
de ce royaume, l'origine de calamits ni de troubles. de choses
il n'y a jamais eu de Les religieux ont dans
et des Mo ni sans prix. prcieuses Le roi tant entr dans ce trsor, vit en le visitant un joyau Mo ni, et aussitt il en eut envie et dsira l'enlever. Trois jours aprs il vint trsor infinit Il manda rsipiscence. les religieux, se prosterna devant eux et se Ouvrant son coeur aux religieux, il leur dit : Je dsirerais repentit. un rglement aux rois l'avenir que vous tablissiez qui interdise
l'entre sacrifices entrer.
de
votre en
trsor, de
moins mendiants;
qualit
n'aient qu'ils accompli quarante alors il leur sera permis d'y et de grands, et les difices droits. Dans et de bien tous
de magistrats par beaucoup marchands Sa pho (16). Les maisons y sont belles orns. Les rues et les chemins sont plans et les carrefours quatorzime et chaire, castes on a bti des salles
La ville
est habite
de prdication. Le huitime, le de la lune on y tablit une haute et le quinzime jour une grande de monde il s'assemble des quatre quantit
la loi. Les gens du pays disent entendre pour qu'il peut y soixante avoir chez eux en tout cinquante mille religieux, qui tous Le roi en a part dans la ville cinq six mille en commun. mangent auxquels il donne bassin que de Fo manger particulier ce que leur en commun. Quand ils ont leur plein faim, faut. ils Ils leur portent ne prennent retournent. au milieu expose au public de la troisime lune. Dix jours le roi ayant choisi avec auparavant, soin un grand lphant, envoie un prdicateur d'habits qui, revtu et mont sur l'lphant, du tambour et dclame en royaux frappe disant : Phous, sans dans le cours de trois austrits, donn A seng /a (18), a pratiqu des son corps et sa vie. Il a abanles yeux pour les donner La dent (17) est communment et vont vase chercher ce qu'il contenir tout
peut
et s'en
la reine
mnagement son pouse;
pour il s'est arrach
CHAPITRE un sacrifi affam, homme; sa tte il s'est pour
XXXVIII.
555
coup la chair faire l'aumne;
et n'a pas pargn la moelle austrits de cette espce et en pratiquant des macrations les tres vivants, c'est ainsi qu'il est devenu Fo. Pendant neuf
un pigeon; il a pour racheter il a jet son corps un tigre de ses os (19). C'est ainsi, par des pour tous
quarante-
il prcha la loi et convertit ans qu'il fut dans le sicle, par la doctrine. il les affermit; Ceux qui n'taient ceux qui ne pas fermes, connaissaient en connurent. Tous les tres vivants pas de rgles, tant ainsi sauvs, il entra dans le Ni houan. Depuis le Ni houan, il s'est coul les tres 14g 7 ans (20). Quand Dix jours aprs, prouvrent la dent de Fo est porte de la Montagne sans crainte. la chapelle Dans le royaume, les gens clairs qui veulent planpar la doctrine la route, ter le bonheur, chacun de leur ct aplanir orviennent vivants ner tles chemins et les rues, rpandre toutes sortes de fleurs et de Alors, parfums pour l'honorer. aprs les chants, des deux cts de la route, des reprsentations nifestations formes, successives telles (21) dans le roi fait disposer, des cinq cents males yeux du sicle une grande douleur. furent teints, tous
que celle de clair (24), celle du (23), celle du roi des lphants sont Ces figures, de diffrentes couleurs, peintes soin et comme de la vivantes. route, et Ensuite on l'adore la dent' partout de o Fo le milieu dans Fo; cels; gieux, jours. chapelle
Phou sa a revtu diverses lesquelles en Siu ta 71011(22), la transformation cerf-cheval excutes est porte (25). avec par Arriv
elle
la chapelle on y brle
de de la Montagne sans crainte, on monte comme des nuages amondes parfums qui forment toutes sortes d'actes relion allume des lampes; on pratique le tout durant sans interruption, quatre-vingt-dix jour et nuit, dans la ville. Celte la chapelle Alors la dent est reporte est trs-lgante; les crmonies le jour on conformment en ouvre les portes, et on y la loi.
passe. la salle
pratique A l'orient tagne,
dans
de la Chapelle sans crainte, quarante li, il y a une monPo thi (26), o il peut y nomme est une chapelle laquelle
556 avoir deux mille religieux.
FO Dans
KOU-.KI. le nombre,
d'une il y a un Samanen Th mo kiu ti, pour lequel les gens du pays nomm vertu, grande clans une maison de ont la plus grande vnration. Il a demeur d'actions ans, constamment occup pierre pendant prs de quarante des charitables. Il tait parvenu faire vivre dans la mme maison serpents et des rats, sans qu'ils se nuisissent les uns aux autres.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVIII.
(i) Ce royaume.] L'origine fabuleuse de Ceylan, telle qu'elle est raconte par Hiuan thsang, est videmment emprunte des traditions recueillies sur les lieux offre des diffrences assez mmes, ou puises dans les originaux, quoiqu'elle notables avec les rcits des Singhalais \ Suivant le voyageur chinois, la fille d'un roi de l'Inde mridionale partit, un jour heureux, pour aller pouser le prince s'enfuit la vue d'un lion, la laisd'un pays voisin. L'escorte qui l'accompagnait sant ainsi expose au pril. Mais le roi des lions, la plaant sur son dos, la porta dans sa caverne, situe dans un endroit recul des montagnes. L il prit des cerfs pour elle, il lui apporta des fruits et fournit tous ses besoins suivant les saisons. Pendant des mois et des annes, la princesse vcut ainsi avec lui, et tant devenue enceinte, elle donna le jour un fils et une fille, qui, pour la figure, ressemblaient des hommes, quoiqu'ils eussent t engendrs par un tre d'une nature toute diffrente. Le fils grandit, et bientt il eut acquis une force gale celle de son pre. Parvenu l'ge de pubert, et se sentant tre homme, il dit sa mre : Comment un animal du dsert peut-il tre mon pre, tandis que ma mre est un tre humain? N'tant pas de la mme espce, comment ont-ils pu s'unir l'un l'autre? La mre lui ayant appris ce qui s'tait pass jadis, Les hommes et les btes sont de nature diffrente, ajouta-t-il; il faut sur-le-champ nous enfuir de ces lieux pour n'y plus revenir. Avant de nous enfuir, lui rpondit sa mre, il faudrait savoir mena suivre le lion; il gravit avec examina son chemin avec soin; puis prit aussitt sa mre et sa soeur sur habits par des hommes. si nous le pourrons. Alors son fils comlui les montagnes, passa par les dfils et son pre s'tant loign une autre fois, il ses paules, et gagna avec elles les lieux La mre' leur dit : Cachons tous soigneusement notre
" Couf. Bool:s of Ceylon,vol. II, pag. iG3. Upham's Thesacrcdandhistorical
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVIII.
557
secret et gardons-nous de raconter notre histoire; car si on la savait, on nous mpriserait. Tchons d'aller d'ici dans le royaume de mon pre; nous ne sommes pas en scurit dans un pays o la religion est diffrente de la ntre. Les habitants leur ayant demand d'o ils taient, ils rpondirent: Nous sommes ori ginaires de ces contres; exils dans des lieux loigns, les enfants et la mre, s'aidant mutuellement, cherchent retourner chez eux. Aussitt les gens du de leur fournir ce dont ils avaient pays, touchs de compassion, s'empressrent besoin. Cependant le roi des lions revenu dans sa caverne, et ne trouvant nulle part son fils et sa fille chris, sortit furieux des profondeurs de la montagne et se dirigea vers les habitations des hommes. Ses rugissements faisaient trembler la terre. Il attaqua les gens et les bestiaux, et dtruisit tout ce qui avait vie. Les habitants sortirent aussitt pour le prendre et le tuer. Us battirent le tambour, sonnrent de leurs grandes conques, et s'tant arms d'arbaltes et de lances, se formrent en troupes, afin de mieux rsister au danger. Le roi leur ordonna de ne pas s'carter les uns des autres, et s'tant lui-mme mis leur tte, on circonvint peu peu la fort et on passa les montagnes. Les rugissements du lion furieux frapprent de terreur les hommes et les animaux, qui s'enfuirent pouAlors le roi fit proclamer que celui qui prendrait le lion et dlivrerait le royaume de la calamit qui l'affligeait, recevrait toutes sortes de rcompenses et d'honneurs. En entendant cet dit du roi, le fils, s'adressant sa mre, lui dit : Notre misre est extrme; je ne sais plus que faire pour y subvenir; il faut que je rponde cet appel. Ne parlez pas ainsi, dit la mre; quoique ce soit une bte froce , ce n'en est pas moins votre pre , et notre infortune ne saurait tre une raison pour que vous alliez le tuer. Le fils rpondit : Les hommes et les btes sont de nature diffrente; quels rapports de justice peut-il y avoir entre eux ? Pour nous, le droit est celui de la rsistance ; pour lui, quel espoir peut-il nourrir en son coeur? Gela dit, il s'arma d'un poignard et s'offrit pour excuter ce que l'on demandait. Une arme nombreuse se joignit lui. Le lion tait couch dans la fort, et aucun des hommes n'osait en approcher. Ds que le fils se montra, le lion fondit sur lui et le terrassa; aussitt l'autre, saisi de fureur, qu'il tait son pre et lui plongea son poignard dans le ventre. Le lion ressentit une vive souffrance de cette blessure, et mourut en conservant encore de la tendresse pour son fils, comme si celui-ci ne lui et fait aucun mal. Le roi demanda : Quel est cet homme? S'il y a quelque chose de surnaturel en lui, il faudra lui accorder des rcompenses, mais le frapper d'une peine svre. Le fils ayant racont son histoire : Approche, lui dit le il ne pouvait avoir aucune affection paternelle. est difficile vaincre, et les mauvais sentiments coeur. Dtruire ce qui nuisait au peuple est une de son pre est une violation roi. Ton pre tait trs-cruel ; L'espce des animaux froces naissent facilement dans leur grande action; trancher la vie de toute sorte pour 43 oublia vants.
du coeur. Des rcompenses
558
FOE
KOUE
KL
de cette manire honorer cette action, l'exil pour punir cette transgression; et la parole du roi n'est pas double. Alors il fit la loi de l'tat est respecte, de vivres, et ne quiper deux grands vaisseaux qu'il chargea de provisions et voulant pas que le fils du lion restt plus longtemps dans le royaume, il lui donna des jeunes gens et des jeunes filles, qui se mirent en mer en rcompense sur un vaisseau diffrent, suivant leur sexe. Celui qui portait les hommes arriva l'le des Joyaux; et comme ils y trouvrent beaucoup de choses prcieuses, ils s'y tablirent. Dans la suite, des marchands ayant abord dans cette le, les retinrent leurs femmes et en eurent habitants turent le chef de ces marchands, et des magistrats pour beaucoup d'enfants. Ils lurent des chefs pour gouverner, et en rgler toutes les affaires; ils fondrent des villes, btirent des villages; mmoire de l'action courageuse de leur aeul, ils donnrent son nom au royaume qu'ils formrent. Le vaisseau des femmes aborda l'ouest de la Perse, dans une contre habite par des gnies ; celles qui le montaient eurent des enfants de leur commerce avec ces gnies et formrent le grand royaume occidental des Femmes. Les hommes du royaume des Lions ont la figure ovale, le teint noir, le menton carr, le front lev; ils sont courageux et robustes; leur caractre est emport et violent. Comment supporteraient-ils l'outrage, eux, les descendants d'une bte froce a?C. L.
(2) Il n'y avait que des dmons et des gnies.] La plupart des voyageurs qui ont t porte de connatre les traditions religieuses et historiques de Ceylan, ont avec lesquels les premires colonies venues de parl de ces tres surnaturels, l'Inde luttrent pendant longtemps avant de possder l'le entire et de pouvoir y vivre sans trouble. Suivant le Rdjvali, les dmons passaient pour avoir habit Ceylan pendant 1844 ans, c'est--dire depuis l'poque o cette le fut dpeuple par suite des fameuses gueiTes qui eurent lieu entre Rama et Rvana, jusqu'au temps o Shkya mouni, voulant y tablir sa religion, suscita un feu considrable qui brla tout le pays et fora les dmons de se prcipiter dans la mer, et de se rfugier dans l'le de Yakgiri deivinah. Suivant la supputation de quelques auteurs, ce fait aurait eu lieu quand Bouddha avait 35 ans, 588 ans avant J. C, et 45 ans avant l'entre dans le Nirvana c. avec toute la prolixit prtentieuse qui lui est ordinaire, les lgendes bouddhiques o l'on raconte comment Seng kia lo (Sinhala) acheva de purger Ceylan pour toujours des dmons cjui s'taient soustraits la puissance de Shkya, au moment o celui-ci avait soumis ceux de leur race. Dans ce rcit, Hiuan thsang rapporte, que nous abrgeons considrablement, il est dit qu'il y avait autrefois, dans l'le
" Pian i lian, liv. LXVI, L Boohs hy L'pliam,L II, p. G, pag. netsuiv.- Sacredandhistorical ofCeylon, el p. 168 et suiv. " Transactions t. III, p. 58. oflhe Asialic Society,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVIII.
559
des Joyaux, une ville de fer qui tait habite par cinq cents femmes Lo cha (Rkchasi), ou dmons femelles, dont les artifices galaient la cruaut. Des marchands les Lo cha, portant des parfums et des tant venus dans l'le pour y commercer, s'avancrent leur rencontre et les engafleurs, et jouant de divers instruments, grent entrer dans la ville pour se reposer et se divertir. Sduits par la beaut eurent commerce avec elles .et par le langage de ces femmes, les marchands chacune mit au monde un fils. Le chef de ces trangers se nommait Seng Ida son fils Seng kia lo. Celui-ci ayant eu en songe la rvlation des dangers qui ils gagnrent tous secrtement le rivage de lui et ses compagnons, menaaient, et et le
mer, et avec le secours d'un cheval cleste, parvinrent s'chapper reine des Lo cha s'envola la poursuite de Seng kia lo, et l'ayant rejoint, elle essaya, par ses caresses et ses charmes, de l'entraner revenir; mais Seng kia lo, inbranlable, pronona contre elle des imprcations, et la menaant de son glaive, il lui dit : Vous tes une Lo cha, et moi je suis un homme. tant de nature diff rente, nous ne devons pas nous unir; si nous le faisons, nous serons mutuelle ment malheureux. reprochant l'avoir abandonne, Il faut que votre destine s'accomplisse. Alors la Lo cha, Seng kia lo sa conduite et son ingratitude, l'accusa de publiquement
la de l'le. La
accable de maldictions et d'injures, aprs l'avoir rejete, prise pour pouse et avo' accept ses prsents. Le roi, touch de ses plaintes et aveugl par sa beaut, la protgea contre Seng kia lo, et rejetant les avertissements de celui-ci, il la prit pour pouse. Mais la moiti de la nuit elle s'envola l'le des Joyaux et revint aussitt, avec les cinq cents autres Lo cha, porter la dsolation de tous ceux qui y taient, et le carnage dans le palais du roi. Elles s'emparrent de la chair et du sang des uns, et enlevant les cadavres retournrent dans l'le. Le lendemain, quand il fit jour, les magistrats tisans, assembls pour l'audience du roi, attendirent longtemps que palais s'ouvrt. Ne voyant personne et n'entendant aucun bruit, ils en s'assouvirent des autres, et les courla porte du franchirent
le seuil et ne trouvrent dans la salle que des os amoncels. Dtournant les yeux sans savoir quelle de ce spectacle, ils poussrent de grands cris et se lamentrent tait la cause d'un si grand malheur. Seng kia lo les en instruisit, et leur ayant appris ce qui lui tait arriv lui-mme, ceux-ci, frapps de son courage et de sa sagesse, le choisirent pour roi. Alors il prpara des armes, runit des troupes et s'embarqua pour aller braver la puissance des Lo cha. Les ayant vaincues, il les fora de se prcipiter dans la mer et de se rfugier dans une le voisine; puis il dtruisit la ville de fer. Bientt il vint de tous cts des gens qui s'tablirent dans l'le et ne tardrent pas former un royaume auquel ils donnrent le nom de leur roi, Seng kia lo". Les livres singhalais disent que ce fut Vijeya (Vidjaya), fils de Sinhala, qui, la ' Pian i lian, liv. LXVI, art. 4, p. i3-i6 v. 43.
540
FOE
KOUE
KL
tte de sept cents guerriers, et avec le secours de Cawany, dmon femelle, acheva de dtruire les tres surnaturels qui taient rests dans l'le aprs l'expdition que Shkya avait faite contre eux a. C. L. (3) Ils prenaient la marchandise.] Ce rcit prsente une analogie curieuse avec le passage bien connu de Pline, qui attribue aux Seres celte manire de faire le commerce : Flaminis ulteriore ripa merces positas juxi venalia tolli ah his, si placeat permulatio h. (4) Convertir les mauvais dragons.] Les dragons et les gnies qui, primitivement, habitaient Ceylan, se nomment, les premiers Nga, et les seconds Yakcha, en pli Yakka. Leur conversion par Shkya mouni a fourni aux crivains singhalais la matire de nombreuses lgendes qui forment, avec les traditions relatives Vidjaya, l'poque hroque de l'histoire de Ceylan. Tout est surnaturel dans ces lgendes : le voyage de Shkya de l'Inde centrale Ceylan travers les airs, ses discussions avec les Yakcha, les miracles qu'il opra pour les convaincre, et les circonstances qui accompagnrent leur expulsion dfinitive de l'le, laquelle fut ds lors soumise au culte de Shkya. A ct de ces lgendes se trouvent places celles qui sont relatives Vidjaya Simhabhou, qui vint du Kalinga avec sept cents hommes, et n'occupa d'abord qu'une portion peu tendue des ctes. S'il y a quelc'est que chose d'historique dans ces rcits incohrents et souvent contradictoires, plutt dans les lgendes relatives Vidjaya, que dans celles qui se rapportent au prtendu voyage de Shkya. On peut consulter sur ces divers rcits, la collection souvent cite d'Upham c. On doit en outre remarquer que les circonstances du rcit de l'arrive Ceylan de Mihinda et de la conversion du roi Devenipaetissa, semblent dmontrer que c'est seulement sous ce prince, c'est--dire, si le calcul sindu 4e sicle avant notre re, que le boudghalais est juste, au commencement dhisme fut tabli Ceyland. E. B. [Suivant les Chinois, un sicle aprs le Nirvn'a, Mo hi yn to lo (Mahindra), frre cadet du roi As'oka, abandonna le monde et vint rpandre la doctrine parmi les habitants de Ceylan. Il changea leurs moeurs et les convertit la vraie croyance. Deux sicles aprs, les doctrines de Fo furent partages en deux classes appeles l'une Mo ho pi ho lo (Mahvihra), et l'autre A po ye tchi li (Abhayari)c. C. L.] (5) L'empreinte de ses pieds sur le sommet d'une montagne.] Cette montagne, par son lvation et par la vnration dont elle est l'objet, a de tout temps attir l'atVoyezsur cette lgende, Thesacredand historical Booksof Ceylon,hy Uphani,t. I, p. 69; t. II, p. b 171 et suiv. Ilist. nat. liv. VI, chap. xxiv (22). ' 0 The sacredand hisioricalBoolts oj Ceylon,t. I, 5 et suiv. p. d Ibid.t. I, p. 84 et suiv. ' Pian i lian, liv. LXVI, arl. 4, p. ](j v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVIII.
541
tention des voyageurs, qui la connaissent sous le nom de Pic d'Adam. Lors du troisime voyage que Bouddha fit Ceylan, quinze ans aprs y tre venu pour la premire fois, Saman deva radja vint l'adorer et lui dit : 0 Bouddha! vois cette montagne leve, dont le nom est Samana kouta, qui .semble bleue comme un rocher de saphir et dont la cime se perd dans les nuages! Plusieurs Bouddhas y ont laiss des reliques, au moyen desquelles le souvenir de leur passage sur la terre reste parmi les hommes. Daigne y ajouter un joyau en y dposant l'em preinte de ton pied, ce sera pour cette le une prcieuse bndiction. Alors Bouddha s'leva dans les nuages et vint planer au-dessus de la montagne, qui, s lanant de sa base, vint recevoir, dans l'air, l'empreinte du pied sacr, et retomba ensuite la place qu'elle occupe aujourd'huia. Les Bouddhistes citent un grand nombre d'empreintes de cette espce; la vnration dont elles sont l'objet, qui le cde peine celle qu'ils accordent Bouddha lui-mme, en a sans doute fait ainsi multiplier le nombre. Il tait tout simple que chaque contre voult avoir la sienne et que chaque secte prtendt en faire honneur la divinit qu'elle adorait, ou au chef de la doctrine qu'elle avait embrasse. Toutes n'appartiennent donc pas Shkya mouni, et les textes plis n'en reconnaissent que cinq vritables, qu'ils nomment Pantcha pra Pat'ha, les cinq pieds divins. Le capitaine Low leur a consacr un Mmoire qui est insr dans les Transactions de la Socit asiatique de Londres b. C. L. [Les Singhalais nomment cette empreinte et la montagne sur laquelle elle est Samanhela Sripda, c'est--dire place, Hammanelle Siripade, ou plus exactement, le pied sacr de la montagne de Samana. Samana ou Saman est le dieu tutlaire de cette montagne 0. Dans le Mahvamsa, la montagne se nomme Samanta koit'a parvata, et il est trs-vraisemblable que Samanta kot'a est la forme premire de Samanhelad. Valentyn a donn une description minutieusement exacte de la montagne et des images qui se trouvent sur le sommet du Pic d'Adam; elle fait partie de sa description de Ceylan 6, travail dont Weston a fait amplement usage pour la rdaction de son histoire singhalaisef. Cette montagne est, selon Valentyn, situe environ quatorze milles d'Allemagne de Colombo. On ne peut parvenir au sommet qu'au moyen d'une chane de fer attache au roc et dont les anneaux servent d'chelons. Le sommet forme une aire de cent cinquante pas en.long, et de cent dix en large. Au centre de cet espace est une pierre longue de sept ou huit pieds, et s'levant au-dessus du sol d'environ trois pieds. C'est l que les dvots * SacredBooks of Ceylon, by Upham,t. II, p. 23. b Tome III, page 57. c Thesacredand hislorical Books t. II, of Ceylon, p. a3 et suiv., et p. 168. d Ibid. t. I, p. 202 et pass.; t. II, p. a3 et suiv., etp. 168: t. III, p. 363. van ChoromanValentyn,Keurliche Beschryving del, etc. VyfdeDeel, p. 376 et suiv. ' la Historyof Ceylonby Philaleihcs(^Veston), suite de la relation du sjour de Knov Ceylan. Londres, 1817, in-4. '
542 croient reconnatre la trace,
FOE
KOUE
KL mouni, les autres de
les uns du pied de Shkya
qu'une seule empreinte sur la montagne Samanhela; seulement quelques traditions supposent que Shkya mouni posa l'un de ses pieds sur le mont Samanhela et l'autre sur une montagne du Madur \ Ce qui peut avoir donn lieu la tradition d'une double empreinte rapporte par F hian, c'est que la montagne se divise en deux sommets, sur l'un desquels se voit le S'rpdab; mais la distance de quinze yeou yan qui, selon notre auteur, spare les deux emexagre. Au reste, ainsi qu'on vient de le faire observer, preintes, est certainement n'admettent rien n'est plus frquent, chez les peuples qui suivent le culte de Bouddha, que l'existence des empreintes des pieds de Shkya. A Ceylan mme on raconte que Shkya laissa des empreintes de ce genre dans d'autres parties de l'le, et notamment dans le lit de la rivire Calany 0. E. B.] (6) Quinze yeou yan.] Environ vingt lieues.
celui d'Adam. Mais les Singhalais
(7) Quarante tchang.] Chaque tchang ou toise est de dix pieds chinois, et le pied chinois est de huit lignes plus petit que le ntre. En valuant la toise chinoise la hauteur de cette tour serait de cent environ trois mtres soixante centimtres, CL. vingt-deux mtres. (8) La Montagne sans crainte;] en chinois, Wou 'we. Hiuan thsang parat ne pas avoir connu cet difice; il ne parle, en effet, que du temple de la Dent de Fo, dont il va tre question tout l'heure, et d'un autre temple plus petit qui tait ct de celui-ci, dans le voisinage du palais du roi. L'un et l'autre taient somptueusement orns d. C. L. [Le nom sanscrit de ce seng kia lan est Abhayagiri, mot qui a exactement le sens de Montagne de la scurit. Le Mahvamsa et le Rdjaratnkari rapportent que le roi Walakanabhaya, ou, selon ce dernier ouvrage, Deveny paetissa, fit renverser le temple d'un prtre paen nomm Girrie (sans doute Gbi), et fit construire, sur de cet difice, douze temples consacrs Shkya, qui communil'emplacement quaient les uns avec les autres et au milieu desquels s'levait un immense vihra. Il voulut ensuite que l'on joignt la fin de son propre nom Abhaya celui de Giri, de sorte que le monument tout entier fut nomm Abhayagiri'. Selon le Mahvamsa, cet vnement aurait eu lieu vers l'an 456 de Bouddha, ou environ quatrevingt-sept ans avant notre re. Peut-tre l'explication que donnent les autorits 1 Hisloryof Ceylon,p. 210. '' Ibid. 212, p. d'aprsDiegode Couto. c Thesacredand hislorical Booksof Ceylon,t. I, p. 7; t.. II, p. 22 et 20. 11 Pian i tian, liv. LXVI, art. 4, p. 17. 0 Thesacredand hislorxal Tiooks of Ceylon,t. I, p. 21g; t. II, p. 43.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVIII.
545
singhalaises est-elle force; car en s'en tenant au sens du mot Abhayagiri, qui se traduit rgulirement par Montagne de la scurit, on n'a pas besoin d'avoir recours l'histoire du prtre Giri, d'autant plus que ce dernier nom ne parat pas convenir un homme. Il est bon de remarquer que F hian a entendu ce nom comme nous venons de l'expliquer, de sorte qu'il a eu sur sa valeur des renseignements plus exacts que ceux que l'on trouve dans les lgendes singhalaises. E. B.] (g) La terre de Han] ou la Chine, suivant l'usage o sont les Chinois de dsigner leur pays par le nom des dynasties qui l'ont gouvern avec le plus de gloire, encore qu'elles aient cess de rgner depuis longtemps. C. L. (10) Rflchissant au pass.] Textuellement, regardant en arrire l'ombre.
(11) Du pays de Thsin.] C'est encore le nom d'une dynastie clbre que l'on la Chine entire, mais qui dsigne ici plus particulire. applique ordinairement ment la province de Chen si (voyez chapitre II, note i i, page i 5), dont F hian tait originaire. CL. (12) Dans le royaume du Milieu.] Le royaume vu souvent, le Madhyades'a ou l'Inde centrale. ainsi nomm est, comme on l'a
(1 3) L'arbre Pe to. ] Cet arbre est nomm en sanscrit Bodhi, et il a pris ce nom parce que c'est sous son ombre que Shkya mouni acquit le Bodhi ou la perfection de l'intelligence d'un Bouddha. C'est en effet de l'Inde centrale qu'un des premiers rois de Ceylan reut, selon la tradition singhalaise, fils de Le Rdjvali rapporte que Mihindoukoumra, seurs de Tchandragupta, traa autour de la branche couleur jaune, et qu'il demanda aux dieux que cette une branche de l'arbre Bodhi. Dharms'oka, l'un des succesdroite du Bodhi une ligne de
branche pt tre transporte Ceylan. Dans le mme instant le rameau dsign se dtacha de l'arbre, comme s'il et t coup avec une scie, et s'levant travers les airs, il vint descendre Ceylan, o il fut reu dans un vase d'or, puis ensuite plant dans un terrain consacr \ Cet vnement eut lieu sous le rgne du roi singhalais Deveny paetissa, du 4e sicle avant notre re. Le Mahvamsa le date qui a rgn au commencement l'an de Bouddha 2 36, la huitime anne du roi Dharms'oka et la premire du rgne de Deveny paetissa \ Or l'anne a36 rpond l'an 3oy avant notre re, si l'on admet le calcul singhalais qui, si je ne me trompe, peut subir une rduction d'environ sources annes pour concorder avec d'autres indications puises aux Un passage du Rdjaratnkari prouve que le Bodhi fut brahmaniques. cinquante
' Thesacredand hisloricalBooks h of Ceylon,t. II, p. i84; conf.ibid.p. 34- Ibid.I. I, p. 83.
544
FOE
KOUE
KL
celle-l mme laquelle se rapportent plant auprs de la ville d'Anourdhapoura, les descriptions de F hian, et qui tait encore florissante de son temps. Du reste le rcit de ce dernier ouvrage est beaucoup plus dtaill que celui du Rdjvali'. Selon le Mahvamsa, qui rapporte le fait comme les ouvrages prcdemment et par la cits, la branche de l'arbre sacr fut transporte moins miraculeusement voie ordinaire, c'est--dire sur un vaisseau b. E. B. dcrit par F hian, qui ne peut s'attribuer qu'au [Le mode de reproduction figuier des Brahmanes [ficus religiosa), prouve suffisamment que l'arbre Bodhi n'est pas une espce de palmier [borassus jlabelliformis) comme le pensait M. Kla C. prothc. L.] (i4) Vingt tchang.] Environ soixante et un mtres.
(i 5) Quatre we.] Environ om,o61 2. Le ive quivaut la moiti d'un tsun, lequel est la dixime partie de la coude chinoise, soit om,o3o6. C. L. (16) De marchands Sa pho.] Sa pho est la forme chinoise d'une expression probablement singhalaise; mais les renseignements et philologiques historiques que nous possdons sur Ceylan ne sont pas tellement circonstancis, que l'on puisse, en toute occasion, restituer avec un degr de certitude qui ne laisse rien dsirer, les mots ou les locutions qui se prsentent, surtout quand il ne peut s'y rattacher qu'un intrt secondaire, comme il semble que c'est ici le cas. Toutefois, suivant un rapprochement ingnieux qui nous est propos par M. Jacquet, Sa pho serait la transcription du sanscrit srthavha, marchand, et surtout marchand qui entreprend de grands voyages dans l'intrt de son commerce. Elle est produite par la modification rgulire que subit le mot srthavha en passant dans la langue plie, o il et dans la prononciation vulgaire des satthbahe, que reprsente assez exactement le chinois sa dans les dialectes provinciaux de la Chine mridionale, sat jin (marchands) qui suit, serait alors vraisemblablement devient stthavha, Singhalais, stllwahe ou comme pho, prononc both. L'expression chang mise l comme l'inter-
prtation du mot indien. Au reste cette transcription ne parat devoir tre adopte qu' dfaut de toute autre qui offrirait et un sens meilleur et une analogie plus vidente. CL. l'authenticit de plusieurs (17) La dent de Fo.] Les Bouddhistes reconnaissent reliques du mme genred; mais aucune n'est aussi clbre que celle dont il s'agit ici, aucune n'a prouv des fortunes si diverses. Les Singhalais la nomment Dalada ' Sacredand hislorical Books of Ceylon,tome II, p. 116 et suiv.; voyezencoret. I, p. 73 et g3. '' Ibid.t. I, p. 97. c Conf. ch. XXXI, n. 7, p. 2go, et ch. XXXII, note 11, p. 3oi. d Cf. ch. V, n. 5, 28, et ch XIII, n. p. 8,p. g2.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVIII.
545
wahans (l'honorable dent). Suivant ce qu'ils rapportent, Mahasana, qui monta sur le trne de Ceylan 818 ans aprs la mort de Bouddha", envoya une ambassade avec de riches prsents Gouhsha, roi de Calingou rata (Kalinga des'a), au sud du Bengale, pour obtenir de lui cette prcieuse relique qui se trouvait en son pouvoir. Le roi Gouhsha consentit s'en dessaisu 1; mais Mahasana tant mort dans l'inson fils Kiertissry magawarna la reut avec de grandes solennits et fit tervalle, btir un temple pour l'y dposer. Quatorze cents ans environ aprs la mort de fondre sur Ceylan, et Bouddha, les Malabars vinrent, de la cte de Coromandel, s'en tant empars, perscutrent la religion et transportrent la dent sainte sur les rives du Gange (probablement la Godaivari). Quatre-vingt-six ans aprs, Mahalou Wijayaba chassa les Malabars, et quelques annes ensuite, Parakramabhou rapporta Ceylan la dent de Bouddha. Dans la seconde moiti du xvf sicle, les Portugais s'en emparrent leur tour. Constantin de Bragance, leur chef, refusa les sommes qu'on lui offrait pour la racheter, et anim de tout le zle religieux qui existait alors, il aima mieux la dtruire que la vendre, et la rduisit publiquement en cendres. Mais le lendemain les prtres de Bouddha trouvrent, dans considrables une fleur de lotus, une autre dent toute semblable; c'est celle qui est aujourd'hui au pouvoir des Anglais et pour la restitution de laquelle le dernier empereur des Birmans a envoy deux ambassades Calcutta 1. En rapprochant la premire de ces circonstances de la date discute plus bas (voyez la note 20), on peut en induire que notre voyageur se trouvait Ceylan C. L. peu de temps aprs que le roi de Kalinga y eut envoy la dent de Bouddha. du sanscrit (18) Dans le cours de trois A seng ki.] Ce mot est la transcription asankhy, qui signifie innombrable et qui est le premier des dix grands nombres expliqus par Fo, pour faire comprendre combien sont inpuisables et sans bornes les actes des Bodhisattwas, la mer de les purets et les vertus des Bouddhas, des mondesc. L'asankhya quivaut leurs dsirs et les lois infinies du dveloppement Asankhy signifiant un nombre infini, quoi bon dire trois cent quadrillions. demande le Kiu che lun. C'est, rpond-on, que wou sou signifie asankhyas? innombrable et non pas sans nombre. Shkya Tathgata a men la vie de Bodhisattwa durant trois asankhyas. Le premier comprend l'existence de soixante et quinze mille Bouddhas (ou soixante et quinze ges du monde, puisque le nombre des Bouddhas qui doivent paratre dans chaque l'ancien, jusqu' Chi khi ge du monde est de mille), depuis Shkya, surnomm Fo (S'ikh Bouddha). Dans les premires gnrations, Shkya mouni tait fabri* Ou 844 ans suivant le Radja Ratncari.Conf. Thesacredandhislorical Books of Ceylon,by Upham, t. II, p. 67. " Sacredand historical Books of Ceylon, by Upham, t. I, p. 236 et suiv.; t. II, p. 71. Upham's Historyand doctrine ofBudhism,p. 32. c Hoa yan king, cit dans le San tsangf sou, liv. XLIII, p. 16. U
546
FOE
KOUE
KL
cant de tuiles, et s'appelait Ta kouang ming. Shkya l'ancien tant venu loger chez de le tuilier, celui-ci lui rendit le triple service de lui faire un sige d'herbes, l'clairer avec une lanterne et de lui donner boire. Il adora Fo et conut le dsir, si, dans l'avenir, il devenait Fo, de porter le mme nom que son hte. C'est pourquoi on le nomme prsent Chy kia wen. Le second asankhy commence Chi khi Fo et offre la succession de soixante et seize mille Bouddhas, jusqu' l'avnement de Jan teng Fo (Dpankara Bouddha). Quand Jan teng Fo naquit, son corps parut lumineux comme une lampe; c'est pourquoi il prit ce nom quand il fut devenu Fo. Shkya, qui alors s'appelait Jou toung, lui offrit trois tiges de lotus; il se dpouilla de la peau de cerf dont il tait vtu, la mit sous les pieds du Bouddha pour les garantir de la boue, et tendit ses cheveux par terre. C'est pourquoi Jan teng lui dit : Dans quatre-vingt-onze kalpas tu seras Fo et tu t'appelleras Chy kia wen. Enfin, le troisime asankhy embrasse la vie de soixante el dix-sept mille Bouddhas, depuis Jan teng Fo jusqu' Pi pho chi (Vipas'yi), le premier des sept Bouddhas qu'on nomme ordinairement tives \ C. L, ensemble et auxquels on adresse des invocations collec-
(19) Et n'a pas pargn la moelle de ses os.] Ces diffrents actes accomplis par ont t dj rapports prcdemShkya mouni pendant qu'il tait Bodhisattwa, ment. Voyez notamment les chapitres IX, X et XI. (20) Il s'est coul 1497 ans.] H y a trop peu d'accord entre les diffrentes dates rapportes par F hian, et pas assez d'unit dans sa manire de compter, pour qu'il soit possible d'tablir un point de dpart bien dtermin comme base de sa chronologie. Cependant il faut reconnatre qu'il compte ici d'aprs l're bouddhiadmise (g5o que chinoise la plus gnralement cinq sicles de celle des Singhalais (543 ans avant 1497 depuis le nirvana de Bouddha, rpondrait est aussi celle de l'poque bien certaine du sjour J. C), qui diffre de J. C), et suivant laquelle l'anne l'anne 4io de J. C, date qui de notre voyageur Ceylan. Un grand mouvement religieux agitait alors les esprits ; la lutte qui commenait entre le et qui devait se terminer, quelques annes aprs, brahmanisme et le bouddhisme, de ce dernier culte dans les contres o il avait pris naispar le renversement n'avait pas encore exerc d'influence fcheuse sur Ceylan. Tout au contraire, cette le offrit, pendant quelque temps encore, au proslytisme malheureux , un refuge contre l'intolrance des Brahmanes ; et comme il arrive en pareil cas, la ferveur redoublait mesure que la perscution tait plus grande. Un savant sance, 1 t'hian la ssekiao yi, cit dans le San tsanqf sou,liv. XII, p. 27; cl conf.AbelRmusat,Bssaisutla cosmogonie des Bouddhistes dans )e Journal des Savants,dcembrei83i, p. 720. ans avant
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVIII.
547
prtre venu du continent, Bouddhaghosha, aprs avoir en quelque sorte rgnr la religion dont il tait le zl sectateur, quittait peine Ceylan pour porter la doctrine dans l'Inde en de du Gange, Ava et chez les Birmans' 1, lorsque F hian y arriva, dans les circonstances les plus favorables au but de son voyage, comme le prouve la relation des pompeuses crmonies dont il est le tmoin. Tout l'heure il vient de dire : Depuis l'origine de ce royaume, il n'y a jamais eu de famine, de disette, de calamits, ni de troubles; ce qui prouve qu'il y vint avant la du v sicle, peste qui dsola cette le sous le rgne d'Oupatissa, au commencement et surtout avant l'invasion c'est dans l'intervalle Fo fut apporte de l'arrive de F hian des Malabars, qui eut lieu peu de temps aprs. Ainsi coul entre ces deux vnements et l'poque o la dent de la pninsule (voyez la note 17 ci-dessus), qu'il faut placer Ceylan. On verra plus loin qu'il tait de retour dans son de l'anne 414 ; or il demeura deux ans Ceylan et fut
pays vers le milieu ensuite sept mois en voyage pour revenir en Chine; l'anne 4i 2 est donc l'poque certaine laquelle on doit rapporter cette date de 1497, poque qui concide parfaitement avec les circonstances historiques que nous venons de mentionner,
et qui place la mort de Bouddha l'an io84 ou io85 avant notre re. C'est une nouvelle date joindre toutes celles que l'on a recueillies au sujet de cet vnement 11,et il faudra la rapprocher des autres dates singhalaises discutes par MM. Burnouf et Lassen dans leurs recherches sur la langue sacre des Bouddhistes c. C. L. ici des Cinq cents manifestations successives.] Il s'agit vraisemblablement de Bouddha, auxquelles les Chinois applidjtaka, naissances ou transformations le nom d'incarnation (avatra). Tant que quent quelquefois, mais improprement, ces naissances se succdent, l'tre qui les reoit n'a encore aucun caractre divin; il est soumis l'avidy, c'est--dire toutes les imperfections attaches aux exis(21) tences individuelles, aux erreurs, aux affections, en un mot, aux illusions de toute espce qui constituent le monde sensible, et dont on a eu occasion de rapporter plusieurs exemples dans le cours de ces notes. Ce n'est qu'aprs avoir atteint le degr de perfection absolue, ncessaire pour devenir Bouddha, qu'il se confond avec l'Intelligence infinie et est jamais affranchi de toute individualit, et, par suivant une expression de M. Rmusat, des vicissitudes du monde consquent, phnomnal. F hian ne parle que de cinq cents manifestations; mais on en compte ordinaiet les doctrines relatives la rement cinq cent cinquante comme principales, admettent que Bouddha a parcouru l'chelle entire de la cration, transmigration " Crawfurd's to Ava, p. 491-Burnouf Embassy (i Lassen, Essaisur le pli, p. 62. b Conf. chap. VII, note 5, p. 42. c Essaisurle pli, p. 48 et suiv. Ixk.
548
FOE
KOUE
Kl.
qu'il a pass par toutes les existences de la mer, de la terre et de l'air, et subi chaque condition de la vie humaine. Quand un corps tait dtruit, dit Bouddha lui-mme, j'en recevais un autre, et le nombre de mes naissances et de mes morts ne peut se comparer qu' celui des plantes et des arbres de l'univers entier. On ne pourrait compter les corps que j'ai eus' 1. Ces cinq cent cinquante djtaka sont le sujet de peintures et d'emblmes que l'on conserve pieusement dans les temples, pour les offrir la vnration du peuple, lors de grandes crmonies telles que celle que dcrit le voyageur chinois. A chacune de ces manifestations se rapporte une lgende o le rcit des vnements auxquels Bouddha a t assujetti d'aprs les diverses formes qu'il a revtues, donne lieu une sorte d'instruction pratique, relative la conduite que l'on doit tenir dans toutes les conditions d'existence analogues. M. Upham a publi quatre de ces lgendes accompagnes de leurs figures, ainsi qu'une liste singhalaise des C. L. cinq cent cinquante djtaka h. (22) Celle de Sia ta nou.] Ce nom reprsente ncessairement le sanscrit soutatiou (au beau corps) qui se retrouve dans la liste singhalaise des djtakac. Hiuan thsang l'crit Sou ta nou et l'interprte par JL f% qui a de belles dents d; mais il est probable que cette interprtation, dont on ne pourrait faire ici aucune application , a t altre par une faute de copiste ou d'impression, et qu'il faut lire & C. L. corps, au lieu de fx dent.
(20) La transformation en clair.] Cette transformation n'a rien d'impossible dans les ides bouddhiques, qui admettent que les dieux et les saints peuvent revtir toute espce de corps, et crer mme plusieurs apparences existant simultanment. revtu Bouddha, disent les auteurs chinois, a, par sa puissance surnaturelle, aucun tre cr ayant un corps matriel. diverses formes qui n'appartiennent Pour sauver les vivants et les inonder de bonnes influences, il s'accommode la mesure de leur intelligence et se manifeste en toutes sortes de corps, comme la lumire d'une lune unique se montre rflchie la surface de toutes les eaux. Il se peut qu'il ait t clair, puisqu'il a t arbre et plante; mais cette manifestation n'est pas comprise parmi les cinq cent cinquante djtaka, du moins la liste singhalaise donne par Upham n'offre rien de semblable. Le Radja Ratncari raconte que lorsque la dent de Bouddha arriva Ceylan, il parut qu'elle s'levait aux cieux sous l'apparence d'une plante ; et ayant pris sa Sieou hingpen kcking,cit dansle Chiny tian, liv. LXXVII,p. 8. b The anddoctrine hislory of Budhism, page29. Books t. III, p. 269. Sacred and hislorical of Ceylon, c Sacredandhislorical Books ofCeylon, byUpham, t. III, p. 269. d Pian i tian, liv. LXIII, art. 6, p. i4.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXVIII.
549
place dans le firmament, elle brilla de six couleurs resplendissantes' 1. Ne pourraiton pas supposer que c'est quelque figure peinte en mmoire de ce prodige, que F hian aura vue, et qu'il aura prise pour l'image d'une des manifestations de Bouddha, parmi lesquelles elle se trouvait mle? C. L. (24) Celle du roi des lphants.] Ce djtaka doit tre celui qui figure dans la liste singhalaise sous le nom de Matanga, ou mieux encore peut-tre sous celui de Hatty pla h. CL. (25) Celle du cerf-cheval.] C'est sans doute le djtaka nomm liste Rooroomaga, c'est--dire la gazelle appele Rourouc. C. L. dans la mme
(26) Une chapelle nomme Po thi.] Hiuan thsang ne fait aucune mention de cette chapelle, mais il parle de la montagne sur laquelle elle tait situe et qui se trouve l'angle sud-est du royaume. Il la nomme la montagne Ling kia. Jou la l'a habite autrefois, et c'est l qu'il a expliqu le Ling kia kingd. C. L. * SacredBooks by Upham,t. II, p. 72. of Ceylon, b Idem,t. III, p. 277. ' Idem,t. III, p. 277. d Pian i tian, liv. LXVI, art. 4, p. 18 v.
CHAPITRE
XXXIX.
Chapelle
Mo ho pi ho lo. Brlement du corps d'un Samanen. Destine du pot de Fo.
sept li, il y a une chapelle nomme Mo ho pi ho lo (i), o demeurent trois mille religieux. Il y avait un Samanen d'une haute les prceptes exactement et vivait dans vertu, qui pratiquait Au midi de la ville, la plus grande Les gens du pays croyaient puret. un Arhan. Lorsqu'il de sa fin, le roi vint approcha et conformment la loi, il assembla tous lui que rendre c'tait visite,
des religieux, et leur demanda si le mendiant avait obtenu la doctrine. Ils rpondirent qu'effectivement c'tait un Arhan. il fut mort, le roi ayant consult les Quand rituels Arhan. et les livres A l'orient sacrs, lui fit les funrailles qui conviennent un de la chapelle, quatre ou cinq //, on entassa du bon de trois tchang environ et la mme hauteur; aulargeur du santal, de l'essence de bois d'alos et toutes sortes Des quatre cts on fit des gradins, tissu de laine blanc bien pur. Sur un char funraire, mais
bois sur une dessus
on mit
de bois odorifrants. le tout leva avec un beau
et on couvrit ce bcher on
un grand
lit semblable
Au moment
du che we (3), le roi et les quatre castes et offrirent des fleurs et des parfums. le char Quand pays se runirent fut parvenu au lieu de la spulture, le roi lui-mme offrit des fleurs et des parfums. qu'on lait, arrosa tout Cette partout le monde offrande termine, puis coeur de storax, avait le on plaa le char sur on y mit le feu. Tandis le bcher qu'il brchacun
sans lonng i (2). des habitants du
de recueillement; plein avait l son habit de dessus, et agitait de loin une espce d'ombrelle de plumes le che we fut achev, on repour aider le che we. Quand chercha et on recueillit les os, au-dessus on leva une tour. desquels
CHAPITRE F hian, son arrive, ne trouva plus
XXXIX. ce Samanen vivant,
551 il ne put btir
ses funrailles. qu'assister Le roi croit fermement nouvelle
la loi de Fo.
Comme
il dsirait
une
il commena chapelle pour les religieux, par leur donner un grand festin. Aprs qu'ils eurent il choisit un couple de mang, bons boeufs de labour, dont il fit orner les cornes d'or, d'argent et de choses prcieuses. On fit une belle charrue luid'or, et le roi laboura mme les quatre cts d'un les habitants, les familles, contrat ce bien arpent; puis il s'en dessaisit, les champs et les maisons. dsormais, sans et en donna Il crivit sur
le fer un ration,
que portant se transmettrait,
et de gnration en gnost l'altrer ou le qu'aucun
changer. Fa hian indiens,
tant
dans
ces lieux,
entendit lev,
des
qui du haut d'un trne que le pot de Fo tait d'abord Kian tho we (5) depuis bientt entendit cette lecture, savait
lisant
de la Raison religieux les livres sacrs, disaient il
Pi che li (4), et qu'il est maintenant onze cents ans. [Fa hian, quand
le nombre des annes, au juste mais maintenant il l'a oubli.] Il doit retourner dans le royaume des Yue ti de Yu occidentaux(6). Aprs onze cents ans, il ira dans le royaume ans ; puis il ira dans le royaume de Khia thse (8). Aprs onze cents ans, il doit venir de nouveau dans le Pays de au Royaume Han pour des Lions. onze cents ans; puis il reviendra thian (7) et y restera onze cents Aprs milieu, verra, Alors, durant onze cents ans, il retournera au ciel dans l'Inde du milieu. Mi De l'Inde du le pho sa (10) Je il dira en soupirant : Le pot de Chy kia wen Foe est arriv ! des fleurs et des parfums il lui offrira avec tous les dieux, il s'lvera Teou chou (9). Quand
le bassin reviendra Les sept jours expirs, dans le sept jours. de la mer (12) le prendra thi (n). Le roi des dragons dans Yanfeou la son palais de dragon. Mi le sera sur le point de complter Quand reviendra sa place primitive sur le divis en quatre, loi, le bassin, mont Phin na. Mi ciel (i3) mditeront la loi, les quatre le ayant rois du accompli la loi des conformment de nouveau sur Fo,
552 Fo antrieurs. Quand Quand court, Les mille
FO
KOU
Kl. tous de insen-
ce bassin. siblement. viendra beurre s'armeront
Fo de l'ge des sages (i4) se serviront le bassin n'y sera plus, la loi de Fo s'teindra la loi de Fo sera teinte,
au point de ne durer que devenus Les hommes disparatront. de btons
redel'ge des hommes cinq dix ans. Le riz et le extrmement mchants,
en pes; tous s'attaqueront, qui se changeront Il y en aura dans le nombre entre eux et se tueront. se battront qui dans les montagnes. et de s'enfuir de s'chapper auront le bonheur Quand ront la destruction et reparatront des mchants en se disant sera termine, aux autres les hommes : Ceux sortiles uns d'autrefois
vivaient et agi
mais ils ont commis toutes sortes de pchs trs-longtemps; notre vie a t successivement la loi, voil pourquoi contre et rduite toute cultivons ainsi sorte les
dix ans. Faisons maintenant jusqu' vers la charit, de bien, levons nos coeurs repentants actions et de justice. Chacun d'humanit pratiquant abrge la justice, la dure de l'ge s'accrotra vingt mille ans. Quand Mi le sortira cera tourner la roue fidles de la doctrine, ciples rests maison (i5), ceptes prcieux la loi alors, du
la foi et quatrecommenles dis-
et parviendra et qu'il sicle, d'abord
il convertira
de Chy kia, les hommes hors de leur ceux qui auront reu les trois koue (16) et les cinq prle culte des trois observ la loi et pratiqu (17), ceux qui auront : les seconds Fo. cela, et les troisimes, F hian mais voulut convertis l'instant dans mme cet ordre, copier point sont le livre nous
par protgs qui contenait le savons par
tradition
les gens lui dirent orale.
: Ce n'est
crit,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIX.
(1) Chapelle Mo ho pi ho lo.] C'est le sanscrit mahvihra, le grand temple, ou plutt le grand monastre ; car suivant la dfinition donne par M. Uphama, vihra ne dsigne pas proprement un temple, mais une habitation de religieux avec une " Historyanddoctrine Budhism, of p. ig.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIX.
555
chapelle; ce que les Chinois nomment un seng kia lan. F hian prend ici la partie pour le tout. Hiuan thsang ne fait pas mention de cet difice. C L. (2) Mais sans loung i.] Le texte porte : 4 IL 41
Je dois me borner transcrire les mots manire satisfaisante, et qui dsignent bole funraire sur lequel je ne trouve sont ma disposition. Peut-tre faut-il
loung i, que je ne puis interprter d'une probablement quelque ornement ou symaucun renseignement dans les lexiques qui
entendre simplement par l que le lit ou brancard, qui tait sur le bcher, ressemblait un char funraire, mais que seulement il n'tait pas orn de figures de dragons et de poissons. G. L. (3) Au moment du che we.] Che we est un terme fan qu'il est difficile de restituer avec certitude dans sa transcription originale, soit parce qu'il est compos d'une manire trop irrgulire, soit parce que, depuis longtemps, il aurait cess d'tre en usage. Le San tsang fa sou" l'explique par fen chao, consumer, brler, l'action de brler. Ce pourrait tre la transcription des deux premires syllabes du mot sanscrit avadha, crmation d'un corps. Le che we est une des quatre spultures, celle du feu; les autres sont la spulture de l'eau, celle de la terre et celle des forts \ CL. (4) Pi che li.] C'est la ville indienne de Vas'li. (Voyez ci-dessus, chap. XXV, note 2 , page 2 44-) Les dtails dans lesquels on est dj entr au sujet du pot de Bouddha, nous dispensent d'y revenir en ce moment; mais il faut rapprocher la tradition rapporte ici par F hian, de la mention qu'il a faite prcdemment 0 de l'existence de cette relique, non pas dans le Kandahar, comme il le dit prsent, mais dans un royaume voisin, chez les Bloutches. C. L. (5) Kian tho we.] Ce pays, nomm aussi Kian tho lo et Kan tho lo, est le Kandahar. (Conf. chap. X, note i, page 66.) Selon la Description des contres occidentales, il est l'ouest du royaume d'Ou'dyna et se nommait d'abord Ye pho lo; mais ayant t soumis par les Ye tha (Gtes), il changea de nom. L'Oudyna et le Kandahar sont les contres de l'Inde du nord qui, l'poque du voyage de F hian, conservaient le plus de traditions importantes pour l'histoire du bouddhisme; mais le voisinage o ils taient l'un de l'autre, et la dlimitation si difficile taV, p. 3. h Fa youantchoulin, cit dansle San Isangfa sou,liv. XIX, p. i4 v. c Chap. XII, p. 76 et 78. 45 a Liv.
554
FOE
KOUE
KL
blir entre tant de petits tats toujours en guerre, tantt dominateurs de leurs voisins, tantt soumis par eux, occasionnent quelquefois de lgres diffrences, sinon dans la fixation des lieux tmoins des actions de Fo, au moins dans la dtermination prcise du royaume dans la dpendance duquel ils se trouvaient. C'est ainsi mmorables rapportes par F hian ou Hiuan que plusieurs des circonstances thsang comme ayant eu lieu dans l'Oudyna, peuvent, selon d'autres voyageurs, sans qu'on puisse raisonnas'tre passes dans le Kandahar, et rciproquement, ou les opposer les unes aux blement accuser leurs relations de se contredire, autres. du vie sicle, deux religieux bouddhistes chinois, Soung Tout au commencement yan tse et Hoe seng, vinrent dans le Kandahar, guids par les mmes motifs qui y avaient conduit F hian une centaine d'annes auparavant. La relation qu'ils en mrite, plusieurs gards, d'tre rapproche de celle du Fo kou ki. Au de leur arrive, le royaume tait en guerre depuis trois ans avec le Khi pin, au sujet des limites des deux tats. Le roi tait un tyran cruel, se plaisant au meurtre et au carnage, ne croyant pas la loi de Fo, pratiquant le culte des gnies et ne se fiant qu'en sa force et en son courage. Il avait sept cents lphants donnent moment de guerre, monts chacun par dix hommes arms de sabres et de lances, et la trompe de chaque lphant tait attach un sabre pour frapper les ennemis. Le roi faisait son sjour habituel sur les frontires et au milieu des montagnes sans jamais revenir, en sorte que le peuple souffrait beaucoup et que les familles murmuraient. Soung yun se rendit l'arme pour remettre la lettre impriale. assis Soung yun lui dit : Les montagnes ont du haut rivires ont du grand et du petit; de mme, dans le monde, hommes du sublime et de l'humble. Les "Ye tha et le roi de Ou Le roi la reut et du bas, les il y a pour les
tchang ont tous reu avec respect les lettres impriales : pourquoi le grand roi seul a-t-il t sans respect? Le roi rpondit : Si je voyais en personne le grand seigneur des We, je le saluerais ; mais qu'y a-t-il d'tonnant ce que je reoive et que je lise assis ses lettres? Quand les hommes reoivent une lettre de leur pre ou de leur mre, ils la lisent assis : le seigneur des We est pour moi comme un pre et une mre, et je lis aussi sa lettre assis. En cela, qu'y a-t-il de contraire la raison? Yun ne put le faire changer Aprs cinq journes de chemin vers l'occident, les voyageurs arrivrent l'endroit o Jo la fit l'aumne de sa tte ; il y a une tour habite par vingt religieux. Suivant F hian, cette action aurait eu lieu dans un royaume nomm Tchu cha chi lo (chap. XI), situ sept journes l'orient de Kian tho we, et qui sans doute n'existait dj plus, au moins comme tat indpendant, l'poque du voyage de Soung yun. A trois journes encore vers l'occident est le fleuve Sou theou, sur la rive occidentale duquel est le lieu o Jo la, ayant pris la forme du grand poisson Ma kie (Makara?), sortit du fleuve, et pendant douze ans nourrit
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIX.
555
les hommes de sa chair. On a lev une tour en mmoire de cet vnement, et on voit encore sur une pierre l'empreinte des cailles du poisson. Plus l'ouest, trois journes, on vient la ville de Fo cha fou. Il y a, tant en dedans qu'en dehors de cette ville, d'anciens temples pour lesquels les dvots Ont une vnration particulire. Au nord de la ville, un li, est le palais de l'lphant blanc. C'est un temple ddi Fo. Il est orn de statues de pierre, couvertes de riches ornements; elles ont plusieurs ttes pour un mme corps et sont revtues de feuilles d'or qui blouissent les yeux. Devant le temple est l'arbre de l'lphant blanc. Ses fleurs et ses feuilles sont semblables celles du jujubier; il donne des fruits la fin de l'hiver. Les vieillards disent, par tradition, que quand cet arbre mourra, la loi de Fo mourra aussi Plus l'ouest, une journe de marche, est le lieu o Jo la s'arracha un oeil pour le donner un homme. (Gonf. chap. X.) On y a bti une tour et un temple. Sur une pierre est l'empreinte du pied de Kia ch fo. En continuant sa route vers l'ouest, Soung yun arrive la ville de Kan tho lo, au sud-est de laquelle, sept li, est \e feou tou bti par le roi Kia ni sse kia et qui doit tre le mme difice que F hian place dans le Bloutchistan. (Conf. chap. XII.) La lgende relative au roi Kia ni sse kia est raconte peu prs de la mme manire par ces deux voyageurs et par Hiuan thsang a qui, d'accord avec Soung yun, dit que ce temple se trouvait dans le Kandahar. L'un et l'autre en dtaillent toutes les magnificences, a Parmi les feou thon des contres occidentales, dit Soung yun, celui-ci est le premier. Quand on commena le btir, on se servit de perles pour faire les treillis destins le recouvrir. Mais quelques annes aprs, le roi pensant que ces tissus de perles valaient plusieurs fois dix mille pices d'or, crai gnit qu'aprs sa mort on ne les enlevt, et que si la grande tour tait renverse, personne ne s'occupt de la reconstruire; il prit donc les tissus de perles et les mit dans un vase de cuivre qu'il fit enterrer cent pas au nord-ouest de la tour; au dessus, il fit planter un arbre. Cet arbre se nomme Pho thi; ses rameaux s'tendent de tous cts, et ses feuilles drobent la vue du ciel. Au-dessous sont quatre c< statues assises, hautes chacune de cinq toises et aprs avoir pass une En allant vers le nord-ouest pendant sept journes, grande rivire, on arrive au lieu o Jo la dlivra une colombe. Suivant F hian, c'est dans un pays nomm Su ho to (chap. IX) que le Bodhisatlwa a accompli cet acte de charit. Soung yun n'a pas connu ce nom, qui avait probablement disparu dj avec le petit tat auquel il avait appartenu. A partir de ce point, les voyageurs ngligent de marquer les distances qui sparent les pays qu'ils visitent et d'indiquer la direction de la route qu'ils parcourent. Us arrivent successivement au royaume de Na kia lo ho, qui est le mme que le " Pian i tian, liv, LXIII, aii. 7, p. 8.
556
FO
KOU
Kl.
Na ki, plac par F hian seize yodjanas l'ouest des Bloutches. (Chap. XII.) C'est l qu'est l'os du crne de Fo. Il a quatre pouces de circonfrence et est d'un blanc jauntre; au-dessous il y a un trou qui peut recevoir le doigt d'un homme; il ressemble une ruche d'abeille. Dans la ville est le temple Khi ho lan, o sont treize fragments du Ma cha (collet) de Fo. C'est probablement la chapelle du seng kia li mentionne dans le Fo kou ki. Il y a aussi le bton d'tain de Fo, il est long de sept tchang (environ 2im); on l'arrose avec des tubes remplis d'eau. Il est tout recouvert de feuilles d'or. Le poids de ce bton varie ; il y a des temps o il est si lourd que cent hommes ne pourraient le soulever, et d'autres fois il est si lger qu'un seul homme le porterait. Dans cette mme ville, il y a aussi une dent et des cheveux de Fo; ces reliques sont prcieusement enchsses, et matin et soir on y fait des offrandes. A Kiu lo lo Ion, quinze pas dans la montagne, est la grotte de l'ombre de Fo. Quand on regarde de loin, l'ombre s'aperoit distinctement de tous cts; mesure on ne la distingue plus que comme si les yeux taient troubls; que l'on approche, et si l'on avance la main, on ne sent que les murs de pierre. En reculant, on voit petit petit, la figure reparatre. C'est une chose bien singulire dans le monde. Devant la grotte, il y a une pierre carre sur laquelle est une empreinte du pied de Fo. A cent pas au sud-ouest de la grotte est le lieu o Fo lava ses habits; et un li, au nord-est, est la grotte de Mon lian. Au nord de cette grotte est une montagne au bas de laquelle il y a un grand temple avec un feou thou haut de dix toises. H y a encore sept autres tours, au midi desquelles est une pierre avec une inscription que l'on dit tre de la main de Jo la ; elle est trs-distincte et on la comprend encore trs-bien maintenant". En rapprochant la relation de F hian de celle que nous venons d'extraire, on verra qu'elles ne diffrent l'une de l'autre en aucun point essentiel, et que celle-ci contient quelques particularits dont le premier ne parat pas avoir eu connaissance, ou qu'il a nglig de noter. De ce nombre est la tradition curieuse qui attribue Shkya Tataghta l'inscription dont il a t parl en dernier lieu. En ce qui concerne le pot de Fo, Hiuan thsang rapporte qu'aprs le Nirvn'a il se trouvait dans le Kian tho ive o il fut honor pendant plusieurs sicles, mais qu'ensuite il passa dans d'autres royaumes et qu'il tait alors en Perseb. C. L. (6) Yu ti occidentaux.] Ce sont les grands Yu ti, qui, repousss vers l'occident par les Hioung nou d'abord, et ensuite par les Ousun, quittrent le Tangut o ils menaient une vie errante, se rendirent matres de la Transoxane et y fondrent un empire longtemps puissant, d'o ils tendirent leurs conqutes sur le Caboul, le Kandahar et tous les pays situs sur les deux rives de l'Indus. Voyez ce qui en a dj t dit chap. XII, note 9, page 83. C. L. Pian i tian, liv. LXIII, art. 7, p. 1 v. et suiv. h Idem.ibid.p. 7 v.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XXXIX.
557 III ci-
(7) Le royaume de Yu thian], dessus.
autrement
dit Khotan. Voyez le chapitre
(8) Le royaume de Khiu thse.] M. Rmusat pensait que ce pays pouvait tre celui de Bich-balik; ne serait-ce pas plutt Koutche, qui d'ailleurs faisait partie de l'tat de Bich-balik, mais que l'on aurait plus particulirement voulu dsigner ici? C. L. en sanscrit Touchit, ou ciel de la connaissance suffisix cieux superposs les uns aux autres, lesquels consC'est l que les tres parvenus au degr qui prcde
(g) Au ciel Teou chou], sante. C'est le quatrime des tituent le monde des dsirs. immdiatement la perfection
absolue, c'est--dire les Bodhisattwas , viennent habiter en attendant que le moment de descendre sur la terre, en qualit de Bouddhas, soit arriv. -C. L. (10) Mi le Phou sa], Matreya Bodhisattwa. pitre VI, note 8, page 33. Voyez sur ce personnage le cha-
(11) Le Yan feou thi], le Djambou dvpa. On sait que l'on dsigne par l un des quatre continents qui, dans le systme du monde conu la manire des Bouddhistes, partagent la terre habitable. C'est le continent mridional et celui qui CL. comprend l'Inde. (12) Le roi des dragons.] Voyez ci-dessus, chap. XVII, pages i43 et 161. du
(i3) Les quatre rois du ciel.] Ce sont les ministres d'Indra et les protecteurs monde. On les a fait connatre prcdemment, chap. XVII, page i4o.
(i4) L'ge des sages], en sanscrit Bhadrakalpa. C'est l'ge dans lequel nous vivons et une des priodes assignes au monde pour se former, subsister et se sont dj dtruire. Elle doit durer 236 millions d'annes, dont 161,200,000 coules, et pendant lesquelles mille Bouddhas doivent se succder pour le salut de tous les tres. Il n'en a encore paru que quatre et la vie humaine est sur son dcours, puisque de 84,000 ans elle est rduite 100. Des calamits de diffrente nature atteignent successivement toutes les portions de l'univers. Quand l'ge des hommes sera descendu jusqu' 3o ans, la pluie du ciel cessera; la scheresse et les lgumes de renatre; on ne verra plus qui en rsultera, empchera les plantes d'eau, et un nombre immense d'hommes mourra. Lorsque la vie sera rduite 20 ans, des pidmies et toutes sortes de maladies s'lveront la fois et feront une infinit de victimes. Enfin, quand la vie moyenne n'aura plus qu'une dure
558
FOE
KOUE
KL
de 10 ans, les hommes se livreront aux querelles et la guerre. Les arbres et les plantes mme deviendront des armes entre leurs mains; et ces armes leur fournissant les moyens de s'entre-dtruire, il en prira de cette manire un nombre immense a. Alors, conformment la tradition recueillie par F hian , Mi le (Malreya) paratra en qualit de Bouddha ; il rgnrera s'tendra jusqu' 80,000 ans. C. L. (i5) le monde, et la vie des hommes
Les hommes hors de leur maison.] On a vu cette expression plusieurs fois leur famille pour ememploye pour dsigner les hommes qui ont abandonn brasser la vie religieuse et vivre dans la solitude. (16) Les trois Koue] ou les trois appuis. Voyez ci-dessus, page 32 3. chap. XXXVI, note 7,
(17) Les cinq prceptes.] Voyez chap. XVI, note 12 , page io4. Fa insrdans le Journaldes Savants,dcembre1831, youan tchu lin, cit par M. Rmusatdans son Mmoiresur la Cosmogonie des Bouddhistes, p. 717.
CHAPITRE
XL
ET
DERNIER.
Dpart du royaume des Lions. Royaume de Ye pho ti. Montagne de Lao. Ville de Thsing tcheou. Retour Tchhang 'an. Conclusion.
Fa obtint
hian
demeura
deux
ans
le qui contient enfin il eut une collection des difflong A han et le A han mlang; rents dans la terre de Han. Tsang (i), tous livres qui manquaient il fut en possession de ces volumes en langue Quand il les fan, chargea de deux pourvoir sur un cents aux vaisseau contenir marchand, grand qui pouvait hommes. Derrire tait attach un petit navire, dangers d'un plus pour du
le volume
ce royaume. Il y demanda les prceptes de Mi cha se. Il obtint
dans
et
grand vaisseau.. Ayant trouv deux jours; aprs quoi on fut surpris faisant les marchands voulurent eau, mais monde, leur coult les hommes
voyage par mer et aux dommages un bon vent, on alla l'orient pendant par un
couprent vie, et redoutant fond,
Le btiment ouragan. sur le petit navire; passer de celui-ci, craignant qu'il ne leur vnt trop de le cble. Les marchands furent trs-effrays pour que d'un moment l'autre le vaisseau ne
ils prirent les objets les plus gros et les jetrent F hian, avec l'quipage, travailla aussi puiser l'eau. et l'eau; il le jeta dans la mer. Mais il craitout ce qu'il avait de superflu, gnait unique vivants, que les marchands tait donc pense dans la terre de Han, ne jetassent ses livres et ses images. Son de prier Kouan chi in (3) de faire revenir tous les religieux. Moi, disait-il, chercher la loi; j'espre que j'ai
ce voyage lointain les entrepris pour la navigation et que je pourrai atteindre dieux protgeront le port. treize jours et treize nuits, dur ainsi pendant L'ouragan ayant le flux se fut retir, au rivage d'une le; et quand on parvint ayant
560 dcouvert l'endroit
FO
KOU
KL
en eau, on y remdia par o le vaisseau prenait le bouchant; ensuite on se remit en mer. H y a beaucoup de pirates, et quand on les rencontre, ne peut leur chapper. La mer personne tait vaste, immense et sans rivages; on ne connaissait ni l'orient, ni l'occident; la lune et les dirigeait que par le soleil, toiles. le temps tait couvert ou pluvieux, il fallait suivre le Quand de rgle. vent sans avoir Pendant la nuit, le temps tait lorsque on ne voyait sombre, que de grandes vagues qui s'entre-choquaient, des clairs marins couleur de feu, des tortues, des crocodiles, taient tait sans dans fond, des monstres un trouble et il n'y et d'autres Les prodiges. o ils allaient. marchands La mer on ne se
ignorant profond, avait pas un rocher serein, on sut alors mais en avant; aurait pas
o l'on pt s'arrter. comment s'orienter, et rencontr
le ciel fut redevenu Lorsque et l'on se dirigea de nouveau
si l'on
vingt-dix Les hrtiques pas
eu moyen de sauver alors on arriva jours; et les Brahmanes
rocher il n'y cach, quelque sa vie. On fut ainsi pendant quatre un royaume nomm Ye pho thi (S). y sont en grand nombre; il n'y est
de la loi de Fo. question Fa hian suivit Aprs avoir sjourn cinq mois dans ce royaume, de nouveau des marchands dans un grand vaisseau, conqui pouvait tenir aussi deux cents hommes environ. On avait des provisions pour lune. cinquante F hian vers On partit jours. tait trs-tranquille Kouang de la nuit, marchands hian, cet le seizime sur jour ce vaisseau. d'un vent de la quatrime On faisait route mois affreux environ, et une la pluie
au nord-est seconde violente. effrays. in, avec
tcheou (4). Au bout on rencontra et les un
veille Les F tous
instant,
furent tous passagers galement de tout son coeur Kouan chi pria de Han, calme. demandant Quand aux dieux le calme fut le ciel
les religieux de les secourir et de leur les Brahmanes sur dbarquer
de la terre rendre
rtabli,
tinrent notre
conseil bord est
entre
eux et dirent
de ce Samanen heur; il faut
ce mendiant
ce qui nous sur le rivage
: Le sjour a attir ce mald'une le de ]a
CHAPITRE mer. Il ne faut pas que, pour Le principal un seul
XL. homme, soyons (5) de Fa hian nous
561 exposs dit : Si
de tels vous moi. Han mme religieux. Cependant
dangers.
bienfaiteur
ce mendiant, tuezaussi; autrement dbarquez dbarquez-moi Si vous dbarquez ce Samanen, en arrivant dans la terre de au roi. Le roi de la terre de Han est luije vous dnoncerai trs-attach Les la loi de Fo; incertains, trs-couvert; il honore n'osrent les mendiants et les
marchands, tait
le ciel
et taient fort en route proquement depuis de bouche et dix jours. Les provisions et l'eau allaient plus de soixante tre puises les ali; on prit de l'eau sale de la mer pour prparer et on partagea la bonne en avait environ deux eau; chacun ments, elle tirait sa fin, les marchands tinrent conseil ching (6), Comme et dirent : Le temps de ce long voyage tre de cinquante pouvait Kouang tcheou; voil bien des jours que ce terme jours pour arriver est dpass : nous n'avons il vaut mieux naviguer plus de ressources; vers le nord-ouest le rivage. pour chercher En dional kouang une douze de jours et autant Lao de nuits, (7), situe de bonne aprs tant on fut arriv bien dans on sur arriva les au versant limites de mriTchhang
les pilotes embarrasss. On tait
pas le dbarquer. se regardaient rci-
la montagne kiun (8), et l'on aussi
y trouva prilleuse,
eau
et des lgumes.
navigation tant pendant
plante dant on n'apercevait ne savait dans quel encore savait trer Kouang
de jours, Li ho thsa, on
quand se croyait
de fatigues ce rivage, la terre
Aprs et de craintes en voyant la
de Han; d'hommes, qu'on
ni de traces pas d'habitants lieu on tait. Les uns disaient les autres On monta
cepenet on pas ne
n'tait
tcheou,
quoi s'arrter. dans l'embouchure
du fleuve,
qu'on l'avait dpass ; personne sur une petite barque pour enafin de chercher quelqu'un auprs
de qui s'informer du lieu o l'on tait. On trouva deux chasseurs qui F hian de servir d'interprte retournaient chez eux, et on chargea F hian commena ensuite il par les rassurer; pour les interroger. leur demanda : Quelles gens tes-vous? Ils rpondirent : Nous sommes 46
562 des adhrents dans de Fo. les
FOE On leur
ROUE demanda
Kl. encore : Qu'tiez-vous alls
? Ils nous rpondirent en nous trommontagnes le quinzime lune; nous voupant : C'est demain jour de la septime lions prendre Fo. On leur chose pour faire un sacrifice quelque C'est demanda encore : Quel est ce royaume-ci? Ils rpondirent: de Tchhang Thsmg tcheou (9), sur les limites kouang kiun, de la famille ries Lieou. Les marchands entendu, l'ayant joyeux; quelqu'un ils demandrent Tchhang aussitt kouang. leurs marchandises, qui dpend trsfurent
chercher
la loi de Fo croyait nianens qui portaient et vint jusqu' la mer; barque
Li yng, qui en tait et l'honorait. qu'il y avait des SaApprenant il monta sur une des livres et des images,
et envoyrent le gouverneur,
des gens en avant sur puis il envoya le rivage, et ayant reu des livres et des images, il retourna la ville. Les marchands partirent pour Yang tcheou (10). Ceux de Thsing tcheou, F hian y passer des Lieou, invitrent qui sont sous la domination un hiver et un t. A la fin du ardemment repos d't revoir (n), F hian ses matres. Il dsirait s'loigna 'an (12); mais dans le midi de ce (13);
Tchhang il s'arrta
tant une chose qu'il mdilait alors les matres produisirent F a hian arriver pour versa de , depuis son du Milieu; au royaume revenir Thsing tcheou. sont au nombre il d'au
importante, les livres de
sacrs
dpart
Tchhang
et les prceptes. fin, mit six ans
il y sjourna six ans, Les royaumes qu'il parcourut moins trente. Aprs avoir pass jusque dans l'Inde. La
pour et en mit trois et trale fleuve la
Sable
l'ouest,
parvint
dcence,
la pit des religieux est admirable; il ne saurait gravit, l'exprimer. Ceci n'est ne pouvant encore tre entendu qu'un simple aperu; des matres, il ne jette sur les dtails. II a pas les yeux en arrire la mer, et il est revenu, travers aprs avoir rsist toutes sortes de la ligues; il a eu ainsi le bonheur de recevoir trois hautes et nobles faveurs. mis sages sur Il a t le bambou dans le pril, (i4) ce qui et il y a chapp : voil pourquoi lui est arriv, faire pari dsirant il a aux
de ce qu'il
a entendu
et vu.
NOTES Cette anne
SUR
LE
CHAPITRE
XL.
565
des annes Iyi (i5) des Tsin, l'anne Kyayn, la douzime tant dans l'toile de la longvit, la fin du repos d't, on alla la rencontre de F hian le voyageur il fut arriv, on le retint (16). Quand passer les ftes d'hiver. On discourut avec lui; on lui fit des questions sur ses voyages. Sa bonne foi inspirait de la confiance pour ses rcits : aussi ce qui n'avait t a t mieux Il a mis et la fin. expliqu. Il dit lui-mme : En rcapitulant ce que j'ai prouv, mon coeur s'meut Les sueurs involontairement. qui ont coul dans mes prils ne sont pas le sujet de cette motion. Ce corps a t conserv par les sentiments ma vie, dans qui m'animaient. des pays o l'on C'est n'est mon but qui m'a fait risquer pas sr de sa conservation, pour de mon espoir, tout risque. on est touch de voir un tel qu'imparfaitement en ordre le commencement connu avant lui,
parvenir jusqu' On est touch homme; on se dit
ce qui tait l'objet de ces paroles, que, dans tous
qui se soient expatris en a pas eu qui aient comme l'a fait F hian. la vrit, autrement Sans mrite
il y en a eu bien peu les temps, mais qu'il n'y pour la cause de la Doctrine; oubli leur personne chercher la loi, pour Il faut avoir connu la conviction que produit produit la ne partagera pas le zle que action on n'achve rien. En comment tre livr
on
volont. sant avec
et sans et l'action,
le mrite estime,
accomplis l'oubli? Perdre oh!
ce qu'on
estimer
ce que
les hommes
oublient,
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XL.
(1) Une collection des diffrents Tsang.] Sur les prceptes des Mi cha se, sur les quatre A han (Agama) et sur les diverses classes de livres compris sous le nom de Tsang ou collection, voyez les explications donnes ci-dessus, chapitre XXXVI, page 326, notes 10 et 12. (2) Kouan chi in,] Avalokites'wara, personnage bien connu de la mythologie note 37, page 1 17.) F hian l'invoque dans sa bouddhique. (Voyez chapitreXVI, 46.
564
FOE
KOUE
KL
dtresse comme le dieu dont la puissance s'exerce sur les tres anims, lesquels, suivant le systme thologique dvelopp par M. Hodgson, lui doivent leur formation; de mme que la cration des divers tages dont se compose le monde matriel, depuis les cieux jusqu'aux enfers, est l'ouvrage de Mandjous'ri. Les Bouddhistes ont consacr Kouan chi in un des dix jours fris dans lesquels ils divisent chaque mois; c'est le 2 k- Ce jour-l, les quatre rois des dieux descendent parmi les hommes pour comparer les bonnes et les mauvaises actions. Si l'on prononce le nom de Kouan chi in Phou sa, on teint toutes les douleurs, on accrot et on alimente toutes les vertusa. C. L. (3) Un royaume nomm Ye pho ti,] Yava dvpa. C'est la premire mention de l'le de Java que l'on trouve dans les auteurs chinois ; mais ce ne fut que quelques annes aprs le retour de F hian que l'on eut des dtails sur sa position gographique, sur les productions de son sol et sur les moeurs de ses habitants. Une ambassade que le roi de ce pays envoya l'empereur de la Chine, la douzime anne yuen Ma (436), sous la dynastie des Soung, commena des relations qui, rares d'abord et interrompues par d'assez longs intervalles, se multiplirent, vers le milieu du x sicle, par suite des tablissements que les Chinois y avaient forms. Ceux qui s'y taient fixs furent appels Tang, du nom de la dynastie sous laquelle s'tait opre cette colonisation. Ce fut vers cette poque qu'on adopta la forme Tche pho pour reprsenter le nom de Java, et cette transcription prvalut pendant longtemps. Sous la domination des Mongols, plusieurs expditions militaires eurent lieu contre les Javanais, dont le pays reut alors le nom de Koua wa (son de courge), qui lui fut donn sur la ressemblance qu'on crut remarquer entre le son de la voix de ses habitants et celui que rend une courge sur laquelle on frappe. Enfin les gographes et les annalistes modernes ont appliqu Java des dnominations particulires d'autres les ou des districts placs dans son voisinage ou sous sa dpendance. Telle est celle de Pou Ma loung qui appartient une le [Borno?) que l'on dit tre huit journes de navigation de Tche pho; telle est celle encore de Kiao lieoa pa, qui est probablement la province de Cheribon, dans l'le de Java mme. Le San tsa tou hoe, cit dans l'Encyclopdie japonaise, dit : Pou Ma loung, Ta Tche pho et Koua wa sont trois royaumes diffrents l'un de l'autre; jadis ils n'en faisaient qu'unb. Le nombre et la varit des anciens monuments que l'on retrouve Java ont fait penser que cette le avait t colonise par diffrents peuples du continent de l'Asie; mais la religion, les institutions et la littrature de l'Hindoustan paraissent n'y avoir t gnralement rpandues que vers le milieu du ixGsicle, et ce n'est FayouentchouUn,cil danslo Santsang fa sou, liv. XLII, p. 3. * Encyclopdie japonaise,liv. XIV, p. 10-12, et cl'. Wenhianihoung khao,liv. CCCXXXII, p. 6. h
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XL.
565
gure qu' partir de cette poque que l'on peut commencer accorder quelque confiance aux traditions des Javanais. Tout ce qui prcde est confus, obscur, contradictoire et'interpol des histoires fabuleuses et hroques de l'Inde continentale. Les sectateurs de Bouddha, repousss par les Brahmanes vers les extrmits de l'Asie et dans les les adjacentes, durent se rfugier Java, comme ils l'avaient fait Ceylan, Ava, Siam; mais il est vraisemblable que si le bouddhisme n'y fut gnralement rpandu que vers cette poque, il y avait t du moins introduit antrieurement. On voit par la relation de F hian qu'au commencement du Vesicle cette religion n'y comptait encore ni de nombreux proslytes, ni des monuments bien importants; c'tait le brahmanisme qui y dominait. D'aprs une description de Java crite en chinois, qui fait partie de la prcieuse bibliothque laisse par M. Klaproth, il faudrait assigner l'introduction du bouddhisme dans cette le, une date beaucoup plus ancienne que celle qu'on lui attribue gnralement. Il y est dit que sous le rgne de l'empereur Koung wou ti des Han (de il\ 57 de J. C), les hommes du royaume de Ou In toa (l'Inde) traversrent la mer et vinrent Java. Ayant vu les choses prcieuses que produisait l'le, ils s'unirent avec les habitants pour un commerce d'change, et introduisirent chez eux l'art de btir des maisons, la science de l'criture et la loi de Bouddha". A la vrit, le volume d'o nous tirons cette particularit, imprim Batavia et n'est pas de nature rdig presque entirement d'aprs des sources europennes, faire autorit lui-mme. Ici pourtant la citation du nom d'un empereur de la Chine semble devoir donner quelque consistance ce passage en indiquant que la notion qu'il contient est tire des annales chinoises. Quelque peu probable que cette date puisse paratre, et quoiqu'elle soit en contradiction avec ce qui est rapport par F hian, et que les ouvrages chinois ne m'aient offert rien qui la confirme, j'ai pens qu'il tait bon de la recueillir et de la signaler l'attention de ceux qui voudraient en discuter l'authenticit contradictoirement avec les traditions extraites par Rames el Crawfurd. Dans ce mme livre, le nom de Java est transcrit par Tchao ya, et l'auteur dit que ce nom a t donn au pays cause de la grande quantit de milleth [panicum Italieam) qu'il produit. Il ajoute que les Tang appellent ce royaume Kiao lieou pa, sans que l'on connaisse l'origine de cette dnomination qui est particulire une localit, tandis que Tchao ya est le nom gnral de toute l'le. C. L. (4) Vers Kouang tcheou.] C'est la ville nomme Canton par les Europens, la capitale de la province de Kouang toung. C. L. (5) Le principal bienfaiteur.] En chinois, tan youe. Je me suis conform, ' Kiaolieou lun, p. 58 v. ' L'le d'Orgede Ptolme. pa tsoung et
pour le
566
..
FOE
KOUE
Kl.
sens de cette expression emprunte la langue fan, l'explication que M. Rmusat. de cet ouvrage. (Voyez chapitre I, note 12, en a donne au commencement CL. page 5.) (6) Deux ching.] Le ching est la vingtime partie du chi ou boisseau chinois, et sa capacit est calcule pour contenir cent vingt mille grains de millet. C. L. (7) Lao.] Montagne du district de La tcheou fou, dans le Chan toung, sur le bord de la mer. On lui donne vingt-cinq li de hauteur sur une circonfrence de quatre-vingts li. Elle s'tend par toute la presqu'le au nord de laquelle est situe la ville actuelle de Tsy me hian, et est soixante li sud-est de cette dernire ville. On distingue un grand et un petit Lao chan. Les deux montagnes se tiennent, et autrefois elles n'en faisaient qu'une. La rivire Pe cha y prend sa source. Les gographes modernes l'appellent jj_| J^T ; mais dans la gographie du We chou, dans le Tang chou, dans l'histoire des Soung et dans celle des Kin, ce nom est crit de la mme manire que dans le Fo kou M", jjj _fc,. CL. (8) Tchang kouang kiun.] La ville actuelle de Ping tou tcheou, dans ment de La tcheou fou du Chan toung, portait, sous la premire dynastie le nom de Tchang kouang kiun, qui fut chang par les We en celui C. kouang hian, et cessa entirement d'tre en usage sous les Soub. (g) Thsing tcheou.] C L. toung. C'est la ville actuelle le dpartedes Soung, de Tchang L.
de Thsing tcheou fou dans le Chan
(10) Yang tcheou.] A l'poque o F hian crivait, le Yang tcheou comprenait tout le Kiang nan, une partie du Ho nan et l'angle septentrional du Kiang si. Aujourd'hui Yang tcheou n'est plus qu'un dpartement de la province de Kiang sou,. qui n'est elle-mme qu'un dmembrement de la partie orientale de l'ancien Kiang nan. Le Yang tcheou actuel est deux cents li nord-est de Kiang ning fou (Nankin) sur le grand canal. Cette position en fait une des villes les plus commerantes de la Chine, e! la majeure partie de son immense population se compose de marchands r. C L. (11) A la fui du repos d't.] Pour, ce sjour tant termin. Cette locution, qui revient frquemment dans le rcit de F hian, a t explique plus haut, cha C. L. pitre f, note 8, page 4. * Ta h c tsingy loungtchi,liv. CVII, p. 7 v Id. ibid.p. 2. Jd. 1.XXXVII,p. 1; et 1. XLIX,p. 1.
NOTES
SUR
LE
CHAPITRE
XL.
567
(12) Tchhang an.] Autrement Si 'an fou, dans le Chen si, patrie de Chy i hian. Voyez chapitre I, note 2 , page 3. C. L. ( 13) Il s'arrta dans le midi. ] C'est--dire Nan king o il publia les livres religieux qu'il avait rapports. C'est l le devoir important dont F hian s'tait impos l'accomplissement avant de retourner dans son pays natal. C. L. (1 4) Il a mis sur le bambou]. Plus exactement, taffetas de bambou [tchou py). Cetle expression dsignait la substance ou la partie du bambou sur laquelle on crivait avant l'invention du papier, soit en gravant les caractres au stylet, soit en les traant avec une espce de vernis; mais elle ne doit s'appliquer ici qu'au papier, dont l'usage remontait dj plusieurs sicles. C L. (1 5) La douzime des annes I yi. ] C'est l'an 41 4, la dix-huitime anne du rgne de 'An ty. L'toile de la longvit [cheou sing) est une des douze divisions du zodiaque chinois, tel qu'il tait figur au temps des Han; elle rpond la Balance", ce C. L. qui indique que l'anne tait parvenue l'quinoxe d'automne. lao j in que l'on (16) F hian le voyageur.] C'est cette mme expression ,/vjff a dj vue employe (chap. IV, note 1, page 22), que M. Rmusat avait traduite par prtre et que M. Klaproth regardait comme synonyme de Tao sse ou religieux de la Raison. Il me semble que, par la manire dont elle est employe en cet endroit, il ne peut rester aucun doute sur son acception vritable. Le sens figur du mot tao pour doctrine, raison, quoique consacr par l'usage le plus ordinaire, doit tre ici mis de ct, et il faut revenir sa signification primitive et naturelle de chemin : Taojin, l'homme du chemin. C. L. " Gaubil, Astronomie du P. Souciet,p. 98. dans le III*vol. des Observations chinoise,
FIN DU FO ROUE Kl.
APPENDICE.
47
_._..,-_, .,^.,^rwr,^^,,
APPENDICE.
RSUM
GOGRAPHIQUE
DES PRINCIPAUXLIEUX MENTIONNESPAR CHY FA HIAN.
Chap.
I.
De TCHHANG'AN (SI 'AN FOU), en traversant de KHIAN KOUE. royaume
les monts
LOUNG, au
De KHIAN KOUE (KIN TCHHING) au royaume de NEOU THAN. De NEOU THAN (SI PHING), aprs avoir pass les monts YANGLEOU, TCHANGY. De TCHANGY (KAN TCHEOU) THUN HOUANG. De THUN HOUANG(CHA TCHEOU) on traverse le grand dsert de CHA HO [fleuve de Sable), et aprs i,5oo li (10 lieues) et 17 jours de marche, on arrive au royaume de CHEN CHEN. II. LEOU LAN), en voyageant De CHEN CHEN (autrefois on vient au royaume de Ou 1. nord-ouest, 15 jours au
De Ou 1 (lisez Ou HOU, OUIGOURS), aprs un mois et 5 jours d'un voyage pnible, F hian arrive Yu THIAN , tandis que se sparent de lui pour se rendre trois de ses compagnons dans le KAO TCHHANG (OUIGOURS MRIDIONAUX). IV, V. De Yu THIAN (KHOTAN), aprs 2 5 jours, Un autre compagnon de F hian rendre de TSEI HO. royaume part de KHOTANpour se
dans le Ki PIN (COPHNE). De TSEU HO (KOUKEYR), k jours de marche au midi, on entre TSOUNG LING, et dans un rameau de I'HIMALAYAnomm on parvient au royaume de Yu HOEI. De Yu HOEI (LADAK), aprs 26 jours l'ouest, royaume TCHHA, au milieu des monts TSOUNG LING. 47de KIE
572 VI.
FO
KOUE
KL
De KIE TCHHA, l'ouest, aprs avoir mis un mois pour traverser les monts TSOUNG LING, on se trouve dans I'INDE DI NORD. Sur la limite de THO LY. de cette contre la chane est situ le royaume
VII, VIII.
De THO LY (DARADAP), en suivant dant i 5 jours, on traverse est dans le royaume plus
penle SIN THEOU (L'INDUS) et on d'O TCHANG, qui forme le point le
au sud-ouest
X. XI. XII. XIII.
de l'Inde du nord, c'est--dire de la septentrional partie de l'Inde situe sur la'rive droite de l'Indus. D'O TCHANG(OGDYNA), au midi, royaume de Su HO TO. De Su HO TO, 5 journes l'orient, royaume de KIAN THO WE. De KIAN THO WE (KANDAHAR), 7 journes l'orient, royaume de TCH CHA CHI LO (TCHYOUTASIRA). Du mme lieu, k journes au midi, royaume de FO LEOU CHA. De FO LEOU CHA (BLOUTCHES), 16 yeou yan (22 lieues) de NA KI. l'ouest, royaume De NA KI, 3 lieues au sud-est, ville de Hi LO. Du mme lieu, on traverse les PETITES MONTAGNES DE NEIGE de SOULEIMAN KOUII dans l'Afghanistan), et au (rameau midi de cette chane est le royaume de Lo 1. De Lo 1, 10 journes au midi, royaume de Po NA. De Po NA, en allant l'orient 3 jours, on passe de pendant nouveau le SIN THEOU et on arrive au royaume de Pi TCHHA.
XIV.
XVI.
De Pi TCHHA, au sud-est, l'est de l'Indus, arrive au royaume
on traverse
le grand
dsert
de Sables on
et aprs 80 yeou yan (1 i5 lieues), de Mo THEOU LO.
De Mo THEOU LO (MATHOUR), au del des Sables et de la rivire Pou NA (DJAMN) est le ROYAUME DU MILIEU (MADHYADESHA) ou l'Inde centrale. XVII. XVIli. Du mme lieu, 18 yeou yan (26 lieues) de SENG KIA CHI. au sud-est, royaume
XIX.
De SENG KIA CHI (SAMKASSAM), 7 yeou yan (10 lieues) au suddu Gange. est, ville de Ki JAO I sur la rive mridionale [F hian passe sur la rive gauche du Gange.] De KI JAO I 10 yeou yan (i4 lieues) au sud(KANYKOUBDJA), ouest, royaume de CHA TCHI.
APPENDICE. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV.
575
au midi, De CHA TCHI OU CHA TI, 8 yeou yan (11 lieues) de Kiu SA LO (KOS'ALA) et ville de CHE 'WE. royaume au sud-est, De CHE WE (AOUDE), 12 yeou yan (16 lieues) ville de NA PI KIA. ville de KIA 'WE LO 'WE, De NA PI KIA, une lieue vers l'orient, de Shkya. lieu de la naissance De KIA 'WE LO 'WE (KAPILA), 5 yeou yan (7 lieues) vers l'orient, de LAN MO. royaume De LAN MO (RAMAPOURA), 19 yeou yan (27 lieues), ville de Kiu 1 NAKI. Au nord, la rivire Hi LUN (GAND'AKI), sur le bord de laquelle c'est la limite septentrionale Shkya mourut; du Bahar. De Kiu I NA KI (KOUS'INAGARA), 25 yeou yan de Pi CHE LI. royaume (36 lieues),
XXV. XXVI.
De Pi CHE LI (VAS'ALI), en suivant la gauche du GAND'AKI, k on trouve les CINQ EMBOUCHURES. yeou yan (6 lieues), [F hian repasse sur la rive droite du Gange.] est le Du mme lieu, un yeou yan au sud de ce confluent, de Mo KI THO (MAGADHA) et la ville de PA LIAN royaume FO. De PA LIANFO (PT'ALIPOUTRA) [PATNA], 9 yeou yan (i 2 lieues) au sud-est, est la montagne du Rocher isol; et un yeou des NA LO, lieu on trouve les hameaux yan au sud-ouest, de la naissance et de la mort de Che li Fo. on Adent la ville de Lo De NA LO, un yeou yan vers l'occident, YUKHI (RDJAGRIHA),nouvelle ville de la Rsidence royale. On trouve des vestiges de Yancienne ville, k li au sud, dans Cinq montagnes. Dans cette valle, 15 (i vers le sud-est, est le pic KHI TCHE (GRIDIIRAKOTA), auGIDDORE. jourd'hui De Lo YU KHI, 4 yeou yan (5 lieues) l'ouest, ville de KIA YE, du Pied de coq (Kouet plusieurs li au sud, montagne la valle des KOUT'APDA). De KIA YE (GAY), F hian suivant le cours revient la ville HENG vers de PA LIAN FO en
XXVII.
XXVIII.
XXXI.
XXXIV.
du fleuve
il arrive yeou yan (28 lieues), (KS'I) et la ville de PHO LO NA.
et 22 l'occident; au royaume de KIA CHI
574
FOE
KOUE
KL
XXXV.
De PHO LO NA (VARAN'AS) [BNARS], i3 yeou yan (16 lieues) au nord-ouest, de KEOU THANMI (KAUS'MB), et royaume 200 yeou yan (270 lieues) au sud, celui de TH THSEN (DAKCHIN'A)[le DECCAN] : ni l'un ni l'autre par F hian. n'ont t visits
XXXVI. XXXVII.
l'orient, revient encore [F hian quitte BNARS, et se dirigeant une fois PATNA. L il s'embarque et sur le Gange, 18 yeou yan aprs en avoir suivi le cours l'est pendant le royaume (2 4 lieues), il aperoit sur la rive mridionale de TCHEN PO.] De TCHEN PO (TCHAMP), 5o yeou yan (68 lieues), en continuant de descendre le Gange l'orient, de To royaume MO LI TI, sur la droite de la rivire HOUGLI et peu de distance de CALCUTTA. L est l'embouchure du Gange. A To MOLI TI (TMRALIPT) [TAMLOUK]notre voyageur s'embarque; et aprs une navigation de i4- jours et d'autant de nuits en se dirigeant SSE TSEU. au sud-ouest, il arrive au royaume de
XL.
A SSE TSEU (SINHALA) [CEYLAN] F hian se remet en mer; et aprs sans tenir de route 90 jours d'une navigation dangereuse, il vient relcher au royaume de YE PHO THI. certaine, De YE PHO THI (JAVA) on se dirigea d'abord au nord-est vers tant survenue, KOUANGTCHEOU; mais une tempte aprs on tourna vers le nord-ouest, et au bout de 70 jours, 12 jours et de 12 nuits, on arriva au versant mridional de la montagne de LAO, sur les limites de la ville de de THSING TCHEOU. TCHHANGKOUANG,dans le dpartement F hian arrt y passa un hiver Nanking, il revint t, puis Si 'AN FOU. et un aprs s'tre
APPENDICE.
575
IL
ITINRAIRE
DE
HIUAN
THSANG.
Hiuan thsang visita les mmes contres que Chy f hian, mais il tendit son plerinage beaucoup plus loin que lui. Il parcourut le Tokharestan, l'Afghanistan, le Sind, presque toutes les parties de l'Hindoustan; et sa relation, intitule Si iu ki, ou Description des contres de l'occident, nous offre un tableau complet de l'tat de l'Inde dans la premire moiti du vif sicle de notre re. Malheureusement on ne la possde pas Paris dans sa forme originale et primitive; elle ne se trouve que morcele et par fragments, mais cependant presque en entier, dans la grande compilation historique et gographique qui, sous le nom de Pian i lian, contient l'histoire des peuples trangers, classs suivant les poques auxquelles ils ont commenc tre connus des Chinois, en sorte que l'on a t oblig d'intervertir tout fait l'ordre dans lequel les voyageurs avaient distribu leurs rcits. C'est cet ordre que j'ai essay de rtablir, en ce qui concerne Hiuan thsang, dans le Rsum qui suit, l'aide de quelques indications publies dans ces derniers temps par M. Klaproth, et je crois tre arriv le faire avec certitude. La relation de Hiuan thsang a t cite trop de fois dans les notes du Fo liou ki, elle a fourni trop d'claircissements utiles, pour qu'un dernier rapprochement, embrassant l'ensemble de la marche des deux voyageurs, puisse tre considr comme superflu. J'ai indiqu par un trac cette route ainsi restitue sur la carte chinoise-japonaise de l'Inde qui accompagne le prsent volume. C. L.
Pian i tian. Liv. LI, art. x. 1. A KI NI, anciennement Ou KHI. 200 li sud-ouest, deux grands fleuves. petite montagne, A 700. ft ouest, 2. Kou TCHI, anciennement KOUE TSEU ( KOUTCH). Monastre de A tche li ni kia san. A 600 LU, art. 1, p. 3. li ouest, en traversant le petit dsert
Id. art. n.
pierreux, 5. PA LOU KIA, anciennement li, mer chaude ou mer
Cm ME OU KOU ME. 400 sale, de 1000 li de tour
(lac TEMOURTOU). De ce lac, 5oo li nord-ouest, Sou YE, ville. De cette ville, 4.00 li ouest, pays des de Mille sources, ayant au midi les Montagnes
576
FO
KOU
KI.
ville 4o ou 5o li ouest, neige. Des Mille sources, de THA LO SSE. De Sou YE, 10 li sud, petite ville De l, 200 de SIAO KOU, peuple par des Chinois. 200 li sud (ou li sud-ouest, ville de l'Eau blanche. de TALAS), ville de KOUNG IU. De l 4o ou 5o li sud, en cantons 4. Nou TCHHI KIAN, pays partag au sud chacun art. 1, p. 11. leur chef. De l, 200 li ouest, 5. TCHE CHIou Cm (anciennementTA
LXXIII,
art.
1.
qui
ont
LIX,
des Pierres, Royaume mais des chefs pas de chef gnral, pour chaque ville, sous la domination De l, 1000 li sud-est, LXXIII, art. n. 6. Pou KAN, l'ouest, la rivire YE. A 1000 Idem, art. ni. 7. Sou fleuve touche Tou
wrAN)[TACHKEND]. sur la rivire YE. Ce pays n'a particuliers des Turcs.
LI SE NA; l'est,
li ouest, TOU LI SE NA (OSROUCHNA), touche
l'orient
au
YE, qui sort des monts TSOUNG LING et coule au nord-ouest. Au nord-ouest on entre dans le grand dsert de Sable.
XLVII, LXVIII, Idem, Idem, LVII, Idem. Idem.
art.
1,9 V. art. vu.
Aprs 5oo li on vient 8. So MO KIAN OU KHANG KIU, OU KHANG (SAMARKAND). 9. Mi MO HO (MEMORG). De l au nord, 10. KIE POU TAN NA ou TSAO. De l, 3oo li ouest, 11. Kiou CHOUANG NI KIA ou KOUE CHOUANG NO. li ouest, 12. Ko HAN, TOUNG 'AN. De l, 4oo li ouest, 15. Pou HO (BOUKHARA), TCHOUNG 'AN. De l, 4oo li ouest, 14. FA TI, SI 'AN. De l, 200
art. iv. art. vin.
art. 1.
LXXIII,
art. iv.
De l, 5oo li sud-ouest, 15. Ho LI SI MI KIA ou Ho TSIN. De So MO KIAN, 3oo li sud-ouest,
APPENDICE. LXVIII, LXVII, art. ix. art. v. 16. Ko CHOUANG NA OU SSE. A 3oo de fer. De l 17. Tou li sud-est,
577 la Porte
HO LO; l'orient, les monts TSOUNG LING; PHO LA SSE (la PERSE) ; au midi, les grandes l'occident, de neige ; au nord, la Porte de fer. Montagnes Ce pays est au nord du fleuve FA TSOU (l'Oxus). En le descendant on vient
LXXIII, Idem, Idem, Idem, Idem, Idem, Idem, Idem, art. art. art.
art. vi. vu.
v.
18. TAN MI, au nord du fleuve Fou SSE TSOU; IO kia lan. De l l'est, 19. TCHHI 'AO YANNA; IO Ida lan. 20. 21. 22. 25. 24. 25. De l l'est, Hou LOU MO; 2 kia lan. De l l'est, lu MAN; au sud-ouest, De l touche la rivire FA TSOU.
vin.
art. ix. art. x. art. xi. art. xn.
KiOu HO YANNA; 3 kia lan. De l l'est, Hou CHA. De l l'est, Ko TOU LO ; l'est, De l Kiu MI THO; monts TSOUNG LING; au sud-ouest, la rivire FA TSOU; au sud, le royaume de Cm KIU le FA TSOU, on vient aux NI; au sud, en passant de THA MO SI THIE TI, de Po TO TSANG royaumes NA, de YIN PO KIAN, de Kiou LANG NOU, de SSE MO THA LO, de Po LI HO, de KE LI SSE MO, de Ko io HOU, de A LI NI, de MENG KIAN, tous dcrits dans l'histoire du retour. Du royaume de Houo (voyez n i 2 2 ), au sud-est, on vient aux royaumes de Houo si TO et de AN THA LO FO. Au sud-ouest, on vient les monts TSOUNG LING.
Idem, Idem, Idem,
art.
xm.
26. 27. 28.
Fo KIA LANG. De l au sud, KE LOU SI MIN KIAN. De l au nord-ouest, Hou PIN; io kia lan. 48
art. xiv. art. xv.
578
FOE
KOUE
KL
LXXIII,
art. xvi.
De l l'ouest, 29. Fo KO (BADAKCHAN);au nord, FA TSOU; la capitale s'appelle ioo kia lan. Au sud-ouest dans FO SENG KIA LAN (nouveau On entre vient
il touche
la rivire
la petite Ville Royale; de la capitale est le NA et on
monastre). de neige, les Montagnes
Idem, art. xvn. Idem, art. xvm. Idem, art. xix. Idem, art. xx. Idem, art. xxi.
50. YOUE MI THO. Au sud-ouest, 31. Hou cm KIAN. on vient
Au nord-ouest, on vient 52. TA LA KIAN(TALKAN); l'ouest, il touche De Fo KO, i oo li au sud, 55. Ko TCHE; au sud-est, de neige. on entre
PHO LA SSE.
dans les Montagnes
54. FAN YANNA (BAMIYAN); l'est, on entre dans les Montagnes de neige, on passe les Pics noirs, on vient 35. KIA PI CHE (CABOUL). La ville est adosse aux monts TSOUNG LING. AU sud de la ville, 4o li, ville de Si PI TO FA LA SSE. De l 3o li sud, mont A LOU NAO. Royaume de TSAO KIU THO; mont SSE NA SSE LO (SSE NA, nom d'un Dva). Au nord-ouest de la ville royale, 200 li, les grandes de Montagnes neige; l tait l'ancien royaume Au sud-ouest de la mme ville, LO (solide comme un lphant). Kia lan Pi TO KIE OU de l'alisier de KIAN THA LO. le mont Pi LO so le De l au nord, mordu.
Idem, art. XXII.
De l l'est, 600 li, par les dfils impraticables des Pics noirs, on vient la frontire de l'Inde du nord, et Idem, art. xxm. 36. LAN PHO, adoss aux Pics noirs. De l au sud-est, 100 li, passant la grande chane et traversant le grand fleuve, on vient 37. NA KO LO HO, limite de l'Inde du nord; entour de de tous cts. A l'est de la ville, 3 li, montagnes bti par stoupa de 300 pieds, sud-ouest de la ville est un stoupa le roi Asoka. Au ville de l'ancienne
LXII1,
art. x.
APPENDICE.
579
o Shkya Bodhisattwa acheta des fleurs pour le Bouddha Autre bti par Asoka. Dipankara. on Au sud-est, 5oo li au travers des montagnes, vient LXIII, art. vu. A l'est, il 58. KIAN TO LO (GANDHARA)[Inde du nord]. touche au fleuve SIND. La capitale s'appelle Pou LOF CHAPOU LO. Arbre Pipala. Kia lan du roi Kia ni sse kia (4oo ans aprs le Nirvn'a de Fo). Au nord 5o li, en passant le grand est de ce dernier, fleuve, on vient la ville de Pou SE KO LO FA TI. Au de CHANGMOU KIA PHOU SA, ville de PA LOU 5o li de PA LOU CHA, temple CHA. Au nord-est, sud-est de Pi ma, femme 'Iswara. De l au sud-est, i 5o li, ville de Ou TO KIAHANTCHIIA, qui touche au sud l'Indus. De l au nord-ouest, 20 li, cit de P110 LO TOU LO, lieu de la naissance de l'ermite PHO M de la musique. NI, fondateur au nord De l, passant Idem, art. v. les et les de l'Inde
montagnes limite
rivires, 600 li, on vient 39. Ou TCHANG NA (OUDYANA) [Jardin], du nord.
de la Capitale MENG HO LI. Au nord-est capitale, 25o ou 260 li, on entre dans une grande et on vient la source A PHO LO LO , qui montagne, est celle du fleuve Sou PHOFA SOU TOU, lequel coule au sud-ouest. Au sud-ouest de la source, 3o li, sur la rive septentrionale du pied de Bouddha. du fleuve, est une empreinte Au sud de MENG HO LI, 4oo
li, mont Yi LO, et 200 li, grande fort MA HA FA 3o ou 4o li, MA IU KIA NA. De l au nord-ouest, des Fves. De l l'ouest, 60 on LAN, monastre fond par Asoka. Au sud-ouest de 70 li, monastre du roi Chang MENG HO LI, 60 ou 70 /(', monastre 5o li, passant le grand fleuve, kiun. A l'ouest, monastre d'Asoka, nomm Lou YI TA KIAOU rouge. de Ko rou TO. De 3o li, monastre l l'ouest, passant le grand fleuve, image d'A fo lou tchi ti che fa lo Phou sa. De l au nord-ouest, Au nord-est, 48.
580 i4o
FO ou
KOU i5o
KL
li, mont LAN PHO LOU. AU nord-est de et remontant MENG HO LI , en passant les montagnes de le SIND, faisant 1000 li travers des chanes on vient des ponts volants, etc., montagnes, la capitale ruisseau THA LI LO , o tait autrefois I'OUDYANA. De l l'est, on vient LXXIV, art. i. 40. Po LOU LO, entre Retour Passant et coule Idem, art. n. 4L Ou au midi passant les montagnes, oo au de
li,
de neige. les Montagnes TO KIA HAN TCHHA (voyez le Sind, qui est large on vient
n 38). de 3 ou 4 li
au sud-ouest,
TAN TCHA cm LO (limite de l'Inde du nord); dpende la capitale, dant du Cachemire. Au nord-ouest 70 li, tang du dragon Yi lo po tan lo. De l, sud-est, 3o li, monastre de la tte). Pays du roi (aumne cle la lune). Sjour la pho (lumire pou keou ma lo lo to. Au sud-est de bti par le fils cl'Asoka, ce pays, De au sud-est, 700 par Asoka Tchen tha lo po du matre King stoupa les bti
la ville, Keou lang nou.
li travers
montagnes, Idem, art. m. 42. SENG HO POU LO (limite de l'Inde du nord); dpendant du Cachemire. A l'ouest, il s'appuie sur le fleuve SIND. Au sud de la capitale, fond stoupa 4o ou So li, un autre par Asoka. Au sud-est, fond par le mme. Retour nord de TAN TCHA CHI LO. On Au sud-est, bti par Stoupa de ce pays. pierre. passe le SIND au 200 li, grande porte Asoka ( aumne du
corps). De l au sud-est, Idem, art. iv. 45.
oo li, par les montagnes, Ou LA cm (limite de l'Inde du nord); dpendant du Cachemire. Ne suit pas la loi de Fo. Au sudouest Asoka. de la capitale, 4 ou 5 li, stoupa bti par
APPENDICE. De l au sud-est, montagnes, 1000 li, on arrive LUI, art. Khi pin, p. 6 v. 44. ponts
581 de fer; aprs
KIA CHE MI LO (CACHEMIRE), limite de l'Inde du nord. Fond 5o ans aprs le Nirvana, par Mo tian d'Ananda. La capitale ti kia, disciple s'appuie, sur un grand l'ouest, btis par Asoka. fleuve. H y a quatre stoupas
[Asoka, roi de Magadha, roo ans aprs le Nirvana.] [Kia ni sse kia, roi de Gandhara, 4oo ans aprs le Nirvana.] [ Sse ma tsiu lo, roi de Tou ho lo, 6oo ans aprs le Nirvn'a. ] Au sud-est ville. art. de la nouvelle passant Au sud-ouest, on vient LXXIV, Idem, v. ville, io li, ancienne les montagnes, 700 li,
art. vi.
du Cachemire. 45. PAN NOU TCHA (PENDJAB), dpendant De l au sud-est, 4oo li, du Cachemire). 46. Ko LO TCHE POU LO (dpendant Tous les pays, depuis LAN PHO jusqu' celui-ci, les langues sont sauvages, les habitants grossiers, barbares. mais une pas la vritable limite de l'Inde, dtourne de ses frontires. civilisation Ce n'est passant de l'Inde la rivire, du nord). 700 li, A l'est, la
De l au sud-est, Idem, art. vu.
47. THSE KIA (limite le fleuve SIN TOU; au rivire Pi PO TCHE; l'ouest, sud-ouest de la grande ville, 1 4 ou 15 li, ancienne il y a plusieurs ville de TCHE KO LO, o rgnait, sicles, le roi Ma yi lo kiu lo. Stoupa du roi Asoka. Au nord-est 48. de la nouvelle ville, autre stoupa. de roi De l l'est, 5oo li, limite TCHI NA POU TI (rig par les Chinois); du l'Inde du nord. Lieu o tait le domaine Kia ni sse kia.
Idem,
art. vin.
Les pches et les poires y ont t d'o les poires introduites par un prince chinois; ont reu le nom de Tchi na ni (venues de Chine), et les pches celui de Tchi na lo tche fe la lo (fils du roi de la Chine). Au sud-est de la grande ville, 5oo tre de THA MO SOU FA NA (fort obscure). li, monasL a vcu
582
FO le docteur Monastre art. ix.
KOUE
KL ans aprs le Nirvn'a.
Kia to yan na, 3oo fond par Asoka.
LXXIV,
i4o ou i5o li, De l au nord-est, 49. TCHE LANTHA LO (limite de l'Inde du nord); nement brahmanique. De l au nord-est, 700 li, escarpes, franchissant de l'Inde
ancien-
des montagnes du nord; envide
Idem,
art. x.
50. Kmou ronn
LOU TO, limite de montagnes,
et voisin
des Montagnes
neige. Stoupa bti par Asoka. De l au nord, 2000 li, au travers des montagnes, de Mo LO PHO, aussi nomm on arrive au royaume SAN PHO HO. LOU TO, au sud, 700 li, passant de et un grand fleuve, on vient montagnes grandes 51. CHE TO THOU LOU, limite de l'Inde du nord; born l'ouest par un grand fleuve. Au sud-est de la ville, 3 ou 4 U, stoupa bti par Asoka. 800 li, De l au sud-est, 52. PHO LI YE THA LO, limite de l'Inde roi est de la race de Fe che. LX1V, art. 1. De l l'est, 5oo li, Inde moyenne. Trois stoupas 55. Mo THOULO (Matoura), btis par Asoka. Maison de pierre o Ou pho kieou io a prch. De l au nord-est, 500 li, 54. SA THA NI CHE FA LO; la capitale a 200 /(' de tour, et Terre du bonheur. Au nord-ouest, 5 li, s'appelle stoupa bti par Asoka. Au sud, 100 li, monastre de Khia min tchha. [dent, art. xiv. De l au nord-est, 4oo li, A l'est, appuy sur 55. Sou LOU KIN NA (Inde moyenne). le Gange; au nord, adoss une grande montagne. La rivire YAN MEOU NA (YAMOUNA) coule travers ce l'est, sur le YAN La capitale s'appuie, royaume. MEOU NA; l'est de la capitale et l'ouest de la rivire est un stoupa bti par Asoka. De Kmou
Idem, art. xi.
Idem, art. xn.
du milieu.
Le
LXXIV,
art. xm.
APPENDICE. Traversant vient LXXIV, art. xv. la rivire, sur la rive orientale,
585 on
Le roi est de la race 56. Mo TI POU LO (Inde moyenne). des Chou to lo. Au sud de la grande ville, 4 ou 5 du matre Kia nou po la pho (lumire li, monastre de vertu). Au nord de celui-l, 3 ou 4 li, monastre fort des Matres. Au nord-ouest de An mou lo. A ct, mi io lo (ami sans tache). Au nord-ouest du Gange, de roche). rservoir de l, 200 pas, monastre de Pi mo lo
de ce pays, sur la rive orientale ville de Mo iu LO (qui produit du cristal avec un nomment
L est un temple brahmanique, sur le Gange, que les Indiens
Idem, art. xvi.
la porte du Gange. De l au nord, 300 li, 57. PHO LO KI MA POU LO (Inde du nord), entour de de tous cts. Au nord de ce royaume, montagnes dans les Montagnes de neige, est le royaume de Sou FA LA NOU KIU THA LO (famille tire de l'or excellent. Il est gouvern on d'or), d'o l'on par une femme;
des Femmes orientales. l'appelle royaume au nord, Khotan: l'est, il confine aux Tibtains; l'ouest, au PAN PHO LO. De Mo TI POU LO, au sud-est, 4oo li, on vient NA(Inde moyenne), 2000 li de tour. 58. Kiu PI CHOUANG De l au sud-est, 4oo li, 59. 0 YI TCHI THA LO (Inde moyenne), Stoupa fond par Asoka. De l au sud, 260 ou 270 Gange, puis au sud-ouest, Idem, art. xix. 60. Pi LO SAN NOU (Inde Ruines Idem, art. xx. d'un stoupa De l au sud-est. 3ooo li, en li dtour. le
Idem, art. xvn. Idem, art. xvm.
passant
2000 moyenne), bti par Asoka. 200 li,
li de lour.
61. KIE PI THA (anciennement 2000 li de tour. moyenne], 20 li, grand cinquante stoupa (escalier pas de longueur.
SENG KIA CHE) [Inde A l'est de la ville, du ciel). Muraille de
584
FO
KOU
KI. moins de 200 li,
De l au nord-ouest, LXXV, art. 1.
62. Ko JO KIOU TCHE (KANYAKOUBDJA, KANOUDJE) [Inde 4ooo li de tour. La ville de KANYAKOUBmoyenne], DJA, appele Kou sou MAPOU LO (palais des fleurs). Le roi est de la race Fe che; il se nomme Ko li cha de la ville, fa lan na (accru en joie). Au nord-ouest stoupa bti par Asoka. Au sud-est de la A'ille, 100 li, ville de NA FO THI PO KIU LO, sur la rive est du l'est clu Gange, temple Gange. De l au nord-ouest, brahmanique. De KANOUDJE, au sud-est, Gange et allant au sud, 600 li, passant le
Idem, art. 11.
65. A m THO (AOUDE) [Inde moyenne], ooo li de tour. Dans la capitale, temple de FA SOU PANTOU PHOU SA (parent clu sicle). Au nord de la ville, 4 ou 5 li sur le Gange, grand monastre bti par Asoka. A 4 ou 5 li, stoupa des l'ouest de ce monastre, Au nord de ongles et des cheveux clu Tathgata. Che li lo to [vicioria receptus) composa le celui-ci, Pi pho cha. Au sud-ouest de la ville, 5 ou 6 li, n clans le temple ruin d'A seng kia, Bodhisattwa de KIAN TO LO, 1000 ans aprs la mort de royaume 4o li, au nord du Gange, Fo. Au nord-ouest, temple d'A seng kia Bodhisattwa. De l l'est, on vient 3oo li, passant au nord clu Gange,
Idem, art. m.
64. A YE MOUKIE (Inde moyenne), 2 4oo ou 2 5oo li. La capitale est sur le Gange. Au sud-est de la ville sur le Gange, stoupa bti par Asoka. De l au sud-est, 700 li, en passant Gange, au nord du YAN MOUNA, au sud du
Idem, art. iv.
65. Po LO NA KIA (Inde
5ooo li de tour. La moyenne), capitale est au confluent des deux rivires. Au sudouest de la capitale, dans une fort de fleurs de po kia, stoupa d'Asoka. querelle avec un hrtique. Tchen Dcva Phousa, sa
APPENDICE. De l au sud-ouest, passant aprs 5oo li, on vient LIV, art. i. 66. KIAO CHANG MI (KAUSAMBI) [Inde une grande
585 fori,
6000 // moyenne], de tour. Statue de Fo par le roi OH tho yan na. A. l'angle sud-est de la ville, ancienne maison du grand Khiu sse lo. Plusieurs de la stoupas. Au sud-ouest ville, 8 ou 9 li, grotte du Dragon venimeux. Stoupa d'Asoka. De l au nord,
170 ou 180 li,
LXXV,
art. v.
Idem, art. vi.
67. Pi so KIA (Inde 4ooo li de tour. moyenne), De l au nord-est, 500 li, 68. CHE LO FA SI TI OU CHE 'WE (SIRAVASTI), 6000 li de tour. La capitale est la ville o rgnait le roi Po lo si na tchi to. Jardin de Ho kou tou (qui donne aux et aux isols). Temple de Djita. Au nordorphelins est de Ho KOU TOU, lieu de la gurison des Pi Isou. Au nord-ouest de la capitale, lieu de la naissance du Bouddha Kasyapa. De l au sud-est, 5oo li, moyenne]. 69. KIE PI LO FA SOU TOU (KAPILA) [Inde [Manque dans le Pian i tian.]
LXIV,
art. vu.
70. LAN MO. De l au nord-est, grande fort et montagnes
LXXV, art. vu.
sauvages. 71. Kiu cm NA KI LO (KOUSINAGARA). Stoupa bti par Asoka. Au nord-ouest de la ville, 3 ou 4 li, en passant la rivire A TCHITO FA TI, anciennement appele Cm LA NOUFA TI (rivire o il y a de l'or), sur la rive occidentale, fort de So LO. Stoupa de Sou pa io lo (bon sage). 5oo li au travers des forts. 72. PAN LO NI SSE (BNARS) [Inde moyenne], 4ooo li de tour. Grande ville sur le Gange. Au nord-est de la ville, d'Asoka. l'ouest Au nord-est de la rivire de la ville, du temple, Po LO NI, stoupa 10 li, PARC DES stoupa d'Asoka. A l'histoire 4Q de
Idem, art. vin.
CERFS. Au sud-ouest ct, stoupa
o Me tha li ye recul
586
FOE
KOUE
KI.
LXXV,
art. ix.
de ce stoupa, lieu o Shkya Bodhisattwa reut son histoire de Kasyapa. De l, suivant le Gange vers l'est, 3oo li, 2000 li de tour. La 73. TCHEN TCHU (Inde moyenne), capitale est sur le Gange. A l'est de la ville, 200 li, Fo. A l'ouest seng kia lan d'A pi tho ko la nou (oreille non perce). 100 li, passant au sud Au sud-est de ce monastre, du Gange, ville de MA HA so LO. De l au nord-est, ou 5o li, on vient passant le Gange, faisant 4o
LXIV.
art. ix.
5ooo li de 74. FE CHE LI (VASALI) [Inde moyenne], de la ville, 5 ou 6 li, kia lan tour. Au nord-ouest o Ananda devint Arhan. Au sud-est de ce monaspar le roi Fe che li. Au nordhabitaouest, stoupa du roi Asoka. Au nord-est, de tion de Pi ma lo ki (sans tache). Au nord-ouest tre, stoupa bti la ville de FE CHE LI, ancienne kravarti 15 li, Mahadeva. Au sud-est ville d'un roi Tchade la ville, i4 ou se tint l'assemble des
o grand stoupa 1 10 ans aprs le Nirvana. De l au sud, Arhans, 8 ou 9 li, monastre de Che fe to pou lo. Au sudest de l, 3o /;, sur le Gange, deux monastres. LXXV, art. x. De l au nord-est, 5oo li, 75. FE LI TGHI (dans le nord, appel SAN FA TCHI) [Inde li de tour. La capitale s'appelle du nord]; 4ooo TCHEN CHOUNOU. De l au nord-ouest, les montagnes, Idem, art. xi. i4oo ou i5oo li, passant des
76. Ni PHO LO (NPAL), 4ooo li de tour de neige. De l, retour Montagnes passant le Gange au midi, on arrive
au milieu
FE CHE LI;
LXV.
77. MA KIE THO (MAGADHA), 5ooo li de tour. Au sud du Gange, ville ruine de KEOU SOU MA POU LO aussi nomme PHO (palais des fleurs odorifrantes), THOLI TSEU (PATALIPOUTRA;PALIBOTHRA des anciens). Le roi A chou kia, arrire-petit-fils de Pin po so lo, 100 ans aprs le Nirvn'a, se transporte de la ville
APPENDICE. des Rois PATALIPOUTRA.Au sud-est de Khiou ville, monastre des Poules). Au sud-ouest mont lieu KIA YE. AU sud-est de la naissance
587 de l'ancienne
to ho lan mo (royaume de fa ville, 5 ou 6 h, de la montagne KIA YE,
de Kasyapa (BOUDDHAGAYA). A l'est de KIA YE KASYAPA,aprs avoir pass le grand on trouve la montagne Po LO NOU ro TI. fleuve, A l'est de l'arbre Bodhi, passant la rivire Ni LIAN TCHEN NA, grand l'est de la rivire mont THO [Pied coq, oo du dans une fort, etc. A stoupa Mou HO, grande fort; i oo li, KOUKOUTAPADA [Pied du coq) ou Kiu LOU PO
du Pied du Vnrable). Au nord-est li, mont Fo THO FA NA. De l l'est, 3o li, SI SE TCHI, fort. Au sud-ouest de la fort, io
A 6o /(' l'est, ville de Kiu li, grande montagne. TCHE KO LO POU LO, situe juste au milieu du MAGADHA. Son nom signifie Palais couvert de chaume; c'est l'ancienne des rois du pays. Ville capitale des Montagnes. A i li de la porte septentrionale de cette ville, jardin de Kia lan tho. A l'est de ce jardin, stoupa bti par A tou to che tou lo (Adjtas'atrou), autrement A tche chi. Assemble non loin, Au nord-est, SSE (demeure de Maha Kasyapa. ville de Ko LO TCHE KOU LI de de
naissance royale). Au nord-ouest, Tchu li sse kia. Monastre de Sinq ly, monastre Na lan tho.
LO kia lo a yi to. Fo tho kiou to. Tha [Rois de MAGADHA. ka to kiou io. Pho lo a yi to. Fa iche Io.] de KEOU LI KIA. Mont YIN THO LO cm Bourgade LO KOU HO. Au nord-est, i 5o ou 160 li, monastre de Kia pou te kia. Au nord-est, 70 li, au midi du Gange, grand village. A l'est dans les montagnes et les forts, 100 li, Lo YIN NI LO, village. et forts; aprs De l l'est, grandes montagnes LXXV, art. XII. 200 li, on vient 3ooo li de 78. Yi LAN NOU PO FA TO (Inde moyenne), tour. La capitale est sur le Gange. A ct de cette 49.
588
FOE
KOUE
KL
capitale est le mont Y5 LAN NOU, qui vomit de la fume de manire obscurcir le soleil et la lune. A l'ouest, lieu de la naissance de Che leou to pin che le mendiant. ti keou ti (cent millions), De l, en suivant le Gange sur la rive mridionale, 3oo li l'est, 79. TCHEN PHO (BHAGALPOUR)[Inde moyenne], 4ooo li La capitale est adosse, au nord, sur le Gange. A l'est de la ville, 4o ou 5o li au midi du Gange, montagne d'eau. isole, entoure Idem, art. xiv. De l l'est, 4oo li, 80. Ko TCHU WEN TI LO (Inde moyenne), Ko TCHEN KO LO, 2000 li de tour. septentrionale, de briques. Idem, art. xv. non loin du Gange, aussi nomm Sur la limite tour de tour.
LXXV,
art. XIII.
grande
De l, passant le Gange l'est, 6oo li, 81. PAN NA FA TANNA (4ooo li de tour). A l'ouest de la de Pa chi pho. A ct, ville, 20 li, monastre stoupa d'Asoka. De l l'est, 900 li, passant le grand fleuve, 82. KIA MALEOUPHO (limite de l'Inde orientale), 10,000 li de tour. Les gens de ce pays ne sont pas encore point encore bti de monastres. Le roi est Brahmane ; il est surnomm Pho se ko lo fa ma, et nomm Keou ma lo (jeune homme). Dans les montagnes, l'est, il n'y a pas de grand royaume ; il touche aux barbares du sud-ouest. En deux mois on peut atteindre la frontire mridionale de CHOU, mais par des chemins extrmement difficiles et dangereux. De l au sud, 1200 ou i3oo li, 85. SAN MATHA THO (Inde orientale), 3ooo li de tour. Pays bas sur le bord de la mer. Prs de la ville, sur le bord stoupa bti par Asoka. De l au nord-est, de la mer, royaume est, au coin de la grande des montagnes et des valles, de CHE LI TCHATHA LO. Plus loin, au sudmer, royaume de KIA MA au milieu convertis et n'ont
Idem, art. xvi.
Idem, art. xvn.
APPENDICE.
589
LANGKIA. Plus loin, l'est, royaume de To LO PO de CHANGNA POU LO. Plus TI. Plus l'est, royaume l'est encore, au sud-ouest, royaume de MA HG TCHENPHO. Plus royaume de l'le de YAN MANA. Hiuan point entr dans ces six royaumes, 900 li,
n'est thsang et il n'en parle que sur ou-dire. De SAN MATHA THO, l'ouest, LXXV, art. XVIII.
84. TAN MALI TI (TMRALIPT) [Inde orientale], i4 ou i5oo li de tour. La capitale est sur le bord de la mer; grand commerce par eau et par terre. A ct de la capitale, stoupa bti par Asoka. De l au nord-ouest, 700 li, 85. Ko LO NOUsou FA LA NA (Inde orientale), 44oo ou 45oo li de tour. A ct Lo to we tchi (argile par Asoka. De l au sud-ouest, de la ville, monastre de rouge). Non loin, stoupa bti 700 li, li dtour. sud Stoupas clu royaume, de Phou se monastre au bord de la mer, par ceux qui
Idem, art. xix.
LIV, art. 11.
86. Ou TCHA (Inde orientale), 7000 btis par Asoka. Sur la limit dans une grande montagne, pho ti li. Sur la limite sud-est,
ville de Tche li ta lo, trs-frquente font le commerce maritime. Au sud, 20,000 li, de SENG KIA LO, O est la dent de Fo, etc. royaume De l au sud-ouest, LXXVI, art. 1. 87. KOUNGIU THO (Inde capitale est sur le bord par une fort, 1200 li, 1000 li dtour. La orientale), de la mer, point entre dans un endroit de religion dans un de
escarp. Langue particulire; Fo. i o petites villes. on De l au sud-ouest,
dsert, on traverse une fort paisse, 100 li, on vient Idem, art. 11.
grand et aprs i 4 ou 5ooo d'hrtibti par li
88. Ko LINGKIA (KALINGA) [Inde mridionale], de tour. Peu de vrais croyants, beaucoup ques. Au sud, Asoka. prs de la ville, stoupa
590
FOE
KOUE
KL par les montagnes et les
De l au nord-ouest, forts, 1800 li, LX1V, art. iv.
89. KIAO SA LO (Inde moyenne), 6000 li de tour. Le roi est Khsatrya. Les peuples sont noirs et sauvages. Au sud de la ville, stoupa bti par Asoka. Au temps de Loung meng, roi nomm So to pho lo. Deva Bodhisattwa arrive de Ceylan. Au sud-ouest de ce royaume, 3oo li, mont PA LO MO LO KI LI (Pic noir) perc par le roi So to pho lo pour Loung meng. De l au sud, 900 li, 90. AN THA LO (ANDRA)[Inde mridionale], 3ooo li de tour. PIIING KHI LO. Langue capitale s'appelle Habitudes sauvages. Alphabet de l'Inde particulire. moyenne. Stoupa bti par le Arhan A tche lo. Autre, au sud-ouest de celui-l, bti par Asoka. Au sud 20 li clu stoupa d'A tche lo, sur une ouest, montagne Phousa. isole, stoupa o a demeur Tchin na La
LXXVI,
art. m.
Idem, art. iv.
De ce dsert, au sud, 1000 li, 91. TA NA KO THSE KIA, aussi nomm grand 6000 /;' de tour. (Inde mridionale), noirs
AN THA LO Habitants
et sauvages. A l'est de la ville, sur une monmonastre de We pho chi lo (montagne tagne, A l'ouest de la ville, monastre de A fa orientale). lo chi lo (montagne occidentale). Au sud de la ville, o a demeur Pho pi ta kia. montagne Idem, art. v. De l au sud-ouest, 1000 92. TCHU LI YE (Inde mridionale), de tour. li, 24oo ou 25oo li
froces, Peuples sauvages, hrtiques. des dieux. Au sud-est de la ville, stoupa Temples bti par Asoka. A l'ouest, ancien monastre o tait le Arhan Wen ta la (suprieur). De l au sud, on entre dans une fort dserte; aprs i5 ou 1600 li, on arrive Idem, art. vi. 95. THA LO PI TCHHA (Inde mridionale), 6000 li de tour. La capitale est KIAN TCHI POU LO (KANDJEVARAM).La langue et les lettres ont quelque diffrence
APPENDICE. avec celles de l'Inde
591
LXXVI,
art. vu.
Cette ville est le moyenne. lieu de la naissance de Tha ma pho lo (gardien de la loi) Phousa. Au sud de la ville, grand stoupa bti par Asoka. De l au sud, 3ooo li, 94, Mo LO KIU THO OU TCHI MO LO (Inde mridionale), 5ooo ' mer. li de tour. Peuple stoupas btis Beaucoup de richesses venues par noir et sauvage. A l'est de la ville,
par Asoka et son frre cadet Ta ty. Le royaume est bord au sud par la mer. L est la de Mo LO YE. A l'est de cette montagne montagne est le mont Pou THALO KIA. De l sort une rivire et va se jeter dans de cette montagne, qui fait le tour de la montagne la mer du midi. Au nord-est sur le bord
de la mer, ville o l'on s'embarque pour la mer du midi et le royaume de SENG KIALO. On y arrive en allant l'est, l'espace de 3ooo li. LXVI, art. iv, p. i i. 95. SENG KIALO (CEYLAN) [non compris dans les limites de l'Inde], l'le des 7000 li de tour. Anciennement Trsors. enleve La fille d'un roi de l'Inde mridionale est de l'le au boudpar un lion. Conversion dhisme, dans le Ier sicle aprs le Nirvn'a, par Mafrre cadet d'Asoka. Deux sicles aprs, hendra, division de la doctrine en deux classes : Mo ho pi ho lo et A po ye tchi li. Temple de la dent de Fo. A l'angle sud-est du royaume, mont LING KIA, O Fo a dbit le Ling kia king. Au sud de l'le, de li dans la mer, le de NA LO milliers plusieurs KI LO, dont les habitants sont des pygmes hauts de trois pieds, qui vivent de cocos, etc. De l l'ouest, par mer, plusieurs milliers de li, dans une le isole, colosse de pierre de Fo, haut de cent pieds, assis et tourn vers l'est, etc. A l'ouest, milliers de li par mer, le des Trsors plusieurs inhabite. De THA LO PI TCHHA,au nord, vage , 2000 h, par une fort sau-
592 LXXVI, art. vin.
FOE
KOUE
KI.
96. KOUNGKIANNA POULO (KANKARA) [Inde mridionale], ooo li de tour. Au nord de la ville, fort de To lo, dont les feuilles servent crire dans tous les stoupa bti royaumes de l'Inde. par Asoka. De A l'est de la ville,
l au nord-ouest, on entre sauvage, et 2 4oo ou 2 5oo li, Idem, art. ix.
dans une fort
97. MA HA LA THO (MAHRATTES) [Inde mridionale], 6ooo li. La capitale s'appuie, l'ouest, sur une grande rivire. De l l'ouest, i ooo MO THO, et on arrive li, on passe la rivire NA
Idem, art. x.
98. PA LOU KO TCHEN PHO (2 4oo OU 2oo li de tour). Les habitants vivent du commerce maritime. De l au nord-ouest, 2000 li,
Idem, art. xi.
99. MA LA PHO OU royaume de Lo mridional (Inde 6000 li de tour. La capitale est au mridionale), sud-est de la rivire Mou HO. Dans les cinq Indes, les deux principaux sont royaumes pour l'tude MA LA PHO au sud-ouest, au nord-est. et MAGADHA L'histoire du pays dit qu'il y a soixante ans le roi se nommait Chi lo a ti to. Au nord-ouest de la ville, 20 li, ville des Brahmanes. De l au sud-ouest, on s'embarque, et allant 24oo ou 25oo li, on vient nord-ouest, au
Idem, art. xn.
100.
A TCHALI OU A THO LI (Inde de tour.
mridionale),
6000
li
De MA LA PHO, au nord-ouest, Idem, arl. xm. 101.
300 li, on arrive Pas
Km TCHA (Inde mridionale), 3000 li de tour. de roi; dpend de MA LA PHO. De l au nord, ooo li, on vient
Idem, art. xiv.
102. FA LA PI OU royaume de Lo septentrional. Limite de l'Inde du midi, 6000 li de tour. Il y a beaucoup de marchandises des pays lointains. Asoka y a lev des stoupas. Le roi est Khsatrya et de la race de Chi lo a ii lo de MA LA PHO. Maintenant le roi de Ko JO
APPENDICE. KIOU TCHE (n 62), nomm de Chi lo a ti to. gendre LXXV, art. xv. 103.
595 Tou lou pho pa tho, est
De l au nord-ouest, 700 li, A NAN THO POU LO (ANANTPOUR) [limite 2000 occidentale], de MA LA PHO. li de tour.
de l'Inde
Pas de roi; dpend
Idem,
art. xvi.
104.
De FA LA PI, l'ouest, 5oo li, on arrive Sou LA THO (SURATE) [Inde occidentale], 4ooo li de tour. La capitale s'appuie, l'ouest, sur la rivire Mou YI. Ce pays est le chemin naturel vers la mer d'occident. maritimes. Les Prs habitants aiment de la ville, mont De FA LA PI, au nord, 1800 li, Kiu TCHE LO (Inde occidentale), 5ooo ; peu de croyants. d'hrtiques Pi LO MA LO. entreprises YEOU CHENTO. les
Idem, art. xvn.
105.
li. Beaucoup La capitale se nomme
Idem, art.
xvm.
106.
De l au sud-est, 2800 li, Ou TCHE YAN NA (OUDJIYANI) [Inde 6000 li de tour.
Stoupa; bti par Asoka. (Conf. Fo kou ki, chap. 1000 li, De l au nord-est, LXXVII, art, 1. 107. TCHI TCHI THO (Inde Le roi ment 108. est de race mridionale), 4ooo
mridionale], de l'enfer emplacement XXXII.) li de tour. ferme-
brahmanique; aux trois Prcieux.
il croit
Idem,
art. 11.
De l au nord, 900 li, 3ooo MA YI CHE FA LO POU LO (Inde moyenne), ne croyant pas la loi de Fo. Hrtiques
li.
Kiu TCHE LO, au nord, traDe l, retournant versant un dsert, passant le SIN TOU, on arrive au de royaume Idem, art. m. 109. SIN TOU (SIND) [Inde occidentale], 7000 li de tour. PHO POU LO. Le roi est de la race La capitale Pi TCHEN Chou to lo. Asoka y a bti Ou pho kieou to a parcouru De l l'est, 900 li, passant sur la rive orientale de l'Indus, 4ooo li de MEOU LO SANPOU LO (Inde occidentale), 5o beaucoup ce royaume. de stoupas.
Idem,
art. iv.
110.
594 tour.
FOE
KOUE
KI. d'adorateurs 700 des li, Quatre stoupas d'Asoka; Lieu o le matre Tchin a compos son livre. 1 5 ou 1600 li, dieux, peu de
Beaucoup Bouddhistes.
De l au nord-est, LXXVII, art, v. 111. Po FATO (5ooo
li dtour).
Idem,
art. vi.
112.
vingt temples d'hrtiques. na fe tha lo (trs-vainqueur) De SIN TOU, au sud-ouest, A THIAN PHO TCHI LO (Inde
La capitale s'appelle sont, l'ouest, prs du fleuve SIN TOU, et voisins bord de la grande mer. Pas de roi; dpendant SIN TOU. Asoka y a bti six stoupas. Idem, art. vu. 115. De l, l'ouest LANG KO LO (Inde de li en tous moins de 2000 li, occidentale), sens. La capitale plusieurs
5ooo li. occidentale), Ko TCHI CHE FA LO. Les murs du du
milliers
Sou TOU LI s'appelle CHE FA LO. Ce pays est sur le bord de la grande mer. Il y faut passer pour aller chez les Femmes d'occident. Pas de roi; il dpend de PHO LA SSE. Les caractres sont semblables ceux des Indiens. Dans la ville, un La langue est un peu diffrente. temple de Maha Iswara. LVI, art. iii. 114. De l au nord-ouest, PHO LA SSE (PERSE) [non
compris dans l'Inde], plusieurs fois dix mille li de tour. La capitale s'appelle Sou LA SA TANGNA. Beaucoup de temples o les disDeux ou ciples de Thi na pa font leurs adorations. trois monastres. Tradition relative au pot de Fo. (Conf. Fo kou ki, chap. XXXIX.) A l'est du palais du roi, ville de Hou MO. Ce pays, au nord-ouest, touche FE LIN. AU. sud-ouest d'occident, des Femmes sud-ouest. de FE LIN , royaume dans une le de la mer du
LXXVII,
art. vm.
115.
De A THIANPHO TCHI LO, au nord, 700 li, Pi TO CHI LO (Inde occidentale), 3ooo li dtour. Ce pays est sans roi; de la ville, i5 ou de plusieurs stoupa il dpend du SIN TOU. AU nord 16 li, dans une grande fort, centaines de pieds bti par
APPENDICE.
595
LXXVII,
art. ix.
116.
Asoka. Non loin, l'est, monastre bti par le grand Arhan Ta kia ta yan na. De l au nord-est, 3oo li, A PAN TCHHA (Inde occidentale), 2 4oo ou 2oo li de tour. Pas de grand roi; il dpend du SIN TOU. Stoupa bti par Asoka. au nord-est, 900 FA LA NOU (Inde occidentale), pays dpend De,l li, 4ooo li de tour. Ce
Idem, art.
x.
117.
cle celui de KIA PI CHE. La langue a peu avec celle de l'Inde moyenne. On dit que d'analogie ce pays touche, l'ouest, Km KIANGNA, dans les montagnes. ;De l au nord-ouest, on passe de grandes monon traverse de petites tagnes et de larges courants, et aprs 2000 de villes, li, on sort des limites l'Inde, et on arrive Idem, art. xi. 118. h de tour). Langue et caractres particuliers. Stoupas btis par Asoka. Temple du dieu Tsou na, venu du mont A LOU NAO, prs de KIA PI CHE. De l au nord, 5oo li, FO LI CHI SA TANG NA (2000 1000 li de l'est l'ouest, s'appelle H ou (turque). Il THSAO KIU THO (7000
Idem, art. xn.
119.
li du sud au nord). La capitale PHI NA. Le roi est de race Thou kioue est attach aux trois Prcieux.
De l au nord-est, franpassant les montagnes, chissant les rivires et sortant des limites de KIA PI CHE, aprs dix petites villes, on atteint les grandes de neige et la chane PHO LO SI NA. C'est Pendant 3
Montagnes le plus grand Idem, art. XIII. 120.
jours AN THA LO FO (ancien pays de Tou HO LO), 3ooo li de tour. Pas de grand roi; il est soumis aux THOU KIOUE. Stoupa bti par Asoka. en entrant dans les valles, De l au nord-ouest, en franchissant les chanes et passant par plusieurs petites villes, 4oo li, 5o.
pic du Djambou dwipa. on descend et on arrive
596 LXXVII, art. xiv. 121.
FOE Houo 3ooo
KOUE
KL pays grand de Tou roi; HO LO), soumis aux
si TO (anciennement li de tour. Pas de
THOU KIOUE. De l au nord-ouest, les valles Idem, art. xv. 122. Houo et plusieurs en passant les montagnes, villes, on arrive
(anciennement pays de Tou HO LO), 3ooo li de tour. Pas de souverain ; soumis aux THOU KIOUE. croient aux trois Prcieux. Peu honorent Beaucoup les esprits. A l'est, on entre dans les monts LING. Ces monts sont au centre du Djambou Au sud, ils tiennent aux grandes TSOUNG dwipa. de Montagnes
Au nord, ils vont jusqu' la mer chaude neige. et aux Mille sources. A l'ouest, jusqu'au royaume de Houo; et l'est, jusqu' Ou CHA : ils ont plude li en tous sens. sieurs milliers art. xvi. 125. Vers l'est, i oo li, on vient MENG KIAN (anciennement pays de Tou HO LO). Pas de grand roi ; il est soumis aux THOU KIOUE. Au nord, on vient A LI NI (anciennement pays de Tou HO LO). Embrasse les deux rives du FA TSOU. 3oo li de tour. A l'est, Idem, art. xvm. 125. on vient de Tou HO LO), cantons
Idem,
Idem,
art. xvn.
124.
Ko LO HOU (anciennement pays au nord, au FA TSOU. touche, A l'est, passant la chane, et cits, 3oo li,
aprs plusieurs
Idem, art. xix.
126.
KE LI SE MO (anciennement li de l'est l'ouest, Allant au nord-est, 3oo
pays de Tou HO LO), IOO du nord au sud. h
on vient
Idem, art. xx.
127.
Po LI HO (anciennement de l'est l'ouest, 3oo
pays de Tou HO LO), ioo li du sud au nord. les montagnes, l'est,
De KE LI SE MO, passant 3oo li, on vient Idem, art. xxi. 128.
SSE MO THA LO (anciennement oooo li de tour. A l'ouest LING, la domination des Thou
pays de Tou HO LO), des monts TSOUNG khioue a beaucoup
APPENDICE. altr les moeurs
597 et dplac les peuples. Ce pays celui de KE LI SE MO.
LXXVII,
art. XXII. 129.
l'ouest, touche, De l vers l'est, 200 li, Po THO TSANGNA (anciennement 2000 li de tour. croyance des trois Prcieux. De l au sud-est, 200
pays de Tou HO LO), Le roi est fermement attach la li au travers des mon-
Idem,
art. xxm.
130.
tagnes, YIN PO KIAN (anciennement pays de Tou HO LO), 1000 li de tour. La langue est un peu diffrente de celle de Po THO TSANGNA. De l au sud-est, franchissant chemin prilleux, 3oo li, la chane par un
Idem,
art. xxiv.
151.
Kiou LANGNOU (anciennement pays de Tou HO LO), 2000 li de tour. Point de loi. Peu de Bouddhistes. Le peuple est sauvage et laid. Le roi croit aux trois Prcieux. De l au nord-est, gravissant une route difficile, 5oo li, les montagnes par
LXVII,
art. xxv. (Cf. n 25.)
132.
THA MO SI THIE TI ou THIAN PIN, OU HOU MI (anciennement pays de Tou HO LO), 15 OU I 600 li de l'est 4 ou 5 li [sic) du sud au nord. Entre deux sur le fleuve FA TSOU. Les habitants ont montagnes, l'ouest, des yeux verts, diffrents de ceux de tous les autres pays. CHE KHI NI (2000 li de tour). La capitale s'appelle WEN TA TO. Ce pays est au nord des grandes Montagnes de neige. Au sud montagnes, CHANG MI (2600 ou 2600 li de tour). Les lettres sont les mmes que celles de Tou HO LO; la langue est diffrente. Le roi est de la race de Che. La loi de Fo y est en grand honneur. Au nord-est, en passant les montagnes par un 700 li, on vient la valle de chemin prilleux, PHO MI LO (PAMIR), qui a 1000 li de l'est l'ouest, de THA MO SI THIE TI et des grandes est le
LXXVII,
art. xxv.
133.
Idem, art. xxvi.
134-
598
FO et 100
KOUE li du nord
KL
au sud; elle est entre deux montagnes de neige. L est le grand lac des Dragons, et o du nord au qui a 3oo li de l'est l'ouest, sud. Il est dans les monts TSOUNG LING. C'est le terrain le plus une branche lev du Djambou occidentale dwipa. De l part coule l'ouest et va
qui se joindre au FA TSOU, sur la limite orientale de THA MO si THIE TI, et coule ensuite vers l'occident, ce qui est droite coule dans cette direction. Une grande branche au nord-est, coule, jusde KIE CHA, sur ses frontires occiqu'au royaume et se joint au fleuve Si TO , pour couler dentales, vers l'est, ce qui est gauche coulant vers l'orient. car tout
Au sud de PHO MI LO , en passant les montagnes, est le royaume de Po LOU LO (BOLOR, qui produit d'or). La partie sud-est de PHO MI LO est beaucoup inhabite. En passant les Montagnes de neige et les glaciers, on arrive Ko PHAN THO (2000 li de tour). La capitale est sur une grande de pierre, et appuye montagne adosse au fleuve SI.TO. .Le roi a pris le titre de Tchi na thi pho kiu ta lo (race du dieu du soleil de fa Chine). Ce pays tait autrefois dsert. Le roi de ayant pris en mariage une princesse chinoise, on la conduisit jusqu' ce lieu, etc. Au sud-est de la ville, 3oo li, grand rocher, deux maisons de Perse des Arhans. Au nordpierre qui ont appartenu est de ce rocher, en passant la chane, PUN JANG cm LO (maison du bonheur), sur le revers oriental des TSOUNG LING, entre quatre montagnes. De l, descendant les TSOUNG LING l'est et grimpant d'autres montagnes, aprs 800 li, on sort des TSOUNG LING, et on vient Ou SA (1000 li de tour). au sud, au Touche, fleuve Si TO. Les lettres et la langue ressemblent peu celles de KIE CHA. On honore Fo. Point de
LXVII,
art.
i.
135.
LXXVII,art.XXVII.
156.
APPENDICE. roi particulier; soumis au Ko PAN THO. A l'ouest la ville, 200 li, grande montagne. De l au nord, par des montagnes dsertes, LVI, art, vu. 157. li, KIE CHA (KASHGAR), ooo 5oo li de tour. le fleuve
599 de
5oo li, passant De l au sud-est, TO, les grands Sables et la chane, LXXVII,art.XXVIII. 158. TCHO KEOUKIA (1000 les mmes que celles est diffrente. LV, art. 1, p. 1 4- 139.
Si
li de tour). Les lettres sont de Kiu SA TAN NA. La langue
On y croit aux trois Prcieux. De l l'est, passant la chane, .800 li, Kiu SA TAN NA (KHOTAN) [Mamelle de la terre |, vulTu WAN NA. Les Hioung nou l'appellent gairement Kou TAN; et les Yin lou. SIAN; les autres barbares, KIOU TAN. 4ooo li de tour. De l 4oo li,
Idem, Idem, Idem,
p. 24-
140. 141.
Tou HO LO (ancien pays de). De l l'est, 600 li, TCHE MA TANNA OU terre de Ni MO.
1000 li, De l au nord-est, PHO OU terre de LEOU LAN. 142t"teso
INDEX.
Pour faciliter les recherches et obvier la confusion qui pourrait rsulter du mlange de tant de mots emprunts des idiomes diffrents, j'ai dsign chacun de ces mots par l'initiale de la langue laquelle ils appartiennent; ainsi, S. sanscrit; P. pli; Sg. singhalais; C. chinois; T. tibtain; Md. mandchou et Mg. mongol.C, L.
A A.S. [La terre.)page 92. Agnideva.S. Dieudu feu.i63. Ababanaraka. S. Undes huit en- Agniya. S. Pays. i63. fers froids.29g. Ahahanaraka. S. Un des huit enfersfroids. 2gg. Abhayari.S. Divisiondes doctrines bouddhiques.34o. Ahan. C.Livressacrs.327. Ai. C.Saintpersonnage.198, 208 S. Monastre. 3.42. Abhayagiri. Abhidharma.S. Une des classes et suiv. des livres sacrs.3, 108, 109, 'Ainou.C.Dmon.i42. 24g, 326. Abhidharmapi- Aipara.Mg.Fleuve. 37. taka.320. Ajassat. Sg.Roi. 319. S. Unedes douze Aj Kiaotchhin ju. C.SaintperAbhyavakashika. observances. 310. 62. sonnage. Abka.Md. Les dieux. i38. S.Saintpersonnage. Aks'agarbha. Achi to f ti. C. Rivire.236. 190, 193. khi A choukia. C.Roi. 67, 23o,2g5. A to hiu che kin pho lo. C. Acht'amahnarakh.S. Les huit Hrtique. i4g. Alan jo. C. (Lieutranauille.) <5o. enfersprincipaux.3oo. Achyma kie pho. C. (Succin. ) go. Ale tche. C. Royaume.240. A chy pho chi. C. Saint person- Ali lo pho ti. C.Rivire.236. destroischarset destrois Allgorie nage. 267. S. Unedes clasanimaux.10. Adbhoutadharma. ses des livres sacrs. 12, 321 Alo han. C. (Vnrable.) 3i, 94. Alou pa. C. Une des sept choses et suiv. P. Saintpersonprcieuses.89. Adjakondandjan. Altan gerel. Mg. Livre cit. 75, nage. 310. 228. Adjtas'atrou.S. Roi. 23o, 25i, Altan tchidaktchi. Mg. Un des 267, 319. Bouddhas de la priodeactuelle. Afeouth mo. C. Une des classes des livressacrs.322. ig4, 312. Afou-loutchi ti che faloPhousa. Amita.P. Princessede la racedes C.Saint personnage.56. Shkyas.216. S. Livressacrs.10g, i34, Amitabha.S. Bouddhadivin. 20, Agama. 21, 119. 327. S. Roi. 118. 182, 246, 295. Amitas'ouddhi. Agesdeshommes. S. Roi. 78, i85, 2o3, S. Undes cieuxsuper- Amitdana. Aghanisht. 216. poss. i46, 156. Amiye ganggar oola.T. Montagne. 5. Ammnat. Rivire. 224, 227, 277, 3o5. Amourliksan.Mg. Saint personnage. 248. Angm.S. Classede saints per32, g5, 16/1. sonnages. Ana han. C.Idem.g5, 273. A na liu ou A na liu tho. C. Dis124, 101, 2o3. ciplede Shkya. Anan ouA nan tho. C. Saint personnage.70, 76, 78, 101, n3, 2o3.,211, 242, et S. 2/16,24g, 25o, 26g, 270, 272. Ananda.S. Le mmeque le prcdent. 78, 111, n3, 211, 248, 24g, 320. = Saintefemme.290. Anarodha. S. Saint personnage. 168. Anawadata. S. Lac. 36, 37. An'da.S. Secte. i53, i58. Andhra.S. Pays.177. Andjana.P. Prince de la race des 215. Shkyas. Aneou leou tho. C. Le mme que Ana liu. i3i. A neou tha. C. Lac. 36 et suiv. S. Pioyaume. 22g, 32g. Anga. Angirasa.S. Prince de la famille des Shkyas. 214. S. Livresacr.327. Angottargama. et Angottaranikya. Angotternikaya S. Livresacr.320. Anho. C. Ville.i93. 5i
402 Ani leou leou.C. Le mmeque A na liu. 131. Anityam.S. Une des quatre ralits. 16g, 181. 'Anlo.C.Monde,ng. Anmoulo.C.Saintefemme.245, =46. 'An moulo ko.C. Sortede pierre. 307. Anoumanam. P. Rivire.231et s. A nou mo. C.Rivireet royaume. 23i, 233. Anourouddha. reSg. Personnage ligieux.320. Anouvrata. S. Le mmeque A na liu. i3i. Anpho lo. C.Saintefemme.242, 245, 263. Anszu.C. Peuple. 38,83. Antaravsaka. S. Vtement,gkAntchha.C.Secte.i53, i 58. Antho hoe.C. Vtement.94. Anto. C. Offredu riz Bouddha, aprssesannesde macration. 290. 'An tsing. C. Nomde religion.3. Aoudc. Royaume. 176, 201, 2i3. A pho tho na. C. Unedes classes des livressacrs.322. Api tha mo. C, Le mme que le suivant. 108, 32. Api than.C.Unedes trois classes deslivresde la loi. 101, 108, 318, 326 et suiv.
FOE
KOUE
KL Assocarahama. Sg. et As'okrma. S. Temple.321. Assoulakounou.Sg. Beauts de Bouddha. 310. As'vdjit. S. Personnageclbre. 267, 3io. S. Le chef des chevaux. As'vapati. 82. P. Chevalde Shkya. Aswardja. 232. Atatanaraka. S. Un des huit enfers froids.2gg. A tcha chi ou A tche chi. C. Roi. 25o et suiv.262 , 267. A tcheou tho khou. C. Saint personnage.5i. Atou to ch tou lou. C. Roi. a5.i. Avadna.S. Une des classes des livressacrs.322. S. Personnage Avalokites'wara. mythologique. 21, 56, 117, 119, 121, i36, 263. Avatra.S. (Incarnation.) 347S. (L'ignorance.) i65, 286, Avidya. 347. Avtchi.S. Undeshuit enfers.3oo. A yi to. C. Saint personnage.33. = Surnomde Matreya. 323. S. Ville. 176, 201, 2i3. Ayodhya. S. DisciAyoushnin Mngalyna. ple de Shkya.213. Ay. C.Roi. 5o, 66, 67, 125, 227, 22g, 253 et suiv. 293, 2g5. A yu tho. C. Royaume. 202.
A po lo lo.C. Dragon.53. Apo ye tchi li. C.(Abhayari.) 34o. Arabko.Md. Une des bouchesdu lac Aneoutha. 37. S. Elphantde ShAradjavartan. kya. 2o3. S. (Lieutranquille.) 60. Aran'yaka. = Un des noms de Bouddha. 286. Arban terghetou. Mg. Roi. 23o, 248. Arbouda.S. Un des huit enfers froids. 299. Arhn.S. (Vnrable.) 3i et suiv. g4, g5, i64, 207, 3o2, 3o3. RunionsdesArhanspourla rdactiondeslivressacrs.24-7, 272, 274, 320. Ari.Md.Dmons.247Arighon ideghetou.Mg. Prince. 2o3. Arighona OEkuktchi. Mg. Roi. 178. Arsalan.Mg. Roi. 23o. Arya.S. Titre de saintet.107. S.Mesurede temps.71, Asankhy. 119, 345. A sengki. C.Idem.334, 345. Asi.S. Rivire.307. Asieoulo. C. Gnies.123, 161. S. (Succin.)90. As'magarbha. As'oka. S. Roi. 67, 126,229, 248, 261, 278, 2g5, 320. S. Gnies.123, i38, 16a. Asoura.
B P. Prince de la Baddhakatchna. familledesShkyas. 216. Badiri.Md. (Pot.) 83. Badma.Mg.Le lotus.Un deshuit emblmes.311. Bahar.Ville.3o5. Baktchicl Baklchou.Mg.Fleuve. 37. Bala.S. Offre du riz Bouddha. 2go. Balkh.Pays.83, 84. Ballakedje. Lgenderelative ce 2g1. personnage. Balokl.S.Lieu clbre.23i. Bana-wara. despomes Sg.Division sacrs composede 25o vers. 320. Banoura.Rivire.3o5. Barkho.Mg. Fleuve. 37. boudBton, attributdu mendiant dhiste. g3. BtondeFo. 86, g3, 356. Bdja Gramisnn dwp.T. Un des quatre Continents.82. Behat. Rivire.98. Beloutches. 78, 84Bnars. 201, 307. Bern'.S.Rivire.307. Rivire.98. Beyah. Bhadrakalpa.S. L'ge des Sages. 245, 357. P. Roi. 216. Bhgirasa. Bhgrath.S. Rivire.201, 214. S. Prince. 214. Bhard'hwadja. Bharata.P. Roi. 216. Bhavva. S. Un des Nidnas.288. Bhikshou. S. (Mendiants.) 60, 180, 217. Bhikshouni.S. (Mendiantes.) 60, m, 180. Bhou ram ching pa. T. Prince. 214-
INDEX. S. 33. Bhouvana. Bich-balik. Royaume., 357. Bimbsra. S. Roi. 67, 229, 23o, 247, 280. Bindhousra. P. Roi.236. Bismantoegri. Mg.Dieu. i3g. Bodhi.S. (La doctrine.)11, 62, 94, 108, 290. = Arbresacr.343. Bodhidharma. S. Patriarche.83. Bodhisattwa. S. Classede saints personnages. 9,10,21,65,120, i46, 2,17,3or. Bom bb in nom. Mg.Doctrinereligieuse,231. Bonbo. T..Secte.23o. Bon ghi tsis. T. Doctrinereligieuse.23o. Bouddha.S. g, 20, 67 et suiv. 166, 29a. = Un des troisPrcieux.42, 3oo et suiv. Bouddhas (lessept). 196et suiv. BouddhaGaya. S.Ville.277, 3o5. Bouddhaghosha.S. Savant religieux.347. Bouddhisme. 35, 4o,, 4i, 43, 47, gg, io3, 106, 123, 34o, 365. Bouddhistes. 2, 12, 181. Boumba.,Mg. Un des huit emblmes.311. Bouramchingpa hp'hgss'kyes po. T. Roi.214. C Caboul. 83. Castes(les quatre).186. Ceylan.326, 33o, 332 et suiv. 336 et suiv.34o, 346. Chabi.Md. (Disciple.)114. S. Un des douze Chad'yatama. Nidnas.287. Chaho.C.Le Fleuvede sable.2, 6. Chamanisme. i3. Chamen.C.LesSamanens. 7, i3. ha mi. C. Classede. religieux. 101, n 3, 182.. de religieuses. Chamini.C.Classe n4, 182. Chamo.C. Lemmeque Chaho. 2, 6. Changna ho sieou.C.Patriarche. 79, 186. Chan ni lo che.C. Ruisseau.55. Chan tche ye pi lo tchi. C. Hrsiarque. 149. Chanthi lan. C. Monde. 118. Charbons (lourdes). 235. Char gi Lus pag dwp.T. Undes 82. quatre Continents. Chars( lestrois ). 1o. Chatcheou.C. Ville.6, 48. Chatchi. C. Royaume. 170. Chatili. C. (Kshatrya.)186. Rivire.29. Chayouk. Ch chang kia. C. Roi.261. Chei. C. Royaume. 175, 188. Che li. C. Reliques.58, 59, 191, 228, 24o Cheli fang. C. Samanen.4i. Che li fo.C. Disciple de Shkya. 70, 101, 107, n3, 257, 262, 264 et suiv.267, 272. Che li ma li lo kia.C. Classede religieux.114. Che li tseu.C.Le mmeque Che li fo. 107. tho lo.C.Monastre. 224. Chelo.p Chenchen.C.Royaume. 2, 7, 8. Chen ching. C.Mrede Keouna han meouni Fo. ig5. Chenfan tseu. C.Gnie.189. Chen hian. C. Demeured'Indra. 129. ==Saintpersonnage.239. Chenhouan.C. i84. Chenkiaking.C.Livresacr.327. Chenki tseu. C.Personnage myig3. thologique. Chenpou. C.Ile. 80. Chen ra'bs. T. Fondateur de la secte Bonbo.231. Chen tchi.C. Montagne.5o. = Mre de Keouleou sun Fo. i93. Chentchu tchin pao chan wang Jou la. C. 11g. du roi Kan Chen yen. C. Femme, tche. 3o8.
405 Brahma.S. 21, 122, i35 et suiv. 157, 186, 218. S.Ouvrage cit.108. Brahmadjla. S. Un des cieuxde Brahma-kyika. Brahma.i36. Brahmanes. 148, 179, 186. Brahmanisme. io3, 106. Brahmaparipaty.S. Arme de Brahma. i36. S. Ministresde Brahmapourohita. Brahma.i36. S. Undescieux Brahma-prashdya. deBrahma.i36. Brahmalchri. S. (JeuneBrahmane. ) 6g. Bre'wozas.T. Roi.2o3.
Cheou.C. 286,287. (Laperception^) Cheoukia. C. Ceuxqui ont reu les dfenses. 327. Cheouleng yan. C. Ouvrage bouddhique.270, 271. Cheoutho. C. (Sotra.) 186. Che'we.C.Ville. 33,171,176,177. = Crmonie de la crmationdes corps.35o, 353. Chey. C.Undes nomsde Shkya. 3o8. = Royaume. Ibid. Chi. C. (Sicle.)113. Chi eul Theoutlio king. C. Livre cit. 60. Chikhi.C.i36. Nomd'un Bouddha. 345. Chikour.Mg. (Le parasol.)Undes huit emblmes.3n. Chilai na fati. C. Rivire.236. Childa.Mg.Fleuve. 37. Chi li cha. C. Arbre. ig3. Chi lo. C. Prceptes.110. Chimnou.Mg.Voyez Simnou. Chi moche na. C. (Champ destombeaux.)272, 273. Chin.C. (Divin.)i3o. Ching.C.Mesurede capacit.361, 366. Ching tao Cha men. C. Classede Samanens. i3. Chingtchang.C. (Bton.)g3. Si.
404 i o, 3oi, Chingwen.C.(Discinles.) 32i, 327. gChin olclie.T. Roi des enfers. 1/14. gChinrdje. T. Princede la mort, 3oo. Clan tlioung.C. Une des sixfacults surnaturelles.i3o. Chintou.C. L'Inde. i4, 38. Chi pi kia.C. Surnomde Jou la. 55. Chito.C. Temple.17g. Chi tsun. C. Un des dixsurnoms desBouddhas. g4, 113. Chouangmi. C. Ville.83. Chouc lao Cha men. C. Classe de Samanens.i3. Chouwen.C. Ouvragecit. i4. Chou yu. C. (Cristalde roche.) 90. Choumengpe li. C.Ville.52. Choutho lo.C. (Sotra.) 186. Chu.C. Pays.38.
FOE
KOUE
KI. Chylo f sy ti. C. Ville.177. Chymoti yo.C. Undesenfers.297. Chytchama na ou Chytcha ni. C. Classede religieuses. 182. Chytchoung.C.Sa lgende.07. Chytchoung.C. (Racede Shkya.) 60, 187 et suiv. Chythihouan in. C. Nomd'Indra. 64, i84. Chy ti ou Chy thian ti. C. Idem 263. Chytyking.C.Livresacr.327. Colombe de la). 314, ( monastre 3i6. Contenants (lestrois). 108, 326. Continents (lesquatre).80, 81. 22, 23. Cophcs, Cophne. 106. Coquilles-monnaie. Core.il\. Introduction du Bouddhisme danscepays. 43.. 80, 81. Cosmographie bouddhique. Colories. 106. Crne deFo.85, 356.
Chunki.C.Beau-pre de Shkya. 204. Chuphan na.C.Gnie.ig5. Chy. C. (Shkya.)3. =UndesdouzeNidnas.286,287. Chy.C. (Indra.) 64, 76, 262, 263. F hian. ChyF hian. Voyez Chy kiaFo. C. 2g, 295, 3o8. Joula. ChykiaJoula.C.53.Voyez Chykiamou ni. C. Le mmeque Chykia wen. 161. Chykia pi lingkia. C. Pierre prcieuse.90. Chykia wen.C. (Shkya mouni.) 70, 161, 175, 187, 28g. Chy li fo. C. Saint personnage. Cheli fo. 70. Mieux Chy li khieouto. C. Personnage clbre.267. Chyli Kiach.C.Converti par Shkya.2g2, 310. Chy li mo li lo kia. C. Classede religieux.182. D
Dadzanloung.Md. Unedes bouchesdu lac Aneou tha. 37; Dahoe. 38. Dahder.Rivire.3o5. Dakchin'a. S.LeDeccan.315. Dalada wahans. Sg.DentdeBouddha. 345. Dna.S. Un des dixPramit.6, 27, 71. Darada.Pays.3i. S. Pioi.23o. Das'aralha. Das'awalaKs'yapa.S. Converti par Shkya.2g2, 310. Debjin gshegs pa. T. Undestitres desBouddhas.191. Dentde Fo. 27, 86, 92, 333 et suiv.344, sl)e snod gsoum. T. Lestroiscontenants.108. Deva. S. Lesdieux.21, 138, 161, 185. DevaBodhisattwa. S. 159. Devadha sakka.P. Roi.215 et s. Devadatla. S. Perscuteurde Shkya.185,211et suiv.216, 225, 247,267, 271,274.
S.Dieuxinfrieurs.186. Devlaya. S.Nomhonorifique de Devatideva. Shkya.221. Devenipaetissa. Sg.Roi.34o, 343. Dhran'. S. (Invocation.) Livres sacrs. 109, 190, ig3, ig5, 248,327. Dharma.S. 21.Un des troisPrcieux.42, 3oo et suiv. = Unedes divisions des livressacrs-323. S. Un destroistats Dharmakya. de Bouddha.gi. Dharmapadeya. Sg. Livre sacr. 320. S. (LeFlambeau Dharmapradpik. dela loi.)Ouvragecit. 3oo. Dharms'oca. S.Roi. 320, 33o. Dharmavardhana. S. Prince. 67. Dhldana.S. Roi. i85, 2o3 et 216. Dhoudh. T.Chefdesdmons. 247. Dhyna. S. Degrs de saintet. 265, 3i 1. Dhynibouddha.S. 118, 120. Dib. S. (Ile.) 81.
S. Dierganikayaou Drghanikya. Livresacr.320. Dieux(quatre classes de). i38, 145. Dieux(les quatreroisdes). 122. Dieux(les trente-trois). 128, 1/14. Dpankara.S. Nomd'un Bouddha. 68,346. S. Livresacr.327. Drghgama. Couvent. Djalandharaet Djalandri. 248. Djamboudip. Mg. Le mme que le suivant.82. Djamboudvpa.S. Un des quatre Continents. 78, 80, 81, 82, 217, 261. Djambou dwip.T. Idem.82. Djambougling.T. Idem.82. T. (Mandjous'ri.) hDjam dVyang. 115. Djamn.S. Rivire.io.3. sDjan ras gZigs dVang tchhoug. T. (Avalokiteswara.) 117. S. Un des Nidnas. Djrmaran'a. 166,288. Djtaka. S. Une des classesdes livressacrs.12, 322.
INDEX. = Naissances deBouddha. 347 et suiv. Djti.S.UndesNidnas.288. P. Roi. 2i5 et suiv. Djayasena. Djet et Djetavana.P. Temple. 17g, i85. nDjigrten gyigtsobo. T. (Honorabledusicle.)113. Fleuve.36. Djihoun. Djina.P. (Shkya mouni.) 216. Rivire.98. Djylam. Doctrine sa rdaction. bouddhique, 243, 247. = Trente-sept classesde doctrine. 286. Donpa. T. Mesure. 33. Dorona Oulamdzi beyeto dip.Mg. Un des quatre Continents. 82. bDoudhr,tsi zas.T. Roi.2o3. Douhkham. S. Une des quatreralits. 16g. hDoul-ba.T. Les prceptes.108. Douldouri. Md. (Bton.)g3. etDoungcrdeni. Doung ouDoungar 311, Mg.Undeshuitemblmes. 3l2. E enCore. Ecriture,soiiintroduction 43. P. Une des douzeobEkapnika. servances. 61. Ekavtchika. S. 72. Elments ( les cinq ). g2. Embouchures (lescinq). 25o. Enchanements (lesdouze).10. Enfer. ig3. Lesgrandset lespetits enfers.2g6 et suiv. Entres(lessix). 287. 'Eou heou. C.Un des huit enfers froids.2gg. Erannoboas. Rivire.257. ErdeniSar. Mg.Roi. 23o. Ergetoukhomsimbodisatou.Mg. (Avalokites'wara.) 117. F
405 Doutes (lescinq). 158. Dragons (rois des). 49, 53, 67. 161. Dvli. P. Roi.216. Dwpa(les quatre). S. 80, 81. Dyan.Mg. Le plus haut degr de saintet.3n. Dzsoun.S. (LesPoissons.) Undes huit emblmes. 311. Dzighasoun. Mg. Les mmes que les prcdents. 311. Dzina.Mg. Les prceptes. 108.
Erlik khakan.Mg. Roi des enfers. 144,3oo. Ertundjin tooli. Mg.Ouvragecit. 37. Esroun tegri. Mg. Le mme que Brahma.137, 3i 1. Eul kiang.C. Peuplade.8.
Fa. C. Un destrois Prcieux.3oo Fan ma you.C. Mre de Mi le. Sesstatues. 4i, 172. desespieds. et suiv. 34. 45, 4g. Empreintes Facults surnaturelles( les six). Fan tchi.C. (Brahmatchri.) 63, 255, 261, 332, 34K 6g. 356. i3o. Fan tchu. C. (Brahma.)218. F hian ou ChyFa hian.C. 1, 2, Fan t. C. Pre du Fo Kia che. Abandonne soncorps un ligrt. 5o, 7.4,75. 77, 172, 26g, 3i8, 32i, 333, 18g. Sonpot.27, 76, 82, 351,356. 347, 35g et suiv.362.Re'- Fan wang.C.Livresacr.327. Osdesoncrne.85, 356. sumdesonvoyage. 368 etsuiv. Farghana.Pays.38. Sa dent. 27, 76, 86, g2, 333. F hingwang.C.Roi. 43. Fe che. C. (Vasya. ) 186. Fa hoaking. C. Livresacr.322. Fe che li. C.Ville.244. circonstances de sa Diffrentes vie. 4g et suiv.54, 65, 66, F i. C. Roi. 66, 67. Fechi. C. Le souper.107. Fe chi ti yo. C. Un des enfers. 124,i83, 275 et suiv.290, Falgo.Rivire.224, 277. Fmi. C. Sectaire.53. 3o5, 354 et suiv. 2g6. Sonbton.86 , 92, g3, 356. Familles Fe lieou li ye. C. (Lapislazuli.) (lesquatre).i3-j. SonSengkiali. g2,g3. Fan. C. Langue. i5, 125. go. = Brahma.135. Sonombre. Femmes 45, 87, g4, 356. (royaume des), ik, 338. Ses tribulations. Fa na. C. (Foret.)54. Fen (les quatre). C. Les quatre 183,184, 271, 279Fang.C.(La loi.)-Fang kouang, degrs.327. de la loi.) 323. Samort.235, 237et suiv.335, Fen to ly. C. Un des huit enfers (Grandeur Fan hing. C. (Brahinaniquement.) froids.2gg. 347. Sesreliques. 3. Feou thou. C. Bouddha.g, 4i. 27,g2, 2.4o. = Sortedechapelle. ou maniFan kang.C.Ouvragecit.108. 5o, gi, 355. Ses transformations Fan lan ma. C. Brahma.135. Fo. Sanaissance. 335, 347. gg. festations.
406 Fo. C.Undes troisPrcieux.3oo et suiv. Fo cha fou.C. Ville.355. Foleoucha.C. Royaume. 76,78, 84. Fopho thi..C. Le mmeque Fo yu thai. 81.
FOE
KOUE
KL
Fo tho. C. Un des troisPrcieux. Foudanna.S. Dmons.i3g. 43. Fou jin C. Titre de la mre de Fo yu thai. C. Un des quatre Con- Bouddha.120. tinents. 81, i35. Fou lan na Kia che. C. HrsiarFormules divines. 18.9. que. 149, i5Setsuiv. Fothatha.C.surnomdeJoula. 54. Fruits (les cinq). 94, 164. F thsou. C. Fleuve.36. Fung t. C.Ville. 177. G
Gadjapati. S. (Le chef des. lphants.) 82. dG Idan. T. Un des tages du paradis.33. Gand'aki.S. Rivire.236, 25o. Gandhra.S.Pays. 3i, 66, 67, 83. Gandharva.S. Gnies. 123, i38, 161. Gandjour.T. Ouvragecit. 108. , Gang sgar. S. Embouchure du Gange.202. Gange.36, 168, 201, 245, 25,i, 328, 33o. mGan-hgis.T. (Le Gange.)37. dGanpa. T. (Monastres.) 19. Garoud'a.S. Oiseaufabuleux.138, 161. Gatchinkunas'ana. S. Royaume. 248. GatchouOH Gatchi.Mg.Royaume. 80, 248. Gth. S. Une des classes des livressacrs. 12, 322. Gutama.S. Prince de la famille des Shkyas.214-
==Un des noms de Shkya.3o8 et suiv. Gaya.S. Ville. 277, 3o5. S.Convertipar ShGayKs'yapa. kya. 2g2. Geoutam.T.Undes nomsde Bouddha. 3o8. Gerelsakiktchi.Mg.,Undes Bouddhasde la priodeactuelle.189, 3l2. dGe slong. T. [Mendiants..) 60. Gtes(les)-.78. Geya.S. Unedes classesdes livres sacrs. 12, 821 et suiv. Ghasalang oughe Nom-unkhaghan. Mg. Roi. 23o, 248. rGhioun dhou joughs bha. T. Classe de saints personnages. 210. Ghiou ourgo. Md. Une des bouches du lac Aneoutha. 37. Ghrou h,dzin. T. Ville. 21,4. Giddore.. 260. Montagne., Gnia thri zzanbo. T. Roi. 231,. Gni rnahi g.ngen, T. Nom d'un H
prince de la familledes Shkyas. 214. Gdhanya.S. Un des quatre Continents. 81. Gmal. Fleuve. 23. Gmat. S. Nom d'un monastre, et d'une rivire. 20. Goodam. Mg. ( Geoutam.) 268, 3o8. hGor-la;. T. (Boues.)28. Gtama.S. Saint personnage.214, 3og. Gouhsha^ Sg. Roi 3.45. Gorbanamak saba. Mg. Les trois contenants.3, 108. Gouroupda.S. Montagne.3o2. Goyeni. S. Le mme que Gdhanya. 143. Grantha.S. (Donations.). 106. Gridhrakot'a.S. Montagne.2,60, 270. Gunduk. Rivire.236. rGyalsrid d,ghah. T. Roi. 2.15 hGyour.T. 1081.
Hammanelle Siripad. Sg. Montagne. 34i. Han. C. La terre de Han (la Chine).7, 8, 343. Han ping ti yo.C.Undes seizeenfers. ag8. Han tha. C. Le Kandahar. 83. Hao khou. C. Saint personnage. 187 et suiv. Hatly pla. Sg. Unedesmanifestations de Bouddha.34g. Hautearme(roi de la). 55, 58.
He cha ti yo.C. Un desseizeenfers. ag6. He ching ti yo.C.Un deshuit enfersbrlants. 298. Heng ou Heng kia.C. Le Gange. 36, 167, 168, 242. Hrsiarques (lessix). 149, 225. Hian ki. C. L'ge des Sages.245. Hian theou. C. L'Inde. i4. Hian yang. C.Bourgade.41 Hiaohiao po.C.Un des huit enfers froids. 2gg.
Hia pen king..C. Livresacr. 162. Hia tso. C. (S'asseoir en t.) Expression, explique.4. Hieoumi, C. Peuplade.83K Hieouthou. C. Pays.4i. Hiki lo.C. (Bton.)g3. Hi lian. C. Rivire. 2,35,236, 25o Hi lo. C. Montagne.54. = Ville. 85, 89. Himalaya.S. 21, 3i, 35, 36, 97. Hing. C. Une des douze conditions de l'existence.286, 287.
INDEX. Hioungnou.C.Peuple. 38 et suiv. Hiran'ya. S. (Or.) Rivire. a36. S. Hiran'yabhou etHiran'yawha. Rivire.257. Hi tun. C. Peuplade.83. Hiuanthsang.Prtre bouddhique. 228. Extraits de son voyage. 244, 246, 267, 336, 338. Rsumde sarelation, 372 et s. Hiu tchin. C. Auteur du Chou wen. 14. H'ias b.stan. T. Ville. 215. Hoa tao Cha men. C. Classede Samanens.13. Hoa tchhingyuphin. C. Livresacr. 322. Hoa yan. G.Ouvragecit. 108. Ho chang.C.Laquesbouddhistes. 173, 181, 182. Hoeh. C. Peuple. i5. Iloe h li yo. C Un des enfers. 297Hoe kian.C.Samanen.2, 6. Hoe king. C. Compagnonde F hian. 1, 4, 16, 45y77, 96. Hoe seng. G. Son voyage dans l'Inde. 48*49, 354. Hoe tha. C. Samanen. 16, 20, 45, 77. Hoe 'we et Hoe yng. C. Compagnons de F hian. 1, 4. Hoho.C.Undeshuit enfersfroids. 299Ho kia lo. G. Une des classesdes livres sacrs.323. Ho king. C. Mauvais gnie. 126, i63. Ho li. C. Fort clbre. 167. Ho man. C. Shkya dans une de ses existences antrieures. 27g. I 1 che na. C. Hrtiques.157. I chen na. C. Ville. 43. Ikshwakou. S.Fondateurdelarace des Shkyas.213 et suiv. fkshwakouViroudhaka. S. Prince. 214. Iletou nomoun. Md. Classe de livressacrs. 108. Ilgaksoundjimik.Mg.Un deshuit emblmes.311. Ilmoun khan.Md. Roi des enfers. i44, 3oo. I lo po. C. Nom d'un dragon. 3o5. Images(procession des). 17, 20. Inde (I). 14,39,82. Indecentrale. 45, 5g. Indedu nord.3o, 3i, 92. Indra. S. 21, ai, 64, i46, 218, 263. S.Montagne. 263. Indras'ilagouh. Inekou dzikhe.Md. Un des titres des Bouddhas.191. Ingachar.Pays.25. Ing soung. C. ( Chant,redoubl. ) 322. In tho lo. C. Indra. 64. 1 po. C. Expressionconsacre. 83. J Jan teng Fo. C. Nomd'un Bouddha. 346. Jardins (les quatre)desdieux.12g. Java (le de). 364 et suiv. Jin jo. C. Immortel.53.
407 Ho m. C.Ville. 83. : . Honorable dusicle.113. Hotao Cha men. C: .Classede Samanens.i3. '": ,:" ". Hou. C. Mesurede capacit.84. Houangchoui.G.Rivire.:5. Houa li. C.Sectaire.53. '. Ho fan wang. C. Roi. 78, 178, 185, 2o3, 24g, 3io. Hougli.Rivire.33o. Hou hi. C. Lgende relative ce : 279/ personnage. Hou khiu ping. C. Gnral chinois. 4i' Houngchi.C.Nomd'annes.1j 3. Houleou. C. (Moulian.) 68. Hou tsao.C. Ville. 83. Hou yu. C. (Langue barbare. ) 1/1.
Issa patana ramaaou Issi patne. P. Temple.3o6. Istewirrewade. Sg.Livresacr.320. Iswara.S. Dieu du mondedes dsirs. 122, 156, 807. Iswere patne rny. P. Temple. 3o6. I szu mo wang.C. Un des anctres de Shkya.2o3. Itihsa. S. Une des classes des livressacrs. 12, 322. I ti mou to. C. Idem.822. I tsun kheou.C. Apportedeslivres bouddhiques la Chine. 41.
tifsdes Bouddhas.4g, 5o, 53, Jo than. C. Prince.5. Jo thi. C.MredeNikiantho. 15o. 54, 55, 58, 191. Jou i. C. (Perle.) go. Joyaux(l'ledes).33o, 338. = Lac des dieux. 12g. Jy tchoung. C. Un des nomsde Jou la. C. Un des titres qualificaShkya.3o8. K
Ka.S. (Lvent.) 92. Kabilik.Mg.Royaume.200. Kafristan.Pays. 47.
T. Ouvragecit.108, bKh. T. Classede livressacrs. hKh-hGyour. 201. 108.
40.8 Kalas.Montagne.201. - ; Kalsoka. Sg. Roi. (As'oka.)32i. Klastra. S. Un des huit en/ers . principaux.3oo. : ... Kal dzian ching r,ta. T.,Rivire. 214. . . Klitha.S. Saint personnage.68. Kalpa.S. Agesdu monde.68, 118, i32, 245. Kalpatarou.S. Arbre.5o. P..Rois.2i6Kalynika. Kamhala.S. Hrtique.149. Ka na hia meou ni. C. (Kanaka mouni.) ig4. Kanaka.S. (Or.) ig4. Kanakamouni. S. Un des Bouddhas de la priodeactuelle.160 187, ig4, 271, 3i2. Kanardji.S. Ville. 168. Kandahar. Pays. 66, 83, 353 et s. Kang dhoub djian. T. Prince. 214 et suiv. Kanika.Mg. Roi. 80, 248. Kanloufan wang.C.Prince. 2o3. Kan.loutsing.C. Roi. 68. S. Ville. 168. Kanoudje. Kantakanam. P. Cheval deShkya. 232. Kan tche. C. Un des noms de Shkya.3o8. = Roi. Ibid. Kan tcheou.C. Pays. 5. Kan tholo.C. Le Kandahar. 353, 355. S. Ville. 168. Kanykoubdja. Kan yng. C. Gnral chinois.35, 3g. Kaofou. C.Ville. 83. Kaoli. C.La Core.43. Kaotchhang. C. Pays.8, i5. Kapila.S. Hrsiarque.i4g, i52, 200, 214Kapilapour.S. Royaume.200ets. Kapilavastou.S. Royaume. 188, 200, 2l4P. Le mme.200. Kapilavatthu. Karsou.S.Rivire. 25, 2g. Karkoutchandaet mieuxKrakoutchhanda.160,187, 192etsuiv. 271. Kar madh tong. T. Prince de la race des Shkyas.2i4 et suiv.
FOE
KOU
KL Khiang. C.Le Tibet.38. .. Khiankoue.G.Royaume et prince. i,4. Khian tchhou. C. Instrument sonore. 20. -.."-.". Khiantchou ti yo. C. Un des seize enfers. 2g7. Khian. t. C. Cheval de Shkya. 232 et suiv. Khih o lan. C. Temple.356. Khi lian chan. C. Chane de montagnes. 5. Khin pho lo. C. Hrtique.r4g. Khi sin lun. C. Ouvragecit. og. Khi tchekhi. C. Montagne.115, i85, 253, 260, 26g, 270. Khi khi tcha. po tho. C. Montagne. 3o2. Khiu lo wang. C. Un des anctres de Shkya. 2o3. Khiu niu tchhing. C. Ville. 168. Khiu thse. C. Pays. 351,35.7Khi ye. C. Unedes classes des.livres sacrs.321. Kh lo tche ky li hi. G. Ville, 267. Kho phan tho. C. Pays. 24. Khormpusda.Mg- et Khourmousda. S. Le mme qu'Indra. 65, 265, 311. Khotan. Ville. 18. Khoungphin.C,Livresacr.322. Khoutoukhtou. Mg. (Incarnation.) 264. Khuen.C. Divinit.,i4i. Khy fo Koujin. C. Roi. 4. Kia cha. C. Espce de collet. 4g, 61, 62. Kia ch. C. Disciple de Shkya. 101, 272, 274, 2g2, 3o2, 3o3. = Mrede Fou lan na. 1/1 g. = Un des Bouddhasde la priode actuelle. 175 et suiv. 187, 18g, 27g, 3i4, 3i5. Kia ch ou Kiase. C.Lestroisfrres convertispar Shkya.276, 2g2. Kia che pho. C. Le mme que le prcdent. 53, 18g. Kia chi. Ci Fioyaume. 3o4, 3o8. Kiatho. C.Lieu clbre.21g. Kiathou. C. (Dlivrance.) g2. Kia lan. C. Abrviationde Seng kialan. g.
Karn'a.S; Roi. 2i4, 329. '-' Karn'apoura.S. Ville. 329. Kasn.P. Princesse.. 215. Ks'i.S. Royaume. 368. . Un des Bouddhasde Ks'yapa.S.> la priode actuelle. g3,' 160, 1.87,189,190; 1.96,271, 3o3, 3i2, 3i5. = Disciplede Shkya.248>24g, ' 320. = Lestroisfrres. 2g2. ;. = Mrede Fou lan na. i4g= Secte. 53. Katchn. S. Femme de Shkya. 204. Kaus'mb. S. Royaume. 202, 313. S. Personnage Kavanpati. mythologique. 168. Kengkhi.C.Anciennomdu Bouddha Ks'yapa. 53. Kenglo. C. Un des Nidnas.287. Keou chen mi, imprim par erreur Keouthanmi. C.Royaume. 3o5, 313. Keouchi. C. Ville. 58. Keouleou sun. C. Un des Bouddhas de l'ge actuel. 187, 192. Keouleou thsin fo.C. Le mme que le prcdent. 192. Keouli cha li. C. Pre de Ma ye. 72, 12g. Keou lin ou Keouli tha tseu. C. Personnageclbre. 3o4, 3og. Keouna han meou ni. C. Undes Bouddhasde l'ge actuel. 187, 192, 194. Keoutchi. C. Lumiredivine.54. Keouthan mi. Voyez Keouchen mi. Kha. S. (L'ther.)g2. S. Classede Khadgavis'nkalpa. saints. i65. S. Une Khaloupas'wadhaktinka. des douzeobservances. 61. Khamdan. Rivire. 2g. Khmeh.Branche de l'Indus. 2g, 37Khamouk tousayi butughektchi. Mg. Nom deShkya. 225. Khang kiu. C. Pays. 38. Khanth pho. C.Gnies.123,161. Khasalangoughe.Mg. Roi. 67. Kheouphan tho. C.Dmons.i4o.
INDEX. Kia lan tho. C. Personnage et temple. i85, 272, 273. Kia leoulo. C.Gnies.161. Kia lo. C. Tempsdes repas. 107. = Roi desDragons.220. Kia lo kieoutho kia tchin yan. C. Hrtique.149. Kia lo pi na kia. C. Pays. 264Kia ni sse kia. C. Roi. 80, 248, 355. Kiantho lo. C. Royaume. 66, 248, 353. Kian tho we. C. Royaume. 66, 35i,353. Kiao chang mi. C.Pioyaume. 302, 3i3. Kiao fan pa thi. C. Personnage mythologique.168. Kiao lieou pa. C. Pays.364. Kiao sa lo. C. Royaume. 176, 202. Kiaotchhin ju. C.Nomde famille. 3io. Kiaowen ti yo. C. Un des huit enfersbrlants. 2g8. Kiapi che.C. Royaume.8g. Kiapi li et Kia pi lo.C.Hrsiarque. i4g, i52. = Royaume.176, 200et suiv. Kia ch. Kia se. Voyez Kia se koue. C. Une des classes des prceptes.325. Kia tchin yan. C. Nomde famille de Kialo kieoutho. i4gKia tho. C. Une des classes des livressacrs.54, 322. Kia'we lo 'we. C.Ville.ig8, gg et suiv. Kia ye. C. Ville.275, 277, 3o5. KieetKietho. C. (Pome.)54. Kieoucheou. C. Roi.43. Kieoui. C.Femme de Shkya.70, 204, 211, 232. Kieouyi. C.Explic.de ce mot. 4o. Ki pi lo f so tou.C. Royaume. 200. Kipi tha. C. Royaume.128. Ki tchha. C. Royaume. 16, 22, 26, 29. Kiha. C. 3. Kit.Mg. (Monastres.) 19. Kijaoi.C. Ville. 167, 168. Kilo. C. Monde. 119. Kims'ouka. S. Arbre. 90. Kmchantchaoming.C.Saintpersonnage. i4i. King.C. Les livressacrs. 3, 108, 110,321, 326. Kingkia.C.Le Gange.245, 256. Kin hian. C. Ville.4. Kini kia. C.Roi. 76, 80. Kin kang mi tsi. C. Dieu. i4o. Kin kouang ming king. C. Livre sacr.322. Kin nalo. C. Etres fabuleux.123, 161. Kinnara.S. Idem.123, i38, 161. ou Kanoudje. 168. Kinnodje Kin tchhing. C. Ville.4. Ki '0 ti yo. C. Un des enfers. 296. Ki pin. C. Pays.22, 23. Kiu che. C. (Contenant.) 108, 10g. Kiu che lan. C. Livrecit. i34. Kiuchinakilo et Kiuchitchhing. C. Ville.236. Kiu i na ki. C. Ville. 235, 236. Kiulolo lou.C. Pays.356. Kiu lou po tho. C. Montagne. 3o2. Kiu ma ti. C. Nomd'un monastre. 16, 20. Kiu na han meouni. C. (Kanaka mouni.) ig4. Kiu sa lo. C. Royaume.171, 176. Kiusou mo phou lo.C.Ville.256, 258. Kiusse lo. C. Temple.3o5, 3i3. Kiutan. C.Un desnoms de Shkya. 3o4, 3o8. Kiu tche ki lo phou lo. C.Ville. 256, 208. Kiu tse lo. C. Pays.176. Kiu ye ni. C.Un des quatre Continents. 81, i35. Koli. C. Pays.53. dKon mtchhog soum.T. Triade. 42.
409 Ko pou to. C. Sthopa clbre.56. Kos'ala.S. Royaume.176 et suiv. 201. Kosha.S. (Contenant.) 108, 10g. Koti yo. C. Un des enfers. 296. Kouanchi in. C. Personnagemythologique.101,117, 121,363. Kouangtcheou.C,Ville. 36o, 365. Kouanin. C. Le mmeque le prcdent. 121. Kouawa.C.Java. 364Koue (les trois). C. Les trois appuis. 3i8, 323. Kouechouang.C. Pays. 83. Kouenming. C. Peuple.39. Koukeyar. Pays.25. S. Montagne. 3o2. Koukkout'apda. Koumouda. S.Uu desenfersfroids. 299Koungsun. C.Pioi.7. Kourou.S. Nomd'une tribu. 81. Kous'mba. S. Fondateur de Kaus'mb.3i3. Kous'anbha. S.Roi. 168. S. Ville.236. Kous'inagara. Kousinara. P. Ville.236. Ville.258, 25g. Kousoumapoura.S. Kou stana.S. Etymologiede Khotan. 18. Koutche. S. Pays.357. Kouvera.S. Dieudesrichesses.56. Krakoutchhanda.S. Un des Bouddhas de la priodeactuelle.160, 187, ga etsuiv. 271. Kshnti.S. Un des six moyensde salut.71. Kshatrya.S. Unedes quatrecastes. 137, 186, 216. Kshma.S. 116. K jo ki tche.C. Ville.168. g. Kulgun.Mg.(Translation.) Kurdou. Mg. La roue de la puissance. 28, 3i 1. P. Ville. 216. Kus'avati. Ky kou tou. C. Lieu clbre. 162, 178. = Surnomde Siuth. 178. Kyli. C. Pays.53. Kyly tho lo khiuta. C. Montagne. "260.
OA
410
FOE '
KO.UE L
KI.
Ladak.Ville. 2,g. Lagh na rdo rdzie. T. Saint personnage.23g. Laghr,na. T. Prince..214< Lah, T. Les dieux.i38. . Lakchanaou Laks'ana.S. Beauts de Bouddha. 72, g4, i34, 210. Lan chi.C.Ville.83. Lang ha. T. Personnageclbre. 3io, 3i2. Langga.Md. Lac. 37. Lang po tsie dhoul. T. Prince de la race des Shkyas. 2i4 et suiv. Lan mo. C. Royaume.227, 228. Lan pho lou. C. Montagne.56. Lan pi ni. C. Lieu clbre. 17g, 219. Lao.C.UndesdouzeNidnas. 286, 288. = Montagne.361, 366. Lakika.S. Secte. i54. Leh.Ville.2g. Lengyan king. C. Ouvragebouddhique.271,323. Leoulan. C. Pays.8. Le so pho.C. Secte. 151. Li. C. Mesurede distances.123, i48.
Liang. C. Dynastie.5, 6. Liang h ti yo. C. Un des enfers. 297' Liang tcheou.C.Dpartement.5. Lieou li. C.Une des sept choses prcieuses, go. = Roi. 175, 178, 187, 198. Li hao.C. Prince. 2,6. Ling kia.C. Montagne.349Lingkia king. C.Livresacr.34g. 5o. Ling tchi. C. Champignon. Ling th. C. Tour des Esprits. 79Ling tsieou fung. C. Montagne. 260. Ling yen tcheou. C. Livre sacr, 327. Lions(royaumedes) 328, [Ceylan]. 332 et suiv. Li tchhe.C.Habitantsde Vas'ali. 235, 240, 244, 25o, 252. Litchtchivi. S. Idem. 24o, 244, 252. Li t. C. Pre de Keouleou sun Fo. 193. Li. C. Les prceptes.3, 327. Livresbouddhiques. 12, 108, 243, 247,272, 274,818,321. Lo.C. Fils de Shkya.70, Lob.Lac. 6,8. M
Locha. C. Dmonsfemelles.33g. Lo han. C. ( Vnrable. ) 3o, 3i, 94. LohitaetLohitaka.S. (Rouge.) 56Lo i. C. Royaume. 96, 97. du Lokadjyeshtha. S. ( Honorable sicle.)g, g4, 113. Lo tha szu pho mi. C. Saint personnage.253. Louan.C. Oiseaufabuleux,211. Lou hi ta kia. C. Sthopa clbre. 56. Loujy. C. Un des douzeNidnas. 287. Lou kia ye. C. Secte.i54, 155Loung. C. Dragons. 161. = Montagnes.1, 4. Loung chou. C. Saint religieux. i5g. Loungmini. C. Lieu clbre.179, 219. Loungsi. C. Dynastie.4.. Lo siang.C. i83. Lo yang.C. Ville.44. Lo yu khi. C. Ville. ii5, 188, 266. Lun. C. Les discours.3, 28, 327. Lun ming. C.Jardin royal o naquit Shkya. gg, 21g. 240. Lyseng. C. (Laques.)
Ma. S. (La connaissance.) g2. Macrations. i58. de Shhya. 275, 27g. Machi baya souktchi ergbeto. Mg. Roi desdmons.247S. L'Inde centrale. Mad'hyades'a. 5g, 187,260. S. Livre sacr. Madhyamgama. 327. et MaddimeniMadhyamanikya kya.S. Livresacr.320. P. Saintpersonnage. Madhyntika. 32. P. (Mad'hyades'a. Madjdjadsa. ) 260.
S. Pays.67, 201, 256. Magadha.. S. 310. Magoul-lakounou. S. i36. Mahbrhmana. Mahdeva.S. Prince. 71. = Hrtique.248. Ma ha fa na. C. Monastre.54. MahIswara.S. Dieu. 122, i4o, i57. MahKs'yapa. S. Patriarche.7g, 101, 168, 186, 274, 292, 3o3, 320. Mah my. S. Mre.de Shkya. 12g, 220, 226. Maha Moukianlian. C. Disciple de Shkya.68 , 70.
Mahmouni. S. 216. Mahmoutchala. P. Roi. 216. Mah Nada.S. Prince. 71. Maha nan. C.Prince. 178,208. Mah padma. S.-.Undes huit enfers froids.3oo. Mah Padmapati Nanda. S. Roi. 22g, 23o, 25g. Ma ha Pho che pho thi. C. Tante de Shkya.111. Ma ha po the mo. C. Un des huit enfersfroids.3oo. Mah Pradjpat. S. ( Ma ha Pho che pho thi.) 111. P. Roi. 216. Mahpranda.
INDEX.
411
P. Roi. 216. ou Transformations Mo.C. (Mra.) 247. Manifestations Mahpratpa. - putte -Tissemahastewira. deBouddha. Mah rdja tgri. Mg. Les gar335, 347. Moggali 320. diens des quatre rgions du Ma ni pa tho.C. Gnie.i4i. Sg.Personnage religieux. Mantchucheli. C. (Mandjous'ri.) Mohany. Rivire.22.4. monde. 311. Mhdhtoudip.Mg. Un des quaMahratha. S. Roi. 71. 114. tre Continents. 82. Mahrurava. S. Un des huit en- Manyun. C. 5i. Mohi yan tho lo.C. Saint personfersprincipaux. 3oo. Mapamdala. Md. Lac. 87. Mahsammanta. S.Pioi.214, 216. Mra. S. Chef des dmons.246, nage.25g, 34o. Moho pi ho lo. C. ( Mahavihra.) Mahasana. 247, 270, 274, 288. Sg. Roi. 345. Mahsatwa. S. Nomde Shkya Marakata.S. (Emeraude.) 34o. gi. = Nomd'unechapelle. ant- Mrgas'ira. S. Roi. 23o, 247. dans une desesexistences 35o, 352. rieures. 71. Margisiriamogolangouiledouk- Mo ho sengtchhi. C. Recueil des tchi. Mg.Roi.23o. Mahsthnaprpta.S. Titre d'un 3i8, 31g et suiv. prceptes. 120. Bodhisattwa. Matanga. Sg. Une des manifesta- Mokiali kiu che li. C. Hrsiartionsde Bouddha.34g. Mahtchakravarti que. i4g. radja.S. Roide Ma teng. C.Samanen. MokiathoetMokithi. C. Royaula roue. 131. 44. cit. me. 2i3, 24o, 253, 206. Mahavihra.S. Divisiondes doc- Ma tengkia king.C.Ouvrage trines bouddhiques. 186. Mokshadeva. S. Religieuxde la 34o. Ma tho lo.C. Secte.157. =: Nomd'un monastre.352. petitetranslation.n4. Molokiali. C. Unedesseptchoses Mahyna.S. La grande transla- Mathour.S. Ville.102. tion. 1o, 114. 90. My. P. et Ma ye. C. Mre de prcieuses. Molokiatho. C. (Emeraude.) Mahendra.S. Saint personnage. Shkya.70, 216. 91. Mehou tseu.C.Samanen. Mondes 43. (lesdix). 11o, 321. 259, 34o. Mahsa.S. Dieu.i36. Mendiants bouddhistes. 60. S. Disciplede ShMngalyna. S. Ciel. i46. Mengkili. C. Ville. 52, 53. Mahs'waravasanam. kya.213. Moni. C. (Joyau.) go, 328, 331. 12,3, Mengsan. C. Roi. 5. Mahoraga.S.Etresfabuleux, Meou pho l ki l pho. C. Une Montagne sans crainte.Monastre. !38, 161. Mahoulo kia.C.Idem.123, 161. des sept chosesprcieuses, 332,342. go. Ma ho yan ouMo ho yan. C. La Miaochen.C. Princesse.121. de neige. 3o,31, 96,g7Montagnes gg, 102. grande translation. 101, n4, Michase. C. Unedes classesdes Motheoulo.C.Royaume, 3i8. Mo thian ti kia. C. Saint personprceptes.326, 35g. Ma i cheoulo. C.Dieu. i4o, 157. Mietchang.C. Ceuxdontlesdisnage. 32, 59. Motikia. C.Saintpersonnage. 21, 79. Matreya.S.Saintpersonnage. putessonttermines.327. Mi le Phou sa.C. Saint person- Mots 33, 4s, 71, ig7, 278, 323. (lessix). 153. gnrateurs Makie. C. Poisson.354nage.3o, 33,35, 3o5, 35i, 358. Mouho. C.Rivire.802. de ShMala nankouei.C.Samanen. 43. Milieu(royaume du). 45, 60, gg, Moukian lian. C. Disciple Ma li tchi.C. Divinit.i43. io4kya.32, 68. Cf.Moulian. Manao.C. (Agate.)go. de Mingpo lo.C, Undes huit enfers Moukti. S. Affranchissement l'me.9, 92. Mandhta.P. Roi.216. froids. 2gg. lian.C.Disciple deShkya. 1o 1, Mandjou ghcha.S.Le mmeque Mingse.C.UndesdouzeN'idnas. Mou le suivant.115. 107, ii3, 124,131, 262, 272. 287. S. Saint personnage. Mingti. C.Roi.36, 44. Mouni.S. (Repos.) ig4. Alandjous'ri. P. Roi. 216. 21, 71, 114 et suiv.260. Ming tsu. C. Lemmeque Ming Moulchala. P. Roi. 216. S. Disciple de Shse. 287. Moutchalinda. Manggalyam. clbre. Motchi lin tho. C.Lac. 2go. kya.68, i3i. Mingzan.T. Personnage C.Roidesdmons.247. bkourva.T. Roi. 214. 3io. Mowang. Mang-pos Moyu. C. Monastre. Mani. C.etMan'i.S. (Joyau.)go, Mithila.S.Ville.216. 54. 80. 33.. Mi tho kins.C.Livresacr.3.23. My to.C. (Vextinction.)
'I.
412
FOE
KOUE
KL
rNa bha tsian.T. Pioi.2i4. Nad Ks'yapa. S. Converti par Shkya.2g2. Naga.S. Dragons.i38, 161, 34o. Nagakochouna.S. Saint personnage.15g, 162. g.Nagh h.dzogh.T. Roi.215. Nachadhika.S. Une des douze observances. 62. Naman takil. Mg. Les huit emblmes. 28, 3n. Narakas. S. Beautsde Bouddha. 210. Naissances (les quatre). 228. Nakialoho.C.Royaume. 8g, 355. Naki.C. Royaume. 4:5,85, 88. Nalo. C. Pays. 262, 264. S. Un des douzeNiNmaropa. dnas. 287. de la famille Nanda.S. Personnage des Shkyas. 211 et suiv. = Roi. 23o, 269. Nanthi ho lo. C. Personnagemythologique.20.4 et suiv. 219, -'32. Nantho. C. Personnage de la famille des Shkyas. 198, 2o3, 211et suiv. Napi kia. C.Ville. ig2. Naraka.S. Les enfers.3oo. Narandzara.Mg.Rivire.224. Narapati,S. (Lechefdeshommes.) 82.
S. Dieu. 137, 153, i56, Nryana. ' i57: ^ T.Classe de saintspergNas-hrtan. 32. sonnages. rNa va tchan. T. Prince. 214. Nayeoutha. C. ( Billion. ) 119. Neouthan. C. Royaume. =Prince. 2,5. Idzian.T. Cheval de ShsNgaghs kya. 232. Nga. C. Un des douze Nidnas. 286, 287. clbre. Ngangzen.T. Personnage 3io, 3i2. S. Naissance. 3i 1. Nichpana. Nidna.Unedes classesdeslivres sacrs..822. NidnaBouddha.S. 122, i65. Nidnas(lesdouze).S. Conditions de l'existence. 91, g5, 165, 286 et suiv. Ni rghial. T. Saint personnage. 264. Nifeoulo wang. C. Undes anctres de Shkya.2o3. Ni houan. C. (L'extinction.) 80, 166, 235, 238,335. Ni keouliu. C.Arbre.198, 218. Ni kian tho j thi tseu.G.Hrtique. i5o, 157. ennemi Ni kian tse.C.Personnage de Shkya.262. Ni kian tseu. C. Secte. 167. S.Rivire.224,277,3o5. Niladjan.
Nlntchana.S. Rivire.224. Ni lay feouto. C. Un des huit enfers froids. 29g. Nili. C.Ville.255, 261. Ni lian et Nilian chen. C. Rivire. 17g, 224, 284, 289, 3o5. Nimalo thi. C.Dieu.68.' Ni mo.C.Prince. 118 et suiv. Ni pan. C. (L'extinction.) 58,324. Ni pan king. C.Livresacr.327.. Nipouna.P. Roi.216. P. Rivire.224. Nirandjanam. Nirandjara. Mg.Rivire.224. Nirarbouda.S. Un deshuit enfers froids. 29g. Niraya.S. Les enfers.3oo. S. (Incarnation.) Nirmnakya. gi, 264. Nirvn'a.S.(L'extinction. ) 80, 137, i56. Nirvn'ade Fo. 237 et suiv. Nisa khi. C. (Abandonner.)io5. Nisbana. 311. Mg. Naissance. Ni tho lo. C. Unedes classesdes livressacrs.322. Nitseu pou to. C. U11 deshuit enfers froids. 29g. Noubgii Balang bdjoddwp.T. Un des quatre Continents.82. Nounghioueti yo.C. Un des enfers. 2g7. S.Arbre.67, 18g,218. Nyagrdha. S Nomd'un systme. Nyya. 3og.
O Observances 60. '0 liu yi. C. Les douzemauvaises (lesdouze). OEldzaitou tsoun.Mg.Undeshuit actions.3oo. emblmes. 3i 1. Ombre de Fo. 45, 87, 94. '0 feoulo ou'0 pouto. C. Undes Ommani padmhom.T. Formule huit enfersfroids. 29g. d'invocation.118., Oghadjitouarsalan. Mg. Prince. 0 pi. C. Personnageclbre.262, 2o3. 267, 3io. de l'). 21. 'O. po po. C. Un des huit enfers Oignon (montagnes Okkkaba. P. Roi. 216. froids. 29g. Okkkamouka. P. Roi. 216. Ortchilong i ebdektchi. Mg. Un Olana ergudeksenkhagan. Mg. des troisBouddhas dela priode Roi.214. actuelle.192, 3i2.
letkouktchi. Mg. Dieu. Ortchilong i3g. '0 tcha tcha. C. Undeshuit enfers froids.2g9Otchirbani.Mg. Saint personnage. i4o, 23g. Ouche yan na. C. Pays.176. Oud. S. Personnage del famille des Shkyas.211. Oudna. S. Une des classesdes livressacrs.12, 332 et suiv. Oudasi.S. Roi. 2.5g.
INDEX. S. Pays.176. Oudjan. Oudoumbara. S. Arbre. ig5. S. Pays.3i, 46, 47,353. Oudyna. Ouhou et Oui. C.Royaume. 7, i5. i5. Ouigours. Oulan mouran. Mg.Rivire.5'., S.UndesNidnas. 288. Oupdna. des Oupades'a.S. Une des classes livressacrs.322. S. 325. Oupagoupta. Oupali.S. Disciple deShkya.216 et suiv.24g. 325. Oupa'si.S.Saint personnage. Oupsika.S. (Fidles-.) 67, 123. Oupaya.S. Un des six moyensde salut. 71. Oupayi.S. (Femmes pures.) 180, 181, 182. Ou pho so kia.C. (Oupsika.) 181 et suiv. Ou pho ssekia.C. (Oupayi.)182. P. Roi. 216. Oupobatha. OurounaUkerdlektchidip..Mg. Un des quatre Continents. 82. Ourouwilwa S. Converti Ks'yapa. par Shkya.2g2. . P Padjpat.P. pousede Souddhdana. 216. Padma.S. (Nnuphar Undes rouge.) huit enfersfroids.29g. Padma pni. S. Saint personnage. 21, 117 et suiv.i36. S.Unedessept choses Padmarga. prcieuses,go. Padmatchenbb.T. Roi. 22g, 23o. Padmavati. S.Ville. 25g. Padouma.P. Un deshuit enfers froids. 2gg. Paktchhou.T. Fleuve.37. Pal. S.'(Corail.)go. Pa lian fou ou fo. C. Ville. 253, 256, 3o5 et suiv. Palibothra. Ville. 256 et suiv. Paloucha. C.Ville. 78, 84. Pa nan tho.C. Dragon.168. Pan jo pho lo mi to. C. Livres sacrs.10g. Pannihouan.C. (L'extinction.) 76, 80, 171, 17g, 238, 3i8. Pan ni phan. C. 80. Pantchla.S. Le Pendj-b.g8. Pantcha pra Pat'ha. P. Les empreintes du pied de Bouddha. .34i. Pan tche. C. 262et suiv. Pan tche yu sse. C. Crmonie bouddhique. 26, 27. Paochi.C.Monde.115. 118. Paoha.C.Saintpersonnage. Pao ingjou la.C.Nomd'un Bouddha. 115.
415 Ou siun.C. Peuple. 3g. Ousouman.C.Gnie.282. Ousun tchhang.C. Pays.46. Ou tchang.C. Royaume. 45, 46. Ou tchang na. C. Pays.47, 59. Oulchha. C.Pays.46, 5i. Ou tho yan na. C. Roi. 3i3. Outsan pho lomen. C.Arbre.1go. OuttaraKourou. S. Undes quatre Continents. 81. Outtarasnght'i.S. Vtement.g3. Oxus.36.
Pao tsang. C. Saint personnage. Pellelup.Sg. (Pt'alipoutra.) 320. 118. P lun. C.Livrebouddhique.15g. Pao yun. C. Samanen. 2,6, 77. Pendj-b.g8. Pardhimkcha.S. Lieu clbre. Pen sing. C. ( Nature primitive. ) 21g. 287. Pramita. S. Les dix moyensde Pen sse.G.(Affaireprimitive.) 322. salut.6. Pensse phin. C. Livresacr.322. Paranirmitavas'avartit. S. Un des Pe Thian tchu. C. L'Inde du nord. 3i. tagesdu ciel. 247. Parasvati.S.Dieu. i36. P tsi. C. Pays.43. Parc des cerfs de l'Immortel, lieu P tsing. C. Roi, pre de Shkya. consacr.3o4, 307. 70,72, 78, ig8, 202. Pari nirvn'a. S. 80, 238. Voyez P'halgou.S.Rivire.224, 277. Nirvana. Phan jo pho lo mi. C. Un des dix P. Roi. 216. Parisandjaya. moyensde salut. 101, 114. Paswaga Mahanounansi.P. Les Phan tchao.C.Gnralchinois.3g. cinq grandsprtres. 3io. Phengla. C. Montagne.4g. P ta ling th ming hao king. C. Phi che li. C. Royaume.24o, 242, 244,35i,353. Ouvragecit. 180. a4o. Pt'alipoutra.S. Ville. 256 et s. Phi neou.C. Royaume. 3o6, 32i. Phing cha. C. Roi. 67, 23o, 262. Patcheka Bouddha.P. Classede Phing wang.C.Roi. 35, 42. Phi siun.C. Roi des dmons.26g, saints. i64. Pa tche lo. C. (Lediamant.)gi. 270. Phi yu. C. (Comparaison.) Pa thi. C.Prince.2o3. 322. Pho fou. C. Personnageclbre. Patna.S.Ville. 267, 25g. 3io. Ptra. S. (Pot.) 83. Pchs (les huit) des religieuses. Pho kian. C. Temple.5i. 112. Phokian lo pho. C. Royaume. 2 lo. Pfan.C. Roi. 78, i85, 2o3. Pho leou.C.Arbre.5o. Pe tchhi. C. Coquilles-monnaie. Pho li. C. Unedes septchosesprcieuses,go. 106 Pholo. C. Pays.83, 84. Pe tching.C. Roi.3o8. Peto.C. Arbreconsacr. 276,2go, =Femme qui offritdu riz Bouddha. 290. 2g4, 3oi, 333, 343.
kl II Pho lo i. C. (Corruption.) io4 et suiv. Pho lo men. C. ( Brahmanes.) 186. Pho lo n. C. Rivire.307. Pho lo na. C,Ville. 3o4, 307. Pho lo ni mi. C. Dieu. 67. Pho lo pho.C.Gnie.18g. Pholo thi moutcha.C.Prceptes. 1io. = Lieu clbre.21g. Pho lo thi thi cheni. C.Classede prceptes.io5. Pho lo toulou. C. Pays. 52. Pho lo yu. C. Monastre de la Colombe.3i4, 316. Pho so. C.Prince.2o3. Pho sse no. C. Roi. 171, 178. Pho tho. C. Une des classesdes livressacrs.322 et suiv. Pho ti ho. C. Rivire. 287. Phi)ti kia.C. (Cristal de roche.)37. Pho to. C. Kalpades sages.70. ,Pho to li tsu. C.Ville.256 et suiv. 28. Pho tso fou lo. C. Une des classes des prceptes.326. Phou li. C. Pays. 24. Pho li. C. Pays. 5i. Phoulwari.S. Ville. 26g. Phou sa. C. Classede saints personnages.17, 20, 65,67, 120Phou thi thang. C. ( Estrade du Bodhi.)286. Phou wangJou la. C. 1A4. Pho y thi. C. (Tomber.) io5. Pliyough na rdor rdzie.T. Saint personnage.23g Pic d'Adam. Montagne.34i Pi cha men.C.Dieu. i3g. Pi che. C. (Vais'ya.)186. Pi che khiu.C.Saint personnage. 173, 183. Pi che tche.C. Dmons.i4o. Pi chi. C. Hrtiques.57, 167. Piedde Coq(montagne du). 3o2. Pi folio. C. Une des classes des livressacrs.323. Pi khieou.C. (Mendiants.) 45, 60, 180, 181,327. Pi khieouni. C. (Mendiantes.) 101, 111,1 80, 1S2, ,827. 1i leou.C. Gnie.193.
FOE
KOUE
KL Pou'nd'arka.S. (Nnupharblanc.) Un des huit enfersfroids. 2gg. Poun'ya.S. (Pur.) io3. Pourn'a.S. 323. Pourout. S. Pays.51. Porvavideh.S. Un des quatre Continents.81. Poussa.VoyezPhousa. Poussires (lessix). 287. Poutraka. S. Lgenderelative ce personnage.3o6. Pou tsi tho. C. Saint personnage. 69. Prabla.S. (Corail.)90, Pradigaboud.Mg. Classede saints. 164. Pradjn. S. (La science.) i4, 71, n3, 282. Pradjn pramit. S, Livressacrs. 109, 1i. Pramit. P. Princesse.216. Pranada.P. Roi. 216. Prasendjit.S. Roi. 178, 187. Pratpa.P. Roi. 216. = Un des huit principaux enfers. 3oo. Pratimoksha.S. Prceptes.110. PratyekaBouddha.S. (Intelligences distinctes.) 9, 10, g'i, 95, 122, i64, 327. Prceptes (lesdix).io4--Prceptes Ibid. Troissortesde suffisants. prceptes.110. Diversescollections desprceptes. 318 et suiv. 325. Prceptes(la tour des). 101. Prcieuses (les septchoses).71, 89 et suiv. Prcieux (les trois), ki, i5g, 3oo et suiv.323. Prsages (les trente-deux). 221 et suiv. Prlh. S. Dmons de la faim.110. Prithv. S.Divinit.i36. Procdsrespectueux (les huit). 11i et suiv. des images.17, 20. Procession Puissance surnaturelle. 32. Pylieou li. C.Roi.:187. Py lou tsc kia. C.Roi. 187. Py tchi Fo ou Py tchi kia lo. C g4, g5, 163 et suiv.
Pi leou le tcha. C. Dieu. 13g. Pi lieou li. C. Dieu. 13g. Pi lieou po tcha. C.Dieu. i4o. Pilomalo. C. Ville. 176. Pi lo tchi. C. Mrede Chan tche ye. 149. Pi lou chy kia. C. Personnage mythologique.56. Pi na ye.C.Unedes classes des livressacrs.108. P. ( Mendier sa nourPin'd'aptika. riture.) 60. Ping tou tcheou.C. Ville.366. Pi ni. C. Prceptes.110, 325. Pin po solo. C.Roi. 67, 23o. Pi phao tha. C.Sortede tours. 91. Pi pho chi. C.Nomd'un Bouddha. Pi pho lo et Pin pho lo. C. Lieu. 272, 273. Pis'ouna.S. Roi desdmons. 270. Pil'aka.S. Signification de cemot. 3,78, 108. Pi tchha ouPi thsa. C. Royaume. 98. Pi thsiu et mieux Pi tsou.C. (Mendiants.)60, 181. Pi tsou ni.C. (Mendiantes.) 182. Po. C. (Pot.) 83. P lo si na chi to. C.Roi. 178. Po lo so. C. (Corail.)go. Po lou lo.C. Pays. 5g. Po ma lo kia. C. Une des sept chosesprcieuses,go. Po mao.C. Ville. 83. Po na. C. Royaume.g6, g7Pot de Fo.27, 76, 82, 284, 351, 353, 356. Potala.Ville. 214. Po teoumo ouPo the mo, C. Un des huit enfers froids. 2gg. Pthi.C. Personnageclbre.31o. = Chapelle.335, 3 4g. Arbre. 224. Poto lo.C. (Pot.) 83. Pou.C.Une des classesdes livres sacrs.321. Pou chi. C. Un des dix Pramit. 27. Pouchtikher.Montagne.2g. Pou hiuan. C. Prince. 118, 11y. Poukia loung. C.Ile. 364. Pou na. C.Rivire,gg, 102.
INDEX.
415
Rlia. S. (Lefeu.) g2. Iurava. S. Un des huit enfers Rab dvangphyoughou Rabvangprincipaux.3oo. tchouk.T.Roidesdmons.3.47. Ravi. Rivire.98. Rachiyan ideghetou. Mg.Roi.2o3. Rawanhrada.S. Lac. 37. Racines Ralits(les quatre). 16g. 208 et (lessix). 287. suiv. Rdjagaha.Sg. et Rdjagrha. S. Ville. ii5, 202, 216, 266, 3o5, Repas (temps pour les). 107. 320. Rvolution (la grande et la petite). Pikchasi.S.Dmonsfemelles.33g. VoyezTranslation. Rama. 176, 228. Riddhi.S. Puissancesurnaturelle. S. Saintpersonnage. 246, 248. Ratnagarbha. 118. Riddi khoubilgan.Mg. Puissance Ratnkara. S. Saint personnage. surnaturelle. 32, 2.48. 118. Rishabna.S. Secte.i5i. Ratneya.S. Monde.115 Rodja.P. Roi.216. S Sa. S. (La pense.)92. SabbekamiYasa.Sg. Personnage religieux.320. Sadnand.S. Unedes femmesde Shkya.2o4. Sgara.S. Roi des dragons.i43, 161.Cf. 202, 216. Sa ghim. T. Prince. 215. Sabasra,S. 210. Sa ho sa. C. 210. Sa.C. Peuple. 3g. Sanbousou nidoutou.Mg. Dieu. i4o. S'akra, S'akrardjaet S'akradeva. S. (Indra.) 263. Sakridgm.S. Classede saints. 95, i64. Sala.S. Arbre. 236, 283, 2go. Saltchan. Mg. Roi. 178. Samdhi.S. (L'extase.)25i, 265. Samana.P. (Samanen.) i3. Samana kouta et Samanhela.Sg. Montagne.34i. S. Un des trois Sambhogakya. tats de Bouddha.191. S.Un deshuit enfers Samdjvana. principaux.3oo. Samght.S. Un des huit enfers principaux.3oo. Samkassa.P. Pioyaume. 128. San tsang f sou.C. Ouvrage boudSamyuktgama.S. Livre sacr. dhique.10g. Sa 327. pho. C. ( Marchands. ) 334 , S. Livre sacr. 344. Samyuktanikya. 320. Sa pho to. C. Un desrecueils des Sandjaya.S. Hrtique.i4g. prceptes.318, 325. Sanga.S. Nom collectif des reli- Sapta Bouddhastotra. S. Ouvrage cit. ig3 et suiv. gieux. 8, 15g.Division des Sangasen quatre classes,g. Saques(les). Peuple.3g. Undes troisPrcieux.42, 3oo. S'radwatiihou et S ri bon. T. S. (Monastres.) 19. Sanggram. (S'ripoutr. ) 264. Sanghl'i.S.Vtement des Boud- S'aril.Mg. (S'arira.) 228. dhistes. g3. S'ripoutr. S. Disciplede Shkya. Sang men. C. Le mme que Cha 107, 266, 264 et suiv. men. i3. S'rira.S. (Reliques.) 7g, 191, 217. Sa ni. C.Gnie.1g3. 228, 24o. 344. Saninktenikaya.Sg. Livre sacr. Srthavha.S. (Marchands.) 320. Sarvakmi Yas'a.S. PersonnagereSankhya.S. Secte.i5i, i52, 157. ligieux.320. San mi ou San me.C. (L'extase.) Sarvrtha siddha. S. NomdeSh79- 260. kya. 20.4,225. San mo ye. C. Tempspour les Sarvastouti. S. Une des femmesde repas. 107. Shkya.2o4. Sansra.S. (La matire.) 228. Sa so cha ti. C.Monastre.55. Sanskra.S.Undesdouze Nidnas. Sa tchi ou Sa tchi sieou ma. C. Dieu. i4o. 287. San tsang.C.Collectiondes livres Sa tho. C. Nom de Bouddhadan.' une de ses existencesantrieureligieux.8. Valeurde celte Ibid.108, 24g. res. 48, 78. expression. Rohini.S.Rivire.201, 202. Roisde la roue. i34 et suiv.295. VoyezTchakravarii. Roisdu ciel (lesquatre).i4o. Rooroomaga. Sg. Unedesmanifestationsde Bouddha.34g. Pwuesbouddhiques. 27, 28, 181 et suiv. 17g. Faire tourner la rouedela loi. 225. Ropa.S. (Lecoqis.)287. Ropya. S. Une des sept choses prcieuses. 8g. Ropyavatchara.S. Lemondedes formes.136. Routchi.P. Roi. si 6.
416 Satlwa.S. Le mme que le prcdent. 75. Sugandhika.S. Un des enfers froids.2gg. Savaloka. S. Monde.116, 136. Sectes. 53, i52. Seghersandalitoukhagan. Mg.Roi. 23l. de ce mot. 8, Seng.C. Explication i5g. =Un desdouze Nidnas. 286,288. = Un des troisPrcieux.3oo et suiv.324. Seng chao.C. Compagnonde Fa hian. 2, 6, 22. 19. Sengfang.C. (Monastres.) Senggheh,ghram.T.Prince.2o3, 215. Sengkia.C.UndestroisPrcieux. 43. = Secte.187. 24,128. Scngkiachi.C. Royaume.1 Sengkialan. C. Sorte de monastre. 16, 17,353.Explication de ce mot. 19, 168. Seng kiali. C. Manteaudesreligieux.45,4g.deFo.86, g3. Sengkia lo. C. Royaumede Ceylan. 33o, 33g. = Prince.338 et suiv. Sengkia po chi cha. C. Une des classes des prceptes.io4, io5. Sengkiali. C.Lammechoseque Sengkia li. g3. de Fa Sengking. C. Compagnon hian. 2, 6, 77. Se pho ti kia.C. (Cristal de roche.) 90. Spultures (lesquatre).353. Ser s.kya g,ji ou Ser s,kya 200. ghrong.T. Royaume. Riwre.g8. Sctledj. S. Nomd'unancienBoudSlikya. dha. 345. =r Nomde familled'unBouddha. 161. terrestre. Shkyamouni.Bouddha dans 20, 186. Saprdication le royaumede Kapila. 67. Principalespoques de sa vie. 68 et .^uiv. 7g, ii5, 124, ig8, 201.220,225,23s, 235,275et
FOE
KOUE
KL Sinhahna kabn. P. Prince.208. Sinhala. S. Royaume de Ceylan. ' 320. = Prince.338 et suiv. Sinhndandi.S. Saint personnage. 160. Sinhsana.S. (Trne du lion.)188. Sinhavhana. P. Pioi.216. Si ning fou.C.Ville.5. Sin lo.C. Pays.43. Sin theou.C. L'Inde. 24. = Le Sind, fleuve. 35, 36, g6, 97>102Si phing. C.Ville.5. S'iravasli. S. Pays.177. Sirgaldzin gol.Mg.Rivire.6. S'ircha.S.Arbre. ig3. Si tha et Si thto. C.Nomde Shkya.2o3, 2o4, 221. Si to. C.Fleuve. 37. Siumathi. C.Mauvais gnie.288. Siu mi. C. Le mme que Soumrou. 47. Siu mothi. C. Personnage clbre. 271. Siu pho fo,C.Pays.2o4. Siu p. C. Saintpersonnage.235, 23g. Siu ta nou.C. Une des manifestationsde Bouddha.335, 3 i8. Siuth.C.Patriarche.171,173,178. Siuthan.C.Personnage clbre, 271. Siu thohouan ou Siu tho wan.C. Classedesaintspersonnages. g4, ig8, 218, 273. Siu ye che. C. Personnage clbre. 271. Si ye. C. Pays. 23. Skandha.S. (Les cinqamas.) 151. Skyanar ghi bou.T. Ville.257. S'mas'na. S. (Cimetire.) 273. S'ms'nika. S. Une des douze observances. 62. Sobhanavati. S.Ville.ig5. (la). 38. Sogdiane Sokie. C. Roides dragons.13g. So kielo. C. Le mme. 161. So ko lo.C.Gnie.i43. Solo. C. Arbre.236, 283, 2go. S'on'a.S. Rivire.25y, 3o2. Soubhadra. S. Saint personnage. 28g.
suiv. 334 et suiv.346, 354 et suiv. Sa gnalogie. 2o3. 2o4, 211, 218,220, Lgendes. 23i, 237, 27g et suiv. Epoques de sa naissanceet de sa mort discutes.42, 287, 284, 335, 346. Premires rdactionsde sa doctrine. 243, 247, 320. VoyezFo et cf. p. 181, 271, 28g, 3og, 3i 1. Shkyas(familledes). 188, ig8, 2i3 et suiv. Shkyasinha.S. Surnomde Shkya. 188. S.Nomd'Indra.64. Shatamanyou. Si'an.C.Ville.Sonanciennom.3. Siang ti yo.C. Un deshuit enfers brlants. 2g8. Siaocheoulin.C.PioideCore. 43. Siao kou chy chan.C. Montagne. 263. Siaokouwang. C.RoideCore. 43. Siaotching.C. La petite translation, g. Sida.T. LeSi to. 37. Sidda ou Childa. Mg. Nom du Sind. 37. Siddha.S. (Shkyamouni.) 2o4 et suiv.221. Siddhrla.S. Le mme.i34, 2o3, 211. Sieou fan ma. C. Pre de Mi le Phousa. 34Sieoulo. C.Gnies.321. Sieou to lo. C. Classede livres sacrs. 108, 321. Shahuou. P. Prince.215et suiv. Shassara. P. Roi. 215et suiv. Sikhi.S. (Legrand.Brahma.) 145. = Nom d'un Bouddha. ig6 et suiv. 345. S'la. S. Un des six moyensde salut. 71, 110. S'lavritta.S. Monastre. 224. Shmiou ou Chimnou. Mg. Dmons.247Sind.Fleuve.36. Sindhou.T. Idem.i"]. Sing dzing khampa.T. Lemme que Sing tchou. 2g. Sing tchou. C. Branchede l'Indus. 29.
INDEX. Soudt. S. Patriarche.178. S'ouddhdana. S. Roi. 129, 2o3, 216. Soudjatawou.Sg. Offredu riz Bouddha.290. Sou fa lo. C. Unedes sept choses prcieuses. 89. Sou. C. Peuple.3g. Souillures (lestrois).324. Sou thsou thang chou mou. C. Ouvragecit. 160. Soujin. C.Explic.de ceterme. 12. Souk'hvati. S. Monde.11g. S'oukldana. P. Roi.78, 2o3. Soule.C.Khashgar. 23. Souleiman koah.PetitesMontagnes de neige.97. Soulin. C. Montagne.288. Sou ma. C.Tour.55. Soumerou. S. Montagne.47, 80 et suiv. Soung.C. (Chant.)322, 327. dans Soungyun tse.C.Sonvoyage le Ou tchang.48 et 4g, 354 et suiv. S'ounyat.S. Gnie.168. Sou pho f sou thou. C. Fleuve. 52, 53. Soup tho lo.C.Saintpersonnage. 23g. P. Prince de la Souppabouddha. race des Shkyas.216. S. Pays. 204. Souprabouddha. Souroutchi. P. Roi. 216. Soryavans'a.S.Prince de la famille des Shkyas. 214. Souta lan.C.Livressacrs.(Sieou to lo. ) 109. Soutanou.S. Une des manifestations de Bouddha. 348. South to.C. Patriarche.178. Southeou.C.Fleuve.354. Southeou pho et Soutou po. C. Tour. 53, 91. Sotra. S. Une des classesdes livressacrs. 3, 12, 108, 24g, 32i, 327. =Unedes quatrecastes.137,186. Sotra pit'aka. S. Livre sacr. 320. Soutternipataet Sotranipla.S. Livresacr.320. SouvaBouddha.S. Beau-prede Shkya.204. S. Une des septchoses Souvarn'a. prcieuses.8g. Souwarna prabhsa. S. Ouvrage cit. 75. Spars'a.S. Un des douzeNidnas. 287. S. (Cristalde roche.)37, Sphat'ika. 90. S'rman'a.S. (Samanen.) i3, 3o8. S'rvakas.S. (Auditeurs.) 9, 10, 91,1 22, 161,218,327. S.Ville.177. S'rvasli. S'renka.S. Roi. 229. S'ri.S. 115.
417 S. Personnageclbre. S'rgod'ha. 267. Srivasta. S.Undeshuit emblmes des neufBodhisattwas. 3n. S'rotpanna.S. Classe de saints personnages. g4, i42, i64, 218. Sse fen liu. C. Les quatre sections.10g. Ssena. C. Lieu et personnage clbres.282et suiv. Sse pe. C. Les quatre troupes. 180. Sse pou. C. Les quatre classes. 180. Ssethohan.C.Classe de saints.g5. Ssetseu koue.C.Ceylan. 33o. Sthaviravda. S. Livresacr.320 . Sthopa. S. Tour. g, 53, 91. clbres. 55. Sthopas Siho to. C. Royaume.45, 64. Sukkodana. P. Prince.216. Sun to li. C. 173, i83. S. Rivire.286. Swarn'awat. Swastika. S.Croixmystique. 23o. Sytchang. C. (Btond'lain.)93. Sy tha. C. Le mme que Si tha. 2oi et suiv. Szu.C.UndesdouzeNidnas. 286, 288. Szu chy eul tchang king. C. Ouvragebouddhique.264. 24o. Szukia na pho.C. Royaume. Szutsu ki wang.C. Prince. 2o3, 2l5.
T Ta 'ai. C. Personnage.184. Ta 'ai tao. C. Tante de Shkya. 111, 198. Ta chen sengWang. C.Undes anctresde Shkya.2o3. Tadjiks(les). Peuple.39. Toegri. Mg. Lesdieux. 21, i38. Ta fang Fo hoa yen. C.Livresacr. 327. Tagoutsilaniraksan. Mg. Un des titres des Bouddhas.gi. Ta hia. C. Les Dahoe. Peuple.38. Ta Kiaowen ti yo.C. Undeshuit enfersbrlants. 298. Ta kouangming. C. Nom d'un Bouddha.161. Tla. S. Arbresacr.2go. Tamalipti, Tamalilti et Tamralipti.S. Ville.33o. Ta maothsao.C. Roi.3o8. Tamlouk. Ville.33o. des Tamoghna.S.Unedes classes 325. prceptes. TanouTanna. S. (Aumnes.) 6. Tangsouk ideghetou. Mg. Roi. 2o3. Tan mo ly ti. C. Pioyaume. 32g. Tan the. C. Montagne.48. Tantra.S. 323. Tan woute ouTan mo khieouto. C. Une des classesdes prceptes.325. Tan youe. C. Explicationde ce mot. 5, 365. Tao'an. C.Nompropre.3. de ce ternie. Taojin. C. Explication 22, 98,367. Taoli (cielde). C. 124, 128. Taosse.C.Secte.22, 227, 23o. Taotching.C. Un des compagnons de Fa hian. 1, 4, 16, 45, 77, 172,319. 53
418
FOE
KOUE
KL Tchi tho oit Tchi to. C. Temple. Tchi tsy.C.Saintpersonnage. 322. Tchi yan. C. Compagnonde Fa hian. 2, 6. Tchoufa lan. C. Samanen. 44. Tchoungho.C.Undeshuit enfers brlants. 2g8. Tchoung koue. C. Royaume du milieu (l'Inde centrale).60. Tchouri.S.Undeshuit emblmes des neufBodhisattwas. 311. Tchu.C. Poids. 147. Tchcha chi lo. C. Royaume. 74. Tchukiu pho ouTchukhiu phan. C. Pays.23 et suiv. Tchu yi. C. Vtement.147. Tchy mang.C. Nompropre.3 S. Pays.74. Tchyoutasira. Tegolder amourliksan.Mg. Saint 248. personnage. Tejo. C. Pays. 24. Temples( Tsing tche ). Les cinq 185. principaux. Teng ching.C.Roi. 68. Teng h ti yo. C. Un des huit enfersbrlants. 2g8. Teou. C. Boisseau; sa capacit. 84. Teou chou.C. Le mme que Teou sou.35, 357. Teouseou pho.C. Tour. gi. Teousou ouTeou sou tho. C. Un des tages du paradis.3o, 33. Terre.Sa division,suivantles cos80. mographies bouddhiques. Ters. Mg.Hrtiques.225. T tchang.C. (Bton.)g3. Th. C.Tour. 19. Thabbral. T. Dieu. i44. Tha li lo. C.Ruisseau. 52, 5g. Tha mo. C. Un des trois Prcieux. 43. Tha mo in tho ho sse. Roi de Outchang.Sa lettre l'empereurde la Chine.52. Tha mo kiu ti. C. Saint personnage. 336. Th thsen. C. Royaume. 3i4, 3i5. Theou chy. C. Sorte de pierre. 307.
Tapa.S. Undes huit enfersprin- Tchaotchy ti yo. C. Un des huit enfersbrlants. 2g8. cipaux.3oo. Tpsdjuye. Lgenderelative ce Tchaoya. C. (Java.)365. Tcha phi. C. (Combustion.) 24o. personnage.291. S. Pnitent. 157. Tcharaka.P. Roi.216. Tapasvi. Tapasvimouni. S. Saint person- Tchatrapati.S. Le chef du para sol.82. nage. 208 et suiv. Ta pe.C.Livresacr.327. Tchaylang ti yo. C. Undes seize Ta pe Phou sa.C. 121. enfers.2g7. Ta pho. C. Synonyme de slhonpa. Tche lo kia lo. C. Royaume. 24o. Tchenpho.C.Royaume. 328,32g. 91Ta Tchao tchy ti yo. C. Un des Tchen tcha lo. C. Secte. 100, huit enfersbrlants. 298. io5. Ta tchi chi. C. Titre d'un Bodhi- Tchentche mo na. C.Sonaccusation contre Fo. 174, i83 et sattwa.120. Ta tching. C. La grande transla- suiv. Tchen tho lo. C. Le mme que tion, g. Ta tchoung.C.Secte.53. Tchentcha lo. io5. Ta tchy tou lun. C. Livre sacr. Tcheou.C. Coude. i48. =Une des classesdes livresreli327. Ta te. C. Pre de Keou na han gieux.327. meouni Fo. ig5. Tche pho. C. (Java.)364 et suiv. Tathgata. S. Un des titres des Tchetiya.P. Roi. 216. Bouddhas. des 4g, 7g, 115et suiv. Tche tokia.C.Unedes classes 1g1.Formules desTathgata. livressacrs. 322. 18g et suiv.ig3, ig5. Tchhang'an. C. Ville. 1, 3, 362, Ta thoung ho. C. Rivire.5. 367. rerTa toi. T. Personnageclbre. Tchhanghouan.C.Personnage 310, 3i 2. ligieux.18.4. Ta wan. C. Pays, le mme que Tchhang kouang kiun. C. Ville. 36i, 366. Farghana.38. Tchhesse.C. Peuplade.8. Tcha che ma li. C. Arbre.162. Tchhe ti. C. Edificeclbre.272, Tcha.C. ( Djeuner. ) 107. 274. Tchatya.S. Tabernacle.19. Tchakra.S. (Roues.) Tchhouan.C. 28, 17g.Voy. (Roues.)28. Pioucs. Tchhu. C.Un des douzeNidnas. Tchakravarti. S. Roisde la roue. 287. Tchiche.C.Nomd'un gnie.18g. 28, 82, i3i et suiv. Tchi houan.C. Temple. 171 et s. Tchamp.S. Ville.32g. Tchanakya.S. Nom d'un Brah175, 178, 17g, 3i8, 321. mane. 23o. Tchikholaaktchi.S.Saint personTchandagouttaP. et Tchandranage. 248. Tchinb. Rivire.g8. goupta.S.Roi.23o. Tchan'dls. S. Secte.io5. Tchin choukia.C. Arbreet pierre Tchandamoukha. P. Roi.216. prcieuse,go. Tchandim. P. Roi.216. Tching.C.(Translation.) Significacheou.C. Prince.3o8. tion de cemot. Tchang g. Tchang kian.C. Gnralchinois. Tchintchha, Tchin chaou Tchen dans che. C. i83. 14, 35. Sonexpdition l'Asiecentrale. 37 et suiv. Tchin yu. C. Vtementdes reliTchangy. C. Pays.2, 5. gieux.281. Tchaosian.C.La Core.i4. Tchi tchang.C. (Bton.)g3.
INDEX. Theoutho.C.Lesdouzeobservances des mendiants. 60. Thi. C. (Dwpa,le.) 81. Thian.C.Lesdieux. 21, i38. Thian sse.C. Templesdes dieux des Brahmanes. 185. Thiantchu.C.L'Inde.i4, 3g,319. = Dieux matresdu ciel.218. Thiantou? (Thiantchu) [l'Inde]. i4. Thiaoth. C.Ennemide Shkya. 17i, 175, i85, 2o3,211et suiv. 269, 271, 272, 274. Thi che.C.Gnie.18g. Thi ho 'we.C. Pays 68, 92. de ce Thing tha. C. Explication terme. 91. Thi pho th tou.C. Le mme que Thiaoth. i85, 271. Thi theou la tho ou Thi to lo tho. C.Dieu. 139. Thi ting ti yo.C. Un des enfers. 2g6. Thi wanli yo.C.Un des seizeenfers. 2g7. Tholo. C.Temple.5o. Tholo ni. C.Livressacrs.10g. Tho ly. C. Royaume.(Darada?) 3o, 3i. i3o. Thoung.C. (Intelligence.) = (De'sir. ) UndesNidnas. 287. Thsayn. C.Samission dansl'Hindoustan.44. T. (Brahma. Thsangs-pa. ) 187. Thsin (la terre de). La Chine.7, i5, 343. Thsin occidentaux, 4. dynastie. Thsin. C.Un des douzeNidnas. 286, 288. Thsing.C.Rivire.4. Thsingtcheou.C.Ville.362, 366. C.Fodansune de ses Thsingyan. existences antrieures.183. Thsin king.C.Lettrclbre.4i. Sa missiondans l'Hindoustan. 44. Thsytchoung.C. Les sept multitudes.181. Thun houang.C.Ville.2, 6, 48. Ti. C. Peuple.3g. Tian chou kou. C. Cabinetdes affairestrangres.4o. Tiaotchi.C. Peuple.3g. Ti chy.C. (Indra.) 64, 218. Ting kouang.C. Nomd'unBouddha. 68, 86, g2. Fleuve. Lemme Tingsa-b-osteng. que Tiz-h.25. Ti yo.C.Lesenfers.2g6 et suiv. Tiz-b.Fleuve.25. Tomoli ti. C.Royaume. 328,32g. To toung h ti yo. C. Undesenfers.297. Touannie.C.Prince.5. Md.Unedesbouches Touigochal. du lacAneoutha. 37. Tou ki. C.Classede saints.i64 et suiv. Toungh ti yo. C.Undes enfers. 296. 'Tour decenttoises. 84.Tourdes Lohan.^ desPy tchiFo.87. deLanmo.227. desCharbons.235. des Arcset des armesdposs. 242. Toursou Pagodes. 16, 19, 87, 101, 110, 179. de dlivrance. 86, 91, 92. Tours 74, 75, (1rsquatregrandes). 277. Toushit.S. Undes tagesduparadis.33, i45, 357. Touwe.C. Ville.175,188. Touyya ti yo. C. Enfer desmon2g8. tagnescomprimes. S. Une desdouze Tratchvarika. observances. 61. Trangsrongtsienpo.T. Saintper20g. sonnage. et la petite). Translation (la grande decha7, g, 10.Livressacrs cune.322 et suiv.327. Trayastrinsh.S. Un des cieux 64, 128, i44superposs. deterre(causes Tremblements des). 217.
419 Triadesuprme. 42, 3oo etsuiv. Triadesbouddhiques. 21. Tribulations de Shkya (les neuf). i83, 184, 271,27g. Trichn'.S.Un desNidnas. 287. Triratna. S. Les troisEtres prcieux.42. Troupes (lesquatre).322. Tsagha ideghetou. Mg. Prince. 2o3. Tsatchu. C. Mrede Ks'yapa. 18g. rTsamtchogh grong.T. Ville.2,36. de ce mot. Tsang. C. Explication 3, 10g. Tsang (les trois). C. (Contenants.) 78, 10g,326. 3. Tsangliu. C.Les prceptes. Tsa soui. C.Vtement. g3. Tseuho. C. Royaume. 22,23,25. Tseu li. C. Anciennom du Jou la.56. Tseu ti. C. Expression explique. 91Tsiang.C. (Bouillon.) 107. Tsi chun liu in. C. Saintpersonnage.115. Tsieoufung.C.Montagne. 260. Tsin ching Jou la. C. Bouddha. 184. Tsinfan.C. pouxde Mahmaya. 12g. Tsingche.C.Temples.167, i85. Tsingfan wang.C.Roi.202. de ce Tsing tsin. C. Explication terme.25. mdonpa. T. Une des classes Tsios deslivressacrs.108. Tso.C. Peuple.3g, Tsoktsas-undjirouken. Mg. Roi. 23o. S. 21, Tsoungling. C. Montagne. 22, 25, 27, 3o. Tsuntche. C. Titre de Mou lian. 107. Tu ki. C. (Intelligence distincte.) 122.
53,
420
FOE
KOU
KL
u treltou.Mg.Dieu. i4o. Upatcharaka. Ulumtchi P. Roi.216 Utphala. S. Un des huit enfers Sg. Saint personna- Urussar. Mg.Jour de la naissance froids. 2gg. Uplisthavira. de Shkya.261. ge.320. V Va.S, ( L'eau.)g2. 323. Vda.S. (Comparaison.) Vadjra.S. (Lediamant.)gi. Vadjraatcharya.S. Laquesbouddhistes.i83. Vadjrapni.S.Personnage mytho21, i4o, 23g. logique. S. (Lapislazuli.)90. Vadourya. S. Unedes classesdes Vapoulya. livressacrs.12, 322 et suiv. S. Mrede Chantche ye. Varag. 149. Vas'li.S. Ville.178,240,244, 25i, 320, 353. Vashesika. S. Secte.i52. Vasya.S. Une des quatre castes. i37, 186. Vana.S. (Fort.)54. Vananda.S. Dragon.168. dVangpo. T. Indra. 65. Varamandhta. P. Roi.216. Varan'. S. Rivire.307. Varan'as. S. Ville.22.5,307. P. Roi.216. Vararodja. S. Classede saints. Varggatchri. i65. Vrisra.S. Roi.23o. Varoun'a. S. Divinit.i36. Vaste solitude de la). 3o4, (temple 3o6. Vatch.(L'Oxus.) 36. S.Ville.313. Vatsapattana. Vautour (montagne du). 260, 270, 3o5. Vyou.S. Divinit.136, 168. Vdan.S. UndesNidnas.287. Vdas(les). i5g.Secte des Vdas. i53, i56. Vrits (lesquatre). 10, 312. Vrits (les six). 71. Vesliet Vesaliyapouri.P. Ville. 244. Vessantara. P. Roi.216. Vtements desreligieux. 93. Vibhoti. S. Sectaires.i53. Vichn'oumitra.S. Saint personnage. 248. Vidha.S. (Oriental.)81, i43. S. Prince.33g et suiv, Vidjaya. Vidora. S.Montagne. 90. Vihra.S. Sortede temple.19, 352. w 186. Wa tao.C. (Hrtique.) Wakshou.(VOxus.)37. dedimension. We.C.Mesure 344WeouWeto.C.Dieu.i4i. Weche wen.C. Gnie.i4i. Wechi.C. Sectaire.i52. We ni. C.Jardin.220. We tho.C. LesVdas.i5g. 60. 'We yi. C.Les quatre actions. nomoun. Md.LesprWemboure ceptes.108. Wentalosina. C.Roid'Outchang. 58. Wen tchu sse li. C. Personnage 101, 114. mythologique. =Titre desBrahmanes. 253, 260. Wen w.C. Ville. 177. Widjnna.S. Un desdouzeNidnas. 287. Wilford. Ses travauxsur la gographiedesPouranas.46, 47. Wpho. C.Immortel.5i. Wou ching. C. Personnagereligieux.i84. Woukian ti yo.C. Undeshuit enfersbrlants.298. Wou liang. C. (Cent quintillions.) 119. Wou liang cheou. C. Nom d'un Bouddha.120. Wou liang thsing tsing. C. Roi. 118. 286. Wou ming.C. (Ignorance.) Wou nou.C.R.oi.68. Wou tseng nian. C. Roi. 118. Wou'we.C.Monastre. 342. Wou youan.C.Roi. 68. Wouyu. C.Roi. 55, 56, 67. Vijeya. Sg.Prince.33g. in koundi. 248. Vimaladjana Vimbasra. Bimbasra. Voyez Vinaya. S. Une des classes des livres sacrs. 3, 108, 10g, 110, 24g, 320, 325. Vinnapittaka.Sg. Livresacr.320. Vipas'yi. S. Nom d'un Bouddha. g3, ig6 et suiv.346. Vrya. S. Undes dixPramit.25, 71Visalah.Sg.Ville.(Vas'li.)320. Visatcha. S. Dmons.i4o. Vishn'ou.S. Dieu. i36. Vis'wabhou.S. Nom d'un Bouddha. 1g6 et suiv. Vtarga [les huit]. S. (Emblmes.) 28, 3n. Voies (les six). 288. Vrikchamolika. S. Unedesdouze observances. 62. Vtehirban'i.Mg.Saint personnage. 23g. Vues(lessept). i5o. S. Une des classesdes Vykarana. livressacrs.12, 322 et suiv.
INDEX. Y Yakshaou Yakcha.S. Yakka.P. Dmons.56, 123, 138, i4o, 161, 34o. Yma.S. Roi des enfers. i44, 3oo. Yamoun. S. Rivire.io3. Yna. S. (Translation.) Signification de ce mot. g, 28, i65. des quatre Yanfeouthi. C.Second 255,2g3, Continents.76,80,81, 357. Yangbadjian. T. Ville.224. Yang chi Go di ni ya. T. Saint 310, 312. personnage. Yanghi hissar.Lemme que Ingachar.25. 2. Yangleou.C.Montagnes. Yang tcheou.C.Districtchinois. 362, 366. Yan lagh s,kyes.T. Prince de la familledes Shkyas. 214. Yan lo. C.Roi des dmons.2g3, 2g6, 3oo. Yanma lo ouYanmo lo.C. Dieu de la mort. i3g, i44, 3oo. Yansse. C. Fille du roi desdragons.Lgende.57. Yaoheng.C.Prince.3. Yas'odhar. P. Princesse delarace des Shkyas.215. Ythpant'ari.P. Une des douze observances. 61. Yavadvpa.S.Java. 364. Yayangseng.C.Undes Sangas. g. Ycha, mieux Yocha. C.Dmons. 56, 123, 161. YekLinkhoa. Mg.Roi.23o. Yema. G.Roides enfers. i44. Yeou.C. Un des douzeNidnas. 286, 288. Yeoulo tho wang.C. Un des an. ctresde Shkya.2o3. Yeoupho chykia. C. (Oupsika. ) 181.
421
Yeou pho i. (Femmes pures.)C. Yodjana. S. Mesurede longueur. 123, 180,182, 322. 87, 88. Yeoupho kieouto.C. Patriarche. Yonti.Prtre bouddhique.265 et suiv. i86,325. YeouphoU.C.Disciple de Shkya. Yo po lo. C. Un des huit enfers froids.29g. 198, 216 et suiv.327. Yeoupho lo.C.Saintemendiante. Yolo leou.C.Gnie.ig5. Youan tou. C. Pour Siu theou, 124, i3i. Yeou pho se. C.-(Hommes l'Inde. i4. purs.) Youe chi. C. Le mme que Yu 123, 180, 181, 182,322. Yeoupho ti che.C.Unedesclasses chi. 76, 83. Youti, C. Gtes.78. des livressacrs.322. Yeousiun.C.Mesurede longueur. Fouiarik.Pays.25. 88. Youngdhroungpa. T. Secte.23o. Yeoutho. C. Personnage de la fa- Young sse tchhing.C.Ville.4 211 et suiv. Youtti.Peuple. 83. mille des Shkyas. Yeoutho na. C. Une des classes Yowang. C.Saintpersonnage. .822. deslivressacrs.322 et suiv. Ythsykouangmingkoung t chan Yeouthsengyo.C. Enfers.296. Jou la. C. 11g. Wang Yeouyan. C.Mesurede longueur. Yuan.C.Expression 84, explique. i65. 87,88. Yuankio.C.(Intelligences Yepholo. C. Pays.353. distinctes.) Ye pho ti. C. Royaume. et 36o, 364. 10, 122, 164 suiv.3oi, 321, Ville.24. Yerkiyang. 327. Yetcha. C.Saint personnage. 5i. Yuantchhouan. C. Ville.4Yetha. C. LesGtes. 24,.353. Yu chen na. C. Mesure de lonYintou. C.PourSintheou,l'Inde. gueur.88. Yuchi.C. Peuple.83. i4. Yn [les cinq]. C. (Imperfections.)Yu tchi ouYu ti. C. Peuple.38, 288. 76, 78, 83, 35i, 356. Y na.C. Pays. 24. Yuli (lespetits). C. 84. Ynfouti yo. C. Un des seizeen- Yuhoe.C. Royaume, 22, 25, 2g. fers. 297. Y kia lo. C. Roi des dragons. 220. Yng. C. Prince de Tchou, embrassele bouddhisme. Ykin. C. Espced'herbeodorif44rante.52. Yngkiu.C.Gnie.171, 178. Yngkiu ma lo.C. Le mme.178. Ytan yu.C. Undes quatreConYnkouang.C.Secte.53. tinents.81. Yn tho lo chilo kiu ho.C.Mon- Yu theoulan fo.'C. Lieu clbre. 234. tagne.263. Ynyuan [les douze]. C. (Condi- Yu thian. C. Royaume,le mme tionsde l'existence.) 286. Conf. queKhotan.8, 16, 18. Yu tolo seng.C. Vtement. 322. g3 Yocha.C.Dmons. 56, ia3. z
Zang don. T. Personnageclbre, Zas d,kur.T. Prince.2o3. ma.T. Prince.2o3. Zasd,zzang 3io, 3i 2.
Zhobi.Rivire.23.
TABLE
DES
CHAPITRES.
Introduction CHAP. I.
Pages. i Dpart de Tchhang 'an. Monts Loung.Thsin d'occident. Liang du midi. Liang du nord. Thun houang. ; Dsert de sable Ou hou. Kao tchhang. . . Royaumes de Chen chen. Royaume de Yu thian Royaume de Tseu ho.Monts Tsoung ling.Royaume de Yu hoe Royaume de Ki tchha Monts Tsoung ling.Neiges perptuelles. Inde du nord. Colosse de Mi le Phou sa. . . Royaume de Tho ly. Fleuve Sin theou Empreinte du pied de Fo. ... Royaume d'Ou tchang. Royaume de Su ho to Royaume de Kian tho we Le tigre affam Royaume de Tchu cha chi lo. Royaume de Fo leou cha. Pot de Fo Ville de Hi lo. Os du crne de Royaume de Na ki. Fo. Dent de Fo. Bton de Fo. Manteau de Fo. Ombre de Fo de Lo i.Royaume Petites Montagnes de neige.Royaume Sin theou. , de Po na.-Fleuve Royaume de Pi tchha. . , Rivire de Pou na Royaume de Mo theou lo. '. Royaume de Seng kia chi Ville de Ki jao i. Rivire Heng. Fort de Ho li
i 7 16 22 26 3o 35 45 6/t 66 7/1 76
CHAP.IL CHAP.III. CH\P. IV. CHAP. V. CHAP.VI. CHAP.VII. CHAP.VIII. CHAP. IX. CHAP.X. CHAP.XI. CHAP.XII. CHAP.XIII.
85 96 98 99 12/1 167 170
CHAP.XIV. CHAP.XV. CHAP.XVI. CHAP.XVII. CHAP.XVIII. CHAP.XIX. CttAr. XX. CHAP.XXI.
Royaume de Cha tchi Temple de Royaume de Kiu sa lo.Ville de Che 'we. Tchi houan. Ville de Tou we 171 Ville de Na pi kia. Lieu de la naissance de Keou leou thsin fo et de Keou na han meou ni fo 192
TABLE CHAP. XXII. CHAP. XXIII.
DES
CHAPITRES.
425
Pages. Ville de Kia 'we lo 'we. Naissance de Champ du roi. Fo 198 tang du du Royaume de Lan m. dragon.-Aventure roi A y avec le roi des dragons.lphants qui font le service prescrit par la loi. . , 227 Tour des Charbons. Ville de Kiu i na ki. - Rivire Hi lian 2 35 Royaume de Phi che li. Tour de la moiti du corps d'A nan. Jardin de la femme An pho lo. Lieu o Fo entra dans le Nirvn'a. Tour des arcs et des armes dposs. sicle. A nan ne prie pas Fo de demeurer dans le Recueil des actions et des prceptes de Fo. . 2/12 des cinq rivires.Nirvn'a d'A nan. Sa mort 200
CHAP. XXIV. CHAP.XXV.
CHAP. XXVI. CHAP. XXVII.
Runion
au milieu du fleuve Royaume de Mo ki thi.Ville
de Pa lian fo. Mont Khi tche kiu.Montagne leve par les gnies. Fte pour l'anniversaire de la naissance de Fo.Hospices. Empreinte du pied de Fo.Inscription.Ville de Ni li 2,53
CHAP.XXVIII.
des Na lo.NouMontagne du Rocher isol.Hameaux velle ville de la Rsidence royale.Les cinq Montagnes. Ancienne rsidence du roi Ping cha. Jardin d'An pho lo Pic de Khi tche. Le dmon Phi siun se mtamorphose en vautour. Peur d'A nan.Trne des quatre Boud Sacridhas.Pierre jete contre Fo par Thiao th. 262
CHAP. XXIX.
CHAP. XXX.
CHAP.XXXI.
fice de F hian 269 Jardin des bambous de Kia lan tho.- Chi mo che na, ou le cimetire. Grotte de Pin pho lo.Maison de pierre Tchhe ti.Premire collection des paroles de Fo. Caverne de Thiao th. Pierre noire du Pi khieou. . . 272 Ville de Kia ye.-Lieu o Fo vcut pendant six ans dans les macrations. Lieu o il accomplit la loi.Il est lieux saints. expos aux attaques du dmon.Autres Quatre grandes tours en l'honneur de Fo 275 A y devient roi de la roue de fer et rgne sur le Yan feou construire une prison pour thi.Il visite l'enfer.Fait d'un Pi khieou qui entra punir les criminels.-Histoire dans cette prison. Le roi se convertit 2g3
CHAP.XXXII.
AMWE X'Ilmeraire de HlUtift
ME
IWDE, PL.I.
est indiqu par la point. l/lSCtTlfjf
IL PZAJYCJIE
*'&" isik/A'SZ.y'af*
WSSfiSjSi'&sS
INDEX. Pour faciliter les recherches et obvier la confusion qui pourrait rsulter du mlange de tant de mots emprunts des idiomes diffrents, j'ai dsign chacun de ces mots par l'initiale de la langue laquelle ils appartiennent; ainsi, S. sanscrit; P. pali; Sg. singhalais; C. chinois; T. tibtain; Md. mandchou et Mg. mongol. - C. L. A A. S. (La terre.) page Ababanaraka. S. Un des huit enfers froids. Abhayari. S. Division des doctrines bouddhiques. Abhayagiri. S. Monastre. Abhidharma. S. Une des classes des livres sacrs. - Abhidharma pitaka. Abhyavakashika. S. Une des douze observances. Abka. Md. Les dieux. A chi to fa ti. C. Rivire. A chou kia. C. Roi. Acht'a mahnarakh. S. Les huit enfers principaux. A chy ma kie pho. C. (Succin.) A chy pho chi. C. Saint personnage. Adbhoutadharma. S. Une des classes des livres sacrs. Adja kondandjan. P. Saint personnage. Adjtas'atrou. S. Roi. A feou tha mo. C. Une des classes des livres sacrs. A fou lou tchi ti che fa lo Phou sa. C. Saint personnage. Agama. S. Livres sacrs. Ages des hommes. Aghanisht. S. Un des cieux superposs. Agni deva. S. Dieu du feu. Agniya. S. Pays. Ahahanaraka. S. Un des huit enfers froids. A han. C. Livres sacrs. A i. C. Saint personnage. 'Ai nou. C. Dmon. Aipara. Mg. Fleuve. Ajassat. Sg. Roi. A jo Kiao tchhin ju. C. Saint personnage. Aks'agarbha. S. Saint personnage. A khi to hiue che kin pho lo. C. Hrtique. A lan jo. C. (Lieu tranquille.) A le tche. C. Royaume. A li lo pho ti. C. Rivire. Allgorie des trois chars et des trois animaux. A lo han. C. (Vnrable.) A lou pa. C. Une des sept choses prcieuses. Altan gerel. Mg. Livre cit. Altan tchidaktchi. Mg. Un des Bouddhas de la priode actuelle. Amita. P. Princesse de la race des Shkyas. Amitabha. S. Bouddha divin. Amitas'ouddhi. S. Roi. Amitdana. S. Roi. Amiye gang par oola. T. Montagne. Ammnat. Rivire. Amourliksan. Mg. Saint personnage. Angm. S. Classe de saints personnages. A na han. C. Classe de saints personnages. A na liu ou A na liu tho. C. Disciple de Shkya. A nan ou A nan tho. C. Saint personnage. Ananda. S. Le mme que le prcdent. Ananda. = Sainte femme. Anarodha. S. Saint personnage. Anawadata. S. Lac. An'da. S. Secte. Andhra. S. Pays. Andjana. P. Prince de la race des Shkyas. A neou leou tho. C. Le mme que A na liu. A neou tha. C. Lac. Anga. S. Royaume. Angirasa. S. Prince de la famille des Shkyas. Angottargama. S. Livre sacr. Angotternikaya et Angottaranikya. S. Livre sacr. An ho. C. Ville. A ni leou teou. C. Le mme que A na liu, Anityam. S. Une des quatre ralits. 'An lo. C. Monde. An mou lo. C. Sainte femme. 'An mou lo ko. C. Sorte de pierre. Anoumanam. P. Rivire. A nou mo. C. Rivire et royaume. Anourouddha. Sg. Personnage religieux. Anouvrata. S. Le mme que A na liu. An pho lo. C. Sainte femme. An szu. C. Peuple. Antaravsaka. S. Vtement. An tchha. C. Secte. An tho hoe. C. Vtement. An to. C. Offre du riz Bouddha, aprs ses annes de macration. 'An tsing. C. Nom de religion. Aoude. Royaume. A pho tho na. C. Une des classes des livres sacrs. A pi tha mo. C. Le mme que le suivant. A pi than. C. Une des trois classes des livres de la loi. A po lo lo. C. Dragon.
A po ye tchi li. C. (Abhayari.) Arabko. Md. Une des bouches du lac A neou tha. Aradjavartan. S. Elphant de Shkya. Aran'yaka. S. (Lieu tranquille.) 0 Aran'yaka. = Un des noms de Bouddha. Arban terghetou. Mg. Roi. Arbouda. S. Un des huit enfers froids. Arhn. S. (Vnrable.) Arhn. Runions des Arhans pour la rdaction des livres sacrs. Ari. Md. Dmons. Arighon ideghetou. Mg. Prince. Arighona Oekuktchi. Mg. Roi. Arsalan. Mg. Roi. Arya. S. Titre de saintet. Asankhya. S. Mesure de temps. A seng ki. C. Idem. Asi. S. Rivire. A sieou lo. C. Gnies. As'magarbha. S. (Succin.) As'oka. S. Roi. Asoura. S. Gnies. Assocarahama. Sg. et As'okrma. S. Temple. Assoulakounou. Sg. Beauts de Bouddha. As'vdjit. S. Personnage clbre. As'vapati. S. Le chef des chevaux. Aswardja. P. Cheval de Shkya. Atatanaraka. S. Un des huit enfers froids. A tcha chi ou A tche chi. C. Roi. A tcheou tho khou. C. Saint personnage. A tou to che tou lou. C. Roi. Avadna. S. Une des classes des livres sacrs. Avalokites'wara. S. Personnage mythologique. Avatra. S. (Incarnation.) Avidya. S. (L'ignorance.) Avtchi. S. Un des huit enfers. A yi to. C. Saint personnage. A yi to. = Surnom de Matreya. Ayodhya. S. Ville. Ayoushmn Mngalyna. S. Disciple de Shkya. A yu. C. Roi. A yu tho. C. Royaume. B Baddhakatchna. P. Prince de la famille des Shkyas. Badiri. Md. (Pot.) Badma. Mg. Le lotus. Un des huit emblmes. Bahar. Ville. Baktchi et Baktchou. Mg. Fleuve. Bala. S. Offre du riz Bouddha. Balkh. Pays. Ballakedje. Lgende relative ce personnage. Balo kl. S. Lieu clbre. Bana-wara. Sg. Division des pomes sacrs compose de 250 vers. Banoura. Rivire. Barkho. Mg. Fleuve. Bton, attribut du mendiant bouddhiste. Bton de Foe. Bdja Gra misnn dwp. T. Un des quatre Continents. Behat. Rivire. Beloutches. Bnars. Bern'. S. Rivire. Beyah. Rivire. Bhadrakalpa. S. L'ge des Sages. Bhgirasa. P. Roi. Bhgrath. S. Rivire. Bhard'hwadja. S. Prince. Bharata. P. Roi. Bhawa. S. Un des Nidnas. Bhikshou. S. (Mendiants.) Bhikshouni. S. (Mendiantes.) Bhou ram ching pa. T. Prince. Bhouvana. S. Bich-balik. Royaume. Bimbsra. S. Roi. Bindhousra. P. Roi. Bisman taegri. Mg. Dieu. Bodhi. S. (La doctrine.) Bodhi. = Arbre sacr. Bodhidharma. S. Patriarche. Bodhisattwa. S. Classe de saints personnages. Bom bo in nom. Mg. Doctrine religieuse, Bon bo. T. Secte. Bon ghi tsis. T. Doctrine religieuse. Bouddha. S. Bouddha. = Un des trois Prcieux. Bouddhas (les sept). Bouddha Gaya. S. Ville. Bouddhaghosha. S. Savant religieux. Bouddhisme. Bouddhistes.
Boumba. Mg. Un des huit emblmes. Bou ram ching pa hp'hgs s'kyes po. T. Roi. Brahma. S. Brahmadjla. S. Ouvrage cit. Brahma-kyika. S. Un des cieux de Brahma. Brahmanes. Brahmanisme. Brahmaparipaty. S. Arme de Brahma. Brahmapourohita. S. Ministres de Brahma. Brahma-prashdya. S. Un des cieux de Brahma. Brahmatchri. S. (Jeune Brahmane.) Bre'wo zas. T. Roi. C Caboul. Castes (les quatre). Ceylan. Chabi. Md. (Disciple.) Chad'yatama. S. Un des douze Nidnas. Chaho. C. Le Fleuve de sable. Chamanisme. Cha men. C. Les Samanens. Cha men. ha mi. C. Classe de religieux. Cha mi ni. C. Classe de religieuses. Cha mo. C. Le mme que Cha ho. Chang na ho sieou. C. Patriarche. Chan ni lo che. C. Ruisseau. Chan tche ye pi lo tchi. C. Hrsiarque. Chan thi lan. C. Monde. Charbons (tour des). Char gi Lus pag dwp. T. Un des quatre Continents. Chars (les trois). Cha tcheou. C. Ville. Cha tchi. C. Royaume. Cha ti li. C. (Kshatrya.) Chayouk. Rivire. Che chang kia. C. Roi. Che i. C. Royaume. Che li. C. Reliques. Che li fang. C. Samanen. Che li foe. C. Disciple de Shkya. Che li ma li lo kia. C. Classe de religieux. Che li tseu. C. Le mme que Che li foe. Che lo po tho lo. C. Monastre. Chen chen. C. Royaume. Chen ching. C. Mre de Keou na han meou ni Foe. Chen fan tseu. C. Gnie. Chen hian. C. Demeure d'Indra. Chen hian. = Saint personnage. Chen houan. C. Chen kia king. C. Livre sacr. Chen ki tseu. C. Personnage mythologique. Chen pou. C. Ile. Chen raebs. T. Fondateur de la secte Bon bo. Chen tchi. C. Montagne. Chen tchi. = Mre de Keou leou sun Foe. Chen tchu tchin pao chan wang Jou la. C. Chen yen. C. Femme du roi Kan tche. Cheou. C. (La perception.) Cheou kia. C. Ceux qui ont reu les dfenses. Cheou leng yan. C. Ouvrage bouddhique. Cheou tho. C. (Sotra.) Che'we. C. Ville. Che'we. = Crmonie de la crmation des corps. Chey. C. Un des noms de Shkya. Chey. = Royaume. Chi. C. (Sicle.) Chi eul Theou tho king. C. Livre cit. Chi khi. C. Chi khi. C. Nom d'un Bouddha. Chikour. Mg. (Le parasol.) Un des huit emblmes. Chi lai na fa ti. C. Rivire. Childa. Mg. Fleuve. Chi li cha. C. Arbre. Chi lo. C. Prceptes. Chimnou. Mg. Voyez Simnou. Chi mo che na. C. (Champ des tombeaux.) Chin. C. (Divin.) Ching. C. Mesure de capacit. Ching tao Cha men. C. Classe de Samanens. Ching tchang. C. (Bton.) Ching wen. C. (Disciples.) gChin otche. T. Roi des enfers. gChin rdje. T. Prince de la mort. Chin thoung. C. Une des six facults surnaturelles. Chin tou. C. L'Inde. Chi pi kia. C. Surnom de Jou la. Chi to. C. Temple. Chi tsun. C. Un des dix surnoms des Bouddhas. Chouang mi. C. Ville. Choue tao Cha men. C. Classe de Samanens.
Choue wen. C. Ouvrage cit. Chou yu. C. (Cristal de roche.) Chou meng pe li. C. Ville. Chou tho lo. C. (Sotra.) Chu. C. Pays. Chun kio. C. Beau-pre de Shkya. Chu phan na. C. Gnie. Chy. C. (Shkya.) Chy. = Un des douze Nidnas. Chy. C. (Indra.) Chy Fa hian. Voyez Fa hian. Chy kia Foe. C. Chy kia Joula. C. Jou la. Chy kia mou ni. C. Le mme que Chy kia wen. Chy kia pi ling kia. C. Pierre prcieuse. Chy kia wen. C. (Shkya mouni.) Chy li foe. C. Saint personnage. Mieux Che li foe. Chy li khieou to. C. Personnage clbre. Chy li Kia che. C. Converti par Shkya. Chy li mo li lo kia. C. Classe de religieux. Chy lo fa sy ti. C. Ville. Chy mo ti yo. C. Un des enfers. Chy tcha ma na ou Chy tcha ni. C. Classe de religieuses. Chy tchoung. C. Sa lgende. Chy tchoung. C. (Race de Shkya.) Chy thi houan in. C. Nom d'Indra. Chy ti ou Chy thian ti. C. Nom d'Indra. Chy ty king. C. Livre sacr. Colombe (monastre de la). Contenants (les trois). Continents (les quatre). Cophs, Cophne. Coquilles-monnaie. Core. Core. Introduction du Bouddhisme dans ce pays. Cosmographie bouddhique. Cowries. Crne de Foe. D Dadzan loung. Md. Une des bouches du lac A neou tha. Dahoe. Dahder. Rivire. Dakchin'a. S. Le Deccan. Dalada wahans. Sg. Dent de Bouddha. Dna. S. Un des dix Pramit. Darada. Pays. Das'aratha. S. Roi. Das'awala Ks'yapa. S. Converti par Shkya. De bjin gshegs pa. T. Un des titres des Bouddhas. Dent de Foe. De snod gsoum. T. Les trois contenants. Deva. S. Les dieux. Deva Bodhisattwa. S. Devadha sakka. P. Roi. Devadatta. S. Perscuteur de Shkya. Devlaya. S. Dieux infrieurs. Devatideva. S. Nom honorifique de Shkya. Devenipaetissa. Sg. Roi. Dhran'. S. (Invocation.) Livres sacrs. Dharma. S. 21. Un des trois Prcieux. Dharma. = Une des divisions des livres sacrs. Dharmakya. S. Un des trois tats de Bouddha. Dharmapadeya. Sg. Livre sacr. Dharmapradpik. S. (Le Flambeau de la loi.) Ouvrage cit. Dharms'oca. S. Roi. Dharmavardhana. S. Prince. Dhtdana. S. Roi. Dhoudh. T. Chef des dmons. Dhyna. S. Degrs de saintet. Dhyni bouddha. S. Dib. S. (Ile.) Dierganikaya ou Drghanikya. S. Livre sacr. Dieux (quatre classes de). Dieux (les quatre rois des). Dieux (les trente-trois). Dpankara. S. Nom d'un Bouddha. Drghgama. S. Livre sacr. Djalandhara et Djalandri. Couvent. Djambou dip. Mg. Le mme que le suivant. Djambou dvpa. S. Un des quatre Continents. Djambou dwp. T. Un des quatre Continents. Djambou gling. T. Un des quatre Continents. hDjam dVyang. T. (Mandjous'ri.) Djamn. S. Rivire. sDjan ras gZigs dVang tchhoug. T. (Avalokiteswara.) Djrmaran'a. S. Un des Nidnas. Djtaka. S. Une des classes des livres sacrs. Djtaka. = Naissances de Bouddha. Djti. S. Un des Nidnas.
Djayasena. P. Roi. Djet et Djetavana. P. Temple. nDjig rten gyi gtso bo. T. (Honorable du sicle.) Djihoun. Fleuve. Djina. P. (Shkya mouni.) Djylam. Rivire. Doctrine bouddhique, sa rdaction. Doctrine bouddhique, sa rdaction. = Trente-sept classes de doctrine. Don pa. T. Mesure. Dorona Oulamdzi beyeto dip. Mg. Un des quatre Continents. bDoudh r, tsi zas. T. Roi. Douhkham. S. Une des quatre ralits. hDoul-ba. T. Les prceptes. Douldouri. Md. (Bton.) Doung ou Doungar et Doungerdeni. Mg. Un des huit emblmes. Doutes (les cinq). Dragons (rois des). Dvli. P. Roi. Dwpa (les quatre). S. Dyan. Mg. Le plus haut degr de saintet. Dzsoun. S. (Les Poissons.) Un des huit emblmes. Dzighasoun. Mg. Les mmes que les prcdents. Dzina. Mg. Les prceptes. E Ecriture, son introduction en Core. Ekapnika. P. Une des douze observances. Ekavtchika. S. Elments (les cinq). Embouchures (les cinq). Enchanements (les douze). Enfer. Les grands et les petits enfers. Entres (les six). 'Eou heou. C. Un des huit enfers froids. Erannoboas. Rivire. Erdeni Sar. Mg. Roi. Ergetou khomsim bodisatou. Mg. (Avalokites'wara.) Erlik khakan. Mg. Roi des enfers. Ertundjin tooli. Mg. Ouvrage cit. Esroun tegri. Mg. Le mme que Brahma. Eul kiang. C. Peuplade. F Fa. C. Un des trois Prcieux. Facults surnaturelles (les six). Fa hian ou Chy Fa hian. C. Fa hian Rsum de son voyage. Fa hing wang. C. Roi. Fa hoa king. C. Livre sacr. Fa i. C. Roi. Falgo. Rivire. Fa mi. C. Sectaire. Familles (les quatre). Fan. C. Langue. Fan. = Brahma. Fa na. C. (Fort.) Fang. C. (La loi.) - Fang kouang. (Grandeur de la loi.) Fan hing. C. (Brahmaniquement.) Fan kang. C. Ouvrage cit. Fan lan ma. C. Brahma. Fan ma youe. C. Mre de Mi le. Fan tchi. C. (Brahmatchri.) Fan tchu. C. (Brahma.) Fan te. C. Pre du Foe Kia che. Fan wang. C. Livre sacr. Farghana. Pays. Fe che. C. (Vasya.) Fe che li. C. Ville. Fe chi. C. Le souper. Fe chi ti yo. C. Un des enfers. Fe licou li ye. C. (Lapis lazuli.) Femmes (royaume des). Fen (les quatre). C. Les quatre degrs. Fen to ly. C. Un des huit enfers froids. Feou thou. C. Bouddha. Feou thou. = Sorte de chapelle. Foe. Sa naissance. Foe. - Ses statues. Foe. - Empreintes de ses pieds. Foe. - Abandonne son corps un tigre. Foe. - Son pot. Foe. - Os de son crne. Foe. - Sa dent. Foe. - Diffrentes circonstances de sa vie. Foe. - Son bton. Foe. - Son Seng kia li. Foe. - Son ombre. Foe. - Ses tribulations. Foe. - Sa mort. Foe. - Ses reliques. Foe. - Ses transformations ou manifestations.
Foe. C. Un des trois Prcieux. Foe cha fou. C. Ville. Foe leou cha. C. Royaume. Foe pho thi. C. Le mme que Foe yu thai. Foe tho. C. Un des trois Prcieux. Foe yu thai. C. Un des quatre Continents. Formules divines. Fothatha. C. surnom de Jou la. Fo thsou. C. Fleuve. Foudanna. S. Dmons. Fou jin C. Titre de la mre de Bouddha. Fou lan na Kia che. C. Hrsiarque. Fruits (les cinq). Fung te. C. Ville. G Gadjapati. S. (Le chef des lphants.) dG Idan. T. Un des tages du paradis. Gand'ak. S. Rivire. Gandhra. S. Pays. Gandharva. S. Gnies. Gandjour. T. Ouvrage cit. Gang sgar. S. Embouchure du Gange, Gange. mGan-hgis. T. (Le Gange.) dGan pa. T. (Monastres.) Garoud'a. S. Oiseau fabuleux. Gatchiin kunas'ana. S. Royaume. Gatchou ou Gatchi. Mg. Royaume. Gth. S. Une des classes des livres sacrs. Gutama. S. Prince de la famille des Shkyas. Gutama. = Un des noms de Shkya. Gaya. S. Ville. Gay Ks'yapa. S. Converti par Shkya. Geoutam. T. Un des noms de Bouddha. Gerel sakiktchi. Mg. Un des Bouddhas de la priode actuelle. dGe slong. T. (Mendiants.) Gtes (les). Geya. S. Une des classes des livres sacrs. Ghasalang oughe Nom-un khaghan. Mg. Roi. rGhioun dhou joughs bha. T. Classe de saints personnages. Ghiou ourgo. Md. Une des bouches du lac A neou tha. Ghrou h, dzin. T. Ville. Giddore. Montagne. Gnia thri zzan bo. T. Roi. Gni mahi g,ngen. T. Nom d'un prince de la famille des Shkyas. Gdhanya. S. Un des quatre Continents. Gmal. Fleuve. Gmat. S. Nom d'un monastre, et d'une rivire. Goodam. Mg. (Geoutam.) hGor-lae. T. (Roues.) Gtama. S. Saint personnage. Gouhsha. Sg. Roi. Gorban amak saba. Mg. Les trois contenants. Gouroupda. S. Montagne. Goyeni. S. Le mme que Gdhanya. Grantha. S. (Donations.) Gridhrakot'a. S. Montagne. Gunduk. Rivire. rGyal srid d,ghah. T. Roi. hGyour. T. H Hammanelle Siripade. Sg. Montagne. Han. C. La terre de Han (la Chine). Han ping ti yo. C. Un des seize enfers. Han tha. C. Le Kandahar. Hao khou. C. Saint personnage. Hatty pla. Sg. Une des manifestations de Bouddha. Haute arme (roi de la). He cha ti yo. C. Un des seize enfers. He ching ti yo. C. Un des huit enfers brlants. Heng ou Heng kia. C. Le Gange. Hrsiarques (les six). Hian kie. C. L'ge des Sages. Hian theou. C. L'Inde. Hian yang. C. Bourgade. Hiao hiao po. C. Un des huit enfers froids. Hia pen king. C. Livre sacr. Hia tso. C. (S'asseoir en t.) Expression explique. Hieou mi, C. Peuplade. Hieou thou. C. Pays. Hi ki lo. C. (Bton.) Hi lian. C. Rivire. Hi lo. C. Montagne. Hi lo. = Ville. Himlaya. S. Hing. C. Une des douze conditions de l'existence. Hioung nou. C. Peuple. Hiran'ya. S. (Or.) Rivire. Hiran'yabhou et Hiran'yawha. S. Rivire. Hi tun. C. Peuplade.
Hiuan thsang. Prtre bouddhique. Hiuan thsang. Extraits de son voyage. Hiuan thsang. Rsum de sa relation, Hiu tchin. C. Auteur du Choue wen. H'las b,stan. T. Ville. Hoa tao Cha men. C. Classe de Samanens. Hoa tchhing yu phin. C. Livre sacr. Hoa yan. C. Ouvrage cit. Ho chang. C. Laques bouddhistes. Hoe he. C. Peuple. Hoe ho ti yo. C Un des enfers. Hoe kian. C. Samanen. Hoe king. C. Compagnon de Fa hian. Hoe seng. C. Son voyage dans l'Inde. Hoe tha. C. Samanen. Hoe 'we et Hoe yng. C. Compagnons de Fa hian. Ho ho. C. Un des huit enfers froids. Ho kia lo. C. Une des classes des livres sacrs. Ho king. C. Mauvais gnie. Ho li. C. Fort clbre. Ho man. C. Shkya dans une de ses existences antrieures. Ho me. C. Ville. Honorable du sicle. Ho tao Cha men. C. Classe de Samanens. Hou. C. Mesure de capacit. Houang choui. C. Rivire. Houa ti. C. Sectaire. Hou fan wang. C. Roi. Hougli. Rivire. Hou hi. C. Lgende relative ce personnage. Hou khiu ping. C. Gnral chinois. Houng chi. C. Nom d'annes. Hou teou. C. (Mou lian.) Hou tsao. C. Ville. Hou yu. C. (Langue barbare.) I I che na. C. Hrtiques. I chen na. C. Ville. Ikshwakou. S. Fondateur de la race des Shkyas. Ikshwakou Viroudhaka. S. Prince. Iletou nomoun. Md. Classe de livres sacrs. Ilgaksoun djimik. Mg. Un des huit emblmes. Ilmoun khan. Md. Roi des enfers. I lo po. C. Nom d'un dragon. Images (procession des). Inde (l'). Inde centrale. Inde du nord. Indra. S. Indras'ilagouh. S. Montagne. Inekou dzikhe. Md. Un des titres des Bouddhas. Ingachar. Pays. Ing soung. C. (Chant redoubl.) In tho lo. C. Indra. I po. C. Expression consacre. Issa patana ramaa ou Issi patene. P. Temple. Istewirrewade. Sg. Livre sacr. Iswara. S. Dieu du monde des dsirs, Iswere patne rny. P. Temple. I szu mo wang. C. Un des anctres de Shkya. Itihsa. S. Une des classes des livres sacrs. I ti mou to. C. Une des classes des livres sacrs. I tsun kheou. C. Apporte des livres bouddhiques la Chine. J Jan teng Foe. C. Nom d'un Bouddha. Jardins (les quatre) des dieux. Java (le de). Jin'jo. C. Immortel. Jo than. C. Prince. Jo thi. C. Mre de Ni kian tho. Jou i. C. (Perle.) Jou i. = Lac des dieux. Jou la. C. Un des titres qualificatifs des Bouddhas. Joyaux (l'le des). Jy tchoung. C. Un des noms de Shkya. K Ka. S. (Le vent.) Kabilik. Mg. Royaume. Kafristan. Pays. bKh. T. Classe de livres sacrs. bKh-hGyour. T. Ouvrage cit. Kalas. Montagne. Kalsoka. Sg. Roi. (As'oka.) Klastra. S. Un des huit enfers principaux. Kal dzian ching r,ta. T. Rivire. Klitha. S. Saint personnage. Kalpa. S. Ages du monde. Kalpatarou. S. Arbre. Kalynika. P. Rois. Kambala. S. Hrtique.
Ka na hia meou ni. C. (Kanaka mouni.) Kanaka. S. (Or.) Kanaka mouni. S. Un des Bouddhas de la priode actuelle. Kanardji. S. Ville. Kandahar. Pays. Kang dhoub djian. T. Prince. Kanika. Mg. Roi. Kan lou fan wang. C. Prince. Kan lou tsing. C. Roi. Kanoudje. S. Ville. Kantakanam. P. Cheval de Shkya. Kan tche. C. Un des noms de Shkya. Kan tche. = Roi. Kan tcheou. C. Pays. Kan tho lo. C. Le Kandahar. Kanykoubdja. S. Ville. Kan yng. C. Gnral chinois. Kao fou. C. Ville. Kao li. C. La Core. Kao tchhang. C. Pays. Kapila. S. Hrsiarque. Kapilapour. S. Royaume. Kapilavastou. S. Royaume. Kapilavatthu. P. Le mme. Karsou. S. Rivire. Karkoutchanda et mieux Krakoutchhanda. Kar madh tong. T. Prince de la race des Shkyas. Karn'a. S. Roi. Karn'apoura. S. Ville. Kasn. P. Princesse. Ks'i. S. Royaume. Ks'yapa. S. Un des Bouddhas de la priode actuelle. Ks'yapa. = Disciple de Shkya. Ks'yapa. = Les trois frres. Ks'yapa. = Mre de Fou lan na. Ks'yapa. = Secte. Katchn. S. Femme de Shkya. Kus'mb. S. Royaume. Kavanpati. S. Personnage mythologique. Keng khi. C. Ancien nom du Bouddha Ks'yapa. Keng lo. C. Un des Nidnas. Keou chen mi, imprim par erreur Keou than mi. C. Royaume. Keou chi. C. Ville. Keou leou sun. C. Un des Bouddhas de l'ge actuel. Keou leou thsin foe. C. Le mme que le prcdent. Keou li cha ti. C. Pre de Ma ye. Keou lin ou Keou li tha tseu. C. Personnage clbre. Keou na han meou ni. C. Un des Bouddhas de l'ge actuel. Keou tchi. C. Lumire divine. Keou than mi. Voyez Keou chen mi. Kha. S. (L'ther.) Khadgavis'nkalpa. S. Classe de saints. Khaloupas'wadhaktinka. S. Une des douze observances. Khamdan. Rivire. Khmeh. Branche de l'Indus. Khamouk tousayi butughektchi. Mg. Nom de Shkya. Khang kiu. C. Pays. Khan tha pho. C. Gnies. Khasalang oughe. Mg. Roi. Kheou phan tho. C. Dmons. Khiang. C. Le Tibet. Khian koue. C. Royaume et prince. Khian tchhou. C. Instrument sonore. Khian tchou ti yo. C. Un des seize enfers. Khian te. C. Cheval de Shkya. Khih o lan. C. Temple. Khi lian chan. C. Chane de montagnes. Khin pho lo. C. Hrtique. Khi sin lun. C. Ouvrage cit. Khi tche khiu. C. Montagne. Khiu khiu tcha po tho. C. Montagne. Khiu lo wang. C. Un des anctres de Shkya. Khiu niu tchhing. C. Ville. Khiu thse. C. Pays. Khi ye. C. Une des classes des livres sacrs. Kho lo tche ky li hi. C. Ville. Kho phan tho. C. Pays. Khormousda. Mg. et Khourmousda. S. Le mme qu'Indra. Khotan. Ville. Khoung phin. C. Livre sacr. Khoutoukhtou. Mg. (Incarnation.) Khuen. C. Divinit. Khy fou Koue jin. C. Roi. Kia cha. C. Espce de collet. Kia che. C. Disciple de Shkya. Kia che. = Mre de Fou lan na. Kia che. = Un des Bouddhas de la priode actuelle. Kia che ou Kia se. C. Les trois frres convertis par Shkya. Kia che pho. C. Le mme que le prcdent. Kia chi. C. Royaume.
Kia tho. C. Lieu clbre. Kia thou. C. (Dlivrance.) Kia lan. C. Abrviation de Seng kia lan. Kia lan tho. C. Personnage et temple. Kia leou lo. C. Gnies. Kia lo. C. Temps des repas. Kia lo. = Roi des Dragons. Kia lo kieou tho kia tchin yan. C. Hrtique. Kia lo pi na kia. C. Pays. Kia ni sse kia. C. Roi. Kian tho lo. C. Royaume. Kian tho we. C. Royaume. Kiao chang mi. C. Royaume. Kiao fan pa thi. C. Personnage mythologique. Kiao lieou pa. C. Pays. Kiao sa lo. C. Royaume. Kiao tchhin ju. C. Nom de famille. Kiao wen ti yo. C. Un des huit enfers brlants. Kia pi che. C. Royaume. Kia pi li et Kia pi lo. C. Hrsiarque. Kia pi li et Kia pi lo. = Royaume. Kia se. Voyez Kia che. Kia se koue. C. Une des classes des prceptes. Kia tchin yan. C. Nom de famille de Kia lo kieou tho. Kia tho. C. Une des classes des livres sacrs. Kia 'we lo 'we. C. Ville. Kia ye. C. Ville. Kie et Kie tho. C. (Pome.) Kieou cheou. C. Roi. Kieou i. C. Femme de Shkya. Kieou yi. C. Explic. de ce mot. Kie pi lo fa sou tou. C. Royaume. Kie pi tha. C. Royaume. Kie tchha. C. Royaume. Ki ha. C. Kit. Mg. (Monastres.) Ki jao i. C. Ville. Ki lo. C. Monde. Kims'ouka. S. Arbre. Kin chan tchao ming. C. Saint personnage. King. C. Les livres sacrs. King kia. C. Le Gange. Kin hian. C. Ville. Ki ni kia. C. Roi. Kin kang mi tsi. C. Dieu. Kin kouang ming king. C. Livre sacr. Kin na lo. C. tres fabuleux. Kinnara. S. tres fabuleux. Kinnodje ou Kanoudje. Kin tchhing. C. Ville. Ki 'o ti yo. C. Un des enfers. Ki pin. C. Pays. Kiu che. C. (Contenant.) Kiu che lan. C. Livre cit. Kiu chi na kie lo et Kiu chitchhing. C. Ville. Kiu i na kie. C. Ville. Kiu lo lo lou. C. Pays. Kiu lou po tho. C. Montagne. Kiu ma ti. C. Nom d'un monastre. Kiu na han meou ni. C. (Kanaka mouni.) Kiu sa lo. C. Royaume. Kiu sou mo phou lo. C. Ville. Kiu sse lo. C. Temple. Kiu tan. C. Un des noms de Shkya. Kiu tche kie lo phou lo. C. Ville. Kiu tse lo. C. Pays. Kiu ye ni. C. Un des quatre Continents. Ko li. C. Pays. dKon mtchhog soum. T. Triade. Ko pou to. C. Sthopa clbre. Ks'ala. S. Royaume. Kosha. S. (Contenant.) Ko ti yo. C. Un des enfers. Kouan chi in. C. Personnage mythologique. Kouang tcheou. C. Ville. Kouan in. C. Le mme que le prcdent. Koua wa. C. Java. Koue (les trois). C. Les trois appuis. Koue chouang. C. Pays. Kouen ming. C. Peuple. Koukeyar. Pays. Koukkout'apda. S. Montagne. Koumouda. S. Un des enfers froids. Koung sun. C. Roi. Kourou. S. Nom d'une tribu. Kous'mba. S. Fondateur de Kaus'mb. Kous'anbha. S. Roi. Kous'inagara. S. Ville. Kousinara. P. Ville. Kousoumapoura. S. Ville.
Kou stana. S. Etymologie de Khotan. Koutche. S. Pays. Kouvera. S. Dieu des richesses. Krakoutchhanda. S. Un des Bouddhas de la priode actuelle. Kshnti. S. Un des six moyens de salut. Kshatrya. S. Une des quatre castes. Kshma. S. Ku jo kie tche. C. Ville. Kulgun. Mg. (Translation.) Kurdou. Mg. La roue de la puissance. Kus'avati. P. Ville. Ky kou tou. C. Lieu clbre. Ky kou tou. = Surnom de Siu tha. Ky li. C. Pays. Ky ly tho lo khiu ta. C. Montagne. L Ladak. Ville. Lagh na rdo rdzie. T. Saint personnage. Lagh r, na. T. Prince. Lah. T. Les dieux. Lakchana ou Laks'ana. S. Beauts de Bouddha. Lan chi. C. Ville. Lang ba. T. Personnage clbre. Langga. Md. Lac. Lang po tsie dhoud. T. Prince de la race des Shkyas. Lan mo. C. Royaume. Lan pho lou. C. Montagne. Lan pi ni. C. Lieu clbre. Lao. C. Un des douze Nidnas. Lao. = Montagne. Lakika. S. Secte. Leh. Ville. Leng yan king. C. Ouvrage bouddhique. Leou lan. C. Pays. Le so pho. C. Secte. Li. C. Mesure de distances. Liang. C. Dynastie. Liang ho ti yo. C. Un des enfers. Liang tcheou. C. Dpartement. Lieou li. C. Une des sept choses prcieuses. Lieou li. = Roi. Li hao. C. Prince. Ling kia. C. Montagne. Ling kia king. C. Livre sacr. Ling tchi. C. Champignon. Ling tha. C. Tour des Esprits. Ling tsieou fung. C. Montagne. Ling yen tcheou. C. Livre sacr. Lions (royaume des) [Ceylan]. Li tchhe. C. Habitants de Vas'ali. Litchtchivi. S. Idem. Li te. C. Pre de Keou leou sun Foe. Liu. C. Les prceptes. Livres bouddhiques. Lo. C. Fils de Shkya. Lob. Lac. Lo cha. C. Dmons femelles. Lo han. C. (Vnrable.) Lohita et Lohitaka. S. (Rouge.) Lo i. C. Royaume. Lokadjyeshtha. S. (Honorable du sicle.) Lo tha szu pho mi. C. Saint personnage. Louan. C. Oiseau fabuleux. Lou hi ta kia. C. Sthopa clbre. Lou jy. C. Un des douze Nidnas. Lou kia ye. C. Secte. Loung. C. Dragons. Loung. = Montagnes. Loung chou. C. Saint religieux. Loung mi ni. C. Lieu clbre. Loung si. C. Dynastie. Lou siang. C. Lo yang. C. Ville. Lo yue khi. C. Ville. Lun. C. Les discours. Lun ming. C. Jardin royal o naquit Shkya. Ly seng. C. (Laques.) M Ma. S. (La connaissance.) Macrations. Macrations de Shhya. Machi bay souktchi ergheto. Mg. Roi des dmons. Mad'hyades'a. S. L'Inde centrale. Madhyamgama. S. Livre sacr. Madhyamanikya et Maddimenikya. S. Livre sacr. Madhyntika. P. Saint personnage. Madjdjadsa. P. (Mad'hyades'a.) Magadha. S. Pays. Magoul-lakounou. S. Mahbrhmana. S.
Mah deva. S. Prince. Mah deva. = Hrtique. Ma ha fa na. C. Monastre. Mah Iswara. S. Dieu. Mah Ks'yapa. S. Patriarche. Mah my. S. Mre de Shkya. Ma ha Mou kian lian. C. Disciple de Shkya. Mah mouni. S. Mahmoutchala. P. Roi. Mah Nada. S. Prince. Ma ha nan. C. Prince. Mah padma. S. Un des huit enfers froids. Mah Padmapati Nanda. S. Roi. Ma ha Pho che pho thi. C. Tante de Shkya. Ma ha po the mo. C. Un des huit enfers froids, Mah Pradjpat. S. (Ma ha Pho che pho thi.) Mahpranda. P. Roi. Mahpratpa. P. Roi. Mah rdja tgri. Mg. Les gardiens des quatre rgions du monde. Mah ratha. S. Roi. Mahrurava. S. Un des huit enfers principaux. Mah sammanta. S. Roi. Mahasana. Sg. Roi. Mah satwa. S. Nom de Shkya dans une de ses existences antrieures. Mah sthnaprpta. S. Titre d'un Bodhisattwa. Mah tchakravarti radja. S. Roi de la roue. Mahavihra. S. Division des doctrines bouddhiques. Mahavihra. = Nom d'un monastre. Mah yna. S. La grande translation. Mahendra. S. Saint personnage. Mahsa. S. Dieu. Mahs'waravasanam. S. Ciel. Mahoraga. S. Etres fabuleux. Ma hou lo kia. C. Etres fabuleux. Ma ho yan ou Mo ho yan. C. La grande translation. Ma i cheou lo. C. Dieu. Matreya. S. Saint personnage. Ma kie. C. Poisson. Ma la nan kouei. C. Samanen. Ma li tchi. C. Divinit. Ma nao. C. (Agate.) Mandhta. P. Roi. Mandjou ghcha. S. Le mme que le suivant. Mandjous'ri. S. Saint personnage. Manggalyam. S. Disciple de Shkya. Mang-pos bkour va. T. Roi. Ma ni. C. et Man'i. S. (Joyau.) Manifestations ou Transformations de Bouddha. Ma ni pa tho. C. Gnie. Man tchu che li. C. (Mandjous'ri.) Man yun. C. Mapam dala. Md. Lac. Mra. S. Chef des dmons. Marakata. S. (Emeraude.) Mrgas'ira. S. Roi. Margisiri amogolang ouiledouktchi. Mg. Roi. Matanga. Sg. Une des manifestations de Bouddha. Ma teng. C. Samanen. Ma teng kia king. C. Ouvrage cit. Ma tho lo. C. Secte. Mathour. S. Ville. My. P. et Ma ye. C. Mre de Shkya. Me hou tseu. C. Samanen. Mendiants bouddhistes. Meng kie li. C. Ville. Meng san. C. Roi. Meou pho lo kie la pho. C. Une des sept choses prcieuses. Miao chen. C. Princesse. Mi cha se. C. Une des classes des prceptes. Mie tchang. C. Ceux dont les disputes sont termines. Mi le Phou sa. C. Saint personnage. Milieu (royaume du). Ming po lo. C. Un des huit enfers froids. Ming se. C. Un des douze Nidnas. Ming ti. C. Roi. Ming tsu. C. Le mme que Ming se. Ming zan. T. Personnage clbre. Mithila. S. Ville. Mi tho king. C. Livre sacr. Mo. C. (Mra.) Moggali - putte - Tissemahastewira. Sg. Personnage religieux. Mohany. Rivire. Mh dhtou dip. Mg. Un des quatre Continents. Mo hi yan tho lo. C. Saint personnage. Mo ho pi ho lo. C. (Mahvihra.) Mo ho pi ho lo. = Nom d'une chapelle. Mo ho seng tchhi. C. Recueil des prceptes. Mo kia li kiu che li. C. Hrsiarque. Mo kia tho et Mo kie thi. C. Royaume. Moksha deva. S. Religieux de la petite translation.
Mo lo kia li. C. Une des sept choses prcieuses. Mo lo kia tho. C. (Emeraude.) Mondes (les dix). Mngalyna. S. Disciple de Shkya. Mo ni. C. (Joyau.) Montagne sans crainte. Monastre. Montagnes de neige. Mo theou lo. C. Royaume. Mo thian ti kia. C. Saint personnage. Mo ti kia. C. Saint personnage. Mots gnrateurs (les six). Mou ho. C. Rivire. Mou kian lian. C. Disciple de Shkya. Mou lian. Moukti. S. Affranchissement de l'me. Moulian. C. Disciple de Shkya. Mouni. S. (Repos.) Moutchala. P. Roi. Moutchalinda. P. Roi. Mou tchi lin tho. C. Lac. Mo wang. C. Roi des dmons. Mo yu. C. Monastre. My tou. C. (L'extinction.) N rNa bha tsian. T. Roi. Nad Ks'yapa. S. Converti par Shkya. Naga. S. Dragons. Naga kochouna. S. Saint personnage. g,Nagh h, dzogh. T. Roi. Nachadhika. S. Une des douze observances. Naman takil. Mg. Les huit emblmes. Narakas. S. Beauts de Bouddha. Naissances (les quatre). Na kia lo ho. C. Royaume. Na kie. C. Royaume. Na lo. C. Pays. Nmaropa. S. Un des douze Nidnas. Nanda. S. Personnage de la famille des Shkyas. Nanda. = Roi. Nan thi ho lo. C. Personnage mythologique. Nan tho. C. Personnage de la famille des Shkyas. Na pi kia. C. Ville. Naraka. S. Les enfers. Naran dzara. Mg. Rivire. Narapati. S. (Le chef des hommes.) Nryana. S. Dieu. gNas-hrtan. T. Classe de saints personnages. rNa va tchan. T. Prince. Na yeou tha. C. (Billion.) Neou than. C. Royaume. Neou than. = Prince. sNgaghs Idzian. T. Cheval de Shkya. Nga. C. Un des douze Nidnas. Ngang zen. T. Personnage clbre. Nichpana. S. Naissance. Nidna. Une des classes des livres sacrs. Nidna Bouddha. S. Nidnas (les douze). S. Conditions de l'existence. Ni rghial. T. Saint personnage. Ni feou lo wang. C. Un des anctres de Shkya. Ni houan. C. (L'extinction.) Ni keou liu. C. Arbre. Ni kian tho jo thi tseu. C. Hrtique. Ni kian tse. C. Personnage ennemi de Shkya. Ni kian tseu. C. Secte. Niladjan. S. Rivire. Nlntchana. S. Rivire. Ni lay feou to. C. Un des huit enfers froids. Ni li. C. Ville. Ni lian et Ni lian chen. C. Rivire. Ni ma lo thi. C. Dieu. Ni mo. C. Prince. Ni pan. C. (L'extinction.) Ni pan king. C. Livre sacr. Nipouna. P. Roi. Nirandjanam. P. Rivire. Nirandjara. Mg. Rivire. Nirarbouda. S. Un des huit enfers froids. Niraya. S. Les enfers. Nirmnakya. S. (Incarnation.) Nirvn'a. S. (L'extinction.) Nirvn'a de Foe. Ni sa khi. C. (Abandonner.) Nisbana. Mg. Naissance. Ni tho lo. C. Une des classes des livres sacrs. Ni tseu pou to. C. Un des huit enfers froids. Noub gii Balang bdjod dwp. T. Un des quatre Continents. Noung hioue ti yo. C. Un des enfers. Nyagrdha. S. Arbre. Nyya. S Nom d'un systme. O
Observances (les douze). Oeldzaitou tsoun. Mg. Un des huit emblmes. 'O feou to ou 'O pou to. C. Un des huit enfers froids. Oghadjitou arsalan. Mg. Prince. Oignon (montagnes de l'). Okkkaba. P. Roi. Okkkamouka. P. Roi. Olana ergudeksen khagan. Mg. Roi. 'O liu yi. C. Les douze mauvaises actions. Ombre de Foe. Om mani padm hom. T. Formule d'invocation. O pi. C. Personnage clbre. 'O po po. C. Un des huit enfers froids. Ortchilong i ebdektchi. Mg. Un des trois Bouddhas de la priode actuelle. Ortchilong tetkouktchi. Mg. Dieu. 'O tcha tcha. C. Un des huit enfers froids. Otchir bani. Mg. Saint personnage. Ou che yan na. C. Pays. Oud. S. Personnage de la famille des Shkyas. Oudna. S. Une des classes des livres sacrs. Oudasi. S. Roi. Oudjan. S. Pays. Oudoumbara. S. Arbre. Oudyna. S. Pays. Ou hou et Ou i. C. Royaume. Ouigours. Oulan mouran. Mg. Rivire. Oupdna. S. Un des Nidnas. Oupades'a. S. Une des classes des livres sacrs. Oupagoupta. S. Oupali. S. Disciple de Shkya. Oupasi. S. Saint personnage. Oupsika. S. (Fidles.) Oupaya. S. Un des six moyens de salut. Oupayi. S. (Femmes pures.) Ou pho so kia. C. (Oupsika.) Ou pho sse kia. C. (Oupayi.) Oupobatha. P. Roi. Ourouna Uker edlektchi dip. Mg. Un des quatre Continents. Ourouwilwa Ks'yapa. S. Converti par Shkya. Ou siun. C. Peuple. Ou sou man. C. Gnie. Ou sun tchhang. C. Pays. Ou tchang. C. Royaume. Ou tchang na. C. Pays. Ou tchha. C. Pays. Ou tho yan na. C. Roi. Ou tsan pho lo men. C. Arbre. Outtara Kourou. S. Un des quatre Continents. Outtarasanght'i. S. Vtement. Oxus. P Padjpat. P. Epouse de Souddhdana. Padma. S. (Nnuphar rouge.) Un des huit enfers froids. Padma pni. S. Saint personnage. Padmarga. S. Une des sept choses prcieuses. Padma tchenbo. T. Roi. Padmavati. S. Ville. Padouma. P. Un des huit enfers froids. Paktchhou. T. Fleuve. Pal. S. (Corail.) Pa lian fou ou foe. C. Ville. Palibothra. Ville. Pa lou cha. C. Ville. Pa nan tho. C. Dragon. Pan jo pho lo mi to. C. Livres sacrs. Pan ni houan. C. (L'extinction.) Pan ni phan. C. Pantchla. S. Le Pendj-b. Pantcha pra Pat'ha. P. Les empreintes du pied de Bouddha. Pan tche. C. Pan tche yue sse. C. Crmonie bouddhique. Pao chi. C. Monde. Pao ha. C. Saint personnage. Pao ing jou la. C. Nom d'un Bouddha. Pao tsang. C. Saint personnage. Pao yun. C. Samanen. Pardhimkcha. S. Lieu clbre. Pramita. S. Les dix moyens de salut. Paranirmitavas'avartit. S. Un des tages du ciel. Parasvati. S. Dieu. Parc des cerfs de l'Immortel, lieu consacr. Pari nirvn'a. S. Nirvn'a. Parisandjaya. P. Roi. Paswaga Mahanounansi. P. Les cinq grands prtres. Pa ta ling tha ming hao king. C. Ouvrage cit. Pt'alipoutra. S. Ville. Patcheka Bouddha. P. Classe de saints. Pa tche lo. C. (Le diamant.) Pa thi. C. Prince.
Patna. S. Ville. Ptra. S. (Pot.) Pchs (les huit) des religieuses. Pe fan. C. Roi. Pe tchhi. C. Coquilles-monnaie. Pe tching. C. Roi. Pe to. C. Arbre consacr. Pellelup. Sg. (Pat'alipoutra.) Pe lun. C. Livre bouddhique. Pendj-b. Pen sing. C. (Nature primitive.) Pen sse. C. (Affaire primitive.) Pen sse phin. C. Livre sacr. Pe Thian tchu. C. L'Inde du nord. Pe tsi. C. Pays. Pe tsing. C. Roi, pre de Shkya. P'halgou. S. Rivire. Phan jo pho lo mi. C. Un des dix moyens de salut. Phan tchao. C. Gnral chinois. Pheng la. C. Montagne. Phi che li. C. Royaume. Phi neou. C. Royaume. Phing cha. C. Roi. Phing wang. C. Roi. Phi siun. C. Roi des dmons. Phi yu. C. (Comparaison.) Pho fou. C. Personnage clbre. Pho kian. C. Temple. Pho kian lo pho. C. Royaume. Pho leou. C. Arbre. Pho li. C. Une des sept choses prcieuses. Pho lo. C. Pays. Pho lo. = Femme qui offrit du riz Bouddha. Pho lo i. C. (Corruption.) Pho lo men. C. (Brahmanes.) Pho lo na. C. Rivire. Pho lo na. C. Ville. Pho lo ni mi. C. Dieu. Pho lo pho. C. Gnie. Pho lo thi mou tcha. C. Prceptes. Pho lo thi mou tcha. = Lieu clbre. Pho lo thi thi che ni. C. Classe de prceptes. Pho lo tou lou. C. Pays. Pho lo yue. C. Monastre de la Colombe. Pho so. C. Prince. Pho sse no. C. Roi. Pho tho. C. Une des classes des livres sacrs. Pho ti ho. C. Rivire. Pho ti kia. C. (Cristal de roche.) Pho to. C. Kalpa des sages. Pho to li tsu. C. Ville. Pho tso fou lo. C. Une des classes des prceptes. Phou li. C. Pays. Phou liu. C. Pays. Phoulwari. S. Ville. Phou sa. C. Classe de saints personnages. Phou thi thang. C. (Estrade du Bodhi.) Phou wang Jou la. C. Pho y thi. C. (Tomber.) Phyough na rdor rdzie. T. Saint personnage. Pic d'Adam. Montagne. Pi cha men. C. Dieu. Pi che. C. (Vais'ya.) Pi che khin. C. Saint personnage. Pi che tche. C. Dmons. Pi chi. C. Hrtiques. Pied de Coq (montagne du). Pi foe lio. C. Une des classes des livres sacrs. Pi khieou. C. (Mendiants.) Pi khieou ni. C. (Mendiantes.) Pi leon. C. Gnie. Pi leou le tcha. C. Dieu. Pi lieou li. C. Dieu. Pi lieou po tcha. C. Dieu. Pi lo ma lo. C. Ville. Pi lo tchi. C. Mre de Chan tche ye. Pi lou chy kia. C. Personnage mythologique. Pi na ye. C. Une des classes des livres sacrs. Pin' d'aptika. P. (Mendier sa nourriture.) Ping tou tcheou. C. Ville. Pi ni. C. Prceptes. Pin po so lo. C. Roi. Pi phao tha. C. Sorte de tours. Pi pho chi. C. Nom d'un Bouddha. Pi pho lo et Pin pho lo. C. Lieu. Pis'ouna. S. Roi des dmons. Pit'aka. S. Signification de ce mot. Pi tchha ou Pi thsa. C. Royaume. Pi thsiu et mieux Pi tsou. C. (Mendiants.) Pi tsou ni. C. (Mendiantes.)
Po. C. (Pot.) Po lo si na chi to. C. Roi. Po lo so. C. (Corail.) Po lou lo. C. Pays. Po ma lo kia. C. Une des sept choses prcieuses. Po mao. C. Ville. Po na. C. Royaume. Pot de Foe. Potala. Ville. Po teou mo ou Po the mo. C. Un des huit enfers froids. Po thi. C. Personnage clbre. Po thi. = Chapelle. Po thi. = Arbre. Po to lo. C. (Pot.) Pou. C. Une des classes des livres sacrs. Pou chi. C. Un des dix Pramit. Pouchti kher. Montagne. Pou hiuan. C. Prince. Pou kia loung. C. Ile. Pou na. C. Rivire. Pou'nd'arka. S. (Nnuphar blanc.) Un des huit enfers froids. Poun'ya. S. (Pur.) Pourn'a. S. Pourout. S. Pays. Porvavideh. S. Un des quatre Continents. Poussa. Voyez Phou sa. Poussires (les six). Poutraka. S. Lgende relative ce personnage. Pou tsi tho. C. Saint personnage. Prabla. S. (Corail.) Pradigaboud. Mg. Classe de saints. Pradjn. S. (La science.) Pradjn pramita. S. Livres sacrs. Pramit. P. Princesse. Pranada. P. Roi. Prasendjit. S. Roi. Pratpa. P. Roi. Pratpa. = Un des huit principaux enfers. Pratimoksha. S. Prceptes. Pratyeka Bouddha. S. (Intelligences distinctes.) Prceptes (les dix). Prceptes (les dix). Prceptes suffisants. Prceptes (les dix). Trois sortes de prceptes. Prceptes (les dix). Diverses collections des prceptes. Prceptes (la tour des). Prcieuses (les sept choses). Prcieux (les trois). Prsages (les trente-deux). Prth. S. Dmons de la faim. Prithv. S. Divinit. Procds respectueux (les huit). Procession des images. Puissance surnaturelle. Py lieou li. C. Roi. Py lou tse kia. C. Roi. Py tchi Foe ou Py tchi kia lo. C. R Ra. S. (Le feu.) Rab dvang phyough ou Rab vangtchouk. T. Roi des dmons. Rachiyanideghetou. Mg. Roi. Racines (les six). Rdjagaha. Sg. et Rdjagriha. S. Ville. Rkchasi. S. Dmons femelles. Rama. Ratnagarbha. S. Saint personnage. Ratnkara. S. Saint personnage. Ratneya. S. Monde. Rurava. S. Un des huit enfers principaux. Ravi. Rivire. Rawanhrada. S. Lac. Ralits (les quatre). Repas (temps pour les). Rvolution (la grande et la petite). Voyez Translation. Riddhi. S. Puissance surnaturelle. Riddi khoubilgan. Mg. Puissance surnaturelle. Rishabna. S. Secte. Rodja. P. Roi. Rohini. S. Rivire. Rois de la roue. Tchakravarti. Rois du ciel (les quatre). Rooroomaga. Sg. Une des manifestations de Bouddha. Roues bouddhiques. Roues bouddhiques. Faire tourner la roue de la loi, Ropa. S. (Le corps.) Ropya. S. Une des sept choses prcieuses. Ropya vatchara. S. Le monde des formes. Routchi. P. Roi. S Sa. S. (La pense.) Sabbe kami Yasa. Sg. Personnage religieux.
Sadnand. S. Une des femmes de Shkya. Sgara. S. Roi des dragons. Sa ghim. T. Prince. Sahasra. S. Sa ho sa. C. Sai. C. Peuple. San bousou nidoutou. Mg. Dieu. S'akra, S'akrardja et S'akradeva. S. (Indra.) Sakridgm. S. Classe de saints. Sla. S. Arbre. Saltchan. Mg. Roi. Samdhi. S. (L'extase.) Smana. P. (Samanen.) Samana kouta et Samanhela. Sg. Montagne. Sambhogakya. S. Un des trois tats de Bouddha. Samdjvana. S. Un des huit enfers principaux. Samght. S. Un des huit enfers principaux. Samkassa. P. Royaume. Samyuktgama. S. Livre sacr. Samyuktanikya. S. Livre sacr. Sandjaya. S. Hrtique. Sanga. S. Nom collectif des religieux. Sanga. Division des Sangas en quatre classes. Sanga.= Un des trois Prcieux. Sanggram. S. (Monastres.) Sanght'i. S. Vtement des Bouddhistes. Sang men. C. Le mme que Cha men. Sa ni. C. Gnie. Saninktenikaya. Sg. Livre sacr. Sankhya. S. Secte. San mi ou San me. C. (L'extase.) San mo ye. C. Temps pour les repas. Sansra. S. (La matire.) Sanskra. S. Un des douze Nidnas. San tsang. C. Collection des livres religieux. San tsang. Valeur de cette expression. San tsang fa sou. C. Ouvrage bouddhique. Sa pho. C. (Marchands.) Sa pho to. C. Un des recueils des prceptes. Sapta Bouddha stotra. S. Ouvrage cit. Saques (les). Peuple. S'radwatii bou et S'ri bou. T. (S'ripoutr.) S'aril. Mg. (S'arira.) S'ripoutra. S. Disciple de Shkya. S'rira. S. (Reliques.) Srthavha. S. (Marchands.) Sarvakmi Yas'a. S. Personnage religieux. Sarvrtha siddha. S. Nom de Shkya. Sarvastouti. S. Une des femmes de Shkya. Sa so cha ti. C. Monastre. Sa tchi ou Sa tchi sieou ma. C. Dieu. Sa tho. C. Nom de Bouddha dans une de ses existences antrieures. Sattwa. S. Le mme que le prcdent. Sugandhika. S. Un des enfers froids. Savaloka. S. Monde. Sectes. Segher sandalitou khagan. Mg. Roi. Seng. C. Explication de ce mot. Seng. = Un des douze Nidnas. Seng. = Un des trois Prcieux. Seng chao. C. Compagnon de Fa hian. Seng fang. C. (Monastres.) Sengghe h, ghram. T. Prince. Seng kia. C. Un des trois Prcieux. Seng kia. = Secte. Seng kia chi. C. Royaume. Seng kia lan. C. Sorte de monastre. Seng kia lan. - Explication de ce mot. Seng kia li. C. Manteau des religieux. Seng kia li. C. Manteau de Foe. Seng kia lo. C. Royaume de Ceylan. Seng kia lo. = Prince. Seng kia po chi cha. C. Une des classes des prceptes. Seng kia ti. C. La mme chose que Seng kia li. Seng king. C. Compagnon de Fa hian. Se pho ti kia. C. (Cristal de roche.) Spultures (les quatre). Ser s,kya g,ji ou Ser s,kya ghrong. T. Royaume. Setledj. Rivire. Shkya. S. Nom d'un ancien Bouddha. Shkya. = Nom de famille d'un Bouddha. Shkya mouni. Bouddha terrestre. Shkya mouni. Sa prdication dans le royaume de Kapila. Shkya mouni. Principales poques de sa vie. Satiwa. S. Le mme que le prcdent. Sugandhika. S. Un des enfers froids. Savaloka. S. Monde. Sectes. Segher sandalitou khagan. Mg. Roi. Seng. C. Explication de ce mot.
Seng. = Un des douze Nidnas. Seng. = Un des trois Prcieux. Seng chao. C. Compagnon de Fahian. Seng fang. C. (Monastres.) Sengghe h, ghram. T. Prince. Seng kia. C. Un des trois Prcieux. Seng kia. = Secte. Sengkia chi. C. Royaume. Seng kia lan. C. Sorte de monastre. Seng kia lan. Explication de ce mot. Seng kia lan. C. Manteau des religieux. Seng kia lan. C. Manteau de Foe. Seng kia lo. C. Royaume de Ceylan. Seng kia lo. = Prince. Seng kia po chi cha. C. Une des classes des prceptes. Seng kia ti. C. La mme chose que Seng kia li. Seng king. C. Compagnon de Fabian. Se pho ti kia. C. (Cristal de roche.) Spultures (les quatre). Ser s,kya g,ji ou Ser s,kya ghrong. T. Royaume. Setledj. Rivire. Shkya. S. Nom d'un ancien Bouddha. Shkya. = Nom de famille d'un Bouddha. Shkya mouni. Bouddha terrestre. Shkya mouni. Sa prdication dans le royaume de Kapila. Shkya mouni. Principales poques de sa vie. Shkya mouni. - Sa gnalogie. Shkya mouni. Lgendes. Shkya mouni. Epoques de sa naissance et de sa mort discutes. Shkya mouni. Premires rdactions de sa doctrine. Shkya mouni. Voyez Foe et cf. p. 181, 271, 289, 309, 311. Shkyas (famille des). Shkya sinha. S. Surnom de Shkya. Shatamanyou. S. Nom d'Indra. Si'an. C. Ville. Son ancien nom. Siang ti yo. C. Un des huit enfers brlants. Siao cheou lin. C. Roi de Core. Siao kou chy chan. C. Montagne. Siao kou wang. C. Roi de Core. Siao tching. C. La petite translation. Sida. T. Le Si to. Sidda ou Childa. Mg. Nom du Sind. Siddha. S. (Shkya mouni.) Siddhrta. S. Le mme. Sieou fan ma. C. Pre de Mi le Phou sa. Sieou lo. C. Gnies. Sieou to lo. C. Classe de livres sacrs. Shahnou. P. Prince. Shassara. P. Roi. Sikhi. S. (Le grand Brahma.) Sikhi. = Nom d'un Bouddha. S'la. S. Un des six moyens de salut. S'lavritta. S. Monastre. Simnou ou Chimnou. Mg. Dmons. Sind. Fleuve. Sindhou. T. Sing dzing khampa. T. Le mme que Sing tchou. Sing tchou. C. Branche de l'Indus. Sinhahna kabn. P. Prince. Sinhala. S. Royaume de Ceylan. Sinhala. = Prince. Sinhndandi. S. Saint personnage. Sinhsana. S. (Trne du lion.) Sinhavhana. P. Roi. Si ning fou. C. Ville. Sin lo. C. Pays. Sin theou. C. L'Inde. Sin theou. = Le Sind, fleuve. Si phing. C. Ville. S'iravasti. S. Pays. Sirgaldzin gol. Mg. Rivire. S'ircha. S. Arbre. Si tha et Si tha to. C. Nom de Shkya. Si to. C. Fleuve. Siu ma thi. C. Mauvais gnie. Siu mi. C. Le mme que Sou merou. Siu mo thi. C. Personnage clbre. Siu pho foe. C. Pays. Siu po. C. Saint personnage. Siu ta nou. C. Une des manifestations de Bouddha. Siu tha. C. Patriarche. Siu than. C. Personnage clbre. Siu tho houan ou Siu tho wan. C. Classe de saints personnages. Siu ye che. C. Personnage clbre. Si ye. C. Pays. Skandha. S. (Les cinq amas.) Skya nar ghi bou. T. Ville. S'mas'na. S. (Cimetire.) S'ms'nika. S. Une des douze observances. Sobhanavati. S. Ville.
Sogdiane (la). So kie. C. Roi des dragons. So kie lo. C. Le mme. So ko lo. C. Gnie. So lo. C. Arbre. S'on'a. S. Rivire. Soubhadra. S. Saint personnage. Soudt. S. Patriarche. S'ouddhdana. S. Roi. Soudjatawou. Sg. Offre du riz Bouddha. Sou fa lo. C. Une des sept choses prcieuses. Soui. C. Peuple. Souillures (les trois). Sou thsou thang chou mou. C. Ouvrage cit. Sou jin. C. Explic. de ce terme. Souk'hvati. S. Monde. S'oukldana. P. Roi. Sou le. C. Khashgar. Souleiman kouh. Petites Montagnes de neige. Sou lin. C. Montagne. Sou ma. C. Tour. Sou merou. S. Montagne. Soung. C. (Chant.) Soung yun tse. C. Son voyage dans le Ou tchang. S'ounyat. S. Gnie. Sou pho fa sou thou. C. Fleuve. Sou po tho lo. C. Saint personnage. Souppabouddha. P. Prince de la race des Shkyas. Souprabouddha. S. Pays. Souroutchi. P. Roi. Sorya vans'a. S. Prince de la famille des Shkyas. Sou ta lan. C. Livres sacrs. (Sieou to lo.) Soutanou. S. Une des manifestations de Bouddha. Sou tha to. C. Patriarche. Sou theou. C. Fleuve. Sou theou pho et Sou tou po. C. Tour. Sotra. S. Une des classes des livres sacrs. Sotra. = Une des quatre castes. Sotra pit'aka. S. Livre sacr. Soutternipata et Sotranipta. S. Livre sacr. Souva Bouddha. S. Beau-pre de Shkya. Souvarn'a. S. Une des sept choses prcieuses. Souwarna prabhsa. S. Ouvrage cit. Spars'a. S. Un des douze Nidnas. Sphat'ika. S. (Cristal de roche.) S'rman'a. S. (Samanen.) S'rvakas. S. (Auditeurs.) S'rvasti. S. Ville. S'renka. S. Roi. S'ri. S. S'rgod'ha. S. Personnage clbre. Srivasta. S. Un des huit emblmes des neuf Bodhisattwas. S'rotpanna. S. Classe de saints personnages. Sse fen liu. C. Les quatre sections. Sse na. C. Lieu et personnage clbres. Sse pe. C. Les quatre troupes. Sse pou. C. Les quatre classes. Sse tho han. C. Classe de saints. Sse tseu koue. C. Ceylan. Sthaviravda. S. Livre sacr. Sthopa. S. Tour. Sthopa. Sthopas clbres. Su ho to. C. Royaume. Sukkodana. P. Prince. Sun to li. C. Swarn'awat. S. Rivire. Swastika. S. Croix mystique. Sy tchang. C. (Bton d'tain.) Sy tha. C. Le mme que Si tha. Szu. C. Un des douze Nidnas. Szu chy eul tchang king. C. Ouvrage bouddhique. Szu kia na pho. C. Royaume. Szu tsu kie wang. C. Prince. T Ta 'ai. C. Personnage. Ta 'ai tao. C. Tante de Shkya. Ta chen seng wang. C. Un des anctres de Shkya. Tadjiks (les). Peuple. Taegri. Mg. Les dieux. Ta fang Foe hoa yen. C. Livre sacr. Tagoutsilan iraksan. Mg. Un des titres des Bouddhas. Ta hia. C. Les Dahoe. Peuple. Ta Kiao wen ti yo. C. Un des huit enfers brlants. Ta kouang ming. C. Nom d'un Bouddha. Tla. S. Arbre sacr. Tamalipti, Tamalitti et Tamralipti. S. Ville. Ta mao thsao. C. Roi. Tamlouk. Ville. Tamoghna. S. Une des classes des prceptes. Tan ou Tan na. S. (Aumnes.)
Tangsouk ideghetou. Mg. Roi. Tan mo ly ti. C. Royaume. Tan the. C. Montagne. Tantra. S. Tan wou te ou Tan mo khieou to. C. Une des classes des prceptes. Tan youe. C. Explication de ce mot. Tao 'an. C. Nom propre. Tao jin. C. Explication de ce terme. Tao li (ciel de). C. Tao sse. C. Secte. Tao tching. C. Un des compagnons de Fa hian. Tpa. S. Un des huit enfers principaux. Tpsdjuye. Lgende relative ce personnage. Tapasvi. S. Pnitent. Tapasvi mouni. S. Saint personnage. Ta pe. C. Livre sacr. Ta pe Phou sa. C. Ta pho. C. Synonyme de sthopa. Ta Tchao tchy ti yo. C. Un des huit enfers brlants. Ta tchi chi. C. Titre d'un Bodhisattwa. Ta tching. C. La grande translation. Ta tchoung. C. Secte. Ta tchy tou lun. C. Livre sacr. Ta te. C. Pre de Keou na han meou ni Foe. Tathgata. S. Un des titres des Bouddhas. Tathgata. Formules des Tathgata. Ta thoung ho. C. Rivire. rTa tol. T. Personnage clbre. Ta wan. C. Pays, le mme que Farghana. Tcha che ma li. C. Arbre. Tcha. C. (Djeuner.) Tchatya. S. Tabernacle. Tchakra. S. (Roues.) Roues. Tchakravarti. S. Rois de la roue. Tchamp. S. Ville. Tchanakya. S. Nom d'un Brahmane. Tchandagoutta P. et Tchandragoupta. S. Roi. Tchan'dls. S. Secte. Tchandamoukha. P. Roi. Tchandim. P. Roi. Tchang cheou. C. Prince. Tchang kian. C. Gnral chinois. Tchang kian. Son expdition dans l'Asie centrale. Tchang y. C. Pays. Tchao sian. C. La Core. Tchao tchy ti yo. C. Un des huit enfers brlants. Tchao ya. C. (Java.) Tcha phi. C. (Combustion.) Tcharaka. P. Roi. Tchatrapati. S. Le chef du parasol. Tchay lang ti yo. C. Un des seize enfers. Tche lo kia lo. C. Royaume. Tchen pho. C. Royaume. Tchen tcha lo. C. Secte. Tchen tche mo na. C. Son accusation contre Foe. Tchen tho lo. C. Le mme que Tchen tcha lo. Tcheou. C. Coude. Tcheou. = Une des classes des livres religieux. Tche pho. C. (Java.) Tchetiya. P. Roi. Tche to kia. C. Une des classes des livres sacrs. Tchhang 'an. C. Ville. Tchhang houan. C. Personnage religieux. Tchhang kouang kiun. C. Ville. Tchhe sse. C. Peuplade. Tchhe ti. C. Edifice clbre. Tchhouan. C. (Roues.) Tchhu. C. Un des douze Nidnas. Tchi che. C. Nom d'un gnie. Tchi houan. C. Temple. Tchikhola aktchi. S. Saint personnage. Tchinb. Rivire. Tchin chou kia. C. Arbre et pierre prcieuse. Tching. C. (Translation.) Signification de ce mot. Tchin tchha, Tchin cha ou Tchen che. C. Tchin yue. C. Vtement des religieux. Tchi tchang. C. (Bton.) Tchi tho ou Tchi to. C. Temple. Tchi tsy. C. Saint personnage. Tchi yan. C. Compagnon de Fa hian. Tchou fa lan. C. Samanen. Tchoung ho. C. Un des huit enfers brlants. Tchoung koue. C. Royaume du milieu (l'Inde centrale). Tchouri. S. Un des huit emblmes des neuf Bodhisattwas. Tchu. C. Poids. Tchu cha chi lo. C. Royaume. Tchu kiu pho ou Tchu khiu phan. C. Pays. Tchu yi. C. Vtement. Tchy mang. C. Nom propre. Tchyoutasira. S. Pays.
Tegolder amourliksan. Mg. Saint personnage. Te jo. C. Pays. Temples (Tsing tche). Les cinq principaux. Teng ching. C. Roi. Teng ho ti yo. C. Un des huit enfers brlants. Teou. C. Boisseau; sa capacit. Teou chou. C. Le mme que Teou sou. Teou seou pho. C. Tour. Teou sou ou Teou sou tho. C. Un des tages du paradis. Terre. Sa division, suivant les cosmographies bouddhiques. Ters. Mg. Hrtiques. Te tchang. C. (Bton.) Tha. C. Tour. Thab bral. T. Dieu. Tha li lo. C. Ruisseau. Tha mo. C. Un des trois Prcieux. Tha mo in tho ho sse. Roi de Outchang. Sa lettre l'empereur de la Chine. Tha mo kiu ti. C. Saint personnage. Tha thsen. C. Royaume. Theou chy. C. Sorte de pierre. Theou tho. C. Les douze observances des mendiants. Thi. C. (Dwpa, le.) Thian. C. Les dieux. Thian sse. C. Temples des dieux des Brahmanes. Thian tchu. C. L'Inde. Thian tchu. = Dieux matres du ciel. Thian tou? (Thian tchu) [l'Inde]. Thiao tha. C. Ennemi de Shkya. Thi che. C. Gnie. Thi ho 'we. C. Pays Thing tha. C. Explication de ce terme. Thi pho tha tou. C. Le mme que Thiao tha. Thi theou la tho ou Thi to lo tho. C. Dieu. Thi ting ti yo. C. Un des enfers. Thi wan ti yo. C. Un des seize enfers. Tho lo. C. Temple. Tho lo ni. C. Livres sacrs. Tho ly. C. Royaume. (Darada?) Thoung. C. (Intelligence.) Thoung. = (Dsir.) Un des Nidnas. Thsa yn. C. Sa mission dans l'Hindoustan. Thsangs-pa. T. (Brahma.) Thsin (la terre de). La Chine. Thsin occidentaux, dynastie. Thsin. C. Un des douze Nidnas. Thsing. C. Rivire. Thsing tcheou. C. Ville. Thsing yan. C. Foe dans une de ses existences antrieures. Thsin king. C. Lettr clbre. Thsin king. Sa mission dans l'Hindoustan. Thsy tchoung. C. Les sept multitudes. Thun houang. C. Ville. Ti. C. Peuple. Tian chou koue. C. Cabinet des affaires trangres. Tiao tchi. C. Peuple. Ti chy. C. (Indra.) Ting kouang. C. Nom d'un Bouddha. Tingsa-b-osteng. Fleuve. Le mme que Tiz-b. Ti yo. C. Les enfers. Tiz-b. Fleuve. To mo li ti. C. Royaume. To toung ho ti yo. C. Un des enfers. Touan nie. C. Prince. Touigochal. Md. Une des bouches du lac A neou tha. Tou kio. C. Classe de saints. Toung ho ti yo. C. Un des enfers. Tour de cent toises. - Tour des Lo han . Tour des Py tchi Foe. Tour de Lan mo. Tour des Charbons. Tour des Arcs et des armes dposs. Tours ou Pagodes. Tours de dlivrance. Tours (les quatre grandes). Toushit. S. Un des tages du paradis. Tou we. C. Ville. Touy ya ti yo. C. Enfer des montagnes comprimes. Tratchvarika. S. Une des douze observances. Trang srong tsien po. T. Saint personnage. Translation (la grande et la petite). Translation (la grande et la petite). Livres sacrs de chacune. Trayastrinsh. S. Un des cieux superposs. Tremblements de terre (causes des). Triade suprme. Triades bouddhiques. Tribulations de Shkya (les neuf). Trichn'. S. Un des Nidnas. Triratna. S. Les trois Etres prcieux. Troupes (les quatre).
Tsagha ideghetou. Mg. Prince. Tsa tchu. C. Mre de Ks'yapa. rTsa mtchogh grong. T. Ville. Tsang. C. Explication de ce mot. Tsang (les trois). C. (Contenants.) Tsang liu. C. Les prceptes. Tsa sou i. C. Vtement. Tseu ho. C. Royaume. Tseu li. C. Ancien nom du Jou la. Tseu ti. C. Expression explique. Tsiang. C. (Bouillon.) Tsi chun liu in. C. Saint personnage. Tsieou fung. C. Montagne. Tsin ching Jou la. C. Bouddha. Tsin fan. C. Epoux de Mah may. Tsing che. C. Temples. Tsing fan wang. C. Roi. Tsing tsin. C. Explication de ce terme. Tsios mdon pa. T. Une des classes des livres sacrs. Tso. C. Peuple. Tsoktsas-un djirouken. Mg. Roi. Tsoung ling. C. Montagne. S. Tsun tche. C. Titre de Mou lian. Tu kio. C. (Intelligence distincte.) U Ulumtchi tareltou. Mg. Dieu. Uplisthavira. Sg. Saint personnage. Upatcharaka. P. Roi. Urus sar. Mg. Jour de la naissance de Shkya. Utphala. S. Un des huit enfers froids. V Va. S. (L'eau.) Vda. S. (Comparaison.) Vadjra. S. (Le diamant.) Vadjra atcharya. S. Laques bouddhistes. Vadjra pni. S. Personnage mythologique. Vadourya. S. (Lapis lazuli.) Vapoulya. S. Une des classes des livres sacrs. Varag. S. Mre de Chan tche ye. Vas'li. S. Ville. Vashesika. S. Secte. Vasya. S. Une des quatre castes. Vana. S. (Fort.) Vananda. S. Dragon. dVang po. T. Indra. Varamandhta. P. Roi. Varan'. S. Rivire. Varan'as. S. Ville. Vararodja. P. Roi. Varggatchri. S. Classe de saints. Vrisra. S. Roi. Varoun'a. S. Divinit. Vaste solitude (temple de la). Vatch. (L'Oxus.) Vatsapattana. S. Ville. Vautour (montagne du). Vyou. S. Divinit. Vdan. S. Un des Nidnas. Vdas (les). Vdas (les). Secte des Vdas. Vrits (les quatre). Vrits (les six). Vesli et Vesaliya pouri. P. Ville. Vessantara. P. Roi. Vtements des religieux. Vibhoti. S. Sectaires. Vichn'oumitra. S. Saint personnage. Vidha. S. (Oriental.) Vidjaya. S. Prince. Vidora. S. Montagne. Vihra. S. Sorte de temple. Vijeya. Sg. Prince. Vimaladjana in koundi. Vimbasra. Voyez Bimbasra. Vinaya. S. Une des classes des livres sacrs. Vinna pittaka. Sg. Livre sacr. Vipas'yi. S. Nom d'un Bouddha. Vrya. S. Un des dix Pramit. Visalah. Sg. Ville. (Vas'li.) Visatcha. S. Dmons. Vishn'ou. S. Dieu. Vis'wabhou. S. Nom d'un Bouddha. Vtarga [les huit]. S. (Emblmes.) Voies (les six). Vrikchamolika. S. Une des douze observances. Vtchir ban'i. Mg. Saint personnage. Vues (les sept). Vykarana. S. Une des classes des livres sacrs. W Wa tao. C. (Hrtique.)
Wakshou. (L'Oxus.) We. C. Mesure de dimension. We ou We to. C. Dieu. We che wen. C. Gnie. We chi. C. Sectaire. We ni. C. Jardin. We tho. C. Les Vdas. We yi. C. Les quatre actions. Wemboure nomoun. Md. Les prceptes. Wen ta lo si na. C. Roi d'Outchang. Wen tchu sse li. C. Personnage mythologique. Wen tchu sse li. = Titre des Brahmanes. Wen we. C. Ville. Widjnna. S. Un des douze Nidnas. Wilford. Ses travaux sur la gographie des Pouranas. W pho. C. Immortel. Wou ching. C. Personnage religieux. Wou kian ti yo. C. Un des huit enfers brlants. Wou liang. C. (Cent quintillions.) Wou liang cheou. C. Nom d'un Bouddha. Wou liang thsing tsing. C. Roi. Wou ming. C. (Ignorance.) Wou nou. C. Roi. Wou tseng nian. C. Roi. Wou 'we. C. Monastre. Wou youan. C. Roi. Wou yu. C. Roi. Y Yaksha ou Yakcha. S. Yakka. P. Dmons. Yma. S. Roi des enfers. Yamoun. S. Rivire. Yna. S. (Translation.) Signification de ce mot. Yan feou thi. C. Second des quatre Continents. Yang ba djian. T. Ville. Yang chi Go di ni ya. T. Saint personnage. Yanghi hissar. Le mme que Ingachar. Yang leou. C. Montagnes. Yang tcheou. C. District chinois. Yan lagh s,kyes. T. Prince de la famille des Shkyas. Yan lo. C. Roi des dmons. Yan ma lo ou Yan mo lo. C. Dieu de la mort. Yan sse. C. Fille du roi des dragons. Lgende. Yao heng. C. Prince. Yas'odhar. P. Princesse de la race des Shkyas. Ythpant'ari. P. Une des douze observances. Yava dvpa. S. Java. Ya yang seng. C. Un des Sangas. Ye cha, mieux Yo cha. C. Dmons. Yek Linkhoa. Mg. Roi. Ye ma. C. Roi des enfers. Yeou. C. Un des douze Nidnas. Yeou lo tho wang. C. Un des anctres de Shkya. Yeou pho chy kia. C. (Oupsika.) Yeou pho i. (Femmes pures.) C. Yeou pho kieou to. C. Patriarche. Yeou pho li. C. Disciple de Shkya. Yeou pho lo. C. Sainte mendiante. Yeou pho se. C. (Hommes purs.) Yeou pho ti che. C. Une des classes des livres sacrs. Yeou siun. C. Mesure de longueur. Yeou tho. C. Personnage de la famille des Shkyas. Yeou tho na. C. Une des classes des livres sacrs. Yeou thseng yo. C. Enfers. Yeou yan. C. Mesure de longueur. Ye pho lo. C. Pays. Ye pho ti. C. Royaume. Yerkiyang. Ville. Ye tcha. C. Saint personnage. Ye tha. C. Les Gtes. Yin tou. C. Pour Sin theou, l'Inde. Yn [les cinq]. C. (Imperfections.) Y na. C. Pays. Yn fou ti yo. C. Un des seize enfers. Yng. C. Prince de Tchou, embrasse le bouddhisme. Yng kiue. C. Gnie. Yng kiu ma lo. C. Le mme. Yn kouang. C. Secte. Yn tho lo chi lo kiu ho. C. Montagne. Yn yuan [les douze]. C. (Conditions de l'existence.) Conf. Yo cha. C. Dmons. Yodjana. S. Mesure de longueur. Yonti. Prtre bouddhique. Yo po lo. C. Un des huit enfers froids. Yo to leou. C. Gnie. Youan tou. C. Pour Sin theou, l'Inde. Youe chi. C. Le mme que Yue chi. Youe ti. C. Gtes. Youl arik. Pays. Young dhroung pa. T. Secte.
Young sse tchhing. C. Ville. Youtti. Peuple. Yo wang. C. Saint personnage. Y thsy kouang ming koung te chan wang Jou la. C. Yuan. C. Expression explique. Yuan kio. C. (Intelligences distinctes.) Yuan tchhouan. C. Ville. Yu chen na. C. Mesure de longueur. Yue chi. C. Peuple. Yue tchi ou Yue ti. C. Peuple. Yue ti (les petits). C. Yu hoe. C. Royaume, Yu kia lo. C. Roi des dragons. Yu kin. C. Espce d'herbe odorifrante. Yu tan yue. C. Un des quatre Continents. Yu theou lan foe. C. Lieu clbre. Yu thian. C. Royaume, le mme que Khotan. Yu to lo seng. C. Vtement. Z Zang den. T. Personnage clbre. Zas d, kur. T. Prince. Zas d, zzang ma. T. Prince. Zhobi. Rivire. TABLE DES CHAPITRES. Introduction CHAP. I. Dpart de Tchhang'an. - Monts Loung. - Thsin d'occident. - Liang du midi. - Liang du nord. - Thun houang. - Dsert de sable CHAP. II. Royaumes de Chen chen. - Ou hou. - Kao tchhang CHAP. III. Royaume de Yu thian CHAP. IV. Royaume de Tseu ho. - Monts Tsoung ling. - Royaume de Yu hoe CHAP. V. Royaume de Kie tchha CHAP. VI. Monts Tsoung ling. - Neiges perptuelles. - Inde du nord. - Royaume de Tho ly. - Colosse de Mi le Phou sa CHAP. VII. Fleuve Sin theou CHAP. VIII. Royaume d'Ou tchang. - Empreinte du pied de Foe CHAP. IX. Royaume de Su ho to CHAP. X. Royaume de Kian tho we CHAP. XI. Royaume de Tchu cha chi lo. - Le tigre affam CHAP. XII. Royaume de Foe leou cha. - Pot de Foe CHAP. XIII. Royaume de Na kie. - Ville de Hi lo. - Os du crne de Foe. - Dent de Foe. - Bton de Foe. - Manteau de Foe. - Ombre de Foe CHAP. XIV. Petites Montagnes de neige. - Royaume de Lo i. - Royaume de Po na. - Fleuve Sin theou CHAP. XV. Royaume de Pi tchha CHAP. XVI. Royaume de Mo theou lo. - Rivire de Pou na CHAP. XVII. Royaume de Seng kia chi CHAP. XVIII. Ville de Ki jao i. - Rivire Heng. - Fort de Ho li CHAP. XIX. Royaume de Cha tchi CHAP. XX. Royaume de Kiu sa lo. - Ville de Che 'we. - Temple de Tchi houan. - Ville de Tou we CHAP. XXI. Ville de Na pi kia. - Lieu de la naissance de Keou leou thsin foe et de Keou na han meou ni foe CHAP. XXII. Ville de Kia 'we lo 'we. - Champ du roi. - Naissance de Foe CHAP. XXIII. Royaume de Lan mo. - Etang du dragon. - Aventure du roi A yu avec le roi des dragons. - Elphants qui font le service prescrit par la loi CHAP. XXIV. Tour des Charbons. - Ville de Kiu i na kie. - Rivire Hi lian CHAP. XXV. Royaume de Phi che li. - Tour de la moiti du corps d'Anan. - Jardin de la femme An pho lo. - Lieu o Foe entra dans le Nirvn'a. - Tour des arcs et des armes dposs. - A nan ne prie pas Foe de demeurer dans le sicle. - Recueil des actions et des prceptes de Foe CHAP. XXVI. Runion des cinq rivires. - Nirvn'a d'A nan. - Sa mort au milieu du fleuve CHAP. XXVII. Royaume de Mo kie thi. - Ville de Pa lian foe. - Mont Khi tche kiu. - Montagne leve par les gnies. - Fte pour l'anniversaire de la naissance de Foe. Hospices. - Empreinte du pied de Foe. - Inscription. - Ville de Ni li CHAP. XXVIII. Montagne du Rocher isol. - Hameaux des Na lo. - Nouvelle ville de la Rsidence royale. - Les cinq Montagnes. - Ancienne rsidence du roi Ping cha. Jardin d'An pho lo CHAP. XXIX. Pic de Khi tche. - Le dmon Phi siun se mtamorphose en vautour. - Peur d'A nan. - Trne des quatre Bouddhas. - Pierre jete contre Foe par Thiao tha. Sacrifice de Fa hian CHAP. XXX. Jardin des bambous de Kia lan tho. - Chi mo che na, ou le cimetire. - Grotte de Pin pho lo. - Maison de pierre Tchhe ti. - Premire collection des paroles de Foe. - Caverne de Thiao tha. - Pierre noire du Pi khieou CHAP. XXXI. Ville de Kia ye. - Lieu o Foe vcut pendant six ans dans les macrations. - Lieu o il accomplit la loi. - Il est expos aux attaques du dmon. - Autres lieux saints. - Quatre grandes tours en l'honneur de Foe CHAP. XXXII. A yu devient roi de la roue de fer et rgne sur le Yan feou thi. - Il visite l'enfer. - Fait construire une prison pour punir les criminels. - Histoire d'un Pi khieou qui entra dans cette prison. - Le roi se convertit
Vous aimerez peut-être aussi
- Magie Et Religion Dans L'afrique Du Nord, Edmond DouttéDocument628 pagesMagie Et Religion Dans L'afrique Du Nord, Edmond Douttémohammed bousettaPas encore d'évaluation
- Martines de Pasqually - Traite de La RéintégrationDocument363 pagesMartines de Pasqually - Traite de La RéintégrationstilbonePas encore d'évaluation
- Stephen Jourdain - WikipédiaDocument5 pagesStephen Jourdain - WikipédiaGerrit06Pas encore d'évaluation
- André Padoux - Mantra Et CorpsDocument16 pagesAndré Padoux - Mantra Et Corpsbb100% (1)
- Blocages Socio-Culturels DéveloppementDocument12 pagesBlocages Socio-Culturels DéveloppementabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Histoire Authentique de La Société ThéosophiqueDocument483 pagesHistoire Authentique de La Société ThéosophiquesantseteshPas encore d'évaluation
- La Mouche - Jacob LorberDocument55 pagesLa Mouche - Jacob Lorberestaran25% (4)
- Le VRAI Rôle de La France Dans Le Processus de L'ascension Planétaire - Laurent Dureau - 5D6D - 16 Janvier 2012Document10 pagesLe VRAI Rôle de La France Dans Le Processus de L'ascension Planétaire - Laurent Dureau - 5D6D - 16 Janvier 2012Les TransformationsPas encore d'évaluation
- Livret FR en PDFDocument145 pagesLivret FR en PDFFoto GrafPas encore d'évaluation
- Dupuis Charles-François - Origine de Tous Les Cultes, Ou Religion Universelle Volume 1Document578 pagesDupuis Charles-François - Origine de Tous Les Cultes, Ou Religion Universelle Volume 1slimane g100% (2)
- Kelly, Edward - Les Ecrits AlchimiquesDocument79 pagesKelly, Edward - Les Ecrits AlchimiquesAnonymous 8VbEv5tA3100% (1)
- La Parabole de Mars de Busto NicenasDocument6 pagesLa Parabole de Mars de Busto NicenasBelhamissi100% (1)
- Boyance TetractysDocument8 pagesBoyance TetractysYves le BrasPas encore d'évaluation
- La Vie Mysterieuse n42 Sep 25 1910Document16 pagesLa Vie Mysterieuse n42 Sep 25 1910XymoxPas encore d'évaluation
- Dupuis Charles-François - Origine de Tous Les Cultes, Ou Religion Universelle Volume 2Document645 pagesDupuis Charles-François - Origine de Tous Les Cultes, Ou Religion Universelle Volume 2slimane gPas encore d'évaluation
- Pierre Deleage - Livres Et RituelsDocument22 pagesPierre Deleage - Livres Et RituelsEric WhitePas encore d'évaluation
- Practicalkabbalah Part1Document188 pagesPracticalkabbalah Part1Alvaro De PazPas encore d'évaluation
- (Esotérisme) (Divers) (FR) Les Contes de Fée Du TibetDocument17 pages(Esotérisme) (Divers) (FR) Les Contes de Fée Du TibetMarc ViotPas encore d'évaluation
- Philo - Federico González - René Guenon (Autour De) - Esoterisme Au XXI Siècle - 2Document123 pagesPhilo - Federico González - René Guenon (Autour De) - Esoterisme Au XXI Siècle - 2Stradin Bien Aime100% (1)
- Panther, Oscar - Augustin Et La ManichéismeDocument0 pagePanther, Oscar - Augustin Et La ManichéismeThomas XPas encore d'évaluation
- Totem - 1 - Livre U1 PDFDocument24 pagesTotem - 1 - Livre U1 PDFkim hoaPas encore d'évaluation
- Interpretations Spirituelles de LalchimiDocument10 pagesInterpretations Spirituelles de LalchimiVince 04100% (1)
- Les 3 Livres de La Vie FicinDocument435 pagesLes 3 Livres de La Vie Ficinsantsetesh100% (1)
- Pentagramme, Pentalpha Et PentacleDocument22 pagesPentagramme, Pentalpha Et PentacleThechosen WolfPas encore d'évaluation
- The Ashtavaka Gita PDFDocument17 pagesThe Ashtavaka Gita PDFDeroy GarryPas encore d'évaluation
- 16 Guénon, Le Centre Du Monde Dans Les Doctrines Extreme-OrientDocument5 pages16 Guénon, Le Centre Du Monde Dans Les Doctrines Extreme-OrientBelhamissiPas encore d'évaluation
- Eckartshausen. Nuée Sur Le SanctuaireDocument41 pagesEckartshausen. Nuée Sur Le Sanctuairepedro_el_loboPas encore d'évaluation
- Les Dix Mille EtresDocument15 pagesLes Dix Mille EtresTurba PhilosophorumPas encore d'évaluation
- La Tradition 1887-05 (N2)Document38 pagesLa Tradition 1887-05 (N2)kaldeterPas encore d'évaluation
- Traite Sur Le Réintégration Des ÊtresDocument396 pagesTraite Sur Le Réintégration Des ÊtresThierry Bouzat100% (2)
- Le Corps de L'âme Et Ses États Taylor 2009Document13 pagesLe Corps de L'âme Et Ses États Taylor 2009vmanriquez14035Pas encore d'évaluation
- Mensonge 04 PDFDocument201 pagesMensonge 04 PDFkarpov604604Pas encore d'évaluation
- Vajra YanaDocument70 pagesVajra YanahautrivePas encore d'évaluation
- Barbarin Georges - Réhabilitation de Dieu PDFDocument71 pagesBarbarin Georges - Réhabilitation de Dieu PDFmarcoPas encore d'évaluation
- La Doctrine Secrete AnahuacDocument59 pagesLa Doctrine Secrete AnahuacHunterOfNightPas encore d'évaluation
- Langue Hebraique Reconstituée Fabre D-Olivet Partie 1 PDFDocument384 pagesLangue Hebraique Reconstituée Fabre D-Olivet Partie 1 PDFjorgebernardes100% (1)
- Le Sens de L'absolu Selon Sankara Et Swedenborg B. K. GUPTADocument19 pagesLe Sens de L'absolu Selon Sankara Et Swedenborg B. K. GUPTAkartoukPas encore d'évaluation
- BJ French La Venue DuDocument11 pagesBJ French La Venue Duecoboy93Pas encore d'évaluation
- 235 - Dante Alighieri La Divine Comedie PDFDocument491 pages235 - Dante Alighieri La Divine Comedie PDFOhel servicetechPas encore d'évaluation
- Runes Elfiques - Recherche GoogleDocument1 pageRunes Elfiques - Recherche GoogleLou NoelPas encore d'évaluation
- Aphorismes de ShivaDocument3 pagesAphorismes de ShivaTiffany Brooks100% (1)
- Hubert Larcher - L'Incorruption de La ChairDocument9 pagesHubert Larcher - L'Incorruption de La ChairRaphael888Pas encore d'évaluation
- Les Quatre Règnes.Document28 pagesLes Quatre Règnes.Brunyck BonouPas encore d'évaluation
- De Lombre A La Lumiere - Livre Complet PDFDocument170 pagesDe Lombre A La Lumiere - Livre Complet PDFgheorghe.mihaela1369Pas encore d'évaluation
- Dieu Dans Le Vaudou Haïtien PDF - Télécharger, Lire TÉLÉCHARGER LIRE ENGLISH VERSION DOWNLOAD READ. DescriptionDocument7 pagesDieu Dans Le Vaudou Haïtien PDF - Télécharger, Lire TÉLÉCHARGER LIRE ENGLISH VERSION DOWNLOAD READ. DescriptionDéesse NoirePas encore d'évaluation
- RORE Communique-2008-12-22 Couvert Angleterre Gnostique PDFDocument11 pagesRORE Communique-2008-12-22 Couvert Angleterre Gnostique PDFAngelo BandiniPas encore d'évaluation
- SAINT-MARTIN Louis-Claude de - Tableau Naturel Des Rapports Qui Existent Entre Dieu, L'homme Et L'univers - 1900Document335 pagesSAINT-MARTIN Louis-Claude de - Tableau Naturel Des Rapports Qui Existent Entre Dieu, L'homme Et L'univers - 1900MarcoGuimarãesJr.Pas encore d'évaluation
- La Vie Mysterieuse n39 Aug 10 1910Document16 pagesLa Vie Mysterieuse n39 Aug 10 1910XymoxPas encore d'évaluation
- Copie de Phallus - SolaireDocument3 pagesCopie de Phallus - SolaireRaben789Pas encore d'évaluation
- Kyobon 2016 1Document58 pagesKyobon 2016 1DeodatPas encore d'évaluation
- René Guénon - Recueil Posthume - Restes 1Document195 pagesRené Guénon - Recueil Posthume - Restes 1DIegob100% (1)
- Le Doctrinal Des Jouissances Amoureuses, Se Doutent Déjà: La Magie Sexuelle /288p 5/11/02 11:42 Page 7Document3 pagesLe Doctrinal Des Jouissances Amoureuses, Se Doutent Déjà: La Magie Sexuelle /288p 5/11/02 11:42 Page 7Sergio R Fritz RoaPas encore d'évaluation
- René Guénon, Deux Lettres À A. A K Coomaraswamy ReincarnationDocument4 pagesRené Guénon, Deux Lettres À A. A K Coomaraswamy ReincarnationIbrahima SakhoPas encore d'évaluation
- Lumière Sur Le SentierDocument71 pagesLumière Sur Le Sentiersantsetesh100% (2)
- Lin TsiDocument3 pagesLin TsiJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Essais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsD'EverandEssais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsPas encore d'évaluation
- Les Incas, ou la Destruction de l'Empire du PérouD'EverandLes Incas, ou la Destruction de l'Empire du PérouPas encore d'évaluation
- Les nouvelles Fourberies de Djeha: (l'autre Nasr Eddin Hodja)D'EverandLes nouvelles Fourberies de Djeha: (l'autre Nasr Eddin Hodja)Pas encore d'évaluation
- Essai de Mythologie Comparée - Max MüllerDocument105 pagesEssai de Mythologie Comparée - Max MüllerzazatoPas encore d'évaluation
- 5 Pâques C 2013Document4 pages5 Pâques C 2013sokoryubuzimaPas encore d'évaluation
- Tableau Correspondance Chakras Ragas IndiensDocument2 pagesTableau Correspondance Chakras Ragas IndiensVéronique MartinPas encore d'évaluation
- 1 Un Appel Solennel de Lalaji IDocument3 pages1 Un Appel Solennel de Lalaji IGorka CruzPas encore d'évaluation
- The Ashtavaka Gita PDFDocument17 pagesThe Ashtavaka Gita PDFDeroy GarryPas encore d'évaluation
- Les Temps Du RecitDocument2 pagesLes Temps Du Recitsimcrem69880% (1)
- Paul Sedir - Le Fakirisme Hindou Et Les Yogas (1911)Document111 pagesPaul Sedir - Le Fakirisme Hindou Et Les Yogas (1911)Eau ErrantePas encore d'évaluation
- La Presence de L'inde Dans Le Fonds Romain RollandDocument73 pagesLa Presence de L'inde Dans Le Fonds Romain RollandMichal wojcikPas encore d'évaluation
- Cosquin, Emmanuel: Études Folkloriques, Recherches Sur Les Migrations Des Contes Populaires Et Leur Point de Départ.Document650 pagesCosquin, Emmanuel: Études Folkloriques, Recherches Sur Les Migrations Des Contes Populaires Et Leur Point de Départ.samecz100% (2)