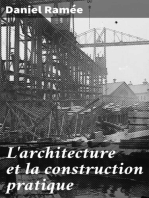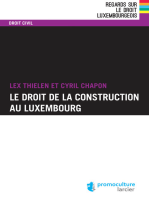Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
3.7 Diagnostic Et Traitement Des Pathologies Structurelles Du Batiment PDF
3.7 Diagnostic Et Traitement Des Pathologies Structurelles Du Batiment PDF
Transféré par
Karim Zaza0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
248 vues21 pagesTitre original
3.7 Diagnostic et traitement des pathologies structurelles du batiment ..pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
248 vues21 pages3.7 Diagnostic Et Traitement Des Pathologies Structurelles Du Batiment PDF
3.7 Diagnostic Et Traitement Des Pathologies Structurelles Du Batiment PDF
Transféré par
Karim ZazaDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 21
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES PATHOLOGIES STRUCTURELLES DU BTIMENT
J os Luis Gonzlez Moreno-Navarro
1. INTRODUCTION
Domaine dapplication
Principes de lICOMOS en rapport (rappel)
Importance de la connaissance globale pralable
Causes des dsordres structurels
Prsentation du plan de lexpos
2. LMENTS STRUCTURELS DE LHABITAT MDITERRANEN
3. PRINCIPES DE DTERMINATION ET DEXPLICATION
Approche globale
Rapport espace habitable / forme constructible
Efficacit de la production
Intgrit long terme - entretien
Apprivoisement du milieu
Adquation esthtique
Application aux lments
Les murs
Les lments de connexion avec lextrieur
Les ouvertures
Les espaces semi-extrieurs
Les lments horizontaux rectilignes
Les planchers et les charpentes de couverture
Les lments horizontaux arqus
Les arcs et les arcades
Les votes
Les coupoles
Application au btiment dans son ensemble
La relation entre tous les lments
4. POSSIBLES DSORDRES STRUCTURELS ET DIAGNOSTIC
Types deffets : apparents et non apparents
Causes accompagnes deffets apparents
Causes lointaines, causes directes
Modifications de lquilibre (action/raction) comme cause essentielle
Inventaire des effets apparents (indices ou symptmes)
Tableau densemble
Exemples concrets de causes directes et effets associs
Cause directe dans les fondations
Cause directe dans les murs
Le diagnostic
5. LINTERVENTION
Critres gnraux
Dans les fondations
Dans les murs
Baisse du coefficient de scurit
Suite une perte de rsistance due la dgradation de la maonnerie
Suite laugmentation des contraintes de compression
Dsolidarisation des couches des murs
Fissures dues des causes extrieures au mur
Dans les votes et coupoles
Dans les planchers
Dans lensemble du btiment
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES
PATHOLOGIES STRUCTURELLES
DU BTIMENT
J os Luis Gonzlez Moreno-Navarro
1. INTRODUCTION
Domaine dapplication
Cette prsentation traite des
lments qui assurent la stabilit de
lensemble des organes de fermeture crant
un espace diffrenci de lespace naturel,
dans lequel les habitants du bassin
mditerranen ralisaient les activits de la
vie quotidienne avant la rvolution
industrielle. La caractristique
fondamentale distinguant ces lments de
ceux que lon trouve aujourdhui rside en
ce que les lments qui assurent la stabilit
concident avec ceux qui enclosent lespace,
de sorte que la structure fait office dorgane
de fermeture et lorgane de fermeture de
structure. En dautres termes, parler de
structure, en matire de btiments
traditionnels, cest parler galement, dans
prs de 90 % des cas, dorganes de
fermeture, le domaine dapplication de cette
prsentation embrassant, ce titre, la
totalit du btiment.
Ce type de conception des
btiments est en gnral tranger aux
professionnels du btiment forms au XXI
e
sicle, la spcialisation des lments
constructifs actuels voulant que certains
assurent la stabilit pendant que dautres
sparent de lextrieur, do lutilit de
souligner cette diffrence dans cette entre
en matire.
Principes de lICOMOS en rapport
(rappel)
Les critres adapts la
restauration ou la rhabilitation de ces
lments structurels que nous aborderons
ici ne nous appartiennent pas en propre,
mais ils se basent sur une srie de principes
dbattus, ces dernires annes, dans les
cercles dexperts en restauration, sous
lgide de lorganisation internationale
mandate par lUNESCO pour exercer ces
comptences en matire de conservation du
patrimoine, savoir lICOMOS.
Nous citerons ici deux des
documents qui recueillent ces critres et qui
constituent les vritables piliers soutenant
les dveloppements de notre expos :
La Charte du Patrimoine Bti
Vernaculaire (1999)
Principes pour lanalyse, la
conservation et la restauration des
structures du patrimoine architectural
(2003)
Le second document est
particulirement important, tant donn
quil porte sur les lments structurels des
btiments patrimoniaux relevant du
patrimoine monumental aussi bien que
domestique ou vernaculaire.
Par ailleurs, nous partageons,
videmment, cent pour cent tous les
critres dcrits dans louvrage Architecture
Traditionnelle Mditerranenne.
Importance de la connaissance globale
pralable
Ajoutons, dans cette introduction,
quon ne saurait aborder ltude des aspects
structurels de tout btiment patrimonial
sans lintgrer un cadre plus vaste
dtudes abordant toutes les variables de cet
difice, telles que ses aspects historiques et
sociologiques, son comportement depuis sa
construction, lentretien dont il bnficie
habituellement ou encore ses types dusage
actuels, etc. Cet ensemble de variables nous
fournit en effet une srie dinformations
indispensables si lon veut comprendre son
comportement structurel, mais aussi les
ventuelles dfaillances ou pathologies dont
il pourrait tre lobjet.
Cest pour cela que lexpert, qui a
une vision partielle des problmes
pathologiques, doit faire partie dune plus
large quipe et mener un dialogue continu
avec les autres spcialistes dans les
domaines divers de lhistoire, de la
sociologie, etc. La connaissance dun
btiment et de ses problmes requiert de
manire quasi systmatique une
connaissance de son histoire quotidienne
relle, tant de son pass le plus ancien que
de son histoire rcente.
Causes des dsordres structurels
La question que nous venons de
mentionner prend toute son importance
lorsquon constate, comme la
pertinemment exprim Abdelmajid
Choukaili lors de son intervention
Marrakech sur Les dsordres spcifiques
lutilisation des matriaux , quon peut
considrer, de manire gnrale, lhabitat
traditionnel comme le rsultat dune
optimisation sur une longue priode
historique de types associs des usages,
aboutissant finalement une conception en
adquation avec le lieu et le mode de vie de
ses occupants. Mais au XX
e
sicle, les
conditions dusage connatront une
transformation radicale, qui sest traduite
par :
- laugmentation des charges actives par
suite dajouts dans les parties suprieures
accentuant leffort sur les murs en rez-de-
chausse,
- laugmentation de la population utilisant
un mme parc bti,
- la perte dune tradition dun mode
dentretien ncessaire la conservation des
lments assurant une rsistance aux agents
atmosphriques, tels que les revtements
fondamentaux pour la prservation des
capacits porteuses des murs, qui, linstar
du pis, sont trs sensibles cette
exposition aux intempries.
Nous sommes ainsi conduits
analyser des btiments qui se trouvaient
peut-tre dans un parfait tat de
conservation au XIX
e
sicle, pour ne citer
que cette poque, et qui commencent se
dgrader, le XX
e
sicle finissant, non pour
des raisons de conception dfaillante, mais
cause du considrable changement
survenu dans les conditions dusage et
dentretien qui caractrise le sicle dernier.
Justification du plan de lexpos
La consquence immdiate de cette
hypothse explicative des pathologies
implique que ltude des problmes
pathologiques et de leur rsolution, tant sur
un plan gnral que pour des cas
particuliers, aborde en premier lieu la
description de ces lments structurels dans
leur tat originel, avant dexpliquer les
causes prsidant leur tat actuel. Dans une
troisime partie, nous examinerons les
principes qui dterminent et expliquent ces
lments structurels. Une fois que nous
aurons saisi les facteurs expliquant en quoi
consistent ces lments, ou en quoi ils
consistaient lorigine, il nous sera bien
plus facile de comprendre pourquoi ils sont
passs dun bon tat originel un tat final
dgrad.
Renseigns sur leur tat originel,
sur leur tat actuel et sur le pourquoi de leur
dgradation, nous serons alors en mesure
denvisager les mthodes actuelles qui ne
seront pas ncessairement des mthodes de
pointe, les mthodes traditionnelles
amliores pouvant faire laffaire
capables de nous faire passer de la
dgradation un tat le plus proche
possible de loriginal. Et ce, non seulement
par volont de conservation du patrimoine
historique, mais surtout parce que, face
des conditions, un lieu et un usage
donns, il ny a pas de meilleure faon
dassurer leur stabilit, dun point de vue
purement pratique, que de leur restituer leur
tat et leur mode dentretien originels.
2. LMENTS STRUCTURELS DE
LHABITAT MDITERRANEN
Comme nous lavons vu en
introduction, nous ne pourrions pas trouver
de meilleure illustration pour le titre de
cette partie que celle comprise entre les
pages 66 et 96 de louvrage Architecture
Traditionnelle Mditerranenne. Nous
nallons pas rpter ici ce qui est expliqu
dans ce livre, mais nous allons projeter
quelques images choisies parmi les
magnifiques illustrations de cet ouvrage.
3. PRINCIPES DE DTERMINATION
ET DEXPLICATION DES LMENTS
STRUCTURELS
Notre objectif, dans cette partie,
sera dexposer de manire systmatique les
raisons expliquant les proprits des
lments constructifs de larchitecture
mditerranenne. Pour ce faire, nous
appliquerons la mthode employe
lEcole dArchitecture de Barcelone, selon
laquelle tout lment est la consquence
dune ncessit de :
- crer un espace au moyen dune
forme btie stable ds le dpart
- au moyen dune mthode de
production la plus efficace possible
- en assurant au bti la plus longue
dure possible grce un entretien
appropri
- en contribuant amliorer le
milieu
- de sorte que lassemblage des
formes et des matriaux satisfasse les
aspirations esthtiques que tout peuple
prouve, mme le plus primitif, du fait de sa
nature humaine.
Approche globale
Rapport espace habitable / forme
constructible
L'analyse d'une construction prise
au hasard des images vues dans la
deuxime partie nous permet de constater
que ces btiments visent crer un espace
diffrent de lespace naturel, au moyen,
dans la plupart des cas, dlvations
verticales servant de soutien dautres
lments suprieurs de forme incline,
horizontale ou en arc.
Cela tant, ces formes allonges
verticales, horizontales ou en arc doivent
tre constructibles, et elles nexistent dans
limagination du constructeur qu
condition davoir t construites
auparavant, et non pas ltat de formes
imaginaires en dehors de toute exprience
acquise.
Mais tout acte de construction,
comme nous en avons tous fait lexprience
dans notre enfance, soulve une grande
difficult, qui nest autre que laction de la
gravit : si les lments ne sont pas bien
disposs, ils tombent. Cette forme
constructible doit ainsi tre stable pour faire
face la gravit dentre de jeu. Cette
question fondamentale continue marquer
lexistence dun nombre illimit de
btiments, sans constituer pour autant une
explication suffisante, et il nous faut donc
passer aux variables suivantes.
Efficacit de la production
Derrire tout btiment populaire, on
trouve la raret des ressources qui oblige
user dingniosit ; la mise en uvre de
toute solution doit produire un maximum de
bnfices avec un minimum defforts
physiques, non seulement de la part du
constructeur, mais aussi de lensemble de la
population, pour ce qui est de lextraction et
de lapprovisionnement en matriaux. La
totalit, pratiquement, de lhabitat
mditerranen traditionnel fait appel des
matriaux accessibles, proches de
lemplacement du btiment, et se base sur
des formes constructibles stables ds le
dpart.
Intgrit long terme - entretien
Mais le temps passe, il pleut, il y a
du vent, il fait chaud, il fait froid, et ce qui
constituait, au dpart, une solution aux
problmes perd sa forme initiale ou une
partie de ses matriaux et se dgrade. Pour
parer ces dsordres, le constructeur essaye
de dtecter les dfauts survenus et met au
point une nouvelle mthode qui se rvlera
peut-tre plus durable, en mme temps quil
dtermine les soins rguliers que requiert le
btiment.
Rsultat : un espace bien construit
et durable, o lon doit pouvoir vivre, de
plus, dans un certain confort intrieur.
Apprivoisement du milieu
Cest l la raison dtre de la
construction du logis. De tout temps, tous
les peuples ont cherch amliorer les
conditions environnementales extrieures :
viter de se mouiller sous leffet de la pluie
ou de lhumidit du sol ; ne pas avoir trop
chaud ni trop froid ; parer lexcs de
lumire. Rsultat : un espace quilibr,
efficacement produit et conu pour durer.
Adquation esthtique
Mais cet espace doit aussi
engendrer un paysage agrable la vue, qui
suscite lorgueil et tmoigne de la
personnalit de ses habitants : les textures,
couleurs, dessins et formes qui soffrent au
regard doivent, en plus dapporter une
solution aux problmes pratiques,
saccorder une culture donne. Sil en est
ainsi, cest quon a cr de larchitecture.
Application aux lments
Les murs
La forme des murs sorganise selon
un paralllpipde dont les dimensions
longue (longueur) et courte (paisseur) sont
perpendiculaires entre elles et parallles au
sol ; la troisime dimension, ou hauteur, est
situe la verticale. Cette forme rsulte de
leur rle de structuration de lespace en
mme temps quelle constitue, comme nous
le savons tous depuis lenfance, la meilleure
manire dassurer la stabilit dun lment
vertical face sa contrainte la plus
immdiate, savoir laction de la gravit.
La longueur est dtermine par le
plan au sol du btiment, la dimension
intermdiaire, ou hauteur, dpend de la
hauteur de lespace recherche, et la
troisime dimension, lpaisseur, essentielle
dans le comportement structurel, est
conditionne par la stabilit comme par le
matriau et le procd constructif employs.
Sil sagit dun matriau homogne
comme le pis banch, toute lpaisseur est
constitue du mme matriau. Sil se
compose de petits lments, on aura besoin,
en fonction du rapport entre la taille de ces
lments et lpaisseur totale, de deux,
voire trois couches ou feuilles. Dans les
deux cas, il est indispensable que
lensemble des deux ou trois feuilles soit
parfaitement assembl pour viter que
chacune delles agisse indpendamment des
autres, ce qui entranerait un risque lev de
bombement partiel.
Une fois le matriau fix, cette
paisseur dpend :
- de la hauteur du btiment et des
charges des diffrents niveaux, avec leurs
planchers ou leurs votes.
- de la sveltesse, ou rapport entre
hauteur et paisseur, de chaque pan de mur,
la hauteur tant comprise comme la
distance entre lappui infrieur du mur et
llment suprieur qui sert de fixation par
un procd quelconque.
Toutes les charges produites par le
btiment se transmettent aux murs du rez-
de-chausse, et de ceux-ci au terrain par
lintermdiaire des fondations.
Habituellement, la maonnerie des murs
montre une rsistance la compression de
lordre de 10, 15, 20 kg/cm
2
, ou gure plus.
Mais, la plupart des sols ayant des
rsistances sensiblement infrieures, autour
de 3, 4, 5 kg/cm
2
, il devient invitable
dlargir la zone de contact entre le mur et
le sol au moyen des fondations. Cette
surlargeur se calcule en gnral
proportionnellement lpaisseur du mur,
un lment quil conviendra de connatre
parce quil est la base de la stabilit de
tout lensemble du bti.
Dans de nombreuses rgions, la
stabilit des murs est assure par des
lments en bois qui constituent la vritable
structure ; les lois rgissant leur stabilit
diffrent radicalement de celles que nous
venons daborder.
Les lments de connexion avec
lextrieur
Les ouvertures
En tout cas, les murs sont des
lments qui doivent tre traverss, soit de
portes pour laccs intrieur, soit de
fentres qui assurent lentre dair et de
lumire et ouvrent la vision sur lextrieur.
On ne doit pas considrer ces ouvertures
comme une fragilisation, mais plutt
comme une partie intgrante des murs,
mme sil est indniable que la capacit
portante globale diminue en proportion du
nombre des ouvertures pratiques.
En matire douvertures, le point
cl, cest llment suprieur qui permet de
transmettre aux montants de la baie, ou
jambages, les charges de la partie
suprieure du mur. Cest dordinaire un
linteau, le plus souvent en bois, ou un arc
surbaiss fait dans le mme matriau que le
reste du mur.
Les espaces semi-
extrieurs
Dautres lments verticaux
dlimitent les porches ou les espaces semi-
extrieurs : les piliers ou les pidroits dont
les dimensions sont fonction des lments
horizontaux selon lesquels le porche
sorganise, droits ou en arc.
Les lments horizontaux
rectilignes
Les planchers et les
charpentes de couverture
La subdivision sur le plan vertical
de lespace gnr par les murs et la
fermeture suprieure, ou couverture, se fait
le plus souvent laide dlments
vgtaux, en gnral des troncs darbre ou
de palmiers, dont la principale
caractristique est la rsistance la traction
et la compression et, partant, la flexion.
Ces lments doivent rpondre
deux exigences essentiels: ne pas cder et
viter une flexion excessive, et leurs
performances cet gard sont fonction de
leur forme (porte couverte et section, ou
dimension verticale), du matriau utilis, de
leur rsistance la traction et de leur
rigidit.
Pour des questions dconomie, on
rduit le recours aux lments rectilignes de
grande longueur permettant de franchir la
porte totale, gnralement plus coteux, en
les combinant avec des lments courts de
couvrement placs entre deux lments
rectilignes principaux.
Les matriaux franchissant la porte
de llment de couverture font dordinaire
office de poutres obliques sans former une
vritable charpente triangule, du fait de la
difficult engendre par la ralisation de
deux assemblages entre les diffrents
lments. On trouvera le plus souvent un
entrait sur lequel un poinon, ou poteau
court, reoit deux poutres obliques gales
la moiti de la porte qui portent les plans
dvacuation des eaux.
Dans les rgions plus sches, on
rencontre les couvertures plates, semblables
aux planchers sur le plan statique, hormis
les charges suprieures auxquelles elles
sont soumises, en raison de tout le poids
ajout selon un procd de superposition de
couches jamais totalement impermables,
afin dassurer limpermabilit de
lensemble.
Les lments horizontaux arqus
Les arcs et les arcades
Les arcs sont en gnral raliss
selon trois mthodes possibles :
- avec des voussoirs bien taills
permettant des joints trs fins entre les
pierres,
- avec des moellons plus bruts,
dpaisseur relativement faible, permettant
de former la structure de rayonnement et de
crer larc en le hourdant au mortier, ou
- au moyen de briques disposes
dans le sens du rayon de la circonfrence de
larc et fixes au mortier, le joint de mortier
se chargeant de donner les diffrentes
paisseurs en intrados et en extrados pour
obtenir la courbe.
Dans les deux derniers cas, le
mortier joue un rle fondamental
dadhrence entre les diffrentes pices.
Dans le premier cas, au contraire, les joints
fins servent simplement galiser les
surfaces.
Pour comprendre les arcs, il faut
tenir compte dun point-cl, savoir le fait
que leur construction requiert un lment
auxiliaire provisoire, le cintre, dont les
caractristiques dpendent de la maonnerie
de larc et des techniques mises en uvre
localement.
En tout cas, larc gnre des forces
obliques, ou pousses, qui agissent sur les
contreforts, comme lindique la figure.
Lintgrit de larc requiert ds le dpart
des contreforts ou des appuis totalement
indformables. Le moindre mouvement
rotatif ou dplacement de la cule
augmentant un tant soit peu la porte
couverte par larc entranerait sa rupture.
Les performances de stabilit de la
cule sont fonction de son
dimensionnement sur le plan de larc.
Historiquement, les btisseurs ont mis au
point des rgles simples mettant en rapport
la porte de larc et lpaisseur de la cule.
Dans le cas dune arcade o les arcs
retombent symtriquement sur un pilier, les
pousses des arcs squilibrent entre eux,
gnrant ainsi uniquement une charge
verticale, ce qui nest pas le cas pour les
arcs situs aux deux extrmits qui
requirent un pidroit plus large.
Les votes
Comme les arcs, les votes peuvent
tre ralises laide de voussoirs
parfaitement taills un exemple plutt rare
parce que dune grande difficult , de
maonnerie en pierre faisant appel des
pices relativement plates, comparables aux
briques, qui permettent dobtenir la courbe
en jouant sur les paisseurs de mortier, ou
encore de briques disposes de chant.
Ceci dit, il existe toute une
tradition, dans une grande partie du bassin
mditerranen, de fabrication de votes o
les briques sont positionnes non pas de
chant, mais plat, en parallle lintrados.
Ces votes reoivent des noms diffrents
selon les rgions, comme la vote tabicada,
de ma de pla, in foglio, ou encore la vote
sarrasine ; les maons catalans layant
diffus dans toute lEspagne, en France, en
Amrique du Nord et du Sud, elles sont
galement connues sous le nom de vote
catalane ou catalan vault. Elles requirent
un minimum de deux couches de briques, la
premire tant fixe avec du pltre. Ce
systme permet de rsoudre le problme
fondamental soulev par la construction de
tout lment arqu, savoir le cintre. Les
votes catalanes peuvent sen passer.
Une multitude de techniques ont t
mise en uvre pour rduire au minimum le
besoin de supports provisoires pour les
votes ; cest le cas, par exemple, des
votes en briques de chant dont la
construction commence par les coins. Tout
cela peut tre analys en observant
lappareil de lintrados.
Dans tous les cas, pour recevoir les
forces inclines, ou pousses, exerces par
les votes, les appuis requirent une
paisseur suprieure celle quexigent de
simples planchers.
Comme pour les arcs, il est
important dtre renseign sur la rgle
suivie par les constructeurs depuis des
temps immmoriaux, faite de connaissances
empiriques accumules, pour mettre en
rapport la forme de la vote, la porte
couverte et lpaisseur correspondante du
mur assurant la stabilit.
Ainsi, par exemple, une rgle en
usage au XVII
e
sicle sur le territoire
espagnol pour les votes en berceau dictait
ce que lon peut observer sur cette figure.
Dans le cas de berceaux croiss,
comme les votes darte ou en croise
dogives, les charges sont transmises aux
artes ou aux arcs diagonaux, et de ceux-ci
aux quatre appuis requis. La rgle associe
la construction gothique met en rapport
porte, forme de larc et paisseur de la
cule, comme nous pouvons le voir sur
cette figure.
Nous pouvons raisonnablement
supposer que tous les btisseurs
traditionnels possdent dans ce domaine
leurs propres rgles, transmises du matre
lapprenti, des rgles quil est indispensable
de connatre dans chaque cas.
Insistons encore une fois sur le fait
quun btiment planchers nest pas
comparable un difice votes. Ces
dernires produisent des charges excentres
la base des murs et sur les fondations, ce
qui nest pas le cas des planchers
horizontaux. Une charge excentre
parfaitement rpartie au dpart est
susceptible de provoquer, au fil du temps,
de petits tassements diffrentiels au sein des
fondations qui peuvent entraner un lger
basculement du mur et des fondations, et
lapparition dune petite fissure sur la
vote. Cela naura peut-tre pas de
consquences majeures, mais cela peut
aussi signifier le dbut dun enchanement
ngatif aboutissant leffondrement du
mur.
Les coupoles
On peut considrer les coupoles
comme un type particulier de votes et leur
appliquer toutes les considrations
antrieures, auxquelles sajoute une
caractristique essentielle : leur plan
circulaire ou quasi circulaire permet
dtablir un systme dquilibre des
pousses au moyen dun tirant circulaire,
qui limine ces pousses. La coupole ne
transmet plus alors que des charges
verticales, permettant une rduction trs
sensible de lpaisseur des murs. La
vrification de ltat de conservation de cet
lment de compensation primtrale situ
la base de la coupole fait partie du travail
de recherche pralable pour tout btiment
coupole.
La statique graphique est,
aujourdhui encore, un outil dune
remarquable utilit pour essayer de
comprendre et de dterminer les degrs de
prcarit de la stabilit des difices
traditionnels. Pour lheure, le recours aux
outils informatiques, comme la mthode
des lments finis, etc., ne comporte aucun
avantage par rapport aux conclusions que
nous apporte lemploi de la statique
graphique.
Application au btiment dans son
ensemble
La relation entre tous les
lments
La construction dun btiment
implique de la part du constructeur
lintelligence de la relation unissant tous les
lments que nous avons abords jusquici.
Leur explication demande de les analyser
un un, mais le btiment est le rsultat
synergique de lensemble, cest--dire, quil
est plus que la simple disposition de ces
lments les uns ct des autres. Cest l
un point fondamental si lon veut
comprendre son comportement sur le long
terme.
Prenons le cas des murs, par
exemple : lunion dun mur un autre au
moyen dun angle de bonne facture peut lui
permettre dtre bien moins pais quun
mur isol, et le dotera en outre dune
stabilit trs suprieure contre des forces
horizontales. Do lon dduit que la
disposition des murs selon une forme de
caisse, formant des angles ou des unions en
T, constitue une question-cl dans le
comportement des btiments murs. Au
bout du compte, la stabilit ne peut se
comprendre que comme stabilit de
lensemble des murs runis.
Et cela nous amne la dernire
variable qui rentre en jeu, en matire de
dure long terme : dans les zones o
lactivit sismique est nulle, les seuls
phnomnes pouvant affecter la stabilit du
btiment au fil du temps, comme nous
lavons mentionn au dpart, sont
rechercher du ct de laugmentation des
charges, de la rduction des paisseurs, ou
encore de la dgradation des matriaux.
Il est cependant indispensable de
tenir compte de lactivit sismique dans les
rgions exposes un fort risque. Et il est
ncessaire, ce titre, de comprendre le
comportement densemble de tous les
lments.
Un mur isol soumis un
mouvement sismique perpendiculaire son
plan tombera facilement. Si ce mme mur
forme un U avec deux autres murs
perpendiculaires, il peut tout fait offrir
une stabilit lpreuve de mouvements
sismiques bien suprieurs encore.
Dans des contextes de forte activit
sismique, lexprience des constructeurs les
conduit ajouter des lments
dassemblage plus efficaces, comme des
barres de fer reliant des murs opposs.
Ailleurs, la stratgie adopte
combine la maonnerie et des lments de
bois constituant lossature du mur, qui fait
alors preuve dun tout autre comportement
quun mur plein.
4. POSSIBLES DSORDRES
STRUCTURELS ET DIAGNOSTIC
Toutes ces observations sur la
raison dtre des lments constructifs
constituent un premier inventaire des
possibles pathologies structurelles lies la
dfaillance dune des cls que nous
estimons fondamentales pour un
comportement structurel correct. Nous
pourrions baser notre approche sur cet
inventaire, mais il est prfrable daborder
directement les dsordres les plus courants,
selon ce que nous enseigne lexprience, en
commenant par les causes possibles, pour
passer ensuite leurs effets apparents, ce
qui nous permettra une approche du bti et
de ses pathologies comparable la
dmarche du mdecin auscultant son
patient. A travers ces effets apparents ou
ces symptmes, nous essaierons de dceler
les causes, la manire du mdecin qui sait
quun mme symptme peut correspondre
des causes trs diverses. Cela tant, certains
cas peuvent ne pas avoir deffets apparents.
Types deffets : apparents et non
apparents
La plupart des causes produisent des
effets parfaitement visibles, fissures,
ruptures, dformations, affaissements, etc.,
qui reprsentent, comme pour une maladie,
un avertissement explicite sur les
changements affectant les quilibres initiaux.
Mais une baisse du coefficient de
scurit peut galement se produire, sans
indice apparent, par suite dun changement
dusage poussant lextrme la capacit de
rsistance dun mur sans la dpasser. Quand
il est connu, il est ncessaire dintervenir sur
un dsordre de ce type, car il comporte un
grave danger pour les usagers, le moindre
changement pouvant entraner une
dfaillance.
On peut observer un phnomne
similaire, en apparence, quand on applique au
bti existant les normes de scurit
structurelle du neuf, apparues au XX
e
sicle,
que certaines lgislations nationales ont
rendu obligatoire en matire de procdures de
rhabilitation. Dans la plupart des cas, le bti
existant nest pas aux normes, ce qui nous
amne conclure alors une subite
pathologie structurelle du btiment concern,
sans quaucun symptme ni changement ne
se soit manifest. La situation varie selon que
les normes renvoient uniquement laction
de la gravit ou incluent les activits
sismiques.
Dans le premier cas, tout dpend du
coefficient de scurit requis par les
normes ; il peut osciller entre 2,5 et 3 pour
le neuf. Si le calcul de ce coefficient pour
un difice existant donne 2, on pourrait en
dduire un manque de scurit. Il serait
pourtant insens de le soumettre une
procdure complexe et agressive de
renforcement, vu que le constat dun
quilibre existant sur des dizaines dannes,
en labsence de dommage, constitue une
preuve aussi scientifique, si ce nest plus,
que lapplication dune norme.
La ralisation dtudes
gotechniques donne lieu un cas
particulier. Ces tudes indiquent
frquemment que le terrain sur lequel est
assis un btiment depuis 200 ou 300 ans
nest pas en condition de garantir sa
stabilit. Lerreur peut non seulement
driver de lapplication dun coefficient de
scurit disproportionn, mais aussi du fait
que ltude a t mene hors du btiment,
sur un terrain distinct de celui situ sous ses
fondations.
Le problme est autre quand les
normes prennent en compte les activits
sismiques. Dans les rgions o les sismes
de grande ampleur obissent des
frquences trs espaces, leurs effets ne
sont pas gravs dans la mmoire collective.
De ce fait, les constructeurs ne dotent pas le
bti de mesures antisismiques. Une
nouvelle rglementation, base sur des
donnes historiques et gologiques prcises
inconnues jusqualors, peut avertir de la
probabilit dun nouvel pisode sismique,
auquel le bti serait manifestement
vulnrable. A lvidence, nous ne sommes
pas l devant un cas de pathologie, mais la
procdure de rhabilitation nen devrait pas
moins servir introduire les renforcements
ncessaires.
Causes accompagnes deffets apparents
Causes lointaines, causes directes
Les causes directes des effets visibles
sont leur tour, de manire quasi
systmatique, des effets dautres causes, que
lon appellera causes secondes ou lointaines
et qui, mme loignes de la localisation du
symptme, sont les causes lorigine du
problme. Laffaissement dune partie des
fondations sera la cause directe dune fissure
dans le mur, mais la cause qui produit ce
tassement des fondations peut venir dune
modification survenue de manire naturelle
dans le niveau phratique des lieux, ou bien
dun changement dans la circulation des eaux
souterraines la suite des travaux raliss par
un voisin loign. Les recherches doivent
donc tre menes selon un parcours qui va du
symptme la cause directe ou immdiate, et
de celle-ci la cause seconde ou lointaine
rellement lorigine du dsordre ou de la
pathologie.
Modifications de lquilibre
(action / raction) comme cause essentielle
Ltat originel dun btiment
prsente une situation dquilibre total :
toute action drive de la charge ou de
lusage correspond une raction gale dans
le sens contraire qui lquilibre. Une
pathologie structurelle a pour cause
essentielle une variation dans ce rapport
dquilibre, qui peut dcouler dune
variation des actions ou des ractions. Les
actions sont en gnral le rsultat de
facteurs anthropiques, comme
laugmentation des charges provoque par
la transformation dune chambre coucher
en magasin, par exemple. Mais elles
peuvent galement tre le fruit dune
dgradation survenue dans les lments
constructifs, telle que la rupture du tirant
dune vote tirant qui produit une
nouvelle action absente de ltat originel.
Les ractions sont elles aussi
sujettes variations, la plus courante tant
la modification de la capacit des
rsistances de la maonnerie par suite de la
dtrioration des matriaux. Mais il faut
galement considrer de possibles
changements dans la forme des lments
dus des actions des usagers, comme le
percement, par exemple, dune ouverture
dans un mur existant, qui a forcment des
rpercussions sur lquilibre original, la
partie restante du mur devant fournir une
raction suprieure face aux actions
existantes.
Lexprience nous enseigne
galement quune pathologie est le plus
souvent le rsultat de deux causes
concomitantes, si ce nest plus. Le principe
de prudence exige en toute logique
dexaminer les causes en profondeur, parce
que le seul fait den dtecter une ne
rsoudrait pas le problme.
Ajoutons ici une cause dont les effets
trs apparents fissures et crevasses ne
sont pas attribuables une modification de
lquilibre : loxydation et linvitable
augmentation de volume des lments
mtalliques encastrs dans la maonnerie. Au
cours de la deuxime moiti du XIX
e
sicle et
dune partie du XX
e
, la construction de
planchers ou de tirants de coupole en acier
oxydable tait monnaie courante. En se
dgradant, ces lments cassent, fissurent et
lzardent tous les matriaux lentour.
Inventaire des effets apparents (indices ou
symptmes)
Tableau densemble
Le tableau ci-joint met en regard les
diverses causes directes et le lieu, la zone ou
la partie de llment o elles produisent
leurs effets. Selon le lieu, leffet sera plus ou
moins visible ; sil se produit dans les
parements du mur, il sera aisment
perceptible ; si leffet est un affaissement ou
une dformation du mur, il sera uniquement
observable en vue de profil, si cest possible,
etc.
Si la cause directe est :
a) variation du rapport entre charges et
capacit portante
b) variation entre les axes principaux daction
et de raction
b.1) par suite de modification dans
les actions
vertical,
horizontal (traction, compression)
b.2) par suite de modification dans
les ractions
courte,
longue,
inverse
Si la zone principale de manifestation de
leffet est :
a) parements des murs
b) plan transversal du mur
cause directe
parements des murs
plan transversal du
mur
variation du rapport entre
CHARGES ET CAPACITE
PORTANTE
variation entre les axes
principaux daction et de
raction par suite de
modification dans les
ACTIONS
vertical
horizontal a compression
horizontal a traction
dans les REACTIONS
longue
courte
inverse
Exemples concrets de causes directes et
effets associs
Cause directe dans les fondations
a) effets principaux sur les murs
a.1) sur les parements
tassements diffrentiels aux extrmits du
btiment
tassements diffrentiels au centre du btiment
dplacement du terrain
a.2) dans un plan perpendiculaire au mur
basculements et affaissements diffrentiels
b) effets diffrs sur les lments adjacents
(couvertures, votes, planchers)
Si lon dispose de tmoignages
(photographiques, par exemple) montrant que
le btiment tait en parfait tat par le pass,
les causes lointaines sont rechercher du ct
de la variation des conditions initiales. Ces
causes peuvent ainsi rsider dans la
dtrioration des matriaux, comme nous
lavons vu, dans laction des eaux (
variation du niveau phratique,
variation du taux dhumidit pouvant
provoquer expansion ou rtraction des
argiles, ou diminution des rsistances) ou
dans la proximit dun chantier produisant
affouillements et entranements dblais ou
remblais.
Cause directe dans les murs
a) effets : rupture par compression,
bombement global des feuilles, rupture par
effort de cisaillement
b) effets diffrs sur les lments
adjacents (couvertures, votes, planchers)
Les seules causes lointaines
possibles sont laccroissement des charges ou
la dgradation des matriaux.
Cause directe dans les lments adjacents
(couvertures, votes, planchers)
effets : affaissements, basculements,
etc., sur murs.
Les causes lointaines possibles sont
des pousses latrales des couvertures,
votes, planchers, dues laccroissement des
charges, la rupture de tirants, le mouvement
du bois ou loxydation des lments
mtalliques.
Le diagnostic
Face des altrations visibles, le
diagnostic consiste identifier les causes en
remontant lenchanement qui les a produites
dans cet ordre : dommage-effet-cause
directe-cause lointaine.
La conduite du diagnostic doit suivre
toutes les phases dune investigation. Il
dmarre par lobservation directe et la plus
dtaille possible des dgts. Sil sagit de
fissures similaires celles que nous venons
de dcrire, il est ncessaire, dans un premier
temps, dessayer den dterminer la cause
immdiate. Pour ce faire, lobservation
dtaille doit identifier quel mouvement des
lvres correspond la fissure en question, et
lobservation densemble doit dboucher sur
le dessin le plus prcis possible du
phnomne.
Grce la comparaison avec
l'inventaire prcdent, nous pourrons obtenir
une premire hypothse explicative du
rapport de cause effet ; le nombre des
causes excdant celui des effets, il est
cependant ncessaire de mettre le bien-fond
de cette premire hypothse lpreuve des
faits. Si elle indique un excs de charge ou
lapparition dune nouvelle action, il faudra
modliser lensemble au moyen dune simple
descente de charges ou dune analyse statique
graphique. Si la cause relve dun autre type,
il est important de sassurer de lexistence de
tous les effets associs celle-ci dans
dautres parties du btiment.
En supposant que nous avons trouv
la cause immdiate, il nous faut encore
trouver la cause lointaine en continuant
dappliquer la mthode de la vrification des
hypothses.
Quoi quil en soit, il est ncessaire
de savoir si le dommage a pour origine un
phnomne pass ou sil est en train de se
produire sur le moment ; si lon a affaire
une fissure, on parle en la circonstance de
fissure arrte ou active. Dans le cas dune
fissure active, il est indispensable de
connatre sa vitesse de propagation.
Lensemble des oprations
dobservation, dinstrumentation et
dexprimentation dcrites dans la
confrence de Xavier Casanovas Les outils et
instruments pour le diagnostique constitue
toujours un instrument incontournable pour
un bon diagnostic.
Pour conclure, je pense quil est intressant
de citer quelques Principes tirs du document
tabli par lICOMOS ce sujet, les qui
viennent appuyer et largir notre propos :
2.5 La conservation des structures du
patrimoine bti requiert simultanment des
analyses qualitatives et quantitatives. Les
premires sont fondes sur lobservation
directe des dsordres et de la dgradation
des matriaux. Elles sappuient sur les
recherches historiques et archologiques.
Les secondes concernent essentiellement les
tests spcifiques, le suivi des donnes et
lanalyse des structures.
2.6 Avant de prendre une dcision
concernant une intervention sur des
structures il est indispensable de dterminer
les causes des dsordres, et ensuite
dvaluer le niveau de scurit de la
structure.
2.7 Lvaluation du niveau de scurit (qui
est la dernire tape dans le diagnostic ou le
besoin de traitements est effectivement
dtermin) doit tenir compte des analyses
quantitatives et qualitatives et de
lobservation directe, des recherches
historiques, de la modlisation
mathmatique le cas chant et, en tant que
besoin des rsultats exprimentaux.
2.8 Le plus souvent lapplication de
coefficients de scurit conus pour les
ouvrages neufs conduit des mesures
excessives, inapplicables pour les difices
anciens. Des analyses spcifiques devront
alors justifier de la diminution des niveaux
de scurit.
5. LINTERVENTION
Critres gnraux
Les Principes tirs de ce document
qui a trait au patrimoine monumental sont
galement porteurs de critres gnraux
dintervention, applicables plus forte
raison au bien plus fragile patrimoine
domestique mditerranen. Nous avons
extrait six de ces critres quil est
indispensable de connatre avant dentrer
dans le dtail des cas particuliers :
3.1 La thrapie reprsente le champ des
actions exerces sur les causes profondes
des dsordres, et non sur les symptmes.
3.2 La meilleure thrapie pour la
conservation est lentretien prventif.
3.4 Aucune action de doit tre entreprise
sans que son caractre indispensable nait
t dmontr.
3.5 Les interventions doivent tre
proportionnes aux objectifs de scurit
fixs et tre maintenues au niveau minimal
garantissant stabilit et durabilit avec le
minimum deffets ngatifs sur la valeur du
bien considr.
3.7 Le choix entre les techniques
traditionnelles et les techniques
innovantes doit tre fait au cas par cas, en
donnant la prfrence aux techniques les
moins envahissantes et les plus
respectueuses des valeurs patrimoniales,
tenant en compte les exigences de scurit
et de durabilit.
3.9 Les mesures choisies doivent tre
rversibles autant que possible, de telles
sorte que, si de nouvelles connaissances le
permettent, des mesures plus adquates
puissent tre mises en uvre. Si les
mesures ne peuvent tre rversibles, on doit
sassurer que des interventions ultrieures
puissent encore intervenir.
3.10 Tous les matriaux utiliss pour les
travaux de restauration, particulirement les
nouveaux matriaux, doivent tre tests de
manire approfondie et apporter les preuves
non seulement de leurs caractristiques
mais galement de leur compatibilit avec
les matriaux dorigine, afin dviter les
effets secondaires non souhaitables.
Ladoption de ces critres,
manifestement rationnels, suppose
labandon des techniques demploi courant
dans la seconde moiti du XX
e
sicle qui ny
rpondent pas, et se sont avres, en outre,
nettement prjudiciables, peu de temps
aprs leur mise en uvre.
A nen pas douter, les interventions
que lon peut projeter sur la base de ces
critres requirent, dune part, une
connaissance approfondie du btiment
rhabiliter, cest--dire une mise en uvre
pousse des points abords propos du
diagnostic, et, de lautre, une connaissance
approfondie non seulement des techniques
actuelles les moins agressives, mais surtout
des savoir-faire traditionnels qui ont
faonn le bti dorigine, tout cela tant
pour le moins complexe.
Les techniques que nous allons
examiner maintenant visent avant tout
neutraliser les causes directes de manire
gnrale, chaque btiment possdant ses
caractristiques spcifiques, en mme
temps que les causes de la pathologie
propre chaque difice. Seule ltude
particulire de chaque cas, par la mise en
uvre des critres et des mthodes que
nous avons exposes, permettra une
intervention adapte. Et noublions pas les
causes lointaines derrire les causes
directes.
Nous exposerons ces techniques en
les associant directement aux causes
immdiates des pathologies les plus
frquentes.
Dans les fondations
Les effets visibles peuvent tre les
fissures dont nous avons parl ou des
affaissements de murs, provoquant
lapparition de fissures sur les votes, etc.
Le plus souvent, la cause directe est
une perte de rsistance du terrain,
attribuable son tour une seconde cause,
ou cause lointaine, qui peut tre une cause
quelconque parmi celles que nous avons
vues. Lintervention peut prendre trois
directions : augmenter la surface de contact
des fondations afin de rduire la contrainte
de compression, raccorder la fondation un
terrain plus rsistant en profondeur, ou
augmenter la rsistance du terrain.
Laugmentation de la surface de
contact est une opration dlicate et
coteuse, mais ralisable laide de
techniques exclusivement traditionnelles. Il
sagit de remplacer le terrain sous la
fondation par une maonnerie plus large.
En gnral, il nest pas du tout
ncessaire darmer cette nouvelle
maonnerie. Au vu des petites charges
caractrisant larchitecture domestique
mditerranenne, cest la solution la plus
approprie.
Comme on le voit sur la figure,
lopration doit sexcuter par tronons
alterns afin de ne pas laisser une trop
grande largeur de fondation hors appui.
Le raccordement de la fondation
un terrain plus rsistant en profondeur met
en uvre la technique des micropieux. En
ralit, cette solution nest ncessaire que
dans trs peu de cas. Cest assurment une
option trs agressive, laquelle on ne devra
recourir que dans les cas extrmes.
Pour accrotre la rsistance du
terrain, nous disposons lheure actuelle
des techniques qui ne sont pas accessibles
dans toutes les rgions. Il sagit
manifestement de techniques qui nont rien
de traditionnel, faisant appel des
matriaux qui nexistaient pas par le pass,
potentiellement porteurs deffets
secondaires.
Rappelons ici quil est essentiel de
dterminer la cause lointaine de cette perte
de rsistance du terrain et noublions pas
quelle ne tient peut-tre qu un rapport
gotechnique.
Etant donn la complexit de toutes
ces interventions possibles, il peut tre
envisageable de ne pas agir sur les causes,
mais uniquement sur les effets. Face
laffaissement dun mur la suite dune
dfaillance du terrain, par exemple, il est
toujours possible de monter un contrefort
pour en neutraliser le mouvement ou de
lentretoiser sur des parties saines du
btiment.
Dans les murs
Baisse du coefficient de scurit
Suite une perte de
rsistance due la dgradation de la
maonnerie
Si la dgradation vient dune perte
de mortier sur les joints extrieurs, il est
ncessaire de les reconstituer par
rejointoiement. Si cette perte est interne aux
murs, on ralisera des injections de coulis
pour colmater les interstices.
Les pierres endommages peuvent
tre remplaces si lon dispose de pices de
mme nature.
Si la dgradation affecte de grands
pans de mur, la solution exige alors une
reconstruction totale des zones affectes.
Si la dgradation affecte la totalit
du mur, on devra procder un
remplacement fonctionnel en laborant une
nouvelle structure parallle dont la
maonnerie sera probablement diffrente de
loriginelle.
Suite laugmentation des
contraintes de compression
Cette cause directe ne peut avoir
pour causes lointaines que les seules actions
anthropiques, telles que changement
dusage, rduction des surfaces par suite de
percements douvertures ou actions
similaires. Au vu des difficults souleves
par toutes les interventions possibles, il est
vident que la solution ce problme
consiste ne pas accepter ces changements
effectus ou proposs par les usagers ou les
promoteurs.
Une solution couramment
envisage consiste disposer des deux
cts du mur des renforcements pais en
bton liaisonns entre eux. Une autre
prconise laugmentation de la rsistance au
moyen de nombreuses barres dacier
introduites par perforations obliques venant
coudre les pices de la maonnerie en
augmentant leur enchevtrement.
Il semble presque superflu dajouter
que le changement conceptuel et pratique
entran par ces procds, aux rsultats
douteux long terme, ne se justifie que
dans des cas trs spciaux.
Si le renforcement savre
indispensable et que lon veut suivre les
principes exposs auparavant, cette
augmentation de la surface portante devra
se faire au moyen dune surpaisseur de la
mme maonnerie et liaisonne au
maximum avec lancienne.
Dsolidarisation des couches des
murs
Ses effets se traduisent par un
renflement des parements, la portance des
murs sen trouvant sensiblement rduite,
comme nous lavons signal. Lintervention
la mieux adapte passe par ltayage de la
partie affecte, prlude un dmontage et
une reconstruction laide du plus grand
nombre possible de parpaings ou boutisses
de liaison des couches.
Fissures dues des causes
extrieures au mur
Quand on a remdi aux causes
directes et lointaines des fissures, il
convient de boucher ces dernires pour
assurer la continuit de la transmission des
charges et ltanchit.
La mthode la plus radicale, quon
appelle cucci e scucci en italien, consiste
dsassembler la maonnerie des deux cts
de la fissure pour la remonter en colmatant
louverture cre au dmontage.
Le rejointoiement est la mthode la
plus courante.
En gnral, lemploi dlments
mtalliques faisant office dagrafes est
dpourvu de sens. Quand on a remdi aux
causes, les agrafes ne servent rien, et si les
causes sont encore actives, elles sont tout
aussi inutiles, vu que la maonnerie ne peut
pas assumer les tractions et, dfaut de
cder sur la zone agrafe , elle cdera un
peu plus loin.
Dans les votes et coupoles
Comme nous avons pu le constater
prcdemment, les pousses des votes et
des coupoles peuvent constituer les causes
directes ou lointaines des fissures ou des
affaissements survenant dans les murs, et
les fissures qui peuvent apparatre sur ces
votes et coupoles ont pour origine soit ces
affaissements mmes, soit des dsordres
dans les fondations. Si les causes lointaines
sont sous contrle, les murs ou les
fondations renforces, il faut alors les
rejointoyer.
Ceci dit, devant le prix lev de ces
renforcements, comme nous lavons vu, on
dcide souvent de sattaquer la cause,
savoir la vote, en annulant ses pousses.
Nous sommes face deux mthodes
possibles : la pose de tirants ou la
ralisation dune deuxime vote en bton
arm sur lextrados de la premire, qui met
un terme au problme en vitant sa
dformation.
Au vu de nos principes, il est clair
que cette solution est difficilement
acceptable. Le tirant constitue certainement
une solution traditionnelle bien plus
recevable.
Ce doublage sur lextrados
semploie galement comme renforcement
face de nouvelles charges dexploitation.
Lintervention doit tendre viter ces
nouvelles charges et quand cela savre
impossible, excuter le renforcement en
augmentant lpaisseur de la vote laide
dune maonnerie identique.
A la base des coupoles, une
pathologie peut manifester ses symptmes
en intrados comme en extrados, savoir
loxydation du tirant circulaire.
Lintervention requiert en gnral son
extraction et son remplacement par un
lment similaire depuis lintrieur ou
lextrieur de la coupole.
Dans les planchers
La perte de rsistance des
principaux lments en bois est attribuable
la dgradation ou la perte de section
provoque par des agents biologiques, tels
que champignons de la pourriture ou
insectes. Si la perte affecte llment dans
son ensemble, la solution est le
remplacement. Si elle naffecte que les
parties encastres dans les murs, les parties
affectes peuvent tre remplaces par des
rsines qui en reproduiront la forme
originelle et amlioreront la rsistance et la
durabilit de la poutre, en armant ces
rsines pour assurer lassemblage avec la
partie bois.
Si la perte est due un
vieillissement invitable de poutres dj
rares lorigine, une solution simple et
efficace, bien que peu sduisante, consiste
ajouter une poutre transversale sur la partie
infrieure, de sorte diviser la porte
couverte.
Si lon prfre, on peut galement
raliser ce renforcement sur la partie
suprieure en augmentant la section des
poutres ou de lensemble du plancher
laide de panneaux de particules de bois
faisant office de chape de compression.
Quant la chape de bton arm,
tellement rpandue, cest une solution
viter si possible.
Dans lensemble du btiment
Nous avons dj abord deux
situations pour lesquelles lintervention
affecte lensemble du btiment : les
entretoisements destins viter des
affaissements ou des dformations de murs.
La mise en uvre systmatique de cette
solution entre tous les murs permet de
rduire efficacement la vulnrabilit
sismique de lensemble du btiment.
Le renforcement au bton arm de
la surface des planchers que nous venons de
voir sest longtemps fait au nom des
contraintes sismiques, mais outre le fait
dtre difficilement acceptables sur un plan
conceptuel, ses effets peuvent se rvler
contreproductifs en cas dpisode sismique.
Une fois encore, les solutions
traditionnelles sont plus compatibles avec le
bti traditionnel, en toute logique.
En guise de conclusion, il est utile
de rappeler certains des principes sur
lesquels cette partie sest ouverte :
3.7 Le choix entre les techniques
traditionnelles et les techniques
innovantes doit tre fait au cas par cas, en
donnant la prfrence aux techniques les
moins envahissantes et les plus
respectueuses des valeurs patrimoniales,
tenant en compte les exigences de scurit
et de durabilit.
3.10 Tous les matriaux utiliss pour les
travaux de restauration, particulirement les
nouveaux matriaux, doivent tre tests de
manire approfondie et apporter les preuves
non seulement de leurs caractristiques
mais galement de leur compatibilit avec
les matriaux dorigine, afin dviter les
effets secondaires non souhaitables.
* * *
Vous aimerez peut-être aussi
- Pathologie, Diagnostic, Réparation Et ProtectionDocument5 pagesPathologie, Diagnostic, Réparation Et ProtectionBelal FaridPas encore d'évaluation
- Cours - Pathologie Des TerrassementsDocument60 pagesCours - Pathologie Des TerrassementsJean-Cédric WakabletPas encore d'évaluation
- Les Techniques D'auscultation Des Ouvrages en Béton ArméDocument57 pagesLes Techniques D'auscultation Des Ouvrages en Béton ArméNguyen Dang Hanh100% (18)
- Réhab PathologieDocument15 pagesRéhab PathologieUnal AkturkPas encore d'évaluation
- Fissuration Des Bétons PathologieDocument22 pagesFissuration Des Bétons PathologiejolegendePas encore d'évaluation
- Pathologie Des ConstructionDocument91 pagesPathologie Des ConstructionThibault CostetPas encore d'évaluation
- RÉHABILITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS Chapitre 3Document27 pagesRÉHABILITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS Chapitre 3SAIDA GENIE CIVIL100% (1)
- Pathologies Et Réparations Structurales-Ppt-Pdf-2011Document232 pagesPathologies Et Réparations Structurales-Ppt-Pdf-2011mrili100% (7)
- Dégradation BétonDocument10 pagesDégradation BétonelkhayariPas encore d'évaluation
- Rapport PathologieDocument12 pagesRapport PathologieEL Housni AminePas encore d'évaluation
- PATHOLOGIE DES STRUCTURES Chapitre 7 Diagnostic Et Amélioration AcoustiqueDocument13 pagesPATHOLOGIE DES STRUCTURES Chapitre 7 Diagnostic Et Amélioration AcoustiqueSAIDA GENIE CIVILPas encore d'évaluation
- Pathologies Diagnostic Béton ArméDocument186 pagesPathologies Diagnostic Béton ArméTomás MurPas encore d'évaluation
- RÉHABILITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS Chapitre 2Document13 pagesRÉHABILITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS Chapitre 2SAIDA GENIE CIVIL100% (1)
- Chapitre 7 - Pathologies Des RevêtementsDocument12 pagesChapitre 7 - Pathologies Des RevêtementsSAIDA GENIE CIVIL100% (1)
- RÉHABILITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS Chapitre 4Document14 pagesRÉHABILITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS Chapitre 4SAIDA GENIE CIVILPas encore d'évaluation
- PATHOLOGIE DES STRUCTURES Chapitre 2 Pathologie Des TerrassementsDocument10 pagesPATHOLOGIE DES STRUCTURES Chapitre 2 Pathologie Des TerrassementsSAIDA GENIE CIVIL100% (1)
- PATHOLOGIE DES STRUCTURES Chapitre 5 Pathologie Des StructuresDocument19 pagesPATHOLOGIE DES STRUCTURES Chapitre 5 Pathologie Des StructuresSAIDA GENIE CIVILPas encore d'évaluation
- 5 Fissures 2012Document40 pages5 Fissures 2012Mongi Ben Ouezdou100% (1)
- Pathologie Des StructuresDocument17 pagesPathologie Des StructuresRida Elhaimer100% (1)
- 1 Catalogue Des DésordresDocument46 pages1 Catalogue Des DésordresKhatiri Meryem100% (1)
- Pathologies FondationsDocument47 pagesPathologies FondationsIkram Khalyl100% (8)
- Pathologie Des Structures Copie 150501082247 Conversion Gate01 PDFDocument16 pagesPathologie Des Structures Copie 150501082247 Conversion Gate01 PDFCoco AmalPas encore d'évaluation
- Fabem 1Document470 pagesFabem 1charrue100% (2)
- Corrosion ArmaturesDocument3 pagesCorrosion ArmaturesBedis Moalla100% (2)
- 13-Guide de Cas Pathologiques Sur L'étancheite Des Toitures Terrasses Et Façades PDFDocument20 pages13-Guide de Cas Pathologiques Sur L'étancheite Des Toitures Terrasses Et Façades PDFBENSAAOUDPas encore d'évaluation
- Rehabilitation Du Beton ArmeDocument107 pagesRehabilitation Du Beton ArmeMohamed Radhouane100% (1)
- Partie N°2 Pathologie Du Béton ArméDocument108 pagesPartie N°2 Pathologie Du Béton ArméHAYTHEMPas encore d'évaluation
- Les Causes de Degradation Des BetonsDocument13 pagesLes Causes de Degradation Des BetonsMeryam67% (3)
- Expo FissurationDocument46 pagesExpo Fissurationkhadim tall100% (1)
- Pathologie de Béton ArméDocument75 pagesPathologie de Béton ArméYassine GC100% (1)
- Pathologie Des Fissures Dans Le BatimentDocument6 pagesPathologie Des Fissures Dans Le Batimentbradbader100% (4)
- PATHOLOGIE DES STRUCTURES Chapitre 3 Pathologie Des Murs de SoutènementDocument14 pagesPATHOLOGIE DES STRUCTURES Chapitre 3 Pathologie Des Murs de SoutènementSAIDA GENIE CIVIL100% (5)
- La fin du ciment: Les bonnes et les mauvaises raisons d'une technologie sans avenirD'EverandLa fin du ciment: Les bonnes et les mauvaises raisons d'une technologie sans avenirÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Rehabilitation de Batiments AnciensDocument8 pagesRehabilitation de Batiments AnciensLecondor BauerPas encore d'évaluation
- Analyse de La Fissuration de BétonDocument70 pagesAnalyse de La Fissuration de BétondjennatialiPas encore d'évaluation
- Réparation Des Bétons AltérésDocument62 pagesRéparation Des Bétons AltérésKhoudir MoualekPas encore d'évaluation
- Rehabilitation Des StructuresDocument75 pagesRehabilitation Des Structuresssarra99100% (2)
- A3 FondationsDocument9 pagesA3 FondationsiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Pathologie Générale - Pathologie Du BétonDocument122 pagesPathologie Générale - Pathologie Du Bétonnajwa ouadghiriPas encore d'évaluation
- La Pathologie Du Béton ArméDocument20 pagesLa Pathologie Du Béton ArméChafiq Oufrid100% (5)
- Réparation Du BétonDocument28 pagesRéparation Du Bétonticus33100% (5)
- L'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirD'EverandL'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirPas encore d'évaluation
- Memoire l3Document48 pagesMemoire l3Joe VegasPas encore d'évaluation
- 3.8 Experiences Dintervention Structurelle Sur Les Batiments en TunisieDocument12 pages3.8 Experiences Dintervention Structurelle Sur Les Batiments en TunisiejoePas encore d'évaluation
- 2012.TH.18442. de Almeida Joao ManuelDocument117 pages2012.TH.18442. de Almeida Joao ManuelHassanPas encore d'évaluation
- Architecture EvolutiveDocument30 pagesArchitecture EvolutiveZ ZakariaPas encore d'évaluation
- Memoire Mbenga 2022-2023Document21 pagesMemoire Mbenga 2022-2023mnengaclaudePas encore d'évaluation
- M Tech Systèmes Parasismiques (F)Document42 pagesM Tech Systèmes Parasismiques (F)Anonymous bVFHovPas encore d'évaluation
- SYLLABUS Construction 4Document69 pagesSYLLABUS Construction 4JOENNETTE LUKWIKILU100% (1)
- ProjetDocument13 pagesProjetLinh LêPas encore d'évaluation
- Dedans Dehors - Concevoir La Fenêtre Innombrable - Presses Universitaires de Franche-ComtéDocument31 pagesDedans Dehors - Concevoir La Fenêtre Innombrable - Presses Universitaires de Franche-ComtéBabacar GarnierPas encore d'évaluation
- Technique Actuelle Fondation 2002Document80 pagesTechnique Actuelle Fondation 2002Trung DOPas encore d'évaluation
- Outil 8 Les Techniques de RehabilitationDocument34 pagesOutil 8 Les Techniques de RehabilitationkhouriPas encore d'évaluation
- La Durabilit Des B Tons Bases Scientifiques Pour La Formulation de B Tons Durables Dans Leur EnvironnementDocument824 pagesLa Durabilit Des B Tons Bases Scientifiques Pour La Formulation de B Tons Durables Dans Leur EnvironnementRamzi ChemaliPas encore d'évaluation
- DPE - Guide Recommandation - 2009-03 - Ministère Logement PDFDocument71 pagesDPE - Guide Recommandation - 2009-03 - Ministère Logement PDFbommobPas encore d'évaluation
- Conception Parasismique Des Structures: Un Cours Pour Les ArchitectesDocument3 pagesConception Parasismique Des Structures: Un Cours Pour Les ArchitectesLevi FFPas encore d'évaluation
- DPE-Guide de Recommandations-V2Document89 pagesDPE-Guide de Recommandations-V2MEP EngineeringPas encore d'évaluation
- The Role of Geotechnical Engineeers in Saving Monuments and Historical SitesDocument13 pagesThe Role of Geotechnical Engineeers in Saving Monuments and Historical SiteswwcqlqhsllrwnvnfouPas encore d'évaluation
- CT B90DDocument22 pagesCT B90DMagloire KajidPas encore d'évaluation
- Reconnaissance D'un Ouvrage D'art en VouteDocument8 pagesReconnaissance D'un Ouvrage D'art en VouteMyriam Ben SaidPas encore d'évaluation
- Architecture en 30 Secondes by Edward Denison, Marie-Noëlle AntolinDocument217 pagesArchitecture en 30 Secondes by Edward Denison, Marie-Noëlle Antolinkerrouche khadidjaPas encore d'évaluation
- Monographie de Dar Mustapha Pacha AlgerDocument7 pagesMonographie de Dar Mustapha Pacha AlgerHanaa manar Ramdani100% (1)
- Lucia Mondardini PDFDocument27 pagesLucia Mondardini PDFFredericPas encore d'évaluation
- Etude ConstructiveDocument2 pagesEtude ConstructiveHanaa manar RamdaniPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Raisonné de L - Architecture Française, Tome III - M. Viollet-Le-DucDocument397 pagesDictionnaire Raisonné de L - Architecture Française, Tome III - M. Viollet-Le-DucLola MaiaPas encore d'évaluation
- Mon Rapport ACPDocument13 pagesMon Rapport ACPReagan Busangu100% (5)
- La Voûte ÉtoiléeDocument3 pagesLa Voûte ÉtoiléeMehdi JerjiniPas encore d'évaluation
- 3.8 Diagnostique Et Traitement Des Pathologies Structurelles Du BatimentDocument19 pages3.8 Diagnostique Et Traitement Des Pathologies Structurelles Du BatimentbastophePas encore d'évaluation
- 6-Soutenement Des OsDocument15 pages6-Soutenement Des OssoltanePas encore d'évaluation
- Architecture Médiévale - LexiqueDocument16 pagesArchitecture Médiévale - LexiqueJames N'ZAOUPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument9 pagesIntroductionWalid GGPas encore d'évaluation
- TPE Aménagement VouteDocument15 pagesTPE Aménagement VoutevictorPas encore d'évaluation
- Presentation FinaleDocument19 pagesPresentation Finaleis guePas encore d'évaluation
- L'Art GothiqueDocument6 pagesL'Art Gothiquetychowo73Pas encore d'évaluation
- Nouvelle - Annales - de - La - Construction - H.Fontaine - Stabilité Des Planchers Voutes en Brique - 1865Document10 pagesNouvelle - Annales - de - La - Construction - H.Fontaine - Stabilité Des Planchers Voutes en Brique - 1865sautier_thomasPas encore d'évaluation
- Eth 32756 02Document167 pagesEth 32756 02patrick vibilaPas encore d'évaluation
- Tunnels Methodes D Execution PDFDocument176 pagesTunnels Methodes D Execution PDFGiap313Pas encore d'évaluation
- DP Genie Civil Section 5 Cle581c97-2 PDFDocument23 pagesDP Genie Civil Section 5 Cle581c97-2 PDFElloco MoordenaarPas encore d'évaluation
- 4Document8 pages4Sara RimasPas encore d'évaluation
- L Art Roman L Art GothiqueDocument13 pagesL Art Roman L Art Gothiqueturpen01Pas encore d'évaluation
- Correction QCM D'histoire GéographieDocument3 pagesCorrection QCM D'histoire Géographiedumasfyona3Pas encore d'évaluation
- Manuel Dar Cholo Gi 01 BabeDocument328 pagesManuel Dar Cholo Gi 01 BabeMirandaFerreiraPas encore d'évaluation
- Mémoire BourezgDocument71 pagesMémoire BourezgTito Fcb100% (1)
- Extraits SimondonDocument128 pagesExtraits SimondonJaqpsousa100% (1)
- Classement Des Structures PDFDocument8 pagesClassement Des Structures PDFStimphat Jean ColsonPas encore d'évaluation
- 3.7 Diagnostic Et Traitement PathologiesDocument21 pages3.7 Diagnostic Et Traitement Pathologiesyassine63100% (4)
- Cours Histoire de StylesDocument6 pagesCours Histoire de StylesAbdelbasset GhabriPas encore d'évaluation
- Histoire de L'art G2 AI 2021-2022Document49 pagesHistoire de L'art G2 AI 2021-2022JudithPas encore d'évaluation
- 1876 Notes VoutesDocument12 pages1876 Notes VoutesAne Splin GPas encore d'évaluation