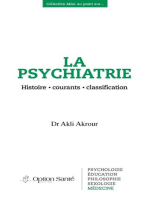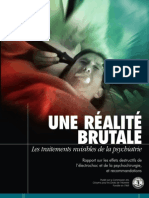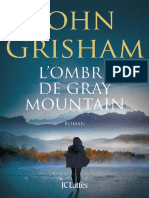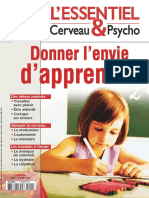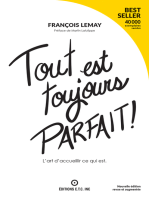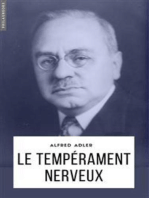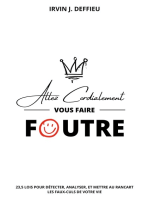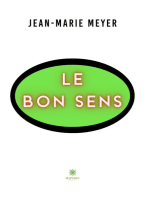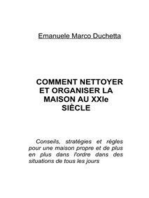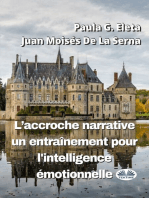Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Adler Enfant Dificile
Adler Enfant Dificile
Transféré par
Sorin SorinCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Adler Enfant Dificile
Adler Enfant Dificile
Transféré par
Sorin SorinDroits d'auteur :
Formats disponibles
Alfred ADLER (1930)
LENFANT
DIFFICILE
Technique de la psychologie individuelle compare
Traduction franaise de lAllemand par le Dr Herbert Schaffer, 1949.
Un document produit en version numrique par Gemma Paquet,
collaboratrice bnvole et professeure la retraite du Cgep de Chicoutimi
Courriel: mgpaquet@videotron.ca
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay,
Bnvole et professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
et dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 2
Cette dition lectronique a t ralise par Gemma Paquet,
collaboratrice bnvole et professeure la retraite du Cgep de
Chicoutimi partir de :
Alfred Adler (1930)
LENFANT DIFFICILE. Technique de la psychologie individuelle
compare
Une dition lectronique ralise partir du livre dAlfred Adler, LENFANT
DIFFICILE. Technique de la psychologie individuelle compare. Traduction
franaise de lAllemand par le Dr Herbert Schaffer, 1949. Paris : ditions Payot,
1962, 214 pages. Collection Petite bibliothque Payot, n 15. Prcdemment publi
dans la Bibliothque scientifique chez Payot.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft
Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 10 juillet 2002 Chicoutimi, Qubec.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 3
Table des matires
Prface du traducteur, Dr Herbert Schaffer, 1949
Avant-propos de lauteur, 1930
Introduction : Lhomme et son semblable, par Dr Alfred Adler, 1930
Chapitre I.- Exagration de l'importance de sa propre personne (vantardise)
Chapitre II. - Une lve redouble sa classe
Chapitre III. - Un pre empche le dveloppement du sentiment social
- La benjamine en lutte
- Lutte de lan pour ses droits hrditaires
Chapitre IV. - Une benjamine gte
- Examen de lintelligence
Chapitre V. - Les prtendues crises de la pubert
Chapitre VI. - L'enfant unique
Chapitre VII. - Le benjamin dcourag
Chapitre VIII. - Faible d'esprit ou enfant difficile ?
Chapitre IX. - Une ambition qui se fourvoie
Chapitre X. - L'enfant dtest
Chapitre XI. - L'enfant unique qui veut jouer un rle ?
Chapitre XII. - L'an dtrn
Chapitre XIII. - Le mensonge, moyen de se mettre en valeur
Chapitre XIV. - L'hrosme dans l'imagination remplace le rendement utile dans la
ralit
Chapitre XV. - Trouble-fte
Chapitre XVI. - La lutte pour le paradis perdu
Chapitre XVII. - Vol cause d'une affection perdue
Chapitre XVIII. nurtique
Chapitre XIX. L'nursie, moyen de liaison
Chapitre XX. Auprs de frres et surs brillants
Chapitre XXI. Comment je parle aux parents
Chapitre XXII. La tche du jardin d'enfants
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 4
Dr Alfred Adler
Ancien professeur au long Island Medical College de New York, est avec Freud et
Jung l'un des pionniers de la psychologie contemporaine.
Cet ouvrage sur L'enfant difficile rvle l'un des aspects pratiques les plus
intressants de la doctrine adlrienne : son application au domaine de la psycho-
pdagogie. Au moment o le monde entier se penche sur le problme de l'enfance
difficile ou dlinquante, cet ouvrage intressera au plus haut point tous les parents,
ducateurs, sociologues, psychopdagogues, etc.
Petite Bibliothque Payot
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 5
N en 1870 dans un faubourg de Vienne, ALFRED
ADLER est avec C. G. Jung l'un des principaux disciples et dissidents de Freud. Il
est mort en 1937 Aberdeen, en cosse, o il tait venu faire des confrences.
Depuis la fin de la deuxime guerre mondiale, l'enseignement adlrien commence
tre universellement connu et son retentissement sur l'volution des ides en
psychopathologie, psychothrapie, pdagogie et mdecine est considrable.
Dans cet ouvrage sur L'enfant difficile, le lecteur dcouvrira l'un des aspects
pratiques les plus intressants de la pense adlrienne et comprendra quelle aide une
telle doctrine peut apporter aujourd'hui aux parents, ducateurs, mdecins ou psycho-
pdagogues.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 6
Prface du traducteur
Dr. Herbert Schaffer, 1949
Retour la table des matires
L'tude de l'me enfantine avec ses difficults caractrielles est l'ordre du jour.
Une abondante littrature psychopdagogique, des dispositions lgislatives concer-
nant l'enfance dlinquante, des enqutes frquentes des quotidiens et priodiques sur
l'enfance malheureuse, des missions radiophoniques ducatives, tmoignent de
l'intrt suscit par ce sujet. Un grand nombre de consultations pour enfants difficiles,
des Child Guidance Cliniques, essaient d'apporter aide ces cas.
Depuis toujours on a voulu cristalliser les expriences dans un enseignement et
chaque poque a connu son systme pdagogique. Mais la prise de conscience de la
donne suivant laquelle l'adulte se prsentera demain dans la vie tel que l'aura form
l'ducation de ses premires annes d'enfance semble une notion rcente et une d-
couverte de la psychopdagogie. Comment parler l'enfant, comment le comprendre,
le guider, dans quel sens l'lever, voil autant de questions qui font la proccupation
permanente de tous ceux qui se sont attaqus ce problme.
Or, si l'ampleur de cette littrature et si l'importance du mouvement en faveur des
questions de psychologie infantile nous montrent que le problme est ainsi pos, elles
nous dmontrent en mme temps qu'il est loin d'tre rsolu.
Dans les consultations pour enfants difficiles le jeune sujet est pes, tois, aus-
cult, test, tiquet. Il est ncessaire de connatre l'tat physique de l'enfant, il est
utile de pouvoir dnommer la nature de ses difficults. L o le terrain somatique est
dficient - ces cas reprsentent une minorit: enfant nonchalant par hypothyrodisme,
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 7
surmenage, etc. - la mdecine, en particulier l'endocrinologie, nous apporte la modes-
te contribution des prparations stimulantes, neurovgtatives ou opothrapiques.
Mais bien souvent les complications caractrielles surgissent chez des enfants en
parfait tat de sant physique.
La thorie du milieu voudrait influencer favorablement l'enfant en le plaant dans
une ambiance convenable. Il est certes prfrable d'lever l'enfant dans un entourage
quilibr et comprhensif et de l'loigner de toute influence nocive. Cette condition
est hlas bien souvent irralisable. Tous les psychologues connaissent d'ailleurs des
cas d'enfants difficiles survenus dans des milieux harmonieux, Le changement des
circonstances extrieures n'entrane pas toujours le rsultat espr, tant donn que
l'enfant conoit le monde environnant d'aprs un schma prtabli, un style de vie
faonn depuis les premires annes de son existence et que son aperception sera
tendancieuse.
La doctrine de l'hrdit caractrielle ne connat que des aptitudes transmises. Elle
devrait, de ce fait, renoncer toute tentative pdagogique.
D'autres auteurs encore veulent ramener les perturbations caractrielles des
traumatismes sexuels infantiles.
Dans les congrs de neuropsychiatrie, dans les rencontres priodiques de psycho-
pdagogues et d'ducateurs se discutent et s'opposent les rsultats des diffrentes
recherches. Le systme ducatif de la discipline la plus svre et du laisser faire le
plus absolu s'affrontent dans ces discussions.
La psychologie d'Alfred Adler apporte ce dbat l'avis comptent d'un grand
mdecin et d'un grand ducateur. Sa mthode reprsente le premier essai systmati-
que pour remdier par une action psychopdagogique aux troubles de nature psycho-
gne. Le traitement s'adresse la structure psychique propre de l'enfant, explore le
sens intime de ces troubles, en dcouvrant le but cach de leur raison d'tre
subjective.
L'introduction du livre familiarisera le lecteur avec les donnes essentielles de
l'enseignement adlrien. Il est d'ailleurs inutile d'y revenir en dtail car, dans d'autres
ouvrages thoriques - Le Temprament nerveux, La Caractrologie, Le Sens de la vie
- le fondateur de la psychologie individuelle compare expose l'ensemble de ses vues
et de sa doctrine. Mais la psychopdagogie est un art qui a son ct technique qu'il
importe de ne pas ngliger. L'amateur qui admire au muse du Louvre le regard
expressif de la Joconde trouvera dans un simple dessin que possde le muse de
Chantilly une preuve de ces multiples tentatives qui mnent au rsultat final, dessin
o le matre a voulu, par la juxtaposition de deux cercles dessinant la prunelle, con-
crtiser toute la vivacit de l'expression de son modle. Comme il est instructif de
connatre ces croquis htifs dont sont issus tel chef-d'uvre ou telle toile de matre, il
sera profitable au lecteur - et surtout au pdagogue et tous ceux qui s'occupent
d'ducation - de connatre la manire d'agir de l'illustre psychopdagogue que fut
Alfred Adler et d'assister ses conversations avec les enfants difficiles.
Des interprtations de comptes rendus rdigs par des instituteurs, des rsums de
cas comments au moment de la lecture, des entretiens stnographis pris sur le vif,
ont fourni la matire du prsent recueil. En face de la simplicit apparente des dialo-
gues on pourrait tre parfois tent d'oublier la grandeur de la tche qui incombe au
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 8
psychopdagogue. Mais il importe avant tout de parler le langage de l'enfant pour le
comprendre et le mettre l'aise et ensuite se faire comprendre par lui en se mettant
encore sa porte. Il ne faudra donc pas s'attendre trouver dans ces chapitres des
chafaudages philosophiques - du moins dans la partie pratique de ce recueil - ou des
formules toutes faites pour tirer les vers du nez l'enfant difficile. Ceux, par
contre, qui affrontent dans la pratique journalire les difficults des problmes de
l'ducation, instituteurs, jardinires d'enfants, parents soucieux du devenir de leurs
enfants, psychopdagogues et psychothrapeutes, pdiatres et mdecins y cueilleront
une riche moisson de renseignements. Ils y dcouvriront des problmes semblables
aux cas qu'ils rencontrent dans leur propre activit professionnelle, des analogies de
structure psychique, des ressemblances de situations ou de constellations familiales,
des tournures heureuses dans le dialogue qui leur seront utiles. Mais ces dessins
caractriels et ces courts mtrages de sances ducatives seront surtout profitables
l'lve - ne sommes-nous pas tous lves ? - qui, de la parole, de la phrase et de la
formule employe saura progresser au sens et la comprhension profonde de la
structure du cas individuel. Car, pour reprendre l'exemple de l'art pictural, la qualit
de la cration ne dpend pas du mouvement de tel trait de fusain ou de l'emploi de
telle couleur, mais de l'heureuse disposition de l'ensemble et de l'harmonieuse
juxtaposition de toutes les nuances et de toutes les formes. Pour y parvenir il faut
savoir saisir le sens intime du sujet qu'on aborde.
Voici dfiler devant nous l'enfant gt, le menteur, le voleur, l'enfant dtest,
l'ambitieux, l'nurtique et tant d'autres encore. Chaque cas apparat avec son tiolo-
gie particulire, ses manifestations propres et son dynamisme spcifique. Tous pr-
sentent les visibles dfauts d'une invisible structure de leur personnalit dont le trait
essentiel est l'insuffisant dveloppement du sentiment social.
Voici quelques notions d'ducation donner aux parents - dont l'attitude est par-
fois la base des troubles de l'enfant - sans blesser leur susceptibilit ; et pour
terminer quelques pages sur l'importance du jardin d'enfants, importance qui
n'chappera personne si l'on tient compte de la valeur des premires impressions de
la personnalit naissante pour la destine future de l'tre humain.
Dr Herbert SCHAFFER.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 9
Avant-propos de
l'auteur
1930
L'enfant est le pre de l'homme.
Retour la table des matires
Dans la psychologie individuelle cette maxime prend toute sa vigueur. Les quatre
ou cinq premires annes de sa vie suffisent l'enfant pour complter son entrane-
ment spcifique et arbitraire vis--vis de ses impressions. Celles-ci proviennent non
seulement de sa valeur organique mais aussi des excitations manant de l'extrieur. A
partir de cette priode commencent l'assimilation et l'utilisation des expriences
vcues, non plus d'une faon arbitraire et encore moins en suivant de prtendues lots
de causalit, mais en fonction du style de vie. L'individu est dtermin par la structure
de son style de vie. A ses lois obissent dsormais et pendant toute la dure de
l'existence les sentiments, les motions, les penses et tes actions. L'activit cratrice
du style de vie commence son uvre. Pour faciliter cette activit, des rgles, des
principes, des traits de caractre et une conception du monde son labors. Un
schma bien dtermin de l'aperception s'tablit et tes conclusions, les actions sont
diriges en pleine concordance avec cette forme finale idale laquelle on aspire. Ce
qui dans le conscient se rvle comme ne crant pas de perturbation, comme agissant
conformment ce sens, y est maintenu. Le reste est oubli, rduit ou encore agit
comme un modle inconscient, soustrait plus qu' l'ordinaire la critique ou la
comprhension. Le rsultat final de ce schma, qu'il renforce les lignes dynamiques
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 10
conscientes, qu'il les annihile ou les paralyse par une raction, conduisant ainsi des
conflits par inhibition, est toujours dtermin d'avance par le style de vie.
Les modles du style de vie, par exemple les lignes de conduite des traits de
caractre, se construisent toujours aprs un long entranement en vue duquel on peut
retrouver, dans le conscient comme dans l'inconscient, les restes de souvenirs gnra-
lement incompris. Ce ne sont pas les souvenirs ni les expriences vcues qui fournis-
sent les facteurs dterminants, mais bien le style de vie qui leur a donn une forme,
les a dirigs et utiliss dans son propre sens. Une comprhension suffisante permet de
saisir cet accord complet de la force agissante du conscient et de l'inconscient. Et la
comprhension des deux ne s'tend aussi loin que si l'action, la sphre d'action du
style de vie, n'est pas perturbe.
Il est permis de compter sur une certaine probabilit, acquise par une longue
exprience. lorsque l'on n'a en main que quelques fragments de la vie de l'me,
probabilit qui permet pourtant de tirer certaines conclusions. Mais l'on doit toujours
vrifier trs soigneusement si ces conclusions correspondent galement au systme
complet de la vie de l'me d'un individu. Le plus souvent il n'est pas possible d'agir
autrement. C'est l un procd qui correspond parfaitement aux exigences du
diagnostic mdical, o nous sommes galement obligs de tirer les conclusions d'un
symptme partiel, de limiter la sphre de la maladie prsume, jusqu' ce qu'un
second, un troisime symptme viennent nous aider tablir un diagnostic tout fait
prcis.
Dans le prsent ouvrage j'ai essay, tout en poursuivant la description de la
technique de la psychologie individuelle compare , de dgager le style de vie des
enfants difficiles.
Cette tche ncessite la connaissance la plus prcise de la technique de la
psychologie individuelle compare et de ses ressources prouves: elle montre gale-
ment d'une manire trs nette la connaissance de l'art de l'interprtation. Pour ce faire,
de mme que dans le diagnostic mdical, on ne peut se passer de la facult de
divination. Cette divination ne peut se justifier que s'il est prouv que toutes les
manifestations partielles sont en nette cohsion avec l'ensemble et font apparatre des
dynamismes identiques. Parmi ces aspirations, semblables dans tous leurs dtails, les
plus importantes sont:
1 Le degr de coopration (du sentiment social et de l'intrt social).
2 La manire caractristique dont l'individu recherche la supriorit (scurit,
puissance, perfection, dprciation d'autrui).
Ces formes d'expression, invariables, peuvent tre diffrentes dans leurs moyens
mais non dans leur finalit (finalisme de la psychologie individuelle compare). Le
degr du courage, du sens commun manifests, le mot d'ordre individuel de la con-
ception du monde, l'utilit ou le caractre nuisible pour la collectivit, refltent le
degr d'aptitude au contact social. La solution plus ou moins russie, conforme
l'esprit de notre poque, des trois principaux problmes de la vie (communaut,
profession, amour) ou le degr de leur prparation dvoilent le complexe d'infriorit
toujours prsent et sa compensation manque, le complexe de supriorit.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 11
Celui qui ne reconnat pas ou n'a pas compris le fait de l'unit du style de vie ne
parviendra pas, mme avec les principes d'airain de la psychologie individuelle,
comprendre la formation des symptmes. Celui qui a saisi cette notion doit savoir
qu'il est capable de changer le style de vie mais non les symptmes.
Je me propose de parler ailleurs du diagnostic gnral et spcial de la psychologie
individuelle compare, de la technique et du comportement du conseiller.
Dr Alfred ADLER.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 12
Introduction
L'homme et son semblable
Retour la table des matires
Il serait extrmement tentant de dcorer ce thme de belles guirlandes verbales et
d'une avalanche de phrases. Je pourrais galement, remontant aux sources de la civili-
sation, dcrire l'effort prodigu en vue de l'tablissement d'une unit de l'humanit
dans le sein d'une tribu, d'un peuple, d'un tat, d'une communaut religieuse. Je pour-
rais montrer comment ce mouvement a toujours t reprsent par quelque ide dont
l'homme tait plus ou moins conscient, unit de l'humanit au point de vue politique
ou religieux. Je ne veux pas en parler. Je voudrais dmontrer que les tendances qui
visent la cration d'une unit dans la socit humaine ne doivent pas tre apprcies
uniquement du point de vue moral, politique ou religieux, mais avant tout du point de
vue de la vrit scientifique.
Je voudrais faire ressortir que la vie de l'me humaine ne se dpeint pas par le
verbe tre , mais par le verbe devenir . Tous ceux qui se sont obstins faire
ressortir des fragments, des complexes l'intrieur de cette vie de l'me, n'ont pas
beaucoup progress. tant donn qu'ils estiment qu'il s'agit l d'une sorte de machine.
Dans chaque organisme vivant qui tend vers une forme idale nous trouvons la vie
psychique se frayant un chemin qui la mne au triomphe sur les difficults, difficults
qu'elle est appele affronter sur cette terre dans le sens de la socit et dans les
rapports entre les sexes. La solution de ces questions ne s'obtiendra pas comme celle
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 13
d'un problme de mathmatiques. Je sais qu'elles peuvent tre rsolues correctement
mais je sais aussi qu'elles peuvent tre rsolues de faon errone. Je voudrais faire ici
une remarque marginale dont le but est d'attirer votre attention sur le fait que nous ne
pouvons pas nous attendre une solution absolument correcte. Ce ne peut tre qu'un
effort en vue d'atteindre pour chacun et pour tous un but o l'unit du genre humain
apparat sauvegarde. Ce que nous appelons bon est bon eu gard son utilit
pour l'ensemble des hommes, ce que nous nommons beau ne l'est que de ce point
de vue galement; ce point la notion de la socit est-elle enracine dans le langage
et dans les ides. Nous retrouverons toujours, dans toutes les formes d'expression de
l'individu et de la masse, comment elles se placent vis--vis de la question de la
communaut. Personne ne peut sortir de ce cadre. La faon dont chacun s'y meut est
sa propre rponse. Si les solutions justes ne se ralisent que par rapport la com-
munaut, il est comprhensible qu' l'intrieur de la sphre des relations humaines il
se produise des rsistances lorsque quelqu'un rpond d'une faon errone. Cette
particularit atteint toujours celui qui n'est pas troitement uni la communaut, qui
ne se sent pas une partie du tout, qui n'est pas chez lui l'intrieur de l'humanit. Il ne
doit pas seulement compter sur les avantages qui lui sont offerts par la civilisation
mais aussi avec les inconvnients, les envisager comme le concernant et les accepter
tels quels. Ce que nous nommons l'intrt pour la gnralit, n'est qu'un ct de
l'union troite avec les autres, ce que nous appelons courage est ce rythme qu'a en lui
un individu et qui lui permet de se sentir un lment de l'ensemble. Nous ne devons
pas tre induits en erreur lorsque nous prenons en considration la moyenne de
l'volution actuelle et que nous voyons tout ce qui manque encore. Cela nous impose
de nouveaux devoirs pour notre devenir. Nous ne devons pas ressentir notre existence
comme une essence, nous ne devons pas nous comporter comme quelque chose de
statique, ni prendre une position belliqueuse contre l'aspiration l'volution ; il est
ncessaire que nous considrions les difficults comme des problmes dont la
solution est exige de nous, qui nous incitent un optimisme actif. Seuls ont pu avoir
voix au chapitre dans l'histoire de l'humanit ceux qui taient anims d'un optimisme
actif, ils taient les reprsentants de l'volution et le seront; tous les autres en ralit
ne sont pas vraiment leur place, ils retardent la marche de l'volution. Es ne peuvent
pas ressentir en eux le sentiment de bonheur comme l'ont ceux qui cooprent sciem-
ment la marche du temps. Le sentiment de la valeur provient galement de l'union
troite avec le tout et de la participation l'action du temps. Ces conclusions provien-
nent des observations de la psychologie individuelle, et elles sont le fruit d'un long
travail. tre un homme n'est pas seulement une faon de parler, c'est tre une partie
de l'ensemble, se sentir une partie de l'ensemble, Le fait qu'encore actuellement tant
de gens manquent cette voie tient l'erreur de leur personnalit. Celui qui est arriv
saisir la connexion des faits sociaux ne renoncera pas dornavant se plonger dans le
courant qui progresse vers le bien de la socit.
Si nous nous souvenons combien l'homme est mal partag dans la nature, une
chose nous apparat clairement : cet tre vivant, rduit lui-mme, n'aurait certes pas
t capable de vivre. Nous ne trouvons nulle part la trace d'un individu vivant seul,
aussi loin que nous pouvons suivre l'histoire de l'humanit. La foi de la socit a
toujours exist. Cela est parfaitement comprhensible si nous tenons compte de la
faiblesse humaine en face de la nature. L'homme ne possde pas les armes dont
disposent d'autres tres vivants, il n'a pas les dents des carnassiers, pas de cornes, pas
la mme rapidit, il ne peut pas grimper, ni voler, il n'a pas l'acuit de la vue, de
Poulie, de l'odorat, avantages grce auxquels d'autres tres vivants ont la possibilit
d'attaquer et de se dfendre, de s'assurer -une place sur cette pauvre corce terrestre.
Il dispose d'organes faibles pour la sant desquels - aussi bien en vue du maintien de
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 14
la vie de l'individu que de celle de l'ensemble - l'union avec les autres a toujours t
ncessaire. C'est dans cette union qu'il a puis de nouvelles forces. Si l'on pense
l'tendue de la culture humaine, on comprendra que ceux qui l'ont cre et ont t
amens l'utiliser, n'taient pas suffisamment forts en face de la nature. Ils devaient
chercher des complments, des compensations pour ce qui leur manquait. L'homme
doit apprendre vaincre la nature pour se servir d'elle. L'union a t la plus grande et
la plus importante invention du genre humain. Il ne doit pas tre fait allusion ici
uniquement l'homme, nous trouvons galement dans le royaume des animaux que
les tres vivants plus faibles se rassemblent en troupes pour trouver une protection ou
pour chasser ensemble. Le gorille, dont nous admirons la force, le tigre, la terreur la
plus redoute de tous les animaux, n'ont pas besoin de la communaut. L'homme, si
nous nous le reprsentons dnu de tous les secours de la culture; dpouill de tous
les moyens que son intelligence lui a procurs, aurait t perdu ds le premier jour s'il
s'tait trouv sans coopration dans la fort vierge. Notre observation nous mne
encore plus loin. Les acquisitions les plus prcieuses de l'homme, au cours de
l'volution, lui sont venues de sa faiblesse. Si nous pensons la vie de l'homme, la
dure du genre humain, nous ne pouvons comprendre sa survivance que si nous
pensons en mme temps au grand secours que lui a apport la communaut. Certes
dans sa nature psychique et dans sa constitution physique lui sont donns tous les
moyens qui permettent cette union. Dj si l'on considre les fonctions des organes
des sens, il est clair qu'ils servent cette liaison. Dans la faon dont chacun regarde
l'autre se trouve la prparation au contact et l'expression de la liaison avec les autres.
Sa manire d'couter nous traduit ses possibilits de se lier aux autres, sa manire de
parler reprsente le lien qu'il tablit entre lui-mme et son semblable. Allons-nous
comprendre prsent pourquoi tant d'hommes ne regardent pas, ne parlent pas ou
n'coutent pas correctement? Ce ne sont pas les organes qui importent mais la vie
instinctive, car toute vie psychique est draine vers ces plans o l'individu trouve sa
place en face et ct des autres. C'est de nouveau la faiblesse de l'organisme
enfantin qui contraint cette liaison. Le rapport du nourrisson avec sa mre est la
premire formation sociale. Dans ce rapport social, o le moi du nourrisson ralise le
toi de la mre, se dveloppent toutes les possibilits et les aptitudes. Nous com-
prenons de ce fait qu'il nat l pour la mre une tche importante : diriger le dvelop-
pement de l'enfant de faon telle qu'il puisse rpondre plus tard correctement aux
exigences de la vie sociale. Le cadre tant pos, l'enfant parlera, coutera et regardera
en rapport avec la mre. C'est l que rside la premire fonction de la mre. Les
mres se trouvent la source du sentiment social, elles doivent la tenir pour sacre.
Ce mcanisme joue tout instant et il devient finalement un automatisme psychique
qui faonne la forme de vie de l'enfant. Si nous rflchissons la faon dont
s'effectue le dveloppement de la parole, fonction sociale si importante, nous pou-
vons comprendre o la communaut met ses forces en oeuvre. Je dois parler comme
je prsume que chacun devrait parler afin que tous le comprennent. Nous trouvons
frquemment que l o la premire fonction de la mre a chou, cette dernire n'a
pas su russir dans sa deuxime fonction : largir le sentiment social de l'enfant vis--
vis des autres, le prparer afin qu'il affronte correctement ses semblables. Nous
trouverons un intrt insuffisant pour les autres, tat qui fera l'objet principal de nos
proccupations. O trouvons-nous la possibilit de raliser le dveloppement du
sentiment social si cette relation n'a pas t effectue pendant les premires annes de
la vie enfantine? Cet intrt insuffisant a dj pris forme et apparence, un but est
prsent l'esprit; cheminer dans la vie sans intrt pour les autres, toujours prendre et
ne jamais donner. Le sentiment de la valeur commence dj agir. Seul celui qui se
sent sa vraie place le possdera. Celui qui n'a pas fait de soi une partie de l'ensemble
ne le connatra pas. Si nous pensons la plus grande facult de l'homme, l'intelli-
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 15
gence, nous pouvons dire - il n'y a pas d'intelligence prive, pas d'intelligence de
l'individu, l'intelligence a une valeur gnrale . Elle ne s'est dveloppe que dans
la comprhension des autres, ce qui veut dire s'approcher de ses semblables, s'iden-
tifier eux, voir avec leurs yeux, entendre avec les oreilles des autres, sentir avec le
cur des autres. Comprendre signifie concevoir un homme, un vnement de la faon
dont nous nous attendons que chacun le conoive. L aussi nous accompagne le
contrle et le jugement de la communaut. Je ne veux pas parler de morale, d'thique,
ce ne sont que les rgles du jeu nes du sentiment social. Nous ne pouvons nommer
morale et thique que ce qui est utile la communaut. La mme chose vaut pour
l'esthtique. Ce que nous appelons beau doit avoir une valeur d'ternit pour la
communaut. Nous ne devons pas nous tonner d'tre sujets aux erreurs. Nous avons
toujours t prts reconnatre nos erreurs et les corriger. Mme si un changement
dans l'idal de beaut se manifeste nettement, il est certain que seul peut se maintenir
comme beau ce qui l'est pour l'ternit et ce qui se trouve en connexion avec nos
notions sur sa sant. Je voudrais attirer l'attention sur la puissance norme du senti-
ment social pour l'individu, cette puissance capable de crer des unions d'importance
plus ou moins grande, des courants nationaux, politiques ou religieux. Pour tablir les
formes utiles la socit, nous nous servirons des mmes mesures. Nous ne pouvons
reconnatre comme valables que celles qui se placent sur le plan de l'utilit gnrale.
On peut longuement discuter l-dessus, il est parfois difficile de donner une rponse
prcise. La vie humaine est un devenir. Ce que nous prouvons aujourd'hui n'est
qu'un point d'intersection dans le mouvement ternel qui tend vers le but de la forme
parfaite. Qu'arrive-t-il ceux qui n'agissent pas dans le cadre de la socit? Ceux
chez lesquels ne se manifeste pas le sentiment social? Je voudrais intercaler ici : ce
qu'un individu dit ou pense de lui-mme est absolument sans importance, nous ne
pouvons en faire aucun cas. Nous ne pouvons apprcier que les actes. Aussi peut-il
arriver que quelqu'un se tienne pour un goste et nous constatons qu'il est capable de
collaboration et d'altruisme. Beaucoup peuvent considrer qu'ils collaborent : lors
d'un examen plus attentif nous devrons malheureusement constater qu'il n'en est pas
ainsi. Il n'est pas ncessaire que ce soient des mensonges, les erreurs dans la vie
psychique jouent un rle beaucoup plus grand que les mensonges conscients. Com-
ment s'introduisent ces erreurs dans la vie psychique? Comment se fait-il que notre
effort impatient vers la communaut se dveloppe si lentement? Il y a cela plusieurs
rponses. Une grande partie des hommes est pntre de cette ide : cela dpasse les
forces humaines Ce sont les pessimistes, ceux qui ne contribuent gure l'volution,
volution qui nous semble la tche essentielle de la vie et qui rclame le triomphe sur
les difficults. J'ai l'habitude vis--vis de mes lves de recourir trs souvent une
fiction : J'imagine que nos anctres trs loigns, jadis assis sur une branche d'arbre,
peut-tre encore pourvus d'une queue, rflchissaient ce qu'on pourrait faire, cette
vie tant vraiment trop pauvre. L'un dit : A quoi bon se tourmenter, cela dpasse
toutes les forces, le mieux est de rester ici en haut. Que serait-il arriv si celui-l
l'avait emport? Aujourd'hui encore nous serions assis dans l'arbre et nous aurions
gard une queue. Vraiment, o sont-ils rests, ceux qui taient en haut de l'arbre?
Extermins. Ce processus d'extermination se poursuit continuellement, il est terrible-
ment cruel, la logique des faits est cruelle. Il n'y a aucun doute que des myriades
d'hommes ont t sacrifis, parce qu'ils ne sont pas descendus de l'arbre. Des peuples
ont t extermins, des familles dtruites parce que leurs rponses aux exigences de
la vie taient mauvaises. Ce processus se droule sous une forme dissimule de sorte
qu'on retrouve rarement sa trace; la troisime ou quatrime gnration il peut arriver
sa fin et personne ne sait pourquoi. Lorsqu'on examine de plus prs ce problme on
trouve ceci : il est impossible de donner une rponse incorrecte aux exigences de la
logique de la vie en socit sans que ces fautes se paient; qu'il s'agisse de maladies,
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 16
de graves processus de dgnrescence, d'atrophies psychiques de quelque sorte que
ce soit. Il est clair que ce sont les suites des fautes - peu prs ce que blme Emerson
lorsqu'il dit que nous voulons viter les suites mais pas les fautes. J'ai indiqu o
commence ce processus. Chacun prend position l'gard de la vie. Ce n'est qu'un
verbiage lorsque quelqu'un croit que la conception du monde ne regarde que la philo-
sophie et non pas chacun de nous. Partout o vous regardez vous voyez apparatre
clairement la conception que chacun se fait du monde. Pour celui qui l'a ralise, il
est vident qu'on ne peut pas aider le sujet qui n'arrive pas une meilleure conception
du monde. La question est la suivante : quelle conception du monde allons-nous
adopter pour remplacer celle qui nous semble errone? Dans la confusion des voix
vous entendrez dire : une conception du monde nationale, religieuse, europenne,
asiatique. Nous ne sommes prvenus contre aucune, ce que nous demandons c'est
qu'elle prenne une forme aboutissant la conception du sentiment social; ceci est la
conception philosophique de la psychologie individuelle. Nous nous appliquons en
faire la pierre de touche parce que nous avons appris chez l'individu, aussi bien que
chez les masses, o ils ont commis leurs fautes. Nous ne pouvons pas tre d'accord
avec ceux qui rclament des facilits, qui croient que tout est sauv si les difficults
sont abolies. Cette solution ne peut venir que par le sentiment social, qui tire son
origine de la force cratrice de l'individu. La mre est la mdiatrice indispensable
pour la vie, elle doit dgager le sentiment social, le guider et le diriger vers les autres.
Mais il y a des passages dangereux o le dveloppement peut chouer, par exemple
lorsque la mre n'est pas une vritable coopratrice, de telle sorte qu'elle ne peut
absolument pas dvelopper le sentiment social. Ou bien elle n'est collaboratrice que
pour l'enfant et pas pour les autres. Elle le lie si fortement elle qu'elle compromet
l'panouissement ultrieur de l'enfant. Ce sont l les fautes capitales ; toutefois il y a
d'autres phases dangereuses dans le dveloppement de l'enfant.
Des enfants qui naissent souffreteux considrent ce monde comme une valle de
larmes et ne manifestent pas du tout cette joie du dveloppement que nous apprcions
tant chez les enfants. Nous pouvons dj comprendre pourquoi de tels enfants, qui
sont surchargs, qui ressentent leur corps comme un fardeau et trouvent la vie
pesante, sont beaucoup plus intresss par leur propre personne que par les autres. Il
en rsulte un tat d'me de panique : sauve qui peut. Nous trouvons des traits gostes
qui entravent le dveloppement du sentiment social. Ce groupe d'enfants avec des
organes faibles est important, ce qui n'a rien d'tonnant tant donn que tout l'orga-
nisme humain est faible par rapport l'organisme animal. Ensuite il y a un second
groupe d'enfants : ils sont surchargs ds le dbut de leur vie; les enfants gts qui ne
sont intresss que par une seule personne, ils veulent constamment se faire assister
par elle. Aussitt que le style de vie est parachev, dans la quatrime ou la cinquime
anne d'existence, il ne subit plus de changement radical. Tout ce que les enfants
prouvent dans cette forme de vie ils l'assimilent avec leur style de vie : ils regardent
le monde avec leurs yeux, ils ont leur propre conception de la vie, celle d'tre assists
par les autres, ils veulent avoir un succs immdiat, ils chouent lorsqu'ils doivent
fournir un effort. Je n'ai pas besoin d'indiquer que de tels enfants chouent lorsqu'ils
se trouvent dans une nouvelle situation et que tout changement de situation
provoquera chez eux l'apparition de difficults. Les enfants gts occupent une place
norme dans la vie, je ne crois pas exagrer en disant qu'il y a 50 60 % de tous les
enfants qui ont t rendus dpendants et dpourvus d'initiative. Ce manque d'ind-
pendance se manifeste pendant toute la vie, tout leur est trop difficile. Ils n'ont aucune
confiance en eux-mmes. Il existe dans l'histoire amricaine un exemple intressant
illustrant ces cas. Dans la guerre hispano-amricaine, les Amricains taient allis
avec le gnral Garcia. Il tait indispensable de lui adresser un message, mais on ne
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 17
parvenait pas le trouver. Le message tait important et il ne resta au gnral am-
ricain rien d'autre faire que d'annoncer publiquement qu'il avait un message pour
Garcia et de demander qui voulait le porter. Aprs un long silence quelqu'un s'avance,
prend la lettre et part. Des coliers amricains reurent comme devoir de classe de
dire quel tait, selon eux, le plus grand hros des temps modernes. Un lve crivit :
Le soldat charg du message pour Garcia et il expliqua : la plupart auraient dit :
comment peut-on le trouver ? ou : un autre ne pourrait-il pas le faire mieux? L'un ne
dit rien et partit. Il tait indpendant, les autres se sentaient faibles. - Voil la source
de tous nos maux dans notre me, le trop grand sentiment de faiblesse, le manque de
confiance dans sa propre force. Appartiennent au troisime groupe ceux qui, au
dpart, sont surchargs et qui ne peuvent pas s'intresser leurs semblables : les
enfants has. Ils n'ont jamais appris qu'il existe un prochain. Il y en a une masse
norme dans la vie, illgitimes, non dsirs, orphelins, pour lesquels notre culture n'a
pas cr les conditions de vie ncessaires ; les enfants laids, qui apprennent bientt
que l'on n'est pas favorablement dispos leur gard. Nous comprenons pourquoi
parmi les criminels, les ivrognes on trouve si souvent des hommes laids. Il y en a
aussi de beaux, ce sont ceux qui ont t gts. Ils reprsentent un grand pourcentage
d'individus pour qui se posent des problmes et qui par leur allure dmontrent qu'ils
n'ont aucun intrt pour les autres. Ce sont des enfants difficiles, dont la conception
du monde est la suivante : que ma volont soit faite. Ils en arrivent des larcins, ils
font des fugues, ils ne travaillent pas. Ils sont tous dignes de piti, car chacun sent
qu'ils ne cooprent pas. Qu'arrivera-t-il lorsqu'ils seront placs devant des tches plus
importantes? Il se rvlera qu'ils ne peuvent pas participer aux jeux des autres. Les
nvross et les alins s'efforcent de sortir du cadre de la communaut parce que les
tches leur apparaissent insolubles. Ici aussi se manifeste la conception du monde :
pour moi une autre plante serait ncessaire o il n'y aurait pas de tches, o l'on
trouverait tout ce qu'on dsire. Les criminels sont des individus qui manquent d'int-
rt pour leurs semblables et qui sont guids par l'ide qu'il faut facilement et
rapidement arriver des succs sans s'occuper d'autrui. Nous trouvons dans tous ces
groupes un manque de courage pour reconnatre les tches de la vie. Ce sont des
fuyards, ils veulent que les choses leur soient plus faciles, diffrentes, ils ne s'effor-
cent pas de se crer les conditions qui sont ncessaires pour rsoudre les problmes
de la vie. Ensuite viennent les candidats au suicide qui nous dmontrent combien peu
d'intrt ils ont pour la coopration, combien ils ont peu de courage pour affronter les
tches de la vie. On ne doit pas croire que l'on peut saisir la totalit de ce mal avec de
simples statistiques. Laissez monter les prix du bl, vous aurez plus de suicides, crez
des conditions d'habitation dfavorables, vous trouverez une masse norme de gens
penchs vers le ct antisocial de la vie. La disposition s'vader du ct utile est
norme. Il n'y a pas de dveloppement idal du sentiment social, il faut que nous
l'ayons devant les yeux comme but, non pas pour des motifs normaux, sociaux,
charitables, mais pour des motifs scientifiques. Nous voyons que des fautes ne
peuvent pas tre commises sans qu'elles se paient. Il en est de mme pour les peuples,
lorsqu'ils ne possdent pas assez de courage pour s'insurger contre les guerres, lors-
qu'ils n'ont pas assez d'intrt pour les autres. L'histoire du monde est un enchane-
ment de tels vnements malheureux. Je ne voudrais pas m'arrter davantage la
question des dipsomanes, mais insister simplement, avant de finir ce chapitre, sur
l'importance du dveloppement social.
Aucune des circonstances de notre vie ne peut se passer de sentiment social. J'ai
fait allusion prcdemment aux fonctions des organes des sens. L le sentiment social
de l'enfant se manifeste dans ses rapports avec la famille, avec ses frres et surs.
Lorsque l'enfant commence frquenter l'cole, il est prouv quant au degr de son
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 18
sentiment social. Au moment o apparat le problme de la camaraderie, surgit la
question : Jusqu' quel point as-tu dvelopp ton degr d'intrt pour les autres ; et
nous comprenons pourquoi, lorsqu'il fait dfaut, le sentiment social se venge, puisque
du fait de cette carence, l'individu n'est pas mme de payer ce qu'il doit.
Mais nous voyons aussi qu'il n'est pas responsable. Il nous faut penser un
remde autre que ceux employs jusqu' prsent. Il s'y ajoute encore le problme de
la profession et la question se pose alors : Comment pourrais-je me rendre utile
dans un travail? Il n'existe pas d'activit professionnelle qui ne soit pas utile aux
autres. Les problmes de l'amour et du mariage rclament galement un intrt accru
pour les autres. Nous voyons de nouveau comment l'extermination progresse lors-
qu'un individu ne se sent pas li la communaut. Cela se manifestera dans le choix
de son partenaire, selon que le sujet voudra dominer ou qu'il se sentira intimement
uni avec lui. Et tant d'autres problmes qui tous exigent un sentiment social. Il en est
exactement de mme pour les questions qui concernent la vie des peuples. Un peuple
ne pourra progresser que s'il a de l'intrt pour la communaut. S'il place au premier
rang des intrts gocentriques, l'autre peuple fera de mme. Il serait bon d'avoir un
mot d'ordre. L'humanit actuelle aime les mots d'ordre. Je pense que le rsultat des
observations de la psychologie individuelle est le suivant : notre tche doit tre de
nous dvelopper nous-mmes ainsi que nos enfants pour devenir les instruments du
progrs social.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 19
Chapitre I
Exagration de l'importance
de sa propre personne (vantardise)
Retour la table des matires
Poursuivant les efforts entrepris dans le but de dvoiler les secrets d'un psycho-
logue individuel, je voudrais vous montrer, en quelques confrences, la faon
approximative dont je procde, lorsque se prsente moi l'histoire d'un enfant diffi-
cile, d'un nvros, d'un criminel. Je m'efforce de dcouvrir les bases et d'tablir les
vritables causes de ses actions errones. A l'issue de ces recherches nous constatons
que tout ce qui est arriv ne devait pas forcment se produire, mais, tant donn les
circonstances, a pu arriver. De fait, si nous parvenons sentir avec l'enfant, penser
avec lui, agir avec lui, nous pouvons aussi nous pntrer du rle que l'enfant a jou
et nous dire : dans les mmes conditions, avec la mme conception errone d'une
supriorit personnelle nous aurions agi peu prs de la mme faon. De cette
manire une bonne part de ce qui relve de la punition disparat, ce qui est loin d'tre
un mal. Notre comprhension, notre connaissance augmentent, le fait primordial tant
que nous pouvons tablir la connexion de toutes les manifestations et manires d'tre
intimes avec le style de vie de l'enfant ou de l'adulte.
Pour vous donner une notion exacte de la faon dont nous nous mettons l'uvre,
j'entreprends la description d'un cas que je ne connais pas ou qui a disparu de ma
mmoire et vais le discuter devant vous. Je n'ai aucune ide des vnements qui sont
dcrits; je veux essayer de suivre cette mme voie qui m'est habituelle dans mon
activit de praticien. Il se peut que je commette une mprise que viendra rvler la
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 20
suite de l'expos. Je ne me dcouragerai pas pour autant. J'ai conscience, dans mon
rle, d'tre semblable au peintre, au sculpteur, qui au dbut doivent agir d'une faon
quelconque d'aprs leur exprience, leur aptitude, pour contrler ensuite, renforcer,
adoucir, modifier les traits afin d'obtenir l'image correcte. Sur ce point vous pouvez
voir que nous agissons tout autrement que ces psychologues qui, voulant compter
avec des grandeurs presque mathmatiques, lorsque leur calcul ne russit pas, s'effor-
cent de trouver les causes de leur chec dans l'hrdit, domaine obscur o l'on peut
introduire tout ce que l'on veut, et rendent responsables des processus organiques,
domaine non moins obscur, ou d'autres encore peine contrlables. On ne peut pas
saisir ces processus et, leur grande satisfaction, la psychologie y trouve rapidement
un terme. Nous nous passons de telles conceptions. Nous prfrons plutt avouer des
erreurs que d'utiliser de semblables moyens d'information. En revanche nous connais-
sons mieux la connexion des traits particuliers avec le tout; nous sommes mieux
arms. Nous cartons les menus dtails. Il nous est devenu possible de conclure d'un
lment l'ensemble, comme en histoire naturelle on tire d'un petit os des rensei-
gnements sur le spcimen, ou comme on dduit l'architecture d'un btiment d'aprs un
petit angle de la fentre. Nous sommes cependant beaucoup plus prudents que
d'autres, qui veulent tayer la description et la comprhension d'une vie, par leurs
propres prjugs. Dans l'expectative nous procdons par suppositions et corrections
successives, l'esprit curieux toujours en veil.
En me proposant maintenant de dcrire l'histoire d'une vie qui m'est tout fait
inconnue, je me doute bien que je percevrai plus nettement certains traits quinze jours
plus tard. Mais j'ai aussi conscience que, comme tous les gens exercs de notre cole,
j'arriverai aux mmes conclusions. Il est significatif que nous ayons cette certitude,
bien que nous parlions avec d'autres mots, que nous choisissions d'autres images, que
nous reportions mme parfois l'accent sur quelque chose d'autre. Mais la consid-
ration de l'unit de la personnalit reste toujours pour nous la ressource la plus
puissante. Nous savons que chaque enfant commence par un sentiment d'infriorit et
cherche le compenser, qu'il tend vers la supriorit, la totalit, qu'il procde au
dploiement de ses forces afin de se sentir la hauteur de toutes les difficults. Nous
apprcions s'il agit sur le ct utile ou inutile de la vie. Le ct utile est celui qui sert
la gnralit et correspond au niveau le plus lev du sens commun, o le dvelop-
pement et le progrs se rvlent prcieux pour cette gnralit. Nous cherchons
reprer l'obstacle qui a provoqu la dviation; nous cherchons dcouvrir le probl-
me qui a prsent de trop grandes difficults. Ces difficults continuant se manifes-
ter dans l'attitude de l'adulte, nous pourrons dire : ici le chemin de la vie a subi une
perturbation, il s'est dvelopp un tat d'me, comme si l'intress n'tait pas alors
la hauteur de ces difficults. Notre attention se concentre sur ces problmes qu'il a
vits. Il est donc clair que nous ne pouvons pas lui attribuer beaucoup de courage.
Une autre question se pose : comment un jour le sujet a-t-il pu ne pas se sentir la
hauteur des problmes de la vie? Comment, un moment dtermin, s'est-il rvl
non prpar? L'exprience nous a montr qu'il s'agit toujours de ces enfants chez qui
le sentiment social s'est insuffisamment dvelopp, de sorte qu'ils ne se sont pas
sentis chez eux, qu'ils n'taient pas lis par ce sentiment social. C'est pourquoi il leur
a t plus facile d'hsiter, de s'arrter, de s'esquiver, de se contenter d'une solution
strile du problme prsent, attitude qui marque dj en elle le prjudice port
autrui.
Je vais essayer d'utiliser et de montrer notre technique dans l'interprtation d'un de
ces cas. En ce qui concerne le cas actuel je sais qu'il doit remonter dix ou douze ans.
J'ai vu cet enfant et, dans la communication que l'on m'a remise, je nie trouve devant
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 21
la description suivante : Je me permets de vous proposer le cas suivant en vous
demandant si l'on peut y porter remde par l'ducation. Il s'agit d'une enfant de onze
ans, bien dveloppe, trs sage la maison comme l'cole, actuellement lve de la
premire classe du lyce.
Cette question de l'efficience de l'ducation soulve le problme suivant - que
peut faire l'ducation quand il s'agit d'checs? De quelle manire l'ducation doit-elle
se comporter en face de ces cas? Il est vident qu'il faut parler, donner des exemples,
s'abstenir de punitions, comme nous le faisons toujours. Punir n'a aucune utilit, le
style de vie est fix aprs la quatrime ou cinquime anne d'existence et ne peut tre
modifi que par l'autoreconnaissance par le sujet de ses fautes et de ses erreurs. Que
peut-on changer par la parole? Uniquement des erreurs.
S'il s'agit dans le cas suivant d'une formation errone du style de vie et que nous
soyons en mesure de comprendre cette erreur, alors peut-tre notre science nous
permet-elle de persuader l'enfant en question qu'il commet une faute sur ce point,
faute qui portera prjudice aux autres. Il n'est pas possible de commettre une faute
sans que plus tard elle se mette en vidence pour ne pas dire qu'elle se paie. Car on
doit, non pas prtendre que dans cette fcheuse formation d'un processus de vie, une
erreur se paie, mais au moins reconnatre qu'elle est prouve. Nous voulons nous
placer parmi ceux qui le reconnaissent; nous voulons tablir la connexion, la rendre
comprhensible l'intresse et essayer de le persuader si bien que, sans cette
persuasion, il ne puisse plus faire un pas en avant. Souvent l'objection suivante est
souleve : Que faites-vous lorsque l'individu a reconnu l'erreur et ne la corrige
pas? S'il reconnat effectivement son erreur, s'il comprend la connexion et qu'il
persiste dans son attitude malgr le prjudice entran, alors force est de dire qu'il n'a
pas tout compris. Je n'ai pas encore vu de cas semblable. Reconnatre vraiment une
erreur et ne pas la modifier va l'encontre de la nature humaine, s'oppose au principe
de la conservation de la vie. L'objection prcdente concerne une pseudo-reconnais-
sance des erreurs, ce n'est pas une reconnaissance fondamentale, o la connexion
sociale arrive vraiment se raliser.
S'il s'agit vraiment d'erreurs dans le cas prsent, nous pouvons y remdier par
l'ducation. L'enfant est une fillette de onze ans, bien dveloppe, sage la maison et
l'cole, lve d'un lyce. Elle frquente la classe qui correspond son ge. Nous
pouvons conclure que, dans la mesure o il s'agit de la solution de la seconde
question vitale, le problme du travail, nous trouvons cette fillette sa place. Nous
n'aurons lever aucune objection srieuse en ce qui concerne la question de sa
situation et nous pourrons soutenir que cette enfant n'est pas au nombre des faibles
d'esprit. On parle beaucoup trop de ces derniers, comme si les enfants de ce genre
foisonnaient.
... Lorsque, le matin, cette enfant doit aller en classe, elle est d'une telle nervo-
sit que tous les habitants de la maison en souffrent.
Nous voyons cela souvent. Le problme de l'cole revt une importance dme-
sure. Nous pouvons ds lors comprendre la connexion : d'un ct elle est bonne
lve, de l'autre elle envisage le problme de l'cole avec une tension extraordinaire.
Mais nous pourrions imaginer cette fillette atteinte de tension sans que les habitants
de la maison eussent en souffrir. Nous en tirerons ainsi la conclusion qu'il faut
souligner la peine des autres habitants de la maison. La tension nerveuse s'explique
non seulement par la manire de voir de la fillette, mais aussi par l'intention de
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 22
montrer clairement aux autres le caractre apparemment effrayant du problme. Vous
voyez l le dsir de prouver aux autres la difficult effrayante de son propre probl-
me. Elle est cependant tout fait en tte de la classe malgr les normes difficults
qu'elle rencontre. Elle surmonte malgr tout les obstacles. Nous verrons par la suite si
nous trouvons d'autres confirmations pour ce type dou d'une particulire force
d'expansion.
- Dj au rveil la petite pleure et dit qu'on l'a veille trop tard.
Les autres doivent mme participer au lever.
... Elle ne sera pas prte. Au lieu de s'habiller elle s'assied et pleure.
Cela vrai dire nous surprend. Chez cette fillette, nous nous attendions la voir
se rendre l'cole l'heure exacte mais avec beaucoup de difficults. Peut-tre le cas
n'est-il pas expos convenablement. Nous avons appris qu'elle est une bonne colire.
Il y a lieu de supposer que cette remarque tendait souligner davantage la significa-
tion du cas. Je me permettrai de placer ici un point d'interrogation, et cela non par
vanit d'auteur. Mais je veux maintenir ce doute, je veux rechercher si vraiment cette
fillette arrive souvent trop tard. Nous vrifierons srement dans la suite s'il en est
ainsi. Dans notre civilisation il n'est gure possible qu'une enfant allant au lyce, et y
arrivant souvent en retard, soit cependant une bonne lve.
... La coiffure, en particulier, donne lieu de frquentes plaintes; aucune ne lui
convient, mme pas celle qui d'ordinaire lui plat le plus.
On ne peut comprendre ce fait autrement que par son dsir d'augmenter la tension
nerveuse par la crmonie de la coiffure. Elle veut branler fortement son entourage
et elle en trouve le moyen dans le problme de la coiffure. Une question se prsente
alors : comment cette fillette peut-elle dployer une telle ruse pour trouver le moyen
qui lui permettra d'branler son entourage? Que l'on n'aille point parler ce propos de
ftichisme des cheveux ; ce serait d'une psychologie boiteuse, qui pose des rgles,
procde d'aprs des rgles, qui introduit simplement dans un schma sexuel des mots
trangers qui n'en disent pas plus que nous n'en savons dj, mais laissent s'insinuer
secrtement une rsonance sexuelle. Notre psychologie, elle, a la chaleur de la vie;
elle ne veut pas avoir de rgles, elle est une action cratrice, la rcration d'un tre
vivant. Nous abstenant de toute autre interprtation, nous reconnatrons seulement
que cette fillette, avec une grande subtilit, a trouv dans son entourage un point
faible d'o surgiront des difficults.
... Le temps passe, l'enfant part finalement en courant, sans avoir djeun, en
pleurant et en se plaignant.
Ce cas non plus n'est pas rare, nous le rencontrons souvent. Si j'ai exprim
auparavant un petit doute en ce qui concerne l'arrive en retard, si j'ai pens que
c'tait peut-tre une exagration de nature faire valoir le tourment de l'entourage,
nous en trouvons ici la confirmation : le temps passe. Il faut tre l'cole l'heure,
on ne peut pas admettre que les lamentations de l'enfant commencent cinq heures,
mais plus vraisemblablement sept heures.
... Nous avons essay de remdier ce dernier inconvnient (la coiffure) en lui
faisant couper les cheveux.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 23
Si nous avons raison, cela ne peut servir rien. La coiffure lui importe peu, il
s'agit plutt pour elle de crer une tension dans son entourage. La coiffure n'est qu'un
des nombreux moyens possibles. Nous allons bien voir ce qu'elle va faire lorsqu'elle
n'aura plus de coiffure. Si nous avions un doute quant l'intelligence de cette fillette,
il va disparatre ici. C'est l l'examen de la psychologie individuelle en ce qui con-
cerne l'intelligence et la faiblesse d'esprit, ainsi que je l'ai recommand. Si elle est
intelligente, nous devrons pouvoir nous en rendre compte. Nous verrons si dans cette
conjoncture nouvelle elle a le style de vie que nous prsumons exister chez les
enfants intelligents, c'est--dire si elle trouvera un autre moyen pour arriver au mme
but.
... Mais cela n'a pas servi grand-chose, car tout coup est apparue une ques-
tion de rsille. Et les mmes plaintes se renouvellent pour la pose de la rsille.
Elle est donc intelligente, nous voil rassurs.
... Le fait que l'enfant parte pour l'cole sans avoir pris de petit djeuner doit se
remarquer aussi pendant les cours, car je ne peux supposer qu'une enfant puisse rester
en classe en soutenant son attention jusqu' onze heures.
En dernier lieu on exprime ainsi le doute qu'une enfant puisse tenir jusqu' onze
heures sans petit djeuner. Or, si son vritable but tait d'tre rassasie, il serait juste
d'admettre qu'il lui serait impossible d'attendre jusqu' onze heures. En ralit cette
enfant a un autre but, elle veut importuner son entourage avec la question de l'cole.
Je ne sais pas si l'on doit en tirer d'autres conclusions. Pourtant nous pouvons dire en
l'occurrence : cette enfant est anime par l'ambition, cette enfant dsire tre le seul
objet de l'attention, l'cole comme la maison, elle chemine l sur la voie de l'utilit
gnrale. Nous apprenons en outre qu'elle est trs obissante la maison; elle n'a
qu'un seul dfaut, elle voudrait que l'on s'occupt constamment d'elle. Elle recherche
l'approbation dans un domaine dplac. Le matin, lorsqu'elle doit aller l'cole, sa
pense principale est : comment vais-je reprsenter mes parents l'norme difficult
que je rencontre? C'est ce que nous pouvons appeler de la vantardise .
Si nous voulons prsent tablir le degr de courage de cette enfant nous devrons
dire : elle cherche prsenter la solution de son problme comme une action d'clat.
Mais ce n'est pas l excs de courage, car sans qu'elle y contribue volontairement,
sans qu'elle le comprenne elle-mme il en rsultera pour elle une certaine scurit. En
effet, si un jour elle n'est plus une bonne lve, les parents en seront rendus respon-
sables. Ce processus de la vie humaine devrait tre beaucoup mieux peru qu'on ne le
fait actuellement. Il est futile de qualifier ce processus d' inconscient . Son
droulement que nous nous efforons de saisir par la pense est en connexion avec la
vie. Nous le suivons tous, mais nous ne le dsignons pas explicitement. Nous ne
pouvons le pntrer que si nous en tablissons la connexion. Aussi nous pouvons dire
maintenant : cette fillette n'a pas beaucoup de courage. Nous pouvons galement
parler de la formation de son sentiment social : personne ne mettra en doute que le
tourment que cette fillette impose sa famille lui pse peu. Nous pouvons tablir que
ce qui lui importe uniquement c'est d'avoir la couronne du martyre. Elle rend la
situation encore plus pnible en accentuant toutes les difficults et en jenant jusqu'
onze heures. Elle est extraordinairement attentive la gloire personnelle; elle ne prte
pour ainsi dire pas d'attention la personne des autres. Peut-tre alors pourrions-nous
tirer encore d'autres conclusions. Je suis navr de ne pouvoir les confirmer, mais nous
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 24
n'avons pas d'autres donnes. Nous pourrions demander par exemple : quelle situation
a form le style de vie de cette fillette? Quelles ont t les premires empreintes qui
l'ont marque, quelles circonstances ont contribu former ce style de vie? C'est une
fillette ambitieuse, qui veut se trouver en tte. Si j'avais le faire, je tirerais la
conclusion suivante - c'est une enfant unique. Considrant d'autre part l'importance
que la mre attache la nourriture, je gnraliserai cela et affirmerai que dans cette
famille la nourriture joue un rle inusit. Nous pourrons aller encore jusqu' dire que
nous nous reprsentons cette enfant comme dlicate et ple. Car si elle tait robuste et
joufflue, la mre n'prouverait pas cette inquitude. Mais toutes ces dductions ne
contribuent pas tellement nous familiariser davantage avec l'image de cette enfant,
parce que nous les formulons uniquement titre d'exercice, sans pouvoir les
confirmer.
Quelques mots au sujet du traitement de ce genre d'enfant. Cette fillette jouit de sa
domination sur la famille. Elle n'en sait rien. Elle prouve seulement le tourment, la
tension des autres. Cela ne doit pas nous induire en erreur. Croyez-vous qu'un multi-
millionnaire pense toujours au montant de sa fortune? Vous verrez seulement
combien souvent cet homme se met en colre quand tout ne va pas suivant ses dsirs.
Cette fillette est dans la mme disposition d'esprit. Elle est en possession de la
domination, aussi n'prouve-t-elle pas le besoin de s'en rjouir constamment. Il lui
suffit de la possder. Ainsi nous pouvons comprendre pourquoi elle suit ce chemin
sans en envisager l'aboutissement, toute proccupe qu'elle est des difficults qu'elle
rencontre. Mais si elle savait tout cela, si l'on pouvait lui faire comprendre qu'elle
surestime exagrment ce problme ordinaire de l'cole, pour se vanter, ce serait un
grand progrs. Il se pourrait toutefois que malgr cela elle ne se corriget pas. Peut-
tre alors devrait-on aller plus loin, lui montrer exactement ce qu'est un vantard. On
lui inculquerait la conviction que seul se vante celui qui croit n'tre pas assez par lui-
mme. Seul s'efforcera de mettre en branle les autres celui qui ne croit pas pouvoir
par ses propres actions apporter suffisamment de preuves de son importance. Vis--
vis de cette fillette on peut aussi adopter le point de vue suivant : si tu m'en crois, tu
fais tout trs bien. Mais peut-tre devrais-tu faire encore plus. Tout cela indique
seulement que tu es une fillette trs intelligente, qui trouve le bon chemin pour mou-
voir son entourage . Afin de convaincre cette fillette, il faudrait avoir recours
l'explication d'autres vnements et d'autres souvenirs; lui montrer que, de sa position
d'enfant unique, sont nes toutes ces tendances qui la conduisent des fautes
inluctables. Il faut lui dire : ce sont choses courantes qui arrivent souvent aux
enfants uniques . Ceci lui ferait connatre ce qu'elle ne savait pas auparavant. Ce
nouveau savoir influencerait lui seul la complexit du droulement de ses penses.
Les actions se trouveraient manifestement en contradiction avec son sentiment social.
Elle se contrlerait et probablement on verrait apparatre le fait suivant : dans les
premiers jours, aprs avoir fait tomber la famille dans l'tat de tension nerveuse
habituelle, elle se dirait : le docteur Adler prtendrait que je fais cela uniquement
pour me rendre intressante . Elle continuerait peut-tre un certain temps ce mange.
S'il n'en tait pas ainsi, je pourrais alors y aider. Il viendrait ainsi un moment o dj
en pleine crise de nervosit elle se souviendrait de la faon dont j'ai interprt sa
conduite et ds lors nombre de ses attitudes disparatraient. Puis bientt peut-tre, ds
le rveil elle prendrait conscience de ceci : Maintenant je veux provoquer l'excita-
tion de mon entourage. Ce serait le simple droulement d'un tel traitement. D'autres
voies seraient galement possibles. Moi-mme j'aime emprunter d'autres chemins.
Mais si je crois que l'on puisse parler ainsi, je dis alors : L'cole est la chose la plus
importante dans la vie d'un tre humain, tu devrais faire encore plus de tapage. Par
l'exagration je saperais sa tendance de pareils actes. Tu dois faire sans arrt du
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 25
vacarme pour souligner tes actions et l'importance de ta personne, car il est vident
que tu ne peux te contenter d'attirer l'attention des autres par des actions utiles. Il y
a cent mthodes qui sont propres, comme le dit Kaus, gcher la bonne con-
science que l'on a de ses mauvaises actions. cris en grandes lettres sur un billet
que tu accrocheras au-dessus de ton lit : tous les matins je dois mettre ma famille
dans le plus grand nervement. Elle ferait ainsi consciemment, mais avec une mau-
vaise conscience, ce qu'elle faisait auparavant inconsciemment sans le comprendre,
mais avec une bonne conscience. Je n'ai pas encore vu qu'un de mes malades ait suivi
le dernier conseil.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 26
Chapitre II
Une lve redouble sa classe
Retour la table des matires
Lorsque nous interprtons le compte rendu concernant un enfant difficile, il ne
nous importe pas de caractriser spcialement cet enfant. Nous voulons considrer
comme typique ces courtes et insignifiantes descriptions et exercer sur elles notre
exprience pour trouver jusqu' quel point elles s'cartent de la norme; ou encore
pour nous prouver nous-mmes dans la recherche des replis cachs de l'me et
dterminer la position que doit prendre l'ducateur lorsqu'il suit le point de vue de la
psychologie individuelle. A la lecture de ces descriptions, il ne faudra pas oublier que
nous ne voulons pas analyser prcisment tel ou tel enfant. Il nous importe de faire
ressortir certains points. Nous voulons nous y intresser et voir dans quelles formes
de vie ces difficults apparaissent.
On nous parle d'une enfant de neuf ans. Elle redouble sa seconde classe.
Ces renseignements nous incitent nous demander si nous ne nous trouvons pas
en face d'un enfant faible d'esprit. Nous ne savons rien de plus sur cette enfant, sauf
qu'elle redouble la seconde classe. Nous ne savons pas si elle a redoubl la premire,
ni comment elle se conduit d'ordinaire l'cole, finalement si elle n'est pas passe
dans la classe suivante par suite d'une indulgence particulire. Si ce n'est pas le cas, si
cette enfant est passe normalement de la premire la seconde classe, nous pouvons
dire avec certitude qu'elle n'est pas faible d'esprit.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 27
En ce qui concerne la faiblesse d'esprit : dans notre cercle prcisment la tendance
dclarer un enfant faible d'esprit est rare, si rare que parfois des erreurs se
produisent en sens contraire; elles font considrer un enfant faible d'esprit comme
n'tant que difficile duquer. C'est une moindre faute que de dclarer faible d'esprit
un enfant normal. Pour en finir brivement avec ce problme je veux vous relater une
constatation courante. Lorsqu'un enfant montre une intelligence infrieure de deux
ans celle de son ge, on peut considrer comme fond le soupon d'une faiblesse
d'esprit; c'est l'exploration de l'intelligence. Il faut aussi entreprendre un examen
physique srieux pour savoir si cet enfant ne prsente pas un retard de dveloppement
du cerveau, s'il existe des troubles ou des modifications dans son dveloppement
endocrinien, si les glandes scrtion interne ne fonctionnent pas anormalement et si,
de ce fait, le dveloppement intellectuel n'est pas perturb. Cet examen doit tre
confi un mdecin expriment. Il devra tablir si la croissance du cerveau a t
lse, si l'enfant est hydrocphale, microcphale, mongolode, etc. Je ne peux pas
m'occuper de la description de ces tats, ce n'est que de la juxtaposition de ces deux
facteurs que nous pourrons tirer une conclusion et dire : cet enfant est vraisembla-
blement faible d'esprit. Avec ces deux mthodes on ne se tire pas d'affaire dans les
cas lgers de dbilit, c'est pourquoi je me suis habitu entreprendre un troisime
examen, qui est dcisif lorsqu'il est conduit correctement et par un psychologue
individuel exerc. Il s'agit d'tablir si cet enfant a un style de vie : car, si cet enfant a
un but qui ne cadre pas avec celui d'un enfant approximativement normal, mais si, en
concordance avec ce but, il procde intelligemment, bien que d'une manire trs
diffrente de la normale, alors l'enfant est intelligent. Cet enfant a un style de vie
anormal, mais il agit avec l'intelligence correspondante. C'est ce qu'on appelle les
enfants difficiles . Nous allons essayer de classer cette enfant dans une de ces
catgories. Dans le cas qui nous occupe il ne peut gure tre question d'un examen
mdical, encore moins d'une vrification de l'intelligence. Cette vrification est consi-
dre chez nous avec une certaine circonspection, personne ne s'y fie compltement;
nous serons donc amens tablir si cette enfant a un style de vie.
On nous dit que cette enfant a des difficults particulires pour le calcul.
Notre exprience nous enseigne que ces enfants sont le plus souvent des enfants
gts, qui ne veulent pas agir par eux-mmes, parce que de toutes les matires le
calcul ncessite la plus grande indpendance. Dans le calcul, en dehors de la table de
multiplication, il n'y a aucune scurit, tout repose sur une combinaison indpendante
et libre. Nous savons que les enfants gts, en particulier, sont trs loigns de cette
manire de penser indpendante, si elle ne leur a pas t enseigne spcialement
d'une faon ou d'une autre. Il existe encore un autre type d'enfants qui, du fait de
certains vnements ayant agi sur eux d'une faon prolonge, se sont trouvs particu-
lirement dcourags, prcisment en ce qui concerne le calcul. Ils ont eu un mauvais
dpart, ils n'ont pas pu suivre, ces enfants n'ont pas t encourags l'origine. Il leur
manque une base suffisante et il en rsulte une bonne part de dcouragement. Je ne
suis pas dou pour le calcul. S'ils ont dans leur entourage un membre de la famille
qui a le mme point de vue, ils ont devant eux un adepte de la thorie de l'hrdit. Il
y a aussi d'autres causes. Je voudrais en faire ressortir une. Il existe contre les filles
un prjug particulirement accablant. Les filles ont trs souvent l'occasion d'enten-
dre dire que le sexe fminin n'est pas dou pour le calcul. Nous savons dj ce que
nous devons penser du sujet dou. Du moment que l'enfant n'est pas faible d'esprit,
nous sommes d'avis qu'il peut venir bout de toutes les tches, s'il possde suffisam-
ment de courage. Nous n'arrivons pas encore au but recherch lorsque nous
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 28
apprenons que des enfants faibles d'esprit ne peuvent arriver rien en calcul. Plu-
sieurs domaines particuliers des mathmatiques sont mieux compris par des faibles
d'esprit que par des gens normaux.
Le directeur de l'cole croit qu'au point de vue intellectuel la fillette n'est pas
la hauteur des exigences du programme d'tudes; il recommande de lui faire suivre un
cours auxiliaire.
Nous ne pouvons pas discuter l-dessus.
L'opinion des parents est que l'enfant est normale au point de vue intellectuel.
L'opinion des parents est assez significative. En rgle gnrale les parents sont les
premiers remarquer un retard quelconque au point de vue intellectuel, mme l o
ils ont tort. Je ne me souviens d'aucun cas o des parents auraient dclar d'un enfant
faible d'esprit qu'il tait normal. Nous pouvons donc provisoirement tre d'accord
avec les parents.
Ils pensent que la raison des difficults se trouve dans un manque de confiance
en soi.
J'ai tendance soutenir l'opinion des parents. Jusqu'ici nous avons seulement
entendu dire que l'enfant tait mauvaise en calcul. Si dans toutes les autres matires
l'enfant russit passablement, elle a subi avec succs l'examen de son intelligence, Le
fait qu'elle soit en retard en calcul, n'implique pas obligatoirement un diagnostic de
faiblesse d'esprit.
Il ne parait pas impossible aux parents que l'enfant utilise son incapacit pour
attirer sur elle l'attention de la famille. Celle-ci s'occupe beaucoup d'elle.
A ce sujet nous nous souvenons que de prime abord nous avons mis la supposi-
tion qu'il s'agissait d'une enfant gte. Elle a la particularit de vouloir maintenir sa
situation agrable et elle s'efforce ainsi d'atteindre son but : obliger ses parents
s'occuper d'elle. Si nous pouvons nous fier cette description - beaucoup de faits
plaident en faveur de la justesse de cette description -nous dirons que d'un ct elle
n'a pas suffisamment de confiance en elle-mme, et que d'un autre ct elle cherche
toujours un appui. En consquence elle remplit les conditions que nous avons exiges
lorsque nous avons admis qu'elle tait une enfant gte. Tout coup nous voyons
qu'elle a un style de vie, qu'elle a un but, elle voudrait tre aide par ses parents. Nous
pourrons tablir avec suffisamment de certitude qu'elle n'est pas faible d'esprit. Nous
devrons donner tort au directeur de l'cole, l'enfant ne doit pas aller dans un cours
auxiliaire.
La sur ane ainsi que la benjamine, toutes deux trs doues, s'efforcent de
l'aider. Nous voyons sous un jour nouveau cette enfant Place entre deux surs
doues et indpendantes. Nous pouvons nous imaginer peu prs ce qui a pu se
passer. Pendant un certain temps cette fillette a t la plus jeune, brusquement cette
situation a chang. Derrire elle apparat une enfant qui lui a donn l'impression de
vouloir la dpasser. En tant que pune, elle n'est pas arrive non plus mettre l'ane
dans l'ombre. Ici notre exprience des puns nous vient en aide. Leur idal consiste
dpasser les autres. Nous pouvons admettre qu'elle s'y efforce et qu'elle essaie de
raliser une volution peu prs normale aussi longtemps que cet espoir de rejoindre
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 29
la premire ne disparatra pas. Elle n'y a pas russi. Elle doit tre classe parmi ce
type d'enfants qui ont perdu l'espoir d'galer l'ane, voire mme de la dpasser. Elle
devra grandir dans des conditions aggraves, vivre avec le sentiment de ne pas tre
gale aux autres. Elle a un grand sentiment d'infriorit. Si, dans son dos, la troisime
enfant apparat comme un nouvel ennemi, notre enfant se considrera bientt comme
perdue; elle commence dsesprer, particulirement sur les points o un succs
rapide ne lui est pas donn. Cela parait avoir t le cas en calcul. Voici pourquoi la
description de son attitude en ce qui concerne le calcul correspond ce que nous en
attendions. Elle n'a plus d'espoir. C'est une attitude vis--vis du calcul qui est
inopportune. Mais o est l'effort de cette enfant pour se mettre en valeur? Cet effort
pour se mettre en valeur n'est pas perdu, il porte d'une certaine manire les traits d'une
enfant pune. Cela ne marche pas en calcul, vraisemblablement dans les autres
matires non plus, elle doit redoubler sa classe. Mettez-vous la place d'une telle
enfant. En ce qui concerne le progrs cette enfant ne peut pas concourir, alors elle y
renonce. Mais elle doit trouver un autre chemin pour dpasser sa sur. La question
est la suivante : o voyons-nous cette aspiration? Elle ne peut y russir que d'une
manire quelconque qui ne se trouve plus du ct utile et qui vise occuper conti-
nuellement les parents. Les parents ont faire avec elle, elle est l'enfant difficile, elle
est le centre de l'attention. Nous obtenons la rponse notre question : est-elle
intelligente? Que celui qui en doute se mette la place de cette enfant laquelle le
chemin vers le ct utile est barr. Que lui reste-t-il faire, alors que tout tre ne peut
vivre que s'il a l'espoir d'avoir une valeur en tant qu'tre humain, en tant qu'individu?
J'agirais exactement de la mme faon. J'en tire la conclusion audacieuse que cette
fillette agit intelligemment en vue d'atteindre un but erron. tre le centre de la
famille n'est qu'une supriorit fictive, un but du ct inutile. Une vritable suprio-
rit n'existe que dans le sens du sentiment social, dans le domaine du sens commun.
Ce qu'elle fait n'a pas de sens commun, le directeur l'a justement compris. De l il a
tir la conclusion errone que cette fillette est faible d'esprit.
Sa faon d'tre au sein de la famille est dominatrice et asociale. Elle participe
rarement aux jeux en commun.
Cela fait bien notre affaire. L'effort de cette fillette n'a pas disparu, elle est domi-
natrice, elle s'efforce de placer tout le monde sous son sceptre. Quand il s'agit de
communaut, elle s'esquive; elle n'est prsente que l o elle joue le premier rle.
Quelques mots brefs au sujet du traitement. Je suis persuad qu'on essayera
d'amener cette enfant ne plus occuper autant les parents et faire des progrs en
calcul. Mais si cette enfant a dj abandonn tout espoir de se tenir au mme pas que
ses surs dans les choses srieuses ou de s'y mesurer avec elles, il ne nous reste rien
d'autre faire que d'encourager cette fillette. C'est vrai dire la formule la plus
importante que nous ayons notre disposition. Nous ne pouvons nous attendre ce
que sa manire d'tre, ses tendances dominatrices, ses revendications vis--vis des
parents s'attnuent tant qu'elle n'a pas une voie libre o elle puisse aller de l'avant
d'une manire utile. Nous devons ouvrir une voie cette enfant. Je crois qu'il y a des
parents qui, sans comprendre ce point de vue, pourraient avoir un certain succs avec
l'enfant. Nous ne mettrions pas en doute que cette enfant puisse tre compltement
amliore. J'ai dit que cela pourrait russir mme si quelqu'un a une conception tout
fait fausse de cette enfant et se rfre peut-tre une notion de sexualit. Il peut
mme, s'il dveloppe ses thories, encourager l'enfant, ne serait-ce qu'en lui dmon-
trant : Tes problmes sont assez intressants pour que quelqu'un s'en occupe. Il
pourra bavarder tant qu'il voudra, si seulement ce rayon d'espoir claire l'me de
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 30
l'enfant. L'enfant ira de l'avant sans savoir comment, tandis que le mdecin qui l'aura
traite jurera que sa mthode est bonne. Nous dfendons le point de vue d'aprs
lequel nous devons encourager l'enfant. Ce n'est pas une chose facile. Que devons-
nous faire pour cela? Nous devons amener l'enfant ce qu'elle agisse par elle-mme,
ce qu'elle soit persuade qu'elle peut rsoudre ses calculs, qu'elle acquire de la
confiance en soi, qu'elle bouche les brches qui se sont produites. Il ne suffit pas de
lui donner du courage en paroles, il est indispensable d'amener l'enfant dans la
situation o se trouvent ses camarades. Si cette enfant commence travailler et si
dans huit jours il y a une composition, il n'y a pas de doute qu'elle chouera. Les
brches ne se laissent pas combler si rapidement; il faut valuer combien de temps
cela ncessitera. Jusque-l, il faut lui laisser un dlai de protection, on ne peut pas
encore faire subir l'enfant un examen, comme si elle tait dj aussi avance que les
autres, sinon toute la peine prise par l'ducateur est perdue. Par la suite il sera extr-
mement difficile d'encourager nouveau cette enfant. Lorsqu'on envisage d'encoura-
ger un tre humain, on doit avoir soin de crer une situation psychique qui soit
remplie de confiance. On doit l'amener un tat rceptif, c'est--dire qu'on doit aupa-
ravant gagner sa confiance. On doit se comporter vis--vis de lui comme un ami, on
ne doit pas faire montre son gard d'une supriorit et ainsi accabler l'enfant; on ne
doit pas l'affronter rudement. On a rudoy ces enfants, de sorte que finalement ils ont
raison s'ils cessent le travail. Il est indispensable de les amener des rapports ami-
caux avec l'ducateur afin que s'largisse le cercle des gens en qui ils ont confiance.
Cette enfant n'a confiance qu'en ses parents. A l'cole elle joue un mauvais rle. A
vrai dire son attention est uniquement dirige vers les parents. Si une personne tran-
gre russissait largir son cercle d'intrt pour d'autres personnes, son sentiment
social s'en trouverait augment, sa confiance grandirait. Ainsi disparatrait le plus
grand mal, savoir le fait pour cette enfant de croire : je n'ai de place que dans le
cercle familial, auprs de mes parents. Ce processus de mise en confiance doit prc-
der toutes les autres mesures. Nous nous trouvons ramens la source originelle de
l'ducation, o la fonction de la mre a t prcisment de gagner la confiance de
l'enfant et d'veiller en lui l'intrt pour les autres, l'intrt pour les problmes de la
vie, pour lui crer un foyer l'intrieur de cette socit. De ce fait, l'enfant devient
courageux, indpendant, il se sent un facteur gal aux autres. Si nous faisons le point
pour voir la faute partir de laquelle s'est dveloppe cette inaptitude, nous distin-
guons clairement que les deux surs, entre lesquelles se trouve cet enfant, sont
prsentes comme tant trs doues. Ce n'est pas l une constatation fortuite, cela se
droule journellement, chaque heure. Ce sujet a continuellement l'impression de ne
pas tre quivalente ses surs. Ici apparat clairement l'erreur fondamentale de cette
enfant. Je ne peux pas dcider en quoi les deux autres se sont montres doues, mais
je puis dire que la premire enfant a support la tragdie d'avoir une sur, parce
qu'elle avait une position ferme dans la priode antrieure la naissance de l'enfant.
Je puis dire galement que la deuxime enfant n'a pas bien support la naissance de la
troisime enfant. Si vous ajoutez cela le caractre de la benjamine qui est ambi-
tieuse, vous pourrez comprendre que notre enfant, qui tait dj en dclin, a de
nouveau t lse par la naissance de la benjamine. Nous posons la question : o tait
la mre? Il semble que la douceur maternelle ait clair plus vivement les deux autres
enfants. La tentative de la deuxime enfant de mettre les autres contribution est
ressentie d'une faon dsagrable par la mre. Cette dernire n'a donc pas russi
enseigner cette enfant l'intrt pour ses semblables, pour ses surs, pour les tches
de la vie. Elle est reste dans la dpendance o elle tait comme nourrisson, elle
montre encore aujourd'hui les traits d'une petite enfant maladroite.
Deuxime cas : Une fillette de neuf ans qui redouble la troisime classe.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 31
Nous verrons aussi dans cette unique communication que, si cette enfant est
arrive normalement jusqu' la troisime classe, elle non plus n'est pas faible d'esprit.
Certains vnements de sa vie doivent pouvoir expliquer pourquoi cette enfant n'a pas
pu suivre l'cole. Elle a d trouver que l'cole n'tait plus un lieu de sjour agrable.
Dolance particulire : tendance mentir et voler.
En ce qui concerne le mensonge et sa structure psychologique, on peut dire que
manifestement il doit y avoir proximit une main ferme que l'enfant craint. Norma-
lement tous les enfants diraient la vrit s'ils se sentaient assez forts. Nous arrivons
la conclusion que l'enfant ne se sent pas l'aise. Je vous prie de considrer, lorsque
vous entendez parler de la tendance mentir d'un enfant, que c'est la forme d'expres-
sion d'un sentiment de faiblesse. Il s'agit l d'une compensation pour ne pas donner
son sentiment d'infriorit l'occasion de se manifester; l'enfant se prsente comme
tant la partie la plus faible, comme celui qui doit craindre l'autre qu'il estime plus
fort. Il y a deux formes principales de mensonge : premirement le mensonge par
crainte. La crainte est un ct du sentiment d'infriorit. Quand quelqu'un se sent
assez fort, il n'a aucune crainte. Deuximement les mensonges o quelqu'un essaie
d'apparatre plus grand qu'il ne se croit en ralit. C'est aussi la compensation d'un
sentiment de faiblesse et d'infriorit. A partir d'une grande faiblesse se dveloppe la
tendance l'imagination. Si, par hasard, quelqu'un voulait faire ici la diffrence entre
les mensonges qui poursuivent un dessein prcis et les autres, il ferait fausse route; il
n'y a pas de mensonges sans but. Nous allons dans notre cas chercher la main puis-
sante en question. Lorsqu'on nous dit que cette enfant, chez laquelle nous supposons
un fort sentiment d'infriorit, vole aussi et qu'elle a tendance chapper par des
dtours la supriorit des autres, nous sommes renforcs dans notre opinion. La
structure psychologique du vol se comprend par le fait que quelqu'un se sent appauvri
et qu'il tente de couvrir ce dficit en s'enrichissant. il ne le fait pas d'une faon qui
conviendrait au ct utile de la vie, mais par un artifice qui ressemble beaucoup au
mensonge. Le vol est galement une tentative d'chapper au fort, un moyen astucieux
de l'galer. J'ai montr que dans le vol nous ne pouvons jamais trouver de courage.
Nous voyous nettement ce qu'il a de caractrologique, l'enfant manifeste ici sa
lchet. Nous ne sommes pas en mesure d'tablir si un autre enfant, dans la mme
situation, ne mentirait pas. Mais nous savons d'une faon tout fait certaine que, si
cette enfant tait en possession de la force, nous ne comprendrions pas qu'elle vole ou
qu'elle mente. Si alors elle devait encore voler et mentir, no-us la tiendrions pour
faible d'esprit. Nous comprendrons que cette enfant doit avoir un grand sentiment de
faiblesse et qu'elle s'efforce d'en sortir avec les moyens du faible. Mais l'enfant agit
intelligemment, cela va si loin que nous pourrions, si les circonstances le permet-
taient, pardonner un mensonge, parce que nous le trouvons conforme au but : le pieux
mensonge. Nous ne pouvons pardonner quelqu'un ses vols que lorsqu'il est prs de
mourir de faim; dans ces conditions nous le trouverons mme justifi. Il nous faut
tout comprendre d'aprs les connexions. Le mensonge et le vol chez cette enfant
retiendront notre attention ds le dbut de notre examen et nous constaterons qu'elle
ne se sent pas l'aise.
Les parents vivent spars depuis la fin de la guerre.
Nous trouvons cela souvent chez les enfants difficiles. Une union malheureuse est
certes trs nuisible l'enfant. L'exprience statistique et personnelle confirme que les
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 32
enfants d'un mnage spar progressent difficilement. On trouve parmi ces enfants un
nombre trs lev de cas graves d'checs.
On lui laissa le choix de rester avec la mre, mais elle ne voulut pas.
Cela nous rappelle ce que nous avons dit auparavant. La mre n'a pas russi
gagner la confiance de l'enfant, elle a chou dans sa premire fonction. Nous allons
voir si cette enfant s'est tourne vers le pre. La relation affectueuse de l'enfant avec
le pre est, dans toutes les circonstances, une seconde phase. Auparavant a eu lieu la
rupture avec la mre. Cela ne peut arriver que si cette enfant a l'impression que la
mre n'a pas t rellement une collaboratrice. Souvent l'enfant a cette impression
tort. Beaucoup d'enfants se dtournent de la mre, lorsqu'il arrive un second enfant,
parce qu'ils considrent cela comme une trahison et ils manifestent un esprit critique
vis--vis de la mre. C'est souvent le point de dpart d'un dveloppement dfectueux
dans l'laboration du style de vie. Voyons maintenant si le pre a remplac la mre
dans ses deux fonctions. Dans un mnage spar cela n'est pas facile, surtout lors-
qu'on nous dit que le pre n'a pas eu beaucoup de temps libre. Que reste-t-il alors
comme possibilit pour que cette seconde fonction s'accomplisse : l'largissement du
sentiment social? On nous dit que l'enfant vole et ment. C'est un signe que l'enfant n'a
pas dvelopp un haut degr son sentiment social; qu'elle a grandi comme en pays
ennemi. Lorsque nous apprenons que l'enfant n'a pas russi l'cole, et qu'elle a d
redoubler sa classe, nous comprenons qu'elle n'ait pas trouv le professeur agrable.
Vous voyez que, si cette enfant considre les autres tres humains comme tant des
ennemis, elle se trouve prise dans un pige dont elle ne pourra s'chapper par ses pro-
pres forces. Sa mfiance, son animosit contre les autres font qu'elle n'a pas d'amis,
qu'elle ne considre pas une nouvelle situation comme pleine d'espoir, qu'elle ne se
sent pas l'aise l'cole. Toutes ces consquences fcheuses amnent l'enfant subir
des checs. Elle croit pouvoir y puiser la confirmation que la vie est effectivement
pleine d'hostilit. Nous pouvons imaginer qu'il sera excessivement difficile de trouver
un pont qui nous mnera vers cette me. Plus d'un en sera sans doute rebut. Nous
avons prsent dlimit le terrain sur lequel nous sommes en droit d'esprer trouver
d'autres apports, confirmations ou contradictions.
De tout temps la mre la traitait avec peu d'affection.
Nous venons d'apprendre ce quoi nous pouvions nous attendre.
Elle traite l'enfant presque avec aversion. L'enfant est trs attache son pre,
bien qu'en raison de ses dlits il la punisse souvent et la corrige.
Cela parat, dans un certain sens, une contradiction. Nous ne voulons pas oublier,
si nous nous trouvons sur la bonne voie, que cette enfant n'a qu'un seul tre au monde
dans lequel elle ait confiance, du moins partiellement. C'est pourquoi les coups ne
produisent pas pour elle une impression aussi effrayante. Si le pre l'abandonnait, elle
n'aurait plus personne. En dehors des corrections qu'il inflige son enfant, il semble
que le pre ait aussi de bons cts, de telle sorte qu'il apparat l'enfant comme ayant
plus d'attrait que la mre.
Elle promet alors de s'amliorer, mais elle rcidive toujours.
Admettons que cette enfant, aprs la correction, ne promette pas de s'amliorer ou
qu'elle prtende ne pas vouloir s'amliorer, quelle en serait la consquence? Elle ne
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 33
pourrait pas jouer ce jeu, le pre perdrait tout espoir. Tous les enfants, tous les adultes
sentent automatiquement qu'on ne peut plus rien faire avec un tre dsespr, qu'il
reprsente pour lui-mme et pour les autres le plus grand danger, parce qu'il se dfait
de tout sentiment social. Dans la pratique cela signifie : si je fais le dsespoir de mon
pre, il me jettera dehors. Mais elle rcidive. Nous sommes moins surpris que le pre
car nous savons : cette enfant se sent dpouille, elle a pour but de s'enrichir. Elle se
sent infrieure, elle n'ose pas dire la vrit. Nous voudrions vous inciter imaginer
l'effet que peut avoir la maison une mauvaise note. Quand nous donnons une mau-
vaise note, l'affaire ne s'arrte pas l. Ses effets se font sentir jusqu' la maison o
l'enfant sera peut-tre puni, o on le consolera en lui faisant un cadeau, o l'on donne
tort au professeur, consquences que nous ne pouvons approuver du point de vue de
la psychologie individuelle. C'est pourquoi nous sommes partisans d'abolir les notes,
tant donn que l'on ne prvoit pas ce qui peut en rsulter. Si le professeur tient
compte de la situation familiale pour tablir ses notations, alors c'est plus facile, mais
dans ce cas le systme des notes n'a plus aucune raison d'tre. Si l'on accable l'enfant
de mauvaises notes, il n'aura pas de bon temps la maison.
Pour des raisons professionnelles le pre ne conserva pas l'enfant avec lui et la
confia aux grands-parents. Ces derniers ne purent pas la garder longtemps.
Nous sommes habitus ce que les grands-parents soient indulgents et doux avec
les enfants. Cette enfant est ne sous une mauvaise toile, les grands-parents eux-
mmes chouent. De plus la mauvaise rputation qui poursuit cette enfant, disons
plutt qui la prcde, est sans doute largement diffuse parmi son entourage. Cela
cre une nouvelle difficult. Cette enfant, que chacun voit d'une manire hostile,
prouve rellement cette hostilit. Vous voyez l le pige dans lequel cette enfant est
prise. Vous comprendrez combien il lui est difficile d'en sortir. Vous savez quel
point cela est difficile pour les adultes, que pouvons-nous attendre des enfants?
Elle alla vivre alors chez des parents adoptifs T. o habitent galement ses
propres parents.
Nous ne pouvons pas considrer la situation comme tant amliore de cette
faon. Elle ne veut pas aller avec sa mre, le pre n'a pas le temps de s'en occuper,
elle est chez des parents adoptifs et elle considre comme une dpossession le fait de
se trouver prive du seul tre dans lequel elle ait confiance. Cette enfant se voit
frustre. Il s'y ajoute un deuxime facteur : on lui interdit de rencontrer sa mre. C'est
une des plus lourdes fautes que de rendre impossibles ou difficiles l'enfant les
relations avec l'un de ses parents. Il peut certes y avoir des raisons qui justifient une
telle interdiction, manque d'honorabilit, conduite immorale, mais la partie qui
possde l'influence devrait faire en sorte que la seconde personne reste inattaque, ne
soit pas dprcie.
Cette faon d'agir est prjudiciable l'enfant, car, de la sorte, il est pouss croire
qu'il est de mauvaise descendance. Il croit avoir les mmes dfauts que ceux imputs
la personne mise en cause.
Malgr cette interdiction elle visita ses parents lgitimes et profita de cette visite
pour drober un peu d'argent. Elle l'utilisa pour acheter des friandises qu'elle distribua
ses camarades.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 34
Ce don d'argent vol ou de friandises est une manifestation frappante dans les vols
commis par des enfants ou des sujets l'ge de la pubert. Il dmontre le besoin de se
vanter, de se grandir. L'autre aspect de cette attitude nous apparat ainsi clairement. Il
indique que le sujet cherche se faire aimer. Lorsque cette enfant qui se sent elle-
mme frustre, fait des cadeaux aux autres, elle prsente l un trait que nous devons
interprter : l'enfant recherche l'affection qui lui a t refuse par la mre, que le pre
lui a accorde de temps en temps, mais c'est une affection qui est fortement menace.
Elle est mauvaise lve. Que peut-on faire pour tre estime Il ne reste? rien d'autre
que de gagner d'autres enfants par la corruption. C'est ce qu'elle essaie maintenant :
elle recherche l'affection et l'amour, et dans cette recherche rside la plus forte
impulsion de cette enfant : se faire aimer en volant et en faisant des cadeaux aux
autres. De cette faon elle se sent plus riche. Cela est galement la manire d'agir du
faible. C'est une enfant qui n'a pas assez de confiance en elle-mme pour esprer tre
aime de quelqu'un. On trouve ce trait de caractre chez les adultes.
Elle agit de mme avec le produit de la vente d'ufs. Ces oeufs, elle les subtilisa
ses parents adoptifs pour les porter la matresse qui dsirait en acheter.
Elle joue celle qui ravitaille la matresse avec des denres alimentaires. Nous ne
savons pas si elle ne voulait pas faire un cadeau la matresse. Peut-tre a-t-elle reu
de l'argent en change des ufs. Quoi qu'il en soit, elle a su rendre un service. Elle
n'aurait certainement pas connu le dsir de la matresse si cette dernire ne l'avait
exprim.
Les dlits furent connus l'cole, depuis on l'vite. Les parents adoptifs ne
veulent pas la garder davantage, car, plusieurs reprises, ils ont constat des larcins,
notamment de denres alimentaires.
Nous ne savons pas ce qu'elle a fait de ces denres comestibles. Il se peut que
cette enfant, qui se sent frustre, ressente fortement certaines impulsions de faim,
parce qu'il s'y mle le sentiment d'tre abandonne. La personne assise devant un plat
rempli ressentira beaucoup moins la faim que celle qui n'a rien devant elle.
La situation T. est intenable, le pre voudrait bien se dfaire de l'enfant.
Vous voyez l'effet du pige.
Le pre est sans ressources.
Nous en tirerons la conclusion qu'en plus l'enfant n'a pas une situation brillante en
ce qui concerne la nourriture.
Voici encore une remarque qui est extraordinairement significative :
Par suite du manque d'affection de la mre et du jugement port par tout son
entourage, l'enfant se trouve en opposition avec tout le monde. Ses dlits peuvent tre
en partie l'expression de sa rvolte intrieure. En tout cas, en raison de la situation
donne, l'adaptation de cette enfant la socit est rendue plus difficile.
Vous avez l un exemple parfait du troisime type d'enfants prsentant un senti-
ment d'infriorit accentu : les enfants has, illgitimes, non dsirs, les orphelins et
les infirmes. Chez tous ces enfants, nous pouvons trs souvent constater, qu' tort ou
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 35
raison, ils se sentent has. Nous devons corriger l'erreur, nous devons faire com-
prendre l'enfant que, mme s'il a raison, il n'a aucun motif de penser qu'il n'y a pas
de gens compatissants. Chez cette enfant ce sentiment est en partie attnu du fait que
son pre prend soin d'elle. Cependant il ne peut pas faire grand-chose. L'ultime
conclusion de sa sagesse est de se dfaire de l'enfant. Celle-ci a d le sentir. L'enfant
a d toujours tre pntre de ce sentiment : mon pre ne pourra pas dpenser beau-
coup pour moi. C'est pourquoi cette enfant se trouve prise dans un pige d'o elle se
conduit en ennemi l'gard de toute autre personne. Son sentiment social ne peut pas
tre dvelopp. Aussi nous voyons apparatre au premier plan certaines manifesta-
tions: mensonges et vols en tant que points de dpart du crime. Nous venons de
dcouvrir un facteur qui fait apparatre le cas comme ayant un pronostic moins
sombre. Cette enfant recherche l'affection, de ce fait il doit tre relativement facile de
gagner sa confiance. Il s'agit d'exercer la premire fonction de la mre et ensuite
d'veiller largement son intrt pour les autres. Il faut la dlivrer de cette erreur qui
lui fait croire que l'homme est mauvais par nature. Ces lacunes doivent tre combles.
Ayant ainsi montr les grandes lignes du traitement, nous devons encore ajouter que
l'enfant doit tre dlivre de sa situation trop pesante.
L'enfant donne l'impression d'avoir grandement besoin d'affection et d'aide.
Ceci confirme l'hypothse que nous avons cru pouvoir difier partir des premiers
renseignements. L'enfant cherche, il n'a pas encore trouv : son courage ne s'est pas
effondr.
Pour terminer, je voudrais vous soumettre une pense qui m'est venue la lecture
de ces lignes. Considrons ceci : cette enfant, dont la situation est indigente, grandit
en souffrant du froid, de la faim ainsi que du manque d'espoir et d'assurance en ce qui
concerne son avenir professionnel, cela tout en recherchant l'amour et l'affection ;
dans ces conditions que va-t-elle devenir? Personne pour la protger, nulle part un
endroit sr : elle succombera la prostitution. Admettons que cette enfant perde con-
fiance et dsespre de ne jamais trouver quelqu'un qui s'intresse elle. Lorsqu'elle
sera un peu plus ge, il se trouvera un homme qui s'approchera d'elle en faisant le
beau, comme s'il voulait lui prodiguer de l'affection ; cela arrive frquemment et
conduit le plus souvent la prostitution. Admettons que cette enfant perde le dernier
reste d'espoir de trouver quelqu'un qui la prenne avec lui. Elle ne croit plus pouvoir
trouver d'affection, elle ne peut rien faire l'cole, elle n'a pas de foyer, elle doit
rder, elle peut facilement tomber par hasard sur une bande qui l'oriente vers l'cole
du crime. Ou bien, elle peut faire quelque chose de son propre chef, chercher un
profit paraissant facile obtenir. Elle est entrane pour une forme de dlit, elle peut
continuer. Elle peut finalement, prive de toute autre possibilit, devenir une voleuse
par habitude. Alors les juges et les psychiatres du tribunal arriveront la conclusion
qu'il est trs difficile pour les dlinquants de s'amliorer, qu'il faut infliger des peines
plus fortes. Elle dsespre de trouver une possibilit quelconque ; elle vole, parfaite-
ment consciente qu'elle sera emprisonne si elle est apprhende. Elle est obnubile
par l'ide qu'elle ne sera pas prise. Si cependant cela lui arrivait, elle serait mise en
prison. L elle se trouverait en contact avec d'autres malfaiteurs qui lui montreraient
de nouvelles voies. Une fois relche sa situation peut empirer. Comment alors
esprer une amlioration de son cas? Pense-t-on qu'un encouragement puisse tre
donn de cette faon? C'est impossible. Une aide ne pourrait lui tre apporte que s'il
existait un service susceptible de lui fournir ce que nous tenons pour indispensable :
l'encouragement et l'explication de ses erreurs. S'il en tait ainsi, on pourrait aider
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 36
cette enfant. Il peut se faire qu'un ducateur, qui se trouverait confi la fillette,
accomplisse accessoirement et sans le comprendre, l'action ducative la plus impor-
tante : donner du courage cette fillette.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 37
Chapitre III
Un pre empche le dveloppement
du sentiment social
Retour la table des matires
L'expos que j'ai entre les mains se distingue par sa particulire brivet, par son
laconisme. Si j'entreprends son interprtation, c'est parce que, d'une faon gnrale, je
ne dispose pas d'exposs plus dtaills. Nous devons apprendre tablir des observa-
tions partir de cours exposs. Il y aurait intrt pratiquer davantage l'art de rdiger
un compte rendu. S'il en tait ainsi un jour, j'aurais une proposition intressante
faire : que l'on adresse l'histoire dtaille, d'un enfant difficile, d'un criminel, d'un n-
vros, d'un buveur, etc., d'minents collaborateurs des diverses coles psycholo-
giques en les incitant interprter le cas et nous indiquer les moyens qu'ils prco-
nisent pour le redresser. La confusion qui, de nos jours, obscurcit la psychologie
moderne, prendrait fin trs rapidement. Grand nombre d'auteurs qui, d'ordinaire, ne se
prsentent pas prcisment d'une faon trs modeste, s'clipseraient tout coup. Un
long laps de temps nous spare peut-tre encore de la ralisation pratique de cette
proposition. Nous voulons utiliser ce temps pour nous exercer dans l'interprtation
des cas et dans l'art de lire une telle description. Nous sommes rsolus trouver les
moyens d'carter ou de modifier les erreurs inhrentes la structure du style de vie.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 38
Le prsent expos concerne un garon de six ans qui frquente la premire classe
de l'cole primaire. L'introduction est ainsi conue :
Avant que l'enfant ne vive dans sa famille.
Cela doit vouloir dire qu'il tait ailleurs, probablement en nourrice ou l'orpheli-
nat. Et dj nous apparaissent des images, favorables ou dfavorables, de situations
analogues.
Il tait l'hpital et fut ensuite plac en nourrice.
On dirait que l'enfant est illgitime. La phrase suivante le confirme :
Il est n avant le mariage.
Malgr tous les progrs de notre lgislation, ce n'est pas l une situation tout fait
indiffrente, car, mme si la lgislation allait jusqu' mettre les illgitimes et les
lgitimes sur le mme plan d'galit, nous ne pourrions pas empcher qu'un tel enfant
grandisse d'abord chez des parents nourriciers. Ce seul fait marque dj profond-
ment la vie d'un enfant ; non parce qu'il y trouve un entourage plus mauvais que ses
propres parents - souvent il est mme meilleur - mais parce que cette situation sociale
est tout fait significative. Nous ne croyons pas davantage que J'attitude sociale
gnrale vis--vis de l'illgitimit pourrait aller de pair avec les progrs de la lgisla-
tion. Je voudrais aujourd'hui encore vous mettre tous en garde en vous donnant
l'avertissement suivant : ne venez pas au monde comme enfants illgitimes.
Les conditions de vie : les parents sont trs pauvres.
Cela nous amne penser que l'enfant est chez ses propres parents, il est seule-
ment n avant le mariage.
Ils se tirent d'affaire comme vendeurs de journaux. Les parents et quatre enfants
de un, deux, quatre et six ans, habitent une seule pice : pour la nuit ils n'ont que deux
lits leur disposition. Le garon est l'an et couche avec son pre. On dit que le pre
est tuberculeux, il souffre de crises d'asthme et de ce fait ne peut pas dormir la nuit ; il
est alors facilement irrit contre le gamin et il le bat.
Ainsi l'enfant doit dormir dans le lit du pre et de plus il reoit des coups. C'est
trop. L'un des deux suffirait. Il montre apparemment peu de sympathie pour le
garon, ses prfrences vont vers une sur de quatre ans la cadette.
Nous avons l de nouveau le problme que nous connaissons bien, celui d'un
garon plus g et d'une sur plus jeune. Nous savons qu'en soi le garon est dans
une situation assez dsagrable ; mme si toutes les autres difficults taient suppri-
mes. Nous savons que le deuxime enfant est toujours comme en comptition et
qu'il s'efforce constamment de dpasser le premier. Si le second enfant est une fille et
si le plus g est un garon, ce tableau est particulirement net. La fille pune sent
d'une manire quelconque le privilge du garon et veut montrer qu'elle le vaut,
qu'elle est autant que lui et mme plus. La nature lui vient en aide. Les filles se
dveloppent plus rapidement jusqu' la dix-septime anne ; le garon ignore ce fait,
se trouve en retard et subit cela comme tant sa destine. C'est pourquoi nous trou-
vons le plus souvent que de tels garons -l'analogie des cas en est frappante - sont
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 39
moins actifs, perdent bientt l'espoir et de prfrence s'efforcent d'obtenir ce qu'ils
dsirent par des moyens dtourns. Des situations intercurrentes peuvent d'ailleurs
modifier cet tat de choses. Ils renoncent l'activit. La sur est toute diffrente. Elle
est prodigieusement nergique, bouscule tout. Lorsqu'elle rencontre une rsistance,
elle devient entte, rcalcitrante. Le plus souvent elle se dveloppe bien, elle est la
meilleure lve, pertinente et beaucoup plus active. Cela va le plus souvent si loin
que les parents disent : c'est bien dommage que la garon ne soit pas devenu une fille
et la fille un garon. tant donn qu'on retrouve ce tableau avec une telle frquence -
ces garons finissent mal, deviennent difficiles, prsentent un degr lev de nvrose,
deviennent parfois des criminels, des buveurs - on est oblig de dire : quel sens a
donc le bavardage sur les instincts? Quel sens cela a-t-il de parler de facults menta-
les innes, lorsque l'an a toujours cette apparence qui lui est propre et la fille pune
la sienne. Ce tableau peut tre modifi, il peut tre prvenu par une mthode d'duca-
tion correcte, condition de comprendre ces situations aigus et de ne pas intervenir
brutalement par des procds qui ne sont pas justifis.
L'enfant raconte que l'anne dernire il lui est arriv plusieurs reprises de ne
pas rentrer la maison avant minuit.
Nous pouvons facilement conclure, si nous considrons ces faits de notre point de
vue, que l'enfant n'est pas particulirement dsireux de se trouver la maison, sans
quoi il rentrerait plus tt. On a l'impression qu'il essaye d'tablir une distance entre
lui-mme et sa maison. J'ai dj expos ces cas devant vous. Si quelqu'un s'en va de
la maison, c'est l'indice qu'il ne se sent pas l'aise chez lui.
Et qu'il a t recueilli par la police cinq reprises diffrentes.
Vous vous rendez compte que le sort commun rserv l'an vis--vis de la sur
cadette, ne lui a pas t pargn. Il s'y ajoute le fait que sa situation la maison est
indiscutablement trs mauvaise.
Il a mendi devant des confiseries et des cinmas.
Cette manire d'agir dcoule de son sentiment d'humiliation. Lorsqu'il s'enfuit et
qu'il ne peut mme pas profiter de la pitre nourriture qui lui est offerte, que peut-il
faire d'autre que de mendier? Peut-tre mme voler. Ceci ne nous tonnerait pas.
Vous avez l devant vous, sous forme Prcise, le cas du dveloppement d'un enfant
dont j'ai parl plus haut, et qui rsulte du rapport garon an et sur cadette.
Conduite l'cole.
Nous pouvons facilement nous l'imaginer. Si ce garon pouvait de quelque faon
que ce soit, prsenter un bon rendement, il pourrait chapper son destin d'une
manire quelconque. tant donn qu'il n'y a pas chapp, nous pouvons conclure avec
certitude qu'il est particulirement mauvais l'cole, un vritable souillon, Voyons ce
qui est not.
L'enfant arrive l'cole sale, non lav, non peign, avec des habits dchirs.
En ce qui concerne les habits dchirs il n'en porte peut-tre pas la responsabilit ;
quant aux autres points, je croirais volontiers que la sur se prsentera autrement
lorsqu'elle aura six ans. A six ans il devrait dj se laver et se peigner.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 40
Il ne reste pas assis tranquillement.
Ne pas se tenir assis tranquillement l'cole! c'est un
une. Il faut savoir rester assis l'cole. Celui qui ne le fait pas prouve par sa
conduite qu'il ne dsire pas frquenter l'cole. Ce fait d'tre assis l'cole a une autre
signification qu'ailleurs dans la vie, c'est une fonction sociale. Dans cette attitude
s'exprime la connexion sociale d'un enfant avec l'cole. Donc lorsque nous apprenons
qu'il ne peut pas rester assis tranquille, nous pouvons en dduire qu'il n'a pas de senti-
ment social, pas d'intrt pour l'instituteur, pour les lves et d'une faon gnrale
pour l'cole et ses problmes. Que fait-il alors? Je crois qu'avec une certaine perspi-
cacit nous pouvons le deviner.
In se promne dans la classe, il chante pendant l'enseignement et singe les
rponses de ses camarades.
Cela ne semble-t-il pas dj exprimer sa fuite? Mais ce n'est pas facile, certaines
menaces apparaissent. On enverra un avertissement aux parents et avec toutes les
forces de police et de gendarmerie ce garon sera tran l'cole. On n'y chappe pas.
Notre sujet aurait sans doute prfr prendre la fuite. Il peut pousser les choses
jusqu' se faire mettre la porte. A ce moment il ne risquera plus rien.
Il cherche querelle son voisin, ses camarades.
Il prsente ainsi une insuffisance manifeste d'intrt l'gard des autres. De mme
lorsque nous lisons :
Il bouscule tous ceux qu'il rencontre et il se rjouit particulirement lorsqu'un de
ses camarades tombe.
L encore vous voyez son manque d'intrt pour les autres. Nous sommes en droit
de nous demander : que se passera-t-il lorsque ce garon sera plus g de dix ou vingt
ans? A l'cole, il a fait les expriences les plus amres ; lorsqu'il mendiait galement ;
la maison il n'a aucune satisfaction. Qu'est-ce que cela donnera plus tard. Je crois
que c'est facile deviner. Il manque ce point de sentiment social qu'il ne reste pour
lui qu'une seule voie, puisqu'il dispose encore d'une certaine activit - il se rjouit du
mal des autres -, puisqu'il essaye de gner les autres. Il ne lui reste que la voie du
crime.
Il n'y a pas longtemps, il aurait presque cass le doigt d'un camarade. Il emploie
couramment des expressions vulgaires. C'est un garon veill qui peut trs bien
rpondre aux questions qu'on lui pose et qui est trs fort en calcul.
Ce dernier point ne peut nous tonner. Nous pouvons bien comprendre ; ce garon
a toujours d calculer : si on allait lui donner quelque chose manger, combien
d'argent il recevrait en mendiant, etc., ainsi il a t amen apprcier le prix des
choses, il a d calculer. Il est difficile de parler ici d'un talent inn en ce qui concerne
le calcul, il a simplement bnfici d'un bon entranement.
Mais ses exercices d'criture laissent particulirement dsirer et encore, quand
il consent crire.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 41
A ce sujet, j'essayerai bien de me renseigner afin de savoir s'il ne s'agit pas d'un
enfant gaucher. Car ce garon, si adroit et si veill, ne serait-il vraiment pas capable
de russir en tout? Il est permis de supposer, qu'en dehors de tous ses malheurs, il a
d subir le fardeau d'une main droite insuffisante (fonctionnellement).
En matire de dessin, il n'a pas dpass le stade du griffonnage.
Cela plaide en faveur d'un enfant gaucher.
Encore une remarque qui nous parat significative
L'enfant est de nationalit trangre, ce qui lui interdit l'entre dans un tablis-
sement d'tat.
Il est prs d'atteindre son but, savoir : se faire mettre la porte de l'cole. Il y est
presque parvenu : l'instituteur qui s'est laiss prendre son jeu, fait ce que le garon
dsire. Ce dernier est malheureusement de nationalit tchcoslovaque, pour cette
raison nous ne savons pas dans quelle institution le placer. Ce serait trs bien d'tre
lev dans une telle institution. Mais il n'est pas tellement certain que dans cet ta-
blissement il se trouverait quelqu'un susceptible de comprendre le cas. Nous nous
efforons depuis vingt-cinq ans de faire comprendre ces rapports de la premire
enfance et leur importance pour le dveloppement futur de l'tre humain, aucun
tablissement n'a pris ces donnes en considration. Si ce garon vit dans le sentiment
qui a pris naissance en lui du fait de ses expriences : j'aurai toujours quelqu'un qui
me dpassera, jamais je ne serai bon quelque chose, il faut que je me faufile, il faut
que j'essaye par des malices de me soustraire aux exigences de la vie, il entrera dans
cet tablissement avec la mme attitude automatise et bientt il y recommencera le
mme jeu qu'auparavant. L aussi, il entrera dcourag, il ne s'attendra pas trouver
une situation agrable, par exemple celle d'tre le premier. Pourtant, il voudrait tre le
premier, il voudrait que tous se tournent vers lui et il souhaite ardemment se trouver
au centre de l'attention. Il y est d'ailleurs parvenu. La classe toute entire s'occupe de
lui. Aucun des garons ne donne l'instituteur autant d'occupation que lui. Il est
effectivement devenu le personnage le plus important. Ce qu'il n'a pu raliser la
maison - o la sur est le personnage le plus important - il l'a obtenu l'cole. Il y est
parvenu par un subterfuge, par le fait que son activit s'est dirige dans un sens
inutile, par le fait qu'il s'est donn un but idal de la supriorit personnelle et qu'il a
suivi ce but. A prsent, l'tat tout entier peut se proccuper de ce qu'on va faire de lui.
Ce n'est pas une petite russite. Si le garon voulait mditer sur ce qui se passe, il
pourrait se dire : si j'tais rest tranquillement assis et si la nuit, sans broncher, j'avais
accept les coups de mon pre, qui se serait occup de moi? Jusqu' un certain point,
ce garon a raison. Nous ne pouvons pas le nier et nous ne devons pas l'oublier au
moment o nous nous apprtons faire quelque chose pour lui. L'ducateur n'arrivera
pas plus faire disparatre chez ce garon la tendance la valorisation que ne le
peuvent d'autres coles de psychologie. L'enfant veut tre apprci. Cette tendance ne
se laisse pas touffer. Il faut lui ouvrir une voie sur le ct utile de la vie. Nous
devons fortifier son courage pour qu'il se croie apte russir quelque chose d'utile.
Son malheur c'est qu'il se croit absolument incapable. Un adepte de l'cole freudienne
pourrait dire : ce sont des instincts ataviques de la collectivit primitive, le garon
voudrait tuer son pre. Comme il ne se croit pas capable de le faire, il s'y essaye avec
l'instituteur. L'instituteur se fera un tel mauvais sang qu'il contractera peut-tre une
maladie grave qui l'emportera, dans ce cas le garon aura atteint son but. Mais les
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 42
choses se prsentent autrement. Ce qui se passe ici sont les consquences et non le
dbut. Il est hors de doute que le garon se serait rjouit de jouer un rle identique
celui de sa sur. Mais cela ne lui a pas t permis l'origine. Ce garon n'tait pas
mchant, mais bon, comme tous les enfants qui viennent au monde. On l'a empch
de dvelopper son sentiment social, parce qu'il ne s'est trouv personne pour l'veiller
en lui. Qui est cet effet, la personne la mieux dsigne? La mre. Nous entendons
dire : l'enfant tait d'abord l'hpital, puis pensionnaire, avant qu'il n'arrive chez ses
parents ; c'est un enfant illgitime. Deux annes plus tard une sur venait au monde,
celle-ci est devenue la prfre. Qui aurait d enseigner J'enfant qu'il existe d'autres
tres qui sont nos semblables? Nous ne doutons pas qu'il tait capable de remplir le
rle d'un tre socialement utile. Il faudrait qu'il rencontre quelqu'un qui lui ouvre les
yeux ce sujet. Ceci n'est pas une tche facile, mais elle est ralisable. Il s'agit
d'exercer la premire fonction qui incombe normalement la mre, fonction qui
jusqu' prsent n'a pas t ralise envers lui. Il faut que quelqu'un remplace la mre
auprs de l'enfant dans ce sens, qu'une personne lui donne l'impression d'tre son
prochain en qui il peut avoir confiance. Une fois ceci admis, il devra assumer la
deuxime fonction de la mre, qui consiste largir le sentiment social veill et le
diriger sur d'autres personnes. C'est avant tout le pre dont nous avons entendu dire
qu'il s'est montr inapte dvelopper le sentiment social, peine existant, puis les
surs, qui, elles aussi, n'taient pas capables de lui tre utiles. Notre art consiste
remplacer la mre et raliser sa deuxime fonction.
Je ne crois pas qu'un penseur puisse nous faire le reproche de chercher devi-
ner , et que dans l'art de la divination, nous ayons atteint une certaine habilet. Je
considre en ralit comme un devoir primordial d'exercer mes lves dans l'art de la
divination. Il ne faut pas videmment comparer notre divination avec la divination
occasionnelle d'un individu, peu vers dans l'art de la psychologie individuelle, qui se
figure lorsqu'il prononce des mots comme sentiment social et surcompen-
sation , ou encore unit de la personnalit , qu'il a devin quelque chose dans le
sens que nous donnons cette notion. Il n'a vu l que le clavier et ne connat rien de
l'art d'en jouer.
Tous les grands progrs de la science se sont raliss grce la divination. Si
quelqu'un place un signe pniblement ct de l'autre et s'il s'abstient de tout acte
crateur, ceci n'est rien d'autre qu'une exprience strile. Ce que certains appellent
intuition , n'est peut-tre rien d'autre que de la divination. Une personne ayant fait
des tudes mdicales ne devrait pas douter que l'art du diagnostic est en ralit de la
divination -exactement comme dans la psychologie individuelle -, en se basant
videmment sur une grande exprience, lie une comprhension des rgles de la vie
humaine.
En nous basant sur notre exprience, nous pouvons soutenir que nous sommes
capables de tirer, partir d'indices minimes, des conclusions quant la structure de
l'ensemble ; que nous pouvons dduire le style de vie partir des empreintes de la
dmarche. Nous ne sommes pas ce point infatus de nous-mme pour tirer des
conclusions fermes partir de quelques mots isols, mais nous pouvons dans l'expos
ultrieur de la description trouver la confirmation de notre thse ou par contre nous
voir obligs de procder des corrections. La premire manire de faire est celle de
l'expert en matire de psychologie individuelle, la seconde celle du dbutant.
En nous servant de ces exposs, nous allons rechercher jusqu'o peut aller notre
comprhension de ces enfants. Ces histoires sont incompltes, tant donn que ceux
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 43
qui les rdigent ne savent pas exactement ce qui nous intresse. La difficult ici est
plus grande que si nous avions l'enfant devant nous, amen par les parents qui
peuvent nous renseigner sur certaines particularits. Nous pouvons dans ce cas diriger
nos questions sur les points qui nous intressent ; savoir : premirement quelle tait
la situation difficile o les dfauts ont fait leur apparition et deuximement, quelles
particularits prsentait l'enfant dj auparavant? Avec une assez grande certitude,
nous pouvons arriver la conclusion que nous avons devant nous un enfant qui n'est
pas suffisamment prpar pour la solution des problmes de la vie. Ce que l'enfant a
pu amener sur cette terre par l'hrdit ne prsente pas d'importance. Le facteur
hrditaire ne s'extriorise pas si l'enfant n'est pas prpar dans le sens social. Lors-
que la solution d'un de ses problmes rclame un sentiment social, nous allons
constater une hsitation particulire. Nous voici arrivs sur un terrain ferme ; il ne
nous restera plus qu' saisir pourquoi ce sentiment social n'a pas pu se dvelopper
normalement. Nous ne verrons pas d'originaux, d'enfants difficiles, de nerveux, d'al-
cooliques, de pervers sexuels, de criminels ou de candidats au suicide chez lesquels il
ne soit possible de dmontrer avec une pleine certitude qu'ils -ne reculent devant la
solution des problmes de la vie, que parce qu'ils n'ont pas t duqus correctement
dans le sens du sentiment social. Ce point de vue doit tre retenu. C'est la diffrence
fondamentale entre nous et d'autres coles psychologiques.
La benjamine en lutte.
Retour la table des matires
Une fillette de quatre ans. Ce n'est pas une enfant unique, niais une benjamine.
Nous connaissons suffisamment les caractristiques du benjamin. Je rpterai
cependant que le benjamin, du fait de sa position dans sa famille, prsente une
tendance constante suivre son chef de file, et si possible le dpasser. Ds le dbut,
il a un sentiment d'infriorit trs prononc et, par l mme, il aura plus de peine
rgler sa course dans le domaine social. Il prsentera une plus grande tendance
laisser de ct la socit au profit d'une supriorit personnelle. Ceci ne reprsente
pas encore un chec. Lorsque son espoir n'est pas trahi, l'enfant peut se maintenir en
bon quilibre. S'il perd l'espoir, il devient l'adversaire des autres. Il cherchera la voie
la plus facile, en essayant de trouver des subterfuges ; il se prsentera dans la vie
comme afflig de cette jalousie qui caractrise la classe indigente. Nous trouverons
toutes les particularits qui se manifestent en pareil cas, si l'autocritique est insuffi-
sante et si le sujet n'a pas entirement saisi l'importance de la socit. Pensons au
Joseph de la Bible, aux contes dans lesquels le benjamin joue son rle et nous
comprendrons cette exprience sculaire d'aprs laquelle le style de vie, la structure
psychique d'un individu, sont influencs par le fait qu'il est benjamin. Tous les autres
facteurs n'ont plus la mme importance. Il doit soumettre ses ventuelles facults
hrditaires au rle de benjamin suivant cette loi qui le guide depuis le dbut de son
existence. Ce dynamisme peut se manifester sur le ct utile de la vie, dans le cadre
de la socit, mais aussi sur le ct inutile. Pour lui la sduction sera plus forte que
pour celui qui, pendant les quatre ou cinq premires annes, aura vcu dans un plus
grand quilibre et n'aura pas reconnu, d'une faon aussi frappante, sa faiblesse et sa
petitesse.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 44
Elle suce son pouce.
A quatre ans cette habitude devrait tre abandonne depuis longtemps. Tous les
enfants peuvent occasionnellement sucer leur pouce. Les constatations que nous
pouvons enregistrer sont indubitablement les suivantes : l'entourage n'est pas arriv
dshabituer cette enfant de son dfaut par un moyen qu'elle et accept. Si on
commence lutter, on constatera qu'elle accepte cette lutte : les parents russiront
d'autant moins l'en dshabituer qu'ils feront plus d'efforts dans ce but. Elle essayera
sans cesse de se faire remarquer par son geste. Peut-tre une certaine sensation de
chatouillement, sensation rpandue sur toute la surface cutane de l'enfant, y est-elle
pour quelque chose, sinon on ne pourrait comprendre pourquoi elle porte aussi
d'autres objets sa bouche. Les enfants qui sucent leur pouce expriment par cette
attitude leur tendance la lutte. Nous pouvons l'affirmer avec d'autant plus de certi-
tude que cette action ne reprsente pas le seul moyen dont se servent les enfants dans
leur lutte. Si les parents dsirent que leur enfant soit propre, vous constaterez que,
dans le cas o une harmonieuse entente n'a pu tre ralise, les enfants se mettront
justement sucer leur pouce. On pourrait pousser n'importe quel enfant dans une
attitude d'opposition. Si les parents s'intressent particulirement l'absorption de la
nourriture, les enfants trouveront l la motif de la lutte. S'ils tiennent ce que l'enfant
aille rgulirement la selle, vous trouverez toujours que les enfants prsenteront des
difficults sur ce point. C'est une des raisons pour lesquelles certains dfauts se
maintiennent. Il en est de mme en ce qui concerne la masturbation. Des cas persis-
tants de masturbation infantile signifient toujours la lutte. Une autre cause, peut-tre
plus puissante encore, est certainement en rapport avec les circonstances invoques
ci-dessus. Lorsqu'un enfant a t dlog d'une situation avantageuse, il essayera de
rattraper par tous les moyens cette situation qui lui a permis de se trouver au centre de
l'attention. L'exprience leur prouve que certaines mauvaises habitudes attirent
particulirement l'attention des parents. Lorsque l'enfant a fait cette observation, il
sera trs difficile de le dshabituer de ce dfaut qui, d'aprs son exprience person-
nelle, s'est rvl avantageux pour lui. Dans sa tendance attirer l'attention des siens,
l'enfant va jusqu' accepter les punitions, pourvu qu'il ait seulement le sentiment de se
trouver au centre de l'attention de son entourage. Nous osons supposer que le fait de
sucer son pouce est la consquence d'une lutte de cette enfant contre ses parents.
Lutte rsultant probablement du fait que l'enfant a t dloge d'une situation agr-
able et qu' tout prix elle veut rcuprer cette situation. Il est vident que nous devons
attendre la confirmation de cette supposition. Mais je me contenterai, en guise d'exer-
cice, d'tablir pareille hypothse. Je n'oublie pas qu'il existe d'autres conceptions se
rapportant ce dfaut. Les conceptions freudiennes par exemple le considrent
comme une action sexuelle. Le fait de sucer son pouce et de se masturber est pour
l'enfant un moyen adquat et lui semble plus indiqu que d'autres. Le docteur Lvy,
mdecin New York, a recueilli certaines observations mais il n'a pu dcouvrir la
moindre trace d'une excitation sexuelle. Il soutient qu'il s'agit toujours d'enfants qui
ont obtenu le lait maternel sans effort, qui n'ont pas t obligs de le sucer car il
s'coulait trop facilement ; par suite leur appareil de succion n'avait pas entrer en
action et maintenant ils essayaient de l'actionner, ce qui les incitait sucer leur pouce.
Il n'est pas facile de comprendre pourquoi ces enfants n'actionnent pas autrement leur
appareil de succion, par exemple comme le font ceux qui, au lieu d'utiliser leur pouce,
sucent leurs lvres. Il faudra attendre des rsultats plus prcis, trouver des lments
plus nombreux. A la suite de recherches plus vastes, l'exprience a prouv que
d'autres explications sont encore possibles. Nous maintenons pour notre part la
conception de la psychologie individuelle, savoir que cette enfant est en lutte et
qu'elle veut tre au centre de l'attention. Si nous arrivons confirmer cette assertion il
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 45
sera dmontr que, d'un seul coup, la psychologie individuelle a saisi une grande par-
tie de la structure psychique de l'individu. Si ceci ne se confirme pas il faudra corriger
notre opinion.
Elle suce son pouce malgr tous les moyens employs.
Si elle suce son pouce malgr tout, le spcialiste pourra supposer qu'il s'agit d'une
enfant en lutte. Mais il pourrait encore subsister un doute. Peut-tre le fait-elle pour
d'autres raisons et lutte-t-elle pour le maintien de cette jouissance ; mais il ne fait plus
de doute qu'il s'agit d'une enfant en lutte. Il ne faut pas s'attendre voir se confirmer
la vracit de notre opinion l'occasion de ce dfaut. Il faut qu'il ressorte de
l'ensemble de sa vie que nous avons affaire une enfant en lutte et l'attitude hostile
doit ressortir de chaque geste.
Dans la majorit des cas, surtout lorsqu'elle est en opposition, elle fourre son
doigt dans sa bouche.
Nous venons d'entendre que cette enfant peut aussi se mettre en opposition. Nous
croyons savoir d'avance qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Il est
particulirement remarquable qu'elle fourre son doigt dans sa bouche lorsqu'elle est
en opposition. Pour l'observateur impartial c'est une confirmation de nos ides et un
dmenti oppos d'autres conceptions.
Elle vomit au moindre nervement.
Nous connaissons ces vomissements chez les enfants qui possdent une grande
habilet dans le refus de l'absorption des aliments. Nous pouvons admettre que cette
enfant prsente probablement une infriorit de l'appareil digestif. Cette infriorit a
amen la facilit avec laquelle elle vomit. Cela nous dmontre comment tout le
dynamisme psychique a t entran dans cette attitude de lutte. Notre enfant dispose
de moyens pour attaquer. Le vomissement en est un. Si cette enfant tait isole et si
elle n'avait qu' compter sur elle-mme, guide par la faim et l'amour, nous ne
pourrions comprendre pourquoi elle vomit lorsque quelque chose ne lui convient pas.
Le rapport avec la socit ressort ici clairement: lorsqu'elle ne joue pas le premier
rle, cette enfant s'nerve, commence vomir comme si elle voulait accuser les autres
et se venger d'eux. Cette attitude reprsente un rapport social et ne signifie rien
d'autre que la lutte d'un enfant qui rclame sa valorisation.
Lorsqu'elle refuse la nourriture.
Cette enfant vomit facilement, ce qui ne peut laisser les parents indiffrents.
... l'occasion du bain, chaque ordre des parents qui ne lui convient pas met
l'enfant dans un tat d'excitabilit nerveuse extrme : hurlant, se dbattant, elle
repousse ceux qui tentent de la calmer.
L'enfant est un lutteur comme on ne saurait mieux se le reprsenter. Si on avait
dout et cru qu'elle tait pousse par la faim ou l'amour, par ses instincts , lors-
qu'elle hurle et se dbat, on pourrait difficilement se contenter d'explications
superficielles de cette sorte.
J'ai par exemple essay de calmer cette enfant en lui racontant un conte.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 46
Un essai pour intresser l'enfant. Nous savons o nous devons classer cet essai. Il
nat de la deuxime fonction de la mre : faire collaborer l'enfant, la faire jouer avec
d'autres. Si je souligne le mot avec , le moins clairvoyant devrait comprendre que
ceci reprsente un essai pour amener l'enfant vers la socit, fonction qui a t
trouble.
Je ne m'adressais pas directement l'enfant.
C'est un subterfuge comme nous en employons souvent. Nous le faisons d'une
manire peu frappante parce que l'enfant, dans son attitude de lutte, ne ragit plus
d'une faon objective, mais subjective. Elle rpondrait par la dfensive si on s'adres-
sait directement elle.
Mais je racontais une histoire sa sur, une fillette de six ans et demi.
Il est question d'une sur ge de six ans et demi et dont on ne se plaint pas. Nous
pouvons supposer qu'elle a su s'adapter, que, de ce fait, elle est plus apprcie ; elle
pourrait porter ombrage sa sur cadette, lorsque cette dernire essaye de la dsar-
onner. Le subterfuge de s'adresser la sur tait bien choisi, car la cadette essaye
d'galer son ane dans tous les domaines,
L'enfant nerve couta attentivement.
On a l'impression que cette enfant saisit intelligemment le contenu de cette
histoire. Nous sommes plutt en droit de supposer que cette fillette voudrait ce que
possde sa sur. Elle aussi rclame des histoires. Nous retrouvons cette situation
frquemment chez des enfants en lutte.
Elle se calma progressivement et vers la fin elle se montra vivement intresse
par l'histoire.
La cure n'est pas termine. Cette fillette devrait tre adapte la socit dont elle
lse les lois videntes et traditionnelles. Il nous faut renforcer son sentiment social ;
on pourra dire que cela peut se raliser de diffrentes faons. Mais c'est le but qu'il ne
faut pas perdre de vue : faire comprendre l'enfant que nous croyons nous-mmes la
comprendre et la librer de son sentiment d'infriorit. Ces enfants manifestent
parfois leurs sentiments de la faon la plus cocasse : Si je suis triste, c'est que je
n'aurai jamais le mme ge que ma sur ane. Ils quittent le terrain de la collabo-
ration et du jeu collectif et ils tendent d'une faon personnelle devenir le point de
mire de leur entourage. Ce qui importe est la relation individu-socit. Dans ce cas on
a pch par manque d'exactitude, par des dfauts dans l'ducation. Je crois que la
nourriture se trouve ici porte au premier plan ; l'importance de la question alimen-
taire a t trop souligne. Je conseille aux parents de ne pas laisser voir l'enfant
l'importance qu'ils y attachent. Lorsque les enfants se trouvent en lutte ils dirigeront
leurs attaques l o elles portent.
Deuxime cas : Enfant unique, blas. Garonnet de trois ans. Pendant les deux
premires annes de sa vie les parents vivaient dans une situation pcuniaire parti-
culirement difficile. Ils ne pouvaient mme pas offrir l'indispensable l'enfant.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 47
Les conditions sociales interviennent ici d'une faon gnante. L'enfant ne les
ressent peut tre pas trop, tant donn qu'il n'a jamais vu autre chose. Mais il a d
ressentir la vie comme tant difficile. Il s'y ajoute encore que les parents se sont peut-
tre plaints en sa prsence de leur situation pnible et qu'ils ont veill en lui une
sombre apprhension quant l'avenir.
Pendant les derniers mois, au contraire, les conditions se sont considrablement
amliores ...
Une nouvelle situation!
et en consquence ils voulaient brusquement tout rattraper.
Cela veut bien dire qu'ils couvrent l'enfant de toutes sortes de cadeaux, de jouets,
de gteries, etc. Nous admettons volontiers que cette mthode d'ducation n'est pas
recommandable.
Les parents surchargent l'enfant de jouets ; il n'y trouve pas d'intrt et, d'une
faon gnrale, il passe ct de toutes ces choses sans montrer la moindre joie.
On peut supposer que, par un excs de jouissance de ces jouets et de ces gteries,
l'enfant a perdu tout intrt et qu'il est blas ; il croit que tout lui est d. On trouve
ventuellement que ces enfants prfrent fabriquer eux-mmes leurs jouets, confec-
tionner eux-mmes leurs poupes, mme s'ils sont trs simples. Ces jouets les int-
ressent souvent plus que les plus belles poupes qu'on aurait pu leur acheter. Cette
ducation dtourne les enfants de la socit ; ils n'ont fournir aucun effort et ils
vivent dans un monde qui est en contradiction avec le ntre. De ce manque d'intrt
qu'il manifeste, il rsulte automatiquement que cet enfant ne veut entendre parler de
rien et que peut-tre il voluera dans un cadre plus rduit, favoris par l'attitude des
parents. Il ne dploiera pas d'activit, tant donn qu'il ne s'y est pas exerc.
La mre considre l'enfant comme tant sensible, quant moi je soutiens qu'il
est apathique.
Nous accepterons galement cette deuxime interprtation.
Il prfre jouer seul, mais s'il est ml d'autres enfants il se montre soit irrit,
soit servile.
Il n'est pas habitu cette nouvelle situation, elle lui parat difficile, ce qui expli-
que son irritation. Peut-tre est-il servile parce qu'il ne se croit Pas capable
d'initiative.
Vaincu dans le jeu il se rfugie immdiatement auprs de sa mre.
Il n'a pas de rsistance. C'est l une faute d'ducation, en effet. Par une succession
de dfaites, cet enfant est arrach l'engrenage de la socit. Toutes les situations
sont ressenties comme difficiles ; l'enfant a grandi sans initiative, comme cr pour
une situation dans laquelle on obtient tout sans effort, pour un pays de Cocagne. Vous
voyez l'erreur de cette ducation en ce sens qu'il barre le chemin de la socit aux
enfants. Le traitement consisterait veiller chez l'enfant l'intrt pour les autres,
pour les exigences de la vie, c'est--dire le librer de son sentiment d'infriorit, le
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 48
remplir d'un optimisme actif qui lui fasse comprendre qu'il peut rsoudre tous les
problmes.
Lutte de l'an pour ses droits hrditaires.
Retour la table des matires
Garon de cinq ans, l'an de plusieurs enfants.
Chez l'an nous sommes habitus trouver une attitude qui traduit sa crainte
d'tre dsaronn. Il a une grande comprhension pour les conditions du pouvoir, ce
qui fait qu'il le considre comme la chose la plus prcieuse de la vie et qu'il essaye
toujours de l'atteindre. Vous trouverez rarement un homme aussi proccup de rgles
de vie que l'an. Le cadet est un ennemi jur des rgles et des principes, un adver-
saire du pouvoir tabli, qu'il aura tendance attaquer. Il ne voudra pas trop croire au
pouvoir magique des rgles et des lois de la nature. Dans toutes les circonstances il
aura tendance dmontrer qu'il n'existe pas de rgles fixes. Ainsi pouvons-nous
supposer que notre garonnet aura, un degr lev, le sens du pouvoir et qu'avec
une certaine apprhension, avec la peur d'tre dsaronn, il essayera de maintenir ce
pouvoir ou de le reconqurir. A partir du moment o il a perdu tout espoir, mme si
apparemment ses attitudes changent, il reprsente encore la mme structure. Il
exprime le regret et le dsespoir de ne jamais obtenir le pouvoir, c'est le mme type,
mais dou de moins de courage. Nous allons voir lequel de ces deux aspects sera
celui de notre garon. Les deux aspects, d'ailleurs, ont ceci de commun qu'ils tradui-
sent ce dsir intense de se retrouver la hauteur de sa situation d'an.
Nous apprenons que ce garon veut toujours jouer l'adulte, qu'il est toujours
proccup de se montrer comme un modle vis--vis de sa sur cadette. Cette atti-
tude concorde avec notre conception.
L'enfant appartient en tous points la catgorie des enfants intellectuellement
normaux, s'intresse tout et dispose d'une force extraordinaire.
Souvenons-nous que cet enfant travaille dans un tat de tension permanente pour
conserver le commandement, pour rester au gouvernail, ce qui peut paratre le signe
d'une grande force de volont. Nous ne sommes pas certains qu'un garonnet de cinq
ans mrite cet attribut de force de volont.
Il serait capable de bousculer des enfants et de briser du mobilier, mme des
choses prcieuses, bref tout ce qui pourrait se trouver sur son chemin.
Cette attitude doit se rapporter des vnements o l'enfant voulait dmontrer
qu'il tenait se maintenir au gouvernail et elle nous prouve que son sentiment social a
souffert. Nous y verrons moins cette faim et cet amour que sa recherche de la
puissance. Il ne souffre pas d'excitations ou d'impressions refoules, mais le dvelop-
pement de son sentiment social est simplement entrav. Cette recherche amplifie de
la puissance est d'autant plus comprhensible qu'il ne croit pas tout fait en lui-mme
et que d'autre part il a une sur cadette. Nous savons dj que, dans la rivalit entre
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 49
frre et sur, cette dernire est favorise parce qu'elle se dveloppe plus rapidement
que le garon ; aussi l'an aura-t-il du fil retordre pour conserver le pouvoir en face
de sa sur cadette. D'autres circonstances ont galement jou, car ce seul fait ne
serait pas dcisif, tant qu'il n'a pas perdu l'espoir de triompher de sa sur. S'il
dsespre d'y russir, il l'essayera par la ruse. L'an est un enfant qui, un moment
donn, a t unique. Plus tard il ne l'a plus t et cela, sans avoir t prpar ce
changement de situation dans le sens de la socit.
Son pre me raconta que l'enfant fut lev svrement un certain moment.
Nous ne savons pas par qui il fut lev svrement, peut-tre par le pre. Ceci
indiquerait qu'il en veut son pre et qu'il dirigera ses attaques contre lui.
Le pre soutient qu' la suite d'un dveloppement intellectuel et physique sain,
l'enfant possde un excs d'nergie.
C'est le dsir stimulant du pouvoir, que le pre mconnat.
et c'est pour cela qu'il tombe dans l'exubrance. Jusqu' prsent l'enfant n'a eu
aucune des maladies infantiles.
On dirait que le pre croit en l'influence particulire des maladies infantiles sur le
dveloppement du caractre.
A mon avis, contrairement aux enfants infrieurs celui-ci est considrer
comme ambitieux.
Si l'enfant, au contraire, se sentait sr de lui, il ne ferait pas de tels efforts. Il n'est
pas infrieur , mais il prsente un sentiment d'infriorit .
On lui pose toujours son pre comme modle, c'est un homme dou et
attrayant.
Le pre parat donner le ton, ce qui crispe encore davantage le garonnet.
On donne l'enfant l'ide qu'il arrivera galer la personnalit du pre.
Cela ne nous parat pas tellement difficile, mais l'enfant semble tri tre effray.
Le pre est ingnieur et se distingue dans le dessin et dans la peinture.
En se posant comme modles leurs enfants beaucoup de parents croient ainsi
favoriser le dveloppement du jugement et de l'action indpendante.
Dans ce deuxime cas il s'agit galement d'tablir jusqu' quel degr le sentiment
social de l'enfant a t dvelopp. Toutes les autres causes disparaissent comme tant
secondaires. Cela n'a rien voir avec les sciences naturelles, avec la faim et
l'amour . Seul importe ici le but de se faire valoir et c'est lui qui dtermine le degr
du sentiment social.
Ici je voudrais ajouter quelques remarques en rapport avec une objection de
l'ducateur :
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 50
Qui est donc responsable du fait qu'un gamin de cinq ans s'nerve la moindre
occasion? A qui faut-il attribuer la responsabilit de ces crises gastriques nerveuses
dont souffre une fillette de quatre ans? Dans la plupart des cas j'ai observ que ce sont
les parents eux-mmes qui maltraitent leurs enfants, non pas prcisment par des
actes de brutalit mais, ceci n'excluant pas une tendresse trs vive, par leur propre
attitude dcousue et inconsquente. N'ont le droit d'duquer des enfants que ceux qui,
en dehors des connaissances ncessaires, prsentent un cur chaleureux et une
profonde comprhension sociale.
le me sens oblig de diminuer la responsabilit des parents. Car si, par exemple,
on russit faire avancer ces enfants, cultiver davantage leur sentiment social, alors
les parents n'ont plus de responsabilit, ainsi notre sentiment social doit se proccuper
de dcharger les parents de ces difficults. C'tait l le dbut de la pratique de la
psychologie individuelle, malgr toutes les rsistances. Nous nous sommes dit : il
n'est pas d'instance capable de dbarrasser les parents de ces difficults. Nous avons
conscience de ne pas pouvoir accomplir seuls cette oeuvre, nous voulons simplement
commencer et donner un exemple. Nous avons reu assez d'encouragement pour
poursuivre notre route.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 51
Chapitre IV
Une benjamine gte
Retour la table des matires
La fillette est ge de onze ans ; le pre est retrait des chemins de fer, la mre
s'occupe de son intrieur. La mre aurait eu quatorze enfants dont sept sont vivants.
Ptronille est la benjamine.
Nous avons une opinion bien dfinie, en ce qui concerne la structure caractrielle
du benjamin. Vous connaissez certainement tous l'histoire du Joseph de la Bible qui
aurait bien voulu que le soleil, la lune et les toiles s'inclinent devant lui et qui
raconte ce rve dont le sens est trs bien compris par ses frres. Ils mettent le frre
dans un sac et le vendent. Cette lgende est trs instructive. Plus tard Joseph devient
l'appui de toute la famille, voire de tout le pays et il sauve toute une population. Le
benjamin! Vous constaterez souvent que, d'une faon ou d'une autre, le benjamin
devient une personnalit, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, personnalit
souvent prcieuse et puissante. Nous ne savons rien de prcis sur le sexe et les
rapports de ces quatorze enfants. Nous pouvons tablir que le benjamin est souvent
particulirement gt, tant donn que les parents se rjouissent beaucoup d'avoir pu
procrer, encore leur ge, cet enfant ( moins que cela les contrarie). Le benjamin
grandit dans une ambiance tout autre que les autres enfants, tant donn qu'il est le
seul qui n'ait pas de successeur. D'o sa situation relativement privilgie. Quant aux
autres, ils vivent cette tragdie qui consiste voir leur place prise par un autre enfant.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 52
Pareille tragdie est pargne au benjamin et ce fait se manifeste aussi dans son
attitude. Le benjamin ne sent personne derrire lui, il est dgag du dos.
Du questionnaire nous tirons les donnes suivantes
Elle travaille volontiers par priode, puis le zle diminue.
Lorsque vous voyez pareille instabilit dans l'activit d'un colier, vous pouvez
avec certitude conclure qu'il s'agit d'un enfant gt. Pareil enfant n'avance que sous
conditions : lorsqu'il ne doit pas dployer un effort pour produire, lorsque facilement
il russit quelque chose. Si l'atmosphre chaude et agrable disparat, son rendement
diminue. D'aprs le livret scolaire nous pouvons diagnostiquer si tel colier est un
enfant gt. Tout comme un bon mdecin-praticien nous sommes capables de
diagnostiquer ce type de l'enfant gt.
L'enfant prfre l'criture, le dessin, les travaux manuels.
Cet enfant est habile de ses mains. Cela peut avoir son origine dans un entra-
nement manuel de longue date. Du fait que ds sa premire enfance il a prsent une
tendance s'occuper manuellement nous pouvons aussi conclure qu'il est peut-tre
gaucher, qu'il a compens les difficults et qu'il a particulirement bien entran sa
main droite. Mais cette deuxime hypothse est considrer avec circonspection, elle
est facile confirmer ou infirmer.
La mre dfend la mauvaise conduite de l'enfant.
Ici nous trouvons une mre qui dfend l'enfant, mme si la critique est justifie.
Nous obtenons ainsi la confirmation que cet enfant est gt.
L'attention est facile veiller.
Cela nous indique que l'enfant s'intresse tout, qu'il voit et entend tout et qu'il
prsente un vif intrt pour la vie. Il s'agit d'un enfant qui n'a pas perdu le courage,
qui ne recule pas, qui n'est pas renferm mais qui cherche le contact avec le monde
extrieur. Nous retrouvons ici une activit sociale qui se meut peut-tre sur un terrain
spcial en rapport avec des choses futiles, mais la base est donne.
Elle essaye de dtourner l'attention des autres en drangeant.
Il nous faut comprendre que cette enfant est toujours proccupe de gner l'ensei-
gnement. Cela ne nous surprend pas, car nous savons que pareille enfant gte,
pourvue d'un certain dynamisme, donnera libre cours sa tendance dominante :
s'arranger toujours de faon devenir le centre d'intrt de son entourage; malheu-
reusement le plus souvent du ct inutile de la vie. Elle ira d'ailleurs dans ce sens
assez loin tant donn qu'elle trouve chez sa mre l'appui ncessaire.
Comprhension remarquable.
Le moindre doute quant l'intrt veill de cette enfant disparat donc. Je ne
serai pas tonn qu' l'occasion d'un examen de l'intelligence le niveau intellectuel se
trouve au-dessus de la moyenne.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 53
Observe d'une faon indpendante et juste les vnements de la vie journa-
lire.
Il se confirme que cette enfant dispose d'un potentiel d'activit qui la pousse
s'occuper de tout et prendre position en face des problmes d'une faon raisonnable.
Reprsentation claire, enfant doue, sens critique.
Nous ne voulons pas dire que son sens critique se fourvoie toujours. Si occasion-
nellement elle a raison, nous admettrons tout de mme que cette enfant a une certaine
tendance a vouloir dpasser les autres.
S'attaque courageusement tout travail nouveau.
Nous pouvons en conclure qu'au dbut d'un nouveau travail elle avance d'une
faon dcide. Une fois de plus son activit est mise en vidence. Le style de vie de
cette enfant commence se dessiner; nous avons l'image d'une enfant remuante qui
s'intresse au monde extrieur et qui certainement a tendance s'lever au-dessus des
autres. Lorsqu'elle se trouvera dans le milieu social de l'cole, quelle sera son attitude
vis--vis du matre?
Par moments lunatique dans son travail.
C'est la confirmation de ce que nous avons dj dit antrieurement.
Reconnatre que son travail est russi l'encourage vivement.
Elle prsente un dsir ardent d'tre approuve, elle voudrait jouer un grand rle.
Elle est joyeuse.
Cela nous montre nouveau un aspect de son courage, de son esprit de dcision.
Elle ne vit peut-tre pas chez elle de journes tristes, car nous savons que sa mre la
dfend.
Elle aime maintenir ses dcisions.
Comme ceux qui se sentent forts.
Elle dtourne l'attention des autres enfants en troublant l'enseignement.
On peut supposer qu'elle veut atteindre un but, se placer au centre de l'attention.
Cela ne russit qu'en gnant l'enseignement.
Prsente la tendance diriger.
La benjamine - le petit Joseph.
Mais se montre peu doue pour le faire.
Pourquoi ne dispose-t-elle pas de ce don? Les autres enfants s'y opposent, ils ne
veulent pas se laisser constamment conduire par ce petit bout de chou. Elle n'a pas
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 54
encore compris comment on arrive conduire les autres. Elle arrivera certainement
acqurir un jour ou l'autre ce don du meneur.
S'exprime bien et parle facilement.
La parole est galement un moyen pour attirer l'attention sur soi-mme. Vous
trouvez souvent chez des enfants difficiles, chez des nvross ou des alins cet
amour de la parole; ces gens parlent sans cesse.
Les observations prcdentes proviennent de la vie de l'enfant l'cole primaire,
prsent suivent des observations de l'cole secondaire :
Ne se fait pas particulirement remarquer au dbut. A l'occasion de la premire
promenade (excursion avec l'instituteur) des camarades se plaignent de pitreries et de
drangements de la part de l'enfant.
A cette occasion l'enfant savait dj vouloir; elle veut rserver sa place. Pourquoi
ne s'est-elle pas fait remarquer immdiatement? Ceci plaide en faveur du bon
entranement de l'enfant. Elle doit d'abord trouver comment le faire.
Depuis environ deux trois semaines elle fait preuve d'une conduite inad-
missible. Elle crie pendant l'enseignement, quitte sa place constamment, bouscule les
autres et essaye de les dranger.
Sa conduite signifie probablement qu'elle avance dans sa tendance dpasser les
autres. Nous comprenons ce qu'elle veut obtenir par cette conduite : elle veut montrer
sa puissance, elle veut arriver la domination des autres enfants.
A l'occasion d'une rdaction, l'enfant ne travaille pas et lorsqu'on lui fait une
observation elle saisit, dans sa colre, l'encrier, verse de l'encre sur ses mains, se lave
littralement les mains avec et salit le pupitre.
L'enfant dpasse la mesure et se conduit comme un vainqueur enrag qui veut
montrer tout prix qu'il est le plus fort. tant donn que nous avons affaire ici une
enfant intelligente, nous pouvons conclure que cette enfant ne se sent pas l'aise
l'cole et qu'il faudra faire quelque chose de plus pour elle. Cette fillette nous dmon-
tre par son attitude qu'elle a perdu l'espoir de pouvoir jouer un rle l'cole.
On appelle la mre qui, perdant dans sa colre tout contrle, tire les cheveux de
l'enfant, lui frappe stupidement la figure et lui tord les bras.
La mre elle-mme a perdu son sang-froid. Nous devons remarquer que ceci n'est
pas la bonne mthode pour punir le dernier dynamisme, l'ultime extriorisation de
l'enfant. Celle-ci s'en rjouira, si seulement elle arrive indisposer la mre et l'insti-
tuteur. J'ai lu dernirement un passage dans une biographie de Rosegger o l'auteur
raconte qu'il avait une joie immense lorsque, comme enfant, il pouvait indisposer son
pre d'une faon telle que ce dernier le battait. Plus tard, ayant compris que le pre
l'aimait, il changea d'attitude. L'enfant voudrait avoir l'assurance qu'il est aim et
qu'on croit en lui. Lorsqu'il ne l'a plus, il s'efforce d'agacer quelqu'un et de le pousser
bout jusqu' ce qu'il arrive son rsultat. Cela peronne sa force.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 55
La directrice a de la peine calmer la mre et elle fait retourner l'enfant rapide-
ment en classe. L'enfant n'a pas pleur, n'a pas cri, elle est reste ferme,
Vous voyez comment elle dmontre sa mre : Tu es trop faible pour moi, je
suis plus forte que toit
La mre est peine partie que l'enfant est renvoye la directrice parce qu'elle
rend impossible l'enseignement dans la classe.
L elle dmontre aussi que rien ne l'impressionne, que personne ne peut l'influ-
encer . Dans un certain sens cette enfant mrite notre admiration - elle est particu-
lirement forte. Si on pouvait canaliser cette puissance extraordinaire dans un sens
utile, on pourrait en faire quelque chose de bien.
La directrice lui parle avec bienveillance et l'enfant promet d'tre obissante,
mais tout en promettant elle n'a gure l'intention de tenir sa promesse.
L'enfant se rend compte que la directrice s'intresse elle avec sympathie. Elle
voudrait bien rendre service la directrice et tre obissante, niais en classe le mca-
nisme de son style de vie commence jouer. Certains auteurs ont tendance croire
qu'il s'agit ici d'une ambivalence, que d'un ct l'enfant est serviable alors que de
l'autre ct elle est dsobissante. Mais il ne faut pas se reprsenter l'me humaine
d'une faon aussi automatique. Ce style de vie mcanis ragit videmment suivant
son schma mais il est variable suivant la situation. Chez la directrice elle a l'impres-
sion : cette personne m'est acquise, elle m'appartient - en classe elle n'a pas cette
mme impression.
La directrice lui donne une fonction de confiance, celle de mettre jour le
calendrier.
C'est un moyen pour, calmer une enfant l'cole et cela a mme une signification
plus profonde : agir sur les enfants dont la recherche d'une supriorit peut tre
calme par une fonction de confiance. Mais l'enfant voudrait plus que cette fonction,
elle voudrait tre plus que tous les autres enfants et nous ne croyons pas que l'enfant
se calmera d'une faon dfinitive.
L'institutrice rentre en classe. Remarque de l'enfant comme elle a de beaux
bigoudis, o pourrait-on en acheter.?
Cela signifie une hostilit franche. Il est vident que cette enfant se trouve en lutte
ouverte avec cette institutrice, seule une ennemie dclare peut parler de cette faon.
Les enfants de cette classe, gs de dix ou onze ans, sont videmment trop
jeunes pour se dsintresser de pareilles remarques. Le drangement continue. Au
dbut on avait l'impression que l'enfant voulait simplement agacer cette institutrice,
mais plus tard les autres y passaient leur tour.
Il est peut-tre impossible pour les autres comme aussi pour cette institutrice de
fournir l'enfant ce qu'elle rclamait et la placer tout de suite en tte de la classe.
Nous voyons d'autre part que nous ne pourrons rien tirer de cette enfant si nous ne
devinons pas tout de suite ce qu'elle dsire, Elle nous entranera dans cette mme lutte
dans laquelle elle a entran les autres. Ce serait une erreur que de lui reprocher ces
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 56
dfauts. Il faut entamer une conversation avec elle en parlant de ses qualits. La
manire de faire dpend de l'individualit du conseiller,
Durant deux leons de sciences naturelles la directrice a d rester en classe pour
que l'enseignement puisse se faire.
Sa force n'est pas suffisamment grande pour se mettre en lutte avec la directrice;
avec cette dernire elle parat d'ailleurs tre en meilleur rapport. Cela peut tre du
respect, mais aussi de la reconnaissance pour l'avoir dfendue.
L'institutrice chargea l'enfant de quelques fonctions pousseter le matriel
d'enseignement, chercher l'eau, mais l aussi trs rapidement elle commena faire
d'es btises.
Cela nous incite rflchir. Comme nous le voyons elle effectue d'une faon
satisfaisante ce que la directrice lui demande. Si une autre institutrice la charge d'une
fonction, elle l'effectue mal. L aussi nous pouvons apprendre quelque chose : la
faon d'approcher cette enfant. Comme je le vois, l'ducation moderne a tendance
placer l'enfant dans une situation agrable et on peut observer que dans cette situation
un enfant se conduit d'une faon plus satisfaisante. La psychologie individuelle
essaye par contre d'habituer l'enfant ne pas perdre son quilibre, mme lorsqu'il se
trouve dans une situation dfavorable. Si nous nous remmorons les conditions dans
lesquelles se forme le style de vie mcanis, nous voyons que ce dernier est construit
de faon telle. que la mre. doit fournir l'enfant une situation agrable, pour pouvoir
gagner la confiance de l'enfant. Elle doit ensuite faire de l'enfant un partenaire social
de la vie en collectivit. Nous ne pouvons pas nous soustraire cette fonction qui
incombe la mre, nous devons commencer par l et gagner la sympathie de l'enfant
pour pouvoir ensuite l'incorporer la socit. Si nous ne le gagnons pas, nous n'y
parviendrons pas.
Pendant les exercices physiques l'lve se montre turbulente et quitte le rang.
On l'enferme au vestiaire - elle jette des bouts de papier sur le sol, puis les robes des
lves. Il est impossible de la dcider remettre les affaires en ordre.
Toujours la mme lutte.
La directrice mme est oblige de lui parler longuement avant qu'elle ne se
dcide enlever les boules de papiers et faire de l'ordre.
La directrice russit mme l'amener faire amende honorable et s'humilier.
Une autre fois elle russit changer au vestiaire chaussures et bas de ses
camarades d'tude. Une enfant ne trouve pas ses bas et on suspecte videmment la
petite H. Ni la directrice, ni l'institutrice ne supposent un instant que l'enfant aurait pu
s'approprier les bas, tant donn que l'enfant est trs propre et correctement vtue.
Elle ne manque certainement de rien, ni en ce qui concerne la nourriture, ni en ce qui
concerne l'habillement. Le lendemain la directrice, la mre et la mre de l'enfant lse
insistrent auprs de la petite pour qu'elle avoue o elle avait cach les bas. Mais
l'enfant n'avoue rien. Aprs de longues recherches le concierge trouve les bas dans
l'ouverture du ventilateur au-dessus du parquet; jusqu' prsent l'enfant jure ne pas
avoir cach les bas.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 57
Je dois dire que l'enfant ne prsente pas de tendance mentir. L o nous trouvons
le mensonge, nous ne trouvons pas cette activit. Car le mensonge est signe de
lchet. Il faut tre prudent dans pareilles circonstances, car il est possible qu'un autre
enfant ait cach les bas. Nous pouvons imaginer quel point cette enfant doit se sentir
suprieure si, ne serait-ce qu'une seule fois, elle est suspecte tort. J'ai vu des cas o
des personnes ont excut de nombreux vols; pour une fois elles n'avaient pas vol, et
il tait cocasse d'observer quelle tait leur attitude lorsqu'elles furent accuses. Elles
laissrent poursuivre l'enqute qui les rendait suspectes, et elles jouissaient de
l'injustice qu'on leur faisait subir.
Comme la monitrice de gymnastique dcline toute responsabilit quant la
scurit de l'enfant et des autres lves, la directrice assiste la leon. Elle dclare
que l'enfant se conduit d'une faon impeccable, autant en ce qui concerne la conduite
qu'au point de vue des exercices. A la leon suivante on loue l'enfant, mais dj elle
commence briller par des grimaces. Elle se plaint : le pied me fait mal.
Cette manire de lutte est moins brutale que celle dont nous avons entendu parler
antrieurement.
L'institutrice pense que si involontairement l'enfant ne s'applique pas aux exer-
cices de gymnastiques elle devrait avoir la plus mauvaise note. D'aprs les renseigne-
ments de la mre, l'enfant aurait pleur la maison. La mre la console : Mais ne
t'en fais donc pas!
Ici nous pouvons presque parler d'une occasion manque. Il est trs difficile de
trouver chez un enfant la bonne occasion pour J'amener vers une amlioration. Il n'est
pas exclu que l'enfant ait vraiment souffert de son pied et qu'elle soit dj sur le
chemin de l'amlioration. C'est en rponse sa plainte qu'on la menace de la plus
mauvaise note.
Elle collabore pendant la leon d'criture, quoique mme l elle fut envoye la
direction pour avoir trop drang.
Elle semble intresse par J'criture, nous avons suppos qu'elle est habile de ses
mains, ici elle collabore peut-tre pour dpasser les autres. Nous voyons que l o
elle ne peut pas atteindre ce but elle recommence gner l'enseignement.
Le professeur de gographie, d'histoire, de langues et de chant loue la manire
dont s'exprime l'enfant et fait dans les premires semaines l'observation que l'enfant
pourrait suivre les cours A (plus difficiles).
Nous apprenons que cette enfant n'est pas dans le cours A (normal). C'est une des
questions les plus brlantes de la rforme scolaire dans le monde entier. La plupart
des pays se sont dcids crer deux cours. Participent au cours A les enfants qu'on
considre comme normalement dvelopps, au cours B ceux qui donnent l'impression
de se dvelopper plus lentement. L'enseignement du cours B en tient compte. Cer-
tains allgements pour les enfants qui ne sont pas suffisamment prpars crent une
situation et un enseignement plus facile. Mais il ne faut pas perdre de vue les dfauts
de cette rforme. Pour ma part j'ai l'impression que ces enfants du cours B auront le
sentiment qu'ils sont au-dessous de la moyenne. Il n'est pas rare qu'ils entendent des
injures telles que cours d'imbciles , etc. Certains enfants profiteront certes des
avantages du cours B, mais sur d'autres les dsavantages psent lourdement. Mes
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 58
recherches au cours desquelles j'ai pu tablir que dans le cours B se trouvent en
majorit des enfants difficiles, pauvres, me semblent particulirement importantes.
Cela veut dire que ces enfants sont moins prpars pour l'cole que les autres. Cette
question n'est pas encore tout fait rsolue. Les dfauts de cette institution ne sont
pas entirement limins. Ce qui importe cette occasion, c'est l'opinion de l'enfant
concernant ce cours B.
L'institutrice lui disait aussi qu'elle pourrait suivre le cours A. Si nous saisissons
bien le style de vie de cette enfant, nous pourrons supposer qu'elle se sent diminue
du fait qu'elle se trouve dans le cours B. Les dsavantages du cours B doivent nous
donner rflchir dans ce cas particulier.
Travaux manuels.
C'est un travail qu'elle doit pouvoir excuter correctement.
Le professeur de travaux manuels raconte que pendant le cours elle injuria une
des lves qui tait en train de lui dposer sa place le matriel de travail : Salope,
sale bte, veau, et d'autres expressions qu'il est impossible de reproduire ici. Le
professeur de dessin : un travail critiqu par le professeur...
Naturellement c'est pour nous un mot d'ordre, il faudra que quelque chose se
passe!
Par mchancet, l'enfant barbouille tout son dessin de couleurs et l'abme. Le
professeur essaye de la raisonner. Rsultat : Mon pre viendra et vous enfoncera
l'estomac, a vous fera passer l'envie de m'ennuyer!
Au catchisme : l'enfant est catholique mais ne suit pas l'enseignement reli-
gieux. Elle assiste pourtant au cours et l'abb l'interrogea plusieurs reprises. Une
fois elle fut la seule lve capable de donner une rponse exacte la question. Elle
raconta cela joyeusement sa mre. Au cours suivant l'abb l'envoya la direction
parce qu'elle se montra particulirement mal leve.
Nous ne savons pas ce qui se passa entre les deux cours, mais l aussi une
occasion s'tait prsente pour gagner son attention.
Constatations de la directrice : lorsque l'enfant arriva a la direction elle se con-
duisit d'une faon particulirement aimable. L'lve devait faire du calcul ou crire,
au dbut tout allait trs bien, mais vers la fin elle dessina des bons hommes. A la
question o on lui demandait pourquoi elle ne faisait pas ses exercices de calcul elle
rpondit : je ne le peux pas!
C'est videmment une vilaine affaire. Lorsqu'elle ne sait pas quelque chose, elle
ressent un tel sentiment d'infriorit qu'elle est oblige de le compenser d'une certaine
faon.
A la fonction d'honneur dont nous avons dj parl (mise jour du calendrier)
s'en ajoutrent d'autres : cacheter des imprims, servir de liaison avec les classes
voisines. A cette occasion elle parat l'enfant la plus douce qui existe et quelques
minutes plus tard, malgr sa promesse de rester sage on est nouveau oblig de la
renvoyer de la classe.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 59
L'enfant a trouv le point d'attraction, c'est le bureau de la directrice. Si on l'en
enlve et qu'on l'adresse ailleurs, elle tend y retourner. Le mouvement s'accuse dans
ce sens parce qu'elle s'y trouve dans une situation agrable. Il est possible que l'insti-
tutrice lui veuille encore plus de bien que la directrice, mais tout dpend de la faon
dont l'enfant l'a compris.
L'enfant raconte : ma mre n'aime pas les grands , elle n'aime que moi.
Cette impression rsulte du fait que la mre la gte trop.
Souvent elle m'apporte quelque chose, mais pas des sucreries, des saucissons,
du jambon ou du jambonneau seulement.
Je voudrais devenir ducatrice.
Ce dsir ne nous surprend pas tant donn que dans la personne d'une ducatrice
elle semble retrouver l'image d'un matre.
Si j'avais affaire un enfant mchant je ne ferais que le battre.
Je dois entrer au cours de danse, ma sur a dit que je pourrai m'en donner
cur joie. Mais ma mre ne me laisse pas partir, elle dit qu'elle peut duquer elle-
mme son enfant, qu'elle n'a pas besoin des autres. Ma place n'est pas dans la rue X,
sur la liste j'tais prvue pour l'cole de la rue Y.
Le terrain de l'cole de la rue X. est suffisamment explor pour elle. Elle y a
montr tout ce dont elle tait capable. Elle a l'impression qu'elle pourrait briller
davantage dans l'cole de la rue Y. Ce sont des mensonges dans le but de se vanter,
de bluffer et d'impressionner les autres.
L'enfant est renvoye au bureau de la directrice et celle-ci lui demande ce
qu'elle a encore fait. Elle ne rpond pas immdiatement. Aprs des questions et des
exhortations rptes elle se dcide parler et elle raconte la vrit. Une fois elle a
menti la directrice. La monitrice de gymnastique rapporte que l'enfant soutient
qu'elle lui a tir l'oreille, ce qui l'obligea porter un pansement. La directrice inter-
roge l'enfant qui maintient ses dires. Elle lui explique que ses parents la croiront et
demanderont des explications l'institutrice 'enfant annonce d'une faon menaante
la visite du pre); celle-ci se plaindra et les parents seront punis pour l'avoir offense.
A ce moment l'enfant avoue s'tre querelle avec sa sur qui l'avait frappe sur
l'oreille, ce qui a ncessit ce pansement.
Ce mensonge est un mensonge de lutte. Elle voulait mettre dedans l'insti-
tutrice. Nous ne pouvons pas parler ici d'une habitude de mensonge par lchet. Ce
n'est pas un mensonge, c'est une mdisance.
Une autre fois l'enfant mentit encore : la mre avait fait demander que l'on
plat sa fille au dernier rang pour qu'elle ne dranget pas les autres. Cela fut fait. Le
lendemain l'enfant arriva avec des lunettes en criant qu'elle ne voyait pas du dernier
rang et qu'elle devait tre place au premier rang. Le mdecin se trouvant par hasard
sur place examina l'enfant; mis au courant du cas, il rassura la fillette et lui dit que ce
n'tait qu'une question de nervosit et qu'elle pourrait travailler tranquillement au
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 60
dernier rang. Aprs une enqute plus serre, et non sans avoir louvoy un certain
temps, la directrice arrive faire avouer l'enfant qu'il s'agit des lunettes de sa mre.
L'opinion de la mre, propos de l'histoire des lunettes, tait tout autre.
Les parents donnent l'impression d'avoir compris que l'enfant est mauvaise et ils
avouent ne pas savoir comment agir vis--vis d'elle. Le pre raconte que la mre
soutient l'enfant; la mre dit que les autres enfants plus gs repoussent souvent la
fillette et qu'elle-mme est la seule me sur laquelle l'enfant puisse compter.
Voil une fois de plus le problme de Joseph. C'est la mme explication que nous
retrouvons ici.
Pour finir voici quelques renseignements qui compltent la description :
Compte rendu de la monitrice - pendant certaines leons l'enfant se conduit
d'une faon impeccable, puis elle recommence gner l'enseignement; la plupart du
temps ses cahiers sont en dsordre, mais elle apporte ses devoirs et ses exercices
d'une faon satisfaisante; elle aime tre interroge.
Pendant la leon de chant elle est incapable de s'accorder avec les autres, elle
chante plus vite ou plus lentement et se rjouit d'une faon manifeste si elle peut nous
gner.
Sont particulirement flagrants son manque d'affection, voire mme la joie avec
laquelle elle torture ses camarades d'tude et sa tendance vouloir toujours jouer le
premier rle.
Cela est suffisamment significatif.
La prtention, l'arrogance, la prsomption, la mchancet et le mensonge. D'une
faon gnrale elle semble en ce moment plus calme, sa mchancet a un peu
diminu.
Une lgre amlioration semble se manifester depuis peu.
La monitrice de travaux manuels raconte : elle s'assied sur une chaise et se pro-
mne ainsi en la tranant travers la salle; lorsque la monitrice la menace d'en parler
ses parents, elle rpond : a leur est gal, je n'ai pas peur, mme pas si le maire
venait!
A la leon suivante, elle imite le chant des oiseaux et attire l'attention de la
monitrice sur son talent.
Elle travaille ses devoirs d'arithmtique sans renoncer, il faut le dire, l'aide
permanente de l'institutrice.
Elle veut avoir constamment quelqu'un sa disposition, c'est le trait de l'enfant
gt.
Une fois elle faisait un tel tapage au dbut du cours qu'il tait impossible de
continuer l'enseignement; elle courait dans la salle, frappait les enfants, les insultait.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 61
A un certain moment elle cria : Je te plante un couteau dans le ventre! Elle ne colla-
bora pas davantage ultrieurement; elle disait : Cela je ne le peux pas.
Ceci a la mme signification : Je dois donc gner les autres. Si je ne peux pas
jouer le premier rle, alors je ne peux pas en jouer d'autres.
Examen de l'intelligence
Retour la table des matires
D'une faon gnrale au-dessus de la moyenne, en avance sur son ge. Reprsen-
tation trs bonne. Dfinitions lgrement dfectueuses. Dans la connaissance des
choses, lgrement en retard, bonne en questions pratiques, semble tre proccupe
par les travaux du mnage. Mmoire lgrement au-dessous de la moyenne.
Dr A : Il serait de la plus grande importance, pour une enfant de ce genre, de la
placer dans une maison qu'on pourrait appeler maison de convalescence. Je considre
une telle institution comme un complment indispensable nos consultations et je
rclame cette institution depuis longtemps. Cette maison devrait tre dirige par des
pdagogues et des psychologues qualifis. Nous nous efforons de modifier le style
de vie erron de cette enfant avec l'aide des parents et des instituteurs. Il est impos-
sible de changer cette enfant en dix minutes. Il serait particulirement favorable que
l'on n'abandonnt pas entirement cette enfant sa mre et que quelqu'un s'en occupt
pour lui montrer les possibilits de se faire remarquer d'une faon utile.
(En s'adressant la mre) : Nous voudrions bien vous aider et aider l'institutrice.
Savez-vous que dans le fond cette enfant nous plat? Elle est trs dcide; mais peut-
tre ne se plat-elle pas l'cole?
La mre : Elle devrait frquenter l'cole de la rue Y.
Dr A : Pourquoi prfre-t-elle cette cole?
La mre : Elle croit qu'elle n'a pas t affecte cette cole parce qu'elle est trs
mauvaise lve.
Dr A : Comment se comporte-t-elle la maison?
La mre : Elle est la plus petite, les plus gs la taquinent. J'ai eu quatorze
enfants...
Dr A : Je vous flicite!
La mre : Une bouche de plus nourrir ne compte pas. Les ans la jalousent et ne
l'aiment pas.
Dr A : A-t-elle des amies?
La mre : Oh oui!
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 62
Dr A : Nous avons confiance en cette enfant, nous croyons que c'est une fillette
capable. Elle veut toujours jouer le premier rle.
La mre : Elle s'est souvent plainte du fait que l'institutrice ne l'interrogeait pas. A
la maison elle est gentille, elle m'aide souvent.
Dr A : Comment fut son ducation? a-t-elle t svre?
La mre : Il faut toujours tre svre avec les enfants.
Dr A : Je crois que si on expliquait les choses cette enfant, cela irait aussi.
La mre : a ne marche pas sans punitions.
Dr A. : Moi je pensais que si on pouvait trouver quelqu'un ici qui comprenne cette
enfant, qui se promne avec elle, qui lui donne de meilleures ides, bref si cette
enfant avait un peu de socit, cela lui serait utile. Si vous y consentez, je veux bien
lui envoyer une de mes lves.
La mre : Elle a dj frquent une amicale d'enfants .
Dr A : J'aurais prfr qu'elle ft sous l'influence de cette jeune fille, en dehors de
l'cole. Elle pourrait apprendre quelque chose d'utile auprs d'elle.
La mre : Je crois que j'ai bien lev mes autres enfants, il me semble que j'arri-
verai aussi lever celle-ci.
Dr A : La petite voudrait bien jouer le rle le plus important. Vous souvenez-vous
encore de l'histoire de Joseph? Si actuellement l'enfant manifeste de telles difficults
l'cole on ne pourra rien obtenir par des coups. Soyez toujours aimable. Si vous
acceptez, dites-le-nous et nous vous enverrons la jeune fille.
La mre : Ce qu'elle fait l'cole elle ne le fait que pour plaisanter, vous avez l-
bas des enfants plus distingus qui sont plus susceptibles.
Dr A : (aprs le dpart de la mre) : Vous voyez ici l'aversion des gens en face de
nos conseils. Il nous faut attendre pour le moment.
(S'adressant l'enfant) : Quelle grande fille! J'ai cru qu'elle tait beaucoup plus
petite. Tu voudrais toujours paratre plus grande, tu aimerais te mettre sur la pointe
des pieds pour que chacun puisse t'apercevoir. Cela se voit souvent chez les benja-
mins, ils veulent toujours se faire remarquer. Tu es une bonne lve, capable, et j'ai
entendu dire que tu es une enfant intelligente. Ne crois-tu pas que tu pourrais briller
par tes connaissances pendant les cours? Si tu y russis, tu russiras aussi dans ce que
tu dsires. Alors tout le monde t'estimera et t'aimera. Ne devrais-tu pas l'essayer
immdiatement pour faire plaisir ton institutrice? Alors, tout le monde te respec-
terait. Crois-tu que tu puisses y arriver?
L'enfant (se tait pendant tout ce temps).
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 63
Dr A : Tu pourras devenir une des meilleures lves; qu'en dis-tu ? Est-ce que ce
ne serait pas bien? La lutte que tu mnes devrait cesser ici, a serait plus joli. Il faut
toujours te souvenir de cela : Je ne suis pas oblige de me trouver toujours au premier
plan et de me faire remarquer; il est plus joli de bien travailler pour qu' la fin on
m'aime, mais ceci ne doit pas forcment arriver ds le dbut. Combien d'lves y a-t-
il dans ta classe?
L'enfant : 32.
Dr A : L'institutrice ne peut pas faire avec toutes les lves ce qu'elle fait avec toi.
Veux-tu essayer de l'aider un peu? Je t'avertis que cela n'est pas facile, mais je crois
que tu y arriveras.
Reviens dans un mois, je me renseignerai pour savoir si entre-temps tu as pu
russir ou si tu persistes rester le centre d'attraction de ta classe.
L'enfant (aucune rponse).
Dr A (aprs avoir renvoy l'enfant) : Dans le fond c'est une me tendre, on aurait
pu la faire pleurer. Il faut videmment attendre pour voir ce qui se passera. Je dois
attirer votre attention sur un dtail technique. J'ai acquis la conviction que faire
paratre un enfant devant une runion de gens a une bonne influence. Ceci signifie
pour l'enfant que ses difficults ne sont pas une affaire prive puisque cela intresse
aussi des trangers. Peut-tre son sens social est-il mieux veill par l. Je rpte
toujours : Je me renseignerai pour savoir comment vous vous tes comport. Ce n'est
pas une menace, c'est une certitude de l'attente que je voudrais faire comprendre
l'enfant. Dans notre mthode il y a un ct artistique qui ne se laisse pas saisir d'une
faon scientifique. Si je touche le point sensible, l'enfant me comprendra certai-
nement et ce fait de le placer dans la socit en est un lment capital. L aussi on
peut formuler des objections, par exemple que ceci pourrait rendre l'enfant vaniteux
lorsqu'il s'apercevra qu'on s'occupe de lui, ou bien que ceci l'impressionne beaucoup.
On peut y remdier par la manire dont on parle l'enfant. C'est se conformer
l'esprit de notre temps que de formuler des objections et ne rien faire.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 64
Chapitre V
Les prtendues crises de la pubert,
Retour la table des matires
Des plaintes ont t formules au sujet d'une fillette de quatorze ans qui aurait
commenc une srie d'expriences sexuelles, qui aurait disparu pendant dix jours de
chez elle et qu'on aurait retrouve prs de la maison de ses parents.
Les antcdents : famille pauvre avec trois enfants. L'an, trs longtemps malade,
gagne maintenant sa vie et remet tout son argent sa mre, aussi est-il considr par
elle. Le pre et l'an, constamment malades, ont eu souvent besoin des soins de la
mre. Le pre ne pouvait travailler que par courtes priodes. On peut imaginer que
cette fillette ne pouvait jouir d'une attention particulire dans une situation aussi
pesante. Il naquit encore un troisime enfant, galement une fille, et, par des circons-
tances malheureuses, il se trouva qu' cette poque le pre et le fils furent en conva-
lescence, ce qui permit la mre de s'occuper davantage de a benjamine. Cela
reprsentait pour notre fillette une situation particulirement dfavorable. La mre ne
pouvait pas s'occuper d'elle; elle avait alors l'impression d'tre mise l'cart. Elle
grandit comme une enfant dteste, sans la chaleur de l'amour maternel. En fait, dans
une certaine mesure l'quilibre tait tabli, mais la fillette vivait dans l'ide qu'elle
tait dsavantage par rapport son frre et sa sur. Le pre reprsentait bien
l'autorit et les enfants lui obissaient volontairement quoiqu'il ft svre. Nous
pouvons prdire que cette fillette se dveloppera comme une enfant dteste, sans
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 65
espoir. Elle a pris conscience du fait qu'elle n'tait pas aussi choye que les autres.
Semblable enfant ralise tout moment ce que nous dcrivons l et son style de vie
s'en imprgne. Une circonstance heureuse apparat : elle passe chez un instituteur
qu'elle aime beaucoup; elle s'panouit, devient une des meilleures lves et on lui
prdit qu'elle arrivera loin. A 14 ans elle doit monter d'une classe et elle change
d'cole.
L le malheur recommence : le nouvel instituteur ne comprend rien l'me
enfantine et l'aborde svrement. Or, son seul appui consistait dans l'estime dont elle
jouissait l'cole. Par le seul fait que l'instituteur la traite sans affection elle
commence douter d'elle-mme, ne peut pas rpondre et reoit des mauvaises notes.
Elle tombe dans le pige qui lui tait prpar. Nous pouvons prdire qu'un jour ce
mauvais dpart se manifestera. Elle n'avancera que si elle rencontre de l'affection et
des louanges. Elle manque l'cole. L'instituteur fait une enqute et apprend qu'elle
frquente des jeunes gens, on dcide de l'exclure de l'cole. C'est la pire des choses
que l'on puisse faire. La russite l'cole est manque, la maison elle se sent
frustre, que lui reste-t-il? L'art du psychologue individuel consiste s'identifier avec
la situation o se trouve cette fillette. Nous pouvons poser le problme : que ferions-
nous si, tant une fillette de quatorze ans et cherchant nous faire apprcier, notre
famille nous refuse cette apprciation? Il n'existe qu'une voie : chercher cette appr-
ciation auprs du sexe oppos. Elle l'a fait d'une faon intelligente, quoiqu'en
contradiction avec le sens commun. Sachant que cette fillette est intelligente, nous
pouvons prdire ce qui doit se passer maintenant; sur cette voie elle ne trouvera pas
l'apprciation recherche. Pareilles amourettes ne reprsentent qu'une russite
apparente. Celui qui a acquis une certaine exprience dans l'observation des rapports
amoureux sait que de tels rapports, facilement tablis, doivent aboutir un chec.
Elle se voit comme tant l'objet, le jouet de l'homme. Si nous continuons nous
identifier avec cette situation, que devons-nous faire d'autre? Il ne reste que le
suicide. De tous les cts la reconnaissance lui est refuse. Dans quelques lettres, elle
annonce du reste un suicide. Il aurait pu se produire si une circonstance heureuse ne
l'avait retenue. Il ne faut pas considrer comme de la lchet le fait qu'elle n'ait pas
ralis son projet, la lchet rside plutt dans l'acte mme du suicide. Il se produit
dans une crise de colre, chez une personne dcourage. Le facteur qui l'en a
empche, est la situation relativement favorable de sa famille. Les parents taient de
pauvres gens, cela elle le savait, elle savait aussi que de toute faon on lui
pardonnerait. Le chemin de la maison paternelle lui tait rest ouvert, elle y trouverait
une espce d'apprciation. Nous aurions donc pu dire la mre : promenez-vous
autour de la maison, c'est l que vous retrouverez la jeune fille. Car elle devait suivre
ce chemin. La mre la rencontra en effet un jour et la ramena la maison. Elle eut
alors recours une consultation psychopdagogique. Il faut donner l'occasion de se
faire valoir cette fillette si assoiffe d'apprciation. Il faut savoir quel est son
meilleur entranement en vue d'une activit utile; or, pour elle, c'est l'cole. La
psychologie individuelle dclare - si pareille enfant reoit l'impression d'un manque
d'affection, elle dveloppe un fort sentiment d'infriorit, avec toutes les suites d'une
prparation insuffisante pour la socit. Elle perd tout intrt pour sa famille et on
constate facilement son manque de courage. Si elle n'avait pas un lourd sentiment
d'infriorit elle se serait dit : l'instituteur ne me comprend pas, peut-tre dois-je faire
de plus grands efforts. Mais elle maintenait l'ide de se faire apprcier tout prix.
Ceci semble lui avoir russi par ses aventures amoureuses.
Je voudrais ici insister sur la question de la pubert. On la considre comme la
psychologie des possds. Tous les malheurs sont attribus aux glandes gnitales.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 66
C'est un argument ridicule. Ces glandes agissent depuis le jour de la naissance et
mme avant. La pubert se caractrise par d'autres facteurs : plus de libert, plus de
possibilits et plus d'attirance de la part des jeunes filles pour le sexe oppos. Les
enfants sont puissamment stimuls par le fait qu'ils veulent prouver qu'ils ne sont plus
des enfants. A l'occasion de ces preuves ils dpassent le plus souvent leur but.
L'enfant dsire tre remarque en tant que fille et croit ne pas pouvoir trouver
d'apprciation ailleurs que dans ce domaine. La pubert n'est pas un tat morbide, elle
ne fait qu'extrioriser ce qui se trouvait dans le style de vie; rien ne change, la fillette
reste ce qu'elle tait. Si elle devait changer nous ne pourrions rien prdire. Elle a
simplement renonc un chemin qui lui paraissait barr, rien d'autre ne s'est pass. Il
est important de signaler que les facteurs qui induisent les gens en erreur ne sont pas
des faits rels mais rsultent simplement de la manire errone dont ils les compren-
nent. Tous ceux qui croient que la vie psychique humaine est base sur la causalit se
trompent. La jeune fille donne une valeur de causalit un facteur objectivement
neutre. Tout coup, l'affection refuse devient cause; si elle gurit, ce manque
d'affection n'est plus une cause. Elle ne se contente pas seulement d'lever l'affection
refuse au rang d'une cause, elle lui donne aussi des suites qu'elle produit elle-mme.
Il n'est pas absolument indispensable que, n'ayant pas trouv d'affection chez son
instituteur, elle soit oblige de la chercher ailleurs. C'est l son erreur. Nous avons
raison lorsque nous refusons de croire l'effet d'une tendance inne.
Nous comptons avec les erreurs de la vie psychique humaine. Ce ne sont pas les
faits qui agissent, mais l'opinion que nous nous en faisons. La psychologie
individuelle a fait ce pas dcisif qui consiste rechercher les possibilits d'erreur et
les rduire un minimum par le traitement. Les conclusions de deux tres peuvent
tre fondamentalement diffrentes. Il ne faut pas oublier que ces ralits sont mal
comprises et mal interprtes par la majorit des gens.
Il faut donner cette jeune fille la possibilit de prouver qu'elle est capable d'arri-
ver ce qui lui paraissait interdit, savoir, devenir une bonne lve. L apparaissent
de nouveau d'autres difficults : avec de tels antcdents se, voir exclue de l'cole!
Ceci semble signifier de la part de l'instituteur qu'il n'est pas capable lui-mme de
rsoudre le problme de cette lve. Les consultations psychopdagogiques ont
apport une aide. Dans les coles qui disposent d'une consultation psychopda-
gogique, on n'exclut pas les lves, il n'y a mme pas de redoublants. Si pareil cas se
prsente et si nous ne sommes pas capables de conserver cette lve alors il faut se
demander ce qu'il y a faire. Je ne vois pas pourquoi cette enfant constituerait une
menace pour une autre cole. Il ne faut pas oublier quel pesant fardeau reprsente
pour elle le stigmate de l'exclusion. Peut-tre serait-il plus simple de consulter
quelqu'un de comptent. Peut-tre pourrait-on la confier un instituteur qui sache ce
qu'il doit faire avec cette enfant. Il faut tout mettre en uvre pour lui rendre son
succs pass l'cole : ce moment le mal de la pubert disparatra.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 67
Chapitre VI
L'enfant unique
Retour la table des matires
L'institutrice : L'enfant frquente la quatrime classe. Classe mixte. J'ai cet enfant
depuis deux ans. La premire et la seconde anne il a chang d'instituteur. C'est un
enfant unique. Le pre et la mre travaillent, l'enfant est chez la grand-mre et ne lui
obit pas. Il fait ce qu'il veut : il entend mal; il a une bonne mmoire des chiffres,
prsente un certain sens critique. Son criture est horrible.
L'anne dernire cet enfant tait trs bavard, trs dsordonn et incommodait les
autres filles et garons. Les exhortations bienveillantes et les punitions le laissaient
indiffrent; si on insistait, il pleurait, promettait de s'amliorer, et, peu aprs, il tait
nouveau le mme.
Cette anne, c'est la mme chose. Il utilise son encrier comme crachoir, il casse
tous les couvercles d'encrier. J'ai essay la bont et la svrit. J'ai fait semblant de ne
pas le remarquer et de ne pas tenir compte de ses tours. Rien n'y faisait. Il essaye
toujours de se faire remarquer d'une faon quelconque. Les enfants mirent de l'argent
de ct, l'cole, pour une grande excursion collective. Lui apporta seulement 2
francs. Pendant la rcration, les enfants racontrent que K. avait 16 francs. Je lui
demandai de me donner l'argent en m'inquitant de sa provenance. Voici sa rponse :
c'est de ma cagnotte . J'ai dit l'enfant que sa mre pourrait toucher cet argent la
direction, car, comme il tait dsordonn, il valait mieux qu'il ne risqut pas de le
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 68
perdre sur le chemin du retour. La mre ne se prsenta pas. Je savais trs bien que
l'enfant n'avait rien dit la maison, car ses parents sont des gens trs gentils et trs
convenables et ils prennent souvent des renseignements l'cole. Finalement je
convoquai officiellement la mre. Celle-ci en tait stupfaite et elle se souvint qu'
plusieurs reprises des petites sommes avaient disparu de chez elle. Elle raconta aussi
que l'enfant mentait souvent la maison.
J'ai observ maintes fois que si, l'cole, on lui dmontre ses mensonges il lui
arrive de jeter sur vous un regard si vide qu'on a l'impression de se trouver en face
d'un enfant prsentant un dfaut mental.
L'enfant put voir sa mre pleurer la direction. Il fut admonest avec bienveil-
lance. Puis il retourna dans sa classe o il fit des btises et amusa tous les lves. La
mre tait effraye et soutenait que son mari tuerait l'enfant. Nous lui conseillons de
ne rien dire pour le moment au mari. Le lendemain le pre se prsenta; la mre lui
avait tout racont et il n'avait pas corrig l'enfant.
Ce dernier rejetait la responsabilit sur un garon plus g qui l'aurait incit
voler. Ce garon ne frquente pas l'cole publique, il parat qu'il frquente un cours
priv.
Dr A : Nous entendons nous-mmes les diffrents passages et c'est partout et
toujours la mme mlodie. Le garon est dsordonn; probablement y a-t-il toujours
une personne derrire lui qui met de l'ordre. A l'cole il travaille lentement. Il prsen-
te le style de vie d'un enfant gt. D'autres traits l'indiquent galement. Il faudrait
disposer d'une personne qui s'occupt de lui l'cole. Il voudrait toujours se faire
remarquer. Il serait utile de savoir quel moment il a surtout prsent son dfaut
(vol). Il ne faut pas improviser.
Depuis deux ans la mre a quitt la maison. L'enfant se trouve chez sa grand-mre
et semble en tre mcontent. Il se sent comme frustr; il manque de beaucoup de
choses que sa mre lui offrait. Nous voyons chez lui le trait de caractre de quelqu'un
qui veut s'enrichir. Le vol est une compensation pour remplacer ce qu'il a perdu. Il
faut tenir compte du fait, expos par le garon lui-mme, qu'il a t dtourn par un
autre garon plus g. Il n'y a pas de dlinquant ou de criminel. qui n'essaye de
s'excuser, qui ne cherche une justification pour faire apparatre son mfait sous une
lumire plus douce. Ceci nous dmontre que le garon sait trs bien qu'il s'est loign
du chemin de la socit, du sentiment social. Il a vol parce qu'il voulait paratre plus
grand. Il n'a pas trouv d'autre voie. Il tait habitu sa mre et il arrive dans une
situation plus difficile. La grand-mre n'a pas vis--vis de lui la mme attitude que sa
mre. Elle est plus dure qu'elle. Il lutte avec cette vieille femme. Une tension hostile
parat entre eux. Un tel enfant, qui a l'habitude de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, s'y
sent comme dans un pige. Son style de vie est dj fix et il cherche toujours un tre
qui paraisse s'occuper de lui. Or cela il ne l'a plus. C'est partir de ce moment, je
pense, qu'il commena voler. Qu'est-ce qui aurait pu empcher cet enfant de voler?
C'est le fait d'occuper une place honorable l'cole. Cela est particulirement difficile
chez des enfants gts. Si pareil enfant se propose de tout obtenir comme chez sa
mre, il agit d'une faon intelligente et il n'est pas faible d'esprit.
Vis--vis de son instituteur, il est dshonor. Il a l'habitude de grandir dans un
climat de chaude sympathie. On est arriv calmer le pre et le garon croit que, par
l, tout est rentr dans l'ordre. Il rpondra chaque privation et chaque frustration
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 69
par une nouvelle tentative de s'enrichir. Je ne crois pas que ce garon ait commenc
ses vols depuis deux ans. Ceci doit remonter plus loin dans son pass. Qu'a-t-il fait
avec ses sous mystrieux? Je crois qu'il s'est achet quelques sucreries. (L'institu-
trice : il s'est achet un saucisson.) Comment lui vient cette ide qu'un autre lui aurait
donn l'impulsion? Comment pourrait-il savoir qu'un garon plus g peut dtourner
quelqu'un? On devrait demander la mre si elle ne l'a pas mis en garde en lui disant
: ne frquente pas ce garon, il pourrait te dvoyer . Ou peut-tre y a-t-il vraiment
un garon plus g qui a su le gagner. S'il avait l'argent depuis quelque temps sur lui,
il faut croire qu'il avait un autre but. Peut-tre voulait-il se crer un appui, un fonds. Il
nous faut parler de cette question avec la mre. Nous devons galement connatre
d'autres manifestations, manifestations que nous remarquons principalement chez les
enfants gts. Il est peut-tre craintif, il ne veut pas rester seul, ainsi pouvons-nous
comprendre qu'il se joigne un garon plus g. Ce n'est pas forcment cela mais
nous pouvons tirer nos conclusions. Peut-tre crie-t-il aussi la nuit. La mre pourrait
confirmer ou infirmer ceci, elle pourrait aussi nous dire si l'enfant manifestait dj
antrieurement cette tendance s'approprier des choses. Il nous faudrait dire aussi
qu'il n'a pas beaucoup d'intrt pour les autres et que sa manire de les frquenter
n'est pas la bonne. Il est incapable de se faire des amis -s'il joue avec d'autres il veut
toujours avoir le premier rle -, il prsente une tendance frquenter des enfants plus
jeunes ou plus gs que lui. Chez les enfants uniques on trouve frquemment une
prdilection pour des personnes plus ges, car ces enfants ont toujours vcu dans un
milieu de gens plus gs. Il faut nous mettre d'accord sur la faon d'influencer la
mre. Nous devons aussi faire avancer le garon l'cole et stimuler son courage. Il
faut qu'il ait l'espoir de pouvoir y jouer un rle, de s'y faire remarquer. Je vous
conseille de vous exercer dans l'examen de ce que j'appelle le rayon d'action. Chez les
enfants difficiles ce dernier est toujours rduit. Pareil enfant n'a pas un grand cercle
d'action. Il faut essayer d'largir ce rayon; or cela n'est possible que si nous lui
donnons beaucoup de courage et s'il croit que lui aussi peut se rendre utile. C'est l
que lui serait donne la possibilit de modifier totalement son rayon d'action. Dans le
cercle si troit o il se trouve actuellement il ne lui reste rien d'autre faire que de
s'enrichir en secret et d'empcher par le mensonge qu'il ne baisse dans sa propre
estime et dans son attitude.
L'institutrice : il n'est mauvais qu'en criture et en orthographe, mais pas ailleurs,
il est aim l'cole, il n'est pas mis l'cart. Il n'est certainement pas dtest dans la
classe; il n'a jamais redoubl. C'est un lve lent, mais il apprend assez bien.
Dr A : Nous cherchons savoir pourquoi l'lve n'est pas content l'cole. Une
des causes principales doit tre le fait qu'il veut toujours se trouver au centre
d'attraction. Pareil enfant essaye d'y parvenir soit en faisant le clown, soit en traitant
les autres avec bienveillance. Dans les deux cas c'est leur propre personne qui est en
cause. Notre garon essaye d'une faon ruse d'obtenir tout ce qu'il veut. Il veut par
son charme obtenir tout ce qui lui parat dsirable et il s'y est entran depuis sa
premire enfance, en raison de l'attitude de sa mue qui l'a toujours gt.
Un instituteur : J'ai eu un lve qui a t jusqu'au vol. Je l'ai surpris en train de
voler 50 centimes un autre. Il dclara que les autres enfants avaient tout et que lui
ne possdait rien. Son pre, pauvre, ne lui donnait rien. Il aurait voulu aussi tout avoir
comme les autres enfants. Je lui ai donn 20 30 centimes Pour qu'il puisse s'acheter
quelque chose. Je l'ai fait plusieurs reprises et partir de ce moment je n'ai jamais
entendu dire que cet enfant ait vol.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 70
Dr A : Nous n'avons pas de rgles pour amliorer un enfant. Nos mesures agissent
sur chaque enfant diffremment. La mme mesure ne peut pas s'appliquer diffrents
cas. En plus de la possession des 20 ou 30 centimes cet enfant sent renatre en lui un
sentiment de solidarit qui le fortifie moralement. Je ne serais pas tonn si quelqu'un
me disait : je l'ai battu et partir de ce moment il n'a plus vol. Ces choses sont trop
compliques pour qu'on puisse en juger d'un seul trait. Ce que nous essayons avant
tout, c'est de comprendre l'enfant. Notre enfant vit dans l'ide qu'il a un droit sur tout
et ceci immdiatement et sans effort. C'est l une erreur que nous essayons de lui
faire comprendre et par cette comprhension de la faire disparatre.
L'institutrice : La situation familiale de l'enfant est bonne.
Dr A : Trouvez-vous gnralement dans votre cole des enfants plus pauvres dans
les classes plus lentes et des enfants de situation meilleure dans les classes o
l'enseignement est plus rapide?
L'institutrice rpond affirmativement.
Dr A : Si vous y regardez de prs vous ne trouverez pas un seul homme qui n'ait
vol quelque chose dans sa vie, des fruits, des sucreries, des bagatelles, etc. Dans mes
recherches j'ai rencontr cela d'une faon presque permanente.
Dr A : (aux parents) : Je voudrais parler ce garon. Il est possible de le librer de
ses dfauts. D'un certain point de vue il semble tre un enfant particulier. N'avez-vous
pas trouv qu'il avait besoin de tendresse? Il vous charge toujours de quelque chose
pour pouvoir rester avec vous. Il attend toujours que quelqu'un d'autre fasse quelque
chose pour lui. Prsente-t-il des difficults au moment des repas?
(La mre raconte qu'il faisait auparavant des difficults pour absorber sa nourri-
ture, mais que depuis l'anne dernire, il mange correctement).
Dr A : A-t-il t malade? A-t-il mouill son lit?
La mre : Il a toujours eu mauvaise mine, il a toujours souffert de l'estomac.
Dr A : tait-il craintif? Ne voulait-il pas rester seul? A-t-il frquent le jardin
d'enfants? Quel rle joue-t-il ? A-t-il des amis?
Le pre : Nous n'en savons rien. Il n'tait pas craintif. Mais il pose des questions
stupides. Il demande : Mre, qu'est-ce que ceci ou cela. Il sait pertinemment de quoi
il s'agit; il veut simplement agacer sa mre.
Dr A : Comment fait-il ses devoirs? Les fait-il seul ou a-t-il besoin d'aide?
Le pre : Si quelqu'un est derrire lui, a marche merveilleusement bien. Il prfre
la socit des gens qui sont les plus gentils avec lui.
Dr A : Sait-il nager? A-t-il des rves angoissants? N'est-il pas supertitieux ?
Aime-t-il la gymnastique?
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 71
Le pre : Il a un norme respect pour la natation. Une fois, il a t effray et
depuis il ne veut plus nager. Il aime bien la gymnastique; l'anne dernire il en a fait
rgulirement.
Il n'a pas de rves angoissants et n'est pas anxieux. Il me craint un peu car je suis
trs nerveux.
Dr A : Soyez gentil pour lui et promenez-vous avec lui sans votre femme pour
qu'il puisse se lier d'amiti avec vous et fasse par amour et par amiti ce que vous
voulez, non pas par crainte.
Dr A : N'a-t-il des difficults que pour l'criture et l'orthographe? Avez-vous
examin s'il n'est pas gaucher? Peut-tre est-il n gaucher?
(Les parents ne savent pas s'il s'agit d'un gaucher. On constate que la mre est
gauchre.)
La mre se plaint encore que son fils se refuse trahir celui qui l'a incit voler et
qu'il ait indiqu un nom fictif.
Dr A : Il ne frquente pas d'autres enfants? Comment fait-il pour s'habiller, faire
sa toilette et se peigner?
Le pre : Il a eu un ami qu'il frquentait antrieurement mais celui-ci est mort.
La mre : Lorsqu'il s'habille, il faut que je le rappelle sans cesse l'ordre jusqu'
ce qu'il soit prt.
Dr A : On n'a pas besoin de le rappeler l'ordre, il s'agit surtout de le rendre
indpendant bien lentement et bien gentiment. Si vous le dsirez, je veux bien essayer
de l'influencer. Va-t-il volontiers l'cole? Dit-il ce qu'il veut faire plus tard? Est-il
vaniteux? Quelle est sa position lorsqu'il est couch? Ronge-t-il ses ongles? Met-il
ses doigts dans son nez?
(Les parents racontent qu'il est excessivement vaniteux, qu'il voudrait devenir
menuisier, qu'autrefois il rongeait ses ongles, que par ailleurs ils n'ont rien remarqu
de particulier chez lui. Il va volontiers l'cole.)
Dr A : Rendez-le plus indpendant pour qu'il prouve encore davantage d'intrt
pour l'cole et puisse s'y faire une certaine place. Cela le dtournera de pareils faux-
pas. Ne le menacez pas, et ne lui parlez plus de cette affaire. Il est trs intressant de
constater que ce garon, qui a tant souffert de l'estomac, s'achte des choses comme
du saucisson. Ne lui faites plus de reproches et essayez de le rendre indpendant.
Dr A : Nous n'avons pas l'image pure d'un enfant gt, la puret de cette image est
brouille par le fait que le garon a t dress en vue de la libert. Il y a une grande
diffrence entre un enfant qui est constamment surveill et celui qui est habitu tre
seul.
(Entre-temps le garon est entr et le docteur Adler s'adresse lui) - Que veux-tu
faire plus tard?
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 72
L'enfant : Je veux devenir menuisier.
Dr A : Que veux-tu faire lorsque tu seras menuisier?
L'enfant : Raboter.
Dr A : Combien d'amis as-tu?
L'enfant : Trois.
Dr A : Que font-ils donc?
L'enfant : Ils volent.
Dr A : Je leur dirais : Que deviendrez-vous en agissant ainsi? Les suis-tu
volontiers?
L'enfant : Non.
Dr A : Pourquoi obis-tu ces garons? Il me semble que tu croyais que personne
ne remarquerait ton vol et que tu pourrais acheter quelque chose ainsi. As-tu peur? Tu
es courageux, il faut aussi que tu aies du courage l'cole. Tu es dj un grand
garon, il faut que tu fasses tout toi-mme; tu sais t'habiller tout seul. Et te laver, le
fais-tu aussi, ou faut-il que ta mre t'aide? Tu veux lui donner un surcrot de travail.
Or tu sais dj faire tout toi-mme, n'attends donc pas que ta mre t'aide. Comment
va l'criture? Fais un effort supplmentaire et a ira mieux.
(L'enfant est galement gaucher.)
Ne crois pas que l'on ait pu t'entraner pour voler, c'est une btise. Il ne faut pas se
laisser entraner. Reviens dans un mois et tu me raconteras alors si tu fais tout par toi-
mme, si tu t'exerces dans l'criture et si tu te laisses entraner. (On prend cong de
l'enfant.) Les enfants gauchers ont l'impression de n'tre pas capables de rsoudre les
problmes comme les autres. lis s'efforcent de travailler de la main droite et lorsqu'ils
voient que cela ne va pas, alors ils s'imaginent que chez eux cela ira toujours de
travers. Il est possible de diagnostiquer l'enfant gaucher d'aprs beaucoup de signes.
Lorsqu'un enfant a des difficults pour lire, crire, etc., il faut penser qu'il s'agit peut-
tre d'un gaucher. Dans la majorit des cas la moiti gauche de la face est mieux
dveloppe que la droite. Un grand nombre de gauchers prsentent des difficults,
beaucoup d'entre eux renoncent progresser; ils garderont toute leur vie une
mauvaise criture. D'autres, par contre, s'y appliquent particulirement et arrivent
avoir une trs belle criture comme le droitier. Ce sont ceux qui ont surmont leur
infriorit et qui, d'une faon gnrale, ont acquis une grande aptitude triompher des
difficults; ils deviennent artistes, etc. - Si vous voyez une trs belle criture que
quelqu'un a acquise avec sa main droite, il faut se souvenir qu'il est peut-tre gaucher.
Dans la ville vous avez peut-tre 35 50 % de gauchers. Ils ne le savent peut-tre pas
mais ils en subissent les consquences. Vous trouverez un trs grand nombre
d'enfants gauchers parmi les meilleurs et les plus mauvais des hommes, chez les
natures problmatiques - commencer par les artistes - jusqu'aux enfants difficiles.
Dans notre cas le garon est maladif, gt par la mre, rudoy par le pre, ce qui
le pousse encore davantage se rfugier auprs de sa mre. Le pre devrait s'entendre
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 73
avec elle en ce qui concerne l'ducation du garon. Dernirement apparat une
nouvelle situation pour laquelle il n'est pas prpar. Il arrive chez sa grand-mre avec
qui il ne peut pas s'entendre. Elle dsire avoir sa tranquillit. A l'cole il avance bien,
pourtant il s'enfuit. Il y avance parce qu'il peut y avancer. Il cherche une compen-
sation : il gne l'enseignement et amuse les enfants. Cela ne lui suffit pas, il a le dsir
de voler. Admettons qu'il se soit laiss entraner. Ceci faisait son affaire. Il ne s'est
pas laiss entraner pour exercer son criture. Il a l'impression qu'on ne le traite plus
d'une faon aussi chaleureuse que celle laquelle il a t habitu jadis. Peut-tre est-il
maintenant dans une situation plus favorable, mais il n'est pas en possession de son
courage. Peut-tre n'a-t-il pas t accueilli antrieurement l'cole d'une faon aussi
aimable qu'aujourd'hui. Il faudra se demander si cet enfant n'a pas besoin d'encou-
ragement. Il ne faut pas le presser, il faut attendre et lui accorder un sursis. Il faudra
peut-tre lui dire : Je vois que tout ira bien! Je constate que tu seras de nouveau
parmi les meilleurs lves. Il a toujours dsir que l'institutrice s'occupt de lui. S'il
se conduit encore une fois d'une faon insolite, je lui dirai : Ce n'est mme pas la
peine, nous nous occupons tous de toi. Pareille remarque pourrait peut-tre l'im-
pressionner. Comment la prononcer dpend de l'individualit de chacun. Je le ferais
peut-tre d'une faon humoristique.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 74
Chapitre VII
Le benjamin dcourag
Retour la table des matires
mile est g de 14 ans.
C'est l'ge de la pubert. Nous savons que ce problme a t envisag de diff-
rentes faons selon les auteurs. Certains ont pu supposer qu' cette poque l'enfant
tait comme possd par le diable, ou encore intoxiqu par quelque poison interne. Or
nous savons maintenant que rien ne saurait se manifester sans avoir auparavant
prexist sous une forme latente. Le facteur capital est qu'au moment de la pubert,
l'enfant a tendance dmontrer qu'il est un adulte et non plus un enfant. Si je
m'efforce de prouver que je ne suis plus un enfant, j'irai toujours trop loin, je ferai des
mouvements exagrs et j'essaierai, par tous les moyens, d'imiter les adultes dans
toutes leurs manifestations. La supposition des psychologues (qui ne sont pas des
mdecins), selon laquelle les glandes gnitales ne se dveloppent qu' partir de la
pubert, est rejeter.
C'est le benjamin de cinq autres enfants gs de 26 17 ans. A l'cole primaire
il tait toujours parmi les premiers, mais, depuis son entre au lyce, il prsente un
relchement et il risque d'tre exclu de l'cole.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 75
Les efforts du benjamin tant qu'il se trouve dans une situation agrable sont
victorieux, mais si la situation vient changer nous nous apercevrons qu'il n'a pas t
suffisamment prpar. Il ne peut s'adapter qu' condition d'tre parmi les premiers.
Il a d redoubler sa classe et depuis il n'avance qu'avec beaucoup de diffi-
cults.
Les troubles ont sans doute commenc plus tt, savoir au dbut de son entre au
lyce. Il ne supporte pas cette nouvelle situation. Le lyce a ses exigences propres.
Les professeurs sont nouveaux, ne connaissent pas encore cet ancien pharaon et ne le
traitent pas avec suffisamment d'affection; il est offens et relgu l'arrire-plan. A
l'cole primaire sa situation tait facile, il tait bien vu, prsent il se heurte des
difficults et il n'avance plus.
Il dit que l'cole ne lui plat plus car il y prouve plus de peine que de joie.
Bien qu'exprim d'une autre manire cela signifie pour nous la mme chose : il ne
se sent l'aise que s'il a une certaine satisfaction et s'il peut tre le premier.
Le lyce lui parat particulirement dtestable depuis qu'un de ses anciens
camarades d'cole primaire qui n'y avait pas enregistr de succs particulier, a russi
ne pas redoubler la classe et, ce moment, l'a devanc d'une anne.
Le benjamin ne supporte pas qu'un autre le devance. Il a parcouru un long chemin
jusqu' ce qu'il ait dpass les autres et il a lutt avec beaucoup de difficults.
Il se plaint du mauvais traitement qu'on lui fait subir l'cole, il rejette la
majeure partie de cette faute sur son instituteur qui, parat-il, lui rend la vie pnible
par sa mchancet.
Il suffit donc de ne pas le gter pour qu'il montre aussitt sa mauvaise humeur.
La mre nous dit qu' partir de son entre au lyce il a chang en tout point,
son dsavantage.
La question primordiale que nous posons souvent est la suivante : dans quelles
situations a-t-il donn lieu des plaintes, et quels moments ses dfauts se sont-ils
manifests? Le lyce peut tre considr comme un test. Le fait que, depuis son
entre au lyce, il est transform, est un indice qu'il n'a pas t bien prpar pour cette
situation. La deuxime question est la suivante : comment se fait-il que ce garon
prsente une prparation insuffisante? Nous le savons, il est le benjamin et ce dernier
est gnralement gt. Nous devrons donc, dans notre examen, chercher confirmer
qu'il s'agit effectivement d'un enfant gt.
Il est nerveux et irritable...
Comme quelqu'un qui se sent gn et dans une situation qui l'accable.
... trs excit et n'obissant gnralement pas.
Nous comprenons pourquoi sa conduite est si mauvaise la maison. Aussi long-
temps qu'un individu connatra un succs quelconque et enregistrera des russites,
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 76
cela se rpercutera dans d'autres domaines galement. Si ce garon russissait
l'cole, on le remarquerait aussi la maison. Nous pouvons comparer sa conduite
celle de l'employ subalterne qui prouve des contrarits dans son service, o il se
trouve expos des injures et des critiques et qui ensuite rentre chez lui o,
gnralement, il se querelle avec sa femme et ses enfants. L'enfant voudrait occuper,
au moins chez lui, la position la plus leve. C'est ce qu'exprime le fait qu'il n'obit
pas.
D'aprs les renseignements de la mre il est bon, il sait gagner son entourage par
son amabilit et sa tendresse.
Vous trouverez frquemment des enfants gts trs habiles gagner les autres et
s'attirer leur affection. On a souvent l'impression d'une amabilit particulire de leur
part.
Il fait tout pour sa mre lorsqu'il voit qu'elle pleure ou qu'elle souffre.
tant dispensateur de tendresse, il a dj atteint son but, savoir tyranniser sa
mre et la dominer. Dsormais il peut dmontrer sa tendresse. C'est encore agir d'une
faon intelligente. S'il se conduisait durement, on le mettrait peut-tre en pension
pour ne pas avoir souffrir de cette duret, mais cela s'ajoutant son mauvais rende-
ment scolaire, il perdrait la partie. Nous voyons que ce garon a encore un certain
espoir, sinon il ne montrerait pas sa bont et ses sentiments. Il faut bien qu'il pense
garder la faveur de sa mre et trouver une aide auprs d'elle. Nous ne considrerons
pas sa bont comme une vertu mais comme un subterfuge russi pour ne pas tendre
les cordes l'excs.
Le pre ne se trouve plus au domicile depuis trois ans.
C'est peut-tre cette circonstance qui a amen le changement dans son attitude
scolaire. Le dpart du pre a pu concider avec la priode prparatoire de son entre
au lyce et ce dpart a d l'impressionner profondment. Peut-tre aurait-il voulu
partir avec son pre, peut-tre aussi est-ce l que commence la nouvelle situation, le
pre qu'il aime (quoiqu'il reprsentt alors, lui aussi, une barrire pour l'enfant) est
dsormais absent ; il voudrait donc jouer au grand Monsieur .
D'aprs l'opinion de la mre, il manque une main ferme.
Cela constitue un renseignement prcieux quant au style de vie de la mre : elle
vit dans la conviction que, dans sa situation, une femme est beaucoup trop faible et
que seul un homme pourrait arriver un rsultat. Si je me permettais ici de soutenir
que la mre exprime non seulement par l son sentiment d'infriorit, mais encore
qu'elle sous-entend : Je suis trop faible, je ne russirais pas , beaucoup ne le com-
prendraient pas partir de cette seule rflexion il manque une main ferme pour le
garon . Elle ne peut rien faire d'autre que montrer sa souffrance.
Elle soutient ne pas pouvoir venir bout de ce garon.
Depuis six mois il dort dans la chambre de sa mre.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 77
Peut-tre est-ce un rsultat acquis par lui, peut-tre au contraire la mre avait-elle
besoin de sa prsence. De toute faon ceci dmontre une attache puissante mais
excessive si nous considrons que ce garon a dj 14 ans.
Il faut toujours insister pour qu'il se mette table.
Un des indices habituels chez les enfants gts est qu'ils font des difficults pour
absorber leur nourriture.
D'une faon gnrale il ne suit pas les conseils qu'on lui donne. Il reste souvent
au lit jusqu' neuf heures et il arrive en retard l'cole.
La raison en est qu'il se trouve une grande distance de l'cole. Si un enfant
arrive en retard l'cole c'est l'indice que ses rapports avec elle sont loin d'tre bons.
Dans ce cas il ne prend pas son petit djeuner et il rapporte souvent son goter
la maison.
Voil le point sensible de la mre, et l'enfant, qui l'a dtect trs exactement, la
torture par son attitude. La mre a trop insist sur l'importance de la nourriture, elle
l'a surestime, montrant elle-mme son point faible l'enfant qui dsormais la
tient .
D'aprs la mre il ne ment pas souvent et rarement en matire d'argent.
La mre n'exprime pas l une opinion trs nette, car il s'agit tout de mme de
mensonges.
Son ambition semble s'exprimer dans d'autres domaines.
Ici se confirme ce que je pensais trouver dans un passage antrieur. Il voudrait
tre le premier quelque part ; il n'en abandonne pas l'espoir et cherche le moyen d'y
arriver.
Il est premier soliste dans la chorale d'un grand Temple.
Nous constatons ainsi qu'il est arriv tre le premier. Maintenant se pose la
question : pourquoi ne s'en contente-t-il pas? (Notons qu'il a un frre excellent
chanteur qui se produit dans des concerts.) Il est probable qu'avoir russi tre
premier soliste dans la chorale d'un Temple ne lui suffit pas. Son ambition n'est pas
suffisamment satisfaite. Peut-tre voudrait-il arriver encore plus haut. Il faudrait lui
donner une chance dans d'autres domaines galement. Peut-tre alors se conduirait-il
correctement l'cole dans ces conditions. Il n'a pas perdu tout espoir, il n'abandonne
pas la course. Mais quoi ne pourrions-nous pas nous attendre de la part de ce gar-
on, s'il perdait compltement courage? Il pourrait commettre un crime ou sombrer
dans la nvrose. Si nous voulons approfondir cette question en nous servant des
renseignements dont nous disposons jusqu' prsent, nous nous trouverons dans une
situation relativement difficile. Nous ne voyons aucun autre signe, nous permettant de
supposer que ce jeune homme prsente quelque hsitation. Nous ne trouvons pas qu'il
soit agressif, il est donc plus vraisemblable qu'il deviendra un nvros. S'il tait plus
actif, s'il prsentait par surcrot une tendance nuire aux autres, avancer d'une faon
plus agressive, nous pourrions supposer qu'il pourra embrasser une carrire
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 78
criminelle. Le fait qu'il mente sur des questions d'argent ne nous renseigne pas suffi-
samment. Il faut plutt prsumer qu'il pourra devenir nvros, s'il perd son espoir.
Depuis quelque temps il s'intresse surtout la bicyclette.
Le benjamin! Le fait qu'il sait bien rouler bicyclette pourrait donner penser
qu'il participera peut-tre des courses cyclistes plus tard.
Son plus grand dsir actuel est d'en possder une. D'aprs les renseignements de
la mre, il est dpensier.
Si cela se confirmait on pourrait y trouver une possibilit d'interprtation et penser
que ce garon serait capable de commettre des vols s'il venait perdre tout espoir.
Il dispose d'une somme d'argent assez importante.
Cette remarque est probablement exagre.
Il a quelques amis appartenant une autre cole, mais ils ne plaisent pas sa
mre.
Il est intressant de constater qu'il ne cherche pas ses amis l o il subit ses
checs, mais qu'il cherche plutt ceux d'une poque o il tait encore en plein clat.
Il se trouva heureux pendant un sjour chez son pre, en Angleterre.
L sa conduite a certainement t des plus aimables et polies car il se trouvait
dans une situation agrable et le fardeau de l'cole ne pesait plus sur lui.
Probablement parce qu'il tait dispens de frquenter l'cole.
Depuis un certain temps il serait moins dsordonn.
(Traitement du Dr V.)
C'est le signe de l'enfant gt.
Une enqute l'cole nous indique que la famille tout entire est probablement
responsable du nglig de cet enfant.
Ils restent tous au lit jusqu' midi.
Je voudrais vous faire part d'une observation qui me parait trs importante. A
notre poque o la ncessit du travail intense du pre et, dans la plupart des cas, de
la mre elle-mme, offre trop peu d'occasions de resserrer les liens familiaux, il me
semble particulirement important, pour la vie ultrieure de l'enfant, que toute la
famille se trouve runie le matin sept heures, pour le petit djeuner (compte tenu de
nos conditions scolaires). Vous trouverez que l o ceci n'est pas ralis, de
nombreux ennuis surgissent dans la famille. Il manquera la base d'une vritable
ducation sociale des enfants qui, ds leur plus jeune ge, n'auront pas t habitus
se runir autour de la table familiale. C'est cette place que l'on devrait entretenir la
bonne humeur et la gaiet, changer des ides, discuter ouvertement, mais non sur
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 79
des sujets critiquables ou sur les mauvais rendements scolaires, etc. Il faut remettre
cela pour un autre moment. Vous ne sauriez assez apprcier l'avantage d'avoir la
famille runie pour le petit djeuner, sept heures. J'insiste sur ce conseil depuis
vingt ans. La rponse est souvent un sourire incrdule, beaucoup s'y refusent. Je peux
pourtant constater que je n'ai trouv certains dfauts que l o cette habitude n'avait
pas t tablie. Il est tout fait naturel que celui qui reste toute la matine au lit ne
puisse pas s'endormir le soir ; la fatigue naturelle ne se manifeste pas ce moment-l.
Lorsque nous entendons des plaintes au sujet des enfants qui, le soir, fuient leur
maison pour passer leur temps au bistrot ou au cinma, nous pouvons imputer cela
la circonstance indique ci-dessus. Par ce moyen, si simple et si facile raliser, on
pourrait prvenir bien des maux.
D'aprs les renseignements de l'instituteur, toute la famille ment et il semble
indiqu d'accueillir les renseignements avec une certaine mfiance, car la mre ne
semble pas dire la vrit, par fanfaronnade...
Si nous tenons compte de ce qui prcde nous ne trouvons pas grand-chose de la
fanfaronnade de la mre. C'est un fait incontestable que le garon est intelligent et a
une belle voix ; cela reprsente probablement beaucoup aux yeux de la mre, mais je
ne chercherais pas y voir de la fanfaronnade.
Parce que tous les professeurs s'accordent pour trouver ce garon menteur,
inattentif, fainant et sournois.
Cela est dur. Admettons-en l'exactitude, ce n'en est pas moins une critique svre.
Le garon semble voir, dans tous ses professeurs des ennemis. Ces particularits sont
des manifestations hostiles correspondant une lutte permanente.
Mais ils sont tous convaincus que ce garon n'est pas sot qu'il pourrait satisfaire
aux exigences de l'cole, s'il se trouvait dans de meilleures conditions ; actuellement
il n'y satisfait pas.
Lorsque ce garon, qui veut toujours se trouver en tte, aborde une situation diffi-
cile, il ne peut plus satisfaire aux exigences de l'cole. Nous trouverons ici les traits
de caractre du lutteur oppos une puissance suprieure.
Dans quatre matires seulement il se montre insuffisant : mathmatiques, his-
toire, gographie, religion.
Il est surprenant qu'il ne russisse pas en matire de religion, mais peut-tre
s'entend-il mai avec le professeur qui l'enseigne, Il est intressant de constater quel
point il a baiss l'cole. En ce qui concerne les mathmatiques vous trouverez gn-
ralement que les enfants gts ont des difficults en cette matire. Il est possible aussi
qu'il soit l encore en lutte avec cet ducateur. Je ne peux m'expliquer les difficults
rencontres par cet enfant dans les mathmatiques que par le fait que, contrairement
aux autres matires, les mathmatiques se passent de toute rgle. Cette matire
dpourvue de toute rgle plane dans l'espace libre ; il faut arriver une conclusion par
sa propre force et par des combinaisons. Or c'est une chose dont sont incapables les
enfants gts, car ils voudraient s'appuyer sur quelque chose, avoir un soutien. Ce
soutien ils pourraient le trouver ventuellement dans les rgles d'une langue tran-
gre, mais non dans les mathmatiques, d'o les frquents checs de ces enfants en
cette matire.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 80
Il est probable que l'examen d'intelligence qui a t ralis dernirement confir-
mera ce rsultat.
L'examen d'intelligence rvle approximativement 1.
Nous sommes convaincus que ce garon est intelligent. Nous nous demandons
alors ce qu'il convient de faire. La thrapeutique dcoule automatiquement de ce qui a
t dit.
Il faudrait trouver quelqu'un qui pt gagner cet enfant. Quelqu'un qui pourrait
aussi l'encourager et accrotre son intrt pour ses camarades et les matires de
l'enseignement. Il pourrait parler ouvertement avec lui et lui rendre comprhensible
ce que le garon ressentait d'une manire obscure, dans son comportement. Aprs
cela le garon rduira sans doute au minimum son attitude errone. On pourrait aussi
attirer son attention sur le fait que des difficults existent et qu'il faut se montrer fort
en face de celles que l'on rencontre. Mais ne pourra russir que celui en qui le garon
aura confiance. Il est probable qu'un ami y russira mieux, car le garon estimera les
femmes aussi peu que sa propre mre et, d'autre part, nous savons qu'il se conduit vis-
-vis de son pre d'une faon tout fait diffrente, son attitude tant aggrave partir
du moment o ce dernier ne put plus s'occuper de lui. Son frre an devrait gagner sa
confiance, devrait comprendre toute la situation et ses corrlations. Il devrait, sans le
critiquer, lui proposer une nouvelle vie, l'oubli de tout le pass. Il devrait lui rendre
comprhensible son secret dsir de devenir un chanteur. Il devrait le convaincre qu'il
a perdu son intrt pour l'cole parce qu'il croyait ne pouvoir jouer un rle que
comme chanteur. Ce frre an devrait aussi demander aux professeurs un certain
rpit pour le garon, car, mme si le frre russit le redresser, le rsultat serait mau-
vais au cas o le garon recevrait une mauvaise note l'cole. Son mauvais rende-
ment actuel l'cole est mettre sur le compte du sentiment d'oppression qu'il y
prouve.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 81
Chapitre VIII
Faible d'esprit ou enfant difficile ?
Retour la table des matires
Il est extrmement important que nous nous fassions une ide par nous-mmes sur
le cas, avant d'avoir vu la mre ou l'enfant. Je vous exposerai l'histoire du cas en
question et vous verrez comment je m'efforce de tirer des conclusions du moindre
renseignement :
Lorsque, l'automne de 1925, B. arriva dans un jardin d'enfants, il tait l'enfant
le plus nglig et le plus arrir, physiquement comme intellectuellement, que l'on
puisse imaginer.
Nous pouvons en dduire que personne ne s'est occup de lui. C'est le propre du
dveloppement intellectuel ; il faut qu'un enfant se trouve obligatoirement en rapport
avec quelqu'un qui lui permettre d'exercer son esprit.
Il tait sous-aliment, mal soign, insuffisamment vtu et manquait de chaussu-
res quoique l'hiver ft dj trs avanc.
Il s'agit probablement d'un enfant issu d'une famille trs pauvre.
Il tait galement trs arrir intellectuellement et pouvait peine parier.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 82
Le dveloppement du langage de l'enfant ne peut se faire que dans le rapport
social. Si un enfant manque de ce rapport, son langage ne saurait se dvelopper.
Nous, devrons aussi nous demander si cet enfant n'est pas faible d'esprit. Ceci n'est
qu'une supposition et il faut continuer nos recherches avec prudence, car si nous
mettons un tel diagnostic, c'en est fini avec cet enfant. C'est une erreur impardon-
nable que d'appeler faible d'esprit un enfant qui ne l'est pas.
Lorsqu'on lui adressa la parole il se cacha et commena crier et se dbattre.
Si quelqu'un cherche se lier avec lui il s'en dfend. Il donne l'impression d'ap-
partenir au troisime type d'enfants, ceux que l'on n'a pas dsirs, les illgitimes ou
les infirmes. Vous voyez qu'il considre son entourage avec hostilit.
Il tait trs lche...
Il n'y a de courage dans un tre que l o il se sent chez lui.
Il attaqua les enfants tout en veillant ne pas l'tre par eux.
Il avait besoin d'aide au moment des repas et attendait toujours qu'on l'ali-
mentt.
Il faut accueillir ce renseignement avec rserve. Ce sont gnralement les enfants
gts qui prsentent des difficults pour absorber leur nourriture. Mais il est possible
qu'il s'attende mme ici une attitude hostile. On peut en effet prendre la peine de
donner manger un enfant qu'on n'aime pas pour en finir plus vite avec lui. Ainsi il
n'apprend pas manger.
Mais il refusa souvent la nourriture bien qu'ayant faim.
Cet enfant se conduit comme en territoire ennemi. Mais il faut examiner attenti-
vement s'il ne prsente pas des signes de faiblesse d'esprit.
Ce n'est qu'aprs une scne, dont l'entourage ne tint d'ailleurs aucun compte,
qu'il se calma et absorba avidement la nourriture.
C'est donc qu'il ne mangeait pas tellement mal.
C'est un enfant lgitime. Il a appris trs tard marcher et parler, mais jusqu'
prsent il n'a pas encore su s'exprimer correctement.
Nous comprenons ses difficults en ce qui concerne son langage. Quant la
marche il nous faut penser l des difficults organiques. Peut-tre sa dentition tait-
elle en retard. Ce dfaut fait partie du mme tableau de maladie.
Il occupa beaucoup son entourage...
Il ne peut commander que s'il trouve quelqu'un sa disposition, Remarque
tonnante. Son apparence nglige rsulte peut-tre du dsespoir des parents et sans
doute y avait-il, dans son entourage, une personne qui s'tait occupe de lui. Une
grand-mre peut-tre, une tante, une sur ane, dont il pouvait disposer dans une
certaine mesure. Dans ces conditions nous pourrons tirer notre conclusion et com-
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 83
prendre son attitude au jardin d'enfants. Si notre conception ne se confirme pas, nous
la modifierons -volontiers.
... et se rvolta contre lui la moindre occasion.
Il est probable que son entourage ne l'a pas trait avec beaucoup de duret.
S'opposer est un moyen de lutte et devant un entourage particulirement puissant, un
enfant ne se rvolte pas. Peut-tre tait-il auparavant dans un milieu o il tait entour
d'une certaine affection, ce qui ne fut plus le cas par la suite. Il faut nous en souvenir
pour pouvoir continuer nos recherches.
Il donnait des coups de pied, se roulait terre, hurlait et frappait tout ce qui
s'offrait lui.
Cette constatation vient encore renforcer l'hypothse d'un entourage qui aurait
chang au dtriment de l'enfant. Il est probable qu'il y a eu l changement de situa-
tion. Notre supposition se confirme : d'abord gt, il fut nglig ultrieurement, ce qui
l'a rendu sauvage et hostile.
Il mouille constamment son lit.
Il est probable qu'il veut occuper quelqu'un de sa personne et qu'il a tendance se
faire remarquer d'une faon dsagrable.
... et ronge ses ongles.
Chez les enfants ttus vous retrouvez cette habitude. On leur dit constamment de
ne pas ronger leurs ongles et c'est en persistant qu'ils dmontrent leur opposition.
Son avidit tait telle aux repas que parfois il drobe quelque chose aux autres
enfants, au goter.
Il n'a pas un grand sentiment social et ce fait se manifeste galement par ses
gestes.
Il tait trs rachitique et trs arrir intellectuellement.
Cela est une confirmation.
Il n'tait pas sociable, ne s'entendait avec personne.
Cela correspond aussi bien au type de l'enfant gt qu' celui de l'enfant dtest.
Il torturait btes et gens.
Pareille attitude, vous la retrouverez chez les deux types cits. Ils veulent dmon-
trer leur puissance.
Il crasait les mouches avec joie.
Vous voyez le fort en face du faible.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 84
Il voulait toujours tre le premier.
Notre opinion mise au dbut se confirme. Ses parents se trouvaient peut-tre
antrieurement dans une meilleure situation, et celle-ci a chang ; depuis il manque
d'amour et de la chaleur de l'affection.
Toujours proccup de commander, s'il n'y russissait pas, il frappait ses cama-
rades, renversait tables et chaises, se jetait sur le sol et n'coutait aucun conseil
bienveillant.
Ce sont les traits de caractre d'un enfant gt qui veut toujours se trouver au
centre de l'attention.
Maintenant il frquente volontiers le jardin d'enfants et s'efforce d'avoir toujours
sur lui le mouchoir dont je lui ai fait cadeau.
lu commence dj s'adapter, signe qui nous permet de conclure qu'il s'est dj li
avec la jardinire d'enfants. Nous voyons que celle-ci a su le gagner et recrer la
situation agrable dans laquelle il a t gt. Il se traduit lui-mme cette impression
: Te voil dans la situation agrable vers laquelle tu tends toujours. Dsormais son
intrt doit tre veill pour d'autres choses qui ne lui ont pas russi jusqu' prsent.
Il s'intresse ce qu'on lui montre ici. Il est heureux si on l'occupe beaucoup,
par exemple nourrir un oiseau, arroser des fleurs, balayer, aider les plus jeunes
mettre leurs chaussures, etc.
Notre supposition selon laquelle il pourrait s'agir d'un enfant faible d'esprit com-
mence tre branle. Il s'adapte probablement, se lie la jardinire d'enfants et agit
d'une faon sense. Le diagnostic de faiblesse d'esprit me semble insuffisamment
motiv et ne mrite pas d'tre retenu.
Sa situation familiale est on ne peut plus triste. Son pre est mort de la tuber-
culose, sa mre est ouvrire et ne se proccupe pas de son ducation.
O se trouve la personne qui l'a gt? Peut-tre tait-ce le pre avant sa mort?
Elle vend les affaires de l'enfant, ainsi le manteau d'hiver, les chaussures, etc.,
que nous lui avons donns et elle nous le renvoie couvert de haillons.
Reprsentez-vous la situation de cet enfant dtest, lev sans amour et sans
chaleur (presque au sens propre tant donn qu'elle vend son manteau d'hiver).
C'est le benjamin ; les autres sont des garons de dix, quinze et dix-neuf ans.
Voil qui nous permet de supposer que peut-tre, parmi ces enfants, l'un d'eux se
serait occup particulirement de lui. En ce qui concerne son dveloppement, nous
devons tenir compte de sa situation de benjamin. Si nous retenons le fait qu'il a t
gt, il est certain que, comme benjamin, il disposait d'une certaine puissance. Il a
trois chefs de file et il veut les imiter. Mais il ne veut pas que d'autres disposent de
plus de pouvoir et il voudrait se trouver au premier plan, tre en tte, tre plus que les
autres.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 85
Il pleure souvent mais seulement lorsqu'il manifeste son opposition ou lorsqu'il
est en colre.
Pleurer est une arme particulirement efficace. Si les enfants remarquent qu'ils ne
nous font aucune impression en pleurant, ils s'arrtent. Lui s'en sert pour se faire
valoir. Un couple sourd-muet avait un garon qui parlait et entendait bien. Lorsqu'il
se blessait, il pleurait, mais sans le moindre bruit. Les larmes coulaient sur ses joues
mais on n'entendait aucun son. Nous comprenons fort bien cela puisque le garon
savait que le bruit n'avait aucun effet sur ses parents. Nous trouvons toujours l'em-
preinte de l'entourage.
Ses jeux prfrs sont la gymnastique et la construction.
Cet enfant n'est probablement pas tellement maladroit, ni arrir.
Ses histoires prfres sont : Rumpelstilzchen et La belle au bois dor-
mant.
Chercher tirer des conclusions d'histoires de ce genre est une occupation fcon-
de. Dans la premire il est question d'une ruse djoue par une autre ruse. Le choix de
La belle au bois dormant nous parat plus comprhensible. Il aime sans doute
cette histoire parce qu'elle exprime en quelque sorte l'espoir de s'assurer un certain
succs par une bravoure particulire. Je crois que cette matire doit tre explore
fond dans le but d'tablir quels sont, dans ces histoires, les lments qui impression-
nent particulirement les enfants. Si nous connaissons bien notre garon nous
pourrons mieux comprendre pourquoi il a prfr ces deux contes.
Il rve souvent tard dans la journe.
Si je dois comprendre cela comme la construction, par l'enfant, de quelques rves
diurnes, ce mouvement nous rappelle la belle au bois dormant qui dort elle aussi.
Peut-tre trouverons-nous un fil conducteur susceptible de nous aider mieux
comprendre cet enfant.
Il y a quelque temps encore il s'endormit par faiblesse, ce qui laissa craindre
qu'un jour il ne se rveille pas.
Peut-tre cette faiblesse tait-elle en rapport avec l'ide de la belle au bois dor-
mant . Je peux imaginer que pareil enfant soit plus intress que d'autres par le
sommeil, lorsqu'il a t passionn par une histoire comme celle-l.
Apparemment cet enfant a t martyris.
La mre n'est probablement pas avare de coups.
Il se sent partout repouss et rclame l'attention des autres.
Ce trait ne se voit pas chez l'enfant martyris qui tourne le dos et essaye toujours
de s'esquiver. C'est l'enfant gt qui rclame toujours de l'attention.
Les louanges sont tout pour lui. Lorsqu'on lui dit : Allons B., tu es un brave
garon! ses yeux brillent et, pour un moment, tout va bien.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 86
C'est le caractre d'un enfant gt. Dans une telle situation, il se sent l'aise ; elle
est le but de sa vie, de ses tendances.
S'il a entrepris une occupation, il la mne jusqu'au bout. et si on le loue il ne
demande qu' la recommencer.
Voil le fil par lequel vous pouvez faire agir ce garon, Il travaille, d'abord parce
qu'il arrive dans la situation o on le loue et o on l'aime. Il faut utiliser cette situation
et continuer lui faire comprendre qu'il doit se rendre utile, cela en s'abstenant de
louanges immdiates. Il ne faut pas le louer immdiatement, il suffit de lui dire : si tu
le fais de telle et telle faon a sera trs bien.
Il se conduit comme un enfant de deux ans, fait le sot ou le bb pour qu'on
puisse le caresser et le gter.
Vous verrez souvent des enfants gts ou mme des adultes se conduire comme
des bbs en zzyant par exemple comme de petits enfants. Ils regrettent cette
ancienne situation et voudraient revenir cette poque o ils se sentaient aussi bien
qu'au Paradis. Il est probable qu'on a gt ce garon pendant sa maladie. Au cours de
celle-ci on constate des manifestations graves o on ne peut faire autrement que de
gter l'enfant. De l vient son besoin de se faire gter et ses tendances se faire louer
et aimer. Il vit de cette faon, sans le savoir et sans s'en rendre compte. On pourrait
donc tout obtenir par des explications.
Il parle trs mal. Il est bien conform, mais ses oreilles coulent de temps en
temps.
Il s'agit probablement d'une otite moyenne non encore gurie. S'il n'a pas t
profondment touch par cette maladie, il se pourrait qu'il prsentt une plus grande
sensibilit pour l'audition et la musique tant donn que son oue est probablement
plus fine que dans la moyenne des cas. Nous en avons une confirmation dans cette
srieuse maladie de sa premire enfance. Tous les enfants ne font pas d'otite moyen-
ne. Nous pourrons peut-tre lui rvler un nouveau domaine par cette preuve. On
pourrait le rapprocher de la socit par le moyen d'une chorale ou par la musique.
Il est en retard intellectuellement et se prsente comme un enfant de trois ans.
Le garon qui veut toujours jouer l'enfant de trois ans et donne l'impression de
manquer d'intelligence, alors qu'il a dj cinq ans, pourrait peut-tre laisser supposer
qu'il est faible d'esprit; mais il faut le soumettre des preuves srieuses avant de
conclure.
D'une faon gnrale il ne ragit que vis--vis de personnes auxquelles il est
habitu.
Trait de caractre d'un enfant gt.
Ses rendements positifs ne sont notables que dans le domaine physique, car c'est
la gymnastique normale ou rythmique qui est son occupation favorite, et l il arrive
des russites brillantes.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 87
Je ne me permets pas encore de conclure. Nous entendons rarement parler chez
les enfants faibles d'esprit de russite en gymnastique et en rythmique. Mais russir
un mouvement systmatique de gymnastique, arriver des russites brillantes nous
indique un don de la combinaison dont ne dispose pas un faible d'esprit.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 88
Chapitre IX
Une ambition qui se fourvoie
Retour la table des matires
L'institutrice nous expose le cas suivant :
M. est ge de neuf ans et frquente la quatrime classe. Elle est la plus jeune de
cinq enfants. Ses frres et surs sont respectivement gs de 25, 23, 15 et 14 ans.
L'ane, dj marie, a un enfant g de quelques semaines. En tant que benjamine,
jolie et agrable, M. fut particulirement gte par ses parents et par ses frres et
surs. Son ducation et sa surveillance furent confies avant tout ses frres et surs
car les parents travaillaient toute la journe. Le pre est employ dans une maison de
commerce et il est absent de la maison de sept heures du matin six heures du soir.
La mre est corsetire et elle est galement occupe toute la journe. A son entre
l'cole, l'enfant se fit remarquer dans sa classe d'une faon dsagrable par ses
bavardages, par sa vivacit exagre, son attitude arrogante, son insensibilit, ses
tendances se quereller et sa sauvagerie. L'institutrice de la premire classe la cite
souvent comme une enfant terrible , mais trs intelligente, et, selon son humeur,
tantt trs travailleuse, tantt trs paresseuse.
Moi qui connais l'enfant depuis la seconde classe, je ne peux pas parler de
fainantise. Au contraire, elle travaille d'une faon parfaite, est assez forte en rdac-
tion, son imagination est vive, elle s'exprime bien, rcite bien, prsente une belle
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 89
criture et insiste sur la propret, rsultat de sa coquetterie il faut bien le dire. Elle
aime beaucoup se faire admirer. Lorsqu'elle aura particulirement russi un devoir,
elle viendra certainement avant la classe me montrer son cahier et remarquera avec
fiert : Voil, c'est moi qui ai crit a. Elle se rjouit lorsqu'on la loue. Elle
s'attaque au travail d'une faon habile et courageuse, en gymnastique, elle est trs
bonne et pleine de bravoure. Elle a appris elle-mme aller bicyclette et nager;
elle dsire actuellement des patins pour apprendre, cette anne, le patinage. Telles
sont ses qualits.
Mais sa tendance la valorisation et particulirement forte, elle exige sans cesse
qu'on la remarque, chose impossible dans une collectivit de trente enfants. Elle gne
alors l'enseignement en coupant la parole aux autres, sans pouvoir se dominer,
quoiqu' plusieurs reprises elle ait t rprimande ce sujet. Elle ne peut pas
davantage matriser sa curiosit. Lorsque je signale une autre lve une faute dans
son cahier, elle quitte sa place pour prendre connaissance, elle aussi, de la faute de sa
compagne. Ce qui est interdit l'attire particulirement. L'anne dernire la directrice
s'opposa tout dguisement avant le mardi gras car les enfants de la premire classe,
voisine de celle-ci, auraient pu s'effrayer. Le lendemain, pendant la rcration, M. alla
aux W.-C. et quelques minutes plus tard se prcipita dans la classe, dguise en
diable, brandissant une verge, bousculant les enfants en hurlant. Je la rprimandai et
lui demandai si elle n'tait pas au courant de l'interdiction de se dguiser : je n'obtins
pas de rponse. Elle agit toujours de cette faon lorsqu'on l'interroge. Il est
remarquer qu'elle ne peut jamais regarder quelqu'un droit dans les yeux. Elle laisse
apparatre les signes d'une grande inquitude si, pendant le cours, je la regarde un
certain temps. Alors elle dtourne les yeux d'une faon gne, jetant par moments un
regard timide dans ma direction pour savoir si je la regarde encore. Disons en passant
qu'elle n'est pas malhonnte. La mre dit aussi que l'enfant ne ment jamais. Son
besoin de valorisation se manifesta d'une faon frappante par l'vnement suivant :
L'anne dernire l'inspectrice assista un cours de chant que suivait ma classe. A
plusieurs reprises dj, par mesure disciplinaire, M. avait t exclue de ce cours
cause de son bavardage et de ses ternelles interruptions. Cette fois-ci elle fut de
nouveau admise. N'ayant pas t soumise au mme entranement que les autres, elle
ne pouvait videmment pas briller. Mais, se trouver simplement dans le rang, faire
comme les autres, sans se faire remarquer, lui tait insupportable. Pendant la rcra-
tion elle s'approcha de l'inspectrice qui conversait avec l'institutrice et fit une
pirouette, car la gymnastique est son fort. Elle aime faire des farces. Ainsi elle me
raconta qu'un jour elle a laiss s'chapper l'oiseau d'une cage que le propritaire avait
place dans la cour. Elle se rjouit de voir que le propritaire ne trouvait pas l'auteur
de cette farce. Elle prtend avoir eu piti de cet oiseau qui piaillait. Au cours des
vacances, s'amusant dans la rue, elle tira compltement le rideau de fer d'une
boucherie situe en face de chez elle. Lorsque la bouchre sortit et corrigea M., sa
mre sortit son tour de son magasin et administra un soufflet la bouchre, ce qui
lui valut un procs et une amende de 10 francs. La mre me pria d'tre trs svre
avec la petite qui, la maison, l'extnuait. Elle est ttue et lorsque sa mre lui
commande quelque chose elle rpond : Je ne veux pas y aller! et ne cde gnra-
lement qu' la force. Si cette femme avait dispos des moyens ncessaires, elle aurait
confi l'enfant des trangers qui lui auraient donn une ducation correcte, car les
parents, avec leur commerce, ne peuvent pas suffisamment s'en occuper. Quant aux
frres et surs, elle les repousse, bien qu'ils l'aiment beaucoup et soient trs doux
avec elle. A l'cole, elle se conduit d'une faon identique. Il ne se passe pas de jour
sans qu'on la voie battre une camarade ou la jeter terre sans motif. A deux reprises
dj, deux fillettes ont t srieusement blesses, pousses contre le mur ou contre
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 90
l'extrmit d'un banc. Sur le chemin de l'cole, elle tire les cheveux de ses camarades
ou, quand elles sont arrives, les menace de les corriger la sortie. A cause de tout
cela on la craint et on ne l'aime pas dans sa classe. Si, pendant les cours, une voisine
lui demande de se tenir tranquille, elle lui donne des coups de poing, la pince ou la
frappe avec ses pieds, sous le banc. Les convocations des parents n'ont donn aucun
rsultat jusqu' prsent. C'est toujours la mre qui est venue et elle a rejet la faute sur
le pre qui gte trop cette enfant. Je n'ai jamais pu m'entretenir personnellement avec
le pre, mais la mre a promis de nous l'amener aujourd'hui.
Dr A : Dans la description dtaille de cette enfant, le point central de son
dveloppement est soulign avec beaucoup de prcision. Cette enfant prsente une
tendance particulirement marque la valorisation mal dirige. Nous entendons dire
qu'il s'agit d'une benjamine et qu'elle a t gte; ceci parat expliquer que sa
tendance la valorisation soit si grande. En tant que benjamine elle voudrait dpasser
tous les autres. Mais ct de son bon rendement, on constate une telle quantit de
dfauts qu'on en est tonn. Nous comprenons pourquoi la conduite de l'enfant va en
s'aggravant. L'enfant se conduit comme dans une souricire, elle ne peut chapper
son sort, elle voudrait tre le point de mire mais elle a dj si mal agi qu'elle se heurte
partout une rsistance et partout elle est incite continuer. Je voudrais rapidement
rpter ce qui m'a frapp, dans cette excellente description, relativement la ligne
dynamique de l'enfant.
Elle montre la tendance vouloir tre plus que les autres l'cole. Elle n'a qu'un
succs partiel et elle essaye de complter la partie manquante par ses interruptions de
l'enseignement, par ses attaques, par les difficults qu'elle prsente vis--vis de sa
mre. Nous pouvons mettre l'ide que si elle tait la premire de sa classe, sa
conduite changerait compltement. Ce n'est pas elle-mme qui changerait, mais sa
situation serait meilleure, sa tendance la valorisation ne supporte pas la vie la
maison; l'cole, vis--vis de ses camarades, elle se trouve en lutte. Dans cette lutte
elle voudrait tre victorieuse. Il est impossible de dtourner cette enfant de sa voie par
des coups ou par des punitions. Car peut-tre dans ce cas, n'osant plus agir au grand
jour et nuire ouvertement aux autres, elle le ferait d'une faon cache. Ce serait aussi
inciter l'enfant mentir. Je crois que le vrai motif pour lequel elle a laiss chapper
l'oiseau n'est pas, comme elle le disait, la piti, mais plutt une certaine joie procure
par l'attaque du bien d'autrui. C'est pour la mme raison qu'elle regarde les cahiers de
ses camarades. Dans cette joie maligne que lui procurent les erreurs des autres, elle
trouve sa supriorit et croit tre plus et mieux que les autres. Si elle russissait
toujours triompher cela ne prjugerait en rien de sa vie venir. Elle ne trouvera
certainement personne pour lui offrir constamment cette possibilit. Il faut intervenir
pour saisir le mal sa racine. Il faut rendre comprhensible l'enfant l'erreur o elle
vit. Il faut lui montrer qu'elle prsente une tendance se trouver toujours en tte et,
n'y russissant pas du ct utile, elle essaye alors de se faire valoir du ct nuisible
(en molestant ou en tyrannisant les autres). Mais cette explication qu'il faut lui donner
ne doit pas revtir la forme d'un reproche, car l elle recommencerait lutter. Une
enfant de cette sorte prsente, la suite de pareille affirmation, un tat d'esprit qui
l'amnerait penser : Dsormais je le ferai davantage. Les enfants veulent dmon-
trer qu'ils sont quand mme les plus forts. Je ne crois pas qu'on puisse liminer ses
dfauts par une conversation. Un sujet tranger, ne dpendant absolument pas du
cercle de ses relations, devrait un jour lui donner amicalement quelques indications et
lui montrer ce qui se passe en elle. Elle sait que sa mre la dfend et ne prend donc
pas au srieux ses menaces. tant intelligente, elle connat les limites qu'un instituteur
ne peut pas dpasser et elle sait qu'on ne poussera pas les choses jusqu'au bout.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 91
Nous entendons dire que ses parents, comme ses frres et surs, l'aiment, et
malgr tout elle les torture, elle est peu aimable avec eux. Elle essaye de subjuguer
les autres, mais cela ne russit pas entirement chez ses frres et surs, d'o son
besoin de les attaquer. Partout nous retrouvons le mme rythme et la mme structure.
Les menaces de la mre sont compltement inutiles et en la rudoyant on n'arrivera
aucun rsultat chez cette enfant. Elle sait que le pre, en toute circonstance, sera de
son ct. Il est probable d'ailleurs qu'il ne porte pas toute la responsabilit dans
l'ducation errone de l'enfant, car les membres de la famille se rejettent cette
responsabilit l'un sur l'autre. Il est ncessaire qu'on donne des indications aux
parents, qu'on leur fasse comprendre que, dans le fond, cette enfant n'est pas respon-
sable puisque, jusqu'alors, elle n'avait eu qu' suivre un style de vie tabli ds sa
premire enfance. On ne saurait s'attendre un changement tant qu'elle maintiendra
son but erron, savoir tre toujours la premire et se trouver toujours au centre de
l'attention.
Le moyen le meilleur pour clairer l'enfant en mme temps que la mre, serait de
faire comprendre cette dernire qu'on constate trs souvent chez les benjamins cette
tendance vouloir toujours se trouver au premier plan.
Dr A (s'adressant aux parents) : Il ne faut pas lutter avec un enfant car souvent on
perd; les enfants sont toujours les plus forts. Il faut lui parler d'une faon aimable et
lui dire que si elle recommence vouloir dominer les autres, ce qu'on trouve souvent
chez les benjamins, cela ne prsente rien de particulier. Il faudrait faire comprendre
l'enfant d'o vient chez elle ce besoin qu'elle ne comprend pas elle-mme, de se
trouver toujours au centre de l'attention.
Conseil l'institutrice: Considrer les rechutes ventuelles avec un sourire
comprhensif et attirer l'attention de l'enfant en lui disant : Je crois que tu voudrais
de nouveau te trouver au centre de l'attention.
Dr A (s'adressant l'enfant qui pleure sans cesse) : Voudrais-tu tre la meilleure
lve et russir dj beaucoup de choses? Tu es une enfant intelligente. Il faut
seulement que tu perdes l'habitude de forcer les autres s'occuper constamment de
toi. Tu es la benjamine et tu veux toujours montrer que tu es la matresse. On voit
souvent cela chez les benjamins, tu n'en es pas responsable, nous le reconnaissons.
Regarde, tu cris bien, tu es forte en gymnastique, dois-tu constamment ennuyer les
autres petites filles? Tu as un bon pre et une bonne mre; tu pourrais tre contente;
as-tu vraiment toujours besoin de te pousser au premier rang? Je t'assure que tes
larmes sont tout fait superflues, tu n'es pas ici pour tre punie, mais pour qu'on
t'explique o se trouve ton erreur. Tu veux toujours dmontrer que tu es la matresse
la maison, cela n'est pas ncessaire. Tu en sais autant que les autres. Il faudrait aussi
regarder les gens dans les yeux et leur dmontrer que tu as une bonne conscience.
Dis-toi : je ne veux pas dominer, je ne veux pas tre dsagrable, je ne veux pas
donner de travail supplmentaire ma mre pour qu'elle soit toujours oblige de
s'occuper de moi. Essaie de lui faire plaisir, tu y parviendras et tu te diras : je suis
peut-tre la benjamine, mais tout le monde m'aime. Qu'en penses-tu, crois-tu que tu y
arriveras ou veux-tu continuer te conduire comme quelqu'un qui dit toujours : me
voil!
Reviens dans un mois.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 92
Chapitre X
Lenfant dtest
Retour la table des matires
H. est un enfant n avant terme ( huit mois).
In faut tre prudent devant cette premire remarque. Un enfant n avant terme et
huit mois ne se distingue pas facilement d'un enfant n terme et il n'est pas toujours
certain que le diagnostic soit juste. J'viterais que l'enfant ft renseign l-dessus. En
fait, cela n'a aucune importance.
A l'ge de neuf mois il commenait dj courir et douze mois babiller. Sa
premire dent apparut douze mois.
Elle aurait d percer six mois.
Les dents suivantes vinrent rgulirement. Jusqu'alors il avait eu la rougeole. La
mre ne pouvait pas donner de renseignements sur d'autres maladies ventuelles, car
l'enfant tait en nourrice. A cette poque le pre de l'enfant tait garon de caf, il vit
actuellement loin de la ville et paye une pension aux parents nourriciers. La mre ne
connat pas exactement sa situation matrielle. Il tait grossier, brutal et alcoolique.
La mre n'a fait qu'une seule maladie : une pneumonie. D'aprs les renseignements de
la mre nourricire, il n'y a pas de maladie hrditaire dans la famille.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 93
Nous savons qu'il ne faut pas prendre au srieux les conditions hrditaires en ce
qui concerne les qualits intellectuelles.
La mre de l'enfant est marie un ouvrier. Leur vie familiale serait bonne. De
cette union sont ns deux enfants dont l'un est mort l'ge d'un an, tandis que l'autre,
vivant, a actuellement trois ans.
H. fut plac chez des parents nourriciers K. Le pre nourricier est monteur dans
une usine gaz; il est alcoolique et d'une brutalit excessive. Les parents nourriciers
ont un fils de 17 ans et une fille de deux ans. L'an ne s'entend pas avec H., l'agace,
l'excite, se moque de lui, le bouscule et le bat la moindre occasion. Le petit a un trs
mauvais exemple sous les yeux, surtout lorsque le pre nourricier est ivre ; il se passe
alors des scnes terribles. Il bat sa femme et ses enfants, on prtend qu'il aurait lanc
un jour le petit comme une balle.
Vous savez ce que signifie le fait d'tre un enfant dtest .
J'ai pu me convaincre personnellement de la profonde trace laisse sur cet
enfant par ces impressions. A un garon, qui jouait avec du sable j'adressais un jour
cette remarque : fais attention ta culotte sinon ta mre te grondera. Et notre H.
ajouta : Mon pre nourricier nous a toujours gronds, ma mre et moi, il nous a
mme battus parfois avec une courroie et alors ma mre pleurait.
Pendant l'tat d'ivresse du pre toutes les intimits de la vie familiale se
droulaient devant H. On peut rapprocher ce fait de la dclaration de la mre selon
laquelle l'enfant avait l'habitude de jouer avec son sexe.
Ce sont des manifestations que l'on rencontre trs souvent chez les enfants.
La mre relate une scne o elle le trouva dans le lit avec son frre, g de trois
ans, jouant avec son sexe et celui de son frre. H. tait trs excit et haletant. Ses
expressions concernant cette question sont effrayantes. J'ai remarqu que H. avait une
certaine tendance torturer les animaux : sur les fentres il cherche soigneusement
des mouches et des cafards pour les craser. Une fois je l'ai trouv en train de rouler
quelque chose autour de son doigt. En m'approchant j'ai pu voir qu'il s'agissait d'un
ver de terre qu'il avait dj fort maltrait et dont il ne voulait pas se sparer.
La torture des animaux traduit chez lui une attitude hostile vis--vis des tres
faibles. Il considre le monde comme lui tant hostile.
Depuis le mois d'avril, il se trouve chez sa propre mre, son entourage a chang.
La mre se trouvant l'hpital pour quatre semaines, H. fut plac dans une maison
d'enfants G. et pendant deux jours dans une famille. Le 25 septembre, il entre au
jardin d'enfants. Il est physiquement nglig, chtif, mais ne prsente pas d'anomalies
organiques; son corps est couvert d'ruptions, sa tte pleine de parasites. Le jardin
d'enfants aurait envoy le petit l'hpital pour indiquer la mre un traitement
suivre mais elle n'a pas suivi les indications et la gurison ne survint pas. La mre ne
cache pas qu'elle n'aime pas l'enfant.
Un enfant dtest : peut-tre illgitime?
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 94
A ma premire entrevue avec la mre celle-ci me disait : soyez svre envers
l'enfant, moi aussi je le punis et je le corrige. Il faut lui parler durement sans quoi il
n'obit pas; il en a l'habitude, c'est de cette faon qu'il a t trait jusqu' prsent; c'est
d'ailleurs un enfant illgitime qui a t lev en nourrice.
On a l'impression que la mre le rend responsable du fait qu'il est enfant
illgitime.
Moi il me respecte, mais il aime mon mari plus que moi. Lorsque je m'approche
de lui il se met aussitt pleurer. Cet enfant me donne sans cesse de l'occupation. Il
est instable et remuant et il gne tout travail. Le silence au moment du travail et des
repas l'nerve par-dessus tout. Il pousse des petits cris, trpigne, dplace les chaises
bruyamment ou frappe sur les tables pour attirer l'attention sur lui.
C'est peine vraisemblable. On ne pourrait l'imaginer qu'au cas o les chtiments
corporels ou l'anxit lui procureraient une excitation sexuelle. Ces enfants-l
provoquent volontairement les coups qu'on leur donne. Nous savons que le garon est
sexuellement excitable et il se pourrait qu'il appartnt ce type.
Lorsque je lui demande de rester calme, il rit de moi et continue crer du
dsordre. Si je ne fais pas attention lui, il s'nerve et recommence de plus belle. Il se
jette parfois terre et pleure sans motif apparent.
On a l'impression qu'il voudrait provoquer son entourage; il sait trs bien ce qui
lui arrivera.
Son opposition donne un mauvais exemple au groupe. En effet, lorsque je donne
un ordre tous les enfants, et un ordre prcis, H. crie : non, je ne le ferai pas!
Cette conduite traduit son attitude hostile, il ne sait pas qu'il existe aussi des tres
qui lui sont bienveillants.
Je traite sa rvolte autrement que chez les autres, mais il y a dans le groupe des
lments qui imitent son exemple et croient qu'ils peuvent faire la mme chose.
Pareille conduite est parfois contagieuse lorsqu'il s'agit d'enfants qui ont un fort
sentiment d'infriorit et qui cherchent se faire valoir. Les enfants dsirent l'galit.
Vous avez probablement dj remarqu que si, l'cole, un enfant perd connaissance,
deux ou trois autres perdent connaissance leur tour.
Il n'a pas de sentiment social. Il excite les autres enfants, leur enlve leurs jouets
et leur matriel de construction alors qu'il a les mmes jouets que les autres. Il
bouscule, griffe et frappe les autres sans motif.
Il se conduit comme un ennemi.
La notion du tien et du mien n'est pas trs nette en lui.
Ces notions ne peuvent tre claires que si on a de l'intrt pour les autres.
Un exemple : H. enlve R. son sifflet; R. vient se plaindre. J'essaye d'arranger
les choses et je conseille R. de prter son sifflet H. pour un certain temps.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 95
Finalement R. insiste tout de mme et revendique ses droits. Je fais signe H., mais
ce dernier se rfugie dans le coin le plus recul du jardin. Lorsqu'enfin il s'approche
de moi, il se jette sur le sol. Je lui dis tranquillement : lve-toi et rends maintenant le
sifflet, R. voudrait siffler un peu lui aussi; plus tard il te le reprtera. Le seul rsultat
de mes paroles est qu'il commence crier et trpigner et qu'il essaye de me frapper.
Voyant ce qui se passe au jardin, une multitude d'enfants s'est amasse et parmi eux
mme des enfants d'un autre groupe. Puisqu'en insistant je n'obtiens rien, je le relve
et le porte la maison. Au bout d'un certain temps il se calme et j'essaye de lui faire
comprendre que lui non plus ne serait pas content si on lui enlevait quelque chose. Sa
raction fut inattendue. Ses dents se mirent claquer comme s'il avait la fivre et le
reste de la journe il ne me quitta plus, prenant gentiment ma main qu'il baisa
plusieurs reprises. Plus tard j'appris au cours d'une conversation avec la mre que les
parents nourriciers avaient enlev l'enfant tous ses cadeaux et qu'on ne lui avait rien
rendu.
Cette scne o il se conduit d'une manire si soumise et si reconnaissante est trs
suspecte. On lui a tout de mme enlev son sifflet et il est difficile de comprendre
pourquoi il est reconnaissant. Peut-tre tait-il en outre sexuellement excit a ce
moment-l ou peut-tre tait-il reconnaissant qu'on ne l'ait pas battu?
Le moment du repos fait surgir une difficult trs importante dont ptissent ses
petits camarades. Il interrompt le calme ambiant en criant sans motif, en se levant
prcipitamment, en faisant du bruit avec son lit et en parlant tout seul. Les autres, qui
commencent s'endormir ou dorment dj, sont nouveau veills.
Il se conduit comme un ennemi particulirement mchant.
La mre nous donne le renseignement suivant : H. n'a jamais mouill son lit, il
ronfle rarement. Il dort avec le pre et aime dormir prs de lui.
Cela parait confirmer la supposition qu'il est sexuellement excitable.
on le couche 8 heures. Son sommeil est agit, il est haletant et respire parfois
difficilement. Il se rveille rgulirement une heure du matin et ne veut plus dormir.
Les parents usent de tous les moyens, le plus souvent de coups, pour qu'il se ren-
dorme. Lorsqu'il se trouve la maison, midi, on le couche avec son frre, chacun
dans un coin du lit et, aprs quelques coups, il s'endort. Cela montre une fois de plus
quel point cet enfant martyris est inaccessible. J'ai essay d'influencer l'enfant en
louant ses plus petites russites. Il ragit momentanment mais il n'est pas incit
amliorer son rendement. Pendant les premiers jours de sa prsence au jardin
d'enfants, j'ai constat que, bien que se trouvant une certaine distance, il interrom-
pait ses jeux lorsque je caressais un autre enfant.
Il faut nous souvenir qu'il se trouve dans une situation qu'il a dj domine
plusieurs reprises et qui lui rappelle celle de son frre cadet, qui est mieux trait que
lui.
Il reste comme fig, me fixer du regard. Le lendemain j'ai recommenc la
manuvre volontairement, tout prs de lui; de nouveau H. resta comme paralys et
nous fixa; je vois quelle impression cette scne lui fait. Elle est peut-tre en rapport
avec son manque d'entranement se concentrer. Ce manque se manifeste dans toutes
ses actions.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 96
Vous voyez de nouveau que ses fonctions sont insuffisamment dveloppes du
fait qu'il ne cherche pas de communication avec les autres.
Ses paroles sont sans suite et dsordonnes; se met-il balayer? aprs quelques
coups de balai il abandonne et commence jeter dehors les poupes de guignol.
Mme au cours du repas il se fait particulirement remarquer; un repas normal, assis
tranquillement, lui est chose inconnue. Il faut l'aider lorsqu'il s'habille ou se dsha-
bille. Ces derniers jours j'ai pu observer qu'il apprenait distinguer le juste de
l'injuste, car il s'acharne d'une faon ou d'une autre sur les enfants qui commettent des
fautes.
Il cherche le contact avec l'institutricel
Je ne suis pas certaine que, par ces dnonciations, il ne cherche pas obtenir la
punition de l'enfant.
H. aime aller au jardin d'enfants. La mre dit que le dimanche il le rclame
toujours; avant de s'y rendre, il n'est gure mu. Les premiers jours il refusa mme de
rentrer chez lui.
Cela indique bien sa prfrence pour le jardin d'enfants. Je ne doute pas qu'il fasse
des progrs par cette voie.
Il pleura beaucoup et se jeta sur le sol des vestiaires. Seuls nos conseils et la
promesse qu'il pourrait revenir le lendemain, purent l'amener se lever et rentrer
chez lui, avec une fillette de son voisinage dont le frre se trouve galement au jardin
d'enfants. Sa peur du chez soi ne se manifeste plus d'une faon aussi nette, mais
lorsque arrive le moment o on vient le chercher, il est inquiet et semble troubl.
H. donne l'impression d'tre un garon veill. Il saisit bien les choses sa
manire et un grand dsir d'activit l'anime. Il est gnreux et aime donner; par
exemple, il me donne une prune de son goter; peu de temps aprs, il revient m'en
donner une deuxime en disant : en voici encore une pour que tu en aies deux.
D'une faon gnrale il aime bien donner ce qu'il a.
Voil qui prouve qu'il commence acqurir un certain sentiment social. Il se
passe un certain temps avant qu'un enfant de ce genre commence s'chauffer. Cela
ne se ralise pas immdiatement, il faut de la patience et ce n'est qu'alors que l'on
peut surmonter d'autres difficults. J'aimerais demander la mre s'il ne provoque pas
les coups. Il est vident que je ne dois rien suggrer par l. J'essayerai de lui faire
comprendre amicalement qu'elle doit faire natre dans l'esprit de l'enfant le sentiment
qu'il a autant de valeur que les autres.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 97
Chapitre XI
L'enfant unique
qui veut jouer un rle
Retour la table des matires
L'instituteur S. relate le cas d'un garon de onze ans qui ne s'entend avec personne
et gne constamment l'enseignement. Il a drob sa mre 50 centimes. La principale
plainte porte sur le fait qu'il ne peut tre en compagnie d'autres enfants sans se
quereller avec eux et jouer toujours le premier rle. C'est un enfant unique.
Son rendement scolaire est moyen, il semble tre intelligent.
Aucun renseignement sur la situation familiale.
Enfant unique et gt, du fait qu'on s'occupe trop de lui, il ne peut avoir de con-
tacts avec d'autres enfants, ce qui a empch son sentiment social de se dvelopper.
Je voudrais m'entretenir avec la mre.
La mre raconte que le garon a de bons cts mais qu'il se laisse trop influencer
par les autres. Il y a des moments o il obit trs peu. Les garons racontent la mre
qu'il leur aurait dit : Je ne veux pas faire ce que ma mre me demande! Il lui ment
souvent et elle le punit pour ses mensonges. Parfois elle a la main vive , d'autres
fois elle le prive de tout ce qu'il aime. Pendant un certain temps il fut plac chez des
parents nourriciers; il y fut bien trait. A la maison, il est encore mieux trait et ne
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 98
manque de rien. Auparavant, lorsqu'on le punissait, il demandait pardon; maintenant
il boude ou rpond d'une faon narquoise. Il aimerait jouer le rle du matre de la
maison et prsente une tendance la fanfaronnade. L'poux actuel de la mre n'est
pas le pre de l'enfant; mais il est trs gentil pour lui; le garon ignore du reste que ce
n'est pas son pre. Lorsque ce dernier est la maison, le garon se conduit encore
moins bien car il est trop bon pour lui. Les instituteurs ont conseill la svrit.
L'enfant, par ailleurs, n'a pas d'amis; il ne pourrait s'entendre avec eux. Il est auto-
ritaire, les autres ne l'aiment pas. Il fait ses devoirs tout seul.
La semaine dernire la mre constata qu'il lui manquait 50 centimes dans son
portefeuille. Elle en rendit le garon responsable. Ce dernier nia avoir pris l'argent,
mais la mre le retrouva chez lui. Elle ne put pas savoir pourquoi il lui avait drob
cet argent.
Il change et collectionne volontiers diffrents objets tels que papiers, images,
crayons, etc. Elle lui demanda de cesser ces changes en lui promettant en compen-
sation un peu d'argent de poche chaque semaine. Ceci lui a fait grand plaisir. A part
cela il est gentil, J'aide volontiers sans avoir lui-mme besoin qu'on l'aide.
En ce qui concerne ses rves, la mre raconte qu'un jour, pendant un voyage en
bateau sur le Danube, il fit un rve angoissant et ce rve prit une telle apparence de
ralit qu'on finit par le retrouver sur le pont du bateau. Il avait rv qu'il tait assis
sur la chemine et craignait de tomber : on l'y trouva cramponn et crisp. Il a
exprim le dsir de devenir capitaine ou pilote de navire et fit remarquer une fois que
commander tout le bateau lui ferait plaisir.
Il est conome. Sa mre se plaint de ses mensonges et de son insociabilit; pour le
punir, elle le bat souvent.
Discussion avec la mre : Qu'il ait vol 50 centimes. n'est pas tellement grave,
vous ne devriez pas lui en parler. Vous avez trs bien fait de lui donner de l'argent de
poche. S'il sait qu'il peut compter sur ce revenu, il se calmera. Personnellement,
j'essayerais de ne plus le battre du tout. Ce garon croit que, par ses mensonges et ses
fanfaronnades, il arrivera attirer l'attention des autres et devenir ainsi le point de
mire de tous. Il serait indiqu de changer et mme d'abolir toutes les punitions, en les
rduisant progressivement. Il faudrait aussi lui faire penser son avenir et lui
expliquer que la profession de capitaine qu'il a envisage par vanit ne reprsente pas
une occupation srieuse. A votre place je ne l'entourerais plus de soins maternels. Il a
l'habitude de vous voir toujours derrire lui. Si la gymnastique lui plat, laissez-le
pratiquer ce sport pour qu'il puisse se joindre ainsi d'autres enfants. Je lui ferais
sentir qu'il n'est plus un enfant, ce qui lui donnera plus de confiance en soi. Il a l'im-
pression d'tre gn; le dernier incident vient de l. Il voudrait avoir le sentiment qu'il
est quelqu'un et se convaincre qu'il joue un rle.
Dr A (s'adressant l'auditoire aprs le dpart de la mre) : Ce garon est un enfant
qui aime jouer son rle mais qui est gn par sa mre.
Dr A (s'adressant au garon) : Tu es un bon mathmaticien! que voudrais-tu deve-
nir plus tard?
L'enfant : Capitaine sur un transatlantique. Je, voudrais partir pour Hambourg.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 99
Dr A : Il faut commencer par tre mousse. Quel ge dois-tu avoir pour pouvoir
partir Hambourg?
L'enfant : 20 ans.
Dr A : Tu peux dj le faire 15 ou 16 ans. D'ici l, et avant de devenir capitaine,
il faut apprendre beaucoup de choses.
Pourquoi aimes-tu tellement cette profession? Es-tu dj all sur un bateau?
Qu'est-ce qui te plat tellement ?
L'enfant : C'est que l'on peut y commander.
Dr A : Et que fais-tu en ce moment? Pourquoi ne fais-tu rien chez ta mre ou
l'cole?
L'enfant : Je commande les autres.
Dr A : Si tu veux tre capitaine, il faut aussi commander intelligemment pour que
chacun dise que ce que tu fais est bien. Mais au milieu des enfants, l'cole, tu n'es
pas capitaine, il n'est pas bon que tu les commandes. Je ne comprends pas pourquoi tu
veux commander l'cole, C'est cause de cela que tu n'auras certainement pas
d'amis. Les enfants ont raison, ils ne sont pas l pour qu'on les commande. Tu
commenceras plus tard, pour le moment, sois aimable, essaie de te faire des amis. Le
capitaine est aimable avec les passagers. Il faut aussi qu'il sache faire autre chose que
de commander. Il faut aussi qu'il ait des amis. Si les autres ne l'aiment pas ou le
dtestent, ils ne lui obiront pas. Il faut que tu apprennes te comporter d'une faon
aimable avec les autres enfants. Commander c'est de la fanfaronnade. Tu aimes bien
changer tes affaires et acheter. Tu aimes bien jouer un rle. Tu veux toujours arriver
ce qu'on te regarde comme un capitaine. Te souviens-tu encore de quelque chose
qui t'aurait frapp tant tout petit?
L'enfant : J'ai vu une fois comment on hissait une cloche au sommet d'une tour.
J'avais environ trois ou quatre ans.
Dr A : Cela t'a intress?
L'enfant : La faon dont les gens s'y sont pris m'a plu.
Dr A : Cela t'a plu de voir comment on arrive hisser quelque chose? Je voudrais
que tu aies des amis. Ne voudrais-tu pas frquenter un patronage? Ta mre te laissera
peut-tre aussi apprendre la gymnastique. On peut tout apprendre. Tu pourrais faire
tes devoirs au patronage, a serait assez amusant. Que veux-tu faire de l'argent que tu
conomises?
L'enfant : Si un jour je suis dans la gne, j'aurai quelque chose.
Dr A : As-tu peur de te trouver dans la gne? de tout perdre et de tomber? Si tu es
travailleur, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans la misre. Tu sais, avoir de
l'argent n'est pas la plus grande scurit. Aimes-tu aussi fanfaronner?
L'enfant : Oui.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 100
Dr A : - Il faudrait que tu en perdes l'habitude. Si on veut tre capitaine, il ne
faut pas mentir. Ta mre et l'instituteur t'aiment bien; si tu travailles comme il faut et
que tu deviennes un homme honnte, tu peux tout esprer. Et pour devenir capitaine
il faut tablir une bonne base de dpart.
Reviens dans un mois et raconte-moi si tu as dj des amis, si tu ne gnes plus
l'enseignement et si tu commandes encore.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 101
Chapitre XII
L'an dtrn
Retour la table des matires
J'ai deux enfants, gs respectivement de 7 et 9 ans. Je ne peux pas encore juger
le travail du second tant donn qu'il frquente la premire classe.
Nous voyons ici deux garons, l'an et le cadet. Or, dans une famille, tous les
enfants grandissent dans des conditions diffrentes. Il est impossible de supposer
qu'ils se dveloppent dans une situation identique. L'an reste seul pendant deux ans;
tant enfant unique il est probablement le centre de l'attention et il est trs gt. Toute
la maison est sa disposition. Brusquement apparat un deuxime enfant et la
situation change du tout au tout. Il tait habitu pouvoir disposer de tout comme un
monarque. Soudain l'attention de la mre se porte sur le second enfant et elle ne peut
plus consacrer son an autant de temps que par le pass. Comme il n'est pas facile
de prparer ce dernier l'arrive du second, nous constaterons qu'effectivement cette
prparation lui a manqu. Il se trouve en prsence d'un test difficile. Beaucoup
d'enfants se consument alors de jalousie, commencent une lutte farouche pour
s'assurer l'attention des parents et pour rtablir la situation favorable qu'ils occupaient
antrieurement. Le second enfant, lui, a une tout autre situation, il n'est jamais seul. Il
a quelqu'un qu'il peut suivre, qu'il veut suivre, qu'il veut mme rejoindre. Un enfant
me disait : Si je suis aussi triste, c'est que je ne serai jamais aussi g que mon
frre (cf. Esa et Jacob).
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 102
L'an vit une vritable tragdie au moment de la naissance du cadet. Si nous
entendons dire que ce garon a toujours peur d'tre suivi par le second, voire mme
d'tre dpass par lui, qu'il perd tout courage, nous comprendrons que cette attitude
est la consquence d'un automatisme. Un signe avertisseur apparat dans son psychis-
me et lui dit ce nouveau venu va tout accaparer.
L'attitude variera selon les enfants. Elle dpend, premirement : du degr de dve-
loppement qu'a atteint jusque-l le style de vie de l'enfant et de la facilit plus ou
moins grande de le modifier; deuximement : du comportement du second enfant;
troisimement : du comportement des parents, et enfin : de la prparation de l'an et
du niveau de son sentiment social et de son intrt pour les autres. Ce sont des faits
significatifs dont il faut tenir compte.
Maintenant nous allons voir comment ce garon se dveloppe : L'an par contre
est, mon avis, un fainant.
La fainantise dnonce l'attitude hsitante; nous pouvons en dduire qu'il croit ne
plus pouvoir avancer, il a perdu tout courage. Il sait que du ct utile cela n'ira plus.
Sa tendance la valorisation se manifestera du ct inutile de la vie. Sa fainantise
signifie : telle matire m'agace parce qu'elle me fait travailler et que je dois m'en
occuper. Cela paratra curieux, mais il a peut-tre atteint ce quoi il a toujours
aspir : attirer davantage l'attention sur sa personne, occuper davantage les autres de
sa personne. La fainantise reprsente la rpugnance qu'il affecte devant la solution
de ses problmes, c'est une attitude hsitante. Lorsque vous considrez le style de vie
automatique des enfants paresseux, vous constatez que leur conduite diffre de celle
d'un enfant qui a confiance en lui-mme. Ils vous diront souvent : Je ne me consi-
dre pas comme tant plus bte que les autres, mais cela ne m'intresse pas. S'il
s'attendait une russite, le garon ne serait pas fainant. La paresse est l'indice d'une
mdiocre estime de soi-mme. Dans la paresse se traduit sa tendance se faire valoir.
Les enfants fainants se trouvent gnralement au centre de l'attention et de l'intrt
de leur entourage. lis se sont proposs un travail supplmentaire : amener l'entourage
s'occuper davantage de leur personne. Nous ne serions pas tonns, en questionnant
un tel garon sur sa paresse, s'il nous rpondait : Voyez-vous, je suis le garon le
plus fainant de la classe, mais on s'occupe constamment de moi et on est toujours
gentil et aimable avec moi. Mon voisin est trs travailleur et personne ne s'occupe de
lui. Il tire profit de sa paresse.
Le moindre rendement est immdiatement lou; s'il ne russit pas. il s'entend
dire : Si tu n'tais pas paresseux, tu pourrais tre le meilleur. Il est tonnant d'ob-
server quel point un enfant fainant peut se contenter du sentiment qu'il pourrait
tre le meilleur. Il ne veut mme pas essayer. L nous rencontrons, une fois de plus,
la tendance la valorisation, du ct inutile de la vie.
Toutes les exhortations aimables ou svres n'ont donn aucun rsultat jusqu'
prsent.
Le garon ignore ce qui se passe en lui et agit d'aprs son propre style de vie. Il se
trouve comme dans une souricire. Le fait qu'il se laisse exhorter montre qu'effecti-
vement il veut se trouver au centre de l'attention. Certains enfants aiment volontiers
recevoir des coups, ils ressentent alors le triomphe d'avoir agac leur pre. Certains
trouvent mme dans ces coups une jouissance, une joie qui peut parfois impliquer un
contenu sexuel.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 103
Il promet de s'appliquer devenir plus travailleur.
Vous voyez qu'il sait dire : je veux!
mais ne fait rien pour y arriver. Pendant la rdaction il se laisse dtourner de son
travail par n'importe qui ou n'importe quoi.
Il pense ne pas pouvoir se faire apprcier par son travail. Il suit un autre chemin.
Tout l'intresse, sauf ses devoirs. Pour lui faciliter son travail je lui ai ordonn
de me rendre compte de ce qu'il avait appris pendant la journe l'cole.
Nous le voyons l se trouver de nouveau au premier plan. Tous les soirs il parle
avec le Pre, le bon dieu!
Lorsque je rentre le soir la maison, il n'apparat pas pour tenir sa promesse.
Il faut que le pre s'en souvienne lui-mme.
Ce n'est que lorsque je l'ai interpell directement qu'il me rpond : je ne sais
pas.
Nous le savons, il croit qu'il ne pourra pas se faire apprcier. Il faut l'encourager et
lui montrer qu'il peut, mme en ce qui concerne ses devoirs, se placer au premier plan
s'il s'en donne la peine.
Les matires qui sont les plus difficiles pour lui sont la grammaire, le calcul et
l'criture et ce sont celles qu'il dteste le plus. Un lment supplmentaire de son
lourd sentiment d'infriorit est peut-tre le fait qu'il est gaucher. Il serait important
de diagnostiquer cette particularit, Je voudrais attirer votre attention sur le fait que,
parmi les enfants prsentant des difficults en calcul, se trouvent des enfants gts qui
cherchent un appui. Toutes les matires comportent des cls qui faciliteront leur assi-
milation. En calcul il n'y en a pas. L, chacun doit travailler d'une faon indpendante
et rflchie. Les enfants gts se montrent particulirement mal prpars en matire
de calcul.
Le dgot avec lequel il se met au travail prouve son aversion l'gard de ces
matires. Il semble avoir plus d'entrain pour l'histoire naturelle. Il aimerait aussi le
dessin, mais il ne produit que des caricatures horribles, il manque sans doute de
talent.
C'est probablement un enfant gaucher!
Il peut rester parfois pendant des heures assis ou couch regarder dans le
vide.
Le plus grand ennemi de ces enfants qui ont une aussi faible estime d'eux-mmes
est le temps. Le garon a trouv un moyen pour faire passer le temps : Il regarde
dans le vide.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 104
Bien qu'il dispose de beaucoup de livres et en ait dj commenc quelques-uns,
il n'en a termin aucun.
Pas de patience, pas de persvrance! Personne ne s'occupe de lui, il ne peut
s'attendre rien de la part des autres.
Il cherche des jouets qu'il dlaisse peu de temps aprs sans en prouver de
plaisir.
Le ct social de cet enfant ou plutt de ces enfants n'est pas brillant, bien qu'ils
ne souffrent pas de la faim.
Ce qu'il y a de plus triste dans leur vie est probablement le fait qu'ils se trouvent
pendant la journe dans un home pour enfants.
C'est une supposition ose, car nous esprons que c'est prcisment l que le
garon sera bien compris et encourage.
La directrice de ce home a une animosit particulire contre mon an car elle
est elle-mme catholique ardente et nous sans confession. Elle me disait qu'il mentait,
qu'il tait sournois et lche et cela parce qu'il avait t lev sans religion.
Nous ne doutons pas que ces particularits ressortent du fait de son manque de
courage, Je dois avouer que ce garon sans confession ne pourra s'amliorer dans un
home clrical que s'il y est encourag. Si la directrice dit qu'il prsente ces difficults
parce qu'il a t lev sans religion, il est probable qu'elle n'a pas la comptence
ncessaire pour chercher le point faible de cet enfant.
Le pre ajoute :
A vrai dire, j'ai constat moi-mme tous ces vilains traits de caractre. Alors que
le petit n'a pas de dfauts et qu'on ne parle de lui qu'en bons termes, on n'a que des
critiques adresser J'an.
Tout cela dmontre que l'an a t repouss larrire-plan par le cadet.
Est-ce par hasard que l'an s'est dvelopp dans le mauvais sens et le second dans
le bon? Certainement pas. L'an croit avoir t chass par le cadet de sa situation
antrieure qui tait agrable, et plus il perd d'amiti et d'amour, plus il se dcourage.
Le cadet, qui est actuellement le vainqueur, se sent, lui, dans une situation agrable et
il n'a pas besoin de se faire remarquer d'une faon pnible.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 105
Chapitre XIII
Le mensonge,
moyen de se mettre en valeur
Retour la table des matires
J'ai ici l'occasion de vous prsenter l'histoire d'un enfant difficile dont la mre
tait dj quelque peu au courant de nos ides. Vous verrez sa position devant ce
problme, vous verrez jusqu' quel point sa comprhension nous suit et comment elle
collabore avec nous bien que la chose ne lui paraisse pas trs facile.
Mon fils, Philippe, g de neuf ans, est ce qu'on appelle un enfant difficile.
Cela signifie qu'il lui donne du souci, qu'il la proccupe beaucoup et qu'il affecte
une conduite qui ne cadre plus avec le sentiment social. Nous n'aurions aucune raison
de nous torturer l'esprit et de chercher duquer les enfants si le sentiment social
existant ne se rvoltait pas contre les dfauts de pareils enfants.
Si la mre nous dit : il est nerveux , elle ne nous renseigne pas suffisamment.
En gnral, lorsque les gens emploient ce terme, ils veulent dire que l'enfant est
instable et d'un abord difficile. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la
sensibilit est l'lment le plus important de la nvrose. Cette sensibilit ne se pr-
sente pas toujours comme telle, mais peut se manifester par ses consquences. C'est
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 106
ce dernier cas que nous avons affaire ici et nous verrons que la consquence de sa
sensibilit se traduit chez cet enfant par la tentative de chercher mettre en valeur sa
personne. C'est ce qu'on appelle en Amrique, sous l'influence de la psychologie
individuelle, le superiority complex . Or ceci est dj la deuxime phase, le rsul-
tat de l'inferiority complex , c'est--dire du sentiment d'infriorit. Vous pouvez
comprendre qu'entre les deux une hypersensibilit entre en jeu et que l'enfant, ce
point sensible, ressentira sa situation comme un chec. En consquence il essayera
d'en sortir, cherchera une compensation, d'o il concevra des sentiments de grandeur.
Il est terriblement instable.
Voil confirm ce fait que, dans sa situation, il n'arrive plus trouver la
tranquillit.
Il n'apprend rien.
Ces renseignements sont dsordonns et cette dernire remarque est comprendre
et interprter dans un autre sens. Ne se sentant pas la hauteur des exigences de
l'cole, c'est pour cela qu'il n'y fait aucun effort.
Il n'est pourtant pas sot et il surprend parfois par son jugement.
Nous pouvons trs bien comprendre cela. Nous avons suppos que cet enfant se
trouvait simplement faible en face des exigences de l'cole. Il peut s'intresser
d'autres problmes. D'aprs ce qui a t dit, nous ne pouvons pas le compter parmi les
enfants courageux. Nous savons que ces derniers ont peu d'intrt pour les autres et
qu'ils en ont beaucoup pour leur propre personne.
Rien ne lui chappe de ce qui se droule dans la rue.
Je crois que beaucoup de psychologues modernes passeraient tranquillement
ct de ce fait sans le remarquer. Nous avons le droit de supposer qu'il s'agit d'un
garon qui s'intresse tout ce qui est visible. Cela explique beaucoup de choses. S'il
ne s'intresse qu' ce qui est du domaine visuel, c'est l'avantage de l'enseignement
pratique et il aura moins tendance couter les explications thoriques. C'est impor-
tant pour l'cole et beaucoup d'checs peuvent s'expliquer par ce mcanisme. Nous
retiendrons le fait qu'il est de ces enfants qui satisferont avant tout leurs tendances
visuelles. Si vous rflchissez la question : que peut-on faire si on se contente de
regarder les choses? vous trouverez qu'on ne peut pas faire grand-chose d'utile et en
tout cas pas grand-chose o puisse se manifester le sentiment social. Vous penserez
au dessin, la peinture, peut-tre une meilleure comprhension de tout ce qui est
visible. Le problme n'est pas trs facile, lorsque quelqu'un a accentu ce point un
ct .de la vie. Dans ces conditions en effet il ne reste plus suffisamment d'intrt
pour les autres ncessits de l'existence et l'individu ne peut plus se dvelopper dans
ce sens. Notre garon n'est pas entran comme il faut pour l'cole, ce n'est pas sa
faute; mais il a un grand intrt pour tout ce qui est visuel, pour tout ce qui est
apparence extrieure. Si nous sommes sur la bonne voie, mme dans une description
imparfaite de sa vie nous pouvons esprer trouver des confirmations de nos
suppositions.
Il se souvient de tout ce que disent les adultes.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 107
mettons l'accent sur cette circonstance, elle nous montre son intrt pour ce qui
est grand. Nous y retrouvons nettement sa tendance la valorisation, son dsir d'tre
grand.
Et il sait le rpter d'une faon juste, au bon moment.
Nous commenons tre renseigns dans une certaine mesure sur le style de vie
de ce garon de neuf ans. Il nous manque encore des confirmations et des indications
quant la variante spcifique de ce type.
Mais il est lche.
Ce dfaut ne nous surprend pas.
Il a peur de tout et fuit tout danger.
Il n'a aucune confiance en lui-mme. Nous pouvons supposer que la mre joue un
grand rle dans son dveloppement. Il n'est pas indpendant, il ne s'efforce pas de
rsoudre lui-mme ses problmes. Il n'a d'ailleurs aucunement l'intention de les
affronter, tant donn que, jusqu' prsent, il a t habitu voir sa mre les rsoudre
sa place. Mieux que toutes les autres coles psychologiques, nous pourrons cons-
tater ce sujet qu'il s'agit d'un enfant gt. Ces enfants jouent un trs grand rle et se
trouvent en grand nombre parmi les enfants difficiles, les nerveux, les candidats au
suicide, les ivrognes, les criminels, les pervers sexuels. C'est un fait si important que
je veux tout de mme ajouter quelques mots et dfinir ce que nous entendons par
enfant gt. (Les mres disent souvent : Il m'arrive de donner des coups. Elles
s'imaginent que par l elles ne peuvent tre souponnes d'avoir gt leur enfant.)
Disons tout de suite que nous ne comprenons pas sous ce terme un rapport sexuel
dans le sens freudien. C'est un enfant qui est dcharg de son fonctionnement ind-
pendant et autonome. Quelqu'un d'autre parle pour lui, remarque les situations
dangereuses, les carte de lui, bref il se laisse remorquer par lui. L'enfant dispose
d'une seconde personne, il construit sa vie en symbiose avec elle.
Pareil enfant prsente un caractre parasitaire, il essaye d'obtenir tout ce qu'il
dsire par l'intermdiaire de sa mre.
Il sait trs bien que la lchet est quelque chose de laid et maintenant il cha-
faude les pires mensonges.
Nous devinons de quelle nature sont ces mensonges, tant donn qu'il est tent de
se montrer, de se faire voir et apprcier. Comme nous avons entendu dire qu'il coute
ce que disent les grands, il se comportera sans doute dans ses mensonges comme un
hros.
Il raconte par exemple : tant en Angleterre et en regardant d'o je me
trouvais, au-del du coin d'un mur, je vis un tigre.
En soi c'est un gros mensonge. Mais ce qui m'intresse particulirement c'est qu'il
ne regarde pas seulement, il regarde aussi au-del du coin du mur . C'est de la
virtuosit; tout le monde n'y parvient pas. Mais cela nous dit encore beaucoup plus :
l'intrt du garon est particulirement marqu et il est incit vaincre des difficults,
difficults qu'il prsente comme insurmontables. Rappelons-nous cette occasion que
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 108
dans ces cas nous avons gnralement affaire des enfants qui prsentent une
infriorit de l'appareil visuel. Si maintenant je vous dis que ce garon est lche; vous
comprendrez d'o vient son intrt pour tout ce qui est visuel, pourquoi il est devenu
ce que l'on qualifie du terme nouveau d'eidtique. Dans son expression de vouloir
regarder au-del du coin du mur , se traduit la tendance de ce garon accomplir
des tours de force dans le domaine de la vue.
Une fois je rentre chez moi, la porte est ouverte, personne n'ose entrer, prs du
coffre se trouve un voleur, je saisis la hache et je le tue.
L encore il voit quelque chose et il accomplit un acte d'hrosme. La mre
constate avec justesse :
Il veut toujours jouer au hros, il veut toujours tre celui qu'on admire et qui
peut tout. S'il raconte : Aujourd'hui personne n'a rien su l'cole sauf moi , alors je
suis certaine que cela a mal march l'cole et rgulirement tout se confirme.
A cette occasion je voudrais clairer son mode de compensation, quoiqu'il soit
suffisamment apparent. Il semble compenser dans son imagination et l tout se perd
dans le nant. Il ne devient pas actif dans sa compensation. C'est encore ce que nous
avons exprim antrieurement : il est lche. Il a l'habitude d'tre aid par sa mre qui
fait tout sa place.
Je le comprends, je sais qu'il voudrait bien tre un bon lve et un garon coura-
geux, j'ai dj appris que ses mensonges ne lui servent qu' lever le sentiment de sa
personnalit.
Vous reconnaissez dj l la manire de voir de la psychologie individuelle. C'est
la voix du bon sens.
Je ne le punis pas.
Nous sommes tout fait d'accord avec la mre. Ce garon qui, de toute manire,
dsespre de son savoir et de son pouvoir, qui toujours, lorsqu'il doit raliser quelque
chose, se trouve comme en face d'un abme et recule avec raison, ne mrite pas d'tre
puni. Ce serait une injustice flagrante. Nous voyons dj ce qui devrait se passer : il
faudrait le faire avancer suffisamment pour qu'il reprenne courage et apprenne que les
problmes peuvent tre rsolus. Il pourrait bien se dvelopper s'il avanait. Cela ne se
ralisera pas tant que son but sera d'acqurir, sur le ct inutile de la vie, un sentiment
de valorisation et tant qu'il vitera la solution du problme sur le ct utile de la vie.
Tout lui sera bon pour prouver qu'il n'a rien faire sur ce ct utile. Nous compre-
nons pourquoi il ne faut pas punir un tel enfant; il n'y trouverait que la confirmation
de son incapacit et il emprunterait d'autres voies pour chapper la punition et pour
pouvoir reculer devant l'abme.
J'aime ce petit garon.
Une confirmation qui nous manquait et qui nous prouve que la mre gte cet
enfant.
Je l'aime de toutes les forces de mon cur. Mais il ment, il ment de plus en plus
et il craint qu'on n'aille dvoiler ses mensonges.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 109
L apparat l'espoir, la possibilit de le voir un jour cesser de mentir par crainte et
se rapprocher de la vrit. O reste alors son but de supriorit? Est-ce la seule
conclusion qu'un enfant comme lui puisse tirer? Il y en a encore une deuxime :
construire ses mensonges d'une faon si habile et si raffine qu'il puisse avoir l'espoir
de ne jamais tre dmasqu. Tel est le chemin qu'il doit parcourir ; il ne lui reste rien
d'autre, tant donn qu'il ne peut pas perdre compltement le sens de sa personnalit.
Il est devenu menteur pour reprsenter quelque chose et ainsi nous comprenons qu'il
ne puisse pas abandonner ses mensonges pour risquer de se prsenter comme un
zro , comme une quantit ngligeable. Il aura encore recours en effet des men-
songes plus subtils.
Mon mari dit que je le gte.
C'est une particularit que vous trouverez toujours. Si la sueur de votre front
vous avez dcouvert le style de vie de votre sujet, vous trouverez toujours dans son
entourage quelqu'un qui a dj dit cela. Vous souvenez-vous des manires d'agir de
nos adversaires psychologues, insistant sur le fait qu'ils disent eux aussi la mme
chose et se figurent que l'ayant dite, ils ont dj obtenu un rsultat? C'est exact,
l'enfant est gt. Mais comprend-il les rapports de l'ensemble? Mme s'il savait que
chaque enfant prsente une tendance la valorisation, serait-il capable d'en analyser
le processus d'apparition. Rien n'est encore fait si l'on dit qu'il est gt. On ne sait que
faire de ce mot. Les mres ont raison lorsqu'elles demandent : Comment devrais-je
m'y prendre pour ne pas le gter? Cette question prsente un aspect intressant tant
que la mre, elle, n'a pas encore saisi le rapport, comme nous le constatons dans le
cas prsent.
... Il prtend que c'est pour cela qu'il est aussi instable et menteur, et qu'en plus
il a un grain , tant donn que mon pre a pous une cousine.
Chez les grands-parents on a dcouvert une consanguinit. N'ai-je pas eu raison
de soutenir qu'on n'avait encore rien fait si, comme le disait le pre, on le qualifiait
d'enfant gt. Lui-mme n'y croit pas et cherche un deuxime motif qui semble plus
convaincant. Il met l'instabilit de l'enfant sur le compte de ses antcdents consan-
guins. Vous voyez quel point la science a facilit les choses ce pre, qui peut ainsi
faire endosser la mre la responsabilit des checs de l'enfant et s'en dgager
brillamment lui-mme.
Ce mariage entre consanguins est la maldiction de sa vie, il m'en fait tout un
plat . Ailleurs aussi il arrive qu'un enfant soit plus difficile qu'un autre, mais mon
mari ne se lasse pas d'en rendre responsable ce mariage entre consanguins. Il faut que
je lui prouve le contraire, il faut que je fasse quelque chose de ce garon. Il n'est pas
mchant, au contraire, il a bon cur.
Il est probable que sa bont n'est qu'un aspect de sa lchet. Vous voyez que nous
avons profondment raison de soutenir qu'on ne peut pas isoler un lment d'un style
de vie et que chaque lment peut s'interprter diffremment. La bont peut repr-
senter quelque chose de ngatif, la beaut devient laideur, la laideur beaut . C'est
cette diversit qui fait que personne n'arrive comprendre intrieurement un tre
humain s'il n'a pas saisi auparavant son style de vie.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 110
Il fait mme cadeau de ses affaires d'autres enfants dans le simple but de
gagner leur faveur.
Vous voyez que cette bont prsente un trait d'gosme, il essaye de corrompre les
enfants pour se faire gter par eux.
Il fait cadeau de choses qui lui sont chres et il aime son pre quoique ce dernier
ne le gte pas.
L je voudrais ajouter que dans une certaine mesure ce garon est dj dans cette
voie o il voudrait non seulement gagner sa mre mais aussi les autres. Comme nous
l'avons constat antrieurement, il cherche se faire protger et il voudrait tre
apprci et admir, c'est ce but que visent aussi ses mensonges.
Ainsi par exemple, c'est pour lui une grande fte de sortir avec son pre. Je vous
demande conseil. Dois-je procder avec svrit? Je ne crois pas que ce soit efficace!
Il pleure, il promet tout et dix minutes plus tard il a tout oubli.
Sa mre avait essay une ducation svre, mais videmment sans rsultat, la
seule mthode possible tant d'veiller sa comprhension pour les dfauts de structure
de son style de vie. Ce qui veut dire pratiquement : le rendre indpendant et auto-
nome, veiller en lui la confiance dans sa propre personne. Tant que ceci n'est pas
ralis, la svrit ou la bont semblent inopportunes, quoique nous prfrions la
bont. Ce garon n'est pas prpar, il est inhumain d'exiger d'un tre ce pour quoi on
ne l'a pas prpar. On est tout dispos mesurer exactement ce que peuvent rendre
les animaux et ne rien exiger qu'ils ne puissent fournir. Quant aux tres humains, on
ne s'en proccupe pas. Rflchissez limportance de cette remarque pour l'cole o
les enfants arrivent diffremment prpars. Employer le systme des notations qui,
dans le fond, juge la prparation de l'enfant et non ses aptitudes, c'est les mettre tous
dans le mme bain .
Ainsi il est oblig de mentir tant donn qu'il s'enlise de plus en plus dans ses
mensonges.
La mre sans s'exprimer d'une faon claire veut dire qu'il ne trouve pas d'autre
voie pour se faire apprcier.
Elle rclamait un conseil et je lui en donnai un dans le sens de ce que je viens de
vous indiquer brivement ici.
Mais dans la suite de ce compte rendu il se trouve peut-tre encore d'autres
passages importants.
Lorsque dernirement il recommena mentir, je fis comme s'il s'agissait d'une
plaisanterie et, en riant, je lui expliquait pourquoi il mentait.
Dans ce pourquoi vous reconnaissez les indications que j'ai donnes la mre.
Philippe, admettant son mensonge, se trouva gn et commena rire.
Le garon est profondment conscient de son mensonge qui se trouve donc dans
la sphre de sa conscience. Nous allons mettre l'preuve les auteurs qui prtendent
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 111
tablir une diffrence entre conscient et inconscient et croient que le mauvais instinct
se trouve dans l'inconscient et ne pntre dans la conscience qu' travers la censure et
comme voil. Que signifie ce mensonge? Si on pntre le conscient et qu'on ne se
contente pas seulement d'admettre le mensonge comme tel, alors on sait que ce der-
nier est un moyen pour se faire remarquer. Si nous examinons ce garon quant son
inconscient, nous verrons qu'il y cache un lourd sentiment d'infriorit qui cherche
se librer. A partir de ce sentiment d'infriorit nat la tendance se faire valoir. Ce
n'est donc rien d'autre que ce que nous voyons aussi dans le conscient.
Je commets videmment des erreurs. Dernirement, Philippe pria son pre de
l'accompagner au cimetire, car il devait faire une rdaction pour l'cole. Mon mari
refusa et il alla avec la bonne. Le lendemain la rdaction tait trs russie mais il n'y
avait pas un mot de vrai.
Je voudrais ici remarquer au passage qu'il n'est pas ncessaire que la rdaction soit
forcment vraie ; mais la mre a raison si elle retrouve dans la rdaction la mme
ligne de conduite que celle qu'il suit dans ses mensonges.
Il raconta en dtail comment il s'tait rendu au cimetire avec son pre et com-
ment ce dernier aurait pleur. A la fin il disait : moi je ne pleurais pas ; un homme ne
pleure pas.
Il a dpass son pre, en imagination seulement. La mre comprend trs bien cela.
Il a donc aussitt rabaiss son pre et il s'est donne lui-mme de l'importance
tout en mentant.
Il a rabaiss son pre et fait l'important. Qui de nos contemporains ne se
souvient pas du soi-disant complexe d'Oedipe ? Est-ce pour cela qu'il rabaisse son
pre et le fait pleurer au cimetire, ou bien ses aspirations le poussent-elles faire lui-
mme l'important et dpasser ce pre avec lequel il se trouve en lutte? Ne se
pourrait-il pas que se dveloppent ici des ides sexuelles prmatures sur le complexe
d'dipe, mais d'un complexe qui se trouverait lui aussi dans le conscient? Il s'agit de
rflchir cette question. Nous autres, psychologues individuels, nous n'hsitons pas.
Nous voyons que la ligne dynamique du psychisme tend pendant toute la vie d'un
en bas vers un en haut , et dans cette ligne est aussi inclus le dveloppement de
la sexualit.
Mais la rdaction a t bonne, l'instituteur a flicit le garon et, la fin du
cours, il a lu cette rdaction. Je n'ai pas eu le courage de le confondre. Je me suis tue
et je me suis donn l'air de ne pas avoir fait attention.
L se termine la description relative ce garon. Nous pouvons dire avec juste
raison qu'il fait partie de ce type si rpandu de menteurs qui veulent se donner de
l'importance. C'est la tendance vers laquelle sont entrans si souvent les enfants,
cause de leur petitesse. Rflchissez au point de dpart de ce garon, gt par sa
mre, opprim par son pre. Ce qu'il a pu acqurir auprs de sa mre n'a pas de valeur
en dehors du cercle de famille. Nous pouvons admettre que les enfants qui souffrent
de strabisme ne sont pas particulirement aims ; ils l'apprennent vite et comme
consquence ils ne comprendront pas le monde comme il est en ralit. Il n'est pas
tonnant que ce garon, ds ses premiers pas dans la vie, ait peru une rsistance et
un aspect particulier de la vie. Sa rponse est la fuite. tant donn que personne ne
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 112
peut chapper sa propre tendance ascendante, il doit trouver la ligne sur laquelle il
oprera : ce sera la fanfaronnade, le mensonge. Il existe aussi d'autres formes, mais
dans toutes vous trouverez la tendance sortir de sa position infrieure (par exemple
en dtournant les faits lorsqu'on est menac de punition), recouvrer de l'importance
par un subterfuge et se laisser remonter. Dans d'autres mensonges, dans les fanfa-
ronnades, nous pouvons toujours constater qu'il s'agit de choses vis--vis desquelles
l'enfant se trouve trop faible et auxquelles il essaye d'chapper, par son imagination.
C'est comme s'il voulait se hisser sur la pointe des pieds. Vous pouvez comprendre
quel point il est erron de punir svrement cet essai qui rsulte d'un vritable besoin.
Seule l'explication peut tre fconde. Il est inutile que tu t'esquives, que tu t'en tires
avec un mensonge, que tu fanfaronnes. Si seulement tu t'y attaques srieusement, si tu
fais un effort, tu pourras satisfaire tes tendances la valorisation par des occupations
utiles et tu ne seras pas oblig d'avoir recours des niaiseries.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 113
Chapitre XIV
L'hrosme dans l'imagination remplace
le rendement utile dans la ralit
Retour la table des matires
L'instituteur raconte qu'il a suivi l'enfant dont nous allons nous occuper
aujourd'hui, partir de la deuxime classe. Ce garon g de neuf ans fait preuve de
brutalit dans sa conduite.
Il ne ressort pas de ces renseignements si l'enfant avait neuf ans lorsqu'il tait en
seconde ; nous esprons qu'actuellement il frquente la troisime classe.
A son entre l'cole il barbouillait encore, ce n'est que petit petit qu'il apprit
crire.
Nous nous souvenons que sa conduite est rude, il a sans doute un temprament de
lutteur. Il appartient probablement cette catgorie de gens qui jurent sur l'idal du
hros, sur le code de l'honneur . Pourquoi a-t-il appris si difficilement crire?
Nous pensons qu'il est gaucher, mais ce n'est pas certain.
C'est surtout le calcul qui est son point faible.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 114
L non plus nous ne nous trouvons pas sur un terrain ferme. Peut-tre appartient-il
aux enfants gts qui prouvent tant de difficults en calcul, cette matire n'offrant
aucun appui. Dans les autres matires, il existe des rgles, on peut apprendre quelque
chose par cur ; pour le calcul, c'est inutile, sauf pour la table de multiplication. tant
donn que les enfants gts ne veulent jamais rien faire spontanment, nous ne
sommes pas tonns de trouver de mauvais calculateurs parmi eux. Si statistiquement
nous pouvons le prouver, la superstition du don s'en trouverait branle.
Dans cette matire il reoit des cours supplmentaires.
Ainsi l'enfant arrive obtenir qu'on s'occupe de lui, ce qui, en quelque sorte,
revient encore se faire gter.
Il frquente volontiers ces cours supplmentaires.
Nous ne savons pourquoi. Peut-tre l'instituteur est-il aimable, peut-tre l'enfant
trouve-t-il l ralises les conditions qu'il demande l'enseignement, savoir se faire
gter.
Il aime qu'on s'occupe spcialement de lui.
Voici la premire confirmation : il s'agit bien d'un enfant qui dsire se faire gter ;
d'autres confirmations suivent :
Il demande une aide pour s'habiller, on le conduit l'cole et on l'en ramne, il
ne fait jamais le chemin seul. Il est pourtant grand et bien dvelopp pour son ge. Il
a des cheveux roux.
A propos des cheveux roux, on sait qu'ils exposent les enfants des moqueries
dont ils souffrent. Les garons plus que les filles ; chez celles-ci on les trouve souvent
jolies. Par contre, les garons roux ne sont pas particulirement aims. Ce sont des
superstitions archaques qui reprsentent des erreurs grossires : en effet parmi les
enfants qui offrent des difficults nous trouvons souvent des roux. C'est une
constatation qui m'a t confirme de diffrents cts, mais ce ne sont pas des dfauts
prsentant un caractre dfinitif. On a l'impression que finalement ces garons
arrivent malgr tout surmonter leurs difficults. S'il n'est pas particulirement
agrable d'tre l'objet de railleries au-dehors, au sein de sa famille il en va diff-
remment, le sentiment d'infriorit y pse assez peu.
S'il excute mal un travail et que sa mre le critique, il devient furieux.
Ce qui veut dire qu'il a pu tablir entre lui et sa mre un rapport par lequel il l'a
rendue dpendante. Il y parvient par sa fureur, parfois peut-tre par des coups qu'il
reoit. On voit cela frquemment car on peut arriver, avec les enfants gts, un
point o on ne peut plus les gter de la mme faon. Ainsi sont-ils menacs d'une
aggravation par la nouvelle situation ne du fait qu'ils grandissent.
Si on le loue, il s'encourage lui-mme en se disant que cela marchera.
Nous y trouvons la preuve qu'il n'est pas compltement dcourag.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 115
Il a appris normalement parler et crire.
Nous pouvons en dduire qu'il n'a pas rencontr de difficults dans son dvelop-
pement organique.
Depuis l'ge d'un an et demi il montre des signes de colre.
Si cette observation est juste, il faudra bien la retenir. Personnellement j'ai pu
constater ces signes, mme chez un enfant de six mois : il s'agissait d'un enfant,
nourri au biberon, qui se dveloppait trs bien, s'alimentait rgulirement et ne
prsentait aucune difficult. A l'ge de six mois on constata la particularit suivante :
lorsque ce bb s'veillait, il gmissait doucement ; si on s'approchait de lui avec le
biberon et qu'il pt boire il se conduisait d'une faon parfaite, mais si on se prsentait
sans biberon, il commenait hurler furieusement avec des signes manifestes de
colre. On avait pris l'habitude, dans la famille, de se prsenter toujours cet enfant
avec le biberon.
A l'cole, il avait au dbut une conduite efface.
Nous le comprenons facilement : il cherche la situation o il pourra se faire gter.
Il veut tre le point de mire de l'attention, il veut diriger. A l'cole, ne trouvant pas
une telle occasion, les enfants ont une attitude efface, c'est ce signe que nous pou-
vons reconnatre l'enfant gt. A l'aide de la psychologie individuelle, les instituteurs
peuvent trs facilement obtenir ainsi le portrait moral de l'enfant. Ils peuvent btir sur
cette base, non sans chercher videmment des confirmations et sans procder des
corrections ventuelles.
Son imagination est grande.
Nous pouvons en dduire qu'il n'est pas en bons termes avec la ralit parfois
gnante. Il se construit un monde imaginaire dans lequel il vit l'aise. L il trouve la
tranquillit, il est puissant, il peut commander comme il le dsire. On imagine ici des
conqutes, des luttes victorieuses, l'acquisition d'une fortune immense avec laquelle
on rcompense et on sauve les autres. De tels enfants se considrent aussi parfois
comme les sauveurs de personnalits suprieures. Dans leur imagination ils ont des
chevaux emballs, sauvent le roi ou sa fille, se jettent l'eau pour sauver les prin-
cesses, qui, videmment, se montrent trs reconnaissantes. Lorsqu'ils se retrouvent
sur la terre ferme de la ralit, ils se montrent trs effacs.
Ses penses fourmillent d'histoires de peaux-rouges et de brigands.
C'est un hros en imagination, Vous pouvez en tre sr, ce garon est lche ; il y a
l un essai de compensation de sa part.
Il a toujours tendance lutter contre un ennemi invisible.
On peut utiliser cette imagination et le garon pourrait duquer son psychisme
contre la lchet. Quels qu'ils soient, ces enfants russissent certainement par ce
moyen se librer au moins en partie de ce dfaut.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 116
Son imagination s'emballe parfois, il raconte sa mre des vnements ima-
ginaires survenus l'cole et il dit la fin : Tu sais, maman, tout cela est faux, je
me le suis imagin.
L aussi on trouve un petit bout de sentiment social. Il ne voudrait pas passer
pour un menteur, il garde le contrle de la ralit sa porte. S'il ne l'avait pas, ce
serait un mensonge nvrotique. Mme si les enfants s'chauffent leur jeu, ils savent
ce qu'ils doivent la ralit. Ce qu'il raconte dans son imagination prouve que le
garon veut se hisser sur la pointe des pieds et paratre plus qu'il n'est. Nous pouvons
en dduire qu'il a un sentiment d'infriorit puissant, ce qui est en rapport avec le
qualificatif d'enfant gt que nous lui avons dcern.
Sa mre raconte qu'il a t trs malade dans sa premire enfance : coliques
intestinales quatre mois, scrofule plus tard et pneumopathie.
Nous ne pouvons pas nous permettre un jugement, ni dire jusqu' quel point la
mre a raison de considrer l'enfant comme tant trs malade. Ce qui nous intresse
davantage est le fait que, l'ayant considr comme tel, elle a d l'lever avec des soins
et un amour particuliers. Elle a d rendre cet enfant extrmement dpendant d'elle.
Si un enfant est malade, il faut le mnager, dit-elle.
Elle exprime d'une autre faon ce que nous venons de dire sur l'enfant.
Il a peur de l'obscurit.
Voici nos signes de l'enfant gt. Avoir peur de l'obscurit signifie : Il faut que
quelqu'un reste auprs de moi.
Il est trs maladroit.
Notre hypothse sur la possibilit de le considrer comme un enfant gt se trouve
ainsi renforce.
Dans sa maladresse, il est mal influenc par sa sur, de huit ans son ane.
Nous entendons parler d'une sur de huit ans plus ge et nous pouvons supposer
qu'elle ne se conduit pas vis--vis de lui comme une sur, mais comme une mre ou
une tante. Le garon pouvant difficilement la considrer comme une rivale grandit
comme un enfant unique.
Elle intervient dans ses efforts en critiquant et en bougonnant.
Elle est comme une mre qui critique, on pourrait dire comme une belle-mre.
Il est trs agressif...
Il sait que sa mre est derrire lui pour le dfendre. Il sait que sa sur ne pourra
pas aller trs loin s'il arrive l'entraner dans la lutte.
Surtout vis--vis des plus forts que lui.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 117
Ce renseignement semble suspect. Je ne suis pas dispos croire que ce soit
entirement exact. S'il ne l'est qu'en partie, l'enfant n'est pas tout fait dcourag, il
se croit capable de quelque chose. Mais ce n'est pas encore de l'hrosme, car les plus
forts sont probablement, comme sa sur, les membres de sa famille. Peut-tre aussi
s'attaque-t-il l'instituteur qui nous apparat comme quelqu'un de fort ; mais mme l
il n'est pas dit que ce garon le voie sous le mme angle. Il peut avoir le sentiment
que l'instituteur n'existe que pour lui.
On se moque souvent de lui cause de la couleur de ses cheveux, il devient
alors furieux.
C'est, comme nous le constatons, un enfant gt qui, tant par la faute de sa sur
que du fait de la couleur de ses cheveux, se trouve systmatiquement dans un tat
d'excitation. On peut rendre furieux un animal en l'excitant, et on y arrive de la mme
faon chez ce garon.
Il rve haute voix et son sommeil est agit.
Nous avons toujours constat ces signes chez les enfants gts.
Il est trs agit lorsqu'il fait ses devoirs.
Si nous devons interprter cette excitation, nous dirons que, par ses devoirs, il est
plac dans une situation tendue et que cette tension se traduit par son agitation.
Il est sauvage et il s'entend difficilement avec les autres.
Nous pouvons le comprendre, il se trouve dans un tat d'excitation chronique.
Mais il est aussi charitable.
Cela n'est pas une contradiction. Je ne vois pas pourquoi, tenace en face de son
ennemi, il ne ferait pas preuve de charit en rencontrant quelqu'un qui souffre. Celui
qui trouve ici une contradiction croit la thorie de l'ambivalence. Nous disons pour
notre part : le mme style de vie s'extriorise diffremment dans diverses situations.
Sa piti se manifesta un jour o sa sur s'tait blesse la tte.
Elle tait alors l'ennemie vaincue. Nous dirons qu'il s'est gard une certaine dose
de sentiment social et qu'il est capable de se montrer humain dans une situation qui
lui est favorable.
Il observe scrupuleusement l'heure d'entre l'cole.
Je n'ose pas interprter cela de faon prcise. Si je recherche les rapports avec ce
que nous savons dj, je dirai : il tend a progresser, il veut dmontrer l'importance de
l'cole ; ce qui correspond galement au zle qu'il met frquenter les cours suppl-
mentaires. Il n'est pas trop dcourag, il voudrait un jour tre vainqueur.
La mre elle-mme est trs nerveuse et perd patience facilement.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 118
Voici une nouvelle difficult pour un garon qui se trouve dans un tat d'exci-
tation chronique et nous comprenons mieux maintenant pourquoi souvent il devient
furieux.
Pendant la journe, le pre est au thtre o il est lectricien. La famille est
dirige par la mre.
L aussi il se tourne contre le plus fort.
La mre est une femme forte, criarde, qui se donne beaucoup d'importance, ainsi
que la sur. On lve l'enfant en le critiquant sans cesse.
Voil un supplment d'attaque, provoqu par la mre, qui accentue encore l'exci-
tation du garon.
Le pre est bon pour lui.
Il nous semblerait normal que le garon se joigne davantage au pre ; ce qui serait
la seconde phase. Pendant la premire partie de sa vie, il tait certainement plus prs
de sa mre, tant un enfant malade. Elle a d s'en occuper et le gter. Il est probable
que plus tard, il n'a pas pu maintenir ce rapport entre elle et lui.
Si l'enfant dsire quelque chose et ne le reoit pas, il pleure, tant que son dsir
n'est pas exauc.
Il est ttu et il sait que ses pleurs font impression. Nous retrouvons ce trait chez
beaucoup d'enfants et chez beaucoup d'adultes. Ils ont l'impression que leurs larmes
constituent une arme invincible. Ajoutez cela qu'il existe des gens qui ne supportent
pas de voir pleurer quelqu'un. Ils sont obligs d'exaucer son dsir ou bien alors ils
manifestent les signes d'une extrme agitation. L'un ou l'autre suffit celui qui pleure.
La mre : Moi, je suis plus svre avec lui, mais mon mari lui cde en tout.
Nous savons que ce n'est pas la bonne mthode tant donn que l'enfant, attach
son pre, aura tendance exclure encore davantage sa mre. Il vaudrait mieux que les
parents s'entendent pour trouver une ligne de conduite qui les satisfasse tous les deux.
Il faut qu'ils s'aident mutuellement.
Je ne cde pas toujours.
C'est la confirmation de ce que nous savons dj.
Le frre et la sur se querellent souvent. La sur a aussi ses dfauts ; elle
l'excite toujours. Mais il veut toujours avoir raison et il est trs autoritaire.
De plus il est le benjamin, et comme tel A dploie beaucoup d'efforts et de
persvrance pour dpasser les autres. Si les difficults apparaissent, il cherche les
contourner par une voie plus facile. Les benjamins finissent toujours par trouver la
voie qui leur assure la domination sur les autres, dans le bien ou dans le mal.
Le garon voudrait tre lectricien comme son pre.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 119
Le pre reprsente une tape dans ses tendances idales vers la supriorit. Qu'il
veuille devenir ce qu'est son pre dmontre son admiration pour lui. Il croit que la
profession du pre reprsente tout simplement un pouvoir divin.
Mais il voudrait aussi devenir chasseur.
Nous pouvons comprendre ce dsir partir de sa tendance jouer au hros ; mais
ce rle, il ne le joue pas jusqu'au bout. Il voudrait chasser les animaux sans dfense,
ce qui n'est pas prcisment le rle du hros.
Ses jouets prfrs sont les armes. Il n'a pas d'ami.
L ressort le trait de caractre d'un enfant gt qui ne russit pas se lier d'autres
enfants. Par sa tendance la domination, il gte tout.
Il ne s'entend avec personne. C'est un trouble-fte.
Il n'a pas confiance en lui, mme lorsqu'il s'agit de jouer le premier rle dans les
jeux ; il prfre troubler la fte.
Son imagination prend son point de dpart dans la ralit.
Renseignement obscur, car on peut le dire de toute imagination. On ne peut
admettre qu'il soit possible de trouver quelque chose qui ne soit pas li la ralit.
Ces derniers temps il aurait toujours voulu pntrer dans la jungle.
Il est probablement le matre de la jungle, arm de canons (les btes n'ont pas
d'armes).
Il joue son rle de hros devant la glace.
Ce qui nous suggre l'ide qu'il pourrait, ventuellement, entreprendre une
carrire d'acteur. C'est peut tre mme la voie habituelle ; tout acteur au dbut de sa
carrire a probablement jou au thtre le rle d'un hros. Jamais je n'ai vu notre
pense jouer le rle de la petite vieille, ce serait plutt celui de la Pucelle d'Orlans.
Il brandit son pe de bois devant la glace et, lorsqu'il a fini, il dit avec
satisfaction : Maintenant tout est abattu.
Nous retrouvons ici le trait que nous avons pu observer chez beaucoup d'enfants :
ils s'entranent dans une aptitude particulire et s'identifient avec une situation. Ils se
conduisent comme s'ils jouaient vraiment un rle de hros. Ils sont intrieurement
remplis du sentiment d'tre ce qu'ils voudraient tre. Chaque homme a cette possi-
bilit. Elle se manifeste l o la ralit est trop gnante, o on se heurte des diffi-
cults dans ses tendances ascendantes. La rsistance est claire : il est molest par sa
sur, critiqu par sa mre, cause de ses cheveux on se moque de lui au dehors et,
l'cole, il ne joue pas de rle brillant. Si quelqu'un nous posait le problme : admettez
que vous ayez neuf ans, que personne ne vous estime la maison ou au dehors, qu'en
plus vous soyez le benjamin, que feriez-vous? Il ne resterait qu'une possibilit : se
rfugier dans l'imagination, y puiser ce que la ralit nous refuse. Je vous prie de le
retenir : agir ainsi n'est pas logique. L'intelligence d'un adulte, surtout d'un ducateur,
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 120
objecterait : il faudrait que ce garon fasse plus d'efforts l'cole. Nous ne savons pas
s'il ne s'y est pas employ. Peut-tre l'a-t-il fait sans rsultat. Nous comprenons que
cette question ne semble pas facile au garon. Peut-tre est-il gaucher sans le savoir,
ce qui fait qu'il a lutt avec de relles difficults. Sachant qu'il a abord l'existence
avec le style de vie d'un enfant gt et qu'il assimile tout d'aprs le schma d'un tel
style, nous devons dire : il agit d'une faon parfaitement intelligente ; il n'y a pas de
faute dans ce qu'il fait. Nous le disons parce que nous pouvons nous identifier avec
lui. Si je me trouvais la place de ce garon et si j'prouvais exactement les mmes
difficults, j'agirais probablement de la mme faon. Cela prouve que le garon n'est
ni faible d'esprit, ni coupable. Il se trouve dans une situation difficile, sans issue. Le
traitement peut alors russir sous diffrentes conditions, par exemple si le garon
devient meilleur lve : rsultat possible par des cours supplmentaires. Il ressentirait
certainement une amlioration si on tait la parole la mre et la sur, du moins
pour un certain temps, et si on pouvait surtout leur faire comprendre qu'elles ont nui
ce garon. Il faudrait essayer de l'aider. Il faudra tout expliquer d'une faon aimable,
sans quoi on risquera de voir ces deux caractres agressifs se retourner contre le
conseiller. Le fait le plus important est de rendre le garon indpendant et de l'encou-
rager. Pour encourager quelqu'un, il n'est pas ncessaire d'tre expert en matire
d'ducation ou de psychologie. Mais ce ne sera pas une tche facile. Le garon s'est
embourb dans cette conviction qu'il ne pourra jouer un rle hroque que dans son
imagination. Il serait trs utile qu'on lui trouvt un camarade capable de reconnatre
ses bons cts. La seule voie sre est le traitement par la psychologie individuelle. Il
faut attirer l'attention du garon sur ce qui s'est pass. Il faudrait lui montrer que celui
qui s'efforce sans cesse de se trouver au centre de l'attention des autres, sera toujours
expos des vexations. Il doit chercher une satisfaction sur le ct utile de la vie. Par
exemple, il devrait prendre part aux jeux au lieu d'tre un trouble-fte. Il faudrait lui
rvler qu'il existe toute une srie d'injustices dans l'humanit et que souvent les gens
trouvent le moyen d'opprimer les autres. Cela se passe partout de la mme faon. Un
peuple veut-il en rabaisser un autre, une famille se croit-elle plus leve qu'une autre,
on met alors l'accent sur certaines choses pour trouver un point d'attaque. Mais cela
n'a lieu qu'autant que l'autre s'y prte. Le garon doit comprendre qu'il n'est pas l
pour servir de cible aux autres en les laissant l'agacer. De mme dans la vie, si
quelqu'un manifeste de l'agacement, l'attaquant persiste. Il devrait considrer l'attaque
propos de ses cheveux rouges comme la marque de la btise de celui qui la lance.
J'ai eu l'occasion de converser avec de nombreux tres appartenant des races
opprimes, avec des juifs et des ngres ; j'ai attir leur attention sur la trs grande
gnralisation de cette tendance opprimer son prochain. Chacun cherche trouver
le moyen qui lui permettra de s'lever peu de frais. On ne peut nier que le Franais
considre l'Allemand comme un infrieur, alors que l'Allemand se considre, lui,
comme appartenant une nation lue. Le Chinois ddaigne le Japonais. Ceux qui ont
l'habitude de voyager ont trouv que les hommes sont partout peu prs semblables
et toujours enclins trouver quelque chose pour rabaisser l'autre. On voit encore cela
entre le bourgeois et le proltaire. Existe-t-il un tre humain qui n'ait pas senti la
jalousie et l'envie des autres envers lui? Pourquoi serait-on oblig de prendre au
srieux les critiques et les vexations dont on peut tre l'objet sur des questions de
nations, de confession ou mme de couleur de cheveux? Ce n'est que la cristallisation
concrte d'une tendance commune, d'une nvrose obsessionnelle gnralise.
Jusqu'au moment o l'humanit consentira faire un pas en avant dans son degr
de civilisation, force nous est de considrer ces tendances hostiles non pas comme
tant des manifestations spcifiques, mais comme tant l'expression d'une attitude
humaine gnrale et errone.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 121
Il faudrait amener ce garon comprendre que les gens vous attaquent mme
cause de la couleur de vos cheveux! S'il arrivait saisir ce qui constitue un point
d'attaque permanent, celle-ci du reste pouvant se rapporter d'autres caractres, il en
rirait, ce qui aurait pour effet d'ter quiconque l'envie de l'attaquer. Nous arriverons
encourager ce garon, nous nous rapprocherons de lui avec des moyens que nous
fournira la psychologie individuelle. On pourra mme lui dmontrer qu'il est capable
de devenir bon en calcul. Il en existe de nombreux exemples. Moi-mme j'ai connu
cette souffrance et je passais pour parfaitement inapte en matire de calcul. Si mon
pre avait suivi les conseils qu'on lui donna alors, s'il m'avait retir de l'cole pour me
faire apprendre un mtier manuel, je serais peut-tre devenu un trs bon serrurier,
mais j'aurais vcu dans la conviction qu'il existe des gens dous pour le calcul et
d'autres qui ne le sont pas. M'tant trouv moi-mme dans ce bourbier je peux donc
dire, en toute connaissance de cause, que je n'y crois plus.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 122
Chapitre XV
Trouble-fte
Retour la table des matires
Les lves G. et S. se prsentent la consultation. Ce ne sont pas des cas extraor-
dinaires, mais des types courants de trouble-fte, qui veulent se faire remarquer tout
prix et contre lesquels l'instituteur s'nerve inutilement et mne une lutte strile.
L'un, que je voudrais prsenter en premier lieu, est g de huit ans, l'autre a sept
ans. Tous les deux frquentent la deuxime classe, l'an ayant d redoubler sa classe.
L'anne dernire ils frquentaient la mme classe mais furent spars, car ensemble
ils auraient rendu tout enseignement impossible. Spars, ils sont plus supportables,
quoique leur absence se fasse ressentir d'une faon bienfaisante autant pour le person-
nel enseignant que pour la classe. La cause du dfaut caractriel est diffrente chez
les deux garons. G. est, d'aprs les renseignements de la mre, l'enfant d'un alcoo-
lique. Le pre est cocher, ainsi qu'un frre, g de 17 ans. Un frre, g de 16 ans, fait
avec sa moto des courses pour un boulanger, un autre frre, g de 14 ans, est
apprenti boulanger. En plus, il y a dans la famille un benjamin de cinq ans. Le garon
en question frquente l'cole tous les matins, l'aprs-midi le patronage. Il passe son
temps libre l'curie o il accompagne les cochers bien connus de lui. La mre doit
travailler ; elle sert prcisment chez le boulanger o ses fils travaillent. Elle ne voit
pas le garon de toute la journe, car il est interdit ce dernier de la voir, mme pour
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 123
un renseignement, probablement parce que le patron craint ses tours. La maison
paternelle est remplie de disputes et de querelles. La mre reconnat, au moins en
partie, les dfauts du garon, mais elle ne peut rien faire contre lui. Il est en effet le
prfr du pre et ce dernier le dfend contre tout le monde. Les promesses et les
rcompenses d'argent sont utilises dans la maison paternelle comme principal moyen
d'ducation. A l'occasion des ftes on y boit et les couplets les plus vulgaires
jaillissent d'un phonographe, couplets qu'videmment le garon assimile avec le plus
grand intrt en guise de bien spirituel. Il parat qu'on emmne aussi l'enfant
l'auberge o on lui sert des boissons alcoolises, mais il est difficile d'tablir ce fait
d'une faon certaine, ce garon faisant preuve, dans ce qu'il raconte, d'une grande
imagination, alors que, d'autre part, les parents nient pareille conduite. L'enfant reoit
aussi de l'argent pour s'acheter des saucisses l'auberge, pendant que les parents vont
au cinma ; c'est du moins de cette faon qu'il explique la provenance d'une pice de
50 centimes qui se trouvait dans sa poche.
Ses aptitudes sont au-dessous de la moyenne, il n'est pas travailleur. Il rapporte
rarement un devoir, oublie le cahier et ne trouve l'tude aucun plaisir. A l'cole il ne
collabore volontairement qu'au dessin et, la rigueur, l'criture. Il ne semble
prouver un rel intrt que pour les chevaux. Pendant et aprs l'anne scolaire il n'a
jamais t srieusement malade. Son attention est dtourne par la moindre futilit.
On ne peut pas tablir d'une faon certaine s'il ment volontairement ou s'il ne fait que
dbiter les produits de son imagination. Il raconte, par exemple, avoir t avec son
pre tel ou tel endroit, avoir frquent en sa compagnie telle ou telle auberge, avoir
pass la nuit chez sa tante, alors que, d'une faon certaine, on a pu tablir qu' ce
moment-l il n'avait pas quitt son domicile. Ou encore il soutient avoir vu la
campagne qu'on dterrait les pommes de terre avec une charrue, simplement parce
qu'un autre garon l'avait racont. Il manque totalement de sens critique. Il fait tou-
jours ses travaux d'une faon dsordonne. Dans sa volont, il est facilement
influenable et il se dcide vite.
A l'cole il fait tout pour attirer l'attention sur sa personne il crie et se querelle
pendant la rcration, mais aussi frquemment pendant l'enseignement. Il bat ses
camarades et avoue avoir cherch les faire souffrir. Il ne tient pas compte des
remontrances quon peut lui faire. Les fonctions dont on le charge sont utilises pour
se quereller et pour faire des btises ; frquemment il tache volontairement les vte-
ments de ses camarades. Quant aux siens, mme neufs, il ne les mnage pas. Pendant
un certain temps, il voulait les laver l'cole. Pendant la classe, il chante. Tout ce que
disent les autres est critiqu haute voix et il gne ainsi l'enseignement. Il corrige
volontiers les rponses exactes de ses camarades en se trompant d'ailleurs et il bat les
lves qui veulent rpondre. Il se moque de l'instituteur, si celui-ci dit : Je sais qui a
fait cela , il crie : Si seulement c'tait vrai! Dans la rue il singe cet homme ; il est
brutal envers gens et btes.
Ne prsentant pas de dlit de vol, il cache toutefois les objets trouvs. Il a t
impossible de le garder dans la classe avec son ami S. Si on devait les faire travailler
dans le bureau ou s'ils devaient se joindre une autre classe lorsque j'avais rem-
placer un collgue, ils se conduisaient gentiment, parce qu'il leur manquait la
connaissance du climat de cette classe, ou du moins la connaissance de ses lments.
De toute faon, les garons isols se conduisent d'une autre manire que lorsqu'ils
sont ensemble et se renforcent mutuellement. Je propose donc de les observer
ensemble et isols. Depuis un mois les deux amis sont spars et G. se trouve dans
une autre classe, o il est le fardeau d'un autre instituteur. L il dessine pendant que
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 124
les autres traitent un sujet, ou il met des remarques superflues qui font rire toute la
classe ; il emploie des mots trs vulgaires. Ds que l'instituteur tourne le dos il quitte
sa place et commence se quereller. Pendant la rcration il faut l'isoler, sans quoi il
bat ses camarades et il les pitine. Dans la salle de gymnastique, il grimpe rapidement
sur les agrs et hurle en mme temps. En ce qui concerne la soire actuelle il
remarque, videmment sans qu'on lui en pose la question (en argot) : je sais bien
que le directeur demandera si je suis gentil ou si je suis mchant. Je dirai gentil. Je
m'en moque. Je vais me cacher cinq heures et six heures et demie personne ne
pourra me trouver. Je dormirai, ils peuvent toujours essayer de me rveiller. Ma mre
travaille jusqu' neuf heures du soir !
Le cas S. s'explique autrement. Sa mre est atteinte d'une nphrite grave et elle a
reu avant la naissance de l'enfant de nombreuses injections. A l'ge de cinq ans, le
garon s'est laiss glisser sur la rampe de l'escalier du deuxime tage jusqu'au
premier et de l il est tomb. Il a t emmen sans connaissance l'hpital o il est
rest quelque temps en observation sans qu'on ait pu constater quelque chose. Jusqu'
son entre l'cole - nous dit la mre - le pre tait entich de lui ; le garon tait trs
mchant, ne rentrait que tard dans la soire et la mre ne pouvait rien contre lui. Il
demandait souvent : Quand vas-tu mourir? quand iras-tu l'hpital? Aprs les
premires plaintes l'cole, le pre devint particulirement svre envers son fils,
mais sans rsultat. Le pre tait agent de police, actuellement il reste la maison.
L'anne dernire est ne une petite sur et cet vnement provoqua la jalousie du
garon. La mme anne on lui enleva les amygdales et il fut trs malade. Il demanda :
Pourquoi me vaccine-t-on et m'opre-t-on moi, et non pas la petite sur? Si la
mre le menace de le mettre en pension, il dit qu'il aime bien mieux tre en pension
que chez lui. Ses rapports avec un oncle et une tante qu'il aime plus que sa mre, ne
sont pas trs clairs. Il ne dissimule pas cette prfrence qu'il accorde son oncle et
sa tante. Il n'est pas exclu que l'aversion vis--vis de sa mre y trouve ses racines.
Pendant l't toutes les classes passrent leurs rcrations au jardin et il s'exprima
ainsi au sujet d'une fillette trs soigne : J'aimerais bien l'embrasser. Je l'ai pris
part et lui ai demand d'une faon amicale pourquoi il dsirait cela, et si, d'une faon
gnrale, il aimait embrasser les autres. Finalement, je lui conseillai d'embrasser sa
mre, ce qu'il refusa violemment. En ce qui concerne cette histoire de baiser, banale
en elle-mme, je crois avoir compris que ce garon semble manquer fortement
d'amour chez lui. Je fis venir la mre et je lui suggrai d'essayer de redresser la
situation par un baiser et bien souvent par de l'amour, plutt que par les coups qu'elle
lui donne actuellement. Mais l je me heurtai une rsistance farouche : Chez eux,
cela ne se faisait pas.
Du reste le garon est physiquement trs bien entretenu, mais il ne fait pas plus
attention ses affaires qu' ses fournitures d'cole. Les parents veillent svrement
ce qu'il fasse ses devoirs. Ses aptitudes sont au-dessus de la moyenne, son attention
facile dtourner. Lui aussi est un travailleur et il voudrait tout faire lui-mme. D'une
faon gnrale sa volont est facile influencer et il se dcide vite. Pendant la classe
il interrompt l'instituteur, n'coute pas les remontrances, frappe, sans aucun motif, des
lves assis loin de sa place, leur jette sa serviette, ou les blesse au visage avec ses
sandales de gymnastique. Il se couche aussi sur le pupitre, jette des chtaignes dans la
salle, siffle et chante, fait des remarques sur chaque mot de l'instituteur et de ses
camarades. Il substitue des crayons de couleurs et soutient que ce sont les siens.
Lorsque la classe ralise des jeux de construction et qu'on les accroche au mur, il en
enlve des lments pour les faire disparatre dans son cartable. Il jette frquemment
terre les ncessaires de travail et lorsqu'il les ramasse, il en retire les ciseaux.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 125
Les fonctions honorifiques dont on le charge pour l'amliorer seront mal excu-
tes et ne seront pour lui que l'occasion de faire des btises ou de se quereller. Il
asperge les murs et les images avec une ponge. Il croit cette conduite hroque. Il
fanfaronne, par exemple en racontant qu' l'hpital il a chapp l'injection en se
sauvant. Son ami G. coute ses histoires bouche be. Si on accuse S. de quelque dlit,
il nie violemment et en impute ventuellement la faute G. Des discussions et des
dnonciations mutuelles sont des procds ordinaires chez ces deux garons. S.
accuse aussi certains camarades de dfauts imaginaires. La dcision de ses parents de
l'amener aujourd'hui la consultation l'a d'abord outr, surtout lorsqu'il s'est rendu
compte qu'il ne s'agissait pas d'une visite gnrale.
A l'cole on avait dj tout essay, avec des rsultats ingaux d'ailleurs, pour
changer ces deux garons. Tous ces moyens ducatifs restrent sans suite. Exhor-
tations bienveillantes, promesses d'exaucer un dsir, charges honorifiques, appel au
sentiment de l'honneur, perspective de l'avenir, veil de la comprhension, explica-
tions leur montrant combien il serait pnible pour eux si d'autres agissaient de la
mme faon, exclusion d'un cours qu'ils aiment, travail individuel la direction, etc.
Rien n'y fit. On peut raisonner S. de temps en temps, mais G. n'a qu'un sourire pour
tout cela. Le moyen le plus efficace jusqu' prsent tait un vritable regard de
dompteur , mais on ne peut videmment pas en user constamment.
Dr A : Il n'est certes pas difficile d'arriver une conclusion d'ensemble au sujet de
la description prsente de ces deux garons runis, qu'il faudra considrer, non
seulement du point de vue de la psychologie individuelle, mais aussi du point de vue
de la psychologie sociale. Ils paraissent diffrents lorsqu'ils se trouvent ailleurs mais
ils sont toujours les mmes. Il faudrait loigner ces garons de chez eux et les placer
comme pensionnaires, pour un ou deux mois. Ce placement me parait un devoir
envers l'avenir de ces enfants. De mme, des cas particulirement difficiles doivent
tre placs dans de semblables institutions qu'on pourrait qualifier de maisons de
convalescence, o les garons seraient bien traits, mais o on pourrait les tudier
fond et clairer les enfants eux-mmes sur les causes de leurs dfauts. C'est notre
devoir de trouver ces claircissements et je veux essayer de vous reprsenter le type
de ces deux garons sous un aspect simplifi.
Le premier cas est un garon de huit ans que caractrise surtout le fait qu'il a d
redoubler sa classe, il se trouve au-dessous de la moyenne et s'intresse particu-
lirement aux chevaux.
Ce garon ne collabore pas l'cole. si nous laissons de ct les faits et si nous
regardons comment ce garon se comporte, se meut et quelle attitude il prend vis--
vis des exigences de l'cole, nous pourrons dire qu'il est en train d'exclure et de
refuser toutes ces exigences. La cause se trouve dans son opinion, car il croit ne pou-
voir rien russir l'cole. Cette cause me semble suffisante, car si je devais m'iden-
tifier avec ce garon et me reprsenter que je ne pourrais rien russir, si on m'obli-
geait malgr tout frquenter l'cole, je me considrerais de la mme faon que lui le
fait. Or si nous pouvions brusquement veiller l'attention de ce garon et lui expliquer
qu'il pourrait trs bien russir car il a tort de croire qu'il n'est dou que pour l'curie et
pas du tout pour l'cole, il serait possible d'veiller son intrt pour cette dernire. Il
faudrait videmment essayer de lui apporter une aide personnelle et de lui rendre
facile, au bout d'un certain temps, une russite dans une matire de l'enseignement.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 126
Nous savons que de par les conditions familiales, tout le milieu ne s'intresse
qu'aux chevaux, aux auberges et aux grivoiseries. Il ne faut pas compter que ce milieu
veille son intrt pour l'cole. Ce doit tre quelqu'un d'autre, et on pourrait exiger ce
rle d'une maison comme celle dont j'ai parl antrieurement. Cependant, tant donn
que nous ne disposons pas pour l'enfant d'une pareille maison, une aide ne pourrait se
raliser que si nous pouvions lui donner quelqu'un qui s'occupt tout spcialement de
lui. Je pense la fonction d'un frre an bienveillant qui pourrait gagner la sympathie
de ce garon et le ramener sur le chemin du courage social. Tout ce qu'il fait l'cole
est l'expression de sa lchet et je m'efforcerais de lui expliquer cela. Je voudrais
aussi lui rendre comprhensible que c'est la raison pour laquelle nous ne le trouvons
pas sur le ct utile de la vie, mais ailleurs, sur le ct inutile. J'attends beaucoup de
cette explication. Il prsente de grosses lacunes et il ne sera pas facile de le lui prou-
ver. Il nous manque la base sur laquelle nous aurions pu btir. Il faut tenir compte du
fait qu'il est le prfr du pre. Cette famille semble prsenter par ailleurs certains
bons cts, car, par exemple, les enfants n'y sont pas maltraits, ce qu'on ne pourrait
pas dire avec certitude pour la famille du deuxime garon. De ce milieu trop doux
proviennent les enfants qui, lorsqu'ils se heurtent une difficult, s'esquivent imm-
diatement. Ils ne supportent pas de se trouver dans une situation dsavantageuse. Par
tous les moyens ils jouent le rle de celui qui parat plus qu'il n'est. Vous constatez ici
la tendance de ce garon la valorisation et son besoin de se pousser au premier plan.
Or il croit que, sur le ct utile de la vie, la route lui est barre. Il nous incombe le
devoir de confirmer ce que nous venons d'avancer. La mre pourrait nous indiquer si
elle a gt le garon et dans quelles conditions ce dernier a grandi. Je voudrais
souligner ceci : le garon n'est pas courageux et il nous faut constater si ce manque de
courage ne se manifeste pas dans d'autres circonstances. Peut-tre la nuit rclame-t-il
la prsence de sa mre, peut-tre crie-t-il pendant son sommeil? Si l'cole il se
conduit d'une faon arrogante vis--vis de son instituteur, ce n'est pas du courage; il
connat les limites qui sont imposes l'instituteur et il peut se conduire comme s'il
tait un hros.
Le deuxime cas est un type compliqu, plus gt par le pre que par la mre, ses
rapports avec celle-ci sont tendus, car il n'a pas su gagner sa sympathie. D'aprs sa
rponse concernant la suggestion de l'instituteur lui demandant de traiter l'enfant de
prfrence avec de l'amour, de l'embrasser de temps en temps au lieu de le frapper, on
peut supposer que cette femme est dure et froide. Nous nous souvenons qu'elle avait
rpondu: ce n'est pas l'habitude chez nous . Pour que la mre se conduise de la
sorte, il est probable que des choses plus graves ont d se passer.
Ce garon a une sur cadette. Si vous entendez dire qu'un enfant est plus attach
son pre qu' sa mre, vous pouvez supposer que c'est dj la deuxime phase de
l'volution de cet enfant. Si la mre, d'une faon ou d'une autre, manque de contact
avec l'enfant, alors le pre passe au premier plan. Il faudra encore essayer de savoir
si, avant notre garon, la mre n'a pas eu un autre enfant qui aurait dtourn sa
tendresse. Peut-tre le pre, une tante, un oncle se sont-ils davantage occups de lui,
du fait que la mre ne le pouvait pas cause de sa maladie. Nous ne savons pas si la
maladie de sa mre a t un motif suffisant pour dtourner l'enfant de celle-ci.
Il se pourrait qu'il ait quelques dfauts organiques. Il est dou au-dessus de la
moyenne. Il est probable que la cote d'intelligence de cet enfant, l'occasion d'un
examen par test, le montre suprieur la moyenne, puisque son aptitude tablir des
rapports entre les faits est trs bonne. Son attitude l'cole s'explique d'un point de
vue tout autre que celle de son ami. Il a besoin de tendresse. Il prouve le besoin de
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 127
se faire gter. Au dbut de son existence et pendant six ans, il tait enfant unique et il
a vcu au centre de l'attention des autres, cajol par tous, comme toujours lorsque
l'enfant est unique. La tante et l'oncle y ont particip. Il arrive l'cole en exigeant
qu'on s'occupe particulirement de lui. Mais cela ne peut se faire en ce lieu, car,
mme si on le voulait, on en serait empch. Ces enfants qui veulent toujours attirer
l'attention sur eux, prfrent se faire remarquer d'une faon dsagrable, sur le ct
inutile, que d'une faon agrable, sur le ct utile de la vie. Ces enfants gts ne sont
gnralement pas courageux, ils prfrent se mettre au premier plan dans une
situation plus facile. Par rapport sa situation antrieure, notre garon se sent frustr,
autant l'cole qu' la maison. Que fait un enfant s'il se sent frustr? Il essaye de
s'enrichir et il manifeste cette tendance dans son essai de jouer au suprieur, au hros.
Dans son imagination mensongre, nous reconnaissons le mme trait. Nous ne
sommes pas tonns de constater que ces enfants volent. Chez ce garon la position
de dpart d'une pareille attitude s'est dj manifeste, car les futilits qu'il drobe
ses camarades d'cole reprsentent le dsir de s'enrichir facilement. Il se conduit
comme quelqu'un qui a le dynamisme, le besoin de possder et d'tre plus que les
autres.
Le premier garon devra tre encourag dans ses tudes; chez le second, il faut
faire ressortir qu'il n'est pas toujours ncessaire d'tre le centre d'attention et qu'il n'y
a pas se juger frustr toutes les fois o l'entourage s'occupe de quelqu'un d'autre. S'il
veut toujours se trouver au centre de l'attention, il faut aussi qu'il collabore. Si une
personne trangre lui dit cela, il y rflchira. Ainsi il s'enrichit d'une nouvelle notion.
D'ailleurs cette ide pourrait tre approfondie l'occasion par un sourire comprhen-
sif de l'institutrice, comme si on voulait lui dire : tu n'es pas encore assez grand
pour rendre vivant en toi ce sur quoi nous discutons pour le moment .
Il nous faut trouver la confirmation de notre thse au cours de notre conversation.
Nous cherchons tablir si nous nous trouvons sur la bonne voie ou si nous serons
obligs de renoncer notre travail. Il est trs important pour nous de montrer un
chemin ce garon car cela agit probablement d'une faon plus pesante et tablit un
meilleur rapport social que si nous le punissions. Si nous lui rendons l'cole plus
dsagrable par des punitions, il est possible qu'il refuse dfinitivement d'y aller.
Dr A (s'adressant la mre de G.) : Le point le plus important est de faire
progresser cet enfant. Il a perdu tout courage et il croit que jamais il ne pourra tre un
bon lve. A-t-il des amis?
La mre : Il n'a pas d'ami. A l'cole il aime bien crire, mais il n'aime pas lire. Il
prfre frquenter le patronage.
Dr A : Au patronage il n'y a ni examen, ni notation. Il faut lui permettre d'avancer,
de remporter un succs. J'aimerais bien que vous nous aidiez dans notre intention de
l'encourager. Dites-lui : tu es un garon intelligent, n'abandonne pas. Est-ce un
gentil garon, par ailleurs?
La mre : Oui, mais il est turbulent.
Dr A : Est-ce que les autres enfants l'aiment?
La mre : Il se querelle volontiers avec eux.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 128
Dr A : Comment est-il avec son pre, avec ses frres? Est-il aim dans la famille?
La mre : Ils se querellent souvent, comme tous les enfants.
Dr A : Le pre est-il tendre avec lui?
La mre : Mon mari l'aime beaucoup et l'enfant s'attache lui; moi, il ne m'obit
que si je lui parle gentiment.
Dr A : A-t-il t malade tant tout petit?
La mre : Il a t malade des poumons.
Dr A : Il faut le faire examiner par un mdecin qui vous donnera srement des
conseils quant cette maladie. Dort-il bien, est-il agit? A-t-il peur, la nuit, de fan-
tmes?
La mre : Il ne craint rien.
Dr A : Envoyez-le-moi pour que nous voyons s'il est timide ou non, mais ne lui
dites rien.
(A l'auditoire, aprs le dpart de la mre) : Un enfant peut compenser sa timidit
et tre arrogant.
(S'adressant l'enfant) : Que veux-tu faire plus tard?
G : (pas de rponse).
Dr A : Qu'est-ce qui te plairait le plus? Aimerais-tu devenir un garon intelligent
qui peut quelque chose ou crois-tu que tu ne russiras jamais?
(On constate qu'il s'agit d'un enfant gaucher.)
Ce fait a d handicaper grandement les progrs de l'enfant.
- Tu manques de courage et tu crois que les autres peuvent tout et toi rien. Tu
crois que tu ne russiras rien et c'est pour cela que tu gnes les autres. Moi, je croyais
que tu tais un garon courageux. a serait bien si tu t'attaquais avec courage ton
travail et si tu faisais attention. Ce n'est ni demain, ni aprs demain que a ira mieux,
mais d'ici une quinzaine tu pourras peut-tre devenir un bon lve; tout ira mieux;
qu'en penses-tu? veux-tu essayer? Mme si tu ne reois pas la meilleure note, il ne
faut pas abandonner. Si tu gnes l'enseignement, penses-y, tu le fais parce que tu
crois ne pas pouvoir russir.
Le garon regarde terre et de ct.
- Je suis curieux de savoir, lorsque tu reviendras dans un mois, si tu auras dj
plus de courage ou si tu seras rest le mme poltron.
(Le garon, qui pendant tout ce temps n'a pas prononc un seul mot, s'loigne.)
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 129
Dr A : ( l'auditoire) : Je voudrais ajouter une remarque. Il faut une certaine exp-
rience pour pouvoir parler des parents ou des enfants, mais qui donc pourrait le
faire, sinon l'instituteur lui-mme? Il ne s'agit pas seulement d'expliquer les choses
par de simples paroles. C'est un problme dramatique que nous affrontons l. En tant
que psychologue et ducateur, nous nous trouvons dans un certain rle que nous
sommes obliges de jouer convenablement et d'une faon juste, en vue d'un but donn.
Nous ne pouvons comparer notre action rien d'autre. Il faut bien prciser, c'est cette
impression qui est ncessaire, cette impression que nous ne trouvons que dans l'art.
C'est d'une grande efficacit autant pour les enfants que pour les adultes.
(A la mre de S.) : tes-vous contente de votre fils?
La mre : Il est trs mchant. Il agace les petits.
Dr A : Pendant six ans il est rest seul. Il a vcu une tragdie au moment de la
naissance de la petite, car, d'un seul coup, il n'tait plus seul. Qu'en dites-vous? Voil
ce que nous devons comprendre. On n'est pas oblig de penser toujours d'une faon
aussi svre, mais tout se passe comme si on devait quitter brutalement la chaleur
pour aller dans le froid. Est-il trs li d'autres personnes?
La mre : Non, peut-tre suis-je trop svre.
Dr A - Il est toujours difficile pour un enfant de constater que les parents font des
diffrences dans le traitement des frres et surs. Il serait utile que vous puissiez en
parler au pre et travailler de concert.
La mre : Je suis malade; je viens de passer quatre mois l'hpital, je suis trs
nerveuse. L'enfant ne m'a jamais aime, il n'aime que son pre.
Dr A : O se trouve l'enfant lorsque vous tes l'hpital?
La mre : L'anne dernire j'ai pass six mois l'hpital et six mois dans une
station balnaire. Pendant ce temps mon fils resta chez sa grand-mre.
Dr A : Les grands-parents gtent toujours les enfants; maintenant il remarque la
diffrence. Crie-t-il la nuit? Mouille-t-il son lit?
La mre : Il est seulement un peu agit. Depuis l'ge de deux ans il ne mouille
plus son lit.
Dr A : Se fait-il facilement des amis?
La mre : Il est trs autoritaire.
Dr A : Il a l'impression qu'il n'est plus le premier, comme dans le temps, chez sa
grand-mre, o il a eu cette impression. L'obissance reprsente pour lui un abaisse-
ment. Il croit tre victime d'une injustice si on ne s'occupe pas de lui.
La mre : Il faut toujours que je discute avec lui, il n'coute rien de ce qui vient de
moi. Il est ngligent, mais il aime bien faire sa toilette. Il se lve seul.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 130
Dr A : C'est trs bien et trs gentil, il semble prsenter un bon rendement; ce n'est
que lorsqu'on ne s'occupe pas de lui qu'il devient mchant.
La mre : Il m'agace toujours. La semaine dernire il a quitt la maison 10 heu-
res et m'a promis de rentrer midi, mais il n'est rentr qu' 18 heures.
Dr A : Il aime qu'on le cherche et qu'on se soucie de lui. Est-il courageux?
La mre : Il ne craint rien.
Dr A : J'aimerais lui parler pour lui dire de ne pas toujours jouer au hros. Car s'il
agit ainsi l'cole, il prendra finalement un mauvais chemin dans la vie. Essayez
d'tre plus aimable avec lui et dites-lui gentiment : tu veux que je m'occupe toujours
de toi, mais tu es dj un grand garon!
(On prend cong de la mre.)
(A l'auditoire : Cette femme ne me parat pas particulirement malade!)
Dr A (s'adressant l'lve S.) : Comment a va l'cole?
S : Trs bien!
Dr A : Aimerais-tu tre le premier? Quel beau rsultat si tu tais le meilleur en
calcul, en criture et si tu pouvais toujours russir! Mais il te faudrait collaborer, or
pour le moment tu t'y opposes le plus souvent. Ne veux-tu pas collaborer? Ce serait
pourtant beaucoup mieux!
(On constate que l'enfant est gaucher.)
Tous les enfants ne savent pas qu'ils sont des enfants gauchers, mais ils en subis-
sent les consquences.
- Comment va l'criture?
S : Pas bien.
Dr A : Si tu voulais tre travailleur au lieu de causer des troubles, si tu voulais
faire un effort, tu pourrais avoir une belle criture.
(A l'auditoire) : Voil deux matires (criture et lecture), qui prsentent des diffi-
cults particulires pour l'enfant gaucher. Si vous faites trs attention la faon dont
lisent ces enfants, vous verrez qu'ils pellent de droite gauche. Cette sorte de lecture
sonne faux et on a l'impression qu'ils ne savent pas lire.
Dr A (s'adressant S) : Il faut bien que l'instituteur s'occupe de toi. Mais il n'est
pas juste de le gner dans son enseignement. Qu'y gagnes-tu?
S : Rien du tout.
Dr A : Tu pourrais tre un bon lve. videmment a ne se fait pas du jour au
lendemain, mais si tu t'exerces, tu auras une belle criture. D'ici un mois tu me
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 131
montreras la belle criture que tu auras alors. Raconte-moi aussi si tu as suffisamment
de courage pour collaborer. Fais attention ta petite sur et veille ce que tes
affaires soient en ordre. Ta mre est malade, elle finira pas gurir, mais aide-la un
peu.
Je voudrais encore ajouter quelques mots au sujet de l'extrme frquence de l'en-
fant gaucher. Il n'existe pas d'enfant dou ou non dou; ce sont deux types d'enfants :
le premier type, qui dlaisse tout, ne fait aucun effort, quant au second, il se pousse
toujours en avant. Certains se trahissent pendant toute leur vie par une certaine
maladresse; ils ne savent pas qu'ils sont des enfants gts, mais ils subissent les
consquences de cette disposition. Il arrive trs souvent qu'ils se sous-estiment et
qu'ils sur-estiment les autres. Vous trouvez un trs grand nombre de gauchers parmi
les enfants difficiles, les nvross, les criminels, les candidats au suicide, les pervers
sexuels, mais vous les trouvez aussi parmi les tres suprieurs; les artistes, par
exemple, fournissent un grand pourcentage de gauchers.
L'encouragement est le point de vue le plus important. Si vous vous bornez
encourager un colier qui est gaucher, vous aurez toujours du succs.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 132
Chapitre XVI
La lutte pour le paradis perdu
Retour la table des matires
Il s'agit d'un colier, g de cinq ans, dont Io cas nous permettra de conclure,
partant de sa vie, comment il se conduira l'cole. Je vais vous montrer, trs rapide-
ment, la faon dont on peut arriver la comprhension de la structure d'un cas et sa
confirmation.
Il s'agit d'un enfant difficile.
Cet enfant est srement en lutte et il vit dans cet tat, avec un entourage doux qui
l'a certainement gt. Alors se pose la question : pourquoi est-il en lutte cri ce mo-
ment? Pourquoi a-t-il l'impression qu'en ce moment, il n'est plus gt comme avant.
Actuellement sa position n'est plus aussi favorable qu'elle ne l'a t. Nous pouvons
prdire tout cela.
Il est hyperactif.
Est-ce quelque chose de nouveau pour nous? Et pouvons-nous nous reprsenter
un lutteur qui ne soit pas hyperactif ? S'il n'tait pas aussi actif, nous penserions qu'il
est un faible d'esprit. Car il est indubitable que les deux vont de pair et font partie du
style de vie d'un enfant moderne.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 133
Il aime casser les choses.
C'est une manire de lutte,
A l'occasion il fait des crises de colre.
Toutes ces choses sont videntes et il faut que ce soit un enfant intelligent. Or il
s'agit d'tablir s'il faisait partie de la catgorie d'enfants qui sont faibles d'esprit et
qu'il faut lever d'une faon toute diffrente. Ces enfants n'ont pas de style de vie. Le
ntre, par contre, a un but : lutter et vaincre, avoir la jouissance, la sensation du
vainqueur.
La mre raconte que l'enfant est en bonne sant, plein de vie... et qu'il veut tou-
jours occuper quelqu'un de sa personne.
C'est une lutte comme celle qui peut se drouler dans une
158
famille o il faut absolument faire quelque chose pour irriter les autres.
Il grimpe avec ses lourdes chaussures sales sur la plus belle table. Il prouve la
plus grande joie jouer avec la lampe pendant que sa mre est occupe,
Il sait trs exactement en quel point il faut attaquer.
Si sa mre va jouer du piano ou si elle lit, il choisit ce moment pour jouer avec
la lumire. Il ne reste jamais tranquille, toujours en mouvement pendant les repas, il
rclame une surveillance permanente.
Il veut tre vainqueur et se trouver toujours au centre de l'attention. L nat l'ide
suivante : S'il lui manque tellement de se trouver au centre de l'attention, il faut croire
qu'il y a dj t une fois et qu'il dsire rtablir cette situation. Quel vnement a
donc pu aggraver tellement sa situation? C'est la naissance dun petit frre.
Il boxe toujours avec son pre et il veut jouer avec lui.
Nous voyons qu'il trouve ce qu'il lui faut pour lutter et pour gner.
Il a l'habitude de plonger sa main dans le gteau et de s'en remplir la bouche.
Il pourrait aussi prouver sa lutte par le refus des aliments.
Si la mre a des invits, il les pousse, les chasse de leur chaise et s'assied leur
place.
Cet acte nous prouve qu'il n'aime pas les autres; nous y voyons un manque de
sentiment social, qui explique sa mauvaise humeur contre son jeune frre.
Si le pre et la mre chantent ou jouent du piano, l'enfant crie sans cesse et dit
qu'il n'aime pas ce chant.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 134
Cela ne lui convient pas; il voudrait que l'on s'occupt exclusivement de sa
personne. Mais lorsque nous constatons un dfaut il ne faut pas punir, la punition
n'est pas une aide. Nous savons o nous devons commencer. Ce petit garon se sent
offens, froiss, mis l'arrire-plan.
Le pre est chanteur et chante dans un concert. La mre l'accompagne. Le
garon crie fortement : Pre, viens ici!
Tous ses efforts consistent donc occuper le pre et la mre constamment de sa
personne.
Il a des crises de colre, s'il dsire quelque chose et qu'il ne l'obtienne pas
immdiatement.
Voil qui caractrise son attitude de lutteur.
Il dmolit tout avec un tournevis, il enlve toutes les vis de son lit.
L apparat de nouveau son attitude asociale. Il fait tout ce qu'il peut pour nuire
ses parents et pour prouver sa mauvaise humeur.
il fait parfois des remarques cyniques, surtout lorsqu'il a mal agi et qu'il sait que
ces remarques l'aideront sortir du mauvais pas. Les gens le considrent comme un
garon intelligent parce qu'il fait des rflexions mordantes. Il est instable et il ne peut
s'occuper longtemps de la mme chose. La mre essaye de le dtourner de cette
mauvaise habitude (videmment sans y parvenir).
Si sa mre lui donne une gifle, il rit et reste peut-tre deux minutes tranquille.
La mre pense que le pre et la grand-mre ont gt l'enfant d'une faon excessive.
Maintenant, vrai dire, il n'est plus gt.
Son sentiment social n'a pas pu se dvelopper puisqu'il est rest li uniquement
sa mre et son pre, d'o une formation errone.
Pre et mre sont toujours puiss, le garon jamais.
Il est vident qu'il ne se fatigue pas un jeu qui lui plat. Le travail d'ducateur ne
plat ni la mre ni au pre; il les fatigue. La contrainte ne sert rien car il se venge
lorsqu'on le contraint.
Il n'a pas de mmoire et il ne peut pas se concentrer.
C'est qu'il ne dispose pas du ncessaire et n'a pas la prparation requise pour
pouvoir fonctionner d'une faon indpendante. De l vient son manque de mmoire et
de concentration.
Il n'a jamais frquent le jardin d'enfants.
La mre semble donc l'avoir lev uniquement pour elle-mme.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 135
Il est trs important de se rendre compte de la faon dont nous comprenons ces
rapports. Nous pouvons parler de comprhension lorsque nous savons qu'il s'agit ici
d'un lment de l'ensemble. Cela n'est pas un processus physiologique. Comprendre,
c'est saisir le rapport des choses et des faits.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 136
Chapitre XVII
Vol cause d'une affection perdue
Retour la table des matires
L'enfant est n dans une ville mridionale de Hongrie. Lorsque l'enfant eut deux
ans et demi, son pre fit faillite.
Ce fait nous donne penser que l'enfant a probablement vcu jusqu' l'ge de trois
ans dans une situation matrielle favorable, situation qui a d changer par la suite. A
la suite de la faillite du pre, l'enfant se trouvait dans une mauvaise situation o il a
pu se sentir comme accabl. Il n'est pas facile de s'adapter une situation dfavorable
lorsque l'on a vcu dans la situation oppose. Les enfants qui ont connu au dbut une
bonne situation matrielle sont toujours impressionns si un changement survient
plus tard.
Il dmnagea avec sa femme et son Fils unique Vienne, pour y chercher du
travail.
Nous comprenons donc qu' cette poque l'enfant tait unique, gt et habitu se
trouver au centre de l'attention. Nous Pouvons prsager qu'ici, une nouvelle situation
dfavorable a d exercer une forte impression sur cet enfant.
Les sept annes suivantes le pre gagna sa vie comme voyageur de com-
merce...
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 137
Cette circonstance est retenir, car nous avons souvent constat que, lorsque le
pre est voyageur de commerce, la mre - vu les frquentes absences du pre - ne
peut pas remplir sa deuxime fonction, savoir largir l'intrt social de l'enfant vers
d'autres personnes et en premier lieu vers le pre. D'une faon gnrale, cet lment
compte lorsque le pre est contraint des absences frquentes. La mre ne peut pas
accomplir sa deuxime fonction. Le mme facteur joue lorsqu'il y a de graves
msententes dans le mnage. L aussi il est impossible d'veiller l'intrt de l'enfant
pour d'autres. Les enfants des mnages malheureux sont trs souvent difficiles. Des
crises de colre du pre ou l'emploi de moyens autoritaires gnent le dveloppement
du sentiment social.
... et se dbattit dans le procs qui avait suivi sa faillite.
Si nous voulons nous identifier avec la situation dans laquelle vivait cet enfant,
nous pourrons comprendre l'extrme tristesse dont ce procs imprgna l'atmosphre
familiale.
L'enfant ne se souvient pas si cette atmosphre l'avait fortement impressionn.
Il est probable que, si le souvenir de cette atmosphre a disparu de sa mmoire, il
a du moins influenc son style de vie.
De toute faon c'tait auparavant un enfant obissant, tranquille et tendre...
Ce qui signifie pour nous qu'il tait trs attach sa mre.
... qu'un grand amour liait sa mre trs jeune, mais pas toujours trs juste, et
plus encore son pre doux et bon.
Si cette observation est exacte, il faut souligner particulirement l'expression
pas toujours trs juste . La mre n'tant peut-tre pas en tat de remplir correctement
sa premire fonction, l'enfant chercha une autre personne. Malgr ses frquentes
absences du foyer le pre a pu gagner l'affection de l'enfant, qui dans une seconde
phase s'attacha davantage lui.
Au printemps la famille changea de domicile et le pre fonda un commerce pour
la mre et pour un de ses frres.
Nous interprtons ainsi le fait : tant donn que la mre commence une nouvelle
occupation, la situation s'aggrave pour l'enfant car la mre ne dispose plus du mme
temps qu'auparavant pour le gter et s'occuper de lui.
Il est probable que l'enfant a t en mauvaise socit.
Ce renseignement confirme notre hypothse que la mre avait peu de loisirs
consacrer l'enfant qui dsirait avoir quelqu'un auprs de lui.
Il vola des cravates dans le magasin de ses parents...
Cet enfant a probablement le sentiment d'tre spoli. La pre est en voyage, la
mre au magasin, l'enfant priv de soins; cette situation lui donne le sentiment d'tre
frustr. Nous allons apprendre ce qu'il faisait de ses cravates. Peut-tre en faisait-il
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 138
cadeau d'autres enfants pour gagner leur tendresse et la chaleur de leur affection,
sentiments qu'il ne trouvait plus chez sa mre.
... pour en faire cadeau aux apprentis matelassiers qui se trouvaient dans cette
maison.
Ce qui confirme fortement notre conception.
Il vola des roses dans un parc voisin, soit pour les porter chez lui, soit pour les
offrir une tante, trs belle et qu'il aimait beaucoup.
Il commence, comme nombre de ces enfants qui se sentent spolis, corrompre
les autres par des cadeaux pour gagner leur amour et leur tendresse. C'est l'un des
motifs les plus frquents parmi les vols d'enfants. Ce motif est compltement mcon-
nu au tribunal des mineurs par exemple, o personne ne se soucie de ce point de vue.
Un jour, le garon, qui avait ce moment huit ans, sortit de l'cole avec ses
camarades et, alors que ces derniers saluaient poliment l'abb qu'ils rencontrrent, lui-
mme lui lana une norme grossiret.
C'est donc un libre penseur! Il faut pousser plus loin nos dductions : ce garon
qui dsire tant se trouver au centre de l'attention, prsente probablement une grande
tendance se faire remarquer. Comme pour lui cela ne prsente aucune chance de
succs, il l'essaye autrement.
Pourquoi? demande alors celui qui a rdig ce compte rendu.
Il n'avait jamais eu affaire cet abb. Quel tait donc le motif de sa mauvaise
conduite?
Une heure plus tard, il fut conduit l'cole pour baiser la main de l'abb et lui
demander pardon, mais il s'y refusa.
Vous avez l de nouveau l'image de tout son caractre. Lui qui a toujours voulu
jouer un rle dominant, ne veut plier devant personne. Il ne veut pas reconnatre son
tort. Nous ne sommes pas enclins exiger de la part des enfants qu'ils demandent
pardon ou qu'ils reconnaissent leur tort. Nous aurions prfr procder de la manire
dont on a procd une fois avec moi. A l'ge de six ans j'avais jou un vilain tour
mes parents. Ma mre me demanda des explications avec un visage rouge de colre et
j'tais trs gn car j'tais conscient de ma faute. Mon pre, qui se tenait tout prs
d'elle sans rien dire, finit par me prendre par la main en lui disant : Laisse-le.
Cette scne m'a fortement impressionn et je m'en souviens toujours. Je suis recon-
naissant mon pre de son attitude. Il m'a ainsi plus profondment influenc que si
on m'avait demand de faire amende honorable ou si ma mre m'avait donn une
tape. Ce n'est pas une bonne mthode que celle qui consiste exiger de l'enfant qu'il
demande pardon. Il n'y a pas de doute possible, ce garon sait qu'il a mal agi.
Pourquoi lui demander cet aveu public? Pourquoi le confondre publiquement et lui
montrer qu'il a d se soumettre?
Il reut une mauvaise note de conduite et le reste de l'anne scolaire, il fut
oblig de s'asseoir au dernier rang.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 139
Nous pouvons prdire que cette mesure ne pourra pas non plus exercer une bonne
influence sur lui, puisque par l il restera au centre de l'attention de la classe. Il se fera
remarquer d'une faon dsagrable et se conduira en hros.
L'instituteur n'tait pas mchant envers lui.
Voil assurment une circonstance attnuante qui portera de bons fruits. Si l'insti-
tuteur avait montr une attitude hostile, le garon se serait cabr davantage.
Un vnement banal de cette poque s'est fix d'une faon ineffaable dans sa
mmoire. L'enfant, se promenant dans la cour, donna un ouvrier qui travaillait l un
bout de pain azyme qu'il tait en train de manger. L'ouvrier plaa le bout de pain sur
son tabli et le rduisit en miettes avec son marteau en disant : c'est comme a qu'on
devrait craser tous les Juifs.
Comme nous le constatons il s'agit d'un garon isralite. Il est naturel que pareille
remarque ait profondment pes sur cet enfant avide de douceur, d'affection et de
gentillesse. Nous-mmes nous n'irons pas en rire, nous percevrons plutt l l'expres-
sion d'une tendance gnrale et si nous voulons approfondir cette question nous
chercherons plutt les racines de ce sentiment. Nous allons voir si cet vnement a eu
d'autres suites.
Il n'est pas possible d'tablir si cet vnement s'est pass avant ou aprs
l'incident avec l'abb.
Il aurait t intressant et important d'tablir ce point. Il est possible que cet
vnement ait dclench chez lui une attitude hostile et que l'offense envers l'abb ait
t le rsultat de son attitude hostile.
Au printemps de l'anne suivante le pre liquida le commerce et la petite famille
dmnagea nouveau, dans le neuvime arrondissement. Un peu plus tard le pre dut
commencer purger la peine de prison laquelle il avait t condamn pour sa
faillite.
Une nouvelle impression s'ajoute dans l'me de l'enfant avide d'affection et trs li
son pre. Il doit supporter qu'on mette son pauvre pre en prison. Je ne serais pas
tonn que cet enfant montrt une vive opposition vis--vis de notre lgislation et
jett le gant toute la socit. Peut-tre cette impression l'empchera-t-elle dfinitive-
ment de manifester un intrt grandissant pour les autres, et ruinera-t-elle le dernier
reste de cet intrt. Il affichera une tendance se joindre des gens qui menacent
l'ordre social ; il trouvera peut-tre mme la voie du crime.
Jamais personne n'a pu parler de cet vnement l'enfant.
Il est excessivement difficile de lui cacher pareil vnement. Il et t videm-
ment plus fcond qu'il n'et jamais t mis au courant de ce fait. Mais nous doutons
que cela et pu se raliser dans ce cas.
Plus tard, comme adolescent et comme adulte, il vita d'aborder une discussion
ce sujet.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 140
Il l'a ressenti comme une humiliation et une vexation profondes. Il affectait
toujours d'ignorer cet vnement, et n'en parla mme jamais ses amis les plus
intimes.
Ce fait est trs intressant, car, si le garon s'tait rvolt, s'il l'avait ressenti com-
me une injustice, il aurait avec raison insist sur l'hypothse que son pre avait t
arrt tort. Mais il est probable qu'il tait fortement influenc par la tradition et les
conceptions bourgeoises et qu'il n'a pas pu dominer cette conception pour en parler
d'une faon ouverte et libre. On ne peut pas parler de tout ; il est des faits dont il est
insens de parler. Chez ce garon qui commence sortir du cadre de la socit dans
un mouvement violent de rvolte, nous pouvons coup sr trouver une certaine
hsitation dans son attitude. Les vnements extrieurs sont d'une importance
capitale. Il est possible qu'il aurait suivi une bonne voie si son pre n'avait pas t mis
en prison et s'il ne s'tait pas senti opprim du fait de sa religion.
Brusquement sa turbulence des deux dernires annes disparut, l'enfant entoura
d'une tendresse redouble sa petite maman si jeune et si belle et il se montra obissant
et tranquille.
L vous voyez la manifestation d'un besoin de se lier quelqu'un, non pas un
cercle tendu, mais une personne unique. Sa structure est telle qu'il ne peut se lier
qu' une seule personne. Si on lui enlve pour un certain temps son pre, il cherche
quelqu'un d'autre. Lorsque sa mre tait occupe, il voulait gagner la sympathie de
l'apprenti ; il lui faut toujours quelqu'un avec qui se lier.
Lorsque le pre fut libr, il put, par son travail incessant, surmonter les difficul-
ts matrielles nes de son absence. Cette longue oppression qui avait pes sur la
famille avait-elle disparu?
De par ces difficults matrielles, le garon a de nouveau ressenti la pesanteur des
circonstances extrieures.
L'enfant se ranima.
Nous ne sommes pas encore suffisamment satisfaits car nous ne savons pas ce que
cela signifie ni pourquoi cela s'est produit. Il ne sait pas encore quelle doit tre son
attitude, car son pre vit dans sa mmoire comme quelqu'un qui l'a gt.
Pendant les premires annes d'cole, il tait parmi les meilleurs ; depuis, il se
plaa au-dessous de la moyenne. Et maintenant le voil vif et joyeux.
Cela correspond l'poque du retour de son pre.
Tout en restant obissant et travailleur, bientt il fut parmi les premiers de sa
classe.
Il est probable qu'il avait rencontr un instituteur avec lequel il sympathisait.
Il fut lou plusieurs reprises, pour cette amlioration, par l'instituteur qu'il
estimait beaucoup et ces louanges lui firent du bien.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 141
De nouveau il avait trouv une personne qui s'occupait de lui. Il semble tre sauv
par l'amour et l'affection qu'on lui prodigue.
A l'automne, au lyce, il prit un bon dpart.
Nos seules apprhensions se rapportent la suite de son volution : que se
passera-t-il s'il ne peut pas acqurir l'cole une position o il sera estim? Il se
pourrait qu'il rencontre un instituteur qui ne lui convienne pas ou qu'il ait des
difficults cause de sa religion et qu'il se sente dsavantag. Peut-tre rencontrera-t-
il des difficults dans une certaine manire ou ne pourra-t-il pas trouver la mthode
adquate pour son travail. Plus tard, dans la vie, il pourra aussi connatre des
situations o cette chaleur lui manquera. Voil nos rserves quant l'avenir de son
volution.
Au mois de novembre, on ramena le pre gravement malade.
L aussi notre exprience nous vient en aide et elle nous dit que, si un tel enfant
perd le contact, du fait de la maladie du pre ou du fait de la mre qui l'avait gt
jusque-l (la maladie du pre occupe presque entirement la mre) - et ne possde
plus comme antrieurement le sentiment de ce contact, c'est parfois pour lui une
situation nouvelle et souvent trs difficile. C'est dans de semblables conjonctures que
se manifestent des checs. Nous pouvons nous reprsenter ceci. On ramne le pre
gravement malade, la mre doit s'en occuper et de nouveau, l'enfant est isol. S'il
avait la chance de trouver cette poque l'cole un instituteur qui pourrait s'en
occuper, cette difficult pourrait s'effacer, mais pour le moment, nous n'en savons
rien.
A son retour, pendant le voyage, le pre, g ce moment de quarante ans, fit
un ictus et resta hmyplgique.
Nous pouvons comprendre ce que signifie, dans un foyer, la maladie du chef, du
soutien de famille, surtout lorsqu'il s'agit d'un mnage uni, et il est certain qu'il en
tait ainsi. Nous pouvons aussi imaginer les consquences de cet vnement.
Ce sont les grands sacrifices matriels qu'il avait d faire pour ses nombreux
frres et surs plus jeunes et pour ses parents qui l'avaient conduit la faillite.
C'est l'explication qu'on a d probablement donner l'enfant, ce qui laisse paratre
son pre comme un homme juste et honnte.
L'nervement du procs, qui a dur plusieurs annes, les vexations, le regret de
ne plus pouvoir aider ses parents, ses frres et surs, le surmenage et cette particu-
larit malheureuse de ne pas pouvoir confier autrui, ni mme sa femme, qu'il
gtait d'ailleurs beaucoup, les soucis qui l'accablaient, tous ces facteurs ont certai-
nement caus l'effondrement physique de cet homme, jusque-l parfaitement sain.
Ici s'arrte le compte rendu et nous devons avoir recours des suppositions. Si le
garon se sent l'aise l'cole, il surmontera ses difficults. S'il est arrach l'cole,
il sera oblig de se soumettre son sort et de se contenter d'une fonction subalterne,
situation dont il souffrira profondment. Nous savons qu'il possde un style de vie
automatique, qui se manifeste par son besoin de trouver une personne qui se lier.
Nous ne serons pas surpris de constater que de nouveau se ranime ce que nous avons
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 142
dj observ, une rvolte vive, s'il vient se sentir dsavantag ou si un lourd senti-
ment d'infriorit l'opprime. S'il rencontre une situation favorable, dans le cas o
quelqu'un s'occupe de lui, il se peut que ce garon suive le chemin de sa vie sans que
personne n'ait rien reprendre.
Plus tard, il avancera peut-tre d'une faon satisfaisante. Dans l'exercice de sa
profession, il ne rencontrera pas de difficults particulires, s'il est dans une situation
qui lui convienne. La solution du problme de l'amour sera plus difficile pour lui,
tant donn qu'il cherchera toujours se faire gter. Dans la vie il cherchera toujours
une femme qui se conduise un peu comme cette mre, chez qui il trouva tout ce qu'il
dsirait, comme nous avons pu le constater. Mais pareille situation ne pourrait se
prsenter que par une heureuse concidence.
Nous ne sommes pas fchs d'avoir d nous exercer sur un fragment de compte
rendu et d'y avoir essay nos connaissances. Je voudrais cette occasion vous faire
remarquer qu'il est beaucoup moins important de savoir si nous avons devin tout ce
qui pourrait se passer ultrieurement. Il nous suffit d'avoir pu nous exercer et
souligner des dtails d'une faon plus prcise qu'on ne le fait habituellement. Dans la
vie, il en va de mme lorsque nous rencontrons des tres dont nous ne saisissons
qu'un fragment et au sujet desquels nous devons deviner le reste. Il ne nous est pas
donn de trouver un portrait achev, nous devons toujours tirer nous-mmes nos
conclusions.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 143
Chapitre XVIII
nurtique
Retour la table des matires
mile est g de 12 ans et souffre d'nursie.
Lorsque nous entendons parler d'nursie, nous pouvons supposer, en nous basant
sur notre exprience, qu'il s'agit d'un dynamisme psychique qui vise tablir un
contact avec la mre, quoique d'une faon peu courante. Le garon en question nous
parle par son nursie. Tout se passe comme s'il parlait un jargon de la vessie.
Nous pouvons considrer toutes les formes d'expression d'un sujet comme tant les
varits d'un langage. Ici le langage signifie je ne suis pas assez avanc, il faut
qu'on me surveille encore! Et d'une faon gnrale, la mre est oblige de se lever
deux ou trois fois par nuit, de surveiller l'enfant et de l'veiller. L'enfant charge sa
mre d'un travail supplmentaire.
L'nursie n'est pas une maladie organique et nous savons que l'enfant nurtique
peut trs bien surveiller sa vessie pendant la journe. Le problme qui se pose est de
savoir pourquoi il ne peut la surveiller pendant la nuit? La raison en est qu'il se trouve
dans une tension psychique qui lui rend impossible cette fonction de retenir ses
urines. D'o vient cette tension? Nous savons avec quelle constance les enfants
persistent dans leur nursie. Ils recherchent un contact, ils dsirent tre lis avec
quelqu'un, charger quelqu'un d'un travail supplmentaire (remarque d'un malade :
ils veulent crer comme une succursale chez quelqu'un ). Voil le type de l'enfant
gt. Lorsque nous constatons pareil effort pour se faire gter davantage, alors nous
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 144
savons que l'enfant prouvait une certaine difficult maintenir cette connexion.
Nous sommes dj assez clairs pour pouvoir dire que l'nursie est probablement
une attaque rsultant d'une attitude adopte par un enfant pour s'approprier quelqu'un.
A ce type appartiennent aussi les enfants qui remuent sans arrt pendant la nuit, qui
crient la nuit (pavor nocturnus) et qui, par le bruit, essayent d'tablir le contact avec
d'autres. Il en existe aussi qui se lvent, qui marchent pour tablir par l ce contact et
qui, de ce fait, recherchent la liaison avec les autres. C'est le langage exprim par un
autre organe. Il est significatif de voir comment l'enfant arrive l'exprimer. Il y a l
un rapport avec une infriorit de la vessie et avec les centres nerveux qui la
commandent. J'tais le premier (en 1907) indiquer que chez l'nurtique on trouve
une faiblesse de la colonne lombaire. J'ai soulign aussi que l'nursie est en rapport
avec la spina bifida ou avec un naevus congnital de cette rgion. (Le Professeur
Fuchs partage cet avis.) D'autre part, il faut comprendre comment l'enfant arrive
parler ce jargon de la vessie . On le constate principalement chez les enfants dont
on a attir l'attention sur l'importance de la fonction, et lorsque la mre s'est donn
une peine inusite pour tenir l'enfant propre la nuit, parce qu'elle a surestim cette
propret. L'enfant arrive ainsi automatiquement l'ide : ici il y aurait lieu de faire
quelque chose, ici il y a un point d'attaque. Car vous comprendrez que chez tous ces
enfants on retrouve toujours les signes de l'enfant gt.
Nous ne voulons pas rester dogmatique et nous allons voir la suite.
Il a douze ans. Nous ne devons pas perdre de vue qu'il a t gt et que, depuis
que l'nursie persiste, il a l'impression qu'il ne reoit plus suffisamment d'amour.
Nous pouvons en dduire certains dtails. Il a probablement un frre ou une sur
cadette. Ce sont des motifs pour lesquels un enfant gt commence une lutte, ou c'est
manifestement par ce dfaut qu'il accuse ses parents de moins le gter. Une
accusation est identique une attaque, il n'y a pas de diffrence. Il a t dlog de sa
situation. Peut-tre a-t-il un beau-pre ou une belle-mre. Nous n'avons pas de rgle
fixe. Il est trs important pour nous de savoir ce qui se passe. Il nous faut trouver
pourquoi cet enfant est actuellement moins gt. Le garon a un but idal fictif (son
idal est son intentionnalit) : se faire gter, avoir quelqu'un d'autre mettre
contribution. Il faut changer ce but, lui en montrer un autre, afin qu'il puisse se rendre
utile.
Jamais la nuit, uniquement le jour.
C'est un renseignement qui influence fortement notre manire de penser. Le jour il
se trouve dans une grande tension, la nuit il semble tre content. On peut se faire
toutes sortes d'ides et supposer que souvent, la nuit, il dort avec sa mre, tandis que
le jour il dsire se faire remarquer d'une faon dsagrable, comme s'il voulait dire :
occupez-vous davantage de ma personne. Le jour sa lutte est plus intense.
Il perd souvent aussi ses matires.
Pour cette mme raison il se fait aussi remarquer en se salissant avec ses matires.
La lutte est mene dans un tat de dcouragement complet. tablir le diagnostic
d'imbcillit dans ce cas dpend de l'ide que l'on se fait de ce mal. Nous deman-
dons : Pourquoi ne le fait-il pas la nuit? Nous trouvons parfois que des enfants qui
s'engagent beaucoup dans leurs jeux, perdent tout contrle de ces fonctions. En
partant de ces dtails, nous pouvons remarquer qu'il s'agit l d'une fonction sociale. Il
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 145
faut considrer comme anormale une fonction qui s'accomplit en dehors de toute
conduite sociale.
Il s'agit d'un enfant illgitime.
Nous pouvons nous atteindre ce que cet enfant ait grandi sans amour, sans la
chaleur de l'affection et sans cette atmosphre de tendresse qu'on cre normalement
autour des enfants pendant les premires annes de leur existence. Mais nous
trouvons aussi parmi les enfants illgitimes des enfants gts. Il nous faudra donc
encore obtenir des claircissements ce sujet :
Son pre est tomb au champ d'honneur, sa mre s'est remarie.
L'hypothse de la prsence d'un beau-pre se confirme.
De cette deuxime union sont ns deux enfants, un garon qui a huit ans et une
fille qui a six ans.
Si vous vous souvenez que j'ai parl antrieurement d'un accusation, vous verrez
dj mieux que notre manire d'interprter le cas tait juste. Il a probablement raison
d'accuser et il n'y a pas de doute qu'il le ressente. Je me souviens d'un cas o un
garon avait perdu sa mre lorsqu'il avait deux semaines. Le pre s'tait remari peu
de temps aprs et personne ne savait que l'enfant n'tait pas de sa mre actuelle. On
ne le lui avait jamais dit. Plus tard naquit un deuxime enfant. Lorsqu'il me consulta
par la suite, il me raconta qu'il avait vcu jusqu' l'ge de 14 ans dans l'ide que cette
femme n'tait pas sa mre, mais sa belle-mre, et cette impression s'tait alors
confirme. Le fait vous prouve quel point les enfants ressentent distinctement ces
dtails, mme lorsqu'ils sont bien traits. Ils peroivent malgr tout une diffrence ;
s'il y a d'autres enfants, ils sentent que ces derniers jouissent de plus d'attention et de
plus de soins.
L'enfant se conduit envers ses frres et surs d'une faon tout fait satis-
faisante.
Vous ne voyez pas de lutte parmi ces enfants. J'ai souvent constat qu'un enfant
peut tre jaloux, mais peut quand mme aimer ses frres et surs. Il peut se sentir
dsavantag, mais il peut s'entendre avec eux. Pareil sentiment peut avoir des suites
diffrentes. Une fillette de cinq ans, enfant unique jusque-l, avait une sur cadette.
Plus tard, on apprit que cette ane avait tu trois petites filles, comme si elle voulait
dire : toutes les filles doivent disparatre. Vis--vis de sa petite sur par contre,
elle s'tait conduite d'une faon impeccable. Elle a excut ses meurtres avec une
habilet insigne et ce West qu'au troisime qu'elle a t dcouverte.
Le beau-pre tait, au dbut, particulirement svre envers lui.
Le garon a vcu une triste priode ; l'arrive du beau-pre sa situation s'est
aggrave, c'est ce moment-l que commena son accusation.
Mais grce l'intervention de la mre sa situation s'est amliore,
Nous pouvons imaginer que cette amlioration n'tait pas telle que le garon l'ait
ressentie d'une faon permanente.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 146
L'enfant a grandi gnralement loin de la maison, soit chez une tante...
Au dbut de son existence il a d se trouver l'aise. Chez des tantes ou des grand-
mres, les enfants sont gnralement bien traits.
... soit l'orphelinat.
Je n'affirmerai pas qu'il en tait de mme dans cet tablissement. Mes impressions
sur ces maisons ne sont pas des meilleures. Il y rgne une certaine discipline exigeant
que les enfants ne se mouillent pas et ne se salissent pas. Vous voyez que cette
discipline tait trop svre pour cet enfant. Il est probable que la tante, elle aussi, a
attribu trop d'importance ces fonctions. Nous pouvons observer que, si on essaye
de faire comprendre un enfant l'importance de l'absorption des aliments, l'enfant
montrera des difficults dans ce domaine. Ceux qui veulent tre matres de leurs
fonctions ou de leurs membres se refusent recevoir des ordres ce sujet. On pourra
voir qu'il se lve, la nuit, dans un tat de demi-sommeil, qu'il s'assied sur le vase et
n'a presque besoin d'aucune assistance. Mais lorsqu'il s'veille et qu'on le met sur le
vase, il refuse et ce sont alors des crises de colre. Nous ne sommes pas suffisamment
clairs pour savoir o a t commise l'erreur dans l'ducation de cet enfant. Il est
probable que d'une situation agrable, il a d passer dans une situation peu favorable.
L'enfant frquente maintenant la premire classe du lyce.
Je crois que c'est un peu tard pour son ge. C'est l'ge de dix ou onze ans qu'il
aurait d frquenter cette classe. Vous pouvez admettre comme certain que, s'il a pu
avancer jusque-l et qu'il frquente le lyce, il n'est ni idiot, ni considrer comme
imbcile ou dbile. Il est vraisemblable qu'il aurait t meilleur lve s'il n'avait pas
souffert constamment de cette tension psychique.
Il a d redoubler la premire et la troisime classe de l'cole primaire.
Ce qui corrobore notre hypothse selon laquelle il a souffert d'une certaine tension
et n'a pas pu prparer suffisamment ses classes, surtout s'il avait affaire un insti-
tuteur svre. Il a fait un pas de plus vers le dcouragement. A la maison ces circons-
tances n'ont pas d lui tre favorables.
Maintenant il progresse convenablement l'cole.
Il est probable que l'instituteur est aimable.
Il a des amis.
Il commence reprendre espoir et regarder la vie avec plus de courage.
Souvent, l'cole ou dans la rue, il fait des grimaces.
Ces grimaces ont de nouveau une forme de dynamisme que nous pouvons consi-
drer comme un langage. Qu'est-ce dire, sinon que ce garon demande qu'on le
regarde? Il joue un rle, une comdie qui a pour but d'attirer l'attention des autres. L
vous avez un phnomne analogue celui de l'nursie et au fait qu'il se salit avec ses
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 147
matires. Il souhaiterait se pousser davantage au premier plan. Il a l'impression qu'on
le nglige et il lutte pour se faire remarquer.
Il aurait commenc marcher onze mois et a parl assez tard.
Il existe des enfants dont le dveloppement du langage se rgle d'aprs les cir-
constances extrieures (mutisme). Nous aurions mme compris celui qui et soutenu
que cet enfant est imbcile, quoique ce ne soit pas le cas ici.
Il montre en outre un dfaut de prononciation. Lorsqu'il parle, sa langue vient
buter contre les dents.
C'est ce que nous appelons zzayer . Je ne comprends pas pourquoi on ne
remdie pas pareil dfaut ; il faudrait montrer doucement l'enfant comment il faut
tenir sa langue lorsqu'on parle ou employer des dispositifs en fil de fer, On arrive
facilement faire disparatre ce dfaut, qui, en l'occurrence, a d contribuer encore
lui faire considrer son rle comme dsagrable. Sans doute s'est-on moqu de lui, ce
qui a d le dcourager.
Le pre aurait prsent le mme dfaut de prononciation.
Ce n'est pas le dfaut de prononciation qui s'est transmis, mais la forme de la
langue ou la conformation du maxillaire. Tout dfaut de prononciation est favoris
par une disposition organique spciale. Nous constatons trs frquemment chez les
bgues, soit une disposition anormale de la charpente osseuse du maxillaire ou du
larynx, soit des anomalies dentaires. Toutes ces circonstances contribuent gner le
droulement normal de la prononciation et ouvrent la voie un dfaut de langage.
Maladies infantiles : rougeole, varicelle, en plus pneumonie. Ablation des vg-
tations et des amygdales il y a trois ans.
Nous ne devons pas ddaigner ces renseignements.
L'enfant est chtif, asthnique et donne une impression de timidit et
d'anxit.
Nous ne nous attendons pas ce que l'enfant nous donne l'impression d'tre cou-
rageux. Il touche au dcouragement. S'il s'est lgrement amlior ces derniers temps,
c'est peut-tre parce qu'il est en progrs l'cole.
Du fait que son maxillaire suprieur est plus prominent que le maxillaire
infrieur et qu'il garde la bouche presque constamment ouverte, il donne une impres-
sion de niaiserie.
Vous voyez qu'il prsente des anomalies de la charpente osseuse. Son aspect niais
a d contribuer augmenter sa singularit.
Examen organique gnral : rien signaler, rflexes normaux ; l'examen neuro-
logique n'a pas encore t effectu ; l'examen du nez et du pharynx non plus. La mre
et un frre avaient une nphrite.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 148
Il est trs intressant du point de vue de la psychologie individuelle, que l'on
trouve chez les nurtiques une infriorit de tout le systme urognital (par exemple
infriorit d'un rein), fait sur lequel j'ai dj insist dans mon tude sur l'infriorit
des organes . Ces infriorits causent parfois des maladies, ce qui ne veut pas dire
que l'nursie est elle-mme la suite d'une maladie organique. Il existe une infriorit
embryonnaire qui favorise l'apparition de l'nursie. Une faiblesse du tractus digestif
et une faiblesse de l'appareil gnital se constatent galement chez les nurtiques. La
faiblesse de J'appareil gnital est prsente dans presque tous les cas.
Il s'agit maintenant de voir de quelle faon nous pouvons parler la mre et
d'tablir si le cas de cet enfant est vraiment aussi dsespr. Nous essayons par
ailleurs de nous rendre compte si le sujet s'est amlior ces derniers temps, alors que
nous constatons des signes favorables tels que le fait d'avoir des amis et un meilleur
rendement l'cole. Il s'agit aussi de dterminer la mre faire comprendre cet
enfant qu'il a sa valeur et lui montrer qu'on ne le nglige pas. Il faudrait enfin
l'engager obtenir du pre qu'il adopte une meilleure conduite envers le garon, qu'il
lui fasse plaisir parfois, en l'emmenant par exemple en promenade, seul, un diman-
che. Dans ces conditions l'enfant abandonnera son attitude accusatrice et ne gchera
plus les joies de la famille.
Il nous faut encourager le garon lui-mme pour qu'il puisse avoir des succs, il
faut aussi lui proposer un but, en tant certains qu'il pourra l'atteindre. Nous essaye-
rons de lui prciser ce but et nous lui demanderons s'il est capable d'tablir des
rapports amicaux entre lui-mme et ses parents. Si nous russissons le rendre plus
aimable, alors il fera lui-mme des efforts pour viter d'attirer des ennuis aux autres.
On peut supposer qu'il ne se salit pas chez l'instituteur
il ne se salit que l o il se sent compltement dcourag.
Vous percevez les points de vue les plus importants obtenir de la part des parents
une attitude plus favorable envers l'enfant, encourager le garon et lui faire compren-
dre l'importance d'une profession.
Dr A ( la mre) - Nous voudrions vous parler au sujet du garon. Comment
travaille-t-il l'cole?
La mre : Ces derniers temps il a fait des efforts.
Dr A : A-t-il dj dit ce qu'il voudrait faire dans la vie?
La mre : Il voudrait devenir lectricien.
Dr A - Il a dj de l'ambition. Comprend-il quelque chose ce mtier?
La mre : Oui, il montre un certain intrt pour ce mtier.
Dr A : Se rend-il utile la maison?
La mre : Oui.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 149
Dr A : Est-il heureux lorsqu'on reconnat ses services et lorsqu'on le loue?
J'aimerais qu'on lout souvent cet enfant. Il a soif de louanges, il voudrait qu'on le
traitt avec tendresse et sensibilit. Comment s'entend-il avec vous?
La mre : Il obit ; on peut compter sur lui.
Dr A : Surveille-t-il les autres enfants ; s'entend-il avec eux, n'a-t-il pas t trop
isol?
La mre : Le second ne se laisse pas influencer par lui.
Dr A : Le second est beaucoup plus leste, plus rapide, les seconds se meuvent
toujours plus rapidement. Comment dort-il?
La mre : Il ronfle fortement, il a eu des vgtations.
Dr A : O dort-il?
La mre : Il dort dans ma chambre. Je crois que mon fils craint mon second mari
et il est trs peureux. Avant il tait chez des trangers ; sa tante tait trs bonne avec
lui, puis il entra l'orphelinat.
Dr A (le changement de la situation a commenc l'orphelinat) : Ne pourrait-on
pas faire comprendre au pre qu'il doit faire perdre l'enfant cette tendance avoir
peur de lui? C'est un gentil garon, il a besoin d'tre trait tendrement et aimablement.
On peut en faire quelque chose. Si le pre voulait, un dimanche, l'emmener en
promenade et lui faire quelque plaisir, ce serait trs bien. Il ne faut jamais battre le
garon ni crier aprs lui. Il est sur une trs bonne voie et il se dveloppera bien.
Comment est-il couch la nuit?
La mre : Il est couch sur le ventre.
Dr A : il se dtourne de la vie et se cache.
La mre : Il tire aussi la couverture par-dessus sa tte. Depuis qu'il est rentr de
l'orphelinat il est trs craintif.
Dr A : Essayez une fois de ne pas le critiquer, de ne pas le gronder; moi je lui
dirais : tu es capable! Je le louerais et lui montrerais que je l'aime. Pareil enfant a
besoin d'une preuve d'affection. S'il en tait ainsi tout irait mieux avec lui. N'a-t-il pas
envie de vous quitter?
La mre : Lorsque je lui dis que je le ferai retourner l'orphelinat, il a peur.
Dr A : Je ne lui dirais pas une telle chose. Est-il le mme l'cole et la maison?
La mre : L'enfant a peur l'cole parce qu'il ne peut pas quitter la classe quand il
le veut. Lorsqu'il a envie de sortir, il n'ose pas le demander l'instituteur.
Dr A : Peut-tre serait-il bon d'avertir l'instituteur par un mot provenant de
l'hpital. (On prend cong de la mre.)
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 150
Dr A (s'adressant mile) : Bonjour! Travailles-tu bien l'cole? Que voudrais-tu
devenir?
mile : Mcanicien.
Dr A Bravo! En es-tu capable? Comment va l'criture? mile Pas bien!
Dr A Et le dessin?
mile Assez bien.
Dr A Tu peux devenir un bon mcanicien mais il faut que tu aies du courage, il ne
faut pas avoir peur. On ne te veut pas de mal. Veux-tu apprendre ne pas avoir peur?
Tu n'es pas oblig de faire le bb devant l'instituteur! Tu es dj grand, tu n'es plus
un nourrisson ; mme si tu as une fois des mauvaises notes, il ne faut pas avoir peur.
Moi aussi, j'ai eu des mauvaises notes, mais alors je me suis attaqu avec plus
d'acharnement la question et ensuite les choses marchaient mieux. Il ne faut pas
toujours avoir peur! Lorsque tu as peur, tu te conduis comme un bb. Combien de
temps dois-tu frquenter l'cole?
mile Pendant deux ans encore, puis j'entre en apprentissage.
Dr A Et en gymnastique, comment a va?
mile J'ai eu deux !
Dr A As-tu beaucoup d'amis?
mile J'ai aussi des amis mchants. Ils me battent toujours.
Dr A Te querelles-tu avec eux?
mile Parfois.
Dr A Il ne faut pas faire de mal aux autres. Sais-tu qu'on peut se quereller sans
blesser. Ce sont en quelque sorte des exercices de gymnastique. Te querelles-tu aussi
avec ton frre?
mile Il a huit ans.
Dr A Alors tu es l'an. Est-il gentil?
mile Lui aussi est mchant et il se querelle avec moi.
Dr A Il ne semble pas tellement peureux. Il faut que tu essayes de faire des
progrs. S'il peut se conduire comme un adulte huit ans, il faudra bien que tu y
arrives toi aussi. Reviens dans un mois et raconte-moi comment tu vas, si tu as dj
plus de courage et si tu te conduis en adulte et non pas comme un bb. Essaye cela et
tu me raconteras si tu as pu y arriver. (On prend cong de l'enfant.)
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 151
Pour le moment nous sommes l'poque de l'encouragement. Si nous parlons de
ses dfauts, nous sommes loin de l'encourager. S'il revient dans un mois et si nous
constatons qu'il progresse, alors on pourra aborder la question de ses dfauts.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 152
Chapitre XIX
L'nursie, moyen de liaison
Retour la table des matires
F., g de douze ans, est prsent la consultation pour dfaut d'nursie.
C'est probablement un enfant lutteur, gt sans doute antrieurement et qui
certains vnements ont fait perdre le bnfice de ce traitement. Depuis il se sent mal
l'aise et commence attaquer sa mre de faon l'obliger s'occuper de lui, mme
la nuit. Il nous faut rechercher les indices qui nous permettront d'affirmer qu'il s'agit
d'un enfant gt, savoir : s'il est dcourag, jaloux d'un enfant plus jeune, s'il fait des
difficults au moment des repas, essaye de se trouver au centre de l'attention, ou
cherche se concilier la sympathie d'autres personnes.
... qu'il prsente souvent le jour...
Si vous entendez dire qu'un enfant mouille le jour, c'est l'indice d'une lutte dj
trs violente. Il ne se contente pas de dranger les autres pendant la nuit. Il le fait
aussi le jour. Nous devons au moins tablir s'il ne prsente pas de dfauts mentaux.
Les maladies organiques qui causent pareille nursie sont trs rares.
... rarement la nuit.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 153
Pendant la journe il mne une lutte violente, la nuit il se trouve probablement
dans une situation plus favorable et il se calme. Nous ne serions pas tonns si on
nous disait qu'il mne cette lutte d'une faon consciente et si le trait dominant de son
caractre tait l'arrogance. Car l'arrogance est une lutte presque consciente.
Lorsqu'il est accompagn par sa mre ou lorsqu'il se trouve l'cole, il ne se
mouille jamais.
C'est l'indice que son nursie est motive par des lments psychiques. Si sa
mre se trouve prs de lui, il n'a pas besoin de chercher l'attirer lui. Il est probable
qu' l'cole aussi il se sent l'aise. Peut-tre est-il bon lve ou veut-il viter de se
faire exclure de l'cole.
La mre est divorce.
Des msententes dans le mnage ont une trs mauvaise influence sur les enfants.
Les poux qui se querellent s'occupent gnralement peu des enfants et manifestent
de la mauvaise humeur leur gard. Il est remarquer que parmi les enfants
difficiles, les dlinquants, les nvross, les pervers sexuels, les ivrognes, on trouve
trs souvent les enfants de mnages malheureux ou mauvais. Nous allons essayer de
voir si cet enfant n'a pas t surcharg, la surcharge tant toujours un motif d'aggra-
vation.
Il habite chez ses grands-parents.
Il faut se souvenir que les grands-parents se conduisent souvent d'une faon trs
tendre avec leurs petits-enfants. Pas toujours : car si la mre gte l'enfant, la grand-
mre lui en fait le reproche, - et si la mre ne gte pas l'enfant, alors c'est la grand-
mre qui le fait.
L'enfant dormait antrieurement dans la chambre des parents.
Cela prouve que cet enfant tait gt, soit parce que, grce ses propres efforts, il
a pu s'approcher de sa mre, soit parce que les parents voulaient toujours l'avoir avec
eux.
Maintenant il dort seul.
Cette circonstance ne nous est pas indiffrente et joue certainement un rle dans
la gense de son nursie. Si l'enfant couchait dans le lit de sa mre il ne se mouille-
rait pas.
L'enfant est fortement attach sa mre.
Ce qui confirme l'ide que cet enfant est profondment li sa mre. Il essaye de
gagner sa mre et de l'utiliser comme aide.
Il est trs gt par ses grands-parents.
Nos suppositions sont donc confirmes.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 154
Il y a quatre ans, il resta alit l'hpital pendant sept mois cause d'une
ostomylite de la hanche et du fmur.
Il s'agit d'une maladie chronique pendant laquelle on gte normment les enfants.
De semblables circonstances provoquent habituellement, aprs la gurison de ces
enfants, un manque terrible de cette tendresse dont on les entourait pendant leur
maladie. Jamais un enfant ne sera autant gt que lorsqu'il sera hospitalis pour une
maladie telle qu'une ostomylite.
On avait mme propos l'poque une amputation, mais le mal a pu gurir,
laissant toutefois une ankylose importante.
Il a donc aussi un dfaut organique. Cette circonstance contribue veiller et
maintenir chez ces enfants un lourd sentiment d'infriorit. Les enfants gts ont dj
priori un sentiment d'infriorit ; ils doutent de leurs aptitudes. Du fait que ce
garon prsente une ankylose, son sentiment d'infriorit se renforce, il essaye de
s'appuyer encore davantage sur les autres. A cause de cette maladie il a manqu
l'cole de sept dix ans. Ces annes il les a videmment passes auprs de sa mre.
A l'ge de dix ans il est entr dans la troisime classe auxiliaire et maintenant il
frquente la quatrime classe auxiliaire.
Les classes auxiliaires reprsentent encore une accentuation de l'infriorit,
moins qu'il ne s'agisse d'un enfant imbcile ou dbile. Car l l'enfant ne s'aperoit pas
qu'il se trouve parmi des enfants arrirs. Il est tout fait courant Vienne, par
exemple, de parler de classes d'imbciles dans ce cas. Un enfant normal a l'im-
pression d'une dgradation si, par malheur, il arrive dans une classe auxiliaire. Cet
enfant a donc de nombreux motifs pour se sentir comme infrieur et dsavantag.
Il travaille bien l'cole.
Nous ne sommes pas tonns d'apprendre qu'il progresse bien l'cole, s'il est
psychiquement normal. Ce n'est pas un avantage que d'tre borgne parmi les aveu-
gles ; ce n'est pas un triomphe.
Il rencontre des difficults en calcul.
Si un jour il trouve la bonne faon de calculer, il fera l aussi des progrs et il
pourra aussi bien calculer que les autres.
Si l'on pose des questions d'autres lves, c'est lui qui intervient haute
voix.
Nous pouvons en dduire qu'il s'agit d'un enfant intelligent. Cet enfant gt
voudrait se mettre en avant. Son nursie est galement un moyen pour y parvenir. A
l'cole il se trouve dans une position satisfaisante ; il peut tre content de lui ; mais l
encore il voudrait devancer les autres et c'est pour cela qu'il lve toujours la voix.
Mme lorsqu'il s'amuse avec d'autres, il faut qu'il joue le premier rle.
Il a son propre style, ce que vous ne trouverez pas chez les faibles d'esprit, et nous
pouvons dire que sa place n'est pas l'cole auxiliaire. Nous savons que, du fait de sa
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 155
maladie, il n'a pas t suffisamment prpar pour une classe normale et qu'il lui serait
difficile de la suivre. Il serait ncessaire d'ouvrir une cole prparatoire spciale pour
de tels lves.
Il a un frre, de 4 ans et demi son an, qui dans le temps fut trs gt par son
pre.
Nous tirons la conclusion qu'il n'a pas de frre ou de sur cadets. Il vit proba-
blement dans l'ide que le frre an le devance. Celui-ci est gt par le pre et il n'est
pas l'cole auxiliaire.
Le frre an est trs joli. Il a d redoubler la premire classe de l'cole primaire,
mais maintenant il travaille trs bien, il est trs srieux et trs rflchi.
Lorsque nous entendons parler de deux frres o l'an se dveloppe bien et est
imbattable, le cadet est gnralement un enfant difficile. Si c'est le cadet qui avance
bien, suit facilement son an ou mme le menace dans sa position, c'est l'an qui
deviendra un enfant difficile. Une fois de plus cette conception se trouve confirme
ici. Il est probable que l'an ne se gne pas pour faire remarquer que son frre se
trouve l'cole auxiliaire.
Notre enfant aime beaucoup faire le pitre.
Manifestation frquente chez les enfants qui ont un vif sentiment d'infriorit, qui
ne font rien et veulent se placer au centre de l'attention. Nous trouvons souvent chez
ces enfants trois manifestations parallles : l'nursie, le besoin d'interrompre les
autres et la pitrerie. Toutes formes d'extriorisation d'un tre faible et ambitieux.
Celui qui a confiance en soi ne se conduira pas de la sorte.
Il crie souvent la nuit.
L aussi il cherche un contact. Crier et faire le pitre sont des preuves de son
intelligence ; il fait tout d'une faon correcte, il le fait comme nous-mmes sans doute
l'aurions fait - si j'ose m'exprimer ainsi - si nous avions t dans la mme situation et
si nous avions mal compris cette situation, qui exige du courage.
Pendant les repas il ne fait pas de difficults pour absorber ses aliments.
Signe que l'on n'a pas commis d'erreur en matire d'ducation dans cette famille,
on n'a pas trop mis l'accent sur l'importance des repas. L'enfant a commis ici une
erreur : il devrait, l aussi, crer des difficults. Nous n'avons pas nous tonner si,
dans la structure d'un style de vie, nous constatons l'absence de certains symptmes
auxquels nous aurions pu nous attendre de par notre exprience.
Il s'habille et fait sa toilette seul.
Dans ce domaine on a probablement procd d'une faon satisfaisante.
Les parents et les grands-parents paternels sont des consanguins.
Au fond, cela n'a pas d'importance, car ce mme fait se prsente chez beaucoup
d'enfants. On ne peut pas imputer son dfaut des facteurs hrditaires. Mais je
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 156
voudrais souligner que je trouve toujours des mariages entre consanguins parmi des
gens sans courage. Ils cherchent une sorte de scurit dans le choix de leur partenaire.
Et ils la trouvent plutt chez des personnes qu'ils connaissent depuis leur enfance.
C'est l'indice d'un faible sentiment social car leur famille reprsente pour eux toute la
socit. Je ne voudrais pas nier que les mariages consanguins donnent des enfants qui
prsentent des infriorits organiques (infriorit de la vue ou de l'oue). Mais, d'aprs
ce que j'ai pu constater jusqu' prsent, c'est seulement dans les cas o des infriorits
identiques se trouvent chez les deux partenaires. Et nous trouvons d'autre part des
enfants parfaitement sains chez des consanguins o ces infriorits parallles n'exis-
tent pas. Nous nous opposons au mariage consanguin uniquement parce que le
sentiment social exige un vaste mlange sanguin. Des individus qui tablissent une si
grande diffrence entre les personnes de leur propre famille et les autres n'ont pas un
grand sentiment social.
L'enfant a eu la varicelle et la coqueluche.
Pendant ces maladies les parents gtent beaucoup les enfants. Vous observerez
qu'il existe une srie de maladies infantiles qui entranent automatiquement les pa-
rents gter leurs enfants. Ce sont par exemple : la scarlatine, la coqueluche. Elles
sont souvent suivies d'une srie de difficults caractrielles qu'on a tendance impu-
ter la maladie. Inversement, vous pouvez parfois constater qu'un enfant difficile
s'amliore aprs une maladie grave. On n'irait cependant pas jusqu' soutenir que la
scarlatine pourrait exercer une influence favorable sur le caractre de l'enfant.
Il a appris marcher l'ge de seize mois.
Si la mre ne se trompe pas, l'enfant a peut-tre prsent du rachitisme. Il est vi-
dent que, dans ces circonstances, il a t plus surveill par la mre qu'il ne l'et t
dans des circonstances normales.
Ce n'est qu' l'ge de trois ans qu'il a appris parler correctement.
Ce qui prouve qu'il n'avait pas particulirement besoin du langage, car si le
langage lui avait paru ncessaire, il aurait parl plus tt. On a d satisfaire tous ses
dsirs et faire tout pour lui sans qu'il ait parler. Cela se prsente galement chez les
muets qui entendent. De tels enfants sont en gnral particulirement gts et ils n'ont
pas besoin de parler. On voit souvent les mres remarquer alors avec fiert qu'elles
prvoient toujours les dsirs de leurs enfants ; ces derniers souhaitent toujours qu'on
les comprenne sans qu'ils aient parler et qu'on s'occupe constamment d'eux. Mais
tant donn que ces enfants ne parlent pas et que d'autre part la personne choisie
excute toujours le travail supplmentaire dont ils la chargent, nous pouvons com-
prendre comment se constitue la structure psychique de ces muets qui entendent.
Nous savons aussi que les enfants peuvent former et rgler toutes leurs fonctions
d'aprs leur entourage.
Je connais le cas d'un enfant, n d'un mnage de sourds-muets, mais qui tait lui-
mme parfaitement normal ; il entendait et parlait normalement. S'il venait se
blesser, il commenait pleurer, mais sans bruit. Les larmes coulaient sur ses joues,
son visage tait triste, mais on ne l'entendait pas. Il savait que le bruit tait inutile.
Les fonctions se dveloppent d'une faon diffrente. Vous pouvez inclure dans ces
considrations la psychologie des instincts, car les instincts se dveloppent seulement
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 157
d'aprs J'entourage. On a pargn ce garon la ncessit de parler, et ainsi son
langage n'a pu se dvelopper temps.
Actuellement il parle d'une voix un peu nasillarde. On procda l'ablation des
amygdales et des vgtations il y a quatre ans. Il est probable qu'il faudra recom-
mencer l'intervention sur les vgtations d'ici peu. Type lgrement mongolode.
Nous sommes un peu surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un type mongolode. Il y a
lieu de craindre qu'il n'appartienne finalement au groupe des enfants dbiles. Je ne le
classerais pas coup sr parmi les enfants de type mongolode. Jusqu' prsent on n'a
pas trouv un seul enfant de ce genre qui ne soit pas faible d'esprit ; mais il ne faut
pas oublier que certains sujets ressemblent des mongolodes sans pour cela tre
faibles d'esprit.
Il a la racine du nez large, des oreilles dcolles, la lvre infrieure prominente.
L'examen du systme nerveux ne prsente rien de particulier et l'intelligence est
normale. Sa iambe droite est raide. L'enfant aime faire de la gymnastique et il a pu
obtenir l'autorisation de prendre part aux exercices dans la mesure o sa jambe le lui
permet, alors qu'au dbut toute gymnastique lui tait interdite.
J'ai souvent constat que des enfants qui prsentent des dfauts des membres
suprieurs ou infrieurs s'adonnent avec beaucoup de zle la gymnastique. Ici se
confirme une fois de plus une des thses fondamentales de la psychologie indivi-
duelle, savoir que les meilleurs rendements s'obtiennent par un intrt spcial, pro-
voqu par un organe infrieur. Il y a quelques annes, dans notre ville, un danseur
unijambiste se produisait devant le public.
Vous pouvez imaginer que nous ne pouvons, dans le peu de temps qui nous est
donn, raliser tout ce qu'on peut obtenir de cet enfant. Si quelqu'un voulait se mettre
la disposition de la mre et de l'enfant notre travail serait grandement facilit. Il faut
essayer de rendre l'enfant plus indpendant et plus courageux et, par des leons
supplmentaires, l'amener pouvoir frquenter l'cole normale. Il faudrait lui
proposer un but, et lui montrer la manire d'arriver un rendement brillant sur le ct
utile de la vie. A partir du moment et dans la mesure o il enregistrera des succs, ses
mauvaises habitudes n'auront plus de raison d'tre ; son dernier refuge tait l'nursie.
Mais si nous faisons cette proposition l'enfant, en ayant la mre contre nous, l'enfant
ne sortira pas de ses difficults. Je veux montrer la mre la vritable structure de la
personnalit de l'enfant et essayer de l'influencer.
Dr A ( la mre) : Nous allons parler de votre enfant. Dites-moi, c'est un des
meilleurs lves de sa classe?
La mre : Je ne pourrais pas dire cela.
Dr A : C'est un des meilleurs lves de la classe auxiliaire?
La mre : Cela va assez bien, sauf pour le calcul. D'autres enfants sont plus forts
que lui. L'institutrice dit que s'il lit lentement, tout va bien, mais il s'emballe...
Dr A : Que voudrait-il devenir?
La mre : Menuisier.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 158
Dr A : Que fait son pre?
La mre (firement) : Il est mcanicien dentiste. Le grand-pre a un magasin de
meubles. Mon pre disait qu'il voudrait que l'enfant apprenne le mtier pour s'y
connatre dans la confection des meubles.
184
Dr A : Il veut donc dire menuisier? A-t-il des amis?
La mre : Justement, toujours des enfants plus jeunes que lui.
Dr A : A-t-il tendance se joindre d'autres enfants?
La mre : Il ne veut jouer qu'avec des enfants plus jeunes que lui.
Dr A : Frquente-t-il un patronage ?
La mre : Il tait chez les amis des enfants . Une fois les enfants se sont
querells. L'institutrice leur a tir les oreilles et les a placs contre le mur.
Dr A : Dit-il la vrit?
La mre : Il arrive parfois qu'il raconte des histoires, mais il ne ment pas.
Dr A : Sait-il se servir de l'argent?
La mre : Oui, il est trs srieux. Dans le commerce, on peut trs bien l'utiliser et
il sait trs bien ce qu'il fait ; il rpond au tlphone et on peut lui confier des petites
occupations. Mais il est trs naf.
Dr A : Comment se sent-il l'cole?
La mre : Il se sent trs bien l'cole. Auparavant, il frquentait un cours priv,
nous pensions qu'il avancerait mieux, mais on ne s'est pas occup de lui l-bas. Un
neurologue a trouv l'enfant normal et nous a conseill de le placer l'cole
auxiliaire.
Dr A : Comment sont ces enfants de l'cole auxiliaire?
La mre : Ces enfants sont effrayants mais il ne s'en soucie pas. On y trouve des
enfants qui sont trs en retard. Si je savais coup sr qu'il soit capable de se dfendre
tout seul...
Dr A : Vous en avez dout quelquefois?
La mre : Les instituteurs m'ont toujours dit qu'il deviendrait un bon commerant.
Il s'intresse tout, sait parler de beaucoup de choses et donne l'impression d'tre
indpendant. Mais il est tellement naf!
Dr A : Se mouille-t-il souvent?
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 159
La mre : Oui. J'ai t chez l'institutrice et j'ai demand comment il se comportait
l'cole. Elle se plaignait seulement de ce qu'il parlt trop haute voix ; il faut qu'il
en perde l'habitude. A l'cole aussi il se mouille. Elle disait qu'il s'agissait d'une
faiblesse (organique). Ces derniers temps ce dfaut s'est aggrav.
Dr A : Sa situation s'est-elle aggrave l'cole?
La mre : Il progresse. Avant il ne faisait pas ses devoirs tout seul, maintenant il
],es fait lui-mme.
Dr A : N'a-t-il pas t blm ? en calcul?
La mre : En calcul les autres sont plus forts que lui. Dr A : Ce serait bien s'il
pouvait aussi faire des progrs dans cette matire. Voudriez-vous envoyer cet enfant
dans notre garderie? (Dr A donne l'adresse.) Peut-il s'y rendre tout seul?
La mre : Oui, il sait prendre le tramway, il va l'cole tout seul.
Dr A : Dans cette garderie on arrivera le convaincre qu'il pourra tout russir et
qu'il pourra arriver frquenter l'cole normale.
La mre : Chez les amis des enfants il a galement fait de belles choses. Il a
confectionn un beau thtre. Il a quelque chose qui manque beaucoup d'enfants,
comme dit l'institutrice, il est trs consciencieux.
Dr A : Il serait plus favorable pour l'enfant de frquenter l'cole normale. Com-
ment est l'autre garon?
La mre : C'est un garon magnifique.
Dr A : Comment se conduit-il vis--vis du cadet?
La mre : Ils s'aiment beaucoup maintenant. Leurs entrevues sont plus espaces.
Je suis chez mes parents. L'an est chez sa grand-mre et les enfants se voient
rarement.
Dr A : Taquine-t-il le cadet?
La mre : Il se proccupe beaucoup de lui, il tremble pour lui.
Dr A : Il se conduit comme un pre, on trouve souvent ce trait de caractre chez
les ans vainqueurs.
La mre : L'an s'est toujours bien dvelopp.
Dr A : L'an semble tre trs populaire.
La mre : Le petit encore plus. L'an est orgueilleux.
Dr A : N'a-t-on pas taquin le petit cause de l'cole auxiliaire ou ne s'est-on pas
moqu de lui?
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 160
La mre : On ne le taquine pas cause de l'cole, mais on le taquine, on se moque
de lui cause de son pied, c'est effrayant!
Dr A : Cela s'arrangera et le fait de se mouiller aussi. Je vous conseillerais d'en-
courager l'enfant, de ne pas le critiquer, de ne pas le blesser et de l'exercer tout faire
par lui-mme.
La mre : Ma famille l'agace, le critique et le blesse constamment.
Dr A : Transmettez-leur mes amitis et dites-leur qu'il faudrait mettre un frein aux
critiques, reproches et vexations ; nous allons essayer une nouvelle mthode pour
l'amliorer.
La mre (prend cong en remerciant).
Dr A : Il est trs important de savoir qu'on l'attaque toujours la maison. Je ne
sais pas si vous avez vu, au jardin zoologique, le tapir. Ce tapir a la particularit, si
quelqu'un l'agace ou l'indispose, de lui tourner le dos et d'uriner. Il est trs gnant,
parfois, de rprimander quelqu'un qui n'est pas coupable.
Dr A (s'adressant l'enfant) : Comment a va l'cole? L'enfant : Bien.
Dr A : Tu es un bon garon, tu pourrais tre bon lve. Je crois que tu es faible, tu
n'as pas confiance en toi, tu crois ne pas pouvoir arriver en calcul, ce n'est qu'une
bagatelle. Tu arriveras facilement, je t'aiderai devenir bon en calcul! Alors nous
pourrons arriver ce que tu frquentes une autre cole ; l aussi je voudrais t'aider.
Nous nous y attaquerons habilement ; tu t'en rjouiras et tout coup on dira : a y
est, il avance . Je voudrais que tu frquentes ma garderie d'enfants ; on y joue, tu
pourrais y faire tes devoirs et tu y serais heureux. Moi aussi j'tais trs mauvais en
calcul et quelqu'un a d me montrer comment on y arrivait, puis je suis devenu le
meilleur calculateur. Que dirait l'institutrice si tu devenais le meilleur calculateur?
L'enfant : Elle serait heureuse.
Dr A : Veux-tu lui faire plaisir?
L'enfant : Oui.
Dr A : Reviens bientt et ne te chagrine pas si un garon te dit quelque chose de
mchant, il le dit par btise. Si on te critique la maison, il ne faut pas que tu te
fches tout de suite et que tu te mouilles. Il faut que tu m'aides! Est-ce que je peux
compter sur toi?
(On prend cong de l'enfant.)
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 161
Chapitre XX
Auprs de frres et surs brlants
Retour la table des matires
Je continue la srie des explications par lesquelles je voudrais montrer comment
je procde. J'ai devant moi une srie de comptes rendus de cas relatifs des enfants
difficiles, comptes rendus que je n'ai pas examins depuis un certain temps. Je
voudrais travailler ce sujet avec vous, vous donner une impression approximative de
la manire dont on doit examiner ces cas, vous montrer comment, nous aidant de
notre exprience, nous devons envisager chaque point en dtail, pour retrouver les
rapports et englober toutes les manifestations dans un ensemble harmonieux. Vous
allez comprendre ce que nous entendons par explorer , par interprter , notions
dont beaucoup d'auteurs ont parl, mais dont je soutiens qu'elles n'ont pas t
suffisamment comprises. Si ventuellement on lit des exposs sur la psychologie
individuelle, on trouve que l'on croit avoir compris cette psychologie, en parlant de
tendance la valorisation , ou encore en employant les expressions sentiment
d'infriorit ou tendance la domination . On n'oublie jamais que ces notions ont
t employes par Nietzcshe. Tous croient connatre la psychologie individuelle. Ces
derniers temps s'est manifest un courant qui s'appelle caractrologique et qui
pratique la caractrologie de la faon la plus dissolue. Sans cesse vous trouverez
qu'on se rclame de Nietzsche. Nous ne devons pas nous laisser bluffer, car nous ne
sommes pas obligs d'attribuer de la finesse psychologique ceux qui citent ce nom.
Si par vanit quelqu'un cite aujourd'hui le nom de Nietzsche, il est dj suspect.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 162
L'enfant en question a beaucoup souffert de maladies infantiles.
Avant de mentionner qu'un enfant, ayant beaucoup souffert de maladies infantiles,
a t gt, je voudrais souligner que la psychologie individuelle s'est pose comme
thme principal d'explorer et d'interprter la manire dont un individu se conduit vis-
-vis des autres, tant donn qu'il n'existe pas pour lui d'autre moyen d'extriorisation.
Nous savons seulement qu'il doit se mettre en rapport avec ses semblables et il nous
faut tablir comment il le fait. Et partant de cette rgle, nous sommes en tat de
trouver une donne perceptible. Lorsque je dis : tel enfant a beaucoup souffert de
maladies infantiles, nous voyons se dessiner le tableau d'une corrlation sociale.
Comment cet enfant s'est-il mis en rapport avec son entourage?
Il a eu la diphtrie et a reu des injections.
Si ce compte rendu est crit par les parents, nous pouvons dire que l'importance
des injections les a fortement impressionns et qu'ils y voient une chose effrayante.
Ce n'est certes pas une futilit que d'avoir la diphtrie et de recevoir des injections,
mais d'aprs la manire dont est rdig l'expos, nous concluons sur un rapport qui
nous est prsent par les parents eux-mmes. On veut nous donner l'impression que
l'enfant a fortement souffert.
Au moment de la convalescence survinrent des troubles nerveux : l'enfant se-
couait ses paules, frottait ses mains contre ses cuisses et parlait d'une faon
particulirement prcipite.
On peut considrer ces manifestations comme des troubles nerveux, mais les
complications nerveuses que connat le mdecin, et qui surviennent la suite de la
diphtrie, sont diffrentes. Ce sont des paralysies du voile du palais, de certains
groupes musculaires, des localisations crbrales, - or dans le cas prsent il n'en est
pas question. Nous penserons qu'il s'agit soit d'un tic, soit d'un mouvement volontaire,
qui a un but. Ce but, on peut aussi le trouver dans le cas d'un tic, mais pas d'une faon
aussi vidente. Lorsque nous entendons dire qu'un enfant se faire remarquer en
frottant ses mains contre ses cuisses, nos conceptions selon lesquelles il ne s'agit pas
d'un substratum organique, se confirment. La conduite de cet enfant est suspecte et il
faut se souvenir que pareilles manifestations apparaissent au dbut d'une dmence
prcoce. Mais d'aprs l'expos il semble ressortir que ces manifestations ont fait leur
apparition en si bas ge qu'il ne nous est pas possible de penser une semblable
affection. Il nous faut songer autre chose et introduire notre thme principal :
comment cette attitude agit-elle sur les autres? C'est un mode d'extriorisation, mais
un mode non satisfaisant. Remuer les paules, frotter ses cuisses, ces gestes ont
certainement attir l'attention des parents et, d'une faon gnrale, de l'entourage. Il
nous faut supposer qu'il y a eu un heurt dans les rapports de l'enfant avec ses parents,
car habituellement on ne se conduit pas de cette manire,. Nous savons, par notre
propre exprience, et chacun conclura de la mme faon, que pareille conduite attire
l'attention. Ayant tabli que cet enfant a d tre gt, nous allons supposer que dans
ses efforts ultrieurs pour maintenir la tendresse de son entourage, il a amplifi ce
mouvement. Cette manire de se pousser au centre de l'attention n'est pas la plus
courageuse, l'enfant ne semble pas tre sr de lui, sans quoi il aurait eu recours des
moyens plus courants; il aurait, par exemple, travaill srieusement, il se serait
conduit gentiment, il se serait prsent sous un aspect aimable et plaisant. Il aurait
progress sur le ct utile de la vie. Il semble que cette ide ne lui soit pas venue,
probablement parce qu'il n'a pas confiance en lui-mme. Cet enfant parle d'une faon
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 163
trs prcipite. Nous nous souvenons qu'il s'agit dans ce cas d'une tentative pour
attirer l'attention de l'entourage par une manire particulire de s'exprimer. Ces
grands mouvements apparaissent lorsqu'on a affaire un fort sentiment d'infriorit.
Il serait trs beau si, dj en ce moment, nous pouvions tablir la cause de ce
sentiment d'infriorit. Nous devons comprendre pourquoi cet enfant a recours de si
grands mouvements. S'il s'est trouv dans une situation psychique trs agrable - il a
subi des maladies et reu des injections, de ce fait il a t gt outre mesure - alors il
ne quitte pas volontiers cette situation agrable. Mais le droulement des choses et le
sort de ces enfants veulent qu' un moment donn leur situation change. Ils ont alors
l'impression d'tre dtrns. Dans cette tendance la valorisation qui anime tout le
monde, il est naturel qu'ils recherchent les moyens de redevenir le centre de l'atten-
tion de leur entourage. Actuellement, bien que guri, notre sujet cherche toujours la
voie qui pourrait amener la tendresse qu'on lui avait prodigue pendant sa maladie. Je
ne peux pas encore dire si cela constitue l'unique motif qui pousse cet enfant
vouloir faire revivre la situation agrable. Il existe peut-tre d'autres causes. Nous ne
pouvons pas nous laisser dcourager en constatant que d'autres enfants prsentent les
mmes manifestations sans avoir eu de maladies graves, puisque presque tous les
enfants traversent une phase o ils dsirent se faire gter. Pendant les deux ou trois
premires annes tout enfant pourra contracter l'habitude de se laisser gter, si les
parents n'adoptent pas la mthode qui consiste diriger l'intrt de l'enfant sur d'au-
tres choses et sur d'autres personnes. C'est pour cela qu'il est ncessaire de chercher
d'autres motifs qui auraient pu renforcer ce sentiment d'infriorit.
Le mdecin qu'on appela souvent en consultation disait que ce mal disparatrait
au moment de la pubert.
Je crois que nous ferions bien, devant cette affirmation, de tirer la dduction que
l'enfant n'tait pas encore sa pubert. Cette explication du mdecin n'est d'ailleurs
pas plus exacte que, d'une faon gnrale, toutes les conceptions fantasques, je dirai
inquitantes, de certains psychologues sur l'importance de la pubert. Ils croient que
la pubert est une phase effrayante, que la sexualit ruine les enfants et qu' cette
poque une transformation fondamentale se produit dans l'organisme. En ralit il ne
se passe qu'une chose : l'enfant obtient plus de libert, plus de forces, plus de possi-
bilits et cette poque retentit en lui comme un appel se conduire comme s'il
n'tait plus un enfant. A cet appel il rpond toujours d'une faon excessive. Notre
poque prsente une grande tendance vouloir comprendre le comment et le pour-
quoi d'un individu partir du dveloppement de ses glandes gnitales. Bientt il ne
nous sera plus permis de douter que le sige de notre intelligence se trouve dans les
glandes gnitales. On la prsente selon l'utilit qu'on veut en retirer : s'il y a aggra-
vation, c'est la faute de la pubert, s'il y a amlioration, c'est encore la pubert qui en
est la cause. La pubert est dsormais bien plus un Asylum ignorantiae qu'un
terrain de recherches.
Le pre du garon souffrait galement pendant son enfance de timidit, mais
dans une moindre mesure.
Nous comprenons ici, entre les lignes, que l'enfant lui aussi souffre de timidit. Je
ne sais pas comment les caractrologues qui se rfrent Nietzsche comprennent la
timidit. Si nous y appliquons notre mesure sociale, ce terme indique une sous-
estimation de sa propre personne ou, ce qui signifie la mme chose, une surestimation
des autres, autrement dit le garon se sent faible. Cette faiblesse s'exprime par de
grands mouvements, de l'arrogance vis--vis des parents. Nous ne sommes pas
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 164
tonns de voir que, lorsqu'il se heurte, avec son sentiment d'infriorit, des forces
plus grandes, chez les trangers, le vritable contenu de sa mentalit apparat nette-
ment. Cette timidit signifie se mettre de ct , ne pas vouloir se joindre aux
autres. D'aprs ce mouvement vous pouvez tablir de quoi il s'agit : c'est un enfant
qui ne se croit capable de rien. Si nous tenons l un fait certain, rien ne pourra plus
nous surprendre. Tout doit se drouler comme nous l'attendons. Nous pouvons tablir
comment il se conduira devant tel ou tel problme social, par exemple l'amiti.
Les autres enfants ne souffraient pas de cette timidit.
Il y a donc d'autres enfants dans la famille. Si nous entendons dire que les autres
enfants ne sont pas timides, nous pouvons tablir qu'ils n'ont pas un sentiment
d'infriorit aussi marqu. Ce lourd sentiment d'infriorit peut provenir du fait que
ce garon a t fortement gt et qu'il s'est trop longtemps appuy sur d'autres per-
sonnes, situation qui a d cesser un moment donn. En apprenant l'existence
d'autres enfants, nous sommes aussi en droit de penser que ce garon a pu vivre une
deuxime tragdie. Il est peut tre rest le benjamin un certain temps. Je n'ose pas
dire enfant unique. Le benjamin est plus que les autres au centre de l'attention, et si,
plus tard, arrive le moment o un autre prend sa place, nous pouvons comprendre
qu'il a ressenti une aggravation de toute sa situation. Si nous apprenons qu'il existe un
benjamin qui a peut-tre la prfrence de son entourage, nous comprendrons que ce
garon soit enclin se faire remarquer.
L'an termine ses tudes universitaires.
Si, dans une famille, l'un termine des tudes universitaires et l'autre pas, cette
diffrence dclenche toujours chez le commun des mortels une forte rage. Et
d'ailleurs peut-tre pas sans raison, car le cadet serait en droit de dire : Pourquoi ne
m'avez-vous pas pouss devenir un homme remarquable! Nous allons chercher si
cette remarque ne signifie pas : ce garon ne pourrait pas arriver aussi loin. Si c'est ce
qu'on lui fait ressentir, nous aurons alors les matriaux ncessaires pour tablir
finalement pourquoi ce garon se sent infrieur.
Le benjamin tait un enfant particulirement dou.
C'est une remarque qui renforce fortement nos suppositions.
Il y a deux ans, il est mort brusquement d'une mningite, g alors de quinze
ans.
Nous sommes renseigns sur l'ge de notre candidat; il est g de plus de dix-sept
ans. Nous pouvons donc lucider la question des tudes universitaires. Nous
apprenons que le benjamin tait particulirement dou. Reprsentez-vous la situation
en fonction de laquelle notre garon a d arriver des succs. L'an est tudiant, le
benjamin est dou, lui se trouve au milieu. Nous ne savons encore rien de ses
aptitudes, nous savons seulement qu'il emploie des moyens de faible valeur. Il est
clair que ce garon ne s'est pas montr apte faire des tudes universitaires, sinon il
n'aurait pas remu ses paules, tap sur ses cuisses, et n'aurait pas t timide. Cela ne
veut pas dire que les timides ne soient pas aptes faire des tudes, mais dans ce
rapport nous trouvons que l'expos vise nous faire comprendre : il est en retard, on
ne peut pas le comparer aux autres. Pour motiver ces symptmes ce sont des lments
vraiment minimes, mais si nous l'avons devant nous, nous trouverons cent fois plus.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 165
Ce garon ne travailla pas particulirement bien l'cole.
Je peux tenir mes promesses, Nous n'apprendrons plus rien de nouveau sur ce
garon. Notre exprience nous permet d'ajouter que cet enfant n'est pas faible d'esprit.
Tout se produit en fonction de son style de vie, comme nous l'avions prvu; il faut
qu'il y ait de l'intelligence et de la raison dans sa conduite.
Il a d redoubler sa classe deux fois.
Cet chec n'a pas d l'encourager. Il y a des enfants qui, lorsqu'ils redoublent leur
classe, se mettent au travail, deviennent de bons lves et progressent rapidement.
Mais, gnralement, pareil chec pse sur l'enfant pour longtemps. Je crois qu'il faut
longuement rflchir avant de faire redoubler une classe un enfant et se demander si
on ne pourrait pas employer d'autres moyens.
Par autorisation spciale il a pu rester l'cole jusqu' l'ge de seize ans, ce qui
lui a permis de terminer sa scolarit.
On nous a signal quel point il tait en retard par rapport son frre an. Je dois
ajouter, comme il tait prvoir : c'est un cadet. Il essaye par tous les moyens
d'acqurir le droit d'anesse (cf. Jacob et Esa). Il n'existe pour lui qu'une seule voie,
pour dtrner un frre an aussi capable : se joindre davantage aux parents et essayer
de les attirer de son ct par des moyens du reste sans valeur. Ainsi se manifeste ce
que nous avons expliqu et ce que les recherches des autres auteurs n'ont jamais pu
claircir : si parmi deux frres le cadet arrive suivre l'an et qu'il ne perde pas
l'espoir de l'galer un jour, le dveloppement se fait sans heurt et le cadet aura des
particularits qui le caractriseront. Il sera toujours sous pression, il aura un
dynamisme trs ardent, il courra. Si cette action lui russit au point de maintenir
toujours son espoir ou son courage, son dveloppement est assur. S'il n'y parvient
pas, s'il perd l'espoir, il devient un enfant difficile . Il nous faut retenir cela. Le
cadet prsente ce trait de caractre; il. avance comme dans une comptition. Au cours
de mes recherches je l'ai toujours constat dans le cas d'effondrement complet.
Pouvons-nous trouver des signes de cette comptition, mme dans le cas prsent?
L'enfant parle d'une faon particulirement prcipite! Vous pouvez constater tout au
moins ici un mouvement rvlateur d'un tat de pression certain; il veut devancer les
autres par son langage.
Aprs l'cole il devint apprenti ptissier.
Vous voyez nouveau une diffrence de situation. Il faut comprendre ce que
signifie le fait d'avoir un frre tudiant, en tant soi-mme apprenti ptissier. Ce n'est
pas une situation facile et il faudrait beaucoup de grandeur d'me pour supporter de
s'entendre dire qu'on est la moyenne et rester calme. Si nous n'avons que cette
consolation lui offrir, il vaudrait mieux cesser notre travail. Il aurait raison de tout
abandonner,
D'aprs les renseignements fournis par son patron, il prouve des angoisses
terribles s'il se trouve en face de problmes difficiles.
Vous voyez le poids de son sentiment d'infriorit, son dcouragement; la grande
distance qui le spare du problme social du travail. On ne le comprendra qu'en s'y
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 166
attaquant avec la mesure sociale. Si vous croyez que ces faits sont en rapport avec ses
glandes et ses scrtions internes, alors nous n'y pouvons rien, il faudra encore lui
faire des injections.
Il se met trembler et on est oblig de le librer de son travail.
Ce qui signifie qu'il a bti toute sa vie sociale sur l'ide qu'un autre doit faire le
travail pour lui. C'est le style de vie de l'enfant gt, qui ne veut rien faire seul et qui
cherche toujours quelqu'un pour l'aider.
Il se montra trs dou en calcul.
Je ne sais pas ce que veulent dire les parents, mais puisque nous pouvons tablir
que ce garon a suivi l'cole avec beaucoup de zle, nous pouvons supposer qu'il
possde des connaissances suffisantes en calcul, telles qu'on les rclame dans
l'enseignement de l'cole primaire.
On pouvait lui confier de fortes sommes, il n'a jamais rien perdu et n'a jamais
donn lieu des critiques. Cela veut dire qu'il n'a jamais vol, trich, ou perdu
quelque chose. Il manque seulement de confiance pour raliser quoi que ce soit par
lui-mme. Il vit comme un parasite. C'est une vive critique, il faut le dire; or sa
manire d'tre n'est rien d'autre qu'une tragique erreur. Car de cette faon, il lui est
impossible d'tablir un rapport social.
Ce garon est un tre particulirement bon.
Des Freudiens objecteraient ce moment - son subconscient est sans doute rempli
de haine, il l'a refoul et c'est par ce mcanisme qu'il est devenu bon. S'il avait t
rempli de haine contre son entourage - ressentiment qu'on parat nier en cas de
dcouragement - il serait clair que celle-ci proviendrait de son subconscient (com-
plexe d'dipe) et qu'il ne serait pas possible de l'aider; ce serait un garon charg de
dsirs de meurtre et de dispositions criminelles. Nous, nous croyons qu'il s'agit d'un
garon docile, certainement un bon enfant, qui aurait aim se joindre aux autres. Par
sa timidit, par l'ostentation de sa faiblesse, il a essay d'extorquer un acte de
bienveillance. Vous avez entendu dire qu'il tremble tellement qu'on est oblig de le
librer de son travail. Nous croyons que, tant dans son conscient que dans son incon-
scient, la docilit est son trait de caractre dominant.
Il est trs fort en calcul mental et il apprend trs vite par cur.
il s'est bien entran et il est probable que pendant toute son existence il aurait t
un lve docile, mais il n'a pas dpass ce stade. A partir du moment o il affronte la
vie mme, il montre qu'il n'est pas prpar pour cette vie.
Il a l'oreille musicale et il s'intresse la littrature. Sa distraction prfre est la
visite des muses.
Lorsque les parents disent qu'il s'intresse la littrature, ils indiquent par l qu'il
aime lire. C'est suspect, car la lecture lui permet de se dtourner des vritables
problmes de la vie.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 167
Il est capable de comprendre correctement des confrences et mme de les
rciter parfaitement.
Cette dernire remarque nous donne rflchir. Il aime lire, il aime visiter les
muses et nous entendons dire qu'il assiste des confrences qu'il peut rciter correc-
tement : tout cela signifie qu'il essaye d'imiter son frre dont il sait qu'il lit beaucoup
et qu'il assiste lui-mme des confrences. Comme vous le voyez, il ne se laisse pas
vaincre et il prsente un mouvement ascendant tout en tant apprenti ptissier. Voici
le point qui nous permettrait d'entrer en action et de l'amener un niveau plus lev.
Nous comprenons que son tremblement anxieux exprime sa tendance chercher une
occupation dans un autre domaine, car il n'est pas content de son mtier de ptissier.
Il n'a qu'un seul dsir : qu'un autre fasse cela pour lui; il prfre les occupations
intellectuelles. Au muse il ne tremble pas, il se montre capable. Il semble que cette
voie lui parat barre, tant donn que personne ne le comprend, et peut tre aussi
parce qu'il a d redoubler deux fois sa classe.
Il parle avec une prcipitation effrayante.
Nous avons dj touch ce point; il voudrait tre le premier.
Regard fuyant et baiss.
C'est le mode d'expression des yeux qui nous dvoile la timidit, la rpugnance
tablir un rapport par le regard. Mme nos organes des sens - tant pis pour les autres
psychologues! - ont des fonctions sociales; ils cherchent un rapport, comme les
organes du langage. Le langage reprsente la tentative d'tablir un contact avec notre
voisin. Dans son jargon du regard il exprime le sentiment de sa faiblesse aussi
bien que dans la technique de son langage. Il montre sa faiblesse par sa parole
prcipite. Il craindrait de subir une attaque s'il ne parlait pas aussi vite.
Pas d'intrt pour le sport.
videmment.
Il a t exempt de gymnastique pendant sa scolarit cause d'une adnopathie
inguinale.
L se reflte, encore une fois, la trop grande tendresse dont fut entoure son
enfance. Que quelqu'un soit libr d'une faon dfinitive des exercices de gymnas-
tique, cause d'une adnopathie, me semble exagr. Cette adnopathie est probable-
ment due une petite plaie qu'il a d contracter entre les orteils. Gnralement,
pareils accidents s'effacent trs vite.
Lors de l'examen mdical gnral auquel doit se soumettre tout lve de l'cole
d'apprentissage, les mdecins constatrent une maladie nerveuse et le garon dut tre
soumis un traitement spcial. Or ce projet choua car son patron ne pouvait se
passer de lui cause du manque de personne] et d'un accroissement momentane du
travail.
Il faut donc supposer qu'il s'est rendu utile malgr tout.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 168
Actuellement le garon a pass brillamment son examen d'apprenti; pourtant les
parents envisagent l'avenir avec angoisse. Ils sont convaincus que le garon n'est pas
la hauteur des exigences de son mtier et du travail que ce dernier demande.
Malgr sa russite l'examen d'apprenti, avec mention! On ne trouvera certes pas
beaucoup de parents qui prouvent des soucis en pareil cas. Cet enfant semble avoir
toujours t l'objet de la sollicitude des parents. C'est probablement cette attitude
mme qui a contribu dcourager ce garon. On ne l'a jamais cru capable de
quelque chose; on a toujours regard son avenir avec angoisse, cette attitude ne me
semble pas justifie. On a donc peu encourag cet enfant. Le plus important des
moyens employer est d'clairer l'enfant sur ce dfaut. Je ne sais si on peut appeler
cela une thorie, car ce n'est pas mettre sur le mme plan que d'autres thories
psychologiques. Nous ne serions pas gns si un profane, s'occupant de cet enfant,
concluait de la mme faon. D'autre part il ne faudrait pas nous en faire le reproche,
si nous dcouvrons tout cela mieux que d'autres grce notre exprience. Il faut
supposer que la frquentation de la psychologie et de la philosophie a rendu myopes
jamais tous ceux qui en ont fait leur mtier. Cela est trs regrettable mais la faute n'est
pas de notre ct. Une dernire indication montrera encore quel point la sexualit
est surestime notre poque.
Il faut noter que l'on n'a pas encore remarqu la moindre tendance sexuelle chez
ce garon.
Il est g de 17 ou 18 ans. On pourrait objecter que les parents n'en savent peut-
tre rien. Si nous avons raison, nous pourrons soutenir que les parents ont vu juste. Si
en effet ce garon tait courageux dans ses rapports sociaux - et la tendance sexuelle
reprsente elle aussi un rapport social - nous nous trouverions alors dans une contra-
diction que nous ne pourrions pas expliquer. Mais, l'organisation de sa vie instinctive
prsente exactement les mmes modifications que sa vie tout entire. Il se pourrait
que ce garon ait hrit d'un instinct dpassant tout ce que l'on peut imaginer, il
pourrait avoir depuis sa naissance les instincts les plus pervers, les instincts des tres
dous d'une puissance extraordinaire ou au contraire les instincts les plus faibles.
Mais ce faisceau d'instincts devra obir au but majeur de ce garon, c'est--dire se
tenir distance et esquiver la solution de ses problmes, faire travailler les autres
pour lui. Nous pouvons jeter un regard vers l'avenir, nous ne serons pas en droit de
donner tort ses parents, car les difficults s'accentueront si cet enfant ne change pas
son style de vie. Nous pouvons deviner quels seront le mouvement et la distance qui
lui interdiront toujours la solution de ses problmes. Lorsqu'il trouvera un appui,
lorsqu'il sera lve, il ne se fera pas remarquer, mais lorsqu'il devra se conduire en
homme, alors on pourra se rendre compte qu'il n'a pas pris au srieux son propre rle
d'homme.
L'attitude de l'ducateur vis--vis de ce garon se dduit de ce que nous venons de
dire. Je voudrais encore ajouter un mot. Le mode d'ducation ressort automatique-
ment de l'exploration du style de vie de l'enfant et des erreurs que nous y avons
trouves. Il faut encourager ce garon. Cela ne peut se faire qu'en attirant son atten-
tion sur une juste comprhension de ses points faibles. Il faut qu'il ralise qu'il
n'avarice pas dans la vie, ayant t trs gt. Ce qui laisse sous-entendre qu'il affron-
tera tous les vnements avec la question : qu'est-ce que cela me rapportera? Car il
cherche la chaleur et l'apprciation des autres ainsi que leur aide; et ce n'est pas une
chose tellement difficile que d'arriver faire comprendre quelqu'un pareille notion.
Si on s'y attaque avec le tact psychologique voulu et si on saisit le problme avec de
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 169
l'intuition artistique, on y parviendra. Il faudra renoncer cette ide qu'il a moins de
talent que son frre. Il faudra lui expliquer qu'il peut arriver tout, condition de
s'entraner suffisamment. Mais il faut galement dgager sa voie. Le pre et la mre
ne doivent pas persister dire : tu n'arriveras rien. Il serait utile que ce garon n'en
croie rien - car s'il a cependant connu des checs, c'est parce qu'il a abord la vie par
un ct erron et avec l'ide malheureuse qu'un autre devait tout faire pour lui. Il faut
lui rendre tout cela comprhensible et l'clairer sur le fait qu'il n'a pas encore atteint
les limites de ses possibilits. Il faut lui dire : tu tintresses aux confrences et tu les
suis, tant donn que tu y es prpar et que tu as t un bon lve. Il a l'avantage
d'avoir exerc son cerveau dans ce sens. On peut arriver l'encourager jusqu'au point
o il pourra battre son frre. C'est sous cette bannire que nous devons avancer :
la supriorit appartient celui qui triomphe!
Le tact pdagogique et l'interprtation artistique au moyen desquels nous devons
embrasser les problmes sont des fonctions sociales. Le tact pdagogique s'applique
l'attitude d'un tre humain vis--vis de son semblable. Il est dtermin par le dsir
d'amliorer l'tat d'me de son semblable d'une faon bienveillante. Comment expli-
quer pareille attitude? C'est facile, il faut produire en soi-mme cet tat d'me et se
mettre en rapport avec l'autre. Il faut voir avec les yeux de l'autre, entendre avec les
oreilles de l'autre, il faut sentir avec le cur de l'autre, il faut s'identifier avec lui.
C'est un tout autre processus que celui qui correspond la conception freudienne. Il
s'agit plutt de celui qui est dsign dans la psychologie comme l'identification. On
ne peut l'apprendre que dans la socit lorsqu'on a d'une faon utile dvelopp le
rapport du moi avec son entourage, et lorsqu'on a suivi l'idal d'un dveloppement
dans le sens de l'tre social. L'entranement ne s'est pas ralis dans le vide mais dans
les rapports de notre moi avec nos semblables. Il faut goter toutes les formes des
rapports sociaux, la camaraderie, l'intrt pour les autres. Nous devrions prsenter la
tendance devenir ce que nous demandons que soient nos enfants, ni plus, ni moins.
Je marche sur un volcan lorsque j'aborde la question de l'artiste et du travail
artistique. Beaucoup de psychologues de second ordre se donnent l'apparence d'tre
trs avancs en estimant si hautement l'art en tant qu'art, alors que nous nous n'y
comprenons rien . Nous avons toujours pu observer que lorsque nous nous sommes
rapprochs d'un artiste avec notre faon de comprendre, nous l'avons lev dans sa
dignit. Lorsque nous observons des artistes nous ne les considrons pas comme des
tres incomprhensibles et qu'on n'arrive pas connatre, nous leur attribuons la plus
grande dignit : celle d'tre des amis et des guides de l'humanit! Ce sont eux qui
nous ont appris comment voir, penser et sentir. Nous leur devons les plus grands
biens de l'humanit. Si, une fois de plus, nous appliquons la mesure sociale, nous
nous apercevons que l'artiste ralise une fonction sociale dans la mesure la plus large.
Un jour on s'en est rendu compte, aujourd'hui on l'a oubli. Je pense au mot
d'introduction adress par Lessing Schiller l'occasion de l'ouverture du thtre de
Hambourg : La scne considre en tant qu'institut de morale . L'artiste ne devrait
tendre rien d'autre qu' enrichir l'humanit, ouvrir des voies nouvelles, pour une
meilleure comprhension et une sensibilit plus profonde. Et l nous nous trouvons
nouveau sur un terrain ferme, sur la base mme de la psychologie individuelle.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 170
Chapitre XXI
Comment je parle aux parents
Retour la table des matires
Je crois qu'il est important de parler correctement aux parents. Mais il est difficile
d'en expliquer la technique. Il serait utile que tous les conseillers discutent de temps
en temps cette question entre eux. Il faut d'abord gagner les parents; il ne faut pas les
brusquer. Si les parents viennent nous pour nous consulter, ils le font par un certain
sentiment d'imperfection. Ils s'attendent notre critique de leur sens de la respon-
sabilit, Il faut avant tout ter ce fardeau aux parents. Je leur dis toujours : Comme
je le constate, vous tes sur la bonne voie. Mme lorsque je suis convaincu du
contraire. Lorsque je veux agir d'une faon utile, il faut que je sache choisir la mtho-
de adquate. J'ai vu dans une vieille biographie de Benjamin Franklin qu'il procdait
de la mme faon. Il se dispensait de toute parole dogmatique. En ce qui concerne
une question de dtail, j'ai remarqu qu'on ferait bien de ne pas trop questionner la
mre. Dans les consultations scolaires nous avons l'aide de l'instituteur. Les institu-
teurs ont compris l'importance de semblables consultations. Nous, les psychologues,
nous sommes dans une situation relativement favorable, l'instituteur et la mre vivent
le reste de la journe avec l'enfant : ce sont eux qui portent la plus lourde charge. Il
est trs important de saisir le point essentiel du cas, mais il est aussi important de ne
pas jeter la tte de la mre immdiatement tout ce que l'on a compris. Il faut le
garder pour soi et y faire allusion occasionnellement. Acqurir cette aptitude et suivre
ce processus sont une ncessit. Le sens critique des psychologues et des pdagogues
est fortement enracin. Il est recommand d'employer des mots expltifs tels que
peut-tre ou je pense que ceci serait efficace . Nous ne sommes pas en tat de
traiter galement les parents; nous pouvons ventuellement leur donner des ides. Il
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 171
est impossible de modifier par quelques mots un systme enracin. C'est d'ailleurs
superflu lorsque nous pouvons nous assurer la confiance des enfants et que nous leur
montrons qu'il ne faut pas prendre les difficults au tragique, qu'il est plus important
d'tre courageux. Un conseiller dispose de moyens pour encourager en une demi-
heure un enfant qui se sent prs de l'effondrement. Aussi bien notre situation est-elle
avantageuse : nous avons affaire des enfants qui ont t critiqus. Brusquement, ils
arrivent dans une atmosphre nouvelle o ils peuvent se rendre compte qu'on ne les
considre pas comme des cas dsesprs. Il serait bon que nous eussions la possibilit
d'tre plus longtemps en contact avec ces enfants, que nous puissions disposer d'un
nombre suffisant d'ducateurs. Nous ne pouvons malheureusement pas publier de
statistiques, mais les instituteurs nous rapportent des rsultats encourageants.
Il faut d'emble gagner les parents. Chaque conseiller peut dvelopper cette m-
thode a un degr trs lev. D'avance nous sommes obligs de nous conduire avec
beaucoup de douceur. Certains pdagogues ont atteint une vritable matrise dans la
pratique des traitements doux. C'est ncessaire lorsque vous parlez de dfauts tels que
la colre. Mais nous n'oublierons jamais que cette douceur n'est que l'aspect extrieur
du problme et qu'il s'agit pour nous d'clairer le point central, de tirer la lumire le
style de vie du sujet en question. C'est le grand avantage qui nous distingue des
autres. Il nous faut pratiquer cette technique en tant conscients de notre tche, et la
pratiquer avec intelligence. Nous ne voulons pas obtenir des amliorations chez
l'enfant en le gtant, mais nous visons le problme central, son dcouragement, ses
dfauts et le fait qu'il s'est condamn lui-mme C'est l le centre du problme, le reste
n'est que l'introduction. Voil pourquoi la mthode du contact doit prcder le reste.
Mais celui qui se bornera l'tablissement du contact, se trompe. Il s'imagine que de
ce fait il obtiendra une gurison. S'il enregistre des gurisons, ce sera par hasard, et
non par russite thrapeutique. Il existe des conjonctures o l'enfant comprend ce que
le pdagogue n'a pas compris. Il ne suffit pas d'tre un ami du genre humain, un
conseiller bienveillant; tous procdent de la mme faon. Ces ducateurs rendent la
vie agrable aux enfants, ils ne cessent de les louer, s'imaginant qu'ils arriveront des
rsultats par le charme de leur personnalit. Il est inutile de signaler la controverse sur
le point de savoir s'il faut employer la douceur ou la svrit. Ce n'est que par la
modestie qu'on arrive trouver l'accs l'me humaine. C'est un art que de gagner
quelqu'un, que d'veiller en lui certains sentiments, de l'amener couter et
comprendre ce qu'on lui explique, et cet art est indispensable auprs de ces enfants.
Nous avons entendu dire : A la consultation l'enfant est souvent doux, mais la
maison, il est pire que le diable. S'il a compris, c'est le premier pas vers une entente.
On ne peut pas maintenir constamment un enfant dans des circonstances qui lui soient
favorables. On ne peut pas, en le gtant, faire disparatre ses dfauts; mais il faut
arriver lui faire comprendre ce qu'il y a d'erron dans son dveloppement et l, les
lois d'airain de la psychologie individuelle nous guident. Il suffit parfois de dix
minutes pour qu'un conseiller soit compltement clair sur un cas. L'art consiste
faire comprendre quelqu'un ce qu'on a dj compris. Il existe des gens qui ont un
grand savoir, mais qui sont incapables de le communiquer par J'enseignement. Ceux
qui ont un certain contact avec les gens auront la tche plus facile, tant donn que
dans le commerce journalier avec les hommes, ils ont appris s'expliquer. Voil le
devoir primordial du conseiller de psychologie individuelle.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 172
Chapitre XXII
La tche du jardin d'enfants
Retour la table des matires
Je n'ai certes pas besoin d'attirer votre attention sur l'extrme importance qui
revient l'ducation d'un enfant en ge de scolarit. La nouvelle psychologie que je
reprsente - la psychologie individuelle - a insist sur le fait que l'ducation reue
l'cole est la plus importante, et marque toute la vie de l'enfant. Il est certain qu'aprs
les quatrime et cinquime annes, le style de vie d'un enfant est dj si bien dfini
que des influences extrieures ne peuvent plus le changer. On croyait antrieurement
que, suivant les situations et diffrents ges, le comportement d'un enfant tait
diffrent. Un fruit vert parat diffrent d'un fruit mr, Pourtant, un connaisseur pourra
dire ce qu'il en adviendra. J'ajouterai mme que ce fruit mrissant est plus qu'un amas
cellulaire qui se dveloppe. Il s'agit de quelque chose de vivant, de tendancieux, d'un
dynamisme psychique, qui tend une forme idale, qui dsire et qui doit, dans sa
configuration dfinitive, s'expliquer avec les devoirs de la vie. Chaque mouvement
s'est dj mcanis chez l'enfant, ds les premires annes de sa vie. Ces mouvements
ne sont plus succinctement mdits ni analyss, ils sont au contraire les vivantes
rponses tous les problmes de l'existence en fonction de ce style de vie. On peut
diffrencier les enfants d'aprs leur comportement psychique. Le vrai connaisseur se
trompera rarement lorsqu'il aura tabli qu'un enfant est timide ou renferm, ou encore
que cet enfant plac devant un devoir l'aborde de loin ou s'en loigne le plus possible,
hsite ou essaie de s'esquiver. Ce ne sont que de petits dtails, mais nous pouvons en
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 173
tirer beaucoup de renseignements. Nous ne devons pas considrer le petit enfant hors
de la socit humaine. Dans les quatrime et cinquime premires annes, les bases
de l'individualit et de la personnalit sont dj poses. Si quelque chose est
dfectueux, on n'y peut rien changer par des influences extrieures.
Notre vie intrieure n'est faite que de formes de relation. Il est trs intressant, en
physiologie et en biologie, de rechercher, d'aprs certaines parties, ce que sont les
mouvements, les instincts. En psychologie, nous sommes toujours dans le domaine
des relations. Par exemple, on n'obtiendra pas de rponse cohrente d'un enfant si on
ne le questionne pas. Nous ne saurons comment il ragit que lorsque nous le mettrons
en face d'un devoir. Dans une situation agrable, un enfant ne trahira pas le diable qui
se cache en lui. Une fois l'enfant confront avec une situation difficile ce diable le
trahira. L'tat d'esprit d'un enfant n'apparatra que dans une telle confrontation. me
et psychisme signifient pour nous : relation et mouvement social. Nous allons voir
d'o provient cette relation sociale, et pourquoi elle est si varie.
Toutes les facults que nous pourrons observer chez l'enfant existent dj lors de
sa naissance. Nous ne pouvons pas examiner les capacits d'un enfant pour l'avenir,
pas plus que nous ne pouvons savoir jusqu'o il nous sera possible de les dvelopper.
En utilisant une mthode adquate, il est possible de faire natre quelque chose de
prodigieux partir de forces trs limites. Par exemple : Helen Keller, sourde et
aveugle, est devenue une personnalit minente. Nous avons souvent constat que des
enfants peu dous se sont dvelopps jusqu' devenir quelqu'un de trs grand, simple-
ment parce que l'on avait trouv la mthode d'ducation adquate. Le dveloppement
des facults d'un enfant est fonction de l'entranement bien plus que des forces qu'il
possde. tablissons une comparaison : quelqu'un possde une grande fortune,
dpense tout et se trouve en difficult; un autre n'ayant que peu de moyens n'prouve
aucun ennui.
Le devoir des ducatrices consiste carter les obstacles, ouvrir la voie afin que
la personnalit acquise par l'enfant ds ses quatre ou cinq premires annes devienne
telle qu'elle lui permette d'accomplir plus tard tous ses devoirs. Un. idal doit
prexister, non pour qu'on l'atteigne, mais pour montrer la route suivre. L'ducation
en vue de la formation d'tres sociables n'est pas une ide thorique. On doit faire
comprendre l'enfant que le manque de sociabilit est la pire erreur qu'il puisse
commettre dans sa vie parmi les adultes. Comment s'tablissent les bases de cette
premire relation? C'est dans la personne de sa mre que l'enfant ralise sa premire
exprience d'une relation sociale. L'enfant s'intresse d'abord sa mre, c'est son
premier pas vers l'intrt qu'il portera plus tard aux autres. Cette premire exprience
est trs significative pour l'enfant. La faon dont il fait l'exprience de sa mre est
capitale pour l'enfant.
Au jardin d'enfants, les ducatrices remplacent la mre et doivent exercer le rle
de la mre. Elles doivent corriger les erreurs commises par la mre. Elles doivent
guider les enfants afin de leur donner la possibilit de trouver des relations avec
autrui. Ce rapport Toi moi joue un rle capital dans toutes les facults impor-
tantes de l'individu. Le langage par exemple est un rapport de Toi moi . La voix
est le lien d'un tre un autre. Si ce lien n'est pas compltement dvelopp, le langage
ne se dveloppera pas bien. Tous les enfants dont le langage se dveloppe mal et qui
d'autre part n'ont pas de dfauts organiques, n'ont pas t suffisamment prpars, pour
la plupart, aux relations de Toi moi , Vous pouvez tirer des conclusions partant
de la pauvret ou de la richesse du langage d'un homme, car il ne peut s'exercer et
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 174
acqurir un riche vocabulaire que dans un milieu social o il contracte des relations et
l o il les accepte.
La comprhension n'est pas une affaire prive. Comprendre signifie penser, juger,
conclure, etc., comme je suppose que chaque homme raisonnable pense d'une faon
absolument identique dans des circonstances semblables. La valeur de la raison est
universelle. Je ne puis la faonner selon un point de vue personnel.
Vous remarquerez que les enfants difficiles ont des ides personnelles de l'ordre
de celles que nous ne considrons pas comme raisonnables. Elles ne correspondent
pas au sens commun (common sense); il en est de mme pour le beau et le laid. Ce
que nous appelons beau reprsente galement une valeur gnrale.
Le premier devoir de la mre consiste veiller chez l'enfant le sens de la vie
sociale, en lui inculquant l'ide de l'existence de ses semblables. Vous rencontrerez
beaucoup d'enfants qui, n'ayant pas reu cette ide, ignorent qu'ils ont des semblables.
Ce sont surtout des orphelins et des enfants illgitimes. Cette rgle n'est pas absolue,
car parmi ces enfants vous en trouverez qui ont un sens social. Ces enfants grandis-
sent sans reconnatre la socit. Cette absence de sens social se trouve galement
chez les enfants laids, les enfants non dsirs et les infirmes. On doit se rendre
compte de l'effet produit sur eux : toujours repousss sans jamais entendre de bonnes
paroles. Ils croissent comme s'ils taient en pays ennemi. Les ducatrices doivent leur
inculquer l'ide qu'ils sont semblables aux autres. La mission de l'ducatrice est trs
belle. Si vous admettez ce point de vue, vous commettrez peu d'erreurs. Le rle de la
mre comporte une autre fonction importante. Durant les premires annes de l'du-
cation de son enfant, elle doit aiguiller l'intrt naissant du petit vers autrui et elle ne
doit pas l'arrter et le fixer elle. Ainsi par exemple : les enfants gts ne s'intressent
qu' leur mre ou une personne qui les choie, l'exclusion de toutes les autres.
Lorsque vous remarquez cette tendance, vous pouvez conclure que vous tes en
prsence d'un enfant gt qui exige que tout lui soit facilit et que quelqu'un fasse
toujours quelque chose pour lui.
Les institutrices doivent aiguiller ce sens social naissant vers autrui et avertir la
mre afin qu'elle dirige cet intrt galement sur le pre, pour fixer en accord avec lui
la manire de vivre de l'enfant. Il faut en outre prparer l'enfant l'arrive possible de
frres ou surs plus jeunes. C'est un point que l'on nglige souvent et qui a une
grande influence sur le style de vie de l'enfant.
Le jardin d'enfants est un prolongement de la famille. Il doit accomplir et corriger
ce qui dans la famille, par suite de mauvaise comprhension et rsultant de vieilles
traditions, n'a pas t fait. Les ducatrices reoivent des enfants que l'on ne peut plus
comparer une page vierge. A cet ge les enfants possdent dj une individualit
laquelle les expriences ultrieures ne changeront rien. Grce leur supriorit
intellectuelle, les ducatrices arrivent peut-tre faire renoncer l'enfant tel ou tel
projet; travers les cachotteries cependant, son style de vie percera. Si vous dsirez
corriger et carter les dfauts d'un enfant, vous devez exercer les deux fonctions
maternelles. L'enfant remarquera ses propres dfauts et peut se corriger lui-mme.
Certains enfants, dont on a attir l'attention sur leurs dfauts, dprcient tout suivant
leur style de vie et concluent leur faon qui n'est pas celle du sens commun
(common sense), de la raison. Un enfant gt s'efforcera soit de devenir un centre
d'attraction de son entourage, soit de s'esquiver. Un tel enfant rencontrant des diffi-
cults ne saura pas les surmonter, et si vous lui enlevez quelque chose, il concluera
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 175
toujours : Je ne suis pas ma place, j'tais mieux prs de maman. Pareils enfants
trahiront toujours leur malaise et montreront qu'ils ne se sentent pas chez eux.
Lorsque, la place de la mre, vous exercerez ces deux fonctions, et que vous aurez
tabli le contact social, vous observerez des russites remarquables. L'enfant accep-
tera les difficults sans branlement et il s'efforcera de les surmonter de faon utile.
Vous constaterez que l'enfant est courageux. Le courage est une fonction sociale. Ne
peut tre courageux que celui qui se considre comme partie d'un tout. L'optimisme,
l'activit, le courage, la sociabilit sont fonctions de l'opportunit avec laquelle on
effectue cette ducation dans le cadre de la socit. Le dveloppement de l'individu
ne peut tre garanti que si son sens social est suffisamment grand. Si je m'intresse
la prosprit d'autrui, mon individualit est assure, alors je puis me rendre utile aux
autres. Si je ne pense qu' moi, je suis absolument inapte rsoudre les problmes de
ce monde, Je veux attirer votre attention sur un fait similaire qui n'est pas encore
assez bien compris. Chaque problme exige un sens social dvelopp. La sociabilit
d'un enfant se manifeste dans la manire dont il accueille la naissance d'un frre ou
d'une sur puns. La tche du jardin d'enfants est une ralisation sociale. L'cole, la
camaraderie, l'amour, le mariage, la position politique, les ralisations artistiques sont
toutes des tches sociales. L'art, la science signifient pour nous des ralisations utiles
la socit. Si quelqu'un n'est pas sociable, il ignore la route sur laquelle il doit
s'engager; voici pourquoi nous devons dvelopper la sociabilit des enfants.
Comment se fait-il que tant d'enfants, tant d'adultes prsentent un manque de sens
social? La psychologie individuelle a dcouvert les obstacles au dveloppement
correct du sentiment social.
Nous avons pu tablir que les enfants dtests et gts sont surchargs et qu'ils
vivent comme accabls d'un fardeau. En ce qui concerne les enfants dtests nous
comprenons cette affection, mais chez les enfants gts? Toute notre vie sociale vise
empcher les enfants, ceux qui ont t tant gts durant les premires annes de leur
vie, de l'tre davantage. Peu peu la mre mme cesse ses tendresses et elle juge plus
tard les exigences de l'enfant trop exagres. L'enfant fait l'exprience de contesta-
tions continuelles, tout en essayant de conserver sa position initiale si agrable. Il
grandit lui aussi dans une atmosphre hostile. La premire raction d'un tel enfant est
de s'intresser plus lui-mme qu'aux autres.
Il vous est loisible par exemple de constater qu'au jardin d'enfants pareille rac-
tion peut parfois dgnrer en panique. Ces enfants vomissent, ne mangent plus et
prsentent des signes manifestes d'une tension intrieure voisine de la maladie. Ils
sentent que leur position est menace. Ce sont des gostes. Ce n'est pas un bon tat
de sant. Lorsqu'ils auront un problme social rsoudre, ils n'auront pas l'entrane-
ment ncessaire leur permettant de gagner des amis, de se lier l'instituteur. Ils sont
incapables de se concentrer parce qu'ils ont toujours peur. Si vous punissiez un tel
enfant, il se sentira encore plus opprim et menac. Si ces enfants sont arrogants, cela
signifie qu'ils se sentent petits et faibles. Ils agissent comme s'ils se dressaient sur la
pointe des pieds afin de paratre plus grands qu'ils ne le sont.
Il existe un troisime type d'enfants, qui pour la plupart sont incapables de
dvelopper quelque intrt pour autrui. Ce sont ceux qui sont ns faibles, chtifs ou
ceux ns avec des organes infrieurs. Ils considrent leur faiblesse, leur souffrance
comme un fardeau et de ce fait ils sont autant grevs que les autres types. lis essaient
de se procurer une situation plus facile. Par suite de la dbilit de leur organisme, ils
n'ont que peu ou pas de courage et aucune confiance en eux. Ils portent un intrt
exagr leurs infirmits corporelles. Quelques-uns tentent de surmonter cette fai-
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 176
blesse tandis que d'autres sombrent dans le dsespoir. Par exemple : des enfants dont
la vue est faible sont pour la plupart mieux entrans percevoir les choses visibles
que ceux dont la vue est bonne. Ils sont particulirement intresss mieux pouvoir
reconnatre les choses visuelles, d'une faon ou d'une autre; ils observent plus atten-
tivement les couleurs, les ombres, les perspectives. De cette faiblesse visuelle nat
une grande force. Ces faits sont aussi valables pour les autres infirmits, pour les
oreilles, la respiration, l'appareil digestif, etc.
Les jardins d'enfants reoivent des enfants dont le degr de courage est trs
variable. Dans certains cas chaque pense, chaque sentiment devient une indication
permettant de comprendre ce qui se passe dans l'me de l'enfant. Il est extrmement
important de dterminer si un enfant est faible d'esprit ou non. En cas d'idiotie ou
d'imbcillit le dveloppement ne peut atteindre le degr normal. Ces enfants doivent
tre duqus d'une manire trs diffrente. Ils n'atteindront jamais le degr des
enfants normaux. Il est trs difficile de dterminer si un enfant est faible d'esprit.
Seule, la collaboration entre les instituteurs, les psychologues et les mdecins permet
de juger et d'en dcider. Certains dfauts seraient imputables la faiblesse d'esprit.
Les cas les plus bnins exigent une grande exprience de la part du mdecin. Un
grand nombre d'anomalies n'affecte en aucune faon l'intelligence. Pour conclure la
faiblesse d'esprit, le fait qu'un enfant soit hydro ou microcphale n'est pas suffisant. Il
est ncessaire d'tablir d'abord si un enfant a ou n'a pas souffert d'erreurs dans son
ducation. On devrait peut-tre essayer les tests en premier lieu. Les faibles d'esprit
n'ont pas de personnalit dfinie. Vous serez a mme de prvoir le comportement
d'un faible d'esprit en face de telle ou telle tche qu'aprs l'avoir entran ce sujet. Il
ne peut tendre un style de vie cohrent, car il lui manque cette unit de la vie
psychique humaine que nous pouvons reconnatre chez les autres enfants par leur
manire de vivre. Il faut avant tout tablir si un enfant est faible d'esprit ou non, car
vous devez agir tout diffremment suivant le cas. On doit explorer fond la vie
psychique de l'enfant. On doit le comprendre et alors la forme de l'ducation lui
donner s'tablira d'elle-mme.
Les ducatrices reoivent galement des gauchers, particularit que tout le monde
ignore. Ces enfants sont maladroits, crivent ou lisent difficilement; examinez-les et
voyez s'ils ne sont pas gauchers. Les dclarations des parents n'ont pas d'importance.
Un tel enfant se dcourage facilement, il ralise la faiblesse de sa mauvaise main et se
croit dtest. Un enfant se dcourage aussi si l'on se moque beaucoup de lui, si on le
taquine toujours. Il perd courage et il devient timide. On doit savoir qu'une ducation
trop svre cause galement des gros dgts. Il est impossible que pareil tre faible et
dlaiss ose se joindre d'autres s'il a perdu tout courage. Vous verrez des enfants
pour lesquels la mre a toujours pris la parole. On constate que la mre l'a dcharg
de toute difficult et ainsi l'enfant est devenu totalement dpendant d'autrui. Peut-tre
a-t-il un dfaut de prononciation, ne peut-il se concentrer parce que sa pense n'est
pas bien dveloppe. D'autres enfants s'interrompent au milieu d'une phrase, ce sont
ceux que la mre arrte continuellement sans leur laisser le temps de placer un mot.
Ceux-ci en porteront toujours les marques. Vous devez comprendre toutes ces formes
d'expression afin de pouvoir dterminer ce degr de courage et d'optimisme de
l'enfant.
La rivalit entre frres et surs joue un trs grand rle. Il est ncessaire de
connatre les ges respectifs des frres et surs de l'enfant. On ne doit pas ngliger le
fait qu'un enfant est l'an, le cadet, le benjamin ou l'enfant unique, une fille seule au
milieu de garons, un garon seul, etc.
Alfred Adler (1930), LENFANT DIFFICILE. 177
Nous devons comparer les enfants un arbuste faisant partie d'un bosquet; tous
cherchent la lumire.
La situation d'un an est toute diffrente de celle d'un second enfant. Il a t seul
un certain temps, puis tout coup son espace vital a t rduit par suite de la
naissance d'un autre enfant. Pour lui c'est une tragdie. Plus tard, ces enfants se
comportent comme s'ils craignaient toujours qu'un autre les supplante. Ils guetteront
toujours pour voir si personne d'autre ne leur est prfr. Ils se presseront toujours au
premier plan. Un second enfant n'a jamais t seul, n'a jamais t un centre d'attrac-
tion. Sa situation est meilleure, il dispose d'un Pathmaker , qui, sous plusieurs
rapports, lui facilite les choses. Ainsi que dans une comptition, il se comporte
comme s'il voulait supplanter celui qui le prcde, si rien toutefois ne l'en empche.
Le benjamin grandit dans une tout autre situation; personne ne lui succde, par contre
plusieurs le prcdent. Il est certainement le plus avantag, il joue franc jeu dans ses
aspirations et il veut surtout prouver qu'il doit tre en tte (par exemple, Joseph dans
la Bible tait le benjamin). Cette activit est rcompense, car un tel enfant est
particulirement bien arm dans sa lutte contre les difficults.
Celui qui triomphe l'emporte. Nous devons donc veiller donner aux enfants le
matriel qui leur permettra de vaincre. Nous devons leur donner du courage, c'est
le droit le plus important de l'ducation. Il est dangereux qu'un enfant se dcourage.
Bien des problmes de la vie enfantine sont difficiles, mais jamais il ne doit perdre
courage.
En conclusion : on ne doit jamais combattre un enfant; pour la simple raison qu'il
est le plus fort. L'enfant ne prend aucune responsabilit. Celui qui assume une res-
ponsabilit n'est jamais le plus fort.
La pratique sera notre vraie uvre. Aucune ducation ne peut-tre construite dans
le vide. Vous avez lutter contre les difficults qui rsultent des diffrentes interpr-
tations de la recherche scientifique. Nous tolrons la comparaison. Vous devez
prendre galement connaissance des autres thories et points de vue. Comparez
soigneusement, ne croyez personne sur parole - moi pas plus que les autres.
FIN DU LIVRE
Vous aimerez peut-être aussi
- Clerc - Medecine, Religion Et PeurDocument82 pagesClerc - Medecine, Religion Et Peurdharmavid100% (2)
- Miracles Scientifiques Du Coran Et de La SunnaDocument23 pagesMiracles Scientifiques Du Coran Et de La SunnaISLAMICULTURE93% (15)
- Nivat Vivre en RusseDocument667 pagesNivat Vivre en RusseAlessandra Francesca100% (5)
- Des Mots Pour Le DireDocument82 pagesDes Mots Pour Le DireCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Le Métal Et La Chair. Anthropologie Des Prothèses InformatiséesDocument473 pagesLe Métal Et La Chair. Anthropologie Des Prothèses InformatiséesNatheasSouthcoPas encore d'évaluation
- Reflexions GuillotineDocument44 pagesReflexions GuillotineFrancine Reinhardt RomanoPas encore d'évaluation
- ADLER 1927 Connaissance de L'hommeDocument213 pagesADLER 1927 Connaissance de L'hommerenejanusPas encore d'évaluation
- Adler Temperament NerveuxDocument263 pagesAdler Temperament NerveuxruiampereiraPas encore d'évaluation
- Alfred Adler - Le Sens de La VieDocument162 pagesAlfred Adler - Le Sens de La VieCasablanca, Morocco100% (5)
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Document154 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Casablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Cet Enfant Qui Ne Dort PasDocument136 pagesCet Enfant Qui Ne Dort PasazertyPas encore d'évaluation
- Adda Arielle-L' Enfant DouéDocument704 pagesAdda Arielle-L' Enfant Douéjo100% (1)
- Soigner Ses Enfants Avec Les Huiles Essentielles - Leduc's EditionsDocument317 pagesSoigner Ses Enfants Avec Les Huiles Essentielles - Leduc's EditionsgrimaudPas encore d'évaluation
- Traitement Par Électrochocs (ECT) FrenchDocument32 pagesTraitement Par Électrochocs (ECT) Frenchofficialcchr100% (1)
- Psychologie de L'enfant Et de L'adolescentDocument13 pagesPsychologie de L'enfant Et de L'adolescentclement MascletPas encore d'évaluation
- Zéro est arrivé !: Regard d'une psychanalyste sur l'enfant à l'écoleD'EverandZéro est arrivé !: Regard d'une psychanalyste sur l'enfant à l'écolePas encore d'évaluation
- DS PAGES EinsteinDocument10 pagesDS PAGES EinsteinDiallo SandatiaPas encore d'évaluation
- Art de Faire Le Beurre Et Les Meilleurs Fromages... 3e Édition, Revue, Augmentée Et Complétée. 1866.Document408 pagesArt de Faire Le Beurre Et Les Meilleurs Fromages... 3e Édition, Revue, Augmentée Et Complétée. 1866.anihumPas encore d'évaluation
- Traitement Des Psychonévroses Par La (... ) Vittoz Roger Bpt6k56127082Document152 pagesTraitement Des Psychonévroses Par La (... ) Vittoz Roger Bpt6k56127082Ahmad ShahriyariPas encore d'évaluation
- Dépression Causes Conséquences Et TraitementDocument191 pagesDépression Causes Conséquences Et Traitement15091965100% (3)
- TimiditeDocument17 pagesTimiditeToufik TebbalPas encore d'évaluation
- 1-Psychologie de L'enfantDocument32 pages1-Psychologie de L'enfantMikael IshakPas encore d'évaluation
- Précis de Gymnastique Occulaire - Lionel Clergeaud PDFDocument155 pagesPrécis de Gymnastique Occulaire - Lionel Clergeaud PDFYann Loosli100% (1)
- Acteur de Votre Vie - 153182Document98 pagesActeur de Votre Vie - 153182Isabelle BKAPas encore d'évaluation
- Fiches Jeux Gym CveaDocument16 pagesFiches Jeux Gym Cveaapi-282397630Pas encore d'évaluation
- Le Training SophrogeneDocument46 pagesLe Training SophrogenemarcmaxPas encore d'évaluation
- Les Fabuleux Pouvoirs de LhooponoponoDocument28 pagesLes Fabuleux Pouvoirs de LhooponoponoChrsPas encore d'évaluation
- Pour Parler Des Émotions PDFDocument4 pagesPour Parler Des Émotions PDFVILLAURRUTIA100% (1)
- Analyse Transactionnelle 2Document10 pagesAnalyse Transactionnelle 2kirk1985Pas encore d'évaluation
- La Motivation - Guide PratiqueDocument51 pagesLa Motivation - Guide PratiqueLOICKPas encore d'évaluation
- Cap Sur La Discipline PositiveDocument24 pagesCap Sur La Discipline PositiveNabil CharjanePas encore d'évaluation
- Agressivite Chez L EnfantDocument22 pagesAgressivite Chez L EnfantMagali Durand100% (1)
- L'Amour Maternel... Un Amour ImpératifDocument30 pagesL'Amour Maternel... Un Amour ImpératifAdalene SalesPas encore d'évaluation
- Apprivoiser L - Hyperactivite - Colette SauveDocument139 pagesApprivoiser L - Hyperactivite - Colette SauveArabicuser YoucefPas encore d'évaluation
- 16 PDFDocument125 pages16 PDFStephen SandersPas encore d'évaluation
- Comprendre Et Guider Le Jeune Enfant - Sylvie BourcierDocument172 pagesComprendre Et Guider Le Jeune Enfant - Sylvie BourcierMatMitrPas encore d'évaluation
- 18 09 28 - Etude - Sexualite 3 PDFDocument46 pages18 09 28 - Etude - Sexualite 3 PDFLyne SaighiPas encore d'évaluation
- Je D 233 Couvre Le Yoga by Gilles Diederichs Veronique Salomon-RieuDocument51 pagesJe D 233 Couvre Le Yoga by Gilles Diederichs Veronique Salomon-RieuivanPas encore d'évaluation
- Lettre A La Generation Qui Va T - Raphael GlucksmannDocument107 pagesLettre A La Generation Qui Va T - Raphael Glucksmannsidikouaboubakar33100% (1)
- EmpathieDocument6 pagesEmpathieKarine Aubry Hse100% (1)
- Parents ToxiquesDocument39 pagesParents ToxiquesGeanina Ionela Petrea Gheorghiu100% (1)
- Le Seigneur Des AnneauxDocument14 pagesLe Seigneur Des AnneauxElie Désiré100% (1)
- Langue Des Signes Française: Table Des MatièresDocument92 pagesLangue Des Signes Française: Table Des MatièresIsaac CaradiPas encore d'évaluation
- TED, Asperger Ou Borderline ?Document4 pagesTED, Asperger Ou Borderline ?Caroline BaillezPas encore d'évaluation
- Comment Vaincre Sa Jalousie MaladiveDocument18 pagesComment Vaincre Sa Jalousie MaladiveTrina MillerPas encore d'évaluation
- John Grisham - L'Ombre de Gray MountainDocument388 pagesJohn Grisham - L'Ombre de Gray Mountainpiecol1965100% (1)
- Être Un Enfant À Haut-Potentiel, Pas Toujours Un CadeauDocument45 pagesÊtre Un Enfant À Haut-Potentiel, Pas Toujours Un CadeauNasa nasa44100% (1)
- L'Amnésie Traumatique - Un Mécanisme Dissociatif Pour Survivre.Document23 pagesL'Amnésie Traumatique - Un Mécanisme Dissociatif Pour Survivre.Michel Blanc100% (1)
- Psychologie Sociale Leyens YzerbytDocument49 pagesPsychologie Sociale Leyens YzerbytTanguy Bocquet100% (1)
- Cerveau 2fpsycho11Document98 pagesCerveau 2fpsycho11Serge TarragoPas encore d'évaluation
- Aubin Deckeyser - Sagesses Africaines Du Jour Et de La NuitDocument4 pagesAubin Deckeyser - Sagesses Africaines Du Jour Et de La NuitwandersonnPas encore d'évaluation
- Tout est toujours parfait: L'art d'accueillir ce qui estD'EverandTout est toujours parfait: L'art d'accueillir ce qui estPas encore d'évaluation
- Ana Maria Alves - de L'antisémitisme Chez Louis-Ferdinand Céline PDFDocument224 pagesAna Maria Alves - de L'antisémitisme Chez Louis-Ferdinand Céline PDFMichel LabellePas encore d'évaluation
- PsychoDocument78 pagesPsychoapi-3802618100% (7)
- Allez cordialement vous faire foutre: 23,5 lois pour détecter, analyser, et mettre au rancart les faux-culs de votre vieD'EverandAllez cordialement vous faire foutre: 23,5 lois pour détecter, analyser, et mettre au rancart les faux-culs de votre viePas encore d'évaluation
- Comment nettoyer et organiser la maison au 21ème siècleD'EverandComment nettoyer et organiser la maison au 21ème sièclePas encore d'évaluation
- L'Accroche Narrative, Un Entraînement Pour L'Intelligence ÉmotionnelleD'EverandL'Accroche Narrative, Un Entraînement Pour L'Intelligence ÉmotionnellePas encore d'évaluation
- Tout commence par une pensée: Un accompagnement essentiel dans votre développement personnelD'EverandTout commence par une pensée: Un accompagnement essentiel dans votre développement personnelPas encore d'évaluation
- Lymphatic SystemDocument15 pagesLymphatic SystemCasablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Calculs Commerciaux Ter-TceDocument99 pagesCalculs Commerciaux Ter-TceAziz Aouragh100% (1)
- Code Marche Public MarocDocument63 pagesCode Marche Public Marocdrlaaroussi100% (9)
- La Crise Des Subprimes - Rapport Du CAEDocument284 pagesLa Crise Des Subprimes - Rapport Du CAEFrançois DelattrePas encore d'évaluation
- Intelligence Avant Le LangageDocument166 pagesIntelligence Avant Le Langagetadjoura1100% (1)
- Le Nouvel Ordre Des BarbaresDocument32 pagesLe Nouvel Ordre Des BarbaresdootjeblauwPas encore d'évaluation
- Alfred Adler - Le Sens de La VieDocument162 pagesAlfred Adler - Le Sens de La VieCasablanca, Morocco100% (5)
- Codes RegimesDocument4 pagesCodes RegimesCasablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie IndDocument147 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie IndCasablanca, Morocco50% (2)
- Alfred Adler - L'enfant DifficileDocument177 pagesAlfred Adler - L'enfant DifficileCasablanca, Morocco100% (2)
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Document154 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Casablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Sciences PolitiquesDocument206 pagesSciences PolitiquesCasablanca, Morocco100% (8)
- Du Contrat Social (JJ Rousseau)Document152 pagesDu Contrat Social (JJ Rousseau)Casablanca, Morocco100% (1)
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Document154 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Casablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Delacroix - L'enfant Et Langage PDFDocument67 pagesDelacroix - L'enfant Et Langage PDFRodrigo CornejoPas encore d'évaluation
- Pierre Janet - La Medecine PsychologiqueDocument157 pagesPierre Janet - La Medecine PsychologiqueCasablanca, Morocco100% (2)
- Pierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T1 - p2Document140 pagesPierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T1 - p2Casablanca, Morocco100% (1)
- Pierre Janet - Debut de L'intelligence ADocument107 pagesPierre Janet - Debut de L'intelligence ACasablanca, Morocco100% (1)
- Pierre Janet - Debut de L'intelligence BDocument52 pagesPierre Janet - Debut de L'intelligence BCasablanca, Morocco100% (1)
- Pierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T2 - P1Document297 pagesPierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T2 - P1Casablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Alfred Adler - Complement NevroseDocument12 pagesAlfred Adler - Complement NevroseCasablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie IndDocument147 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie IndCasablanca, Morocco50% (2)
- Alfred Adler - Le Sens de La VieDocument162 pagesAlfred Adler - Le Sens de La VieCasablanca, Morocco100% (5)
- Intuition de InstantDocument90 pagesIntuition de InstantYoussef JabriPas encore d'évaluation
- Analyse - Schematique-Jacques RoumainDocument137 pagesAnalyse - Schematique-Jacques RoumainMichner AlfredPas encore d'évaluation
- Verite N'interessait PersonneDocument415 pagesVerite N'interessait PersonneMichel BergèsPas encore d'évaluation
- 40A Keynes Theorie Generale 1Document142 pages40A Keynes Theorie Generale 1Hayet Ben SaidPas encore d'évaluation
- "Caractéristiques de La Bureaucratie.": Max WEBER (1864-1920)Document13 pages"Caractéristiques de La Bureaucratie.": Max WEBER (1864-1920)Le CaméléonPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de Linguistique LarousseDocument30 pagesDictionnaire de Linguistique LarousseChebah FaizaPas encore d'évaluation
- Enquete Sur Le TerrainDocument218 pagesEnquete Sur Le TerrainAbdoulaye BathilyPas encore d'évaluation
- Histoire Du Peuple HaitienDocument460 pagesHistoire Du Peuple Haitienaltagrace payenPas encore d'évaluation
- Operations Coup de PoingDocument25 pagesOperations Coup de PoingAroun Iboun Saïd Tidjani100% (1)
- Chav Toukiue PDFDocument370 pagesChav Toukiue PDFsergio_hofmann9837Pas encore d'évaluation
- Connaissance SurnaturelleDocument356 pagesConnaissance SurnaturelleGerard Mulot100% (1)
- Precis de Psychologie W JamesDocument526 pagesPrecis de Psychologie W JamesMF Leblanc100% (1)
- Ecoles SociologiquesDocument24 pagesEcoles Sociologiquesabderrrassoul100% (1)
- Teilhard de Chardin - Hymne - de - UniversDocument143 pagesTeilhard de Chardin - Hymne - de - Universpadre_johnny865641100% (2)
- Controverses Sur IndividualismeDocument153 pagesControverses Sur Individualismechochitto.2011Pas encore d'évaluation
- Anarchisme Et LiberalismeDocument34 pagesAnarchisme Et LiberalismeMikael Kevelouri100% (1)
- Anthropologie EconomiqueDocument182 pagesAnthropologie EconomiquekambalahyeratostenePas encore d'évaluation
- Eloge de La PauvreteDocument51 pagesEloge de La Pauvretezao1020004497Pas encore d'évaluation
- DecouverteDocument240 pagesDecouverteAndré BernardesPas encore d'évaluation
- Aide Devel Therapie AfriqueDocument17 pagesAide Devel Therapie AfriqueGNINESS100% (1)
- Le Bouddha - Sa Vie, Sa Doctrine, Sa Communauté (H. Oldenberg)Document597 pagesLe Bouddha - Sa Vie, Sa Doctrine, Sa Communauté (H. Oldenberg)lepton100Pas encore d'évaluation
- Le TabouDocument459 pagesLe TabouGelu DiaconuPas encore d'évaluation
- Seance 5e Anniversaire ANSDDocument16 pagesSeance 5e Anniversaire ANSDGlody mbembePas encore d'évaluation
- Reflexions Civilisation ImageDocument30 pagesReflexions Civilisation ImageStefaniaAOPas encore d'évaluation
- Baudrillard Societe Consommation PDFDocument23 pagesBaudrillard Societe Consommation PDFPhanieGruwierPas encore d'évaluation
- Norbert ROULAND (1988) Introduction Historique Au Droit PDFDocument755 pagesNorbert ROULAND (1988) Introduction Historique Au Droit PDFJuliano BonamigoPas encore d'évaluation
- Marcel Mauss - La Démonologie Et La Magie en Chine PDFDocument8 pagesMarcel Mauss - La Démonologie Et La Magie en Chine PDFDereck AndrewsPas encore d'évaluation
- 1 - Bergson - Matière Et Mémoire 1896Document147 pages1 - Bergson - Matière Et Mémoire 1896Michel GalabruPas encore d'évaluation