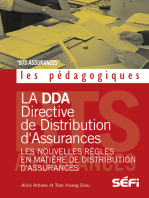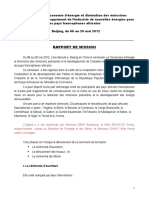Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ES441K
ES441K
Transféré par
Meryam TajabriteCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
ES441K
ES441K
Transféré par
Meryam TajabriteDroits d'auteur :
Formats disponibles
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 205
RETRAITES
Limpact des systmes de retraite
sur le niveau de vie des personnes ges
au Maghreb
Jean-Marc Dupuis*, Claire El Moudden*, Nacer Eddine Hammouda**,
Anne Petron*, Mehdi Ben Braham*** et Ilham Dkhissi****
Cet article tudie limpact des systmes de retraite sur le niveau de vie et la pauvret des
personnes ges dans trois pays du Maghreb : lAlgrie, le Maroc et la Tunisie. Les sys-
tmes de retraite du Maghreb sont tous des systmes contributifs de type bismarckien. Il
apparat que les taux de pension sont assez levs dans les pays du Maghreb. Les retrai-
tes moyennes reprsentent environ 50 % du salaire moyen. Cependant les disparits sont
fortes selon les secteurs dactivit et entre hommes et femmes. De plus, une forte pro-
portion de la population nest pas couverte par lassurance vieillesse au Maghreb, ce qui
rduit dautant lincidence des systmes de retraite sur le revenu des personnes ges.
En labsence ou en complment dune couverture retraite, quelles sont les ressources des
personnes ges ? Les donnes denqutes permettent destimer chacune des sources de
revenu dans les trois pays. Dune manire gnrale elles apparaissent diversifes, les
revenus dactivit et laide des enfants et de la famille arrivant en tte. Mais de fortes
diffrences existent entre les trois pays.
La pauvret des personnes ges dans les pays du Maghreb est cependant moins marque
que dans le reste de la population, contrairement ce qui est observ dans dautres pays
en dveloppement. La solidarit familiale y contribue pour beaucoup et probablement
autant que les systmes de retraite. Face aux changements dmographiques, conomi-
ques et culturels en cours, et en labsence dune extension de la couverture une plus
large population, le choix de prestations non contributives, mises en place par dautres
pays, pourrait tre une voie suivre au Maghreb pour lutter contre cette pauvret.
* CREM, Universit de Caen
** CREAD, Alger
*** LEGI, cole polytechnique, Tunis
**** CREM, Universit de Caen et Universit de Rabat Agdal
206 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
U
n petit nombre de travaux empiriques
sur lAfrique du Sud, le Brsil ou le
Sngal mettent en valeur limpact des sys-
tmes de retraite sur le revenu des personnes
ges et la rduction de la pauvret. Si cette
question est cruciale dans les pays en dve-
loppement, elle reste cependant peu tudie,
la question de la pauvret des personnes ges
ntant pas considre comme prioritaire au
regard notamment de la pauvret des enfants.
Elle est pourtant incontournable pour ces
pays, comme pour ceux du Maghreb qui sont
en pleine mutation. Tout dabord, la transi-
tion dmographique en cours actuellement au
Maghreb est marque et beaucoup plus rapide
que ce quont connu et connaissent les pays
dvelopps ; leur vieillissement dmographi-
que est de ce fait rapide. De plus, les syst-
mes de protection informelle (notamment la
famille) risquent dtre compromis par ces
volutions dmographiques mais aussi par les
volutions conomiques et sociales. Quelle
sera alors la capacit du modle familial
assumer les personnes ges ? Enfn les syst-
mes de protection sociale formelle que sont les
rgimes de retraite sont confronts de multi-
ples problmes : lextension de la couverture,
le vieillissement dmographique, la viabilit
fnancire moyen et long terme, lamliora-
tion de la gouvernance et bien sur la pauvret
dune partie des populations ges. Cet article
tudie limpact des systmes de retraite sur le
niveau de vie des personnes ges dans trois
pays du Maghreb : lAlgrie, le Maroc et la
Tunisie.
Un impact sur le revenu des
personnes ges potentiellement
limit par la faiblesse des taux
de couverture
L
impact des systmes de retraite sur le
revenu des personnes ges est fonction
de plusieurs facteurs. En premier lieu, linci-
dence sera dautant plus forte que le niveau des
retraites verses aux pensionns sera lev. En
second lieu, limpact des rgimes dpend du
nombre de personnes couvertes par ces syst-
mes. Dans des pays o les systmes de retraite
ne couvrent quune frange de la population,
sintresser limpact des systmes de retraite
sur le niveau de vie des personnes ges nces-
site donc de distinguer les insiders des outsi-
ders et de poser la question du taux de cou-
verture.
Mode de calcul et niveau des retraites
Toutes choses gales par ailleurs, limpact dun
systme de retraite sur les revenus des personnes
ges est dautant plus marqu que les retraites
verses sont dun montant lev. Aprs avoir
prsent les rgimes de retraite contributifs, les
lments de calcul des retraites sont analyss
pour ensuite estimer le niveau des pensions par
rapport celui des salaires.
Des rgimes contributifs
Limpact des rgimes de retraite sur le revenu
des retraits tient tout dabord au type de
rgime de retraite mis en place. Les systmes
de retraite du Maghreb (cf. encadr 1) sont tous
des systmes contributifs de type bismarckien.
Lempreinte laisse par la colonisation peut
apparatre vidente mais en ralit lhistoire est
plus complexe. Si la colonisation a bauch des
systmes contributifs, les tats auraient pu se
librer lindpendance de cet hritage fnale-
ment embryonnaire. Pour diffrentes raisons,
ils ont consolid et largi les systmes existants.
Ils ont ainsi maintenu une logique de justice
commutative, o la prestation est lie leffort
contributif pass, plutt que de sinscrire dans
une logique de pension universelle forfaitaire.
Avec ce choix dune logique contributive, les
systmes de retraite du Maghreb adoptent le
principe prsent ainsi par Laroque en 1946 :
il ny a pas de scurit vritable pour les tra-
vailleurs si les prestations ne sont pas dans une
certaine mesure proportionnes aux revenus
perdus (1).
Des taux de pensions levs
Les montants des taux de pension sont les pre-
miers dterminants de limpact des retraites sur
le niveau de vie des personnes ges. Le taux de
pension, issu de la rglementation en vigueur,
sapplique un salaire de rfrence au moment
de la liquidation pour dterminer le montant de
la pension. Il est diffrent du taux de remplace-
ment, instrument dobservation, qui rapporte la
premire pension reue au dernier salaire de la
carrire. La valeur du taux de pension, dfnie
par la rglementation du rgime, est obtenue
dans les trois pays en multipliant un taux dan-
nuit par le nombre dannes de cotisation. La
rglementation fxe un taux maximum de pen-
sion. Dans certains pays des dispositifs redis-
1. Laroque (1946, p 16).
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 207
tributifs relvent les pensions les plus faibles,
obtenues par application du taux de pension
rglementaire, pour atteindre un seuil minimum.
Il existe galement, dans certains rgimes, des
mcanismes de plafonnement.
Les salaris du public au Maroc et en Tunisie
obtiennent des taux de pension suprieurs ceux
du priv : 90 100 % aprs 40 ans de carrire
contre 70 80 % aprs 28 30 ans de carrire
(cf. tableau 1). En Algrie, le taux de pension
est identique pour les deux catgories puisquil
existe un rgime unique. Ces taux de pension
apparaissent levs par rapport ceux offerts
dans les rgimes europens.
Mais ils sont calculs pour des carrires compl-
tes et indpendamment du niveau de salaire ce
qui conduit ngliger lincidence des disposi-
tifs de pension minimale et de plafonnement des
pensions. Pour comparer les trois pays, les taux
de pension sont calculs par niveau de salaire
relatif en rapportant le montant du salaire au
salaire moyen (2) des cotisants de chaque anne
(cf. graphique I). Les donnes sont prsentes
pour des niveaux de salaire variant de 20 %
plus de 200 % du salaire moyen pour chaque
pays en 2004. Enfn les taux de pension dpen-
dant de la dure de cotisation, plusieurs carri-
res types sont retenues, ce qui permet de faire
varier le taux entre son minimum et son maxi-
mum. Ces carrires types sont thoriques dans
la mesure o il est fait lhypothse dun salaire
constant durant toute la carrire, sans prise en
compte des mcanismes de revalorisation.
2. Les salaires moyens sont des donnes complexes obtenir.
Pour plus de prcisions, se reporter Dupuis et al., 2008, Les
retraites au Maghreb, une premire analyse , Rapport pour la
MIRE.
Encadr 1
PRSENTATION DES SYSTMES DE RETRAITES AU MAGHREB
Les systmes de retraite de lAlgrie, du Maroc et de
la Tunisie prsentent de nombreux traits communs : ils
sont bismarckiens, assurent une couverture partielle
de la population, offrent des taux de remplacement
levs aux cotisants et reprsentent une part modre
des ressources des conomies. Dans ces trois pays,
les rgimes complmentaires obligatoires sont quasi
inexistants. Mais le rapprochement fait aussi appa-
ratre des diffrences marques notamment quant
larchitecture.
Des systmes Bismarckiens obligatoires
Les trois systmes de retraite relvent du principe
bismarckien : ils sont obligatoires, professionnels
et contributifs. Les salaris du secteur public et des
entreprises prives sont soumis lobligation dassu-
jettissement ainsi que les travailleurs indpendants,
sauf au Maroc dans ce dernier cas. Cette relative iden-
tit entre les trois pays trouve pour partie son origine
dans lempreinte coloniale puisque les rgimes publics
ont t crs assez tt, la fn du 19
e
sicle en Tunisie,
au dbut du 20
e
sicle en Algrie et au Maroc. Seule
lAlgrie a bnfci de la mise en place avant son
indpendance, partir de 1953, de rgimes obliga-
toires pour le secteur priv. Ces derniers ont t ins-
taurs aprs lindpendance au Maroc et en Tunisie et
les nouveaux tats, y compris celui de lAlgrie en ne
modifant pas larchitecture de leurs systmes, confr-
maient leur prfrence pour les principes bismarckiens.
Le fnancement se fait par rpartition, les pensions des
retraits sont payes par les cotisations des actifs (
la charge des employeurs et des salaris). Certaines
caisses de retraite marocaines mettent en uvre une
rpartition provisionne : les rserves ont pour objectif
de permettre la fxation des taux de cotisation assu-
rant lquilibre sur le moyen terme. Dans les trois pays,
le systme ne comprend que des rgimes de base,
lexception dune curiosit au Maroc puisquil existe
un rgime complmentaire facultatif en rpartition.
Une architecture gomtrie variable
La comparaison des trois pays met en relief des diffren-
ces quant larchitecture des systmes. Les systmes
de retraite du Maroc et de la Tunisie sont assez proches
puisquune distinction est opre entre secteurs public
et priv. Le Maroc comprend quatre caisses, deux pour
le public : la CMR (Caisse Marocaine de Retraite) pour
les titulaires, le RCAR (Rgime Collectif dAllocation de
Retraite) pour les contractuels et deux pour le priv : la
CNSS (Caisse Nationale de Scurit Sociale) pour les
salaris du priv et la CIMR (Caisse Interprofessionnelle
Marocaine des Retraites), seule caisse complmentaire
du Maghreb. Larchitecture tunisienne est apparem-
ment plus simple avec deux caisses : la CNRPS (Caisse
Nationale de Retraite et de Prvoyance Sociale) pour le
public et la CNSS (Caisse Nationale de Scurit Sociale)
pour le priv, mais en ralit cette dernire comprend
sept rgimes diffrents. LAlgrie se dmarque avec
une seule caisse pour les salaris du public et du priv,
la CNR (Caisse Nationale de Retraite), et la CASNOS
(Caisse Nationale de Scurit Sociale des non-salaris)
pour les indpendants.
Des prestations contributives
Les pensions sont prestations dfnies, elles sont
calcules en fonction du nombre dannes de cotisa-
tions et dun salaire de rfrence : la pension sobtient
en appliquant un taux de pension au salaire reprsen-
tatif de la carrire. Lge douverture des droits est
de 60 ans dans les trois pays mais des dispositifs de
retraite anticipe existent en Algrie.
208 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
En Algrie, quil sagisse des salaris du priv
ou du public, le taux de pension varie (pour des
carrires non concernes par le minimum) entre
80 % et 37,5 % ; 80 % tant le taux atteint par
ceux qui ont cotis 32 ans (ou plus). loppos,
avec 15 ans de cotisations (qui est le minimum
requis pour obtenir une pension), le taux nest
que de 37,5 %, mais peut encore tre obtenu
des ges prcoces (45 ans) pour les femmes
dans le cadre de la retraite proportionnelle.
Avec 20 ans de cotisations, hommes et femmes
peuvent partir tt (respectivement 50 et 45 ans)
avec un taux de pension de 50 %.
Au Maroc, les taux de pension des salaris du
priv restent levs mais de manire moins mar-
que. Tout dabord, si lon exclut les extrmes,
le taux de pension de la Caisse Nationale de
Scurit Sociale (CNSS) est compris entre 50 et
70 %. 70 % est le taux maximum obtenu 60 ans
aprs seulement 28 ans de cotisation. 50 % est le
taux obtenu (toujours 60 ans puisquil nest pas
possible de liquider sa retraite avant) mais avec
15 ans de cotisation. En revanche, le taux de pen-
sion est trs affect par un effet de plafonnement.
Les salaires retenus dans le calcul de la CNSS
sont limits hauteur de 7 000 dirhams soit envi-
ron 1,7 fois le salaire moyen. Au-del, les retrai-
tes plafonnes voient leur taux de pension baisser.
Les fonctionnaires marocains dpendent quant
eux soient de la Caisse marocaine de Retraite
(CMR) sils sont titulaires, du Rgime Collectif
dAllocation de Retraite (RCAR) sils ne le sont
pas. Au RCAR, le taux de pension est fx 2 %
par anne de service, avec un maximum de 90 %.
la CMR, le taux de pension est fx 2,5 % par
anne de service avec un maximum de 100 %.
Au total, les salaris du public sont traits de
manire trs diffrente, les titulaires bnfciant,
dures de cotisation gales, de taux de pension
bien suprieurs ceux des non-titulaires. Les
non-titulaires bnfcient mme de taux de pen-
sion plus faibles que les salaris de la CNSS.
En Tunisie, les taux de pension du priv 60 ans,
ge lgal de dpart en retraite, atteignent 80 %
avec 30 ans de service. Ce taux nest que de 20 %
pour cinq ans de travail dans le secteur formel.
Les fonctionnaires tunisiens, ont des taux de pen-
sion relativement proches de ceux des marocains,
une exception de taille prs : pour les carrires
longues (plus de 40 ans), ces taux sont infrieurs
pour les fonctionnaires tunisiens dans la mesure
o ils sont plafonns 90 %.
Au total, les taux de pension sont levs dans
les pays du Maghreb, tout comme dans len-
semble de la rgion. Selon Robalino (3), le
taux de remplacement brut thorique (4) moyen
au nord et au centre-est de lAfrique est de
75,7%, contre 57% dans les 24 pays de lOCDE
(cf. graphique II).
Des carrires plus ou moins largement
prises en compte
Le montant de la retraite dpend en second
lieu du mode de dtermination du salaire de
rfrence reprsentatif de la carrire. Dans des
rgimes prestations dfnies tels quils existent
au Maroc, en Algrie et en Tunisie, cette notion
de carrire sapprhende techniquement via
deux facteurs : le nombre dannes de carrire
retenu pour le calcul du salaire de rfrence et la
manire dont ces annes de carrires sont reva-
lorises (cf. tableau 2).
Hormis le RCAR au Maroc, tous les rgimes
retiennent une rgle de calcul du salaire moyen
plutt favorable aux assurs, puisquun nom-
bre relativement rduit dannes de carrire est
retenu. Les rgimes publics du Maroc et de la
Tunisie bnfcient dune rgle trs favorable en
retenant le dernier salaire ; les rgimes privs
calculent le salaire moyen sur les cinq meilleu-
res annes (public et priv pour lAlgrie) et
huit ou dix dernires annes au Maroc et en
Tunisie. Les modes de revalorisation des salai-
3. Op. cit., p 7.
4. Le taux de remplacement rapporte la premire pension au der-
nier salaire. Le taux de pension appliqu au salaire reprsentatif
de la carrire permet de dterminer le montant de la pension.
Les taux de remplacement brut thoriques sont quivalents des
taux de pension pour des rgimes prestations dfnies quand
les carrires sont constantes.
Tableau 1
Taux de pension pour un dpart la retraite 60 ans et une carrire complte (Lgislations 2008)
Algrie Maroc Tunisie
Salaris du public
80 % avec 32 ans
de cotisation
CMR : 100 % avec 40 ans
de cotisation
RCAR : 90 % avec 40 ans
de cotisation
90 % avec 40 ans
de cotisation
Salaris du priv 70 % avec 28 ans de cotisation 80 % avec 30 ans de cotisation
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 209
res de la carrire sont extrmement variables.
Ils nont bien sr pas lieu dtre pour les rgi-
mes qui retiennent le dernier salaire. Le mode
le plus favorable est celui du RCAR au Maroc
avec lvolution du salaire moyen des cotisants.
Les salaris de la CNSS marocaine sont dans
la situation la plus dfavorable puisque leurs
salaires sont pris tels quels, sans aucune reva-
Graphique I
Taux de pension en fonction du niveau de salaire et de la dure de carrire en 2004
Lecture : le taux de remplacement dun salari du priv au Maroc est de 70 % avec 28 ans de cotisations et un salaire gal au salaire
moyen.
Source : calcul des auteurs.
210 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
lorisation. Pour la CNR algrienne et la CNSS
tunisienne, la revalorisation est dcide par
lautorit de tutelle.
Des retraites de lordre de 50 %
du salaire moyen
Le montant effectif des retraites est apprci
laide dun indicateur, le taux de remplacement
instantan qui rapporte les pensions moyennes
verses par les caisses de retraite aux salaires
moyens du secteur formel de chaque pays : les
retraites moyennes reprsentent environ 50 %
du salaire moyen (cf. graphique III).
En Algrie, la pension moyenne verse en 2005
slevait 13 000 dinars (DZD) (5), soit 130 %
du salaire minimum (SNMG) et 57 % du salaire
moyen. De manire attendue, les diffrences sont
marques entre les types de retraites, les retraites
sans condition dge (6) tant les plus leves. (5)
Au Maroc, la pension moyenne verse en 2005
slevait 2 357 dirhams (MAD), soit 128 %
du salaire minimum et 54 % du salaire moyen.
En pourcentage du salaire moyen et minimum,
les donnes sont comparables celles de lAlg-
rie. Les diffrences entre salaris du priv et du
public sont trs nettes, les retraites des titulaires
de la fonction publique tant en moyenne prs de
trois fois plus leves que celles du priv. (6)
En Tunisie, la pension moyenne verse en 2005
slevait 203 dinars tunisiens (TND), soit
5. En janvier 2005, 100 TND = 61 EUR ; 100 DZD = 1,05 EUR ;
100 MAD = 9 EUR.
6. La retraite sans condition dge, a t institu par lordon-
nance du 31 mai 1997 et supprime en 2010. elle tait servie au
travailleurs ayant cotis pendant 32 annes.
Tableau 2
Modes de dtermination du salaire de rfrence
Algrie Maroc Tunisie
CNR CASNOS CNSS CMR RCAR CNSS CNRPS
Nombre dannes
retenues dans le calcul
du salaire moyen
5 meilleures
annes
8 dernires
annes
Dernier
salaire
Toute la carrire
10 dernires
annes
Dernire
anne
Mode de revalorisation
de ces annes
Discrtionnaire
Pas de
revalorisation
/
Revalorisation
selon lvolution
du salaire moyen
des afflis
Revalorisation
selon barme
fx par dcret
/
Graphique II
Taux de remplacement brut thorique
Source : Robalino D. (2005).
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 211
86 % du salaire minimum et 52 % du salaire
moyen. Les pensions verses sont infrieures
en moyenne au salaire minimum retenu, le
SMAG 48 heures. En pourcentage du salaire
moyen, les donnes sont lgrement infrieu-
res celles de lAlgrie et du Maroc. Au sein
de la CNSS, les assurs du secteur non agri-
cole, qui sont les plus nombreux, sont aussi
ceux qui bnfcient dune pension moyenne
la plus leve.
De fortes disparits dans les montants de
retraite
Au Maroc comme en Tunisie, la disparit est
forte entre les retraits des secteurs priv et
Graphique III
Pensions moyennes et taux de remplacement
A - Algrie
B - Maroc
212 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
public. Cette disparit en faveur des fonction-
naires du public sexplique par deux lments :
les rgimes du public sont souvent plus gn-
reux, et les salaires servant de base de calcul
des droits la retraite sont galement trs levs
par rapport au priv. En Algrie, les salaris du
priv et du public relvent dun mme rgime et
donc dune mme lgislation. Les seuls carts
qui peuvent donc apparaitre sont le fait de car-
rires diffrentes. Cependant les statistiques du
rgime ne permettent pas de diffrencier ces
deux types de salaris. Au total, les rgimes de
retraite ont vraisemblablement plus dimpact
sur les revenus des retraits du public que du
priv.
En Algrie, la diffrence entre rgimes dpend
plutt du statut, les retraites tant plus leves
dans le rgime des salaris (CNR) que dans
celui des non-salaris (CASNOS) du fait de la
lgislation et des formes de carrire.
Dans les trois pays du Maghreb, il existe des
disparits homme/femme (cf. tableau 3), en
faveur des hommes. Ceux-ci bnfcient en
effet beaucoup plus de pensions de retraite que
les femmes, situation qui sexplique par le ds-
quilibre des taux dactivit.
Lcart des taux dactivit entre les hommes
et les femmes est particulirement lev au
Maroc, dans un rapport de trois un, plus faible
en Algrie avec un rapport de lordre de deux
un. Si les hommes sont beaucoup plus nom-
breux percevoir une retraite de droit direct,
ils peroivent aussi des pensions moyennes
plus leves au Maroc et en Algrie mais pas
en Tunisie. Cette disparit tient au fait que les
hommes avaient un accs plus facile au tra-
vail que les femmes, leur permettant de cotiser
dans des caisses de retraite pour percevoir une
pension la fn de leur carrire. Par ailleurs,
un foss persiste entre les salaires perus par
les femmes et ceux perus par les hommes, la
majorit des femmes gagnant 27 % de moins
que les hommes dans la zone MENA (Middle
East and North Africa).
Graphique III (suite)
C - Tunisie
Lecture : la pension mensuelle moyenne la CNSS tunisienne slve 257 dinars tunisiens pour le rgime RSNA, ce qui reprsente
111,6 % du SMIG et 67,3 % du salaire moyen tunisien.
Source : calculs des auteurs.
Tableau 3
Taux dactivit de la population de 15 ans et
plus en 2008
En %
Algrie Maroc Tunisie
Hommes 80 80 71
Femmes 37 27 26
Source : BIT, Laborsta.
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 213
Enfn, par lintermdiaire du mcanisme de
revalorisation des retraites, lge des retrai-
ts est un facteur important de disparits (cf.
tableau 4). Dans plusieurs rgimes, les rgimes
publics marocain et tunisien et le rgime priv
tunisien, les pensions suivent lvolution du
traitement des fonctionnaires ou celui du salaire
minimum. Mais au Maroc les salaris du priv
ne bnfcient qupisodiquement dune revalo-
risation de leur pension ; elle nest intervenue
que quatre fois depuis 1979. Dautres rgimes,
tels que la CNR en Algrie, procdent des
revalorisations annuelles ngocies entre le
gouvernement et les partenaires sociaux.
Seule la revalorisation en fonction des salaires
des actifs permet de maintenir le pouvoir dachat
des retraits au niveau des nouveaux retraits
ayant eu des carrires identiques. En revanche,
labsence de revalorisation conduit des ingali-
ts croissantes entre jeunes et vieux retraits.
Des taux de couverture faibles
qui limitent lincidence des retraites
Une forte proportion de la population nest pas
couverte par lassurance vieillesse au Maghreb
ce qui rduit dautant lincidence des systmes
de retraite sur le revenu des personnes ges.
Deux taux de couverture sont gnralement
utiliss, lun pour les actifs, lautre pour les
retraits. Le taux de couverture des actifs (le
plus couramment calcul) permet de conna-
tre la proportion dindividus qui cotise et donc
touchera une retraite ultrieurement : il mesure
en quelque sorte limpact futur des rgimes de
retraite. Le taux de couverture des retraits, la
proportion de personnes ges (de 60 ans et
plus) qui peroit une pension de retraite, value
limpact actuel.
Les taux de couverture des actifs occups
(nombre des cotisants rapport la population
occupe) vont du simple au triple : de 26 % au
Maroc 57,4 % en Algrie, jusqu 77,6 % en
Tunisie en 2004. Le caractre partiel de la cou-
verture dans les trois pays tient lexistence du
secteur informel, plus ou moins important selon
les pays. La mesure de limportance de ce der-
nier est dlicate mais elle peut tre approche
par la rpartition de la population active occu-
pe selon son statut. Ainsi, le salariat ne dpasse
pas 60 % des emplois en Algrie et en Tunisie
et atteint seulement 37 % au Maroc. Une par-
tie de ces emplois salaris peut aussi relever de
lemploi informel dans de petites entreprises qui
ne dclarent pas tout ou partie de leurs emplois.
Enfn, les passages entre secteurs formel et
informel sont frquents ainsi que le cumul des
deux types demploi.
Au Maroc, la faible proportion des salaris
dans la population active tient limportance
de lagriculture qui emploie, en 2004, 46 % de
la population active. Cette situation explique
le faible taux de couverture sociale du Maroc,
amplif par labsence de rgimes obligatoires
pour les non-salaris. En revanche, la Tunisie
(Cherif et Essoussi, 2004) dveloppe une poli-
tique trs active dextension de la couverture
sociale en crant des rgimes spcifques
certaines professions. En Algrie, o le secteur
informel progresse, le taux de couverture dimi-
nue au cours des dix dernires annes.
Les taux de couverture des personnes ges
mettent galement en lumire des situations qui
diffrent selon les pays. Si moins de 20 % des
plus de 60 ans touchent une pension au Maroc,
ce sont 35 % en Algrie et 38 % en Tunisie. Ces
taux peuvent paratre faibles au regard des taux
de couverture des cotisants. Ils sexpliquent
cependant par le fait que le systme est assu-
rantiel (et non universel) et quil faut donc tra-
vailler pour souvrir des droits dans chacun des
pays concerns. Sont donc exclus du champ de
la retraite lensemble des inactifs, les femmes
au foyer par exemple mais aussi les chmeurs.
Tableau 4
Modes de revalorisation des pensions
Algrie Maroc Tunisie
Salaris du public
CNR : Revalorisation
discrtionnaire pour la pension
lge lgal, et la pension de
retraite anticipe.
Pas de revalorisation pour la
retraite proportionnelle et la
retraite sans condition dge
CMR : revalorisation en fonction des
traitements de la fonction publique
RCAR : revalorisation en fonction du
salaire moyen de laffli
CNRPS : indexation sur les
salaires
Salaris du priv
CNSS : revalorisation
discrtionnaire peu frquente
(4 revalorisations depuis 1979)
CNSS : indexation sur le salaire
minimum (SMIG)
214 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
Au total, seule une minorit, voire une petite
minorit, des personnes ges est concerne par
le systme de retraite.
Avec des taux de couverture aussi faibles,
quelle que soit la gnrosit des rgimes, lim-
pact des systmes de retraites ne peut rester que
limit. Pour les insiders du systme, cest dire
les salaris qui lont t pendant une priode
suffsamment longue (environ 30 ans selon les
pays et les rgimes), limpact est rel. Mais il
est nul pour les outsiders qui, dans les gnra-
tions actuelles de retraits, sont les femmes, les
salaris du secteur informel et les indpendants
pour lessentiel.
Il faut cependant noter que ces taux de couver-
ture sont sous-estims pour deux raisons.
Tout dabord le taux de couverture ne prend
en compte que les seules pensions verses aux
assurs de droits directs. Or dans les trois pays
du Maghreb, les pensions verses aux ayants
droit concernent une population importante de
veuves (mais aussi dans certains cas des orphe-
lins). Ainsi en 2006, les pensionns survivants
reprsentaient 44 % du total des pensionns en
Algrie et en Tunisie et 29 % au Maroc. Certes
le montant de ces pensions est souvent faible :
en 2006, en Algrie les pensions des veuves
slvent en moyen mensuelle 6 924 DZD,
soit moins de 60 % du montant des pensions
de droits direct. De surcrot ces pensions bn-
fcient des personnes de 60 ans et plus mais
galement des populations plus jeunes. Il nen
reste pas moins quun petit nombre de veuves
bnfcie dun revenu de retraite, mme sil est
faible.
Dautre part, des migrants, au moment de leur
retraite, reviennent rsider dans leur pays dori-
gine. Travailleurs assurs en Europe (France,
Espagne, Pays-Bas), ils chappent la
mesure du taux de couverture qui ne prend en
compte que les seules retraites nationales. En
2004, prs de 650 000 prestataires de la CNAV
sont des retraits ns en Algrie ; 245 000 den-
tre eux sont retourns vivre leurs vieux jours
dans leur pays de naissance et reprsentent une
part importante des retraits algriens (environ
25 %). Les effectifs sont moins importants au
Maroc mme si les retraits CNAV reprsentent
presque 10 % des retraits du rgime du secteur
priv. De surcrot ces retraits, ns et rsidant
au Maroc, qui peroivent une pension CNAV ne
sont pas couverts dans leur trs grande majorit
par un rgime de retraite marocain. La Tunisie
est moins concerne, moins de 10 000 presta-
taires CNAV retournant vivre dans leur pays de
naissance ce qui reprsente moins de 5 % des
retraits du priv tunisien.
Au total, la faiblesse des taux de couverture,
mme si les dfnitions et mesures de ce taux
mriteraient dtre revues, implique quune
frange importante de la population risque
davoir des revenus insuffsants pour subvenir
ses besoins, mme dans des pays o la struc-
ture familiale est un relais fort de protection des
personnes ges.
et diffcile apprhender
D
ans un pays caractris par la faiblesse
du taux de couverture, il est logique
que le vieillissement entrane une diminution
du revenu sauf si les retraites ne constituent
quune partie des ressources des personnes
ges. Dans ce cas il est possible que leur
niveau de revenu reste proche de celui du reste
de la population.
Les retraites ne constituent pas
la principale source de revenus
des personnes ges
En labsence ou en complment dune cou-
verture retraite, les ressources des personnes
ges viennent dune activit profession-
nelle, de la possession dun patrimoine et/ou
de transferts intergnrationnels directs des
descendants. Les donnes denqutes dans les
trois pays permettent destimer limportance
de chacune de ces sources de revenu. Dune
manire gnrale, elles apparaissent diver-
sifes, les pensions, les revenus dactivit et
laide des enfants et de la famille arrivant en
tte. Mais de fortes diffrences existent entre
les trois pays (cf. tableau 5).
En Algrie, contrairement au Maroc et la
Tunisie, les pensions de retraite sont consid-
res comme la premire ressource des person-
nes ges. Ainsi, en 2002, 52,6 % de lensemble
des personnes ges en Algrie ont dclar leur
pension de retraite comme principale source de
revenu contre 27 % au Maroc et seulement 18 %
en Tunisie. Ces rponses ne signifent en rien
que les retraites verses y sont plus leves mais
que leur poids par rapport aux autres revenus est
considr par les mnages comme important et
donc que limpact des systmes de retraites, tel
quil est peru, est plus fort.
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 215
Laide des enfants et de la famille occupe une
place primordiale dans les revenus des person-
nes ges, la prise en charge de la personne ge
relevant toujours de la solidarit familiale. Cette
aide demeure la premire source de revenu
aussi bien au Maroc quen Tunisie. Au Maroc,
prs de 75 % des mnages avancent laide fami-
liale comme principale ressource contre 56,2 %
en Tunisie. Selon la dernire enqute sur les
personnes ges effectues au Maroc en 2006,
77,5 % des personnes ges ont dclar rece-
voir une aide matrielle, sous forme de dons en
nature ou en espce. Cette solidarit familiale,
toujours trs prsente, tire son origine des tradi-
tions qui accordent une place importante len-
traide entre les diffrents groupes et gnrations
composant la socit, que ce soit dans le milieu
urbain ou rural. En Algrie, laide familiale nar-
rive quen second rang et en tant que ressource
principale dans seulement 28 % des cas. Ceci
pourrait sexpliquer par le fait que la majorit
des personnes ges de 60 ans et plus en Algrie
soutiennent les autres membres de leur mnage,
surtout quand ceux-ci sont au chmage.
Limportance de laide familiale est trs large-
ment dpendante des modes de cohabitation
intergnrationnelle qui sont trs variables
selon les pays du Maghreb (cf. tableau 6). En
Algrie, la cohabitation est frquente, les per-
sonnes ges vivant avec leurs enfants repr-
sentant 87,10 % du total. Cette situation semble
paradoxale puisque selon lenqute algrienne
sur la Sant de la Famille (EASF) en 2002
cite plus haut, seulement 28 % de lchantillon
des personnes ges a dclar laide familiale
comme principale ressource. Ny aurait-il pas
alors sous-estimation de laide fnancire appor-
te par les enfants, celle-ci ne se traduisant pas
forcment par des transferts en espce ?
Au Maroc, laide familiale est perue le plus
souvent au sein de structure familiale largie :
malgr les changements dmographiques, co-
nomiques et culturels constats, la cohabitation
des parents avec leurs enfants et/ou petits enfants
reste importante (52,4 % ont dclar vivre sous
le mme toit avec deux enfants et plus (7)). La
taille moyenne des mnages dont font partie les
personnes ges est dailleurs relativement le-
ve (5,8 personnes), plus de la moiti dentre
elles (58,9 %) faisant partie de mnages de cinq
personnes et plus (cf. tableau 7).
Si laide de la famille est, elle aussi, frquente en
termes de revenu en Tunisie (cite par 56 % des
enquts), il apparait que les personnes ges
vivent trs majoritairement avec leur conjoint
sans prsence de leurs enfants, contrairement
dautres pays du Maghreb (cf. tableau 8).
Au total, au Maroc comme en Tunisie (le pays
ayant le taux de couverture le plus lev parmi
les trois), la source principale de revenu des
personnes ges demeure laide familiale. En
7. Enqute nationale sur les personnes ges au Maroc (HCP),
2006.
Tableau 5
Sources de revenu des personnes ges
En %
Algrie
(2002)
Maroc
(1995)
Tunisie
(1996)
Retraite 53 27 18
Activit
professionnelle 6 35 12
Aide des enfants et
de la famille 28 72 56
Revenus de la
proprit 8 21 8
Aide sociale 11 5 7
Champ : Algrie - personnes ges de 60 ans et plus ; Tunisie -
personnes ges de 65 ans et plus vivant domicile.
Sources : Algrie - enqute algrienne sur la Sant de la Famille,
2002, ONS. Maroc - enqute nationale de la Famille, 1995, El
Youbi (2002). Tunisie - enqute nationale mdico-sociale sur
ltat de sant et les conditions de vie des personnes ges de
65 ans et plus vivant domicile, dcembre 1996, ministre des
Affaires Sociales et Organisation Mondiale de la Sant.
Tableau 6
Cohabitation des personnes ges avec le
conjoint et les enfants selon le sexe en Algrie
En %
Homme Femme Total
Vit avec
le conjoint 92,84 52,07 72,54
Vit avec
les enfants 89,41 84,78 87,10
Vit seul 0,73 2,95 1,85
Source : enqute algrienne sur la Sant de la Famille (EASF),
ONS, 2002.
Tableau 7
Rpartition des personnes ges selon la
taille du mnage au Maroc
En %
Taille du mnage
Sexe
Total
Homme Femme
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes et plus
Total
Taille moyenne
3,4
10,3
9,7
13,3
63,3
100,0
6,1
9,8
14,8
9,0
11,5
54,9
100,0
5,5
6,8
12,7
9,3
12,3
58,9
100,0
5,8
Source : enqute nationale sur les Personnes ges au Maroc
(HCP), 2006.
216 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
Algrie, cette source vient au second rang, aprs
la retraite, mais reste cependant importante si
lon considre le taux trs lev de cohabitation
intergnrationnelle. Limpact des systmes de
retraite sur le revenu des personnes ges parait
donc limit, par rapport au systme de protec-
tion informelle quest la famille.
Le niveau de revenu des personnes ges
semble assez proche du revenu
du reste de la population
Dans certains pays dvelopps comme la France,
les systmes de retraite complts par les revenus
du patrimoine assurent aux personnes ges un
niveau de vie en moyenne comparable celui des
actifs (8). Au Maghreb, limpact des systmes de
retraite est limit par la faiblesse des taux de cou-
verture. Quen est-il alors du niveau de vie des
personnes ges par rapport aux actifs ?
En Algrie, selon le Rapport national sur le
dveloppement humain 2006, le revenu annuel
moyen (sont pris en compte dans cette enqute
les revenus salariaux, les revenus non salariaux,
les transferts publics et privs et les revenus de
la proprit) augmente avec lge, les personnes
ges bnfciant dun revenu annuel moyen pro-
che de 300 000 dinars (cf. graphique IV). Cette
situation peut sexpliquer par la prsence de
plusieurs actifs dans le mnage. Elle peut aussi
sanalyser par la prsence de revenus non sala-
riaux comme les revenus de la proprit. (8)
Au Maroc, lenqute nationale sur le niveau de
vie des mnages mene en 1998/1999 a permis
de dterminer le revenu des mnages issu aussi
bien des revenus dactivit que des transferts
en nature ou en espce, de lautoconsomma-
tion de biens alimentaires ou des revenus du
patrimoine. La dispersion de ces revenus ne
fait pas apparatre de trs grandes diffrences
selon lge. Ainsi, les plus gs ne semblent pas
prsenter des niveaux de revenus infrieurs
ceux du reste de la population. Plusieurs hypo-
thses peuvent tre formules pour expliquer
cette situation. La cohabitation est un premier
facteur dexplication, les plus gs tant de
surcrot vraisemblablement prsents comme
chefs de mnage, mme quand ils ne sont plus
les destinataires de la principale source de
8 Voir Augris et Bac, 2009, volution de la pauvret des per-
sonnes ges et minimum vieillesse , Retraite et Socit, n 56,
pp 13-40.
Tableau 8
Mode de vie familiale des personnes ges en
Tunisie
En %
Ensemble Homme Femme
Personne ge vivant
chez elle avec son conjoint 61,7 82,4 39,1
Personne ge vivant
chez elle avec ses enfants 17,0 7,7 27,2
Personne ge vivant avec
des parents avec dautres
personnes de son ge 1,7 0,7 31,0
Personne ge vivant
chez les enfants 19,6 9,2 2,7
Source : enqute nationale mdico-sociale sur ltat de sant
et les conditions de vie des personnes ges de 65 ans et
plus vivant domicile, dcembre 1996, ministre des Affaires
Sociales et Organisation Mondiale de la Sant.
Graphique IV
Revenu annuel moyen selon les groupes dge du chef du mnage en Algrie
Source : tude LSMS, CENEAP 2005.
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 217
revenu. La poursuite frquente dune activit
indpendante, bien au-del de 60 ans, est aussi
une source importante de revenus pour les per-
sonnes ges.
Les donnes relatives au revenu des personnes
ges en Tunisie sont peu nombreuses : si la
nature des sources leurs revenus est connue, les
niveaux de ces revenus ne le sont pas.
Cependant les valuations du revenu
des personnes ges restent fragiles
Les mthodes retenues pour valuer le revenu
des personnes ges prsentent un certain nom-
bre de faiblesses qui conduisent mettre des
rserves sur les mesures actuelles. En effet,
quelle que soit limportance des enqutes dis-
ponibles (cf. encadr 2), il est diffcile dap-
Encadr 2
LES SOURCES ET LES DONNES DENQUTE DISPONIBLES
Les sources
Les donnes prsentes dans cet article sont tires de
Dupuis et al. Les systmes de retraite au Maghreb :
une premire analyse (2008). La ralisation de
cette recherche sest heurte trois types de diff-
cults quant aux sources. Laccs aux donnes est
trs variable dune institution lautre, dun pays
lautre. Certaines caisses de retraite, peu nombreu-
ses, publient des rapports annuels. Seul au Maroc,
le ministre des Finances, en tant que tutelle, publie
annuellement un rapport exhaustif sur les retraites. En
labsence daccs public, les donnes ont t obte-
nues par lintermdiaire de laboratoires de recherche
comme le CREAD Alger ou tires de rapports publics
(Conseil conomique et social, rapport du Plan). En
matire de dmographie, demploi et de comptes
nationaux, les donnes sont issues des instituts natio-
naux de statistiques ou des institutions internationales
(BIT, ONU) dans la mesure o ces dernires prcisent
la source primaire. La deuxime diffcult rside dans
le caractre non homogne des donnes ou leur trs
grande agrgation. Dans un tel contexte, la compa-
raison conduit adopter le plus petit dnominateur
commun, cest--dire la donne la plus agrge. La
troisime diffcult est lie la raret des sries conti-
nues, en particulier dans le domaine de lemploi. Le
rapport mentionn ci-dessus dcrit et analyse les
sources utilises.
Les donnes denqute disponibles
Lorigine des donnes sur les revenus varie fortement
selon les pays, les enqutes pouvant tre effectues
par les instituts nationaux ou des organismes interna-
tionaux.
Lenqute internationale Living Standard Measurement
Study (LSMS) centre sur la mesure des niveaux de
vie, a t mise en place par la Banque Mondiale en
1980 afn damliorer la nature et la qualit des don-
nes sur les mnages recueillies par les bureaux de
statistiques des pays du tiers- monde (Ravallion,
1996). Cette enqute a t ralise en 1995 en Algrie
et en Tunisie, et en 1998 au Maroc.
Une enqute pilote par la Ligue des tats arabes a t
ralise conjointement en 2002 notamment en Algrie,
Maroc et Tunisie (en collaboration avec les organismes
nationaux concerns). Cette enqute sur la Sant de
la famille donne des informations importantes et com-
parables sur les structures familiales.
Au Maroc, le Haut Commissariat au Plan labore et
publie tout un ensemble denqutes ralises auprs
des mnages. Les rsultats de trois de ces enqutes
sont repris dans cet article.
Lenqute nationale - sur la Consommation et les
Dpenses des Mnages ralise pour la dernire fois
en 2000/2001 est centre sur la consommation et la
dpense. Elle est essentielle pour une approche de la
pauvret des personnes ges par la consommation.
Lenqute nationale - sur les Niveaux de Vie des
Mnages dcrit la situation socio-conomique globale
des divers groupes sociaux et mesure les ingalits des
niveaux de vie entre les diffrents groupes sociaux et les
diverses rgions du pays. La priodicit de publication
de cette enqute est dcennale, la dernire enqute de
ce type ralise au Maroc datant de 2007 Cependant
les rsultats ne sont pas encore tous rendus publics,
notamment le revenu et la pauvret par ge.
Lenqute nationale - sur les Personnes ges rali-
se en 2006 est une approche socio-conomique de
cette population mais comporte cependant peu din-
formations sur le revenu des personnes ges.
En Tunisie, lInstitut National de la Statistique labore
et publie des enqutes auprs des mnages dont len-
qute sur la Consommation des Mnages, enqute
quinquennale parue pour la dernire fois en 2005. Il
a aussi ralis en 1998, en collaboration avec lOffce
National de la Famille et de la Population, lenqute
nationale mdico-sociale sur ltat de sant et les
conditions de vie des personnes ges de 65 ans et
plus vivant domicile. Cette enqute est riche en infor-
mations sur le mode de vie des personnes ges mais
pauvre quant aux questions relatives au revenu.
En Algrie, les donnes sont peu nombreuses et ne
sont pas rgulirement publies. La dernire enqute
effectue auprs des mnages, intitule le niveau de
vie et la mesure de la pauvret, a t ralise et publie
en 2005 par le Centre National dtudes et dAnalyses
pour la Population et le Dveloppement (CENEAP).
Elle permet davoir des donnes sur le revenu et la
pauvret par ge.
Les enqutes cibles sur le niveau de vie des person-
nes ges et leur pauvret sont inexistantes.
218 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
prhender le niveau de vie des personnes ges
pour diffrentes raisons mthodologiques dont
certaines sont assez classiques. Se pose bien
videmment la question du revenu, de sa df-
nition, de sa diffcile apprhension et surtout
de son partage au sein de mnages composs
de plusieurs gnrations notamment dadultes
(cf. encadr 3).
Lapprhension correcte du revenu des person-
nes ges vivant dans ces mnages ne peut se
faire laide du revenu rel moyen par tte, car
il ne permet pas de tenir compte des conomies
dchelles que ralise un mnage compos de
plusieurs personnes. Pour prendre en compte
la taille et la composition dmographique du
mnage, il est dusage de rapporter le revenu
un nombre dunits de consommation, cest
le principe de base des chelles dquivalence.
Une chelle dquivalence est un jeu de coeff-
cients associs aux diffrents types de mnages,
ces coeffcients sont fonction du nombre dindi-
vidus composant le mnage, et aussi de lge de
ses membres.
Jusqu la fn des annes 1980, lchelle dqui-
valence la plus connue tait celle dOxford (9),
mais elle a t par la suite remplace par
lchelle dite OCDE modife (10) ; cette
dernire chelle est la plus utilise en Europe, et
permet une apprhension correcte du revenu des
individus vivant dans un mme mnage.
Au Maghreb, lutilisation de lchelle dOxford
est prconise (11) dans les travaux de recherche
sur la pauvret, mais nest pas employe. Elle
nest pas vraiment transposable aux trois pays
du Maghreb pour deux raisons. La premire est
relative au contexte sociodmographique sp-
cifque ces trois pays. En effet, les habitudes
de consommation et de dpense ne sont pas les
mmes en Europe et au Maghreb. La seconde
raison tient la structure des mnages : la coha-
bitation dans des mnages largis aux ascen-
dants, o les conomies dchelle jouent diff-
remment, est courante au Maghreb.
Il serait donc ncessaire destimer une chelle
dquivalence adapte au contexte sociodmo-
graphique local, prenant en compte de la pr-
sence de personnes ges dans des mnages
de grande taille. Mais, des cueils mthodolo-
giques se posent quant la nature de lchelle
estimer. Faudrait-il estimer des coeffcients
dchelle dquivalence par poste budgtaire
(groupe de dpense) ou des coeffcients globaux
comme ceci a t fait auparavant dans les tra-
vaux de recherche ? Enfn une autre spcifcit
des pays du Maghreb est relative aux dispari-
ts qui existent entre milieux urbain et rural ; il
conviendrait peut tre destimer deux chelles
dquivalence, lune propre au milieu urbain et
lautre au milieu rural. (9) (10) (11)
Cest lintrt dun travail de recherche en
cours (12) consistant estimer une chelle
dquivalence qui prend en compte la personne
ge de 60 ans et plus. Il sera alors possible
destimer correctement le revenu par unit de
consommation des personnes ges quel que soit
le type du mnage auquel elles appartiennent.
Au fnal, limpact des systmes de retraite sur
le revenu des personnes ges est bien rel en
raison des montants des retraites verses mais
9. Lchelle dOxford attribuait 1 UC la personne seule, 0,7 UC
par adulte supplmentaire et 0,5 UC par enfant.
10 . Lchelle OCDE modife ne compte plus que 0,5 UC par
adulte supplmentaire et 0,3 UC par enfant.
11. T. Abdelkhalek, 2009, Cadre stratgique national de rduc-
tion de la pauvret au Maroc : propos du concept de pauvret
et analyse de la situation
12. Il sagit du travail de thse de I. Dkhissi intitul Estimation
dune chelle dquivalence prenant en compte les personnes
ges de 60 ans et plus : cas du Maroc (2011).
Encadr 3
COMMENT APPRHENDER LE REVENU DES PERSONNES GES ?
Il existe plusieurs types de revenus, quil sagisse du
revenu dactivit, du patrimoine, des transferts en pro-
venance dautres mnages notamment dans le cadre
dentraide familiale et enfn des prestations sociales.
Ils peuvent prendre une forme montaire comme le
mandat dun enfant ses parents ou le loyer dune
location, ou non montaire comme le partage des res-
sources des enfants dans le cadre dune cohabitation
ou loccupation dun logement par son propritaire. Or,
il nest pas sr que ceux dont les revenus montaires
sont les plus faibles soient ncessairement les plus
pauvres : certains peuvent tre propritaires de leur
logement ou vivent en autarcie grce une production
domestique. En milieu rural, le revenu na pas la mme
composition quen milieu urbain. Le monde rural est
srement moins montaris : lautoconsommation des
produits tirs de llevage et de la culture des terres
produit une source de revenu non ngligeable, mme
si elle lie niveau de vie et alas climatiques. La com-
paraison des mnages impose que ce soit la mme
notion de revenu qui soit retenue, ce qui semble diff-
cile compte tenu de la nature des diffrentes sources
disponibles dans les trois pays pour apprhender le
revenu.
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 219
reste limit faute dune couverture suffsante de
la population. Les donnes denqute semblent
corroborer ces observations puisque les retrai-
tes ne sont pas mises en avant comme premire
source de revenu mme si au total les revenus
de personnes ges semblent se situer au mme
niveau que ceux des plus jeunes.
Une contribution rduite
la rduction de la pauvret
des personnes ges
L
a lutte contre la pauvret des personnes
ges est au cur de tout dispositif de
retraite. Cest ainsi que la France en 1945 a
maintenu la rpartition notamment pour rduire
la pauvret des personnes ges qualifes
lpoque dconomiquement faibles. Cette lutte
imposait le versement de pensions ds la cra-
tion du rgime et seule la rpartition permettait
de servir un repas gratuit la premire gn-
ration ; la rpartition a ainsi permis de prendre en
charge les pensions denviron 700 000 retraits
nayant jamais cotis. La place des personnes
ges dans la lutte contre la pauvret fait dbat
dans les pays en dveloppement. Il est souvent
envisag de mettre en place des pensions non
contributives du premier pilier qui prsentent
lavantage doffrir une pension minimale une
large proportion de la population des personnes
ges.
Faute de couverture par lassurance vieillesse,
certains tats du Maghreb ont par ailleurs mis
en place des programmes sociaux destins aux
personnes ges. Ils peuvent dans une certaine
mesure permettre de rduire la pauvret.
Au total, les personnes ges du Maghreb font-
elles partie des catgories les plus pauvres,
comme cela est assez souvent avanc pour de
nombreux pays en voie de dveloppement ? Il
semble en fait que la prvalence de la pauvret
est moins marque pour les personnes ges que
pour le reste de la population.
Des pensions minimales
au sein des rgimes contributifs
Au Maghreb, les retraites sont contributives
avec essentiellement des rgimes prestations
dfnies. Sil nexiste pas de pensions sous
condition de ressources ou encore moins de
pensions universelles, la quasi-totalit des rgi-
mes ont mis en place une pension minimale au
sein des rgimes contributifs.
En Algrie, la pension minimale verse par
la CNR ne concerne que les seules pensions
dnommes dge lgal (retraites liquides
aprs 60 ans pour les hommes et 55 ans pour
les femmes) soit environ 30 % des retraits de
60 ans et plus. Elle est fxe 75 % du Salaire
National Minimum Garanti, ce qui en 2000
quivaut 6 000 dinars mensuels, le seuil de
pauvret algrien tant de 1 550 dinars par per-
sonne et par mois. Ainsi, la CNR avec son dis-
positif de pension minimale permet au retrait
dge lgal (retrait vivant seul ou en couple)
davoir un revenu par tte suprieur au seuil de
pauvret. Cependant, plus de 85 % des retraits
ont un revenu infrieur cette pension minimale
et la moiti un revenu infrieur 4 500 dinars.
Au Maroc, la CMR et la CNSS ont introduit
un correctif au proft des pensions les plus fai-
bles tel quelles ne peuvent tre infrieures
500 dirhams la CMR (aprs 5 ans de servi-
ces dans le public) et 600 dirhams la CNSS.
Une tude de la CNSS (1999) estime 12,4 %
le nombre de pensionns qui avait en 1999
un salaire infrieur la pension minimale. Le
RCAR, pour les contractuels du secteur public,
na pas mis en place de pension minimale.
Enfn, selon la lgislation du systme de scu-
rit sociale tunisien, la pension minimale ver-
se par la CNSS pour le rgime des salaris non
agricoles ses pensionns atteint 75 ou 50 % du
SMIG selon la dure de cotisation. Ce minimum
est diffrent pour les autres rgimes, de 30 %
50 % du SMIG ou du SMAG selon les rgi-
mes (13) Le nombre de pensionns touchant un
minima de retraite nest pas donn la CNSS.
Mais il apparait que 45 696 retraits touchent
mois de 120 dinars par mois, 7 000 dentre eux
ayant mme une retraite infrieure 30 dinars
par mois.
En dfnitive, le dispositif de pension minimale
instaur dans les trois pays du Maghreb permet
ses bnfciaires davoir un revenu au-dessus
du seuil de pauvret. Cependant ils sont peu
nombreux et leur revenu est souvent partag au
sein de mnages de grande taille.
13. De 30 % du SMIG ou du SMAG pour le rgime des sala-
ris tunisien ltranger (RTTE) et pour les non-salaris (RTNS,
Rgime des Travailleurs Non Salaris), de 40 % du SMAG pour le
RSA (Rgime des salaris agricoles) et de 50 % du SMAG pour
le RSAA (Rgime des Salaris Agricoles Amlior).
220 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
Des programmes sociaux en faveur des
personnes ges en Algrie et en Tunisie
Pour couvrir les populations ges non couvertes
par lassurance vieillesse, en Europe les tats ont
mis en place des dispositifs dassistance spcif-
ques, fnancs par limpt. Il sagit par exemple
en France du minimum vieillesse qui garantit
toute personne de 65 ans et plus un revenu mini-
mum. Mais en raison de la couverture trs large
de la population par lassurance vieillesse, ces
programmes dassistance ne concernent quune
faible part de la population.
La situation est totalement diffrente dans des
pays comme ceux du Maghreb qui doivent
faire face au contraire une population majo-
ritairement non couverte par des rgimes de
retraite. Les programmes dassistance mis en
place varient fortement dun pays lautre. Au
Maroc, il nexiste pas de programmes daide
sociale spcifque aux personnes ges. En
Algrie, laide sociale concerne un nombre
non ngligeable des personnes dmunies dont
des personnes ges, mais des montants trs
faibles, voire mme trs infrieurs au seuil de
pauvret. De plus, les aides sociales de ltat
algrien ont t introduites avec la mise en
place du programme dajustement structurel,
pour remplacer certaines subventions de pro-
duits de premire ncessit. La Tunisie a mis
en place un ensemble de programmes sociaux
en vue dassister les personnes ncessiteuses,
par le biais de subventions et daides. Parmi ces
programmes sociaux, les deux les plus impor-
tants, en termes de montant des ressources qui
leur sont affectes et du nombre de leurs bn-
fciaires, sont le Programme National dAides
aux Familles Ncessiteuses PNAFN et
le Fonds de Solidarit Nationale FSN . Le
montant des aides accordes par le PNAFN
a atteint, en 2001, 452 dinars par famille soit
un montant suprieur au seuil de pauvret. Le
PNAFN a concern prs de 78 000 personnes
ges en 2004, qui ne sont plus ds lors consid-
res comme pauvres.
Une pauvret des personnes ges
moins importante que celle de lensemble
de la population
Sil est soulign dans les confrences interna-
tionales que les personnes ges sont systma-
tiquement parmi les plus pauvres dans toutes
les socits, les donnes quantitatives dispo-
nibles pour le confrmer restent peu nombreu-
ses concernant les pays en dveloppement.
Barrientos et al. (2003) ont entrepris une com-
paraison des taux de pauvret de lensemble
de la population, des personnes ges et des
enfants pour une trentaine de pays, essentiel-
lement dAmrique latine et dEurope centrale
(lAfrique et lAsie nen comptent que cinq).
Sept pays ont un taux de pauvret des person-
nes ges suprieur celui de lensemble de la
population, quatorze un taux infrieur et huit
un taux du mme ordre de grandeur. Deux pays
se dmarquent, le Brsil et lArgentine, parmi
ceux prsentant un taux de pauvret des person-
nes ges infrieur celui de lensemble de la
population ; ce taux ny dpasse pas la moiti de
celui de lensemble de la population. Ces deux
pays ont mis en uvre des programmes dassis-
tance pour les personnes ges pauvres.
Ltude effectue sur le Maghreb situe les trois
pays considrs dans la catgorie de ceux pour
lesquels la pauvret montaire des personnes
ges est moins importante que dans le reste de
la population (cf. encadr 4).
En 2000, lAlgrie comptait 2,5 millions de
personnes pauvres pour une population totale
de 30,5 millions, soit un taux de pauvret de
8 %. Parmi cette population pauvre, un peu plus
de 125 000 sont gs de plus de 60 ans, soit un
taux de pauvret des personnes ges de 5,6 %,
taux infrieur celui du reste de la population
(cf. tableau 9)
Au Maroc, selon les premiers rsultats de len-
qute nationale sur les niveaux de vie des mna-
ges de 2007, le taux de pauvret a diminu, pas-
sant de 15,3 % 9 % entre 2001 et 2007. En
termes deffectif, le nombre des pauvres tait de
4 461 000 en 2001 contre 2 773 000 en 2007.
Les donnes dtailles de lenqute 2007 ntant
pas encore disponibles, il convient de se repor-
ter lenqute nationale sur le niveau de vie des
Tableau 9
Pauvret par ge en Algrie
En %
Groupe
dge
Structure de
la population
pauvre
Structure de
la population
totale
Taux de
pauvret
0 5 ans
6 11 ans
12 17 ans
18 24 ans
25 34 ans
35 59 ans
60 ans & +
12,9
18,7
20,4
14,8
10,8
18,3
4,2
11,2
13,4
15,5
16,0
15,9
20,5
7,5
11,6
14,0
13,3
9,3
6,8
9,0
5,6
Total 100,0 100,0 10,1
Source : enqute Consommation, ONS 2000.
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 221
mnages en 1998/1999 pour connatre la pau-
vret par ge (cf. tableau 10).
Les mnages dont le chef est une personne ge
sont moins concerns par la pauvret que les
autres : sur prs de 1 600 000 mnages dont
le chef a plus de 60 ans, 16,7 % sont pauvres
contre 19 % dans lensemble de la population.
En Tunisie, selon lenqute nationale sur le
Budget, la Consommation et le Niveau de Vie
des Mnages en 2000 le taux de pauvret tait
Encadr 4
SEUIL DE PAUVRET ET MESURE DE LA PAUVRET AU MAGHREB
Dans les trois pays du Maghreb, la mesure de la pau-
vret effectue par les diffrents organismes nationaux
est essentiellement base sur une approche montaire
absolue, la mthode de calcul des seuils de pauvret
suivant les prconisations effectues par la Banque
Mondiale depuis les annes 1980 pour les pays en voie
de dveloppement. Cette mthode de calcul amne
distinguer deux seuils de pauvret montaire : un seuil
de pauvret alimentaire et un seuil de pauvret global
qui additionne le seuil de pauvret alimentaire une
composante non alimentaire.
Le seuil de pauvret alimentaire : ce seuil est dter-
min sur la base des dpenses alimentaires minimales
requises permettant chacun de satisfaire ses besoins
alimentaires de base recommands par lOMS et la
FAO. Sur la base de cette mthode commune, chacun
des trois pays du Maghreb tablit son propre panier
de consommation de base alimentaire, le plus souvent
selon les habitudes de sa population, do quelques
diffrences entre les seuils.
La premire diffrence tient lquivalent en calories
de ces seuils : il est de 2 100 calories par jour et par
personne en Algrie, seulement de 2 000 calories au
Maroc et de 1 830 calories en milieu rural en Tunisie.
titre de comparaison, le BIT dans ses approches de la
pauvret retient une ration nergtique ncessaire de
2 200 calories par personne adulte et par jour soit prs
de 20 % de plus que ce quadopte lInstitut National
de la Statistique en Algrie.
La seconde diffrence tient lapproche entre zone
rurale et urbaine retenue dans les trois pays. Chacun
retient un seuil diffrenci gographiquement, tenant
ainsi compte dun modle de consommation des
populations urbaines diffrente de celui des popu-
lations rurales, du fait notamment de la possibilit
dautoproduction en zone rurale. Cette diffrence tient
aussi des prix diffrents entre le milieu rural et le
milieu urbain. On notera cependant que si la diffrence
de seuil est peu importante au Maroc et en Algrie, il
y a un rapport de 1 2 entre les seuils urbain et rural
en Tunisie.
La dernire diffrence tient la comparaison de ces
seuils en monnaie nationale : mme si les habitudes
ne diffrent pas de manire trs marque dun pays
lautre du Maghreb, certains biens consomms ne
sont pas changeables. La comparaison des seuils,
mme effectue en parit de pouvoir dachat, peut
donc poser problme, dautant plus que certains pays
du Maghreb ne publient ni le contenu, ni la valeur de
ces seuils.
Le seuil de pauvret global (appel seuil de pauvret
gnrale en Algrie) : ce seuil est gal au seuil de pau-
vret alimentaire major par celui de la pauvret non
alimentaire, correspondant une dotation minimale de
biens et services non alimentaires tels que lhabille-
ment, lhabitation, etc. (cf. tableau). Contrairement aux
besoins alimentaires, les besoins non alimentaires de
base sont diffciles dterminer. Ils sont donc esti-
ms partir des dpenses non alimentaires des seuls
mnages dont les dpenses alimentaires dpassent le
seuil de pauvret alimentaire. Les mthodes destima-
tion ainsi que la population rfrente utilise pour
effectuer ces estimations varient dun pays lautre,
do des diffrences (certes srement peu marques)
de seuils de pauvret non alimentaires.
Le seuil de pauvret global est actualis dans chacun
des pays en utilisant lindice des prix la consomma-
tion.
Certaines tudes sur le Maroc et la Tunisie retiennent
aussi des seuils de pauvret montaire relative, calcu-
ls sur la base de 50 % du revenu moyen ou mdian.
Lapproche montaire absolue est cependant celle
retenue en premire intention dans de nombreux tra-
vaux non spcialiss et cest celle que nous avons pri-
vilgie dans cet article.
Seuils de pauvret montaire annuels exprims en monnaie nationale
Algrie Maroc Tunisie
Source Commissariat gnral au Plan
et la prospective
Haut Commissariat
au Plan
Institut National
de la Statistique
Seuil de pauvret
alimentaire
Urbain Rural Urbain Rural
Non publi
13 946 dinars
en 2000
13 849 dinars
en 2000
1 878 dirhams
en 98/99, non
publi ensuite
1 878 dirhams
en 98/99, non
publi ensuite
Seuil de pauvret global Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural
19 794 dinars
en 2000
19 692 dinars
en 2000
3 834 dirhams
en 2006/2007
3 569 dirhams
en 2006/2007
428 dinars
en 2000
221 dinars
en 2000
222 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
de 4,2 %, ce qui reprsente 60 000 mnages
vivant en dessous du seuil de pauvret. Parmi
ces mnages pauvres, 20,6 % ont un chef de
famille de 60 ans et plus, alors que dans la popu-
lation non pauvre cette proportion est de 28,8 %
(cf. tableau 11).
Mme si on ne dispose pas de taux de pauvret
par ge, lexistence dun taux de pauvret de
la population de 4,2 % et une prvalence de la
pauvret plus faible chez les personnes ges
permettent de conclure que les taux de pau-
vret sont peu levs parmi les personnes ges
tunisiennes.
Dans les trois pays du Maghreb, les personnes
ges sont moins touches par la pauvret que
lensemble de la population. Mais derrire ce
constat se cachent des taux de pauvret trs dif-
frents, prs des 5 % des personnes ges alg-
riennes tant considres comme pauvres contre
13,2 % au Maroc et prs de 4 % en Tunisie.
Labsence de pensions sociales
au Maghreb
La pauvret des personnes ges dans les pays du
Maghreb serait donc moins marque que pour le
reste de la population, contrairement ce qui est
observ dans dautres pays en dveloppement.
Si les rgimes de retraite ne sont pas trangers
cette situation avec les minima mis en place,
ils ont cependant un impact limit, compte
tenu de la faiblesse de la couverture retraite.
La solidarit familiale est probablement autant
mettre en avant que les systmes de retraite.
Cependant, face aux changements dmogra-
phiques, conomiques et culturels en cours, le
choix de prestations non contributives du type
pensions sociales nest-il pas une piste de
rfexion pour les trois pays du Maghreb ?
Un nombre relativement faible de pays en dve-
loppement a mis en place des prestations non
contributives assimiles des pensions sociales.
LAfrique du Sud et le Brsil sont les deux pays
qui ont instaur les programmes de pensions
conditionnes les plus importants. Le Botswana,
Maurice, la Namibie et le Npal sont quant eux
les rares pays avoir cr une pension univer-
selle. Les travaux empiriques sur cette question
(Barrientos et al., 2003) mnent penser que les
pensions sociales reprsentent un enjeu essen-
tiel pour les pays en dveloppement comme rel
moyen pour lutter contre la pauvret des per-
sonnes ges. La mise en place de pensions non
contributives dans les pays en dveloppement
est aussi lapproche aujourdhui privilgie par
les diffrentes institutions internationales pour
tendre la couverture et lutter contre la pauvret
des personnes ges (OIT 2010, Banque mon-
diale 2009). Linitiative plus large des Nations
unies pour un socle commun de protection
sociale sinscrit dans cette logique.
Dans le cadre dune problmatique dextension
de la couverture retraite par des pensions socia-
les, plusieurs axes de recherche se dgagent.
Comment faire des pensions non contributives
un vritable pilier anti-pauvret tout en jugu-
lant les cots fscaux ? Comment envisager un
rapprochement entre pensions sociales et autres
dispositifs daide sociale ? Comment appr-
hender les transferts pour la retraite de manire
coordonne et dans leur globalit pour viter
tout effet contre-incitatif des pensions sociales
sur les systmes contributifs ou sur lemploi ?
Quel est le cot de ces dispositifs ? Ces ques-
tions ouvrent de nombreuses pistes de rfexion
pour explorer les voies possibles de lextension
de la couverture retraite au Maghreb.
* *
*
Limpact des systmes de retraite sur le revenu
et la pauvret des personnes ges pourrait tre
non ngligeable, compte tenu des montants des
retraites verses, mais reste limit faute dune
Tableau 10
Pauvret par ge du chef de mnage au
Maroc
En %
ge du chef
du mnage
Urbain Rural Total
15 24 ans
25 34 ans
35 44 ans
45 59 ans
60 ans et plus
10,2
8,5
13,3
11,4
12,3
15,9
29,3
29,4
31,9
21,7
13,5
19,6
20,2
20,5
16,7
Source : enqute nationale sur le Niveau de Vie des Mnages
(1998/1999).
Tableau 11
Rpartition de la population pauvre selon lge
du chef du mnage en Tunisie
En %
ge du chef du
mnage
Population
pauvre
Population
non pauvre
Ensemble de
la population
Infrieur 40 ans
40 50 ans
50 60 ans
60 ans et plus
24,2
34,2
21,0
20,6
20,2
31,7
19,3
28,8
20,3
31,8
19,4
28,5
Total 100,0 100,0 100,0
Source : enqute nationale sur le Budget, la Consommation et le
Niveau de Vie des Mnages, 2000.
CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011 223
large couverture de la population. Les donnes
denqute semblent corroborer cette analyse
puisque les retraites ne sont pas cites comme
principale source de revenu des personnes
ges. Cependant leurs revenus semblent se
situer au mme niveau que ceux des plus jeunes.
Quant la pauvret, si elle est moins marque
pour les personnes ges que pour le reste de la
population, elle reste cependant des niveaux
levs.
Deux solutions pourraient tre envisages pour
augmenter cet impact des systmes de retraite sur
le niveau de vie des personnes ges : accrotre
la couverture ou mettre en place une prestation
universelle. La question du vieillissement dmo-
graphique, qui commence toucher les popula-
tions du Maghreb, est une source dinquitude
quant lavenir des systmes. Alors quon sat-
tendrait la mise en place dune rforme den-
vergure et rapide dans chacun des pays, il appa-
rat que la prise de conscience du problme a t
tardive et que la rfexion samorce seulement.
Mais dans aucun de ces trois pays ces processus
de rformes nont conduit un dbat sur la place
des diffrentes classes dge dans la socit. La
jeunesse du Maghreb est confronte un ch-
mage massif, des diffcults de logement, et
plus largement un problme dinsertion dans
la socit. La tendance actuelle est daborder
la rforme en termes paramtriques et non en
termes denjeux de socit, notamment relative-
ment la pauvret des personnes ges.
La question du niveau de vie, de la pauvret des
personnes ges et de limpact des rgimes de
retraites reste largement tudier. Les enqutes
cibles sur le niveau de vie des personnes ges,
leur pauvret, quelles soient pensionnes ou
non, sont quasi inexistantes. Les travaux tho-
riques permettant de prendre correctement en
compte le revenu dune personne ge au sein
dune structure familiale largie sont eux aussi
largement dvelopper. n
BIBLIOGRAPHIE
Abdelkhalek T. (2009), Cadre stratgique
national de rduction de la pauvret au Maroc :
propos du concept de pauvret et analyse de
la situation , PNUD Maroc et Ministre du
dveloppement social de la famille et de la
solidarit.
Ajbilou A. et Fazouane A. (2002), Les per-
sonnes ges face la pauvret au Maroc ,
Jeunesse, vieillesse, dmographie et socit,
ss.la direction de F. Gendreau, D. Tabutin, M.
Poupard, pp. 243-253.
Barrientos A. (2002), Old age, poverty and
social investment , Journal of international
development, vol. 14.
Barrientos A. (2003), Pensions and develop-
ment in the South , The Geneva papers on risk
and insurance, vol. 28, n 4, pp. 696-711.
Barrientos A., Gorman M. et Heslop A.
(2003), Old age in developing countries: con-
tributions and dependence in later life , World
development, vol. 31, n 3.
Barrientos A. et Lloyd-Sherlock P.(2003),
Non-contributory pension schemes: a new
model for social security in the South? , 4
th
International research conference on social
security, AISS, Anvers.
Banque mondiale (2009), Closing the Coverage
Gap : the Role of Social Pensions and others
retirement income transferts, Washington DC.
Boulahbel B. (2005), La pauvret en Algrie ,
communication au colloque de lAssociation
Maghrbine pour ltude de la Population,
Nouakchott.
Cherif M. et Essoussi K. (2004), Lextension
de la scurit sociale aux populations non cou-
vertes, Tunisie , Colloque des directeurs dins-
titution de scurit sociale des pays francopho-
nes dAfrique, AISS, Limb, Cameroun, 28-30
janvier.
Dekker A. (2003), The role of informal social
security in an inter-generational society ,
4
th
International research conference on social
security, AISS, Anvers.
Dufo E. (2003), Grandmothers and grand
daughters : old age pensions and intrahousehold
allocation in South Africa , World bank eco-
nomic review, vol. 17, n 1.
Dupuis J.-M. et El Moudden C. (2004),
Retraite et dveloppement, un tat des lieux ,
Communication aux XXIV
es
Journes dcono-
mie sociale, Nantes, 9-10 septembre 2004.
Dupuis J.-M. et El Moudden C. (2002),
conomie des retraites, Economica.
224 CONOMIE ET STATISTIQUE N 441-442, 2011
Dupuis J.-M., El Moudden C. et Ptron A.
(Dir.), (2008), Les retraites au Maghreb, une
premire analyse, Rapport pour la MIRE.
El Youbi A. (2002), La cohabitation interg-
nrationnelle et la prise en charge des personnes
ges au Maroc , Jeunesse, vieillesse, dmogra-
phie et socit, sous la direction de F. Gendreau,
D. Tabutin et M. Poupard, pp. 243-253.
Laroque P. (1946), Le plan franais de
Scurit sociale , Revue franaise du travail,
n 1, avril.
Orszag P.R., Stiglitz J.E. (1999), Rethinking
pension reform : ten myths about social security
system , World Bank, Working paper.
Organisation internationale du Travail
(2010), World Social Security Report 2010/11 :
Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO Publications, Genve.
Ravallion M.(1996), Comparaisons de la
pauvret : Concepts et mthodes , Banque
Mondiale, Document de travail, n 122.
Robalino D. (2005), Pensions in the Middle
East and North Africa: time for change , the
world bank, coll Orientations in development
series, Washington DC.
Seklani M. (2006), La stratgie de lutte contre
la pauvret en Tunisie en ce dbut du XXI
e
si-
cle, ministre de la Sant Publique et Offce
National de la Famille et de la Population.
Vous aimerez peut-être aussi
- La DDA et les nouvelles règles en matiere de distribution d' assurances: AnalyseD'EverandLa DDA et les nouvelles règles en matiere de distribution d' assurances: AnalysePas encore d'évaluation
- Les assurances de personnes en 60 cas pratiques: Ouvrage pédagogiqueD'EverandLes assurances de personnes en 60 cas pratiques: Ouvrage pédagogiquePas encore d'évaluation
- Programmation Avec DELPHIDocument84 pagesProgrammation Avec DELPHIbendjillali youcefPas encore d'évaluation
- Brochure CnfdiDocument20 pagesBrochure CnfdiernejeannePas encore d'évaluation
- Actualité Du Système de RetraiteDocument4 pagesActualité Du Système de RetraitechamsiPas encore d'évaluation
- Sys Retraite MarocDocument13 pagesSys Retraite MarocMoHamed Iyad GuerboubPas encore d'évaluation
- Assurance Retraite Au Maroc - RépartitionDocument13 pagesAssurance Retraite Au Maroc - RépartitionSara Lina100% (1)
- Introduction de CnssDocument2 pagesIntroduction de CnssWalid BahyouPas encore d'évaluation
- Les Régimes de Retraite Au MarocDocument23 pagesLes Régimes de Retraite Au MarocMarwane Bayar100% (2)
- Le Rôle de L'assurance Maladie Obligatoire Dans Le Financement Des Soins de Santé Au MarocDocument13 pagesLe Rôle de L'assurance Maladie Obligatoire Dans Le Financement Des Soins de Santé Au Marockemmach toufikPas encore d'évaluation
- Système de Retraite MarocDocument105 pagesSystème de Retraite MarocKyro ZenPas encore d'évaluation
- RetraiteDocument9 pagesRetraiteYounes U-nés BenchairaPas encore d'évaluation
- Presentation CMRDocument16 pagesPresentation CMRcamli kamliciusPas encore d'évaluation
- Guide PP Rcar 2016Document40 pagesGuide PP Rcar 2016Abad AbanasPas encore d'évaluation
- Ec Print 2022 2Document7 pagesEc Print 2022 2Amine ChettatPas encore d'évaluation
- CIMRDocument14 pagesCIMRHamza HichamiPas encore d'évaluation
- Presentation Retraite Par Capital Is at IonDocument36 pagesPresentation Retraite Par Capital Is at IonNada BenchekrounPas encore d'évaluation
- Programme ActuariatDocument31 pagesProgramme ActuariatSaleh BgfPas encore d'évaluation
- Cour en Droit de La Sécurité SocialeDocument19 pagesCour en Droit de La Sécurité SocialeMomo MomoPas encore d'évaluation
- 1 FilaliDocument12 pages1 FilaliRachid ChebbahPas encore d'évaluation
- PowerPoint Coumba CisséDocument18 pagesPowerPoint Coumba Cissécoordinateurlpa coordinateurlpaPas encore d'évaluation
- 14-12-15 Diagnostic Retraite Au MarocDocument6 pages14-12-15 Diagnostic Retraite Au MarocjihjihPas encore d'évaluation
- Chapitre 11 Protection Sociale Et Solid A Rites CollectivesDocument8 pagesChapitre 11 Protection Sociale Et Solid A Rites Collectivesmariage100% (2)
- Presentation Securite Sociale AlgerieDocument20 pagesPresentation Securite Sociale AlgerieTarikPas encore d'évaluation
- CNSSDocument14 pagesCNSSAlaska Junior AkoumanyPas encore d'évaluation
- CNSSDocument4 pagesCNSSNordine WalyadPas encore d'évaluation
- Rapport de Mission ChineDocument7 pagesRapport de Mission ChinechahiPas encore d'évaluation
- Projet de Guide Tofe Dto Novembre 2020 Version Finale v.30112020Document168 pagesProjet de Guide Tofe Dto Novembre 2020 Version Finale v.30112020guymbulaPas encore d'évaluation
- Départ À La RetraiteDocument12 pagesDépart À La RetraiteFleide Wilian Rodrigues AlvesPas encore d'évaluation
- Memoire Sur Les Fraudes Des Caisses D'assurancesDocument56 pagesMemoire Sur Les Fraudes Des Caisses D'assurancesOke mbaPas encore d'évaluation
- Différence Entre CNSS Et CIMRDocument4 pagesDifférence Entre CNSS Et CIMRjibari100% (1)
- AMODocument3 pagesAMOSamir KerouazPas encore d'évaluation
- UE2 2021 SujetDocument11 pagesUE2 2021 SujetSommiePas encore d'évaluation
- CTX PrimeDocument32 pagesCTX PrimeNaima Errajai0% (1)
- Securite SocialeDocument10 pagesSecurite SocialeBA MBENEPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Protection Sociale Des SalariésDocument9 pagesChapitre 4 Protection Sociale Des SalariésNawfal Fathi El IdrissiPas encore d'évaluation
- Guide Pratique: "La Retraite Supplémentaire Collective Des Salariés"Document28 pagesGuide Pratique: "La Retraite Supplémentaire Collective Des Salariés"Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)Pas encore d'évaluation
- Livret Indh VFDocument68 pagesLivret Indh VFsaid kabbachPas encore d'évaluation
- Assurance Sur La Maladie ObligatoireDocument21 pagesAssurance Sur La Maladie ObligatoireLacenPas encore d'évaluation
- La Pérennité Financière Des Caisses de Sécurité Sociales en AlgérieDocument20 pagesLa Pérennité Financière Des Caisses de Sécurité Sociales en AlgérieYannis Boudina Graïne100% (1)
- CIMRDocument11 pagesCIMRRania MahboubPas encore d'évaluation
- Rapport Mondial Sur La Protection Sociale-OITDocument498 pagesRapport Mondial Sur La Protection Sociale-OITHicham AoumouPas encore d'évaluation
- La Physionomie Du Syndicalisme Au MarocDocument2 pagesLa Physionomie Du Syndicalisme Au Maroclounes41Pas encore d'évaluation
- La Libéralisation Des Assurances P-Ch. Pradier, Cairn - InfoDocument33 pagesLa Libéralisation Des Assurances P-Ch. Pradier, Cairn - Infosimplice tene penkaPas encore d'évaluation
- Chiffres Clés Assurance MarocDocument16 pagesChiffres Clés Assurance MarocBakriPas encore d'évaluation
- Lassurance Takaful Dans Le MondeDocument58 pagesLassurance Takaful Dans Le MondeAmine Lrhaich100% (4)
- Rapport RamedDocument184 pagesRapport Ramedأحلام المغربيةPas encore d'évaluation
- Problématique Et Réforme Caisse de CompensationDocument14 pagesProblématique Et Réforme Caisse de CompensationFatim Zora100% (1)
- Securite SocialeDocument39 pagesSecurite SocialeTarikPas encore d'évaluation
- Les Composantes Du Système de Protection Sociale Au Maroc Ont Été Développées de Manière Fragmentée Sur Une Période Très LongueDocument9 pagesLes Composantes Du Système de Protection Sociale Au Maroc Ont Été Développées de Manière Fragmentée Sur Une Période Très LongueSarah agoPas encore d'évaluation
- La Caisse Nationale de Securite SocialeDocument14 pagesLa Caisse Nationale de Securite SocialeJawkiniPas encore d'évaluation
- CNSS SfeDocument61 pagesCNSS SfeRajae AbaidiPas encore d'évaluation
- Assurance Maladies ObligatoireDocument7 pagesAssurance Maladies ObligatoireMarwane BoumouhPas encore d'évaluation
- Chomage Des Jeunes Et Inegalites DinsertDocument186 pagesChomage Des Jeunes Et Inegalites DinsertmehdiPas encore d'évaluation
- Couverture Sanitaire Universelle Cours 2017Document44 pagesCouverture Sanitaire Universelle Cours 2017IlhamManarPas encore d'évaluation
- PLF 2024 Maroc FGTDocument7 pagesPLF 2024 Maroc FGTmariam bouasriaPas encore d'évaluation
- AcapsDocument236 pagesAcapsWax SaracenPas encore d'évaluation
- 95400-Strategie Nationale Csu-MadagascarDocument54 pages95400-Strategie Nationale Csu-MadagascarAntsatiana Jésuelle RabialahyPas encore d'évaluation
- Industrie de L'assurance Et Financement de L'ã©conomieDocument17 pagesIndustrie de L'assurance Et Financement de L'ã©conomieGuillaume KOUASSIPas encore d'évaluation
- Taxe Sur Les AssurancesDocument33 pagesTaxe Sur Les AssurancesNaima FirarPas encore d'évaluation
- Droit de La Securite Sociale 01Document27 pagesDroit de La Securite Sociale 01Mila SilaPas encore d'évaluation
- L'assurance du particulier: Tome 1: Assurances de dommagesD'EverandL'assurance du particulier: Tome 1: Assurances de dommagesPas encore d'évaluation
- 2.1 - Modèle D'organigrammeDocument3 pages2.1 - Modèle D'organigrammeGael RaserijaonaPas encore d'évaluation
- 2.6 - Le Bilan de CompétencesDocument2 pages2.6 - Le Bilan de Compétencesbendjillali youcefPas encore d'évaluation
- Les FonctionsDocument2 pagesLes Fonctionsbendjillali youcefPas encore d'évaluation
- Gestion Logistique Et Transport 157824Document31 pagesGestion Logistique Et Transport 157824Mohamed MouhoubPas encore d'évaluation
- Exos2011 PDFDocument29 pagesExos2011 PDFbendjillali youcef71% (7)
- Ue FPG104Document2 pagesUe FPG104bendjillali youcefPas encore d'évaluation
- Les FonctionsDocument2 pagesLes Fonctionsbendjillali youcefPas encore d'évaluation
- 2 La Preparation de La Paie2Document4 pages2 La Preparation de La Paie2bendjillali youcef100% (1)
- Paie DunodDocument22 pagesPaie Dunodbendjillali youcef100% (1)
- 200 Modeles de Lettres-1Document320 pages200 Modeles de Lettres-1nishanth abir100% (1)
- Memento de Correspondance A L Usage de L Officier D Etat Major France 2008Document80 pagesMemento de Correspondance A L Usage de L Officier D Etat Major France 2008bendjillali youcef100% (1)
- Installation Windev 17 Sur W8Document1 pageInstallation Windev 17 Sur W8bendjillali youcef100% (1)
- Installation Windev 17 Sur W8Document1 pageInstallation Windev 17 Sur W8bendjillali youcef100% (1)
- Correspondance CommercialeDocument39 pagesCorrespondance CommercialeAbdellatif Akherraz100% (3)
- Module B Gestion Du PersonnelDocument38 pagesModule B Gestion Du Personnelbendjillali youcefPas encore d'évaluation
- Attestation Professionnelle de DéplacementDocument2 pagesAttestation Professionnelle de DéplacementLes Nouvelles CalédoniennesPas encore d'évaluation
- Chap I INTRODUCTION GENERALE-1Document7 pagesChap I INTRODUCTION GENERALE-1Johny Vestalys WilliamPas encore d'évaluation
- Évaluation Des Performances de Coca ColaDocument1 pageÉvaluation Des Performances de Coca ColaScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Le Marché Du TravailDocument3 pagesLe Marché Du TravailKhalid RahmaniPas encore d'évaluation
- Le Monde Campus Novembre 2017Document60 pagesLe Monde Campus Novembre 2017LeMonde.fr100% (3)
- Permis de Travail Pour Le Travail Sur L'electricitéDocument2 pagesPermis de Travail Pour Le Travail Sur L'electricitéOusmane KantéPas encore d'évaluation
- Cours HPEC L2-S4 UTS 2021 - 2022Document33 pagesCours HPEC L2-S4 UTS 2021 - 2022Abdoul Faïçal OUEDRAOGOPas encore d'évaluation
- 231 Modele CV Etudiant 97 2003Document4 pages231 Modele CV Etudiant 97 2003Loubna Ľőůbņā Ģø ELPas encore d'évaluation
- Journal N°3Document52 pagesJournal N°3Chaouki AbdallahPas encore d'évaluation
- Mémoire PFE PDFDocument56 pagesMémoire PFE PDFMarie LinePas encore d'évaluation
- 666-Article Text-2408-1-10-20210725Document17 pages666-Article Text-2408-1-10-20210725vincenzo essombaPas encore d'évaluation
- Situation Des Travailleurs ÉtrangersDocument10 pagesSituation Des Travailleurs ÉtrangersJustin OuedraogoPas encore d'évaluation
- Les Métiers Du SIRHDocument9 pagesLes Métiers Du SIRHAchraf AmilaPas encore d'évaluation
- Bulletin de Salaire: Ministère Des Finances Et Du BudgetDocument2 pagesBulletin de Salaire: Ministère Des Finances Et Du BudgetMame Diara NDIAYEPas encore d'évaluation
- Carole BrevitazDocument6 pagesCarole BrevitazlagazetteredacPas encore d'évaluation
- Liste A Fournir Pour Un Visa Allemand NewDocument4 pagesListe A Fournir Pour Un Visa Allemand NewJosé BenitesPas encore d'évaluation
- Les Ressources de Recrutement - 2 PDFDocument11 pagesLes Ressources de Recrutement - 2 PDFŠøŋ Gõĥặŋ KüŋPas encore d'évaluation
- Dossier Caf PDFDocument3 pagesDossier Caf PDFJulien AmeliPas encore d'évaluation
- Situer Decathlon Aulnoy Lez Valenciennes Dans Son EnvironnementDocument7 pagesSituer Decathlon Aulnoy Lez Valenciennes Dans Son EnvironnementnassimhouatproPas encore d'évaluation
- Declara Situation RessourcesDocument6 pagesDeclara Situation RessourcesKamel NouhPas encore d'évaluation
- 20SME05 spe4RUDiDocument359 pages20SME05 spe4RUDiVergnieux StevenPas encore d'évaluation
- 1 - La Gestion Du Contrat de Travail - 2018 CorrigéDocument32 pages1 - La Gestion Du Contrat de Travail - 2018 CorrigéJulien WedeuxPas encore d'évaluation
- Bulletin de Paie Juillet 2022: Interlog SolutionsDocument1 pageBulletin de Paie Juillet 2022: Interlog SolutionscacaPas encore d'évaluation
- Avis de Recrutement Chef de Projet D Chets Au Togo 1686823456Document5 pagesAvis de Recrutement Chef de Projet D Chets Au Togo 1686823456BABALEPas encore d'évaluation
- Fiches Les Bonnes Questions o Se Poser.99502Document4 pagesFiches Les Bonnes Questions o Se Poser.99502Jallal DianePas encore d'évaluation
- Actualisation 12 2022Document3 pagesActualisation 12 2022GlowackiPas encore d'évaluation
- Outils Ressources HumainesDocument32 pagesOutils Ressources HumainespamelasegbemonPas encore d'évaluation
- Modele Convention Tripartite Amenagement Duree OpcoepDocument3 pagesModele Convention Tripartite Amenagement Duree OpcoepEXPERT CONSEILSPas encore d'évaluation
- Séance 1 Les Enjeux de La Santé Et Sécurité Au TravailDocument4 pagesSéance 1 Les Enjeux de La Santé Et Sécurité Au Travail100 50ccPas encore d'évaluation