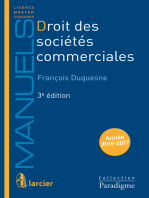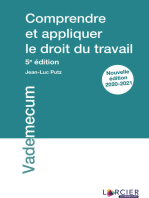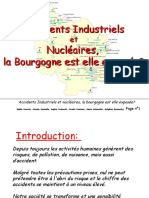Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Droit Des Affaires Commercants
Droit Des Affaires Commercants
Transféré par
rachid45Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Droit Des Affaires Commercants
Droit Des Affaires Commercants
Transféré par
rachid45Droits d'auteur :
Formats disponibles
Droit des affaires
Introduction
Le droit des affaires est une branche entire du droit priv, et emprunte aussi au droit public dans
son mode dlaboration, dans sa fonction Il existe une approche publiciste du droit des affaires (fin du
XVII avec DOMA dans son livre 1 Titre 12). Pour DOMA le droit commercial est un phnomne lgislatif. Le
droit commercial est ncessaire alors le droit tatique va sen emparer. Le statut du droit du commerce,
selon lauteur, relverait du droit public car cest une mission de lEtat dassurer la prosprit. Mais
aujourdhui le droit commercial est une branche du droit priv.
Les affaires regroupent beaucoup de situations (vendre du pain ou un avion cest des affaires). Du
coup, le droit des affaires couvre un grand espace :
Banques
Faillites
Brevets
Bourse
Le droit des affaires, comme le droit civil, a un corpus de rgles : Le code de commerce, hritier de la
codification napolonienne (il date de 1807), mais a t re-codifi selon la mthode de codification droit
constant en 2000.
La question est la suivante, le code civil sert au droit civil mais le code de commerce au droit des
affaires, pourquoi cette diffrence de dnomination ? la codification de 1807 consacre le mot commerce,
doit alors suivre une notion de droit commercial, et on enseignait donc le droit commercial. La rupture
arrive assez vite au XIX. La foi dans la codification commerciale faiblit rapidement, dautant plus que la
lgislation commerciale se dveloppe en dehors du code. Se fait alors jour lide quil ne faudrait pas
cantonner le droit commercial ltude du code de commerce comme ctait alors le cas. On notera
aussi que la pratique a toujours t trs rticente lemploi de lappellation du droit commercial.
Cette double tendance plaide pour un changement de terminologie, on parlait de droit
conomique ou de droit lentreprise . En fait ce nest pas ce qui est important, on peut lappeler
comme on veut, il faut tre daccord sur leur sens. Mais ces controverses terminologiques sont toujours
vivaces, et sont le reflet de nombreux changements dans la matire.
Une seconde question se pose, cest la dfinition du droit commercial. Si le droit nest pas le droit
du code de commerce, quest ce que cest ? On va dfinir le droit commercial comme celui qui concerne
les rapports juridiques qui trouvent leur source dans le commerce ou les affaires. Le mot commerce
comprend :
Les oprations de circulations et de distribution des richesses
Les oprations de production (effectues par les industries)
Les oprations financires (faites par les banquiers)
Il faut justifier ltude du droit commercial. Pourquoi ltudier comme si ctait une branche
autonome ? La rponse est historique. Les changes conomiques appellent du droit par leur
existence. Attention, on ne dit pas que ca rend ncessaire la LOI mais le DROIT, le droit nest pas la
Loi, mme si en France on peut tre amens confondre. Il sagit de droit qui est une rponse aux
questions des marchands, une manire particulire de trancher des litiges qui naissent de lactivit
commerciale et qui en cela prsente des spcificits.
Les Romains admettaient alors lexistence de rgles propres aux marchands, drogatoires aux
rgles civiles. Le droit du commerce romain (lex mercatoria) se caractrisait par le fait quil tait
international. Cest dailleurs toujours le cas. La circulation des richesses est internationale donc le
droit qui la rgit lest aussi. Hlas, cette conception romaniste du droit commercial nest pas passe
dans le droit franais, elle la influenc, plus prcisment elle a influenc le droit civil. Cest en partie
grce ca que le modle du contrat franais ressemble beaucoup au contrat romain. Cest en
travaillant sur le droit du commerce romain que lon a dcid que les contrats devaient tre faits de
bonne foi.
Au moment o le commerce saccroit de manire spectaculaire (autour de lan mille), a
cette poque o lon avait besoin dun droit pour rgir ces nouveaux changes, le droit romain navait
pas t dcouvert. Voila pourquoi le droit des affaires na pas t trs influenc par le droit romain.
Cest galement pourquoi le droit commercial franais est spcifique la France. Il est autonome par
rapport au droit civil, alors que dans dautres pays, ils forment un tout.
La rvolution commerciale commence par lItalie du nord. Trs rapidement les marchands
prouvent le besoin de formes simplifies pour leurs transactions, leurs ngociations, leurs socits Ils
ont besoin de procdure pour le rglement rapide de leurs litiges, de rgles sur le crdit et le payement
comptant. Les changes se droulent sur des foires. Cest donc cet endroit que les litiges naissent et
doivent tre dnous (aprs la foire chacun rentre chez lui donc cest mort).
Les marchands ne trouvent de rponse ni dans le droit coutumier ni dans le droit de lEglise, et le
droit romain nest pas redcouvert. Il faut donc inventer un droit pour quil leur soit favorable. Cest donc
un droit de coutumes qui naissent de la pratique. Ce droit commercial son origine ne repose pas sur un
projet politique. On na pas pour but prcis dassurer la prosprit des citoyens. Cest donc un droit plus
pragmatique, car dans son fondement il na quun but : Faciliter le commerce, il ne vient pas du haut ( le
lgislateur), mais du bas (la pratique). En ce sens cest un droit spontan.
Le droit commercial mdival prsente trois caractres :
Il est appliqu par des tribunaux spciaux dont une partie de ceux qui jugent sont des
marchands. Cest ce que lon appelle la juridiction consulaire : Les juges sont lus. Ce trait
du droit commercial va perdurer tel point quil sera consacr lorsque le droit
commercial sera lgalis (commencera venir den haut).
Il est fond sur la coutume, c'est--dire sur un ensemble de rgles non crites et des
usages.
Il sapplique exclusivement la communaut marchande
Lorsque la France statise, le droit commercial change de nature, de coutumier il devient lgislatif. Cest
la grande ordonnance de 1673, quon appellera aussi code Savary qui fixera les devoirs et droits des
marchands, ngociants ou banquiers, quils agissent seuls ou en socit, pour leur compte ou comme
intermdiaires. LEtat nation se structure, il lui faut donc un droit sa mesure, et le pouvoir royal veut
pouvoir intervenir dans les changes commerciaux. On rejoint donc la dfinition publiciste du droit
commercial. Le droit commercial devient national (puisquil est interne lEtat). Paradoxalement ces
changements ne vont pas toucher la spcificit du droit commercial et continueront crer des
juridictions consulaires (les marchands lus). Ces juridictions deviennent un des bras arms de la justice
royale. On unifie donc le droit commercial dans le pays. Cette unification au XVII XVIII est bien plus
importante que pour le droit civil.
Lorsque le temps des codifications vient, le droit commercial est dj presque codifi, mme si le
code SAVARY est lacunaire. Do le peu de prestige du code du commerce, son seul prestige est de suivre
de 3 ans le code civil. Le code de commerce oscille entre le recopiage et la mise jour de lordonnance de
1673. Le code de commerce de 1807 passe a cot des objectifs napoloniens :
Le code de commerce nest pas exhaustif car lordonnance SAVARY ne ltait pas, il est lacunaire
Le code de commerce nest pas cohrant
Vu quon tait dans une priode de faillite, cest aussi la matire la plus importante dans ce code. Le
reste du droit commercial est trs peu dvelopp, voir pas du tout : On ne trouve rien sur le fond de
commerce et quasiment rien sur le droit bancaire.
Il y a une grande distance entre la dfinition de lacte de commerce et le commerant, pourtant ces
deux dfinitions sont lies (et il y a 600 articles entre les deux), cest incohrent.
Le code de commerce est mal n et a mal vcu, des rgles sont apparues par la suite et nont pas t
codifies. La trs grande Loi sur les procdures collectives de 1985 na pas t codifie par exemple.
Beaucoup de Lois sont donc hors du code. On parle de dcodification (on ne le dtruit pas mais on le laisse
dormir ).
Ceci dit, limportance du droit commercial est telle de nos jours que se pose la question de linfluence
du droit commercial sur le droit civil, on se demande mme si le droit commercial nabsorbe pas le droit
des contrats du droit civil. On se demande aussi si on ne devrait pas fusionner les deux.
Les raisons quon peut avoir, cest quen 1904, centenaire du code civil, la codification va mal, on
a faillit abandonner le code. On stait interrogs ce moment l sur la fusion entre le droit civil et
commercial car le droit commercial semble suprieur car libral. Cest ce caractre libral quenvient les
civilistes. Mais avec les guerres mondiales, la crise de 1929, le droit commercial devient dirigiste, il se
publicise. Du fait du dirigisme, la ncessit de fondre le droit civil et commercial disparait. LEtat intervient
pour diriger des activits prives, on veut amliorer la production et la distribution des richesses.
La politique dirigiste sur le droit commercial se traduit sur :
La rglementation du crdit
Le contrle de lchange
La rglementation des banques
Le contrle de linflation des prix
Louverture de nouveaux commerces
En mme temps, la Loi doit tre linstrument de lgalit sociale, et donc on tente de corriger
certains dsquilibres en instaurant des lgislations protectrices des parties faibles dans des rapports
juridiques donns. La relation de travail (patron / ouvrier) est un exemple, le droit du travail acquiert son
autonomie cette poque.
Ce regard port sur la partie la plus faible fait que le regard sur les dbiteurs en matire
commerciale va changer. Linsolvabilit des dbiteurs appelle une intervention lgislative. La satisfaction
du crancier jusqu prsent considre comme laboutissement naturel du contrat est parfois mise de
cot au profit dun traitement de la situation des dbiteurs, en matire civile, on instaure des dlais de
grce et on annule parfois les dettes. On le retrouve dans le droit commercial, comment traiter
lentreprise commerciale qui ne peut plus payer ses dettes.
Au cours du XIX la rponse du droit lgard dune entreprise ne pouvant plus payer ses dettes a
chang. On parle toujours de faillite (en 1907 la faillite ctait pas bons du tout pour le dbiteur, on limine
le mauvais commerant, mais on le tue pas hein !), mais on cre une procdure parallle pour la faillite de
bonne foi, cest la liquidation judiciaire (4 mars 1889). On limine toujours les mauvais commerants,
mais le point de mire est de sauver lentreprise. Les Lois se succdent, et laspect pnal de la faillite est
rduit au minimum.
Le droit commercial se distingue du droit civil, au sein du droit priv, mais son tude est justifie
par la matire qui le compose et par son volution historique.
Le Droit commercial est un droit paradoxal.
Ltatisation du droit commercial affirme son caractre national l o son adaptation aux changes le
rend a-national.
Cest un droit cartel : Cest en mme temps la lex mercatoria internationale romaine, elle se
veut efficace, simple rapide et scurisant les transactions :
Larticle L110-3 du code de commerce prvoit la libert de la preuve des actes de commerce
lgard des commerants. On privilgie ici le fond sur la forme. Lcrit ne simpose pas comme mode de
preuve.
Larticle L 110-4, les obligations entre commerants ou entre commerants et non commerants
se prescrivent en 10 ans. On prennise les situations juridiques plus tt quen droit civil. (Prescription :
2279 du CC. Moyen dacqurir ou de se librer par un laps de temps et par certaines conditions).
Mails il y a aussi des tendances interventionnistes nationales qui imposent des rgles aux
commerants. Il y a une tendance la correction des excs du libralisme et du capitalisme.
Larticle L 145 : La rglementation relative au bail commercial vise limiter linflation en
contrlant le prix du contrat. Cest dirigiste.
Plus correcteur, le droit de la concurrence, dans larticle L 420-20 sur les pratiques antis
concurrentielles, on vise ici prserver la saine concurrence, viter les monopoles et les abus de position
dominante.
Le droit commercial est donc difficile apprhender car il nobit pas une seule logique qui
pourrait nous guider. Du coup le droit commercial est un corps de rgles qui sont susceptibles de varier
considrablement dans le temps au gr de telle ou telle vision de lconomie. Cela entache donc leur
valeur en droit, mais dans le mme temps, on a conserv certains aspects du droit commercial qui sont
dsus datant de 1807.
Il ny a donc pas de grande ligne directrice.
Les sources mme du droit commercial sont dsorganises. On avait essay en 2000 de redonner
une cohrence ces sources en re-codifiant droit constant. On a remis en forme les lois commerciales
mais on ne leur a pas donn de cohrence, cest donc rat.
En fait il y avait eu une sorte demballement des pouvoirs publics sur la codification, on na pas re
codifi que le code du commerce. On explique cet emballement par le besoin dintelligibilit et
daccessibilit du droit. En 1807, on avait recopi lordonnance SAVARY, et en 2000 on a recopi le code
de commerce, avec quelques amliorations, on a rapproch les dfinitions dacte de commerce et de
commerant.
Lobjectif dune codification est de runifier le droit, de runir tout en un code, cest plus une
sorte de compilation. Et comme le code de 1807, le code de 2000 est lacunaire (en plus il y a eu 2 lois pour
corriger 90 erreurs de rdaction).
On re codifie en 2000 et juste aprs il y a eu deux Lois denvergure qui ajoutent et corrigent des
dispositions du code de commerce, de plus il y a des chevauchements entre diffrents codes. Nanmoins
a sera notre outil de travail.
Dans le code on a adopt le mode de numrotation tiroirs (avec des tirets). Cest la
numrotation mi anglo-saxonne, mi-franaise.
Il y a 9 livres :
1. Livre I : Du commerce en gnral (notre objet dtude privilgi)
2. Livre II : Socits commerciales et groupements
3. Livre III : De certaines formes de ventes et de certaines clauses dexclusivit (vente et
droit de la distribution).
4. Livre IV : De la libert des prix et de la concurrence (acte fondateur du droit de la
concurrence).
5. Livre V : Les effets de commerce et les garanties (lettre de change, billet ordre)
6. Livre VI : Les difficults des entreprises (aboutissement du Droit commercial : Procdures
collectives).
7. Livre VII : Juridiction commerciale (toujours consulaire ce jour)
8. Livre VIII : De quelques professions rglementes (dune part ceux qui interviennent dans
les procdures collectives, mandataires judiciaires)
9. Livre IX : Disposition applicables en outre mer.
Le droit commercial est directement concern par lmergence du Droit de la consommation, il a
un code de la consommation. Il y a galement le droit communautaire de la consommation bien que la
conception franaise et europenne soit diffrente (en France on prsume quil y a un parti fort (vendeur)
et un faible (consommateur) , en droit communautaire cest plus une question de compromis.)
La responsabilit des fait et des produits dfectueux est insre dans le code civil, mais elle
concerne celui qui fabrique et qui met le produit en circulation, en ce sens il est commerant, sa situation
est rgie par un texte qui est rgie par un texte communautaire mais prsent dans le code civil.
Il en est de mme sur la garantie de conformit intgre au code de la consommation.
Plus largement les Lois civiles intressent parfois au premier chef les commerants. Le droit civil
est le droit commun, donc lorsque le droit commercial sefface, on en retourne au droit commun. La
matire fiscale va cependant largement influer le droit commercial galement.
Il existe aussi ce que lon appelle lmergence du droit de la rgulation (soppose
rglementation). Cest un droit dconnect du processus classique dlaboration. Cest la conjonction dun
nouveau rapport entre le droit et lconomie. Elle est ne de louverture la concurrence de certains
secteurs conomiques (nergie, transport). Cette ouverture donne lieu la cration dautorits de
rgulations : Conseils de la concurrence, CSA Ces autorits sont ni prives ni publiques, elles sont en
dehors, donc on drglemente
Tout cela finit par crer un corps de Droit notamment parcque les dcisions des autorits de
rgulation peuvent faire lobjet dun recours devant le juge.
Outre la Loi, il y a une place particulire rserve dans le droit commercial aux usages. Cest bien
le droit commercial qui forme le domaine de prdilection des usages. Le droit commercial est spontan
do limportance des usages.
La parre est une attestation dexistence dune coutume dlivre par la chambre de commerce.
Certains textes du code de commerce renvoient directement la coutume (L 442-2)
Certains usages caractre impratifs y sont pour beaucoup dans lautonomie du droit
commercial. La solidarit est prsume en droit commercial : Cest linverse du droit civil (1202 du CC)
Egalement, lanatocisme du compte courant est de droit pour un commercial. Cest la
capitalisation des intrts (En fait, on intgre les intrts au capital pour quils puissent leur tour gnrer
dautres intrts). Cest contraire au droit civil.
La rfaction du contrat par le juge est possible en droit commercial. Le juge peut modifier un
contrat commercial alors quen droit civil il ne peut pas le faire.
Limportance des rglementations professionnelles est une autre source de droit. Les rgles
dontologiques, limportance des marchs, les contrats type psent aussi sur le droit commercial.
Il ya galement une importance du droit du commerce international. Droit de larbitrage
international.
Il y a aussi la lex mercatoria qui perdure aujourdhui.
Le droit commercial concerne les commerants certes mais cest quand mme des gens, do une
justice commerciale a part.
Partie I : Les personnes
En fait cest les commerants. On peut dfinir le commerant soit en tant que personne, soit en
considration de son activit.
Il y a donc deux approches diffrentes du commerant et deux catgories de personnes : Personnes
physiques ou morale.
Titre I : Le commerant : Personne physique
La dfinition du commerant est donc une approche subjective de la commercialit et suppose la dfinition
de lacte de commerce.
La qualit de commerant est bien lie lactivit du commerce
Chapitre I : La qualit du commerant li lexercice du commerce
Comment acqurir la qualit de commerant, et quelles sont les consquences de cette qualit ? On
sintressera aussi au cas particulier de lartisan.
Section I : Lacquisition de la qualit du commerant
Sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (L 121-
1 du Code de commerce)
Dans ce texte, la jurisprudence ajoute quil faut exercer le commerce de manire personnelle et
indpendante.
1 : Laccomplissement dactes de commerce
La prsentation du code de 2000 diffre de celle de 1807. Cest mme linverse. Lacte de commerce est le
critre pour qualifier un commerant. Avant ctait le contraire.
Article L 110-1 : Prsente une liste des actes de commerce (Mais comment utiliser une liste pour dfinir
lacte de commerce ?).
Soit on utilise cet article pour essayer deffectuer un classement fond sur lactivit conomique, soit on
essaye dlaborer une dfinition unitaire de lacte de commerce, plus abstraite mais plus large quune liste.
A) Les actes de commerces rattachs des secteurs conomiques
On peut regrouper la liste en 4 secteurs conomiques :
Distribution
Production
Services
Auxiliaires et intermdiaires
1. La distribution
Ici, cest lachat pour la revente. Ici lide qui domine cest celle du bnfice. On note que le code de
commerce dispose que cela concerne tout bien meuble (denre alimentaire, PS3). Les biens immeubles
sont aussi concerns (L 110-2 2
nd
).
Lacquisition dun produit en vue de travailler la matire de ce produit ou mise en uvre de ce
produit est galement concerne par larticle 110.
Le texte concerne tant le petit commerce que la grande distribution.
Lachat pour revente constitue bien le cur de la distribution.
Secteur de la distribution : La distribution pour but lcoulement rgulier dune production de
masse au moyen de diffrentes techniques de circuit court (producteur au consommateur directement) et
de circuits longs (chaine de vente successive entre le producteur et le consommateur).
Il y a une distinction entre le producteur et le distributeur qui est importante notamment lors de la
responsabilit pour produit dfectueux.
2. La production
On est toujours dans le cadre de larticle L 110-1 1
er
qui vise la manufacture. On nous renvoi ici aux
lieux de production industriels. L encore le secteur est trs vaste, on songe lensemble des produits
industriels, de la construction et vente dun boulon a celle de la vente dune centrale nuclaire cl en
main.
Relve aussi de la production les oprations de construction de meubles et immeubles.
Certains meubles comme les btiments de navigation intrieurs ou extrieurs (les bateaux) et leur
rparation en font partie. Certains immeubles (ils y a une attirance des immeubles vers le droit civil) aussi.
La Jurisprudence considre que les entreprises de constrictions sont galement des commerciaux.
Cela dit la production peut aussi tre intellectuelle et/ou artistique, certaines oprations relatives aux
uvres intellectuelles sont commerciales. Lditeur, le producteur, la publication de journaux/revues
3. Les services
Les prestations de services dans toute leur dimension sont des actes de commerce. La location de meuble,
le transport de personnes, les entreprises de fourniture, les agences
Egalement les contrats de dpts , les contrats de garde ne relvent pas du droit civil et relvent de
larticle L 110-1 du Code de commerce
4. Les auxiliaires et intermdiaires
On considre ici, sagissant des intermdiaires et auxiliaires, quil sagit pour la plupart de la matire
bancaire (oprations de change, banque, courtage, larticle L 110-1 8
e
rajoute les banques publiques,
ltablissement de crdit). On rattache dsormais le caractre commercial des oprations de bourse
larticle L 110-1 7
e
, avant on le rattachait aux achats pour revendre. Rattacher les oprations de
banques la distribution pouvait poser problme.
Lactivit commerciale peut se borner fournir aux commerants et a des particuliers le moyen
dexercer une activit par exemple en leur facilitant certaines oprations. On les rattache aux actes
commerciaux car ils agissent leurs risques et prils en exposant leur propre patrimoine.
Le courtage consiste rapprocher des personnes qui veulent contracter. Les activits de courtage
sont rglementes. Le courtage matrimonial est galement rglement. (y a pas que le trader).
Entrent galement dans cette catgorie les agents daffaire . Cette catgorie rassemble plusieurs
professions, cest tous ceux qui grent les affaires dautrui.
On ajoute aux intermdiaires les agents commerciaux qui agissent au nom dautrui et les
commissionnaires qui agissent pour le compte dautrui mais en leur nom propre.
Le code de commerce prsente des imperfections : On a ici une liste, ce nest pas pratique. De
plus cette liste nest pas cohrente.
Pour ce qui est du domaine maritime, on a gard les listes pratiquement en ltat depuis 1807.
Lenjeu du critre de commerciabilit cest bien de prvoir des solutions : A telle qualification
correspond telle rgle de droit (utiliser le droit commercial ou non). Alors la recherche dune
dfinition gnrale vaut la peine dtre faite.
B) Les actes de commerce en qute dune dfinition gnrale
Premier critre : Celui labor par THALLER (fin XIX). Lacte de commerce est un acte de
circulation. Ce que tous les actes de commerce ont en commun est de sinterposer entre un
producteur et un consommateur. Cest donc lorigine des biens (la production) et la destination
des biens (la consommation) qui est considre par THALLER comme critre.
On a donc un cadre qui ne peut pas tre considr comme un acte de commerce. La fabrication
nest pas en elle-mme un acte de commerce.
Mais il manque une dimension conomique ce qui peut prter confusion. Certaines oprations
seraient qualifies comme conomiques alors quelles nont aucun intrt commercial. (une
entreprise qui revend des biens sans marge).
LYON CAEN (fin XIX et dbut XX) et RENAUD se sont livrs une approche de lacte de
commerce. Lacte de commerce est un acte de spculation. Il est effectu dans le but de dgager
des bnfices. On espre que la valeur du bien va saccroitre pendant sa transformation ou son
change. On a une prise en compte de la finalit conomique mais aussi les moyens, la prise de
risque que justifie lesprance dun gain (risque calcul). Une opration est commerciale alors
mme quelle serait dficitaire. Ce critre corrige le premier : Lactivit commerciale est mue par
la recherche de bnfice.
Cela dit comment dfinit on le bnfice ? De plus cest une dfinition trs large, mme le non-
commerant spcule dans certaines occasions (assurances vies par exemple).
On a dgag, pour corriger les critres prcdents un nouveau critre : Lacte de commerce est
un acte dentreprise. On considre lactivit dans ses rapports avec une entit conomique.
Lentreprise a pour raison dtre, lactivit commerciale. Mais l encore cest imprcis : Toute
entreprise nest pas commerciale. Et puis on dplace la dfinition sur celle de lentreprise.
En somme le critre le plus satisfaisant consiste rapprocher les deux premiers critres.
Lacte de commerce serait lacte de nature conomique rsultat dactivit de production, distribution
ou service ralis dans un but lucratif.
Mais lacte de commerce ne suffit pas lui seul dterminer le commerant en tant que personne. Sont
commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
2 Laccomplissement dacte de commerce titre de profession habituelle
A contrario, un individu peut effectuer des actes de commerce sans pour autant tre commerant. On va
sinterroger sur le caractre professionnel et lhabitude.
La profession : laccomplissement dactes de commerce doit tre une source de revenus. On sy
consacre rgulirement dans le but den dgager un certain profit.
Lactivit commerciale nest pas forcment principale, elle peut tre secondaire. Il nest pas non
plus ncessaire que ce soit la profession dont on tire le plus de revenus.
Celui qui a des revenus viagers et qui ouvre une picerie, il sagit dune profession qui recourt
des actes de commerce mme si ce nest pas la principale.
Les deux activits doivent cependant tre distinctes. Une activit suppose parfois
laccomplissement dactes de commerce mais ils restent accessoires.
Exemple : Le chirurgien dentiste pratique souvent lachat pour revente de prothses dentaires.
Comme cette activit est accessoire, ca ne fait pas du chirurgien un commerant, et ce mme sil
fait bien son beurre avec ca.
En fait la rcurrence de lactivit peut tre un critre mais il faut aussi prendre en compte les
bnfices. On lapprcie au cas par cas.
Lhabitude : Elle est connue en droit. Elle suppose un lment matriel et intentionnel.
Llment matriel tant la rptition et la dure.
Il faut que lacte de commerce sinscrive dans le temps. Ces critres ne sont pas des quantum
cest toujours du cas par cas, il ny a pas de plancher fix.
Il faut quil y ai plusieurs actes de commerces. Un acte ne suffit pas mme sil dure longtemps.
Les raisons intentionnelles suppose que laccomplissement dacte de commerce soit volontaire.
Lintrt dajouter lhabitude la profession est dexclure de la qualit de commerant ceux qui se
comportent comme tel de manire occasionnelle. Une association organisant des soires de temps en
temps ne fait pas delle une association commerante
3 Laccomplissement dacte commercial de manire personnelle et indpendante.
Cest une jurisprudence de longue date selon laquelle le commerant est celui qui exerce un acte
commercial de manire personnelle et indpendante.
Donc linverse celui qui passe des actes de commerce pour autrui nest pas commerant ? Pas vraiment.
En fait on se pose ici la question de qui prend le risque ? Quel patrimoine est expos lors de lactivit
commerciale. Le risque pse sur celui dont le patrimoine garantit le risque. Ainsi le salari nest pas
commerant car il est dans un rapport patrimonial de subordination, il nest donc pas indpendant, il
nexpose pas son patrimoine. Un grant salari dun fon de commerce nest pas commerant car il nagit
pas de faon indpendante puis quil est salari.
Le locataire qui gre un fon de commerce na la plupart du temps pas la qualit de commerant.
Le problme qui surgit ici est celui des intermdiaires du commerce (courtiers, commissionnaires, agents
daffaire). On distingue ces intermdiaires en ce quils engagent leur patrimoine dans leurs activits. Si
cest le cas ce sont des commerants et cest eux que vise larticle L 110-1.
Encore une fois, cest une interprtation au cas par cas.
Il est donc difficile de dterminer la fonction de commerant. Cela dit il ny a pas normment de
contentieux, et cest toujours les mmes situations.
De plus en pratique il existe une prsomption qui rgle le problme, cest limmatriculation au Registre du
Commerce et des Socits (RCS).
Larticle L 123-7 du Code de Commerce prsume quun Tiers immatricul au Registre du Commerce et des
Socits (RCS) est un commerant. La preuve du contraire peut tre apporte, et cette prsomption ne
sapplique que de bonne foi. Si on sait que la personne nest pas commerante, on ne peut pas faire jouer
la prsomption.
La qualit de commerant emporte lapplication de certaines rgles.
Section II : Les consquences de la qualit de commerant
Acqurir la qualification de commerant emporte deux sries de consquences :
Pour les personnes
Pour les actes
La dtermination du commerant emporte le statut. Ca apporte automatiquement des obligations mais
aussi des consquences sur les actes.
1 Les personnes
Chapitre III du Livre II du Code de commerce Obligations gnrales des commerants .
Deux types dobligations :
Obligations la publicit
Obligations la comptabilit
Article 123 et suivant.
Le commerant est astreint certaines rgles de publicit dont le principal est limmatriculation au
Registre du Commerce et des Socits (RCS) qui apporte la connaissance de tous, un certain nombre
dinformations telles que la structure de lentreprise, de la localisation
Larticle L 123-9 assure la production de certains effets de droits la personne elle mme.
Le commerant a pour obligation de tenir une comptabilit (L123-12).
Le but tant de rendre possible pour les Tiers une connaissance instantane de lactif et du passif de
lentreprise. Les Tiers intresss peuvent tre ladministration fiscale ou un Tiers intress pour reprendre
la socit.
La comptabilit enregistre les mouvements patrimoniaux actifs et passifs. Elle tablit un inventaire
consistant valuer lexistence et la consistance du patrimoine.
Ltablissement de comptes annuels permet dapprcier les rsultats dune entreprise.
Outre la tenue dune comptabilit il y a la ncessit dun compte en banque car tous les payements
professionnels doivent avoir lieu par virements, chques et lettres de change. On cherche viter les
mouvements en espce. L 123-24
En contre partie de ces obligations, les commerants ont les bnfices de procdures particulires en cas
dchec de lactivit commerciale. Le droit de la faillite qui est le droit des procdures collectives. On
cherche sauvegarder lactivit commerciale.
2 Les actes
1. Le rgime des actes de commerce
Ce sont les rgles de droit faites pour lefficacit de ces actes.
La qualit de commerant a pour consquence une diffrence de rgime. Voyons quelques lments du
rgime du droit commercial.
Contrairement la matire civile, la maxime qui ne dis mot consent sapplique. Le silence est
crateur dobligation. Exemple : Celui qui reoit des marchandises sans mettre de rserve se
trouvera engag par cette livraison.
Larticle L110-3 A lgard des commerants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous
moyens moins quil nen soit autrement dispos par la loi. .
On peut en dduire que :
o Cest contre le commerant que la preuve est mixte ( lgard de ), donc dans un acte
mixte, le non commerant pourra prouver lacte de commerce par tout moyen par
rapport au commerant, par contre le commerant devra respecter les rgles civiles
(article 1341 du Code Civil). En fait il faut que le commerant soit dfendeur pour que
larticle L110-3 sapplique. Ca oblige le commerant faire un acte crit avec un non-
commerant.
o Le commerant ne fait pas que des actes de commerce, il peut aussi faire des actes civils
qui devraient se prouver par les rgles de droit civil. Exemple : Les actes relatifs un
meuble mais qui sont des ventes civiles.
NB : Le problme des actes civils exercs par un commerant, cest comment les
distinguer des actes de commerce ? Voir plus tard.
Larticle L110-4, les actes mixtes se prescrivent par 10 ans, on droge donc au droit civil.
On prsume la solidarit en matire commerciale. En droit civil, on prsume que lobligation est
conjointe.
Solidarit : En obligation civile (conjointe), le crancier doit prendre la part chez chacun, tandis
quen cas de solidarit, le crancier peut prendre la totalit de sa crance chez un seul dbiteur,
qui sarrangera ensuite avec lautre.
La solidarit amliore la confiance du crancier
Les litiges sont soumis une juridiction particulire, le Tribunal de commerce, juridiction
consulaire, les juges sont lus et choisis parmi les pairs des commerants. La procdure est plus
rapide et moins couteuse. Cela dit, ce nest pas un ordre spar, cest juste une juridiction
spcialise.
Il existe une catgorie dactes particuliers qui sont les actes mixtes qui posent problme, ils se
trouvent dans les articles L 110-3 et L110-4
Les actes de commerce par accessoire : Laccessoire suit le principal (immeubles par destination par
exemple, ou encore lacquisition par la thorie de laccession, je suis propritaire dun fon, jai aussi ce quil
y a dessus).
Sagissant des actes de commerce, un acte normalement civil peut tre qualifi de commercial par
lapplication de la thorie (cest des actes civils devenus commerciaux car pratiqus par un commerant
pour les besoins de son commerce).
A linverse, un acte qui est plutt normalement un acte de commerce peut est disqualifi en acte civil car
pratiqu par un non commerant.
Quels sont les critres de laccessoire ?
Un acte conu comme un acte civil pose un problme de qualification, on se demande sil ne doit pas tre
rattach la qualification des actes de commerce selon la thorie de laccessoire.
Deux conditions :
Pour tre un acte de commerce par laccessoire, lacte litigieux, civil par nature, doit avoir t
conclu pour les besoins de lactivit commerciale. En somme cet acte civil par nature rpond un
besoin commercial, il est commercial par destination, cest son but
Mais comment dterminer si un acte est pass pour les besoins du commerce ? Pour le prt,
applique t on le droit commercial ? On narrive jamais faire la part des choses dans ce cas.
Souvent on trouve la solution dans une prsomption dorigine prtorienne. Les actes de toute
nature accomplis par un commerant sont supposs tre des actes accomplis pour les besoins du
commerce. On rsout le problme par un transfert de la charge de la preuve (cest donc une
prsomption simple et non irrfragable). Donc par dfaut on appliquera le droit du commerce
sauf si le commerant prouve que lacte na pas t fait pour les besoins de son commerce. Cela
reposera in fine sur une prsomption simple devant le juge
On tempre la prsomption. Certains actes sont par nature commerciaux. Ainsi les obligations
nes louverture dun commerce entre commerants, sont considres comme tant
commerciales. Elles sont considres comme tant linstrument juridique ncessaire, do leur
nature commerciale. On se sert du cadre, si un acte est fait dans le cadre du commerce. Ici cest
trs imprcis, on na pas de critre pour trancher.
Lide dominante est que de manire globale, la thorie de laccessoire existe pour accroitre le champ
dapplication du droit commercial, on transforme un peu du droit civil en droit commercial.
Hypothses dapplication :
Premire application : Le cautionnement donn par un dirigeant de socit pour les dettes de sa socit.
Cautionnement : Contrat par lequel une personne sengage payer les dettes dautrui si ce dernier ne
peut pas le faire.
Le dirigeant joint son patrimoine propre la socit.
Cest un acte civil, moins que la caution ayant ou non la qualit de commerant ait un intrt
patrimonial au paiement de la dette garantie, alors mme quelle ne participe pas directement ou
indirectement lactivit du dbiteur (chambre commerciale du 20 Juillet 1981).
Il nimporte pas que la caution soit commerant ou non.
La part de lactivit de la caution dans lactivit commerciale est aussi indiffrente.
Le dirigeant ne prend pas part lactivit commerciale car cest la SARL qui exploite le fon de commerce.
Le critre dterminant est lintrt patrimonial car la caution va garantir lopration. Mais partir de quel
moment a-t-on un intrt patrimonial du paiement de la dette garantie ?
Lintrt patrimonial est jug au gr des litiges, mais la Jurisprudence a pos une prsomption : Le
dirigeant est prsum avoir un intrt patrimonial lorsquil cautionne les dettes de la socit quil dirige.
(Arrt du 18 Janvier 2000 par la chambre commerciale).
La Jurisprudence a t confirme par la cour dappel.
Le cautionnement est donc civil par nature, mais il faut prouver quil est commercial par accessoire.
Il y a de nombreux enjeux, la solidarit par exemple.
Deuxime application : Le cautionnement nest plus donn par un dirigeant mais par un associ.
Le principe est le mme, le cautionnement donn par un associ est en principe civil sauf si lassoci a un
intrt direct au payement de la garantie.
Par contre, on ne peut pas appliquer de prsomption sauf si lassoci est le dirigeant. Le principe est
toujours le mme cest un acte civil. Il faudra donc prouver lintrt patrimonial quil a au payement de la
garantie
Na pas dintrt patrimonial un actionnaire minoritaire. Souvent on passe par lengagement de capital
(critre principal) et dactivit de lassoci. Si lassoci est majoritaire, fondateur on a des indices forts
sur son implication.
Le cautionnement, acte civil par nature a une structure qui se prte fondamentalement assez mal cette
ide selon laquelle on a un intrt payer la dette dautrui (cest pour ca que sil y a un intrt on le
considre comme commercial.)
Section III : Lartisan
Pendant trs longtemps, la ncessit de distinguer les rgles applicables aux commerants et aux
artisans ne sest pas fait sentir.
Le statut de lartisan est diffrent alors quil se livre des activits assez proches, un statut se dessine
partir du XX. Ce qui rend la question trs complexe. Il ny a pas de statut clair de lartisan, dun
point de vue fiscal, il a une autonomie pour les actes de droit priv. Le statut de lartisan va se
rapprocher du commerant. Les deux catgories ont tendance converger mais la qualification de
lartisanat nest pas la mme que celle du commerce. La rglementation est assez dense en matire
dartisanat, il y a un code de lartisanat, annexe du Code de commerce.
On est dans les limites du droit commercial. Lartisan nest pas assimilable au commerant.
1 Les lments de dfinition
Ce qui caractrise lartisanat cest labsence de mouvement unitaire. Dans un premier temps,
lartisanat ntait pas distinct du commerce. Depuis le sicle dernier, on a dessin un statut
lartisanat. Cest surtout par des rglementations, des dcrets administratifs. Ce nest pas lgislatif. Il
tend ramener lartisan sur un terrain distinct du droit commercial.
A la demande des artisans, certaines rgles applicables aux commerants ont t appliques aux
artisans comme le nantissement de leur fond de commerce.
il y a donc forcment un statut hybride, une approche fiscale, commerciale et artisanale de lartisanat
puisquil existe depuis le 30 janvier 1952 un code de lartisanat.
Lartisanat est rglement par la chambre des mtiers.
Lartisanat est dfini dautant de manires que de branches de droit sy intressent.
Le droit fiscal sy intresse car lartisan nest pas soumis au paiement de la taxe professionnelle. Pour
lui est artisan celui qui travail faon pour les particuliers avec des matires leur appartenant (
faon dsigne lactivit manuelle).
On met laccent sur le fait que ce qui fait vivre lartisan cest son travail manuel et non la
transformation dun bien.
Dfinition de lartisan par le Code de lartisanat : Pour distinguer lartisan du commerant, il y a un
certain nombre de conditions. Le chef de lentreprise artisanale doit tre enregistr au registre des
mtiers qui est le pendant artisanal du Registre du Commerce et des Socits (RCS). Il faut quil
sagisse dune entreprise de moins de 10 salaris (Loi du 5 juillet 1996, article 19 du code de
lartisanat).
Lartisanat cest lexercice dune activit professionnelle indpendante de production,
transformation, prestation de services doit relever de lartisanat (je sais cest dbile, pour tre de
lartisanat, il faut faire partir de lartisanat : / )
Larticle 16 du code de lartisanat contient une liste dactivits qui requirent une qualification
professionnelle particulire. Le droit ici a en ligne de mire lorganisation de la qualit professionnelle
de lartisan.
La dfinition de lartisanat suppose de rapprocher les articles 16 et 19 de la Loi de 1996. Cest une
dfinition plus large que celle du droit fiscal. Un arrt ministriel qui fixe une liste dactivits
artisanales et il faut tre inscrit au registre des mtiers.
Il existe aussi de la Jurisprudence commerciale qui sest penche sur la question.
Elments de dfinition et dorganisation
Il faut savoir quil y a des chambres des mtiers, un rpertoire des mtiers et de lartisanat.
Chapitre II : Les limites lactivit du commerant
Il y a des personnes qui entendent exercer une activit commerciale et pourtant on ne leur attachera
pas la qualit de commerant.
Une premire catgorie de personnes va pratiquer le commerce et le droit ne les considrera pas
comme commerants. Cest souvent le problme du conjoint commerant.
Lun des poux est commerant et son conjoint participe lactivit. Quelle est sa situation en droit ?
Il existe aussi une catgorie de personnes qui entendent exercer le commerce mais le droit va le leur
refuser car il va les considrer comme incapables ou alors cela fait lobjet dune interdiction.
Section I : Le conjoint du commerant.
Article L121-3 et L121-4 : Le conjoint du commerant peut acqurir la qualit de commerant si
lactivit commerciale est spare de son poux et son application relvera de L121-4
1 Le principe
Quels sont les enjeux ?
Est-ce que le conjoint commerant sera lui aussi concern par la faillite ? Peut-il bnficier du droit
des procdures collectives ? Est-ce que ses propres biens sont labri des procdures collectives ou
sont ils engags dans lactivit commerciale si bien quil faut tendre la procdure au conjoint ?
Si on tend la procdure au couple, cest lensemble des biens du couple qui pourraient tre remis
flot ( est ce que je peux sauver les bijoux de grand-mre ? ).
Il y a un enjeu sur les cranciers du couple commercial. Peuvent-ils se faire payer sur le patrimoine
des conjoints ? Peuvent-ils sadresser lpoux (se) du conjoint commerant ?
Position du problme
A quel moment la question va-t-elle se poser ?
A quel moment le litige va-t-il se former ?
Nous avons l un conjoint qui effectue des actes de commerce de manire habituelle et de manire
presque indpendante. Il bnficie des fruits de lactivit commerciale. Si cest de manire habituelle
et de manire indpendante ce devrait tre un commerant, mme si lindividu exerce les activits
commerciales de son conjoint.
Exemple :
Petite entreprise publicitaire, monsieur fait la comptabilit, madame fait les relations avec les clients.
Lun est enregistr au registre du commerce, lautre est il commerant ?
Sagissant des pouses, le droit pendant trs longtemps a apport une rponse assez nette, lpouse
ne pouvait exercer une activit commerciale que si elle avait lautorisation de son poux,
autorisation discrtionnaire et recevable.
Au XX, on admet le principe selon lequel lpouse peut exercer une activit commerciale titre
indpendant mais le pre de famille peut sy opposer.
Cest avec la lgislation de 1942 que la femme peut exercer le commerce sans lautorisation de son
poux (vu lpoque, les poux taient soit morts, soit prisonniers, faut bien vivre !).
Cest en 1965 que la libert commerciale de lpouse est acquise.
Cest avec lmancipation commerciale de lpouse que la question du conjoint sest pose.
Paradoxalement, libert commerciale oblige, puisque lpouse a la libert commerciale, elle peut
donc acqurir la qualit de commerant, quen est-il de sa qualit lorsquelle exerce une activit
commerciale avec son conjoint ?
A cette question, il y a une rponse de principe larticle L121-3
La rponse de principe est claire. Le conjoint du commerant nest lui-mme commerant que sil
exerce une activit commerciale spare de son poux (se).
Le principe est que le seul fait de participer lactivit commerciale de son conjoint ne suffit pas
acqurir la qualit de commerant.
Il y a mme une sorte de prsomption dans L121-3, il y a une inversion de la charge de la preuve de
la sparation de lactivit commerciale.
Il faudra montrer charge celui qui veut tablir la qualit de commerant que son activit
commerciale est spare de celle de son conjoint.
Dans une entreprise commerciale donne exerce conjointement par les poux, lequel est
commerant ?
La Jurisprudence rpond de la manire suivante : Est commerant celui qui dirige et contrle
lexploitation. Il existe aussi un faisceau dindices comme limmatriculation au Registre du Commerce
et des Socits (RCS) par exemple. On examinera aussi qui est le propritaire du fond de commerce
(le propritaire sera le commerant). On regardera aussi celui qui effectue les payements, celui qui
tire les lettres de changes
Soit lhomme soit la femme peut donc tre considre comme conjoint du commerant. On note
tout de mme une certaine tendance de la part de la Jurisprudence attribuer la qualit de
commerant lpoux plutt qu lpouse.
Lapplication des critres ne tient en principe pas compte des sexes.
2 Les applications de principe la rgle de larticle L121-4 et suivants
Comment traiter le conjoint en droit ? Les articles L121-3 et -4 sont venus complter le rgime
juridique du conjoint du commerant, celui qui na pas la qualit de commerant mais exerce une
activit commerciale avec son conjoint.
Larticle L121-4 : Il y a une option prendre, celui qui exerce rgulirement une activit commerciale
auprs de son conjoint doit opter pour un statut, ntant pas commerant, il doit prendre une des
branches de loption suivante :
Soit le statut de collaborateur
Conjoint associ
Conjoint salari
Il fera alors lobjet dune publicit particulire du statut larticle L121-4 4
me
point. Mention faite du
choix du statut du conjoint du commerant.
Le conjoint collaborateur
Il sagit daccomplir un travail de manire subordonne sans percevoir de rmunration. La question
qui se pose est de savoir si pour bnficier du statut de conjoint collaborateur il faut tre mari. La
Jurisprudence a tendance rpondre que oui .
Mais les textes en parlant de conjoints posent le problme des couples non maris.
Cela dit larticle L121-5 parle de communaut qui nexiste que dans le mariage.
Cest largument patrimonial qui va primer ici. Cela concerne aussi bien le droit commercial que le
droit des rgimes patrimoniaux.
A priori le Pacs est exclu du rgime de collaborateur.
Linformation tant faite sur loption prise par le conjoint collaborateur, il dcoule un certain nombre
de consquences judiciaires.
Ainsi le conjoint collaborateur aux termes de larticle L121-6 est rput avoir reu du chef de
lentreprise commercial mandat pour effectuer des actes dadministration qui concernent les besoins
de lentreprise.
Cette prsomption de mandat emporte des consquences importantes sagissant des actes passs
par le conjoint collaborateur. Il agira aux yeux des Tiers en tant que mandataire commercial. En lieu
et place et pour le compte du conjoint commerant. Les cranciers peuvent agir sur le commerant
lui-mme au nom du mandat.
Il ne peut en tre autrement que si la prsomption lgale est renverse et la procdure de rvocation
du mandat est lourde. On ne peut mettre fin cette prsomption quavec une dclaration devant
notaire dans les conditions voques dans larticle 121-6 alina 2.
La rvocation de ce mandat nest donc opposable que sil y a eu dclaration notarie et terme il
faudra prouver que les Tiers avaient connaissance de cette rvocation.
En cas de sparation de corps ou de biens, ou en cas dabsence prsume la prsomption de mandat
tombe aux termes de larticle L121-6 alina 3.
Consquence juridique logique, et nanmoins apprhende par larticle 121-7, le conjoint
collaborateur est rput avoir accomplis ses actes pour le compte du commerant de sorte que le
conjoint collaborateur ne rpond pas personnellement de ses actes de gestion et dadministration
pour les besoins de lentreprise lgard des Tiers. On ne traite que des rapports entre le conjoint
collaborateurs et les cranciers. Dans les rapports du couple, le conjoint collaborateur peut tre tenu
comme responsable.
Les droits et obligation se traduisent surtout en matire de pouvoir de reprsentation de lentreprise
commerciale. Celui ntant pas commerant participe nanmoins lactivit de lentreprise.
Linscription du conjoint collaborateur au registre du commerce nemporte pas prsomption de
commerciabilit.
Le conjoint salari :
Le conjoint est partie un contrat de travail. Lemployeur tant en gnral la socit ou le conjoint
lui-mme, si lexploitation de la socit est sous forme sociale (L784-1). Ce texte est abrog mais
labrogation entre en vigueur en mars 2008. Il rendait les dispositions du code de travail applicable
au conjoint salari.
Une condition de fond pour reconnaitre la qualit de salari. Le salari doit participer effectivement
lexploitation commerciale, il doit sagir de sa profession habituelle et sa rmunration doit
correspondre au minima social en vigueur.
Existence du contrat de travail soustrait par elle-mme au conjoint la qualit de commerant : Lien
de subordination entre lemployeur et le salari. Le lien exclu par hypothse le critre du
commerant car il est indpendant par dfinition.
La difficult portera donc sur lexistence mme du Code de travail et notamment on pourra douter
du lien de subordination.
Consquence pour le conjoint salari, cest le bnfice de la protection sociale accorde tous les
salaris, lgislation sociale en gnral. La relation professionnelle est rgie par le code de Travail.
Le lien de subordination est difficile dfinir cause du fait que nous soyons devant des conjoints.
La Jurisprudence a assoupli la dfinition, et estime que le lien de subordination nest pas ncessaire
pour obtenir la protection sociale. Donc on sattache au critre formel : Le salariat.
Le conjoint associ
Lexploitation commerciale sous la forme dune socit entre poux est relativement rcente et date
du milieu des annes 80s. Les poux qui exploitent sous la forme sociale auront un statut dassocis.
Toutefois les statuts de la socit doivent prvoir la participation aux parts sociales de manire
galitaire.
Chacun des poux doivent avoir de manire similaire la participation aux gains et la mme
contribution aux pertes.
Trs souvent, les petites exploitations commerciales sont des SARL et il a longtemps t impossible
dapporter son apport en industrie aux SARL (jusquen 2001). Les associs peuvent apporter au fond
une comptence particulire : Un apport en industrie mais on peut aussi faire un apport en nature.
De la mme manire que pour le conjoint salari, les options faites au conjoint et les options du
statut de salari, ont pour consquences que les rapports sont rgis par les rgles de droit des
socits.
L121-4-2
me
: On limite lexercice de loption. Loption en faveur du statut du conjoint associ est
rduite par le code de Commerce selon deux considrations :
La qualit du commerant lui-mme, le conjoint qui exploite le fond de commerce
Le statut de conjoint associ est rserv certains types de socit. On voulait viter le
problme des SARL
Le vritable statut rglement par le droit commercial cest le statut de conjoint collaborateur. Ici
encore, cest loption la plus naturelle lexercice conjoint de lactivit commerciale.
Nanmoins, on peut imaginer que le conjoint peut ne pas avoir opt pour un statut. Quelle est sa
situation ?
Cest la Jurisprudence qui a dcid quil existait une qualit de co-exploitant. Ce nest pas vraiment
un statut mais une qualification par dfaut ( en fait cest le nom du conjoint dont la situation nest
rgle par aucune rglementation spcifique). Cest ce moment que va se poser la question de
qualit de commerant et de son attribution.
Le principe tant que la qualit de commerant est exclue sauf si le conjoint une activit spare.
Une dcision de justice : En dpit de larticle L121-3, accorde le statut de commerant des conjoints
qui exeraient aux cots de leurs poux. On ne sait pas expliquer cette Jurisprudence.
Certaines dispositions concernent le conjoint du commerant quelle que soit loption ou la non-
option, mesures de protection du conjoint du commerant, en particulier sagissant des biens qui
sont affects lexercice de lactivit commerciale. Cest larticle L121-5 : Cette rgle ressemble trait
pour trait la protection du logement familial.
Le consentement exprs c'est--dire formel du conjoint est ncessaire pour aliner ou grever de
droits rels dexploitation le fond de commerce qu'ils exploitent. Il faut que les biens en question
dpendent de la communaut. Le mot communaut renvoi au rgime matrimonial.
Sont galement viss une catgorie de droits personnels qui viendraient aliner lexploitation
commerciale : Le bail (acte de disposition).
Au droit rel soppose le droit personnel. Quand on donne bail (contrat permettant de jouir de la
chose, cest sur la personne, pas sur le bien que a porte), on cre des droits de type personnels. Le
droit personnel vient nanmoins peser sur la chose.
La sanction est prvue lalina 2 cest une action spciale, en nullit relative (elle ne peut tre
invoque que par une catgorie de personnes, protges par la rgle dont la nullit est oppose, la
nullit absolue peut tre invoque par tout le monde).
Laction en nullit est valable 2 ans compter du jour o le conjoint a eu connaissance de lacte. En
cas de dissolution de la communaut, on rgle les consquences patrimoniales donc le dlai peut
courir partir de la dissolution de la communaut.
On a born ce dlai pour protger les cranciers en limitant la possibilit dinvoquer la nullit.
Ce texte protge le conjoint qui travail en entreprise.
Section II : Limpossibilit dexercer le commerce
Cette impossibilit contrevient a priori un principe du droit franais (qui vient du droit intermdiaire
quon a conserv) : La libert du commerce et de lindustrie, cest une libert publique.
Toutefois on conoit facilement que lexercice de lactivit commerciale puisse tre born par la Loi.
Lactivit commerciale qui vise exercer des bnfices a un corolaire qui est le risque patrimonial. Ce
risque fait quil faut protger cette catgorie de personnes.
Cest pourquoi il y a des incapacits en droit commercial cause de la prise de risque particulire. Le
commerce repose galement sur le crdit qui repose quand lui sur la confiance.
Le commerant doit donc susciter la confiance, dans une certaine mesure, le droit doit se doter
dinstruments susceptibles dassurer la confiance. A linverse, certaines personnes ne sont plus
dignes de confiance. Elles sont donc inaptes lexercice du commerce. Le commerce leur est donc
interdit ou fortement limit.
1 Les incapacits
Lincapacit consiste soit dans linaptitude acqurir des droits soit dans limpossibilit de les faire
valoir soit mme.
Deux catgories de personnes sont concernes : Le mineur par principe et le majeur par exception
A) Lincapacit totale du mineur
Le mineur ne saurait acqurir la qualit de commerant mme sil est mancip. Le problme est
celui de la transmission de lentreprise commerciale par le biais successoral.
Un mineur devient propritaire ou dun fond de commerce ou par transmission successorale des
parts de la socit qui exploite le fond de commerce.
Cest problmatique car lexercice commercial lui est ferm donc il ne pourra pas exploiter le fond de
commerce de manire indpendante.
Lexploitation du fond de commerce devient impossible, donc le fond va cesser et le mineur perd ses
revenus.
La solution rside essentiellement dans le systme de la reprsentation qui nest pas sans difficult
admettre pour les mineurs. On agit au nom et pour le compte dautrui. Donc celui qui est engag est
le reprsent et non le reprsentant. Or le patrimoine du mineur est protg, donc la reprsentation
peut tre conue comme inadquate. Jusquen 1974, le mineur tait un incapable et ne pouvait pas
tre reprsent dans lactivit commerciale.
On a imagin diffrentes techniques qui visent assurer au mineur les fruits de son fond de
commerce : La technique de la location du fond de commerce, ou encore la possibilit de former une
socit avec un commerant.
Lassoci dune socit nest pas forcment commerant, cest la socit qui lest. Le reprsentant
lgal peut reprsenter le mineur dans une socit qui exploite le fond de commerce. Lassoci tant
celui qui va grer, exploiter le fond de commerce.
La sanction :
Cest la nullit de lacte pass au mpris des rgles de capacit, si un mineur passe un acte de
commerce, cet acte peut faire lobjet dune action en nullit, souvent par le reprsentant du mineur.
Cest une nullit relative car elle ne peut pas tre invoque par le cocontractant du mineur.
Cest une nullit relative mais son rgime est tout de mme assez stricte, la nullit tant convenue du
seul fait de la minorit, il nimporte pas que lacte soit lsionnaire.
On applique les prescriptions de droit civil qui est quinquennale (5 ans). On apprcie la minorit au
jour de la formation de lacte. Etant une nullit relative, elle est susceptible de confirmation, le
mineur disposant du droit de critique.
B) Les incapacits des majeurs
La rgle diffre car la protection est variable. Deux degrs de protection existent, la tutelle et la
curatelle.
La tutelle (mesure de protection la plus forte) est une technique qui rpond soit la dformation des
facults mentales, soit une faiblesse de type patrimonial. Dans les deux cas, on considre que le
majeur doit tre reprsent juridiquement. Le majeur sous tutelle ne peut jamais acqurir la qualit
de commerant.
Autant il y a un problme particulier vis--vis des Tiers, car lincapacit des mineurs peut tre juge
par le cocontractant, autant il ne peut pas forcment tre en mesure de savoir si son cocontractant
majeur est sous tutelle. Il sexpose donc un risque de voir son acte de commerce annul.
Une rgle de publicit a t mise en place, louverture de tutelle doit donner lieu une publication.
Le jugement de louverture de la tutelle est publi au Registre du Commerce et des Socits (RCS).
Cest une condition dopposabilit de la tutelle et donc pour que lon puisse sen faire valoir.
La curatelle est une mesure dassistance, une technique de protection moindre, car les troubles sont
moindres.
Un majeur sous curatelle peut tre commerant. Il ne fait pas cesser la qualit de commerant, a
condition que la personne concerne fasse lobjet dune assistance constante. Il arrive que le
curateur soit le conjoint.
Quelle est la sanction en cas de dfaut dassistance ?
Cest l encore une nullit de protection qui va jouer. L encore les mmes difficults que pour la
mise sous tutelle sont prsente voir encore plus. Le jugement de mise sous curatelle doit faire lobjet
dune publicit dans le Registre du Commerce et des Socits (RCS) sous peine dirrecevabilit des
actes commerciaux passs par lincapable sous curatelle sans assistance.
Il existe galement la sauvegarde de justice qui est une technique de sauvegarde temporaire. Dans
lhypothse dune maladie curable, dun problme mental ou physique qui empche
temporairement le commerant dexercer lactivit commerciale.
L encore une action en nullit est possible, mais cette fois pour les actes lsionnaires (dsquilibre
contractuel, prix de vente trop bas par exemple).
Il y a aussi une action spciale lors dun acte lsionnaire, cest la rescision qui aboutit soit la nullit
soit une rduction (rquilibrage du contrat).
Les interdictions partent du constat quil faut protger de lactivit de certaines personnes toutes les
autres. Les raisons pour lesquels on exclue certaines personnes sont diverses. Il y a des
incompatibilits, des dchances et des interdictions.
Les incompatibilits
Situation dans laquelle lactivit professionnelle dun individu ne peut tre en adquation avec
lactivit commerciale. Si lon met au centre de lactivit commerciale la recherche du gain, il y a
certaines professions, incompatibles avec lide mme de spculation, cest le cas pour les
fonctionnaires, les officiers ministriels (notaires, huissiers), cest galement pour toutes les
professions librales regroupes en ordres (mdecins, avocats).
Il y a un risque de conflit dintrt. La recherche dun gain, et de lautre cot viter les excs de la
recherche du gain.
Dun autre cot il faut signaler ici que cest une vision discutable. Si on conoit assez bien quil existe
des activits antinomiques, mais on ne peut pas ignorer que ces professions ont accs un march
dans le cadre de leur activit professionnelle. Le march est un phnomne concurrentiel dont lide
est le profit. Une rgle de conciliation est ncessaire. Sagissant des professions librales on a cr
une possibilit dexercer une profession librale sous la forme dune socit librale responsabilit
limite (SLRL).
Lide est celle de la conciliation, il faut des intermdiaires. Sinon cest de lhypocrisie (dire que le
gars quest avocat qui gagne 500 de lheure nest pas comme un chef dentreprise).
Or il existe des sanctions pour ceux qui exercent lactivit commerciale alors quils font partie dun
ordre. Il y a des sanctions disciplinaires. Il existe aussi une sanction lgale : La personne peut se voir
appliquer la qualit de commerant son dsavantage. Ca dsavantage la personne et ca protge les
Tiers. Le rgime est plus strict en droit commercial, donc cest peru comme une sanction.
La dchance
Cest quand une personne avait acquis la qualit de commerant et se voit contrainte dabandonner
cette qualit. En cas de fraude fiscale, le commerant est dchu par exemple, ou quand on a tendu
une procdure collective au patrimoine personnel du commerant (ltat de cessation de payement
rsulte dune faute de gestion du commerant).
La consquence est que lexercice du commerce est interdit au dchu et cela mme par
reprsentation. En gnral les dchances sont souvent accompagnes de sanctions pnales.
Les interdictions
Cest ltat dune personne qui lempche par principe daccder la qualit de commerant.
Diffrentes raisons justifient ces interdictions, le plus souvent il sagit de protection de lordre public
dans des matires particulirement sensibles (genre cabinet mdical). Linterdiction prend aussi une
autre coloration et est aussi sous couvert de lordre publique
Cela permet lEtat de contrler lactivit de lexercice commercial sur son territoire. Par le biais des
interdictions des activits commerciales, il est question dun certain protectionnisme tatique. Cest
le problme du commerce par les trangers. Nous sommes en plein dans le paradoxe du droit
commercial. Historiquement, lactivit commerciale est lactivit la plus a-nationale. Le critre de
nationalit accole lactivit na historiquement aucun sens. A lorigine, on trouve prcisment les
changes des marchands qui appartiennent diffrentes cites, en tout cas en droit romain,
lexistence dun droit des marchands, jus gentium tait partie de lide que les marchands ne
pouvaient accder aux droits civils, puisquils navaient pas la qualit de citoyen. A linverse,
nationalisme et interventionnisme tatique obligent, les interdictions du commerant en sont
corolaires. On trouve dailleurs aux articles L122-1, lorigine du commerce exerc par les trangers.
Ltranger voulant exercer la profession commerciale en France doit demander lautorisation au
prfet. Le non respect entraine des sanctions pnales, 6 mois demprisonnement et 300 damende.
Il y a une exception du fait de lexistence de la communaut europenne. Ca marche aussi pour
laccord sur lespace europen. (Abrog en 2006)
Lautorisation pralable est dsormais une dclaration.
Les commerants trangers, pour eux lvolution de la rglementation est mettre au parallle avec
lactivit conomique, plus la part de lintervention de lEtat sur lactivit conomique saccroit, plus
les restrictions lacquisition de la qualit de commerant par un tranger en France sont
importantes.
Aujourdhui on assiste plutt un dsengagement juridique de lEtat sagissant du contrle de
lactivit commerciale par les trangers.
On passe dune autorisation (pouvoir discrtionnaire du prince dautoriser ou non lexercice de
lactivit commerciale).
Aujourdhui avec la rforme du 24 juillet 2006, ltat conserve un contrle sagissant de la
rglementation en matire commerciale. On peut penser que la tendance trs rglementaire en droit
commercial est en train de sinverser pour passer la rgulation.
Ce nouvel article L122-1 : On passe dun systme dautorisation de lEtat, donc un refus motiv ou
non, et encore la motivation est propre lEtat, un systme de dclaration.
Ce changement de nature du contrle est rvlateur de la tendance que prennent aujourdhui les
droits. On passe dun contrle pris dans un sens actif (avec une intervention, choix orients), un
regard port sur lactivit commerciale mais il ny a plus de parti prit (cest une veille), cest lide du
monitoring . On porte une contrle mais il nest pas effectif, cest une rgulation et non une
intervention. La Loi se dote dinstruments pour organiser lactivit commerciale des trangers en
France.
On voit que la matire est assez difficile aborder comme un tout. La lgislation commerciale est
mme mlange un peut toutes ces questions.
Article L128-1 du code de commerce est une liste qui comprend les incapacits. Le principe est clair :
Impossibilit dexercice direct ou indirecte pour son propre compte ou pour celui dautrui, de diriger,
administrer, grer ou contrler, un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une socit commerciale.
La condition est quil faut avoir fait lobjet dune condamnation pnal dfinitive depuis moins de 10
ans pour des raisons comme la banqueroute, la fraude fiscale
Il y a galement un renvoi au code de la consommation. On trouvera aussi larticle L128-3 les
rciprocits.
Il nest pas ncessaire que les condamnations dans larticle L121-1 aient t prononces par une
juridiction franaise.
Il y a galement un principe de rciprocit, on interdit lexercice du commerce une personne
trangre qui aurait t interdit dexercice du commerce dans son pays.
A cela il y a une condition : Il faut que la dcision de justice trangre qui prononce cette interdiction
soit intgre lordre normatif franais, c'est--dire quil faut que cette dcision de justice trangre
ai force excutoire et pour ce il faut un exequatur (acte juridictionnel par lequel une juridiction
franaise reconnait le caractre juridique dune dcision juridique qui na pas t prise par la
juridiction franaise.).
Titre II : Le commerant, personne morale
Les socits se caractrisent par le fait quelles sont des personnes morales. Mme si nous parlons
dune personne morale, on retrouve les critres classiques de lacquisition de la qualit de
commerant mme si on ne se posera pratiquement jamais la question car les socits sont
commerciales par la forme.
Chapitre prliminaire : Remarques gnrales sur les groupements dont les socits ne sont
quune fraction.
En effet les personnes morales peuvent se dfinir comme des groupements de personnes ou de
biens. Ces groupements sont dots sous certaines conditions de la personnalit morale. On distingue
trois catgories de groupements susceptibles davoir la personnalit morale qui se traduit
concrtement par le fait quen tant que personnes, les personnes morales auront leurs patrimoines
propres.
Les catgories :
Fondations
Associations
Socits
Les fondations
Se caractrisent par le fait que cest des groupements de biens affects certaines activits dintrt
gnral qui peuvent intervenir sur le terrain conomique et qui sont parfois dots de la personnalit
morale. On affecte une masse de biens une activit dtermine.
Il faut ici voquer la question de la fiducie. Dsormais le droit franais connait la fiducie qui veut tre
un trust la franaise.
La fiducie est un contrat par lequel une personne quon appel le constituant transfert une personne
quon appel le fiduciaire des droits, des biens ou des surets, le fiduciaire tenant les biens transfrs
spars de son propre patrimoine (article 2011 du Code Civil).
La fiducie sert constituer une garantie (le fiduciaire est notre crancier et on lui met des biens dans
son patrimoine en garantie), ca peut aussi tre une technique de gestion ou de transmission
dentreprise.
Les conditions sont strictes, une personne ne peut pas faire lobjet dune fiducie.
Les associations
Groupement de personnes qui peut intervenir sur le terrain conomique, tant entendu que son
activit nest pas commerciale (pas de recherche de bnfices). But autre que lucratif
Les socits
Elles forment le cur de la commercialit des personnes morales. La socit repose sur un contrat
vis par larticle 1832 du Code Civil.
La socit est un contrat par lequel des personnes physiques ou morales conviennent daffecter
une activit commune des biens ou leur force de travail en vue de partager le bnfice de cette
activit ou de profiter de lconomie qui peut en rsulter.
Les parties au contrat de socit sappellent les associs et sengagent aussi par contrat contribuer
aux pertes de lactivit de la socit. Double engagement de la part des associs : Vocation aux
bnfices ou lconomie que doit procurer la socit mais aussi la contribution aux pertes.
Le pacte tant conclu, il donne naissance une personne morale, lorsque la socit est immatricule.
Ds linstant o une personne existe elle a un patrimoine. Donc ds immatriculation, la socit a un
patrimoine distinct de celui des associs.
On peut donc considrer que cest une technique daffectation de biens une activit donne.
Le principe est que les cranciers ne peuvent se payer quavec le patrimoine de la socit.
3 lments sont ncessaires la formation du contrat de socit :
Apport
Engagement de participer aux gains et de contribuer aux pertes
Affection societatis
Lapport
Acte par lequel un futur associ sengage transfrer des biens et des droits la socit une foi
quelle sera cre (souvent cest du fric). Lapport ne constitue pas uniquement en un bien ou un droit
rel. On peut aussi apporter son savoir faire. Donc lassoci sengage faire pour la socit. Donc soit
engagement de donner soit engagement de faire.
Or on estime quil existe trois types dapports :
Nature : On apporte un bien
Numraire : On apporte de largent
Apport en industrie : Cest un engagement de faire.
La runion de tous les apports forment le capital social venant remplir le patrimoine de la socit. Ce
patrimoine est le gage commun des cranciers sociaux.
Lengagement de participer aux gains et de contribuer aux pertes
Il est fonction des apports. Je contribue aux pertes (rpartition finale de la dette) et je participe aux
gains proportion de mon apport dans la socit.
Affection societatis
Cest lintention de se comporter en associ. Volont propre aux socits. Sagissant de la
constitution dun contrat de socit, les droits et obligations qui naissent sont dtermins entre les
apports (on ne fait pas une division par le nombre dassocis).
En contre partie de lengagement du contrat de socit, chacun des associs dispose dune crance
sur la socit que lon appel les parts sociales calcule en fonction de son apport.
Il convient de distinguer la socit et lassociation, puis la socit et lindivision.
Socit et association
Lassociation dun point de vue extrieur sapparente une socit, en effet cest un regroupement
de personnes et qui plus est cest un contrat entre plusieurs personnes qui mettent en commun leurs
connaissances et leurs activits dans un but commun. De manire semblable, il y a un engagement
dans un but commun, dans la dure et un certain intrt commun dans un but donn
Les gens dans une association sont socitaires et dans une socit sont associs. Cest une
tranget de la langue.
Le but de lassociation est forcment non lucratif. Cela dit une association peut faire des bnfices
(sinon comment elle assurerait son financement ?). On sintresse au sort des bnfices et de
laffectation des bnfices (si on les partage entre les socits ce nest plus une association mais une
socit). Cest lide du partage qui est prise en compte.
Socit et indivision
Lindivision a un caractre temporaire. Les indivisaires nont pas rellement un but commun, la
preuve, ils ne peuvent tre tenus de demeurer dans lindivision.
Lindivision sauf quand elle est conventionnelle ne repose pas sur un contrat, alors que la socit
repose toujours sur un contrat.
Une distinction trs importante tient labsence de personnalit morale dans lindivision alors que
les socits en ont une (du moins, la plupart, certaines nen ont pas et ressemblent fort lindivision).
Lindivision est une sorte de technique socitaire. On peut sen servir pour les hritages par exemple.
On peut aussi la subir, dans lhypothse dune cration dune SCI familiale qui est annule,
lindivision prendra sa place.
Lindivision est inadquate la socit mais il existe certains rapprochements.
Chapitre I : Le principe de dtermination des socits commerciales.
Un problme : La rglementation clate du droit des socits
Le partage entre les socits civiles et commerciales en est la cause.
La principale difficult vient du fait que la catgorie des socits civiles est une catgorie rsiduelle.
Seront civiles les socits qui ne sont pas commerciales, cest une catgorie par dfaut. On comprend
pourquoi : le but dune socit tant de faire un gain, lactivit spculative pouse le commerce.
Le problme qui vient projeter la confusion, cest le droit commun de toutes les socits qui figurent
au Code Civil, articles 1832 et suivants, solde minimum commun des socits. Cela tient une raison
historique car la socit telle quon la conoit aujourdhui repose sur le contrat du droit romain qui
est inclus naturellement dans le contrat de socits. Cest une catgorie sur lesquelles reposent les
socits, cest une catgorie civile.
Le fond commun de la socit est rglement par le Code Civil, et est un rgime spcial des socits
civiles. La socit cette fois ci en tant quopration, ce but tant commercial, cest donc dans le Code
du commerce que repose les rgles des socits commerciales, la catgorie de principe.
Nous avons dun cot le support juridique de la socit qui est une catgorie civile, dun autre cot,
nous avons une entit conomique qui est du ressort du droit commercial.
Les socits sont commerciales par la forme. Cest le critre principal. Elles le sont parfois et cest le
critre subsidiaire par leur objet.
En prsence de tel ou tel type de socit, on saura si elle est civile ou commerciale. L210-1 du Code
de commerce.
Sont commerciales par la forme quel que soit leur objet :
Socit en nom collectif
Socit en Commandite simple
SARL
Socit par action
Lactivit sociale sera rgie par lensemble du droit commercial, mme si lactivit est civile.
Pour le reste, il y a des socits commerciales qui le sont par leur objet. Cest rare. Il faudra examiner
lobjet social tel quil est dfinit dans le contrat de socit et lactivit effective proprement dite.
Exemple :
Les socits en participation, non commerciales par la forme dont le statut est rgit par le Code Civil.
Elles nont pas non plus la personnalit morale. Ce sont des socits purement contractuelles. Elles
peuvent tre cres pour faire des pools bancaires, la Cour de cassation a galement admis que lachat
en commun dun billet de loterie relve dune socit en participation.
Une distinction importante est galement celle des socits commerciales de personnes et de
capitaux.
Ces deux catgories rpondent une question :
Quel lment dtermine la socit ?
La personnalit des associs (personnes), ou les capitaux investis (capitaux)
Diffrence de rpercussions au niveau du rgime juridique, lment structurant diffrents. Pour une
part sociale, si ce qui importe dans la socit, cest linvestissement qui domine, on aura tendance a
avoir une attitude librale sagissant de la cession (cder) des parts sociales comme les socits
cotes en bourse.
En revanche pour les socits de personnes, puisque la considration de la personne est au cur, on
traitera de manire plus rigoureuse la cession des parts sociales.
Chapitre II : Les socits de personnes
La socit dans laquelle la part des personnes est prpondrante :
Les socits en nom collectif (SNC)
Les socits en commandite simple (SCS)
Les socits en participation
Les SARL
Les Socits en nom collectif (SNC)
Repose sur les articles L221-1 et suivants.
Les associs en nom collectifs ont tous la qualit de commerants et rpondent indfiniment et
solidairement des dettes sociales.
Donc tous les associs doivent pouvoir tre commerants (pas dinterdiction, incompatibilit ou
autre). Ici, ce qui est remarquable, cest que la socit ne fait pas cran, les associs sont tenus des
dettes sociales.
Ils sont tenus de (indfiniment) toutes les dettes que contractera la socit. Ils sont tenus
solidairement, donc tenus de la totalit de la dette vis--vis des cranciers (voir schma ci-dessus).
Cest une socit dangereuse. On ne peut pas sabriter derrire le patrimoine social. Il y a une
exigence dune mise en demeure pralable, acte formaliste, qui nest pas une simple lettre, sans cet
alina 2 les cranciers pourraient sadresser directement aux associs.
Dans une socit dans laquelle chacun est commerant et o chacun rpond de lintgralit de la
dette, on repose sur la confiance mutuelle des associs. Les parts sociales de la SNC dpendent de la
confiance entre les associs. Les parts sociales de la SNC dpendent de la confiance entre les
associs. Les parts sociales ne peuvent donc tre cdes quavec laccord unanime des associs
(rgime des socits commerciales de personnes)i.
Chacun des associs doit tre inscrit au registre du commerce au titre personnel donc il doit pouvoir
tre commerant.
Les SNC tant bases sur la confiance, elles ont plus de chance davoir des crdits, car le crancier
leur fera plus confiance car il sait que les patrimoines susceptibles de le dsintresser sont multiples.
La socit en commandite simple (SCS)
Tmoigne dune convergence dintrts. Elle runit deux types dassocis (L222-1) :
Commandits (outre les capitaux, ils offrent leur patrimoine comme gage commun aux
cranciers). Ils sont tenus solidairement de la dette de la socit. Ils ont le mme statut que
des associs en nom collectif.
Commanditaires (ceux qui apportent juste leurs capitaux). Ils ne sont tenus des dettes
sociales quen fonction de leur apport. Ils nengagent pas leur patrimoine personnel. Lapport
en industrie est exclu (en gros cest des riches qui font que mettre leur argent dedans).
En premier abord, le rattachement de la SCS aux socits de personnes peut paraitre discutable car
lide du financement dactivit (commanditaires) est importante ce qui la rend proche de la socit
de capitaux. Nanmoins, llment fdrateur est la convergence dintrt, la confiance mutuelle sur
lesquels repose la socit.
Cette confiance explique que les parts sociales de la SCS ne soient pas librement cessibles. Elles sont
cessibles lunanimit. Cest une rgle suppltive : Larticle L222-8, le choix des associs au contrat
est limit car il y a des rgles respecter. On distingue la cession des parts des commanditaires et
des commandits.
La socit en participation
Elle na pas la personnalit morale. Elle est purement contractuelle. Elle figure au Code Civil. Cest
une socit cre de fait, elle repose sur le mcanisme classique des socits. Socit cre de fait
rvle aprs coup, cest une socit qui signore (les associs nont pas eu conscience de crer une
socit).
On continue les diffrencier mme si le rgime juridique est le mme. La socit en participation
repose sur la confiance mutuelle entre les associs qui est souvent cre pour tre occulte (ne pas se
montrer la concurrence, ca peut tre une alliance entre socits). Elle nest pas immatricule, nest
pas publie, et na pas de patrimoine. Les associs sont donc tenus indfiniment et solidairement sur
leur patrimoine des dettes de la socit.
SARL
Il nest pas vident de la mettre dans la catgorie des socits de personnes. L223-1. La
responsabilit est limite.
Le patrimoine de la socit est engage (constitu des apports des associs). Les associs nengagent
donc pas leur patrimoine au-del de leurs apports dans la socit (ne peuvent pas perdre plus que
leur apport).
Lassoci de la SARL peut tre unique (un seul associ). La cration du patrimoine ressemble fort la
cration dun patrimoine daffection (feinte pou ne pas pouvoir tre saisit) qui est interdit en droit
franais.
En crant une SARL on met labri son patrimoine personnel.
Lassoci de SARL na pas la qualit de commerant.
De tous les points de vue, il est difficile de croire que cest une socit de personne. Son apport
compte mais il nest pas tenu des dettes de la socit, ce nest donc pas une socit de capital.
Surtout employ par les petites entreprises. Et on met ses biens labri (mais sous caution de
lassoci pour garantir la dette).
La cession des parts sociales de SARL nest possible quavec la majorit de la moiti des associs.
L223-14. Ca ressemble la cession des parts sociales des socits personnelles.
Corolaire de cette responsabilit limite cest la capacit de crdit plus faible. Lorsquon veut obtenir
du crdit, on fournit dautres garanties au crancier (comme sengager titre personnel
rembourser le crdit si la socit ne peut le faire, un cautionnement qui peut tre hypothcaire)
La libert des associs trouve une limite dans les crdits.
Chapitre III : Les socits commerciales de capitaux.
Deux formes principales :
Socits anonyme (SA). Leurs parts sociales sappellent les actions .
Socit en commandite par action
Ce sont des unions de capitaux, plus de personnes.
Les actions sont librement cessibles. Tout ce qui importe cest les capitaux, la surface financire de la
socit.
Celui qui a les moyens dacheter des actions acquiers plus de pouvoirs dans la socit do le
phnomne de pouvoir susceptible de changer.
Lide de souplesse prdomine ici, on veut faire voluer la socit, mais il y aura une tendance ce
que la majorit des actions aillent dans les mains de quelques actionnaires, donc les pouvoirs avec.
La responsabilit des actionnaires est lie leurs apports.
Lcran de la personnalit morale joue. Les actionnaires ne sont pas commerants.
Partie II : Les biens
La notion de biens, ici na pas grand-chose voir avec la dfinition du droit civil.
On entend les biens comme les moyens ncessaires lexploitation commerciale.
Certaines catgories de biens sont rserves lexploitation commerciale. Le fond de commerce par
exemple.
Dautres catgories de biens se prsentent de manire diffrente, exemple, le bail commercial, qui
techniquement nest pas un bien. Cependant, cest un bien au sens commercial.
Enfin, on trouvera parmi ces biens certains droits a priori plus accessoires mais qui sont aussi
ncessaires lexploitation commerciale et qui entretiennent une notion plus civiliste car cest une
proprit dbarrasse de la matire, proprit industrielle ou intellectuelle.
Il ne sagit pas des biens que lon connait en droit civil.
Titre I : Le fond de commerce.
Cette notion est passe dans le langage courant. Lide du fond de commerce nous renvoie un
certain nombre de situations concrtes (boutique, bureau de banque, usines).
Lide du fond de commerce tend intuitivement un lieu. Cest erron. Le fond de commerce est
exploit dans un lieu mais ce nest quun lment parmi dautres, de sorte quil faut thoriquement
rompre avec cette ide que le fonds de commerce renvoie un lieu.
Au dbut du XX, la Loi du 17 mars 1909 a propos une approche du fonds de commerce dont on peut
tirer une dfinition, ce nest pas le fonds de commerce lui-mme que la Loi aborde mais des actions
relatives ce fonds de commerce. Cest encore lapproche propose par le Code de commerce
Le titre 4, livre 1
er
du code de commerce : le fonds de commerce est abord au regard des oprations
dont il est lobjet.
Lapproche lgaliste du fond de commerce se situe comme un objet qui nest pas dfinit. Peut tre
que finalement lapproche lgaliste est la plus raisonnable, pragmatique, peut tre parcque le fond
de commerce nest pas dfinissable ou peut tre quil nest pas ncessaire la dfinition des
oprations relatives au fond de commerce.
Recherche dune dfinition :
Il faut une approche qui sollicite le code. Approche de lintrieure (presque introspective). Cest donc
une approche analytique.
Article L143-3 : Texte spcialis, indications qui concernent le fond de commerce.
Le fond de commerce peut se concevoir comme un ensemble de biens mobiliers corporels et
incorporels runis par un commerant en vue dacqurir et de conserver une clientle.
Cest une masse de biens affects un but particulier. Mais on trouve peut tre ici, en creux, la
possibilit daborder autrement la fondation du fonds de commerce.
Il existe aussi une approche synthtique, non pas en considrant le contenu mais son contenant.
Peut tre que lide de patrimoine fournit un modle, ne se confond pas avec son contenu.
La grande diffrence cest que le fond de commerce ne peut pas tre dfinit comme une universalit
de droits car il nest pas un patrimoine. Et pourtant, lide persiste, on a bien un ensemble de biens.
Il y a donc un ensemble qui nest pas une universalit de droits car il na pas de patrimoine et ne se
confond pas avec la personne physique du commerant. Cette ide persiste, on a bien un ensemble
de points. Il y a donc un ensemble car il ny a pas de personne. Cependant cette ide duniversalit
juridique a t prsente mme dans la Jurisprudence du XIXe sicle et pourtant, lutilisation de cette
personnalit juridique est regrettable car quivoque car elle laisse supposer que les lments qui
composent le fonds de commerce nont pas de valeur en soi, et les biens qui le composent nont pas
de nature particulire, chacun des lments du fonds de commerce conserve sa nature. Il ny a pas
(THALLER) dconomies propres au fonds de commerce. Peut tre que ce qui runit les biens qui
forment le fonds de commerce est peut tre davantage la volont dune personne plutt que le but
conomique de cette masse de biens qui runit le fonds de commerce.
La notion de fond de commerce est utile lorsquon veut faire des oprations juridiques avec. Leur
support est le contrat. En effet lunit de lacte de commerce ne prend forme que lors des oprations
juridiques. Si la volont est capable de dissocier, cela veut dire quil y a des lments qui peuvent
tre exclus du fonds de commerce, donc qui ne sont pas ncessaires) sa qualification de fond de
commerce.
Tous les lments du fonds de commerce ne se valent pas et ne sont pas toujours prsents dans le
fonds de commerce. De sorte que lon sest longtemps pos la question de sil ne se confondait pas
avec la notion de clientle.
Puisque cela ne se rduit pas la notion de clientle, alors on ne peut la considrer comme une
universalit de droits juridiques car ses lments ne sont pas homognes, il y a alors des lments
variables dans le fond de commerce.
Si cette universalit de droit existait, elle se dtacherait du commerant, comme le patrimoine
daffectation, or ce nest pas le cas. Le fond de commerce nest pas une personne juridique.
Si ce nest pas une universalit de droit, cest une universalit de faits. On conserve lide de
patrimoine sans les consquences de droit.
Cest comme un patrimoine sauf quil ny a personne sa tte.
Le fond de commerce est toujours un meuble incorporel.
Chapitre I : Les lments du fond de commerce
Larticle L141-5, lment corporel et incorporel
1 Le matriel et loutillage
A) La notion de clientles
Llment associ lactivit commerciale, est servant de cette activit. Il permet lexploitation
commerciale proprement dite (vhicules dune entreprise de transport, les coffres forts dune
banque).
Tout ce qui est ncessaire au commerce. Utilit pratique qui suppose quon linclut dans les fonds de
commerce. Il est utile de pouvoir traiter les biens comme une unit, un tout lors dun acte prenant le
fond de commerce pour objet.
Dautre part, une vision plus finaliste sagissant des biens corporels. Sils sont inclus dedans cest
quils sont ncessaires lactivit et ont permis au dveloppement de la clientle.
Conception qui permet de simplifier les oprations relatives au fonds. On va pouvoir cder en bloc. Il
ny a aura pas dactes juridiques spars dun fond dune part et des lments servant ce fond
dautre part. Similitude ici avec le droit civil et les immeubles par destination.
Do lintrt de les imaginer comme un tout (limites), mais il ne faut pas oublier que cest une
universalit de fait et de la dissociation de lerreur est possible do lutilit pratique, conomique.
Cest un lment du fond de commerce mais ne sy confond pas.
2 Les marchandises
Ce sont des biens meubles qui sont censs tre destins soit tre vendus en ltat ou soit aprs une
transformation destine une clientle.
Du fait de la dfinition, il est difficile distinguer avec la notion prcdente.
Ce nest pas la nature des biens qui permet de la distinguer mais cest la destination des biens qui est
le critre de distinction.
Celle-ci qui doit apparaitre dans lintrt du fonds de commerce un intrt direct, le matriel est
prsum stable et les marchandises instables.
Cest la notion des stocks. Les stocks sont variables par hypothse alors que le matriel ne lest pas
car ncessaire lexploitation des fonds.
Intrt dune distinction avec lide renouvele, en deux temps, sparation matrielle et
marchandise. Jusqu rcemment constitue dune garantie mais pas sur la marchandise elle-mme
du fait de leur stabilit : Nantissement.
Depuis peu, on peut non seulement constituer du crdit sur le matriel, mais aussi sur le stock. On
peut faire un gage sur le stock. La vocation circuler des marchandises nest plus un obstacle.
Article L527-1 et suivants a propos des garanties.
Cest un systme de gage sans dpossession mais il y a un droit rel constitu sur ces marchandises.
Comment a fonctionne ?
On considre les stocks comme un contenant, et on se moque du contenu. Donc la valeur se
reconstitue au fur et mesure de lcoulement des biens.
3 Les livres de commerce et la correspondance commerciale
Sagit-il dlments du fond de commerce et dans quelle mesure ?
Remarque :
La prsence de livres de comptes et de fonds de commerce comme lments peut sembler
anecdotique mais il ne faut pas les ngliger, ils sont lis la matire commerciale. Historiquement
elle est un facteur de constitution important du droit commercial.
Les livres de compte ont toujours une importance particulire dans la matire commerciale.
Larticle L142-2 : La vente du fond de commerce suppose que soient viss les livres de comptabilit
tenus par le vendeur durant les 3 derniers exercices comptables prcdent celui de la vente . il
faut galement viser le chiffre daffaire mensuel ralis entre la clture du dernier exercice et le mois
prcdent celui de la vente.
Ces livres font lobjet dun inventaire sign par les partis et donc un exemplaire est remis chacune
dentre elles.
Il sagit dune obligation de mettre disposition des livres de comptes lis la vente du fonds de
commerce. Davantage, il faut viser les documents comptables, en dresser un inventaire en double et
remis chacune des parties, procdure formaliste, bref une sorte dtat des lieux comptable. Ce qui
est obligation, cest un droit sinformer sur la situation comptable de la socit, durant les trois ans
de possession du fonds, cette obligation est substantielle au point que toute clause contraire est
rpute non crite.
Cest assez logique que ce soit linformation, objet du droit, il faut bien que celui qui a acquis le fonde
de commerce puisse tablir la situation comptable
4 Les immeubles
Ils peuvent tre destins lexploitation commerciale et pourtant, ils sont par principe exclus non
seulement du fond de commerce mais aussi du droit commercial. Par nature, il sexclue du droit
commercial car il nest pas amen circuler, de plus il relve du droit civil quil sagisse de cession,
de publicit etc.
Il est exclu du fond de commerce car ce dernier une nature mobilire et est incorporel. Un meuble
ne peut pas contenir un immeuble.
La question va se poser sagissant des immeubles par destination.
Il y a des immeubles par destination qui sont affects lactivit commerciale et sont pourtant
qualifis dimmeubles par destination, dans les armoires frigorifiques dune boucherie par exemple.
Du seul fait quils soient immeubles par destination on va les exclure du fonds de commerce. Ils
pourraient se rattacher par destination au matriel et loutillage, mais de par leur nature ils sont
immeubles et cest a qui lemporte.
A loccasion de la cession de commerce, il faudra cder les immeubles par destination par acte
spar.
Nantissement : Donner en garantie ses cranciers pour avoir un crdit.
Si on nantit le fond de commerce, sans disposition spciale, les immeubles par destination nen font
pas partie. Donc le crancier ne peut pas se servir dessus.
Le principe demeure donc avec toutes ses consquences.
Section II : Les lments incorporels du fond de commerce
Il ne porte que sur les lments du fonds numrs dans la vente et dans linscription, et dfaut
de dsignation prcise, que sur lenseigne et le nom commercial, le droit au bail, le client le et
lachalandage L141-5
Le dfaut correspond au minima.
1 La clientle et lachalandage
Achalandage : Ce sont des personnes de passage attirs par lemplacement du fond de commerce et
qui ne sy fournissent que de manire occasionnelle.
La clientle se distingue de lachalandage avec le lien quil existe entre elle et le fond. Elle y est lie
par les habitudes, les horaires, ou encore, par la confiance. Le lien peut aussi tre plus fort, il peut
tre juridique : Cest le cas des clients lis par contrat dapprovisionnement et qui sont parfois eux
mme des commerants.
La clientle et lachalandage se trouvent runis lorsquon voque le fond de commerce, et forment
lensemble des personnes qui se fournissent chez le commerant ou qui utilisent ses services.
La clientle est en fait des personnes, mais cest aussi une valeur, et cest dailleurs ce qui fait la
valeur commerciale. De ce point de vue, la clientle est un lment essentiel du fond de commerce
pris du point de vue de luniversalit de fait. La clientle est la condition de la valeur conomique du
fond.
Dun autre cot, le fond de commerce, sil nest rien sans clientle, se donne aussi pour but,
lacquisition, la conservation, le dveloppement de sa clientle.
La perspective change un peu, le fond de commerce na plus la clientle comme lment car il se la
donne pour but.
la valeur du fond serait donc la propension dun fond conserver et acqurir une clientle.
Selon quon adopte lun ou lautre point de vue, vu que ce qui forme la valeur nest pas la mme
chose, le contenu du fond de commerce va compltement varier.
La clientle donne sa valeur au fond de commerce. Mais dans un cas on dit que la clientle est un
lment du fond de commerce, dans lautre cas on dit que ce nest pas un lment mais un but.
Si cest un but, ce nest pas la clientle elle-mme qui donne sa valeur au fond mais la propension de
ce dernier la dvelopper, la conserver.
Donc selon quon adopte lun ou lautre point de vue, le contenu du fond de commerce va
compltement changer :
Dans le premier cas, la clientle est un objet, donc dans lvaluation du prix, il faut apporter
des lments pour prouver que la clientle existe. Donc la clientle va jouer sur le prix mais
aussi dans lobligation de dlivrance (sil ny a pas de clientle quand lacheteur acquiert le
fond il pourra assigner le vendeur en lui disant quon lui a vendu une clientle alors quil ny
en a pas)
Dans le second cas, on examinera les potentialits du fond, dans la capacit du fond
gnrer du chiffre , et cela conditionnera sa valeur et pas la clientle elle-mme. On dira
que tout est fait pour que ca marche (belle enseigne, vendeuses avenantes, cest joli, bonne
comptabilit).
L lacheteur ne pourra pas assigner le vendeur sil na pas de client. Il faudra quil prouve
que le fond ntait pas propre conserver une clientle ou lacqurir (si on lui avait vendu
en disant quil le pouvait).
Les consquences peuvent tre radicales
Premier point de vue : Cest la position presque naturelle, la position la plus simple. La
clientle et lachalandage est un lment essentiel et presque suffisant. On peut donc
considrer que le fond peut exclure tous, ou du moins certains, lments du fond, car il y a
une clientle donc le fond de commerce existe.
A linverse, pas de clientle, pas de fond de commerce, on pourra avoir des machines, un
emplacement merveilleux, on naura pas de fond de commerce.
Donc la prsence dune clientle ou dachalandage suffit lacquisition dun fond de
commerce, mme dfaut dautres lments. A linverse, le dfaut de clientle ou
dachalandage exclu le fond de commerce.
La Jurisprudence va dans ce sens La clientle est la condition essentielle lexistence dun
fond de commerce (voir la Jurisprudence de larticle L141-5).
La doctrine a t force de remarquer que la clientle pouvait tre un but de fond de commerce. Car
en droit il est impossible de considrer la clientle comme lment du fond de commerce : On ne
peut pas vendre de gens.
La clientle est donc une fin et non un moyen. La clientle justifie laffectation de biens au fond de
commerce.
Second point de vue : Il peut y avoir un fond de commerce sans clientle. Celle-ci ne peut
pas suffire la fixation de la valeur dun fond de commerce.
Pour que lon puisse envisager quon puisse transmettre autrui quelque chose qui en droit porterait
sur la clientle comme lment dactivit commercial on pourrait imaginer quil y ait quelque chose
cder en rapport la clientle condition quelle ne soit pas civile.
Si la clientle est civile, on peut considrer quelle est attache la personne qui exerce lactivit et
prcisment, la clientle ne pouvait pas faire lobjet dune cession, alors quon a toujours parl de
cession de clientle (mdecins, avocats) alors en droit civil, selon larticle 1118, annulation de ce
type de convention.
En Jurisprudence, on a dit que la convention tait sauve si on ne vendait pas la clientle mais la
prsentation de cette dernire.
Cest la mme chose dite autrement.
On peut parler de manire ce que la condition de la libert de choix des clients soit respecte.
Ce problme ne se posait pas en matire commerciale, car on pouvait cder le fond de commerce,
donc on englobait les cessions de clientle dans les fonds de commerce.
Daprs THALLER, la clientle est juste un lment servant dterminer la valeur du fond dans le but
de le vendre.
Peut tre que la question des clientles civiles venue de la distinction entre droit commercial et civil
est venue polluer le raisonnement. La Jurisprudence civile a adopt un raisonnement rationnel.
Du coup, la divergence de traitement juridique (civil vs commercial), ce qui nous intresse cest de
savoir quelle sest attnue.
Il ny a plus distinguer fondamentalement la clientle civile et commerciale, de sorte que tout cela
se met au service de notre premire conception, comme lment du fonds de commerce.
Deuxime degr daffinage (on reste dans loptique de la vente).
Le caractre personnel de la clientle, c'est--dire lide selon laquelle la clientle est bien attache
au fond dont il est question.
Un problme se pose chaque fois quune activit commerciale se dveloppe dans une enceinte plus
large que le seul commerce dont il est question, ou chaque fois que lon se trouve dans un rseau
de distribution, o le commerant revend le produit dune marque.
Il vient chaque fois quil y a intgration gographique ou juridique de lactivit commerciale.
Y a-t-il une clientle personnelle, attache au fond dont la vente est envisage.
Est-ce que le McDo a une clientle propre au fond, les gens sont ils attirs par le fonds ou la
marque ?
Ainsi, un arrt dassembl plnier de 1970 vient jeter le trouble. Lactivit tant exerce dans une
enceinte qui dpasse lactivit litigieuse, et il ne sagit pas dexploiter une clientle propre mais celle
dautrui. Ainsi les exploitants de la buvette nont pas de clientle de distincts de celle du champ de
course. Il ny a donc pas de fond de commerce.
Arrt de la 1
re
chambre civile du 27 Fvrier 1973 : La Cour de cassation considre que le 1
er
grant
libre de la station service (qui vend les produits dun ptrolier dune certaine marque) ne trouve
aucune clientle son entre en jouissance du fond et na donc jamais acquis la proprit dun fond
de commerce car aucune clientle attache au fond navait t cre. Pas de clientle, pas de fond
de commerce.
Puis linterprtation sest attnue. On a considr quun franchis (celui qui vend les produits dun
franchiseur : Le patron dun McDo) pouvait se lier une clientle lorsque celle-ci a t attire au fond
par un lment li la personnalit du grant (organisation dun karaok tous les vendredis soirs).
Linterprtation a encore volu de manire assez radicale. Au dbut des annes 2000s, la Cour de
cassation a considr que le fond de commerce existait partir du moment o lexploitant assume
personnellement la charge des risques de lexploitation. Ce faisant, la Cour de cassation labore une
distinction :
Il y a une clientle nationale attache la marque et une locale qui nexiste que du fait des moyens
mis en uvre par le franchis. Cette clientle (locale) est cre par lactivit du franchis avec les
moyens quil a contract titre personnel mis en uvre ses risques et prils . On met au centre de
cette interprtation les risques de lexploitation. Ces risques sont pris pour dvelopper lactivit
commerciale.
On a remis au centre du dbat les lments de la qualification du commerant.
La question est donc de savoir si lactivit commerciale permet de gnrer une clientle. Cest bien la
seconde interprtation dont on sapproche ici.
Arrt du 27 Mai 2003 : La Cour de cassation admet que peut tre rapport la preuve dune clientle
propre. Il nest pas ncessaire que cette clientle propre est prpondrante (on peut exploiter la
clientle dautrui et avoir une clientle propre).
Ce nest plus la clientle personnelle qui est le critre mais le risque patrimonial. La constitution de
clientle est le corolaire des risques pris. (Dun cot, un risque, de lautre, une cration de richesse :
Cest la base du commerce).
On peut avoir deux conceptions de clientle : Soit cest un lment essentiel, soit cest un but du
fonds de commerce. Linterprtation navigue entre ces deux ples avec une tendance vers la
deuxime conception. Mais il ny a pas de vrit.
La clientle et bien lessence du fond de commerce en tant quuniversalit de fait. Mais il nya pas de
droit cr sur la clientle. Mais la clientle tant un but pour le fond de commerce, on na pas
vraiment dincompatibilit. La question est de savoir si lon sattache au but (clientle nest pas un
lment proprement parl mais sa raison dtre) ou la volont. Une position intermdiaire est
concevable.
B) La protection de la clientle
Une action en responsabilit : Action en concurrence dloyale. La clientle est traite comme une
chose en fait mais en droit ca ne peut pas tre une chose. Cette non chose quest la clientle peut
faire lobjet dune protection. Protection effectue par une action gnrale car ce sont des atteintes
la libert du commerce et de lindustrie qui forment le terrain de la clientle. La clientle est
protge par larticle 1382 du Code civil. Le principe gnral en droit franais. Ici on attache laction
en concurrence dloyale larticle 1382.
Lide est quil y a une atteinte et un prjudice, lide quil y a une atteinte la libert du commerce
et de lindustrie. Est dloyale la concurrence qui ne respecte pas la libert du commerce et de
lindustrie, et il est possible dinvoquer larticle 1382.
Quel est le but de cette action ? Cest une action en responsabilit et elle a pour but la rparation
dun prjudice qui peut tre dfini comme la lsion dun intrt protg. Laction a pour but
dobtenir des dommages et intrts. Le succs de laction est subordonn 3 conditions :
Faute : Employer des moyens illicites (contraire aux Lois) ou dloyaux (contraire aux usages
du commerce), ces moyens sont mis au service dun but, dtourner la clientle dautrui en
crant par exemple une confusion dans lesprit des acheteurs.
Exemple : Sappeler Coco cola et vendre du soda
Un prjudice : Soit le dtournement est effectif, soit il nest que potentiel mais qui
reprsente un risque que lon peut quantifier, on le mesurera sur le chiffre daffaire. On
montre la perte subie ou un gain manqu.
Une relation de causalit : La faute doit tre lie au prjudice. Il faudra donc tablir devant
le juge le rapport de causalit entre les fautes et le prjudice. Par exemple prouver que la
baisse du chiffre daffaire d au dtournement de clientle.
On se souviendra que la preuve incombe au demandeur. La sanction ne se limite pas aux dommages
et intrts, il peut y avoir des interdictions de commerce et des mesures de publicit de jugement
(cest la pire celle l).
Voila donc la premire technique de protection de clientle. Mais le problme cest quil faut quand
mme avoir dj reus un prjudice.
De plus comme toute action en justice, elle est conditionne par un ala, il y a un risque de perdre,
on ne sait jamais comment ca va tourner. En fait cette protection nest efficace que lorsque laction
en justice russit. De plus cela dpend du montant des dommages et intrts qui eux dpendront de
largumentation des parties.
Il y a donc des incertitudes et il faut essayer de se prmunir contre les atteintes la clientle, contre
la concurrence.
Laction peut tre exerce collectivement, par une organisation professionnelle (article L470-7).
Cela nous amne la protection conventionnelle. On rappelle que la concurrence en elle-mme est
souhaitable et donc lgale, de plus elle est protge par le droit de la concurrence. Pour se prmunir
de la concurrence dloyale, on peut faire une clause particulire que lon appelle la Clause de non
concurrence : Cest une stipulation par laquelle lune des parties sengage exercer une activit
distincte de celle de lautre personne.
Le lieu privilgi de ce genre de stipulations cest le contrat de travail et cest une obligation de ne
pas faire qui nait au moment o le contrat de travail est rompu. On peut galement le trouver dans
les baux commerciaux, on peut insrer dans le bail commercial une clause de non concurrence.
Une telle clause qui limite la libert du commerce doit tre strictement limite. Il y a un certain
nombre de rgles dfaut desquelles la clause peut tre annule.
Il y a 4 conditions.
La clause de commerce de non concurrence doit tre limite dans le temps. Parcque lon ne
saurait sengager perptuit. Un engagement perptuit est illicite car cest de
lesclavage.
Il faut une limite dans lespace. On le limite une ville par exemple
Le type dactivit doit tre prcisment dfini. Il ne doit pas tre trop vague.
Il faut que la clause soit proportionne lobjet du contrat : Cest le plus important, il y a
une exigence de proportionnalit. On attribue un pouvoir au juge, cest une sorte de
condition subsidiaire.
Exemple : Pourrait tre disproportionne la clause suivante :
Jexerce une activit de traiteur italien, je cherche un local plus grand donc je donne bail
celui que jai, et je cre une clause stipulant que toute activit en rapport avec la restauration
serai interdite. Cest disproportionn. Ca serait disproportionn aussi si jinterdisais la vente
de cannes pche.
Cela dit cest le juge qui une marge dapprciation, des lments de Jurisprudence ont
stipul quil ne faut pas une atteinte excessive (sinon cest nul).
Cette condition module les autres. Cest la marge dapprciation qui est importante. Mais ne
serais ce pas dangereux dinsrer une clause de non concurrence ? Comment savoir si cest
excessif ?
Le bon pre de famille nabuserait pas, il sait se tenir
On peut galement rpondre quil faut garder lesprit quil ne faut pas prouver que cest
proportionn, il faut juste ne pas sexposer la disproportion (rendre la preuve plus difficile).
En droit commercial, il nest pas ncessaire que la clause de non concurrence donne lieu une contre
partie financire dans les contrats commerciaux. En revanche, pour ce qui est du droit du travail, la
clause de non concurrence doit comporter une contre partie financire. Cest donc une condition
supplmentaire.
Il y a un risque de nullit si toutes les conditions ne sont pas respectes.
2 Certains droits de proprit industrielle et commerciale
L141-5 du code de commerce. Il y a encore des lments incorporels en plus de la clientle et de
lachalandage.
Le droit au bail : Cest un lment du fond de commerce. Cest une vidence puisque les
murs ne font jamais partie dun fonds de commerce. Les droits rels dont disposerait une
entreprise commerciale ne font pas partie du fond de commerce. Pourrait donc faire partie
du fond de commerce le droit de jouissance exerc sur limmeuble dans lequel est exerce
lactivit commerciale. Cest un droit personnel. Il y a donc une crance de jouissance sur les
lieux lous par le commerant afin dexercer une activit commerciale.
Droit personnel mais le rapport entretenu avec la personne et le lieu est tellement important
quon a donn un nom particulier ce droit de crance de jouissance sur un local, on
lappelle la crance sur la proprit commerciale.
Donc lorsque les parties nont rien convenu sur le fond de commerce, le droit au bail en fait
partie. Mais le fond de commerce peut en pratique se rduire peu de choses. Sagissant du
droit au bail, il faudra distinguer. Si de manire suppltive cest bien un lment de plein
droit dans le fond de commerce, les parties peuvent y droger. Ce nest pas un lment de
plein droit dans le fond de commerce. Le fond de commerce peut exister sans droit au bail.
La Jurisprudence est constante sur ce point. On distinguera selon limportance de la
localisation pour lexercice de lactivit commerciale. Plus la localisation importe plus on aura
tendance inclure le droit au bail dans le fond de commerce.
A) Le droit au nom commercial
1. La notion de nom commercial
Cest une appellation sous laquelle un commerant exerce son activit. Le choix du nom commercial
est libre. On peut utiliser son nom, prnom ou pseudonyme. Le problme nait lorsque le nom utilis
est un nom de famille parce qualors un mme objet, le nom, se trouve soumit deux sortes de
rgles : Le droit civil et commercial.
Le nom est dabord rgit par un corps de rgles qui rgit ltat des personnes, faut il le soustraire au
droit civil pour le mettre dans un droit distinct ?
Les rgles civiles et commerciales sont antinomiques (incompatibles, opposes). Les lments lis
ltat des personnes ne peuvent tre cds ou saisis.
Comment alors appliquer ces rgles un objet commercial qui a vocation circuler ? (on est toujours
dans loptique de la vente du fond de commerce).
Le nom fait partie du fond commercial, mais comment vendre le nom en droit commercial puisquil
nest pas cessible en droit civil.
Si on fait prvaloir le nom de famille, il ne peut pas suivre le fond de commerce dans la vente, si on
fait prvaloir le nom de commerce, on pourra laliner et en faire usage.
On ne tranchera pas cette situation. On appliquera les rgles du droit civil, mais on considrera qu
un moment donn, le nom se dtache de la personnalit. Il y a une cohabitation juridique.
Aprs tout, il y a bien plusieurs personnes qui ont le mme nom, alors pourquoi empcher un
commerant de donner son nom la personne morale de sa socit. Utilis comme nom commercial,
le nom se dtache de la personne. Il cesse dtre un nom de famille.
Sagissant des personnes morales, le nom commercial sappelle la raison sociale.
La dtermination de la raison sociale est parfois rglemente, ainsi dans le cas des socits de
personnes, la raison sociale doit forcment comporter le nom des associs.
Le choix du nom commercial doit respecter certaines rgles. Il joue une fonction dindentification. Le
nom ne doit pas tre trop gnral sinon il ne pourrait pas tre cd. (Ex : Un magasin de meubles qui
sappelle meuble). Quand le nom est trop gnrique il ne peut plus tre cd avec le fond de
commerce.
Le nom commercial ne doit pas tre de nature tromper, il ne doit pas tre dceptif. On pourrait
alors contester le choix du nom commercial (Dlice dOrient qui vendrait des chaussettes).
Enfin le choix du nom commercial ne doit pas troubler lordre public et ne doit pas tre contraire aux
bonnes murs.
2. La protection du nom commercial
Action en concurrence dloyale. Elle sest affine jusqu devenir presque spciale. Le Jurisprudence
a impos des conditions particulires qui en font presque une action spciale. Cest toujours de la
mme action quil sagit. On a pour but principal lobtention de dommages et intrts. Mais laction
en concurrence dloyale a des conditions propres.
Le nom usurp doit tre un nom original. A priori les noms gnriques sont exclus
Le nom usurp doit avoir une notorit suffisante. On peut imaginer que cette condition
pallie la condition prcdente bien quen thorie elles soient cumulatives (tu prends un nom
commun mais trs connu, laction est ouverte).
Il ny a pas de solution de principe. Le droit nest que rarement un catalogue de solutions. Par
largumentation, il faut montrer la confusion sur la clientle.
Si le nom a une notorit hors du commun, la vraie question est de savoir si le risque de confusion
est une concurrence dloyale (confondre le Chanel des parfums, et chanel volaille mouais).
Cest dlicat car on touche dune part la question du nom de famille (ce nest pas si simple que a, on
ne peut pas tout interdire ou tout autorit), dautre part la question notorit du nom est relative,
difficile cerner.
B) Le droit lenseigne
Lenseigne est un lment dindividualisation. Lenseigne peut tre une instruction, une forme, une
image, un signe qui ont en commun dtre apposs sur un immeuble comme se rapportant une
activit exerce dans cet immeuble. Deux possibilits pour la composer.
Soit le nom commercial : La protection se fait sur le terrain du nom commercial.
Soit cest distinct du nom commercial : Logo, Forme, Dessin. La protection de lenseigne se
fait par le biais du droit de proprit. Le propritaire du fond de commerce est aussi
propritaire de lenseigne.
Sagissant de la protection de lenseigne lorsque celle-ci nest pas le nom commercial, il ne sera pas
ncessaire de recourir laction en concurrence dloyale. On pourra agir sur laction sur atteinte au
droit de proprit. Cela dit rien ninterdit de porter le litige sur le terrain de la concurrence dloyale.
C) Le droit de proprit portant sur des lments incorporels
Quel est le rgime des crances et des dettes relatives lexploitation du fonds de commerce. Les
dettes et les crances sont des droits personnels ns loccasion de lactivit commerciale, et de ce
fait qui sont lis au fonds.
La question ramne au patrimoine. Mais le fonds de commerce est une universalit de fait, on
raisonne comme sil a un patrimoine, mais en droit il na ni la personnalit morale ni de patrimoine.
Les dettes et les crances sont donc dans le patrimoine du commerant ou de la socit.
Il y a un obstacle irrductible la transmission des crances et des dettes. Le transfert du fond de
commerce nemporte pas lui seul la transmission des crances et des dettes.
Il y a des inconvnients pratiques : Lactivit de ses fournisseurs est une condition parfois essentielle
du dveloppement de la clientle du fond de commerce (on ne se place pas dans loptique de la
franchise). Les crances ne sont pas reconduites automatiquement lors de la vente dun fonds de
commerce.
Si on admettait le patrimoine daffectation, la socit intgrerais le patrimoine du fonds de
commerce donc le fond de commerce naurais rien dans son patrimoine . Cest un inconvnient
thorique.
Dun autre cot, labsence de transmission des crances et des dettes, lors de la transmission du
fonds de commerce, laisse libre lacqureur de tisser ses relations commerciale. Dj il nest pas tenu
dun point de vue financier, et il peut donc crer son propre rseau. Cest un avantage pratique. De
plus on ne se trouve pas dbiteur des dettes du vendeur.
Si on souhaite continuer les relations avec le fournisseur il faut faire la cession de crance et mme
la cession de contrat. Cela peut tre la solution pour que la reprise fonctionne. Il faudra cder les
contrats au cas par cas de manire accessoire au fond de commerce.
Ce principe des crances et des dettes comporte des exceptions. Il y a des contrats qui sont
automatiquement cds (Ex : Le droit au bail, et aussi les contrats de travail (L102-12 du code du
travail), cest une transmission de plein droit dans le souci de protection des salaris, il y a galement
certains contrats dassurance qui sont transmis de plein droit dans un souci de protection de tiers
pendant la priode ou la socit inquisitrice na pas encore souscrit ses propres assurances , il y a
aussi les abonnements, les autorisations aux licences dexploitation).
Chapitre II : Les oprations relatives au fond de commerce
Section I : La cession du fond de commerce
La cession du fond de commerce : Commentaire des articles 141 et suivants du code de commerce.
Cest une vente ayant pour objet un fonds de commerce (en droit vente = cession). Parce que cest
une vente, certains lments relvent du droit commun de la vente figurant au Code Civil. Certains
textes du code de commerce y renvoient directement.
Dans le code commerce, lacte de vente est pris au sens instrumentaire.
L141-1 : I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie
mme sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en socit d'un fonds de
commerce, le vendeur est tenu d'noncer :
1 Le nom du prcdent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette
acquisition pour les lments incorporels, les marchandises et le matriel ;
2 L'tat des privilges et nantissements grevant le fonds ;
3 Le chiffre d'affaires qu'il a ralis au cours de chacune des trois dernires annes d'exploitation,
ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploit depuis plus de trois ans ;
4 Les bnfices commerciaux raliss pendant le mme temps ;
5 Le bail, sa date, sa dure, le nom et l'adresse du bailleur et du cdant, s'il y a lieu.
II. - L'omission des nonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acqureur forme
dans l'anne, entraner la nullit de l'acte de vente.
Dans le I, on sait dj qu cet instant le texte traite des conditions de forme. Il importe peu que
lacte en cause ne soit pas directement une cession du fonds de commerce, quil soit laccessoire
dun autre contrat.
Cet article applique le mme rgime juridique du fond de commerce que pour lapport en socit. Le
vendeur est formellement tenu dun certain nombre dnonciations. Le II dtermine la sanction.
En cas de cession de commerce, quel que soit lacte, il y a un certain nombre dnonciations dfaut
desquelles la nullit est encourue.
Cest une nullit et une nullit relative.
Cest donc comme si lacte navait jamais exist en droit. Cest la sanction qui frappe un acte
juridique irrgulirement form.
Laction en nullit tant relative, elle ne peut tre exerce que par certaines personnes. Ici cest
lacqureur uniquement qui peut invoquer la nullit. Cest une nullit relative aussi parce que cest
une possibilit. Elles sont susceptibles de confirmation, dfaut daction de celui qui peut invoquer
la nullit, la situation se prennisera en droit.
La demande en nullit est prescrite en un an. Cest une action de forme, cest pour a que le dlai est
trs court. Le dlai court partir de la date de conclusion de la cession.
Ce nest pas une nullit automatique, de plein droit. Le juge dispose dune marge dapprciation.
Le 1 nonce lhistorique du fond de commerce
Le 2 nonce que le vendeur doit faire connaitre lacheteur les droits quont acquis les tiers
sur le fond de commerce.
Le 3 nonce laspect conomique de lexploitation du commerce qui doit tre mentionn.
Cest le Chiffre daffaire.
Le 4 nonce la mention des bnfices commerciaux pendant la priode du chiffre daffaire
Le 5 nonce les informations relatives au bail
La liste est limitative (il ny a pas le mot notamment dans la liste ce qui aurait voulu dire quelle
ntait pas limitative). On ne pourra pas exercer laction spciale de larticle 141-1 pour dautres
raisons.
L141-2 : Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilit qui ont
t tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables prcdant celui de la vente, ce
nombre tant rduit la dure de possession du fonds si elle a t infrieure trois ans, ainsi qu'un
document prsentant les chiffres d'affaires mensuels raliss entre la clture du dernier exercice et
le mois prcdant celui de la vente.
Ces livres font l'objet d'un inventaire sign par les parties et dont un exemplaire est remis
chacune d'elles. Le cdant doit mettre ces livres la disposition de l'acqureur pendant trois ans,
partir de son entre en jouissance du fonds.
Toute clause contraire est rpute non crite.
Obligation qui porte sur des documents comptables (ce nest pas les livres de comptes, cest
linventaire). Cest une obligation de mise disposition et non de remise.
On ne peut pas y droger. Toute clause insre dans un contrat de cession de commerce contraire
cet article serait considre comme nulle.
Article L141-3 : Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie
raison de l'inexactitude de ses nonciations dans les conditions dictes par les articles 1644 et 1645
du code civil.
Les intermdiaires, rdacteurs des actes et leurs prposs, sont tenus solidairement avec lui s'ils
connaissent l'inexactitude des nonciations faites.
Le vendeur nest pas responsable mais doit garantir lacheteur raison de linexactitude de ses
nonciations dans des conditions similaires celles du code civil. Nous sommes toujours dans le
rgime des obligations.
En cas de dfaut des dnonciations il y a laction en nullit.
Linexactitude est sanctionne par laction en garantie contre les vices cachs. On ne peut pas
droger lobligation dexactitude des nonciations prvues larticle L141-1.
Larticle 1644 du code civil donne une option tout acheteur en vice cach.
Soit il rend la chose et se fait restituer le prix.
Soit il peut se faire restituer une partie du prix et conserver la chose
Le rgime de cette action est assez complexe. Notamment, la Jurisprudence est trs difficile
comprendre. Il faut montrer, pour le succs de cette action, que lon subit un prjudice (cest une
aberration juridique), il faut montrer en fait le caractre rdhibitoire du vice (que le vice rend la chose
impropre son usage). Un vice cach qui amliorerait la chose nentrainerait pas la restitution dune
partie du prix.
Larticle 1645 du code quand lui permet dobtenir des dommages et intrts supplmentaires
lorsque le vendeur tait de mauvaise foi, c'est--dire quil connaissait les vices de la chose.
Donc ici, le vendeur en cas dinexactitude sexpose une rduction du prix.
De plus, les intermdiaires, les rdacteurs dactes et leurs prposs (notaire, avocat) sont tenus
solidairement avec le vendeur sils sont au courant de linexactitude. Ce nest pas une hypothse
dcole.
Le texte ne renvoi pas formellement L141-1. Donc autant ces dernires pourront en cas
dinexactitude amener une rduction du prix, mais toutes les nonciations du contrat peuvent y
amener.
L o toute action en nullit tait limite dans larticle L-, en revanche, laction en rduction des prix
ne lest pas.
Ce texte pose notamment une question : Par lintermdiaire de ce texte, la question se pose de
ltendue et du contenu de la garantie sagissant des nonciations relatives la clientle. Donc le
vendeur doit garantir lutilit de la chose, il doit garantir de lviction de lacheteur. Au titre de la
garantie d par le vendeur, lacheteur peut former une action en rduction du prix si le vendeur
mvince de la chose par sa concurrence (il sinstalle cot). On peut donc pallier une clause de
non concurrence. Mais il vaut quand mme mieux prvenir le risque par une telle clause, car lissu
dune action en justice nest jamais certaine.
Article L141-4 : L'action rsultant de l'article L. 141-3 doit tre intente par l'acqureur dans le dlai
d'une anne, compter de la date de sa prise de possession.
Le texte na rien de spcial sinon sa prescription spciale pour la garantie vise larticle L 141-3. Elle
doit tre exerce dans lanne.
Son point de dpart est compter de la prise de possession, diffrence avec laction spciale en
nullit car le point de dpart tait compter de la vente.
Section II : Les privilges du vendeur
Article L141-5 : Le privilge du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a t
constate par un acte authentique ou sous seing priv, dment enregistr, et que s'il a t inscrit sur
un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploit.
Il ne porte que sur les lments du fonds numrs dans la vente et dans l'inscription, et dfaut de
dsignation prcise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientle et
l'achalandage.
Des prix distincts sont tablis pour les lments incorporels du fonds, le matriel et les
marchandises.
Le privilge du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste d, s'exerce distinctement
sur les prix respectifs de la revente affrents aux marchandises, au matriel et aux lments
incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants
s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matriel.
Il y a lieu ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique un ou plusieurs
lments non compris dans la premire vente.
Le privilge : Cest un avantage particulier confr au vendeur. Un privilge cest une garantie
accorde ici au vendeur qui se traduit concrtement de suite et droit de prfrence qui portent sur le
fonds de commerce, ceci afin de garantir au vendeur le prix de vente.
Le droit de prfrence assure au vendeur le premier rang parmi les cranciers du dbiteur. Il sera
pay sur le fonds de commerce par prfrence tous les autres cranciers.
Le droit de suite confre le droit daller rcuprer le fonds de commerce entre les mains des
acqureurs successifs car cest un droit rel accessoire. On peut donc aller rcuprer la chose entre
les mains dun Tiers qui laurait achet au premier acheteur.
Concrtement, on peut forcer la vente du fonds de commerce ou une partie si le prix de vente na
pas t acquitt par lacheteur.
Larticle L141-5 dans son alina premier impose un certain nombre de conditions pour que le
vendeur puisse se prvaloir de son privilge.
Il faut que lacte qui constate la vente soit un acte authentique pass par un officier ministriel en
gnral un notaire. On accepte un acte sous seing priv condition quil soit dment enregistr. Il y a
des conditions de publicit.
Lalina 2 dtermine lassiette du privilge (les lments sur lesquels le privilge va porter). Sy
trouvent les lments numrs dans la vente et dfaut, dautres lments que lon a dj vu ici
(clientle, enseigne).
A loccasion de la dtermination de lassiette, le code aborde les lments du fonds de commerce par
une ventilation des prix.
Lalina 3 impose des prix distincts pour les lments incorporels du fonds de commerce et les
lments corporels.
Lalina 4 procde la ventilation des prix dans la cession. La cession du fonds de commerce est un
acte unique, addition de prix distincts des lments du fonds de commerce qui existent afin que
sexerce le privilge du vendeur.
Lalina 4 exige que la garantie de chacun de ces prix de vente sexerce distinctement sur les prix
respectifs de la revente des lments incorporels dune part et dautre part sur les lments
corporels. Le privilge du vendeur suit cette distinction.
Lalina 5 dit quon ne peut pas y droger, cest de lordre public et cest donc une Loi imprative.
Il y a un ordre dtermin par la Loi entre les lments corporels du fonds entre la marchandise et le
prix du matriel.
Ce privilge est un droit rel accessoire car cest un accessoire du prix de vente. Il porte donc sur les
choses. Cest donc un droit de prfrence et de suite attachs la chose et non la personne. Le fait
que la distribution des prix se fasse dabord sur les marchandises puis sur le matriel est logique. On
considre que le prix pay pse dabord sur les marchandises. On cherche dgrever les
marchandises des droits qui psent sur elles en priorit.
Larticle 141-6 : L'inscription doit tre prise, peine de nullit, dans la quinzaine de la date de l'acte
de vente. Elle prime toute inscription prise dans le mme dlai du chef de l'acqureur ; elle est
opposable aux cranciers de l'acqureur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu' sa
succession bnficiaire.
L'action rsolutoire, tablie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, tre
mentionne et rserve expressment dans l'inscription. Elle ne peut tre exerce au prjudice des
tiers aprs l'extinction du privilge. Elle est limite, comme le privilge, aux seuls lments qui ont fait
partie de la vente.
Linscription : Le privilge pour produire des effets doit faire lobjet de publicit. Ces droits attachs
au vendeur vont concerner les tiers, donc cest logique car cest une protection des tiers pour
connaitre la situation de leur dbiteur.
A peine de nullit, le privilge garantie le premier rang au vendeur du fonds de commerce pour un
privilge.
Alina 2 : Si lacheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut forcer la vente. Application de larticle
1654 du CC, il y a rsolution de la vente si lacheteur ne paye pas.
La rsolution consiste comme sanction un anantissement du contrat. Lexercice de laction est
encadr sagissant de la vente du fond de commerce puisque son exercice doit tre prvu dans
linscription du privilge. Lexercice de laction en rsolution est subordonn linscription du
privilge. Elle est subordonne une condition de publicit.
Larticle L141-13 doit tre au moins signal puisquil est une consquence technique de publicit de
la vente du fonds de commerce.
Ne pas confondre la publicit dun acte avec les formalits relatives lenregistrement.
Lenregistrement est une formalit fiscale. Il faut a la foi enregistrer la vente du fonds de commerce
et en mme temps faire les formalits de publicit.
Cest donc un acte hyper formaliste : Publicit du fonds de commerce (importante parce quelle est la
condition ce que lon appelle lopposition au prix de vente vise larticle L121-14).
L141-14 : Dans les dix jours suivant la dernire en date des publications vises l'article L. 141-12,
tout crancier du prcdent propritaire, que sa crance soit ou non exigible, peut former au domicile
lu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, peine de nullit,
nonce le chiffre et les causes de la crance et contient une lection de domicile dans le ressort de la
situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou choir, et ce,
nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie
du prix n'est opposable aux cranciers qui se sont ainsi fait connatre dans ce dlai.
Il nous indique que cette publicit rend possible lopposition.
\\\Attention, quand on parle du droit de crance on ne parle pas du privilge.///
Lopposition au paiement du prix : Peut tre forme par le crancier du prcdent propritaire. Cela
veut dire quon empche que le vendeur du fonds de commerce rcupre le prix de la vente (largent
finit dans la poche du prcdent crancier). La somme qui correspond au prix va tre bloque.
Cette opposition doit avoir lieu dans les 10 jours (trs court) et elle doit comporter quelques
conditions de formes sous peine de nullit.
Articles L141-15 et -16 :
Ils permettent au vendeur celui qui subit lopposition dagir en rfr pour obtenir malgr tout le prix
(devant le juge des rfrs : Le juge de lurgence). On peut rcuprer le paiement du prix condition
de consigner une somme suffisante pour dsintresser les cranciers pour rpondre des causes de
lopposition dans le cas ou le vendeur serait jug dbiteur ou sil se reconnait dbiteur des sommes
en question.
De l on peut dduire que cela na dintrt que dans la mesure o le prix de la vente est suprieur
au prix en question.
Dautre art cest un mcanisme particulirement utile lorsquon entend contester la qualit du
crancier en question.
Exemple : Un crancier forme une opposition sur la base dune reconnaissance de dettes formes par
moi, mais je lai dj pay. Je vais voir le juge des rfrs, je consigne la somme et je demande le
versement du prix. Cest utile car jentends bien montrer ultrieurement que je ne suis pas dbiteur.
Cet utile aussi si je suis bien dbiteur mais le prix de vente est suprieur, alors je demande davoir le
prix de la vente quand mme.
Il y a des conditions particulires pour que le juge puisse autoriser ce payement du prix.
Larticle 141-16 prvoit une autre possibilit de saisine du juge des rfrs lorsque lopposition a t
faite :
Sans titre (pas de documents, dinstruments attestant de ma crance)
Sans cause (je ntablis pas la cause juridique de ma crance)
Nulle en la forme (je nai pas respect les conditions de formes de larticle L121-14).
Larticle L141-17 : L'acqureur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes
prescrites, ou avant l'expiration du dlai de dix jours, n'est pas libr l'gard des tiers.
Il met la charge de lacqureur les paiements du crancier. A premire vue il sanctionne les
consquences du dfaut de publicit (L141-12 et -13).
Cest lacqureur qui supporte le risque des dfauts de publicit. Cela dit il ne les supporte que sil
paye sans avoir fait de publication en ce sens quil nest pas libr lgard des tiers (les cranciers
du vendeur, on le sait grce a la place du texte, cest juste aprs larticle L141-16). Cest presque
lapplication de qui paie mal paie deux fois . Sil nest pas libr lgard des tiers, il devra subir
les recours des tiers le cas chant. Ca marche aussi sil a pay avant lexpiration du dlai pendant
lequel les cranciers peuvent exercer lopposition. On ne peut donc pas empcher lopposition.
On peut aussi dire que le payement du prix avant le dlai de 10 jours ne libre pas lacheteur. On va
faire comme si on navait pas vers le prix de vente lgard des tiers, comme si lopposition avait
dj t exerce.
Si on est acqureur il faut vrifier que les publicits ont t faites et ne pas payer avant 10 jours.
Le texte apparait aussi comme lapplication dun principe gnral que lon retrouve partout avec la
publicit. La situation qui na pas t publie est inopposable la situation de lobjet protg. Le
dfaut de publicit dune situation rend inopposable cette situation aux tiers que la rgle de publicit
avait pour objet de protger. On fera comme si la nouvelle situation juridique nexistait pas lgard
des Tiers si elle na pas t rgularise.
Rgles particulires :
L141-18 et suivants
Des rgles peuvent influer et modifier le prix de vente du fonds de commerce de sorte que tant que
ces rgles nont pas pu jouer, il est difficile de dire que le prix a t dfinitivement acquis. Il y a un
dlai de latence pendant lequel la cession du fonds de commerce nest pas scurise.
Complexit de la cession du fonds de commerce qui a des consquences particulires sur lobjet de
la vente. Il y a un enjeu par rapport au droit des tiers et mfiance du droit civil.
Section III Le nantissement du fonds de commerce
On situe le nantissement par rapport aux utilits du fonds de commerce. Le fonds de commerce est
une valeur conomique, donc on peut constituer du crdit sur ces biens en offrant ces biens en
garantie. Raison pour laquelle on dit quon ne prte quaux riches.
Le nantissement est une suret qui porte sur une chose donc cest une suret relle qui nemporte
pas dpossession du dbiteur qui constitue la sret cest l lutilit de lopration.
1 Le nantissement conventionnel
L142-1 et suivants
A) Les conditions
Article L142-1 : Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres
conditions et formalits que celles prescrites par le prsent chapitre et le chapitre III ci-aprs.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au crancier gagiste le droit de se faire
attribuer le fonds en paiement et jusqu' due concurrence.
Champs dapplication dune part et ralisation de lautre.
Celui qui bnficie du nantissement du fonds de commerce sappelle le crancier gagiste (alors que
ce nest pas un gage mais un nantissement).
Le nantissement ne permet pas au crancier gagiste de se faire attribuer le fonds de commerce. Il ne
pourra pas saisir le fonds de commerce entre les mains du commerant. On veut prserver lactivit
commerciale, mme si cest le fonds qui constitue lassiette.
Le crancier gagiste ne peut pas rcuprer le fonds de commerce en paiement de sa crance.
Question :
Est-ce que cest un texte dordre public, donc est ce que les parties peuvent y droger en insrant
une clause de pacte commissoire permettant de prendre le fonds de commerce en paiement de
la crance ?
La rponse est probablement ngative, car jusqu la rforme de 2006 en droit le pacte commissoire
tait prohib car on ferait comme si on avait un droit de proprit conditionnelle sur la chose. La
rforme de 2006 rendait possible lacquisition de la chose en cas de non paiement mais on reste sur
loptique ngative.
L142-2 : Sont seuls susceptibles d'tre compris dans le nantissement soumis aux dispositions du
prsent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le
droit au bail, la clientle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matriel ou l'outillage servant
l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modles
industriels, et gnralement les droits de proprit intellectuelle qui y sont attachs.
Le certificat d'addition postrieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit
le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constitu.
A dfaut de dsignation expresse et prcise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne
comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent tre
dsignes par l'indication prcise de leur sige.
On dtermine plus prcisment lassiette du nantissement du fonds de commerce.
Le principe est que le nantissement ne peut porter que sur les lments incorporels : Lenseigne, le
nom commercial, la clientle et lachalandage (alina 3) sauf dsignation expresse et prcise des
parties, dans ce cas le nantissement peut porter sur des lments corporels.
On voit bien quici la notion de fonds de commerce ne recouvre pas celle que nous connaissons.
On rappelle que les marchandises ne peuvent pas tre comprises dans le nantissement du fonds de
commerce, mais ca peut tre dommageable car toutes les marchandises nont pas vocation circuler
de la mme faon. Celui qui vend des matires rares, ou des objets forte valeur ajoute
(Lamborghini), le stock peut rester en place un moment. Mais dsormais, le gage du stock existe mais
distinctement du nantissement du fonds de commerce.
L142-3 et suivants : Le contrat de nantissement est constat par un acte authentique ou par un acte
sous seing priv, dment enregistr.
Le privilge rsultant du contrat de nantissement s'tablit par le seul fait de l'inscription sur un
registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploit.
La mme formalit doit tre remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est
situe chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
Conditions de forme : Acte formaliste puisque lacte de nantissement doit tre par un acte
authentique ou sous sein priv. Protection des tiers.
La sanction est la nullit.
Le contrat doit tre rendu public dans les 15 jours peine de nullit.
Compte tenu de la valeur que peut reprsenter le fonds de commerce, il peut tre donn en garantie
plusieurs cranciers.
Au moment de la ralisation de leurs droits par les cranciers pour se payer, on se pose la question
de leur rang. On rgle la question par la date de leur inscription (qui sera pay en premier).
B) Les effets du nantissement conventionnel
Cest un droit rel accessoire.
Mais quel est lavantage dun crancier titulaire dune suret (ici le nantissement) par rapport un
crancier lambda ?
Le droit de prfrence (faire saisir le fonds et avoir la priorit sur la valeur dgage, ce que les
crancier lambdas nont pas cest la priorit). La vente peut tre amiable ou force.
Mais quelle est la diffrence avec lalina 2 de larticle 142-1 ? Deux attitudes sont concevables :
Soit je dis que jai un droit rel sur la chose, je prends la chose en paiement. Cest
impossible : Le nantissement na pas deffet de transfert de proprit ventuel en cas de non
paiement
Soit je fais saisir la chose en madressant au juge, il sensuit une vente force ou amiable, et
je serais prioritaire pour rcuprer une fraction du prix de vente. Ici cest un droit rel
ACCESSOIRE, cest pour a quil ny a pas de transfert de proprit mais plutt un droit de se
faire payer sur la vente.
Il y a aussi un droit de suite puisquil peut suivre le bien en quelle que main quil se trouve.
Do lintrt de la publicit des fonds de commerce pour savoir quels droits sont constitus sur ce
fonds.
Le crancier gagiste a dautres droits sur le nantissement, droit linformation. Le crancier doit tre
prvenu de certains lments affectant son droit en cas de vente dun lment du fonds de
commerce par exemple. De mme, le crancier gagiste doit tre prvenu en cas de rsiliation du bail
commercial.
2 Le nantissement judiciaire
Cela relve plutt de la matire des Lois dexcution. La Loi du juillet 1991 prvoit la possibilit
dobtenir le nantissement judiciaire du fonds de commerce. Cest une mesure conservatoire.
Cela nous renvois lhypothse dans laquelle un crancier Chirographaire qui craint de voir
dprir son droit. Il veut se prmunir contre le risque dinsolvabilit de son dbiteur. Il peut alors
obtenir le nantissement judiciaire.
Le crancier sadresse alors au prsident du TGI ou au prsident du tribunal de commerce. Il peut
donc se faire attribuer en justice un droit quivalent de celui qui nait du nantissement conventionne.
Cest trs important car ici il ny a pas de consentement du dbiteur, do la ncessit de prouver le
risque, lurgence, pour le crancier. Ca reste rare.
Par nature, ce nantissement est provisoire, mais il peut aussi tre dfinitif.
Section III : La location grance
Cest un contrat par lequel le propritaire ou lexploitant dun fonds de commerce en concde
totalement ou partiellement la location un grant qui lexploite ses risques et prils.
Cest un contrat synallagmatique titre onreux. Le loueur est tenu de dlivrer la chose, le locataire
est tenu dun loyer que lon appellera ici les redevances.
Ce contrat de location grance est rgit par les articles L144-1 et suivants.
L144-1 : Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propritaire ou
l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un tablissement artisanal en concde totalement ou
partiellement la location un grant qui l'exploite ses risques et prils est rgi par les dispositions
du prsent chapitre.
Cest un texte dordre public. Il est impratif.
On nous dfinit la location grance.
Exploitation ses risques et prils, ce qui laisse penser que cela sadresse aux commerants.
La location grance peut tre partielle.
Ide de qualification, par consquent, automatiquement le contrat de location grance est soumis
aux rgles obligatoires qui suivent.
On ne peut pas le soustraire en bloc lapplication du rgime de la location grance (on ne peut pas
lappeler autrement et dire nan ca marche pas , tout ce qui rpond la dfinition entre sous son
rgime).
L144-2 : Le locataire-grant a la qualit de commerant. Il est soumis toutes les obligations qui en
dcoulent.
Lorsque le fonds est un tablissement artisanal, le locataire-grant est immatricul au rpertoire
des mtiers et est soumis toutes les obligations qui en dcoulent.
Le locataire la qualit de commerant, de ce fait il est soumis toutes les obligations qui procdent
de cette qualit
L144-3 : Les personnes physiques ou morales qui concdent une location-grance doivent avoir
exploit pendant deux annes au moins le fonds ou l'tablissement artisanal mis en grance.
Il fixe les conditions de fond concernant le loueur quil soit personne physique ou morale qui concde
la location grance, c'est--dire que le loueur doit avoir exploit pendant 2 ans au moins le fonds de
commerce.
Ce dlai peut tre rduit ou supprim au terme dune procdure spciale qui dbouche sur une
ordonnance du prsident du TGI.
La requte qui le demande doit sappuyer sur le fait que le loueur est dans limpossibilit dexploiter
son fond personnel ou par lintermdiaire de ses prposs.
L144-4 : Le dlai prvu par l'article L. 144-3 peut tre supprim ou rduit par ordonnance du
prsident du tribunal de grande instance rendue sur simple requte de l'intress, le ministre public
entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilit d'exploiter son fonds
personnellement ou par l'intermdiaire de prposs.
La Jurisprudence est assez librale quand aux raisons aboutissant la suppression ou rduction du
dlai, on songe la maladie, mais aussi limpossibilit dexploiter par lintermdiaire de salaris.
L144-10 : Tout contrat de location-grance ou toute autre convention comportant des clauses
analogues, consenti par le propritaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les
conditions prvues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer
cette nullit l'encontre des tiers.
La nullit prvue l'alina prcdent entrane l'gard des contractants la dchance des droits
qu'ils pourraient ventuellement tenir des dispositions du chapitre V du prsent titre rglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux loyer
d'immeubles ou de locaux usage commercial, industriel ou artisanal.
La sanction est une nullit particulire puisque les contractants nont pas la possibilit dinvoquer la
nullit contre les tiers.
Le locataire ne pourra pas opposer ses cranciers la nullit de ce contrat pour se librer des dettes
formes pendant lexploitation du fonds de commerce. La nullit est inopposable.
La particularit de cette location grance est son caractre progressif dont tmoignent les textes du
code de commerce. Il va tirer toutes les consquences de la personnalit de celui qui lexploite.
Ainsi, larticle L144-6 prvoit ce que lon pourrait rapprocher dun systme de purge des dettes
dexploitation commerciale au moment o la personne de lexploitant doit changer.
Les dettes contractes par le loueur du fond de commerce peuvent tre dclares au moment de la
location grance immdiatement exigibles.
Autrement dit, les cranciers peuvent provoquer la dchance du terme en cas de location grance.
(le crancier peut exiger le paiement des dettes contractes mme si le terme nest pas encore arriv).
Ce nest pas un pouvoir discrtionnaire des cranciers, elle peut tre provoque condition que la
location grance mette en pril le recouvrement des crances.
Lorsque les cranciers estiment que la location grance peut avoir comme consquence de mettre
en pril leur crance, ils peuvent la rendre exigible immdiatement et en obtenir le paiement
anticip.
Action spciale, dlais stricte de 3 mois, dlai de forclusion ( compter de la publication du contrat de
grance), cest lalina 3 de larticle 144-6.
Article L144-6 : Au moment de la location-grance, les dettes du loueur du fonds affrentes
l'exploitation du fonds peuvent tre dclares immdiatement exigibles par le tribunal de commerce
de la situation du fonds, s'il estime que la location-grance met en pril leur recouvrement.
L'action doit tre introduite, peine de forclusion, dans le dlai de trois mois dater de la
publication du contrat de grance dans un journal habilit recevoir les annonces lgales.
Clause conventionnelle de dchance. Il sera plus prudent si je suis crancier dintroduire dans le
contrat pass avec lexploitant du fonds de commerce des clauses conventionnelles de dchance :
il est attendu que la dette est immdiatement exigible en cas de location grance entreprise avec le
dbiteur . Ca permet dviter de passer par le systme judiciaire. La demande nest pas ici de plein
droit.
Il sagit pour les cranciers de pouvoir se payer avant que le patrimoine du loueur ne soit diminu
puisquil ne tire plus les revenus de lexploitation commerciale.
Larticle 144-7 : Jusqu' la publication du contrat de location-grance et pendant un dlai de six
mois compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le
locataire-grant des dettes contractes par celui-ci l'occasion de l'exploitation du fonds.
Il instaure une solidarit spciale sagissant des dettes contractes par le locataire grant loccasion
de lexploitation du fonds.
Le loueur et le locataire sont tenus sagissant des dettes loccasion de lexploitation du fonds de
commerce.
Cette solidarit est limite dans le temps : Elle a lieu jusqu la publication du contrat de location
grance et dans les 6 mois qui suivent cette publication.
Le plus souvent, la charge dfinitive de la dette repose sur le locataire puisque cest lui qui les
contracte.
Il sagit de prmunir les cranciers de certains risques qui peuvent tre lis au changement de
lexploitant, on garanti les cranciers par le biais de la solidarit.
Autre systme de purge qui ressemble larticle 144-6 cest celui de larticle 144-9 :
L144-9 : La fin de la location-grance rend immdiatement exigibles les dettes affrentes
l'exploitation du fonds ou de l'tablissement artisanal, contractes par le locataire-grant pendant la
dure de la grance.
Attache des consquences la fin du contrat de grance, cest lexigibilit immdiate des dettes
affrentes lexploitation.
Ici cest de plein droit.
Obligation des parties :
Pour le locataire, il faut payer le prix et dautre part, exploiter le fonds comme un bon pre
de famille. On pourrait lui reprocher es ngligences, imprudences, fautes quil pourrait
commettre.
Le prix du contrat, c'est--dire le loyer, cest dire les redevances, ce prix est amen varier
puisquil est susceptible de faire lobjet dune clause dindexation et dune possibilit de
rvision du loyer de lallocation grance.
Pour le loueur, en tant que civiliste il doit faire jouir le loueur de la chose, dun point de vue
commercialiste, ca se traduit par la dlivrance de la chose et la garantie contre les vices et
lviction. Elle ressemble beaucoup la situation du vendeur de fonds de commerce, ceci
prt quil na pas cder la proprit du fonds.
Le bail commercial, il est un contrat spcial du droit civil, il obit des rgles spcifique en droit
commercial, cest le contrat par lequel une partie sengage a faire jouir lautre dune chose contre le
paiement dun prix que lon appelle le loyer. Nous transposons la dfinition en matire commercial,
le contrat de bail cest le contrat par lequel le titulaire dun fond de commerce obtient le droit de
jouir dun immeuble appartenant par hypothse au bailleur en vue dy exercer une activit
commercial moyennant le paiement dun prix que lon pourra appeler le loyer.
Cest un contrat spcifique car il obit un rglement spcifique, la rglementation du bail
commercial illustre idalement le paradoxe du droit commercial, en ce sens que pour lexercice
dune activit commercial qui requiert libert et souplesse, il a fallut lui opposer une rglementation
complexe, rigide et qui enferme les parties au contrat dans un statut. La rglementation civiliste ont
sembl un moment inadapt au droit commercial en particulier les rgles relative au cong. Le bail
du droit commun vise aussi bien limmeuble que le meuble. Le principe civiliste est que le bail est
librement rvocable sous rserve dun pravis. En matire de bail commercial cette libre rvocabilit
convient assez mal la stabilit que requiert lactivit commerciale. La localisation du commerce
peut tre un lment trs important de telles sortes que la dlocalisation du fond de commerce
emporte un risque plus ou moins lev de dperdition de lactivit. Il fallait assurer une certaine
stabilit du bail commercial, cest ce que lon a pens un moment, un autre problme est apparu.
Cest laugmentation des prix de limmobilit li cette instabilit de linstallation commercial.
Si vous savez que votre temps dactivit commercial est entre les mains du cocontractant vous aurez
tendance a transfrer le risque financier de la fin du contrat sur le client (augmentation des prix),
dans le mme temps la hausse des prix immobilier qui vient peser sur la rinstallation favorise le
contexte de trs forte inflation. Un contexte interventionniste aussi. Ltat doit rguler lconomie,
une rglementation des baux commerciaux voit le jour en 1953.
Cest un moyen comme un autre de lutter contre linflation en instaurant un dsquilibre dans le
contrat au profit dune des parties, ici en faveur du commerant. Corrlativement cest lemprise que
le commerant exerce sur le local une emprise tellement forte que lon a parler de proprit
commerciale, ce qui nest videmment pas un droit rel mais un droit personnel, lemprise de fait a
t qualifi de proprit commerciale.
Plus on renforce la stabilit du contrat, plus on renforce lemprise du locataire sur la chose, on sest
pos la question si le droit de bail nemportait pas un droit rel.
Plus on va rendre difficile la fin du contrat, plus on va accroitre lemprise.
Depuis ce moment le droit est en qute dquilibre, il y a ce paradoxe, libert contre scurit . Le
droit va donc jouer sur les prix, voila pourquoi la rvision des loyers est trs importante dans le droit
franais.
Chapitre II : Lexcution
Statut : le statut soppose au contrat. Cest un ensemble de rgles automatiques qui sappliquent aux
individus qui rentrent dans leurs champs dapplication, le statut est considr comme un bnfice
contrairement au contrat qui repose sur lalination de la libert.
On parle de statut des baux commerciaux. Il est des situations dans lesquelles on nappliquera pas
ces statuts des baux commerciaux. Les oprateurs conomiques peuvent esprer sortir des statuts,
ils doivent tre pour cela tre dans des situations qui nentre pas dans le champ dapplication des
statuts.
La question est de savoir, quand sort-on du statut ?
Les parties ont invent ce quon appelle les conventions doccupation prcaire. Cest un contrat
pass entre le propritaire dun local et celui qui veut occuper ce local, cest une occupation qui se
veut prcaire, les parties entendent pouvoir rsilier cette convention tout moment, il sagit
clairement dchapper au rgime de stabilit du bail commercial. Comme cest une situation qui se
veut une exception, la jurisprudence ne peut ladmettre que de manire trs exceptionnelle. Cest
une prcarit qui doit tre objective. C'est--dire que la prcarit ne dpend pas de la volont des
parties.
Comment la prcarit peut tre objective ?
La chose na donc pas vocation durer, elle est prcaire. Le terme des contrats ne dpend pas de la
volont des parties.
Autre hypothse, cest la situation de loccupant sans titre, loccupation sans titre correspond
lhypothse selon laquelle une partie la jouissance dun immeuble sans acte juridique fonde cette
jouissance. Cest une occupation de fait.
Ce nest pas une situation de possession. Loccupant sans titre sait bien quil jouit dun bien dont
autrui est propritaire. Cette situation est marginale mais loccupation sans titre est souvent la
consquence que la situation juridique a cess de produire des effets mais la situation demeure. Il
devient occupant sans titre. Deux consquence cela, cest le paiement dune indemnit, le
propritaire peut mettre fin lobligation sans titre et ce sans pravis. Cela peut tre une obligation
pour le propritaire dans le cas o il a cd son bien et pour respecter la garantie dviction.
Section 1 : les conditions relatives la chose, les conditions relative limmeuble.
Limmeuble est un immeuble btit, ce nest pas le fond, article L145-1 qui se charge Il est clair que
limmeuble doit tre destin lactivit commerciale et la destination lactivit commercial
dpends dune autorisation administrative. Ladministration dcide dans lintrt gnral. Il faut que
limmeuble soit clos et dune taille suffisante. Il y a certaines conditions pour que ladministration
donne son acceptation.
Lorsque limmeuble nest pas a des caractristique qui pourraient le faire chapper limmeuble
btit destin lactivit commerciale.
Est-ce quun local accessoire emprunt le statut des baux commerciaux ? Cest un local qui ne
correspond pas au lieu o se droule la principale activit commerciale mais dont le commerant use
dans le but de lexploitation commerciale. En droit laccessoire suit le principal, le local accessoire
suit le rgime du local principal.
Le code de commerce prends sur lui de le prciser.
Faut-il un lien physique ? (cave par exemple). Non
En fait ca dpends si le local est ncessaire lexercice de lactivit commerciale. (L145-1)
Si une fois le local soustrait, lactivit commerciale ne peut pas se drouler de la mme manire,
alors on appliquera le rgime des baux commerciaux. Une condition supplmentaire dont parle le
texte est celle de la proprit du local accessoire, le propritaire doit tre le mme que celui du local
commercial principal sauf si en cas de pluralit de propritaire le local accessoire a t joint lors de la
conclusion du bail commercial au local principal.
Autre hypothses : les locaux mobiles, est-ce quune construction mobile ou dmontable est soumise
la rglementation des baux commerciaux ? Ca va de la baraque a frite lemplacement sur un
march.
La cour de cassation a considr que la lgislation des baux commerciaux ntait pas applicable la
location dune structure dmontable ou mobile (puisque ca ne gne pas dexercer lactivit
commercial ailleurs, le statut des baux commerciaux perd son sens).
Autre hypothse, les locaux secondaire, le principe est lextension, la condition est purement
administrative, il y aura applicable des lors que le commerant fait figurer au registre le local
secondaire.
Le bail consentit sur un terrain nu sur lequel des constructions ont t faite pour lactivit
commercial, ce bail sera soumis aux baux commerciaux condition que ces constructions aient eu
lautorisation express du propritaire du terrain.
On ne peut pas se soustraire au statut des beaux commerciaux en invoquant le fait que le bail est
port sur le terrain et non sur limmeuble btit.
On ne peut pas profiter du statut des baux commerciaux si le propritaire du terrain ny a pas
consentit.
Section II : Les conditions relatives lactivit exerce
Il faut que lactivit rende lgitime le recours au bail commercial.
Ici encore en cas de doute on va se reporter la thorie de lacte du commerce.
En revanche certaines questions peuvent se poser. Larticle L145-2 tente dy rpondre.
L145-2
Sera soumis aux baux commerciaux les locaux servant lducation, lactivit artisanale.
Une exception existe dans le texte. Sagissant des autorisations doccupation prcaire accord par
ladministration sur des immeubles acquit par ladministration suite des dclarations dutilit
public, celui qui y exercera lactivit commerciale chappera la lgislation sur les baux
commerciaux.
Section III : Les conditions relatives aux personnes, aux parties
Deux parties aux contrats : Bailleurs et preneur
Le bailleur doit tre propritaire mais cette condition reoit une exception car la sous location est
possible en matire de bail commercial. Cela dit lorsque la sous location est possible, le bailleur nest
pas ncessairement le propritaire.
La sous location a sembl incompatible avec lobjectif de la rglementation des baux commerciaux,
car si le preneur locataire a entendu sous louer, il nentend plus bnficier du maintient dans les
lieux, il est donc priori incompatible avec lobjectif de la lgislation. Nanmoins, il y a une certaine
souplesse.
Le preneur doit avoir la qualit de commerant, il doit tre titulaire du fond de commerce (L145-1).
Chapitre 2 : Lexcution
Cest sur le terrain de lexcution du contrat que les rgles juridique doivent exister.
La protection des intrts du preneur.
Elle ne doit pas occulter le fait quil est lui mme un dbiteur au contrat devant un certain nombre
doccupation. Il est bien tenu dexploiter le fond mais les aspects spcifiques de la lgislation se
traduisent par autre chose.
A cette stabilit vont disputer dautres considration parce quaprs tout, lobjectif premier, la
finalit conomique des baux commerciaux est lexercice de lactivit commerciale, elle se
caractrise par la qute de bnfice en contrepartie dun risque. Cet objectif de stabilit ne doit pas
sacrifier lactivit conomique.
A lintrieur de lintrt du preneur se disputent plusieurs objectifs :
Politiques : Stabilit, scurit
Economique : Assurer lactivit commerciale
La lgislation des baux commerciaux doit balancer entre la stabilit et la souplesse. Certaines
dispositions ont tendance privilgier lintrt du preneur.
1) Stabilit et souplesse.
La stabilit, la rigueur, on trouvera ici les rgles relatives la dure du contrat, on y trouvera aussi
celle du renouvellement du contrat de bail
A) La dure
Cest llment essentiel, le bail commercial connait une dure minimum, elle ne peut tre infrieur
9 ans. Il est offert au preneur la facult de donner cong lexpiration dune priode triennale, le
locataire peut rsilier le contrat au bout de trois ans et par priode de trois ans.
La possibilit de conclure un bail drogatoire au statut des baux commerciaux, article L141-5 au
terme duquel les parties ont la possibilit lors de lentre dans les lieux du preneur de droger aux
dispositions du prsent chapitre la condition dune dure maximale de deux ans.
Alternative qui appelle deux sries de remarques :
-il faut toujours se poser la question de lapplication du statut des baux commerciaux, possibilit
donne par la loi.
Pour bnficier de la possibilit de droger au statut des baux commerciaux, encore faut-il que le
contrat soit qualifi de bail commercial lui-mme.
-Cest la faveur accord au preneur ici. On lui donne le soin de vrifier la viabilit du bail commercial.
Pendant 2 ans, il peut vrifier si le CA est la hauteur de ce que lon attendait et dfaut, il peut
rsilier le contrat.
A lexpiration de cette priode si les choses se passent mal, le bailleur pourra rsilier sous rserve du
respect dun pravis. Au bout de deux ans les choses peuvent aussi bien se passer et il convient alors
de rintgr le rgime des baux commerciaux.
Le texte le prvoit lalina 2 : si le preneur demeure dans les lieux aprs expiration du dlai de
deux, il sopre un nouveau bail celui la soumit au statut des baux commerciaux. Report pour une
dure minimum de 9 ans, logique ctait un contrat drogatoire.
La solution est identique quil sagisse dun preneur laiss en possession ou dun renouvellement
tacite du contrat. Cest bien le rgime des baux commerciaux qui sappliquent.
Si on dcompose la dure de 9 ans est impose une seule des deux 2 parties, le bailleur na pas de
prise sur cette dure, le preneur lui peut rsilier par priode triennale (bail 3-6-9). Mais cela peut
aussi paraitre rigide pour le preneur aussi do lintrt dy droger avec larticle 145-4 (bail conclu
pour 2 ans).
Du cot du bailleur, il y a la possibilit de rsilier tout moment pour entreprendre certains travaux
qui ncessitent une vacuation des lieux selon une dfinition donne par le code de lurbanisme.
Cest une possibilit donne par larticle L145-6 ce texte est toujours situ dans la section de la
dure.
Le bailleur qui doit effectuer ses travaux peut offrir de reporter le bail dans un autre immeuble.
Sinon, le cas contraire, le preneur a une indemnit de dpossession (L145-7).
B) Le renouvellement
Hypothse de dpart, nous sommes lexpiration du bail commercial et le preneur entend rester
dans les lieux. Le renouvellement est la conclusion dun nouveau contrat.
Le principe cest le renouvellement en ce sens que les textes sont amnags afin de faciliter le
maintien dans les lieux de lactivit du preneur.
Mais on nous parle dans le code de droit au renouvellement, donc sil y a un droit cest quil y a une
obligation ds lors il faut trouver un crancier et un dbiteur donc le dbiteur cest le bailleur. De
sorte que pse sur le bailleur le risque contractuel de refuser le renouvellement, raison pour laquelle
on trouvera la section 3 du renouvellement, une section 4, le refus du renouvellement larticle
L145-14 et qui accorde une facult au bailleur pour refuser le renouvellement du bail.
Il y a donc un droit de renouvellement du preneur qui a pour rponse un droit de sy opposer du
bailleur. On parle dune option pour le bailleur. Il va y avoir deux rgimes diffrents.
Si le bailleur peut sy opposer, il doit par principe une indemnit dviction qui a pour but de rparer
le prjudice pose par le dfaut de renouvellement lorsquil refuse de renouveler le bail commercial.
L145-14.
Voila peut tre pourquoi le texte parle dun cot du droit au renouvellement et de lautre, une
possibilit (payante) de refuser.
Lalina 2 de larticle 145-14 nous indique ce qui contient lindemnit :
-La valeur marchande du fonds de commerce
-Les frais de ddommagement
-Le cout fiscal de lacquisition dun fond de mme valeur
Cest une liste non exhaustive qui a charge pour le preneur qui subit un prjudice pas lev. Dans le
mme temps, larticle L145-14 laisse la possibilit au bailleur dtablir que le prjudice du preneur est
moins important.
Ce texte a pour objet de soulager le preneur, de dgager les chefs de prjudice qui sont prvus par la
loi, ce qui permet de faon objective de fixer le montant de cet tat dindemnit dexcution. Cest
un texte qui allge la charge et le risque de la preuve pour le preneur. On le sait car le texte ralise en
permettant au bailleur dtablir que le prjudice a t moindre, on permet donc de renverser la
charge de la preuve. Celui qui veut obtenir quelque chose du juge doit avancer une preuve. Sur ce
texte, la preuve revient au preneur.
Sagissant de lindemnit de renouvellement, on peut dire quelle est lourde supporter pour le
bailleur qui refuserait le renouvellement, elle est tellement leve dans son principe mme que la loi
prvoit un droit de repentir pour le bailleur, c'est--dire quil est prvu que le bailleur qui a refus le
renouvellement puisse revenir sur son choix pour accorder le renouvellement.
Nanmoins, le bailleur peut refuser le renouvellement donc de payer, exception cela et aussi au
droit de renouvellement (in specie ou avoir de largent).
Article L145-17
Il faut donc un motif grave et lgitime. Cest notamment linexcution de lobligation du preneur, la
cessation injustifie de lexploitation du fond voir plus grave, infraction pnales, perte de qualit du
commerant. Deuxime hypothse en cas de destruction totale ou partielle de limmeuble.
Il existe galement une attnuation du principe larticle L145-18 o il peut se soustraire au
paiement dune indemnit en offrant un autre local.
Sagissant du rgime spcifique, le locataire a un droit de priorit sur le local exploit dans un nouvel
immeuble en cas de destruction du premier.
2) La souplesse
On a vu les rgles qui rigidifient le contrat (on enlve les droits au bailleur), maintenant voyant les
rgles qui tendent rendre le rgime contractuel plus souple (on ajoute les droits au bailleur).
Hypothse :
Les fonds est exploit pour lactivit commerciale dune entreprise mais les choses se passent mal
(vache folle pour un boucher par exemple).
Quelles sont les difficults auxquelles ont va tre confront ?
Si on veut modifier le contenu contractuel, il faut modifier la loi du contrat, article 1134 du code civil,
intangibilit du contrat, ce que lon ne veut pas modifier, rvoqu avec consentement mutuel.
Il faut adopter la mme procdure que celle de sa cration, les parties doivent saccorder pour
modifier le contenu du contrat
Mais finalement si on voit le contrat de bail commercial comme un contrat donnant droit
lexploitation dun fonds, changer dactivit commerciale ne change finalement rien.
Se pose la question de la dspcialisation :
Possibilit offerte au preneur de modifier unilatralement le contenu du contrat afin de modifier la
destination des lieux lous.
Le but tant de passer dune activit commerciale une autre et le moyen est la dspcialisation. De
ce point de vue, on doit aller au del de la modification de laccord lui-mme. Il va falloir faire
quelques amnagements (les nons pour clairer de la barbaque convient moins pour clairer des
fringues). Il faut donc modifier les prvisions contractuelles. On modifie le risque contractuel, cest
un facteur de souplesse mais cre un risque pour le bailleur.
La encore lintroduction dune telle facult pour le preneur doit transiger entre la ncessaire
souplesse du contrat et le danger de la modification.
On distingue la dspcialisation partielle dune part et la dspcialisation totale.
A) La dspcialisation partielle.
Le principe est tirer avec les articles L145-47 et 48.
L145-47 : Le locataire peut adjoindre lactivit prvu au bail des activits connexes ou
complmentaires. On nous parle dadjonction. La dspcialisation partielle est une extension dune
activit qui existait dj, raison pour laquelle cest une facult laisse au preneur.
Deux remarques :
-Il y a une procdure des formalits.
-Sur le fond, le problme va bien tre de dfinir ce quest une activit connexe ou complmentaire.
Evidemment en face de ce genre de situation la jurisprudence nous donne une aide qui est
casuistique.
Si une activit nest pas complmentaire, elle peut tre connexe. Lide de connexit est un peu plus
loigne que lide de complmentarit. Cest peut-tre lide de laccessoire. Elle peut simplement
tre dfinie abstraitement comme un lien dune nature particulire et on est capable dtablir un lien
suffisamment tangible pour quun rapport soit fait entre deux lments.
On pourrait parler de connexit pour celui qui exploite un htel, un restaurant dans un immeuble
voir la complmentarit. La diffrence entre connexit et complmentarit est assez difficile saisir.
Un critre plus fiable, cest lide dadjonction. On veut ajouter une activit et non la remplacer par
une autre. On rduit le champ des problmes.
Le problme est que quand on exerce dans un mme local deux activit diffrentes, y a-t-il un lien
entre les deux ?
Le problme tant dobtenir ou pas lautorisation et donc de la solliciter. On passe de la
dspcialisation totale lorsque lautorisation est qui est requise doit tre motive.
B) La dspcialisation totale
L145-48 : La grande diffrence ici, cest quon nous parle de consentement du bailleur quil faut
obtenir ici car la modification de lactivit est radicale.
Sil y a une autorisation requise, quelles en sont les consquences ?
Si on impose de motiver un lment objectif, cest que forcment on pense exercer un contrle de
cette motivation et on trouvera ce contrle larticle L145-52, texte qui dispose que le TGI peut
autoriser la transformation totale ou partielle si ce refus nest point justifi par un motif grave et
lgitime.
La demande doit tre motive, le refus aussi. La dspcialisation partielle peut-tre conteste par le
bailleur si linformation du bailleur est prvue.
Remarque :
On conseillera au preneur dviter une dspcialisation totale dans les trois premires annes du bail
commercial parce que le droit au renouvellement est subordonn lexploitation commerciale dune
dure de 3 ans.
Section 2 : La protection des intrts du bailleur
On examinera ici le rgime du prix du contrat, c'est--dire des loyers.
Plusieurs directions viennent lesprit si lon songe aux moyens dassurer les intrts du bailleur, on
veut faire varier les prix du contrat. On va amnager des rgles relatives au prix.
La dtermination du loyer, son principe, cest la libert la plus totale, il ny a pas de rgles qui
encadrent la dtermination du prix initial du contrat.
L145-33 et suivants.
Il nest pas fait mention du prix du loyer initial mais il est question des loyers des baux
renouvellements ou rviss. Ce qui intresse le lgislateur ce sont les variations du prix.
Le principe est clair :
Le prix est libre sauf partir du moment ou lon rvise le prix ou que lon renouvelle le contrat, et l
le critre de dtermination du prix est la valeur locative.
Les lments qui permettent de dfinir la valeur locative sont envisags par le texte.
Hypothse :
Nous arrivons au terme du bail, c'est--dire 9 ans, le preneur entend rester dans les lieux,
renouvellement mais ce moment l il faut parler du prix, il est logique que dans ces conditions, il
soit possible de parler du prix.
La deuxime chose que nous dit le texte est la rvision du loyer.
Il faut savoir que la rvision est de droit larticle L145-38 qui prvoit que la demande en rvision ne
peut tre forme que 3 ans au moins aprs la date dentre en jouissance.
On comprendre quon peut former une demande en rvision autant le preneur ou le bailleur en la
sollicitant compter dune dure minimale de jouissance de 3 ans. On peut rediscuter les conditions
au terme du renouvellement ou de la rvision. A ce moment l, les modalits de discussion et de
variation du prix sont clairement ancres dans lide de valeur locative.
Article 145-33
Vous aimerez peut-être aussi
- Droit Des Affaires Cours CompletDocument196 pagesDroit Des Affaires Cours CompletAriel Bitton100% (5)
- Evolution Du Droit CommercialDocument24 pagesEvolution Du Droit CommercialSoukaïna Ziouani100% (3)
- PR Selma El Hassani Sbai COURS DROIT COMMERCIAL PDFDocument106 pagesPR Selma El Hassani Sbai COURS DROIT COMMERCIAL PDFRed WanePas encore d'évaluation
- Cours Droit Des Affaires Version FinaleDocument27 pagesCours Droit Des Affaires Version FinaleOthmane Eddahi100% (1)
- Exposé Sur Les Specifitée Du-Droit-Des-AffairesDocument108 pagesExposé Sur Les Specifitée Du-Droit-Des-AffairesnabilusRC50% (4)
- Droit Commercial Du MarocDocument142 pagesDroit Commercial Du MarocMed Benali Balahcen100% (3)
- Cours Droit DES AFFAIRESDocument106 pagesCours Droit DES AFFAIRESsr9ofzki100% (2)
- Droit CommercialDocument24 pagesDroit CommercialIs SamPas encore d'évaluation
- Le Droit CommercialDocument46 pagesLe Droit CommercialJEAN OUMAR THIANE100% (1)
- Le Droit Commercial s2Document30 pagesLe Droit Commercial s2Mostafa Taby50% (2)
- Droit des sociétés commerciales et coopératives dans l'espace OHADAD'EverandDroit des sociétés commerciales et coopératives dans l'espace OHADAPas encore d'évaluation
- Énergétique Du BatimentDocument223 pagesÉnergétique Du Batimentbaccar_ichraf238892% (12)
- Cours de Droit Commercial BassimeDocument43 pagesCours de Droit Commercial BassimeKhalidAG100% (2)
- Droit Des Affaires (Complet)Document127 pagesDroit Des Affaires (Complet)Hadrien DorelPas encore d'évaluation
- Les Sources Du Droit CommercialDocument11 pagesLes Sources Du Droit Commercialunknown81Pas encore d'évaluation
- Cours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialeDocument69 pagesCours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialePitchoune628950% (2)
- Comprendre et appliquer le droit du travailD'EverandComprendre et appliquer le droit du travailÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Le gage sur actions: Constitution, utilisation, réalisation et limitationsD'EverandLe gage sur actions: Constitution, utilisation, réalisation et limitationsPas encore d'évaluation
- La constitution d'une société par le titulaire d'une profession libérale: (Droit belge)D'EverandLa constitution d'une société par le titulaire d'une profession libérale: (Droit belge)Pas encore d'évaluation
- L'Ohada et le secteur informel: L'exemple du CamerounD'EverandL'Ohada et le secteur informel: L'exemple du CamerounÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Droit des affaires et sociétés: Actualités et nouveaux enjeux (Droit belge)D'EverandDroit des affaires et sociétés: Actualités et nouveaux enjeux (Droit belge)Pas encore d'évaluation
- Droit CommercialDocument73 pagesDroit CommercialOussama1120100% (2)
- Résumé de Droit Commercial MarocainDocument10 pagesRésumé de Droit Commercial MarocainSaloua Ben67% (12)
- Cours de Droit Des Societes-Nouvelle-VersionDocument64 pagesCours de Droit Des Societes-Nouvelle-VersionMohamed ZahrouniPas encore d'évaluation
- Les Actes de Commerce Marocai1Document5 pagesLes Actes de Commerce Marocai1Fatima zahraePas encore d'évaluation
- Résumé de Droit CommercialDocument4 pagesRésumé de Droit CommercialRania Khms67% (3)
- Droit CommercialDocument78 pagesDroit CommercialKarimPas encore d'évaluation
- Droit CommercialDocument10 pagesDroit CommercialMÕhãmêdFîlãLîPas encore d'évaluation
- Le Fonds de Commerce Au MarocDocument10 pagesLe Fonds de Commerce Au MarocBrahim's GhoostPas encore d'évaluation
- Droit Des SociétésDocument15 pagesDroit Des Sociétésbintmila100% (1)
- Chapitre 1 Droit Commercial PDFDocument9 pagesChapitre 1 Droit Commercial PDFAymane ZidaniPas encore d'évaluation
- Resumé Droit CommercialDocument10 pagesResumé Droit CommercialawabPas encore d'évaluation
- Droit Des SociétésDocument173 pagesDroit Des SociétésHassanElbohaly100% (2)
- Droit CommercialDocument56 pagesDroit CommercialIman NouriPas encore d'évaluation
- Droit Des Affaires Maroc - Livre I Version 2009-2010Document48 pagesDroit Des Affaires Maroc - Livre I Version 2009-2010redog007Pas encore d'évaluation
- Droit Des Affaires ASSASDocument80 pagesDroit Des Affaires ASSASBakor Al-tayar100% (19)
- Cours de Droit Des Affaires DROIT COMMERCIAL S5 PDFDocument226 pagesCours de Droit Des Affaires DROIT COMMERCIAL S5 PDFwidad amzaPas encore d'évaluation
- Droit Commercial SynthèseDocument66 pagesDroit Commercial SynthèseGaetanoPas encore d'évaluation
- Cours Droit Des Affaires S5-2021Document40 pagesCours Droit Des Affaires S5-2021Mr SiMO Press67% (3)
- Commerce InternationalDocument13 pagesCommerce InternationalDalal HalPas encore d'évaluation
- Droit CommercialDocument181 pagesDroit CommercialMeriemFadil100% (3)
- Droit Des SociétésDocument57 pagesDroit Des SociétésKarim100% (3)
- Droit CommercialDocument81 pagesDroit Commercialtibo74Pas encore d'évaluation
- Cours de Droit CommercialDocument114 pagesCours de Droit CommercialSoukaina Moumen100% (2)
- Résumé Droit CommercialDocument5 pagesRésumé Droit CommercialKHALID RGPas encore d'évaluation
- Cours-Droit CommercialeDocument43 pagesCours-Droit Commercialemekdis86% (22)
- Introduction Au Droit FSJES SaléDocument100 pagesIntroduction Au Droit FSJES SaléHamza Glili100% (1)
- Résumé Droit Commercial s4Document5 pagesRésumé Droit Commercial s4Asmaa Lahouaoui100% (8)
- Droit Commercial S4 Économie ABBOURDocument23 pagesDroit Commercial S4 Économie ABBOURMahfoudi Mohamed100% (1)
- Droit SocialDocument28 pagesDroit SocialABDELILAH TERTAPas encore d'évaluation
- Cours Droit Des SociétésDocument16 pagesCours Droit Des SociétésTaha Can75% (8)
- Droit Du Commerce InternationalDocument60 pagesDroit Du Commerce InternationalJulien ChaouatPas encore d'évaluation
- Exposé Droit CommercialDocument12 pagesExposé Droit CommercialMeryem Imourig100% (1)
- Fac DT Des Sociétés 2017Document111 pagesFac DT Des Sociétés 2017Ilyass ElmouhahPas encore d'évaluation
- Droit Des AffairesDocument99 pagesDroit Des AffairesSaid FaroukiPas encore d'évaluation
- Droit Des Societes TD 2015Document73 pagesDroit Des Societes TD 2015Drinima NezhaPas encore d'évaluation
- Resume de Droit Commercial MarocainDocument16 pagesResume de Droit Commercial MarocainAbdo Slimane50% (2)
- Présentation PP-LF 2019 ImprimableDocument145 pagesPrésentation PP-LF 2019 Imprimableenarkom echouatPas encore d'évaluation
- Devoirs de VacancesDocument3 pagesDevoirs de VacancesAkil MhannaPas encore d'évaluation
- Expose AccidentsDocument39 pagesExpose AccidentsMOHAMED CHERIF SARRAPas encore d'évaluation
- HammadaDocument6 pagesHammadakhalidlkkkPas encore d'évaluation
- TP DRAGSTER de Compétition BDocument5 pagesTP DRAGSTER de Compétition Blucasblondelle8Pas encore d'évaluation
- MAS57Document121 pagesMAS57chawki bagouziPas encore d'évaluation
- CP Fonciere Magellan ColivimDocument4 pagesCP Fonciere Magellan ColivimanisPas encore d'évaluation
- CSN Thematique Risques BiologiquesDocument2 pagesCSN Thematique Risques BiologiquesMery MansouriPas encore d'évaluation
- 2023-24 Convocation L1sps S1 Parcours 04 SC Terre Et UniversDocument1 page2023-24 Convocation L1sps S1 Parcours 04 SC Terre Et Universjonasserfaty12Pas encore d'évaluation
- 2 TéléinformatiqueDocument15 pages2 Téléinformatiqueahmed guenouzPas encore d'évaluation
- Projet Info 2ADocument36 pagesProjet Info 2AMohamed AssiliPas encore d'évaluation
- FAQ MaximeDocument2 pagesFAQ MaximeSerge Donaldr OptimiserPas encore d'évaluation
- Wa0005.Document1 pageWa0005.Boubalgha MohamedPas encore d'évaluation
- Bilan Articles ExercicesDocument3 pagesBilan Articles ExercicesLoredana Vancia0% (1)
- Cerfa 16119-01Document8 pagesCerfa 16119-01BORIS ANOUEPas encore d'évaluation
- Docker - Tout Savoir Sur La Plateforme de ContainérisationDocument34 pagesDocker - Tout Savoir Sur La Plateforme de Containérisationmoisendiaye245Pas encore d'évaluation
- Marché Des CapitauxDocument20 pagesMarché Des CapitauxLardia Marcel ThiombianoPas encore d'évaluation
- Slides Modele RelationnelDocument138 pagesSlides Modele RelationnelMakhmout Sy100% (2)
- Cahier de Charge Suivi Des CommerciauxDocument4 pagesCahier de Charge Suivi Des CommerciauxBOKOVI CHRISTOPHEPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°1 (Avec Correction) Lycée Pilote - Technologie Poste Automatique de Poinçonnage - 1ère AS Toutes Sections (2013-2014) MR Ghanem GhanemDocument4 pagesDevoir de Contrôle N°1 (Avec Correction) Lycée Pilote - Technologie Poste Automatique de Poinçonnage - 1ère AS Toutes Sections (2013-2014) MR Ghanem GhanemmaherPas encore d'évaluation
- Avant ProjetDocument20 pagesAvant ProjetFouad DimanePas encore d'évaluation
- Comparaison Multiples de MoyennesDocument6 pagesComparaison Multiples de Moyennesmousdo100% (1)
- Dave Weckl-Tower of Insp-SheetMusicCCDocument2 pagesDave Weckl-Tower of Insp-SheetMusicCCPaulDaamenPas encore d'évaluation
- Cours 2 - Master Audit (Techniques Comptables) PDFDocument18 pagesCours 2 - Master Audit (Techniques Comptables) PDFAli AfirPas encore d'évaluation
- Contrôle Microbiologique Des AlimentsDocument5 pagesContrôle Microbiologique Des Alimentsksenouci0% (1)
- TP-3 - VLANs - VTPDocument5 pagesTP-3 - VLANs - VTPMed Nour Elhak JouiniPas encore d'évaluation
- CV Dakki - Oct 2009 PDFDocument26 pagesCV Dakki - Oct 2009 PDFMohamed FrkPas encore d'évaluation
- RattrapageDocument8 pagesRattrapageridwane biyaoPas encore d'évaluation
- T.P Langage AssembleurDocument6 pagesT.P Langage Assembleurababele jacques100% (1)