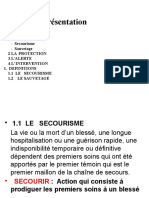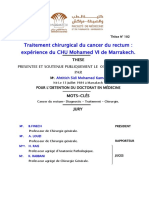Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Premiers Secours PDF
Premiers Secours PDF
Transféré par
Ludo DurantTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Premiers Secours PDF
Premiers Secours PDF
Transféré par
Ludo DurantDroits d'auteur :
Formats disponibles
LE SECOURISME ET LES
GESTES LMENTAIRES DE
SURVIE
Houcine KHALDI
Direction et Coordination
Professeur Ahmed SBIHI
Conception et Ralisation
Younes EL GAF
LE SECOURISME ET LES
GESTES LMENTAIRES DE
SURVIE
SOMMAIRE
PREAMBULE 9
PREFACE 10
INTRODUCTION 12
CHAPITRE I : ORGANISATION DES SECOURS 14
I.1- PLANS DURGENCE - Module M
1
14
I.1.1- Plan Orsec 14
I.1.2- Plan Rouge 15
I.1.3- Le Plan Blanc 16
I.1.4- Le plan de mise en alerte des services hospitaliers 17
I.2- MEDECINE DURGENCE PREHOSPITALIERE
Module M
2
18
I.2.1- Le SAMU : 18
I.2.2- Le SMUR : 18
I.2.3- Le centre 15 ou la protection civile 19
I.2.4- La direction des hpitaux et des soins ambulatoires 19
I.3- LINTERVENTION SUR LES LIEUX DU SINISTRE
Module M
3
20
I.3.1- Catgorisation des blesss graves en prhospitalier 20
I.3.2- Le systme franais de secours et soins prhospitaliers 21
I.3.3- Le systme amricain de secours et soins prhospitaliers 21
I.4- EVALUATION INITIALE DU BLESSE - Module M
4
22
I.4.1- Mise en condition et stabilisation du bless 22
I.4.2- Protection et balisage : 23
I.4.3- Dgagements durgence et mesures de sauvegarde 41
I.4.4- Techniques de dgagement 42
I.4.5- Retrait du casque intgral deux sauveteurs 44
I.4.6- Retrait du casque intgral un seul sauveteur 45
I.5- RECONNAISSANCE, SURVEILLANCE
ET BILAN D'UNE DETRESSE - Module M
5
46
I.5.1- La fonction ventilatoire (la respiration) 46
I.5.2- La fonction circulatoire 47
I.5.3- La fonction neurologique 48
CHAPITRE II : TECHNIQUES ET GESTES
ELEMENTAIRES DE SURVIE (GES) 50
II.1- LIBERTE DES VOIES AERIENNES
SUPERIEURES (LVAS) - Module M
6
51
II.1.1- Bascule de la tte en arrire avec soutien du menton 51
II.1.2- Ouverture buccale par la manuvre des doigts croiss 52
II.1.3- Pro-traction de la mandibule 52
II.1.4- Subluxation de la mandibule 52
II.1.5- Risques et accidents des gestes de la LVAS 53
II.1.6- Vrification de lefficacit de la libert des VAS 53
II.2- TECHNIQUES ELEMENTAIRES DE VENTILATION
ARTIFICIELLE PAR VOIE ORALE - Module M
7
54
II.2.1- Le bouche bouche (BAB) 54
II.2.2- Le bouche bouche et nez chez le nouveau n
et le nourrisson 55
II.2.3- Le bouche nez 56
II.2.4- Les risques de contamination 57
II.3- OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES
PAR UN CORPS ETRANGER (la toux artificielle)
Module M
8
58
II.3.1- Lextraction digitale dun corps tranger 58
II.3.2- Les tapes dorsales 59
II.3.3- La manoeuvre DE HEIMLICH 59
II.3.4- Les compressions thoraciques basses 61
II.4- MASSAGE CARDIAQUE EXTERNE (MCE)
PAR COMPRESSIONS THORACIQUES
EXTERNES - Module M
9
63
II.4.1- La technique du MCE par la pompe cardiaque 64
II.4.2- La dfibrillation prcoce 67
II.4.3- Les nouvelles modalits des techniques du MCE 68
II.4.4- La dcision darrt du massage cardiaque externe 69
II.5- CONTROLE DUNE HEMORRAGIE
SANS MATERIEL MEDICAL - Module M
10
70
II.5.1- Lappui sur la plaie est possible 70
II.5.2- Les points de compression artrielle distance 72
II.5.3- Le garrot artriel 74
II.6- LINSTALLATION DES MALADES ET DES
BLESSES EN POSITIONS ELEMENTAIRES
ET POSITIONS DATTENTES - Module M
11
77
II.6.1- Le dcubitus dorsal (D.D) 77
II.6.2- La position demi assise 77
II.6.3- La position latrale de scurit (PLS) 78
II.7- LA COUVERTURE DE SAUVETAGE
Module M
12
80
II.8- LES PROBLEMES SPECIFIQUES
POSES PAR LE TRANSPORT - Module M
13
81
II.8.1- les manipulations et les mobilisations diverses 81
II.8.2- Les acclrations et les dclrations 81
II.8.3- Les chocs et secousses 82
II.8.4- Les vibrations 82
II.8.5- Les bruits 82
II.8.6- Les agressions thermiques 82
II.8.7- Le vhicule, moyen de transport 82
CONCLUSION 83
REFERENCES 84
7 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Prambule
Il n'y a pire frustration que celle de perdre une vie humaine alors qu'un
geste simple aurait peut-tre pu la sauver. Toute la structure du secourisme
repose sur ce principe en offrant une panoplie de gestes pouvant intervenir
dans les cas d'urgence.
Sans tre forcment labors et gnralement la porte de tous, de
telles pratiques font partie des connaissances de base inculques dans un
certain nombre de pays dans les coles et les structures d'enseignement, alors
que des campagnes d'apprentissage sont organises au profit de toutes les
personnes intresses.
Enseignant l'Institut de Formation aux Carrires de Sant, Monsieur
Houcine KHALDI a le mrite de faire germer une premire semence pour
l'mergence d'une culture de secourisme au Maroc. L'ouvrage auquel il s'est
consacr en porte le tmoignage, tandis que le style et la cohrence refltent
la qualit didactique et pdagogique de l'auteur.
A nos yeux, ce genre d'initiatives s'inscrit parfaitement dans la dynamique
que le Ministre de la sant tente d'impulser au systme des urgences au
Maroc. Grce aux efforts dploys dans ce sens, les prmisses de Systmes
d'Assistance Mdicale des Urgences (SAMU) commencent voir le jour et
un travail de fond, actuellement en cours, laisse prsager de leur mise en
place prochainement.
Toutefois, toute cette architecture ne serait efficacement oprante sans la
matrise des premiers gestes de secours qui reprsentent une part dterminante
dans les chances de survie de la personne en situation d'urgence. C'est
pourquoi, dans l'arsenal des mesures prvues pour la cration des SAMU, une
large place est rserve la formation du personnel charg des vacuations
dans les gestes qui sauvent.
Cet ouvrage intervient donc point nomm pour offrir tout un chacun le
privilge de possder les rflexes et les automatismes ncessaires pour porter
assistance toute personne dans le besoin. Et, cet gard, il mrite toutes
nos louanges.
Thami EL KHYARI
Ex Ministre de la sant
8 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie Le secourisme et les gestes lmentaires de survie 9
Prface
Chaque anne, plus de 80 milles personnes au Maroc sont victimes d'un
accident de la voie publique et plus de 3700 en meurent. A cela s'ajoutent
les catastrophes de plus en plus frquentes et les accidents de la vie courante
(chutes, chocs, brlures, lectrocutions, noyades, intoxications et autres
accidents) auxquels, quotidiennement la population marocaine est expose.
Comme Marocains, nous attachons une grande importance notre sant et
notre systme de soins et nous savons galement qu'en grant les risques
actuels et ceux qui pointent, nous aiderons notre population mieux se
prmunir afin d'tre moins vulnrable aux risques majeurs qui rsultent des
changements rapides survenant dans notre collectivit et qui constituent un
vritable enjeu de sant publique avec de nouveaux dfis relever pour notre
systme de sant.
Aujourd'hui, il est largement admis que les gestes de sauvetage et de
secourisme doivent tre prodigus sur les lieux mme de l'accident avant
mme l'intervention des quipes spcialises de secours. Un grand nombre
de dcs pourrait tre ainsi vit si les tmoins taient forms intervenir en
attendant l'intervention des secours mdicaliss. Toutes les tudes montrent
que le pronostic vital est troitement li la rapidit de l'alerte et l'efficacit
des actions entreprises avant l'arrive des secours spcialiss.
En effet, l'action initiale devant la grande majorit des situations de dtresse
repose sur quelques gestes simples, ralisables sans matriel autre qu'un
tlphone (dans ce cadre l'avnement des tlphones mobiles est un don du
ciel) et deux mains, mais qui ncessitent nanmoins, un apprentissage et un
changement de comportements adapt pour rpondre aux besoins de toute
situation de dtresse.
Aussi, que vous soyez un parent qui se proccupe de la sant de ses proches,
un bnvole auprs d'une ONG caritative dans le secteur de la sant,
un professionnel de sant, un scientifique, un enseignant ou toute autre
personne, la connaissance des gestes lmentaires de survie devient une
obligation pour tout citoyen qui peut un jour se trouver confront un tel
vnement mais ce que les gens ignorent c'est qu'ils constituent trs souvent
le premier maillon de toute une chane de secours : " la chane de survie "
car, trs souvent sans le savoir, ils sont les seuls pouvoir immdiatement
intervenir de manire dcisive.
Cette situation nous interpelle pour uvrer, dans un cadre multisectoriel,
l'laboration d'une stratgie d'enseignement des gestes qui sauvent, c'est
dire des gestes lmentaires de survie que se soit au niveau des facults de
mdecine et de pharmacie, des tablissements de l'enseignement primaire et
secondaire ou en milieu professionnel. L'objectif de cet enseignement visera
principalement l'acquisition de notions essentielles de secours aux personnes
en situation de dtresse vitale, travers un enseignement bref, pratique,
limit l'urgence vitale et assimilable par tous.
Enfin, que Monsieur Houcine KHALDI trouve ici l'expression de mes
encouragements et mes sincres souhaits de russite. Un tel travail,
simple, didactique, constitue sans aucun doute un apport non ngligeable,
particulirement un moment o notre pays se prpare laborer une
vritable stratgie de gestion des catastrophes et des urgences. Dans ce cadre,
le volontariat, dont les secouristes volontaires jouent un rle d'appoint, est
d'une importance capitale.
Mohamed Cheikh BIADILLAH
Ministre de la Sant
11 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Evaluation initiale et conduite tenir en prsence dune victime :
arbre dcisionnel permettant de conduire au bon geste
Protger la victiome, les tmoins et le sauveteur
(module M1, M2)
Examen de la victime
(module M3)
CAT
Victime sans dtresse vitale
Transport, couvertures de sauvetage
(module M4, M12 et M13)
Saignement ? OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
Compression
(module M10)
Consciente ?
(module M5)
L.V.A.
(module M6)
Position latrale
de scurit (module M11)
Ventilation artificielle
(module M8)
Massage cardiaque
externe (module M9)
2 insufflations
(module M7, M8)
Respire ?
Pouls ?
10 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
INTRODUCTION
Le secourisme, ou les premiers gestes lmentaires de survie, est
lensemble des gestes pratiques simples qui peuvent prvenir le danger de
mort immdiate, rendre le bless transportable vers un centre hospitalier et
rduire les consquences immdiates et tardives des blessures.
Chacun, dans la vie quotidienne, la maison, au travail, dans les activits
de loisirs, peut tre confront une situation de dtresse ou un accident.
Toutes les tudes montrent que le pronostic vital est troitement li
lintervention de tmoin dun accident par la rapidit de lalerte et lefficacit
des actions entreprises avant larrive des secours spcialiss.
La loi Marocaine fait obligation tout citoyen que sans risque pour lui, ni
pour les tiers de porter assistance une personne en pril, soit par une action
personnelle, soit en dclenchant un secours et punit labstention de peines
damende et de lemprisonnement de trois mois cinq ans ou lune de ces
deux peines (article 431 du code pnal, Dahir n 1-59-413 du 28 Joumada II,
26 Nov. 1962).
Le but de ce document est de faire de chaque tmoin un sauveteur
potentiel. Pour les professionnels de sant, il constitue un rfrentiel pour
lexercice de leur art auprs des victimes et sinistrs en dehors de lhpital.
Ce document se prsente en deux parties qui se veulent cohrentes et
logiques par rapport aux tapes de la chane de secours.
La premire partie dont lobjectif semble avant tout didactique et
pdagogique prsente une stratgie pragmatique organisationnelle en cas
de sinistre et vulgarise les termes de loxyologie, la connaissance du cadre
dinterventions, les types de plans dorganisation de secours et les schmas
de commandement.
La deuxime partie situe les cas dassistance urgente sans matriel
mdical. Lampleur de cette partie, largement illustre, a t consentie dans
le but de fournir aux secouristes, aux tudiants, aux intervenants et aux
diffrents acteurs de lurgence, llment essentiel quest la ralisation des
gestes de survie.
13 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
division prfectorale ou provinciale de la protection civile et, comprenant
les chefs des six services composant le groupement mobile dintervention
(GMI) et la cellule de direction du plan ORSEC.`
Ces six services sont
- Liaisons et transmissions (services des transmissions tlphoniques et
cellulaires)
- Police, Gendarmerie Royale (maintien de lordre)
- Secours, sauvetage (Protection Civile, Pompiers, FAR, Forces
Auxiliaires)
- Soins mdicaux (Ministre de la Sant, Croissant Rouge Marocain
CRM)
- Transport, travaux (quipement, FAR, ONE, ONEP)
- Accueil et hbergement (ONG, Associations, CRM)
I.1.2- Plan Rouge
Il assure lorganisation des secours pour des catastrophes effets limits
provoquant des victimes (> 10 en gnral) : accidents de la voie publique,
explosions, effondrements ou en prsence de victimes polyagresses (risque
technologique, chimique, pollution).
Le plan rouge est dclench par le gouverneur, la direction des soins repose
sur deux responsables aux fonctions bien distinctes, mais qui travaillent en
parfaite collaboration :
- Le directeur des secours a en charge la lutte contre le sinistre, lextinction
dun feu, la localisation des victimes, les travaux de dgagement ou de
franchissement, la dsincarcration, le dblaiement, le sauvetage et la mise
en scurit.
- Le directeur des secours mdicaux (DSM) gre la prise en charge mdicale
des victimes et survivants et assure la mise en place et le fonctionnement de
la chane mdicale de secours.
Le plan rouge est caractris par la rapidit de la mise en place des
moyens de secours et dune organisation sanitaire qui repose sur :
- Une quipe dintervention rompue aux techniques durgence et lutilisation
des moyens de tlcommunication. Cette quipe est forme de secouristes,
de mdecins, dinfirmiers, de brancardiers, dambulanciers facilement
identifiables aux moyens de brassards ou de chasubles de couleurs diffrentes
selon leurs fonctions. Ils assurent la relve des victimes et leur transfert vers
un centre de tri, sous contrle mdical. Ce premier transfert constitue la
petite NORIA de ramassage.
NORIA est un mot dorigine arabe (N Ora).
12 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Il est admis actuellement quune catastrophe est une situation ralisant
une inadquation entre le nombre de victimes et les moyens de secours
immdiatement disponibles. Une catastrophe gnre un afflux massif et
brutal de blesss survenant dans un contexte de crise o rgnent linscurit,
le dsordre et le chaos. Toute organisation en cas dafflux de nombreuses
victimes repose sur des plans de secours prtablis. En effet limprovisation
nest pas de mise dans de telles situations rares mais prvisibles. Il faut
disposer des plans de secours la fois prcis ou plutt prciss par
lexprience et la simulation.
Les pouvoirs publics ont ainsi mis en place des plans durgence prtablis,
polyvalents pour faire face ces prils. Le tronc commun de ces plans est
prsent par la chane de secours qui est le dispositif qui permet lors dun
sinistre de raliser :
- Lalerte et le balisage
- Le ramassage des blesss " blesss techniqus "
- La ralisation des premiers soins " gestes de survie "
- Le tri et lvacuation des victimes dans lordre de lurgence
- Laccueil des victimes lhpital
- La rgulation mdicale
I.1- MODULE M
1
: PLANS DURGENCE
I.1.1- Plan Orsec
Le Plan Orsec ou organisation provinciale des secours, concerne les
catastrophes tendues qui affectent gravement la vie normale des populations.
Il est dclench et dirig par le gouverneur ou le wali de la province ou de la
wilaya concerne par le sinistre. Il permet la rquisition des moyens et des
personnes ncessaires la gestion de la crise. Pour remplir cette mission le
gouverneur ou le wali dispose dun tat major sous lautorit du chef de la
CHAPITRE I
ORGANISATION DES SECOURS
15 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
I.1.4- Le plan de mise en alerte des services hospitaliers
A lhpital, le plan blanc organise laccueil des victimes ; cette organisation
est centre sur le plan de mise en alerte des services hospitaliers (MASH) qui
comprend :
- La mobilisation des diffrents intervenants et la rpartition de leurs
tches,
- lidentification dun circuit diffrent de celui habituel des urgences qui ne
doit pas tre utilis par le MASH
- La cration de zones dexception de rception et lamnagement de
surfaces de dgagement (hall dentre, amphi, salle de rveil, caftria)
permettant linstallation de brancards, de matriel de soins et de lots de
ranimation,
- La ralisation dun flchage spcifique :
* ANACOR = antenne daccueil et dorientation
* SAU = service daccueil des urgences, un accs dgag et un
parking pour ambulances
* Un centre de communication et dinformation : famille, autorit,
mdias ont droit linformation ; une seule source autorise, un
seul discours prcis et courtois.
- La participation des services de diagnostic : radiologie, laboratoire et
de services de logistique : cuisine, lingerie, crche
14 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Un poste mdical avanc (PMA) ou centre de tri primaire et de
catgorisation des blesss en : clops, urgence extrme et urgence relative.
Il est plac proximit du sinistre en zone sre. Le PMA est la structure de
la chane mdicale en cas de sinistre grave, elle est anime par des mdecins
du SAMU et par lquipe dintervention. Les victimes sont regroupes dans
plusieurs PMA o ils reoivent les premiers soins avant dtre vacus vers
le centre mdical dvacuation. Ce deuxime transfert constitue la petite
NORIA dvacuation.
- Le centre mdical dvacuation (CME) : cest le point de rpartition des
vacuations. Ce centre est situ en retrait de la catastrophe. Il sintercale entre
les PMA et les structures hospitalires daccueil. Le CME est implant sous
tente ou dans des modules utilisant parfois des locaux en dur disponibles
sur place. Il est compos dune zone de rvision du tri, dun poste de mise
en condition, dun secteur de ranimation et gestes de chirurgie durgence et
dun sas dattente dvacuation. Lvacuation des victimes vers les structures
hospitalires constitue la grande NORIA.
Outre le plan rouge, certains entreprises industrielles risque (industrie
chimique, raffinerie, aroports...) sont dotes de plans dopration internes
(POI) o seul le personnel de lentreprise est sollicit et des plans particuliers
dintervention (PPI) ncessitant la collaboration de tous les moyens extrieurs
lentreprise (sapeurs pompiers, SAMU, Protection Civile,). Le POI et le
PPI sont sous la responsabilit du directeur de lentreprise.
I.1.3- Le Plan blanc
Cest un plan daccueil particulier lhpital devant faire face un afflux
de victimes dpassant la capacit habituelle de son service des urgences. Cest
lhomologue du plan rouge au sein des hpitaux. Il relve du directeur de
lhpital. Le plan blanc permet dtablir des rgles pour assurer la meilleure
qualit de soins et la meilleure orientation possible des blesss dans lhpital.
La rpartition des blesss dans plusieurs tablissements permet dviter
lafflux vers un seul hpital. Lhpital le plus proche est tenu en rserve de
dispositif car les victimes ayant quitt les lieux avant larrive des secours
vont sy prcipiter spontanment ou quand les secours prhospitaliers sont
inexistants ou dpasss. Cette ventualit ne correspondrait qu dplacer la
catastrophe des lieux o elle est survenue vers les urgences de lhpital le
plus proche qui va se retrouver submerg.
17 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
infirmier anesthsiste avec son lot de ranimation portable autonome en
nergie, le matriel de transmission, vhiculs par un oxybus adapt la
mission.
Le SMUR est par ailleurs, lexpression originale dune ide travers le
monde : " le soin mdical urgent doit aller sur les lieux de la dtresse, ce nest
pas aux dtresses daller vers le soin". Cest donc lhpital avec ses moyens
de ranimation qui vont chercher la victime ralisant ainsi une chane
mdicale de soins. Le SMUR reprsente dsormais une cole de loxyologie
qui est la science de la mdecine rapide.
I.2.3- Le centre 15 ou la protection civile
La protection civile met la disposition de la population 24H/24 un
numro dappel unique, simple mmoriser, permanent et gratuit le " 15
" pour assurer la permanence de la rponse aux demandes de secours et de
soins.
I.2.4- La direction des hpitaux et des soins ambulatoires
Au niveau national, il nexiste quune seule stratgie appele : plan
dorganisation des secours dfinie dans une circulaire de ministre dEtat
lintrieur (circulaire de 25 janvier 1983 qui modifie et complte la circulaire
de 07 septembre 1966).
La direction des hpitaux est conue selon le dcret n 2-94-285 du
21.11.94 et est constitue de quatre divisions : la division des hpitaux, la
division de lassistance, la division des soins ambulatoires et la division des
urgences et secours ; cette dernire est charge de :
- Dvelopper une stratgie pour lorganisation dun service daide mdicale
urgente lensemble du Royaume
- Contribuer veiller au ramassage mdicalis des victimes daccidents de
la circulation ou autres catastrophes.
- Dfinir les programmes de formation en urgentologie et contribuer leur
ralisation.
- Coordonner une stratgie de restructuration des services des urgences
travers le Royaume et contribuer sa mise en uvre et lvaluer de faon
continue.
16 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
I.2- MODULE M
2
: MEDECINE DURGENCE
PREHOSPITALIERE
I.2.1- Le SAMU :
Le Service dAide Mdicale Urgente est un service mdico-technique
implant dans le centre hospitalier le plus important de la rgion ou de la
province. Il est dirig par un mdecin anesthsiste ranimateur. La principale
mission oprationnelle du SAMU est la rception des appels urgents.
Le SAMU est charg de lcoute permanente des appels daide urgente,
ces appels sont pris en charge par des permanenciers (res) dont le rle est de
dterminer les coordonnes de lappelant, deffectuer une premire analyse
sommaire de la gravit de la situation et de rfrer lappel vers le mdecin
rgulateur du SAMU. Celui-ci doit tre dot de la plus haute comptence
(anesthsiste - ranimateur) pour exploiter au mieux linformation contenue
dans lappel, en posant des questions permettant lestimation prcise de
ltat du patient, en calmant leffet panique du patient. Cest galement
cet organe rgulateur qui aura grer, de la manire la mieux adapte
ltat du patient, laction de secours et ventuellement lorganisation de
laccueil hospitalier des victimes. Le SAMU est aussi impliqu dans la
gestion des situations de " crise " (plan ORSEC, plan rouge), et dans
la formation en urgentologie des mdecins, infirmiers et secouristes. Le
SAMU est dot dun centre denseignement spcialis en urgence (CESU)et
constitue un observatoire remarquable des urgences. Il est actuellement vrai
que le bnfice du SAMU sexprime en vies humaines sauves et que toute
demande dassistance mdicale exige une rponse adapte. La dmarche du
SAMU doit tre rapide, mme si sa description est longue.
I.2.2- Le SMUR :
Le Service Mobile dUrgence et de Ranimation est une unit hospitalire
rattache au SAMU ou au service des urgences, implant dans le principal
hpital rgional. Le SMUR intervient la demande du SAMU pour la prise
en charge lextrieur de lhpital, le ramassage et le transfert des blesss en
tat grave ; cest lintervention primaire en dehors de lenceinte hospitalire;
il peut sagir aussi dun transport secondaire qui constitue toute intervention
au dpart dun service de soins vers un autre service hospitalier de soins
ou de diagnostic. Le SMUR reprsente le moyen oprationnel privilgi du
SAMU et la rponse la plus lourde et la plus sophistique qui puisse tre
apporte un appel durgence en prhospitalier. Le SMUR comprend au
moins une unit mobile hospitalire (UMH), celle-ci correspond lquipe
de ranimation hospitalire anime par un anesthsiste ranimateur et un
19 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
I.3.2- Le systme franais de secours et soins prhospitaliers
Le systme franais par rapport celui qui est en vigueur aux Etats-
Unis, a lavantage de permettre la prsence de mdecins et danesthsistes
directement sur le terrain (mdicalisation des actions de lavant) ce qui
autorise un triage mdical et lemploi de mdicaments et drogues durgence.
Cette prsence mdicale sur le terrain permet de garantir la scurit
dadministration des produits aussi bien en termes de posologie que de
contrle de leurs ventuels effets secondaires. Lorchestration mdicale de
lavant permet une meilleure adquation entre lanalgsie, la ranimation
prhospitalire et le retard dvacuation aux dpens dune meilleure mise en
condition de transfert.
I.3.3- Le systme amricain de secours et soins prhospitaliers
La mdicalisation prhospitalire des urgences graves est particulirement
discute aux Etats-Unis, en effet ces derniers considrent que le maximum
defficacit est obtenu lorsque les malades ou blesss sont amens le plus vite
possible au dpartement des urgences hospitalires. Pour cela leur systme
repose avant tout sur de nombreuses classes dintervenants de diffrents
niveaux, donc de diffrentes comptences. Les infirmiers dans ces quipes
htrognes dintervention rapide assurent la plupart du temps des fonctions
de formateurs - superviseurs ou dquipage dhlicoptres sanitaires. Ces
quipes sont constitues galement de secouristes ou dauxiliaires mdicaux
"paramedics" qui interviennent selon des protocoles standardiss et qui ont
reu une formation spciale sanctionne par une validation initiale de la
licence dexercice et dun contrle de procdures et de squences rgulires
de revalidation et de recertification tous les deux ans.
18 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
I.3- MODULE M
3
: LINTERVENTION SUR LES LIEUX
DU SINISTRE
Le poste mdical avanc (PMA) est la structure de la chane mdicale
de lavant. Les victimes sont regroupes dans ce poste o ils reoivent les
premiers soins et bnficient dun triage mdical qui a une double finalit :
diagnostique et thrapeutique.
La catgorisation des blesss par le triage permet de dresser un ordre
de priorit dvacuation, opposant les urgences absolues risque vital
aux urgences relatives risque potentiel ou fonctionnel, aprs bien sr,
la pratique des premiers gestes thrapeutiques et la mise des blesss en
condition dvacuation.
I.3.1- Catgorisation des blesss graves en prhospitalier
Cette catgorisation comporte 4 degrs durgence utilisant le dlai
propratoire comme critre de classification.
Les urgences absolues comportent 2 niveaux :
- Urgences extrmes : UE, blesss en danger de mort, pour lesquels une
ranimation intensive simpose demble, sans elle tout acte chirurgical serait
illusoire : Priorit 1.
- Urgence U1 : premire urgence, blesss en danger de mort par lapparition
de troubles physiopathologiques irrversibles dont le traitement chirurgical
doit tre effectu dans un dlai de 6 heures : Priorit 2
Les urgences relatives comportent galement 2 niveaux.
- Urgence U2 : deuxime urgence, blesss dont le traitement peut tre diffr au
maximum la 18me heure : Priorit 3
- Urgence U3 : troisime urgence, blesss dont le traitement peut attendre 36 heures,
sous rserve dune mise en condition approprie et rvision du diagnostic en cours
dvacuation : Priorit 4
Quelle que soit limportance des lsions somatiques, une attitude de prise
en charge des lsions psychologiques de stress post-traumatique est organise
: ainsi les victimes susceptibles dvoluer vers la nvrose post-traumatique
sont prises en charge par des cellules durgences mdico-psychologiques
(CUMP) une fois arrives lhpital et lorsque les thrapeutiques somatiques
auront t mises en route.
21 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
POINTS FONDAMENTAUX DE LVALUATION DE LA SITUATION :
- La rgle des " 3s " : Scurit, Scne, Situation.
- La mthode START (Simple Triage And Rapid Transport) en cas de
nombreuses victimes.
- Les gestes lmentaires de conditionnement assurent essentiellement
des mesures de sauvetage des fonctions vitales. La mise en condition va
succder lacte de diagnostic, elle correspond lacte thrapeutique tout
aussi important sinon plus que la catgorisation de lurgence. Cest dire que
le conditionnement engage tout le pronostic.
I.4.2- Protection et balisage :
PROTEGER
Il faut avant tout geste de secours, en fonction de la nature de laccident,
assurer la protection afin dviter un suraccident.
Le suraccident est un deuxime accident qui est provoqu par le premier
ou par ses consquences.
Accident d au gaz
Dans un environnement clos, ou dans une salle a sent le gaz !
- ouvrir la fentre (arer), ventuellement casser les carreaux
- fermer le robinet de gaz
- ne pas utiliser ni briquet, ni allumette
- ne pas allumer de cigarettes
- ne pas provoquer dtincelle
- ne pas toucher llectricit
- si la lumire est allume, la laisser allume
- si la lumire est teinte, la laisser teinte
- si vous avez besoin de tlphoner , aller tlphoner lextrieur
- si lon doit se servir dune lampe lectrique, lallumer lair libre
Accident d llectricit
Ne jamais toucher une victime en contact avec llectricit, car vous
seriez lectrocuts votre tour.
* Courant usage domestique (basse tension)
La plupart des accidents sont ds labsence de mise la terre dappareil
lectrique. Dans ce genre daccident brutalement la victime pousse un cri et
scroule.
20 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
I.4- MODULE M
4
: EVALUATION INITIALE DU BLESSE
Lvaluation initiale est clinique, elle doit tre rpte et compare tout au
long de la chane de secours. La prise en charge dbute donc par un examen
rapide du bless. La connaissance biomcanique des traumatismes est une aide
prcieuse lvaluation initiale et complmentaire du bless. Lobjectif essentiel
est de dtecter une dtresse vitale patente ou potentielle qui ncessite la mise
en uvre des gestes lmentaires de survie ; il est donc illusoire de chercher
tablir un diagnostic prcis qui ne peut tre obtenu qu lhpital par des
examens complmentaires.
I.4.1- Mise en condition et stabilisation du bless
Par bless grave, il faut entendre un bless dont le pronostic vital ou
le pronostic fonctionnel est mis en jeu court ou moyen terme. De ce fait
ds que possible, ce bless est mis labri et immobilis par des matelas
dpression en respectant la rectitude de laxe tte-cou-tronc surtout si le
bless se plaint de douleur rachidienne ou sil est inconscient ; si pas de
contre indication la position dorsale est choisie, cest la position dexamen,
de ranimation et de mise en condition. La tte est sur le mme plan que
les paules. Tout de suite prvenir lhypothermie par le rchauffement et
lutilisation de couvertures isolantes ou de couvertures de sauvetage.
POINTS FONDAMENTAUX DE LVALUATION INITIALE :
Gestes durgence par ordre immuable
A : Airway : voies ariennes suprieures
B : Breathing : respiration
C : Circulation : circulation
D : Disability : tat neurologique
E : Exposure : dvtir, surveiller la temprature, lutter contre
lhypothermie
La rgle VIP (very important person)
Dans labord du malade grave, Weil a propos de considrer tout malade
grave comme tant une VIP pour mettre un certain ordre de priorit dans les
manuvres de ranimation et la revue des trois premiers actes de ranimation
:
V : Ventilate (ventilation, changes gazeux)
I : Infuse (liquide intraveineux)
P : Pompe cardiaque
23 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
adoptes : noyade primaire, noyade secondaire ( un malaise ou une
syncope). La CAT est la mme pour le secouriste. Les lsions sont diffrentes
dans la noyade primaire, selon quil sagit de noyade en eau douce ou en eau
de mer, la conduite est la mme pour le secouriste.
Causes de la noyade
Incapacit maintenir la tte hors de leau, le sujet ne sait pas nager, il
peut sagir aussi de chute accidentelle ou volontaire dans leau. La noyade
reprsente chez lenfant la quatrime cause daccident aprs les traumatismes,
les intoxications et les brlures et le deuxime rang des causes de mortalit
accidentelle.
Que faire dans leau ?
Lessentiel est de dgager au plus tt la tte de la victime du milieu o
sest produit la submersion, puis dobtenir rapidement un plan dappui afin de
pouvoir tendre le noy et dbuter la ranimation. Avant ce stade, les gestes
lmentaires peuvent tres pratiqus (libert des voies ariennes suprieures
au doigt, retirer mucosits, corps tranger, algues, bouche--bouche). Les
noys ncessitent de trs fortes pressions dinsufflation lors de la manoeuvre
du bouche bouche.
Que faire hors de leau ?
Un bilan rapide permet de typer la situation : il doit porter sur la ventilation
(coloration, frquence respiratoire, signes de lutte), la circulation (prsence
de pouls carotidien ou fmoral, frquence cardiaque, marbrures) et ltat
neurologique (conscience, mouvements anormaux). Les lsions traumatiques
sont recherches en particulier au niveau de rachis cervical.
Les gestes non spcifiques sont toujours de mise ne retardant jamais les
gestes de survie : dshabillage, installation labri du vent, schage prudent par
tamponnement sans friction puis enveloppement dans une couverture isotherme;
vacuation de leau dglutie pour amliorer la cintique diaphragmatique. La
manuvre de HEIMLICH nest indique que lorsque labsence de rponse la
ventilation artificielle laisse prsumer lexistence dun corps tranger dans les
voies respiratoires, elle na aucun intrt pour leau contenue dans les alvoles
qui est en fait absorbe en quelques minutes.
22 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Que faire ?
- Empcher lentourage et la famille de se prcipiter sur la victime
- Couper le courant lectrique soit la prise, soit au disjoncteur pour viter
un suraccident et limiter le risque dlectrisation collective.
* Courant usage industriel ou cble de haute tension
Dans la rue, vous vous trouvez devant un cble qui pend et trane au sol, des
personnes se dirigent vers le cble.
Que faire ?
- Empcher les badauds dapprocher
- Rester une distance dau moins 20 mtres de laccident. Le courant diffuse
le long du cble et vous pouvez tre lectrocut sans toucher au cble.
- Llectricit devra tre coupe par les services comptents.
En cas dlectrisation et avant toute mobilisation aprs stre assur que
le courant a bien t interrompu, effectuer les premiers gestes de secours. Un
premier bilan doit tre effectu : valuation de la ventilation, de la circulation
et de ltat neurologique.
De nombreux arrts circulatoires chez les lectrocuts sont ds une
fibrillation (trouble de rythme ne permettant plus au muscle cardiaque
davoir des contractions efficaces). Un branlement thoracique brutal peut
suffire alors faire repartir les battements cardiaques. Pour ce faire, une
fois la victime dgage, avant mme de commencer les deux insufflations
habituelles, le sauveteur frappe un grand coup au milieu de la poitrine
laide de rebord de sa main ou avec son poing ferm. Ensuite il pratique deux
insufflations et vrifie le pouls carotidien. La conduite tenir ultrieure est
fonction des rsultats de lexamen (PSL, VA, VA + MCE).
Dans le cadre dun accident potentiellement grave (chute dchafaudage,
dune chelle ou dun toit), il faut mobiliser le patient avec prcaution, car on
ne peut exclure des lsions graves du rachis. Il peut exister aussi de graves
brlures qui doivent tre nettoyes et enveloppes strilement. Il faut penser
prvenir lhypothermie.
Les noyades
Cest lirruption de liquide dans larbre respiratoire gnrant un syndrome
asphyxique. La noyade survient le plus souvent en contexte accidentel ; le
pronostic dpend de la rapidit et de lefficacit de la prise en charge initiale.
On parle aussi dhydrocution ; actuellement les expressions suivantes sont
25 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- dsinfection de la plaie,
- examiner et valuer la conscience, l'tat respiratoire, le pouls, la tension
artrielle et la temprature,
- surveillance de la prsence d'un ou de plusieurs signes prdictibles de
gravit ou de raction clinique gnralise (frissons, sueurs, rougeur cutane,
temprature > 38, manifestations digestives : nauses, vomissements,
diarrhes, ballonnement abdominal, hypertension artrielle, priapisme, ge
< 10 ans),
- alerter les secours spcialiss et assurer une vacuation dans un service de
soins intensifs.
Le malaise
Un malaise est une sensation pnible et anormale ressentie par la victime
la suite d'un trouble de fonctionnement d'un ou de plusieurs organes.
Que faire devant un malaise ?
- rechercher les signes de gravit du malaise
- interroger la victime sur son tat de sant
- mettre la victime en position de repos
- demander un avis mdical
Les questions poser la victime en tat de malaise ou son entourage :
- Depuis combien de temps sentez-vous mal ?
- Est ce la premire fois que cela vous arrive ?
- Souffrez-vous de maladie ?
- Prenez-vous des mdicaments ?
- Avez-vous eu un accident rcemment ?
Les signes de gravit d'un malaise
Ces signes peuvent tre isols ou associs. Ils peuvent tre exprims
spontanment par la victime ou tre retrouvs lors de l'interrogatoire. Ils
peuvent tre constats par le sauveteur. Ces signes de gravit sont :
- violents maux de tte,
- nauses,
- vomissements prolongs et rpts,
- anomalies du pouls :
difficile sentir
suprieur 130/mn ou infrieur 40/mn pour un adulte
- difficult respirer,
24 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Laccident de circulation
Un accident vient de se produire, vous tes tmoin
Que faire ?
- Garer votre vhicule aprs laccident et distance de celui-ci pour ne pas
gner la circulation
- Allumer les feux de dtresse de votre vhicule
- Couper le contact de votre vhicule
- Faire un balisage de la zone de laccident laide dun triangle de
prsignalisation plac 150 200 mtres avant laccident. Le balisage doit
galement tre effectu aprs laccident sil sagit dune voie double sens
de circulation
- La nuit, utiliser une lampe pour signaler laccident en restant sur le bas-ct
de la route
- Ne pas fumer et empcher de fumer sur la zone de laccident
- Interdire lapproche de la zone de laccident en particulier si un
danger persiste (vhicule transportant des matires dangereuses, risque
dexplosion)
La piqre de scorpion (envenimation scorpionique) est plus frquente
durant les mois chauds avant 9h du matin et aprs 18h, les parties les plus
touches sont les mains et les pieds.
Ce qu'il faut viter
Le centre antipoison du Maroc recommande de :
- de bannir imprativement le traitement traditionnel,
- l'incision et la scarification : risque d'largir la surface de diffusion du venin
avec risque d'infection,
- la succion qui risque d'entraner l'envenimation de la personne qui la
pratique,
- la pose du garrot qui risque d'entraner une gangrne et par consquent une
amputation du membre bless.
Ce qu'il faut faire
- calmer la victime et son entourage,
- paractamol si douleur,
- mettre la victime au repos,
- surveillance des signes locaux au point d'inoculation (douleur, rougeur,
engourdissement local)
27 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Cet tat est caractris par une sensation de malaise, une pleur, des
sueurs, des vertiges, une sensation de faim.
Que faire ?
- Il suffit souvent d'absorber du sucre pour faire cesser le malaise,
- Si la victime rclame du sucre, il faut lui en donner, par exemple sous forme
de boisson sucre.
Ce malaise, l'origine bnin, peut se transformer en malaise grave avec perte
de connaissance si les premiers signes sont ngligs.
Les plaies
Comment reconnatre une plaie simple ?
Une plaie simple est :
- une atteinte superficielle de la peau par coupure, piqre ou raflure,
- saignant peu,
- qui n'est pas situe proximit d'un orifice naturel.
Que faire ?
- Nettoyer la plaie l'eau et au savon,
- Ou la dsinfecter avec un antiseptique non color,
- Si besoin, protger avec un pansement,
- Vrifier le statut vaccinal antittanique,
- Surveiller la plaie jusqu' cicatrisation complte. Si apparat un des signes
de l'infection (rougeur, douleur, gonflement, augmentation de la chaleur
autour de la plaie), il faut consulter un mdecin.
Comment reconnatre une plaie grave ?
Pour reconnatre une plaie grave, il faut rechercher les lments de gravit :
- l'tendue de la plaie suprieure la moiti de la paume de la main du
bless,
- la profondeur. Elle est suspecte en fonction de la cause de la plaie (exemple
: plaie par arme blanche),
- les localisations particulires :
plaie de l'il,
plaie au niveau du cou, de la poitrine, du ventre,
plaie au niveau d'un orifice naturel (bouche, nez, oreille, anus, orifice
gnital ou urinaire),
prsence de corps tranger,
prsence de souillure,
26 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- paralysie d'un ou de plusieurs membres,
- sensation de faiblesse extrme,
- paralysie de la face,
- pleur intense inhabituelle,
- propos incohrents,
- agitation,
- angoisse,
- sueurs abondantes inexpliques,
- douleur serrant la poitrine,
- douleurs abdominales intenses prolonges, rptes.
La douleur thoracique
La douleur thoracique localise derrire le sternum irradiant dans le
bras gauche et/ou la mchoire infrieure est caractristique de l'infarctus du
myocarde. La principale complication immdiate est l'arrt cardiaque.
L'infarctus du myocarde survient la suite de l'obstruction d'une artre
coronaire ou d'une de ses branches. Les artres coronaires sont les artres
qui oxygnent le cur. Il existe des traitements permettant de dboucher les
artres coronaires. Ils doivent tre administrs le plus rapidement possible
par l'quipe mdicale.
Ce type de douleur doit toujours tre considr comme grave.
Que faire ?
- mettre la victime au repos,
- lui interdire tout effort,
- alerter rapidement les secours mdicaliss,
- si la victime a des antcdents cardiaques connus, elle peut avoir un
mdicament prendre en cas de douleur thoracique. Il faut alors lui faciliter
la prise de ce mdicament.
Le malaise hypoglycmique
Il est d une baisse du taux de sucre dans le sang.
Il peut survenir chez un diabtique. Il est alors provoqu par une erreur de
traitement ou de rgime alimentaire.
Il peut galement survenir chez une personne non-diabtique. Il apparat
alors distance d'un repas, par exemple en fin de matine chez une personne
qui n'a pas pris de petit djeuner.
Comment reconnatre un malaise hypoglycmique ?
29 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Les brlures
Une brlure est une lsion provoque par
la chaleur , par des substances chimiques,
par l'lectricit, par des radiations ou par des
frottements.
Pour limiter l'extension de la brlure la fois
en surface et en profondeur, il faut la refroidir
l'eau courante et allonger la victime sur un drap
propre (fig. I.1 et fig. I.2).
Comment reconnatre une brlure simple ?
Une brlure simple est :
- une rougeur intressant une petite surface de
la peau,
- une cloque d'une surface infrieure la moiti
de la paume de la main de la victime.
Que faire ?
- refroidir le plus tt possible les brlures
rcentes moins de 15 mn l'eau froide pendant
5 mn, avec de l'eau entre 10 et 15 degrs, qui
ruisselle une distance de 10 15 cm,
- ne pas percer les cloques,
- protger avec un pansement strile adhsif,
- vrifier la vaccination antittanique,
- si apparat un des signes de l'infection (rougeur, douleur, gonflement,
augmentation de la chaleur autour de la plaie), il faut consulter un mdecin.
Comment reconnatre une brlure grave ?
Une brlure grave est :
- une rougeur tendue (coup de soleil gnralis),
- une cloque unique ou de multiples cloques d'une surface suprieure celle
de la moiti de la paume de la main de la victime,
- une brlure avec destruction profonde donnant un aspect noirtre,
- une brlure localisation particulire :
au niveau du visage. Les brlure de la bouche et du nez doivent faire
craindre une brlure des poumons,
au niveau des mains,
au niveau d'un orifice naturel (bouche, nez, oreille, anus, orifice
fig. I.1 : Allonger la victime,
surveiller le pouls
fig. I.2 : Surveiller la
conscience
28 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
plaie par morsure ; elles sont graves car elles s'infectent toujours.
S'il existe au moins un lment de gravit, il s'agit d'une plaie grave.
Que faire ?
- mettre au repos,
- alerter ou faire alerter les secours,
- surveiller la conscience, la respiration et le pouls.
Les plaies par amputation
En cas d'amputation incomplte (l'extrmit coupe reste attache la
main)
Que faire ?
- immobiliser la main avec une attelle pour diminuer la douleur et maintenir
l'extrmit ampute sa place,
- envelopper la main dans un pansement compressif pour arrter l'hmorragie
ou empcher son apparition si elle n'a pas encore commenc,
- mettre la main dans un sac en plastique tanche,
- poser la main dans un rcipient contenant de l'eau et des glaons,
- alerter le 15 et les secours mdicaliss.
En cas d'amputation complte (l'extrmit coupe est dtache de la main).
Que faire ?
- envelopper l'extrmit ampute dans un pansement compressif pour arrter
l'hmorragie ou empcher son apparition si elle n'a pas encore commenc,
- rcuprer tous les fragments coups,
- dans l'tat o ils sont (ne pas les laver), les mettre dans une compresse ou
un linge propre puis les enfermer hermtiquement dans un sac en plastique,
- mettre des glaons dans une bote et poser dessus le sac hermtiquement
ferm contenant les fragments coups,
- alerter le 15,
- ne jamais mettre les fragments coups directement sur de la glace, car la
glace provoquerait une gelure ce qui rendrait impossible la rimplantation,
- ne jamais faire de garrot, car la circulation du sang serait arrte entre le garrot
et l'extrmit du membre ce qui rendrait impossible la rimplantation.
31 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
La vrification de ltat de la vaccination antittanique (serum
antittanique, vaccin antittanique).
Le ttanos est une maladie provoque par la pntration dans l'organisme
du bacille de Nicolaier. Ce bacille pntre par une lsion de la peau (plaie ou
brlure). Une fois dans l'organisme, il scrte une toxine qui provoque une
contracture musculaire douloureuse. Cette contracture dbute habituellement
au niveau des muscles masticateurs et provoque un trismus (contracture des
muscles de la mchoire). Elle s'tend ensuite progressivement vers la nuque,
le tronc et les membres. Cette maladie se termine souvent par la mort.
La vaccination anti-ttanique protge contre le ttanos. Cette vaccination
ncessite un rappel tous les cinq ans chez l'enfant et tous les dix ans chez
l'adulte.
Le traumatisme d'un membre (fig. I.3)
Les signes d'une atteinte traumatique d'un membre sont :
- les circonstances de l'accident,
- la douleur : la seule prsence de la douleur suffit aprs un accident
suspecter une atteinte d'un membre,
- le gonflement ou la dformation,
- la difficult ou l'impossibilit de bouger.
Les fractures
Une fracture est un os cass. Il peut s'agir :
- d'une fracture ferme non dplace ; les
fragments osseux sont rests leur place,
- d'une fracture ferme dplace. Il y a une
dformation du membre. Il peut y avoir
raccourcissement, rotation ou angulation,
- d'une fracture ouverte. Il y a une plaie en
regard du foyer de fracture.
Les risques d'une fracture sont :
- l'atteinte d'un nerf qui provoque des troubles
sensitifs et/ou une paralysie
- l'atteinte d'un vaisseau qui provoque un
coulement de sang l'origine d'un hmatome
ou d'une hmorragie
- l'atteinte de la peau. Lorsqu'il y a une plaie, la
fracture est ouverte. Les germes pntrent par la
plaie. Il y a risque d'infection
fig. I.3 : Surveiller la victime,
lui parler
30 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
gnital ou urinaire),
au niveau des articulations.
S'il existe au moins un lment de gravit, il s'agit d'une brlure grave.
Que faire ?
- arroser, le plus tt possible, l'eau froide pendant 5 mn,
- retirer les vtements de la victime sans ter ceux qui collent la peau,
- allonger la victime sur un drap propre, sans prendre appui sur la zone
brle,
- alerter ou faire alerter les secours,
- surveiller la conscience, la respiration et le pouls.
Que faire devant les cas particuliers de brlures ?
Les cas particuliers sont toujours des brlures graves. Il est ncessaire
d'alerter les secours mdicaliss.
Brlures par produits chimiques
- ter immdiatement les vtements imbibs de produits chimiques en
faisant attention ne pas se brler,
- arroser abondamment jusqu' l'arrives des secours.
Brlures par l'lectricit
- il s'agit toujours d'une brlure grave mme si la surface cutane
brle est minime, car il existe des brlures internes,
- allonger la victime,
- surveiller la conscience, la respiration et le pouls en attendant l'arrive
des secours.
Brlures par inhalation dans les poumons
- mettre la victime en position demi-assise,
- surveiller la conscience, la respiration et le pouls en attendant l'arrive
des secours.
Brlures par ingestion d'un produit caustique
- mettre la victime en position demi-assise,
- ne pas lui donner boire,
- ne pas la faire vomir,
- surveiller la conscience, la respiration et le pouls en attendant l'arrive
des secours.
33 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Immobilisation l'aide des vtements
Utiliser un pull, un tee-shirt, un pan de
chemise ou un pan de veste
- retourner le vtement pour immobiliser l'avant-
bras plaqu contre la poitrine
- retenir le vtement par des pingles de sret
ou par une cravate
Immobiliser l'aide d'un triangle de toile
- glisser l'une des pointes du triangle entre
l'avant-bras et le thorax (fig. I.7),
- la poser sur l'paule du ct bless,
- rabattre l'autre pointe et l'amener sur l'autre paule,
- nouer les deux pointes ensemble en s'assurant que le poignet est surlev
par rapport au coude (fig. I.8),
- faire un nud avec le sommet du triangle
(angle droit) se trouvant au niveau du coude
(fig. I.9).
Comment russir l'immobilisation du
membre infrieur ?
- Caler le membre dans la position o il se
trouve,
- Maintenir le pied l'aide du calage (fig. I.10)
Le traumatisme de la colonne vertbrale
Il peut s'agir :
- d'une fracture d'une vertbre,
- d'une entorse d'une articulation entre deux
vertbres,
- d'une luxation d'une articulation entre deux
vertbres.
La gravit d'un traumatisme de la colonne
vertbrale est fonction de la gravit de
l'atteinte de la moelle pinire. L'atteinte de la
moelle pinire peut provoquer des paralysies
dfinitives.
fig. I.7 : Immobilisation
laide dun triangle de toile
fig. I.8 : Nouer
fig. I.9 : Angle droit au niveau
du coude
32 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Les entorses
L'entorse est une dchirure ou un tirement d'un
ou de plusieurs ligaments d'une articulation
Les risques d'une entorse sont les rcidives
lorsque le ligament est mal cicatris
Les luxations
La luxation est le dbotement d'une articulation.
Il y a toujours une atteinte ligamentaire associe
au dbotement de l'articulation
Les risques d'une luxation sont :
- l'atteinte d'un nerf comprim par l'os dplac,
ce qui provoque des troubles sensitifs et/ou une
paralysie
- l'atteinte d'un vaisseau comprim par l'os
dplac. Le sang ne peut plus irriguer l'extrmit
du membre
Que faire ?
Devant une suspicion d'atteinte traumatique
d'un membre, il faut (fig. I.4, I.5 et I.6) :
- immobiliser ou empcher de bouger
- alerter les secours
- surveiller la victime
- ne jamais essayer de remettre en place
l'articulation luxe, car on peut provoquer des
lsions irrversibles (ex. lors de la luxation
de l'paule, arrachement de l'innervation du membre suprieur ce qui
entrane une paralysie irrversible et dfinitive
du membre)
- immobiliser l'articulation dans la position o
elle se trouve
- diriger le bless vers le centre hospitalier le
plus proche
Comment russir l'immobilisation du
membre suprieur ?
Avant d'immobiliser le membre, penser
enlever les bagues car un gonflement des doigts
peut apparatre ultrieurement
fig. I.5 : Immobiliser, utiliser
un pull
fig. I.6 : Immobiliser, utiliser
le pan de la chemise
fig. I.4 : Immobiliser, vtement
retenu par des pingles
35 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Que faire ?
- mettre la victime au repos en position allonge (fig. I.12),
- alerter les secours,
- surveiller la conscience,
- si la victime devient inconsciente, la mettre en position latrale de scurit
condition que la respiration reste efficace (fig. I.13).
Les traumatismes
oculaires
Une rosion
cornenne est
provoque par un coup
d'ongle, une branche
d'arbre, une feuille
du papier les corps
trangers sont souvent
une projection de
mtal quand le marteau
frappe sur le burin.
On se trouve devant
un il rouge qui doit
faire suspecter la prsence d'un corps tranger et impose qu'on retourne la
paupire suprieure et l'extirper en totalit y compris la rouille aprs bien sr
un lavage des mains soigneux ; l'il peut tre aussi douloureux et associ
une photophobie et un larmoiement.
Une contusion du globe oculaire est provoque par un coup de poing,
balle de tennis, bouchon de champagne pouvant donner un hmatome
palpbral.
Les brlures oculaires
Il peut s'agir :
- brlures thermiques par retour de flamme, vapeur chaude, metal en
fusion
- brlures par UV : coup d'arc des soudeurs, ophtalmie des neiges
- brlures par gaz lacrymogne : irritation trs gnante, mais sans gravit
- brlures chimiques, elles sont particulirement graves
fig. I.12 : Position allong
fig. I.13 : PLS
34 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Comment reconnatre ?
- les circonstances de l'accident : une chute
d'une hauteur plus ou moins leve,
- la victime se plaint de douleur dans le dos.
Que faire ? (fig. I.11)
- Ne pas dplacer une victime qui se plaint de
douleur dans le cou ou dans le dos,
- Empcher la victime de bouger. Elle ne doit ni
se relever, ni marcher,
- Maintenir la tte de la victime dans la position
o elle se trouve,
- S'agenouiller derrire la tte de la victime,
dans l'axe de son corps,
- Placer une main de chaque cot de la tte pour
la maintenir,
- Alerter les secours,
- Surveiller la victime,
- Lui parler, la rassurer.
Le traumatisme crnien
Il s'agit d'un coup sur la tte qui la plupart
du temps est sans aucune consquence, mais
parfois peut entraner des lsions.
Il peut s'agir de lsions osseuses (fractures du
crne) et/ou de lsions neurologiques (atteintes du cerveau directement ou
par un hmatome qui le comprime).
La gravit d'un traumatisme crnien est fonction de la gravit de la lsion
neurologique.
Comment reconnatre ?
- les circonstances de l'accident : une chute sur la tte ou un coup sur la tte
- rechercher les signes de gravit :
une plaie ou une bosse sur la tte,
des maux de tte persistants et inhabituels,
des nauses (envies de vomir),
des vomissements,
un saignement par le nez ou par une oreille,
un comportement anormal (agitation ou prostration),
l'absence de souvenir de l'accident.
fig. I.10 : Caler avec des sacs
de sable
fig. I.11 : La tte est sur le
mme plan que les paules
37 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Rejoindre un local clos avec un linge sur la bouche et le nez,
- Condamner fentres, portes, chemine, bouches d'aration, ventilation,
- Se laver grande eau les mains et le visage en cas d'irritation,
- Ne pas tlphoner, sauf ncessit pour ne pas saturer le rseau et entraver
les secours,
- Ne jamais quitter l'abri sans consignes des autorits,
- Ecouter la radio et regarder la tlvision.
Accident nuclaire :
- Rejoindre un local clos,
- Quitter ses vtements,
- Condamner portes, fentres
Inondations :
- Rejoindre sans tarder un lieu protg situ en dehors des limites d'invasion
de l'onde de submersion,
- Obstruer portes et soupiraux,
- Monter dans les tages les denres alimentaires,
- Ranger les produits toxiques l'abri de l'eau,
- Couper l'lectricit et le gaz,
- Eviter de s'aventurer dans les zones inondes,
- Conduire les animaux d'levage sur les hauteurs.
Tremblement de terre :
Ds les premires secousses :
- Dehors : s'loigner des constructions ou s'abriter sous un porche,
- En voiture : ne pas quitter l'habitacle,
- A la maison : s'abriter sous une table solide ou l'angle d'un mur,
- Ne pas fuir pendant les secousses,
- Se mfier des chutes d'objets,
- Ne pas fumer,
- Ecouter la radio et regarder la tlvision.
Aprs les secousses :
- Gagner un endroit isol muni d'objets de premire ncessit,
- S'loigner des zones ctires (risque de raz de mare).
LALERTE
Alerter : cest faire intervenir, le plus vite possible, les moyens de secours
comptents adapts au type de laccident. Lalerte doit tre ralise le plus
36 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Conduite tenir :
En cas de brlures par gaz lacrymogne, la conduite consiste avant tout
retirer le plus tt possible tous les vtements imprgns et prendre une
douche nergique avec lavage des cheveux pour se dbarrasser de toutes les
particules qui continuent tre irritantes.
En cas de brlures chimiques, le pronostic est troitement li la rapidit
de mise en uvre du traitement avant la consultation d'un spcialiste ;
chaque minute compte :
- Calmer la victime qui est souvent agite
- Noter l'heure et les circonstances exactes de l'accident
- Noter le corps tranger suppos tre en cause et les rfrences exactes
du produit chimique (nom de la marque, concentration) ou mieux, amener
l'tiquette du flacon ou le flacon lui-mme avec le patient aux urgences
ophtalmiques.
- Sur les lieux de l'accident :
demander la victime de s'allonger, lui faire pencher la tte vers le bas.
verser de l'eau sur l'il en demandant la victime de regarder dans toutes
les directions pour bien rincer les culs de sacs conjonctivaux.
faire un lavage immdiat abondant et rpt l'eau ou au srum
physiologique des yeux et culs de sacs conjonctivaux pendant trente minutes
ou durant toute l'attente du transfert de la victime vers le centre spcialis.
le lavage doit tre doux et long.
Comment ragir face un risque technologique et naturel majeur ?
Le signal national d'alerte a pour objet d'avertir la population de la
ncessit de s'abriter immdiatement en un lieu protg et de se porter
l'coute de la Radio et Tlvision Marocaine (RTM) qui va confirmer l'alerte
sur tout ou une partie du territoire national et indiquer la population la
conduite tenir et les premires mesures dtailles de protection prendre
ainsi que l'organisation des secours.
Attentat terroriste :
Se protger des effets de l'explosion
- A l'extrieur : s'allonger prs du trottoir pour viter les projections,
- A l'intrieur : chercher les zones les plus rsistantes pour s'y abriter
(encadrement des portes et fentres ou sous la table).
Nuages toxiques :
- Ne pas rester dans un vhicule,
39 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- La localisation exacte de laccident ou de la victime (ville, rue, douar,
kiada)
- La raison de lappel (accident de la route, incendie, noyade)
- Les circonstances particulires (camion effectuant un transport de produits
dangereux, risque dincendie ou dexplosion, blesss incarcrs)
- Le nombre de blesss ou de malades
- Le bilan de la ou des victimes
- Les gestes de secours effectus
Lorsque le message dalerte est achev, vous devez attendre les instructions
de votre interlocuteur avant de raccrocher. A partir dun tlphone portable,
lappel narrive pas toujours au standard du centre de secours le plus proche
qui couvre cette zone. Il peut parfois arriver dans une autre ville ou province.
Il est important de prciser avec exactitude le lieu de laccident, le sens de la
circulation de laccident et le point kilomtrique sil sagit dun accident sur
autoroute.
Au cas o vous ne restez pas sur les lieux de laccident, vous devez le
prciser parce que votre numro peut servir de numro de contre appel en
cas de ncessit.
I.4.3- Dgagements durgence et les mesures de sauvegarde
La nature est mauvaise conseillre ; tous les gestes faits spontanment
sont faux. La victime ne doit pas tre dplace avant larrive des secours.
Parfois la protection de laccident est impossible et le risque ne peut tre
supprim.
Labsence de protection met la vie de la victime en danger car celle ci
peut tre inconsciente ou incapable de se soustraire elle-mme ce danger ;
si elle reste lendroit o elle se trouve, elle peut se compliquer ou subir un
suraccident. Il est donc ncessaire de dgager le plus rapidement possible la
victime dun danger :
- Vital : la victime va mourir si elle reste o l elle se trouve
- Rel : le suraccident va se produire avec certitude
- Immdiat : le suraccident va se produire dans les secondes ou la minute
qui suivent.
Lors dun dgagement en urgence, le sauveteur ne doit pas mettre sa
propre vie en danger. Ce nest pas en prenant des risques que le sauveteur
donne le maximum de chance la victime.
38 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
rapidement possible aprs avoir effectu la protection de laccident, un bilan
rapide des victimes et commencer les gestes de secours. Lalerte est effectue
par un tmoin de laccident ou par le sauveteur sil est seul.
Qui alerter ?
Larrive des secours va dpendre de la qualit et de la rapidit de lalerte;
cela dpend la fois du type de laccident et du lieu o lon se trouve.
Les numros dappel durgence sont gratuits partir des tlphones fixes
ou des tlphones portables. A partir des tlphones publics, ils peuvent tre
composs sans carte de tlphone et sans pices de monnaie (150 ; 19 ; 177)
et le 112 uniquement partir dun GSM ; ce numro met en contact avec le
177 (gendarmerie) en zone rurale ou le 19 (police) en zone urbaine.
La protection civile : P.C numro 150
La P.C, en fonction de lappel, peut envoyer un vhicule de ranimation
avec un mdecin ou une ambulance pouvant assurer lvacuation primaire
des blesss vers lhpital.
Les sapeurs pompiers : numro 150
Les S.P assurent les premiers secours en cas daccident, ils teignent
les incendies, effectuent les interventions spcialises particulires : le
dblaiement, la dsincarcration ou le dgagement des blesss et leur
transport vers lhpital.
La police numro 19, et la gendarmerie royale numro 177
La police et la gendarmerie rglent les problmes dordre public, elles
assurent la protection de la zone de laccident (protection des victimes,
des tmoins ou secouristes et des biens) elles tablissent les constats et
peuvent donner lalerte lchelon suprieur provincial ou prfectoral.
Que dire pour alerter ?
Le message dalerte doit tre clair, prcis et permettre votre interlocuteur
de comprendre :
La situation afin de vous envoyer les secours adapts laccident.
Le message de lalerte doit comprendre :
- Le numro du tlphone do vous appelez, en cas de ncessit, les secours
doivent pouvoir vous joindre.
41 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Se redresser en utilisant la force des cuisses
- Tirer la victime reculons jusqu ce quelle
soit en lieu sr (fig. I.16)
- Pour poser la victime au sol, saccroupir, ce
qui fait asseoir la victime.
- Se dcaler sur le ct
- Soutenir les paules et la tte de la victime et
les accompagner jusquau sol (fig. I.17).
Dgagement dun vhicule ou manuvre
de RAUTEK : Cette technique est effectue
lorsque le conducteur ou le passager se trouve
dans un vhicule commenant prendre feu
ou quand la victime ne peut pas sortir seule.
Sassurer que laccs au lieu de dgagement est libre. Ouvrir largement
la porte du vhicule, dtacher ou couper la ceinture de scurit ; sassurer
quand il sagit du chauffeur que ses pieds
ne sont pas coincs dans les pdales (fig.
I.18).
Technique :
- Saccroupir hauteur du sige du
vhicule
- Passer une main sous laisselle la plus
proche et saisir le menton, la tte de
laccident lgrement bascule en arrire
et plaque contre lpaule oppose du
sauveteur.
- Passer lautre main sous lautre aisselle et saisir :
- Soit la ceinture de la victime
- Soit son aisselle
- Se redresser pour sortir la victime du
vhicule
- Se dgager reculons jusqu ce que la
victime soit en lieu sr
- Pour poser la victime au sol, saccroupir,
ce qui fait asseoir la victime
- Se dcaler sur le ct en maintenant la
tte
- Accompagner les paules et la tte de la
victime jusquau sol.
fig. I.18 : Dgagement durgence
hors dun vhicule
fig. I.16 : Tirer la victime
reculons
fig. I.17 : Soutenir et accompagner
la tte et les paules de la victime
jusquau sol
40 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
I.4.4- Techniques de dgagement
La traction par les chevilles (fig. I.14) :
Cette technique de dgagement est effectue lorsque :
- La victime est allonge sur une route grande circulation :
- La victime se trouve dans une pice enfume ou en feu et le sol ne prsente
pas dobstacles; il ny a pas descalier, pas de marche, pas dboulis.
- La victime est menace par un boulement, un effondrement, une coule de
boue ou la monte des eaux et le
sol ne prsente pas dobstacle,
il est plan.
Technique :
- Se positionner au niveau des
pieds de la victime dans laxe
du corps
- Saisir les chevilles
- Les soulever jusquaux genoux du sauveteur
- Se dplacer reculons
- Tirer la victime rapidement jusqu ce quelle soit en lieu sr
- Faire attention car la tte repose sur le sol lors du dgagement
Saisie par les poignets (fig. I.15) :
Cette technique est effectue lorsque :
- La victime se trouve dans une pice enfume ou en feu et le sol prsente des
obstacles : il y a des marches et des escaliers passer ; il y a des boulis
- La victime est menace par un boulement, un effondrement, une coule
de boue ou la monte des eaux et le sol prsente des obstacles, le sol nest
pas plan
Technique :
- Saccroupir la tte de la victime
- Soulever la tte et les paules de la victime
pour lasseoir
- Passer les bras sous les aisselles de la
victime
- Croiser les bras de la victime et saisir les
poignets opposs (main droite du sauveteur
pour le poignet gauche de la victime et la main
gauche du sauveteur pour le poignet droit de la
victime)
fig. I.15 : Saisie par les
poignets
fig. I.14 : Dplacement par traction par les
chevilles
43 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Dtacher la jugulaire.
- Se placer la tte de la victime dans l'axe du corps. Se reculer suffisamment
pour pouvoir enlever le casque.
- Appliquer latralement les mains de chaque ct du casque.
- Tirer doucement le casque dans l'axe du corps. (fig. I.21)
- Lorsque le casque est moiti enlev, placer une main sous la nuque pour
viter la chute brutale de la tte.
- De l'autre main, continuer tirer dans l'axe. (fig. I.22)
- Lorsque le casque est entirement enlev,
poser doucement la tte sur le sol.
Complter la libration des voies ariennes
et commencer la ventilation artificielle.
Le casque d'un motocycliste n'est enlev
qu'en cas d'arrt respiratoire.
I.5- MODULE M
5
:
RECONNAISSANCE,
SURVEILLANCE ET BILAN
D'UNE DETRESSE
L'examen de la victime est effectu ds
que la protection est assure.
Il permet :
De reconnatre la dfaillance d'une
des trois fonctions vitales afin de mettre
rapidement en uvre les gestes de survie.
Transmettre lors de l'alerte un bilan
de la victime permettant d'envoyer des
secours adapts.
La fonction ventilatoire fait pntrer
l'oxygne dans le corps.
La fonction circulatoire transporte
l'oxygne dans le corps et le distribue aux organes.
La fonction nerveuse rgule le travail des diffrents organes de corps.
Ces trois fonctions sont appeles fonctions vitales, la dfaillance d'une
ou de plusieurs de ces fonctions entrane la mort en l'absence de gestes de
survie.
fig. I.21 :
fig. I.22 :
42 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
1.4.5- Retrait du casque intgral a deux sauveteurs
Chez un motocycliste porteur d'un casque intgral, le premier geste de
libration des voies ariennes consiste enlever le casque intgral car la
mentonnire empche l'accs la bouche et la pratique de la ventilation
artificielle.
Il faut enlever le casque d'un motocycliste uniquement en cas de risque
vital immdiat
S'il garde son casque, il va mourir car il est en arrt respiratoire.
1
er
sauveteur
- Se placer au niveau de la tte dans l'axe du bless, se reculer suffisamment
pour pouvoir enlever le casque.
- Appliquer latralement les mains de chaque ct du casque pour le
maintenir. (fig. I.19)
2
me
sauveteur
- Se placer sur le ct au niveau de la tte,
en trpied, le genou au sol est celui le plus
proche de la tte.
- Dtacher la mentonnire.
- Placer la main ct tte sous le cou du
bless, l'autre main les doigts en crochets
sous le menton du bless. (fig. I.20)
- Maintenir la rectitude de l'axe tte-cou-
tronc pendant toute la manuvre.
1
er
sauveteur
- Tirer prudemment le casque dans l'axe.
- Basculer lgrement le casque en arrire
pour ne pas accrocher le nez.
- Le casque tant enlev, la tte est pose
doucement sur le sol.
- La rectitude de l'axe vertbral est
maintenue.
1.4.6- Retrait du casque intgral un
seul sauveteur
Lorsqu'il y a un seul sauveteur, le geste est
plus difficile.
fig. I.19 :
fig. I.20 :
45 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
I.5.2- La fonction circulatoire
La dtresse cardio-circulatoire peut se manifester sous forme dun arrt
cardiaque ou dun choc hypovolmique :
L'arrt cardiaque :
L'arrt cardiaque ou inefficacit circulatoire est facile reconnatre : perte
de connaissance plus ou mois brutale avec coma, aspect gris ou cyanos du
visage, ple, livide, blme.
Disparition des pouls carotidiens et fmoraux, arrt respiratoire avec gasp
(grandes inspirations espaces et bruyantes), trs rapidement la mydriase
apparat.
Le choc hypovolmique : collapsus et tat de choc :
Le collapsus est la chute importante et durable de la tension artrielle, le choc
est la diminution de la perfusion tissulaire. L'tat de choc accompagne des
situations aussi diverses que les hmorragies, les insuffisances myocardiaques
ou les infections graves. En pratique, on agit d'abord par les gestes du survie
et on recherche la cause ensuite.
Les signes de choc hypovolmique : pleur extrme, pression artrielle
effondre, pouls imprenable, altration de la conscience (la priode de choc
dite "compens" est souvent dpasse), plus rarement on observe des signes
de choc avec turgescence des jugulaires.
Evaluation de la fonction circulatoire :
La fonction circulatoire s'value par la prise du pouls carotidien. Le pouls
est la perception des contractions du cur qui sont transmises le long de la
paroi des artres. L'artre carotide passe sur la face latrale du cou, sur les
cts de la trache. C'est une grosse artre o le pouls est facile percevoir
avec les doigts.
Chez un adulte, la frquence du pouls varie de 50 80 pulsations par
minute.
Chez l'enfant, le pouls est plus rapide, la frquence varie de 80 120
pulsations par minute ; plus l'enfant est jeune plus le pouls est rapide.
La frquence du pouls augmente l'effort.
Chez le bb de moins de 1 an, les pulsations de l'artre carotide sont
difficiles percevoir. Il est prfrable d'effectuer la prise du pouls au niveau
de l'artre humrale, qui passe sur la face interne du bras.
Pour effectuer la prise du pouls humral, il faut :
- Maintenir le bras en posant le pouce sur la face externe du bras.
44 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
I.5.1- La fonction ventilatoire (la respiration)
Les signes de la dtresse ventilatoire :
Bless agit, polypneique ou dyspneique prsentant des gasps, une
anxit, une ventilation peu ample, chaque inspiration semble un effort,
les muscles respiratoires accessoires sont mis en jeu. Le tirage des muscles
du cou l'expiration (pouls respiratoire), le creusement l'inspiration de la
paroi abdominale, l'apparition de sueurs et de battements des ailles du nez
la respiration sont des signes de gravit. La victime transpire beaucoup, par
instant sa ventilation semble sarrter, puis rapidement apparaissent dlire,
confusion puis coma. La dtresse respiratoire peut accompagner un tat de
choc ou un coma.
Evaluation de la fonction ventilatoire :
La respiration s'value en recherchant les mouvements d'entre et de
sortie de l'air des poumons. Le flux d'air se sent, s'entend et se voit.
Chez un adulte au repos, la frquence ventilatoire est de 12 20
mouvements par minute.
Chez l'enfant, la frquence est de 20 30 mouvements par mn.
La frquence ventilatoire augmente l'effort. Les mouvements ventilatoires
sont rguliers et silencieux.
Comment valuer la respiration ?
- Se pencher vers le visage de la victime (fig. I.19)
- Sentir l'arrive d'air sur la joue ou sur la main du sauveteur
- A l'oreille chercher les bruits de la ventilation (sifflements, ronflements,
gargouillements)
- Avec les yeux, regarder le ventre et / ou la
poitrine se soulever et s'abaisser
Si le sauveteur :
- Ne sent pas le flux d'air sur sa joue ou sur sa
main
- N'entend aucun bruit respiratoire
- Ne voit aucun mouvement du ventre et / ou
de la poitrine.
La ventilation est absente, cest larrt
respiratoire ou apne
fig. I.19 : Evaluation de la
respiration
47 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Toute victime inconsciente doit bnficier d'une libration des voies
ariennes avec bascule de la tte en arrire. Toute victime inconsciente qui
respire doit tre mise sur le ct en position latrale de scurit.
Evaluation sur l'chelle de Glasgow
L'chelle de Glasgow est une cotation simple et prcise et tudie trois
paramtres :
Ouverture des yeux (Y)
Spontane 4
A l'appel ou au bruit 3
A la douleur 2
Aucune 1
Meilleure rponse verbale (V)
Claire, oriente 5
Confuse 4
Incohrente 3
Incomprhensible 2
Aucune 1
Meilleure rponse motrice (M)
Volontaire la demande 6
Adapte, sur le site 5
Retrait, vitement 4
Flexion anormale 3
Extension 2
Aucune 1
Le calcul du score du Glasgow: Y+V+M = 3 15
Le rsultat 7 est un score charnire en dessous duquel se situe l'tat de coma grave.
L'valuation de la profondeur du coma par ce score sert la surveillance de base en
s'assurant que les modifications de l'tat de conscience de mme que les signes de
localisation ne sont pas ds une autre lsion (fracture, luxation)
46 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Appuyer la pulpe de l'index et du majeur sur
le trajet de l'artre humrale, la face interne
du bras, gale distance entre l'paule et le
coude.
Chez un bb, la frquence cardiaque varie de
120 130 pulsations par minute.
Comment valuer la fonction circulatoire ?
(fig. I.20)
- L'valuation de la fonction ventilatoire et
de la libert des voies ariennes sont relies
directement par lexamen de la fonction circulatoire.
- Le sauveteur palpe la carotide du ct o il se trouve en continuant si
besoin maintenir la tte par la pointe du menton.
- Poser l'extrmit des trois doigts mdians sur la ligne mdiane du cou.
- Appuyer doucement vers l'arrire du cou sans empcher le sang de passer.
- Si le sauveteur ne sent ni le pouls carotidien ni le pouls fmoral pendant 5
6 secondes = Circulation arrte.
I.5.3- La fonction neurologique
La conscience est assure par le bon fonctionnement du cerveau.
La perte de connaissance peut tre provoque :
- Par un accident (traumatisme crnien = coup sur la tte)
- Par un produit toxique (gaz ou fumes toxiques, alcool, intoxication
mdicamenteuse)
- Par une diminution ou un arrt de l'apport d'oxygne au cerveau.
- Par une maladie atteignant le cerveau (accident vasculaire
crbral, infection, tumeurs)
Laltration de ltat neurologique peut se manifester par une agitation,
des troubles de la conscience ou une aggravation rapide vers un coma
qui est l'abolition de la conscience avec altration de la motricit et de la
sensibilit.
Evaluation de la fonction neurologique :
La perte de connaissance entrane un arrt de la vie de relation, la victime ne
parle plus. Elle ne rpond plus aux questions. Elle ne rpond plus aux ordres
simples (voir score de Glasgow). L'insuffisance respiratoire aigu, le choc
lypovolmique altrent l'tat de conscience et constituent des piges lors de
l'examen.
fig. I.20 : Evaluation de la
fonction circulatoire par la
palpation de la carotide
49 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
demeurent le maillon de la chane le plus faible. Non bien assures, elles
rduisent lefficacit des deux suivantes, la dfibrillation prcoce et la
ranimation cardio-pulmonaire spcialise (RCPS) dans la chane de survie
de CUMMINS (fig. II.1).
II.1- MODULE M
6
: LIBERTE DES VOIES AERIENNES
SUPERIEURES (LVAS)
Cest un pralable toute ranimation ou ranimation. La LVAS repose sur
des gestes simples, en cas dobstacle ventilatoire, l'air ne pntre plus dans
les poumons, nous ne disposons pas de stock d'oxygne dans le corps. Ces
gestes consistent :
- Desserrer les vtements
: charpe, cravate, col,
ceinture (fig. II.2)
- Favoriser le passage de
l'air et viter l'obstruction
des voies ariennes
suprieures
- L'ouverture sans
matriel de l'orifice
buccal et des cavits buccales et pharynges.
II.1.1- Bascule de la tte en arrire avec
soutien du menton
Les voies ariennes sont dgages par une
main plat sur le front qui maintient la tte et
appuie vers le bas et en arrire (head tilt), en
mme temps l'index et le majeur de l'autre main
se placent sous le menton pour l'attirer vers le
haut par un mouvement verticale (chin-lift)
(fig. II.3). On exerce une traction vers le haut,
la tte est alors doucement bascule en arrire
ce qui vite lobstruction des voies ariennes
par la chute de la langue dans larrire-gorge
(fig. II.4).
Une alternative moins efficace mais
conseille en cas de doute sur lintgrit du
rachis cervical consiste placer la deuxime
fig. II.2 : Desserrer la cravate, col et la ceinture
fig. II.3 : bascule de la tte
en arrire avec soutien du
menton (points dappui
initiaux)
fig. II.4 : bascule de la tte
en arrire avec soutien du
menton (position finale
maintenir)
48 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Les techniques de la ranimation cardio-pulmonaire de base (RCP) se
pratiquent sans matriel et doivent tre connues de tous, mdecins, infirmiers,
quipiers secouristes, pompiers, citoyens Toutes les tudes montrent que
le pronostic vital est troitement li l'efficacit de ces gestes, comme il n'est
plus dmontrer que les techniques de ranimation spcialises ne serviront
rien si les gestes des premiers secours n'ont pas t ralises temps.
Les techniques des GES sont dfinies selon des protocoles simples
standardiss un chelon international. Elles ont pour buts de gagner
du temps en attendant l'arrive des secours organiss et de suppler
immdiatement une dfaillance des fonctions vitales. Leur mise en uvre
amliore notablement le pronostic et ce d'autant plus que l'alerte est prcise,
rapide et circonstancie.
Les victimes ou blesss prsentent des cas d'urgences absolues ou relatives
dans des contextes particuliers. L'valuation dans ce contexte fait appel des
sauveteurs aguerris, performants qui doivent aller au-del des automatismes,
assurant une valuation initiale des fonctions vitales qui correspond aux trois
actions :
A : pour Airway, B : pour Breathing et C : pour circulation qui sont dcrites
depuis 35 ans dans les recommandations de l'American Heart Association.
Les deux premires actions de la chaine de secours, lalerte et les GES
CHAPITRE II
TECHNIQUES ET GESTES
ELEMENTAIRES DE SURVIE (GES)
Fig. II.1 : la chane de survie daprs CUMMINS
Alerte prcoce RCP de base
prcoce
Dfibrillation
prcoce
Mdicalisation
prcoce
51 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
3
me
temps : il bascule la tte vers larrire
par une rotation des poignets vers le haut (fig.
II.9).
II.1.5- Risques et accidents des gestes de la
LVAS
- Ces gestes sont dautant plus mesurs quune
lsion du rachis cervical est suspecte.
- En cas de coma, la LVAS ne prvient pas les
risques dinhalation.
- Risque de morsure lors de louverture buccale
par la manuvre des doigts croiss dautant
que cette technique peut savrer impossible
raliser si le coma est ractif.
- Risque de morsure en cas de coma ractif
pour la technique de la pro-traction mandibulaire, de mme quon est
appel faire la part des avantages et inconvnients lors de la ralisation
de cette technique, en cas de fracture de la mchoire infrieure et en cas de
traumatisme facial.
II.1.6- Vrification de lefficacit de la libert des VAS
Une fois les VAS dgages, la prsence ou labsence de la respiration doit
tre dtermine. En ventilation spontane, lefficacit du geste est juge par
le bruit du passage de lair travers les voies ariennes et les mouvements
du thorax. Lamplitude du geste est adapte en consquence.
Si le malade ne respire pas, la ventilation artificielle simpose et lefficacit
du geste ventilatoire artificiel est alors juge sur labsence de rsistances aux
insufflations.
fig. II.8 : Sub-luxation de la
mandibule, 2
me
temps
fig. II.9 : Sub-luxation de la
mandibule, 3
me
temps
50 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
main sous la nuque pour la soulever vers le haut. Pour le droitier, il est plus
facile deffectuer les manuvres en se plaant la droite de la victime.
II.1.2- Ouverture buccale par la manuvre des doigts croiss
Cette technique permet linspection visuelle, et le toucher endo-buccal
afin de vrifier labsence de corps tranger ou ter une ventuelle prothse
dentaire amovible chez toute victime en coma non ractif.
Technique : Le pouce sappuie sur les incisives
suprieures, il est oppos au majeur qui sappuie
sur les incisives infrieures . Ceci permet
de visualiser la cavit buccopharynge et de
lexplorer avec lindex ou la pince pouce-index
de la main oppose (fig. II.5).
II.1.3- Pro-traction de la mandibule
Possibilit de technique de libration des VAS
chez les sujets hypotoniques avec ventilation
conserve et chez les obses.
Elle permet louverture de la bouche pour une exploration digitale et
lextraction du corps tranger.
Technique : La mandibule est saisie entre
le pouce plac lintrieur de la bouche et
les autres doigts de la main referms sous le
menton, une traction est alors effectue vers
lavant (fig. II.6).
II.1.4- Subluxation de la mandibule
Cette technique de libration des VAS est
plus performante que les prcdentes, plus difficile raliser. Elle est
indique en cas de suspicion de lsion rachidienne cervicale.
Technique : le sauveteur se place la tte de la victime
1
er
temps : il soulve les branches montantes de la mandibule avec les trois
doigts mdians de chaque main en exerant une
pression vers lavant et vers le haut (fig. II.7).
2
me
temps : il appuie ses deux pouces sous
les commissures des lvres et exerce une
pression sur la mandibule sous-jacente vers le
bas ouvrant ainsi la bouche (fig. II.8).
fig. II.5 : Ouverture buccale
par la manoeuvre des doigts
croiss
fig. II.6 : Pro-traction de la
mandibule
fig. II.7 : Sub-luxation de la
mandibule, 1
er
temps
53 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Bouche ouverte, le sauveteur, aprs avoir rempli
ses poumons dair, applique hermtiquement et
soigneusement ses lvres autour de celles de la
victime (fig. II.12)
- Souffler progressivement dans la bouche de la
victime jusqu ce que le thorax se soulve
- Se relever lgrement pour reprendre son souffle
et regarder la poitrine de la victime saffaisser (fig.
II.13)
- Recommencer une deuxime fois
- Vrifier la prsence du pouls carotidien aprs les
deux insufflations initiales (de dpart)
- Si le pouls est peru, continuer les insufflations
une frquence de 12 15 par minute chez ladulte
(souffler toutes les 4 secondes environ)
- Labsence du pouls fait associer immdiatement
le message cardiaque externe aux insufflations.
Chez lenfant : lexpansion pulmonaire est atteinte
pour de moindres volumes insuffls. La frquence
des insufflations est de 15 20 par minute, soit une insufflation toutes les 3
4 secondes.
II.2.2- Le bouche bouche et nez chez le nouveau n et le nourrisson
Pour le petit enfant, on utilise la mthode de B.A.B et nez. Le bb ne ragit
pas et ne respire pas (peau bleute). La bouche du sauveteur englobe la
fois la bouche et le nez de lenfant. Les insufflations sont encore moindres.
La frquence est de 25 30 par minute ; soit une insufflation toutes les 2 3
secondes. Le volume insuffl est adapt la capacit thoracique du sujet.
La technique (fig. II.14) :
- Nettoyer la bouche
- Poser une main sur le front du bb
- Poser un ou deux doigts de lautre main au niveau
du menton
- Basculer la tte en arrire
- Mettre un linge pli sous les paules, les surlever
afin de faciliter le maintien de la bascule de la tte
en arrire
- Appliquer sa bouche grande ouverte autour de la
fig. II.14 : Bouche
bouche et nez
fig. II.13 : Regarder la
poitrine de la victime
fig. II.12 : Insufflation
52 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
II.2- MODULE M
7
: TECHNIQUES ELEMENTAIRES
DE VENTILATION ARTIFICIELLE PAR VOIE ORALE
Les techniques lmentaires de ventilation artificielle permettent de faire
entrer de lair dans les poumons des victimes qui ne respirent plus. Elles
consistent souffler dans la bouche de la victime lair contenu dans les voies
respiratoires du sauveteur. Lair expir par le sauveteur contient 12 17%
doxygne qui, sont suffisants pour maintenir un apport doxygne et pour
assurer la survie initiale de la victime.
Rcemment, le volume ncessaire une ventilation efficace a t revu
la baisse 400 500 ml au lieu de 1000 1200 ml par insufflation.
Linsufflation doit tre pratique en 1,5 2 secondes et lon doit attendre
une expiration complte 3 4 secondes avant de raliser une deuxime
insufflation, afin dviter une insufflation progressive gastrique. Un grand
volume dair insuffl, une insufflation trop rapide entranent des risques de
barotraumatisme et une surpression pharynge suprieure 15 cm deau qui
ouvre la voie sophagienne et favorise lentre de lair dans lestomac et sa
distension, responsable de rgurgitation et dinhalation et rduit les volumes
pulmonaires par suite de llvation de diaphragme.
II.2.1- Le bouche bouche (BAB)
Quand ?
- Devant toute victime inconsciente qui ne respire
pas ;
- Devant toute apne, oligopne ou bradypne avec
une frquence respiratoire ne pouvant satisfaire les
besoins en oxygne de lorganisme estims pour
un adulte entre 200 et 300 ml par minute.
Comment ?
La victime est inconsciente, elle ne respire pas,
- Sagenouiller hauteur des paules de la victime
- Sassurer pralablement de la libert des VAS
- Placer une main sur le front pour maintenir la tte
bascule en arrire (fig. II.10)
- Obstruer le nez de la victime en le pinant avec
le pouce et lindex de la main situe sur le front
(fig. II.11)
- De lautre main, maintenir le menton en le tirant
en avant vers le haut.
fig. II.10 : Sassurer de
la LVAS
fig. II.11 : Obstruer le
nez
55 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
II.2.4- Les risques de contamination
Bien quils soient rares les risques infectieux existent lors de la ventilation
artificielle par voie orale. Il existe un risque de contamination par des germes
prsents dans les voies respiratoires ou dans la salive. Ce risque peut tre rel
pour la tuberculose, les hpatites et les mningites. En revanche aucun risque
de transmission du virus HIV par la salive seule, en labsence de sang na t
dmontr ce jour.
Pour des raisons de protection, il est recommand au sauveteur, sil en a la
possibilit dutiliser un cran protecteur ou un champs ou un masque usage
unique pour effectuer une mthode de ventilation orale. Ces crans filtres
peuvent tre attachs un porte-clefs (life-key) ou mis dans un porte feuille.
Ils sont usage unique, ils sont accompagns dun aide mmoire des gestes
de secours.
54 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
bouche et du nez du bb
- Souffler uniquement le volume dair contenu dans la bouche du sauveteur
- Recommencer une deuxime fois
- Vrifier la prsence du pouls humral aprs les deux insufflations de
dpart
- Labsence de pouls fait associer immdiatement le message cardiaque
externe aux insufflations
- Les insufflations sont pratiques une frquence de 25 30 par minute,
jusqu la reprise efficace dune ventilation spontane avec recoloration de
la peau ou jusqu larrive des secours organiss. Le pouls humral doit tre
contrl en permanence.
II.2.3- Le bouche nez
Technique utilise en cas de trismus ou de traumatisme facial.
La technique (fig. II.15) :
- Tte maintenue en arrire par une main sur le front
- De lautre main soulever le menton et maintenir
la bouche de la victime ferme en appuyant avec
le pouce la lvre infrieure de la victime contre sa
lvre suprieure.
- On insuffle de lair hermtiquement et avec les
mmes paramtres que ceux du bouche bouche
chez ladulte ou de bouche bouche et nez chez le
bb (fig. II.16)
- Louverture de la bouche de la victime au
temps expiratoire si elle est possible, favorise
lexpiration.
Lefficacit de la ventilation artificielle de base
par voie orale dpend de ltanchit du circuit et
elle est confirme par la sensation de la rsistance
des poumons de la victime et par la sensation
auditive et tactile de lair expir et le regard des
mouvements du thorax.
Les insufflations sont pratiques jusqu la reprise
efficace dune ventilation spontane ou jusqu
larrive des secours organiss.
fig. II.15 : Bouche nez
fig. II.16 : Insufflation
par le nez
57 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
II.3.2- Les tapes dorsales
Quand ?
Le corps tranger est de faible taille et de faible densit.
Comment ?
Cette technique de toux artificielle provoque de brefs pics de pression
dans larbre tracho-bronchique et lhypopharynx. Elle se pratique sur un
sujet conscient debout, assis ou allong sur le ct, la tte et les paules tant
abaisses par rapport au thorax, face vers le sol, afin de tirer profit des forces
de gravit.
On donne nergiquement des tapes du plat de la main dans le dos entre
les omoplates par sries de 4 avant dobserver lventuelle reprise dune
ventilation aise.
II.3.3- La manoeuvre DE HEIMLICH : Compression abdominale sous-
diaphragmatique
La mthode consiste crer une toux artificielle en provoquant une
expiration brutale et force. Le sauveteur cre ainsi une hyper-pression
abdominale qui refoule le diaphragme en haut et augmente la pression intra-
thoracique : la manuvre est ralise par une srie successive de quatre
compressions abdominales sous diaphragmatiques : le corps tranger va tre
expuls. La manuvre doit-tre rpte jusque sa russite.
Quand ?
- Lorsque les tapes dorsales nont pas donn de rsultat positif
- Demble, si le corps tranger est de gros volume
- Le maintien dune ventilation spontane aprs labsorption dun corps
tranger est une contre-indication la pratique de
la mthode de dsobstruction selon HEIMLICH.
Comment ?
Victime adulte consciente, position debout ou
assise
- Se placer derrire la victime (fig. II.17)
- Passer ses bras sous ceux de la victime
- Le sauveteur plaque le dos de la victime contre
sa poitrine
fig. II.17 : Se placer
derrire la victime
56 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
II.3- MODULE M
8
: OBSTRUCTION DES VOIES
AERIENNES PAR UN CORPS ETRANGER (la toux
artificielle)
Cest un sujet qui, au cours dun repas, se lve brusquement, thorax
distendu, et ne peut mettre ni air, ni son. Ses voies ariennes (cordes vocales)
sont obstrues par un corps tranger totalement occlusif (viande, fibre,
noyau,). Ce corps tranger bouche compltement les voies respiratoires,
lair ne peut plus passer. Il faut faire ressortir ce corps tranger pour rtablir
la circulation de lair.
Les circonstances dapparition et les manifestations cliniques dpendent
du degr dobstruction
En cas dobstruction incomplte par un corps tranger, les efforts naturels
de dgagements (toux, vibration de lhypopharynx, suivies de tentatives
dexpectoration) seront respects et encourags aussi longtemps quils restent
efficaces. Quand ces possibilits deviennent insuffisantes ou impossibles ou
en cas dobstruction complte, il faut tenter les gestes de dsobstruction.
II.3.1- Lextraction digitale dun corps tranger
Quand ?
Lorsque un corps tranger volumineux et dense entrane une obstruction
oropharynge brutale (bonbon, noyau, nourriture)
Comment ?
Bouche ouverte par la manuvre des doigts croiss, ou par la subluxation
de la mandibule pour soulever la mchoire infrieure et la langue, et faciliter
lintroduction de lindex de la main oppose qui descend le long de la joue
dans la gorge pour tenter de dloger le corps tranger. Si le corps tranger
est peru, il est saisi par la pince pouce-index ou pouss vers lextrieur par
lextrmit de lindex. Il faut viter par cette technique denfoncer plus en
avant le corps tranger dans les voies ariennes.
Obstruction incomplte
- La victime ne parvient pas cracher le
morceau de nourriture par une violente
quinte de toux
- Prsente une petite toux inefficace, un
stridor respiratoire, une dyspne svre.
- Eventuellement une cyanose
Obstruction complte
(victime consciente)
- Bouche ouverte
- Ne tousse pas, ne dit rien
- Cherche de lair, porte la main son
cou, indique elle-mme la source du
problme en portant la main la gorge.
59 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Donner quatre tapes avec la main entre les
omoplates de faon mobiliser le corps tranger
en branlant la colonne dair intra-trachale (onde
de choc)
- En cas dchec placer cette main sur le dos du
bb et le retourner tte basse en lui soutenant la
tte
- Effectuer avec trois doigts quatre pousses, ou
pressions sur le devant du thorax au milieu de
sternum (fig. II.21)
II.3.4- Les compressions thoraciques basses
Quand ?
- Chez le grand obse dont il nest pas possible
denserrer le corps
- Chez la femme enceinte dont le ftus pourrait
souffrir de la compression abdominale.
Comment ?
En position debout :
Cette technique se pratique comme la manuvre
de HEIMLICH, mais le poing est appliqu au-
dessus de lappendice xyphode.
En position allonge :
- Le sauveteur se place latralement la victime
- Les paumes des mains superposes sont appliques sur le sternum au-
dessus de lappendice xyphode
- Exercer une pression bras tendus
La toux artificielle par laugmentation de la pression lintrieur du
thorax provoque lexpulsion du corps tranger. Son expulsion et/ou la reprise
de la ventilation sont la preuve de lefficacit de la mthode.
En cas dchec, elle peut tre rpte plusieurs fois de suite.
Risques et accidents
- Malheureusement, le principal accident est lchec de la manuvre
- La rupture dun organe abdominal ou des ctes basses est un moindre mal,
si on a pu toutefois dsobstruer les voies ariennes de la victime.
fig. II.21 : Pressions au
milieu de sternum
fig. II.20 : Les tapes
dorsales
58 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Poser un poing ferm, dos de la main tourn vers
le haut dans le creux pigastrique, sous le sternum
(au-dessus de lombilic)
- Placer la paume de lautre main autour de ce poing
(la deuxime main empaume la premire)
- Le sauveteur tire alors violemment en arrire ses
deux poings serrs. Cest ainsi quil exerce donc
quatre compressions brves en arrire et en avant
; sans prendre appui sur les ctes de manire ce
que les coudes et les bras ncrasent pas les ctes
flottantes (fig. II.18).
Victime adulte inconsciente, position allonge
Si le sauveteur arrive tardivement, le malade
inconscient est allong au sol en arrt ventilatoire. Lobstruction des voies
ariennes a provoqu une perte de connaissance. Les tentatives dinsufflations
au bouche bouche sont inefficaces.
Technique (fig. II.19) :
- Sauveteur cheval sur la victime au niveau de ses cuisses
- Placer la paume dune main au-dessus du nombril
plat ; doigts relevs
- Placer lautre main sur la premire
- Appuyer brusquement vers le sol en direction des
omoplates de la victime
Chez lenfant
De plus de un an, la mthode de dsobstruction
selon HEIMLICH est identique celle de ladulte.
Il est ncessaire toutefois dadapter la force du
geste la corpulence de lenfant.
Enfant de moins de 18 mois : Ne jamais
suspendre lenfant par les pieds, car on peut bloquer
le corps tranger dans les voies respiratoires. Aucun geste de dsobstruction
nest tent si lenfant respire.
Technique
- Placer le bb plat ventre sur les genoux du sauveteur (ou sur lavant-
bras) en lui soutenant la tte (fig. II.20)
fig. II.18 : Position
exacte : la compression
fig. II.19 : Victime
inconsciente
60 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Ractivit ?
Verbale
Et/ou motrice
Oui
Non
Crier pour appeler
( laide, alerter)
LVA
Evaluer la respiration
Respiration efficace
Action A :
- Mettre en position latrale de scurit
- (faire) demander de laide
Absence du pouls
Action C :
- (faire) demander de laide
- dbuter la RCP
Absence de respiration efficace, pouls
peru
Action B :
- pratiquer 10 insufflations bouche
bouche
- (faire) demander de laide
- poursuivre la ventilation (B.A.B)
Vrifier la prsence du
pouls
Protger, surveiller et rvaluer
intervalles rguliers
Demander de laide si ncessaire (alerter)
PRISE EN CHARGE INITIALE ET DESCRIPTION DES TECHNIQUES
LORS DUN ARRT CARDIAQUE (ADAPTE DAPRS LES
RECOMMANDATIONS DE LEUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL).
II.4- MODULE M
9
: MASSAGE CARDIAQUE EXTERNE
(MCE) PAR COMPRESSIONS THORACIQUES EXTERNES
Quand ?
Le MCE se fait devant labsence de pouls pendant 5 10 secondes, avec
tat de mort apparente, ou en tat de respiration agonique.
Cette dmarche diagnostique doit prendre moins de 30 secondes. Le MCE
ne se conoit quassoci la ventilation artificielle.
Le MCE conventionnel a t dcrit pour la premire fois en 1960 par
KOUWENHOVER. Cest encore aujourdhui la technique la plus utilise
pour suppler lactivit cardiaque en cas dinefficacit circulatoire, cest
le composant principal des GES et de la ranimation cardio-pulmonaire.
Celle-ci fait partie intgrante de la chane de survie dcrite par
CUMMINS.
61 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
II.4.1- La technique du MCE par la pompe
cardiaque
Le MCE fait circuler artificiellement
le sang en comprimant le coeur entre deux
plans durs, en avant le sternum et en arrire la
colonne vertbrale. (fig. II.22)
- Le patient en arrt circulatoire est install
sur un plan dur (sol, planche), la tte ne
peut tre surleve par rapport au corps, ce
qui pourrait diminuer le dbit crbral. En
revanche les jambes peuvent tre surleves
pour augmenter le retour veineux au cur.
- Assurer la librt des voies ariennes
- Pratiquer deux insufflations par B.A.B (fig.
II.23)
- Sassurer de larrt circulatoire par la prise
du pouls carotidien dans la gouttire latro-
trachale pendant au moins 5 secondes (fig.
II.24)
- Mettre le bras de la victime la perpendiculaire
par rapport au corps
- Se positionner
cheval sur le bras
cart, de prfrence gauche de la victime, un
genou dans le creux de laisselle
- La zone dappui est strictement mdiane sur la
partie haute de la moiti infrieure du sternum (fig.
II.25)
- Le point mdian du sternum est rapidement repr
en plaant le majeur dune main au dessus du
manubrium sternal la base du creux situ en
haut du sternum
- Le majeur de lautre main repre le creux o
les ctes se rejoignent (sous la xiphode, en bas
du sternum)
- Les deux pouces sont rapprochs et dterminent
le milieu du sternum
- Le talon dune main est plac juste sous ce
fig. II.22 : La pompe
cardiaque
fig. II.23 : Insufflations
initiales
fig. II.24 : Contrle du
pouls
fig. II.25 : Zone dappui
62 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
point mdian (le haut de la moiti infrieure du
sternum) (fig. II.26)
- La paume de lautre main sappuie sur le dos de
la premire. Les doigts sont tendus et carts et ne
reposent pas sur la poitrine
- Les bras du sauveteur sont bien tendus, coudes
bloqus strictement verticaux et les paules exactement
au-dessus des mains afin dassurer une pression
entirement verticale.
Cette procdure est la
moins fatigante pour le
sauveteur (fig. II.27)
Intensit et rythme
- Au rythme de 80 100 compressions par
minute chez ladulte
- Le temps de la compression active est gal au
temps de la dcompression passive ou temps de
relaxation, ce qui correspond un rapport relaxation / compression de lordre
de 1/1
- La relaxation est complte sans toutefois dcoller les mains du sternum
- Le thorax est enfonc de 4 5 cm chez ladulte
- La pousse vers le bas doit tre verticale par rapport au sol et le rester
pendant toute la compression
- Relcher entirement la compression afin que le thorax revienne sa
position initiale
Un seul sauveteur : rgle de 15/2
Effectuer en alternance 15 compressions pour 2 insufflations : faire 4
cycles de 15 MCE pour 2 insufflations par
minute.
2 sauveteurs : rgle de 5/1 (fig. II.28)
Le masseur sagenouille la hauteur du
creux axillaire du patient, celui qui ventile se
place sa tte, latralement pour le bouche
bouche.
Le masseur compte et 1 et 2 et 3... ceci
permet deffectuer des compressions gales aux
fig. II.26 : Le talon de
la main
fig. II.27 : Rgle 15/2
fig. II.28 : Rgle de 5/1
63 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
relaxations et de donner la cadence haute voix. Une insufflation dair est
pratique par le deuxime sauveteur toutes les 5 compressions.
Les compressions sont peine interrompues pendant la ventilation
artificielle.
Faire 5 compressions pour une insufflation
- Surveiller le pouls toutes les deux minutes
- Pouls absent : continuer le MCE , continuer le B.A.B
- Pouls prsent : arrter le MCE, continuer le B.A.B
La tendance gnrale est deffectuer le MCE trop rapidement, les
compressions prcordiales sont peine interrompues pendant la ventilation
artificielle. Si on est deux, la personne qui assure le MCE ne doit pas hsiter
se faire remplacer aux premiers signes de fatigue. Elle doit lannoncer
suffisamment lavance pour permettre son remplaant de se prparer de
manire ce que le changement se fasse de manire souple et coordonne.
Lefficacit du massage est contrle par le sauveteur qui ventile.
Le MCE chez lenfant (fig. II.29)
La technique est identique en utilisant le talon
dune seule main et en appuyant moins fort. A
chaque compression le thorax est enfonc de 2
3 centimtres, faire 6 cycles de 15 MCE et 2
insufflations par minute.
Chez le nouveau n et le nourrisson (fig.
II.30)
Chez le nouveau n, le MCE est pratiqu
avec les deux pouces, la frquence de 120 compressions par minute. Les
mains du sauveteur entourent la base de la cage thoracique du nouveau n. La
compression thoracique peut se faire laide de trois doigts (index, majeur at
annulaire).
- La zone dappui
: sur le sternum
hauteur des
mamelons
- La victime est
masse des bouts
de doigts
fig. II.30 : MCE chez le nourisson
fig. II.29 : MCE chez
lenfant
64 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Enfoncer de 1,5 2 centimtres
- Relcher compltement
- Effectuer en alternance deux
insufflations pour 15 MCE, 8 cycles de
15 MCE et 2 insufflations par minute
- Chez le nouveau-n, le contrle du
pouls est fait au niveau humral (fig.
II.31)
Risques et accidents
Aucun risque ne peut justifier labstention de la RCPB lorsque larrt
circulatoire a t authentifi par lassociation suivante :
- Perte de connaissance
- Arrt ventilatoire
- Absence du pouls carotidien ou fmoral
Laccident principal est la fracture de ctes entrane par un MCE avec
appui costal ou non strictement mdian.
Un traumatisme des organes intra abdominaux ou intra thoraciques
rsulte de techniques inadquates.
II.4.2- La dfibrillation prcoce
Constitue le troisime maillon de la chane de survie et le seul traitement
des dfibrillations ventriculaires (FV) et des tachycardies ventriculaires (TV)
sans pouls. La fibrillation ventriculaire est la cause la plus frquente des AC
chez des sujets gs ou en milieu hospitalier. Son pronostic est relativement
bon si la dfibrillation est obtenue prcocement. La dfibrillation remplace
le classique coup sternal laide de rebord de la main.
La dfibrillation est ralise laide dun dfibrillateur. Elle est constitue
de sries de trois chocs successifs spars par 3 minutes de RCP, le premier
cycle de trois dfibrillations est dintensit croissante avec 200 250 360
joules (3 joules / kg chez lenfant). Les cycles suivants sont de 360 joules
pour tous les chocs.
Rcemment des dfibrillateurs semi-automatique (DSA) informatiss,
capables de reconnatre une FV sont utiliss par des secouristes spcialement
forms. Ces appareils analysent le rythme cardiaque et aprs validation par
le secouriste, dfibrillent le patient.
fig. II.31 : Contrle du pouls chez
le nouveau-n
65 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
La technique avec laquelle, on ralise le choc lectrique est essentielle
pour assurer lefficacit du geste. La position des lectrodes doit tre
correcte, en gnral sous claviculaire droite et sous axillaire gauche. Les
lectrodes doivent avoir au moins 8 centimtres de diamtre. Elles doivent
tre enduites de pte conductrice et tre maintenues fermement en place
lors de la dlivrance du choc lectrique, le choc doit tre dlivr en fin
dexpiration.
II.4.3- Les nouvelles modalits des techniques du MCE
Ces techniques, avec dautres modalits utilisant des machines masser,
sont en cours de rvaluation et dexprimentation. Mais aucune na fait
ce jour preuve de son efficacit en terme de survie des patients. Le MCE
classique par la pompe cardiaque est encore aujourdhui la technique la
plus utilise, pour suppler lactivit cardiaque en cas dinefficacit
circulatoire.
La compression abdominale intermittente
Cest une technique qui consiste comprimer labdomen lors de la phase
de relaxation du MCE standard. La compression abdominale augmente le
retour veineux vers le thorax, augmente la pression aortique en limitant la
circulation dans la partie infrieure du corps. Cette technique ncessite au
moins trois intervenants, les patients doivent tre intubs donc pris en charge
en RCPS. Lintubation va permettre une expansion pulmonaire et viter
linhalation.
La compression dcompression active (CDA)
Cette technique de CDA fait appel lutilisation dune ventouse (Cardio
Pump Ambu) qui est positionne sur le thorax du patient en AC. Elle ralise,
comme dans le MCE conventionnel, une compression active du thorax. Mais
contrairement la relaxation passive du MCE conventionnel, elle permet
en tirant sur la ventouse de faire une dcompression active du thorax qui
correspond la diastole cardiaque et saccompagne dun remplissage des
cavits cardiaques li une amlioration du retour veineux, ce qui va donner
une augmentation du dbit cardiaque lors de la compression thoracique.
Massage cardiaque externe par veste thoracique
Il sagit dun MCE par compression pneumatique circonfrentielle du
thorax. Elle ralise un modle de la thorie de la pompe thoracique en levant
de manire uniforme la pression lintrieur du thorax. Le matriel utilis
66 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
par cette technique est trs encombrant et ne peut pas encore tre utilis
lextrieur de lhpital. Cest le cas aussi du MCE mcanique (thumper) qui
est fait dun appareillage lourd non toujours facilement transportable sur le
terrain.
II.4.4- La dcision darrt du massage cardiaque externe
Il nexiste pas de rgle formelle pour arrter les manuvres de ranimation,
mais les lments suivants doivent tre analyss :
- La dure de larrt cardiaque avant le massage : il est clairement dmontr
que le pronostic dpend de la rapidit avec laquelle le MCE a t entrepris.
Cependant, la dure de lAC est trs difficile tablir lorsquil ny a pas de
tmoin.
- Lapparition de la mydriase : elle ne doit pas faire prmaturment arrter le
massage. La mydriase bilatrale nest pas obligatoirement le tmoin dune
souffrance crbrale irrversible.
- Les antcdents du patient : ils sont rarement connus et toujours difficiles
analyser en urgence
- Les recommandations et consensus existants : la majorit des recommandations
propose darrter la RCP aprs 30 minutes de ranimation, lorsque tous les
gestes ont t accomplis et leur excution correcte vrifie.
- Lhypothermie : avant tout, il faut savoir diagnostiquer lAC chez un
sujet en hypothermie profonde et entreprendre la RCP au moindre doute
car le pouls peut tre imperceptible. Lhypothermie augmente la tolrance
crbrale lanoxie (15 mn 25 C, 30 mn 20C, 60 mn 15C).
Dans ces cas, le MCE doit tre prolong jusquau rchauffement (no one
is dead unless warm and dead : personne nest mort moins quil ne soit
chaud et mort). La frquence du MCE et la ventilation doivent tre rduites
(divises par 3) devant un AC en hypothermie majeure (<28C).
Lors des hypothermies il faut songer utiliser un thermomtre non mdical,
descendant des niveaux plus bas de temprature.
67 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Saignement
Lappui sur la plaie
est possible
Compression manuelle
Directe / pansement
compressif
Lappui sur la plaie
est impossible :
(fracture, corps tranger)
ou la compression manuelle
est inefficace
Point de compression
II.5- MODULE M
10
: LE CONTROLE DUNE
HEMORRAGIE SANS MATERIEL MEDICAL
La description des techniques
La victime doit tre allonge en position neutre pour faciliter la circulation
du sang et son arrive vers le cerveau.
Lorsque le saignement est important, il est recommand de surlever les
jambes de la victime.
Devant ces cas les membres infrieurs resteront imprativement surlevs
jusqu' larrive du secours. En attendant, les fonctions vitales, les signes
gnraux, le statut hmodynamique, les signes fonctionnels (douleurs,
dyspne) doivent tre surveills, ainsi que lefficacit de lhmostase :
contention efficace, absence de signes dischmie
en aval de la compression.
II.5.1- Lappui sur la plaie est possible
La compression manuelle directe (fig. II.32)
Cest la mthode la plus sre et la plus rapide.
Quand ? Lorsque lappui direct sur la plaie est
possible. Cest la premire technique dhmostase
fig. II.32 : Compression
directe
68 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
mettre en uvre si la surface de la plaie est infrieure celle de la paume
de la main et lors du saignement du visage ou du cuir chevelu
Comment ?
La paume de la main est appuye fermement sur la plaie elle-mme.
Le bless est allong ds que possible et le membre atteint est surlev.
Comprimer directement lendroit qui saigne avec la main suffit souvent
arrter le saignement. On peut interposer des compresses propres ou un linge
pli. Cette technique de tamponnement est notamment recommande pour
juguler un saignement du cuir chevelu. Au sauveteur, il est recommand
sil a la possibilit de mettre sa main dans un sac de plastique (type sac de
supermarch).
Le pansement compressif
Exerce sur la brche vasculaire une pression suffisante pour galer la
pression artrielle et permettre ainsi larrt de lhmorragie.
Quand ?
Le pansement compressif vient en relais de la compression manuelle. Il
permet au sauveteur de se librer pour alerter, pratiquer dautres gestes ou
soccuper dautres blesss.
Le pansement compressif sadresse aux plaies hmorragiques veineuses
ou artrielles de petit calibre, aux saignements " en nappe " au niveau de la
face, du cou, du cuir chevelu, du tronc, des membres et des extrmits.
Comment ? (fig. II.33)
- Faire la compression manuelle
- Mettre un pansement (mouchoir, linge propre)
sur la plaie
- Le pansement doit tre large, la partie la
plus paisse du pansement (mouchoir, linge)
en regard de la plaie exerce une pression
suffisante pour arrter ou franchement diminuer
le saignement (hmostase provisoire), mais pas
trop pour ne pas arrter la circulation dans le
membre.
- Le pansement est maintenu laide dun foulard ou une charpe.
- Surlever le membre bless pour diminuer la pression du sang son
niveau.
fig. II.33 : Pansement
compressif
69 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Le pansement doit tre visible
pour surveiller son efficacit
qui est contrle par larrt de
lhmorragie.
- Seul un mdecin peut dfaire un
pansement compressif efficace
- Si le saignement persiste ; laisser
le premier pansement compressif
en place.
- Mettre un deuxime pansement
par-dessus le premier
- Les pouls distaux sont
syst mat i quement et
rgulirement contrls
II.5.2- Les points de compression
artrielle distance
La compression est forte au
niveau dun axe artriel principal
en amont de la lsion. Les points
de compression artrielle sont
peu nombreux et sont connatre.
La compression artrielle est un procd de fortune qui peut sauver la vie du
bless. Elle consiste comprimer le pdicule vasculaire sur un plan osseux
rsistant. On peut comprimer par le pouce, la contre pression des doigts,
ou le poing. (fig. II.34)
Quand ?
- Lors dhmorragie externe.
- Lorsque lappui direct sur la plaie est impossible
(corps tranger dans la plaie, fracture ouverte) ou
inefficace (plaie tendue).
- Lors des hmorragies de cou.
Le point de compression de lartre carotide
Chez un patient allong, pour toute hmorragie du
cou incontrlable par une compression directe.
Comment ? (fig. II.34bis)
Pour une plaie gauche, le sauveteur utilise sa main
droite.
fig. II.34 bis :
Compression de la
carotide
fig. II.34 : Localisations des points de
compression
Carotide
Fmorale
Axillaire
Poplit
Humrale
70 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- La paume de la main tant ouverte, les quatre derniers doigts prennent
appui derrire le cou
- Le pouce tant referm sur le massif musculaire antro-latral du cou.
- La pulpe de pouce est perpendiculaire la gouttire latro-trachale.
- Appuyer fortement avec le pouce entre la plaie et le cur.
Le point de compression de lartre axillaire
Quand ? devant tout saignement important du membre suprieur, sous-
jacent larticulation de lpaule.
Comment ? (fig. II.35)
- Les deux mains sont ncessaires la
ralisation de cette technique.
- Bras du bless surlev
- Lpaule du bless est empaume par
les 2 mains ouvertes du sauveteur.
- Les 2 pouces du sauveteur sont placs
lun ct de lautre dans le creux
axillaire du bless.
- La pulpe des 2 pouces appuie dans la
partie antrieure du creux axillaire.
- Lappui est progressif jusqu' larrt de
lhmorragie.
Le point de compression de lartre humrale
Quand ? : devant tout saignement du membre suprieur sous-jacent au
coude et lavant bras.
Comment ? (fig. II.36)
- Le sauveteur utilise sa main droite
pour le bras droit du bless
- La main ouverte en pince empaume
le bras
- La pulpe du pouce est place au dessus
du pli du coude en dedans du biceps et
sur la face interne de lhumrus.
- La pression exerce par le pouce est
fig. II.35 : Compression de laxillaire
fig. II.36 : Compression de lartre
humrale
71 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
renforce par un mouvement de rotation de la main
de dedans en dehors.
Le point de compression de lartre fmorale
Quand ? : juguler toute hmorragie importante
du membre infrieur qui ne peut tre contrle par
une compression directe.
Comment ? (fig. II.37)
- Bless lgrement tourn du ct du membre
bless.
- Sauveteur agenouill du ct oppos
lhmorragie.
- Reprer le pli de laine (pli de flexion de la cuisse sur le ventre)
- Placer le poing ferm, plat des premires phalanges au milieu du pli de
laine.
- Appuyer, bras tendu la verticale, avec le poids du corps.
- Une lgre flexion de la cuisse facilite la manuvre.
Le point de compression de lartre poplit
Quand ? : devant toute hmorragie massive au-dessous de larticulation de
genou.
Comment ? (fig. II.38)
- Bless tendu en dcubitus ventral
- Le sauveteur est plac larrire du
bless
- Empaume avec les deux mains le
genou
- Exerce une forte pression au milieu
du creux poplit avec la pulpe des
deux pouces juxtaposs
II.5.3- Le garrot artriel
Quand ? :
- Chaque fois quune hmorragie massive dun membre ne peut tre contrle
ni par une compression locale, ni par un point de compression artrielle
fig. II.37 : Compression
de lartre fmorale
fig. II.38 : Compression de lartre
poplit
72 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
distance de la plaie.
- Lorsque le point de compression ne peut tre
maintenu parce que le sauveteur est seul et
quil doit se librer pour donner lalerte ou pour
soccuper dautres blesss.
Comment ? (fig. II.39)
- Un garrot pour plaie veineuse (sang noirtre, qui
scoule rgulirement) est pos entre lextrmit
du membre et la plaie (en aval) cest dire au-
dessous du saignement
- Bien souvent une hmorragie mixte artrielle
(sang rouge rutilant qui scoule en jets saccads)
ou veineuse oblige poser un double garrot
artriel et veineux
- Le garrot artriel est plac en amont de la plaie,
mais le plus prs possible delle pour limiter le
segment qui sera priv de sang.
- Le garrot ne peut tre pos, sous peine
dinefficacit, sur un segment de membre deux
os (avant-bras, jambe), ce qui va empcher la
striction suffisante (fig. II.39bis)
- Le garrot ne peut tre alors pos que sur le bras
entre le coude et lpaule ou sur la cuisse entre le
genou et la hanche
- Le garrot de fortune non extensible peut tre
ralis avec une cravate, une ceinture ou tout lien
large non lastique
- Les garrots lastiques mdicaux ne sont pas
utiliss pour arrter une hmorragie, car ils
narrtent pas compltement la circulation du
sang
- Avant la pose du garrot, un point de compression
lextrmit du membre va permettre larrt de
lhmorragie, le garrot vient en relais de ce point de compression
- Plier le lien en deux
- Passer le boucle sous le membre
- Ramener une extrmit du lien par-dessus le membre
- La passer dans la boucle ralise par le pliage
fig. II.39 bis : Garrot
seulement sur les
premiers segments de
membres
fig. II.39 : La pose de
garrot
73 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- Lautre extrmit tant tenue fortement
- Serrer, faire un nud (fig. II.40)
- Lcher le point de la compression artrielle
- Le serrage est progressif, juste suffisant pour
arrter lhmorragie
- Noter sur une fiche lheure exacte de la pose du
garrot
- Evaluer ltat gnral de la victime
- Le garrot et la plaie doivent toujours rester
visibles, ne pas les recouvrir
Accidents et prvention
- Le garrot doit tre vit si une ranimation prcoce et efficace est entreprise,
cest une technique de sauvetage vital devant un tat de choc incontrlable
qui ne se substitue en aucun cas lhmostase instrumentale et au traitement
chirurgical de la lsion.
- Le desserrage est obligatoire toutes les heures. Le bless doit tre vacu
au plus tt.
- A la leve ou au desserrage, il faut craindre un tat de choc
- Un garrot artriel insuffisamment serr est inefficace, car il gne le retour
veineux et favorise le saignement.
CAS PARTICULIER DU SAIGNEMENT DE NEZ : Epistaxis
Lors d'un saignement spontan par le nez de
faible abondance, il faut larrter en comprimant
avec le doigt la narine qui saigne.(fig. II.41)
- La victime est assise.
- La tte est penche en avant
- Le doigt comprime la narine qui saigne pendant
10 minutes. La victime ne doit pas tre allonge
sur le dos, car le sang s'coulerait dans les voies
respiratoires.
Il peut tre utile de demander la victime de se
moucher avant de comprimer la narine.
fig. II.40 : Faire un
noeud
fig. II.41 :
74 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
II.6- MODULE M
11
: LINSTALLATION DES MALADES
ET DES BLESSES EN POSITIONS ELEMENTAIRES ET
POSITIONS DATTENTES
II.6.1- Le dcubitus dorsal (D.D)
Cest la position allonge avec ou sans surlvation des membres
infrieurs sans oreiller sous la tte. Cest la position immdiate de repos, elle
est dite aussi position neutre ou position dexamen et de la ralisation des
GES.
Quand ? : de principe tout bless doit tre install en D.D, sauf en cas
de dtresse respiratoire ou, si la victime adopte spontanment une autre
position. Le D.D permet dviter le retentissement de lorthostatisme sur
ltat hmodynamique
Comment ? (fig. II.42)
La victime est allonge doucement, jambes
tendues. En cas de signes de collapsus,
notamment par une hmorragie massive
interne ou externe, les membres infrieurs sont
surlevs. On peut ainsi mobiliser une partie
de la masse sanguine circulatoire au profit des
organes nobles. (fig. II.43)
Couvrir et surveiller la victime rgulirement,
vrifier sa respiration, son pouls carotidien et sa
coloration.
II.6.2- La position demi-assise
La position demi assise entrane une rduction
des pressions exerces sur le diaphragme par le
contenu abdominal. Elle facilite son travail et
celui des muscles respiratoires accessoires.
Quand ? :
- Utilise pour les victimes prsentant une gne ventilatoire avec tat
hmodynamique satisfaisant
- Elle est utilise lorsque la victime ladopte spontanment ou quand elle
insiste pour ne pas tre allonge
fig. II.42 : D. D. et position
des GES
fig. II.43 : Jambes
surleves en cas de choc
75 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- En cas de traumatisme, lorsquil existe un doute
sur lintgrit du rachis, cette position est exclue,
car elle peut mobiliser une fracture du rachis et
entraner des dommages neurologiques
Comment ? (fig. II.44)
Langulation du tronc par rapport au plan
de support oscille entre 30 et 60 degrs.
La position dite de relaxation associe une
position demi-assise une flexion partielle des
membres infrieurs, lesquels sont lgrement
surlevs. La position demi-assise sur le ct
est utilise lorsque la victime a des nauses ou
des vomissements. (fig. II.45)
II.6.3- La position latrale de scurit (PLS)
La PLS est toujours de prfrence latrale gauche pour amliorer le retour
veineux vers le cur. Laltration de la conscience entrane un arrt de la vie
de relation : la victime ne parle plus, ne rpond plus aux questions, ne rpond
plus aux ordres simples. La perte de connaissance entrane galement une
diminution du tonus musculaire (hypotonie), les muscles sont relchs. La
langue est un muscle. Chez la victime inconsciente lorsque la tte est flchie
vers lavant, la langue chute dans larrire gorge et empche le passage de
lair, par contre lorsque la tte est bascule en arrire par les techniques de
la libert des voies ariennes, la langue revient vers lavant de la bouche et
libre le passage de lair.
La perte de connaissance entrane aussi une perte des rflexes de scurit
qui sont la toux et la dglutition. Lorsque des liquides se trouvent dans la
trache, la toux les ramne vers la gorge, tandis que la dglutition autre
rflexe de scurit est laction davaler. Cette action et ce geste ou ce rflexe
envoie les liquides de la gorge vers lestomac.
La victime inconsciente na plus de rflexes de scurit. Si elle reste en
position dorsale, les liquides prsents dans la bouche vont scouler vers les
voies respiratoires et provoquer une inhalation et un arrt respiratoire.
Quand raliser la PLS ?
- Toute victime en coma et en perte de conscience, mais en ventilation
spontane doit tre installe en position de dcubitus latral appele PLS.
- Les brlures ou blessures cutanes dorso-lombaires et fessires peuvent
aussi faire choisir cette position .
fig. II.44 : position demi-
assise
fig. II.45 : Demi-assise avec
risque de vomissements
76 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Comment ?
La victime tant initialement en D.D
- Le sauveteur se place genoux au niveau de la
taille de la victime du ct du retournement 50 cm
environ de la victime. (fig. II.46)
- Mettre le bras le plus proche de soi au del de la
perpendiculaire, paume de la main tourne vers le
ciel pour viter de comprimer les vaisseaux et les
nerfs.
- Saisir lpaule oppose et placer lavant bras du
patient sur lavant bras du sauveteur.
- De lautre main, saisir la hanche oppose (fig.
II.47)
- Faire pivoter le corps de la victime de 90 vers
soi lentement et rgulirement en bloc et sans mouvement de torsion, en
gardant les bras tendus pendant le retournement afin de ne pas tordre la
colonne vertbrale de
la victime, respectant
ainsi laxe du rachis.
- Lavant bras situ
vers le haut repose au
sol, coude flchi.
- Placer sur la hanche
la main qui tait au
niveau de lpaule pour
maintenir le corps de la
victime en quilibre.
- Maintenant saisir de lautre main le creux du genou pour le ramener vers
soi et le caler en avant au sol.
- Le pied flchi se cale derrire le genou de la jambe controlatrale.
- Lorsque la victime est cale, se placer sa tte et rebasculer la tte
soigneusement et doucement en arrire.
- Cette manuvre est complte par un
nouveau contrle des fonctions vitales et par
le rchauffement de la victime (fig. II.48 et fig.
II.49)
fig. II.48 : Recontrle des
fonctions vitales
fig. II.47 : Le retournement
fig. II.46 : Prparation
la PLS
77 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Risques et prvention
La PLS est un geste
simple dont les rsultats
ne sont pas apparents
parce que prventifs.
- En cas de lsion
thoracique unilatrale
la victime est tourne
sur le ct atteint.
- En cas de fracture dun membre infrieur, cest autour de celui-ci
que la rotation seffectuera, il reste ainsi au contact du sol, limitant ses
dplacements.
- Toute femme enceinte au del du 5me mois est de principe allonge sur le
ct gauche pour permettre un meilleur flux veineux cave infrieur.
II.7- MODULE M
12
: LA COUVERTURE DE
SAUVETAGE
Elle est indispensable aide sur les lieux de laccident. Grce la rflexion
de 80% de la chaleur du corps, elle protge contre le froid, la chaleur,
lhumidit et les frissons gros consommateurs doxygne. Cette couverture
permet dviter lhypothermie chez le bless lors du sauvetage et protge
tout aussi bien contre une trop forte chaleur du soleil. Le bless reste visible
mme une grande distance. Lors daccident sous la neige, il convient
dutiliser la couverture ct dor vers lextrieur.
Quand ? : toute victime doit tre rchauffe
Comment ?
- La couverture de sauvetage doit toujours envelopper le bless de manire
souple
- Ne pas serrer le corps afin dviter la transpiration lorsquil fait chaud
- Interposer une alse pour viter la perte de chaleur secondaire un contact
trop direct de la couverture de survie avec le corps, lorsquil fait froid
- Au besoin la couverture peut tre fixe par un ruban adhsif
II.8- MODULE M
13
: LES PROBLEMES SPECIFIQUES
POSES PAR LE TRANSPORT
Le transport primaire ou secondaire doit se faire sans aggraver ltat des
malades, ni perdre un temps prcieux cest dire sans ajouter une pathologie
fig. II.49 : Position finale PLS
78 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
du transport ni une surmdicalisation ou une pathologie iatrogne.
Le principe est de raisonner la mise en condition et de ne rien avoir
refaire en cours de route.
Le patient est au dpart quilibr par les GES dbuts et excuts sur
place selon laphorisme classique, il doit tre :
- Chaud (normothermie)
- Rose (respiration parfaitement contrle)
- Sec (absence dhypercapnie et de douleur)
- Rempli (quilibre circulatoire tabli)
Au cours du transport, le malade est soumis un certain nombre
dagressions quil faut surveiller et contrler.
II.8.1- les manipulations et les mobilisations diverses
Elles peuvent provoquer :
- Des douleurs
- Des troubles ventilatoires et hmodynamiques (changement de position au
cours du chargement et du dchargement du brancard, ou par les positions
trop accentues).
- Augmentation de la pression intracrnienne lors de la position dclive
- incidents techniques : dplacements, arrachements des tuyaux, sondes,
drains pour les blesss ayant bnfici dune ranimation spcialise.
II.8.2- Les acclrations et les dclrations
Elles justifient que le bless ou malade soit mis :
- La tte vers lavant dans lambulance et vers larrire dans lhlicoptre,
en raison essentiellement des mouvements dacclration imposs la masse
sanguine.
- Dans une ambulance malade tte vers lavant : les acclrations ont
tendance diminuer la tension artrielle et les dclrations laugmentent
et de ce fait augmentent la pression intracrnienne. Des modifications du
rythme cardiaque ont t galement observes.
- Dans une ambulance malade tte en arrire : la dclration pourrait
provoquer une ischmie aigu crbrale par la chasse du sang vers le segment
infrieur du corps. Les fortes acclrations ou dclrations provoquent des
dplacements internes des viscres et de la masse sanguine. Le sang va et
vient comme leau dune bassine quon pousse du pied.
79 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
II.8.3- Les chocs et secousses
Provoquent des douleurs et des lsions tissulaires.
II.8.4- Les vibrations
Provoquent des douleurs, une vasodilatation cutane et des lsions
tissulaires.
II.8.5- Les bruits
Augmentent le stress, dclenchent des crises dagitation et des
convulsions.
II.8.6- Les agressions thermiques
Cest essentiellement le froid qui est frquemment en cause. Une
insuffisance de prcautions peut aboutir une hypothermie grave avec
frissons et consommation importante de loxygne.
II.8.7- Le vhicule, moyen de transport
Les moyens de transport comprennent le brancard de relevage, les
ambulances lgres et lourdes et les hlicoptres. Leur choix dpend des
cas rencontrs, des distances parcourir, des moyens techniques mettre
en uvre et des difficults daccs au site du sinistre. Aucune discontinuit
ne doit se produire dans la chane de secours. Les vhicules doivent tre
accrdits et il faut se souvenir que le confort du malade passe avant la
vitesse. La vitesse peut tre extrmement dangereuse non seulement en
raison des risques daccidents, mais du fait de limportance des phnomnes
dacclration et de dclration. Le gain de temps est habituellement
relativement minime par rapport aux risques encourus par le malade. Il y
a galement ncessit choisir entre les fourgons avec une grande cellule
sanitaire permettant de raliser aisment des gestes, les petits vhicules
utiliss pour les longues distances afin dtre plus rapides, et lhlicoptre
quand il y a ncessit de choisir entre moyens terrestres et moyens ariens ;
surtout pour les longues distances. A retenir quil nest pas possible de faire
beaucoup de gestes de ranimation lorsque lappareil est en vol.
80 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
Le pronostic vital nest plus matris par le seul recours la vitesse du
transport. La prcocit de lalerte et la ralisation immdiate de gestes adapts
conditionnent la survie et le pronostic des patients et victimes daccidents.
Les techniques de ranimation les plus sophistiques ne serviront rien si
les gestes des premiers secours nont pas t raliss temps. Ces gestes
lmentaires de survie donnent ce document le label des protocoles de
rfrence dans lenseignement dapprentissage des gestes durgence de
base.
Rappelons-nous cependant avec KOUVENHOWEN que nimporte qui,
nimporte o, peut faire de la ranimation cardiaque ; il suffit pour cela de
deux mains.
CONCLUSION
81 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- CARLI. P. Prise en charge prhospitalire du polytraumatis, congrs de la SMAR
Anesthsie Ranimation en situation durgence, 1998, pp : 7, 8.
- ROZENBERG. A., TELION. C. Massage cardiaque externe : physiopathologie
et nouvelles modalits, confrences dactualisation, 1998, 40me congrs national
danesthsie ranimation, p : 583.
- KOCH. P. A propos du dfibrillateur externe, OXYMAG n 32, 1995, pp: 14-20.
- HIROSHI NAKAJIMA. Les catastrophes frappent sans prvenir, soyons prts, revue
OMS, 1991, pp : 2, 3.
- American Heart Association. Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and
emergency cardiac care, JAMA, 1992, p : 268.
- MOREAU F., CAUSANEL J. M. Organisation gnrale des secours mdicaux
extrahospitaliers, ARNETTE, J-E-P-U, 1987, pp : 15, 22.
- CARLI. P. LAMBERT. Y. Ramassage et transport dun bless grave, ARNETTE, J-E-P-U,
1987, pp : 23, 30.
- BERTRAND. C. et Al. Apprentissage des gestes durgence lcole, E.M.C 24000 C-15,
ELSEVIER, PARIS, 1999, 4p.
- Direction des hpitaux et soins ambulatoires. Division des urgences. Projet de plan de
dveloppement sanitaire, 1999-2000 / 2003 / 2004, stratgie sectorielle et plan daction,
fvrier 2000, 4p.
- HABERER. J. P., HELMER. J. Acquisitions rcentes dans la ranimation de larrt
circulatoire, SFAR, 1989, 10p.
- CARLI. P. et Al. Ranimation de larrt cardio - respiratoire, SFAR, 1990, 4p.
- KAMRAN SAMII. SAMU-SMUR, Anesthsie ranimation chirurgicale, mdecines
sciences FLAMMARION 2me Ed., pp : 1697, 1700.
- LACOMBE GILES. Les premiers soins, BEAUCHEMIN, 1996, pp : 63 - 67.
- ASKENASI. R. Manuel de linfirmire de lurgence, 2me Ed. Editions de luniversit
REFERENCES
82 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
de Bruxelles, MALOINE, pp : 71 88.
- First aid and emergency procedures, hand book of the hospital corps, United States
Navy, chapter 11.
- NORBERT VIEUX et al. Manuel de secourisme, mdecine sciences FLAMMARION,
1990.
- METTE. C., LECLERCQ G. Premiers secours, conduite tenir, MALOINE, 1999.
- MAAZOUZI. W. et Al. Les gestes qui sauvent, Ed. OKAD, 1990.
- DESCAMPS. F. Les centres denseignements des soins durgence, OXYMAG n53,
2000, pp : 26-27.
- VINCENT. J. L. le manuel de ranimation soins intensifs et mdecine durgence, 1999,
SPRINGER, p : 407.
- BALAGNY. E. SAMU SMUR , ARNETTE, 1987, 1re Edition.
- DUBOULOZ. F. Organisation des secours et accueil des urgences, nouveaux cahiers de
linfirmire, n21, MASSON, 3me Ed., 2000, pp : 3-7.
- GRIZEL. Y. et al. Prise en charge des principales dtresses vitales, nouveaux cahiers de
linfirmire, MASSON, 2000, pp : 19-31.
- WLODARCZYK. S. Les enjeux de la formation lurgence des paramdicaux :
comptences ou performances, ELSEVIER, Paris, 1999.
- ROUBY J. J. Les modes dassistance ventilatoire partielle, ARNETTE, J.E.P.U , 1995.
- Recommandations de la SFAR. Ranimation des arrts cardio-respiratoires de ladulte,
1995.
- MOLENDA S. et Al. Stress spcifique aux personnels exerant en SAMU et en SMUR,
ELSEVIER PARIS, 2000, pp : 179, 183.
- Socit franaise de mdecine de catastrophe. Urgences mdicales, ELSEVIER, volume
IX, n4, 1990, pp : 244, 252.
- DEAKIN C. Soins prhospitaliers et mort vitable, urgences pratiques, septembre 2000,
n42, p : 39.
- GOLDSTEIN P. et Al. Prise en charge prhospitalire du polytraumatis, cours
suprieurs durgence, ch VIII, socit francophone durgence mdicale, ARNETTE, 1999,
pp : 67 79.
83 Le secourisme et les gestes lmentaires de survie
- BOURICHE. M. Ranimation prhospitalire, Journal Janssen danesthsie ranimation,
Mai 1993, n 8, pp : 2,3
- DURBOUS. V. Soins prhospitaliers et vacuation sanitaire en Amrique du Nord,
ARNETTE, 2000, pp : 19,28
- XXIIe runion de perfectionnement des infirmiers et infirmires anesthsistes. Lurgence
prhospitalire, 2000, ARNETTE.
- BASQUET. M. La ventilation artificielle durgence, mthode du Bouche bouche,
mdecine de catastrophe, pp : 1278,1280
- BARRIOT. P. Accidents collectifs et catastrophes, aspects tactiques et logistiques,
mdecine de catastrophe, pp : 1188, 1193
- ROZENBERG. A. SAMU et afflux de victimes : le plan blanc, mdecine de catastrophe
pp : 1208, 1211
- PETROCIC. T. Arrt cardiorespiratoire en lan 2000 : acquis et perspectives davenir,
ARNETTE, 2000, pp : 65,73
- BASTIAS. A. Aide humanitaire dEtat, le SAMU mondial, ARNETTE, 2000, pp : 128,
131
- ROCHET. G. UMH et les vhicules de ranimation prhospitalire, mdecine de
catastrophe, pp : 1234, 1239
- CARLI. P. LAMBERT. Y. protocoles 92, LEHMANN CAUTURIER, 1992, urgences
plans et schmas thrapeutiques
- FONTANELLA. J. M. et AL. Les matriels et les techniques de ranimation pr-
hospitalire, les units mobiles hospitalires des SAMU, collection mdecine durgence,
SAMU, pp : 89,115
- GOLDSTEIN. P. ET AL. Transports sanitaires hliports, pourquoi non ? ELSEVIER
PARIS, 2000, pp : 57,68
- MORIZOT. L. et Al. Formation aux urgences, profil de poste, profil des personnels,
ELSEVIER PARIS, 1999, pp : 45, 51.
- BOISORIEUX. C. et Al. Formation et valuation pratique des lves infirmiers (es) aux
gestes durgence. Nouvelle approche, ELSEVIER, collection de la SFAR, 1999, p : 145
- Lvnement mdical, N2 Novembre/Dcembre 2001, p : 22.
L
es techniques de la ranimation cardio-pulmonaire
de base (RCP) (la libert des voies ariennes,
la ventilation par bouche bouche, le massage
cardiaque externe, la manoeuvre de HEIMLICH, la position
latrale de scurit et le contrle dune hmorragie) se
pratiquent sans matriel et doivent tre connues de tous,
mdecins, infirmiers, secouristes, pompiers, citoyens
Toutes les tudes montrent que le pronostic vital est
troitement li l'efficacit de ces gestes, comme il
n'est plus dmontrer que les techniques de ranimation
spcialises ne serviront rien si les gestes des premiers
secours n'ont pas t raliss temps.
Les techniques des gestes lmentaires de survie sont
dfinies selon des protocoles simples standardiss un
chelon international. Elles ont pour buts de gagner du
temps en attendant l'arrive des secours organiss et de
suppler immdiatement une dfaillance des fonctions
vitales. Leur mise en uvre amliore notablement le
pronostic et ce d'autant plus que l'alerte est prcise, rapide
et circonstancie.
Houcine KHALDI - M.H.A
Secrtariat Gnral
du Ministre de la Sant
Rabat - Maroc
hkhaldi7@yahoo.fr
Dpt lgal : 2005/0387 - ISBN : 9981 - 813 - 47 - 8
Vous aimerez peut-être aussi
- Premiers SecoursDocument40 pagesPremiers Secoursbensss100% (4)
- Formation Aux Premiers SecoursDocument67 pagesFormation Aux Premiers Secoursjwimili100% (1)
- Urgences Dentaires Et MédicalesDocument372 pagesUrgences Dentaires Et MédicalesCharaf Mh100% (1)
- Secourisme de BaseDocument87 pagesSecourisme de BaseDenisco NkemgnePas encore d'évaluation
- SecourismeDocument13 pagesSecourismeBenouna Fert100% (1)
- Soins D'urgenceDocument35 pagesSoins D'urgenceCäll Męh Nïåh100% (1)
- Referentiel Formation A L Usage Des Formateurs SST 7000Document78 pagesReferentiel Formation A L Usage Des Formateurs SST 7000AbderrahmaneNajid100% (1)
- Sauveteur Secouriste Du TravailDocument22 pagesSauveteur Secouriste Du Travailghada gattouchPas encore d'évaluation
- Devenir Sapeur-Pompier de PairsDocument20 pagesDevenir Sapeur-Pompier de PairsEddiePas encore d'évaluation
- Le Guide Des Premiers Soins PDFDocument16 pagesLe Guide Des Premiers Soins PDFbendiazz3430Pas encore d'évaluation
- Technique SecourismeDocument19 pagesTechnique Secourismeelga74100% (1)
- 1242 Manipulation ExtincteursimportantDocument34 pages1242 Manipulation Extincteursimportantdjamilio100% (1)
- Anthony Fauci Bill Gates Big Pharma Leur Guerre Mondiale Contre La Democratie Et La Santé Robert F Kennedy JR Christian PerronneDocument834 pagesAnthony Fauci Bill Gates Big Pharma Leur Guerre Mondiale Contre La Democratie Et La Santé Robert F Kennedy JR Christian PerronnePhilou100% (2)
- Memento Du Chef de Garde PDFDocument192 pagesMemento Du Chef de Garde PDFLokmene Idrisse100% (4)
- Supplement CarieDocument24 pagesSupplement Carielamia temmouchePas encore d'évaluation
- RCFR 2015 - 09 Securite Hygiene Environnement PDFDocument16 pagesRCFR 2015 - 09 Securite Hygiene Environnement PDFPirlo Polo100% (1)
- Manuel de SecourismeDocument39 pagesManuel de SecourismeHamza Bensenouci100% (1)
- (CDG72) Travail en HauteurDocument9 pages(CDG72) Travail en Hauteurf.BPas encore d'évaluation
- Chef D Équipe Sapeur-Pompier VolontaireDocument20 pagesChef D Équipe Sapeur-Pompier Volontaireomar benounaPas encore d'évaluation
- Formation ÉvacuationDocument48 pagesFormation ÉvacuationYoussef100% (1)
- Courss2 Secourisme 2022 EtudDocument20 pagesCourss2 Secourisme 2022 EtudRøü DāîNäPas encore d'évaluation
- BSP 2002 16 Secours Routiers PDFDocument12 pagesBSP 2002 16 Secours Routiers PDFJojo75000Pas encore d'évaluation
- Document Reference SSTDocument60 pagesDocument Reference SSTdxsszszPas encore d'évaluation
- CoursDocument25 pagesCoursvicente ondo nguema medja100% (1)
- DTA Aide Mémoire 1er Chef D'agrèsDocument2 pagesDTA Aide Mémoire 1er Chef D'agrèsIsak LaxPas encore d'évaluation
- Questions BSP 200.13Document15 pagesQuestions BSP 200.13SimonMoreauPas encore d'évaluation
- Tout Sur Le Secourisme.Document55 pagesTout Sur Le Secourisme.Omr Aissa100% (1)
- Mon Harnais de Securite PDFDocument8 pagesMon Harnais de Securite PDFLak niam NzikePas encore d'évaluation
- SecourismeDocument26 pagesSecourismekaoutharPas encore d'évaluation
- SecourismeDocument111 pagesSecourismeKa Đer100% (1)
- (Benachi, AlexandraDocument465 pages(Benachi, AlexandraDeliaPas encore d'évaluation
- Questions Réponses BSP 200.13Document45 pagesQuestions Réponses BSP 200.13Vince Maertini100% (1)
- Rapport de StageDocument8 pagesRapport de StageHanen HanounaPas encore d'évaluation
- Module SecourismeDocument85 pagesModule SecourismeRayhane Ben Saada100% (3)
- GNR Lot de Sauvetage Et de Protection Contre Les Chutes PDFDocument37 pagesGNR Lot de Sauvetage Et de Protection Contre Les Chutes PDFMHAMED100% (1)
- SECOURISMEDocument32 pagesSECOURISMEMame Médoune Dieuguène100% (2)
- PansementDocument4 pagesPansementAbakar Adoum HassanPas encore d'évaluation
- SecourismeDocument68 pagesSecourismeMybrahim AitmoussaPas encore d'évaluation
- Fiches Reperes Sur Les Facteurs de RisqueDocument46 pagesFiches Reperes Sur Les Facteurs de RisquenicolasPas encore d'évaluation
- BSP 200 2 04 Bilans PDFDocument26 pagesBSP 200 2 04 Bilans PDFBaptiste Giai-viaPas encore d'évaluation
- Hs2010-Web FDocument33 pagesHs2010-Web Fpatrick_friessnerPas encore d'évaluation
- BSP 200.2 - P2-FT41.6 Cueillette D Une Victime Dans Un Véhicule Sur Le CotéDocument4 pagesBSP 200.2 - P2-FT41.6 Cueillette D Une Victime Dans Un Véhicule Sur Le CotéDavidLhermenierPas encore d'évaluation
- BSP 200.2 - P2-FT41.4 Cueillette D Une Victime Affalée CapotDocument4 pagesBSP 200.2 - P2-FT41.4 Cueillette D Une Victime Affalée CapotDavidLhermenierPas encore d'évaluation
- BSP 2002 05 Troubles Et Detresses Neurologiquespdf PDFDocument14 pagesBSP 2002 05 Troubles Et Detresses Neurologiquespdf PDFtutoPas encore d'évaluation
- Osteopathie Et Orthodontie PDFDocument107 pagesOsteopathie Et Orthodontie PDFYohann BalletPas encore d'évaluation
- 2.1 Equipes en Binome, Etablissement Des LancesDocument59 pages2.1 Equipes en Binome, Etablissement Des LancesAlexandre PoissonPas encore d'évaluation
- Contrôle Secourisme 2Document1 pageContrôle Secourisme 2Serraji Max100% (1)
- BSP 200.2 - P2-FT41.5 Cueillette D Une Victime Dans Un Véhicule Sur Le ToitDocument4 pagesBSP 200.2 - P2-FT41.5 Cueillette D Une Victime Dans Un Véhicule Sur Le ToitDavidLhermenierPas encore d'évaluation
- FT 03. Chaîne de SecoursDocument1 pageFT 03. Chaîne de SecoursSocieté EpsPas encore d'évaluation
- SecourismeDocument72 pagesSecourismeCedu69120Pas encore d'évaluation
- Résumé de Secourisme (Alerte, Perte de Connaissance, Obstruction VAS, Arret Cardiaque)Document5 pagesRésumé de Secourisme (Alerte, Perte de Connaissance, Obstruction VAS, Arret Cardiaque)Boujemaa SbekaPas encore d'évaluation
- Secours RoutiersDocument9 pagesSecours RoutiersJerome De RamPas encore d'évaluation
- Ademe - INRS Hygiène Et Sécurité Sur Les Chantiers de Réhabilitation de Sites Pollués (1995)Document66 pagesAdeme - INRS Hygiène Et Sécurité Sur Les Chantiers de Réhabilitation de Sites Pollués (1995)jpvuillePas encore d'évaluation
- Techniques de Manutention AmbulanciersDocument7 pagesTechniques de Manutention AmbulanciersFrereBethorPas encore d'évaluation
- CACES 1, 3, 5 RecyclageDocument1 pageCACES 1, 3, 5 RecyclageKhalil RadouanePas encore d'évaluation
- 4-Securite GazDocument12 pages4-Securite GazAfef NejiPas encore d'évaluation
- Fiche de Poste GraissageDocument1 pageFiche de Poste GraissageJonathan KacouPas encore d'évaluation
- Brancardage ImmobilisationsDocument11 pagesBrancardage ImmobilisationsDiopPas encore d'évaluation
- Officiel de La République Algérienne Démocratique EtDocument3 pagesOfficiel de La République Algérienne Démocratique Etyouchadz6317Pas encore d'évaluation
- Binome Incendie Isere 2007Document39 pagesBinome Incendie Isere 2007omar benounaPas encore d'évaluation
- Gestes de Secourisme en UrgenceDocument15 pagesGestes de Secourisme en UrgenceKenz L'AïdPas encore d'évaluation
- Sikalatex FDS PDFDocument5 pagesSikalatex FDS PDFegsamir1075Pas encore d'évaluation
- Techniques de Détection Des DéfaillancesDocument77 pagesTechniques de Détection Des DéfaillancesYahiyaoui SofyanePas encore d'évaluation
- BENDRISS Massinissa-SofianeDocument101 pagesBENDRISS Massinissa-SofianeabdouPas encore d'évaluation
- Bulletin L' Académie Nationale de Médecine: Tome 199 - Avril-Mai - N 4-5 2015Document304 pagesBulletin L' Académie Nationale de Médecine: Tome 199 - Avril-Mai - N 4-5 2015nadiaPas encore d'évaluation
- Les Aspirations Professionnelles Des Jeunes Médecins en Ile de FranceDocument25 pagesLes Aspirations Professionnelles Des Jeunes Médecins en Ile de FranceTNS SofresPas encore d'évaluation
- These Pharma PedDocument180 pagesThese Pharma PedMalek AmamouPas encore d'évaluation
- DSH Et Tble Hydro SodésDocument83 pagesDSH Et Tble Hydro SodésDoc Zak100% (1)
- Liste Des CIC Biothérapies InsermDocument3 pagesListe Des CIC Biothérapies InsermNotre Recherche CliniquePas encore d'évaluation
- L'édition Française Des Révélations Du DR Richard Day, Le Nouvel Ordre Des Barbares (1969), Est Désormais Disponible Aux Éditions DédicacesDocument9 pagesL'édition Française Des Révélations Du DR Richard Day, Le Nouvel Ordre Des Barbares (1969), Est Désormais Disponible Aux Éditions DédicacesmikelsonPas encore d'évaluation
- TP Ems PDFDocument12 pagesTP Ems PDFabigael ilungaPas encore d'évaluation
- Soins Palliatif OncologieDocument36 pagesSoins Palliatif OncologieCinomegasPas encore d'évaluation
- Fiche 12 - La Spécialisation en MédecineDocument4 pagesFiche 12 - La Spécialisation en Médecinedavidmoreau2000Pas encore d'évaluation
- Hulot DorianDocument119 pagesHulot DoriansaidaPas encore d'évaluation
- Problèmes Respiratoires Péri Opératoires Chez L'enfant: DR F. Bordet Hopital Debrousse LyonDocument8 pagesProblèmes Respiratoires Péri Opératoires Chez L'enfant: DR F. Bordet Hopital Debrousse LyonAnas KammounPas encore d'évaluation
- Répartition Stages 22-23Document6 pagesRépartition Stages 22-23Vichy PotchiraPas encore d'évaluation
- 3-6 Compression Nerfs Au CoudeDocument105 pages3-6 Compression Nerfs Au CoudeProfesseur Christian DumontierPas encore d'évaluation
- Memoire Power (Enregistrement Automatique)Document24 pagesMemoire Power (Enregistrement Automatique)isra bourafaiPas encore d'évaluation
- Résolution Projet de Transformation Clinique CH La SarreDocument2 pagesRésolution Projet de Transformation Clinique CH La SarreRadio-CanadaPas encore d'évaluation
- Archi Et PsychiatrieDocument2 pagesArchi Et PsychiatriesusCitiesPas encore d'évaluation
- Evaluación y Tratamiento de Dolor LumbarDocument167 pagesEvaluación y Tratamiento de Dolor LumbarPere Antoni Fernandez SerraPas encore d'évaluation
- Programme Formation Continue 2023 6Document1 pageProgramme Formation Continue 2023 6SuzannePas encore d'évaluation
- Mamoire MarrekchDocument180 pagesMamoire MarrekchSylia ZaidiPas encore d'évaluation
- Calcul de La Dysharmonie Dentomaxillaire (DDM) Quelle Méthode de MesureDocument14 pagesCalcul de La Dysharmonie Dentomaxillaire (DDM) Quelle Méthode de MesureHafaifa TaiebPas encore d'évaluation
- Info - Express #69Document2 pagesInfo - Express #69خالد بن الوليد صحراويPas encore d'évaluation
- TCG Diag Pec Et PCDocument110 pagesTCG Diag Pec Et PCsoamintydelphinePas encore d'évaluation
- Anesthesie Peri BulbaireDocument74 pagesAnesthesie Peri BulbairemechackPas encore d'évaluation
- 01-Histoire de La RééducationDocument25 pages01-Histoire de La Rééducationchrisusap66Pas encore d'évaluation
- Examen Cause Douleur Et Limitation Articulaire Cyriax PDFDocument15 pagesExamen Cause Douleur Et Limitation Articulaire Cyriax PDFAmir JedidiPas encore d'évaluation