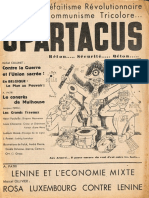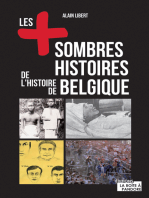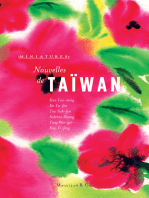Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Histoire Chine
Histoire Chine
Transféré par
Melkor DracoCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Histoire Chine
Histoire Chine
Transféré par
Melkor DracoDroits d'auteur :
Formats disponibles
@
HISTOIRE de la CHINE
par
Ren GROUSSET (1885-1952)
( 1942 )
Un document produit en version numrique par Pierre Palpant,
collaborateur bnvole
Courriel : pierre.palpant@laposte.net
Dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales"
dirige et fonde par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web : http ://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiquesdessciencessociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de lUniversit du Qubec Chicoutimi
Site web : http ://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
Un document produit en version numrique par Pierre Palpant, collaborateur bnvole,
Courriel : pierre.palpant@laposte.net
partir de :
Histoire de la Chine,
Par Ren GROUSSET (1884 1940)
Club des Libraires de France, sans date, 344 pages.
dition originale 1942
Polices de caractres utilise :
Pour le texte : Times, 12 points, et
Pour les citations : Times 12 points et Comic sans MS 10 points.
Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11
dition complte le 30 novembre 2004 Chicoutimi, Qubec.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
TABLE
DES
MATIRES
Tableau des dynasties Notes sur lart chinois Notes
Carte des provinces Carte du continent
Chapitre 1. Terre chinoise
Chapitre 2. Lexpansion dune race de pionniers
Chapitre 3. Fodalit et chevalerie
Chapitre 4. Les sages dautrefois
Chapitre 5. Par le fer et par le feu
Chapitre 6. Le Csar chinois
Chapitre 7. De lempire militaire lempire traditionnel
Chapitre 8. Pax sinica
Chapitre 9. Triomphe des Lettrs
Chapitre 10. La route de la soie
Chapitre 11. Rvlation du bouddhisme
Chapitre 12. Splendeur et dcadence des Han
Chapitre 13. Lpope des trois royaumes
Chapitre 14. Les grandes invasions et le bas empire
Chapitre 15. Une autre sculpture romane : lart Wei
Chapitre 16. Yang-ti, fils du ciel
Chapitre 17. Tai -tsong le Grand
Chapitre 18. Drames la cour des Tang
Chapitre 19. Un grand sicle : au temps du pote Li Tai -po
Chapitre 20. Crise sociale et ruine de ltat
Chapitre 21. Les Song et le problme des rformes
Chapitre 22. Un rveur couronn : lempereur Houei -tsong
Chapitre 23. La douceur de vivre
Chapitre 24. Cristallisation de la pense chinoise
Chapitre 25. Le conqurant du monde
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
Chapitre 26. Qoubila, le grand sire
Chapitre 27. Marco Polo
Chapitre 28. Une restauration nationale : les Ming
Chapitre 29. Le drame de 1644
Chapitre 30. Les grands empereurs mandchous : Kang -hi et Kien -long
Chapitre 31. Lirruption de l Occident
Chapitre 32. La rvolution chinoise
Chapitre 33. Donnes permanentes et problmes actuels
*
**
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
A ma fille Ginette, Madame Pierre Lenclud
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
CHAPITRE PREMIER
Terre chinoise
La civilisation en Asie est le fait des Msopotamies , cest --dire des
grandes plaines dalluvions dont la fertilit naturelle a suscit chez lhomme la
vocation agricole. Tel fut le cas dans lAsie occidentale pour la Babylonie. Tel
est le cas dans lAsie orient ale pour la Grande Plaine chinoise.
Elle stend, cette Grande Plaine, depuis Pkin au nord jusquau Houai -ho
au sud, depuis les approches de Lo-yang louest jus qu lperon
montagneux du Chan-tong vers lest, sur 324.000 kilomtres carrs, superfi cie
suprieure celle de lAngleterre et de lIrlande. Comme lEgypte, selon le
mot dHrodote, est un don du Nil , la Grande Plaine est un don du Fleuve
Jaune et des autres cours deau associs. A une poque relativement rcente,
du moins dans le sens que les gologues donnent cet adjectif, cette
plaine tait un bras de mer dont les vagues venaient battre contre la falaise du
Chan-si, tandis que lactuelle presqule du Chan -tong tait une le. Pendant
des sicles, le Houang-ho a dpos sur cette aire les masses normes de limon
quil avait arraches, plus louest, aux plateaux de terre jaune, crant ainsi de
toutes pices un sol alluvial dune merveilleuse fertilit. Sous cette
accumulation de dpts limoneux, la mer sest comble, le litt oral a recul
toujours plus lest. Ce travail, notons -le, se continue de nos jours encore.
Cest ainsi que le limon exhausse danne en anne le lit du Fleuve Jaune, au
point que les riverains sont obligs de surlever proportion leurs digues et
que le fleuve finit spectacle paradoxal et combien dangereux par couler
comme sur une gouttire au-dessus du niveau de la plaine.
A louest et en arrire de la Grande Plaine rgnent les terrasses de terre
jaune do descend le fleuve nourricier et qui c ouvrent une superficie de plus
de 260.000 kilomtres carrs. Toute cette zone de collines est en effet
recouverte dune immense nappe de terre jauntre, analogue au lss dAlsace,
fine poussire dargile, de sable et subsidiairement de calcaire, dpose de puis
des millnaires par le vent, accumule en masse norme et dcoupe en
terrasses par le ravinement. Terre en principe aussi fertile (quand la pluie ne
fait pas dfaut) que la Grande Plaine, et ne, comme elle, en vocation
agricole : cest le royaume d u millet et du bl (1). Du reste la zone de terre
jaune des terrasses du nord-ouest et la Grande Plaine de limon alluvial du
nord-est se soudent en transitions insensibles sur dimmenses espaces qui
constituent mme, de Pkin K ai-fong et de Kai -fong aux approches de
Nankin, la partie la plus fertile de lensemble : ici la culture du millet, propre
aux terrasses de lss, se combinera avec la culture du riz, propre aux bassins
du Houai-ho et du Yang-tseu (2).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
La civilisation chinoise naquit dans cette zone avec lagricul ture mme,
plus prcisment avec la culture du millet, puis du riz. Les sicles inconnus de
la prhistoire furent consacrs lin cendie et au dfrichement de la brousse
qui couvrait les plateaux de lss au nord-ouest, lasschement des marais
qui couvraient au nord-est la majeure partie de la Grande Plaine. Les vieilles
chansons du Che king clbrent ce labeur. Ah ! ils dsherbent, ah ! ils
dfrichent ! Leurs charrues ouvrent le sol. Des milliers de couples
dessouchent, les uns dans les terrains bas, les autres dans les terrains levs.
Et plus loin : Pourquoi a-t-on arrach la brousse pineuse ? Pour que nous
puissions planter notre millet. Parmi les hros divins qui la socit
chinoise attribuera la direction de ce labeur collectif, elle placera Chen-nong
qui a appris aux hommes les incendies de brousse ainsi que lusage de la houe,
et Heou-tsi le Prince-Millet . Une non moindre importance est reconnue
aux travaux dasschement et dendiguement mis sous le nom de Yu le Grand,
fondateur de la dynastie lgendaire des Hia : il sauve la terre des eaux, mne
les fleuves la mer , multiplie les fosss et les canaux.
Ce fut la vie agricole et sdentaire ainsi pratique par les anctres des
Chinois aux confins du lss et de la Grande Plaine qui les diffrencia davec
les tribus sans doute de mme race restes au stade des chasseurs
nomades dans les steppes du Chen-si et du Chan-si septentrionaux dune part,
dans les forts marcageuses du Houai-ho et du Yang-tseu dautre part. Il ny
a pas lieu de supposer ici dopposition ethnique, encore moins dima giner une
immigration des Proto-Chinois soi-disant venus de lAsie centrale. Du rest e,
les tribus barbares qui encerclaient ainsi ltroit domaine chinois primitif
devaient se siniser leur tour ds la fin de la priode archaque, quand elles
abandonnrent (spontanment pour ce qui est des tribus du Yang-tseu) la vie
nomade pour la vie agricole. De mme, au Tonkin, si les Annamites se sont
diffrencis de leurs frres, les Muong, cest quils se sont consacrs la
culture des rizires dans les basses plaines littorales, tandis que dans les forts
de larrire -pays les Muong ne voulaient connatre de lagriculture que la
pratique intermittente du ray.
La vie de la socit paysanne dans la Chine archaque ne dut peut-tre pas
diffrer beaucoup de ce quelle est aujourdhui encore dans ces mmes
rgions. Dans la Grande Plaine, maisons en torchis (la brique interviendra plus
tard) qui rsistent mal aux pluies de mousson et au forage des rongeurs ; sur
les plateaux de lss, troglodytisme avec chambres creuses flanc de falaise,
de sorte que le champ surplombe la ferme et que les chemines da ration
des chambres viennent parfois paradoxalement souvrir au milieu des cultures.
Dautre part, la sriciculture parat fort an cienne. Si nous en croyons la carte
conomique que suggre le tribut de Yu (environs du VIIe sicle avant J.-C.),
le Chan-tong et les districts voisins pourraient bien tre la patrie du
mrier . La tradition veut dailleurs que le deuxime des Trois Souverains mythiques, le lgendaire Houang-ti, ait appris lui-mme aux Chinois
lever les vers soie et remplacer par des tissus les vtements barbares ,
faits en peau de bte ou en paille. Enfin il semble que ds lorigine le paysan
chinois, aprs avoir arrach la glbe la brousse ou au marcage, ait, pour
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
maintenir sa conqute, adopt le systme, encore en vigueur chez ses descendants actuels, de la culture intensive : comme on la crit, lagriculture
chinoise nest quun jardinage agrandi . Ajoutons que, nayant trouv son
berceau, ni sur les plateaux de lss ni sur les alluvions de la Grande Plai ne, de
sylve vritable (3), le Chinois sera hostile la fort partout o il la rencontrera.
Or la Chine centrale et mridionale, quil sera appel coloniser par la suite,
tait lorigine une zone uniquement forestire. Quand i l sen rendra matre,
le Chinois la dboisera systmatiquement, quitte manquer ensuite de
combustible et sans mme mettre en valeur les collines ainsi dnudes parce
que, ici encore, fils des terrasses du nord-ouest ou des immenses tendues
basses du nord-est, il rpugnera sinstaller sur les hauteurs (4). La terre jaune
et la Grande Plaine auront faonn le Chinois pour lternit.
Au demeurant, pas de vie plus laborieuse que celle de ces paysans chinois.
En dpit de leur patience acharne et sans nerfs, malgr la virtuelle fertilit
des plateaux de lss comme de la Grande Plaine, les terres de lss sont
menaces, par temps de scheresse, deffroyables famines. Dans la Grande
Plaine le danger de scheresse, bien que moindre par suite des pluies de
mousson, se combine avec celui de linondation, sans parler des divagations
terribles du Fleuve Jaune : la crainte superstitieuse des anciens Chinois pour la
divinit des eaux, le Comte du fleuve , comme ils lappelaient, montre bie n
la terreur quen temps de crue inspi rait aux riverains ce voisin indompt : pour
se le propitier, ils lui sacrifiaient priodiquement des garons et des filles. En
ces immenses tendues plates et sans dfense contre les eaux ou contre la
scheresse parce que sans rserves forestires, le paysan dpendait plus
troitement que partout ailleurs de la terre. Le rythme de sa vie se modelait
strictement sur le rythme des saisons.
Plus encore quen tout autre pays agricole, la vie rurale se par tageait donc
ici en deux phases nettement tranches : travaux des champs du printemps
lautomne, puis rclusion hivernale. A lquinoxe du printemps, linterdit
qui pendant lhiver avait frapp la terre tait lev, la terre tait dsacralise
par une crmonie capitale, le premier labourage du champ sacr, labourage
solennellement excut par le roi en personne. Lquinoxe du printemps qui
annonait la fcondation de la terre, annonait aussi celle de la race. Le jour
du retour des hirondelles , les mariages, interdits en hiver, commenaient
tre clbrs. Dans la campagne, au premier cri du tonnerre , jeunes
paysans et jeunes paysannes se runissaient, chantaient ensemble des chansons damour et sunissaient au milieu des champs
La Tchen avec la W ei
Viennent de dborder.
Les gars avec les filles
Viennent aux orchides.
Les filles les invitent
L-bas sinous allions,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
Car,la W eitraverse,
Stend un beau gazon ?
Lors les gars et les filles
Ensem ble font leurs jeux,
Et puis elles reoivent
Le gage dune fleur (5).
A lquinoxe dautomne, aprs les ftes de la moisson, com menait pour
les villageois la priode de rclusion hivernale durant laquelle les femmes
sadonnaient aux travaux du tissage.
Le cycle de la vie paysanne, on le voit, se calque troitement sur le cycle
des saisons. De cette conformit pourraient bien driver les premires
conceptions chinoises sur lunivers et tout dabord le premier classement
des choses en deux catgories gnrales, classement que nous verrons prsider
par la suite et jusquaux temps modernes tous les systmes philosophiques
chinois sans exception. La vie paysanne archaque, on la vu, se divisait trs
rigoureusement en priode de rclusion hivernale o dominaient les travaux
fminins (ctait la saison des tisserandes), et priode de travaux agricoles en
principe rservs aux hommes. Daprs une distribution analogue, toutes les
choses seront par la suite rparties entre deux principes ou modalits : le
principe yin qui correspond l ombre, au froid, la rtraction, lhu midit et
au genre fminin, le principe yang qui correspond la chaleur, lexpansion
et au genre masculin (6). Ces deux principes, comme les phases saisonnires
sur lesquelles ils semblent se modeler, sopposent et, en mme temps, se
conditionnent, sappellent et se muent lun en lautre. Leur interdpendance
ou, si lon prfre, lordre qui prside leur alter nance et leur mutation sera
lordre mme du monde comme de la socit, ou, comme disent les Chinois,
sera le tao, notion centrale qui, nous le verrons, deviendra la cl de vote de
toutes les doctrines philosophiques ultrieures, mais dont, ici encore, il faut
chercher lorigine dans les premires conceptions naturalistes dun peuple
dagriculteurs (7).
La religion chinoise primitive a dailleurs pour but primordial dassurer la
concordance entre le cycle des saisons et le cycle de la vie agricole ou, comme
on dira bientt, entre le Ciel et lhomme. Lor dre supra-humain est rgl par
lAuguste Ciel ( Houang-tien), aussi appel le Souverain dEn -Haut
(Chang-ti), lequel rside dans la Grande Ourse. Lordre terrestre sera, sur le
mme modle, assur par le roi investi, cet effet, du mandat cleste (tien
ming) qui le fait Fils du Ciel (tien tseu), En harmonie avec le Souverain
dEn -Haut, le roi fixera donc le calendrier destin rgler les travaux
agricoles et ouvrira les saisons par les sacrifices et gestes rituels ncessaires.
Dans ses fonctions de grand pontife, il procdera dabord, pour ouvrir lanne
nouvelle et appeler le printemps, au sacrifice dun taureau roux immol au
Seigneur dEn Haut, puis, comme nous lavons vu, au labourage du champ
sacr pour donner le signal des travaux agricoles. Au deuxime mois dt il
offrira un nouveau sacrifice accompagn de supplications pour obtenir la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
10
pluie, crmonie suivie, en cas dchec, de la mise mort des sorciers et
sorcires dont les incantations auront t vaines et qui seront alors brls vifs.
Enfin, lapproche de lhiver, il clbrera labandon des champs et le retour
aux habitations par le sacrifice connu des Romains sous le nom de suovetaurile et dans lequel le taureau, ici, devra tre un taureau noir. Ce sacrifice,
offert au dieu du sol , sera suivi dun autre, offert aux Anctres. Le cycle se
clora par la fte de la moisson, la plus importante de toutes, laquelle tout le
peuple sassociera par une ripaille et une beuverie gnrales. Ajoutons que le
roi revtira chaque saison des vtements de la couleur approprie, suivant
les conceptions chinoises, lorientation de cette saison, vtements noirs
en hiver, verts au printemps, rouges en t, blancs en automne : ornements
sacerdotaux avec lesquels il officiera dans tous les actes de sa vie pontificale.
Il sera aid dans ces diverses fonctions par tout un clerg de scribes, de
devins et de sorciers dont nous verrons par la suite le rle dans llaboration
de la philosophie chinoise archaque.
A ct du cycle saisonnier , le cycle ancestral , aujourdhui commun
toute la population chinoise, mais rserv, durant la priode archaque, la
classe noble. En effet le noble seul avait quelque raison de se proccuper de
ses anctres, parce que, seuls, les gens de sa classe possdaient une me
capable de survie. Ils possdaient mme deux mes, lune (8) qui ntait que le
souffle animal destin, aprs la mort, devenir une sorte de revenant (9)
vivotant autour du cadavre, lautre, lme spirituelle (10), qui, aprs le dcs,
montait au ciel sous forme de gnie (11), mais qui ne pouvait sy maintenir
quautant que sa substance se trouvait alimente par les offrandes funraire s
de ses descendants. Le culte des anctres ainsi cr rsidait
essentiellement dans ces offrandes quotidiennes ou saisonnires qui
continuaient faire participer la vie de la famille le dfunt reprsent par sa
tablette funraire. Ctait gal ement la religion seigneuriale que se
rattachait lorigine le culte du dieu du sol , primitivement reprsent par
un arbre ou par une pierre brute et qui fut la divinit des premiers
groupements territoriaux divinit dailleurs farouche et cruelle : Il aimait
le sang, note Henri Maspero, et les sacrifices quon lui offrait commenaient
en oignant sa pierre-tablette du sang frais de la victime ; celle-ci tait
gnralement un buf, mais les victimes humaines ne lui dplaisaient pas.
Ds les temps les plus anciens que les textes nous permettent dentrevoir,
nous discernons ainsi, vers la jonction de la Grande Plaine et des dpts de
terre jaune, une socit paysanne tout occupe au dfrichement de ce domaine
chinois primitif, socit encadre par une classe noble et couronne par
linstitution royale. La prsence de tels chefs de guerre prouve dailleurs que
lagri culteur chinois devait se maintenir en tat dalerte constante en face des
tribus de chasseurs semi-nomades qui encerclaient son horizon.
La richesse accumule par le labeur de cette socit paysanne nallait pas
tarder spanouir en luxe au sommet de la hirarchie. Si nous ne savons
presque rien sur lhistoire politique de la pre mire dynastie royale, celle des
Hia (12), larchologie commence nous fournir quelques indications sur
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
11
loutillage de cette lointaine poque. Quant la deuxime dynastie, celle des
Chang (entre 1558 et 1050 environ ?), elle nous a, cet gard, rserv depuis
sept ans des dcouvertes inattendues.
De lpoque hia nous navons dabord quune poterie sommaire ment
dcore suivant la technique dite au peigne , technique abondamment
reprsente en Russie dEurope et bien connue en Sibrie entre 2000 et 1500,
ce qui nest pas sans nous suggrer dj des rapports eurasiatiques
intressants (13) ; mais ensuite viennent les vases peints rcemment dcouverts
dans les villages de Yang-chao et de Kin -wang-tchai, province du Ho-nan,
vases en terre rouge brique, avec un dcor dune nervosit pleine de verve, fait
dun groupement imprvu de bandes, de triangles, de pois, de lignes croises
et dyeux cilis : et cette cramique de Yang-chao dbuterait aux environs de
1700 avant J.-C., ce qui correspondrait la seconde phase de la dynastie des
Hia.
Avec la cramique de Pan-chan, ainsi nomme dun site de la province de
Kan-sou (qui a t explor depuis 1921), nous serions entre 1500 et 1400 ou,
selon dautres, entre 1400 et 1300, donc premire moiti de la dynastie c hang.
Nous arrivons l au grand art avec une magnifique ornementation de spirales
rouges et noires dune valeur dcorative digne de lgen. La comparaison, du
reste, nest pas seulement stylistique, car on a retrouv des thmes analogues
dans la cramique peinte de lUkraine et de la Roumanie prhistoriques, ce
qui nous amne supposer quils ont pu se transmettre de la mer Ege la
Chine du nord-ouest par lintermdiaire des steppes russes. Mais sans doute ce
dcor import ne put-il prendre durablement racine en terre chinoise. A
Pan-chan nous avions vu apparatre, ct des spirales gennes , un dcor
beaucoup plus simple, le dcor en damier, visiblement imit de la vannerie.
Cest ce nouveau dcor indigne celui-l qui se retrouve seul, la spirale
tant dsormais abandonne, la priode suivante, dans les fouilles de
Ma-tchang, au Kan -sou, vers le XIVe sicle avant J.-C (14). Nous assistons l
la traduction des divers entrelacs de la vannerie dans la cramique peinte, en
attendant, la priode suivante, de les voir passer dans le dcor des premiers
bronzes.
Nous touchons ici au mystre de lapparition du bronze en Chine. Le
bronze, selon larchologue Menghin, aurait t intro duit en Sibrie vers 1500
avant J.-C. Or diverses pointes de flches de bronze trs archaques trouves
en Chine, Ngan-yang notamment, paraissent rvler une origine sibrienne.
Par ailleurs, selon la remarque de labb Breuil, plusieurs vases de bronze
chinois archaques, dpoque chang, trahissent une imitation nave du travail
sur bois, le bronzier ayant fidlement copi jusqu lencoche et la marque
du couteau. Les Chinois, brusquement mis en prsence de la technique
sibrienne du mtal, auraient, du jour au lendemain, traduit en bronze les
anciens vases rituels de terre cuite ou de bois.
Ce sont ces problmes que posent les dcouvertes faites en 1934-1935
Ngan-yang. Dans cette ancienne capitale des Chang, situe dans la partie la
plus septentrionale de lactuel Ho -nan et dont le rle historique se placerait au
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
12
XIIe sicle avant J.-C., nous nous trouvons brusquement en prsence dune
civilisation matrielle dj son apoge, bien que rien jusquici ne nous ait
fait assister ses dbuts. Un des champs de fouilles, denviron 6 hectares, est
entirement occup par les fondations dun btiment considrable quon
suppose tre le palais royal. Les tombes offrent la trace de sacrifices
funraires avec victimes humaines et animales. Nous savons en effet que les
sacrifices humains continurent assez longtemps tenir une place importante
dans les solennits : la cour, on inaugurait lanne nouvelle en cartelant des
victimes aux quatre portes cardinales de la ville. Des os inscrits et des cailles
de tortue usage divinatoire trouvs dans les tombes de Ngan-yang portent les
premiers caractres chinois parvenus jusqu nous. Il sagit dune criture
encore assez proche de la pictographie, cest --dire du dessin mme des
objets, puisque ce sont de tels dessins qui ont donn sparment naissance aux
hiroglyphes gyptiens, aux cuniformes babyloniens et aux caractres
chinois. Toutefois les caractres dcouverts Ngan-yang sont dj
suffisamment styliss pour nous obliger admettre une longue priode
dlaboration pralable d epuis les dessins vraiment primitifs qui, eux,
nont pas encore t re trouvs.
Ce qui est le plus caractristique dans les fouilles de Ngan-yang, ce sont
les admirables vases de bronze sacrificiels que depuis 1934-1935 elles ne
cessent de nous livrer. Grand a t ltonne ment des archologues quand ils
ont t obligs de constater que ds cette lointaine poque la forme rituelle des
divers types de bronzes et leur dcor taient peu prs entirement
constitus (15). Il y aurait l de quoi crier au miracle Athna sortant tout
arme du cerveau de Zeus ! si nous ne remarquions que, dans la tradition
chinoise, Ngan-yang nest en somme quune des dernires capitales de la
dynastie chang. Les capitales antrieures de cette maison, correspondant aux
premires bauches des bronzes chinois, nont jamais t fouilles. Si nous
admettons que lart du bronze peut avoir t introduit de Sibrie en Chine
dans le courant ou vers la fin du XVe sicle avant J.-C., cest une priode
denvi ron trois sicles quil resterait explorer pour nous permettre dassister
aux dbuts du bronze chinois.
Cest donc un apoge, sans les invitables ttonnements du dbut, que
nous rvlent de plain-pied les bronzes chang rcemment dcouverts
Ngan-yang et dont les Parisiens ont pu admirer des spcimens ou des
quivalents aux expositions organises par Georges Salles lOrangerie en
1934 et par nous-mme au muse Cernuschi en 1937 (16). Jamais aux poques
suivantes les bronziers chinois natteindront une telle puissance dans la
construction architecturale du vase rituel, dans lquilibre des masses qui le
composent. Nous ne pouvons cet gard que renvoyer aux catalogues illustrs
des expositions prcites, notamment pour les grandes marmites couvercle
connues sous les noms de yu ou de lei. Mais la mme robustesse se manifeste
dans les formes plus sobres comme les marmites tripodes li et ting ou comme
la coupe tripode tsio ; du reste, cette sobrit ne nuit en rien llgance des
formes, comme on peut sen assurer par les vases kou, grands calices vass
dune tonnante sveltesse. Les motifs gomtriques ou my thologiques qui
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
13
ornent la plupart des bronzes rituels ne sont pas dune moindre splendeur
dcorative. Notons la vigueur des masques de monstres, commencer par la
tte de monstre appele tao -tie, issue lorigine du ralisme animalier
tte de taureau, de blier, de tigre ou dours et qui se stylise
progressivement en apparition dpouvante. Une autre figure mytho logique
quon trouve sur les bronzes (et aussi sur les jades) chang est le dragon appel
kouei, buf et dragon qui fait le bruit du tonnerre et avec la peau duquel
les hros de la lgende chinoise fabriquaient des tambours qui
commandaient la foudre . Symboles de puissances cosmiques, dit
excellemment Georges Salles, ces animaux fabuleux chargeaient lobjet quils
dcoraient dun pouvoir secret et redoutable.
Les fouilles de Ngan-yang ont livr aussi quelques vigoureuses sculptures
sur marbre en ronde-bosse ou plutt quelques blocs de marbre inciss,
reprsentant galement des monstres mythologiques. (Cette tendance vers la
ronde-bosse semble dailleurs stre arrte aprs les Chang pour ne
reparatre que beaucoup plus tard, lpoque dite des Royaumes
Combattants.)
Enfin, en mme temps que les bronzes, la civilisation de Ngan-yang nous
offre de remarquables jades galement rituels. Le jade, symbole de puret,
possdait en effet, dans les croyances chinoises archaques, une vertu
intrinsque : nous savons par les classiques chinois que le bonnet royal
comportait des pendants de jade, de mme que linsigne par excellence du
pouvoir royal tait une tablette de jade, un grand kouei de trois pieds fix la
ceinture du souverain. Les fouilles dpoque chang nous ont livr de grands
couteaux, haches et haches-poignards (ko) de jade (certains dentre eux, de
teinte brune ou noire, semblent choisis dessein comme imitant la couleur du
bronze) ; aussi deux types bien caractristiques de jades rituels, le pi, disque
centre reperc qui reprsenterait le ciel, et le tsong, cylindre encastr dans un
cube qui symboliserait la terre, ces deux formes de jade ayant peut-tre,
comme les bronzes, figur dans les sacrifices saisonniers que le roi offrait au
Ciel pour obtenir la fcondit de la terre.
La richesse de cette civilisation matrielle concorde avec ce que les
anciennes annales chinoises nous disent des rois de la dynastie chang. Le
dernier dentre eux, Cheou -sin, a laiss la rputation dune sor te de Nron
chinois, produit de cour raffin, fastueux et corrompu, dj un civilis de
dcadence. Son savoir lui permettait de contredire les remontrances, son
loquence lui permettait de colorer ses mfaits. Il assemblait un nombre
toujours plus grand de chiens, de chevaux et dobjets rares, il tendait sans
cesse les parcs et les terrasses de sa capitale. Il y organisait de grands
divertissements, il y donnait des orgies qui duraient toute la nuit. Mais sous
cette faade babylonienne lexpansion de l a race chinoise continuait.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
14
CHAPITRE 2
Lexpansion dune race de pionniers
Pour paradoxal quil paraisse, sil fallait comparer lhistoire de la Chine
celle de quelque autre grande collectivit humaine, cest lhistoire du
Canada ou des tats-Unis quil faudrait songer. Dans les deux cas, il sagit
essentiellement et par-del les vicissitudes politiques, de la conqute
dimmenses territoires vierges par un peuple de laboureurs qui ne trouvrent
devant eux que de pauvres populations semi-nomades. Le plus dur de la lutte
dut tre men contre la nature elle-mme en dfrichant le sol, en abattant la
fort primitive, en domptant les fleuves, en faisant partout de la terre arable.
Seulement il na fallu que trois sicles aux Franco -Canadiens et aux
Anglo-Saxons pour soumettre la charrue le continent nord-amricain, tandis
que la conqute agricole du continent chinois a exig prs de quatre
millnaires. Commence aux confins du lss et de la Grande Plaine vers le II e
millnaire avant J.-C., elle nest pa s encore entirement termine de nos jours
puisque dans les montagnes du sud-ouest les aborignes Lolo et
Miao-tseu ont rsist aux empitements du fermier chinois.
Ce fut sans doute ds le milieu de la dynastie chang (XIVe sicle avant
J.-C.) que les colons chinois commencrent essaimer par groupes compacts
hors de la Grande Plaine pour aller crer de nouvelles aires de dfrichement
au milieu des barbares quils soumettaient, assimilaient ou se conciliaient .
Le processus ne dut pas tre sensiblement diffrent de celui qui a marqu au
XIXe sicle lempitement des labours chinois sur la terre des herbes
mongole, au XXe sicle leur empitement sur la fort mandchourienne. Cette
premire expansion chinoise fut dirige au sud vers le bassin du Yang-tseu,
alors presque tout entier couvert de forts, au nord vers les terrasses de terre
jaune du Chan-si, au nord-ouest vers la valle encaisse de la Wei, au Chen-si,
galement taille dans la terre jaune. Aux approches du Yang-tseu, les laboureurs chinois rencontraient des peuplades restes demi-sauvages (bien que
sans doute de mme race queux) qui vivaient de chasse et de pche et que
leur exemple amena progressivement la vie agricole. Il en allait de mme au
nord-ouest. De ce ct stablit une maison de hardis pionniers, celle des
Tcheou qui se rattachait symboliquement au demi-dieu agricole, le PrinceMillet , et qui entreprit le dfrichement et lensemencement de la riche plaine
alluviale taille dans le lss et saupoudre de lss o s leva depuis la
ville de Si-ngan, ou Tchang -ngan, capitale du Chen-si. Terre si fertile en
millet et en bl quon a pu la comparer un Canada. Des premiers seigneurs
de la famille Tcheou qui sy tablirent, les vieilles annales nous disent avec
une sobre nergie quavant tout ils sappliquaient labourer et semer .
Mais ces laboureurs taient des soldats-laboureurs en raison de la lutte
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
15
perptuelle quils se voyaient obligs de mener contre les tribus barbares au
milieu desquelles ils staient ta blis. Les colons de ce Far-West chinois
menaient en effet la rude existence de tous les pionniers placs dans des
conditions analogues. Leur obstination faire de la terre arable au dtriment
des clans de chasseurs demi-nomades qui erraient sur les terrasses
environnantes fut paye par bien des mauvais jours. Les vieilles annales nous
les montrent obligs par moments de reculer devant la rue des sauvages et
redescendant alors des plateaux de lss vers la valle de la Wei, les
guerriers aidant les vieillards et soutenant les faibles .
A ce rude mtier de dfenseurs des marches et de pionniers des hautes
terres, les seigneurs Tcheou saguerrirent. Au milieu du XI e sicle avant J.-C.,
celui dentre eux que lhistoire connatra sous le nom de Wou -wang profita de
limpopularit o tait tomb le dernier roi chang, Cheou -sin, que ses cruauts
et ses dbauches avaient rendu odieux. Il se rvolta et tailla en pices larme
royale. Cheou-sin, rentr en fuyard dans son palais, se suicida
dramatiquement : il monta sur la Terrasse du Cerf, il se para de ses perles et
de ses jades et se jeta dans les flammes . Wou-wang fit dans la capitale une
entre triomphale. Il saisit le Grand Etendard Blanc. Les seigneurs vinrent se
prosterner devant lui. Il pntra dans le lieu o gisait le cadavre de Cheou-sin
et descendit de son char ; avec son poignard il frappa le cadavre ; avec la
Grande Hache jaune il lui trancha la tte, puis, cette tte, il la suspendit au
Grand Etendard Blanc.
Ctait la victoire des gens des ma rches, des rudes pionniers des hautes
valles du Grand Ouest sur la cour luxueuse et sur les riches agriculteurs de la
plaine centrale. Ainsi promus la royaut, les Tcheou eurent pendant prs de
trois sicles encore la sagesse de conserver leur rsidence dans cette haute
valle de la Wei do ils tiraient leur force et do ils dominaient la Grande
Plaine. Lart de cette poque (X e et IXe sicles), tout dernirement bien isol
par larchologue sudois Karlgren (1935), est caractris par des bronzes
du n style plus rude que le style prcdent, avec un rythme de lignes (ou de
motifs de dragons ) dun gomtrisme svre, parfois un peu lourd (17). Si
nous nous en rapportons ces indices, la civilisation matrielle des premiers
Tcheou semble bien, comme on pouvait dailleurs sy attendre, marquer une
certaine rgression sur le luxe et les blouissantes crations artistiques des
Chang.
Une catastrophe mit fin la puissance des Tcheou. En 771 leur capitale fut
surprise et pille par les barbares de louest. La dy nastie, abandonnant le
sjour des marches, se replia sur la rgion de Lo-yang, lactuel Ho -nan, au
centre de la Chine de ce temps, au seuil de la Grande Plaine. Elle sy trouva
videmment beaucoup plus en scurit, mais elle perdit du coup son caractre
guerrier et ses princes tombrent trs vite au niveau de simples rois fainants,
tandis que tout le pouvoir passait aux seigneurs fodaux.
CHAPITRE 3
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
16
Fodalit et chevalerie
La Chine archaque, du VIIIe au IIIe sicle avant J.-C., pourrait fournir
nos mdivistes des matriaux pour une tude compare du rgime fodal
travers lhistoire. Dans la socit chinoise de ce temps comme dans la France
du Xe sicle, la disparition du pouvoir royal entrana en effet des institutions
assez analogues. Le morcellement des seigneuries fut dabord pouss aussi
loin, puis, ici aussi, un certain nombre de grandes baronnies prparrent le
regroupement territorial.
Nous nnumrerons pas ici tous ces tats fodaux chinois, mais il
convient de faire remarquer que, dans la plupart des cas, leur formation se
modelait sur les donnes gographiques. Les provinces chinoises actuelles,
souvent aussi grandes que plusieurs de nos tats europens, correspondent,
comme ces derniers, des units permanentes qui simposent et reparaissent
toujours travers les vicissitudes de lhistoire. Ce sont ces grandes units
rgionales qui se manifestent dj dans les principauts archaques. Au
nord-ouest, par exemple, lactuel Chen -si, dans la valle de la Wei creuse en
plein lss et qui domine de haut la plaine du Ho -nan, stait affirm ds
laube de la priode historique : nous avons vu que, de cette marche de
louest, les princes Tcheou taient partis la conqute de la royaut. Le rle
de seigneurs des marches quils dsertrent par la suite y fut repris par leurs
vassaux, les comtes de Tsin qui fondrent au Chen -si une baronnie galement
destine une fortune retentissante. Sur les terrasses de terre jaune du Chan-si
se fonda une autre principaut qui profita de sa situation surplombante par
rapport la Grande Plaine pour obtenir et conserver assez longtemps
lhgmonie. Une troisime principaut hgmonique stait fonde lest, au
Chan-tong, province bien individualise entre le massif sacr du Tai -chan et
sa presqule rocheuse, son Armorique terminale. Sur le moyen Yang-tseu,
au Hou-pei, cuvette coupe de lacs et alors couverte de forts, des tribus
barbares, gagnes par lexemple de la civilisation chinoise, se sinisrent
spontanment et fondrent un quatrime grand tat. Mais ce ntaient l que
les baronnies les plus puissantes. Si nous voulions numrer toutes les autres,
nes au hasard des partages fodaux dans le cadre plus modeste des
sous-divisions rgionales, cest une soixantaine de fiefs quil nous faudrait
passer en revue.
Nous nentrerons pas non plus dans le dtail des luttes entre ces diverses
principauts. Il serait aussi fastidieux que celui des querelles fodales dans la
France du XIe sicle et nintresse que la gographie hi storique (18). Ce qui
importe ici, cest le milieu mme, cest la socit de ce temps, quivalent de
notre socit chevaleresque.
Lpoque o nous sommes arrivs est en effet celle de la chevalerie
chinoise . La guerre de ce temps reste une guerre chevaleresque, conduite par
larme noble par excellence, la charrerie. Ces chars de guerre archaques nous
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
17
sont bien connus, non seulement par les anciennes annales mais aussi par les
reproductions que nous en donnent les bas-reliefs han populariss parmi nous
par les estampages de la mission Chavannes (19). Le char est attel de quatre
chevaux, deux au timon, les deux autres tirant en aile par des courroies. Ce
sont des coursiers courts, ramasss et muscls, lencolure paisse et renfle,
grassement nourris et pleins de feu. Les mors sont orns de clochettes. Les
chars, troits et courts, sont forms dune caisse ouverte larrire et monte
sur deux roues. Le char chinois, comme le char assyrien, porte trois hommes
au milieu le conducteur, droite le lancier, gauche larcher. Tous trois sont
vtus dune cuirasse, de brassards et de genouil lres faits en peaux de buf
vernisses. La lance du lancier est arme dun crochet pour harponner
lennemi, les a rcs ont des extrmits divoire. Les boucliers des trois
compagnons sont peints de couleurs vives, le vernis de leurs armes brille au
soleil, tandis qu lavant -garde, larrire -garde et en flanc-garde flottent des
tendards portant les Btes symboliques des Quatre Directions : lOiseau
Rouge du Midi, la Tortue Noire du Nord, le Tigre Blanc de lOuest, le Dragon
Vert de lEst.
Larme de la seigneurie envahit -elle une principaut voisine ? Le
seigneur de celle-ci, par bravade et dfi, lui envoie un convoi de vivres. Mais
le dfi parfois est sanglant : les barons dpchent leur adversaire des braves
qui se coupent la gorge devant lui. Ou bien un char de guerre vient toute
allure insulter les portes de la cit adverse. Puis cest la mle des chars, l a
manire assyrienne. Les mille quipages se heurtent, fanion contre fanion et
honneur contre honneur. Comme dans lpope homrique, les guerriers des
deux armes, ds quils se reconnaissent, changent, du haut de leurs chars,
des politesses hautaines . Parfois, avant la lutte, ils changent encore une
coupe de boisson, parfois mme leurs armes. Le combat, entre de tels
partenaires, doit se conformer en principe de svres rgles de courtoisie.
Ladversaire en mauvaise posture est pargn sil a fait preuve de bravoure ou
sil sait sadresser son vainqueur en chevalier. Comme plus tard dans le
Japon des samurai, le prestige se gagne au moyen de gestes gnreux .
Cest dj lquivalent du bushid, le code de lhonneur chevaleresque, avec
des paladins qui, avant de tirer leur tour, sexposent, impassibles, aux
flches de ladversaire, avec des cuyers qui se font dlibrment tuer pour
honorer le blason de leur seigneur. Plus dun passage du Tso-tchouan est, cet
gard, digne de lpope, co mme celui o le chef des chars du prince de Tsin,
perc de flches, ne cesse de faire rsonner le tambour, car celui qui a revtu
la cuirasse doit aller fermement jusqu la mort : la roue de gauche du char
est devenue pourpre de mon sang. Seigneur, ai-je os dire que javais
mal (20) ?
En temps de paix, le mme idal pntre le gentilhomme. La ceinture
garnie dune breloque de jades au tintement harmonieux , il vient, la cour
de son seigneur, prendre part aux nobles joutes du tir larc, jeu courtois,
rythm par des airs de musique, coup de beaux saluts, rgl comme un
ballet .
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
18
Cet idal chevaleresque de loyaut envers le seigneur comme envers
ladversaire, ce souci de probit militaire, ce code de cour toisie nobiliaire
traduit en temps de paix dans la religion de ltiquette autant de leons qui
devaient laisser des traces profondes dans lme chinoise. La morale
confucenne en a tir une partie de son enseignement.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
19
CHAPITRE 4
Les sages dautrefois
La philosophie chinoise, comme la philosophie indienne et la philosophie
grecque, reprsente un des aspects originaux de la pense humaine.
La spculation philosophique en Chine, on la vu, sort peut -tre de trs
anciennes conceptions naturalistes nes au spectacle de lalternance des
saisons. Ce serait devant le rythme saisonnier que la pense chinoise de
lpoque archaque aurait t amene classer les choses selon deux
catgories gnrales, le yin et le yang, qui reprsentaient lobscurit et la
lumire, lhumidit et la cha leur, et, par analogie, la terre et le ciel, la
rtraction et lexpan sion, le genre fminin et le genre masculin, principes dont
lopposition et lalternance, mais aussi linterdpendance ou, mieux encore, la
mutation expliquaient le processus des choses et toute la vie de lunivers. A
ces deux principes opposs sen superposa bientt un troisime, le tao, qui
tait comme la loi mme de leur solidarit, de leur interdpendance et de leur
enchanement sans fin.
Ces conceptions naturalistes, qui plongent dans les premires
classifications de la mentalit primitive, furent suivies de notions plus
labores, sorties des coles de devins (21). Les devins, dont le rle tait fort
considrable dans la socit chinoise archaque, imaginrent pour la
commodit de leurs oprations, au-dessus du monde sensible, un monde
abstrait commandant le prcdent, un peu comme dans la philosophie grecque
le commandent les Ides platoniciennes ; mais chez les devins chinois il
sagissai t dabstractions gomtriques, savoir des diffrentes combinaisons
que peut former tout un systme de lignes brises ou continues, ordonnes en
trigrammes et hexagrammes et qui par la suite symbolisrent les
diverses combinaisons du yin et du yang, cest --dire, ici encore, les divers
aspects de lunivers, les diverses ventualits de lavenir. Ajoutons cet
ensemble les notions purement chinoises sur la valeur qualitative des
nombres (22) et nous aurons prsentes lespr it les conceptions trs
particulires qui ont servi de point de dpart toute lvolution de la
philosophie de lExtrme -Orient.
Ce fut dans ce milieu intellectuel que vcut Confucius, en chinois Kong
fou-tseu, matre Kong (dates traditionnelles : 551-479 avant J.-C.). N
dune famille noble mais pauvre dans la princi paut de Lou, province actuelle
du Chan-tong, il dut un moment sen loigner pour frquenter les cours
voisines, puis y revint fonder une cole de sagesse. En raison du caractre
moral de son enseignement on la compar Socrate. De fait ils ont entre eux
ce point commun de navoir pas laiss dcrits. Nous sommes obligs de
reconstituer la physionomie de Socrate daprs les images parfois
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
20
divergentes que nous en ont laisses Platon et Xnophon. Plus dlicat
encore est peut-tre le travail en ce qui concerne Confucius. Les entretiens que
nous possdons de lui et qui contiennent ses aphorismes ne nous sont
parvenus que dans une dition remanie, postrieure denviron cinq cents ans
sa mort. Toutefois on doit reconnatre que de ce texte semble se dgager
lesquisse dune personnalit attachante avec des mouve ments charmants de
sensibilit et une spontanit de rplique que nauraient pu inventer de toutes
pices des pangyristes conventionnels.
Pour autant que nous puissions de la sorte suivre la dmarche de sa
pense, nous constatons que Confucius ne cherche nullement innover. A la
manire des vieilles coles de scribes auxquelles il se rattache, son
enseignement se prsente comme un commentaire de la tradition des anciens.
On retrouvera donc chez lui le respect d au Ciel, cest --dire lordre
cosmique, les notions classiques du yin et du yang, la notion suprieure du tao
avec le doublet tao-t ( le tao et la vertu ) que nous reverrons avec un sens
diffrent dans le vocabulaire de ses rivaux, les taostes, mais qui chez lui
traduit surtout un idal de perfectionnement moral. Avec tous les sages de son
cole, Confucius prche la pit filiale et la pit envers les mnes,
cest --dire le culte des anctres. Mais en dpit de ce traditionalisme, quelques
anecdotes nous montrent quil ne se considrait pas comme li par les
formules rituelles ; tout au contraire, ce quil parat avoir avant tout pris,
cest la puret de lintenti on, la sincrit du cur. Sa doctrine se prsente
essentiellement comme une doctrine daction, son enseignement comme une
morale agissante. Cest en tant que directeur de conscience quil semble
avoir mrit son prestige.
Le confucisme se rsume dans la notion du jen, notion qui implique
la fois un sentiment dhumanit envers autrui et un sentiment de dignit
humaine envers soi-mme, au bref le respect de soi et des autres avec toutes
les vertus secondes que cet idal commande : magnanimit, bonne foi,
bienfaisance. Dans les relations extrieures, le jen se traduit par le contrle
constant de soi-mme, par le respect des rites et par une politesse formelle qui
ne fait, comme on la dit, que manifester la politesse du cur. Nous
retrouvons l la haute courtoisie qui, dans la classe noble, sous lempire de
lidal chevaleresque, inspirait ltiquette fodale.
Comme lenseignement socratique, le confucisme tend appren dre avant
tout lhomme se connatre lui -mme pour se perfectionner. Comme
Socrate renoncera aux recherches des philosophes ioniens sur lorigine du
monde, Confucius sans dailleurs tre aucunement agnostique se refuse
scruter le mystre de la destine, discourir sur les esprits, parler des
prodiges . Ce quon sait, savoir quon le sait. Ce quon ignore, savoir quon
lignore, professait -il. Tu ne sais rien de la vie ; que peux-tu savoir de la
mort ? Dautre part cet enseignement tout orient vers le perfectionnement
de lhomme ne distingue pas la morale individuell e de la morale civique ou
sociale. Le but de Confucius reste le bon gouvernement du peuple, assur,
comme dans tous les systmes chinois, par laccord des vertus du prince avec
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
21
lordre du Ciel. Cest la vertu du souverain, linfluence surnaturelle quil
tient de sa charge, du mandat cleste, qui fait la bonne ou la mauvaise
conduite du peuple. Par laccent donn ces maximes, Confucius mritera
de devenir par la suite le sage type, le docteur par excellence de lcole des
lettrs officiels.
Si nous devions rsumer en une seule formule lesprit du confucisme,
nous dirions que cest un civisme en communion, mieux encore : en
collaboration avec lordre cosmique.
Le continuateur de Confucius qui montra le plus doriginalit fut Mo -tseu
(fin du Ve sicle avant J.-C., premires annes du IVe). Par un coup daile
hardi, cet illustre penseur se rapprocha singulirement du thisme. Au lieu du
Ciel impersonnel de ses prdcesseurs, il invoqua le Seigneur dEn -Haut, dieu
personnel, tout-puissant, omniscient et essentiellement moral : Le grand
motif de se bien conduire, ce doit tre la crainte du Seigneur dEn -Haut, lui
qui voit tout ce qui se fait dans les bois, les valles, les retraites obscures o ne
pntre aucun regard humain. Cest lui quil faut tche r de plaire. Or, il veut
le bien et hait le mal. Il aime la justice et hait liniquit. Tout pouvoir sur terre
lui est subordonn et doit sexercer selon ses vues. Il veut que le prince soit
bienfaisant pour le peuple et que tous les hommes saiment les u ns les autres
parce que lui, il aime tous les hommes.
De son thisme, Mo-tseu tire en effet une morale dune remar quable
lvation. Chez lui, laltruisme de Confucius devient lamour universel pouss
jusquau sacrifice de soi -mme : Tuer un homme pour sauver le monde, ce
nest pas agir pour le bien du monde. Simmoler soi -mme pour le bien du
monde, voil qui est bien agir ! Dans le mme sens, Mo-tseu condamne
nergiquement les guerres fodales. Et, pour finir, cette maxime o se rsume
toute sa pense : La science consiste dans ladoration du Ciel et lamour des
hommes.
Tout autre fut lcole taoste.
Les origines de cette cole remontent aux spculations des devins
prhistoriques sur les notions de yin, de yang et de tao dont nous avons parl
prcdemment. Elles se rattachent aussi aux pratiques dautosuggestion des
anciens sorciers et sorcires dont les danses frntiques aboutissaient des
tats de transe et dextase capables de capter lattention et de retenir la
prsence des dieux. Il y a d ailleurs loin de ces pratiques sauvages, toutes
empreintes encore de la magie primitive, la pense, si leve, des pres du
taosme , et la tradition orthodoxe veut ignorer ces troubles hrdits.
Daprs elle, le taosme philosophique aurait t fond par un sage, Lao-tseu,
sur lequel nous ne savons rien de positif et qui, selon la lgende, aurait vcu
vers la fin du Ve sicle avant J.-C. Nous nen savons pas davantage sur le
deuxime sage taoste, Lie-tseu. Au contraire, le troisime dentre eux,
Tchouang-tseu, est effectivement attest comme ayant vcu dans la seconde
moiti du IVe sicle : il serait mort vers 320.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
22
Des antiques recettes de sorcellerie qui lui ont donn naissance, le taosme
a conserv des pratiques trs curieuses sur le contrle de la respiration, ou
plutt une vritable gymnastique respiratoire qui devait amener liniti
un tat dextase et de lvitation, toutes mthodes qui ne sont pas particulires
la Chine archaque puisquon les retrouve chez les yogi indiens. Mais ces
procds dautosuggestion sont ici ennoblis par une pratique de la vie
mystique qui toujours comme dans le Yoga indien devait rendre lme
vide de toute autre chose que de sa pure essence . Le saint taoste parvenait
ainsi une sorte dtat exta tique permanent, tat de grce magique qui tait
aussi ltat de nature .
Les textes taoques nous rvlent les tapes successives de la voie
mystique ainsi comprise : Depuis que jcoute vos ins tructions, dclare dans
le livre de Tchouang-tseu un disciple du sage, jai dabord appris considrer
mon moi comme un objet extrieur, puis je nai plus su si jtais mort ou
vivant. Et de mme dans un autre passage : Aprs avoir vu lUnique (le
tao), il (le disciple) put arriver ltat o il ny a ni prsent, ni pass, puis
celui o lon nest ni mort ni vivant. Le livre de Lie-tseu analyse avec plus
de prcision ces tats contemplatifs, maintenus au sein mme du tourbillon
des choses parce quen communion avec lui : Mon cur se concentra, mon
corps se dispersa. Toutes mes sensations furent pareilles. Je neus plus la
sensation de ce sur quoi mon corps tait appuy ni o posaient mes pieds. Au
gr du vent jallais lest et louest comme une feuille darbre, comme une
tige dessche, tant qu la fin je ne savais plus si ctait le vent qui me portait
ou moi qui portais le vent.
Cette ascse intellectuelle dote le taoste de pouvoirs inous. Arriv, crit
excellemment Granet, ntre plus qu une puissance pure, impondrable,
invulnrable, entirement autonome, le saint va se jouant en toute libert
travers les lments.
Dans sa transcendance, enseigne Tchouang-tseu, le Sage est au-dessus des
contingences : Que la foudre tombe des montagnes, que louragan
bouleverse locan il ne sinquite pas. Il se fait porter par lair et les nues, il
chevauche le soleil et la lune, il sbat par -del lespace ! Comme un pur
esprit il traverse toute matire, car pour lui toute matire est comme poreuse.
Le livre de Tchouang-tseu souvre sur le mythe platonicien du grand oiseau
cleste senlevant ainsi la recherche du tao. Le grand oiseau slve sur le
vent jusqu une hauteur de 90.000 stades. Ce quil v oit de l-haut, dans
lazur, sont -ce des troupes de chevaux sauvages lancs au galop ? Est-ce la
matire originelle qui voltige en poussire datomes ? Sont-ce les souffles qui
donnent naissance aux tres ? Est-ce lazur qui est le ciel lui -mme, ou
nest -ce que la couleur du lointain infini ? Dans ce vol plantaire sur les
ailes du grand oiseau mythique, dans cette aspiration perdue atteindre dun
seul coup daile la force innome qui meut les mondes, Tchouang -tseu se sent
matre de lunivers.
Mais pour sunir ainsi lessence de la Nature, pour ainsi sassocier
llan cosmique, le taoste doit abolir en lui la raison raisonnante, vomir son
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
23
intelligence . Que tes yeux, enseigne Tchouang-tseu, naient plus rien
voir, tes oreilles plus rien entendre, ton cur plus rien savoir. La socit,
la civilisation ne sont que conventions. Le taoste doit les rejeter. Comme le
disciple de Jean-Jacques Rousseau, il doit retourner ltat de nature, vivre
dans lintimit des btes sauvages et libres. Pour retrouver en soi lhomme
naturel, il ny a en effet qu dpouiller le civilis. L rside le secret de
longvit, recherch par toute lcole : pour prolonger indfiniment notre vie,
il nous suffit de conserver en paix, sans interventions artificielles, notre lan
vital. Dans la pratique quotidienne, la sagesse taoste consiste essentiellement
dans le refus de toute agitation inutile : Sans franchir ton seuil, dit Lao-tseu,
tu peux connatre lempire entier ; sans regarder par la fentre, tu peux
possder le tao cleste.
En approfondissant lantique notion du tao, le taosme a donn la
pense chinoise une mtaphysique. Mtaphysique dune remar quable
puissance, encore quchappant toute tentative de dfi nition trop prcise. Le
tao, cest la substance cosmique avant toute spcification. Avant le temps et
de tout temps, dit Lao-tseu, fut un Etre existant de lui-mme, ternel, infini,
complet, omniprsent. Impossible de le nommer, car les termes humains ne
sappliquent quaux tres sensibles. Or lEtre primordial est essen tiellement
non-sensible. En dehors de cet tre, avant lorigine, il ny eut rien. On
lappelle nant de forme, ou mystre, ou tao. Rien de ce qui est nest en
dehors de lui. Il pntre tout, confirme Tchouang-tseu. Il est dans cette
fourmi ; plus bas encore dans cette brique ; plus bas encore : dans cet
excrment. Substance unique dont le yin et le yang ne sont que les modes,
continu cosmique qui permet leur ternelle rversibilit, il reste un pur
inconnaissable, un pur ineffable : Le tao qui peut tre nomm nest pas le
tao vritable (23) . On ne peut le dfinir que ngativement. Cest ce
quexpriment les quatre vers, si souvent cits, du livre de Lao-tseu :
O grand carr quina pas dangles,
Grand vase jam ais achev,
Grande voix quine form e pas de paroles,
Grande apparence sans form e !
Mais on se tromperait radicalement en prenant ce monisme pour un
monisme statique. Cest le dynamisme mme. Comme lont fait observer
Maspero et Granet, le tao est moins conu comme un tre que comme une
force. Il est tout jaillissement et lan vital. Il est la spontanit qui meut les
mondes , ou, mieux encore, le principe permanent de luniverselle sponta nit , llan cosmique identique llan vital.
Par un curieux renversement, ce monisme absolu aboutit un relativisme
radical. Si les dix mille tres ne sont quun, ils sont interchangeables et
interrversibles. Le sage lui-mme, ayant dpouill son nom, sa personnalit,
son moi individuel, sidentifie tout le reste de lunivers. Comment, crit
Tchouang-tseu, savons-nous si le moi est ce que nous appelons le moi ? Jadis
moi, Tchouang-tseu, je rvai que jtais un papillon , un papillon qui voltigeait
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
24
et je me sentais heureux. je ne savais pas que jtais Tchouang -tseu. Soudain
je mveillai et je fus moi -mme, le vrai Tchouang-tseu. Et je ne sus plus si
jtais Tchouang -tseu rvant quil tait un papillon, ou un papillon rvant quil
tait Tchouang-tseu. Ou bien la scne shakespearienne o Lie-tseu, montrant
un crne ramass sur le bord du chemin, murmure, Hamlet chinois : Moi et
ce crne, nous savons quil ny a pas vritablement de vie, pas vritablement
de mort. Avant limage de Renan sur le point de vue de Sirius ,
Tchouang-tseu, pour tablir son relativisme universel, nous a invits
envisager les choses dun observatoire analogue : Si tu montes dans le char
du soleil ... De ces hauteurs le moi et autrui , nous dirions le sujet .et
lobjet, sont identiques : un centenaire nest pas vieux, un mort -n nest pas
jeune, un ciron vaut une montagne, un brin dherbe vaut lunivers .
Ce relativisme ou plutt cette universelle rversibilit aboutit une
attitude de dtachement, de quitude, dacceptation sereine devant toutes les
vicissitudes humaines. O monde, dira Marc-Aurle, tout ce que tu
mapportes est pour moi un bien. Quand nous avons compris, dit de
mme Tchouang-tseu, que la terre et le ciel sont un grand creuset et le
Crateur un grand fondeur, o irions-nous qui ne ft bon pour nous ? O
mon matre, mon matre, scrie encore Tchouang -tseu sadressant au tao, tu
anantis toute chose sans tre cruel, tu fais largesse aux dix mille gnrations
sans tre bon. La dernire leon du taosme sera cette leon dindiffrence.
Une philosophie particulire est celle de Yang-tseu, lequel vivait vers le
milieu du IVe sicle avant J.-C. Nous sommes ici dans la terrible poque des
Royaumes Combattants . La guerre rgne en permanence avec
deffroyables tueries, le massacre en masse des populations civiles. Aussi la
vision que Yang-tseu nous a laisse de ces sicles de fer est-elle une vision
dsespre, cynique aussi. Son enseignement est un fatalisme pessimiste avec,
dans lamertume, un accent personnel qui rappelle notre Lucrce. Cent ans
sont lextrme limite de la vie humaine. Lenfance porte sur les bras et la
dcrpitude radoteuse en occupent la moiti. La maladie et la douleur, les
pertes et les peines, les craintes et les inquitudes remplissent le reste.
Quest -ce que la vie de lhomme, quel en est le plaisir ? Morts, les hommes ne
sont quune pourriture puante. Mais que serait la vie ternelle !
Si le spectacle du rel dcevait profondment les penseurs, il fut une cole
qui laccepta rsolument, celle des lgistes qui, dans cette socit de fer,
cherchrent tablir une doctrine de ltat indpendante de la morale. Prenant
lhomme tel quil est, avec ses vices, les lgistes tablirent sur ces bases
essentiellement empiriques une thorie du bon gouvernement. Les lois
devaient, mme sous des princes personnellement mdiocres, assurer le salut
de ltat, voire le bien du peuple, et cela par le jeu altern des deux
poignes , savoir les chtiments et les rcompenses. La politique est une
technique ; le critrium de la valeur des lois nest pas leur qualit morale
thorique, cest leur efficacit pra tique. Le principal cet gard est que les
lois ne soient pas dsarmes : Ce qui permet aux tigres de triompher des
chiens, ce sont leurs griffes et leurs crocs.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
25
Mencius (Meng-tseu), qui vcut entre 372 et 288 environ, est un moraliste
de lcole confucenne. Il enseigne une doctrine de juste milieu, galement
loigne de lindividualisme goste de Yang -tseu et de la totale immolation
de soi prche par Mo-tseu. Il ne proteste pas moins contre la duret de lcole
des lgistes. En somme il revient lhumanitarisme confucen en lquilibrant
par une thorie plus raliste de la justice. Une place particulire est faite ici
lducation : Lexcellence du cur rsulte de la culture dun germe de
bont, telle une semence dorge qui profite dun bon sol et dune anne
heureuse. Mais cette doctrine modre ne devait avoir son plein succs que
plus tard, l poque du calme gouvernement des Han. Pour le moment,
lpoque des Royaumes Combattants tait ses plus terribles heures et tout le
ralisme des lgistes ntait pas de trop pour les leons que leur demandaient
aventuriers et tyrans.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
26
CHAPITRE 5
Par le fer et par le feu
Du chaos fodal staient finalement dgages quelques grandes
principauts qui absorbrent les seigneuries secondaires et qui sengagrent
bientt dans des luttes mort, chacune luttant contre toutes les autres pour
savoir laquelle raliserait son profit lunit du territoire chinois (24). A partir
de 335 avant J.-C., les princes territoriaux les plus importants, sans plus se
soucier des rois fainants de la dynastie Tcheou, assumrent eux-mmes le
titre royal comme, dans le monde grec, aprs la mort dAlexandre, ses
lieutenants, les Diadoques, devaient le faire en 305. Lpoque des Royaumes
Combattants (25) battait son plein.
Avec les Royaumes Combattants lancienne guerre de chev alerie fit place
une guerre daventuriers sans piti ni loyaut, puis des guerres de masse o
toute la population dun pays tait lance contre les populations voisines.
Larme noble par excellence, larme des beaux tournois la manire de notre
Iliade, la charrerie, commena faire place larme des attaques brusques et
des incursions en trombe, la cavalerie proprement dite. Cette rvolution dans
lart militaire fut entreprise en 307 avant J. -C. par un roi de ltat de Tchao,
dans le nord de la ctuelle province de Chan-si. Ayant lutter contre les Huns
de la Mongolie, il stait aperu que ce qui faisait la supriorit de ces
nomades, ctaient leurs archers monts dont la mobilit et les rapides
volutions surprenaient toujours la lourde charrerie chinoise. Leur empruntant
leur tactique, il cra leur exemple des corps darchers cheval. Son voisin et
rival, le roi de Tsin (dans lactuel Chen -si), fit mieux encore : il se donna non
seulement une cavalerie, mais aussi des corps de fantassins quips la
lgre, arme en quelque sorte nationale par laquelle il remplaa les lentes
leves fodales. En mme temps apparaissait la poliorctique avec linvention
de machines de sige, de tours roulantes et de catapultes qui constiturent une
vritable artillerie . Mais la courtoisie de la guerre fodale tait bien
rvolue. Les luttes entre Royaumes Combattants devenaient inexpiables. Au
lieu de tirer noblement ranon des prisonniers, les vainqueurs, dsormais, les
faisaient excuter en masse. Les soldats du royaume de Tsin, le plus
belliqueux de tous ces tats rivaux, ne recevaient leur solde que sur
prsentation de ttes coupes. Dans les villes prises dassaut, voire prises par
capitulation, la population tout entire, femmes, vieillards, enfants, tait le
plus souvent gorge. Remettant en honneur les pratiques cannibales de
lhumanit primitive, les chefs, pour accrotre leur prestige , nhsitaient
pas jeter lennemi vaincu dans des chaudires bouillantes et boire cet
horrible bouillon humain, mieux encore, obliger en boire les parents de
leur victime.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
27
Parmi les Royaumes Combattants, le Tsin, lactuel Chen -si, jouissait
dailleurs par sa position gographique dune situation privilgie. De la haute
valle de la Wei, il surplombait les riches plaines du Ho-nan, enjeu de toutes
ces comptitions. Cest ce quindique en termes saisissants lHrodote de la
Chine, le vieil historien Sseu-ma Tsien (mort vers 80 avant J. -C.) : Le pays
de Tsin est un tat que sa configuration mme pr destinait la victoire.
Rendu difficile daccs par la ceinture que forment autour de lui le Fleuve
Jaune et les montagnes, il est suspendu mille li au-dessus du reste de
lempire. Avec 20.000 hommes il peut tenir tte un million dhommes arms
de la lance. La disposition de son territoire est si avantageuse que, lorsquil
dverse ses soldats sur les seigneurs, il est comme un homme qui lancerait de
leau dune cruche du haut dune maison leve. Ajoutons ces avantages
gographiques les qualits militaires de la race, race de pionniers et de
soldats-laboureurs en ces marches extrmes du Far-West chinois. Pour mettre
profit ces divers dons naturels, une dynastie locale raliste et dure qui
discerna de bonne heure le vice secret des autres dynasties rivales :
lmiettement du domaine princier en sous -fiefs et tenures au profit des
compagnons du chef. Evitant cette cause daffaiblissement, les rois de Tsin
surent rcompenser leurs fidles sans morceler le domaine royal. Enfin ils
sentourrent dune cole de lgistes, nous avons fait allusion cette
catgorie de philosophes , qui, pour asseoir lautorit royale et justifier
la conqute, laborrent de toutes pices une thorie absolutiste du Prince et
de ltat.
Il ne faudrait pas ngliger non plus les durs ministres-rgents qui, pendant
les minorits, assurrent plus virilement encore que les rois eux-mmes la
continuit de la politique royale : tel cet extraordinaire Wei Yang dont
lannaliste nous dit laconiquement, sous la rubrique de 359, q u il
encouragea le labourage et les semailles et augmenta dans larme les
rcompenses comme les punitions : le peuple en souffrit dabord, mais ltat y
trouva son avantage . Le Richelieu chinois fut dailleurs mal pay de ses
services. Un nouveau roi, quil avait jadis morign comme prince hritier, le
fit carteler entre des chars . Un pareil supplice pour un aussi haut
personnage montre la rigueur des lois de Tsin. A tous les degrs de la
hirarchie elles taient impitoyables : Ceux qui font quelque critique sont
mis mort avec toute leur parent. Ceux qui tiennent des conciliabules, on
abandonne leurs corps sur la place publique. Du moins une discipline stricte
fut-elle ainsi impose lensemble de la population.
Sous de tels chefs, la conqute, par le royaume de Tsin, des autres
royaumes de la Chine de ce temps, le bassin du Fleuve Jaune, la valle du
Yang-tseu demanda malgr tout un sicle et demi (26). Seules les annales
des rois dAssyrie, les Sennachri b et les Assourbanipal, talent un tel luxe
datrocits. En 331, Tsin fait prisonnire larme de Wei et dcapite 80.000
hommes. En 318 Tsin disperse la coalition de Wei, de Han et de Tchao
quavaient aids les Huns, et coupe 82.000 ttes. En 312 Tsin b at Tchou et
coupe 80.000 ttes. En 307 on se contente dun tableau de 60.000 ttes. Mais
avec lavnement du roi Tchao -siang (il rgnera sur le Tsin de 306 251), les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
28
ftes seront plus somptueuses. En 293 il bat Han et Wei et soffre pour
commencer un butin de 240.000 ttes. En 275 campagne contre Wei 40/000
ttes seulement. En 274 nouvelle expdition contre le mme adversaire : cette
fois, 150.000 ttes. En 260 grand succs sur le Tchao : bien quon et
promis la vie sauve aux ennemis, on en dcapita plus de 400.000. Une terreur
grandissante sem parait des autres royaumes chinois. Il ntait plus de
dcennie o Tsin, la bte froce de Tsin , namputt lun dentre eux. Ce
fut alors que monta sur le trne de ce mme Tsin le prince qui allait mene r
bien luvre de ses prdcesseurs, lunificateur de la terre chinoise, le futur
Tsin Che Houang -ti.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
29
CHAPITRE 6
Le Csar chinois
Lorsque, en 246 avant J.-C., le fondateur du csarisme chinois, qui ne
sappelait encore que le roi Tcheng, monta s ur le trne du Tsin, il navait que
treize ans. Sa jeunesse laissa quelque rpit aux autres royaumes chinois, mais
le sursis devait tre de courte dure. Ctait, dit un de ses conseillers, un
homme au nez prominent, aux yeux larges, la poitrine doi seau de proie,
la voix de chacal, avec le cur dun tigre ou dun loup. Il avait vingt-cinq
ans lorsque, en 234, un de ses gnraux, vainqueur du royaume rival de
Tchao, dans lactuel Chan -si, lui offrit le trophe colossal de 100.000 ttes
coupes. Les autres princes se sentirent perdus. Seul lassassinat du jeune roi
pouvait les sauver. Lun deux organisa le meurtre (la. scne nous a t
transmise par un bas-relief du Chan-tong, estamp par la mission Chavannes),
mais le roi chappa et ce fut lassas sin qui fut coup en morceaux. Ds lors les
conqutes se succdrent une allure foudroyante. Entre 230 et 221 tous les
autres royaumes chinois, correspondant aux provinces actuelles du Chan-si et
du Ho-nan, du Ho-pei et du Chan-tong, du Hou-pei et du Ngan-houei, furent
successivement annexs. En 221 toute la Chine de ce temps tait unifie sous
lautorit du roi de Tsin. Celui -ci prit le titre imprial dAuguste Seigneur
(Houang-ti) et cest sous ce nom de Premier Auguste Seigneur Tsin , en
chinois Tsin Che Houang-ti, quil est connu dans lhistoire.
Lempire chinois tait fond en mme temps qutait ralise lunit
chinoise. Il devait, sous des dynasties diverses, durer pendant deux mille cent
trente-trois ans (de 221 avant J.-C. 1912 de notre re).
Lunification territoriale de la Chine par Che Houang -ti fut suivie dun
travail dunification politique et sociale, intellectuelle aussi, qui nest pas la
partie la moins remarquable de son couvre. Personnalit hors de pair, le Csar
chinois ne fut pas seulement un conqurant, mais aussi un administrateur de
gnie. La centralisation militaire et civile cre par ses prdcesseurs dans leur
royaume du Chen-si, il ltendit lempire entier. Par des changes en masse
de populations il sut briser les rgionalismes les plus obstins. Son csarisme
autoritaire en finit avec une fodalit qui semblait inhrente la socit
chinoise. Loin de crer, comme lespraient ses gnraux, et en leur faveur,
une fodalit nouvelle, il divisa lempire en trente -six commanderies
directement administres chacune par un gouverneur civil, un gouverneur
militaire et un surintendant. Son ministre Li Sseu unifia les caractres
dcriture, rforme dun importance capitale pour lavenir en raison des
diffrences de dialectes travers lesquels lidentit de lcri ture est souvent,
de Pkin Canton, le seul truchement commun. De mme il unifia les lois et
les rgles, les mesures de pesanteur et les mesures de longueur ; les chars
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
30
eurent des essieux de dimensions identiques . Cette dernire mesure se rfre
la cration dun systme de routes impriales de largeur uniforme (larges de
cinquante pas), plantes darbres et surleves contre les inondations.
A linstigation de son ministre Li Sseu, le Csar chinois, en 213 av ant
J.-C., ordonna la destruction des livres classiques, notamment de tous ceux de
lcole confucenne, mesure qui travers les sicles a vou sa mmoire
lexcration des lettrs. En ralit les lettrs, traditionnellement attachs au
culte du pass fodal, se faisaient consciemment ou non les dfenseurs du
rgime que Che Houang-ti venait dabolir. Pour en finir avec leur opposition
sournoise, lempereur proscrivit les livres , mesure radicale qui, du reste,
ne dut pas tre aussi gnrale quon la d it puisque finalement les classiques
ont survcu. Laissons donc protester les lettrs. Seule, luvre de Che
Houang-ti compte, et cette uvre gale en importance et dpasse
singulirement en dure celles dAlexandre ou de Csar. Au pays
territorialement le plus morcel, socialement le plus fodal, son csarisme sut
en une vingtaine dannes imposer une centralisation assez forte pour durer
vingt et un sicles. En somme un des plus puissants gnies qui il ait t
donn de reptrir une humanit.
Les inscriptions que le Csar chinois fit graver aux quatre coins de son
empire prouvent quil tait conscient de la grandeur histo rique de son uvre.
Il a runi pour la premire fois le monde , dit magnifiquement linscription
du Tai -chan. Il a renvers et dtruit les remparts intrieurs , dit
linscription de Kie -che. Il a rgl et galis les lois, les mesures et les
talons qui servent tous les tres, dit la stle de Lang-ya ; il a mis lordre
dans la terre orientale, il a supprim les batailles, formule dune Pax Sinica
quivalente, pour lExtrme -Asie, ce que sera la Pax Romana pour le monde
mditerranen. Et plus loin dans le mme sens : Les ttes noires (cest --dire
les Chinois) jouissent du calme et du repos ; les armes ne sont plus
ncessaires ; chacun est tranquille dans sa demeure. Le Souverain Empereur a
pacifi la ronde les quatre extrmits du monde , formule qui, elle aussi,
voque un orbis sinicus se suffisant lui-mme et analogue lorbis romanus.
Les inscriptions rupestres de Che Houang-ti commmoraient ses voyages.
La Chine une fois unifie, il avait en effet tenu en parcourir lui-mme les
principales rgions. On le vit ainsi faire lascension de la montagne sacre du
Tai -chan pour sy entretenir avec les esprits cl estes, puis aller contempler
locan du haut de la terrasse de Lang -ya do il essaya dentrer en
communication avec les gnies de la mer, habitants des les mystrieuses o
se lve le soleil ...
Une des proccupations de Che Houang-ti fut de mettre la Chine labri
des incursions des nomades turco-mongols. Ces barbares, alors connus sous le
nom de Huns, erraient sur les frontires de lempire du ct de la Mongolie.
Pour les contenir, les anciens princes chinois avaient construit des murailles
partielles en divers points des marches du nord. En 215 Che Houang-ti fit
runir en une ligne de dfense continue ces anciens lments de fortification.
Ce fut la Grande Muraille qui courut depuis la passe de Chan-hai-kouan, sur
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
31
le golfe de Petchili, jusquaux sour ces de la Wei, au Kan-sou, dans les
marches du nord-ouest.
Jusqu cette poque le territoire chinois ne comprenait, on la vu, que le
bassin du Fleuve Jaune et la valle du Yang-tseu. La Chine mridionale
actuelle, notamment la rgion cantonaise, restait allogne et barbare. En 214
Che Houang-ti y envoya une arme qui occupa Canton et commena la
sinisation du pays. A cet effet lempereur fit faire des rafles de gens sans aveu
et les envoya peupler les nouvelles provinces, depuis lembouchure du
Yang-tseu jusqu Canton. Lhistoire de la colonisation euro penne nous
montrerait maintes fois appliqu ce systme de la peuplade au moyen de
convicts.
Le Csar chinois mourut en 210 avant J.-C. Il fut enterr, conformment
sa volont, prs du village actuel de Sin-fong, au Chen-si, sous un tumulus
norme, haut de 48 mtres au-dessus de lembase, de prs de 60 au -dessus de
la limite antrieure des travaux de terrassement, vritable montagne dun
demi-million de mtres cubes, construite de main dhomme. On mur a dans sa
tombe une partie de ses femmes et les ouvriers qui y avaient transport ses
trsors.
La priode ascensionnelle du royaume de Tsin lpoque des Royaumes
Combattants, depuis la seconde moiti du VIe sicle avant J.-C., et la brve
apothose impriale de cette maison sous Che Houang-ti (221-210) virent se
dvelopper dans lart des bronzes un style propre, profondment novateur. Ce
style, appel nagure art tsin et aujourdhui art des Royaumes Combattants , est caractris par la libration de la ronde-bosse dans les
reprsentations danimaux couchs au flanc des vases, comme on peut le voir
par les clbres bronzes de Li-yu, aujourdhui au Louvre. Il est caractris
surtout par un dcor nouveau, avec des entrelacements et des chevauchements
de lignes, de boucles, de crochets, de tresses, de spirales et de mandres
donnant lim pression dun fourmillement et dune danse en mouvement per ptuel. Le mme rythme trpidant entrane les dragons en forme de lzards
qui, dj opposs, mais dans un mouvement encore assez lent, sur le dcor des
bronzes tcheou, senlvent ici en une sarabande effrne. Il anime galement
les scnes de chasse qui servent de dcor aux derniers de ces bronzes en
transition vers le han. Notons que ce style, bien que logiquement driv de
celui de lpoque tcheou, peut avoir t influenc par un art voisin qui apparat
alors pour la premire fois aux frontires septentrionales de la Chine : lart des
steppes.
A lpoque qui nous occupe, limmense zone de steppes qui s tend depuis
la Russie mridionale, sur les rives septentrionales de la mer Noire, jusqu la
Muraille de Chine, travers le sud de la Sibrie et la Mongolie, tait occupe
par des nomades de races diverses, Scythes de race aryenne en Russie,
Huns de race turco-mongole en Mongolie, mais qui tous transhumaient la
suite de leurs troupeaux. Scythes ou Huns, tous ces cavaliers de la steppe
possdaient un art particulier, reprsent surtout par des plaques de bronze
avec des combats danimaux fauves et quids, rapaces et cervids
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
32
curieusement tourments et contorsionns en une stylisation toute de
mouvement. Nous avons vu par ailleurs quen 307 avant J. -C. les Chinois,
pour lutter armes gales contre les Huns de Mongolie, crrent leur
exemple des corps darchers monts. Du coup ils emprun trent aux Huns une
partie de leur costume, le pantalon du cavalier qui remplaa la robe de
lhomme de char, une partie aussi de leur quipement, notamment les
appliques et agrafes de bronze. Or, avec ces plaques et ces boucles nous
voyons apparatre en Chine des motifs animaliers styliss dont le rythme est
en rapports assez troits avec lart des steppes tout en appar tenant au style
chinois des Royaumes Combattants et de lpoque tsin dont il a pu fav oriser
lclosion. Le fait, comme on le voit, est intressant puisquil nous permet de
dceler certains contacts de lart chinois non seulement avec lart animalier
des Huns de la Mongolie et avec celui des bronzes sibriens (rgion de
Minoussinsk), mais mme, par cet intermdiaire, avec lart scythe de la Russie
mridionale, ce dernier bien connu par ailleurs pour ses relations avec lart
grec ...
Quoi quil en soit de ces rapprochements archologiques qui nen sont du
reste qu leur dbut, la Chine, l poque o nous sommes arrivs, allait de
toute faon entrer dans le courant de lhistoire mondiale. Lempire unitaire,
cr par Che Houang-ti, allait, sous la dynastie suivante, tre appel
connatre le monde indien, lIran et le monde romain.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
33
CHAPITRE 7
De lempire militaire lempire traditionnel
La monarchie absolue cre par Tsin Che Houang -ti ne se comprenait
quavec un homme fort. Or le fils du Csar chinois se trouva un adolescent
incapable. Au bout de trois ans de dsordres, il dut se suicider au milieu de la
rvolte gnrale. Le pays retomba dans la plus affreuse anarchie et les chefs
darmes sarrachrent les diverses provinces.
Les historiens chinois se sont plu opposer le caractre des deux
principaux capitaines qui se disputaient ainsi le pouvoir, Lieou Pang et Hiang
Yu : Hiang Yu, gant brutal aux allures de soudard ; Lieou Pang, type de
Chinois politique, rus et adroitement gnreux, encore que, lui aussi,
aventurier sans pass. De Lieou Pang surtout ils nous ont laiss un portrait
haut en couleur. Ctait un homme au nez prominent, au front de dragon,
avec une belle barbe. Sur la cuisse gauche il portait soixante-douze points
noirs signe, videmment, de sa grandeur future. Bien que fort pauvre,
il aimait le vin et les femmes. On nous apprend quil allait boire chez une
vieille marchande, la dame Wang ; soit gnrosit, soit vantardise, il offrait
toujours de payer le vin au-dessus du prix fix ; en ralit il nachetait qu
crdit. Il est vrai quun jour que, parfait ement ivre, il stait endormi dans la
boutique, la vieille crut voir au-dessus de lui planer un dragon, nouveau
prsage dune haute destine : plus que jamais elle donna son vin crdit.
Abandonnant la vie de paysan, Lieou Pang avait de bonne heure pris du
service comme officier de police dans une circonscription rurale. A ce point
de sa carrire sa biographie continue nous conter sur lui de joviales
anecdotes comme le jour o, invit par le prfet du district verser en
cadeau mille pices de monnaie, il sen tira en payant daudace sans
remettre un liard. Ctait le temps o, dans la ruine de lempire tsin, tout
aventurier pouvait faire fortune. Lieou Pang commena par se constituer une
troupe, dassez curieuse faon, du reste : un jour quil tait charg descorter
une colonne de condamns, il trouva plus avis de les dlier de leurs chanes
et de se mettre leur tte comme chef de bande. Il aspergea de sang son
tambour, prit le rouge comme emblme de ses tendards , et se tailla un fief
au Kiang-sou, sa patrie. En 207 il marcha sur la province impriale, le
Chen-si, et, tout de suite, sut sattacher la population par son humanit. Au
contraire, son rival, Hiang Yu, qui occupa peu aprs le Chen-si sur ses traces,
ravagea pouvantablement le pays. Hiang Yu, stant empar du pre de
Lieou Pang, menaa, si ce dernier ne se soumettait pas, de faire bouillir le
vieillard. Lieou Pang ne se laissa pas intimider pour si peu. A cette horrible
menace il rpondit sur le ton le plus aimable : Hiang Yu et moi, nous avons
t nagure frres darmes. Mon pre est donc devenu le sien. Sil veut
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
34
absolument faire bouillir notre pre, quil nou blie pas de men rserver une
tasse de bouillon ! Interloqu par un tel sang-froid, Hiang Yu ne tarda pas
relcher son captif.
Bientt, du reste, ladresse de Lieou Pang eut accul son adver saire au
dsastre final. Dans une furieuse bataille livre sur la rivire Houai, Hiang Yu
fit des prodiges de valeur, traversa plusieurs fois avec sa cavalerie les rangs
ennemis et abattit de sa main un des lieutenants de Lieou Pang ; mais, perc
de dix blessures, il se vit encercl par des forces suprieures ; parmi ses
poursuivants il reconnut un de ses anciens compagnons darmes : Je sais que
ma tte est prix, lui cria-t-il. Tiens, prends-la ! Et il se trancha la
gorge (203).
Lieou Pang navait plus de rival. Le soldat de fortune se trouvait
empereur ! Par un dnouement imprvu, ctait pour ce fils de paysan
quavaient travaill trente -sept gnrations de princes de Tsin ; ctait
finalement pour lui que Tsin Che Houang -ti avait cr le csarisme chinois.
Lheureux aventurier se trouvait en moins de cinq ans lhritier inattendu de
cette longue suite dorgueilleux fodaux, le bnficiaire de luvre accomplie
par lhomme de gnie qui avait cr de toutes pices la centralisation
impriale et lunit chinoise. Les dbuts de son rgne furent dailleurs
modestes, difficiles mme. Pour rcompenser les autres condottieri qui
lavaient aid monter sur le trne, il dut leur accorder de larges fiefs, les
nommer rois provinciaux, semblant ainsi rtablir en leur faveur la fodalit
abolie par Tsin Che Houang -ti. Mais ce quil donnait dune main, il le
reprenait de lautre ; les rois locaux quil avait t oblig de crer, il profitait
du moindre prtexte pour les dplacer comme de simples prfets ou pour les
acculer la rvolte et les supprimer. Finalement la nouvelle fodalit des Han,
domestique et dpourvue de toute autorit administrative, devait rester une
simple noblesse de cour qui nen trava en rien le pouvoir absolu de lempereur.
Cet homme heureux devait bnficier de ce qui, pour un fondateur de
dynastie, est encore la meilleure fortune : une ligne de descendants qui
conserva lempire pendant quatre sicles. Il ntait pas, lorigine, de pouvoir
plus discutable et prcaire que le sien. Il ne devait pas y avoir, par la suite, de
lgitimit plus sre que celle qui put se rclamer de lui parce que sa dynastie,
celle des Han, devait durer de 202 avant J.-C. 220 de notre re et marquer si
fortement le destin du peuple chinois que celui-ci aujourdhui encore se
glorifie de ce nom : les fils des Han .
Nul cependant ne fut moins enivr de sa fortune que ce fondateur de
dynastie. Au fate des honneurs, il noubli a jamais la simplicit de ses
origines : Cest en tant vtu dhabits de toile et en tenant en main une pe
de trois pieds de long que je me suis empar de lempire ! Il ne se plaisait
rellement quauprs des petites gens de son pays natal, lactuel Kiang-sou
(province de Nankin) avec lesquels il aimait voquer le temps de sa jeunesse.
Cependant il dut sen sparer pour aller rsider dans sa nouvelle capitale de
Tchang -ngan (lactuel Si -ngan), dans la province de Chen-si qui tait la terre
impriale par excellence. Avant de quitter sa province natale, il donna un
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
35
grand banquet populaire. Il y invita tous ceux, jeunes et vieux, quil avait
autrefois connus et fit circuler le vin. Avec eux il but et dansa. Les vieillards,
les matrones et les anciens amis de Lieou Pang passrent plusieurs jours se
rjouir et boire. Ils se racontaient les vnements passs pour en rire et pour
sen amuser. Avant de se sparer deux, lempereur ne put retenir ses
larmes : Le voyageur safflige en pensant sa terr e natale ; quoique je doive
aller rsider dans lOuest, mon me, aprs ma mort, se plaira encore penser
votre pays.
En mme temps quavec les villageois, ses compatriotes, Lieou Pang
sattardait parmi ses soldats dont il partageait les gots. Quant a ux lettrs
confucens, sil ne les perscuta pas systma tiquement comme lavait fait
Tsin Che Houang -ti, il les mprisait profondment et les criblait de
sarcasmes. Ceux dentre eux qui lui rabattaient les oreilles avec les textes
classiques, les Odes et les Annales, se faisaient vertement rabrouer : Jai
conquis lempire cheval ! Que me font vos Odes et vos Annales ? Du reste
ce ntait gure le moment de dmilitariser lempire. En 200 lempereur se
laissa cerner par les Huns sur un plateau prs de Ping -tcheng, dans le nord
du Chan-si. Pendant sept jours le gros de larme ne put lui faire passer de
vivres. Il sen tira par une ruse, en faisant tenir au roi des Huns le portrait
dune beaut chinoise. Deux ans plus tard il se rsigna en effet env oyer au
chef barbare une des jolies filles de son harem. Les potes ne cesseront depuis
de plaindre la pauvre perdrix chinoise livre en mariage loiseau
sauvage du nord .
Lieou Pang englobait les mdecins dans le mpris gnral o il tenait tous
les lettrs. Souffrant dune blessure de guerre, il refusa daccepter leurs soins.
La plaie senvenima et il mourut Tchang -ngan, g seulement de
cinquante-deux ans, le 1er juin 195.
Le fondateur des Han laissait le trne lun de ses fils, un adolesce nt trop
jeune pour gouverner. Le pouvoir fut exerc par la mre du jeune homme,
limpratrice douairire Lu, femme dune nergie farouche dont les conseils
avaient jadis aid Lieou Pang assurer sa fortune. Un moment Lu avait d
disputer sa place une concubine plus jeune qui, dans les dernires annes du
rgne de Lieou Pang, avait fait figure de favorite. A peine lem pereur dcd,
Lu tira de sa rivale une vengeance atroce. Elle lui fit couper les mains et les
pieds, arracher les yeux, brler les oreilles, puis, aprs avoir administr la
malheureuse une drogue stupfiante, elle la jeta, truie humaine , dans la
porcherie du palais o on la nourrissait de dtritus. LAgrippine chinoise
redoutait encore un jeune prince que le dfunt souverain avait eu dune
troisime concubine. Au cours dun banquet elle lui prpara la mort de
Britannicus. Mais le petit empereur, qui ntait pas averti du dessein form
contre son demi-frre, avana le premier la main pour vider la coupe
empoisonne. Limpratrice neut que le temps de bondir de son sige et de
renverser le fatal breuvage. Inutile dajouter que la victime, miraculeusement
chappe la mort, se hta de fuir cette dangereuse maison.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
36
La douairire profita de son autorit pour placer les gens de son propre
clan toutes les avenues du pouvoir. Mais ds le lendemain de sa mort, dans
un nouveau drame de palais, ils furent collectivement gorgs par les princes
impriaux (180 avant J.-C.).
A travers ces secousses, la dynastie han prenait chaque jour plus dauto rit
et, si lon peut dire, de lgitimit . Peut-tre ses premiers souverains
exception faite de Lieou Pang furent-ils des personnages sans grand clat.
Comme nos premiers Captiens directs, ils eurent lavantage non seulement
de durer, mais de reprsenter excellemment les principes sur lesquels tait
fond le systme religieux et moral de leur temps. Le mieux connu dentre
eux, lempereur Hiao -wen (180-157), parle comme un lettr de lcole
confucenne, ayant sans cesse la bouche la sainte intelligence de
lEmpereur dEn -Haut , linfluence surnaturelle du Ciel et de la Terre , le
culte des anctres et limportance de lagriculture, la bndiction des dieux
de la terre et des moissons , le rgime patriarcal que les lettrs confucens
projetaient dans le mirage des sicles mythiques.
Ne sourions pas trop de ces dclamations vertueuses. Leur rptition
mme nous montre que labsolutisme imprial, le brutal csarisme cr par
Tsin Che Houang -ti et maintenu par Lieou Pang, tait en train dobte nir le
ralliement des lettrs, adhsion qui le consacrait au point de vue traditionaliste
puisquelle ne tendait rien de moins qu le rattacher, par -del les sicles de
fer, aux saints et aux sages de lge dor.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
37
CHAPITRE 8
Pax sinica
La plus forte personnalit de la dynastie des Han fut lempereur Wou -ti.
Ce prince bnficia dailleurs dun rgne exceptionnelle ment long. Mont sur
le trne seize ans, il loccupa pendant cinquante -trois annes (140-87). Dou
dune activit prodigieuse, dune vi gueur extraordinaire, il se dpensait sans
compter. On le voyait, comme autrefois les vieux monarques assyriens, forcer
les fauves au milieu des hautes herbes, au pril de sa vie et pour le plus grand
effroi de son entourage. Remarquablement intelligent, plein de conceptions
novatrices et hardies, ayant le got de lauto cratie, il savait cependant couter.
Ce fut ainsi que, ds le dbut de son rgne, il sentoura de lettrs confucens
dont il sollicitait ostensiblement les conseils. Les lettrs, nous lavo ns vu,
taient longtemps rests lgard du csarisme chinois dans une opposition
boudeuse quexpliquait assez la perscution de Tsin Che Houang -ti contre les
livres , quexpliquaient aussi les sarcasmes de Lieou Pang. Comment
interprter les avances que leur prodiguait maintenant Wou-ti, Wou-ti dans
lequel, prcisment, semblaient revivre la fougue, le temprament absolutiste
du premier et tout le ralisme politique du second ? Certes nul moins que lui
ne pouvait se laisser prendre aux thories utopiques dont les lettrs taient les
inlassables dfenseurs. Seulement ils servaient, sans le savoir, sa politique
contre la noblesse. La classe des lettrs le futur mandarinat qui commenait
alors sorganiser en tant que tel permettait au grand empereur de faire
pice laristocratie ter rienne, la nouvelle fodalit de cadets impriaux que
Lieou Pang avait laisse se reconstituer. Relguant toute cette noblesse dans
des honneurs vides, il la remplaa la tte des affaires par des fils du peuple
signals pour leur savoir, comme il la remplaait la tte des armes par des
capitaines de basse extraction. Par ce dtour, le futur mandarinat permit au
csarisme chinois dache ver son uvre de nivellement. De surcrot, Wou -ti
prit une mesure radicale pour rduire limportance des apanages : sous couleur
de sintresser la situation des cadets, il obligea, chaque dcs, les princes
apanags partager indistinctement leur fief entre tous leurs enfants sans
aucune constitution de majorat. Comme notre code Napolon, cette lgislation
galitaire eut vite fait, au bout de deux ou trois gnrations, de morceler,
dappauvrir et dannihiler la proprit fodale.
Dans le domaine extrieur, lempereur Wou -ti entreprit la conqute de
lAsie connue des Chinoi s de son temps, et tout dabord de la haute Asie.
De la Grande Muraille de Chine la taga sibrienne, la haute Asie
subissait la domination des Huns, anctres des Turcs et des Mongols de notre
moyen ge. Leurs diverses hordes se partageaient les steppes mongoles, aussi
bien la partie de la Mongolie situe au nord du Gobi oriental et qui est
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
38
aujourdhui connue sous le nom de Mongolie Extrieure, que la terre des
herbes qui stend la lisire mridionale du Gobi et que nous appelons
Mongolie Intrieure. Ces pres nomades, dont les troupeaux constituaient
toute la richesse, transhumaient leur suite, la recherche de nouveaux
pturages, en dressant de loin en loin lagglomration temporaire de leurs
yourtes de feutre. Tels que les dcriront au Ve sicle de notre re les crivains
latins, tels nous les montrent dj les vieilles annales chinoises qui font
galement deux les barbares types avec leur tte trop grosse aux traits peine
labors mais aux yeux de braise, avec leur buste massif, charpent pour
rsister aux nuits glaciales comme aux journes torrides du Gobi, avec leurs
jambes arques par lusage perptuel du cheval. Cavaliers ns et archers
incomparables, ils constituaient pour le paysan chinois des marches
septentrionales nord du Ho-pei, du Chan-si et du Chen-si les plus redoutables des voisins. La scheresse avait-elle tari les points deau et brl lherbe
de la steppe ? Le Hun, dont le troupeau avait pri, se jetait sur les cultures. Il
apparaissait limproviste, razziait et tuait , puis disparaissait avec son butin
de lautre ct des solitudes avant que les garnisons chinoises aient eu le
temps de se concerter.
Avant dentreprendre la grande guerre contre les Huns, lem pereur Wou-ti,
pour les encercler, conut une politique vraiment mondiale . A lautre
extrmit de lAsie centrale, dans les steppes de lactuel Turkestan russe,
vivaient dautres nomades, scythes, semble -t-il, ceux-l, que les Huns avaient
nagure chasss du Gobi. Wou-ti leur envoya un missaire qui les rejoignit
aux confins de la Sogdiane et de la Bactriane, cest --dire au seuil des
royaumes grecs successeurs dAlexandre le Grand en ces rgions. Il pro posait
ces Scythes de prendre les Huns revers du ct de louest, tandis que lui mme attaquerait par la Mongolie. Loffre ayant t dcline, il commena
seul les oprations. En 128 avant J.-C., son lieutenant Wei Tsing un
ancien ptre qui comme archer et comme cavalier pouvait rivaliser avec les
Huns eux-mmes conduisit travers le Gobi mongol un contre-rezzou
qui poussa jusqu lOnghin, surprit lennemi et coupa des ttes . Ce
systme des contre-rezzous qui retournait contre les Huns leur tactique
sculaire se complta par la cration de colonies militaires, cest --dire de
camps de soldats-laboureurs analogues ceux de lEmpire romain et destins
la fois protger le limes et accrotre les terres cultives chinoises aux
dpens de la terre des herbes hunnique. Ces colonies jalonnrent
notamment la grande boucle du Fleuve Jaune, en englobant dsormais dans
lempire la steppe des Ordos, ce coin de Gobi que la boucle du fleuve a inclus
dans les limites virtuelles de la Chine et qui, aux heures de dfaillance, a
toujours servi de point de concentration aux nomades pour attaquer les
provinces du nord.
Plus remarquable encore que Wei Tsing tait son neveu Houo Kiu -ping.
Il navait quune vingtaine dannes lorsquil rorganisa toujours sur le
modle hunnique la cavalerie lgre chinoise. En 121 avant J.-C., avec dix
mille de ses cavaliers, il enleva aux Huns le Kan-sou occidental, cest --dire le
point de dpart de la route de la soie. En 119, son oncle Wei Tsing et lui
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
39
conduisirent avec cinquante mille chevaux un raid foudroyant en haute
Mongolie. Wei Tsing, avec la colonne de gauche, pntra jusquau cours
infrieur de lOnghin, surprit le roi des Huns et lui infligea un complet
dsastre au milieu dune tempte qui rabattait le sable du Gobi dans les yeux
des barbares. Quant Houo Kiu -ping, avec la colonne de droite, il traversa la
haute Toula, vers les contreforts orientaux des monts Khangha o, aprs
stre empar de quatre -vingts chefs hunniques, il fit des sacrifices solennels
aux esprits, symbole de la prise de possession de la haute Mongolie par les
armes chinoises. Le jeune hros mourut peu aprs son retour (117). Sur la
tombe de ce grand cavalier, Hien-yang, prs de Tchang -ngan, on dressa une
puissante sculpture en ronde bosse, tudie en 1914 par lamiral Lartigue, et
qui reprsente un cheval chinois foulant aux pieds un barbare.
Mais les expditions chinoises dans les sauvages districts de la haute
Mongolie ne reprsentaient que des raids punitifs ou prventifs. Ctait du
ct de lAsie centrale que la Chine regar dait de prfrence. L, dans lactuel
Turkestan chinois, vivaient des populations sdentaires que les dcouvertes
rcentes nous ont montres appartenir la famille indo-europenne. Les oasis
qui sy chelonnaient en double arc de cercle au nord et au sud du Tarim
taient les tapes naturelles de la route des caravanes qui allait mettre en
communication lempire chinois et le monde grco -romain. Ds 108 avant
J.-C. nous voyons les lieutenants de lempereur Wou -ti imposer la suzerainet
chinoise deux des principales oasis de cette rgion, celle du Lobnor et celle
de Tourfan. En 102 un des capitaines chinois, Li Kouang-li, dans une marche
dune audace inoue, poussa avec plus de soixante mille hommes jusquau
seuil de lactuel Turkestan russe, jusquen Ferghna. Le but de cette
expdition est significatif. Pour lutter contre la redoutable cavalerie des Huns,
les Chinois, en dpit des magnifiques exploits dun Houo Kiu -ping ou dun
Wei Tsing, se sentaient mal laise. Les Huns, indpendamment de leurs
qualits de cavaliers ns, disposaient en effet du petit cheval de Mongolie dont
lendurance et le feu sont proverbiaux. Les Chinois, moins bons cavaliers,
navaient leur opposer quun coursier de taille semblable mais beaucoup
moins rsistant. Or, lIran, la Transoxiane et le Ferghna taient la patrie
du ne race de grands coursiers analogues nos anglo-arabes et dont les
qualits ont t clbres, sous la rubrique des talons nisens , par les
historiens grecs. Ce fut pour se procurer cette race et acqurir pour leur
remonte une supriorit dcisive sur les cavaliers huns que les Chinois
obligrent, en 102 avant J.-C., le Ferghna verser en tribut annuel un
contingent donn dtalons. Ajoutons que le fait a laiss sa trace dans
lhistoire de lart. Alors que les bas -reliefs funraires han du Chan-tong et du
Ho-nan nous prsentent surtout lancien cheval chinois trapu, sorte de
poney-percheron la croupe et au poitrail massifs, les terres cuites de mme
poque en Chine et en Core nous montrent un coursier beaucoup plus
lgant, proche du modle grec et qui sans doute nest autre que le cheval
import de Transoxiane en 102.
Cependant en Mongolie les Huns navaient pas dsarm et, vers la fin du
rgne de Wou-ti, les Chinois eurent se repentir de leur excessive confiance
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
40
ce sujet. En 99 un jeune capitaine chinois nomm Li Ling se fit fort de
conduire une colonne de cinq mille fantassins de la Grande Muraille au cur
du pays mongol. Sorti de Chine par lEtzin -gol, il senfona dans le Gobi,
marchant droit vers le nord en direction de lOnghin et des monts Khangha.
Mais il se vit bientt entour par la cavalerie des Huns dont les masses
tourbillonnantes criblaient de flches sa petite troupe. Il comprit son
imprudence, fit dcapiter toutes les ribaudes que les soldats avaient caches
dans les fourgons et qui retardaient sa marche, et battit en retraite, poursuivi
par le harclement des nomades. Aprs avoir perdu le tiers de son effectif,
puis ses flches et abandonn ses chariots, il tait parvenu une
cinquantaine de kilomtres de la frontire lorsquil fut cern dans une gorge
do, pendant la nuit, les Huns faisaient rouler sur les siens dnormes
quartiers de roche. Quatre cents Chinois seulement parvinrent schapper.
Tout le reste fut fait prisonnier, y compris le tmraire Li Ling.
Malgr la fureur qui saisit cette nouvelle lempereur Wou -ti, il y a loin
de cet insuccs un dsastre de Varus. La scurit du limes ne fut mme pas
remise en question. Tout au plus renona-t-on pour quelque temps au systme
des contre-rezzous en Mongolie. Le plus grave est que cet pisode servit de
prtexte aux lettrs confucens pour protester contre la politique darme ments
et dexpansion et rclamer le retour une attitude purement dfensive :
Quelque grand que soit un pays, sil aime la guerre il prira . Les armes sont
des instruments nfastes. Les territoires quon arrache aux Huns sont
impropres la culture. Du reste, ces brutes sont inassimilables. Il ny a qu
les ignorer et les laisser patre leurs troupeaux dans leurs solitudes. Nous
retrouverons rgulirement au long de lhistoire chinoise ces dclamations
dintellectuels qui correspondent la doctrine permanente du mandarinat.
Elles finiront la longue par avoir raison du temprament guerrier de la Chine
antique. Le jour viendra o la carrire des armes, dconsidre par les
intellectuels, sera rpute un mtier infrieur et o toute guerre prventive sera
rendue impossible par le pacifisme utopique des mmes milieux.
Avec des souverains comme Wou-ti ces dclamations ne portaient gure.
Non content de tracer le cadre de lexpansion chi noise en Asie centrale, il
accomplit une uvre encore plus impor tante : il rattacha dfinitivement
lempire la Chine du Sud.
Nous avons vu que durant toute la priode archaque le territoire chinois
st ait pratiquement limit ce qui est aujourdhui la Chine du Nord et la
Chine centrale, cest --dire au bassin du Fleuve Jaune et au bassin
septentrional du Yang-tseu. La Chine mridionale actuelle restait, au mme
titre que lIndochine, une terre trangr e : terre de montagnes ou tout au moins
de collines boises contrastant avec les basses plaines alluviales comme avec
les terrasses de lss de la Chine primitive. Tsin Che Houang -ti, on la vu,
avait, l comme en tout, donn limpulsion dcisive en accomp lissant un
voyage dinspection jusqu Tchang -cha, au cur de lactuel Hou -nan, et en
envoyant un corps expditionnaire occuper la rgion cantonaise. Mais aprs sa
mort les chefs de cette arme se dclarrent indpendants, fondant Canton
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
41
un royaume sino-indigne qui attira dans son orbite les Annamites de lactuel
Tonkin. En 111 avant J.-C., lempereur Wou -ti mit fin cette dissidence et
Canton fut dfinitivement annex la Chine, vnement dune porte
incalculable pour la suite de lhistoire. Lann e suivante le grand empereur
rattacha de mme la Chine la province de Tch-kiang (au sud de Chang-ha),
annexion non moins importante si lon songe que cette Chine nouvelle, et qui
ntait encore quune Chine coloniale, deviendra au moment des grandes
invasions le dernier rempart de lempire et la Chine vritable. Enfin Wou -ti
tablit la domination chinoise au nord-est sur une partie de la Core, et au
sud-est sur le pays annamite, cest --dire, cette poque, sur le Tonkin et sur
les provinces les plus septentrionales de lactuel Annam jusquau nord de
Hu.
Rsumons cette uvre. A lintrieur le csarisme chinois dfi nitivement
stabilis par le ralliement des lettrs et la ruine des derniers fodaux ; le
territoire de la Chine propre dfinitivement circonscrit jusquaux havres de
Tch-kiang et jusqu Canton. A lextrieur le domaine historique de
limprialisme chinois dli mit de mme travers lAsie centrale jusquau
Turkestan russe, travers la pninsule corenne jusqu hauteur de Soul,
travers lIndochine jusquaux approches de Hu. En vrit, si les Chinois
aujourdhui encore shonorent du titre de Fils de Han, cest au grand empereur
des annes 140-87 quils le doivent. Ctait lpoque o les victoires de
Marius et de Sylla achevaient d tablir dans le monde mditerranen la
domination romaine. Les armes de Wou-ti avaient tabli de mme dans lAsie
centrale et orientale une Pax Sinica, quivalent extrme-oriental de notre Pax
Romana.
Le vritable continuateur de ce grand monarque fut son arrire-petit-fils
Siuan-ti (73-49 avant J.-C.). Dj ce prince lucide eut loccasion de discerner
les tendances subversives des lettrs, pacifistes professionnels et adversaires
sournois de lexpansion chinoise. Les Han, scriait -il un jour, ont leur code
eux qui est un code de conqurants. Nous ne sommes plus au temps des
Tcheou, du gouvernement par la vertu et lducation. Les lettrs ne compren nent rien aux besoins divers des poques diverses. Ils disent toujours du bien
de lantiquit et du ma l du prsent. Ils blouissent les simples en faisant
miroiter leurs yeux des mots brillants et vides. Comment donne-t-on des
charges des hommes vivant dans lutopie et ce point dpourvus de sens
pratique ?
Et la conqute de lAsie centrale continua . Sous le rgne de ce mme
Siuan-ti, les armes chinoises occuprent les points principaux du bassin du
Tarim, lactuel Turkestan chinois : Tourfan, Qarachahr, Yarkand, etc. Plus au
nord la politique chinoise obtint un succs dcisif : en attisant les querelles
entre deux prtendants huns, elle provoqua la scission de lempire hunnique.
Lun des chefs huns, celui qui devait rester matre de la Mongolie, rechercha
lappui de la Chine, se reconnut vassal et, comme tel, vint en 51 avant J. -C.
lanne de la soumission dfinitive de la Gaule par Jules Csar battre du
front la cour de Tchang -ngan devant lempereur Siuan -ti. Son rival vinc
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
42
partit dans les steppes du Qazakistan (Turkestan russe), fonder un nouveau
royaume hunnique louest du lac Balk hach, mais en 35 avant J.-C. une
arme chinoise vint ly relancer, ly rejoignit, surprit ses campe ments et le
dcapita. Cette action hardie arrta net lexpansion des Huns de louest et par
contre-coup sauva sans doute pour plus de quatre sicles notre Europe : ce ne
sera en effet quen 374 de notre re que ces mmes Huns occidentaux,
regroups autour de la famille dAttila, reprendront leur marche conqurante
travers le monde germanique et le monde romain ...
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
43
CHAPITRE 9
Triomphe des Lettrs
Nous venons dvoquer le paralllisme entre la formation de lempire
romain et celle de lempire des Han. Il faut que la conqute romaine ait t
bien solide pour navoir pas t remise en question par la guerre civile qui, du
passage du Rubicon la bataille dActium, svit de manire peu prs
permanente dans le monde latin (49-31 avant J.-C.). De mme la Chine des
Han subit quelques annes plus tard une crise si grave que la dynastie faillit y
disparatre, mais laquelle la domination chinoise en Asie devait finalement
rsister.
La dcadence de la premire branche des Han vint videmment de
latmosphre assez spciale de la vie de cour. Ce nest pas en France
seulement que les Versailles prparent la chute des dynasties. Ajoutons
linfluence croissante des cercles intellectuels, avec leur idologie sans rapport
avec les faits. Lhistoire des derniers souverains de cette branche nest plus
quun rcit dintrigues entre la camarilla des eunuques et les lettrs, les uns et
les autres galement incapables den visager de haut les donnes permanentes
de la grandeur chinoise. Lempereur Yuan -ti, mont sur le trne vingt-sept
ans, mort quarante-trois (48-33 avant J.-C.), ne fut quun lettr timide et
irrsolu qui se laissa chambrer par les eunuques. La dgnrescence saccrut
avec lempereur Tcheng -ti (32-7 avant J.-C.), mont sur le trne dix-neuf
ans, mort quarante-cinq, la fois lettr et dbauch (la nuit, il courait sous le
voile de lanonymat les maisons de plaisir de la capitale, au risque de se fa ire
assommer). Lempereur Ngai -ti, galement proclam dix-neuf ans et qui
rgna de 6 avant J.-C. lan 1 de notre re, vcut dans la socit des mignons
et nomma son Antinos gnralissime. Ces turpitudes achevrent de
dconsidrer la dynastie. Une vieille impratrice douairire, veuve de Yuan-ti,
en profita pour faire confier le pouvoir son propre neveu, politicien dune
ambition effrne, le clbre Wang Mang. Celui-ci maintint encore pendant
quelques mois un empereur fantme, un enfant de neuf ans auquel il fit
ensuite boire une coupe de poison, aprs quoi il se proclama lui-mme Fils du
Ciel (10 janvier de lan 9 de notre re).
Wang Mang, qui usurpa ainsi le pouvoir, ntait pas un ambi tieux
quelconque. Sans doute lhistoire officielle, crite p lus tard la louange des
Han restaurs, a poursuivi lusurpateur de sa vindicte. Ce quelle ne dit pas ou
tout au moins ce quelle essaie de dissimuler, cest que son rgne (annes 9
22 de notre re) marqua le triomphe du parti des lettrs. Aussi bien tait-il
nourri de leur enseignement et partageait-il leurs thories sur le gouvernement
patriarcal, le soi-disant gouvernement des souverains mythiques et des
premiers Tcheou, lequel jouait un peu l-bas le rle dune Salente idale ou
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
44
encore de ltat d e nature cher notre Rousseau. Wang Mang dcrta dans cet
esprit une srie de rformes, fort intressantes du reste, car elles
correspondaient une indniable crise sociale.
Depuis lavnement du csarisme chinois les latifundia staient accrus, la
classe des petits propritaires avait diminu dautant pour augmenter le
nombre des clients et des esclaves. Aux poques de famine en particulier, les
pauvres gens vendaient en masse leur patrimoine et se vendaient eux-mmes
comme esclaves, eux et leurs enfants. Wang Mang entendit lutter contre cet
asservissement de la population rurale, ramener le temps o chaque homme
possdait cent acres de terre et payait comme impt ltat la dme en nature
de ses revenus . Depuis lors, ajoutait-il en portant le fer dans la plaie, les
puissants ont acquis dimmenses proprits, tandis que les pauvres nont plus
un pouce de terrain (27). De plus on a institu des marchs desclaves o lon
vend ceux-ci comme des bufs et des chevaux, ce qui est manifestement
contraire aux volonts du Ciel et de la Terre, lesquels ont donn lhomme
une nature plus noble que celle des animaux. En consquence Wang Mang,
en lan 9 de notre re, reprenant une vieille utopie du philosophe
Mencius, octroya chaque famille de huit personnes une proprit de cinq
hectares, mais en mme temps il obligea les propritaires des domaines plus
vastes distribuer lexcdent leurs parents ou leurs voisins. Du reste, pour
empcher la reconstitution des grands domaines, il dclara en principe ltat
seul propritaire du sol et interdit toute modification ce statut, donc tout
achat ou vente de terres, comme il interdit tout trafic desclaves, ltat seul
ayant le droit den possder.
Lanne suivante (an 10 de notre re), Wang Mang institua une srie de
fonctionnaires chargs de rglementer lconomie : surveillants des marchs,
pour fixer chaque trimestre le prix maximum de chaque denre ; galisateurs
des prix , pour acheter au prix courant les marchandises (grains, soieries et
tissus de toile) amenes au march et qui navaient pas trouv acqureur ; ces
agents gardaient en magasin le stock invendu et le remettaient en vente quand
le manque dune denre donne menaait de faire hausser les prix ; banquiers
officiels enfin qui prtaient au taux (dailleurs fort lourd) de 3 % par mois.
Dautre part limpt fut bas sur la dme du bnfice. Indpendamment des
agriculteurs pour lesquels le calcul, chaque rcolte, tait facile, on exigea
une dclaration de profession des divers mtiers, chasseurs et pcheurs,
leveurs de bestiaux ou de vers soie, filateurs et tisserands, ouvriers en
mtaux, marchands, mdecins, devins et sorciers, tous devant galement
avouer leurs recettes et en reverser le dixime ltat. Wang Mang procda
aussi plusieurs refontes successives de la monnaie (do la quantit
surprenante de pices quon retrouve son nom), refontes au cours desquelles
il ne cessa den diminuer le titre lgal. A cet effet, il dcrta le monopole de
lor et mit lembargo sur le cuivre.
Ces rformes nous rvlent un esprit hardi, proccup de trouver des
solutions radicales la crise de son poque, mais sans doute aussi un
intellectuel quelque peu utopiste, plus thoricien que connaisseur dhommes.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
45
Son tatisme tracassier ne tarda pas provoquer une rsistance gnrale. Le
monopole de lor avait ruin la noblesse. Le cours forc des nouvelles
missions montaires de titre infrieur, joint lobligation de reverser pour le
mme prix ltat les anc iennes monnaies de meilleur aloi, ruinait le
commerce. Enfin le monopole de ltat sur les coupes forestires et sur les
pcheries lsait gravement les paysans (28). Lconomie tant dsorganise,
ds que survinrent de mauvaises rcoltes la famine ravagea les provinces. Des
jacqueries clatrent, notamment au Chan-tong, pays surpeupl dont la
fertilit naturelle ne rsiste pas quelques mois de scheresse ou dinondation
et qui, de ce fait, a toujours servi de foyer aux agitations sociales et aux sectes
dillumins taostes. Or en 3 avant J. -C. le Chan-tong subit une telle
scheresse que les foules affames se mirent parcourir le pays en invoquant
les divinits taoques. En 11 de notre re le Fleuve Jaune rompit ses digues,
inondant les plaines du Chan-tong et du Ho-pei ; en 14 la famine tait telle
que les paysans devenaient anthropophages. Un chef de brigands runit les
jacques en bandes organises, en leur enjoignant, comme signe de
reconnaissance, de se peindre les sourcils en rouge. Les Sourcils Rouges ,
appuys par la sympathie des populations, dfirent les troupes rgulires et se
trouvrent bientt matres du bassin infrieur du Houang-ho (18 de notre re).
Cependant le lgitimisme ntait pas mort, la dynastie Han ava it conserv
ses partisans. Devant lchec des rformes de Wang Mang et dans le dsordre
produit par la jacquerie des Sourcils Rouges, les lgitimistes se soulevrent.
Deux princes Han, Lieou Sieou et Lieou Hiuan, se mirent leur tte, le
premier dans la province de Ho-nan, le second dans la province de Hou-pei.
Les deux groupes eurent la sagesse de se runir en acceptant Lieou Hiuan
comme chef (an 22 de notre re), puis ils marchrent sur Tchang -ngan, la
capitale impriale, qui fut emporte. Abandonn des siens, Wang Mang se
rfugia dans le parc imprial, au sommet dune tour construite au milieu dun
tang. Il y fut assassin et sa tte fut apporte aux princes han. Ainsi finit
lhomme qui avait rv de changer selon lidal des lettrs les bases de la
socit chinoise (septembre-octobre 22).
Lusurpateur abattu, lordre ne se trouva pas encore rtabli. Lieou Hiuan,
le prince han au nom duquel stait faite la restauration, ntait quun
personnage mdiocre qui, une fois au pouvoir, se rvla un incapable. Tout
ses plaisirs, on le vit faire mandarin un bon cuisinier. Or les Sourcils Rouges
tenaient toujours les provinces de lest et, devant la carence de Lieou Hiuan,
marchaient leur tour sur la capitale. Ils sen emparrent sans effort, tandis
que Lieou Hiuan prenait la fuite. Matres de la grande cit, les jacques la
livrrent au plus affreux pillage. Quant Lieou Hiuan qui avait fini par tomber
entre leurs mains, ils le firent trangler.
Restait le second prtendant han, Lieou Sieou, un tout autre homme, celuil, adroit et nergique, chef populaire et bon soldat, qui, devant la destruction
de Tchang -ngan, avait tabli son sige Lo-yang o il stait proclam
empereur (an 25 de notre re). Les Sourcils Rouges, aprs avoir entirement
pill Tchang -ngan, refluaient vers lest. Larme de Lieou Sieou les cerna
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
46
entre cette ville et Lo-yang, en massacra une infinit et fit prisonnier tout le
reste, quatre-vingt mille brigands et ribaudes. Dailleurs Lieou Sieou, en
politique qui savait comment on termine une rvolution, enrla les plus
robustes dentre eux dans ses rgiments (an 27). Trois ans aprs, son
administration rparatrice avait dj obtenu de tels rsultats que limpt put
tre ramen du dixime au trentime des rcoltes et des bnfices.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
47
CHAPITRE 10
La route de la soie
La dynastie des Han tait restaure. Lheureux Lieou Sieou, devenu
lempereur Kouang Wou -ti, allait consacrer ses trente-deux annes de rgne
(25-57) effacer lintrieur les maux de la guerre et rtablir lhgmonie
chinoise dans lAsie orientale.
Car pendant la priode des troubles la Chine avait, bien entendu, perdu la
plupart de ses dpendances extrieures. Lexemple tait contagieux et
certaines possessions, jusque-l fidles, se trouvrent le sige de rvoltes
retardement. Tel fut, en Indochine, le cas du pays annamite. Le pays annamite,
lpoque qui nous occupe, ne comprenait que le Tonkin et la partie
septentrionale de lAn nam actuel jusquau nord de Hu, les provinces qui
forment aujourdhui le centre et le sud de lAnnam tant alors au pouvoir du
peuple malayo-polynsien des Tcham. Ou plutt, dans cette aire rduite, les
Annamites noccupaient proprement que le delta tonkinois et ltroite zone
littorale du Nord-Annam, car lAnna mite est essentiellement le cultivateur des
rizires littorales, habitat et genre de vie qui le distinguent de son congnre,
le Muong chasseur des montagnes boises de larrire -pays. Habitat et genre
de vie qui, en mme temps, rapprochaient les Annamites des Chinois. Aussi la
domination chinoise tablie dans le pays vers 110 avant J.-C. avait-elle t
docilement accepte : les tombes du Thanh-hoa, explores depuis 1930 par les
missions Goloubew et Jans, nous montreront pour la priode suivante
lassociation, sur les mmes sites, de loutillage indonsien des
Proto-Annamites et de pices purement chinoises. Mais en lan 40 de notre
re, la suite de maladresses administratives, les Annamites secourent le
joug lappel de deux hrones, deux surs, clbres dans la lgende l ocale.
Lempereur Kouang Wou -ti chargea de les rduire un vieux capitaine nomm
Ma Yuan, qui ses exploits sur cette cte indochinoise, extrme limite des
explorations des navigateurs clestes cette poque, allaient valoir le titre de
pacificateur des flots . Entr au Tonkin en 42 de notre re, Ma Yuan au
commencement de lanne suivante dompta la rvolte anna mite. La tradition
lui attribue lrection dune colonne de bronze au Quang -nam (rgion de
Tourane), pour marquer la frontire entre les possessions chinoises et les
terres, alors sauvages, du Tchampa.
De lIndochine, Ma Yuan alla lautre extrmit de lempire repousser les
attaques des Huns de Mongolie et dautres hordes turco -mongoles qui
nomadisaient plus lest, aux confins mand chouriens, du ct du Grand
Khingan (45 de notre re). Peu aprs les Huns se divisrent. En 46 stait
produite en haute Asie une scheresse telle que, pendant trois ans, la steppe
mongole demeura nue, sans trace de vgtation, et que la moiti du btail, puis
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
48
des nomades prit de faim. La discorde, comme toujours chez les Huns, suivit
la famine. Ceux dentre eux qui nomadi saient en Mongolie Intrieure se
rvoltrent contre le chef qui rgnait en Mongolie Extrieure, sur le haut
Orkhon, et acceptrent la suzerainet chinoise (48). On les tablit comme
fdrs sur le limes des provinces actuelles du Kan-sou, du Chen-si et du
Chan-si, dans la boucle des Ordos, pour la garde de la Grande Muraille et du
Fleuve Jaune. Ces Huns fdrs, ces Huns ripuaires, devaient rester fidles
la Chine tant que celle-ci sut maintenir sa force, cest --dire pendant plus de
deux sicles. A la mort de lempereur Kouang Wou -ti lhgmonie chinoise
tait donc restaure en Extrme-Orient. Restait la rtablir de mme en Asie
centrale. Ce fut luvre du rgne suivant, celui du fils de Kouang Wou -ti,
lempereur Ming -ti (58-75). Sous ce rgne en effet les Chinois entreprirent de
trancher dfinitivement le problme du Tarim.
Le bassin du Tarim est, cas frquent en Asie centrale, un bassin ferm. Les
cours deau descendus des Tien -chan ou du Pamir ne tardent pas pour la
plupart sanmier avant davoir pu rejoindre le fleuve et lui -mme est dj
agonisant quand il va se perdre dans les marais du Lobnor. Cependant le sol
de son bassin est en principe compos du mme lss que la Chine du Nord, si
bien que l o lirrigation est encore possible lagriculture et le jardinage
voient leurs moindres efforts rcompenss. En fait, il sagit l dun Nil ou
dun Euphrate moribond dans une Mso potamie en voie de desschement. La
vie sest retire du cours mme du fleuve et de ses affluents. Elle ne subsiste
que sur le double arc de cercle montagneux qui entoure le bassin du Tarim,
larc de cercle du Tien -chan au nord, larc du Mouztagh et de lAltyn -tagh au
sud. L, aux pentes des monts do descendent les cours deau encore vivants,
se sont rfugies les cultures en un chapelet doasis schelonnant de Kachgar
louest au Lobnor lest : au nord, aprs Kachgar, Koutcha et
Qarachahr do scarte ver s le nord-est le groupe de Tourfan ; au sud, et
toujours en partant de laxe quest Kachgar, Yarkand, Khotan, Niva et
Miran ; cette dernire oasis situe aux approches du Lobnor.
Lintrt de ce double chapelet doasis, cest quil constitue une doubl e
ligne dtapes entre la Chine dune part, lInde, lIran et le monde
mditerranen de lautre. Cest lintermdiaire indis pensable entre
lExtrme -Orient et lOccident. Aussi les oasis que nous venons de nommer
ont-elles de tout temps fait lobjet dune mise en valeur intensive, avec des
travaux dirrigation qui ont transform chacune delles en autant de
cits-jardins o poussent le mas et le bl, le melon, la pastque, la pomme,
labricot, la grenade et le raisin. Les paysans qui cultivent ces oasis n e se
rattachent dailleurs pas aux nomades altaques qui les entourent, mais (bien
quaujourdhui linguistiquement turciss) aux autres populations agricoles de
lAsie indo -europenne : de nos jours encore leur type physique nest pas
celui des Turco-Mongols, mais un type trs proche de liranien, cheveux et
barbe abondants et bruns, peau blanc ros quand elle nest pas bronze par
lair et le soleil, face longue et ovale, nez fin et prominent, sou vent droit,
yeux bruns non obliques . Tels les dcrit lexplora teur Fernand Grenard, tels
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
49
nous les montraient dj les voyageurs chinois de lantiquit ou du haut
moyen ge.
Les fouilles effectues dans cette rgion de 1902 1914 par les missions
Pelliot, Aurel Stein, Grunwedel, von Lecoq et Otani, ont confirm ces
constatations ethnographiques en nous apprenant que jusquau IX e sicle de
notre re les gens de Tourfan, de Qarachahr, de Koutcha et de Kachgar ne
parlaient pas encore des dialectes turcs, mais bien des langues nettement
indo-europennes, sur s de liranien, du sanscrit et de nos langues dEu rope.
Il y a l toute une avance du monde indo-europen du monde aryen ,
comme on dit aujourdhui, qui depuis lpoque de notre Charlemagne sest
effondre, mais qui, du fait de sa situation, jouait alors un rle considrable,
plus considrable mme que ne laurait laiss supposer la faible importance
numrique de cette avant-garde de notre race au cur du monde jaune.
Ce rle des oasis du Tarim sur la grande route entre la Chine et lOccident
ne manquait pas dveiller lintrt des deux grandes puissances militaires de
lExtrme -Orient et de la haute Asie : les Chinois et les Huns. Les Huns des
hauteurs du Khanga, les Chinois de leur marche-frontire du Kan-sou
surveillaient la double piste des caravanes et prtendaient sen rserver le
contrle. Dj, sous la premire dynastie des Han, aux environs de lan 100
avant J.-C., les Chinois avaient impos leur suzerainet aux petits royaumes
du Tarim, mais l encore les guerres civiles qui avaient marqu en Chine les
vingt-cinq premires annes de notre re leur avaient fait reperdre une bonne
partie du terrain.
Pour le reconqurir, pour souvrir les contres dOccident , la cour des
seconds Han eut la chance de disposer dune quipe de grands soldat s. En 73
de notre re deux de ces gnraux, Teou Kou et Keng Ping, le commandant
des chevaux rapides , dirigrent une expdition pralable du ct de la
Mongolie o les Huns du nord se drobrent par la fuite. Pour barrer la route
ces barbares, une colonie militaire fut tablie dans loasis de Ha -mi, au cur
du Gobi oriental. En 74, Teou Kou et Keng Ping allrent attaquer loasis de
Tourfan. Le roi sortit de la ville, enleva son bonnet et, tenant embrasses les
pattes du cheval de Keng Ping, fit sa soumission.
Le plus hardi de ces capitaines chinois tait le gnral de cavalerie Pan
Tchao. Il appartenait une famille fort cultive. Son frre et sa sur une
des femmes de lettres les plus clbres des annales chinoises sont les
auteurs de lhis toire de la premire dynastie han. Lui, la gloire du pinceau
prfrait celle des armes et par-dessus tout la vie daventures dans le Grand
Ouest. Aussi bien pensait-il que celui qui ne pntre pas dans lantre du tigre
ne prend pas les petits du tigre . Envoy en observation avec un dtachement
dans la rgion du Lobnor, il devina latti tude ferme du roi local que celui-ci
devait tre travaill contre la Chine par quelque missaire des Huns. Avisant
un indigne, il linterpella limproviste : Il est arriv un messager des
Huns. O se trouve-t-il ? Lautre, interloqu, avoua tout. Pan Tchao runit
alors ses officiers. Il se mit boire du vin avec eux. Quand ils furent tous
chauffs, il les mit au courant : Si lmis saire persuade au roi du Lobnor de
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
50
nous livrer aux Huns, nos ossements seront la pture des loups. Profitons de la
nuit pour attaquer limproviste les barbares ! Mais comment prendre une
telle initiative sans obtenir lassentiment du commissaire civil chinois qui
accompagnait larme ? Lobjection exaspra Pan Tchao : Notre vie ou
notre mort se dcide aujourdhui. Quavons -nous besoin dun vulgaire officier
civil ? Si nous linformons de notre plan, il aura certainement peur, et nos
projets seront divulgus. Et il les entrana. La nuit tait venue. Le vent du
dsert soufflait en tempte. Pan Tchao ordonna ses hommes de prendre
des tambours et de se cacher derrire les baraquements des barbares ; il tait
convenu avec eux que, ds quils verraient les flammes sl ever, ils feraient
tous rsonner leurs tambours en poussant de grands cris. Le reste de ses gens
se dissimula en armes devant les portes. Alors Pan Tchao dchana lincendie
dans la direction du vent, tandis quclatait le vacarme des cris de guerre et
des tambours. Les barbares furent surpris en pleine confusion. Pan Tchao tua
de sa propre main trois hommes. Ses soldats en dcapitrent trente, dont
lenvoy des Huns. Quant au reste des barbares, savoir une centaine, ils
prirent carboniss. Cela fait, Pan Tchao manda auprs de lui le roi du
Lobnor et simplement lui montra la tte du Hun. Le roi, qui avait t sur le
point de trahir, rentra en tremblant dans la vassalit de la Chine.
Dans le sud du Tarim, le roi de Khotan prtait lui aussi loreille aux
missaires des Huns. Le fait tait non moins grave car, comme le Lobnor
pouvait couper larrive des caravanes, Khotan comman dait toute la piste du
sud. Pan Tchao, avis, se rendit limpro viste Khotan. Le roi le traita avec
peu dgards ; il y tait incit par un sorcier local qui avait partie lie avec les
Huns. Lenvoy chinois, dclara le sorcier du roi, possde un cheval bai. Ce
cheval, nos dieux veulent que je le leur sacrifie ! Intimid, le prince osa
rclamer le cheval Pan Tchao. Celu i-ci feignit dy consentir condition que
le sorcier vnt lui-mme prendre livraison de lanimal. A peine le sorcier
arriv, Pan Tchao le dcapita fort proprement et envoya sa tte au roi. Celui ci se soumit et livra les agents des Huns.
Cependant en 75 une rvolte gnrale contre le protectorat chinois clata
au Tarim. Pan Tchao se vit assiger dans Kachgar tandis que dautres
gnraux chinois taient de mme bloqus prs de Tourfan. On mangea le cuir
des quipements, mais on tint jusquau bout. Toutefo is la cour de Chine
commenait seffrayer de ces guerres incessantes. Lempereur Ming -ti
venait de mourir, remplac par son fils Tchang-ti qui navait que vingt ans
(75). Ordre fut donn dvacuer le Tarim. Pan Tchao fit mine dobir ou du
moins il battit en retraite jusqu Khotan, puis il se ravisa et dlibrment, en
dpit des consignes reues, revint sinstaller Kachgar, non sans y dcapiter
ceux qui, dans lintervalle, avaient fait dfection. Pendant ce temps les lgions
chinoises du Kan-sou reconquraient sur les Huns la rgion de Tourfan.
Elles couprent trois mille huit cents ttes de barbares et semparrent de
trente-sept mille ttes de btail. Les Huns du nord (de Mongolie) senfuirent,
terrifis.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
51
Dans un mmoire adress au nouvel empereur, Pan Tchao sefforait de
concilier lesprit timor de la cour avec sa propre exprience du Grand Ouest.
Ces campagnes lointaines que les lettrs condamnaient comme inutiles, le
hros chinois montrait que ce ntait que de la dfensive bien comprise. Il
sagissait de mettre la terre chinoise labri des priodiques agressions des
Huns : Semparer des trente -six royaumes de lAsie centrale, cest couper le
bras droit aux Huns. Quant sa mthode, ctait celle dune vritable
politique coloniale : Se servir des barbares pour attaquer les barbares. De
fait, la conqute du Tarim, il la ralisait grce aux contingents que chaque
oasis nouvellement soumise tait tenue de lui fournir contre les oasis encore
rebelles. Les lments proprement chinois n taient gure reprsents que par
une poigne daventuriers ou de dports qui venaient se re faire un honneur
dans la vie mouvemente des marches. Et tous vivaient sur le pays quils
protgeaient dailleurs contre un retour offensif des Huns. A Yarkand,
Kachgar, expliquait Pan Tchao lempereur, le sol cultiv est fertile. Les
soldats quon y cantonnera ne coteront rien lempire. Et il montrait fort
judicieusement la diffrence entre cette rgion o la proximit du Pamir
maintient la verdure avec, mme, vers le Mouztagh, un arrire-plan de forts,
et le dsert caillouteux ou argilo-salin qui stend du Lobnor la marche de
Touen-houang.
Toute politique coloniale repose sur la connaissance de la psychologie
indigne. A ce jeu Pan Tchao tait pa ss matre. En 87 le roi de Kachgar, qui
venait de se rvolter, feint de se soumettre et demande une entrevue laquelle
il se rend avec un fort contingent de cavalerie pour tenter un coup de main.
Pan Tchao feint son tour de croire ses bonnes intent ions, lui offre un
banquet, puis, quand le vin a circul, il se saisit du prince et le dcapite. Au
mme instant, les troupes chinoises, se dmasquant, se sont jetes sur celles de
lennemi et les ont massacres. Devant Yarkand, en 88, nayant avec lui
qu une arme infrieure en nombre tant de Chinois que dauxiliaires
khotanais, il feint de battre en retraite pendant la nuit, puis il revient par une
marche force et au chant du coq tombe sur les gens de Yarkand, leur
coupe cinq mille ttes et les oblige se soumettre.
Au nord, en Mongolie, les mules de Pan Tchao besognaient non moins
ferme. En 91 les lgions chinoises poussrent jusquau cur du pays
hunnique, sans doute jusqu lOrkhon, et firent prisonnire toute la famille du
roi des Huns. Au Tarim, la grande oasis de Koutcha, perdant tout espoir de
secours de ce ct, stait soumise ds 90. Ne restait plus en tat de rbellion
que loasis suivante, Qarachahr. En 94, avec des auxiliaires de Koutcha et du
Lobnor, Pan Tchao marcha sur la ville reb elle. En vain les gens de Qarachahr
avaient-ils coup les ponts sur la rivire du Youldouz. Pan Tchao passa la
rivire avec de leau jusqu la ceinture et apparut au milieu des marais devant
Qarachahr. Quelques habitants purent senfuir sur le lac Bagh ratch, mais le
reste dut se rendre. Le roi du pays fut dcapit sur la place mme o il avait
nagure fait prir un rsident chinois. Pan Tchao lcha ses soldats au
pillage. Ils couprent plus de cinq mille ttes, ils sem parrent de trois cent
mille chevaux, bufs et moutons. Honor par la cour du titre de Protecteur
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
52
gnral des contres dOccident , le conqurant chinois tait un vritable
vice-roi de lAsie centrale. Il faisait la loi jusquaux Pamirs et aux Passages
Suspendus , cest --dire jusquaux portes de lIran et de lInde.
Du ct de lAfghanistan et de lInde rgnaient les Indo -Scythes dont nous
aurons loccasion de reparler amplement, car cest de chez eux, on le verra,
que le bouddhisme allait arriver en Chine. LIran appartenait au x Parthes
Arsacides qui, du fait des conqutes de Pan Tchao, se trouvaient, sinon en
contact, comme on la dit, avec les Chinois, du moins en relations
commerciales avec ceux-ci, comme ils taient, sur lEuphrate, les voisins
directs de lempire romain. S ans doute les Parthes, matres, en gros, de lIran
et de lIrq actuels, se trouvaient territorialement spars des conqutes
chinoises par la Transoxiane et par lAfghanistan indo -scythe. Mais les
Romains les menaaient en Msopotamie et voici que semblait sapprocher,
des versants orientaux du Pamir, la marche des lgions chinoises ... En lan 94
de notre re, les Parthes jugrent donc sage, en se servant de nombreux
interprtes successifs , denvoyer la cour des Han une ambassade avec des
cadeaux qui purent tre qualifis de tribut. En 97 Pan Tchao chargea un de
ses lieutenants nomm Kan Ying daller tablir des relations rgu lires avec
ces mmes Parthes, et, derrire eux, avec lempire romain.
Lempire romain tait dj assez bien connu des Chin ois qui voyaient en
quelque sorte en lui lquivalent occidental de leur propre domination et qui,
dans ce sens, lappelaient assez curieuse ment la Grande Chine (Ta-tsin) .
Ils connaissaient mme les capitales de lOrient romain, Antioche sous la
transcription de Hien-tou, et Alexandrie sous le nom de (Ng)an-tou. Si
lenvoy de Pan Tchao avait pu arriver jusque dans lempire romain, il y
serait parvenu au moment o lempereur Trajan montait sur le trne, Trajan
dont le rgne (98-117) allait marquer l apoge de lexpansion romaine en Asie
et qui, au cours dune campagne mmorable, entrerait en vainqueur dans la
capitale parthe, Ctsiphon (116). On peut rver lalliance des lgions
chinoises et des lgions romaines pour un condominium sur lOrient moy en
ou, plus modestement, un systme dententes englobant, contre les Parthes,
les Romains de Trajan, les Indo-Scythes de Kanichka et les vtrans de Pan
Tchao. Rves vains, puisque lenvoy chi nois, Kan Ying, une fois chez les
Parthes, se laissa dtourner par eux de pousser jusquaux frontires romaines.
Le fait parat dailleurs significatif et semble montrer combien les Parthes
redoutaient prcisment lentente possible entre Rome et la Chine.
Pan Tchao prit sa retraite en 102. A son retour dans la capitale,
Lo-yang, il se vit combl dhonneurs, mais il tait puis par vingt -neuf ans de
campagnes et il mourut au bout de quelques mois. Aprs lui son uvre subit,
comme il tait invitable, de nouvelles secousses. Cest que ses successeurs
dans le gouvernement du Tarim, dhonntes gnraux des garnisons de
lintrieur, ne comprenaient rien lambiance coloniale. Avant de partir, il les
avait pourtant prvenus. Les officiers qui servent dans ces contres
lointaines ne sont pas ncessairement des fils pieux et des petits-fils obissants
(Lyautey dira quon ne fait pas des colonies avec des rosires) ; tous ont t
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
53
dports ici pour quelque faute et cest prcisment pour cela quon les a
envoys servir dans les marches-frontires. Dautre part les ba rbares ont une
versatilit doiseaux ou de btes sauvages. Sachez tre coulants pour les pe tites fautes et contentez-vous de tenir la main la discipline gnrale. Ces
sages conseils ne furent pas couts. Le rsultat fut quen 106 une rvolte
gnrale clata au Tarim.
De nouveau la cour de Chine se dcouragea. Les lettrs eurent beau jeu, au
nom de leurs vieilles thories pacifistes, rclamer lvacuation des colonies,
labandon du protectorat. Le thme tait toujours le mme : au temps des
premires dynasties qui, on la vu, correspond dans les dclamations des
intellectuels chinois un ge dor la Chine navait pas de possessions
extrieures : Enferm dans ses limites propres, le peuple vivait heureux.
Pourquoi sobstiner entretenir ces ga rnisons lointaines qui cotent si cher et
qui se montrent impuissantes devant les rvoltes priodiques ? Lavis des
lettrs tait sur le point de lemporter dans le conseil quand quelquun
demanda la parole ; ctait le propre fils de Pan Tchao, Pan Yon g. Si vous
abandonnez le Tarim, vous le livrez aux Huns. Cest leur rendre leur magasin
et leur trsor, cest leur recoller un bras coup ! Et le jour viendra bientt o
les barbares insulteront de nouveau les frontires de la Chine propre. Nous
reverrons le temps o les portes de nos villes devaient tre fermes en plein
jour ! Il entrana ladhsion du conseil et en quelques annes (123 -127)
rtablit le protectorat chinois en Asie centrale.
Ltablissement du protectorat chinois dans ces rgions prse nte,
lpoque qui nous occupe, une importance considrable pour lhistoire de la
civilisation. Ctait en effet le moment o, grce louverture de cette double
route du Tarim, route du nord par le Lobnor, Qarachahr, Koutcha et
Kachgar, route du sud par le Lobnor, Niya, Khotan, Yarkand et de nouveau
Kachgar, la Chine entrait en rapports commerciaux avec le monde romain.
Par l les Chinois expdiaient lAsie romaine leurs produits au premier rang
desquels tait la soie. La route du Tarim avec sa double piste, septentrionale et
mridionale, tait la route de la soie.
La sriciculture, on le sait, remontait en Chine au plus lointain pass. Le
Yu-kong et le Tcheou-li, textes qui datent respectivement des IXe-VIe sicles
et du IVe sicle avant J.-C., nous parlent de la soie comme dune des
principales richesses des rgions qui correspondent au Chan-tong et au
Ho-nan actuels. Sous les Han les rouleaux de soie quivalaient au numraire
dans les changes officiels avec les cours trangres.
Or, depuis que le monde grco-romain avait appris connatre la soie, il
ntait pas de produit plus demand. Alexandrie et Rome sen disputaient les
arrivages. Lucain nous apprend quau cours dun banquet Cloptre, voulant
faire ses htes une surprise inoue, leur apparut resplendissante dans un
vtement de soie. Virgile, dans ses Gorgiques (II, vers 120-121), chante les
cocons du ver soie, ces laines dlicates que le Sre enlve aux feuilles de
ses arbres . Ce nom de Sres, pour dsigner les Chinois, est dai lleurs
rvlateur. Il vient du nom mme de la soie (sseu en chinois), de sorte que la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
54
Chine, pour les Romains, ctait avant tout le pays de la soie , Serica. Tel
fut lengouement de la mode que, sous Tibre, des lois somptuaires durent
interdire aux hommes, pour les rserver lusage fminin, les vtements de
soie. Pline et Martial nous parlent encore du commerce des soieries qui se
faisait dans le quartier le plus lgant de Rome. Tout ce commerce, on la vu,
passait ncessairement par lempire parthe . Les annales chinoises remarquent
ce sujet que les Parthes entendaient se rserver le monopole des soies de
Chine, ce pourquoi ils empchaient toute communication directe entre la
Chine et Rome, comme nous lavons vu par lexemple de Kan Ying.
Au 1er sicle de notre re un commerant grco-romain originaire de la
Macdoine mais qui parat avoir eu le centre de ses affaires en Syrie, Mas
Titianos, eut lide hardie de triompher de cet obstacle en faisant directement
reconnatre par ses agents la route de la soie depuis la Syrie jusquen
Chine. Le rsultat de son enqute nous a t transmis par Marin de Tyr (vers
110 de notre re) travers le gographe Ptolme (vers 170). Liti nraire,
videmment parti dAntioche, traversait lEuphrate Hirapoli s (lactuel
Menbidj, lest dAlep), pntrait dans lem pire parthe o il passait par
Ecbatane (Hamadhan) et Hcatompylos (Chhroud ?), gagnait ensuite
Antioche de Margiane (Merv) et aboutissait Bactres (Balkh), dans lempire
indo-scythe. De l il tournait au nord jusqu la monte du pays montagneux
des Kmdoi , au pied du Pamir, puis, traversant ces montagnes, il tournait
au midi jusquau ravin qui souvre dans la plaine et par o on atteignait le
lieu dit la Tour de pierre (Lithinos Pyrgos), point que Hackin situe
Tach-kourgan au sud-ouest de Yarkand, tandis quAlbert Herrmann le place
dans la valle suprieure de lAlta, louest de Kachgar. De l, en tout tat de
cause, la route dcrite par Marin de Tyr et Ptolme passe par le pays de
Kasia qui peut (quoi quon en ait dit) correspondre Kachgar ( Kacha en
sanscrit), puis par Issedon Scythica qui peut tre loasis de Koutcha,
Damna qui serait loasis de Qarachahr, Issedon Serica qui correspondrait la
rgion du Dobnor, Daxata qui serait la Porte de jade, cest --dire la porte de la
Chine lentre de la marche de Touen -houang, Throana qui serait Touenhouang mme, Thogara qui pourrait tre la ville actuelle de Kan-tcheou, dans
la province de Kan-sou par o aujourdhui encor e arrivent en Chine toutes les
caravanes de lAsie centrale, Sera metropolis enfin qui peut tre la premire
capitale des Han, la premire grande ville chinoise en venant de louest,
Tchang -ngan, notre Si-ngan-fou.
La voie de terre, la route de la soie, ntait pas la seule par la quelle
lempire des Han correspondait avec lempire romain. Les gographes
alexandrins Marin de Tyr et Ptolme nous dcrivent aussi une route
maritime, la future route des pices, dont la dernire chelle est le port
de Kattigara quon peut rechercher dans lactuel Tonkin, du ct de
Haphong. Le Priple de la mer Erythre (90 de notre re) nous dit de son
ct quen naviguant vers le nord au -del de la Chersonse dOr (presqule
de Malacca), on parvient une grande ville situe lintrieur des terres et
appele Thina (29), do les soies sriques , les fils de soie et les soieries
parviennent jusqu Bactres. Il est vraisemblable qu la date dont il sagit la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
55
Thina du gographe grec, transcription hellnique du nom mme de la Chine,
correspond la nouvelle capitale des Han, Lo-yang, notre Ho-nan-fou. Nous
savons enfin par les annalistes chinois quen 166 de notre re arriva en Chine
un personnage qui se disait envoy de lempereur Marc -Aurle (Antoun en
chinois, transcription trs fidle de Marcus Aurelius Antoninus). Ltranger
tait venu par la voie maritime, dau -del du Je-nan , province chinoise qui
correspond lAnnam septentrional actuel.
Par ces deux routes la route transcontinentale et la voie maritime le
bouddhisme allait pntrer en Chine, et cest l un fait dune importance
capitale pour les destines de lExtrme -Orient.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
56
CHAPITRE 11
Rvlation du bouddhisme
Le bouddhisme est une religion essentiellement indienne et qui resta
limite lInde pendant six cents ans. Son fondateur, kyamouni, qui mrita
de devenir le Bouddha, cest --dire le sage par excellence, avait vcu dans le
bassin oriental du Gange entre 563 et 483 avant J.-C. Ctait un jeune noble de
la jungle npalaise qui avait renonc au monde pour mener la vie rmitique.
Aprs de longues macrations il en discerna linutilit et sous lArbre de la
bodhi, Gay, au sud de lactuel Patna, dans le Sud -Bihar actuel, il parvint
lillumination . Il comprit la loi de la douleur universelle : le monde ntait
quun torrent dim permanence se rsolvant en douleur. Ce pessimisme,
disons-le tout de suite, provenait dune croyance universellement admise dans
lInde, la croyance la mtempsycose ou transmigra tion des mes. Le
spiritualisme occidental nous propose comme rcompense la vie ternelle. La
vie ternelle que proposaient les doctrines indiennes prenait forme de
cauchemar parce que lie aux alas de la transmigration : natre, souffrir,
mourir, renatre pour ternellement souffrir et mourir, ctaient les travaux
forcs de la vie ternit .
A ce cauchemar le Bouddha apportait une solution : pour chapper au
cycle ternel des renaissances, au monde de la transmigration, il importait
avant tout d teindre la soif du moi qui provoque les renaissances,
dteindre le moi, extinction qui est proprement le nirvna. Le Bouddha
prchait cet effet non certes le suicide (qui naurait comme rsultat que de
nous replonger dans les rincarnations les plus affreuses), mais la lutte contre
les passions, limmolation de lindividu tous les tres, luniver selle charit,
pousse jusquau constant sacrifice de nous -mme, envers toutes les cratures,
hommes ou animaux. Sa doctrine, mtaphysiquement ngative, aboutissait
dans la pratique une morale toute de renoncement, de chastet, de charit et
de douceur.
Pour comprendre la diffusion immense dont devait par la suite bnficier
le bouddhisme, notons tout de suite lattirance que ne pouvait manquer
dex ercer sur les mes les plus hautes un tel climat spirituel. Signalons en
particulier llment de posie, dune tendresse franciscaine, que constiturent
pour la littrature et pour lart les lgendes sur les vies antrieures
(djtaka) du Bouddha au cours de ses pr-incarnations successives sous
diverses formes humaines ou animales : le roi des cerfs qui simmole pour sa
harde, le livre qui se jette dans le feu pour nourrir un brahmane affam, le roi
des lphants qui offre ses dfenses son meurtrier, etc.
Le bouddhisme fut prch du vivant de son fondateur dans les provinces
du Gange oriental, dans le Magadha (Sud-Bihar), Bnars et dans lAoudhe,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
57
do il devait se rpandre progressive ment dans le reste de lInde. Lglise
quil avait constitue tait une communaut de moines runis en monastres et
autour desquels se groupaient des tiers ordres de zlateurs lacs. Bien
entendu, la doctrine bouddhique, au cours des cinq sicles qui suivirent, se
modifia. Au moralisme un peu froid de son fondateur se superposa une
vritable thologie, correspondant aux besoins du cur hu main. Le Bouddha
historique, tant nirvn, cest --dire teint , se trouvait difficilement
accessible la prire. Le bouddhisme ultrieur obvia cette difficult en
crant un certain nombre de futurs bouddhas les bodhisattva qui
attendent, en de merveilleux paradis, lheure de leur incarnation et qui
occupent cette attente sauver les cratures. Certains de ces bodhisattva
finirent par lempo rter dans la dvotion populaire sur le bouddha historique.
Ce fut le cas de Maitrya, le bodhisattva dont lincarnation est la plus
prochaine et quon a appel, de ce fait, le messie du bouddhisme ; le cas
dAvalokitvara dont le nom sanscrit d signe une sorte de Providence
bouddhique et qui, sous la figure dune madone bouddhique , la desse
Kouan-yin, jouera un rle si considrable dans le bouddhisme chinois ; tel est
le cas encore dun autre bouddha mtaphysique, troitement associ au
prcdent : Amitbha ( Lumire infinie ) qui, sous le nom dAmida,
assumera un rle non moins important dans les sectes pitistes
sino-japonaises. La cration de ce panthon, qui parat stre dfinitivement
constitu dans lInde du Nord aux premiers sic les de notre re, acheva de
donner au bouddhisme sa physionomie historique au moment mme o celuici allait entreprendre la conversion de lExtrme -Orient.
A cette conversion les bodhisattva nouvellement crs allaient dailleurs
contribuer pour une bonne part. Ces hautes figures spirituelles, toutes de
compassion et de misricorde, faisaient natre autour delles un climat de
confiance et de tendresse, un pitisme, une religion du cur dont lAsie
orientale ne pouvait offrir aucun quivalent. La Chine en particulier (
laquelle le confucisme et le taosme ne prsentaient rien de semblable) allait
y trouver la rvlation dun nouveau monde spirituel. Et cela aux tages les
plus divers de la socit. La pense philosophique devait y dcouvrir un
aliment inpuisable grce la mtaphysique dont, vers le premier sicle de
notre re, le bouddhisme indien acheva de se couronner. Les systmes ainsi
labors enseignaient en gnral un idalisme absolu, fond sur lirralit du
monde extrieur comme du moi. Lu nivers ne sera plus quun rien que
pense , un ocan didaux , et nous nous permettrons danticiper pour
faire remarquer quune telle doctrine allait, certains gards, la rencontre du
vieux taosme chinois. Par ailleurs, rptons-le, le sentiment des foules ne
pouvait qutre attir par les innombrables lgendes relatives chaque
bodhisattva, par ces images tendres et merveilleuses quon proposait leur
amour, par les vies de saints, la Lgende dore du bouddhisme , par le
chatoiement de ses paradis et de ses enfers, enfin et ce nest pas le moins
important par lart bouddhique lui -mme.
Jusqu lre chrtienne le bouddhisme indien stait donn un art plein de
charme parce quinspir par le naturalisme ternel de lInde. Toutefois dans
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
58
ces premires coles de sculpture proprement indiennes les artistes navaient
jamais os figurer limage du Bouddha, pas plus que les musulmans ne
reprsentent celle dAllah ou de Mahomet. Sans doute mme y avait -il l plus
quune ques tion de respect : une question de logique, car il ntait pas sans
quelque contradiction de vouloir ressusciter par limage Celui qui tait
dfinitivement nirvn, cest --dire dpersonnalis . Jusque dans les
scnes de sa vie on remplaait donc limage de Bouddha par un certain
nombre de symboles conventionnels. Mais quand lhellnisme se fut implant
dans le nord-ouest de lInde, dabord sous les rois grecs successeurs
dAlexandre le Grand en ces rgions, puis sous les rois indo -scythes
successeurs des rois grecs et eux aussi nettement philhellnes, le point de vue
changea. Les Grecs convertis au bouddhisme prouvrent le besoin de reprsenter rellement le Bouddha. Ils sinspirrent cet effet du type de leur
dieu Apollon. Le premier bouddha ainsi model aux environs de notre re
dans la rgion de Pchawer, lancien Gandhra, fut un pur Apollon auquel on
avait seulement ajout les caractristiques rituelles : le point de sagesse entre
les deux yeux, lallongement du lobe des oreilles ( cause des lourds pen dants
doreilles, nagure ports par le Bouddha quand il tait prince), enfin le
chignon pour le turban bouffettes, devenu par la suite, quand cette
disposition de toilette ne fut plus comprise, une protubrance crnienne.
Ce sont ces bouddhas grecs, au profil purement apollonien, la draperie
purement hellnique, que nous ont livrs par centaines les fouilles pratiques
dans lancien Gandhra et, plus louest, entre Pchawer et Caboul, Hadda
(ces dernires abondamment reprsentes au muse Guimet). Et ces t ce
mme type de bouddha grec qui se transmettra de sicle en sicle, de proche
en proche travers toute lAsie centrale jusquen Chine et au Japon, donnant
naissance aux innombrables bouddhas de lExtrme -Orient. Bien entendu, au
cours de cet immense voyage travers lespace et le temps, le type grec
originel se modifiera. Il finira par se siniser, mais mme alors il conservera
souvent dans la rectitude du profil et lordonnance de la draperie le lointain
souvenir de ses origines hellniques.
Le bouddhisme indien venait de se donner cette iconographie grecque
lorsquil entreprit la conversion de lAsie centrale (bassin du Tarim) et de la
Chine.
Lvanglisation de la Chine par les missionnaires bouddhistes peut
paratre singulirement tardive. Le Bouddha est mort en 483 avant J.-C. et ce
nest que dans les annes 60 -70 de notre re quon nous signalera lexistence
dune premire communaut boud dhique en Chine. En ralit lvanglisation
de la Chine par les missionnaires bouddhistes a pour la premire fois t
rendue possible par la coexistence de deux grands faits politiques. Dune part
lInde du nord -ouest et lAfghanistan (terre alors aussi pro fondment
bouddhique que le bassin du Gange) ont t englobs dans un grand empire,
celui des Indo-Scythes originaires de lAsie centrale et rests de ce fait en
rapports avec la politique chinoise, mais qui, une fois installs sur les confins
indo-iraniens, dans lhritage des derniers rois indo -grecs, staient largement
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
59
ouverts la fois aux croyances indiennes, au bouddhisme en particulier,
et lhellnisme. Du plus clbre des rois indo -scythes, de Kanichka (v.
78-110 ou 144-172 ?) peut-tre le contemporain de Pan Tchao et de Trajan,
nous avons de belles monnaies portant limage du Bouddha, traite la
grecque avec le nom de celui-ci en caractres grecs : Boddo. Or, lexception
dune courte brouille en 88 de notre re parce que les Indo-Scythes avaient
voulu intervenir au Tarim, intervention qui fut du reste arrte net par Pan
Tchao, leurs relati ons avec la Chine des Han taient excellentes, ce qui
garantissait la scurit des communications entre lInde et le protectorat
chinois du Tarim.
Car, et cest le second fait historique qui favorisa la dif fusion du
bouddhisme travers lAsie orientale , on ne saurait exagrer les
consquences spirituelles des conqutes des Han dans la direction de
louest. La formation de lempire mondial des Han, son extension jusquau
Pamir, cest --dire jusquaux portes de lInde, louverture de la route de la
soie par les armes dun Pan Tchao, cette pousse victorieuse qui faisait de la
Chine la voisine directe de lempire indo -scythe, ctait l une situation qui ne
stait jamais prsente jusqualors et dont la religion universelle qutait le
bouddhisme allait immdiatement bnficier. De mme, et vers la mme
poque dailleurs, la conqute romaine allait rendre possible la propagation du
christianisme en Occident. La Pax Sinica dans lAsie orientale eut cet gard
les mmes consquences spirituelles que la Pax Romana dans le monde mditerranen.
Lapostolat bouddhique commena naturellement, comme le commandait
la gographie, par la rgion de Khotan, dans la partie mridionale du bassin du
Tarim. Il est attest dans ces parages par des dcouvertes de sculptures
grco-bouddhiques. A Rawak, au nord-est de Khotan, des bas-reliefs sculpts
datant des deux premiers sicles de notre re, dans la cour dun ancien stopa
bouddhique, nous offrent des draperies dune eurythmie purement grecque.
Comme nous lavon s annonc, la route de lvanglisation bouddhique
concidait ici avec la route du commerce de la soie. Sur le site de lancien
Khotan ( Yotqan) et beaucoup plus lest, dans la valle du Niya, on a
trouv des intailles de travail romain reprsentant des dieux antiques Pallas
Athn, Zeus, Eros, Hrakls ou des quadriges classiques. Il semble que la
plupart de ces intailles aient pu tre tailles sur place par des lapidaires
itinrants, Grecs dAsie, Syriens ou Bactriens que lappt du gain ou le go t
des voyages avaient attirs jusquau pays des Sres . A Miran, au sud du
Lobnor, un ancien sanctuaire bouddhique du IIIe sicle de notre re environ
nous a livr des fresques qui, linspiration bouddhique mise part, pourraient
avoir t trouves dans lAsie romaine ou Pompe : nous avons la surprise
dy dcouvrir un Bouddha accompagn de ses moines, des gnies ails, des
personnages imberbes coiffs du bonnet phrygien, des joueuses de mandoline,
des quadriges enfin qui relvent directement de la rt romain de Syrie. Lune
des fresques porte une inscription en caractres indiens qui donne le nom du
peintre : Tita, et on croit voir dans ce nom une forme indianise de Titus.
Faut-il en conclure, se demande Victor Goloubew, que le peintre est un
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
60
Eurasien n dans lInde ou doit -on voir en lui un artiste form dans quelque
atelier dAntioche ou de Bactriane ? En tout cas, rien de plus rvlateur que
ces peintures bouddhiques et romaines en pleine rgion du Lobnor, aux
dernires haltes des caravanes avant le premier poste-frontire chinois de
Touen-houang.
Mais le bassin du Tarim ntait pour les missionnaires bouddhistes venus
de lInde du nord -ouest que le vestibule de la Chine. Ds les annes 60-70 de
notre re une premire communaut bouddhique se forma la cour dun cadet
de la dynastie han apanag dans lactuelle province de Kiang -sou. Dtail
intressant, ce prince tait taoste. De fait, le bouddhisme, quand il fut alors
pour la premire fois prch en Chine, apparut aux Chinois comme une secte
taoste. Ainsi pour les Romains le christianisme ne fut dabord quune secte
juive. Les missionnaires bouddhistes profitrent consciemment ou non de cet
alibi initial dont leur prdication ne pouvait que bnficier. Ayant se crer de
toutes pices un vocabulaire pour traduire en langue chinoise et, si je puis
dire, en pense chinoise les concepts indiens, ce fut tout naturellement la
terminologie taoque quils empruntrent leurs quivalents, ce fut daprs cet
exemple quils modelrent leurs nologis mes. Un cas analogue devait se
prsenter au XVIIe sicle pour les missionnaires jsuites qui, pour rendre les
concepts thologiques chrtiens, durent emprunter une partie de leur
vocabulaire celui des lettrs confucens. Ainsi encore les apologistes
chrtiens du IIIe sicle empruntant leur terminologie philosophique Platon et
Philon. Le rsultat fut que les premires communauts bouddhiques en
Chine furent, selon lexpression de Henri Maspero, des groupes dun
taosme bouddhisant .
La plus importante communaut bouddhique fut naturellement celle qui se
cra dans la seconde moiti du IIe sicle de notre re Lo-yang (Ho-nan-fou),
la capitale impriale. Le fondateur en fut un Parthe arriv en Chine en 148 et
qui devait mourir en 170. Le fait que parmi les premiers missionnaires
bouddhistes en Chine on compte un Parthe peut paratre curieux, mais le cas
nest nulle ment isol. Dans les rangs des aptres du bouddhisme en Chine
cette poque ou dans la premire partie du IIIe sicle de notre re on trouve
dautres Parthes ou encore des Indo -Scythes, originaires de cet empire
indo-scythe, de culture la fois indo-iranienne et hellnisante, qui rgnait sur
lAfghanistan et lInde du nord -ouest. La prsence de ces Iraniens parmi les
communauts bouddhiques nouvellement tablies dans lempire han ne rend
que plus intressante lintroduction du bouddhisme en ce pays, puis que la
religion du Bouddha napportait pas lExtrme -Orient seulement la pense
indienne et lart grec, mais aussi certaines influ ences venues de la civilisation
du vieil Iran.
Htons-nous dajouter que malgr ces succs locaux, le boud dhisme ne
bnficia jamais dans la Chine des Han dune vogue gnrale. Le taosme,
dont les analogies superficielles avec lui avaient dabord favoris sa
propagande, ne tarda pas dnoncer cette erreur et poursuivit les
missionnaires bouddhistes dune haine de moines qui ne dsarma jamais.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
61
Quant aux lettrs confucens, ils prononcrent contre la religion trangre
une condamnation sans appel : le monachisme bouddhique tait antisocial
parce quil teignait la famille en laissant pricliter le culte des anctres et que
le moine bouddhiste, gostement proccup de son salut individuel, se
montrait indiffrent au sort de ltat. Ctait l une que relle qui devait durer
jusquaux temps modernes. Confucens et bouddhistes lutteront dailleurs
armes ingales, le confucisme au sens le plus large du mot devant
rester la doctrine officielle, une doctrine dtat, tandis que le boud dhisme,
mme sous les empereurs personnellement favorables cette religion, ne
devait reprsenter quune tendance particulire, une religion de groupes qui,
quelque extension quelle ait pu prendre certaines poques de ferveur,
demeurait trangre la famille chinoise et ltat chinois.
Sous les Han, en tout cas, le bouddhisme, bien que nullement perscut, ne
devait pas avoir dans ltat chinois plus dimportance que le christianisme
dans lempire romain lpoque de Trajan ou de Marc -Aurle.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
62
CHAPITRE 12
Splendeur et dcadence des Han
La longue paix des Han valut la Chine une richesse inoue. Lhistoire de
lart en porte tmoignage.
Lart des Han est particulirement intressant pour nous parce quil est
laboutissement de toute lvolution artistique des poq ues antrieures. Et cela
la veille du moment o les influences trangres, introduites par le
bouddhisme, vont bouleverser les donnes traditionnelles.
Nous avons signal sa place chacune des grandes tapes de lart des
bronzes chinois archaques. Rsumons maintenant la courbe de cette
volution. Dabord lpoque Chang : priode de prodigieuse activit cratrice,
avec une puissance de sve, une spontanit, une varit de motifs depuis lors
ingales. Puis le dbut des Tcheou : priode dalourdissement et
dappauvrisse ment des formes comme du dcor. Enfin lge des Royaumes
Combattants et des Tsin : renouveau dactivit cratrice, avec un dcor anim
dun rythme trpidant. Avec les Han les formes se simplifient au point que tel
bronze chinois de cette poque rejoint parfois par la puret de ses lignes la
sobrit dun vase grec. Dans le dcor, quand ce dcor, en dehors des
tao -tie des anneaux danse, nest pas entirement supprim, lexub rance
et lenchevtrement des Royaumes Combattants font p lace une non moindre
simplicit. Toute surcharge disparat (et il faut se rappeler quelle avait t
celle de certains bronzes archaques). Llgance des motifs rside dsormais
dans la symtrie dcorative, les russites dun graphisme plein dadresse et
la sobrit de la ronde-bosse . Le dcor en relief se trouve souvent remplac
par les motifs gravs et par des incrustations de turquoise, de malachite, dor
ou dargent. Ainsi, crit Georges Salles, furent ralises les merveilleuses
parures soit gomtriques, soit animes de scnes relles ou fantastiques,
figures de monstres, danses de gnies, scnes de guerre ou de chasse, toutes
surprenantes par leur prodigieux lan. Les mmes incrustations de turquoise
et de mtaux prcieux se retrouvent sur les agrafes han (et sans doute dj sur
celles des Royaumes Combattants), ornements vestimentaires dont nous avons
signal plus haut lori gine peut-tre hunnique (30). Par ailleurs il nest pas
impossible que la technique des incrustations, si rpandue en Chine sous les
Han, soit, de son ct, une importation venue du monde grco-iranien.
A lpoque des Royaumes Combattants et lpoque han appa raissent et
se multiplient les miroirs de bronze, de destination magique autant
quut ilitaire, avec le dcor caractristique pour ces deux poques. Les miroirs
proprement han prsentent ainsi la simplicit gomtrique des vases de bronze
contemporains, simplicit qui nexclut nullement larrire -fonds dides
taoques sur la puissance magique du miroir .
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
63
Le mme dcor lgant dentrelacs, de rinceaux et de spirales que nous
remarquons sur les bronzes incrusts et sur les miroirs han se retrouve sur les
laques de mme poque dcouverts non seulement dans la Chine propre, mais
aussi par les Japonais dans les tombes chinoises de Core (district de Rakur,
ou Lo-lang), par la mission Kozlov dans la tombe hunnique de Non-Oula,
prs dOurga, en Mongolie, et par la mission Hackin (1939) Bgram, prs de
Caboul, en Afghanistan.
Les gravures sur pierre et les bas-reliefs des chambrettes funraires du
Ho-nan et du Chan-tong (mission Chavannes) constituent sans doute la copie
artisane et faite au ciseau de fresques de palais aujourdhui perdues. Cest
un art linaire, graphique, tout de mouvement et de vitesse, quil sagisse de
cavalcades et dfils de charrerie ou de rondes fantastiques de dits et de
monstres. Art qui, du reste, nous intresse doublement parce que dans les
scnes nobiliaires et militaires il cherche ressusciter sous nos yeux lhistoire
de la priode archaque, telle que lima ginaient les lettrs han, et parce que
dautre part les scnes fantastiques voquent pour nous une mythologie en
partie perdue puisque bannie par le confucisme officiel, mythologie que nous
connatrions encore plus mal si la survivance nen avait t conser ve dans les
lgendes taoques. Nous aurons loccasion de voir laction du no -taosme la
fin de lpoque han et le rle que devait jouer le mouvement spirituel en
question dans la chute de la dynastie. Les reliefs funraires (31) du Chan-tong
et du Ho-nan nous aident comprendre la sous jacence de ce courant qui
devait miner la socit confucenne, en apparence si solide, de ce temps.
Sur les piliers funraires du Sseu-tchouan (mission Lartigue et Sgalen),
notamment sur le clbre pilier de Chen , les hauts-reliefs sculpts
prsentent des qualits suprieures, dans un style qui se rapproche davantage
de notre classicisme grco-romain. uvres dartistes, en tout cas , et non plus
dartisans. Remarquons par ailleurs que certains reliefs sculpts han, ceux qui
par exemple, au Chen-si, reprsentent des lions (animal inconnu en Chine),
semblent inspirs de modles sinon, comme on la dit, purement iraniens, du
moins grco-iraniens. Linfluence de la route de la soie est ici fort possible.
La sculpture en ronde-bosse, qui semblait avoir disparu de Chine aprs les
marbres chang, avait reparu lpoque des Royaumes Combattants avec les
dragons et les animaux (tigres, bovids, etc.) qui surmontent souvent le
couvercle des bronzes de ce temps. Le ralisme sobre de ces figures slargit
sous les Han. La ronde-bosse, libre du rle de motif dcoratif, est traite
pour elle-mme. Nous voyons apparatre une multitude de figurines funraires
en terre cuite, personnages, animaux, tres fantastiques, etc. Il sagit ici,
comme dans lEgypte antique, de substituts des vivants, devant permettre au
mort de continuer dans la tombe son existence accoutume. La qualit
dominante de cette petite sculpture cest, notamment dans les statuettes
danimaux, le mme ralisme rapide et sobre, sans excs de musculature, tout
de mouvement.
Si lart han na pas encore subi linfluence du bouddhisme, certaines de
ses techniques ont continu tre en liaison avec lart animalier des steppes,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
64
ainsi que le fait stait dj produit lpoque prcdente, celle des Royaumes
Combattants. Nous avons indiqu les caractristiques de cet art des steppes,
reprsent par de petits bronzes dquipement ou de har nachement (boucles,
agrafes, plaques, etc.) dcors de motifs animaliers styliss (combats
danimaux plus ou moins enchevtrs en opposition fr quemment
dissymtrique). Nous avons galement vu quen dpit dun grand nombre de
variantes chronologiques et topographiques, lart des steppes stendait du
domaine scytho-sarmate de la Russie mridionale aux domaines hunniques de
la haute Mongolie et de lOrdos. La continuit de cet art est marque par les
fouilles de Pasyryk, dans lAlta russe, qui, pour le d but du 1er sicle avant
J.-C., nous ont livr des objets daspect tant scytho -sarmate que hunnique.
Plus intressant encore est le tumulus de Non-Oula prs dOurga en haute
Mongolie qui date des premires annes de notre re. Cette tombe de chef
hunnique renfermait en effet cte cte un laque chinois dat (de lan 2 avant
J.-C.), des soieries chinoises et un magnifique tapis de laine brod de combats
danimaux du plus pur style des steppes, preuve vidente de la pntration des
deux cultures. Comme contre-preuve, le muse Cernuschi, sur linitiative de
M. Sagot-Vandel, a acquis en 1941 un bronze han o le thme du combat
danimaux des steppes est trait dans un style purement chinois. Nous avons
vu comment au 1er sicle avant J.-C. les Han avaient tabli dans lOrdos une
partie des Huns comme barbares fdrs et gardiens du limes : dans cette
marche-frontire de lOrdos la pntration rciproque de lart chinois et de
lart des steppes ne devait plus cesser jusqu lpoque gengiskhanide.
Ltablissement des Huns fdrs au pied de la Grande Muraille prouvait
la confiance que la Chine avait dans sa propre force. Cette confiance tait
lgitime. Jusquau IV e sicle ces Huns de lOrdos se montrrent des
auxiliaires dociles. Quant aux Huns de la haute Mongolie (bassin de
lOrkhon), ils furent, vers lan 150 de notre re, remplacs dans lhgmonie
de la Mongolie orientale par dautres hordes nomades : les Sien-pei
originaires du Khin-gan ti septentrional et qui semblent les anctres des
Mongols historiques. Bien entendu, les Sien-pei, comme toute nouvelle horde,
attaqurent les frontires de lempire chinois, mais ces attaques qui se
renouvelrent par intermittence pendant toute la seconde moiti du IIe sicle
de notre re, notamment dans le sud de lactuelle M andchourie, furent chaque
fois repousses. Contrairement lempire romain, lempire des Han ne devait
pas succomber devant les invasions. Sa chute allait tre la consquence dune
crise intrieure assez complexe, la fois politique, sociale et intellectuelle.
Au point de vue purement politique, la dynastie des Han laquelle la
restauration de lan 25 de notre re semblait avoir rendu une vigueur nouvelle,
ne tarda pas retomber en dcadence ou mieux, en dgnrescence. Ses
princes, parvenus tout jeunes au trne, mouraient la fleur de lge,
videmment puiss par une vie de plaisirs prmature. Dans le milieu
artificiel de la cour, la camarilla devint toute-puissante, lascendant des
douairires, des concubines et des eunuques, prpondrant. Mais l heure
mme o le pouvoir central saffaiblissait ainsi, lcole des lettrs sefforait
den consolider les assises en donnant dfinitivement lempire et la socit
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
65
une doctrine officielle. Ce fut en effet lpoque des seconds Han, en 79 de
notre re, quune commission de lettrs fixa le texte, jusque -l quelque peu
flottant, des uvres attribues Confucius et son cole, texte qui eut ds lors
une valeur canonique. De 175 183, pour assurer la prennit de cette
rdaction, on grava le mme texte sur une srie de stles en pierre dont
lestampage de multiples exemplaires quivalait une prfiguration de
limprimerie, limprimerie chinoise devant dailleurs avoir une origine
analogue (32). Cette constitution de la doctrine confucenne en doctrine
canonique eut comme consquence la constitution de la classe des lettrs en
classe organise. Les lettrs confucens, forts de se sentir les dpositaires
dune doctrine dtat, tendirent devenir un corps dtat, le premier corps
de ltat, qui chercha sassurer le pouvoir la cour. Ils se heurtrent la
camarilla reprsente par les eunuques et la suite de luttes politiques
acharnes eurent pour le moment le dessous : plusieurs dentre eux payrent
noblement de leur vie leur tentative pour arrter la dcadence de la dynastie
des Han (175-179).
Vers la mme poque les sectes taostes commenaient de leur ct se
constituer en glises organises (33). Le taosme, nous lavons vu, sortait
des vieilles coles de sorciers dont, malgr llvation de sa mtaphysique, il
ne stait jamais dgag. Limit jusque -l de petits cercles dillumins, il
allait, vers la fin des Han, voir son recrutement dcupl la faveur dune crise
sociale grave, du pauprisme qui svissait dans la classe rurale. Nous avons
signal les premires manifestations de cette crise que les rformes de Wang
Mang avaient tent de rsoudre et que lchec du rformateur avait laisse
saccrotre. Les milieux ruraux du temps des Han, crit Henri Maspero,
taient constitus en haut par un petit nombre de grands propritaires riches,
pour la plupart fonctionnaires ou descendants de fonctionnaires, et en dessous
par un vritable proltariat de paysans sans terres ou petits propritaires dont
les plus heureux cultivaient des lots de terres de villages, tandis que les autres
migraient, se faisaient soldats ou pirates, se louaient comme ouvriers
agricoles ou affermaient les terres des grands propritaires, mais sans jamais,
que par exception, russir sortir dfinitivement de la misre. Lheure tait
favorable aux agitateurs. Une famille de magiciens taostes, la famille Tchang,
organisa cet effet du ct du Sseu-tchouan et de la valle suprieure de la
Han une socit secrte qui, dans la seconde moiti du IIe sicle de notre re,
joua un rle politique actif (34). Les Tchang accomplissaient des prodiges,
gurissaient les malades, remettaient les pchs et se signalaient la
reconnaissance des populations en se substituant aux autorits dfaillantes
dans certains travaux dutilit publique, tels que rfection des routes ou
rparation des ponts, sans parler de distributions gratuites de riz aux affams.
Au bout de quelques annes ils furent suivis par des centaines de milliers
dadeptes quils armrent et rpartirent en corps de troupes rgulirement
commands et qui se reconnurent au port de turbans jaunes. Puis ils
annoncrent que lanne 184 correspondait, daprs la conjonction des astres,
louvert ure dun nouveau millenium.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
66
Au signal donn la rvolte clata dans le sud du Ho-pei, les districts
avoisinants du Chan-tong et le bassin du Houai-ho. Les pouvoirs publics,
compltement surpris, furent partout dbords. La cour dut lever des armes
considrables pour reconqurir le pays. Quand les Turbans jaunes eurent t
chasss du Chan-tong, ils se reformrent dans la valle de la Han et la rvolte
ne fut dompte que par la prise de leur dernier rduit, Nan-yang, dans le
sud-ouest du Ho-nan (184). Tous les jacques que lon put prendre furent
inexorablement mis mort. Mais aprs de telles horreurs, la misre tait
encore pire. Le Pome des sept tristesses du pote Wang Tsan (177 -217)
nous a trac un poignant tableau de ces annes terribles :
Lanarchie rgne dans la capitale de louest, trouble par les tigres
et les loups...Les ossem ents hum ains couvrent la plaine.A u bord dune
route, une fem m e en proie la fam ine abandonne son petit enfant
dans les herbes. M algr ses vagissem ents elle ne le reprend pas.
M oi-m m e, m urm ure-t-elle, je ne sais o je vais aller m ourir ... je
prcipite le pas de m on cheval,je fuis pour ne pas entendre de telles
paroles. U ne dernire fois je tourne la tte pour contem pler la ville
de Tchang-ngan. Je pense tant de victim es ; le c ur serr, je
soupire longuem ent (35).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
67
CHAPITRE 13
Lpope des trois royaumes
Tandis que la jacquerie des Turbans jaunes ravageait les provinces, la
cour la camarilla des eunuques squestrait des rgentes sans nergie et des
empereurs-enfants. En 189 les officiers exasprs procdrent dans le palais
un massacre radical des eunuques, mais le gnral Tong Tcho que les conjurs
avaient appel leur aide en profita pour sattribuer la dictature. Ce fut le
signal de lanarchie militaire, car la leve de milices provinciales pour
combattre les Turbans jaunes avait amen la constitution darmes de guerre
civile qui nobissaient qu leurs chefs. Tandis que Tong Tcho sinstallait en
matre dans la capitale, dautres gn raux sattribuaient le pouvoir dans les
provinces. Tong Tcho qui ntait quun soudard brutal se montra incapable de
dominer cette anarchie. En 190, voulant transporter sa rsidence Tchang
ngan, il laissa piller par ses troupes et brla ensuite le palais imprial de
Lo-yang. Les trsors dart accumuls depuis deux sicles par les Han furent
dtruits. Mais la tyrannie de Tong Tcho, ses fureurs sanguinaires finirent par
lui aliner ses propres lieutenants qui lassassinrent. Son cadavre fu t livr nu
la populace (lhomme tait norme, bouffi de graisse ; on lui passa dans le
nombril une mche de lampe quon alluma : elle brla durant plusieurs jours).
Alors commena une priode de confusion pire que tout ce quon avait vu
jusque-l.
A la faveur des troubles les Huns recommenaient leurs ravages. La
potesse Tsai Yen, capture par eux, nous a laiss dans son Chant de dtresse
un poignant tableau de leurs chevauches : Ils massacraient le peuple, les
cadavres sentassaient dans les rues. A lencolure de leurs chevaux, ils
suspendaient les ttes des hommes, ils enlevaient les femmes en croupe de
leurs montures. Les prisonniers tournaient la tte vers le pays natal dont ils
sloignaient chaque jour. Au nombre de dix mille ils reurent des b arbares
lordre de se regrouper. Les membres dune mme famille nosaient changer
leurs impressions. Quelques-uns murmurrent. Alors les barbares grondrent :
Tuons-les ! Que leur sang rougisse notre sable ! Pendant ce temps, la cour,
les factions se disputaient le pouvoir jusquau jour o un des chefs darme,
Tsao Tsao, se rendit Lo -yang la tte de ses troupes et sy proclama
protecteur de lempire, le jeune empereur ntant quun jouet entre ses mains
comme prcdemment entre les mains de Tong Tcho (196).
A la diffrence du grossier soldat quon venait dabattre Tsao Tsao avait
ltoffe dun chef. Bon capitaine et entraneur dhommes, sans scrupules
certes et volontiers brutal, mais politique adroit, il tait de surcrot fort lettr,
puisque les anthologies nous ont conserv ses posies, la plupart dun
puissant lyrisme et dune mle nergie (36). Si quelquun avait pu refaire
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
68
lunit de lempire, ctait cet homme fort. Mais en huit ans de luttes
incessantes (196-204) il ne russit se rendre matre que du bassin du Fleuve
Jaune, des provinces du nord qui constituaient, il est vrai, la partie du
beaucoup la plus peuple et la plus riche de lempire. Dans le bassin du
Yang-tseu dautres chefs darmes staient taill des royaumes. Lun deux,
Souen-Kiuan, se rendit indpendant sur le bas Yang -tseu et bientt presque
toute la Chine mridionale reconnut son autorit. Ctait dailleurs un curieux
personnage, pris de doctrines nouvelles et qui accorda sa faveur aux
missionnaires bouddhistes.
En mme temps, un troisime prtendant, Lieou Pei, entrait en scne. Il
tait de la plus noble origine : ctait un prince han, mais dune branche
cadette tombe dans une telle pauvret quil gagnait sa vie et faisait vivre sa
vieille mre en tressant des sandales de paille. Devant la dcadence de ses
cousins, les empereurs fainants de Lo-yang qui ntaient plus que des jouets
entre les mains du dictateur Tsao Tsao, Lieou Pei sentit bouillonner le sang
imprial qui coulait aussi dans ses veines. Il trouva pour laider trois
compagnons incomparables, trois paladins que lhistoire et la lgende, le
roman et le thtre devaient immortaliser par la suite : Kouan Yu dabord, que
la religion populaire canonisera comme dieu de la guerre, Tchan Fei
ensuite, personnage n dune famille trs modeste (ctait un ancien boucher),
mais dune bravoure toute preuve : lui et Kouan Yu donneront leur vie pour
leur matre, Tchou-ko Leang enfin, la fois guerrier et diplomate, qui
abandonna ses champs pour se dvouer corps et me au prtendant dont il
devint le principal conseiller. Ce fut en effet sur le conseil de Tchou-ko Leang
que Lieou Pei jeta son dvolu sur la province de Sseu-tchouan o il finit par
tablir son autorit.
Les luttes que se livrrent les trois prtendants Tsao Tsao, Souen
Kiuan et Lieou Pei jouissent encore aujourdhui en Chine dune
extraordinaire popularit parce quici lhistoire a t conserve et amplifie
par la lgende. Le Roman des Trois Royaumes qui da illeurs ne remonte
quau XIV e sicle et dinnombrables pices de thtre qui en ont t tires
ont confr ces luttes la valeur dune pope, en ont fait lquivalent de nos
chansons de geste. Voici la bataille de Kiang-ling en 208, au cours de laquelle
Lieou Pei, encercl par larme de Tsao Tsao, arrive avec une poigne de
cavaliers se faire jour travers les masses ennemies. Puis cest Tchang Fei
qui, une fois son matre sauv, retourne larrire -garde et, comme notre
Bayard, dfend lui seul un pont. La lance sur lencolure de son cheval, il
criait : Cest moi, Tchang Fei ! Que celui qui veut faire connaissance avec moi
sapproche ! Et il tint assez longtemps pour intimider lennemi. Un peu plus
loin le mme Tchang Fei retrouve le jeune fils de son matre Lieou Pei dont
les ennemis sont sur le point de semparer. Il couche lenfant sur le pommeau
de sa selle, senlve au milieu des rangs ennemis et atteint avec son prcieux
fardeau les bords du Yang-tseu o une barque les reoit. Cependant Tsao
Tsao avec son arme se prparait tra verser le Yang-tseu pour soumettre la
Chine mridionale comme il avait soumis le nord. Dj sa flotte se disposait
assurer le passage lorsque Lieou Pei lana sur le fleuve une srie de brlots
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
69
qui, pousss par le vent, vinrent incendier les navires ennemis. Les flammes se
propagrent jusquaux paillotes du camp lev par Tsao Tsao sur lautre
rive. Hommes et chevaux prirent en foule dans les flammes ou dans les flots.
Le dictateur du Nord dut renoncer conqurir la Chine du Sud (208).
Le lgitimisme han tait rest vivace au fond des curs. Lieou Pei qui
incarnait ce sentiment semblait sur le point dexploiter sa victoire en relanant
lusurpateur jusque dans les provinces du nord. Mais il avait compt sa ns le
troisime prtendant, sans Souen Kiuan. Souen Kiuan, qui avait jusque -l
t son alli (ils taient mme devenus beaux-frres), commenait craindre
un triomphe trop complet des lgitimistes. A la faveur de la guerre civile, il
tait en train de se tailler un vaste royaume comprenant les provinces du bas
Yang-tseu et la rgion cantonaise. Craignant pour lavenir de ses possessions,
il abandonna brusquement lalliance de Lieou Pei pour celle de Tsao Tsao
(217). Cette dfection arrta net la reconqute lgitimiste et le vieux
compagnon darmes de Lieou Pei, Kouan You, le brave des braves, y trouva la
mort. Il guerroyait contre les nordistes quand les gens de Souen Kiuan le
prirent revers : abandonn par ses troupes et battant en retraite avec une
poigne de fidles, il tomba dans une embuscade. Il fut pris et sommairement
dcapit (219).
Raffermi par ce renversement des alliances, le dictateur du Nord, Tsao
Tsao, se prparait franchir le dernier pas en dtrnant son souverain,
lempereur fain ant de la dynastie han, lorsquil mourut (220). Il laissait le
pouvoir son fils Tsao Pei, hritier de ses ambitions comme de ses talents
(ctait, lui aussi, un pote de race). Le premier soin du nouveau matre fut de
raliser le projet paternel. En cette mme anne 220, il dposa la dynastie han
et se proclama empereur Lo-yang comme fondateur de la dynastie des Wei.
Lusurpation tait consomme, tout au moins dans les provinces du nord,
car autour de Lieou Pei le sentiment lgitimiste ragit avec vigueur. Il tait
dsormais lhritier avr, le reprsentant qualifi de la dynastie han. Il fut
donc, de son ct, et, reconnaissons-le, avec infiniment plus de titres que son
rival, proclam empereur dans ses possessions du Sseu-tchouan. Peut -tre
mme, sil avait profit du sentiment gnral pour attaquer Tsao Pei avant
que celui-ci ft consolid, et-il pu refaire lunit de la Chine et restaurer dans
sa personne la dynastie lgitime. Mais par point dhonneur chevaleresque il se
crut dabord oblig de venger son fidle Kouan Yu, mis mort par le
troisime prtendant, par le roi du bas Yang-tseu, Souen Kiuan. Ce fut
donc contre celui-ci quil se tourna, faute quhistoriens, romanciers
et dramaturges nont cess de lui reprocher car ctait refaire la coalition de
ses ennemis au lieu de les dissocier. De plus il perdit dans cette campagne son
autre fidle, Tchang Fei, que des tratres turent dans sa tente et dont ils
allrent porter la tte Souen Kiuan (221). Lieou Pei mourut dcourag au
retour de cette campagne malheureuse, en chargeant de la tutelle de son fils le
magnanime Tchou-ko Leang (223).
La Chine se trouva dfinitivement partage en trois royaumes : 1 le
royaume fond par Lieou Pei au Sseu-tchouan et auquel seul lhistoire
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
70
reconnat le caractre imprial parce que Lieou Pei, tant un prince han, se
trouvait le seul prtendant lgitime ; 2 le royaume empire illgitime
fond par les usurpateurs de la famille Tsao et qui possdait, avec la capitale
impriale, Lo-yang, lensemble d es provinces du nord ; 3 le royaume fond
par Souen Kiuan sur le bas Yang -tseu (il prit le nom de royaume de Wou et
eut partir de 229 Nankin comme capitale) qui, sauf le Sseu-tchouan,
engloba peu prs toute la Chine mridionale.
Il est intressant de constater que cette coupure de la Chine soprait
suivant des lignes de faille inscrites dans la gographie. Lopposition de la
Chine du Nord et de la Chine du Sud est une loi de la nature. Tout les
diffrencie. La premire relve encore du climat des steppes, la seconde dj
du climat subtropical ; la premire se rattache au socle du Gobi, la seconde
lAsie des moussons. La Chine du Nord, constitue par la Grande Plaine de
lss et dalluvions et par les plateaux de lss qui en forment lhinterland, est
la terre du millet et du bl ; la Chine du Sud, forme dun moutonnement de
hauteurs longtemps boises et baignes par les pluies de mousson, est la terre
du riz et du th, o le buffle remplace le cheval auprs de lagriculteur. La
premire, o le Fleuve Jaune reste indompt, se prsente comme le pays des
transports terrestres. La seconde, o le Yang-tseu constitue une voie navigable
dune merveilleuse efficacit, est le pays des transports par eau. Ajoutons
quau III e sicle de notre re la diffrence devait tre non moins tranche au
point de vue anthropologique. La Chine du Nord, surpeuple, avec sa culture
intensive, tait seule la Chine vritable. La Chine mridionale, exception faite
des provinces du bas Yang-tseu, ntait encore quune terre de col onisation,
une Chine nouvelle, en grande partie toujours boise, peuple dallognes et
o les immigrants chinois tablis par les Han restaient ltat de groupements
sporadiques. Mme si nous ngligeons ici les districts encore demi barbares,
mal peupls et peine coloniss de la rgion cantonaise, il y a lieu de
remarquer que les terres du moyen et du bas Yang-tseu o le nouveau
royaume de Wou eut ses capitales, Wou-tchang, Nankin, bien que dj
mieux sinises lpoque qui nous occupe, ne lta ient au fond que depuis le
rgne de Tsin Che -Houang-ti qui, le premier, avait systmatiquement
travaill leur colonisation et leur assimilation.
Quant au Sseu-tchouan, ce nest pas sans raison que le lgiti misme han
lavait choisi comme un inviolab le asile. Le Sseu-tchouan le pays des
Quatre-Rivires constitue en effet une des units gographiques les plus
fortement accuses du continent chinois . Isol des grands centres
historiques de la Chine par dnormes distances, il lest aussi par son puissant
rseau alpestre, par les chanes de montagnes qui le dfendent au nord et
lest, comme lest galement les rapides de Yi -tchang le dfendent contre
les flottilles qui remontent le Yang-tseu. Sa position excentrique loblige se
suffire lui-mme, mais la richesse de son sol le lui permet. Au cur du
Sseu-tchouan stend en effet le fameux Bassin Rouge, fait de grs tertiaires
tendres, dont ltendue en terres cultives est presque gale celle de la
Grande Plaine du nord-est. Lal titude de la rgion, jointe aux avantages dun
climat doux et humide, permet de combiner ici les cultures du nord et celles
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
71
du sud, le riz et le bl. Cette autonomie naturelle du Sseu-tchouan a t
souligne par tous les gographes, par tous les conomistes, par tous les
historiens. Nous la verrons reparatre tous les tournants de lhistoire
chinoise.
En rsum, au moment o le grand empire unitaire des Han se partageait,
ce partage soprait suivant les donnes permanentes de la gographie
physique et humaine : Chine du Nord et Chine du Sud ; Vieille Chine et Chine
Nouvelle ; Chine originelle et Chine coloniale ; et, en marge des deux,
excentrique et vou une vie particulariste, le Sseu-tchouan.
Lpoque des Trois Royaumes avait commenc comme une p ope. Les
protagonistes, la premire gnration, avaient t des hros de chanson de
geste. Ds la troisime gnration, nous ne voyons plus que de ples pigones.
Dans le nord, notamment, les rois de Wei de la famille Tsao tombrent dans
une dgnrescence rapide. Devenus de simples rois fainants, ils laissrent le
pouvoir passer une maison de maires du palais hrditaires, la maison des
Sseu-ma. Un de ces maires du palais, lnergique Sseu -ma Tchao, parut
dailleurs porter son apoge la fortune d e la dynastie Wei dont il grait les
intrts : en 263 il dtruisit et annexa aux possessions de son matre le
royaume han du Sseu-tchouan. En ralit cette conqute achevait daccrotre
lautorit du tout -puissant ministre. En 265 son fils et successeur Sseu-ma Yen
tira les consquences de cette situation : il dposa le dernier roi fainant de la
dynastie wei et monta sa place sur le trne de Lo-yang comme fondateur de
la dynastie tsin. En 280 il complta cette uvre en annexant le dernier des
Trois Royaumes, le royaume Wou de Nankin : la Chine mridionale rentra
ainsi dans lunit chinoise.
Aprs soixante ans de morcellement, lempire chinois unitaire tait donc
reconstitu en faveur de la famille Sseu-ma ou, comme elle sappelait
dsormais, de la dynastie tsin. Les jours de la grande Chine des Han
semblrent revenus. En ralit aucune dynastie chinoise ne tomba dans une
dgnrescence plus rapide que les Tsin. Leur histoire nest que celle de
parents qui sentrgorgent dans des drames de palais atroce s sans quaucune
ide politique, aucune grandeur viennent relever ces monotones tueries, sans
quaucune personnalit en merge.
Ce fut alors que les hordes turco-mongoles envahirent lempire.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
72
CHAPITRE 14
Les grandes invasions et le bas empire
Nous avons vu que lempire chinois, au moment de sa toute -puissance,
avait autoris certains clans de Huns stablir titre de fdrs dans la
grande boucle du Fleuve Jaune et le long de la Grande Muraille. Ces Huns
fdrs, ces Huns ripuaires staient penda nt longtemps montrs des
auxiliaires fidles. Mais lors des guerres civiles qui marqurent dans les
dernires annes du IIe sicle de notre re lagonie de la dynastie han, ils
profitrent de linattention gnrale pour commencer leurs empitements.
Franchissant la Grande Muraille sans que personne dans la carence du pouvoir
central songet les en empcher, ils vinrent tablir leurs cantonnements au
cur de la province du Chan -si (195). On tait en Chine la veille de la chute
des Han. Le chef des Huns se rappela opportunment quune des ses aeules
appartenait cette illustre maison. Payant daudace et non sans habilet, il
affecta de se rclamer delle pour donner sa famille le nom mme de la
grande dynastie chinoise. Ainsi la lgitimit, teinte en Chine par une srie
dusurpateurs, pourrait renatre sous les yourtes hunniques. En 308, en effet,
un de ces chefs huns au nom dsormais chinois, Lieou Yuan, dans une grande
assemble tenue Tai -yuan, au Chan-si, se proclama solennellement
lhritier lg itime des Han et rclama avec hauteur lhritage de ses
anctres , cest --dire lempire chinois !
Le fils de Lieou Yuan, Lieou Tsong, devait mettre ces menaces
excution. Comme beaucoup de jeunes barbares fdrs, il avait t lev la
cour de Lo-yang et lhistoire nous affirme quil y tait mme devenu un bon
lettr chinois. En tout cas ce lettr navait pas oubli les qualits militaires de
sa race puisquil restait capable de bander un arc de trois cents livres, mais de
son sjour la cour impriale il avait retenu de prcieuses indications. La
pompe du crmonial et la majest du vieil empire pouvaient aux yeux des
non-initis dissimuler la dgnrescence de la dynastie, les tares du personnel
dirigeant, le caractre vermoulu des institutions, la faiblesse relle du colosse
aux pieds dargile : lil du Hun fdr avait perc tout cela. En 311 il lana
quatre colonnes de cavalerie sur la capitale impriale, Lo-yang, notre
Ho-nan-fou. Les Huns entrrent en trombe dans la ville, coururent au palais et
firent lempereur prisonnier. Le prince imprial fut massacr avec trente mille
habitants. Le palais fut livr aux flammes ; on viola les tombes impriales
pour en arracher les trsors. Quant lempereur, il fut tran en captivit
auprs de Lieou Tsong qui le contraignit lui servir dchanson jusquau jour
o dans un accs de barbarie il le fit excuter.
Un autre prince de la famille impriale fut alors proclam Tchang -ngan
(Si-ngan-fou, au Chen-si) au milieu des ruines quy avait laisses une rcente
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
73
incursion de la cavalerie hunnique. Dans les ruines de Tchang -ngan, o il
sassit sur le trne, il restait en tout comme population un peu moins de cent
familles. Les herbes et les broussailles avaient tout envahi. En 316, pendant
lhiver, le s Huns reparurent limproviste devant la ville. Comme leur arme
tait toute en cavalerie, incapable dorganiser un sige en rgle, elle se mit
tourner sans arrt autour des murailles. Ce carrousel obstin finit par avoir les
effets du blocus le plus rigoureux : la ville, en proie la famine, dut se rendre
(dcembre 316). De nouveau le roi hun Lieou Tsong, assis sur son trne, reut
un empereur de Chine prisonnier et lobligea rincer les coupes dans les
banquets . Puis un jour que devant ce triste spectacle un des captifs chinois
stait permis de verser des larmes, le Hun, furieux, fit excuter linfortun
souverain.
Devant cette succession de catastrophes la dynastie impriale des Tsin,
abandonnant toute la Chine du Nord linvasion, se rfugia labri du
Yang-tseu, dans la Chine du Sud o Nankin allait lui servir de capitale (318).
Pendant prs de trois sicles (318-589) on allait voir se perptuer ainsi dans la
Chine du Sud une sorte de bas-empire qui nous rappellera les tares et aussi la
paradoxale vitalit de notre empire byzantin, Nankin remplaant l-bas
Tchang -ngan et Lo-yang comme chez nous Byzance devait remplacer Rome
et Milan.
Durant tout ce temps, dans la Chine du Nord, les hordes turco-mongoles se
bousculaient et sentre -dtruisaient en un perptuel croulement de
dominations phmres. Aprs la mort de Lieou Tsong sa famille fut
renverse par un de ses anciens lieutenants, un autre chef hun nomm Che Lei
(329). Encore ce Hun illettr prenait plaisir se faire expliquer les classiques
chinois, mais ses successeurs allaient combiner la sauvagerie hunnique avec
tous les vices dune civilisation dcadente. Lun deux, Che Hou (334 -349)
ntait quune brute dbauche que son fils essaya dassassiner et qui fit
excuter son fils. Ce dernier, Barbe-Bleue tartare, faisait rtir et servir table
les plus jolies de ses concubines : De temps en temps il faisait dcapiter
quelquune des filles de son harem, la faisait apprter et la servait ses
convives, tandis que la tte crue passait la ronde dans un plat pour prouver
quon navait pas immol la moins belle. Contraste frquent chez ces
barbares pervertis par leur premier contact avec la civilisation, mais capables
dtre retourns par la prdication dun saint : Che Hou fut un des plus zls
protecteurs du bouddhisme.
De fait, le bouddhisme, il faut bien se lavouer, gagnait aux invasions
barbares. Tout dabord, au milieu des atrocits de ce temps, les mes
meurtries se tournaient naturellement vers les consolations spirituelles dont il
tait le dispensateur. Puis les grossiers barbares qutaient les Huns ne
pouvaient avoir contre lui les irrductibles prventions des lettrs confucens.
En dpit de lopposition des lettrs, Che Hou publia donc un dit pour auto riser formellement la prdication bouddhique. Telle fut galement lattitude
dun autre roi barbare qui fut un moment matre de toute la Chine du Nord, le
clbre Fou Kien (357-385) Ou plutt, le temps commenant faire son
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
74
uvre, il ne sagit plus ici dun chef de horde qui n e voit dans les
thaumaturges indiens que des chamans dune classe suprieure pouvant
favoriser ses entreprises, mais dj dun barbare en voie dadaptation, sinc rement ralli la culture chinoise et qui, en mme temps que bouddhiste dune
relle pit, se montre un administrateur humain et misricordieux.
Nanmoins, malgr la bonne volont personnelle de quelques chefs, les
remous des hordes qui sentre -dtruisaient enlevaient toute consistance aux
mesures prises. Nous nnumrerons pas ici toutes les tribus barbares qui se
disputrent pendant ces terribles dcennies le bassin du Fleuve Jaune et la
rgion pkinoise. Contentons-nous de dire que la lutte fut circonscrite entre les
Huns, sans doute de race proto-turque , et les clans de Sien-pei
sans doute de race proto-mongole , les premiers, comme on la vu,
descendus de lOrdos, les seconds des confins mandchouriens, au nord -est de
Pkin, les uns et les autres ayant tour tour exerc lhgmonie dans la Chine
du Nord.
Au demeurant, lins tallation des nomades au milieu de ces vieilles terres
agricoles nallait pas sans dincalculables dommages. Non seulement les
grandes villes historiques, comme Tchang -ngan, sont, on la vu, mises sac,
incendies, dpeuples, mais, dsastre plus durable, les terres, dans les
campagnes abandonnes par les paysans, restent en friche. Ainsi vide de ses
habitants, la riche valle de la Wei, autour de Tchang -ngan, est envahie par
les loups et les tigres. Le chef barbare qui rgnait en 354-357 au Chen-si,
Fou-Cheng, se voit sollicit par ses sujets chinois terroriss de les dlivrer des
fauves. Il refuse, en homme qui se sent plutt du ct des loups que des
cultivateurs : Ces animaux ont faim. Quand ils seront repus, ils ne
mangeront plus personne ! Sous cet humour froce on devine la secrte
satisfaction du chef barbare : linvasion du pays par la faune de la steppe en
complte loccupation par les hordes turco -mongoles. Dans ces cantons
dpeupls les rois huns installent dailleurs des tribus entires , mesures qui,
remarquons-le, nont pu manquer davoir leur influence sur la composition
ethnique actuelle de la Chine du Nord (37).
Tandis que ces dsastres sabattaient sur la Chine du Nord devenue pour
deux sicles une simple dpendance de la steppe mongole, la dcadence
saccentuait dans lempire national chinois de Nankin, la cour des derniers
Tsin, ces Byzantins de lExtrme -Orient. Au dbut du Ve sicle, un soldat de
fortune, Lieou Yu, ancien savetier devenu gnral, rendit au vieil empire une
phmre vitalit. A la suite de succs passagers sur les barbares, il dtrna
les Tsin et se proclama empereur. Mais sa maison, qui occupa le trne de
Nankin de 420 479, tomba aprs lui dans une dgnrescence pire que tout
ce qu on avait vu jusque-l. Le troisime empereur de cette maison fut
assassin linstigation dun de ses fils (453). Le parricide fut ensuite mis
mort par son propre frre (454). Le nouvel empereur (454-465), par crainte
dun sort semblable, fit massacrer la plupart des autres princes du sang. Le
souverain suivant qui ne rgna que six mois (465) mont sur le trne
seize ans, assassin dix-sept fut une manire de Nron qui fit massacrer
ses rgents, ses proches parents, ses concubines. Il fut bientt abattu lui-
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
75
mme, mais son oncle et successeur, surnomm le Porc cause de son obsit,
ne fut pas moins sanguinaire, faisant excuter son tour ses frres et ses
neveux (465-472). En mourant le Porc lgua le trne au fils de son mignon.
Cet empereur de hasard, gamin prcoce (couronn dix ans, tu quinze),
montra une telle frocit quon dut le dcapiter en profitant dune nuit
divresse (477). La famille de Lieou Yu tait dcime et dshonore lorsque,
en 479, un Officier la dposa pour fonder une nouvelle dynastie, celle des
Tsi.
Les Tsi occuprent le trne de Nankin de 479 502. Trs vite la
toute-puissance leur tour les dtraqua. Leur histoire, comme celle de la
maison prcdente, nest quune suite dassas sinats, chacun de ces princes
prenant soin de se dbarrasser des membres de sa famille jusqu ce que
quelque parent oubli se dbarrasse de lui. Cest aussi le rgne des mignons
avec, pour empereurs, des phbes quil faut assassiner dix -neuf ans pour
cause de sadisme et de frocit. En 502 un gnral, le futur Leang Wou-ti,
sempara du trne et, bien quapparent la famille impriale, voulut rompre
avec cette maison tare en fondant une dynastie nouvelle, la dynastie leang.
Leang Wou-ti, qui occupa le trne de Nankin de 502 549, fut un assez
grand souverain qui ne rompit pas seulement en paroles avec le milieu
corrompu de ses prdcesseurs. Dune sim plicit de vie qui allait jusqu
laustrit, probe et humain, il apportait sur le trne des vertus de soldat, en
mme temps que le respect des lettres et des lettrs. Tel tait ce moment son
got pour le confucisme quil leva Nankin un temple Confu cius et remit
en honneur ltude des classiques. Dans le mme esprit il rorganisa et
hirarchisa la classe des mandarins . Il y eut l un effort mritoire, aprs les
abominations des dynasties prcdentes, pour ramener dans ltat et dans la
famille les ides morales traditionnelles sur lesquelles reposait la socit
chinoise. Mais bientt les sympathies de Leang Wou-ti changrent dobjet et
sous linfluence des moines indiens venus Nankin par voie de mer, il se
convertit au bouddhisme. Il manifesta dabord son respect pour les doctrines
bouddhiques de non-violence (ahims) en interdisant dimmoler des
animaux dans les sacrifices aux anctres, interdiction qui ne manqua pas
dattirer le blme des lettrs. En 527 il alla plus loin : il fit profession de foi
monastique et ltat dut racheter son souverain au clerg. Sa pit bouddhique
parat du reste avoir t fort claire et sincre, mais il faut bien concder aux
lettrs, devenus dsormais ses censeurs impitoyables, que le bonze en lui finit
par faire disparatre lhomme dtat. Dans sa misricorde bouddhique, il ne
pouvait se rsoudre, mme en cas de complot, ordonner une excution
capitale. Tomb dans une dvotion quelque peu snile, il finit par se laisser
jouer par un gnral rvolt qui vint limproviste lassiger dans Nankin. Il
mourut quatre-vingt-six ans dans cet croulement de sa maison, et de ses
illusions. La dynastie leang, affaiblie par ses fautes, ne lui survcut que peu
dannes, et celle des Tchen qui rgna ensuite (557 -589) neut pas le temps
de donner sa mesure : en 589 les souverains de la Chine du Nord prirent
Nankin et abolirent le Bas-Empire chinois .
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
76
En ralit, pendant la priode que nous venons de rsumer, lexistence de
celui-ci navait t quune longue dcadence. Cest dans le nord que se faisait
lhistoire et cest cette histoire de la Chine sino -turque du Nord quil nous
reste maintenant examiner.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
77
CHAPITRE 15
Une autre sculpture romane : lart Wei
Nous avons vu, pendant tout le cours du IVe sicle, les hordes
turco-mongoles se succdant et sentre -dtruisant dans la Chine du Nord en un
incessant croulement de royauts phmres. De ce chaos sortit enfin une
domination durable, celle dun peuple aussi intressant pour lhistoire de la
civilisation que pour lhis toire de lart, le peuple tabghatch.
Les Tabghatch (To -pa en transcription chinoise) taient une tribu turque
tablie depuis le commencement des grandes invasions dans la partie la plus
septentrionale de la province de Chan-si. Entre 396 et 439 ils dtruisirent ou
absorbrent toutes les autres hordes installes dans la Chine du Nord et
runirent ce pays sous leur domination. Ainsi les Francs survivant aux Burgondes, aux Wisigoths, aux Lombards et sur leurs ruines fondant lempire
carolingien. Et de mme encore que les Francs surent concilier en eux le
germanisme et la latinit, les Tabghatch surent longtemps conserver intacte la
force turque tout en faisant progressivement sa part la tradition chinoise. Ils
eurent du reste aux yeux des Chinois le mrite de dfendre la Chine du Nord
contre de nouveaux envahisseurs ventuels, en lespce contre la horde
mongole des Avar alors matresse du Gobi. Pendant tout le Ve sicle ils
allrent, en une suite dexpditions prventives et de contre -rezzous
foudroyants, relancer ces nomades en pleine Mongolie.
Le roi tabghatch To -pa Tao qui fonda dfinitivement la grandeur de sa
maison (424-452) passa sa vie mener cette double lutte : au nord, campagnes
dans le Gobi pour mettre la terre chinoise labri de nouvelles invasions de
nomades ; au midi pression incessante au dtriment du bas-empire chinois de
Nankin. Dans un curieux discours que les annalistes nous ont transmis, il
voquait lui-mme ce sujet sa double supriorit de demi-Chinois par
rapport aux Barbares et de demi-Barbare par rapport aux Chinois : Les
Chinois (cest --dire les gens du bas-empire, Nankin) sont fantassins et nous
sommes cavaliers : que peut un troupeau de poulains et de gnisses contre un
tigre ou contre une bande de loups ? Quant aux nomades (les Avar), en t ils
font patre leurs troupeaux au nord du Gobi, puis en hiver ils viennent razzier
sur nos frontires. Mais il suffit daller les atta quer dans leurs steppes au
printemps. A ce moment leurs chevaux ne sont bons rien, les talons sont
occups des cavales et les juments des poulains. Il ny a qu les surprendre en
cette saison, leur couper laccs des herbages et des points deau et en
quelques jours on les a merci ! a Ainsi fit-il en 425 : cinq colonnes de
cavalerie lgre traversrent le Gobi du sud au nord ; aucun convoi ne
retardait la chevauche, chaque cavalier portant pour quinze jours de vivres.
Les Avar, entirement surpris, furent rejets de la steppe mongole dans les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
78
montagnes du Bakal ou de lOrkhon. Nouveau raid en 429, conduit par
To -pa Tao en personne. De nouveau surpris et bousculs, les nomades durent
livrer par centaines de mille leurs chevaux et leurs chariots, leurs bufs et
leurs moutons. Rappelons que ce sont les derniers descendants de ces mmes
Avar que prs de quatre sicles plus tard un autre dfenseur de la civilisation,
notre Charlemagne, devait exterminer en Hongrie.
Comme Charlemagne harmonisant la culture germanique et la culture
latine, To -pa Tao travailla harmoniser les croyances turques de sa race et
les donnes de la pense chinoise. Le Tngri, le dieu-Ciel des tribus altaques,
se ramenait assez facilement au Tien, au Ciel que le confucisme plaait au
sommet de sa thologie. Les Altaques avaient galement une desse-Terre,
des divinits des sources et des sommets qui pouvaient assez vite concorder
avec les dits du naturisme chinois. Ainsi les Romains assimilant leurs
dieux les dieux des nations voisines. Mais To -pa Tao poussa plus loin que ses
prdcesseurs en abandonnant ceux des cultes altaques qui ne russissaient
pas cadrer avec les cultes confucens . Toutefois, sil travailla ain si une
large sinisation de son peuple, il ne permit pas celui-ci de perdre ses vertus
guerrires. Ce fut ainsi quil refusa dabandonner les campements de ses
aeux, lextrme frontire du Chan -si, lore de la steppe, pour les capitales
historiques de la Chine, Lo-yang et Tchang -ngan, conquises par ses armes. Il
maintint aussi la barbare et prudente coutume ancestrale qui voulait quavant
lavnement dun nouveau roi tabghatch la mre de celui -ci ft mise mort
afin dviter les rancunes et les ambitions de la future douairire ou de son
clan. Enfin, la diffrence de tant dautres chefs barbares, il redouta
linfluence amollissante du bouddhisme et lextension du clibat monastique.
En 438 il promulgua contre les moines bouddhistes un dit de lacisation
renforc en 444 et 446 par de vritables mesures de perscution. La malice des
annalistes confucens veut que ldit de 446 ait t d la dcouverte dalcool
et de femmes dans un des monastres les plus rputs. Mais le grief majeur
dont les lettrs poursuivaient la grande religion indienne tait plus grave : le
monachisme bouddhique supprimait la famille , teignait par contre-coup
le culte des anctres et, de surcrot (largument devait porter prs dun soldat
comme To -pa Tao), permettait desquiver le service militaire.
La perscution cessa aprs la mort de To -pa Tao, avec lavne ment de
son petit-fils To -pa Tsouen (ou To -pa Siun) en 452. To -pa Hong qui rgna
ensuite sur les Tabghatch (466-471) savra franchement bouddhiste. En 4 71
il abdiqua en faveur de son fils un enfant de cinq ans et se fit moine. Il
se retira dans une pagode construite dans le parc royal et y vcut en communaut avec des bonzes contemplatifs, refusant dapprendre autre chose que
les vnements dune g ravit exceptionnelle. Le jeune roi, son fils que
les histoires occidentales connaissent sous le nom de To -pa Hong II
(471-499) montra une non moindre sympathie pour la grande religion
indienne. Ce fut sous cette influence quil humanisa la rude lg islation des
vieux Tabghatch. Les mutilations furent remplaces comme peine par
lemprison nement. La charit bouddhique envers toutes les cratures fit mme
supprimer ou considrablement rduire en nombre les victimes animales
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
79
immoles dans les sacrifices au Ciel, la Terre, aux Anctres ou aux gnies.
Le mme roi acheva la sinisation de son peuple en portant en 494 sa capitale
de Ping -tcheng (dans lextrme nord du Chan -si) Lo-yang, la vieille
capitale historique du Ho-nan, et en imposant aux officiers tabghatch lusage
de la langue et du costume chinois la place de leur dialecte et de leurs
vtements nationaux, cest --dire turcs.
De 515 528 le royaume tabghatch fut gouvern par la reine douairire
Hou. Cette hritire des vieux chefs barbares est le dernier grand roi de la
dynastie. Femme dune nergie sans scrupules, elle ne recula, pour garder le
pouvoir, devant aucun crime. Redoutant une ancienne rivale quelle avait
oblige entrer au couvent, elle ly fit assassiner. Elle faisait excu ter de
mme ceux de ses amants qui avaient cess de lui plaire. En 528 son fils
commenant se lasser de subir la tutelle de ces favoris, elle lempoisonna,
mais les officiers indigns se rvoltrent. Se sentant perdue, la terrible reine
coupa sa chevelure et courut prononcer ses vux dans une bonzerie. Les
insurgs len tirrent et la prci pitrent dans le Fleuve Jaune. En dpit de ses
crimes, Hou, comme les rois ses prdcesseurs, stait montre les poques
barbares ont de ces contradictions et le c ur humain a de ces paradoxes
une bouddhiste fort dvote ... Les clbres cryptes bouddhiques de Long-men
lui doivent une partie de leurs amnagements et ce fut elle qui envoya en
mission dans lInde le plerin Song Yun (518 -521).
Les sicles de fer sont souvent des sicles de foi. Cest aux Tabghatch,
aux Wei, comme les dnomme leur appellation dynastique chinoise, quest
due la plus grande sculpture religieuse quait possde la Chine, celle des
grottes bouddhiques de Yun-kang, dans le nord du Chan-si (452-515), et de
Long-men, prs de Lo-yang, au Ho-nan (depuis 494).
On la dit, il sagit ici, avec six et huit sicles davance, de lquivalent
extrme-oriental de notre sculpture romane et gothique. Le point de dpart,
grco-bouddhique en Chine, gallo-romain chez nous, est dailleurs analogue.
Et de mme que les imagiers romans ou gothiques devaient adapter les
traditions de la plastique grco-romaine des fins purement spirituelles, lart
wei ne veut se rappeler la science gandhrienne de la draperie et
lappollonisme des visages quafin de mieux rendre la pure spiritualit
bouddhique. Celle-ci commande tout. La plastique, quand elle subsiste, la
draperie, quand elle na pas t schmatise en grandes cassures anguleuses
ou en petites ondes arrondies, le charme humain des visages quand ils ne sont
pas entirement macis, tout cela nest quen fonction de la pense
mtaphysique. Rien ne subsiste ici qui ne soit religiosit, ferveur, foi sans
alliage. Tel bodhisattva de Yung-kang nest plus que la M ditation. Tel autre
bouddha du mme sanctuaire, au sourire suraigu comme celui dun ange de
Reims, ne traduit plus que le dtachement des choses prissables avec,
peut-tre sans lavoir cherch, une secrte ironie, une ironie dailleurs pleine
dindulgence devant le spectacle de luniverselle vanit et de la folie
universelle. Mais le plus souvent cette ironie transcendante parat sapaiser
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
80
pour ne plus laisser transparatre, avec la plnitude du recueillement, que lim mense paix de la Dlivrance.
Il nes t pas impossible de tracer la courbe dvolution de lart de
Yun-kang. A lorigine, linfluence grco -bouddhique, venue de lAfghanistan
avec les missionnaires gandhriens si nombreux la cour des rois tabghatch.
Cest ainsi que les statues colossales de bouddhas qui dominent lensemble
des grottes rappellent par leur facture sommaire les bouddhas gants de
Bmiyn, en Afghanistan. Plus remarquable est la manire dont se dgagent
des leons de la plastique gandhrienne les statues de moindre dimension qui
peuplent les niches de la falaise. Ces figures minces, allonges, souvent
anguleuses, avec une draperie aux plis nerveux, mais qui conservent une
simplicit apaisante et une grce juvnile, nous apportent ce que la sculpture
purement formelle du Gandhra navait pu nous donner : un art de pure
spiritualit. Les formes, crit en ce sens Hackin, empreintes dune aimable
gravit, tmoignent dune adaptation rapide de lart aux exigences de la foi ;
elles expriment une haute qualit de vie spirituelle ; discrtement leur
apparence plastique sest attnue et cesse de solliciter lat tention, et le
sourire, si tendrement humain, reste la seule concession faite au monde par le
Bienheureux. Il y a l une harmonie qui dailleurs na pas t atteinte du
premier coup. Daprs Sirn, lvolution de la sculpture de Yun -kang irait de
la scheresse la plus mystique une rhabilitation relative des formes : En
atteignant sa maturit, lart de Yun -kang semble se dpartir quelque peu de sa
stylisation archaque. Les formes acquirent plus de rondeur et de plnitude,
les plis du manteau deviennent moins raides, larabesque des lignes a plus de
souplesse ; nanmoins les personnages gardent un aspect relativement svre,
je ne sais quel air dintrospection et de dtachement qui les classe un rang
lev dans la sculpture religieuse.
On peut admirer Paris, au rez-de-chausse du muse Cernuschi, un des
plus beaux bodhisattva de Yun-kang quil nous soit donn de connatre.
La sculpture des grottes de Long-men continue celle de Yun-kang.
Souvent mme, comme dans plusieurs niches dates, par exemple, de 509 et
de 523, le mysticisme et la stylisation lem portent encore. Ces figures
allonges, rigides, limmobile sou rire, la draperie durement casse en
grands plis secs ou purilement apaise en petites ondes restent aux antipodes
de toute proccupation plastique. Sous limmense nimbe en pointe qui les
entoure de sa haute flamme, ce ne sont plus des tres matriels, cest la
stylisation du manteau monastique. Ce hiratisme mme confre aux
bodhisattva de Long-men jentends ceux du VI e sicle, de lpoque
proprement Wei un caractre de mysticisme saisissant. Il est permis ici
dvoquer lart roman condition toutefois de sentendre sur cette
comparaison dont lintrt rside surtout dans un point de vue de
philosophie compare , pour le recoupement et la confrontation des
valeurs humaines. Si, travers lespace et le temps, lart wei et lart roman
sapparentent, cest que tous deux drivent du canon classique, mais du canon
classique dbarrass de ses poncifs, rnov par un grand lan mystique et
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
81
appel dsormais rptons-le traduire, au lieu de la beaut des corps,
des valeurs purement spirituelles. Il y a de lart grco -bouddhique lart de
Yun-kang et de Long-men la mme distance que de lart romain lart de nos
cathdrales.
Les poques sont rares qui ont atteint au grand art religieux. Lpoque wei
est de celles-l.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
82
CHAPITRE 16
Yang-ti, fils du ciel
Les Tabghatch taient maintenant trop profondment siniss, trop
compltement fondus dans la masse chinoise pour ne pas tomber en
dcadence. En 534 leur dynastie se divisa en deux branches qui se partagrent
la Chine du Nord, puis chacune de ces deux maisons fut remplace par ses
maires du palais respectifs. En 581 les deux royaumes furent runis par un
ministre nergique, Yang Kien, qui fonda une nouvelle dynastie, la dynastie
Souei. En 589 Yang Kien complta son uvre en faisant la conqute du
bas-empire de Nankin, cest --dire de toute la Chine mridionale. Aprs un
morcellement de deux cent soixante et onze ans (318-589) la Chine recouvrait
enfin son unit. Lantique mtropole des Han, Tchang -ngan (notre Singan-fou, au Chen-si) redevint capitale.
Yang Kien, le nouvel empereur pan-chinois , apportait sur le trne de
solides qualits. Assez peu lettr, ctait un administra teur ponctuel,
examinant tout par lui-mme. Mfiant et conome, il poursuivit svrement
les fonctionnaires prvaricateurs. Par des moyens parfois peu sympathiques, il
ramena un ordre strict dans la socit et dans ltat. A lextrieur il recueillit
le bnfice du regroupement chinois.
Depuis le milieu du VIe sicle, un grand vnement stait pro duit en
haute Asie : la fondation de lempire turc. Cest en ef fet vers cette poque que
les Turcs nous apparaissent pour la premire fois (du moins sous leur nom
historique puisque nous avons eu dj loccasion de signaler plusieurs peuples
vraisemblablement de mme race comme les anciens Huns et, plus
rcemment, les Tabghatch eux-mmes). Ce nom de Turcs qui, en langue
turque, signifie les forts , dsigne sans doute une tribu dorigine hun nique
originaire des monts Khangha, en haute Mongolie. Pendant la premire
moiti du VIe sicle de notre re ces Turcs taient encore subordonns aux
Avar, horde mongole matresse, on la vu, du Gobi et de la haute Mongolie.
En 552 les Turcs se rvoltrent contre les Avar, les crasrent et les chassrent
de la Mongolie. Une partie des vaincus senfuirent jusquen Europe o il s
allrent fonder en Hongrie un khanat qui terrorisa Byzance et qui, deux sicles
et demi aprs, fut dtruit par Charlemagne.
Les Turcs devinrent ainsi matres de toute la Mongolie o leurs chefs qui
portaient le titre de qaghan, cest --dire de grands-khans, eurent leur rsidence
dans la rgion du haut Orkhon, prs de lac tuel Qaraqoroum. En 565 les Turcs
doublrent leurs possessions en enlevant la horde mongole des Hephthalites
le Turkestan occidental ou Turkestan russe actuel (Tachkent, Boukhara,
Samarqand). Ils contrlrent alors toute la haute Asie, depuis la Grande
Muraille de Chine jusquaux frontires de la Perse. Linscription turque de
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
83
Kocho-Tsadam, de 732, en Mongolie, chante en un magnifique pome ces
immenses conqutes : Quand le ciel bleu en haut et la sombre terre en bas
furent crs, entre les deux furent crs les fils des hommes. Au-dessus des
fils des hommes slevrent les qaghan mes anctres. Aprs tre devenus
matres, ils gouvernrent lempire et les institutions du peuple turc. Aux
quatre coins du monde ils avaient beaucoup dennemis, mais, fai sant des
expditions avec des armes, ils asservirent et pacifirent beaucoup de peuples
aux quatre coins du monde. Ils leur firent baisser la tte et ployer le genou. Ils
nous firent nous tablir depuis les monts Kinghan lest jusquaux portes de
fer louest. Si loin entre ces deux points extrmes stendaient en souverains
les Turcs Bleus ! Il est vrai que presque aussitt cet immense empire se
divisa entre deux branches de la famille royale turque : dune part le khanat
des Turcs orientaux qui conserva son sige sur lOrkhon et possda la
Mongolie, dautre part le khanat des Turcs occidentaux qui eut son sige
autour du lac Issyq-koul et qui possda le Turkestan occidental. Le premier
guerroya contre la Chine, le second contre la Perse sassanide.
La diplomatie de lempereur Yang Kien, ds quil eut restaur ;1 son profit
lunit chinoise, sattacha attiser les discordes entre Turcs occidentaux et
Turcs orientaux. A sa mort, en 604, les Turcs, paralyss par leurs guerres
civiles, laissaient la Chine rtablir sa suprmatie diplomatique en Asie
centrale.
Le fils de Yang Kien, lempereur Yang -ti, fut un grand souverain ou plutt
son rgne fut un grand rgne (605-616). Lhomme en effet tait ingal,
fantasque, partag entre priodes dactivit dvorante et priodes de
dcouragement et dinertie. Tel, avec tous ses dfauts et ses vices, il eut un vif
sentiment de la grandeur impriale retrouve, une conscience trs haute de la
mission dominatrice de la Chine en Asie.
Nul plus que lui naima le luxe et le faste. A la capitale de son pre,
Tchang -ngan, il en ajouta une autre, Lo-yang. Il en embellit les environs
dun parc de 120 kilomtres de tour avec un lac artificiel de 9 kilomtres,
duquel mergeaient les trois les des Immortels, couvertes de pavillons
magnifiques. Le long dune voie deau qui dbouchait dans le lac il fit btir
seize villas pour ses favorites. On y abordait en barque. Tout le raffinement de
luxe de lpoque se dplo yait dans ces demeures et dans les jardins qui les
entouraient. En automne, quand tombaient les feuilles des rables, on
garnissait arbres et arbustes de feuilles et de fleurs en toffes chatoyantes. Le
lac tait aussi orn non seulement de lotus, mais de fleurs de lotus artificielles
quon renouvelait sans cesse. Le plaisir de lempereur tait de naviguer sur le
lac ou de courir le parc cheval, durant les nuits de clair de lune, avec une
bande de jolies filles qui faisaient des vers et chantaient des chansons. Mais
ct de ces amnagements de magnificence, Yang-ti fit procder de grands
travaux dutilit publique. Ce fut ainsi quil fit creuser un premier canal
imprial entre Lo-yang (Ho-nan-fou) et lembouchure du Yang -tseu.
A lextrieur, Yan g-ti continua la politique paternelle en attisant les
discordes entre les chefs turcs, ce qui lui permit de jouer le rle darbitre entre
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
84
leurs divers khanats. Le prestige chinois tait si bien restaur quen 608
lempereur fit la frontire du Kan -sou une tourne triomphale au cours de
laquelle il reut lhommage de plusieurs oasis de louest, notamment des gens
de Tourfan. Yang-ti fut moins heureux du ct de la Core. Il dirigea contre ce
pays trois grandes expditions, en 612, 613 et 614. Toutes trois chourent. La
retraite de larme impriale tourna au dsastre. Pour rtablir le prestige
chinois, notamment envers les Turcs, Yang-ti fit une tourne dinspection le
long de la Grande Muraille, sur la lisire du Gobi. Il y fut surpris par une
attaque des Turcs qui le tinrent un mois assig dans une place-frontire et ne
schappa quavec peine (615).
Yang-ti avait fatigu le peuple par sa fiscalit, ses constructions, les excs
de la corve. Ds 616 la rvolte tait gnrale. Le Xerxs chinois, comme on
la appel propos du dsastre de Core, finit comme le Sardanapale de la
lgende. En cette mme anne 616, il se retira sur le bas Yang-tseu,
Kiang-tou, lactuel Yang -tcheou, o il chercha oublier la catastrophe dans
une vie de plaisirs. En avril 618 ses gardes du corps firent irruption dans le
palais, massacrrent sous ses yeux son fils prfr, le sang rejaillit jusque
sur le manteau imprial, puis un des leurs trangla linfortun monarque. Il
navait que cinquante ans.
Lhistoire est svre p our les deux empereurs Souei. Elle oublie quils ont
restaur lunit de la Chine et commenc la restauration de lhgmonie
chinoise en Asie centrale. En ralit ils ont t clipss par leurs successeurs,
les empereurs Tang. Ceux -ci allaient en effet mener bien luvre entreprise
par Yang Kien et Yang-ti et refaire de la Chine larbitre de lAsie orientale.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
85
CHAPITRE 17
Tai -tsong le Grand
La chute de la dynastie souei semblait devoir prcipiter la Chine dans une
nouvelle priode de morcellement et danarchie. Dans chaque province
surgissaient des chefs militaires qui se disputaient le pays. Ce fut alors
quapparut le guerrier de gnie qui de ses puissantes mains allait restaurer
lempire et imposer pour trois sicles un cours nouveau lhist oire et la
civilisation chinoises.
Il sappelait Li Che -min. Son pre Li Yuan, comte de Tang et gouverneur
dune circonscription militaire au Chan -si, tait un gentilhomme de bonne
race, un gnral estim, un fonctionnaire honnte autant que pouvait l tre un
personnage de son importance, un esprit timor craignant toujours de se
compromettre et conservant assez de loyalisme pour ne rompre un serment
qu la dernire extrmit. Du reste, tout plein de sagesse confucenne et de
doctes maximes. Li Che-min aussi, malgr sa jeunesse (il tait n en 597 et
avait donc un peu plus de vingt ans), avait t nourri de rminiscences
historiques et de belles sentences. Mais lhabitude de la vie des camps car
le fief de son pre tait une sorte de marche en alerte perptuelle devant les
razzias turques, lhabitude aussi de la vie de cour, cette cour des Souei
la plus magnifique, la plus corrompue et la plus fantasque quon ait vue en
Extrme-Orient, avaient appris au jeune homme se servir de la sagesse
confucenne plutt qu se laisser asservir par elle. Quoi quil fasse par la
suite (et nous verrons sur sa conduite de singulires ombres), il saura toujours
avoir la morale de son ct. Avec cela une vitalit prodigieuse, une sret
presque infaillible de dcision, la ruse et la bravoure, laudace et le bon sens
squilibrant parfaitement en lui et, de ce fait, lhomme complet pour un
Chinois de son temps.
Lempire, on la vu, tait en pleine anarchie militaire. Lem pereur Yang-ti,
retir Yang-tcheou, vers lestuaire du fleuve Bleu, y menait une vie
dabdication et de dbauches tandis que ses gnraux se disputaient les
provinces. Le jeune Li Che-min, assur dune solide clientle militaire dans
ses domaines du Chan-si, fort de relations damiti personnell e avec plusieurs
khans turcs, ayant en outre nou de prcieuses intrigues avec divers
fonctionnaires du palais, rongeait son frein devant le loyalisme anachronique
de son pre. Pour forcer la main ce dernier, il eut recours un procd bien
chinois. Il avait li partie avec un eunuque du palais imprial. A linstigation
de Li Che-min leunuque offrit Li Yuan une fille destine au souverain. La
jeune recluse devait tre jolie car, sans rflchir, le digne Li Yuan accepta le
dangereux cadeau. Aprs quoi Li Che-min fit remarquer son pre que leur
famille venait de se mettre au ban de lempire, lenlvement dune fille du
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
86
palais tant, en droit, puni de mort. Li Yuan en fut atterr, mais quy faire ? Il
tait trop tard pour reculer. Il convoqua ses fidles et mobilisa les troupes de
son gouvernement Tai -yuan, sa rsidence, capitale de lactuel Chan -si, non
sans calmer ses propres scrupules en annonant quil ne prenait les armes que
par loyalisme, pour dlivrer lempereur des autres prtendants.
Ctait tout ce que demandait Li Che-min. Comme il avait su se mnager
des complicits jusque dans le harem imprial, il stait par sa rondeur
militaire concili la sympathie des Turcs et ces dangereux voisins avaient mis
sa disposition cinq cents mercenaires dlite et deux mille chevaux. En
mme temps sa sur, une jeune hrone qui monte cheval aussi bien que lui,
vend ses bijoux et avec largent ralis enrle dix mille hommes quelle lui
amne. Li Che-min dispose bientt de soixante mille soldats prouvs dont il
partage les fatigues, quil sait fanatiser par son exemple et qui lui seront
dvous jusqu la mort. Pendant plus de quatre ans (618 -622) il va, province
par province, arme par arme, ordonner le chaos chinois.
Tout dabord les scrupules de son pre sont apaiss par les circonstances.
L-bas, sur le Yang-tseu, les prtoriens, profitant du dsordre gnral, ont
assassin Yang-ti, lempereur lgitime. Sur quoi le comte de Tang se dclare
le vengeur de la dynastie et assume ce titre, au nom du n dernier Souei, la
lieutenance gnrale de lempire, en attendant, quelques mois plus tard,
linsti gation de Li Che-min, de dposer ce souverain fantme et de se
proclamer lui-mme empereur (618).
La capitale impriale, Tchang -ngan, notre Si-ngan-fou, qui dans lhistoire
chinoise joue un peu le mme rle que Rome dans lhistoire dOccident, avait
la premire ouvert ses portes (618). Les Tang ntaient -ils pas originaires de
cette province du Chen-si o, depuis le premier Csar chinois, se sont toujours
leves les grandes dynasties ? Puis Li Che-min vint assiger la seconde
capitale, Lo-yang, notre Ho-nan-fou, o commandait un des plus redoutables
rivaux de son pre. Entreprise difficile, car la ville tait particulirement forte
et les autres prtendants que le succs des Tang commenait inquiter,
nallaient pas manquer de la secourir. Le jeune hros emmenait avec lui un de
ses adversaires de la veille, Yu-tche King-te, quil avait gagn sa cause aprs
lavoir fait prisonnier et auquel, malgr le s conseils de mfiance des siens, il
avait, avec sa gnrosit coutumire, donn un commandement.
En arrivant en vue de la place, Li Che-min alla en reconnatre les abords
avec un parti de huit cents cavaliers, mais la garnison laperut, fit une sortie
et enveloppa la petite troupe. Comme, le sabre la main, il tchait de souvrir
un passage, un officier ennemi le reconnut et fona sur lui, la pique basse. Le
futur empereur allait payer sa tmrit de sa vie lorsque King-te, qui ne le perdait pas de vue, abattit lassaillant. A ce moment les bataillons tang entrrent
en ligne et tirrent leur chef de ce mauvais pas. Cependant une arme
ennemie, commande par un des prtendants, descendait du Ho-pei pour
dgager Lo-yang. Tandis quelle nest encore qu quelques milles de la place,
Li Che-min, prenant avec lui llite de sa cavalerie, part au petit jour, galope
jusquau camp ennemi, y pntre par surprise et sabre tout jusqu la tente du
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
87
gnral qui, au milieu du dsordre des siens, est bless dun coup de pique et
captur. Quelques jours plus tard Lo-yang capitulait.
Li Che-min revint triompher Tchang -ngan (621). Les annalistes chinois
nous peignent avec une couleur qui sort de leurs habitudes ce retour du jeune
vainqueur. Ils nous le montrent traversant lentement les rues de la capitale sur
un coursier richement harnach, revtu de sa cotte darmes et dune cuirasse
dor, ayant le casque en tte, larc en charpe, le carquois garni de flches sur
lpaule et le sabre la main. Les prtendants vai ncus marchaient des deux
cts de son cheval, prs de ltrier. Et cette description de lHistoire des
Tang prend nos yeux un relief extraordinaire depuis que les rcentes
dcouvertes archologiques nous permettent de lvoquer directement. Nous
connaissons par les terres cuites funraires toute cette cavalerie tang piaffante
et caracolante. Nous connaissons mme, avec leur portrait, leur nom et leurs
tats de service, les montures prfres de Li Che-min, ces robustes chevaux
crinire tresse quil a fait sculpter en relief Li-tsiuan -hien sur les dalles de
sa tombe. Dtail plus prcis encore : le coursier qui participa au triomphe
Tchang -ngan fut sans doute Rose dautomne qui est clbr comme le
bon compagnon du matre lors de la conqute du Ho-nan. Quant larmure du
conqurant, nous en voyons chaque jour la rplique exacte sur les robustes
paules des guerriers ou des lokapla dans les portraits funraires ou les
statues bouddhiques de nos collections.
Lunit chinoise se trouvait refa ite. Il ntait que temps. Les Turcs
arrivaient.
Lanarchie militaire au sein de laquelle se dbattait la Chine avait paru aux
Turcs une occasion excellente pour intervenir. Le khan des Turcs orientaux,
El-qaghan, et son neveu Toloui avaient pris la tte dune grande chevauche
qui balaya les postes-frontires et pntra jusquaux faubourgs de la capitale
impriale, Tchang -ngan. Le vieux Li Yuan saffolait, parlait dvacuer la
capitale. Li Che-min le laissa dire et se porta en avant avec cent cavaliers
dlite pour relever le dfi des Turcs. Payant daudace, il les aborde, pntre
dans leurs rangs et se met les haranguer : La dynastie des Tang ne doit
rien aux Turcs. Pourquoi envahissez-vous nos tats ? Me voici prt me
mesurer avec votre khan ! En mme temps il faisait personnellement appel
certains chefs comme Toloui avec lesquels le liait une ancienne camaraderie
militaire, et rveillait chez eux le sentiment de la fraternit darmes. Une si
ferme contenance, jointe une telle connaissance de lme turque, intimida
ces esprits mobiles de barbares. Les chefs de hordes se concertrent quelque
temps, puis tournrent bride. Quelques heures aprs, une pluie diluvienne
sabattait sur la rgion. Aussitt Li Che -min assembla ses capitaines :
Camarades, lui fait dire son biographe, cest le moment de donner nos
preuves. Toute la plaine nest plus quune mer. La nuit va tomber et sera des
plus obscures. Il faut marcher : les Turcs ne sont craindre que quand ils
peuvent tirer des flches. Courons eux, le sabre et la pique la main, nous
les enfoncerons avant quils se soient mis en tat de dfense ! Ainsi fut fait.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
88
Au petit jour le camp turc fut enlev et la cavalerie chinoise sabra jusqu la
tente du khan. Celui-ci demanda traiter et se retira en Mongolie (624).
Le jeune hros saffirmait de plus en plus comme le soutien de lempire.
Ses deux frres, jaloux de sa gloire, rsolurent de se dfaire de lui. Son pre
lui-mme, qui lui devait le trne, prit insensiblement ombrage de sa popularit
et lcarta des affaires. Alors commena un de ces drames sauvages dont la
Cit Interdite offre daussi frquents exemples que le Palais Sacr de
Constantinople : ne croirait-on pas lire une page de l Epope byzantine quand
on suit dans l Histoire des T ang le rcit de ces tragiques journes ? Dans un
banquet quils lui offrent pour fter ses vic toires, les frres de Li Che-min le
font empoisonner. Il prend du contre-poison. Alors ils lattendent avec des
spadassins prs dune porte du palais. Mais un tr atre lavertit, toute cette
histoire est belle de trahisons autant que de sang et de dclamations vertueuses, et Li Che-min prend les devants. Prvenant les desseins de
ladversaire, ses fidles apostent des retres aux endroits conve nables. A
lheu re o le guet-apens contre lui se prpare, il marche lennemi, le mme
dans cette guerre dassassinats que sur le champ de bataille. Il endossa sa
cuirasse, mit son casque, prit son carquois et ses flches et sortit pour se
rendre au palais. Daussi loin que ses deux frres laperurent, il lui
dcochrent une vole de flches. Mais ils le manqurent, tandis que Li Chemin sa premire flche abattit lun deux. Le second fut tu par le lieutenant
de Li Che-min. A ce moment les soldats placs en embuscade par ce dernier
parurent et, dit lHistoire des Tang, personne nosa plus remuer .
Cependant, continue lannaliste, comme les serviteurs du palais et la populace
elle-mme commenaient sattrouper, Li Che -min ta son casque, se fit
connatre et devant les cadavres sanglants de ses deux frres harangua la
foule : Mes enfants, ne craignez pas pour moi. Ceux qui voulaient
massassiner sont morts ! Alors un des fidles de Li Che-min, King-te,
coupa la tte des deux princes et la montra au peuple.
Restait annoncer lexcution lempereur dont la partialit en faveur des
deux victimes avait toujours t vidente. Li Che-min en chargea King-te.
Celui-ci, au mpris des rgles les plus sacres de ltiquette, pntra tout arm
dans lappartement d e lempereur, les mains peut -tre encore rouges du sang
des princes. A travers le rcit officiel des annales on entrevoit ce qui dut se
passer, belle scne dhypocrisie confucenne o les meurtriers, tout chauds du
combat, se mettent dbiter des maximes morales et nont quun souci :
rentrer dans la lgalit en sauvant la face.
En apprenant la nouvelle, le vieil empereur navait pu rprimer sa colre et
ses sanglots. Son premier mouvement fut pour exiger une enqute svre. Il ne
comprenait pas encore qu il ntait plus le matre. Discrtement un de ses
courtisans le rappela la ralit. Il ny a plus denqute faire ... De quelque
manire que la chose se soit passe, vos deux fils morts sont coupables et Li
Che-min est innocent. Paroles dignes de Tacite et qui compltent laccent de
ce drame nronien. Du reste, les mmes courtisans dcouvraient maintenant
des crimes monstrueux la charge des victimes : les deux princes massacrs
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
89
navaient -ils pas nou des intrigues avec plusieurs des femmes de leur pre ?
Ctait plus quil nen fallait pour lgitimer leur excution !
Li Che-min se faisait annoncer. Quand le fratricide se prsenta en donnant
dailleurs toutes les marques de la plus mou vante pit filiale, le vieux
monarque lembrassa en pleurant et le flicita mme davoir sauv leur
famille. Ce fut une scne attendrissante. Lempereur, crit
imperturbablement lannaliste officiel, avait toujours hsit entre ses fils. La
mort des deux ans mit fin ses perplexits, et son ancienne affection pour Li
Che-min reprit tous ses droits dans son cur. Ds quil le vit ses pieds dans
la posture du criminel qui semble demander grce, il ne put retenir ses larmes.
Il le releva, lembrassa et lassura que, loin de le croire coupable, il tait
persuad que Li Che-min navait agi quen tat de lgitime dfense. Cela
dit, lempereur abdiqua, comme on sy attendait, en faveur de son fils, non
sans de nouvelles scnes difiantes : conformment ltiquette Li Che -min
refuse le trne ; en vain lassembl e des grands, lunanimit, se
prononce-t-elle en faveur du matre de lheure ; il refuse encore et, se jetant
aux genoux de son pre, le supplie avec larmes de garder le pouvoir jusqu sa
mort . Mais le vieillard ordonne et Li Che-min, en fidle sujet, doit obir. Il
se laisse donc forcer la main et monte enfin sur le trne. Ctait le 4 sep tembre
626. Pour teindre toute vendetta et achever de pacifier lempire, le nouveau
monarque fit mourir sans tarder ses belles-surs et tous ses neveux. Quant
lancien empereur, il se retira dans un de ses palais o, nous affirme -t-on, il
vcut dans la jouissance de tous les honneurs et des plaisirs tranquilles, sans
que son fils lui donnt jamais la moindre occasion de regretter la dmarche
quil avait fai te en abdiquant .
Cependant ce drame de palais avait rendu lespoir aux Turcs. A peine le
nouvel empereur tait-il sur le trne que cent mille cavaliers turcs, sortis de la
haute Mongolie, traversrent le Gobi et coururent jusqu Tchang -ngan. Le
23 septembre 626 leurs escadrons apparurent devant le pont de Pien, face la
porte nord de la ville. Les courtisans, cette fois encore, suppliaient le jeune
souverain dabandonner une capitale aussi expose. Mais Li Che -min que
nous appellerons dsormais, de son nom canonique, lempereur Tai -tsong
ntait pas homme se laisser intimider. Insolemment le khan turc, El -qaghan,
avait envoy un des siens rclamer le tribut, faute de quoi un million de
nomades viendraient saccager la capitale. Tai -tsong rpondit en menaant de
faire trancher la tte de lambassadeur. Il payait daudace, car il semble
navoir eu ce moment Tchang -ngan quassez peu de troupes. Pour donner
le change, il ordonna de les faire sortir par diverses portes et de les dployer
au pied des murailles, tandis que lui-mme avec une poigne de cavaliers
prendrait les devants et irait son habitude reconnatre larme ennemie.
Malgr les reprsentations de ses compagnons il savana ainsi le long du
cours de la Wei, face aux escadrons turcs, la merci de la premire flche.
Cest quil pntrait mieux que les siens la psychologie des nomades. Les
Turcs me connaissent, lui fait dire son biographe. Ils ont appris me craindre.
Ma vue seule leur inspirera de la terreur et, en voyant dfiler mes troupes, ils
les croiront bien plus nombreuses quelles ne sont en ralit. Il continua
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
90
donc chevaucher vers lennemi avec la mme confiance que sil ft all
visiter son camp. A sa vue les Turcs, frapps de cet air de grandeur et
dintrpidi t qui tait rpandu sur toute sa personne, descendirent de cheval et
le salurent la manire de leur pays . Au mme moment larme chinoise se
dployait derrire lui dans la plaine, faisant briller au soleil ses armures et ses
tendards. Tai -tsong sa vana encore vers le camp des Turcs, puis, tenant son
cheval par la bride, il fit signe larme chinoise de reculer et de rester en
ordre de bataille.
Lempereur, levant la voix, appela les deux khans turcs, El -qaghan et
Toloui, pour leur proposer un combat singulier, selon la mode des guerriers de
la steppe : Li Che-min, devenu empereur, na pas oubli de se servir de ses
armes ! Et au nom de lhonneur militaire, leur parlant leur langage et faisant
appel leur sentiment de guerriers, il leur reprocha violemment davoir rompu
les trves et trahi leur serment. Bravs en face, subjugus par tant de bravoure
et dailleurs surpris par le dploiement de la cavalerie chinoise, les khans turcs
demandrent la paix. Elle fut conclue le lendemain, sur le pont mme de la
Wei, aprs le sacrifice traditionnel dun cheval blanc. Cette fois les Turcs
avaient compris la leon. Ils ne devaient plus revenir.
Pour viter le retour de semblables alertes, on conseillait Tai -tsong de
renforcer la Grande Muraille. Il sourit : Quest -il besoin de fortifier les
frontires ? De fait, des discordes intrieures, des rvoltes savamment
entretenues par lui minaient lau torit des Turcs de lOrkhon. Sur une
imprudente provocation dEl -qaghan, Tai -tsong, en 630, lana contre lui
toute larme chinoise. Les Impriaux rejoignirent le qaghan dans la Mongolie
Intrieure, au nord du Chan-si, surprirent son campement prs de Koueihoua-tcheng et dispersrent ses hordes, puis le relan crent lui-mme en haute
Mongolie vers lOrk hon et le Kruln et le forcrent se rfugier chez une
tribu qui le leur livra. Pour cinquante ans (630-682) le khanat des Turcs
orientaux fut soumis la Chine.
L Histoire des Tang nous dcrit avec complaisance le spectacle grandiose
des chefs turcs prosterns aux pieds de Tai -tsong. Lem pereur voulut les voir
tous ensemble en audience publique, les ennemis vaincus de la veille comme
les khans rallis de longue date. Arrivs dans la salle daudience, ils firent
les crmonies respectueuses en frappant la terre du front trois reprises diffrentes et trois fois chaque reprise. Le grand-khan El-qaghan fut trait en
prisonnier de guerre et ne prit rang quaprs les chefs des hordes loyalistes.
Du reste, aprs cette humiliation, la subtile politique impriale devait lui
accorder son pardon et, tout en le maintenant dans une demi-captivit, lui
attribuer un palais la cour.
Tout lancien khanat des Turcs orientaux, cest --dire notre actuelle
Mongolie, fut rattach lempire chinois (630). Les fils des nobles turcs, dit
linscription turque de Kocho -Tsadam, devinrent esclaves du peuple chinois,
leurs pures filles devinrent serves. Les nobles des Turcs abandonnrent leurs
titres turcs et, recevant des titres chinois, ils se soumirent au qaghan chinois et
pendant cinquante ans lui vourent leur travail et leur force. Pour lui, vers le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
91
soleil levant comme louest jusquaux Portes de Fer (au Turkestan), ils firent
des expditions. Mais au qaghan chinois ils livraient leur empire et leurs
institutions.
Avec de tels auxiliaires, Tai -tsong, aprs avoir cras les Turcs de la
Mongolie, devait, au cours des vingt annes qui suivirent, faire entrer dans sa
clientle les Turcs du Turkestan et les oasis indo-europennes du Gobi. Avec
lui une Chine inattendue, une Chine dpope, se rvla lAsie surprise.
Loin de composer avec les barbares et dacheter prix dor leur retraite, il les
fit trembler son tour. Lart raliste de ce temps, le puissant art animalier et
militaire des reliefs, des statues et des terres cuites funraires, avec sa vigueur
presque excessive (voyez les lokapla athltiques du Long-men), avec son
got de laccent allant jusqu la violence caricaturale, exprime bien cet tat
desprit. Il nest pas jusqu la cramique tang aux co uleurs un peu brutales,
en jaune orange et vert franc, qui ne soit rvlatrice des gots de lpoque.
Confrontant un jour son uvre celle des grands conqurants du temps
jadis, Tai -tsong devait voquer le nom du plus illustre empereur de lantiquit
chinoise, Han Wou-ti. Par-del les invasions barbares du IVe sicle, la Chine
des Han se trouvait en effet ressuscite et la chevauche des Han allait mme
se voir dpasse par celle des Tang. Mme Pan Tchao, le contemporain et
lmule de notre Trajan, le conqurant de la Kachgarie antique, navait pas eu
son actif autant de troupeaux razzis, de hordes rompues, de milliers de ttes
coupes que nen compteront les gnraux des Tang. Cest que dans
lintervalle la Chine, ploye durant trois sicles sous l es invasions barbares, a
absorb le sang des hordes victorieuses ; elle sen est nourrie et fortifie et elle
retourne maintenant contre les gens de la steppe, en y ajoutant limmense
supriorit de sa civilisation millnaire, la force quelle a tire d eux.
Regardons dans nos collections de statuettes funraires ce peuple de
cavaliers ou de fantassins, coiffs du bonnet des auxiliaires turcs ou du casque
des lgionnaires tang, frustes visages toujours demi tartares, traits durcis
jusqu la grimace. Les voici rudement camps dans leur armure de cuir
bouilli, renforce, pour le plastron et la dossire, de plaques de mtal,
pansire de cuir ou dcailles mtalliques, grand bouclier rond ou
rectangulaire orn de figures de monstres, prts pour la traverse du Gobi
ou lescalade du Khanga. Mme dans les uvres bouddhiques, comme les
statues ou les peintures reprsentant les gardiens de temples (lokapla) ou le
gnie-gardien Vadjrapni, nous trouvons ces armures de crustac, cet aspect
formidable et hargneux. Et toute cette cavalerie tang qui, dans nos terres
cuites funraires, piaffe, hennit et sbroue encore dimpatience en attendant
les raids annoncs vers Kachgar ou Koutcha ! Les Turcs occidentaux
eux-mmes qui font trembler lempire sassanide, q ui inquiteront plus tard la
jeune puissance arabe, ploieront devant cette cavalerie si semblable la leur.
On la verra sabattre en trombe sur leurs campements, brler leurs chariots,
disperser leurs yourtes de feutre jusquaux gorges du Tarbagata, les relancer
jusque sur la steppe plate des Kirghiz.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
92
Les Turcs de Mongolie une fois abattus, Tai -tsong put en effet soccuper
des Turcs du Turkestan. Ceux-ci taient encore unis sous le sceptre dun
puissant souverain, Tong le Yabghou, qui rgnait depuis lA lta jusqu la
mer dAral (il rsidait en t dans les monts Tien -chan et en hiver prs du
lac chaud , lIssyq -qoul) et qui nous est assez bien connu par la description
que nous a laisse de lui le plerin bouddhiste Hiuan-tsang. Ce fut aux environs de Toqmaq, louest de lIssyq -koul, dans lactuel Kirghi zistan, que le
plerin, au commencement de 630, rencontra le khan et son immense
cavalerie, la horde se dplaant alors en direction de louest. Tous taient
monts sur des chevaux ou des chameaux et vtus de fourrures ou de laine,
portant de longues lances, des bannires et des arcs droits. Leur multitude
stendait tellement loin que lil nen pouvait dcouvrir la fin. Lempe reur
Tai -tsong qui pensait quil faut sunir ceux qui sont loi n contre ceux qui
sont proches , avait mnag ces hordes de louest, du moins tant quil avait
eu sur les bras celles de Mongolie. Mais en cette mme anne 630, celle
prcisment o il venait de soumettre la Mongolie, le hasard un hasard
peut-tre sollicit le servit point nomm : le khan du Turkestan dont la
puissance avait tellement impressionn le plerin fut assassin dans des
circonstances assez mystrieuses et aussitt son royaume se morcela en
plusieurs groupes de tribus ennemies. Ainsi disparut le khanat des Turcs
occidentaux comme venait de disparatre celui des Turcs de Mongolie ...
Celles des tribus qui voulurent rsister furent crases isolment en 642 par un
corps expditionnaire chinois dans les environs dOuroumtsi. Les autres
acceptrent lh gmonie chinoise.
Ayant annihil les Turcs, lempereur Tai -tsong pouvait rtablir le
protectorat chinois sur le bassin du Tarim.
Pour comprendre le rle considrable jou au haut moyen ge par les
oasis, aujourdhui si misrables, du bassin du Tarim, il faut nous rappeler ce
que nous en disions dj pour lpoque han. Au point de vue ethnique tout
dabord : une partie au moins de ces oasis, Tourfan, Qarachahr, Koutcha,
taient habites par des populations parlant des dialectes indo-europens,
proches parents non seulement des langues aryennes dAsie (iranien et
sanscrit), mais aussi de nos langues dEurope (slave, italo -celtique, etc.), sans
Parler de l iranien oriental parl dans la rgion de Kachgar. Au point de
vue culturel ensuite : du IIIe au VIIIe sicle de notre re lactuel Turkestan
chinois fut, du fait de lvanglisation bouddhique, une province de lInde
Extrieure o la littrature et la philosophie sanscrites ou pracrites taient
aussi honores que sur les bords du Gange. Pour la mme raison, le
bouddhisme, nous lavons vu, stant donn une iconographie alexandrine,
ce pays fut au point de vue artistique une conqute posthume dAlexandre.
Tandis que la Grce tait dfunte Byzance, son influence artistique,
dsormais indissolublement lie au dogme bouddhique, continuait jusquen
plein VIIe sicle de notre re se faire posthumment sentir depuis Kachgar
jusqu Tourfan et au Lobnor ; et peut-tre mme pourrions-nous, travers la
Kachgarie, suivre cette influence posthume jusque dans le libre classicisme de
certains miroirs chinois dpoque tang (38). Ainsi la lumire dune toile
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
93
morte depuis des sicles continue nous parvenir travers lespace et le
temps. Mais aujourdhui, de cette brilla nte activit commerciale, religieuse et
artistique, rien ne subsiste. La saharification, dans le bassin du Tarim, a
achev de tuer la terre, comme lislam a teint les anciens foyers de culture
bouddhique. Il y a l souvenons-nous, civilisations, que nous sommes
mortelles ! tout un pan de ldifice humain qui sest effondr, mais sans
lequel, nagure, naurait pas t possible le passage du monde indo -europen
au monde chinois ...
Lpoque laquelle nous sommes arrivs est prcisment celle o nous
possdons une description vivante des oasis du Tarim grce au rcit que nous
a laiss de son passage le plerin chinois Hiuan-tsang (annes 629-630 au
voyage daller, en 644, au retour). Cest la priode aussi laquelle se rfrent
pour une bonne part les trouvailles archologiques effectues dans la rgion
de 1902 1914.
A lpoque que nous rvlent ces fouilles, lart du bassin du Tarim
provient directement des ateliers bouddhiques de lAfgha nistan avec le double
courant grco-indien et irano-bouddhique que nous avons dj signal. La
dcouverte par J. Hackin, Mme Hackin et Jean Carl des stucs de
Fondoukistan, entre Caboul et Bamiyan, stucs dats par des monnaies du roi
sassanide Khosros II (590-628), est cet gard rvlatrice. En effet ces stucs
montrent lart bouddhique de lAfghanistan reproduisant toujours des modles
hellniques pour les types de bouddhas, mais y associant des modles
purement hindous pour les types fminins et des modles perses sassanides
pour les types masculins lacs. Or cest e xactement cette association que nous
restituent les fresques des grottes bouddhiques de Qyzyl prs de Koutcha,
dans la partie septentrionale du bassin du Tarim, fresques dont Hackin situe la
premire priode entre 450 et 650 et la seconde entre 650 et 750. Lensemble
nous prouve que si la civilisation spirituelle dune oasis comme Koutcha tait
alors, grce au bouddhisme, nettement indienne, sa civilisation matrielle
accusait une influence perse sassanide considrable. De fait les seigneurs lacs
et, ici, les princesses elles-mmes rvlent limitation directe des modles
iraniens. Rien ne saurait montrer mieux le rle de ces oasis caravanires, non
seulement comme tapes du plerinage entre la Chine et lInde, mais aussi
comme haltes commerciales entre la Chine et lIran. Et ce que nous disons des
fresques de Qyzyl est galement vrai des stucs de Chortchouq prs de Qarachahr, des stucs et des fresques du groupe de Tourfan ceci pour le nord du
Tarim, et, pour le sud, des peintures de Dandan Oliq dans la rgion de
Khotan.
La Chine des Tang qui aspirait la domination de la haute Asie, ne
pouvait se dsintresser des oasis du Tarim dont le protectorat lui tait
indispensable pour contrler la route des caravanes vers lIran et lInde.
Lempereur Tai -tsong esprait les attirer pacifiquement dans son orbite.
Loasis la plus voisine tait celle de Tourfan. Ctait aussi celle qui subissait
le plus directement linfluence de la culture chinoise, comme le prouvent les
fresques bouddhiques de la rgion o le style tang se mle aux copies
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
94
indiennes et iraniennes, comme le prouve galement la nationalit de la
dynastie rgnante qui tait chinoise dorigine. En 629 le bouddhiste chinois
Hiuan-tsang, traversant Tourfan pour se rendre en plerinage dans lInde,
avait reu du roi local un accueil empress (si empress quil avait eu toutes
les peines du monde sarracher cette hospitalit pour reprendre sa route).
Le mme roi vint lanne suivante rendre hommage lempereur Tai -tsong.
Mais en 640 il commit la folie de sallier des rvolts turcs pour couper la
route des caravanes entre la Chine, lInde et lIran. Il comptait pour se
protger sur les sables du Gobi. Un corps de cavalerie chinoise franchit le
dsert et apparut limproviste devant Tourfan. A la nouvelle de ce raid, le roi
tait mort de saisissement. Les Chinois mirent le sige devant la ville. Dj
une grle de pierres sabattait sur loasis. Le nouveau roi, un tout jeune
homme, vint se prsenter au camp imprial. Avant que ses explications
fussent devenues dune humilit complte, un des gnraux chinois se leva et
dit : Il faut dabord prendre la ville ; quest -il besoin de discuter avec cet
enfant ? Quon donne le signal et quon marche lassaut ! Le jeune roi,
tremp de sueur, se prosterna terre et accepta tout. Les gnraux chinois le
firent prisonnier et vinrent loffrir Tai -tsong dans la grande salle dhonneur.
On clbra le rite des libations du retour et pendant trois jours on fit des
distributions de vin. Lpe orne de j oyaux du roi de Tourfan fut donne
par lem pereur au condottiere turc A-che-na Ch-eul.
Les gens de Qarachahr loasis qui suivait celle de Tourfan sur la piste
de louest avaient aid la Chine craser les Tourfanais, leurs frres
ennemis. Tourfan une fois annex, ils prirent peur et sallirent aux Turcs
dissidents. Tai -tsong envoya dans le Gobi une nouvelle arme conduite par
Kouo Hiao-ko, guerrier plein de ressources. Le site de Qarachahr avait un
pourtour de dix-sept kilomtres. Il tait protg sur les quatre cts par les
monts des Tien-chan et par le lac Baghratch ; aussi les habitants taient-ils
convaincus quils ne pourraient tre surpris. Mais Kouo Hiao -ko, savanant
marches forces, franchit la rivire et arriva de nuit au pied des remparts. Il
attendit le point du jour pour donner lassaut au milieu des cris de la multi tude. Les tambours et les cornes sonnrent grand bruit et les soldats des
Tang se donnrent libre carrire. Les habitants furent saisis de panique. On
coupa mille ttes. De sa capitale, Tai -tsong avait tout dirig. Un jour
lempereur dit aux ministres qui se trouvaient ses cts : Kouo Hiao-ko
est parti pour Qarachahr le onzime jour du huitime mois, il a pu arriver la
seconde dcade et doit avoir dtruit ce royaume le vingt-deuxime jour ; ses
envoys vont arriver. Soudain on vit apparatre le courrier qui annonait la
victoire. (644).
La plus prospre des cits indo-europennes du Tarim tait loasis de
Koutcha dont les fresques bouddhiques nous ont montr la civilisation
raffine. Le roi de Koutcha qui portait dans le dialecte indo-europen local le
nom de Swarnatep, le dieu dor , avait en 630 fait le meilleur accueil au
plerin chinois Hiuan-tsang et reconnu la suzerainet des Tang, mais e n 644
il avait fait volte-face pour sallier aux Qarachahris contre lempire. Il mou rut
peu aprs, remplac par son jeune frre connu en sanscrit bouddhique sous le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
95
nom de Haripouchpa, Fleur divine (646). Le nouveau roi, sentant venir
lorage, se ht a denvoyer la cour des protestations de dvouement (647).
Trop tard. Le condottiere turc au service de la Chine, A-che-na Ch-eul,
partait pour louest avec une arme de rguliers chinois et de mercenaires
tartares.
Les habitants de Koutcha attendaient lattaque du ct du sud -est, la
sortie du Gobi. Elle vint par le nord-ouest, A-che-na Ch-eul ayant suivi la
piste qui mne dOuroumtsi au petit Youl douz, du ct des Tien-chan. A la
place de leurs allis qarachahris, les Koutchens terrifis virent les escadrons
chinois se dployer dans le dsert pierreux qui stend au nord de la ville. Une
ruse de guerre acheva leur dfaite. Le roi Haripouchpa tant sorti des
murailles au-devant des envahisseurs, les Chinois, suivant la tactique des
vieilles guerres mongoles, feignirent de cder, attirrent la brillante chevalerie
koutchenne dans le dsert et ly dtruisirent. Ce fut le Crcy et lAzincourt
des beaux seigneurs que nous admirions tout lheure aux fresques
bouddhiques de Qyzyl. A-che-na Ch-eul, le sabreur turc la solde de
lempire, entra en vainqueur Koutcha et, comme le roi Fleur divine
stait rfugi avec les dbris de son arme dans le bourg de Yaqa -ariq, il ly
relana et aprs quarante jours de sige emporta la place. A Koutcha,
A-che-na Ch-eul coupa onze mille ttes. Les entres dOccident furent
saisies de terreur.
Ce fut la fin de lindpendance pour la cit indo -europenne du Gobi, la
fin dun monde charmant et raffin, survivant attard des races dautrefois. La
brillante civilisation quvoquent pour nous les fresques bouddhiques de
Qyzyl ne se relvera jamais entirement de la catastrophe. Les recherches, sur
place, de J. Hackin marquent pour cette date de 648-650 une coupure entre les
deux styles de peinture de Qyzyl, le second cherchant compenser par des
couleurs plus vives la diminution du model et bien que sy fasse encore sentir
une nouvelle vague dinfluences perses sassanides : en ralit il sagit ici dun
sassanide posthume, des rfugis perses, aprs la conqute de leur pays par les
Arabes en 652, tant venus abriter des Coblentz sassanides dans le
nouveau protectorat chinois du Tarim.
Aprs les oasis septentrionales du Tarim, les oasis du sud. De ce ct, le
roi de Khotan avait ds 632 accept la suzerainet du lempereur Tai -tsong.
En 635 il avait envoy son propre fils servir dans la garde impriale. Mais ces
preuves de bonne volont ne parurent pas suffisantes. En 648, quand les
Chinois eurent cras Koutcha, ils prouvrent le besoin de se subordonner
plus troitement les oasis mridionales. Aprs ce coup, les contres
dOccident sont frappes de terreur. Cest le moment de prendre de la
cavalerie lgre et daller passer le licou au roi de Khotan ! Aussitt dit,
aussitt excut. Les escadrons chinois tombrent limproviste sur loasis de
Khotan. Le roi de Khotan tremblait. Le gnral chinois lui exposa le prestige
et la puissance surnaturelle des Tang et lexhorta venir se prsenter au Fils
du ciel . Le roi sexcuta. Il ne devait dailleur s pas y perdre puisque aprs
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
96
un sjour de plusieurs mois la cour de Tchang -ngan on lui permit de rentrer
chez lui avec une robe dhonneur et cinq mille pices de soie.
Chez les Tibtains, jusque-l entirement barbares, un chef nergique tait
en train dorganiser dans la rgion de Lhassa une royaut rgulire. Aprs
avoir guerroy contre la Chine, il entra dans la clientle des Tang et obtint de
lempereur Tai -tsong la main dune infante chinoise (641). Ce fut ainsi que la
civilisation commena sin filtrer chez ces sauvages montagnards. Dans
lInde mme, Tai -tsong envoya une ambassade lempereur nord -indien
Harcha (643). Mais le meilleur ambassadeur pour la Chine fut encore lillustre
plerin Hiuan-tsang qui, parti de Tchang -ngan en 629, ny revi nt quen 644,
aprs avoir parcouru de part en part lAsie centrale et lInde. Nous avons fait
allusion son itinraire daller par Tourfan, Qarachahr, Koutcha, les
Tien-chan, lIssyq -koul, Toqmaq, Samarqand, Balkh et la valle de Caboul, et
son voyage de retour par le Pamir, Kachgar, Yarkand, Khotan, le Lobnor et
Touen-houang. Cet itinraire, remarquons-le, ntait autre que lantique route
de la soie avec sa double piste, au nord et au sud du Tarim. Cest ainsi que la
Paix des Tang rouvrait de la Chin e lIran et lInde les routes
transcontinentales en partie obstrues depuis la chute des Han. Les armes de
Tai -tsong furent mme amenes suivre dans cette direction les pas des
plerins. Une ambassade chinoise ayant t attaque pendant un voyage aux
Indes, lambassadeur chinois Wang Hiuan -ts alla demander des renforts aux
chefs tibtains et npalais vassaux de lempire, puis, avec leurs contingents,
redescendit dans lInde o il tira vengeance de ses agresseurs (647). Il ramena
ceux-ci enchans la cour de Tchang -ngan.
A la suite de ces conqutes, lautorit directe de la Chine attei gnait le
Pamir. On comprend le lgitime orgueil de Tai -tsong. Ceux qui ont jadis
soumis les barbares, lui fait dire sa biographie, ce sont seulement Tsin
Che-Houang-ti et Han Wou-ti. Mais en prenant en main mon pe de trois
pieds de long, jai subjugu les Deux Cents Royaumes, impos silence aux
Quatre Mers et les barbares lointains sont venus se soumettre les uns aprs les
autres !
Cette extension de la puissance chinoise vers lInde et lIran ne pouvait
manquer davoir des consquences dans le domaine spirituel.
Depuis la fin de la maison des Tabghatch le bouddhisme quils avaient la
fin favoris avec tant de zle avait subi de nombreuses attaques. En 574 une
des phmres maisons royales qui leur avaient succd dans la Chine du
Nord avait port un dit de proscription contre la religion trangre , de
mme dail leurs que contre le taosme, mais au bout de six ans cette perscution avait pris fin. Les deux empereurs Souei, dabord confucens
orthodoxes (toute dynastie qui se fonde a besoin, pour tablir sa lgitimit, de
lappui du mandarinat) avaient ensuite montr plus de sympathie au
bouddhisme. Quant au rude soldat qutait lempereur Tai -tsong, il navait,
son avnement, que des prventions contre la religion dabdication et de
renoncement apporte de lInde. Lempereur Leang Wou -ti, remarquait-il, a
si bien prch le bouddhisme ses officiers que ceux-ci nont pas su monter
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
97
cheval pour le dfendre contre les rvolts. Au reste il englobait dans la
mme rprobation le non-agir des taostes : Lempereur Yuan -ti
expliquait ses gens les textes de Lao-tseu. Il aurait mieux fait de marcher
contre les barbares qui envahissaient le mpire ! Le confident de Tai -tsong
en ces matires, un vieux lettr qui avait proprement le bouddhisme en
horreur, lui remettait un placet encore clbre de nos jours et o tenaient tous
les griefs du confucisme dtat contre les moines de kyamouni. I l faut
citer cette page qui claire bien la lutte des ides en Chine :
Le bouddhisme, dit en substance ce pamphlet, est dabord venu par la
voie du Tarim sous une forme trangre qui ne pouvait tre encore que peu
nocive. Mais ensuite, depuis les Han, on a traduit en chinois les Ecritures
indiennes. Leur diffusion sape la fidlit dynastique et la pit filiale. Les
jeunes gens embrassent la vie monastique pour se soustraire aux charges
publiques. Ils se rasent la tte, vivent de qutes et refusent les prosternations
dues leur prince et leurs propres parents. Du reste, la doctrine du
Bouddha est remplie dextravagances et dabsurdits. Ses dis ciples passent
leur vie dans loisivet sans se donner aucune peine. Sils portent un habit
diffrent du ntre, cest pour influencer les pouvoirs publics et se dlivrer de
tout souci. Par ces rveries ils font courir les simples aprs une flicit
chimrique et leur inspirent du mpris pour nos lois et les sages institutions
des anciens . Et plus loin : Cette secte compte aujourdhui plus de cent
mille bonzes et autant de bonzesses vous au clibat. Il serait de lintrt de
ltat de les marier ensemble. Ils formeraient cent mille familles et
donneraient de futurs soldats. Nous retrouverons jusqu nos jours ces
accusations contre le caractre antisocial, anticivique et antinational du
monachisme indien. Il y a l les lments dun vritable anticlricalisme qui
est devenu une tradition chez les lettrs confucens, cest --dire dans la
presque totalit du mandarinat.
Ds lanne de son avnement (626) lempereur Tai -tsong qui partageait
cette manire de voir diminua considrablement le nombre des moines et des
monastres. Mais ltablissement de la domination chinoise sur un pays aussi
profondment bouddhiste que le bassin du Tarim et ltablissement de
relations politiques suivies avec lInde elle -mme ne manqurent pas de
modifier la longue les tendances de lempereur. Cest ce qui ressort du rcit
de Hiuan-tsang. Quand le clbre docteur bouddhiste avait sollicit en 629
lautorisation de partir en plerinage vers la Terre Sainte du Gange, les
autorits impriales lui avaient refus les passeports ncessaires. Il avait d
franchir le limes en cachette, en vitant le poste-frontire de Touen-houang, et
sengager sans guide au milieu du dsert de Gobi o il avait failli prir ds les
premires tapes. Cependant le prestige chinois autant que la pit
bouddhique des dynastes locaux lavait ensuite protg pendant la traverse
du bassin du Tarim et il avait pu, travers le Turkestan et lAfghanistan,
parvenir dans lInde. L il avait reu laccueil le plus empress non seulement
de ses coreligionnaires mais mme des princes hindouistes curieux dentendre
le voyageur venu de Chine pour tudier parmi eux la philosophie sanscrite.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
98
Hiuan-tsang, en effet (do lintrt quil prsente pour lhis toire
gnrale), nest pas seulement un bouddhiste dvot, pouss par le dsir de
contempler dans le bassin du Gange les lieux saints tmoins de la nativit, de
la prdication et de la mort du Bouddha. Cest aussi un philosophe hors pair
qui a approfondi les divers systmes mtaphysiques du brahmanisme et du
bouddhisme. Le systme auquel il sest arrt, celui quil a expos dans une
synthse dune remarquable profond eur, est celui de lidalisme absolu, un
peu la manire de Berkeley et de Fichte, comportant ici la ngation du moi
personnel comme du monde extrieur ou plutt leur rduction commune ce
quil appelle le rien-que-pense ou, si lon prfre, le plan des idaux .
Philosophie nuance qui oscille, on le voit, du subjectivisme au monisme,
mais sans pouvoir se dfinir proprement par aucune de ces deux attitudes
intellectuelles, puisque, la diffrence du monisme, elle nie toute notion de
substance, et qu la diffrence de notre sub jectivisme, elle nie le moi, du
moins le moi substantiel.
En ralit, ctait bien plus que le systme ainsi dfini que des traducteurs
comme Hiuan-tsang rvlaient la Chine. Ctait tout un trsor de concepts,
de points de vue, de constructions mtaphysiques ou de dissociations
intellectuelles. Ctait tout lhritage de la pense indienne, ctait toute la
virtualit de la pense indo-europenne que de tels systmes traduisaient en
pense chinoise . Ctait lh ritage dun monde le ntre qui tait ainsi
rendu accessible aux sujets des Tang. En dpit de loppo sition des lettrs
confucens il y eut l une invasion dides -forces qui ne put tre arrte.
La preuve en est qu lpoque song le no -confucisme dun Tchou Hi en
sera, sans le savoir, pntr. Il y a l une transfusion mentale qui ne peut
tre compare qu la brusque invasion des systmes occidentaux au XX e
sicle. Avouons du reste, en ce qui concerne Hiuan-tsang, que luvre la plus
tonnante de lillustre plerin nest peut -tre pas la traverse du Gobi et des
Tien-chan, du Pamir et de lHindou kouch, cette extraordinaire randonne qui
lgale aux plus grands explorateurs modernes ; cest notre avis
lexploration de ce monde inconnu de la pense indienne, de cette fort
exubrante, en apparence inextricable, travers laquelle il sest trac des
cheminements srs ; cest le travail prodigieux par lequel, aprs de nom breux
devanciers sans doute, mais mieux que tout autre, il a achev, pour traduire les
concepts mtaphysiques indiens les plus complexes, les plus dlicats et les
plus nuancs, de crer un vocabulaire chinois adquat et cela avec loutil
imparfait que constituaient les caractres, au bref presque une langue
nouvelle. Ici encore seuls les missionnaires catholiques qui ont eu traduire
en caractres chinois notre philosophie thomiste peuvent apprcier son
mrite un tel effort.
Mais Hiuan-tsang nest pas seulement le plerin plein de pit et le
traducteur de cette somme mtaphysique dont la puissance nous tonne. Cest
encore un des explorateurs les plus aviss, un des gographes les plus prcis
que nous connaissions. Le rcit de son voyage est le relev, pays par pays,
kilomtre par kilomtre, de la gographie physique, politique, conomique de
lAsie centrale et de lInde dans la premire moiti du VII e sicle. On y trouve
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
99
le tableau de la vie agricole et commerciale de toutes les contres parcourues
depuis la frontire chinoise jusquaux approches de la Perse, depuis
lAfghanistan jusqu lAssam et la pointe du Dkhan. Un tableau aussi des
langues (il y a inclus un rsum de la grammaire sanscrite), des institutions et
des murs (il y a un aperu du systme des castes), des superstitions, des
religions et des philosophies des divers peuples traverss. Enfin un rapport
fort prcis des dominations politiques et du caractre des diffrents
souverains.
Ce dernier point de vue dut tre particulirement prcieux pour la
politique mondiale qui tait devenue celle de Tai -tsong. Nous avons vu
quen 629 il avait voulu sopposer au dpart du plerin. Quand celui -ci fut de
retour en Chine en 644, lem pereur lui rserva laccueil le plus flatteur et le
plus amical. Il interrogea longuement le voyageur sur la situation des
royaumes indiens et fut si satisfait de ses rponses quil et voulu lui confier
les fonctions de ministre. Hiuan-tsang, tout la rdaction de ses ouvrages
religieux et philosophiques, dclina cette offre. Du moins se fixa-t-il
Tchang -ngan, au couvent de la Grande Bienfaisance quon tait en train
dachever et do Tai -tsong qui lavait pris en amiti, le faisait souvent
appeler au palais pour converser avec lui. La conscration de ce monastre
donna lieu une procession solennelle sur le passage de laquelle lem pereur,
par affection pour Hiuan-tsang, consentit apparatre. La biographie de notre
saint nous dcrit le magnifique cortge form cette occasion autour des
bannires et des statues bouddhiques rapportes de lInde. Les dcouvertes
archologiques rcentes confirment ce qui nous est dit ici au sujet des origines
indiennes dune partie de la sculpture bouddhique chinoise lpoque qui
nous occupe. Dj pour une priode sensiblement concordante, en tout cas
tang, les grottes du Tien -long-chan, dans le nord du Chan-si, nous avaient
livr des statues de bodhisattva directement imites de lart indien goupta avec
une douceur de model, un charme plastique, un fondu qui ne laissent pas de
surprendre en terre chinoise : toute lesthtique indienne, avec son inhrente
sensualit tropicale, est de nouveau ici prsente. Du reste, la rhabilitation de
la plastique ds lpoque souei et le dbut des Tang est gnrale. La sculpture
bouddhique, abandonnant la scheresse de lart roman chinois , restitue
progressivement sa valeur au model. Nul doute que cette rhabilitation ne se
soit en partie effectue devant lexemple des modles indiens rapports par les
plerins comme Hiuan-tsang.
Lextension de lempire des Tang jusquaux confins indo -iraniens ne
provoquait pas seulement un contact plus troit avec lInde bouddhique. Par la
mme voie arrivait de lIran et de la Transoxiane le christianisme, en lespce
le christianisme nestorien. En 635 on vit ainsi arriver Tchang -ngan un
prtre nestorien, connu sous le nom dA -lo-pen, ce qui est la transcription
chinoise du titre syriaque de Rabban. En 638 ce missionnaire construisit une
glise dans la capitale. Linscription syro -chinoise de 781 clbrera cet
vnement ainsi que la bienveillance de lempere ur Tai -tsong pour le
christianisme (39).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
100
Aprs vingt-trois annes dun des rgnes les plus glorieux de lhistoire
chinoise, Tai -tsong mourut cinquante-trois ans, dans son palais de
Tchang -ngan, le 10 juillet 649. Il fut enterr prs de l, Li-tsiuan -hien. Il
avait fait sculpter autour de sa tombe la statue des rois vaincus et aussi limage
de ses chevaux de guerre. Tel tait le dvouement de ses vtrans que lun
deux, le vieux capitaine turc A -che-na Ch-eul, voulait se tuer sur sa
dpouille, la vieille manire tartare, pour garder la tombe de
lempereur (40).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
101
CHAPITRE 18
Drames la cour des Tang
Lempereur Kao -tsong, fils de Tai -tsong le Grand, navait que vingt -deux
ans quand il monta sur le trne. Il devait rgner trente-trois ans (650-683).
Ctait un homme appliqu, plein de bonne volont, naturellement
bienveillant, quoique, on le verra, dune navrante faiblesse de caractre. Sa
pit se manifesta envers tous les cultes. Il alla sur la montagne sacre du
Tai -chan offrir des sacrifices au Souverain Seigneur de lAuguste Ciel ; il
accomplit un plerinage la tombe de Confucius, un autre aux plus anciens
temples taostes. Au tmoignage de la stle syro-chinoise de
Tchang -ngan, il protgea le christianisme nestorien. Sous son rgne, au
moins au dbut et grce aux vtrans de son pre, lexpansion chinoise
continua. Tai -tsong le Grand, pas plus que lempereur Yang -ti, navait russi
conqurir la Core. Kao-tsong y parvint. De 660 665 ses gnraux
soumirent un des trois royaumes corens, le Paiktchei, situ sur la cte
sud-ouest de la pninsule. En 668 ils semparrent de mme du principal de
ces royaumes, la Core propre, situ au nord-ouest de Soul. Le troisime
royaume coren, le Sinra, situ sur la cte orientale, ayant spontanment
reconnu la suzerainet chinoise, toute la pninsule entra dans lorbite de la
Chine. Au Turkestan lempire eut rprimer une rvolte des tribus de Turcs
occidentaux qui nomadisaient au nord-est de lIssyq -koul. Le gnral chinois
Sou Ting-fang marcha au seuil de lhiver contre les rebelles. Lhiver appro chait, le sol tait couvert de neige : nul chez les Turcs ne souponnait que les
Chinois pussent sengager en une telle saison dans ces soli tudes dsoles. Sou
Ting-fang surprit les nomades sur la rivire Borotala, affluent de lEbinor, en
Dzoungarie, puis les battit encore sur la rivire Tchou, louest de
lIssyq -koul et fora leur khan senfuir Tachkend o on le livra la Chine
(657). Les Turcs occidentaux acceptrent comme khans des clients de
lEmpire.
Lempereur Kao -tsong semblait avoir parachev luvre pater nelle
lorsque brusquement la situation changea. A partir de 665 les Turcs
occidentaux se rvoltrent dfinitivement contre lui. En 670 les Tibtains,
peuple alors peu prs sauvage, firent irruption dans le bassin du Tarim et
enlevrent aux Chinois ce quon appelait les Quatre Garnisons , Koutcha,
Qarachahr, Kachgar et Khotan. Evnement plus grave encore, le khanat des
Turcs orientaux, le khanat de Mongolie qui avait son centre sur le haut
Orkhon et que lempereur Tai -tsong avait dtruit en 630, se reconstitua sous
un descendant de lancienne famille royale turque, le qaghan Qoutlough. Les
mauvais jours recommenaient. Pendant trente-neuf ans (682-721) les Turcs
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
102
de Mongolie allaient de nouveau, pareils aux loups , venir ravager du ct
de la Grande Muraille les terres des Chinois, pareils aux moutons .
En mme temps lintrieur le rgne de Kao -tsong finissait
lamentablement du fait de limpratrice Wou Ts -tien.
Wou Ts-tien tait une ancienne favorite de lempereur Tai -tsong.
Entre au harem quatorze ans en 637, elle y avait brill autant par son esprit
que par sa beaut. Lorsque lempereur Kao -tsong ntai t encore que prince
hritier, il lavait aperue dans le troupeau des femmes de son pre et depuis
ce jour il lavait aime en silence. A la mort de Tai -tsong les dames du harem
avaient d couper leur chevelure et entrer au couvent. Ds que le deuil officiel
fut termin, Kao-tsong, devenu Fils du Ciel, fit sortir la jeune femme de sa
retraite et lui rendit sa place la cour. Mais un rle subalterne ne suffisait pas
lambi tieuse concubine. Selon limage de son ennemi, le pote Lo Pin -wang,
ses sourcils arqus comme des antennes de papillon ne consentaient pas
cder aux autres femmes. Se cachant derrire sa manche, elle sappliquait
calomnier. Son charme de renarde avait le pouvoir particulier densorceler le
matre. Pour parvenir ses fins, elle nhsita point commettre le crime le
plus monstrueux : elle trangla de ses propres mains lenfant qu'elle venait
davoir de lempereur et fit accuser de ce forfait limpratrice lgitime.
Les annales des Tang nous ont racont ce drame qui rappelle Tac ite avec,
en plus, toute une mise en scne de politesse hypocrite. A la naissance de
lenfant, une fille, limpratrice tait venue rendre visite Wou
Ts-tien. Elle caressa lenfant, la prit dans ses bras, flicita la jeune mre.
Ds quelle fut pa rtie, Wou Ts-tien touffa le nouveau -n puis le replaa
dans son berceau. On annonait larrive de lempereur. Wou Ts -tien reut
celui-ci avec un visage rayonnant de joie et dcouvrit le berceau pour lui
montrer leur fille. Horreur, ce ntait quun p etit cadavre ! Eclatant en
sanglots, elle se garda bien daccuser directement celle quelle voulait perdre.
A la fin, presse de questions, elle se contenta dincriminer ses suivantes.
Naturellement celles-ci, pour se disculper, rappelrent la visite faite quelques
instants auparavant par limpratrice. La scne avait t si habilement
machine que Kao-tsong fut convaincu de la culpabilit de cette dernire. Il la
dgrada et leva la place Wou Ts-tien (655). Malgr loppo sition des
vieux compagnons de son pre, il tomba bientt entirement sous le joug de sa
nouvelle pouse. Pareille lAgrippine antique, celle -ci assistait derrire un
rideau aux dlibrations du Conseil. Comme Kao-tsong continuait visiter en
secret limp ratrice rpudie, Wou Ts-tien fit couper la malheureuse les
mains et les pieds.
A partir de 660 ce fut Wou Ts-tien qui dirigea au nom du faible
Kao-tsong toutes les affaires de ltat. Grce au systme de dlation quelle
avait tabli, elle put, au gr de ses jalousies et de ses vengeances, terroriser
impunment la cour et dcimer jusqu la famille impriale des Tang. Aprs
avoir fait prir les mandarins qui lui rsistaient, elle obligeait leurs filles ou
leurs veuves lui servir desclaves. Le lamentable empereur connais sait
linnocence des victimes, mais nosait ragir. Seulement le remords rongeait
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
103
sa sant ; mais peut-tre son affaiblissement tait-il aid par les soins de son
pouse. Les annalistes nous disent en effet que dans les derniers temps sa
tte enfla et il devint comme aveugle. Son mdecin offrit de ponctionner les
parties tumfies. Wou Ts-tien scria que porter les mains sur le visage
imprial tait un crime de lse-majest qui mritait la mort. Le mdecin tint
bon et pratiqua les ponctions, sur quoi la vue de lempereur se dgagea ...
Limpratrice, feignant dtre ravie, courut chercher cent pices de soie
quelle offrit elle -mme par brasses au mdecin. Mais un mois plus tard on
apprit que lempereur tait retomb soudainement malade et quil venait de
dcder sans tmoins (27 dcembre 683). Sous le nom de leur fils, Wou
Ts-tien allait pendant vingt -deux ans rester matresse absolue de lempire
(683-705).
Femme suprieure dailleurs, autrement entendue que son malheureux
poux la pratique des affaires. Sous son nergique impulsion la machine
administrative des Tang continua fonc tionner et, malgr les tragdies de
srail, les vtrans continrent presque partout les barbares. Ce fut mme sous
le gouvernement de Wou Ts-tien quau Tarim la Chi ne recouvra les
Quatre Garnisons , Koutcha, Qarachahr, Kachgar et Khotan (692). Il est vrai
quelle fut moins heureuse contre les Turcs de Mongolie qui vinrent presque
chaque anne en de brusques razzias piller le limes du Kan-sou, du Chen-si,
du Chan-si et du Ho-pei. En ce temps-l, dit linscription turque de
Kocho-Tsadam, les esclaves chez nous taient eux-mmes devenus
propritaires desclaves, tellement nous avions fait dexpditions
victorieuses !
Mais lintrieur Wou Ts -tien ne rencontrai t pas dobstacle. Tout pliait
devant cette femme indomptable. Son audace alla jusqu dposer son propre
fils, le jeune Tchong-tsong (684) et finalement jusqu se faire proclamer
elle-mme empereur (690). En vain les princes du sang, honteux de se voir
gouverns par lancienne concubine, staient rvolts. lappel du pote Lo
Pin-wang. Ils avaient t crass et leurs ttes apportes limpratrice.
Cependant Wou Ts-tien comprenait la ncessit de se concilier les Turcs de
Mongolie, pour mettre fin leurs razzias tout dabord, pour avoir leur appui
contre ses ennemis ensuite. Elle envoya une ambassade leur qaghan
Bk-tchor, en demandant pour son propre neveu la fille de ce chef. Le Turc
refusa avec hauteur : il destinait sa fille non pas au neveu de lusurpatrice,
mais lempereur lgitime, cart par cette dernire. Se posant en arbitre entre
les coteries de la cour impriale, il se dclarait le dfenseur de la lgitimit et
menaait, si les Tang ntaient pas restaurs, de venir procder c ette
restauration la tte de ses hordes. Wou Ts-tien prit peur. Elle affecta de
reconnatre les droits de Tchong-tsong. En ralit elle continua gouverner
seule.
Matresse du pouvoir, elle y satisfaisait tous ses caprices. Bien que plus
que mre, elle prit pour favori un jeune bonze quelle fit aussitt nommer
suprieur dun des principaux couvents de I.o -yang avec licence dentrer au
palais toute heure du jour et de la nuit . Du reste, et en dehors des qualits
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
104
personnelles de son jeune chapelain, le bouddhisme intressait beaucoup la
vieille douairire. Chez cette femme extraordinaire la religiosit voisinait avec
tous les sursauts de la cruaut et de la luxure. Elle manifestait par passades
une grande dvotion. Cest ainsi quon la vit de 672 675 faire sculpter aux
grottes de Long-men, au sud de Lo-yang, le clbre grand bouddha rupestre
avec son entourage de bodhisattvas, de moines et de rois-gardiens. Et sans
doute de telles uvres, justement parce quelles ont remplac le mysti cisme et
l idalisme de jadis par une violence raliste quelque peu choquante, nous
clairent sur le genre de bouddhisme que pouvait goter Wou Ts-tien. Elles
nen tmoignent pas moins de lcla tante protection que la souveraine
accordait la foi. Cette protection se manifesta notamment lgard du
plerin bouddhiste Yi-tsing Yi-tsing tait un moine du Ho-pei qui, en 671,
stait em barqu pour lInde via Sumatra. Aprs vingt -quatre ans de sjour
aux sanctuaires bouddhiques de lInde et de lInde extrieure, il revint,
toujours par la voie maritime, en 695, avec un grand nombre de textes
sanscrits. A son arrive Lo-yang, Wou Ts-tien se porta sa rencontre avec
un immense cortge et mit tout sa disposition pour laider dans le travail de
traductions auquel il consacra le reste de sa vie.
Cependant le rgne de Wou Ts-tien touchait sa fin. Devant le
mcontentement de lopinion publique, devant aussi, on la vu, une menace
dintervention turque, elle stait dcide restaurer, nominalement tout au
moins, lempereur Tchong -tsong. En ralit elle continuait gouverner seule
avec ses nouveaux favoris, les frres Tchang. Mais un complot se tramait
contre elle. Une nuit de lan 705 les conjurs envahirent en armes le palais. Ils
rencontrrent le timide Tchong-tsong, lempereur sans pouvoir, laccla mrent,
lentranrent de force dans les appartements de Wou Ts -tien. La vieille
impratrice, rveille dans son sommeil, seule et sans dfense, ses favoris
gorgs ses pieds, tint encore tte la rvolte. Elle essaya une dernire fois
dintimider Tchong -tsong et peut-tre y serait-elle parvenue si les conjurs lui
en avaient laiss le temps. Mais ils lui mirent le poignard sur la gorge et
lobligrent abdiquer (22 fvrier 705). Elle mourut de dpit quelqu es mois
plus tard. Elle avait quatre-vingt-un ans.
Lempereur Tchong -tsong replac la tte des affaires se montra lhomme
bon et faible que nous connaissons. Son plus grand dlassement tait daller
sentretenir avec le moine bouddhiste Yi -tsing, tandis que celui-ci traduisait
en chinois les critures sanscrites rapportes de lInde. Tchong -tsong se
rappelait dailleurs que jadis, lorsquil tait perscut par son affreuse mre, il
avait longuement invoqu le bodhisattva, le bon mdecin des corps et des
mes, et que sa prire avait t exauce. Replac sur le trne par les
vnements de 705, il ne voulut pas se montrer ingrat envers ses clestes
protecteurs. Aussi mandait-il frquemment au palais les plus saints religieux
de la capitale, notamment Yi-tsing qui passa auprs de lui lt de 707.
Lempereur se rendait mme dans le couvent du plerin, sasseyait sur sa natte
et participait de sa propre main la traduction des critures indiennes.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
105
Mais laffectueuse collaboration du saint moine et du doux emper eur allait
tre bientt interrompue par un nouveau drame de palais. La femme de
Tchong-tsong, la jeune impratrice Wei, tait dplorablement lgre. Elle
avait pris pour amant un des neveux de la dfunte impratrice Wou Ts-tien,
le beau Wou San-sseu. Tchong-tsong abus ne sapercevait de rien. En vain
un jeune prince du sang, exaspr de ces turpitudes, poignarda Wou San-sseu
(707). Lempereur dsavoua le justicier. Finalement la Messaline chinoise que
ce fantme dpoux gnait encore, lempoisonna pour r gner seule (3 juillet
710). Mais elle navait pas la terrible autorit de Wou Ts -tien. Son crime,
aussitt que connu, provoqua la rvolte des membres de la famille impriale
conduits par le jeune prince Li Long-ki. Le 25 juillet, pendant la nuit, les
conjurs, renouvelant le drame de 705, envahirent le palais et abattirent
limpratrice coups de flches. Sa tte fut plante sur une pique et jete la
foule. Li Long-ki fit alors nommer empereur son propre pre, Jouei-tsong.
Pendant ce temps les Turcs de Mongolie et leur redoutable khan,
Bk-tchor, continuaient leurs ravages. En 706 le neveu de Bk-tchor,
Kul-tgin, avait remport sur les Chinois une grande victoire prs de Ning-hia,
au Kan-sou : Nous luttmes contre les Chinois, dit linscription fun raire de
Kul-tgin. Dabord Kul -tgin monta le cheval gris Tadiking-tchour et attaqua.
Ce cheval fut tu l. Alors il monta le cheval gris Ichpara-Yamatar et attaqua.
Et ce cheval aussi fut tu. Enfin il monta le cheval bai Kedimlig et pour la
troisime fois conduisit la charge. Droit dans son armure, il atteignit de ses
flches plus de cent ennemis. Son attaque est dans le souvenir de beaucoup
dentre vous, nobles Turcs. Et cette arme chinoise, nous lanantmes l !
Lempereur Jouei -tsong avait de grandes qualits morales, mais il ne se
sentait pas la vigueur ncessaire pour redresser la situation au-dedans et
lextrieur. Ne sachant que faire, il consulta un philosophe taoste. Celui -ci lui
conseilla la pratique de linertie cosmique selon la pure doctrine de Lao-tseu.
En quoi consiste la perfection du gouverneur ? Dans linaction ! Laissez
aller les choses et le monde se gouvernera de lui-mme. Jouei-tsong prfra
remettre le pouvoir son fils, le prince Li Long-ki, celui-l mme qui avait
excut limpratrice Wei et dont la brillante activit annonait un grand
rgne. Le 8 septembre 712 il abdiqua en faveur de Li Long-ki. Sous le nom de
Hiuan-tsong, celui-ci allait fournir un des plus grands rgnes de lhistoire
chinoise (712-756).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
106
CHAPITRE 19
Un grand sicle : au temps du pote Li Tai -po
Lempereur Hiuan -tsong son avnement navait que vingt -huit ans. Il
tait actif, courageux de sa personne il lavait prouv dans la dramatique
nuit du 25 juillet 710, avec un sentiment trs vif de ses devoirs, de la
grandeur de sa maison, du rle imprial de la Chine en Asie. Son rgne
(712-756) fut un des grands rgnes, son sicle fut bien des gards le Grand
Sicle de lhistoire chinoise. Rarement autant de talents se trouvrent
groups. Fort lettr, pote et musicien lui-mme, Hiuan-tsong protgea
personnellement les lettres et sentoura dune pliade de potes. Ce fut de son
temps que vcurent les deux plus grands lyriques de la Chine, Li Tai -po
(701-762) et Tou Fou (712-770).
Alors que la posie chinoise, faite en partie dallusions litt raires, nous
chappe trop souvent, les lyriques tang nous semblent plus accessibles parce
que les sentiments quils voquent participent dun humanisme universel.
Peut-tre ce caractre provient-il des sources multiples auxquelles le lyrisme
tang a puis. Si nous en analysons les lments, nous y retrouvons la fois la
grande rverie cosmique du vieux taosme, faite dun lan perdu vers le
divin, et la mlancolie bouddhique devant lcoulement universel des choses.
Cette double inspiration se marque quelques vers de distance dans les
pomes de Li Tai -po :
Le Fleuve Jaune coule vers locan de lest,
Le soleildescend vers la m er de louest.
Com m e le tem ps leau fuit pour toujours.
Ils ne suspendent jam ais leur course !
Q ue ne puis-je m onter sur un dragon cleste
Pour respirer lessence du soleilet de la lune
A fin dtre im m ortel!(41)
Parfois un vers de Li Tai -po (42) livre lui seul toute lme de
lenseignement bouddhique sur limpermanence universelle :
Les flots passent les uns aprs les autres,
et se poursuivent ternellem ent.
Quelquefois le ton est plus pre, plus dsespr, comme dans ce solvet
sculum du mme pote, qui se termine sur un vanitas vanitatum :
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
107
Le soleilet la lune steindront,
La terre retournera en cendre.
Toi,parce que tu ne vivras pas m ille ans,
Pourquoite plaindre que la vie soit courte ?
Et encore :
Vivre,cest voyager,
M ourir,cest retourner au sol.
Lunivers ressem ble une auberge,
Les annes quiscoulent, de la poussire.
O n se plaint en pensant au pass.
O n se plaindrait davantage sion songeait lavenir !
Voici enfin, toujours chez Li Tai -po, notre thme romantique : Jeter
lancre un seul jour :
Le voyageur sur la m er profite dun vent favorable,
Illve lancre et part pour de lointains pays.
Com m e loiseau quitraverse des nuages innom brables,
Son sillage ne laisse aucun souvenir.
Dautres pomes de Li Tai -po sont dinspiration nettement taoste :
Je joueraisur le kin lair de la fort de pins agits.
En levant m a coupe jinviteraila lune.
Le vent et la lune seront m es am is ternels.
M es sem blables dici-bas ne sont que des am is phm res.
Enfin, par-del le taosme mme, cette extraordinaire envole au symbole
transparent, propos du vieux mythe de loiseau rock :
Loiseau rock m onte,m onte.
Ses m ouvem ents branlent les quatre coins de la terre.
Soudain au sein du firm am ent
Son volse rom pt,ses ailes sont puises,iltom be,
M ais le vent provoqu par le battem ent de ses ailes
Troublera m ille et m ille sicles encore !
Quand ils ne slvent pas ces hauteurs, les po tes tang se contentent de
nous donner de la terre et des eaux, des monts et des lointains une vision qui
est proprement la cration du paysage. Voyez dj le distique clbre de
Wang Po (648-675) :
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
108
Les nuages bas volent avec le canard sauvage solitaire,
Leau autom nale se confond avec le cielsans fin.
Du peintre Wang Wei (699-759) ce vers qui est une peinture :
Les pluies se succdent sans trve.Fort dserte.
La fum e de la ferm e slve avec peine.
Chez Li Tai -po ces larges visions despace abond ent, traites dans une
manire impressionniste trs pntrante. Voici une marine , le lac
Tong-ting :
D e bon m atin jerre sur les bords du lac Tong-ting.
Je prom ne m es regards et nulobstacle
ne barre lhorizon.
Le lac tend son eau dorm ante et lim pide.
Cest bien un paysage dautom ne
D aspect glacialet m lancolique.
Cependant latm osphre est claire.
Les m ontagnes bleues se confondent avec les forts.
U ne voile apparat peu peu lhorizon lointain
Et des oiseaux senvolent dans laube.
La brise se lve sur la rive du ct de Tchang-cha
Et le givre blanchit les cham ps.
Vision despace, en montagne :
Les oiseaux ne dpassent pas le som m et de la m ontagne
Q uenveloppe le cielim m ense.
Je m onte sur le som m et pour contem pler
la vision grandiose.
L-bas le grand fleuve coule et ne revient pas
Et laquilon pourchasse les nuages sur dix m ille li.
Crpuscule :
A u crpuscule je passe au pied de la m ontagne bleue.
La lune sem ble m e suivre.
Je tourne la tte et regarde le chem in parcouru.
U ne brum e lgre voile le feuillage.
Nocturne :
U ne lueur argente pntre dans m a cham bre
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
109
Jusque devant m on lit.
Je la prends pour du givre.
Je lve la tte,japerois la lune
quise pose sur la colline.
Je baisse la tte et pense m on pays natal.
Bien entendu, lins piration bouddhique ou taoque ne manque pas de se
manifester avec le thme, classique dans la posie comme dans lart, de la
visite lermitage . Voici, toujours de Li Tai -po, lermitage bouddhique :
Le bonze du Sseu-tchouan possde une m andoline ;
Ildescend vers louest de la m ontagne
Et joue en m on honneur.
Les sons vibrants ressem blent au bruissem ent
dune fort de pins agits.
Com m e siltait lav dans leau de la rivire,
M on c ur se trouve purifi.
La m lodie sunit au tintem ent de la cloche lointaine.
Insensiblem ent le crpuscule tom be
Et les m ontagnes sestom pent dans le brouillard lger.
Et, du mme auteur, la visite lermitage taoste :
D es aboiem ents lointains se m lent
au chuchotem ent du ruisseau.
La pluie lgre ravive le rose de la fleur de pcher.
Parfois on entrevoit la silhouette dune biche craintive.
U ne rivire se droule,caressante ;
La cloche lointaine ne trouble pas son m urm ure.
D e-cide-l,quelques pointes de bam bous
percent le brouillard bleutre.
U ne cascade cum euse se suspend au flanc du m ont.
Je vous rends visite,m ais je ne vous rencontre pas.
M lancolique,je reviens en m appuyant
de tem ps en tem ps contre les pins robustes.
Mais il y aurait injustice ne pas citer ct de Li Tai -po son mule et
ami, lautre g rand pote tang, Tou Fou. Lui aussi est un paysagiste, comme le
prouve cette vision dautomne :
D ans le clair autom ne nulobstacle ne lim ite le regard.
A lhorizon slve une brum e lgre.
La rivire lointaine se confond avec le ciel.
U ne cit isole senfonce dans le brouillard laiteux.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
110
La brise fait tom ber encore de rares feuilles.
Le soleildescend derrire la colline serpertante.
Com m e la grue solitaire rentre tard !
D j dans le crpuscule les corbeaux
se pressent vers la fort.
Mais Li Tai -po et Tou Fou nont pas t seulement de grands lyriques.
Lamiti de lempereur Hiuan -tsong a fait deux des potes de cour. Ils ont
chant la vie inimitable au palais de Tchang -ngan, le charme de la favorite
impriale, la belle Yang Kouei-fei. Cette femme, aussi clbre par son esprit
que par sa beaut et qui devait tre la fois la Pompadour et la MarieAntoinette de la Chine , tait la matresse dun des fils de Hiuan -tsong
lorsque lempereur sprit delle, la spara de son fils et en fit sa bien -aime.
Cest elle que clbre Li Tai -po sous lallusion de lhirondelle :
Le prince choisit les jeunes fem m es
quilaccom pagneront.
Parm iles concurrentes quise pressent de toutes parts
Q uelle est la plus jolie ?
Cest lhirondelle volante quiloge dans le palais.
Et un peu plus loin, cet hommage dlicat :
Lorsquelle term ine son chant et sa danse,
Je crains quelle ne se transform e
en un nuage m ulticolore
Et ne m onte au ciel.
Un autre pome de Li Tai -po compos la demande de lempereur nous
dit de la favorite :
Le nuage ressem ble sa robe
Et la fleur son visage.
Tou Fou a clbr lui aussi :
Les desses dont le corps de jade est entour
dun nuage de parfum s.
Voici, de lui, une promenade la cour :
Sur les bords de la rivire de Tchang-ngan
se prom nent les belles.
D m arche onduleuse,esprit lointain,elles vont,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
111
srieuses et naturelles.
Leurs robes de soie sont brodes de dragons dor
et de licornes dargent.
D es fleurs dm eraude cachent leurs tem pes.
Parm ielles,sous de larges parasols sabritent
les s urs de Yang Kouei-fei.
Plus tard, aprs la dispersion de ces Trianons chinois et le massacre de la
favorite, Tou Fou se rappellera la vision dune de ces ftes de cour avec son
cortge damazones :
La prem ire des dam es du palais (Yang Kouei-fei)
A ccom pagnait lem pereur dans la m m e voiture.
D evant eux chevauchaient ses s urs elle,
portant larc et le carquois.
Leurs m ontures taient blanches avec des m ors prcieux.
Soudain lune delles,renversant le buste en arrire,
visa le ciel.
Elle riait,m ais dune seule flche
elle transpera deux oiseaux.
A la gnration suivante un autre pote clbre, Po Kiu-yi (772-846),
voquera son tour ces ftes galantes dans le Chant des regrets sans fin :
D ans la fam ille Yang une jeune fille naquit.
U n jour elle fut choisie pour dem eurer
aux cts du souverain.
A u frais printem ps elle fut autorise
se baigner dans ltang du palais.
A vec leau tide et claire de la source
elle lavait sa peau lisse com m e la glace.
Les suivantes la soutenaient,flexible et lasse.
Ctait la prem ire fois quelle recevait
les faveurs im priales.
A u-dessus de son visage de fleur les bandeaux de ses cheveux
relevs en form e de nuage taient orns
dune pingle dor et de perle.
Sous la tide m ousseline,brode de fleurs de lotus,
elle reposait pendant les nuits printanires,
M ais les nuits taient trop courtes et le soleil
se levait trop tt.
A lors lem pereur ne donna plus daudiences m atinales.
Les plaisirs,les festins ne luilaissaient aucun loisir.
Jour et nuit pour elle seule les am usem ents et la joie
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
112
jam ais ne sinterrom paient.
D ans le palais vivaient trois m ille fem m es
M ais les faveurs im priales se reportaient
sur un seulcorps.
A lintrieur de la M aison dO r,cline,
elle term inait sa toilette et attendait la nuit.
O u bien dans le Pavillon de Jade sachevaient des festins
dont la griserie saccordait livresse du printem ps.
Elle chantait et dansait doucem ent,et les instrum ents
ralentissaient alors leur rythm e.
Toute la journe le souverain la contem plait
sans pouvoir sen rassasier (43).
A dfaut de la peinture laque tang dont, exception faite de quelques
portraits de donatrices sur les fresques ou bannires de Touen-houang, il nous
reste peu de chose, on peut, pour voquer ces jeux lgants la cour de
Hiuan-tsong, venir voir voluer le petit peuple des figurines tang,
musiciennes et danseuses, grandes dames et suivantes, amazones et joueuses
de polo, aujourdhui si nombreuses parmi les terres cuites de nos muses.
La lgre polychromie qui avive leur teint et nuance leurs charpes ajoute
encore la grce de leurs attitudes. Autant quun vers de Li Tai -po et de Tou
Fou, elles ressuscitent pour nous le temps de la vie inimitable au palais de
Tchang -ngan (44). De mme la cavalerie tang, piaffante et selle, les
auxiliaires barbares au type ethnique si accus, voire les rois-gardiens
bouddhiques redisent dans nos collections les jours de lpope chinoise en
Asie depuis Tai -tsong jusqu Hiuan -tsong (45).
En effet la vie de cour nempchait nullement Hiuan -tsong de poursuivre
en Asie la politique dexpansion de son grand aeul. Ds les premires annes
de son rgne il eut la chance de se voir dbarrass de son principal ennemi,
Bk-tchor, roi des Turcs de Mongolie qui fut massacr dans une rvolte et
dont la tte fut envoye la cour de Chine (716). Le neveu et successeur de
Bk-tchor, Bilgqaghan ( le grand-khan sage ), fit sincrement la paix avec
lempire (721 -722). Des relations amicales sta blirent entre la brillante cour
de Tchang -ngan et la cour barbare du haut Orkhon, avec une dfrence
marque de la seconde envers la premire. En 743-744 le khanat des Turcs de
Mongolie fut dailleurs renvers par la rvolte de tribus congnres. A sa
place une de ces tribus, donc galement turque, celle des Ouighour,
sarrogea lempire de la Mongolie avec, pour centre, la mme rgion du haut
Orkhon o les Ouighour eurent leur capitale au site actuel de Qarabalghasoun
la ville noire prs de lactuel Qaraqoroum. Les Ouighour, nous 1e
verrons par la suite, devaient se montrer les allis fidles de la dynastie des
Tang.
Du ct des Turcs occidentaux ou Turcs du Turkestan russe actuel
(Smiretchi et Sir-darya), les Chinois avaient remport Toqmaq en 714 une
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
113
victoire dun grand retentissement qui ra mena dans la clientle impriale une
partie des tribus. En 736, en 744 nous voyons encore les gnraux impriaux
abattre divers khans turcs rebelles du Smiretchi (bassin de lIl i, au sud du
lac Balkhach). En 748 on lve signe visible de lextension de lempire
tang au Turkestan occidental un temple chinois Toqmaq, louest de
lIssyq -qoul. Au Tarim, les petits royaumes de Qarachahr, Koutcha, Khotan et
Kachgar, si longtemps indociles, taient redevenus des vassaux fidles. Ces
vieilles populations indo-europennes du Tarim trouvaient en effet dans le
protectorat chinois une dfense indispensable contre de nouveaux
envahisseurs, les Tibtains et les Arabes. Nous avons vu quen 670 les quatre
villes avaient t conquises par les Tibtains et que la Chine navait pu les
dlivrer quen 692. Nul doute quelles ne prfrassent la suzerainet des Tang
la domination de ces bandes tibtaines encore presque entirement sauvages.
Quant aux Arabes, depuis quen 652 ils avaient dtruit lempire sassanide et
soumis la Perse, ils avaient pouss leurs conqutes jusquen Transoxiane : en
709 ils avaient impos leur suzerainet aux rois de Boukhr et de Samarqand.
En 712-714 ils atteignirent Tachkend et pntrrent en Ferghna. Le roi du
Ferghna se rfugia en Kachgarie (46) o il implora laide des garnisons
chinoises. Sa requte fut immdiatement accepte. Ds 715 une arme
chinoise entra au Ferghna et le rtablit sur son trne en chassant les postes
arabes. Les rois de Boukhr et de Samarqand essayrent dob tenir une
intervention analogue, ainsi que le roi du Tokharestan ou Bactriane (pays de
Balkh en Afghanistan). De 718 731 on voit tous ces princes envoyer sans
cesse leurs dclarations de vassalit la cour de Chine. Lempereur
Hiuan-tsong rpondait en leur confrant des diplmes dinvestiture et en les
faisant aider contre les Arabes par les tribus turques soumises sa suzerainet,
mais il hsita toujours envoyer si loin un corps expditionnaire chinois. En
revanche il intervint de lautre ct du Pamir.
Cest que de ce ct il sagissait darrter lexpansion tibtaine. Les
Tibtains, la Chine les retrouvait maintenant partout. Elle tait notamment
oblige de soutenir contre eux une guerre de frontire puisante dans la
sauvage rgion du Koukou-nor. A lautre extrmit du Tibet, les Tibtains
menaaient les petits royaumes au sud du Pamir, sur le versant indien du
massif : le Wakhan, Gilgit et le Baltistan par o passait la route la plus directe
entre le protectorat chinois du Tarim et lInde. Or la Chine des Tang, unie au
monde indien par les liens du commerce et du plerinage bouddhique, tenait
essentiellement la libert du passage travers ces hautes valles
pamiriennes. Les Tibtains ayant impos leur suzerainet Gilgit, le gnral
imprial Kao Sien-tche, un Coren au service de la Chine et qui tait
gouverneur en second de Koutcha, franchit en 747 le Pamir par la passe de
Kilik ou le col de Baroghil, et tablit Gilgit le protectorat chinois. En 749 le
roi du Tokharestan (Balkh, au nord de lHindou kouch) ayant demand laide
des Chinois contre un petit chef montagnard alli des Tibtains et qui
interceptait les communications entre Gilgit et le Cachemire, Kao Sien-tche
franchit de nouveau le Pamir et nettoya une fois de plus la rgion (750). En
mme temps le rdja du Cachemire dune part, le chh du Kapia cest --dire
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
114
de Caboul de lautre, se montraient les fidles allis de la cour de Chine qui
leur envoya diverses reprises des brevets dinvestiture.
Installe sur les Tien-chan et le Pamir, matresse Tachkend, au Ferghna
et Gilgit, protectrice du Cachemire, protectrice de Balkh et de Caboul,
cest --dire de la meilleure partie de lactuel Afghanistan, invoque contre les
Arabes par les gens de Boukhr et de Samarqand, la Chine avait une situation
incomparable en Asie. De sa rsidence de Koutcha, Kao Sien-tche faisait
figure de vice-roi chinois de lAsie centrale.
Brusquement tout seffondra, et du fait de ce mme Kao Sien -tche qui
avait port si loin les armes chinoises.
Le roi turc de Tachkend, dans lactuel Turkestan russe, avait toujours t
un vassal fidle de la Chine dont il tait la sentinelle avance contre les
Arabes. Or en 750 Kao Sien-tche, pour sappro prier ses trsors, inventa contre
lui un grief imaginaire, se rendit chez lui avec une arme et le dcapita. Cet
acte de violence provoqua la rvolte des Turcs occidentaux. Le fils de la
victime implora laide des Ara bes qui sempressrent denvoyer son secours
leurs garnisons de Boukhr et de Samarqand. En juillet 751 Kao Sien-tche
fut encercl et cras sur les bords du Talas, prs de lactuel Aouli -Ata, par
les forces turco-arabes coalises. Les Arabes ramenrent Samarqand des
milliers de captifs chinois. Cette journe historique dcida du sort de lAsie
centrale ou tout au moins du Turkestan : au lieu de devenir chinois, comme la
tournure des vnements semblait lannoncer, il allait devenir musulman.
Peut-tre cependant le dsastre chinois du Talas aurait-il pu tre rpar,
mais il allait devenir irrmdiable parce quil con cida avec un affaissement
gnral de la puissance militaire des Tang. En cette mme anne 751, au
Yun-nan, prs du lac de Ta-li, les Nan-tchao, indignes de race lolo, taillrent
en pices une arme impriale, et, toujours en cette anne de malheur,
louest du Leao -ho, dans lactuel jehol, la horde mongole des Kitat dfit le
gnral chinois Ngan Lou-chan.
En ralit la Chine tait puise par son effort militaire. Lopi nion
publique tait lasse de ces expditions lointaines dont elle ne comprenait pas
lintrt, lasse surtout de la conscription. Les potes de cour eux -mmes,
comme Li Tai -po, ne nous ont rien laiss ignorer de cet tat desprit :
La Grande M uraille quispare la Chine du grand dsert
Serpente jusqu linfini.
D e part et dautre de la frontire
A ucune ville ne subsiste plus aujourdhui.
et l quelques ossem ents hum ains pars
Sem blent exprim er leur haine ternelle.
A rrachs leurs foyers,trois cent soixante m ille hom m es
Pleurent en disant adieu leur fam ille.
Puisque cest lordre du prince,on doit obir,
M ais com m ent pourra-t-on encore cultiver les cham ps ?
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
115
Cest surtout chez Tou Fou que se manifeste cette lassi tude, bien quil
dguise sa critique en la transposant lpoque des Han. Voici, sur ce thme,
la chanson des chars de guerre qui date prcisment de 752 :
Les chars de guerre savancent en grinant,
Les chevaux les tranent en hennissant.
Les soldats portent au flanc leurs arcs et leurs flches.
Leurs parents,leurs pouses leur font cortge.
Tous,retenant les tres chers par leurs vtem ents,
Tentent de barrer la route la colonne et sanglotent.
H las !les m obilisations se succdent.
A lge de quinze ans on part dans le nord pour garder le Fleuve Jaune.
A lge de quarante ans on est
soldat laboureur dans louest.,
A g,cheveux blancs, peine de retour,
on est de nouveau m obilis.
A la frontire le sang coule flots.
M ais lam bition guerrire de lem pereur
nest jam ais satisfaite.
Et pourtant les cham ps cultivs sont abandonns
et chaque village est envahipar les ronces.
Et tandis quon m obilise partout
pour les confins occidentaux,
Le sous-prfet taxe oppressivem ent les rcoltes.
Com m ent pourrait-on le payer ?
O h !vraim ent avoir des garons est un m alheur.
N e voyez-vous pas quautour du Koukounor
Les squelettes blanchis restent exposs depuis lantiquit ?
Les m nes des m orts rcents exprim ent leurs regrets,
les m nes des anciens pleurent ;
Par tem ps som bre et pluvieux ils poussent des cris aigus.
Sous la rubrique de lanne suivante (753), la critique de Tou Fou se fait
plus directe :
Tristes,tristes,les soldats quittent leur pays natal.
Ils vont au-del de Tourfan
O les attend le filet du m alheur.
Le souverain possde dj un vaste em pire.
Pourquoipense-t-ilencore ltendre ?
Voici les recrues arrives en haute Asie :
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
116
Ilneige,larm e pntre dans les hautes m ontagnes.
Le sentier est prilleux ;de peur de glisser
on saccroche de rocher en rocher.
Les doigts gels glissent contre la glace paisse
de plusieurs couches.
Icion est loin du soldes H an.
Q uand se contentera-t-on de construire une m uraille
contre les barbares ? quand retournera-t-on
au pays natal?
Le pis est que Tou Fou compare la misre du peuple au luxe de la cour, en
particulier aux richesses accumules par la famille de la favorite :
A la cour on distribue des rouleaux de soie
Q ue les fem m es pauvres ont tisss.
Pour les leur arracher et les offrir lem pereur
on a fait battre de verges leurs m aris.
D e plus jaientendu dire que tous les plats dor
du palais im prial
Em igrent peu peu dans la fam ille de la favorite.
A u palais ily a telle abondance quon laisse
se corrom pre les viandes et saigrir les vins
Cependant que dans la rue les gens m eurent
de m isre et de froid (47).
Le milieu tait prt pour une rvolte. Elle vint du ct o on let attendue
le moins, dun gnral de cour, Ngan Lou-chan. Ce personnage tait un
aventurier tartare au service de la Chine. Lem pereur et la belle Yang Koueifei staient engous de lui au point den faire leur favori. Mais Ngan
Lou-chan, au courant de la dsaffection dont les souverains taient lobjet,
leva brusquement ltendard de la rvolte en 755 dans son gouvernement
militaire du Leao-tong. En quelques semaines il traversa le Ho-pei, descendit
sur Lo-yang, sen empara et marcha sur Tchang -ngan, la capitale impriale.
A son approche lempereur Hiuan -tsong sen fuit pendant la nuit vers le
Sseu-tchouan avec Yang Kouei -fei, les deux surs de celle -ci et un sien
cousin dont elle avait fait un ministre. En cours de route, les soldats de
lescorte, manquant de vivres, se mutinrent. Il s massacrrent le ministre,
cousin de Yang Kouei-fei, piqurent sa tte sur une lance et vinrent la
prsenter lempereur. Ils coururent ensuite gorger de mme les deux surs
de la favorite. Effray par leurs clameurs, lempe reur sortit et essaya de les
calmer par de bonnes paroles, mais les mutins exigeaient maintenant la tte de
Yang Kouei-fei elle-mme. Hiuan-tsong, assig par lmeute, laissa
emmener la malheureuse qui fut trangle par les soldats ; satisfaits, ceux-ci
reformrent alors leurs rangs.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
117
Tou Fou, qui avait nagure clbr Yang Kouei-fei au temps de sa
splendeur, devait en un poignant pome pleurer sa fin tragique :
O sont donc m aintenant ces prunelles brillantes
et ces dents nacres ?
Le sang souille lm e quine reviendra jam ais.
Le souverain et sa favorite ne se reverront plus.
A la gnration suivante, le pote Po Kiu-yi (772-846), dans le Chant des
regrets sans fin, chantera son tour cette fin dramatique :
Voicique le roulem ent des tam bours m ilitaires
a fait trem bler le sol.
Ilcoupe net le Chant de la Jupe diapre.
La fum e et la poussire slvent
aux neuf portes du Palais.
M ille voitures senfuient vers le sud-ouest.
Les drapeaux im priaux flottent,puis sim m obilisent.
O n na encore franchiquune centaine de li
a louest de la capitale
Et soudain les six lgions de la Garde sinsurgent
et ne veulent plus avancer.
Cest alors quau m ilieu des cavaliers prit la belle
aux sourcils de papillon.
Ses ornem ents en form e de fleurs jonchaient le sol
et nulne les ram assa.
N ulne ram assa lornem ent de sa coiffure,le m oineau
dor orn de plum es de m artin-pcheur,
nison pingle cheveux en jade.
Lem pereur,cachant son visage,navait pu la sauver.
Iltourna la tte,regarda encore.
Ses larm es coulaient avec du sang ...
H las !le cielet la terre passeront,
tandis que ses regrets seront ternels (48).
Pendant ce temps Ngan Lou-chan occupait Tchang -ngan, la capitale
impriale (18 juillet 756). Le lamentable Hiuan-tsong continua sa fuite vers le
Sseu-tcho uan, ce qui tait une abdication. Son fils Sou-tsong alla se mettre
la tte des forces loyalistes dans la rgion de Ning-hia, au Kan-sou, sur la
frontire nord-ouest de la Chine, o ses soldats le proclamrent empereur (12
aot 756).
Sou-tsong, prince actif et plein de bonne volont, dut consacrer tout son
rgne (756-762) la reconqute de la Chine sur les rebelles. Il fut second
dans cette tche par un grand soldat, Kouo Tseu-yi, modle de loyaut
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
118
militaire et de dvouement dynastique auquel plus qu tout autre la maison
des Tang allait devoir sa restauration. Pour se procurer des renforts,
Sou-tsong sadressa aux Turcs auprs desquels, depuis Tai -tsong, le prestige
de la dynastie tang restait considrable. La plus puissante des nations turques,
celle des Ouighour, pour lors, on la vu, matresse de la haute Mongolie, lui
envoya des contingents grce auxquels les Impriaux purent reprendre aux
rebelles Tchang -ngan et Lo-yang (757). Mais la rvolte tait loin dtre
touffe, et Sou-tsong mourut la peine (mai 762). Les rebelles semparrent
mme une seconde fois de Lo-yang. Pour les en chasser dfinitivement, pour
en finir avec eux, il fallut lintervention du roi des Ouighour en personne,
descendu de Mongolie avec sa cavalerie (novembre 762).
Au cours de cette campagne le roi ou qaghan des Ouighour fit en Chine la
connaissance dun prtre manichen. Le manichisme, on le sait, tait une
religion mixte fonde en Perse au IIIe sicle avec des lments emprunts
partie au mazdisme indigne, partie au christianisme. A la suite de cette
rencontre, le prince ouighour se convertit au manichisme et en fit la religion
dtat de son peuple. Curieuse destine que celle de cette doctrine aberrante,
qui, aprs avoir failli entraner ladhsion de saint August in, faisait maintenant
la conqute de la Mongolie. Il faut dailleurs reconnatre que le manichisme
contribua adoucir les murs des Ouighour. Par ailleurs il propagea chez eux
un art en grande partie emprunt, comme ses dogmes, lIran. Les fresques et
miniatures manichennes de la rgion de Tourfan (entre 800 et 840 environ)
se trouvent en ralit les premires peintures persanes parvenues jusqu nous.
La dynastie des Tang navait rien refuser ces rois ouighour qui
lavaient sauve et restaure : elle leur accorda mme diverses reprises la
main dinfantes chinoises. Les Ouighour pro fitrent de leur influence pour
protger le manichisme en Chine. A leur demande la cour de Tchang -ngan
dut autoriser la cration de temples manichens dans plusieurs grandes villes.
Cette protection dura autant que la domination ouighoure. Quand cette
dernire seffondra en Mongolie sous les coups des Turcs Kirghiz en 840, les
communauts manichennes de Chine se virent du jour au lendemain
proscrites.
Le christianisme sous sa forme nestorienne bnficia au contraire de la
faveur peu prs constante des Tang. Nous avons signal la construction
dune premire glise nestorienne Tchang -ngan en 638. La mme anne
lempereur Tai -tsong le Grand prit en faveur de la communaut un dit qui
fait le plus grand honneur lesprit de tolrance de la dynastie : La vraie loi
(religieuse) na pas quun seul nom. Les saints nont pas de rsidence fixe. Ils
parcourent le monde, rpandant la religion, exhortant le peuple et secourant en
secret la multitude. A-lo-pen, homme dune grande vertu, est venu du
royaume loign de Ta-tsin pour nous offrir des livres sacrs contenant une
nouvelle doctrine dont il nous a expliqu le sens. En parcourant ces livres, en
examinant cette doctrine, on la trouve profonde, merveilleuse et parfaite,
particulirement profitable lhomme. Linscription qui relate ces faits fut
grave Tchang -ngan en 781, avec une double lgende, syriaque et chinoise.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
119
Ce texte clbre commence par un rsum du dogme chrtien ( la religion
radieuse ) et continue par le rcit des faveurs accordes la communaut
nestorienne par les empereurs Tang depuis Tai -tsong le Grand, notamment
par Hiuan-tsong qui orna lglise de Tchang -ngan dune inscription log ieuse
trace de sa propre main. Le nestorianisme ne devait avoir souffrir quen
845, lorsquil fut englob dans une perscution dclenche contre le
bouddhisme.
Mais manichisme et nestorianisme ntaient que des doctrines peu
rpandues, pratiquement rserves aux rsidants iraniens ou turcs. En fait, la
lutte des ides restait circonscrite entre confucens , taostes et
bouddhistes. Dans la seconde moiti du rgne de Hiuan-tsong, prince qui avait
fini par se laisser grandement influencer par les taostes, les livres taoques
furent pour la premire fois runis en 745 en une collection unique, base du
futur canon de la doctrine. De mme en 837 on procda la gravure en creux,
sur pierre, du texte des neufs traits du canon confucen : les lettrs purent
ainsi estamper volont ce texte, ce qui, on la dit, quivalait une premire
bauche d imprimerie . Enfin nous avons vu quen ce qui concerne le
bouddhisme, les plerins comme Hiuan-tsang et Yi-tsing ramenrent de lInde
en Chine des bibliothques entires de textes sanscrits que lon tra duisit
aussitt en langue chinoise (49). Lnorme somme du Tripi taka chinois atteste
limportance de cet effort.
Au nom de la vieille sagesse confucenne, les lettrs protestaient avec
nergie contre la vague de mysticisme qui dferlait la fois avec le
bouddhisme et avec le taosme. Lempereur Hien -tsong, partag entre ces
deux croyances, reut en grande pompe en 819 des reliques du Bouddha. Il en
fut blm par un des plus clbres lettrs tang, lcrivain Han Yu, dans un
placet vhment, souvent cit aujourdhui encore : Le Bouddha ntait quun
barbare qui ne connaissait pas notre langue et ignorait jusqu la coupe de nos
vtements. Esprit honnte et courageux, un peu troit peut-tre, Han Yu
rangeait dans la mme rprobation bouddhisme et taosme, galement
condamns par lui comme antisociaux et anticiviques. Les uns et les autres
prtendent gouverner leur cur, mais ils rejettent le pays et la fa mille, ils
teignent les lois naturelles, ils sont fils et ne considrent pas leur pre comme
pre, ils sont sujets et ne considrent pas leur prince comme prince, ils sont
hommes et ne travaillent pas. Nous retrouverons tout au long de lhistoire
chinoise ces attaques des lettrs contre le monachisme et loisivet
bouddhiques, contre la passivit ou lalchimie et la sorcellerie taoques.
Toutefois confucisme et taosme pouvaient, le cas chant, sunir contre la
religion trangre , contre le bouddhisme. Cest ce qui arr iva en 845, lorsque
lempereur Wou -tsong, qui tait personnellement adonn au taosme,
promulgua contre les bouddhistes un dit o il reprenait tous les arguments de
Han Yu. Il lacisa un grand nombre de moines et fit fermer 4.600 bonzeries et
pagodes. Mais son deuxime successeur, Yi-tsong (860-873), fut un
bouddhiste pieux sous lequel les bonzes recouvrrent toute leur influence.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
120
Le bouddhisme dailleurs tait en train de prendre dfinitive ment pied en
Chine, prcisment parce quil y devenait chinois.
Le bouddhisme tardif, tel qu lpoque des Tang il tait ap port de lInde
du Nord en Chine travers le bassin du Tarim, tait une forme trs volue de
lantique religion indienne, pres que une religion nouvelle. On a dj vu qu
la doctrine, somme toute assez simple, prche par le Bouddha historique,
staient superposes dans lInde mme, partir du commence ment de notre
re, une mtaphysique et une mythologie inattendues. Cette transformation
tait luvre des coles dites du Mahyna ou Grand Vhicule du salut. Une
partie dentre elles professaient au point de vue philosophique un idalisme
absolu, ou plus exactement un monisme idaliste un peu analogue au systme
de Fichte et qui, dissolvant la fois le moi et le monde extrieur, ne laissait
finalement subsister que le rien-que-pense , le monde des idaux . Tel
tait, on la vu, le systme rapport de lInde par le plerin Hiuan -tsang. Des
conceptions assez semblables formaient la trame dun autre systme fo nd
dans les dernires annes du VIe sicle de notre re par un bouddhiste chinois
sur le mont Tien-tai, au Tch -kiang. La doctrine du Tien-tai retrouvait
dans lcoulement universel qui, selon le bouddhisme, constitue le monde,
lessence universelle dont la conqute permettra au fidle de parvenir la
bouddhit. On aboutissait ainsi une sorte de monisme mystique dans lequel
il ne serait pas difficile de dceler des infiltrations taostes : les sence
universelle du Tien-tai se prsente comme une rplique du tao, tel que nous
lavons plus haut dfini . Une autre secte bouddhique, dite de la
contemplation (dhyina en sanscrit, tchan en chinois), sattachait galement par
la voie intuitive dcouvrir au fond du cur less ence de la bouddhit. Et
sans doute cette replonge intrieure, cet affouillement mystique peut se
rclamer de toute lascse des yogi indiens, aussi bien brahma nistes que
bouddhistes. Il nen est pas moins vrai que nous nous sentons ici encore
pntrs, comme en une insensible osmose, de concepts taoques. La
contemplation du Tchan ne se diffrencie gure de lextase taoste, telle que
nous avons essay de la dfinir. Mais si le vieux taosme indigne influenait
ainsi lvolution du bouddhisme, la rcip roque ntait pas moins vraie. A
limitation du bouddhisme le taosme sefforait maintenant de sorganiser en
glise et ses sages se groupaient en communauts sur le modle des couvents
indiens.
Ce qui dans le bouddhisme attirait le plus les foules chinoises, ctait sans
doute sa mythologie, ctaient les nombreuses dvotions auxquelles elle
donnait lieu et tout dabord le culte des bodhisattva, ces tres surnaturels crs
pour suppler le Bouddha historique. Une telle cration simposait. Une
religion a besoin de sassurer de clestes protecteurs qui puissent sadresser
les supplications des fidles. Or le bouddhisme avait exclu toute notion
dAbsolu ; et comment prier le Bouddha historique dont la personnalit (toute
la doctrine bouddhique rside dans cette affirmation) est entre dans le
nirvna, cest --dire dans lextinction dfinitive ? Aussi partir des environs
de notre re, le bouddhisme du Grand Vhicule fit-il, dans lInde mme, une
place considrable un vritable Messie, le bodhisattva Maitreya (Mi-lo-fo en
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
121
chinois) qui doit sincarner son tour et, comme la fait jadis le Bouddha
kyamouni, sauver nouveau le monde. Pendant les six premiers sicles de
notre re environ, la pit des foules se tourna vers ce Messie qui, en Chine,
joue encore un assez grand rle dans liconographie wei, Yun -kang et
Long-men. Puis, le Messie tardant apparatre, le messianisme insensiblement
diminua. La pit populaire se porta vers un autre bodhisattva, vers
Avalokitvara, sorte de Providence bouddhique (son nom signifie en
sanscrit : celui qui regarde den haut ). Par une curieuse mtamorphose, ce
bodhisattva sembla, en Chine, revtir une apparence fminine : Avalotvara
devint la desse Kouan-yin, sorte de madone toute de mansutude et de
compassion qui sauve les mes, les retire des enfers et les fait renatre ses
pieds, dans le lotus mystique, en de merveilleux paradis. Kouan-yin partagea
ce rle avec une autre divinit, le dhyni-bouddha (bouddha mystique)
Amitbha (A-mi-to) qui est considr comme son pre spirituel et dont elle
porte limage dans ses cheveux. La dvotion Amitbha, lamidisme,
donnera naissance une religion du cur, un culte nettement personnel, un
vritable pitisme, mieux encore : un quitisme fait dune confiance sans
limite en la bont du bodhisattva puisquun seul regard de compassion de
celui-ci, comme une seule invocation lui adresse du fond du cur, suffit
nous sauver.
Cette religion personnelle, toute de tendresse et de confiance, valut sans
doute plus dadeptes au bouddhisme dans la masse du peuple chinois que les
spculations des philosophes. Ni le confucisme ni le taosme ne pouvaient
prsenter rien de pareil. La desse Kouan-yin fut adopte par les foules au
point de prendre place dans le panthon populaire ct des divinits taoques
ou confucennes, adopte par le taosme lui-mme. A ce titre elle occupe
aujourdhui encore une place de premier rang dans le syncrtisme de toute
provenance qui constitue la religion des foules chinoises.
Les bannires de lpoque des Tang ou des Cinq Dynasties, rapportes de
Touen-houang au muse Guimet par M. Pelliot nous montrent ces divers
cultes bouddhiques en voie dvolution : le messianisme maitreyen y rivalise
avec les paradis dAvaloki tvara, et lAvalokitvara indien y devient sous
nos yeux la Kouan-yin chinoise. Cest en quoi les fameuses grottes
bouddhiques de Touen-houang sont particulirement intressantes. Touenhouang nest pas seulement la plaque tournante o lon passe de lart encore
indianisant du Tarim lart chinois. Cest aussi, tant au point de vue de
liconographie que du dogme, et aprs la conqute de la Chine par le
bouddhisme, un tmoin unique de la contre-annexion du bouddhisme par la
Chine.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
122
CHAPITRE 20
Crise sociale et ruine de ltat
La Chine des Tang ne se remit jamais compltement de la secousse
cause par la rvolte de Ngan Lou-chan. La restauration impriale qui parut
terminer le drame ne russit point ramener lancienne prosprit. P endant les
troubles la Chine avait perdu, exception faite de lAnnam -Tonkin, toutes ses
possessions extrieures. Les huit annes de guerre civile (755-763) avec leur
bilan de pillages, de destruction de richesses, dabandon des cultures,
provoqurent une norme diminution de la population. A la veille de la guerre
civile, aprs cent quarante ans de paix intrieure, le recensement de 754 avait
accus un nombre de familles quivalant 52 millions dhabitants. En 839,
quand cependant la restauration avait eu dj trois quarts de sicle pour
effacer les maux de la guerre civile, le recensement ne donnait plus que 30
millions.
Cet appauvrissement dmographique saccompagnait dune crise
conomique et sociale sans prcdent. A lpoque tang, ltat restait
thoriquement propritaire de tout le sol chinois. En ralit, il se contentait
den tre le rpartiteur. En arrivant lge dhomme, tout paysan recevait sur
les terres du village une concession viagre de 3 6 hectares et une
proprit , transmissible ses descendants, dun hectare et demi au plus, le
tout inalinable. Ces concessions paysannes avaient comme contrepartie
limpt foncier, la corve et le service dans la milice. A la mort du
concessionnaire, le lot de terrain revenait aux biens communaux en vue dune
nouvelle rpartition. Seuls les fonctionnaires pouvaient acqurir de grandes
proprits et, surtout, les conserver hrditairement. Les grands propritaires
ainsi crs faisaient cultiver leurs terres par des ouvriers agricoles pays
la nne. Ces grands domaines taient soit exploits par des rgisseurs, soit
lous des fermiers.
Or, la petite proprit paysanne, base dans chaque village sur la
concession viagre de lopins de terre aux cultivateurs, disparut brusquement
au milieu du VIIIe sicle. La rvolte de Ngan Lou-chan avait, on la vu, ruin
les finances impriales et la rpression avait exig la leve de milices de plus
en plus considrables. Les impts, les corves, le service militaire devinrent si
lourds, crit Henri Maspero, les dettes des ruraux si pressantes que les
paysans, malgr les interdictions, vendirent en masse leurs terres aux grands
propritaires pour se faire fermiers ou ouvriers agricoles, cest --dire
pratiquement serfs. La petite proprit disparut ainsi au bnfice des
latifundia. A la fin du VIIIe sicle les familles de propritaires ne
reprsentaient plus que le 5 % de la population. Au lieu dun peuple de
paysans aiss, la Chine ne possda plus quune sorte de proltariat agricole.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
123
Le commerce, de son ct, tait ruin. Pour remplir le trsor vid par la
guerre civile, ltat, dans les annes 781 -783, avait confisqu une partie des
biens des marchands. Tchang -ngan, la capitale impriale, qui tait le
principal centre commercial de la Chine comme point de dpart de la route de
la soie et point darrive des caravanes venues de lIran et de lInde, se trouva,
aprs lexcution de ces mesures, aussi dvaste quaprs une mise sac par
les barbares. Les prlvements fiscaux furent si brutaux quils provoquren t
des meutes. Ltat nen maintint pas moins un impt fort lourd sur les
achats, ventes, oprations commerciales et transactions de toute sorte. Nous
savons par exemple quen 793 le th venant de Sseu -tchouan subissait encore
une taxe de 10 %.
Il y avait l, rassembls, tous les lments dune rvolution. Elle
commena la fin de lanne 874. Le principal promoteur en fut un lettr
aigri, nomm Houang Tchao, qui une injustice flagrante avait donn une
mentalit de dclass, personnage fort intelligent dailleurs et dune nergie
sans scrupules. La rvolte clata aux confins du Ho-pei mridional et du
Chan-tong, rgion qui, des Turbans jaunes aux Boxers, a toujours t le point
de dpart de tous les mouvements analogues. Il sagit, on la vu, dun pays
surpeupl, de villages ltroit , dans une basse plaine de lss et
dalluvions o aucun pouce de terrain nest perdu, mais expose tour tour
la scheresse ou des inondations qui font prir les rcoltes et provoquent de
terribles famines. Le mouvement de 874 se prsente en effet comme une
jacquerie, un soulvement de malheureux qui sorganisent en Grandes
Compagnies pour se livrer au pillage. Pour combattre la rvolte, le
gouvernement prit une mesure qui naboutit qu la favoriser et la re ndre
gnrale : il ordonna la population de sarmer contre les rebelles et lui en
fournit les moyens. Aussitt arms, les paysans que les excs de limpt
avaient obligs vendre leurs terres et les boutiquiers galement ruins par le
fisc sempressren t de se joindre la jacquerie.
Houang Tchao amalgama tous ces lments et, en quelques mois, une
partie du Chan-tong, puis la riche plaine de Kai -fong, au Ho-nan, furent
pouvantablement ravages. De l il conduisit ses bandes piller les grands
ports de la Chine mridionale, Fou-tcheou (878) et Canton (879). Canton tait
une des plus grandes places de commerce de ce temps, le port o abordaient
les plus grands navires trangers, lentrept de tout le trafic maritime . Les
gographes arabes, qui la connaissent sous le nom de Khnfo, nous
apprennent quelle renfermait une trs importante colonie de marchands
arabes et persans de toute confession musulmans, nestoriens, manichens
et juifs, tablis pour lexportation de la soie, des porcelaines, du t h, de
lalos, du camphre et des autres produits du inistn . Devant larrive
des bandes de Houang Tchao, les Cantonais fermrent leurs portes et il dut
entreprendre un sige en rgle. Houang Tchao offrit la paix si la cour le
nommait gouverneur de Canton. Les ministres refusrent, ne voulant pas
livrer un rebelle les immenses richesses que renfermait la ville . Il la prit
dassaut, massacra toute la population, y compris la colonie arabe, et pilla de
fond en comble les entrepts. De plus il coupa les mriers de tout ce pays,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
124
de sorte quil ny eut plus, pour longtemps, de soie expdier dans lem pire
arabe (automne de 879). Cependant les jacques de Houang Tchao,
originaires des provinces septentrionales, souffraient du climat tropical de
Canton ; la malaria les dcimait. Il les ramena vers le nord et sempara des
capitales impriales, Lo-yang et Tchang -ngan, o tout fut saccag et
massacr (22 dcembre 880, 15 janvier 881), pendant que la cour senfuyait
une fois de plus au Sseu-tchouan.
Dans cette extrmit, la dynastie tang fit appel une horde turque, dite la
horde du dsert de sable Tchl en turc, Cha-to en chinois. Les Cha -to,
originaires en effet du Gobi, avaient t tablis comme fdrs dans la boucle
des Ordos. A la faveur de la guerre civile, ils venaient de sinstaller dans la
partie septentrionale du Chan-si (878). Leur chef, Li Ko -yong, navait que
vingt-huit ans. Cest une des figures les plus sympathiques de son temps. La
bravoure et la loyaut de ce Turc contrastent avec les tares des autres
protagonistes du drame o sombrait la Chine des Tang. Ce fut lui que la
cour sadressa pour la sauver des rvolts. Il accepta et ds lors voua la
famille des Tang une fidlit qui ne se dmentit jamais. Ses cavalier s (quon
appelait les Corbeaux de Li Ko -yong parce quils portaient un uniforme
noir) descendirent du Chan-si sur Tchang -ngan. L les troupes de Houang
Tchao fondaient vue dil : les jacques, aprs le pillage de la capitale, ne
songeaient qu me ttre leur butin en scurit et dsertaient les uns aprs les
autres pour regagner leurs villages. Au commencement de 883, Li Ko -yong
chassa leurs dernires bandes et rappela lempereur. La cour revint donc dans
la capitale. Les herbes et les broussailles poussaient dans les rues dsertes o
les livres et les renards avaient tabli leur gte : Houang Tchao se rfugia
au Chan-tong o il fut tu. Son principal lieutenant, Tchou Wen, stait ralli
temps la cause impriale et avait obtenu pour prix de ce ralliement un fief
important au Ho-nan autour de Kai -fong. Quant Li Ko -yong, le sauveur de
la dynastie, il reut de mme la province du Chan-si laquelle il ajouta peu
aprs le nord du Ho-pei.
En ralit, ce ntaient l que les exemples les plus marquants du
lotissement gnral de lempire. A la faveur de la guerre civile et de
larmement des milices locales, gouverneurs de pro vinces et commandants
darmes staient rendus pratiquement indpendants : une fodalit
hrditaire sinstallait parto ut, comme chez nous la mme poque (et dans
des circonstances un peu analogues), lors de la chute de lempire carolingien.
Toute la Chine du Sud se trouva bientt partage de la sorte entre sept
dynasties provinciales, tandis que dans le nord, le pouvoir tait disput entre le
chef turc Li Ko -yong et le capitaine de bandits Tchou Wen.
Ce fut Tchou Wen qui lemporta. Li Ko -yong tait entrav par ses
scrupules loyalistes : ce Turc chevaleresque ne voulait pas violer le serment de
fidlit quil avait prt la dynastie des Tang. De telles considrations
nembarrassaient gure Tchou Wen. Lancien capitaine dcorcheurs chercha
mme se dfaire de son rival en lattirant dans un guet -apens : il linvita un
banquet, lenivra, puis le fit assaillir par un e bande dassassins. Les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
125
compagnons de Li Ko -yong le rveillrent en lui versant de leau frache sur
le visage et purent le faire chapper en le descendant du haut du rempart par
une corde. Tchou Wen traitait dailleurs ses propres soldats avec non moin s de
brutalit : il leur faisait tatouer sur la face le numro de leur rgiment, de sorte
que tout dserteur, facilement reconnu, tait aussitt dcapit. Ayant attir
dans son fief du Ho-nan la famille impriale, il fit assassiner lempereur (22
septembre 904) ; un peu plus tard il runit les frres de la victime dans un
banquet lissue duquel il les massacra tous, au nombre de huit (905). Il avait
mis sur le trne un dernier prince tang, g de treize ans. Le 12 mai 907 il
dposa cet enfant (il le fit excuter neuf mois aprs) et se proclama lui-mme
empereur.
Pour un demi-sicle le monde chinois retombait dans lanarchie. Nous
avons vu que sept dynasties provinciales staient partag la Chine du Sud.
Dans le domaine imprial, rduit aux provinces du nord, avec le Ho-nan
comme centre, la maison de Tchou Wen ne garda le pouvoir que seize ans.
Elle en fut chasse par la famille de Li Ko -yong, mais celle-ci ne rgna son
tour que treize ans (923-936), remplace ensuite par une autre famille de
mme origine, cest --dire turque comme elle-mme. Encore les Turcs en
question, les Cha-to, taient -ils maintenant tout fait siniss. Mais voici
quapparaissait dans la rgion de Pkin une horde reste purement barbare et
qui allait rclamer sa part du lotissement chinois : les Kitat.
Les Kitat (50) taient un peuple de race mongole qui nomadisait aux
confins de la Mandchourie mridionale et de la Chine, dans le bassin du
Charamurn, entre Leao-yang et Dolon-nor, au nord-est de Pkin. L occasion
dintervenir dans les affaires chinoises leur fut offerte par les Chinois
eux-mmes. En 936 un gnral chinois, Che King-tang, rvolt contre la cour
impriale, fit appel eux. Leur khan, Ye-liu T-kouang, descendit au Ho-pei
avec 50.000 cavaliers et aida Che King-tang sinstaller Kai -fong comme
fondateur dune nouvelle dynastie impriale. Pour prix de leur intervention,
les Kitat se firent cder par leur protg lextrme nord du Ho -pei, y compris
lactuel Pkin, et lextrme nord du Chan -si, y compris Ta-tong (936). Ctait
linstallation des barbares lintrieur de la Grande Muraille, dans ces
marches du nord do ils pouvaient contrler leur gr toute la politique
chinoise. La trahison de Che King-tang ouvrait la premire brche da ns
lintgrit du territoire chinois, brche qui ira ensuite slar gissant et par o
toutes les hordes sengouffreront pour conqurir toute la Chine du Nord au
XIIe sicle, toute la Chine au XIIIe. Pkin, occup par Ye-liu T-kouang,
passera de la horde mongole des Kitat la horde tongouse des Djurtcht, puis
des Djurtcht aux Mongols gengiskhanides et restera ainsi au pouvoir des
tribus tartares de 936 1368.
Du reste, les consquences de loccupation de Pkin par les Kitat ne
tardrent pas se faire sentir au dtriment de ceux-l mmes qui lavaient
livr. Le successeur de Che King-tang, ayant voulu saffranchir de lonreuse
protection des Kitat, attira sur lui une nouvelle invasion. Le 25 janvier 947 le
khan kitan Ye-liu T-kouang fit son entre dans Kai -fong, la capitale imp-
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
126
riale. Il ne reprit le chemin de Pkin quaprs avoir conscien cieusement
saccag la ville et en tranant sa suite toute la cour chinoise prisonnire.
Aprs le dpart des Kitat, une nouvelle maison chinoise monta sur le trne de
Kai -fong, sans dailleurs pouvoir le conserver plus de quatre ans (947 -951)
Lorsquune grande dynastie impriale, celle des Song, y accda son tour
(fvrier 960), le morcellement tait encore accru par la cration dun nouveau
royaume chinois dissident tabli au Chan-si avec Tai -yuan pour capitale. Si
lon se rappelle que la Chine du Sud avait dj t partage entre sept
royaumes indpendants, cela faisait huit tats provinciaux scessionnistes en
face de lempire pratiquement rduit au Chen -si, au Ho-nan, au nord du Nganhouei, au Chan-tong et au sud du Ho-pei (51).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
127
CHAPITRE 21
Les Song et le problme des rformes
La dynastie des Song est une dynastie selon le cur du peuple chinois.
Non quils aient renouvel en Asie les conqutes des Han et des Tang. Tout
au contraire, ils ne russirent pas chasser les Tartares des portions du
territoire national que ceux-ci dtenaient encore et dans la seconde moiti de
leur rgne ils durent abandonner ces mmes Tartares toute la Chine du Nord.
Mais les lettrs chinois nont jamais pris la gloire des armes lgal de la
culture ; leur tournure desprit classique, sans doute aussi leur jalousie de
classe lgard de llment militaire les poussaient dnigrer
systmatiquement au nom de la philosophie toute politique guerrire, quitte,
lorsque leurs thories antimilitaristes avaient provoqu linvasion, opposer
aux armes victorieuses une protestation impuissante et un patriotisme tardif.
La lecture du Tong kien kang mou, lhistoire gnrale de la Chine crite
prcisment par le reprsentant le plus qualifi des intellectuels song, est
caractristique cet gard. En revanche la dynastie song ne pouvait que
mriter leur sympathie par son got pour la culture classique, les spculations
philosophiques, lrudition, lar chologie, le dilettantisme.
Reconnaissons du reste quil na pas tenu aux fondateurs de la dynastie
song que celle-ci ne recomment la glorieuse carrire des Han et des Tang.
Le premier dentre eux, Tchao K ouang -yin, reste, en tout tat de cause, une
des figures les plus sympathiques de lhistoire chinoise. Avant son avnement
il tait gnral au service de la dynastie prcdente. Le souverain venait de
mourir, ne laissant quun enfant de sept ans. Or, on tait en pleine guerre
contre les redoutables Kitat, guerre que Tchao Kouang -yin conduisait avec
bonheur. Larme, qui sentait la ncessit de voir un homme fort assumer le
pouvoir, fora la main son gnral. Un jour, laube, les soldats entourrent
la tente de Tchao Kouang -yin. Rveill en sursaut, il se vit environn de ses
officiers qui, sabre au clair, lui dclarrent quils le nommaient empereur.
Avant quil et pu rpondre, il fut revtu par eux de la robe impriale jaune,
enlev sur leurs paules, hiss cheval et entran au milieu des troupes qui,
lacclamant, se formrent en colonne et sbranlrent en direction de la
capitale. Mais au bout de quelques minutes, tirant sur la bride de son
cheval , il commanda de faire halte et harangua les soldats : Mobirez vous ? Si vous ne voulez pas mobir, moi je ne veux pas tre votre
empereur ! Sautant bas de leurs chevaux, tous les chefs crirent quils lui
obiraient. En ce cas, leur dit Tchao Kouang yin, coutez-moi bien. Vous
nattent erez pas la vie de limp ratrice douairire et du petit empereur, mes
anciens matres ! Vous ne molesterez pas les ministres, mes anciens
collgues ! Vous ne pillerez ni le trsor, ni les magasins, ni les arsenaux
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
128
impriaux ! Si vous manquez quelquun de ces points, je ne vous pargnerai
pas ! Tous le lui jurrent et larme reprit sa marche dans un ordre parfait.
Le lendemain elle entrait dans Kai -fong, la capitale. Tchao Kouang -yin
assura non seulement la scurit, mais encore le bien-tre de le nfant imprial
et de la douairire, aprs quoi il monta sur le trne (fvrier 960).
Son rgne ne devait pas dmentir ces prmices. Administrateur humain et
habile, esprit pondr, il pansa les plaies de trois quarts de sicle de guerres
civiles et refit presque entirement lunit chinoise. En quinze ans de rgne il
soumit lun aprs lautre les divers royaumes provinciaux qui se partageaient
la Chine du Sud (prise de Canton en 971 et de Nankin en 975). Ce qui est
particulirement remarquable, cest quen dpit du fait de guerre ces
conqutes ne saccompagnrent daucune violence civile. Les gn raux
impriaux avaient ordre, aussitt les villes prises, dy pro clamer une amnistie
totale. Quant aux princes dont le territoire faisait ainsi retour au domaine
imprial, Tchao Kouang -yin non seulement ne les molestait pas, mais les
pensionnait et les attachait sa cour. Lex -roi de Nankin avait rsist le plus
longtemps. Lempereur se contenta, non sans humour, de le crer marquis
rcalcitrant (975).
Ctai t par un pronunciamiento militaire que Tchao Kouang -yin tait
mont sur le trne, comme dailleurs toutes les dynasties prcdentes lavaient
fait depuis la chute des Tang. Mais, une fois au pouvoir, il rsolut de mettre
fin ces pratiques. Il runit les chefs darmes, ses anciens compagnons
darmes, et, au cours dun banquet amical, il obtint deux sans menaces, par la
seule persuasion, que dans lintrt de ltat ils renonassent leurs
commandements, en change de quoi il les combla de terres et de richesses.
Ainsi prit fin le rgime des coups dtat militaires qui depuis plus dun demi sicle puisait la Chine ; ainsi fut enfin restaur lempire civil .
Tchao Kouang -yin montra la mme sagesse jusquau bout. Sentant venir
sa fin, il estima que son fils tait trop jeune pour assumer le pouvoir. Il fit
appeler son frre, dtacha la hache darmes suspendue prs du lit imprial et la
lui remit comme insigne de lautorit en lui recommandant dtre son tour
un bon empereur ; puis il expira (novembre 976).
Le nouvel empereur, Tai -tsong (52) (976-997), acheva luvre fraternelle
en runissant lempire le dernier royaume provincial, celui du Chan -si dont
la capitale, Tai -yuan, fut prise aprs un long sige et malgr linter vention
des Kitat (juin 979). Il entreprit alors darracher aux Kitat eux -mmes les
territoires que ceux-ci dtenaient lintrieur de la Grande Muraille : Ta-tong
et Pkin. En juillet 979 il marcha sur Pkin dont il commena le sige, mais il
fut dfait par les Kitat au nord-ouest de la ville et dut battre prcipitamment en
retraite. En 986 il recommena la guerre, mais cette fois il ne put mme pas
arriver jusqu Pkin. Entre Pkin et Pao -ting il subit un vritable dsastre.
Les Kitat lancs sa poursuite coururent jusque dans le sud du Ho-pei. Sous
le rgne de son fils Tchen-tsong (998-1022), les Kitat firent en 1004 une
nouvelle invasion dans la partie chinoise du Ho-pei. Ils arrivrent jusquau
Fleuve Jaune, en face de la capitale impriale, Kai -fong. Dans cette ville, les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
129
courtisans saffolaient, conseillaient lempereur de se retirer labri du
Yang-tseu, Nankin, voire au Sseu-tchouan. Tchen-tsong sy refusa. Au nord
du Fleuve Jaune, vis--vis de Kai -fong, la petite place chinoise de
Chen-tcheou tenait toujours et sa rsistance arrtait les Kitat dans leur
descente vers la capitale (53). Courageusement lempereur sy transporta. Sa
ferme attitude lectrisa les dfenseurs et en imposa aux Kitat. Ceux-ci se
dcidrent dans cette mme ville de Chen-tcheou signer la paix en vacuant
leurs rcentes conqutes dans le sud du Ho-pei et en se contentant, comme par
le pass, de la possession de Pkin et de Ta-tong (1004). Il est vrai quau
cours de cette lutte les embarras de lempire avaient t mis profit par un
peuple de race tibtaine, les Tangout, qui, aux environs de lan mille, staient
rendus matres de lOrdos, de lAlachan et du Kan -sou o ils fondrent un
royaume indpendant, le royaume de Si-hia.
Le retentissant chec des deux tentatives des Impriaux pour recouvrer
Pkin sur les Kitat et la cration, dans les marches du nord-ouest, du nouveau
royaume barbare des Tangout dgotrent la dynastie song de la politique
guerrire. Satisfaite davoir arrt la contr e-attaque des Kitat, elle se rsigna
laisser en la possession de ceux-ci la marche de Pkin (54) et la marche de
Ta-tong, laisser de mme aux Tangout lOrdos et le Kan -sou. En ce qui
concerne notamment Pkin, il faut noter que le sacrifice tait beaucoup moins
considrable quil ne nous le parat aujourdhui. Pkin, indpendamment de sa
situation excentrique, ntait alors quune ville provinciale fort secondaire,
une ville-frontire qui navait jusque -l jou aucun rle et dont limpor tance,
au contraire, date prcisment du jour o elle devint capitale des Kitat. Si nous
nous plaons au point de vue des Chinois du XIe sicle, en renonant Pkin
et Ta-tong dune part, au Kan -sou de lautre, ils sacrifiaient peu de chose .
Ces trois marches extrmes mises part, les Song conservaient toute la Chine
historique. Pendant plus dun sicle ils allaient pouvoir sy consacrer leur
got pour les lettres, lart, les controverses intellectuelles. Lpoque song fut
par excellence celle des grandes discussions dides, principalement de la
querelle des conservateurs et des rformistes .
Cette controverse, du reste, ntait pas un simple passe -temps
dintellectuels. La crise conomique et sociale qui avait provoqu la chute de s
Tang avait abouti lasservissement gnral de la population rurale, les petits
propritaires ayant d, comme nous lavons indiqu, vendre leurs terres pour
entrer comme fermiers ou comme manouvriers au service des possesseurs de
latifundia. Un crivain clbre de ce temps, Sou Siun (1009-1066) nous a
laiss le tableau de cette situation : Les champs ne sont pas la proprit de
ceux qui les cultivent et ceux qui possdent les champs ne les cultivent pas.
Les champs des cultivateurs dpendent des riches. Les gens riches ont des
terres tendues, de vastes proprits ; leurs parcelles se touchent, ils font venir
des migrants et leur en partagent la culture. La cravache et le bton activent
les corves, le matre les traite comme des esclaves ... Des produits des
champs il prend la moiti : il ny a quun propritaire et il y a dix cultivateurs,
en sorte que le propritaire, accumulant de jour en jour sa moiti, arrive la
richesse et la puissance, et le cultivateur, vivant au jour le jour de sa moiti,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
130
parvient la misre et la faim. Et il ny a aucun recours (55). Un texte de
1308 dira de mme que sous la dynastie song le propritaire considrait la
vie et la mort des fermiers comme un brin dherbe .
Un pome de Wang Yu-tcheng (mort en 1001) nous trace un tableau
poignant de la misre des campagnes par temps de famine, avec les cortges
de paysans dracins, obligs migrer droit devant eux :
Cest la fam ine ...
Les alim ents font partout dfaut.
A ucune fum e ne slve des chem ines.
Sur la route,une bande de m endiants passe.
Cest une fam ille,un vieillard avec sa vieille
quiest m alade.
Trois enfants conduits par un hom m e
suivent en pleurant.
U n litre de grain com m e provision
et pas cent sapques pour viatique !
Ils sont partir de Tchang-ngan lan dernier,
pousss par la fam ine.
La m re des enfants est m orte et on la enfouie en terre trangre.
Ils cherchent m aintenant regagner le jardin
quiles faisait vivre.
H ves,am aigris,sans force et sans appui.
Jaibien peur quun jour de pluie ou de neige
leurs cadavres ne restent dans quelque valle (56).
Certes il sagit l dun tableau qui nest pas particulier lpoque song.
Les annes de famine reviennent priodiquement dans lhistoire chinoise avec
leur cortge de misre. Mais il est certain que le problme agraire nayant pas
reu de solution, la misre des paysans semblait sans remde. Par ailleurs les
finances publiques se trouvaient dsorganises par la disparition de la petite
proprit, disparition qui bouleversait de fond en comble lassiette de limpt.
De surcrot ruines par un sicle de coups dtat et de guerres civiles, elles
taient dans une situation lamentable (57).
Les Song, dont lavnement apr s tant de guerres civiles se prsentait
comme une restauration gnrale des valeurs traditionnelles, se proccuprent
tout dabord de donner cette restau ration des bases intellectuelles dfinitives.
Ds son accession au trne, le fondateur de la dynastie, le sage Tchao
Kouang -yin, stait appuy sur la classe des lettrs confucens ( jou) parmi
lesquels lui et ses successeurs recrutrent leur personnel administratif. Pour
fournir ce recrutement, ils rtablirent ou rformrent le systme des examens
publics qui reut alors sa forme dfinitive. Lempereur Jen -tsong (1025-1063)
complta ces mesures en crant des coles de lettrs dans les principales
villes, une cole impriale suprieure dans la capitale et en refondant le
programme des examens publics avec trois matires principales : style
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
131
administratif, narration et posie. Enfin il confia de hautes charges aux deux
lettrs les plus minents de son poque, Ngeou-yang Sieou (1007-1072) et
Sseu-ma Kouang (1019-1086), tous deux connus comme historiens et le
premier galement comme pote.
Mais les lettrs navaient pas tard se diviser. Bien que se rclamant tous
de lorthodoxie confucenne, ils diffraient sur son interprtation comme sur
la solution donner la crise conomique et sociale de leur temps. Deux
partis staient forms parmi eux, le parti conservateur et le parti novateur ou
rformiste. Sous le rgne de lempereur Chen -tsong (1068-1085) les
rformistes arrivrent au pouvoir dans la personne du clbre Wang
Ngan-che.
A la vrit, bien avant lui les rformes taient dj dans lair . Dj
sous lempereur Jen -tsong (1023-1063) on avait en 1057 cr des greniers
de bienfaisance (kouang-houei) pour les distributions de grains aux
vieillards, aux enfants, aux pauvres et aux malades. Lempereur Ying -tsong
(1064-1067), souverain de tendances conservatrices cependant, avait consacr
un million de sapques la dotation des greniers rgulateurs
(tchang-ping ) dans les annes de rcolte excdentaire et de chute des prix,
ces greniers achetaient du grain un taux suprieur celui du march ; dans
les annes de mauvaise rcolte, quand la spculation faisait monter les prix, ils
cdaient le grain un taux infrieur. Ces magasins dtat avaient donc pour
double mission de constituer des rserves de grain pour les jours de disette et,
en toute circonstance, dquilibrer les prix en brisant la spculation.
Mais Wang Ngan-che allait vite dpasser ces modestes essais.
Wang Ngan-che (1019-1086) est une des figures les plus intressantes de
lhistoire chinoise (58). Nul de son vivant na t plus attaqu. On lui
reprochait son enttement de doctrinaire, ses vtements ngligs, son visage
mal lav qui faisaient contraste avec la tenue des autres lettrs. De nos jours
au contraire on la port aux nues. On en a fait non seulement un socialiste
dtat , mais un dmocrate, un prcurseur de Sun Yat-sen et du Kouomin-tang. En ralit, ses rformes semblent avoir t surtout dictes par des
proccupations fiscales. Il sagissait daider le peup le produire davantage
pour que ltat pt senrichir de lenrichisse ment gnral. Ce fut dans ce
double but amliorer le sort du peuple en enrichissant ltat que Wang
Ngan-che fit instituer en 1069 une commission permanente des rformes quil
prsida. Et aussitt la refonte du rgime conomique commena. Wang
Ngan-che tablit un budget des recettes et des dpenses de ltat suivant un
programme fixe quon ne devait dpasser sous aucun prtexte et qui rduisait
les dpenses de 40 %.
Lagriculture ta it, de beaucoup, la grande richesse de la Chine. Pour en
augmenter le rendement, Wang Ngan-che rsolut de soustraire les paysans la
misre cette misre dont nous avons vu plus haut un tableau si prcis et
aux saisies de leurs cranciers. A cet effet ltat consentit aux paysans des
prts sur rcolte (59). Ces avances leur taient faites au printemps. A
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
132
lautomne, aprs la rcolte, les prts, augments dun intrt, taient restitus
ltat par les bnficiaires. Par ailleurs les campagnards se plaignaient dtre
victimes de larbitraire des fonctionnaires pour lexcution des corves. Wang
Ngan-che supprima la corve et la remplaa par une taxe annuelle qui
constitua un fonds sur lequel furent pays les travaux publics. Innovation fort
importante, car la taxe ainsi cre ntait autre que la premire apparition de
limpt personnel. Dans le mme esprit le cadastre fut complte ment refondu,
refonte rendue indispensable par la transformation agraire du IXe sicle. Dans
la Chine ancienne limpt foncier avait port sur la proprit paysanne, la
proprit de village dont nous avons plus haut montr lconomie. Depuis
quau IX e sicle la petite proprit avait disparu au profit des grands
domaines, il fallait trouver autre chose. Cest quoi pourvut Wang Ngan -che
en procdant, non certes, comme on la prtendu, une redistri bution de la
proprit, mais une redistribution du cadastre. En 1073 il divisa tout le
territoire en carrs dun li (576 mtres ) de ct, carrs destins tablir
lassiette du nouvel impt foncier. Comme le fait remarquer Henri Maspero,
ce fut l une rforme purement fiscale, sans aucun caractre social : Les
proprits subsistrent comme auparavant, sans aucune relation avec ces
divisions fiscales nouvelles ; les propritaires dont les biens se trouvaient en
tout ou en partie sur le mme carr, payaient une part de limpt du carr
proportionnelle ltendue de ce qui leur appartenait. Le rgime de la
proprit foncire resta celui des latifundia (mme un rformateur comme
Wang Ngan-che ne songea point y porter atteinte), mais lempire fut dot
dun plan cadastral prcis et commode.
Ltatisme, cependant, triomphait. A partir de 1074 tout pro pritaire fut
tenu faire la dclaration de tout ce quil possdait, y compris les porcs et
les poules . Le commerce tait dailleurs, lui aussi, rglement. Tous les
produits furent tarifs par les mandarins qui fixrent le cours forc du march.
Ltat stocka les produits invendus. Les impts furent dautre part pays en
nature. Les mandarins, devenus de la sorte magasiniers officiels, conservaient
ces denres pour les redistribuer titre davances au moment des semailles ou
en cas de disette. Le but de ces mesures tait de maintenir des prix
raisonnables et de briser la spculation en empchant toute hausse illicite
comme toute dprciation exagre des produits. Mais ici encore le but
dernier tait fiscal. Les marchandises en magasin furent frappes dun im pt
annuel de 20 % garanti par ces mmes marchandises et par le btiment qui les
abritait. Le dlai de paiement coul, limpt tait augment de 2 %. Mais en
mme temps et de mme quil avait institu le prt sur les moissons,
Wang-Ngan-che ds 1071-1072 avait cr le prt dtat sur la proprit pour
favoriser les entreprises commerciales. Plus prcisment un tribunal
spcialement cr pour lorganisation du commerce sur les mar chs (che-yi
wou) put consentir aux commerants des avantages sur hypothques.
Wang Ngan-che tait un lettr. Mais il estimait que le programme des
examens ntait bon qu former des pdants et non des administrateurs. En
1071 il en bannit les compositions littraires o le style lemportait sur les
ides et toute la littrature proprement dite. Le programme comporta
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
133
dsormais linterpr tation des classiques confucens daprs lexgse
nouvelle du rformateur, des narrations et des pices administratives, les candidats devant tre jugs beaucoup plus daprs leurs ides person nelles et
leurs connaissances pratiques que par les grces de leur style.
Ces rformes dans le domaine littraire bien plus encore que ses
innovations conomiques valurent Wang Ngan-che loppo sition la plus
violente de la majeure partie du mandarinat. Sa nouvelle interprtation des
livres canoniques dans le sens de ses ides parut aux confucens conservateurs
une manire de sacrilge. Toutes ses rformes furent tournes en drision et
lhistoire chinoise ultrieure nallait tre quun long pamphlet cont re lui.
Avouons dailleurs quil nous est difficile de nous faire une opi nion
puisque ce sont en effet ses adversaires triomphants qui ont crit son histoire.
Il semble cependant que sa rforme agraire ait eu pour consquence une
diminution du prix de la vie. A son propre tmoignage et tant que sa
lgislation resta en vigueur, le riz tait devenu aussi bon march que leau .
Un des ses pomes (car, comme tous les lettrs de son temps, il tait aussi
pote), dune sincrit assez mouvante, nous montre d ailleurs quel
sentiment profondment humain animait en lui lco nomiste :
Q uelquun m anque-t-ildargent pour le m ariage
ou les funrailles ?
Je luien prte pour dissiper son inquitude.
Q uelquun a-t-ilune rcolte insuffisante ?
Je luidonne tous les grains que je possde
pour laider vivre.
Sila m oisson est en abondance,je la recueille.
Sila m oisson nest pas suffisante,je distribue
tout ce que je possde pour quon puisse travailler.
D e nos jours on ne sen occupe pas,
m ais m oije suis rsolu rprim er les accapareurs.
Traduction Tcheou Hoan
Il nen est pas moins vrai que les rformes, peut -tre appliques avec trop
de rigidit, soulevrent une opposition dautant plus formidable quelle se
traduisait par la force dinertie. Lemmaga sinement des produits par les
fonctionnaires et exig une administration incorruptible, ce qui, parat-il,
ntait point le cas. Il ntait pas jusquaux avances de semailles aux paysans
qui ne se tournassent contre lintention du lgislateur. Trop souvent les
paysans qui lavance avait t consentie ne la remboursaient pas et se
voyaient, de ce fait, expropris par le fisc. Le chef du parti conservateur,
lhistorien Sseu -ma Kouang, avait beau jeu critiquer l-dessus tout le
systme : Rien de plus spcieux, rien de plus beau en thorie, rien de plus
prjudiciable ltat dans la ralit. On prte des grains au peuple, et il
commence par en consommer une partie. On lui prte des grains, et il les vend
et son activit cesse : il devient paresseux. A quoi Wang Ngan-che
rpondait : Les lettrs ne veulent marcher que sur des routes battues par
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
134
leurs anctres : quon leur en offre de plus sres, de plus utiles, de plus
commodes, ils ne daignent mme pas faire un pas pour sassurer si elles sont
telles !
Mais le grief le plus srieux quon pt formuler contre les rformes de
Wang Ngan-che tait que ltat naccordait aux paysans la fameuse avance
sur rcolte que moyennant un intrt de 20 %. Sans doute tait-ce l un taux
relativement modr par rapport aux 50 % dintrt dans les prts consentis
par des particuliers. Il nen est pas moins vrai que les ruraux sendettaient
ainsi dans des conditions singulirement onreuses. Pour peu que la rcolte ft
mauvaise ou que, sans souci du lendemain, comme le prdisait Sseu-ma
Kouang, ils eussent gaspill les sommes prtes, ils navaient, lheure du
remboursement, effectivement le choix quentre lexpropriation ou la fuite.
Danger dautant plus grand que, si les malheureux ne savaient gure rsister
la tentation de cette brusque avance de fonds, les fonctionnaires locaux, eux,
se trouvaient personnellement intresss les y faire succomber. En effet
lintrt de 20 % qui accompagnait le prt sur rcolte constituait une des
meilleures sources de revenu pour les finances provinciales. Ladministration
se trouvait donc amene employer tous les moyens de pression en son
pouvoir pour persuader au paysan de sendetter. Le prt sur rcolte prenait, en
dpit des intentions de Wang Ngan-che, les allures odieuses dun vr itable
sur-impt extorqu la simplicit ou la misre des cultivateurs. Ltat
rformiste se conduisait en vritable usurier. Au fond Wang Ngan-che se
trouvait en porte--faux entre son humanitarisme, son dsir gnreux de venir
en aide au peuple, et la ncessit o il se voyait de relever les finances de
ltat. Ses adversaires, les conservateurs, ne manquaient pas dadresse lors quils opposaient son systme du prt sur rcolte la pratique, plus modeste
mais plus sre, des greniers rgulateurs , tels que nous les avons plus haut
dfinis.
La mort de lempereur Chen -tsong en avril 1085 et lavnement de son fils
qui navait que quinze ans, sous la rgence de limp ratrice douairire Kao,
amenrent la disgrce des rformistes et le retour au pouvoir des
conservateurs dirigs par Sseu-ma Kouang. Wang Ngan-che mourut peu
aprs, suivi dans la tombe par Sseu-ma Kouang lui-mme (60) (1086). Aprs
Sseu-ma Kouang, la principale personnalit du parti conservateur fut le pote
Sou Che ou Sou Tong-po (1036 -1101) dont laction semble avoir t heu reuse. Ayant une comprhension intime du peuple, des manires de voir et des
vritables aspirations des petites gens, il chercha abaisser les barrires qui
sparaient les sujets du trne, rompre lisolement dangereux de la cour :
Aux poques de bon gouvernement, disait-il, le plus humble sujet doit tre
libre de faire connatre lempereur ses dolances. Cependant sa franchise
ne tarda pas faire disgracier Sou Che, et limpratrice rgente, qui favorisait
les conservateurs, tant son tour dcde en 1093, le jeune empereur
Tche-tsong rappela les rformistes. Le souverain suivant, Houei-tsong, dont
nous verrons plus loin la dramatique destine (1100-1125), revint aux
conservateurs (1106), puis rendit sa confiance aux rformistes (1112). Mais
sans doute sagissait -il dsormais moins du sort mme des rformes que de
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
135
luttes de personnes entre politiciens des deux partis. Du reste, en dpit des
querelles politiques, la paix des Song produisait ses bienfaisants rsultats. On
a vu que le recensement de 845 avait donn pour lempire une trentaine de
millions dhabitants Celui de 1083 accusa prs de quatre -vingt-dix millions,
non sans doute que la rgion du Nord, la Vieille Chine, dj fort peuple, ait
t le sige dune augmentation trs considrable, mais parce que la partie
mridionale de lempire, la Nouvelle Chine, syst matiquement colonise
depuis les Han, commenait acqurir une densit suffisante.
Il tait temps, dailleurs, que c ette colonisation sachevt. La politique de
lempereur Houei -tsong, en provoquant linvasion des provinces du nord par
les barbares, allait de nouveau amener le Sud servir de refuge
lindpendance chinoise.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
136
CHAPITRE 22
Un rveur couronn : lempereu r Houei-tsong
Lempereur Houei -tsong, mont sur le trne de Kai -fong lge de
dix-neuf ans en fvrier-mars 1100, fut un des souverains les plus cultivs
quait possds la Chine. Esthte et archologue, grand collectionneur et
critique dart, il fut lu i-mme un peintre de talent. Il prsidait en personne les
runions du Tou -houa-yuan, acadmie de peinture dont les membres, vtus
de violet et portant des insignes dor et de jade, jouissaient du privilge dtre
admis dans les appartements privs du souverain. Houei-tsong proposait luimme aux peintres les sujets de concours et jugeait les candidats. Nous
connaissons quelques-uns de ces thmes qui montrent bien le got imprial :
Les bambous enveloppent lauberge prs du pont ; ou bien : une barque
restant toute la journe sans emploi, personne ne dsirant passer la rivire ;
et encore : la promenade dun faisan dans le parc du palais .
personnellement lempereur tait spcialis dans les peintures doiseaux et de
fleurs et il est possible que certaines des uvres lui attribues dans les
collections japonaises soient effectivement de son pinceau. Il avait dautre
part runi dans son palais de Kai -fong une collection unique de peintures
anciennes (plus de six mille noms !) dont nous avons encore le catalogue.
Houei-tsong ntait pas moins pris de spculations religieuses. Depuis un
sicle un renouveau religieux se manifestait dans les diverses confessions
chinoises. Chez les bouddhistes ctait lami disme ou culte du dhynibouddha Amitbha. Vritable religion nouvelle dans le sein de la vieille
religion indienne, lamidisme, nous lavons vu, apportait aux foules chinoises
lquivalent dun thisme, mieux encore : un pitisme, un quitisme
accessibles tous les hommes de bonne volont, une religion du cur telle
que jusque-l lAsie orientale navait rien connu de pareil. Lme fidle
navait qu se confier sans rserve la misricorde dAmi tbha et, sauve par
sa grce, elle renaissait ses pieds dans un ineffable au-del, dans un vritable
paradis (soukhvat), la Terre de puret , parmi les bienheureux. Les
portraits darhat ( lo-han en chinois), cest --dire de saints bouddhiques que
nous a laisss le peintre Li Long-mien (1040-1106), avec leurs longs visages
asctiques dune si tra nge intellectualit, nous montrent quel point le
bouddhisme avait pntr lme chinoise, puisque ces thmes essentiellement
indiens taient maintenant entirement siniss.
Vers la mme poque le taosme volua, lui aussi, vers un thisme
analogue en crant le culte dune divinit transcendante, le Pur Auguste ,
littralement lAuguste de Jade (le jade tant en Chine symbole de puret).
A la vrit, ce dieu suprme tait de naissance quelque peu tardive : cest
exactement en 1012 de notre re quil stait pour la premire fois manifest
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
137
en rvlant son existence lun des prdcesseurs de Houei -tsong,
lempereur Tchen -tsong. Houei-tsong son tour lui manifesta une grande
dvotion. Depuis longtemps le monarque cherchait entrer personnellement
en rapports avec les Gnies et les Immortels du panthon taoste lorsque ses
vux furent exaucs : un jour dhiver quil se promenait dans la campagne
prs de Kai -fong ctait en dcembre 1113 il aperut lhorizon un
palais cleste dont les constructions feriques flottaient dans les airs
au-dessus des nuages . Ctait, nen pas douter, le sjour mme des Im mortels et cela donnait envie de passer de la poussire de ce monde cette
le des bienheureux . Cest cette vision batifique qu au tmoignage des
contemporains Houei-tsong aurait cherch reproduire dans un de ses
tableaux.
Selon la remarque du Pre Wieger, Houei-tsong semble dail leurs avoir
conu une sorte de syncrtisme confuco-taoste o, de surcrot, le
bouddhisme devait trouver sa place. Le dieu suprme du no-taosme,
l Auguste de jade auquel il avait vou un culte officiel, fut par lui dclar
identique au Souverain dEn Haut , l Auguste Ciel des lettrs
confucens, et il incorpora au panthon ainsi prsid les divers bouddhas et
bodhisattvas venus du ciel indien (61).
Les intellectuels devraient apporter le plus grand soin ne jamais se mler
de politique, singulirement de politique trangre. Le rveur couronn
qutait Houei -tsong aurait achev de couler des jours heureux en rassemblant
des uvres dart, en peignant des cailles ou des pruniers en fleurs et en
fusionnant cultes et divinits. Pour son malheur et celui de son pays, il se
lana dans la grande politique et y commit une faute irrparable pour
rcuprer Pkin sur les Kitat, il sallia contre eux aux Djur tcht, peuple
tongous parent de nos actuels Mandchous qui habitait les forts du nord-est
mandchourien et notre province maritime russe.
Ctait une folie. Depui s un sicle, les Kitat, en grande partie siniss,
satisfaits de possder, en plus de lactuel Leao -tong, de lactuel Tchakhar et de
lactuel Jehol, les deux marches de Pkin et de Ta -tong, taient devenus pour
lempire song des voisins assagis et pacifiqu es. Au contraire, les Djurtcht
restaient encore des demi-sauvages dont on venait voir avec curiosit les
danses farouches, au milieu de leurs clairires, devant leur khan assis sur
douze peaux de tigre. La Chine avait tout perdre au remplacement des
premiers par les seconds. Mais Houei-tsong, tout son dsir de russir, en
recouvrant Pkin, l o ses anctres avaient chou, se persuada que les
Djurtcht vainqueurs se contenteraient des confins de la Mongolie Intrieure
et de la Mandchourie. Il conclut donc un pacte avec leur khan Agouda qui, en
1114, prit les Kitat revers en Mandchourie. Tout marcha dabord selon ses
vux. Les Kitat furent crass, et en 1122 Pkin, leur dernire place, tomba
aux mains des Djurtcht. Mais ce fut alors que pour la cour de Chine
commencrent les difficults.
Lancien royaume kitan tait maintenant tout entier au pouvoir des
redoutables Djurtcht et ceux-ci devenaient les voisins immdiats de lempire
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
138
song. Conformment aux termes de leur ancien trait, lempereur Houei -tsong
leur demanda de lui remettre Pkin. Ils y consentirent, dassez mauvaise
grce, du reste. La prudence commandait de sen tenir l. Houei -tsong, au
contraire, prtendit encore se faire cder par eux plusieurs places entre Pkin
et la Grande Muraille. Ne les obtenant pas, il fomenta en sous-main dans cette
rgion des rvoltes de la population chinoise contre le vainqueur.
Ce fut la guerre, une guerre en vue de laquelle la cour de Kai -fong navait
rien prpar. Non seulement les Djurtcht sad jugrent Pkin, mais en
quelques mois leur cavalerie, lance en trombe, descendit travers le sud du
Ho-pei, balayant toute la Grande Plaine jusquau Fleuve Jaune. A Kai -fong la
cour tremblait. Mais au lieu de se mettre la tte des troupes, lincurable
intellectuel qutait Houei -tsong procda un changement de ministre. Il
chassa les rformistes, rappela les conservateurs au pouvoir et, conformment
au dsir de ces derniers, rtablit lan cien programme des examens en rendant
sa place dhonneur la littr ature... Pendant ce temps, les Djurtcht avaient
travers le Fleuve Jaune et commenc le blocus de Kai -fong. Eperdu, Houeitsong capitula (fin 1126). Avec son fils an, toute sa suite, tous ses trsors, il
fut dport au fond du pays djurtcht, dans le nord de la Mandchourie (dbut
de 1127).
Lempereur dilettante, le collectionneur raffin devait mourir sans avoir
revu sa patrie, neuf ans plus tard, g de cinquante-quatre ans seulement, en
quelque clairire de la fort mandchourienne, parmi les chasseurs vtus de
peaux de btes ...
Cependant un fils cadet de Houei-tsong avait chapp la catastrophe. Ce
jeune homme (il avait vingt et un ans), qui devait porter le nom de rgne de
Kao-tsong, fut proclam empereur dans le sud, Nankin, labri de la barr ire
du Yang-tseu (mai-juin 1127). Pendant ce temps les Djurtcht achevaient la
conqute de la Chine du Nord ; puis ils atteignirent le Yang-tseu quils fran chirent avec deux armes, lune au Hou -pei, prs du lac Po-yang, lautre sur le
cours infrieur du fleuve. La premire poussa jusquau sud de la province de
Kiang-si. La seconde surprit Nankin et courut jusquau port de Ning -po, sur la
cte du Tch-kiang (1129-1130). Cependant ces colonnes tout en cavalerie,
arrtes par des difficults de remonte et dangereusement hasardes dans un
pays coup de collines, de rivires et de rizires, durent bientt songer au
retour. Elles avaient maintenant retraverser le Yang-tseu, large comme un
bras de mer et que leur barraient les jonques chinoises. Elles russirent enfin
oprer leur passage lest de Nankin et rentrrent au Ho -nan. Le Sud tant
alors dbarrass denvahisseurs, lempereur Kao -tsong vint en 1132 sta blir
Hang-tcheou, le chef-lieu actuel de la province du Tch-kiang, ville qui allait
rester jusqu la conqute mongole la capitale de lempire song.
Les gnraux chinois profitrent de lessoufflement des Djurt cht pour
rcuprer diverses places (1134). Le plus vaillant dentre eux, Yo Fei, dj
vainqueur en plusieurs rencontres, allait en 1138 marcher sur Kai -fong et
sans doute rendre lempire son an cienne capitale, quand un ministre jaloux
de ses succs lobligea sarrter, puis le fit incarcrer sous un prtexte
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
139
imaginaire et finalement supprimer dans sa prison. Du reste, lempereur K aotsong, personnage indolent et faible, tait fatigu de la guerre. En cette mme
anne 1138 il conclut la paix avec les Djurtcht en leur abandonnant tous les
territoires quils occupaient, cest --dire toute la Chine du Nord, tout le bassin
du Fleuve Jaune, et mme, plus au sud, tout le pays jusquau fleuve Houai.
Les Song conservaient la Chine du Sud, cest --dire le bassin du Yang-tseu et
la rgion foukinaise et cantonaise avec, comme on la dit, pour capitale la
ville de Hang-tcheou, au Tch-kiang.
Dans la Chine du Nord, les Djurtcht ne tardrent pas se siniser. Leurs
rois prirent le nom dynastique chinois de Kin, ou Rois dor , et cest sous
ce nom de Kin quils sont connus de lhistoire classique et que nous les
dsignerons dsormais. A partir de 1153 les Kin, qui avaient jusque-l
conserv leur rsidence royale en Mandchourie, transfrrent signe visible
de leur sinisation leur capitale Pkin.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
140
CHAPITRE 23
La douceur de vivre
La dynastie des Song, ayant renonc lespoir de reconqu rir la Chine du
Nord, ne songea plus, dans son empire dsormais restreint aux provinces
mridionales, qu retrouver latmosphre de posie et dart des palais de
Kai -fong, la douceur de vivre. Deux courtes guerres contre les Kin, en 1161
et 1206, ne troublrent qupisodiquement la paix. En dpit des normes
pertes territoriales faites par lempire, la catastrophe de 1126 ne sembla
elle-mme quun simple pisode. Dans tous les domaines la dli cate
civilisation des Song, fleur de la culture chinoise, continuait. Le moment est
venu den voquer lart et la posie. Nous commen cerons par un retour sur
lpoque de Kai -fong (960-1126) pour passer ensuite celle de Hang-tcheou
(1132-1276).
Sur la conception du paysage chez les Song ds lpoque de Kai -fong,
nous possdons un document prcieux, le trait sur les monts et les eaux
(chan-chouei) du peintre Kouo Hi (n vers 1020). On y voit quels
observateurs de la nature furent dj les matres du XIe sicle. Les nues et
les vapeurs des paysages, remarque ce texte, ne sont pas identiques dans les
quatre saisons. Au printemps elles sont lgres et diffuses, en t riches et
denses, en automne disperses et minces, en hiver sombres et sauvages.
Quand les tableaux savent rendre ces effets, les nues et les vapeurs ont un air
de vie. La brume qui entoure les montagnes nest pas la mme aux quatre
saisons. Les montagnes du printemps sont lgres, sduisantes, souriantes,
pour ainsi dire. Les montagnes de lt ont une couleur dun bleu vert qui
semble stale r sur elles. Les montagnes de lautomne sont gaies et proprettes,
comme si on venait de les repeindre. Les montagnes de lhiver sont tristes et
calmes, comme si elles dormaient. Et plus loin : Le grand mont
majestueux rgne sur les montagnes moindres qui lentourent. Les crtes et les
mamelons, les bois et les ravins proches ou lointains, grands ou petits, le
reconnaissent pour matre. Son aspect est celui dun empereur trnant au
milieu des princes assembls. Les pins lancs et droits sont chefs parmi
les arbres. Ils soutiennent les plantes rampantes et grimpantes qui se confient
eux comme des matres. Kouo Hi enseigne encore que le montagnes
changent daspect et pour ainsi dire de per sonnalit suivant la distance.
Chaque distance amne une diffrence, les formes en varient chaque pas.
Une seule montagne peut runir en elle les formes et les aspects de plusieurs
centaines de monts. Elles varient aussi dme avec la saison, montagnes
de printemps, voiles de brumes cotonneuses, et les gens sont heureux ;
montagnes dt avec leurs arbres ombreux et les gens sont satisfaits ;
montagnes dautomne, claires et pures avec les feuilles qui tombent, et les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
141
gens sont calmes ; montagnes dhiver, couvertes de nuages sombres et
balayes par la tempte, et les gens sont silencieux et solitaires (62) .
On remarquera que le trait de Kouo Hi est purement et simplement le
commentaire de lide retrouve bien plus tard chez nous que le
paysage est un tat d me.
Un des sujets sur lesquels insiste le matre song est limpor tance, en
montagne, des jeux dombre et de lumire, limportance surtout des
interpositions de brumes. Les formes de la montagne dpendent du soleil et
de lombre. Les endroits de la mont agne quenveloppent le brouillard et les
vapeurs doivent rester voils, ceux quils natteignent pas resteront seuls
visibles. Et enfin cette maxime : Les montagnes sans brumes ni nuages
sont comme un printemps sans fleurs. Nous savons par les historiens chinois
que Kouo Hi peignait en effet daprs ces maximes les vieux pins, les
rivires sinueuses, les corniches surplombantes, les gorges profondes, les pics
levs, les falaises escarpes, en partie caches par les nuages et les bancs de
brouillard ou estompes par la brume . Les peintures lui attribues dans les
collections japonaises nous donnent au moins une ide de sa manire. Effets
dhiver : la neige sentasse dans les crevasses et la glace encombre la rivire,
l o le bac fait passer les voyageurs grelottants . Effets de printemps : les
vagues clapotent, les montagnes se perdent dans une brume lgre . Soires
dautomne, son sujet favori : le ciel sclaircit aprs laverse, les oies sau vages traversent lespace en longues file s qui paraissent rejoindre les chanes
de montagnes lointaines . Ce sont des paysages analogues que nous a laisss
lautre grand peintre de Kai -fong, Mi Fei (1051-1107). Nul na mieux rendu
que lui le facis caractristique des plis siniens , tel que le dcrivent les
modernes gographes, tel que le reproduisent ses peintures, moutonnement
de collines boises et de montagnes aux sommets arrondis qui percent
travers des bancs de brume cotonneuse .
Les pomes song, pour une grande partie, ne sont pas autre chose que la
transposition littraire des chefs-duvre de la pein ture. Le pote Ngeou-yang
Sieou (1007-1072), qui vcut lpoque de Kai -fong (il fut un des chefs du
parti conservateur), nous dit par exemple dans son chant des montagnes
lointaines (63) :
U ne teinte uniform e couvre m ontagnes proches
et m ontagnes lointaines.
O n a m arch toute la journe,m ais la m ontagne
est toujours l,en face de nous.
Constam m ent varie laspect des pics et des collines,
M ais le voyageur passe sans connatre leur nom .
Ou bien cette marine :
Sur la rivire glace fond la neige entasse
depuis quelques jours.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
142
Les bords com m encent dgeler.
A u crpuscule tout le m onde rentre chez soi.
A lors les m ouettes viennent se poser
sur les barques des pcheurs.
Et cette autre marine, sur le thme du pcheur :
Le vent trane le filde la longue canne pche.
Coiff dun chapeau de paille et habill dun m anteau
dherbes,le pcheur se cache parm iles roseaux.
D ans la fine pluie de printem ps on le perd de vue
Et le brouillard m ontant de leau cache
la m ontagne den face (64).
Le mme Ngeou-yang Sieou nous a laiss, cette fois en prose, dautres
impressions non moins pntrantes, musicales celles-l, sur les bruits de
lautomne :
U ne nuit je lisais quand jentendis un son qui venait du
sud-ouest. A u dbut quelque chose sem blait tom ber, com m e
tom bent une une les gouttes deau avec un bruit faible et
triste. Puis une bourrasque de vent sleva soudain, slana,
sem porta et se m it claquer com m e les flots m utins dans la
nuit, com m e lorage subitem ent dchan. Ctait com m e si des
guerriers m archaient en silence vers lennem i: ni appels ni
ordres, seulem ent le bruit sourd de la m arche des hom m es et
des chevaux. Jenvoyai m on jeune dom estique se rendre
com pte au-dehors de ce que ctait. Il revint, m e disant : Les
toiles et la lune sont claires et sereines,la Voie Lacte est au
ciel.N ulle part on nentend de son hum ain.Le son est parm iles
arbres.Cest le son de lautom ne (65).
Lautre grand pote song, Sou Che, appel aussi Sou Tong -po
(1036-1101) (et qui, lui aussi, fut lpoque de Kai -fong un des chefs du
parti traditionaliste), nous a laiss son tour des notations dignes des vieux
matres tang. Son excursion la Falaise Rouge , sur les bords du
Yang-tseu, au Hou-pei, est un des morceaux les plus clbres de la littrature
chinoise :
Le vent tait peine perceptible, les vagues ne se
soulevaient pas ... Peu aprs, la lune apparut au-dessus des
m ontagnes de lest et com m ena son voyage hsitant parm i les
constellations. La rose blanche stendait sur le fleuve ; leau
scintillante se confondait avec le ciel.En laissant notre barque
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
143
driver sa guise, nous voguions sur lim m ensit. O n et dit
que nous voguions dans le vide, m onts sur le vent ... N ous
tions lgers com m e sinous avions quitt le m onde et que nous
fussions libres de tout support, tel un hom m e parvenu ltat
dIm m ortel et qui plane dans lespace ... U n des invits savait
jouer de la flte. Les sons soupiraient com m e une plainte ou
une passion,com m e des pleurs ou des lam entations et lcho se
prolongeait, ondulant sans sinterrom pre, com m e un fil de soie
...U n dentre nous dit : N ous som m es des passagers dun jour
entre le ciel et la terre. A h !tre le Yang-tseu qui ne spuise
jam ais ! Sunir un Im m ortel, senvoler avec lui, saisir la lune
brillante et durer ternellem ent ! Je rpondis : M ais
connaissez-vous leau et la lune ? Cette eau qui sen va ainsi,
elle nest jam ais partie. Cette lune, tantt pleine et tantt
dim inue, finalem ent elle naugm ente nine dim inue.Car,sinous
considrons les choses du point de vue de ce qui change, alors
le ciel et la terre passent en un instant ; m ais si nous les
considrons du point de vue de ce quidem eure,alors les tres
et nous-m m es,rien na de fin (66).
Tel tait lhritage que les Song, en abandonnant linvasion les provinces
du nord, apportaient avec eux dans la Chine du Sud.
Il ny priclita point. Hang -tcheou, la nouvelle capitale (elle devait le
rester de 1132 1276), clipsa bientt le souvenir de Kai -fong. Elle aussi
devint une ville-muse. En y transportant sa rsidence, lempereur Kao -tsong
(1127-1162) y regroupa les artistes qui avaient brill la cour de son pre,
Kai -fong, et bientt il put y reconstituer lacadmie de peinture. On le vit,
comme lavait fait Houei -tsong, confrer lui-mme aux plus grands artistes les
insignes de la Ceinture dOr et les hberger dans son palais. Il se plaisait
calligraphier de sa main danciens pomes dont il leur confiait ensuite
lillustration. Son petit -fils, lempe reur Ning-tsong (1195-1224), devait tre
galement un grand amateur de peinture qui confra la Ceinture dOr non
seulement des matres de lcole officielle des lettrs, mais encore plu sieurs artistes de lcole indpendante, cest --dire bouddhique. Les textes de
ce temps nous montrent avec quel amour Kao-tsong et Ning-tsong faisaient
dcorer par les membres de lacadmie impriale les palais et les pavillons
dont ils couvraient maintenant Hang-tcheou.
La ville se prtait ce rle. Elle tait situe dans une position admirable,
bien faite pour sduire ces artistes ns qutaient les derniers So ng. Baigne
lest par le Tsien -tang prs du point o le fleuve se jette dans la baie de
Hang-tcheou, et de lautre ct par le Lac Occidental (Si -hou), cest, comme
Venise, une cit des eaux. Marco Polo, qui la aime parce quelle lui
rappelait sa patrie, smerveille de ses embarcations innombrables, de ses
ponts de pierre, de son lac dont les lots boiss et les rives verdoyantes
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
144
abritaient une multitude de pavillons, de kiosques, de pagodes et de palais. A
lhorizon se dressait le rideau des montagn es aux valles profondes, aux pics
curieusement dcoups, pleines der mitages bouddhiques quont
immortalises peintres et potes, car il nest pas un de ces paysages de la
rgion de Hang-tcheou qui nait t depuis longtemps class par les vieux
matres song. La cour impriale donnait lexemple. Lempereur Kao -tsong
avait fait construire dans la montagne, au-dessus du Lac Occidental, un grand
et magnifique pavillon que le peintre Siao Tchao dcora dun vaste panorama
de sommets et de rivires, si bien quon ne savait si ctait une peinture
quon contemplait ou si ctait le paysage voisin . Mais ce ntait pas
seulement Hang-tcheou, ctaient tous les paysages du Tch -kiang qui allaient
renouveler linspiration artistique. Province privilgie par la varit de ses
aspects. Au nord, de lembouchure du Yang -tseu Hang-tcheou, une zone
ctire de polders, des paysages hollandais (67) avec une plaine maritime
haute peine dun ou deux mtres, stendant perte de vue et coupe en tous
sens dinnombrables canaux. Au sud, partir de Hang -tcheou jusquau
Fou-kien et au-del, une cte rias avec des baies aux contours dcoups se
ramifiant entre des montagnes de granite aux escarpements inattendus, des
falaises dchiquetes, des prairies hrisses de blocs de porphyre (68). Les
gographes ont depuis longtemps montr lanalogie de ces for mations avec
celles qui bordent la Mer Intrieure, au Japon. Il ne faudra donc pas nous
tonner si les paysagistes japonais ( partir du XVe sicle) prsentent avec les
matres de Hang-tcheou dvidentes affinits. Sans doute les premiers ont
copi les seconds, mais ils ont copi aussi les sites de leur propre pays et le
fait suffit pour expliquer la ressemblance avec certains paysages du Tchkiang.
Mais ces lments matriels, chez les matres de Hang-tcheou, ne sont que
pour nous transporter sur le plan de la pure spiritualit. En dpit du dessin le
plus sr qui ft jamais, le monde des formes dans cette cole nes t plus, selon
la formule bouddhique, qu un monde de rose , une charpe de bues
travers laquelle les pics les plus vertigineux ne se dressent quen appari tions
irrelles. Paysages noys de brume et perdus de lointains, poignants comme
un visage. Et cest bien le visage du monde que les matres de Hang -tcheou
ont voulu traduire sous son aspect le plus gnral ; ou plutt ils ont voulu
rendre sa signification profonde, car la matrialit des formes nest indique
que pour nous suggrer ce qui se cache par-del. Plus cette face de terre et
deau, de valles et de montagnes sera estompe de brumes et simplifie par
lloignement, mieux lesprit se laissera deviner au travers. Do la
composition habituelle du lavis. Au premier plan, volontairement peine
bauchs, quelques arbres au tronc tordu, une masure, une barque sur la rive
qui tout de suite simprcise, car le brouillard qui noie la valle se fond avec le
flot. A lhorizon, des distances impossibles valuer, les interpositions de
brume nous ayant fait perdre pied avec le rel, des chanes de montagnes dont
la ligne vaporeuse nous parat suspendue dans les airs. Paysages o
lenveloppe de vapeurs deau, en sparant les plans, en voilant demi les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
145
formes concrtes des choses proches, ne laisse finalement subsister que
lespace pur dans lidalit des lointains.
Parmi les matres de cette cole quelques noms simposent, car ils
comptent parmi les plus grands de tous les temps : Ma Yuan dont lactivit est
atteste partir de 1190 et qui dut mourir avant le milieu du XIIIe sicle, et
son fils, Ma Lin, puis Hia Kouei qui, comme Ma Yuan, travaillait sous le
rgne de lempereur Ning -tsong (1195-1224), et enfin Lean Kai et Mou -ki
qui vivaient entre 1200 et 1270.
De Ma Yuan les collections japonaises et amricaines estiment possder
quelques lavis originaux. Voici, au muse de Boston, un paysage au dbut du
printemps : dans le fond, de hautes collines ; leur pied, un village voil par
la brume ; une nappe deau enjambe par un pont et, tout au premier plan,
deux saules aux branches grles et frmissantes ; on sent lair du matin
effleurer les arbres ; la brume va se dissiper ; nul mouvement, nul bruit ; le
printemps hsite venir (69) . A la collection Mitsui, un pcheur solitaire,
tendant sa ligne dans sa barque, sur un lac, lhiver : la barque perdue au milieu
de limmensit du lac sans rivage visible ; rien que leau immobile et lhomme
attentif sa besogne. A la collection Iwasaki, un paysage de pluie ; au premier
plan, barque amarre, rochers et grands arbres, puis interposition de brume et
enfin, larrire -plan, pics estomps. A la collection Kuroda, un pote, sous
un pin en surplomb au flanc de la montagne, regarde la lune monter dans le
ciel. De Ma Lin, le clbre paysage du soir de la collection Nezu : les
hauteurs de la cte mergent seules de la brume, un vol dhirondelles emporte
notre imagination dans lespace . Le muse Guimet possde une copie de Ma
Lin : les gnies se runissant au-dessus de la mer , romantique vocation
dune demeure de rve surgie au milieu de rochers abrupts et dont la haute
terrasse domine un brumeux paysage docan et de rcifs travers par des
oiseaux.
Hia Kouei est sans doute reprsent par des uvres originales dans le s
collections Kawasaki et Iwasaki et au Muse national de Pkin. Le kakmono
de la premire collection voque en quelques traits de pinceau une bourrasque
en montagne : Dans une gorge, un coup de vent rabat les arbres au-dessus
dun pavillon couvert de chaume ; les feuilles sparpillent ; un bonhomme
qui franchit la passerelle sous son parapluie lutte contre le grain, un autre sest
rfugi dans un pavillon ; derrire laverse qui cache le paysage perce la crte
dune colline o quelques arbustes sont f urieusement secous par la rafale, le
tout indiqu avec la force et la rapidit de louragan (70). La peinture de la
collection Iwasaki, attribue Hia Kouei, est une marine, baie ou rivire avec
une barque amarre derrire une pointe de terre ; quelques herbes deau sur la
droite, quelques arbres traits par taches et petits coups de pinceau, suivant le
procd de lartiste ; au fond lentrevision dun horizon de montagnes ;
impression de largeur dans les tendues deau, lenvo l de la chane lointaine ;
eau et lumire fondues ensemble, en contraste avec les crayonnages des
premiers plans. Enfin le rouleau de lancien muse de Pkin est un long pano rama o tout sharmonise dans latmosphre : rives rocheuses, montagnes o
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
146
les pins poussent dru, arbres tordus et penchs, huttes niches dans les
buissons, ponts de bambou reliant les promontoires, nappe deau qui parfois
passe dans les dfils, en forme de baies profondes, et ailleurs slargit en un
bras de mer dont on naper oit pas lautre bord et o les jonques lointaines se
perdent dans la brume. Tout cela exprim par le simple lavis ... .
Ces divers paysagistes appartenaient aux cercles de lettrs confucens ,
lacadmie impriale de Hang -tcheou. Un autre groupe est form par les
artistes dinspiration bouddhique, comme Leang Kai et Mou -ki dont il nous
reste maintenant parler.
Ils professaient le bouddhisme contemplatif de lcole tchan que nous
avons tudie plus haut et peignaient dans les temples et ermitages de cette
secte dissmins prs de Hang-tcheou, autour du Lac Occidental ou dans les
escarpements de la montagne. Malgr la faveur personnelle de lempereur
Ning-tsong, Leang Kai avait abandonn lacadmie impriale de Hang tcheou pour aller vivre dans un de ces monastres. Son chef-duvre, qui se
trouve aujourdhui au Japon, la collection Sakai, reprsente kyamouni
se rendant larbre de la bodhi ; le fondateur du bouddhisme est reprsent
sous les traits dun ascte debout, mditant, appuy sur son bton, prs dun
torrent, dans un trange paysage de montagnes abruptes ; lintensit de la
pense, la violence de la mditation sont exprimes avec une pre spiritualit
dans ce visage hirsute, presque sauvage ; cette violence intrieure, autant que
le vent qui souffle dans la gorge de la montagne, anime les plis tranges du
maigre vtement et trouve sa rplique dans les branchages noueux, semblables
des btes monstrueuses, qui rampent en se tordant aux pieds de lasct e.
Dun autre Leang Kai de la collection Sakai on peut dire quil est fait avec
rien : au premier plan, un rocher surplombant leau et habit par trois troncs
darbre dpouills et comme prostrs ; gauche une hauteur couverte de neige
et qui se perd tout de suite ; dautres montagnes neigeuses, presque invisibles,
au fond ; dans lintervalle, toute la brume ; en ralit, ce qui fait le sujet du
tableau, ce qui est lme du paysage, cest la mditation dhy nique, la
communion avec lunivers.
Mou-ki, le plus grand gnie de ce temps, tait entr comme religieux au
monastre bouddhique du Lieou-tong -sseu, prs de Hang-tcheou. On lui doit
des apparitions surhumaines dans le domaine de lanimalit fabuleuse ou du
divin. De ce grand visionnaire le Daitokuji possde notamment un dragon
dune puissance tonnante : dans le clair-obscur dune nue dorage ltre
fabuleux surgit avec son mufle dpouvante, ses longs tentacules de crus tac,
ses cornes de dmon et ses yeux fulgurants dont le regard a la lueur blafarde
de lclair ; toute la menace indtermine de linconnaissable se ramasse
soudain dans ce masque bestial et divin. Mou-ki retrouve ici les vieilles
mythologies prconfucennes que nous avions entrevues quelque douze
sicles avant notre re sur les bronzes chang.
Mou-ki est plus grand encore quand son gnie cherche rendre des ides
bouddhiques. La puissance farouche et presque sauvage qui sexprimait dans
son dragon, la voici mise au service du mysticisme tchan quand il nous peint
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
147
dans la collection Iwasaki un ascte ravi en extase. Le solitaire est assis sur
une corniche de montagne. Un norme serpent lentoure de ses anneaux et
pose sur ses genoux une tte menaante. Mais lascte demeure impas sible : la
puissance de sa concentration mentale domine le reptile. Au-dessous deux,
flanc de montagne, se creuse labme do montent des nues qui semblent
porter ltrange groupe. Dune inspiration tout autre mais de composition
analogue, la Kouan-yin du Daitokuji, blanche apparition lexpression
mditative, la fois douce et grave, assise au pied des monts, au bord des
eaux, dans une atmosphre de brume qui estompe les pics du fond. Le
manteau de Kouan-yin est indiqu en longues lignes inflexions douces qui
suggrent lharmonie intrieure et le calme complet, comme leau
parfaitement lisse qui baigne le rocher. Mou-ki peut galement surpasser
comme paysagiste les matres confucens eux-mmes, comme dans le rouleau
de la collection Matsudaira reprsentant le retour des jonques un hameau de
pcheurs sur le lac Tong-ting. Les barques, on les distingue peine, tant tout
le paysage est fait deau, dair brumeux, despace et de lointain ; les
montagnes disparaissent peu peu dans la brume ; les trois quarts du tableau
sont occups par ltendue sans premier plan ni arrire-plan ; le hameau luimme sestompe et se tapit dans son bouquet darbres langle gauche du
rouleau, tant les uvres de lhomme se confondent dans limmensit.
Espaces infinis, harmonies de silence , cest la face mme de la terre que
nous peignent ici les vieux matres song et jamais elle naura t devine,
traduite et aime comme par eux.
Avec de telles uvres la peinture chinoise atteint presque le domaine de la
mtaphysique. Nous rentrons dans celui de lart pur avec la cramique song.
Elle aussi fait partie du grand art. Comme les peintres avaient de prfrence
adopt le lavis, le monochrome lencre de Chine, la cramique song prfre
la monochromie ou tout au moins le ton sur ton. Cest quelle aussi comme
lcri t Mme Daisy-Lion rpond au got dune socit de dilet tantes qui
concevait la sobrit comme le luxe suprme : sa beaut est toute en sourde
richesse, en nuances dlicates, en harmonies subtiles ; plus qu toute autre
poque la matire vaut par elle-mme, par son onctuosit, son lustre, ses
vibrations et ses reflets, faite autant pour la joie des yeux que pour les plaisirs
dlicats du toucher . Cest ce que proclamait expressment, la veille de
lavnement des Song, un rescrit imprial des annes 9 54-959 qui exigeait que
la porcelaine tchai -yao ft aussi bleue que le ciel, aussi claire quun miroir,
aussi mince que le papier, aussi sonore quune pierre musicale de jade .
Le groupe jou, ainsi appel des fours de Joutcheou, au Ho-nan, et dont la
production est antrieure au XIIe sicle, rpond bien cette dfinition avec
son mail gnralement gris lavande bleut ou bleu lavande ple, dune rare
dlicatesse. Un autre centre de fours est celui de Tseu -tcheou, au Ho-pei,
apparu dj sous les Tang et qui continua fonctionner durant toute lpoque
song. Il est reprsent notamment par un lgant dcor floral en mail brun sur
fond dmail crme. Le groupe ting, ainsi appel de la ville de Ting-hien,
galement au Ho-pei, donne principalement un mail ivoire, crme ou
chamois, parfois craquel, parfois avec dcor floral, souvent avec bord
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
148
mtallique. Par la finesse de leur matire, de leur dcor, llgance de leurs
formes, crit un collectionneur passionn, on peut considrer ces pices
comme la meilleure cramique de tous les pays et de tous les temps. Aprs
le repliement de la cour des Song de Kai -fong sur Hang-tcheou, les potiers de
Ting-hien se retirrent King-t-tchen, au Kiang-si, o la production
continua encore pendant toute lpoque ming. Un groupe apparent, dit
groupe du Ho-nan, comprend une srie de pices noires ou marron fonc dont
le reflet mtallique imite le bronze. Sous les Song de Kai -fong taient
galement apparus des cladons, caractriss par leur ton vert olive assez
sombre.
Ces cladons du nord sont en rapport avec la cramique corenne, par
ailleurs si rare en Europe (voir collection Robert de Billy). Les cladons du
sud sortirent des fours de Long-tsiuan, au Tch-kiang. Leur vert jade clair
trs lumineux les distingue premire vue des prcdents. Une varit voisine
est celle des craquels connus sous le nom de ko, aux toiles daraigne
dune dlicatesse infinie (mail gnralement vert deau, gris vert, gris bleut
ou gris cendr). Il est souvent fort difficile de les distinguer dune autre varit
de craquels, mail bleu gris ou lavande et connus sous le nom de kouan.
Les kouan, sous les Song de Kai fong, taient fabriqus dans les fours
impriaux de cette ville, au Ho-nan. Aprs 1127 les potiers de kouan
migrrent, eux aussi, Hang-tcheou. Au contraire les fameux clairs de
lune , mail bleu lavande ou mauve, opalescent et tach de pourpre, dont
les teintes se dgradent lune dans lautre ( flambs de transformation ),
semblent tre rests groups autour de Kiun-tcheou, au Ho-nan, do ils tirent
leur nom (groupe kiun). Ils se continueront lpoque mongole. Quant au
groupe kien, originaire du Fou-kien, il est constitu par les bols mail
marron fonc ou terre de Sienne, paillet ou tachet de reflets plus clairs,
quon appelle pour cette raison poils de livre ou plumes de perdrix .
Enfin Michel Calmann runit dans un groupe hors srie, le groupe clair ,
plusieurs genres de pices sans tradition crite, appeles dordinaire
ying-tsing ( azur nuageux ) et dmail, en effet, souvent bleutre (71).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
149
CHAPITRE 24
Cristallisation de la pense chinoise
Lpoque song nest pas marque seulement par cette extraordi naire
floraison artistique, mais aussi par la renaissance de la philosophie
confucenne et, plus gnralement, par limportance accor de aux luttes
dides. Or il se trouva que prcisment cette poque la mise au point dune
dcouverte inestimable vint donner la pense chinoise un instrument encore
inconnu partout ailleurs : la dcouverte ou plutt la gnralisation de
limprimerie.
La dcouverte de limprimerie ne fut pas plus en Chine quen Europe et
bien moins encore luvre dun seul homme, ralise dun coup de gnie.
Elle fut ici le rsultat du lent travail des sicles, procdant par transitions
presque insensibles. Lorigine en remonte dailleurs trois autres dcouvertes
beaucoup plus anciennes : celle du papier, celle de lestampage, celle des
sceaux sens normal .
La Chine archaque stait servie, pour crire, de minces tablettes de
bambou. Un peu plus tard, les Chinois employrent des pices de soie dune
espce particulire. Mais les tablettes de bambou restaient dun maniement
difficile, la soie tait chre. Daprs la tradition, un certain Tsai Louen,
employ au palais des seconds Han partir de lan 75 de notre re, mort en
114, aurait invent le papier en employant cet effet des corces darbre, des
fils de chanvre, de la vieille toile ou des filets de pche, soumis une longue
bullition, broys et rduits en bouillie paisse, en pte papier . A
lpoque des Tang lusage du papier tait assez gnralis pour que les
prisonniers chinois capturs par les Arabes la bataille du Talas en 751
passent pour en avoir introduit la technique dans le monde musulman.
Quant au procd de lestampage, nous avons vu que lorigine en remonte
la prise de copies sur les textes classiques confucens qui avaient t pour la
premire fois gravs sur pierre en 175-183 de notre re. Toutefois, comme ils
avaient t gravs en creux, les estampages ne venaient quen blanc sur fond
noir. Dailleurs la gnralisation de lestampage ne remonte pas au -del du
VIe sicle. De plus cest moins par ce procd que par lusage des sceaux que
les plus grands perfectionnements techniques furent obtenus. Comme les
inscriptions sur pierre, les sceaux furent longtemps gravs en creux. Au dbut
du VIe sicle on commena les graver en relief et en sens inverse, de sorte
que limpression en vin t enfin dans le bon sens et en noir (ou rouge) sur
fond blanc, dcouverte dont il est inutile de souligner limportance car elle
contenait le principe mme de limprimerie (cf. N. Vandier, l.c.).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
150
Sous les Souei la gravure sur bois ou xylographie avec impression de
caractres fit de nouveaux progrs. Un dit de 593 ordonna de graver sur bois
un grand nombre de textes et de dessins. Mais ce furent surtout les
bouddhistes et les taostes qui gnralisrent ce procd par limpression des
dhran ou formules-amulettes magiques multiples caractres. Les
xylographies bouddhiques du VIIIe sicle trouves Touen-houang par les
missions Pelliot et Aurel Stein relvent de cette technique, mais cest prin cipalement sur le bas Yang-tseu et au Sseu-tchouan qu e lim pression sur bois
parat, lpoque tang, stre le plus largement rpandue, et cela pour la
confection de calendriers astrologiques populaires imprims au moyen de
planches. Quant au plus ancien livre chinois imprim que nous possdions,
cest un texte bouddhique de 868 (le Sotra du diamant), rouleau compos de
feuilles de papier colles bout bout et actuellement au British Museum.
Le confucisme officiel ne fit ici que suivre lexemple du bouddhisme et
du taosme. En 904 un perfectionnement fut apport dans la gravure sur pierre
des textes canoniques : on commena les graver, eux aussi, en sens inverse
pour obtenir des estampages dans le bon sens. Nanmoins ce procd venait
trop tard pour quon puisse lui attribuer linvention de limprim erie, dj
acquise cette poque du fait de la xylographie et dont bnficiaient
maintenant les textes confucens . En 932, en effet, un dit imprial
ordonna de graver sur bois les classiques. La dcouverte finale serait due un
certain Pi Cheng (entre 1023 et 1063), le prcurseur, quatre sicles davance,
de notre Gutenberg et qui aurait invent les caractres mobiles, mouls en
terre cuite.
La gnralisation de limprimerie ne put manquer davoir dans la Chine
des Song une influence certaine sur le mouvement des ides. Limpression,
sur papier, des neuf classiques, puis dune foule de commentaires canoniques
multiplia lusage des instru ments de travail et apporta au commerce des
esprits des facilits inattendues.
Or, jamais vnement ne pouvait arriver plus son heure. Depuis les
Tang il tait visible que la pense chinoise tait anxieuse dtablir le bilan
spirituel des sicles antrieurs et devant ce spectacle, comprenant ce qui lui
manquait encore, dy ajouter une philosophie premire. Cta it une tendance
gnrale, sensible aussi bien chez les taostes et chez les bouddhistes que chez
les lettrs et qui tait en train de faire apparatre un no-taosme, un nobouddhisme et un no-confucisme plus proches les uns des autres que,
respectivement, des antiques coles de sagesse dont tous trois se rclamaient.
En ralit tous trois arrivaient au mme rsultat : le monisme, lexplication de
lunivers et de lhomme par un l ment unique. Les sectes bouddhiques du
Tchan et du Tien -tai y avaient, on la vu, abouti ds le VI e sicle de notre re
en retrouvant au fond de lme humaine comme au sein de lunivers le
principe de la bouddhit conu comme lessence universelle. Cest dans le
mme sens qu lpoque song les taostes tiraient des aphoris mes de Lao-tseu
une cosmogonie et une mtaphysique cohrentes : Le Vide, enseigne un de
leurs traits datant de cette poque, nest pas en ralit le vide absolu (le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
151
nant). Cest, bien qu ltat non encore perceptible, le tao (terme qui dsigne
ici le principe universel). Pour se manifester, le tao se rend accessible aux
sens. Le sensible, cest lensemble de tout ce qui a forme et figure, mais
formes et figures contiennent le tao et cest lui qui agit en elles. Dans tout tre
sensible il y a un esprit identique au tao , cest --dire au principe
cosmique (72).
Cest par un monisme analogue que lcole des lettrs song allait son
tour couronner le confucisme antique. Linitiative de ce grand mouvement
philosophique revient un auteur du XIe sicle, contemporain, par
consquent, des Song de Kai -fong : Tcheou Touen-yi (1017-1073). Ctait un
soldat qui stait retir pour mditer sur la destine. Lhomme que nous
entrevoyons derrire le philosophe avait une me trs noble et a peint son
idal dans une pice clbre, sous lallusion transparente de lamour des
lotus :
Parm i les fleurs, nom breuses sont celles qui peuvent
plaire. Le pote Tao Yuan-m ing naim ait que les
chrysanthm es.D epuis les Tang les gens du m onde ont vou un
culte la pivoine.M oije naim e que le lotus quisort de la boue
sans se souiller, dont le m ilieu est creux et la tige droite, qui
na ni branches ni ram eaux, dont le parfum est encore plus pur
distance, quon peut voir de loin et quon ne peut m anier pour
son am usem ent ...La pivoine rouge reprsente entre les fleurs
la richesse et la noblesse, m ais le lotus reprsente la sagesse.
H las ! ceux qui aim ent la pivoine sont nom breux, m ais je
crains dtre seul aim er le lotus ...
Ce fut Tcheou Touen-yi qui introduisit dans le confucisme la notion du
premier principe, dsign par lui sous le nom de tai -ki, littralement fate
suprme et conu, la manire du vieux tao de Lao-tseu et de
Tchouang-tseu, comme lunit primordiale (73). Mais lexemple du
no-taosme de son temps, il se reprsentait cette essence primordiale sous un
aspect non point mtaphysique mais nettement cosmogonique, semblable la
matire infiniment rarfie et diffuse de nos nbuleuses, poussire qui sous
laction interne des lois de la nature sorganise et produit par voie dvolution
lensemble de lunivers.
Les mmes ides furent dveloppes par son contemporain Chao Yong
(1011-1077). Tcheou Touen-yi avait t une sorte de mathmaticien de la
mtaphysique et, comme on la dit, un Spinoza chinois . Chao Yong fut,
lui, un libre rveur qui nous a laiss des vers dignes de Verlaine :
D evant les fleurs je bois du vin et je m e grise.
Ivre,tenant une branche fleurie,je continue chanter..
O ravissantes fleurs,ne riez par
en voyant m a tte blanche ;
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
152
M a tte blanche a dj vu
dinnom brables belles fleurs !(74)
Il vivait dans la banlieue de Kai -fong, dans une misrable cabane ouverte
aux vents et la pluie, manquant de feu en hiver et dventail pour se
rafrachir en t . Il avait donn cette masure le nom potique de Nid de
la joie tranquille . Il refusa tous les postes officiels, se contentant de recevoir
dans sa chaumire les hommes les plus minents de son temps, entre autres
lhistorien et ministre Sseu -ma Kouang quand celui-ci, fatigu de la vie
orageuse de la cour, venait auprs de lui chercher quelques instants de paix.
La doctrine de Chao Yong est un pur monisme.
Lhom m e est un avec le ciel et la terre, avec tous les
tres de tous les tem ps, car la loi de lunivers est unique. Loi
du ciel et de la terre, participe dans tous les tres,
atteignant dans chaque espce dtre un degr de
dveloppem ent qui en constitue la nature spcifique et dans
chaque individu un degr de perfection qui le caractrise.
Ltre prem ier, duquel est issu tout ce qui est, cest le tao,
cest le Fate Suprm e (Tai-ki), cest le Fate A uguste
(houang-ki), nom s dem prunt, car ltre prim ordial est
indfinissable, innom m able, ineffable. Le ciel et la terre ne
sont pas dune autre nature que le reste des tres. Ce sont
deux tres interm diaires par lesquels le Fate Suprm e
produisit tous les autres. La m atire universelle est une,
participe par tous les tres. Lesprit vital est un, particip
par tous. Les genses et les cessations, les naissances et les
m orts sont pures transform ations de ces deux entits. Tous
les tres sont un avec m oi. A lors, prenant la question de m on
ct, je dis : Y a-t-il rellem ent des tres ? Prenant la
question du ct des tres, je dem ande : M on m oi existe-t-il
rellem ent ? (75)
Comme on le voit, nous sommes ici tout prs et presque dans les
mmes termes des mditations du vieux philosophe taoste Tchouang-tseu
(voir plus haut). Mais Chao Yong, comme tous les penseurs de son temps, ne
se contente pas de ces lvations potiques . Il ordonne ces antiques
notions en un systme cohrent, une sorte dvolutionnisme dune
remarquable ampleur : Le Fate Suprme, cest ltre dans son premier tat
dinaction. Etant un, il produisit, par un premier acte, un autre un, la matire
tnue. Ensuite dans cette matire il produisit la pluralit par la double
modalit du yin et du yang. Il est curieux de retrouver ici les plus antiques
notions de la socit chinoise primitive, associes non plus seulement aux
laborations du taosme tardif, mais aux cosmogonies indiennes, telles que le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
153
bouddhisme les avait apportes avec lui en Extrme-Orient, le tout recouvert,
tant bien que mal, du manteau de lorthodoxie confucenne.
Ctait une vieille conception hindoue que le monde passe par des phases
alternantes dexpansion et de rtraction travers le cycle ternel des kalpa.
Nous retrouvons maintenant les mmes ides chez le philosophe
no-confucen Tchang Tsai (1020-1076), au point quon pourrait se demander
sil ne sagit pas ici de ladaptation dun texte sanscrit :
Tout com m ena par la condensation de la m atire
rarfie. Condense au point de tom ber sous les sens, ctait
une m asse gazeuse, vaporeuse, floconneuse (ki). Sa
quintessence non condensable, invisible et im palpable, cest la
force vitale ou esprit (chen). D epuis que le double m ouvem ent
dexpansion et de rtraction com m ena,la m atire ne peut plus
sy soustraire. Elle spanouit irrsistiblem ent en tres
m ultiples quirentrent dans son sein quand elle se contracte.Ce
double m ouvem ent est sans arrt. Il se passe dans la m atire
sans altrer la m atire. Il est sem blable au double phnom ne
du gel et du dgel de leau, laquelle reste inaltre sous ces
deux tats...Toute naissance est une condensation,toute m ort
est une rsolution de la m atire.A la naissance rien ne vient,
la m ort rien ne part.D ans lindividu la norm e cleste est esprit
vital; puis,elle redevient norm e cleste.Condense,la m atire
est un tre ; rarfie, elle est le substratum des
transform ations. (76)
La philosophie premire de lcole des lettrs tait donc consti tue en ses
traits essentiels quand Tchou Hi lui donna sa forme dfinitive.
Tchou Hi naquit au Fou-kien en 1130. Plus ou moins imbu, dans ses
premires annes, dides bouddhiques, il y renona dfi nitivement vers 1154.
pour revenir au confucisme officiel. En 1163 il se vit appel la cour de
Hang-tcheou par lempereur Hiao -tsong qui le nomma bibliothcaire. Par la
suite il exera les fonctions de gouverneur dans plusieurs villes importantes
(1170-1196). Ayant pris part aux querelles de partis qui divisaient la cour, il
fut la fin disgraci (1196). Il mourut dans la retraite en 1200. En plus de ses
traits de philosophie, il laissa une histoire gnrale de la Chine, abrg de
celle de Sseu-ma Kouang et qui reste encore aujourdhui le manuel le plus
consult. Quant son uvre philosophique, elle exera une telle influence,
elle clipsa si bien celle de ses prdcesseurs que le systme tout entier est
gnralement dsign sous le nom de tchouhisme .
A lorigine des choses, Tchou Hi place la notion de wou-ki, terme qui
signifie textuellement non-tre , absolu non-tre , mais qui, dans le
systme, reprsente en ralit bien plutt ltre en puissance, la virtualit
universelle, ou, comme dit lcole, le grand vide (tai -hiu). En effet cest
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
154
du wou-ki que sort le tai -ki, le principe de toute chose, lequel est chez Tchou
Hi comme chez ses prdcesseurs la cl de vote du systme. Les dfinitions
quil en donne prsentent ce premier principe comme ltre pur, infini, ternel,
absolu, la substance dans sa plnitude, principe du monde et raison des
choses. A ce titre on le dit extrmement lev, extrmement excellent,
extrmement subtil, extrmement esprit . Mais sil peut tre considr
comme spirituel, il est, aussitt que pos, pos dans la matire. Esprit si lon
veut, mais esprit non distinct de la matire, un avec elle, infus dans la masse
quil anime et organise. Ceux qui ont voulu voir dans le tchouhisme une
mtaphysique, ont pris le tai -ki pour un absolu transcendant. Dautres, pour
qui la doctrine ne st quun monisme matrialiste, donnent le tai -ki pour une
sorte dther cosmique. Et il faut bien reconnatre que le texte mme de Tchou
Hi peut prter aux deux interprtations. Tchou Hi crit, en effet, dans le
second sens : Tai -ki est semblable une racine qui germe et monte, qui se
divise en plusieurs branches, puis se divise encore et produit des fleurs et des
feuilles et ainsi de suite sans interruption. Un de ses prdcesseurs avait dit
de mme : Une plante ayant produit sa graine, cette graine seme produit
une plante. Cette seconde plante nest pas la plante premire, mais son esprit
vital est le mme, car lesprit vital universel est un : cest la loi de toutes les
genses. Mais un peu plus loin Tchou Hi, parlant toujours du premier
principe, emploie une autre image qui donne de sa pense une interprtation
toute diffrente. Voulant expliquer lomniprsence du tai -ki dans le monde, il
crit : Cest comme la lune qui claire la nuit. Elle est une au ciel et
pourtant, quand elle rpand sa douce lumire sur les fleuves et sur les lacs, on
la voit refltant partout son disque sans quon puisse dire pour cela que la lune
est divise et perd son unit. En ralit, le tai -ki, raison dtre de la masse
cosmique en gnral et de chaque tre en particulier, est la fois transcendant
et immanent, principe intellectuel du monde moral et principe interne du
monde matriel. A la manire de lancien tao, il met le monde, mais le
monde, bien que consubstantiel lui, ne se confond pas absolument avec lui
par le fait mme que le tai -ki est ternel, tandis que le monde quil met et
rabsorbe priodiquement reste, chaque fois, phmre.
Cette mission ou, si lon prfre, cette organisation du monde, le tai -ki
lopre par lintermdiaire du princi pe li, terme quon peut traduire par
raison , loi et qui reprsente en effet la raison des choses, lensemble
des lois de la nature. Cette loi immuable, ncessaire, valable pour tous les
rgnes et dans tous les mondes, est le moule permanent dans lequel viennent
se modeler les formes phmres. Cest ce que Tchou Hi exprime en ces
termes : Li est comme le matre de maison qui reoit et demeure. Il est
ternel et ses htes passent. Les lois de la nature prexistaient la cration :
Certainement avant le ciel et la terre li existait et cest lui qui, mettant
lnergie (ou la matire) en mou vement, produisit le monde.
Ici intervient en effet un nouveau principe, ki , terme qui possde une
gamme assez tendue de significations. Cest originel lement la masse
gazeuse, ariforme, essence et virtualit du cosmos et support des lois de la
nature. La loi, ou raison des choses li (et lun voit bien ici quil sagit des lois
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
155
de la nature) veille et met en branle cette masse ; suscite et libre lne rgie
qui dormait en elle ; et son tour lnergie cosmique dclenche par la produc tion et la combinaison des contraires yin et yang, principe mle et principe
femelle tout le processus de lvolution. Ainsi la raison universelle, tout en
transcendant infiniment les tres, leur est immanente. En se ralisant dans la
matire, elle anime, ptrit, modle et organise intrieurement les choses. Cest
le canal par lequel le premier principe, le tai -ki, se communique aux choses.
Mais cette communication nes t que temporaire : les existences particulires
ne sont que des prts court terme de la substance universelle, et la destine
de chaque tre nest quune drivation infinitsimale des lois de la nature.
Le philosophe chinois insiste sur les rapports de li et de ki, des lois de la
nature et de la masse gazeuse qui est lorigine de la matire, et cela en
termes que ne dsavouerait pas Herbert Spencer. La loi, fait-il remarquer, ne
tombe pas sous les sens, mais sa porte est sans limites et elle est le principe
de toute unit. La matire au contraire, perceptible aux sens, est limite et
source de toute diversit. Cest, on le voit, la diffrence mme qui existe dans
nos philosophies europennes entre les notions de loi et de matire. Mais
comme la loi et la matire dont ils sont les quivalents chinois, il et ki restent
troitement complmentaires et ne peuvent exister lun sans lautre. Cest
pour la commodit du raisonnement que le philosophe les isole. En ralit ce
sont deux co-principes insparables, bien que thoriquement li ait sur ki , la
loi sur la matire, une antriorit logique.
Ces principes philosophiques une fois poss, la cosmogonie de Tchou Hi
se droule suivant un scientisme rigoureux. Au commencement tait le Tai hiu, mot mot le Grand Vide, en ralit, comme on la vu, ltendue
considre comme le rceptacle de lther, la substance infiniment rarfie et
disperse des nbuleuses. En effet la matire, pour diffuse et rarfie quelle
pt tre ltat primordial, nen existait pas moins avec toutes ses virtualits
dans le Grand Vide, ce dont Tchou Hi nous avertit lui-mme en nous disant
que le Grand Vide ne peut exister sans matire. Puis, sous laction des lois de
la nature, cette matire diffuse sagglomre. Cest la phase du ch aos
primordial (houen touen, houen ti) qui correspond ce que nous appellerions
la condensation de la nbuleuse. Le chaos son tour sorganise en vertu,
toujours, du principe li, des lois de la nature, et, par la giration et le rythme
alternant yin-yang (nous retrouvons, on le voit, les vieilles conceptions
chinoises prhistoriques), il produit lensemble du cosmos visible.
La force latente, inhrente toute m atire, crit Tchou
H i, produisit le m ouvem ent giratoire ; le ciel et la terre
taient alors une m asse de m atire voluante, tournant com m e
une m eule. Ce m ouvem ent de rotation sacclrant, les parties
lourdes se condensrent au centre, form ant la terre, tandis
que les parties lgres, entranes vers la priphrie, form aient le ciel. Entre la terre et le ciel, apparurent les
hom m es.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
156
Tchou Hi enseigne dailleurs que cette cration nest que tem poraire. Le
cosmos organis nest, comme lindividu, quun aspect momentan de
lnergie universelle. Aprs une centaine de mille ans commencera une phase
de dsagrgation de la matire, suivie dune nouvelle phase de condensation
giratoire et de cration. Et ainsi de suite linfini, dans lavenir comme dans
le pass, car ce rythme alternatif est ternel et ncessaire, ntant que la
consquence mathmatique des lois de la nature. Un rigoureux dterminisme
commande lvolution. Destructions et crations senchanent ; cest
lexemple, dj cit, de la plante qui meurt en produisant la graine, laquelle
son tour reproduira la plante aprs une srie de transformations le grain sem
est revenu sa forme originelle.
La morale de Tchou Hi dcoule de sa philosophie premire. Cette morale
est purement rationaliste. Le principe li, cest --dire le faisceau des lois de la
nature, est la norme du monde moral comme du monde physique. La loi
morale est lapplication hu maine des lois de la nature. Elle est donc ncessaire
comme celles-ci et nous oblige au mme titre.
Ce rationalisme carte sensiblement la philosophie de Tchou Hi des
virtualits thistes quon pouvait entrevoir chez certains moralistes de
lantiquit chinoise. Lui -mme dit expressment :
Le ciel, cest lazur qui tourne sur nos ttes. Il ny a pas
dans lazur de Souverain du Ciel (quoi quen disent les anciens
livres).La loidirigeant,la m atire volue.Les tres sortent et
rentrent com m e les godets dune noria dont les uns, vides,
redescendent dans le puits,tandis que les autres,tant pleins,
rem ontent, la chane se droulant sans cesse. Toutefois il ne
faut pas dire que le m onde est sans m atre,puisque le principe
li(les lois de la nature) le gouverne.
Mais ce moteur du monde quest le principe li ne saurait tre conu
comme une conscience universelle, une ineffable spiritualit, lme des mes
et des mondes du panthisme indien : li, spcifie notre philosophe, agit sans
penser. Son action est ncessaire, fatale et inconsciente . Tout spiritualisme
est donc exclu.
Il en est, crit encore Tchou H i, des gnrations des
hom m es com m e des vagues de la m er. Chaque vague est ellem m e.La prem ire nest pas la seconde,la seconde nest pas la
troisim e, m ais elles sont toutes des m odalits de la m m e
eau. A insi de lhom m e. M oi qui suis aujourdhui, je suis une
m odalit de la raison universelle et de la m atire du ciel et de
la terre. M on anctre fut, lui aussi, une m odalit des m m es
lm ents. Il nest plus. Les lm ents restent. je suis en
com m union avec lui, par com m unaut de constitution, de raison
et de m atire.D e m m e le ciel,la terre,tous les tres sont un
avec m oi. je puis appeler le ciel m on pre, la terre m a m re,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
157
tous les tres m es frres,car tous m e sont unis,tout lunivers
est avec m oiun tre unique (77).
Ladversaire de Tchou -Hi, Lou Siang-chan (1139-1192) sex primera de
manire assez analogue :
En fait, tout est infini. Lhom m e, le ciel, la terre et toute
chose sont dans linfini ... Toute affaire de lunivers est notre
propre affaire,toutes nos affaires sont celles de lunivers.
On remarquera dailleurs quen fondant en esprit scientifique ce principe
de la solidarit de lhomme et de lunivers, Tchou Hi et Lou Siang -chan ne
faisaient que dvelopper une des plus antiques conceptions de la pense
chinoise, conception apparue, il nous en souvient, ds la protohistoire et sur
laquelle toute la sagesse archaque tait base. Cest encore cette mme
pense que dveloppe Lou Siang-chan lorsquil crit :
Lunivers nest pas autre chose que m on c ur [au sens
dm e, principe psychique] ; m on c ur est lunivers. Prs de la
m er O rientale nat un sage : son c ur et sa raison
(littralem ent son li, cest--dire les lois de sa pense) doivent
ressem bler aux m iens ; prs de la m er O ccidentale nat un
autre sage : lui aussi son c ur et sa raison doivent
ressem bler aux m iens. Parti de ce principe, on peut rem onter
aux sicles les plus reculs ou descendre indfinim ent le cours
des sicles futurs, les c urs et la raison de tous les sages
anciens,prsents ou futurs doivent tre identiques.
Si nous traduisons en vocables occidentaux, nous dirons que le sage de la
Grce antique et celui de la Chine mdivale doivent se poser le problme du
monde dans les mmes termes quun Leibniz ou un Kant parce que les lois de
la pense partout sont identiques et fonctionnent partout sur les mmes
donnes. Cest laffirmation de la valeur un iverselle de la raison en mme
temps que de lunit de lesprit humain. La porte philosophique dune telle
attitude ne saurait tre surestime et une histoire de la pense humaine qui ne
tiendrait pas compte de ces mtaphysiciens chinois du XIIe sicle serait une
histoire mutile, car ce que nous entrevoyons ici, ce nest rien de moins que le
fondement philosophique dun humanisme universel.
Mais sans doute y a-t-il une certaine distinction maintenir entre le
systme de Lou Siang-chan qui offre encore la spiritualit quelques voies
dvasion, et le systme purement mcaniste de Tchou Hi. Or, cest ce dernier
qui a eu une influence dterminante sur la pense chinoise. Cest lui qui a fait
la loi pendant les sept sicles qui nous restent parcourir. Il est donc
important de prciser quelle allait tre son action et pour cela de le juger dans
son ensemble.
Ce systme est imposant. Cest une synthse cohrente o ont t
rlabors la plupart des matriaux fournis par les doctrines chinoises
antrieures, depuis les classifications immmoriales entre le yin et le yang
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
158
jusquaux envoles mtaphysiques des pres du taosme et aux leons
morales du confucisme officiel. Nous avons mme pu y reconnatre des
emprunts indiens inavous. Le tout, fortement repens par un cerveau
puissant, si bien que len chanement sen droule avec une rigueur
scientifique impressionnante, tel dun Spinoza employant les matriaux de
Herbert Spencer. Les matriaux de toute provenance mis en uvre par Tchou
Hi ont t par lui si bien maonns que ldifice se prsente comme une masse
rigide sans fissure.
Un peu aussi comme une prison do lesprit chinois ne pourra plus que
difficilement schapper. Car la puissance du systme ne doit pas nous en
dissimuler les dangers, et ces dangers taient graves. En enfermant la
spculation dans une sorte dvolution nisme mcaniste circuit ferm avec
pour tout horizon la perspective nietzschenne du retour ternel , en lui
interdisant toute chappe de spiritualisme, Tchou Hi arrtait lessor de la
pense chinoise et mettait un terme prmatur au grand renouveau
philosophique des X-XIIe sicles. Sa doctrine, devenue par la suite
positivisme dtat, barrera la route aux spculations ultrieures, plongera le
mandarinat dans le matrialisme et la routine et sera pour une bonne part
responsable de lankylose qui frappera la philosophie dExtrme -Orient du
XIIIe au XXe sicle. Fait dau tant plus grave que les vnements politiques, la
conqute mongole dabord, le conservatisme ming ensuite, allaient concourir
au mme rsultat.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
159
CHAPITRE 25
Le conqurant du monde
Tandis que dans leur ville dart de Hang -tcheou les derniers Song se
passionnaient pour des problmes desthtique ou de m taphysique,
Gengis-khan avait commenc la conqute de lAsie (78).
Il tait n en 1167 sous une yourte de feutre, en haute Mongolie, prs des
sources de lOnon et du Kruln. Les tribus mon goles auxquelles il
appartenait comptaient parmi les plus arrires de lAsie. Quel que ft leu r
genre de vie chasseurs forestiers dans le nord, aux confins de la taga
sibrienne, ptres nomades au sud, dans les steppes immenses qui sallongent
entre la zone forestire et le dsert de Gobi, ctaient encore des demi sauvages. Toute leur richesse, comme celle des Huns leurs anctres, consistait
dans leurs troupeaux la suite desquels ils transhumaient la recherche des
pturages et des points deau. Vivant sous un climat terrible, tour tour
torride et glacial, exposs mourir de faim quand la scheresse, tuant lherbe
de la steppe, tuait du coup le troupeau, leur existence tait misrable. Ignorant
lcriture, la vie urbaine, la culture agricole, ils navaient en fait de croyances
quun grossier chamanisme. Le christianisme nestorien qui av ait pntr chez
leurs voisins, les Krit de la Mongolie centrale, les Turcs Naman de la
Mongolie occidentale, les Turcs ngut de la Mongolie Intrieure, navait pu
filtrer jusqu eux. Mais ces nomades si dshrits possdaient sur les vieux
empires civiliss dont ils convoitaient les richesses, une redoutable supriorit
militaire. Ctaient de merveilleux cavaliers et des archers infaillibles. Le
Mongol du XIIIe sicle est essentiellement larcher cheval qui apparat,
crible ladversaire de flche s, se drobe, disparat, reparat plus loin pour une
nouvelle salve, jusqu ce que lennemi fourbu et puis soit bon pour lassaut
final. La mobilit de cette cavalerie lui confrait en effet une ubiquit
hallucinante qui constituait dj un avantage stratgique considrable sur les
armes du temps. De plus la virtuosit des ptres ou des chasseurs mongols
dans lusage de larc quivalait au point de vue tactique une sorte de tir
indirect dune non moindre influence sur lissue du combat.
Les guerres les plus dures queut soutenir Gengis -khan furent diriges
contre les autres tribus turco-mongoles qui lui disputaient lhgmonie en
Mongolie. En 1206 il en avait fini avec elles et tait matre de tout le pays. Il
dirigea alors ses armes du ct de la Chine.
Le territoire chinois, nous lavons vu, tait partag entre trois dominations
dingale tendue. Le royaume tongous des Djurtcht ou Kin, capitale Pkin,
dtenait la Chine du Nord, le bassin du Fleuve Jaune. Depuis quatre-vingts ans
que les Kin occupaient ces vieilles provinces chinoises, ils staient
srieusement siniss. Lempire national chinois des Song, capitale
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
160
Hang-tcheou, possdait la Chine mridionale, cest --dire le bassin du
Yang-tseu et les provinces ctires correspondantes. Enfin le peuple des Tangout ou Si-hia, daffinits tibtaines, stait rendu matre de lOrdos, de
lAlachan et du Kan -sou, cest --dire des marches du nord-ouest. Lui aussi
tait en voie de sinisation.
Ce fut par une attaque contre ce dernier tat que Gengis-khan commena
la conqute de la Chine. Aprs plusieurs campagnes, il obligea les Tangout
reconnatre sa suzerainet (1209). Il se tourna ensuite contre les Kin et
entreprit de forcer les bastions de la Grande Muraille qui, du ct de
Siuan-houa et de Jehol, dfendaient les approches de Pkin (1211). Les Kin,
qui, malgr leur sinisation, navaient rien perdu des qualits militaires des
vieux Tongous, se dfendirent opinitrement. Le barde mongol de lHistoire
secrte est le premier saluer en eux des adversaires vaillants et pleins de
cran. Les combats furent dun acharne ment inou. Neuf ans aprs, les
voyageurs signaleront encore sur la route de Kalgan Pkin les champs de
bataille reconnaissables aux entassements dossements humains. Dautres
tmoins nous parlent aussi des monceaux de cadavres pourrissant sur le sol et
des pidmies sorties de ces charniers.
Larme mongole, toute en cavalerie et qui, cette poque, ne savait pas
encore faire un sige en rgle, pitina pendant prs de deux ans devant les
bastions de la Grande Muraille, dans la rgion de Siuan-houa et de Jehol,
avant de pouvoir descendre dans la plaine de Pkin (1211-1212). En 1213
enfin, Gengis-khan ayant forc les passes, envahit avec trois armes le Ho-pei
et le Chan-si. Il savana j usquau cur de lactuel Chan -tong, saccagea les
campagnes, pilla les villes secondaires, mais sans pouvoir prendre Pkin dont
il se contenta dtablir le blocus. Au cours dune trve, le souverain kin
le Roi dOr dsesprant de dfendre plus longtemps la place, transporta
sa rsidence Kai -fong, labri du Fleuve Jaune (juin 1214.). Gengis -khan
en profita pour recommencer la guerre : en mai 1215 ses lieutenants entrrent
Pkin dont ils massacrrent la population et quils incendirent. La
destruction dura un mois. Les ruines furent telles que lorsque, quarante-cinq
ans plus tard, le petit-fils de Genghis-khan, Qoubila, voudra venir habiter la
ville, il devra la faire reconstruire sur de nouveaux plans.
Cette destruction montre quel point les Mongols taient arrirs par
rapport aux autres barbares qui les avaient prcds, Kitat ou Djurtcht. Les
Kitat en 936, les Djurtcht en 1122 staient eux aussi rendus matres de
Pkin, mais, loin de la dtruire, les uns et les autres en avaient au bout de peu
de temps fait leur capitale. Aprs le minimum de massacres, ils avaient
assum tout de suite la succession des dynasties prcdentes. Cest que Kitat
et Djurtcht taient dj plus au moins frotts de culture chinoise, candidats
la sinisation. Les Mongols, au contraire, restaient encore en pleine sauvagerie.
Leur attitude tait celle dun clan de Sioux faisant irruption au milieu des
fermes amricaines. Ne connaissant que la vie nomade, ils ne concevaient pas
ce quils pouvaient faire dune g rande ville, le parti quils pouvaient en tirer
pour la consolidation de leurs conqutes. Ils ne discernaient point lavantage
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
161
quil y avait ne pas dtruire ce qui devenait dsormais leur proprit. Le
hasard leur ayant livr les belles terres agricoles de la plaine pkinoise, ils y
anantissaient tout non par sadisme, mais par embarras, faute de savoir faire
mieux.
Il y a un curieux contraste entre le caractre personnel de Gengis-khan et
la conduite des armes mongoles. Daprs les t moignages les plus
authentiques que nous possdions sur lui, le conqurant mongol se rvle
comme un prince sage, pondr, plein de mesure et de bon sens, soucieux
dquit, de moralit, sachant rendre justice un adversaire valeureux, ayant
horreur des tratres. Mais il sortait peine de la sauvagerie primitive et ne
concevait la soumission des vaincus que par un rgime de terreur gnralise.
Pour lui comme pour tous les siens la vie humaine ne comptait absolument
pas. Comme tous les nomades du Grand Nord, il navait, no us lavons vu,
aucune notion de ce que pouvaient tre la vie des sdentaires, lhabitat urbain,
les labours, tout ce qui ntait pas la steppe natale. Dans ces limites, qui sont
celles de son milieu et de son temps, ctait un organisateur n, sachant
couter les conseils des civiliss, ayant mme, en raison de sa haute
intelligence, une aptitude naturelle la civilisation.
Parmi les prisonniers faits la prise de Pkin, il discerna un personnage
illustre, Ye-liu Tchou -tsai, qui appartenait lan cienne famille royale des
Kitat, ces Tartares entirement siniss qui, un sicle auparavant, avaient rgn
sur Pkin (79). Comme beaucoup de Kitat, Ye-liu Tchou -tsai possdait
fond la culture chinoise. Ctait, par ailleurs, un hom me de gouvernement qui
avait rempli de hautes charges dans ladministration des Kin. Gengis -khan fut
frapp de son aspect ( de sa haute stature, de sa longue barbe et du son
imposant de sa voix , dit notre source). Il lui demanda pourquoi il avait si
longtemps servi les Kin, spoliateurs des anciens Kitat : La maison des Kitat
et celle des Kin ont toujours t ennemies. Je vous ai vengs ! Mon pre,
mon aeul et moi-mme, rpondit Ye-liu Tchou -tsai, nous avons t les
sujets et les serviteurs des Kin. Jaurais t coupable si je ne les avais pas
servis loyalement. On a vu quel point le conqurant mongol apprciait le
loyalisme dynastique, mme chez lad versaire. Cette rponse lui plut
particulirement. Il sattacha lhomme et en fit bientt un de ses conseillers les
plus couts. Ye-liu Tchou -tsai mit noblement profit son influence. Au
cours des campagnes suivantes, tandis que les chefs mongols faisaient main
basse sur les biens et les gens, il se contentait de recueillir les livres chinois
et aussi les produits pharmaceutiques avec lesquels il sauva la vie des
milliers dindividus lorsque, peu aprs, une maladie pidmique clata dans
larme mongole .
Le royaume kin tait maintenant rduit, autour de Kai -fong sa nouvelle
capitale, au Ho-nan et quelques districts du Chen-si. Mais Gengis-khan ne
prtait plus aux affaires chinoises quune attention secondaire. Cest du ct
de louest quil regardait dsor mais. Emmenant avec lui la grande arme
mongole, il partit en 1219 la conqute du Turkestan et de lIran oriental. Il
ne devait rentrer en Mongolie que cinq ans plus tard, pendant lhiver de
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
162
1224-1225. Pendant ce temps la lutte contre les Kin avait continu au ralenti.
Les lieutenants quil en avait chargs ne dis posaient dailleur s que deffectifs
rduits. La guerre dgnra en guerre de siges, les places fortes passant de
mains en mains parce que la cavalerie mongole se contentait toujours de
mettre les villes sac sans faire ensuite doccupation effective.
Cependant la dernire campagne de Gengis-khan eut de nouveau le sol
chinois pour thtre. Toutefois elle ne fut pas dirige contre les Kin, mais
contre le royaume tangout ou si-hia du Kan-sou qui avait offens le
conqurant en lui refusant des auxiliaires. Gengis-khan commena la
campagne lautomne de 1226 et la poursuivit avec tenacit, malgr les
douleurs internes, provoques par une chute de cheval, qui le faisaient
durement souffrir. Pour en finir avec la rsistance des Tangout, les gnraux
mongols proposrent lexterm ination radicale de la population. Ils reprsentrent Gengis-khan que ses sujets chinois ne lui taient dau cune utilit et
quil vaudrait mieux tuer jusquau dernier habitant pour tirer au moins parti du
sol qui serait converti en pturages. Ce fut Ye-liu Tchou -tsai qui fit carter
ce projet. Il dmontra les avantages quon pourrait retirer de contres fertiles
et dhabi tants industrieux. Il exposa quen mettant un impt modr sur les
terres, des droits sur les marchandises, des taxes sur la lcool, le vinaigre, le
sel, le fer, les produits des eaux et des montagnes, on pourrait percevoir
annuellement environ 500.000 onces dargent, 80.000 pices dtoffe de soie
et 400.000 sacs de grain. Et il eut gain de cause. Gengis-khan le chargea
dtab lir sur ces bases lassiette de limpt.
Tandis que larme mongole assigeait la capitale tangout, la ville de
Ning-hia, Gengis-khan, de plus en plus malade, stait install, pour fuir les
chaleurs de lt, dans les montagnes du Kan -sou, au nord-ouest de
Ping -leang. Ce fut l quil dcda le 18 aot 1227. Quelques jours aprs sa
mort, les dfenseurs de Ning-hia capitulrent. Conformment sa volont
posthume, ils furent tous massacrs. Tout le royaume tangout Kan-sou,
Alachan et Ordos fut annex lempire mongol.
Gengis-khan eut comme successeur la tte de lempire mongol son
troisime fils, Ogdi (80) (1229-1241). Ctait un vrai Mongol, lourdaud,
bonasse et ivrogne, jovial et volontiers clment, gnreux lextrme pour
son entourage, du reste nullement dpourvu dintelligence et mme de finesse.
Il continua rsider en Mongolie, autour de Qaraqoroum o il stait fait
construire une capitale fixe. Son conseiller, le Kitat sinis Ye-liu Tchou -tsai,
lencourageait dans cette voie : Lempire, disait -il Ogdi, a bien t
conquis cheval, mais il ne peut tre gouvern cheval. Ye-liu Tchou -tsai
sefforait en effet de doubler lempire tout militaire des Mongols dun empire
administratif la manire chinoise. Il fit crer une sorte de budget fixe, les
Mongols devant donner le dixime de leur btail, tandis que leurs sujets
chinois paieraient un impt en argent, en pices de soie et en grains, rparti
par feux. A cet effet, les parties conquises de la Chine du Nord, jusque-l
considres comme un terrain vague pour pillages arbitraires, furent au dbut
de 1230 divises en dix circonscriptions rgulires avec un personnel
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
163
administratif de fonctionnaires mongols et de lettrs chinois. Ye-liu
Tchou -tsai fit m me ouvrir Pkin et au Chan-si des coles pour enseigner
les lettres chinoises aux jeunes seigneurs mongols et inversement il attira dans
lad ministration mongole nombre de Chinois rallis.
Mais la conqute mongole ne fut pas pour autant ralentie. En Chine un
nouvel effort simposait. Les Kin faisaient preuve dune vitalit tonnante.
Non seulement leur rduit du Ho-nan restait intact, mais depuis la mort de
Gengis-khan ils contre-attaquaient dans les provinces voisines. Pour en finir
les Mongols imaginrent un plan grandiose. Le grand-khan Ogdi, avec le
gros de larme, descendit du Chan -si au Ho-nan, en attaquant cette province
directement par le nord. Pendant ce temps son frre cadet Toloui, avec un
corps de cavalerie, excutait un immense mouvement tournant par louest,
travers le Chen-si mridional et apparaissait brusquement dans le sud du
Ho-nan, prenant ainsi les Kin revers. Dans ce suprme combat les Kin firent
jusquau bout preuve dun hrosme qui fora ladmiration de ltat -major
mongol, bon connaisseur en la matire : leurs gnraux se laissaient couper les
articulations des membres plutt que de se rallier au vainqueur. Mais ils furent
encercls et crass. En mai 1233 leur capitale, Kai -fong, fut prise par le
gnral mongol Subti, le vainqueur de la Perse et de la Russie. Subti
entendait dtruire Kai -fong comme Gengis-khan avait dtruit Pkin. Ye-liu
Tchou -tsai intervint. Ogdi connaissait bien le sens de ces interventions :
Tu vas encore pleurer pour le peuple ? lui disait-il. Et le grand-khan
bougonnait, mais cdait. Cette fois encore il couta son conseiller et ordonna
dpargner Kai -fong, ordre que les soldats mongols, avec leur admirable
discipline, excutrent rigoureusement. Quant au souverain kin, au dernier des
Rois dOr, il avait quitt Kai -fong avant la fin pour se rfugier dans une
forteresse voisine, Ju-ning, mais, quand il vit les Mongols sur le rempart de
ce dernier rduit, il se suicida pour ne pas tomber vivant entre leurs mains (31
janvier 1233-2 mars 1234).
Tout lancien royaume kin, toute la Chine du Nord, tait aux mains des
Mongols. Dsormais ceux-ci taient les voisins immdiats de lempire song.
Pendant la guerre entre les Kin et les Mongols, la cour impriale chinoise,
la cour de Hang-tcheou, avait conclu une alliance avec les seconds, dans
lespoir dobtenir une part des dpouilles du royaume kin. Les Kin une fois
abattus, le grand-khan Ogdi remit en effet aux Chinois quelques districts
mridionaux du Ho-nan. Les gouvernants chinois auraient d sestimer
heureux de stre attir la bienveillance des terribles Mongols. Tout au
contraire, ils se dclarrent mal rcompenss de leur concours et, dans leur
insigne folie, ils essayrent de disputer aux vainqueurs le reste du Ho-nan. Le
rsultat ne se fit pas attendre. Ce fut la guerre. En 1236 trois armes,
mongoles envahirent lempire song et ravagrent le Sseu -tchouan et le
Hou-pei.
Toutefois ce ntait l quune expdition de reconnaissance et bientt les
oprations se ralentirent. Cest que dans cette norme ruche humaine de la
Chine centrale et mridionale, compartimente par tant de rivires et de
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
164
montagnes, sur ce sol coup de rizires et de lacs, avec tant dagglomrations
urbaines, la guerre ne pouvait tre quune guerre de siges dans laque lle les
cavaliers de la steppe se trouvaient encore assez dsorients. Conqurir la
Chine du Nord, cest ce quoi avaient russi avant les Gengis khanides
dautres hordes turco -mongoles depuis les Huns et Tabghatch des IVe et Ve
sicles jusquaux Rois d Or de 1126. Conqurir la Chine mridionale cest ce
quoi elles avaient toutes chou. En ralit, pour conqurir la Chine du Sud,
il allait falloir faire une guerre la chinoise, avec de larges contingents de
fantassins chinois et toute une artillerie de machines de sige servies par
des ingnieurs chinois ou trangers. Du reste les armes mongoles taient
alors absorbes par de nouvelles expditions en Europe, travers la Russie, la
Pologne et la Hongrie. Et en 1241 le dcs du grand-khan Ogdi vint
pratiquement interrompre les hostilits entre Mongols et Chinois.
La guerre reprit sous le deuxime successeur dOgdi, le grand -khan
Mongka, lequel gouverna lempire mongol de 1251 1259. Chef nergique,
administrateur svre mais juste, politique dur mais intelligent, bon guerrier,
Mongka avait dcid de pousser fond la lutte contre les Song. Il ne sagissait
plus avec lui dexp ditions de pillage, mais de la conqute effective du pays.
Il commena en 1251 par associer cette tche son frre cadet Qoubila quil
nomma gouverneur du Ho-nan, choix heureux car Qoubila, qui montrait un
got trs vif pour la civilisation chinoise, travailla dans son gouvernement
restaurer lagriculture, ruine par la guerre, en distribuant des semences et des
outils aux paysans et en transformant ses soldats indignes en laboureurs. Les
oprations dcisives contre lempire song commencrent en 1258. Tan dis que
Qoubila attaquait la ligne du moyen Yang-tseu du ct de Wou-tchang,
Mongka lui-mme pntrait au Sseu-tchouan pour tourner la Chine
mridionale par le sud-ouest ; mais il dcda au cours de cette campagne,
emport par une pidmie le 11 aot 1259.
Sa mort allait faire la place libre pour son frre Qoubila.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
165
CHAPITRE 26
Qoubila, le grand sire
Lorsque la mort de son frre Mongka le rapprocha du trne, Qoubila avait
quarante-trois ans. Des petits-fils de Gengis-khan ctait de beaucoup le plus
remarquable. Homme dtat comme son illustre aeul, bon capitaine et
politique avis, il joignait aux solides qualits de sa race lavantage de stre
dlibrment ralli la civilisation, en lespce la culture chinoise. Comme
nous lavons vu, la mort de Mongka il assigeait sur le Yang -tseu la ville
chinoise de Wou-tchang, au Hou -pei. Pour avoir les mains libres, il conclut
un armistice avec les Chinois et regagna aussitt Pkin, puis, plus au nord,
prs de lactuel Dolon -nor, sa rsidence dt de Chang -tou. Ce fut l que le 6
mai 1260 il se fit proclamer grand-khan par son arme.
En ralit son avnement au trne mongol ne fut pas sans susciter
dopposition dans sa famille. Son plus jeune frre, Ariq -bg, se proclama de
son ct grand-khan Qaraqoroum, en Mongolie, et ctait prcisment pour
pouvoir le combattre que Qoubila avait si prcipitamment conclu une trve
avec les Chinois. La guerre entre les deux frres, qui eut la Mongolie pour
thtre et pour enjeu, dura quatre ans. Enfin en aot 1264 Ariq-bg vaincu
vint faire sa soumission Qoubila.
Dbarrass de ces comptitions familiales, Qoubila put reprendre la
conqute de lempire song. Lempereur song Tou -tsong (1265-1274) accordait
sa confiance des politiciens nfastes qui neutralisrent les efforts de
gnraux souvent pleins de cur. Nanmoins il fallut aux Mongols plus de
huit ans pour en finir avec la rsistance chinoise. Le sige des deux cits
jumelles de Siang-yang et de Fan-tcheng, au Hou -pei, exigea plus de cinq ans
(1268-1273). Les dfenseurs firent preuve dune extraordinaire opinitret.
Bloqus du ct de la terre, ils furent quelque temps encore ravitaills par eau
grce deux hardis capitaines qui russirent remonter jusque-l la rivire
Han, non sans payer de leur vie cette action dclat. Les Mongols mirent alors
en batterie une vritable artillerie de balistes et de catapultes construites et manuvres par des ingnieurs ouighour ou arabes leur service. Ce
bombardement finit par avoir raison de lhrosme des assigs et la chute des
deux villes permit aux Mongols datteindre par la basse Han le moyen
Yang-tseu, puis de descendre la valle du fleuve depuis Wou-tchang jusqu
Nankin. A la fin de 1275 toutes les armes mongoles convergeaient sur
Hang-tcheou, la capitale song.
L tout tait dans la confusion. Lempereur Tou -tsong, esprit fort cultiv
mais souverain inepte, maintenait aux affaires un excrable ministre, Kia
Sseu-tao, dont tout le programme consistait brimer llment militaire.
Tou-tsong tant mort sur ces entrefaites, Kia Sseu-tao, pour conserver le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
166
pouvoir, mit sur le trne un enfant de quatre ans (1274). Pendant ce temps les
places du bas Yang-tseu tombaient les unes aprs les autres aux mains de
lennemi. La rgente finit par dgrader Kia Sseu -tao, mais il tait trop tard :
Hang-tcheou tait investi. Dcourage, elle capitula (fin fvrier 1276). Le
gnral mongol Bayan fit son entre dans limmense cit et envoya le petit
empereur Qoubila. Celui-ci traita son jeune captif avec une remarquable
humanit. Aprs lui avoir assign une rente, il se contenta, comme eussent fait
nos anctres pour un Mrovingien ou pour un Carolingien dtrn, de le faire
lever dans la clricature : lhritier des Song devait mourir paisiblement
quarante-sept ans plus tard dans un couvent bouddhique. Limpratrice
rgente, au tmoignage de Marco Polo, reut de son ct un accueil dfrent
avant de se retirer, elle aussi, dans un couvent. On mesure par l ltape
franchie par les Mongols depuis Gengis-khan. En deux gnrations ces demisauvages staient levs au niveau des vieilles races civilises.
Il restait encore soumettre la rgion cantonaise o les derniers patriotes
chinois staient groups autour du frre cadet du petit empereur dtrn, un
autre enfant, suprme espoir de la dynastie song. Mais ce dernier foyer de
rsistance ne put tenir bien longtemps. Canton succomba en 1277. Le dernier
des Song il avait huit ans fut recueilli par le hros loyaliste Tchang
Che-kie sur une escadre qui russit pendant plusieurs saisons se cacher dans
les havres de la cte cantonaise. Mais les Mongols taient tenaces. Ils
quiprent une flotte suprieure et vinrent encercler lescadre chinoise prs de
llot de Yarchan, au sud -ouest de Canton (13 avril 1279). Ce fut le dsastre.
Les jonques chinoises les plus rapides parvinrent percer les lignes ennemies,
mais le navire imprial tait trop lourd pour pouvoir suivre la manuvre. Un
des serviteurs de lenfant imprial se prsenta devant lui : Cen est fait de
lempire, lui dit -il gravement. Vous devez finir avec lui. Votre frre sest
lchement rendu aux vainqueurs. Ne renouvelez pas cette honte ! Il dit,
saisit lenfant bras le corps et se jeta avec lui dans les flots. Quant au vaillant
Tchang Che-kie, la mort avait paru le fuir quand un typhon clata autour de sa
jonque. Il refusa datterrir, grimpa la hune du gr and mt et, levant un
btonnet dencens, adjura le Ciel : Moi, Tchang Che-kie, jai vcu toute ma
vie pour servir les Song. Voici que le dernier dentre eux est mort. Sil reste
encore quelque chance pour leur cause, si leurs sacrifices doivent se perptuer,
que le Ciel me sauve pour que je les serve encore. Sinon, jai assez vcu ! A
linstant mme un tourbillon engloutit sa jonque et il disparut dans les flots.
Ctait la premire fois que la Chine tout entire, sud compris, tombait aux
mains dun c onqurant tranger. Ce quaucun des envahisseurs du haut moyen
ge navait pu accomplir, Qoubila y russissait enfin. Il ralisait le rve
obscurment poursuivi depuis des sicles, travers dinnombrables
gnrations de nomades, par tout ce qui vivait sous une yourte de feutre
depuis la steppe des Kirghiz jusqu la fort mandchourienne. Seulement et
par bonheur, de Genghis-khan Qoubila la conqute avait t assez lente
pour que les plus dangereux rsultats en fussent amortis. Car pour conqurir la
Chine entire, depuis la premire incursion de Genghis-khan dans le royaume
tangout du Kan-sou jusqu la destruction de la dernire escadre song par les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
167
amiraux de Qoubila, il navait pas fallu aux invincibles Mongols moins de
soixante-quatorze ans (1205-1279). Lorsque cette uvre gigan tesque fut
acheve, au lieu de Gengis-khan, le sauvage vtu de peaux de btes, le
nomade qui ne savait que tuer et brler, les vaincus se trouvrent en face dun
Mongol presque pareil eux-mmes.
Dans la personne de Qoubila, en effet, si le petit-fils de Gengis-khan
conquit la Chine, il avait au pralable t lui-mme conquis par la civilisation
chinoise. Sa totale victoire allait lui permettre de raliser le constant objectif
de sa politique personnelle : devenir un vritable Fils du Ciel, faire de
lempire mongol un empire chinois. La voie tait enfin libre. Les Song une
fois disparus, il devenait le matre lgitime de lempire quinze fois centenaire.
Sa dynastie, qui prit le nom de dynastie Yuan, naspira plus qu conti nuer les
quelque vingt-deux dynasties chinoises qui lavaient prcde. Signe visible
de cette sinisation : Qoubila, bien que matre de la Mongolie, renona y
habiter. Ds 1260 il tablit sa capitale Pkin, et en 1267 il commena
construire au nord-est de lancienne cit une ville nouvelle qui fut connue en
turco-mongol sous le nom de Khanbaliq, la ville du khan , do Marco
Polo a fait Cumbaluc.
Comme grand-khan mongol, Qoubila eut soutenir plusieurs guerres en
Asie. Une fois matre de la Chine, il rclama lhommage des autres pays de
lExtrme -Orient. La Core, plus ou moins rebelle ses prdcesseurs,
accepta sa suzerainet, mais les escadres et les corps expditionnaires quil
envoya par deux fois au Japon (en 1274 et en 1281) et Java (1293)
chourent : les guerriers de la steppe se sentaient dpayss sur mer et les
marins corens ou chinois quils taient obligs demployer ne servaient qu
contre-cur. Un typhon qui, le 15 septembre 1281, dispersa larmada
mongole mit fin aux tentatives contre le Japon. De mme en Indochine. Les
forces que Qoubila envoya contre le royaume dAnnam (Tonkin et
Nord-Annam actuel) et contre le royaume du Tchampa (Sud-Annam actuel)
en 1283, 1285 et 1287, chourent aussi et pour une raison analogue : les
guerriers venus des confins sibriens taient dcims par le climat tonkinois.
Ces checs dailleurs nempchrent pas les souverains de lAnnam, du
Tchampa et de la Birmanie de reconnatre par la suite la suzerainet de la
maison de Qoubila. Enfin mais le fait tait plus grave Qoubila eut
disputer le titre de grand-khan mongol et la Mongolie elle-mme un de ses
cousins, Qadou, qui rgnait du ct de lEbinor, au Tarbagata et en
Dzoungarie.
Qoubila, en devenant un Fils du Ciel, en adoptant la civilisation chinoise,
en sinisant de plus en plus lempire mongol, en dlaissant le sjour de
Qaraqoroum pour celui de Pkin, avait mcontent beaucoup de Mongols
rests fidles aux traditions de leur race, la vie de la steppe, lme nomade.
Ces mcontents staient dabord groups autour de son plus jeune frre,
Ariq-bg, dont ils avaient soutenu vainement dailleurs les prtentions
au trne. Ariq-bg une fois abattu, ils trouvrent un nouvel anti-Csar dans la
personne de son cousin Qadou, petit-fils, lui aussi, de Gengis-khan, mais qui
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
168
continuait mener dans le Grand Ouest la rude existence de ses aeux
nomades. Ce loup de la steppe tait lantithse vivante du Mongol sinis et
sdentaire qutait Qoubila. A partir de 1267 il russit enlever Qoubila la
suzerainet des deux Turkestans (Turkestan chinois et Turkestan russe
actuels), ce quon appelait alors le khanat de Djaghata. Leffort que fit
Qoubila en 1275 pour recouvrer le Turkestan (81) ne tarda pas chouer et ce
fut Qadou qui en 1277 faillit lui enlever la Mongolie. Dix ans plus tard
Qadou forma contre lui une nouvelle coalition de princes gengiskhanides,
depuis le Turkestan jusqu la Mandchourie. Qoubila, il avait alors
soixante-douze ans, dans une campagne difficile qui eut cette fois la
Mandchourie pour thtre et que nous a raconte Marco Polo, brisa la
coalition (1287), mais il tait rserv son successeur, le grand-khan Tmur,
den finir dfinitivement avec Qadou (1301).
En somme, comme grand-khan mongol, Qoubila est loin davoir partout
russi. Bien quil ait pu conserver la possession de la Mongolie proprement
dite, ses cousins, les autres princes gengiskhanides qui rgnaient au Turkestan
ou en Russie mridionale, ne reconnurent pas sa suzerainet. Seule, la famille
de son frre Hulgu qui rgnait en Perse fut pour lui une vassale fidle. Et tous
ces embarras dans sa propre maison venaient de ce quil avait abandonn le
genre de vie de sa race pour devenir un empereur chinois.
En ralit, cest surtout comme empereur de Chine que Qou bila a
pleinement russi. Cest ce titre quil a mrit dtre appel par Marco Polo
le plus puissant souverain et possesseur de gens, de terres et de trsors qui
ait exist depuis Adam jusqu nos jour s . jamais Fils du Ciel ne prit son rle
plus cur que ce petit -fils du terrible Gengis-khan. Son administration rparatrice pansa les maux dun sicle de guerres. Aprs la chute des Song, non
seulement il conserva les institutions et les cadres administratifs de la dynastie
tombe, mais il mit toute son application obtenir le ralliement personnel des
fonctionnaires en place. Aprs la conqute du sol il russit celle des esprits et
son plus grand titre de gloire nest peut -tre pas davoir, le premie r dans
lhistoire, conquis la Chine entire, mais de lavoir pacifie.
Aprs tant de dvastations et de destructions, ltat du pays tait pitoyable.
Les statistiques de recensement en donnent une ide. Vers 1125 la Chine avait
compt 20.882.258 familles, soit au taux ordinaire, 100 millions dhabitants.
En 1290 elle ne comptait plus que 13.196.206 familles, soit pas tout fait 59
millions dmes. Pour relever le pays un grand effort simposait dans tous les
domaines.
La question des communications, si importante pour ladminis tration et le
ravitaillement de limmense empire, fut lobjet de la sollicitude de Qoubila. Il
fit remettre en tat les routes impriales, les fit en principe ombrager darbres
et y leva de distance en distance des caravansrails. Il tendit la Chine le
systme de la poste mongole (djam) qui fit ladmiration de Marco Polo et
dOdoric de Pordenone. Plus de deux cent mille chevaux, rpartis entre les
diffrents relais, auraient t affects ce service. Pour ravitailler Pkin et y
amener le riz du bas Yang-tseu, il se livra des travaux de canalisation
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
169
considrables entre Yang-tcheou et la capitale. Ainsi fut cr le Grand Canal
Imprial (Yun-ho), avec le trac qui existe encore aujourdhui. Pour lutter
contre la famine, il remit en vigueur les mesures de prvoyance dtat , la
lgislation tatiste laquelle sous les Song de Kai -fong le clbre Wang
Ngan-che avait attach son nom. Comme Wang Ngan-che, il promulgua les
dits de maximum. Dans les bonnes annes lexcdent des r coltes tait achet
par ltat et emmaga sin dans les greniers publics. En cas de disette et de
hausse des prix, ces greniers taient ouverts et les grains distribus gratuitement (82). Dautre part lassistance publique fut ror ganise. Un dit de 1260
ordonna aux vice-rois de subvenir aux besoins des lettrs gs, des orphelins,
des malades, des infirmes (83). Un dit de 1271 institua des maisons
dhospitalisation. Des distributions de riz et de millet f urent faites
rgulirement aux familles ncessiteuses. Qoubila lui-mme, nous dit Marco
Polo, nourrissait chaque jour trente mille indigents.
Le ct le plus dfectueux de ladministration mongole fut le ct
financier. Dans les institutions des Song, Qoubila avait trouv lusage du
tchao ou papier-monnaie. Il sagissait en principe de bons ou coupons
auxquels tait confre une valeur quivalente un lingot dargent. Qoubila
en gnralisa la pratique et en fit la base de sa politique financire. Marco
Polo constate, non sans humour, que les Mongols ont dcouvert l la
vritable pierre philosophale , lart de fabriquer de lor avec des billets en
corce de mrier. Ds 1264 fut promulgu un dit qui fixait la valeur, en
papier-monnaie, des principales marchandises, mesure qui avait la fois au
point de vue conomique la porte dune loi du maximum rglementant le
march, et au point de vue financier la signification dune loi du cours forc
pour les billets de banque. Le premier ministre des finances de Qoubila, le
musulman Seyid Edjell, originaire de Boukhr (mort en 1279) parat avoir
maintenu les missions dans des limites raisonnables Les imprudences
commencrent avec les ministres suivants, dabord un autre Transoxianais,
Ahmed Benket (mort en 1282), puis lOuighour Sangha. Tous deux
pratiqurent une politique dinflation effrne qui avilit rapidement le tchao .
Pour trouver de largent, ils eurent recours des conversions rptes et de
lourds monopoles. Ahmed, assassin en 1282, fut dgrad posthumment par
Qoubila. Sangha fut condamn mort pour malversations (1291). Sous le
deuxime successeur de Qoubila, le grand-khan Qachan, il faudra en 1309
renoncer enrayer la baisse des missions prcdentes et fabriquer de
nouveaux assignats qui se dprcieront leur tour.
Finalement on fut contraint de revenir la monnaie mtallique usite sous
les dynasties prcdentes, mais il nest pas possible que la crise financire
ltat permanent qui avait marqu le rgne de Qoubila (1260 -1294) et celui de
son petit-fils Tmur (1295-1307) nait pas eu de rpercussions morales. Cette
inflation perptuelle, les dvaluations successives qui en taient linvitable
consquence, la perturbation qui en rsulta pour le march ne pouvaient
manquer de rendre le rgime mongol impopulaire dans les parties les plus
commerantes de la Chine, grosses agglomrations du bas Yang-tseu et ports
du Fou-kien ou de la rgion cantonaise, pays o toute la population urbaine
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
170
des puissantes guildes clbres par Marco Polo aux petits boutiquiers
entrevus par Odoric de Pordenone ne vivait que de banque et de commerce.
Or ce sera prcisment dans cette rgion quau milieu du XIV e sicle
commencera la rvolte populaire contre le rgime mongol.
Nous venons de voir deux musulmans diriger successivement les finances
impriales. Leur cas nest pas isol et tient aux condi tions mmes du rgime
foncier sous les Mongols.
Dans la Chine du Nord par eux conquise sur les Kin les Mongols avaient
trouv un rgime foncier trs diffrent de celui de la Chine ancienne. Avant
eux, les prcdentes dominations tartares qui avaient possd ce pays, les
Kitat dabord (X -XIe sicles), les Djurtcht ou Kin ensuite (XIIe sicle)
avaient rduit ltat de serfs un grand nombre de propr itaires chinois pour
constituer en grands domaines les terres ainsi asservies et en faire cadeau
aux seigneurs kitat dabord, kin ensuite. A la veille de la conqute mongole,
en 1183, les serfs formaient dans le royaume kin, dans la Chine du Nord, plus
du cinquime de la population totale : 1.345.947 serfs ou esclaves sur
6.158.636 habitants.
Les Mongols, quand ils remplacrent les Kin dans la Chine du Nord,
semparrent de tous les apanages ou bnfices qui avaient t ainsi constitus
en faveur de laristocratie des Kin. Dans la Chine mridionale, lempire song,
les expropriations au profit des Mongols ne furent pas moins considrables :
les princes gengiskhanides et mme les simples nobles mongols (noyat,
baatout ) sadjugrent titre de proprit personnelle une grande partie du
territoire chinois. Pour remettre en mouvement lconomie chi noise, ils
imaginrent, lorsque la priode du pillage brutal eut t close, de consentir des
prts dargent, gros intrts du reste, la population chinoise , cette
mme population quau mo ment de la conqute ils avaient si souvent rduite
au servage dans les campagnes ou spolie dans les entreprises commerciales
urbaines (84). Ces prts furent effectus par lintermdiaire de gu ildes ou
socits bancaires, gnralement composes de musulmans, guildes connues
sous le nom mongol d ortoq. Les musulmans (en lespce des Turco -Iraniens
de la rgion de Boukhr et de Samarqand) jourent un peu ici le rle la fois
de nos Lombards au moyen ge et de nos fermiers gnraux au XVIIIe
sicle. Ils furent, dit Pelliot, les grands marchands dargent de lExtrme Orient lpoque mongole. Ils devaient tre fort pres au gain puisque, en
1298, le successeur de Qoubila, le grand-khan Tmur, sentit la ncessit de
soustraire les populations de la Chine mridionale leur arbitraire ou
larbitraire des seigneurs mongols sexerant par leur intermdiaire. La
population reut alors des garanties contre les recouvrements usuraires
exercs par les guildes musulmanes et contre la saisie des femmes et des
enfants des dbiteurs.
Plus gnralement et en dehors de cette question particulire, la dynastie
mongole dans sa lgislation officielle, le Code des Yuan, se proccupa
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
171
damliorer la situa tion des esclaves, ouvriers agricoles et fermiers travaillant
sur les grands domaines. Elle tenta de protger ces pauvres gens contre
larbitraire de leurs matres mieux que ne lavait fait la lgislation des Song.
Un dit du grand-khan Tmur, ds le dbut de son rgne (1295), interdit
mme aux seigneurs mongols de compromettre les rcoltes en chevauchant
travers les plantations. Le code des Yuan, au dbut du XIVe sicle, ajoute
Henri Maspero, punissait de cent sept coups de bton tout propritaire qui
avait frapp mort un ouvrier agricole ou un fermier. Lexistence des fermiers
tait si dure que les ordonnances intervinrent plusieurs fois pour diminuer le
prix exagr des fermages privs. En 1285 il fut diminu dun dixime, en
1304 de deux diximes au Kiang-si et en 1354 la mesure fut tendue
lempire entier.
La politique mongole en Chine est particulirement significative dans le
domaine religieux.
Qoubila, comme le remarque Marco Polo, fit preuve de la plus large
tolrance ou mieux dune unive rselle bienveillance envers les divers cultes. La
raison de cette attitude est double. Le fond de la religion mongole au temps de
Gengis-khan tait un chamanisme qui redoutait et rvrait toute manifestation
possible des Puissances caches dans le ciel, les monts et les eaux ; qui
rvrait de mme et par la mme crainte superstitieuse les Pouvoirs de tous les
thaumaturges. Or, toutes les religions tablies, tous les clergs qui les
reprsentaient avaient indistinctement droit cette prudente dfrence. Par
ailleurs lhomme dtat de grande classe qutait Qoubila comprit tout de
suite lintrt quil avait domes tiquer les diffrents clergs pour ses fins
politiques. Ce nest pas un concordat quil conclut cet effet, ce fut autant de
concordats quil y avait de religions tablies. Ds quil se fut officielle ment
substitu la dynastie song, il accomplit, nous le verrons, les gestes rituels
envers le confucisme , comme chef de la religion impriale millnaire.
Mais il navait pas attendu le ralli ement des lettrs pour comprendre le parti
quil pourrait tirer (et prcisment contre le lgitimisme obstin de ceux -ci) en
sappuyant sur le bouddhisme et le taosme. A cet effet il entendit organiser
lglise bouddhique et lglise taoque en instituti ons dtat avec, pour
chacune, un chef nomm par lui et responsable devant lui. Cest ainsi que
Napolon concevra les rapports de ltat et des glises.
Mais (et en dehors du vieux chamanisme mongol quil ne dut jamais
abandonner entirement) ce fut incontestablement le bouddhisme et en
particulier le bouddhisme tibtain qui eut ses prfrences personnelles.
Invoqu comme arbitre dans des querelles de moines entre bouddhistes et
taostes, il se pronona nettement en faveur des premiers contre les seconds.
Au tmoignage de Marco Polo il fit venir de Ceylan des reliques du Bouddha.
Il manda du Tibet sa cour, prit en amiti et protgea un jeune saint
bouddhiste, le lama Phags-pa (mort en 1280). Il le chargea mme de composer
lusage des Mongols un alphab et imit de lalphabet tibtain (entreprise qui
dailleurs ne russit pas, les Mongols ayant finalement prfr lalphabet
turc-ouighour, tir du syriaque).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
172
Les successeurs de Qoubila continurent et accrurent encore la faveur
quil accordait aux moines b ouddhistes, en particulier aux lamas tibtains.
Grce la protection impriale, il se dveloppa alors en Chine un vritable
clricalisme lamaque qui nalla pas sans inconvnients. On voit, dit un
rapport administratif, ces lamas se rpandre dans les villes et, au lieu de loger
dans les htelleries, stablir dans les maisons particulires dont ils cartent
les matres pour abuser plus facilement de leurs femmes. Non contents de se
livrer la dbauche, ils enlvent encore au peuple le peu dargent qui l
possde. Ce sont des sangsues publiques, plus cruelles encore que les agents
du fisc. De tels propos nont rien de nouveau : nous y retrouvons les vieilles
diatribes des lettrs confucens contre le monachisme bouddhique ; mais il est
certain que les lettrs rendirent le rgime mongol responsable des privilges
excessifs quil accordait au clerg adverse, et ce sera sans doute un des motifs
de mcontentement qui contribueront limpopularit, puis la chute de la
dynastie.
En somme le bouddhisme bnficia auprs de la dynastie mongole de la
mme faveur quauprs de tant de dynasties tartares du temps pass, les Wei Tabghatch du Ve sicle par exemple. La grande religion indienne, malgr la
protection personnelle quavaient pu au cours des sicles lui accorder de
nombreux empereurs chinois (sous les Tang par exemple), navait jamais t
considre par ltat national chinois que comme une secte tran gre le
grief est cent fois rpt dont les conseillers officiels de la couronne, les
lettrs, avaient pu temporairement tolrer, mais navaient jamais entrin les
priodes de faveur. Au contraire les matres nomades de la Chine Turcs,
Mongols ou Tongous allaient au bouddhisme sans arrire-pense. Les
cadres administratifs confucens, qui se trouvaient chaque fois parmi les
vaincus de la conqute tartare, navaient, tout au moins au dbut de
loccupation, pas droit au chapitre. Aussi le bouddhisme en Chine na -t-il
jamais autant prospr que sous la domination trangre.
Il convient toutefois de faire ici une rserve. Ce que nous venons de dire
est vrai du bouddhisme officiel chinois comme du lamasme tibtain. Or il
existait aussi en Chine des socits secrtes se rclamant du bouddhisme, mais
qui nen taient en ralit que des hrsies, comme l e Lotus Blanc et le Nuage
Blanc. On sest demand si le Nuage Blanc navait pas subi des conta minations de lhrsie manichenne, propage, on la vu, entre 763 et 840
grce aux Turcs ouighour. Quant au Lotus Blanc qui tirait son origine du
pitisme amidiste, il avait t vers 1133 constitu en socit secrte avec un
grand matre, des tenues nocturnes, etc. Toujours plus ou moins inquites par
le gouvernement des Song, ces socits secrtes paraissent avoir collabor
ltablissement de la dynastie mo ngole qui, en retour, leur accorda la libert
de culte et mme une existence officielle. Toutefois le Lotus Blanc dut
recommencer conspirer, car ladministration mongole son tour le prohiba
(1308, 1322). De fait, ses tenues nocturnes serviront bientt de rendez-vous
aux ennemis du rgime mongol.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
173
Le taosme avait t favoris par les premiers conqurants mongols qui
voyaient assez naturellement dans ses thaumaturges lquivalent de leurs
chamans. Cest dans cet esprit que Gengis -khan lui-mme avait en 1222 fait
venir de Chine en Afghanistan, o il guerroyait alors, le moine taoste
Tchang -tchouen. Bien que le saint nait pu lui livrer le secret de la drogue
dimmor talit et se soit content de lui prcher la doctrine du tao, le
conqurant conut beaucoup destime pour lui et accorda des brevets
dimmunit pour les communauts taostes. Sous Qoubila la faveur des
taostes baissa. Les bouddhistes portrent devant lui leurs vieux griefs contre
ces rivaux : les taostes ne prtendaient-ils pas que la religion du Bouddha
ntait quune drivation de la leur ? Un colloque fut runi dans lequel les
taostes furent convaincus davoir falsifi les textes et fabriqu des
apocryphes. En consquence Qoubila dont les sympathies bouddhiques, on
la vu, ntaient p as douteuses, ordonna un autodaf douvrages suspects et fit
rendre aux bouddhistes certains couvents usurps par leurs adversaires (1281).
Ctaient l querelles de moines. Plus dlicate tait lattitude adopter
lgard du confucisme officiel parce q ue de cette attitude allait dpendre le
ralliement plus ou moins sincre de la classe des lettrs. Qoubila tait un
homme dtat trop avis pour lignorer. Par une manifestation symbolique, il
fit venir sa cour le chef de la famille de Confucius (on sait que la descendance du Sage sest perptue sans solution de continuit Kiu -feou, au
Chan-tong) et lhonora publiquement. Le premier acte de son petit -fils et
successeur, lempereur Tmur, fut pour ordonner dans un dit solennel aux
Mongols comme aux Chinois le culte de Confucius, ce qui ne manqua pas de
lui attirer la sympathie des lettrs (1295).
Le ralliement au moins temporaire des lettrs au rgime mongol est illustr
par un nom clbre, celui de Tchao Mong-fou (1254-1322). Ctait un
personnage reprsentatif entre tous puisquil appartenait la famille impriale
des Song. Ayant accept en 1286 de servir Qoubila, il fut nomm diverses
fonctions administratives (en 1316 il devait recevoir un poste lev dans le
collge des Han-lin), et servit fidlement. Or il se trouvait que Tchao
Mong-fou tait un des plus grands peintres de son temps. En particulier, ce fut
un peintre de chevaux : les peintures de chevaux qui nous restent sous son
nom sont si nombreuses quon doit ne voir dans la plupart que des copies. Il
rien est pas moins certain que mme ces copies, quand elles reprsentent le
poney bourru de Mongolie et son cavalier tartare, sont des documents fort
intressants comme vocation de lpope mongole (85).
En marge du confucisme, du taosme et du bouddhisme solidement
ancrs dans les croyances chinoises, figurait le christianisme, en lespce le
christianisme nestorien.
Le nestorianisme, on se le rappelle, avait t introduit sous les Tang par
des missionnaires venus de lIran : une glise nestorienne avait t construite
Tchang -ngan en 635. Il avait prospr sous cette dynastie, sinon sans doute
dans la population proprement chinoise, du moins parmi les rsidants iraniens
ou syriaques attirs par le commerce de la route de la soie et aussi parmi les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
174
Turcs fdrs du limes. Cest encore sur le limes que nous le retrouvons nu
XIIIe sicle, chez les Turcs ngut alors matres de cette rgion, au nord de la
Grande Muraille, en bordure de la province du Chan-si, autour de lactuel
Souei-yuan et de lactuel Kouei -houa-tcheng, dans ce qui est aujourdhui la
Mongolie Intrieure. Ces Ongut avaient une importance considrable la cour
mongole parce quils staient montrs ds la premire heure les fidles
vassaux de Gengis-khan. En rcompense le conqurant avait donn sa propre
fille en mariage leur roi et depuis lors les unions de familles navaient pas
cess entre grands-khans mongols et princes ngut. Cest ainsi que le prince
ngut Georges, au nom, comme on le voit, bien chrtien (Krguz en turc),
pousa une petite-fille de Qoubila. Par eux le christianisme se maintint
pendant plusieurs gnrations sur les marches mmes du trne, dans la famille
impriale. Et comme ils continuaient se montrer les meilleurs soutiens de
lempire (le prince Georges se fera tuer hroquement en 1298 au service du
grand-khan Tmur), le crdit quils pouvaient mettre la disposition de leur
foi tait illimit.
Du reste, les Turcs ngut ntaient pas le seul peuple du Gobi profess er
le nestorianisme. Nous avons vu que tel tait aussi le cas des Krit, tablis du
ct de la Toula, en haute Mongolie, et que Gengis-khan avait en 1203
englobs dans son empire. Or la propre mre de Qoubila, la princesse
Sorghaqtani, femme, nous le savons, remarquablement intelligente et adroite,
appartenait prcisment lancienne famille royale krit et tait une
nestorienne fort pratiquante. Nul doute que Qoubila, en protgeant le
nestorianisme, nait voulu se montrer fidle, non seule ment son amiti et
ses liens de famille avec les princes ngut, mais aussi au souvenir de sa propre
mre. On le vit bien en 1287 quand le nestorianisme se trouva tout coup
dans une situation dlicate. Un prince mongol nomm Nayan, qui tait
nestorien, se rvolta en Mandchourie contre Qoubila et, en marchant contre
lui, mit la croix sur ses tendards. La rbellion une fois vaincue, les
adversaires des chrtiens ne manqurent pas den prendre avantage contre
eux. Cest au contraire lloge de la Croix, rp ondit Qoubila. Nayan tait
tratre son seigneur : la Croix ne pouvait vouloir le protger. Votre Dieu a
montr sa sagesse en se comportant ainsi. Du reste, et toujours au
tmoignage de Marco Polo, aux ftes de Pques qui suivirent la dfaite de
Nayan, Qoubila se fit apporter lEvangile, le baisa et lencensa en public.
On se tromperait sans doute en voyant l au point de vue thologique autre
chose quun respect gnral lgard des princi pales religions connues des
Mongols, quune simple assurance ou contre-assurance envers les diverses
manifestations de la divinit. Cest ce quavouait navement lempereur :
Les uns, lui fait dire Marco Polo, vnrent Jsus, les autres Mahomet,
dautres le Bouddha. Ne sachant lequel est le plus grand, je les rv re tous et
leur demande tous de me protger. La sympathie de Qoubila pour le
christianisme nestorien nen est pas moins cer taine au point de vue politique et
elle se manifesta non seulement par des paroles, mais aussi par des mesures
concrtes. En 1275 le patriarche nestorien de Baghdd put crer un
archevch Pkin. Des glises nestoriennes slevrent Yang -tcheou et
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
175
Hang-tcheou. En 1289 Qoubila institua un bureau spcial pour soccuper du
culte chrtien. En 1291 il nomma commissaire pour le culte chrtien un
nestorien syrien nomm Isa (Jsus en arabe) dont il fit peu aprs un de ses
ministres.
La vie des communauts nestoriennes en Chine sous Qoubila nous est
bien connue par lhistoire du patriarche Mar Yaballaha et de Rabban auma.
Rabban auma (1225-1294) et Yaballaha, de son nom Marcos (1245-1317),
taient deux moines nestoriens ns le premier prs de Pkin, le second en pays
ngut (au Souei-yuan) qui en 1275-1276 partirent de Chine pour tenter
daccom plir le plerinage de Jrusalem. Les princes ngut avaient vainement
essay de les en dissuader : Pourquoi partir pour lOcci dent quand nous
nous donnons tant de peine pour attirer ici des vques et des moines venus de
l-bas ? Voyant que la rsolution des plerins restait inbranlable, ils leur
fournirent tout lquipement ncessaire pour la traverse de lAsie centrale.
auma et Marcos traversrent donc la Kachgarie, le Turkestan, et en 1278
arrivrent enfin en Msopotamie, dans le khanat mongol de Perse. Le khan de
Perse tait alors Abaqa, le neveu de Qoubila. Fort satisfait de voir arriver ces
deux compatriotes, il fit en 1281 nommer Marcos au sige patriarcal nestorien
de Sleucie-Baghdd. Marcos, ainsi devenu le patriarche Mar Yaballaha III,
devait jusqu la fin de sa vie jouer un rle de premier plan dans lhistoire du
khanat mongol de Perse. Quant Rabban auma, le khan de Perse Arghoun
lenvoya en 1287 en mission en Occident en vue dune alliance entre les
Croiss et les Mongols contre les Mamelouks dEgypte. Rabban auma ar riva
en septembre 1287 Paris o Philippe le Bel lui fit en personne les honneurs
de la Sainte-Chapelle. Il fut reu Rome par le pape Nicolas IV qui le fit
communier de sa main le jour de Pques 1288 et
sentretint avec lui de lorganisation dune nouve lle croisade. Curieuse
destine que celle de ce Mongol n prs de Pkin et devenu ambassadeur
de Perse auprs du pape et du roi de France...
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
176
CHAPITRE 27
Marco Polo
Lexemple des chrtiens mongols partis de Pkin travers lAsie centrale
pour faire le plerinage de Jrusalem montre quel point la conqute
mongole, en unifiant lAsie, avait rouvert les routes transcontinentales. Cette
antique route de la soie et du plerinage bouddhique, ferme depuis le XIe
sicle par les progrs de lIslam, voici quelle laissait nouveau passer les
caravanes de marchands et de plerins. L est lindniable bienfait de la
conqute mongole
Gengis-khan avait rendu possible Marco Polo.
Le pre et loncle de Marco Polo Nicolo et Maffeo taient deux
commerants vnitiens qui, en 1260, partirent de Constantinople pour une
tourne dans le khanat mongol de la Russie mridionale. De l, par Boukhr
et le Turkestan chinois, ils poussrent jusquen Chine o Qoubila leur fit bon
accueil. Quand ils furent sur le dpart, le grand-khan les chargea dune
mission auprs du pape : en lespce de demander celui -ci de lui envoyer
cent docteurs savants dans les sept arts . Les Polo quittrent la Chine en
1266. Ils traversrent de nouveau lAsie centrale et, par la Syrie, se rendirent
Rome. Le Saint-Sige ne comprit malheureusement pas limportance de la
demande adresse par Qoubila et dont la ralisation lenvoi dune centaine
de lettrs latins et peut-tre boulevers le monde ... Les Polo reprirent le
chemin de la Chine la fin de 1271 en nemmenant avec eux que Marco, le
fils de Nicolo, limmortel auteur du rcit que nous allons rsumer.
Les trois voyageurs, cette fois, traversrent le khanat mongol de Perse, le
nord de lAfghanistan, franchirent le Pamir, puis, t ravers la Kachgarie
mridionale, suivirent, vi Kachgar, Yarkand, Khotan et le Lobnor, lantique
Route de la soie qui les conduisit la province chinoise du Kan-sou o ils
firent halte Kan-tcheou (Campiiu chez Marco Polo), ville o ils
constatrent la prsence dune communaut nestorienne. Ils reprirent ensuite
leur marche vers lest, visitrent lancienne capitale des Tangout, Ning -hia
(Egrigaia), o ils remarqurent aussi, en pays de majorit bouddhiste,
lexistence dune communaut nestorienne. De l ils pntrrent dans le pays
ngut (Tenduc chez Marco Polo, cest --dire dans lactuel Souei -yuan) dont
ils signalent la foi nestorienne. Marco Polo mentionne la famille du fameux
Prince Georges , protectrice, comme nous lavons vu, du christianisme. En
sortant du pays ngut, ils entraient dans la Chine du Nord que, comme les
Turcs de ce temps et les Russes actuels, Marco Polo appelle le Cathay, du
nom des anciens Khitai ou Kitat qui lavaient pos sde au XIe sicle. Ils
parvinrent enfin Chang-tou (Chandu), prs de lactuel Dolon -nor, rsidence
dt de Qoubila. Les Polo remirent ce dernier une lettre du pape Grgoire
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
177
X. Marco Polo suivit ensuite la cour Pkin (Cambaluc). Qoubila qui parat
lavoir distingu, lui confia un emploi (dans ladmin istration de la gabelle)
Yang-tcheou (Yan-giu), prs de lembouchure du Yang -tseu.
Le livre de Marco Polo dcrit en Chine deux itinraires nord-sud, lun
louest, de Pkin au Yun -nan par le Chan-si, le Chen-si et le Sseu-tchouan,
lautre lest, de Pkin au Fou-kien par le Chan-tong, le bas Yang-tseu et le
Tch-kiang. Au cours de ce rcit, il dresse une carte conomique prcise de la
Chine du Nord (Cathay) et de la Chine du Sud, lancien empire song ( Manzi).
Il mentionne les mines de charbon de la Chine du Nord, manire de pierres
noires qui sextraient des montagnes comme par veines, qui brlent comme
des bches et sont si bonnes cela que par tout le Cathay on ne brle pas
autre chose . Lutilisation des voies navigables ne lmerveille pas moi ns. Il
remarque surtout limportance commerciale du Yang -tseu-kiang (le Kian),
artre matresse de lconomie chinoise : Il va et vient par ce fleuve plus de
navires et de riches marchandises quil nen va par tous les fleuves et toutes
les mers de la chrtient. Marco Polo ajoute que chaque anne deux cent
mille bateaux remontent le fleuve, sans parler de ceux qui le redescendent. Il
note aussi le rle conomique du Canal Imprial, ramnag et complt par
Qoubila et qui permettait damener Pkin le riz du bas Yang-tseu.
Pour diriger cet norme commerce intrieur comme pour trafiquer avec
lInde et lInsulinde, il stait fond dans les ports du bas Yang -tseu, du
Tch-kiang et de la rgion cantonaise de puissantes guildes marchandes qui
pouvaient rivaliser avec les Mtiers des Flandres et les Arts de Florence.
Parlant des guildes de Hang-tcheou (ville quil appelle Quinsai), Marco Polo
crit : Il y avait l tant de marchands si riches, faisant un commerce si
important quil nest personne qui pou rrait lvaluer. Et sachez que les matres
de mtiers qui taient chefs dentreprises ni leurs femmes ne touchaient rien
de leurs mains, mais ils menaient une existence si riche et si lgante quon
et dit des rois. Lemploi gnral du papier -monnaie que Marco Polo
appelle plaisamment la vritable pierre philosophale ( larcane parfait )
facilitait les transactions : Et je vous dis que chacun prend volontiers (ces
billets) parce que partout o les gens se rendent sur les terres du grand-khan,
ils peuvent acheter et vendre avec, tout comme si ctait de lor fin. Les
merveilleuses aptitudes commerciales de la race chinoise frappent
dadmiration notre Vnitien. A tout instant il voque le spectacle de toutes ces
richesses : nefs revenant de lInde ch arges dpices, poivre, gingembre,
cannelle ; jonques descendant le Yang-tseu ou remontant le Grand Canal avec
leur cargaison de riz ; boutiques de Hang-tcheou ou de Tsiuan -tcheou,
dbordant de marchandises prcieuses : soie grge, soie damasse, camocans
et brocarts dor, samis ou soieries lourdes de luxe, tartaires et satins, etc. Bref,
une vritable gographie conomique de la Chine au XIIIe sicle.
Dans le mme esprit, Marco Polo nous renseigne sur les principaux
marchs chinois : Pkin (Cambaluc), centre des soieries du nord : il nest
pas de jour o il ny entre mille charretes de soie avec laquelle se fabriquent
quantit de draps dor ; Tcheng -tou (Sindufu), le chef-lieu de
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
178
Sseu-tchouan, qui fabriquait des cendals et exportait ses soieries en Asie
centrale ; Yang-tcheou (Yan-giu), le grand march de riz du bas
Yang-tseu ; Hang-tcheou (Quinsai) enfin, lancienne capitale des Song la quelle une place part est rserve. Marco Polo, nous lavons vu, nous la
dcrit comme une sorte de Venise chinoise. Ctait, notamment, le grand
march du sucre. Dinnombrables navires y apportaient les pices de lInde et
de lInsulinde et en ex portaient les soieries destines lInde et au monde
musulman. Aussi y rencontrait-on une nombreuse colonie de marchands arabes, persans et chrtiens. Enfin le Fou-kien renfermait les deux grands ports
de Fou-tcheou (Fujiu) et de Tsiuan -tcheou (aiton). Les marchands de
Fou-tcheou possdaient dincroyables stocks de gingembre et de gaingal. Il
y a aussi dans cette ville une vente trs considrable de sucre et un grand
march de perles et de pierres prcieuses apportes jusque-l par les navires
venus des Indes. Mais le plus grand emporium de la Chine restait encore
Tsiuan -tcheou, la aiton de Marco Polo o, dit-il, tous les navires des Indes
arrivent si chargs dpices, de pierres prcieuses et de perles que cest
merveilleux. Cest le port o affluent tous les mar chands du Manzi, le grand
centre dimportation pour toute la Chine. Et je vous dis que pour un navire
charg de poivre qui va des Indes Alexandrie ou dans tout autre port
destination du monde chrtien, il en vient plus de cent aiton .
Au commencement de 1292 Marco Polo, son pre et son oncle se
rembarqurent pour lEurope en emmenant avec e ux, de la part de Qoubila,
une jeune princesse destine au khan mongol de Perse. Ils firent escale
Sumatra, dbarqurent Ormuz et furent de retour Venise en 1295.
En mme temps que les hardis commerants dont Marco Polo est le type,
on voyait arriver dans la Chine mongole les missionnaires catholiques. En
1289 le pape Nicolas IV, qui venait dap prendre par Rabban auma
lexistence de nombreuses chrtients indignes dans lempire mongol,
envoya en Extrme-Orient le franciscain Jean de Montcorvin. Montcorvin,
aprs un sjour dans le khanat mongol de Perse (1290), puis une escale dans
lInde (1291), sembarqua pour la Chine o le grand -khan Tmur
(1294-1307), petit-fils et successeur de Qoubila, lui fit bon accueil.
Montcorvin construisit Pkin deux glises, en partie grce la libralit du
commerant italien Petrus de Lucalongo qui lavait accompagn. En peu
dannes il baptisa plus de dix mille Tartares et commena traduire le
psautier dans un de leurs dialectes. Il convertit au catholicisme le prince ngut
Georges, jusque-l nestorien. Le jeune fils de Georges fut baptis sous le nom
de Jean en lhonneur de Montcorvin.
En 1307, le pape nomma Montcorvin archevque de Cambaluc ,
cest --dire de Pkin. En 1313 arrivrent dans cette ville trois franciscains
destins devenir ses suffragants. Lun deux, Grard, devint vque de
aiton , cest --dire de Tsiuan -tcheou, au Fou-kien, ville o une riche
Armnienne fit btir une glise. Le second successeur de Grard dans lvch
de Tsiuan-tcheou, le franciscain Andr de Prouse, nous a laiss une lettre
date de janvier 1326. Il nous y apprend que le grand-khan lui accordait une
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
179
pension de cent florins dor. Il nous dit encore quil a cons truit prs de
aiton un couvent pour vingt-deux religieux et quil partage son temps
entre son glise et son ermitage en montagne.
Aprs Montcorvin et Andr de Prouse, le plus clbre missionnaire
catholique de la Chine mongole fut le franciscain Odoric de Pordenone.
Odoric sembarqua Venise entr e 1314 et 1318. Il traversa le khanat mongol
de Perse, fit escale aux Indes et vers 1324-1325 dbarqua Canton quil
appelle Sincalan. Dans le rcit de son voyage, il note, propos de cette ville,
la densit de la population, la richesse du pays, labon dance et le bon march
des denres, le caractre industrieux des habitants, commerants ns et
ouvriers dart merveilleux, le foisonnement du panthon populaire. Il ne
sintresse pas moins Tsiuan -tcheou (aiton), ville deux fois plus grande
que Rome , o il fut reu dans le couvent de ses frres en saint Franois et o
il put admirer la cathdrale et lermitage de montagne que nous avons men tionns. Hang-tcheou, que ses manuscrits appellent Cansai, lmer veille
davantage encore. Cest, nous dit -il, la plus grande ville qui soit au monde,
situe entre deux lacs, des canaux et des lagunes comme notre Venise . A
propos des lments si divers Chinois, Mongols, bouddhistes, nestoriens,
etc. qui cohabitaient dans cette norme agglomration, Odoric rend
hommage ladministration mongole. Le fait que tant de races diffrentes
puissent vivre paisiblement cte cte et tre administres par le mme
pouvoir me semble une des plus grandes merveilles du monde. Grce un
dignitaire mongol converti au catholicisme, notre voyageur put visiter un
couvent bouddhique et discuter sur la mtempsycose avec les bonzes.
Sur le bas Yang-tseu il signale limportance des pcheries, no tamment de
la pche (pratique encore de nos jours) laide des cormorans. Il arrive enfin
Khanbaliq, notre Pkin. Cest l, nous dit -il, que rside le grand-khan dans
un palais si vaste que les murs ont au moins quatre milles de tour et
renferment eux-mmes plusieurs palais secondaires. La cit impriale est ainsi
constitue de plusieurs enceintes concentriques, et cest dans la deuxime que
vit le grand-khan avec toute sa cour. A lintrieur de lenceinte slve une
colline artificielle qui porte le palais principal. Elle est plante de trs beaux
arbres et a reu de ce fait le nom de Colline Verte. Elle est entoure dun lac et
dun tang. Au milieu du lac est lanc un pont merveilleux, le plus beau que
jai vu par la qualit du marbre et la finesse de larchi tecture. Sur ltang on
aperoit une multitude doiseaux pcheurs, canards, cygnes et oies sauvages.
Lenceinte renferme aussi un grand parc plein de btes sauvages. Ainsi le
grand-khan na pas sortir de son palais pour se livrer aux plaisirs de la
chasse.
Et moi, frre Odoric, poursuit notre missionnaire, je demeurai pendant
trois ans et demi (1325-1328) dans cette ville (Pkin), dans la compagnie de
nos frres Mineurs qui y possdent un couvent et qui mme ont rang la cour
du grand-khan. En effet un de nos frres (Montcorvin) est archevque de la
cour et bnit le grand-khan chaque fois que celui-ci doit voyager. Et Odoric
de dcrire une de ces entrevues. Les franciscains se rendent en procession,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
180
vque en tte, au-devant du souverain qui trne sur son char. Nous portions
devant nous une croix fixe une hampe et chantions le Veni, sancte Spiritus.
Lorsque nous fmes arrivs proximit du char imprial, le grand-khan, ayant
reconnu nos voix, nous fit avancer jusqu lui. Comme nous approchions, la
croix haute, il se dcouvrit en enlevant sa coiffure, dont le prix est
inestimable, et fit rvrence la croix. Lvque lui donna sa bndiction et le
grand-khan baisa la croix trs dvotement. Je mis alors de lencens dans
lencensoir et notre vque encensa le prince.
Odoric note, comme avant lui Marco Polo, l excellente organisation et
lextraordinaire rapidit du systme de postes cr par les Mongols : Les
courriers galopent, ventre terre, sur des chevaux prodigieusement rapides ou
emploient des mharis. En arrivant en vue des relais, ils sonnent du cor pour
annoncer leur approche. Ainsi avertis, les gardiens font aussitt prparer un
autre cavalier ou un autre mhariste avec une monture nouvelle. Celui-ci saisit
les dpches et galope jusquau relais suivant o la mme relve a lieu. Le
grand-khan obtient ainsi dans les vingt-quatre heures des nouvelles provenant
de pays normalement situs , au moins, trois journes de cheval.
Odoric de Pordenone semble avoir quitt Pkin en 1328. Il traversa le pays
ngut, dont il signale, lui aussi, la foi nestorienne, puis le Kan-sou, en notant
que sur cette grande route des caravanes les villes ou bourgades taient
tellement rapproches quen sortant de lune on apercevait les murs de la
suivante. Il passa par lAsie centrale et fut de retour dans son couvent de
Padoue en mai 1330.
La chrtient de Chine tait maintenant bien connue en Europe. En 1340 le
pape Benot XII envoya en Extrme-Orient le franciscain Jean de Marignolli
qui passa par le khanat mongol de la Russie mridionale et le khanat mongol
du Turkestan. Matignolli arriva Pkin en 1342. Le 19 aot il y fut reu en
audience par le grand-khan Toghan Tmur, dixime successeur de Qoubila,
qui il offrit un grand cheval dOccident, cadeau qui, nous le savons, fut trs
sensible ce monarque. Il se rembarqua Tsiuan-tcheou le 26 dcembre
1347, fit un sjour dans lInde et fut de retour Avignon en 1353. En 1370 le
pape Urbain V dsigna encore un archevque pour le poste de Pkin, mais ce
prlat ne put jamais en prendre possession : la dynastie mongole venait dtre
renverse par la rvolte nationale des Ming, et les Chinois vainqueurs
englobaient le christianisme dans la proscription dont ils frappaient toutes les
doctrines trangres que les Mongols avaient favorises.
Avant de clore ce chapitre, essayons dtablir en quelques mots le bilan de
la domination mongole.
Tout dabord les bienfaits du rgime.
Lunification de lAsie presque entire par les Mongols a, nous lavons vu,
rouvert les grandes voies transcontinentales obstrues depuis le x sicle. La
route de la soie, telle que nous en avons suivi les tapes lpoque des
Antonins et des Han, la route du plerinage bouddhique dont nous avons
mesur limportance au VII e sicle lpoque de Hiuan -tsang, cette longue
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
181
piste de caravanes qui unissait travers le Pamir lIran lExtrme -Orient,
elle voyait maintenant passer Marco Polo. La Chine reprenait contact avec
lIran et, par -del lIran, avec le monde occidental. Les distances taient
abolies, les continents rapprochs. Deux moines ns prs de Pkin devenaient
lun patriarche de Baghdd, lautre ambassadeur auprs du pape et du roi de
France. Des disciples de saint Franois taient nomms archevques de Pkin
ou allaient btir des cathdrales sur la cte du Fou-kien. Un commerant
vnitien entrait dans ladministration chinoise de la gabelle lembouchure du
Yang-tseu. Il apprenait connatre le nom du Bouddha kyamouni et
admirer cette grande figure. La tempte mongole, en abattant les murs qui
entouraient les jardins clos et en dracinant les arbres, avait port dun jardin
lautre la semence des fleurs. L orbis mongolicus prsentait cet gard un peu
les mmes avantages que nagure l orbis romanus et il allait falloir la
dcouverte du cap de Bonne-Esprance, la dcouverte aussi de lAmrique
pour valoir au monde un sicle digne du sicle de Marco Polo.
En face de ces avantages, des rsultats funestes. Non pas tant dans le
domaine matriel, car nous avons vu le petit-fils de Gengis-khan, le grand
Qoubila, se comporter comme un des meilleurs souverains quait connus
travers de longs sicles lhis toire chinoise et relever en un rgne rparateur
tout ce quavait dtruit son terrible aeul. Mais au point de vue moral, aprs la
domination mongole, un ressort aura t cass qui ne pourra de longtemps tre
rpar, le ressort de lme chinoise. Certes, aprs lexpulsion des Mongols, la
nouvelle dynastie nationale des Ming va dans tous les domaines restaurer le
pass, affecter de biffer dun trait le temps de loccupation trangre,
recommencer exactement lhistoire au point o elle en tait vers 1260, voire
en 907. Mais par cette fidlit mme et prcisment parce quelle voudra en
tout copier le pass, elle se vouera une uvre sans vie. Et cest l que rside
le mal fait la Chine par linvasion mongole. Elle a donn une telle
commotion lorganisme chinois, lui a imprim une telle courbature que
celui-ci, une fois la tourmente passe, se repliera, se recroquevillera sur luimme, craintivement. La spontanit cratrice du gnie chinois semblera
brise. Cette Chine qui pendant des sicles avait prodigu sans se lasser les
plus prodigieuses crations littraires, artistiques, philosophiques, nosera plus
faire autre chose que rpter des poncifs et copier des copies. En cela, et alors
quelle prtendra rester fidle son lass, elle deviendra le contraire
delle -mme, car ce qui dans le pass avait fait la grandeur chinoise, ctait
avant tout cette libre facult de jaillissement et de renouvellement, cette
spontanit cratrice qui nous avait valu tour tour la splendeur des bronzes
chang, lenvol mtaphysique dun Tchouang -tseu, les visions surhumaines
dun Mou -ki. Dsormais plus rien de tel, mais une mfiance de soi -mme et
du monde extrieur, une timidit qui seront aux antipodes des grands sicles
rvolus.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
182
CHAPITRE 28
Une restauration nationale : les Ming
Au cours de sa longue histoire, la Chine compte peu de souverains aussi
remarquables que Qoubila. Par sa forte personnalit, ses qualits dhomme
dtat, sa haute sagess e, la fermet et lhuma nit de son gouvernement, ce
Mongol se place sur la mme ligne que les plus grands empereurs chinois du
temps pass. Son petit-fils et successeur Tmur fut encore un prince nergique
et consciencieux (1294-1307). Mais aprs eux leur dynastie, la dynastie Yuan,
comme elle se dnommait, tomba dans une rapide dgnrescence. Ses
princes, perdus de dbauches et atteints daboulie, ne rach tent leurs vices que
par une bigoterie lamaque dont les lettrs confucens leur font un nouveau
grief. Surtout ils ne cessent de se quereller entre eux, ruinant en quelques
annes limposante faade administrative qui sous Qoubila a provoqu
ladmiration de Marco Polo. Le dernier dentre eux, Toghan Tmur (1333 1368) qui ne se plaisait que dans la compagnie des lamas tibtains et des
mignons, laissa le dsordre dgnrer en anarchie.
Le spectacle de cette dchance encouragea les patriotes chinois se
rvolter contre la domination trangre. Linsurrection, comme en 1912, fut
prpare par les socits secrtes, notamment par la secte du Lotus Blanc,
secte millnariste qui annonait la venue de Maitreya, le messie bouddhique.
Comme en 1912 galement, le mouvement dbuta sur le bas Yang-tseu et
dans la rgion cantonaise. Commence en 1352, la rvolte ds 1355 stendait
toute la Chine mridionale, tout lancien empire song, mais elle
saccompagnait dune affreuse anarchie car elle tait dirige par un grand
nombre de chefs, moiti patriotes, moiti bandits qui se battaient entre eux en
mme temps quils guerroyaient contre les Mongols.
Tous ces aventuriers devaient tre clipss par le plus habile dentre eux,
Tchou Yuan-tchang, le futur fondateur de la dynastie des Ming. Fils dun
pauvre laboureur de la province de Ngan-houei, il avait dix-sept ans quand
une pidmie emporta toute sa famille. Pour vivre, il entra dans une bonzerie.
Mais sans doute la vocation bouddhique tait-elle chez lui bien superficielle
car, ds que commena dans le sud la rvolte populaire contre les Mongols,
il avait alors vingt-cinq ans, il jeta le froc et prit les armes sur les bords du
bas Yang-tseu. Bien quau dbut simple chef de bande comme tous ses
concurrents, il se distinguait deux par son esprit politique et par une adroite
humanit envers les populations quil savait sattacher au lieu de les pressurer.
Semparait -il dune ville, il interdisait le pillage ses soldats, de sorte que les
habitants lappelaient comme un librateur non seulement contre les Mongols
mais contre les autres chefs insurgs. En 1356 il se rendit matre de Nankin et
y tablit une capitale fixe, un gouvernement rgulier qui tranchait sur
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
183
lanarchie partout ailleurs gnrale. Son principal concurrent, le fils dun
simple pcheur, stait, de son ct, rendu matre du Hou -pei, du Hou-nan et
du Kiang-si. En 1363 Tchou Yuan-tchang le vainquit, le tua et sempara de
ses terres. Lorsque, en 1367-1368, il eut occup la rgion cantonaise, il se
trouva en possession de toute la Chine mridionale. Alors il marcha sur Pkin.
Ce fut une marche triomphale. Limbcillit des derniers Mongols facilita
dailleurs la tche du librateur. Au lieu de faire front contre linsurrection, ils
continuaient se quereller, diviser leurs forces. Dans la nuit du 10
septembre 1368, lindigne descen dant du grand Qoubila, le lche empereur
Toghan Tmur, senfuit de Pkin pour se rfugier en Mongolie, tandis que
Tchou Yuan-tchang faisait son entre dans la capitale.
Dans Pkin dlivr des Mongols, Tchou Yuan-tchang fut proclam
empereur par son arme comme fondateur de la dynastie des Ming. Il navait
que quarante ans. En treize annes de lutte, le bonze dfroqu, lancien
misreux tait devenu le librateur de sa patrie, lhritier des Han et des
Tang. Car la fortune de lheureux aventurier tait plus prodigieuse en core que
celle des Song qui navaient jamais russi chasser les barbares de cette ville
de Pkin quil venait, lui, de reconqurir si facilement. Par -del les Song,
ctait donc aux Tang quil entendait se rattacher, cest --dire la dernire
dynastie nationale qui avant lui et possd lintgralit du territoire chinois,
et en 1373 il publia un code inspir de celui des Tang. Toutefois il ne
transporta pas sa capitale dans le Nord. Il continua rsider Nankin. Homme
du bas Yang-tseu, ayant chass ltranger avec une arme de Mridionaux, ce
fut avec eux quil gouverna dabord. Du reste il y avait deux cent
quarante-deux ans que la Chine du Nord tout entire tait au pouvoir des
Tartares et, pour Pkin mme, il y avait quatre cent trente-deux ans. Pendant
ces longs sicles les provinces septentrionales staient satures dlments
barbares. Ctait la Chine du Sud qui, de 1126 1279, avait servi de refuge
lindpendance chinoise. Ctait delle aujourdhui qutait parti le
mouvement de libration nationale. Elle reprsentait maintenant la Chine
vritable et dans la personne des Ming ctait elle qui triomphait. Mais le
nouvel empereur tait un politique trop avis pour accepter longtemps la
prpondrance exclusive des gens du Midi. Pour faire cesser au contraire la
diffrenciation du Nord et du Sud, diffrenciation que deux sicles et demi de
vie spare navaient fait quaccrotre, pour restaurer moralement comme
politiquement lunit chinoise, il dcida en 1380 de faire admi nistrer le Nord
par des fonctionnaires du Midi, mais aussi le Midi par des gens du Nord. Dans
le mme esprit il nhsita pas proscrire en 1370 les socits secrtes du
Lotus Blanc et du Nuage Blanc qui avaient pourtant si grandement contribu
au renversement de la domination mongole ; mais les temps taient changs. Il
est vrai aussi que dans la comptition pour le trne elles avaient mal mis et
staient prononces pour les rivaux du nouvel empereur ...
Dans tous les domaines le fondateur des Ming sattachait oprer la mme
restauration des valeurs, relier par-del lhiatus de la domination djurtcht
ou mongole, la Chine nouvelle au plus lointain pass, et sans doute
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
184
apporta-t-il cette entreprise minemment traditionaliste un zle dautant plus
grand quil tait lui -mme sorti de rien. En 1370 il refondit en ce sens le
systme des examens pour le recrutement du mandarinat et rtablit les titres de
noblesse. Le culte confucen fut solennellement clbr et il associa son
uvre les acadmies de lettrs qui sous les Mo ngols avaient t un foyer
dopposition contre le clrica lisme bouddhique. Mais lancien bonze
noubliait pas ses coreli gionnaires. Il continuait mme sentourer
personnellement de moines bouddhistes et il en cuisit aux lettrs qui voulurent
lui adresser des remontrances sur ce terrain : lun deux, un Grand juge, fut
mme excut. Le fait est dailleurs symptomatique. A mesure que lempereur
avanait en ge (il ne devait mourir qu soixante -dix ans en 1398), il
supportait de moins en moins les contradictions et perdait cette bonhomie
populaire qui avait tant contribu son triomphe. Devenu souponneux, il fit
une fois excuter dix-huit grands personnages avec toute leur famille. A la
suite dun complot, vrai ou suppos, on supplicia Nankin 15.000 pe rsonnes.
Lancien aventurier devenu Fils du Ciel voulait, avant de mourir, avoir rtabli
labsolutisme.
Le vritable continuateur de Tchou Yuan-tchang fut son deuxime
successeur, son second fils, lempereur quon a lhabi tude de dsigner par le
nom de la priode Yong-lo (86) (1403-1424). Ce souverain guerrier eut de son
rle une conception largie. Qoubila avait nagure entendu faire de lempire
mongol un empire chinois. Renversant les termes, lempereur Yong -lo voulut
donner la Chine lhritage mongol des Qoubilades. Le grand khan Qoubila
avait, du Fleuve Jaune au Tonkin, obtenu la soumission de toute la terre
chinoise et tait devenu un authentique Fils du Ciel. En retour, le troisime
souverain ming entendra soumettre la Mongolie et y jouer un rle de
grand-khan.
Ce fut dans cet esprit quen 1409 lempereur Yong -lo transfra sa capitale
de Nankin Pkin. Ce fut lui qui arrta le plan grandiose de la ville impriale
qui forme le centre du Pkin moderne, et plus particulirement le plan
de la Ville violet pourpre interdite (87) ; ce fut lui qui conut cette succession
de palais, de terrasses de marbre, de salles du trne, de jardins et de
perspectives digne des plus hautes traditions chinoises, lui qui fit largir ces
lacs, construire ces collines artificielles, planter ces jardins o il voulait
retrouver la vgtation de son Yang-tseu natal, ensemble que les empereurs
mandchous du XVIIIe sicle achveront ou restaureront, mais o tout porte la
marque de lempereur Yong -lo. Et cest toujours Yong -lo qui construisit prs
de la muraille sud de Pkin le Temple du Ciel (1420) et le Temple de
lAgriculture (1422).
Le transfert de la capitale Pkin tait tout un programme. Aucune
dynastie purement chinoise navait eu lide de choisir une telle rsidence. Le
rle historique de Pkin navait commenc quavec les Tartares. Ctaient les
Kitat, de race proto-mongole, qui, au Xe sicle de notre re, y avaient les
premiers install une de leurs capitales. Ils avaient t imits par les Djurtcht
ou Kin, de race tongouse, au XIIe sicle, puis par Qoubila en 1260. Un tel
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
185
choix chez tous ces conqurants descendus du nord se comprend aisment.
Pkin est presque extrieur la Chine. Cest, en tout cas, le chef -lieu dune
marche-frontire. A travers le seuil de Chan-hai-kouan, cest dj la
Mandchourie. A travers la passe de Nan-keou, cest dj Kalgan et la steppe
mongole. Gographiquement et historiquement, Pkin est un compromis
sino-tartare. Le Chinois y est encore chez lui, mais le Tartare ne sy sent pas
encore dpays. En abandonnant le sjour de Nankin pour installer sa cour au
seuil de la Mongolie, dans lancienne capitale de Qoubila, lempereur Yong lo revendiquait sur cette mme Mongolie lhritage des Qoubilades.
Son pre, il est vrai, lui avait donn lexemple dans cette direction : Tchou
Yuan-tchang, aprs avoir chass les Mongols du territoire chinois, les avait
relancs jusque chez eux. Ds 1372, une colonne chinoise stait avance en
haute Mongolie jusqu la Toula. En 1388 cent mille Chinois avaient encore
travers le Gobi oriental et taient venus battre les tribus au sud du Bouir-nor,
entre le Khal-kha-gol et le Kruln. Mais ce ntait l que la poursuite
aprs la victoire, des expditions de reprsailles destines inspirer aux
nomades une crainte salutaire. Au contraire, lempereur Yong -lo pratiqua en
Mongolie une politique suivie. Lautorit des Gengiskhanides ny avait pas
survcu la perte de face quavait entrane leur expulsio n de Chine.
Lempereur Yong -lo sappliqua soutenir contre eux la rvolte des autres
chefs de tribus, notamment celle des Orat ou Mongols occidentaux. Il
intervint diverses reprises dans les guerres civiles qui sensui virent en haute
Mongolie et notamment en 1410-1411 poussa jusquau haut Onon, jusqu la
prairie natale de Gengis-khan. Il contribua ainsi au remplacement des
Gengiskhanides par les khans orat dans lhgmonie de la haute Mongolie,
mais un proche avenir devait prouver que la Chine avait plus perdu que gagn
voir des tribus nouvelles se substituer au pouvoir dcadent qui paralysait les
hordes.
En Indochine galement, lempereur Yong -lo voulut reprendre la grande
politique impriale des Han et des Tang. Le royaume dAnnam, cest --dire
le Tonkin et le nord de lactuel Annam jusqu Tourane, venait de voir sa
dynastie lgitime renverse par un usurpateur. Lempereur Yong -lo en profita
pour occuper lAnnam -Tonkin quil partagea en dpartements chinois (1407).
Mais dix ans ne staient pas couls que les Annamites commenaient contre
les troupes doccupation une puisante gurilla. Quatre ans aprs la mort de
Yong-lo, le chef des rvolts, L Loi, semparera de Hano et chassera les
Chinois (1428).
Lempereur Yong -lo ne se contenta point de revendiquer le protectorat de
la Mongolie et dannexer lAnnam. Il entendit assurer la Chine lhgmonie
navale dans les mers de la Sonde et locan Indien. Ses escadres firent
reconnatre la suprmatie du pavillon chinois sur les ctes du Tchampa, du
Cambodge, du Siam, de la presqule de Malacca, de Java et de Sumatra, de
Ceylan (o lamiral imprial chtia le rdja local qui avait manifest des
intentions hostiles), du Bengale et de lInde mri dionale. Elles croisrent
jusqu Ormuz sur le golfe Per sique, Aden et Djedda, le port de la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
186
Mecque. Nous sommes dans les annes 1405-1424, au commencement du
sicle dont la fin verra larrive des Portugais aux Indes (1498). Quel et t
le destin de lAsie si, en abordant aux Indes et en Malaisie, les nav igateurs
europens y avaient trouv tablie une thalassocratie chinoise ? L encore
lempereur Yong -lo avait vu plus grand que le temprament de son peuple ou
plutt que lidologie du mandarinat ne le permettait. La Chine quil tait en
train de faire tait trop grande pour elle-mme. Les Chinois navaient pas la
vocation maritime. Le climat du Tonkin tait trop chaud, le climat de la
Mongolie trop froid pour leurs soldats. Le monde des lettrs demeurait hostile
aux conqutes extrieures, coteuses et inutiles. La politique mondiale de
lempereur Yong -lo neut pas de lende main. La Chine se replia sur elle-mme,
laissant passer sur terre et sur mer lheure du destin.
Dans le domaine de la pense, ce fut le mme repliement qui rapidement
prvalut. Lempereur Yong-lo tait personnellement bouddhiste. Il nen fit pas
moins compiler les textes de lcole no -confucenne et en 1416 il dcrta que
cette somme philosophique constituerait, au mme titre que les anciens
canoniques, la base de lenseignement officiel , ce qui tait pratiquement faire
du tchouhisme la doctrine de ltat ming. Cependant contre ce
matrialisme, disons tout au moins contre ce positivisme dtat, une certaine
raction se produisit un sicle plus tard dans la personne de Wang Yang-ming
(1472-1528). Non que ce penseur ait combattu visire ouverte le positivisme
mcaniste de Tchou Hi. Il enseigna seulement que notre participation lordre
cosmique, la loi universelle (li) rside moins dans la raison raisonnante que
dans le cur ; que, pour communier avec lessence du monde, il faut bien
moins avoir recours ce que nous appellerions lintelligence discursive qu
la connaissance intuitive (leang tche), suprme dictamen inn au fond du
cur. A travers lespace et le temps, crit Wan g Yang-ming, la
connaissance intuitive ne varie pas dans le cur humain. A dfaut de
labsolu mtaphysique banni par le tchouhisme, on retrouvait du moins
labsolu de la loi morale, la pure lumire intrieure qui claire tout homme
venant en ce monde : Dans le cur de tout homme, dit encore Wang
Yang-ming, habite un Confucius. La personnalit de Wang Yang-ming, sa
noblesse de caractre achvent de nous le rendre sympathique. Mais son
uvre, dailleurs limite la morale, reprsente une tendance plu tt quun
systme. Et la preuve que la doctrine de Tchou Hi restait de beaucoup prpondrante, cest que, pour faire accepter son enseignement, Wang
Yang-ming dut affecter de se rattacher elle.
Lempereur Yong -lo, mort en 1424, avait t la dernire grande figure de
la dynastie des Ming. Aprs lui cette famille devait se perptuer pendant plus
de deux sicles encore sans quaucune personnalit marquante en merget.
De nouveau comme la fin des Han et des Tang (mais comparativement bien
plus tt) la camarilla des eunuques chambra des souverains mdiocres et
gouverna sous leur nom. Pendant ce temps en Mongolie les Orat ou Mongols
occidentaux que lempereur Yong -lo avait aids remplacer les
Gengiskhanides dans lhgmonie des hordes, taient devenus un e puissance
redoutable. Leur khan Ysn demanda la main dune infante chinoise. Ne
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
187
lobtenant pas, il vint ravager le limes au nord du Chan-si et du Ho-pei.
Lempereur Ying -tsong marcha contre lui avec son favori, un eunuque qui
prtendait commander aux gnraux. Larme chinoise qui stait avance
sans vivres, fut cerne et dtruite prs de Siuan-houa, dans la montagneuse
rgion qui stend entre Pkin et Kalgan. Cent mille cadavres chinois restrent
dans les gorges et lempereur Ying -tsong fut fait prisonnier (1449). Les Orat,
dont la victoire dpassait les esprances, vinrent camper sous les murailles de
Pkin, mais ils ntaient pas outills pour un sige. Au bout de quelques mois
le khan Ysn se dcida relcher lempereur (1450) et en 1453 il fit sa paix
avec lempire.
Un sicle plus tard, nouvelle alerte. Le pril, cette fois, ne venait plus des
Mongols occidentaux mais des Gengiskhanides. Pendant le dernier quart du
XVe sicle, une restauration gengiskhanide stait en effet produite en
Mongolie. Un des khans de cette famille, Altan, qui nomadisait dans la
Mongolie Intrieure, au nord du Chan-si, vint diverses reprises, de 1529
1570, piller les districts septentrionaux de cette province ou du Ho-pei. En
1550 il poussa jusquaux portes de Pk in, clairant de ses incendies les
faubourgs de la capitale.
Les Mongols, ctaient pour la Chine les ennemis de toujours. Mais voici
que surgissait sur les ctes un nouvel adversaire, hardi, insaisissable,
invincible en raison de son insularit : le Japon. Une nue daventuriers et de
corsaires, sortis de toutes les criques de larchipel, commenaient infester les
ports du Tch-kiang, du Fou-kien et de la rgion cantonaise. En 1555 ils
remontrent le Yang-tseu jusqu Nankin, en pillant les bourgs ouvert s. Ces
pirates ntaient que les enfants perdus de lexpansion japonaise dont la Chine
allait prouver toute la force dans les affaires de Core.
Ce fut sous le rgne du treizime empereur de la dynastie ming, celui que
nous avons pris lhabitude de dsign er par les annes de rgne Wan-li
(1573-1620), que le conflit clata. Le Japon tait alors gouvern par le clbre
Hideyoshi (1585-1598). Cet homme dtat, un des plus grands de lhistoire
japonaise, forma le projet audacieux de conqurir lempire mi ng. Les corsaires
qui venaient priodiquement cumer les ports de la Chine centrale lavaient -ils
averti de la dcrpitude du gouvernement des Ming ? En tout cas, la facilit
avec laquelle, cinquante ans plus tard, les Mandchous allaient semparer de
Pkin prouve que lide de Hideyoshi tait ralisable. Mais il lui fallait obtenir
pour ses troupes le passage travers la Core. Les Corens, pour qui les
Japonais taient des ennemis hrditaires, opposrent un refus. Hideyoshi
envoya alors en Core une arme de 200.000 hommes qui entra Soul, la
capitale corenne (12 juin 1592) et poussa jusqu Pyng -yang, en direction
de la Mandchourie (15 juillet). Le plan de ltat -major japonais tait dj celui
qui devait reparatre dans la guerre sino-japonaise de 1894. Il sagis sait dj
datteindre le Yalou et, travers le Leao -tong et la passe de Chan-hai-kouan,
de redescendre sur Pkin. Mais la rsistance des Corens avait donn le temps
aux Chinois dintervenir avec des forces suprieures. Les Japonais dure nt
vacuer Soul (mai 1593) et battre en retraite sur la cte mridionale. En 1597
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
188
Hideyoshi envoya en Core une nouveau corps expditionnaire, mais cette
fois les Japonais ne purent mme pas atteindre Soul. Ils furent de nouveau
rejets sur la cte mridionale o la lutte dgnra en guerre de sige
(1597-1598). La mort de Hideyoshi survenue sur ces entrefaites (16 septembre
1598) entrana le rapatriement des troupes nippones et la cessation des
hostilits. Le Japon attendra trois sicles (1598-1894) avant de recommencer
la lutte contre la Chine sur le corps de la Core.
Ce que les Ming auraient d retenir de la guerre dont ils venaient de sortir
victorieusement, cest que lisolement de leur pays avait cess. De fait, en
mme temps que les corsaires japonais lassaillaient sur les ctes de la Chine
centrale, les navigateurs portugais faisaient leur apparition sur le littoral cantonais.
Depuis quen 1498 le dcouvreur portugais Vasco de Gama, ayant ralis
la circumnavigation de lAfrique, avait abord aux Indes, la route des mers de
Chine tait ouverte aux Europens. En 1511 lamiral portugais Albuquerque
stait empar de Ma lacca dont limportance au point de vue commercial et
stratgique tait alors la mme quaujourdhui celle de Singapour. En 1514 les
premiers navires de commerce portugais touchrent aux ports chinois. Entre
1549 et 1557 les Portugais reurent des mandarins locaux lautorisation de
fonder Macao, lentre de la rivire de Canton, un tablissement qui garda
un caractre essentiellement commercial. En 1582 les autorits portugaises de
Macao payaient pour ce trafic au vice-roi de Canton un tribut de 500 taels.
Avec les Portugais, le christianisme, chass de la Chine depuis la chute
des Mongols, y pntra de nouveau. Cette nouvelle vanglisation fut luvre
de la Compagnie de Jsus, notamment de deux de ses fils, Matthieu Ricci et
Adam Schall.
Le jsuite italien Matthieu Ricci (1552-1610) arriva en Chine par Macao
en 1582. Pendant treize ans (1582-1595) son apostolat sexera dans la r gion
cantonaise. Les missionnaires, pour se faire tolrer, devaient sassimiler une
des catgories existantes. Ricci, qui avait pris le nom chinois de Li Ma-teou,
adopta dabord le vtement des bonzes bouddhistes ; puis, avec un
remarquable discernement, il y renona et revtit le costume des lettrs :
ctait associer fort habilement le christianisme la doctrine dtat
confucenne. Toute la politique des jsuites fut base sur cette heureuse
comprhension de la mentalit chinoise. En 1595 Ricci qui avait su gagner la
faveur de hauts fonctionnaires cantonais, put partir pour le bas Yang-tseu. Il
stablit dabord Nankin o il put se livrer lapostolat sans tre inquit. Le
4 janvier 1601 il fut autoris pntrer Pkin, et aussitt il chercha entrer
en contact avec la cour impriale en prsentant celle-ci un clavecin, une
mappemonde et deux horloges sonnerie. Il crivait lempereur Wan -li :
Votre humble sujet connat parfaitement la sphre cleste, la gographie, la
gomtrie et le calcul. A laide dinstruments il observe les astres et sait faire
usage du gnomon. Ricci reut une pension mensuelle et fut autoris rsider
dans la Cit Impriale. La faveur du missionnaire se trouva complte quand il
fut charg de donner des leons de sciences un des fils de lempereur.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
189
Lorsquil mourut Pkin le 11 mai 1610, g de cinquante -huit ans, la Chine
comptait plus de trois cents glises catholiques. Il laissait une grande carte
de lunivers (wan kouo yu tou ) et une traduction chinoise de la gomtrie
dEuclide.
Son vritable continuateur fut le jsuite allemand Adam Schall, connu des
Chinois sous le nom de Tang Jo -wang (1591-1666). Arriv en Chine en 1620,
il prcha dabord Si -ngan-fou. Mathmaticien, astronome et aussi linguiste
remarquable, il fut charg par la cour impriale de travailler la rforme du
calendrier. Le dernier empereur ming, Tchouang-lie-ti, que nous dsignons
aussi par le nom de la priode Tchong -tcheng (1628-1644), lui tmoigna une
particulire bienveillance et en 1636 lui fit tablir prs du palais imprial une
fonderie de canons. Nous verrons quaprs la conqute de la Chine par les
Mandchous, Adam Schall ne jouit pas dune moindre faveur auprs des
nouveaux matres de lempire.
Lintrt quavait suscit la cour des Ming la science des jsuites montre
que les derniers souverains de cette dynastie se rendaient obscurment compte
quil et fallu moderniser le pays. Mais cette constatation venait trop tard.
Quand les Ming taient monts sur le trne (1368), la Chine et lOccident se
trouvaient, au point de vue de loutillage et de la technique, sensiblement sur
le mme niveau. A la chute de la dynastie, en 1644, lEurope se rvlera dj
en possession de la science moderne et de loutillage correspondant. La Chine,
elle, en sera reste au moyen ge : pour la grande cratrice quelle avait t
jusque-l, les deux cent soixante-seize annes de lpoque ming auront t
comme perdues.
La production littraire des Ming ne dment gure ce jugement. Ce quelle
nous a laiss de plus vivant consiste en romans et en pices de thtre. Le
roman le plus clbre (il date du XVIe sicle) est celui qui a pris pour thme
les voyages du moine bouddhiste Hiuan-tsang de la Chine dans lInde
travers lAsie centrale, dans les an nes 629-645. Malheureusement, quand on
a lu le passionnant rcit laiss par lillustre plerin, il est difficile de trouver
grand intrt laffabulation quen a tire le romancier ming. Au lieu des
descriptions la fois si prcises et si pittoresques du texte mdival,
temptes de sable du Gobi, chanes neigeuses des Tien-chan ou du Pamir, Inde
des grandes palmes, ce ne sont ici quaventures fantastiques, magie et
sorcellerie, merveilleux artificiel digne des contes tibtains. Les autres romans
ming sattachent en gnral quelque intrigue sentimentale travers des
pripties romanesques, avec, souvent aussi, il est vrai, des scnes de murs
intressantes.
La peinture ming a t dfinie dun mot : lacadmisme. Des traits
comme celui du jardin grand comme un grain de moutarde tudient dans le
paysage song les donnes du pittoresque et en transmettent les recettes
soigneusement inventories. Le rsultat, cest trop souvent un pittoresque
artificiel et forc avec par exemple, en montagne, dinv raisemblables
surplombs de rochers ; cest aussi labus des allusions potiques transposes
dans le domaine pictural. Toutefois il ne faudrait videmment pas exagrer ces
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
190
critiques. Le malheur de la peinture ming, cest quelle est crase par la
comparaison avec lpoque de grande cration des Song. Il y a beaucoup de
charme dans les portraits de jeunes femmes et les scnes de gynce, une
remarquable virtuosit dans la peinture en couleurs de fleurs et doiseaux. Et
dans le lavis les paysagistes ming ont souvent encore de la puissance comme
on peut sen assurer par la collection rcem ment acquise par le muse du
Louvre. Enfin les portraits funraires ming genre renouvel se
distinguent frquemment par leur ralisme sobre, la largeur et la prcision du
mtier, lacuit de lexpression. Nous sommes parfois assez prs ici des
dessins de Drer, de Holbein ou de Clouet.
Le grand art sous les Ming, cest la cramique. L encore, pour tre
quitable, on doit viter la comparaison avec lpoque song et juger les pices
ming pour elles-mmes. Elles le mritent dautant plus quun grand effort a
t fait par les souverains, commencer par le fondateur de la dynastie qui ds
1369 rebtit au Kiang-si la manufacture impriale de King-t-tchen o se centralisa ds lors presque toute la production : le kaolin tire son nom de largile
blanche du site de Kao-ling ( la haute passe ), voisin de King-t-tchen.
La cramique song avait t reprsente surtout par des monochromes ou
par des dgrads en ton sur ton. On trouve galement la monochromie chez les
Ming. Eux aussi nous ont laiss des cladons moins lumineux, plus laiteux
sans doute que ceux des Song, mais encore souvent fort beaux et quon
exportait jusqu Ispahan, au Caire et Stamboul ; aussi des pices blanches
fabriques T-houa (Fou-kien) et reprsentes notamment par des statuettes
de divinits bouddhiques, et encore des violets aubergine ou des bleus
sombres fort riches. Mais cest surtout dans la polychromie et plus
particulirement dans le dcor histori que triomphent les potiers ming. La
qualit du kaolin employ King-t-tchen saccommodait des plus hautes
tempratures et permettait ainsi la coexistence des maux les plus varis.
Parmi les maux de grand feu se distinguent les bleus et blancs , avec
leurs bleus de cobalt dont lintensit varie suivant la pro portion o le bleu
indigne est ml de bleu des musulmans .
La vogue en fut peu peu clipse par les pices de trois couleurs ou
san-tsai (vert, jaune et violet aubergine) et de cinq couleurs ou wou-tsai
(avec addition du bleu et du rouge). Cette prfrence pour les couleurs
hardiment juxtaposes, les tons rutilants, les dcors peints est caractristique
de lpoque. En ralit la cramique tendait ne plus tre qu une annexe de la
peinture, la porcelaine le disputant dsormais aux rouleaux de soie pour
solliciter du pinceau des peintres ming leurs thmes habituels, dlicates
silhouettes fminines, dcor de papillons, doi seaux et de fleurs.
Ce got va triompher sous la dynastie mandchoue.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
191
CHAPITRE 29
Le drame de 1644
Pendant la priode Wan-li (1573-1620) la Chine, nous lavons vu, avait
heureusement rsist la menace japonaise. Mais peine ce danger cart,
surgit le pril mandchou.
Les Mandchous taient un peuple de race tongouse, parent des anciens
Djurtcht ou Kin qui avaient au XIIe sicle conquis la Chine du Nord. Ils
habitaient les clairires de la Mandchourie septentrionale, dans le bassin du
Soungari jusqu lactuelle Pro vince Maritime russe, du ct de Ningouta,
sous un climat froid et humide, au milieu dimmenses forts de pins, de sapins
et de mlzes. Ces chasseurs forestiers vivaient rpartis en clans rivaux
lorsque dans les premires annes du XVIIe sicle un chef nergique,
Nourqatsi, les runit sous son autorit et fonda ainsi le royaume mandchou
historique. La Chine possdait alors la partie mridionale de lactuel
Mandchoukouo, cest --dire le pays de Moukden, de Leao-yang et de
Port-Arthur. Nourqatsi lui dclara la guerre et en 1621-1622 sempara de toute
cette rgion. Signe visible de ces accroissements, il mit en 1625 sa capitale
Moukden o se dresse encore aujourdhui sa spulture. Il essaya mme de
forcer la Grande Muraille mais choua devant les canons fondus pour les
Ming par les Pres jsuites.
Son fils, Abaqa (1627-1643), fut un de ces barbares de gnie comme
lExtrme -Orient en a tant connu et qui joignaient aux qualits militaires de
leur race lintuition de la vie civilise. Dis cernant la dcrpitude de la dynastie
ming, son ambition avoue fut de monter un jour sur le trne imprial. Pour
rendre son peuple digne des hautes destines quil rvait pour lui, il seffora
de lui donner un vernis de culture chinoise. Ainsi avait agi trois sicles et
demi plus tt un autre conqurant tartare, le grand Qoubila. Aussi bien
Abaqa entendait-il recommencer avec ses Mandchous laventure de Qoubila
et des Mongols. Pendant lhiver de 1629 -1630 il savana jusquaux portes de
Pkin. Les Mandchous ntaient pas encore outills pour entrep rendre un
sige en rgle, mais avant de se retirer, Abaqa se rendit aux tombeaux des
anciens souverains djurtcht, des Rois dOr du XII e sicle auxquels il se
rattachait par le sang, et leur offrit des sacrifices solennels : crmonie
significative qui renouait la tradition entre eux et proclamait en droit la
lgitimit de ses revendications au trne de Pkin.
Cependant quelques dommages que les incursions priodiques des
Mandchous causassent aux campagnes et aux bourgs ouverts du Ho-pei
septentrional, rien ntait encore compromis. Mme les bastions de la Grande
Muraille, de Chan-hai-kouan Siuan-houa, tenaient toujours. Pour livrer le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
192
vieil empire ses ennemis, il ne fallut rien de moins quune rvolution
intrieure suivie dune guerre civile.
Le prince ming qui rgnait alors Pkin, lempereur Tchouang -lie-ti (88)
(1628-1644) tait un lettr doux et bien intentionn, mais un souverain sans
nergie. Comme il arrive souvent quand la Chine ne se sent plus gouverne,
des rvoltes clatrent partout. Soldats mcontents de leur solde et paysans
souffrant de la famine sorganisrent en grandes compagnies qui, sous la
conduite de gnraux rebelles ou daventuriers audacieux, se mirent ravager
le pays. Le plus intelligent de ces aventuriers, Li Tseu-tcheng, un paysan
lettr devenu chef de brigands, se rendit matre du Ho-nan et du Chen-si
(annes 1640 et suivantes) et en 1644 marcha sur Pkin. Son approche trouva
la cour impriale compltement dsempare. La meilleure arme de lEmpire,
sous les ordres de Wou San-kouei, tait retenue loin de la capitale, vers la
passe de Chan-hai-kouan o elle contenait les Mandchous. Li Tseu-tcheng,
ne trouvant aucune rsistance srieuse, marcha sur Pkin dont la trahison lui
ouvrit les portes. Le malheureux empereur Tchouang-lie-ti se pendit pour ne
pas tomber vivant aux mains des rebelles et le mme jour Li Tseu-tcheng fit
son entre dans Pkin (3 avril 1644).
Tout jusque-l avait russi Li Tseu-tcheng. Mais laudacieux aventurier
avait compt sans larme impriale, cantonne face aux Mandchous dans la
marche de Chan-hai-kouan, et sans le chef de cette arme, Wou San-kouei. A
la nouvelle de la chute de Pkin et du suicide de lempereur, Wou San -kouei
se hta de conclure un armistice avec les Mandchous. Non seulement ceux-ci
y consentirent, mais ils mirent sa disposition un fort contingent de troupes
pour laider chtier les rebelles. Lorsque Li Tseu -tcheng apprit que larme
des marches sentendait contre lui avec les Mandchous, il pr it peur et offrit
Wou San-kouei de partager le pouvoir avec lui. Wou San-kouei non seulement
refusa, mais dfit Li Tseu-tcheng dans un premier combat, sur le seuil de
Yong-ping. De dpit lusurpateur fit excuter les parents du gnral. Ce fut
ds lors entre les deux hommes une haine furieuse, inexpiable. La pit filiale,
sentiment sacr pour un Chinois, et la soif de la vengeance firent oublier
Wou San-kouei la prudence la plus lmentaire. Il se confia entirement aux
Mandchous et descendit avec eux sur Pkin. A son approche Li Tseu-tcheng,
aprs avoir fait main basse sur le trsor imprial, mit le feu au palais et se
retira avec son arme au Chan-si.
Wou San-kouei entra dans Pkin avec ses allis mandchous. Il remercia
alors ces derniers de leur concours et chercha les congdier. Mais les
Mandchous lui firent comprendre son erreur. Ils avaient maintenant Pkin
une arme de cent mille hommes que renforaient sans cesse de nouveaux
contingents descendus de Moukden. Sans tenir compte des objurgations de
Wou San-kouei, ils se saisirent des portes de la capitale. Leur khan Abaqa
tait mort quelques mois auparavant, laissant comme hritier son neveu, g
de sept ans. Les chefs mandchous proclamrent cet enfant empereur de Chine,
avec le nom de priode Chouen-tche, la place des Ming, dclars dchus.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
193
Wou San-kouei, la dupe des Mandchous, devenue par la force des choses
leur complice, dut accepter le fait accompli. Il reut deux une somptueuse
vice-royaut au Chen-si, charge pour lui d en chasser Li Tseu-tcheng. La
colre contenue que ne pouvait manquer de lui causer le cours des derniers
vnements, il la tourna contre le meurtrier de son pre. Il sacharna sur Li
Tseu-tcheng, le refoula loin du Chen -si, puis organisa contre lui travers le
Ho-nan et le Hou-pei une vritable chasse lhomme qui se termina par la
mort de lancien bandit (1644).
Pendant ce temps, Pkin, les oncles du jeune empereur Chouen-tche qui
exeraient la rgence en son nom organisaient le rgime mandchou. Ils eurent
lhabilet de ne pas changer la forme du gouvernement, ne supprimant ni les
emplois ni les titulaires et se contentant, pour les postes importants, de doubler
le fonctionnaire chinois par un fonctionnaire mandchou. Seule la coutume de
se raser le sommet du crne, impose aux Chinois par les conqurants, marqua
lavnement dune dynastie tartare.
Cependant lautorit des Mandchous ntait reconnue que dans la Chine
du Nord. Un prince ming avait t proclam empereur Nankin et toutes les
populations mridionales staient prononces en sa faveur. Le premier soin
des Mandchous aprs la conqute de Pkin fut dtouffer ce foyer de
rsistance. Au printemps de 1645 ils convergrent sur Nankin. Le prtendant
ming qui avait trop tard song demander l aide des Portugais de Macao, se
noya dans sa fuite. Nankin fut occup par les Mandchous le 9 mai 1645.
Les derniers dfenseurs de lindpendance chinoise et de la dynastie ming
se rfugirent au Tch-kiang et dans la rgion cantonaise. Trois princes ming,
chapps au dsastre de leur famille, cherchrent organiser la rsistance au
Tch-kiang, au Fou-kien et Canton. Malheureusement ils ne surent pas
sentendre entre eux et usrent leurs dernires forces se quereller. Dans ces
conditions les Mandchous neurent aucune peine soumettre le Tch -kiang
dabord, le Fou -kien ensuite (1646).
Lhinterland de la rgion cantonaise tint plus longtemps. Un dernier prince
ming y fut proclam empereur sous le nom de Yong-li avec capitale
Kouei-lin, dans les montagnes du Kouang-si. Les Mandchous marchrent sur
Kouei-lin, mais ils furent repousss par les lgitimistes qutaient venus
renforcer trois cents Portugais de Macao avec des canons sous les ordres de
Nicolas Fereira. En ralit, ctait lintervention por tugaise qui venait de
sauver les Ming. Cette intervention sexplique. Un des conseillers les plus
couts de Yong-li tait le Pre jsuite Koffler. De plus sa femme tait une
chrtienne baptise sous le nom dAnne. Le fils de Yong -li et dAnne fut lui mme baptis sous le nom de Constantin et limpratrice douairire sous le
nom dHlne. Le plus fidle dfenseur des Ming, lhroque Kiu Che -sseu, se
convertit galement au catholicisme sous le nom de Thomas. Ce soldat
chrtien jeta un rayon de gloire sur les derniers jours de la dynastie. En 1650
le Pre jsuite Boym partit de Kouei-lin pour lEurope afin de solliciter en
faveur des Ming laide de la chrtient. Mais la mme anne une grande
arme mandchoue descendait du nord avec mission de rduire cote que cote
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
194
le Kouang-si et le Kouang-tong. A son approche, le faible Yong-li prit peur et
malgr les supplications de Kiu Che-sseu, senfuit de Kouei -lin. Abandonn
par son matre et par la moiti des troupes, Kiu Che-sseu dfendit quand
mme Kouei-lin avec ses derniers fidles. La ville fut emporte dassaut et
lui-mme fut fait prisonnier, les armes la main. Suivant leur politique
habituelle, les Mandchous essayrent dobtenir son ralliement en lui offrant
mme un poste de vice-roi. Comme il refusait obstinment de trahir ses
matres, il eut la tte tranche, mais en considration de son hrosme les
vainqueurs lui accordrent de glorieuses funrailles (1650). Les Mandchous
semparrent ensuite de Canton, tandis que Yong -li se rfugiait en Birmanie
(1651).
Le dernier dfenseur de lindpendance chinoise fut le corsaire que nous
appelons (daprs la transcription portugaise de son nom) Koxinga.
Koxinga est une des plus curieuses figures de lhistoire de
lExtrme -Orient. Cest le premier reprsentant de cett e Chine Extrieure qui
naissait alors et dont lexpansion sur tous les rivages de locan Pacifique et
de locan Indien se prsente comme un des faits capitaux du dernier sicle.
Son pre, Tcheng Tche-long, simple pcheur du Fou-kien devenu capitaine de
pirates, avait pass sa jeunesse Macao o il avait t baptis par les
Portugais. Il avait ensuite sjourn Manille, chez les Espagnols, puis au
Japon o il stait mari : Koxinga naquit de ce mariage. Rentr en Chine,
Tcheng Tche-long se fit corsaire au service des Ming et guerroya contre les
Mandchous sur les ctes du Tch-kiang, du Fou-kien et du Kouang-tong
(1645). Captur en trahison par les Mandchous, il fut envoy Pkin et nen
revint plus (1646).
Son fils, Koxinga, jurant de le venger, reprit la mer. A la tte descadrilles
insaisissables il allait pendant seize ans diriger une terrible guerre de course
contre les gouverneurs mandchous du bas Yang-tseu, du Tch-kiang, du
Fou-kien et de la rgion cantonaise.
Koxinga commena par sassurer de so lides points dappui sur le littoral.
Ce fut ainsi quen 1653 il tablit une base navale dans lle dAmoy, au
Fou-kien. En 1656 il occupa de mme lle de Tsong -ming qui commande
lestuaire du Yang -tseu. En 1657 il remonta le Yang-tseu et osa assiger
Nankin. Repouss de ce ct, il se tourna vers lle de Formose o depuis
1625 les Hollandais staient tablis. Ayant rassembl dans son repaire
dAmoy une puissante escadre, il dbarqua dans lle le 30 avril 1661. Le 1 er
fvrier 1662 il sempara, aprs un long sige, de la citadelle hollandaise de
Zelandia. Galamment il accorda au gouverneur hollandais les honneurs de la
guerre, mais le fora se rembarquer et se proclama roi de Formose. Il
songeait enlever de mme Manille aux Espagnols quand il mourut
prmaturment lge de trente -neuf ans, le 2 juillet 1662.
Koxinga reprsente un destin hors srie . Fils dun chrtien chinois et
dune japonaise, lve des conquistadors hispaniques, oblig par linvasion
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
195
trangre vivre en marge de son pays, son horizon dpassait videmment
celui de ses compatriotes. Ce fut sans doute limitation des navigateurs
portugais, espagnols et hollandais quil conut lide hardie de se tailler un
empire maritime dans les mers de Chine. Sa tentative, comme nous lannon cions, prsente pour lhistorien un intrt capital comme tant la premire
rvlation dun fait jusque -l bien inattendu : la vocation maritime et coloniale
du peuple chinois. Laventure de Koxinga ouvrait en effet lre de la grande
migration des Fils de Han qui aujourdhui de Cholon Singapour, de Batavia
Manille et aux Hawa couvrent toutes les ctes des mers du Sud, fait
immense dont les consquences lointaines ne peuvent encore tre values.
Quant au royaume de Formose tabli par Koxinga, il passa son fils qui
en resta paisible possesseur de 1662 1681. Aprs la mort de ce dernier, il fut
en 1683 annex lempire mandchou par lempereur Kang -hi.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
196
CHAPITRE 30
Les grands empereurs mandchous : Kang -hi et Kien -long
La mainmise des Mandchous sur le trne de Chine en 1644 avait, il faut
bien le reconnatre, tenu de lescamotage. Avec une habilet quon net gure
attendue de ces barbares, les rgents mandchous staient glisss dans Pkin
la faveur de la lutte entre le bandit usurpateur et le gnral lgitimiste, en
aidant le second chtier le premier, le tout aux applaudissements des
loyalistes et du mandarinat ; dans la carence du pouvoir et sans effusion de
sang ils staient alors trouvs matres du vieil empire. Il y avait loin de cet te
prise de possession, somme toute pacifique, aux vingt annes de dvastations
et de massacres quavait exiges au XIII e sicle la conqute de la Chine du
Nord par les Mongols. Dans la Chine du Sud, il est vrai, les Mandchous,
comme on vient de le voir, durent guerroyer sept ans encore avant den finir
avec les derniers Ming, mais l non plus on ne saurait comparer ces
campagnes (dailleurs limites aux provinces -frontires de la rgion
cantonaise) aux quarante-trois ans de luttes terribles quavait exigs des
Mongols la conqute de ce mme Midi. Dail leurs lhabile rgent qui dirigeait
le gouvernement mandchou pour le compte de son neveu, lempereur -enfant,
eut soin demployer surtout cette tche les Chinois eux -mmes, en comblant
les rallis de titres et de profits. Pour mener bien ce ralliement et achever la
pacification, il constitua dans le sud trois grandes principauts dont il investit
trois dignitaires chinois, parmi lesquels un descendant de Confucius. Aprs sa
mort, lempereur Chouen -tche, malgr son jeune ge, il navait quune
quinzaine dannes, dclara, comme notre Louis XIV, vouloir tre luimme son premier ministre et assuma en effet directement la charge du
pouvoir (1er fvrier 1651).
Le jeune souverain ne tarda pas donner des preuves de sa sagesse et de
sa capacit. Il marquait une estime particulire pour le Pre jsuite Adam
Schall quen 1645 les rgents mandchous avaient dj nomm codirecteur du
service astronomique et qui il confra en 1653 le titre de docteur trs
profond . En 1654 Schall lui offrit un trait dastronomie europenne qui fut,
lanne suivante, officiellement adopt par la cour, Schall semble mme avoir
eu loccasion de jouer un rle plus intime auprs du souverain.
Lempereur Chouen -tche navait que dix -sept ou dix-huit ans lorsque, un
jour, au cours dune fte au palais, il aperut la jeune femme dun des hauts
dignitaires, la belle Tong Siao-wan. Il fut aussitt passionnment pris. Le
mari, sapercevant de cette passion, se suicida. Chouen -tche fit entrer la jeune
femme au palais avec le titre (il tait dj mari) de deuxime impratrice.
Pendant plusieurs annes il fut heureux : son amour ne faisait que grandir.
La deuxime impratrice eut un fils. Le bonheur de Chouen-tche fut complet.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
197
Puis, sans quon st de quelle maladie, la mre et lenfant moururent,
peut-tre empoisonns. La douleur de lem pereur fut effrayante. Il fit
immoler sur la tombe trente personnes de la suite de la jeune femme et les fit
enterrer au pied du cercueil. On ne sait sil vengeait la dfunte ou si ( la
manire tartare) il lui donnait des compagnons pour lau -del (89). Chouentche tenta mme de se suicider ; on larrta temps, mais il se laissait dprir.
Le Pre Schall, auquel il tmoignait de plus en plus damiti, lui prodigua ses
encouragements pour lamener se ressaisir : en vain, car lempereur qui avait
cess de soigner sa sant mourut peu aprs, le 5 fvrier 1661, de la petite
vrole, affirma-t-on. Il navait que vingt -cinq ans. La rumeur populaire voulut
quil et secrtement abdiqu pour se faire moine boud dhiste sur la montagne
sacre du Wou-tai -chan. On a aussi voulu voir lcho de ce drame dans le
clbre roman de Tsao Siue -kin (1719 -1763), le Rve dans le pavillon
rouge, mais en ce cas lallusion serait singulirement voile...
A la mort de Chouen-tche, les princes mandchous mirent sur le trne un
enfant de sept ans (il tait n le 4 mai 1654) que nous dsignerons par le nom
des annes de rgne Kang -hi.
Kang -hi, qui devait avoir un rgne presque aussi long que son
contemporain Louis XIV (1662-1722), est un des plus grands souverains de
lhistoire chinoise. Comme pour notre Louis XIV les contemporains sont
unanimes vanter sa beaut, sa majest naturelle, sa prsence desprit (90).
Dune taille au -dessus de la moyenne et bien proportionn, le visage bien
fait et plein, des yeux remplis de vivacit et plus ouverts que le commun des
Chinois, le front large, le nez un peu aquilin, la bouche pleine, un air gracieux
et doux, mais majestueux et grand qui le faisait aisment distinguer au milieu
dune cour nombreuse : tel est le portrait que nous ont laiss de lui les
missionnaires jsuites, lesquels lont bien connu. Ces dehors avantageux,
ajoutent-ils, annonaient chez ce monarque une me grande qui le laissait
matre absolu de rgler ses passions, un esprit vif et pntrant, un jugement
sain et solide, une mmoire heureuse laquelle rien nchappait. A son
intelligence naturelle il joignait un got pour ltude qui fit de ce prince tartare
un empereur selon le cur des lettrs chinois. Toutefois, on le verra dans les
affaires du christianisme, il resta pour sinis quil ft suffisamment
indpendant des routines confucennes. Enfin en politique extrieure, le khan
mandchou se retrouvait en lui sous le Fils du Ciel ou plutt ces deux aspects
de sa puissante personnalit se compltaient ici. Mais sans doute est-ce son
hrdit mandchoue quil dut de voir si grand, lorsquil reprit en haute Asie
luvre non seulement des Han et des Tang, mais aussi des grands -khans
mongols.
Pendant son adolescence, le pouvoir fut exerc par quatre rgents qui sur
certains points prirent le contre-pied de la politique de Chouen-tche. Ce fut
ainsi que le 4 janvier 1665 ils promulgurent un dit proscrivant le
christianisme. Le Pre Schall, lami personnel du dfunt empereur, fut arrt
et condamn mort, mais limpratrice douairire indigne le fit remettre en
libert. Le vieillard, bris par cette catastrophe, ne tarda pas mourir (15 aot
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
198
1666). En mme temps, par un dcret de 1662, les rgents dcidrent que dans
les examens pour le choix des fonctionnaires, il serait tenu compte avant tout
des compositions littraires selon lenseignement officiel de lcole de Tchou
Hi, systme qui devait fonctionner jusquen 1905.
Cependant Kang -hi, malgr son jeune ge, supportait impatiemment la
tutelle des rgents. Il navait que treize ans quand, le 25 aot 1667, il prit en
mains les rnes du gouvernement. Deux ans plus tard, il soumit un examen
svre la gestion des rgents, fit, le 14 juin 1669, arrter lun deux, le
condamna la dcapitation, peine quil commua ensuite en prison perptuelle,
et pronona la dgradation dun autre. Comme don de joyeux avn ement la
population indigne, il ordonna que les terres injustement saisies par les
Mandchous fussent restitues leurs propritaires chinois. Malgr ces
mesures librales, une grave rvolte nallait pas tarder clater contre la
domination mandchoue.
On a vu que les conqurants mandchous, pour obtenir moindres frais la
soumission des provinces mridionales et sassurer le ralliement des
populations, avaient confi le gouvernement de la Chine du Sud trois hauts
dignitaires chinois levs au rang de princes et pratiquement autonomes. Lun
de ces princes gouvernait le Fou-kien, lautre la rgion cantonaise, le
troisime qui ntait autre que le clbre Wou San -kouei avait le Sseutchouan et le Yun -nan. Nous avons vu le rle dcisif jou par Wou San-kouei
dans la tragi-comdie de 1644, et comment ce gnral loyaliste, aprs avoir
pris les armes pour venger la dynastie lgitime, se trouva son insu faire le
jeu des envahisseurs mandchous. Dupe des Mandchous devenue par la force
des choses leur complice, il avait t royalement rcompens par eux, dabord
par la vice-royaut du Chen-si, puis par la principaut du Sud-Ouest. L il se
trouvait dautant plus indpendant quil tait pres que invulnrable : les Alpes
du Sseu-tchouan et du Yun -nan formaient ces provinces cartes une
protection qui semblait dfier toute attaque. Les Mandchous qui nignoraient
pas ce quils lui devaient (sans son attitude de 1644 ils nauraient jamais
occup Pkin) le mnageaient, traitaient presque avec lui dgal gal. Ils
avaient mme donn en mariage son fils une sur de leur empereur
Chouen-tche.
Le nouvel empereur, Kang -hi, supportait mal ces autonomies rgionales.
Inquiet de voir Wou San-kouei trancher du souverain, il linvita se prsenter
la cour. Wou San-kouei, arguant de son grand ge, se droba (1672). Sur une
nouvelle invite plus pressante, le vieillard se mit en tat de rbellion ouverte et
appela le peuple chinois la rvolte nationale contre les Mandchous (1674).
Son exemple fut suivi par les deux autres princes autonomes du sud, ceux
de Canton et du Fou-kien. En Mongolie Intrieure, la principale des tribus
mongoles, celle des Tchakhar qui nomadisait au nord de la province du
Ho-pei, entra dans la coalition. Le khan des Tchakhar, Bourni, qui tait le
descendant direct de Gengis-khan et de Qoubila, appela les Mongols
orientaux la rvolte contre la suzerainet mandchoue, mais les autres tribus
ne le suivirent pas et il fut fait prisonnier. Dans le sud, le Fou-kien et la rgion
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
199
cantonaise furent galement soumis assez vite (1676-1677). Quant Wou
San-kouei, il se retira du Sseu-tchouan au Yun -nan o les Mandchous ne
jugrent pas propos de le relancer, mais il y mourut peu aprs de vieillesse
(octobre 1678). Ce ne fut qu la fin de 168 1 que les Mandchous occuprent le
Yun-nan. Toute la famille de Wou San-kouei fut excute ; les ossements du
rebelle furent rduits en poudre et jets au vent (1682). En 1683 Kang -hi
complta sa victoire en annexant le royaume chinois autonomiste qui s tait
constitu dans lle de Formose. La Chine mridionale qui avait bnfici
jusque-l dun rgime exceptionnellement favorable, connut alors les rigueurs
de lannexion militaire.
La dfaite des Tchakhar avait assur Kang -hi la suzerainet de la
Mongolie Intrieure (tribus Ordos et tribus Tchakhar). Il put alors se consacrer
la Mongolie Extrieure.
La Mongolie Extrieure ou haute Mongolie tait partage entre deux
groupes de tribus, les Mongols orientaux ou Khalkha et les Mongols
occidentaux, aussi appels Orat ou Kalmouk. Les Khalkha, rpartis entre cinq
rois qui tous descendaient de Gengis-khan, occupaient la Mongolie
proprement dite, du bas Kruln aux lacs de Kobdo. Les Kalmouk
nomadisaient plus louest et au sud -ouest, de Kobdo aux Tien-chan. La
principale tribu parmi ces derniers tait celle des Tchoros que nous avons pris
lhabitude de dsigner sous les noms dEleuthes et de Dzoungar et qui habi taient autour du Tarbagata, depuis Kobdo jusquau fleuve Ili. Or, de 1676
1697 les Dzoungar eurent leur tte un personnage extraordinaire, Galdan,
sorte de Gengis-khan avort qui rva en effet de reconstituer au profit de ses
Mongols occidentaux lancien empire gengiskhanide. Dans son enfance
Galdan avait vcu comme moinillon au Tibet, auprs de ce pape du
bouddhisme qutait le dala -lama de Lhassa. Il avait conserv lamiti du
Saint-Sige lamaque dont lnorme influence politique sur tous les
bouddhistes de la haute Asie resta toujours son service. Protecteur du
bouddhisme au Tibet, Galdan sarrangea pour tre en Kachgarie le dfenseur
de lIslam. Il renversa dans ce pays le dernier khan gengiskhanide et installa
la place la thocratie musulmane des Khodja (1678-1680). Il entreprit ensuite
la conqute de la Mongolie propre sur les Khalkha et en deux ans de guerre
(1688-1690) soumit ce pays, de Kobdo au Kruln.
Les princes khalkha dpossds se rfugirent prs de la Grande Muraille,
implorant laide de lempereur Kang -hi. Celui-ci ne pouvait laisser se
constituer aux portes de la Chine un nouvel empire mongol. Galdan, lanc la
poursuite des Khalkha, osait maintenant savancer vers la Mongolie Intrieure
sur la route dOurga Kalgan. Kang -hi envoya contre lui une arme avec de
lartillerie, cette artillerie que les jsuites avaient fondue pour la cour
impriale. Dans la rencontre qui se produisit le 2 septembre les Dzoungar,
ayant pris position derrire un marais, purent rsister aux Impriaux, mais la
canonnade dut les intimider car Galdan vacua mme la haute Mongolie, le
pays khalkha (fin 1690). Le rsultat de son chec fut dassurer lempire le
protectorat de la haute Mongolie. Les princes khalkha que lintervention de
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
200
Kang -hi avait sauvs de la domination dzoungare, vinrent solennellement lui
rendre hommage dans une dite tenue au Dolon-nor en mai 1691.
Le statut de la Mongolie Extrieure qui fut alors tabli devait durer
jusquen 1912, les princes khalkha payant tribut lempire sino -mandchou et
recevant en revanche des gratifications de lem pereur. Entre ces descendants
de Gengis-khan et lempereur mand chou, se cra un lien de fidlit
personnelle que devaient cimenter diverses reprises des alliances de famille.
Un tel systme, lem pereur ming Yong-lo y avait song, mais, comme
Chinois, il ne pouvait le faire accepter par les Mongols. Kang -hi y russit au
contraire sans difficult parce qutant lui -mme tartare. Le nouveau statut de
la Mongolie reposa en effet sur lattachement, de nomade nomade, des
khans mongols au grand-khan mandchou. Le fait est que le jour o en 1912 la
dynastie mandchoue disparatra, remplace par la Rpublique Chinoise, les
princes mongols, sestimant dlis du serment de fidlit, se dclareront
indpendants.
La guerre reprit entre Galdan et lempire en 1695. Le chef dzoungar
envahit de nouveau la haute Mongolie, le pays khalkha, et pntra jusquau
Kruln. Pour en finir, Kang -hi prpara une grande expdition quil dirigea
en personne. Le 16 fvrier 1696 il runit au palais ses officiers gnraux et
leur offrit de sa main le vin du dpart. Le 13 avril il se mit en marche. Il stait
fait accompagner du Pre jsuite Gerbillon qui nous a laiss le rcit de
lexpdition, notant lordre parfait qui tait maintenu, la frugalit observe
par le souverain et par son entourage, sa sollicitude pour les soldats quil
voulait voir installs dans leurs campements avant dentrer lui -mme sous sa
tente . La marche travers une contre toujours pauvre et alors dvaste
imposa de terribles souffrances larme. Lempereur en prit sa part et
repoussa avec mpris les prires des mandarins qui le suppliaient de ne pas
sexposer davantage. Son attitude nergique enflammait les troupes. Le
corps darme que commandait personnellement Kang -hi se porta sur le
Kruln, tandis quavec un autre corps so n lieutenant Feryang-kou marchait
sur la Toula pour couper la retraite de Galdan. Le 12 juin 1696 Feryang-kou
atteignit lennemi sur la rive mridionale de la Toula, Tchao -modo, au sud
dOurga et, grce sa mousqueterie et son artillerie, lui infligea un complet
dsastre. La femme de Galdan fut tue, tout son quipage fut pris, ses
troupeaux restrent aux mains des Impriaux. Ayant perdu la moiti de ses
troupes, le chef dzoungar prit la fuite dans la direction de Kobdo, tandis que
Kang -hi revenait en triomphe Pkin et que les Khalkha, de nouveau sauvs
par lui, reprenaient dfinitivement possession de leur territoire sous le
protectorat, dsormais incontest, de la cour de Pkin.
Cette grande uvre le sauvetage , le ralliement et la domestication
des Mongols gengiskhanides fut luvre person nelle de Kang -hi. Il sy
consacra tout entier, mettant son application tablir entre lui et les princes
mongols des rapports de confiance et damiti durables. Aussi bien
apportait-il aux choses mongoles le got le plus vif. Avec les khans khalkha
ou ordos, ce Fils du Ciel se retrouvait lui-mme chef de horde. Il savait leur
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
201
parler le langage qui leur convenait, faisant appel lhonneur de la
bannire , la fidlit militaire, sentiments si forts chez eux. A leur contact
toute une hrdit nomade semblait se rveiller en lui. Il ntait jamais aussi
heureux que lorsque, loin des pompes de la Cit Interdite, il pouvait au milieu
de ses vassaux mongols chasser le livre ou lantilope. Les livres des Ordos
ont un fumet exquis, crivait-il dune de ses campagnes son fils. Tout ce
quon trouve ici me semble plus savoureux que ce quil y a de meilleur
Pkin.
Quant aux Dzoungar, Kang -hi, satisfait de les avoir chasss de la
Mongolie propre, nava it pas cherch les relancer dans leur patrimoine du
ct de Kobdo, du Tarbagata et de lIli. Leur chef Galdan tait dcd peu
aprs sa dfaite de 1696. Mais son neveu, Tswang Rabdan, qui lui avait
succd (1697-1727) reprit bientt ses projets ambitieux, orients cette fois
vers le Tibet. Le 2 dcembre 1717 une arme dzoungare entra Lhassa,
massacra tous les lamas partisans de la Chine et sinstalla en perma nence dans
la ville sainte. Kang -hi envoya aussitt au Tibet un premier corps
expditionnaire qui fut repouss (1718). Il prit son temps et lautomne de
1720 une arme impriale plus considrable entra Lhassa et chassa les
Dzoungar. Un dala-lama du parti imprial fut intronis et deux
hauts-commissaires chinois furent placs auprs de lui, avec mission de
diriger la politique extrieure de lglise lamaque.
Au nord de la Mandchourie, Kang -hi se heurtait lexpansion russe.
Matres de la Sibrie occidentale depuis la fin du XVIe sicle, les Russes, dans
leur marche vers locan Pacifique , avaient atteint le fleuve Amour sur les
bords duquel en 1651 ils levrent le fort dAlbazin. La rgion, habite par
des Tongous, proches parents des Mandchous et soumis la suzerainet de la
cour de Pkin, tait riche en zibelines. Les Russes firent aussitt la plus
redoutable concurrence aux trappeurs indignes et aux fourreurs chinois. La
nomination dun gouverneur russe Albazin en 1682 acheva de porter
ombrage au gouvernement de Pkin. Kang -hi, qui les jsuites avaient fondu
une bonne artillerie, agit nergiquement. En juin 1685, 15.000
Sino-Mandchous avec 150 pices de campagne et 50 pices de sige vinrent
attaquer le fort qui capitula et fut incendi (22 juin 1685). Mais aprs le dpart
des Chinois les cosaques revinrent Albazin et y rdifirent une nouvelle
forteresse qui fut aussitt assige par les Chinois. Des ngociations
souvrirent enfin Nertchinsk, ngociations pour lesquelles Kang -hi
adjoignit la dlgation chinoise deux Pres jsuites, dont le Franais
Gerbillon. Ce fut grce Gerbillon que le 6 septembre 1689 put tre conclu en
russe, en chinois, en mandchou et en latin le trait de Nertchinsk, qui constitua
une transaction. Les Russes abandonnrent le territoire dAlbazin dont le fort
fut ras, mais ils conservrent Nertchinsk. Le confluent de la Chilka et de
lArgoun marqua la frontire entre les deux empires, tout le bassin de lAmour
proprement dit, y compris ses affluents septentrionaux, restant la Chine. En
somme les Russes taient rejets loin des rives du fleuve, au-del des monts
Stanovoi ; la Mandchourie, terre natale de la dynastie, se trouvait dgage de
la menace qui avait pes sur elle. Kang -hi tmoigna sa reconnaissance au
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
202
Pre Gerbillon qui, plus qu tout autre, il devait en effet ce succs
diplomatique.
Kang -hi, en prenant le pouvoir personnel, avait trouv en vigueur ldit
du conseil de rgence du 4 janvier 1665 qui proscrivait le christianisme. Mais
les jsuites simposaient par leur valeur scientifique. Parmi les anciens
compagnons du Pre Ricci se trouvait notamment un jsuite belge, le Pre
Verbiest Nan Houai-jen de son nom chinois (1623-1688), arriv en
Chine en 1659 et qui se distinguait par ses connaissances en mathmatiques et
en astronomie. En 1669 Kang -hi, malgr lavis des lettrs con fucens, lui
donna raison sur le terrain scientifique et adopta sa rforme du calendrier.
Verbiest fut rtabli dans la prsidence du tribunal des mathmatiques . Le
christianisme ne pouvait manquer de bnficier de la faveur personnelle dont
jouissaient Verbiest et les autres jsuites. Sans doute Kang -hi, tout en les
honorant comme savants, tout en leur permettant, contrairement ldit de
1665, de pratiquer personnellement leur religion, maintint en 1669 et en 1671
linterdiction du proslytisme dans la population chinoise. Mais les vice-rois,
constatant la faveur dont la cour bnficiaient les jsuites, firent surtout
preuve de la plus large tolrance lgard de la prdication chrtienne. Du
reste, le crdit du Pre Verbiest augmenta encore lorsque, en 1674, au moment
de la rvolte de Wou San-kouei, il fondit plusieurs pices de canon qui
contriburent grandement au succs des armes impriales.
Le Pre Verbiest mourut en pleine faveur Pkin le 29 janvier 1688, et le
7 fvrier arriva la capitale celui qui devait tre son continuateur, le jsuite
franais Gerbillon. Prsent la cour le 21 mars, Gerbillon plut Kang -hi qui
lui fit donner des leons de mandchou pour pouvoir causer plus librement
avec lui. Lorsquils purent converser ensemble, l empereur sentretint
frquemment de questions scientifiques avec le missionnaire et fit rdiger par
celui-ci en mandchou un expos de la gomtrie dEuclide. Nous avons vu
dautre part les services que Gerbillon rendit la Chine comme ngociateur du
trait de Nertchinsk. Kang -hi reconnaissant promulgua les 17 et 19 mars
1692 deux dits de tolrance en faveur du christianisme. Le premier dclarait :
Les hommes de lOccident (les missionnaires) ont mis en bon or dre le
calcul du calendrier. Au moment de la guerre ils ont rpar les anciens canons
et en ont fabriqu de nouveaux. Ils se sont dpenss pour le bien de lempire
et se sont donn beaucoup de peine. Dailleurs la religion catholique ne
contenant rien de mauvais ni de drgl, ses adhrents doivent, comme de
coutume, continuer la pratiquer en libert. Nous ordonnons de rapporter les
prcdents mmoires et dlibrations (contre ladite religion).
La Chine souvrait au christianisme. La malheureuse question des rites
pour laquelle lOccident s e passionna en toute ignorance de cause, vint ruiner
les rsultats obtenus. Les jsuites avaient admis quen principe la notion
confucenne du Tien (Ciel, dieu du ciel) peut correspondre la conception
chrtienne de Dieu, et que, de plus, les crmonies pratiques en lhonneur de
Confucius dune part, le culte des anctres dautre part, peuvent tre
considrs comme de simples rites civiques, un simple hommage aux vertus
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
203
du Sage ou un simple acte de pit filiale. Sans rien sacrifier du dogme
chrtien, sans admettre aucun acte de paganisme, ils vitaient ainsi de heurter
de front les lettrs confucens, cest --dire tout le mandarinat. Ainsi en avait
jug le pape Alexandre VII, ainsi devaient en juger de nos jours Leurs
Saintets Pie XI et Pie XII. La campagne contre les Rites nen fut pas
moins poursuivie par des chrtiens fort zls sans doute, mais certainement
moins bons sinologues que les jsuites, et donc moins capables queux
dapprcier la porte mtaphysique et thologique des concepts chino is. En
1715 les rites furent condamns. Kang -hi qui tait fort cultiv, stait
intress personnellement la question. Il avait pris la peine de spcifier luimme quil ny avait aucune arrire -pense didoltrie dans les hommages
rendus aux tablettes de Confucius ou des Anctres : On nesprait et
nattendait rien, crivait -il, de Confucius ou des Anctres. Personne ne croyait
leur prsence dans les tablettes. Ce quon lisait dans les rituels et qui pouvait
le donner entendre tait une figure du nombre de celles qui sont en usage
dans la langue chinoise. Bless de ce quon et pass outre ses
explications, il rpondit par ldit du 17 mai 1717 qui interdisait la prdication
du christianisme.
La campagne des jansnistes contre les jsuites avait port ses fruits. La
Chine qui souvrait la foi chrtienne, se referma.
Lempereur Kang -hi qui avait pris froid en chassant dans le parc de Haitseu mourut lge de soixante -neuf ans le 20 dcembre 1722. Il laissait le
trne son quatrime fils qui fut lem pereur Yong-tcheng (91) (1723-1735).
Yong-tcheng qui avait quarante-six ans son avnement, emprisonna ou
fit disparatre la plupart de ses frres. Malgr ces dbuts fcheux, ce fut un
prince appliqu, travailleur, soucieux du bien public, mais dont la figure plit
ct de celle de son pre. Tandis que ce dernier avait fait preuve dune
indpendance desprit quil devait sans doute au sang mandchou,
Yong-tcheng, dj plus circonvenu par le mandarinat, montra souvent
beaucoup dtroitesse de jugement, notamment lgard du christianisme. En
1724 il ordonna lexpulsion de tous les missionnaires, excep tion faite de ceux
qui taient tolrs la cour mme en raison de leurs connaissances
scientifiques.
Au dehors il reprit la lutte contre les Dzoungar. En 1731 il envoya chez
eux une arme qui occupa Kobdo mais qui fut deux mois aprs surprise et
dtruite. En 1734 une autre expdition chinoise poussa encore jusquau pays
de Kobdo. Cependant, lanne suivante, Yong -tcheng mit fin aux hostilits.
Yong-tcheng mourut le 7 octobre 1735, laissant le trne son quatrime
fils g de vingt-quatre ans que nous dsignons par le nom des annes de
rgne Kien -long.
Le rgne de Kien -long fut aussi long que celui de son aeul Kang -hi
(1735-1796). Ce fut aussi le dernier grand rgne de la dynastie. Nous allons
voir quil acheva luvre de Kang -hi en Mongolie et au Tibet. Nanmoins
ces conqutes ne furent pas conduites par le souverain en personne. A la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
204
diffrence de Kang -hi, ce ne fut pas un soldat, mais seulement un diplomate
et un administrateur.
Nous venons de voir que Yong-tcheng avait chou dans sa tentative pour
annexer la Dzoungarie. Kien -long fut mieux servi par les circonstances. Les
Dzoungar taient en proie la guerre civile. En 1754 un des prtendants
dzoungar, Amoursana, se rfugia en Chine. Kien -long le reut Jehol et le
donna comme guide une arme impriale qui alla occuper la Dzoungarie.
Mais alors Amoursana se brouilla avec ses protecteurs et, appelant les
Dzoungar aux armes, se jeta sur le corps doccupation qui subit des pertes
terribles. Un nergique marchal mandchou, Tchao Houei, rtablit la situation,
crasa les rvolts sur lImil, au Tar bagata, et occupa Kouldja qui tait un
autre centre de la rsistance ennemie (1757). Amoursana senfuit en Sibrie
o il disparut.
Ce fut la fin de la nationalit dzoungare. La Dzoungarie au sens large du
mot, cest --dire larrondissement de Kobdo, le Tarbagata et la province de
Kouldja sur lIli, fut direct ement annexe lempire chinois. Le peuple
dzoungar fut extermin en bloc (600.000 hommes gorgs). Kien -long
repeupla le pays avec des immigrants de partout, notamment des Tarantchis
ou musulmans de la Kachgarie et des Dounganes ou musulmans du Kan-sou.
En 1771 il tablit au sud et lest de Kouldja les Torghout, Mongols
occidentaux frres des Dzoungar et qui revenaient au pays natal aprs une
longue nomadisation du ct dAstrakhan, en Russie.
Nous avons vu que vers 1680 les Dzoungar avaient impos leur
suzerainet la Kachgarie en y installant comme vassale la thocratie
musulmane des Khodja. La Dzoungarie une fois soumise, le marchal
mandchou Tchao Houei envahit la Kachgarie (1758) et, aprs deux siges
opinitres, sempara de Kachgar et de Yarkan d (1759). La Kachgarie fut
purement et simplement annexe sous le nom de Nouvelle Marche, :
Sin-kiang.
La conqute de la Kachgarie par les gnraux de Kien -long marquait la
ralisation du programme dix-huit fois sculaire suivi par toutes les grandes
dynasties chinoises depuis les Han jusquaux Tang.
Au Tibet galement Kien -long acheva luvre de son aeul. En dpit de
ltablissement de deux hauts -commissaires impriaux Lhassa, auprs du
dala-lama, il y avait toujours eu dans la ville sainte un parti dzoungar et antichinois. En 1750 ce parti fomenta une meute qui massacra les deux
commissaires avec tous les rsidants chinois. Kien -long envoya Lhassa une
arme qui neut aucune peine rtablir lordre (1751). Il en profita pour ratta cher plus troitement le Tibet lempire. Les deux hauts -commissaires
chinois (amba) reurent tout le pouvoir politique et eurent dsormais voix
prpondrante dans la dsignation du tout nouveau dala-lama. Lglise
lamaque entra ainsi dans les cadres de ladmi nistration chinoise. Kien -long
ddommagea du reste le dala-lama de la perte de son indpendance en
augmentant ses honneurs et dignits : il le confirma solennellement dans le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
205
titre de roi temporel du Tibet. Mais par surcrot de prcautions, il eut soin
daccrotre dautant les attributions de lautre pontife tibtain, celui du
monastre de Tachilounpo quil fit roi de Chigats. En 1779 ce prlat rendit
visite Kien -long qui le reut en grande pompe Jehol et Pkin. Jusquen
1912 le Tibet restera troitement rattach lempire mandchou.
Le rle de protecteur de lglise tibtaine assum par Kien -long lamena
intervenir au Npal. Les Gourkha du Npal avaient en 1791 fait une
incursion de pillage au Tibet. Kien -long envoya aussitt un corps
expditionnaire qui traversa les hauts plateaux, franchit lHimalaya, descendit
au Npal, crasa les Gourkha et les obligea se reconnatre tributaires de la
Chine (septembre 1792).
Dans le sud de la Chine les montagnes encore boises et les causses du
Kouei-tcheou avaient servi de refuge aux Miao-tseu, aborignes qui
avaient jusque-l maintenu leur autonomie, les colons chinois se contentant de
dfricher les valles. En 1775 Kien -long entreprit de soumettre ces
nergiques montagnards. On fora lune aprs lautre leurs retraites fortifies
au milieu des rochers et des prcipices. La population fut dcime. Ses chefs,
conduits Pkin, prirent dans les supplices et leurs ttes coupes furent
exposes dans des cages.
La soumission des Miao-tseu marque une date. Avec elle sache vait la
conqute de la Chine par les Chinois, uvre immense, entreprise par les
dynasties lgendaires lpoque dOur et de Babylone, et qui se terminait la
veille de la Rvolution franaise. En mme temps la soumission de la
Mongolie, de la Dzoungarie, de la Kachgarie et du Tibet par Kang -hi et
Kien -long ralisait le programme de lexpansion chinoise en haute Asie,
programme suivi, nous lavons vu, depuis lre chrtienne. A la fin du rgne
de Kien -long, en 1796, lempire chin ois englobait de nouveau, comme
lapoge des Han et des Tang, lespce de continent clos compris entre la
Sibrie, lAlta, le Tien -chan, le Pamir et lHimalaya.
La dynastie mandchoue fit galement beaucoup pour le peuple chinois au
point de vue conomique et social, dans la question agraire. Sous les Ming
stait dvelopp dans des proportions dange reuses un type de proprit
privilgie ou de bnfice exempt dimpts et de corves. Les latifundia ainsi
crs au profit de princes, de courtisans ou de fonctionnaires taient cultivs
par des fermiers et ouvriers agricoles que le Code des Ming livre sans dfense
au propritaire : Le Code des Ming, note Henri Maspero, donne au matre le
droit de chtier ses esclaves et ses serviteurs gages coupables de
dsobissance et ninquite pas le matre, mme si le chtiment a caus la
mort. En mme temps stait constitue au profit de la maison impriale une
masse norme de terres naturellement exemptes, elles aussi, dimpts dtat et
dont les protestations des mandarins honntes ne parvinrent pas arrter
lextension. La population agricole charge dexploiter ces terres tait la
merci de toutes les exactions des pouvoirs publics. La dynastie mandchoue,
par une dcision dont il faut lui tenir compte, rendit ltat, en les faisant
rentrer dans le rgime commun, une partie des terres de la maison impriale.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
206
Quant aux proprits privilgies des familles riches, elles furent confisques
et en partie distribues par parcelles aux paysans qui en devinrent propritaires.
La dynastie mandchoue ne sen tint pas l. Selon la constatation de Henri
Maspero, elle encouragea constamment le dveloppement de la petite
proprit et exera une surveillance svre pour empcher le retour au rgime
des latifundia. Les propritaires perdirent le droit de coercition qui avait
facilit lexploitation des grands domaines par la main -duvre servile ou
salarie. On appliqua strictement la lgislation qui punissait de cent coups de
bton et de trois ans de dportation le matre qui avait fait prir sous les
mauvais traitements un de ses esclaves ou un de ses ouvriers. Mieux encore :
les fermiers dont la famille cultivait la mme terre depuis des gnrations
finirent par tre considrs comme possdant un droit lgal sur la surface du
sol, le propritaire conservant son droit sur le fond. Le fermier put ainsi
acheter et vendre des surfaces .
Le rsultat de ces mesures et de lesprit dans lequel elles taient
appliques fut le morcellement gnral de la proprit en Chine. A lheure
actuelle, dit H. Maspero, les proprits de moins de trois hectares dtiennent
plus de la moiti du sol et forment 83 % des cotes foncires. La moiti de la
population paysanne vit du produit de ses proprits. Un quart doit joindre
ce quil poss de laffermage de terres complmentaires. Le dernier quart,
dnu de terres, gagne sa vie comme ouvriers agricoles salaris. Dans
lensemble, amlioration considrable dans le sort de la classe rurale par
rapport au rgime ming. Do accroissement massi f de la population. Si nous
nous fions aux statisticiens chinois, celle-ci serait passe de 60.692.000
habitants en 1578 (fin des Ming) 104.700.000 en 1661, puis 182.076.000
en 1766 et enfin 329.560.000 en 1872.
En politique religieuse lempereur Ki en-long continua comme son pre
employer personnellement les missionnaires catholiques signals par leurs
talents. Ce fut ainsi que le frre Castiglione, de son nom chinois Lang
Che-ning, arriv Pkin en 1715 et qui devait y rester jusqu sa mort en
1764, fut un des peintres prfrs du souverain chinois. A la demande de ce
dernier, Castiglione fit le portrait de dames de la cour. Il peignit aussi lem pereur recevant en tribut un lot de chevaux kirghiz, rouleau actuellement au
muse Guimet. Ce fut galement Castiglione que lempereur chargea avec
deux autres jsuites (Attirer et Sickelpart) et avec laugustin Jean Damascne
de dessiner vers 1760-1765 les scnes de la conqute de la Dzoungarie. Ces
dessins furent ensuite envoys en France pour y tre gravs sous la direction
de Bertin, secrtaire de lAcadmie des Beaux -Arts (1765-1774). Un bon
tirage en existe au muse Guimet.
Mais ces sympathies personnelles pour tel peintre ou tel mathmaticien de
la Compagnie de Jsus navaient pas empch Kien -long dinterdire
nouveau ses sujets dembrasser le christia nisme (dit du 24 avril 1736).
Toutefois les jsuites ne se trompaient pas sur ses sentiments rels. Avec
beaucoup dobjectivit le Pre de Ventavon crivait en 1769 : Cest un
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
207
grand prince. Il voit tout fait tout par lui-mme. Plus il avance en ge, plus il
devient favorable aux Europens. Lui et les grands conviennent que notre
religion est bonne. Sils sopposent ce quon la prche publiquement et sils
ne souffrent pas les missionnaires dans les terres, ce nest que par des raisons
de politique et dans la crainte que sous le prtexte de la religion nous ne
cachions quelque autre dessein. Ils savent en gros les conqutes que les
Europens ont faites dans les Indes. Ils craignent pour la Chine quelque chose
de pareil. Du reste, lEurope elle -mme semblait prendre cur darrter les
progrs des missions catholiques. En 1764 le gouvernement de Louis XV
avait chass de France les Pres jsuites. Sous une pression inoue des cours
de Versailles et de Madrid le Saint-Sige, son corps dfendant, finit par
cder temporairement. La Socit de Jsus dut disparatre dEurope et de
Chine (1773). Les beaux esprits qui Paris applaudirent cette mesure ne se
doutrent point quen tout cas l a France, en reniant les meilleurs de ses
pionniers spirituels, tait en train de subir un recul presque gal la perte des
quelques arpents de neige du Canada.
Lpoque de Kang -hi, de Yong-tcheng et de Kien -long marqua une
renaissance artistique, notamment dans le domaine de lar chitecture et de la
cramique.
Nous avons vu que lempereur ming Yong -lo avait entre 1409 et 1424 cr
dans ses grandes lignes, au centre du Pkin moderne, lensemble connu sous
le nom de Cit rouge (ou mieux : violet pourpre) interdite . Cet ensemble
incomparable avait t incendi lors de la chute des Ming en 1644. Les trois
grands empereurs mandchous le restaurrent et le compltrent. Ils entrrent si
bien dans la pense des architectes ming quils peuvent bon droit passer
pour les seconds fondateurs de la Cit Interdite. Du reste, ce nest qu travers
leurs restaurations que nous pouvons juger luvre de Yong -lo.
On la souvent fait remarquer : les constructions de la Cit Interdite
nobissent pas seulement des rgles esthtiques, mais aussi des
considrations astronomiques et gomantiques o se rsume toute lancienne
religion chinoise. Cet ensemble de portiques, descaliers, de terrasses, de
palais et de salles du trne orients face au sud, mais suivant un axe de
progression sud-nord, est dispos en harmonie avec lordre cosmique , en
harmonie aussi avec lordre humain puisque tout y converge vers le trne
imprial, centre du monde. Aprs la Porte mridionale (Wou-men) o
lempereur venait recevoir ses a rmes victorieuses, aprs la Rivire dor
serpentant entre ses ponts de marbre, aprs la Porte de la suprme concorde
(Tai -ho-men), souvre la cour dhonneur entoure de terrasses de marbre
supportant chacune quelque palais. Le principal, au milieu, avec son toit dor,
la Salle du trne de la suprme concorde (Tai -ho-tien), destine certaines
assembles solennelles comme celles du nouvel an, tait vraiment le centre
de la vie crmonielle de lempire , le centre de la religion impriale.
Derrire et dans le mme groupe, le Tchong-ho-tien et le Pao-ho-tien, salles
du trne non moins augustes, la premire o avant le labourage du printemps
lempereur examinait les instruments aratoires, la seconde o il recevait les
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
208
princes vassaux. Plus loin encore, mais toujours dans le mme axe, le Palais
de la puret cleste (Kien -tsing -kong), salle des audiences impriales o il
dcidait des affaires de ltat. En sor tant de lenceinte des palais de la Cit
Interdite, mais encore dans le mme axe sud-nord, la Montagne de charbon
(Mei-chan) dressant ses cinq tertres surmonts dautant de pavillons.
En bordure et gauche de la Cit Interdite, les trois lacs, nappe deau
longitudinale divise en trois par des tranglements ; le Pont de marbre jet
entre le lac du nord et le lac du milieu donne, gauche, sur le Pai-ta, colline
artificielle surmonte dun dagoba blanc lev par lempereur Chouen -tche.
De l, avant de retrouver la Montagne de charbon, on arrive au Ta-kao-tien,
temple recouvert de tuiles jaunes vernisses, lev par lempereur ming Kia tsing (1522-1566), embelli sous Yong-tcheng et Kien -long et o les
empereurs allaient prier pour obtenir la pluie en temps de scheresse.
Dans le quartier sud de Pkin, tout prs de la muraille extrieure, dans un
vaste parc plant dacacias, de pins et de cyprs, lempereur ming Yong -lo
avait construit en 1420 lautel du Ciel ( Tien -tan ), qui fut restaur par
Kien -long et qui en ralit ne renferme pas moins de cinq autels ou palais.
Ctait l quen trois occasi ons solennelles lempereur se rendait en tant que
grand pontife de la religion trente fois centenaire : au solstice dhiver il venait
rendre compte au Ciel de sa mission sur la Colline ronde (Yuan-kieou ), autel
circulaire fait dune triple plate -forme ronde et pyramidale en marbre ; la
premire lune il revenait se faire investir par le Ciel de la mission de
gouverner pendant lanne ; vers la fin du printemps, il venait solliciter du
Ciel la pluie fcondante et une bonne rcolte. Puis, aprs deux portiques de
marbre blanc, le Temple du Ciel proprement dit (Houang-kiong-yu), de forme
ronde, avec une toiture circulaire soutenue par huit colonnes. A gauche du
Temple du Ciel, le Temple de lAgricul ture (Sien-nong-tan ), construit par les
Ming, restaur par lem pereur Kien -long.
Kang -hi, Yong-tcheng et Kien -long ne se contentrent pas de restaurer et
de complter les difices levs par les Ming. Ils construisirent dans la grande
banlieue nord-ouest de Pkin une sorte de Versailles chinois , le Palais
dEt, compos en ralit de deux groupes : le Jardin du printemps
prolong (Tchang -tchouen -yuan) quhabita Kang -hi, et le Jardin de la
clart ronde (Yuan-ming-yuan) quhabita Yong -tcheng. Kien -long runit les
diffrents palais et y fit travailler deux missionnaires, recherchs pour leur
talent de peintres, Castiglione et Attiret. Nous devons au Pre Attiret une
agrable description de cet ensemble : On a, crit-il le 1er septembre 1743,
lev des mamelons de 20 60 pieds, ce qui forme une infinit de petits
vallons. Des canaux dune eau claire, provenant des hautes montagnes qui
dominent la rgion, arrosent le fond de ces vallons et, aprs stre diviss,
vont se joindre en plusieurs endroits pour former des bassins, des tangs et des
mers . Les montagnes, les collines, leurs pentes sont couvertes darbres
fleurs si communs en Chine. Les canaux nont aucun alignement. Les pierres
rustiques qui les bordent sont poses avec tant dart quon dirait que cest
luvre de la nature. Tantt le canal slargit, tantt il est resserr, ici il
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
209
serpente. Les bords sont sems de fleurs qui sortent des rocailles et chaque
saison a les siennes.
Cette description du clbre jsuite est une des meilleures tudes que nous
ayons sur lart des jardins, tel quil tait pratiqu en Chine au milieu du XVIII e
sicle, art qui suit visiblement le canon de la peinture ming et mandchoue.
Arriv dans le vallon, poursuit Attiret, on aperoit les btiments. Toute la
faade est en colonnes et en fentres ; la charpente dore, peinte et vernisse ;
les murailles de briques grises, bien tailles, bien polies. Les toits sont
couverts de tuiles vernisses, rouges, jaunes, bleues, violettes, qui, par leur
mlange et leur arrangement, font une agrable varit de compartiments et de
dessins. Chaque vallon a sa maison de plaisance, petite eu gard ltendue
de tout lenclos, mais assez considrable pour loger le plus grand de nos
seigneurs avec sa suite. Plusieurs de ces maisons sont bties en bois de cdre
quon am ne de 500 lieues et dans cette vaste enceinte on compte plus de
deux cents de ces palais, sans parler des pavillons pour les eunuques.
Les canaux sont coups par des ponts de formes trs varies. Les
balustrades de quelques-uns de ces ponts sont en marbre blanc, travailles
avec art et sculptes en bas-reliefs. Au milieu du grand lac slve sur un
rocher un petit palais au point central que lar chitecte a choisi pour que lil
dcouvre toutes les beauts de ce parc. On parcourt les plus grandes pices
deau sur de magni fiques bateaux.
On voit la forme que revt le sens de lart aux poques Kang -hi,
Yong-tcheng et Kien -long. Si la peinture et la sculpture sont en dcadence,
larchitecture et surtout lart de larchitecte urbaniste et de larchitecte
paysagiste se sont surpasss. Enfin la cramique chinoise nous donne ses
derniers chefs-duvre.
Pendant lpoque Kang -hi (1662-1722), la manufacture impriale de
King-t-tchen, au Kiang-si, fut reconstruite (1680) et lart de la porcelaine
atteignit son apoge avec des monochromes clatants comme le sang de
buf , la peau de pche , le bleu saphir , surtout avec les pices dcor
peint comme celles de la famille verte o le vert forme la base dune
agrable polychromie, comme les bleus poudrs dune grande douceur,
comme la famille noire , si recherche. A lpoque Yong -tcheng
(1723-1735) les pices dcor peint sont reprsentes par la famille rose
dune remarquable dlicatesse. Enfin lpoque Kien -long (1736-1796)
ajoutera la famille rose le beau dcor dit aux mille fleurs . Mais aussitt
aprs viendra la dcadence : les cramistes chinois travailleront pour
lexportation, en vue de la commande europenne qui veut de la
chinoiserie et qui sera servie en consquence.
La dcomposition de la vieille Chine est commence. Elle se poursuivra
pendant tout le XIXe sicle.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
210
CHAPITRE 31
Lirruption de lOccident
Cest le rythme mme de lhistoire chinoise que les lignes impriales,
aprs deux ou trois gnrations dhommes de valeur, tombent dans
labtardissement. Le vieil empire que les fondateurs de dynasties avaient
priodiquement refait, se dissocie nouveau. La famille mandchoue monte
sur le trne en 1644 et qui devait le conserver jusquen 1912, nchappa point
cette loi. A partir de son cinquime souverain, Kia-king (1796 -1820), la
dgnrescence tait vidente et ne devait faire que saccentuer. Le mal heur
voulut que cette priode dpuisement dynastique corres pondt lpoque o
le reste du monde, sous linfl uence de lesprit scientifique et du machinisme,
se renouvelait. Les consquences furent rapides. Vers 1650-1700 la Chine
stait encore maintenue peu prs au niveau de lEurope comme lavaient
prouv lex pulsion des Hollandais de Formose et le recul des Russes
Albazin. Vers 1820-1850, elle se trouva tout coup en retard de plusieurs
sicles.
Il navait pas tenu aux premiers empereurs mandchous, notam ment
Kang -hi, quil en ft autrement. Avec quel intrt ils staient fait initier par
les jsuites aux progrs des sciences europennes, sciences pures et sciences
appliques, astronomie et artillerie ! Lempereur Kia -king abandonna ces
traditions. En 1805 il promulgua un dit gnral de perscution contre les
chrtiens. Inintelligent, cruel et ivrogne, indolent, livr aux eunuques, adonn
la pdrastie, il ne tarda pas susciter contre lui lopposition des socits
secrtes, en lespce de la secte de la Raison Cleste, issue de lancienne secte
du Lotus Blanc. Dans le secret des loges les affilis prparaient le
renversement de la dynastie mandchoue. Le 13 juillet 1813 ils assaillirent
Pkin le palais imprial et faillirent capturer ou assassiner lempereur qui ne
fut sauv que par son fils, le futur Tao-kouang.
Lempereur Tao -kouang (1821-1850) ne put arrter la dcadence gnrale.
Les Puissances occidentales sefforaient dobtenir la signature de traits de
commerce et louverture officielle dun certain nombre de ports. En ralit le
trafic tait depuis longtemps assez actif, notamment entre lInde britannique et
la rgion cantonaise. Malheureusement le principal article en tait limporta tion de lopium.
Il est humiliant pour la civilisation occidentale de stre mani feste
lExtrme -Orient sous cet aspect. En effet il sagit bien ici dun vice
dimportation. Lemploi de lopium est relativement rcent en Chine.
Jusquau XVIII e sicle il ntait utilis quau titre mdical. Ce furent les
Anglais qui, ayant cette poque pratiqu la culture du pavot aux Indes,
cherchrent des dbouchs pour la drogue. Ils commencrent lexporter vers
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
211
les ctes chinoises, en particulier vers la rgion cantonaise o lusage sen
rpandit avec la rapidit dune pidmie. Dans le premier quart du XIX e sicle
dinnombrables fumeries fonctionnaient dj. Dev ant les ravages causs, les
plus honntes des mandarins protestrent. Un placet prsent en 1838
lempereur Tao -kouang disait : Depuis que lempire existe, il na jamais
couru un tel danger. Ce poison dbilite notre peuple, dessche nos os ; ce ver
ronge notre cur, ruine nos familles. Que la contrebande de lopium soit
inscrite parmi les crimes punis de mort ! Le 28 mars 1839 les autorits de
Canton obligrent le reprsentant britannique Elliot livrer 20.291 caisses
dopium qui furent jetes la m er. Elliot demanda le versement dune
indemnit. Elle fut refuse et le vice-roi de Canton suspendit tout commerce
avec les Anglais. Ce fut la guerre.
Lescadre britannique commena les hostilits dans la rivire de Canton
(juin 1840). De l les oprations stendirent aux ports du Tch -kiang. Les
Anglais occuprent Ning-po et Chang-hai (9 mars et 18 juin 1842). Quand ils
eurent remont le Yang-tseu jusqu Nankin, le gouvernement de Pkin cda.
Le 29 aot 1842 il signa le trait de Nankin qui ouvrait au commerce les ports
de Canton, Amoy, Fou-tcheou, Ning-po et Chang-hai et cdait lAngleterre
llot de Hong -kong qui commande lentre de la rivire de Canton. Les traits
signs Whampoa par les plnipotentiaires amricains (3 juillet 1844) et
franais (24 octobre 1844) accrurent encore les possibilits du commerce
tranger. Le plnipotentiaire franais, M. de Lagren, obtint peu aprs la
promulgation dun dit de tolrance en faveur du christianisme (20 fvrier
1846).
En ralit le gouvernement imprial cherchait gagner du temps. A la
diffrence des grands empereurs du temps pass, il ne mesurait nullement
limportance de la civilisation occidentale. Un des plnipotentiaires chinois
qui avaient sign les traits, Ki Ying, crivait la cour : Les barbares
anglais ayant t amadous, les barbares franais et amricains sont aussi
venus cette anne. Je les ai galement traits de manire les mettre en belle
humeur. Ns et levs dans des pays trangers, ces barbares sont incapables de
comprendre les choses de lEmpire du Milieu. Je leur ai fait lhonneur de leur
donner des repas et jai t ensuite invit par eux dans leur rsidence. Tous se
sont disputs qui moffrirait manger et boire. Ces barbares ont une
grande affection pour leurs femmes. Cest au point que le barbare amricain
Parker et le barbare franais Lagren ont amen les leurs. Quand jallai chez
eux pour traiter daffaires, soudain ces femmes parurent pour me saluer. Je fus
trs mal laise, tandis quelles taient charmes. On v oit par l quil est
impossible dexiger quoi que ce soit de ces barbares en fait de crmonial et
quil est inutile dclairer leur stupidit.
A lempereur Tao -kouang, dcd le 25 fvrier 1850, succda son fils
Hien-fong, un incapable (1851-1861). Non seulement, en dpit des traits, le
commerce fut sournoisement entrav, mais des missionnaires furent
martyriss. Napolon III et le gouvernement britannique envoyrent dans le
golfe du Petchili en 1858 un corps expditionnaire qui le 30 mai occupa
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
212
Tien -tsin. Le gouvernement chinois sinclina, signa tout ce quon voulut
(traits de Tien -tsin des 26-27 juin 1858) et les Allis se retirrent, satisfaits,
pendant quun dit imprial donnait linterprtation offi cielle de leur retraite :
Les barbares ayant os venir sur leurs vaisseaux jusqu Tien -tsin, nos
plnipotentiaires leur ont fait une rprimande affectueusement svre qui les a
dcids sen aller. De fait, quand les Allis saperurent quils taient
jous et voulurent roccuper Tien -tsin, leur attaque choua devant les forts de
Ta-kou (26 juin 1859) et leur escadre dut se retirer. Il fallut prparer une
expdition plus importante. Le 1er aot 1860 dbarqua dans le golfe du Petchili
un corps franco-anglais de 16.000 hommes qui dans les journes du 21 et du
22 prit das saut les forts de Ta-kou et le 24 occupa Tien -tsin. La cavalerie
mandchoue essaya darrter les Allis prs du pont de Pa -Li-kiao, sur le
Canal Imprial, lest de Pkin. Elle y fut crase malgr sa relle bravoure,
le 21 septembre 1860, par lartillerie franco -anglaise, victoire qui devait valoir
au gnral franais Cousin-Montauban le titre de comte de Palikao . Le 13
octobre les Allis firent leur entre dans Pkin. En reprsailles des cruauts
infliges ceux de leurs parlementaires qui taient tombs entre les mains des
Chinois et que ceux-ci avaient torturs, lord Elgin fit le 18 octobre incendier le
Palais dEt o les scnes de torture avaient eu lieu.
Lempereur Hien -fong qui stait retir Kalgan chargea so n oncle le
prince Kong (sixime fils de lempereur Tao -kouang) de ngocier avec les
Allis. Kong tait le personnage le plus intelligent de la famille impriale et il
allait si bien russir dans sa mission que nous le verrons jusqu sa mort en
1898 charg de toutes les affaires un peu dlicates avec les Europens. Il signa
avec lord Elgin pour lAngleterre et avec le baron Gros pour la France, les 24
et 25 octobre 1860, un trait qui accordait aux deux Puissances et leurs
ressortissants toutes les indemnits exiges. De plus, le territoire britannique
de Hong-kong fut agrandi. La Russie avait profit de ces vnements pour se
faire cder par la Chine en juin-juillet 1858 tous les territoires tongous sur la
rive septentrionale du fleuve Amour (province de lAmour) et le 14 novembre
1860 les territoires entre lOussouri, la mer du Japon et la Core qui forment
depuis la Province Maritime russe (Khabarovsk et Vladivostok).
Dautre part les traits de 1858 avaient rorganis le systme des douanes
maritimes chinoises sous la direction dun Europen. De 1863 1908 le poste
de directeur des douanes fut occup par lAnglais Robert Hart qui russit
maintenir le fonctionnement de ce service au milieu des pires vnements
intrieurs ou internationaux.
La dynastie mandchoue navait accept que contrainte et force de
collaborer avec les Europens. Ce furent cependant ces mmes Europens qui
la sauvrent dune rvolte indigne sous laquelle elle et immanquablement
succomb.
Depuis le commencement du XIXe sicle une agitation persistante se
propageait dans la population chinoise pour chasser les Mandchous. Cette
agitation avait pour foyer les socits secrtes base dsotrisme et de
magie. Ce fut dans ces mmes milieux quapparut la secte des Tai -ping, ou
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
213
de la Grande Puret. Thaumaturges et annonciateurs dun nouveau millenium,
les chefs Tai -ping admettaient hommes et femmes, frres et surs
comme ils se dnommaient, sans distinction de classe sociale. Comme tous les
illumins analogues que nous avons rencontrs au cours des sicles, des
Sourcils Rouges aux Turbans Jaunes, ils enrlaient les jacques affams, les
bandits et les pirates sans emploi. Le prophte de la secte, Hong Sieou-tsiuan
(1812-1864), un Cantonais de race Hakka, avait frquent les missionnaires
protestants, lu la Bible et lEvangile. Il se dclarait le fils cadet de Dieu et le
frre du Christ et prenait le titre de Roi Cleste.
La rvolte des Tai -ping avait clat dans le Sud, au Kouan g-si, ds 1850.
Le 19 mars 1853 ils prirent Nankin o le Roi Cleste tablit sa capitale. De l
ils marchrent sur Pkin et le 30 octobre 1853 atteignirent Tien -tsin. Cest
ainsi quen 1368 avaient pro cd les Ming pour chasser les Mongols.
Laventure du premier Ming semblait la veille de se renouveler : le Roi
Cleste allait chasser les Mandchous dcrpits et fonder une nouvelle dynastie
impriale. Malheureusement pour eux, les Tai -ping, faute de cavalerie, ne
purent profiter de leur avantage pour foncer de Tien -tsin sur Pkin o le
gouvernement mandchou eut le temps de concentrer des troupes. Leur coup
manqu, les Tai -ping se retirrent sur la rive mridionale du Yang -tseu.
Tout allait dpendre de lattitude des rsidants occidentaux. Lintrt de
ceux-ci fut un moment veill par ce quil y avait dans les doctrines Tai -ping
demprunts, au moins verbaux, au christianisme. Mais les actes de pillage
commis par les Tai -ping au dtriment du commerce europen ou amricain
amenrent les Occidentaux se dcider autrement. Comme les Tai -ping se
prparaient attaquer le port de commerce de Chang-hai, principal entrept
du trafic international, les rsidants occidentaux constiturent pour dfendre
leurs intrts une petite arme sous les ordres des aventuriers amricains Ward
et Burgevine, larme toujours victorieuse qui collabora avec les autorits
mandchoues contre les rebelles.
Sur ces entrefaites mourut Jehol le 22 aot 1861 lempereur Hien -fong,
g de trente ans seulement, mais pourri de dbauches, dj dcrpit et
perclus . Il laissait le trne son fils unique, qui navait que quatre ou cinq
ans et qui devait tre connu par le nom des annes de rgne Tong -tche
(1862-1875). La mre de lenfant tait une concubine mandchoue, la fa meuse
Tseu -hi, alors ge de vingt-sept ans. Le grand-oncle du nouvel empereur, le
prince Kong dont nous avons vu le rle dans les ngociations avec les
Europens, sempara de la rgence. Il avait secrtement li partie avec la jeune
femme qui, sil avait des qualits de diplomate, possdait, elle, une
indomptable nergie. De fait, ctait Tseu -hi qui de 1862 1908 allait soit au
grand jour, soit par personnes interposes, contrler ou diriger continment la
politique chinoise.
Pour le moment et malgr sa xnophobie de Mandchoue ractionnaire, elle
ne pouvait que se rallier la politique du prince Kong qui, pour en finir avec
les Tai -ping, sollicitait le concours des aventuriers anglo -amricains de
l Arme toujours victorieuse . Le chef des Tai -ping, le Roi Cleste, qui
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
214
tait devenu moiti fou, faisait maintenant tirer sur les navires trangers,
achevant ainsi de sceller contre lui laccord des Europens et des Mandchous.
En mme temps venait de se rvler un jeune fonctionnaire chinois qui devait
depuis jouer un rle considrable dans les affaires : Li Hong-tchang
(1822-1901) faisait ses dbuts dans la carrire politique. Intelligent et
nergique, il avait compris limportance du facteur europen. En liaison avec
lArme toujours victorieuse, il leva lui-mme une troupe pour la reconqute
du bas Yang-tseu sur les rebelles. LAnglais Gordon, le nouveau chef de
lArme toujours victorieuse, et Li Hong -tchang enlevrent une une les
places des rebelles. Le Roi Cleste se suicida en avalant de l or et le 19 juillet
1864 Nankin fut repris par les Impriaux. Cent mille hommes furent passs au
fil de lpe. Le cadavre du Roi Cleste fut exhum, coup en morceaux et
brl. Depuis quinze ans que durait la rvolte, six cents villes avaient t
dtruites. Dans la seule province dont Nankin est le chef-lieu on estime vingt
millions le nombre des victimes humaines. La province de Kiang-si fut
dpeuple au point davoir d tre colonise depuis par des immigrants du
Hou-pei. Ce mouvement qui aurait pu rnover la Chine navait servi qu la
ruiner.
Europens et Amricains avaient sauv la dynastie mandchoue qui sans
eux et t certainement renverse par les rebelles. Sils croyaient quelle leur
en saurait gr, ils ne tardrent pas tre dtromps. Le mouvement xnophobe
et anti-chrtien ne fut pas long reparatre, et le 21 juin 1870 Tien -tsin
vingt Franais, dont le consul Fontanier, dix surs de charit et deux
missionnaires furent avec la complicit tacite des autorits massacrs et
odieusement mutils par la populace. La xnophobie de limpratrice Tseu -hi
paralysait les vellits conciliatrices du prince Kong, personnalit sans grande
nergie quelle dominait de plus en plus par son autorit de femme -chef, la
vieille manire tartare, et sa sre connaissance de la psychologie chinoise.
Le jeune empereur Tong -tche mourut le 12 janvier 1875 lge de
dix-neuf ans. Sa mre, Tseu -hi, disposa du trne : ce fut un cousin germain
de Tong -tche, g de quatre ans, quelle fit proclamer empereur sous le nom
des annes de rgne Kouang-siu (1875-1908). Bien entendu, Tseu -hi
conserva la rgence, toujours assiste par le prince Kong. Toute lhabilet de
ce dernier nallait pas tre de trop devant les difficults extrieures qui
sannonaient.
Le Turkestan chinois ou Kachgarie, pays de langue turque et de religion
musulmane, stait rvolt contre la domination chinoise et, de 1865 1877,
constitua un tat indpendant sous la direction dun chef nergique,
Yaqob -beg. La Russie avait profit des circonstances pour occuper la valle
suprieure de lIli ou rgion de Kouldja. Ce ne fut quaprs la mort de
Yaqob (29 mai 1877) que les Chinois purent rannexer la Kachgarie (hiver
1877-1878). Quant Kouldja, les Russes, aprs avoir t la veille de la
guerre, consentirent en 1881 la rtrocder la Chine.
Au Yun-nan, province rattache seulement lempire par la dynastie
mongole, au XIIIe sicle, lIslam avait fait depuis cette poque de grands
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
215
progrs. En 1856 les musulmans de Yun-nan se rvoltrent. En 1860 ils
taient matres de toute la rgion de Ta-li. Linsurrection ne put tre dompte
quen 1873 au prix dune rpression effroyable. La ville de Mong -tseu tomba
de 80.000 12.000 habitants, Ta-li 6.000. Actuellement le Yun-nan
dpeupl ne compterait plus que huit millions dmes. Au Kan -sou, autre
province comportant une forte minorit musulmane, une rvolte analogue tint
lautorit en haleine de 1862 1877. Cette rvolte et la rpression qui suivit
auraient fait, tant au Kan-sou quau Chen -si, dix millions de victimes. (Une
dernire insurrection musulmane au Kan-sou, en 1928, aurait cot la vie
200.000 personnes (92).)
A peine la Chine en avait-elle fini avec les insurrections musulmanes
quelle se trouva entran e dans une guerre contre la France. Tandis que la
France tablissait son protectorat au Tonkin, des irrguliers chinois, les
Pavillons Noirs, pour la plupart dbris des anciennes bandes Tai -ping,
taient intervenus dans le haut pays contre les colonnes franaises. Le 23 aot
1884 lamiral Courbet bombarda larsenal chinois de Fou -tcheou. Sur terre la
mprise de Lang-son (28 mars 1885) nempcha pas la signa ture du trait
franco-chinois du 9 juin 1885, ngoci du ct chinois par Li Hong-tchang et
qui laissait la France les mains libres en Indochine.
Plus srieuse pour la Chine allait tre sa querelle avec le Japon dans les
affaires de Core.
Tandis que les derniers Mandchous laissaient la Chine dans une bien
dangereuse stagnation au milieu des progrs matriels du monde moderne, le
Japon stait avec ardeur associ ces progrs. Un souverain remarquable,
lempereur Mutsuhito, depuis connu sous le nom de Meiji -tenn (1866-19l2),
avait rsolument modernis son pays et emprunt lEurope et lAmri que
leurs techniques et leur outillage. Le Japon stait surtout donn une arme
excellente, dote des derniers perfectionnements.
Il allait en faire lessai contre la Chine.
Depuis longtemps la Chine et le Japon taient en lutte din fluence propos
de la Core. Le royaume pninsulaire restait thoriquement vassal de la Chine,
mais les Japonais navaient jamais oubli qu la fin du XVI e sicle,
lpoque de leur grand Hideyoshi, ils avaient failli sen rendre matres. En
1894 une rvolte ayant clat en Core, la cour de Soul fit simultanment
appel laide de la Chine et du Japon. Une fois leur corps de dbarquement
arriv Soul, les Japonais dposrent le souverain coren (23 juillet 1894) et
forcrent son remplaant dclarer, de concert avec eux, la guerre la Chine
(27 juillet).
Marchant de Soul vers le nord-est, les Japonais crasrent une arme
chinoise Pyng -yang dans les journes des 15-16 septembre 1894. Le 24
octobre ils franchirent le Yalou, fleuve qui spare la Core de la Mandchourie.
Le 21 novembre ils semparrent de limportante forteresse de Port -Arthur qui
commande la presqule terminale du sud mandchourien. Le 12 fvrier 1895
un autre corps de dbarquement fit capituler Wei-hai-wei qui, la pointe de
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
216
l Armorique du Chan-tong, ferme au sud le golfe du Petchili comme
Port-Arthur le ferme au nord. En Mandchourie Leao-yang tomba le 4 mars
1895. Enfin un corps expditionnaire dbarqua Formose.
Par Leao-yang, la route de Chan-hai-kouan, cest --dire de Pkin, tait
ouverte au vainqueur. Devant la supriorit de lartillerie japonaise la
continuation de la lutte savrait inutile (certains gnraux chinois staient
battus avec beaucoup dhrosme). Li Hong -tchang, envoy au Japon par le
prince Kong, se rsigna signer le 17 avril 1895 le trait de Shimonoseki. La
Chine cdait au Japon la presqule du Leao -tong (Port-Arthur) et lle de
Formose. Mais la Russie qui avait des vises sur la Mandchourie ne pouvait
laisser le Japon sy installer. Le gouvernement de Saint -Ptersbourg entrana
ladhsion du gouvernement franais et du gouvernement allemand. Une note
fut remise Tky par les trois Puissances pour demander aux japonais
dvacuer la presqule du Leao -tong. Le Japon dut sincliner. Le 8 novembre
1895 il rtrocda ce district la Chine, y compris Port-Arthur auquel il tenait
tant. De ses conqutes il ne garda que Formose.
Les Puissances avaient sauv la Chine, mais ctait pour sen rserver
lhritage. Les victoires japonaises avaient rvl lEu rope la dcrpitude,
encore insouponne, de ltat mandchou. Lhomme malade de Pkin
savrait moribond. Lempire mandchou tait un autre empire ottoman dans
lequel les Puissances allaient, sous le nom de sphres dinfluence , se
tailler de vritables zones de protectorat.
Les socits secrtes dillumins et de brigands tendances xnophobes
obligeaient dailleurs les Europens dfendre leurs nationaux. Le 1 er
novembre 1897 les affilis de lassociation du Grand Couteau assaillirent la
mission allemande de Kia-tchouang et assassinrent deux religieux.
LAllemagne fut amene prendre des garanties. Le 14 novembre le
contre-amiral von Diederichs prit possession, au nom du Reich, de la baie de
Kiao-tcheou et de la place de Tsing-tao, au Chan-tong, un des meilleurs
mouillages et une des cls des mers de Chine. Le 27 mars 1898 la Russie se fit
cder bail par la cour de Pkin le grand port de la presqule du Leao -tong,
Port-Arthur, quelle avait quatre ans plus tt forc le Japon vacuer. Le 1 er
juillet 1898 lAngl eterre occupa au Chan-tong le port de Wei-hai-wei dont
nous avons vu limportance stratgique comme le Tanger du golfe de
Petchili . Mieux encore, elle obtenait de la Chine un droit de premption sur
le bassin du Yang-tseu, vritable hypothque qui lui rservait lexpectative de
cette riche rgion. Enfin la France acquit en location la baie de
Kouang-tcheou-wan, en face de Hai-nan. Elle obtint aussi par le trait du 10
avril 1898 le droit de construire un chemin de fer de Loa-kay, sur la frontire
sino-tonkinoise, Yun-nan-fou, chemin de fer qui devait tre achev en 1910.
Par ailleurs Chang-hai, ville cosmopolite, sino-trangre, surgie depuis 1842
sur lestuaire du Yang -tseu, la concession internationale (anglaise, amricaine,
japonaise, etc.) et la concession franaise avec leur vie propre, leur
municipalit et leur police autonomes, leur chiffre daffaires en accroissement
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
217
vertigineux, achevrent de prendre un essor digne des nouvelles cits nordamricaines.
Le prince Kong qui dirigeait la politique trangre de la Chine tait mort
sur ces entrefaites le 29-30 mai 1898, g de soixante-sept ans et us par
lopium. La disparition de ce grand seigneur intelligent, fin et courtois laissa
un grand vide la cour, et cela lheure la plus grave. La cure
europenne se faisait menaante. Et pour y faire face ne restaient en
prsence quune douai rire rtrograde et un jeune empereur sans exprience.
Lempereur Kouang -siu avait vingt-trois ans. Bien intentionn, il souffrait
vivement des malheurs de son pays, des dsastres de la guerre avec le Japon,
du dpcement de lempire par les Puis sances occidentales. Il ntait pas sans
comprendre que le salut de la Chine rsidait dans des rformes hardies pour
mettre le pays au niveau de lEurope, comme le Japon en avait donn
lexemple. Imiter le souverain japonais, tre le Mutsuhito de la Chine, tel
parat avoir t son rve. Or dans les ports ouverts, au contact des concessions
europennes, principalement Canton prs de la colonie anglaise de
Hong-kong, commenait se former ce quentrevoyait Kouang -siu, une Chine
nouvelle, convaincue de la ncessit dune transformation. Le chef du
mouvement, lhis torien Kang Yeou -wei, tait un de ces lettrs cantonais qui,
de surcrot, avait quelque temps rsid au Japon. Vivement frapp des progrs
accomplis par ce pays, il le proposait comme un modle ses concitoyens, en
mme temps que lexemple dune autre puissance assez rcemment
occidentalise : la Russie et son rformateur, Pierre le Grand. Inversement,
dans une histoire de la dcadence turque, il montrait le sort qui attendait les
peuples momifis dans leurs traditions. Ces ouvrages et dautres encore,
anims dun gnreux patriotisme, parvinrent jusqu lempereur Kouang -siu.
Se sentant en communion de pense avec leurs auteurs, il voulut les connatre,
se fit prsenter les chefs rformistes, Kang Yeou -wei et Leang Ki -tchao, et
partir du mois de juin 1898 entreprit la mise sur pied dun vaste programme
de rformes.
Un patriotisme gnreux animait le jeune souverain et ses amis.
Nous sommes menacs du sort de lInde, de lEgypte et de la Turquie,
crivait Kang Yeou -wei lempereur. Nous navons ni troupes, ni armes, ni
munitions. Chemins de fer, commerce, banques, douanes, rien nest nous,
rien ! Si nous paraissons encore exister, cest en ralit comme si nous
nexistions dj plus ! Aussi Kouang-siu mettait-il une hte fbrile
rattraper le temps perdu. En des dits retentissants il portait la hache dans le
vieil difice politique, dnonait les abus, sattaquait aux vices du man darinat,
la bureaucratie millnaire. Bien quhritier dune dynas tie mandchoue, il
carta comme incapables les dignitaires mandchous et ne sentoura que de
purs Chinois. La Chine fut invite se mettre lcole d e lEurope. On cra
un bureau des traductions en vue de rpandre chez les lettrs les
dcouvertes de la science occidentale. Un dit imprial fit appel au peuple :
La Chine et lEurope estiment toutes deux que le premier objet du
gouvernement est le bien du peuple. Mais lEurope est alle plus loin que nous
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
218
dans cette voie. Dailleurs les nations tran gres cernent notre empire. Si nous
ne consentons pas adopter leurs mthodes, notre ruine est irrmdiable... Les
lments ractionnaires traversent nos intentions, mais lempire peut se fier
son souverain ! Que le peuple collabore la rforme et au relvement du pays.
Nos lettrs ne connaissent pas les branches du savoir occidental destines
augmenter la prosprit matrielle du peuple et son bien-tre physique.
Il y avait dans ces proclamations rptes une hte fbrile o se
trahissaient lirritation cause par une opposition croissante, la conscience de
ne pouvoir briser cette opposition et la faiblesse relle, lisolement du jeune
souverain. Cest quen effet Kouang -siu se trouvait presque seul avec sa petite
poigne dintellectuels cantonais frachement revenus du Japon, personnages
sans exprience ni influence (93). La famille impriale et laristocratie mand choue dont il menaait les privilges devaient lui tre forcment hostiles.
Quant limpratrice douairire, quant sa tante Tseu -hi, elle gardait un
silence lourd de menaces. Elle avait maintenant soixante-trois ans. Elle avait
toujours gouvern. Elle ne pouvait qutre suffoque de laudace de cet enfant
quelle avait mis sur le trne quatre ans et qui aujourdhui se permettait de
vouloir tout changer. De plus, ne vivant que de la vie artificielle du palais,
dans un entourage deunuques, elle ignorait tout de lEurope et les innovations
de son imprial neveu ne pouvaient lui paratre quune folie des diables
trangers .
Tseu -hi avait dailleurs pris soin de faire nommer vice -roi du Tche-li un
homme elle, son neveu favori, le gnral mandchou Jong-lou. Le 15
septembre 1898, presse par la noblesse mandchoue, elle sortit de son
apparente rserve et somma lempereur de renvoyer ses conseillers
rformistes. Kouang-siu comprit que, sil ne prenait pas les devants, il tait
perdu. Prs de la capitale stationnaient les premiers bataillons chinois exercs
leuropenne. Leur chef tait le grand -juge du Tche-li, Yuan Che-kai.
Kouang-siu sadressa ce personnage, le mit dans ses confidences, le char gea
de faire excuter Jong-lou et darrter Tseu -hi. Yuan Che-kai supputa les
chances des deux partis, trouva celles du jeune empereur dcidment trop
faibles et, au lieu dexcuter Jong -lou, il lavisa de ce qui se prparait et par
Jong-lou fit prvenir lim pratrice.
La vengeance de Tseu -hi et du parti mandchou fut impitoyable. La
terrible impratrice fit occuper les portes du palais par larme de Jong -lou et
excuter tous les rformistes quelle put saisir. Kang Yeou -wei et Leang Ki tchao neurent que le temps de se rfugier la lgation dAngleter re do ils
gagnrent secrtement le Japon. Quant au malheureux empereur Kouang-siu,
Tseu -hi sempara de sa personne, le dclara faible desprit et le squestra
jusqu la fin de ses jours, invisible et sans communication avec le monde,
dans un kiosque du palais. Elle ne le dtrna pas expressment, mais se
contenta de rgner sous son nom. Lempire libral avait dur cent jours (10
juin-20 septembre 1898).
Redevenue matresse de lempire, Tseu -hi cassa tous les dcrets de
rforme. Le parti mandchou, Jong-lou en tte, fut appel au pouvoir. Mais la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
219
raction ne sarrta pas la politique intrieure. Elle aboutit une rupture
avec les Puissances.
Le mouvement rformiste stait plac sur le terrain du patrio tisme.
Limpratrice douairire, crivait encor e de son exil Kang Yeou -wei, a
vendu aux trangers des possessions qui sont lhri tage de nos anctres.
Pour viter ce reproche, les Mandchous se livrrent leur tour des
surenchres nationales. A la place du patriotisme clair des rformistes, ils
rpandirent dans les masses une xnophobie qui, dans ltat des relations
internationales, ne pouvait aboutir qu la catastrophe. Les instruments de
cette politique furent les Boxeurs .
La socit des Boxeurs (en chinois Yi-ho kiuan, le poing de la concorde
et de la justice ) tait une des nombreuses socits secrtes affilies la secte
des Grands Couteaux et celle du Nnuphar Blanc et se rattachait aussi la
franc-maonnerie des Triades dont avaient relev cinquante ans plus tt les
Tai -ping . Son centre tait le Chan-tong, province qui a de tout temps donn
naissance aux agitations dillumins et aux jacqueries. Les doc trines des
Boxeurs, comme celles des sectes analogues, taient un mlange de
sorcellerie, de thaumaturgie et de millnarisme. Dans leur principe elles
pouvaient fort bien, ainsi que nagure le Lotus Blanc et les Tai -ping, se
tourner contre la dynastie mandchoue. Le gouvernement de Pkin, qui
craignait cette ventualit et redoutait les Boxeurs, eut ladresse de driver
contre ltranger leur mouvement. Il leur prodigua dabord des
encouragements officieux, puis les patronna ouvertement. En mme temps,
la cour, Tseu -hi donnait toute sa confiance aux lments les plus ignorants et
les plus xnophobes, comme le prince mandchou Touan. Lorsque Touan jugea
que lagitation des Boxeurs tait point, au printemps de 1900, il donna le
signal de laction. Mais le mot dordre ne fut suivi ni par les vice -rois du Sud
ni par ceux du Yang-tseu, non pas mme par le prudent Yuan Che-kai, alors
gouverneur du Chan-tong.
Tseu -hi et ses conseillers engagrent donc la lutte dans les conditions les
plus imbciles : avec seulement la populace de la capitale et les forces
rgulires du Tche-li et cela dans le Tche-li seulement. Encore les rguliers ne
furent-ils lancs dans laction quhypocritement, comme soutiens des
meutiers. Car, pour dclarer la guerre au monde entier Europe, Amrique
et Japon la cour de Pkin ne savait que soulever, et Pkin mme, une
meute. Donc le 10 juin limpra trice dclara au Grand Conseil que les
trangers devaient tre supprims sans retard. Le 13 la populace de la capitale,
entrane par les Boxeurs, commena le massacre des prtres europens et des
chrtiens indignes ainsi que le sige des lgations. Le 20 juin le ministre
dAllemagne, von Ketteler, fut assassin. Les reprsentants des Puissances et
les rsidants trangers, assaillis dans les immeubles des lgations par une
foule hurlante, bientt entirement coups du monde extrieur, improvisrent
une dfense de fortune. Une premire colonne internationale de 2.000
hommes qui essaya de marcher de Tien -tsin sur Pkin sous le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
220
commandement de lamiral anglais Seymour, ne put souvrir la route et dut
battre en retraite (10-26 juin).
Cependant une expdition internationale plus importante, place sous les
ordres du marchal allemand von Waldersee, sorganisait. Les premiers
contingents europens, amricains et japonais sem parrent de Tien -tsin le 14
juillet et le 14 aot entrrent Pkin.
Saisie de panique, la cour mandchoue navait pas attendu larri ve des
Allis. Tseu -hi, dguise en paysanne, avait pris la route du Chen-si. Elle
stablit dans cette province, Si -ngan, sur les frontires occidentales de la
Chine. Le vieux Li Hong-tchang, nomm vice-roi du Tche-li, ngocia la paix
avec les Puissances. Tseu -hi, pour obtenir son pardon, sacrifia les plus
compromis des princes mandchous. Le prince Touan fut exil en Kachgarie.
Plusieurs organisateurs du massacre reurent la permission de se suicider .
Des comparses furent excuts. Le prince Tchouen, frre de lempereur
Kouang-siu, alla Berlin prsenter les excuses de la cour pour le meurtre du
baron de Ketteler.
La principale bnficiaire de la guerre des Boxeurs se trouva tre la
Russie. Quatre ans auparavant, par la convention du 27 aot 1896, elle avait
obtenu du gouvernement de Pkin lau torisation de construire un chemin de
fer travers la Mandchourie, puis (15 mars 1898) de prolonger cette ligne
jusquau ter minus de Port-Arthur, port qui venait de lui tre cd bail. Ds
que commena lagitation des Boxeurs, la Russie fit occuper militairement la
ligne du transmandchourien, ce qui quivalait pratiquement loccupation de
la Mandchourie (anne 1900). Le gouvernement russe luda les demandes
dvacuation qui lui furent adresses et entreprit lexploitation des richesses
du pays, notamment de ses immenses forts.
Cette annexion dguise provoqua lanimosit du Japon. Le gouvernement
de Tky voyait avec amertume Port-Arthur et Dalny dont il avait t chass
en 1895 au nom de lintgrit de la Chine, occups aujourdhui par ses rivaux.
Il avait limpression davoir t jou. LAngleterre ne voyait pas avec moins
dinquitude les Russes dominer par la possession de Port -Arthur le golfe du
Petchili. Le 30 janvier 1902 lord Lansdowne conclut avec lam bassadeur
japonais Hayashi un trait qui devait changer la face de lExtrme -Orient : en
cas de guerre russo-japonaise lAngleterre se chargeait dempcher toute
intervention de la France et de lAllemagne en faveur des Russes.
Ayant les mains libres, sr de ne pas voir se renouveler contre lui la
coalition de 1895, le Japon attaqua (8 fvrier 1904). Ses armes se lancrent
la conqute de la Mandchourie. En deux batailles disputes, Leao-yang
(aot-septembre 1904) et Moukden (fvrier-mars 1905), elles refoulrent
les Russes de la partie mridionale et centrale du pays. Dans lintervalle elles
staient empares de Port -Arthur (2 janvier 1905). Le 27 mai, la dernire
escadre russe fut dtruite Tsushima. Le 5 septembre 1905, par le trait de
Portsmouth, les dirigeants de Saint-Ptersbourg se rsignrent reconnatre
les intrts prpondrants du Japon en Core et dans la partie de la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
221
Mandchourie occupe par ses troupes. La Mandchourie septentrionale, au
nord de Ghirin, restait sous linfluence russe (dmarcation entre chemins de
fer russes et chemins de fer japonais Tchang -tchouen 109 kilomtres au
sud de Kharbin).
La Chine durant le conflit tait reste neutre, bien que les hostilits eussent
eu pour thtre cette Mandchourie qui relevait toujours de sa souverainet. Le
rsultat de la lutte nen eut pas moins une influence dcisive sur ses destines :
il provoqua indirectement la rvolution chinoise et la chute de la dynastie
mandchoue.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
222
CHAPITRE 32
La rvolution chinoise
Les victoires japonaises de 1904-1905 avaient t pour la cour de Pkin
une rvlation. Limpratrice Tseu -hi et les princes mandchous comprirent
enfin quen sopposant ladoption des mthodes europennes, il s staient
privs du moyen de tenir tte lEurope. Adorant ce quelle avait brl, la
vieille souveraine (elle avait maintenant soixante-dix ans) promulgua des dits
qui rappelaient sy mprendre les fameuses instructions impriales de la
priode des Cent jours. Comme elle ne pouvait cependant faire appel aux
rformistes de 1898 dont la sparait trop de sang vers, elle plaa la
direction des affaires les vice-rois progressistes dont elle avait si longtemps
nglig les conseils et au premier rang le nouveau vice-roi du Tche-li, Yuan
Che-kai.
La personnalit de Yuan Che-kai domine la priode qui san nonait ainsi.
Curieuse figure que celle de cet homme dtat chinois qui, force dnergie,
de patience, de ruse et de trahisons, faillit renouveler sous nos yeux laventure
des anciens fondateurs de dynasties. Indiffrent aux ides et aux principes,
mais sachant sen servir, ctait avant tout un raliste. Peu attach la
dynastie (lvnement allait le prouver), il navait pourtant pas hsit en 189 8
trahir au profit des princes mandchous les patriotes chinois. Il y avait gagn
la faveur de Tseu -hi qui aprs cette preuve de dvouement fit de lui un de ses
hommes de confiance.
Yuan Che-kai profita de son crdit pour amener la cour de Pkin vers l es
rformes. Aprs avoir trahi les rformistes au profit des ractionnaires, les
Chinois au profit des Mandchous, il ralisa lui-mme les principales ides des
rformistes et sut faire entreprendre par les Mandchous une partie du
programme chinois. Les vnements de 1898 avaient donc tourn son
avantage. Ayant fait carter les chefs du mouvement libral qui lui portaient
ombrage, il se trouvait maintenant lhomme indispensable, seul mme de
moderniser la Chine. Il rouvrit lre des rformes en inspira nt Tseu -hi un
curieux dit qui dclarait que le gouvernement doit tre lmanation de la
volont nationale et en lui faisant instituer des conseils provinciaux lus,
premire bauche dune reprsentation populaire (22 juillet et 25 aot 1908).
On annonait mme pour 1917 la convocation dun parlement.
Malheureusement ces concessions venaient trop tard. Faites dix ans plus
tt, elles auraient ralli la dynastie mandchoue tous les rformistes.
Maintenant les intellectuels levs au Japon, Chang-hai, Hong-kong ou
Singapour et qui de ltranger dirigeaient le mouvement libral, ne sen
contentaient plus. De loyaliste quelle tait encore en 1898 , lopposition tait
devenue antidynastique. Lancien collaborateur de lempereur Kouang -siu,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
223
Leang K i-tchao, avait donn le signal de cette volution. Du Japon o il
stait rfugi avec la plupart des bannis, il dirigeait contre la dynastie
mandchoue une redoutable campagne de presse. A ct de lui, un autre leader
rvolutionnaire, Sun Yat-sen, allait plus loin encore et rclamait la fondation
dune rpublique socialiste (94).
N prs de Canton en 1866, Sun Yat-sen partit lge de treize ans pour
les les Hawa o il entra au collge amricain dHonolulu. Il suivit les cours
de la Facult anglaise de Hong-kong o il prit ses diplmes de mdecine et
termina ses tudes en Amrique et Londres. Converti au protestantisme,
rpublicain radical et marxiste, il apportait la dfense de ses ides une
intransigeance de doctrinaire. Ses ennemis ont aussi dnonc chez lui une
certaine inquitude de dracin et il est certain que, mme au pouvoir, il
conservera des habitudes de carbonaro. De bonne heure, il stait affili la
franc-maonnerie chinoise des Triades qui gardait dans lombr e de ses loges
la tradition des Tai -ping et de toutes les vieilles rvoltes sudistes contre les
matres tartares du Nord. Il donna lagitation de ces socits secrtes un but
et une doctrine et trouva en elles un merveilleux instrument de propagande.
Avec elles il fonda vers 1900 le parti national ou Kouo-min-tang (95) qui
se recruta surtout dans les milieux intellectuels et commerants de la rgion
cantonaise et dans les colonies chinoises de Bangkok, Cholon, Singapour,
Batavia et Manille.
Avec le Kouo-min-tang, en effet, la dynastie mandchoue allait se heurter
une force dont elle souponnait peine lexistence : la Chine Extrieure. De
lune lautre il y avait la distance de plusieurs sicles. Tandis que les
dix-neuf provinces en taient encore lpoque de Marco Polo, il stait cr
du Siam San Francisco une Chine nouvelle de mentalit presque amricaine.
Transplant sous dautres cieux et jet dans la mle conomique moderne, ce
vieux peuple y devenait une jeune nation avec toutes les qualits dadaptation,
dinitiative et dnergie des races colo niales. Le contact de cette Chine
ultra-moderne allait faire tomber en poussire lempire millnaire. Mais
justement parce que les premiers rvolutionnaires chinois taient souvent des
dracins ayant perdu contact avec leur pays et devenus parfois presque
trangers ses habitudes mentales, le rgime quils allaient fonder risquait de
ne pas correspondre au milieu ...
Limpratrice Tseu -hi ne vit pas la catastrophe. Elle mourut le 15
novembre 1908, prcde de quelques jours par sa victime, Kouang-siu,
lempereur fantme. Morts bizarres, crit Georges Maspero, maladies
tranges, bruits dempoisonnement auxquels est ml le nom de Yuan
Che-kai. On imagine en effet que la vieille douairire ne se souciait gure
de laisser le pouvoir au malheureux souverain quelle tenait depuis dix ans
dans une vritable captivit. Et Yuan Che-kai, de son ct, naurait pu voir
sans terreur Kouang-siu, sa dupe de 1898, venir lui demander compte des
anciennes trahisons. Kouang-siu mourut donc en temps utile ...
A cette heure grave entre toutes, le trne passa non point au frre de
Kouang-siu, au prince Tchouen, homme fait dont tout le prestige net pas
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
224
t de trop, mais au fils de Tchouen, Pou -yi, un enfant de trois ans (n le
11 fvrier 1906) qui devint lempereur Siuan -tong. Il est vrai que la rgence
fut confie son pre, au prince Tchouen. Mais Tchouen tait un homme
sans capacits, infod aux clans mandchous les plus arrirs. Il arrivait au
pouvoir avec le dsir assez honorable de venger son frre, le malheureux
Kouang-siu, sur le tratre de 1898, sur Yuan Che-kai. Il chassa donc ce
dernier, mais il se priva ainsi du seul homme capable de guider lempire dans
la voie des rformes et dempcher le divorce entre lintelligence chinoise
et la dynastie mandchoue. En tout tat de cause, il tait imprudent de saliner
un personnage aussi influent que Yuan Che-kai. Lancien vice -roi stait
attach personnellement les troupes du Tche-li qui lui restrent fidles jusque
dans sa retraite. Il devait faire payer cher aux Mandchous sa disgrce de 1908.
Pendant ce temps, Sun Yat-sen redoublait daudace. Sa cam pagne de
libelles suscitait contre la dynastie llite europani se des ports ouverts et,
par les ports, gagnait lintrieur. Nous avons perdu notre patrie, scriait -il.
Sur le globe nous sommes le quart de la population terrestre, et nous restons
les esclaves dune poigne de Mandchous !
Pour calmer les extrmistes, le rgent runit le 14 octobre 1909 les
conseils provinciaux crs par Tseu -hi. Bien qulus par un suffrage fort
restreint, ces conseils devinrent dans chaque province dactifs foyers
dopposition. En janvier 1910, ils envoyrent Pkin une dlgati on qui
rclama la convocation dune assemble constituante. La cour se contenta de
runir un snat consultatif nomm en partie par les conseils provinciaux, en
partie par le rgent. Malgr la prpondrance de llment officiel, cette
assemble, ds ses premires sances, demanda la convocation dune vritable
Chambre lue et un rgime constitutionnel.
Devant les atermoiements de la cour, la rvolte clata. Le 11 octobre 1911
les agitateurs cantonais provoqurent le soulvement de la garnison de
Wou-tcha ng, au Hou-pei. Wou-tchang, Han -yang et Han-keou tombrent au
pouvoir des insurgs qui proclamrent la rpublique et organisrent
Wou-tchang mme un gouvernement provisoire prsid (en labsence de Sun
Yat-sen, encore en Amrique) par leur gnral Li Yuan-hong, avec, comme
ministre dirigeant, le Cantonais Wou Ting -fang. A ces nouvelles Canton se
rvolta son tour et entrana dans le mouvement toute la Chine du Sud. La
partie ntait pourtant pas perdue pour les Impriaux. Un moment ils reprirent
mme lagglomration Han yang et Han-keou (27 -28 octobre). Mais ils
nosrent poursuivre leur succs. Les troupes rpublicaines en profitrent pour
descendre le Yang-tseu, occuper Chang-hai et Nankin (4 et 30 novembre) et
transporter dans cette dernire ville le sige du gouvernement provisoire. En
ralit le rgent avait perdu la tte. Epouvant par lampleur du mouvement, il
se jeta dans les bras de ce mme Yuan Che-kai quil avait mortellement
offens trois ans plus tt et qui lui apparaissait maintenant comme le seul
sauveur possible. Ctait se livrer son pire ennemi.
Yuan Che-kai se fit investir par la cour de pouvoirs dicta toriaux, avec le
commandement de toutes les armes impriales. Mais au lieu de marcher
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
225
contre les rebelles, il se contenta de leur faire sentir sa force (reprise de
Han-keou). Loin de vouloir les dtruire, il allait se servir deux pour
renverser la dynastie. Les princes mandchous staient dsarms eux -mmes
en sa faveur. Ils taient maintenant sa merci. Yuan les affola en leur
dclarant que seule la dmission du rgent calmerait le peuple. Quand le
rgent se fut excut (6 dcembre 1911), Yuan fit un pas de plus : il demanda
labdication de la dynastie. Ses dsirs taient des ordres. Le 12 fvrier 1912 le
petit empereur Pou -yi abdiqua ou plus exactement institua lui-mme la
rpublique en remettant nommment le pouvoir Yuan Che-kai.
Aprs avoir escamot la dynastie impriale, il restait Yuan Che-kai
jouer mme jeu avec les rpublicains. Ceux-ci, qui venaient de constituer
Nankin un gouvernement provisoire, se trouvaient en prsence dune situation
assez inattendue. Ils avaient pris les armes contre la dynastie mandchoue et
voici qu sa place ils voyaient surgir la figure quivoque de lancien vice -roi
du Tche-li. Ils ne pouvaient oublier sa trahison de 1898, sa longue collusion
avec Tseu -hi. Dautre part ctait lui quils devaient la chute des
Mandchous et le triomphe de la rpublique. De plus, il avait la force, son
arme tant certainement suprieure la leur. L assemble rpublicaine de
Nankin, il est vrai, venait (29-30 dcembre 1911) de nommer prsident
provisoire de la rpublique le leader radical Sun Yat-sen. Mais maintenir ce
choix, ctait rompre avec Yuan Che -kai. Les gens du Kouo -min-tang ne
losrent p oint. Pour ne pas avoir subir Yuan Che-kai, ils recoururent un
procd dj bien parlementaire : ils le nommrent eux-mmes prsident de la
rpublique la place de Sun Yat-sen qui dmissionna (15 fvrier 1912). Ils
espraient que Yuan resterait ainsi leur crature et leur oblig.
En ralit ce compromis ntait quune solution dattente. Llec tion de
Yuan Che-kai la prsidence ne fit cesser quen appa rence le dualisme
chinois. La Rpublique (Tchong houa min kouo) ntait quune tiquette. Le
prsident et lassemble constituante restaient en face lun de lautre, le
premier Pkin au milieu de sa fidle arme, la seconde Nankin sous la
garde des troupes rvolutionnaires. Yuan ne voyait dans les dputs du genre
de Sun Yat-sen que des thoriciens sans exprience, des utopistes qui
conduiraient la Chine la dissolution. Et les dputs de leur ct se rendaient
compte que le fauteuil prsidentiel ntait pour Yuan quune tape vers le
trne. Les uns et les autres taient dans le vrai.
Yuan Che-kai essaya dabord de donner satisfaction tous en rpartissant
quitablement entre ses propres partisans et ceux du Kouo-min-tang les
portefeuilles ministriels. Mais les lections la Chambre des reprsentants
(Tchong yi yue) en janvier-fvrier 1913 rompirent laccord. Comme de juste
les candidats prsidentiels lemportrent Pkin et dans le Nord, le
Kouo-min-tang sur le Yang-tseu et dans la rgion cantonaise. Le
Kouo-min-tang entreprit alors contre Yuan Che-kai une opposition violente
qui empcha tout travail parlementaire. En juillet 1913 ses membres passrent
aux actes : runis Nankin sous la prsidence de Sun Yat-sen, ils votrent la
dchance de Yuan Che-kai.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
226
Ctait librer Yuan de ses entraves constitutionnelles. Heureux de
loccasion off erte, il envoya contre Nankin ses meilleures troupes qui
occuprent la ville (27 aot 1913) et forcrent Sun Yat-sen se rfugier au
Japon. Le 4 novembre, pour en finir avec lopposition, Yuan fit expulser les
300 dputs et les 100 snateurs affilis au Kouo-min-tang. Il conserva
quelque temps encore le parlement ainsi pur, puis le 1o janvier 1914 il en
pronona la dissolution et le remplaa par un conseil dtat compos damis
prouvs. Cette assemble lui confra la prsidence dcennale, indfiniment
renouvelable. Ctait le consulat vie en attendant lempire. Bientt une
active propagande monarchique fut entreprise par ses partisans. Ils
provoqurent un plbiscite qui se pronona lunanimit pour le
rtablissement, en sa faveur, de la dignit impriale, et le 11 dcembre 1915 le
Conseil dtat, la suite du vote dune Convention Nationale , le proclama
empereur sous le nom de Hong-hien.
Le rgne de Yuan Che-kai, selon la remarque de Georges Maspero, devait
durer moins de cent jours, un peu moins que le gouvernement du pauvre
empereur Kouang-siu auquel en 1898 ce mme Yuan avait si tratreusement
mis fin. Car le vieil homme dtat, malgr son art des transitions, avait encore
t trop vite. A la nouvelle de son avnement le Kouo-min-tang reprit les
armes. Les provinces du Sud qui avaient toujours t hostiles au dictateur du
Nord formrent Canton un gouvernement provisoire qui pronona sa
dchance. Les autres chefs militaires, jaloux de son lvation, se dclarrent
contre lui. Mais surtout la tentative de restauration de la monarchie se heurtait
lopposition trangre : les Puissances sinquitaient de voir un homme fort
devenir matre du vieil empire et elles avaient les moyens de se faire couter...
Devant lagitation qui se propageait , Yuan Che-kai fut oblig de revenir la
forme rpublicaine (23 fvrier 1916). Cette concession nayant pas dsarm
ses adversaires, le souverain manqu qui voyait svanouir en un jour le fruit
de vingt-six annes de patient effort, se suicida discrtement (6 juin 1916).
Lchec de Yuan Che -kai, d lintervention ouverte de la Chine
Extrieure et lintervention secrte des Puissances tran gres, dtourna
lhistoire chinoise de son cours habituel. Lancien vice -roi du Tche-li, avec
ses qualits dh omme dtat, son nergie et sa souplesse, sa tnacit et ses
trahisons, sa connaissance et son mpris des hommes, sa virtuosit se servir
des mots et son indiffrence pour les ides, se prsente nous comme la
moderne incarnation des fondateurs de dynasties du temps pass.
Lavortement de son entreprise dynastique rejeta la Chine dans une srie de
crises do elle nest pas encore sortie. Et tout dabord il se produisit ce qui
arrive chaque fois que le vieil empire nest pas tenu en main par une dynastie
forte : lmiettement provincial. Au lendemain de la chute des Mandchous la
personnalit de Yuan Che-kai avait contenu les dissidences rgionales. Lui
disparu, elles triomphrent comme aux plus mauvais jours du Xe sicle. Sous
le nom de rpublique, ce fut lanarchie militaire dans le nord, lanarchie
politicienne dans le sud.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
227
Le vice-prsident Li Yuan-hong qui, la mort de Yuan Che-kai, accda
la prsidence, se montra incapable de rtablir aussi bien lunit territoriale
quun minimum dunion morale. Les provinces du nord furent disputes entre
un certain nombre de tou-kiun ou commandants darme dont la presse, il y a
une vingtaine dannes, se demandait gravement lequel serait le sauveur de la
Chine. La Mandchourie, dans la mesure o les intrts prpondrants du
Japon le tolraient, devint le fief du marchal Tchang Tso-lin, ancien bandit
mu en chef de gouvernement. Pkin appartint dabord au marchal Touan
Ki -jouei ; en juillet 1920 la capitale fut enleve ce personnage par deux
autres chefs militaires, Tsao Kouen et le chef dtat -major de Tsao Kouen,
Wou Pei -fou. Tsao Kouen sinstalla alors Pkin, tandis que Wou Pei -fou
stablissait Lo -yang comme tou-kiun du Ho-nan. Le 6 octobre 1923 Tsao
Kouen se paya le luxe de se faire nommer prsident de la Rpublique par un
parlement dment achet, mais en septembre 1924 lui et Wou Pei -fou furent
attaqus par le dictateur de la Mandchourie, Tchang Tso-lin. Ce dernier
lemporta grce la dfection dun autre aventurier militaire, Fong Yu -siang,
personnage quivoque qui se faisait appeler le gnral chrtien parce quil
se serait converti au protestantisme (96), qui sentendait en mme temps avec
les Soviets et qui, en ralit, appartenait au plus offrant (octobre 1924). Le
gnral chrtien essaya dailleurs de garder Pkin pour lui -mme, mais en
avril 1926 il en fut chass par Tchang Tso-lin qui unit ainsi le Ho-pei son
fief mandchourien.
Ctait, comme on le voit (et je simplifie dessein limbroglio politi que),
le retour aux phases de grand miettement quavait priodiquement
connues la Chine, la rapparition de la fodalit militaire quon avait vue
fleurir aprs la chute de chaque grande dynastie et avant le triomphe dune
dynastie nouvelle. Le Sud, il est vrai, prtendait maintenir le gouvernement
civil et la rpublique unitaire. Lancien parlement Kouo -min-tang, le
parlement-croupion stait runi Canton et ds le 11 avril 1921 y avait
lu prsident de la Rpublique le docteur Sun Yat-sen, mais le vieux
rvolutionnaire, sans doute plus animateur quhomme dtat, narrivait gure
se faire obir de ses propres partisans, les gnraux sudistes. Ngligeant les
misres de lheure prsente, il cher chait fdrer la Chine et le Japon. En
novembre 1924, il se rendit dans cette intention Tky, mais il dcda son
retour en Chine le 12 mars 1925. Aprs lui le premier rle parmi les chefs
sudistes allait revenir un de ses lieutenants, Tsiang Kieche, ou, selon la
prononciation cantonaise, Tchiang Kai-chek. Ce jeune gnral (il tait n en
1887) devait russir l o Sun Yat-sen avait chou et soumettre le Nord
lautorit du Midi.
Le programme des Sudistes, en lespce des intellectuels can tonais dont
Tchiang Kai-chek allait tre le reprsentant, comprenait deux articles
principaux : dune part lviction de la dictature militaire, cest --dire des
soldats de fortune qui se partageaient les provinces du Nord ; dautre part la
suppression des concessions et privilges conomiques et juridiques
(exterritorialit) acquis par les trangers depuis 1842 ou, selon la formule
consacre, labo lition des traits ingaux . Les Cantonais pouvaient
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
228
compter cet effet sur laide des Soviets qui leur envoyrent le commis saire
Borodine assist du technicien militaire Galentz avec des cadres et des
munitions. Ainsi rorganises, les troupes cantonaises russirent le 8
septembre 1926 enlever au marchal nordiste Wou Pei -fou les grosses
agglomrations industrielles du Hou-pei, Wou-tchang, Han -keou et l arsenal
de Han-yang. Les concessions britanniques furent occupes et les rsidants
britanniques finalement expulss (7 janvier 1927). Le 22 mars 1927 les
Sudistes entrrent Nankin, succs qui malheureusement saccompagna du
massacre de plusieurs Europens. Quand les troupes sudistes arrivrent aux
portes de Chang-hai o les concessions internationale et franaise
constituaient de vritables villes europennes, le pire fut craindre. Tchiang
Kai-chek demandait la suppression des dfenses qui protgeaient les
concessions, et le retrait des troupes internationales concentres dans la ville
(26 mars). Toutefois il retint ses soldats et empcha le choc, satisfait de voir
les rsidants britanniques vacuer toute la valle du Yang-tseu.
Du reste, Tchiang Kai-chek venait de se brouiller avec ses allis, les
communistes de Han-keou, et avec leurs conseillers russes. Le 3 avril 1927 il
forma Nankin un gouvernement nationaliste modr, purement
Kouo-min-tang, la tte duquel il plaa lhri tier politique de Sun Yat-sen, le
docteur Wang Tsing-wei. Puis il attaqua les communistes de Han-keou. Le
22 mai il leur enleva larsenal de Han -yang. Le 13 novembre 1927 le
gouvernement communiste de Han-keou fut dfinitivement dispers. Les
agents russes se retirrent Canton o le 12 dcembre 1927 ils organisrent
un mouvement rvolutionnaire avec les cellules communistes locales en
lespce avec la population du quartier flottant qui, au nombre de 20.000
mes, vit sur les sampans et les chalands dans lestuaire . Dans la ville et
dans la rgion, des proclamations ordonnrent dexcuter les propritaires et
de semparer de leurs biens. Tchiang Kai-chek envoya en hte des troupes
qui reprirent la ville et massacrrent les Rouges, au nombre den viron deux
mille. Le Russe Kirischeff, chef de lcole communiste militaire, fut excut
avec tous les siens. Nanmoins des groupements rouges subsistrent au
Fou-kien et surtout au Kiang-si o une rpublique communiste se perptuera
encore jusquen 1933 -1934 poque o elle sera dtruite par Tchiang Kai-chek.
Cependant Tchiang Kai-chek avait rsolu dentreprendre la conqute du
Nord. Le matre du Nord, ctait toujours le marchal Tchang Tso -lin, le
er
tou-kiun de la Mandchourie et de Pkin. Le 1 mai 1928 les Sudistes lui
enlevrent Tsi-nan, le chef-lieu du Chan-tong, province si ravage par toutes
ces guerres entre gnraux que prs du cinquime de la population aurait pri
ou migr au Mandchoukouo. Devant lapproche de larme sudiste, Tchang
Tso-lin, le 2 juin, vacua Pkin pour se retirer dans son fief mandchourien. Il
devait tre tu dans la nuit du 3 au 4, en arrivant Moukden, par lexplosion
dune bombe mystrieu sement dpose dans son train. Pendant ce temps les
Sudistes faisaient leur entre dans la capitale.
La victoire du Kouo-min-tang sur les aventuriers militaires, du Sud sur le
Nord, tait complte, encore que cette victoire nait pu tre acquise que grce
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
229
la dfection de plusieurs gnraux nordistes, comme Fong Yu-siang, passs
la cause du Midi. Tchiang Kai-chek tira la conclusion de sa victoire en
annonant le 16 juin 1928 que la capitale serait transfre de Pkin Nankin.
Le 4 octobre 1928 une nouvelle constitution fut promulgue, sanctionnant ce
transfert, et le 9 octobre Tchiang Kai-chek fut lu prsident de la Rpublique.
Tandis que ces guerres civiles dsolaient la Chine, ses dpendances
extrieures staient dtaches delle.
Ds la chute de la dynastie mandchoue les Tibtains staient dclars
indpendants, avaient massacr l amban imprial install Lhassa et expuls
tous les rsidants chinois.
La Mongolie Extrieure avait de son ct fait scession. Le pays tait
partag entre les quatre dynasties khalkha, issues de Gengis-khan, et les hauts
dignitaires bouddhiques dont le plus respect tait le grand lama dOurga. Ces
divers princes laques ou ecclsiastiques se trouvaient depuis le XVIIe sicle
en lespce depuis lempereur Kang -hi attachs la dynastie
mandchoue par un lien de fidlit personnelle qui leur faisait considrer
lem pereur de Pkin comme leur grand khan lgitime. Ce lien purement
fodal se trouva rompu lorsque la dynastie mandchoue eut t chasse du
trne imprial. Les vassaux mongols se dclarrent affranchis de toute
allgeance envers la Rpublique chinoise. Une confrence des princes et des
lamas khalkha runie Ourga le 1er dcembre 1911 proclama lindpendance
de la Mongolie Extrieure sous la prsidence du grand lama dOurga. Yuan
Che-kai, durant sa dictature, essaya vainement de ramener par la persuasion
les princes mongols dans lobissance. Tout au plus parvint -il y maintenir
les princes de la Mongolie Intrieure (Tchakhar, Ordos, etc.). Quant la
Mongolie Extrieure, son indpendance tait dsormais garantie contre la
Rpublique chinoise par le gouvernement imprial russe. Laccord
russo-mongol conclu Ourga le 3 novembre 1912 assurait aux princes
mongols la protection du tzar, protection qui prenait dj les allures dun
protectorat.
Leffondrement de la Russie des tzars en 1917 parut changer les donnes
du problme. En octobre-novembre 1919 la Chine, profitant de lanarchie
russe, obligea par un ultimatum la Mongolie Extrieure rtablir son lien avec
elle. Le 2 dcembre 1919 une garnison chinoise sinstalla Ourga en
dsarmant les troupes mongoles. Mais lanarchie dans laquelle sombrait la
Chine elle-mme ne lui permit pas de soutenir cet effort. Et de nouveau
apparut le protecteur russe, dabord sous les espces dun Russe blanc, le
gnral-baron Ungern-Sternberg qui les 3-4 fvrier 1921 expulsa la garnison
chinoise dOurga et sinstalla en dictateur dans cette ville. Puis en juillet 1921
les Soviets chassrent Ungern et entrrent Ourga. Depuis cette date la
Mongolie Extrieure a t pratiquement une dpendance des Soviets. La
Constitution vote par le qourilta de novembre 1924 organisa dfinitivement
ltat mongol ( Monggholoun oulous) en rpublique populaire sovitique, avec
capitale Ourga (Oulanbator).
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
230
La premire consquence de la chute de la dynastie mandchoue avait donc
t pour la Chine la perte de la haute Mongolie. Mais il ne sagissait l que
dune dpendance extrieure qui ne touchait pas au corps mme du vieil
empire. Tout autre tait le cas de la Mandchourie.
La Mandchourie, aprs laccident mortel du marchal chinois Tchang
Tso-lin (juin 1928), tait reste, par la tolrance des Japonais, au pouvoir de
son fils Tchang Siue-leang, gnral vingt ans, marchal vingt-neuf. Le 18
septembre 1931 les Japonais chassrent ses garnisons de Moukden, puis des
autres villes mandchouriennes et le forcrent senfuir Pkin. Le 19
novembre les troupes japonaises entrrent Tsitsikhar dans la partie septentrionale de la Mandchourie (Hei-long-kiang), jusque-l considre comme
sphre dinfluence russe. Le 1 er mars 1932 la Mandchourie fut rige en tat
indpendant du Mandchoukouo, auquel fut adjointe, en Mongolie Intrieure,
la province de Jehol. Les Japonais mirent la tte du nouvel tat Monsieur
Pou -yi ; cest --dire le dernier empereur mandchou dtrn en 1912 par la
rvolution chinoise et pour lors g de vingt-six ans. Le 1er mars 1934 Pou -yi
fut proclam empereur du Mandchoukouo sous le nom de rgne de Kang -t.
Le 15 juillet 1937, le gouvernement japonais adressa un ultimatum
Nankin pour exiger lindpendance de la province mongole du Tchakhar
(Mongolie Intrieure) et du Ho-pei (province de Pkin). Ctait la guerre. Les
armes japonaises occuprent Pkin (29 juillet), Chang-hai (27 octobre),
Nankin (14 novembre 1937) et Canton (21 octobre 1938). Le prsident
Tchiang Kai-chek, chass des provinces ctires, transporta sa capitale
Han-keou, puis, aprs la chute de cette ville (octobre 1938), Tchong -king,
place qui allait devenir linviolable rduit de lindpendance chinoise. Les
Japonais poussrent au nord jusquau grand coude du Fleuve Jaune, au sud
jusqu Yi -tchang, mais ils spuisaient devant une universelle gurilla et
partout des lots de rsistance sorganisaient. Le 30 mars 1940, il est vrai, un
lieutenant de Tchiang Kai-chek, Wang Tsing-wei, tant pass au parti
japonais, constitua Nankin un gouvernement collaborationniste, tandis que
Tchiang Kai-chek bnficiait de laide des Anglais qui le ravitaillaient par la
route de Birmanie. La capitulation du Japon devant la marine et laviation des
Puissances anglo-saxonnes (14 aot 1945) allait assurer enfin la libration du
sol chinois, Mandchourie comprise. Mais il ne faut pas oublier que la tnacit
invincible de Tchiang Kai-chek, sa force dme, ses qualits de chef avaient
seules rendu possible un tel rsultat.
Reste rsoudre la question des rapports entre le gouvernement de
Tchiang Kai-chek, restaur Nankin, et le gouvernement communiste dont le
centre tait tabli Yen-ngan, dans le nord du Chen-si. Le problme,
dailleurs, nest pas purement chinois, puisquil intresse lensemble des
relations russo-amricaines en Extrme-Orient.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
231
CHAPITRE 33
Donnes permanentes et problmes actuels
Les vnements actuels, trop mouvants pour que nous puissions en
dgager les consquences immdiates, ne doivent pas nous masquer les
grandes lignes de lvolution chinoise. Aussi bien, pour dsordonns quils
nous paraissent, ne font-ils que rpter un des priodiques aspects de lhistoire
dynastique o les phases dmiettement et danarchie succdent aux phase s de
regroupement, et les prcdent.
Le grand fait de lhistoire chinoise, ce quune vue plantaire en
dgagerait avant tout, cest la mise en valeur agricole du continent chinois
par le laboureur de la Grande Plaine. A travers les rvolutions des dynasties
archaques, ce que nous avons discern de permanent, cest lensemencement
en millet, puis en bl de ces immenses tendues planes, de cette Grande
Plaine alluviale du nord-est que prolongent au nord-ouest les terrasses de
terre jaune. Seules aux tats-Unis les grandes plaines du Middle-West
prsenteraient une telle surface densemencement. Le rsultat du labeur
poursuivi depuis quarante sicles nous est fourni par les photographies
davion, plus loquentes que tout commentaire : un damier de lopins de terre
diviss avec une rgularit gomtrique, des exploitations qui en moyenne ne
dpassent pas six ou sept hectares. Une culture devenue ce point intensive
que la terre est jardine plutt que cultive . Tout a t dbois, dfrich,
galis, mis en valeur par la fourmilire humaine. Do, dans la Grande
Plaine, une densit atteignant aujourdhui 250 habitants au kilomtre carr,
densit presque gale celle de la Belgique et cela sur une superficie de
324.000 kilomtres carrs. La densit tombe 83 au kilomtre carr sur les
terrasses de lss du nord -ouest, soit en tout 80.979.000 mes pour la Grande
Plaine et 43.923.000 pour le lss.
A lpoque archaque encore, vers ce que nous appelons lge des
Royaumes Combattants, lagriculture chinoise avait gagn (moins dailleurs
par conqute que par la conversion des populations locales la vie agricole) la
plaine du Yang-tseu, autre terre alluviale seme de rivires et de canaux,
royaume du riz dont la fertilit permet aujourdhui une dens it inoue de 346
habitants au kilomtre carr, soit 67.943.000 mes. Enfin, sans doute un peu
plus tard, lpoque Han, le Bassin Rouge du Sseu -tchouan commena tre
srieusement mis en valeur jusqu atteindre aujourdhui une densit de 224
habitants au kilomtre carr, soit 43.860.000 mes (97).
Au sud du Yang-tseu le paysan chinois abordait une contre nouvelle : au
lieu des tendues plates du nord il se trouvait maintenant en prsence dun
pays montueux, form dun moutonn ement de collines orientes du sud-ouest
ou nord-est, les plis siniens , rgion autrefois recouverte par la fort
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
232
subtropicale. Le dfrichement de cette vaste rgion forestire, sa
transformation en rizires (il ne saurait encore tre question, pour cette
poque, de th et de canne sucre) fut une uvre de longue haleine,
poursuivie depuis les Han jusquaux Cinq Dynasties. Mais les immigrants
venus du nord ou du bas Yang-tseu qui colonisrent ces terres nouvelles
entendirent les adapter leurs mthodes de culture bien plutt que sadapter
elles. Originaires de rgions immmorialement dboises, ils abattirent
systmatiquement et en quelque sorte instinctivement la fort mridionale qui
ne subsiste aujourdhui que sur les massifs de crte sparant les valles.
Or ces collines quil dnudait, le paysan chinois ne les a pas livres la
charrue, parce que, habitu dans le nord et sur le bas Yang-tseu une culture
de plaines, il continuait ici ne cultiver que les valles en ngligeant les
versants. Du reste le dboisement irraisonn a entran dans ces amphithtres
de collines une rosion qui aurait suffi en tout tat de cause rendre la plupart
des coteaux improductifs : et la province de Hou-nan par exemple est pour les
huit diximes compose de collines. Il sensuit que, malgr la culture
intensive (en rizires notamment) dont les valles continuent tre lobjet, la
proportion des terres cultives nest plus ici quentre 19 et 15 %, alors quelle
tait de 66 % dans la Grande Plaine et de 71 % dans la valle du Yang-tseu.
Ces provinces sont donc ncessairement moins peuples que celles du nord.
Mais comme la population sy entasse uniquement dans les valles, on aboutit
ce rsultat paradoxal que la surpopulation de la surface cultive y est bien
plus grande que dans le nord : la densit de la population par kilomtre carr
de terre cultive qui est de 378 habitants dans la Grande Plaine, atteint 866
dans les collines au sud du bas Yang-tseu, 1.021 au Fou-kien et 1.318 dans la
rgion cantonaise. La Chine du Nord est normalement, la Chine du Sud
artificiellement surpeuple.
Dans les deux cas, et cest l le bilan terminal de lhistoire chinoise,
la surpopulation est vidente. Et cela quand prs de 85 % du sol restent
inutiliss (98).
La fourmilire chinoise est priodiquement ravage par des famines
auxquelles, nous lavons vu, sont imputables une partie des rvoltes qui, dge
en ge, ont renvers les dynasties. Ces famines sont dues au fait mme de la
surpopulation et aussi deux flaux qui tiennent aux donnes gographiques :
la scheresse et linon dation. La plaine du Nord et surtout les plateaux de lss
sont soumis des pluies si irrgulires que souvent les rcoltes font totalement
dfaut. Les annes 1927 et 1928 ont vu une scheresse et partant une disette
caractristiques : Par ailleurs le Fleuve Jaune est sujet des inondations
terribles. Au cours des temps historiques, son embouchure na cess de se
dplacer une distance de 500 kilomtres, tantt au nord, tantt au sud de la
presqule du Chan -tong, depuis Tien -tsin jusqu la province de Nankin
( que lon imagine la Loire balayant les plaines de lIle -de-France pour
aboutir tantt Nantes, tantt Dunkerque ). Ces rvoltes du fleuve
indompt qui causent priodiquement autant de pertes que la plus cruelle des
guerres, sont en partie imputables une faute initiale des riverains, lorsque
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
233
ceux-ci, il y a peut-tre trente sicles, ont endigu le Houang-ho sans se
proccuper des surlendemains. Ils ne se sont pas aviss que dans cette norme
masse deau qui charrie le lss des hauts plateaux, le lit du fleuve se trouve
sans cesse exhauss par le dpt de limon. Au fur et mesure de cet
exhaussement, ils ont eux-mmes surlev le parapet de leurs digues, de sorte
que le fleuve a fini par couler en surplomb jusqu 5 mtres au -dessus du
niveau de la plaine. Quand la crue est trop forte ou simplement lorsque par
suite des guerres trangres ou civiles lentretien des digues se trouve nglig,
comme en l an 11 de notre re, en 1194 et en 1853, le fleuve descend en
cataractes et dans ces plaines infinies cherche une nouvelle voie
dcoulement. Des districts entiers ont ainsi t rendus pour de longues annes
impropres la culture. En 1921, 1924 et 1925 le fleuve est encore sorti de son
lit. En 1925 il a bris ses digues, inond plus de mille villages, fait dinnom brables victimes.
Ces flaux naturels, en aggravant celui de la surpopulation, ont
priodiquement contraint la masse chinoise migrer.
Pendant longtemps lmigration lintrieur a pu suffire. Les annales des
Han, des Six Dynasties et des Tang nous montrent souvent ladministration
tablissant des colons dans les rgions encore mal peuples de la Chine du
Sud ou des marches occidentales. Depuis lors, le mouvement na pas cess. Le
rattachement du Yun-nan au XIIIe sicle de notre re, la soumission des lots
miao-tseu du Kouei-tcheou la fin du XVIIIe ont ouvert de nouveaux champs
de colonisation intrieure, mais la rpugnance du paysan chinois pour lhabitat
de montagne na pas permis dexploiter compltement ces possibilits : au
Yun-nan les plaines ne reprsentent gure que les 10 % de la superficie. Pour
tirer parti de ces plateaux et de ces causses, il et fallu que le Chinois sadon nt llevage, occupation laquelle il restera, semble -t-il, toujours tranger.
En ralit, partir du XVIIIe sicle la colonisation intrieure de la Chine tait
pratiquement termine. Lmigration chinoise devait se porter vers
lextrieur : Mongolie, Mandchourie, Indochine, Insulinde, Ocanie.
En Mongolie Intrieure, au nord de la Grande Muraille, dans le Ning-hia,
le Souei-yuan, le Tchakhar et le Jehol, le fermier chinois depuis, surtout, le
XVIIIe sicle, na cess dempiter sur la steppe, la terre de la farine
(mien-ti), de gagner sur la terre des herbes (tchao-ti). La glbe na pas de
valeur aux yeux du ptre mongol qui, en toute insouciance, vend limmi grant des cantons entiers et recule toujours plus loin vers le Nord, en direction
du Gobi. Les tentes du nomade, les yourtes de feutre blanc, cdent
progressivement la place aux fermes chinoises en pis. De vastes franges de
steppe ont pu tre laboures et converties en champs de millet, davoine,
dorge, de bl ou de sorgho. Cest ainsi que trois des quatre provinces de la
Mongolie Intrieure comprennent aujourdhui une superficie de terres
cultives de 276.250 hectares pour le Souei-yuan, 585.200 pour le Tchakhar et
812.150 pour le Jehol. Ainsi le fermier amricain ou canadien a pouss ses
labours au dtriment du Peau-Rouge refoul toujours plus loin vers les dserts
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
234
du Grand Ouest ou les glaces du Grand Nord. Comme le pionnier du
Mississipi ou du Saint-Laurent, le Chinois ici fait de la terre .
Toutefois la Terre des herbes, une fois dfriche, ne saurait tre assimile
lancienne Prairie amricaine. La faiblesse des pluies menace toujours ici le
fermier dannes conscutives de sche resse qui amnent bientt la dsertion
de lentreprise. Les seules exploitations agricoles sres de la venir sont celles
qui sappuient sur le voisinage du Fleuve Jaune. Il y a prs de deux mille ans
quun remarquable rseau de canaux, drivs du fleuve, a arrach la steppe
de lAlachan dun ct, celle des Ordos de lautre, la rgion de Ning -hia.
Actuellement encore luvre se poursuit. Par exemple, un rcent projet de
canalisation autour de Saratchi dans le Souei-yuan donnerait lagriculture
100.000 hectares. Mais moins de possder de srieuses rserves en capitaux
et en semences, le paysan chinois risque gros saventurer trop loin du fleuve
nourricier. Du reste un danger plus grave que la scheresse elle-mme le
menace ici : une fois arraches les herbes de la steppe qui retenaient au sol la
terre vgtale, celle-ci est souvent emporte par lr osion ou par le vent du
dsert pour ne laisser affleurer que la roche strile.
Autrement pleine de promesses est la colonisation de la Mandchourie.
La plaine mandchourienne, nous disent les gographes, est une prairie
vierge au riche humus noirtre, prdestine pour les crales et le soja. Le
rgime des pluies et la forte nbulosit de lair, en rendant impossibles les
scheresses dont souffre priodiquement la Chine du Nord, facilitent les
labours rpts . Le climat, malgr sa rigueur, est, comme celui du Bas
Canada, stimulant pour lhomme. A lest les montagnes qui sparent le pays
de la Core et de la Province Maritime russe, au nord-ouest les monts Khingan
renferment les plus belles rserves forestires de lExtrme -Orient en pins,
sapins, mlzes et bouleaux. Jusquau milieu du XIX e sicle le pays ntait
habit que par les Mandchous ou par dautres tribus appartenant la mme
race tongouse, chasseurs forestiers ou pasteurs de la prairie, et aussi vers
louest, sur le versant oriental du Grand Khingan, par des ptres mongols. A
ces Mandchous il tait arriv au milieu du XVIIe sicle une aventure
inattendue, inoue, ne, nous lavons vu, dune surprise, dun vri table
escamotage : ils avaient, en 1644, fait la conqute de la Chine. Or, ils ont t
depuis, on la souvent fait remarquer, les victimes de leur conqute . Ils
ntaient quune poigne dhommes. Quand ils eurent soumis limmense
empire chinois, la plupart sy fixrent titre daristocratie militaire ou
simplement de garnisons privilgies, grassement nourris aux frais des
indignes. Ceux qui restrent au pays natal, arrire-garde dsormais
singulirement clairseme, taient eux aussi entretenus par lempire.
En somme la Mandchourie constituait une rserve au profit de la race
conqurante, une zone interdite pour limmigrant chinois. Mais mesure qu
Pkin la dynastie mandchoue se sinisait plus profondment, il lui devenait
plus difficile de dfendre ses sujets chinois lentre de ses provinces
ancestrales. En 1867 la porte de la Mandchourie commena sentrouvrir ; en
1878 elle souvrit dfinitivement. A partir de 1900, pour lutter contre la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
235
menace russe, limmigration fut non seulement tolre mais encourage. A
cette date Moukden et Chirin taient dj des villes chinoises.
Il avait suffi que linterdit ft lev pour quune rue se pro duist. Lappel
dair tait en effet irrsistible des terres surpeuples de la Chine
septentrionale vers les terres vierges de Mandchourie. 250 habitants au
kilomtre carr dans la Grande Plaine, 27 en Mandchourie. Ctaient surtout
le Ho-pei et le Chan-tong qui fournissaient les migrants, ceux du Ho-pei
cheminant par le seuil de Yong-ping et la passe de Chan -hai-kouan, ceux du
Chan-tong (les plus nombreux) sembarquant Kiao -tcheou ou Tche-fou
pour Dairen. Il y eut l un rush analogue celui qui, au milieu du XIXe sicle,
a fait la fortune de lancienne Prairie amricaine et du Canada. De fait, les
gographes se sont plu montrer lanalogie des deux contres. La plaine
centrale de la Mandchourie, crit Cressey, ressemble celle de lIowa, de
lIllinois et du Kansas et le Nord au Canada. La Mandchourie allait donc
tre la Chine ce que les pays louest des Grands Lacs furent il y a un sicle
pour la Nouvelle-Angleterre.
Seulement ici ce furent les trangers qui se trouvrent les animateurs du
mouvement. Quand les Russes eurent tendu leur protectorat de fait sur la
Mandchourie, protectorat quils exer crent de 1898 1904, ils entreprirent
dexploiter et de moder niser le pays et, cet effet, commencrent la
construction du rseau ferroviaire transmandchourien, destin drainer les richesses du pays depuis le Khingan jusqu Vladivostok, depuis Kharbin
jusqu Port -Arthur. Les Japonais qui aprs 1905 succdrent aux Russes dans
ce protectorat officiel ou officieux continurent leur uvre. Tandis que,
depuis 1911, la Chine se dbattait dans une affreuse anarchie, au milieu des
guerres civiles et des ravages de tous les aventuriers militaires, la
Mandchourie, grce, il faut bien le dire, ses tuteurs trangers, se trouva jouir
dune paix exceptionnelle. Banques russes et banques japonaises et ingnieurs
des deux pays sappliqurent doter le Canada mandchourien dun
outillage industriel et agricole de premier ordre. A leur instigation les autorits
locales favorisaient limmi gration par des mthodes imites de celles de la
prairie canadienne ou de lArgentine. Dans le Nord mandchourien par
exemple, lad ministration affermait souvent des lots de terres pour des prix
purement nominaux et mettait elle-mme les instruments agricoles la
disposition des immigrants. Si lon songe qu la mme poque (1911 -1941)
la province de Chan-tong, jadis si riche, aurait, du fait des annes de famine,
comme en 1926-1928, et aussi des guerres civiles incessantes, perdu ou vu
fuir prs du cinquime de sa population, on ne stonnera plus des chiffres de
limmigration chinoise au Mandchoukouo : 295.000 en 1925 et 836.000 en
1927, en ne tenant comte que des immigrants dfinitivement rests dans le
pays, soit pour les seules annes 1923-1929, 2.859.000 colons.
Vers 1905 la Mandchourie ne comportait encore quune popu lation de
8.500.000 mes. Elle a atteint 24 millions en 1926, 30 millions en 1932, 38
millions en 1941. Llment chinois re prsente le 95 % de ce total, le reste
tant constitu par 2 millions de Mandchous (Tongous), 200.000 Japonais et
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
236
600.000 Corens. La superficie des terres cultives qui ntait que de
6.662.421 hectares en 1915, tait dj en 1932 de 12.516.000 hectares,
double en moins de vingt ans.
On arrive donc cette conclusion paradoxale que la modernisation de la
Mandchourie par les Russes et les Japonais a avant tout profit aux Chinois.
Ce ne sont ni les moujiks ni les paysans nippons qui ont bnfici de la mise
en valeur de ces terres vierges, mais les migrants du Ho-pei et du Chan-tong.
La proclamation de ltat du Mandchoukouo en 1932 a paru constituer
une grave mutilation politique au dtriment de la Chine. Elle a, en ralit,
consacr un des plus notables accroissements dmographiques de la race
chinoise au cours des sicles.
En Indochine limmigration chinoise remonte au XVII e sicle. En 1679,
3.000 Chinois du Sud, compromis dans la rvolte de Wou San-kouei contre
les Mandchous, abordrent en Annam, Tourane, sur cinquante jonques. Les
Annamites les tablirent en Cochinchine, Bien-hoa et Mytho. Dans les
dernires annes du XVIIe sicle, dautres migrs chinois, venus de la rgion
cantonaise, stablirent, avec lautorisation des fonctionnaire s annamites,
Hatin, Rachgia et Camau. Cette colonie sest accrue depuis 1859 de
nouveaux migrants venus du Fou-kien et de la rgion cantonaise, et
aujourdhui elle atteint le chiffre de 203.000 mes pour la seule Cochinchine,
sans parler des 95.000 Chinois du Cambodge. Limmigration reste, on le
voit, infiniment moindre que celle qui est venue peupler la Mandchourie.
Aussi bien ne reprsente-t-elle nullement lexode en masse de fermiers et
dou vriers agricoles. Cest une immigration de commerant s. Tout au plus
sadonnent -ils aussi aux cultures marachres ou celle du poivrier dont ils
ont dailleurs acquis le monopole. Cholon (avec 48 % de la population de
race Cleste) est le chef-lieu de cette colonie chinoise de Cochinchine. Les
immigrants chinois y furent nagure parqus comme dans un ghetto par les
empereurs dAn nam. Ils en ont fait aujourdhui une ville daffaires dont les
banques contrlent presque tout le march du riz cochinchinois. Depuis le
moment o le paddy a t coup jusqu l instant o le riz part de Saigon, note
Etienne Dennery, la plus grande partie de la production ne quitte plus les
entreprises chinoises. Ce sont les Chinois qui possdent une bonne partie
des rizeries et la presque totalit des grosses jonques paddy. Ce sont eux qui
se sont rendus les intermdiaires indispensables entre le producteur annamite
et lEuropen. A Saigon mme, llment chinois repr sente 27 % de la
population.
Ici encore le Chinois, dans ses colonies sans drapeau, se trouve le
bnficiaire de la colonisation officielle des autres peuples. Cest, nous
lavons vu, pour le paysan du Chan -tong ou du Ho-pei que la Russie, puis le
Japon ont grands frais modernis la Mandchourie. De mme cest en partie
pour le commerant cantonais install Cholon que la France risque
finalement davoir trans form la Cochinchine. Quant au Siam, les Chinois y
sont depuis le XVIIe sicle fortement tablis. Phaya Tak, le librateur de ce
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
237
pays aprs loppression birmane (1769), tait un mtis sino -siamois et de nos
jours Bangkok compte 32 % de Clestes.
Dans la Malaisie britannique, limmigration chinoise prsente un troisime
aspect. Il sagit ici dune main -duvre destine fournir les dfricheurs de la
fort vierge, les planteurs dhva et les mineurs des mines dtain. Le
mouvement, qui na pris une srieuse importance quau commencement du
XXe sicle, donne aujourdhui un chiffre de 350.000 immigrants chinois
dbarquant annuellement Singapour. Arrivs comme manouvriers, nombre
de ces nouveaux venus parviennent la fortune : beaucoup de plantations de
caoutchouc, beaucoup de mines dtain se trouvent dj entre leurs mains. A
Singapour quelques-unes des plus grosses fortunes sont chinoises. De
grands commissionnaires chinois, note Etienne Dennery, rivalisent pour la
conqute du march extrme-oriental avec les commissionnaires anglais ou
hollandais... Dans les grosses automobiles qui vont Singapour du quartier
des rsidences au quartier des affaires ou au quartier des plaisirs sont assis
maintenant plus de Chinois que dEuropens. En 1930 la Malaisie
britannique comprenait 1.534.000 Chinois et Singapour les 74 % de la
population savraient chinois. La proportion est moindre dans les Indes
nerlandaises o Batavia nen a que 17 % et o ils ne s ont, pour toute lle de
Java, que 650.000, ce qui est peu par rapport aux 36.900.000 habitants de lle,
ce qui est davantage si lon considre leur rle dans la vie commerciale du
pays. A Borno ils sont 250.000, rpartis entre les diverses stations ctires.
Aux Philippines ils ne sont que 55.000 mais ils reprsentent les 12 % de la
population de Manille. Dans ces rgions, ils monopolisent toute une srie de
mtiers et entre les blancs vous au rle daristocratie et les indignes, ils
tendent faire figure de bourgeoisie commerante.
Enfin les Chinois ont essaim dans toute la Polynsie o ils sont 5.000,
cantonns dans le petit commerce. Aux Hawa o le pavillon amricain couvre
65 % dAsiatiques, ils sont 25.000. Mais nous sommes ici sur la route des
tats-Unis, et des lois svres arrtent limmigration jaune ...
Lexpansion de la race chinoise sur toutes les ctes du Paci fique ne fait
que commencer. Srieusement entrave aujourdhui par le protectionnisme
ethnique des nations anglo-saxonnes, elle marque un temps darrt. Il nen est
pas moins vrai qu lheure o sachevait la colonisation intrieure de la
Chine, une Chine Extrieure venait de natre, de Cholon Singapour, de
Batavia Honolulu. Le fait est dautant plus remarquable que, linverse des
colonies europennes ou japonaises, ces colonies sans drapeau ont toujours t
ignores du gouvernement imprial et que la rpublique chinoise na gure eu
le loisir de soccuper delles. Et cependant telle est dj leur importance
quelles ont ragi sur la mre patrie au point davoir dtermin la
transformation de celle-ci. Cest en effet la Chine Extrieure qui, dans la
personne de Sun Yat-sen, son reprsentant qualifi, a renvers lempire mill naire et provoqu la rvolution de 1912. Cette Chine ultra-moderniste de
Cholon et de Singapour, cest elle qui aujourdhui entrane les XVIII
Provinces dans son sillage.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
238
Toutefois rien ne dit que les barrires dresses devant lmi gration
chinoise par les actuels matres de la mer seront de longtemps leves. Or, dans
ltat prsent de lconomie chinoise, la surpopulation des XVIII Provinces
est vidente, et la Mandchourie ne peut tout absorber. Quelles solutions
envisagent les conomistes ?
Tout dabord une transformation profonde des procds agri coles en vue
dun rendement suprieur des rcoltes. La Chine, crit George Cressey, se
trouve en prsence dun grand problme : ou rduire radicalement le nombre
de ses habitants ou accrotre trs sensiblement sa production. Car pour les
denres alimentaires, la production, malgr son intensit, reste encore
infrieure la consommation locale. Il y a mme l comme un apparent
paradoxe. Lexemple le plus frappant est celui du riz qui forme la base de
lalimentation dans toute la Chine centrale et mridio nale (99). Le rendement
moyen qui est de 54 boisseaux lacre, soit 4.403 kilos lhectare, est deux
fois plus lev que la moyenne mondiale. Et cependant depuis de nombreuses
annes la production sest rvle insuffisante p our les besoins de la
population et la Chine a d importer des quantits considrables de riz de
lIndochine, du Siam et de la Birmanie. En ralit la contradiction nest
quapparente. Le paysan chinois a beau, par un labeur inou, faire rendre ses
rizires plus que la moyenne mondiale, son obstination nexploiter que les
valles rduit singulirement laire cultive. De plus le pitre tat des
communications intrieures diminue, en cas de famine locale, le moyen de
ravitailler rapidement avec laid e des provinces indemnes les provinces frappes. De mme pour le bl qui constitue laliment principal des provinces du
nord : production insuffisante et ncessit dimporter des bls du Canada et
des tats-Unis (100).
Quels sont les obstacles qui entravent le rendement de lagri culture
chinoise ? Tout dabord, le morcellement (heureux dautres gards) de la
proprit. Ce morcellement, sil continuait une allure acclre, risquerait,
du fait du surpeuplement, de devenir un flau. La parcelle thorique de terrain
par tte dhabi tant qui, si nous nous fions aux statistiques, tait de 57 ares 75
en 1578, est tombe 26 ares 20 en 1661, 20 ares 35 en 1766 pour
descendre jusqu 12 ares 45 en 1872 et se relever 15 ares 90 en 1916. Or,
les statistiques estiment par ailleurs quaux taux de natalit actuels des
familles paysannes la population doit doubler en soixante-dix ans. On
arriverait alors la moyenne thorique, vraiment drisoire, dune proportion
de 8 ares par habitant. Le morcellement qui prive lagriculteur de tout capital,
explique sa routine, routine qui elle-mme maintient, en dpit dun labeur
acharn, un rendement insuffisant du sol. Nous avons signal la pire de ces
routines, celle qui, dans le Sud, pays de collines, consiste ne cultiver que les
valles, soit seulement 12 % du terrain. Une seule exception : le Bassin Rouge
du Sseu-tchouan ; l les pentes des collines ont t, par un effort dailleurs
admirable et qui remonte lantiquit, amnages en terrass es o un ingnieux systme dirrigation a permis dtager les rizires. Si cet exemple tait
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
239
suivi dans les autres provinces mridionales, des surfaces fort vastes
pourraient tre rcupres pour les cultures alimentaires.
Au nord-ouest, sur les collines de lss, notamment au Kan -sou, les pentes
sont, par la mme exception quau Sseu -tchouan, souvent bien cultives.
Mais par une trange fatalit ce soin mritoire a, du fait dun dboisement
intensif, tourn ici contre ses auteurs. Dans les districts o les forts avaient
par bonheur t pargnes, note Cressey, les habitants se sont mis les
dtruire systmatiquement pour tendre leurs cultures, mais sur les pentes trs
inclines ils ne peuvent faire plus de trois rcoltes, cinq au maximum, aprs
quoi les ravages de leau sont tels que toute nouvelle culture devient
impossible. Cest alors un vritable dsastre car les terres entranes par les
pluies descendent dans les valles o elles recouvrent les champs cultivs et
les rendent entirement impropres la culture. Il suffit de cinq ans pour
transformer une belle valle dont les habitants menaient une existence
prospre et qui tait arrose par un cours deau aliment par des collines
couvertes darbres, en une terre de misre et de dsolation.
La premire condition du salut agricole et partant dmographique de la
Chine est la rconciliation du Chinois avec larbre. Mais pour cela il devra
renoncer des habitudes plusieurs fois millnaires.
Le mme traditionalisme mal entendu nuit gravement la Chine sur le
march commercial et entrave lexportation. Le th chinois est peut -tre en soi
le meilleur du monde. Mais comme il continue tre prpar selon des
procds archaques, il se trouve victorieusement concurrenc par les ths de
Ceylan ou de lA ssam plus chargs de tannin parce que traits en usine (101).
De mme pour la soie : faute de mthodes rationnelles pour lutter contre les
maladies du mrier, le paysan chinois laisse ses races de vers soie dgnrer
au profit du bombyx japonais. Notons dailleurs que, malgr sa routine, ce
mme paysan sait parfois rvolutionner assez heureusement ses mthodes :
lexemple en est fourni par la facilit avec laquelle il a su sadapter la
culture du coton qui, cependant, na dbu t ici quau XIII e sicle (elle est
venue alors du Turkestan par le Kan-sou). Elle donne aujourdhui
principalement au Hou-pei et dans la Grande Plaine un rendement annuel
den viron cinq cent mille tonnes, production qui vient immdiatement aprs
celles des tats-Unis et de lInde. Il est vrai que la fibre du coton chinois est
assez grossire et gagnerait, elle aussi, tre amliore.
Enfin les agronomes se sont demand si le sol chinois, du fait mme de
leffort trois fois millnaire exig de lui, ne serait pas en train de spuiser.
Des amendements tels que la marne seraient peut-tre ncessaires pour
renouveler la fertilit de la Grande Plaine. De mme le Sud, dpourvu de
btail autre que le buffle des marais, aurait sans doute besoin de pratiquer en
grand lim portation des engrais. Ces problmes, qui se posent galement
lagronomie europenne, revtent ici, du fait du danger de famine, une
particulire acuit.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
240
Non moins vital est en un pays ce point menac par la disette le
problme des communications.
Il ne se prsente pas aujourdhui autrement que dans lantiquit ou au
moyen ge. Rien de plus suggestif que la comparaison dune carte routire
lpoque song par exemple et du rseau ferroviaire actuel, condition quon
ajoute pour ce dernier aux lignes exploites les lignes en construction ou en
projet.
La carte routire chinoise qui na gure chang depuis les Song (X e-XIIIe
sicles) nous suggre une fois de plus un contraste absolu entre la Chine du
Nord le royaume du bl et du millet o le Fleuve Jaune reste
pratiquement rebelle la navigation, et la Chine centrale le royaume du riz
o le Yang-tseu, comme la bien observ Marco Polo, constitue une des
plus admirables artres commerciales qui soient au monde. Dans le nord, la
carte le montre, le commerce doit se faire par voie de terre ; sur le Yang-tseu,
la voie deau suffit. La grande route impriale du nord, destine suppler la
carence du Fleuve Jaune, court horizontalement dest en ouest. Elle a son
centre Kai -fong, grenier de la Grande Plaine, do la route impriale
descend lest jusqu lembouchure du Yang -tseu, et do elle remonte
louest vers Tchang -ngan et les relais du Kan-sou : l elle rejoint les pistes de
lAsie centrale, lancienne route de la soie. A df aut du Fleuve Jaune qui se
refuse au rle dintermdiaire entre les provinces quil traverse, cette route
est-ouest met en communication le riz et les pcheries du bas Yang-tseu, le bl
et le millet du Chen-si et du Ho-nan. Au contraire, dans la Chine centrale et
mridionale pas de route est-ouest. Au centre, comme nous le disions, la voie
deau suffit ; au sud, le moutonnement des plis siniens coupe, sauf pour le Sikiang, toute communication dans le sens latitudinal.
Ds le moyen ge la carte routire de la Chine comporte quatre grandes
voies de pntration nord-sud qui mettent en communication les trois Chine :
Chine du bl au nord, Chine du riz au centre, Chine tropicale de la canne
sucre au midi. Ces quatre Nord-Sud , sensiblement parallles, sont de lest
louest : 1 Une route parallle elle-mme au littoral et qui dessert la partie
orientale de la Grande Plaine, de Pkin Tsi-nan du Chan-tong et, de l,
lembouchure du Yang -tseu ; elle parcourt ensuite la rgion o slvera
Chang-hai, dessert Hang-tcheou, Fou-tcheou et trouve son terminus
Tsiuan -tcheou du Fou-kien, le aiton de Marco Polo. 2 Une branche de cette
route sen dtache prs de Siu -tcheou, au Kiang-sou, gagne au sud les bords
du lac Po-yang, remonte la valle longitudinale du Kiang-si, puis, par le
clbre col de Mei-ling, redescend vers la cte cantonaise. 3 Un autre
nord-sud dessert la bande occidentale de la Grande Plaine, de Pkin Kai fong, ville qui est longtemps reste la rgulatrice du rseau routier et o
cette route coupe en effet angle droit la grande artre est-ouest dont nous
parlions tout lheure. Aprs Kai -fong la route en question gagne le lac
Tong-ting, remonte la valle longitudinale du Hou -nan et vient dboucher,
elle aussi, sur la rivire de Canton. 4 Enfin louest une voie de pntration
partie de Tchang -ngan franchit successivement les monts Tsin -ling et le
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
241
Ta-pa-chan et sengage ensuite travers le rseau alpestre du Sseu -tchouan
pour aboutir au Bassin Rouge et la fameuse plaine agricole de Tcheng -tou.
Cette dernire voie, malgr ses difficults daccs, prsente une
importance considrable, puisque cest elle qui arrache le Bassin Rouge son
isolement et rattache sa production la Chine du Nord comme la navigation
fluviale sur le Yang-tseu le rattache aux grands ports de la Chine centrale. Un
cas un peu analogue est celui des terrasses de lss du Chan -si, de longue date
centres mtallurgiques importants, mais, elles aussi, assez lcart des grands
courants. Elles sont attaques par deux voies, dj bien indiques sur les cartes
song : un nord-sud local qui, courant depuis Ta-tong, prs de la Grande
Muraille, jusquau grand coude du Fleuve Jaune, suit le sillon longitudinal de
la rivire Fn ; et une voie de pntration qui, partie de la plaine du Ho-pei
hauteur de Tcheng-ting, escalade les passes des monts Tai -hang et rejoint
angle droit, Tai -yuan, le nord-sud prcit.
Regardons maintenant la carte ferroviaire de 1941. Cest exac tement la
mme, du moins si lon sen tient aux lignes projetes. Car ltat actuel du
rail, sil cherche suivre le rseau des routes mdivales, est loin dy tre
parvenu.
Deux grands nord-sud, calqus sur lancien systme routier, vont lun de
Pkin Nankin et Hang-tcheou, mais pour sarrter peu aprs, au sud de
Ning-po (un embranchement relie Hang-tcheou au lac Po-yang) ; lautre ligne
va de Pkin Tcheng-tcheou (entre Kai -fong et Lo-yang), puis Han-keou,
do, par le lac Tong -ting, le rail atteint Tchang -cha et Heng-yang ; aprs
avoir pass louest du col de Mei -ling, il descend ensuite la valle de la
rivire Pei-kiang jusquau terminus de Canton. Depuis 1936, le
Pkin-Canton est achev.
Les terrasses du Chan-si, plus importantes que jamais du fait de leur
richesse en charbon et en fer, sont, comme par les anciennes routes, desservies
par un triple rail : 1 un nord-sud depuis Ta -tong ou plutt Tai -yuan, qui
descend le sillon de la Fn et atteint le coude du Fleuve Jaune ; 2 un tronon
ouest-est qui coupe Tai -yuan la ligne prcdente et la relie la grande
verticale du Ho-pei occidental ; 3 un second tronon ouest-est, plus septentrional, qui relie Ta-tong Pkin, vi Kalgan.
Dest en ouest court un premier Transchinois. Cette voie ferre, qui suit le
trac de lanci enne chausse impriale, va de la cte mridionale du
Chan-tong Tchang -ngan vi Kai -fong et Lo-yang. Cest actuellement la
seule voie de pntration en profondeur, la seule artre qui desserve le
nord-ouest chinois, les avenues du Turkestan oriental.
Quant au Yang-tseu, la remonte en est aujourdhui assure la grande
navigation rgulire jusquaux rapides de Yi -tchang et mme aux petits
steamers jusqu Souei -kiang, au fond du Sseu-tchouan. Comme au moyen
ge, sa navigabilit a sembl rendre inutile son doublement par voie de
terre.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
242
Comme on peut le constater, les voies ferres chinoises sont encore loin de
recouvrir partout le trac des anciennes routes mdivales. Il sen faut que
toutes les provinces soient desservies. Presque toute la Chine occidentale,
presque toute la Chine du Sud restent encore sans chemins de fer (102). Ce
retard nous oblige dail leurs suspendre notre jugement sur la plupart des
problmes prcdemment poss. On ne saurait se rallier aux conclusions pessimistes de certains sur lavenir conomique de la Chine tant quelle naura
pas t enfin dote dun rseau ferroviaire lui per mettant dexploiter ses
immenses richesses et den assurer tout dabord une meilleure rpartition entre
ses provinces.
Cette rserve est dautant plus ncessaire que lindustrialisation de la
Chine, actuellement ses dbuts, est appele modifier toutes les donnes du
problme. Si nous en croyons certaines statistiques, la Chine (spcialement la
Chine du Nord, Ho-pei, Chan-tong, Chan-si, Ho-nan) serait le troisime pays
du monde pour lim portance des rserves de houille, savoir 996.613 millions
de tonnes mtriques, venant immdiatement aprs les 3.838.657 des tats-Unis et les 1.234.269 du Canada, et bien avant les 189.533 de
lAngleterre (103). Il est vrai quil sagit l dune valuation optima et quun
calcul rectifi donne le chiffe, singulirement diffrent, de 246.081 millions.
Mais mme dans cette dernire estimation la rserve chinoise serait encore
bien plus considrable que celle de nos patries europennes. Il y a l de quoi
animer sans compter pendant des sicles une industrie formidable une
poque o beaucoup de nos gisements europens commenceront sappau vrir. Dautre part le fer existe aussi, quoique en quantits beaucoup moindres.
Daprs les statistiques de Tegengren, il y aurait, comme rserves reconnues
en minerais de fer, 396 millions de tonnes et, comme rserves possibles,
555.700.000 tonnes. Il est vrai que la plupart de ces gisements sont faible
teneur (35% de fer). Cependant les mines de Ta-ye accusent une teneur en fer
de 58 % et, de surcrot, elles ont la chance dtre situes pro ximit des hauts
fourneaux de Han-yang.
Car lentement, en dpit des rvolutions et des guerres, lin dustrie chinoise
se cre sous nos yeux, notamment autour de Chang-hai, de Tsing-tao, de
Han-keou et, en raison de la proximit des houillres, jusquau Chan -si
oriental. Sans doute une partie de ces industries les chantiers navals et les
filatures de coton de Chang-hai par exemple sont-elles en majorit dues
linitiative de capitaux trangers. Mais dj les hauts fourneaux de Han -yang,
capables aujourdhui de produire un million de tonnes de fonte par an, ont t
construits avec des capitaux indignes. Du reste, cest par des dbuts
analogues, sous le contrle de techniciens trangers, qua dbut il y a une
cinquantaine dannes la grande industrie japonaise qui exporte aujourdhui
ses produits sur la moiti de la plante. Que sera-ce quand lexemple japonais
aura t suivi en grand par les quatre cents millions de Chinois ? Le moins que
lon puisse dire, cest que les rserves du sous -sol chinois et les tonnantes
capacits de louvrier chinois feront de la Chine, dans la lutt e industrielle du
XXIe sicle, une concurrente redoutable. Les Puissances qui lont rveille et
outille pourraient bien lavoir outille contre elles.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
243
Au terme de cette histoire de plus de trente sicles, que conclurons-nous ?
Par quels points de repre jalonner cet immense pass ? Si nous posions la
question aux rudits chinois, ils nous inviteraient sans doute nous reporter
la liste, singulirement brve, de ceux de leurs souverains qui, au cours de
lhistoire, sesti mrent dignes doffrir le sacrifice fong .
Ctait la crmonie la plus auguste de lantique religion imp riale,
clbre dans la province du Chan-tong, sur le sommet du Tai -chan, la
montagne la plus leve de la Chine orientale qui, de ce fait, dans la croyance
populaire, assurait la fermet du sol, la rgularit des pluies fcondantes,
larrive des mes au berceau, le dpart des mnes lheure de la mort.
Lempereur ne gravis sait le suprme sommet que pour sentretenir
directement avec la divinit, lui annoncer que lempire jouissait du calme, et
la dynastie du mandat cleste. Or, ce tmoignage solennel, cinq souverains
seulement ont, au cours des sicles, cru pouvoir en assumer la responsabilit,
et les annales chinoises les numrent avec respect : ce furent lempereur
Wou-ti, lhomme fort de la premire dynastie Han, en 100 avant J. -C., quand
la Pax Sinica fut par lui tablie sur presque toute lAsie orientale ; puis
lempereur Kouang Wou -ti en 56 de notre re, quand les Han eurent t par
lui restaurs pour deux sicles de gloire ; puis les empereurs Kao-tsong et
Hiuan-tsong, en 666 et 725, deux dates o la Chine des Tang apparaissait
comme la matresse de lAsie ; enfin lexcellent empereur Tchen -tsong en
1008, lorsque la dynastie des grands Song eut rtabli lunit c hinoise et une
longue paix.
Depuis lors depuis neuf cent trente-quatre ans aucun chef dtat
chinois, non pas mme les Ming, pourtant si favorables aux divinits du Tai chan, nestima pouvoir se confronter avec le dieu qui prside la stabilit du
sol comme la naissance et la mort des gnrations. Mais par-del dynastes
et dynasties, plus ancien mme que le culte des sages confucens, celui de la
montagne demeure, et dinnombrables plerins continuent gravir le sommet
sacr pour obtenir la fcondit de leur foyer et de leur champ. Existe-t-il
meilleur symbole dune stabilit et dune conti nuit qui survivent toutes les
vicissitudes de lhistoire, la sta bilit de cette patiente race de paysans, la
continuit du labeur obstinment poursuivi sur cette mme glbe depuis plus
de trois millnaires ?
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
244
CHAPITRE 34
volution de la situation en Chine de 1945 1951
Lesprit de rsistance dont avait fait preuve, dans lensemble, pendant la
dernire invasion japonaise, le gouvernement de Tchong-king , lincontestable
dignit morale de Tchiang Kai-chek et la capitulation du Japon devant les
forces de Mac Arthur (14 aot-2 septembre 1945) faisaient de la Rpublique
Chinoise une des Grandes Puissances victorieuses de la seconde guerre
mondiale. Avant mme la victoire finale, Tchiang Ka-chek avait t reconnu
lun des Quatre Grands par Roosevelt la confrence du Caire o celui-ci
lavait convi (21 novembre 1943). Il est vrai qu la confrence de Yalta
laquelle le Prsident de la Rpublique Chinoise ne fut pas invit, Roosevelt,
au risque de compromettre lintgrit territoriale de la Chine, engagea Staline
faire occuper la Mandchourie (11 fvrier 1945). Lors de leffondrement
japonais, les Russes pntrrent donc dans lancien Man-tchou-kouo ,
firent capituler larme japonaise locale et occuprent Kharbin et Moukden
(19 aot 1945), puis Dalny (Dairen, Ta-lien) et Port-Arthur (22 aot).
Pralablement dailleurs (14 aot 1945) un accord entre Tchiang Kai -chek et
les Soviets avait stipul que ces derniers remettraient ensuite la Mandchourie
la Chine, mais quils conserveraient pour trente ans, en proprit commune
avec elle, les chemins de fer mandchouriens et quils utiliseraient, gale ment
en commun avec la Chine, les ports de Dalny et de Port-Arthur.
A cette exception prs qui, en Mandchourie, semblait rtablir en faveur
des Russes la situation privilgie des annes 1897-1904, le nationalisme
chinois voyait toutes ses revendications satisfaites. Au cours de la seconde
guerre mondiale les Nations Libres comme les Puissances de lAxe avaient
renonc, les premires en faveur de Tchiang Kai-chek, les secondes en faveur
de Wang Tsing-wei, aux privilges dexterritorialit, ou comme disaient les
Chinois, au bnfice de la lgislation semi-coloniale et des traits
ingaux . Dautre part, aux termes de la capitulation japonaise, Mac Arthur
obligea le Japon, aprs une occupation dun demi -sicle (1895-1945),
rtrocder la Chine lle de Formose.
Tchiang Kai-chek et le gouvernement du Kouo-min-tang semblaient leur
apoge. Do vient que, moins de quatre ans aprs, ils aient t balays du sol
chinois ? Il faut incriminer dabord la politique financire du Kouo -min-tang,
sa politique agraire ensuite. Quelles que fussent lintgrit pe rsonnelle et la
bonne volont de Tchiang Kai-chek (et elles sont hors de cause), son
entourage ne faisait pas preuve du mme dsintressement. Les principaux
argentiers du rgime taient les deux beaux-frres de Tchiang, T. V. Song et
H. H. Kong, financiers habiles certes (le consortium de banques et les trusts
dentreprises que chacun deux dirigeait ralisrent de fabuleux bnfices),
mais avec eux la dmocratie de Kouo-min-tang se voyait couronne par une
vritable ploutocratie o les affairistes manuvr aient les ressorts de la po-
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
245
litique. Aux chelons infrieurs de ladministration stalait une effroyable
vnalit. Une inflation catastrophique fit passer le dollar amricain de 600
dollars chinois en 1945 12 millions en aot 1948, date aprs laquelle les prix
augmentrent encore de 810%.Instabilit montaire et inflation, ctaient les
causes mmes qui, dans le pass, avaient dconsidr les plus puissantes
dynasties chinoises (notamment, on la vu, la dynastie des Yuan sous
Qoubila).
Les Amricains, qui avaient envisag un plan grandiose pour la mise en
valeur du sol chinois et loutillage industriel de la Chine, avaient livr sans
compter au gouvernement du Kouo-min-tang armes, surplus , capitaux
prts fonds perdus. Ces avances semblaient disparatre dans un gouffre. Pis
encore. Le nationalisme chinois accusait les conseillers techniques amricains
de prparer, sous prtexte daide, une vritable colonisation cono mique du
pays. Le gnral Marshall, venu en 1946 pour mettre de lordre dans les
affaires chinoises, rentra en Amrique en janvier 1947, dcourag, avec la
conviction que le Kouo-min-tang se drobait toute rforme. Sur ses conseils,
les tats-Unis allaient se dsintresser de la question chinoise et abandonner
le gouvernement de Tchiang Kai-chek son sort. Ctait abandonner aussi la
Chine au communisme, laisser passer les 450 millions dhommes dans le
camp sovitique.
Le gouvernement du Kouo-min-tang navait pas pratiqu une politique
agraire moins dsastreuse. Il avait laiss se reconstituer au dtriment de la
petite proprit rurale cette plaie priodique de lhistoire conomique
chinoise : les latifundia. Dans les campagnes (et prs des 80 % de la
population chinoise sadonnent lagriculture), il avait, pour les commodits
de sa gestion, dsign comme dlgus, investi de lautorit administrative et
prpos la leve de limpt les hobereaux ou grands propritaires fonciers
qui, jouant ainsi le rle de nos anciens fermiers gnraux , se servaient les
premiers au dtriment du fisc comme de la paysannerie. De plus, ces
hobereaux ou leurs agents prtaient sur gage de rcolte aux petits
propritaires, fermiers ou mtayers, avec intrts de 30, 50, voire 100 %, puis
saisissaient et expropriaient le dbiteur insolvable, ainsi rduit, souvent avec
des contrats de famine, la condition de serf de la glbe. Comme aux plus
mauvais jours de lhistoire chinoise, la terre (au Ho -nan et au Chan-tong par
exemple) tendait par ce processus tomber entre les mains dun petit nombre
de familles privilgies, constituant une fodalit nouvelle au-dessus dune
paysannerie prive de tout droit, taillable et corvable merci. Dans les
provinces maritimes, autour des grandes villes amricanises, les hommes
daffaires en relation avec ltr anger, les compradores, plaaient, eux aussi,
leurs bnfices en proprits foncires, accroissant dau tant ltendue des
latifundia. Or, nous lavons vu (et Henri Maspero la dmontr), ctait la
plaie qui, priodiquement, des Han aux Ming, avait ruin la popularit et
prpar la chute des plus grandes dynasties chinoises.
Pendant ce temps, le parti communiste avait sa tte un politique raliste,
Mao Tse-tong (ou mieux Mao Ts-tong). N au Hou-nan, en 1886, dune
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
246
famille de paysans moyens, Mao avait t conduit aux doctrines marxistes par
ltude du problme agraire, comme le rappellent ses applications ( La
nouvelle Dmocratie, 1940 ; La dictature du peuple, 1945). Pote ses heures
(Pomes du sable et du vent), ctait surtout un organisateur, un ent raneur
dhommes, un soldat nergique. Lors de la chute de lphmre rpublique
communiste du Kiang-si, il avait conduit ses dernires troupes depuis cette
province mridionale jusqu Yen -ngan, dans lextrme nord de la province
septentrionale du Chen-si. Ce fut la Longue Marche (10.000 kms) qui
avait dur doctobre 1934 octobre 1935. A Yen -ngan, dans la zone frontire
au seuil de la Mongolie Intrieure, Mao avait ensuite particip la lutte contre
les troupes japonaises doccupation, organisant co ntre elles, au Chen-si et au
Chan-si, une efficace gurilla. Aprs la victoire commune, il rompit
dfinitivement avec le gouvernement de Tchiang Kai-chek et la guerre civile
commena.
Prenant le contre-pied de la politique agraire du Kouo-min-tang, Mao
Tse-tong, autour de Yen-ngan, puis dans tous les districts dont il acqurait le
contrle, rduisait, suivant les cas, 15 ou mme 5 % lintrt des
hypothques rurales et contraignait les landlords cder une partie de leurs
terres aux paysans quil grou pait ensuite en coopratives agricoles. Cette
adroite politique agraire lui valut, contre les armes du Kouo-min-tang, la
complicit de la paysannerie dans les provinces du nord. Le 22 janvier 1949, il
sempara de Pkin, ville laquelle il rendit son rang de capitale et o, le 30
septembre, il allait tre lu prsident de la Rpublique populaire chinoise .
Etait-ce la vieille division entre le Nord et le Sud qui allait recommencer, Mao
Tse-tong gouvernant Pkin, tandis que Tchiang Kai-chek continuerait gouverner Nankin ? De fait, entre les deux Chines, le bas Yang-tseu, large
comme un bras de mer, aurait pu constituer une barrire srieuse pour peu que
laviation amricaine en et interdit le passage. Mais les Amricains,
conformment aux directions du gnral Marshall, se dsintressaient de la
question... Le Yang-tseu fut donc travers sans difficult par les troupes de
Mao et Nankin fut occup les 23-24 avril 1949, Han-keou le 17 mai,
Chang-ha le 22 mai, Canton le 15 octobre, le Sseu-tchouan fin
novembre-dbut dcembre. En ce mme mois de dcembre 1949, Tchiang
Kai-chek se rfugia Formose.
Le Kouo-min-tang, par sa malheureuse politique agraire et financire,
navait pas seulement perdu le sol chinois. Il stait galement alin une
bonne partie de l intelligenzia, cette classe des lettrs qui a toujours exerc
une influence si dterminante sur lvolution politique chinoise. Vers 1945,
les intellectuels, les cercles de professeurs et dtudiants, de jour en jour plus
dtachs du Kouo-min-tang par lincapacit de celui -ci se rformer, mais
non encore rallis au communisme, eussent volontiers constitu un tiers parti.
On ne fit rien pour eux ... Ds 1947-1948, Mao Tse-tong obtint leur ralliement
en sentourant dun braintrust au premier rang duquel figuraient Kouo Mo-jo
et Tchou En-lai. Grand universitaire, archologue, historien, romancier, auteur
dramatique et pote, Kouo Mo-jo faisait depuis longtemps profession de
socialisme quand la nouvelle rpublique populaire chinoise lui confia la
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
247
direction de lducation nationale, en mme temps que les Beaux -Arts taient
attribus au directeur de lAca dmie de Pkin, le peintre Jupon (Siu Peiwong). Quant Tchou En-lai qui avait fait des tudes en France, sa
connaissance de lEurope allait tr e prcieuse au nouveau rgime.
Les Amricains avaient eu beau se dsintresser de lissue de la guerre
civile et abandonner dlibrment la Chine Mao Tse-tong, la victoire de
celui-ci nen plaait pas moins les 450 mil lions dhommes dans le camp
sovitique. Stant rendu auprs de Staline, Mao signa Moscou, le 14 fvrier
1950, un trait dintime alliance. Rorganise sur le modle russe par lui mme et par son ministre de la Guerre, Tchou T, larme chinoise fut bientt
assez forte pour intervenir dans la guerre de Core. A la fin de novembre
1950, quand Mac Arthur eut occup la capitale nord-corenne, Pyong-yang,
les divisions de volontaires chinois, commandes par le gnral Peng
Te-houai, franchirent en masse le Yalou, surprirent les colonnes amricaines
et les refoulrent jusquau -del de Soul, ville qui fut occupe par les
Sino-Corens le 4 janvier 1951 et que les Amricains ne devaient recouvrer
que le 14 mars. Le coup de tonnerre produit par cette intervention annonait
que les rapports de forces entre continents entraient dans une phase nouvelle,
quune nouvelle priode de lhistoire du monde venait de commencer.
Ltroite symbiose russo -chinoise risque de bouleverser sur bien dautres
points la face de lAsie. Cest ainsi quau moment o sin terrompent les
relations maritimes entre la Chine et lOccident, comme entre la Chine et
lAmrique (les installations indus trielles de Chang-ha viennent dtre
dmnages vers lintrieur), la mise en valeur du Sin -kiang (Kachgarie ou
Turkestan Chinois) avec le concours dingnieurs russes tend faire revivre
les antiques pistes transcontinentales, la Route de la Soie. On sait lintrt
apport par les Soviets au dveloppement du Ferghna et du Smiretchi ou
Djty-sou, provinces de leur Turkestan Occidental situes la frontire du
Turkestan Chinois. Par l, les chemins de fer sovitiques arrivent aux
approches de la frontire chinoise ; les chemins de fer du Ferghna atteignent
le poste russe dAndidjan do le col du Trek -Davane conduit au poste
chinois de Kachgar ; plus au nord le chemin de fer du Turksib atteint le poste
russe dAlma -Ata, do, en remontant la valle de lIli, la route gagne le poste
chinois de Kouldja, puis, en sengageant entre les plissements des Monts
Clestes, la ville dOuroumtsi ou Ti houa, chef-lieu du Sin-kiang. Des deux
cts de la frontire, lamnagement dautostrades est maintenant poursuivi
avec activit, dautant que les champs ptrolifres et sans doute aussi les
gisements duranium du Ferghna se continuen t en territoire chinois, du ct
dOuroumtsi. Lautostrade ne fait dailleurs quan noncer ici la construction du
futur chemin de fer transasiatique qui reliera un jour la gare dAndidjan ou
dAlma -Ata, terminus russe, la gare de Si-ngan-fou ou Tchang -ngan, au
Chen-si, terminus chinois. Ltroite symbiose entre les Soviets et la nouvelle
Rpublique populaire chinoise va rveiller l des pistes tombes en sommeil
depuis le passage de Marco Polo, au temps de lempire gengiskhanide. Entre
le subcontinent chinois et lEurasie slavo -tartare la soudure est faite ; le vieil
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
248
empire mongolo-russo-chinois est reconstitu, et il bnficie cette fois, en plus
de sa continuit territoriale, du ciment dune commune idologie.
En mme temps, la rpublique de Mao Tse-tong a pris pied au Tibet. Ds
son avnement, elle disposait des sympathies dun des deux pontifes tibtains,
le Panchem-rimpoch ou Tachi-lama de Tachilumpo, traditionnellement
dress contre lautre pontife, le Dala -lama de Lhassa, ce dernier protg des
Anglo-Indiens. Mao envoya au Tibet un corps expditionnaire qui brisa la
rsistance des Tibtains Tchaomao (dcembre 1950) et occupa sans autre
difficult Lhassa. Devant linvasion, le Dala -lama stait enfui la frontire
indienne, du ct du Sikkim. Puis, aucun secours ne lui venant de Londres ni
du Pandit Nehru, chef du gouvernement indien, le Dala-lama regagna Lhassa
en aot 1951 en acceptant auprs de lui la prsence dune garnison chinoise
dont le chef, le gnral Tchang Tsing-wou, tait charg de conseiller le pontife
en matire de politique trangre : le protectorat de la Chine communiste tait
dsormais tabli au Tibet, et, par le rayonnement de lglise tibtaine, Mao
Tse-tong allait pouvoir un jour agir sur les populations lamastes de lIn de du
Nord, au Ladakh, au Npal, au Sikkim. Ctait lpoque de limprialisme
chinois en haute Asie qui semblait revenir, quand, la fin du XVIIIe sicle,
lempereur Kien -long, agissant comme protecteur de la papaut lamaque,
tait intervenu militairement au Npal. De mme lintervention ouverte du
communisme chinois en Core, son intervention plus ou moins avoue au
Vitnam nous ramnent lpoque de la plus grande expansion chinoise en
ces directions, sous les empereurs Tang ; aussi, en ce qui concerne le
Vitnam, au temps de lempereur Yong -lo, au dbut du XVe sicle, quand les
luttes entre partis annamites permirent aux armes des Ming dintervenir en
arbitres au Tonkin. Enfin pour la premire fois la Chine Extrieure, la Chine
coloniale, obit aux consignes venues de Pkin. En Malaisie par exemple,
autour de Singapour, cest la gurilla mene par les colons chinois qui tient en
chec les troupes anglaises. Ces vieilles colonies sans drapeau dont les
membres taient considrs par la Chine elle-mme comme des enfants
perdus, se rclament maintenant avec orgueil du nouveau drapeau chinois.
Rsumons dun mot ces rapprochements, symptmes du retour un pass
que la lgret des Europens de 1900 croyait aboli : en se plaant la tte
des nationalismes locaux, rvolts contre le colonialisme occidental ou
atlantique, la Chine de Mao Tse-tong reprend son compte le programme
millnaire de lexpansion chinoise en Asie. Lhistoire une fois lance ou
relance sur cette voie, que montrera nos petits-fils la carte de lan 2000 ?
Pour rpondre semblable question, peut-tre suffirait-il douvrir, telle ou
telle page bien connue de nous, les atlas historiques de lancienne Chine et de
ses dpendances, lpoque de ses plus conqurantes dynas ties ...
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
249
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
TABLEAU
DES
250
DYNASTIES
Chine du Nord (Bassin du Fleuve Jaune)
Dynastie des Hia, 1989-1558 ( ?).
Dynastie des Chang ou Yin, 1558-1050 ( ?).
Dynastie des Tcheou
1 Tcheou occidentaux (au Chen-si), 1050 ( ?)-771.
2 Tcheou orientaux (au Ho-nan), 770-256.
Priode des hgmons, VIIe VIe sicles.
Priode des Royaumes Combattants, Ve IIIe sicles.
Chine du Sud (Bassin du Yang-tseu et rgion cantonaise)
Dans le bassin du Yang-tseu, barbares Man en voie de sinisation (ils forment
notamment au Hou-pei le royaume de Tchou, 704-223). Plus au sud, Barbares
daffinits Tha, Miao -tseu, Lolo, etc.
Lempire unitaire :
Dynastie impriale des Tsin (Tsin Che Houang -ti et son fils), 221-207
Dynastie des Han (famille Lieou)
1 Han antrieurs, Tchang -ngan ou Si-ngan (Chen-si), de 202 avant J.-C.
lan 8 de notre re.
2 Usurpation de Wang Mang, 9-22 de notre re.
3 Han postrieurs, Lo-yang (Ho-nan fou), 25-220.
Morcellement : les Trois Royaumes :
1 Dynastie Wei (famille Tsao ) Lo-yang, 220-265.
2 Dynastie Wou (famille Souen) Nankin, 221-280.
3 Dynastie Han (famille Lieou) au Sseu-tchouan, 221-263.
Brve restauration de lunit :
Dynastie des Tsin (famille Sseu-ma), Lo-yang (Tsin septentrionaux), 265-316.
Epoque des Grandes Invasions dans le Nord et du Bas-Empire dans le Sud.
Hordes turco-mongoles dans le Nord :
Huns Tchao, 316-352.
Mou-jong (Sien-pei, ProtoMongols) 349-407.
Fou Kien, 357-385.
Tabghatch (To -pa) ou Wei du Nord, 398-550 et 557, continus par les Pei Tsi
(550-577) et Pei Tcheou (557-581).
Dynasties nationales chinoises dans le Sud ( Nankin) :
Tsin mridionaux (famille Sseu-ma), 318-420.
Song (famille Lieou), 420-479.
Tsi (famille Siao), 479-502.
Leang (famille Siao), 502-556.
Tchen (famille Tchen ),557-589.
Restauration de lunit :
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
251
Dynastie des Souei (famille Yang), Tchang -ngan, 589-618.
Dynastie des Tang (famille Li), Tchang-ngan, 618-907.
Dans le Nord, les Cinq dynasties ( Lo-yang, puis Kai -fong) :
1 Heou-Leang (famille Tchou), 907-923.
2 Heou-Tang (maison turque des Li), 923-936.
3 Heou-Tsin (maison turque des Che), 936-946.
4 Heou-Han (famille Lieou), 947-950.
5 Heou-Tcheou (famille Kouo), 951-959.
A partir de 936 Pkin et lextrme nord du Ho -pei appartiennent au peuple tartare
(proto-mongol) des Kitat, Ki tan ou Khitai ou Leao (maison des Ye-liu), 936-1122
(ou 1125) Et, de 1001 1227, royaume des Tangout ou SiHia (race tibtaine) au
Kan-sou.
Dans le Sud, morcellement :
Au Xe sicle, la Chine du Sud fut partage entre huit royaumes provinciaux : Wou,
puis Nan-Tang, Nankin, 902-975 ; Wou-Yue au Tch-kiang, 907-978 ; Nan-Han
Canton, 909-971, etc.
Restauration de lunit :
Dynastie des Song (famille Tchao), Kai -fong (Song septentrionaux), 960-1126,
1127. Cette dynastie a rtabli lunit, excep tion faite de la rgion de Pkin, reste
aux Kitat (936-1122), et du Kan-sou, tomb au pouvoir des Tangout (1001-1227).
Nouvelle sparation du Nord et du Sud :
Dans le Nord : Royaume des Djurtcht (Jou-tchen) de race tongouse, dynastie
Wan-yen, dite dynastie Kin, Pkin et dans toute la Chine du Nord depuis 11251127. Dure jusquen 1233-1234.
Dans le Sud : Dynastie des Song (famille Tchao) rduite la Chine du Sud, capitale
Hang-tcheou (Song mridionaux), 1127-1276 (ou 1279).
Restauration de lunit
Dynastie mongole (famille de Gengis-khan et de Qoubila), dite dynastie Yuan,
capitale Pkin, 1260-1368.
Dynastie Ming (famille Tchou), capitale Nankin, puis (1409) Pkin, 1368-1644.
Dynastie Mandchoue ou des Tsing, capitale Pkin, 1644-1912. Rpublique chinoise,
1912, capitale Pkin, puis (1928) Nankin.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
NOTES
SUR
LART
252
CHINOIS
(31) Chronologie des
reliefs han.
Nous avons voqu les caractristiques de la sculpture han dans les reliefs
funraires. Voici quelques points de repre chronologiques portant sur ceux
de ces reliefs dont lon peut voir les estam pages ou les photographier aux
murs de nos muses.
1 Groupes du Ho-nan et du Chan-tong (mission Chavannes) : Teng-fong
hien (Honan), 118 et 123 de notre re. Hiao-tang chan (Chan-tong),
antrieurement 129. Tombe de la famille Wou Kia-siang (Chan-tong)
entre 147 et 168.
2 Groupe du Sseu-tchouan (mission Lartigue et Sgalen) : Pilier de
Fong Houan Kiu hien, 121. Pilier de Chen Kiu -hien, 155. Voir louvrage
de lamiral Lartigue sur lArt funraire lpoque des Han ( Paris, ditions
Geuthner, 1935)
(61) Le syncrtisme religieux
et lart populaire chinois.
Nous avons signal les convergences du bouddhisme, du no-taosme et du
no-confucisme dans le domaine philosophique et religieux partir de
lpoque song. Nous avons mentionn ce propos la cration, en 1012 de
notre re, dun dieu suprme taoque, lAuguste d e jade (ou Pur Auguste),
conu limage du Seigneur dEn -Haut confucen. On pourrait mentionner
au mme titre le culte de la Princesse des Nuages Multicolores, cest --dire
de laurore, divinit taoque dapparition non moins rcente puisquelle ne
ses t manifeste quen lan 1008 de notre re, date de lin vention de sa statue
au sommet du mont Tai -chan, et que son culte ne prit son plein dveloppement que sous les Ming. Or, bien quil sagisse en prin cipe dune
divinit purement taoque (elle est la fille du dieu du Tai -chan et elle porte
une coiffure forme de trois oiseaux aux ailes dployes, comme la Siwang-mou, la Reine des Immortels, de lpoque archaque ), elle ne se
prsente pas moins bien des gards comme une rplique de la Kouan-yin
des bouddhistes. Cest ainsi que par lintermdiaire dune de ses sui vantes,
elle joue, elle aussi, le rle dune donneuse den fants , et quelle est, de ce
fait, invoque dans la Chine du Nord au mme titre que la Kouan-yin aux
vtements blancs dans le Sud. Les exemples du mme ordre sont assez
nombreux. Sur linterprtation de ce syncrtisme populaire dans lestampe,
les blancs de Chine et les ivoires Ming et Tsing, voir Henri Maspero,
dans Mythologie asiatique illustre, 1928, et Henri Maspero et Ren
Grousset, Les ivoires religieux chinois, Exposition du Muse Cernuschi,
Editions dart et dhistoire Van Oest, 1939.
(68a) Les
sources dinspiration du paysage song.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
253
Nous avons rappel que, pour irrels quils parai ssent souvent, les paysages
Song de lpoque de Hang -tcheou reproduisent fidlement la nature que les
artistes avaient sous les yeux, en particulier laspect des plis siniens , tels
quils se prsentent au Tch -kiang et au Fou-kien. On a signal aussi la
ressemblance entre ces paysages et le paysage japonais. Lorsque Richthofen
visitait le Tch-kiang, dit Sion, il notait chaque page de ses carnets de route
la ressemblance avec le Japon : peu de futaies, mais, prs de chaque rocher
bizarrement dcoup, une pagode entoure de cyprs majestueux ; dans les
valles, des touffes paisses de bambous, de grands arbres, din nombrables
moulins eaux, des maisons massives toutes blanches. Et surtout un foisonnement de vgtation sur ces collines bien arroses : et l, des bosquets de
pins et de chnes, darbres suif et vernis ; dimmenses fourrs
darbrisseaux aux feuilles char nues o senlacent des plantes grimpantes
comme le chvrefeuille, les glycines ; des versants entiers disparaissent sous
les myrtes, les azales, les rhododendrons, les roses sauvages. Cest le pays
des arbustes verts et des fleurs. Nulle part en Chine on ne trouve ce pittoresque, cette varit de formes et de couleurs . Il y a sans doute dans le
paysage Song des XIIe-XIIIe sicles dune part, dans le paysage japonais des
XVe-XVIe sicles de lautre lex pression dune certaine philo sophie de la
nature ; mais il y a aussi laspect rel des sites du Tch -kiang ou du Fou-kien,
laspect rel des sites japonais, les uns et les autres tant par ailleurs si
souvent apparents. Cest ainsi que les montagnes granitiques ou
porphyriques du Tch-kiang, avec leurs pentes raides que gravissent des
escaliers taills dans le roc et do se prcipitent des cascades par fois
hautes de plus de cent mtres (comme dans la Valle Neigeuse prs de
Ning-po) abondent les sries comparatives de photographies japonaises en
font foi en paysages nippons .
Naturellement, les sites historiques autour de Hang-tcheou ont t
reproduits avec une dilection particulire par les artistes song et ming, et au
premier rang les bords et les lots du lac occidental le Si-hou. La
meilleure description de ce lac clbre est celle dAr nold Vissire : Les
montagnes stagent dans le loin tain et ceignent le lac louest. La plus
rapproche porte une haute pagode construite sur un massif rocheux aux
flancs couverts dinscriptions. On longe cette hauteur, puis on arrive au pont
Touan-kiao mis au nom bre des dix merveilles du lac et qui se continue
par une digue. Cette chausse dalle, construite sous les Tang par le pote Po
Kiu-yi, mne lle Solitaire ou Kou -chan. Quand on a parcouru plus de la
moiti de cette frache et jolie voie, on arrive un autre pont de pierre jet
sur une interruption de la digue laissant un passage aux eaux entre les deux
lacs. Cest le Pont semblable une ceinture de soie brode . Les plus
clbres de ces sites sont ceux qui slvent dans lle Solitaire elle -mme :
A droite la montagne qui a donn son nom lle. Elle est assez haute,
boise, verdoyante, seme et l de kiosques et de petites constructions
blanches abritant des inscriptions lapidaires, tmoins du pass. A gauche, sur
le bord des eaux, des pavillons, des temples, des dbarcadres pour les
bateaux de plaisance, et plus loin un pied--terre imprial entour de murs
peints en rouge brun qui gravissent jusquau sommet les pentes mri dionales
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
254
du Kou-chan. Le premier pavillon qui, gauche, avance sur les eaux du lac
ses balcons de pierre, ses balustrades et son pont bien chinois, est un autre
site catalogu du Si-hou. Il a pour devise :
Sur le lac tranquille,
la lune en automne.
De tous les cts soffrent aux regards, sur les bords du lac et dans les les
qui en occupent le milieu, dlgantes constructions entoures de feuil lage,
des temples, des villas particulires. Par un chemin dall on gravit le
Kou-chan couvert dune vgtation pres se, de rocailles et dinscriptions
lapidaires. Notons un beau pavillon qui projette ses rampes de pierre sur le
bord du petit lac, le Pavillon du lancer des cigognes . Sur le continent,
dans les montagnes de lOuest, un pic si abrupt que les Chinois lui ont donn
la nom de Pic venu par la voie des airs , et le chemin dall serpentant au
milieu darbres gigantesques, parmi les ruis seaux retombant en cascades, qui
monte vers un ancien temple bouddhique . Quant au palais imprial,
aujourdhui ruin, il se dressait sur le ver sant mridional de lle do lil
pouvait embrasser les perspectives gracieuses ou grandioses du lac, depuis
les murailles de la ville de Hang-tcheou jusquaux pics levs du cou chant
(Vissire et Madrolle, 1. c.).
Les sries de photographies comparatives publies par les critiques dart
japonais montrent la fidlit des grands paysagistes chinois la nature quils
avaient ici sous les yeux.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
255
N O T E S
(1) Le millet et le bl se partagent aujourdhui la Chine du Nord. Au Chan -si, le millet domine
avec 43 % de lensemble d es crales contre 16 % de kaoliang et 14 % de bl. Au Ho-nan, au
Chen-si et au Kan-sou, cest le bl avec entre 45 et 60 %.
(2) Le riz est en effet tranger la Chine du Nord, cest --dire au domaine chinois primitif.
Cest da ns la Chine du Sud (longtemps allogne) quon trouve les plus anciennes traditions
historiques sur sa culture et cest de l quelle se propagea vers les premiers tats chinois.
Toutefois elle y arriva anciennement puisque le riz est mentionn parmi les cinq crales au
VIIIe sicle avant J.-C., avec deux espces de millet, lorge et un ha ricot qui est sans doute le
soja. (J. Sion.)
(3) Et, en tout cas, sil en avait trouv sur les alluvions, il ly avait immmorialement d truite.
Cependant il semble bien que le Chan-tong oriental et la rgion de Tien -tsin et de Pkin durent primitivement faire partie de la zone boise.
(4) Exception faite pour le Bassin Rouge du Sseu-tchouan o les collines ont t amnages
en terrasses pour les cultures.
(5) Traduction Granet. [Ftes et chansons, chant LII]
(6) Ces deux noms de catgories, que nous retrouverons si souvent dans lhistoire de la pen se
chinoise, taient primitivement deux termes de la langue populaire dsignant, yin, un temps
froid et couvert, un ciel pluvieux ; et yang, lensoleillement et la chaleur. Par exemple, pour
une montagne ou une valle, yin est le versant ombreux, yang le versant ensoleill.
(7) Le mot tao est un des termes philosophiques qui ont le plus vari de sens suivant les
coles. Etymologiquement il signifie chemin, voie . Il en arrivera dsigner soit lor dre
qui prside au rythme du yin et du yang, soit la synthse de ces deux modalits.
(8) Appele en chinois : po.
(9) En chinois : kouei.
(10) En chinois : houen.
(11) En chinois : chen.
(12) Entre 1989 et 1558 daprs des traditions qui se veulent sans doute trop prcises.
(13) Voir notamment la cramique incise ou peinte, avec lignes parallles ou quadrillages
trs simples, rcemment trouve Heou-kang, prs de Ngan-yang, dans lex trme nord du
Ho-nan. Aussi la cramique de Heou-kia-tchouang, toute voisine, dcore par impression de
fibres ou de vannerie. Les deux groupes pourraient dater des commencements de la dynastie
des Hia. (G. D. Wu, Prehistoric pottery in China, 1938.)
(14) En ralit on retrouve encore sur certains vases de Ma-tchang des ondes circulaires qui
rappellent Pan-chan. Seulement elles ne sont plus traites pour elles-mmes, mais servent
entourer les cercles dcor de quadrillage caractristiques. (Voir les planches de G. D. Wu,
Prehistoric pottery in China, 1938).
(15) Cette fixation, peu prs ne varietur, ds la priode archaque, des divers types de vases
de bronze tient videmment leur importance rituelle, leur conscration religieuse, au rle
qui fut une fois pour toutes attribu chacune de ces formes dans la prsentation des
diffrentes offrandes, viandes ou boissons sacrificielles.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
256
(16) 1937 : Voir Georges Salles, Bronzes chinois, Exposition de lOrange rie, mai-juin 1934
(Publications du muse du Louvre). Ren Grousset, volution des bronzes chinois
archaques. Exposition du muse Cernuschi, mai-juin 1937, avec illustrations (ditions dArt
et dHistoire Van Oest).
(17) Plusieurs formes de bronzes apparaissent cette poque comme le tchong, ou cloche
chinoise, et le yi, sorte de saucire pieds de bovid. Elles correspondent bien la
dfinition que nous donnons ci-dessus du style proprement tcheou. Voir les illustrations de
notre catalogue, Lvolution des bronzes chinois archaques daprs lexposition du muse
Cernuschi en 1937 (ditions dArt et dH istoire Van Oest, 1937).
(18) Contentons-nous de signaler que pendant la premire moiti du VIIe sicle avant J.-C.
lhgmonie fut reven dique et jusqu un certain point exerce par la principaut tablie au
Chan-tong, dont nous parlions plus haut (principaut de Tsi). Puis, entre 635 et 573 et mme
512, elle fut dtenue par la principaut fonde au Chan-si (principaut de Tsin). Pour le dtail
de ces luttes, nous renvoyons notre volume sur LAsie Orientale, tome X de lHis toire
Gnrale des Presses Universitaires (1941).
(19) Exposition permanente du muse Cernuschi.
(20) Daprs Granet. [ Tso tchouan, C., II, p. 11]
(21) La Chine archaque a connu deux modes de divination : par lcaille de tortue (fissures
de lcaille au contact du feu) et par lachille. Ce sont les diverses dis positions possibles des
tiges dachil le qui ont donn naissance la thorie des hexagrammes dont nous parlons plus
bas.
(22) Le nombre 1 = leau = le nord = la couleur noire ; 2 = le feu = le sud = le rouge ; 3 = le
bois = lest = le vert ; 4 = le mtal = louest = le blanc ; 5 = la terre = le Centre = le jaune.
Lanimal symbolique du nord est la tortue noire, celui du sud loiseau rouge, celui de lest le
dragon vert, celui de louest le tigre blanc.
(23) Do linutilit, en ces matires, de la raison raisonnante : Ceux qui voudraient obtenir
le tao par ltude, dit Tchouang -tseu, cherchent ce que ltude ne donne pas. Ceux qui
voudraient lobtenir par le raisonnement cherchent ce que le raisonnement ne donne pas.
(24) Dans lensem ble, nous lavo ns vu, ces principauts correspondaient en gros aux principales provinces chinoises actuelles, du moins celles du bassin du Fleuve Jaune et de la rive
septentrionale du Yang-tseu. Rappelons dailleurs qu lchelle o nous som mes les
provinces chinoises galent souvent en tendue nombre dtats europens.
(25) En chinois, Tchan kouo (V-IIIe sicles). Nous restons ici fidle la terminologie
consacre. En ralit, lexpres sion franaise Royaumes Combattants applique lart de
cette priode parat dfectueuse puisque les principauts en question ne se sont arrog le titre
royal qu partir de 335 avant J. -C., alors que le style des bronzes dont il sagit remonterait,
daprs Karlgren, au milieu du VII e sicle. Il faudrait, pour tre exact, dire, comme en anglais
et en allemand, art des tats combattants , ainsi que le veut dail leurs lexpression chinoise
Tchan-kouo.
(26) Nous nentrerons pas ici dans la gographie historique de ces roya umes fodaux que
nous avons tudie ailleurs (LAsie Orien tale, Presses Universitaires, 1941). Rappelons
seulement que tandis que le royaume de Tsin correspondait lactuelle province de Chen -si,
les royaumes de Tchao et de Wei correspondaient en principe au Chan-si, le royaume de Tsi
au Chan-tong, le royaume de Han au centre-nord du Ho-nan, et le royaume de Tchou au
Hou-pei. Nous avons analys dans louvrage prcit les guer res de ces divers tats jusqu la
fin des Royaumes Combattants. Pour le dtail des faits nous nous permettons de renvoyer ce
volume.
(27) Ou, selon limage chi noise, on voit les champs des riches saligner par cent et par
mille, tandis que les pauvres nont mme plus le terrain suffisant pour p lanter une aiguille.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
257
(28) Orner Dubs, Toung pao, 1940, liv. 4, p. 219.
(29) Thina dans le Priple, Thinai chez Ptolme.
(30) Certaines de ces agrafes sont de purs chefs-duvre , dune merveilleuse lgance. Voir
Solange Lematre, Les Agrafes de la collection Coiffard , Revue des Arts Asiatiques,
septembre 1936, page 132 (ditions dArt et dHistoire Van Oest).
(32) Dans cette premire gravure des textes, les caractres, creuss en sens direct, venaient
lestampage en blanc sur fond noir. La gravure dans le sens rel est dabord apparue non
sur les inscriptions, mais (et partir du dbut du VIe sicle) sur les sceaux. Cest alors quon
verra fabriquer des sceaux gravs en relief et en sens inverse. imprims, ils venaient en noir
ou en rouge sur fond blanc .
(33) Le taosme primitif tait le fait de cnacles sans doute assez ferms, de petites
chapelles pour initis, les Pres du systme taoste ayant t aux antipodes de toute
prdication populaire (leur indiffrence envers les foules et notamment envers ce que nous
appelons la politique tait totale). Ce fut limitation du bouddhisme, encore quils le
combattissent prement, que les no-taostes de la fin des Han songrent se donner une sorte
dorganisation ecclsiastique, laquelle fut amene se proccuper de propagande populaire et
de questions politiques et sociales, toutes choses si loignes des Pres de la doctrine (voir
plus haut).
(34) Un auteur du XIIe sicle, Hong Mai (1123-1202) formule ainsi la loi des rvolutions
chinoises : Depuis lantiquit, lappari tion ou la cessation des brigandages ont dpendu des
famines produites par les inondations ou les scheresses. Pousss par le froid ou par la faim,
les hommes se rassemblent grands cris pour piller ... Quand il y a des dvoys pratiquant des
doctrines de sorcellerie qui alors abusent le peuple et, ayant attendu leur heure, se soulvent,
le mal quils peuvent faire est incalcula ble. (J. A., 1913, I, 344-345.)
(35) Trad. Sung-nien Hsu.
(36) Par exemple sa Chanson brve, souvent cite et qui est un chant improvis un banquet
quil donnait aux lettrs de son parti :
D evant le vin on doit chanter.
Com bien de tem ps dure la vie hum aine ?
Elle ressem ble la rose m atinale.
Les jours passs sont trop nom breux !
Plus loin, ce nocturne :
Entour de lueur argente,
on peut peine distinguer quelques toiles.
Les pies rveilles volent vers le sud ;
autour dun arbre elles tournent trois fois,
sans savoir sur quelle branche se poser.
Et pour finir, cette maxime o se peint le surhomme quil fut p our ses contemporains :
U ne m ontagne nest jam ais assez haute,
une m er jam ais assez profonde !
Traduction Sung-nien Hsu.
(37) Nous possdons de cette poque (Ve sicle ?) un curieux pome qui conte la vie dune
hrone nomme Mou-lan, originaire du Chan-tong et qui, prenant lhabit dhomme, fit la
guerre sous les drapeaux dun des chefs barbares qui se disputaient la Chine du Nord :
A u m arch de lest elle achte une excellente m onture,
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
258
une selle celuide louest ;
elle acquiert les m useroles,les m ors et les rnes la foire du sud,
celle du nord une longue cravache.
Le m atin elle quitte ses parents,
le soir elle sarrte au bord du Fleuve Jaune.
Le lendem ain au coucher du soleil,elle atteint le m ont N oir (H o-pei).
A u pied du m ont Yen,les chevaux des H uns hennissent
m lancoliquem ent.
Pour rejoindre le quartier gnralelle parcourt des m illiers de li.
Les m onts et les forts dfilent com m e sils volaient.
D ans lair froid du nord rsonnent les appels des veilleurs.
Les rayons glacs se refltent sur larm ure des soldats.
Trad. Sung-nien Hsu.
On ne sait sil sagit ici dune fille de colons barbares ou dune Chinoise ayant pris les ha bitudes des Huns. Lexemple, en tout cas, est curieux comme mon trant la Chine du Nord en
train dadopter les murs de la steppe.
(38) Beaucoup de miroirs chinois dpoque tang continuent simplement la tradition indi gne
des Six Dynasties. Mais certains dentre eux, avec leur galop de chevaux, de cerfs et de lions
se poursuivant dans un dcor de rinceaux et de grappes de raisins, semblent bien trahir des
rminiscences grco-romaines ou, par instants, iraniennes. Toutefois il ne peut sagir ici aussi,
une telle date, que de linfluence dantiques attards . Sptantike !
(39) Lexpansion chi noise en Asie centrale, aux confins de lInde et de lIran, eut galement
sa rpercussion dans le domaine conomique. Ce fut, par exemple, lpoque des Tang et
limitation des Indiens que les Chi nois apprirent fabriquer du sucre avec la canne sucre (et
lon sait limpor tance acquise de nos jours par les plantations de canne sucre du Sseutchouan et de la rgion cantonaise). De mme pour le vin de raisin. Ds lpoque des
premiers Han, la Chine, on la vu, tait entre en relations troites avec les oasis de la
Kachgarie (Tourfan, Qarachahr, Koutcha) et avec le Ferghna, tous pays clbres pour leurs
raisins. Daprs la tradition, le raisin aurait t ainsi introduit en Chine vers 125 avant J.-C.
Nanmoins ce ne fut qu partir des Tang, au VII e sicle, que les Chinois, sans doute
lexem ple des viticulteurs de Tourfan, se mirent fabriquer du vin de raisin ct des vins de
riz, de millet ou dautres grains, immmoriale ment connus chez eux. Quant au th, plante du
sud, lusage en tait connu dans la Chine du Nord ds lpoque tcheou, mais sous les Han il
restait encore une boisson de luxe, rserve aux hautes classes et la classe moyenne. Ce ne
fut que sous les Tang, au VIII e sicle, que le th devint une boisson vraiment nationale,
accessible tous.
(40) Ce sont ces vtrans du grand empereur quau sicle sui vant le pote Li Tai -po a immortaliss dans ses vers sur les enfants de la frontire :
Les enfants de la frontire
Pendant toute leur vie ignorent la littrature.
Ils ne savent que chasser et m onter cheval.
Lautom ne vient,les herbes croissent,
les chevaux deviennent gras ;
Ils sautent alors sur leurs m ontures
et les laissent galoper.
Q ue leurs gestes vont agiles et leur air ddaigneux !
Ils font claquer leur fouet et chantent haute voix.
Faucon au poing, m oiti ivres,ils vont chasser.
Ils tendent leur arc et atteignent toujours leur but :
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
259
D une seule flche ils abattent deux oiseaux !
Traduction Sung-nien Hsu.
(41) Traduction Sung-nien Hsu.
(42) Les posies de Li Tai -po et celles de Tou Fou que nous citons ici sont toutes empruntes
aux traductions de M. Sung-nien Hsu, notamment dans son Anthologie de la Littrature
chinoise, Paris, Delagrave, collection Pallas, 1933.
(43) Traduction Sung-nien Hsu.
(44) On trouvera une bonne collection de ces statuettes en terre cuite tang les Tanagras
chinoises , comme on les a appeles au muse Cernuschi.
(45) Voir au muse Cernuschi plusieurs terres cuites tang reprsentant des types de barbares,
et au muse Guimet les puissants rois gardiens bouddhiques en armure de guerre,
rapports de Touen-houang par la mission Pelliot.
(46) Je me conforme lorthographe courante de nos atlas. En ralit il faudrait crire Kchghar, Kchgharie comme on crit Ferghna.
(47) Traduction Sung-nien Hsu.
(48) Traduction Sung-nien Hsu. On songe, devant la chute dramatique de lempereur vieilli,
que ce mme Hiuan-tsong a crit le Chant des marionnettes, souvent cit dans les
anthologies :
O n sculpte dans le bois des m arionnettes en form e de vieillards ;
O n les m anie avec des fils ;
A vec leur peau plisse et leurs cheveux blancs elles ressem blent
des vieillards vritables.
M ais une fois la com die acheve,toutes retom bent im m obiles.
Tels les tres hum ains quitraversent la vie com m e un songe.
Trad. Sung-nien Hsu.
(49) Rappelons que le voyage de Hiuan-tsang eut lieu entre 630 et 644 et celui de Yi-tsing
entre 671 et 695.
(50) En mongol, Kitan au singulier. Kitat au pluriel. En chinois, Ki -tan. En turc, en persan et
en arabe, Khita. Cest par ce nom que les Turcs (et leur suite les Russes) ont depuis dsign
la Chine. A leur exemple, cest par ce mme nom ( Cathay) que Marco Polo dsignera la
Chine du Nord.
(51) Ho-pei : Sans parler du pays annamite (Tonkin et nord de lAn nam actuel) qui avait
profit du morcellement chinois pour secouer la domination chinoise en 939.
(52) Ne pas confondre avec lempere ur de mme nom qui avait illustr la dynastie des Tang.
(53) Le Chen-tcheou des Song correspond lactuel site de Chen -yuan prs de Pou -yang,
une trentaine de kilomtres au nord du cours actuel du Fleuve Jaune, dans lextrme sud du
Ho-pei.
(54) La frontire entre la Chine et les Kitat passa de ce ct entre Pkin (aux Kitat) et Pao-ting
(aux Chinois).
(55) Traduction Henri Maspero, dans Le Servage, Universit libre de Bruxelles, 1937, pp.
294-295.
(56) Traduction Wieger.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
260
(57) En 1065, la veille des rformes de Wang Ngan-che, les dpenses ordinaires de ltat,
de laveu de lHistoire des Song, slveront 120.343.174 sa pques, plus 11.521.278
sapques de dpenses extraordinaires, tandis que les recettes natteindront que 110.138.400
sapques. Selon la remarque de M. Tcheou Hoan, ltat chinois sera la veille de la faillite
quand Wang Ngan-che entreprendra la refonte du systme financier.
(58) Il est intressant de constater que le fameux rformateur se trouvait un Chinois du Sud : il
tait n le 3 octobre 1019 dans le district de Lin-tchouan, au Kiang -si.
(59) En chinois tsing -miao. Linstitution en remonte septem bre 1067 (cf. Tcheou Hoan, Le
prt sur rcolte, Paris, 1930).
(60) Wang Ngan-che avait eu pour beau-frre le pote Wang Ling dont je citerai un poignant
pome sur la douleur (traduction Wieger) :
Les m orts sont m orts,cest irrvocable.
Les regretter ne sert rien.
Et cependant les vivants ne cessent pas
D e soupirer en pensant aux m orts.
O n a toujours pleur ainsisur cette terre
Et ilcontinuera en tre ainsi.
Casse,la corde plaintive se rem onte sans cesse,
Le chant douloureux se rpte toujours.
Ce sont les yeux de lhom m e quipleurent,
M ais les larm es m ontent de son c ur.
Illes arrte un instant en se contraignant,
M ais narrivera pas en tarir la source profonde.
(62) Sirn, Histoire de la peinture chinoise, II, 19-20 (ditions dArt et dHistoire Van Oest).
Page 175.
(63) Sirn, 1. c., II, 15.
(64) Traduction Sung-nien Hsu.
(65) Traduction Margoulis.
(66) Traduction Margoulis.
(67) Lexpression est dj dans le gographe Karl Ritter.
(68) Les Japonais ont publi rcemment de bien intressantes comparaisons entre dune part
les peintures les plus clbres de lpo que song, dautre part des photo graphies des ctes ou
des montagnes du Tch-kiang et du Fou-kien : la fidlit des matres song la nature quils
avaient sous les yeux est frappante. Voir pp. 173-177 (les sources du paysage song) [et n. 68a]
(69) Sirn, 1. c., II, 81.
(70) Sirn.
(71) Les Parisiens ont pu admirer une remarquable collection de cramique song
lexposition organise par Georges Salles lOrangerie en 1937. Une partie en est aujourdhui
entre en la possession des Muses nationaux. Le muse Cernuschi possde aussi des
cladons et des fourrures de livre de bonne qualit. Voir Georges Salles, Arts de la Chine
ancienne, 1937. Et dans ce mme catalogue, ltude de Mme Vandier -Nicolas sur la gravure
et lestampe chinoise, sujet abord au chapitre suivant.
(72) Traduction Wieger.
(73) Voir plus haut.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
261
(74) Traduction Sung-nien Hsu.
(75) Traduction Wieger.
(76) Traduction Wieger.
(77) Traduction Wieger.
(78) Je nai parler ici de Gengis -khan quen fonction de lhis toire chinoise. Pour lhistoire
de la haute Asie en gnral, voir mon Empire des steppes, Payot, 1939. Pour lhistoire
mongole en particulier, mon Empire Mongol, de Boccard, 1941.
(79) De 936 1122.
(80) Prononcer : gdi.
(81) En lespce la Kach garie et la rgion de lIlli.
(82) Cest le systme des greniers rgulateurs (tchang ping ) qui fonctionnait dj sous les
Song (voir plus haut).
(83) Ici encore, reprise, sans doute, du systme des greniers de bienfaisance (kouanghouei), dj en fonctionnement sous les Song (voir plus haut).
(84) Notons que nous retrouvons l le principe du fameux prt sur rcolte , si onreux, accord (ou impos) aux paysans chinois lpoque de Wang Ngan -che (voir plus haut).
(85) On a cherch aussi, mais avec moins de raison, retrouver linfluence du milieu guerrier
qui fut celui de lpoque mongole dans les uvres du roman cier Lo Pen (vers 1330-1400), notamment dans le clbre Roman des Trois Royaumes, histoire romance de la lutte des trois
tats qui se partagrent en 220 de notre re lempire des Han. Et sans doute ce rcit
mouvement, avec ses figures bien dessines (les hros lgitimistes : Lieou Pei, Tchou-ko
Leang, Tchang Fei, Kouan Yu ; le tratre Tsao Tsao), est une manire de geste pique.
Mais il ne faut pas oublier quil ne peut avoir t com pos que tout fait la fin de la
dynastie mongole, sinon au dbut des Ming. Bien mieux, les hros en sont des rvolts,
insurgs au nom du droit contre un pouvoir illgitime, ce qui correspondra assez la situation
de 1355, quand la Chine du Sud se soulvera contre le rgime mongol.
(86) Je suivrai pour les souverains ming et mandchous lhabitude prise par les historiens occi dentaux. En ralit le nom ainsi communment donn ces souverains nest pas proprement
le leur, mais celui de leurs annes de rgne.
(87) En chinois, Tseu-kin-tcheng. Ce nom de ville violet pourpre donn la cit interdite
lui est appliqu par analogie avec la couleur thorique de ltoile po laire et parce que ltoile
polaire est le centre du monde cleste comme la ville interdite est le centre du monde terrestre.
(88) Souvent dsign par le nom de la priode Tchong -tcheng.
(89) Souli de Morant, LEpope des jsuites en Chine.
(90) Le Pre Gerbillon et les autres jsuites nous ont transmis de lui plusieurs traits plaisants,
comme celui-ci : Un jour quil se promenait dans son parc, il avisa un mandarin de sa suite
qui venait, il le savait, de se faire payer par un solliciteur 20.000 tals dargent. Prends la
bride, lui dit-il, et fais-moi faire un tour. Le tour fait, lempereur dmonta. Voici pour ta
peine , lui dit-il. Et il lui donna un tal. Et maintenant, ajouta-t-il, ton tour : monte !
Lautre dut sexcuter. Lempereur prit la bri de, lui fit faire le mme tour, puis : A toi de
payer maintenant. Combien de fois suis-je plus grand que toi ? Infiniment ! balbutia le
mandarin. Mettons vingt mille fois, trancha lempereur. Tu me dois vingt mille tals ! Et
le fonctionnaire prvaricateur dut sexcuter ...
(91) Ainsi dsign par le nom de ses annes de rgne.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
262
(92) Il y aurait encore environ 700.000 musulmans chinois au Yun-nan et entre 1.400.000 et
3.810.000 au Kan-sou, mais ces chiffres sont trs approximatifs.
(93) Kang Yeou -wei (1858-1927), le doctrinaire de la rforme de 1898, pour grand lettr
quil ft, ne se rvlait pas moins comme un utopiste dont certaines opinions de vaient choquer
singulirement tous les tenants de la tradition chinoise, fonde sur le respect de la famille et le
culte des anctres. Un des articles de son programme comportait la suppression de la famille
et du mariage, aucune union ne devant dpasser un an. Un autre article disposait que tout mort
serait incinr et qu ct de chaque four crmatoire une usine dengrais serait ins talle...
Son lve, Leang Ki-tchao (1873 -1929), professait des ides non moins singulires.
(94) Nous le dsignons par la graphie de son nom en dialecte cantonais, telle quelle a t
popularise par les journaux : en ralit, il faudrait en cantonais Siun Yat-sin. En langue
mandarine, Souen Yi-sien, aussi appel Souen Wen.
(95) Dabord kouo-ming tang, parti du mandat national (par opposition au mandat de
droit divin de la dynastie mandchoue) ; par la suite kouo-min-tang, parti national (avec le
caractre min, peuple ), dnomination qui a dfinitivement prvalu.
(96) Ne racontait-on pas quil avait f ait baptiser collectivement toute son arme avec des
pompes incendie ?
(97) Cest vers 170 avant J. -C. que lingnieur Li Ping tablit le rseau dirrigation de la
plaine de Tcheng -tou. Une inscription rupestre Kouan-hien rappelle encore ses sages
maximes : Tenez toujours les canaux creuss et les digues basses.
(98) Suivant les mthodes de calcul, les terres en culture reprsentent soit les 14,8 %, soit les
18 % de la superficie totale des provinces.
(99) La Chine produit actuellement 520 millions de quintaux de riz, ce qui fait delle le
premier pays producteur du monde (lInde ne vient quensuite avec 455 millions de quintaux).
(100) Mais ici se prsente une cause dappauvrissement parti culire. Les provinces de lss du
nord-ouest qui sont les principales productrices de bl sont restes si isoles, si mal relies au
reste de la Chine, que lexportation de leurs produits est un problme. Lexp ortation du bl
par animaux de bt ou par charrettes exige des frais de transport trop coteux. Les paysans du
Chen-si et du Kan-sou ont donc tendance transformer les champs de bl en champs de
pavots, lopium tant facile expdier sous un petit volu me. Do accroissement des risques
de famine locale. Ajoutons dailleurs quune fois cette crise des transports rsolue, la Chine se
retrouvera, ici encore, dans une situation assez avantageuse : daprs les statistiques du
gouvernement chinois, elle produirait actuellement 250 millions de quintaux de bl, arrivant
immdiatement aprs la Russie (313 millions).
(101) Culture de coteaux, analogue la vigne , le th est particulirement productif dans la
zone des hauteurs qui spare le Kiang-si du Tch-kiang et du Fou-kien. Mais il semble que
son rendement pourrait tre accru dans dautres parties, res tes incultes, des plis siniens.
(102) Il ny aurait en Chine lheure actuelle pas plus de 18.000 19.000 kilomtres de
chemins de fer (alors que la France en possde 47.000). Il est vrai quun effort plus srieux a
t tent pour la construction des routes. Si on fait abstraction des vieilles routes dalles,
larges de 1 m. 50, sur lesquelles aucune voiture ne pouvait circuler, il ny avait en 1921 que
1185 kilomtres de routes modernes dans toute la Chine. Grce au systme de rquisition des
paysans appliqu en grand par Tchiang Kai-chek, les progrs ont t rapides. La Chine
possdait dj 34.000 kilomtres en 1929 et 109.149 la fin de 1936.
(103) Les rserves de charbon sont rparties entre le Chan-tong (massif du Tai -chan), les
rives du moyen et du bas Yang-tseu, le Sseu-tchouan (ce dernier avec des charbons
jurassiques de moindre valeur) et surtout le Chan-si : on estime que le bassin
carbonifre du Chan-si reprsente 80 % des rserves chinoises en charbon.
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
*
**
263
Ren GROUSSET Histoire de la Chine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33
Tableau des dynasties Notes sur lart chinois Notes Table -
264
Nom du document : histoire_chine_rg.doc
Dossier :
C:\CSS\Envoi021204\grousset_ren
Modle :
C:\WINDOWS\Application
Data\Microsoft\Modles\Normal.dot
Titre :
Histoire de la Chine
Sujet :
srie Chine
Auteur :
Ren Grousset
Mots cls :
Chine antique, Chine classique, Chine moderne,
civilisation chinoise, ancient China, dynasties chinoises, Hia, Chang,
Tcheou, Han, Song, Ming, mongol, gengis-khan, histoire de la chine,
empereur de chine
Commentaires :
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sc
iences_sociales/index.html
Date de cration :
04/08/04 00:42
N de rvision :
12
Dernier enregistr. le : 01/12/04 15:50
Dernier enregistrement par : Pierre Palpant
Temps total d'dition:45 Minutes
Dernire impression sur :
05/12/04 12:42
Tel qu' la dernire impression
Nombre de pages :
264
Nombre de mots : 109 685 (approx.)
Nombre de caractres : 625 205 (approx.)
Vous aimerez peut-être aussi
- Marxismes ImaginairesDocument19 pagesMarxismes ImaginairesPaulo FreirePas encore d'évaluation
- Robespierre La Fabrication Dun Monstre (Jean-Clément Martin)Document287 pagesRobespierre La Fabrication Dun Monstre (Jean-Clément Martin)Phil RomanskiPas encore d'évaluation
- Pour Comprendre Les Discriminations Racistes. Dialogue Imaginaire Entre Deux HabitantsDocument14 pagesPour Comprendre Les Discriminations Racistes. Dialogue Imaginaire Entre Deux HabitantsbakuninjaPas encore d'évaluation
- Résistance VS DictatureDocument119 pagesRésistance VS DictatureAntoine Peillon100% (1)
- La Violence Nazie - Une Généalogie EuropeenneDocument214 pagesLa Violence Nazie - Une Généalogie Europeennefrchj mouPas encore d'évaluation
- De La Servitude ModerneDocument25 pagesDe La Servitude ModerneMathieuLkekajanPas encore d'évaluation
- Spartacus 30s n09Document16 pagesSpartacus 30s n09Renoir Mariane100% (1)
- L'écriture Marxiste de L'histoire Irlandaise - Corps Du MémoireDocument570 pagesL'écriture Marxiste de L'histoire Irlandaise - Corps Du MémoirekarlarthurPas encore d'évaluation
- Ouvriers Dans La Societe Franca - Gerard NoirielDocument405 pagesOuvriers Dans La Societe Franca - Gerard NoirielHerve OstacolpinPas encore d'évaluation
- Israël Contre Israël (Martine Gozlan) (Z-Library)Document113 pagesIsraël Contre Israël (Martine Gozlan) (Z-Library)Ci Nema100% (1)
- Lâge Des Cénacles (Glinoer)Document847 pagesLâge Des Cénacles (Glinoer)Ghustavo Muniz100% (1)
- Le Chevalier, La Dame, Le Diable Et La Mort by Raoul Vaneigem (Vaneigem, Raoul)Document158 pagesLe Chevalier, La Dame, Le Diable Et La Mort by Raoul Vaneigem (Vaneigem, Raoul)Ricardo MantovaniPas encore d'évaluation
- Anatomie Du Nazisme - Frédéric SalléeDocument158 pagesAnatomie Du Nazisme - Frédéric Salléezarathos100% (2)
- Réseau ManouchianDocument11 pagesRéseau ManouchianSébastien PeignéPas encore d'évaluation
- Lyotard - La Phénoménologie (Que Sais-Je)Document92 pagesLyotard - La Phénoménologie (Que Sais-Je)Ricardo Filipe Afonso MangeronaPas encore d'évaluation
- Emmanuel Berl, La Fin de La IIIe RépubliqueDocument22 pagesEmmanuel Berl, La Fin de La IIIe RépubliqueAnonymous va7umdWyhPas encore d'évaluation
- Arendt Le Systeme TotalitaireDocument9 pagesArendt Le Systeme TotalitaireJean DamascènePas encore d'évaluation
- La France Pendant La Guerre de Cent AnsDocument312 pagesLa France Pendant La Guerre de Cent Ansstefstefano100% (1)
- La Société Terminale 2. Dispositifs Spec (Tac) UlairesDocument372 pagesLa Société Terminale 2. Dispositifs Spec (Tac) UlairesSchmoll Patrick100% (1)
- Walter Benjamin, Thèse Sur L'histoire XVIIa: "Marx A Sécularisé La Représentation de L'âge Messianique "Document4 pagesWalter Benjamin, Thèse Sur L'histoire XVIIa: "Marx A Sécularisé La Représentation de L'âge Messianique "ixcuintla72Pas encore d'évaluation
- L'Occupation Américaine Et Les Larmes de Sang Prédites Par Hannibal Price-1 de 5Document4 pagesL'Occupation Américaine Et Les Larmes de Sang Prédites Par Hannibal Price-1 de 5kiskeyadminPas encore d'évaluation
- L'épistémologie Des Sciences Sociales, RISS N° 102, UNESCO, 1984Document176 pagesL'épistémologie Des Sciences Sociales, RISS N° 102, UNESCO, 1984ddufourt50% (2)
- Histoire Mondiale Du Communisme - Vol 2Document1 139 pagesHistoire Mondiale Du Communisme - Vol 2bogdan2276Pas encore d'évaluation
- Problèmes Des Idées Dans Le Monde Musulman (Bennabi, Malek)Document153 pagesProblèmes Des Idées Dans Le Monde Musulman (Bennabi, Malek)Mutanga Shemny100% (1)
- Oscar Wilde, du dandy à l'écrivain: Grandeur et décadence d'un artiste provocateurD'EverandOscar Wilde, du dandy à l'écrivain: Grandeur et décadence d'un artiste provocateurPas encore d'évaluation
- Les plus sombres histoires de l'histoire de Belgique: Secrets et anecdotesD'EverandLes plus sombres histoires de l'histoire de Belgique: Secrets et anecdotesPas encore d'évaluation
- Chine Depuis 1949 - Clara BLANCHERDocument16 pagesChine Depuis 1949 - Clara BLANCHERsami995Pas encore d'évaluation
- L'ombre de Dionysos PDF - Télécharger, Lire Télécharger Lire English Version Download Read. DescriptionDocument6 pagesL'ombre de Dionysos PDF - Télécharger, Lire Télécharger Lire English Version Download Read. Descriptionjeanmand franamandPas encore d'évaluation
- Ecrire L'histoireDocument14 pagesEcrire L'histoireZobel ClemensPas encore d'évaluation
- Georg Lukacs Réalisme Critique Dans La Littérature RusseDocument442 pagesGeorg Lukacs Réalisme Critique Dans La Littérature RusseJean-Pierre Morbois100% (2)
- ELLUL Jacques - 1981 - La Parole HumiliéeDocument310 pagesELLUL Jacques - 1981 - La Parole HumiliéeSintia yamgniePas encore d'évaluation
- Personne Ne Sort Les Fusils - Sandra LucbertDocument119 pagesPersonne Ne Sort Les Fusils - Sandra LucbertFanny HollandPas encore d'évaluation
- Alain Testart, Éléments de Classification Des SociétésDocument12 pagesAlain Testart, Éléments de Classification Des SociétésCarmen LlerenasPas encore d'évaluation
- De L'écologie À L'autonomieDocument7 pagesDe L'écologie À L'autonomierichardPas encore d'évaluation
- La Culture de Masse Lasch PDFDocument26 pagesLa Culture de Masse Lasch PDFΦΧΦΠPas encore d'évaluation
- Histoire de L'esclavageDocument8 pagesHistoire de L'esclavageAnonymous HLBjNdHuPas encore d'évaluation
- Le patrimoine culturel, cible des conflits armés: De la guerre civil espagnole aux guerres du 21è siècleD'EverandLe patrimoine culturel, cible des conflits armés: De la guerre civil espagnole aux guerres du 21è sièclePas encore d'évaluation
- Le Bouddhisme - Levenson ClaudeDocument65 pagesLe Bouddhisme - Levenson ClaudePaulo Vidal100% (1)
- Comment Peut-On Être Anarchiste - Claude GuillonDocument444 pagesComment Peut-On Être Anarchiste - Claude Guillonmichelone129925100% (1)
- Histoire de L'art 06 Sixieme Partie L'Art ContemporainDocument192 pagesHistoire de L'art 06 Sixieme Partie L'Art ContemporainroropopoPas encore d'évaluation
- Francis Delaisi - La Revolution Europeenne (1942)Document295 pagesFrancis Delaisi - La Revolution Europeenne (1942)NunussePas encore d'évaluation
- 9791037100955Document29 pages9791037100955Allan Baldini100% (1)
- Ebook Cours CNED Cinquieme - FrancaisDocument742 pagesEbook Cours CNED Cinquieme - Francaisgeekos77Pas encore d'évaluation
- 3e Sexe Social InuitDocument33 pages3e Sexe Social InuitEmmanuel GrimaudPas encore d'évaluation
- Les Femmes de La Révolution by Michelet, Jules, 1798-1874Document108 pagesLes Femmes de La Révolution by Michelet, Jules, 1798-1874Gutenberg.org100% (4)
- Animalite Darwin FreudDocument7 pagesAnimalite Darwin FreudNour BeydounPas encore d'évaluation
- A Propos de L'après 68, de L' Ultra-Gauche Et de La Communauté HumaineDocument12 pagesA Propos de L'après 68, de L' Ultra-Gauche Et de La Communauté Humaineapollo2Pas encore d'évaluation
- André Lorulot - La Vie Des JésuitesDocument248 pagesAndré Lorulot - La Vie Des JésuitesNunusse100% (4)
- Les Gilets Jaunes: La répression occidentale des meilleures valeurs de l'OccidentD'EverandLes Gilets Jaunes: La répression occidentale des meilleures valeurs de l'OccidentPas encore d'évaluation
- La Presse Comme Appareil D'hégémonie Selon GramsciDocument18 pagesLa Presse Comme Appareil D'hégémonie Selon GramsciFenzi2013Pas encore d'évaluation
- Guerre D'algérieDocument4 pagesGuerre D'algérieAlice TissotePas encore d'évaluation
- La Chine Et Le Monde Depuis 1949Document7 pagesLa Chine Et Le Monde Depuis 1949Thomas HeimburgerPas encore d'évaluation
- Il Nous Faut Regarder L'animal AutrementDocument4 pagesIl Nous Faut Regarder L'animal Autrementelecomte2100% (1)
- 3B Le Groupe ManouchianDocument9 pages3B Le Groupe ManouchianSOULIEPas encore d'évaluation
- Le Roman Inachevé Aragon FicheDocument2 pagesLe Roman Inachevé Aragon FicheFrancky Dilcius0% (1)
- Victor SERGE - La Revolution D Octobre A MoscouDocument11 pagesVictor SERGE - La Revolution D Octobre A Moscouernesto_colocolinoPas encore d'évaluation
- Le Devoir Des Neutres PDFDocument105 pagesLe Devoir Des Neutres PDFDéboraPas encore d'évaluation
- Ayn Rand La Source ViveDocument2 354 pagesAyn Rand La Source ViveSara 24Pas encore d'évaluation
- Les Nouveaux Chiens de GardeDocument69 pagesLes Nouveaux Chiens de GardeMahdi ZanzibarPas encore d'évaluation
- Pelletier Ludwig KlagesDocument4 pagesPelletier Ludwig KlagesAbelScribPas encore d'évaluation
- Un Navire français explose à Cuba: Enquête inédite sur un attentat oubliéD'EverandUn Navire français explose à Cuba: Enquête inédite sur un attentat oubliéPas encore d'évaluation
- Pistes Recit de VoyageDocument6 pagesPistes Recit de VoyageOlga Salcedo MolinerPas encore d'évaluation
- Théâtre AFRICAINDocument11 pagesThéâtre AFRICAINTAKI ROGERPas encore d'évaluation
- Gradhiva 2810Document19 pagesGradhiva 2810gilson planoPas encore d'évaluation
- Philatélie AlgérienneDocument33 pagesPhilatélie AlgériennePierre CoutelierPas encore d'évaluation
- La FocalisationDocument1 pageLa Focalisationchaimaeelkhamar2100% (1)
- Commentaire Compose Lisbonne 1Document7 pagesCommentaire Compose Lisbonne 1Soufiane CherifPas encore d'évaluation
- TC Statistique AppliquéeDocument56 pagesTC Statistique Appliquéer7hskcks5hPas encore d'évaluation
- Article Shmes 1261-9078 1991 Act 20 1 1505Document53 pagesArticle Shmes 1261-9078 1991 Act 20 1 1505clemens.tremere7606Pas encore d'évaluation
- Liens Architecture Moderne Et Art NouveauDocument3 pagesLiens Architecture Moderne Et Art Nouveauapi-3709589100% (1)
- Fascicule LTICS Histoire 2nde 2021Document26 pagesFascicule LTICS Histoire 2nde 2021Aliou FayePas encore d'évaluation
- Etienne Lussier - L'Ennui Autopsie D'une Afflication Moderne. Autour de L'oeuvre de Walter BenjaminDocument141 pagesEtienne Lussier - L'Ennui Autopsie D'une Afflication Moderne. Autour de L'oeuvre de Walter BenjaminjioPas encore d'évaluation
- Zoosystema2019v41a11 PDFDocument58 pagesZoosystema2019v41a11 PDFAndrásBenyóPas encore d'évaluation
- Djurdjura de BoulifaDocument456 pagesDjurdjura de Boulifasabd001Pas encore d'évaluation
- Traces Désirs Et Volonté Dètre OcrDocument486 pagesTraces Désirs Et Volonté Dètre OcrKarim KhelifiPas encore d'évaluation
- Université Catholique de LouvainDocument6 pagesUniversité Catholique de LouvainadelaidehaverlandPas encore d'évaluation
- The Thousand Buddha Motif A Visual Chant in Buddhist Cavetemples Along The Silk RoadDocument131 pagesThe Thousand Buddha Motif A Visual Chant in Buddhist Cavetemples Along The Silk RoadVirgoMore100% (1)
- Notes Sur L'Ordre Du Discours (Sur Foucault)Document12 pagesNotes Sur L'Ordre Du Discours (Sur Foucault)msnorbertoPas encore d'évaluation
- L'allégorie Du Patrimoine Francoise ChaoyDocument9 pagesL'allégorie Du Patrimoine Francoise ChaoyWafaa Keltoum Abou-bekrPas encore d'évaluation