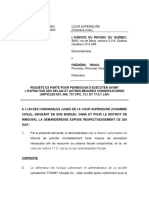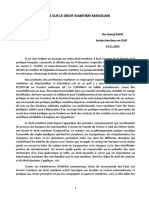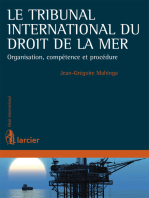Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Nouveau Code Maritime Algerien PDF
Le Nouveau Code Maritime Algerien PDF
Transféré par
Karim ImeTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Nouveau Code Maritime Algerien PDF
Le Nouveau Code Maritime Algerien PDF
Transféré par
Karim ImeDroits d'auteur :
Formats disponibles
LE NOUVEAU CODE MARITIME ALGERIEN
Prsent par : Mr. NEFFOUS Mohamed Mankour
Introduction
Dans lhistoire du droit de la rpublique algrienne, une loi du 31 dcembre 1962
avait reconduit dans tous les domaines la lgislation en vigueur lpoque sauf
dispositions contraires la souverainet nationale ou dinspiration colonialiste ou
discriminatoire ou portant atteinte lexercice normal des liberts dmocratiques .
Cette loi de 1962 avait donc pour effet de reconduire la lgislation maritime franaise en
vigueur au 31 dcembre 1962 qui tait ancienne puisquelle sinspirait du livre II du
code de commerce, rdig en 1807, promulgu en 1808. Par la suite, une ordonnance
du 5 juillet 1973 est venue abroger la loi du 31 dcembre 1962, et prvoir que toute
lgislation devrait tre algrianise au 5 juillet 1975.
Cette ordonnance qui prvoyait dans son art. 3 quune instruction prsidentielle
en fixerait les modalits dapplication ; or, cette instruction na jamais t donne, a eu
pour rsultat dacclrer le mouvement de codification et dlaboration dune lgislation
spcifiquement algrienne. Et comme lalgrianisation la date du 5 juillet 1975 na pu
tre tenu, le CMA ( 23/10/1976) prvoit la rtroactivit du code jusqu cette date dans
son art. 887.
Lordonnance n76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime a paru au
Journal Officiel de la Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire du dimanche 10
avril 1977.
Lavnement dun nouveau code maritime tait cette poque un vnement, et
dautant plus, en la circonstance, quil sagissait dune codification entreprise par lun
des pays leaders du tiers monde. Cette codification rpondait une ncessit
vidente : lconomie algrienne dpendait de son commerce extrieur et celui-ci
seffectuait par voie maritime.
Avec la chute du mur de Berlin, la fin du monopole, et intervention du FMI, le
lgislateur algrien a vu la ncessit de modifier quelques dispositions du CMA afin de
le mettre en harmonie avec la ralit conomique. ( loi n98-05 du 25 juin 1998 portant
code maritime).
Cette modification a touch le navire (I), sa nationalit; lexploitation commerciale
du navire (II), la libralisation des transports maritimes, rgime de responsabilit du
transporteur. Ce nouveau code a apport une rvolution dans le domaine de
lexploitation portuaire ( III), en ouvrant les activits de manutention et dacconage au
priv.
Caractres principaux du CMA
Le premier caractre qui ressort de la lecture du CMA est son caractre
internationaliste. Le lgislateur algrien sy est procd en trs nombreuses occasions
par rfrence directe aux rgles des conventions internationales existantes et la loi
franaise.
Le CMA ne saligne pas ncessairement sur les conventions internationales les
plus modernes lorsquil existe plusieurs moutures rglant le mme domaine ; dautre
part, il peut se faire que lAlgrie ait adhr ou ratifi une convention internationale et
sinspire de la concurrente de celle-ci pour organiser sa lgislation interne. (ainsi,
lAlgrie a adhr la convention de Bruxelles de 1925 sur les privilges et
hypothques, mais sinspire de la convention de Bruxelles de 1967 pour organiser ce
domaine. Le CMA renvoie purement et simplement la convention de Bruxelles du 25
Aot 1924 dans sa version originelle pour ce qui concerne les transports maritimes
sous connaissement ratifie par lAlgrie mais il fait rfrence au protocole modificatif
de 1968 (art.805), il renvoie directement la convention de Bruxelles de 1957 sur la
limitation de responsabilit des propritaires de navires (art.96), la convention de
Bruxelles de 1969 sur la responsabilit civile pour les dommages dus la pollution par
les hydrocarbures (art.121), la convention de Bruxelles de 1961 en matire de transport
de passagers (art.), la convention de Bruxelles de 1967 en matire de transport de
bagages par mer (art.824).
Dans dautres domaines, la rfrence nest pas aussi directe, mais linspiration
reste certaine : ainsi la convention de 1910 inspirent certainement les rgles de
labordage et de lassistance, alors que le rgles de la Haye et York inspirent la
rglementation des avaries communes (il sagit pas l dune convention internationale.
On trouve aussi rfrence la convention des nations unis sur le droit de la mer
(Monteo Bay 7/12/82), art.519 et art. 520, et la loi franaise : lettre de garantie (art.757)
et les cas excepts.
10
CHAPITRE I
LE NAVIRE
1. Notion du navire :
Le navire est dfini par lart.13 comme : tout btiment de mer ou engin flottant
effectuant une navigation maritime, soit par son propre moyen, soit par remorque dun
autre navire, ou affect une telle navigation , et lart.161 dfinit la navigation maritime
comme celle qui est exerce sur mer et dans les eaux intrieures pour des navires tels
quils sont dfinis lart.13 de la prsente ordonnance, et lart. 162 stipule que la
navigation maritime comprend :
la navigation auxiliaire relative au transport de marchandises et des
passagers ;
la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remorquage, lassistance et
le sauvetage, le chalandage, le dragage, le sondage ainsi que la recherche
scientifique en mer ;
la navigation de pche ;
la navigation de plaisance effectue dans un but dagrment ;
la navigation de servitude .
Le CMA apporte des solutions quant la qualification de certains objets et
engins flottant en navire car dune part, tout ce qui est affect la navigation maritime
est considr comme navire (un bateau de rivire est un navire), et dautre part, les
engins remorqus sont considrs comme navires.
Le Professeur Bonassies avance 4 propositions pour dfinir un navire :
navire et dimension
navire, engin flottant
navire et eaux maritimes
navire et aptitude affronter les risques de mer
le lgislateur algrien dans da dfinition du navire, la quatrime proposition
nexiste pas car mme les engins remorqus qui ne sont pas aptes affronter les
risques de la mer dune part, et dautre part ils sont dpourvus dautonomie de conduite,
sont considrs comme navire selon lart.13.
11
Le professeur Bonassies considre quil faut exiger un minimum dautonomie
pour affronter les risques de la mer, les chalands tracts et les engins de forage
peuvent tre des engins nautiques, des btiments de mer. Il ne sont pas des navires.
Il ajoute aussi, que le navire inapte affronter les risques de la mer devient
innavigable ce qui lui fait perdre la notion de navire. Il devient autre chose, soit une
pave sil est abandonn et gt au fond de leau, soit un simple engin, sil est utilis
dautres fins que la navigation.
Le CMA est un droit des navires et non un droit des engins nautiques
2. Individualisation du navire
Aux termes de lart. 14 du CMA, les lments dindividualisation des navires
sont : le nom, le tonnage, le port dattache et la nationalit.
Parmi ces lments, la nationalit a t lobjet dune modification dans le
nouveau code, alors, elle va tre traiter part.
A/ Nom :
Lart.16 du CMA dispose que chaque navire doit avoir un nom qui le distingue
des autres btiments de mer. Et les navires jusqu 10 tonneaux de jauge brute, sont
caractriss par un numro comme ils peuvent porter un nom(1).
Suivant les dispositions de larrt du 5 avril 1989 fixant les conditions
dattribution et de changement de nom de navires, le nom du navire est inscrit sur le
registre algrien des navires par lautorit administrative maritime, cette administration
se rserve le droit de rejeter toute demande dattribution ou de changement de nom de
navires dans les cas suivants :
Lorsque le nom propos par larmateur ou le propritaire du navire est port
par un autre navire ;
Lorsque larmateur ou le propritaire est dans lincapacit de justifier la
proprit du navire.
: Art.19 du CMA
12
Quant au choix des noms des navires de commerce, lart.10 du prsent arrt
nonce que les navires de commerce devront tre dnomms essentiellement en
considration de nom :
De martyrs de la Rvolution Algrienne ou de grandes figures de lhistoire
algriennes ;
De montagnes algriennes ;
De gisements algriens ;
Doueds algriens ;
De villes algriennes ;
De poissons.
Dans son art.17, le CMA exige que le nom doit tre indiqu de chaque ct de la
proue et sur la poupe en caractre arabe et latin.
B/ Tonnage
Le deuxime lment de lindividualisation des navires, tonnage et jauge, qui est
dfinit par lart.18 comme lexpression de la capacit intrieure du navire.
La jauge du navire a une importance considrable quant son exploitation, car
elle permet de dterminer les droits et taxes inhrents au passage des navires dans un
port. Elle permet aussi de calculer le plafond de limitation de responsabilit du
propritaire de navire. Lopration de jaugeage est effectue par lautorit administrative
comptente ou par le service des douanes.
Le CMA dans son art. 22 stipule que : le jaugeage est effectu conformment
aux rglements spciaux fonds sur les dispositions des conventions internationales,
auxquelles lAlgrie est partie, mais en ralit lAlgrie nest pas adhrente la
convention de 1969 sur le jaugeage des navires, la seule convention se rapprochant au
jaugeage dont lAlgrie a ratifi est la convention de Londres de 1930 sur les lignes de
charges.
Un certificat de jauge est dlivre au propritaire de navire qui le dpose au
bureau dimmatriculation.
13
C/ Port dattache
Le port dattache est celui du lieu de son immatriculation (2). Gnralement, le
choix du port dattache dpendra souvent des taxes professionnelles et comme en
lAlgrie, le seul armateur propritaire est ltat, cette notion na pas dimportance car
ses navires ont t immatriculs dans les annes 70, lpoque socialiste o le rgime
fiscal tait diffrent.
Le nom du port dattache du navire doit tre indiqu sous le nom du navire qui
figure sur la poupe en caractre arabe et latin.
Aux termes de lart. 47 : linscription dun navire algrien sur un registre
tranger ne peut avoir lieu avant la radiation de celui-ci du registre algrien
dimmatriculation des navires ; pareillement, pour les navires inscrits sur un registre
tranger ne peu obtenir linscription sur le registre dimmatriculation des navires avant
dtre radis du registre tranger (3).
3. Nationalit du navire
A/ Conditions dalgrianisation des navires
A-1/ Conditions de proprit
La convention de 1986 (4) dans son art.7 laisse la possibilit ltat
dimmatriculation de choisir dans sa lgislation nationale, soit les dispositions
concernant la proprit, soit celles relatives lquipage des navires ou mme les deux
la foi.
Le lgislateur algrien sest inspir de la convention de 1986, puisque lart.28 du
CMA dispose : pour obtenir la nationalit algrienne, le navire doit appartenir pour
51% au moins des personnes physiques ou morales de nationalit algrienne.
Cet article a t modifi par le nouveau texte quant la participation des
nationaux personnes physiques ou morale la proprit.
: Art.17 in fine
: Art.46
4
:Non-entre en vigueur lAlgrie a donn sa signature le 24 fvrier 1987
3
14
Personnes physiques
Art.28 du nouveau code exige une part 100% algrienne pour les personnes
physiques. Ce qui confirme limpossibilit pour les trangers de possder des navires,
surtout que ltat algrien est le seul propritaire de tous les navires de commerce.
La proprit 100% tait utilise en France selon lacte de navigation du 21
septembre 1793 jusquen 1845 dans lintrt de protger la construction navale cette
poque puisquon autorisait lattribution du pavillon franais quaux navires construits en
France, proprit exclusive de franais, et arm par un quipage franais pour
lessentiel, mais les textes actuels qui sont inscrits dans la loi du 3 janvier 1967 sont
moins rigoureux et ils exigent une proprit europenne 51%.
Personne morales
Le nouveau code a modifi les conditions dattributions du pavillon algrien aux
personnes morales, et il exige la nationalit :
dans les socits de personnes, le socits en nom collectif ou le
associs commanditaires ;
-
dans les socits responsabilit limite, les propritaires de majorit
des parts ;
-
dans les socits par actions, les propritaires de la majorit du capital et,
selon le cas, le prsident directeur gnral et la majorit des membres du conseil
dadministration ou le directoire et la majorit du conseil de surveillance.
Cet article a pris en considration les socits commerciales, qui nont pas t
dfinies par lancien code, mais reste toujours un vide juridique quant aux socits
mixtes qui dtiennent des navires et dont la participation algrienne est minoritaire
comme dans la COMAUNAM (5) et la COBENAM (6), la condition principale nest pas
remplie, savoir une majorit algrienne, ce qui rend lalgrianisation de ces navires
juridiquement impossible. Tout a fait pareil pour la CALTRAM (7) dont lAlgrie et la
Libye participent galit au capital.
: Compagnie Mauritanienne de Navigation Maritime
:Compagnie Bninoise de Navigation Maritime
7
: Compagnie Algro-libyenne de Transport Maritime
6
15
Nous pouvons constater que cet article nest que lancien article de la loi
algrienne de 1963 amende en 1976
Dans la loi franaise, lorsque le navire est proprit et coproprit de personnes
physiques ou morales, ou coproprit de personnes morales, il faut que le navire soit
100% europen.
Sur cette importance capitale de lexploitation des navires par des personnes
morales, il faudrait bien encourager et faciliter limmatriculation des navires sous
pavillon algrien par la mise en place dun dispositif de coproprit avec tous les
avantages fiscaux que les propritaires peuvent y bnficier, systme mis en place par
les grands pays maritimistes tel que la France surtout que actuellement lAlgrie est
dans limpossibilit de renouveler son parc de navires et dici vingt ans, tous les navires
algriens ne seront plus cts par les socits de classification
A-2/ Composition de lquipage
Lart.28 du CMA stipule que : pour obtenir la nationalit algrienne, le navire
doit tre pourvu dun quipage dont la proportion est conforme aux dispositions de
lart.413 de lordonnance n76-80 du 23 octobre 1976. Cet art.413 est repris in extenso
dans le nouveau code, et qui prvoit que : lensemble des membres de lquipage du
navire doit tre compos de marins algriens. Le ministre charg de la marine
marchande peut toutefois fixer une certaine proportion de marins trangers dans la
composition de lquipage ou autoriser un marin tranger sembarquer au service dun
navire algrien .
Cette possibilit pour les marins trangers embarquer sur les navires algriens
tait une ncessit aprs lindpendance de lAlgrie, car la marine marchande
algrienne tait dpourvue dofficiers, le seul personnel navigant se composait de
marins ayant occups des fonctions subalternes bord des navires franais. Aprs la
cration de lInstitut Suprieur de Bou-Smail, le membre des officiers algriens sest
accru considrablement, et le lgislateur a vu quil ne fallait plus recourir aux marins
trangers mais une autorisation dembarquement peut tre donne suite un arrt du
ministre fixant la proportion des marins trangers. (8)
: Jusqu maintenant, aucun arrt na paru.
16
En droit algrien, la rgle de lquipage est une condition pralable pour
lattribution de la nationalit algrienne. Cette rgle est tout fait diffrente en France,
car elle nest plus une condition mais une consquence de la francisation, lart.221 du
code des douanes nonce que : le personnel dun navire portant le pavillon franais
doit, dans une proportion dfinie par arrt du ministre charg de la marine marchande.
En ralit, la pratique maritime algrienne est loin dappliquer les dispositions du
code maritime, car lAlgrie est signataire daccords bilatraux avec dautres pays
notamment la Libye (9), et les fondements de lart.28 ne sont pas respects. Les
autorits algriennes ne se sont pas prononces sur ce point, car ces accords
permettent le dveloppement des changes commerciaux dune part, et dautre part, ils
assurent une indpendance vis--vis des armements trangers.
Compte tenu de la crise conomique qui secoue actuellement lAlgrie,
larmement algrien nest plus en mesure dacqurir de nouveau navires, cest pour a
le lgislateur algrien a maintenu cet article dans le but dassurer des emplois aux
marins nationaux forms Bou-Smail
A-3/ Acquisition et perte de la nationalit
Pour obtenir la nationalit algrienne, la personne physique de nationalit
algrienne ou la personne morale de droit algrien doit se conformer aux conditions de
proprit et de la composition de lquipage.
Inversement, un navire perd le bnfice du pavillon algrien(10), si :
il ne remplit plus les conditions de nationalit requise ;
il a t vendu ltranger ( il ne peut plus arborer le pavillon algrien).
: Supra. 7
: Art.9 de larrt du 17 mai 1980.
10
17
Le navire vendu ltranger va perdre la nationalit algrienne, ce qui va porter
prjudice aux cranciers hypothcaires si lhypothque maritime nexiste pas dans cet
tat tranger, cet effet, la CMA dans son art.71 considre que : est nulle et de nul
effet, toute opration qui entrane la perte de nationalit algrienne par le navire
hypothqu (11).
B/ Acte de nationalit
Un arrt a vu le jour le 17 mai 1980 qui est relatif aux modalits de dlivrance
de lacte dalgrianisation aux navires, et qui nonce dans son art.1 que la nationalit
algrienne
dun
navire
est
atteste
par
un
acte
de nationalit
dit : acte
dalgrianisation qui confre la qualit de btiment algrien, lui permettant de battre le
pavillon national et de jouir des droits qui sy rattachent.
Tout navire de commerce, de pche ou de plaisance est soumis lobtention de
lacte dalgrianisation (annexe 1). Sont exempts dalgrianisation, les navires de la
marine national, les embarcations et canots annexes des navires algrianiss, et les
embarcations dun tonnage infrieur ou gal 6 tonneaux.
Lacte de nationalit nonce le nom, le type et les caractristiques principales du
navire, le nom du propritaire et de larmateur, le lieu dimmatriculation ainsi que
dautres renseignements figurant sur la matricule dinscription du navire mentionns
lart.35 (12) lacte de nationalit est dlivre par lautorit administrative maritime(13)
comptente au lieu dimmatriculation du navire contrairement la France o lacte de
francisation est dlivre par le receveur des douanes.
11
: Cette sanction civile suppose que le navire soit ramen en Algrie.
: Art.35 stipule que : il est tenu pour chaque navire une matricule sur laquelle sont inscrits : - Le numro dordre
du matricule et la date dinscription du navire
13
: Le service national des gardes ctes exerce cette mission.
12
18
Lacte de nationalit a une valeur fondamentale car il tablit la nationalit
algrienne au navires, les soumet au droit algrien et leur permet de rclamer la
protection de ltat algrien. (14)
C/ Obligation darborer la pavillon algrien
Le port du pavillon algrien lentre des navires dans les eaux territoriales et
dans les ports est une obligation et elle est passible damendes pour tout capitaine qui
lenfreint (15).
Le CMA exige aussi que le capitaine doit hisser la pavillon algrien dune
manire approprie conformment la pratique maritime internationale sinon il est
passible damendes (16).
4. Droits rels accessoires sur le navires
1/ Dfinition :
Lart.72 du CMA dfinit le privilge comme une sret relle lgale qui confre
aux cranciers le droit de prfrence sur les autres cranciers, raison de la nature de
crance, cest--dire, un privilge est un droit que la loi donne certains cranciers
dtre prfrs aux autres. En droit maritime, le privilge est caractris par :
Il bnficie dassez nombreux cranciers ;
Ide de responsabilit du navire, le navire est responsable de ses actes et
responsable des crances qui sont nes de son exploitation.
Une personne victime dun accident caus par le navire (par ex : un abordage),
les ayants droits bnficient dun privilge sur le navire, par contre en droit terrestre,
une personne heurte par un camion, mme si le camion nest pas assure, la victime
ou ses ayant droits nont pas de droits sur le camion.
Les cranciers du propritaire du navire peuvent aussi invoquer non seulement
les privilges maritimes mais aussi les privilges du droit commun suivant lart.76 du
CMA qui seront classs quaprs les hypothques.
14
: En cas de guerre, la distinction entre un tat belligrant et neutre est indispensable.
:Art.506-2.
16
: Art.507.
15
19
Cependant, selon les dispositions du c.civ.alg, le trsor public, le fisc(17), le
vendeur(18), peuvent invoquer sur le navire, les privilges prvus par le droit civil.
2/ Catgories des privilges maritimes
A convention de 1926 a voulu renforcer la valeur des hypothques
conventionnelles et cette fin, elle a limit le nombre des cranciers privilgis qui
pourraient passer avant les cranciers hypothcaires. Pour raliser cet objectif, elle a
dclar quil aurait dsormais dans les lgislations des pays signataires deux catgories
de privilges, les privilges de premier rang qui passeraient avant les hypothques, et
les privilges de second rang qui passeraient aprs. Elle a dautre part, numr les
privilges de premier rang en laissant la libert aux tats dtablir les privilges de
second rang.
A. Privilges de premier rang
Ils passent avant les hypothques. LAlgrie na pas suivi lnumration de la
convention de 1926, elle est sinspire aussi de la convention de Bruxelles du 26 mai
1969.
1 Frais de justice et frais de gardiennage et conservation du navire(19)
Lancien code excluait ces frais, le lgislateur algrien a profit de la modification
pour les inclure dans le premier numro en suivant les dispositions de la convention de
1926, car les frais de justice exposs pour parvenir la vente du navire et la
distribution de son prix, ont une utilit commune tous les cranciers.
En deuxime rubrique, on trouve les frais de gardiennage et de conservation du
navire, ce privilge a une importance considrable car ces frais permettent de garder et
de conserver la valeur du gage des cranciers.
17
: Art.991 c.civ.alg.
: Art.997 c.civ.alg.
19
: Art.77 du CMA prcise que : les frais de justice et les frais de gardiennage ont priorit sur tous autres
privilges maritimes.
18
20
2 Les gages et autres sommes dues au capitaine et aux membres de
lquipage en vertu de leur engagement bord du navire
Les
crances
rsultant
du
contrat
dengagement
ont
lune
des
proccupations majeures de la politique socialiste algrienne, le code maritime leur a
rserv la premire place, mais reste savoir si ces crances comprennent les
cotisations sociales.
3 Les droits de port, de canal et dautres voies navigables ainsi que les
frais de pilotage
Le CMA mentionne les voies navigables, malgr quelles sont inexistantes en
Algrie.
4 Les crances contre le propritaire du chef de mort ou de lsions
corporelles survenant sur terre ou sur leau, en relation directe avec
lexploitation du navire
Le CMA fait rfrence aux indemnits pour dommages causs par le navire aux
passagers et aux membres de lquipage, en relation avec son exploitation. Quelle sera
la porte du CMA lorsque le navire est exploit par un armateur non propritaire ?
5 Les crances dlictuelles ou quasi dlictuelles contre le propritaire,
non susceptibles dtre fonds sur un contrat, du chef de perte ou
dommage un bien survenant sur terre ou sur leau, en relation directe
avec lexploitation du navire
Le CMA sinspire de la convention de 1967 en numrant ce genre de crances
qui implique un rapport entre la personne et la chose, et suivant le Professeur
DuPontavice, le privilge est attach la nature de la crance et une crance
dlictuelle nest pas privilgie, parce que lide du crdit est absente de lide de
rparation du prjudice.
21
6 Les crances du chef dassistance et de sauvetage, de relvement
dpave ou de contribution aux avaries communes
Sont privilgies les crances qui prservent le navire des prils de mer et qui
contribuent sa survie. Il sagit principalement des crances de chef dassistance et de
sauvetage, les cranciers des contributions des avaries communes sont aussi
privilgis. Ces crances sont importantes et suivant le code des assurances, ils sont
la charge de lassureur(20).
Contrairement la convention de 1926, les crances de relvement dpaves
sont privilgies.
7 Les crances dun constructeur ou rparateur de navires rsultant de la
construction ou rparation des navires
Ces crances sont inexistantes dans la convention de 1926, et malgr tout, elles
figurent en premier rang. LAlgrie ne dispose pas encore de vritables chantiers
navals.
B. Privilges de deuxime rang
La convention internationale aprs avoir numr les privilges de premier rang,
dcide que les lgislations nationales pourront admettre comme privilges au second
rang, passant aprs les hypothques maritimes, toutes les crances quelles voudront.
1 Les crances provenant des contrats ou doprations effectues par le
capitaine
Il sagit des contrats passs ou doprations effectues par le capitaine hors du
port dattache, en vertu de ses pouvoirs lgaux, pour les besoins rels de la
conservation du navire ou de la continuation du voyage.
La confrence du CMI de 1922 na pas voulu reconnatre cette crance la
primaut sur les privilges car cest aux fournisseurs quil a appartient de se renseigner
sur la situation hypothcaire du navire.
20
: Art.101-a du code des assurances
22
La confrence de 1926 la class au cinquime privilge du premier rang, car ce
privilge montre bien comment le privilge maritime est inspir par le souci de favoriser
le crdit de lexpdition. Si le capitaine ne peut plus commander les rparations et les
fournisseurs ? Le navire restera dans un port lointain, il faudra le vendre et il sera mal
vendu, et cest tous les cranciers sui seront perdant, commencer par les cranciers
hypothcaires.
Le classement algrien est en contradiction avec lnumration de la convention
de 1926 et mme la convention de 1967 dont le CMA sinspire, supprimer cette
catgorie de privilges sur le navire.
Reste aussi de savoir linterprtation des tribunaux algriens sur les dpenses
effectues non pas par le capitaine mais par un membre de lquipage (21).
2 Les crances contractuelles du chef de perte ou avaries la cargaison
et aux bagages
la convention de 1926 numre dans son art.2-4 un certain nombre de crances
en raison de pertes et dommages :
a- les indemnits pour abordage et autres accidents de navigation, ainsi que
pour dommages causs par le navire aux ouvrages dart des ports et voies
navigables ;
b- les indemnits pour lsions corporelles aux passagers ou lquipage ;
c- les indemnits pour pertes et avaries de cargaison ou de bagages.
Il sagit ici de la responsabilit de larmateur envers les tiers : les passagers,
lquipage et le chargeur. Le CMA spare les deux dernires catgories de crances
privilgies, lesquelles concernent des crances nes, au sens large, daccidents de
navigation par le navire, crances de responsabilit contractuelle, crances
dindemnits pour lsions corporelles qui sont classes au premier rang, et les
crances pour pertes et avaries de cargaison et bagages sont classes au deuxime
rang. Solution tout fait diffrente de celle apporte par la convention ratifie par
lAlgrie..
21
:Le trib. de commerce de Rouen a accord le privilge prvu par lart.31-6 de la loi 1967(DMF 88-108), le chef
mcanicien a agi comme mandataire du capitaine.
23
Enfin, nous pouvons constater que le CMA na pas tenu en compte lvolution
des pratiques maritimes, en voquant les crances que font natre contre larmateur les
actes du consignataire lorsquil contracte au lieu et place du capitaine pour les besoins
normaux du navire.
3/ lassiette du privilge
On remarque dans le CMA que les privilges portent seulement sur le navire (22),
et ils ne portent pas sur les fret du voyage auquel est n la crance privilgie.
Selon le professeur Bonassies, la convention de 1926 ainsi que la loi franaise
sont fondes sur un thme qui remonte aux origines mme du droit maritime, celui de la
fortune de mer, envisage comme lensemble des intrts mis en jeu par un armateur
loccasion dun voyage en mer. Cet ensemble comprend le navire, mais il inclut aussi
les sommes qui, tout au long du voyage, vont sincorporer au navire, tel que le fret
gagn durant le voyage, autre bnfice exceptionnel fait par le navire, par exemple,
lindemnit dassistance qui lui est d loccasion de laide apporte un navire.
On peut mme se demander si les privilges peuvent se reporter sur certaines
crances de remplacement (23). Le code maritime a t modifi, sans que le chapitre
consacr au privilge soit complt, et la question qu'on se pose, est ce que les
indemnits dues au propritaire en vertu du contrat dassurance ne sont pas
considres comme accessoires ?
4/ Les effets du privilge maritime
Un privilge maritime confre au crancier qui en bnficie de droits
considrables, non seulement un droit de prfrence et un certain droit de suite.
22
: Selon le Professeur Bonassies, malgr le silence des textes, il faut certainement tendre les privilges aux agrs
et apparaux.
23
: Le professeur Du Pontavice dfinit les crances de remplacement comme tant le montant destin remplacer
dans le patrimoine de larmateur des valeurs sur lesquelles le privilge aurait port.
24
1/ le droit de prfrence
Le droit de prfrence des cranciers sexerce dans le cadre dune vente
judiciaire du navire, travers un classement des cranciers lors de la distribution du
prix. Les cranciers maritimes privilgis de premier rang, ont priorit sur les
hypothques maritime dment inscrits, en troisime passe les cranciers privilgis de
deuxime rang, et en quatrime place immdiatement avant les cranciers simplement
chirographaires, les cranciers qui ne bnficient que dun privilge de droit commun.
Reste le classement des cranciers privilgis entre eux. Lart.80 nonce une
srie de rgles. En premier lieu, il prvoit que les cranciers privilgis de chaque
voyage sont prfrs ceux du voyage prcdent, selon le Professeur Bonassies, cette
rgle, lavantage dinciter tout crancier privilgi agir rapidement pour faire rgler
sa crance, et par lide que le crancier privilgi a rendu service au navire quil a
particip sa conservation. Or, cest le dernier conservateur qui, ayant rendu
service tous les autres cranciers, y inclus le conservateur prcdent , mrite
dabord dtre privilgi.
En effet, pour des raisons dordre social, les crances nes dun contrat
dengagement unique portant sur plusieurs voyages, elles sont assimiles aux crances
du dernier voyage, viennent toutes au mme rang avec les crances du dernier de ces
voyages (elles passent au premier rang).
2/ Le droit de suite
Le CMA dans son art.82 stipule que les privilges maritimes suivent le navire
malgr tout changement de proprit ou dimmatriculation. Reste le problme qui peut
de poser : le privilge, linverse de lhypothque maritime, nest pas assujetti aux
formalits de publicit. Rien ne vient donc avertir les nouveaux acqureurs de
lexistence dun privilge.
Dans on art.87-c, le CMA nonce quen cas de vente de navire, ou autre mode
de transfert volontaire de la proprit, le privilge steint, et par l, le droit de suite quil
inclut, trois mois aprs lenregistrement de lacte de transfert. Le privilge steint aussi
en cas de confiscation du navire, aprs une action en justice, et en cas de vente force
du navire.
25
5/ Lextinction des privilges
Outre les causes dextinction des privilges en cas de confiscation, dune vente
force du navire, ou en cas de transfert volontaire de la proprit, trois mois aprs
lenregistrement de lacte de transfert, le privilge peut disparatre en cas de
prescription ( art.84), dont le dlai est de un an partir de la date de la naissance de la
crance, moins quavant lexpiration de ce dlai, le navire ait t lobjet dune saisie
excution. Le point de dpart du dlai de premption des privilges maritimes est
divers :
Crances du chef de lsions corporelles une personne ou de perte ou
dommage un bien, le jour o ils ont en lieu ;
Crance pour contribution lavarie commune, le jour de lacte gnrateur
de cette avarie ;
Crances du chef dassistance, de sauvetage, ou de relvement dpave, le
jour auquel ces oprations ont t acheves ;
Crances du chef de perte ou avarie de marchandise ou de bagage, le jour
de leur dlivrance ou le jour auquel ils eussent d tre dlivres en cas de perte
totale ;
Pour certaines crances (frais de justice, crances nes du contrat
dengagement, le jour o la crance devient exigible).
Le privilge steint aussi lorsque le navire cesse dtre en la possession du
constructeur ou du rparateur du navire, selon le cas.
Ce dlai dun an nest susceptible daucune suspension ni interruption, toutefois,
ce dlai ne court pas, tant quun empchement lgal met le crancier privilgi dans
limpossibilit de saisir le navire sans quil puisse dpasser trois ans depuis la
naissance de la crance privilgie.
Selon le professeur Viallard, une autre cause fait disparatre les privilges
maritimes pouvant profiter tel ou tel crancier, est la constitution du fonds de
limitation : la rpartition du fonds se fera proportionnellement au montant des crances
reconnues, sans aucune prfrence dun crancier bnficiant de la limitation par
rapport lautre.
26
B. Hypothques maritime
1- Dfinition :
Lhypothque maritime constitue une sret conventionnelle qui confre aux
cranciers un droit rel sur le navire.
Le c.civ.alg dans son art.886 nonce que sauf disposition contraire,
lhypothque ne peut tre constitue que sur les immeubles, en excluant de son
champs les meubles. Le lgislateur algrien sinspirant des lgislations des pays
maritimistes comme la France (24), a institu lhypothque maritime sur les navires dans
le code maritime.
2- Constitution de lhypothque maritime
La convention des parties constitue la seule source de lhypothque
maritime ;une hypothque maritime peut tre constitue sur tout navire mme en
construction, elle peut tre aussi constitue sur tout btiment de mer.
Lhypothque maritime ne peut tre consentie sur les navires et btiments de
mer appartenant ltat, ou aux collectivits locales, et cette disposition est mme
confirme par lart.689 du c.civ.alg qui dispose que les biens de ltats sont
inalinables, insaisissables et imprescriptibles, et comme la quasi-totalit de la flotte
algrienne appartient ltat ou ses manations (CNAN), il ny a aucun intrt
pratique, car lhypothque nest susceptible dtre applique qu des bateaux de pche
ou de plaisance, de trs faible tonnage.
Le CMA dans son art.57 prvoit que lhypothque maritime ne peut tre
constitue que par le propritaire du navire, qui doit avoir la capacit dhypothquer, ou
selon le droit commun (25), un tiers qui consent lhypothque dans lintrt du dbiteur.
En ce qui concerne les navires en coproprit, lhypothque sur la totalit du
navire doit tre consentie par la majorit des copropritaires. Cependant, chaque
copropritaire du navire peut hypothquer sa part indivise sur le navire avec tous les
risques que lhypothque peut engendrer.
24
25
La loi du 10 dcembre 1984.
:Art.884 c.civ.alg
27
3- Formes du contrat dhypothque
Le contrat dhypothque maritime doit tre conclue par un acte authentique
seulement, le lgislateur algrien ne reconnat pas les actes sous-seing priv.
4- Publicit des hypothques
Lart.63 du CMA prcise que les hypothques constitues sur un navire doivent
faire lobjet dune inscription sur la matricule du navire concern, tenu au registre
dimmatriculation des navires par les gardes ctes de la marine algrienne.
Tout navire grev dhypothques doit avoir obligatoirement dans ses documents
de bord, un tat des inscriptions hypothcaires mis jour la date de son dpart. En
effet, le registre algrien dimmatriculation des navires tant public, lautorisation
administrative doit le mettre la disposition des personnes intresses pour
consultation. (26)
5- Premption et radiation
Lhypothque maritime est conserve pendant dix ans compter de la date de
son inscription rglementaire. A lexpiration de ce dlai et, en cas de non
renouvellement, lhypothque est annule (art.66).
Par ailleurs, elle peut faire lobjet dune radiation soit avec le consentement des
parties ayant capacit cet effet, soit par voie judiciaire.
6- Assiette de lhypothque maritime
Lhypothque maritime porte sur le navire et autres btiments de mer, et elle
stend sur tous les accessoires, machines et apparaux ainsi qu tous les lments qui
sont distinctement identifis comme tant destins tre incorpors au navire, tel quun
moteur neuf remplaant un moteur plus g.
26
: art.14 de larrt du 20.10.1988 fixant les modalits de tenue du registre dimm.
28
Cet art.58 prcise que lhypothque maritime stend aux accessoires, machines,
sauf convention des parties, il est donc possible que le propritaire prvoit dans le
contrat dhypothque que lhypothque stend pas tel matriel ou au matriel
ultrieurement mis bord.
Aux termes de lart.61, en cas de perte ou davarie grave plaant le navire en tat
dinnavigabilit les cranciers hypothcaires exercent leurs droits sur les indemnits ou
sommes subroges et ses accessoires. Sont subroges au navire et ses
accessoires :
Les indemnits dues au propritaire raison des dommages matriels subis
par le navire hypothqu ;
Les sommes dues au propritaire pour contribution aux avaries communes
subies par le navire ;
Les indemnits dues au propritaire du navire hypothqu pour lassistance
prte ou le sauvetage effectu depuis linscription de lhypothque, dans la mesure
o elles reprsentent la perte ou lavarie du navire hypothqu ;
Les indemnits dassurance sur le corps du navire.
En revanche, lhypothque maritime ne stend pas au fret.
7- Effets de lhypothque maritime
1/ Droit de saisir le navire
Si un crancier nest pas pay, il a le droit de saisir le navire dans les mains du
dbiteur, et de le faire vendre pour tre pay sur le prix de vente.
En effet, le CMA dans son art.71 prvoit que : est nulle et de nul effet, toute
opration qui entrane la perte de nationalit algrienne par le navire hypothqu , et
ceci pour viter que le dbiteur viole les droits des cranciers hypothcaires. Et selon le
professeur Bonassies, les dispositions de lart.71 ninterdisent pas la vente ltranger
dun navire hypothqu lorsque cette vente est faite dans les conditions telles que le
remboursement du crancier par lacheteur, ou transfert de lhypothque sur le registre
tranger avec laccord du crancier.
29
2/ Droit de suite
Le droit de suite organis par lart.67 prvoit que les hypothques maritimes
suivent le navire ou portion du navire hypothqu, nonobstant tout changement de
proprit ou de navire hypothqu. Etant donn que lhypothque est publie au
registre des hypothques, le nouveau acqureur peut connatre ltat des inscriptions
hypothcaires.
3/ Droit de prfrence
Les cranciers hypothcaires sont classs daprs lordre chronologique de leur
inscription, les cranciers inscrits le mme jour seront classs dans lordre de leur
inscription, et ne seront pas mis, comme en droit franais, en concurrence les uns avec
les autres.
4/ Effets de lhypothque sur une part de coproprit
Le CMA prvoit que chaque quirataire peut hypothquer sa part, et le crancier
peut saisir cette part, mais il ne sest prononc si lhypothque pour assiette plus de la
moiti du navire, et est ce quil est possible de vendre du navire ?
30
CHAPITRE II
1) Dispositions prliminaires
Le CMA dans son art.571 stipulait que : le monopole dtat est institu sur les
activits de transports maritimes , et mme ces activits sont rserves aux
socits nationales et organismes algriens.
Le lgislateur algrien a vu la ncessit de libraliser les activits de transport,
lart.578 a t abrog, lart.571 a t modifi en prenant en considration lart.17 de la
constitution qui nonce que : le transport maritime est une proprit publique .
Le lgislateur, en voulant contourner cet article, a ajout un alina stipulant que
le transport maritime peut faire lobjet dune concession, consentie sur la base dun
cahier de charge.
La concession (annexe 2) est une convention par laquelle ladministration charge
une personne physique ou morale de droit priv ou de droit public, dassurer ses
risques, le fonctionnement dun service public sur lequel elle percevra une rmunration
prleve auprs des usagers (27).
La concession est octroye toutes personnes ayant la qualit darmateur, qui
en font la demande et qui remplissent des conditions de moralit, de moyens humains
et matriels. Le concessionnaire doit se conformer aux normes en matires
dexploitation maritime quant la scurit des navires, la qualification du personnel
100% algrien.
En plus des exigences du cahier de charge que les armateurs doivent satisfaire,
en contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits en
sus des charges sociales et des redevances fiscales, contracter lensemble des
assurances couvrant les risques dus lexploitation de la concession et ceux relatifs
ses engagements et ses responsabilits (28).
27
: La concession, ce qui faut retenir de manire gnrale, A. BOUDJELLAL, le Phare, juin 1999, n2
: Dcret excutif n2000-81 du 9 avril 2000 fixant les conditions et les modalits dexploitation des services de
transport maritime.
28
31
Ces exigences sont trs rigoureuses, car la chose primordiale chez les
armateurs est de minimiser au maximum les cots et, de chercher des gains de
productivit.
Equipage 100% algriens et tous ces frais inhrents la concession en plus
des charges sociales et fiscales, nattirent pas les personnes investir dans le domaine
maritime, car, ils pourront exercer ces activits en battant dautres pavillons plus
attractifs (pavillons de complaisance), et ils pourront desservir les ports algriens sans
que lAlgrie refusera leurs dessertes et leurs escales. En effet, le droit international, en
particulier la convention de Genve de 1958 sur la haute mer, et la convention de 1982
sur le droit de la mer, obligent un tat ctier daccepter sur son territoire maritime le
droit de passage innocent des navires et la libert daccs dans cet tat. LAlgrie ayant
sign ces conventions internationales, ne pouvait que respecter ce droit.
Une compagnie dont le sige est en Algrie mais dont les dynamiques
propritaires et dirigeants ne le sont pas, et qui est capable de mettre des navires
supplmentaires en ligne, mrite dtre encourage, ne serait ce que parce quelles
acquittent bien plus dimpts et, elles embarquent des marins algriens, surtout que
dune part, lAlgrie nassure que 30% du trafic, et dautre part, sur les 125 navires
desservant les pays membres du mmorandum de Paris, 35 navires dont immobiliss
pour non-conformit aux conventions internationales (29).
La proccupation majeure du lgislateur algrien reste celle de la libralisation
graduelle du secteur des transports et lemploi des marins algriens. Et selon M.Poirier
dAnge dOrsay, il faut raisonner dune faon plus large en termes de tissus et de la
prsence du pavillon national dans le monde (30).
29
30
: Documentations M.Bottala Gambetta, Cours DESS Droit maritime, Promo 2000.
: P.Poirier dAnge dOrsay, DG de lArmement Dreyfus, IMTM 1989
32
2) Armateur
a) Notion darmateur :
Lart.572 du CMA considre larmateur comme toute personne physique ou
morale qui assure lexploitation dun navire en son nom soit titre de propritaire du
navire, soit dautres titres lui attribuant lusage du navire.
1. Armateur propritaire :
Le seul armateur propritaire en Algrie est la CNAN (31), dont son patrimoine
actif et passif nest que le patrimoine de ltat algrien.
A lpoque du monopole, cette notion darmateur a perdu beaucoup de son
intrt car toutes les activits relatives lexploitation commerciale dun navire sont
dclares monopole dtat. Pis encore, cette proprit publique a conduit les tribunaux
trangers saisir les navires en se fondant sur la thorie de lmanation.
Le droit international, notamment la convention de Bruxelles du 10 avril 1926
pour lunification de certaines rgles concernant les immunits des navires(32) stipule
que les navires de ltat qui sengageaient dans des activits commerciales ne
bnficiaient pas ni de limmunit de juridictions ni de limmunit dexcution, un
crancier dun tat tranger peut saisir un navire de la CNAN.
2. Armateur non-propritaire
Le CMA dans sa dfinition de larmateur, fait rfrence lexploitant du navire
non-propritaire, et il stipule que : est considr comme armateur toute personne
physique ou morale qui assure lexploitation dun navire en son nom soit titre de
propritaire du navire, soit dautre titres lui attribuant lusage du navire.
Or, dautres titres lui attribuant lusage du navire concerne laffrteur
temps, laffrteur coque nue qui peuvent tre assimils des armateurs. Aujourdhui
aussi, on peut qualifier le grant darmateur, car mme la convention internationale
31
: C.N.A.N. : Compagnie Nationale Algrienne de Navigation, cre par Dcret n63-489 du 31 dcembre 1963
(JORA du 17 janvier 1964)
32
: Non encore ratifie par lAlgrie.
33
relative lunification de la responsabilit des propritaires de navire linclut parmi les
bnficiaires du droit de la limitation aux cts des propritaires (33).
Un grant peut tre armateur surtout quand il gre un navire de commerce
appartenant une socit nationale. La loi n89-01du 7 fvrier 1989 prend en
considration les avantages de la grance, et stipule dans son art.1 que : le contrat de
management est le contrat par lequel un partenaire qui jouit dune rputation bien tablie,
dnomm gestionnaire, sengage grer au nom et pour le compte dune entreprise
publique conomique, ou dune socit dconomie mixte, moyennant une rmunration,
tout ou partie du patrimoine de cette dernire, en y apportant un label, selon les normes
et standards et la faire bnficier de ses rseaux de promotion et de vente . Ce texte
touche toutes les socits nationales, et comme la CNAN est une socit nationale, elle
peut faire lobjet dune grance soit par un partenaire national ou tranger.
b) Responsabilit du propritaire du navire
1) Source de la responsabilit
Tout
dabord,
larmateur
une
responsabilit
contractuelle
avec
son
cocontractant. Il rpond la bonne excution des contrats conclus par lui, comme aussi
des contrats conclus par ses prposs (consignataire de navire).
Il aussi une responsabilit extra contractuelle, car suivant lart.574, larmateur est
tenu dassurer que le navire en son exploitation rpond aux normes de la navigabilit, de
la scurit de larmement, de lquipement et du ravitaillement
Aux termes de lart.577, larmateur est responsable des fautes de ses prposs
terrestres et maritimes (capitaines, consignataire de navire). Larmateur est aussi
considr comme le gardien du navire(34), le c.civ.alg dans son art.138 prcise que :
toute personne qui a la garde dune chose et qui exerce sur elle un pouvoir dusage,
de direction et de contrle, est prsum responsable des dommages quelle occasionne
Ici, la responsabilit de larmateur est du fait des choses, reste savoir, son application
par les tribunaux algriens.
33
: art.111 du CMA prvoit que : les dispositions du prsent chapitre (Responsabilit du propritaire du navire)
sappliquent , larmateur grant .
34
: Cdc. Arrt Lamoricire du 19 juin 1951 (D. 1951.717)
34
Le CMA sinspire de la convention de 1957 quant la responsabilit du propritaire
de navires(35), il prcise dans son art.92 que : le propritaire dun navire peut limiter sa
responsabilit , sauf si une faute prouve lui est personnellement imputable .
La simple faute de larmateur, ds lors quelle tait une faute personnelle et non la
faute du capitaine ou celle de lun de ses prposs, le prive de la limitation de
responsabilit, dans la jurisprudence franaise, larrt le plus remarquable est celui du
NAVIPESA DOS. La porte arrire de ce navire roulier ntant pas parfaitement tanche,
une importante quantit deau avait pntr dans la cale, occasionnant pour le navire
une gte dangereuse, et entranant la chute la mer dune partie de la cargaison charge
en ponte(36). Reste savoir, linterprtation des tribunaux algriens de la faute
personnelle.
LAlgrie na toujours pas sign la convention de 1976 sur la limitation de
responsabilit en matire de crances maritimes, le lgislateur na pas introduit dans le
code modifi, la notion de faute inexcusable, malgr que cette notion nest pas nouvelle
en droit maritime algrien, elle est reprise dans lart.809 et 841 comme causes de
dchances de la limitation de responsabilit, en matire de transport de marchandise,
et de transport de passagers et de leurs bagages.
Nous considrons quil tait utile dintroduire cette notion, afin que le seul armateur
actuel qui est la CNAN puisse tre labri des futures dcisions rigoureuses tel quil tait
le cas dans les tribunaux franais et anglais(37).
Dans lattente de lavnement dune flotte prive, peut tre le lgislateur algrien
sera tent de sauvegarder les intrts des chargeurs en adoptant la convention de 1976
dans le but daugmenter les plafonds de limitation.
2) Limitation de responsabilit de larmateur
Le lgislateur algrien a abandonn les dispositions de la convention de 1957,
nonant que le propritaire du navire peut limiter sa responsabilit pour toute obligation
ou responsabilit relative lenlvement des paves , et il a adopt la loi du
35
: Dcret n64-74 du 2 mars 1964 portant adhsion de lAlgrie.
: Professeur P.Bonassies, Cour de Droit maritime, p 373
37
: La chambre des lords a reproch larmateur, comme une faute entranant dchance du droit de limitation, le
fait de ne pas avoir mis en place un systme adquat permettant un contrle effectif du comportement de ses
capitaines, Cour de Droit maritime, Professeur Bonassies, p 373
36
35
21/12/1984 modifiant lart.59 de la loi du 31/01/1967(38), en prcisant dans son art.94
que : la limitation de la responsabilit du propritaire dun navire nest pas opposable
aux crances de ltat ou de tout autre organisme public qui aurait, aux lieu et place du
propritaire, refoul, enlev, dtruit ou rendu inoffensif un navire coul, naufrag ou
abandonn y compris tout ce qui trouve ou sest trouv bord.
Dornavant, les armateurs algriens ne peuvent plus opposer la limitation un
port algrien invoquant une crance ne du relvement de leurs navires.
Lart.93 (d) a t maintenu, qui stipule que : toute obligation ou responsabilit
des dommages causs par un navire aux ouvrages dart des ports, bassins, et voies
navigables, nous pouvons constater que les voies navigables qui sont des voies fluviales
et non maritimes sont inexistantes en Algrie.
Le CMA dans son art.11 numre tous les bnficiaires ventuels de la limitation
sans citer lassureur. En effet, lart.149 de lordonnance n95-07 du 25 janvier 1995
relative aux assurances dispose que : en cas de constitution dun fonds de limitation,
les cranciers dont le droit est sujet limitation dans les termes des art.92 93 et 95 de
lordonnance n76-80 portant code maritime, nont pas dactions contre lassureur .
Le Professeur Bonassies considre que, si un fonds de limitation a t constitu,
ce qui se fera dailleurs le plus souvent linitiative de lassureur, ce dernier bnficiera
de la limitation.
2- Auxiliaires de lexploitation du navire
a- Consignataire du navire :
a-1- Dfinition :
Le consignataire du navire, ou agent maritime, est le mandataire salari de
larmateur dans un port o cet armateur na ni reprsentant ni succursale.
38
: Dans son acte dadhsion la convention de 1976, la France a en effet dclar vouloir se rserver le droit vis
lart.18 qui stipule que : tout tat signataire peut rserver lors de la signature ou de la ratification, le droit dexclure
lapplication de larticle 2, alina (d) et (e)
36
Le CMA, dans son art.609 dfinit le consignataire du navire, comme toute
personne physique ou morale qui en vertu dun mandat de larmateur ou du capitaine,
sengage moyennant une rmunration effectuer pour les besoins et le compte du
navire et de lexpdition des oprations que le capitaine naccomplit pas lui-mme ainsi
que dautres oprations habituellement attaches au sjour dun navire dans un port. Il a
tout pouvoir pour ngocier les contrats de transport, coter, recruter et encaisser
ventuellement les frets mettre et signer les connaissement correspondants, assurer la
logistique des conteneurs et ngocier ventuellement tout contrats relatifs aux oprations
annexes.
Le rle du consignataire du navire est trs variable, il prpare dune part, lescale
du navire au port, et dautre part, il accomplit pour le compte de larmateur un certain
nombre doprations commerciales : les oprations de rception et de livraison des
marchandises aux lieu et place du capitaine, la conduite administrative du navire auprs
des autorits locales. La conclusion des contrats de manutention, de remorquage et de
pilotage, lassistance au navire pendant son sjour dans le port, la fourniture des fonds
ncessaires au capitaine, le paiement des droits, des frais et dautres charges dus
loccasion de lescale du navire dans le port.
a-2- Relations avec larmateur
Le consignataire ou agent maritime excute une opration ponctuelle, il sera
considr comme un simple mandataire rmunr par une commission fixe par une
convention, par un tarif, ou dfaut par lusage, il est responsable des fautes quil
commet dans lexercice de ses fonctions dans les termes du droit commun (39).
Sa responsabilit contractuelle ne peut tre mise en jeu que par celui qui a requis
ses services, il nest donc responsable quenvers son mandant en loccurrence larmateur
et lui seul.
Cependant, ds que les relations entre armateur et consignataire soient
permanentes, la jurisprudence considre que le consignataire sera protg (40), il ne
pourra tre rvoqu ni sans raisons, ni sans pravis.
39
: Le c.civ.alg dans son art.576 stipule que : le mandataire doit toujours dans lexcution du mandat, y apporter la
diligence dun bon pre de famille
40
: art.587 nonce que le mandant doit indemniser le mandataire du prjudice quil prouve du fait de sa rvocation
intempestive ou sans motifs
37
Aux termes de lart.618, le contrat de consignation du navire est rsili ou
dnonc dans les dlais convenus (dlais de pravis suffisant). Toujours, pour un motif
grave, chacune des parties peut mettre immdiatement fin au contrat.
Le CMA confre au consignataire les pouvoirs dester en justice en nom de
larmateur.
Contrairement au droit franais, toute action dcoulant du contrat de consignation
du navire est prescrite par deux ans compter du jour de lexigibilit de la crance
b- Consignataire de cargaison
Le consignataire de cargaison est le mandataire salari des ayants droits la
marchandises, il sengage moyennant une rmunration, prendre livraison des
marchandises en leurs lieu et place au moment de la livraison par le transporteur au nom
et par le compte de ses mandants, de payer le fret pour les marchandises, sil est d, et
de rpartir les marchandises entre les destinataires.
Le consignataire prend donc livraison des mains du transporteur ou de son
reprsentant (consignataire du navire). Juridiquement, lintervention dun consignataire
de cargaison est trs importante, car elle libre le transporteur de sa responsabilit
linstant o il lui livre la marchandises. En revanche, dans le cas o ltat et la quantit de
la marchandise ne rpondent pas aux indications du connaissement ou dautres
documents de transport, le consignataire doit mettre contre le transporteur ou son
reprsentant, les rserves au moment de la livraison de la marchandise.
Faute de rserves, le consignataire de la cargaison est considr, jusqu preuve
du contraire, avoir reu les marchandises dans ltat et limportance dcrite au
connaissement ou dans tout autre document de transport. On constate quil y a une
prsomption irrfragable lgard des ayants droits de la marchandise ; et cest une
prsomption simple dans les rapports du consignataire de cargaison et du transporteur.
Le consignataire de cargaison est responsable des fautes et dommages lis son
activit de mandataire, et sa responsabilit sera engage dans les termes du droit
commun. Sa responsabilit est aussi aligne sur celle du manutentionnaire. Ainsi,
lorsque le manutentionnaire effectue des oprations de manutention, il est responsable
des dommages dus sa faute.
38
Comme le consignataire du navire, le contrat de consignation de cargaison est
rsili ou dnonc dans les mme conditions et dlais, et la prescription tant de 2 ans.
Le consignataire de cargaison peut ester en justice en nom des ayants droits sur
la marchandise dans la mesure o la reprsentation lui est confre, par contre, le droit
franais ne confre pas au consignataire de la cargaison un pouvoir lgal de reprsenter
en justice.
En attendant le dveloppement des NVOCC (41) en Algrie, lintervention du
correspondant pour les oprations de dgroupage, conduit-elle les tribunaux lassimiler
un consignataire de cargaison, et la livraison faite ?.
c- Courtier maritime
Est un mandataire qui agit comme intermdiaire pour conclure des contrats
dachats et de vente des navires, des contrats daffrtements et de transport maritime et
dautre contrats relatif la commercialisation.
Il est renseign en permanence sur le march boursier du fret et des
marchandises, et il essaie de mettre en contact un chargeur et un armateur, il est tenu
dagir dans les limites des pouvoirs quil lui sont confis et conformment aux instructions
de son mandants.
Un courtier a t condamn pour avoir propos un navire dont la gomtrie des
cales ne permettaient pas lemplacement des marchandises (fardeaux de bois), alors
que le laffrteur lui avait communiqu les caractristiques (42).
Il a droit une rmunration fixe par un tarif ou dfaut, par lusage, et toutefois,
le courtier na pas droit cette rmunration si le contrat na pas t conclu par ses
soins(43).
Le CMA naborde pas la fonction du courtier conducteur qui consiste faciliter les
formalits affrentes lentre et la sortie des navires trangers dans les ports
algriens, et aussi lactivit du courtier interprte qui assure la traduction de tous les
41
: Non Vessel Operating Commun Carrier, fonction inexistante en Algrie due la rglementation douanire d
une part, et dautre part la rglementation de changes.
42
: Navire Atlantish, Paris, 24 octobre 1984, DMF85- 361
43
: Art.635 in fine.
39
documents administratifs tels que la charte-partie et les connaissements. Ces deux
fonctions sont gnralement assures par le consignataire des navires.
En droit franais, cest les dispositions de lart.80 du C.Cce qui dfinissent les
courtiers maritimes, cependant, le courtier daffrtement na aucun statut spcifique.
Cette fonction de courtier daffrtement nest pas encore dveloppe en Algrie.
d- Consignation et courtage lpoque du monopole
Dans Les annes 70, les diffrents monopoles des activits du shipping ont t
confies larmement national(44) et cette poque l, lagent consignataire national
unique (navire et cargaison) traitait jusqu 1200 navires / an, et recevait environs 20
millions de tonnes de marchandises hors hydrocarbures, quivalent lchange de
500.000 de connaissements (45).
Dans certaines circonstances, le CMA sest avr hors ralit, du fait que les
monopoles ont confr une autorit aux entreprises, les rendant hors la loi (saisie
conservatoire dun car ferry de la CNAN son bord 1000 passagers en faveur dun
fournisseur espagnol qui na pas t crdit par son client algrien, alors que la
marchandise a t livre par lagent consignataire national unique). (46)
Le CMA dans son art.624 nonce que dans le cas o ltat et la quantit de la
marchandise ne rpondent pas aux indications du connaissement ou dautres documents
de transport, le consignataire de cargaison doit mettre contre le transporteur ou son
reprsentant des rserves. Et comme lagent consignataire algrien unique tait coiff de
deux casquettes, en ralit, il ne pouvait mettre des rserves contre personnes.
Prenons aussi lart.613 du CMA qui stipule que dans la mesure o la
reprsentation de larmateur lui est confre, le consignataire du navire peut ester en
justice en son nom. Nous pouvons constater de cet acte que, larmateur tranger est
devant une situation de diktat, il na aucun choix de confrer sa reprsentation un autre
reprsentant.
44
: Monopole dtat sur la consignation.
: Source : Direction des activits portuaires (CNAN), statistiques 1983.
46
: Voir M.Khelifa, Guide des changes internationaux, Ed Dahlab, 1994.
45
40
La fonction du courtier interprte a t confie la CNAN dans le cadre du
monopole, et elle est passe aux oubliettes en la rangeant dans une case
dorganigramme chez le consignataire national unique dont son rle de limite dposer
en douane le manifeste du navire.
Nous considrons aussi quil est aussi regrettable quavec un trafic potentiel de
marchandises homognes, les importateurs algriens dadressent toujours aux courtiers
trangers qui dont certains nont exist que par le trafic vers lAlgrie et pour lAlgrie, en
rglant des commissions de courtage en devises trangres.
Du fait que la CMA est devenu sur certains aspects hors ralit , le lgislateur
algrien a vu la ncessit de le mettre en conformit avec la ralit conomique et
conjoncturelle algrienne, en abrogeant les dispositions confrant aux entreprises dtat
les monopoles (47), et aussi en dcrtant le 25 dcembre 1991 un dcret autorisant
lexercice des fonctions de consignataire de navire, de cargaison et de courtier maritime.
Cette autorisation est subordonne un certain nombre de conditions comme
justificatifs de la qualification requise, et un arrt du 5 octobre 1996 a complt le
dcret, en exigeant une caution bancaire de 400.000 DA.
4- Contrat de transport de marchandises par mer
a- Dfinition :
Par le contrat de transport de marchandises par mer, le transporteur sengage
acheminer une marchandise dtermine dun port un autre port et le chargeur en
payer la rmunration appele fret (48).
47
48
: art. 571 du CMA.
: art. 738 du CMA.
41
b- Lgislations applicables
Le transport de marchandises par mer est rgi aujourdhui, tant par les
conventions internationales que par le droit interne.
La convention de Bruxelles du 25 aot 1924 constitue la base de la
rglementation internationale en la matire. Elle a t modifie une premire fois par le
protocole du 23 fvrier 1968 (dnomme rgles de Visby), puis une seconde fois par le
protocole du 21 dcembre 1979. LAlgrie a ratifi seulement la convention de 1924,
mais elle sinspire des rgles de Visby quant la responsabilit du transporteur.
Le transport de marchandise est rgi par le CMA (art.738 816).
Le 31 mars 1978, une nouvelle convention sur le transport maritime a t signe
Hambourg, linitiative des pays en voies de dveloppement, leur tte lAlgrie,
lesquels trouvaient le texte de 1924 trs favorable aux transporteurs maritimes. En cette
convention, plus communment appele Rgles de Hambourg, est entre en vigueur le
01 novembre 1992. Elle apporte des modifications importantes au rgime juridique du
transport maritime de marchandises. LAlgrie na pas encore ce jour ratifi les rgles
de Hambourg.
En matire de relations contractuelles, le CMA pourra rgir les contrats conclus en
Algrie (49), moins que les parties contractantes ne conviennent quune autre loi sera
applique. Cette rgle a t rappele par lart.747 du CMA qui prcise que : aux
transports maritimes entre les ports algriens et les ports trangers, les dispositions
particulires de la convention internationale en la matire, dont lAlgrie est partie, sont
applicables aux besoins.
c- Comptence territoriale
Le droit interne algrien apporte une rponse la question de la comptence
territoriale, laction sera porte soit, selon les dispositions du droit commun (50), devant la
juridiction du domicile du dfendeur soit, selon les dispositions de lart.745, devant la
juridiction du port de chargement ou de dchargement, si celui-ci est situ sur le territoire
national.
49
50
: Art.18 al 1er, c.civ.alg.
: Art. 8 du C.P.C.
42
Dans ce sens, il a t jug (51) que le demandeur a le droit de choisir la juridiction
pour quil soit indemniser des pertes et dommages, suite un transport de marchandises
par mer. Donc, les destinataires algriens intenteront des actions en justice contre le
transporteur maritime devant les juridictions des ports algriens.
Nous pouvons constater aussi, daprs lart.747, que le CMA prend garde de
lexistence trs frquente des clauses dattribution de comptence et des clauses
compromissoires, clause Paramount, en stipulant que les dispositions du CMA ne sont
applicables que dans la mesure o dautres stipulations nont pas t expressment
convenues. Ces clauses sont contractuelles, par lesquelles, les parties (transporteur)
dsignent un tribunal comptent, plus commode. Daprs cette jurisprudence suscite,
ces clauses ne sont pas opposables aux tiers malgr quelles soient connues et
acceptes par lautre partie du contrat du transport, car mme lart.10 du CPC nonce
que : tout tranger, mme non rsident en Algrie, pourra tre cit devant les
juridictions algriennes, pour lexcution des obligations par lui contractes en Algrie
avec un algrien. Il pourra tre traduit devant les juridictions algriennes pour les
obligations par lui contractes en pays tranger envers des algriens . Cet article
confirme que mme si le contrat de transport est sexcute ltranger, et comme en
droit maritime, on rencontre les problmes de localisation des contrats, laction en justice
doit tre intente devant les tribunaux algriens.
La mme chose pour la clause Paramount, qui est une clause par laquelle les
parties soumettent volontairement leurs contrats de transport une autre loi que celle qui
a normalement vocation le rgir : il sagit, comme le prcise le doyen Rodire, dune
clause souveraine (52).
Le CMA dans son art.747 se dclare applicable que dans la mesure o dautres
stipulations nont pas t expressment convenues, nous pouvons constater que cet
article confirme la validit dune clause renvoyant une convention autre que celle
ratifie par lAlgrie.
51
: Arrt n 162697 du 16/12/1997, Jurisprudence de la chambre commerciale et maritime de la cour suprme
algrienne, 1999.
52
: Dfinition du Lamy Transport Tome 2, P384.
43
d- Sectionnement juridique du contrat
Suivant le Professeur Vialard, les phases du transport maritime peuvent tre
schmatiser en trois temps :
Au port de dpart, phase de pr embarquement de la marchandise bord du
navire (prise en charge par le transporteur maritime, entreposage, acheminement de
la marchandise sur le terre-plein jusquau long du navire) ;
Phase maritime proprement dite : chargement, dplacement, par voie de mer,
dchargement ;
Au port darrive, phase postrieure au dchargement jusqu la livraison au
destinataire.
La convention de Bruxelles ne couvre que la phase proprement maritime du
transport, oprant un sectionnement juridique (53) de la relation contractuelle. Elle
considre aussi que le contrat de transport ne se termine au minimum que par le
dchargement des marchandises, et elle a introduit un minimum lgal que chaque tat
contractant doit au moins reprendre dans sa lgislation interne. Et la rduction de la
priode o la convention est applicable nest pas contractuellement possible.
Cest pour ces raisons, que lAlgrie comme de trs nombreux pays (France) ont
introduit la livraison comme dernire tape du contrat de transport.
e- Conclusion du contrat et obligations des parties
Le contrat de transport maritime est un contrat consensuel qui donne lieu
lmission dun crit pour constater laccord des parties et ses modalits. Cependant, le
connaissement continue de jouer un rle absolument essentiel dans le transport
maritime.
Lart.748 du CMA impose au transporteur ou son reprsentant dmettre un
connaissement sur demande du chargeur ; cest--dire, si le chargeur ne demande pas
ce titre, le transporteur nest pas tenu de le lui remettre.
53
: Professeur A.Vialard, Droit maritime, PUF, 1997.
44
e-1- Spcificit juridique du connaissement
Suivant le professeur Scapel (54), le connaissement est une invention gniale, car
il peut maintenant :
Revtir plusieurs formes ;
Assumer plusieurs fonctions.
e-2- Les formes du connaissement
Lart.758 stipule que le connaissement peut tre tabli :
Au nom dun destinataire dsign par un connaissement personne
dnomm ;
A lordre dun chargeur ou dune personne indique par lui au connaissement
ordre
Au porteur .
Il ajoute aussi, que si dans un connaissement ordre, la personne lordre de
laquelle le connaissement est tabli, na pas t dsign, il est considr comme tabli
lordre du chargeur.
e-2-1- Le connaissement nominatif (A personne dnomme)
Il indique nommment qui est le destinataire, de ces avantages, il nest pas
expos au risque de perte et de vol, car le connaissement dsigne expressment le
destinataire, ce qui oblige le transporteur livrer ce destinataire qui figure dans la case
destinataire.
Ce connaissement prsente un inconvnient du fait quil ne circule pas de faon
commode, puisquil ne peut pas tre transfr suivant les formes simplifies du droit
commun. Il peut tre cd selon les rgles du droit commun.(55)
54
: Professeur C.Scapel, cour de transport maritime, DESS Droit maritime et des transports, Promo. 1999/2000.
45
b- Le connaissement ordre
Cest un connaissement dans lequel il est indiqu le nom du destinataire, et
lorsquil est mis ordre, il est transfrable par endossement et, le dernier endossataire
devient destinataire.
Le connaissement joue un rle important dans le crdit documentaire.
Le CMA nonce dans son art.758 que si un connaissement ordre en blanc, le
chargeur doit lendosser, selon le professeur Scapel, cet endossement na aucune
ncessit juridique, car en fait, cest un connaissement au porteur (56).
c- Le connaissement au porteur
Ce connaissement a lavantage de circuler en toute libert, il se transmet par sa
remise une autre personne. Il se transmet aussi comme un billet de banque par
tradition (TRADERE). (57)
Lart.760 du CMA apporte une disposition tout fait diffrente celle du droit
franais, il prcise que le transporteur est tenu de dlivrer au chargeur autant
dexemplaires identiques du connaissement que ce dernier le juge ncessaire.
En revanche, lart.37 du dcret n66-1078 du 31 dcembre 1966 prvoit que
chaque connaissement est tabli en deux originaux au moins, un pour le chargeur et
lautre pour la cargaison, mais il est souvent rdig en quatre exemplaires : celui du
capitaine, dit connaissement chef, celui de larmateur et deux exemplaires pour le
chargeur, les deux dernier ne sont pas ngociables, les autres le sont.
Cette multiplication a des inconvnients pratiques comme la dlivrance des
marchandises au premier qui se prsente au capitaine, en cas dun connaissement au
porteur.
55
: Art.221 du c.civ.alg stipule que la cession nest opposable au dbiteur ou au tiers que si elle est accepte par le
dbiteur ou si elle lui est notifie par acte extrajudiciaire.
56
: ibid. 54.
57
: Supra 54
46
En cas de divergence entre les exemplaires du connaissement, chaque partie ne
peut de prvaloir que des indications portes sur lexemplaire quelle dtient que si ces
indications figurent galement sur celui se trouvant entre les mains de lautre partie.
Tandis, quen doctrine, Le doyen Rodire prcise dans son opinion que seul les
nonciations du connaissement chargeur sont prises en considration, car ce
connaissement va servir au crdit documentaire.
Lart. 785 nonce que sil se prsente plusieurs dtenteurs du connaissement pour
rclamer les marchandises, le transporteur ne peut dlivrer a aucun entre eux, mais doit
pour le compte du destinataire lgitime, consigner les dites marchandises en lieu sr et
en informer immdiatement ceux qui se sont prsents et le chargeur. Cest pratique
difficile, car comme on le sait, le chargeur se situe lautre ct, et il est impossible de
lappeler pour se prsenter, par ailleurs, il peut participer par un change dcrits (58)
Le droit franais quant lui, prcise que le capitaine remettra la marchandise au
premier qui se prsentera pour la retirer.
f- Excution du contrat
f-1- Obligations du transporteur
Le transporteur maritime est tenu avant et au dbut du voyage dexercer une
diligence raisonnable, cest--dire, agir comme un bon pre de famille, et ceci pour :
Mettre le navire en bon tat de navigabilit
La convention de Bruxelles ainsi que le CMA dans son art.770 dispose que le
transporteur est tenu, avant et au dbut du voyage dexercer une diligence raisonnable
pour mettre le navire en bon tat de navigabilit, cest--dire, convenablement arm,
quip et approvisionn le navire, mettre en bon tat les cales, chambres frigorifiques et
tout autres parties du navire o les marchandises seront charges pour leur reception,
leur transport et leur conservation. La diligence raisonnable est celle dun bon pre de
famille. Cette notion de navigabilit comporte deux aspects : nautique et commerciales
58
: Cest lun des inconvnients de la pluralit dexemplaires du connaissement.
47
A/ Navigabilit nautique : elle touche ltat de la coque du navire (tanchit et
solidit), les moyens de propulsion et de lapprovisionnement des soutes.
B/ Navigabilit commerciale : elle concerne les amnagements intrieurs du
navire conus pour la reception, le transport et la conservation des marchandises (cales citernes appareils frigorifiques systme de refroidissement ).
Prise en charge
La prise en charge est lacte la fois matriel et juridique par lequel le
transporteur prend possession effective de la marchandise et laccepte au transport (59).
Cest donc au moment de la prise en charge, et seulement ce moment, que le
transporteur devient garant de la marchandise et que commence jouer la Prsomption
de responsabilit dcoulant de lart.802 du CMA. Cest partir de cette reception que le
transporteur est tenu de dlivrer un connaissement la demande du chargeur mais ce
titre ne sera un connaissement embraqu quaprs le chargement de la marchandise
bord (60).
Cest la convention des parties, cest--dire les conditions gnrales et / ou
particulires des connaissements qui dterminent le moment de la prise en charge
condition, de ne Pas contrevenir aux dispositions de lart.773 aux termes duquel la prise
en charge ne Peut tre retarde au-del de linstant o lembarquement commence
parce que le CMA Met imprativement au compte du transporteur lobligation de
procder de faon approprie et soigneuse au chargement, la manutention,
larrimage de la Marchandise .
Chargement et arrimage de la marchandise
Aux termes de lart.773 du CMA, les oprations de chargement et darrimage sont
la charge du transporteur quil doit les excuter de faon approprie et soigneuse .
- Le chargement est lopration qui consiste mettre la marchandise bord du
navire ;
59
60
: T.Comm.Marseille, 21 juin 1994, BTL 1994, p.605, en extrait.
: Art.751.
48
- Larrimage, cest lensemble des oprations consistant mettre la bonne place
et disposer la marchandise dans les diffrents compartiments du navire (61)
Larrimage doit se faire en cale, cependant, lart.812 nonce que, par drogation
son art.811, les clauses relatives la responsabilit ou la rparation sont autorises
dans les transports des animaux vivants et dans les transports des marchandises
charges sur le pont du navire.
Ralisation du voyage
Cest le seul domaine o le transporteur a une libert puisquil va affronter les
risques de la mer, cet effet, cest lui qui choisit litinraire le plus sr, le plus
conomique. Le CMA dans son art.775 nonce que : les marchandises doivent tre
transportes dans un dlai convenable par la route annonce ou convenue et, dfaut,
par la route la plus habituelle. Il ajoute aussi quaucun droutement pour sauver ou tenter
de sauver des vies humaines en mer ni aucun droutement raisonnable ne sera
considr comme une infraction au contrat de transport maritime, et le transporteur ne
sera responsable daucune perte ou dommage rsultant (62).
Le transporteur doit, peine de prjudice, en cas dinterruption de voyage, faire
diligence pour assurer le transbordement des marchandises et leurs dplacement
jusquau port de destination convenu (63).
En cas de transbordement des marchandises sur un autre navire au cours dun
voyage interrompu, le CMA nonce dans on art.778 que les frais de transbordement et le
fret d pour achever le dplacement des marchandises sont la charge du transporteur,
sauf dans les cas o cette interruption du voyage est due aux causes exonrant le
transporteur le de sa responsabilit (cas excepts).
61
: Voir Lamy Transport, T2.
: Selon le Professeur Vialard, lart.775 ouvre une large facult de dtournement pour assistance et sauvetage mais
galement de tout droutement raisonnable, laissant ainsi au capitaine (et aprs lui, les tribunaux), un trs large
pouvoir dapprciation, DMF 81.
62
49
Lorsque le connaissement mentionne Anvers comme port de dchargement du
navire, le transport maritime se termine normalement Anvers : le transporteur qui a
transport les marchandises en allges Rotterdam ne peut invoquer les clauses de son
connaissement qui lexonrent de sa responsabilit pour les pertes et avaries qui
surviennent aprs le dchargement du navire (64).
En ce qui concerne le retard, le CMA fixe le dlai convenable, cest--dire, le dlai
normal dacheminement compte tenu des circonstances de faits. Ds lors, le retard la
livraison nengage de plein droit le transporteur maritime que si un dlai a t prvu au
contrat. A cet effet, un dlai de un mois pour effectuer un transport de Marseille Oran
sera considr comme anormal.
Le CMA ninterdit pas les clauses de non-responsabilit quen matire de pertes
ou avaries aux marchandises, de telles clauses appliques au retard sont a priori
valables.
Dsarrimage Manutention Dchargement de marchandises
Selon le professeur Scapel, cette phase est la plus fertile sur le plan juridique et
technique, car le transporteur ne peut pas se librer en sous-traitant.
La cour dAix-en-provence a dfini le dchargement comme lopration qui
consiste enlever la marchandise du navire pour la mettre quai. Il prend fin lorsqu
celle-ci se termine et que la chose transporte peut tre achemine dune manire
terrestre (65).
Il a t jug par la chambre maritime de la cour suprme dans un arrt du
26/5/1998 que : malgr que le dchargement se fait par lentreprise portuaire, il est
sous la responsabilit du transporteur , et ceci contre la dcision de la cour dappel
dAlger qui a statu que : le transporteur nest pas responsable des comportements de
lentreprise portuaire, et il na aucune relation avec cette entreprise monopolistique
suivant lart.875 (66)
63
: Art.776.
: CA Anvers, 16 avril 1986, Jurispr. Anvers 1986, p.1333.
65
: CA Aix-en-provence, 24 novembre 1994, BTL 1995, p.411, en extrait.
66
: Article abrog par le nouveau code.
64
50
Livraison
La livraison marque la fin juridique du contrat de transport maritime et de la
responsabilit du transporteur maritime, en remettant la marchandise au
rceptionnaire ou son reprsentant lgal, mais la question qui se pose : est quel
moment cette opration doit- elle intervenir ?est ce au moment :
De la remise de la marchandise lacconier ?
De lchange du connaissement ?
De lenlvement de la marchandise par le destinataire aprs obtention du
bon de sortie dlivr par lacconier ?
Le nouveau code maritime algrien a apport une rponse cette question du
moment de la livraison et surtout du fondement de responsabilit du transporteur
maritime, il la dfinit comme suit : la livraison est lacte juridique en vertu duquel le
transporteur sengage livrer la marchandise transporte au destinataire ou son
reprsentant lgal qui exprime son acceptation, sauf stipulations contraires au
connaissement .
Le CMA opte clairement pour la conception matrielle de la livraison, mme
volution apporte par la jurisprudence franaise (annexe 3) qui nonce que la
livraison est lopration par laquelle le transporteur remet la marchandise layant droit
qui laccepte , en prcisant que le destinataire manifeste son acceptation en tant mis
en mesure den vrifier ltat et, le cas chant, dassortir son acceptation de rserves,
puis de prendre effectivement possession de la chose livre (67). Il ne peut y avoir
livraison que sil y a remise matrielle cest--dire quaprs obtention du bon de sortie et
non aprs change du connaissement contre un bon livrer ( comment peut-on livrer
un marchandise vole ?
Selon le Professeur Bonassies, on ne peut admettre que le transporteur maritime
soit dispens de prsenter effectivement la marchandise au destinataire ni attribuer au
connaissement une vertu lie sa seule restitution. Une telle conception irait
lencontre de toute jurisprudence rcente laquelle tend, au contraire, limiter le rle
reconnu au connaissement.
51
Le terme mme du bon dlivrer manifeste bien que le transporteur ne
considre pas la remise dun tel bon au destinataire comme quivalent la remise de la
marchandise mais seulement comme impliquant pour ce destinataire le droit dobtenir
une telle livraison (68).
Il a t toujours considr quil ne constitue pas livraison conforme, la remise des
marchandises
par le transporteur lacconier qui le reprsente, la situation du
monopole dacconage en Algrie a amen les tribunaux franais (annexe 4) dire quil
ya livraison ds que la marchandise est confie une socit monopolistique, et
mme parfois avant la mise quai des marchandises (69).
Cette jurisprudence nest pas conforme larticle 1.e de la convention de
Bruxelles de 1924 qui prvoit que le contrat de transport couvre le chargement des
marchandises bord jusqu leur dchargement.
Mme certains tribunaux algriens considraient le dchargement comme
moment de la livraison, jusquau 20 dcembre 1993, o la cour suprme algrienne a
statu dans un arrt cassant et annulant la dcision de la cour dAlger que la livraison
se fait au moment o le destinataire accepte la marchandise, et non au dchargement,
dune part, et dautre part, les rserves doivent tre notifies au transporteur ou son
reprsentant au moment de la livraison et non au moment du dchargement (70).
La livraison ne peut pas intervenir avant la fin des oprations de dchargement.
Cest la fin du rgime impratif mis en place par la convention ; cest le moment o la
livraison peut intervenir au plus tt au regard du CMA. Mais la livraison peut avoir lieu
plus tard : auquel cas le transporteur reste responsable dans les termes de larticle 802
pour toutes les oprations terrestres de manutention et de gardiennage jusqu ce que
la marchandise soit livre au destinataire o son reprsentant lgal.
67
: Cass.Com., 17 novembre 1992, BTL 1993, p.50.
: BTL n 2434 du 24 juin 1991,
69
: CA Paris, 10 juillet 1981, DMF 81-723.
70
: Arrt n 111518 du 20/12/1993, Jurisprudence de la chambre commerciale et maritime de la cour suprme
algrienne, 1999.
68
52
Livraison sous palan
Le transporteur maritime stipule dans ces conditions gnrales au verso du
connaissement (annexe 5) des clauses de mandat (71) nonant que sa responsabilit
cesse ds la remise de la marchandise une entreprise de manutention, et comme le
connaissement est un contrat trois personnes : le transporteur, le chargeur et le
destinataire, reste la question de savoir est ce que cette clause est opposable au
destinataire ?
Le CMA dans son article 812-a inexistant dans la loi franaise prcise quune
clause sous-palan peut tre autorise, et que la responsabilit du transporteur cesse
lors de la livraison sous-palan au port de destination, cependant, cette clause nautorise
pas le transporteur ne pas procder aux oprations de dchargement. A notre avis,
cet article est motiv et conforme mme la dfinition de la livraison : or sauf
stipulations contraires au connaissement, ce qui veut dire que si le connaissement
contient cette clause qui sera accepte par le destinataire, elle lui sera opposable.
Toujours sur ce point l, reste le pouvoir souverain dapprciation du juge quant
au moment de lacceptation. Aprs la phase de dchargement, il peut intervenir un
transitaire pour prendre livraison des marchandises, cas dun correspondant dun
NVOCC (72) pour les oprations de dgroupage, et de les rpartir entre les ayants
droits, aprs avoir encaisser les dbours. Peut-on considrer dans ce cas que la
livraison est rpute faite ds la prise en charge des marchandises par ce dernier ?
Le consignataire de cargaison qui est le reprsentant lgal du destinataire, est
aussi habilit prendre livraison des marchandises en son nom et pour son compte.
Son intervention libre-t-elle le transporteur maritime ?
Notre code maritime prvoit dans son art. 920 que lacconage comprend les
oprations tendant assurer la rception, le pointage et la reconnaissance terre des
marchandises ainsi que leur gardiennage jusqu leur dlivrance. Lintervention de
lacconier personne physique ou morale pour le compte du rceptionnaire, transforme
t-elle son activit un consignataire de cargaison ? Et le transporteur sera t-il librer ?
71
72
: Art.7 du connaissement CALTRAM.
: Supra 41.
53
f-2- Obligations du chargeur
Obligation au fret
Par le contrat de transport de marchandises par mer, le chargeur sengage
payer une rmunration appele fret, rappelle lart.738. Ensuite, Lart.797 nonce que le
chargeur doit le prix du transport ou fret dont le montant et les modalits sont tablis par
convention entre les parties. Toutefois, en cas de fret payable destination, le
destinataire en est galement dbiteur sil accepte la livraison des marchandises.
Si des marchandises ont t perdues par fortune de mer, aucun fret nest d,
moins quelles ne soient perdues par suite de vice propre, dun emballage dfectueux, ou
par suite dun fait imputable au chargeur.
En cas de transbordement des marchandises sur un autre navire au cours dun
voyage interrompu, les frais de transbordement et le fret d pour achever le dplacement
des marchandises sont la charge du transporteur, sauf dans le cas o cette interruption
de voyage est due aux causes exonrant le transporteur de sa responsabilit.
En cas de non-paiement du fret, le transporteur a un privilge sur les
marchandises suivant lart.818-d.
Autres obligations du chargeur
Le chargeur ou son reprsentant doit prsenter les marchandises aux temps et
lieu fixs par la convention des parties ou par lusage du port de chargement. Le
chargeur qui ne prsente pas sa marchandise en temps et au lieu indiqus, paiera une
indemnit correspondante au prjudice subi par le transporteur, et au plus, gal au
montant du fret convenu (73).
Les autres obligations du chargeur sont des obligations de renseignements, cest-dire, le chargeur est considr avoir garanti au transporteur lexactitude de sa
dclaration concernant les marques, le nombre, la quantit, et le poids des marchandises
ce titre. Il rpond envers le transporteur de toutes pertes, dommage et dpenses
provenant ou rsultant dinexactitude sur ces points (74).
73
74
: Art.772
: Art.753
54
f- Responsabilit du transporteur maritime
Prsomption de responsabilit du transporteur maritime
En raison des alas de la navigation maritime, la responsabilit du transporteur
maritime est soumise un rgime diffrent et moins rigoureux que celui applicable aux
autres transporteurs.
Ainsi, le CMA dans son art.802 prvoit que le transporteur est responsable des
pertes et dommages subis par les marchandises depuis leur prise en charge jusqu leur
livraison au destinataire ou son reprsentant lgal. Sauf dans les cas excepts.
Le texte fait peser sur le transporteur maritime une prsomption de responsabilit
qui nest pas irrfragable, elle peut tre combattue par les causes exonratoires.
55
Art.803
Convention de Bruxelles
Loi franaise
Innavigabilit du navire
Faute nautique du capitaine
Incendie
Prils, dangers, ou accidents
de mer
E
Force majeure
Grve, lock-out, darrts
Vice propre de la marchandise
Faute du chargeur notamment
dans lemballage, le marquage
Vices cachs du navire chappant
une diligence raisonnable
J
Faits constituant un vnement
non imputable au transporteur
Acte ou une tentative de sauvetage
Des vies ou des biens en mer
Toute autre cause ntant pas due
une faute du transporteur.
Selon le professeur Vialard, le CMA distingue nettement la force majeure des cas
excepts, y compris les prils, dangers ou accidents de la mer ; do il dduira que tous
ces autres cas excepts nont pas prsenter les caractristiques spcifiques de la force
majeure pour valoir cause dexonration de responsabilit ; le droit civil algrien assimile
la force majeure une cause que lon ne peut normalement prvoir (75).
75
: Art.138 c.civ.alg.
56
La cour suprme a soulign quune tempte de force 6 intervenue au cours de
lhiver et provoquant des dommages aux marchandises, fait partie des risques
dexploitation, et elle ne constitue pas un cas de force majeure exonrant le transporteur
de sa responsabilit (76).
Rparation du dommage et la limitation de responsabilit
Lorsque le transporteur maritime ne peut sexonrer de sa responsabilit, il va
invoquer le principe de la limitation de responsabilit. Le plafond de limitation tabli par
colis ou unit, ou par Kilo de poids brut des marchandises perdues ou endommages,
est calcul daprs les rgles du protocole de 1968 auquel renvoie lart.805 (77).
Cet article prcise in fine, quil est entendu, au sens de la prsente loi, par unit de
compte, une unit de compte constitu de 65,5 milligrammes dor au titre de 900
millimes de fin. Ce qui signifie que les units de compte sont des franc poincarr, ce qui
pose problme de leur conversion en dinar algrien.
On sait dores et dj que la conversion en franc franais, ou en dinar algrien du
franc poincarr nest plus thoriquement possible depuis le 1 avril 1978, date de lentre
en vigueur du second amendement du statut du FMI Accords de Jamaque , ce qui
implique que le dinar algrien na plus de valeur exprimable en terme dor (78).
Toujours sur ce point de la conversion du franc poincarr en dinar algrien, nous
regrettons le fait de convertir le franc poincarr en franc franais, pour dterminer sa
valeur en dinar algrien.
Le CMA dans son art.808 prvoit une diminution du montant du plafond lorsque le
crancier est un tranger dont sa lgislation tablit une limitation de responsabilit moins
leve, le professeur Vialard considre cette disposition comme un rflexe de
protectionnisme destin viter la sortie des devises.
76
Prescription
: Arrt n 15325418 du 24/6/1997, Jurisprudence de la chambre commerciale et maritime de la cour suprme
algrienne, T2, 1997.
77
: LAlgrie a modifi lart.805 du CMA en sinspirant des rgles de Visby dont elle na pas ratifi.
78
: Voir IMTM 1986, Limite dindemnisation du transport maritime, J.Bonnaud, p.181.
57
Lart.742 prcise que : les actions dcoulant du contrat de transport sont
prescrites de deux ans compter du jour o les marchandises ont t ou auraient du
tre livres. Ces actions sont :
Laction du transporteur contre le chargeur due linexactitude de sa
dclaration de sa dclaration concernant les marques, le nombre, la quantit et le
poids des marchandises ;
Laction du transporteur contre le chargeur qui ne reprsente pas la
marchandise en temps et lieu voulus indiqus ;
Laction du transporteur contre le chargeur pour tout dommage et dpense
rsultant
directement
ou
indirectement
de
lembarquement
des
matires
inflammables
Laction du transporteur contre le destinataire qui, suite un retard injustifi, il
na pas pris livraison des marchandises.
Laction du transporteur contre le destinataire pour le paiement du fret.
Dans son art.743, le CMA prcise aussi quen plus des actions dcoulant du
contrat de transport dont elles sont prescrites de deux ans, les actions contre le
transporteur maritime raison des pertes ou prjudices subis aux marchandises
transports en vertu dun connaissement sont prescrites par un an.
Le CMA reste muet sur le point de dpart de la prescription. Commence t-elle le
jour de Larrive du navire au port de dchargement ou, le jour du dchargement des
marchandises ou, Le jour de leur dlivrance au destinataire ?
La chambre commerciale et maritime de la cour suprme a rpondu cette
question, en statuant que le point de dpart de la prescription est le moment de la
dlivrance des marchandises, car le contrat de transport maritime se termine ce
moment l suivant les dispositions des art.739 - 790 et 802 du CMA.
Ce dlai de prescription peut toutefois tre prolong jusqu deux ans par accord
conclu entre les parties, postrieurement lvnement qui a donn lieu laction.
Les actions rcursoires peuvent tre exerces mme aprs lexpiration du dlai
annal, celui-ci nexcdant pas toutefois trois mois compter du jour o la personne qui
58
exerce laction rcursoire a rgl la rclamation ou, elle a reu signification de
lassignation.
Dans ce contexte, la chambre commerciale et maritime de la cour suprme (79) a
statu que laction de lassureur subrog dans les droits de son assur est recevable, car
elle tait intente dans les trois mois suivant le rglement de la rclamation, malgr
lexpiration du dlai annal prvu par lart.743. Elle ajoute aussi, que les dispositions de
lart.744 ne sappliquent quaprs lexpiration du dlai annal prvu par lart.743
5- Conditions dexercice de lactivit daffrtement
Lactivit daffrtement tait un monopole dtat, et seulement les organismes
publics algriens avaient le droit de conclure des contrats daffrtements.
Le monopole a t abrog, lart.649 modifi comme suit : les activits
daffrtements de navires peuvent tre exerces par toute personne physique de
nationalit algrienne ou Toute personne morale de droit algrien ayant la qualit
darmateur et dont le centre principal dactivit se trouve sur le territoire national.
Donc, pour tre affrteur, il faut tre armateur et, suivant lart.572 : larmateur est
toute personne physique ou morale qui assure lexploitation dun navire en son nom soit
titre de propritaire du navire, soit lautre titre lui attribuant lusage du navire.
Laffrteur peut tre assimil in armateur, et un affrteur doit obligatoirement tre
armateur pour exercer les activits daffrtements, cest--dire, tre propritaire du navire
Cette condition constitue un obstacle que les importateurs algriens rencontreront pour
ngocier les contrats daffrtement, ce qui les amnent faire appel des ngociants
trangers qui ne souffrent daucune contrainte, ntant pas oblig davoir cette qualit,
tout en rglant les commissions de 1,25% en devises.
Nous constatons que cette condition davoir la qualit darmateur pour exercer les
activits daffrtement nest que complmentaire lactivit de courtage, car en pratique
cest le rle du courtier dagir comme intermdiaire pour conclure des contrats
daffrtements.
79
: Arrt n 84781 du 10/05/1992, Jurisprudence de la chambre commerciale et maritime de la cour suprme
algrienne, T2, 1999.
59
Cette disposition aboutirait rserver lactivit de courtier daffrtement au seul
armateur, ce qui constitue une autre forme de monopole, et contraint les oprateurs
algriens a achet directement leurs marchandises en cots et fret
CHAPITRE III Lexploitation portuaire
1- Principes gnraux
60
Dans ce titre, le CMA dans son art.889 dfinit le port, et il le classe selon sa
destination en port de commerce, en port de pche, et en port de plaisance.
Ainsi, sont rputs ports de commerce et classs dans cette catgorie, les ports
destins assurer dans les meilleures conditions conomiques et de scurit, toute les
oprations dembarquement et de dbarquement de personnes, de marchandises et
danimaux vivants transitant du monde maritime au mode terrestre de transport et
inversement ainsi que toutes les oprations lies la navigation maritime.
Cette modification du code maritime apporte une rorganisation des ports
algriens base sur la sparation des activits de services publics, relevant des
prrogatives de ltat. A savoir, le dveloppement, lentretien, la gestion, la prservation
et la conservation du domaine public portuaire, et celles relevant un caractre purement
commercial (manutention acconage remorquage).
Les missions de services publics sont dvolues des institutions cres cet effet
dnommes autorits portuaires . Ils sont, en fait, trois tablissements rgionaux qui
prendront en charge ces missions. Lun sera bas lOuest regroupant les ports dOran,
Ghazaouet, Arzew et Mostaganem, lautre au centre regroupant les ports dAlger, Tenes,
Dellys et le troisime regroupant les ports de Bejaia, Djendjen, Skikda et Annaba.
Jusquici, ce sont les entreprises portuaires qui exeraient ce pouvoir en plus de lactivit
commerciale lucrative dont ils ont accord un intrt particulier.
Cette nouvelle organisation est avantageuse, car dune part, ces autorits
portuaires vont tre autonomes lgard de la tutelle quant au dveloppement et
lentretien du domaine public portuaire qui est compos selon lart.894 dinfrastructures,
de superstructures portuaires et de dpendances greves de servitude au profit de la
circulation maritime, et dautre part, elle favorise lunicit de dcision.
Du fait de cette sparation entre les services publics et les services commerciaux,
le lgislateur algrien veut rhabiliter lautorit portuaire (fonctions de police et de
61
coordination), libraliser les activits commerciales qui, malgr lavnement du dcret du
18 octobre 1988 (80), sont restes sous le monopole des entreprises portuaires.
De ce type dorganisation, le systme portuaire algrien passe du systme
dautorit type operating port dont lautorit portuaire doit en plus de la ralisation des
investissements en quipements, assurer leurs fonctionnements, celui qui est
classique Tool port dont lautorit portuaire met la disposition des oprateurs dans le
cadre de contrat de dure limite des quipements dont elle est propritaire (81).
2- Les activits portuaires
a/ Manutention portuaire
La manutention dans les ports algriens lpoque du monopole, tait une
caractristique distinguant les transports maritimes destination dAlgrie. cependant,
une jurisprudence abondante sest dveloppe sur ce point arrivant jusqu mettre fin au
contrat de transport maritime la prise en charge des marchandises par lorganisme
public.
a-1- Dfinition
lancien code dans son art.873 donne la mme dfinition que celle de lart.50 de la
loi franaise du 18 juin 1966 : oprations de chargement, darrimage, de dsarrimage et
de dbarquement des marchandises, les oprations de mise et de reprise des
marchandises sous-hangar et sur le terre-plein. Le texte ajoute la garde et la
conservation des marchandises dbarques ou destines tre embarques.
On trouve les dispositions de lart.920 du nouveau code concernant lacconage.
Ceci tant dit que, le CMA de 1976 intgrait la fonction de lacconier dans celle de
manutentionnaire sans pour autant viser la rception et la reconnaissance.
80
: dcret portant abrogation de toutes les dispositions rglementaires confrant aux entreprises caractre
conomique lexclusivit dune activit le monopole de la commercialisation de produits ou de services.
81
: Le nouveau CMA, K.Haddoum, Annuaire de droit maritime, CDMO, Ed. Pdone, 99
62
Le doyen Rodire (82) sest demand si, tout comme les acconiers franais, les
acconiers algriens sont chargs de la livraison au sens propre ou de faire prendre en
charge par les transporteurs. Il estime que cest une question importante parce que, sils
sont chargs de la livraison, cest eux de prendre des rserves contre le bord quand ils
constatent des manquants ou des avaries et que labsence des rserves les constituent
en faute. Il ajoute que si la SONAMA, unique manutentionnaire, ne prend pas de
rserves, qui sadresser ? Prenons lexemple dune marchandise partant de Marseille
Oran, dbarque sans rserves de la SONAMA ; qui le destinataire va-t-il sadresser
pour obtenir rparation ? Au transporteur qui lui rpondra quil est protg par la
prsomption de livraison conforme (790, al 1), ou lorganisme monopolistique, qui lui
rpondra quil ntait pas tenu de prendre de rserves.
Toujours selon le doyen Rodire, la question devient plus angoissante et le
problme devient plus pineux xil sagit dun chargeur tranger notamment franais, et
qui charge sur un navire CNAN, et cette dernire insre dans ses connaissements une
clause attribuant comptence aux tribunaux algriens.
Toutes ces oprations cites au-dessus, sont effectues par les organismes
publics habilits cet effet. En fait, il sagit de la SONAMA dont le lgislateur algrien lui
a confr le monopole des activits dacconage et de manutention (83).
Le code maritime a t modifi, les dispositions confrant aux organismes publics
le monopole de la manutention abroges. La manutention est dfinie dans le titre relatif
aux activits portuaires. Le CMA Opre une distinction entre la manutention portuaire
et lacconage, il saligne sur la loi franaise en stipulant dans son art.912 que : la
Manutention portuaire comprend les oprations dembarquement, darrimage, de
Dsarrimage et de dbarquement des marchandises et les oprations de mise et de
Reprise des marchandises sur terre-pleins ou dans las magasins, cest--dire, les
oprations matrielles que le stevedore effectue. Le CMA dans son art.914 in fine
renvoie la voie rglementaire qui fixera les conditions et les modalits dexercice de
lactivit de manutention.
Enfin, les ports seront ouverts au secteur priv, ce qui va contribuer forcement
accrotre la productivit et amliorer la qualit des prestations.
82
83
: R.Rodire, rgime de manutention en Algrie, BTL 1978, p.122.
: Ordonnance du 9 avril 1971 portant cration de la Socit Nationale de Manutention.
63
a-2- Contrat de manutention
Art.875 al 1 du CMA a t maintenu dans lart.913 qui stipule que : les
oprations de manutention portuaire sont effectues en vertu dun contrat et le texte
ajoute quelles donnent lieu une rmunration. En revanche lart.875 al 2 qui nonait
que : le mode de la conclusion de ce contrat et les indications que celui-ci doit porter
sont fixes par le rglement portuaire , a t abrog. Le texte ne dit rien sur le caractre
solennel ou dordre probatoire du contrat, est ce que labsence dun crit entrane t-elle la
nullit du contrat ?
a-3- Lentreprise de manutention et le principe dontologique
Lart.878 nonce le principe dontologique que les oprations doivent tre
effectues avec la comptence et la diligence, compte tenu des moyens disponibles.
Lart.914 du code maritime modifi reprend les mmes dispositions sauf quil supprime
compte tenu des moyens techniques disponibles, phrase qui permet dans un port mal
quip au manutentionnaire de sexcuser si les oprations ne sont pas bien accomplies.
La cour dappel dAix-en-provence (annexe 6) a considr que la SONAMA na
pas apport lexcution de ses oprations les diligences et prcautions ncessaires, le
fait, dune part de linsuffisance des rserves qui nont pas permis de fonder un recours
contre le transporteur, et dautre part, que les avaries se sont produites lors du sjour
quai et des manipulations des marchandises lorsquelles se trouvaient aux mains et sous
la garde de la SONAMA (84).
a-4- Rgime de responsabilit
Le lgislateur algrien sest inspir de la loi franaise, en rapprochant le rgime
de lentreprise de manutention dans toute la mesure su possible, de celui applicable au
transporteur maritime. Ceci, pour viter que les destinataires agissent en responsabilit
contre lentreprise de manutention. Le souci sest exprim, tant en ce qui concerne
ltendue de responsabilit de lentreprise, quen ce qui concerne la limitation de
responsabilit et la prescription.
84
: CA Aix, 3 avril 1980, Rev.Scapel 1980, p.43.
64
Lart.915 du CMA nonce que : En cas de faute, le manutentionnaire est
responsable envers celui qui a engag ses services . Nous constatons des imprcisions
quant la dtermination de la responsabilit du manutentionnaire, le CMA parle de faute
du manutentionnaire, sans pour autant prciser si cette faute va causer des dommages
la marchandise. Lal.2 ajoute que le manutentionnaire est responsable davaries et
manquants dont il est tabli, expertise contradictoire lappui, quils se sont produits
pendant les oprations dont il a la charge.
Cette responsabilit est prsume, comme en transport maritime, qui chevauche
avec un autre rgime de prsomption de responsabilit du transporteur maritime.
Dans ce rgime de responsabilit, le manutentionnaire est responsable, la victime
naura pas prouver quil a commis une faute ; mais le manutentionnaire pourra
sexonrer en prouvant labsence de faute dune part, et dautre part, en dmontrant,
notamment un cas dexonration du transporteur maritime.
De tous les cas excepts qui exonrent le transporteur maritime, le
manutentionnaire de manutention pourra dmontrer que les cas suivants :
Incendie ;
Force majeure ;
Grves, lock-out, arrts ou entraves apports au travail pour quelque cause
que ce soit, partiellement ou compltement ;
Faute du chargeur, notamment dans lemballage, le conditionnement ou le
marquage des marchandises ;
Vice cach des marchandises.
65
Il peut aussi sexonrer en dmontrant que le dommage sest produit pendant le
transport maritime ce qui tablira essentiellement au moyens de rserves appropris quil
avait fait contre le transporteur. Ces rserves lgard de larmement doivent tre
formules au moment de dbarquement, mme sil sagit des conteneurs (85).
La responsabilit de lentrepreneur se trouve comme celle du transporteur, tre
dordre public lgard du chargeur ou du rceptionnaire, cest--dire, est nulle toute
clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet, dexclure ou de
limiter la responsabilit de lentrepreneur.
Le CMA prcise dans son art.916 que si les dommages subis par les
marchandises surviennent au cours des oprations de chargement, de dchargement et
de transport utilisant les allges ou autres moyens dembarcations portuaires. Le
manutentionnaire peut limiter sa responsabilit. Cette limitation lgale de responsabilit
de lentreprise de manutention nest pas applicable en cas de dclaration de valeur, et en
cas de faute inexcusable.
Lart.812 quant lui prcise que sont autorises les clauses relatives la
responsabilit ou la rparation pour la priode allant de la prise en charge par le
transporteur jusqu livraison, aussi lorsquil sagit des marchandises charges en ponte
et danimaux vivants. A notre avis, cette clause de non-responsabilit peut exclure du
champs les oprations de manutentions dfinies par lart.912, la phase antrieure et
postrieure la convention de Bruxelles de 1924 (les oprations de mise et de reprise
sur terre-plein ou dans les magasins).
a-5- Action en justice
Action contractuelle rserve au donneur dordre
Lart.915 pose un principe fondamental : en cas de faute, lentrepreneur de
manutention est responsable envers celui qui a engag ses services .
Sur le terrain contractuel, ce sera toujours le transporteur pour, les oprations de
chargement et de dchargement proprement dites, qui lui incombent imprativement.
85
: CA Aix-en-provence, 28 mai 1991, BTL 92, p.311.
66
La cour dOran a jug que cest le transporteur qui a requis les services de
lentreprise de manutention le fait de labsence dun contrat de manutention entre le
rceptionnaire de marchandises et le manutentionnaire (86).
Action quasi dlictuelle
Seule la partie ayant qui requis ses services dispose dune action contractuelle
contre lentrepreneur de manutention. En effet, cet article fait obstacle toute action
autre que contractuelle contre le manutentionnaire. Cette disposition ne concerne pas les
tiers au contrat de manutention, par exemple, le commis du transitaire ayant subi des
dommages corporels suite la chute de palanque. Selon les fondements des art.124
138 du c.civ.alg (87), les tiers disposent dune action quai dlictuelle contre le
manutentionnaire.
Manutentionnaire requis par le transporteur agissant comme mandataire du
donneur dordre
Le manutentionnaire excute toujours pour le compte du transporteur maritime les
oprations de chargement, arrimage, dsarrimage et dchargement.
Il est permis que le transporteur utilise des clauses valant mandat, des clauses o
layant droit se fait reprsenter par lui au dpart, ou larrive du navire, pour passer un
contrat de manutention avec le manutentionnaire. Le mandat peut dcouler directement
des termes du connaissement, la reprsentation obit aux rgles de mandat, de sorte
que laction ventuelle de layant droit sera ouverte contre le manutentionnaire et non
contre le transporteur.
Le CMA ne sest pas prononc sur un ventuel avis au manutentionnaire.
Responsabilit pour retard
On constate selon les dispositions du CMA relatives aux consquences de
limmobilisation des navires pour retard d aux oprations de manutention.
86
87
: CA Oran, 27 septembre 1999, Arrt n 99/378.
: Equivalent aux art. 1382- 1384 du c.civ.fr
67
Lancien code dans son art.882 reprenait les mmes dispositions qui ntaient pas
cette poque sans intrts compte tenu des conditions de travail qui rgnaient dans les
ports algriens. Au del du dlai contractuel, le manutentionnaire est tenu responsable
du prjudice occasionn au navire pour tout retard dans les oprations de chargement et
de dchargement, sauf quand le dpassement de ce dlai ne lui est pas imputable.
Si des interruptions des oprations de manutention surviennent, les consquences
pcuniaires en sont supportes par celui qui cette interruption est imputable sauf ces
de force majeure (88).
Prescription contre le manutentionnaire
Lart.919 du CMA dispose que : les actions dcoulant du contrat de manutention
se prescrivent par un an compter du jour de lachvement de la dernire opration
prvue par ce contrat, cest--dire, les oprations de mise et de reprise des
marchandises sur terre-plein ou dans les magasins, sinon aux oprations de
dchargement, si le contrat prvoit des clauses de mandat.
Le monopole de la manutention et la jurisprudence franaise
Du fait du monopole de la manutention en Algrie, la jurisprudence franaise
interrompait toujours le contrat de transport au dchargement.
La cour dappel dAix-en-provence (89) (annexe 7) a jug que le fait que la
SONAMA est un manutentionnaire impos par la loi, est compter du dchargement de
la marchandise, le mandataire lgal du rceptionnaire intress, et que ce dernier, ou
son assureur subrog dans ses droits est recevable agir contre elle raison de ses
fautes.
88
89
: art.883
: CA Aix-en-provence, 3 avril 1980, Rev.Scapel, p.45.
68
Le fait aussi que la SONAMA a pris des rserves insuffisantes, et trop imprcises,
le transporteur est mis hors cause, car les rserves nindiquaient pas si les dommages
se sont produit pendant la phase maritime (90). (annexe 8)
Dans la mme optique, le tribunal de Marseille (91) a statu que la responsabilit
du transporteur cessera au moment de la remise des marchandises un organisme
public jouissant du monopole des activits dacconage et de manutention dans le port o
la marchandise a t dcharge.
Dans un autre arrt (92) (annexe 9), la SONAMA a t jug responsable le fait
quelle a mis par erreur les marchandises la disposition dun tiers, et quelle ne pouvait
pas sexonrer de sa responsabilit relative cette erreur de livraison quen prouvant
quelle agit sur instruction du destinataire.
La SONAMA pour sexonrer toujours, elle fait valoir quen sa qualit de
manutentionnaire, elle est responsable que des avaries survenues en cours de
manutention, et quelle nest mandataire ni du rceptionnaire, ni du consignataire de la
cargaison.
En revanche, les tribunaux algriens dboutent toujours lentreprise de
manutention, malgr que les dommages se sont produits au dchargement, phase dont
le transporteur la charge, ils lestiment responsable des marchandises tant que la
livraison na pas t effectue (93).
b- Acconage
Afin de pallier au vide juridique de titre VII du CMA de 1976 relatif la
manutention.
Le lgislateur algrien a dissoci les oprations de manutention avec celles
dacconage, en dfinissant les oprations matrielles relatives la manutention et les
oprations juridiques affrentes lacconage.
90
: Jugement, 16 mars 1982, Rev.Scapel, p.30.
: Supra 89.
92
: 2me Chambre, 30 octobre 1980, Rev.Scapel, p.44.
93
: CA Oran, 13 septembre 1999, Arrt n 99/256.
91
69
Lart.912 nonce que lacconage comprend les oprations tendant assurer la
rception, le pointage et la reconnaissance terre des marchandises dbarques ainsi
que leur gardiennage, jusqu leur embarquement ou leur dlivrance au destinataire.
La diffrence entre lancien chapitre rgissant la manutention et celui-ci, on le voit,
le code maritime modifi vise la rception et la reconnaissance, et que les acconiers
algriens seront chargs de la livraison. Le lgislateur algrien confirme cette obligation
de livraison dans lart.923 qui nonce que lacconier prend toutes les rserves contre le
bord ou le livreur pour tous les manquants constats contradictoirement sur le mauvais
tat de la marchandise ou son conditionnement. Nous constatons que le CMA prcise
que le constat et lexpertise doivent tre contradictoires, cest--dire, en prsence des
deux parties.
Lacconier est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour la conservation
des marchandises confies sa garde durant leur sjour sur terre-plein ou dans les
magasins, comme par exemple : pour les conteneurs Reefers , il doit procder au
branchement et au dbranchement des conteneurs au moment du stockage, il doit en
outre, vrifier le bon fonctionnement du groupe frigorifique, surveiller et relever les
tempratures intervalle rgulier. En ce qui concerne le matriel roulier, il doit le
conserver dans un lieu sr, bcher les remorques.
Comme nous lavons constat au titre relatif la manutention, les oprations
dacconage sont aussi effectues en vertu dun contrat librement ngoci et donnent lieu
une rmunration. Reste toujours la question de savoir, si labsence dun contrat
entrane t-elle sa nullit ?
Lart.922 nonce que les oprations dacconage sont effectues avec la
comptence et les qualifications requises. Mme principe dontologique que celui des
oprations de manutention.
70
a-1- Responsabilit de lacconier
Lart.924 du CMA prcise quen cas de faute prouve, lacconier est responsable
envers celui qui a engag ses services. Donc sa responsabilit ne peut tre engage
que si une faute est prouve son encontre.
Le rsultat escompt est souhait par le crancier, mais il nest pas promis par
lacconier qui sengage seulement mettre en uvre les moyens ncessaires pour y
parvenir. Lacconier est devant un rgime de responsabilit pour faute, sa responsabilit
ne peut tre engage que si une faute est prouve son encontre, cest--dire, que les
moyens promis nont pas t mis en uvre. En revanche, lacconier franais est soumis
un rgime de prsomption semblable celle applicable aux transporteurs.
Lacconier est tenu dune obligation de moyens.
Le CMA ajoute que lacconier ne peut tre tenu responsable davaries et de
manquants dont il est tabli, expertise contradictoire lappui quils se sont produits
avant et / ou aprs les oprations dacconage. Quen est-il si lacconier reoit des
marchandises, des mains du transporteur maritime sans prendre des rserves, ce qui va
juridiquement librer le transporteur maritime, et aprs expertise contradictoire, il remet
en cause la responsabilit du transporteur en dmontrant que les dommages se sont
produits pendant la phase maritime ?
Nous considrons quil est difficile de distinguer le rle de lacconier celui du
consignataire de cargaison, car juridiquement, leurs interventions librent le transporteur
maritime de sa responsabilit. En outre, ils sont tenus de prendre des rserves sinon ils
sont considrs avoir reu les marchandises dans ltat dcrit au connaissement ou dans
tout autre document de transport. Il a t jug dans un arrt (94), que cest la SONAMA
qui accomplit le rle de consignataire de cargaison, car elle dispose du monopole de la
manutention dans les ports algriens, et que la livraison ne peut tre effectue que par
ses soins.
A notre avis, afin de faire la distinction, il faudrait rechercher le ct administratif ;
car ces deux fonctions ne peuvent tre exerces quaprs obtention de deux agrments
distincts.
94
: Supra. 89.
71
3- Organisation portuaire
a- Sjour des marchandises dans les ports
Il ressortissait de lordonnance n75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du
sjour des marchandises dans les ports, que les marchandises dbarques sont
classes par arrt du ministre charg de la marine marchande en trois catgories
pendant laquelle, elles sont autorises sjourner dans les ports :
Les marchandises de la catgorie I sont obligatoirement dcharges
directement sur moyens de transport. Toutefois, en cas dimpossibilit matrielle, le
directeur du port peut autoriser leur dchargement sur quai ou en magasin, et le
rceptionnaire doit procder son enlvement immdiat ;
Les marchandises de la catgorie II sont dcharge directement sur moyens
de transport. En aucun cas, elles ne sont autorises stationner dans les ports ;
Les marchandises de la catgorie III sont autorises sjourner sur les terre-
pleins ou en magasins pendant trois jours aprs la fin des oprations de
dchargement du navire qui les transportent.
En ce qui concerne le dlai de ce sjour quai, lart.10 de cette ordonnance
stipule que des drogations peuvent tre accordes par le directeur du port, si les
marchandises font lobjet davaries ou de confiscations, afin daccomplir les formalits
dexpertise. Pass le dlai de trois jours, le directeur du port est autoris dcider le
transfert doffice des marchandises vers les zones de dgagement extra portuaires, aux
frais et risques et prils des destinataires de la marchandise. Lart.18 ajoute aussi que
lorsque les marchandises sjournent plus de trente jours dans une zone extra portuaire,
le directeur du port adresse leur propritaire une mise en demeure. Pass ce dlai, le
directeur du port met les marchandises en souffrance la disposition du ministre du
commerce
72
A cette poque, cette ordonnance navait aucun pratique, car les oprations
dimportations taient rserves aux socits nationales. Par contre, les privs algriens
pouvaient importer la condition de possder une AGI (95) dlivre par le ministre du
commerce. Aussi, dans le mme contexte, le monopole de transit a t attribu la
SONATMAG (96) pour les entreprises nationales et trangres, ceci a engendr
lencombrement des ports, et pour pallier ce problme, le lgislateur algrien a autoris
lenlvement des marchandises sans prsentation du connaissement original, mais sur
prsentation dune lettre de garantie.
Cette ordonnance a t suivie dune ordonnance n76-80 du 23 octobre 1976
portant code maritime qui ne fait aucune rfrence au sjour des marchandises dans les
ports. Cependant, lart.885 du code maritime stipulait que : toutes dispositions
antrieures contraires celles de la prsente ordonnance, sont abroges. En effet, les
dispositions de l'ordonnance n75-40 du 15 juin 1975 sont antrieures aux dispositions
du code maritime, mais elles ny sont pas contraires, car le code maritime est muet sur
ce point l.
Le code maritime dans sa nouvelle modification aborde le sjour des
marchandises dans les ports dans son chapitre I du titre IV relatif lorganisation
portuaire. Dans son art.927, il prcise que les marchandises transitant par les ports de
commerce ne peuvent sjourner au-del du dlai ncessaire laccomplissement des
formalits telles que fixes par la lgislation en vigueur.
Le code des douanes dans son art.66 prcise que lorsque les marchandises, ds
leur arrive au bureau des douanes, ne font pas lobjet dune dclaration en dtail
rglementaire, elles peuvent tre dcharges dans les endroits dsigns cet effet pour
y sjourner sans contrle douanier en attendant le dpt de la dclaration en douane.
Ces endroits sont dnomms magasins et aires de dpt temporaire . Et il ajoute
dans son art.71 que la dure maximale de sjour des marchandises dans les magasins
et aires de dpt temporaire est de vingt et un jours. Au-del de ce dlai et aprs mise
en demeure pralable adresse au propritaire de la marchandise ou son mandataire,
lenlvement des marchandises est obligatoire. Lentreprise, en cas de non respect de
ces dispositions, les marchandises sont transfres vers les zones de dgagement et
aires de ddouanement prvues cet effet et agres par les douanes.
95
96
: Autorisation Globale dImportation.
: Socit Nationale e Transit et de Magasins Gnraux, cre par Ordonnance n70-12 du 22 janvier 1970.
73
En pratique, et compte tenu des retards considrables dans le ddouanement des
marchandises, ces dernires sont transfres sans mise en demeure.
Le code des douanes prcise dans son art.209 que le dlai maximal de sjour des
marchandises en dpt est de quatre mois, et il ajoute dans son art.210 que les
marchandises qui ne sont pas enleves dans les quatre mois, sont vendues par
ladministration des douanes.
Lart.932 traite le sjour et le transit des marchandises dangereuses qui en
pratique sont dcharges sur moyens de transport, en attendant la mise en place dans
les ports de commerce des parcs feu.
Dans le cadre de la mise en uvre des actions tendant amliorer la gestion des
ports de commerce, il a t cre une commission permanente (97) charge notamment :
Dinspecter les marchandises places dans les zones sous-douane ;
De faire procder au recensement des marchandises avaries et / ou en
souffrance dans les hangars, entrepts, magasins, aires dentreposage portuaires ou
en zones sous-douane ;
De faire expertiser les marchandises prsentant des signes davarie ou de
dtrioration et qui sont susceptibles de constituer ou dengendrer une gne, une
nuisance ou un danger pour les personnes, les installations et infrastructures,
lexploitation rationnelle ou la scurit du port ainsi que pour lenvironnement ;
De faire ordonner, aprs avoir statu sur leur sort, lenlvement des
marchandises avaries ou en sjour prolong en vue de leur destruction, de leur
vente ou, le cas chant, de leur cession titre gratuit des associations caritatives
ou des tablissements hospitaliers, conformment aux procdures prvues en ce
domaine par la lgislation en vigueur ;
De dresser des procs-verbaux de constatations des faits relevant de ses
attributions, en reprenant tous les lments caractrisant la situation inspecte ;
97
: dcret excutif n97-481 du 15 dcembre 1997 portant cration de commission permanente charge de
linspection et de lvaluation des marchandises avaries ou de sjour prolong au niveau des ports de commerce.
74
De proposer toute mesure susceptible de contribuer laccomplissement de
ses missions ;
De veiller la mise en uvre de la procdure douanire et en particulier,
celle relative la vente aux enchres des marchandises.
Lorsque les marchandises sont expertises et dclares avaries, la commission
est habilite instruire le service technique comptent de la commune du lieu
dimplantation du port de commerce pour lui signifier de faire vacuer lesdites
marchandises et de procder leur destruction et ce, dans les dlais fixs par la
commission.
Dans la mesure o des marchandises ne sont pas vacues aprs le dlai lgal
de sjour en magasin ou en aire de dpt temporaire prvu par le code des douanes
(quatre mois), la commission saisit lexploitant concern pour lui signifier leur vacuation
doffice, sous escorte douanire, vers des zones de ddouanement et ce, aux frais du
propritaire des marchandises.
Cette commission est prside par le chef de lentreprise portuaire en sa qualit
dautorit portuaire, et elle est compose : - du chef de linspection divisionnaire des
douanes, le directeur de la concurrence et des prix, le directeur de la sant, dun
magistrat, de linspecteur de lenvironnement, dun acconier, dun reprsentant des
services de la protection civile, dun reprsentant de la direction gnrale de la sret
nationale.
b- Rgime demploi des dockers
LAlgrie
toujours
soucieuse
des
conditions
sociales
de
travail,
une
ordonnance(98). intgre les travailleurs de la catgorie dockers professionnels dans le
personnel de la SONAMA. Depuis cette ordonnance, on commenait parler de la
permanisation des dockers qui a suscit de vives critiques, en la considrant comme une
entrave la productivit portuaire, ajoute la monopolisation.
Certes, les annes 70 en Algrie taient considres comme lre du social :
diminution des taux de chmage par laccroissement des effectifs, distribution des
bnfices aux entreprises dficitaires.
98
: : Ordonnance n74-49 du 17 avril 1974 portant intgration des ouvriers dockers.
75
Nous considrons que cette pratique sociale tait la cause du flchissement de la
productivit portuaire car, les surcots qui pouvaient natre de la dfaillance des
entreprises taient rpercuts sur les usages et les oprateurs travers des pratiques
tarifaires.
Ces surcots touchent en premier lieu le transit par la faiblesse de la productivit
du travail. Cependant, les horaires du travail lgal ne sont pas respects, il nexiste
quune seule vacation de 7 16 heures, que celle qui est en vigueur dans les autres
ports, de 7 19 heures. Il en rsulte, un ralentissement de 80% de lactivit portuaire
partir de 16 heures, car le travail de nuit, mme sil permet un grand nombre de rotations,
est encore loin de rencontrer l'assentiment gnral des importateurs (99)
Le retour des dockers dans le droit commun des salaris, qui a exist depuis 26
ans, constitue aujourdhui une ncessit dans la plus part des pays maritimistes. La
France a procd un processus de rforme(100) du rgime des dockers par le retour
dans le droit commun des salaris. La Grande Bretagne a suivi ce processus par
labrogation du Dock Labour Scheme.
Les pays maritimistes considrent quen offrant un contrat de travail dure
indtermine, les oprateurs portuaires entendent dvelopper des liens rels avec leurs
ouvriers portuaires, ce qui devrait amliorer les relations, en crant un vritable dialogue
social rendu impossible par lintermittence.
Le rgime de mensualisation existe en Algrie, mais il sest pos un problme de
fiabilit. Chacun sait que les navires mis en service aujourdhui ont un cot quotidien trs
lev. Ce quil faut, cest respecter les horaires descale quils puissent bnficient dune
certitude descale sans attente. Ce manque de comptitivit se manifeste dans les ports
algriens de labsence totale de polyvalence dans le choix des mthodes de travail.
Lentreprise portuaire a besoin des hommes plus qualifis, elle doit rechercher
continuellement des quipements de plus en plus performants pour rpondre aux
attentes de la clientle. Et maintenant que le monopole de la manutention est abrog, et
lexercice de cette fonction, est ouverte au secteur priv. Comment va tre le statut des
dockers ? Est ce que le mme rgime sera retenu ou bien les entreprises prives
recouront au rgime ancien de lintermittence ?
99
. Les activits algriennes de transport maritime lheure de la libralisation, K.Haddoum, Annuaire de droit
maritime, CDMO, Ed. Pdone, 2000
100
: Loi 92.
76
Conclusion
Le CMA constitue la partie intgrale de la lgislation maritime algrienne. Cette
nouvelle modification aura vritablement dintrt sur le plan interne, dune part, comme
la libralisation des transports maritimes, les activits de consignation de navires, de
cargaison et de courtage maritime dans le but dencourager les investisseurs nationaux
et trangers, pour assurer une indpendance vis--vis des armements trangers. Aussi
la dmonopolisation des activits de manutention et dacconage constitue une grande
chose dans lexploitation portuaire algrienne, surtout qu une certaine poque, ces
activits caractrisaient les transports vers lAlgrie. Dautre part, ce nouveau code
marque un recul par rapport lancien quant aux conditions dalgrianisation des navires
et la participation des trangers personnes physiques, et lexercice des activits
daffrtement.
Sans que lAlgrie ait ratifie les nouvelles conventions internationales, elle
sinspire de leurs dispositions en les insrant dans le code maritime.
Ce nouveau code reste muet sur certaines questions importantes comme
lalgrianisation des navires lous en crdit-bail ou affrts coque nue par une personne
physique ou morale algrienne, le caractre solennel ou dordre probatoire du contrat de
manutention et dacconage, lavis du manutentionnaire quant lapplicabilit des clauses
de mandat insres dans les connaissements.
Le dveloppement dune jurisprudence montrera quelques imperfections de ce
code : conversion du Franc Poincar en Dinar Algrien, linterprtation de la notion de
valeur courante et usuelle , validit des clauses de mandat, et le rgime de
responsabilit de lacconier.
Enfin, nous pourrons dire que lAlgrie a procd une grande tape dans le
systme de rforme engag.
Vous aimerez peut-être aussi
- Droit Maritime: Arnaud MontasDocument18 pagesDroit Maritime: Arnaud MontasRANDRIAMANJAKA BRIEL TANIEN100% (1)
- L'approche Juridique Du NavireDocument10 pagesL'approche Juridique Du NavireabdoulmatinePas encore d'évaluation
- Chapitre PartielDocument84 pagesChapitre PartielRolf Christopher Mpouho100% (1)
- Requête 17.0.1 - Revenu Québec C. Frédéric RiouxDocument10 pagesRequête 17.0.1 - Revenu Québec C. Frédéric RiouxRadio-CanadaPas encore d'évaluation
- ExcutoireDocument17 pagesExcutoiresabrine.fadhlaoui.36Pas encore d'évaluation
- La Saisie Conservatoire Des Navires de Commerce Dans Les Ports MarocainsDocument8 pagesLa Saisie Conservatoire Des Navires de Commerce Dans Les Ports MarocainsDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- CONSERVATOIREDocument14 pagesCONSERVATOIREsabrine.fadhlaoui.36Pas encore d'évaluation
- Cours - LE NAVIREDocument6 pagesCours - LE NAVIREYounous TCHAOPas encore d'évaluation
- Cod 84877Document100 pagesCod 84877Déodat SalehPas encore d'évaluation
- Code de Commerce Maritime 1Document84 pagesCode de Commerce Maritime 1rorofesPas encore d'évaluation
- Les Règles de La Saisie Conservatoire Des Navires Dans Le Cadre de La Modification de La Législation Maritime de 2010Document8 pagesLes Règles de La Saisie Conservatoire Des Navires Dans Le Cadre de La Modification de La Législation Maritime de 2010gana slimPas encore d'évaluation
- Le Navire 1 ConvertiDocument66 pagesLe Navire 1 ConvertiMehdiPas encore d'évaluation
- Droit Maritime Francais-CompletDocument75 pagesDroit Maritime Francais-CompletMarin FagerosPas encore d'évaluation
- Notions de Droit MaritimeDocument24 pagesNotions de Droit MaritimeMed RedjahPas encore d'évaluation
- Le Transport de La MarchandiseDocument10 pagesLe Transport de La MarchandiseEl Mehdi ElbarakyPas encore d'évaluation
- La Saisie Conservatoire Des NaviresDocument71 pagesLa Saisie Conservatoire Des NaviresAnge AxelPas encore d'évaluation
- Historique Du Transport MaritimeDocument20 pagesHistorique Du Transport MaritimeRolf Christopher Mpouho0% (1)
- ExposeDocument6 pagesExposeDonjaime De BanyPas encore d'évaluation
- Problematique Des Affretements de NavireDocument3 pagesProblematique Des Affretements de NavireRIHANI Mohamed100% (1)
- Imprimer - Le Contrat D'affrètement Au Regard Du Droit Maritime Guinéen. Par Albert Dione, Docteur en DroitDocument7 pagesImprimer - Le Contrat D'affrètement Au Regard Du Droit Maritime Guinéen. Par Albert Dione, Docteur en Droitalbertdione518Pas encore d'évaluation
- Code de Commerce MaritimeDocument77 pagesCode de Commerce MaritimeLarbi Fsjes KenitraPas encore d'évaluation
- Le NavireDocument3 pagesLe Navireomar ahmadoun100% (1)
- Le Pilotage MaritimeDocument77 pagesLe Pilotage MaritimeMoussa Sow100% (2)
- Le Système de Réparation en Droit Maritime MarocainDocument7 pagesLe Système de Réparation en Droit Maritime MarocainAyoub Ben AbdAllahPas encore d'évaluation
- Le Statut Juridique Du NavireDocument9 pagesLe Statut Juridique Du Navireabdoulmatine100% (1)
- La Charte-Partie SynacomexDocument24 pagesLa Charte-Partie SynacomexHakim HaddouchiPas encore d'évaluation
- PrivilègesDocument10 pagesPrivilègessabrine.fadhlaoui.36Pas encore d'évaluation
- Ordonnance N° 62-0F-30 Du 31 Mars 1962 Portant Code de La Marine Marchande Du CamerounDocument83 pagesOrdonnance N° 62-0F-30 Du 31 Mars 1962 Portant Code de La Marine Marchande Du CamerounCharles Fokouh100% (1)
- Charte Partie SynacomexDocument67 pagesCharte Partie SynacomexfaridPas encore d'évaluation
- Droit Maritime Algerien - Cours Professeur A. BerchicheDocument75 pagesDroit Maritime Algerien - Cours Professeur A. BerchicheRIHANI Mohamed100% (2)
- Dip Marins PC PDFDocument8 pagesDip Marins PC PDFKocam GamhaPas encore d'évaluation
- L'adhesion de L'algerie A La Convention Internationale de 1989 Sur L'assistanceDocument15 pagesL'adhesion de L'algerie A La Convention Internationale de 1989 Sur L'assistancemohamed madiPas encore d'évaluation
- Code de Commerce MaritimeDocument30 pagesCode de Commerce MaritimeBabay OumaymaPas encore d'évaluation
- L Indemnité D Assurance Maritime Rédigé Par HARO Clement SOMMAIREDocument118 pagesL Indemnité D Assurance Maritime Rédigé Par HARO Clement SOMMAIREghislain philippe ndoh ekitePas encore d'évaluation
- Droit Maritime (Extrait IKI)Document43 pagesDroit Maritime (Extrait IKI)Soufian AsloujePas encore d'évaluation
- Cours de Transport Maritime Log3-2021Document116 pagesCours de Transport Maritime Log3-2021yacoubakromanPas encore d'évaluation
- Cours de Management de TranspoprtDocument248 pagesCours de Management de TranspoprtRolf Christopher MpouhoPas encore d'évaluation
- Convoyage Des Navire PlaisanceDocument7 pagesConvoyage Des Navire PlaisanceJuan L. PulidoPas encore d'évaluation
- Sujet AffrètementDocument5 pagesSujet Affrètementfati kenzaPas encore d'évaluation
- Collision - Evenements de Mer - Abordage PDFDocument18 pagesCollision - Evenements de Mer - Abordage PDFLouBna Mensouri100% (2)
- English Maritime LawDocument11 pagesEnglish Maritime LawMarin FagerosPas encore d'évaluation
- Code de Commerce MaritimeDocument65 pagesCode de Commerce MaritimehiooPas encore d'évaluation
- R Sum DuCours FAC. Moh MDC 17 1Document66 pagesR Sum DuCours FAC. Moh MDC 17 1ayoubPas encore d'évaluation
- Contrat Affrètement DIA 2018Document18 pagesContrat Affrètement DIA 2018OUMAYMA BEN MAACHOUPas encore d'évaluation
- Pensee en Droit Maritime MarocainDocument4 pagesPensee en Droit Maritime MarocainMohammed BenaliPas encore d'évaluation
- Convention de BruxelleDocument19 pagesConvention de BruxelleKawtar OulhousPas encore d'évaluation
- STCWDocument152 pagesSTCWsailor21316Pas encore d'évaluation
- Cours de Droit International Public 2 - UAO - 2019Document95 pagesCours de Droit International Public 2 - UAO - 2019Samuel KouassiPas encore d'évaluation
- Cours Droit Des AffrètementsDocument32 pagesCours Droit Des AffrètementsMaher FriouiPas encore d'évaluation
- Police Des Ports Portuaire 27092010Document11 pagesPolice Des Ports Portuaire 27092010mourad asfariouPas encore d'évaluation
- Document Sans TitreDocument45 pagesDocument Sans TitrepalafarahPas encore d'évaluation
- Contratdetransport 130705135021 Phpapp01Document76 pagesContratdetransport 130705135021 Phpapp01Hermod Jessia Befourouack100% (1)
- Presentation Gael Piette-2Document7 pagesPresentation Gael Piette-2fatihi abdoul karimiPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument5 pagesIntroductionhouda lasouedPas encore d'évaluation
- Contrat Affrètement MDAF 2018Document17 pagesContrat Affrètement MDAF 2018Rihab MekhloufPas encore d'évaluation
- Droit Maritime Licence 3Document179 pagesDroit Maritime Licence 3Mamadou FayePas encore d'évaluation
- Dr. DAKOURI Jean-ClaudeDocument179 pagesDr. DAKOURI Jean-ClaudeMichel TiaPas encore d'évaluation
- Le Tribunal international du droit de la mer: Organisation, compétence et procédureD'EverandLe Tribunal international du droit de la mer: Organisation, compétence et procédurePas encore d'évaluation
- Blocus: Encerclement stratégique et tactiques militaires dans la guerre moderneD'EverandBlocus: Encerclement stratégique et tactiques militaires dans la guerre modernePas encore d'évaluation
- L’assurance R.C. auto: Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989D'EverandL’assurance R.C. auto: Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989Pas encore d'évaluation
- Corrig - Masse Volumique, DensiteDocument3 pagesCorrig - Masse Volumique, Densiteamirouche15Pas encore d'évaluation
- 1 Securite Maritime Chap 1Document32 pages1 Securite Maritime Chap 1amirouche15Pas encore d'évaluation
- Q.C.M SecuriteDocument12 pagesQ.C.M Securiteamirouche15100% (2)
- Stab 1Document48 pagesStab 1amirouche15Pas encore d'évaluation
- Préavis de GrèveDocument2 pagesPréavis de GrèveAnais Elphie MenguePas encore d'évaluation
- Agatha Christie - L-Affaire ProtheroeDocument164 pagesAgatha Christie - L-Affaire ProtheroeSokoura90100% (1)
- Mémoire DéfinitifDocument164 pagesMémoire DéfinitifBouaPas encore d'évaluation
- Réflexions Sur L'intérêt Général - Rapport Public 1999Document6 pagesRéflexions Sur L'intérêt Général - Rapport Public 1999Dounia Elk100% (1)
- Fiche de Revision Droit PrivéDocument16 pagesFiche de Revision Droit PrivéJohn JoshuaPas encore d'évaluation
- Centre Du Commerce InternationalDocument18 pagesCentre Du Commerce InternationalOmar ELJATTIOUIPas encore d'évaluation
- Charpente Industrielle - Système ConstructifDocument11 pagesCharpente Industrielle - Système Constructifarnaudeyriey100% (1)
- Maroc - Zones Franches, Droits Des Travailleurs Et Strategies SyndicalesDocument72 pagesMaroc - Zones Franches, Droits Des Travailleurs Et Strategies SyndicalesMidoGestionPas encore d'évaluation
- 19 FTP Protocol PrinciplesDocument11 pages19 FTP Protocol PrinciplesSalem TrabelsiPas encore d'évaluation
- Le Courant Des LumièresDocument20 pagesLe Courant Des LumièresBachar Yakine100% (1)
- Rapport Bengrich Version FinaleDocument29 pagesRapport Bengrich Version FinaleImane BlaliPas encore d'évaluation
- Sourceislam - Le Mérite de Jeûner Le Mois Sacré de Mouharram Et Le Jour de AchouraDocument3 pagesSourceislam - Le Mérite de Jeûner Le Mois Sacré de Mouharram Et Le Jour de AchouraNiouma Aicha SoumarePas encore d'évaluation
- CEJM T1C3 SyntheseDocument3 pagesCEJM T1C3 SyntheseRIYAD TERMOULPas encore d'évaluation
- Vinted S1060589971Document1 pageVinted S1060589971d8mybw4qdgPas encore d'évaluation
- DC - Groupe A - 2023-2024 - Fiche 6 - Le GouvernementDocument16 pagesDC - Groupe A - 2023-2024 - Fiche 6 - Le Gouvernement8fmqqykz6zPas encore d'évaluation
- L Ingenierie Juridico FinanciereDocument32 pagesL Ingenierie Juridico FinanciereJuge PierreJeanPas encore d'évaluation
- Kant's Gesammelte Schriften. Band 9 / Herausgegeben Von Der Königlich Preußischen Akademie Der WissenschaftenDocument583 pagesKant's Gesammelte Schriften. Band 9 / Herausgegeben Von Der Königlich Preußischen Akademie Der WissenschaftenDiogo SequeiraPas encore d'évaluation
- Partie PrenanteDocument7 pagesPartie PrenantesinchicovichPas encore d'évaluation
- Le Regime Juridique D'exequatur Des Sentences Arbitrales InternationalesDocument371 pagesLe Regime Juridique D'exequatur Des Sentences Arbitrales InternationalesSamir Bel-Amin80% (5)
- Délit D'initiéDocument11 pagesDélit D'initiéElmostafa Zakaria HamdouchePas encore d'évaluation
- ADHE 20230902 F6a7 0Document64 pagesADHE 20230902 F6a7 0Mathieu CHOUPPas encore d'évaluation
- 8 Bonus 2 - Comment Ne Pas Finir Dans Les SpamsDocument5 pages8 Bonus 2 - Comment Ne Pas Finir Dans Les SpamsChahine OffPas encore d'évaluation
- 7jours 220610 LGBT A2 ProfDocument3 pages7jours 220610 LGBT A2 ProfMaison L. ElisaPas encore d'évaluation
- Yabiladi: Immobilier Au MarocDocument58 pagesYabiladi: Immobilier Au MarocspiritualbeingPas encore d'évaluation
- Liste Des NormesDocument2 pagesListe Des NormesnoneladPas encore d'évaluation
- Petit Guide de Maîtrise D'ouvrages Communale Et Urbaine en AfriqueDocument33 pagesPetit Guide de Maîtrise D'ouvrages Communale Et Urbaine en AfriqueArmel Gautier NguenePas encore d'évaluation
- Cast Member Flash Prime Dinteressement 2020 FraDocument7 pagesCast Member Flash Prime Dinteressement 2020 FraValérie BPas encore d'évaluation
- Exetat M13Q15S4H3Document6 pagesExetat M13Q15S4H3Silvanho BamuthPas encore d'évaluation
- Hmimid HabitatDocument6 pagesHmimid HabitatAhmed NahalPas encore d'évaluation