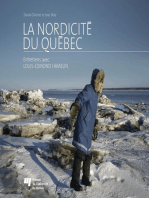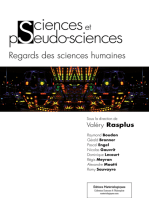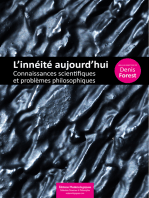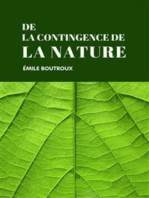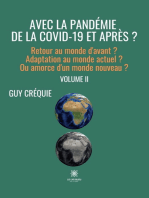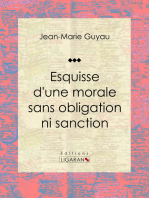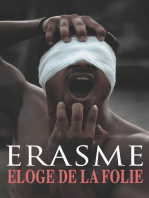Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Perspectivisme & Multinaturalisme Dans La Amérique Indigène - Viveiros de Castro
Transféré par
Florencia Rodriguez GilesCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Perspectivisme & Multinaturalisme Dans La Amérique Indigène - Viveiros de Castro
Transféré par
Florencia Rodriguez GilesDroits d'auteur :
Formats disponibles
Document de travail ERRAPHIS
Perspectivisme et multinaturalisme dans lAmrique indigne
Par Eduardo Viveiros de Castro
in A inconstancia da alma selvagem , Sao Paulo, 2002)
La relativit de lespace et du temps a t imagine comme
si elle dpendait du choix dun observateur. Il est
parfaitement lgitime dinclure lobservateur, sil facilite
les explications. Mais ce dont on a besoin cest de son corps
et non pas de son esprit.
A. N. Whitehead
Ainsi, la rciprocit de perspectives, que jai repre
comme la caractristique propre de la pense mythique,
peut revendiquer un domaine dapplication beaucoup plus
large.
C. Lvi-Strauss
Introduction1
Cet essai a pour objet cet aspect de la pense amrindienne qui manifeste sa qualit
perspective (Arhem 1993) ou relativit perspective (Gray 1996) : il sagit de la
conception, commune plusieurs peuples du continent, selon laquelle le monde est habit par
diffrentes espces de sujets ou personnes, humaines et non-humaines, qui lapprhendent
1
Les pages qui suivent ont leur origine dans un dialogue avec Tnia Stolze Lima. La premire version de
lessentiel des articles ici refondus (Viveiros de Castro > 1996 c) a t rdige et publie en mme temps que
ltude de Tnia sur le perspectivisme juruna, auquel je renvoie le lecteur (Lima 1996). Lessai de Latour (1991)
sur la notion de modernit a t une source indirecte, et pourtant dcisive, dinspiration pour cette premire
version. Quelques mois aprs voir publi larticle de 1996, jai lu un vieux texte de Fritz Krause (1931 ; cit par
Boelscher 1989 : 212 n.10) o jai trouv des ides bizarrement convergentes avec certaines de celles qui sont
ici exposes ; elles seront discutes une autre occasion. Nanmoins, la relle convergence ignore dans
larticle de 1996 est celle entretenue avec la thorie dveloppe par Roy Wagner dans The invention of culture,
livre que javais lu quinze ans auparavant (en 1981, anne de sa deuxime dition), mais que javais
compltement effac de ma mmoire, certainement parce quil tait au-dessus de ma capacit de
comprhension. Je me suis rendu compte, le relisant en 1998, que jen avais assimil quelque chose, puisque
certains pas cruciaux de largument de Wagner avaient t rinvents (ceci deviendra plus clair dans le chap. 8
infra). Peter Gow, Aparecida Vilaa, Phiippe Descola et Michael Houseman ont contribu, comme toujours, par
leurs suggestions et commentaires, aux diffrentes tapes de llaboration du texte. Enfin, les dveloppements
actuels (em curso) des thses ici exposes (Viveiros de Castro en prparation) doivent, pour linstant, aux
lumires de Bruno Latour et de Marilyn Strathern beaucoup plus quil est possible den rendre compte.
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
daprs des points de vue distincts. Les prsupposs et les consquences de cette ide sont
irrductibles (comme la bien montr Lima 1995 : 425-38) notre concept courant de
relativisme, mme sils semblent lvoquer au premier abord. Ils se disposent, en vrit, de
manire exactement orthogonale par rapport lopposition entre le relativisme et
luniversalisme. Une telle rsistance du perspectivisme amrindien aux termes de nos dbats
2
pistmologiques met en doute la robustesse et la transportabilit des partitions ontologiques
qui les nourrissent. En particulier, ainsi que beaucoup dautres anthropologues lont dj
conclu (quoique pour dautres motifs), la distinction classique entre Nature et Culture ne peut
tre utilise pour dcrire des dimensions ou domaines internes aux cosmologies non
occidentales sans passer pralablement par une critique ethnologique rigoureuse.
Une telle critique, dans le cas prsent, exige la dissociation et la redistribution des
prdicats subsums sous les deux sries paradigmatiques qui sopposent traditionnellement
sous les labels de Nature et Culture : universel et particulier, objectif et subjectif, physique et
moral, fait et valeur, donn et construit, ncessit et spontanit, immanence et transcendance,
corps et esprit, animalit et humanit, et bien dautres. Ce nouveau battage des cartes
conceptuelles me fait suggrer le terme multinaturalisme pour marquer un des traits
contrastifs de la pense amrindienne par rapport aux cosmologies multiculturalistes
modernes. Tandis que celles-ci sappuient sur limplication mutuelle entre lunicit de la
nature et la multiplicit des cultures la premire tant garantie par luniversalit objective
des corps et de la substance, la deuxime tant engendre par la particularit subjective des
esprits et du signifi2 , la conception amrindienne supposerait, en revanche, une unit de
lesprit et une diversit des corps. La culture ou le sujet seraient ici la forme de luniversel ; la
nature ou lobjet, la forme du particulier.
Cette inversion, peut-tre assez symtrique pour tre plus que spculative, doit se
dplier dans une interprtation phnomnologiquement riche des notions cosmologiques
amrindiennes, et capable de dterminer les conditions de constitution des contextes que lon
pourrait appeler nature et culture . Recombiner, donc, pour ensuite dsubstantialiser,
2
Telle est la logique dun discours, normalement connu comme occidental, dont le fondement ontologique
consiste en une sparation des domaines subjectif et objectif, le premier tant conu comme le monde
intrieur de lesprit et du signifi, le second, comme le monde extrieur de la matire et de la substance
(Ingold 1991 :35).
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
car les catgories de Nature et Culture, dans la pense amrindienne, non seulement ne
subsument pas les mmes contenus, mais ne possdent pas non plus le mme statut que les
catgories occidentales analogues ; elles ne marquent pas des rgions de ltre, mais plutt des
configurations relationnelles, perspectives mouvantes, bref points de vue.
Daprs ce qui vient dtre mis en lumire, je pense que la distinction nature/culture
3
doit tre critique, mais non pas aux fins de conclure quune telle chose nexiste pas (il y a
dj pas mal de choses qui nexistent pas). La valeur surtout mthodologique que LviStrauss (1962b :327) a pu lui attribuer sera ici comprise comme valeur surtout comparative.
Lindustrie florissante de la critique du caractre occidentalisant de tous les dualismes plaide
en faveur de labandon de notre hritage intellectuel dichotomique ; le problme est tout fait
rel, mais les contre-propositions ethnologiquement motives se laissent rsumer, jusqu
prsent, des souhaits post-binaires bien plus verbaux que proprement conceptuels. En ce qui
me concerne, je prfre, en attendant, mettre en perspective nos contrastes, en les faisant
contraster avec les distinctions effectivement opratoires dans les cosmologies amrindiennes.
Perspectivisme
Le stimulus initial pour cette rflexion a rsid dans les nombreuses rfrences, faites
par lethnographie amazonienne, une conception indigne daprs laquelle la manire dont
les tres humains voient les animaux et autres subjectivits qui peuplent lunivers dieux,
esprits, morts, habitants dautres niveaux cosmiques, plantes, phnomnes mtorologiques,
accidents gographiques, objets et artefacts est profondment diffrente de la manire par
laquelle ces tres voient les humains et se voient eux-mmes.
Caractristiquement, les humains voient, dans des conditions normales, les humains
en tant quhumain et les animaux en tant quanimaux ; en ce qui concerne les esprits, le fait de
voir ces tres, normalement invisibles, est bien un indice de ceci que les conditions ne sont
pas normales. Nanmoins, les animaux prdateurs et les esprits voient les humains en tant
quanimaux de proie, tandis que les animaux de proie voient les humains en tant quesprits ou
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
animaux prdateurs : Ltre humain se voit soi-mme en tant que tel. La lune, le serpent, le
jaguar et la Mre de la variole le voient en tant quun tapir ou un pcari quils tuent ,
remarque Baer propos des Machiguenga (1994 : 224). En nous voyant comme non-humains,
cest eux-mmes que les animaux et les esprits voient en tant quhumains. Ils se comprennent
comme, ou deviennent, anthropomorphes quand ils sont chez eux, la maison ou dans un
4
village, et ils font lexprience de leurs propres habitudes et caractristique sous lespce de la
culture : ils voient leur aliment en tant qualiment humain (les jaguars voient le sang comme
cauim3, les morts voient les grillons en tant que poissons, les vautours voient les vers de la
viande gte en tant que poisson rti, etc.), leurs attributs corporels (pelage, plumes, griffes,
bec, etc.) en tant quornements ou outils culturels, leur systme social organis identiquement
aux institutions humaines (avec des chefs, des chamanes, rites, rgles de mariage, etc.). Ce
voir en tant que fait littralement rfrence des percepts, et non pas analogiquement
des concepts, quoiquon force laccent, dans certains cas, plutt sur laspect catgoriel du
phnomne que sur son aspect sensoriel ; de toute manire, les chamanes, matres du
schmatisme cosmique (Taussig 1987 :462-63) dvous communiquer et administrer les
perspectives croises, sont toujours l pour rendre sensibles les concepts ou intelligibles les
intuitions.
Bref, les animaux sont des personnes ou se voient en tant que personnes. Telle
conception est presque toujours associe lide que la forme manifeste de chaque espce est
un revtement (un vtement ) qui cache une forme interne humaine, normalement visible
seulement aux yeux de lespce mme ou de certains tres interspcifiques, comme les
chamanes4. Cette forme interne est lesprit de lanimal : une intentionnalit ou subjectivit
formellement identiques la conscience humaine, matrialisable, pour ainsi dire, dans un
schma corporel humain cach sous le masque danimal. Nous aurions, donc, de prime abord,
une distinction entre une essence anthropomorphe de type spirituelle, commune aux tres
anims, et une apparence corporelle variable, caractristique de chaque espce, qui ne saurait
tre un attribut fixe, mais un vtement interchangeable et retournable. La notion de
vtement est, en effet, une des expressions privilgies de la mtamorphose des esprits,
3
En langue tupi, kaun, bire de manioc (Note du traducteur).
Quand ils sont rassembls dans leurs villages, dans la fort, par exemple, les animaux se dshabillent et
prennent leur figure humaine. Dans dautres cas, le vtement serait pour ainsi dire transparent aux yeux de
lespce mme et des chamanes humains.
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
morts et chamans qui prennent des formes animales, des btes quont vu dautres btes, des
humains qui sont, par inadvertance, transforms en animaux processus omniprsent dans le
monde trs transformationnel (Rivire 1994) propos par les cultures amazoniennes5.
Ces conceptions sont consignes dans plusieurs ethnographies sud-amricaines, mais
elles ont fait, en rgle gnrale, lobjet de rapports succincts et semblent tre labores et de
5
faons assez diverses par les cosmologies en question6. Elles se prsentent aussi, et avec une
valeur qui y est encore plus prgnante, dans les cultures de la zone septentrionale de
lAmrique du Nord et de lAsie, et plus rarement parmi quelques chasseurs-cueilleurs
tropicaux dautres continents7. Dans lAmrique du Sud, les socits du nord-ouest amazonien
exhibent des dveloppements plus complets (voir Arhem 1993 et 1996, chez qui la
caractrisation dont il a t question plus haut sest largement inspire ; Reichel-Dolmatoff
1985 ; S. Hugh-Jones 1996a). Nanmoins, ce sont les ethnographies de Vilaa (1992) sur le
cannibalisme wari et de Lima (1995) sur lpistmologie juruna qui apportent les
contributions les plus directement en affinit avec ce prsent travail, car elles relient la
question des points de vue non-humains et de la nature relationnelle des catgories
cosmologiques au cadre plus large des manifestions dune conomie gnrale de laltrit
(Viveiros de Castro 1993a, 1996a)8.
La notion de vtement corporel a t attribue, parmi dautres, aux Makuna (Arhem 1993), aux Yagua
(Chaumeil 1983 : 125-27), aux Piro (Gow com.pess.), aux Trio (Rivire 1994) ou aux Alto-Xinguanos (Gregor
1977 :322 ; Viveiros de Castro 1977 : 182). Elle est probablement panamricaine, trouvant un grand profit, par
exemple, dans la cosmologie kwakiutl (Goldman 1975 : 62-63, 124-25, 182-86, 227-28).
6
Cf., quelques exemples : Baer 1994 : 102, 119-224 (Machiguenga) ; Grenand 1980 : 42 (Waypi) ; Jara 1996 :
68-73 (Akuryio) ; Osborn 1990 : 151 (Uwa) ; Viveiros de Castro 1992a : 68 (Arawet); Weiss 1969 : 158
(Campa).
7
Cf., par ex., Saladin dAnglure 1990, Fienup-Riordan 1994 (Esquimaux) ; Nelson 1983, McDonnell 1984
(Koyukon, Kaska) ; Tanner 1979, Scott 1989, Brigthman 1993 (Cree) ; Hallowell 1960 (Ojibwa) ; Goldman 1975
(Kwakiutl) ; Gudon 1984 (Tsimshian) ; Boelscher 1989 (Haida). Pour la Sibrie, cf. Hamayon 1990. Cf., enfin,
Howell 1984, 1996 et Karim 1981, pour les Chewong et Ma Betisk de la Malaisie. Ltude de Howell 1984 a
t une des premires qui sest attache au sujet. Des conceptions semblables ont t galement rapportes
dans une cosmologie mlansienne, celle des Kaluli (Schiefflin 1976 : cap.5).
8
Cf. chapitres 2 et 4, supra. Les notions de perspective et de point de vue ont un rle dcisif dans des textes
que jai crit auparavant, mais la dynamique intra-humaine, le cannibalisme tupi en particulier, et son sens
presque toujours analytique et abstrait, y tait son noyau dapplication principal (Viveiros de Castro 1992a :
248-51, 256-59 ; 1996a [chap. 4 supra]). Les tudes de Vilaa et, surtout, celui de Lima mont montr quil tait
possible de gnraliser ces notions. (N.B. La rfrence la notion de perspective dans les dernires lignes du
chap.1 du prsent livre napparaitrait pas dans les versions originales des articles qui y sont fondu).
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
Quelques explications initiales sont ncessaires. Dabord, le perspectivisme sapplique
rarement en extension tous les animaux (indpendamment du fait quil englobe dautres
tres) ; il donne limpression de concerner plus souvent les espces telles que les grands
prdateurs et charognards, comme le jaguar, lanaconda, les vautours ou la harpie, ainsi que
les proies typiques des humains, tels que le pcari, les singes, les poissons, les cervids ou le
6
tapir. Cest que lune des dimensions fondamentales, peut-tre mme la dimension
constitutive, des inversions perspectivistes concerne les statuts relatifs et relationnels du
prdateur et de la proie9.
Lontologie amazonienne de la prdation est un contexte
pragmatique et thorique trs propice au perspectivisme.
Deuximement, la personnit et la perspectivit la capacit occuper un
point de vue sont un problme de degr et de situation, plutt que des proprits diacritiques
fixes dune ou dautre espce. Quelques non-humains actualisent ces potentialits de manire
plus complte que dautres ; dailleurs, quelques uns parmi eux les manifestent avec une
intensit suprieure celle de notre propre espce et, en ce sens-l, ils sont plus personnes
que les humains (Hallowell 1960 :69). En outre, la question possde une qualit a posteriori
fondamentale. La possibilit quun tre, jusque-l insignifiant, savre comme un agent
prosopomorphique capable daffecter les affaires humaines est toujours ouverte ; lexprience
personnelle, propre ou celle dautrui, est plus dcisive que nimporte quel dogme
cosmologique substantif.
En plus, me ou subjectivit ne sont pas toujours attribues aux reprsentants
individuels, empiriques, des espces vivantes ; il y a des exemples de cosmologies qui
refusent tous les animaux post-mythiques la capacit de conscience, ou quelque autre
prdicat spirituel10. Nanmoins, la notion desprits matres des animaux ( Mre de la
chasse , Matres des queixadas , etc.) est, comme on le sait, de grande diffusion dans le
continent. Ces esprits-matres, invariablement dous dune intentionnalit analogue celle de
lhumain, fonctionnent comme des hypostases des espces animales auxquelles ils sont
associs, de sorte quun champ intersubjectif humain-animal soit cre lendroit mme o les
animaux ne sont pas spiritualiss. Il faut ajouter que la distinction entre les animaux vus sous
Cf. Renard-Casevitz 1991 : 10-11, 20-31 ; Vilaa 1992 :49-51 ; Arhem 1993 :11-12 ; Howell 1996 :133.
Overing 1985 :249-ss ; 1986 :245-46 ; Viveiros de Castro 1992a :73-74 ; Baer 1994 :89.
10
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
leur aspect-me et les esprit-matres des espces nest pas toujours claire ou pertinente
(Alexiades 1999 :194) ; du reste, il est toujours possible que, loccasion dune rencontre
forestire, ce qui semblait tre seulement un animal se rvle tre le dguisement dun esprit,
de nature tout fait diffrente.
Rappelons, enfin et surtout, le fait que sil y a une notion virtuellement universelle
7
dans la pense amrindienne, cest celle dun tat originaire dindiffrenciation entre les
humains et les animaux, dcrit par la mythologie :
[Quest-ce quun mythe ?] Si vous demandez un indigne amricain, il est assez
probable quil vous rponde : cest une histoire du temps dans lequel les hommes et les
animaux ne se distinguaient pas encore. Cette dfinition me semble beaucoup profonde
(Lvi-Strauss & Eribon 1988 :193).
Les rcits mythiques sont peupls dtres dont forme, nom et comportement mlangent
inextricablement
attributs
humains
et
non-humains,
dans
un
contexte
commun
dintercommunicabilit identique celui qui dfini le monde intra-humain actuel. Le
perspectivisme amrindien fait donc du mythe un lieu, pour ainsi dire gomtrique, o la
diffrence entre les points de vue est en mme temps annule et exacerbe. Dans ce discours
absolu, chaque espce dtre apparait aux autres tres comme elle apparait elle-mme
cest--dire, comme humaine et, pourtant, elle agit (355) comme si elle manifestait dj sa
nature distinctive et dfinitive danimal, de plante ou desprit. Dune certaine faon, tous les
personnages qui peuplent la mythologie sont des chamanes, ce qui est, dailleurs, affirm par
quelques cultures amazoniennes (Guss 1989 :52). Discours sans sujet, a dit Lvi-Strauss
propos du mythe (1964 :19) ; discours seulement sujet , pourrait-on galement dire, cette
fois-ci en faisant rfrence non pas lnonciation du discours, mais son nonc. Point de
fuite universel du perspectivisme, le mythe parle dun tat de ltre dans lequel les corps et les
noms, les mes et les actions, le moi et lautre sinterpntrent, plongs dans un mme milieu
pr-subjectif et pr-objectif. Milieu que la mythologie a prcisment pour but de raconter.
Cette fin dans le sens aussi de finalit est, comme on le sait, cette diffrenciation
entre culture et nature analyse dans la monumentale ttralogie de Lvi-Strauss (1964, 1966,
1967, 1971). Pourtant, et ce point a t relativement peu remarqu, ce processus ne parle pas
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
dune diffrenciation de lhumain partir de lanimal, comme cest le cas dans notre
mythologie volutionniste moderne. La condition originelle commune aux humains et aux
animaux nest pas lanimalit, mais lhumanit. La grande division mythique montre moins la
culture se distinguant de la nature que la nature sloignant de la culture : les mythes racontent
comment les animaux ont perdu les attributs hrits ou prservs par les humains (Lvi8
Strauss 1985 :14, 190 ; Brightman 1993 :40,160). Les humains sont ceux qui sont rests
pareils eux-mmes : les animaux sont des ex-humains et non pas les humains des exanimaux.11
(356) On trouve, dans quelques ethnographies amazoniennes, clairement formules,
lide que lhumanit est la matire du plenum primordial, ou la forme originaire du
virtuellement tout, non pas seulement des animaux :
La mythologie des Campa est amplement lhistoire de comment, un un, les Campa
primordiaux furent, de manire irrversible, transforms en les premiers
reprsentants de plusieurs espces danimaux et de plantes, ainsi que de corps
clestes ou daccidents gographiques. [] Le dveloppement de lunivers fut, donc,
un processus de diversification, et lhumanit est la substance premire partir de
laquelle surgirent plusieurs sinon toutes les catgories dtres et de choses dans
lunivers ; les Campa daujourdhui sont les descendants des Campas ancestraux qui
chapprent la transformation (Weiss 1972 :169-70).
Ainsi, si notre anthropologie voit lhumanit chafaude partir des animaux comme
fondation, normalement cache par la culture ayant t jadis compltement animale, et
demeurant, en son fond , animale , la pense indigne conclut, en revanche, que, ayant t
11
Lide selon laquelle ce qui distingue le sujet les hommes, les indignes, mon groupe serait le terme
historiquement stable de la distinction entre le moi et lautre les animaux, les blancs, les autres indignes
apparait aussi bien dans le cas de la diffrenciation interspcifique que dans le cas de la sparation intraspcifique, comme on peut le remarquer dans les diffrents mythes amrindiens sur lorigine des Blancs (cf.,
par ex., DaMatta 970,1973 ;S. Hugh-Jones 1988 ; Lvi-Strauss 1991 ; cf. aussi chap. 3 supra, et Viveiros de
Castro 2000). Les autres ont t ce que nous sommes, et non pas, comme pour nous, sont ce que nous tions.
On peroit ainsi comment peut tre pertinente la notion de socits froides : lhistoire existe, oui, mais cest
quelque chose qui arrive seulement aux autres, ou en raison deux.
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
jadis humains, les animaux et dautres tres du cosmos continuent tre humains, quoique de
manire non vidente.
Bref, pour les amrindiens, le rfrentiel commun tous les tres de la nature nest
pas lhomme en tant quespce, mais lhumanit en tant que condition (Descola 1986 :120).
Cette distinction entre lespce et la condition humaines doit tre souligne. Elle prsente une
9
connexion vidente avec lide que les vtements animaux cachent une essence humainespirituelle commune, et avec le problme du sens gnral du perspectivisme.
Chamanisme
Le perspectivisme amrindien se trouve associ deux caractristiques rcurrentes en
Amazonie : la valorisation symbolique de la chasse et limportance du chamanisme12. En ce
qui concerne la chasse, on remarque quil sagit dune rsonance symbolique et non pas dune
dpendance cologique : les horticulteurs laborieux, comme les Tukano ou les Juruna qui
sont, par ailleurs, principalement pcheurs , ne se distinguent pas assez des grands chasseurs
du Canada ou du Alaska du point de vue de limportance attribue la prdation animale
(chasse ou pche), de la subjectivation spirituelle des animaux et de la thorie selon laquelle
lunivers est rempli dintentionnalits extrahumaines doues de perspectives propres13. Ainsi,
la spiritualisation des plantes, mtores et outils pourrait peut-tre tre vue comme secondaire
ou drive vis--vis la spiritualisation des animaux : lanimal semble tre le prototype
extrahumain de lAutre, en soutenant un rapport privilgi avec dautres figures prototypiques
de laltrit, comme les affins14.
12
Le rapport entre le chamanisme et la chasse est une question classique. Cf. Chaumeil 1983 :231-32 et Crocker
1985 :17-25.
13
Dans des socits dont lconomie se trouve fonde dans lhorticulture et dans la pche plutt que dans la
chasse, limportance de la relation venatorio-chamanistique avec le monde animal suscite des problmes
intressants pour lhistoire culturelle de lAmazonie (Viveiros de Castro 1996b cf. chap. 6 supra).
14
Cf. Erikson 1984 :110-12 ; Descola1986 :317-30 ; Arhem 1996. Nanmoins, remarquons que, dans les cultures
de lAmazonie occidentale, surtout celles qui font lusage des hallucinognes, la personnification des plantes
semble tre au moins aussi importante que celle des animaux, et que, dans des rgions comme le Alto Xingu, la
spiritualisation des outils exerce un important rle cosmologique.
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
Idologie de chasseurs, elle est aussi et surtout une idologie de chamanes. Que les
non-humains actuels possdent un cot prosopomorphique invisible, cette notion est un
prsuppos fondamental de plusieurs dimensions de la pratique indigne ; mais elle place au
premier plan, dans un contexte particulier, le chamanisme. Le chamanisme amazonien peut
tre dfini comme lhabilet que manifestent certains individus franchir dlibrment les
10
barrires corporelles et adopter la perspective de subjectivits allo-spcifiques, de manire
devenir capable dadministrer les rapports entre celles-ci et les humains. Voyant les tres nonhumains comme ceux-ci se voient (comme humains), les chamanes sont capables dassumer
le rle dinterlocuteurs actifs dans le dialogue trans-spcifique ; et surtout, ils sont capables de
revenir pour en raconter lhistoire, ce que peut difficilement faire un lac. La rencontre ou
lchange de perspectives est un processus dangereux et un art politique une diplomatie. Si
le multiculturalisme occidental est un relativisme en tant que politique publique, le
perspectivisme chamanique amrindien est un multinaturalisme en tant que politique
cosmique.
Le chamanisme est un mode dagir qui implique un mode de connatre, ou plutt un
certain idal de connaissance. Un tel idal est, sous divers aspects, loppos polaire de
lpistmologie objectiviste favorise par la modernit occidentale. Dans celle-ci, la catgorie
de lobjet fournit le telos : connatre, cest objectiver ; cest pouvoir distinguer dans lobjet ce
qui lui est intrinsque de ce qui appartient au sujet connaissant et qui a t, en tant que tel,
indment et/ou invitablement projet dans lobjet. Ainsi, connatre, cest dsubjectiver, cest
expliciter la part du sujet prsente dans lobjet, de manire la rduire un minimum idal.
Aussi bien les sujets que les objets sont vus comme la rsultante de processus
dobjectivation : le sujet se constitue ou se reconnait lui-mme dans les objets quil produit ;
et se connait objectivement quand il parvient se voir du dehors , comme un a . Notre
jeu pistmologique a pour nom objectivation ; ce qui na pas t objectiv demeure irrel et
abstrait. La forme de lAutre est la chose.
Le chamanisme amrindien semble tre orient vers lidal inverse. Connatre, cest
personnifier, prendre le point de vue de ce qui doit tre connu - de cela, ou mieux, de celui ;
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
car la connaissance chamanique envisage un quelque chose qui est quelquun , un autre
sujet ou agent. La forme de lAutre est la personne.15
Faisant usage dun vocabulaire qui est en vogue, je dirais que la personnification ou
subjectivation chamaniques refltent un penchant universaliser l attitude intentionnelle
tel que le souligne Dennet (1978) et dautres philosophes modernes de lesprit (NDT : mind).
11
Pour tre plus prcis vu que les indignes sont parfaitement capables dadopter les attitudes
physique et fonctionnelle (op.cit.) dans leur vie quotidienne je dirais quon est face
un idal pistmologique qui, loin de chercher rduire lintentionnalit ambiante zro
afin datteindre une reprsentation absolument objective du monde, prend la dcision
oppose : la connaissance vraie vise la rvlation dun maximum dintentionnalit, par la
voie dun processus d abduction de puissance dagir (Gell 1998) systmatique et dlibr.
Jai dit plus haut que le chamanisme tait un art politique. Ce que je suis en train de dire,
maintenant, cest que cest est un art politique.16 Car la bonne interprtation chamanique est
celle qui parvient saisir chaque vnement comme tant, en vrit, laction, lexpression
dtats ou prdicats intentionnels dun certain agent (id. : 16-18). Le succs interprtatif est
directement proportionnel lordre dintentionnalit que lon parvient attribuer lobjet ou
nome.17 Un tant ou un tat de choses qui ne se prte pas la subjectivation, cest--dire, la
dtermination de son rapport social avec celui qui connait, est chamanistiquement insignifiant
un rsidu pistmique, un facteur impersonnel qui rsiste une connaissance prcise.
15
Je note que cette faon dexprimer le contraste nest pas seulement semblable la clbre opposition entre
don et marchandise . Jentends par l quil sagit du mme contraste, formul en termes nonconomicistes : si, dans une conomie mercantile, les choses et les personnes prennent la forme sociale de la
chose, alors dans une conomie du don elles assument la forme de la personne (Strathern 1988 :134 ; cf.
Gregory 1982 :41).
16
La dfinition thorique-anthropologique de l art en tant quenveloppant le processus dabduction de
puissance dagir est remarquablement expose par Alfred Gell dans Art and agency (1998).
17
Je fais rfrence ici au concept de Dennett sur la n-ordinalit des systmes intentionnels. Un systme
intentionnel de deuxime ordre est celui o lobservateur attribue non seulement croyances, dsirs et dautres
intentions lobjet, mais aussi bien croyance etc. sur les autres croyances etc. La thse cognitiviste la plus
accepte veut que seul lhomo sapiens fasse preuve dune intentionnalit dun ordre gal ou suprieur deux.
Il faut remarquer que mon principe chamanistique de l abduction dun maximum de puissance dagir
(agency) se heurte, bien videment, aux dogmes de la psychologie physicaliste : Les psychologues ont
souvent fait usage du principe connu sous le nom de loi de parcimonie de Lloyd Morgan, qui peut tre vu
comme un cas particulier du rasoir dOccam. Ce principe dtermine quil faut attribuer un organisme un
minimum dintelligence, ou de conscience, ou de rationalit suffisantes pour rendre compte de son
comportement (Dennett op.cit. : 274). En effet, le grelot du chaman est un instrument dun genre
compltement diffrent du rasoir dOccam ; celui-ci peut servir la rdaction darticles de logique, mais il ne
sert rien quand il sagit, par exemple, de rcuprer des mes perdues.
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
Notre pistmologie objectiviste, on peut le dire, a pris une autre direction : elle considre
lattitude intentionnelle du sens commun comme une simple fiction commode, quelque chose
quon adopte lorsque le comportement de lobjet-cible est assez compliqu pour tre
dcompos en processus physiques lmentaires. Une explication scientifique exhaustive du
monde doit pouvoir rduire toute action une chane dvnements causaux et, ceux-ci des
12
interactions matriellement denses (pas d action distance).
Bref, si dans le monde naturaliste de la modernit un sujet est un objet insuffisamment
analys, la convention interprtative amrindienne suit le principe inverse : un objet est un
sujet incompltement interprt. Il faut ici savoir personnifier, parce quil est ncessaire de
personnifier pour savoir. Lobjet de linterprtation est la contre-interprtation de lobjet18.
Car, celui-ci doit ou bien tre tendu jusqu ce quil atteigne sa forme intentionnelle pleine
desprit, danimal sous ses traits humains , ou, au moins, avoir rapport avec un sujet
dmontr, autrement dit, il doit tre dtermin comme quelque chose qui existe dans
lentourage dun agent (Gell op.cit.). En ce qui concerne cette deuxime possibilit, lide
selon laquelle les agents non-humains se peroivent eux-mmes ainsi que leur comportement
sous la forme de la culture humaine, prend un rle crucial. La traduction de la culture pour
les mondes des subjectivits extra-humaines a comme corolaire la redfinition de plusieurs
vnements et objets naturels comme tant des indices partir desquels la puissance
dagir sociale peut tre abductionne. Le cas le plus rpandu consiste dans la transformation
de quelque chose, qui est un simple fait ordinaire pour les humains en un artefact ou un
comportement hautement civilis du point de vue de lautre espce : ce que nous appelons
sang est la bire du jaguar ; ce que nous prenons pour une argile boueuse, le tapir le
prend pour une grande maison de crmonie, et ainsi de suite. Les artefacts possdent cette
ontologie intressante et ambige ; ce sont des objets, mais ils renvoient ncessairement un
sujet, car ils sont comme des actions figes, incarnation matrielle dune intentionnalit nonmatrielle (Gell 1998 : 16-18, 67). Et, ainsi, ce que les uns appellent nature peut bien tre
18
Comme le note Marilyn Strathern, propos dun rgime pistmologique comme lamrindien : [Cette]
convention postule que les objets dinterprtation humains ou pas soient compris comme dautres
personnes ; en effet, lacte mme dinterprtation suppose la personnit [personhood] de ce qui est en
train dtre interprt. [] Ce qui est, donc, trouv lorsque lon fait des interprtations, ce sont toujours des
contre-interprtations (1999 :239).
[Tapez un texte]
Document de travail ERRAPHIS
la culture des autres. Voil une leon dont lanthropologie pourrait bien faire quelque
profit19.
[]
Traduction par Cleber Lambert
Relecture : Norman Ajari
13
19
Wagner (1981) a t un des seuls quont su le faire.
[Tapez un texte]
Vous aimerez peut-être aussi
- Prières À ST Michel - Protection Efficace - Retour Aux SourcesDocument3 pagesPrières À ST Michel - Protection Efficace - Retour Aux SourcesMichel Dumas100% (5)
- Ordinario de La Misa en FrancésDocument7 pagesOrdinario de La Misa en FrancésNuria Contreras ContrerasPas encore d'évaluation
- Zs Piron Occupation Op Coro v2Document122 pagesZs Piron Occupation Op Coro v2Giovanni GiovannettiPas encore d'évaluation
- Jean Flori. Pour Une Redéfinition de La CroisadeDocument23 pagesJean Flori. Pour Une Redéfinition de La CroisadeCARLOS PELLEGRINIPas encore d'évaluation
- Marxisme Et Politique - Henri LefebvreDocument26 pagesMarxisme Et Politique - Henri LefebvreAndrés Díez de PabloPas encore d'évaluation
- La NORDICITE DU QUEBEC: Entretiens avec Louis-Edmond HamelinD'EverandLa NORDICITE DU QUEBEC: Entretiens avec Louis-Edmond HamelinPas encore d'évaluation
- Combat Spirituel Strategique 1Document13 pagesCombat Spirituel Strategique 1Agnès-mariam de la CroixPas encore d'évaluation
- Le Bot, Jean-Michel - Par Delà Nature Et Culture La DialectiqueDocument19 pagesLe Bot, Jean-Michel - Par Delà Nature Et Culture La DialectiqueParaboa Clara100% (1)
- AnalogismeDocument6 pagesAnalogismeanalozanoriveraPas encore d'évaluation
- La place de l'homme dans l'univers: L'unité et la pluralité des mondesD'EverandLa place de l'homme dans l'univers: L'unité et la pluralité des mondesPas encore d'évaluation
- Monadologie Et SociologieDocument56 pagesMonadologie Et SociologieladalaikaPas encore d'évaluation
- La Crise de Production de Subjectivité GuattariDocument10 pagesLa Crise de Production de Subjectivité GuattariNicolasCaballeroPas encore d'évaluation
- Frédéric Lordon - La Condition Anarchique-Le Seuil (2018)Document230 pagesFrédéric Lordon - La Condition Anarchique-Le Seuil (2018)Javier Sánchez MartínezPas encore d'évaluation
- Emile Meyerson Le Physicien Et Le PrimitifDocument38 pagesEmile Meyerson Le Physicien Et Le Primitifegonschiele9Pas encore d'évaluation
- LATOUR, Changer de Société, Refaire de La SociologieDocument52 pagesLATOUR, Changer de Société, Refaire de La SociologieThomas GennenPas encore d'évaluation
- Le Paradigme de L'énaction Aujourd'huiDocument38 pagesLe Paradigme de L'énaction Aujourd'huiDavid Alcantara MirandaPas encore d'évaluation
- Averroès Et SpinozaDocument7 pagesAverroès Et SpinozaKse NoPas encore d'évaluation
- La Biographie Historique en France Un Essai DhistDocument17 pagesLa Biographie Historique en France Un Essai DhistAbdelghani BoualiPas encore d'évaluation
- Goethe - Maximes Et ReflexionsDocument69 pagesGoethe - Maximes Et ReflexionsJinOtakuPas encore d'évaluation
- Alain Testart, Éléments de Classification Des SociétésDocument12 pagesAlain Testart, Éléments de Classification Des SociétésCarmen LlerenasPas encore d'évaluation
- 306 Le Sujet Et Le Pouvoir M FoucaultDocument22 pages306 Le Sujet Et Le Pouvoir M FoucaultToukanphPas encore d'évaluation
- Sartre Et Le LangageDocument10 pagesSartre Et Le Langagenitroo17Pas encore d'évaluation
- MANIGLIER, Patrice. de Mauss À Claude Lévi-Strauss Cinquante Ans Après. Pour Une Ontologie MaoriDocument15 pagesMANIGLIER, Patrice. de Mauss À Claude Lévi-Strauss Cinquante Ans Après. Pour Une Ontologie MaoriSonia LourençoPas encore d'évaluation
- La Revue Socialiste N°57 - Mars 2015Document166 pagesLa Revue Socialiste N°57 - Mars 2015Parti socialistePas encore d'évaluation
- Retour Sur Les Institutions Du Sens de VDocument7 pagesRetour Sur Les Institutions Du Sens de VetiemblePas encore d'évaluation
- Introduction: Les Suites de La Phénoménologie: Denis FisetteDocument20 pagesIntroduction: Les Suites de La Phénoménologie: Denis FisetteFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- Foucault - 339 Qu'est-Ce Que Les LumieresDocument9 pagesFoucault - 339 Qu'est-Ce Que Les LumieresMartín MacíasPas encore d'évaluation
- Judith Butler - Une Morale Pour Temps PrécairesDocument6 pagesJudith Butler - Une Morale Pour Temps PrécairesAntonio MemmioPas encore d'évaluation
- L'Illusion Du Consensus (Chantal Mouffe)Document124 pagesL'Illusion Du Consensus (Chantal Mouffe)Samuel AlexandrePas encore d'évaluation
- Dehors, Chaos Et Matières Intensives Dans La Philosophie de Gilles Deleuze - Mengue, Philippe PDFDocument25 pagesDehors, Chaos Et Matières Intensives Dans La Philosophie de Gilles Deleuze - Mengue, Philippe PDFJulius1982Pas encore d'évaluation
- Aristote Et La StasisDocument19 pagesAristote Et La StasisDerek WilliamsPas encore d'évaluation
- 2014 Bourdin Bernard TheseDocument390 pages2014 Bourdin Bernard TheseYamila JuriPas encore d'évaluation
- Alain Accardo - La Colère Du JusteDocument44 pagesAlain Accardo - La Colère Du JusteDiego Luis SanrománPas encore d'évaluation
- Ian - Hacking Anthropologie Philosophique CERISY-hommage A Philippe Descola (Le 16 Juiller 2006)Document14 pagesIan - Hacking Anthropologie Philosophique CERISY-hommage A Philippe Descola (Le 16 Juiller 2006)ze_n6574Pas encore d'évaluation
- HarawaynbDocument169 pagesHarawaynbChorismos NégatifPas encore d'évaluation
- Critique de Malthus Marx&EngelDocument306 pagesCritique de Malthus Marx&EngelFadmaPas encore d'évaluation
- La Violence Nazie - Une Généalogie EuropeenneDocument214 pagesLa Violence Nazie - Une Généalogie Europeennefrchj mouPas encore d'évaluation
- D'Arcy Thompson, La Forme Et Le VivantDocument5 pagesD'Arcy Thompson, La Forme Et Le VivantPierre SchlaederPas encore d'évaluation
- L2 Descriptifs 2018 2019Document50 pagesL2 Descriptifs 2018 2019Link ZeldaPas encore d'évaluation
- Les Faits Sociaux Sont-Ils Des Choses PDFDocument16 pagesLes Faits Sociaux Sont-Ils Des Choses PDFDiogo Silva CorreaPas encore d'évaluation
- Edmund Burke - Réflexions Sur La Révolution de FranceDocument493 pagesEdmund Burke - Réflexions Sur La Révolution de FranceKoltchak91120Pas encore d'évaluation
- (Dés)équilibres: L'informatisation du travail social en justiceD'Everand(Dés)équilibres: L'informatisation du travail social en justicePas encore d'évaluation
- Sciences et pseudo-sciences: Regards des sciences humainesD'EverandSciences et pseudo-sciences: Regards des sciences humainesPas encore d'évaluation
- L’innéité aujourd’hui: Connaissances scientifiques et problèmes philosophiquesD'EverandL’innéité aujourd’hui: Connaissances scientifiques et problèmes philosophiquesPas encore d'évaluation
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Avec la pandémie de la Covid-19 et après ? - Volume 2: Retour au monde d’avant ? Adaptation au monde actuel ? Ou amorce d’un monde nouveau ?D'EverandAvec la pandémie de la Covid-19 et après ? - Volume 2: Retour au monde d’avant ? Adaptation au monde actuel ? Ou amorce d’un monde nouveau ?Pas encore d'évaluation
- Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction: Essai philosophiqueD'EverandEsquisse d'une morale sans obligation ni sanction: Essai philosophiquePas encore d'évaluation
- Anarchisme: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAnarchisme: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les Règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Sensible Dans Le RêveDocument11 pagesLe Sensible Dans Le RêveFlorencia Rodriguez GilesPas encore d'évaluation
- SartreDocument31 pagesSartreFlorencia Rodriguez GilesPas encore d'évaluation
- La Maîtrise Du Corps D'après Les Manuels de SoufismeDocument17 pagesLa Maîtrise Du Corps D'après Les Manuels de SoufismeFlorencia Rodriguez GilesPas encore d'évaluation
- Le Mythe de NarcisseDocument31 pagesLe Mythe de NarcisseFlorencia Rodriguez GilesPas encore d'évaluation
- Levis-Strauss Introduction À L'œuvre de Marcel MaussDocument44 pagesLevis-Strauss Introduction À L'œuvre de Marcel Maussdiettervon100% (1)
- Techniques CorpsDocument23 pagesTechniques CorpsFlorencia Rodriguez GilesPas encore d'évaluation
- Sur Badiou Et L'art Contemporainet-L'ideeDocument19 pagesSur Badiou Et L'art Contemporainet-L'ideeGKF1789Pas encore d'évaluation
- 007Document72 pages007Luiza Matilda Mitu100% (1)
- DumezilDocument34 pagesDumezilMitoGriegoPas encore d'évaluation
- Les Vertus Du Verset Du Trône (Fadl Âyat Al-Koursî) - L'Exégèse Du Coran - Tafsîr Al-QurânDocument7 pagesLes Vertus Du Verset Du Trône (Fadl Âyat Al-Koursî) - L'Exégèse Du Coran - Tafsîr Al-QurânKavé KaramokoPas encore d'évaluation
- Goethe AchilléideDocument9 pagesGoethe AchilléideAkio OtsukaPas encore d'évaluation
- WingMakers Le Souverain Integral James Interview CamelotDocument53 pagesWingMakers Le Souverain Integral James Interview CamelotwritingboxPas encore d'évaluation
- Une Liturgie de MithrasDocument6 pagesUne Liturgie de MithrasSpartakus FreeMann100% (1)
- Invocations PDFDocument3 pagesInvocations PDFIuiu HuhPas encore d'évaluation
- Engel - Michel Foucault, Connaissance, Veritéet EthiqueDocument5 pagesEngel - Michel Foucault, Connaissance, Veritéet EthiqueDmitry DunduaPas encore d'évaluation
- Prions Saint Michel ArchangeDocument22 pagesPrions Saint Michel ArchangeKerby Pierre LouisPas encore d'évaluation
- Prière Du Cœur PDFDocument4 pagesPrière Du Cœur PDFNicolae Cuncea100% (2)
- SDFDocument32 pagesSDFSanta RaiPas encore d'évaluation
- Entretien Avec André-Georges HaudricourtDocument4 pagesEntretien Avec André-Georges HaudricourtaxiomatizadorrPas encore d'évaluation
- Beria CH ViliDocument13 pagesBeria CH ViliFabian Gonzalez RamirezPas encore d'évaluation
- Osiris ENIM 3Document33 pagesOsiris ENIM 3Imhotep72Pas encore d'évaluation
- Prière de LibérationDocument2 pagesPrière de LibérationOteloPas encore d'évaluation
- Sourate AL Kafh PDFDocument137 pagesSourate AL Kafh PDFdiourouPas encore d'évaluation
- Details Des Cours Parole Benefique Tawhid - LavoiedroiteDocument2 pagesDetails Des Cours Parole Benefique Tawhid - LavoiedroiteJamel NadaPas encore d'évaluation
- Comparaison Des Versions Bibliques J.F. Ostervald Et Louis. SegondDocument8 pagesComparaison Des Versions Bibliques J.F. Ostervald Et Louis. Segondnkapnangluther3099Pas encore d'évaluation
- Diaporama HadesDocument6 pagesDiaporama HadesDupontPas encore d'évaluation
- Gilbert Durand PDFDocument8 pagesGilbert Durand PDFMajid MahiPas encore d'évaluation
- La Connaissance de La Vie, by Witness LeeDocument247 pagesLa Connaissance de La Vie, by Witness Leestephpaul100% (2)
- Plotin Et Les Mythes PDFDocument24 pagesPlotin Et Les Mythes PDFclaude.allegriniPas encore d'évaluation
- La Cabale Des Hébreux - DrachDocument79 pagesLa Cabale Des Hébreux - DrachSpartakus FreeMann100% (3)
- L Origine Des Dieux Du Paganisme Et Le Sens Des Fables Decouvert Tome1 PDFDocument450 pagesL Origine Des Dieux Du Paganisme Et Le Sens Des Fables Decouvert Tome1 PDFLavinia PirvulescuPas encore d'évaluation
- Fiche Pedagogique Les Dieux EgyptiensDocument4 pagesFiche Pedagogique Les Dieux Egyptiensmossachrist19Pas encore d'évaluation
- Em SWEDENBORG Les Merveilles Du Ciel, Et de L'enfer TOME PREMIER Traduction Antoine-Joseph Pernety 1786Document412 pagesEm SWEDENBORG Les Merveilles Du Ciel, Et de L'enfer TOME PREMIER Traduction Antoine-Joseph Pernety 1786francis battPas encore d'évaluation
- La Notion de Panthéon Dans LantiquitéDocument3 pagesLa Notion de Panthéon Dans Lantiquitéanneless14Pas encore d'évaluation