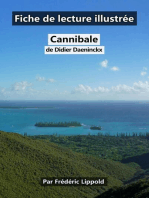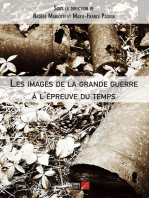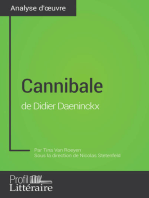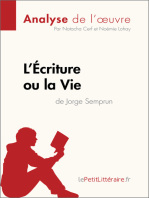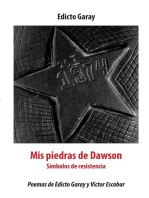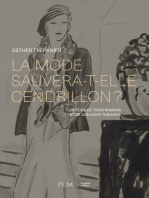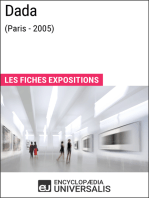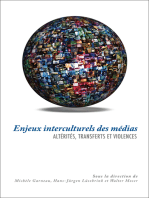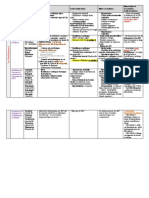Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ethique Esthetique Politique
Transféré par
FLAKUBELA0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
94 vues5 pagesIntroduction de Christian CAUJOLLE,
Actes Sud/Rencontres internationales de la photographie, Arles 1997, 315 p, 230 F.
par Française DENOYELLE
Titre original
Ethique-Esthetique-Politique
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentIntroduction de Christian CAUJOLLE,
Actes Sud/Rencontres internationales de la photographie, Arles 1997, 315 p, 230 F.
par Française DENOYELLE
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
94 vues5 pagesEthique Esthetique Politique
Transféré par
FLAKUBELAIntroduction de Christian CAUJOLLE,
Actes Sud/Rencontres internationales de la photographie, Arles 1997, 315 p, 230 F.
par Française DENOYELLE
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 5
Ethique-Esthtique-Politique
Introduction de Christian CAUJOLLE
thique-Esthtique-Politique, introduction de Christian CAUJOLLE. Actes
Sud/Rencontres internationales de la photographie, Arles 1997, 315 p, 230
F.
par Franaise DENOYELLE
Catalogue des Rencontres internatiornales de la photographie 1997, la
croise de lengagement et de la mmoire, thique-Esthtique-Politique
sarticule autour dune double problmatique et vient fort propos
rappeler, une poque o la photographie contemporaine se veut
plasticienne, la contribution spcifique et lclairage particulier quelle
apporte ces questions.
Trois chapitres structurent le livre : le devoir de mmoire , les formes
de lengagement , les tentations du pouvoir . Une iconographie
exceptionnelle par sa qualit, sa pertinence, son originalit, pointe les
enjeux, apporte des points de vue diffrents, complmentaires mme sils
apparaissent parfois contradictoires. Le devoir de mmoire prsente
S 21 ou le cauchemar cambodgien des photographies prises dans
lancienne cole suprieure Tuol Sleng de Phnom Pen transforme par les
Kmers rouges en centre dextermination. La plupart des vingt mille
Cambodgiens excuts entre 1975 et 1979 dans ce camp rebaptis S 21
furent photographis par un gamin, fils de paysan pauvre choisi par deux
lieutenants de Pol Pot parce quil tait fils dun vrai paysan . ils
lenvoyrent Shangai, o il se forma. son retour, en mai 1976, lge
de 16 ans il devint photographe en chef de Tuol Sleng et responsable de
cinq apprentis. En gnral, je prenais les photos larrive des
prisonniers, aprs quon leur avait accroch un numro avec une pingle,
parfois mme la peau quand ils arrivaient torse nu (p. 72). Ces
photographies prises en quelques secondes ( partir de 1977, il arrive
jusqu six cents personnes par jour) servent de preuve de lexcution.
Aprs lentre des Vietnamiens dans Phnom Pen, Nhem Ein rejoint, avec
ses camarades, la jungle du nord. Ses images ont t exposes pour la
premire fois, en 1979, pour que les habitants de Phnom Pen viennent voir
sils retrouveraient, parmi les sept mille visages, des membres de leur
famille. Depuis Tuol Sleng a t transform en muse mmorial.
Ces portraits ou plus exactement leur utilisation posent avec force le
statut de la photographie. lorigine annexes de procs verbaux
dexcutions, archives dun gnocide programm puis tmoignages de
lhistoire dun peuple et prsentes comme telles Phnom Pen elles ont
acquis depuis un statut quon a peine qualifier dartistique . Elles sont
nanmoins, pour plusieurs dentre elles, entres dans les collections des
muses dart moderne de New York, San Francisco, Los Angeles. Ne
sommes-nous pas dans la confusion des genres ?
thique-Esthtique-Politique a le mrite de restituer clairement le
cadre historique et idologique, de bannir le voyeurisme et la morbidit.
Les photographies font cho dautres images dont le seul vis--vis
pargne bien des discours et souligne le lien tnu quentretient la
photographie avec lexigence de mmoire quimpose un sicle trop
familier de la barbarie. Sur une double page figurent gauche, les enfants
juifs dIzieu, t 1943, un groupe rieur dans linsouciance des vacances,
droite une photographie de Stphane Duroy prise dans le muse
dAuschwitz en 1992 o salignent, au-dessus de quelques vtements
tmoins (brassires, petites chemises), les portraits anthropomtriques
denfants en costumes rays, eux aussi affubls dun numro. Autre vis-vis o Histoire et actualit appellent au devoir de mmoire : gauche,
Femme algrienne, 1960 de Marc Garanger, droite, Algrie 19941997 Photos AFP de Hocine Zaoura. En 1960, Marc Garanger fait son
service militaire en Algrie. On lui demande de photographier les civils. Il a
ainsi photographi deux mille personnes, en majorit des femmes de la
campagne. Elles taient dans lobligation de se dvoiler... Jai reu leur
regard bout protant, premier tmoin de leur protestation muette. (p.
56) Les photographies de lAFP avec leur brve lgende Femmes
pleurant et criant lors des funrailles de dix-huit civils massacrs mardi ,
Hommes devant les corps, ensevelis dans le drapeau algrien, de dixhuit civils massacrs , laissent au lecteur la prise en charge du rcit.
Le chapitre devoir de mmoire rassemble dans une longue litanie les
victimes de lHistoire : cadavre dans une tranche de la Meuse en 1916,
rescaps de Nagasaki, portraits de dports du goulag, Le Silence
Rwanda une installation de Gilles Peress o salignent en rangs serrs
les images dun autre carnage, Les martyrs de Cana simples portraits
damateur des victimes du massacre de Cana perptr en 1996 qui, la
veille du 18 avril trnaient encore sur le poste de radio ou dans des
modestes albums familiaux. Autant dimages qui nous renvoient la
formule glace de Pierre Dac, Lavenir est devant nous et on la dans le
dos chaque fois quon se retourne .
En ce qui concerne le choix des photographies deux observations
simposent. Prompts analyser, commenter le pass des autres, les
Franais ont la mmoire singulirement oublieuse en ce qui concerne
leur propre pass. Ny a-t-il aucune photographie des camps de Drancy o
transitrent vers les camps de la mort prs de 90 000 Juifs, de Gars,
Rivesaltes, mis en place pour accueillir les rfugis de la guerre
dEspagne, ny a-t-il aucun document (autre que ceux de Marc Garanger)
sur nos guerres coloniales ? La guerre du Rif par exemple si dterminante
en ce qui concerne lengagement politique des surralistes (AragonBreton), na-t-elle pas t couverte ? Seconde observation labsence totale
dimages qui ne soient pas cicatrice de linoubliable mais au contraire
preuve des capacits humaines rsister, affirmer sa dignit, conqurir sa
libert. Les reportages ne manquent pourtant pas sur la guerre des pierres
des enfants palestiniens, sur la fin de lApartheid dans Sowetho.
La deuxime partie, consacre aux formes de lengagement, question
rcurrente dans lhistoire de lart du XXe sicle, aborde le sujet de
plusieurs manires. Dun point de vue historique quand art et politique se
rejoignent et lient propagande et avant-garde. Rodtchenko, Klutsis,
Lissitzki imposent une nouvelle reprsentation formelle dun monde la
mesure de leurs rves. Leurs lans seront de courte dure et lesthtique
quils ont forge dans les tracts, magazines, affiches senlisera vite dans
un ralisme socialiste conventionnel. Autre forme dengagement : la prise
de position par rapport lhistoire de la photographie telle quelle sest
constitue pendant un sicle et demi. Des artistes comme Mathieu Pernot,
Eva Leitof ou Klavdij Sluban laborent des solutions plastiques qui par la
mdiation de limage traitent de la situation du monde . Troisime type
dapproche : la place de lindividuel dans le collectif. Des artistes aussi
diffrents que Nan Golding, Sophie Calle, Annette Messager ou Christian
Boltanski sinterrogent sur des faits de socit travers un vcu
individuel. Aux deux extrmes on retrouve un discours critique sur le
monde, la ligne de partage se situant entre ceux qui privilgient un travail
sur le mdium et ceux qui choisissent de se situer par rapport au monde.
Muntadas utilise le matriel des mdias : micros, tlviseurs, une des
journaux, etc., pour analyser et stigmatiser la construction mdiatique de
la ralit. Ses travaux s inscrivent dans la culture du quotidien, du
spectacle en tant que valeur dchange. Word : the Press Conference
Room est une installation qui utilise les conventions visuelles du
spectacle et tablit les nouveaux codes de relations . La transformation de
la confrence de presse en scnographie comme lieu du crime
interroge la fois le spectateur et le journaliste sur le contrle des centres
metteurs de linformation. Tout autre est la dmarche dEugne Richards.
On dit que les drogus du crack ont tous le mme visage et cest
probablement vrai.., mais moi jy trouve autre chose (p. 102), le propos
dEugne Richards rsume lensemble de son travail sur les marginaux
aux tats-Unis. Ses images fragmentaires des laisss pour compte de
lAmerican Way of Life vont au coeur de la dchance humaine. Leur
capacit de provocation et de violence dconcerte quand elle nest pas
rcupre. Ainsi les premires, de familles entires de drogus,
dadolescentes prostitues, de gamins arborant des armes automatiques
parurent dans Life et furent reprises par la presse mondiale. Mais quand, il
rassemble dans Cocaine True Cocaine Blue les portraits successifs dune
prostitue dont chacun deux, au fil des annes, dresse le constat de sa
dchance, les militants des quartiers pauvres dnoncrent avec force le
travail dEugne Richards. Il en fut de mme pour The Knife and Gun Club
un livre financ par le Prix Fugne Smith. Eugne Richards photographia
les urgences de lhpital central de Denver. Il montra lacharnement des
mdecins et du personnel hospitalier, mais aussi leur cynisme, leur
prostration et leur lassitude devant les victimes des guerres urbaines de
Denver : une avalanche de seringues, de fibrillateurs, de torses inanims
sillonns de points de suture, dambulanciers speeds et dinfirmires
effrondres dpuisement (p. 105). Tout en poursuivant son travail sur
lhpital, Richards sillonna lAmrique des laisss pour compte et
rassembla ses images dans Below the line : living poor in America
couronn par le prix ICP en 1987, mais il resta un marginal et ce nest
quau dbut des annes quatre-vingt-dix quil est vritablement reconnu
bien que ses motivations soient souvent critiques tant limage quil
renvoie de lAmrique est peu conforme au politically correct . Ce quoi
il rpond : Les gens trouvent mon choix de sujet aberrant, mais cest
parce quils nont pas compris que pour la majorit de la population
mondiale, la pauvret et la maladie reprsentent la norme. La ralit, cest
a et les bizarrodes, cest nous, les Amricains blancs de la classe
moyenne .
Les portraits dAnthony Aziz et Sammy Cucher bien quaux antipodes de
ceux dEugne Richards nen sont pas moins aussi subversifs et
drangeants. Leurs images numriques alliant terreur et humour grinant
naissent en plein retour de lordre moral aux tats-Unis, lpoque o
Mapplethorpe ou Witkine sont victimes la censure. Faith, Honor and
Beauty par drision propose une image idale dune socit dont
lesthtique renvoie lart publicitaire et au sitcom, un art officiel o
lobscne est banni. Entre allgorie et prophtie la nouvelle race humaine
propose par Aziz et Cucher se rfre la statuaire nazie et laisse percer
un eugnisme sous-jacent. Grands, blonds, nus, les personnages portent
des accessoires symboliques de la socit de consommation (ordinateur,
bb aux normes des spots publicitaires, camescope). Amputs de leur
attribut sexuel ils incarnent les rves dune socit amricaine blanche,
pudibonde gangrne par le politiquement correct, un monde de poupes
Barbie. Avec Dystopia (1994-1995) les portraits passent du sarcasme la
terreur, dans une vision hallucine qui modifie la problmatique la faisant
passer de Quallons-nous faire de la technique ? Quest-ce que la
technique va faire de nous ? Les tres appartiennent un cybermonde,
un univers virtualis aux infinies possibilits o lengagement du corps est
devenu obsolte. Tlprsence, tlactivit, cybersex, la prothse
technologique appelle la disparition des organes des sens. De l ces tres
qui ne sont pas amputs mais dont les yeux, la bouche et en partie le nez
ont disparu suivant un processus qui semble parfaitement naturel, la peau
ayant repris ses droits sur des orifices devenus inutiles. Ce constat
terrifiant soustendent la ncessaire rappropriation du corps face au corps
virtuel et bouleverse les conventions du portrait. La vision de la peau se
substitue celle du visage. Aziz et Cucher ont t forms par les travaux
dartistes comme Beuys ou Kosuth mme si leur production artistique est
trs diffrente ils revendiquent lapport de Debord, Baudrillard et Barthes
et prsentent leur travail comme anthropologique parce quil interroge la
culture contemporaine.
Troisime partie : la tentation du pouvoir. Le portrait est toujours une lutte
contre la mort, contre loubli. Que ce soit dans les pratiques populaires ou
les portraits officiels des gouvernants limage est l comme une preuve
dexistence, daffirmation sociale voire politique. De l les poses
convenues et strotypes des rois, des papes puis des prsidents, de l
labondance de signes comme emblmes de la fonction. Les
reprsentations du chef de ltat franais, en 1940, rompent avec
linsignifiance des photographies des prsidents de la IIIe rpublique. la
froideur, la faiblesse et limpersonnalit de la rpublique dfunte
liconographie vichyssoise substitue limage dun chef qui incarne le vrai
visage de la France et regarde chaque Franais dans les yeux. De l le
plan trs rapproch (totalement exclu jusqualors dans liconographie
prsidentielle) dun visage labour de rides, au sourire triste du
Marchal-Christ toujours prt au sacrifice de sa personne.
De Gaulle, en 1958, renoue avec la tradition de la IIIe rpublique : la main
pose sur un livre, il substitue seulement au fond neutre, la bibliothque
que Pompidou et Mitterrand conserveront. Lapparition de la couleur ne
modifie en rien les codes du portrait officiel dfinis la Renaissance.
(Philippe Il dEspagne a la main sur une table dans une pose qui restera
immuable dans les portraits de prsident jusqu Georges Pompidou.) La
Rpublique ne chercha pas inventer mais prenniser une forme qui
navait rien de rpublicain. Giscard dEstaing, le premier, fait appel un
photographe connu : Jacques-Henri Lartigue. Le prsident, en costume de
ville, sans autre attribut de sa fonction que la lgion dhonneur pose sur
fond tricolore. Laspect dcontract du personnage, par opposition au
maintien trs compass de De Gaulle et de Pompidou, le choix du plein-air
ensoleill composent une image aux allures publicitaires. Le prsident au
teint hl sourit et semble sortir dun clip vantant son septennat.
Mitterrand, avec Gisle Freund pour photographe, renoue avec la tradition.
La bibliothque comme fond est rintroduite, Gisle Freund ne ralise pas
une photographie dauteur mais se plie aux codes du genre. Bettina
Rheims, pour Chirac, rompt avec limmobilisme de ses prdcesseurs .
Chirac semble attendre ses invits devant le palais prsidentiel mais il ne
sait que faire de son corps qui penche vers la gauche comme sil voulait
ostensiblement sortir du cadre. Son sourire contraint renvoie lesthtique
du reportage tlvis.
Sans vouloir tre exhaustif thique-Esthtique-Politique rassemble des
points de vue et surtout offre au lecteur outre un texte de Paul Vinlio :
Des apparences la transparence des travaux de photographes souvent
peu ou mal connus en France que nous navons pas tous voqus comme
Jeff Wall ou Sigmar Polke. Dans le flot des images vnementielles dun
prsent instantan que diffusent les mdias les images et les textes
tentent de donner sens un contenu difficilement cernable, de cibler les
enjeux et de montrer les limites et les infinies possibilits du mdia.
Vous aimerez peut-être aussi
- Fiche de lecture illustrée - Cannibale, de Didier DaeninckxD'EverandFiche de lecture illustrée - Cannibale, de Didier DaeninckxPas encore d'évaluation
- Carnet de Visite Du Camp Des MillesDocument8 pagesCarnet de Visite Du Camp Des MillesMadame B.Pas encore d'évaluation
- Images et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophoneD'EverandImages et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophonePas encore d'évaluation
- Enzo Traverso - Mélancolie de Gauche-La Découverte (2016)Document161 pagesEnzo Traverso - Mélancolie de Gauche-La Découverte (2016)William Blanc100% (1)
- Hirsch Images RescapéesDocument22 pagesHirsch Images Rescapéeseva charbitPas encore d'évaluation
- En première ligne: Le journalisme au cœur des conflitsD'EverandEn première ligne: Le journalisme au cœur des conflitsPas encore d'évaluation
- Les Misérables de Victor Hugo: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Misérables de Victor Hugo: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Entre Tien Avec Boris Cy Rul NikDocument4 pagesEntre Tien Avec Boris Cy Rul Nikelmine.moralesPas encore d'évaluation
- Le Dossier Complet Du Point Sur Laffaire Arendt en PDFDocument5 pagesLe Dossier Complet Du Point Sur Laffaire Arendt en PDFRogério Mattos100% (1)
- Germinal de Zola - Partie V, chapitre 5: Commentaire de texteD'EverandGerminal de Zola - Partie V, chapitre 5: Commentaire de textePas encore d'évaluation
- Cahiers Du Cinema - Alain Resnais Memoire-Shoah PDFDocument6 pagesCahiers Du Cinema - Alain Resnais Memoire-Shoah PDFLuis UgazPas encore d'évaluation
- David OlereDocument4 pagesDavid OlereboutsaPas encore d'évaluation
- Art Memorialisation (Paris 2013)Document13 pagesArt Memorialisation (Paris 2013)CaterinaPredaPas encore d'évaluation
- Cahiers de Chantilly n°10: Etudes d'histoire et d'art du sud de l'OiseD'EverandCahiers de Chantilly n°10: Etudes d'histoire et d'art du sud de l'OisePas encore d'évaluation
- Birth and Death in Nineteenth-Century French CultureDocument261 pagesBirth and Death in Nineteenth-Century French CultureMJ44MJPas encore d'évaluation
- Cannibale de Didier Daeninckx (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandCannibale de Didier Daeninckx (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- Antimaçonnisme, Francs-maçons et Résistance dans le Midi toulousain: De la persécution à la reconstruction des loges (1940-1945)D'EverandAntimaçonnisme, Francs-maçons et Résistance dans le Midi toulousain: De la persécution à la reconstruction des loges (1940-1945)Évaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Copie de Copie de Copie de Sujet D'argu FRDocument3 pagesCopie de Copie de Copie de Sujet D'argu FRViolette 1Pas encore d'évaluation
- 3-Bibliographieducours de LINDEPERGDocument4 pages3-Bibliographieducours de LINDEPERGJean CostaPas encore d'évaluation
- Les Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLes Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les Justes de Camus - Acte II (Commentaire de texte): Document rédigé par Natacha CerfD'EverandLes Justes de Camus - Acte II (Commentaire de texte): Document rédigé par Natacha CerfPas encore d'évaluation
- Les Tabous de L'harassement Sexuel Aux ColoniesDocument11 pagesLes Tabous de L'harassement Sexuel Aux ColoniesVictor E RosezPas encore d'évaluation
- Problématiques identitaires et discours de l'exil dans les littératures francophonesD'EverandProblématiques identitaires et discours de l'exil dans les littératures francophonesÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Taouchichet Sofiane 2015 These PDFDocument596 pagesTaouchichet Sofiane 2015 These PDFMădălina IovuPas encore d'évaluation
- L' Amérique selon Sartre: Littérature, philosophie, politiqueD'EverandL' Amérique selon Sartre: Littérature, philosophie, politiquePas encore d'évaluation
- Art ContempoDocument15 pagesArt ContempoLizzy YuPas encore d'évaluation
- Marie Monique Robin Escadrons de La Mort PDFDocument231 pagesMarie Monique Robin Escadrons de La Mort PDFKouadio yao armandPas encore d'évaluation
- Lhomme 21975Document13 pagesLhomme 21975Marc JacquinetPas encore d'évaluation
- Les Cahiers dessinés (Paris - 2015): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandLes Cahiers dessinés (Paris - 2015): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Marges 06 - Art Et EthnographieDocument73 pagesMarges 06 - Art Et EthnographieIla BadaPas encore d'évaluation
- L'Écriture ou la Vie de Jorge Semprun (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandL'Écriture ou la Vie de Jorge Semprun (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Vidal Naquet Pierre Les Assassins de La MémoireDocument120 pagesVidal Naquet Pierre Les Assassins de La MémoireAkagami Shanks100% (1)
- La COMMUNAUTE DU DEHORS: Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (XIXe-XXe siècle)D'EverandLa COMMUNAUTE DU DEHORS: Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (XIXe-XXe siècle)Pas encore d'évaluation
- Le carnet d'or de Doris Lessing: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"D'EverandLe carnet d'or de Doris Lessing: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"Pas encore d'évaluation
- Art 1 - Parisiennes Citoyennes - Leurs Luttes Oubliées Sortent Enfin de L'ombreDocument10 pagesArt 1 - Parisiennes Citoyennes - Leurs Luttes Oubliées Sortent Enfin de L'ombrecassandra.demaisPas encore d'évaluation
- L'ere Du Temoin PDFDocument94 pagesL'ere Du Temoin PDFDiego Ferreyra100% (3)
- Jacques Ranciere Le Destin Des Images PaDocument5 pagesJacques Ranciere Le Destin Des Images PaLuiza VasconcellosPas encore d'évaluation
- Le petit chat de porcelaine: Préface d'Yvette LévyD'EverandLe petit chat de porcelaine: Préface d'Yvette LévyPas encore d'évaluation
- La MODE SAUVERA-T-ELLE CENDRILLON? AUTOUR DE TROIS ROMANS ET D QUELQUES TABLEAUX: Autour de trois romans et de quelques tableauxD'EverandLa MODE SAUVERA-T-ELLE CENDRILLON? AUTOUR DE TROIS ROMANS ET D QUELQUES TABLEAUX: Autour de trois romans et de quelques tableauxPas encore d'évaluation
- Genre, Modernise Et Culture de Masse Dans La Nouvelle VagueDocument16 pagesGenre, Modernise Et Culture de Masse Dans La Nouvelle VagueAlice in FursPas encore d'évaluation
- Garage Olimpo RubensteinDocument11 pagesGarage Olimpo RubensteinJohan SébastienPas encore d'évaluation
- Dada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandDada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Néoréalisme: Rome Ville Ouverte Païsa Sciuscia Le Voleur de BicycletteDocument4 pagesLe Néoréalisme: Rome Ville Ouverte Païsa Sciuscia Le Voleur de BicyclettelaughtersassassinsPas encore d'évaluation
- Marginalia 90Document42 pagesMarginalia 90Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- La Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLa Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Photographie HumanisteDocument6 pagesLa Photographie HumanistelabiosoPPas encore d'évaluation
- Le PARTAGE DE L'INTIME: Histoire, esthétique, politique: cinémaD'EverandLe PARTAGE DE L'INTIME: Histoire, esthétique, politique: cinémaPas encore d'évaluation
- Paroles de Jacques Prévert (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandParoles de Jacques Prévert (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Enjeux interculturels des médias: Altérités, transferts et violencesD'EverandEnjeux interculturels des médias: Altérités, transferts et violencesMichèle GarneauPas encore d'évaluation
- La Tentation Littéraire de L'art Contemporain. Pascal Mougin (Sous La Direction)Document38 pagesLa Tentation Littéraire de L'art Contemporain. Pascal Mougin (Sous La Direction)FLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Forme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFDocument424 pagesForme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Le Film Comme Contexte D'inscription de L'art - RIVADENEIRA GabrielaDocument9 pagesLe Film Comme Contexte D'inscription de L'art - RIVADENEIRA GabrielaFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Penser en Images, ZYGOURIS RadmilaDocument9 pagesPenser en Images, ZYGOURIS RadmilaFLAKUBELA100% (1)
- Forme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFDocument424 pagesForme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- SCEMAMA Celine - Histoires Du Cinéma - GodardDocument33 pagesSCEMAMA Celine - Histoires Du Cinéma - GodardFLAKUBELA100% (1)
- Forme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFDocument424 pagesForme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Penser en Images, ZYGOURIS RadmilaDocument9 pagesPenser en Images, ZYGOURIS RadmilaFLAKUBELA100% (1)
- Hilliot Dana Professionels Versus AmateursDocument57 pagesHilliot Dana Professionels Versus AmateursFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- L'HERNE Cahier N 31 Beckett PDFDocument5 pagesL'HERNE Cahier N 31 Beckett PDFFLAKUBELA0% (1)
- Rivadeneira Gabriela - LE FILM COMME CONTEXTE D'INSCRIPTION DE L'ART - IntroduccionDocument37 pagesRivadeneira Gabriela - LE FILM COMME CONTEXTE D'INSCRIPTION DE L'ART - IntroduccionFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Resumé These 2015-10-20Document2 pagesResumé These 2015-10-20FLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Penser Limage SommaireDocument12 pagesPenser Limage SommaireFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- L'univers Filmique (1953)Document17 pagesL'univers Filmique (1953)FLAKUBELA100% (3)
- De L'archaïque Au Commencement La Pensée Du Dessin Chez Joseph BeuysDocument15 pagesDe L'archaïque Au Commencement La Pensée Du Dessin Chez Joseph BeuysFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- L-Espace Conduit-Il Au Paradis. Sur L-Exposition Des MotsDocument25 pagesL-Espace Conduit-Il Au Paradis. Sur L-Exposition Des MotsFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Daniel Arasse Le Regard de LescargotDocument11 pagesDaniel Arasse Le Regard de LescargotFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Mémoire, Lieux Et Invention Spatiale Dans La Peinture Italienne Des XIIIe Et XIVe SièclesDocument24 pagesMémoire, Lieux Et Invention Spatiale Dans La Peinture Italienne Des XIIIe Et XIVe SièclesFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- L'analyse Des Films PDFDocument117 pagesL'analyse Des Films PDFFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- ZIZEK La Subjectivation Politique Et Ses VicissitudesDocument36 pagesZIZEK La Subjectivation Politique Et Ses VicissitudesToukanphPas encore d'évaluation
- BAECQUE de AntoineDocument28 pagesBAECQUE de AntoineFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Le Cinéma Pour Solde de Tout Compte (De L'art)Document6 pagesLe Cinéma Pour Solde de Tout Compte (De L'art)andreacirlaPas encore d'évaluation
- José Moure Du Silence AuDocument15 pagesJosé Moure Du Silence Auze_n6574Pas encore d'évaluation
- 1983 Diegese Et EnontiationDocument35 pages1983 Diegese Et EnontiationFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Utopies Et Dystopies de La Transparence. Eisenstein, Glass House, Et Le Cinématisme de L'architecture de VerreDocument30 pagesUtopies Et Dystopies de La Transparence. Eisenstein, Glass House, Et Le Cinématisme de L'architecture de VerreFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Becker - Double Sens OutsiderDocument10 pagesBecker - Double Sens OutsiderFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- La Lutte Pour La Reconnaissance Économie Du DonDocument37 pagesLa Lutte Pour La Reconnaissance Économie Du DonFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- Sur La TraductionDocument68 pagesSur La TraductionFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- 09vueschema PDFDocument5 pages09vueschema PDFBaptiste BastianelloPas encore d'évaluation
- FACGDocument15 pagesFACGserrar ahmedPas encore d'évaluation
- La Grammaire Est Une Chanson Douce PDF - 6Document3 pagesLa Grammaire Est Une Chanson Douce PDF - 6kewugev0% (1)
- Chapitre 2 La Polarisation ProvoquéeDocument30 pagesChapitre 2 La Polarisation ProvoquéeHiba Fg100% (2)
- TD Suite Smai 1Document7 pagesTD Suite Smai 1PHPPas encore d'évaluation
- Fiche - Pedagogique - La Fete Du TravailDocument4 pagesFiche - Pedagogique - La Fete Du TravailCriss SabinaPas encore d'évaluation
- 2021 09 14 Le Marche Du Tatouage FranceDocument53 pages2021 09 14 Le Marche Du Tatouage FranceMaxime LELARGE JESTIN100% (2)
- Doubleroledes ROSDocument17 pagesDoubleroledes ROSFG FirstgraphicPas encore d'évaluation
- Pièce 9.2 - MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIFDocument2 pagesPièce 9.2 - MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIFPatrick Vivian NGOAMBEPas encore d'évaluation
- Formulaire Demande D'attestationDocument2 pagesFormulaire Demande D'attestationRamo MoraPas encore d'évaluation
- Outil Sens Des Responsabilites 1Document1 pageOutil Sens Des Responsabilites 1Anonymous RuB6o4Pas encore d'évaluation
- Ouail Arab - Thérapeutique (Tableau)Document7 pagesOuail Arab - Thérapeutique (Tableau)Ami InaPas encore d'évaluation
- PuissanceDocument2 pagesPuissanceFatima MarzoukiPas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2021-10-25 À 18.29.57Document1 pageCapture D'écran . 2021-10-25 À 18.29.57Guillaume MartinezPas encore d'évaluation
- Capes Ext 2011Document67 pagesCapes Ext 2011Chasa ZigoPas encore d'évaluation
- Dysfonctionnement Visuo-Spatial Chez L - EnfantDocument13 pagesDysfonctionnement Visuo-Spatial Chez L - EnfantNico Michou-SaucetPas encore d'évaluation
- Devis Des Projets 16fevDocument3 pagesDevis Des Projets 16fevboukar BrahimPas encore d'évaluation
- George.R.R.martin. .Le - Trone.de - Fer.14.Les - Dragons.de - MeereenDocument258 pagesGeorge.R.R.martin. .Le - Trone.de - Fer.14.Les - Dragons.de - MeereentheodorePas encore d'évaluation
- BeaccoDocument9 pagesBeaccoFaiza CréatricePas encore d'évaluation
- La Vulgarisation ScientifiqueDocument4 pagesLa Vulgarisation ScientifiqueboujghaghPas encore d'évaluation
- Chapitre 02 Analyse Vibratoire (3emme Partie)Document4 pagesChapitre 02 Analyse Vibratoire (3emme Partie)Yahiyaoui SofyanePas encore d'évaluation
- Arch3 Isbk C3 18 Brevet-Sujet3Document6 pagesArch3 Isbk C3 18 Brevet-Sujet3alexandra.morand.amPas encore d'évaluation
- Lesalgorithmes ArithmétiquesDocument9 pagesLesalgorithmes ArithmétiquesPROF PROFPas encore d'évaluation
- Les 7Document13 pagesLes 7nkeevensPas encore d'évaluation
- Cours1 javaFX RosemontDocument15 pagesCours1 javaFX RosemontdfsfdPas encore d'évaluation
- Amelioration de Temps de ChangDocument95 pagesAmelioration de Temps de ChangmarouaPas encore d'évaluation
- Familles LogistiquesDocument134 pagesFamilles LogistiquesSultan KamalPas encore d'évaluation
- Essec Tunis - Essec Tunis - Liste Des EnseignantsDocument7 pagesEssec Tunis - Essec Tunis - Liste Des Enseignantsapi-326876130Pas encore d'évaluation
- DCG 2019 CorrigéDocument2 pagesDCG 2019 CorrigécecilePas encore d'évaluation
- Manuel IchrakDocument21 pagesManuel IchrakMonta GadhgadhiPas encore d'évaluation