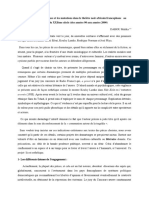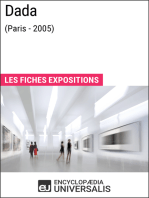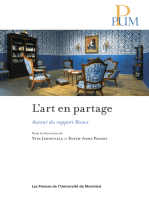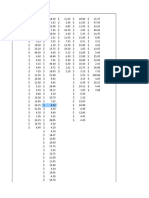Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Genre, Modernise Et Culture de Masse Dans La Nouvelle Vague
Transféré par
Alice in FursTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Genre, Modernise Et Culture de Masse Dans La Nouvelle Vague
Transféré par
Alice in FursDroits d'auteur :
Formats disponibles
Genre, modernisme et culture de masse dans la Nouvelle Vague
Author(s): Geneviève Sellier
Source: Nouvelles Questions Féministes , 2003, Vol. 22, No. 1, Discipline / Indiscipli ne
(2003), pp. 97-111
Published by: Nouvelles Questions Féministes & Questions Feministes and Éditions
Antipodes
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/42900611
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Nouvelles Questions Féministes & Questions Feministes and Éditions Antipodes are collaborating
with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Nouvelles Questions Féministes
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Genre, modernisme
et culture de masse
dans la Nouvelle Vague1
Geneviève Sellier
Rompant avec l'approche esthétique privilégiée jusqu'ici pour étudi
la Nouvelle Vague (y compris dans les études anglo-américaines), je
drais analyser le cinéma de la Nouvelle Vague au tournant des années
dans une perspective d'histoire des représentations pour tenter de com
prendre la nature et les enjeux du renouvellement provoqué par l'arri
massive d'une nouvelle génération de cinéastes entre 1957 et 1962. Cet
périodisation se justifie sur le plan de l'histoire du cinéma, en termes
politique et de production2 et en termes de réception3.
Environ 150 cinéastes font un premier film distribué commercial
ment pendant ces six années (ce qui représente une moyenne de 30 pa
contre une moyenne de 15 dans les années précédentes); parmi eux
une femme (Agnès Varda a fait son premier long-métrage, La po
courte, en 1954), ce qui indique l'absence totale de lien, dans ce champ
cette époque, entre renouvellement créateur et émergence des femmes
La Nouvelle Vague s'inscrit dans l'histoire culturelle française com
un moment fort de légitimation d'un nouveau moyen d'expression ar
tique : malgré son mode de production et de consommation qui l'appar
à une industrie, le cinéma va accéder officiellement, comme en témoi
l'instauration de la prime à la qualité puis de l'avance sur recettes, au
d'art à part entière. De jeunes créateurs ont su plier cet instrument à
exigence de liberté individuelle qui est, depuis le romantisme, une con
tion nécessaire sinon suffisante à la reconnaissance de ce statut. La Nou-
velle Vague se manifeste comme une révolte déjeunes turcs contre la «tra-
dition de qualité» - cette production filmique qui tente de mettre à la
portée du plus grand nombre le patrimoine culturel - au nom d'une capa-
cité créatrice innovante qui se moque des règles académiques. Elle reven-
3. Début de la baisse de fréquentation; substitu-
1 . Une version anglaise de ce texte est disponible
dans Alex Hughes and James S. Williams tion (Eds)des films américains aux films français en
tête du box-office; premier bilan critique de la
(2001). Gender and French Cinema. London: Berg.
2. Entrée en vigueur de la prime à la qualité Nouvelle
en Vague fin 1962 dans les Cahiers du
1956, puis de l'avance sur recettes en 1959 ; forte
Cinéma et dans Positif.
augmentation du nombre des premiers films jus-
qu'en 1962.
NQF Vol. 22, No 1 / 2003 | 9 7 .
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
dique la légitimité d'un point de vue individuel contre l'instance patriar-
cale collective qui sous-tendait le cinéma comme culture de masse. La
plupart de ces films se différencient en effet du cinéma «populaire» de
l'époque, par la présence d'un personnage masculin à partir duquel se
construit le point de vue dominant du film. Comme dans la tradition
romantique du roman d'apprentissage, il s'agit la plupart du temps d'un
jeune homme, sorte d'alter ego de l'auteur, avec lequel le spectateur va
établir une relation d'empathie.
Michelle Coquillat (1982 : 295-318) a montré que le romantisme rece-
lait, depuis son précurseur le plus célèbre, l'auteur de La Nouvelle Héloïse
(Jean- Jacques Rousseau, 1761), une revendication d'auto-engendrement
de la part d'artistes qui associent ontologiquement création et masculinité,
alors que les femmes sont définies du côté de la contingence, de la nature,
de la reproduction. L'artisan humblement soumis aux règles du Beau cède
la place au penseur inspiré, au prophète solitaire, qui n'accepte plus
comme lien social que la fraternité des artistes. Cette valorisation de la
singularité individuelle par rapport aux hiérarchies sociales et à l'environ-
nement collectif s'exprime dans la plupart des grands textes romantiques4
par l'articulation entre le destin tragique du héros masculin et son
«engluement» dans l'amour d'une femme qui lui fait perdre sa capacité
créatrice, ou plus largement sa capacité à être lui-même. Cette dimension
«ontologiquement» misogyne du romantisme (qui s'exprime paradoxale-
ment à travers des personnages féminins très émouvants...) établit un rap-
port d'exclusion entre construction de l'identité masculine et lien amou-
reux avec une femme, et se retrouvera dans la plupart des films de la
Nouvelle Vague, avec la même tonalité tragique qui donne cette exclusion
comme une fatalité.
Mais pour éclairer la tradition culturelle dont se réclame la Nouvelle
Vague, il faut aussi faire référence à la manière dont le champ de la créa-
tion artistique s'est structuré en France, depuis le milieu du XIXe siècle.
Andreas Huyssen (1986: 44-62) remarque à propos de l'invention du
modernisme littéraire par Flaubert, que cette nouvelle posture créatrice
tend à opposer le «mauvais objet» qu'est la culture de masse consommée
par les femmes, au «bon objet» qu'est la culture «authentique» créée par
des artistes masculins. On se souvient du goût d'Emma Bovary pour ce
que nous appellerions aujourd'hui les «romans de gare» :
4. Le Rouge et le Noir (Stendhal, 1830), Le Lys
dans la vallée (Honoré de Balzac, 1836), La
Confession d'un enfant du siècle (Alfred de Mus-
set, 1836), Ruy Blas (Victor Hugo, 1838), La Mai-
son du berger (Alfred de Vigny, 1843).
98.1 NQF Vol. 22, No 1 / 2003
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Édito I Grand angipW^BiiWTmra Parcours | Comptes rendus | Collectifs
Genre, modernisme et culture de masse dans la Nouvelle Vague
Geneviève Sellier
«Ce n'étaient qu'amours, amants, amantes, dames persécutées s' évanouissan
dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux
qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, san
glots, larmes, et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets,
messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme
on ne l'est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes. »
(Flaubert, 1966 [1847]: 71)
Cette description ironique fait irrésistiblement penser au cinéma popu-
laire d'avant la Nouvelle Vague, en particulier aux genres destinés de
façon privilégiée au public féminin, mélodrames et comédies sentimen-
tales, ou woman's films américains.
Au contraire, les œuvres qui se réclament du modernisme se caractéri-
sent, selon Huyssen, par leur auto-référentialité ; elles se veulent l'expres-
sion d'une conscience purement individuelle, et non pas de l'air du temps
ou d'un imaginaire collectif; elles ambitionnent d'être expérimentales au
même titre qu'une recherche scientifique ; elles élaborent le langage dans
lequel elles s'expriment et rejettent les systèmes classiques de représenta-
tion, remettent en cause la primauté du contenu, la vraisemblance, et le
réalisme. Elles sont hostiles à la fois à la culture bourgeoise du quotidien et
à la culture de masse du divertissement5.
Les Cahiers du Cinéma, en mettant l'accent, à propos de films issus de
la culture de masse américaine, sur les aspects les plus abstraits de leur
mise en scène, leur «écriture», sans s'attacher aucunement au contexte
socioculturel dans lequel ils ont été produits et consommés, ni à ce dont
parlent ces films, ont été le laboratoire de ce regard moderniste sur le
cinéma, regard distancie que les films les plus novateurs de la Nouvelle
Vague tenteront de mettre en pratique. Ce sera aussi l'image de marque
d'un certain Nouveau Roman, en particulier chez l'auteur le plus «visible»
de cette mouvance hétérogène, Alain Robbe-Grillet.
Cependant, mise à part la collaboration d'Alain Resnais avec Robbe-
Grillet pour L'Année dernière à Marienbad (1960), le modernisme au
cinéma à cette époque se différencie de celui qui émerge en littérature, et
d'abord, pour reprendre les termes du célèbre article d'Alexandre Astruc
(1992 [1948]: 324-327) sur la «caméra stylo», parce que «le cinéma est
simplement en train de devenir un moyen d'expression, ce qu'ont été tous
les autres arts avant lui, ce qu'ont été en particulier la peinture et le roman.
5. Huyssen (1986) définit en revanche l'avant-ont témoigné, avant d'être liquidés par le fas-
garde comme une tentative de remettre en cause cisme, le stalinisme ou par la guerre, les avant-
l'opposition entre haute et basse culture dont legardes en France, en Allemagne ou en URSS dans
modernisme se nourrit, et d'articuler l'art et la les années 20.
politique, l'art et la vie quotidienne, comme en
NQF Vol. 22, No 1 / 2003 | 99.
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Après avoir été successivement une attraction foraine, un divertissement
analogue au théâtre de boulevard, ou un moyen de conserver les images
de l'époque, il devient peu à peu un langage. »
Ce texte, qu'on peut considérer comme le véritable manifeste du
modernisme au cinéma, est sous-tendu par l'opposition entre culture de
masse et création individuelle. Mais le cinéma comme art en est à sa pré-
histoire : la première étape est l'affirmation de la subjectivité du créateur
contre les conventions des productions culturelles collectives, «ce qui
implique, bien entendu, que le scénariste fasse lui-même ses films. Mieux,
qu'il n'y ait plus de scénaristes, car dans un tel cinéma cette distinction de
l'auteur et du réalisateur n'a plus aucun sens. La mise en scène n'est plus
un moyen d'illustrer ou de présenter une scène, mais une véritable écriture.
L'auteur écrit avec sa caméra comme un écrivain écrit avec un stylo. »
Les cinéastes de la Nouvelle Vague mettront en avant à la fois leur
subjectivité et leur écriture pour s'affirmer comme créateurs. La contradic-
tion n'est qu'apparente entre ces deux postures, romantique et moderniste,
comme en témoignent, par exemple, Tirez sur le pianiste (François Truf-
faut, 1960) ou Le Petit Soldat (Jean-Luc Godard, 1960-63). Mais c'est sans
doute la combinatoire de ce double héritage culturel qui fait l'originalité
de la Nouvelle Vague.
Tirez sur le pianiste choisit un mode d'écriture moderniste6 pour
construire le point de vue d'une subjectivité masculine blessée. Les rup-
tures de ton et le mélange des genres, qui sont l'apport personnel de Truf-
faut au roman noir de David Goodis, créent une connivence avec le public
cultivé sans remettre en cause le rapport empathique avec le héros malheu-
reux: Charles Aznavour avec sa «laideur intéressante», sa petite taille et
son allure de chien battu, à quoi s'ajoute la timidité maladive du person-
nage, son mutisme et sa carrière brisée de virtuose, propose la figure idéale
d'une masculinité vulnérable. La structure cyclique du récit autour de deux
catastrophes, la première étant rejetée dans l'avant du récit, confirme
l'inexorabilité de son destin tragique. Le film associe la grande musique
(celle de l'élite cultivée) à laquelle le héros a dû renoncer et une forme
archaïque de musique populaire, celle des cafés-concerts - aux antipodes
de la culture de masse - où le héros est associé à Bobby Lapointe, chan-
teur à texte adepte du non-sens, apprécié des couches cultivées. Pianiste
virtuose issu d'un milieu populaire (dont sa timidité maladive est la trace),
le héros de Tirez sur le pianiste incarne la figure idéale de l'artiste selon la
Nouvelle Vague : il s'est fait tout seul et renonce à sa carrière plutôt que de
se compromettre avec les milieux bourgeois (l'imprésario). Figure sacrifi-
cielle aux antipodes de la réalité de nos jeunes cinéastes, qui, eux, en prag-
6. L'œuvre de Truffaut se caractérise par le prin- fondés sur l'empathie romantique et variations
cipe de l'alternance contrastée, entre projets «per- plus modernistes, les deux ne se recoupant pas
sonnels » et films plus « commerciaux », entre récits forcément.
1 00. | NQF Vol. 22, No 1 / 2003
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Édito I Grand angle W^^Mffffii Parcours | Comptes rendus | Collectifs
Genre, modernisme et culture de masse dans la Nouvelle Vague
Geneviève Sellier
matiques, ont utilisé toutes les facilités offertes par leur origine sociale ou
leurs alliances matrimoniales pour parvenir à réaliser leurs films...
Les deux personnages féminins du film sont les instruments objectifs
des catastrophes qui s'abattent sur le héros ; la jeune épouse d'abord (Nicole
Berger) dont l'origine modeste (elle était serveuse dans un restaurant) en
fait une proie facile pour l'imprésario cynique, tout en l'empêchant de par-
tager les émotions artistiques de son mari ; son suicide est montré du point
de vue du héros, comme une tragédie qui brise sa vie et sa carrière. L'admi-
ratrice ensuite (Marie Dubois) qui, par le fait même qu'elle aime le héros,
l'entraîne dans les pires complications (dont elle sera finalement victime,
mais sa mort est montrée comme l'accomplissement d'une fatalité). La
femme aimée, qu'elle soit capable ou non de comprendre l'artiste, se révèle
ainsi l'instrument (inconscient) de son échec: dans la plus pure tradition
romantique, le lien amoureux est en soi un obstacle à l'épanouissement de
l'artiste, et plus largement, un obstacle à l'épanouissement de l'identité
masculine, comme on le trouve dans la plupart des films de la Nouvelle
Vague centrés sur un personnage masculin, de Ascenseur pour l'échafaud
(Louis Malle, 1957) à Les Cousins (Claude Chabrol, 1958), À bout de souffle
(Godard, 1959) et Paris nous appartient (Jacques Rivette, 1958-61).
Les films, minoritaires, qui prennent comme protagoniste principal un
personnage féminin, ne contredisent pas ces hypothèses : le point de vue
passe encore, implicitement ou explicitement, par un personnage masculin
qui correspond largement aux caractéristiques du héros romantique (Lola,
La Baie des Anges, Jacques Demy, 1960 et 1963 ; Jules et Jim, Truffaut,
1962). Mais les histoires de femme(s) peuvent aussi se construire dans un
registre «sociologique» où l'auteur décrit son personnage de l'extérieur,
sans en faire une instance de conscience, mais plutôt l'expression d'une
condition (la prostituée dans Vivre sa vie, Godard, 1962; les employées
dans Les Bonnes Femmes, Chabrol, 1960), dans la grande tradition ouverte
par Flaubert avec Madame Bovary (Mulvey et MacCabe, 1989).
Cleo de 5 à 7 (Varda, 1962) et Hiroshima mon amour (Marguerite
Duras et Resnais, 1959) sont les deux seuls films de cette génération de
créateurs qui tentent de construire un personnage féminin comme une ins-
tance de conscience avec qui le spectateur peut s'identifier. Ce sont aussi
les deux seuls films écrits et/ou réalisés par une femme-
Héritage flaubertien chez Chabrol
Le quatrième film de Claude Chabrol, Les Bonnes Femmes, est sans
doute l'exemple le plus abouti de la posture moderniste construite sur deux
pôles opposés : le regard d'un créateur masculin sur un féminin aliéné. Le
cinéaste filmant quatre vendeuses d'un magasin d'électroménager à Paris
revendique une objectivité sociologique pour décrire les divers aspects de la
«condition féminine» populaire dans le Paris contemporain (Chabrol, 1976).
NQF Vol. 22, No 1 / 2003 | 101 .
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Mais Chabrol ne s'en tient pas à un regard «sociologique»: dès la
première scène, dans un Paris nocturne filmé avec toute la modernité de la
Nouvelle Vague, on sent une véritable jubilation de l'auteur à souligner la
grossièreté de deux dragueurs d'âge mûr en décapotable blanche qui
«lèvent» Bernadette Lafont et Clotilde Joano, les emmènent au restaurant
puis au cabaret, en espérant finir la soirée au lit, ce qui se réalisera au
moins avec Bernadette Laffont. L'insistance sur le grotesque des person-
nages et le dérisoire des situations marquent l'ensemble du film, qui suit
les quatre jeunes filles dans leur travail et leurs loisirs pendant quarante-
huit heures. Après une journée de travail interminable dans l'ennui du
magasin, une deuxième soirée au music-hall, puis à la piscine, permet de
dessiner les limites dérisoires de leur monde et de leurs aspirations.
Mais le sommet de la dérision est atteint avec l'intrigue faussement
romantique dont Clotilde Joano, visage de madone triste, est l'objet. Le film
introduit un suspense dès le début avec un personnage de motard flamboyant
amoureux transi, joué par Mario David, qui la suit partout sans l'aborder jus-
qu'au moment où, à la piscine, il la protège contre les deux dragueurs deve-
nus agressifs. Une virée romantique à la campagne, parodie explicite de
romans-photos, se termine par un crime sadique. L'amoureux romantique
était un pervers ! Il étrangle la jeune femme alors qu'elle se donne à lui.
Si le cinéaste réserve ses traits les plus acérés aux hommes dont ces
jeunes filles sont immanquablement les victimes, le spectateur est placé en
situation de supériorité par rapport à ces jeunes femmes qui ne paraissent
pas avoir la moindre conscience de leur situation. Et le fait de ne leur donner
le choix qu'entre de minables dons Juans, un petit bourgeois ridicule ou un
psychopathe, témoigne de la dimension manipulatrice du film. Comme Flau-
bert, Chabrol n'adopte pas le même ton selon que ces «héros» sont des
jeunes gens peu ou prou ses alter ego, aptes à susciter l'empathie du specta-
teur, comme dans Le Beau Serge ou Les Cousins, ses deux premiers films ;
quand ce sont des personnages féminins, elles perdent toute individualité, ce
sont des «bonnes femmes» qu'il construit, sous prétexte de décrire une alié-
nation sociale, comme des «autres» radicalement dépourvues de conscience.
Film très maîtrisé dans sa structure et son ton, Les Bonnes Femmes
reconduit comme un constat « objectif» l'équivalence entre femme et alié-
nation, dans une tradition culturelle particulièrement vivace en France
depuis le milieu du XIXe siècle.
Rozier, un regard documentaire sur le populaire aliéné
Adieu Philippine de Jacques Rozier (1960-62) raconte sur un mode
quasi documentaire, avec des acteurs non professionnels et des péripéties
réduites au minimum, les quelques mois d'un jeune appelé avant son
départ en Algérie : son travail de manutentionnaire à la télévision, puis
ses vacances en Corse avec deux copines qui se disputent ses faveurs.
102.1 NQF Vol. 22, No 1 / 2003
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Édito I Grand angle H^^Mnffil Parcours | Comptes rendus | Collectifs
Genre, modernisme et culture de masse dans la Nouvelle Vague
Geneviève Sellier
Le film adopte un point de vue ironique sur des personnages issus des
classes populaires ou moyennes, aux antipodes du populisme idéalisant du
cinéma des années 30. Le machisme du personnage masculin autour de qui
s'organise le récit est montré comme dérisoire, autant que la coquetterie
des deux « midinettes » qui entreprennent de le séduire.
Mais dans ce regard distancie qui paraît englober dans la même contin-
gence sociologique tous les personnages du film, la balance n'est pourtant pas
aussi égale qu'il y paraît. Le personnage principal, le jeune Michel, est unique,
face à ses deux conquêtes, Juliette et Liliane, montrées comme interchan-
geables (d'autant plus qu'elles se ressemblent et sont inséparables). De plus,
Michel fait un vrai travail salarié à la télévision, même s'il n'est que manuten-
tionnaire, alors que les filles sont incapables de faire aboutir leurs projets pro-
fessionnels, et le film insiste complaisamment sur leur absolue incompétence
(cf. la séquence hilarante des rushs où on les voit recommencer plusieurs fois
sans succès la même publicité pour un produit nettoyant). Enfin l'amitié indé-
fectible des deux jeunes filles, fièrement proclamée au début du récit, ne tien-
dra pas face à leur rivalité vis-à-vis de Michel, dont celui-ci joue avec une
facilité qui rend encore plus dérisoire la «personnalité» des deux filles.
Mais la différenciation « ontologique » entre le masculin et le féminin
se fait par l'utilisation de la guerre d'Algérie: le film de Rozier, réalisé
entre 1960 et 1962, à un moment où plus personne n'ignore les dangers
mortels que courent les appelés du contingent plongés pendant vingt-sept
mois dans cette «sale guerre» qui ne veut pas dire son nom, pose dès le
début du récit une épée de Damoclès sur la tête de son héros masculin : il
doit partir au service militaire dans trois mois (c'est-à-dire à la fin du film).
Le regard du spectateur sur lui en est immédiatement modifié : ce thème du
départ au service court comme un leitmotiv tout au long du film, pour rap-
peler chaque fois au spectateur qu'un garçon court des risques que les filles
ne courent pas, ce qui donne un sens complètement différent aux péripé-
ties de leur jeu de cache-cache : pour le garçon, ce sont les derniers plaisirs
avant la guerre ; pour les filles, c'est leur nature dérisoire de midinettes,
comme le leur rappelle Michel lui-même dans la voiture à la fin (avec des
gros plans empathiques qui tranchent avec le reste du film). La guerre
d'Algérie n'est pas évoquée ici d'un point de vue politique, mais elle est
instrumentalisée comme un moyen décisif de distinguer le masculin du
féminin, au-delà d'une même appartenance aux classes populaires.
Vie privée, un règlement de comptes
Mais c'est dans le rapport des cinéastes de la Nouvelle Vague aux acteurs
et actrices, et en particulier aux plus populaires d'entre eux et elles, que se
marque le plus clairement cette «distinction» culturelle du nouveau cinéma.
Tandis qu'une Anna Karma ou une Jeanne Moreau fonctionnent chez
Malle et Godard comme la «créature» de l'auteur et sa projection érotisée
NQF Vol. 22, No 1 / 2003 | 103.
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
dans le texte, Brigitte Bardot, première star de l'ère des mass media, est un
«objet» étranger au film d'auteur.
Quand Louis Malle accepte, sur proposition de la productrice Chris-
tine Gouze-Rénal, de faire un film avec Bardot sur Bardot7, la star, qui a
fait sa carrière dans le cinéma grand public, vient de connaître ses pre-
miers déboires au box-office, et sa popularité a désormais des accents
grinçants dus à l'agressivité que suscite la liberté de ses mœurs.
Et effectivement, Vie privée se veut non pas un hommage à la star,
mais une dénonciation du caractère aliénant de cette popularité, montrée
comme typique des formes que prend la culture de masse moderne : presse
à scandales alimentée par les paparazzi, cinéma «commercial» qui table
sur la vague erotique, débordements de la vie privée des stars sur leur vie
professionnelle, etc.
Si Louis Malle et son scénariste, Jean-Paul Rappeneau, disent avoir
écrit leur scénario à partir d'une documentation sur le «phénomène B.B.»
et d'après des éléments autobiographiques fournis par la star elle-même,
la confrontation du scénario avec différentes sources biographiques et
autobiographiques (Rihoit, 1986; Bardot, 1997), fait apparaître un travail
de reconstruction sous-tendu par l'opposition (totalement absente des
sources) entre la culture d'élite, incarnée par l'éditeur d'art que joue Mar-
cello Mastroianni, co-star du film, et la culture de masse passive et alié-
née, à quoi est réduit le plus souvent le personnage joué par Bardot. La
construction du personnage féminin comme objet et non pas comme sujet
est renforcée par l'omniprésence d'une voix off masculine (la voix du
Sujet-supposé-savoir) qui commente ses faits et gestes et nous fait accéder
à ses pensées sur le mode balzacien du narrateur omniscient.
Quand un cinéaste (ou plutôt une caméra sans «auteur») repère le
caractère photogénique de cette jeune fille de bonne famille, sa carrière
est lancée, mais dans une totale passivité : elle est un instrument entre
les mains des habiles commerçants qui fabriquent sa célébrité. Toute la
première partie, marquée par un montage rapide de scènes elliptiques
qui interdisent toute identification du spectateur avec l'héroïne, reprend
sans la moindre nuance tous les poncifs sur la culture de masse, comme
produit fabriqué par la classe dominante pour tirer profit des classes
dominées. La jeune femme est une simple marchandise, jamais
consciente ni de sa beauté, ni de son éventuel talent (que le film s'at-
tache soigneusement à nier), ni des manipulations dont elle est l'objet.
La seule expression de sa liberté dans cette première partie est son utili-
sation déjeunes hommes comme objets sexuels dont elle change comme
7. Dans un geste typique du cinéma d'auteur, Private Lives, en proposant à la productrice
Louis Malle transformera radicalement le projet d'écrire avec Jean-Paul Rappeneau un scénario
initial d'adaptation d'une pièce de Noël Coward, original inspiré de la vie de BB.
1 04. | NQF Vol. 22, No 1 / 2003
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Édito I Grand angle IHiBiiWTmH Parcours | Comptes rendus | Collectifs
Genre, modernisme et culture de masse dans la Nouvelle Vague
Geneviève Sellier
de chemise8. Se profile ici un autre stéréotype, l'association du féminin à
la sexualité comme identité principale (alors que les personnages mascu-
lins dans le film ont une identité sociale et professionnelle, sinon un
talent artistique comme Mastroianni).
Le récit passe très vite sur la phase ascendante de sa carrière, et
change de rythme à partir du moment où la célébrité scandaleuse de la star
provoque des réactions agressives contre elle : le film nous la montre alors
comme un animal traqué qui tente de se rebeller contre son sort sur un
mode purement instinctif et parfaitement inefficace. Nous la voyons fina-
lement «craquer», et sa gouvernante l'emmène comme un paquet (elle est
cachée à l'arrière de la voiture sous des couvertures) vers la maison mater-
nelle, en Suisse.
Commence alors la deuxième partie du film avec la rencontre avec
Mastroianni dont le portrait nous a été fait dans le prologue, sur le mode du
génie inaccessible, dont la petite midinette d'alors était secrètement amou-
reuse. Les retrouvailles, alors qu'elle est devenue une star - et qui plus est
une star traquée - changent évidemment la donne : l'artiste fait mainte-
nant attention à elle, mais davantage sur le mode de la compassion que du
désir ou de l'amour: à aucun moment, le film ne suggère qu'il est réelle-
ment amoureux d'elle, justement parce que l'art est le centre de sa vie. Pour
elle, au contraire, la découverte de l'amour est montrée sur le mode de la
dépendance : elle ne peut plus se passer de lui et fait une tentative de sui-
cide dès qu'il la quitte pour aller travailler à sa grande œuvre. Dès le début
de leur relation, elle est donc montrée comme un obstacle objectif à l'ac-
complissement du créateur, dans la grande tradition romantique.
Toute la dernière partie du film est construite sur l'opposition entre
l'autonomie du créateur masculin et la dépendance affective de la femme
associée à la culture de masse : Mastroianni, alter ego des auteurs (Malle,
Kleist, mais aussi Fellini: Mastroianni en 1961 est auréolé du succès de La
Dolce Vita), monte Katherine de Heiïbronn de Kleist, quintessence de la
culture d'élite. Bardot, réduite au rôle de spectatrice oisive, se tuera en
tombant des toits pendant la première représentation de la pièce, pour ten-
ter d'assister au spectacle sans être vue des paparazzi qui la traquent. Sa
chute dans le vide est filmée au ralenti comme si elle planait, accompagnée
par le Requiem de Verdi, et le film se termine sur cette suspension du sens,
comme si le cinéaste ne pouvait lui accorder une dignité artistique qu'au
moment où elle meurt.
Le film de Louis Malle a eu un certain succès au box-office, mais moins
que ne l'espéraient les producteurs, et l'accueil critique a été mitigé. On a
8. A ce propos, on peut constater que les auteurspar tous les documents biographiques sur B.B. qui
du film reprennent les ragots les plus éculés de revendique
la une liberté amoureuse d'une autre
presse à scandales, bien qu'ils soient contreditstenue que ce que nous montre le début du film...
NQF Vol. 22, No 1 / 2003 | 105.
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
souvent reproché à Louis Malle, qui venait de réaliser Zazie dans le métro
d'après Queneau, de s'être trop compromis avec le cinéma commercial
(narration linéaire, gros moyens, deux stars à l'affiche), mais le film souffre
surtout, nous semble-t-il, du caractère contradictoire de son projet : le per-
sonnage féminin principal est constamment montré comme sans intérêt,
sans autonomie, sans projet, sans intelligence de sa situation (une Madame
Bovary cinématographique, mais sans la «perfection» austère de l'écriture
flaubertienne !). En revanche Mastroianni, véritable alter ego de l'auteur,
est fortement valorisé par le film, mais ce n'est pas son histoire qu'on nous
raconte. Le spectateur ou la spectatrice «populaire» est donc frustré-e dans
son désir d'identification avec l'héroïne, comme le spectateur ou la specta-
trice «cultivé-e» est frustré-e dans son désir d'identification avec l'auteur.
Le Mépris, ou les contradictions godardiennes
Godard, qui a déjà réalisé six longs métrages qui font de lui la quin-
tessence du «cinéma moderne», va également se confronter à la star en
réalisant Le Mépris en 1963 d'après le roman d'Alberto Moravia // Dis-
prezzo (publié en 1954, traduit en français en 1955). Le film, comme le
roman, raconte la désintégration d'un couple - Camille (Bardot) et Paul
(Michel Piccoli) - avec en toile de fond les milieux cinématographiques
italiens. Paul travaille à une œuvre de commande pour un producteur
américain du nom de Jeremy Prokosh (Jack Palance). Il s'agit d'une nou-
velle adaptation de L'Odyssée, tournée par Fritz Lang (interprété par lui-
même). Le «mépris» qu'éprouve Camille pour Paul, ostensiblement dû à sa
décision de travailler pour Prokosh, précipite la crise du couple, qui est
notamment racontée dans une très longue et très belle scène dans leur
appartement romain. À Capri, où toute l'équipe se déplace pour terminer
LVdyssée de Lang, Camille commence une liaison avec Prokosh. Ils par-
tent tous deux pour Rome et meurent dans un accident de voiture. Paul se
remet à l'écriture théâtrale, tandis que Lang termine son film.
L'artiste qu'incarne Mastroianni dans Vie privée est ici représenté à la
fois par Paul et Lang, qui figurent, comme le dit Piccoli, «une sorte de
monstre à deux têtes, le double de Godard» (Vimenet, 1991 : 104). Godard
lui-même fait une apparition fugitive comme assistant de Lang dans les
séquences situées à Capri. Face à cette multiple figuration du grand artiste
masculin, Camille est doublement associée au cinéma «commercial» et à
la féminité : par le fait qu'elle est incarnée par Bardot, et par la liaison de
Camille avec Prokosh. Le Mépris reproduit donc la même dichotomie entre
culture d'élite masculine et culture de masse féminine que Vie privée.
Godard cependant complique ce scénario de plusieurs manières.
Tout d'abord Godard modifie la culture savante de LVdyssée et des
grands écrivains cités par Lang (Dante, Hölderlin, Brecht), en y ajoutant
une version «noble» de la culture populaire : Raneho Notorious, Rio Bravo,
«le cinéma de Griffith et Chaplin», Rossellini. Lang représente le summum
106.1 NQF Vol. 22, No 1 / 2003
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Édito I Grand angle H^^Mnffii Parcours | Comptes rendus | Collectifs
Genre, modernisme et culture de masse dans la Nouvelle Vague
'Geneviève Sellier
de l'homme cultivé et, comme le dit Michel Marie, « la politique des auteurs
en chair et en os» (Marie, 1990: 57) permettant à Godard de placer son
propre film dans la sphère de l'Art. Paul et Lang dissertent sur la littérature,
le mythe et le cinéma. Camille, en revanche, ignore la culture savante
(L'Odyssée, c'est «l'histoire du type qui voyage») et le cinéma selon les
Cahiers du Cinéma. Elle répond «bof» lorsque Paul suggère d'aller voir Rio
Bravo. La plaisanterie de Lang sur «les deux BB» (Brigitte Bardot et Bertolt
Brecht) durant la scène au music-hall dans laquelle la musique populaire
italienne est représentée comme inauthentique et vulgaire (c'est un mau-
vais play-back, «tout juste bon pour le sud de l'Australie», dit Lang) sou-
ligne au spectateur - non sans ironie - la distance qui les sépare.
Dans Le Mépris comme dans Vie privée, féminité et société de
consommation étouffent la création masculine. Le désir qu'éprouve
Camille pour son bel appartement est la raison pour laquelle Paul « se pros-
titue» avec Prokosh. Il faut que Camille meure pour que Paul retourne à
son art véritable, le théâtre, et il faut que Camille et Prokosh meurent pour
que le «vrai» film continue. Mais contrairement au charismatique Fabio de
Vie privée, Paul est un médiocre, pris entre deux univers : il n'a ni l'aura du
grand artiste Lang, ni la vitalité du vulgaire, mais puissant Prokosh. La fin
du Mépris n'est pas non plus une affirmation triomphaliste de la grande
création (masculine) telle qu'on la trouve dans Vie privée : elle constitue, à
l'évidence, un commentaire sur «la mort du cinéma» et la fin de la civilisa-
tion occidentale (l'impossibilité de faire revivre le mythe d'Ulysse) qui va
au-delà des personnages : le dernier plan du film de Lang nous montre un
ciel bleu mais vide, sur lequel la voix de Godard prononce le mot
«silence». Il n'en reste pas moins que le métadiscours pessimiste de Godard
passe par une notion sexuée de la créativité, selon laquelle le créateur ne
peut être que mâle. Le cinéma dont Le Mépris fait le deuil est celui de Fritz
Lang, pas celui de Brigitte Bardot.
L'attitude de Godard envers Bardot est plus dialectique que celle de
Malle. Le Mépris fonctionne sur un décalage entre personnage (Camille) et
star (Bardot), alors que dans Vie privée il y a confusion entre les deux. Par
exemple, dans la logique des personnages, la décision de Camille de
rejoindre Prokosh (qu'elle méprise autant que Paul) semble inexplicable;
par contre, dans l'optique du star-système, le couple Bardot-Prokosh est
cohérent. Camille est un personnage opaque, dénué de psychologie, tandis
que Bardot apporte une profondeur visuelle, orale et sémantique. Comme
le fait remarquer Jacques Aumont (2000 [1990]) l'aura mythique de Bardot
l'associe symboliquement aux autres «dieux» du film. La dichotomie entre
personnage et star est particulièrement évidente en ce qui concerne la
représentation du corps de Bardot. Godard, comme toujours, à la fois com-
plice et critique des modes dominants de représentation des femmes (Mul-
vey et MacCabe, 1989), analyse la dimension iconique de Bardot, mais la
ramène constamment à son corps, à sa sexualité. Le corps de Bardot
devient le lieu d'une lutte entre culture d'élite (qui comprend ici le cinéma
d'auteur) et culture de masse.
NQF Vol. 22, No 1 / 2003 | 107.
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Le refus de Godard de montrer le corps nu de Bardot et l'exigence du
producteur Joe Levine que Godard rajoute des scènes dévoilant le corps de
la star, est une des causes célèbres du cinéma français. La riposte de
Godard sera d'ajouter un prologue (situé immédiatement après le célèbre
générique parlé), dans lequel Bardot détaille les différentes parties de son
corps, filmé à travers des filtres aux couleurs violentes (bleu, rouge), qui
alternent avec des plans en lumière naturelle. En transgressant de façon
aussi insolente les codes de représentation erotique, Godard reste fidèle à
son esthétique distanciée, et s'assure donc la fidélité de son public cultivé,
qui reconnaît et apprécie sa signature (avec Bardot nue en prime), en
même temps qu'il s'aliène le public populaire (on n'est pas surpris d'ap-
prendre que Le Mépris, bon score dans la carrière de Godard, fiit un des
plus mauvais pour Bardot).
Dans Vie privée et Le Mépris, les personnages joués par Bardot,
réduits à la féminité, sont exclus du circuit de la créativité masculine. Les
deux films éloignent et marginalisent le populaire dans ce qu'il a de plus
menaçant pour le cinéma d'auteur en tant que culture d'élite : une star
française et un producteur américain. Comme le fait remarquer Andreas
Huyssen, «le modernisme cache sa jalousie de la popularité de la culture
de masse derrière un écran de condescendance et de mépris» (Huyssen,
1986: 17). Il n'est donc pas étonnant que dans les deux films, Bardot
meure à la fin, comme si la star populaire ne pouvait être que victime de
son image (voir Vie privée), alors que Bardot imposera tout au long des
années 60 l'image d'une femme revendiquant son indépendance écono-
mique, professionnelle et amoureuse, image dont l'impact sur les jeunes
femmes de cette génération fut important.
Au terme de cette étude, je dois d'abord préciser que le corpus
retenu a une valeur indicative : si les films analysés ici mettent particu-
lièrement en évidence l'articulation nouvelle qui s'opère dans le cinéma
de la Nouvelle Vague entre les représentations des identités de sexe et
des identités socioculturelles, on pourrait retrouver de façon plus ou
moins explicite le même type de configuration dans la plupart des films
issus ou proches de la mouvance des Cahiers du Cinéma. En revanche,
les cinéastes dits « de la Rive gauche », dont les plus connus sont Alain
Resnais, Chris Marker et Agnès Varda, revendiquent un engagement à la
fois artistique et politique, et leurs films, en tout cas à cette période,
témoignent d'une vision tout à fait différente des identités et des rap-
ports de sexe, tout autant que des identités socioculturelles, qui mérite-
rait une étude spécifique. Hiroshima mon amour et Cleo de 5 à 7 ont en
commun, non seulement d'articuler le politique et le privé, mais aussi, et
ce n'est sans doute pas un hasard, d'avoir été écrits et/ou réalisés par
une femme (Duras et Varda). Mais ces visions qu'on peut qualifier
d'avant-garde n'auront pas l'influence du courant dominant, celui qui
va donner naissance au «cinéma d'auteur», image de marque du cinéma
français depuis les années 60, qui a hérité de l'essentiel des traits que j'ai
tenté de repérer dans cette étude.
108.1 NQF Vol. 22, No 1 / 2003
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Édito I Grand angle W^^MBffii Parcours | Comptes rendus | Collectifs
Genre, modernisme et culture de masse dans la Nouvelle Vague
Geneviève Sellier
En effet, le regard français sur la Nouvelle Vague ne peut être isolé de
la politique culturelle et économique inaugurée par André Malraux, pre-
mier ministre de la Culture de la Cinquième République, qui va littérale-
ment porter la nouvelle génération de cinéastes, à travers la commission
d'avance sur recettes, instrument emblématique de cette intervention typi-
quement française de l'État dans la création artistique.
En France, dès qu'on parle de la Nouvelle Vague, on parle du « cinéma
d'auteur», c'est-à-dire de la production artistique nationale sans doute la
plus prestigieuse aujourd'hui, en particulier à l'étranger. Cette production,
parrainée, encadrée et subventionnée par l'État, fonctionne dans un
contexte de connivences profondes entre institutionnels, professionnels et
critiques de cinéma, alors même qu'elle est de plus en plus boudée par le
public.
Dans ce contexte, le quarantième anniversaire de l'émergence de la
Nouvelle Vague a été marqué par diverses publications d'importance et de
niveau différents, mais qui ont en commun de confirmer la place de la
Nouvelle Vague dans notre univers culturel comme le modèle absolu de la
création artistique «moderne».
L'ouvrage le plus représentatif de cette fétichisation est sans doute le
gros volume richement illustré de Jean Douchet (1998), édité par la Ciné-
mathèque française, autant dire le cœur de la forteresse ! Il s'agit en fait
d'une chronique, où l'auteur, juge et partie, puisqu'il a lui-même participé
à l'aventure, reprend sans se lasser tous les éléments de la doxa, résumée
ainsi sur la page de garde: «La Nouvelle Vague représente une rupture
aussi importante que celle de l'impressionnisme ou de la musique atonale. »
Le dernier chapitre, intitulé «Influence et descendance», énumère d'ailleurs
les figures les plus récentes du cinéma d'auteur international, telles que les
Cahiers du Cinéma continuent bon an mal an à en construire le panthéon.
La célèbre revue propose justement un numéro spécial intitulé très
abusivement «Nouvelle Vague, une légende en question», qui l'entretient
plutôt à travers divers articles et entretiens (Cahiers du Cinéma, 1998). Seul
un article d'Alain Bergala (1998: 36-43) met en question la légende, en
montrant que les jeunes cinéastes choisissent délibérément de tourner en
35 mm, alors que seul le 16 mm peut, à l'époque, leur permettre de tourner
dans les conditions qu'ils souhaitent (décors naturels, son synchrone, cou-
leurs). Il y voit la preuve de leur refus de la marginalité et leur volonté de
prendre la place de leurs aînés dans un cinéma industriel rénové, ce qu'ils
feront effectivement quelques années plus tard.
Deux ouvrages plus universitaires apportent un certain nombre d'élé-
ments nouveaux, sur le plan historique et socioculturel : dans un petit livre
très dense, Michel Marie replace avec beaucoup de précision le cinéma de
la Nouvelle Vague dans son époque pour remettre en cause un certain
nombre de légendes, entre autres celle de la moindre rentabilité des films
NQF Vol. 22, No 1 / 2003 | 109.
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
de la Nouvelle Vague par rapport aux films «populaires» de l'époque
(Marie, 1997). Il montre au contraire que le rajeunissement des profes-
sionnels et la baisse des budgets a permis de retarder de quelques années,
par rapport aux autres pays comparables, l'inexorable baisse de fréquen-
tation liée, entre autres, à l'arrivée de la télévision. Mais son souci de
réévaluation s'arrête dès lors qu'on aborde les films et leurs auteurs, qui
font l'objet d'une identification typique de la cinéphilie française. On
trouve, par exemple, à deux reprises à propos de Godard filmant Karma la
formule «une magnifique déclaration d'amour à l'actrice» (Marie, 1997:
102).
L'ouvrage d'Antoine de Baecque (1998) replace le nouveau cinéma
dans le contexte plus large de l'émergence d'une nouvelle génération en
rupture avec la précédente, dans la France du tournant des années 60. Très
richement documentée, cette enquête sur la culture «jeune» et ses manifes-
tations pêche pourtant par un certain aveuglement sur les contradictions
de classe et de sexe qui marquent cette période. Sans jamais le préciser ni
le commenter, de Baecque parle essentiellement des comportements mas-
culins, y compris du regard sur les nouvelles icônes féminines comme Bri-
gitte Bardot. Repérant justement la brièveté de cette vague qui retombe dès
la fin 1962, il cite en conclusion, sans la commenter, c'est-à-dire en la
reprenant à son compte, cet extrait d'une lettre de Godard à Truffaut: «Les
filles avec lesquelles nous couchons nous séparent chaque jour davantage
au lieu de nous rapprocher.» (De Baecque, 1998 : 147).
On retrouve chez ces deux universitaires français la même limite, due
à leur identification (masculine) aux cinéastes de la Nouvelle Vague qui
les empêche d'analyser la place socioculturelle qu'ils occupaient et ses
effets sur leurs rapports aux femmes (réelles et imaginaires). C'est sur ce
terrain que j'essaie de travailler pour ma part. ■
N.B. Les analyses concernant Vie privée et Le Mépris sont d
ment inspirées d'un article écrit pour la revue Iris « Cultural Studie
der Studies et études filmiques» (1998, Paris, pp. 115-130): «La Nou
Vague et le cinéma populaire: Brigitte Bardot dans Vie privée
Mépris», en collaboration avec Ginette Vincendeau que je remercie
ment.
110.1 NQF Vol. 22, No 1 / 2003
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Édito I Grand angle W^^^Mnffil Parcours | Comptes rendus | Collectifs
Genre, modernisme et culture de masse dans la Nouvelle Vague
Geneviève Sellier
Références
Astruc, Douchet, Jean (1998). Nouvelle Vague. Paris: A
velle Cinémathèque française/Hazan. av
(30 mars 1948). Réédité in Astruc, Alexandre
(1992). Du stylo à la caméra... Écrits (1942-1984) Flaubert, Gustave (1966 [18471). Madame Bovary.
(pp. 324-327). Paris : L'Archipel. Paris : Garnier-Flammarion.
Aumont, Jacques (2000 [19901). «The Fall of the Huyssen, Andreas (1986). After the Great Divide:
Gods: Jean-Luc Godard's le Mépris*. In Susan Modernism, Mass Culture and Postmodernism.
Hayward et Ginette Vincendeau (Ed.), French Bloomington/Indianapolis : Indiana University
Film, Texts and Contexts (pp. 174-186). Londres: Press.
Routledge.
Marie, Michel (1997). La Nouvelle Vague, une
Baecque, Antoine de (1998). La Nouvelle Vague, école artistique. Paris : Nathan Université.
portrait d'une jeunesse. Paris: Flammarion.
Marie, Michel (1990). Le Mépris. Paris : Nathan.
Bardot, Brigitte (1997). Initiales BB. Paris: Ber-
nard Grasset. Mulvey, Laura et Colin MacCabe (1989). «Images
of Women, Images of Sexuality : Some Films by
«Nouvelle Vague» (1962). Cahiers du Cinéma,J. L. Godard». In Visual and Other Pleasures (pp.
138. 49-62). Londres : MacMillan.
«Feux sur le cinéma français». Positif, 46
«Nouvelle Vague, une légende en question (1998).
Cahiers du Cinéma, Hors-série. (juin 1962).
Rihoit, Catherine (1986). Brigitte Bardot, un
Chabrol, Claude (1976). Et pourtant je tourne.
Paris : Robert Laffont. mythe français. Paris: Olivier Orban.
Coquillat Michelle (1982). La poétique du mâle.
Vimenet, Pascal (1991). le Mépris. Paris: Hatier.
Paris : Gallimard.
NQF Vol. 22, No 1 / 2003 | 1 1 1 .
This content downloaded from
5.51.199.233 on Fri, 18 Nov 2022 20:58:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Vous aimerez peut-être aussi
- CINEMA - Les Genres Du CinémaDocument160 pagesCINEMA - Les Genres Du CinémaRayHanim100% (4)
- 2009 Nan 21030Document600 pages2009 Nan 21030Mohammed KachaiPas encore d'évaluation
- Siècle Classiques Et Cinema Contemporain PDFDocument7 pagesSiècle Classiques Et Cinema Contemporain PDFRoseli ReisPas encore d'évaluation
- Les Cahiers Du Cinéma, Histoire D'une Revue, Tome 1 A L'assaut Du Cinéma, 1951-1959-Cahiers Du Cinéma (Antoine de Baecque, 1991) PDFDocument354 pagesLes Cahiers Du Cinéma, Histoire D'une Revue, Tome 1 A L'assaut Du Cinéma, 1951-1959-Cahiers Du Cinéma (Antoine de Baecque, 1991) PDFSdef AdertPas encore d'évaluation
- Ivry Gitlis & FriendsDocument24 pagesIvry Gitlis & FriendsscribdPas encore d'évaluation
- Ecole Complète Et Progressive Du (... ) Renaud 4Document62 pagesEcole Complète Et Progressive Du (... ) Renaud 4Stan FlorinPas encore d'évaluation
- J.OFFENBACH La Grande Duchesse de GerolsteinDocument312 pagesJ.OFFENBACH La Grande Duchesse de GerolsteinAlexandr MatskoPas encore d'évaluation
- Birth and Death in Nineteenth-Century French CultureDocument261 pagesBirth and Death in Nineteenth-Century French CultureMJ44MJPas encore d'évaluation
- Dossier RomantismeDocument29 pagesDossier RomantismeAna Rebeca PradaPas encore d'évaluation
- Mandrou - Histoire Et Cinéma (Annales, 1958)Document11 pagesMandrou - Histoire Et Cinéma (Annales, 1958)custionesPas encore d'évaluation
- Marginalia 48Document41 pagesMarginalia 48Norbert Spehner100% (1)
- Festival Étonnants Voyageurs 2014 - Le CatalogueDocument65 pagesFestival Étonnants Voyageurs 2014 - Le Catalogueavranches.infosPas encore d'évaluation
- AveMaria Schubert 2 VociDocument3 pagesAveMaria Schubert 2 VociGino Tanasini100% (1)
- Le Théâtre Africain Du XXe SièclleDocument13 pagesLe Théâtre Africain Du XXe SièclleLionelAmbeuPas encore d'évaluation
- Medley Grandes Sucessos Cassiane Daniel Rosa PDFDocument62 pagesMedley Grandes Sucessos Cassiane Daniel Rosa PDFDavid B. Sousa100% (1)
- Pièces Sur L'art Paul VALÉRYDocument263 pagesPièces Sur L'art Paul VALÉRYAlice in FursPas encore d'évaluation
- Marginalia 78Document32 pagesMarginalia 78Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Mosaico Oro Solido - Baritone SaxDocument3 pagesMosaico Oro Solido - Baritone SaxLina NiñoPas encore d'évaluation
- Marginalia 88Document42 pagesMarginalia 88Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Isn't She Lovely: From Songs in The Key of Life (1976)Document1 pageIsn't She Lovely: From Songs in The Key of Life (1976)Renne CruzPas encore d'évaluation
- Colonel Bogey March Score and PartsDocument69 pagesColonel Bogey March Score and Partssmith sreesawatPas encore d'évaluation
- Contrabajo Folklore - EjemplosDocument5 pagesContrabajo Folklore - EjemplosDiego Agustín RodriguezPas encore d'évaluation
- Salles. Le Clézio, Un Écrivain de La Rupture...Document18 pagesSalles. Le Clézio, Un Écrivain de La Rupture...Luciano Darío VittonePas encore d'évaluation
- Sur Une Tempête D'aimé Césaire: Thomas A. HaleDocument15 pagesSur Une Tempête D'aimé Césaire: Thomas A. HaleArron EyaPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument25 pagesExtraitJoão GuimarãesPas encore d'évaluation
- La Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLa Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Pierre Michel, "Albert Camus Et Octave Mirbeau"Document68 pagesPierre Michel, "Albert Camus Et Octave Mirbeau"Anonymous 5r2Qv8aonf100% (4)
- Louise Michel - Prise de Possession (2017, Herne)Document84 pagesLouise Michel - Prise de Possession (2017, Herne)nicosiaPas encore d'évaluation
- Marginalia 94Document40 pagesMarginalia 94Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Cinéma Narratif Et Culture Littéraire de Masse: Une Médiation Fondatrice (1908-1928)Document18 pagesCinéma Narratif Et Culture Littéraire de Masse: Une Médiation Fondatrice (1908-1928)Eugenia GuevaraPas encore d'évaluation
- Elie Faure - Introduction À La Mystique Du CinemaDocument17 pagesElie Faure - Introduction À La Mystique Du Cinemavincent souladiePas encore d'évaluation
- Le Naturelisme Recent 7-03-12Document7 pagesLe Naturelisme Recent 7-03-12Poorna MahalingamPas encore d'évaluation
- Jacques Ranciere Le Destin Des Images PaDocument5 pagesJacques Ranciere Le Destin Des Images PaLuiza VasconcellosPas encore d'évaluation
- Marginalia 73Document42 pagesMarginalia 73Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Senga NengudiDocument4 pagesSenga NengudiClara LemercierPas encore d'évaluation
- Itineraires 1290Document14 pagesItineraires 1290BrendaPas encore d'évaluation
- Copie de Copie de Copie de Sujet D'argu FRDocument3 pagesCopie de Copie de Copie de Sujet D'argu FRViolette 1Pas encore d'évaluation
- Skenegraphie 1262Document115 pagesSkenegraphie 1262tamereeuPas encore d'évaluation
- Ouverture Catalogue FemininMasculinDocument2 pagesOuverture Catalogue FemininMasculinGonzalo PechPas encore d'évaluation
- La Nudité Au XIXe SiècleDocument12 pagesLa Nudité Au XIXe SiècleremiramePas encore d'évaluation
- Dada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandDada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Marginalia 52Document34 pagesMarginalia 52Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- L'émergence de La Nouvelle VagueDocument15 pagesL'émergence de La Nouvelle VagueLebron FakesPas encore d'évaluation
- Marginalia 42Document28 pagesMarginalia 42Norbert Spehner100% (1)
- Bibliographie - Théorie de L'art ComtemporainDocument23 pagesBibliographie - Théorie de L'art ComtemporainAhmed KabilPas encore d'évaluation
- Marginalia 96Document30 pagesMarginalia 96Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Brève Histoire Des Cahiers Du CinémaDocument13 pagesBrève Histoire Des Cahiers Du CinémaVictor GuimaraesPas encore d'évaluation
- Marginalia 41Document33 pagesMarginalia 41Norbert Spehner100% (2)
- Le PARTAGE DE L'INTIME: Histoire, esthétique, politique: cinémaD'EverandLe PARTAGE DE L'INTIME: Histoire, esthétique, politique: cinémaPas encore d'évaluation
- Marginalia 35Document29 pagesMarginalia 35Norbert Spehner100% (1)
- TVB Francophonie Et Litterature Monde Sans Page de TitreDocument20 pagesTVB Francophonie Et Litterature Monde Sans Page de TitreTamara ValcicPas encore d'évaluation
- PEC Ecritoras Carina Gonzalez MDocument5 pagesPEC Ecritoras Carina Gonzalez MCarina Gonzalez MarinPas encore d'évaluation
- Du Cinéma: CahiersDocument68 pagesDu Cinéma: Cahiersz74h80st2Pas encore d'évaluation
- Peur Du GenreDocument8 pagesPeur Du GenreIlo IloPas encore d'évaluation
- Culture de MasseDocument9 pagesCulture de Masseleo messiPas encore d'évaluation
- Marginalia 98Document42 pagesMarginalia 98Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Sociologe CinemaDocument4 pagesSociologe CinemaLorena AnderaosPas encore d'évaluation
- Marginalia 45Document44 pagesMarginalia 45Norbert Spehner100% (2)
- Marginalia 68Document30 pagesMarginalia 68Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- CM Approches Culturelles Des FilmsDocument24 pagesCM Approches Culturelles Des Filmsnyls.carbonnelPas encore d'évaluation
- Projet de Mémoire-Histoire Des Femmes & Cinéma, Être À L'écran Et Être Réellement-Theo Karbowski (2024)Document3 pagesProjet de Mémoire-Histoire Des Femmes & Cinéma, Être À L'écran Et Être Réellement-Theo Karbowski (2024)theo509.karbowskiPas encore d'évaluation
- Le RomantismeDocument3 pagesLe RomantismeFATIMA ZAHRA ESSAIDIPas encore d'évaluation
- Anna Gural-Migdal, Entre Naturalisme Et Frénétisme: La Représentation Du Féminin Dans "Le Calvaire"Document9 pagesAnna Gural-Migdal, Entre Naturalisme Et Frénétisme: La Représentation Du Féminin Dans "Le Calvaire"Anonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Marginalia 67Document31 pagesMarginalia 67Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Avant-garde: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAvant-garde: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Cinema Politique 3 Tables RondesDocument84 pagesCinema Politique 3 Tables RondesCaterinaPredaPas encore d'évaluation
- L'Héroïsme Dans La Dramaturgie D'Albert Camus.: To Cite This VersionDocument526 pagesL'Héroïsme Dans La Dramaturgie D'Albert Camus.: To Cite This VersionSiluePas encore d'évaluation
- Ethique Esthetique PolitiqueDocument5 pagesEthique Esthetique PolitiqueFLAKUBELAPas encore d'évaluation
- UntitledDocument9 pagesUntitledAlice in FursPas encore d'évaluation
- HERMÈS Réalité VirtuelleDocument13 pagesHERMÈS Réalité VirtuelleAlice in FursPas encore d'évaluation
- Olivier Lussac Les Passeurs de FrontiereDocument10 pagesOlivier Lussac Les Passeurs de FrontiereAlice in FursPas encore d'évaluation
- A Little Love Tab Guitar.Document3 pagesA Little Love Tab Guitar.Nguyễn Long TùngPas encore d'évaluation
- Cumbia Dominante - TromboneDocument2 pagesCumbia Dominante - TromboneKike TrumpetPas encore d'évaluation
- AJMAK de Chtouka Ait Baha - El Mouataouakil Rachid Et AutreDocument40 pagesAJMAK de Chtouka Ait Baha - El Mouataouakil Rachid Et Autreمحمد أمجوضPas encore d'évaluation
- Afisa: ActriceDocument1 pageAfisa: Actriceapi-542750689Pas encore d'évaluation
- (Free Scores - Com) - Haendel Georg Friedrich Courante 119281Document3 pages(Free Scores - Com) - Haendel Georg Friedrich Courante 119281julio cesar lopezPas encore d'évaluation
- Anacaona Solo de PianoDocument1 pageAnacaona Solo de PianoLuis EduardoPas encore d'évaluation
- Linz Manuale SP E1C 2017 28Document32 pagesLinz Manuale SP E1C 2017 28Justice MachiwanaPas encore d'évaluation
- Delabre - Jeux Croisés, 7 Pièces Pour 2 Et 3 VioloncellesDocument15 pagesDelabre - Jeux Croisés, 7 Pièces Pour 2 Et 3 VioloncellesTiffany DUBOIPas encore d'évaluation
- Solo Pienso en Ti - Trombone 1Document2 pagesSolo Pienso en Ti - Trombone 1Ramon arturo Calle zapataPas encore d'évaluation
- Wolf: Áve MariaDocument1 pageWolf: Áve MariaKitti BálintPas encore d'évaluation
- Brigada LeitugaDocument108 pagesBrigada LeitugaElvis ReisPas encore d'évaluation
- Analisis Compositor - Etkin, Paraskevaidis, Bertola - Áñez García, D - Silence, Repetition and StaticityDocument112 pagesAnalisis Compositor - Etkin, Paraskevaidis, Bertola - Áñez García, D - Silence, Repetition and StaticityOsvaldo SuarezPas encore d'évaluation
- Sailing With WhalesDocument4 pagesSailing With WhalesIsac Ciconha de Oliveira100% (1)
- Agnus Dei Messe de L'ascensionDocument1 pageAgnus Dei Messe de L'ascensionTacite WakilongoPas encore d'évaluation
- El Amor Del Salvador 3 - 1 PDFDocument5 pagesEl Amor Del Salvador 3 - 1 PDFmosiahm19Pas encore d'évaluation
- BASE - AGUA - ASTURIAS OriginalDocument198 pagesBASE - AGUA - ASTURIAS Originalraquel81miranda05Pas encore d'évaluation
- MISKINIS Cantate DominoDocument4 pagesMISKINIS Cantate DominoFernando JiménezPas encore d'évaluation
- Grand Traité D'instruentation Et D'orchestration, Hector BerliozDocument314 pagesGrand Traité D'instruentation Et D'orchestration, Hector BerliozJuan jose SANCHEZ ESCOBARPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu Chapitre Chopin X CouperinDocument5 pagesCompte-Rendu Chapitre Chopin X CouperinAkel FaresPas encore d'évaluation
- Encore - G - ENCOREE - Chiquilin - ChiquilinDocument1 pageEncore - G - ENCOREE - Chiquilin - ChiquilinCésar Manuel Peñaloza VivasPas encore d'évaluation
- Interstellar WorksheetDocument1 pageInterstellar WorksheetRicki ArmstrongPas encore d'évaluation